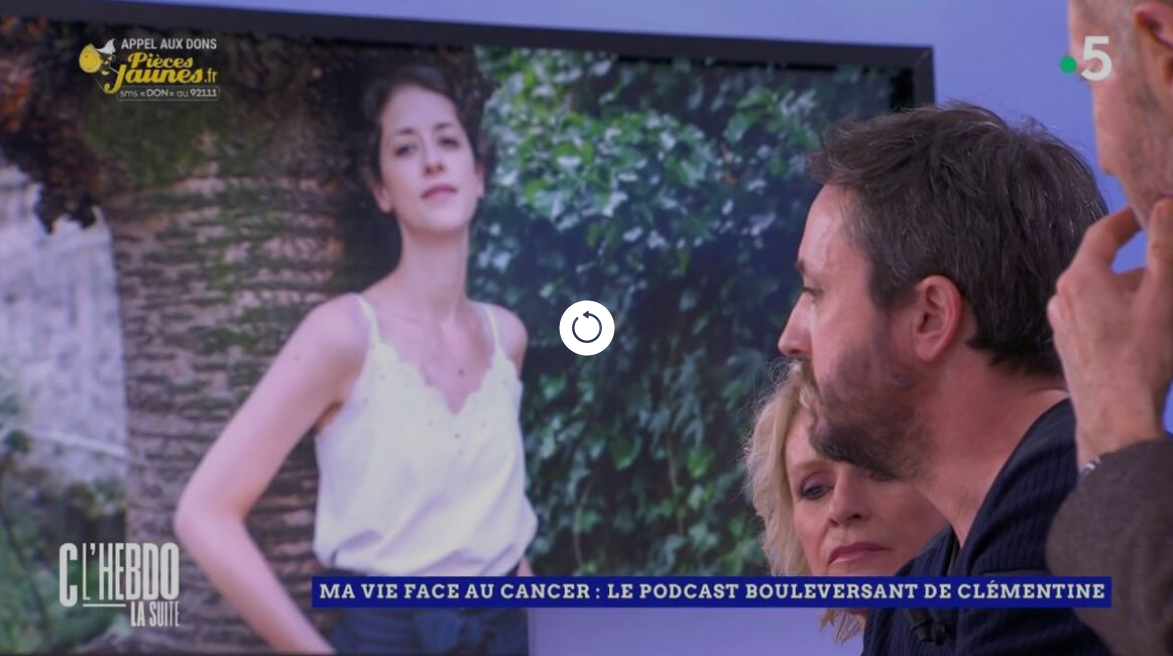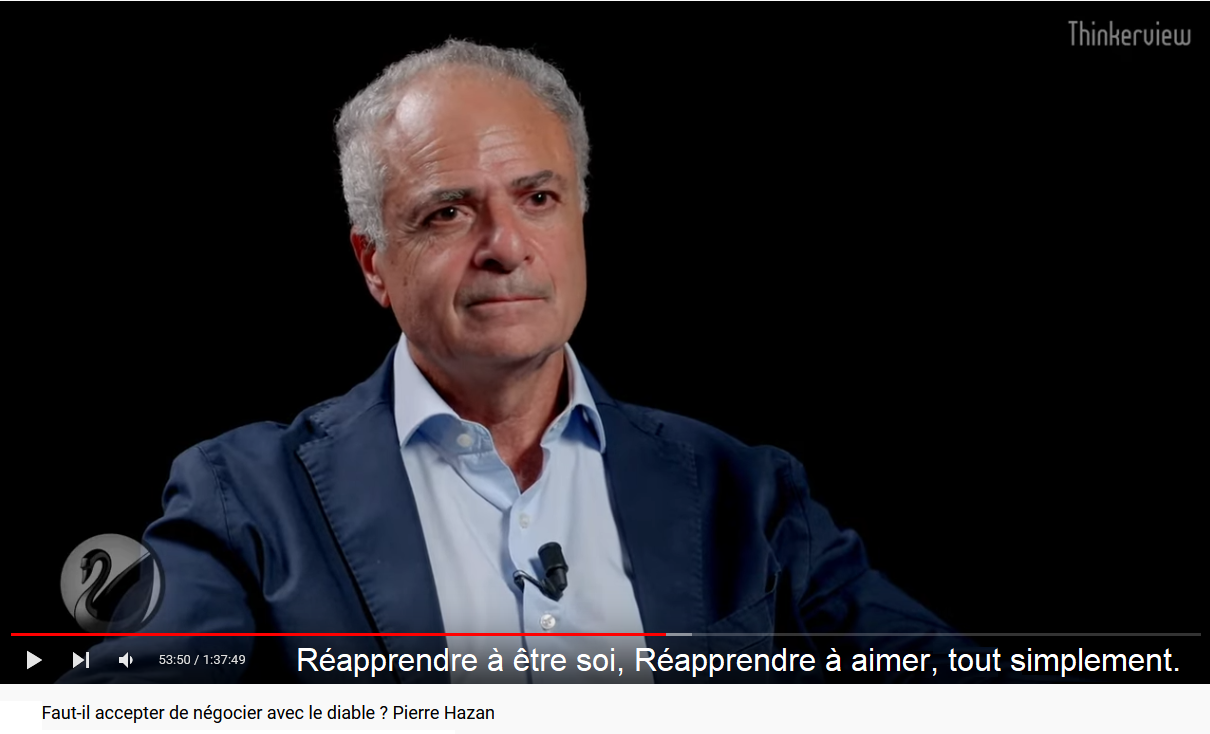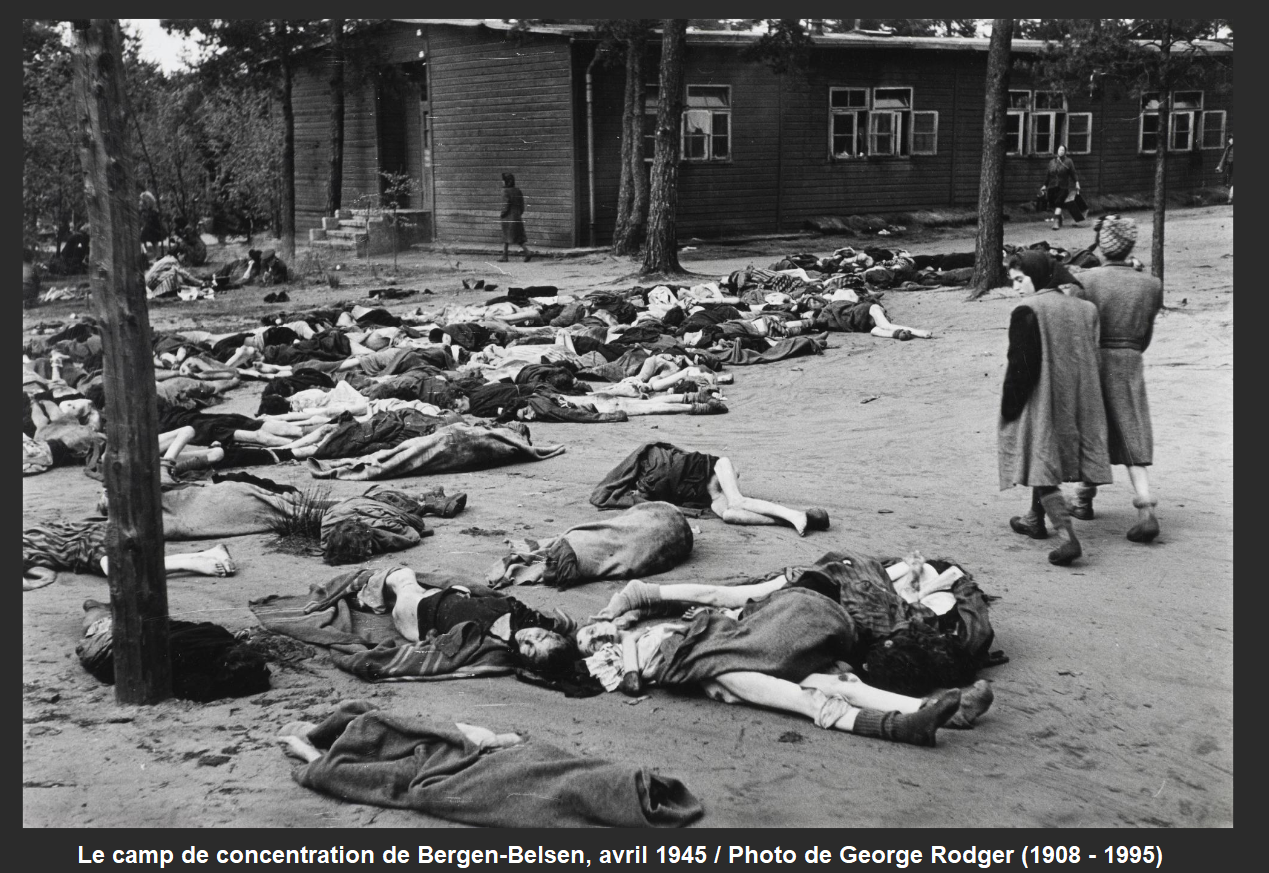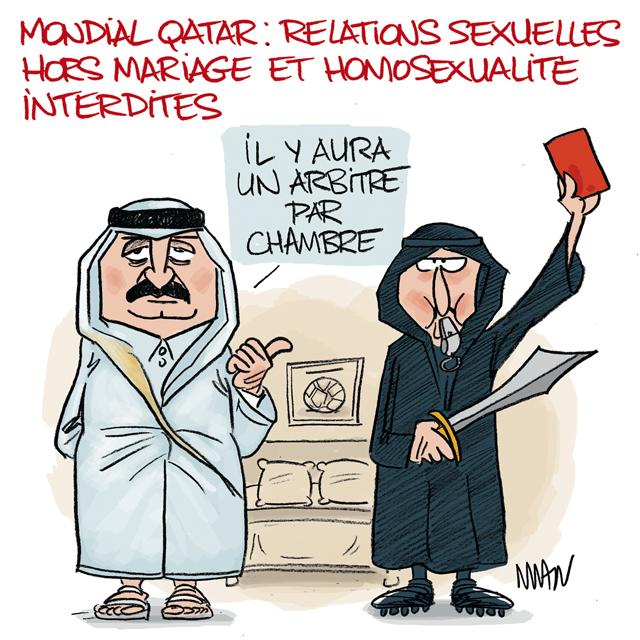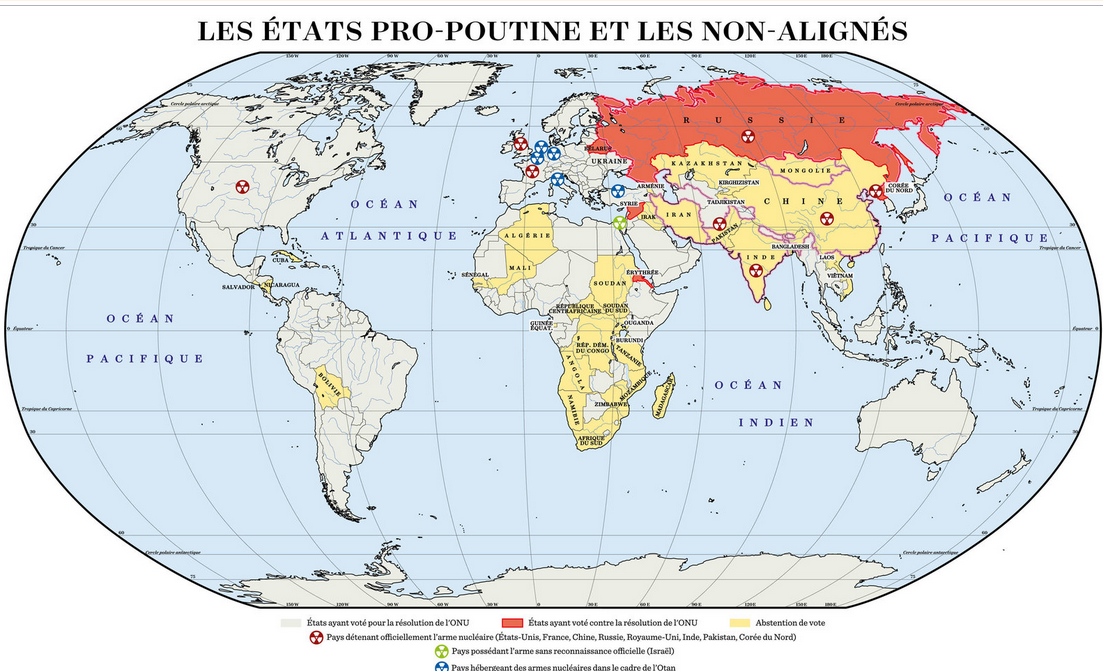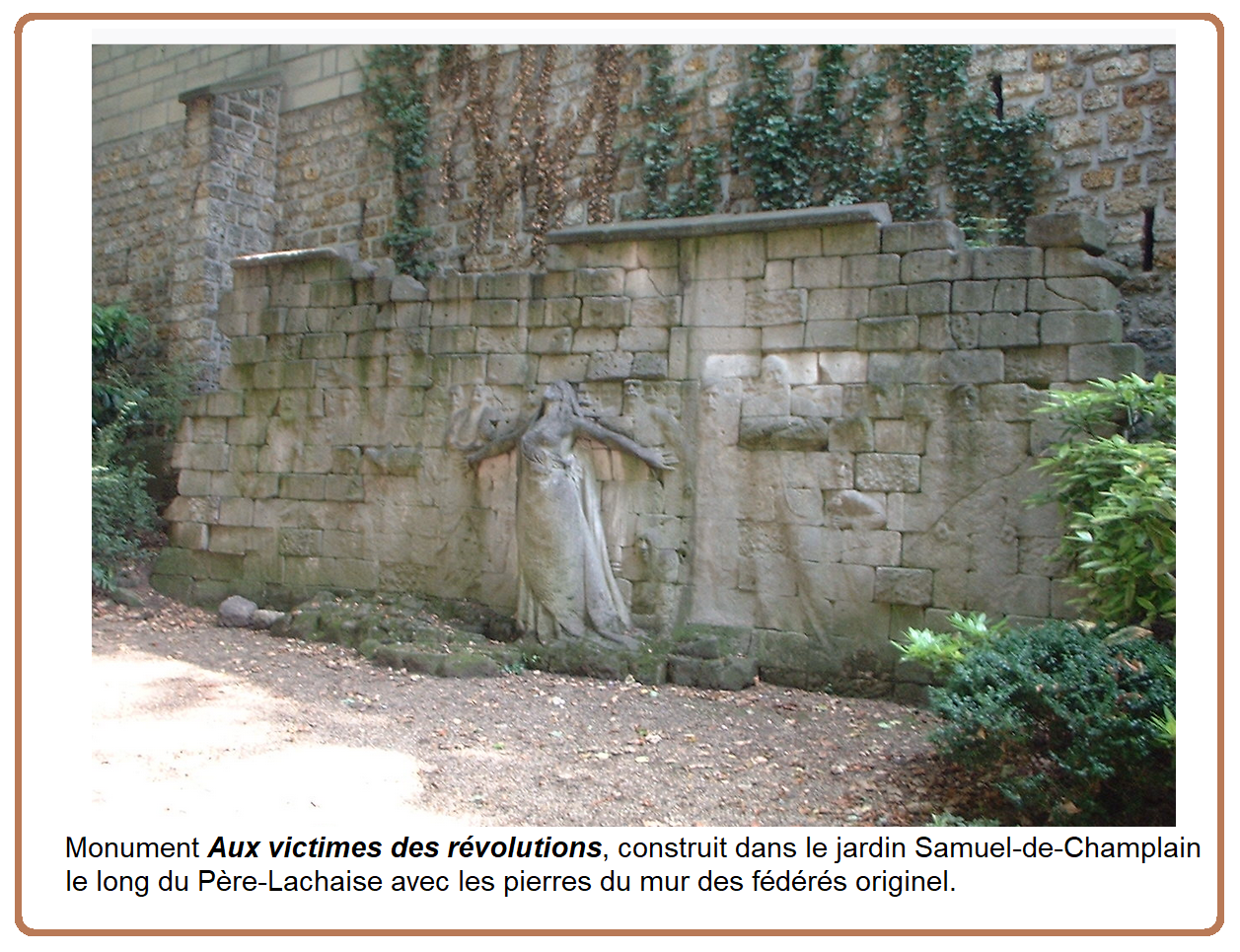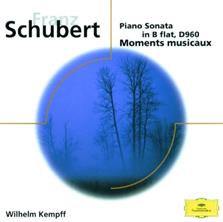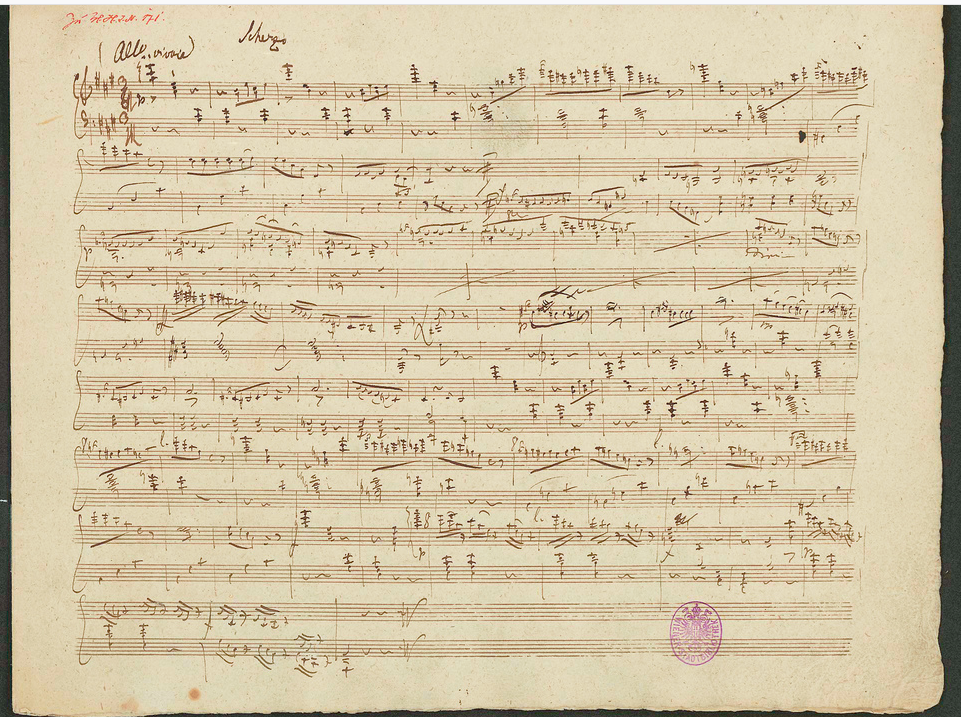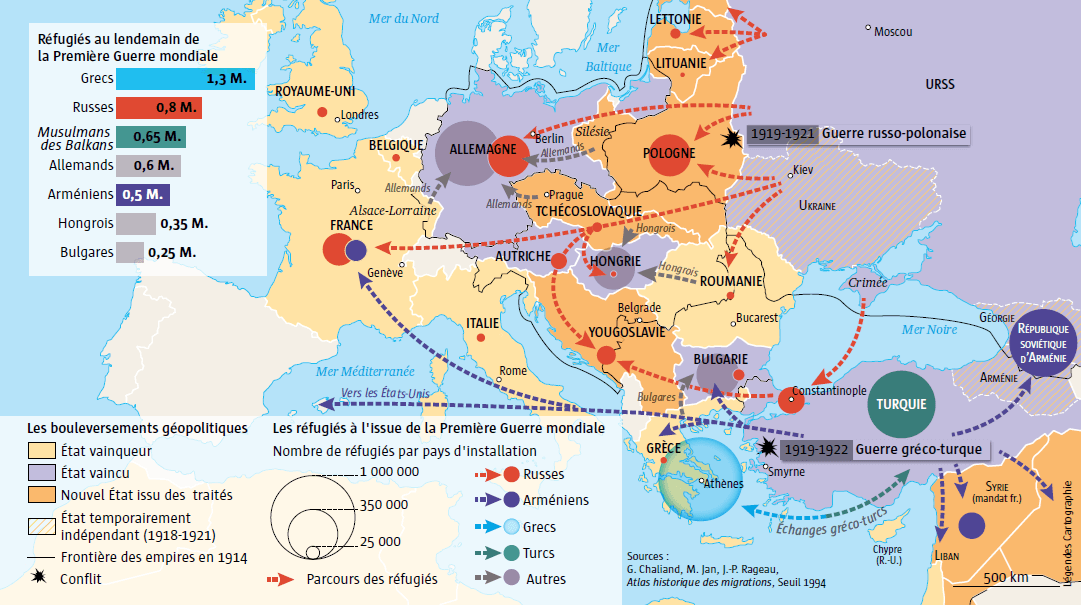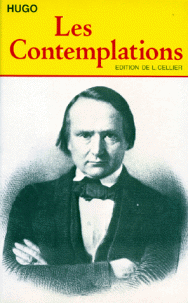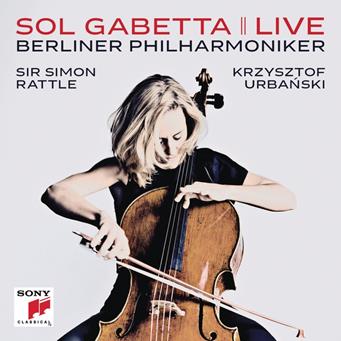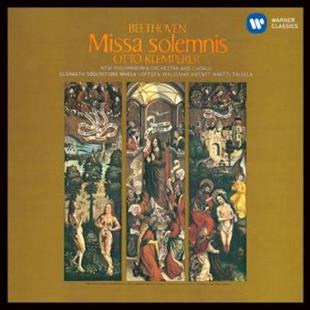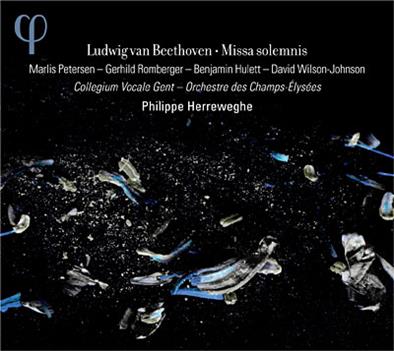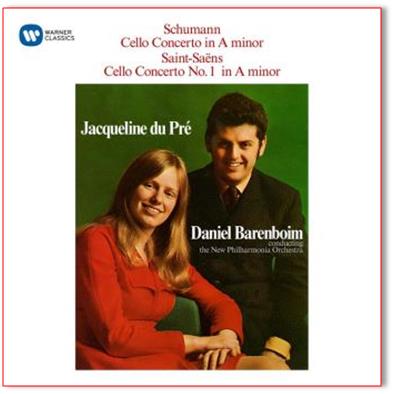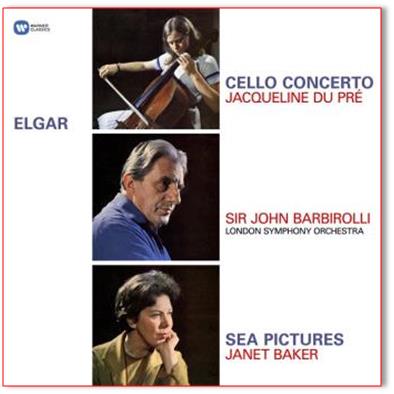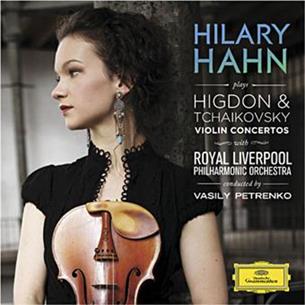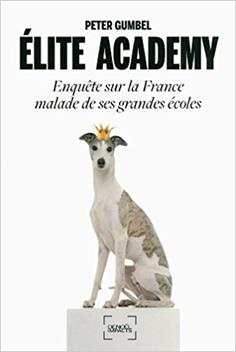-
Mardi 13 janvier 2026
« Que faites vous des ruines ? Nous répondons : Nous construisons des ponts. »Mahmoud Darwich « Le lit de l’étrangère »La tradition nous incite, lors de la naissance d’une nouvelle année, de souhaiter des voeux pour la santé, le bonheur et peut être même la prospérité de toutes celles et de tous ceux avec qui nous sommes en lien. L’année dernière, dès le 2 janvier, j’ai eu la grâce de partager un poème d’une poète allemande Elli Michler : « Je te souhaite du temps » dont je rappelle un extrait :
« Je te souhaite du temps pour espérer encore,
même lorsque tout semble vaciller.
Du temps pour aimer, car il n’y a pas de plus belle manière de le vivre.Je te souhaite du temps pour faire la paix avec le passé,
pour ouvrir tes bras à ce qui vient,
et pour pardonner, à toi-même comme aux autres.Je te souhaite de recevoir le temps comme on reçoit un trésor,
de le savourer, non pas comme une chose à posséder,
mais comme un souffle à embrasser. »Cette année je n’ai pas trouvé pareille inspiration.
Lorsqu’après le chaos, la violence, la régression démocratique et le recul du droit vécu pendant cette terrible année 2025, la nouvelle année a débuté par une intervention illégale décidée par un homme qui proclame qu’il n’a que faire du droit international et que sa seule limite est sa propre moralité, j’ai eu l’intuition que l’année 2026 pourrait être pire que la précédente. Le MAGA-boy a d’ailleurs aggravé la situation en annonçant qu’il voulait s’emparer, s’il le faut par la force, du Groenland, territoire rattaché au Danemark, un des alliés les plus fidèles et dociles des Etats-Unis.
 En octobre 2025, alors que le prédateur américain avait déjà parlé de son appétit pour la plus grande île du monde, hors continent, le Danemark a décidé de continuer à acheter des chasseurs F35 américains. Avions qu’ils ne peuvent utiliser qu’avec l’autorisation des Etats-Unis. En effet, pour fonctionner il est nécessaire, que régulièrement, un logiciel à bord de l’avion se connecte au seul serveur mondial, qui se situe au Texas. De manière rapide, en outre, les américains peuvent inhiber à distance certaines capacités du système d’armes. Si les danois espèrent s’opposer à l’armée américaine avec leurs F35, ils se trompent manifestement. Mais ce n’est pas l’idée de se défendre contre l’armée américaine qui a motivé cette décision d’achat, mais l’espoir que les américains seraient probablement bienveillants à l’égard d’un client si fidèle de leur système militaro industriel. Espoir déçu, le prédateur ne s’assagit pas devant la faiblesse et la soumission de sa proie, bien au contraire, son appétit ne fait que croitre.
En octobre 2025, alors que le prédateur américain avait déjà parlé de son appétit pour la plus grande île du monde, hors continent, le Danemark a décidé de continuer à acheter des chasseurs F35 américains. Avions qu’ils ne peuvent utiliser qu’avec l’autorisation des Etats-Unis. En effet, pour fonctionner il est nécessaire, que régulièrement, un logiciel à bord de l’avion se connecte au seul serveur mondial, qui se situe au Texas. De manière rapide, en outre, les américains peuvent inhiber à distance certaines capacités du système d’armes. Si les danois espèrent s’opposer à l’armée américaine avec leurs F35, ils se trompent manifestement. Mais ce n’est pas l’idée de se défendre contre l’armée américaine qui a motivé cette décision d’achat, mais l’espoir que les américains seraient probablement bienveillants à l’égard d’un client si fidèle de leur système militaro industriel. Espoir déçu, le prédateur ne s’assagit pas devant la faiblesse et la soumission de sa proie, bien au contraire, son appétit ne fait que croitre. La France n’est pas dans la même problématique puisqu’elle possède des rafales et aucun F35, mais Emmanuel Macron espère aussi qu’ « être compréhensif » avec les excès de Trump, puissent lui attirer sa bienveillance, notamment pour l’aide à l’Ukraine. Ainsi dans un premier temps il a pris acte de l’arrestation de Maduro en soulignant la chance du Venezuela de s’être débarrassé d’un dictateur, sans évoquer le viol du droit international. Mais de la même manière, Il n’a pas trouvé la moindre indulgence du chef mafieux qui s’est moqué publiquement de lui, en le décrivant comme un peureux qui aurait accepté, sur sa demande express, une augmentation des prix des médicaments en France de 200%.
Je comprends celles et ceux qui souhaitent se retirer de l’univers des médias et de l’information. Nous vivons actuellement le passage de la fatigue informationnelle à un stade de stress informationnel.
Pour ma part, je ne crois pas qu’essayer de ne pas voir les problèmes permet de les éviter. Il est vrai que nous sommes gavés des menaces, du grotesque et de la vulgarité de Trump.
Philippe Corbé, auteur de la lettre numérique bihebdomadaire Zeitgeist et d’un livre qui vient de paraître « Armes de distraction massive » explique que Trump est devenu maître dans l’art de « capter notre attention ». Notre capacité d’attention est limitée et lui tente d’en capter la plus grande part. Le conseiller de son premier mandat et qui est resté dans les cercles MAGA, Steve Bannon exprimait cette manière d’agir par la phrase suivante :« Il faut inonder la zone »
La véracité ou la pertinence de ce qui inonde n’a aucune importance. L’essentiel est de produire de la sidération. Ce qui fait dire à Dominique de Villepin :
« La nouvelle arme atomique, c’est la sidération ! »
On pourrait continuer à multiplier les exemples qui montre cette manière de fonctionner. Mais il me semble qu’il faut prendre un peu de recul et s’intéresser à un temps historique un peu plus long, ce temps long que recherchait le grand historien français Fernand Braudel. Fernand Braudel, invitait ses étudiants ou ses lecteurs, à ne pas rester en superficie des faits mais d’essayer de percevoir ce qui se passait de manière moins visible, mais qui allait prendre de l’importance dans la durée.
Nous ne sommes probablement pas dans une crise courte, temporaire, nous sommes dans un processus de changement du monde. Il est vraisemblable qu’un jour nous serons débarrassés de Trump qui quittera le pouvoir et finira par mourir avant ou après. Nous serons alors peut être débarrassés du grotesque et de la vulgarité, mais pas des menaces, pas de la volonté de vassalisation des Etats-Unis à l’égard de ses alliés et pas de la violence des relations internationales. Nous avions pourtant compris que l’action des humains sur les ressources de la terre et l’utilisation massive des énergies fossiles étaient délétères pour la vie humaine et se heurtait, en outre, aux limites de notre planète.
Non seulement, les Etats-Unis refusent cette réalité, Busch père disait « le mode de vie des américains n’est pas négociable », non seulement l’administration actuelle tente d’éliminer la science et les institutions qui étudient ces phénomènes, mais bien au contraire ils sont en train avec les chinois et la complicité des autres de se lancer à corps perdu dans cette aventure de l’Intelligence Artificielle qui exige encore plus de ressources et d’énergie puisées dans la terre.
Notre planète reste riche, elle est encore capable de donner beaucoup pendant un certain temps, mais pas à tout le monde. C’est pourquoi nous voyons les empires se lancer dans cette prédation des ressources qui restent à exploiter sur notre terre.
 Raymond Aron utilisait déjà cette formule : la « République impériale » à propos des États-Unis. Depuis Raymond Aron, une autre République impériale est née : La Chine. Et puis on constate que d’autres acteurs aspirent à ce statut : l’Inde et la puissance nucléaire de la Russie. L’Union européenne toujours désunie, sans puissance politique ou militaire tombe dans un rôle bien inquiétant.
Raymond Aron utilisait déjà cette formule : la « République impériale » à propos des États-Unis. Depuis Raymond Aron, une autre République impériale est née : La Chine. Et puis on constate que d’autres acteurs aspirent à ce statut : l’Inde et la puissance nucléaire de la Russie. L’Union européenne toujours désunie, sans puissance politique ou militaire tombe dans un rôle bien inquiétant. Ce n’était pas un membre de l’administration Trump, mais le secrétaire d’Etat de Biden, Antony Blinken qui a synthétisé cette situation, lors d’un forum public à la Conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne :
« Si vous n’êtes pas à la table du système international, vous serez au menu. »
Jean-Luc Melenchon pense encore que le droit international peut être invoqué avec succès et qu’il suffit de discuter poliment avec la Russie pour trouver un arrangement sur l’Ukraine et la stabilité de l’Europe. Ces derniers temps, on entend souvent, sur ce sujet, une référence à Al Capone qui aurait dit :
« On obtient plus de choses en étant poli et armé qu’en étant juste poli. »
J’ai l’intuition que la France ne pourra exister que dans une Europe qui saura défendre la démocratie libérale de manière polie et armée, indépendante des Etats-Unis et avec une Unité Politique réelle. Pour cela il faudra faire des choix drastiques qui imposeront des remises en cause de certains nos éléments de confort. L’autre choix c’est d’être au menu.
Jacques Attali dit des choses très intéressantes et fortes lors de son audition au Sénat du 6 janvier 2026. Je vous invite à l’écouter. Il nous fait partager cet impératif de prendre des décisions en pensant prioritairement à l’intérêt des générations futures. Il reste optimiste
« La démocratie vaincra après une période sombre. À nous de faire en sorte qu’elle soit la plus courte possible »
Peut être a t’il raison, mais cela ne se fera pas sans efforts, sans courage, ni en suivant des hommes politiques qui cultivent le déni, la vacuité et la démagogie. Et pour mettre un peu de poésie dans tout cela, j’ai pensé donner la parole au poète palestinien, Mahmoud Darwich (1941-2008), traduit par Elias Sanbar et qui écrit dans son ouvrage « Le lit de l’étrangère » :
« Ils nous demandent :
Que faites vous des ruines ?
Nous répondons :
Nous construisons des ponts. »Ce texte destiné aux palestiniens peut aussi s’entendre pour le peuple iranien qui veut se libérer de la part sombre de l’islam, un islam politique qui s’impose à la société par la violence et la corruption. Il peut aussi servir la démocratie, après la période sombre, si elle parvient à vaincre comme le pense Attali.
-
Mercredi 24 décembre 2025
« La bûche de Noël »Anton Serdeczny a écrit « La Bûche et le gras », livre dans lequel il raconte l’Histoire de cet élément incontournable des repas de NoëlLes croyants chrétiens, les enfants, les femmes et les hommes de culture chrétienne et bien d’autres encore, fêtent Noël.
J’ai écrit plusieurs mots du jour sur la fête de la nativité. Le premier, en décembre 2013 « Le cadeau de Noël. Histoire d’une invention. ».
Le 23 décembre 2016 je m’intéressais plus précisément à la fête de « Noël ». Je constatais que le christianisme avait remplacé des fêtes païennes qui célébraient le solstice d’hiver, ce moment où s’arrête la décroissance de la durée du jour, c’est à dire la période quotidienne pendant laquelle le soleil brille. Pour les romains, cette fête s’appelait « Sol Invictus » (latin pour « Soleil invaincu », car le soleil renaissait et regagner du temps sur la nuit. Les peuples germaniques connaissaient une autre fête du solstice d’hiver : « Yule ».
Il y a deux ans, le 24 décembre 2023, j’écrivais ma désapprobation absolue contre ces occidentaux qui ne veulent plus utiliser le mot « Noël », pour le remplacer par le mot neutre de « fête » : « Éclaire ce que tu aimes sans toucher à son ombre. »
En 2019, je me suis intéressé à un aspect culinaire de Noël, en dévoilant des secrets de famille : « Les recettes des gâteaux de Noël alsaciens »
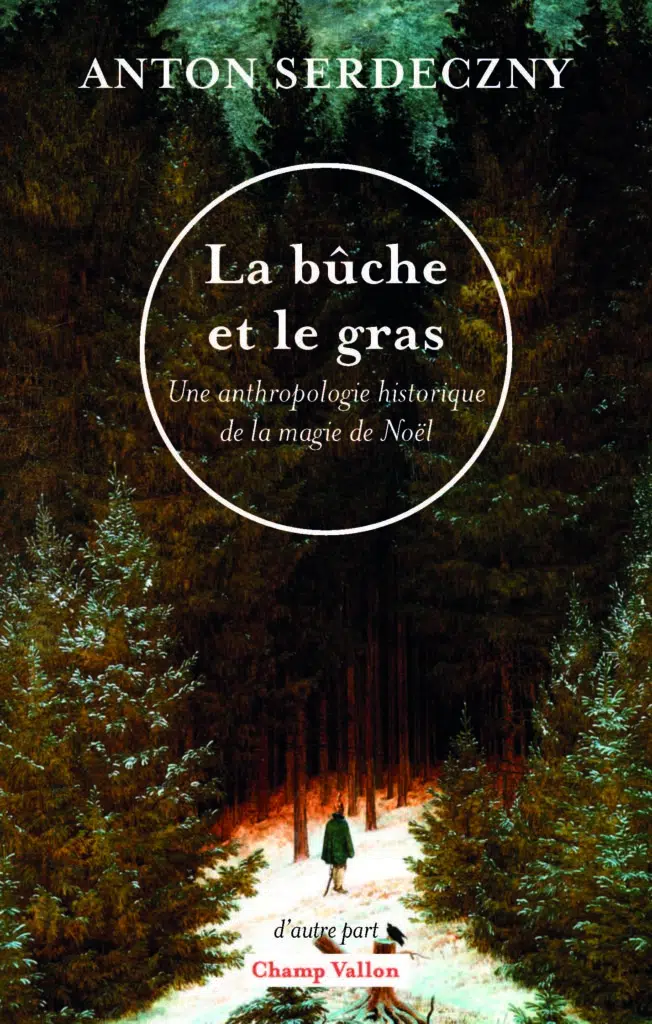 Cette année je vais de nouveau m’intéresser à un sujet alimentaire présent sur les tables de Noël : « La bûche de Noël ». L’histoire de cette bûche est racontée dans le livre « La Bûche et le gras » d’Anton Serdeczny paru en octobre 2025. L’auteur est historien, il est actuellement chercheur au Medici Archive Project à Florence.
Cette année je vais de nouveau m’intéresser à un sujet alimentaire présent sur les tables de Noël : « La bûche de Noël ». L’histoire de cette bûche est racontée dans le livre « La Bûche et le gras » d’Anton Serdeczny paru en octobre 2025. L’auteur est historien, il est actuellement chercheur au Medici Archive Project à Florence. Je l’ai découvert parce qu’il a été invité par Xavier Mauduit dans son émission de France Culture : « Le Cours de l’histoire » du 18 décembre 2025 : « La bûche de Noël, du rondin magique au dessert crémeux »
Dans ma Lorraine natale, pas de discussion, la bûche de Noël est un gâteau avec beaucoup de beurre, une fine génoise pour tenir l’essentiel et un parfum : chocolat, praline, marron pour apporter une touche de poésie. Dans ma famille, nous avions adopté définitivement la bûche du pâtissier Paté à Stiring-Wendel. J’ai appris avec un immense regret que cette pâtisserie a fermé définitivement en juin 2025, sans repreneur.
Mais pourquoi parle t’on de bûche de Noël ?
C’est tout simplement parce que dans le monde d’avant l’ère industrielle, dans un monde presque exclusivement rural, le cœur de la célébration était une bûche de bois.
Anton Serdeczny nous explique qu’il s’agit d’une pratique populaire ancienne qui consiste à brûler une bûche de bois au moment de Noël
 La cérémonie de la bûche consiste à brûler une souche. Elle peut d’abord être baptisée par des libations diverses (vin, eau bénite, sel, huile, eau-de-vie), parfois en prononçant une prière. Dans le feu, la bûche est frappée pour en faire jaillir le plus d’étincelles possible. Il est probable que les illuminations des arbres de Noël soient issues de cette tradition.
La cérémonie de la bûche consiste à brûler une souche. Elle peut d’abord être baptisée par des libations diverses (vin, eau bénite, sel, huile, eau-de-vie), parfois en prononçant une prière. Dans le feu, la bûche est frappée pour en faire jaillir le plus d’étincelles possible. Il est probable que les illuminations des arbres de Noël soient issues de cette tradition.Cette combustion possède des pouvoirs magiques selon la croyance populaire : Plus les étincelles sont nombreuses, plus la prospérité agricole sera grande. Il s’agit évidemment de rites païens qui se sont développés autour du solstice d’hiver et ont été repris par la fête chrétienne.
L’historien raconte aussi qu’après avoir beaucoup brulé et produit des étincelles, la bûche pouvait par la manipulation des adultes, accoucher, le terme utilisé était « pisser », des friandises et même des jouets que les enfants recevaient en cadeau.
La bûche doit brûler une bonne partie de la nuit, mais pas entièrement. Elle est éteinte avec de l’eau afin d’être brûlée de nouveau le lendemain. La combustion doit ainsi durer plusieurs jours, parfois jusqu’au jour de l’An, ou jusqu’à l’Épiphanie, le 6 janvier, ce qui peut être interprété comme un présage de fertilité.
Les cendres de la bûche sont précieusement gardées pour nourrir les champs ou pour servir de protection contre les maléfices. Ce sont plus particulièrement les restes de la bûche qui sont dotés d’une grande puissance magique. Ils sont censés protéger de la foudre et des maléfices, favoriser les bonnes récoltes, éloigner les animaux nuisibles, guérir les maladies, garantir la fertilité et le bon déroulement des accouchements.
La cérémonie de la bûche de Noël, dans son ensemble, apparaît ainsi comme un rite de fécondité.
Anton Serdeczny parle de la magie de Noël, période pendant laquelle s’ouvre un espace partagé avec l’au-delà et le surnaturel pendant la nuit du 24 au 25 décembre :
« Noël et une période de grande puissance magique, qui se déverse sur le monde dès l’avent et pendant les douze jours qui suivent Noël. Cette magie a un pic au 24 décembre à minuit. Pendant l’avent, en Bretagne, les prêtres sont censés être capables de se transformer en animaux »
Sur le site Retronews, le site de presse de la BNF, il précise :
« À la minuit de Noël, si je rassemble et résume les données issues des collectes folkloriques, les animaux se mettent à parler, les abeilles chantent, les pierres s’ouvrent d’elles-mêmes pour montrer de dangereux trésors, les morts viennent se réchauffer au feu de la bûche – qui pouvait alors capter la puissance magique environnante, et en quelque sorte la stocker pour le reste de l’année. Elle était censée protéger de la foudre, de la sorcellerie, des maladies, des animaux nuisibles pour les cultures, favoriser la reproduction des humains et des animaux, la pousse des céréales et beaucoup d’autres choses encore. »
Sur le site de France Culture on peut lire :
« La nuit de Noël, située entre les saisons, entre deux années, entre l’obscurité des nuits les plus longues et la lumière des jours qui commencent à rallonger, entre deux journées, et donc potentiellement entre les morts et les vivants, serait chargée d’une magie particulièrement puissante. La bûche de Noël serait capable de capter et de conserver cette magie pendant une année entière, ce qui explique que des débris en soient précieusement conservés. D’autres objets peuvent être dotés de ce même pouvoir, comme un œuf pondu la nuit de Noël, le gras d’un bouillon ou un pain préparés la nuit de Noël et utilisés ultérieurement comme médicament, une bougie en partie consumée pendant la nuit de Noël…
À partir de la seconde moitié du 19ᵉ siècle, la tradition de la bûche de Noël recule progressivement, même si certaines familles continuent à la pratiquer jusqu’à aujourd’hui.L’urbanisation et l’évolution des modes de vie vont faire reculer cette pratique. La taille des cheminées diminue, ou sont tout simplement remplacées par d’autres modes de chauffage. D’autre part, dans le contexte de l’industrialisation, les sociétés sont de moins en moins tournées vers l’agriculture, ce qui rend moins central le maintien de rituels de fécondité.
La bûche de Noël en bois devient soit un jouet d’enfant, soit plus souvent une pâtisserie rappelant, par sa forme, le rite ancien. L’histoire est controversée, mais il semblerait que cette pâtisserie soit une invention française, perfectionnée par des pâtissiers parisiens.
Au début du 20ᵉ siècle, la bûche gâteau semble avoir durablement supplanté la bûche souche. Un autre rituel va se développer qui mériterait probablement un autre mot du jour celui du sapin de Noël.
Pour aujourd’hui je finirai celui-ci, en vous souhaitant un Joyeux Noël.
-
Mercredi 3 décembre 2025
« Ce dont nous avons besoin c’est d’action collective, de mobilisation, c’est de reconnaissance mutuelle de nos histoires, de nos combats, de nos identités et on sera beaucoup plus forts. »Hanna Assouline, cofondatrice « des guerrières de la paix »La tendance n’est plus tellement au débat, cet art de la discussion qui permet de se parler sans se battre donc de débattre. Le temps est plutôt à l’invective, à l’exclusion, à la délégitimation de celui qui ne partage pas exactement le même point de vue.
Ce point de vue peut être l’utilisation d’un mot comme celui de « génocide » pour qualifier les massacres commis par l’armée d’Israël à Gaza. Si tu n’utilises pas ce mot tu es soit mal informé, soit plus probablement un salaud qui encourage ce génocide.
Je ne sais pas si l’utilisation de ce terme est appropriée, je n’en suis pas convaincu mais ce n’est pas à moi d’en décider, c’est à la justice internationale qui ne s’est pas prononcée, elle a évoqué un risque de génocide.
A force, pourtant de répéter ce terme, comme une évidence,on a commencé à vouloir relativiser le génocide contre les juifs puisqu’Israël et les juifs de cet état faisaient la même chose. Et bientôt, on en est arrivé à ce que tous ceux qui ne voulaient pas utiliser ce terme ou qui tentait d’expliquer que le Hamas avait aussi une grande responsabilité dans ce qui se passait à Gaza devenait de facto des « génocidaires ».
Un professeur d’histoire médiévale, spécialiste de l’inquisition à l’université de Lyon 2, Julien Théry, s’est laissé choir dans cette fange. Il a publié, sur Facebook une liste intitulée « 20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances ». Cette liste incluait pour l’essentiel des personnalités juives.
Un professeur d’université en France, en 2025, peut donc publier une liste de juifs en demandant de les boycotter ou de les canceller en les traitant de ce nom infâme de génocidaires. Ces 20 personnes n’ont, jusqu’à nouvelle révélation, pas touché à un cheveu de palestinien de Gaza. Mais ils sont génocidaires, par appartenance probablement. Le reproche principal à leur encontre serait, semble t’il, le fait qu’ils aient publié une tribune dans le Figaro jugeant que la reconnaissance de l’Etat palestinien par la France n’était pas pertinent actuellement. On peut ne pas être d’accord avec cette opinion, c’est mon cas. Je trouve juste que la France, entraînant d’autres pays avec elle, ait reconnu l’Etat palestinien. Cela ne fait pas des personnes qui ne partagent pas cette opinion, des génocidaires. Mais il n’est évidemment pas indifférent de traiter ces « juifs ».de génocidaires.
Peut être que ce professeur a oublié, un instant, les leçons d’Histoire qu’il a du tirer de ses études sur l’inquisition et dans un moment de colère non maitrisé et passager, a utilisé un mot dépassant sa pensée.
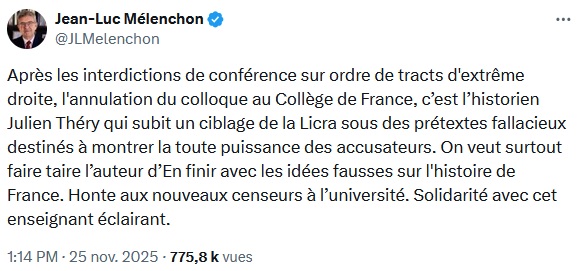 Mais que dire de Jean-Luc Melenchon qui aspire à devenir Président de la République et donc à travailler à l’Unité du peuple qu’il entend diriger, lorsque ce dernier plutôt que de dire que le propos de Julien Théry est exagéré ou hors de propos, écrit le tweet suivant pour répondre à la LICRA qui s’est indigné des propos de M Théry :
Mais que dire de Jean-Luc Melenchon qui aspire à devenir Président de la République et donc à travailler à l’Unité du peuple qu’il entend diriger, lorsque ce dernier plutôt que de dire que le propos de Julien Théry est exagéré ou hors de propos, écrit le tweet suivant pour répondre à la LICRA qui s’est indigné des propos de M Théry :« Solidarité avec cet enseignant éclairant. »
Hanna Assouline, cofondatrice des Guerriers de la paix a publié sur les réseaux sociaux un extrait d’une intervention qu’elle a fait lors d’une réunion :
« On est dans une course à la radicalité, à l’invective, à une forme de violence verbale qui fait qu’on est tous pris dans ce cirque qui non seulement n’aide en rien notre réflexion collective politique, ne nous aide pas ni à nous comprendre, ni à avancer, ni à comprendre le monde correctement mais qui en plus n’aide vraiment pas les gens pour lesquels on prétend s’engager. »
Les excès et la polarisation ne sont pas du seul côté pro palestinien, il y a de la même manière des théories, des récits, on utilise aujourd’hui le terme « narratif » qui prennent fait et cause pour les thèses des messianistes juifs qui prétendent que le peuple palestinien n’existe pas, que la Cisjordanie doit appartenir à Israël parce qu’il s’agit d’une terre bibliquement juive et enfin que la Jordanie est déjà l’Etat des palestiniens et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en créer un autre.
Pour celles et ceux qui croient encore à la paix en Israël et en Palestine, les militants des deux bords sur les terres du conflit, ces affrontements dans notre société française ne les aident pas et ne font rien avancer. C’est ce que rapporte Hanna Assouline :
« Et ça ça fait partie des choses qui ont été dites et redites à de nombreuses reprises par les militants palestiniens et israéliens qui luttent pour la paix, pour la dignité, pour la justice. Ils nous ont répété en fait, quand vous vous déchirez, quand vous utilisez notre cause pour alimenter la haine, l’islamophobie, le racisme, l’antisémitisme, quand vous nous utilisez comme des slogans, comme des étendards, sans vous poser la question réelle de notre avenir, pour régler les comptes de vos propres sociétés et de votre histoire coloniale, de votre histoire vis-à-vis de la shoah, de toutes les failles qui vous appartiennent et qui n’ont rien à voir avec nous. Non seulement vous ne nous aidez pas et vous n’êtes absolument pas dans la solidarité avec nous mais vous nous condamnez davantage à l’impasse. […] Cela nous a été répété par des gens extrêmement différents des Palestiniens comme des Israéliens. Cette idée de quand vous pensez nous aider, vous nous condamnez davantage, quand vous pensez nous aider de cette manière là. »
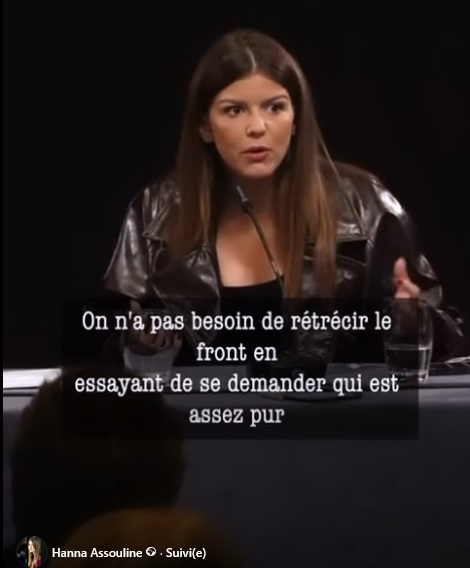 Comme le dit la cofondatrice des guerrières de la Paix nous sommes en face d’une offensive mondiale de l’extrême droite, de la renaissance des logiques d’empire, nous ne pouvons nous permettre, pour ceux qui veulent la paix, c’est à dire la coexistence pacifique de deux peuples sur la terre entre la mer et le jourdain, de nous invectiver et d’aspirer à la pureté des idées.
Comme le dit la cofondatrice des guerrières de la Paix nous sommes en face d’une offensive mondiale de l’extrême droite, de la renaissance des logiques d’empire, nous ne pouvons nous permettre, pour ceux qui veulent la paix, c’est à dire la coexistence pacifique de deux peuples sur la terre entre la mer et le jourdain, de nous invectiver et d’aspirer à la pureté des idées.Un des premiers mots du jour citait cette formule des temps révolutionnaire : « Un pur trouve toujours un plus pur qui l’épure. ». Les choses sont toujours plus compliquées que cette vision biblique de la lutte du bien contre le mal. Quand on en est convaincu, on accepte la complexité du monde et la fécondité du débat.
« Aujourd’hui on a besoin d’action, on a besoin d’un sursaut collectif, on a besoin de tout le monde autour de la table. On n’a pas besoin de rétrécir le front en essayant de se demander qui est assez pur dans son militantisme pour avoir le droit d’être assis à nos côtés. On a besoin d’un sursaut, d’un élan collectif qui soit le plus large possible, sinon on ne va pas y arriver. Et face à nous, on est face à une offensive mondiale fasciste qui est en train de nous écraser et qui se délecte des divisions dans lesquelles on tombe tous. […] »
Hanna Assouline finit par cette invitation à s’écouter et accepter mutuellement à reconnaître l’histoire de l’autre pour pouvoir mieux comprendre comment vivre ensemble.
« Ce dont nous avons besoin c’est d’action collective, de mobilisation, c’est de reconnaissance mutuelle de nos histoires, de nos combats, de nos identités et on sera beaucoup plus forts. Et pour lutter ici, dans nos sociétés et pour lutter pour eux là-bas. »
Je trouve pertinent de partager cet appel à s’écouter, à ne pas pratiquer l’excommunication et a envisager l’hypothèse qu’on peut discuter de tous les sujets.
-
Jeudi 13 novembre 2025
« Le sel de la terre »Documentaire réalisé par Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado sur la vie et le travail de Sebastião SalgadoLors de sa visite en juin 2025, Florence nous avait suggéré de regarder « Le sel de la terre » un documentaire sur le travail du photographe franco-brésilien Sebastiao Salgado, en précisant que c’était exceptionnel.
Depuis je l’ai revu deux fois, la première fois avec ma fille Natacha en juillet, puis plus récemment, hier, avec Annie et ses deux sœurs qui avaient eu la merveilleuse idée de se donner du temps l’une à l’autre pour se retrouver ensemble pendant une grande semaine.
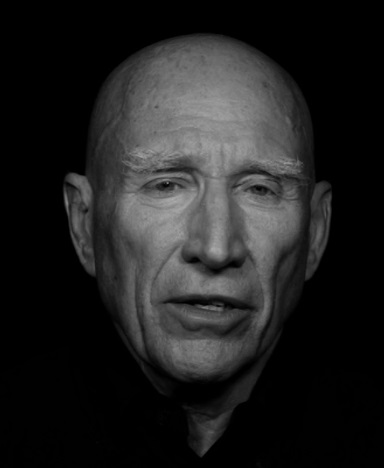
Sebastião Ribeiro Salgado Avant que Florence ne m’en ait parlé je ne connaissais pas Sebastiao Salgado qui venait de mourir le 23 mai 2025 à Neuilly-sur-Seine.
Sebastião Ribeiro Salgado est né en 1944 au Brésil. Son père est un éleveur et propriétaire terrien d’origine espagnol. La famille maternelle d’origine suisse s’était installée au Brésil à la fin du XIXe siècle.
Sur l’injonction de son père il poursuit des études d’économie à l’université de São Paulo. Militant au sein des Jeunesses communistes, Salgado se trouve contraint de fuir la dictature brésilienne en 1969, avec sa femme. Il ne retrouvera son pays qu’en 1979.
En 1969, Sebastião Salgado s’installe à Paris pour suivre des cours à l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae).
Par la suite, il est recruté par l’Organisation internationale du café (ICO), basée à Londres et pour laquelle il réalise des enquêtes jusqu’en 1973. Il va abandonner cette carrière pour devenir photographe. Il explique
« J’emportais mon appareil photo pour mes enquêtes et je me suis aperçu que les images me donnaient dix fois plus de plaisir que les rapports économiques. Je commençais à voir le monde d’une autre manière, à travers le viseur et par un contact direct avec les gens. En fait, j’ai continué à faire la même chose : dresser un constat de la réalité. »
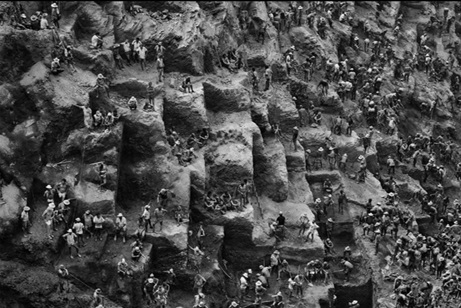
La main de l’homme : Mine d’or de Serra Pelada Salgado travaille toujours en noir et blanc et observe la vie de ceux qui vivent et travaillent dans des conditions difficiles — migrants, mineurs, victimes de la famine. Le documentaire s’ouvre sur des photos de « La Mine d’or de Serra Pelada », qui montre le quotidien dans une mine d’or au Brésil.
Ce documentaire a été réalisé par Wim Wenders qui s’est associé à un des fils du photographe Juliano Ribeiro Salgado pour montrer Salgado à l’oeuvre à travers les projets qu’il a réalisés jusqu’en 2013 : « La Main de l’homme », « Les Enfants de l’exode », « Genesis » qui sont autant de livres qu’il a publié…
Wim Wenders a présenté ce documentaire au festival de Cannes 2014, exactement 30 ans après avoir reçu la palme d’or pour « Paris Texas » en 1984.

Koweit : Un désert en feu – Les puits de pétrole enflammés par les irakiens Le journal « L’humanité » a publié un article « Le Sel de la terre, une leçon de vie qui nous fait tous grandir » le 15 octobre 2014 dans lequel on peut lire :
«Le Sel de la terre est un film sur l’itinéraire d’un homme à travers la misère du monde, entre horreur et destruction, jusqu’à devenir initiatique, entre sérénité et reconstruction. Une leçon de vie, d’art et d’humanité exceptionnelle »
Chaque fois que j’ai visionné ce documentaire j’ai trouvé d’autres richesses, d’autres messages que je n’avais pas perçu la première fois. Les images de Salgado sont d’une immense force car son regard montre les humains dans leur dénuement, leur détresse, parfois leur joie. Il n’est pas allé sur des terres accueillantes, souvent la guerre, une violence inouïe, des épreuves terribles s’abattaient sur les femmes et les hommes qu’il photographiait.

Les enfants de l’exode : guerre en Yougoslavie Il a photographié ces lieux où l’on se tue au travail, où la faim ronge la chair, où la guerre ravage l’espoir, où la terre charrie des flammes. Son regard humaniste permet de montrer ces choses horribles tout en nous laissant la capacité d’observer sans nous détourner et d’être ainsi touché au plus profond de notre âme humaine : des enfants morts, des humains affamés, des charniers qui dévoilent ce que l’homme fait à l’homme sur cette terre. Par son art, il nous rend proche ces êtres humains et nous conduit à intérioriser ce fait pourtant évident : nous faisons partie de la même humanité.
C’est aussi tout le talent de Wim Wenders et du fils du photographe d’accompagner ce travail de révélations et d’explications. Wim Wenders le décrit ainsi :
« Ses photos révèlent son effort pour nous montrer l’âme des peuples mais aussi le contexte qui les entoure. Pourquoi cette famine ? Pourquoi cette guerre ? Il ne veut pas seulement constater mais aussi faire savoir. »

Génocide des Tutsi au Rwanda Après son travail au Rwanda, lors du génocide des tutsis et des évènements qui ont suivis, il perd foi en l’humanité. Il se retire sur les terres de son père au Brésil où l’action de l’homme a conduit à un désastre écologique : Plus rien n’y poussait, les oiseaux avaient disparu, il n’y avait même plus d’herbe pour les vaches. Son épouse depuis 1967, qui l’a accompagné, aidé, soutenu tout au long de sa vie, Lélia Deluiz Wanick Salgado lui donne l’idée de se lancer dans une vaste entreprise de reboisement pour faire revivre le domaine.
De cette initiative naîtra l’Instituto Terra, en 1998. Avec ses millions d’arbres plantés, la nature a repris ses droits, autant qu’elle a guéri l’âme meurtrie de Salgado, éprouvée par la folie et la violence de ses contemporains. Patiemment, sa fondation s’active à replanter chaque arbre, chaque fleur, à réparer ce que l’homme a détruit. Petit à petit, un paysage et un écosystème renaissent de leurs cendres. Salgado affirme que cela a changé leurs vies.
Le Sel de la Terre entre ainsi dans les deux grandes préoccupations de l’humanité d’aujourd’hui : la paix et l’environnement. Wim Wenders conclut son entretien dans le Figaro du 15 octobre 2014 par ces mots.
« Quelqu’un qui a vu toute la misère du monde est capable de montrer un chemin optimiste. On ne l’aurait pas cru au début, mais une renaissance est possible. »

La replantation d’arbre sur le domaine de son père C’est un documentaire d’une beauté et d’une force incroyable, je ne peux que vous recommander, si vous ne l’avez pas déjà fait, de vous donner les moyens de partir à la découverte de cette oeuvre qui magnifie l’art et l’humanisme de cet immense photographe que fut Sebastião Ribeiro Salgado
-
Vendredi 31 octobre 2025
« Et pendant le moment de l’accouchement, le papa tient bien fort la main de la maman pour avoir moins peur !»Une des phrases affichées à l’accueil de la Maternité des Lilas pour faire comprendre aux futurs parents quel était le sexe fort au moment de la naissance.Michel Rocard avait énoncé cette vérité de vie, les deux ou trois plus beaux moments de votre vie n’ont jamais rien à voir avec l’argent.
Et, chacun de s’interroger : mais si je me penche sur ma vie : quels en sont les plus beaux instants ?
Pour moi, je n’ai pas de doute : ces deux plus beaux moments, je les ai vécus 12 Rue du Coq Français dans la petite commune « Les Lilas » en Seine Saint Denis. le premier a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 juin 1991 et le second dans la soirée du 10 janvier 1994.
L’écrin magnifique, magnifique parce qu’il était rempli de l’humanité, de la qualité d’écoute, du dévouement et de la chaleur des personnes qui travaillaient là où ces évènements se sont déroulés, portait le doux nom de « Maternité des Lilas. »
 La maternité des Lilas va définitivement fermer ses portes ce 31 octobre 2025.
La maternité des Lilas va définitivement fermer ses portes ce 31 octobre 2025.Il y eut tant de menaces et de luttes pour la maintenir en activité, que beaucoup pensaient qu’elle avait déjà fermé. Ce n’était pas le cas, c’est aujourd’hui que cette aventure de 61 ans va définitivement se terminer.
La maternité des Lilas a été fondée en 1964 par la comtesse Colette de Charnières avec un statut de clinique privée. Elle poursuivait le même objectif que la maternité des bluets située 9, rue des Bluets dans le 11e arrondissement, refuser ce commandement que l’homme, qui a écrit le texte de la Genèse, fait dire à dieu :
« Il dit à la femme: J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, »
La Bible du Semeur 2015 – Genèse 3-16L’accouchement sans douleur est un ensemble de techniques visant à supprimer l’angoisse et les douleurs de l’accouchement par une préparation durant la grossesse et l’utilisation de techniques complémentaires pendant l’accouchement, et par la création d’un rapport de confiance et de collaboration entre l’équipe médicale et la mère. Ces techniques ont été développées principalement au Royaume-Uni et en URSS au milieu du XXe siècle.
La France était en retard sur ces méthodes. Cette évolution a été introduite en France grâce aux communistes et à la CGT. Le médecin qui en a été le moteur fut le docteur Fernand Lamaze, chef de service de la maternité des Bluets, ouverte en novembre 1947, réalisation sociale des syndicats CGT de la Métallurgie de la région parisienne.
En 1950, le docteur Lamaze avait lu un rapport du professeur russe A.P. Nikolaiev sur la doctrine du physiologiste Pavlov, basée sur la découverte de l’intervention du système nerveux supérieur dans les grandes fonctions de l’organisme ; Nikolaiev démontrait qu’une éducation psychique de la femme enceinte pouvait lui permettre d’accoucher sans douleur.
En 1951 lors d’une mission médicale, F. Lamaze assiste à un accouchement naturel sans douleur, ce qui se pratiquait couramment en URSS :
« Ce fut pour moi un véritable bouleversement de voir cette femme accoucher sans aucune manifestation douloureuse… tous ses muscles étaient relâchés… pas la moindre angoisse dans ses yeux, pas un cri, pas la moindre goutte de sueur ne perlait sur son front, pas une seule contraction du visage. Le moment venu, elle a fait les efforts de pousser sans aucune aide, dans un calme absolu…Après avoir été le témoin d’une chose pareille, je n’avais plus qu’une préoccupation : transplanter cela en France et… cela devenait pour moi une idée fixe »
Il va pouvoir introduire cette méthode avec un confrère, le docteur Vellay, grâce à l’engagement militant de femmes et de membres de la CGT, dans le cadre de la maternité des Bluets.
Mais des forces réactionnaires, probablement marquées par la Genèse, s’opposent à ces évolutions. À deux reprises, Lamaze et Vellay sont traduits devant le Conseil de l’ordre des Médecins. Enfin, ils seront blanchis en 1954.
Et preuve qu’il ne faut pas désespérer de l’Eglise, le 8 janvier 1956, le pape Pie XII crée la surprise en prenant position en faveur de l’accouchement sans douleur devant sept cents gynécologues et médecins. Il déclare :
« la méthode est irréprochable du point de vue moral ».
Si vous voulez en savoir davantage : « https://francearchives.gouv.fr/pages_histoire/40009 »
 La Maternité des Lilas va s’inscrire dans ce mouvement.
La Maternité des Lilas va s’inscrire dans ce mouvement. Quand en 1991, il fallu choisir une maternité, pour Annie et moi, il n’y avait aucun doute il nous fallait choisir entre ces deux établissements. Finalement, ce fut la maternité des Lilas.
L’accompagnement dont nous avons pu bénéficier jusqu’à l’accouchement fut incroyable.
Nous savions que s’il y avait des difficultés il serait possible de rapidement mobiliser des équipes médicales. Mais quand ce n’était pas nécessaire, ce qui fut notre cas, il n’y avait que l’humain, le toucher, la respiration, la confiance et le miracle de la vie qui naissait au milieu d’un petit groupe d’humains, beaucoup de femmes, mais le père avait toute sa place.
L’accouchement sous péridurale qui existait depuis 1975 était possible, mais le plus souvent inutile : les techniques naturelles apprises étaient suffisantes pour que ce moment de joie fut sans douleur. Le cœur de tout cela était de faire de cet instant : l’arrivée au monde d’un petit humain, non un acte exclusivement technique mais avant tout, un acte d’humanité dans lequel un petit groupe relié par l’amour, la bienveillance, l’attention accueillait, en son sein, un nouveau petit être, une nouvelle vie.
 Pour la naissance de 1991 nous habitions près de la Place d’Italie à Paris. En fin de cette année nous avons déménagé dans une résidence, avenue Jean Moulin à Montreuil sous bois. Nous avons eu la surprise d’apprendre, peu à peu, que tous les parents que nous fréquentions régulièrement, étaient allés à la maternité des Lilas, sauf un couple qui était allé à la maternité des Bluets.
Pour la naissance de 1991 nous habitions près de la Place d’Italie à Paris. En fin de cette année nous avons déménagé dans une résidence, avenue Jean Moulin à Montreuil sous bois. Nous avons eu la surprise d’apprendre, peu à peu, que tous les parents que nous fréquentions régulièrement, étaient allés à la maternité des Lilas, sauf un couple qui était allé à la maternité des Bluets.En 61 ans d’existence, l’établissement a été pionnier dans le féminisme en étant un haut lieu de l’accouchement physiologique, qui se veut le plus naturel et le moins médicalisé possible. Il a aussi pratiqué des avortements clandestins avant la Loi Veil. Il continuait aujourd’hui de pratiquer de nombreux IVG. En 1990, la maternité des Lilas a fait l’objet d’une attaque du mouvement américain pro-life « commando anti-IVG ». Toujours à la pointe de la lutte pour le droit des femmes de disposer de leur corps, l’établissement a embrassé plus récemment les luttes LGBT.
Le 1er juillet 2025, l’agence régionale de santé avait annoncé sa fermeture pour plusieurs raisons : une baisse d’activité, la perte de sa certification par la Haute Autorité de santé et des difficultés financières.
Les médias se font l’écho de ce jour de deuil qui voit la fermeture de cet établissement de lumière par manque d’argent. Michel Rocard avait raison, toutefois l’argent est quelquefois nécessaire pour rendre possible les choses belles et remarquables.
France info écrit « Pourquoi la fermeture de la maternité des Lilas suscite tant d’émotions et de regrets.»
La station ICI donne la parole à une maman qui a accouché dans ce lieu : « C’était tellement humain cette maternité, on se sentait comme à la maison ».
Libération publie aussi des témoignages : «Là-bas, je n’étais pas qu’un numéro».
Et le titre de l’article du Monde pour informer sur cette évènement : « Mobilisation contre la fermeture imminente de la maternité des Lilas, pionnière du féminisme ».
Je ne peux m’empêcher d’être triste qu’un tel établissement où les femmes se sentaient respectées, écoutées et accompagnées et où les pères avaient leur place aussi, ne puissent plus continuer à exercer sa noble mission.

-
Jeudi 23 octobre 2025
« La guerre des récits»Une part d’explication du mondeLundi, je rappelais que notre espèce, homo sapiens, se distinguait des autres par le langage qu’elle avait inventé pour communiquer et échanger à l’aide d’une suite de mots. .
Avec ces mots, sapiens a développé un outil d’une puissance inouïe qui lui a permis de s’imposer et de devenir « le maître des espèces sur terre ». Dans la série consacrée à « Sapiens » de Yuval Noah Harari, le mot du jour consacré aux mythes relevait cette belle formule de l’auteur :
C’est cette faculté d’inventer des histoires, des mythes, des religions qui ont donné à Sapiens les moyens de réunir des groupes, tribus, empires immenses liés par ces croyances communes. Aucune autre espèce n’a jamais été capable de réunir autant d’individus liés par un destin et des objectifs communs.
Les groupes humains, pour faire société, se rassemblent, ainsi, autour de « récits » qui font sens pour eux, donnent le lien qui leurs permettent d’affronter ensemble des défis et construire une communauté, une nation, jusqu’à une civilisation.
Ces récits peuvent devenir le ferment de conflits entre groupes humains : « Nous contre Eux »
« La guerre des récits » est une expression que Christine Ockrent a utilisé, en 2020, dans un livre consacré à la pandémie du Covid 19. Le Grand Continent avait interviewé, à cette occasion, l’autrice : « La Guerre des récits, par Christine Ockrent »
Amélie Férey, professeure à Sciences-Po Paris et à École polytechnique et chercheuse à l’Institut français des relations internationales (IFRI) a donné, en 2024, comme titre à un podcast : « De l’Ukraine à Gaza : la guerre des récits » consacré à son dernier livre dans lequel elle explore comment le langage et les récits jouent un rôle crucial dans la conduite des conflits modernes, y compris les guerres en Ukraine et à Gaza.
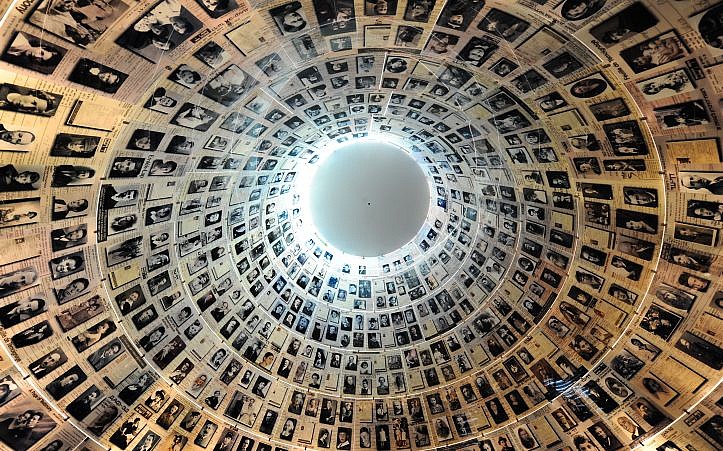
Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem Dans le conflit entre Israël et les Palestiniens, j’ai appris et présenté cette douloureuse histoire en me basant sur le récit sioniste : Un peuple, uni par une religion, rejeté et martyrisé par les nations européennes et chrétiennes qui poursuit le projet de se regrouper sur la terre qui est au cœur de son livre sacré autour de la ville de Jérusalem. C’est ce que j’ai développé dans le mot du jour « Le sionisme apparaît parce qu’il y a l’antisémitisme » ou encore dans celui-ci : « Israël est né d’une angoisse de mort comme aucun peuple n’en a connue à ses origines. ».
Mais on peut aussi raconter une autre histoire, un autre point de vue, un récit concurrent.
En 1914, la Palestine faisait partie de l’Empire Ottoman. Sur ce territoire, selon Wikipedia, habitait 525 000 musulmans, 70 000 chrétiens et 60 000 Juifs, soit 80% de musulmans et 9 % de juifs. C’est une population arabe, fier de sa civilisation, qui est sous le joug d’une nation, certes musulmane, cependant honnie : les turcs, peuple guerrier et impérial.
L’élite du peuple arabe souhaite se débarrasser de ces importuns pour se retrouver « entre arabes » et créer, comme en en Europe, une nation arabe. L’erreur de l’Empire Ottoman d’entrer en guerre du côté des empires centraux, l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne, constitue pour cette élite, une opportunité de pouvoir se libérer des Ottomans.
C’est alors qu’en Europe, un petit groupe de chrétiens protestants mu en partie par des mythes religieux sous la direction de celui qui est le ministre des affaires étrangères du gouvernement de l’Empire Britannique prend l’initiative de produire, ex nihilo, « la déclaration Balfour » qui soutient l’implantation en Palestine d’un « Foyer National Juif »
Il faut considérer cette affaire. Vous êtes musulman arabe, vous voulez vous libérer de l’emprise ottomane. Et voilà, que sur un autre continent, à Londres, le gouvernement occidental, chrétien, de la plus grande puissance colonisatrice européenne de l’histoire de l’humanité déclare la chose suivante : Nous soutenons l’implantation d’une partie de la population européenne, de confession juive, sur la terre que vous habitez. Et c’est ainsi que dans un plan organisé et financé, des juifs européens viennent s’installer sur la terre entre la Méditerranée et le Jourdain. Ce sont certes des juifs, reliés à cette terre, par leurs mythes religieux, mais ils sont très différents de la communauté juive de Palestine, des juifs orientaux qu’on appelle « le vieux Yichouv ». Ils ne se mélangent d’ailleurs pas.
Comment ne pas comprendre que cette histoire est vécue par les habitants arabes de la Palestine, comme une « colonisation » européenne de peuplement, sous la protection de la plus grande puissance coloniale occidentale.
Des mots du jour ont été écrits sur ce sujet. L’analyse cinglante d’Arthur Koestler « Une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d’une troisième. » Et puis plus saisissant encore cette confidence du premier des israéliens David Ben Gourion rapportés par son ami Nahum Goldmann : « Ils ne voient qu’une chose : nous sommes venus et nous avons volé leur pays. Pourquoi l’accepteraient-ils ? ». Et cette synthèse qu’en a fait Dominique Moïsi : «Quand Israël naît […] en 1948, […] Pour le monde Arabe, c’est le dernier phénomène colonial de l’histoire européenne qui est anachronique. Pour les Israéliens, c’est avec quelque retard, le dernier phénomène national de l’histoire européenne du 19ème siècle.[…] Et en fait ce conflit de calendrier n’a jamais été surmonté.»

Goulag, une histoire Soviétique documentaire de Patrick ROTMAN Dominique Moïsi nous entraîne dans une transition plus globale encore entre occidentaux et non occidentaux. L’historien Timothy Snyder, plusieurs fois cités dans les mots du jour, a écrit un ouvrage de référence : « Terres de sang » dans lequel il parle de l’Europe et des meurtres de masse communistes et nazis : Le goulag et la shoah. Pour les occidentaux ce sont les récits des deux plus grandes tragédies du monde.
Les européens depuis leur colonisation de l’Amérique, commencée en 1494, dont ils ont tiré un récit « La découverte de l’Amérique », ont dominé pendant des siècles le monde puis ont passé le relais à leur colonie de peuplement : « Les Etats-Unis ». Cet Occident a dominé, a exploité les richesses du monde, a imposé ses valeurs et ses récits. Les deux grands malheurs de l’humanité furent la shoah et le goulag.
L’Occident domine moins, on lui impose d’autres récits. Pour le reste du monde les deux grands malheurs de l’humanité sont la colonisation et l’esclavage.
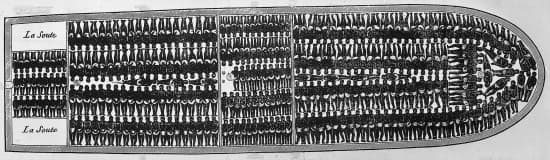
Les bateaux négriers Transportent 300 à 400 Noirs réduits en esclavage.Ces hommes, entassés entre deux ponts.
L’absence d’hygiène fait mourir 10 à 15 % des passagers.
À l’arrivée, les Noirs sont exposés et vendus.Un jour je suis tombé sur cette interview que Thierry Ardisson a fait de Dieudonné. Elle s’intitule « la dernière interview de Dieudonné » car le polémiste antisémite n’a plus,depuis, été invité à la télévision. Dieudonné raconte sa dérive à partir d’un moment particulier de son existence. Il voulait faire un film sur l’esclavage des noirs africains et il s’est heurté, selon son témoignage, à un mur financier qui lui a refusé de faire ce film. Selon son récit dès qu’il s’agit de sujets sur la shoah, les financements sont faciles à obtenir, dès qu’il s’agit de parler de l’esclavage, il n’y a plus personne.
Je ne sais pas quelle crédibilité apporter à ce récit, mais je suis certain qu’il s’agit d’un ressenti fort d’une grande partie du monde et d’une partie de notre société française.
Guillaume Erner a tenté de rapprocher les récits lors de sa matinale du mardi 21 octobre. Il a invité l’essayiste indien Pankaj Mishra qui défend l’idée que « La création de l’État d’Israël s’est faite à rebours d’un processus de décolonisation » dans son livre « Le Monde après Gaza ».
Erner a essayé d’engager un dialogue entre Pankaj Mishra et François Zimeray, président de l’Association française des victimes du terrorisme, l’AFVT, ancien ambassadeur en charge des droits de l’Homme qui défendait davantage le récit occidental.
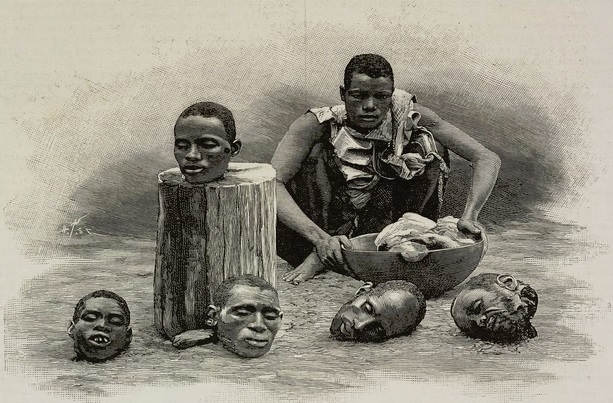
Daniel Schneidermann voit cette image, au Musée de l’armée. Sur la base de cette image il va écrire un essai « Cinq têtes coupées » L’image est une gravure réalisée d’après photographie et reproduite dans le journal L’illustration, numéro 2511 du 11 avril 1891. Les soldats coloniaux trouvaient commode de décapiter les récalcitrants, cela permettait d’imposer la soumission aux autres. Ils ne s’en cachaient pas, comme le montre cette publication de 1891. Force est de constater que cet échange fut très compliqué, parce que chacun est resté sur son récit et n’a pas voulu ou su accueillir le récit de l’autre.
Cela me permet d’arriver à une conclusion provisoire.
Les récits dont il est question ne constituent jamais « la vérité », ils dévoilent une vérité.
Pour que le récit fonctionne, il faut qu’il s’inscrive dans des faits réels, mais il faut aussi une part de conte, de refus d’entrer dans les détails et les nuances. Patrice Boucheron a écrit récemment dans un article de Libération
« La meilleure façon de gâcher une fête traditionnelle, c’est d’y inviter un historien. Rien de tel pour doucher vos enthousiasmes »:
C’est folie que de croire que notre récit explique par lui seul la complexité du monde ou son malheur.
Il nous faut comprendre cette force du récit, être capable d’un saisir, même imparfaitement, les limites. Et surtout, surtout comprendre qu’il peut exister d’autres récits, être en capacité de les accueillir pour tenter de construire ensemble, à partir de nos points de vue différents.
Dans le mot du jour consacré au « Concert de Ramallah », Daniel Barenboim a magnifiquement résumé ce conflit de récit en Palestine :
« Nous avons le choix : nous entretuer ou apprendre à partager ce qui peut se partager. »
-
Lundi 20 octobre 2025
« Ainsi parlait Donald Trump »Un clin d’œil à un célèbre ouvrage de Friedrich NietzscheJ’aime les mots. Je crois que nous sommes nombreux à aimer les mots, ceux qui ont du sens, qui permettent d’exprimer de la profondeur, un raisonnement ou la beauté poétique du monde.
Le langage élaboré, structuré est un des éléments essentiels qui distingue notre espèce « homo sapiens » des autres espèces. C’est le moyen que notre espèce a inventé pour communiquer, pour échanger, pour se comprendre.

Manifestation « No king » du 18 octobre 2025 à Los Angeles Et puis, nous qui vivons aujourd’hui dans un monde d’une complexité qui s’épaissit chaque jour, un monde qui est confronté à des défis de plus en plus redoutable, nous voyons l’homme, que le pays le plus puissant de la planète, a mis à sa tête utiliser des mots simplistes, prononcer des discours effarants.
Un clone d’Ubu roi qui appauvrit la langue, exprime des banalités avec force superlatifs, ment ou dit simplement des choses qui n’existent pas dans la vie réelle.
Il est parfaitement ridicule. Mais personne n’ose lui dire, au contraire les autres chefs d’état ou d’organisation internationale le flatte et n’ont qu’une crainte : le contrarier.
C’est effrayant !
Je sais bien que ces actes et ses décisions en interne comme à l’international sont encore plus effrayants. Mais aujourd’hui, je m’arrêterai au langage utilisé par cet homme, car il faut oser lire ce qu’il dit.

A la Knesset une partie du public porte des casquettes rouges « Trump The Peace President » Après avoir obtenu un cessez le feu, fragile, au moyen-orient, la libération des otages israéliens et de prisonniers palestiniens, il s’est rendu à Jérusalem pour faire un discours à la Knesset, le 13 octobre. Vous trouverez des larges extraits publiés par le site « Le Grand Continent » : « C’est la fin de la guerre ».
Il commence son discours pour prétendre que tout cela est inhabituel, incroyable et que finalement tout va s’arranger bientôt :
« C’est une victoire incroyable pour Israël et pour le monde entier que tous ces pays aient travaillé ensemble en tant que partenaires pour la paix. C’est assez inhabituel, mais c’est ce qui s’est passé dans ce cas précis. C’était un moment très inhabituel, un moment brillant. Dans plusieurs générations, on se souviendra de ce moment comme celui où tout a commencé à changer, et à changer pour le mieux, comme aux États-Unis actuellement. Ce sera l’âge d’or d’Israël et l’âge d’or du Moyen-Orient. Tout va fonctionner ensemble. »
Nous savons que rien n’est réglé et que si cette étape est indiscutablement une merveilleuse nouvelle pour ceux qui souffraient, c’est la plus simple dans un processus de paix qui doit permettre de faire coexister deux peuples qui pour la plus grande part se haïssent aujourd’hui.
Pour continuer, comme souvent il évoque Dieu mais pas le peuple palestinien :
« Les gens disaient autrefois que cela n’existerait pas. Ils ne le disent plus aujourd’hui, n’est-ce pas ? Pourtant, si la sécurité et la coexistence peuvent prospérer ici, dans les ruelles sinueuses et les chemins anciens de Jérusalem, alors la paix et le respect peuvent certainement s’épanouir parmi les nations du Moyen-Orient au sens large. Le Dieu qui habitait autrefois parmi son peuple dans cette ville nous appelle encore, selon les paroles de l’Écriture, à nous détourner du mal et à faire le bien, à rechercher la paix et à la poursuivre. Il murmure donc toujours la vérité dans les collines, les coteaux et les vallées de sa magnifique création. Et Il inscrit toujours l’espoir dans le cœur de ses enfants partout dans le monde. C’est pourquoi, même après 3 000 ans de souffrances et de conflits, le peuple d’Israël n’a jamais cessé d’être exposé à toutes sortes d’autres menaces. Vous voulez la promesse de Sion. Vous voulez la promesse du succès, de l’espoir et de l’amour. Et Dieu et le peuple américain n’ont jamais perdu la foi en la promesse d’un avenir grand et béni pour nous tous. »
Ensuite arrive un moment de révélation de sa part sur l’activité d’une milliardaire américaine ouvertement membre du lobby pro-Netanyahou. Il remercie Miriam Adelson, veuve du milliardaire Sheldon Adelson, à la tête d’une des plus grandes fortunes américaines, elle avait significativement contribué à la campagne de Trump en 2024, avec un don de 106 millions de dollars. Le travail de lobbying existe, mais jamais un président ne l’a ouvertement reconnu comme Trump :
« Miriam et Sheldon venaient au bureau. Ils m’appelaient. Je pense qu’ils se sont rendus à la Maison-Blanche plus souvent que n’importe qui d’autre à ma connaissance. Regardez-la, assise là, l’air si innocent. Elle a 60 milliards à la banque. 60 milliards. Et elle aime Israël, mais elle l’aime vraiment. Ils venaient, et son mari était un homme très agressif, mais je l’aimais. Il était très agressif — mais il me soutenait beaucoup. Et il m’appelait pour me demander s’il pouvait venir me voir. Je lui disais : « Sheldon, je suis le président des États-Unis. Ça ne marche pas comme ça. » Il venait quand même. Ils ont joué un rôle très important dans beaucoup de choses, notamment en me faisant réfléchir au plateau du Golan, qui est probablement l’une des meilleures choses qui soient jamais arrivées. Je lui ai demandé un jour si elle préférait Israël et les États-Unis. Elle n’a pas répondu — ce qui signifie qu’elle préfère peut-être Israël.»
Que dire devant un président qui parle ainsi devant les caméras du monde entier ?
Lorsqu’il parle de la guerre contre l’Iran cela donne ces propos d’adolescent attardé :
« En frappant l’Iran, nous avons écarté un gros nuage du ciel du Moyen-Orient et d’Israël, et j’ai eu l’honneur d’y contribuer.
Ils ont pris un gros coup, n’est-ce pas ? N’est-ce pas qu’ils ont pris un gros coup ? Bon sang, ils l’ont pris d’un côté, puis de l’autre. Et vous savez, ce serait formidable si nous pouvions conclure un accord de paix avec eux. Et je pense que c’est peut-être possible. Seriez-vous satisfait de cela ? Ne serait-ce pas formidable ? Je pense que oui, car je pense qu’ils le veulent, je pense qu’ils sont fatigués. […]
Ce que nous avons fait en juin dernier, l’armée américaine a fait voler sept de ces magnifiques bombardiers B2. Ils sont soudainement devenus si beaux. Ils l’ont toujours été. Je trouvais simplement que c’étaient de jolis avions. Je ne savais pas qu’ils pouvaient faire ce qu’ils ont fait. En fait, nous venons d’en commander vingt-huit autres. »C’est affligeant et effrayant à la fois !
Après la Knesset, le président américain s’est rendu en Egypte, à Charm-el-Cheik, le 14 octobre, où l’attendait quasi tous les chefs d’Etat ou de gouvernement des pays de la Région et des principaux pays occidentaux. Il s’est lancé dans un nouveau discours sans structure et consistance. Ce discours est traduit intégralement par le Grand Continent : « Trump en Egypte »
Il commence par prouver qu’il ignore ce que signifie le mot « paix » entre les nations :
« Ensemble, nous avons réalisé ce que tout le monde disait impossible. Nous avons enfin la paix au Moyen-Orient. C’est une expression très simple : la paix au Moyen-Orient. Nous l’entendons depuis de nombreuses années, mais personne ne pensait qu’elle pourrait un jour devenir réalité. Et maintenant, nous y sommes. »
Après il raconte un conte pour enfants :
« L’aide humanitaire afflue désormais, notamment des centaines de camions chargés de nourriture, de matériel médical et d’autres fournitures, […] Les otages retrouvent leurs proches. C’est magnifique ! Je regarde tout cela depuis les coulisses, l’amour et la tristesse qui s’expriment. Je n’ai jamais rien vu de tel. C’est incroyable, quand on voit qu’ils n’ont pas vu leur mère ou leur père depuis si longtemps et qu’ils ont vécu dans un tunnel, un très petit et très profond tunnel ; l’amour qui s’exprime est tout simplement incroyable. C’est magnifique à voir. D’un côté, c’est horrible que cela ait pu se produire, mais d’un autre, c’est tellement beau à voir. Un nouveau jour magnifique se lève. Et maintenant, la reconstruction commence. »

La photo « souvenir » du sommet de Charm-el-Cheik Puis il va passer la plus grande partie de son discours à parler des différents présents de la manière suivante :
L’émir du Qatar
« C’est un homme extrêmement respecté. Son Altesse le cheikh Tamim est respecté par tous. Il est respecté par tous et de la manière la plus positive qui soit. Non seulement grâce à son pouvoir, mais aussi grâce à son cœur. Il a un cœur d’or, c’est un grand leader et son pays l’aime. Merci beaucoup d’être ici. C’est un honneur. »
Le Président turc Erdogan :
« Il est toujours là quand j’ai besoin de lui. C’est un homme très dur. Il est aussi dur qu’on peut l’être. Mais nous l’aimons. Et quand ils ont un problème avec vous, ils m’appellent toujours pour que je m’en occupe. Et généralement, j’y parviens. Nous avons tout simplement une bonne relation. Et ce, depuis le début. Je tiens donc à vous remercier chaleureusement et à saluer votre épouse, votre magnifique épouse. C’est formidable d’être avec vous.. »
Les présidents arméniens et d’Azerbaïdjan :
« Nous avons l’Arménie. Oh, et l’Azerbaïdjan. C’est une petite guerre que nous avons arrêtée. C’est une petite guerre. Les voilà. Regardez-les. Ils étaient aussi assis quand je les ai rencontrés, dans le Bureau ovale. Ils se sont battus pendant trente-et-un ans, ou un autre nombre délirant. Et il y en avait un assis de ce côté du Bureau ovale, un assis de l’autre côté, et quand nous avons terminé au bout d’une heure, ils s’étreignaient tous les deux. Et maintenant, ils sont amis et s’entendent très bien. Regardez ça. Je tiens donc à vous remercier tous les deux. C’est incroyable. Vraiment incroyable. »
Il va passer ainsi tout le monde en revue et il dira pour la première ministre italienne Giorgia Meloni, :
« En Italie, nous avons une femme, une jeune femme qui est… Je ne peux pas le dire, car généralement, si vous le dites, c’est la fin de votre carrière politique. C’est une belle jeune femme. Aux États-Unis, si vous utilisez le mot « belle » pour qualifier une femme, c’est la fin de votre carrière politique. Mais je vais tenter ma chance. Où est-elle ? La voilà. Ça ne vous dérange pas qu’on vous dise que vous êtes belle, n’est-ce pas ? Parce que vous l’êtes. Merci beaucoup d’être venue. Nous vous en sommes reconnaissants. Elle voulait être ici, elle est incroyable et elle est très respectée en Italie. C’est une politicienne qui a beaucoup de succès. »
Il présente ensuite l’avenir sous une vision radieuse « orientée vers une paix formidable, glorieuse et durable. ».
Il s’inscrit dans les millénaires et s’il est écrit dans les évangiles que le Christ permettait aux aveugles de voir, Trump lui parvient à réaliser que ceux qui ne s’entendaient pas s’entendent désormais.
« Et depuis 3 000 ans, il y a eu ici des conflits, pour une raison ou une autre ; d’énormes conflits, toujours et encore. Mais aujourd’hui, pour la première fois de mémoire d’homme, nous avons une chance unique de mettre derrière nous les vieilles querelles et les haines tenaces. Elles sont la raison pour laquelle tant de personnes dans cette salle ne s’entendaient pas. Certaines s’entendaient, d’autres non, mais toutes s’entendent maintenant. Cela a rapproché les gens. C’est la première fois que la crise au Moyen-Orient rapproche les gens au lieu de les diviser, pour leur faire déclarer que notre avenir ne sera pas régi par les luttes des générations passées, ce qui serait insensé. »
Je crois qu’il faut s’astreindre à lire les discours de Trump pour réaliser à quel point ils sont vides, d’une vacuité absolue.
Bien entendu que la Paix ne peut pas se trouver au bout d’un tel néant de la pensée.
Hakim El Karoui, auteur de « Israël Palestine, une idée de paix » explique dans un long article du Grand Continent : « La paix de Trump n’aura pas lieu ».
La principale raison étant qu’aucune perspective n’est offerte au peuple palestinien pour reconnaître sa dignité et son existence sur cette terre.
-
Lundi 22 septembre 2025
« J’espère que Dieu n’existe pas ! »Y le personnage principal du film « Oui » de Nadav LAPIDAnnie et moi sommes allés voir, ce vendredi, le film « Oui » de Nadav LAPID.
Je crois que je ne suis jamais sorti d’un film en portant un malaise plus grand, tant ce film est sombre, dérangeant avec, en outre, une bande son souvent extrêmement agressive. Par moment on pense à Fellini ou à Pasolini mais sans la poésie et en comprenant que même si, comme pour les deux maîtres italiens, il s’agit d’une fiction, en réalité Nadav Lapid veut nous faire percevoir une certaine réalité israélienne d’aujourd’hui, une réalité terrifiante.
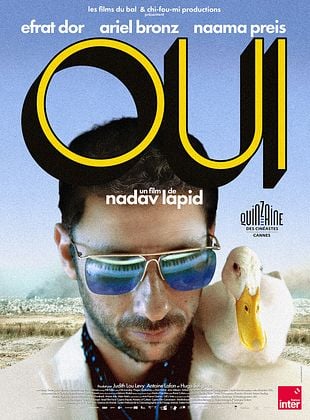 Le film se situe d’abord dans une fête totalement déjantée au sein d’une élite économique et militaire de Tel Aviv. Un couple d’artistes désargentés est employé pour divertir et pousser cette élite jusqu’à la limite de la folie, des orgies sexuelles et des paradis artificiels. Ce couple a un bébé avec lequel ils se comporte à peu près comme des parents normaux. Mais c’est la seule normalité qu’on perçoit chez eux, pour le reste pour reprendre la description du « Monde » : « ils se vautrent, sans état d’âme, dans le stupre et la turpitude. Ils veulent réussir, à n’importe quel prix. »
Le film se situe d’abord dans une fête totalement déjantée au sein d’une élite économique et militaire de Tel Aviv. Un couple d’artistes désargentés est employé pour divertir et pousser cette élite jusqu’à la limite de la folie, des orgies sexuelles et des paradis artificiels. Ce couple a un bébé avec lequel ils se comporte à peu près comme des parents normaux. Mais c’est la seule normalité qu’on perçoit chez eux, pour le reste pour reprendre la description du « Monde » : « ils se vautrent, sans état d’âme, dans le stupre et la turpitude. Ils veulent réussir, à n’importe quel prix. »Nous sommes dans un Israël qui vient de vivre le traumatisme du 7 octobre 2023 et a commencé de déverser des tonnes de bombes sur Gaza. La femme, Jasmine, est danseuse, mais le héros principal, Y, est musicien. Alors qu’il est à la recherche d’un contrat susceptible de le sortir de la précarité, un oligarque d’origine russe lui propose ce qu’il cherche : beaucoup d’argent pour composer un nouvel hymne national dont les paroles sont explicitement génocidaires. Y entretient un dialogue mystique avec sa mère décédée qui était de gauche. Y n’aime pas ce texte horrible, mais il va céder et composer la musique.
Tout dans son être le pousserait à dire « Non » mais il va dire « Oui », le « Oui » de la soumission.
Le philosophe Alain a décrit la différence entre le « Oui » et le « Non » :
« Penser, c’est dire non. Remarquez que le signe du oui est d’un homme qui s’endort ; au contraire le réveil secoue la tête et dit non.
Non à quoi ? Au monde, au tyran, au prêcheur ? Ce n’est que l’apparence. En tous ces cas-là, c’est à elle-même que la pensée dit non. Elle rompt l’heureux acquiescement. Elle se sépare d’elle-même. Elle combat contre elle-même. Il n’y a pas au monde d’autre combat. Ce qui fait que le monde me trompe par ses perspectives, ses brouillards, ses chocs détournés, c’est que je consens, c’est que je ne cherche pas autre chose. Et ce qui fait que le tyran est maître de moi, c’est que je respecte au lieu d’examiner.
Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par cette somnolence.
C’est par croire que les hommes sont esclaves. Réfléchir, c’est nier ce que l’on croit. Qui croit ne sait même plus ce qu’il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. »
Alain Propos sur les pouvoirs, « L’homme devant l’apparence », 19 janvier 1924, n° 139 Pour trouver l’inspiration Y quitte le foyer familial et convoque un amour de jeunesse, rencontré au conservatoire de musique, Leah.
Pour trouver l’inspiration Y quitte le foyer familial et convoque un amour de jeunesse, rencontré au conservatoire de musique, Leah. Elle est jouée par une remarquable actrice Naama Preis qui est devenue propagandiste pour Tsahal, parce qu’elle n’a pas trouvé d’autre job pour gagner sa vie.. Avec elle, il va prendre la route du désert vers Gaza. Pendant le voyage Leah, sur la demande d’Y, raconte le 7 octobre et décrit aussi les horreurs de Gaza. Naama Preis crée un moment de tragédie, le plus fort du film.
Leur périple les amène en haut d’un monticule qui a pour nom « la colline d’amour » sur lequel ils voient Gaza envahie de fumée et entendent le bruit des missiles qui tombent. C’est à ce moment que Y s’écrie : « J’espère que Dieu n’existe pas ! »
Woody Allen a une autre formule :
« Si Dieu existe, j’espère qu’il a une bonne excuse. »
Je sais bien que ces paroles sont insupportables pour mes amis croyants pour qui leur Foi est source de consolation et de force pour agir pour le bien. J’étais moi-même un croyant fervent autour de mes 20 ans. Je comprends intimement cet élan vers la transcendance et la douce voix intérieure qui rend soutenable ce qui peut être si lourd.
Je ne parle pas de cela. Je parle des religions, de ces structures qui ont à leur tête des hommes, parce que c’est toujours des mâles, qui parlent, dans leurs offices, de paix et de pardon mais qui dans leurs actions soutiennent et provoquent la destruction.
Je parle de la religion orthodoxe dont le Patriarche de Moscou est un ancien agent du KGB et qui conseille Poutine et couvre ses actions les plus infames.
Je parle des évangélistes blancs américains, qui sont les soutiens les plus fervents de Donald Trump et qui soutiennent Israël parce que dans leur vision millénariste de fin du monde, ils croient que leur désir ne pourra être accompli que si tous les juifs se retrouvent sur la terre de la Judée antique.
Je parle des messianistes juifs qui veulent reconstruire le temple de Jérusalem même au prix d’une guerre sans fin avec tous les musulmans.
Je parle des islamistes radicaux qui divisent le monde entre « haram » et « halal » et pour lesquels la vie humaine n’a aucune valeur devant le dogme.
L’émission « C Politique » de France 5 du dimanche 21 septembre 2025 parlent des croyances des évangélistes américains. Et pour revenir à notre sujet d’aujourd’hui vous pouvez écouter le grand spécialiste de l’Histoire du Moyen Orient, Henry Laurens sur le problème du sacré et de la religion dans le conflit israélo-palestinien : « Question juive, problème arabe ». Pour lui c’est simple, le fait qu’on ajoute de la religion à un problème territorial rend ce conflit insurmontable.
Ce film suscite des réactions contrastées de la critique française. A France Inter et sur le plateau de « C ce soir », déjà cités dans le mot du jour du 17 septembre 2025, les avis étaient élogieux.
Dans « le Monde », Jacques Mandelbaum écrit dans son article publié le 17 septembre :
« Quelque chose d’assez repoussant à concevoir, douloureux à recevoir, captivant à percevoir. »
Dans « les Cahiers du Cinéma » Élodie Tamayo est plus lyrique :
« Et pourtant ce film dit oui, un oui tonitruant. À quoi ? Au désir de faire du cinéma, même impossible, même monstre. Alors Lapid convoque les forces vives de genres hétérogènes. Le prisme tourne entre le film d’amour épileptique, version Sailor et Lula à Tel-Aviv ; la fiction politique décadente , le cartoon brutal, la comédie musicale désespérée, le cirque fellinien, et l’ombre de Tobe Hooper plane sur des décors de piscine à balles. Les curseurs sont poussés au maximum, dans un geyser de couleurs, une explosion de textures sonores, un vortex de mouvements de caméra et d’effets spéciaux. On oscille entre la secousse organique, l’éveil des sens, et l’étourdissement. »
Dans « le Figaro » du 17 septembre Etienne Sorin est brutal :
« Amos Gitaï et Ari Folman perdus de vue, Lapid, conscience nécessaire mais piètre cinéaste, est l’une des rares voix dissonantes dans le paysage artistique israélien. Elle fait du bruit mais elle porte peu, confinant son cinéma pamphlétaire à un public confidentiel. »
Ce film est une charge très violente contre l’élite israélienne et même l’ensemble de la société israélienne. Dans son interview à France Inter, le réalisateur explique :
« Si je dois quelque chose à mon pays, et si des artistes doivent quelque chose à ce monde, c’est dire leur vérité avec la voix la plus lucide, la plus claire. [Il fait référence à ces] prophètes bibliques qui disaient au peuple parfois des choses très, très dures à entendre, mais qui disaient au peuple la vérité, afin de retirer ce voile qui couvre les yeux et qui suscite cet aveuglement. »
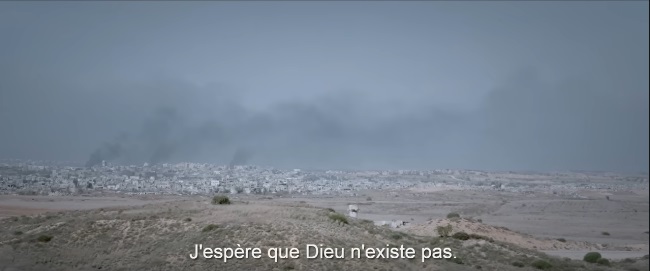 Pour ma part, je ne sais pas à quoi sert ce type de film. Je pense que beaucoup d’israéliens ne se reconnaîtront par dans l’image d’une élite hors sol et dépravée. Les palestiniens et leurs défenseurs seront fortifiés dans leurs certitudes négatives contre la société israélienne. Les modérés, comme moi, ne peuvent sortir qu’anéantis devant un film sans espérance.
Pour ma part, je ne sais pas à quoi sert ce type de film. Je pense que beaucoup d’israéliens ne se reconnaîtront par dans l’image d’une élite hors sol et dépravée. Les palestiniens et leurs défenseurs seront fortifiés dans leurs certitudes négatives contre la société israélienne. Les modérés, comme moi, ne peuvent sortir qu’anéantis devant un film sans espérance. C’est pourquoi, je voudrais finir avec ce poème de Paul Eluard, déjà cité et écrit dans son recueil « Le Phénix »
«La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin
une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie la vie à se partager.» -
Mercredi 17 septembre 2025
« Gaza brûle »Israël Katz, le ministre de la Défense israélienC’est mardi 16 septembre au matin que le ministre de la défense israélien a écrit cette phrase : « Gaza brûle ». Et parallèlement, Israël a lancé l’offensive terrestre, dans la nuit du 15 au 16 septembre, sur la ville de Gaza, baptisée « opération Chars de Gédéon II ».
L’objectif déclaré est de faire plier le Hamas dans son dernier bastion et d’obtenir la libération des 48 derniers otages dont seulement 20 sont présumés encore en vie.
Est ce que cet objectif est réaliste ?
Pour l’instant, la guerre de presque 2 ans, ne donne pas beaucoup de crédibilité à la réalisation de cet objectif. Dans leur folie meurtrière, les terroristes du Hamas entraineront certainement leurs otages dans la mort, juste avant de succomber.
Selon cet article de « Courrier International » des familles d’otages, dans la nuit, à l’annonce de l’offensive terrestre, se sont précipités devant la résidence de Benyamin Nétanyahou à Jérusalem pour protester contre ces opérations qui « mettent, selon eux, en danger leurs proches ».
La mère de Matan Zangauker, qui se trouve encore à Gaza dans des propos relayés par le quotidien israélien d’opposition Ha’Aretz a déclaré :
« Le cabinet de la mort a décidé de faire un pas vers la guerre éternelle et l’occupation de Gaza »
Les officiels israéliens assurent :
« Si le Hamas libère les derniers otages vivants et morts qu’il détient, nous arrêterons la guerre. »
Le Hamas est une organisation criminelle, islamiste qui proclame que chaque mort gazaoui est un martyr pour la cause qui sera récompensé dans « le paradis d’Allah » et que la souffrance quotidienne de chaque habitant de Gaza leur vaudra aussi des récompenses dans l’au delà, en plus de faire avancer la cause. Ces fanatiques n’ont que faire de la vie terrestre et de sa qualité. Ce sont des monstres que je ne défends d’aucune façon. Mais ils ne se rendront pas et le gouvernement d’Israël le sait. Donc ce n’est pas pour libérer les otages que cette offensive est lancée. Selon le journal « La Croix » même le chef d’état major israélien exprime des réticences : « Guerre d’Israël contre le Hamas : des doutes jusqu’au chef de Tsahal ».
Il semble crédible que la principale raison de ce carnage, c’est de rendre la vie à Gaza insoutenable pour les Palestiniens et les contraindre à partir.
Partir où ?
La Jordanie et l’Egypte refusent avec force de les accueillir. Il semble que l’état hébreu et les Etats-Unis tentent de trouver des solutions en Afrique. Selon l’agence Associated Press les États-Unis et Israël ont sollicité le Soudan, la Somalie et sa région séparatiste du Somaliland pour qu’ils accueillent les deux millions de Gazaouis. C’est une déportation, cela a un nom : « un nettoyage ethnique » ce qui constitue un crime contre l’humanité selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les actes inhumains tels que la déportation forcée, la persécution et les transferts forcés de population peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité s’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile.
Cette nouvelle escalade dans le conflit est assez unanimement condamné : Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré que l’offensive allait dans la mauvaise direction et a appelé à une solution diplomatique.
– La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a qualifié l’offensive terrestre d' »irresponsable et effroyable ».
– La Commission européenne a averti que l’intervention militaire entraînerait davantage de destructions, de morts et de déplacements de population.
En Cisjordanie, les exactions des colons à l’égard des Palestiniens s’accentuent. Selon un rapport de Médecins sans Frontière de mai 2025, depuis le 7 octobre 2023, au moins 870 Palestiniens ont été tués et plus de 7 100 ont été blessés. Et désormais, le gouvernement israélien a décidé de mettre en oeuvre le plan de colonisation E1.
Le gouvernement a donné le 20 août un feu vert au projet majeur de construction de logements baptisé “E1”, qui prévoit d’étendre une colonie située à quelques encablures de Jérusalem-Est, ce qui couperait de facto la Cisjordanie en deux. Lors d’une visite à la colonie de Maale Adumim, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré :
« Il n’y aura pas d’État palestinien. Cet endroit nous appartient… Nous préserverons notre patrimoine, notre terre et notre sécurité. Nous allons doubler la population de la ville ». »
Alors que la France, le Royaume Uni, le Canada et 11 autres pays s’apprêtent à reconnaître l’Etat Palestinien à l’ONU, Netanyahu commet un acte pour empêcher cela et donne précisément ses raisons : « Il n’y aura pas d’État palestinien ».
Le ministre des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich, un ancien dirigeant de colons, a salué la décision du gouvernement israélien, affirmant :
« L’État palestinien est en train d’être effacé de la table, non pas par des slogans, mais par des actes. »
Les ministres d’extrême droite voudrait annexer la Cisjordanie qu’ils appellent Judée Samarie. Ils commettraient alors une nouvelle infraction contre le droit international : ce territoire n’appartient pas à Israël, c’est un territoire occupé par Israël, depuis la guerre de 1967.
Netanyahu, jamais en reste d’une nouvelle formule, a dit lors d’une conférence économique à Tel Aviv, qu’Israël doit devenir une « Super Sparte ».
Sparte est cette cité-État de la Grèce antique, connue pour son organisation militarisée, sa discipline, l’obéissance stricte à l’État, tout ce qui donnera l’adjectif « spartiate » encore utilisé de nos jours.
Pierre Haski sur France Inter décrypte la pensée du premier ministre israélien :
« Le premier message est celui d’un état de guerre inscrit dans la durée. La guerre n’est pas un moment anormal entre des périodes normales, c’est désormais un état permanent. […]
Le deuxième message, c’est celui de l’isolement assumé, de l’autarcie. Benyamin Netanyahou a prévenu ses concitoyens qu’Israël devrait en passer par ce relatif isolement international. Il a évoqué les critiques croissantes en provenance d’Europe, qu’il a attribuées à l’immigration musulmane et à la propagande du Qatar et de la Chine sur les réseaux sociaux. »La question qu’on peut poser, peut être doit poser au bout de cette litanie de constats consternants : c’est où et quand qu’on tracera la Ligne rouge ? La ligne où l’Union européenne et la France commenceront à sanctionner Israël pour que cela cesse ! C’est aussi la question que pose Nadav LAPID le cinéaste israélien dont le film « Oui » vient de sortir ce mercredi. Il était l’invité de « C ce soir » de mardi et il posait précisément cette question. Il fut aussi, lundi, l’invité de Sonia Devilliers sur France Inter : « La réalité israélienne est une réalité stéroïdée, qui ouvre une fenêtre sur l’horreur qui peut arriver »
Il existe pourtant des voix autorisées en Israël comme Ehud Olmert, ancien premier ministre et ancien Vice-Premier ministre de Sharon qui disent que la guerre doit cesser et qui soutiennent encore la solution à deux États.
Lors d’un entretien dans « le Grand Continent » du 25 juillet 2025, il déclarait :
« Au fond, il n’y a que deux options.
La première est de continuer à se battre indéfiniment. C’est ce que nous faisons entre Israéliens et Palestiniens depuis 77 ans environ. Nous pouvons poursuivre dans cette voie encore longtemps. Cela conduira à davantage de sang versé, d’Israéliens et de Palestiniens tués, sans qu’aucun changement radical n’ouvre un nouvel horizon.
L’autre option est d’essayer de faire la paix.
Or, il n’existe, à mes yeux, qu’un seul chemin vers une paix durable : la solution à deux États. Bien que cela puisse prendre du temps, tôt ou tard, chacun finira par reconnaître cette réalité incontournable : il n’existe pas d’alternative crédible à la solution à deux États.
Il est clair que le gouvernement actuel repose sur l’opposition à cette solution politique. Il ne s’y oppose pas seulement sur tel ou tel point : il est farouchement opposé à sa substance même.C’est la raison pour laquelle, pour avancer, Netanyahou doit être démis de ses fonctions.»
-
Mercredi, le 3 septembre 2025
« Comment le mouvement pour les droits des homosexuels s’est radicalisé et a perdu son sens »Andrew SullivanNous nous posons tous la question : comment la démocratie en est elle arrivée là ?
Partout dans le monde les démocraties reculent.
L’espoir qui a été suscité, dans les années 90, par la chute des régimes totalitaires communistes et soviétiques, aura été de courte durée. En 1992, on dénombrait, pour la première fois de l’histoire, plus de régimes démocratiques, que de régimes autoritaires.Dans les années 2000, l’humanité semblerait avoir atteint un plateau sur lequel les démocraties représentait environ 60% des Etats.
« Le Grand Continent » a évoqué l’indice démocratique global 2024 publié le 27 février 2025, par The Economist Intelligence Unit (EIU) qui estime qu’il n’y a plus que 71 pays sur 195 dans le monde, soit 38,5%, qui peuvent être considérés comme des démocraties. Rapporté à la population, cette évaluation amène l’institut d’analyse à estimer que 6,6 % de la population mondiale vit dans une démocratie.
Et, en allant plus loin dans son analyse par une distinction entre “vraie démocratie” et “démocratie défectueuse”, l’EIU estime que la vraie démocratie ne se trouve que dans 25 pays
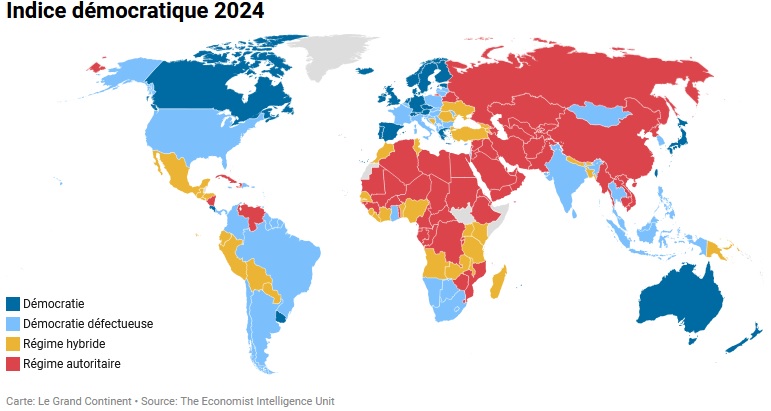
Les Etats-Unis, comme la France étaient classés, en 2024, dans les démocraties défectueuses. Il est probable que depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, en janvier 2025, les Etats-Unis sont tombés encore plus bas dans ce que l’EIU désigne comme des régimes hybrides, entre démocratie et régime autoritaire.
Force est de constater que c’est un vote démocratique, au delà du vote par les grands électeurs, d’une majorité d’américains qui a élu Donald Trump. Les citoyens américains savaient comment agissait cet homme, puisqu’il avait déjà été président pendant 4 ans. Ils l’ont réélu.
« Errare humanum est, perseverare diabolicum » diront ceux qui pensent que le monde du bien s’oppose au monde du mal et que ceux qui se trouvent dans ce second camp sont soit des imbéciles soit des salauds. Je récuse ce simplisme.
Comment peut t’on comprendre qu’au delà d’un noyau d’évangélistes, de racistes et de masculinistes, une majorité de citoyens se soient finalement ralliés à cette candidature au détriment de celle des démocrates ?
Les explications sont multiples. Il y a manifestement une révolte de la classe moyenne contre les effets de la mondialisation qui leur a été défavorable. Il y a une perception d’une immigration massive, mal gérée, mal intégrée qui a permis à Trump de faire des promesses démagogiques qui ont plu. Il y a encore, ce que Marcel Gauchet appelle « Le sentiment d’impuissance des démocraties ».
Il semble, en effet, que la démocratie n’arrive plus à obtenir des résultats d’une part en raison de l’économie qui est mondialisée et sur laquelle elle n’a que peu de prise, d’autre part parce qu’elle a généré, en son sein, un culte de la liberté individuelle qui conduit l’ordre judiciaire à s’opposer à des décisions d’autorité et à empêcher le pouvoir politique à agir. Donald Trump a convaincu les américains qu’il était capable d’agir sur ces tableaux : un interventionnisme économique à travers les droits de douane et un refus de se plier aux décisions judiciaires notamment en demandant à la Cour Suprême qui lui est largement favorable, d’infirmer les décisions judiciaires qui lui sont défavorables.
Il n’y a pas une cause, il y a toutes celles que j’ai évoquées. Il y en a certainement que j’oublie.
Et puis il y en a une qui me semble aussi importante. Beaucoup parle d’« anti-wokisme », je préfère au mot woke celui de « progressisme ostentatoire », en référence au concept inventé par Thorstein Veblen « La consommation ostentatoire ».
J’ai eu la surprise de découvrir que c’est dans le « New York Times » qui était en pointe du combat d’un progressisme sans limite et sans interrogation qu’un journaliste écrivant régulièrement dans ce journal, Andrew Sullivan a publié une tribune le 26 juin 2025, montrant les excès et l’intolérance de ce mouvement porté par une minorité du Parti Démocrate et rejeté par une majorité de l’électorat populaire américain.
Pour se convaincre qu’il s’agit d’une rupture dans la politique éditoriale du New Tork Times, je vous renvoie vers cet article de l’hebdomadaire « Le Point » : « Bari Weiss : Pourquoi j’ai quitté le New York Times ». Article dans lequel cette journaliste évoque la délation, la censure, l’obsession de l’identité et la dérive sectaire de cette institution américaine en 2020.
Cette fois, le journal a accepté de publier cette tribune d’un journaliste gay présenté comme l’un des premiers défenseurs américains du mariage homosexuel. Cette tribune a pour titre « How the Gay Rights Movement Radicalized, and Lost Its Way », qu’on pourrait traduire par « Comment le mouvement pour les droits des homosexuels s’est radicalisé et a perdu son sens ». Vous trouverez cet article sur le site du New York Times, l’accès est payant. Mais vous pouvez trouver cette tribune sur d’autres sites dans sa « version anglaise » et une « traduction française »
Andrew Sullivan énumère d’abord les combats gagnés par les homosexuels et les lesbiennes lors d’une décennie incroyable
« Il y a dix ans, jeudi, le mouvement pour l’égalité des droits des personnes gays et lesbiennes a remporté une victoire qui, dix ans plus tôt, paraissait inimaginable : nous avons obtenu le droit au mariage civil dans tous les États-Unis.
En 2020, une autre victoire retentissante a suivi. Dans une décision majoritaire rédigée par l’un des candidats nommés par le président Trump, le juge Neil Gorsuch, la Cour suprême a estimé que les hommes gays, les lesbiennes et les personnes transgenres étaient couverts par le Titre VII du Civil Rights Act de 1964 et protégés contre la discrimination par les employeurs.
En 2024, le Parti républicain a retiré de son programme son opposition au mariage pour tous, et l’actuel secrétaire au Trésor républicain, Scott Bessent, est un homme gay marié avec deux enfants. Le mariage homosexuel est soutenu par environ 70 % des Américains, et 80 % s’opposent aux discriminations visant les gays, les lesbiennes et les personnes transgenres.
En matière de droits civiques, il est difficile de faire plus décisif ou complet que cela. »Et puis…
En français courant il existe une expression appropriée : c’est parti en quenouille.« Mais une chose étrange s’est produite après ces triomphes. Au lieu de célébrer la victoire, de défendre ces acquis, de rester vigilants tout en alentissant le rythme en tant que mouvement ayant atteint ses objectifs principaux — y compris la fin du VIH en tant que fléau incontrôlable aux États-Unis —, les groupes de défense des droits des personnes gays et lesbiennes ont fait le contraire. Influencés par le virage plus large de la gauche « justice sociale », ils se sont radicalisés. »
Et il donne un premier exemple de ces excès :
« En 2023, la Human Rights Campaign, le plus grand groupe de défense des droits des gays, lesbiennes et transgenres du pays, a déclaré un « état d’urgence » pour ces communautés — une première dans l’histoire de l’organisation. Elle n’avait pas déclaré d’état d’urgence lorsque des hommes gays étaient emprisonnés pour avoir eu des relations sexuelles en privé, ni lorsque l’épidémie de sida a tué des centaines de milliers d’hommes gays, ni lorsque nous avons été confrontés à un projet d’amendement constitutionnel interdisant le mariage homosexuel en 2004.
En réalité, cet « état d’urgence » était presque entièrement lié à de nouveaux projets de loi étatiques visant à restreindre les traitements médicaux pour les mineurs souffrant de dysphorie de genre, aux interdictions d’accès aux toilettes et vestiaires, ainsi qu’à l’intégration des questions transgenres dans les programmes scolaires et le sport »Cette tribune est assez longue (près de 5000 mots), et je vous invite à la lire car elle me semble révélatrice d’un mouvement en train de dérailler au détriment de celles et de ceux qu’il s’agissait de défendre.
Les droits civiques des homosexuels et des lesbiennes ayant été acquis, une autre révolution était en route celle du genre dont le projet prétend vouloir supprimer toutes les limites perçues comme oppressives.
La binarité sexuelle associée à la « suprématie blanche » est remplacée par un spectre large de sexes, ce qui revient à supprimer la différence entre hommes et femmes. Il constate que les mots « gay » et « lesbienne » ont quasiment disparu. LGBT est devenu LGBTQ, puis LGBTQ +, et d’autres lettres et caractères ont été ajoutés. Il fait le constat que ces groupes ont renié leur engagement et ont imposé à toute la société un changement radical à coups de slogans comme le fait que le sexe était assigné à la naissance et non constaté.
Autre mantra selon lui : « Les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes. » Ce n’est pas une proposition, c’est « un commandement théologique », dit-il.
Dès le plus jeune âge, on peut apprendre à des enfants qu’être fille ou garçon relevait d’un choix et qu’on pouvait en changer. Une transition sociale (changement de prénom et de pronom) est possible sans l’autorisation parentale (aux États-Unis).
Le plus grave dans ce mouvement est que toute contradiction, toute critique est interdite. Ceux qui osent s’exprimer sont réduits au silence, disqualifiés publiquement. L’intolérance fait loi, l’autocensure devient la norme.
Dans un podcast publié le 6 août 2025, Hubert Vedrine disait précisément :
« C’était évident depuis longtemps, que l’électorat populaire américain n’accepterait jamais le wokisme. Jamais ! […] On ne va pas débattre du wokisme, parce qu’il peut y avoir de bonnes intentions, mais l’électorat américain le rejetait fondamentalement. »
Comme je l’ai écrit, Hubert Vedrine se garde de prétendre qu’il s’agit de l’unique raison de l’élection à deux reprises de Donald Trump. Dans ce même podcast, il avait cité préalablement d’autres causes :
« Il y a des signes avant-coureurs dans l’électorat populaire américain depuis très longtemps que d’abord la mondialisation à outrance décidé notamment par les élites démocrates, mais pas que. L’idée qu’on a tellement, nous les Américains, gagné après la fin de l’URSS qu’on peut mettre la Chine dans l’OMC même si elle ne remplit pas les critères parce que ça va les rendre plus riche et donc démocratique voyez ce degré d’d’illusion et de toute façon on est les maîtres du jeu. Donc ça c’est l’Amérique depuis assez longtemps. Alors il y a beaucoup du coup on va faire fabriquer une en Chine parce que c’est 50 fois moins cher. Donc ils ont détruit la classe moyenne américaine, ils ont créé l’électorat de Trump. »
Aujourd’hui, le gouvernement de Trump va dans l’excès inverse et en voulant lutter contre le wokisme impose d’autres interdits et fait preuve d’une même intolérance : « Comment la droite américaine a tué le wokisme, pour mieux imposer le sien ».
Alors si des esprits taquins souhaitent me poser la question : entre le progressisme ostentatoire et la réaction obscurantiste trumpiste que préfères-tu ? Je répondrai par cette pensée de la sagesse juive :
« Si on te demande de choisir entre deux solutions, prends toujours la troisième ! »
-
Lundi 25 août 2025
« J’ai toujours éprouvé pour ma mère l’amour le plus absolu. Elle m’a sauvée d’un danger intérieur qu’elle seule avait remarqué. »Amélie Nothomb « Tant mieux » page 195Comme à chaque rentrée, depuis des temps immémoriaux, Amélie Nothomb publie un livre chez Albin Michel. Je ne le lis jamais.
Par hasard, j’ai vu sur le média internet Brut, une interview dans laquelle elle présente celui de cette année : « Tant mieux ».
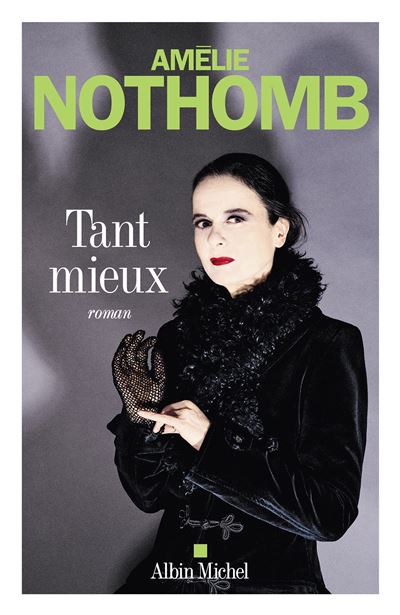 Ce livre est consacrée à sa mère qui est morte début 2024.
Ce livre est consacrée à sa mère qui est morte début 2024. Il faudrait toujours écrire, peut être pas un livre, au moins quelques mots sur notre mère. Pour se souvenir, éclairer des zones d’ombre et surtout comprendre et exprimer sa reconnaissance. Car sauf cas très marginaux et rare, nous avons tous motif à gratitude.
Albert Cohen a écrit un bouleversant document : « Le livre de ma mère », j’en avais tiré un mot du jour en 2018 : « Les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles. ».
Pour Christian Bobin, si sa relation à son père fut lumineuse, celle à sa mère fut plus complexe. Elle avait très peur pour lui et de ce fait l’empêchait de sortir de sa maison sauf pour aller à l’école. Il a ainsi passé une enfance dans la solitude et dans ce qu’il a appelé lui même une agoraphobie. Je ne crois pas qu’il ait écrit un livre sur sa mère, mais il a dit ceci dans l’émission de France Culture « Les Racines du ciel » du 7 septembre 2014 :
« Ma mère, elle a fait comme elle a pu.
Comme chaque femme qui a des enfants, elle a fait le travail impossible qui lui a été assigné. A savoir un travail d’engendrer et puis surtout ensuite de veiller, d’amener au mieux les gens qui lui sont confiés, les enfants.
Ce travail, elle l’a fait, elle l’a bien fait, à sa façon. La vie n’a pas été facile pour elle. Je pense qu’elle aussi à sa façon m’a tout appris. Ce que je sais des mères, ce que j’écris des mères, je le tiens bien d’elle, d’une façon ou d’une autre, même si c’est parfois de façon paradoxale.
C’est par l’absence qu’on connait la présence, c’est par le manque. C’est par la faim qu’on sait ce qu’est un morceau de pain. On sait exactement ce que c’est. On le sait mieux que la personne qui a toujours du pain à volonté sur sa table. […]
Moi, je suis fait de ceux que je rencontre. Je suis fait aussi de mes parents c’est évident. Je suis fait de tout, même de leur manque, même de leur faille. Et c’est par ces failles aussi que, sans doute, j’ai vu la lumière. »
« Christian Bobin: Une vie en poésie »
à 13:10Quand je dis qu’il faudrait écrire sur notre mère, je ne parle bien sûr pas de publier. La littérature se trouve devant un paradoxe terrifiant : il y a de plus en plus d’auteurs qui publient des livres et de moins en moins de lecteurs qui lisent. Ecrire, c’est d’abord pour soi qu’on doit le faire et peut être pour quelques proches. Je m’imagine que la fratrie ou les enfants ne peuvent être indifférents à lire ce que le coeur sait révéler.
Amélie Nothomb a publié le livre sur sa mère et ce qu’elle dévoilait dans son entretien m’a poussé à l’acheter et à le lire immédiatement. Ses livres sont courts, il ne m’a même pas fallu une soirée pour le finir.
La plus grande partie est ce qu’elle appelle dans son entretien, un conte qui raconte l’histoire d’une enfant, Adrienne, dans ses relations avec ses grands parents, ses parents, ses sœurs jusqu’à la rencontre de l’homme de sa vie. Le livre se termine par une partie beaucoup plus courte dans laquelle le conte s’éclaire et Amélie Nothomb parle de sa mère, et c’est bouleversant.
Le livre est désigné par la catégorie « roman », on ne sait pas quel est la part d’invention ou même s’il y a invention. Il semble cependant que l’essentiel correspond à la réalité.
Je ne vais pas divulgâcher le propos du livre. Il me fallait cependant trouver une exergue dans le livre. Elle est mystérieuse et il faut bien expliquer un peu :
« J’ai toujours éprouvé pour ma mère l’amour le plus absolu. Elle m’a sauvée d’un danger intérieur qu’elle seule avait remarqué. Mes deux ainés, dès la naissance étaient lumineux. J’étais sombre. Dès mes cinq ans, j’ai senti cette noirceur grandir en moi. J’étais appelée, je pense, à devenir une dépressive pathologique.
Quand ma mère me voyait sous emprise de cette obscurité, elle me disait :
– Pourquoi es-tu comme cela ?
– Je ne sais pas
– Alors Arrête. Tu n’as pas le droit.
C’était dit avec autorité et douceur.
Cette parole a été entendue. Aujourd’hui encore, lorsque la force atrabilaire se manifeste en moi, la voix maternelle la repousse : Tu n’as pas le droit. C’est d’une efficacité redoutable.
Je n’oublierai jamais ma dette astronomique envers ma mère : Elle m’a livré un bouclier pour lutter contre mes ténèbres. »Je crois que beaucoup d’entre nous pourraient parler de leur dette astronomique envers leur mère.
-
Mercredi 6 août 2025
« La véritable histoire de Hiroshima »Documentaire d’ARTEIl y a 80 ans, le 6 août 1945, à 8h15, le B29 que son pilote Paul Tibbets avait appelé « Enola Gay » a largué la première bombe atomique, une bombe de 4,5 tonnes surnommée « Little Boy » sur la ville de Hiroshima.

Des lanternes flottantes marquent l’anniversaire du bombardement d’Hiroshima. Chaque lanterne représente une vie perdue. Il y a 10 ans, j’avais déjà écrit un mot du jour sur ce sujet « Mon Dieu, qu’avons-nous fait ? ». Ce fut le cri que poussa Robert Lewis, le co-pilote du B29 après avoir vu la puissance destructrice de la bombe. Le pilote principal Paul Tibbets, ne ressentit rien de semblable, il n’a jamais exprimé de regrets pour les victimes d’Hiroshima. De manière factuelle Tibbets est mort à 92 ans , son co-pilote Robert Lewis est mort à 65 ans. Peut être que les regrets sont nuisibles à la santé.
ARTE a mis en ligne un documentaire que j’ai vu avec un grand intérêt et que je partage : « Hiroshima la véritable histoire ».
Ce documentaire est d’abord très clair sur le sujet suivant : l’utilisation de la bombe atomique d’abord sur Hiroshima puis sur Nagasaki 3 jours plus tard n’était pas nécessaire pour faire capituler le Japon. Le Japon via l’URSS et une autre source plus directe avec les Etats-Unis avait déjà proposé une reddition mais avec une seule exigence maintenir Hiro Hito sur le trône impériale du Japon. Condition qui sera appliquée après les bombes et la capitulation.
En outre, le Japon n’avait plus de marine, presque plus d’aviation et n’avait plus les moyens de nourrir la population, il ne pouvait que se rendre. La propagande américaine qui justifiait l’utilisation de la bombe parce que la seule alternative aurait été d’envahir le Japon et que cela aurait couté la vie à 1 millions de soldats américains était un mensonge absolu.
Les scientifiques de Los Alamo avait fait une proposition alternative au Président Truman : Rendre publique l’existence de la bombe atomique et montrer sa puissance dévastatrice dans un essai public pour convaincre les japonais que toute résistance était inutile. Mais cette proposition n’a jamais été transmis par le général Groves, directeur militaire du projet Manhattan. Car ce n’est pas Oppenheimer, le directeur scientifique qui dirigeait mais bien le responsable militaire.
La raison réelle de l’utilisation de la bombe atomique est que les militaires voulaient vérifier, en utilisation réelle, l’impact de la bombe atomique.
Une fois la bombe larguée, les américains ont voulu camoufler les conséquences terribles de tout ce que la bombe a entraîné après son explosion sur les corps et sur la santé des survivants. Le général Mac Arthur, à peine nommé à la tête de l’administration japonaise, adresse une directive aux médecins de Hiroshima, déclarant que toute cette affaire relevait du secret militaire américain, par conséquent personne ne devait effectuer de recherche ni écrire quoi que ce soit sur le sujet. Les troupes d’occupation américaine interdirent toute présence de journalistes non accompagnés de militaires sur le territoire d’Hiroshima.
Mais un journaliste australien Wilfred Burchett parvint à se rendre à Hiroshima après le largage de la bombe atomique, arrivant seul par train de Tokyo le 2 septembre, jour de la reddition officielle à bord de l’USS Missouri.
 Il a envoyé au journal « Daily Express » de Londres un article publié le 5 septembre 1945, sous le titre « The Atomic Plague » « la peste atomique », il s’agissait du premier reportage public dans les médias occidentaux à mentionner les effets des radiations et des retombées nucléaires.
Il a envoyé au journal « Daily Express » de Londres un article publié le 5 septembre 1945, sous le titre « The Atomic Plague » « la peste atomique », il s’agissait du premier reportage public dans les médias occidentaux à mentionner les effets des radiations et des retombées nucléaires. Il écrivit notamment :
« À Hiroshima, 30 jours après que la première bombe atomique a détruit la ville et ébranlé le monde, des gens meurent encore, mystérieusement et horriblement. Des personnes qui n’ont pas été blessées par le cataclysme meurent d’une maladie inconnue, quelque chose que je ne peux décrire que comme une peste atomique. Hiroshima ne ressemble pas à une ville bombardée. Elle a l’air d’avoir été écrasée par un rouleau compresseur monstrueux […]
Sur ce premier terrain d’essai de la bombe atomique, j’ai vu la désolation la plus terrible et la plus effrayante en quatre ans de guerre. Une île du Pacifique dévastée ressemble à un Eden. Les dégâts sont bien plus importants que ne le montrent les photographies. […]
Dans les hôpitaux, j’ai trouvé des personnes qui, lorsque la bombe est tombée, n’ont souffert d’aucune blessure, mais qui meurent maintenant des étranges séquelles. Sans raison apparente, leur santé a commencé à se dégrader. Elles ont perdu l’appétit. Leurs cheveux sont tombés. Des taches bleutées sont apparues sur leur corps. Et les saignements ont commencé à couler des oreilles, du nez et de la bouche. […]
Si vous pouviez voir ce qui reste d’Hiroshima, vous penseriez que Londres n’a pas été touchée par les bombes… »
Finalement, le général Groves est sommé de se justifier devant le Congrès, il minimise le nombre de morts en raison de ces symptômes et ajoute cette remarque « écœurante »
« Les médecins disent que c’est une façon très agréable de mourir »
Le général Groves n’ignorait pas les effets de la bombe atomique après son premier souffle, 80 000 morts dans la première minute de l’explosion. Et l’armée américaine va installer de grands bâtiments sur les collines de Hiroshima qui ne sera pas un hôpital pour soigner, mais une unité de recherche pour répertorier tous les effets de la bombe atomique. Les victimes ne seront pas traités comme des malades mais comme des cobayes.
Les japonais irradiés seront affublés d’un nom par leur compatriote «Les hibakusha » signifiant « personne affectée par la bombe ». Les japonais se détourneront d’eux craignant qu’ils soient contagieux puis refusant de les marier à leurs filles ou leurs fils car ils ne pourront qu’engendrer des enfants malades comme eux. Leur destinée fut terrible.
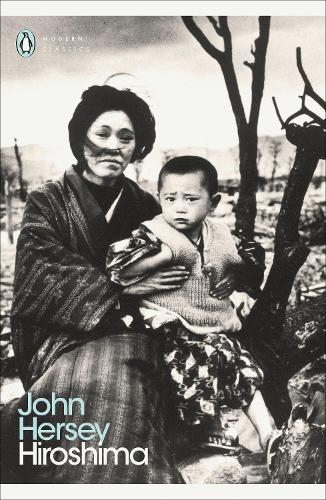 Certains auteurs racontèrent de manière empathique et vraie ce que fut le drame des hibakusha.
Certains auteurs racontèrent de manière empathique et vraie ce que fut le drame des hibakusha. Le documentaire cite le journaliste John Richard Hersey qui se rend en août 1946 à Hiroshima et interviewa six survivants du chaos. Son texte sera publié en intégralité dans le New Yorker.
L’article connaît un immense retentissement au sein de la population américaine qui prend conscience de l’horreur vécue par l’ennemi japonais.
Son récit retrace les instants qui précédèrent et suivirent l’explosion de la bombe H, évoquant sa dimension politique et philosophique à travers six expériences entrecroisées. Cet article devint un livre « Hiroshima »
Je crois qu’il est utile de regarder ce documentaire qui montre la seule utilisation, jusqu’à présent, de la bombe atomique. Ce fut l’œuvre d’un pays occidental, les États-Unis d’Amérique qui n’en avaient pas besoin pour arriver à leurs objectifs et qui ont dans un premier temps menti sur les conséquences de son utilisation.
Lien vers le documentaire d’ARTE : « Hiroshima la véritable histoire ».
-
Lundi 23 juin 2025
« Je tiens à remercier tout le monde, et en particulier Dieu. »Donald TrumpDonald Trump a tenu un discours de 4 minutes pour se féliciter de la réussite des frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes qui se sont déroulées dans la nuit de samedi à dimanche.
Comme d’habitude, dans un langage d’une pauvreté lexicale consternante, il abuse de superlatifs superfétatoires :
« Aucune armée au monde n’aurait pu faire ce que nous avons fait ce soir. Loin s’en faut. Jamais une armée n’a été capable de réaliser ce qui vient de se passer il y a quelques instants. »
L’armée dont il parle a déversé, sur les cibles, les plus grosses bombes non nucléaires créées par l’espèce humaine (des ogives de 13 tonnes) et puis les bombardiers furtifs B-2 Spirit ont parcouru une distance exceptionnellement grande pour atteindre l’Iran à partir de leur base du Missouri. C’est un triomphe de la technologie !
Concernant la stratégie militaire, dans un ciel iranien sans capacité anti-aérienne, l’Histoire militaire comporte des épisodes qui méritent nettement plus de superlatifs que cette opération.
C’est surtout une question d’argent, chaque B-2 coûte plus de 2 milliards de dollars ! Pour la fameuse bombe de 13 tonnes, le coût de développement de la GBU-57 MOP se situe entre 400 et 500 millions de dollars américains et son prix de production unitaire est d’environ 3,5 millions de dollars américains. La folie meurtrière des hommes n’a pas limite en terme de prix.
Mais ce que je voudrais surtout relever ce sont les dernières mots de ce discours de Trump :
« Je tiens à remercier tout le monde, et en particulier Dieu. Je veux simplement dire que nous t’aimons, Dieu, et que nous aimons notre grande armée. Protège-les. Que Dieu bénisse le Moyen-Orient. Que Dieu bénisse Israël et que Dieu bénisse l’Amérique. Merci beaucoup. Merci. »
Que vient faire Dieu là-dedans ? La technologie, l’argent semble suffire à ce désastre ?
En face, le chef iranien, qui se fait appeler guide suprême, dans son discours du mercredi 18 juin dans lequel il oppose un refus catégorique à l’appel de Donald Trump à une « capitulation sans conditions » conclut avec ces mots, en commençant à citer un verset du Coran :
« La victoire ne peut venir que de Dieu, le Puissant, le Sage »
Puis ajoute :
« Et Dieu Tout-Puissant accordera à la nation iranienne la victoire, la vérité et la justice, si Dieu le veut. »
Et si dans les faits la victoire n’est pas donnée à la nation iranienne ? Tout simplement parce que la technologie et l’argent, des choses très matérielles sans une once de spiritualité, donne la victoire aux adversaires de l’Iran. C’est donc selon l’hypothèse de ce responsable religieux que « Dieu ne le veut pas » !
Et dans ce cas, quelle conclusion ce vieil homme en tirera du fait que Dieu ne le veut pas ?
Le troisième responsable de ce chaos et de ses destructions, Benyamin Netanyahou, se trouve dans la même évocation religieuse. Quand, dimanche 15 juin 2025, il se rend à Bat Yam où les missiles iraniens ont fait neuf victimes, il termine son discours par un verset du Deutéronome :
« Puisque vous n’avez vu aucune figure le jour où l’Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. »
Et il conclut :
« Ensemble, avec l’aide de Dieu, nous vaincrons, nous sommes sur le chemin de la victoire. »
C’est encore une fake news ! L’aide dont bénéficie l’armée d’Israël ce sont les armes fournis par les Etats-Unis et depuis ce week end l’intervention directe de l’armée US avec des bombes, des avions décrits précédemment.
Le premier ministre baptise désormais chaque opération militaire par des références bibliques. Ainsi Vendredi 13 juin au matin, à peine les premiers missiles tirés vers l’Iran, le pays apprend que l’opération « Le lion qui se lève » a été lancée. Pour reprendre les termes de l’allocution filmée de son dirigeant : « Nous sommes à un moment décisif de l’histoire d’Israël. Il y a quelques instants, Israël a lancé l’opération « Le lion qui se lève », une opération militaire ciblée visant à supprimer la menace que représente l’Iran par rapport à la survie même d’Israël. »
« Le lion qui se lève » ? C’est une référence à un verset du Livre des Nombres : « Voici qu’un peuple se lèvera comme une lionne, comme un lion il se dressera. Il ne se couchera pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang des victimes ! »
Je perçois le désarroi des croyants sincères qui vivent leur foi comme un appel à devenir plus doux, à aider leur prochain et qui trouvent dans leurs prières, réconfort et aide dans les moments de souffrance et d’angoisse. Ils s’exclament d’une seule voix : « La religion ce n’est pas cela ! »
Pour moi qui fus croyant et pour les consoler je dirais plutôt : « la religion ce n’est pas que cela ! ». Mais il me faut ajouter : « c’est aussi cela, c’est-à-dire la violence et le pouvoir ! »
« Le nouvel Obs » évoque un autre nom d’opération inventé par l’état-major israélien « Chariots de Gédéon ». C’était le nom de l’opération de mai 2025 contre Gaza, visant à une annihilation totale du territoire. Et le Nouvel Obs de rappeler ce que dit le livre sacré des juifs :
« Gédéon est un personnage biblique, un des juges du Livre des Juges, élu par Dieu. Pour punir Canaan d’être revenu à l’idolâtrie, Yahvé a envoyé au peuple élu une invasion de Madianites. C’est Gédéon qui est chargé de la combattre, et qui, avec une toute petite armée de 300 personnes, réussit à infiltrer le camp des Madianites et à les éradiquer ».
Souvent dans la bible hébraïque dieu prend le nom de « dieu des armées », un dieu qui n’a pas de scrupule à demander des tueries de masse.
Le Nouvel Obs évoque une autre citation de Netanyahou :
« Une référence biblique faite par Netanyahou a d’ailleurs été citée dans la plainte de l’Afrique du Sud, déposé devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour génocide. En l’occurrence la phrase : « Souvenez-vous de ce qu’a fait le peuple d’Amalek à notre peuple », répétée à plusieurs reprises par Netanyahou.
Le peuple d’Amalek ? C’est l’ennemi originel d’Israël. Yahvé ordonne à son peuple de l’éradiquer. Ainsi dans le Deutéronome, Dieu appelle à « effacer la mémoire du peuple d’Amalek du ciel ».
Il enjoint aussi au prophète Samuel de se faire l’instrument de la destruction : « Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient ; tu ne l’épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, boeufs et brebis, chameaux et ânes. »
Dans le Premier Livre de Samuel, le roi Saül désobéit à l’ordre divin et décide d’épargner Agag, après avoir exterminé tous les Amalécites. Il ne se résout pas non plus à tuer tout le bétail. Mal lui en prend ! Le prophète Samuel le tance. « N’est-ce pas, quand tu étais petit à tes propres yeux, tu es devenu chef des tribus d’Israël, et l’Éternel t’a oint pour roi sur Israël ?
Et l’Éternel (…) t’avait dit : Va et détruis ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu’à ce qu’ils soient consumés. Et pourquoi n’as-tu pas écouté la voix de l’Éternel ? »
Samuel explique alors à Saül que l’Eternel l’a rejeté. Et il « met Agag en pièces devant l’Eternel ».Le Coran de la même manière contient, à côté de versets bienveillants, d’autres qui expriment une grande cruauté pour tous ceux et toutes celles qui sont en dehors des normes de « la croyance » définies dans ce livre.
Les islamistes radicaux se basent sur ces textes pour justifier leurs actes violents. Par exemple ce texte qu’on appelle « le verset de l’épée » (verset 5 de la sourate IX) :
« Quand les mois sacrés seront expirés, tuez les infidèles quelque part que vous les trouviez ! Prenez-les ! Assiégez-les ! Dressez pour eux des embuscades ! S’ils reviennent [de leur erreur], s’ils font la Prière et donnent l’Aumône (zakat), laissez-leur le champ libre ! Allah est absoluteur et miséricordieux. » — Le Coran (trad. R. Blachère),
Les mois sacrés sont la période de grâce qu’on accorde aux incroyants pour se soumettre à la foi unique, seule cette soumission permet d’échapper à la mort».
Tout cela peut paraître si loin de ceux qui ont vécu la sortie de la religion du quotidien et de la société. Ce que Nietzsche avait synthétisé par ce constat : « Dieu est mort ».
Selon moi, l’évocation de Dieu lors de tous ces déchainements de violence, n’est pas une bonne chose.
Ceux qui font ces évocations sont d’autant plus Désinhibés qu’ils pensent se mettre sous la protection de textes sacrés. Et comment négocier avec des gens qui prétendent que c’est Dieu qui les guide ?
-
Jeudi 19 juin 2025
« Je suis responsable devant le compositeur et surtout devant l’œuvre. »Alfred BrendelAlfred Brendel fut sans doute le plus grand pianiste de la seconde moitié du XXème siècle. Il est mort le 17 juin 2025 à Londres, à l’âge de 94 ans.
 Il naît le 5 janvier 1931, dans une famille allemande, mais dans une commune située actuellement en République tchèque.
Il naît le 5 janvier 1931, dans une famille allemande, mais dans une commune située actuellement en République tchèque. Il réalise son premier récital en 1948, à Graz. Il effectuera ses premiers enregistrements en 1952 et 1953.
Cependant sa carrière prendra toute la lumière vraiment en 1969 quand il signe un contrat avec Philips. La firme néerlandaise utilisera sa puissance de communication pour révéler au monde de la musique le talent, la profondeur, le génie de ce pianiste venu du centre de l’Europe.
En allemand, le terme « Mitteleuropa » sonne mieux, le magazine Diapason écrit :
« C’était l’un des géants du piano et de la musique, comptant parmi les derniers représentants de la Mitteleuropa. Il s’est éteint à l’âge de 94 ans. »
C’est en 2008 qu’il décida de faire sa tournée d’Adieu, après 60 saisons de concerts si on prend comme point de départ son premier concert à Graz, mais si on part de son contrat avec Philips il exerça son magistère sur le piano classique pendant 40 ans de 1969 à 2008.
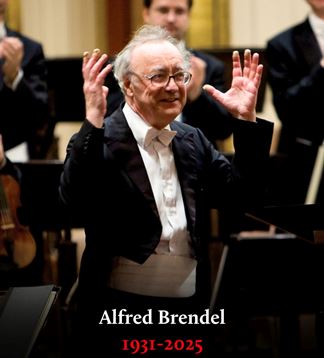 Son ultime concert eu lieu, le 18 décembre 2008, dans la salle dorée du Musikverein de Vienne.
Son ultime concert eu lieu, le 18 décembre 2008, dans la salle dorée du Musikverein de Vienne. Sa tournée d’Adieu fit étape, le soir du 13 juin de cette même année, à l’auditorium de Lyon. La musicologue Marie Aude Roux écrivit dans un article du Monde : « En tournée d’adieux, Alfred Brendel fut magique à Lyon. » :
« Le 13 juin, dans le bel Auditorium de Lyon, Brendel est apparu avec son élégance légèrement guindée, queue-de-pie, large ceinture et nœud papillon jaune pâle et regard rond d’effaré. Il s’est assis au piano et la musique a coulé de source, comme affleurant de ses propres entrailles […] »
Il termina son récital par la dernière sonate de Franz Schubert D.960. Marie Aude Roux traduit :
« Le travail sur la matité du son sous-entend qu’« il faut qu’un cœur se brise ou se bronze ». D’une belle coulée, le « Scherzo », viennois en diable, nostalgie et larmes et sourires mêlés. Puis le « Finale », entre rire et rictus, où Brendel est plus que Brendel, sculpteur de paysages mélodiques, poète du clavier, écrivain des sons, musicien majuscule dans un étrange absolu de la musique. »
Brendel était le musicien de l’approfondissement, revenant toujours au même corpus d’œuvres, toujours aux mêmes compositeurs.
D’abord Beethoven et Schubert, puis Mozart et Liszt avec quelques incartades vers Schumann, Haydn, Bach et même Schoenberg. Mais vous ne trouverez pas d’enregistrement de Chopin ou de Rachmaninov, les compositeurs de prédilection des pianistes du commun.
Il a résumé :
« J’ai essayé de m’en tenir au répertoire de ce que je considère comme de la grande musique, de la musique avec laquelle on peut passer toute une vie et à laquelle on peut revenir. Beethoven, Mozart et Schubert ont constitué l’essentiel […] J’ai fait ce que j’ai pu pour Haydn et Liszt et j’adore Schumann. J’ai également joué des œuvres qui ne sont pas de grandes œuvres, mais qui me plaisent. »
Brendel avait acquis une technique sans faille, mais il n’était pas que pianiste, il était avant tout musicien, cherchant sans cesse à décrypter et à tenter de comprendre les intentions du compositeur et la cohérence interne de l’œuvre qu’il interprétait.
Le premier article de Diapason cité, rappelait cette phrase d’Alfred Brendel :
« Je suis responsable devant le compositeur et surtout devant l’œuvre. »
Beaucoup de pianistes veulent briller grâce aux œuvres et au compositeurs, Brendel a fait le contraire : il partait de l’œuvre pour partager le message et l’émotion qui jaillissait des notes écrites dans la partition.
Dans sa page hommage à Brendel, « Radio France » publie deux citations du pianiste
« Si j’appartiens à une tradition, il s’agit d’une tradition dans laquelle c’est le chef-d’œuvre qui indique à l’interprète ce qu’il doit faire, et non pas d’une tradition où l’interprète impose ses conceptions à l’ouvrage, ou tente de dire au compositeur ce qu’il aurait dû composer. »
« Je dirai qu’il existe deux sortes d’interprètes : ceux qui éclairent l’œuvre de l’extérieur et ceux qui illuminent l’œuvre de l’intérieur. Et cela, c’est beaucoup plus rare. »
Je me rappellerai toujours avec émotion de la première fois que je l’ai vu en concert.
C’était au Palais des Congrès et de la musique de Strasbourg le 28 janvier 1978. J’étais à l’époque élève de classe préparatoire au Lycée Kléber et il me suffisait de traverser la Place de Bordeaux pour me trouver dans la magnifique salle de concert de Strasbourg.
Alfred Brendel n’était pas seul, il était accompagné de l’Academy of Saint Martin in the Fiels et son chef fondateur Neville Marriner. Il y avait aussi Jessye Norman.
Ce Concert était organisé par le Conseil International de la Musique (Unesco) et célébrait les 200 ans de la visite de Wolfgang Amadeus Mozart en 1778 à Strasbourg.
A cette date, Strasbourg appartient à la France depuis le 24 octobre 1681, lorsque Louis XIV est entré en grande pompe dans la ville qu’il avait arraché, par la puissance des armes, le mois précédent au Saint Empire Romain Germanique.
Le génie autrichien de 22 ans débarque, en calèche, autour du 10 octobre 1778 et restera environ 3 semaines à Strasbourg.
Il vient de Paris où il n’a pas eu le succès escompté et où sa mère Anna Maria Mozart vient de mourir le 3 juillet 1778, rue du Gros-Chenet (rue du Sentier). Ses obsèques eurent lieu en l’Église Saint-Eustache.

Hôtel de la Cour du Corbeau, photo époque récente Il arrive à la place du Corbeau et résidera dans la célèbre hostellerie de la cour du Corbeau, un des plus vieux hôtels d’Europe.
C’est dans l’Hôtel du miroir (situé 29 rue des Serruriers ; 1 rue du Miroirs) que Mozart donne son premier concert strasbourgeois.
Il donnera deux autres concerts dans le théâtre situé Place de Broglie. Ce théâtre a été détruit par un incendie le 31 mai 1800 lors d’une répétition avec feux d’artifice de la Flûte enchantée de Mozart !.
La Ville avait transformé en 1706 en théâtre un ancien magasin à avoine. L’opéra de Strasbourg, appelé Opéra National du Rhin, qui l’a remplacé sera édifié entre 1804 et 1821.
Il jouera aussi l’orgue de Jean-André Silbermann de L’église Saint-Thomas, achevé en 1741 et un autre orgue des frères Silbermann au Temple neuf, deux lieux de culte protestant, alors que Mozart était catholique.
Je tire ces informations de ces deux pages :
J’ai donc eu la grâce d’assister à ce concert exceptionnel qui commémorera, avec quelques mois d’avance, les 200 ans de la visite de Mozart dans la capitale alsacienne.
Alfred Brendel jouera le 25ème concerto de Mozart puis accompagnera Jessye Norman dans un air de concert.
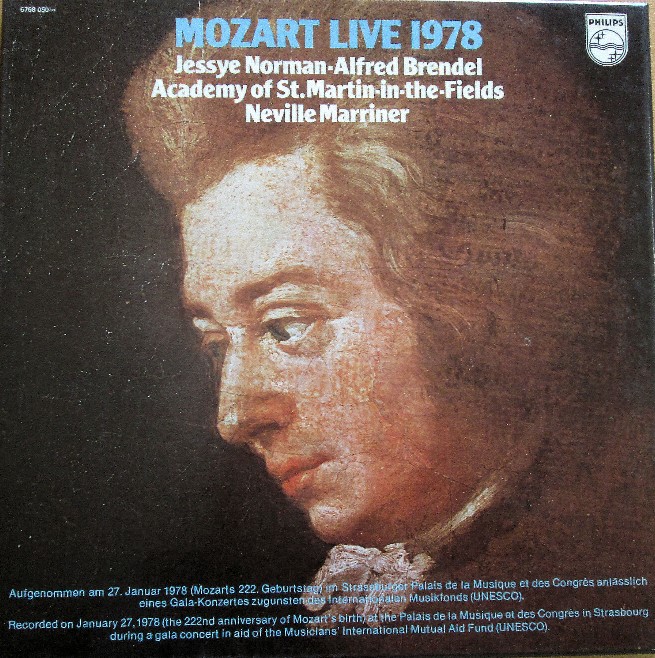 Ce concert fut télévisé et Philips enregistrera ce concert.
Ce concert fut télévisé et Philips enregistrera ce concert. Il est encore possible d’acheter ce disque sur des sites de musique dématérialisée comme « Qobuz ».
Brendel poussa l’éthique et le perfectionnisme si haut qu’il n’est pas possible de se tromper quand on achète un disque de ce pianiste, tous sont excellents et ses derniers sont les meilleurs car il n’a fait que progresser tout au long de sa carrière.
Si je peux donner quelques liens internet, je choisirai
- de Schubert « Klavierstück N°2 D946 »,
- de Beethoven le second mouvement de l’ultime Sonate de Beethoven « Beethoven Sonate N°32 : Aria »
- Ou encore l’oeuvre de Beethoven que Brendel considérait comme la plus accomplie de ses œuvres pour piano : « Variations Diabelli»,
Le monde de l’art est riche d’avoir pu compter dans ses rangs cet interprète exceptionnel que fut Alfred Brendel au cours de sa vie terrestre.
-
Lundi 2 juin 2025
« Une finale incommensurable sur le green de Munich»As, journal espagnol relatant la finale de la ligue des champions du 31 mai 2025De temps à autre je parle de football. Parce que le Football est un formidable laboratoire qui montre beaucoup des réalités de ce monde et du comportement des gens. J’avais commencé la série de mots du jour de 2018, avant la coupe du monde de Russie, par cette citation d’Albert Camus :
« Ce que je sais de la morale, c’est au football que je le dois… »
Cette fois, le football va me permettre de montrer qu’un évènement, qu’un fait peut être examiné à travers des regards ou dois je écrire des filtres différents ?
Si on regarde la chose à l’aide d’un seul filtre, on a une vision tronquée, amputée de sa complexité. J’ai l’intuition que c’est le mode devenu le plus courant pour aborder les questions politiques ou de société.

Page du journal L’équipe du 1er juin 2025 L’évènement footballistique qui me conduit à cette réflexion est évidemment la victoire du Paris Saint Germain en finale de la Ligue des champions, samedi.
Ce ne fut pas une victoire mais un triomphe. Paris a battu l’Inter Milan 5 buts à zéro. Jamais une finale de cette épreuve n’avait été remportée par 5 buts d’écart. Jusqu’à samedi le record était celui de la finale de 1994 dans laquelle le Milan AC entraîné par Fabio Capello, l’autre club de Milan, avait battu le Barcelone entrainé par Johan Cruyff 4-0 et dont les spécialistes disaient que c’était, alors, la meilleure équipe d’Europe.
Lors de cette finale de 1994, le club italien avait été remarquablement efficace et opportuniste, mais n’avait pas surclassé son adversaire dans le jeu comme l’a fait le Paris Saint Germain cette année. Ainsi le journal anglais le Daily Mail a écrit :
« Les Italiens massacrés, le PSG champion d’Europe avec style. Ils n’ont pas seulement battu l’Inter ici à Munich, Ils l’ont complètement anéanti. »
Pour retrouver une telle domination, il faut revenir à la finale de 2011 où l’équipe de Barcelone entraîné par Pep Gardiola a battu le Manchester United de Alex Ferguson. Le score n’était alors que de 3-1 mais le match fut à sens unique faisant dire à Alex Ferguson : « Jamais une équipe ne m’avait autant impressionné. Elle était injouable. »
Les journaux italiens ont reconnu la déroute de l’équipe milanaise. La Gazzetta dello Sport écrit « Quelque chose s’est brisé et s’est terminé ce soir pour l’Inter. », de son côté Tuttosport, reconnaît l’ampleur du naufrage : « Une lourde défaite qui restera dans l’Histoire. »
1/ Un premier regard qui se pose sur cet évènement peut être celui d’une personne attachée au calme d’une société apaisée.
Force est alors de constater que la célébration de cette victoire a déchainé la violence et le chaos. On dénombre deux morts sur l’ensemble des débordements qui ont eu lieu à travers l’Hexagone le 31 mai, ainsi que 192 personnes blessées en région parisienne, selon France Info.
« Le Monde » nous apprend qu’un homme de 17 ans a été poignardé à mort à Dax (Landes), près de la place de la Fontaine chaude où s’étaient réunis les supporteurs ; quatre personnes blessées – dont deux grièvement et une victime dont le pronostic vital reste engagé – après avoir été fauchés par un véhicule à Grenoble.
A Coutances (Manche), un fonctionnaire de police a été placé dans un coma artificiel après avoir été touché à l’œil et à l’arcade sourcilière par un jet de projectile. Sur les réseaux sociaux, les images de dévastation et d’affrontements tournent en boucle : des véhicules en flammes ; un pompier agressé par la foule sur les Champs-Elysées, où un magasin de chaussures de sport a été pillé et vandalisé par des dizaines de personnes – trois autres ont été dégradés – ; un scooter percuté de plein fouet par une voiture à Paris ; le pilote d’une moto violenté et son engin volé sur le boulevard périphérique ; la voiture de deux jeunes femmes saccagée ; Au commissariat de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), « deux policiers se trouvant devant le commissariat ont été victimes d’une soixantaine de tirs tendus de mortiers » l’énumération pourrait continuer…
La soirée et la nuit de samedi à dimanche a conduit à 559 interpellations à travers la France, dont 491 en région parisienne. 307 personnes ont été placées en garde à vue dont 216 à Paris, soit 202 majeurs et 14 mineurs selon le parquet de Paris. Un bilan national encore provisoire fait état de 692 incendies à travers le pays, dont 264 véhicules.
Une semaine auparavant, Le club de rugby de Bordeaux Bègles a aussi gagné la coupe d’Europe des clubs. Le retour des joueurs à Bordeaux a fait l’objet de célébrations euphoriques, il n’y eut aucun incident notable. Ce premier regard peut conduire à jeter le discrédit sur le football et ses supporters, particulièrement en France. Car s’il y a eu des incidents dans d’autres pays, par exemple récemment à Liverpool suite à la victoire de ce club dans le championnat anglais, il n’y a pas ce déchainement de violence dans toute la ville ni dans le reste du pays, dans aucun autre pays européen. Je ne développe pas, mais je voudrais tenir à distance à la fois ceux qui disent que cela n’a rien à voir avec « le monde du football français » et ceux qui trouvent tout de suite des explications qui tombent rapidement dans le racisme et la stigmatisation.
Mais cette réalité existe. Dire, comme certains politiques situés dans les oppositions que c’est la faute de l’organisation des services de sécurité, constitue à la fois un déni et « du foutage de gueule ».
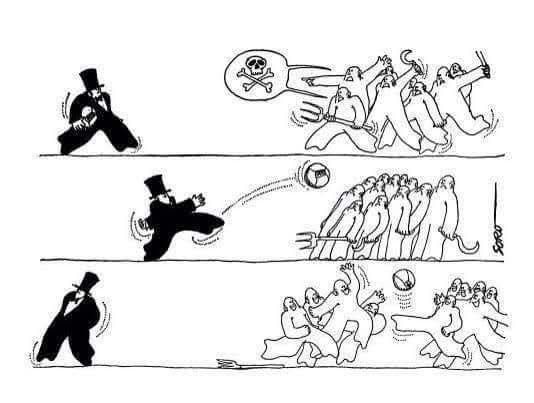 2/ Le deuxième regard pourrait être celui de la personne qui regarde le monde et qui d’un côté voit le peuple gazaoui martyrisé par Israël, le peuple ukrainien sous les bombes russes, la guerre économique déclenchée par Trump, les injustices dans le monde, les défis climatiques et écologiques devant lesquels les humains semblent baisser les bras et qui de l’autre côté voit l’énergie, l’argent et les foules mobilisés par ce jeu de ballon qui ne peut apparaitre devant sa vision du monde que sous une forme dérisoire.
2/ Le deuxième regard pourrait être celui de la personne qui regarde le monde et qui d’un côté voit le peuple gazaoui martyrisé par Israël, le peuple ukrainien sous les bombes russes, la guerre économique déclenchée par Trump, les injustices dans le monde, les défis climatiques et écologiques devant lesquels les humains semblent baisser les bras et qui de l’autre côté voit l’énergie, l’argent et les foules mobilisés par ce jeu de ballon qui ne peut apparaitre devant sa vision du monde que sous une forme dérisoire. « Panem et circenses », « du pain et des jeux » disaient des auteurs romains devant une telle dichotomie du temps de l’Empire. Comment nier que cette vision montre une part de vérité ?
C’est une partie de la réalité, ce n’est qu’une partie.
3/ Le troisième regard que je vous propose est celui de l’économiste, c’est-à-dire de l’étude de l’allocation des ressources.
Nous savons que les meilleurs joueurs ont des salaires mirobolants et qu’en plus ils disposent de revenus tout aussi élevés dans le cadre du sponsoring et de la publicité. Cette réalité a été synthétisé par cette description : « un jeu financé par des gens modestes qui paient très chers pour aller regarder des millionnaires courir après un ballon ». Je n’ai pas retrouvé l’auteur de cette formule qui m’avait marqué quand je l’avais entendue.
Si on s’intéresse aux dix plus gros budgets des clubs européens, le grand Continent a publié ce tableau.

Si, en parallèle, on s’intéresse aux 15 derniers vainqueurs de la ligue des champions on trouve ce tableau :
 Il n’y a que Chelsea qui n’apparait pas dans les dix premiers budgets.
Il n’y a que Chelsea qui n’apparait pas dans les dix premiers budgets. Cette anomalie me semble étonnante, surtout que j’ai pu lire que la source « sportune », identique à celle utilisée par Le Grand Continent, disait que le budget de Chelsea était pour la saison dernière (2023-2024) de 600 millions d’euros ce qui met ce club dans les 10 plus gros budgets.
Et sur le site de la RTBF, j’ai pu lire qu’« Avec 2,64 milliards d’euros dépensés depuis 2014, dont plus d’un milliard depuis son rachat par le consortium américain BlueCo en mai 2022, Chelsea est aussi le club ayant investi le plus d’argent dans des transferts au cours de la dernière décennie. ».
Nous pouvons ainsi être rassuré, ce sont bien les clubs les plus riches qui gagnent.
Ce constat qui est conforme à la marche économique du monde, met à mal ce qu’on appelle « la glorieuse incertitude du sport ». Il y a bien incertitude mais à l’intérieur d’une petite élite sélectionnée par l’argent. C’est assez décevant pour les amateurs du football et répulsif pour les autres.
Il y a bien un troisième groupe, celui des économistes libéraux qui vont se satisfaire de ce marché des joueurs qui semble admirable de cohérence : les meilleurs joueurs, ceux qui font gagner, sont payés le plus cher. Le fait que ce soit les clubs les plus riches, c’est-à-dire ceux qui peuvent embaucher les meilleurs joueurs, qui gagnent est une magnifique démonstration que la loi du marché est juste dans le football…
Ce regard sur le monde du football constitue aussi un éclairage exact de la réalité, mais ne saurait expliquer à lui seul ce que représente le football.
4/ L’analyse géopolitique va nous conduire à voir que cette victoire est celle du Qatar.
C’est le fonds souverain du Qatar qui a acheté le club le 30 juin 2011. Le propriétaire est donc l’Emir du Qatar qui confie la présidence du club à un de ses hommes de confiance : Nasser al-Khelaïfi , toujours en fonction.
 Il n’y a pas de doute que la victoire est celle du Qatar. Quand l’avion de Qatar airways a atterri à Roissy avec les joueurs parisiens, Nasser al-Khelaïfi a tenu à porter la coupe avec le capitaine de l’équipe, il n’était pas concevable de laisser cet objet de convoitise entre les seules mains des joueurs. La même scène a été vu lorsque les joueurs et leur président sont arrivés à l’Elysée dans une tentative de récupération par le Président de la République. Ce dernier a remercié chaleureusement Nasser al-Khelaïfi :
Il n’y a pas de doute que la victoire est celle du Qatar. Quand l’avion de Qatar airways a atterri à Roissy avec les joueurs parisiens, Nasser al-Khelaïfi a tenu à porter la coupe avec le capitaine de l’équipe, il n’était pas concevable de laisser cet objet de convoitise entre les seules mains des joueurs. La même scène a été vu lorsque les joueurs et leur président sont arrivés à l’Elysée dans une tentative de récupération par le Président de la République. Ce dernier a remercié chaleureusement Nasser al-Khelaïfi :
« Cette victoire vous doit beaucoup Président. [ d’autres éloges…] et je remercie avec vous le Qatar qui a toujours été un actionnaire exigeant. Qui a réengagé, qui a réinvestit dans ce club, qui n’a jamais laché. […] Je veux aussi remercier l’Emir du Qatar… ».
C’est un long article du Monde qui dévoile le début de toute cette affaire dans laquelle l’intérêt bien compris du Qatar va rencontrer la bienveillance et les intérêts français : « Le déjeuner à l’Elysée qui a conduit le Mondial au Qatar ».
Il reste des coins d’ombre mais la vraisemblance du récit semble avérée, chacun des protagonistes ayant, de manière plus ou moins explicite, reconnus les faits que je vais résumer.

L’équipe parisienne avec la coupe pose devant l’avion du Qatar Le Qatar poursuit ce rêve fou d’organiser la coupe du monde, alors que son territoire est minuscule, son histoire avec le football proche du néant et qu’en outre les conditions climatiques de ce pays rendent la pratique du football dangereuse pour la santé. Vous savez cela puisque cette coupe du monde a eu lieu.
Le 23 novembre 2010, Nicolas Sarkozy, président de la République, invite Michel Platini, président de l’UEFA, l’organisme européen du football à l’Elysée. Michel Platini dit qu’il ne savait pas qu’il y aurait un autre invité : le prince héritier du Qatar qui sera en 2022 l’émir du Qatar. Michel Platini est une des voix qui va voter pour l’attribution de la coupe du monde. Il est en outre en raison de son passé du plus grand joueur de football de sa génération, un homme très influent dans le monde du football.
Le Président de la FIFA, organisation mondiale du football, Joseph Blatter affirme que Platini lui avait révélé avant novembre 2010 qu’il voterait, pour l’attribution du Mondial 2022, pour les Etats-Unis.
Y a-t-il eu corruption ?
Ce n’est pas jugé. Toutefois selon l’article du Monde, si Michel Platini a nié que le président lui a demandé de voter pour le Qatar, il a toutefois :
« senti qu’il y avait un message subliminal » de la part de Nicolas Sarkozy lorsqu’il s’était « retrouvé avec des Qatariens ».
Nous savons que Platini a voté pour le Qatar.
Le Qatar achetait déjà beaucoup d’armes et d’autres biens et services français, il va en acheter davantage et aussi beaucoup investir en France.
Pascal Blanchard lors de l’émission C ce soir du 2 juin 2017, très intéressante et nuancée sur le Qatar, a donné ces chiffres :
« 47 entreprises françaises ont des investissements significatifs du Qatar, notamment l’hôtellerie, 84% de l’armement du Qatar est français. »
Nicolas Sarkozy est aussi un très fervent supporter du Paris Saint Germain qui en 2010 était en grande difficulté financière et sportive. Selon ses propres dire au journal l’Equipe, il reconnait avoir facilité le rachat du PSG par le Qatar mais prétend que l’intérêt du Qatar pour Paris en raison de son « soft power sportif » existait depuis longtemps et qu’il n’en était pas à l’origine.
Toujours est-il que le Qatar a bien obtenu la coupe du monde de 2022 et a racheté le PSG, 7 mois après ce diner.
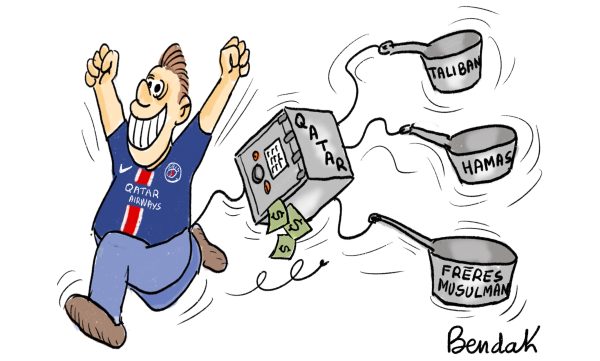 Un rapport récent analysait le rôle problématique des frères musulmans en France. Le Qatar est un des derniers amis de cette confrérie. Le Qatar finance en France des réseaux islamiques qui très probablement professent des valeurs assez éloignées de nos principes républicains. Le Qatar est le financier du Hamas. Le Qatar est aussi le pays qui a été le cadre des négociations entre les Talibans et l’Administration Trump et qui a conduit à la fuite honteuse des américains sous Biden. Le Qatar continue à jouer le rôle de médiateur pour essayer de faire reconnaître le régime des talibans par les pays occidentaux.
Un rapport récent analysait le rôle problématique des frères musulmans en France. Le Qatar est un des derniers amis de cette confrérie. Le Qatar finance en France des réseaux islamiques qui très probablement professent des valeurs assez éloignées de nos principes républicains. Le Qatar est le financier du Hamas. Le Qatar est aussi le pays qui a été le cadre des négociations entre les Talibans et l’Administration Trump et qui a conduit à la fuite honteuse des américains sous Biden. Le Qatar continue à jouer le rôle de médiateur pour essayer de faire reconnaître le régime des talibans par les pays occidentaux. Il faudrait aussi dire quelques mots sur Nasser al-Khelaïfi qui a vu sa longue présidence ponctuée de plusieurs affaires, quelquefois des procédés de barbouzes. Mais cela est développé dans ce documentaire de compléments d’enquête « Pouvoir, scandales et gros sous : les hors-jeux du PSG ».
L’intéressé quand il est interpellé sur ces sujets parle de Qatar bashing, l’accusation d’islamophobie n’est jamais loin.
C’est aussi une réalité du football d’aujourd’hui, le pouvoir de l’argent et l’intervention de fonds d’investissement ou d’Etat qui n’avaient aucun lien historique ou pratique avec le football mais qui ont pris les premières places pour pouvoir augmenter leur sphère d’influence grâce à leur richesse.
5/ Et puis il y a le regard naïf, le regard de l’enfant que nous étions et qui reste en nous..
Tous les angles de compréhension précédents sont justes. Il y en encore certainement d’autres auxquels je ne pense pas. Mais ils n’expliquent pas tout.
J’ai déjà essayé d’aborder ces sujets dans la série de mots que j’avais consacré au football : « Le football par l’Histoire, l’Économie et la Morale ». Je citais l’écrivain Eduardo Galeano qui a beaucoup écrit de manière savante sur le football et qui pour expliquer l’inexplicable pour toutes celles et tous ceux qui sont hermétiques à ce jeu, a fait appel au dialogue entre une journaliste et la théologienne allemande Dorothée Solle :
« – Comment expliqueriez-vous à un enfant ce qu’est le bonheur ?
– Je ne le lui expliquerais pas, répondit-elle. Je lui lancerais un ballon pour qu’il joue avec. ».Dans mon enfance c’était la principale activité de loisirs avec les copains. Dès qu’il y avait un peu de temps libre nous allions jouer au ballon et nous étions heureux. Alors le football jouée dans cette finale par des millionnaires n’a rien à voir avec ces jeux d’enfants !
Est ce si sûr quand on voit la joie des joueurs qui ont marqué ou ces millionnaires qui se cachent le visage et pleurent. Vous croyez qu’ils pleurent parce qu’ils se disent à ce moment là que grâce à cette victoire ils vont pouvoir encore gagner plus d’argent plus tard ?
Ils y penseront probablement quelques jours plus tard, mais à cet instant c’est leur âme d’enfant qui pleure d’avoir pu réaliser leur rêve. Et les supporters, les vrais pas les casseurs, sont en communion avec eux et trouvent aussi ces ressources dans leur âme d’enfant.
Et puis ce jeu quand il est joué comme l’équipe de Paris l’a fait ce samedi, est beau et plein d’intelligence de vie. Le meilleur joueur de Paris, Ousmane Dembélé est un formidable dribbleur et il devenu un buteur performant. Mais dans cette finale, il n’a presque pas dribblé, ni tirer au but. Il a appliqué une tactique au service de son équipe, il a utilisé sa vitesse et son énergie pour harceler le gardien et les défenseurs adverses pour les empêcher de faire de belles passes et relancer positivement leur équipe. Grâce à ce rôle ingrat qu’il a réalisé jusqu’à la dernière minute, ses équipiers sont parvenus à récupérer toujours très rapidement les ballons et relancer leurs attaques. Et ce sont les autres qui ont brillé et marqué des buts magnifiques. Mais comme c’était le joueur le plus brillant qui a fait ce travail défensif tous les autres ont eu la même rigueur et le même enthousiasme pour étouffer l’équipe adverse, ce qui a été réalisé.
C’est ce que le journal espagnol AS a salué dans cet éloge :« Ce que Mbappé, Neymar, Messi, Dani Alves, Ibrahimovic, Beckham, Di María ou Cavani n’ont pas pu réaliser, ces jeunes talents l’ont réalisé en dessinant une finale incommensurable sur le green de Munich. Ils ont laisse l’Inter sans rien, déchiqueté sans aucun signe de pouvoir mordre. »
Car le football est un jeu collectif et lorsque le collectif atteint ce sommet auquel se sont hissés les joueurs parisiens, la joie simple du football comme on rêve de le jouer quand on est enfant sans y parvenir, devient réalité et fait du bien comme une œuvre d’art ou la vision d’un magnifique paysage.
C’est un autre regard, qui n’efface aucun des 4 autres mais qui les complète pour approcher d’un peu plus près le sens et la compréhension de cet évènement qui a eu lieu samedi à Munich.
-
Lundi 26 mai 2025
« Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes »Bible – Livre de la Genèse 18,32Ce qui se passe à Gaza est d’une inhumanité absolue.

Photo parue dans le journal breton Le Télégramme Le mot « inhumanité » est utilisé par l’historien Jean-Pierre Filiu dans la chronique de ce dimanche qu’il a écrit dans le monde : « La guerre inhumanitaire d’Israël dans la bande de Gaza »
La guerre à Gaza a commencé il y a six cents jours. Je n’oublie pas que le premier acte d’inhumanité a été celui du groupe terroriste et fanatique religieux du Hamas qui a massacré et pris en otages des habitants d’Israël, dont, en outre, beaucoup militaient dans le camp de la paix, comme cette extraordinaire femme Vivian Silver, assassinée et brulée par les terroristes le 7 octobre 2023 et dont j’ai fait le cœur d’un mot du jour de décembre 2023 : « Il n’y a pas de chemin pour la paix – la paix est le chemin. ».
Le Hamas a ainsi perpétré un double crime : un crime contre les israéliens et les juifs. Mais il a aussi commis un crime contre les palestiniens de Gaza.
Il ne pouvait pas ignorer que les israéliens répliqueraient avec une violence énorme et un esprit de vengeance. Or le Hamas n’avait aucun moyen de protéger les habitants de Gaza des armes terribles de Tsahal. Le Hamas savait que la souffrance de leur peuple serait terrible. Par mépris de la vie et fanatisme, ils l’on fait quand même. Et nous savons que par cynisme, il espérait même que la réponse d’Israël et la souffrance du peuple de Gaza soit telle qu’Israël au bout de quelques mois serait haï par tous les peuples de la terre qui auront oublié le 7 octobre pour ne plus que voir les massacres de l’armée de « l’entité sioniste » comme disent ceux qui veulent éliminer l’Etat d’Israël.

Paru dans le journal La Croix Ce plan odieux est en train de fonctionner contre Israël qui par aveuglement de son gouvernement et les intérêts de Benyamin Nétanyahou suit la stratégie suicidaire impulsée par les ministres d’extrême droite qui ne représentent qu’environ 10% des électeurs d’Israël.
Ainsi le ministre des finances Bezalel Smotrich qui souhaite un État théocratique soumis à la loi religieuse et l’annexion de toute la Palestine historique a affirmé, mardi 6 mai 2025, que la bande de « Gaza serait totalement détruite » à l’issue de l’offensive et que la population gazaouie, après avoir été déplacée vers le sud, commencerait à « partir en grand nombre vers des pays tiers ». Il parle, sans se cacher, d’un nettoyage ethnique qui constitue un crime contre l’humanité.
L’autre ministre d’extrême droite, qui occupe le poste de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir a déclaré le 20 mai 2025, après l’annonce de la reprise de l’aide humanitaire à Gaza, Israël avait autorisé l’entrée de 100 camions d’aide supplémentaires : « C’est une grave erreur qui retarde notre victoire. ». Lui parle, sans se cacher, de la stratégie d’affamer deux millions d’êtres humains, enfants, femmes et enfants.
Au milieu des morts gazaouis qui ne sont souvent que des chiffres neutres, sans identification humaine, quelquefois jaillissent des victimes identifiées de cette brutalité sans limite. Le Monde a publié hier ce témoignage : « une pédiatre palestinienne perd neuf de ses dix enfants dans le bombardement de sa maison ». On connait le nom de la mère.
« Alaa Al-Najjar travaillait dans un hôpital du sud de la bande de Gaza quand son logement a été bombardé par l’armée israélienne. Les seuls survivants, son mari et l’un de ses dix enfants, sont blessés. […] Un à un, les secouristes palestiniens ont extirpé des petits corps carbonisés, certains démembrés, minuscules silhouettes noircies, recroquevillées. Précautionneusement, ils ont emballé les cadavres, qui manquaient de se désagréger à chaque manipulation, dans des petits sacs mortuaires blancs. Tous étaient frères et sœurs, neuf au total, retrouvés dans les décombres encore fumants de leur maison, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, vendredi 23 mai dans l’après-midi. »
Dans l’émission « C Politique » d’hier, le Philosophe, romancier Nathan Devers qui a revendiqué sa judaïcité, a dans sa première intervention fait référence au texte sacré de la religion juive : le livre de la Genèse. La cité de Sodome devait être détruite par le Dieu d’Israël parce qu’elle était habitée de gens particulièrement méchants. Alors, Abraham a engagé une discussion avec son Dieu :
« 22 – Les hommes s’éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l’Eternel. 23 – Abraham s’approcha, et dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? 24 – Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville: les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d’elle? 25 – Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu’il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d’agir! loin de toi! Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la justice? 26 – Et l’Eternel dit: Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. 27 – Abraham reprit, et dit: Voici, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. 28 – Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq: pour cinq, détruiras-tu toute la ville? Et l’Eternel dit: Je ne la détruirai point, si j’y trouve quarante-cinq justes. 29 – Abraham continua de lui parler, et dit: Peut-être s’y trouvera-t-il quarante justes. Et l’Eternel dit: Je ne ferai rien, à cause de ces quarante. 30 – Abraham dit: Que le Seigneur ne s’irrite point, et je parlerai. Peut-être s’y trouvera-t-il trente justes. Et l’Eternel dit: Je ne ferai rien, si j’y trouve trente justes. 31 – Abraham dit: Voici, j’ai osé parler au Seigneur. Peut-être s’y trouvera-t-il vingt justes. Et l’Eternel dit: Je ne la détruirai point, à cause de ces vingt. 32 – Abraham dit: Que le Seigneur ne s’irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s’y trouvera-t-il dix justes. Et l’Eternel dit: Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes. 33 – L’Eternel s’en alla lorsqu’il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. »
Bible : Livre de Genèse 18, versets 22 à 33, traduction de Louis Segond
Les Juifs d’Israël ne trouveront ils pas dix innocents dans la bande Gaza ? Même dans les textes sacrés de leur religion, ces textes qui ont façonné l’éthique juive, ces hommes qui se prétendent croyants trouvent la réponse que leur action de guerre est devenue illégitime. Après le 7 octobre Biden, déjà bien affaibli, était venu en Israël et a prodigué ce conseil venant de l’expérience des Etats-Unis :
« Ne faites pas les mêmes erreurs que nous après le 11 septembre, ne soyez pas consumés par la rage »
C’est encore Nathan Devers qui dans cette même émission de « C Politique » cite Jacques Derrida qui dans un dialogue philosophique entre l’Allemand Jürgen Habermas appellé le « Concept » du 11 septembre décrit la réaction des américains après le 11 septembre sous la forme d’une maladie auto-immune. C’est à dire la réaction destructrice que peut avoir notre système immunitaire qui en réaction à une agression externe va réagir si fort qu’il détruit aussi le corps qu’il est sensé défendre.
Israël est en train d’entrer dans cette phase de maladie auto-immune. Si les européens sont les amis d’Israël, ils doivent utiliser tous les moyens pour empêcher que ce désastre continue.
-
Samedi 17 mai 2025
« Il faut accepter que tout a une fin »Alejandro JodorowskyC’était il y a un an : le 17 mai 2024. C’était un vendredi.
 Pierre avait réservé trois couverts au restaurant « Le Vivarais », situé dans la Presqu’ile lyonnaise, Place Gailleton.
Pierre avait réservé trois couverts au restaurant « Le Vivarais », situé dans la Presqu’ile lyonnaise, Place Gailleton. Depuis ce jour, j’ai appris que ce restaurant est ouvert depuis le 7 novembre 1917, donc depuis plus de 100 ans. Pierre m’avait dit qu’il s’agissait d’une institution lyonnaise.
C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés à 12:30 en cet endroit Pierre, moi et Fabien. Nous avons très bien mangé et beaucoup parlé.
Le repas terminé, nous avons commencé une ballade le long du Rhône puis nous avons traversé le fleuve et nous nous sommes assis sur la terrasse du grand café de la Préfecture où avons consommé une boisson.
 Pierre ayant une contrainte nous a quitté un peu plus tard. Avec Fabien nous sommes restés encore un temps, avant de repartir vers la Place Bellecour. Nous sommes alors descendus dans le métro, la Ligne D.
Pierre ayant une contrainte nous a quitté un peu plus tard. Avec Fabien nous sommes restés encore un temps, avant de repartir vers la Place Bellecour. Nous sommes alors descendus dans le métro, la Ligne D. Et comme tant de fois, lorsque jadis nous travaillions dans le même lieu à l’Hôtel des Finances, nous nous sommes séparés : Fabien prenant la direction « Gare de Vaise » et moi la direction inverse.
Seulement ce 17 mai 2024, ce fut la dernière fois. La dernière fois que j’ai vu Fabien vivant.
J’ai écrit un mot du jour de deuil le 23 juillet 2024 : « Une lumière si tendre qu’elle semble s’adresser aux morts plus qu’à nous. ».
Pourquoi ce nouveau mot du jour, un an après ?
Parce que le souvenir de cette rencontre d’il y a un an, a fait surgir en moi une évidence que tous les philosophes ou simplement humains sages nous ont toujours transmis : la vie peut s’arrêter brutalement et nous ne savons jamais lorsque nous rencontrons un ami ou un proche, si cet échange n’est pas le dernier.
Fabien avait 62 ans, rien n’indiquait que deux mois plus tard, une maladie foudroyante l’emporterait. Quelquefois ce sont des accidents qui conduisent au même résultat. Je n’épiloguerais pas sur les conséquences de ce constat : chaque rencontre peut être la dernière. Je pense que chacune et chacun peut en tirer sa propre philosophie de vie.
Christian Bobin écrit dans «La Dame Blanche :
« Rencontrer quelqu’un, le rencontrer vraiment – et non simplement bavarder comme si personne ne devait mourir un jour -, est une chose infiniment rare. La substance inaltérable de l’amour est l’intelligence partagée de la vie. »
Fabien adorait la poésie. Parfois, au milieu d’une conversation, il citait de mémoire un poème.
Récemment j’ai découvert un poème d’Alejandro Jodorowsky. C’est un artiste franco-chilien. Il est surtout connu comme scénariste de bande dessinée et réalisateur, mais il est également acteur, mime, romancier, essayiste et aussi poète.
Il est toujours vivant et il est né le 17 février 1929. Il est donc très vieux. Fabien n’a pas suivi ce bel adage : vieillir est la seule façon que nous avons trouvé pour ne pas mourir. J’ai l’intuition cependant qu’il aurait beaucoup aimé ce poème : « Ce n’est pas facile de vieillir. »
Ce n’est pas facile de vieillir,
il faut s’habituer à marcher plus lentement,
à dire adieu à celui qu’on était
et à saluer celui qu’on est devenu.
C’est difficile, ce passage des années,
il faut savoir accepter ce nouveau visage,
arpenter fièrement ce nouveau corps,
se délester des hontes,
des préjugés et de la peur qu’apportent les ans. Il faut laisser venir ce qui doit venir,
Il faut laisser venir ce qui doit venir,
laisser partir ceux qui doivent partir,
et permettre à ceux qui le veulent
de rester à tes côtés.
Non, vieillir n’est pas une tâche aisée.
Il faut apprendre à n’attendre rien de personne,
à marcher seul, à se réveiller seul,
et à ne pas se laisser happer chaque matin
par l’image de l’homme ou de la femme
que reflète le miroir.Il faut accepter que tout a une fin,
que la vie elle-même a son terme,
savoir faire ses adieux à ceux qui s’en vont,
se souvenir de ceux qui sont partis,
pleurer jusqu’à se vider,
jusqu’à se dessécher de l’intérieur,
pour que renaissent de nouveaux sourires,
d’autres espoirs,
et des rêves encore inexplorés.Alejandro Jodorowsky
-
Mercredi 7 mai 2025
« Le grand problème de la science c’est que ce n’est pas une bonne conteuse. Ce sont les histoires qui motivent les gens à agir, pas les faits. »Yuval Noah HarariEcrire en ce moment est difficile. Ce qui se passe dans le monde est en quelque sorte révolutionnaire, c’est à dire en rupture avec ce qui existait avant. La prédation, le rapport de force existaient bien sûr, mais jamais le droit n’a été à ce point nié dans les relations internationales au profit de la seule puissance. Celui qui est puissant peut exiger ce qui lui plait et regarder avec dédain le juge du droit en lui posant la question « De quelle armée, de quelle police disposes-tu pour m’obliger à faire ce que tu prétends m’imposer ? ». Staline, en son temps avait posé les jalons en demandant : « Le pape ? Combien de divisions ? ».
L’élection de Donald Trump joue un rôle d’accélérateur dans ce dérèglement du monde. La lettre numérique « Zeitgeist » de Philippe Corbé continue à nous donner des informations incroyables : « Que la Force soit avec Lui »
Trump était invité dans l’émission Meet the Press, sur NBC, la plus ancienne émission de la télévision américaine, chaque dimanche depuis 1947. Premier échange rapporté par Corbé :
« NBC : En tant que président, n’êtes-vous pas censé défendre la Constitution des États-Unis ? Trump : Je ne sais pas…»
 Il est président et il ne sait pas s’il doit défendre la Constitution des Etats-Unis ! Cet individu a par deux fois en janvier 2017 et janvier 2025, prêté serment, en posant la main sur la bible (c’est ainsi que cela se passe dans ce pays) et il a prononcé alors ces paroles « Je jure solennellement que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis contre tous ennemis, externes ou intérieurs, que je montrerai loyauté et allégeance à celle-ci, que je prends cette obligation librement, sans aucune réserve intellectuelle ni intention de m’y soustraire et je m’acquitterai bien et loyalement des devoirs de la charge que je m’apprête à prendre. Que Dieu me vienne en aide. ». A t’il des trous de mémoire ou simplement ne se sent-il engagé par rien ?
Il est président et il ne sait pas s’il doit défendre la Constitution des Etats-Unis ! Cet individu a par deux fois en janvier 2017 et janvier 2025, prêté serment, en posant la main sur la bible (c’est ainsi que cela se passe dans ce pays) et il a prononcé alors ces paroles « Je jure solennellement que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis contre tous ennemis, externes ou intérieurs, que je montrerai loyauté et allégeance à celle-ci, que je prends cette obligation librement, sans aucune réserve intellectuelle ni intention de m’y soustraire et je m’acquitterai bien et loyalement des devoirs de la charge que je m’apprête à prendre. Que Dieu me vienne en aide. ». A t’il des trous de mémoire ou simplement ne se sent-il engagé par rien ? A la question de savoir, s’il veut concourir à un troisième mandat, ce qu’il n’a pas le droit de faire, il répond :
« C’est quelque chose que, à ma connaissance, vous n’avez pas le droit de faire. Je ne sais pas si c’est constitutionnel qu’on vous empêche de le faire ou autre chose. »
A plusieurs reprises Trump a évoqué un troisième mandat. Ses conseillers lui ont certainement dit qu’il ne pouvait pas le faire, d’où sa réponse. Mais soit il ne leur pas demandé pourquoi, ce qui parait tout de même surprenant ou plus vraisemblablement il l’a oublié.
La réponse juridique est que le président des États-Unis est limité à deux mandats en vertu du 22e amendement de la Constitution américaine, adopté en 1951. Cette limitation a été mise en place après les 4 mandats du président Franklin D. Roosevelt qui est mort lors de son dernier mandat en pleine guerre mondiale.
Au milieu du chaos créé par cet homme sans qualité, ses attaques répétées contre la science sont aussi inquiétantes que son désir impérialiste. Pourquoi la science peut elle être ainsi attaquée sans qu’il n’y ait de réactions du plus grand nombre. La médecine, l’augmentation de l’espérance de vie, la conquête spatiale, la technologie qui nous rend la vie plus confortable et plus facile doivent tout à la science et rien au dieu qu’invoque tant de croyants dans le monde et nombre de supporters de Trump..
J’ai trouvé particulièrement intéressant un entretien diffusé sur ARTE : « Un livre pour ma vie : Yuval Noah Harari » dans lequel l’historien israélien et auteur de « Sapiens » était invité à citer les livres qui ont compté dans sa vie.
Et il a parlé de la difficulté de notre espèce avec la science.
Les humains se nourrissent de récits, récit religieux, récit nationaux, récit mythologique. C’est ainsi qu’ils expliquent le monde :
« Les humains sont ces animaux conteurs d’histoires. On pense en histoires. C’est plus facile, pour nous. Quand on lit des livres récents sur la mécanique quantique qui tentent d’expliquer le fonctionnement physique du monde, ou des livres de biologie cellulaire ou de génétique, c’est tellement compliqué.
Nos cerveaux ne sont pas vraiment évolués ou adaptés pour penser en ces termes. C’est pour cela qu’il faut passer des années à l’Université et s’appuyer sur des équations mathématiques complexes. Et même comme ça, ça reste à distance. En fait, il est très difficile d’intégrer ce que ça signifie parce que nos cerveaux ne fonctionnent pas comme ça.»Les humains sous estiment certainement la complexité de la pensée scientifique. Harari trouve cependant que la Science exprime beaucoup plus de créativité et quand il la compare à la mythologie il souligne le côté trivial et simpliste de cette dernière :
« Quand je pense à la science et à la mythologie, ce qui me frappe c’est que la science est bien plus imaginative, tumultueuse et surprenante que n’importe quel mythe créé par les humains.
La majeure partie de la mythologie humaine ne fait que reprendre les scénarios élémentaires de nos vies personnelles en les amplifiant.
Donc les dieux de la mythologie grecque sont en fait une famille qui se querelle. Et le genre de dispute qu’on entend petit entre son père et sa mère, on les lit dans la mythologie avec Zeus et Héra lorsqu’ils se disputent ou punissent les enfants. Cela va même jusqu’au fondement le plus profond de la mythologie judéo-chrétienne plus récente. Presque toute l’identité juive repose sur le fait de dire qu’on est les enfants préférés de Dieu. C’est tout. Dans toutes les familles les enfants se disputent pour ça. […] Des nations entières construisent leur identité à partir de cette histoire. » Il explique de manière aussi simple la mythologie chrétienne. Son art de d’éclairer ce récit me fascine :
Il explique de manière aussi simple la mythologie chrétienne. Son art de d’éclairer ce récit me fascine : « On peut penser aussi aux théologiens chrétiens. Ils expliquent ce qu’est l’enfer. D’un côté, ils disent que les démons vous font rôtir dans le souffre et le feu pour des millions d’années.
Mais à un niveau plus profond, ils disent que l’enfer, c’est être exclu, déconnecté de Dieu. C’est ce que les enfants craignent le plus, comme tout jeune mammifère, de perdre le contact avec leurs parents. Parce que si la progéniture d’un mammifère, d’un être humain, d’un chimpanzé ou d’un dauphin, perd le contact avec sa mère ou avec ses parents, il meurt. Personne ne les nourrit, personne ne prend soin d’eux. On peut donc rapprocher toute cette mythologie chrétienne de la simple idée d’un enfant perdu qui réclame ses parents. »Et il poursuit en montrant que ces ressorts de la mythologie chrétienne tente d’expliquer le monde, l’univers, mais que dans ce domaine, ils atteignent vite des limites. J’aime beaucoup l’ironie de Harari qui explique que les récits des humains sont motivés par le fait qu’ils sont des mammifères et que s’ils appartenaient à d’autres espèces, les mythologies devraient certainement être revues :
« En ce sens, la mythologie est très profonde émotionnellement. Mais en termes de compréhension de l’univers, elle a quelque chose de très superficiel. En effet, elle ne fait que prendre nos scénarios biologiques déterminés par l’évolution, ces histoires d’enfants et de familles, d’amitiés et les amplifie jusqu’à penser : l’univers entier fonctionne comme ma famille. L’univers entier fonctionne comme notre village.
 Mais les choses comme la mécanique quantique contredisent cela. Il y a certains morceaux de l’univers, comme la vie biologique des mammifères, qui fonctionnent comme cela, mais ce n’est pas le cas de la majorité de l’univers.
Mais les choses comme la mécanique quantique contredisent cela. Il y a certains morceaux de l’univers, comme la vie biologique des mammifères, qui fonctionnent comme cela, mais ce n’est pas le cas de la majorité de l’univers.
Dès qu’on s’éloigne des mammifères, si on passe aux reptiles l’histoire est déjà totalement différente. Prenons la tortue. Vous avez cette image de la maman tortue qui sort de l’océan. Elle creuse un trou dans le sable, elle y pond ses 40 ou 50 œufs. Elle rebouche le trou, puis retourne dans l’eau, et voilà ! Voilà ce que Freud aurait à gérer s’il soignait des tortues. Parce qu’il n’y a plus aucun lien ensuite entre la mère et ses petits. Ce n’est pas un mammifère. Elle n’allaite pas ses petits, ne les protège pas, rien. […] Donc quelle serait la mythologie des tortues ?
Toute cette peur de la mythologie chrétienne celle d’être exclu par son père, n’a aucun sens pour les tortues. Et cette obsession juive du père qui nous aime plus que tous les autres, n’a aucun sens pour les tortues. »Il rappelle aussi que ces mythologies sont très présentes dans les conflits d’aujourd’hui et nous savons que lorsque les religions entrent dans les guerres, c’est rarement signe de paix….
« Certaines guerres actuelles, comme celle dans mon pays… La guerre entre les Israéliens et les Palestiniens est toujours alimentée par ce scénario biologique et mythologique qui veut qu’on soit les enfants préférés de Dieu. Pour les deux camps.»
La science nous laisse froid dit-il, il n’y a pas d’intrigue mais des formules mathématiques. Cela ne fait pas de belles histoires.
« Ce qui diffère chez nous des lapins et aussi des éléphants et des chimpanzés, c’est qu’avec la langue on peut créer des histoires.Nous avons une imagination incroyable,mais les scénarios de base sont toujours les mêmes. [Ils] sont toujours limités par notre biologie de mammifères.
On a donc des mythologies complexes, des poèmes, des films et des séries télé, mais quand on examine l’intrigue, elle découle en fait de la biologie. […]
et on raconte des histoires et des histoires, avec des variations, mais ce sont les mêmes intrigues basiques.
La science fonctionne en dehors de ces intrigues. La mécanique quantique n’est pas un scénario biologique. C’est tellement différent de tout ce qu’on connaît.[…]
Mais grâce aux mathématiques et aux ordinateurs, on arrive à s’en approcher d’une certaine manière. Une immense partie du monde est construite à partir de ces théories et modèles scientifiques.
Mais psychologiquement et politiquement, ils nous laissent complètement froids.
Il est très difficile d’inciter des gens à faire quoi que ce soit en leur disant que E = MC2, ou en leur montrant des équations de mécanique quantique.»Nos histoires, nos récits peuvent être dévoyées et source d’aveuglement et de conflits. Il cite Poutine et aussi le conflit en terre d’Israël et de Palestine.
« Si on vous nourrit des mauvaises histoires, des mauvais mythes, 50 ans plus tard vous êtes Poutine. Cela peut mener à la mort et à la souffrance de millions de gens. Tout commence dans la tête. […]
On croit que les hommes se battent pour les mêmes raisons que les lapins et les chimpanzés, c’est à dire la nourriture ou le territoire. Mais ce n’est presque jamais le cas. […]
Dans le cas de mon pays, le conflit israélo-palestinien n’est pas lié au territoire. Il y a assez de terre entre la Méditerranée et la Jordanie pour construire des maisons et des écoles pour tous. Ce n’est pas lié à la nourriture. Il y en a assez. Il y a assez d’eau, d’énergie…
Mais les gens croient à des fantasmes, à des mythes, à des histoires qui sont incompatibles. Les deux camps le disent : Dieu nous a donné cette terre. On ne peut pas faire de compromis avec l’amour de Dieu. Pas de compromis avec les dons de Dieu.»La science a du mal à être contée. Harari tente de le faire, certains s’en offusquent et lui reproche de prendre quelques fantaisies avec la rigueur scientifique. Lui explique qu’il tente pourtant de le faire parce qu’il sait combien le récit est important pour arriver à toucher le cœur et l’imagination des humains. Parler d’immigration est beaucoup plus simple, l’immigration mobilise tout de suite des récits archaïques qui font bouger les gens.
«Le grand problème de la science c’est que ce n’est pas une bonne conteuse. Ce sont les histoires qui motivent les gens à agir, pas les faits.
Quels sont les problèmes qui préoccupent les électeurs, aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde ? L’immigration est l’un des sujets qui arrivent en tête partout alors que beaucoup de gens nient le changement climatique. L’attrait pour l’immigration résulte d’un scénario biologique.
Un scénario selon lequel nous vivons dans une tribu et nous voyons quelqu’un d’une autre tribu arriver sur notre territoire. C’est quelque chose que les chimpanzés connaissent, tout comme les loups, les lapins …
Regardez ces lapins bizarres qui viennent manger notre herbe !.
Ils comprennent ça. C’est très profond. »Je redonne le lien vers cet entretien qui est beaucoup plus riche que les quelques éléments que j’en ai tirés pour ce mot du jour : « Un livre pour ma vie : Yuval Noah Harari »
-
Jeudi 1 mai 2025
« Même après 100 jours au pouvoir, ce n’est pas de sa faute. C’est Biden. »Propos de Donald Trump rapporté par Philippe CorbéPhilippe Corbé, nouveau directeur de l’information de France Inter, écrit depuis le retour de Trump à la présidence un billet bi-hebdomadaire réservé à ses abonnés, plein d’informations sur les Etats-Unis d’aujourd’hui.
Il a appelé cela « Zeitgeist » ce qui signifie en allemand « l’esprit du temps ». Il parait que c’est un terme couramment utilisé aux Etats-Unis. Dans son dernier opuscule qu’il a titré : « Le patriotisme des poupées ». Il montre l’Ubu de Washington dans toute sa suffisance et son mépris des faits. Il écrit :
« Même après 100 jours au pouvoir, ce n’est pas de sa faute. C’est Biden. »
Rappelons les faits : le département du Commerce a annoncé que le PIB a chuté à -0,3 % au premier trimestre, en rythme annualisé. Un net ralentissement par rapport au taux de + 2,4 % du quatrième trimestre, et bien pire que les + 0,8 % anticipés par les économistes. Selon les analystes c’est pire que prévu.
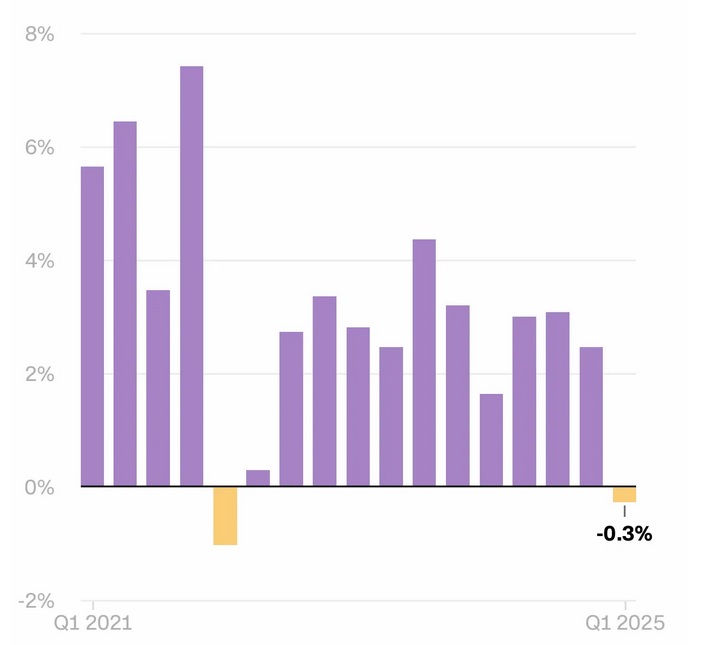 Un dessin valant mieux qu’un long discours, Corbé publie ce schéma qui montre l’évolution du PIB par trimestre depuis début 2021 qui correspond au début du mandat de Biden.
Un dessin valant mieux qu’un long discours, Corbé publie ce schéma qui montre l’évolution du PIB par trimestre depuis début 2021 qui correspond au début du mandat de Biden. Tout le monde s’accorde à expliquer que ce recul vient des investisseurs qui s’inquiètent du chaos tarifaire relancé par la Maison-Blanche, avec des droits de douane qui perturbent consommateurs et entreprises.
Quand ces chiffres ont été annoncés sur Fox Business, la chaîne de télévision que regarde Trump, ce dernier a posté :
« C’est la bourse de Biden, pas de Trump. Je n’ai pris mes fonctions que le 20 janvier. (…) »
Et il a continué en abusant des majuscules
« Notre pays va exploser (dans le bon sens), mais nous devons nous débarrasser du “poids mort” laissé par Biden. Cela prendra du temps, ÇA N’A RIEN À VOIR AVEC LES TARIFS DOUANIERS, seulement avec les mauvais chiffres qu’il nous a laissés. Mais quand le boom commencera, ce sera du jamais vu. SOYEZ PATIENTS !!! »
Lors d’une réunion de cabinet quelques heures plus tard, il a réaffirmé son accusation :
« Ça, c’est Biden, pas Trump. »
Et Philippe Corbé de rappeler que le 29 janvier 2024, près d’un an avant de revenir à la Maison-Blanche, alors que Wall Street affichait des résultats éclatants, le même menteur patenté écrivait :
« C’EST LA BOURSE DE TRUMP PARCE QUE MES SONDAGES CONTRE BIDEN SONT TELLEMENT BONS QUE LES INVESTISSEURS PRÉVOIENT QUE JE VAIS GAGNER, ET CELA FERA MONTER LE MARCHÉ. »
Les majuscules sont de Trump !
Il me semble qu’il est inutile de commenter, le verbatim Trumpien suffit à lui-même.
Pour le complément, Philippe Corbé raconte une interview de Trump avec un journaliste auquel il répond au milieu de l’échange, pour l’intimider :
« C’est moi qui vous ai choisi. C’est vous qui faites l’entretien. Je n’avais jamais entendu parler de vous. Mais vous n’êtes pas très sympa. ».
Lors du premier mandat de Trump, un journaliste a demandé : « Pourquoi certains Britanniques n’aiment pas Donald Trump ? » Nate White, un écrivain anglais a écrit cette réponse :
« Quelques choses me viennent à l’esprit :
Trump manque de certaines qualités que les Britanniques apprécient traditionnellement.
Par exemple, il n’a aucune classe, aucun charme, aucune fraîcheur, aucune crédibilité, aucune compassion, aucun esprit, aucune chaleur, aucune sagesse, aucune subtilité, aucune sensibilité, aucune conscience de soi, aucune humilité, aucun honneur et aucune grâce – autant de qualités, curieusement, dont son prédécesseur M. Obama a été généreusement doté.Pour nous, ce contraste frappant met en évidence les limites de Trump de manière embarrassante.
De plus, nous aimons rire.
Et même si Trump est peut-être ridicule, il n’a jamais dit quoi que ce soit d’ironique, d’amusant ou même de légèrement drôle – pas une seule fois, jamais.
Je ne dis pas cela de manière rhétorique, je le pense littéralement : jamais, jamais. Et ce fait est particulièrement dérangeant pour la sensibilité britannique : pour nous, manquer d’humour est presque inhumain.Mais avec Trump, c’est un fait. Il ne semble même pas comprendre ce qu’est une blague – pour lui, une blague est un commentaire grossier, une insulte illettrée, un acte de cruauté désinvolte.
Trump est un troll. Et comme tous les trolls, il n’est jamais drôle et ne rit jamais ; il se contente de pousser des cris de joie ou de railleries. Et ce qui est effrayant, c’est qu’il ne se contente pas de prononcer des insultes grossières et stupides : il pense réellement en les utilisant. Son esprit est un simple algorithme robotique composé de préjugés mesquins et de méchancetés instinctives.
 Il n’y a jamais de sous-couche d’ironie, de complexité, de nuance ou de profondeur. Tout est superficiel. Certains Américains pourraient considérer cela comme une approche rafraîchissante et directe. Eh bien, nous ne le pensons pas. Nous le considérons comme dépourvu de monde intérieur, d’âme.
Il n’y a jamais de sous-couche d’ironie, de complexité, de nuance ou de profondeur. Tout est superficiel. Certains Américains pourraient considérer cela comme une approche rafraîchissante et directe. Eh bien, nous ne le pensons pas. Nous le considérons comme dépourvu de monde intérieur, d’âme. En Grande-Bretagne, nous sommes traditionnellement du côté de David, et non de Goliath. Tous nos héros sont des outsiders courageux : Robin des Bois, Dick Whittington, Oliver Twist.
Trump n’est ni courageux, ni un outsider. Il est tout le contraire. […]
Dieu sait qu’il y a toujours eu des gens stupides dans le monde, et beaucoup de gens méchants aussi. Mais rarement la bêtise a été aussi méchante, et rarement la méchanceté aussi stupide.
Il fait paraître Nixon digne de confiance et George W. intelligent. »A la conclusion de tout cela, je crois que nous avons deux graves problèmes. Le premier est tout simplement tout le mal que fait Trump au monde, bien au delà de l’économie : à l’écologie et à l’avenir de l’humanité sur la terre, à la science, à la culture et à l’humanisme.
Le second est que la démocratie que nous vénérons a conduit à mettre ce type à la tête des États-Unis !
-
Jeudi 17 avril 2025
« Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh. »Une du journal Libération le 17 avril 1975, au moment de la prise de Phnom Penh par les Khmers rougesIl y a cinquante ans, le 17 avril 1975, de jeunes soldats Khmers rouges entrent dans la capitale du Cambodge : Phnom Penh.
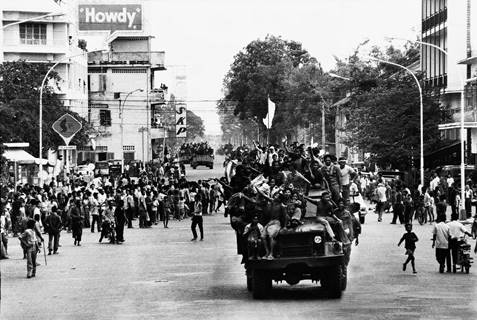 Ils ont eu cette victoire finale sans combat, les forces gouvernementales du maréchal Lon Nol se sont enfuis. Le maréchal Lon Nol avait renversé le roi Sihanouk, 5 ans auparavant avec l’aide des américains. Gangrené par la corruption, le régime est tombé comme un fruit mur, Lon Nol avait fui le pays dès le 1er avril.
Ils ont eu cette victoire finale sans combat, les forces gouvernementales du maréchal Lon Nol se sont enfuis. Le maréchal Lon Nol avait renversé le roi Sihanouk, 5 ans auparavant avec l’aide des américains. Gangrené par la corruption, le régime est tombé comme un fruit mur, Lon Nol avait fui le pays dès le 1er avril. En face il y avait les khmers rouges de Pol Pot, de Khieu Samphân, de Nuon Chea, de Ieng Sary. Le mot « khmer » désigne le groupe ethnique majoritaire (90 %) de la nation cambodgienne. Le surnom « Khmers rouges » (c’est-à-dire « Cambodgiens communistes ») leur a été attribué par Norodom Sihanouk vers la fin des années 1950.
Ce mouvement politique et militaire cambodgien, ultranationaliste et communiste radical est d’inspiration maoïste, soutenu par la Chine communiste. Ce régime, un des plus cruels de l’histoire de l’humanité tombera le 7 janvier 1979, après une défaite militaire contre l’armée du Viet Nam. Le Viet Nam est communiste, allié des soviétiques et ennemi de la Chine. En moins de 4 ans, près de 2 millions de cambodgiens périront, soit un quart de la population, à cause des mesures et de l’organisation mise en place par l’Angkar qui est nom que les Khmers rouges se sont donnés.
En 1975, une grande partie de la Gauche française s’est fourvoyée. Les vainqueurs étaient communistes, les vaincus étaient des suppôts de l’impérialisme américain, il n’en fallait pas davantage pour distinguer « le camp du bien » et « le camp du mal. »
Aujourd’hui, les journaux de droite, rappellent cet égarement. Le Figaro a publié « Quand la presse de gauche encensait les Khmers rouge », Le Point : « Les premiers jours, 2 millions de personnes ont été chassées » et l’Express interroge le cinéaste Rithy Panh qui a perdu sa famille dans le génocide : « A l’époque des Khmers rouges, la gauche française ne voulait pas savoir ».
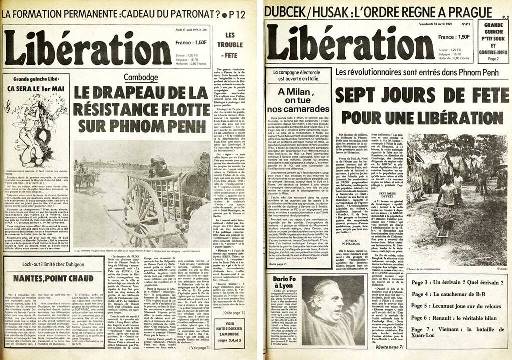 C’est le journal Libération qui était le plus enthousiaste en écrivant le 17 avril 1975 : « Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh. » Le correspondant du quotidien, Patrick Sabatier écrit :
C’est le journal Libération qui était le plus enthousiaste en écrivant le 17 avril 1975 : « Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh. » Le correspondant du quotidien, Patrick Sabatier écrit : « Phnom Penh est donc tombée “comme un fruit mûr”, sans combats violents. Le “bain de sang” prédit par certains, souhaité par d’autres, n’a pas eu lieu. Bien au contraire, la protection des civils est apparue comme la préoccupation principale des forces de libération. »
Le lendemain, le quotidien récidive, avec un titre encore plus ronflant : « Sept jours de fête pour une libération. » et le journaliste continue à encenser les vainqueurs :
« La libération de Phnom Penh aura été, plus qu’un succès militaire, une immense victoire politique pour le Funk (Front uni national du Kampuchéa, coalition anti-Lon Nol dont les Khmers rouges étaient la branche communiste »
Dans « Le Point » Jean-François Bouvet qui a écrit en 2018, le livre « Havre de guerre, Phnom Penh, Cambodge » (Fayard) reconnait que Patrick Sabatier finira par s’excuser de son aveuglement. Bouvet explicite ce a commencé immédiatement dans le Cambodge dirigé par l’Angkar :
« Avec leurs véhicules munis de haut-parleurs, [les khmers rouges] sillonnent la capitale en prétendant que les Américains vont la bombarder et qu’il faut l’évacuer pour trois jours. Imaginez : 700 000 habitants plus 1,3 million de réfugiés. C’est un piège. Dès les premiers jours, les Khmers rouges chassent ces 2 millions de personnes. Ils déportent dans les campagnes une population dont ils sont incapables d’assurer l’approvisionnement. D’où un exode hallucinant, même les blessés sont poussés le long des avenues sur leurs lits d’hôpital. Les villes moyennes subiront le même sort, car c’est la ville en tant que telle, berceau de tous les vices, qui doit être purgée. Le Cambodge va devenir pour trois ans, huit mois, vingt jours un gigantesque camp de travail à ciel ouvert.»
Dans le journal Le Monde, la une est plus factuelle : « Phnom Penh est tombée. ». Les commentaires à l’intérieur du journal ressemblent à celles de Libération :
« La ville est libérée […] L’enthousiasme populaire est évident. »
La veille de l’entrée des troupes communistes, un journaliste du Monde écrivait : :
« Une société nouvelle sera créée ; elle sera débarrassée de toutes les tares qui empêchent un rapide épanouissement : suppression des mœurs dépravantes, de la corruption, des trafics de toutes sortes, des contrebandes, des moyens d’exploitation inhumaine du peuple (…). Le Cambodge sera démocratique, toutes les libertés seront respectées. »
Et Jean Lacouture, dans Le Nouvel Obs, écrit :
« Peut-on dire qu’encerclée par les masses rurales la cité soit tombée “comme un fruit mûr” ? Mûr, Phnom Penh ? Ou abîmé, souillé, avarié par cinq années de guerre civile, d’interventions étrangères et d’intrigues menées par un quarteron d’aventuriers ? Ainsi le Cambodge entre-t-il, au son des roquettes et du canon, dans l’ère du socialisme. »
Je laisse le mot de la fin à un homme qui a vécu cette horreur : Rithy Panh qui s’exprime dans l’Express :
« A l’époque, j’étais dans les rizières, en train d’essayer de survivre. Je me souviens d’avoir vu quelques rares fois une traînée d’avion dans le ciel, et je me disais : « il va nous voir ! ». Après tout, l’homme avait déjà marché sur la lune… Je ne comprenais pas pourquoi personne n’entendait rien, ne disait rien.
Et puis un jour, on nous a dit que certains à l’étranger félicitaient le petit pays qui avait vaincu le régime soutenu par l’impérialiste américain.
La gauche française et mondiale ne voulait pas savoir. Pourtant, dès 1976-1977, des réfugiés cambodgiens témoignaient de ce qu’il se passait à la frontière thaïlandaise : il y avait quand même des informations qui arrivaient. Mais même après le départ des Khmers rouges, en 1979, lorsqu’on découvre l’ampleur des crimes, certains intellectuels continuent à défendre le régime, comme le philosophe français Alain Badiou, qui conclut ainsi sa tribune dans Le Monde, en janvier 1979 : « Kampuchéa vaincra ! ». Ou à relativiser ses crimes, comme le linguiste américain Noam Chomsky, qui se montre très ambigu. « On a pratiquement fini par tenir pour un dogme, en Occident, que le régime [des Khmers rouges] était l’incarnation même du mal, sans aucune qualité qui puisse le sauver », écrit-il en 1980 dans un texte cosigné avec Edward S. Herman.
Par la suite beaucoup de chercheurs de gauche qui étaient très favorables aux Khmers rouges lorsqu’il était au pouvoir ont changé d’avis. Mais, sur le moment, ils étaient enfermés dans leur aveuglement, par idéologie. Il s’est passé la même chose pour l’URSS de Staline, quand des poètes français comme Louis Aragon y allaient et ne se rendaient compte de rien, ou pour la révolution culturelle de Mao, qui a également fasciné la gauche française. » -
Vendredi 4 avril 2025
« S’il avait été un électeur américain, le capitaine Rocca – l’un des rares représentants du peuple présents au dîner – serait ressorti trumpiste du diner d’investiture de la fondation Obama. »Giuliano Da Empoli, « L’heure des prédateurs », page 88Les temps sont troubles, pour rester dans un langage modéré. Certains essayent de rassurer comme Frederic Encel : « Une troisième guerre mondiale est très improbable ».
Il vient de publier un livre qui défend cette thèse.L’Humanité a cependant d’autres défis à relever comme celui du réchauffement climatique, de la limite des ressources, du contrôle, de la maîtrise du développement de l’intelligence artificielle.
Mais désormais Donald Trump est à la tête des Etats-Unis. Nous pensions que ce serait compliqué, c’est bien pire. Il s’attaque à l’état de droit, aux juges, à la science, aux minorités, à tous ses alliés et au reste du monde aussi.
Voici venu « L’heure des prédateurs », titre du dernier livre de Giuliano da Empoli que je viens d’acheter et de commencer à lire.
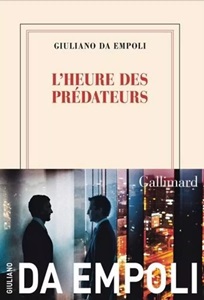 Dans le Figaro du 2 avril 2025 : « Incapable de réagir, la vieille élite a mérité d’être balayée. » il explique
Dans le Figaro du 2 avril 2025 : « Incapable de réagir, la vieille élite a mérité d’être balayée. » il explique
« La réélection de Trump a été une sorte d’apocalypse au sens littéral du terme : non pas la fin du monde mais la révélation de quelque chose. Le chaos, qui était jusqu’alors l’arme des insurgés, est devenu hégémonique. Et nous avons basculé dans le monde des prédateurs. Comme le disait Joseph de Maistre à propos de la Révolution française, « longtemps nous l’avons prise pour un événement. Nous étions dans l’erreur : c’est une époque. » »Joseph de Maistre (1753 – 1821) se trouvait dans une position inverse que celle dans laquelle nous sommes, nous qui voyons une révolution néo-réactionnaire se produire devant nous, alors que nous étions convaincu que même si le rythme se ralentissait parfois, nous étions dans une trajectoire inexorable de progrès des libertés, de l’émancipation et de la science.
Joseph de Maistre est un philosophie contre-révolutionnaire et un critique radical des idées des Lumières. Il considère que la Révolution française représente un crime contre l’ordre naturel. Il défend le retour à une monarchie absolue. Mais il a observé et analysé la révolution française comme un moment essentiel de l’Histoire européenne.
Nous vivons, selon Da Empoli, un moment machiavélien, terme inventé pour caractériser l’art de gouverner, selon Machiavel, développé dans son livre « Le Prince » et qui prenait exemple sur César Borgia.
Pour Da Empoli, le moment machiavélien est constitué dans l’Italie, à la toute fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle et s’est caractérisé par l’irruption de la force. À ce moment, la technologie offensive s’est développée plus vite que la technologie défensive : des canons à boulets en fonte de fer ont pu percer les murailles des petites républiques italiennes très civilisées de la Renaissance. A cette époque, la principale force prédatrice en Europe était la France. Et il décrit la situation contemporaine ainsi :
« Aujourd’hui, nous sommes à nouveau dans un moment où les technologies offensives se développent davantage que les technologies défensives.
À partir du numérique, lancer une cyberattaque ou une campagne de désinformation ne coûte presque rien, mais la difficulté de la défense est évidente ! Dès lors, nos petites républiques, nos grandes ou petites démocraties libérales risquent d’être balayées. […]
Nous sommes en train de vivre le choc de l’humiliation. C’est le choc d’une province romaine qui se réveille avec un nouvel empereur ; un pouvoir très différent, imprévisible et arbitraire lui tombe dessus, et elle se rend compte qu’elle n’était qu’une province. Cette humiliation est actée, et elle est là pour durer. »Mais comment expliquer le succès de Trump et de cette révolution néo réactionnaire ?.
Il y a certainement des raisons multiples. Cependant je voudrais partager aujourd’hui l’histoire que raconte Giuliano Da Empoli à partir de la page 85 de son dernier ouvrage.
Cette histoire se passe à Chicago en novembre 2017. Un an s’est écoulé depuis la première élection de Donald Trump. L’élection, comme le chaos qui s’en est suivi est sidérant, en Europe, le Brexit crée aussi désordre et inquiétude. Et ce jour à Chicago, Da Empoli a l’honneur d’assister au diner inaugural de la fondation de Barack Obama qui a quitté la présidence des Etats-Unis quand Trump s’en est emparé. Il cite un extrait du discours inaugural prononcé lors de ce diner
« Le potager de la Maison-Blanche était très puissant, car très symbolique. Faire pousser des aubergines et des courgettes et montrer des images de la première dame agenouillée dans la terre, entourée d’enfants, renvoyait un message très fort à la nation et au monde. »
Il explique qu’il a parcouru 7000 kilomètres pour être à ce diner parce qu’il pensait trouver sinon des réponses mais au moins des idées pour penser la suite, pour faire barrage à la vague illibérale qui menace de déferler sur l’occident.
Je pense, au moment de la lecture de ce récit, à la célèbre phrase de César amendée par René Goscinny : « Veni, vidi et je n’en crois pas mes yeux ! ».
 C’est l’ancien chef cuisinier de la Maison Blanche qui vantait ainsi les mérites du potager biologique de Michelle Obama. Après le cuisinier, un autre orateur s’approche de la scène. Un certain Michael Hebb. Da Empoli consulte immédiatement sa biographie en ligne et découvre qu’il fut le pionnier de la consommation réfléchie de chocolat en entreprise.
C’est l’ancien chef cuisinier de la Maison Blanche qui vantait ainsi les mérites du potager biologique de Michelle Obama. Après le cuisinier, un autre orateur s’approche de la scène. Un certain Michael Hebb. Da Empoli consulte immédiatement sa biographie en ligne et découvre qu’il fut le pionnier de la consommation réfléchie de chocolat en entreprise. Un peu ébranlé par le contenu des discours, il se tourne vers les autres convives de sa table espérant pouvoir engager des échanges sur des idées politiques pour l’avenir. Mais après l’apparition sur la table de brocolis bio, il va constater que les échanges vont être encadrés. Une jeune personne assise à la table prend la parole :
« «Bonsoir, je m’appelle Heather, je serai votre faciliteur de conversation ce soir. » A la suite de cette brève introduction, nous découvrons avec horreur que le format du dîner ne prévoit pas que les invités interagissent spontanément, mais plutôt une conversation dirigée par Heather, qui nous permettra de dépasser les politesses d’usage pour atteindre un niveau d’échange plus profond.
Dans ce but, les convives sont priés de répondre à 5 questions à tour de rôle. Pourquoi est ce que je m’appelle comme ça ? Qui sont les miens ? Qui m’a le plus influencé ? Qui aimerais je être. Dans quelle mesure ai-je le sentiment de faire partie de ma communauté. »Le centre des débats de cette soirée est donc un positionnement identitaire et la question de l’appartenance à une communauté. La conscience sociale et la réflexion sur la société dans son ensemble est ignorée, comme les défis de l’humanité. Heather commence selon les normes édictées et raconte son parcours de transgenre métis adoptée par une famille de Chicago. Pour expliquer son désarroi, Giuliano Da Empoli s’appuie sur un agent de sécurité :
« J’aperçois la mine déconfite du capitaine Rocca, l’agent de sécurité qui nous accompagne [les italiens] dans ce voyage. Au fil de la soirée, je verrai cet homme bâti comme un chêne, jovial, courageux,qui n’hésiterait pas à prendre une balle pour protéger l’un d’entre nous, rapetisser à vue d’œil, jusqu’à prendre l’apparence d’une brindille tremblante.
A la fin du diner […] il me relatera son calvaire. Après un premier moment de consternation, il a surmonté le choc initial et tout s’est plus ou moins bien passé, jusqu’au moment où il s’est risqué à répondre « moi même » à la question « qui voudrais tu être ? » Tout le monde lui est tombé dessus, le traitant de tous les noms, le faciliteur lui même n’ayant pu s’empêcher de le taxer d’égocentrisme»Da Empoli conclura qu’il a quitté Chicago avec le sentiment d’avoir rencontré de nombreuses personnes sympathiques et pleines de bonnes intentions, mais plutôt mal équipées pour mener à bien la bataille qui s’annonçait. Mais au préalable, il s’autorise ce cheminement de pensée :
« Je n’ai pas pu m’empêcher de penser que, s’il avait été un électeur américain, le capitaine Rocca – l’un des rares représentants du peuple présents au dîner – serait ressorti trumpiste du diner d’investiture de la fondation Obama. Et je crains qu’aucune des activités prévues pendant les 36 heures du sommet ne l’aurait fait changer d’avis : ni la méditation de 7 heures du matin, ni l’entretien avec le prince Harry sur la jeunesse comme vecteur de transformation sociale, ni le dialogue entre Michelle Obama et une poétesse à la mode à propos de ses sources d’inspiration. »
Nous savions que les démocrates étaient largement responsables de la victoire de Trump, ce récit nous permet de toucher de plus près le décalage abyssal qu’il y a entre leurs préoccupations et celles des gens simples. Da Empoli rappelle que l’une des publicités les plus percutantes de la campagne de réélection de Trump en 2024 jouait sur les pronoms non binaires : « Harris est pour iels ; Trump est pour vous. »
-
Lundi 17 mars 2025
« La raison d’être de l’Union européenne, c’est la défaite militaire. […] lors de guerres coloniales. »Timothy SnyderIl me semble nécessaire d’aborder le chaos actuel du monde avec une compréhension de l’Histoire, du long terme et une réflexion sur nos valeurs.
Sinon, nous agissons selon les seules impulsions de nos émotions, de nos peurs et aussi des récits, auxquels nous croyons, sans les interroger.
Pour la peur, j’ai été stupéfait dans l’émission « C ce soir » du 10 mars, l’écrivain et académicien Jean-Marie ROUART expliquer qu’à l’heure de la bombe atomique, on ne peut plus vouloir qu’un tel gagne et qu’en conséquence il était pour la paix, n’importe quelle paix !
Cet homme est donc prêt à se soumettre à la loi du plus fort, du plus injuste, le lâche soulagement en serait la récompense.
Dans ce mot du jour, je vais encore me référer à Timothy Snyder qui a répondu à un entretien dans le journal « LE UN » du 19 février 2025 : « Comment finir une guerre ? »Snyder remet en question le récit d’une Union européenne qui aurait été créée, après la fin de la seconde guerre mondiale, principalement, parce que les Etats européens voulaient établir définitivement la paix sur leur continent, après tant de massacres entre européens.
Mais à la question du journaliste « Avec la guerre en Ukraine, l’Union européenne a-t-elle échoué dans sa mission de maintenir la paix sur le continent ? », il répond ainsi :
« Est-ce seulement sa mission ? C’est du moins le mythe que l’on aime se raconter : les pays européens ont tiré les leçons de la Seconde Guerre mondiale et se sont organisés pour garantir la paix. »
Même si l’aspiration à la paix était compréhensible après les deux terribles guerres du XXème siècle, ce ne fut pas la raison principale, selon lui, de la volonté de créer la communauté européenne devenue l’Union européenne :
« Mais je pense qu’il faut commencer par rejeter ces prémisses, ce mythe fondateur. Si l’on veut penser l’Europe face à la guerre qui fait rage à ses portes, il nous faut être rigoureux sur la raison d’être historique de l’Union européenne.
Et cette raison d’être n’est pas la paix – sinon les pays européens n’auraient pas mené de guerres coloniales pendant les trente ans qui ont suivi l’armistice. Non, la raison d’être de l’Union européenne, c’est la défaite militaire. Plus particulièrement, la défaite militaire lors de guerres coloniales : l’Allemagne en 1945, mais aussi les Pays-Bas en 1948, la France en 1962, l’Espagne et le Portugal dans les années 1970… »En 1948, les Pays-Bas perdent leur colonie les Indes néerlandaises. En 1942, ils avaient du les abandonner aux Japonais. Après la défaite du Japon, les Pays-Bas tentent de reconquérir leur ancienne colonie, mais les nationalistes indonésiens revendiquent l’indépendance de l’archipel. Entre 1947 et 1948, les Pays-Bas lancent deux grandes interventions militaires. Mais les nationalistes tiennent bon et les Néerlandais, sous la pression des Nations unies et des États-Unis, doivent céder. La colonie devient la République des États-Unis d’Indonésie.
En 1962, la France perd l’Algérie.
Si on souhaite donner un peu de consistance à cette vision du passé colonial, on peut consulter une carte de l’empire colonial français avant la seconde guerre mondiale. La superficie de cet empire en 1939 représentait 12 800 000 km². En comparaison, les USA représente 9 833 517 km², ils ne sont dépassés que par le Canada guère plus grand et la Russie plus de 17 000 000 km².
En 1939, l’empire français représentait 8,61 % des terres émergées et 5,15% des habitants de la Planète. Aujourd’hui la France représente 0,45% des terres émergées et 0,84% de la population mondiale. C’est une autre échelle.
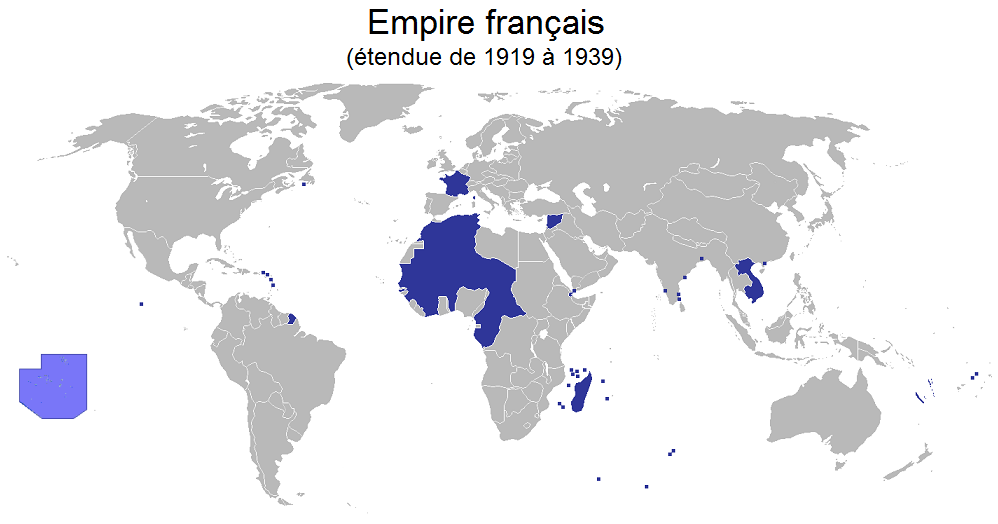
Pour compléter le destin des autres pays européens colonialistes, le Portugal avait conservé de son immense empire colonial, le Mozambique, l’Angola, la Guinée-Bissau et encore quelques autres territoires, comme le Cap Vert. Tous ces États deviendront indépendants après la révolution des œillets en 1974 et des guerres anti coloniales de libération.
En 1968, l’Espagne perdait ses dernières possessions subsahariennes et en 1976 le Sahara espagnol.Pour Snyder la défaite des nazis en 1945 est aussi une défaite coloniale puisque le troisième reich avait eu pour ambition de coloniser quasi toute l’Europe.
Il n’a pas cité la Belgique qui a perdu le Congo Belge en 1960.
Les nations européennes avaient dominé le monde depuis plusieurs siècles. Ils étaient des empires, ils deviennent des puissances moyennes dans un monde dominé par les USA et l’URSS.
On peut comprendre que le fait de s’unir, au moins économiquement, fut une réaction pour continuer à compter dans le monde. C’est au moins la thèse de Timothy Snyder.
« L’UE est une organisation post-impériale, qui réunit ces anciens empires défaits. On l’oublie volontiers, car ces défaites sont honteuses, tout comme les causes de ces guerres. C’est pourtant le fait d’avoir perdu ces guerres qui est au cœur du projet européen. Pour devenir des démocraties européennes contemporaines, des pays « normaux », il a été nécessaire que ces nations perdent leurs dernières guerres impériales. Si l’on garde cette idée en tête, si l’on remplace le concept de paix par celui de défaite, on comprend mieux pourquoi il est crucial que la Russie perde cette nouvelle guerre coloniale contre l’Ukraine »
La récente « Affaire Apathie » montre que la France a toujours du mal à comprendre et à reconnaître son passé colonial et tous les crimes qui ont été pratiqués en son nom. Or ce que Jean-Michel Aphatie a affirmé, le 25 février 2025, à savoir que la France a commis une centaine d’Oradour sur Glane en Algérie est factuellement vrai. Il a pourtant été sanctionné par la radio (RTL) dans laquelle il travaillait, pour avoir dit cette cette vérité.
Les grandes voix du journalisme ne se sont pas pressées pour le défendre. « Le Monde » a enfin, le 16 mars, commis un article expliquant que « Si l’on prend le point de vue des historiens, Aphatie a non seulement raison, mais il ne dit rien de bien révolutionnaire sur l’Algérie ».Voilà qui est dit sur le passé colonial de la France et les autres pays européens n’ont pas agi avec moins de violence. Mais certains esprits de gauche, n’ont pas l’air de comprendre que la relation entre l’immense Russie et la petite Ukraine est également basée sur une domination coloniale. Dans ce cas, simplement la colonie ne se trouve pas de l’autre coté de la mer ou de l’océan, mais jouxte la frontière du prédateur.
Timothy Snyder explique la guerre que mène la Russie à l’Ukraine de manière simple :« Les causes de cette guerre sont elles aussi incroyablement anciennes et traditionnelles : l’appropriation des ressources agricoles et des matières premières d’une part et, d’autre part le refus de considérer ceux qui se trouvent de l’autre côté de la frontière comme de véritables personnes et leur Etat comme un véritable Etat. C’est le discours colonialiste basique qu’ont aussi adopté les Européens en Afrique, en Asie, et partout dans le monde, mais qu’ils ont aujourd’hui bien du mal à reconnaître comme tel. »
Le titre de l’entretien de Snyder dans « LE UN » est « Comment l’Ukraine protège le monde ». Et, le journaliste Louis Héliot demande à l’Historien de quoi l’Ukraine nous protège, après que ce dernier ait utilisé cette formule dans une de ses réponse :
« D’une troisième guerre mondiale.
La Chine, l’Iran, la Corée du Nord sont déjà dans le conflit. SI la digue ukrainienne sautait les pays européens se retrouveraient immédiatement impliqués. […]
En se battant, les Ukrainiens ont non seulement repoussé l’agresseur russe, mais ils ont gardé ouvert, pour l’Europe, le champ des possibles. […] D’une certaine façon c’est inconfortable pour nous. Si les Ukrainiens avaient rendu les armes immédiatement comme Poutine l’escomptait, cela nous aurait été « plus facile » ; nous aurions continué à fermer les yeux ; nous aurions sans doute même été tentés de faire des concessions à Poutine de lui livrer – si l’on pousse la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale- l’équivalent de la Tchécoslovaquie, puis de la Pologne, Mais avec leur résistance, leur détermination, les Ukrainiens ont rendu impossible la stratégie d’apaisement.
Pour résumer, ils nous maintiennent en 1938. A nous maintenant de faire en sorte que l’on ne se précipite pas, la tête la première, vers 1939. »En conclusion de l’article, l’auteur de « Terres de sang » pense que la Russie doit aussi sortir de sa pensée Coloniale pour pouvoir passer à autre chose.
« Il ne nous reste rien d’autre à faire, désormais que d’aider à bâtir une Ukraine libre et fonctionnelle. Et sur le long terme, ce sera également bénéfique à la Russie. La défaite de cette dernière sera sa seule chance de passer à autre chose. »
Cette vision de Timothy Snyder me semble particulièrement féconde, alors que des esprits égarés continuent à tenter d’expliquer la situation par la politique agressive de l’OTAN. Si tant de pays de l’Est comme la Pologne ou les pays baltes ont voulu absolument rejoindre l’OTAN, c’est parce qu’ils avaient peur, à juste titre, de la soif coloniale du prédateur russe et non parce que l’OTAN avait la stratégie de s’étendre.
Le problème supplémentaire auquel nous sommes confrontés aujourd’hui, c’est que les Etats-Unis de Trump ont manifesté officiellement, au moins dans leurs propos, des velléités coloniales sur le Groenland, le Canada et Panama. Les USA n’expriment d’ailleurs aucun désaccord de fond avec la Russie sur ces points. -
Lundi 10 mars 2025
« Trump est un héros de la liberté négative »Timothy SnyderDans l’évolution inquiétante du monde, nous avons besoin d’esprits calmes, capables d’analyser ce qui se passe et de nous éclairer un peu la route sinueuse que nous sommes en train d’emprunter.
Timothy Snyder, historien américain de renom, né en 1969, spécialiste de l’histoire de l’Europe centrale et de l’Est et de la Shoah fait partie de ce cercle restreint. Il est professeur à l’université Yale et membre permanent de l’Institut des sciences humaines à Vienne.
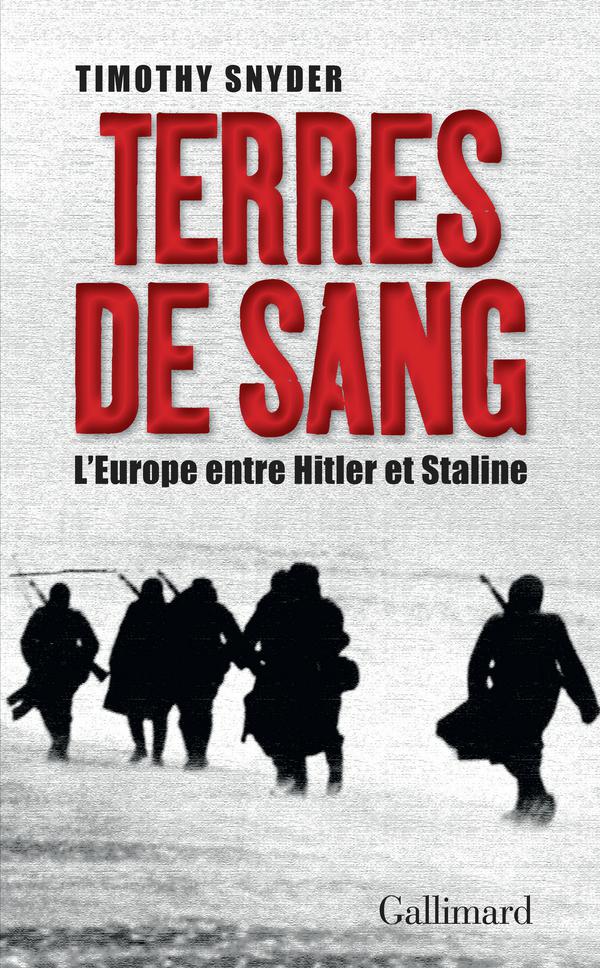 L’ouvrage qui l’a fait connaître en France est « Terres de sang » dans lequel il fait le récit du massacre de masse qui a été perpétré par l’Allemagne nazie et l’Union soviétique sur un territoire auquel il donne le nom de « Terres de sang » et qui s’étend de la Pologne centrale à la Russie occidentale en passant par l’Ukraine, la Biélorussie et les pays Baltes.
L’ouvrage qui l’a fait connaître en France est « Terres de sang » dans lequel il fait le récit du massacre de masse qui a été perpétré par l’Allemagne nazie et l’Union soviétique sur un territoire auquel il donne le nom de « Terres de sang » et qui s’étend de la Pologne centrale à la Russie occidentale en passant par l’Ukraine, la Biélorussie et les pays Baltes. Entre 1933 et 1945, 14 millions de civils, ont été tués. Plus de la moitié d’entre eux sont morts de faim. Les famines préméditées par Staline, principalement en Ukraine, au début des années 1930, ont fait plus de 4 millions de morts, et l’affamement par Hitler de quelque 3 millions et demi de prisonniers de guerre soviétiques, au début des années 1940 – ont été perpétrés ainsi.
Depuis cet ouvrage, il a focalisé ses réflexions sur les menaces pesant sur les systèmes politiques occidentaux.
Il a publié un premier ouvrage sur ce thème : « La route pour la servitude » paru en France en octobre 2023.
Et fin 2024, il a publié un second ouvrage « De la liberté »
Parmi les grands désaccords entre les Etats-Unis de Donald Trump, JR Vance et Elon Musk et la plupart des européens se trouvent la conception de la liberté. Le vice-président des Etats-Unis s’est autorisé lors de la conférence sur la sécurité de Munich de donner une leçon sur la liberté aux européens, en les accusant de ne plus respecter la liberté d’expression : « A Munich, la démocratie selon J. D. Vance sidère les Européens », si vous souhaitez lire la traduction française de l’intégralité du discours c’est « ici »
Lorsqu’on lit ce que l’administration Trump est en train de réaliser aux États-Unis, il me semble qu’on peut être surpris que ce soit eux qui parlent de liberté, peut être la liberté de mentir…
C’est pourquoi Thomas Snégaroff a invité Timothy Snyder dans son émission de France inter, du 8 mars 2025 pour évoquer ce sujet : « La liberté est difficile.»
Snégaroff interroge d’abord Snyder sur son analyse de la liberté prônée par Trump :
« Pour lui, il n’y a pas de différence entre la liberté du peuple et sa propre liberté.
La liberté négative c’est quand je ne pense qu’à moi. Et ma liberté c’est moi contre tous.
En fait pour être libre, il faut avoir une société, au sein de laquelle nous créons tous les conditions dans lesquelles nous pouvons devenir libre.
Donald Trump est un héros de la liberté négative, parce qu’il a hérité de sa fortune. Il peut dire que la liberté cela ne concerne que des gens comme lui.
Et, son administration est en train de détruire le gouvernement. »Dans son ouvrage Timothy Snyder oppose la liberté positive et la liberté négative.
Cette dichotomie a été inventée par Isaiah Berlin (1909-1997) un philosophe et historien des idées d’origine russe. Après une enfance passée à Saint-Pétersbourg, il a émigré avec ses parents en Angleterre, fuyant l’Union soviétique deux ans après la révolution bolchevique.
Sur le site du journal libéral « Contrepoints » vous trouverez une présentation de cette pensée : « Deux conceptions de la liberté, par Isaiah Berlin ».
 Pour Timothy Snyder, la liberté négative est celle qui nous permet de ne pas être opprimée par le gouvernement. C’est une première étape vers la liberté positive mais ce n’est qu’une première étape.
Pour Timothy Snyder, la liberté négative est celle qui nous permet de ne pas être opprimée par le gouvernement. C’est une première étape vers la liberté positive mais ce n’est qu’une première étape.Si on se contente de cette première étape la liberté ne s’adresse qu’aux forts, aux riches et aux puissants. Cette liberté n’est pas pour tout le monde et elle ne permet pas de faire société.
Pour Timothy Snyder la liberté positive s’appuie sur cinq piliers :
- souveraineté, c’est-à-dire cette capacité à construire sa propre liberté ;
- l’imprévisibilité, autrement dit le refus de se laisser enfermer dans les bulles idéologiques ou numériques et la capacité à ne pas agir comme les algorithmes le prévoient ;
- la mobilité, qu’elle soit sociale ou géographique ;
- la factualité, l’ouverture aux faits (« la science du réchauffement climatique est un exemple de vérité générale », cite Snyder à titre d’illustration. « Peut-être n’avons-nous pas envie d’en entendre parler, mais si nous l’ignorons, nous sommes moins libres ») ;
- la solidarité, qui nous amène à nous sentir responsables d’un certain équilibre social.
Thomas Snégaroff interroge l’historien sur ce qu’il pense du concept de liberté d’expression totale défendu par le vice-président US, ce qu’Elon Musk et ses semblables nomment « free speech » :
« Je pense que toute définition de liberté doit commencer par l’individu.
Lorsque les américains parlent de liberté d’expression, on a souvent à l’esprit les algorithmes et en pratique nous finissons par défendre la liberté des milliardaires qui possèdent déjà les plates formes des réseaux sociaux.
Mais si on commence par la tradition de liberté d’expression, à partir d’Euripide, nous nous souvenons que nous avons besoin de la liberté d’expression, parce qu’il est dangereux pour les faibles de dire la vérité aux forts. Donc la liberté d’expression doit commencer comme toutes les autres libertés, par les corps vulnérables et la vérité. Si on s’inquiète de la liberté d’expression, nous ne nous occupons pas seulement de protéger les faibles, nous essayons de créer les conditions où tout le monde peut avoir accès à la vérité. »Natacha Polony soumet à a son analyse la devise de la république française en y ajoutant la célèbre phrase prononcée par Saint Just le 3 mars 1794 : « Le bonheur est une idée neuve en Europe. »
« Le bonheur est l’élément central. Nous pouvons tous être heureux, mais de façon différente. Parce que nous donnons de la valeur à des choses différentes. […]
Le bonheur est une clé pour réfléchir à la liberté positive. Parce qu’on peut pense au bonheur de manière générale, mais cela nous oblige à penser à chaque individu de manière différente. Donc le bonheur nous mène à une notion de liberté positive.
La façon dont l’égalité et la fraternité fonctionnent ensemble avec la liberté est aussi positive. Je ne crois pas comme beaucoup d’américains le font qu’il y a une véritable tension.
Pour moi être libre, je dois écouter ce que vous dites à mon sujet.
Pour moi être libre, je dois me comprendre et je ne peux le faire sans fraternité. Si je ne crois pas que les autres sont mes frères ou mes sœurs, qu’ils sont fondamentalement comme moi, alors je ferais de grandes erreurs sur moi-même.
La fraternité ce n’est pas simplement une forme de gentillesse, c’est aussi une forme d’auto-compréhension. Et comme je l’ai déjà suggéré, c’est semblable à l’égalité. Sans l’égalité, nous n’avons pas les conditions nécessaires pour être libre. Je ne vois pas la liberté, l’égalité et la fraternité comme trois choses séparées.
C’est plutôt qu’on peut appliquer cette notion française d’égalité et de fraternité pour avoir une notion plus riche de liberté. »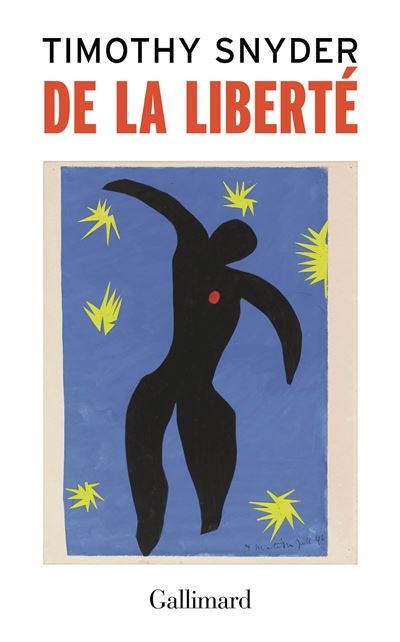 Snyder pense donc qu’on ne peut pas être pleinement libre, si les autres ne le sont pas. Mais il pense aussi que l’individu qui veut être libre doit non seulement s’intégrer dans la société dans laquelle il vit mais aussi s’inscrire dans l’Histoire.
Snyder pense donc qu’on ne peut pas être pleinement libre, si les autres ne le sont pas. Mais il pense aussi que l’individu qui veut être libre doit non seulement s’intégrer dans la société dans laquelle il vit mais aussi s’inscrire dans l’Histoire.« Je ne crois pas qu’on puisse faire de la liberté sans histoire. Je ne crois pas que la France puisse être une société de gens libres sans l’Histoire de France et sans l’Histoire du monde.
Je crois que c’est vrai en général. Une république ne peut avoir un avenir que si elle est reliée à son passé. Et cela ne signifie pas que nos passés soient parfaits. Cela signifie simplement que le passé fournit la seule voie vers l’avenir.
Et il en va de même avec les individus. Comme nous essayons d’envisager les avenirs individuels qui ont toujours un composant normatif ou éthique, nous ne pouvons le faire que par des valeurs que nous avons pris dans le passé. »
Il conclut l’entretien par cet avertissement
« La liberté est difficile. Toute personne qui dit que la liberté est simple, est probablement très riche et essaye de vous exploiter. »
Sur l’excellent site « Grand Continent » Snyder se soumet aussi à un entretien concernant son livre sur la liberté « Je suis frappé par les similitudes entre les milliardaires de la Silicon Valley et les bolcheviks les plus radicalisés ».Dans cet entretien il précise encore sa pensée :
« D’un point de vue philosophique ou psychologique, défendre la liberté négative revient à ne jamais se poser la question de ce que l’on défend, mais uniquement de ce à quoi l’on s’oppose. Sur le plan politique, cela se traduit souvent par une hostilité envers l’État, perçu comme la source principale de l’oppression.
On en vient alors à penser que réduire la taille de l’État accroît la liberté — ce qui est une erreur. La question n’est pas celle de la quantité, mais de la qualité : l’État contribue-t-il ou non à rendre les individus plus libres ? Il peut, certes, le faire en s’abstenant de les opprimer, mais aussi en leur fournissant des biens et services qu’ils ne peuvent obtenir par eux-mêmes, comme l’éducation, les infrastructures ou l’accès aux soins. »
Je redonne le lien vers l’émission de France Inter du 8 mars 2025 : « La liberté est difficile.»
-
Jeudi 6 mars 2025
« Nous étions en guerre contre un dictateur, nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître. »Claude Malhuret, sénateur de l’Allier, discours au Sénat du 4 mars 2025Ecouter un discours de Claude Malhuret constitue toujours un moment savoureux, tant cet homme sait trouver les mots pour décrire une situation, un évènement, le comportement d’un humain.
Souvent, je suis d’accord avec le point de vue de ce centriste qui a été deux ans secrétaire d’état aux droits de l’homme de 1986 à 1988, dans le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac. Il a été maire de Vichy de 1989 à 2017, il est toujours sénateur de l’Allier.
Médecin de formation il a été pendant 8 ans président de Médecin sans frontière à partir de 1978.
Initialement, il était marqué à gauche et même marxiste. Mais il a résolument quitté ce courant de pensée en 1977, au retour d’un voyage en Thaïlande.
Wikipedia nous apprend qu’en 1976 et 1977, en Thaïlande, il est coordinateur des équipes médicales de l’association Médecins sans frontières (MSF) dans les camps de réfugiés cambodgiens, laotiens et vietnamiens. « Nous nous étions misérablement fourvoyés », reconnaîtra-t-il plus tard au sujet du génocide cambodgien, perpétré de 1975 à 1979 par les Khmers rouges. C’est cette expérience qui l’éloignera des utopies radicales et de la Gauche qui prétend incarner « le bien ». En 2003, il publie un livre sur ce sujet : « Les Vices de la vertu ou la Fin de la gauche morale. ».
 Après l’épisode lamentable dans le bureau ovale de la Maison Blanche, pendant lequel Trump et son vice président ont insulté le Président Ukrainien Volodomyr Zelenski, Claude Malhuret a trempé sa plume dans l’acide et a offert au Sénat un discours d’anthologie :
Après l’épisode lamentable dans le bureau ovale de la Maison Blanche, pendant lequel Trump et son vice président ont insulté le Président Ukrainien Volodomyr Zelenski, Claude Malhuret a trempé sa plume dans l’acide et a offert au Sénat un discours d’anthologie : « L’Europe est à un tournant critique de son histoire. Le bouclier américain se dérobe, l’Ukraine risque d’être abandonnée, la Russie renforcée. Washington est devenu la cour de Néron. Un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l’épuration de la fonction publique. C’est un drame pour le monde libre, mais c’est d’abord un drame pour les États-Unis. »
« Un bouffon sous kétamine » désigne Elon Musk. Ce dernier, comme le rappelle « Ouest France », a admis consommer régulièrement de la kétamine, une drogue aux effets dissociatifs puissants, pouvant altérer la perception de la réalité et influencer la prise de décision.
« Le Point » donne des précisions sur la kétamine : « Cette molécule est une substance dérivée de la phencyclidine et produite chimiquement. Actuellement, elle est utilisée par les professionnels de santé comme anesthésique vétérinaire ainsi qu’en médecine humaine également dans le cadre des anesthésies générales. « Sous forme inhalée, ce produit est utilisé pour soulager un trouble dépressif et des idées suicidaires », complète le Pr Amine Benyamina, psychiatre, spécialisé en addictologie et à la tête du service de psychiatrie et d’addictologie de l’hôpital Paul-Brousse (AP-HP) à Villejuif (Val-de-Marne). La kétamine fait partie de la catégorie des hallucinogènes. Mais, elle est aussi détournée de son usage médical à des fins récréatives. « La kétamine peut être utilisée dans les milieux festifs. À doses modérées, elle provoque des hallucinations, un sentiment de détente et des effets sensoriels très importants », alerte l’addictologue. Les adeptes mettent également en avant des états dissociatifs avec une distorsion de la perception visuelle et corporelle. »
Certaines apparitions de Musk en public semble montrer, en effet, que cet homme se trouve dans un état de lucidité aléatoire.
« Le message de Trump est que rien ne sert d’être son allié puisqu’il en vous défendra pas, qu’il vous imposera plus de droits de douane qu’à ses ennemis et vous menacera de s’emparer de vos territoires tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent. Le roi du deal est en train de montrer ce qu’est l’art du deal à plat ventre. Il pense qu’il va intimider la Chine en se couchant devant Poutine, mais Xi Jinping, devant un tel naufrage, est sans doute en train d’accélérer les préparatifs de l’invasion de Taïwan. »
 Il est étonnant de constater que Trump s’attaque d’abord à ses alliés historiques qu’il ne respecte pas alors qu’il répète son respect pour les dictateurs ou autocrates comme Poutine et Xi Jinping. L’analyse du fonctionnement de la rhétorique Trumpiste, nous rapproche des règles mafieuses dans lesquelles le parrain exige la soumission à sa prédation contre une promesse, toujours révocable, de protection.
Il est étonnant de constater que Trump s’attaque d’abord à ses alliés historiques qu’il ne respecte pas alors qu’il répète son respect pour les dictateurs ou autocrates comme Poutine et Xi Jinping. L’analyse du fonctionnement de la rhétorique Trumpiste, nous rapproche des règles mafieuses dans lesquelles le parrain exige la soumission à sa prédation contre une promesse, toujours révocable, de protection.« Jamais dans l’histoire un président des États-Unis n’a capitulé devant l’ennemi. Jamais aucun n’a soutenu un agresseur contre un allié. Jamais aucun n’a piétiné la Constitution américaine, pris autant de décrets illégaux, révoqué les juges qui pourraient l’en empêcher, limogé d’un coup l’état-major militaire, affaibli tous les contre-pouvoirs et pris le contrôle des réseaux sociaux.
Ce n’est pas une dérive illibérale, c’est un début de confiscation de la démocratie. Rappelons-nous qu’il n’a fallu qu’un mois, trois semaines et deux jours pour mettre à bas la République de Weimar et sa constitution. »Claude Malhuret rappelle le précédent fâcheux de la République de Weimar qui en 1933 a permis l’accession des nazis au pouvoir en Allemagne grâce à la complicité des partis de droite et du centre. Arrivé au pouvoir par des processus institutionnels, il a fallu peu de temps à ce parti pour éliminer tous les contrepouvoirs et devenir une dictature. Pour l’instant, Trump est dans le processus de faire taire tous les contrepouvoirs aux Etats-Unis en commençant par la Justice, la Presse et aussi le monde Universitaire.
« J’ai confiance dans la solidité de la démocratie américaine et le pays proteste déjà. Mais, en un mois, Trump a fait plus de mal à l’Amérique qu’en quatre ans de sa dernière présidence. »
Il est certain que par rapport à son premier mandat, Trump est mieux préparé et mieux entouré pour mettre en œuvre sa politique autoritaire, violente et cherchant à réduire la démocratie à son seul pouvoir.
« Nous étions en guerre contre un dictateur, nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître. Il y a huit jours, au moment même où Trump passait la main dans le dos de Macron à la Maison-Blanche, les États-Unis votaient à l’ONU avec la Russie et la Corée du Nord contre les Européens réclamant le départ des troupes russes. Deux jours plus tard, dans le Bureau ovale, le planqué du service militaire donnait des leçons de morale et de stratégie au héros de guerre Zelensky, avant de le congédier comme un palefrenier en lui ordonnant de se soumettre ou de se démettre [applaudissements]. Cette nuit, il a franchi un pas de plus vers l’infamie en stoppant la livraison d’armes pourtant promises. »
Ce n’est pas la première fois que les Etats-Unis n’ont pas voté comme les européens à l’ONU, mais c’est la première fois qu’ils ont voté avec la Russie et la Corée du Nord. Claude Malhuret rappelle aussi que Donald Trump s’est fait exempté du service militaire pour de sombres raisons médicales. Enfin il semble clair à ce stade que ses positions et propositions sont davantage en faveur des thèses de Poutine que de l’intérêt de l’état souverain d’Ukraine agressé par son voisin et ayant une grande part de son territoire occupé et annexé.
« Que faire devant cette trahison ? La réponse est simple : faire face. Et d’abord ne pas se tromper. La défaite de l’Ukraine serait la défaite de l’Europe. Les pays baltes, la Géorgie, la Moldavie sont déjà sur la liste. Le but de Poutine est le retour à Yalta, où fut cédée la moitié du continent à Staline. Les pays du Sud attendent l’issue du conflit pour décider s’ils doivent continuer à respecter l’Europe ou s’ils sont désormais libres de la piétiner. Ce que veut Poutine, c’est la fin de l’ordre mis en place par les États-Unis et leurs alliés, il y a 80 ans, avec comme premier principe l’interdiction d’acquérir des territoires par la force. Cette idée est à la source même de l’ONU, où aujourd’hui les Américains votent en faveur de l’agresseur et contre l’agressé parce que la vision trumpienne coïncide avec celle de Poutine : un retour aux sphères d’influence, les grandes puissances dictant le sort des petits pays. “À moi le Groenland, le Panama et le Canada. À toi l’Ukraine, les pays baltes et l’Europe de l’Est, à lui Taiwan et la mer de Chine.” On appelle cela dans les soirées des oligarques du golfe de Mar-a- Lago le réalisme diplomatique. Nous sommes donc seuls. Mais le discours selon lequel on ne peut résister à Poutine est faux. »
Malhuret espère un sursaut de l’Europe. En sera t’elle capable ?
« Contrairement à la propagande du Kremlin, la Russie va mal. En trois ans, la soi-disante deuxième armée du monde n’a réussi à grapiller que des miettes d’un pays trois fois moins peuplé, les taux d’intérêt à 25%, l’effondrement des réserves de devises et d’or, l´’écroulement démographique montrent qu’elle est au bord du gouffre. Le coup de pouce américain à Poutine est la plus grande erreur stratégique commise lors d’une guerre. »
Stratégiquement Malhuret a probablement raison,
« Le choc est violent mais il a une vertu : les Européens sortent du déni. Ils ont compris en un jour à Munich que la survie de l’Ukraine et l’avenir de l’Europe sont entre leurs mains et qu’ils ont trois impératifs : accélérer l’aide militaire à l’Ukraine pour compenser le lâchage américain, pour qu’elle tienne et pour imposer sa présence et celle de l’Europe dans toute négociation. Cela coûtera cher, il faudra en terminer avec le tabou des avoirs russes gelés ; il faudra contourner les complices de Moscou à l’intérieur de l’Europe par une collaboration des seuls pays volontaires, avec bien sûr le Royaume Uni. En second lieu, exiger que tout accord soit accompagné du retour des enfants kidnappés, des prisonniers et des garanties de sécurité absolue. Après Budapest, la Georgie et Minsk, nous savons ce que valent les accords avec Poutine. Ces garanties passent par une force militaire suffisante pour empêcher une nouvelle invasion. »
Il faut surtout convaincre les peuples européens de cette nécessité. Il existe au sein de ces peuples de nombreuses tendances qui soit par lâcheté, soit par l’influence de lobbys pro-russe prétendent que la Russie ne constitue pas une menace pour l’Europe.
« Enfin, et c’est le plus urgent, parce que c’est ce qui prendra le plus de temps, il faut rebâtir la défense européenne négligée au profit du parapluie [nucléaire] américain depuis 1945 et sabordée depuis la chute du mur de Berlin. C’est une tâche herculéenne mais c’est sur sa réussite ou son échec que seront jugés dans les livres d’histoire les dirigeants de l’Europe démocratique d’aujourd’hui. Friedrich Merz vient de déclarer que l’Europe a besoin de sa propre alliance militaire. C’est reconnaître que la France avait raison depuis des décennies en plaidant pour une autonomie stratégique. Il reste à la construire. Il faudra investir massivement, renforcer le fonds européen de défense hors des critères d’endettement de Maastricht, harmoniser les systèmes d’armes et de munitions. »
Melenchon, Emmanuel Todd aussi, semblent craindre davantage le réarmement allemand que l’hostilité de l’impérialisme russe.
« Accélérer l’entraide de l’Union [europénne] á l’Ukraine qui est aujourd’hui la première armée européenne, repenser la place et les conditions de la dissuasion nucléaire à partir des capacités françaises et britanniques, relancer les programmes de bouclier anti-missiles et de satellites. Le plan annoncé hier par Ursula Von der Leyen est un très bon point de départ. Et il faudra beaucoup plus. L’Europe ne redeviendra une puissance militaire qu’en redevenant une puissance industrielle. En un mot, il faudra appliquer le rapport Draghi pour de bon. »
Redevenir une puissance industrielle, voilà la clé. Est-il réaliste d’y croire ? Est-il possible que les européens se mobilisent pour agir dans ce sens ?
« Mais le vrai réarmement de l’Europe, c’est son réarmement moral. Nous devons convaincre l’opinion face à la lassitude et à la peur de la guerre, et surtout face aux comparses de Poutine, l’extrême droite et l’extrême gauche. Ils ont encore plaidé hier à l’Assemblée nationale, monsieur le premier ministre devant vous, contre l’unité européenne, contre la défense européenne. Ils disent vouloir la paix. Ce que ni eux ni Trump ne disent, c’est que leur paix c’est la capitulation, la paix ou la défaite, le remplacement de “de Gaulle Zelinsky” par un Pétain ukrainien à la botte de Poutine, la paix des collabos qui ont refusé depuis trois ans toute aide aux Ukrainiens. Est-ce la fin de l’Alliance atlantique? Le risque est grand. »
Vouloir la paix tel est le slogan utilisé par l’extrême droite et par l’extrême gauche. Melenchon a l’air de croire qu’il suffit d’aller négocier avec Poutine et de faire appel à sa raison pour sortir avec un solide traité de paix permettant à l’Europe de vivre sereinement à côté de cet impérialisme autoritaire et militarisé. Je suis persuadé, pour ma part, que seul une puissance militaire forte peut négocier sérieusement avec des prédateurs comme Poutine et aussi comme Trump.
« Mais depuis quelques jours, l’humiliation publique de Zelinsky et toutes les décisions folles prises depuis un mois ont fini par faire réagir les Américains. Les sondages sont en chute, les élus républicains sont accueillis par des foules hostiles dans leurs circonscriptions, même FoxNews devient critique. Les trumpistes en sont plus en majesté, ils contrôlent l’exécutif, le Parlement, la Cour suprême et les réseaux sociaux. Mais dans l’histoire américaine, les partisans de la liberté ont toujours gagné : ils commencent à relever la tête. Le sort de l’Ukraine se joue dans les tranchées, mais il dépend aussi de ceux qui aux États-Unis, veulent défendre la démocratie, et ici de notre capacité à unir les Européens, à trouver les moyens de leur défense commune et à refaire de l’Europe la puissance qu’elle fut un jour dans l’Histoire et qu’elle hésite à redevenir. »
L’optimisme du sénateur de l’Allier est doux à entendre. Pour ma part, j’ai des doutes…
« Nos parents ont vaincu le fascisme et le communisme au prix de tous les sacrifices. La tâche de notre génération est de vaincre les totalitarismes du 21e siècle. Vive l’Ukraine libre ! Vive l’Europe démocratique ! »
Nous sommes au temps des prédateurs, il faut résister. Pour cela il faut disposer d’une force morale forte que je sens peu dans notre société. Ce discours restera un moment de lucidité et de combat dans un monde de mollesse et de lâche soulagement. « Le discours de Claude Malhuret »
-
Mardi 4 mars 2025
« L’atmosphère qui régnait dans le bureau ovale lors de cette conversation nous a rappelé les interrogatoires que nous avons subis aux mains des services de sécurité et les débats dans les tribunaux communistes. »Lech Walesa, lettre à Donald TrumpNous avons donc assisté le vendredi 28 février 2025 à un « bon moment de télévision » selon Donald Trump, alors qu’avec son vice président, J. D. Vance, ils venaient de harceler, devant les caméras, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui demandait juste un peu de considération et un appui pour garantir un futur cessez le feu avec la Russie de Poutine.
 Souvent le mot « humiliation » a été utilisé pour décrire cette scène. Je crois que ce mot est inapproprié.
Souvent le mot « humiliation » a été utilisé pour décrire cette scène. Je crois que ce mot est inapproprié. En effet, le dictionnaire Larousse donne comme définition de « humilier » :
« Atteindre quelqu’un dans son amour-propre, sa fierté, sa dignité, en cherchant à le déprécier dans l’esprit d’autrui ou à ses propres yeux »
Et complète cette description dans la version pronominale du verbe, à savoir, « s’humilier » :
« S’abaisser, avoir une attitude servile devant quelqu’un, quelque chose, par faiblesse, lâcheté, intérêt »
Le dictionnaire du CNRS donne la définition suivante pour « humilier » :
« Faire apparaître quelqu’un (dans tel ou tel de ses aspects) comme inférieur, méprisable, par des paroles ou des actes qui sont interprétés comme abaissant sa dignité. »
A aucun moment, je n’ai trouvé que le président ukrainien avait manqué de dignité. Il a fait front face à ces deux hommes qui le harcelaient de questions du type : « avez vous dit suffisamment merci ? » ou « vous voulez la troisième guerre mondiale ? ». Il a résisté à Trump, alors que beaucoup d’autres se couchent devant cet homme sans honneur.
Pour ma part, cette scène m’a fait plutôt penser à des films de mafieux, où Trump aurait joué le rôle du parrain et Vance son homme des basses œuvres : Il fallait se soumettre, dire merci au parrain et le payer pour obtenir sa protection.
 Mais Lech Walesa, le fondateur du mouvement Solidarność, président de la république de Pologne de 1990 à 1995, du haut de ses 81 ans, a écrit hier une lettre au président Trump dans laquelle il fait une autre comparaison. Il compare cette séquence à un interrogatoire des services secrets communistes. Lui les a subi par les services polonais et rappelons que Poutine fut officier du KGB. Mais Lech Walesa exprime d’abord son dégout :
Mais Lech Walesa, le fondateur du mouvement Solidarność, président de la république de Pologne de 1990 à 1995, du haut de ses 81 ans, a écrit hier une lettre au président Trump dans laquelle il fait une autre comparaison. Il compare cette séquence à un interrogatoire des services secrets communistes. Lui les a subi par les services polonais et rappelons que Poutine fut officier du KGB. Mais Lech Walesa exprime d’abord son dégout : « Nous avons regardé le compte rendu de votre conversation avec le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, avec crainte et dégoût.
Nous trouvons insultant que vous attendiez de l’Ukraine qu’elle fasse preuve de respect et de gratitude pour l’aide matérielle fournie par les États-Unis dans sa lutte contre la Russie.
La gratitude est due aux héroïques soldats ukrainiens qui ont versé leur sang pour défendre les valeurs du monde libre. Ils meurent sur le front depuis plus de 11 ans au nom de ces valeurs et de l’indépendance de leur patrie, attaquée par la Russie de Poutine.Nous ne comprenons pas comment le dirigeant d’un pays qui symbolise le monde libre ne peut pas le reconnaître. »
L’ancien syndicaliste polonais qui avait pu compter sur l’aide des USA de Ronald Reagan pour affronter les communistes polonais et leur tuteur soviétique russe, ne peut pas comprendre ce que l’Amérique est devenue sous la présidence du magnat de l’immobilier.
Il fait donc sa comparaison avec les services secrets communistes :
« Notre inquiétude a également été renforcée par l’atmosphère qui régnait dans le bureau ovale lors de cette conversation, qui nous a rappelé les interrogatoires que nous avons subis aux mains des services de sécurité et les débats dans les tribunaux communistes. Les procureurs et les juges, agissant au nom de la toute puissante police politique communiste, nous expliquaient qu’ils détenaient tous les pouvoirs et que nous n’en avions aucun. Ils exigeaient que nous cessions nos activités, arguant que des milliers d’innocents souffraient à cause de nous. Ils nous ont privés de nos libertés et de nos droits civiques parce que nous refusions de coopérer avec le gouvernement ou d’exprimer notre gratitude pour notre oppression.
Nous sommes choqués que le président Volodymyr Zelensky ait été traité de la même manière. »Par la suite, il explique sa vision historique du rôle des Etats-Unis. Vous pourrez lire cette lettre et sa traduction derrière ce « lien ». Je trouve son analyse très pertinente. Vous trouverez la vidéo de ce triste épisode de l’histoire américaine « ici ». Et je finirai par le jugement sans appel du journaliste franco-suisse, Richard Werly, dans une émission de France Télévision :
« Ce Donald Trump est vraiment un sale type !»
-
Vendredi 17 janvier 2025
« L’avenir de tout ce que nous avons de meilleur est en train de se jouer en ce moment même, et la partie semble très mal engagée. »Jean-PIerre Bourlanges en analysant l’attaque en règle que Trump et Musk lancent contre les valeurs, les intérêts et la souveraineté des européensJe voudrais conclure cette série sur Elon Musk qu’aujourd’hui on ne peut plus dissocier du couple disruptif qu’il forme avec Trump.
Pouviez-vous imaginer, un candidat à la présidence d’un grand Etat occidental qui en plein meeting déclare ?
« Je suis favorable aux automobiles électriques. Je n’ai pas le choix car vous le savez, Elon Musk vient de m’apporter son soutien »
C’était Trump en Géorgie, le 4 août 2024. Quatre jours avant le 31 juillet, le même candidat affirmait être « contre tous ceux qui possèdent une voiture électrique » et rappelait qu’il mettrait immédiatement fin aux mesures d’aides à l’achat de ces autos en cas de victoire.
Le fait qu’un candidat épouse la stratégie d’un lobbyiste qui le finance n’est pas nouveau.
Mais le fait qu’il le révèle ouvertement, ça c’est du jamais vu. Trump dit : je suis contre mais je suis payé par Musk, donc je suis pour !Je pourrais continuer à énumérer les « dingueries » d’Elon Musk.
Je viens de lire que l’entrepreneur a affirmé que sa société Boring Company était en mesure de réaliser un tunnel de 4 800 km, sous l’Océan Atlantique, reliant les Etats-Unis et le Royaume Uni. Rappelons que le tunnel sous la Manche mesure 37 km.
Ce projet a été imaginé par d’autres, mais personne ne le pensait réalisable. Certains avaient estimé son coût à 20 000 milliards de dollars. Lui pense que sa société grâce à des technologies révolutionnaires pourrait le réaliser pour 20 milliards de dollar. Autant dire, presque rien : la Cour des comptes estime le coût total de l’ EPR de Flamanville à 23,7 milliards d’euros
Je préfère finir en abordant deux points.
Le premier est d’essayer de comprendre cette volonté de diminuer le rôle de l’Etat et des services publics. Nous avons appris que non seulement les hyper-riches de Californie accaparaient l’eau pour leurs besoins propres, eau qui manquait aux pompiers pour lutter contre les feux. Mais ils font mieux : ils emploient des pompiers privés.
Le Prix Nobel d’Economie, Joseph Stiglitz, analyse cela précisément dans un article du Figaro :
« Quand il y a trop d’inégalités – c’était l’objet de mon livre précédent – les plus riches ne dépendent plus des services publics. À l’époque, je vous avoue que je n’avais pas pensé aux pompiers privés ! Les plus fortunés usent de leur influence sur le système d’information – les médias – et sur l’économie pour encourager à réduire les dépenses sur les services publics dont ils n’ont pas besoin. Et c’est ainsi, de fil en aiguille, que dans la première puissance économique mondiale, on arrive à avoir une des espérances de vie les plus faibles parmi les pays riches, avec de très fortes inégalités. L’un des droits de l’Homme les plus fondamentaux, le droit de vivre, a régressé aux États-Unis. »
Emmanuel Todd ne cesse de répéter que désormais l’espérance de vie moyenne en Russie est supérieure à celle des Etats-Unis.
On pourrait se demander : mais comment Elon Musk pensent-ils pouvoir supprimer autant d’emplois publics ?
La réponse est qu’il pense qu’on peut remplacer la plupart d’entre eux, ceux qui gardent une utilité dans son esprit, par de l’intelligence artificielle. C’est ce que raconte dans « Le nouvel esprit public du 12 janvier », Richard Werly, journaliste et essayiste franco-suisse, qui a fait un long tour des Etats-Unis pendant la campagne électorale de 2024 :
« Et le pire dans tout cela, c’est que cela va donner des résultats. Le cynisme absolu, l’autoritarisme et le talent médiatique de l’un, combiné aux ressources et à la créativité de l’autre, vont forcément produire des résultats.
On se demande comment tout cela pourrait tenir, après les coupes énormes prévues.
Grâce à l’intelligence artificielle. Une fois que le ménage est fait, on remplace tous ces hauts fonctionnaires par des robots. Cela a l’air délirant, mais j’ai entendu tout cela. C’est ainsi qu’on entend gérer l’Amérique, qui restera de toute façon la meilleure, dans la mesure où on aura cassé les rotules de tous les concurrents gênants. »Dans Libération, le 15 janvier 2025, Sylvie Laurent, historienne et américaniste française explique que les dirigeants de la tech qui peuplent aujourd’hui l’administration Trump sont les représentants d’un projet singulier, stade ultime de la fusion entre l’Etat et le capital : « Comment les Etats-Unis sont entrés dans l’ère techno-réactionnaire »
.
Elle montre que plusieurs d’entre eux sont issus ou ont vécus dans l’Afrique du sud de l’apartheid outre Elon Musk, Peter Thiel et David Sacks sont dans ce cas. C’est ainsi qu’elle pense qu’ils sont dans une défense de la minorité blanche. Elle écrit :
« L’oligarchie est génétique. »
Elle prétend que le natalisme de Musk est une réaction à la peur du déclin démographique de l’Occident, l’obsession de Musk. Inspirés par les idéologues qu’elle cite, Sylvie Laurent termine son article par cette description :
« Toute l’idéologie du monde, et elle est solide chez les techno- réactionnaires, n’est jamais que l’idéologie de la classe à laquelle ils appartiennent. Les grandes effusions entre ces capitalistes de la tech, Trump et l’Etat américain n’ont qu’un objectif : obtenir la valorisation de leurs intérêts fiscaux et économiques, fusse en siphonnant les budgets publics, de la recherche et du Pentagone, mais aussi en s’imposant comme seuls prestataires de missions de service public : remplacer la Federal Reserve et le dollar par les cryptomonnaies, les agences de santé par le transhumanisme, les écoles publiques par des formations en ligne et autres mooks, les trains à grande vitesse par des Tesla ou des Hyperloop, la fibre par des accès au réseau Starlink. »
Le second point c’est l’attaque en règle de Musk et de Trump contre ses alliés et notamment contre l’Europe. Non seulement ils s’attaquent à nos valeurs mais ils s’attaquent aussi à nos intérêts. Dans le Nouvel Esprit Public, précité Jean-Pierre Bourlanges décrit la situation :
« On s’est demandé pendant quelques mois si l’élection de Trump se traduirait par une baisse de la protection américaine de l’Europe, mais nous n’avions jamais envisagé que ce serait lui qui nous ferait la guerre. Or objectivement, c’est ce qui est en train d’arriver avec les menaces sur le Groenland […] Ne nous leurrons pas : la situation est réellement hallucinante. Ce qui est en train de se passer est un choc de première grandeur pour le monde, pour l’Europe, et pour la France. C’est la ploutocratie absolue qui règne désormais. Le conflit d’intérêt n’est plus une anomalie ou une exception, il est devenu le moteur de la constitution de l‘équipe de Donald Trump. »
« Sommes-nous prêts ? » est la question qu’a posée « C Politique » du 12 janvier. Les invités très intéressants de cette émission David Djaïz, Asma Mhalla et Céline Spector sont assez peu confiants dans la capacité européenne de répondre au défi.
Ce que l’on peut constater, c’est que l’Europe est désunie. Meloni cherche à s’attirer les bonnes grâces d’Elon Musk qui accepte bien volontiers ses avances dans la mesure où des contrats lui sont promis. Orban est ouvertement l’allié de Trump. Et l’Allemagne si dépendante des Etats-Unis pour sa protection et ses exportations n’aura qu’une idée : ne pas contrarier le duo Musk Trump.
Dans le « Nouvel Esprit Public » Nicolas Baverez explique cela très bien :
« Il n’y a pas si longtemps, l’adversaire désigné était la Chine, mais pour le moment, toutes les cibles des Etats-Unis sont des pays alliés, même les plus proches (Royaume-Uni et Canada). Cette structure intellectuelle est celle de Vladimir Poutine : Trump est en train de nous expliquer qu’il y a un étranger proche des USA (Canada, Panama, Groenland) auquel personne n’a le droit de toucher, et dont on va s’assurer le contrôle. C’est un raisonnement de sphère d’influence, qui n’exclut pas le recours à la force. Il n’y a donc plus de respect de la souveraineté nationale, ni des frontières, c’est le monde de Poutine, de Xi, d’Erdogan. […] Olaf Scholz se fait insulter sans même répondre, Keir Starmer panique, et Kaja Kallas se contente de rappeler que « les Etats-Unis restent l’allié privilégié de l’Europe ». Et parallèlement aux tentatives de division, le duo met sur un piédestal Mme Meloni.
C’est une grande leçon pour l’Europe. L’idée de l’UE, selon laquelle elle va réguler l’IA et le numérique alors qu’elle n’a aucun acteur dans ces secteurs, qu’elle va prendre le leadership de la transition écologique alors qu’elle n’a aucun acteur industriel est une chimère complète. Comment réguler des secteurs dans lesquels on n’a aucun poids ? Sans compter la dépendance européenne en matière de Défense. Les Etats-Unis de MM. Trump et Musk vont nous faire payer tout cela au prix fort. »Jean-Pierre Bourlanges voudrait trouver un Churchill, mais n’en trouve aucun :
« Car nous sommes dans la même situation que Churchill dans son discours passé à la postérité, celui de la « plus belle heure » du Royaume-Uni (« the finest hour »), où il dit que les Britanniques sont les seuls à défendre la civilisation, tout ce en quoi nous croyons, qu’ils doivent mener le combat le plus décisif, à l’enjeu le plus élevé, seuls. Et Churchill dans un formidable élan d’optimisme prophétique, déclare que cette heure la plus sombre est aussi la plus belle. L’Europe est dans la même situation.
Mais est-ce que les Européens sont capables d’un tel sursaut ? […]
Nous sommes dans la situation décrite par Churchill ; l’avenir de tout ce que nous avons de meilleur est en train de se jouer en ce moment même, et la partie semble très mal engagée. »Notre problème est double d’abord nous sommes tellement dépendants à l’égard des américains : de leur technologie, de leur protection militaire, de leur système financier, de notre incapacité à répondre à la puissance de l’extraterritorialité de leur justice.
Ensuite, si nous voulions vraiment défendre nos valeurs et nos intérêts ,il faudrait aussi que l’immense majorité des européens soient des citoyens avant d’être des consommateurs. Car notre confort de consommateur à court terme a beaucoup à perdre, si nous voulions vraiment défendre notre citoyenneté. Mais en agissant ainsi, à moyen terme nous perdrons les deux : notre confort de consommateur et nos valeurs citoyennes.
-
Jeudi 16 janvier 2025
« Vous êtes les médias, maintenant ! »Tweet d’Elon Musk sur X, le lendemain de l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-UnisLe quatrième épisode que France Culture lui consacre a pour titre « Elon Musk, l’homme le plus puissant d’Amérique ? ».
Et voilà qu’en 2022, Elon Musk achète « Twitter » pour 43 milliards de dollars. C’est une entreprise peu rentable. Ce n’est pas pour l’argent qu’il va acheter ce réseau social.
François Saltiel :
« C’est vraiment l’achat de Twitter qui va le plonger dans l’arène idéologique et politique. Il va adhérer à Donald Trump car c’est lui qui est le mieux placé pour propulser ses idées. »
Elon Musk n’a pas le désir de devenir Président des Etats-Unis, nonobstant le fait qu’il ne peut pas se présenter à l’élection présidentielle parce que seul les états-uniens de naissance disposent de ce droit.
François Saltiel insiste sur le fait que même s’il le pouvait, il ne le souhaiterait pas parce que les libertariens ne considèrent pas que le président est l’homme qui a le plus de pouvoir.
François Saltiel cite Peter Thiel qui est un grand joueur d’échec :
« L’équivalent sur l’échiquier du président des Etats-Unis c’est le Roi.
Le Roi n’a pas beaucoup de capacité. Il se déplace comme un pion. C’est la pièce qui a certes le plus grand pouvoir symbolique, mais la plus vulnérable.
Qui protège le Roi ?
La Dame et le Fou, ça ce sont les pièces qui comptent.
Ce sont les rôles que veulent avoir Elon Musk et Peter Thiel. Le Roi ils n’ont pas envie de l’être : avoir la couronne mais ne pas avoir la puissance. Musk se rapproche de Trump, mais il ne veut pas être à sa place. Il veut continuer à développer ses entreprises, continuer à se servir de Donald Trump pour véhiculer ses idées. »Dans cet épisode, on entend Elon Musk répondre à une interview, sur France 2, en juin 2023 :
« Vous êtes reçu comme un chef d’État, y compris par le Président chinois. Est-ce que vous voudriez être Président des Etats-Unis ?
Non je n’ai pas envie !Pourquoi ?
Vous savez les gens imaginent quelquefois que le Président des Etats-Unis est dans un poste extrêmement puissant. Alors, oui d’une certaine façon, bien sûr. Mais la constitution américaine est telle que le Président est dans une position très limitée, en fait.
Président c’est un peu comme être le capitaine d’un très grand bateau, avec une toute petite rame, ou un petit gouvernail. [gros rire] Vous êtes accusé de tout et vous ne pouvez rien faire.Vous êtes en train de dire que vous êtes plus puissant que le Président des Etats-Unis ?
Alors disons que je ne peux pas déclarer la guerre ! »Elon Musk a reconnu avoir voté démocrate pendant longtemps. Parmi les libertariens de la Silicon Valley, seul Peter Thiel avait osé, dès 2016, soutenir Donald Trump.
Mais Musk va changer de camp.Il se lance, selon lui, dans un combat pour la liberté d’expression. C’est semble t’il son argument principal pour le rachat de twitter.
Elon Musk :
« Il est important que les gens aient le sentiment de s’exprimer librement. Et que ce soit une réalité. »
Mais un autre combat ; idéologique, va le motiver : un rejet profond du progressisme et du « wokisme », mouvement qu’il associe à une menace personnelle et sociale.
Elon Musk a eu 12 enfants. C’est un nataliste, il croit que la baisse de natalité conduirait à un effondrement de la civilisation.
En 2022, son ainé décide de changer de genre, il décide de devenir une femme. Constatons que 2022 est aussi la date d’achat de twitter par Musk.
Elon Musk n’accepte pas cette transition, il se lamente dans les médias :
« Le wokisme a tué mon enfant ».
 Il déclare renier son enfant. Le fils devenu fille décide de prendre le nom de sa mère et de s’appeler désormais : Vivian Jenna Wilson. Elle décidera aussi, le lendemain de l’élection de Donald Trump de quitter les Etats-Unis.
Il déclare renier son enfant. Le fils devenu fille décide de prendre le nom de sa mère et de s’appeler désormais : Vivian Jenna Wilson. Elle décidera aussi, le lendemain de l’élection de Donald Trump de quitter les Etats-Unis. Elle explique :
« Je ne vois pas mon avenir aux États-Unis […] La journée d’hier (de l’élection) me l’a confirmé. Même si Donald Trump ne reste au pouvoir que quatre ans, même si les réglementations anti-trans ne sont pas appliquées comme par magie, les gens qui ont voté pour lui ne vont pas s’en aller de sitôt. ».
Le père et la fille s’invectivent sur les médias sociaux, la fille traite Musk de « père absent », « froid », « cruel », et « narcissique ».
L’achat de Twitter était certainement programmé avant, mais cet épisode de la vie d’Elon Musk va le conduire à un tournant idéologique dans son utilisation d’X, non seulement comme outil de communication, mais aussi comme plateforme de lutte culturelle et politique. Depuis son acquisition par Elon Musk, X incarne une vision radicale de la liberté d’expression au détriment de la véracité des faits et de la modération. Cette plateforme devient un levier de polarisation et de désinformation.
François Saltiel explique :
« En réduisant la modération, il cultive ce en quoi il croit, la liberté d’expression à tout crin, provoquant une forme de chaos informationnel où tout le monde, en échange de paiement, pouvait s’offrir de la visibilité. »
En s’emparant de X il va réintégrer de nombreux comptes qui ont été exclus, notamment celui de Trump, il va supprimer la modération, virer une grande partie du personnel et le remplacer par des collaborateurs à ses ordres.
Il va utiliser X comme instrument de propagande au profit de Trump.
Guillaume Erner raconte qu’il a envoyé un message aux utilisateurs arabes pour leur dire que Kamala Harris va favoriser Israël et un message aux utilisateurs juifs disant que Kamala Harris mènera une politique favorable aux Hamas. Il ne recule devant aucun mensonge.
Au lendemain de la victoire de Trump, Elon Musk a simplement publié sur X :
« Vous êtes les médias, maintenant. »
« Le Monde » analyse :
« Vous êtes les médias, maintenant. » Ce tweet d’Elon Musk, publié le 6 novembre et vu plus de 105 millions de fois, n’a pas seulement mis en lumière la croisade que mène l’homme le plus riche du monde contre les médias traditionnels.
Il marque sans doute l’entrée dans un nouveau régime informationnel, dominé par les médias sociaux, dont le modèle économique est indifférent à la qualité et à la véracité de l’information qu’ils propagent.
A bien des égards, Elon Musk incarne mieux que personne la nouvelle dynamique entre influenceurs, algorithmes et foules numériques, décrite par Renée DiResta dans Invisible Rulers (« dirigeants invisibles », PublicAffairs, 2024, non traduit) et qui constitue le creuset d’une part croissante de l’information parvenant sur nos écrans, au détriment de celle qui émane des médias traditionnels. »Guillaume Erner et François Saltiel insistent aussi sur le caractère eugéniste d’Elon Musk et sa défiance à l’égard de la démocratie :
« A la fin, seuls les plus intelligents vaincrons. A la fin ce que veut réaliser Elon Musk c’est de saper la démocratie. Il ne croit pas en la démocratie. Il croit en une élite qui va arriver au pouvoir et qui saura mieux que les autres ce qui est bon pour l’humanité, le bas peuple.
C’est pour cela aussi qu’il fait 11 enfants (un est mort en bas âge) parce qu’il estime qu’il a un QI extraordinaire et qu’il faut qu’il puisse se reproduire. »
Lors du mot du jour consacré à la victoire de Donald Trump, j’avais cité Peter Thiel qui était encore plus explicite :
« Je ne crois plus désormais que la liberté et la démocratie sont compatibles. […] Les années 1920 furent la dernière décennie dans l’histoire américaine où l’on pouvait être parfaitement optimiste à propos de la politique. Depuis 1920, l’augmentation considérable des bénéficiaires de l’aide sociale et l’extension du droit de vote aux femmes – deux coups notoirement durs pour les libertariens – ont fait de la notion de « démocratie capitaliste » un oxymore. »
François Saltiel conclut :
« Nous avons mis finalement le destin de la démocratie américaine dans les mains d’un entrepreneur un peu fou, un peu dingue, un peu génial, un peu maléfique, qui rigole et qui prend les choses avec dérision. Sa posture, mêlant humour noir et stratégies de domination, déstabilise les valeurs traditionnelles des démocraties occidentales. »
Régis Debray avait expliqué que là où l’Etat recule, et c’est le combat que poursuivent Musk, Thiel et les autres, ce sont les mafias et les religieux qui prennent la place…
Que ces transhumanistes réactionnaires constituent une sorte de mafia, relève de l’évidence, leurs croyances et leurs visions messianiques rappellent par leur fanatisme, le pire des religions.
Peut-être comme le prédisent certains, tous ces males alpha ne pourront pas s’empêcher de se battre pour qu’il n’en subsiste plus qu’un et que dans ces disputes, ils se neutralisent.
C’est un espoir fragile, mais possible.
-
Mercredi 15 janvier 2025
« Beaucoup de choses sont improbables, seules quelques-unes sont impossibles ! »Elon Musk
En 2002, Elon Musk et Peter Thiel vendent « Paypal » à « E Bay » pour une somme de 1,5 milliards de dollars. Lors de cet vente les relations entre les deux hommes vont se détériorer.Ne perdant pas de temps, cette même année 2002, Musk fonde « SpaceX », un fabricant aérospatial et une société de services de transport spatial. Il en est le PDG.
Le troisième épisode que France Culture lui consacre a pour titre : « De Tesla à Starlink, un serial entrepreneur dans la Silicon Valley »
Cet épisode raconte ce qui se passe deux ans plus tard.
Elon Musk va investir 6,5 millions de dollars dans une modeste entreprise appelée « Tesla » et qui avait été fondée, un an auparavant, par deux passionnés d’énergie durable : Martin Eberhard et Marc Tarpenning.
Pour cette petite société, l’investissement de Musk est énorme, pour ce dernier il ne s’agit que d’une fraction de sa fortune.
Elon Musk va par ses idées révolutionnaires et un marketing forcené rendre cette marque mondialement célèbre.
Il s’agit bien sûr d’un groupe d’informaticiens qui vont créer une voiture technologique qui allie le physique : le châssis, le moteur électrique et le logiciel.
Les constructeurs automobiles, comme Général Motors, ne voient rien venir, ne comprennent pas cette concurrence qui ne vient pas de leur monde.
C’est exactement la même erreur que les grands distributeurs, qui venaient du monde de l’épicerie, ont commis à l’égard d’Amazon de Jeff Bezos qui est la création de logisticiens totalement insérés dans le monde informatique.
Au début Tesla travaille sur un modèle appelé « Roadster » qui est basé sur le châssis de la « Lotus Ellise » qui était une voiture de sport assez peu utilisable pour la route.

Sa batterie au lithium-ion donne au Tesla Roadster une autonomie de 370 km. Elle se recharge en cinq heures. Elle est vendue aux environs de 84 000 euros et Tesla a vendu environ 2 450 Roadsters dans plus de 30 pays (source Wikipedia)
Les débuts sont difficiles…
Elon Musk (PDG de Tesla et SpaceX) décide d’envoyer un Tesla Roadster dans l’espace vers Mars lors du premier vol de la fusée Falcon Heavy. Le lancement, effectué le 6 février 2018, est réussi. La voiture est désormais en orbite autour du soleil, entre la Terre et Mars.
Le second modèle qu’il créera sera une berline luxueuse le « model S » qui sera vendu environ 100 000 $ et qui est commercialisé à partir de juin 2012.
Et après un troisième modèle le « model X » commercialisé aux USA en septembre 2015, Elon Musk voudra démocratiser la voiture électrique en créant le « model 3 » qui est le quatrième modèle et vaudra 35 000 $. Les premiers modèles sortiront en juillet 2017. Le Model 3, initialement moqué pour des problèmes de production, finit par devenir un succès retentissant.
Il sera produit en beaucoup plus grand nombre et le principal lieu de production sera la Gigafactory de Shangaï en Chine.

Tesla Gigafactory Shanghai en 2024 En 2020 est produit le « Model Y » . Il est le cinquième modèle de l’histoire de ce constructeur, et se présente comme une version surélevée du Model 3. En 2023, il devient le modèle le plus vendu en Europe, toutes énergies confondues.

Tesla Model Y En mars 2020, Tesla avait annoncé la production de la millionième Tesla depuis le lancement de la marque. Il s’agit d’un Model Y de couleur rouge.
Guillaume Erner, grand connaisseur de voiture explique :
« Ce sont des voitures extrêmement performantes, qui vont très vite. […] Il va créer un véritable éco système, un peu de la même façon qu’Apple qui a créé un certain nombre d’objets qui n’existaient pas avant. »
C’est un peu exagéré, la voiture existait avant… Mais une voiture Tesla constitue une véritable rupture avec ce qui existait. Ce qui existait, c’était des voitures avec un ordinateur de bord qui s’y rajoutait. La Tesla est une application informatique qui dirige une voiture. La vocation de l’application informatique est de rendre cette voiture autonome pouvant se passer d’un conducteur humain.
François Saltiel ajoute :
« Posséder une Tesla aujourd’hui, c’est adhérer à un imaginaire. Comme à un moment donné, il fallait avoir un iphone grâce au marketing.
C’est une sorte de communauté. Lorsqu’on roule en Tesla, on appartient à une communauté de gens qui croient au progrès. Avec une bonne conscience du départ.
On parle d’un Elon Musk ecolo, un homme qui faisait des remontrances à Donal Trump parce qu’il ne voulait pas respecter les accords de Paris. »Je me demande ce que peut penser un authentique « bobo » possédant une Tesla en voyant l’évolution récente d’Elon Musk. Mon ami Jean-Louis m’a raconté qu’il a vu une Tesla garée avec un mot derrière le pare-brise : « Excusez-moi. J’ai acheté cette Tesla avant qu’Elon ne devienne dingue ! ».
Guillaume Erner fait le constat de la rupture de Musk : Tesla est une voiture démocrate, de gens aisés mais conscient de certaines problématiques écologiques. Maintenant Tesla est devenu une icône républicaine qui se matérialise dans un nouveau modèle le « Cybertruck » :

Tesla Cybertruck 2024
« Qu’est-ce que le cybertruck ? C’est un camion, un pickup […] C’est une voiture trumpienne avec des angles acérés.
Vous n’en voyez pas en circulation en France parce qu’elle est tout simplement interdite de circulation en Europe. Elle est considérée comme trop dangereuse pour les piétons.
Je trouve cela très caractéristique. Elle est inspirée de l’univers dystopique de Blade Runner, alors que jusqu’à présent les formes de Tesla étaient plutôt féminines. »Il s’agit donc d’une voiture viriliste qui résiste aux balles et qui illustre un changement d’idéologie pour Elon Musk et marque un virage vers une mentalité trumpiste et conservatrice.
Les producteurs de Blade Runner ont attaqué Musk en justice en considérant qu’il trahit l’esprit de leur film avec son dernier modèle : « Quand les producteurs de Blade Runner attaquent Elon Musk »
En 2023, Tesla a vendu plus de voitures dans le monde que Renault. Elle reste cependant loin de Toyota : 1,8 millions contre 9,5 millions pour la marque japonaise.
En revanche, dès 2020 Tesla est devenu la 1ère capitalisation automobile mondiale. En Janvier 2025, la capitalisation boursière pour Tesla s’élève à 1.234 Billion d’euros. Cela fait de Tesla la 8ème entreprise la plus précieuse au monde par capitalisation, la première restant Apple.
Elon Musk va continuer à lancer des entreprises innovantes et créer ainsi un empire tentaculaire.
En 2016, Tesla rachète « SolarCity » spécialisée dans les panneaux solaires pour 2,6 milliards de dollars. Elon Musk déclare que la mission de Tesla depuis sa création est « d’accélérer la transition du monde vers une énergie durable »
En 2019, Elon Musk crée « Starlink » fournisseur d’accès à Internet par satellite de la société SpaceX. Il s’appuie sur une constellation de satellites comportant des milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse. Starlink est le premier fournisseur d’internet par satellite à choisir cette orbite car elle permet de diminuer la latence (le temps de réponse) en la faisant passer de 600 ms à environ 20 ms. La constellation est en cours de déploiement depuis 2019 et repose sur environ 6 300 satellites opérationnels mi-septembre 2024. En septembre 2024, Starlink affirme disposer de plus de 4 millions de clients. Pour atteindre ses objectifs commerciaux, SpaceX prévoit de disposer vers 2025 de 12 000 satellites, chiffre qui doit être porté à terme à 42 000. (source wikipedia).
Toujours dans son ambition de privatiser des domaines qui appartenait à la sphère publique et à l’autorité des Etats, il devient un acteur incontournable de l’infrastructure spatiale comme de la collecte des données.
Il mettra à disposition de l’Ukraine son réseau Starlink, au début de l’invasion russe, pour rétablir des communications qui avait été coupées par l’armée de Moscou. A Mayotte, après la dévastation de l’île par le cyclone chido, le premier ministre François Bayrou fera appel à Starlink pour rétablir l’internet sur le département.
Il tentera encore d’autres innovations telles que « Hyperloop » un transport ferroviaire à très grande vitesse, projet de recherche industrielle proposé en 2013, ou « The Boring Company » société de construction de tunnels fondée en 2016.
Ces tentatives n’ont pas encore abouti.
Par exemple, un projet « Hyperloop Lyst », mené avec l’école des Mines de Saint-Étienne, devait permettre de relier Lyon à Saint-Étienne en 10 minutes. Ce projet a été abandonné.
Il fallait trouver un exergue à ce troisième épisode.
Elon Musk est un grand créateur d’aphorisme. J’ai choisi celui qui me semblait le plus en phase avec les faits relatés dans ce mot du jour :
« Beaucoup de choses sont improbables, seules quelques-unes sont impossibles ! »
Je redonne le lien vers le troisième épisode que France Culture a mis en ligne : « De Tesla à Starlink, un serial entrepreneur dans la Silicon Valley »
-
Mardi 14 janvier 2025
« La mafia paypal ! »Peter Thiel, Elon Musk, David Sacks et d’autres libertariens issu de Paypal et jouant un rôle d’influence dans la techContinuons à nous intéresser au parcours d’Elon Musk jusque dans les bureaux de la Maison Blanche…
Pour le deuxième épisode, France Culture a choisi ce titre : « Elon Musk à l’assaut de l’État »
Dans l’épisode 1, nous avions laissé Elon Musk riche, après avoir vendu sa première Start Up créée avec son frère : Zip2. Nous avons compris que l’argent gagné, il n’allait pas l’utiliser pour s’amuser et payer des loisirs.
Dans la logique de la Silicon Valley, il va utiliser son premier gros gain pour investir dans une nouvelle entreprise : il s’agira d’une plateforme de paiements en ligne qu’il nommera déjà « X », plus précisément « X.com »
François Saltiel explique :
« Il veut déjà court-circuiter le schéma traditionnel pour développer cette entreprise qui va par la suite racheter une jeune pousse qui s’appelle « Paypal ». Et Paypal prendra par la suite le dessus sur X pour devenir ce qui va devenir son premier très grand succès. »
En 2002, Ebay rachètera Paypal pour 1,5 milliards de dollars, ce qui lui permet d’empocher personnellement plus de 180 millions de dollars.
Mais de cette aventure, il ne retire pas seulement de l’argent, c’est aussi une philosophie qui est à l’œuvre. Il s’agit d’une philosophie libertarienne qui vise à réduire le rôle des structures étatiques dans la gestion monétaire.
Il fait partie alors d’un groupe d’entrepreneurs qui partagent l’idée d’une réduction des services publics et souhaitent s’en prendre directement au monopole de l’État, notamment dans le domaine financier.
François Saltiel précise :
« Avec PayPal, c’est la première fois que l’on peut payer, avoir un instrument de paiement qui n’est pas une banque traditionnelle. »
Musk et ses proches transforment leurs idées audacieuses en une révolution économique qui ne dissimule pas ses ambitions politiques. Au fond, il s’agit de préparer la réorganisation de la société autour des nouvelles technologies.
François Saltiel décrit cette révolution ainsi :
« Paypal c’est un « game changer » pour Elon Musk. Il y a un avant et un après Paypal. Lorsqu’il entre dans cet éco système, il fait la rencontre de Peter Thiel. […] Peter Thiel, c’est un investisseur, c’est un des premiers investisseurs de Facebook. Il a beaucoup d’argent. Il est beaucoup plus discret qu’Elon Musk mais il a une énorme influence [dans la silicon valley]. Il est un des chantres du libertarianisme. C’est un transhumaniste. »
Peter Thiel est un des hommes qui comptent le plus dans cet écosystème. Il cofonde « Palantir » dans lequel il joue un rôle essentiel. C’est une entreprise qui fait de l’analyse de données et notamment de données secrètes. Il se sert de l’Ukraine comme un laboratoire d’expérimentation.
Peter Thiel avait étudié la philosophie à l’université Stanford, et se dit très influencé par la pensée de René Girard et sa théorie du désir mimétique. Peter Thiel va soutenir Trump dès 2016.
 En 2007, le magazine «Fortune» utilise le terme de « mafia PayPal » en appui d’une photographie montrant un groupe de 13 hommes liés à l’entreprise PayPal et habillés dans des vêtements évoquant des mafieux. Notons qu’Elon Musk est absent de cette photo…
En 2007, le magazine «Fortune» utilise le terme de « mafia PayPal » en appui d’une photographie montrant un groupe de 13 hommes liés à l’entreprise PayPal et habillés dans des vêtements évoquant des mafieux. Notons qu’Elon Musk est absent de cette photo…Il n’y a pas que le décor, il y a aussi l’influence grandissante de ces entrepreneurs libertariens sur la tech. Outre Elon Musk et Peter Thiel, on y trouve David Sacks, fondateur de Yammer; Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn; Jawed Karim et Chad Hurley, co-fondateurs de Youtube et quelques autres.
Le Figaro publie un article le 6 novembre 2024 : « Elon Musk, Peter Thiel, David Sacks… Comment la «mafia PayPal» a œuvré pour la victoire de Donald Trump » Ce sont eux qui auraient proposé le vice président à Donald Trump : J. D. Vance. Ce dernier présente Peter Thiel comme son mentor.
En 2002, Elon Musk va se lancer dans un nouveau défi : la conquête spatiale. Il crée SpaceX. Son premier objectif est de réduire de manière drastique les coûts des vols spatiaux en devenant le sous-traitant de la Nasa. Peu croit en lui. François Saltiel raconte :
« Tout le monde se moque de lui, surtout qu’il ajoute : Je vais aller construire mes propres fusées et puis on va coloniser Mars. »
Force est de constater qu’il va réussir à devenir indispensable à la NASA. Le projet concurrentiel de Jeff Bezos « Blue Origin » a pris beaucoup de retard. Sans Space X, la NASA n’est plus en mesure de réaliser ses projets.
Ce constat fait dire à François Saltiel : « ce dingue n’est pas fou ». Il n’est pas fou, mais il est peut être dangereux.
Il a beau être libertarien, le succès de SPace X repose quand même sur beaucoup de subventions versées par l’Etat honni.
En revanche, il rempli l’objectif de diminuer les coûts, même si cela doit entraîner une augmentation du risque. Trump l’embauche pour essayer de réaliser les mêmes performances dans l’Administration fédérale.
En conclusion, François Saltiel, caractérise l’homme d’affaire comme l’incarnation du « technosolutionnisme ». Cette hypothèse prétend que si les ressources de la planète sont limitées, l’homme parviendra toujours à repousser ses frontières grâce à la technologie.
Je redonne le lien vers ce deuxième épisode : « Elon Musk à l’assaut de l’État »
-
Lundi 13 janvier 2025
« Je pourrais m’acheter une île dans les Bahamas, mais créer des nouvelles entreprises m’intéresse beaucoup plus ! »Elon Musk, en 1999, après avoir vendu sa première Start upFaut-il en rire ou au contraire s’en inquiéter, voire avoir réellement peur ?
Donald Trump veut récupérer la souveraineté sur le canal de Panama, acheter le Groenland et convaincre les canadiens à devenir le 51ème État des États-Unis…
Et, Elon Musk comme l’homme qu’il soutient parle et écrit à tort et à travers, dans son soutien aux extrêmes-droite en Europe, dans sa volonté de tout déréguler et d’entrer dans un monde où seule la loi du plus fort et du plus riche s’imposera.
Les États-Unis sont sur le chemin de renforcer leur « Ploutocratie ». La ploutocratie est un système de gouvernement où la richesse est la base du pouvoir politique
Les professeurs de droit ont multiplié les mots et les définitions pour expliquer l’organisation du pouvoir.L’Iran est une « théocratie » fondée sur des principes religieux. La Chine est soit une « oligarchie » si on considère qu’elle est dirigée par le Comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois ou une « autocratie » si on se persuade que le pouvoir est entre les seuls mains de Xi Jinping.
Mais revenons à la ploutocratie américaine. Dans l’émission de la 5 « C à Vous » du 7 janvier 2025, le journaliste Philippe Corbe, spécialiste des États-Unis a fait le constat suivant :
« En janvier 2024, la fortune d’Elon Musk était d’environ 251 Milliards de dollars (selon Forbes), il était déjà l’homme le plus riche du monde. Il est en ce début d’année 2025 à 418 Milliards de dollars. […] Dans l’Histoire de l’humanité, il n’y a jamais existé un homme aussi riche. »
Cette augmentation de la fortune s’explique par une valorisation maximale des valeurs boursières de Musk dû au fait que les investisseurs et les spéculateurs parient que maintenant que Musk est au cœur du pouvoir fédéral, les multiples contrats qui le lient avec l’État fédéral des Etats-Unis, vont encore s’épanouir davantage.
Si les actions de Musk peuvent se valoriser aussi rapidement, il est tout à fait rationnel de prévoir qu’elles peuvent se dévaloriser dans les mêmes proportions, tout aussi rapidement.
Toutefois, il semble bien qu’il se sente aujourd’hui très fort, quasi invulnérable et se donne le droit donc d’intervenir sur n’importe quel sujet et de traiter le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de « girl ». Ainsi a-t-il écrit sur son réseau social mercredi 8 janvier à 9:58 :
« Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say »— Elon Musk (@elonmusk)
Ce que la presse québécoise a traduit : « Chérie, tu n’es plus le gouverneur du Canada, donc ce que tu dis, nous importe peu ».
Il attaque le premier ministre britannique et quand celui-ci veut rétablir la vérité, Musk l’accuse de « tenir des propos insensés » puis le qualifie de personne « totalement méprisable ».
Lors de la même émission de « C à Vous » Alain Duhamel, me semble avoir bien décrit Musk et Trump :
« On a l’impression, qu’il y a un génie un peu fou et un fou dont on se demande s’il est génial »
Il me semble donc nécessaire d’en savoir un peu plus sur cet homme né le 28 juin 1971 à Pretoria, dans une famille blanche aisée vivant dans une Afrique du Sud sous le joug de l’apartheid. Nelson Mandela est en prison depuis 9 ans et le restera encore pendant 19 ans.
« France Culture » a produit une série de 4 podcasts, de 15 minutes chacun, qui retrace le parcours de cet homme.
Pour ce faire, Guillaume Erner a interrogé François Saltiel, producteur de « Un monde connecté » sur France Culture.
Le premier épisode s’intitule : « de l’enfant harcelé à l’étudiant rebelle de Stanford »François Saltiel raconte :
« Il est né au moment de l’apartheid, dans un contexte assez violent. Son père est un ingénieur assez fortuné et sa mère une mannequin canadienne. Le fait que sa mère soit canadienne est important dans sa trajectoire. »
Il a une enfance assez difficile. Il est petit et chétif et il est victime d’harcèlement.
François Saltiel poursuit :
« On se moque de lui. Là on a déjà la faille. […] Il y aura une quête de l’enfant humilié qui cherche à se venger. »
Il semble qu’il aurait intégré assez vite qu’il ne peut s’en remettre qu’à lui-même. Il fera des stages de survivaliste où son père l’avait inscrit. Pendant ces stages, la nourriture était insuffisante et on incitait les plus forts de dérober la nourriture des plus faibles. Et Musk était un des plus faibles, il s’est fait avoir plusieurs fois. Il a alors décidé de devenir sportif, de boxer et de faire d’autres sports de combats et de se complaire dans le virilisme.
En 2023, lors d’un conflit avec Marc Zuckerberg, patron de Facebook, il lui a proposé de faire un combat de MMA. Zuckerberg pratique aussi les arts martiaux mixtes (MMA). Ce combat n’aura pas lieu.
Selon François Soltiel, il sera totalement en phase avec la mentalité méritocratique de la Silicon Valley : seul ceux qui le méritent peuvent survivre et s’élever. Il en tirera des règles violentes de management en pointant du doigt ceux qui n’y arrivent pas et en agissant quelquefois au mépris de la loi.
Pour en revenir à l’enfance, il sera décrit comme un enfant supérieurement intelligent. Dès 10 ans il se passionne pour l’informatique et à douze ans, il aurait vendu son premier jeu vidéo pour 500 dollars.Mais François Soltiel nous met en garde d’adhérer trop vite à ce qu’il considère comme un storytelling. Plus nuancé il dira :
« Il s’est auto-diagnostiqué asperger. On est en face d’un enfant qui est assez seul, qui va développer des compétences et se réfugier dans la science-fiction. Il est un grand lecteur d’Asimov et de K. Dick. La plupart de ses entreprises vont naître de ses lectures. »
Selon son biographe, les relations entre Elon Musk et son père sont très mauvaises. Il le voit comme un père violent. Ses parents vont divorcer assez tôt.
 Il va quitter l’Afrique du Sud à 17 ans, parce qu’il veut échapper au service militaire. Il émigre au Canada après avoir acquis la nationalité canadienne grâce à sa mère canadienne. En réalité il veut aller aux États-Unis, patrie de ses romans de science-fiction, mais il pense que par le Canada ce sera plus facile.
Il va quitter l’Afrique du Sud à 17 ans, parce qu’il veut échapper au service militaire. Il émigre au Canada après avoir acquis la nationalité canadienne grâce à sa mère canadienne. En réalité il veut aller aux États-Unis, patrie de ses romans de science-fiction, mais il pense que par le Canada ce sera plus facile.Il va passer deux ans au Canada et fera des études de Physique et d’Économie et pratiquera quelques petits boulots, à côté. Son père lui coupe les vivres
Puis du Canada il pourra se rendre à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie et obtiendra un bachelor de physique et continuera ses études d’économie.
Puis il sera admis en 1995 dans une des plus prestigieuses universités : Stanford
François Saltiel raconte :
« Stanford, c’est l’université de la Silicon Valley qui est au cœur de cet eco-système. C’est à Stanford qu’est né Google. […] Elon Musk va se distinguer en ne restant que deux jours à un moment où il voit Internet monter et il se dit je n’ai pas besoin de suivre ces études. Je vais quitter Stanford pour monter ma première entreprise. »
Et c’est ainsi qu’en 1995, Elon Musk fonde avec son frère la compagnie Zip2, éditeur d’un logiciel de publication de contenu en ligne. Ses principaux clients seront les gros titres de la Presse américaine. Cette même Presse qui est aujourd’hui son grand ennemi.
En 1999, Compaq acquiert Zip2 pour 341 millions de dollars. Elon Musk et son frère Kimbal possèdent alors environ 12 % de Zip2. Elon Musk y gagne 22 millions de dollars, ils avaient investi, 4 ans auparavant avec son frère, 28 000 $.
Dans un reportage de CNN de 1999, on entend Elon Musk dire :
« L’agent c’est juste du papier. […] Je pourrais m’acheter une île dans les Bahamas, mais créer des nouvelles entreprises m’intéresse beaucoup plus. »
François Saltiel conclut ce premier épisode :
« Elon Musk est un personnage fascinant. On peut être inquiet par ses idées. Mais tout le monde lui reconnaît sa capacité d’être là au bon moment, au bon endroit et dans le juste timing. […] Il va toujours anticiper ce que sera la prochaine révolution technologique. »
-
Mardi 7 janvier 2025
« Je suis toujours Charlie »C’est une profession de foiJe me souviens exactement de l’endroit où j’étais, il y a dix ans, vers midi, quand j’ai eu les premières informations qu’il s’était déroulé un massacre effroyable à Paris, dans les locaux de Charlie Hebdo.
J’étais rue du Sergent Michel Berthet, dans le 9ème arrondissement de Lyon, en face de l’immeuble Fiducial et j’attendais ma fille car nous avions rendez vous pour aller ensemble au restaurant.
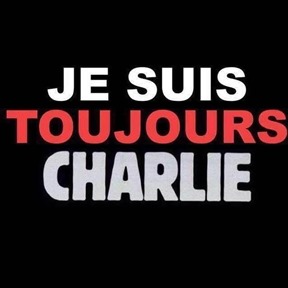 Nous nous souvenons avec précision des moments où nous avons été sidérés : le 11 septembre 2001, les attentats du 13 novembre 2015 et cette journée du 7 janvier 2015 qui allait être suivie par deux autres jours pendant lesquels des tueries allaient avoir lieu d’abord à Montrouge (Hauts-de-Seine), Clarissa Jean-Philippe, 26ans, policière, était tuée d’une balle dans le dos. Puis vendredi 9 janvier, quatre personnes étaient encore tuées dans l’attaque de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes : Yohan Cohen, 20 ans, Philippe Braham, 45 ans, François-Michel Saada, 63 ans, Yoav Hattab, 21 ans.
Nous nous souvenons avec précision des moments où nous avons été sidérés : le 11 septembre 2001, les attentats du 13 novembre 2015 et cette journée du 7 janvier 2015 qui allait être suivie par deux autres jours pendant lesquels des tueries allaient avoir lieu d’abord à Montrouge (Hauts-de-Seine), Clarissa Jean-Philippe, 26ans, policière, était tuée d’une balle dans le dos. Puis vendredi 9 janvier, quatre personnes étaient encore tuées dans l’attaque de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes : Yohan Cohen, 20 ans, Philippe Braham, 45 ans, François-Michel Saada, 63 ans, Yoav Hattab, 21 ans.Tout de suite je me suis senti Charlie et je n’ai pas compris que d’autres osent dire qu’ils n’étaient pas Charlie. Je lisais très rarement ce journal, son humour n’était pas le mien. Mais il n’est pas admissible, qu’en France on puisse être tué parce qu’on a fait un dessin ou écrit un texte. Je me souviens d’une enfant à l’époque qui avait dit : « Quand on n’aime pas un dessin, on ne tue pas, on en fait un plus jolie. ». Dans la naïveté de ces propos se révèle une grande sagesse.
Nous parlons de liberté, de liberté d’expression. Nous parlons de l’obscurantisme prôné par des adeptes religieux figés dans des interprétations archaïques de leurs textes « sacrés ». Je ne conçois pas qu’on puisse manifester la moindre faiblesse à leur égard.
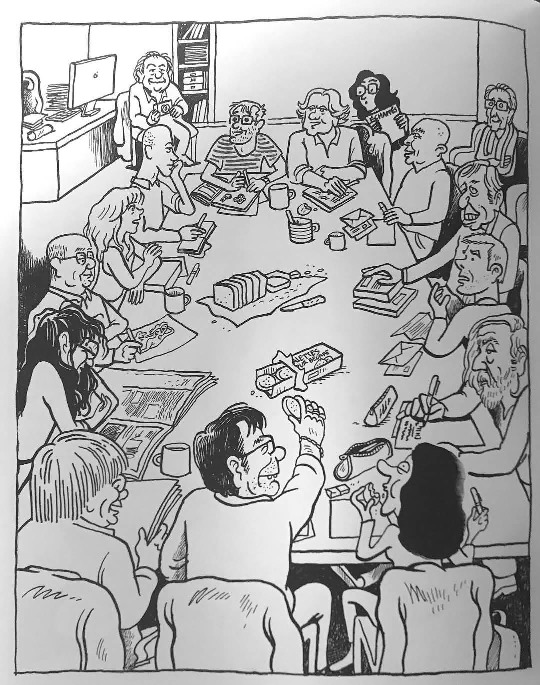
Dessin de Coco dessinatrice de Charlie Hebdo rescapée des massacres Où en sommes nous aujourd’hui ?
Elisabeth Badinter dans un article de l’Express : « Dix ans après l’attentat contre Charlie, je pense que la peur l’a emportée » est très pessimiste :
« Je pense que la peur l’a emporté. La peur, d’abord, de ce qu’il peut en coûter physiquement, pour sa vie, quand on prend la parole sur ces sujets-là, et je pense bien sûr aux morts de Charlie mais aussi à Samuel Paty, décapité à la sortie de son collège.
Les réseaux sociaux jouent un rôle délétère, car on sait désormais comment un « bad buzz » peut se former et grossir jusqu’à atterrir dans le téléphone d’un candidat au djihad.
Notre actualité est émaillée d’affaires comme celles du proviseur du Lycée Maurice Ravel, à Paris, menacé de mort après avoir demandé à une élève d’enlever son voile dans l’enceinte de l’établissement. Ces affaires-là ne peuvent que confirmer la peur qu’a la majorité de parler.
S’ajoute une autre crainte : celle d’être pointé du doigt comme appartenant au « mauvais camp »; de se faire traiter de raciste, d’islamophobe, etc. Alors, il y a quand même encore très peu de gens qui parlent. A part, bien sûr, dans le secret des conversations en famille ou entre amis.Cette dichotomie totale entre la conversation publique et la parole privée n’est pas un signe de santé démocratique. »
Je pense qu’Elisabeth Badinter a raison nous avons reculé, beaucoup d’auto-censure a été pratiquée d’abord par ceux qui ont simplement peur « des fous de dieu ». On se souvient de ses parents qui se sont mobilisés pour que leur collège ne porte pas le nom de Samuel Paty.
Mais plus insidieusement, beaucoup se taisent parce qu’ils ont peur d’être classés parmi les racistes et les islamophobes. Et c’est ainsi que les islamistes gagnent du terrain.
Pour ma part, et sur ce sujet précis je serai toujours du côté de ceux qui dénoncent les ravages de la lâcheté et du renoncement devant les rétrogrades et les groupes religieux qui nous entraînent dans une régression inouïe dans nos libertés et aussi dans l’enseignement de l’Histoire dans nos Collèges comme le pratiquait Samuel Paty et Dominique Bernard . Je serai du côté des journalistes de Charlie Hebdo, de Gilles Kepel, de Caroline Fourest, de Sophia Aram ou de l’avocat Richard Malka et résolument contre ceux qui les traitent d’islamophobe. Richard Malka l’avocat de Charlie Hebdo lors du procès des attentats a plaidé :
« C’est notre faiblesse qui donne à nos ennemis leur marche d’action. C’est un rapport de force avec le fait religieux, ça sera toujours un rapport de force. C’est comme ça… Le meilleur moyen de ne pas avoir d’attentat, c’est de montrer qu’ils n’obtiendront rien, jamais ! Pas un seul recul, pas un seul renoncement. C’est ça leur kérosène, en fait, ce sont nos renoncements, c’est ça l’huile de leur moteur.»Dans un article publié hier le 6 janvier, dans Libération : « Le billet de Thomas Legrand », évoque l’inoubliable Bernard Maris qui a fait partie des victimes du massacre de Charlie Hebdo.
Outre, d’être un économiste humaniste qui expliquait avec humour et pédagogie les perversions qui se cachant derrière les concepts claironnés par ses confrères, Bernard Maris avait une autre passion : Maurice Genevoix et le projet de sa panthéonisation.
 Il était l’époux de la fille de l’écrivain, Sylvie Genevois, jusqu’à la mort de cette dernière en 2012. Il avait créé un mouvement de soutien et il a obtenu la panthéonisation du romancier de la grande guerre. Thomas Legrand écrit :
Il était l’époux de la fille de l’écrivain, Sylvie Genevois, jusqu’à la mort de cette dernière en 2012. Il avait créé un mouvement de soutien et il a obtenu la panthéonisation du romancier de la grande guerre. Thomas Legrand écrit : « Les monstruosités de 14-18 qui fascinaient Bernard l’ont rattrapé. Les attentats, la folie jihadiste sont aussi (les historiens le disent) de lointaines répercussions des dérèglements géopolitiques issus de 1918, avec le tracé par les Français et les Anglais de frontières artificielles au Levant…
Peu avant l’annonce, au printemps 2015, de la panthéonisation de Genevoix, Bernard Maris mourait sous les balles des terroristes. […]
Aujourd’hui, quand je me souviens de Bernard, mon compagnon de matinale de radio, je comprends mieux ces mots «nos morts» qui me paraissaient avant l’attentat contre Charlie un brin cocardiers, inutilement grandiloquents ou même suspects de récupération, sur les monuments du souvenir des communes françaises. Il y a bien autre chose que l’aspect sacrificiel, morts pour la cause. D’autant que Bernard, comme Cabu ou Charb, fan de Brassens, était plutôt du genre à vouloir «mourir pour des idées, mais de mort lente».
Non, nos morts, ce sont aussi ceux qui, disparus, nous accompagnent toujours, sont à nous. […] «A nos morts», dans chaque village, c’était la famille, les voisins, les copains… Je vois maintenant ce que cette expression «nos morts» signifie et a d’utile pour les vivants.
Nous, nous avons Bernard et ceux de Charlie, nos morts.»Et dans cette liste de nos morts je n’oublierai pas Samuel Paty, Dominique Bernard et les autres victimes de cette barbarie qui a débarqué sur notre sol et que nous devons résolument affronter.
-
Jeudi 2 janvier 2025
« Je te souhaite du temps »Elli MichlerElli Michler est une poétesse allemande. Elle est née le 12 février 1923 et elle est morte il y a un peu plus de 10 ans, le 18 novembre 2014.
Le début de l’année est le moment des vœux.
Plus l’âge avance, plus je perçois combien le temps est précieux.
Lors de l’hommage à mon ami Fabien, le 23 juillet 2024, j’écrivais que l’immense cadeau que nous nous offrions l’un à l’autre, deux fois par an, c’était du temps.
On court après le temps, on perd son temps, on tue le temps en l’occupant mollement par des activités ludiques, parfois on gâche son temps pour faire des économies de bout de chandelles lors de cette activité si prégnante dans le monde d’aujourd’hui : la consommation.
Lors du mot du jour, du 2 juillet 2020, j’avais cité José Mujica, président de l’Uruguay de 2010 à 2015 :
« Quand j’achète quelque chose, quand tu achètes toi, on ne le paye pas avec de l’argent. On le paye avec du temps de vie qu’il a fallu dépenser pour gagner cet argent. »
Nous sommes bien obligés de pratiquer des activités utilitaires, mais au-delà, le temps est une denrée rare qu’il faut penser à savourer.
Photo prise par James Webb et finalisée le 27 novembre 2024. Cette photo correspond à une réalité qui date de 40 millions d’années Elle nous donne peut être une image du temps suspendu…

Le télescope spatial James Webb nous montre cette galaxie spirale située dans la constellation de la Colombe à 40 millions d’années-lumière. Les bras spiraux, le gaz et la poussière sont visibles avec d’incroyables détails. Si vous voulez voir cette photo en haute résolution c’est <Ici>
Elli Michler a écrit un texte magnifique que je partage aujourd’hui, pour cette période de vœux.
«Je te souhaite du temps
Je ne te souhaite pas un simple cadeau, mais quelque chose de bien plus précieux,
quelque chose que tant de gens recherchent sans jamais le trouver.Je te souhaite du temps.
Du temps pour rire, pour t’émerveiller, pour te perdre dans la douceur de l’instant.
Si tu sais l’apprivoiser, il t’offrira bien plus que tu ne l’imagines.Je te souhaite du temps pour créer,
pour rêver et pour réfléchir.
Pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux que tu aimes.Je te souhaite du temps,
non pas pour courir après, mais pour ralentir,
pour te poser là où ton cœur se sent en paix.Je te souhaite du temps, non pas pour qu’il s’efface au fil des heures,
mais pour qu’il te reste, pour que tu puisses t’arrêter et contempler le monde,
pour que tu prennes le temps d’avoir confiance,
non pas en l’aiguille d’une montre, mais en la vie elle-même.Je te souhaite du temps pour effleurer les étoiles,
pour grandir, non pas seulement en âge,
mais en force, en tendresse, en toi.Je te souhaite du temps pour espérer encore,
même lorsque tout semble vaciller.
Du temps pour aimer, car il n’y a pas de plus belle manière de le vivre.Je te souhaite du temps pour faire la paix avec le passé,
pour ouvrir tes bras à ce qui vient,
et pour pardonner, à toi-même comme aux autres.
Je te souhaite de recevoir le temps comme on reçoit un trésor,
de le savourer, non pas comme une chose à posséder,
mais comme un souffle à embrasser.Je te souhaite du temps,
pour vivre, pleinement, intensément, librement.
Je te souhaite du temps, pour ta vie et pour la Vie.»
Elli MichlerJe ne connaissais pas Elli Michler avant de lire ce poème, son poème le plus célèbre.
 Elle est née à Wurtzbourg, en Allemagne, pendant une période difficile économiquement et politiquement. Écolière, elle assiste à la destruction par les nazis de son école religieuse.
Elle est née à Wurtzbourg, en Allemagne, pendant une période difficile économiquement et politiquement. Écolière, elle assiste à la destruction par les nazis de son école religieuse.
Elle vivra sous le joug nazi pendant toute la guerre, dans la terreur et le travail forcé dans un groupement industriel de Wurtzbourg.Elle écrira toute sa vie, mais ce n’est que tardivement, à l’âge de 64 ans qu’elle commencera à publier chez Don Bosco Verlag Munich de nombreux recueils de poèmes. C’est sur le site de « cet éditeur » que j’ai appris ce que je suis en mesure d’écrire.
Elle obtiendra un véritable succès populaire en Allemagne.
L’éditeur écrira aussi :
« L’œuvre d’Elli Michler répond ainsi aux trois exigences que Kästner attribue aux poètes :
– l’honnêteté du ressenti,
– la clarté de la pensée
– la simplicité du mot et de la phrase.La réponse de Schopenhauer à la question de ce qu’est un poème – « un fragment d’éternité dans le temps » – a inspiré Elli Michler dans sa volonté d’aider les hommes en proie à un négativisme ambiant à se libérer de leurs peurs et de la frénésie du quotidien en leur offrant, à travers la poésie, des perspectives de tranquillité intérieure, ainsi qu’une approche positive. »
Je vous souhaite une belle année 2025, pendant laquelle vous prendrez du temps pour vivre, pour la vie, pour votre vie et aussi pour le partage avec d’autres qui sauront prendre ce même temps.
-
Lundi 30 décembre 2024
« J’ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s’y sont tenus. »Gisèle PelicotAprès quatre mois d’audiences, La cour criminelle du Vaucluse a rendu son verdict dans le procès des viols de Mazan, le19 décembre 2024.
Ce fut un procès historique en raison du nombre d’accusés, des conditions dans lesquelles ces crimes ont été commis et aussi parce que la victime n’a pas demandé le huis clos des débats et a accepté que des journalistes du monde entier puissent assister aux audiences et voir les viols filmés par le mari de la victime.
 Après le refus par Gisèle Pelicot du huis clos, « le nouvel obs » a compté 165 médias dont 76 médias étrangers qui ont suivi le procès. Les derniers jours à l’approche du verdict, des médias s’accréditaient encore.
Après le refus par Gisèle Pelicot du huis clos, « le nouvel obs » a compté 165 médias dont 76 médias étrangers qui ont suivi le procès. Les derniers jours à l’approche du verdict, des médias s’accréditaient encore.
Je crois que les informations qui ont été diffusées pendant ces quatre mois ont été si répandues qu’il n’est pas nécessaire de rappeler les faits. Si besoin, ils sont précisément décrits dans cette page de de Wikipedia : « Affaire des viols de Mazan ».
La plupart des journaux ont créé une page spécifique regroupant tous les articles sur ce procès. Le nouvel obs a publié les comptes rendus pour chacune des audiences ainsi que des articles de fond écrits par ses journalistes. La plupart sont en accès libre : « Le procès des viols de Mazan »
Il est donc possible d’aller directement aux enseignements que nous apportent cette affaire hors norme et selon la volonté de Gisèle Pelicot de se saisir des débats pour comprendre et faire évoluer notre société.
Ce mot du jour va modestement tenter de faire une partie du chemin, sans être en mesure d’aborder tous les sujets.
Pour commencer, il me semble quand même, essentiel de rappeler que tous les accusés ont été déclarés coupables et ont été condamnés à de la prison, au minimum 1 an ferme et 2 ans de sursis qui s’appliqueront immédiatement en cas de récidive. En outre tous ont été condamnés à poursuivre des soins. Dès lors les journalistes qui ont écrit que certains sont « repartis libre à l’issue du procès » au minimum manquent de précisions. Ce qu’il aurait fallu énoncer c’est que tous ont été condamnés à de la prison, mais que certains ayant déjà purgé leur temps de peine en préventive lors de l’enquête, n’ont pas été incarcérés.
Le premier enseignement de ce procès nous met face à un récit erroné de la réalité des viols. On nous a raconté que le viol se passait dans un parking dans lequel un prédateur sexuel inconnu se jetait sur une femme pour la violer sous contrainte. Cela pouvait se passer la nuit, dans une rue obscure, une femme seule agressée par un inconnu.
Ces histoires existent, mais 91% des viols sont commis par un proche. Le plus souvent dans le cadre familial. D’ailleurs, 45 % des agresseurs sont le conjoint ou ex-conjoint. La cellule familiale qui a vocation à protéger ses membres est le lieu le plus dangereux pour les femmes et aussi pour les enfants. C’est là, dans ce huis clos que les crimes sexuels les plus horribles sont commis.
Le deuxième enseignement est celui de la faillite d’un argument et d’un concept : « le bon père de famille ». Il n’a jamais pu faire cela, c’est un bon père de famille…
Un article du monde présente cette « disqualification définitive des « bons pères de famille ». Cet article cite l’essai de Rose Lamy « En bons pères de famille » (Lattès, 2023 et s’appuie sur une interview pour expliquer :« Selon Rose Lamy. « Dans cette fiction sociale [du bon père de famille], ajoute-t-elle, les hommes violents, ce sont toujours les autres, les monstres, les fous, les étrangers, les marginaux. » D’un côté, les bons pères de famille, qui, certes, parfois, dérapent, étant « trop amoureux, trop lourds, trop malheureux, trop séducteurs, trop bourrés, trop jaloux, mais, croyez-les sur parole, jamais violents » ; de l’autre, les vrais monstres, qui agressent à la nuit tombée.
C’est sans doute cette distinction qui explique les mots de l’un des avocats des accusés du procès de Mazan, Louis-Alain Lemaire, assurant sans sourciller que ses clients sont « tout sauf des violeurs ».Peut être est-il plus fort encore de citer Gisèle Pelicot lors de l’audience du 23 octobre lorsqu’elle interpelle son ex mari :
« Dominique, nous avons eu cinquante ans de vie commune, nous avons été heureux et comblés, nous avons eu trois enfants, sept petits-enfants, tu as été un père attentionné, présent, je n’ai jamais douté de ta confiance. Je me suis souvent dit : Quelle chance j’ai de t’avoir à mes côtés. […] Cela fait quatre ans que je prépare le procès et je ne comprends toujours pas comment cet homme qui était pour moi l’homme parfait a pu en arriver là, comment ma vie a basculé. » Elle élève la voix :
« Comment as-tu pu me trahir à ce point ? Comment as-tu pu faire entrer tous ces individus chez nous, dans ma chambre à coucher ? Cette trahison est incommensurable. J’ai toujours essayé de te tirer vers le haut, tu as choisi les bas-fonds de l’âme humaine. »
Et par la suite devant les témoignages des proches des accusés, elle leur renvoie :« Je voudrais faire remarquer à ces femmes, ces mamans, ces sœurs, qui toutes parlent de leur mari, leur père, leur frère comme d’un homme exceptionnel : j’avais le même à la maison ! »
« Libération » parle de « l’effrayante banalité des 50 accusés », Dominique Pelicot étant traité à part.
Le troisième enseignement est celui de la soumission chimique qui semble se développer de plus en plus. Et dans ce crime c’est encore plus souvent un proche qui utilise cette manipulation. La députée Sandrine Josso qui a fait elle-même l’objet d’une soumission chimique par un collègue l’explique sans détour : « On est le plus souvent drogué par un proche »Cette député préconise d’établir un parcours fléché de soins pour les personnes estimant avoir été droguées. Car cette réalité est encore très méconnue par les victimes et aussi par les professions médicales qui devraient être formées à détecter les cas de soumission chimique. Gisèle Pélicot a consulté de nombreux médecins car elle avait des pertes de mémoire, au point que ses proches pensaient à un cas d’Alzheimer précoce. Aucun médecin n’a eu l’idée d’une drogue et par conséquent de prescrire une analyse
Le quatrième enseignement est celui du retard français concernant le consentement. Beaucoup de législation des pays comparables à la France, la Belgique, le Canada ont lié le viol à l’absence de consentement.
D’ailleurs La France a signé la convention d’Istanbul de 2011 qui fait ce lien, mais pour l’instant le droit positif français n’a pas réalisé cette évolution. L’article du Code pénal qui définit le viol est l’article 222-23 :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »
Lors du procès de Mazan, le viol était caractérisé par « la surprise » qui ne pouvait être discuté.
Mais la Justice française a aggravé son cas. Dans un jugement de 2018 qui concernait des accusations contre Gérald Darmanin qui était alors ministre du budget, il est écrit :« Le défaut de consentement ne suffit pas à caractériser le viol. Encore faut-il que le mis en cause ait eu conscience d’imposer un acte sexuel par violence, menace, contrainte ou surprise ».
Pourtant à chaque interrogatoire, le président de la cour criminelle du Vaucluse a demandé : « Avez-vous d’une manière ou d’une autre recueilli le consentement de Mme Pelicot ? » Et systématiquement l’accusé répondait non. Ils ne l’ont pas recueilli, ils n’ont pas cherché à le faire. Certains ont même dit ne pas avoir cherché à voir son visage.
La journaliste Céline Rastello a expliqué :« Et il y a un phénomène qui est très intéressant, qui est que depuis l’affaire, depuis le procès Pelicot, il y a beaucoup de femmes qui nous ont confié relire leur histoire passée à l’aune de cette notion et elles sont nombreuses à se demander si elles avaient vraiment consenti.
Est-ce qu’elles n’avaient pas plutôt cédé pour de mauvaises raisons ? Ou est-ce qu’elles ne s’étaient pas réellement interrogées ? […]
Il y a cette idée forte aussi dans le consentement qu’on commence à voir émerger, mais qui est une notion très nouvelle qui est qu’on ne donne pas son consentement une bonne fois pour toutes, on ne donne pas son consentement en entrant dans la chambre de quelqu’un. Son consentement, on le donne pour des choses spécifiques.
Prosaïquement, ce n’est pas parce qu’on est toute nue dans le lit de quelqu’un qu’on a donné son consentement pour les cinq prochaines heures à venir. Ça dépend de ce qui va se passer, ce consentement, il est révocable et il est spécifique. Et ça, ce sont des choses nouvelles qui commencent à être connues encore une fois dans le cerveau des gens.»
Le cinquième enseignement découle directement du consentement : le viol conjugal.
Pendant longtemps cette notion, dans un univers patriarcal, de domination masculine et de prédominance du désir sexuel masculin n’était pas envisagé.
L’historienne Aïcha Limbada, autrice de l’essai « La nuit de noces, une histoire de l’intimité conjugale » rappelle que la notion prégnante était plutôt celle du devoir conjugal. Le viol conjugal constitue une notion beaucoup plus récente qui repose entièrement sur la nécessité du consentement.
Chaque homme doit faire son introspection et remettre sur le métier ses croyances, son éducation pour parvenir à intégrer cette réalité : ce n’est pas parce que je vis en couple avec une femme ou un homme, et le mariage ne change rien à cela, qu’il ne faut pas s’assurer du consentement de son partenaire avant tout ébat sexuel.Je m’arrêterais provisoirement à un sixième enseignement alors qu’il en existe encore d’autres : L’avocat a une obligation éthique dans son action de défendre.
Longtemps j’ai cru, que l’avocat avait tous les droits pour défendre son client. L’avocate de Dominique Pelicot, Me Béatrice Zavarro a été remarquable de ce point de vue. Elle a défendu son client sans jamais agresser la victime ou remettre en cause ses paroles. D’autres avocats ont franchi toutes les limites, en déclarant qu’« il y a viol et viol », en croyant percevoir des mouvements de bassin de Giséle Pelicot dans les vidéos projetées, laissant entendre un début de participation au viol ou d’autres vilenies encore.
Or, grâce à ce procès j’ai appris que les avocats étaient tenus de se conformer à un code déontologie. Or voici ce qu’on peut lire dans l’article 3 de ce code :
« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. »
Probité, dignité, humanité et délicatesse… Force est de constater que certains se sont beaucoup éloignés de cette éthique.Pour terminer, il me semble pertinent de redonner la parole à cette femme admirable qui s’est tenue debout devant ceux qui l’ont violée et qui a fait changer la honte du camp de la victime vers celui des criminels. Elle a dit lors de l’audience du 23 octobre :
« J’ai choisi de renoncer au huis clos car j’ai voulu que toutes les femmes victimes de viols, pas seulement sous soumission chimique, puissent se dire “Madame Pelicot l’a fait, on pourra le faire” […]. Je voulais qu’elles n’aient plus honte. Quand on est violée, on a honte. Mais ce n’est pas à nous d’avoir honte. C’est à eux d’avoir honte. Je n’exprime ici ni ma colère ni ma haine, seulement ma volonté et ma détermination à ce qu’on fasse évoluer la société. »
C’est avec un courage et une lucidité incroyable qu’elle s’est avancée à la barre et devant tous ces hommes accusés de viol aggravé sur elle, elle a oublié son cas personnel pour parler de l’avenir :
« Voilà, pour moi le mal est fait, mais je le fais pour les autres parce que j’aurais souhaité pouvoir entendre un tel témoignage. Ça m’aurait aidé si ça avait été le cas. »
Dans sa prise de parole, à l’issue de l’énoncé du verdict à l’égard des 51 accusés, elle a conclu :
« J’ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s’y sont tenus. Je n’ai jamais regretté cette décision. J’ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Je vous remercie. »
-
Mardi 17 décembre 2024
« Et à la fin ce sont les islamistes qui gagnent ! »Réflexion suite à la victoire des islamistes sur Bachar El AssadCette histoire commence en 1979. Je l’avais raconté dans la série consacrée au livre d’Amin Maalouf : « Le naufrage des civilisations. ». La révolution iranienne nous paraissait ouvrir un horizon radieux. Autour du vieux barbu assis en tailleur sous un pommier, à Neauphle le Château, il y avait plusieurs hommes sympathiques qui parlaient de liberté, de justice, de droits de l’homme. Très rapidement, ils seront balayés, tués, emprisonnés ou contraints à l’exil. Le vieux barbu n’était pas sage, il était islamiste d’obédience chiite : « Vous ne pouvez pas comprendre ».
En 1979, il y eut un autre évènement : l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique pour consolider un pouvoir communiste aux abois. Car différentes ethnies, regroupées autour de chefs de guerre ne voulaient pas que le communisme remettent en cause leurs traditions locales et leur religion. musulmane. Nous savons maintenant que le secrétaire d’état américain Zbignizw Brzezinski, dit « Zbig » avait convaincu le président des Etats-Unis Carter d’aider et d’armer les rebelles avant que l’URSS intervienne. Les américains avaient appelés cette opération « cyclone ».
L’Union soviétique avait, à l’époque, réagi à une intervention américaine. Une fois l’armée rouge en Afghanistan, l’aide américaine aux rebelles s’est déployée de manière de plus en plus vigoureuse. J’avais aussi narré cette histoire : « Nous avons maintenant l’occasion de donner à l’URSS sa guerre du Vietnam. » disait Zbigniew Brzezinski.
Nous connaissons la suite, les soviétiques partiront, vaincus, après avoir épuisé énormément de force et de ressources.
Ils avaient bien subi leur Viet Nam. Mais il y eut une grande différence, la révolution vietnamienne qui a chassé les américains de son territoire a créé des liens d’amitié et de collaboration fidèle avec la grande puissance qui l’avait aidé à se débarrasser des américains. Rien de tel en Afghanistan. D’abord Ben Laden qui avait profité de l’aide américaine va créer Al Qaïda et frapper la pays qui l’a aidé par les attentats du 11 septembre 2001.
Parallèlement les chefs de guerre et les ethnies vont utiliser les armes américaines pour s’entretuer dans une guerre civile meurtrière. Ce sera la frange la plus islamiste, la plus radicale « Les talibans » qui l’emportera. Après avoir été chassé du pouvoir par les américains qui voulaient punir Al Qaida et son chef, ils reviendront après le départ des américains, voulu par Trump, avec les même valeurs obscurantistes qui donnent une image délétère de la pratique de l’islam contemporain.
En Algérie, quand en janvier 1992, le pouvoir autoritaire du FLN a tenté un processus électoral et des élections législatives libres, les résultats du premier tour ont donné une victoire nette au Front islamique du salut (FIS) qui veut mettre en place une république islamique. L’armée interrompt le processus électoral et une guerre civile terrible va s’en suivre pendant dix ans. Il ne faut pas parler de ces choses là en Algérie, Kamel Daoud a commis l’irréparable en écrivant « Houris ». L’écrivain explique que « les islamistes ont perdu militairement mais gagné politiquement ». Les islamistes imposent leur règles et leur vision sociétale dans une Algérie où le pouvoir économique reste aux mains du FLN et des chefs militaires qui ont considéré que leur fortune et leur tranquillité méritait bien qu’on laisse la société aux mains des religieux afin que ces derniers se tiennent tranquille. L’Algérie nous donne donc l’exemple d’un pays où même si les islamistes sont battus par les armes, ils reviennent dans la société.
Et puis il y a eu les printemps arabes. Ils commencèrent en Tunisie, le 17 décembre 2010. Plusieurs dirigeants autoritaires furent chassés. En Egypte, Hosni Moubarak fut démis et même condamné à la prison. En Occident, nous aimions ces jeunes manifestants de la place Tahrir du Caire. Ces jeunes dénonçaient les abus de la police égyptienne, la corruption, le manque de liberté d’expression,le chômage etc.. Mais les élections ont envoyé au pouvoir les frères musulmans, des islamistes qui n’avaient aucune réponse à ces questions et qui sur certains points étaient à l’antipode de ce qui était demandé notamment la liberté d’expression. L’armée a repris le pouvoir et un nouveau général dirige l’Egypte avec une main de fer plus dure que celle de Moubarak.
Il serait long de faire le tour de tous les États ayant été touché par les printemps arabes. Mais il faut bien parler de la Syrie.
Bachar El Assad était un tyran abominable qui martyrisait son peuple. Le 29 mai 2012, le ministre français des affaires étrangères, Laurent Fabius, déclarait :
« M. Bachar Al-Assad est un assassin. Il faut qu’il quitte le pouvoir et le plus tôt sera le mieux »
Il est resté au pouvoir jusqu’en 2024. Il y a eu beaucoup de manquements de la part des occidentaux qui n’ont pas soutenu les forces démocratiques. Par la suite ces forces démocratiques ont été anéanties par l’action de l’aviation russe et des milices du Hezbollah qui combattaient avec beaucoup plus de mollesse les islamistes de DAESH.
Finalement la Russie, l’Iran et le Hezbollah trop affaibli n’avaient plus les moyens de défendre le régime de Bachar el Assad. Et c’est ainsi que des forces coalisées ont pu enfin chasser ce monstre. Nous ne pouvons que nous réjouir avec les Syriens de la défaite de cet homme a la tête d’un État mafieux pratiquant le trafic de drogue. A la tête des forces coalisées un mouvement islamiste : Hayat Tahrir al-Cham ou HTC (en français, Organisation de libération du Levant). En anglais le Levant s’écrit al-Sham d’où le sigle HTS.
A leur tête, un homme, Ahmed Hussein al-Chara qui se faisait appeler jusque là par un nom de guerre : Abou Mohammed al-Joulani.
Ahmed al-Chara est le fils d’un économiste, acquis aux idéaux de la gauche nationaliste arabe. Il suivra un chemin différent de son père. Il abandonnera des études de médecine pour poursuivre le jihad, la guerre sainte musulmane.
Il quitte l’université de Damas et se rend à Bagdad pour faire allégeance à Al-Qaïda en Irak, dirigé par Abou Moussab Al-Zarqaoui. Il fera de la prison dans les geôles de l’armée américaine. Quand il sort de prison il se rapproche d’Abou Bakr al-Baghdadi le fondateur de l’Etat islamique, c’est-à-dire Daesh.
Et c’est au nom de Daesh qu’il retourne en Syrie où il fondera le Front al-Nosra le 23 janvier 2012. Il rompt avec Abou Bakr al-Baghdadi pour se rapprocher d’Al Qaïda.
En 2016, le Front al-Nosra annonce qu’il rompt aussi avec al-Qaïda et il prend le nouveau nom avec lequel on le connait aujourd’hui. Il a donc poursuivi un chemin dans lequel il s’est affilié successivement au pire des islamistes
Dans la partition de la Syrie, son mouvement s’implantera à Idlib et sa région. Il y appliquera la charia de stricte obédience.
Il acceptera le parrainage du président turc Erdogan proche des frères musulmans pour prendre le pouvoir à Damas.
Donc en Syrie, c’est aussi les islamistes qui gagnent à la fin !
Beaucoup dénoncent la responsabilité de l’Occident. C’est vrai en partie. En Irak, la guerre déclenchée par G.W. Busch a eu une responsabilité directe dans la création de Daesh.
En Syrie c’est plus compliqué, l’Occident a surtout brillé son inaction, mais c’est bien la Russie et l’Iran qui ont aidé Bachar El Assad à combattre les forces démocratiques et la Turquie qui en se battant contre les Kurdes, seuls à combattre réellement l’État islamique, qui sont les principaux responsables de ce désastre.
En Égypte et en Algérie, le rôle de l’Occident est vraiment ténu. Dans ces deux pays quand des élections libres ont donné la parole au peuple, celui-ci a choisi des islamistes.
Ainsi si les occidentaux doivent assumer leur responsabilité, les musulmans de ces pays ne peuvent pas être exonérés de toute responsabilité dans le développement de la part la plus archaïque et la plus brutale de leur religion.
-
Vendredi 6 décembre 2024
« Ça va très mal finir !»Nicolas Sarkozy à propos de la présidence Macron en octobre 2017Dès octobre 2017, soit 4 mois après l’élection d’Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy avait émis ce jugement sur le parcours présidentiel de Macron. Vous trouverez cette information dans « Le Point » ou « L’Express ». Cette phrase a été prononcée 1 an avant le début du mouvement des gilets jaunes.
Et, après ce mouvement, après la pandémie du COVID 19, après les guerres d’Ukraine et de Gaza, après une réélection en 2022 sans campagne, sans débat, uniquement pour éviter le Rassemblement National et enfin une dissolution en 2024 donnant une chambre ingouvernable, ces propos inquiétants rencontrent une situation politique que nous voyons dégénérer devant nous.
Nicolas Sarkozy avait donné les raisons de ce jugement :« Il n’a pas d’emprise sur le pays. Il ne s’adresse qu’à la France qui gagne, pas à celle qui perd. Il est déconnecté. »
Emmanuel Macron a, en effet, une responsabilité immense dans la situation actuelle.
D’abord il a échoué à réaliser sa promesse de faire reculer l’extrême droite au cours de son mandat. Ces 7 ans n’ont été qu’une progression inexorable du rassemblement national, conséquence de la montée des colères, des exaspérations et même de la haine à l’égard du Président de la République.
 Probablement est-il utile de rappeler, ce que le candidat élu, après une longue marche solitaire au milieu de la cour Napoléon du palais du Louvre, va promettre, le 7 mai 2017, à ses partisans dans la joie de son triomphe et aux français dans l’attente d’une nouvelle ère :
Probablement est-il utile de rappeler, ce que le candidat élu, après une longue marche solitaire au milieu de la cour Napoléon du palais du Louvre, va promettre, le 7 mai 2017, à ses partisans dans la joie de son triomphe et aux français dans l’attente d’une nouvelle ère : « Je sais nos désaccords, je les respecterai mais je resterai fidèle à cet engagement pris : je protégerai la République. […]
Je ferai tout dans les cinq années qui viennent pour qu’ils n’aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes.[…]
Je le sais, la tâche sera dure, je vous dirai à chaque fois la vérité, mais votre ferveur, votre énergie, votre courage toujours me porteront. (…) Je rassemblerai et réconcilierai parce que je veux l’unité de notre peuple et de notre pays. […]
Et enfin mes amis, je vous servirai. Je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise : liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m’avez donnée. Je vous servirai avec amour. »Chacun jugera de la distance entre les promesses et la réalité du pouvoir exercé par ce jeune homme parvenu au sommet de l’État à 39 ans.
Depuis ce jour de mai 2017, il a eu souvent des propos maladroits, blessants, méprisants rendant son pouvoir encore plus insupportable à beaucoup.
Il a aussi échoué à rétablir les comptes publics, à éviter la dégradation de la balance commerciale et l’augmentation de la dette. Il n’a pas pu faire cesser la politique du « quoi qu’il en coûte » à temps. Et il a laissé le déficit public déraper en 2024 sans réagir ni sur les dépenses, ni sur les recettes. Le déficit, pour lequel la prévision annonçait 4,4 %, ce qui était déjà trop élevé par rapport à l’engagement de 3%, dépasse les 6 % en 2024.
Il n’a pas réagi, le nouvel Obs le raconte dans son article du 3 décembre 2024 : « Les trois fautes de Macron » :
« Le premier acte se noue le 8 avril 2024. Le chef de l’État participe, contrairement à son habitude, à la réunion des présidents de groupes de la majorité qui se tient tous les lundis à l’Elysée. « J’entends parler de projet de loi de finances rectificative. Je n’en vois pas l’intérêt. » Puis, au sujet des pistes d’économies réclamées par son ministre Bruno Le Maire : « Il ne faut pas que ça soit la foire à la saucisse. » […] Alors que depuis la fin de 2023, la direction du Trésor alerte sur une baisse inquiétante des recettes et un déficit qui dérape dangereusement, le président décide… de ne rien faire. Les élections européennes s’approchent, il ne faut surtout pas inquiéter les électeurs qui pourraient se détourner du parti présidentiel. Au lieu d’intervenir en urgence, Emmanuel Macron procrastine. Pendant ce temps, les finances publiques flambent.»
Cette première erreur va en entraîner une seconde, il va prendre la décision de dissoudre la chambre des députés, le soir des élections européennes catastrophiques pour son camp. Il ne veut probablement pas affronter le débat budgétaire de la fin de l’année, avec sa majorité relative et la révélation de ce dérapage budgétaire.
Beaucoup explique qu’il ne pensait pas que les partis de gauche, qui s’étaient déchirés et insultés au cours de la campagne européenne, puissent se réconcilier et présenter un front uni, indispensable pour gagner dans un mode de scrutin uninominal à deux tours. Peut être aussi, c’est une hypothèse personnelle, espérait t’il secrètement une victoire du rassemblement national qui aurait, selon toute vraisemblance, devant la difficulté de la tâche et son manque de compétence évidente, perdu de sa crédibilité et son principal argument pour gagner les présidentielles : les français n’avaient jamais essayé son programme jusque là.Lors de ces élections législatives, les français se sont mobilisés et la gauche est arrivée unie aux élections.
L’assemblée qui a été élue est fracturée en 3 blocs à peu près équivalent : La Gauche (NFP) 33% le Bloc central macroniste 29%, l’Extrême Droite 25%, avec une quatrième force, beaucoup plus faible, la droite LR 8%. Chaque bloc refuse de faire alliance avec aucun des deux autres. Les blocs de gauche et central sont même très divisés en leur sein.
Finalement Emmanuel Macron va aussi échouer dans le domaine économique dont pourtant lui-même et ses partisans prétendaient qu’il constituait le point fort de son mandat.Il a accentué la politique de l’offre qui avait été initié par Hollande. Cette politique repose sur l’idée qu’on peut favoriser la croissance en créant un cadre fiscal et normatif très favorable aux entreprises, ce qui leur permet d’être plus compétitive, rentable, d’investir et in fine de créer de l’emploi.
Cette politique de fiscalité très arrangeante pour les entreprises diminue beaucoup les recettes de l’État sauf si un surcroit important de croissance les augmente en volume bien que les taux soient plus faibles. Cela n’est pas arrivé et aujourd’hui les plans de licenciement sont d’une ampleur telle que le chômage est de nouveau en train de repartir à la hausse.
La responsabilité d’Emmanuel Macron dans cette situation désastreuse d’une France qui s’enfonce dans la crise, de services publics qui se détériorent, avec un déficit abyssal, une dette qui ne sert pas à investir mais à payer les frais de fonctionnement, une crédibilité internationale de plus en plus faible, est immense.
 Mais il n’est pas seul responsable, les députés qu’ils soient de son camp comme de l’opposition de gauche ou d’extrême gauche ont aussi une responsabilité énorme. Comment ne pas être choqué par le sourire narquois de Mélenchon en train d’assister, dans les tribunes du palais Bourbon, à la chute de Barnier et qui ne veut aucun compromis, mais espère des présidentielles anticipées qu’il pense pouvoir gagner. Marine Le Pen est dans un état d’esprit similaire. Et les chefs des différents partis du bloc central comme de la droite LR sont aussi, avant tout, préoccupés des élections futures et non de la situation des français et de la France.
Mais il n’est pas seul responsable, les députés qu’ils soient de son camp comme de l’opposition de gauche ou d’extrême gauche ont aussi une responsabilité énorme. Comment ne pas être choqué par le sourire narquois de Mélenchon en train d’assister, dans les tribunes du palais Bourbon, à la chute de Barnier et qui ne veut aucun compromis, mais espère des présidentielles anticipées qu’il pense pouvoir gagner. Marine Le Pen est dans un état d’esprit similaire. Et les chefs des différents partis du bloc central comme de la droite LR sont aussi, avant tout, préoccupés des élections futures et non de la situation des français et de la France.
Incapable de discuter, de débattre. Chaque fois qu’un plateau de télévision présente deux députés d’un camp différent, il n’y a qu’invectives et dialogue de sourd.
Ce n’est pas une élection présidentielle qui règlera ce problème d’une France divisée en trois et demi et qui ne sait plus se parler, ne sait plus faire société ensemble et se réfugie largement dans le déni des contraintes et des contradictions auxquelles la France doit faire face. -
Jeudi 28 novembre 2024
« Il était tétanisé et son visage est devenu très pâle lorsqu’il a réalisé que l’équipage du DC-10 était complètement noir »Simon Diasolua parlant de Mohammed Ali alors qu’il avait pour mission de piloter l’avion qui devait emmener le boxeur au ZaïreC’est une histoire que j’ai lue dans le numéro du Nouvel Obs qui célébrait les 60 ans de l’hebdomadaire créé par Jean Daniel.
Le Nouvel Obs pour fêter ses 60 ans, s’est offert 60 éclats de joie partagés par des personnalités. Parmi ces articles qui fêtaient le pouvoir de la joie, j’ai été particulièrement marqué par celui de l’écrivaine camerounaise Hemley Boum : « Quand Mohamed Ali a découvert que le pilote de son avion était noir… ».
Cet épisode a été aussi décrit sur le site de RTL Info : « Nos destins se sont croisés avant le combat du siècle à Kinshasa ».
Je pense que tout le monde connaît Mohammed Ali, probablement le plus grand boxeur de l’Histoire. Mais il fut aussi un militant de la cause noire luttant contre les injustices et les humiliations qui étaient infligées à ses frères de couleur par le pouvoir et la domination blanche.
Il refusa notamment à aller se battre dans l’armée américaine au Viet-Nam. Lorsqu’on lui reprocha son attitude, il répondit :
« Aucun vietcong ne m’a jamais traité de nègre »
En 1974, il devait se rendre au Zaïre affronter George Foreman pour reconquérir le titre mondial qui lui avait été retiré en raison de son refus d’aller se battre au Viet-Nam.
Pour s’y rendre, un avion d’Air Zaïre avait été mis à sa disposition. Cet avion était piloté par des africains. Le commandant de bord était Simon Diasolua.
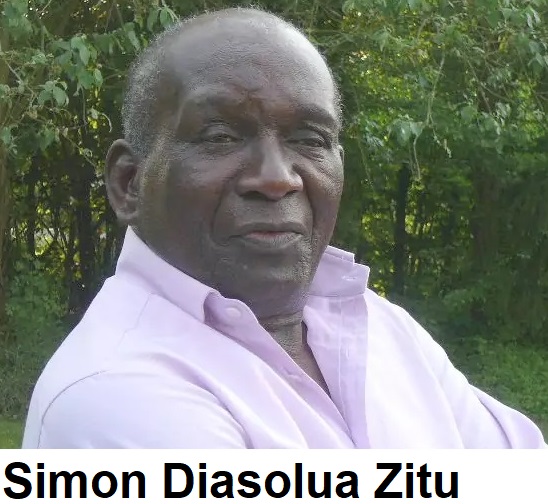 Simon Diasolua Zitu, né à Léopold ville (actuellement Kinshasa), le 14 Novembre 1942, est l’un des deux premiers pilotes Congolais en 1965. Il fut pilote de ligne pendant 37 ans, puis instructeur pilote DC-10, il a également occupé le poste d’Administrateur Directeur des Opérations au sein de la compagnie aérienne étatique Air Zaïre. Expert en enquêtes d’accidents et Consultant en aéronautique. Il a écrit ses mémoires dans un livre intitulé « Entre ciel et terre, Confidences d’un pilote de ligne congolais » paru aux éditions Le Harmattan en 2014.
Simon Diasolua Zitu, né à Léopold ville (actuellement Kinshasa), le 14 Novembre 1942, est l’un des deux premiers pilotes Congolais en 1965. Il fut pilote de ligne pendant 37 ans, puis instructeur pilote DC-10, il a également occupé le poste d’Administrateur Directeur des Opérations au sein de la compagnie aérienne étatique Air Zaïre. Expert en enquêtes d’accidents et Consultant en aéronautique. Il a écrit ses mémoires dans un livre intitulé « Entre ciel et terre, Confidences d’un pilote de ligne congolais » paru aux éditions Le Harmattan en 2014. Et dans ce livre il conte sa rencontre avec Mohamed Ali en 1974 :
« Nos destins se sont croisés un mois et demi avant le combat du siècle à Kinshasa. J’étais pilote pour la compagnie Air Zaïre, qui était à l’époque la compagnie aérienne nationale de la République démocratique du Congo. Je devais piloter l’avion que Mohamed Ali allait prendre pour se rendre à Kinshasa. Le boxeur allait affronter George Foreman »
Les deux hommes ont été présentés lors de la conférence de presse que l’Américain donnait à l’aéroport français. Lorsqu’il a entendu que Simon allait être son pilote, il n’a pas caché sa surprise en comprenant que l’équipage du vol était « noir ».
« Il m’a dit qu’il était fier et étonné d’être piloté par un équipage noir. »
Au moment de l’embarquement, les pilotes ont accepté que Mohamed Ali s’installe avec eux dans le cockpit, les consignes de sécurité étaient beaucoup plus souples à l’époque. Mais lorsque le boxeur est entré, il est resté figé quelques instants.
« Il était tétanisé et son visage est devenu très pâle lorsqu’il a réalisé que l’équipage du DC-10 était complètement noir. »
Mohamed Ali lui a lancé, inquiet :
« Il n’y a pas de blanc ? Je croyais que c’était une blague. »
Le pilote, amusé par la situation, lui a confirmé que toutes les personnes de l’équipage étaient noires. Ensuite, il a demandé au boxeur de s’installer et de mettre sa ceinture.
« Je comprenais sa surprise. J’avais fait un entrainement sur DC-10 en Californie l’année d’avant et les Américains me demandaient si j’étais un vrai pilote. Comme eux, Mohamed Ali était surpris de voir un homme noir aux commandes d’un avion car il n’en avait jamais vu. Je ne lui en voulais pas, bien au contraire. »
Je trouve absolument édifiant que même un homme comme Mohamed Ali, défenseur acharné de la cause noire, de la lutte contre la discrimination contre les noirs, puisse avoir une telle réaction de défiance parce que la situation qui se présente à lui est en dehors de ses schémas mentaux, de ce que la vie jusqu’à ce moment lui avait prescrit : les blancs savent piloter des avions, pas les noirs….
Simon Diasolua va parvenir par sa compréhension de la situation et son calme à rassurer le boxeur et à changer son appréhension en fierté. Quand Mohammed Ali débarque à Kinshasa, il déclare aux journalistes qui l’attendent :
« C’est un sentiment de liberté que je n’ai pas ressenti depuis longtemps. Ce n’est pas rien de voler dans un avion piloté par des Noirs, non ?
C’est vraiment étrange pour nous les Afro-Américains. Nous n’aurions jamais pu imaginer une chose pareille !
A chaque fois que nous regardons la télé, on nous montre Tarzan et les Indigènes et la jungle. On ne nous parle jamais des Africains qui sont plus intelligents que nous ne le sommes. Ils parlent anglais, français et africain. »Deux ans plus tard, Simon a croisé le sportif par hasard à l’aéroport de Los Angeles. Lorsque l’Américain l’a reconnu, il a crié :
« My pilot ! »
-
Lundi 18 novembre 2024
«N’importe qui ! Même un affabulateur, un menteur, un escroc, un violeur ! Tout sauf une femme !»Une invitée d’une émission consacrée à l’élection de Donald Trump comme 47ème président des États-UnisLe monde est tellement compliqué que l’ambition de le comprendre est peut être hors de notre portée. J’ai renoncé à conserver en exergue de mon blog cette phrase que Guillaume Erner avait prononcée lors de la première matinale de France Culture qu’il avait animée : « Comprendre le monde c’est déjà le transformer ».
Il faut probablement être beaucoup plus humble. A ce stade, la parole de sagesse de Rachid Benzine écrite dans son livre « Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? » semble plus appropriée à la situation : « Le contraire du savoir, ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes. »
L’ignorance, dans la mesure où elle est comprise et intégrée, constitue une connaissance précieuse : je sais que je ne sais pas. Dans l’Apologie de Socrate, Platon a rapporté ce propos de son maître en philosophie : « Ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir ! »
Dans son expression publique, Donald Trump semble très éloigné de cette connaissance.
Comment dialoguer avec quelqu’un qui est figé dans ses certitudes ?
Comment vivre en démocratie et organiser le dissensus entre citoyens avec des gens pétris de certitudes ? Je n’ai pas la réponse à cette question.
Donald Trump et ses partisans sont dans cette dérive. Lui qui considère que le réchauffement climatique est une blague. En 2020, visitant la Californie, ravagée par des incendies violents et meurtriers, Donal Trump a nié l’impact du changement climatique sur les phénomènes d’incendies et a déclaré :
« Ça finira par se refroidir, vous verrez. »
Lorsqu’un responsable local de l’agence de protection des ressources naturelles de Californie, à Sacramento lui répond : « J’aimerais que la science dise cela » le président a rétorqué :
« Je ne pense pas que la science sache vraiment. »
Nous sommes entrés dans un monde où la vérité est une opinion parmi d’autre et où un homme, sans étude scientifique, se croit autorisé de contester l’avis de professeurs spécialisés dans le domaine où ils interviennent.
En 2024, Donald Trump persiste et a inventé un slogan qu’il a entonné à de multiples reprises au cours de sa campagne, et qu’il a encore répété lors de son discours de victoire :
« Drill, baby, drill ! » (« Fore, bébé, fore »).
Dans un article du « Nouvel Obs » nous pouvons lire :« « On va forer [du pétrole] comme des malades ! », a promis le magnat aux électeurs américains. « Nous avons plus d’or liquide que n’importe quel pays dans le monde. Plus que l’Arabie saoudite ou la Russie », s’est-il encore félicité dans son discours de victoire, en référence au pétrole et au gaz. « Pendant la campagne, il n’a eu de cesse de dire qu’il fallait “réparer l’économie américaine” en offrant l’énergie la moins chère du monde, et donc en accélérant notamment la fragmentation hydraulique en vue de produire des gaz de schistes », observe Pierre Blanc, professeur à Sciences-Po Bordeaux et Bordeaux Sciences Agro. »
Deux documentaires, d’une heure chacun, publiés par Public Sénat montre ce que fut la première présidence de Donald Trump par celles et ceux qui l’ont vécu au plus près « America First, partie 1 – L’Europe doit payer » et « America First, partie 2 – L’ennemi au Moyen-Orient ». C’est affligeant ! Affligeant dans la prise de décision, dans l’argumentation pour répondre aux partenaires, dans le manque de maîtrise des dossiers et des procédures. Pourquoi Donal Trump a t’il à nouveau gagné, jusqu’au vote populaire ? :
Beaucoup d’analyses ont considéré que le triomphe de Trump était avant tout économique : C’est le pouvoir d’achat des américains dans leur quotidien et aussi pour leur achat de logement qui s’est dégradé pendant la présidence Biden. Tous les économistes nous racontaient que la politique économique de Biden était remarquable. Je prends pour exemple cet article du Monde : « America is back » :
« A huit mois de l’élection présidentielle, le tableau économique est reluisant. […] le chômage est au plus bas ou presque avec un taux de 3,7 % de la population active ; les salaires réels augmentent, notamment au bas de l’échelle ; le pays produit plus de pétrole que jamais, finance un immense plan d’investissement dans l’énergie et les microprocesseurs, et se lance à corps perdu dans l’intelligence artificielle, ce qui fait s’envoler Wall Street. Plus personne ne parle de stagnation séculaire comme dans les années 2010, tandis que le mot « Rust Belt », ceinture de la rouille, nommant les Etats désindustrialisés ayant fait l’élection de Donald Trump en 2016, a disparu des journaux. Premier constat, l’Amérique redevient plus industrielle. Donald Trump en avait rêvé, Joe Biden l’a fait. »
L’article du Monde évoquait bien l’inflation mais pour souligner que Biden était arrivé à la faire diminuer lors des derniers mois. Il semble que nombre d’électeurs américains ont eu une vision différente. Ce décalage arrive quand on donne trop d’importance aux chiffres macroéconomiques et aux moyennes et qu’on ne regarde pas la vie réelle des gens.
D’autres analyses ont insisté sur le sujet de l’immigration qui a déferlé sans maîtrise sur les Etats-Unis pendant la présidence Biden. Enfin d’autres ont considéré que le vote Trump était aussi un vote anti woke qui était défendu par l’aile gauche du Parti démocrate. Probablement qu’il est nécessaire de convoquer toutes ces causes pour expliquer l’élection de cet histrion dangereux qu’est Donald Trump. Mais Thomas Snégoroff y a ajouté une supplémentaire : le masculinisme.
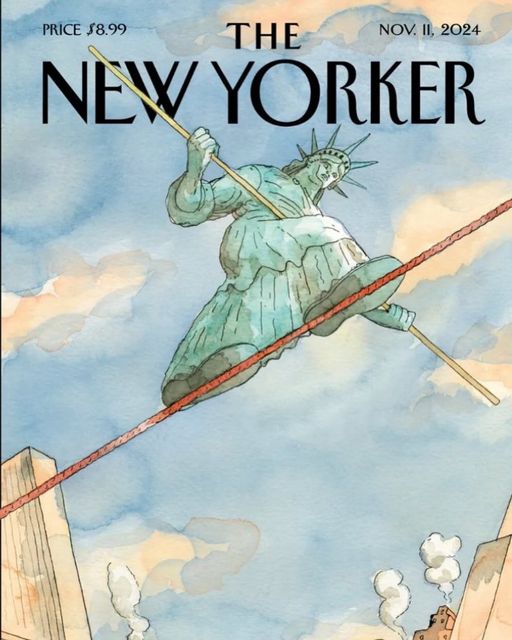 Et lors d’une des nombreuses émissions que j’ai écoutées depuis le 5 novembre, j’ai entendu une intervenante tenir ces propos « N’importe qui ! Même un affabulateur, un menteur, un escroc, un violeur ! Tout sauf une femme !».
Et lors d’une des nombreuses émissions que j’ai écoutées depuis le 5 novembre, j’ai entendu une intervenante tenir ces propos « N’importe qui ! Même un affabulateur, un menteur, un escroc, un violeur ! Tout sauf une femme !».Force est de constater que Trump a perdu une fois contre un homme et a gagné deux fois, chaque fois, contre une femme.
Quand on compare le résultat des démocrates sur 4 ans Kamela Harris a perdu 7,5 millions d’électeurs par rapport à Biden. Et puis le vote des hommes hispaniques a progressé de 18 % en faveur de Trump entre 2020 et 2024. Cette population réputée plus conservatrice peut aussi apparaître comme un signe de ce vote « genré ».
Mais c’est dans l’émission « C Politique » de France 5 du dimanche 17 novembre que cet aspect du vote du 5 novembre a été le mieux contextualisé. Elon Musk est un libertarien, mais l’intellectuel qui l’influence est Peter Thiel, fondateur de Paypal et lui soutient Donal Trump depuis sa première candidature en 2016. Il est aussi l’inspirateur déclaré de Cyrus Vance le vice Président élu. Or cet homme a écrit qu’il ne croyait plus en la démocratie depuis que les femmes avaient obtenu le droit de vote. C’est aussi écrit sur sa page Wikipedia.
J’ai trouvé sur le site le « Grand Continent » une page consacrée aux écrits de cet homme né en 1967 à Frankfort sur le Main et sur laquelle on peut lire :
« Je ne crois plus désormais que la liberté et la démocratie sont compatibles. […] Les années 1920 furent la dernière décennie dans l’histoire américaine où l’on pouvait être parfaitement optimiste à propos de la politique. Depuis 1920, l’augmentation considérable des bénéficiaires de l’aide sociale et l’extension du droit de vote aux femmes – deux coups notoirement durs pour les libertariens – ont fait de la notion de « démocratie capitaliste » un oxymore. »
C’est à la fois extrêmement inquiétant pour la démocratie et bien sûr une attaque en règle contre les femmes. Il me semble donc qu’il ne faut pas sous estimer cette dimension du vote Trump : surtout pas une femme !
-
Mercredi 6 novembre 2024
« Les nouvelles sont comme les feuilles d’automne. »Christian Bobin « Tout le Monde est occupé »Donald Trump a été élu 47ème président des Etats-Unis et nous sommes en automne.
 En automne, nous sommes subjugués par la beauté des couleurs des arbres : dorées, orangées et rouges.
En automne, nous sommes subjugués par la beauté des couleurs des arbres : dorées, orangées et rouges. En outre, les feuilles se détachent des branches et virevoltent jusqu’au sol qu’elles recouvrent d’un tapis humide et parfumé.
La flamboyance de ces couleurs est un vrai enchantement.
J’ai lu un article sur le site de France 3 Occitanie concernant ce sujet et qui tente d’expliquer ce phénomène. C’est cet article que je souhaite partager aujourd’hui : « Pourquoi les arbres s’illuminent en automne ? »
La feuille d’un arbre est un capteur solaire. Les arbres transforment la lumière du soleil en énergie et en nutriments, notamment des glucides, par un mécanisme appelé photosynthèse.
En automne, l’ensoleillement diminue : l’arbre se met alors au repos et va vivre au ralenti. Quand les températures chutent, la sève ne circule plus. Les arbres à feuilles caduques, en opposition aux conifères, perdent leur feuillage en automne.
Ce phénomène se produit quand les conditions de la photosynthèse ne sont plus là. Il est directement lié à la diminution de la durée du jour.
Quand la durée des journées diminue, la photosynthèse est moins efficace. Pour l’arbre, la dépense énergétique pour maintenir ses feuilles devient alors trop lourde et il va s’en débarrasser.
Mais avant cela, les feuilles doivent dépérir. A la baisse de l’ensoleillement et des températures, l’arbre va boucher ses vaisseaux de sève et petit à petit, les pigments de chlorophylle vont disparaître.
Un représentant du conservatoire botanique explique :
« Les pigments jaunes et orangés étaient déjà présents, mais il ne reste qu’eux. Le vert s’estompe et fait ainsi place à ces couleurs extraordinaires. Ce faisant, l’arbre récupère tous les sucres possibles et tombe en dormance. Les quantités de pigments varient d’une espèce à l’autre, d’une feuille à l’autre, selon l’exposition au soleil. Le pigment rouge, lui, par contre n’était pas présent dans la feuille. Il apparaît avec l’arrivée du froid sur certains érables ou les chênes rouges par exemple ».
 L’article explique aussi que l’automne est une période essentielle pour l’arbre qui va assimiler les réserves de sucre accumulées au cours de l’été et les stocker. Il va grandir et mettre en réserve des nutriments dans ses parties souterraines. Ainsi, les racines se développent en hiver. C’est de ce processus que s’inspire le proverbe « À la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine ». La sainte Catherine qui se fête le 25 novembre.
L’article explique aussi que l’automne est une période essentielle pour l’arbre qui va assimiler les réserves de sucre accumulées au cours de l’été et les stocker. Il va grandir et mettre en réserve des nutriments dans ses parties souterraines. Ainsi, les racines se développent en hiver. C’est de ce processus que s’inspire le proverbe « À la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine ». La sainte Catherine qui se fête le 25 novembre.En outre, les feuilles qui tombent à terre se décomposent par l’action des insectes et des vers de terre. Les champignons assimilent et décomposent aussi la matière. Et au fur et à mesure, la microfaune du sol, avec les acariens notamment, mais aussi toutes sortes de microorganismes, produit du compost disponible pour les racines.
Je redonne le lien vers cette explication automnale : « Pourquoi les arbres s’illuminent en automne ? ».
Sur le site de l’Office National des Forêts, une autre page donne des explications : « Quelle est l’influence de l’automne sur l’arbre ? ».
La phrase complète de Christian Bobin dont j’ai extrait l’exergue est la suivante : « Les nouvelles sont comme les feuilles d’automne. Le vent qui les porte les malmène. »
-
Mardi 5 novembre 2024
« Trump n’est que le symptôme d’une crise plus profonde »Gérard AraudNous sommes le mardi qui suit le premier lundi de novembre, quatre ans après la dernière élection présidentielle américaine.
 Ce jour-là a lieu la nouvelle élection présidentielle américaine. Il est plus juste de dire que c’est le dernier jour de l’élection puisque nombre d’américains ont déjà voté par anticipation. En effet, sur les quelque 244 millions d’Américains appelés aux urnes pour l’élection présidentielle, 78 millions, soit 31,9 %, avaient déjà voté de manière anticipée à la date du 3 novembre, selon les données de l’université de Floride. Le vote par anticipation – qu’il soit en personne ou par correspondance – permet aux Américains d’exprimer leur suffrage plus tôt. Cette option est valable dans tous les États du pays, mais la date d’ouverture du vote anticipé varie beaucoup d’un État à l’autre : il peut débuter jusqu’à cinquante jours avant l’élection, ou seulement cinq jours avant.
Ce jour-là a lieu la nouvelle élection présidentielle américaine. Il est plus juste de dire que c’est le dernier jour de l’élection puisque nombre d’américains ont déjà voté par anticipation. En effet, sur les quelque 244 millions d’Américains appelés aux urnes pour l’élection présidentielle, 78 millions, soit 31,9 %, avaient déjà voté de manière anticipée à la date du 3 novembre, selon les données de l’université de Floride. Le vote par anticipation – qu’il soit en personne ou par correspondance – permet aux Américains d’exprimer leur suffrage plus tôt. Cette option est valable dans tous les États du pays, mais la date d’ouverture du vote anticipé varie beaucoup d’un État à l’autre : il peut débuter jusqu’à cinquante jours avant l’élection, ou seulement cinq jours avant. Cela peut paraître curieux, pour nous français qui avons l’habitude de voter le dimanche, de fixer le jour officiel de l’élection, un mardi.
Cela montre toute la différence entre la France laïque et les Etats-Unis otages des bondieuseries. Car le dimanche est le jour sacré des chrétiens, il ne saurait être question pour les américains croyants de « souiller » ce jour dédié à dieu pour une simple raison profane d’organisation du pouvoir terrestre. Alors qu’en France, notre révolution a conduit à considérer « sacré » la République. Nous avons donc pris, sans vergogne, le jour sacré des religieux pour organiser le vote qui se déroule dans les locaux de notre temple sacré : « L’école ».
Mais « Ouest France » nous en dit davantage sur ce mardi de l’élection.La toute première élection présidentielle américaine se tient le 7 janvier 1789, un mercredi. Ce jour-là, les grands électeurs se réunissent pour désigner le président George Washington. Trois ans après, en 1792, une loi est votée pour fixer officiellement les règles de l’Election Day. Elle prévoit que la réunion des grands électeurs prenne place aussi le mercredi, mais cette fois-ci le premier de décembre.
Les différents États doivent alors élire leurs représentants dans les 34 jours avant cette date.
Les élections se déroulent donc en novembre, comme aujourd’hui. Et pour une raison purement pratique : à cette période, les moissons sont terminées, condition primordiale dans la société rurale de l’époque. Autre raison : cette période précède les tempêtes hivernales du Nord-Est des États-Unis, qui auraient empêché certains électeurs de se déplacer.Un problème se pose cependant : comme chaque État vote à un moment différent, les résultats des voisins commencent à influencer les électeurs, à mesure que les moyens de communication se développent. Une date unique est donc instituée en 1845 : le mardi suivant le premier lundi de novembre.
Pourquoi un mardi ? Car contrairement à la France, il est hors de question que le jour du seigneur des chrétiens, le dimanche, soit perturbé. On écarte donc le dimanche, mais aussi le lundi, car cela aurait contraint certaines personnes à voyager le dimanche pour voter à temps. Le vote officiel des grands électeurs a pour sa part toujours lieu en décembre. Aujourd’hui, c’est donc toujours cette même règle qui est appliquée. Les électeurs se rendent aux urnes un mardi, entre le 2 et le 8 novembre, selon les années.
Nous savons que les américains n’élisent pas directement leur président mais élisent des Grands électeurs disposant d’un mandat impératif les obligeant à voter, lors de la réunion du collège des grands électeurs, pour le candidat dont ils ont porté les couleurs.
J’ai tenté d’expliquer ce mécanisme lors d’un mot du jour qui faisait une analyse assez détaillée de l’élection précédente dans laquelle Biden avait battu Trump : « Des chiffres et des électeurs. ».
Je rappelle les points saillants de cette analyse assez dérangeante :- L’affirmation péremptoire que Biden a battu nettement Trump au vote populaire se heurte à la réalité que cet écart s’explique par le vote de deux Etats : la Californie et de New York. En effet ces deux états cumulés représentaient un avantage pour Biden de 7 096 598 voix, c’est-à-dire un nombre de voix supérieur à la différence observée au niveau national.
- Si on élargit un peu la focale à 6 Etats en ajoutant aux deux premiers l’Illinois (Chicago), le Massachusetts (Boston), le Maryland (Baltimore) et aussi le District of Columbia qui même si la démographie en est plus modeste, présente la particularité d’abriter la capitale : Washington, l’avantage pour Biden monte à 10,5 millions d’électeurs.
- Ces 6 Etats représentent 25% des électeurs américains, dès lors, l’ensemble des 44 autres Etats qui représentent donc 75% des électeurs ont voté pour Trump et lui ont donné un avantage de 3,5 millions d’électeurs pour un score relatif de 51,5% à 48,5%.
- Enfin concernant les grands électeurs, j’ai pu démontrer que l’inversion du vote de 21 459 électeurs de Biden vers Trump, c’est-à-dire 0,014% du corps électoral, aurait conduit à un match nul 269 grands électeurs chacun.
Je finissais cet article sur la question de savoir comment expliquer qu’autant d’américains aient voté pour Trump bien qu’ils l’ait vu à l’œuvre pendant 4 ans.
J’osais cette nuance : L’explication simpliste est que 74 000 000 d’américains sont des extrémistes ou des ignorants. La réalité est certainement plus complexe.
Nous sommes 4 ans plus tard, Trump a incité certains de ses partisans à monter à l’assaut du Capitole dans une insurrection qui a stupéfié le monde, il a été condamné pour des faits dans lesquels il montre une attitude qui devrait horrifier tous les évangélistes qui votent pour lui, c’est-à-dire 50% de ses électeurs, il est poursuivi pour d’autres délits, pendant toute la campagne il a tenu des propos d’une violence, d’un esprit de vengeance, d’une volonté de s’attaquer aux institutions démocratiques (« je serais dictateur une journée », « après vous n’aurez plus besoin de voter »), des documents sérieux montrent ses liens étroits et surprenants avec la Russie de Poutine …
Et pourtant, il est tout à fait possible qu’il redevienne Président des Etats-Unis. A celles et ceux qui s’interrogent s’il pourra briguer un nouveau mandat dans 4 ans, la réponse est négative. Seuls deux mandats sont tolérés, ils peuvent être successifs ou disjoints.
Comment expliquer cela ?Gérard Araud, ancien ambassadeur de France à Washington expliquait déjà en 2021 : dans un article de 2021 : «Trump n’est que le symptôme d’une crise plus profonde». Il existe un malaise au sein de la classe moyenne américaine : .
« Le génie [de Trump] a été de comprendre en 2016 l’existence d’un malaise américain que personne n’avait vu venir, car les résultats macro-économiques à la fin du mandat d’Obama étaient bons. Il a su parler aux oubliés, et son génie fut aussi d’arriver à continuer à être leur voix durant son mandat sans être récupéré par les républicains «classiques» qui pensaient pouvoir le manipuler. Cette rébellion est toujours là, et restera. »
Il faut comprendre que la démocratie libérale n’est possible que s’il existe une grande classe moyenne qui la fait vivre et qui est content de son sort ou au moins a l’espoir raisonnable que son avenir et celui de leur enfants seront meilleurs :
« Il y a deux cause possibles à cette rébellion . La première est économique. En effet, si quarante ans de néolibéralisme auront permis aux pays émergents de sortir de la pauvreté, les classes moyennes inférieures ainsi que la classe ouvrière des sociétés occidentales auront vu leur niveau de vie stagner, voire diminuer. Ce phénomène a provoqué une hausse du chômage et un accroissement des inégalités. Ce n’est pas un hasard si la révolte touche particulièrement le Midwest où le chômage, lié à la désindustrialisation, est fort. » .
La mondialisation et le libre échange ont eu des conséquences sur les classes moyennes occidentales non réfléchies par les élites qui ne voyaient que « la mondialisation heureuse ». Ce déclassement économique est certainement premier dans le malaise.
« La seconde est identitaire. La majorité des électeurs de Trump sont des hommes blancs ; plus de 60 % des hommes blancs ont voté pour lui. Sur fond de changement démographiques, l’Amérique blanche sent qu’elle perd le pouvoir. De ce point de vue, le trumpisme peut apparaître comme le baroud d’honneur de cette Amérique-là. » .
Il me semble qu’il existe une autre dimension que Gérard Araud n’aborde pas: c’est le recul de l’hégémonie occidentale sur les affaires du monde. Un monde qui conteste de plus en plus le leadership américain.
Probablement de manière assez confuse, car les américains moyens ne sont pas connus pour leur vision géopolitique, mais le fait que l’homme occidental soit contesté dans le monde est certainement aussi un élément du malaise. A cela s’ajoute, aux États-Unis, une immigration massive non régulée, non accueillie qui heurtent profondément les américains qui voient des tentes et des squats s’installer de plus en plus nombreux dans leurs villes.
Enfin, il y a aussi, à l’intérieur de la société, des fractures sociétales provoquées par des démocrates délaissant les intérêts et les valeurs de la classe moyenne pour entrer dans un progressisme de plus en plus rapide, intolérant à ceux qui pensent différemment pour s’abimer dans le communautarisme, dans des luttes sectorielles où chaque particularité est mis en avant : .
« Les démocrates de leur côté n’utilisaient pas de message national, ils demandaient, pour simplifier aux noirs de voter pour leur camp simplement en raison de leur couleur de peau ! Cela n’a pas vraiment changé. Quand on regarde leur vision de la constitution du gouvernement américain, nous avons l’impression que c’est une répartition avec deux noirs, deux latinos, six femmes et un gay. C’est d’ailleurs présenté comme cela dans la presse. On peut se demander quel est le message national des Démocrates… Les démocrates ne voient plus les citoyens américains qu’à travers leurs identités. La «cancel culture» dans les universités, même si elle reste extrêmement minoritaire, exacerbe ce phénomène. S’il y a un bon exemple des erreurs des Démocrates, c’est la question des transgenres. Si l’on doit le respect à ces derniers, ils ne représentent qu’une infime minorité de la population. En faire un sujet national n’était sans doute pas un bon calcul. » .
Et maintenant, on constate que des latinos et des noirs, surtout les hommes, commencent à voter de plus en plus pour Trump. Je pense que des évolutions sociétales que la Gauche démocrate défend avec ce sentiment d’un combat du bien contre le mal heurtent profondément le conservatisme de ces populations pour qui tout cela va trop vite et trop loin. Trump a su avec ruse et intuition capter ce malaise pour nourrir sa quête du pouvoir. Désormais, pour des raisons électorales il est allé jusqu’à flatter les franges les plus réactionnaires de son électorat qui sont anti-avortement, anti-LGBT, anti-féministe. Ces minorités ne pourraient pas imposer ainsi leurs idées, s’il n’existait pas dans une plus large partie de la population les malaises économiques, les malaises identitaires et les malaises sociétaux .
Je pense qu’en Europe et en France nous sommes sur la même voie, d’un malaise profond de la société auquel prétendent répondre des forces illibérales, des extrêmes droite contre lesquelles la gauche largement dans le déni des problèmes qui se posent, n’a comme seule réponse la diabolisation de l’adversaire et la fuite en avant.
Quand il y a un terrain fertile, des Trump peuvent pousser.
-
Mardi 22 octobre 2024
« Une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d’une troisième. »Arthur KoestlerHeureusement qu’il y a Jean-Louis Bourlanges pour oser monter au créneau et dire simplement, à la fin de l’émission du « nouvel esprit public du 20 octobre 2024 » :
« J’ai été très frappé, de l’atmosphère de dénonciation indignée qui a accueilli un propos du Président de la République qui me paraissait très franchement tout à fait ordinaire et normal. […] De rappeler qu’Israël est un produit de la communauté internationale et qu’il a été créé par une résolution de l’ONU ne me parait ni faux, ni attentatoire à la dignité de ce pays. Je crois que c’est plutôt le signe de la culpabilité profonde de ladite communauté internationale à l’égard du peuple juif qui a été massacré par les nazis dans un climat d’indifférence assez général des Alliés. […] Cela ne sous-estime pas le rôle des forces armées d’Israël dans la protection de [l’Etat].
Il s’agit là d’une indignation tout à fait inopportune ! »Au départ il y a une déclaration d’Emmanuel Macron, lors du conseil des ministres du mardi 15 octobre, qui était tenue à usage interne et qui n’aurait pas dû être rendu public.
Ces propos sont les suivants :
« Nétanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l’ONU […] Et par conséquent ce n’est pas le moment de s’affranchir des décisions de l’ONU »
Si on veut juridiquement être exact, il ne s’agit pas d’une « décision » mais d’une « résolution », qui porte le numéro 181 et qui propose le partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe et un statut particulier et international pour Jérusalem.
Cette proposition sera adoptée le 29 novembre 1947 à la majorité des 2/3.
Sans cette résolution, la Déclaration d’établissement de l’État n’aurait pas pu être proclamée le 14 mai 1948, dernier jour du mandat britannique sur la Palestine dans le hall du Musée d’art de Tel Aviv, par David Ben Gourion, président de l’Agence juive.
Benyamin Nétanyahou conteste vigoureusement ce point de vue.
« Le Monde » sans relativiser la position du premier ministre israélien a simplement rapporté sa réaction :
« Dans la soirée, le chef du gouvernement israélien lui a répondu par communiqué. « Un rappel au président de la France : ce n’est pas la résolution de l’ONU qui a établi l’Etat d’Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d’indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de la Shoah – notamment du régime de Vichy en France », ajoutant que « l’ONU a approuvé des centaines de décisions antisémites contre l’Etat d’Israël »
Ce même journal a rapporté les propos de Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) sans commentaire :
« Laisser penser que la création de l’État d’Israël est le fruit d’une décision politique de l’ONU, c’est méconnaître à la fois l’histoire centenaire du sionisme et le sacrifice de milliers d’entre eux pour établir l’État d’Israël. »
Il a ajouté cette phrase :
« A l’heure où l’antisémitisme se nourrit de l’antisionisme, ces propos renforcent dangereusement le camp de ceux qui contestent la légitimité du droit à l’existence d’Israël »
« Le Figaro » a également pris fait et cause pour le premier ministre d’Israël : « Créé par une décision de l’ONU » : comment Emmanuel Macron a simplifié l’histoire d’Israël.
« L’Opinion » se fait pédagogue et explique pourquoi Macron se trompe.
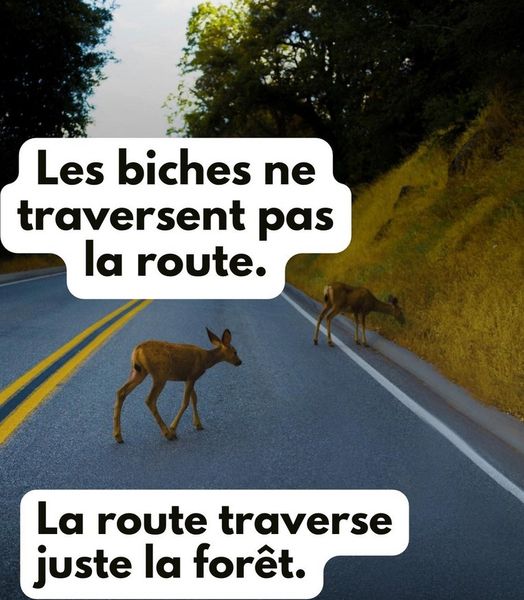 Avant de continuer à plonger dans toute cette complexité et l’article de l’Opinion, il faut se rappeler que l’imaginaire des peuples se forge à travers des récits auxquels ils adhérent.
Avant de continuer à plonger dans toute cette complexité et l’article de l’Opinion, il faut se rappeler que l’imaginaire des peuples se forge à travers des récits auxquels ils adhérent. Ces récits sont fondamentaux pour créer une unité et un sens au destin commun. Mais un récit peut être très dangereux ou plus précisément porteur de violence et de guerre s’il est en contradiction absolue avec ceux d’un autre peuple. La paix n’est possible que si on écoute aussi les récits de l’autre et qu’on est capable d’en tenir compte.
Je prends comme exemple cette illustration. Le récit de l’homme dans sa voiture c’est que la biche traverse la route. Mais le récit de la biche est que c’est la route de l’homme qui traverse la forêt. Il n’y a pas une vérité qui s’impose, mais deux récits qui s’opposent. En est-il un plus pertinent que l’autre ? les deux récits sont-ils conciliables ?
Le Journaliste de l’Opinion affirme que ce qui donne naissance à l’État d’Israël, ce ne sont pas les Nations unies, ni la SDN, c’est le mouvement sioniste, c’est-à-dire la volonté d’une partie des Juifs de retourner dans ce qu’ils considèrent comme leur terre ancestrale, la Palestine. Et cela date de la fin du XIXᵉ siècle. Le premier mouvement de migration juive en Palestine – des Juifs venant de Russie essentiellement, mais aussi du Yémen – remonte à 1881.
Toujours selon ce journaliste, ce sont ces migrations qui incitent les britanniques à faire leur fameuse déclaration Balfour.
Arthur Koestler, (1905 – 1983), célèbre auteur du « zéro et de l’infini » est un juif hongrois qui dans un premier temps va adhérer à la cause sioniste révisionniste et deviendra même, pendant un court moment, le secrétaire du chef de ce mouvement Vladimir Jabotinsky. Il sera remplacé, dans ce rôle, plus tard par le père de Benyamin Nétanyahou. Ce mouvement prône un sionisme armé et agressif pour imposer la présence juive, par la force, aux arabes vivants sur le territoire convoité.
Après avoir vécu beaucoup d’expériences dans sa vie, Arthur Koestler a décrit la déclaration Balfour par cette phrase éloquente : « Une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d’une troisième. » .
Le journaliste continue sa démonstration en rappelant que la résolution 181 n’a pas été acceptée par la partie arabe et que donc la création d’Israël na pas pu avoir lieu sur la base de cette résolution refusée par une des parties.
En conséquence c’est la proclamation par Ben Gourion suivie de la victoire des troupes israéliennes, lors de la guerre d’indépendance, qui a permis de réaliser le rêve des sionistes..
Le mot du jour a déjà évoqué beaucoup des épisodes de cette histoire tragique qui continuent à faire tant de morts.
L’analyse la plus intelligente que j’ai entendu sur la confrontation des récits est celle qu’en a donné Dominique Moïsi : .
« Quand Israël naît […] en 1948, […] Pour le monde Arabe, c’est le dernier phénomène colonial de l’histoire européenne qui est anachronique. Pour les Israéliens, c’est avec quelque retard, le dernier phénomène national de l’histoire européenne du 19ème siècle.[…] Et en fait ce conflit de calendrier n’a jamais été surmonté.»
C’était le mot du jour du lundi 19 octobre 2015.
Cette analyse de Moïsi nécessite un acte fondateur qui autorise la nation juive à obtenir un État. Seule la résolution 181 peut donner cette légitimé, directement issue de l’horreur de la Shoah.
Parce que le récit de Nétanyahou, du président du CRIF ou du journaliste de l’Opinion signifie quoi ?
Des gens venus d’Europe se sont installés sur un territoire occupé par d’autres habitants. Leurs représentants se sont entendus avec l’État occidental le plus colonialiste de l’Histoire pour obtenir une déclaration les autorisant à occuper ce territoire.
Par la suite et le refus des indigènes de se soumettre, le peuple venant d’Europe, armé par les occidentaux, s’est emparé du territoire par la guerre. Cela s’appelle un fait colonial, la colonisation de cette terre entre la Méditerranée et le Jourdain par des personnes venues d’Occident.
Le récit, qui veut que le mouvement sioniste presque sans aide et s’imposant par la force aux arabes a créé un État d’Israël, valide absolument les thèses décoloniales des États du sud global et celles des jeunesses occidentales des Universités. Contrairement à l’affirmation du président du CRIF ce ne sont pas les propos de Macron, mais ce récit qui donne les meilleurs arguments aux ennemis les plus féroces d’Israël.
Et si certains évoquent une légitimité historique datant de 2000 ou 3000 ans. Rappeler simplement ce que signifierait ce concept de « premier occupant » aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle Zélande suffit à en dévoiler l’inanité. Bien sûr, le récit de Nétanyahou autorise tout, jusqu’à l’annexion de la partie arabe du plan de partage, puisque l’État est la résultante de la force armée et des conquêtes.
Ce n’est pas ainsi que la Paix pourra arriver sur ce territoire. Il me semble qu’il vaut mieux s’en tenir au récit que la création d’Israël a été rendue possible par une résolution de l’ONU et qu’il faut trouver un chemin pour que la partie arabe du partage puisse également trouver un État dans lequel elle pourra se reconnaître.
Vous pourrez lire avec intérêt cet article du journal de Montréal « Le Devoir » : « La déclaration Balfour: juste et injuste à la fois? ».
Vous y trouverez cette idée d’un grand penseur juif, Martin Buber d’une « injustice minimale », c’est-à-dire limiter au strict minimum l’injustice causée aux Arabes en ne permettant aux Juifs de s’installer que sur une partie de la Palestine.
-
Mercredi 9 octobre 2024
« Résister pour la Paix »Hannah Assouline et Sonia Terrab, documentaire des guerrières de la paixUn an déjà !
Le 7 octobre 2023 est un jour de haine et de massacre.
On ne sait pas comment le nommer. Certains parlent de pogrom. Mais ce mot n’est pas approprié, car il désignait des massacres de juifs de la diaspora perpétrés par une population majoritaire dans un pays dirigé par des gouvernants antisémites. Cette fois, les crimes ont été commis à l’intérieur de l’État qui avait été justement conçu pour protéger les juifs.
Comment parler de ce jour et des suivants et de toute l’année qui s’est écoulée depuis ?
Beaucoup regardent cet évènement à travers le filtre de leur croyance et de leurs certitudes. Ils s’enferment dans une vision binaire dans laquelle, ils défendent le camp du bien contre le camp du mal. Ce sont deux blocs de haine qui s’affrontent et qui entrainent une grande partie du monde dans cette polarisation dans laquelle l’empathie pour les souffrances de l’autre est anéantie par l’indifférence et la déshumanisation de l’adversaire.
Dès le 9 octobre, le ministre israélien de la Défense. Yoav Gallant a eu cette phrase :
« Nous combattons des animaux humains, et nous agissons en conséquence. »
Que ce soit pendant la shoah, pendant le génocide arménien ou celui des tutsis au Rwanda, la première étape de l’horreur a été de traiter, celui qu’on voulait massacrer, d’animal ou d’insecte. C’est à dire ne plus reconnaître son humanité. Mais les islamistes qui ont attaqué, massacré, torturé les juifs et autres habitants d’Israël qu’ils ont trouvé sur leur route ont agi de même : c’est uniquement parce qu’ils ne voyaient pas dans ces israéliens leurs semblables humains qu’ils ont été capable de perpétrer ces atrocités.
Est il difficile de comprendre que ce 7 octobre constitue un traumatisme pour les israéliens mais aussi pour les juifs du monde entier en raison de leur histoire, de toutes les fois où ils ont été massacrés en nombre, jusqu’à la folie nazi où il fut question de leur anéantissement ?
Et cette fois le massacre a eu lieu sur la terre de l’État qui avait été créé pour empêcher cela. Est-il difficile de comprendre leur désarroi, leur peur et leur colère quand, dès le 8 octobre, des actes d’antisémitisme ont été perpétrés à travers le monde. Se souvient t’on, qu’en France après que Mohamed Merah ait tué 4 juifs dont 3 enfants dans une école juive, le 19 mars 2012, à Toulouse, les actes antisémites se sont multipliés ?
Ils sont victimes d’un acte innommable et on déchaine encore de la violence contre eux. En 2012, il n’y eut aucune manifestation de soutien à la communauté juive, après ces faits.
Existe-t’il un humain, digne de ce nom, qui pourrait ne pas être plein d’empathie pour les juifs du monde entier ?
Parallèlement, existe-t’il un humain qui n’est pas capable d’exprimer une immense compassion pour la souffrance des palestiniens depuis la nakba ?
Israël a répliqué. Depuis un an, Gaza est sous les bombes, les habitations ont été rasées, des dizaines de milliers de gazaouis ont été tués ou blessés, dont beaucoup de femmes, d’enfants et de civils. Les massacreurs du Hamas se cachent dans les tunnels et s’octroient la majorité de l’aide alimentaire. Les autres habitants vivent dans des conditions abominables d’hygiène, d’alimentation et de santé.
Est-il légitime d’arriver à une telle désolation ? Suffit-il de dire que tout est de la faute du Hamas ?
Il existe encore tant d’autres questions. Israël a t’il un plan pour après la guerre ou Netanyahou pense t’il rester dans un état de guerre permanent ? Croit t’il que tout peut se régler par la force ?
Plusieurs fois j’ai entendu des journalistes rapporter des propos de responsables israéliens qui disaient que la paix est trop difficile pour Israël qui a trop à perdre, trop à concéder pour l’obtenir. Ce qu’Israël veut, c’est la sécurité !
Mais la sécurité sans la paix est ce possible ? Les avis sont très tranchés. Je lis que des israéliens disent que le 7 octobre montre qu’il n’est pas possible de donner un État palestinien à de tels individus, ce serait incompatible avec la sécurité d’Israël. Hubert Vedrine et d’autres pensent exactement le contraire : Si un État palestinien avait existé, il n’y aurait pas eu de 7 octobre.
Mais Vedrine ajoute que pour pouvoir parler aux palestiniens il faut un interlocuteur.
Quand en Afrique du Sud, un homme d’État, Frederik de Klerk, a voulu sortir de l’engrenage infernal de la violence, il est allé chercher un militant noir en prison : Nelson Mandela. Or, depuis, qu’il est au pouvoir Netanyahou a systématiquement agi pour ne pas avoir d’interlocuteur. Car évidemment ce mouvement islamiste, régressif qui veut détruire « l’entité sioniste » ne peut pas être un interlocuteur. Quelle meilleure solution pour un homme qui ne veut pas d’un État palestinien que de tout faire pour qu’apparaisse comme représentant des palestiniens un mouvement aussi repoussoir que l’est le Hamas et son chef actuel Yahya Sinwar ? Yahya Sinwar et Benjamin Netanyahou sont des ennemis indispensables l’un à l’autre, car l’un et l’autre ne veulent pas d’une solution pacifique.
La force ne peut pas tout. Elie Barnavi écrit très justement :
« Israël gagne des batailles, mais est en train de perdre la guerre »
En outre, le monde est en train de changer. Les occidentaux n’ont plus le monopole pour proclamer ce qui est juste et les moyens de l’imposer. A l’intérieur de l’Occident, une grande partie de la jeunesse n’a plus la même lecture des évènements que leurs ainés.
Pour les occidentaux seniors, l’État d’Israël a été rendu nécessaire en raison de la shoah : il fallait un État pour les juifs.
Les historiens ont montré que ce n’était pas uniquement la culpabilité de ce qu’ils avaient fait ou laissé faire qui a justifié le comportement des pays occidentaux et de l’Union soviétique pour la création de l’État d’Israël en 1948. Une analyse des échanges diplomatiques de cette époque montre une autre réalité. Dans une Europe exsangue après 6 ans de guerre, le nombre considérable de réfugiés juifs revenant des camps constituait un problème d’intendance immense. Créer un État et y envoyer les survivants et réfugiés représentaient une solution commode pour les européens.
Mais le récit est celui ci : la shoah justifiait la création d’Israël et faisait des juifs les victimes qu’il fallait soutenir et aider.
Pour les pays non occidentaux, qu’on appelle imparfaitement le « Sud global » et pour une grande partie de la jeunesse occidentale, la création de l’État d’Israël correspond à une réalité coloniale. Le grand crime de l’Histoire n’est pas que la shoah, mais aussi la domination coloniale et brutale de l’Occident sur le reste du monde. On peut contester cette vision en disant que le peuple juif n’a pas de métropole d’où il est parti, en conquérant, et dans lequel il peut revenir, si la situation se dégrade. D’ailleurs, beaucoup d’habitants d’Israël viennent des pays arabes. Ces communautés juives, en raison des discriminations subies ont été conduites à rejoindre Israël. Donc pour simplifier : les israéliens juifs ne peuvent pas rentrer chez eux, parce qu’il n’y a pas de « chez eux » ailleurs.
Mais ces arguments rationnels ne convainquent pas les tenants de l’autre thèse : pour deux raisons : la première c’est qu’il y a bien eu une arrivée massive d’une population venant d’Europe qui a pris des terres aux autochtones qui habitaient la Palestine. Et la seconde, qui est plus essentielle encore pour cette thèse : c’est la manière totalement disproportionnée des armes et des moyens de répression dont disposent les israéliens et la disproportion du nombre de morts entre les deux camps. Cette réalité est celle qui existait dans la domination coloniale occidentale. Dans cette pensée, les palestiniens sont les victimes et les israéliens les bourreaux. Cette thèse est expliquée par Gilles Kepel qui ne la partage pas et Didier Fassin qui me semble la partager.
Ce dernier, enseignant à Princeton et membre du Collège de France, avance « le spectre d’un génocide à Gaza ». A l’appui de sa démonstration, il prend l’exemple du génocide des Hereros, exterminés par les colons allemands à la suite d’une révolte en 1904 dans l’actuelle Namibie, et évoque de « préoccupantes similitudes » entre la riposte israélienne au massacre du 7 octobre et cette page d’histoire retenue comme le premier génocide du XXe siècle, préfigurateur de la Shoah. C’est ce qu’il explique dans un débat l’opposant frontalement à Eva Illouz dans le Nouvel Obs : « L’entretien croisé entre Didier Fassin et Eva Illouz », dans lequel il écrit :
« [Les israélien] ont progressivement privé les Palestiniens de leur espace vital, de leur souveraineté et de leur liberté. C’est ce qui amène Maxime Rodinson à parler de « fait colonial ». S’agissant de la paix, le non-respect par les Israéliens des accords d’Oslo, dénoncés dès leur signature, montre que la seule option envisagée par l’État hébreu supposait le rejet du droit international et le renoncement aux droits des Palestiniens. »
Je ne crois pas qu’en restant figé dans de tels récits, il sera possible d’avancer.
C’est pourquoi pour garder l’optimisme il vaut mieux se tourner vers des personnes, en l’occurrence des femmes, des militantes de l’espoir, qui continuent à se battre pour la Paix.
Hannah Assouline et Sonia Terrab deux guerrières de la Paix ont produit un documentaire diffusé sur Public Sénat et que vous pouvez voir derrière ce lien : « Résister pour la Paix ». Il commence le 4 octobre 2023, 3 jours avant… Et il se poursuit après.
Sonia Terrab est née, en 1986, à Meknès au Maroc, elle est d’origine arabo musulmane. Hanna Assouline, est née en 1990 à Paris, son père, David Assouline est né en 1959 à Sefrou au Maroc, dans une famille juive marocaine.
C’est ce documentaire que je souhaite partager aujourd’hui, dans ce monde de chaos, de violence, d’incompréhension, pour qu’il reste une lueur, une espérance.
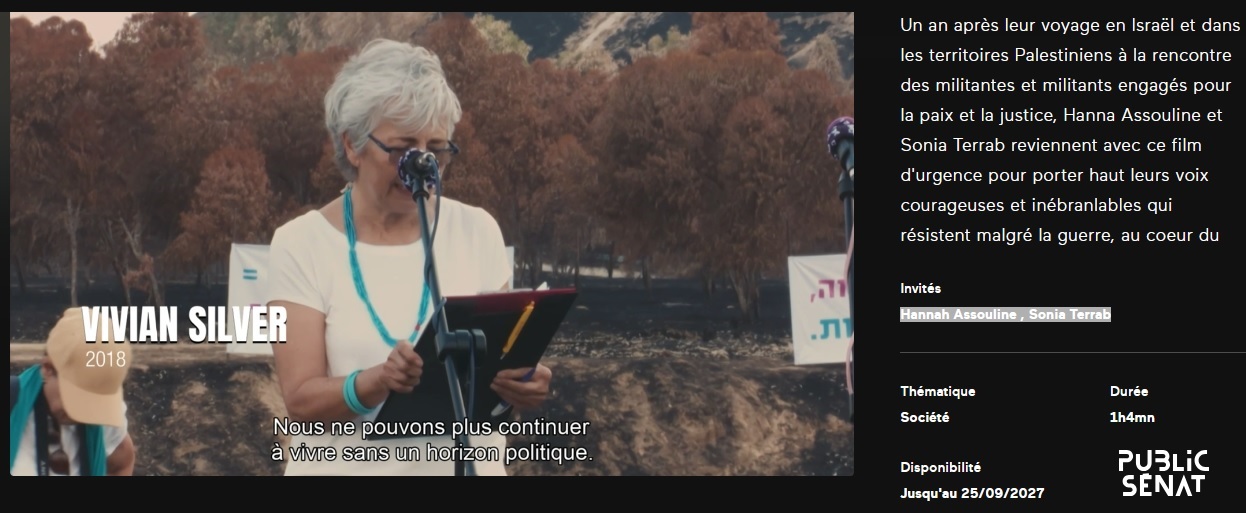
-
Vendredi 4 Octobre 2024
« La Neuvième symphonie de Mahler est l’oméga de la Musique. »Herbert von KarajanLa Phrase complète de Karajan est la suivante :
« La Messe en si de Bach et la Neuvième de Mahler sont l’alpha
et l’oméga de la musique. »Bien sûr il existe des chefs d’oeuvre écrits avant Bach et d’autres après Mahler, mais Karajan veut montrer un arc qui relie deux piliers sur lesquels repose la musique européenne : le premier une messe catholique écrit par un luthérien et achevé en 1749, le second l’aboutissement de la symphonie romantique créée, le 26 juillet 1912, à Vienne sous la direction de Bruno Walter, un peu plus d’un an après la mort de Gustav Mahler, le 18 mai 1911, à 51 ans.
 Mahler avait écrit le premier avril 1910 : « Mise au net, la partition de ma Neuvième est
Mahler avait écrit le premier avril 1910 : « Mise au net, la partition de ma Neuvième est
terminée. ». Il l’avait donc terminé un an avant sa mort, il ne l’a jamais entendue autrement que dans une réduction au piano et dans sa vie intérieure.Concernant la musique de chambre, j’ai déjà évoqué le disque que j’emmènerai sur une île déserte : « Le quintette en ut pour D. 956. » de Franz Schubert. S’il m’était possible d’ajouter un disque de symphonie je prendrai une interprétation de la 9ème symphonie de Mahler.
Hier nous avons eu la joie d’entendre cette symphonie jouée à la Philharmonie de Paris par l’Orchestre de Paris, dirigé par son jeune et talentueux directeur musical : Klaus Mäkelä
S’il faut croire André Peyrègne, un critique ayant assisté à ce concert « Symphonie n°9. Orchestre de Paris / Klaus Mäkelä » :
« La Neuvième symphonie de Gustav Mahler fait partie de ces œuvres monumentales que l’on n’entend en concert que deux ou trois fois dans sa vie. »
Si cette assertion est exacte, j’ai déjà rempli mon quota.
J’ai pourtant eu le sentiment que ce monument mystique de l’Adieu se refusait à moi, en concert. Pourtant, le 17 février 2019, l’Orchestre Philharmonique de Vienne était de passage à Lyon et joua cette œuvre à l’Auditorium. Mais, au même moment, avec Annie et Florence, nous étions déjà à la Philharmonie de Paris, pour assister au concert d’une symphonie de Mahler encore plus rarement joué : la symphonie N°8 symphonie « des Mille » qui nécessite des effectifs démesurés. J’avais écrit un mot du jour le lendemain de ce concert : « une hymne à la sacralité de l’univers ».
Une seconde chance nous fut offerte et nous avions pris nos billets pour assister à l’interprétation de la 9eme par l’Orchestre de San Francisco sous la direction de Michael Tilson-Thomas. Mais ce concert devait avoir lieu le 7 avril 2020, temps de la Covid 19 et de confinement. Et finalement, la première fois eut lieu le 16 septembre 2022, le jour où mon frère m’annonça qu’il était atteint de la leucémie qui l’emportera 40 jours après. Gustavo Dudamel était le chef et l’Orchestre était celui dans lequel mon frère a œuvré pendant 15 ans : l’Orchestre de l’Opéra de Paris. Depuis, Nikolaj Szeps Znaider a interprété cette œuvre avec son orchestre lyonnais, lors de la dernière saison.
Beaucoup de musicologues ont parlé de la superstition de Mahler concernant la symphonie numéro 9 qui fut la dernière de Beethoven, de Schubert et aussi de Dvorak. Il tenta de biaiser, sa vraie 9ème fut en réalité sa précédente œuvre, mais pour conjurer le sort, il l’appela « Le chant de la terre ». Et puis, il n’avait pas encore totalement finalisé la symphonie qu’il numérota 9, pour commencer la composition de la 10 en 1909. Tout ceci fut vain, seul le premier mouvement de la 10 put être, à peu près, fini et la symphonie qu’il appela 9 fut bien sa dernière œuvre achevée qu’il ne put jamais entendre jouée par un orchestre.
L’œuvre est composée de 4 mouvements, le premier est extraordinaire. Alban Berg écrivit :
« Le premier mouvement de sa Symphonie n° 9 est le plus merveilleux que Mahler ait écrit. Il exprime l’amour de ce monde, pour la nature,le désir d’y vivre en paix, d’en jouir pleinement, jusqu’aux tréfonds de son être, avant que la mort, irrémédiablement,ne nous appelle. »
Mahler est dans une période douloureuse de sa vie. Sa fille ainée est morte suite à une brusque maladie, son médecin vient de lui diagnostiquer une maladie cardiaque très grave et son épouse Alma Schindler dont il se rend compte combien elle compte pour lui, s’éloigne de lui et le trompe. Ce premier mouvement émerge du silence. Bernstein entend, dans ce début, le rythme irrégulier d’un cœur qui bat :
« La première chose qu’on entend dans ce mouvement est une prémonition de la mort sous forme d’un rythme irrégulier qui, j’en suis sûr, est pour Mahler le battement irrégulier de son propre cœur. Son rythme cardiaque l’inquiétait beaucoup. Dans la dernière année de sa vie, il connaissait ce problème cardiaque, et il le nota pour en faire le début de cette symphonie. »
Par la suite ce mouvement passera par toutes les phases des émotions humaines : la tendresse, la colère, la révolte, la nostalgie, l’apaisement. Harnoncourt ou Celibidache ne voulaient pas interpréter Mahler parce qu’ils le trouvaient impudique, il mettait toutes ses émotions dans la partition. Sa fille survivante Anna disait qu’il n’a jamais rien écrit de plus accompli, tout Mahler est dans ce premier mouvement. C’est encore Bernstein qui en parle le mieux :
« Dans ce premier mouvement, c’est surtout un adieu à la tendresse, à la passion, un adieu à l’amour humain. […] Toute la symphonie parle de réminiscences, de nostalgie, de tendresse, de relations personnelles. Au milieu de cette nostalgie attristée, il y a une série d’immenses progressions, des rencontres personnelles qui tantôt marchent et tantôt échouent. Elles sont suivies de renoncements, de retraites, de redditions. Suivis de nouvelles tentatives de se souvenir, de ressaisir, de revivre les moments passionnés de la vie. […] Dès que j’arrive à la fin de ce premier mouvement, avec sa rage tempétueuse et ses aspirations, c’est comme si j’étais à la fin d’un roman de Tolstoï. Il dure près d’une demi-heure. C’est une espèce de « Guerre et Paix », et je suis toujours étonné à l’idée qu’il reste encore trois autres longs mouvements à jouer, dans lesquels Mahler fait de nouveau ses adieux à d’autres aspects de la vie. »
Les deuxièmes et troisièmes mouvements sont des danses pleines de fougues, d’ironies et de futilités. Selon Bernstein la première danse est rustique et la seconde urbaine.
Je dirai que Mahler s’amuse, essaye de se divertir entre l’immense premier mouvement et le sublime adagio final. Pour cet adagio, il vaut mieux encore laisser la parole à Leonard Bernstein qui a tant joué, étudié et aimé la musique de Mahler :
« Le mouvement est à peine discernable. L’espace entre les lignes est immense. C’est ce qui se rapproche le plus dans la musique occidentale de la notion orientale de méditation transcendantale. Mais il n’est pas encore prêt à accepter cette solution, ce « Brahma », ce néant. Et il se cramponne donc de nouveau à la vie avec amertume, ressentiment, passion. Tout au long du mouvement, Mahler alterne entre ces deux tentatives de réalisation spirituelle : l’occidentale et l’orientale. Lorsqu’il s’essouffle dans l’une, il essaie l’autre, et inversement. Il y a une série de progressions, dont la dernière n’aboutit pas. Très courte, elle essaie de les surpasser toutes, mais n’y parvient pas.
Après cela, on a soudain le sentiment qu’il laisse filer. C’est le tournant du dernier mouvement, car c’est à ce moment-là que le monde lui glisse entre les doigts. Il réussit à parvenir à une acceptation heureuse, sereine de la fin de la vie. Et il lâche prise. Et ce moment est l’une des choses les plus remarquables de toute la musique : la dernière page de cette symphonie. Qui arrive avec une étonnante lenteur, une étonnante série de silences. Mais après chacun il essaie de nouveau de ressaisir la vie, de s’y accrocher, et elle glisse de nouveau. Il y a une série de tentatives, de moins en moins réussies. Et finalement il lâche, complètement, de la plus merveilleuse façon, par le silence plus que par les notes.
A la fin du mouvement, il n’y a plus qu’une série de « fils d’araignée » : Un petit fil qui le rattache à peine à la vie. Et puis qui lâche, et puis un autre petit fil, juste un la bémol aigu, et il finit, et c’est le silence. Et finalement, l’acceptation, et tout s’éteint. »Ces pianossimos finaux que Claudio Abbado expliquait à ses musiciens par l’image suivante : « le bruit que fait la neige qui tombe sur de la neige ».
La symphonie a émergé du silence et retourne dans le silence, après être passé par des chemins tortueux de violence, de chaos, de méditation et de tendresse. Si le coeur vous en dit Gil Pressnitzer, sur le site Esprits Nomades analyse longuement cette symphonie de l’adieu et de la plénitude : « L’abîme des abîmes »
Que dire de l’interprétation de Klaus Mäkelä du haut de ses 28 ans ?
 D’abord on est frappé une nouvelle fois par la symbiose incroyable qu’il est parvenu à créer avec son Orchestre de Paris qu’il va quitter en 2027 pour devenir le directeur musical de deux orchestres qui se trouvent dans le Top 5 au niveau mondial : L’orchestre du ConcertGebouw d’Amsterdam et le Chicago symphony Orchestra.
D’abord on est frappé une nouvelle fois par la symbiose incroyable qu’il est parvenu à créer avec son Orchestre de Paris qu’il va quitter en 2027 pour devenir le directeur musical de deux orchestres qui se trouvent dans le Top 5 au niveau mondial : L’orchestre du ConcertGebouw d’Amsterdam et le Chicago symphony Orchestra. Ensuite, j’ai été ému et j’ai aimé par ce concert.
Les critiques ont été partagées. Le magazine Diapason a été déçu « Une claudicante Neuvième de Mahler par Klaus Mäkelä ». Le site ResMusica est dans le même esprit :« un beau témoignage orchestral, malheureusement dénué d’émotion, d’intériorité et de continuité. ».
André Peyrègne, déjà cité, est d’un avis opposé « On eut droit à une interprétation étourdissante, bouleversante, mémorable de cette œuvre hors du commun. ». Le plus drôle est Loïc Céry qui non seulement encense Klaus Mäkelä « Une version magistrale de la Neuvième Symphonie de Mahler par l’orchestre de Paris sous la direction de Klaus Mäkelä jeudi 3 octobre », en outre, critique les deux premiers critiques avec un argumentaire solide et structuré.
 Pour ma part, sur le site de Diapason j’ai plus simplement répondu à la première critique par ces mots :
Pour ma part, sur le site de Diapason j’ai plus simplement répondu à la première critique par ces mots : « j’ai beaucoup aimé. Évidemment que dans 40 ans, il jouera autrement ce monument, cet Omega de la musique selon Karajan. Il aura alors 68 ans et je ne serai plus en état de l’entendre.
Alors je suis très heureux et comblé d’avoir pu entendre ce que du haut de ses 28 ans, Klaus Mäkelä pouvait faire résonner de cet œuvre d’adieu, de mort et de beauté.
Il a su donner des moments sublimes dans l’adagio, mais aussi la fin du premier mouvement qui fut un moment de grâce. Et il n’y a jamais eu des moments de vide, tout était habité et intéressant.
Il a eu raison d’interpréter cette oeuvre à ce stade de son développement artistique et humain.
J’étais rempli de beauté et d’émotion à la fin de ce concert.
Et rien ne m’empêche en rentrant d’écouter sur ma chaîne d’autres interprétations : Giulini, Walter a quelques mois de sa mort, Karajan, Klemperer ou Sinopoli et tant d’autres…. Abbado par exemple…
Cette œuvre est si riche et si intense qu’elle autorise beaucoup de regards différents.»Au cours des années, beaucoup d’enregistrements remarquables ont été publiés. Faire un choix est très subjectif.

Sur internet vous trouverez de nombreuses interprétations de cette 9ème symphonie, mais toujours avec cette contrariété absolue d’interruption de la musique par de la publicité, contrepartie de la gratuité.
Si vous passez outre ce sacrilège, vous pouvez visionner le dernier concert, en tant que directeur musical, sur une page coréenne, de Seiji Ozawa à la tête du Boston Symphony Orchestra dans le Boston Symphony Hall, le 20 avril 2002.
Seiji Ozawa fut le directeur musical de cet orchestre durant près de trente ans, de 1973 à 2002.
« Mahler – 9 – Boston Symphony – Seiji Ozawa – 20 avril 2002 »
-
Lundi 30 septembre 2024
« Visiteur, ne t’attarde pas au tympan de l’entrée. »Pierre Soulages dans « Les dits de Pierre Soulages » de Marie Rouanet page 37Dans toutes les plaquettes de tourisme d’Aveyron, le premier élément de l’abbatiale Sainte Foy de Conques qui sera souligné est le tympan de l’abbatiale.
Il jouit dans le Midi d’une réputation qui lui vaut un dicton aveyronnais :
« Qui n’a pas bist Clouquié de Roudès, Pourtel de Counquos, Gleizo d’Albi, Compono dé Mondé, N’a pas res bist. » (Qui n’a pas vu le clocher de Rodez, le portail de Conques, l’église d’Albi, la cloche de Mende, N’a rien vu).
 Ce tympan est considéré comme « l’une des œuvres fondamentales de la sculpture romane par ses qualités artistiques, son originalité et par ses dimensions ».
Ce tympan est considéré comme « l’une des œuvres fondamentales de la sculpture romane par ses qualités artistiques, son originalité et par ses dimensions ». Il date du début du XII° siècle et comporte une scène avec 124 personnages. Il mesure 6,70 m de large et 3,60 m de haut. Dans le détail, la qualité des sculptures et des mises en scène est extraordinaire.
Les humains du moyen-âge avaient poussé leur savoir faire et leur technique à un niveau exceptionnel.
Je me souviens encore d’une conférence d’un grand médiéviste que j’ai vu sur le web et qui rapportait qu’il avait subi des cours d’un professeur d’Histoire qui parlait du « sombre moyen-âge » pendant lequel les hommes avaient sombré dans la régression culturelle en perdant les techniques et l’art que la civilisation romaine avait développés. Or, ajoutait ce médiéviste, ce professeur habitait rive droite (de la Seine) et venait à pied jusqu’à la Sorbonne Dans son trajet pédestre, il passait devant Notre Dame de Paris, création du moyen-âge, qui par sa beauté d’ensemble, comme dans ses détails portaient un démenti cinglant à cette affirmation négative sur la période.
Mais cette technique et cet art étaient mis au service d’un récit religieux qu’il faut essayer d’analyser et de comprendre.
Ce <site consacré à l’art roman> le décrit de manière précise, <L’office de tourisme de Conques> en fait de même, de manière plus simple.
C’est un peu comme une bande dessinée, réalisée au moyen âge pour l’humble croyant qui ne sait pas lire, mais peut comprendre les représentations figuratives.
L’histoire racontée est celle de la parousie.
La parousie est un concept de la théologie chrétienne. Les savants religieux expliquent qu’il s’agit à la fois de la présence invisible du Christ dans le monde depuis la création et son retour sur la Terre à la fin des temps.
Pour les incrédules comme moi, il s’agit de l’annonce de la fin du monde et du jugement dernier. C’est une histoire qui vise à faire peur et à inciter fortement les croyants de suivre le plus fidèlement possible les préceptes et règles édictés par les prêtres de l’Église afin de bien se préparer à ce moment et pouvoir se présenter dans les meilleures conditions devant le juge suprême.
Les religions catholiques, orthodoxes et protestantes ont quelque peu édulcoré ce point central de leur croyance : l’inéluctabilité de la fin des temps et le jugement dernier dans lequel il vaut mieux être le plus irréprochable possible par rapport aux fondamentaux religieux
D’autres, comme les évangélistes et toutes les sectes millénaristes ont gardé, au cœur de leur discours, le retour du Christ et ce moment où les mécréants et les déviants passeront un mauvais quart d’heure et normalement beaucoup de mauvais quart d’heures après. Dans ces milieux fondamentalistes, on insiste, en outre, sur l’imminence de ce moment eschatologique.
En effet, un autre mot est utilisé dans ces dogmes : « une eschatologie », c’est à dire une doctrine relative au jugement dernier et au salut assigné aux fins dernières de l’homme, de l’histoire et du monde.
Les religions monothéistes possèdent chacune des théories sur ce sujet : « l’eschatologie islamique » et « l’eschatologie juive ».
Tous ces récits ont pour objectif de convaincre le croyant qu’il a bien raison de croire ce qu’il croit et que ce serait tout à fait déraisonnable de ne pas suivre tous les commandements qui lui sont prescrits.
Ils renferment aussi une espérance : un jour arrivera où ses mérites seront reconnus et où « les méchants », on peut aussi les appeler les mécréants, les hérétiques, les musulmans parlent de « kâfir » au pluriel « kouffar », seront punis. L’adhésion à ces récits permet de mieux supporter les injustices et les épreuves du présent.
Mais ces croyances génèrent aussi une anxiété : puisque le croyant se demandera, sans cesse, s’il en fait assez, pour être du bon côté au moment ultime, celui du jugement dernier.
C’est la force et la ruse des religions pour obtenir un peuple docile et une société soudée.
Pierre Soulages disait :
« Je ne crois pas en Dieu, mais je crois au sacré. »
propos rapporté dans le journal « La Croix », no. 42453 du 26 octobre 2022 – article « Soulages a rejoint l’outrenoir »Il a aussi donné ce conseil :
« Visiteur, ne t’attarde pas au tympan de l’entrée. »
dans « Les dits de Pierre Soulages » de Marie Rouanet page 37L’abbatiale Sainte-Foy de Conques, à travers cette dichotomie, soulignée par Pierre Soulages répond parfaitement à la distinction que j’ai, tant de fois, tenté d’expliquer entre la religion et la spiritualité.
La religion par son récit angoissant et apocalyptique veut soumettre et contraindre par la crainte et l’espérance au bout de la soumission.
 A Conques, si après avoir admiré la qualité artistique et hors du temps des sculpteurs du XIIème siècle, vous ne vous attardez pas trop et entrez rapidement dans l’abbatiale, vous trouverez autre chose : élévation, paix, sérénité, spiritualité.
A Conques, si après avoir admiré la qualité artistique et hors du temps des sculpteurs du XIIème siècle, vous ne vous attardez pas trop et entrez rapidement dans l’abbatiale, vous trouverez autre chose : élévation, paix, sérénité, spiritualité.Lors d’un échange, à Conques, avec une touriste, j’ai décrit cette sensation d’une spiritualité intense à l’intérieur de l’église. La femme m’a immédiatement interpellé :
« Moi la religion et la spiritualité, cela ne me parlent pas. »
Cette rencontre m’a rappelé que les français avant d’être laïcs sont d’abord majoritairement athées. Mais je disposais de la parade. Elle m’avait été fournie par Jean-Claude Carrière qui s’insurgeait sur la captation du concept de spiritualité par les religions.
Car spiritualité signifie «esprit», «pensée» alors que les religions, le plus souvent, conduisent à éviter de penser pour remplacer la recherche spirituelle par le «dogme».
J’en avais parlé lors du <mot du jour du 12 février 2021>, en hommage, à cet homme d’immense culture. Et grâce à l’évocation de Jean-Claude Carrière, mon interlocutrice devint conciliante :
« Dans ce cas je veux bien retourner dans l’abbatiale et tenter d’y trouver un peu de spiritualité »
Christian Bobin écrit :
« Il faut ouvrir une porte là où il n’y en a pas, puis laisser entrer le silence qui est le seul vrai dieu.»
« La Nuit du cœur » page 31 -
Vendredi 27 septembre 2024
« Cette lumière […] a une valeur émotionnelle, une intériorité, une qualité métaphysique en accord avec la poésie de cette architecture comme avec sa fonction : lieu de contemplation, lieu de méditation. »Pierre SoulagesJ’ai expliqué dans le mot du jour précédent que certains obstacles s’étaient dressés sur le chemin de Pierre Soulages vers la réalisation des vitraux de l’abbatiale de Conques.
Le plus compliqué et le plus long fut cependant la résolution du problème technique : trouver le verre qui parviendra à atteindre les objectifs qu’il s’était fixé.
Il a explicité ses objectifs dans « l’entretien du 14 juin 2001 » avec son ami Pierre Encrevé :
- Ne pas se laisser distraire par le spectacle extérieur,
- Et surtout que les surfaces des baies deviennent émettrices de clarté.
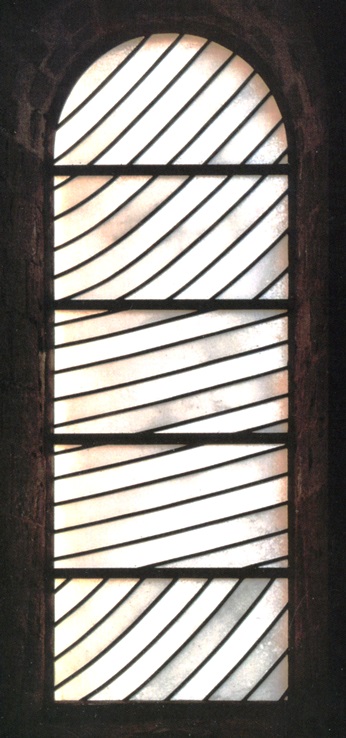 Dès lors il s’est mis à la recherche d’un verre permettant de remplir ces deux objectifs. Il est allé en Italie, en Allemagne et partout où il pensait pouvoir trouver une solution qu’il n’a finalement pas trouvé.
Dès lors il s’est mis à la recherche d’un verre permettant de remplir ces deux objectifs. Il est allé en Italie, en Allemagne et partout où il pensait pouvoir trouver une solution qu’il n’a finalement pas trouvé. Il s’est convaincu que ce verre n’existait pas et qu’il fallait donc l’inventer. Il consacrera sept ans de sa vie à cette quête dont deux pendant lesquels il ne peindra plus, pour se consacrer exclusivement à cette aventure.
En 1987, il va aller voir, à Toulouse, le maître vitrier Jean-Dominique Fleury et c’est avec son aide ainsi que celle d’une jeune artiste verrière hollandaise, Hanneke Fokkelman, qu’il va parvenir à un résultat qui le satisfera.
Les tests seront réalisés à Marseille, au Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva). Plus de 350 plaques d’essai seront réalisées.
Toute une partie du musée Soulages de Rodez est consacrée à ces études.
Un documentaire vidéo passionnant présente ces recherches.
Je ne l’ai pas trouvé sur Internet mais il y a deux vidéos mises en ligne par l’INA qui reprennent en partie ces explications.
Dans un premier extrait il est question de « La conception technique des vitraux de conques » et dans le second d’une durée de 11 mn, vous verrez notamment l’installation des vitraux : « Pierre Soulages et les vitraux de l’abbatiale de Conques »
Pour réaliser le vitrail qui lui convient, il ne va pas teinter le verre mais utiliser du verre blanc et changer la structure du verre.
Il va créer du verre broyé obtenu en versant du verre en fusion dans un liquide froid qui le fait éclater en nombreux petits fragments.
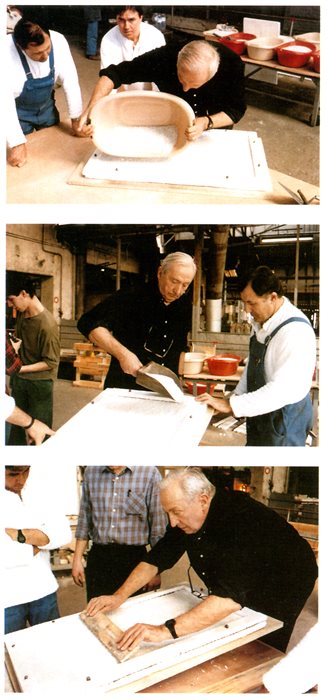 Et comme on le constate sur les photos ci-contre, il va ensuite répartir ces grains de verre de différentes grosseurs. En passant ensuite ces éclats à la cuisson qui les cristallise, on obtient un verre dont la luminosité est modulée en fonction de la taille des grains et de leur répartition dans le moule.
Et comme on le constate sur les photos ci-contre, il va ensuite répartir ces grains de verre de différentes grosseurs. En passant ensuite ces éclats à la cuisson qui les cristallise, on obtient un verre dont la luminosité est modulée en fonction de la taille des grains et de leur répartition dans le moule. Dans un deuxième temps, ils travailleront dans l’Unité de recherche de Saint-Gobain à Aubervilliers. Les translucidités recherchées proviendront d’une variation des températures de cuisson, du calibrage des grains et du type de four utilisé.
Mais quand il s’agira de fabriquer, en nombre, toutes les plaques nécessaires pour réaliser les vitraux des 104 ouvertures de l’abbatiale, Saint-Gobain tergiversera pour investir dans un four de 50 000 F, pour un marché global de 8 000 000 de francs.
Soulages et Fleury trouveront la solution en Allemagne, à Rheine, près de Munster où l’entreprise Glaskunst Klinge possède les installations recherchées. Cette entreprise avait développé, à côté d’une usine de verrerie traditionnelle, une unité pour produire de grandes plaques de verre « securit » permettant de réaliser des parois de verre. Les plaques qui sortent de l’usine font environ 8 millimètres d’épaisseur et mesurent 90 sur 150 centimètres. Leur texture est différente selon leur face : lisse, elle sera orientée vers l’extérieur et réfléchira le soleil ; granuleuse, elle sera réservée à l’intérieur et entretiendra une sorte de continuité avec les murs.
Cette épaisseur a permis de renoncer à la bordure du vitrail traditionnel, chaque vitrail peut directement toucher la pierre. Chaque baie diffuse ainsi de la clarté sur toute sa surface et non sur la seule partie centrale.
Dans ses notes de travail publiées dans le livre publié par Seuil, « Conques les vitraux de Soulages » de Christian Heck, Pierre Soulages explique page 57 :
« J’ai voulu que la transmission diffuse provienne non d’un état de surface comme avec le verre dépoli, mais de la masse même de la matière. J’ai voulu aussi qu’elle soit variée, c’est-à-dire produisant des modulations de luminosité sur la paroi de la fenêtre. Une lumière vivante en quelque sorte, prise dans le verre même, celui-ci devenant émetteur de clarté.
Cette lumière que l’on pourrait dire « transmutée » a une valeur émotionnelle, une intériorité, une qualité métaphysique en accord avec la poésie de cette architecture comme avec sa fonction : lieu de contemplation, lieu de méditation »Après avoir été fabriquées en Allemagne les lourdes plaques de verre sont envoyées à Toulouse, dans l’atelier de Jean-Dominique Fleury, maître verrier qui accompagne Pierre Soulages depuis le début de sa recherche. L’artiste dessine des formes en accord avec la lumière consentie par le verre et avec l’architecture. Des formes qui sont « comme un souffle », des lignes fluides qui ne viennent pas répéter les grandes structures verticales de l’édifice mais le parcourent, comme un flottement, obliques, courbes, tendues vers le haut.
Dans l’atelier de Toulouse, les artisans s’attellent donc à découper ces plaques sous l’œil vigilant et décideur de Pierre Soulages.
Une scie à ruban gigantesque, commandée exprès, est vite abandonnée au profit d’une taille à la main, au diamant ou à la molette. Il faut préciser que les 104 ouvertures qu’il s’agit de fermer par des baies de vitraux sont toutes de tailles différentes. C’est un travail d’artisan non d’industriel.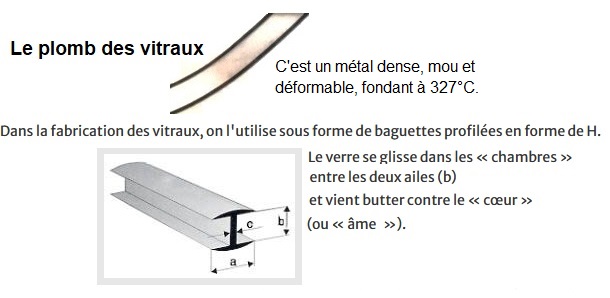
Sur la table couverte d’un drap noir, chaque pièce est choisie pour ses variations de translucidité, qui chanteront avec ses voisines.
Puis il faut les assembler, avec des plombs d’une taille inhabituelle car le verre inédit de Soulages est épais de 8 millimètres, quatre fois plus qu’un vitrail classique ! Le plomb est fondu afin de pourvoir l’incurver selon les désirs de l’artiste. les panneaux de vitrail sont ainsi réalisés en associant le plomb et le verre.
 Ces panneaux fabriqués en atelier seront accrochés, sur site, aux barlotières.
Ces panneaux fabriqués en atelier seront accrochés, sur site, aux barlotières.
La « barlotière » est une traverse en fer qui est fixé sur la maçonnerie et qui tient les panneaux de vitrail.
Lors de ce travail, les artisans vont avoir une surprise :« Un des premiers jours de l’installation, les verriers s’apprêtaient à creuser les trous de fixation des barlotières. Stupéfaits, ils se sont aperçus que les trous existaient déjà. Donc, les barlotières avaient déjà été fixées exactement aux mêmes endroits. »
(Pierre Soulages, Outrenoir. Entretiens avec Françoise Jaunin. La Bibliothèque des Arts, 2012, p.112)Les artisans découvrent donc que les nouvelles mesures correspondent aux trous des barlotières médiévales, qu’on avait abandonnés au cours des restaurations successives…

Deux livres de Christian Heck m’ont particulièrement inspiré pour écrire ces trois mots du jour :
« Conques : les vitraux de Soulages » qui contient des notes de travail de Pierre Soulages avec une préface de Georges Duby et « Présence de la lumière inaccessible, les vitraux de Conques et la peinture de Soulages »
J’ai aussi recopié des extraits de ce long et passionnant article de « Connaissance des Arts » : « Pierre Soulages : un peintre cistercien ».
Des informations sont issues de ce site consacré au : « travail du vitrail »
D’autres ressources sont encore disponibles pour celles et ceux qui souhaitent approfondir :
<Créer le verre et moduler la lumière>Et trois épisodes de l’émission de France Inter : « La marche de l’Histoire » :
<Pierre Soulages et l’abbaye de Conques>,
<Christian Bobin, le visiteur de Sète>,
<Pierre Soulages, le noir est une couleur>
Je laisserai le mot de la fin à Jean-Dominique Fleury :« Lorsqu’on termine un chantier pareil, c’est comme un deuil. Mais quelle expérience aussi ! Soulages m’a appris à savoir attendre. À l’heure de la retraite, je mesure le prix de sa relation au temps… »
-
Vendredi 20 septembre 2024
« Le verre illuminé des vitraux de Conques, doux comme le papier cristal qui protège les livres anciens, dit que nous ne sommes séparés de la grâce que par un rien. »Christian Bobin, « La nuit du coeur » page 202Pierre Soulages aime à raconter que c’est lors d’une visite qu’il fit, enfant, à l’abbatiale de Conques qu’il décida de devenir peintre.
 « La dépêche du midi » précise que c’est en classe de quatrième au lycée Foch, lors d’une visite de l’abbatiale de Conques, que Pierre Soulages fut submergé par une émotion… Il trouva tant de beauté et de majesté dans cette architecture romane… C’est à ce moment-là que le garçon se décida : il serait peintre.
« La dépêche du midi » précise que c’est en classe de quatrième au lycée Foch, lors d’une visite de l’abbatiale de Conques, que Pierre Soulages fut submergé par une émotion… Il trouva tant de beauté et de majesté dans cette architecture romane… C’est à ce moment-là que le garçon se décida : il serait peintre. Pierre Soulages insiste sur ce moment le 14 juin 2001 lors de « L’entretien » qu’il réalisa dans le grand auditorium de la BNF avec Pierre Encrevé, son ami, auteur du catalogue de ses œuvres et qui a publié au Seuil et chez Gallimard quatre volumes consacrés aux œuvres du peintre :
« C’est un espace architectural qui m’avait toujours beaucoup impressionné. C’est même là, je peux le dire, que tout jeune j’ai décidé que l’art serait la chose la plus importante de ma vie, et que tous les gens qui étaient autour de moi perdaient leur vie à la gagner. Il n’y avait qu’une chose définitivement importante pour moi : la peinture. Je n’ai pas pensé devenir architecte. C’est là que ça s’est passé, c’est vrai. »
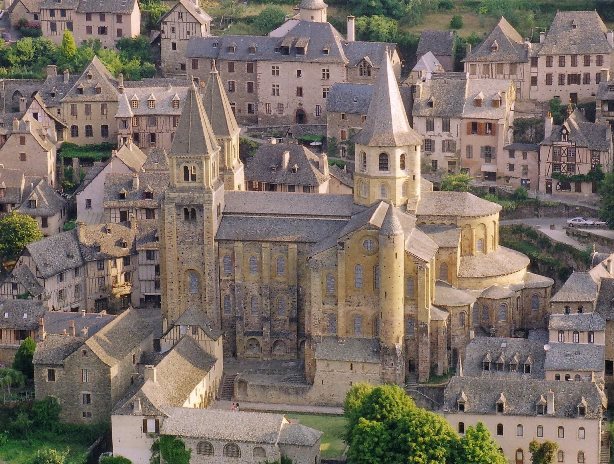
L’abbatiale romane Sainte-Foy de Conques a été construite à partir de 1041.
Elle devient au XIIe siècle une grande étape sur la via Podiensis, route de pèlerinage du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle est d’abord abbaye bénédictine jusqu’en 1537, elle fut ensuite placée sous la responsabilité de chanoines séculiers. Depuis 1873, l’abbatiale est confiée aux frères de l’ordre de Prémontré.
Pendant les guerres de Religion, l’édifice est incendié (1568). Elle subira aussi des dommages pendant la Révolution française et sera désacralisée. Prosper Mérimée, inspecteur général des Monuments historiques, imposera la réhabilitation du site en 1837.
Quand Soulages y pénètre dans les années 1931/32, il n’y a pas de vitraux depuis l’incendie provoqué par les protestants, mais de simples vitres qui laissent entrer pleinement la lumière permettant d’admirer la beauté intérieure de l’édifice.
 Mais cette situation va changer. Le 20 avril 1942, le Comité consultatif d’architecture des monuments historiques commande au maître verrier Francis Chigot de Limoges, une baie d’essai pour l’abbatiale. Et suite à ces essais, le 3 avril 1944, ce comité donnera un avis favorable à l’exécution du projet présenté par M. Chigot avec des vitraux dessinés par Pierre Parot. Ces vitraux finiront d’être installés l’année 1952. Il s’agit de vitraux figuratifs illustrant des thèmes religieux.
Mais cette situation va changer. Le 20 avril 1942, le Comité consultatif d’architecture des monuments historiques commande au maître verrier Francis Chigot de Limoges, une baie d’essai pour l’abbatiale. Et suite à ces essais, le 3 avril 1944, ce comité donnera un avis favorable à l’exécution du projet présenté par M. Chigot avec des vitraux dessinés par Pierre Parot. Ces vitraux finiront d’être installés l’année 1952. Il s’agit de vitraux figuratifs illustrant des thèmes religieux. En 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir et installe Jack Lang au Ministère de la Culture. Ce dernier nomme Claude Mollard directeur des arts plastiques. C’est lui qui va solliciter Soulages pour réaliser des vitraux contemporains dans des églises. Il pense d’abord à Nevers, à Reims et d’autres lieux, Pierre Soulages refuse, jusqu’à ce qu’il soit question de Conques. Dans certaines versions de cette aventure, il est écrit que c’est Soulages qui a suggéré l’abbatiale de Conques devant le découragement de Claude Mollard qui voyait toutes ses propositions se heurter à un refus. Dans un article de 2019 écrit par Sabine Gignoux dans le journal « La CROIX » : « Soulages à Conques : lumières sur un chef-d’oeuvre » elle cite le peintre et le contexte :
« Pierre Soulages observe longuement l’édifice et les vitraux colorés, assez sombres, posés à la fin de la guerre. Rapidement, il confie qu’il souhaite faire exactement l’opposé : valoriser par un verre neutre l’architecture et la lumière. Comme s’il avait voulu retrouver l’éblouissement premier de son adolescence, quand Conques, qui avait été incendiée au XVIe siècle par les protestants, n’offrait plus que des vitres ordinaires. De retour au ministère, le délégué aux arts plastiques annonce la nouvelle à ses équipes goguenardes : « Ah, Soulages va faire des vitraux noirs, disaient-ils, sans comprendre que c’est un artiste de la lumière. » »
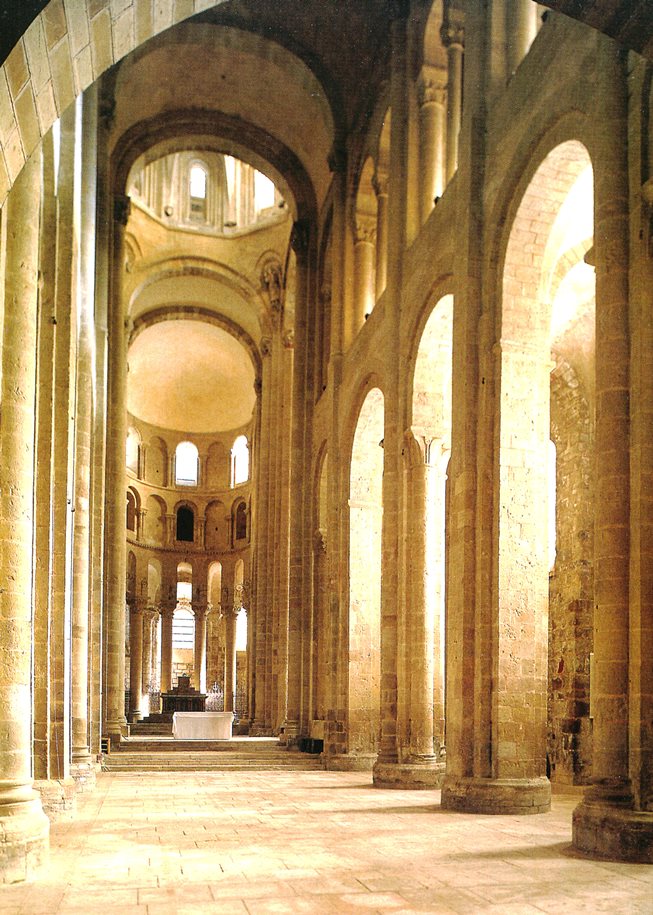 Pierre Soulages n’apprécie pas l’œuvre de Chigot parce ce qu’elle assombrit l’abbatiale, il ne retrouve plus la magie de son enfance et la mise en valeur de l’architecture du moyen âge. Il assène :
Pierre Soulages n’apprécie pas l’œuvre de Chigot parce ce qu’elle assombrit l’abbatiale, il ne retrouve plus la magie de son enfance et la mise en valeur de l’architecture du moyen âge. Il assène : «Quand on met 104 ouvertures dans un bâtiment de 56 mètres, c’est pas pour en faire une crypte».
Je remarque d’ailleurs qu’on oppose souvent Soulages à Chigot, ce qui me semble erroné. Car le travail des vitraux nécessite deux compétences celle du vitrier qu’est Francis Chigot et celle d’un peintre, Pierre Parot était son partenaire.
Il semble plus juste d’opposer Pierre Parot et Pierre Soulages. Ce dernier travaillait avec Jean-Dominique Fleury, maître verrier toulousain qui, lui, pourrait être considéré comme l’alter ego de Francis Chigot. L’histoire n’a pas retenu cette opposition mais celle de Chigot et de Soulages.
L’histoire de la création et de l’installation des vitraux de l’abbatiale que l’on désignera sous le nom des « vitraux Soulages » n’est pas un chemin facile parsemé de roses. Ce fut un cheminement long, compliqué, souvent en milieu hostile.
D’abord, il y a le contexte politique. A l’origine, il y a donc une commande, en 1984, de Claude Mollard directeur au ministère de la Culture dirigé par Jack Lang. Mais en 1986, les élections législatives ouvrent la première cohabitation, les responsables du ministère de la culture changent. Lang est remplacé par Léotard et Claude Mollard perd son poste au profit de Dominique Bozo.
Ce dernier apprécie Soulages, mais prudent, il tente de restreindre la commande à la nef ou aux absidioles.
Pour continuer son grand dessein, le peintre va mobiliser toutes celles et ceux qui reconnaissent son talent et sont fascinés par sa vision artistique. Proche de Claude Pompidou, il est aussi très ami avec l’historien Georges Duby qui dirige le conseil d’orientation du Centre national des arts plastiques.
 Finalement, la commande des vitraux de Conques est confirmée à Soulages, en février 1987.
Finalement, la commande des vitraux de Conques est confirmée à Soulages, en février 1987.Mais si la route de la décision administrative est dégagée, beaucoup d’autres obstacles vont se dresser sur la route de Soulages.
Il y a d’abord l’hostilité de la population. On lit dans l’article de la Croix précité que le jour où l’artiste et le maître verrier décident d’entamer le démontage des anciens vitraux, l’accueil des habitants est glacial. Le patron de l’auberge Saint-Jacques en face de l’abbatiale, Francis Fallières, est nettement antagoniste
« Le tir était parti de Paris. Personne chez nous ne connaissait Soulages et ça nous restait en travers de la gorge. Pour nous, Aveyronnais, un sou est un sou et on ne comprenait pas la nécessité de changer nos vitraux. ».
La population, viscéralement attachée à son patrimoine organise la résistance « Conquois contre les Conquistadors », plaisante l’aubergiste. Des réunions publiques houleuses se tiennent, une pétition circule.
Le propriétaire de notre gite, Michel Falip, ancien maire de Noailhac désormais intégré dans la commune de Conques en Rouergue, nous raconte une autre facette de cette hostilité : les parents des habitants de la commune avaient participé au financement des vitraux de Francis Chigot et ils goutaient peu que leur investissement familial soit relégué, 40 ans après leur mise en place, dans des caisses entreposées dans des caves sombres.
Michel nous a raconté l’accueil des vitraux comme une polarisation extrême : il y avait ceux qui criaient au génie et les autres à l’escroquerie, les positions modérées semblaient inexistantes.
L’architecte des bâtiments de France, Louis Causse, catholique engagé, s’oppose aussi à Pierre Soulages :
« Conques était l’un des édifices du département les mieux vitrés. Alors que tant d’églises ou de chapelles de l’Aveyron avaient des baies nécessitant d’être rénovées, c’était incompréhensible […] Et pourquoi remiser au purgatoire les vitraux figuratifs créés, quarante ans plus tôt, par le peintre Pierre Parot et le verrier Francis Chigot ? » .
Il y a encore les moines chargés du sanctuaire, les prémontrés en habit blanc qui s’insurgent. Leur prieur, frère Renaud, s’exclame, devant les artisans en pleine installation :
« Il n’y a plus qu’à sonner le glas ! »
 Un autre frère Jean-Daniel, apostrophe le peintre :
Un autre frère Jean-Daniel, apostrophe le peintre : « C’est dommage. Avec le dépôt des vitraux, on n’aura plus toutes ces couleurs sur les piliers, le sol et nos habits pendant l’office, c’était joli…»
La réplique cinglante de l’artiste est restée célèbre :
« Mais une église, ce n’est pas une boîte de nuit ! »
Et enfin, il y a un adversaire que le destin capricieux a placé sur la route de cette œuvre.
Un des hommes les plus puissants de la République d’abord porte-parole puis secrétaire général de l’Élysée auprès de François Mitterrand, Hubert Vedrine dont la mère était la fille de Francis Chigot.
Il est très hostile qu’on touche au travail de son grand père. Il cédera mais exigera qu’on conserve les vitraux déposés : Finalement, huit seront envoyés à Limoges et quelques autres exposés à la mairie de Conques ou au centre culturel, qui conserve la totalité. En 2013, le lycée Turgot de Limoges en récupérera certains et les installera dans l’établissement.
Dans l’entretien à la BNF avec Pierre Encrevé précité, Soulages explique que l’omniprésence de la lumière dans l’abbatiale ne l’avait pas marqué lors de sa découverte à 13 ans :
« À cette époque, je ne m’étais pas encore rendu compte à quel point cet espace architectural est lié à la lumière. Je l’ai constaté seulement lorsque j’ai accepté de faire des vitraux. ».
 Et il continue :
Et il continue : « Avant toute chose, j’ai voulu évacuer le côté émotionnel, […], j’ai voulu analyser le bâtiment de la manière la plus froide, la plus détachée, la plus précise possible.
Je me suis aperçu, à ce moment-là, que cet espace architectural était vraiment conçu avec la lumière. Il y a des disproportions stupéfiantes entre les différentes fenêtres, elles ne sont explicables que par un souci d’organisation de l’espace avec la lumière.
Dans la nef, quand on arrive, à la gauche, c’est le nord, à la droite, c’est le sud. Au nord, les fenêtres sont plus basses, plus étroites que celles qui leur font face au sud. Et pourtant, lorsqu’on construit une nef, on est bien obligé de construire les deux côtés à la fois. C’était donc voulu ainsi. […]
La longueur de l’édifice est à peine une fois et demie la largeur, le plan est vraiment très compact. À cette compacité s’ajoute la force de l’épaisseur des murs que l’on ressent devant la profondeur des ébrasements de chaque baie. Alliée à cette force il y a la grâce qui naît de l’élan des colonnes et des piliers alternés d’une des plus hautes nefs de l’art roman. Je pense que c’est dans cette alliance que se trouve l’origine de l’émotion ressentie dans ce lieu.
Mais c’est en mesurant les ouvertures que je me suis rendu compte de l’importance qu’avait la distribution de la lumière. C’est à ce moment-là que j’ai été conduit à imaginer des vitraux qui soient uniquement fondés sur la lumière, et sur la lumière naturelle.
J’avais deux objectifs. Le premier était que le regard ne puisse pas être distrait par le spectacle extérieur, et le deuxième que la surface du vitrail apparaisse comme émettrice de clarté, productrice d’une clarté très particulière »
 Soulages insiste sur la pauvreté des lieux, les bâtisseurs ont construit avec les pierres dont ils disposaient. L’abbatiale bénédictine fut édifiée au XIIe siècle grâce à toutes les pierres du Rouergue : le grès rouge de Combret, le calcaire blond de Lunel, le schiste bleu de Nauviale…
Soulages insiste sur la pauvreté des lieux, les bâtisseurs ont construit avec les pierres dont ils disposaient. L’abbatiale bénédictine fut édifiée au XIIe siècle grâce à toutes les pierres du Rouergue : le grès rouge de Combret, le calcaire blond de Lunel, le schiste bleu de Nauviale… « […] J’ai seulement tenu à respecter, à être fidèle à l’identité de ce bâtiment. Cette identité réside dans les dimensions, les proportions, la nature des matériaux, couleur des pierres et des lauzes, etc. Aussi dans l’organisation de la lumière inséparable de l’espace, telle qu’elle est fixée par les dimensions souvent surprenantes des baies.
À l’époque de la construction, le bâtiment était peut-être coloré, d’après tous les renseignements qu’on peut avoir, et d’après les médiévistes que j’ai consultés.
Mais par contre il n’y avait sûrement pas de vitraux colorés aux fenêtres. Ce pays était très pauvre, le verre très cher, les verres colorés notamment. D’ailleurs les vitraux colorés, c’était au nord de la Loire, c’était Bourges, c’était Chartres. Pas du tout dans le Midi, et les médiévistes que j’ai consultés, que ce soit Jacques Le Goff, que ce soit Georges Duby ou d’autres, pensaient qu’il était possible que les fenêtres soient closes à l’origine par du parchemin, ou peut-être n’y avait-il que des volets de bois… »
La création artistique se conjugue pour lui avec l’amour :
« C’est un bâtiment que j’aime et j’ai voulu le donner à voir tel qu’il nous est parvenu et tel que nous l’aimons, nous, maintenant. C’est ainsi que j’ai été conduit à créer ce verre que vous connaissez. »
Je ne peux pas citer tout l’entretien que je vous invite à lire : « L’entretien »
 La population comme les moines ont pour, leur plus grande part, évolué dans leur ressenti par rapport à ce travail de lumière. Dans l’article de La Croix, la journaliste cite le nouveau prieur, le frère Cyrille :
La population comme les moines ont pour, leur plus grande part, évolué dans leur ressenti par rapport à ce travail de lumière. Dans l’article de La Croix, la journaliste cite le nouveau prieur, le frère Cyrille :« Les vitraux offrent une grande variété de nuances, des laudes jusqu’au soir. Et le dessin des courbes vit. Parfois il nous donne envie de s’élever, parfois il invite au calme […]
Ouvrir dans cette lumière l’abbatiale au matin de Pâques, c’est extraordinaire ! »Christian Bobin, dans l’ultime page de « La Nuit du cœur » consacré à son séjour à Conques et à son émerveillement devant l’abbatiale et le travail de son ami, écrit :
« Le verre illuminé des vitraux de Conques, doux comme le papier cristal qui protège les livres anciens, dit que nous ne sommes séparés de la grâce que par un rien. C’est dans la purification de cette pensée que je m’endors dans la chambre 14. »
Pierre Soulages dans le livre de Marie Rouanet « Les dits de Pierre Soulages » parle du silence :
« Lorsque j’ai entrepris l’exécution des vitraux de l’église Sainte-Foy de Conques, j’avais compris le sens du silence imposé dans les ordres réguliers. Car le silence est l’écrin de la vie intérieure »
Ce livre finit par cette phrase :
« Conques, mon chef d’œuvre, mon chant du cygne. »
Il dit cela à 75 ans. Le destin lui accordera encore plus de 25 ans de vie, pendant lesquelles il continuera à produire, en s’inspirant du travail accompli dans ce lieu de l’Aveyron où souffle les forces de l’esprit.
-
Mardi 17 septembre 2024
« A la place de l’éblouissement des yeux tu trouves l’indicible, l’invisible. »Pierre Soulages dans « les dits de Pierre Soulages » de Marie Rouanet page 39Nous nous trouvons enfin, en ce lundi 9 septembre, dans l’Abbatiale Sainte Foy de Conques.
Dehors, il fait gris, nul bleu dans le ciel, un léger crachin tombe par intermittence.
 Les vitraux gris de Soulages, en l’absence de soleil ne s’embrasent pas.
Les vitraux gris de Soulages, en l’absence de soleil ne s’embrasent pas. Je suis d’abord un peu déçu, ces vitraux avec leurs milles nuances de gris ne subjuguent pas.
Mais bientôt, je comprends mon erreur, l’abbatiale ne constitue pas un écrin, à l’égal d’un musée, pour mettre en valeur l’œuvre du peintre.
Bien au contraire, ce sont les vitraux et leurs lumières qui forment un écrin pour révéler l’abbatiale dans toute sa splendeur.
Dans le petit livre où Marie Rouanet a noté ce que Soulages disait, elle cite ses propos sur les vitraux de Conques :
 « Il est temps d’oublier le monde extérieur.
« Il est temps d’oublier le monde extérieur.
C’est le sens sacré des vitraux.
Vue de dehors, ils ont l’air d’une porte close.
Au-dedans ils maintiennent une lumière voilée.
Tu ne rencontreras pas l’explosion de couleurs attendue, aucun orgue tonitruant ne saluera le cortège des moines et leur psalmodie presque un murmure. Ne sois pas trop déçu. A la place de l’éblouissement des yeux tu trouves l’indicible, l’invisible. »
opuscule cité pages 38 et 39Soulages est pour moi, une découverte tardive.
Il est vrai que l’art que j’ai investi depuis mes plus jeunes années est la musique, non la peinture. J’avais vaguement entendu l’association de Pierre Soulages et de la peinture noire, rien de plus.
Mais, trois « rencontres », je ne trouve pas de mot plus pertinent, vont me conduire en ce lieu dans lequel nous retournerons trois jours de suite, tout en allant aussi au musée Soulages à Rodez.
La première de ces rencontres a eu lieu dans ma cuisine. Ma sensible belle-soeur, Josiane, m’a demandé :
« As-tu déjà vu l’abbatiale de Conques, avec les vitraux de Soulages ? ».
Après ma réponse négative, elle m’a raconté son expérience intense dans cette église qui baigne dans une lumière qui permet de tutoyer les forces de l’esprit.
La seconde rencontre a été provoquée par ma lecture de Christian Bobin qui lui a consacré un livre « Pierre, » dans lequel il raconte son voyage, une nuit de Noël, depuis Le Creusot jusqu’à Sète, pour rencontrer le peintre et lui remettre, en cadeau de son 99ème anniversaire, le manuscrit de « La nuit du cœur ».
Dans cet ouvrage, il écrit ces mots qui font vibrer mes cordes intérieures :
« Les morts ne sont pas plus loin de nous que les vivants.
Je voyage dans cette parole. Elle serre mes tempes, elle va durer trois heures, le temps du trajet.
Aller vers ceux qu’on aime, c’est toujours aller dans l’au-delà. »
« Pierre » dans « Les différentes régions du ciel » page 986.Ce livre, date de 2019, l’année précédente il avait donc écrit « La nuit du cœur ».
Il se trouve, une nuit, dans l’hôtel Sainte Foy à Conques. Une des fenêtres de sa chambre donne sur un flanc de l’abbatiale. Il écrit :
 « C’est dans cette chambre, se glissant par la fenêtre la plus proche du grand lit, que dans la nuit du mercredi 26 juillet 2017, un ange est venu me fermer les yeux pour me donner à voir.
« C’est dans cette chambre, se glissant par la fenêtre la plus proche du grand lit, que dans la nuit du mercredi 26 juillet 2017, un ange est venu me fermer les yeux pour me donner à voir.
Dans l’abbatiale, on donnait un concert.
Je regardais la nuit d’été par la fenêtre, ce drapé d’étoiles et de noir.
Un livre m’attendait sur la table de chevet. Mon projet était d’en lire une dizaine de pages, puis de glisser mon âme sous la couverture délicieusement fraîche de la Voie lactée.
Mais.
Mais en me penchant pour fermer les volets de bois, je vis les vitraux jaunis devenir plus fins que du papier et s’envoler.
Le plomb, le verre et l’acier qui les composaient, plus légers que l’air, n’étaient plus que jeux d’abeilles, miel pour les yeux qui sont à l’intérieur des yeux.
Des lanternes japonaises flottant sur le noir, épelant le nom des morts. À cette vue je connus l’inquiétude apaisante que donne un premier amour. ».Dans ce livre il raconte sa rencontre avec l’Abbatiale, avec Conques. « Conques est un village introuvable. Les routes qui y mènent imposent une lenteur dont le monde n’a plus goût. » page 15 et avec les vitraux de Soulages.
 Page 113, il donne cette clé :
Page 113, il donne cette clé : « A Conques on lève la tête pour voir au fond de soi. »
Et puis, il y a eu une troisième rencontre, ou plutôt le croisement du chemin de vie avec le ruisseau du hasard…
Un signe, dont je ne fais pas un récit et pour lequel je ne prétends donner aucun sens mystique.
J’étais plongé dans un deuil profond, mon frère Gérard venait de mourir.
Le lendemain, le 25 octobre 2022, Pierre Soulages quittait aussi le monde des vivants.
En y regardant de plus près, je m’apercevais qu’il était né le 24 décembre 1919, 14 jours après la naissance de notre père.
La vie de Pierre Soulages qui a duré 102 ans et 10 mois recouvrait quasi exactement la vie de mon père et de mon frère.
Toutes ces rencontres m’ont poussé à aller à la rencontre de l’œuvre de Pierre Soulages et particulièrement ses vitraux.
Dans sa préface du livre « Les vitraux de Conques », le grand Historien médiéviste Georges Duby décrit ainsi cette architecture venue du moyen-âge :« Les hommes de très haute culture qui décidèrent il y a neuf siècles de rebâtir la basilique de Conques entendaient d’abord honorer sainte Foy, présente en ce lieu par ce qui restait de son corps […]La basilique de Conques fut conçue […] pour être le lieu du passage de la transition, de la sublimation. Il faut voir en elle une sorte d’antichambre du Paradis, une réplique imparfaite de la Jérusalem céleste, et se rappeler que les harmonies de son espace interne fut calculées de manière à susciter la vision prémonitoire des perfections intemporelles.
Franchir son seuil devait être vécu comme une rupture, comme une conversion de l’être. ».Dans ce même livre, Pierre Soulages compare l’abbatiale Sainte Foy et la basilique Saint Sernin de Toulouse, toutes deux étapes sur les chemins de pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle.
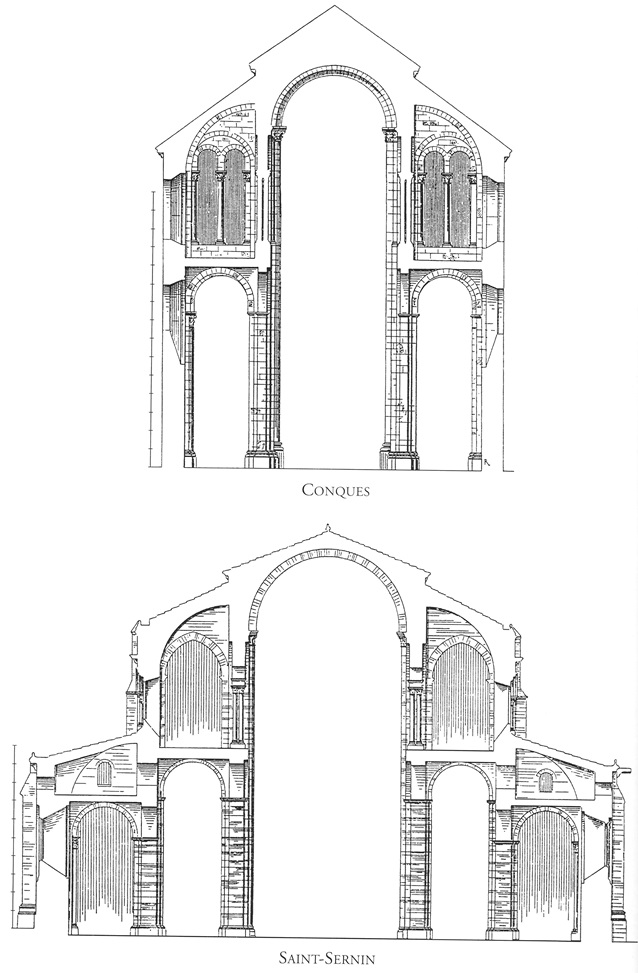 Cette comparaison montre ce que l’église de Conques a de particulier. Saint Sernin est immense 120 m de long, Sainte Foy n’a que 56 m, moins de la moitié.
Cette comparaison montre ce que l’église de Conques a de particulier. Saint Sernin est immense 120 m de long, Sainte Foy n’a que 56 m, moins de la moitié.En revanche, la nef de Saint Sernin a une hauteur de 21,10 m pour une largeur de 8,60m. Alors que Conques possède une nef de 22,10m, soit un mètre de plus pour 6,80 de large, ce qui la fait paraitre encore plus élancée. Nous sommes dans un édifice qui porte haut la force de la verticalité.
C’est cet élan vers le haut qui pousse à élever l’esprit et pour celui qui sait recevoir, accueillir le spirituel. La lumière qu’offre les 104 vitraux de Soulages éclaire ces immenses colonnes surmontées de chapiteaux et illumine les espaces derrière les colonnes.
Christian Heck dans son livre : « Présence de la Lumière inaccessible. Les vitraux de Conques et la peinture de Soulages. » cite le peintre
« C’est ce qui m’a fortement impressionné dans cette aventure : créer pour un tel lieu une matière qui marque l’écoulement du temps est une rencontre qui a un sens profond et qui a beaucoup compté dans la suite de mon travail. »
page 35.Et il a ajouté :
« On ne se rend pas compte à quel point tout ce que je fais est lié aux vitraux que j’ai réalisés à Conques, c’est à dire la lumière. ».

-
Lundi 29 juillet 2024
« L’incroyable cadeau français au monde : la cérémonie d’ouverture la plus originale et dynamique de l’histoire des Jeux Olympiques »Gaston Saiz dans le journal argentin « La Nacion »Je n’avais pas prévu de regarder la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques de Paris du vendredi 26 juillet 2024..
J’étais seul. Annie était aller rendre visite à son amie d’enfance, Rosemarie, à Barcelone. Alors, j’ai d’abord jeté un œil, puis j’ai regardé plus attentivement, pour être finalement captivé par ce spectacle plein de fantaisie et qui a su montrer combien la ville de Paris était belle, le long de la Seine.

Le drapeau français sur le Pont d’Austerlitz Plus de de 23 millions de téléspectateurs français soit 83,1 % de part de marché entre 19 h 26 et 23 h 30, ont regardé cette cérémonie. Il s’agit de la deuxième meilleure audience de l’histoire de la télévision française, après la finale de la Coupe du monde France – Argentine de 2022, que pour ma part j’ai boycotté.
Dans le monde, ils furent plusieurs milliards à regarder selon le CIO. Les réactions furent plutôt très positives.Le journal sportif espagnol MARCA a écrit : « Paris livre la meilleure cérémonie de l’histoire des Jeux ! »

La Une de la Nacion Il y eut d’autres titres dithyrambique dans la presse internationale. Mais celui que j’ai préféré et mis en exergue a été publié par un journal argentin : « La Nacion »
« L’incroyable cadeau français au monde : la cérémonie d’ouverture la plus originale et dynamique de l’histoire des Jeux Olympiques »
La pluie a cependant gâché la fête des 300 000 spectateurs sur place. Ils ont été privés de certains spectacles en directs, ainsi Lady Gaga avait enregistré son numéro de french cancan alors qu’il ne pleuvait pas.
Dès lors, les personnes qui s’étaient déplacés et avaient payés cher leur place n’ont rien vu, sinon ce que tous les téléspectateurs du monde entier ont vu : un spectacle enregistré.
Quand Thomas Jolly avait imaginé son spectacle, il avait pu constater qu’il ne pleuvait quasi jamais un 26 juillet à Paris.

Kantorow sous la pluie Alexandre Kantorow, quant à lui, a bravé la pluie pour être présent sur le parcours de la cérémonie. Le son qu’on entendait été enregistré aussi, mais lui était là, avec un piano trouvé dans la journée, piano médiocre qui pouvait être sacrifié sous l’eau.
« Le Parisien » rapporte qu’il est tombé, précisément, 16 mm d’eau (soit 16 litres par mètre carré) à la station Paris Montsouris, située dans le sud de la capitale – à noter que le compteur va de 8 heures du matin le 26 à la même heure le lendemain. Cela en fait le quatrième 26 juillet le plus pluvieux depuis près de 150 ans, cette station étant l’une des plus anciennes en France.
En outre, manque de chance, la majorité de la pluie sur la seule journée de vendredi est tombée… dans la soirée, après 20 heures, soit en plein pendant la cérémonie d’ouverture.
En regardant le spectacle j’étais émerveillé. Mais en approfondissant un peu et par la révélation de l’absence de Lady Gaga, il faut bien comprendre que cette cérémonie d’ouverture a été imaginée et créée pour la télévision et non pour les spectateurs massés au bord de la Seine. Eux, étaient les bénévoles nécessaires pour faire passer l’idée d’un spectacle en live retransmis à la télévision.

Le bateau portant les athlètes français au niveau de la place du châtelet. Mais c’est la première fois qu’on trouve des bénévoles qui paient très chers leur bénévolat en prétendant qu’ils ont acheté une « place de spectacle. ». Les financiers osent tout, c’est à cela qu’on les reconnait…
Peu de journaux ont souligné ce point : des spectateurs lésés au profit de la télévision. Certains journaux anglais comme « Le Daily Mail ». ont insisté sur la pluie qui a gâché la fête :
« Quelle catastrophe, la cérémonie d’ouverture vire au chaos : la pluie couvre la musique, les athlètes et les invités du Royaume sont obligés de porter des protections et les spectateurs de se mettre à l’abri. ».
Des Anglais qui narguent les Français à cause de la pluie, c’est cocasse.
C’est un média brésilien « UOL » qui a regretté l’ambiance d’un stade et désigné l’objectif des organisateurs : un spectacle de télévision :
« Un spectacle déroutant fait pour la télévision […] Sans public rassemblé, cela manque de dynamisme. […] La pluie n’a pas aidé. […] La cérémonie qui se voulait démocratique a vraiment mal tourné et a frustré des milliers de personnes qui ont rêvé de ce moment et ont parcouru un Paris pluvieux pour tenter de voir quelque chose. Dommage. »
Mais d’autres polémiques ont surgi, montrant des tensions au sein de la société française.
« Le Monde » a publié un article dans lequel il oppose la gauche et l’extrême droite rejoint par une partie de la droite.
 Le premier tableau déclenchant les hostilités fut la prestation d’Aya Nakamura. La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde s’est produite, portant une robe à plumes dorées, aux côtés de la garde républicaine, en uniforme, devant l’Académie française.
Le premier tableau déclenchant les hostilités fut la prestation d’Aya Nakamura. La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde s’est produite, portant une robe à plumes dorées, aux côtés de la garde républicaine, en uniforme, devant l’Académie française. « Le Monde » cite de nombreuses personnalités de gauche qui ont applaudit à ce mélange audacieux. En revanche, Marine Le Pen avait estimé avant la cérémonie que la présence d’Aya Nakamura était une tentative d’Emmanuel Macron pour « humilier le peuple français ».
Le soir su spectacle, elle a laissé le porte-parole du Rassemblement national, Julien Odoul, porter l’attaque :
« Quelle honte ! Aya Nakamura y a pas moyen ! L’ouverture des Jeux olympiques est un saccage pour la culture française. »
Pour ma modeste part, je n’ai a priori aucun goût à la musique d’Aya Nakamura. Je concède cependant que ce partenariat baroque entre une institution militaire française et une chanteuse portant un visage moderne et coloré de la France m’a beaucoup séduit. Tant que l’esprit républicain est respecté, ce qui fut le cas devant l’Académie française, la diversité enrichit et renforce la France, surtout quand celles et ceux qui sont différents savent s’associer pour réaliser des choses ensembles.
Il y eut ensuite la polémique sur le tableau « Festivité » dans lequel des drag-queens se retrouvent autour une table, scène dans laquelle certains esprits orientés ont reconnu la Cène, avec peu après l’apparition du chanteur Philippe Katerine (presque) nu.
Patrick Boucheron qui fut un des inspirateurs de la cérémonie explique :
« Rien, dans le scénario initial, n’évoque explicitement [la Cène]. Nos références étaient plutôt de jouer des connotations dionysiennes — et du fil qui se tisse entre la Grèce olympique et Paris car Dionysos, ou plutôt Denis, est le père de Sequana [la Seine]. Ainsi, cette grande table est un festin des Dieux, qui devient le podium d’un défilé de mode déjanté. ».
 Les politiques d’extrême droite qui se sont exprimés ont, à travers l’appel au récit chrétien, laissé s’exprimer, avant tout, leur homophobie. Marion Maréchal a désigné les jeux sous le nom de « J-Woke 2024 » et a ajouté « A tous les chrétiens du monde qui regardent la cérémonie d’ouverture et se sont sentis insultés par cette parodie drag-queen de la Cène, sachez que ce n’est pas la France qui parle mais une minorité de gauche prête à toutes les provocations. ».
Les politiques d’extrême droite qui se sont exprimés ont, à travers l’appel au récit chrétien, laissé s’exprimer, avant tout, leur homophobie. Marion Maréchal a désigné les jeux sous le nom de « J-Woke 2024 » et a ajouté « A tous les chrétiens du monde qui regardent la cérémonie d’ouverture et se sont sentis insultés par cette parodie drag-queen de la Cène, sachez que ce n’est pas la France qui parle mais une minorité de gauche prête à toutes les provocations. ». Ce rejet a dépassé les frontières de la France. Dans certains pays comme le Maroc, des images de ce type n’ont pas été diffusées et ont été remplacées par des plans fixes sur les monuments.
Mais il faut lire Alexandre Douguine qui est allé plus loin dans les délires pseudo-mystiques d’un christianisme figé et ayant refusé d’évoluer avec la modernité. Douguine est un intellectuel, idéologue d’extrême droite russe connu pour ses positions ultra-nationaliste. Il semble être un intellectuel influent dans les cercles nationalistes, et il est parfois considéré comme un des inspirateurs de la politique étrangère de Vladimir Poutine. Il a commenté ainsi la cérémonie :
« L’ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris est le jugement final de la civilisation occidentale moderne. L’Occident est maudit, c’est une évidence. Quiconque ne prend pas immédiatement les armes pour détruire cette civilisation satanique, sans précédent dans son effronterie, en est complice. Mais un autre aspect est également important. Sur ce pôle, il y a l’Occident et son satanisme affiché. Et sur notre pôle, qu’avons-nous ? Quelque chose d’un peu plus décent […] Mais nous y dérivons encore par inertie et ne remettons certainement pas en question l’étape précédente de notre histoire – sommes-nous même dans le bon train si la dernière station du parcours est les Jeux olympiques français de 2024 ? L’Occident est le diable. […] L’Occident (et donc le diable) a commencé à pénétrer systématiquement en Russie au XVIIe siècle…»
Vous pourrez lire l’intégralité de son commentaire délirant dans cet article du « Grand Continent » : « 86 % des Français considère que la cérémonie d’ouverture a été « un succès » ». J’ai l’intuition qu’un grand nombre d’évangélistes qui suivent Trump exprimeraient des condamnations proches de Douguine.

La conciergerie Le dernier tableau qui fut l’objet des critiques les plus sévères fut celle de la reine Marie-Antoinette, tête décapitée qui chantait « ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. »
C’est en passant devant la conciergerie, où fut enfermée la reine pour ses derniers jours, que ce tableau qui associe le groupe de metal Gojira et la chanteuse d’art lyrique Marina Viotti est réalisé.
Certains s’insurgent en trouvant que cette image est porteuse de division des français. Elle porte aussi le côté rebelle et souvent révolté de la nation française. C’est du théâtre et c’est un instant de l’Histoire française et qui est intimement lié avec ce monument de Paris.
Et puis il y eut 4 tableaux de rêve, de poésie et de force.
 D’abord la jeune et lumineuse chanteuse Axelle Saint-Cirel qui a interprété la Marseillaise.
D’abord la jeune et lumineuse chanteuse Axelle Saint-Cirel qui a interprété la Marseillaise. Elle ne s’est pas retirée comme Lady Gaga, mais a choisi dans des conditions de sécurité compliquées, sous une pluie battante, de monter comme il était prévu sur le toit du Grand Palais et de chanter Une Marseillaise réorchestrée par Victor le Masne et magnifiquement interprétée avec un chœur de femmes.
Patrick Boucheron écrira dans l’article précité :
« Pour moi, c’est une des images les plus fortes — celle du courage, de la jeunesse, du talent. »
Le deuxième tableau qui m’a ébloui fut celui, près du pont Alexandre III, quand sont apparues, émergeant une à une de leur socle au son de la Marseillaise, dix grandes statues dorées représentant des femmes ayant marqué l’histoire de France dans les domaines des sciences, des arts, des lettres, de la politique ou du sport.

Simone Veil et les autres femmes remarquables Il s’agissait de Simone de Beauvoir (1908–1986) ; la magistrate et femme politique française Simone Veil (1927–2017), rescapée de la Shoah et qui obtint la légalisation de l’avortement en France en 1975 après une âpre lutte ; l’écrivaine et militante anarchiste Louise Michel (1830–1905), figure majeure de la Commune de Paris ; l’avocate et femme politique Gisèle Halimi (1927–2020) ; et la dramaturge et activiste Olympe de Gouges (1748–1793), qui plaida en faveur du droit des femmes et des esclaves durant la Révolution française. D’autres, moins connues du grand public, ont été mises en lumière à cette occasion : la philosophe et poétesse Christine de Pizan (1364–1431) qui fut l’une des premières femmes de lettres en Europe ; l’exploratrice et botaniste Jeanne Barret (1740–1807), première femme à avoir fait le tour du monde, déguisée en homme ; l’athlète Alice Milliat (1884–1957), qui œuvra pour l’inclusion des femmes dans le sport en organisant les premiers Jeux mondiaux féminins en 1922 ; la journaliste et écrivaine Paulette Nardal (1896–1985), figure du mouvement de la négritude et l’une des premières femmes noires à avoir étudié à la Sorbonne ; et la réalisatrice, scénariste et productrice Alice Guy (1873–1968), pionnière du cinéma narratif.
Le troisième tableau fut le plus poétique, le plus créatif, comme un conte : un cheval métallique monté par une cavalière qui apporte le drapeau olympique. Je laisse encore la parole à Patrick Boucheron :
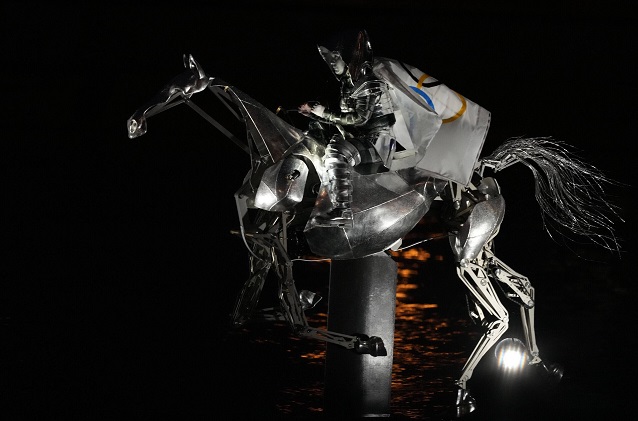
Zeus et sa cavalière sur la Seine « Ces douze minutes de traversée de Paris à cheval devaient passer comme un rêve : celui de notre propre rapport à l’imaginaire. La cavalière est ce vous voulez qu’elle soit : elle peut être la déesse gauloise Sequana qui donne naissance à la Seine, elle peut ressembler à Jeanne d’Arc si vous le souhaitez, mais si vous pensez au cheval de Beyoncé cela va très bien aussi. Impossible là encore de discipliner ses connotations : l’essentiel est qu’elle file sur l’eau noire, vite et droit, comme un trait de lame. […] C’est dans cette superposition de strates imaginaires, sans la dénotation ou la précision de la référence sur le plan historique, que se produit une image pour le monde entier. Entre la pop culture, l’histoire de Paris et son « fluctuat nec mergitur », ce symbole parle à un Japonais, à une Américaine, à un Nigérien ou à une Norvégienne. »
Le quatrième tableau fut celui de l’élévation, de la légèreté, celui de la flamme olympique qui s’élance dans le ciel de Paris.

La Flamme olympique dans le ciel de Paris Cette cérémonie fut pour moi un acte de création, avec beaucoup d’Histoire, un peu de magie et le plus souvent une immense poésie.
Une France qui regarde vers son passé et qui accepte de se tourner vers la modernité et toute la richesse de ses enfants qui peuvent venir d’ailleurs mais qui ont choisi ce pays, cette nation.
-
Mardi 23 juillet 2024
« Une lumière si tendre qu’elle semble s’adresser aux morts plus qu’à nous. »Christian Bobin « Ressusciter »C’était un immense cadeau que nous nous offrions l’un à l’autre : du temps.
 Deux fois par an, l’été et l’hiver, Fabien et moi convenions d’un jour : un vendredi, d’un lieu : un restaurant pour nous offrir ce qu’un être humain a de plus précieux : du temps de vie.
Deux fois par an, l’été et l’hiver, Fabien et moi convenions d’un jour : un vendredi, d’un lieu : un restaurant pour nous offrir ce qu’un être humain a de plus précieux : du temps de vie.
La dernière fois où nous avons eu cet échange à deux, ce fut au restaurant Bulle qui est situé juste à côté de la basilique de Fourvière.
La qualité du repas était importante, mais n’était pas principale.Le cadre, l’écrin du dialogue, était plus essentiel.
A la fin du repas, comme nous avions prélevé 1/2 journée sur notre portefeuille de congé, nous nous accordions encore le reste de l’après-midi, pour continuer la discussion en marchant et en finissant par nous asseoir à la terrasse d’un café.
Nous parlions de tout, de politique, d’économie, d’Histoire, des relations humaines, de la santé, des idées et de la vie.
Et puis nous parlions aussi de notre finitude, la mort s’invitait à notre dialogue.Surtout depuis un épisode qu’il avait vécu.
 Le 30 novembre 2018, notre rendez-vous avait eu lieu au Restaurant « Les téléphones » situé rue Radisson dans le 5ème arrondissement de Lyon, près des ruines romaines.
Le 30 novembre 2018, notre rendez-vous avait eu lieu au Restaurant « Les téléphones » situé rue Radisson dans le 5ème arrondissement de Lyon, près des ruines romaines.
Quelques semaines plus tard, en plein déjeuner, lors de la pause méridienne professionnelle, Fabien s’est écroulé victime d’un arrêt cardiaque.
Un collègue, initié dans cette technique, a immédiatement pratiqué des massages cardiaques pendant que d’autres appelaient le SAMU.
Il fut sauvé !Lors de notre rencontre suivante, il eut ce mot :
« Je suis mort, mais j’ai ressuscité ! »
Il faut croire qu’on ne peut ressusciter qu’une fois.
Fabien a quitté définitivement la communauté des vivants le 20 juillet 2024, il avait 62 ans.
« Ressusciter » est un verbe particulier, il se conjugue à la fois avec l’auxiliaire être et avec l’auxiliaire avoir et il est surtout l’apanage d’une grande communauté de croyants qui racontent une histoire dans laquelle un homme, mais qui dans ce récit était aussi un dieu, est ressuscité, le 3ème jour après sa mort.
Christian Bobin a écrit un ouvrage en 2001 qui a pour titre « Ressusciter », on peut y lire ces mots dont j’ai extrait l’exergue du mot du jour.
« Il y a ce matin sur les arbres, les murs et dans le ciel, une lumière si tendre
qu’elle semble s’adresser aux morts plus qu’à nous.
à moins que ce ne soient les morts qui nous l’envoient,
comme on écrit une lettre rassurante à des parents un peu inquiets. »
« Ressusciter » Page 79 dans la version FolioLa dernière fois que nous nous sommes vus c’était le 17 mai, Pierre s’était joint à nous. Fabien se plaignait bien de quelques douleurs mais il ignorait alors qu’un cancer terriblement agressif était à l’œuvre. La médecine s’est révélée impuissante à stopper le mal.
 Nos agapes et nos causeries fécondes nous éloignaient parfois de Lyon comme ce vendredi de juin 2020, au milieu de deux confinements, où notre lieu de rencontre se situait à Ville-sur-Jarnioux, dans la petite région appelée « Pierres dorées ».
Nos agapes et nos causeries fécondes nous éloignaient parfois de Lyon comme ce vendredi de juin 2020, au milieu de deux confinements, où notre lieu de rencontre se situait à Ville-sur-Jarnioux, dans la petite région appelée « Pierres dorées ».Il venait de découvrir ce petit restaurant plein de charme : « L’Auberge de la place » situé 7 route de Theizé.
Cette fois-là, après le restaurant, nos pas nous ont amené à Chasselay.
7 jours auparavant, j’avais écrit un mot du jour sur «Le Tata sénégalais de Chasselay» parce que 80 ans plus tôt, le 20 juin 1940, des soldats allemands de la Wehrmacht et non des SS comme on l’a cru pendant longtemps, ont assassiné des soldats français parce qu’ils avaient la peau noire et qu’ils avaient résisté avec force et courage à l’armée blanche des bons aryens
 Dans ce mot du jour j’expliquais que « Tata » signifie enceinte fortifiée en Afrique. L’édifice, entièrement ocre rouge, est constitué de pierres tombales entourées d’une enceinte rectangulaire de 2,8 mètres de hauteur. Son porche et ses quatre angles sont surmontés de pyramides bardées de pieux. Le portail en claire-voie, en chêne massif, est orné de huit masques africains.
Dans ce mot du jour j’expliquais que « Tata » signifie enceinte fortifiée en Afrique. L’édifice, entièrement ocre rouge, est constitué de pierres tombales entourées d’une enceinte rectangulaire de 2,8 mètres de hauteur. Son porche et ses quatre angles sont surmontés de pyramides bardées de pieux. Le portail en claire-voie, en chêne massif, est orné de huit masques africains.
On a fait venir de la terre de Dakar par avion, pour la mélanger à la terre française.
188 tirailleurs « sénégalais » ainsi que six tirailleurs nord-africains et deux légionnaires (un Albanais et un Russe) y sont inhumés. Nous nous sommes rendus, plein d’émotion, dans ce lieu de mémoire.
L’Histoire était un de nos sujets de discussion préférés. Fabien lisait énormément, c’était un puits de culture.
Au début de notre rencontre, lors des pauses méridiennes de notre service, Fabien m’étonnait par l’étendue de son savoir qu’il présentait avec assurance mais sans aucune arrogance.
J’étais tellement interpellé qu’après la pause j’allais vérifier ses dires, c’était quasi toujours parfaitement exact. Quand il y avait quelques imprécisions, il pouvait s’expliquer facilement par de petites confusions jamais essentielles. Il reconnaissait d’ailleurs facilement ces quelques erreurs minimes.
Un collègue Louis B. avait eu cette description, finalement assez juste :
« Fabien, c’est ce collègue qui, alors que tu lui demandes l’heure, te narre l’histoire de l’horlogerie »
Mais Fabien était bien plus que cela.Il était d’une profonde humanité et ce que nous échangions ce n’était pas essentiellement nos savoirs mais bien davantage ce que nous avions appris et continuions d’apprendre de la vie.
Après le mot du jour, dans lequel je laissais entrevoir une aggravation de mon état de santé, je lui envoyais un message pour l’inciter à rapidement fixer une date de rencontre car je lui disais que nous ne savions pas combien de rencontres nous pourrions encore nous offrir.
Il m’a alors répondu par ce message :
« Comme tu l’as exprimé dans ton mot du jour du 21 janvier sur « l’attente », la solitude et le silence peuvent être habités.
J’ai ressenti ce mot du jour dans toute sa profondeur comme tu l’auras sans doute deviné, une profondeur qui s’inscrit certes dans mais aussi au-delà de nos histoires et trajectoires personnelles et nous renvoie à l’humaine condition, c’est à dire à l’essentiel.Si « La solitude et le silence peuvent être habités » c’est aussi en partie parce que les mots ne permettent pas toujours d’exprimer avec exactitude la complexité de ce que nous ressentons …
Cher Alain, nous n’allons pas pour autant sacrifier au culte de la vitesse et tu comprendras que je me refuse tout particulièrement à évaluer le nombre de repas qu’il nous resterait à partager faisons comme nous le ressentons.
Comme d’habitude, pour le choix du lieu de nos agapes, je m’en remets lâchement et pleinement à ton choix, ..aussi propose moi ( et c’est un ordre ! ) une prochaine date de rencontre. Il n’appartient qu’à nous de faire de ces moments de vrais moments d’amitié et de liberté. »
 Tous ceux qui l’ont connu, ont apprécié sa bonhomie, sa bienveillance, sa rectitude. Il était de ceux à qui on pouvait toujours faire confiance, on savait que cette confiance était entre de bonnes mains.
Tous ceux qui l’ont connu, ont apprécié sa bonhomie, sa bienveillance, sa rectitude. Il était de ceux à qui on pouvait toujours faire confiance, on savait que cette confiance était entre de bonnes mains.
Il savait écouter avant de parler.
Nous n’étions pas toujours d’accord, mais nous savions accepter nos désaccords et aussi évoluer à cause de l’argumentation de l’autre.
Fabien était mon collègue.
Il est devenu mon ami, un ami précieux, un ami qui fait progresser.
Nous n’irons plus ensemble dans tous ces restaurants comme « l’Étage » place des terreaux auquel on accède après avoir monté un escalier d’un autre temps.
Le serveur à l’humour « pince sans rire » nous révélait qu’il était encore plus difficile à descendre qu’à monter et que parfois après des repas arrosés, des convives descendaient très vite en roulant plutôt qu’en marchant.

Photo prise en décembre 2021 après notre repas à l’Artichaut, je prends en photo Fabien en train de prendre une photo de la basilique d’Ainay Ou encore « l’Artichaut » qui se situe à côté de la merveilleuse Basilique d’Ainay, endroit qui incite au recueillement, à la méditation.
C’est lors de ce repas que Fabien m’a parlé de Jules Supervielle et comme un moment, hors du temps, m’a récité, d’un trait, ce poème :
« Encore frissonnant
Sous la peau des ténèbres
Tous les matins je dois
Recomposer un homme
Avec tout ce mélange
De mes jours précédents
Et le peu qui me reste
De mes jours à venir.
Me voici tout entier,
Je vais vers la fenêtre.
Lumière de ce jour,
Je viens du fond des temps,
Respecte avec douceur
Mes minutes obscures,
Épargne encore un peu
Ce que j’ai de nocturne,
D’étoilé en dedans
Et de prêt à mourir
Sous le soleil montant
Qui ne sait que grandir. »J’en avais fait l’objet du mot du jour du 23 décembre 2021.
Il reste la richesse de tout ce que nous avons échangé, des souvenirs à jamais dans mon cœur de vivant.
« J’écris pour me quitter,
aussi pour inventer une maison pour les vivants,
avec une chambre d’amis pour les morts »
Christian Bobin, « Ressusciter » Page 83 dans la version Folio -
Vendredi 12 juillet 2024
« Gagner »Comment gagner ?Qui gagne ?
Qui perd ?
Jean-Luc Melenchon affirme que le Nouveau Front populaire a gagné et, qu’à l’intérieur du NFP, son parti a gagné .
Il en conclut que c’est au sein du parti le plus à gauche de l’échiquier politique qu’il faut désigner le premier ministre. Et avec tout cela, il veut appliquer son programme, tout son programme.
La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet s’insurge« Emmanuel Macron veut nous voler la victoire ! ».
 D’autres pensent que c’est le Rassemblement National qui a gagné.
D’autres pensent que c’est le Rassemblement National qui a gagné.
D’abord au premier tour comme au second, c’est ce bloc d’extrême droite qui a a obtenu le plus de voix.
Ensuite à l’intérieur de l’hémicycle, si on s’intéresse aux groupes politiques, c’est à dire aux députés qui ont suffisamment de convergence pour accepter de siéger dans un ensemble homogène et identifié au Parlement, le RN est nettement le premier groupe.
En outre, sa progression entre la législature précédente et celle d’aujourd’hui est la plus importante de toutes les formations.Il existe aussi des hommes politiques comme Bruno Retailleau qui prétendent que c’est « la Droite » qui a gagné et qu’il est impossible de nommer un premier ministre de gauche :
« Notre pays est majoritairement à droite ! »
Personne ne s’aventure à dire qu’Ensemble, les formations politiques qui, avant la dissolution, formaient la majorité présidentielle, a gagné. Il y a des limites à l’outrance. Toutefois, le président de la république pour quelques mois encore, au maximum 34, a écrit une lettre le 10 juillet, dans laquelle on trouve cette phrase :
« Personne ne l’a emporté. »
Et, avec tous ces braves gens comment est-il possible de gouverner la France ?
Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Melenchon et quelques autres sont fondamentalement des autocrates, des bonapartistes, non des démocrates.
Il considère qu’il faut un processus de désignation d’un vainqueur, selon des méthodes quelconques.Le fait que des électeurs votent pour leur parti pour éviter une catastrophe plus grande, sans partager leurs options politiques fait partie de ces méthodes. Une fois « ce truc de prestidigitateur » ayant donné un résultat, celui qui est premier pense pouvoir gouverner à sa guise, sans tenir compte des autres. Les institutions de la cinquième république donne d’ailleurs quelques outils pour ce faire.
Dans sa lettre du 10 juillet, Emmanuel Macron, exprime des réticences par rapport à cette méthode. Le problème c’est qu’il l’a appliquée depuis 2022, alors que lui aussi n’avait pas gagné les législatives, sa majorité présidentielle était seulement le groupe le plus important de l’Assemblée.
Que ferait des démocrates ?
Les différents groupes se réuniraient pour discuter d’un programme. Non pas pour choisir dans une liste de distribution de gratification, mais pour répondre à des questions :
- Comment envisagez vous la dette de la France ?
- Que pensez vous qu’on puisse faire pour le pouvoir d’achat des français ?
- Quel est votre plan pour affronter le défi climatique et écologique ?
- Quel est votre plan énergétique, sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire ?
- Que pensez vous faire pour la réindustrialisation de la France et l’attractivité du territoire ?
- Quelle est votre politique européenne ?
- Quelle est votre position sur la guerre en Ukraine ? et à Gaza ? Quelle est votre position sur le budget de la défense ? Quelle est votre vision par rapport à l’OTAN ?
- Que proposez vous pour diminuer les tensions à l’intérieur de la société française ? Comment peut on rendre l’immigration compatible avec les craintes des français ? Quelle est votre modèle républicain et votre conception de la laïcité ?
- Quelle est votre position sur la demande de sécurité des français ?
- Considérez vous qu’il existe un sujet d’insécurité culturelle des français ou cette question est-elle en dehors de votre analyse ?
On pourrait continuer et notamment parler du scrutin proportionnel qui constitue, dans l’état actuel des choses, une arme efficace contre les autocrates.
Qui a gagné ? Qui a perdu ?
Peut être faut il poser la question autrement comment gagne t’on vraiment ?
Et comment perd t’on dignement. ?
Pour donner une piste, je voudrai évoquer un épisode sportif.
Le 2 décembre 2012, une épreuve de cross-country se déroulait à Burlada, en Espagne.
 Le premier de la course, le Kenyan Abel Mutai (médaillé de bronze du 3 000m steeple cet été aux JO de Londres), s’apprête à remporter la course. Pensant avoir franchi la ligne, il coupe sa foulée et regarde son chronomètre… Seulement, il s’est trompé, et la ligne d’arrivée réelle est à quelques dizaines de mètres.
Le premier de la course, le Kenyan Abel Mutai (médaillé de bronze du 3 000m steeple cet été aux JO de Londres), s’apprête à remporter la course. Pensant avoir franchi la ligne, il coupe sa foulée et regarde son chronomètre… Seulement, il s’est trompé, et la ligne d’arrivée réelle est à quelques dizaines de mètres.Derrière lui, l’Espagnol Ivan Fernandez Anaya arrive en pleine lancée. Il s’aperçoit immédiatement de la méprise de Mutai, et lui fait signe que la ligne est plus loin. Il essaye de dire au Kenyan de continuer à courir.
Mutai ne connaissait pas l’espagnol et ne comprenait pas. Alors Fernandez a poussé Mutai à la victoire. A ceux qui lui ont demandé pourquoi il a fait cela, Ivan Fernandez Anaya a déclaré qu’il ne méritait pas de gagner, car il n’aurait jamais pu rattraper Abel Mutai sans son erreur.
Ivan Fernandez Anaya, 24 ans, a été champion d’Espagne espoirs du 5 000 mètres en 2010.
On trouve sur les réseaux sociaux cette belle histoire avec des photos erronées ou des réflexions pleines de sagesse qui aurait été prononcées par l’espagnol et qui ne sont pas exactes.
L’histoire montre simplement un homme qui a une éthique et qui se pose la question : Comment gagne- t-on ? Je crois que c’est une bonne question.
-
Lundi 8 juillet 2024
« La Gauche est très minoritaire dans le pays ! »Des chiffres et une analyse factuelleCertains propos de hier soir ont profondément irrité mon âme démocrate.
Si je me suis réjouis que les citoyens français ont une nouvelle fois, et j’espère que ce ne sera pas la dernière, repoussé la menace de l’arrivée au pouvoir de gens xénophobes, illibéraux et incompétents, il n’est pas décent que des hommes politiques qui combattent cette menace plongent dans la démagogie et le déni.
Quand Jean-Luc Melenchon affirme que son camp a gagné et que le seul choix est d’appliquer son programme, tout son programme et rien que son programme il tient des propos hors sol et dangereux pour la démocratie, parce qu’il ne tient pas compte des autres électeurs.
Revenons simplement à ce qui s’est passé lors de ces deux tours d’élections législatives qui ont permis d’élire une Assemblée nationale dont la durée de vie se situe entre 1 et 5 ans. Et n’oublions pas qu’il ne s’agit pas d’un jeu mais de gouverner notre vieux pays qui est menacé par la guerre, par les dettes, par le défi climatique, par la détresse sociale, par l’insécurité physique et culturelle.
Tous les résultats se trouvent sur le site du Ministère de l’Intérieur à l’adresse suivante : <Résultats législatives 2024>
Voici d’abord le tableau des résultats du premier tour qui s’est déroulé le dimanche 30 juin 2024. J’ai ajouté une colonne regroupement, pour tenter d’inscrire tous ces mouvements politiques dans notre grammaire républicaine qui classe les tendances politiques entre l’extrême gauche et l’extrême droite. Il est nécessaire, pour une petite part, de distinguer une tendance <autre> notamment pour les divers et régionalistes.

Dès lors lorsque qu’on présente les résultats en voix selon cette typologie on obtient ce tableau. Mais visuellement, c’est par l’intermédiaire d’un graphique qu’on peut le mieux discerner l’état des forces en présence.
Dès lors, il est clair que les mouvements qui se réclament de la gauche sont nettement minoritaires dans l’électorat. Pour espérer obtenir une majorité il faudrait que ces mouvements puissent s’adjoindre, convaincre, s’allier avec la quasi l’intégralité du mouvement de centre droit, plutôt à droite de ce qui reste de la majorité présidentielle macroniste.Il me semble que toutes les personnes raisonnables qui ont réfléchi à situation politique dans notre pays ont conclu qu’il faudrait abandonner le scrutin uninominal à deux tours qui n’est plus pratiqué qu’en France pour passer au scrutin proportionnel.
Le scrutin proportionnel a également des défauts, notamment celui d’interdire au corps électoral d’écarter un candidat dont il ne veut pas. En effet, la confection des listes étant entre les mains des dirigeants des partis politiques, les députés sont ceux qui sont choisis par ces dirigeants .
En revanche, et cela me semble la qualité essentielle de ce mode de scrutin, il ne permettra jamais à un force politique qui dispose de l’appui d’un tiers de l’électorat, d’obtenir la majorité absolue des sièges de l’Assemblée nationale et de poursuivre une politique contraire à la volonté des deux tiers des citoyens.
En outre, ce mode de scrutin rend inutile des alliances contre nature entre des partis politiques qui sont en désaccord sur des points fondamentaux. Enfin, il rend indispensable une autre manière de conduire la politique puisqu’il induit la nécessité de coalitions après les élections. Dès lors si on avait appliqué un scrutin proportionnel aux résultats du premier tour, en prenant comme règle que seuls les mouvements disposant au minimum de 5% des voix peuvent obtenir des députés, on arrive à cette assemblée :
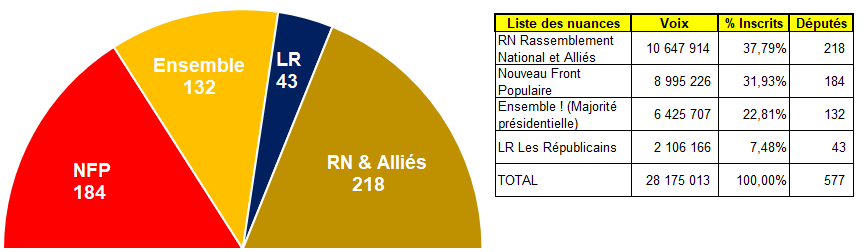
Arrivé à ce stade, il apparait normal de vouloir comparer l’image de cette assemblée avec celle qui est issue du second tour.
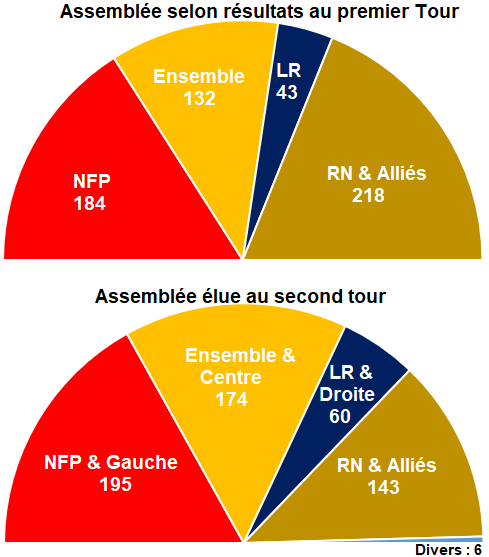 Le scrutin uninominal autorise des candidatures locales qui ne se rattachent pas formellement à un des grands partis.
Le scrutin uninominal autorise des candidatures locales qui ne se rattachent pas formellement à un des grands partis.En outre, des dissidents de l’un ou l’autre parti peuvent aussi obtenir le succès qui leur serait refusé dans un scrutin proportionnel.
Pour pouvoir comparer les deux assemblées, il faut évidemment faire des rapprochements que j’ai effectué ci-contre selon les classements du ministère l’intérieur qui a rangé ces députés selon une répartition gauche, droite, centre. Il reste des régionalistes divers qui sont plus difficilement classables. On constate donc que le Rassemblement national a été très défavorisé par le scrutin actuel. Il me semble très pernicieux que celles et ceux qui se réjouissent de cet effet, en raison de leur opposition radicale à ce parti, considèrent qu’il ne faut pas changer le mode de scrutin qui permet cela. Pour ma part, je n’ai pas de doute, il arrivera un jour où le RN profitera à son tour des effets pervers du scrutin uninominal à deux tours pour obtenir un nombre de sièges disproportionné par rapport à son ancrage électoral.
Hier nous avons donc vécu le second tour, car il restait 501 députés à élire. Pour certains ce fut une divine surprise. De manière factuelle voilà la répartition en voix, en siège et en pourcentage. J’ai repris les mêmes regroupements que pour le premier tour.
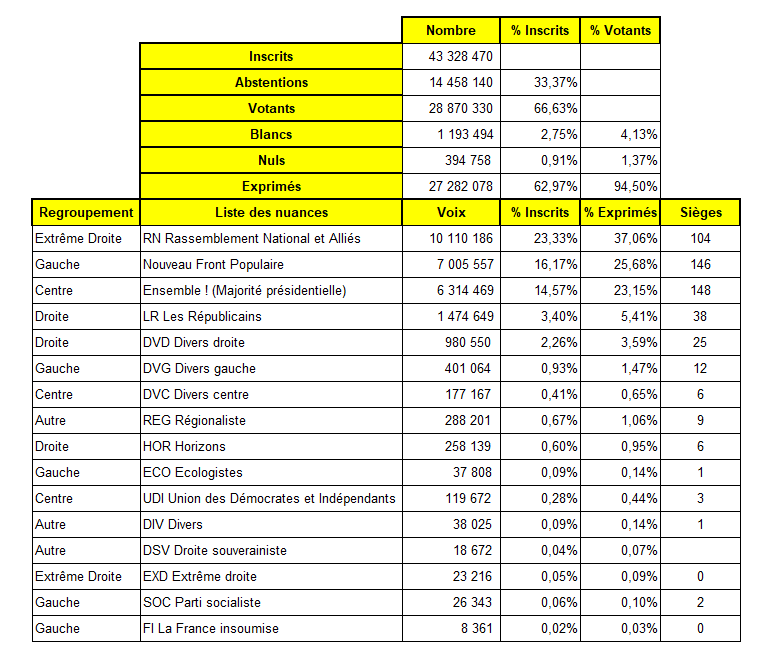
Nous constatons les effets déformants qu’induit ce mode de scrutin dans la distribution des sièges. Le Rassemblement national arrive encore largement en tête du scrutin avec plus de 10 millions d’électeurs, il fait mieux qu’au premier tour avec 37% des exprimés contre 33% au premier tour.
Avant de lire ces chiffres, étiez vous conscients de cette réalité ?
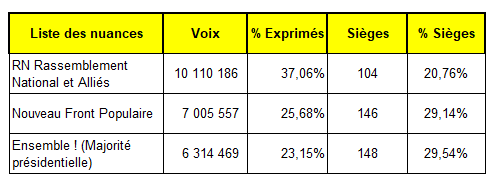 501 sièges étaient à distribuer. Si on ne s’intéresse qu’au trois grands blocs de cette élection, on constate que si 37% des électeurs lui ont donné leur bulletin, ils n’ont récupéré que 20,8 % des sièges. En parallèle la majorité présidentielle avec 23,15% des voix a récupéré près de 30% des sièges. Le nouveau front populaire a obtenu 25,7% des voix, si on a écouté le démagogue Melenchon, hier juste après 20:00, on avait le sentiment qu’il croyait avoir obtenu 50% des suffrages. Et si on refait un graphique des forces en présence comme pour le premier tour on obtient le schéma suivant :
501 sièges étaient à distribuer. Si on ne s’intéresse qu’au trois grands blocs de cette élection, on constate que si 37% des électeurs lui ont donné leur bulletin, ils n’ont récupéré que 20,8 % des sièges. En parallèle la majorité présidentielle avec 23,15% des voix a récupéré près de 30% des sièges. Le nouveau front populaire a obtenu 25,7% des voix, si on a écouté le démagogue Melenchon, hier juste après 20:00, on avait le sentiment qu’il croyait avoir obtenu 50% des suffrages. Et si on refait un graphique des forces en présence comme pour le premier tour on obtient le schéma suivant :
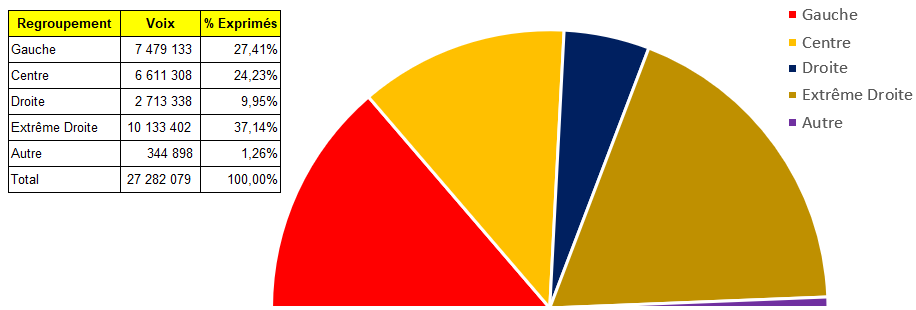
Hier, La gauche n’était pas minoritaire, elle est très minoritaire. Hier soir, après que mon ancien camarade du PS, Philippe Prieto se réjouissait de la victoire de la candidate socialiste dans la circonscription où je vote, je lui écrivais ce message :
« Il y a un peu de répit. Mais attention ce sera très compliqué. Certaines prises de position, ce soir, par des membres de NFP sont totalement hors sol. La Gauche est minoritaire en voix en France. Au premier tour elle représente à peu près 32% des exprimés. Au second tour elle pèse encore moins. Ce n’est pas avec cela qu’on applique « son programme », « tout son programme. ».
C’est le temps de l’humilité, des discussions et des compromis intelligents.
Est ce qu’il y a des hommes de gauche lucides et convaincants qui peuvent prendre ce rôle ».Oui, il faut de l’humilité et le sens du compromis. Sinon ce que nous redoutions reviendra en boomerang, plus fort encore.
-
Mercredi 3 juillet 2024
« La brutalité et la tendresse »Inspiré par François Ruffin.L’extrême droite c’est le mal !
J’en suis convaincu.L’extrême gauche c’est le bien ?
J’ai des doutes.Doute qui s’efface quand j’essaie d’écouter ce clip de rap, publié dans la nuit du 1er juillet, « No Pasaran ». Ce sont 20 strophes ou couplets qui sont alternativement psalmodiés par plusieurs rappeurs.
On commence la première strophe par Sofiane, c’est à dire Sofiane Zermani, né le 21 juillet 1986 à Saint-Denis dans le 93 :
« La menace vient droit des cités (Ouais, ouais, pah), ma gueule, on vote contre les porcs
Jordan, t’es mort, Jordan, t’es mort ».La seconde est confiée au rappeur Zola, de son vrai nom Aurélien N’Zuzi Zola né le 16 novembre 1999 à Évry en Essonne :
« Yeah, j’propose un octogone à Bardella
Ferme les frontières mais la dope remontera d’Marbella quand même (Quand même)
Donc, ouais, c’est pour ça qu’je les ken, donc ouais, c’est pour ça qu’j’ai la paye (Ouais, ouais) »La troisième, Kerchak, anciennement Zolal, originaire de Bois-Colombes, est né le 19 février 2004. Il exprime les sentiments suivants :
« J’suis pas les politiciens genre j’fais pas trop le Mandela (Nan, nan)
Mais tout c’que j’sais, c’est qu’on vote pas Marine et baise la mère à Bardella (Rrrah) »Je joins le texte intégral <No Pasaran> et je dévoile encore quelques passages fleuris :
Le rappeur Alkpote, nom de scène d’Atef Kahlaoui, né le 3 février 1981 dans le 10e arrondissement de Paris :
« J’recharge le Kalachnikov, en Louis Vuitton comme Ramzan Kadyrov (Clique, clique)
Nique l’imam Chalgoumi et ceux qui suivent le Sheitan à tout prix (Trogneux)
Marine et Marion, les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut (Vlan)»Sauf pour la dernière phrase qui devrait faire hurler toutes les féministes de droite et de gauche !!!! Il faut peut être quelques notes explicatives. Ramzan Kadyrov est le président de la Tchétchénie, alliée de Poutine il a pris le pouvoir après que les troupes russes aient massacré la population tchétchène qui voulait s’émanciper du colonialisme russe.
Ramzan Kadyrov applique dans sa république un islamisme rigoriste, il avait minimisé l’acte terroriste de son compatriote qui avait décapité Samuel Paty.
L’imam Chalgoumi est celui de Drancy qui est menacé de mort depuis des années pour ses prises de position républicaines. « Sheitan » est un mot arabe qui signifie : Satan ou démon.
J’ignore ce que vient faire le nom de Trogneux dans ce morceau de haine, nous savons que c’est le nom de naissance de l’épouse du président de la République.
Ce même rappeur continue sa logorrhée par ces propos complotistes :
« Nique tous ces députés, on sait qu’ils manipulent les statistiques (Menteurs) […]
Font du mal à nos enfants, ils veulent nous injecter une puce dans l’sang (Antéchris) »Les francs-maçons sont aussi leurs ennemis : Strophe 8 : « Fuck ******** ******, c’est tous des francs-maçons » Strophe 13 « Espèce de franc-maçon, tu te nourris du sang qu’tu consommes Dans leurs ambassades, c’est le Sheitan qui les passionne Ouais, la France, c’est nous (C’est nous), fuck Eric Zemmour».
Quand ces personnes qui sont françaises et ont leur place en France crient, après toutes leurs invectives, « Ouais, la France, c’est nous » ils en sont au même stade d’exclusion que ceux du RN qui disent « La France, c’est nous ». Il y a alors deux France face à face, ce n’est pas ainsi qu’on fait société, et ces jeunes gens sont aussi coupables que ceux qu’ils veulent combattre.
Je trouve tout cela affligeant. Ce n’est pas ma Gauche.
Le Parisien évoque sobrement « des paroles particulièrement virulentes contre le Rassemblement national ou ses dirigeants ». Sur le site de France Info, on lit que « les rappeurs utilisent des paroles incisives pour dénoncer la montée de l’extrême droite », Le Monde est un peu plus incisif : « les mots souvent excessifs voire insultants, les propos misogynes et complotistes, au risque de brouiller leur message. »
Il faut se tourner vers l’hebdomadaire Marianne : <« No Pasaran » : le morceau indigeste et contre-productif des rappeurs qui veulent s’opposer au RN> ou Le Point <« No Pasaran » : les rappeurs du déshonneur et leurs suiveurs> pour obtenir une analyse qui parvient à trouver des mots qui me parlent, après ce déchainement de haine, de sexisme, d’islamisme et de laideur.
Dans mon éthique, il n’est pas possible de tenter de dénicher toutes les dérives extrémistes et racistes que les élus et militants du RN ont semé sur la toile et ne pas dénoncer avec autant de force ce monument de bêtise et de violence de ceux qui prétendent combattre l’extrême droite.
Je me sens beaucoup plus proche de cette injonction de François Ruffin, au moment de la réforme des retraites d’Emmanuel Macron : « Il faut de la tendresse pour notre pays. » car il jugeait la réforme « brutale ».
-
Vendredi 28 juin 2024
« En politique le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. »Nicholas MachiavelJe n’ai pas retrouvé cette citation d’un ministre allemand qui avait dit :
« Les gens croient que mon job est de choisir entre une bonne décision et une mauvaise décision. Presque toujours je dois choisir entre une mauvaise décision et une décision pire. »
Mais je me suis souvenu de cette phrase que j’ai souvent vu attribuer à Machiavel, sans citer la source exacte.
Il me semble que c’est très juste. Je peux donner un exemple récent. L’Union européenne a augmenté les droits de douane sur les véhicules électriques chinois. <Le Monde> donne des précisions à ce sujet.
Le problème vient du fait que l’Union européenne est submergée par ces voitures chinoises et qu’il est quasi certain que les industries qui les produisent, soient largement subventionnées par l’Etat chinois. Donc bonne décision !
Mais non, mauvaise, car la Chine va répliquer :
« la viande de porc provenant de l’Union européenne est désormais dans la ligne de mire de Pékin. Une enquête antidumping sur les importations de produits porcins est au cœur d’un bras de fer commercial entre l’Europe et la Chine.
La France pourrait-elle perdre des parts de marché ?
Un éleveur de truie en Ille-et-Vilaine réalise 10 à 15% de ses ventes grâce à des exportations en Chine. Les Chinois sont en effet friands de parties du cochon qui sont peu consommées ailleurs dans le monde, comme les oreilles ou les pieds.
Une douche froide pour la filière française porcine […]
Au total, l’an passé, la France a exporté 115 700 tonnes de viande de porc vers la Chine, soit plus de 16% de ses exportations.»Il faudra donc arbitrer entre deux mauvaises décisions.
On pourrait dire de même pour la guerre en Ukraine, il n’y a pas de bonne décision mais une décision « entre le pire et le moindre mal.»
Il en va de même pour nous, en tant qu’électeur, ce dimanche : nous devrons choisir entre le pire et le moindre mal. La seule chose que nous devrions nous interdire, c’est de ne pas choisir.
Pour finir ces pensées de Christian Bobin :
« Il semblerait que la nuit doive s’épaissir encore un peu plus pour qu’on puisse apercevoir quelques étoiles.
Après, on verra les étoiles, par contraste.
Il faut que le noir s’accentue encore pour que les premières étoiles – les premières, ça veut dire qu’il y en aura d’autres – apparaissent.
Il est possible qu’une catastrophe économique soit une grâce, une chance.
Ça nous dessoulera, ça nous sortira d’une ivresse, de l’irréel, de l’avidité, de la consommation. Mais on n’y est pas encore »
Le Plâtrier siffleur, page 13
-
Mercredi 26 juin 2024
« Moi ou le chaos » et en fait « moi et le chaos »Daniel Muraz dans le journal « Courrier Picard » du 18 juinEt maintenant, il parle du risque de guerre civile !
En effet, dans un entretien au podcast «Génération Do It Yourself» diffusé lundi 24 juin, le président de la République a attaqué ses rivaux des «deux extrêmes», et pour ajouter à l’angoisse générale, prophétise la possibilité de la guerre civile !
Nous sommes passés de la promesse de « Moi ou le chaos » au constat du « Moi et le chaos ».
Un Président de la République ne devrait pas dire cela !
Il ne devrait pas attiser les braises mais au contraire apaiser, essayer de rassembler. Daniel Muraz écrit dans le journal « Courrier Picard » du 18 juin :
« En dramatisant les enjeux et en renvoyant caricaturalement dos-à-dos le front populaire de gauche et l’extrême droite. Face à ces « extrêmes » également diabolisées et traités de « fous », le chef de l’extrême centre en a appelé à créer ce « bloc central » qu’il n’a jamais réussi à construire depuis deux ans.
Quant au projet politique, rien de neuf. Bref, c’est juste « moi ou le chaos ». Et en fait « moi et le chaos ».
Chaos sinon créé, du moins accentué par sa dissolution. Chaos évident à droite chez les Républicains. Chaos à gauche ou les rancœurs réapparaissent. Une clarification politique répondrait certes l’Élysée. Mais chaos aussi au sein d’une ex-majorité présidentielle déboussolée, qui a subi deux ans éprouvants à l’Assemblée et qui se voit contrainte de repartir au front dans la pire des situations, avec un RN au plus haut et une gauche qui, déjouant les espérances élyséennes des « gauches irréconciliables », est quand même parvenue à afficher son unité.
Image chaotique encore renvoyée à l’étranger, notamment aux partenaires européens, affaiblissant le poids de la France dans les négociations qui s’ouvrent à Bruxelles pour renouveler les instances européennes. Chaos et K.O. politique surtout pour un président qui s’engageait en 2017 à tout faire pour que les Français n’aient plus aucune raison de voter pour le RN… »Parmi toutes les nombreuses causes à la présence de l’Extrême droite aux portes du pouvoir, ce président ne se rend il pas compte de ce que sa manière d’agir, de gouverner en solitaire et de parler a pu irriter au plus haut point les français ?
Il n’aurait pas pu gagner les élections présidentielles de 2017 ou de 2022 sans l’apport de millions d’électeurs qui n’étaient pas d’accord avec les solutions qu’il proposait, mais voulaient juste éviter le chaos.
En 2022, les électeurs sont allés plus loin, il n’ont donné qu’une majorité relative à son camp. En réponse, il n’a jamais cherché à faire une coalition, il voulait des ralliements pour pouvoir continuer à agir comme lors de son premier mandat, avec une assemblée de députés soumis qui votaient tout ce que ses conseillers et lui proposaient.
Et le sommet de cette dérive fut la gestion de la Loi sur les retraites. Il n’a même pas voulu parler et négocier avec Laurent Berger, l’homme du compromis et de la modération.
Au moment de son départ de la CFDT Laurent Berger a expliqué au JDD, en parlant d’Emmanuel Macron :
« Je ne veux pas tomber dans l’ultra personnalisation des choses, mais on n’a pas la même conception de la démocratie sociale, ni sans doute de la démocratie […] On n’a pas la même conception du modèle social qui doit être le nôtre pour accompagner les Français, les parcours ».
Emmanuel Macron ne nous a pas préservé du chaos, il a été un accélérateur de chaos.
-
Lundi 24 juin 2024
« Et s’ils comprennent quelque chose à notre présence commune sur terre. »Christian Bobin« Je voudrais parfois entrer dans une maison au hasard, m’asseoir dans la cuisine et demander aux habitants de quoi ils ont peur, ce qu’ils espèrent et s’ils comprennent quelque chose à notre présence commune sur terre.»
Christian Bobin, « Ressusciter» p. 159Je ne sais pas quoi ajouter à cette sage injonction de Christian Bobin.
Peut être ajouter deux photos qui montrent que c’est possible de trouver des humains qui ont compris quelque chose à notre présence commune sur terre et ont agi en conséquence.
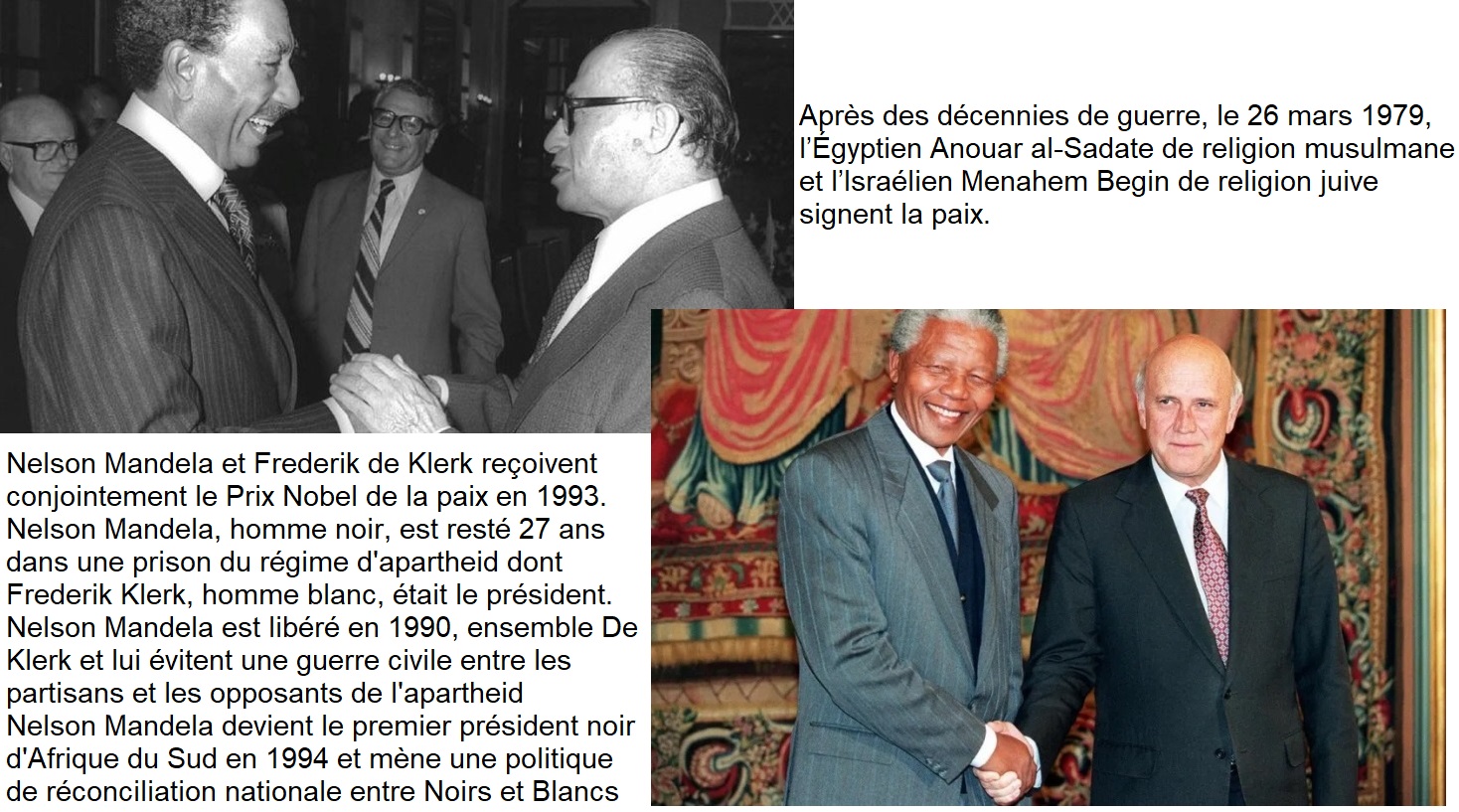
-
Vendredi 21 juin 2024
« Timeo hominem unius libri »Parole attribuée à Saint Thomas d’Aquin et qui signifie « Je crains l’homme d’un seul livre »Thomas d’Aquin est considéré comme l’un des plus grands maîtres de la théologie catholique. Les procédures religieuses l’ont proclamé « Docteur de l’Eglise » catholique.
Il est né autour des années 1225 en Italie et il est mort le 7 mars 1274 à l’abbaye de Fossanova dans les États pontificaux. C’était un religieux de l’ordre dominicain.
Il aurait dit :
« Je crains l’homme d’un seul livre. »
La rigueur nous oblige à dire qu’il n’est pas certain que cette citation soit exacte.
<Cette page anglaise> prétend que c’est l’évêque Jeremy Taylor (1613-1667), qui affirmait que Thomas d’Aquin aurait prononcé cette phrase.
Aujourd’hui, il est devenu banal de citer cette phrase et de l’attribuer au théologien dominicain du XIIIème siècle.
 Ainsi Delphine Horvilleur a écrit sur un réseau social, en utilisant un dessin de Plantu, le 29 octobre 2020 :
Ainsi Delphine Horvilleur a écrit sur un réseau social, en utilisant un dessin de Plantu, le 29 octobre 2020 :
« Thomas d’Aquin a écrit un jour: « je crains l’homme d’un seul livre ». Le fanatique est toujours un mono-lecteur. Ce soir, tandis que nos portes se ferment, promettons-nous de lire DES livres, et surtout ceux qui nous délivrent. »
La citation n’est pas certaine, mais l’Histoire nous a appris qu’elle était juste.
Un <mot du jour récent> a rappelé le combat noble, visionnaire et juste de Simon Leys contre Mao et les maoïstes. Ces fanatiques intolérants étaient les prisonniers intellectuels du « Petit livre Rouge ».
Spontanément on songe aux livres des religions monothéistes : La Torah, la Bible, le Coran qui au cours des siècles et encore aujourd’hui ont nourri des fanatiques qui en croyant comprendre et puiser à une seule source ont commis ou commettent des crimes sans l’once d’un doute ou d’une humanité.
L’ironie de cette citation est que son invention dans le monde chrétien catholique conduisait à une toute autre explication.
On voulait souligner par cette phrase que :
« L’homme qui ne connaît qu’un livre unique mais le connaît à fond est redoutable par la parfaite connaissance qu’il en a…. »
Ce sens primitif, sans grand intérêt, a donc évolué vers deux interprétations :
- Tout d’abord l’idée qu’il faut craindre l’homme qui ne connaît ou ne jure que par un seul livre ce qui conduit à des visions simplistes et intolérantes du monde en prétendant que leur opinion ou leur croyance constitue « la vérité ».
- Ensuite pour fustiger ceux qui n’ayant lu qu’un seul livre croient tout connaître et se retrouvent sur la Montagne de la stupidité, première étape de l’effet Dunning-Kruger
Nous sommes dans une situation très préoccupante : Par la décision solitaire du Prince élu qui nous gouverne, la France peut être, le 8 juillet de cette année, dirigée par un parti démagogue, xénophobe et très peu outillé pour comprendre la complexité de notre monde d’interdépendance, de conflictualité, dans lequel l’arrogance de l’Occident est de plus en plus dénoncée et son leadership contesté par des forces puissantes et déterminées.
Et pour expliquer cette situation, beaucoup ne donne qu’une raison principale, voire unique.
Pour quelles raisons, les citoyens français qui se sont exprimés, ont donné près de 40% des suffrages à des partis d’extrême droite ?
LFI prétend que c’est la question sociale : le pouvoir d’achat, la peur du déclassement et les politiques « ultra libérales » du gouvernement français.
Les médias d’extrême droite prétendent que cette raison est à trouver dans les flux migratoires qui submergent notre pays, l’insécurité qu’ils provoqueraient et l’attaque de notre identité nationale par des groupes venant d’autres pays et portant une vision de la société et des valeurs incompatibles avec la République.
D’autres font porter toute la responsabilité à l’Union européenne et son droit de la concurrence libre et non faussée et les traités de libre échange qu’elle négocie.
Enfin les plus simplistes expliqueront que tout est de la faute d’Emmanuel Macron.
Je crois qu’il est alors possible de reprendre la citation attribuée à Saint Thomas d’Aquin en l’adaptant de la manière suivante : « Je crains l’humain qui croit que le problème complexe qui se pose à lui n’est la conséquence que d’une seule cause. »
Parce que si on est persuadé comme je le suis que l’arrivée au pouvoir du RN serait une catastrophe pour la France, parce qu’il n’a aucune solution réaliste aux problèmes qui se posent et qu’en outre les valeurs qui sous-tendent son action sont xénophobes, racistes, il faut bien comprendre les raisons de ce vote pour essayer de trouver des solutions réalistes et conformes aux valeurs humanistes.
La complexité du vote RN, notamment dans les campagnes, est un peu approchée par Camille Bordenet, journaliste au Monde, chargée des ruralités et Benoit Coquard Sociologue à l’INRAE à Dijon dans « les Matins de France Culture » du mercredi 19 juin 2024 : <Vote RN>
La première raison évoquée est le recul des services publics, la lente désaffection des services publics dans nos campagnes.
Camille Bordenet a observé ce phénomène et explique :
« Des guichets de poste, écoles, centres des impôts, services de maternité et d’urgence ou encore des tribunaux, ont progressivement fermé au gré des plans de restructurations nationaux des vingt dernières années. [C’est un processus] très douloureusement vécu par les habitants et les élus et qui entraîne un sentiment de déclassement et de désengagement de la puissance publique »
Le gouvernement a tenté de pallier ce manque par des guichets France Service qui ont pour vocation de constituer, en un lieu unique, un accueil de premier niveau de quasi tous les services publics. Il ne s’agit, pour l’essentiel, pas de résoudre et de répondre aux besoins des gens mais de les accompagner vers des outils numériques qui constituent, dans l’esprit des technocrates qui nous administrent, le dispositif efficace pour répondre aux demandes de services publics des usagers.
Selon la journaliste ni les habitants ni les agents ne sont à l’aise avec cette organisation : pour les uns le service est insuffisant, pour les autres ils se sentent débordés par l’exigence des populations.
Ce dispositif se heurte aussi au problème de la « fracture numérique » car énormément de personnes dans notre pays ne sont pas à l’aise avec le tout numérique
« Ils sont alors renvoyés à un sentiment d’incapacité qui peut nourrir une aigreur ».
De cette insatisfaction, le Rassemblement national s’est nourri construisant le récit des deux France : celle des villages abandonnés par l’État face à celle de la « France des banlieues nécessairement immigrée et trop aidée » décrit Camille Bordenet.
Benoit Coquard insiste sur l’implantation locale des militants RN et le message délétère qu’ils propagent :
« [Le discours] reconnait que les gens ont beaucoup perdu, assure que la France est en décrépitude et que plus rien ne fonctionne. Mais il rassure aussi en promettant qu’il y aura toujours plus bas socialement que soi ». Un nouvel bouc émissaire est donc créé, la figure de l’assisté social vivant sur les aides d’État, et dont les représentations se recoupent souvent avec celles de l’immigré. »
Il y a donc les difficultés économiques, la peur de s’appauvrir et que les enfants soient encore plus mal lotis, le sentiment de déclassement personnel et du pays, le constat d’être délaissé par l’État, si important en France, la fracture numérique et plus généralement de la modernité.
Mais ce n’est pas tout.
Une grande dame de la Culture, âgée de 85 ans, fondatrice du théâtre du Soleil a publié une Tribune dans « Libération » le 12 juin 2024 :
 «A quel moment doit-on cesser de faire du théâtre sous un gouvernement RN ?»
«A quel moment doit-on cesser de faire du théâtre sous un gouvernement RN ?»
Ariane Mnouchkine fustige l’acte d’Emmanuel Macron :
« et soudain, ce geste du président de la République – ce geste d’adolescent gâté, plein de fureur, de frustration et d’hubris […] Il déverse un bidon d’essence sur le feu qui, déjà, couvait. Il met le feu à notre maison, à notre pays, à la France. »
Elle exprime un espoir à l’égard du nouveau front populaire, mais dit son rejet de la NUPES :
«Je ne pourrais accepter ce qui ne serait qu’un nouveau masque de certains leaders de cette Nupes qui nous a fait tant de mal, car la politique ne doit pas être que tactique cynique au service de convictions plus brutales que sincères. Elle doit se fonder sur la vérité et l’amour de l’humanité. »
Mais elle fait surtout cet aveu :
«Macron est bien trop petit pour porter, à lui seul, la totalité du désastre. Je nous pense, en partie, responsables, nous, gens de gauche, nous, gens de culture. On a lâché le peuple, on n’a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu’ils voyaient, on leur disait qu’ils se trompaient, qu’ils ne voyaient pas ce qu’ils voyaient. Ce n’était qu’un sentiment trompeur, leur disait-on. Puis, comme ils insistaient, on leur a dit qu’ils étaient des imbéciles, puis, comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. On a insulté un gros tiers de la France par manque d’imagination. L’imagination, c’est ce qui permet de se mettre à la place de l’Autre. Sans imagination, pas de compassion. »
Elle parle d’un déni.
Elle parle aussi d’une posture, celle d’un camp du bien, d’un camp « qui sait » et qui traite de salauds celles et ceux qui ne sont pas d’accord.
On évoque là l’insécurité physique et l’insécurité culturelle dont la gauche ne veut pas parler.
Melenchon vante la vertu de la créolisation, c’est-à-dire du mélange des cultures. Cela peut se révéler pertinent sur la longue durée, mais pas en l’espace d’une génération.
Le nouveau front populaire, parle de lutte contre « l’islamophobie », c’est une erreur, il faudrait parler de la lutte contre le racisme anti-musulman.
Il veut abroger la Loi sur le séparatisme, c’est une autre erreur, il faut peut-être l’amender, non la supprimer.
Il faut défendre avec vigueur et force, la laïcité, les sciences, l’Histoire dans l’éducation nationale contre toutes les menaces, les pressions qui s’exercent contre elle par des hommes fanatisés qui croient trouver toutes les réponses dans un seul livre et dans une seule interprétation de celui-ci.
Et puis parallèlement, « les beaux esprits » de la gauche des villes, exactement comme les croyants d’un seul livre, proclament des opinions comme s’il s’agissait de la vérité : s’agissant du colonialisme, du genre, de la culture woke dont ils prétendent, en outre, qu’elle n’existe pas etc…
Sur tous ces sujets, il faut s’éloigner du déni, du dogme et trouver des réponses de gauche, humanistes, universalistes.
Ce sont aussi des raisons qui expliquent le vote RN.
- Tout d’abord l’idée qu’il faut craindre l’homme qui ne connaît ou ne jure que par un seul livre ce qui conduit à des visions simplistes et intolérantes du monde en prétendant que leur opinion ou leur croyance constitue « la vérité ».
-
Mardi 18 juin 2024
« Deux français sur trois. »Valéry Giscard d’EstaingValéry Giscard d’Estaing avait écrit un livre en 1984 : « Deux français sur trois » dans lequel il estimait que pour gouverner la France, il fallait convaincre deux français sur trois.
 Aujourd’hui, nous en sommes loin.
Aujourd’hui, nous en sommes loin.
Nous savons qu’il y a trois blocs qui sont, selon leurs programmes, leurs alliances et les hommes qui les composent, totalement incapables de travailler ensemble ou simplement d’accepter de dire que le programme des deux autres blocs, bien que différent, constitue une alternative acceptable. Les autres sont soient des salauds, des incompétents ou des factieux.
Le bloc le mieux placé peut espérer 33% des voix.
Comment peut-on espérer rassembler les français ainsi.
J’ai déjà écrit deux mots du jour ancien qui d’une part montrait toutes les limites de la 5ème république : <mot du 8 février 2017> et un autre, en 2022, qui expliquait la perversité, dans le contexte actuel, du scrutin uninominal à deux tours : « Les 16 élections législatives de la Vème République : Un regard historique sur un scrutin qui se délite »
Ce scrutin pouvait se concevoir tant que la France était divisée en deux coalitions qui se combattaient mais se respectaient.
Aujourd’hui c’est une catastrophe.
Parce qu’il est envisageable que le Rassemblement National avec 33% des voix puissent, au second tour, avoir la majorité absolue des sièges, alors de 77% des électeurs ne veulent pas de ce programme. Je veux dire qu’ils n’en veulent absolument pas.
Il en va de même pour le nouveau front populaire, qui pourrait avoir, avec 30% des voix, la majorité absolue des sièges alors que tous les autres sont radicalement contre.
Nous avons déjà suffisamment de problèmes pour ne pas y ajouter un type de scrutin qui permet une telle distorsion de la volonté du corps électoral.
Dans l’Union européenne, nous sommes les seuls à ne pas avoir le scrutin proportionnel et nous avons tort.
Avec un scrutin proportionnel, le PS, le PC et les verts n’auraient pas besoin de s’associer à LFI.
Les républicains ne se rallieraient pas au Rassemblement National.
Et les divers partis ne s’ostraciserait pas comme actuellement, car ils sauraient qu’après les élections il faudrait trouver des coalitions.
Ces coalitions éviteraient les mesures excessives et trop décalées par rapport aux autres mouvements politiques.
Il est urgent de passer à la Proportionnelle.
-
Vendredi 14 juin 2024
« Consultation »Que signifie ce mot ?Quelquefois on se pose des questions sur des mots qui nous semblent de la langue courante, mots qu’on utilise sans y penser.
Et puis arrive un évènement qui nous interpelle et on commence à douter du sens de ce mot.
Récemment c’est le mot « consultation » qui m’a conduit à une telle interrogation.
Au départ, il y a cet article du « Canard enchaîné » du 12 juin 2024 :
« Après avoir annoncé aux ténors de la majorité sa décision de dissoudre, Macron leur donne la parole, comme s’ils avaient encore leur mot à dire. Première à s’exprimer, pour des raisons protocolaires Yaël Braun-Pivet, sonnée par la nouvelle, jette un pavé dans la mare.
« Monsieur le Président, selon l’article 12 de la Constitution , vous devez consulter les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Réponse dudit Président :
« Je suis en train de te consulter…
– Pas comme ça. Je vous demande un entretien en tête à tête »
Demande accordée, Macron et Braun-Pivet s’éclipsent dans un salon voisin, où la présidente de l’Assemblée dit tout le mal qu’elle pense de la dissolution.
« J’ai fait mon choix « réplique le chef de l’État qui appelle dans la foulée Gérard Larcher, président du Sénat, pour le « consulter » lui aussi. »
Nous avons bien entendu le Président de la République nous dire le 9 juin
« C’est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l’article 12 de notre Constitution, j’ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote »,
Que dit cet article 12 ?
Article 12 de la Constitution :
« Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. »
Yaël Braun-Pivet, avait donc raison, en omettant toutefois le premier ministre, il faut une consultation préalable de trois autorités avant la décision par le Président de la République.
Mais que signifie consultation ?
Selon le dictionnaire Larousse, « consultation » est un nom féminin dont la définition est la suivante :
« Action de consulter quelqu’un, de lui demander son avis »
Selon ce même dictionnaire « consulter » répond à la définition suivante :
« Demander à quelqu’un son avis, son conseil, chercher des renseignements auprès de lui, interroger ».
<Le dictionnaire du CNRS> donne l’étymologie :
« Empr. au lat. class. consultare « délibérer »
Il s’agit donc de délibérer, de discuter, d’échanger des arguments…
Le Canard enchaîné a raconté la réaction du Président du Sénat :
« En fait de consultation a raconté Gérard Larcher, vingt-quatre heures plus tard en Conférence des présidents, « J’ai eu un coup de fil du chef de l’État pour « m’informer » qu’il allait dissoudre. Je n’ai pu qu’en prendre acte ». Larcher, afin qu’il y ait « une trace » de cette conversation en a fait consigner le contenu dans les archives du Sénat »
Le Président a informé les trois autorités, il ne les a pas consultés.
L’esprit de l’article 12 et donc de la Constitution n’a pas été respecté.
Soazig de la Moissonnière, la photographe officielle de la Présidence, a immortalisé l’annonce de la décision de dissolution lors de la fameuse réunion de l’Élysée :
 On y voit la sidération de Yaël Braun-Pivet, de Gabriel Attal et de Gérald Darmanin.
On y voit la sidération de Yaël Braun-Pivet, de Gabriel Attal et de Gérald Darmanin.
Que signifie, en terme de communication, le fait de rendre public cette photo officielle ?
Je trouve cela étrange.
Autre incongruité de l’organisation de la République française, que j’ai essayée de décrire dans un mot du jour de 2017 : « La cinquième République »
Le vote sanction des électeurs français a été réalisé contre le Président de la République puisque c’est lui qui décide de tout.
Mais la réponse n’est pas sa dissolution, c’est-à-dire sa démission, mais la dissolution et donc le renvoi des députés. Il faut savoir sacrifier les autres !
Il y a quelques jours, le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a demandé la dissolution du Parlement. Mais cette décision s’applique à lui, si le peuple britannique envoie une autre majorité au Parlement, Rishi Sunak ne sera plus premier ministre.
Et il en irait de même en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Danemark, bref dans tous les pays comparables.
Sauf aux États Unis, où le Président a beaucoup de pouvoirs comme en France, mais ne peut pas dissoudre la chambre des représentants.
« Il y a quelque chose de pourri au Royaume du Danemark » écrivait Shakespeare dans « Hamlet ».
Peut-être y a-t-il quelque chose de pourri dans la Vème République française ?
-
Jeudi 13 juin 2024
« Le sexe d’un côté et le fric de l’autre et on arrive à ça ! »Roselyne BachelotC’est dans l’émission <Face à Alain Duhamel> du 12 juin que Roselyne Bachelot explique le chaos actuel de la manière suivante :
« Cette dilution de la vie politique française vient de loin. Elle n’est pas à imputer à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est l’effet de cette dilution, il n’est pas la cause.
Parce que les ferments de la distorsion de la vie politique française, ils ont commencé avec le scandale de Dominique Strauss Kahn, qui fait que l’élection présidentielle de 2012 choisit François Hollande qui n’était pas le bon candidat et qui scelle la mort du PS. Ils ont continué avec le scandale de François Fillon qui tue la Droite républiaine. Donc ces deux éléments, ces deux colonnes vertrébrales de la vie politique française s’effondrent à cause de la faute de deux hommes.
Le sexe d’un côté et le fric de l’autre et on arrive à ça. »Ainsi parle Roselyne Bachelot avec sa gouaille et son sens des formules.
Elle, qui fut ministre de la Culture, post COVID, sous la présidence d’Emmanuel Macron, de 2020 à 2022.
Mais elle fut préalablement, ministre de la Santé et des Sports de 2007 à 2010 et ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale de 2010 à 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy
Et encore avant, cette Docteure en pharmacie, née le 24 décembre 1946 à Nevers, eut sa première expérience gouvernementale, de 2002 à 2004, comme ministre de l’Écologie et du Développement durable. Jacques Chirac était alors Président de la République.
Elle a raison sur un point, Emmanuel Macron est devenu Président de la République suite à un concours de circonstances : un quinquennat raté de François Hollande et une campagne ratée de François Fillon qui proclamait qu’il fallait faire des économies drastiques dans le train de vie de l’État mais qui n’appliquait pas cette règle pour ses besoins personnels et familiaux.
Sans ces deux aventures, Emmanuel Macron n’aurait jamais été élu Président de la République en 2017, malgré ses talents, son ambition et sa bonne étoile.
 Dans son discours de la victoire de 2017, il avait fait la promesse suivante :
Dans son discours de la victoire de 2017, il avait fait la promesse suivante :
« Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République face à l’extrémisme. Je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris : je protègerai la République.
Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd’hui pour Madame LE PEN – ne les sifflez pas, ils ont exprimé aujourd’hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte. Mais je ferai tout, durant les cinq années qui viennent, pour qu’ils n’aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. »
Le résultat des élections européennes du 9 juin 2024 qui a fait monter le Parti de Mme Le Pen à 31,4% des suffrages exprimés et en y incluant les autres mouvements, l’extrême droite à près de 40% des voix, montre que la promesse n’a pas été tenue.
Mais « Le sexe d’un côté et le fric de l’autre » ne suffisent pas à expliquer pourquoi « on arrive à ça ! », c’est-à-dire à une extrême droite devant la porte entrouverte du pouvoir.
Rappelez-vous les dernières années crépusculaires de François Mitterrand, puis les 12 ans de Chirac pour lesquels on se rappelle avec reconnaissance l’opposition à la guerre en Irak, mais qui sur le plan interne ne sut et ne put rien faire sur l’inexorable déclin de la France, l’angoisse de la classe moyenne et l’augmentation des tensions au sein de la société française.
Son successeur, Nicolas Sarkozy, qui a traité son prédécesseur de « roi fainéant » malgré son activisme et son énergie n’a pas davantage réussi à rendre confiance aux français.
Entre temps, il y eut les 5 ans de cohabitation de 1997 à 2002 pendant lesquels Lionel Jospin fut un premier ministre sérieux, rigoureux qui pensait que ses résultats économiques lui permettraient d’accéder, sans difficultés, à la Présidence de la république contre « un Chirac fatigué ».
Que Nenni…
Pour la première fois un représentant de l’extrême droite s’invita au second tour de la Présidentielle.
Puis il y eut François Hollande qui échoua jusqu’au point de ne pouvoir se présenter à sa réélection, trahi il est vrai, par un jeune fougueux qui croyait connaître la solution aux problèmes et qui s’est fracassé, à son tour, au mur des réalités de son impuissance politique, plombé et rejeté avec d’autant plus de force que son arrogance apparait grande.
Je ne crois pas un instant que l’élection de Strauss Kahn en 2012 ou de Fillon en 2017 aurait changé quoi que ce soit de fondamental dans cette évolution.
Pourquoi ?
Je peux essayer d’avancer quelques pistes :
Nous sommes en face d’une impuissance politique, dans laquelle pour se faire élire les politiques promettent des choses qu’ils ne pourront tenir.
Nous n’avons plus ni la démographie, ni la productivité, ni la croissance économique pour faire progresser notre État providence et même le maintenir.
Concernant la démographie, nous avons besoin d’immigration mais nous n’avons plus l’énergie et la force pour intégrer ceux qui viennent et même les enfants de ceux qui sont déjà là. Cette situation crée des tensions identitaires, une montée du communautarisme, alimentée par des groupuscules qui sont hostiles à nos valeurs occidentales, créant en réaction, un rejet de plus en plus fort d’une société en plein doute.
Notre pays s’est désindustrialisé et se trouve bien faible dans un monde interdépendant, mondialisé et financiarisé.
Et je n’ai même pas évoqué le défi climatique et plus généralement de la biodiversité et de l’écologie.
Il faudrait encore parler de notre faiblesse militaire dans un monde de prédateurs carnivores qui se moquent de notre comportement d’herbivores feignant de croire que les normes, les règles de droit sont en capacité d’arrêter ou de faire fléchir ces fauves, ces empires qui nous regardent d’un air narquois.
Mais de tout cela les Politiques ne veulent pas parler et les français probablement ne veulent pas en entendre parler.
Quand des hommes politiques, non démagogues, ont tenté de se faire élire, ils ont été balayés ou empêchés de se présenter. On peut parler de Rocard et de Delors à gauche ou de Barre et de Balladur à droite. Ils n’avaient pas de solutions miracles à proposer, bien sûr, mais ils disaient davantage la vérité.
Interrogé par France Inter Jean-Louis Bourlanges que je qualifierai aussi de Politique à démagogie très modérée, a eu cette phrase :
« Ce que je constate et c’est très dur à dire : c’est un divorce profond entre les besoins du pays et les attentes du pays. Les attentes c’est plus de pouvoir d’achat, c’est plus de subvention, c’est plus de « care » comme disait Mme Martine Aubry. Tout un ensemble de soins et de choses. Et les besoins c’est renforcer les budgets militaires, renforcer l’investissement, renforcer la technologie, accroitre la compétitivité des entreprises. »
-
Mercredi 12 juin 2024
« Le grand remplaçant : La face cachée de Jordan Bardella»Pierre-Stéphane FortBeaucoup pensent que d’ici un mois, il existe une grande probabilité que le premier ministre de la France soit un homme de 29 ans, puisqu’il est né le 13 septembre 1995, à Drancy.
Les premiers ministres sont nommés de plus en plus jeunes.
Le premier ministre actuel Gabriel Attal, avait battu le record puisqu’à 34 ans, le 9 janvier 2024, il est nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, devenant le 25e et plus jeune Premier ministre de la Ve République, devançant de trois ans Laurent Fabius, nommé à 37 ans en 1984.
Jordan Bardella serait alors le 26ème premier ministre et battrait une nouvelle fois le record du premier ministre le plus jeune.
Il parait donc normal de s’intéresser à ce jeune homme plein d’avenir.
Dans les matins de France Culture du mardi 11 juin 2024, Guillaume Erner avait pour invité Pierre-Stéphane Fort : « Le RN ère Bardella : anatomie d’un succès électoral »
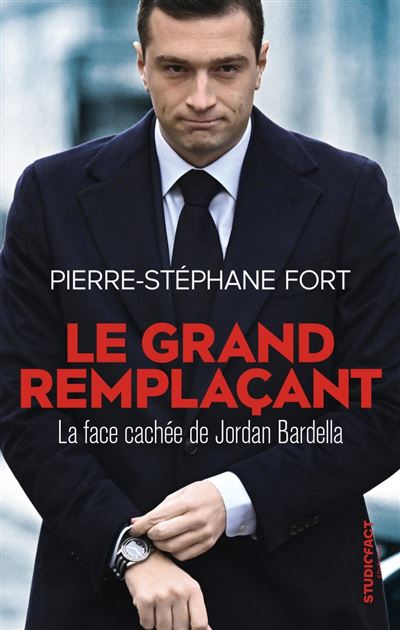 Pierre-Stéphane Fort a écrit « Le grand remplaçant : la face cachée de Jordan Bardella »
Pierre-Stéphane Fort a écrit « Le grand remplaçant : la face cachée de Jordan Bardella »La page Wikipedia consacré à Bardella, nous apprend qu’il est enfant unique.
Son père est un patron de PME, né en 1968 à Montreuil sous-bois, en Seine-Saint-Denis, d’origine italienne et franco-algérienne.
Mais ses parents ayant divorcé, il grandira avec sa mère dans une cité HLM de sa ville natale.
Sa mère est une agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM), Luisa Bertelli-Mota. Elle est née en 1962 à Turin en Italie.
Il commence souvent ses discours en rappelant qu’il vient de Seine Saint Denis et insiste sur ses origines populaires.
Mais Pierre-Stéphane Fort juge que « Jordan Bardella n’est pas Cosette » :
« Jordan n’est pas Cosette et son enfance n’aurait sans doute pas inspiré un roman social à Victor Hugo ou Emile Zola. [Sa mère] gagne sa vie modestement et l’élève au quotidien avec le soutien de sa grand-mère.
Jordan Bardella réalise l’ensemble de sa scolarité dans le privé. Saint-Jean-Baptiste de La Salle, l’établissement catholique qu’il fréquente, est à deux pas de chez lui, il a bonne réputation. Vérification faite, pour y scolariser son enfant, il faut payer environ 1 200 euros par an, sans la cantine. Pas évident quand on touche un petit salaire, il paraît donc probable que le père de Jordan Bardella, jamais cité dans ses discours, leur apportait une aide financière.
Son père travaille dans une PME. Dans la presse, je lis souvent qu’il est patron de cette PME, mais malgré des recherches fouillées, la consultation des statuts, etc., je ne peux l’affirmer. Je peux en revanche vous dire qu’il gagne confortablement sa vie et même qu’il est copropriétaire des locaux dans lesquels est installée cette entreprise. Selon mes informations, quand Jordan est adolescent, il l’emmène faire un long voyage aux États-Unis. A 19 ans, il lui offre sa première voiture, une Smart, petite citadine chic et branchée. A la même époque, il le loge gracieusement dans un appartement qu’il détient, sur la coquette commune d’Enghien-les-Bains dans le Val-d’Oise. […] Bref, Jordan Bardella, comme bien des enfants de divorcés, avait un pied dans deux milieux sociaux différents, c’est ainsi qu’il a grandi. Et puis généralement, quand on souffre de difficultés financières, on travaille dès qu’on le peut. Jordan Bardella, lui, ne travaille pas. Enfin si, un mois seulement, à 18 ans, dans l’entreprise de son père. Point final.
Le mythe de l’enfant pauvre issu des pires quartiers de France, qui a grimpé l’échelle sociale à la seule force de son mérite et de son abnégation, a du plomb dans l’aile. »Ses études ont été courte, il n’a obtenu qu’un baccalauréat économique et social toutefois avec la mention très bien.
Il a tenté d’entrer dans l’Institut d’études politiques de Paris, mais il échoue. Il étudie alors la géographie à l’université Paris-IV mais arrête ses études sans obtenir de diplôme, indiquant préférer se consacrer à la politique.
A part une petite incursion dans l’entreprise de son père, il n’a jamais travaillé. Son métier a été de faire de la politique, rien que de la politique.
Son histoire avec le RN commence en 2012, Il n’a alors que 16 ans lorsqu’il prend sa carte, à l’époque au FN. Il va être remarqué par Marine Le Pen puisqu’il arrive à intégrer son deuxième cercle amical, le clan Chatillon.
Jordan Bardella était en couple avec la fille de Frédéric Chatillon pendant deux ans, qui elle-même est une militante assez radicale. Douze jours après la rencontre entre lui, Marine Le Pen et la fille Chatillon, M. Bardella est nommé porte-parole du Rassemblement national.
<Wikipedia> donne beaucoup d’informations sur Frédéric Chatillon, homme de l’extrême droite dure, ayant travaillé pour le régime syrien d’Assad, tristement célèbre pour ses exactions. Il serait également lié avec le Hezbollah libanais dont il est beaucoup question ces temps-ci. Marine Le Pen a une confiance absolue dans Frédéric Chatillon.
Marine Le Pen mise très tôt sur son storytelling : « Jordan Bardella est le tout jeune homme issu de Seine-Saint-Denis, d’un quartier modeste, d’une famille relativement modeste.»
Pierre-Stéphane Fort raconte :
« Elle mise sur lui et va investir beaucoup d’argent pour le faire former en média training. »
C’est-à-dire qu’il est formé pour devenir un professionnel de la communication dans les médias.
Pour Pierre-Stéphane Fort :
« [Bardella] fait preuve d’un opportunisme chronique. Il a commencé avec Florian Philippot sur une ligne nationaliste sociale. Puis, quand l’étoile de Philippot a commencé à pâlir, il est passé chez les identitaires avec Philippe Olivier. Beaucoup de témoins que j’ai pu rencontrer m’ont dit qu’il sent le vent tourner et qu’il a toujours un coup d’avance. Ce n’est pas un idéologue, mais par contre, c’est un stratège »
Parmi ses talents de communicants, il parvient à toucher beaucoup les jeunes grâce à son utilisation fréquente du média chinois Tiktok.
Pierre-Stéphane Fort souligne par ailleurs la contradiction les paroles et les actes du député européen :« Au Parlement européen, il vote très souvent le contraire de ce qu’il déclare sur TikTok ou dans les médias français. Par exemple, il fait de grands discours dans lesquels il célèbre les droits des femmes dans l’Union européenne. Dans le même temps, il ne s’oppose pas à l’interdiction de l’IVG en Pologne. Idem sur l’égalité salariale entre hommes et femmes, il préfère s’abstenir. Sur les réseaux sociaux, c’est l’un des champions de la lutte contre le réchauffement climatique. La vérité, c’est qu’il n’a jamais voté un texte majeur au Parlement européen en faveur de cette lutte ».
<France Info> et le <Nouvel Obs> analysent le travail modéré réalisé par Bardella au Parlement européen dont il est élu depuis 2019.
Est il compétent pour le job de premier ministre ?
Pour répondre à cette question, je reprendrai ce passage d’un billet d’humeur de François Morel en 2013.
« Je vous répondrai ce que dans le film « Coup de tête » de Jean-Jacques Annaud dialogué par Francis Weber, Michel Aumont répondait à Paul Le Person qui se demandait si l’abruti à qui on allait offrir un poste de maître-nageur, savait nager : « complique pas ! » »
 Mais je ne finirai pas ainsi ce mot du jour. Françoise Hardy qui vient de nous quitter, dans sa chanson « Mon amie la rose », chantait :
Mais je ne finirai pas ainsi ce mot du jour. Françoise Hardy qui vient de nous quitter, dans sa chanson « Mon amie la rose », chantait : « Moi j’ai besoin d’espoir
Sinon je ne suis rien »<1808>
-
Lundi 10 juin 2024
« Dissoudre le peuple »Berthold BrechtLes élections au Parlement européen de ce dimanche ont donc conduit à ce que la liste du parti d’extrême droite obtienne plus de 30% des voix soit deux fois plus que la Liste de la majorité présidentielle.
Le Président de la République a considéré que cette situation devait conduire à la dissolution de l’Assemblée Nationale.
Si on y pense, c’est un drôle de système que celui de la Démocratie. Tous les citoyens ont droit de voter et chaque vote ne compte que pour une voix. Un prix Nobel et un analphabète ont chacun une voix, le patron d’une entreprise de 50 000 salariés et un éboueur pèsent, le jour du vote, le même poids, un scientifique et un platiste (quelqu’un qui croie que la terre est plate) sont égaux face au scrutin. C’est assez déstabilisant.
Certains régimes comme le régime chiite iranien ont trouvé un moyen pour modérer ces inconvénients : pour pouvoir se présenter, les candidats doivent avoir eu l’autorisation par une commission jugeant de leur capacité et surtout de leurs qualités religieuses.
En écoutant certains commentateurs ou politiques hier, il m’a semblé que pour eux le peuple n’avait pas bien voté. Peut être que le président Macron aurait du dissoudre le peuple, plutôt que l’Assemblée nationale ?
C’est ce qu’avait suggéré Berthold Brecht, dans un poème, après une révolte en l’Allemagne de l’Est où il résidait, contre le gouvernement communiste.
Faut-il préciser que le propos de Berthold Brecht était ironique ?
La Solution
Après l’insurrection du 17 juin,
Le secrétaire de l’Union des écrivains
Fit distribuer des tracts dans la Stalinallee.
Le peuple, y lisait-on, a par sa faute
Perdu la confiance du gouvernement
Et ce n’est qu’en redoublant d’efforts
Qu’il peut la regagner.
Ne serait-il pas
Plus simple alors pour le gouvernement
De dissoudre le peuple
Et d’en élire un autre ? -
Vendredi 31 mai 2024
« Un ou une amie, c’est quelqu’un qui vous rend meilleur ! »Aristote, dans son « Éthique à Nicomaque » synthétisé par Charles PépinQue dire ou écrire dans ce monde de chaos sans ajouter son lot d’entropie ?
Parfois raconter de belles histoires, comme celle de l’entraîneur de Lyon, Pierre Sage. immédiatement obscurcies par des hordes de supporters qui n’ont pour objectif que de se battre, montrer leur force brutale ou une virilité dévoyée.
Les histoires d’humains qui s’affrontent, il en est beaucoup, en ce moment, dans le monde..
Outre, l’Ukraine et Gaza, des conflits armés de grande ampleur se déroulent actuellement au Soudan, au Burkina Faso, en Somalie, au Yémen, en Birmanie, au Nigeria et en Syrie. Une guerre est en train de commencer entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, Haïti est en prise à une guerre des gangs sans que les autorités politiques défaillantes du pays ne parviennent à agir pour remettre de l’ordre.
Mais le drame qui revient toujours au premier plan des médias est celui qui oppose Israël et le Hamas, sur le territoire de Gaza.
Après 7 mois de guerre, des milliers de morts israéliens et des dizaine de milliers de morts palestiniens, aucun effet tangible n’a été obtenu par Israël après sa réponse brutale au piège atroce que lui a tendu le Hamas : De nombreux otages sont toujours détenus, le Hamas continue a envoyer des roquettes sur Israël, les chefs du Hamas n’ont pas été neutralisés et aucune solution de sortie de crise n’est envisagée par le gouvernement israélien.
Cela ne marche pas, malgré les destructions, les morts et une population palestinienne contraint, à Gaza, à des conditions de vie indigne et une angoisse permanente.
Vincent Lemirre dans l’émission « 28′ d’Arte » du 29 mai <Israël-Gaza : après le drame de Rafah>, explique l’impasse militaire :
« On mène une guerre en surface, contre un ennemi qui est en sous-sol. […] Ils sont au huitième sous-sol. Ils ont de l’eau, de l’électricité, de la nourriture. Ils ont en rien à faire des populations civiles. Le Hamas mène une guerre révolutionnaire, les pertes civiles ne comptent pas. […] Elles peuvent même être utile politiquement. »
Utile politiquement, puisque pour le Hamas, plus il y a de morts palestiniens, plus le monde oublie les crimes du 7 octobre et ne voit que la violence de l’armée d’Israël.
En outre, ces fanatiques religieux sont aux antipodes de notre respect pour la vie. Pour eux, un mort gazaouis, n’est pas une victime de la guerre, mais un martyr de leur cause auquel est promis le plus bel avenir, dans l’au-delà.
Les dirigeants du Hamas sont monstrueux, beaucoup de celles et ceux qui manifestent pour le cessez le feu, n’expriment pas la pleine conscience de cette réalité.
Mais il n’est pas possible non plus d’exonérer la responsabilité d’Israël et de son gouvernement.
- D’abord dans la disproportion de la violence employée et des victimes alors qu’il devient de plus en plus clair que la seule force ne règlera rien, ni la sécurité d’Israël, ni la stabilité de la région ;
- Aucune solution politique d’après-guerre n’est envisagée ;
- Enfin, il y a un déni au regard de la situation des palestiniens : Tout le territoire de la Palestine mandataire n’appartient pas à l’État d’Israël. Sur la partie que l’ONU a donnée aux arabes : il y a un occupant : Israël et un occupé : le Peuple palestinien.
C’est ce que dit Rony Brauman, né à Jérusalem dans une famille juive dont le père était un militant sioniste, qui s’installa avec sa famille en Israël dès la création de cet État en 1948. Rony Braumann fut d’abord sioniste comme son père, considérant que les arabes de la Palestine pourraient laisser ce petit pays pour les juifs et aller dans un des nombreux états arabes qui se trouvent autour. Avant de se laisser convaincre que les arabes qui vivaient sur cette terre avaient aussi le droit d’y rester et de disposer d’une organisation étatique dans laquelle ils pourraient se reconnaitre, se sentir citoyens et respectés.
Dans l’Invité des matins du 29 mai <Attaque à Rafah : un tournant dans l’opinion ?> Rony Brauman, explique ainsi :
«La reconnaissance d’un État palestinien aurait une vertu majeure, à mes yeux, qui serait d’officialiser la situation d’occupation de la Palestine
La Palestine est selon certains un territoire occupé, selon d’autres un territoire disputé, un territoire administré. On joue sur les mots, on joue sur les significations
Il y a contestation de la part de ceux qui s’estiment être les amis d’Israël
Personnellement cette notion d’ami d’Israël est très discutable. On appelle ami d’Israël, l’amitié qu’un dealer voue à un addict. »
La dernière phrase de Rony Brauman m’a interpellé.
Qu’est-ce qu’un ami ?
J’ai déjà parlé de l’émission de Charles Pépin qui est diffusée le samedi matin à 8h50, sur France Inter : « La Question Philo » dans laquelle il répond aux questions que lui posent les auditeurs.
C’était le mot du jour du 8 janvier 2024 dans lequel il était question de définir ce que signifiait « Réfléchir » et le philosophe ouvrait une piste : « Réfléchir c’est supporter le doute, car c’est précisément quand on ne supporte plus le doute que l’on cesse de réfléchir. »
Or, dans son émission du 4 mai 2024, il a choisi de répondre à la question de Béatrice : <Qu’est-ce qu’un ou une véritable ami(e) ?>
Et voici le début de sa réponse :
« Aristote, chère Béatrice, donne dans son Éthique à Nicomaque une belle définition de l’amitié : un ou une amie, écrit-il en substance, c’est quelqu’un qui vous rend meilleur…
[…] un ami, c’est quelqu’un qui vous permet de devenir un meilleur être humain, de développer vos facultés humaines : votre raison, votre sensibilité… Mais pour bien comprendre ce que veut dire Aristote, il faut avoir en tête la distinction qu’il fait entre ce qui est en Puissance et ce qui est en Acte. Une image pour comprendre : la graine ou l’enfant n’est qu’en puissance, là où la plante et l’adulte sont des êtres accomplis, « en acte ». Même chose quand Aristote distingue les facultés qui sont « en puissance », potentielles, possiblement développées, de celles qui sont « en acte » c’est-à-dire effectivement développées…
Et donc l’ami, c’est celui qui vous permet d’actualiser ce qui n’était en nous qu’en puissance ?
Oui, exactement, l’ami est l’ami de la vie en vous : il est l’occasion favorable, le Kaïros en grec, du développement de la vie en vous. D’ailleurs c’est moins lui qui vous permet de vous développer, que la relation que vous avez avec lui, et vous trouvez là au passage un bon critère d’évaluation de vos amitiés : si vous vous sentez diminué au cœur de votre relation d’amitié, c’est que l’ami en question n’est pas un véritable ami. Et je vous propose donc d’arrêter de le voir.
Grâce à Aristote, on définit un ami véritable non pas par sa disponibilité, non pas par le nombre de coups de téléphone que vous vous passez par semaine, non pas par sa capacité à vous prêter de l’argent, mais par les effets que cette relation d’amitié produit sur vous. »
J’ai essayé de lire les livres VIII et IX de « l’Éthique à Nicomaque » dans lesquels Aristote, le disciple de Platon et précepteur d’Alexandre le Grand, élabore un véritable traité sur l’amitié. C’est assez complexe, je comprends mieux la synthèse qu’en fait Charles Pépin.
Frédéric Manzini, dans un article de Philomag de 2020 : <Qu’est ce qu’un véritable ami ?> fait la même synthèse :
« L’amitié nous rend meilleurs, c’est la thèse forte que soutient Aristote dans l’Éthique à Nicomaque, »
Un ami n’est pas celui qui vous donne toujours raison, mais qui sait dire avec bienveillance, mais fermeté les conseils qui vous rendront meilleur.
Un ami d’Israël dirait probablement :
- Ce que le Hamas a fait le 7 octobre constitue une abomination.
- Je comprends que tu veuilles neutraliser le Hamas, arrêter ou éliminer ses dirigeants et libérer les otages.
- Mais la force brutale ne suffit pas, ce n’est pas ainsi que tu résoudras cette crise et encore moins assureras ta sécurité pour l’avenir, bien au contraire.
- Toute la terre qui se trouve entre la mer et le Jourdain ne t’appartient pas, il faut que tu la partages avec l’autre peuple qui s’y trouve, avec toi.
- S’il faut marginaliser le Hamas chez les palestiniens, il faut aussi que tu sois en mesure de marginaliser les messianistes juifs qui sont contre le partage de la même manière ;
- Une fois, ces choses admises il sera possible de trouver des interlocuteurs palestiniens avec qui tu pourras discuter, peut-être s’en trouve t’il un dans tes prisons.
- Mais toi aussi, tu as cette mission de trouver, en ton sein, un homme ou peut être plutôt une femme capable de porter ce combat vers la justice, l’égalité, la sécurité et la paix.
Un ami ne doit pas vous encourager dans l’aveuglement, mais vous rendre meilleur.
Charles Pepin développe encore d’autres aspects de : « Qu’est-ce qu’un ou une véritable ami(e) ? »
<1807>
- D’abord dans la disproportion de la violence employée et des victimes alors qu’il devient de plus en plus clair que la seule force ne règlera rien, ni la sécurité d’Israël, ni la stabilité de la région ;
-
Jeudi 23 mai 2024
« L’entraîneur sage»Un jeu de mots qui parle de Pierre Sage, entraîneur de footballAlbert Camus nous l’avait appris : le football nous permet de comprendre beaucoup de la vie.
 J’écris « L’entraineur sage » pour faire référence à l’entraineur Pierre Sage de l’Olympique lyonnais.
J’écris « L’entraineur sage » pour faire référence à l’entraineur Pierre Sage de l’Olympique lyonnais.
Pour celles et ceux qui ne suivent pas le football, il me faut narrer un peu cette histoire.
L’olympique Lyonnais a commencé le championnat cette année avec un entraineur de renom : Laurent Blanc. Les résultats furent catastrophiques.
Il fut remplacé rapidement par un entraineur italien, Fabio Grosso qui fut ce joueur qui marqua le dernier penalty de l’équipe d’Italie lors de la finale de la coupe du monde perdue par la France en 2006.
Cet ancien joueur prestigieux n’arriva pas davantage à faire gagner l’équipe puisqu’au bout de 13 journées, Lyon était 18ème et dernier de la Ligue 1 avec 7 pts.
Les spécialistes ont étudié le passé : jamais une équipe, ayant ce nombre de points à la 13ème journée, n’était parvenue à assurer son maintien à l’issue de la saison, c’est-à-dire éviter d’être classée dans les 3 derniers du classement.
Alors on vira aussi Fabio Grosso.
En attendant et de manière temporaire, il fut décidé de prendre Pierre Sage qui était le responsable du centre de formation de Lyon.
Il n’avait pas été un joueur de football de haut niveau, il n’avait même pas le diplôme permettant d’entraîner.
Il commença très mal par deux défaites, puis une remontée historique, dans le sens où cela n’était jamais arrivé avant.L’équipe de Lyon a terminé 6ème du championnat et s’est aussi qualifié pour la finale de la coupe de France qu’elle jouera samedi.
Quand on examine le parcours que cet entraîneur a permis à son équipe de réaliser à partir de la quinzième journée, voici ce que cela donne :
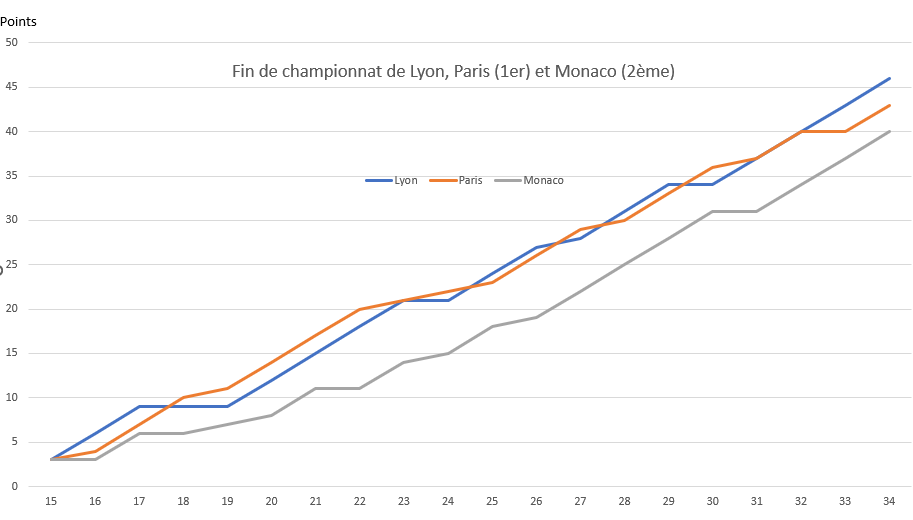
Je compare donc l’évolution des points accumulés depuis la quinzième journée par Lyon et les deux clubs qui ont terminé aux deux premières places du championnat.
Lyon a réalisé un meilleur parcours que les deux premiers. En pratique, Lyon est le club qui a gagné le plus de points à partir de la quinzième journée.
Je ne vais pas aller plus loin dans l’analyse footballistique de ce parcours.
Que nous apprend cette expérience ?
Les journalistes et les spécialistes sportifs ont décortiqué ce qui a fait le succès.
D’abord il est parvenu à redonner confiance aux joueurs.
Son premier succès a été de savoir écouter les joueurs et leur parler.
Contrairement aux autres entraîneurs, il n’a pas changé tout le temps son équipe et a mis en place une stratégie de jeu plutôt simple.
Il s’est appuyé sur les qualités de ses joueurs et les a fait jouer sur le poste qui leur convenait le mieux.
L’équipe a pu recommencer à gagner et la dynamique de groupe a pu se réenclencher.Bien sûr, il a eu un peu de chance de ci de là, mais la chance ne se provoque-t-elle pas ?
Les spécialistes de football pourraient encore expliquer bien des raisons de cette réussite.
Pour ma part je retiendrai : humilité, savoir écouter, parler avec bienveillance, rester simple et faire confiance.
J’ai confiance, je sais faire confiance, on me retourne la confiance.
Ces règles de réussite peuvent s’appliquer dans bien d’autres domaines que le football.
Mais pour agir ainsi, il faut être sage, je veux dire faire œuvre de sagesse.
<1806>
-
Jeudi 16 mai 2024
« Ce n’est pas un hasard si vous avez le gouvernement le plus radical du point de vue de l’orthodoxie juive d’un côté et le Hamas de l’autre côté qui perpétue le pire crime en matière de barbarie en criant «Allah Akbar» et non «Palestine libre» »Eric DanonLa tragédie qui se passe à Gaza ne laisse que peu de personnes indifférentes. Certains, pour leur sérénité, tentent de se tenir à distance.
Pour tous ceux qui ne choisissent pas cette solution, le plus grand nombre se met dans un des deux camps.
Eric Danon, ambassadeur de France en Israël d’août 2019 à juillet 2023, en introduction de sa « Conférence publique à la Sorbonne, le 25 avril 2024 » enjoint cependant, ceux qui sont dans ce cas, de ne jamais omettre de garder, au fond d’eux, de la compassion et de l’empathie pour ce qu’il se passe de l’autre côté.
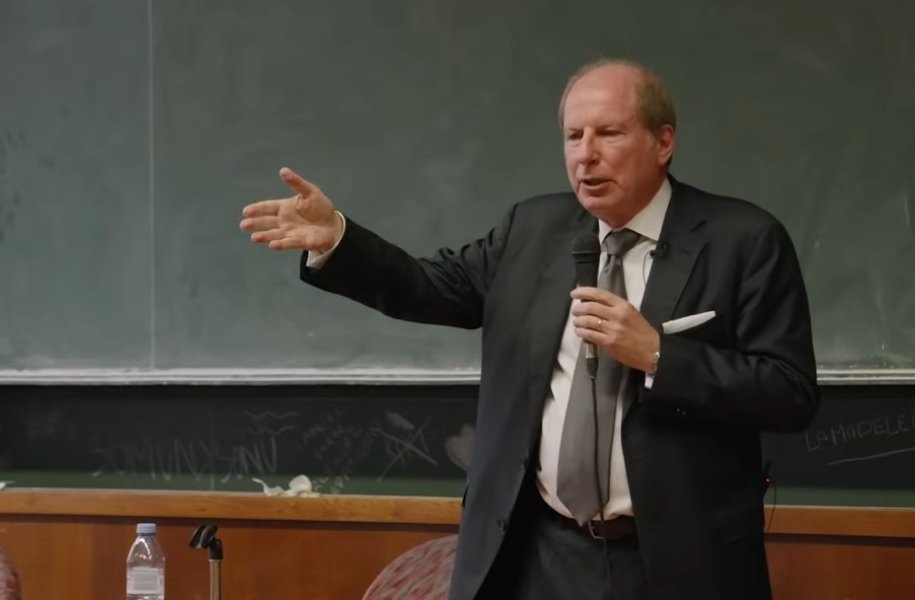 La conférence de ce diplomate de 67 ans qui a été ambassadeur en Israël pendant 4 ans, est d’une hauteur de vue et d’une intelligence rare.
La conférence de ce diplomate de 67 ans qui a été ambassadeur en Israël pendant 4 ans, est d’une hauteur de vue et d’une intelligence rare.Après avoir entendu cette conférence, il devient encore plus clair, que le Moyen orient est lieu de complexité. Il avoue d’ailleurs que c’est encore plus complexe qu’il ne peut l’expliquer dans une conférence d’une heure trente.
Je ne peux que vous encourager à l’écouter, surtout qu’à la fin de la conférence il esquisse une piste de sortie du conflit grâce à l’implication de l’Arabie Saoudite et de son prince héritier qui est, selon lui, le seul dirigeant arabe qui souhaite vraiment la paix et la stabilité de cette région. Et il a ce souhait parce qu’il en a besoin pour poursuivre la stratégie de développement de son pays. Il évoque brièvement une autre possibilité qui passerait par une confédération entre la Palestine et la Jordanie.
Je donne ci-après quelques éléments d’éclairage de cette conférence. Pour ce faire, je me suis largement servi de la synthèse réalisée par Marie-Caroline Reynier et que vous trouverez derrière « ce lien ».
Pour Éric Danon cette guerre va durer parce que ni Israël, ni le Hamas n’ont atteint leurs objectifs respectifs.
Nous connaissons les trois objectifs officiels d’Israël :
- éradiquer le Hamas ou au moins lui infliger des pertes quasi irréparables ;
- libérer les otages ;
- et neutraliser toute menace émanant de Gaza.
Mais Eric Danon prétend qu’Israël poursuit aussi trois objectifs sinon secrets, au moins officieux :
- Israël souhaite rebâtir une dissuasion afin qu’aucun groupe n’ambitionne de faire pareil que le Hamas. Car l’action du Hamas a fissuré les racines, la raison d’exister d’Israël : Protéger les juifs, interdire à jamais qu’il puisse encore exister des massacres de juifs comme ceux qui ont eu lieu en Europe au XIXème et au XXème siècle. Or le Hamas a non seulement réalisé un tel massacre et de plus sur le territoire d’Israël.
- La guerre de Gaza constitue aussi une catharsis pour surmonter le traumatisme du 7 octobre 2023, certains parleront de vengeance.
- Enfin, Netanyahou cherche à faire durer la guerre au moins jusqu’au 5 novembre 2024, date de l’élection présidentielle américaine, car il ne souhaite pas faire le cadeau de la paix au président actuel mais à Trump dont il attend un soutien plus indéfectible que celui offert par Biden.
Le Hamas poursuit aussi trois objectifs officiels :
- rentrer en Israël et tuer le maximum de personnes ;
- capturer le plus d’otages possibles pour les échanger avec des prisonniers ;
- et préempter l’objet « résistance palestinienne » en montrant qu’il est le plus crédible pour porter ce combat.
Il poursuit également un objectif officieux : être présent à la table des négociations du jour d’après. Ce dernier objectif n’est pas atteint, mais le Hamas pense que plus il parviendra à faire durer la guerre et ne pas s’effondrer, plus il parviendra à se rendre incontournable pour la suite.
Nous constatons que pour Israël comme pour le Hamas, la vie et la souffrance des gazaouis n’a pas grande valeur. Il me semble que ce mépris de la vie palestinienne est beaucoup plus fort encore au Hamas, qui considère que chaque victime supplémentaire, « martyr » disent-ils, est une bonne chose car elle fait augmenter le ressentiment contre Israël.
Cette attitude cynique me fait penser à la réplique que Michel Audiard avait mis dans la bouche de Bernard Blier :
« J’ai déjà vu des faux-culs, mais vous êtes une synthèse ! »
(« Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause, 1969 »)L’ancien ambassadeur parle de la souffrance des deux peuples. Il met en avant une souffrance particulière des Palestiniens qui prennent conscience que les pays arabes, notamment méditerranéens, ne sont pas intéressés par la fin du conflit.
La jeunesse palestinienne réalise ainsi qu’ils ont toujours été empêchés, depuis 1948, d’avoir un État par leurs dirigeants ou par ces pays arabes.
Et il explique pourquoi les pays arabes, et tout particulièrement ceux de la Méditerranée, n’ont rien fait pour favoriser l’émergence d’un État palestinien. Et il est vrai que dès la création de l’État d’Israël, les états arabes sont entrés en guerre non pour créer un État palestinien mais pour détruire l’État d’Israël et s’accaparer les territoires ainsi conquis entre Jordanie, Égypte, Syrie et Liban.
- La première raison qu’il cite est que la cause palestinienne constitue un puissant levier de politique intérieure pour les pays arabes. En effet, elle permet d’entraîner la population en faveur des gouvernements au pouvoir. Dès qu’un gouvernement se trouve en difficulté, il évoque la question palestinienne et parvient à recréer une unité autour de lui pour défendre cette cause. Aucun gouvernement ne voudrait se priver d’un tel levier.
- La seconde raison est que si les populations des pays arabes s’entendent bien, leurs gouvernements ne s’apprécient pas, comme le souligne la rivalité entre le Maroc et l’Algérie ou celle entre la Tunisie et l’Égypte. De fait, le rejet d’Israël contribue à rassembler ces pays lorsqu’ils se réunissent, par exemple lors des sommets de la Ligue arabe. Pour que cette entente dure, ils ont donc tout intérêt à ce que le conflit perdure.
- Troisièmement, si le conflit israélo-palestinien prend fin, Israël pourrait devenir encore plus puissant. Israël est déjà une puissance déterminante du Proche-Orient dont le PIB (525 milliards de dollars) est supérieur à l’addition du PIB de tous les pays qui l’entourent. Ce conflit, les dépenses militaires d’Israël et les pertes économiques représentées par les appels au boycott, demeure un frein qui empêche Israël de devenir une superpuissance.
- Enfin, le statut de Jérusalem demeure une des réticences essentielles à la création d’un État palestinien. Le fait que la Palestine récupère ce lieu saint (la mosquée Al-Aqsa) pourrait ne pas convenir à l’Arabie Saoudite ou à l’Iran. Dans leur esprit la Palestine ne mérite pas un tel honneur.
 La religion prend d’ailleurs de plus en plus de place dans ce conflit.
La religion prend d’ailleurs de plus en plus de place dans ce conflit.Car ce conflit n’est plus simplement un conflit territorial, la religion occupe une place de plus en plus prégnante.
Inspirés par la religion, des individus sont profondément contre l’idée de la paix aussi bien du côté palestinien qu’israélien.
Ainsi, du côté palestinien, l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 a d’abord été revendiquée comme une non-acceptation d’Israël, au sens d’un refus du partage de l’ancienne Palestine mandataire (1923-1948). En ce sens, la difficulté originelle, renforcée par l’échec des nombreuses négociations, tient à la non-acceptation de ce partage.
Il rappelle aussi que si on accuse, à raison, le Hamas d’avoir sabordé les accords d’Oslo par des attentats terroristes faisant notamment exploser des bus israéliens, ce sont les messianistes sionistes qui ont commencé le cycle de violence. Ainsi, le massacre du caveau des Patriarches commis par un colon juif fanatique en 1994 a précédé les attentats du Hamas. Il explique que ces groupes religieux étaient motivés par le fait d’éviter à tout prix la création d’un Etat palestinien. C’est encore un fanatique issu de ces rangs qui a assassiné Yitzhak Rabin en 1995 en ayant pour but de tuer le processus d’Oslo.
Ce sionisme messianique, qui a pris une importance grandissante pour des raisons démographiques et politiques, refuse l’existence d’un État palestinien.
Eric Danon avant d’expliciter la piste qui lui semble la plus susceptible pour avancer vers une stabilisation puis une paix pose ces trois prémices : .
- Premièrement, il récuse l’utilisation du terme « solution » (l’expression « solution à deux États » étant très présente dans le débat public) pour parler du conflit israélo-palestinien, et lui préfère l’expression de « tectonique des puissances ». Selon lui, il ne faut pas penser les dynamiques politiques en termes de « solution » mais plutôt d’évolution.
- Deuxièmement, il soutient que la paix est aussi une question de personnes capables de la faire advenir. Or, sortir de ce conflit requiert des gens à la hauteur, ce qui n’est pas le cas au premier trimestre 2024.
- Troisièmement, au vu du rapport de forces déséquilibré entre Israël et la Palestine, il n’est pas possible de les laisser négocier face-à-face. Il faut donc une médiation. Or, celle-ci ne peut pas s’articuler exclusivement autour des États-Unis, médiateur traditionnel, car sa proximité vis-à-vis des Israéliens tend à les disqualifier. M. Danon défend donc une double médiation menée par l’Arabie Saoudite et des États-Unis.
Pour le reste je vous renvoie vers la vidéo de la conférence qui est d’une richesse d’analyse exceptionnelle : « Conférence publique à la Sorbonne, le 25 avril 2024 »
Dans sa conclusion il revient sur ce constat que beaucoup sous-estime la dimension religieuse qu’a pris ce conflit :
Si le conflit israélo-palestinien est de nature géopolitique, il comporte une autre composante déterminante, la dimension religieuse. En effet, les Messianiques juifs refusent de lâcher les territoires pour des raisons religieuses. Une difficulté structurelle à gérer le Mont du Temple persiste. Enfin, les politiques et diplomates souhaitant le compromis se heurtent à la radicalité religieuse. L’attentat du 7 octobre 2023 en est le symbole. Par conséquent, cette montée du religieux déplace les frontières du conflit israélo-palestinien. En effet, le Palestinien est devenu un symbole du refus de l’histoire et des valeurs de l’Occident.
Et il a cette phrase :
« Ce n’est pas un hasard si vous avez le gouvernement le plus radical du point de vue de l’orthodoxie juive d’un côté et le Hamas de l’autre côté qui perpétue le pire crime en matière de barbarie en criant Allah Akbar et non Palestine libre »
Pour Eric Danon, c’est aussi parce que la politique est devenue faible que la religion s’est renforcée. La religion appelle à l’absolu et interdit le compromis que permet la politique. C’est à la politique qu’il faut revenir et dans ce domaine le prince héritier saoudien peut jouer un rôle utile, selon lui.
<1805>
-
Mardi 14 mai 2024
« Leys, l’homme qui a déshabillé Mao »Documentaire consacré à Simon Leys, sinologue belge qui, le premier, a regardé la réalité du maoïsme en faceLa mort de Bernard Pivot a conduit à mettre la lumière sur certaines de ses émissions qui ont été sinon un moment d’Histoire, au moins un moment essentiel de révélation.
Il en a été ainsi de l’émission « Apostrophes » du 27 mai 1983 dans laquelle il invite, enfin, Simon Leys, cet immense sinologue qui a dénoncé avant tous les autres, les crimes et l’incompétence de Mao Tsé Toung et de la politique menée par le Parti communiste chinois.
J’avais déjà consacré un mot du jour à cette émission : « Que les idiots disent des idioties, c’est comme les pommiers qui produisent des pommes, c’est dans la nature. Le problème, c’est qu’il y ait des lecteurs pour les prendre au sérieux. ».
Dans cet épisode, Bernard Pivot avait également invité Maria-Antonietta Macciocchi, qui avait écrit des livres très élogieux sur la Chine de Mao et qui était une référence pour les maoïstes français.
Simon Leys parviendra sur la chaîne nationale à démonter l’argumentaire de Mme Macciochi et hésitera pour qualifier son dernier ouvrage entre « stupidité totale » ou « escroquerie ». D’après une interview de Bernard Pivot, ce fut le seul cas où, à la suite d’un passage à Apostrophes, les prévisions de vente d’un livre furent révisées à la baisse.
Il faut absolument voir le documentaire de 50 minutes diffusé sur la Chaîne « Public Sénat » : <Leys, l’homme qui a déshabillé Mao> qui montre le combat de Simon Leys pour dévoiler la vérité sur la Chine de Mao.
Simon Leys s’appelait dans l’état civil Pierre Ryckmans. Il est né en 1935, en Belgique dans une famille de la grande bourgeoisie catholique belge.
En mai 1955, il a l’opportunité de participer au voyage d’une délégation de dix jeunes Belges invités durant un mois en Chine. La République populaire de Chine avait été proclamé par Mao, 6 ans auparavant. Ce séjour très encadré par le Parti communiste chinois lui permet de rencontrer et d’échanger avec Zhou Enlai, le numéro 2 derrière Mao. Il en sortira fasciné.
Il décide d’apprendre le chinois afin de pouvoir s’ouvrir à la langue et à la culture du pays et d’aller l’étudier dans le monde chinois.
Il commencera à étudier à la section des Beaux-Arts de l’Université nationale de Taïwan. Puis il voyagera beaucoup dans le monde et se fixera d’abord à Singapour, mais devra en partir car il sera soupçonné d’être pro-communiste et ensuite s’installera, à partir de 1963, à à Hong Kong.
Il épousera une journaliste chinoise en 1964 : Han-fang Chang qui sera sa compagne jusqu’à la fin de sa vie et avec qui il aura quatre enfants.
Il étudie beaucoup et a du mal à trouver des emplois suffisamment rémunérés., il complète son salaire en rédigeant tous les quinze jours, de 1967 à 1969, un rapport analysant le déroulement des événements en Chine, pour le compte de la délégation diplomatique belge de Hong-Kong.
Ce sont ces rapports qui se fondent sur les publications officielles du régime communiste, comme sur le témoignage des chinois qui ont pu fuir le pays du livre rouge qui lui permettront d’écrire son premier ouvrage « Les Habits neufs du président Mao » dans lequel il dénonce ce qu’il sait de ce régime horrible et assassin
Il prendra pour nom d’auteur Simon Leys pour des raisons qui sont expliquées dans le documentaire.
Je ne vais pas écrire tout ce que le documentaire décrit. Il me parait très important, en revanche, d’insister sur un point essentiel : Le monde des intellectuels et universitaires, le monde des journalistes et des hommes politiques de gauche feront plus que critiquer le travail de Simon Leys : ils le couvriront d’injures, l’ostraciseront et lui fermeront définitivement les portes de l’Université française, alors qu’il était un des sinologues les plus compétents et les plus lucides qui existait alors sur la place.
Je veux donner la liste de ceux qui se sont trompés et qui, au moment où Simon Leys révélait la vérité, se sont trouvés dans l’autre camp :
- Philippe Sollers et la revue Tel Quel
- Le journal Le Monde
- Le journal Libération qui a été créé par des maoïstes dont Serge July
- Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir
- Roland Barthes
- Michel Foucault
- Louis Althusser et ses disciples Benny Lévy, les frères Miller (Jacques-Alain et Gérard),
- André Glucksmann, père de Raphaël qui se distinguera des autres en pratiquant la plus sévère autocritique, quand il constatera qu’il s’était trompé.
Il sera cependant soutenu immédiatement par Jean-François Revel et René Étiemble.
Tous ses critiques reconnaîtront, plus ou moins, leurs erreurs et la justesse des écrits de Simon Leys sauf le philosophe Alain Badiou qui continue à affirmer que « Les Habits neufs du président Mao » est une « brillante improvisation idéologique de Simon Leys dépourvue de tout rapport au réel politique »
 En attendant Simon Leys trouvera la sérénité et la reconnaissance en Australie, où l’Université ouvrira ses portes à cet homme lucide et habité par la recherche de la vérité. Il s’y installera en 1970, et y finira ses jours en 2014.
En attendant Simon Leys trouvera la sérénité et la reconnaissance en Australie, où l’Université ouvrira ses portes à cet homme lucide et habité par la recherche de la vérité. Il s’y installera en 1970, et y finira ses jours en 2014.« Le Monde » tentera, par un hommage appuyé, un rattrapage de l’aveuglement, 40 ans auparavant :
« Il possédait un goût pour le savoir qui soutenait son immense érudition ainsi que son énergie pour lire, traduire et comprendre. Néanmoins, conscient de la fragilité de nos connaissances, il mêlait volontiers l’humour du sceptique et la modestie du sage. C’est sans doute cette lucidité qui lui permit de voir la Chine maoïste sous son véritable visage et de publier, en 1971, le livre le plus percutant sur la Révolution culturelle, « Les Habits neufs du président Mao » »
Je crois que nous pouvons beaucoup apprendre de ce moment d’affrontement entre un homme lucide, sage et modéré et une cohorte de gens, pour la plupart classés à gauche, convaincus de détenir la vérité et d’être du côté du bien, aveuglés par leur dogme et leurs certitudes.
Le maoïsme et le stalinisme ne sont plus d’actualités, le trotskysme presque plus, mais il reste encore bien des dogmes et des nouveaux combats dits « progressistes » qui aujourd’hui continuent à aveugler des femmes et des hommes qui sont certains d’être du bon côté du combat. Qu’en sera-t-il dans quarante ans ?
Je redonne le lien vers le documentaire : <Leys, l’homme qui a déshabillé Mao>.
<1804>
-
Mardi le 7 mai 2024
« Je vis avec les mots […] Mourir c’est abandonner les mots et cela c’est terrible ! »Bernard Pivot dans l’émission « L’Invité » de Patrick Simonin en mars 2021Même Bernard Pivot est mortel, sa vie s’est arrêtée le 6 mai 2024, le lendemain de son 89ème anniversaire.
Le créateur et animateur des émissions de télévision qui ont rendu les français plus cultivés et instruits : « Apostrophes » (de 1975 à 1990) et « Bouillon de culture » (de 1991 à 2001) a fait l’objet de nombreux hommages dès l’annonce de sa disparition.
Je privilégie une émission plus ancienne, en mars 2021, lorsqu’il a été invité par Patrick Simonin pour parler de son avant dernier livre : « … Mais la vie continue ». Il parle de son grand âge et de ce travail difficile et en perpétuel évolution : vieillir.
« Quand on écrit un livre sur la vieillesse on connait chaque matin le sujet mieux que la veille, et moins bien que le lendemain »
 Pour lui, le problème principal devient la santé :
Pour lui, le problème principal devient la santé :« Les obsèques, on s’en fout. L’important est de vivre le plus longtemps possible et en bonne santé ! L’objet principal du livre est la santé.
A 80 ans passés, la question « Comment vas-tu ?», ce n’est plus une question de politesse, c’est une question médicale ! »On sent dans cette émission sa passion intacte pour la vie, vivre au présent est pour lui une quête de tous les instants. Et il insiste sur le privilège acquis de la liberté, liberté de la maitrise du temps et liberté de parole :
« Le grand privilège de l’âge, par rapport au moment où on est dans la vie active […] c’est qu’on a la maîtrise de son temps et de son jugement. » […] Si vous avez envie de dire quelque chose vous le dites carrément. A 30 ou 40 vous n’osiez pas. »
Il insiste beaucoup sur cette liberté d’organiser son temps à sa guise.
« Ce qui est extraordinaire c’est la maîtrise du temps. Quand vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous, vous avez des décennies devant vous et vous n’avez jamais le temps et quand vous êtes vieux vous n’avez plus beaucoup de temps devant vous, les années sont comptées et vous avez tout votre temps. !
Autrement dit à long terme on n’a jamais le temps et à court terme on a tout son temps. »Et puis il parle des mots. Des mots qu’ils a tant aimé, qui ont été la sève de sa vie, les mots qui finissent avec la mort :
« C’est par amour des mots que nous sommes devenus écrivains ou journalistes. Les mots c’est notre matière première, ce sont nos amis, nos esclaves, ce sont nos fiancés, ce sont nos amants. Nous adorons les mots. […] Les mots cela peut-être du poil à gratter, comme cela peut être de la barbe à papa, cela peut être de la crème caramel comme du poivre de cayenne. […] Les mots sont à notre service, écrire c’est les réunir, les assembler, les biffer c’est un plaisir extraordinaire. Moi je vis avec les mots, trop souvent les gens ne se rendent pas compte que les mots font partie de notre vie, de notre atmosphère, de notre univers. Mourir c’est abandonner les mots et cela c’est terrible ! »
Les mots c’est aussi ceux que l’on oublie quand l’âge avance. Le mot qu’il aime le plus est « Aujourd’hui » en ajoutant qu’il lui plait beaucoup que ce mot comporte une « apostrophe » mais surtout parce qu’il désigne le présent qui était si important pour cet amoureux de la vie.
Il avait aussi beaucoup d’humour, il a écrit dans son livre :
« Rire, ça fait fuir la mort ! »
Il faut ajouter, un certain temps…
<1804>
-
Lundi 29 avril 2024
« L’évocation d’une ancienne tradition qui est en réalité très moderne. »Max Fisher, journaliste qui rappela que le relais de la flamme olympique est une invention de l’Allemagne nazieCes derniers jours quand on allume la radio et je suppose la télévision (que je ne regarde pas) on nous parle beaucoup de la flamme Olympique.
Actuellement, elle se trouve sur le navire le BELEM pour faire le trajet d’Athènes à Marseille où elle arrivera le 8 mai. Puis elle sera portée par de nombreux athlètes dans un très long trajet à travers la France, toute la France, c’est à dire aussi les départements et territoire d’outre mer.
Un site <Relais de la flamme olympique : parcours> vous permet d’en connaître tous les détails. Un article plus simple de l’hebdomadaire <Le Point> donne la liste des villes et les dates.
Lyon et d’autres villes ont refusé d’accueillir la flamme pour ne pas s’acquitter des 180 000 euros exigés pour que le trajet daigne passer par la métropole lyonnaise.
 Au préalable, il a fallu allumer cette flamme à Olympie grâce aux rayons du soleil et l’aide de femmes habillées de manière hollywoodienne, dans l’objectif de ressembler à des prêtresses grecques.
Au préalable, il a fallu allumer cette flamme à Olympie grâce aux rayons du soleil et l’aide de femmes habillées de manière hollywoodienne, dans l’objectif de ressembler à des prêtresses grecques.J’espère que les adeptes exacerbés des trois monothéismes se rendent compte que nous sommes en pleine célébration polythéiste. On ne dira jamais assez que le polythéisme constitue une invitation à la tolérance, contrairement au monothéisme qui confond croyance et vérité.
Le polythéisme est aussi pragmatique puisque la flamme n’a pas été allumée par le soleil le jour prévu, c’est à dire mardi 16 avril, parce que les nuages ne l’ont pas permis. Il y avait un plan B, une flamme, allumée selon le rite, attendait sagement de pouvoir transmettre le feu.
Mais quelle est cette tradition qui consiste à faire parcourir à la flamme olympique un si long trajet ?
Il existe même une question préalable : Cette tradition de la flamme olympique existait-elle lors des jeux antiques ?
Sur le site officiel des jeux olympiques de Paris, les organisateurs prétendent que oui :
« Lors des Jeux Olympiques antiques, la Flamme était générée par les rayons du soleil et restait allumée pendant toute la durée des Jeux dans un sanctuaire d’Olympie, le Prytanée. ».
Ce n’est pas ce qu’affirme Wikipedia dans son article sur la flamme olympique :
« La flamme olympique n’existait pas dans les Jeux olympiques antiques. Elle est apparue pour la première fois le 28 juillet 1928 lors des Jeux olympiques d’été de 1928, à Amsterdam. »
La bible française en matière de sport : L’Équipe pose la question à Vinciane Pirenne-Delforge, professeur au Collège de France, qui confirme : « Pas de flamme olympique dans l’Antiquité ».
Une recherche Google donne comme élément de rapprochement qu’à l’époque, des torches étaient allumées pour des cérémonies religieuses, en hommage à certains Dieux ou durant des compétitions sportives, comme des courses de flambeau !
Voilà qui est dit !
Lors de la création des jeux olympiques de l’ère moderne, en 1896 à Athènes, il n’a pas été question non plus de flamme olympique. Elle est apparue, comme l’écrit Wikipedia en 1928 à Amsterdam.
 Mais le parcours de la flamme à travers des villes et des pays a été inventé par d’autres : les nazis. C’est ce que qu’on peu voir sur le Mémorial de l’Holocauste. Mais un article du journal « Le Monde » de 2012 nous donne plus de précision :
Mais le parcours de la flamme à travers des villes et des pays a été inventé par d’autres : les nazis. C’est ce que qu’on peu voir sur le Mémorial de l’Holocauste. Mais un article du journal « Le Monde » de 2012 nous donne plus de précision : « Le journaliste Max Fisher, du magazine américain The Atlantic, rappelle les conditions dans lesquelles est née cette tradition moderne, en 1936, pour les Jeux de Berlin. Le régime nazi avait inventé cette année-là le relais de la flamme, l’utilisant comme instrument de propagande.
A l’origine, Adolf Hitler ne voulait pas des Jeux, qu’il qualifiait d’« invention des juifs et des francs-maçons » [mais] convaincu par le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, en 1934, Hitler en fit une démonstration du pouvoir nazi, une évocation des racines aryennes du peuple allemand, unifié par « l’esprit combattant » de ses athlètes. Il saisit aussi l’occasion de lier symboliquement son régime aux empires de l’Antiquité qui lui étaient chers. La flamme fut utilisée pour exprimer la continuité historique naturelle, imaginée par le régime nazi, entre son propre essor et l’héritage grec, via Rome et le Saint-Empire romain germanique. Cette année-là, les porteurs de flambeau passèrent par la Tchécoslovaquie. La propagande allemande encouragea des heurts entre des membres de la communauté allemande et la majorité tchèque. Deux ans plus tard, l’Allemagne envahissait le pays. […] L’idée originale de la torche avait été soufflée à Hitler et Goebbels par un dénommé Carl Diem, patron du Comité olympique du Reich, qui avait mené une longue campagne pour obtenir l’organisation des jeux en Allemagne. ».Le Monde cite Max Fisher, qui écrivait que l’on peut encore discerner « les échos lointains de cette première cérémonie […] : les costumes, l’orchestration minutieuse, le fer et la flamme, l’évocation d’une ancienne tradition qui est en réalité très moderne ».
A ce stade, on peut conclure soit que le régime nazi a peut être eu des innovations qu’on peut reprendre, soit sentir un certain malaise devant cette antiquité inventée de toutes pièces par des monstres du XXème siècle.
<1803>
-
Lundi 22 avril 2024
« Dans l’eau, les baleines sont devenues l’espèce dominante, sans tuer leurs semblables. »Heathcote WilliamsC’est une amie d’Annie, habitant la Guadeloupe, qui a conseillé de voir ce documentaire remarquable « Les gardiennes de la Planète ».
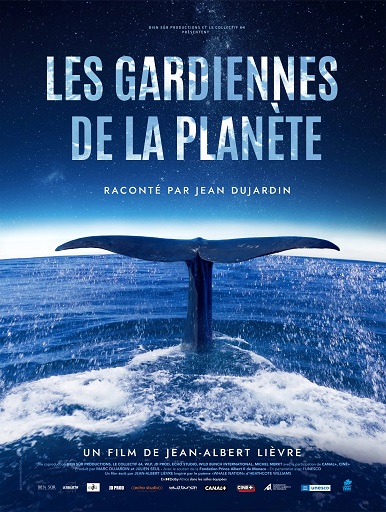 Il a été réalisé par Jean-Albert Lièvre et il est sorti en salle début février.
Il a été réalisé par Jean-Albert Lièvre et il est sorti en salle début février.
Il commence par ces mots écrits par Heathcote Williams dans son ouvrage : « The Whale Nation » traduit en français et ayant pour titre « Des Baleines. :« Vue de l’espace, la planète est bleue
Vue de l’espace, la planète est le territoire
Non pas des hommes, mais de la baleine »Le documentaire s’inspire librement de ce livre, écrit en 1988. Quand nous avions fini de regarder le documentaire, je me suis empressé d’aller emprunter à la bibliothèque le livre de Heathcote Williams traduit par Jacqueline Ollier.
Ce livre, plein de photos, est encore plus magnifique et instructif que le documentaire.
 Je crois que le documentaire est une invitation à lire ce livre qui est un long poème en prose, un hymne à la beauté, à l’intelligence et à la majesté de ce grand mammifère : la baleine.
Je crois que le documentaire est une invitation à lire ce livre qui est un long poème en prose, un hymne à la beauté, à l’intelligence et à la majesté de ce grand mammifère : la baleine.« D’anciens mammifères inconnus quittèrent la terre. En quête de nourriture ou de sanctuaire,Et entrèrent dans l’eau »
Page 10Pendant longtemps les humains ont massacré les baleines. Tout était prétexte à les chasser, les dépecer. Les êtres humains ont utilisé chaque partie de la baleine une part pour la nourriture et une grande part pour l’industrie.
Heathcote Williams est non seulement écrivain et poète, il mobilise aussi de grandes connaissances scientifiques pour expliquer tout ce que les baleines apportent à la biodiversité, à l’équilibre de la vie sur terre.Il montre comment elles se comportent et conseille aux humains d’apprendre de ces doux géants une nouvelle façon de vivre :
« Comme les bouddhistes,
Elles sont très sobres,
Elles peuvent rester huit mois sans nourriture
Et elles ne travaillent pas pour manger
Elles jouent pour manger.
La baleine à bosse attrape sa nourriture en faisant des bulles […]
Quand elles éclatent, elles font un cercle de brume aveuglante. »
Page 15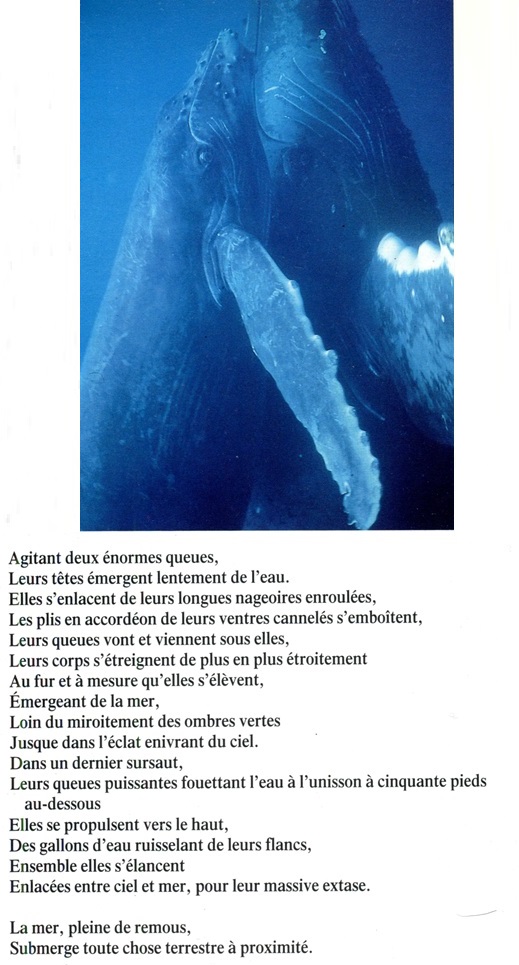 C’est ainsi que les baleines piègent le plancton : les crevettes arctiques, le krill, les papillons de mer.Leur énorme oreille est vingt fois plus sensible que celle de l’homme. Parce que : « La baleine se meut dans une mer de sons »
C’est ainsi que les baleines piègent le plancton : les crevettes arctiques, le krill, les papillons de mer.Leur énorme oreille est vingt fois plus sensible que celle de l’homme. Parce que : « La baleine se meut dans une mer de sons »Elles sont naturellement écologistes :
« Elles se reproduisent en fonction exacte de la quantité de nourriture que contient la mer »
Page 31Il décrit toujours avec poésie et précision comment les baleines qui sont mammifères comme nous se reproduisent. Il ajoute des détails qui touchent notre humanité :
« Si survient une mort prématurée
La mère portera son petit sur son dos
Jusqu’’à ce qu’il se désintègre. »
Page 47Le livre après avoir montré la magie de ces immenses êtres vivants, ne va rien nous épargner de la brutalité, de la rapacité des gens de notre espèce qui voient en ces majestueux voyageurs des océans, uniquement des objets économiques :
« Quand la baleine arrive à portée de tir,
On met le moteur au ralenti.
Un tir précis la touche entre les omoplates […]
La pointe frappe,
Suivie par une charge-retard qui explose trois secondes après.
Déchiquetant et lacérant le flanc de la baleine au passage du harpon.[…]
La baleine serre les mâchoires
Halète, se convulse et crache du sang par son évent. […]
Vingt minutes s’écoulent […]
N’ayant pas d’ennemis dans la mer,
La baleine se refuse à croire qu’on l’attaque, […]
Elle suffoque et meurt […]
Une lance creuse
Fixée à un tube
Est lancée contre son ventre retourné,
Insufflant de l’air comprimé dans son cadavre
Pour le gonfler et le maintenir à flot […]
Le navire-usine, grand comme un porte-avions,
Capable de débiter une baleine toutes les demi-heures
S’approche d’elle… »
Pages 53 à 56La description du carnage continue pendant plusieurs pages, avant que dans une dizaine de pages, l’auteur énumère la liste interminable de tous les usages que les humains ont réalisé à partir du géant des mers.
Les scientifiques se sont rendus compte de l’importance des baleines dans l’écosystème de la terre, la chasse en a été interdite en 1982. Pourtant 3 pays continuent à les tuer : Le Japon, la Norvège et l’Islande.
« France info » nous apprend qu’après la chasse le réchauffement climatique décime aussi la population des cétacés :
« De nouvelles recherches australiennes montrent qu’entre 2012 et 2021, en moins de 10 ans, le nombre de baleines a baissé de 20% dans le Pacifique Nord.
Car les vagues de chaleur marines bouleversent tout l’écosystème marin et réduisent la production de phytoplancton, ces plantes à la base de la chaîne alimentaire des baleines. […] Après avoir été décimées par les chasseurs, aujourd’hui, c’est donc la faim qui tue les baleines. […] Les scientifiques australiens, qui rappellent que les baleines sont des sentinelles de la santé des océans, appellent à agir d’urgence contre le changement climatique. »Le documentaire se termine par ce texte de Heatchcote Williams :
« Dans l’eau, les baleines sont devenues l’espèce dominante,
Sans tuer leurs semblables.Dans l’eau, les baleines sont devenues l’espèce dominante,
Bien qu’elles permettent aux ressources qu’elles utilisent de se renouveler.Dans l’eau, les baleines sont devenues l’espèce dominante,
Bien qu’elles communiquent par le langage plutôt que d’éliminer leurs rivaux.Dans l’eau, les baleines sont devenues l’espèce dominante,
Bien qu’elles ne défendent pas jalousement leur domaine, armées jusqu’aux dents.Dans l’eau, les baleines sont devenues l’espèce dominante,
Sans troquer leur innocence contre l’illusion de posséder.Dans l’eau, les baleines sont devenues l’espèce dominante,
Bien qu’elles admettent l’existence d’autres esprits que les leurs.Dans l’eau, les baleines sont devenues l’espèce dominante,
Sans permettre à leur population d’atteindre des densités catastrophiques.Dans l’eau, les baleines est l’espèce dominante,
Extra-terrestre, qui a déjà atterri…
Pages 99 à 101 Livre d’une beauté magique, d’une science confondante qui nous permet d’approcher et d’un peu mieux comprendre ce mammifère qui a choisi de vivre dans l’eau, qui ne se comporte pas comme homo sapiens et qui fait tant de bien à la terre.
Livre d’une beauté magique, d’une science confondante qui nous permet d’approcher et d’un peu mieux comprendre ce mammifère qui a choisi de vivre dans l’eau, qui ne se comporte pas comme homo sapiens et qui fait tant de bien à la terre. « Wikipedia » nous apprend qu’en outre les baleines jouent un rôle majeur dans la capture du dioxyde de carbone. Car elles agissent comme une pompe biologique, elles se nourrissent de zooplancton, remontent à la surface pour respirer et libèrent dans l’eau de gigantesques vagues de nutriments riches en azote, en phosphore et en fer.
Autrement dit, elles remettent en circulation des nutriments grâce à leurs fèces (excréments), qui vont par la suite nourrir et stimuler la croissance du phytoplancton et des algues marines qui absorbent le carbone de l’atmosphère par photosynthèse. Ainsi, elles contribuent à la séquestration du carbone en ingérant ces organismes qui concentrent une grande partie du carbone atmosphérique. Ces mêmes informations se trouvent dans le documentaire et le livre.
<1802>
-
Lundi 15 avril 2024
« De temps en temps, il faut poser des gestes gratuits de bonté, c’est ce qui rend la vie supportable. »Denys Arcand, dans son film « Testament », sorti en salles le 22 novembre 2023Denys Arcand, cinéaste québécois, est à 82 ans, un des monuments du cinéma mondial.
Ma première rencontre avec son œuvre fut quand, avec Annie, nous avons vu « Jésus de Montréal » (1989) qui venait de recevoir le Prix du Jury de Cannes.
Mais ses films les plus connus et ayant eu le plus de succès furent certainement : « Le Déclin de l’empire américain » (1986) et « Les invasions barbares » (2003).« Testament » est son dernier opus, peut être l’ultime si on veut donner un sens à ce titre.
Ce samedi, nous avons regardé ce film nostalgique et jubilatoire avec Annie.
 Le film montre un vieil homme, célibataire, probablement le double cinématographique de Denys Arcand, interprété par Rémy Girard. À 70 ans, Jean-Michel Bouchard (Rémy Girard) sent sa fin approcher. Dépassé par son époque et pensant souvent à la mort, il vit dans une résidence pour personnes âgées, gérée par Suzanne (Sophie Lorain), et travaille encore deux jours par semaine aux Archives nationales.
Le film montre un vieil homme, célibataire, probablement le double cinématographique de Denys Arcand, interprété par Rémy Girard. À 70 ans, Jean-Michel Bouchard (Rémy Girard) sent sa fin approcher. Dépassé par son époque et pensant souvent à la mort, il vit dans une résidence pour personnes âgées, gérée par Suzanne (Sophie Lorain), et travaille encore deux jours par semaine aux Archives nationales. Jean-Michel et Suzanne vont assister à l’arrivée de jeunes manifestants qui vont camper devant la résidence et marteler leur slogan : « Respect pour les premières nations ». Ils dénoncent la présence dans la résidence d’une fresque murale, réalisée au XIXème siècle, montrant la rencontre entre Jacques Cartier et des autochtones du Canada.
Jacques Cartier (1491-1557) est décrit dans nos livres d’Histoire comme un navigateur et un explorateur français ayant découvert le Canada. Dans la compréhension d’aujourd’hui, c’est un colonialiste qui n’a rien découvert puisqu’il existait une population appelé « amérindienne » qui vivait déjà sur cette terre et que son rôle a consisté à soumettre cette population et préparer l’installation et l’exploitation de cette terre et de ses habitants par les européens.
Jean-Michel, grâce à un ami, va inviter une femme autochtone pour voir, avec son regard, la fresque. Elle va donner son sentiment et dialoguer avec le groupe de jeunes qui veulent la destruction de la fresque.
De cette rencontre, il apparaît que le groupe de jeunes ne compte aucun autochtone mais une vingtaine de vrais « wokes », ayant trouvé une nouvelle cause pour exercer leur censure.
Ce moment est très émouvant car si les jeunes stigmatisent la représentation des amérindiens parce qu’ils sont quasi nus, alors que selon les wokes ils auraient dû être représentés en « tenue d’apparat » accueillant des émissaires européens. La femme autochtone décrit une scène mettant en présence des hommes de l’âge de pierre devant des européens armés de fusils qui vont bientôt servir. Pour elle, ce tableau est l’annonce d’un génocide. Mais il ne semble pas qu’elle en demande la destruction, plutôt une explication. Ainsi, quand elle interpelle les deux occidentaux qui l’accompagnent par cette question : « Vous n’avez jamais vu cette fresque sous cet angle ? », ils acquiescent.
Il ne s’agit pas de rejeter l’intégralité des sources du woke, mais d’en saisir les excès, les anachronismes et parfois la bêtise.
C’est ce que fait Denys Arcand dans ce beau film, drôle, sarcastique, tendre parfois.
Comme cette réplique, dont j’ai fait l’exergue de ce mot du jour, que pose Jean-Michel Bouchard à la fille de Suzanne qui a quitté sa mère brutalement et ne veut plus la revoir.
Car l’affaire de la fresque, n’est pas le seul sujet du film. Il montre aussi le fonctionnement toxique de la télévision et de la radio, qui dramatisent vite et exagérément l’événement. Il s’attaque ensuite au monde politique, qui gouverne en fonction des apparences et qui carbure à l’indignation populaire.
Enfin, l’autre grand sujet de cette comédie satirique est la solitude, celle des vieux en particulier, mais avec des moments d’échange et d’humanité pleins de grâce.
Cependant le sujet de ce mot du jour, n’est pas que mon avis sur ce film.
J’ai voulu connaître les réactions des médias français sur ce film. Et j’ai été frappé par une scission entre deux camps.
« Le Figaro » sous la plume d’Eric Neuhoff est enthousiaste :
« à 82 ans, denys arcand n’a pas l’âge de ses artères. mais avec testament, il a la dent dure. l’époque le désole. il choisit de s’en moquer. le programme est infini. c’est le monde à l’envers. l’inculture le dispute à la bêtise, qu’accompagne souvent l’arrogance […] l’enfer se pare de slogans bien intentionnés. […] ce courant d’air salubre fait un bien fou. contre le politiquement correct, la méthode Arcand est la meilleure. cela se passe au Québec, c’est-à-dire partout. on attend l’équivalent chez nous. il n’est pas interdit de rêver. »
Le magazine de cinéma « Première » est aussi élogieux :
« Denys Arcand […] signe une savoureuse comédie sur la cancel culture qui insiste précisément sur le décalage entre générations. […] si la situation entraîne imbroglios politiques et désaccords existentiels, le film a la judicieuse idée de privilégier l’humour et même d’oser la comédie sentimentale. au final, Arcand se questionne avec une bonne dose d’ironie et de tendresse sur son propre statut de ringard présumé. »
Le journal régional de tours : « La Nouvelle République » nous donne des informations sur l’origine de ce film :
« C’est un événement qui s’est déroulé dans un grand musée de new-york qui m’a donné l’idée du film » raconte Denys Arcand. « sur une grande fresque murale, on voyait la rencontre d’indiens de l’île de Manhattan avec un explorateur hollandais. »
un jour, « un groupe a exigé sa destruction en prétextant que cette toile constituait une insulte aux premiers arrivants. les responsables du musée ont alors placé une vitre devant l’immense tableau et, par quelques notes écrites, ont indiqué : “ il est impossible que cette réunion ait eu lieu en pareilles circonstances ” ou “ les indiens que vous voyez ne sont pas exactement habillés comme ils le devraient ”. ça a satisfait tout le monde et cette vitrine – explicative, en quelque sorte – est encore là, aujourd’hui. cet événement a excité mon imagination. pourquoi ne pas concevoir, dans la chapelle sixtine, de petites notes qui préciseraient : « dieu le père est ici représenté comme un homme blanc, vieux et probablement hétérosexuel, mais libre à vous d’imaginer, à sa place, une femme noire, jeune et enceinte ».La Nouvelle République se situe aussi dans le camp favorable au film :
« C’est une chronique drôle et grinçante sur la « bien-pensance ».
avec testament, le cinéaste québécois Denys Arcand s’amuse à régler des comptes avec les excès d’une époque où réactions épidermiques et parfois irréfléchies ont remplacé analyse et temps de réflexion.
[…] testament est avant tout un film où on sourit. […] peinture réaliste des excès de certains justes combats, testament choisit l’optimisme. »
Le quotidien catholique « La Croix » considère que le film « distille un charme qui doit beaucoup à l’interprétation fluide de Rémy Girard et à une photographie élégante ». le journal trouve le « dénouement lumineux » et juge qu’il « confirme rétrospectivement le soupçon que la satire visait aussi cette génération de seniors indifférente au devenir des plus jeunes. le testament du cinéaste de 82 ans se trouve-t-il dans cet ultime message d’espoir ? »
« Le Point » porte aussi un regard positif sur ce film
« Dans son quinzième film, le cinéaste québécois observe avec humour, et sans ménagement, un monde qui brûle des livres et réécrit des œuvres. »
Et il donne la parole au cinéaste :
« Je crois que ce sont des mouvements qui ressemblent en grande partie à une forme de renaissance religieuse chez un peuple dissident et fondamentalement croyant […]. ces mouvements ne sont pas politiques, n’abordent pas les questions sociales, la condition de vie des gens les plus démunis. Ils sont puritains, prônent la recherche de la rectitude morale, la primauté du genre, de l’origine ethnique et veulent accorder l’histoire à leurs principes. C’est un peu comme le temps de la prohibition où l’alcool fut interdit pour ne pas conduire à la débauche et améliorer l’être humain. pour moi, c’est un des multiples avatars du rêve américain.
[…] difficile de savoir si ces excès, devenus quotidiens, vont durer ou sont passagers […] qu’en pensera-t-on dans vingt ans ? On se dira peut-être : quelle folie cette culture de l’annulation, exactement comme nous paraît aujourd’hui absurde le fanatisme des maoïstes dans les années 1970. Quand je pense à la fascination du Petit Livre Rouge de Mao sur les intellectuels de l’époque : quinze ans après, la réalité prouvait qu’il était un tyran sanguinaire, responsable de millions de morts […] on ne peut jamais rien prévoir : c’est ma vieille formation d’historien qui me fait penser cela. on a déjà commencé à brûler des livres, à réécrire des œuvres. pour l’instant, on s’en prend à Ian Fleming et à Agatha Christie. pourquoi pas Shakespeare très bientôt ? à moins d’un sursaut, on assiste à la fin de l’universalisme. »
Le magazine de la gauche culturelle « Télérama » est plus en nuance. si le journal juge le film « inégal », il a été touché par la mise en scène de ce débat entre la « cancel culture » et la « mémoire nécessaire ». pour l’hebdomadaire, « c’est dans ce nœud gordien que s’infiltre l’intelligence de testament. un film sur l’automne de la vie d’un homme sardonique, qui cherche à ne pas mourir trop vieux ni de cœur ni d’esprit. »
Mais les « vrais médias de gauche » ont massacré le film. En premier lieu « Le Monde »
« Le cinéaste Denys Arcand sombre dans l’antiwokisme. sans finesse, le réalisateur québécois dissèque l’affaissement moral supposé de son pays en mettant les femmes et la jeunesse en première ligne.
[…] le cinéaste ne se montre jamais à la hauteur des débats qu’il soulève, la profondeur analytique de ses saillies pouvant se résumer à un désespéré « tout fout le camp ! » et « on ne peut plus rien dire », tandis que femmes et jeunesse sont filmées comme des monstres irrationnels. en faisant du wokisme l’explication de tous les maux de son pays, Arcand oublie, au passage, de faire le méticuleux décompte de ses privilèges, et notamment celui-ci : il a une heure cinquante-cinq pour raconter n’importe quoi sans être interrompu. en somme, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et, dans ce clair-obscur, surgissent les « boomers ».»
Ce texte peu aimable est de Murielle Joudet qui va jusqu’à oser cette comparaison disqualifiante, pour elle : « Denys Arcand rejoignant là Eric Zemmour en faisant des femmes – et d’une supposée « féminisation de la société » – les agents d’un affaissement intellectuel. ».
Jérôme Garcin n’est pas plus aimable dans « Le Nouvel Obs ». Dans le titre il utilise les termes « vieillot et poussiéreux » et il ajoute :« C’est un film de vieux, que notre époque insupporte et que le politiquement correct exaspère. [..] il n’est pas le seul à dénoncer les excès du nouvel ordre moral, mais il le fait ici avec une délicatesse d’éléphant blessé, échappé du cirque. le pamphlet n’est pas seulement un genre, c’est aussi un art. son film à sketches, où il beurre épais à chaque plan, n’en est pas. »
Avec ses acolytes de l’émission « Le masque et la plume » de France Inter, ils récidivent dans un jugement très défavorable.
Le journal « Libération » pratique la cancel culture : il ne parle pas de ce film !
Il faut aller sur « France 5 » pour entendre les éloges de Pierre Lescure et de Patrick Cohen avec en outre une interview du cinéaste.
Quand Patrick Cohen dit à la fin de la chronique que c’est le film le plus drôle qu’il ait vu depuis la rentrée, Anne Elisabeth Lemoine réplique :« Cela fait peut être de vous un vieux con ? ».
Peut être faut-il savoir être un vieux con pour dénoncer les excès et les effets de mode et de troupeau qui mènent vers le néant.
<1801>
-
Vendredi 5 avril 2024
« Mais, au nom de Dieu, qu’on laisse tranquille la Palestine »Yusuf Dia Khalidi (1842-1906), dans une lettre du 1er Mars 1899,destinée à Theodor HerzlEst-il nécessaire de faire le point sur la situation à Gaza et au Proche-Orient ?
Nous sommes au milieu du chaos. Le Hamas, sans aucune considération et humanité à l’égard de la population de Gaza, a lancé une attaque terroriste d’une ampleur et d’une violence inouïe contre Israël et sa population.
Depuis, dans un mouvement de réaction mais aussi de rage et de vengeance, Israël s’acharne sur les maisons de Gaza et surtout sa population.
Aujourd’hui, je voudrai partager une page d’Histoire. Du 29 au 31 août 1897, Theodor Herzl convoqua le Premier Congrès Sioniste mondial à Bâle, en Suisse. Ce congrès appelle à la création d’un foyer juif en Palestine. Dans son journal, à la date du 3 septembre 1897, il écrit :
«A Bâle, j’ai fondé l’État juif… Dans cinq ans peut-être, dans cinquante sûrement, chacun le verra.»
Un homme, un arabe de Palestine observe ce mouvement avec attention et angoisse. Il a pour nom Yusuf Dia Khalidi , certains écrivent son nom : Youssef Diya Al-Khalidi.
C’est un homme érudit, polyglotte, il a été maire de Jérusalem à plusieurs reprises. Il connaît le projet sioniste par les journaux. Et, il a observé les premières frictions entre les nouveaux arrivants et les fellahs (paysans) locaux, déplacés de force pour permettre la création des colonies.
Alors, le 1er mars 1899, Yusuf Dia Khalidi qui est alors député au Parlement impérial ottoman à Constantinople, prend la plume et envoie, en langue française, une lettre de sept pages au grand rabbin de France, Zadoc Kahn, lui demandant de la transmettre à Herzl.
Vous trouverez cette lettre, ainsi que la réponse de Theodor Herzl sur ce site <Correspondance 1899>. J’en cite quelques extraits. Voici d’abord l’introduction qui montre son empathie pour le peuple juif.
« Je me flatte de penser que je n’ai besoin de parler de mes sentiments vers Votre peuple. Tous ceux qui me connaissent savent bien, que je ne fais aucune distinction entre juifs, chrétiens et musulmans.
Je m’inspire toujours de la sublime parole de Votre Prophète Malachie, n’est-ce pas que nous avons un père commun à nous tous ? N’est-ce pas le même Dieu qui nous à créé tous ?
En ce qui concerne les israélites je prends cette parole au sens de la lettre, car, en dehors de ce que je les estime pour leurs hautes qualités morales et intellectuelles, je les considère vraiment comme parents à nous autres, arabes, pour nous ils sont des cousins, nous avons vraiment le même Père, Abraham, dont nous descendons également. […] Ce sont ces sentiments qui me mettent à l’aise pour Vous parler franchement de la grande question qui agite actuellement le peuple juif. Vous Vous doutez bien que je veux parler du Sionisme. »
Et, il écrit ensuite ce paragraphe que l’historien juif, Georges Bensoussan, relève dans son livre « Les origines du conflit israélo-arabe (1870-1950) » :
« L’idée en elle-même n’est que toute naturelle, belle et juste. Qui peut contester les droits des Juifs sur la Palestine ? Mon Dieu, historiquement c’est bien Votre pays ! Et quel spectacle merveilleux ça serait si les Juifs, si doués, étaient de nouveau reconstitués en une nation indépendante, respectée, heureuse, pouvant rendre à la pauvre humanité des services dans le domaine moral comme autrefois ! »
Yusuf Dia Khalidi exprime d’abord l’idée que le projet sioniste est voué à l’échec. L’Histoire lui a donné tort, l’État d’Israël a bel et bien vu le jour. Mais quand il écrivait cela, il ne pouvait imaginer une succession d’évènements au XXème siècle qui vont rendre possible ce qui semblait impossible : la Première guerre mondiale, la disparition de l’Empire ottoman, l’attitude ambigüe, perverse et colonisatrice britannique, la seconde guerre mondiale, la shoah. Cette succession d’horreurs et d’interventions délétères des États européens vont permettre, avec la volonté, l’action et l’organisation des juifs de Palestine, la réalisation de l’utopie sioniste :
« Malheureusement, les destinées des nations ne sont point gouvernées seulement par ces conceptions abstraites, si pures, si nobles qu’elles puissent être. Il faut compter avec la réalité, avec les faits acquis, avec la force, oui avec la force brutale des circonstances. […] J’ai été pendant dix ans maire de Jérusalem, et après député de cette ville au Parlement impérial et je le suis encore ; je travaille maintenant pour le bien de cette ville pour y amener de l’eau salubre. Je suis en état de Vous parler en connaissance de cause. Nous nous considérons nous Arabes et Turcs, comme gardiens des lieux également sacrés pour les trois religions, le judaïsme, la chrétienté et l’Islam. Eh bien, comment les meneurs du Sionisme peuvent-ils s’imaginer qu’ils parviendraient à arracher ces lieux sacrés aux deux autres religions qui sont l’immense majorité ? Quelles forces matérielles les juifs possèdent-ils pour imposer leur volonté eux qui sont 10 millions au plus, aux 350 millions des chrétiens et 300 millions des musulmans. Les Juifs possèdent certainement des capitaux et de l’intelligence. Mais si grande que soit la force de l’argent dans ce monde, on ne peut acheter tout à coups de millions. […] C’est donc une pure folie de la part de Dr. Herzl, que j’estime d’ailleurs comme homme et comme écrivain de talent, et comme vrai patriote juif, et de ses amis, de s’imaginer que, même s’il était possible d’obtenir le consentement de S.M. le Sultan, ils arriveraient un jour de s’emparer de la Palestine.»
Mais s’il s’est trompé dans sa première prédiction, il ne s’est pas trompé sur le fanatisme et le bain de sang que suivrait une telle réalisation. Il pensait que la plus grande haine viendrait des chrétiens, il a sous estimé la réaction des arabes musulmans de Palestine qui se sont sentis trahis, envahis, ignorés, dépossédés :
Mais je ne me croirais pas en droit d’intervenir si je ne prévoyais pas un grand danger de ce mouvement pour les israélites en Turquie et surtout en Palestine.
Certes, les Turcs et les Arabes sont généralement bien disposés envers Vos coreligionnaires. Cependant il y a parmi eux aussi des fanatiques, eux aussi, comme toutes les autres nations, même les plus civilisées, ne sont pas exemptes des sentiments de haine de race. En réalité, il y a en Palestine des Chrétiens fanatiques, surtout parmi les orthodoxes et les catholiques, qui considérant la Palestine comme devant appartenir à eux seulement, sont très jaloux des progrès des Juifs dans le pays de leurs ancêtres et ne laissent passer aucune occasion pour exciter la haine des musulmans contre les Juifs. Il y a lieu de craindre un mouvement populaire contre Vos coreligionnaires, malheureux depuis tant de siècles, qui leur serait fatal et que le gouvernement doué des meilleures dispositions du monde ne pourra étouffer facilement. C’est cette éventualité très possible qui me met la plume dans la main pour vous écrire. Il faut donc pour la tranquillité des Juifs en Turquie que le mouvement sioniste, dans le sens géographique du mot, cesse. Que l’on cherche un endroit quelque part pour la malheureuse nation juive, rien de plus juste et équitable. Mon Dieu, la terre est assez vaste, il y a encore des pays inhabités ou l’on pourrait placer les millions d’israélites pauvres, qui y deviendraient peut-être heureux et un jour constitueraient une nation. Ce serait peut-être la meilleure, la plus rationnelle solution de la question juive. Mais, au nom de Dieu, qu’on laisse tranquille la Palestine. »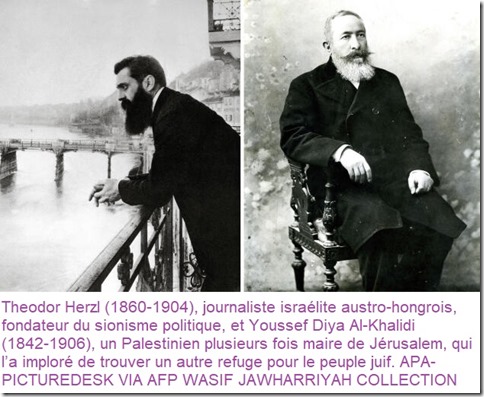 Theodor Herzl lui répondra avec diplomatie, sens de l’économie et en minimisant l’ambition sioniste en ce lieu. A sa décharge, lui aussi ne pouvait imaginer ce que la première moitié du XXème siècle allait bouleverser dans l’histoire de l’humanité et particulièrement de l’Europe :
Theodor Herzl lui répondra avec diplomatie, sens de l’économie et en minimisant l’ambition sioniste en ce lieu. A sa décharge, lui aussi ne pouvait imaginer ce que la première moitié du XXème siècle allait bouleverser dans l’histoire de l’humanité et particulièrement de l’Europe : « […] les Juifs n’ont aucune puissance belligérante derrière eux, et ils ne sont pas eux-mêmes de nature guerrière. C’est un élément tout à fait paisible, et très satisfaisant s’ils sont laissés en paix. Il n’y a donc absolument rien à craindre de leur immigration. […]
Vous voyez une autre difficulté, Excellence, dans l’existence de la population non-juive en Palestine. Mais qui penserait à les renvoyer ? C’est leur bien-être, leur richesse individuelle que nous augmenterons en y apportant la nôtre. Pensez-vous qu’un Arabe qui possède un terrain ou une maison en Palestine d’une valeur de trois ou quatre mille francs sera très fâché de voir le prix de sa terre augmenter en peu de temps, de la voir augmenter de cinq à dix fois en valeur peut-être en quelques mois ? D’ailleurs, cela se produira nécessairement avec l’arrivée des Juifs. C’est ce que la population indigène doit réaliser, qu’elle gagnera d’excellents frères comme le Sultan gagnera des sujets fidèles et bons qui feront prospérer cette province, cette province qui est leur patrie historique. »Je vous redonne le lien vers le site qui donne l’intégralité des lettres : <Correspondance 1899>. J’ai appris l’existence de cet échange par l’excellente série que Thomas Snégoroff a consacré à ce conflit « Six dates clés » et particulièrement la première émission avec l’historien Vincent Lemire : « 1897, l’utopie sioniste »
Bien sûr, ce ne seront pas les historiens qui trouveront les solutions de la Paix aujourd’hui. Mais ils permettent quand même de comprendre que ce territoire est celui de deux peuples et qu’il faut des hommes d’État qui soient capables de trouver les conditions de cohabitation des deux peuples dans l’honneur et la sécurité. Celles et ceux qui pensent qu’il est possible de vider ce territoire de l’autre peuple sont atteints de folie qui ne peut que faire perdurer le bain de sang.
<1800>
-
Jeudi 28 mars 2024
« Personne au monde ne veut de moi, nulle part. […] C’est l’unique raison pour laquelle je porte une arme, pour qu’ils ne me chassent pas d’ici aussi.»Amos Oz, « Une histoire d’amour et de ténèbres », page 450Comme je l’écrivais lundi, les humains aiment se raconter des histoires et développer des narratifs sur lesquels ils s’appuient pour réfléchir, décider et agir.
Cela se passe partout dans le monde, mais dans la partie du globe où sont nés les trois monothéismes c’est encore davantage le cas.
Alors, quand des illuminés des deux camps affirment que c’est leur Dieu qui leur a donné cette terre, la possibilité de la négociation et du compromis est très réduite.
Mais d’autres récits, un peu plus subtils, sont à l’œuvre.
Un des narratifs est celui de « l’anticolonialisme » qui consiste à prétendre que le sionisme serait un colonialisme.
Rappelons que le colonialisme est une idéologie qui consiste à étendre la souveraineté d’un État sur des territoires situés en dehors de ses frontières nationales afin d’y exercer une domination politique et une exploitation économique.
Le colonialisme européen qui s’est développé durant le XIXe siècle et la première moitié du XXème se présentait, en outre, sous l’idée d’une « mission civilisatrice » fondée sur la notion d’impérialisme.
Après les deux guerres mondiales, le principal moteur d’évolution de la politique internationale fut le mouvement de la décolonisation qui créa un très grand nombre d’États indépendants et la fin des empire coloniaux britanniques, français, néerlandais, belge et portugais.
Les mouvements anticoloniaux d’aujourd’hui luttent contre la survivance, dans les sociétés, d’une certaine pensée colonialiste et contre les conséquences du colonialisme.
Une parole attribuée à Einstein affirme :
« Celui qui a dans sa tête un marteau, donnera à chaque problème une forme de clou. »
Ce jeune homme très convaincu par cette cause explique « L’histoire coloniale derrière la guerre Israël-Palestine. »
Certaines de ses thèses apparaissent justifiées : Les peuples arabes du Moyen-Orient étaient bien dans un combat contre le colonialisme de l’Empire Ottoman. Les manœuvres britanniques et françaises pour obtenir un mandat de la SDN pour administrer ces territoires après la défaite ottomane, lors de la première guerre mondiale s’apparente à du colonialisme.
En revanche, pour que le sionisme soit un colonialisme, il faudrait que les juifs sionistes disposent d’une métropole, c’est-à-dire un « chez soi » permettant de se replier, si la colonisation se passe mal.
Pour les colons français en Algérie qui vivaient dans ce pays depuis plusieurs générations, la fin de la colonie signifiait pour eux le retour vers la France, non pas pays de leur enfance, mais de leurs aïeux. Même s’ils n’ont pas aimé cette solution, il existait cependant un État qui les accueillait. On pourrait même dire qui était obligé de les accueillir.
Rien de tel pour les juifs d’Israël.
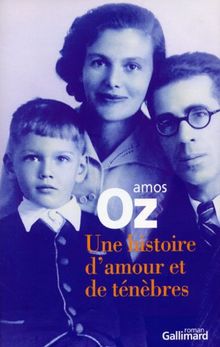 Amos Oz, l’écrivain israélien l’a remarquablement décrit dans son livre « Une histoire d’amour et de ténèbres » :
Amos Oz, l’écrivain israélien l’a remarquablement décrit dans son livre « Une histoire d’amour et de ténèbres » :« Personne au monde ne veut de moi, nulle part. La question est là. Il y a trop de gens comme moi. C’est l’unique raison pour laquelle je suis ici. C’est l’unique raison pour laquelle je porte une arme, pour qu’ils ne me chassent pas d’ici aussi. Mais je ne traiterai jamais d’«assassin» les Arabes qui ont perdu leur village. En tous cas, je ne le ferai pas à la légère. Les nazis, oui, Staline aussi. Et ceux qui s’approprient la terre d’autrui.
– Est-ce que ça s’applique à nous aussi ? Mais on vivait ici, il y a deux mille ans, n’est-ce pas ?
– C’est très simple : où se trouve la terre des juifs sinon ici ? Sous les mers ? Sur la lune ? A moins que les juifs soient les seuls au monde qui ne puissent avoir une petite patrie ?
– Et qu’est-ce qu’on leur a pris ?
– Et bien, tu as peut-être oublié qu’en 48 ils ont essayé de nous tuer tous ? En 48 il y a eu une guerre terrible, et ils se sont débrouillés pour que ça soit : eux ou nous. Et on a gagné et on le leur a pris. Il n’y a pas de quoi être fier ! Mais si c’était eux qui avaient gagné en 48, il y aurait encore moins de quoi être fier : ils n’auraient pas laissé un seul juif vivant. Et d’ailleurs, il n’y a pas un seul juif qui vive dans leur territoire aujourd’hui. La question est là : c’est parce que nous leur avons pris ce que nous leur avons pris en 1948, que nous avons ce que nous avons aujourd’hui. Et c’est parce que nous avons quelque chose maintenant que nous ne devons rien leur prendre de plus. C’est tout. Voilà la différence entre M. Begin et moi : si nous leur prenons plus un jour, maintenant que nous avons quelque chose, nous commettrons un très grave péché. »
Page 450 du livreLe livre est autobiographique et dans cet épisode le jeune Amos se trouve de garde dans son Kibboutz, en compagnie d’un homme plus âgé, Ephraïm Avneri, qui fut des premiers combats pour l’indépendance d’Israël.
Amos Oz compte dans sa famille de nombreux membres qui appartiennent au « sionisme révisionniste. » de Zeev Jabotinsky, un mouvement d’extrême droite qui entend faire parler la violence pour chasser les anglais et les arabes et imposer la suprématie juive sur le territoire de la Palestine mandataire.
C’est de cette mouvance que viennentt Menahem Begin et Bension Netanyahou, historien israélien et père de Benjamin Netanyahou, fut le secrétaire de Jabotinsky.
A la mort de Jabotinsky en 1940, Begin prend le relais et crée le parti politique Hérout qui deviendra plus tard le Likoud.
Avant l’échange avec Ephraim Avneri, Amos Oz aura , influencé par cette pensée révisionniste, dira :
« Personne ne parlait alors de « Palestiniens » : on les appelait « terroristes », « fedayin », « l’ennemi », ou « les réfugiés arabes avides de revanche ». »
Et puis il raconte cette garde qu’il va faire avec son ainé de 24 ans :
« Une nuit d’hiver au kibboutz, je m’étais retrouvé de garde en compagnie d’Ephraïm Avneri (moi 16 ans, lui 40). Je demandais à Ephraïm si, pendant la guerre d’Indépendance (48) ou les émeutes des années 30, il lui était arrivé de tirer ou de tuer un de ces assassins.
Je ne distinguais pas son visage dans le noir, mais je décelai une pointe d’ironie séditieuse, une curieuse tristesse sardonique dans sa voix quand il répondit, après un bref moment de réflexion :
– Des assassins ? Mais qu’aurais-tu voulu qu’ils fassent ? De leur point de vue, nous sommes des extra-terrestres qui avons envahi leur pays et le grignotons petit à petit, et tout en les assurant que nous sommes venus leur prodiguer des bienfaits, les guérir de la teigne ou du trachome, et les affranchir de l’arriération, l’ignorance et la féodalité, nous usurpons sournoisement leur terre. Ey bien, qu’est-ce que tu croyais ? Qu’ils allaient nous remercier ? Qu’ils nous accueilleraient en fanfare ? Qu’ils nous remettraient respectueusement les clés du pays sous prétexte que nos ancêtres y vivaient autrefois ? En quoi est-ce extraordinaire qu’ils aient pris les armes contre nous ? Et maintenant que nous les avons battus à plates coutures, et que des centaines de milliers d’entre eux vivent dans les camps, penses-tu vraiment qu’ils vont se réjouir avec nous et nous souhaiter bonne chance ?
J’étais sidéré. Bien qu’ayant pris mes distances avec l’idéologie du Hérout et de la famille, je n’en demeurais pas moins un pur produit de l’éducation sioniste. J’étais effaré et exaspéré par ce discours. A cette époque, cette manière de penser était considérée comme une trahison. De stupeur, je lui posais une question sarcastique :
– Dans ce cas, que fais-tu ici avec cette arme ? Pourquoi est-ce que tu ne quittes pas le pays ? Tu pourrais aussi prendre ton fusil et aller te battre avec eux ?
Je perçus son sourire triste dans l’obscurité :
– Avec eux ? Mais ils ne veulent pas de moi. Personne au monde ne veut de moi, nulle part… »Dans une dernière tentative d’essayer de mettre en échec la vision d’Ephraïm Avneri, il pose cette question :
« – Et si les fédaiyns débarquaient maintenant ?
– Dans ce cas, soupira Ephraïm, et bien il faudra nous aplatir dans la boue et tirer. Et on aura intérêt à tirer mieux et plus vite. Pas parce que ce sont des assassins, mais pour la simple raison que nous avons également le droit de vivre et d’avoir un pays à nous. Il n’y a pas qu’eux. »Amos Oz évoluera vers des positions de plus en plus à la gauche du spectre politique. Il sera un des fondateurs du mouvement « La Paix maintenant ».
Le sionisme n’est pas un colonialisme, mais un mouvement nationaliste visant à donner une terre aux juifs.
Mais la terre sur laquelle ils ont construit leur État est aussi celui d’un autre peuple qui vivait sur ce territoire : le peuple palestinien.
Lors du « mot du jour du 19 octobre 2015 » j’avais rapporté les propos de Dominique Moïsi qui analysait lucidement ce conflit :
« Parce qu’il y a un conflit de calendrier fondamental.
Quand Israël naît sur les fonts baptismaux de la communauté internationale en 1948, c’est au moment où commence le grand mouvement de décolonisation dans le monde. Pour le monde Arabe, c’est le dernier phénomène colonial de l’histoire européenne qui est anachronique.
Pour les Israéliens, c’est avec quelque retard, le dernier phénomène national de l’histoire européenne du 19ème siècle. Les Allemands ont un état, les Italiens ont un état.
Pourquoi pas les juifs ?
Et en fait ce conflit de calendrier n’a jamais été surmonté.
Dès le début, une immense majorité des arabes n’accepte pas que l’Europe paye ses péchés sur le dos des Palestiniens.
Et une grande partie des Israéliens a du mal à intégrer le fait qu’en réalité, il y a les Palestiniens sur ces territoires. (…) »Comprendre l’autre, pour pouvoir progresser et éviter de continuer à s’entretuer.
<1799>
-
Lundi 25 mars 2024
« L’espèce fabulatrice »Nancy HustonNous nous racontons des histoires.
Nous adorons nous raconter des histoires.
Un jour Moïse est passé à côté d’un buisson ardent, c’est-à-dire qui brulait sans se consumer et il a entendu une voix qui l’interpellait : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. ». Et sur la demande de cette voix, Moïse va rassembler le peuple des hébreux qui est esclave en Égypte et parvenir à convaincre le pharaon de laisser ce peuple partir d’Égypte. C’est ce qu’on lit dans le livre de l’Exode.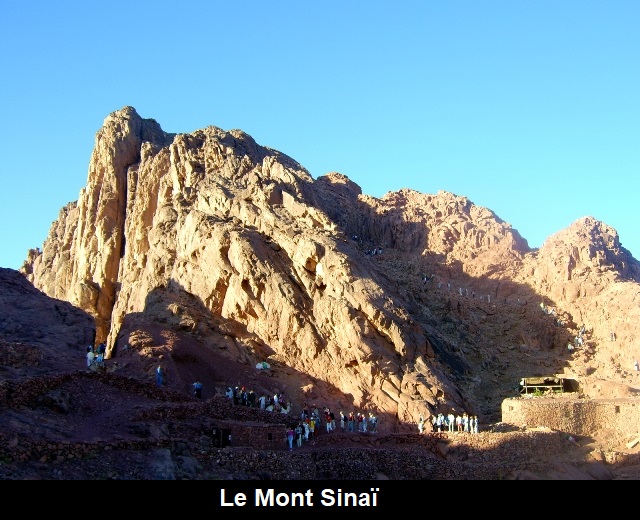 Plus tard, Moïse monte sur le mont Sinaï et reçoit les tables de la Loi de ce même Dieu. Et c’est ainsi que naît la religion qu’on appelle désormais la religion juive.
Plus tard, Moïse monte sur le mont Sinaï et reçoit les tables de la Loi de ce même Dieu. Et c’est ainsi que naît la religion qu’on appelle désormais la religion juive.
Est-ce qu’il existe un début de réalité dans ce récit ? Personne ne le sait, un grand nombre l’a cru et il en est encore qui le croit.
Pour ce récit, des hommes ont consacré quasi toutes les heures de leur vie à étudier, à essayer de comprendre, à écrire des livres, à s’obliger et obliger les autres à suivre avec rigueur des normes sociétales et aussi à faire la guerre.
Une autre histoire a été racontée plus tard : une femme du nom de Marie a enfanté un enfant mais sans avoir de relations sexuelles au préalable. Cet enfant de Galilée, Jésus, a par la suite, prêché, fait des miracles. Il est entré dans Jérusalem et a été accueilli par une foule qui agitait des rameaux en signe de bienvenue et quelques jours après, à la suite d’histoires de désordres et de trahisons, les romains l’ont arrêté et crucifié. Mais deux jours après sa tombe était vide. Certains de ses disciples disent qu’ils l’ont vu vivant, d’autres l’auraient vu mais ne l’ont pas reconnu immédiatement. Ses disciples racontent qu’il est ressuscité d’entre les morts et qu’au bout de quarante jours il a fait une ascension qui pourrait faire penser qu’un vaisseau spatial extra-terrestre l’a emmené. Le récit ne parle pas d’extra-terrestre mais d’une montée vers dieu sans passer par la mort. A partir de ce moment-là, les disciples vont attendre fébrilement son retour, ils appelleront cela l’attente du royaume. Mais au bout de l’attente, ne voyant pas venir le royaume, ils ont créé l’Église. Il y a eu par la suite une rencontre particulièrement féconde avec un empereur romain, Constantin qui dans le cadre d’une guerre civile a trouvé judicieux de raconter, à son tour, une histoire qui disait que c’est avec cette croyance qu’il a pu vaincre son adversaire pour régner sur l’Empire.
Ce récit correspond-il a des faits qui ont vraiment eu lieu ? Personne ne le sait, un grand nombre l’a cru et il en est encore qui le croit.
Michel Onfray prétend que Jésus n’a pas existé. Selon mes lectures, la plupart des historiens pensent plutôt qu’il a existé. Pour le reste nous sommes dans la croyance. Il y a un point qui est historiquement certain : Par l’action de Constantin et de ses successeurs, la religion chrétienne est devenue la religion de l’empire romain. Et c’est ainsi que les persécutés allait bientôt devenir les persécuteurs.
Là encore, des humains allaient consacrer toute leur vie pour suivre et illustrer ce récit. Pour ce récit, ils vont encore construire des cathédrales, des couvents, créer des œuvres musicales et graphiques, mettre en place des œuvres de charité, des hôpitaux, mais aussi faire la guerre, enfermer, torturer, brûler vif celles et ceux que les autorités de l’Église accusaient ne pas suivre les règles de cet autre récit ou narratif.
Il y a une troisième histoire qui s’est passée en Arabie, entre La Mecque et Médine, un homme a raconté avoir rencontré un être spirituel qui lui a expliqué qu’il existait un Dieu unique et qu’il fallait suivre un certain nombre de règles et de principes pour lui être agréable et pouvoir bénéficier de ses faveurs notamment après la mort. C’est une histoire plus récente, mieux documentée. Sa part de vérité n’est pas davantage certaine, un grand nombre le croit encore.En outre, il y a des interprétations. Les membres du Hamas prétendent que la terre de Palestine leur a été donné par Allah. L’Histoire, qui n’est pas croyance mais la science des historiens, nous apprend plutôt que ce sont des armées musulmanes qui ont vaincu dans des combats meurtriers les troupes de l’empire byzantin, appelé aussi empire romain d’orient, notamment lors de la bataille de Yarmouk (2 août 636) en Syrie. Dans le narratif musulman, c’est bien sûr Allah qui a permis ces victoires militaires et humaines. Ce qui est étonnant, si l’on donne crédit à cette hypothèse, c’est ce que ce narratif n’admet pas que si l’armée israélienne a battu les armées arabes, lors des différentes guerres depuis 1948, c’était parce que Allah, qui peut tout, le voulait ainsi…
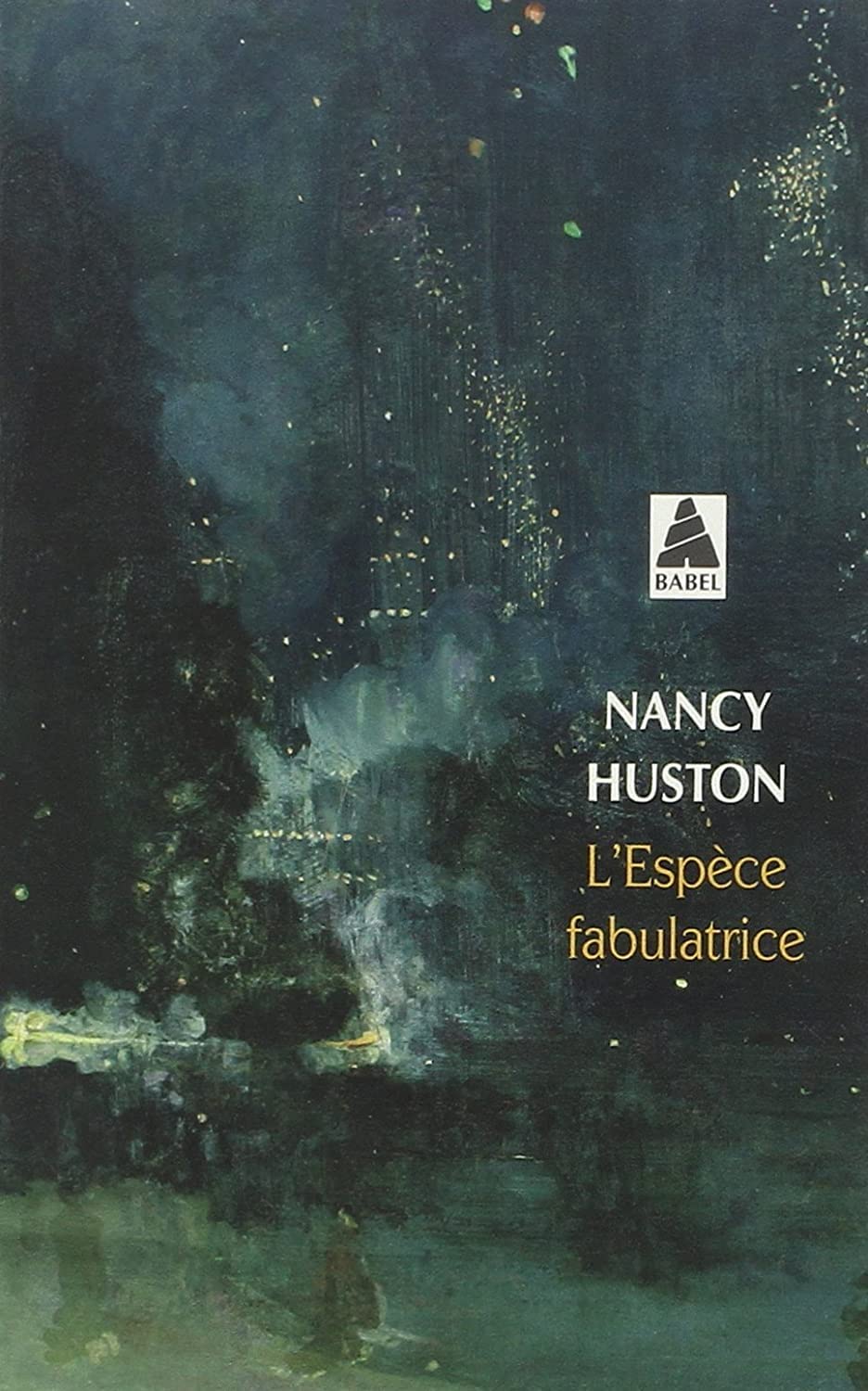 Nancy Huston explique que notre espèce homo sapiens est fabulatrice, donc raconte des fables, pour <les raisons suivantes>
Nancy Huston explique que notre espèce homo sapiens est fabulatrice, donc raconte des fables, pour <les raisons suivantes>
« [Homo sapiens] invente des histoires et construit des mythes en raison de sa fragilité.À la différence de tous les primates supérieurs, l’être humain naît prématurément, plusieurs mois avant terme. S’il naissait à terme, vu le gigantisme de son crâne (dû à la taille exceptionnelle du cerveau chez Homo sapiens) et la minceur du bassin de la mère (due à la station debout adoptée par Homo sapiens), tous les accouchements seraient fatals : pour la mère, l’enfant ou les deux. Ce qui engendrerait, en quelques décennies, la fin de notre espèce. Quant au bébé humain, il doit être aidé, protégé et éduqué pendant de longues années avant de pouvoir se débrouiller seul. Enfin, notre vulnérabilité par rapport aux autres espèces qui nous entourent (presque pas de griffes, de crocs ou de poils […] nous oblige à nous lier entre nous pour la survie de notre espèce. »
C’est une thèse que Yuval Noah Harari, après d’autres, a largement développé dans son œuvre « Sapiens » : Le récit permet de fédérer un grand nombre d’humains qui ne se connaissent pas en dépassant largement le cercle du clan et de la famille, pour réaliser un groupe très fort. Homo sapiens est devenu ainsi l’espèce dominante alors que, seul, homo sapiens était moins fort que plusieurs autres espèces.
Une autre fragilité de notre espèce est qu’elle a conscience de sa finitude, que chaque individu va mourir. Raconter un récit rassurant qui donne une perspective après ce passage inéluctable, permet de calmer un peu les angoisses de la vie, surtout vers la fin.
Celui qui se trouve devant le corps sans vie d’un être aimé, ne peut se résoudre à ce que cela se termine ainsi. Attraper le récit religieux qui donne sens à ce moment, devient tentant et agit tel un baume réparateur en y ajoutant un espoir de se retrouver.
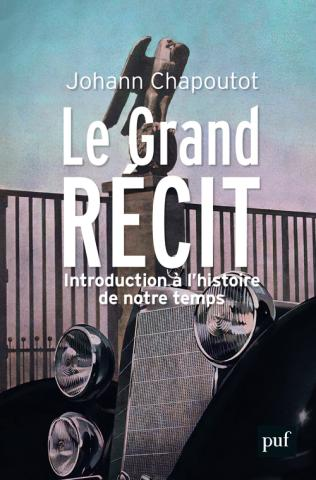 Johann Chapoutot, dans son livre « Le grand récit » parle de ces narratifs religieux et y ajoute des religions sans dieu qui promettait aussi des avenirs radieux, comme le « communisme », le « fascisme », le « nazisme ». C’était encore des narratifs qui voulaient expliquer et donner un sens à l’Histoire. Au bout de la croyance, de beaucoup de sacrifices un avenir radieux était promis, mais sur terre.
Johann Chapoutot, dans son livre « Le grand récit » parle de ces narratifs religieux et y ajoute des religions sans dieu qui promettait aussi des avenirs radieux, comme le « communisme », le « fascisme », le « nazisme ». C’était encore des narratifs qui voulaient expliquer et donner un sens à l’Histoire. Au bout de la croyance, de beaucoup de sacrifices un avenir radieux était promis, mais sur terre.
Johann Chapoutot ne dépasse pas l’horizon occidental. Or il y a aussi des narratifs dans d’autres civilisations confucéennes, bouddhistes, Hindouistes et encore bien d’autres.
Et Johann Chapoutot évoque le philosophe Jean-François Lyotard qui considère que la structuration de la société par les grands récits est désormais remplacée par une fragmentation des récits qui se centre davantage sur l’individu.
Et, selon Chapoutot, on voit l’émergence de nouveaux récits qui structurent notre vision du monde. Ils servent à se cartographier à se repérer et à lire le réel présent pour essayer de lui donner sens : on peut parler de la pensée anticoloniale, woke, des théories du genre.
Ce qui me semble essentiel de comprendre, c’est qu’en étant inspiré de ces récits globaux ou fragmentés, on va appliquer le filtre de ce narratif à la réalité et ainsi totalement modifier la perception des faits et des évènements analysés.
Quand vous observez la guerre à Gaza avec le filtre religieux, ou le filtre anticolonialiste vous changez totalement votre perception des faits, vous écoutez certaines sources et restez sourds à d’autres qui sont en dehors de votre narratif.
Ce que je pense avoir compris c’est que ce narratif est partout. Prenez l’exemple d’un couple qui se défait, rarement les deux protagonistes racontent la même chose. Certains parleront d’un ressenti différent en essayant d’expliquer ou de trouver des raisons au conflit. Mais à la fin, cela conduit inéluctablement à deux narratifs différents qui s’opposent.
Notre société, nos valeurs, notre manière d’agir se basent énormément sur le narratif de la méritocratie. J’ai déjà consacré une série sur ce sujet : <La méritocratie>. C’est un récit essentiel qui assure un ordre assez apaisé à la société : mon sort est la conséquence de mon mérite. Comme la plupart des histoires, ce n’est pas totalement faux : on réussit mieux si on fait beaucoup d’efforts. Mais les études sociologiques et économiques sont suffisamment nombreuses désormais pour constater que la réussite sociale est étroitement corrélée au statut social des parents. Vous êtes très riches parce que vos parents étaient très riches, vous êtes pauvres parce que vos parents étaient pauvres et puis… il y a quelques exceptions qui constituent des alibis du narratif.
Aujourd’hui, nous sommes mêmes rentrés dans un nouveau stade celui des faits alternatifs qu’il est possible d’exprimer ainsi : à chacun ses faits. Les électeurs de Trump et les électeurs de Biden ont chacun leur version des faits, je crains qu’en France les mêmes clivages soient présents.
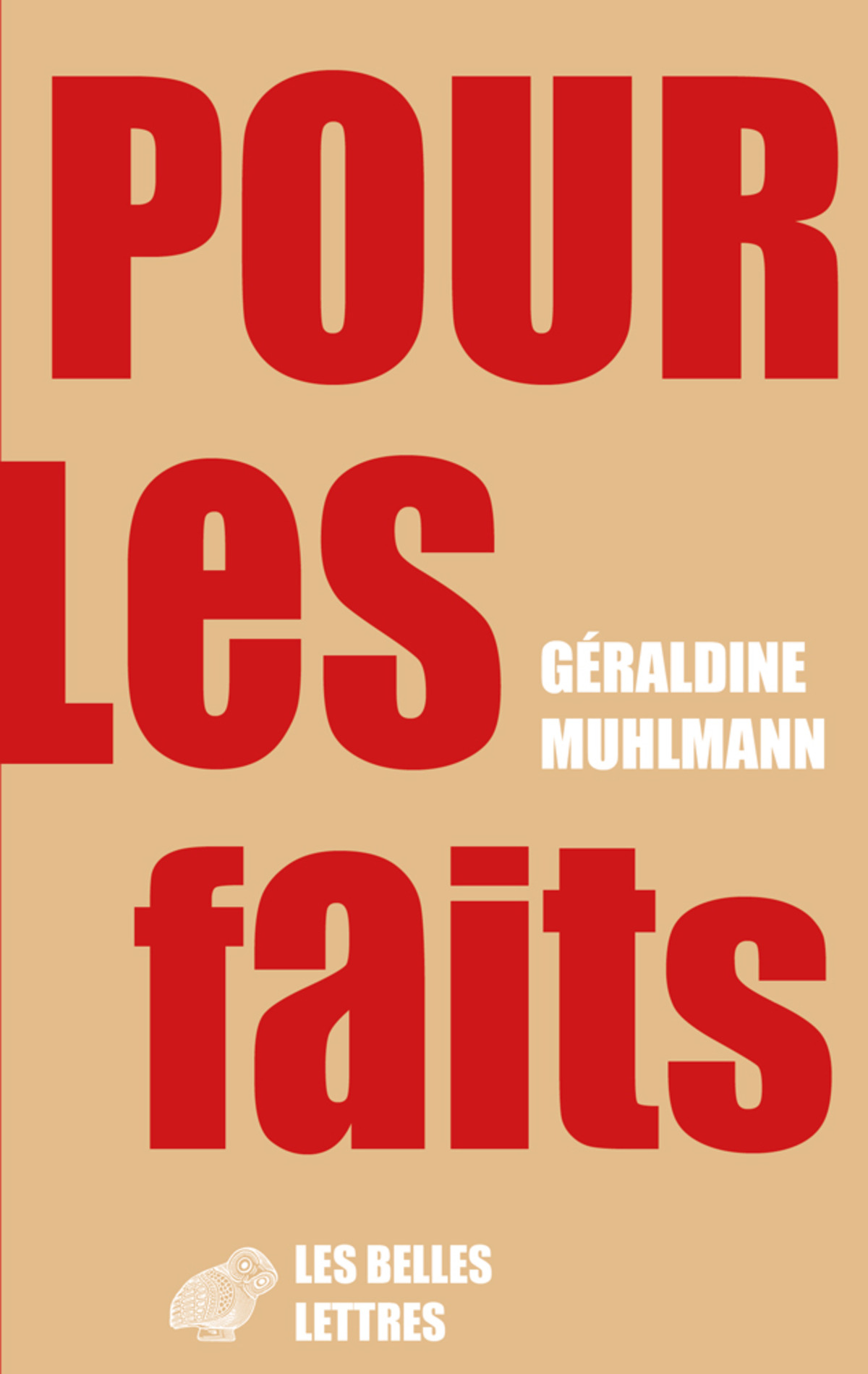 Géraldine Muhlmann, agrégée de Philosophie et productrice de l’émission « Avec philosophie » sur France Culture, a écrit un livre inquiet sur ce sujet : « Pour les faits »
Géraldine Muhlmann, agrégée de Philosophie et productrice de l’émission « Avec philosophie » sur France Culture, a écrit un livre inquiet sur ce sujet : « Pour les faits »
Elle a répondu à une interview dans Ouest-France « Qu’on s’engueule d’accord mais qu’on parle des même faits ! »
Elle cite Charles Péguy, à l’aube de la Première Guerre mondiale :« Il faut toujours dire ce que l’on voit : surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit. »
Et Géraldine Muhlmann plaide qu’on en revienne aux récits des faits.
C’est ce qu’elle développe avec Johann Chapoutot et Tristan Mendès France dans une émission de France Inter de Novembre 2023 « La guerre des récits » largement consacré à la guerre de Gaza.
Peut-être certains seront-ils surpris de ce lien que j’établis entre les grands récits, les récits fragmentés et finalement les faits alternatifs ?
Chacun de ces narratifs, rassurants pour celles et ceux qui les croient, vont contribuer à raconter le monde, non à tenter de le comprendre.
Ils vont écarter certains faits, donner de l’importance à d’autres, en modifier certains pour rester cohérent avec leur narratif.
Ce sont ces dynamiques, dans leurs trois dimensions, grands récits, récits fractionnés, faits alternatifs qui sont à l’œuvre dans le conflit de Palestine, en Ukraine et sur bien d’autres terrains.
<1798>
-
Lundi 11 mars 2024
« C’est vous qui avez fait cela ? »Otto Abetz et Pablo PicassoC’est un échange connu ou, au moins, raconté entre l’ambassadeur allemand à Paris, Otto Abetz et Pablo Picasso devant une photo de la Toile « Guernica » de l’artiste.
L’ambassadeur demande à Picasso :
« C’est vous qui avez fait cela ? », l’artiste a répondu : « Non… vous »
Et, il y a plus de 2 000 000 d’habitants.
Ils vivent dans les gravats, la saleté.
Avoir de l’eau potable, avoir de la nourriture est un problème incommensurable chaque jour.
D’un côté comme de l’autre, on utilise des mots : « pogrom », « génocide ». Des mots venant de l’Histoire, qui rappellent d’autre moments, d’autres faits.
Pour faire réagir, pour essayer d’expliquer le désastre, le chaos.
Faire en sorte que le monde réagisse en faveur du camp défendu.
Je ne crois pas que cela soit la bonne méthode.
Peut-on simplement dire les faits ?
Les membres du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre, ils ont tué 1160 personnes, en majorité des civils et ont emmené 250 otages.
Ce furent des massacres, filmés par les assaillants eux-mêmes et diffusés sur les réseaux en forme de propagande.
La violence fut extrême, les viols assez systématiques.
En face, l’armée d’Israël a réagi tardivement. Elle n’a pas anticipé l’attaque
<Des observatrices de l’armée> avaient pourtant informé leurs supérieurs que des choses bizarres se passaient du côté de Gaza. Elles n’ont pas été entendues.
Les troupes qui devaient défendre Israël du côté de Gaza étaient réduites à la portion congrue.
D’abord, parce qu’une partie de ces troupes étaient mobilisée en Cisjordanie, Judée-Samarie disent beaucoup d’israéliens. Elles étaient mobilisées pour défendre les israéliens qui se sont installés sur ces territoires qu’ils considèrent aujourd’hui comme leur pays historique, mais qui avaient été attribués aux arabes dans le plan de partage de l’ONU de 1947.
Cette présence juive sur une terre qui devait former une partie essentielle de l’État arabe de Palestine est contraire au Droit International.
Mais les implantations juives sont de plus en plus importantes et sont évidemment rejetées par la partie Palestinienne d’où le besoin de présence de l’armée pour protéger les citoyens juifs et éviter les désordres.
Ensuite, une partie plus importante de soldats que d’habitude avaient eu le droit de retourner dans leur famille pour des fêtes religieuses après que le gouvernement ait cédé à des lobbys religieux qui demandaient cette évolution.
Ces deux faits : la non anticipation et la présence réduite de forces de défenses ont facilité l’attaque du Hamas et l’ampleur du désastre.
La gravité des massacres sur le territoire israélien et le sort des otages a créé un traumatisme du côté de la population d’Israël qui a exigé et soutenu une action massive contre le Hamas pour punir et empêcher que de tels évènements se reproduisent.
 Et c’est ainsi que les bombardements et l’attaque de l’armée d’Israël sur Gaza ont commencé.
Et c’est ainsi que les bombardements et l’attaque de l’armée d’Israël sur Gaza ont commencé.
Nous sommes ce lundi au 157ème jour de guerre.
Israël a beaucoup détruit, rendant le territoire de Gaza invivable.
Mais aucun des principaux chefs du Hamas n’a pu être neutralisé. Le Hamas n’est pas détruit et continue à agir.
Les habitants de Gaza sont prisonniers sur leur territoire.
Leurs conditions de vie sont terrifiantes.
Je lis régulièrement « Times of Israël » qui donne le point de vue d’israéliens.
Il n’y a aucune information concernant la situation humanitaire, de famine, de chaos, d’urgence sanitaire et d’accès à l’eau de la population de Gaza.
Du côté arabe, notamment d’Al Jazeera, l’ampleur et la barbarie des massacres du 7 octobre sont parallèlement édulcorées.
L’État Hébreu limite aussi le renouvellement des visas des humanitaires pouvant apporter l’aide à Gaza.
On peut lire dans l’Obs : « A Gaza, la famine est devenue une arme de guerre »
« Presque aucune aide n’atteint le Nord, où des enfants commencent à mourir de faim. […]
A l’hôpital Kamal Adwan, le seul hôpital pédiatrique du nord de la bande de Gaza, près de Beit Lahia, une quinzaine d’enfants sont morts de faim depuis le début du mois de mars. Les médecins, débordés, voient chaque jour des mères affamées mendier du lait pour leurs bébés. Très peu nourries pendant leur grossesse, ces femmes ne parviennent plus à allaiter leurs nouveau-nés et sont contraintes de les nourrir d’une à deux dattes écrasées par jour. […]
C’est dans le Nord de Gaza, ravagé par les bombes, désormais sous contrôle militaire israélien et où vivent encore 300 à 500 000 Gazaouis, que la situation est la plus désespérée. « Les terres n’y sont pas cultivables, les puits sont pourris, on y boit de l’eau saumâtre. Les Gazaouis sont prisonniers et crèvent de faim », relate Jean-François Corty, médecin et vice-président de Médecins du Monde. ».
Il y a aussi ce billet de Guillaume Erner sur France Culture <La famine organisée dans la bande de Gaza>
Il parle de son oncle Dov qui vit en Israël et qui a presque 100 ans. Il avait émigré en Israël après la Shoah.
Guillaume Erner le décrit ainsi :
« Dov a été un militant inlassable de la paix, d’une solution à deux États. Il est devenu artiste, grand artiste. »
Et il finit son billet par ces mots :
« Et c’est pourquoi, en voyant ce visage d’enfant Gazaoui émacié, décrit comme étant en train de mourir de faim, je me suis dit que Dov n’avait jamais voulu cela, que ces images insupportables allaient doublement le hanter, comme homme, mais aussi comme rescapé. Si cette image d’un enfant à Gaza est vraie, et rien n’indique aujourd’hui qu’elle soit fausse, alors l’Israël que voulait Dov est un Israël à l’agonie, car rien ne justifie bien sûr cette famine. Famine organisée, une famine que même les États-Unis ne parviennent pas à rompre. Si cet enfant Gazaoui meurt, c’est avec lui une certaine conception d’Israël qui va disparaître. »
Devant ce désastre, on va poser la question : « C’est vous qui avez fait cela ? »
Le « Vous » c’est le Hamas, le Hamas qui garde les otages, qui a pris l’initiative de cette guerre en sachant que les gazaouis deviendraient les victimes de la réaction d’Israël meurtri. Mais pour eux les victimes ne sont pas des humains qui souffrent mais des martyrs qui aident leur cause.
Mais aujourd’hui le « Vous » c’est aussi le gouvernement d’Israël et son bras prolongé l’armée d’Israël qui s’obstine dans une stratégie.
Le peuple de la Shoah peut-il assumer ce qui se passe sur cette petite enclave, prison de 2000 000 d’habitants qui meurent de faim, de soif et de manque de soins ?
C’est vous qui avez fait cela ?
<1797>
-
Mercredi 6 mars 2024
« Mais cette loi (sur l’IVG) on la doit aussi à un homme Valéry Giscard d’Estaing »Simone VeilPour une fois, la France a réalisé un progrès sociétal avant tous les autres : inscrire la liberté des femmes à interrompre une grossesse dans sa loi fondamentale.
Le Chili l’avait tenté lors de la rédaction de sa nouvelle constitution qui devait remplacer celle qui avait été mise en place sous la dictature du sinistre Augusto Pinochet. Mais par deux fois, cette tentative de nouvelle constitution a été rejetée par les électeurs chiliens en 2023. Par voie de conséquence, la disposition concernant l’avortement n’a pas pu entrer en vigueur.
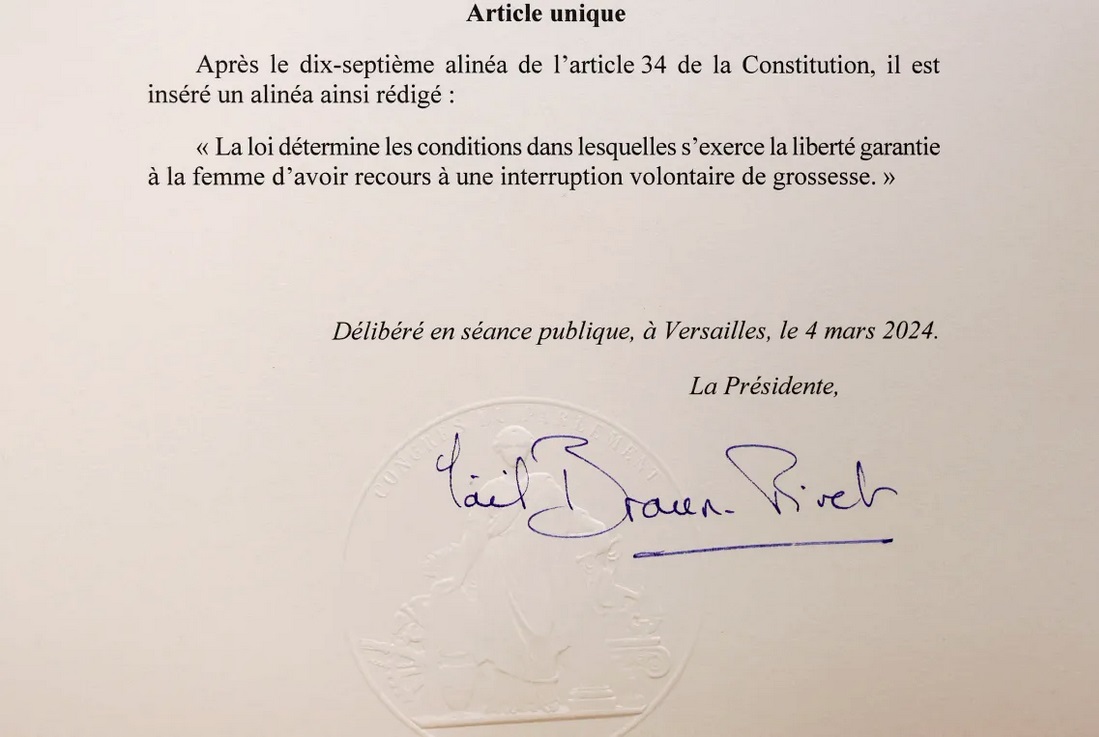 C’est donc la France qui dans l’article 34 de sa Constitution a proclamé :
C’est donc la France qui dans l’article 34 de sa Constitution a proclamé :
« La liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse »
Il fallait après le vote positif sur le même texte par l’Assemblée Nationale et le Sénat, que les deux assemblées réunies en Congrès votent la modification à la majorité des 3/5ème
La majorité des 3/5ème représentait 60,1 % des exprimés, le résultat du 4 mars 2024, fut de 91,5% pour l’adoption de la réforme de la constitution.
<L’église catholique a protesté> contre cette expression de la souveraineté d’un pays laïc.
Cette protestation est-elle légitime ?
Je ne le crois pas.
Dans un billet flamboyant <Sophia Aram> a cité un extrait d’une homélie de Michel Aupetit, archevêque de Paris :
« Satan déteste la vie, toute la culture de mort, de l’avortement à l’euthanasie en passant par la destruction d’embryons surnuméraires et la réduction embryonnaire est son œuvre à lui Satan »
C’est sa croyance, c’est son récit. Il a le droit de le croire. Des hommes et des femmes peuvent librement adhérer à ce récit. Ils seront alors catholiques. Et Monsieur Aupetit comme Monsieur Jorge Mario Bergoglio, responsable de cette église peuvent légitimement dire à celles qui adhérent au même récit qu’eux que si elles veulent suivre l’enseignement de cette église, elles ne devraient pas avorter.
Mais l’un comme l’autre n’a rien à dire aux représentants légitimes du Peuple français qui décident quelle est la Loi de la France et quelle est la Constitution de la France.
Il me semble que nous devons reprendre le flambeau de nos libérateurs de la troisième république pour stopper la prétention revigorée des religieux de tout bord, de vouloir imposer leurs croyances, leurs tabous et leurs interdits à la République française qui n’est soumis à aucun Dieu, mais à la volonté du Peuple souverain.
Mais la raison principale de ce mot du jour est autre.
J’aime la vérité historique et quand des faits sont établis clairement, les rappeler.
Pendant cette réforme, seule Simone Veil a été évoquée pour rappeler son rôle dans la loi de 1975 qui n’était pas une loi pour le droit à l’avortement mais une loi qui dépénalisait l’interruption volontaire de grossesse.
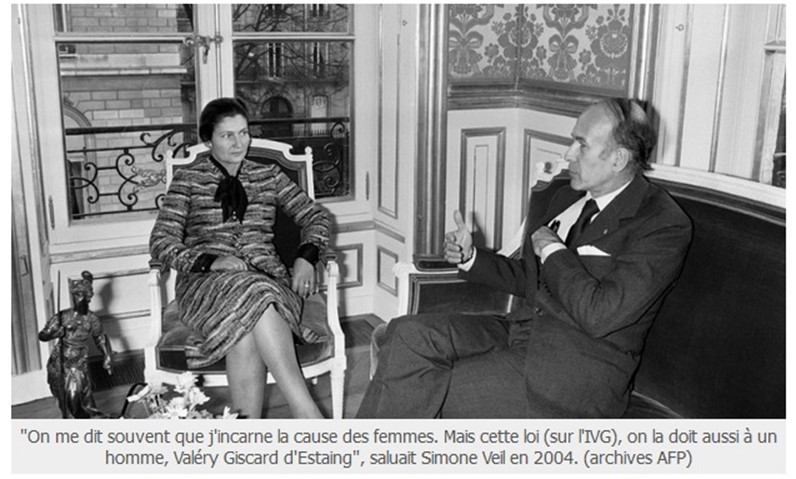 Comme le disait Simone Veil elle-même :
Comme le disait Simone Veil elle-même :
« Mais cette loi (sur l’IVG) on la doit aussi à un homme Valéry Giscard d’Estaing »
J’avais expliqué le rôle de Giscard d’Estaing et le hasard que ce soit Simone Veil qui porta cette réforme : « Mémoire et Histoire du droit à l’avortement »
J’ai beaucoup d’admiration et d’affection pour Simone Veil. Je l’ai écrit dans plusieurs mots du jour.
Rien de tel à l’égard de Valéry Giscard d’Estaing.
Mais c’est lui, alors que sa Foi et son milieu familial et politique s’opposaient à cette évolution, qui à l’écoute de l’évolution de la Société et de l’injustice commise à l’égard des femmes qui n’avaient pas les moyens d’aller à l’étranger avorter dans des conditions sanitaires sécurisées, a promis, lors de la campagne présidentielle de 1974, de réaliser cette réforme s’il était élu président de la république.
Il a agi en homme d’État, contre la majorité qui l’avait élu. D’ailleurs, à l’Assemblée Nationale sa majorité présidentielle vota contre la Loi. On lit dans Wikipedia :
« Après quelque vingt-cinq heures de débats animés par 74 orateurs, la loi est finalement adoptée par l’Assemblée le 29 novembre 1974 à 3 h 40 du matin par 284 voix contre 189, grâce à la quasi-totalité des votes des députés des partis de la gauche et du centre, et malgré l’opposition de la majeure partie – mais pas de la totalité des députés de la droite, […] dont est pourtant issu le gouvernement dont fait partie Simone Veil. »
Valéry Giscard d’Estaing est mort deux jours après Anne Sylvestre le 2 décembre 2020, des suites du COVID19, à 94 ans.
Je ne lui avais pas rendu hommage alors parce que j’ai consacré ce moment à Anne Sylvestre.
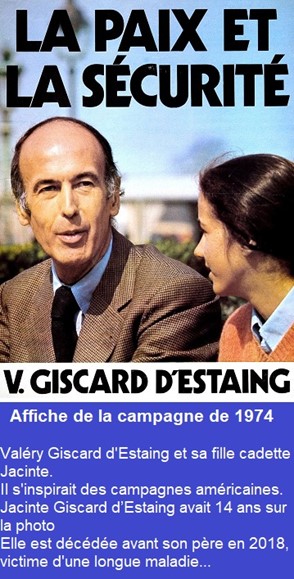 Car, il mérite qu’on lui rende hommage : il a modernisé la France et réalisé plusieurs évolutions majeures, souvent contre l’avis des groupes politiques qui le soutenaient.
Car, il mérite qu’on lui rende hommage : il a modernisé la France et réalisé plusieurs évolutions majeures, souvent contre l’avis des groupes politiques qui le soutenaient.
Ainsi il a demandé au parlement d’abaisser l’âge de la majorité. Ce fut une loi du 5 juillet 1974 qui abaissa la majorité à 18 ans alors qu’elle était fixée à 21 ans pour tous depuis 1907 (25 ans auparavant pour les hommes). Cette mesure avait alors permis à près de 2,4 millions de Français concernés d’accéder au droit de vote. Au Royaume-Uni, la mesure était déjà en vigueur depuis 1970, et depuis 1969 en Allemagne.
Il est probable que sa défaite de 1981 contre Mitterrand fut en grande partie causée par cette évolution. Je ne dispose pas du vote au second tour des électeurs de 18 à 21 ans. Mais de celui des électeurs de 18 à 24 ans et ils votèrent à 63% pour Mitterrand et à 37% pour Giscard d’Estaing.
Valéry Giscard d’Estaing, lors de cette campagne de 1981, refusa la proposition de ses conseillers qui voulaient révéler les rapports troubles de Mitterrand avec le Régime de Vichy et la décoration de la francisque par Pétain. Il rejeta cela parce qu’il trouvait ces méthodes indignes d’une campagne présidentielle.
C’est aussi dans la première année de son mandat, par la loi du 4 décembre 1974, qui comporte plusieurs dispositions relatives à la régulation des naissances, que fut acté le remboursement de la pilule par la Sécurité sociale. Par cette Loi, la contraception devient « un droit individuel », avec la possibilité de délivrer une contraception aux mineures sans limite d’âge et sans autorisation parentale.
C’est encore sous le mandat de Valéry Giscard d’Estaing qu’est adoptée la loi du 11 juillet 1975 introduisant la notion de « consentement mutuel » dans le divorce. Les demandes devaient être auparavant motivées par une faute commise par l’un des deux époux. « Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n’ont pas à en faire connaître la cause », explique le nouveau texte. « Ils doivent seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences. »
Il y eut également cette évolution majeure de nos institutions par la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 qui donne aux parlementaires (60 députés ou sénateurs) la possibilité de contester la constitutionnalité d’une loi. Auparavant, seuls le président de la République, le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Cette évolution permettra enfin de vérifier que les projets de Loi du gouvernement sont conformes à la Constitution.
Et puis il y eut des épisodes moins glorieux, mais ils n’ont pas la place dans ce mot du jour qui se veut un hommage à un homme qui avait certes des défauts, mais qui avait aussi sa part de lumière que j’ai essayé de mettre en avant aujourd’hui.
Pour en revenir à l’évolution législative concernant l’avortement, c’est sous la présidence de François Mitterrand, en 1982, que la Loi Yvette Roudy, complétant la Loi Simone Veil, ordonnera le remboursement de l’IVG par la Sécurité Sociale.
Lors du vote du Congrès, il y eut aussi cette intervention pleine de sens et d’émotion de Claude Malhuret dont j’admire souvent l’intelligence et la qualité des interventions : « Je reverrai le visage de cette jeune femme dont la vie et celle de son bébé ont été anéanties lorsque j’irai voter. »
<1796>
-
Lundi 26 février 2024
« Pour résister, il faudrait une armée d’adultes ! »Judith GodrècheNous ne sommes pas sortis de la pédophilie, de l’inceste, de la violence faite aux femmes et aux enfants.
Le mot du jour a souvent parlé de ces sujets, en montrant combien ces crimes sont incroyablement nombreux et ont été odieusement banalisés.
Aujourd’hui c’est Judith Godrèche qui occupe le devant de la scène.
Je l’ai écoutée sur France Inter <Je n’ai jamais été attirée par Benoît Jacquot mais j’ai été son enfant femme>
Elle raconte, l’emprise, la violence, les coups, la peur à la journaliste Sonia Devillers dont j’ai apprécié la qualité d’écoute et la sensibilité pour accompagner ce témoignage avec dignité et douceur.
Interrogé par Le Monde, Benoît Jacquot nie l’ensemble des accusations. Il insiste sur le caractère « amoureux » de cette relation longue.
Et puis, il y eut aussi Jacques Doillon.
Elle a exprimé une parole forte aux César 2024 : <Je parle mais je ne vous entends pas>
La rentrée littéraire fut marquée par un livre remarquable de Neige Sinno : « Triste Tigre », dans lequel elle raconte son inceste subi entre l’âge de 4 à 7 ans.
Entre temps, il y eut les accusations nombreuses et cohérentes contre Gérard Depardieu et aussi Gérard Miller pour des viols et des violences faites aux femmes. Dans le monde du journalisme il y a PPDA
J’ai écouté le témoignage d’Anouk Grinbert, <Depardieu est comme ça parce que tout le monde lui permet d’être comme ça>
L’émission <L’Esprit Public> du 25 février est revenue, de manière plus globale, sur ces sujets : <Metoo du cinéma : le procès d’une époque ?> en soulignant notamment le caractère symbolique du cinéma :
« Le 7ème art a aussi une responsabilité particulière en ceci qu’il véhicule les stéréotypes, comme celui de la jeune fille sexy qui séduit les hommes bien plus âgés qu’elle. »
Ce sont souvent des actes qui ont été commis au vu et au su de beaucoup de monde.
Des parents, des adultes, des femmes et des hommes étaient là !
Ils n’ont rien dit, rien fait, ils n’ont rien empêché.
Dans l’interview avec Sonia Devillers, Judith Godrèche exprime cette supplique :
« Pour empêcher cela il aurait fallu une armée d’adultes. Pour résister il faudrait une armée d’adultes. »
Alors, on peut se lancer dans de multiples analyses sur le patriarcat, sur la libération des mœurs de mai 68 qui a été délétère sur certains points pour les femmes et les enfants.
Aujourd’hui j’en resterai uniquement sur ce point-là : « il faut une armée d’adultes ».
Des adultes qui connaissent la Loi et qui empêchent quand un homme qu’ils connaissent et qu’ils voient ne s’empêche pas.
On en revient à ces mots du père d’Albert Camus : « Non, un homme ça s’empêche. Voilà ce qu’est un homme, ou sinon… »
Albert Einstein, n’a pas toujours été un modèle de vertu et d’éthique, mais il a écrit une phrase très juste :
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.
Albert Einstein Comment je vois le monde (1934)
Des adultes qui protègent les enfants !
Mais aussi des adultes qui protègent d’autres adultes quand ce qu’ils voient, entendent ou savent n’est pas acceptable.
Encore faut-il être clair dans sa tête sur ces sujets.
Aussi, je partage aujourd’hui une initiative du département de Seine Saint Denis reprise par la maison de l’égalité homme femme de Grenoble et qui tente d’évaluer les violences à l’intérieur d’un couple : <Le violentomètre>
Cet outil utilise un code couleur Vert, Orange et Rouge qui qualifie des comportements.
Le vert, correspond à des attitudes qualifiées de saine, comme par exemple : « le partenaire accepte tes décisions et tes goûts »
L’orange correspond à une situation dans laquelle il faut être vigilant et dire Stop, par exemple : « le partenaire rabaisse tes opinions et tes projets »
Pour le rouge qui est le dernier stade, il faut se protéger, demander de l’aide car il y a danger par exemple « Pète les plombs lorsque quelque chose lui déplait ».
Je ne reproduis pas ici cette échelle que vous trouverez derrière ce lien : <Le violentomètre>
Des adultes ce sont des humains qui posent des limites et avant tout qui se posent des limites à eux-mêmes.
<1795>
-
Vendredi 23 février 2024
« Merci pour toutes ces heures d’écoute. »Clémentine Lecalot-VergnaudClémentine Vergnaud est morte le 23 décembre 2023, après un an et demi de lutte, à l’âge de 31 ans, des suites d’un cancer des voies biliaires.
J’en ai parlé deux fois déjà.
Le 22 juin 2023 : « La mort est au bout du chemin, mais elle s’est un peu éloignée. ». C’était au moment de la publication de la série de 10 podcasts dans lesquels elle décrivait son combat, ses espoirs, sa peur et ses relations avec les médecins et l’administration.
Le 27 décembre 2023 : « 18 mois de vie. » au moment de son décès.
Ce troisième article est motivé par la publication de 6 nouveaux podcasts, les 6 derniers qu’elle a enregistrés et dans lesquels elle raconte ses dernières semaines, son mariage à l’hôpital, et le moment où elle a compris que la maladie avait toujours un coup d’avance et qu’il fallait pour elle, lâcher prise, vivre ses derniers jours avec le plus d’intensité et de saveur possible, tout en reconnaissant la peur devant l’inconnu.
Elle raconte sa peur :
« Comme l’autre soir, alors que j’étais censée me reposer, juste récupérer sur mon lit, et où c’est monté.
Et j’avais mon papa en face de moi, assis sur sa chaise, qui attendait que je me repose.
Et j’ai su lui dire, juste : papa, j’ai peur.
Et il n’a rien fait d’incroyable, il est juste venu près de moi, il a pris ma main et il a dit : « Moi aussi j’ai peur ». Ce n’était pas grand-chose, mais sa main, ma main dans la sienne, et juste savoir qu’il était là, qu’il entendait, qu’il comprenait que je puisse avoir peur, que lui aussi partageait ça…
C’est peu de chose, mais il y a des fois où juste se libérer de cette émotion, juste la dire, la formuler, rien que ça, c’est salvateur.
Et de savoir que les autres sont à côté, qu’ils comprennent ou qu’ils ne comprennent pas, mais en tout cas de lire dans leur regard ou dans leurs gestes qu’ils seront là quoi qu’il arrive, c’est quelque chose qui fait énormément de bien. »
Elle avait vécu d’espoir, la thérapie ciblée qui lui avait été proposée semblait pleine de promesse. Mais elle a provoqué comme effet collatéral un « takotsubo » : appelé aussi syndrome du cœur brisé, proche des symptômes d’un infarctus. La lutte contre le cancer aboutissait à ce que le cœur lâche. Elle bénéficiera d’une autre thérapie, une chimiothérapie qui aura aussi des effets collatéraux désastreux.
Souvent l’émotion déchire le témoignage, ces 6 émissions constituent une leçon de vie dans ce qu’elle a de plus profond, de plus humain.
- <11 La soupe à la grimace>
- <12 Le cœur en chamade>
- <13 Nous nous sommes aimés>
- <14 Compagnons des mauvais jours>
- <15 Toujours un coup d’avance>
- <16 L’expérience d’une vie>
Il faut être prêt à écouter et à entrer dans ce témoignage poignant.
Pour ma part, j’ai été bouleversé, mais aussi rempli de force et d’intelligence pour vivre ce qui doit être vécu en restant pleinement humain et lucide, jusqu’au bout du chemin.
Elle a terminé ces 6 émissions par ces mots :
« La maladie m’a forcément changée. Je ne suis plus la même personne.
Je dirais que je suis à la fois plus enjouée, plus reconnaissante des petits moments, ces petits moments dorés dont on parlait, qu’on peut peut-être laisser filer quand on n’est pas malade.
Et qu’on n’a pas conscience du caractère ténu de ce fil de la vie. […]. Et en même temps, il y a toujours eu cette espèce d’ombre qui plane au-dessus et qui m’a enlevée toute mon insouciance […]
Je pense aussi que ça m’a rendu une part de joie de vivre parce qu’on a quand même beaucoup rigolé dans toutes ces épreuves, souvent. […].
Et puis l’envie de donner, beaucoup, l’envie de donner aux autres et notamment au travers du podcast. Je m’en suis rendue compte par les répercussions qu’il a eu : je pouvais donner énormément de choses aux gens en ayant l’impression d’en faire peu, finalement.
[…] Si j’ai pu aider au moins une personne avec ce podcast, moi, je suis mille fois heureuse parce que quand on est malade, on subit beaucoup.
Et ça m’a rendu tellement de pouvoir sur tout ça. De prise. De possibilités de faire. D’être dans l’agir, d’être là pour les autres.
C’était vraiment, je crois, l’expérience à faire dans cette maladie, l’expérience d’une vie.
Merci pour toutes ces heures d’écoute. Merci pour ça. »
« Merci pour toutes ces heures d’écoute », ces remerciements que Clémentine Vergnaud adresse à celles et ceux qui l’ont écoutée, peuvent aussi bien être renvoyés vers elle, sous la forme d’une immense gratitude que l’on peut exprimer pour ce qu’elle a su donner à celles et ceux qui ont eu la capacité de recevoir son témoignage et sa leçon de vie et de partage.
Son compagnon et mari, Grégoire Lecalot, a été l’invité de France 5 pour raconter sa part dans cette histoire tragique et lumineuse. <le podcast bouleversant de Clémentine>
Il parait juste aussi de citer Samuel Aslanoff qui a co-produit et réalisé cette série de 16 podcasts au total.
<1794>
- <11 La soupe à la grimace>
-
Lundi 19 février 2024
« Si cela se produit, s’ils décident de me tuer, N’abandonnez pas ! »Alexei NavalnyC’est dans un documentaire Navalny, sorti en 2022, que le cinéaste Daniel Roher avait interrogé l’opposant, juste avant son départ pour Moscou, sur la possibilité qu’il soit tué en prison.
Alexeï Navalny, comme très souvent souriant, avait répondu par un message à ses concitoyens :
« N’abandonnez pas. Si cela se produit, s’ils décident de me tuer »
 En 2020 il avait été empoisonné par l’utilisation d’un agent neurotoxique de type Novitchok, arme favorite des services secrets russes. Il avait réchappé à l’empoisonnement après avoir pu être hospitalisé dans un hôpital de Berlin et grâce à l’intervention de médecins allemands.
En 2020 il avait été empoisonné par l’utilisation d’un agent neurotoxique de type Novitchok, arme favorite des services secrets russes. Il avait réchappé à l’empoisonnement après avoir pu être hospitalisé dans un hôpital de Berlin et grâce à l’intervention de médecins allemands.
Le 17 janvier 2021 il a voulu retourner en Russie, en ayant la conviction que malgré les risques, il ne pouvait appeler à la résistance ses concitoyens s’il ne se trouvait pas sur le territoire russe, partageant avec eux le combat contre Poutine et sa clique.
C’est avant son départ qu’il a prononcé ces mots.
Dès son arrivée à Moscou, il fut immédiatement arrêté, condamné pour des motifs d’une vacuité indescriptible : « extrémisme », « escroquerie », « outrage au tribunal » et « fraude aux dons ».
Dans un parcours pénitentiaire de plus en plus rude, il est transféré en décembre 2023, dans la colonie pénitentiaire n°3, surnommée « Loup polaire » de la localité de Kharp, dans l’Arctique russe. On est au-delà du cercle polaire : certaines nuits, la température peut atteindre les -30 ° Celsius.
Le service fédéral de l’exécution des peines a annoncé la mort d’Alexeï Navalny, vendredi 16 février, à 47 ans, dans la prison du Grand Nord russe où il purgeait une peine de dix-neuf ans d’incarcération.
Depuis son arrestation à son retour en Russie, il a été envoyé vingt-sept fois au mitard, pour les prétextes les plus fallacieux : « a mal boutonné son uniforme » ; « n’a pas mis ses mains derrière le dos en marchant » ; « a cité une décision de la Cour européenne des droits de l’homme » ; « a mal nettoyé la cour »…
 Au mitard, il partageait fréquemment sa cellule avec un prisonnier fou et non lavé, qui hurlait toute la journée. Alexeï Navalny se plaignait aussi de devoir écouter, jour après jour, de longues rediffusions des discours de Vladimir Poutine.
Au mitard, il partageait fréquemment sa cellule avec un prisonnier fou et non lavé, qui hurlait toute la journée. Alexeï Navalny se plaignait aussi de devoir écouter, jour après jour, de longues rediffusions des discours de Vladimir Poutine.
Est-il mort assassiné brutalement ou est-il mort d’épuisement, on ne le sait pas ?
Il avait sa part d’ombre, il a commencé sa carrière politique en tant que nationaliste belliqueux ayant des propos scandaleux à l’égard des tchétchènes.
Mais par la suite il a engagé un bras de fer avec Poutine et ses sbires, dénonçant leurs crimes contre la démocratie et la liberté ainsi que et leur corruption généralisée, en la démontrant de manière explicite.
Grand orateur, il souriait et maniait l’humour jusque dans le dernier moment où il a été vu, trois jours avant sa mort, dans une énième confrontation avec un juge. Il était devenu le symbole de la liberté et de l’opposition à Poutine.
Vous pouvez écouter l’émission de Christine Ockrent qui lui a été consacrée ce samedi 17 février : < Russie : le martyre de Navalny >
Il y a aussi ces articles « du Monde » :
<Navalny meurt en emmenant avec lui « les derniers espoirs » d’une Russie libre>
<Alexeï Navalny, de l’engagement au sacrifice>
Il semble utile aussi de s’intéresser à cette affaire qui a conduit la filiale russe de l’entreprise française Yves Rocher à attaquer Navalny et son frère, en justice, sur des accusations mensongères pour complaire au gouvernement : <Procès Navalny : Yves Rocher, une plainte au service du pouvoir>
Toutes les personnes qui en France ou en Europe manifestent la moindre complaisance à ce tyran sanguinaire qu’est Poutine, ne pourront plus se cacher : l’homme qu’ils traitaient avec bienveillance, est un monstre.
Alexei Navalny était un homme courageux et qui menait un noble combat.
Ces choses sont claires et dites.
Mais je ne souhaite pas m’arrêter là.
Le 26 septembre 2022, Vladimir Poutine a accordé la citoyenneté russe à Edouard Snowden, pour lui permettre d’échapper à la justice ou plutôt la vindicte des États-Unis.
 Ce n’était pas le premier choix du lanceur d’alerte. Dès 2013, il avait demandé l’asile politique à la France présidée par François Hollande. Le 16 septembre 2019, Snowden avait réitéré son souhait d’être accueilli par la France. Le 19 septembre 2019, jour de la sortie en France de son autobiographie « Mémoires vives », sa demande était de nouveau rejetée, le ministère des Affaires étrangères indiquant n’avoir « pas changé d’avis » et lui refusant l’asile.
Ce n’était pas le premier choix du lanceur d’alerte. Dès 2013, il avait demandé l’asile politique à la France présidée par François Hollande. Le 16 septembre 2019, Snowden avait réitéré son souhait d’être accueilli par la France. Le 19 septembre 2019, jour de la sortie en France de son autobiographie « Mémoires vives », sa demande était de nouveau rejetée, le ministère des Affaires étrangères indiquant n’avoir « pas changé d’avis » et lui refusant l’asile.
Quel est le crime d’Edouard Snowden ?
Edward Joseph Snowden, né le 21 juin 1983 en Caroline du Nord a révélé l’existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques.
À compter du 6 juin 2013, Snowden rend publiques, par l’intermédiaire des médias, des informations classées top-secrètes de la NSA concernant la captation des données de connexion des appels téléphoniques aux États-Unis, ainsi que les systèmes d’écoute sur Internet des programmes de surveillance.
Le 14 avril 2014, l’édition américaine du Guardian et le Washington Post se voient décerner le prix Pulitzer pour la publication des révélations de Snowden sur le système de surveillance de la NSA, rendues possibles grâce aux documents qu’il leur a fournis.
Quand Snowden quitte les États-Unis, en mai 2013, à 29 ans, après la perte d’un emploi qui lui assurait une vie confortable, il explique :
« Je suis prêt à sacrifier tout cela parce que je ne peux, en mon âme et conscience, laisser le gouvernement américain détruire la vie privée, la liberté d’Internet et les libertés essentielles des gens du monde entier avec cet énorme système de surveillance qu’il est en train de bâtir secrètement »
Quelques voix se sont cependant élevées pour défendre Snowden et dire la vérité « crue » : les manœuvres illégales commises par Snowden sont négligeables devant l’intérêt de ses révélations qui démontrent que la « grande » démocratie américaine, donneuse de leçons au monde entier, écoute massivement les citoyens et les dirigeants des pays alliés et cela même davantage pour des motifs économiques que pour des motifs de sureté nationale. Aggravant ainsi leur faute contre la démocratie et la liberté.
Ainsi, le 10 juin 2014, l’ancien vice-président Al Gore indique qu’Edward Snowden a « rendu un important service », en « révélant le viol de lois importantes, dont des violations de la Constitution des États-Unis », ce qui était « bien plus sérieux que les crimes qu’il a commis »
Mais rien n’y fait, Les États-Unis ne renoncent pas aux poursuites et les pays occidentaux comme la France se rangent délibérément dans le camp des ennemis de la liberté, faisant à la Russie de Poutine le cadeau d’apparaître comme un pseudo défenseur des droits proclamés par les occidentaux.
Cela n’enlève rien à l’ignominie du maître du Kremlin qui n’agit ainsi que pour s’opposer aux occidentaux.
Mais nous [l’Occident] ne sommes décidément pas le camp du bien.
Vous pouvez avoir d’amples informations sur la < Page Wikipedia > qui lui est consacrée.
On peut encore citer le cas de Julian Assange qui est informaticien, journaliste et lanceur d’alerte australien. Il est fondateur, rédacteur en chef et porte-parole de WikiLeaks qui font des révélations sur la manière dont les États-Unis et leurs alliés mènent la guerre en Irak et en Afghanistan,
Il dispose aussi d’une < Page wikipedia >qui relate les différentes étapes de sa vie qui l’ont amené dans une prison de haute sécurité du Royaume-Uni dans l’attente de son extradition aux États-Unis où il risque plus de 170 années de prison.
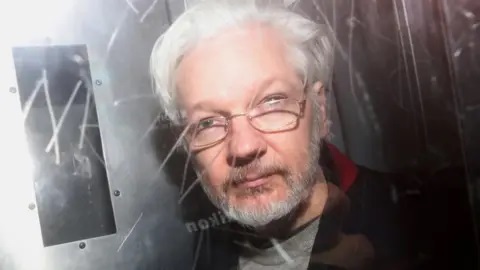 On y lit notamment :
On y lit notamment :
« Assange est soumis à un isolement strict en principe réservé aux terroristes internationaux, alors qu’il est journaliste en détention provisoire. Il est maintenu 23 heures par jour dans un isolement total et ne dispose que de 45 minutes par jour de promenade dans une cour revêtue de béton. WikiLeaks affirme que la détention d’Assange ternit la réputation de défenseur de la liberté de la presse du Royaume-Uni. Quand il quitte sa cellule, « tous les couloirs par lesquels il passe sont évacués et toutes les portes des cellules sont fermées pour éviter tout contact avec les autres détenus »
Dans un état de santé précaire, ses amis et proches craignent pour sa vie.
Je voulais parler aujourd’hui d’Alexei Navalny et du comportement criminel des autorités russes qui ont conduit à sa mort.
Mais que dire, pour les cas d’Edward Snowden et de Julien Assange, des autorités de l’État qui les poursuivent et de la complicité des autres États occidentaux qui laissent faire ou participent à cet acharnement contre les lanceurs d’alerte ?
La voix des occidentaux devient de plus en plus faible aux oreilles du reste du monde, en raison de nos manquements immenses aux valeurs que nous proclamons.
<1793>
-
Mardi 13 février 2024
« Israël est né d’une angoisse de mort comme aucun peuple n’en a connue à ses origines. »Robert BadinterRobert Badinter a vécu les horreurs de l’antisémitisme. :
Il se définissait comme « républicain, laïque et juif », c’est ce qu’a rappelé Richard Zelmati, lors de la <commémoration> de la rafle du 12 de la rue Sainte-Catherine à Lyon, en bas des pentes de la Croix Rousse.
Cette rafle a eu lieu le 9 février 1943. Parmi les 86 personnes arrêtées, il y avait Simon Badinter le père de Robert Badinter.
Le destin a voulu que Robert Badinter soit décédé 81 ans, jour pour jour, après l’arrestation de son père à Lyon.
<Le Mémorial de la Shoah> précise :
« C’est un piège que les nazis tendent au 12 de la rue Sainte-Catherine, siège de la Fédération des sociétés juives de France et du comité́ d’assistance aux refugies, réunis au sein de l’Union générale des israélites de France. La Gestapo attend plusieurs heures sur place pour arrêter le maximum de personnes, employés et personnes qui se présentent dans les locaux.
D’abord emprisonné au Fort Lamothe, le groupe est transféré́ au camp de Drancy le 12 février. Sur place, se trouvent notamment les victimes de la rafle du département de la Seine des 10 et 11 février, opérée par la police française à l’initiative des autorités allemandes. Il s’agit pour beaucoup de personnes âgées et d’enfants accueillis dans des foyers et des hospices, notamment ceux de la fondation Rothschild.
Sur les 86 Juifs raflés à Lyon, 80 sont déportés dans les camps d’Auschwitz-Birkenau, Sobibor et Bergen-Belsen. Le plus jeune a 13 ans. Parmi eux figure Simon Badinter, le père de Robert Badinter.
En 1945, il demeure 4 survivants. »
Le père de Robert Badinter, mourra à 47 ans, dans le camp d’extermination de Sobibor
Robert Badinter fut toujours en première ligne dans le combat contre l’antisémitisme et le négationnisme.
Israël était important pour lui, comme un refuge protecteur des juifs. Mais il considérait toujours qu’Israël devait, pour sa sureté, accepter un état palestinien à côté de lui.
J’ai retrouvé un article dans lequel il expliquait la psychologie de la majorité des juifs israéliens de manière qui m’a paru très pénétrante.
J’ajoute tout de suite qu’il ne parle pas de la minorité des messianiques qui poursuivent une vision religieuse délirante du destin d’Israël et qui, au même titre que le Hamas, sont des propagandistes de la haine et du chaos.
Le Monde avait publié le 20 août 2001 cet article : <L’angoisse et la paix par Robert Badinter>
Il réagissait après un attentat anti-israélien dans une pizzeria, au cœur de Jérusalem, dans lequel 3 enfants de 14 ans, 4 ans, 2 ans avaient été tués avec leurs parents
Robert Badinter écrivait :
« Nul ne saurait demeurer indifférent aux morts et aux souffrances du peuple palestinien. Pour ma part, je souhaite depuis longtemps qu’il connaisse une vie paisible dans un Etat indépendant. »
Et puis il a ajouté cela sur Israël, les juifs et les palestiniens :
« Juif du XXe siècle ayant traversé, jeune adolescent, les ténèbres de la guerre et de l’Occupation, j’ai vu naître, au travers d’épreuves inouïes, l’Etat d’Israël. Il en va des peuples comme des humains.
Les premiers jours de leur vie et ceux qui précèdent leur naissance sont lourds de conséquences pour leur sensibilité et leur avenir.
Or Israël est le fruit de la plus tragique histoire. Les peuples arabes rappellent avec raison qu’ils ne portent pas la responsabilité de la Shoah. Ce crime sans pareil contre l’humanité s’inscrit en lettres de sang dans l’histoire européenne. Dès l’origine, le projet sioniste a pris corps parce que dans les premières décennies du 20e siècle l’antisémitisme n’avait cessé de régner en Europe jusqu’à l’apocalypse nazie.
Les vagues d’immigrants en Palestine depuis le début du 20e siècle succèdent aux persécutions. Le « foyer juif » promis par Lord Balfour pendant la première guerre mondiale répond à cette aspiration d’un peuple si éprouvé à trouver, sur la terre dont les écritures disent qu’elle lui fut promise, un refuge, un lieu de paix et d’enracinement.
On sait ce qu’il advint de cette promesse d’un « foyer juif » du temps du mandat britannique.
Sur la terre de Palestine, les immigrants en petit nombre rencontrèrent l’hostilité de ceux qui s’y étaient établis avant eux. A croire que seuls les juifs n’avaient pas le droit de vivre en Terre sainte !
Après la guerre, lorsque les survivants de la Shoah se comptèrent, l’élan fut irrésistible qui poussa les plus engagés d’entre eux vers la Palestine. Si les autorités anglaises s’y opposèrent, c’est d’abord parce que les peuples arabes de la région ne voulaient pas d’un Etat hébreu parmi eux. On a trop oublié dans quelles conditions fut arrachée la reconnaissance de l’Etat d’Israël, là où d’ailleurs n’avait jamais existé d’Etat palestinien. Cet Etat hébreu était l’expression non pas de l’impérialisme colonial, comme certains le disent aujourd’hui, mais de la tragique condition qu’avait souffert à travers les siècles un peuple dispersé et toujours persécuté. Israël est né de la Shoah. Il ne faut jamais l’oublier. Non parce que les Israéliens ou les juifs seraient devenus des créanciers moraux du monde jusqu’à la fin des temps. Mais parce qu’on ne peut rien comprendre à l’Israël d’aujourd’hui si on ne prend pas en compte cette vérité : Israël est né d’une angoisse de mort comme aucun peuple n’en a connue à ses origines.
Or cette angoisse-là, elle ne l’a jamais quitté. Il faut rappeler à ceux qui aujourd’hui mettent l’accent sur les exactions et les crimes commis par les activistes sionistes lors de la guerre de 1948 que, dès la proclamation de l’Etat d’Israël, toutes les puissances arabes, ses voisins, ont proclamé la guerre sainte et juré sa destruction. Si le sort des armes n’en avait pas décidé autrement, si les Israéliens avaient succombé sous le nombre et le poids de leurs ennemis coalisés, il n’y aurait jamais eu d’Etat d’Israël.
Après un demi-siècle écoulé et tant de campagnes victorieuses, les Israéliens demeurent convaincus en majorité que les peuples arabes autour d’eux veulent en définitive l’anéantissement de l’Etat d’Israël. Sentiment absurde, disent les esprits raisonnables. Tsahal est la première armée de la région. Israël jouit de l’appui inconditionnel des Etats-Unis, superpuissance du monde et gardien ultime de l’ordre international. Aucune menace sérieuse ne pèse donc sur l’avenir d’Israël, hormis son impuissance à résoudre le problème palestinien.
Mais là est précisément le cœur du problème. La plupart des Israéliens sont prêts aux plus importantes concessions pour obtenir une paix réelle pour eux et leurs enfants. Mais la paix n’est acquise réellement que lorsque les adversaires ont renoncé en eux-mêmes à la volonté d’abattre l’autre. La seule paix durable, c’est celle du cœur et de l’esprit. A défaut, il n’y a que des armistices entre deux guerres.
Or cette paix-là, cette paix spirituelle sans laquelle rien ne sera acquis au Proche-Orient, nombre d’Israéliens aujourd’hui demeurent convaincus qu’elle est hors de leur portée. A lire les manuels d’histoire palestiniens, à écouter les discours à usage interne des leaders, à entendre les cris de haine des plus violents d’entre eux, les Israéliens ressentent que c’est bien la destruction d’Israël que leurs adversaires veulent.
Rien ne leur paraît, à cet égard, avoir changé depuis l’époque où les chefs des Etats arabes s’unissaient pour envahir et détruire le minuscule Etat qui venait de naître. A ce sentiment-là, chaque attentat terroriste donne une intensité nouvelle. La mort des victimes, au-delà de la souffrance des parents, résonne dans tout Israël comme le glas de l’espérance de paix. Elle fait renaître cette angoisse existentielle qui n’a jamais cessé depuis la naissance d’Israël, enfant des pogromes et de la Shoah. A quoi bon rendre les territoires, abandonner les colonies de peuplement, reconnaître à Jérusalem-Est le statut de capitale de l’Etat palestinien, indemniser les réfugiés palestiniens, à quoi bon tant de concessions et de renoncements si l’on n’atteint pas le but : la paix, la vraie paix, celle des âmes.
Le recours à la force qui assure le statu quo permet au moins de rassurer pour un moment les esprits. Jusqu’au prochain attentat, jusqu’au prochain mort. La douleur renaît alors, et la colère, et la fureur. Et la riposte vient qui sème à son tour la mort de l’autre côté, en attendant la prochaine bombe de kamikaze qui lui fera écho.
Devant pareil désastre, les hommes de paix s’interrogent sur les moyens de mettre un terme à cette violence toujours sanglante, toujours stérile. Mais tous les efforts demeureront vains s’ils ne prennent pas en compte cette donnée psychologique essentielle : le sentiment angoissé des Israéliens qu’en définitive, pour leurs ennemis, tout accord n’est qu’une étape vers la réalisation de leur objectif ultime : la destruction d’Israël.
Sans doute il incombe aux Israéliens de mettre un terme, sans différer, aux souffrances et aux humiliations subies par les Palestiniens. Mais il appartient à ceux-ci et à leurs alliés de mesurer enfin que, aussi longtemps que demeurera vivant au cœur des Israéliens la conviction que leurs adversaires veulent la mort de l’Etat hébreu, rien ne sera possible.
Au moment décisif, l’homme d’Etat sait que c’est à l’imagination et au cœur qu’il faut s’adresser pour donner à l’histoire un cours nouveau. Le génie de Sadate fut de l’avoir un jour compris. Son exemple, hélas, paraît aujourd’hui oublié. »
Robert Badinter présente l’Histoire de ce conflit du point de vue d’Israël.
Comme toujours, il trouve les mots justes pour décrire très précisément les sentiments et les peurs du côté israélien de cette tragédie.
« Challenges » lui avait rendu visite après le 7 octobre 2023.
Le journaliste Maurice Szafran résume cet entretien, sur ce sujet du 7 octobre et de la suite de la manière suivante :
« Jusqu’à ce pogrom du 7 octobre 2023. « Une monstruosité, évidemment, relève-t-il. Mais il s’est aussi produit un événement capital : Israël devait être le pays du « plus jamais ça », protéger, ce devait être son rôle historique. Et là, Israël a échoué dans sa mission ».
Robert Badinter critique rudement Benyamin Netanyahou — comment pourrait-il d’ailleurs en aller autrement, lui qui a pour référence et « compagnons » Itzhak Rabin et Shimon, Peres, lui qui a toujours défendu la solution à deux états, lui qui estime que « la sécurité des Israéliens passe par l’émancipation des Palestiniens ». « Netanyahou, ajoute-t-il sans même qu’il soit nécessaire de lui poser la question, est un danger pour les Israéliens, un danger pour les libertés publiques, un danger pour la démocratie. Heureusement une partie du peuple s’était soulevée avant le 7 octobre. Il y a pire encore : des partis ouvertement racistes qui « font » la majorité parlementaire, des ministres favorables à l’expulsion des Palestiniens… C’est invraisemblable ». Il dit : « je suis inquiet pour Israël ». Comme un voile de tristesse sur son visage. »
Lucide, pleinement engagé pour la sécurité d’Israël dans la paix, il me semble que lire Robert Badinter permet d’améliorer notre compréhension de cette tragédie.
<1792>
-
Lundi 12 février 2024
« [Son travail] témoigne, mieux que tous les discours, que l’on ne doit jamais désespérer des hommes. »Robert Badinter, avant-propos à l’édition de la thèse de Philippe MauriceBien sûr, il faut honorer la mémoire de cet humaniste que la France a eu la chance de compter dans ses rangs : Robert Badinter.
Il semble légitime d’écrire qu’il est mort de vieillesse à 95 ans, le 9 février 2024.
Au cours du week-end, les médias ont rappelé son histoire et ses combats nombreux, toujours pour défendre l’honneur et la dignité de la personne humaine.
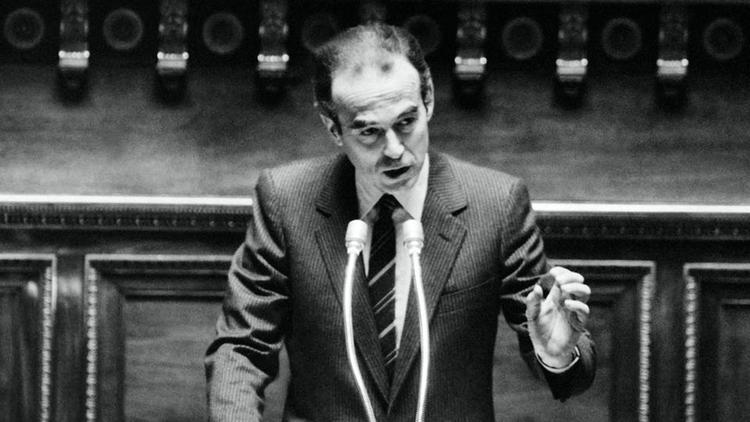 Son grand combat, fut l’abolition de la peine de mort en France.
Son grand combat, fut l’abolition de la peine de mort en France.
Les gens de ma génération se souviennent de ce discours qu’il prononça le 17 septembre 1981 à l’Assemblée Nationale.
<Discours> qui commença par ces mots
« J’ai l’honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l’Assemblée nationale l’abolition de la peine de mort en France. »
Un peu plus loin, il disait :
« La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l’esclavage, ce crime qui déshonore encore l’humanité.
Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d’efforts courageux, l’un des derniers pays, presque le dernier – et je baisse la voix pour le dire – en Europe occidentale dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort.
Pourquoi ce retard ? Voilà la première question qui se pose à nous. »
En 2016, lors d’une commémoration de cette abolition, Robert Badinter avait eu ce mot dans les matins de France Culture :
« La France n’est pas le pays des droits de l’Homme, elle n’est que le pays de la déclaration des droits de l’Homme »
J’en fis le mot du jour du <21 octobre 2016>
Outre, qu’il rappela qu’il n’est jamais apparu que l’existence de la peine de mot eut un effet significatif sur le nombre de crimes de sang, il expliqua les deux raisons fondamentales qui, selon lui, doivent conduire à rejeter définitivement la peine de mort :
« Il s’agit bien, en définitive, dans l’abolition, d’un choix fondamental, d’une certaine conception de l’homme et de la justice. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction : qu’il existe des hommes totalement coupables, c’est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes, et qu’il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir.
A cet âge de ma vie, l’une et l’autre affirmations me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n’est point d’hommes en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurés et angoissés que soient les femmes et les hommes qui jugent, la justice demeure humaine, donc faillible. »
Et puis, il existait au fond de lui cette conviction qu’un être humain, même celui qui avait commis le pire, était toujours capable de devenir meilleur.
Je voudrais pour rendre hommage à Robert Badinter, narrer l’histoire de Philippe Maurice que l’on peut trouver sur Wikipedia.
Philippe Maurice est né à Paris le 15 juin 1956.
En quittant l’armée, Philippe Maurice participe à un trafic de faux billets. Les gendarmes dans l’Aveyron le surprennent en train de forcer un barrage routier avec un véhicule volé. Puis, il est inculpé et incarcéré à la maison d’arrêt de Rodez, en mars 1977, dans le cadre de plusieurs recels de vols de véhicules et de multiples escroqueries (usages de chèques volés, faux monnayage), délits pour lesquels le tribunal de Millau le condamne en 1978 à cinq ans de prison dont un an avec sursis. Lors d’une permission de sortie il ne regagne pas la maison d’arrêt.
Avec un ami, il se lance dans une série de vols à main armée en région parisienne qui se termine dans un épilogue sanglant, d’abord avec le meurtre le 26 septembre 1979 d’un veilleur de nuit qui le surprend en flagrant délit de vol de véhicule dans le 15e arrondissement de Paris, puis avec les meurtres de deux gardiens de la paix de la préfecture de police qui tentent de les intercepter dans la nuit du 7 décembre 1979, rue Monge dans le 5e arrondissement de Paris. Son ami est tué dans la fusillade.
Philippe Maurice est condamné à mort par la cour d’assises de Paris le 28 octobre 1980 pour complicité de meurtre et meurtre sur agents de la force publique.
Il va même tenter une évasion, le 24 février 1981, et blesser grièvement un gardien de prison avec une arme que lui avait remis clandestinement son avocate.
Comme dirait les jeunes de maintenant : « C’est du lourd !»
Son pourvoi de cassation est rejeté le 19 mars 1981, le président d’alors Valéry Giscard d’Estaing repousse volontairement sa réponse pour la demande de grâce, après les élections présidentielles de mai 1981, laissant à son successeur, qui pouvait être lui-même, la charge de répondre à cette demande.
Le 10 mai 1981, François Mitterrand qui avait déclaré qu’il voulait abolir la peine de mort s’il était élu, gagne les élections présidentielles.
Le 11 mai 1981, Robert Badinter va visiter Philippe Maurice dans sa prison et lui dit :
« Vous allez être gracié, l’abolition de la peine de mort est imminente. D’une certaine manière, vous allez symboliser désormais l’abolition elle-même… ». Il lui enjoint de reprendre ses études en prison.
Le 25 mai 1981, le nouveau président de la République, François Mitterrand, quatre jours après son investiture, lui accorde sa grâce et commue sa condamnation à mort en une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Une fois gracié, Philippe Maurice abandonne ses projets d’évasion et suit le conseil de Badinter : il se met à étudier en commençant par l’équivalence du baccalauréat (examen d’entrée à l’université). Il passe sa licence d’histoire en 1987. Le 18 octobre 1989, il soutient sa maîtrise d’histoire du Moyen Âge.
C’est en décembre 1995 qu’il soutient une thèse de doctorat en histoire médiévale, dirigée par Bernard Chevalier et Christiane Deluz, à l’université François-Rabelais de Tours portant sur « La famille au Gévaudan à la fin du Moyen Âge ». Pour sa première sortie de prison sans menottes depuis 16 ans, trois gendarmes et trois fonctionnaires de la pénitentiaire sont chargés de l’observer lors de la soutenance. La thèse recueille les félicitations unanimes du jury et la mention « très honorable ».
À l’automne 1999, il est placé en régime de semi-liberté. Puis le 8 mars 2000, il bénéficie d’une libération conditionnelle. La communauté scientifique de l’université de Tours lui trouve un poste d’assistant de recherche. Par la suite, il sera chargé de recherches, il travaillera à l’EHESS dans les domaines de la famille, de la religion et du pouvoir au Moyen Âge. Il fut également chargé de recherche au CNRS.
Dans l’avant-propos à l’édition de sa thèse, Robert Badinter rappelait qu’il était venu voir Philippe Maurice à Fresnes le lendemain même du 10 mai 1981 :
« Je lui ai dit que, parce qu’il devait sa vie à l’abolition imminente, il symboliserait d’une certaine manière, l’abolition elle-même (…). [Son travail] témoigne, mieux que tous les discours, que l’on ne doit jamais désespérer des hommes. »
Le 25 mai 2000, le journal « Le Monde » lui a consacré un très long article : < Il était une fois… Le retour à la vie de Philippe Maurice >
J’en tire deux extraits. D’abord celui qui décrit la soutenance de la thèse :
« Alors, en décembre 1995, Philippe Maurice soutient sa thèse à Tours, le temps d’une extraction, sous escorte policière, du centre de détention de Caen. Cinq heures de face-à-face érudit, qui rompent la solitude et valident 1 245 pages, fruit de sa patience et de sa volonté. « Une prestation remarquable d’intelligence du sujet », se souvient Jacques Poumarède, historien à Toulouse des institutions du droit. Mention « très honorable » avec félicitations du jury. « Vous m’avez rendue plus intelligente », conclut ce jour-là une professeure de la Sorbonne, à sa place de juré. »
Et ce jugement de deux des plus grands historiens français :
« [Philippe Maurice figure] parmi les meilleurs docteurs en histoire dont j’ai eu connaissance ces dernières années, attestait le médiéviste Jacques Le Goff, en 1996. Il s’agit là d’un cas exceptionnel non seulement de réinsertion psychologique, intellectuelle et morale, mais d’un apport important aux travaux de l’historiographie française contemporaine. » « Je suis tout à fait porté à lui faire confiance pour le travail qu’il pourrait accomplir dans l’avenir », écrivait l’historien et président de la Bibliothèque nationale de France, Jean Favier. »
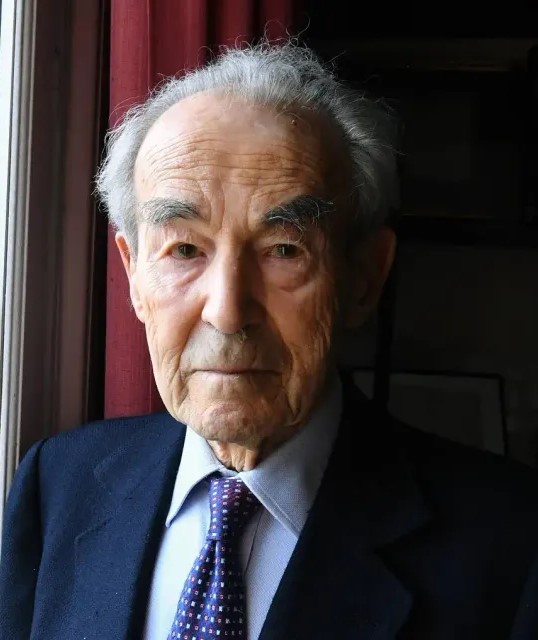 Par <cet article> de « l’Obs » nous apprenons qu’il a été présent en 2021, avec Robert Badinter, pour célébrer le 40ème anniversaire de la peine de mort :
Par <cet article> de « l’Obs » nous apprenons qu’il a été présent en 2021, avec Robert Badinter, pour célébrer le 40ème anniversaire de la peine de mort :
« La célébration du 40ème anniversaire de l’abolition de la peine de mort à l’Hôtel de Lassay, a été l’occasion pour Robert Badinter de plaider pour « l’abolition universelle ». Puis, il s’est adressé à ce professeur d’histoire, discrètement assis dans l’assistance, « il a été l’incarnation de l’abolition et il n’a pas déçu les espérances que nous avions en lui ». Appelé à son tour à prendre la parole, Philippe Maurice a rendu hommage à l’homme qui a consacré sa vie à la justice et, a-t-il ajouté, « à François Mitterrand que j’aurais aimé connaître ». Habillé tout de blanc, couleur des fantômes et des anges, Philippe Maurice tranchait sur l’aréopage en costumes sombres. Nulle effusion entre les deux hommes, l’ancien ministre cultive la réserve et le professeur, la discrétion. L’histoire les a fait se croiser et se recroiser mais Robert Badinter n’a pas été son défenseur. »
 Sollicité par « Ouest-France », Philippe Maurice s’est dit trop pudiquement touché par la mort de Robert Badinter pour évoquer le sujet de vive voix. Il a toutefois rédigé un petit texte que voici à son égard :
Sollicité par « Ouest-France », Philippe Maurice s’est dit trop pudiquement touché par la mort de Robert Badinter pour évoquer le sujet de vive voix. Il a toutefois rédigé un petit texte que voici à son égard :
« Voici plus de quarante ans, dans une cellule de condamné à mort, les pieds et les mains enchaînés, les chevilles ensanglantées, je recevais la visite régulière de Robert Badinter. Je n’étais qu’un gamin de banlieue sans avenir. Nous étions certains que je serais exécuté.
Cet homme, socialement si important, ce grand notable, se présentait toujours avec une boîte neuve de cigarillos. Il posait la boîte sur la table, devant nous, l’ouvrait, et m’invitait à fumer. Il allumait les cigarillos que je grillais ainsi devant lui. Quand, en parlant, je laissais mon cigarillo s’éteindre, attentif, attentionné, il se précipitait sur son briquet pour le rallumer. Je crois qu’il s’apercevait avant moi que le cigarillo était éteint.
Ce petit geste dont il ne s’est jamais vanté, je crois, aurait dû disparaître avec moi… À mes yeux, ce geste modeste reste une marque de sa très grande humanité… Le grand bourgeois se pliait devant la mort à venir d’un gamin destiné à l’échafaud. »
Philippe Maurice a publié plusieurs ouvrages d’historien : « La famille en Gévaudan au XV e siècle (1380-1483) » qui fut l’objet de sa thèse, en 1998, aux éditions de la Sorbonne, « Guillaume le Conquérant » en 2002, chez Flammarion, mais aussi son autobiographie : « De la haine à la vie », en 2001, aux éditions du Cherche Midi et « Adieu la mère », en 2014, aux éditions du Cherche Midi, consacré à la vie si difficile de sa mère.
<1791>
-
Vendredi 9 février 2024
« Une défaite sans vainqueur »Jean-Pierre FiliuLa journaliste de « La Croix l’hebdo » Vinciane Joly a échangé, via WhatsApp, avec Ahmad, un jeune palestinien qui vit à Gaza. Au gré des coupures de communication, il lui a raconté son quotidien sous les bombes. Leur correspondance est un document unique sur la guerre publié par le journal : < Je t’écris de Gaza >.
Ahmad a fui Gaza ville pour aller à Khan Younes où un bombardement l’attendait, qui a laissé son frère handicapé… Les échanges sont terribles, autant pour ce que dit le Palestinien, que par la distance entre celui qui vit un calvaire et celle qui en France, ne peut que trembler et dire sa pitié… Et Ahmad dit :
« Nous nous plaindrons de ce monde à Dieu quand nous Le rencontrerons. »
Le Calvaire continue pour la population de Gaza. Du côté israélien, l’angoisse et le traumatisme du massacre du 7 octobre persistent.
Dieu qui est invoqué des deux côtés ne dispose visiblement d’aucun moyen d’action pour intervenir…
Je comprends la réaction d’Ahmad et il aura bien raison de se plaindre à ce Dieu qui semble responsable de toute cette tragédie et qui n’intervient pas.
Et je pense que pour toutes celles et ceux qui croient en Dieu, « la tempête sous un crâne » pour reprendre la phrase utilisée par Victor Hugo dans les Misérables est de plus en plus forte.
Pour celles et ceux qui ne croient pas ou qui croient mais gardent un doute fécond, il me semble pertinent d’écouter et de suivre les réflexions de l’historien, spécialiste du Moyen-Orient contemporain, Jean-Pierre Filiu.
 Ce 9 février il fait paraître un livre : « Comment la Palestine fut perdue » et comme sous-titre « Et pourquoi Israël n’a pas gagné. Histoire d’un conflit (XIXe-XXIe siècle) »
Ce 9 février il fait paraître un livre : « Comment la Palestine fut perdue » et comme sous-titre « Et pourquoi Israël n’a pas gagné. Histoire d’un conflit (XIXe-XXIe siècle) »
Il était l’invité du « Grand Entretien » de France Inter du mardi 5 février 2024 : <La défaite palestinienne est claire, elle est écrasante>.
Il fait d’abord le constat que la défaite palestinienne depuis le début de ce conflit est écrasante et pourtant Israël, malgré sa supériorité militaire gigantesque et les victoires obtenues dans toutes les guerres contre les palestiniens et les arabes, n’a pas gagné.
Il n’y a en réalité pas de victoire définitive d’Israël.
Il parle d’« une défaite sans vainqueur ».
Jean-Pierre Filiu, à l’instar de beaucoup d’autres, affirme que cela montre qu’il ne peut pas y avoir de victoire militaire, il ne peut exister qu’une solution politique. C’était ce que Itzhak Rabin avait compris, et c’est pourquoi il avait entamé les négociations du processus d’Oslo.
Il rappelle qu’il existe une historiographie dense sur ce conflit qui a tant duré.
Mais Jean-Pierre Filiu a voulu rompre avec le récit chronologique des évènements, les étapes de la tragédie et des solutions avortées, pour analyser ce conflit de manière plus globale en opposant ce qu’il analyse comme « les trois forces d’Israël » aux « trois faiblesses Palestiniennes ».
Au préalable, il entend dénoncer un « certain nombre d’impasses intellectuelles ».
Tout d’abord celle du « mythe d’un État binational » partagé entre juifs et arabes :
« L’État binational est une fausse bonne idée, vu qu’on l’agite en disant vous voyez qu’on n’arrivera pas à faire les deux États, donc pourquoi pas l’Etat binational. Sauf que, l’Etat binational existe déjà, mais sous une forme non avouée. On a un État binational avec une domination israélienne sur la population palestinienne et manifestement ce n’est pas une solution ni pour les uns ni pour les autres. »
Ensuite celle « d’une question palestinienne une fois pour toute enterrée » :
« Ce mythe a volé en éclat, tragiquement, à la face du monde en automne dernier [le 7 octobre] »
A mon sens, ces deux questions sont intimement liées.
Benyamin Netanyahou n’a jamais expliqué comment il entendait sortir de l’impasse. Il ne veut pas, depuis toujours, d’un Etat palestinien.
Déjà en 1984, 12 ans avant de devenir premier ministre pour la première fois ; il est ambassadeur d’Israël auprès des Nations unies à New York. Et il dit son opposition à un Etat palestinien. <Il a été filmé>.
S’il ne veut pas d’un État palestinien que reste-t ‘il ? Un Etat binational !
S’il est démocratique, la souveraineté est partagée, il n’y a plus d’État juif. Inacceptable pour les israéliens !
Donc s’il est binational et juif, cela devient un Etat d’apartheid dans lequel les juifs exercent le pouvoir et les palestiniens sont des citoyens de seconde zone. Inacceptable pour le reste du monde !
C’est pourquoi Netanyahou a voulu rester dans l’ambigüité et le statu quo, c’est-à-dire un état binational qui ne dit pas son nom et qui prétend que la question palestinienne n’existe plus. Il ne reste plus qu’à trouver la voie de la paix avec les Etats arabes, via les accords d’Abraham. Les gouvernements arabes écartant avec la même désinvolture et le même cynisme la question palestinienne. C’est cette stratégie qui a volé en éclat le 7 octobre 2023, selon l’expression de Jean-Pierre Filiu.
Dans la suite de l’émission il développe les trois forces de l’un et les trois faiblesses de l’autre.
Les trois forces d’Israël sont :
- Le sionisme chrétien
- Un pluralisme de combat
- Une stratégie du fait accompli
La première force d’Israël, est selon l’historien, de manière surprenante « un sionisme historiquement chrétien » :
Voilà ce qu’il écrit dans son livre :
« « Le sionisme, en tant que mouvement prônant le rassemblement du peuple juif sur la terre d’Israël, a été historiquement chrétien avant que d’être juif. Cette réalité aussi méconnue que déroutante a représenté un formidable atout pour l’implantation juive en Palestine, malgré la résistance pourtant précoce de la population locale. Le courant évangélique du protestantisme anglo-saxon considère […] tant que le peuple juif n’y [en Palestine] a pas accompli son supposé destin, ouvrant ainsi la voie à l’établissement du Royaume de Dieu. Cette obsession eschatologique conforte le soutien des autorités britanniques au projet sioniste en Palestine, puis celui des Etats-Unis au jeune Etat d’Israël. […] Le sionisme chrétien devenu progressivement un acteur central de la politique américaine, joue un rôle déterminant dans le sabotage du processus de paix israélo-palestinien. C’est enfin lui qui encourage Donald Trump à porter les coups les plus sévères jamais infligés à la légitimité même de la cause palestinienne. »
« Comment la Palestine fut perdue » page 18 et 19
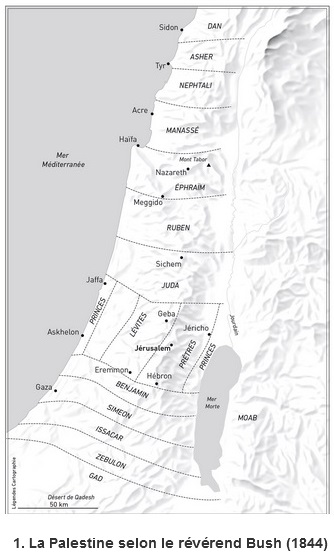 Et il ajoute dans l’émission de France Inter :
Et il ajoute dans l’émission de France Inter :
« C’est une force qui s’est imposée. D’abord dans l’évangélisme anglo-saxon et qui a littéralement façonné l’imaginaire de décideur protestant, qui d’une certaine manière était plus sioniste que les sionistes. En tout cas, il y a une antériorité chronologique incontestable. Et je reproduis une carte très frappante du révérend Busch, en 1844, […] carte de Palestine, sans palestiniens, avec les tribus d’Israël. C’est antérieur d’un demi-siècle de « L’Etat des juifs de Theodor Herzl ». »
Dans un article de « l’Obs » : <La solution à deux Etats est d’une urgence existentielle> il précise :
« Pour résumer, cette mouvance évangélique a lié son salut individuel et collectif au « retour » du peuple juif sur « sa » terre. L’imprégnation biblique du gouvernement britannique a notoirement pesé en faveur de la déclaration Balfour de 1917, à laquelle s’est opposé en vain Edwin Montagu, le seul ministre juif de ce cabinet. »
Selon lui, la déclaration Balfour, c’est-à-dire l’appui que donna le gouvernement britannique à l’implantation, en Palestine, d’un foyer national juif, n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu des membres éminents du gouvernement britannique, dont Lord Balfour, qui partageait cette vision biblique du retour des juifs dans leur antique patrie.
Pour la situation actuelle, il est établi que les évangéliques, cette mouvance fondamentaliste des protestants, ont pris une importance capitale à l’intérieur du Parti républicain et sont les principaux soutiens de Trump.
Trump recueille 81% du vote des évangéliques blancs mais que 25% du vote juif. Le Likoud et Netanyahou sont soutenus essentiellement par ces évangéliques et beaucoup moins par la communauté juive.
Ces évangéliques croient en la fin des temps, c’est la vision eschatologique, et lient cet évènement au retour des juifs à Jérusalem. Dans leur croyance, ces juifs doivent d’ailleurs se convertir, avant l’acte final, au christianisme sous peine d’être définitivement éliminé. Ils sont antisémites mais Israel occupe une importance essentielle dans leur croyance étonnante pour nos yeux de français incrédules.
<Cet article du Monde de 2020> donne les éléments suivants :
« On estime qu’il y a environ 95 millions d’évangéliques aux Etats-Unis, tous groupes confondus. Cela inclut les évangéliques charismatiques, qui sont les plus fervents soutiens de Donald Trump, lesquels représentent 12 à 15 % de la population américaine [Mais leur taux de participation aux élections est très supérieur à la moyenne américaine] ….
Les visions eschatologiques [relatives à la fin des temps] et millénaristes sont très ancrées chez ces chrétiens. Un sondage de 2017 indique que 80 % des évangéliques américains croient au retour prochain du Christ et qu’ils sont convaincus que la création de l’Etat d’Israël en 1948 en est un signe annonciateur. »
Il y a donc une gradation, parmi eux, dans les croyances extrémistes. Mais parmi ces 95 millions, la croyance en la fin des temps et dans le rôle d’Israël dans cet heureux dénouement de notre humanité (selon eux) est proche de l’unanimité (4 sur 5).
J’irais plus vite sur les deux autres forces :
Un pluralisme de combat : C’est-à-dire la capacité du mouvement sioniste d’accueillir en son sein, des tendances contradictoires, mais avec cette dynamique de combat qui ont conduit à ce qu’il y a toujours eu unité dans les moments essentiels ou existentiels de l’histoire du sionisme et d’Israël.
Une stratégie du fait accompli :
« C’est le fait de ne jamais donner l’objectif final. […] Cela a permis de manière très intelligente, pas forcément consciente mais plutôt dans le cadre d’un mécanisme de survie et de mobilisation collective de ne [rater aucune occasion d’avancer], d’abord le foyer national juif, l’Etat juif en 1947, l’occupation des territoires en 1967, et aujourd’hui Netanyahou refuse de dire ce qu’il veut faire de Gaza. »
C’est à la fois une stratégie pour avancer ses pions et puis une fois une position acquise ne jamais reculer.
Ce sont donc ces trois forces, qui selon Jean-Pierre Filiu ont permis le développement du sionisme et de l’Etat d’Israël.
En face, il y a les trois faiblesses palestiniennes :
1 L’Illusion de la solidarité arabe. Les palestiniens pensaient qu’ils pouvaient compter sur le soutien arabe, or ce soutien des pays et des gouvernements arabes leur a le plus souvent été refusé. Il y eut même des guerres atroces entre pays arabes et le nationalisme palestinien : La Jordanie ou la Syrie des Assad ont fait la guerre aux palestiniens et leur ont causé des pertes énormes. Encore aujourd’hui, ils protestent contre la réaction d’Israël à Gaza, mais n’exercent aucune action concrète pour tenter de faire pression contre Israël.
2 La dynamique factionnelle du nationalisme palestinien. Contrairement au pluralisme de combat sioniste, les palestiniens se sont toujours affrontés en leur sein entre familles, entre clans au détriment de leur combat nationaliste.
3 l’incapacité de la communauté internationale de faire respecter le droit international par l’Etat d’Israël. Nous sommes dans ce que l’on appelle les deux poids, deux mesures.
Dans l’article de l’Obs, Jean-Pierre Filiu esquisse une porte de sortie de la violence :
« C’est précisément l’épouvante actuelle qui confère à la solution à deux Etats un caractère d’urgence pratiquement existentielle. Les deux peuples ne peuvent plus être laissés face à face sous peine de s’entraîner l’un l’autre dans une spirale destructrice où chaque affrontement sera plus effroyable que le précédent. Le conflit israélo-palestinien n’est pas un jeu à somme nulle où les pertes de l’un se traduisent mécaniquement en gains pour l’autre, puisque Israël a connu la pire épreuve de son histoire au moment même où le rapport de force en sa faveur était écrasant.
Et s’il y a une leçon à tirer de l’échec du processus de paix de 1993-2000, c’est qu’il faut travailler d’emblée sur le statut final, sans période intérimaire, et avec une implication internationale à la fois volontariste et équilibrée. L’Union européenne a un rôle majeur à jouer en tant que puissance de normes et de droit dans un conflit qui a plus que jamais besoin de normes et de droit pour être réglé. Mais soyons clairs, ce processus de paix, même s’il est couronné de succès, ne fera que négocier les conditions de la défaite palestinienne. Et seule la solution à deux États permettra à Israël de se proclamer enfin vainqueur. D’où le sous-titre de mon livre « Et pourquoi Israël n’a pas gagné ». »
Je vous redonne le lien vers l’émission de France Inter : <La défaite palestinienne est claire, elle est écrasante>.
L’article de l’Obs : <La solution à deux Etats est d’une urgence existentielle>
Il y a aussi une émission de Mediapart du 8 février dont Jean-Pierre Filiu était l’invité : < Israël est en train de détruire Gaza sans détruire le Hamas >
<1790>
- Le sionisme chrétien
-
Lundi 5 février 2024
« Le murmure »Christian Bobin« Le murmure », c’est un son délicat, mais c’est aussi le nom que l’on donne aux grands rassemblements d’oiseaux dans le ciel, où ils forment des masses compactes et mouvantes au crépuscule.
 Cette mystérieuse faculté que possèdent les oiseaux à évoluer, en groupe immense, de manière harmonieuse, sans jamais se cogner, tout en changeant de direction est fascinante.
Cette mystérieuse faculté que possèdent les oiseaux à évoluer, en groupe immense, de manière harmonieuse, sans jamais se cogner, tout en changeant de direction est fascinante.
Je me souviens que lors d’un entretien avec Jacques Chancel, Herbert von Karajan parlait du murmure des oiseaux pour expliquer comment se passe les inflexions : les changements de tempo et de nuances au sein d’un orchestre symphonique composé seulement d’une centaine d’individus. Il expliquait que le groupe était suffisamment en harmonie pour que ces évolutions soient immédiatement perçues par tous, de sorte qu’ils agissent en symbiose.
Le réalisateur hollandais Jan Van Ijken nous apprend dans un documentaire que les formations d’oiseaux ne sont pas dirigées par un seul individu mais bien par tout le groupe. Quand un des individus change quelque chose, les autres réagissent instantanément quelle que soit la taille du murmure. L’information circule dans le groupe quasi sans dégradation.
« Le murmure » est l’ultime livre écrit par Christian Bobin.
Il est paru le 1er février 2024. Le 2 février j’avais fini de le lire, mais certainement pas d’y revenir, maintes et maintes fois.
Le 2 octobre 2022, un Christian Bobin lumineux et semble t’il en forme, était l’invité du « Grand Atelier » de Vincent Josse sur France Inter : « Nous existons si peu, c’est un miracle que cette larme dans les yeux »
La Médiatrice de France Inter a mis en ligne la réaction de quelques-uns des auditeurs qui se sont exprimés suite à cette émission.
J’en citerai deux :
« Quel bonheur cette émission d’aujourd’hui ! D’un seul coup on grandit, on vibre à ses paroles, on est ému par son émotion, sa profondeur. Une interview comme celle-là nous rend plus intelligent. Bravo à Christian Bobin et sa poésie, sa spiritualité de la vie et merci à Vincent Josse de ces deux heures magnifiques ! J’en redemande ! Merci merci !»
« Ahhhh Monsieur Josse, comme j’ai souri en vous entendant dire cette phrase qu’ici même j’envoyais à mon amie « Regarde, on va se prendre une rafale de joie ». J’avais cette sensation d’être parmi vous. Un grand merci pour ce beau rendez-vous, Christian Bobin est une lueur sur tant de chemins !!! »
J’ai réécouté cette émission, ce dimanche, pendant ma marche quotidienne et je me suis dit qu’il faudrait l’écouter chaque fois qu’on n’est pas bien, c’est plus puissant et moins nocif que tous les antidépresseurs.
Quelques jours après cette émission, Christian Bobin a été attaqué par la maladie foudroyante qui allait l’emporter le 23 novembre 2022.
Christian Bobin a fini son existence terrestre, à l’hôpital de Chalons sur Saône, allée Saint Jean des Vignes.
Il avait commencé son livre en juillet, mais c’est sur son lit de souffrance de l’hôpital qu’il l’a continué, et pour la fin il l’a dicté à sa compagne devenue son épouse la poétesse Lydie Dattas auquel le livre est dédié. Ce livre est bien plus : une ode à leur amour partagé.
Lydie Dattas avec l’éditrice Gabrielle Lecrivain ont finalisé cet ouvrage dont l’exergue initial est :
« Rien est le tout de ce que je sais »
Lydie Dattas a accepté une interview très émouvante sur le site de « la Tribune » : « J’ai vécu avec un ange, Christian Bobin » .
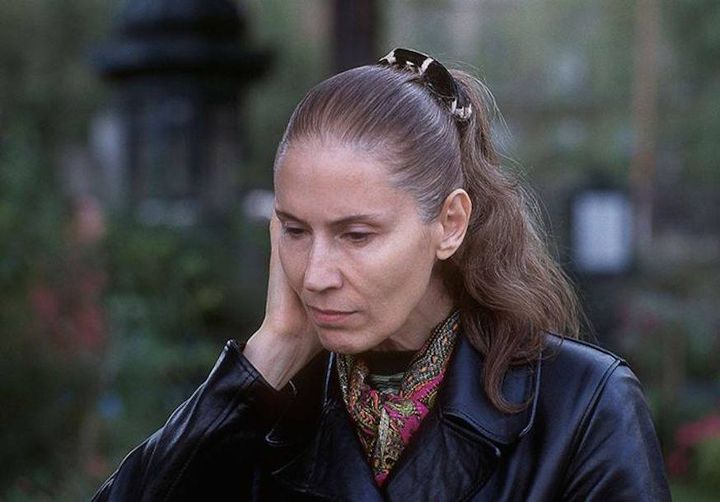 Lydie Dattas est, elle-même, une poétesse reconnue par ses pairs. Elle déclare dans la Tribune :
Lydie Dattas est, elle-même, une poétesse reconnue par ses pairs. Elle déclare dans la Tribune :
« A l’instant où j’ai connu Christian Bobin, je suis devenu sa disciple. J’ai tout de suite vu que j’avais à faire à tellement plus grand que moi. »
Lydie Dattas confirme ce que révèle la quatrième de couverture : « Commencé chez lui, au Creusot, en juillet 2022, poursuivi sur son lit d’hôpital durant les deux mois précédant sa mort, le murmure appartient à ces œuvres extrêmes écrites dans des conditions extrêmes. »
Quand le journaliste lui demande si elle l’a encouragé dans cette aventure inouïe :
« On n’encourage pas le tonnerre à tonner, ni le rossignol à chanter. Il chante tout seul. Ma seule action dans cette affaire, ça a été de noter, parfois à la vitesse de la lumière, une phrase, une parole ou une correction. Parfois en direct, parfois au téléphone. Dans une telle aventure divino-humaine (le fond poétique indestructible du vivant), où la mort peut survenir à chaque instant, il ne peut être question de plans, de désirs, de souhaits : le verbe arrive et il faut juste être à la hauteur de son sens. Malgré sa taille modeste, ce livre restera comme le grand œuvre de Christian Bobin. »
Dans ce livre, il est question d’art, il cite une dizaine de fois le grand pianiste russe Grigory Sokolov, qu’il a découvert tardivement.
Il est question de sa maladie, qui s’adresse à lui :
« Et de paix ! S’exclama la maladie. Sais-tu seulement de quoi tu parles ? Il ne s’agit pas de cesser d’écrire, malheureux ! Regarde : je les ai fait venir pour toi mes auxiliaires : quatre douleurs pour y voir clair. Une guerre pour l’âme, une pour le poumon, tout ! Ils t’apporteront lumière, non ténèbres ! Rien de plus éloigné de la mort ! Bon dit la maladie en claquant des doigts pour rameuter sa troupe : en route ! Nous avons encore du chemin à faire. Je reviendrai. Le message est clair. […]
Si ce livre devrait être le dernier, alors il faudrait qu’il soit le plus jeune de tous ceux que j’ai écrits. »
Le Murmure page 19
La gravité, on la comprend dans ce dialogue avec le médecin :
Le médecin entre dans ma chambre, mon dossier dans les mains, et me dit doctement contrarié : « Je ne sais pas qui vous êtes, mais c’est complétement anormal. Avec ce que vous avez, vous devriez être terrassé ! ».
Le Murmure page 47
Tous les médecins n’ont pas cette brutalité, mais nous, je veux dire nous qui fréquentons assidument les disciples d’Esculape, avons tous rencontré ce que j’appelle « des techniciens » qui ont dans leur tête les protocoles et des tableaux statistiques, mais ont oublié de cocher la case « humanité »…
Christian Bobin lui répond dans son livre :
« Ce spécialiste ne connaît pas les ressources des bébés. Je n’ai pas de ruse. Moi j’arrive sur mes jambes de 4 ans – et je cause. Je saute à pieds joints dans toutes les flaques de découragement qui sont devant moi et je les change en étincelles. »
Et il continue par un mot plus piquant, car Bobin est bienveillant et gentil, mais il n’est dupe de rien et voit aussi l’ombre des choses :
« La sensibilité s’est retirée du monde. Elle a laissé la place à la précision. Si j’étais la lune, je commencerais à faire mes valises… »
Il y a aussi ce moment où le lecteur se dit il est vraiment trop …
« Il pleut… Sur mon lit d’hôpital, je mange un plat incomestible entre un mourant et une vitre en larmes. Ensuite, j’écris ce petit billet pour la cuisinière : « Chère cuisinière, je viens de finir mon assiette : c’était absolument délicieux. Peut être seulement un tout petit peu froid… ».
J’ai un frisson d’ange. Nous ne sommes que rarement les auteurs de nos actes. »
Le Murmure page 35
Mais la critique suit :
« Si seulement on pouvait s’occuper des malades et des pauvres comme leurs majordomes s’occupent des riches… »
Et il finit par cette analyse sur ceux que notre président, lors de la pandémie, a décrit comme les indispensable de notre société :
« C’est grâce à l’insomnie des mères consolant un enfant dévoré par les diables de la nuit ou à un balayeur aidant ici ou là un trottoir à mieux respirer – oui : c’est grâce à ce genre de service que les ténèbres n’ont pas encore refermé définitivement leurs bras sur les humains. Écrire est ce genre de service. »
Mais ce n’est pas la maladie qui a la première place dans ce livre :
« J’écris pour vous construire un nid. Il fait trop froid dehors. »
Le Murmure page 34
C’est un hymne à la nature et tant d’autres choses
« Le Temps est venu d’être félicité pour ce qu’on n’a pas fait, pour ce qu’on n’a pas détruit, pour notre amour des fleurs sauvages, qui avec les cris du cœur ont seule puissance de nous guérir.
Fie-toi aux fleurs ! Toute fleur est une goutte de courage, une transfusion de couleurs dans nos veines flétries de ne croire qu’aux ténèbres. »
Le Murmure page 119
C’est un livre à lire, je ne peux dans ce mot du jour que picorer quelques bribes.
 Mais je voudrai partager la fin de ce livre, car c’est un livre sur la mort et sur l’amour :
Mais je voudrai partager la fin de ce livre, car c’est un livre sur la mort et sur l’amour :
« Je suis au bout du langage. La poésie n’est rien, l’écriture n’est rien, la musique n’est rien. Mais ce qui n’est rien ignore la mort. Les larmes et les sourires sans cause survivent à la fin du monde. On va vers des jours extraordinaires.
Nous ne descendrons pas l’escalier de tristesse. Plus vite que la vie et plus vite que la mort, je te retrouverai TOI . Nous tourbillonnerons dans la lumière.
Le vol magique des étourneaux, seconds violons du ciel. Quand ils rencontrent un obstacle – comme d’un roc qui dépasse d’une rivière-, ils scindent en deux cette masse de grâce sans se heurter, vite recomposent leur amitié après le franchissement de l’épreuve. Cette passe s’appelle « le murmure ».
Quand tu mourras notre amour se recomposera. Il se recomposera dans le ciel rouge, comme le murmure des étourneaux après le franchissement de l’obstacle.
Sur le roc de la mort nous serons deux présences éternelles. Dieu n’éteindra jamais nos yeux qui voyaient. »
Et puis vient la toute dernière page avec une seule phrase.
L’éditrice Gabrielle Lecrivain a expliqué que la page manuscrite, toujours écrite à la main, était entièrement noire, car elle avait été intégralement écrite mais barrée à l’exception de cette phrase :
« Nous serons deux enfants réenfantés »
Après leur rencontre, Lydie Dattas et Christian Bobin se sont installés, en 2005, dans une maison isolée, au lieudit Champ-Vieux, à la lisière du bois de Saint Firmin, à une dizaine de kilomètres du Creusot. Dans <cet article de blog>, il est question de ce lieu enchanteur. Cette maison, ils l’ont abandonnée, pour vivre au Creusot, lorsque l’état de santé de Christian Bobin s’est dégradé. Et, Lydie Dattas finit l’article de la Tribune ainsi :
« Récemment, pour la première fois, je suis retournée à Champ-Vieux où nous avons vécu. Il neigeait. La maison et la clairière étaient toutes blanches. C’était beau à pleurer. J’ai pensé : « J’ai vécu au paradis avec un ange. Pourquoi ai-je eu ce privilège ? Personne ne mérite un tel bonheur. »
<1789>
-
Mercredi 31 janvier 2024
« Car c’est ainsi que les hommes naissent, vivent et disparaissent. »Cécile Coulon, début de son livre « La langue des choses cachées »Ce livre « La langue des choses cachées » commencent ainsi :
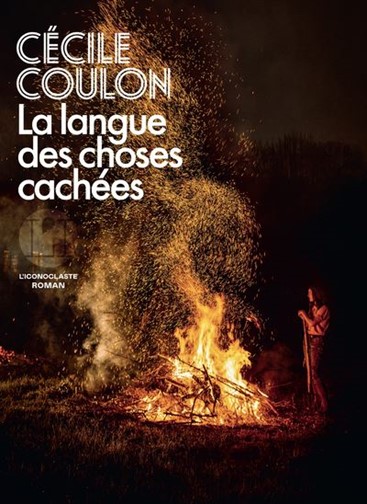
« Car c’est ainsi que les hommes naissent, vivent et disparaissent, en prenant avec les cieux de funestes engagements : leurs mains caressent et déchirent, rendent la peau si douce qu’on y plonge facilement des lances et des épées. Rien ne les effraie sinon leur propre mort, leurs doigts sont plus courts que ceux des grands singes, leurs ongles moins tranchants que ceux des petits chiens, pourtant ils avilissent bêtes et prairies, ils prennent les rivières, les arbres et les ruines du vieux monde. Ils prennent, oui, avec une avidité de nouveau-né et une violence de dieu malade, ils posent les yeux sur un carré d’ombre et, par ce regard, l’ombre leur appartient et le soleil leur doit sa lumière et sa chaleur. Ils se nourrissent des légendes qui font la terre ronde et trouée, le ciel bleu et fauve, ils construisent des villes géantes pour des vies minuscules et la haine de cette petitesse les pousse à toutes les grandeurs. En amour, ils ne comprennent rien aux secousses du cœur et du sexe, ils tentent de les apaiser, leurs forces sont fragiles, leurs corps mal préparés aux tempêtes des sentiments. Ils ont trouvé un langage pour tout dire ; avec ce trésor, ils s’épuisent à convaincre qu’ils sont les chefs, les puissants, les vainqueurs.
Qu’importe qu’ils violent des femmes, des enfants, des frères ou des inconnus, qu’importe qu’ils vident des océans et remplissent des charniers, tout est voué à finir dans un livre, un musée, une salle de classe, tout sera transformé en statue, en compétition, en documentaire. Alors, qu’importe qu’ils incendient des bibliothèques, des villages et des pays entiers, qu’ils martyrisent ceux qu’ils aiment, il faut pour vaincre tout brûler, et regarder les flammes monter au-dessus des forêts jusqu’à ce qu’elles forment sous l’orbe des nuages de grandes lettres illisibles. Qu’importe qu’ils passent sur cette terre plus vite qu’un arbre, une maison, une tortue ou un rivage, ils sont si beaux, avec leurs yeux pleins d’amour et leurs mains pleines de sang, ils sont si beaux, avec leurs corps comme des brindilles, ils se tiennent droit, ils imitent les falaises, ils se croient montagnes ou sommets, ils sont si beaux dans leur soif capable de tarir les sources les plus anciennes, ils sont si beaux dans la timidité du premier baiser, cela ne dure qu’une seconde mais après ils ne seront plus jamais grands. Oui, c’est ainsi que les hommes naissent, vivent et disparaissent.
Au milieu de cette foule aveugle, titubante, certains comprennent les choses cachées.»
A l’origine de mon intérêt pour ce livre se trouve un extrait de « la Grande Librairie » que Florence a partagé sur un réseau social : <Cécile Coulon Lit>.
J’ai, ainsi, entendu Cécile Coulon lire le début du prologue de son dernier livre, accompagné par le violoncelle de Victor Julien-Laferrière interprétant un chant de Noël traditionnel catalan : « Le chant des oiseaux »
J’ai trouvé tant de force et de poésie dans cette déclamation de Cécile Coulon que je suis allé visionner l’intégralité de l’émission de la Grande Librairie du 10 janvier 2024 dans laquelle elle intervenait.
Émission très intéressante, comme toujours, dans laquelle Cécile Coulon irradiait de passion, d’intelligence et de lumière.
Alors, je suis allé acheter ce livre de 130 pages. Je l’ai ouvert, j’ai commencé par le prologue.
J’ai d’abord constaté que la déclamation qu’avait faite Cécile Coulon à la grande librairie n’était pas exactement le texte écrit. Il semblerait qu’elle ait prononcé le texte de mémoire, en réalisant quelques petits écarts avec ce qui était écrit.
Pour ma part, dans l’élan de la lecture j’ai continué et terminé sans m’interrompre.
Le récit, mais aussi le style et la poésie m’ont entrainé jusqu’à la fin, sans passer par la case pause.
L’Histoire est celle d’un guérisseur qui est appelé par les gens d’un village pour soigner un enfant malade.
En réalité, c’est sa mère qui est appelée, mais elle n’a plus la force de se déplacer, alors elle envoie, pour la première fois, son fils, qu’elle a initié, réaliser la mission de guérir.
On appelle cette mère ou son fils quand on ne sait plus quoi faire, que même les médecins sont démunis.
Cécile Coulon avoue dans l’émission « Les Midis de Culture » du 26 janvier 2024 <On n’arrivera jamais au bout du langage, c’est sa grande beauté>, sa fréquentation de semblables pratiquants « des soins archaïques », selon l’expression utilisée dans le livre :
« Ils ont une mission. On y croit beaucoup. Quand je dis qu’on ne comprend pas, c’est qu’on a du mal à expliquer exactement, comme on expliquerait un processus médical […] Étant donné que je suis quelqu’un qui va beaucoup plus souvent voir ce genre de personnes que mon médecin traitant […], j’y crois et je m’y sens bien, je me sens rassuré et en sécurité ».
Cette famille de guérisseur est particulièrement extraordinaire dans ses dons de percevoir ce qui n’est pas dit, caché. Il suffit au fils d’entrer dans une pièce pour sentir des choses graves qui se sont passées dans cette pièce des mois ou des années auparavant.
C’est tellement extraordinaire qu’il ne peut s’agir d’un guérisseur que Cécile Coulon a rencontré.
C’est pourquoi Louis Henri de la Rochefoucault, dans « Lire Magazine » décrit ce livre ainsi :
« Un court conte intemporel »
C’est un conte et il est hors du temps, on ne sait pas à quelle époque se déroule cette histoire.
En revanche, le temps du roman est déterminé : tout le récit se passe au cours d’une seule nuit.
Le guérisseur, en dehors de ses dons de guérir, connait aussi la langue des choses cachées.
 Cécile Coulon explique dans la grande Librairie :
Cécile Coulon explique dans la grande Librairie :
« La langue des choses cachées ce sont tous les mots qui ne sont pas dits. Tout le langage qui existe dans le silence. C’est une langue qu’on apprend quand on regarde les gens et qu’on décide de se taire. Et qu’on essaye de comprendre ce qui se cache derrière les conversations, ce qui se cache derrière les maisons, dans le corps, sous les corps. Et je crois qu’apprendre la langue des choses cachées, c’est aussi la capacité d’être ouvert et attentif à tout et à tous. »
L’écriture est poétique mais répond aussi à une sorte d’urgence, de frénésie que l’autrice explique ainsi :
« J’ai écrit cette histoire dans un état hypnotique, bouillonnant, fiévreux. Je voulais raconter ce que sont ces lieux, ces endroits sans lois inscrites, sans rien si ce n’est une église et un pont, flanqués de quelques maisons. Je voulais écrire que plus on cache un événement, plus il persiste à travers les générations suivantes. Je suis partie d’un lieu tenu par deux familles et un homme d’Église, j’ai voulu qu’en une seule nuit, dans ce hameau, tout soit défait, jusqu’aux entrailles, jusqu’au sang. »
C’est un conte cruel, un conte dur.
Il est question de violence sociale, de violence qu’on fait aux femmes et aux enfants.
Et il se termine avec une rupture de comportement entre l’action du fils et l’apprentissage que lui a donné sa mère.
Et, vous risquez à la fin du roman, si vous le lisez, d’avoir le même questionnement que moi : Faut il agir comme la mère : se contenter de soigner et éviter d’ajouter du désordre dans la société, ou comme, le fils, au risque du chaos, ne pas laisser les choses en l’état ?
<1788>
-
Vendredi 19 janvier 2024
« La chute infinie des soleils. »Pièce de théâtre écrit par Elemawusi AgbedjidjiAvec Annie nous sommes allés, le 17 janvier, au Théâtre des Célestins, à Lyon, voir « La Chute infinie des soleils », écrite et mise en scène par Elemawusi Agbedjidji. Cette pièce sera jouée jusqu’au 27 janvier.
C’est un spectacle qui mêle le récit d’un naufrage, au XVIIIème siècle, avec celui d’un étudiant étranger, en France, qui tente de démontrer à un jury incrédule, lors d’une épreuve universitaire que cette histoire ancienne mérite d’être racontée et étudiée, parce qu’elle parle de nous et de notre humanité. La pièce mêle vérités historiques et fictions.
La scénographie est épurée et seul deux comédiens un homme et une femme se trouvent sur le plateau.
Avec une grande sobriété de moyens, la pièce de théâtre touche juste, et « tape avec le cœur sur le cœur » selon une expression de Christian Bobin.
Le récit historique nous apprend que dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1761, une frégate, de la Compagnie française des Indes, « L’utile » fait naufrage près d’une minuscule ile qui s’appelait alors « l’ile des sables », elle porte désormais le nom d’« île de Tromelin »
 Elle a une superficie de 1 km², le tour de l’île fait 3,7 km et le point culminant se situe à 7m au-dessus du niveau de la mer.
Elle a une superficie de 1 km², le tour de l’île fait 3,7 km et le point culminant se situe à 7m au-dessus du niveau de la mer.
Elle se situe dans l’Océan Indien et se trouve à 436 km à l’est de Madagascar et à environ 560 km au nord des îles de La Réunion et de Maurice
A cette époque, la France et l’Angleterre se combattent au cours de la « guerre de Sept Ans »..
La frégate Utile a été envoyée à Madagascar pour ravitailler les colonies.
Le navire a notamment pour mission de ravitailler l’île Maurice qui portait alors pour nom « l’île de France ». Cette île affronte une sévère famine en raison de la surpopulation d’esclaves. Pour cette raison, le gouverneur Antoine Marie Desforges-Boucher interdit temporairement leur commerce sur les terres qu’il administre (les îles de France et Bourbon, actuellement Maurice et La Réunion).
Mais ce trafic rapportant des sommes considérables, des marins se mettent à leur compte.
Ainsi le capitaine de l’Utile, Jean de La Fargue, malgré l’interdit, fait embarquer 160 esclaves malgaches afin de les revendre à Rodrigues pour sa fortune personnelle.
Ce trafic explique non seulement la route empruntée par le marin français (beaucoup plus au nord que la voie connue), mais aussi sa volonté d’expédier son chargement au plus vite, quitte à risquer le naufrage. Il navigue de nuit.
« La Libre Belgique » a consacré une page documentée sur ce drame
« Nous sommes le 31 juillet 1761, il est 22h20. La nuit est noire, la mer houleuse. Seuls quelques officiers et l’homme de barre sont encore sur le pont de l’Utile […]. Malgré les conditions de navigation difficiles, le bateau suit les ordres du capitaine, Jean de Lafargue, et fait route vers l’est. Le matin-même, une dispute avait éclaté entre le capitaine et son second, Barthélémy Castellan du Vernet, au sujet de la direction à prendre. Chacun, muni d’une carte différente, redoutait de passer trop près de l’Ile des Sables, un îlot d’un kilomètre carré dont la position n’était pas connue avec certitude. Buté, le capitaine Jean de Lafargue avait refusé d’écouter son second. Il en était sûr : la carte fournie par la Compagnie française des Indes Orientales était plus précise que celle, plus récente, dessinée par un vieux loup de mer. Le capitaine avait donc tué toute mutinerie dans l’œuf en déclarant d’un ton autoritaire que le cap resterait inchangé. […] »
Le navire va se fracasser contre la barrière de corail qui entoure l’île :
« En quelques secondes, des cris se firent entendre. Des hurlements de désespoir venant aussi bien des hommes d’équipage de toutes nationalités que des esclaves noirs, enfermés dans les cales du navire, piégés derrière des portes clouées. Castellan se mit aussitôt à distribuer des ordres. Son but : garder son bateau à flot jusqu’à ce que le soleil se lève. Durant dix longues heures, il fit son possible pour l’empêcher de tanguer. Malheureusement, il ne pouvait lutter contre les forces de la nature. Aux alentours de huit heures du matin, le 1er août 1761, le navire se brisa en deux, jetant à la mer des hommes désespérés, Blancs et Noirs, pour la plupart incapables de nager. Beaucoup périrent noyés ou déchiquetés contre les rochers. Mais, comme une lumière au bout du tunnel, l’un d’eux aperçut une minuscule île. A peine eut-il crié « Terre en vue » que tous les survivants usèrent leurs dernières forces pour rejoindre les côtes. Cette île de sable qui avait tant effrayé l’équipage et qui les avait fait sombrer était maintenant devenue leur seul espoir de survie.
Durant cette catastrophe, personne ne vit le capitaine Jean de Lafargue, dont l’Histoire nous apprendra qu’il était resté caché dans les toilettes du navire, sans doute occupé à se demander comment tout cela avait pu arriver. Plusieurs facteurs pouvaient en effet expliquer ce naufrage mais, à chaque fois, le capitaine avait sa part de responsabilité. Ainsi, si le bateau avait respecté sa mission de départ, il n’aurait même jamais emprunté cette route chaotique. »
Sur les 140 membres d’équipage, 18 périssent avant d’atteindre la rive, il en reste donc 122.
 Pour les esclaves noirs le bilan est beaucoup plus catastrophique, sur les 160 qui se trouvaient sur le bateau, il n’y a que 88 survivants. Comme l’Utile n’est pas taillé pour le transport d’esclaves, les cales sont clouées chaque soir pour éviter toute révolte. Cette nuit-là, les prisonniers ne doivent leur délivrance qu’à la violence de la houle, qui brise le pont du navire en même temps que les portes de leurs geôles.
Pour les esclaves noirs le bilan est beaucoup plus catastrophique, sur les 160 qui se trouvaient sur le bateau, il n’y a que 88 survivants. Comme l’Utile n’est pas taillé pour le transport d’esclaves, les cales sont clouées chaque soir pour éviter toute révolte. Cette nuit-là, les prisonniers ne doivent leur délivrance qu’à la violence de la houle, qui brise le pont du navire en même temps que les portes de leurs geôles.
Le capitaine a sombré dans la folie, il est incapable d’organiser le sauvetage. C’est désormais son premier lieutenant, Barthélémy Castellan du Vernet, qui mène les opérations. Après une brève reconnaissance de l’île, ce dernier s’aperçoit que la terre qu’il foule n’abrite ni arbre ni eau douce. L’épave de l’Utile représente quasiment l’unique ressource de l’île. Durant les trois premiers jours, le rationnement décrété par les Français entraîne le décès d’une trentaine d’esclaves, privés d’eau potable.
« Au bout de quelques jours, les survivants entament la construction d’un puits de 5 mètres de profondeur qui leur offrira de l’eau saumâtre, de l’eau de mer dont la majorité du sel est filtré par le corail. Une fosse commune est également creusée afin d’y enterrer les corps des Noirs morts de soif. »
Le lieutenant aura l’idée de construire un bateau pour sortir de cet enfer. Il sera construits en 57 jours par une équipe essentiellement composée par les esclaves venues de Madagascar.
Mais il était trop petit pour emmener tout le monde.
Qui va partir ?
Question naïve : les blancs, ceux qui n’avaient pas participé à la construction du bateau de secours.
Castellan promet aux noirs de venir les rechercher.
Ils vivront, mourront et certaines survivront pendant 15 ans, le temps qu’un bateau vienne les chercher.
Dans le texte de la pièce de théâtre, l’auteur met les paroles suivantes dans la bouche de l’actrice :
« Cela fait 4 018 tombés de soleils dans le lointain depuis que le capitaine s’en est allé sur le dos de l’océan jusqu’à derrière la porte fine de l’horizon. 4 018 jours que l’espoir est né. Aujourd’hui, il s’est consumé dans la courbe infinie des couchers de soleil en même temps que tu quittais, nous quittais »
Pendant 15 ans, tous les jours ils ont vu le soleil se coucher sur cette ile inhospitalière.
D’où le titre de la pièce : « La chute infinie des soleils. »
Pour la défense du lieutenant, l’histoire retient qu’une fois sur la terre ferme, Castellan demande l’autorisation au gouverneur de l’île Maurice d’aller secourir les esclaves. Mais le gouverneur refuse d’affréter un bateau pour des esclaves qu’il leur avait interdit de transporter. Après plusieurs tentatives, Castellan renonce et décide de retourner en France. Tout le monde oublie ces naufragés, sans doute morts mais qui en fait attendent toujours du secours. Mais en 1773, un navire passant à proximité de l’île les repère et les signale de nouveau aux autorités de l’île de France. Un bateau est envoyé mais ce premier sauvetage échoue, le navire n’arrivant pas à s’approcher de l’île. Un an plus tard, un second navire, La Sauterelle, ne connaît pas plus de réussite. A partir de ce moment, il faudra encore trois ans pour organiser le sauvetage. Ce n’est qu’au bout de quinze ans le 29 novembre 1776, qu’un bateau viendra enfin les sauver pour de bon. Celui du chevalier de Tromelin qui donnera d’ailleurs son nom à cette île. Malheureusement, il ne trouvera vivants que sept femmes et un bébé de 8 mois.
<Wikipedia> nous apprend que
« En arrivant sur place, Tromelin découvre que les survivants sont vêtus d’habits en plumes tressées et qu’ils ont réussi, pendant toutes ces années, à maintenir un feu allumé grâce au bois provenant de l’épave, l’île étant dépourvue d’arbres. Les survivants sont recueillis par Jacques Maillart du Mesle, intendant de l’île de France, qui les déclare libres (ayant été acquis illégalement, ils ne sont pas considérés comme esclaves et n’ont donc pas à être affranchis) et leur propose de les ramener à Madagascar, ce qu’ils refusent, au motif qu’elles y seraient « esclaves des autres Noirs ». Maillart décide de baptiser l’enfant Jacques Moyse (Moïse), le jour même de son arrivée à Port-Louis le 15 décembre 1776 de renommer d’office sa mère « Ève » (alors que son nom malgache était Semiavou qui se traduit par « celle qui n’est pas orgueilleuse ») et de faire de même avec sa grand-mère qu’il nomme « Dauphine » d’après le nom de la corvette qui les a secourues. Le trio est accueilli dans la maison de l’intendant sur l’île de France. […]
Condorcet plaidant l’abolition de l’esclavage dans son ouvrage Réflexions sur l’esclavage des nègres, paru en 1781 sous nom d’emprunt, relate la tragédie des naufragés de Tromelin afin d’illustrer l’inhumanité de la traite »
Aujourd’hui, l’île Tromelin est une île de l’océan Indien administrée par la France au sein des îles Éparses de l’océan Indien, entité rattachée aux Terres australes et antarctiques françaises. Ces îles sont revendiquées par Madagascar, indépendant depuis 1960 et par l’ile Maurice, indépendant depuis 1968.
En 1947, l’île commence à intéresser les autorités françaises à des fins de météorologie tropicale pour la surveillance des cyclones tropicaux. La direction de la météorologie nationale française, suivant une demande de l’Organisation météorologique mondiale, installe le 7 mai 1954 une station météorologique permanente qui détruit les derniers vestiges des naufragés de Tromelin.
Premier président de la République à le faire, le Président Macron a visité, le 23 octobre 2019, la plus grande île de l’Archipel « La Grande Glorieuse » <pour parler de biodiversité> mais aussi pour répéter que ces îles sont la France :
« Ici c’est la France, c’est notre fierté, notre richesse. Ce n’est pas une idée creuse. Les scientifiques et militaires qui sont là le rappellent. La France est un pays archipel, un pays monde […] On n’est pas là pour s’amuser, mais pour bâtir l’avenir de la planète. Ce que nous préservons ici aura des conséquences sur les littoraux, y compris dans l’Hexagone. »
Cette déclaration <a fortement déplu> à Madagascar.
Mais, il faut comprendre que ces iles représentent une richesse économique considérable. Par exemple L’îlot Tromelin permet de revendiquer le contrôle de 280 000 km² de zone économique exclusive (ZEE), ce qui fait de la France l’État contrôlant le plus vaste espace maritime au monde avec, au total, 11,7 millions de kilomètres carrés de ZEE. Concrètement, la ZEE permet notamment le contrôle des droits de pêche et d’exploitation d’éventuelles autres ressources. Un enjeu de taille pour une telle surface.
Je ne connaissais pas cette histoire, mais elle a depuis de nombreuses années suscitée l’intérêt et divers travaux.
La première fût une expédition archéologique « Esclaves oubliés » menée par Max Guérout, ancien officier de la marine française et directeur des opérations du Groupe de recherche en archéologie navale et Thomas Romon, archéologue à l’Inrap, a lieu d’octobre à novembre 2006. L’expédition sonde l’épave de L’Utile et fouille l’île à la recherche des traces des naufragés dans le but de mieux comprendre leurs conditions de vie pendant ces quinze années.
Selon Max Guérout, chef de la mission, « En trois jours, un puits de 5 mètres de profondeur est creusé. Cela représente un effort considérable. » « On a retrouvé de nombreux ossements d’oiseaux, de tortues, et de poissons. » « L’arrivée de ces naufragés a dû causer une véritable catastrophe écologique pour l’île. »
Des soubassements d’habitations fabriquées en grès de plage et corail sont également mis au jour (les survivants transgressèrent ainsi une coutume malgache selon laquelle les constructions en pierre étaient réservées aux tombeaux. On retrouva aussi six gamelles en cuivre réparées à de nombreuses reprises et un galet servant à affûter les couteaux. Le feu du foyer est maintenu pendant quinze ans grâce au bois provenant de l’épave, l’île étant dépourvue d’arbres.
D’autres expéditions suivirent cette première.
Wikipedia nous apprend ainsi que cette histoire a inspiré le livre « Les Naufragés de l’île Tromelin » d’Irène Frain paru en 2009.
En octobre 2010, les éditions du CNRS et l’INRAP ont publié « Tromelin : L’île aux esclaves oubliés », un ouvrage scientifique destiné au grand public, rédigé par Max Guérout et Thomas Romon.
Parue en 2015, la bande dessinée Les esclaves oubliés de Tromelin de Sylvain Savoia raconte de façon croisée le naufrage et la vie des rescapés sur l’île Tromelin et l’expédition de fouille de 2010.
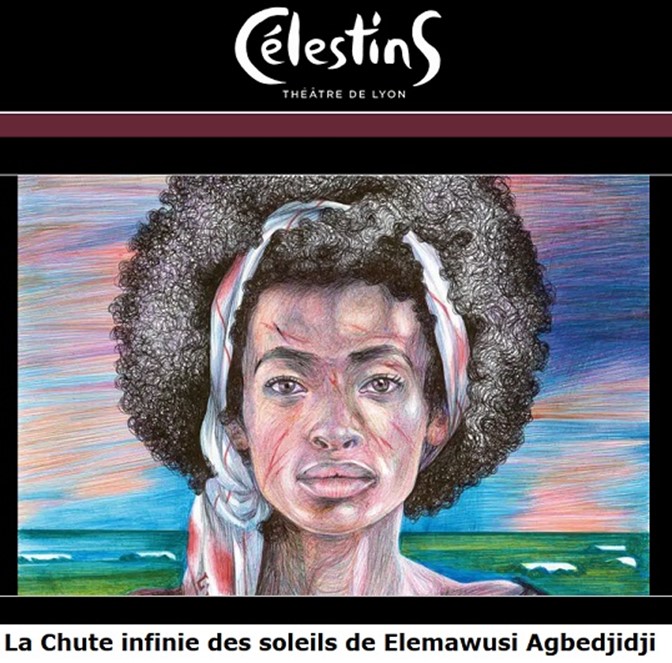 Il existe de nombreuses ressources sur Internet :
Il existe de nombreuses ressources sur Internet :
Deux vidéos d’une heure environ :
Un documentaire de 2013 de TV5 Monde <Les esclaves oubliés de l’île Tromelin>
Une conférence du 18 février 2019 au Musée de l’homme : <Tromelin : Bilan des recherches archéologiques>
Et ces pages d’information :
« France Info » : «Tromelin, l’île des esclaves oubliés » une exposition au musée de l’Homme à Paris, en février 2019.
Un article très détaillé de « Ouest France » : « Le tragique destin des esclaves oubliés de l’île Tromelin »
« L’INRAP » : Un dossier thématique conçu en lien avec l’exposition « Tromelin, l’île des esclaves oubliés » présentée au Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, du 17 octobre 2015 au 30 avril 2016.
« Geo » : <Tromelin : comment des esclaves naufragés ont survécu pendant 15 ans sur une île déserte>
Une page de « Radio France » : « L’histoire des esclaves oubliés de Tromelin en quelques images »
Il y a bien sûr la Page consacrée au spectacle du Théâtre des Célestins : <La chute infinie des soleils>
Le livre de cette pièce a été publié aux <éditions théâtrales>
<1787>
-
Lundi 8 janvier 2024
« Réfléchir c’est supporter le doute, car c’est précisément quand on ne supporte plus le doute que l’on cesse de réfléchir. »Charles Pépin« Réfléchir » est un verbe qui m’intéresse.
Je pense que j’essaie de réfléchir pour écrire les mots du jour.
Je suppose et j’espère que celles et ceux qui me font l’honneur de lire le mot du jour souhaitent aussi réfléchir.
Mais que veut dire « réfléchir » ?
Le premier sens de réfléchir, n’est pas de penser mais de renvoyer, comme le fait un miroir qui réfléchit.
Ce qui a permis à Jean Cocteau de faire un jeu de mots sur les deux sens :
« Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images. »
Le sang d’un poète, Jean Cocteau, 1930
Étymologiquement « réfléchir » vient du latin, « reflectere » qui signifie « courber en arrière, recourber; ramener »,
Le sens de « penser » est second et c’est un sens figuré comme ont peut le lire dans le dictionnaire de l’Académie française :
« Arrêter sa pensée sur un sujet, fixer sur lui son esprit, son attention pour le considérer plus avant.
Réfléchir à un problème, à une situation. Réfléchissez à cette proposition. J’ai réfléchi à ce que vous m’avez dit. Réfléchir sur sa vie. »
Pour le Littre il s’agit de :
« Penser mûrement et plus d’une fois à quelque chose. »
Ce dictionnaire de référence précise que :
« Le sens de penser, méditer, se rattache à l’expression latine reflectere animum, reporter son esprit sur quelque chose. »
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, toutes ces définitions ne nous permettent pas vraiment d’avancer sur la compréhension de ce verbe.
Le Larousse nous donne cependant quelques éclairages, non dans la définition qu’il donne : « Concentrer son attention sur une idée, une question » mais plutôt en donnant certaines citations sur ce verbe :
« Réfléchir, c’est nier ce que l’on croit. »
Émile Chartier, dit Alain (Mortagne-au-Perche 1868-Le Vésinet 1951) « Propos sur la religion, P.U.F. »
« Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes, qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir. »
Henri Poincaré (Nancy 1854-Paris 1912) : « La Science et l’hypothèse, Flammarion »
« Réfléchir, c’est déranger ses pensées. »
Jean Rostand (Paris 1894-Ville-d’Avray 1977) « Pensées d’un biologiste, Stock »
Heureusement, il y a Charles Pépin, né en 1973 à Saint-Cloud, philosophe et romancier.
Il a notamment écrit : « Les Vertus de l’échec » Allary Éditions, 2016. Et en 2023, il a publié « Vivre avec son passé ».
Et, le samedi matin à 8h50, sur France Inter, dans « La Question Philo » il répond aux questions que lui posent les auditeurs.
C’est une sorte de GPT humain, pour le replacer dans un contexte de compréhension contemporaine.
Pour les « vieux » il s’agit d’un exercice de philosophie qui essaye de répondre aux questions qu’on lui pose.
Une auditrice lui a posé cette question qui m’intéresse : « Qu’est-ce que réfléchir ? ».
Sa réponse m’a convaincu et c’est pourquoi je la partage aujourd’hui avec vous.
Si vous préférez l’écouter, il suffit de suivre le lien : < Qu’est-ce que réfléchir ? >
Il commence d’abord à donner les antonymes, c’est-à-dire ce que ne signifie pas réfléchir :
« Réfléchir n’est pas balancer son opinion, car « l’opinion est du genre du cri », écrit Platon dans le Philèbe, et réfléchir ce n’est pas crier, ce serait plutôt cheminer en silence ou, si ce n’est pas en silence, avec une forme de joie de penser qui exclut le cri et s’accommode de l’humilité, de la prudence…
Réfléchir n’est pas exprimer sa conviction car bien souvent nos convictions sont non réfléchies. […}
Réfléchir n’est pas vouloir avoir raison à tout prix, mais bien plutôt savoir reconnaître qu’on a tort.
Réfléchir n’est pas non plus crier son identité, et c’est bon de le rappeler aujourd’hui que chaque débat devient une polémique au cœur de laquelle chacun semble jouer son identité toute entière
Réfléchir n’est pas non plus chose purement intellectuelle, coupée du corps, des émotions et des affects car on réfléchit aussi, évidemment, avec son corps, et c’est pourquoi d’ailleurs, comme Socrate en son temps accompagnant ses interlocuteurs, on réfléchit très bien en marchant, on met sa pensée en mouvement en même temps que ses jambes. »
Et il cite alors Platon qui appelait, « réfléchir, penser », « un dialogue de l’âme avec elle-même. »
Et il dit enfin, de manière positive, ce que signifie pour lui réfléchir :
« Réfléchir, c’est revenir à soi comme le rayon qui se réfléchit sur le miroir, revenir à soi après avoir écouté d’autres arguments, d’autres points de vue, et faire résonner ce voyage au cœur de sa raison, de sa pensée
Dans réflexion, il y a donc résonner avec un « é » et pas simplement raisonner avec « ai ». Et c’est pourquoi, quand je réfléchis, je me sens vivant, vivant de m’ouvrir à d’autres avis que les miens, vivant de douter et surtout de supporter le doute, car c’est précisément quand on ne supporte plus le doute que l’on cesse de réfléchir et sombre dans l’idéologie, qu’Hannah Arendt définissait parfaitement comme l’enfermement dans la logique d’une idée : « idéologie, enfermement dans la logique d’une idée »
Réfléchir, c’est avoir en horreur l’idéologie autant que la certitude, bref tout ce qui est figé, mortifère, et voilà pourquoi on ressent lorsque l’on pense vraiment cette joie de penser qui est une expression de notre vitalité. Montaigne dans les Essais dit penser « par sauts et gambades », réfléchir c’est cela, des sauts et des gambades, des élans et des écarts, des ivresses et des retours en arrière, du concret à l’abstrait et de l’abstrait au concret »
Autrement dit, pour celles et ceux qui ont une explication unique du monde, (la lutte des classes, la culpabilité de l’Occident, nos difficultés provenant exclusivement des immigrés, des musulmans, des USA, des chinois etc…, et enfin toutes celles et ceux qui adhérent de manière exclusive à une croyance ou une religion) il ne leur est pas impossible de réfléchir, mais pour eux, c’est très compliqué.
J’ai entendu récemment un historien qui a affirmé qu’il y avait après la guerre des tenants de « la lutte des classes » qui ont nié la shoah à cause de l’argumentaire suivant : les allemands qui disposaient d’une main d’œuvre gratuite, esclave, ne pouvaient pas se priver de cette ressource pour des raisons économiques, en la tuant sans l’utiliser.
Et Charles Pépin continue :
« Réfléchir c’est rebondir, faire preuve de sens critique, être intranquille toujours, en éveil, réactif, et voilà pourquoi je crois toute vraie pensée est sceptique, voilà pourquoi je crois la vraie philosophie, celle qui est à l’extrême opposé de l’idéologie, est le scepticisme, et j’aurais même envie de dire : le scepticisme gai
Réfléchir, c’est assumer sa pleine humanité : nous sommes au monde, c’est déjà une bonne nouvelle, même si ce monde ne tourne pas rond, mais nous ne nous contentons pas d’être au monde – nous le questionnons, nous l’interrogeons, nous le pensons, car ce monde, et notre être au monde, ne vont pas de soi
Réfléchir, c’est enfin être ensemble, être ensemble jusque dans nos désaccords, et c’est bien en quoi réfléchir ne relève pas simplement d’une logique de l’opinion, car nos opinions nous opposent, tandis que réfléchir ensemble nous rapproche et nous rappelle ce que nous avons en commun : ce monde dont l’existence ne va pas de soi et cette raison curieuse, inquiète, intranquille, par laquelle nous essayons de le penser
Comment notre existence peut-elle être à la fois si miraculeuse et si douloureuse ? Réfléchir, ce n’est pas se prendre la tête mais prendre cette question à bras le corps et découvrir alors que nous n’avons pas besoin d’avoir la réponse pour nous trouver, tout contre cette belle question, au cœur même de la joie de penser, plus humains, et plus vivants »
Je ne pense pas que ChatGPT aurait donné réponse plus pertinente, sauf si cette IA était allée plagier la réflexion d’un humain philosophe qui pense, qui doute et qui considère la question plus essentielle que la réponse.
Je nous souhaite à tous de continuer à essayer de réfléchir ainsi.
<1786>
-
Vendredi 5 janvier 2024
« Mais, n’y a-t-il que les nazis pour fonctionner ainsi ? »Boris CyrulnikL’année 2023 a été terrible pour sa violence, les guerres qui nous sont rapportées par les Médias.
Bien sûr des hommes cultivés pourront nous rappeler que ce n’était pas mieux avant.
Que le XXème siècle avec ses deux guerres mondiales, ses génocides contre les arméniens, les juifs, les tziganes, les tutsis, ses régimes exterminateurs nazis, staliniens, maoïstes, khmers rouges constituent, pour l’instant, une norme d’horreur insurpassable.
Mais il me parait essentiel de toujours revenir à l’Histoire pour essayer d’apprendre et comprendre, les mécanismes de la sortie des valeurs de l’humanisme.
En faisant les ménage dans ma boite courriels, je suis tombé sur un article de Boris Cyrulnik que j’avais envoyé en 2005 à quelques-uns de mes amis.
Je l’ai relu et j’ai perçu toute son actualité. C’est pourquoi, je partage cet article aujourd’hui. J’ai aussi été saisi par sa phrase de conclusion que j’ai utilisée comme exergue.
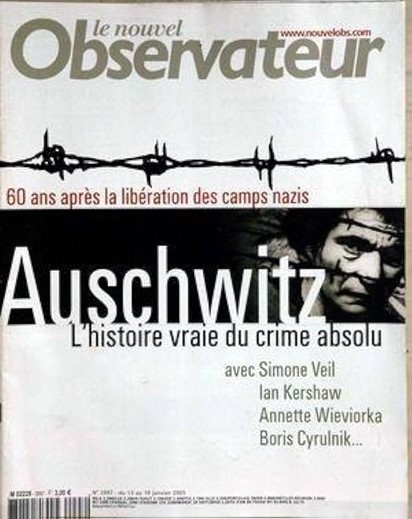 Boris Cyrulnik a écrit cet article dans le numéro 2097 du « Nouvel Observateur », paru le 13 janvier 2005.
Boris Cyrulnik a écrit cet article dans le numéro 2097 du « Nouvel Observateur », paru le 13 janvier 2005.
Il s’agissait d’un numéro consacré aux 60 ans de la libération des camps nazis.
Parmi ces camps, la libération du camp de concentration d’Auschwitz a lieu le 27 janvier 1945. L’Armée rouge libère environ 7 000 survivants. Plus d’un million de victimes ont péri dans ce camp de concentration et centre d’extermination nazi.
Le titre de son article était : « Auschwitz : Les anges exterminateurs »
Le grand psychiatre n’était qu’un enfant quand ses parents ont été raflés à Bordeaux.
Ils ont disparu à Auschwitz. Lui-même arrêté, il a réussi à s’enfuir.
Soixante ans après, cette expérience continue de nourrir sa réflexion sur le nazisme. Et sur la nature humaine… :
« J’avais 6 ans et demi quand, une nuit, j’ai été arrêté par des inspecteurs français portant des lunettes noires. Les policiers m’ont poussé vers la porte où des soldats allemands constituaient avec leurs fusils une haie qui orientait vers des camions. La rue était barrée. Le silence et l’ordre régnaient. Un inspecteur a dit qu’il fallait m’éliminer parce que plus tard je deviendrais un ennemi de la société. J’ai appris cette nuit-là que j’étais destiné à commettre une faute qui méritait une mise à mort préventive.
Soixante ans plus tard, je pense que ce policier a dû éprouver un merveilleux sentiment d’ange exterminateur. En participant avec tant de compétence à une série de coups de filet qui ont tué 1645 adultes et 239 enfants sur les 240 raflés, il a obéi à un ordre moral.
On peut tuer des innocents sans éprouver de culpabilité quand l’obéissance est sacralisée par la culture. La soumission déresponsabilise le tueur puisqu’il ne fait que s’inscrire dans un système social où l’assujettissement permet le bon fonctionnement.
Ce qui compte dans ce cas, c’est l’objectif et non pas la relation. Et même le mot « obéissance » désigne des sentiments différents selon le contexte où il est prononcé.
Quand deux personnes s’affrontent, celui qui obéit éprouve un sentiment de défaite. Tandis que le simple fait d’appartenir à un groupe ennoblit l’obéissance, puisque celui qui se soumet donne le pouvoir à sa communauté grâce à sa subordination.
Quand l’âme du groupe, un dieu, un demi-dieu, un chef ou un philosophe, propose un merveilleux projet d’épuration, c’est au nom de l’humanité que la personne obéissante participe au crime contre l’humanité.
Dès l’âge de 6 ans, il m’a fallu comprendre que ce qui gouverne un groupe ne correspond pas toujours à ce qui gouverne les individus qui composent ce groupe.
Chaque soir, dans la synagogue de Bordeaux transformée en prison, un soldat venait s’asseoir près de moi pour me montrer une photo de sa famille. Je ne comprenais pas ses mots mais je sentais clairement qu’il avait besoin de parler de ses proches et de son petit garçon qui, d’après ses gestes, avait mon âge et me ressemblait.
Plus tard, j’ai vu ce gentil papa frapper à coups de crosse les enfants qui ne se dirigeaient pas assez vite vers les wagons à bestiaux de la gare Saint-Jean. Quand cet homme venait, le soir, me parler de son fils, il répondait à un besoin d’affection. Quand ce soldat poussait les enfants vers les wagons scellés, il obéissait à une représentation théorique qui récitait les slogans du demi-dieu que sa collectivité vénérait.
Depuis ce jour, la récitation des certitudes m’alarme et la vulnérabilité des hommes m’attendrit.
Dès l’âge de 6 ans, il m’a fallu comprendre que mes geôliers se soumettaient avec ravissement, afin de participer à un triomphe.
Aujourd’hui, je pense que peu de personnalités sont capables d’échapper à une pression culturelle qui apporte tant de bénéfices : l’affection des siens, l’estime de soi, la griserie de l’appartenance et la noblesse d’un projet moral épurateur fondé sur une croyance en une surhumanité.
C’est délicieux d’être gouverné par un demi-dieu, ça déresponsabilise, ça supprime l’angoisse.
Quand le « moi » est fragile, le « nous » sert de prothèse et les hommes d’appareil aiment grimper l’échelle des valeurs qui leur sont imposées.
Leur facilité à apprendre les récitations, leur aptitude à faire marcher le système et leur art de la relation les placent rapidement en haut de l’échelle, quelle qu’elle soit.
Ce qui compte pour eux et provoque leur bonheur, c’est de grimper.
Le moindre doute briserait leur rêve d’une société épurée.
Seul un traître peut remettre en cause un si beau projet. Cette heureuse affiliation engage les personnalités conformistes dans une relation perverse, où l’emprise sur l’autre et sa disparition se programment au nom du Bien. Dans tout génocide, le tueur se sent innocent puisqu’il transcende le massacre et, en cas de défaite, explique qu’il n’a fait qu’obéir. Le soumis-triomphant ne se pense pas comme une personne, mais comme un rouage, ce qui provoque sa fierté.
A la Libération, de Gaulle a été accueilli au Grand Hôtel à Bordeaux. On m’a demandé de lui offrir un bouquet de fleurs. La nuit, un milicien s’est infiltré afin d’assassiner le Général. L’homme a été attrapé et lentement lynché, un coup de poing par-ci, un coup de crosse par-là. Il est mort, tué par mes libérateurs, des hommes que j’admirais. Ce jour-là, il m’a fallu comprendre que l’ambivalence est au cœur de la condition humaine et que la vengeance aussi est une soumission au passé.
Le processus qui permet d’exterminer un peuple sans éprouver de sentiment de crime est toujours le même. En voici la recette :
- D’abord, il faut le désocialiser afin de le rendre vulnérable. Personne n’a protesté quand une des premières lois de Pétain a décrété la réquisition des vélos des avocats juifs. Ce n’est pas grave, entendait-on, tant qu’on respecte les personnes. Mais dans une société dépourvue d’essence et de voiture, un homme sans vélo ne peut plus travailler.
- Puis il convient de parler de ce groupe humain en employant des métaphores animales : « des rats qui polluent notre société », « des vipères qui mordent le sein qui les a nourries »
- Quand on arrive enfin à la démarche administrative signée par un représentant du demi-dieu ou énoncée à la radio par un porte-parole du maître, il devient possible de mettre à mort ce peuple sans éprouver de culpabilité car « ce n’est pas un crime tout de même d’éliminer des rats » !
Surhommes dérisoires soumis à des demi-dieux absurdes, les nazis ont provoqué une déflagration mondiale, un massacre inouï pour une bagatelle idéologique, une théorie navrante. Ils ont cru à une représentation incroyable, ils ont récité des fables riquiqui où ils se sont donné un rôle grandiose.
Le panurgisme de ces moutons intellectuels leur a offert une brève illusion de grandeur. Ils avaient besoin de haine pour légitimer et exalter leur programme délirant, car dans le quotidien c’est la banalité et la soumission qui caractérisaient leur projet.
Mais, n’y a-t-il que les nazis pour fonctionner ainsi ? »
Boris Cyrulnik
Je ne veux pas affaiblir ce propos, en pointant tel ou tel groupe humain dans son comportement actuel à l’égard d’un autre.
Je veux en rester au niveau de l’observation des mécanismes qui conduisent à des comportements d’inhumanité et au constat que des humains qui, par ailleurs, ont des comportements familiaux et sociaux normalement bienveillants, sont capables de tels comportements.
- Le premier élément du mécanisme est de déshumaniser l’autre, celui qui appartient au groupe humain qui est considéré comme l’ennemi. On dira de lui qu’il s’agit d’un rat, d’un serpent, d’une vermine, d’un insecte… toute catégorie de vivants qu’il semble normal d’exterminer.
- Le deuxième élément est l’adhésion à un narratif religieux, raciste, nationaliste ou une utopie qui croit en un monde parfait, une fois éliminé les nuisibles.
- Ces deux éléments permettent à un homme d’être affectueux, prévenant, généreux avec les siens qui sont des humains et monstrueux avec les autres qui ne le sont pas dans son imaginaire.
Les enfants de Klaus Barbie ont affirmé que leur père n’était pas capable des horreurs que la justice et que ses victimes dénonçaient.
On attribue à Léon Tolstoï cette citation pleine de sagesse :
« Si vous ressentez de la douleur, vous êtes vivant, si vous ressentez la douleur des autres vous êtes un être humain… »
<1785>
- D’abord, il faut le désocialiser afin de le rendre vulnérable. Personne n’a protesté quand une des premières lois de Pétain a décrété la réquisition des vélos des avocats juifs. Ce n’est pas grave, entendait-on, tant qu’on respecte les personnes. Mais dans une société dépourvue d’essence et de voiture, un homme sans vélo ne peut plus travailler.
-
Vendredi 29 décembre 2023
« Il n’y a pas de chemin pour la paix – la paix est le chemin. »Vivian SilverJ’ai déjà évoqué Vivien Silver, lors du mot du jour du 17 novembre 2023 : « C’était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table […] »
 Vivian Silver, militante pacifiste israélienne a été assassinée par des terroristes du Hamas le 7 octobre.
Vivian Silver, militante pacifiste israélienne a été assassinée par des terroristes du Hamas le 7 octobre.
Canadienne, elle était arrivée en Israël il y a cinquante ans, avec plusieurs membres du mouvement Habonim, des sionistes socialistes.
<La Croix> la présente ainsi :
« Née à Winnipeg au Canada, Vivian Silver part en 1968 étudier la psychologie et la littérature anglaise à l’Université hébraïque de Jérusalem.
Après un bref retour au Canada, elle s’envole à nouveau pour Israël en 1974, quelques mois après la guerre de Kippour qui a fait plus de 2 700 morts côté israélien et près de 20 000 au sein de la coalition arabe.
Vivian Silver part en compagnie d’un groupe de jeunes Nord-Américains qui cherchent à rétablir le kibboutz Gezer, situé dans le centre d’Israël, précise le journal Haaretz.
Là, elle promeut l’égalité des genres au sein du kibboutz et dirige des projets de construction.
L’activiste est aussi un membre actif de l’organisation Chemin vers la guérison, qui transporte gratuitement des patients gazaouis – majoritairement des enfants – jusqu’aux hôpitaux israéliens, où ils peuvent être correctement soignés.
En 1998, Vivian Silver devient directrice exécutive de l’Institut du Néguev pour les stratégies de paix et de développement. L’organisation installée à Beersheba, dans le sud d’Israël, promeut la paix au Moyen-Orient, ainsi qu’un modèle de société partagée entre Juifs et Arabes.
Elle travaille d’abord en lien avec des organisations palestiniennes, avant de se concentrer ensuite sur le sort des communautés bédouines locales.
Vivian Silver milite pour la formation et l’autonomisation de cette minorité d’Arabes musulmans vivant dans le désert du Néguev, rattachée à Israël mais qui conserve des liens étroits avec les Territoires palestiniens.
Juste après la guerre de Gaza de 2014, Vivian Silver participe à la création d’une association féministe et pacifiste israélo-palestinienne, Women Wage Peace (« Les femmes mènent la paix »), qui rassemble plus de 45 000 membres. Un mouvement « non partisan, qui ne soutient aucune solution au conflit » israélo-palestinien et qui milite pour une plus grande représentation des femmes dans les négociations diplomatiques, assure l’organisation.
Vivian Silver a remporté de nombreux prix pour son engagement pour la paix tout au long de sa vie, dont le prix Victor J. Goldberg pour la paix au Moyen-Orient en 2011. « Elle se bat pour la justice, c’est une mère et grand-mère fantastique », avait déclaré Yonatan Zeigen, le fils de Vivian Silver, quelques jours après l’attaque du Hamas. »
Cet article : « Le Hamas n’a pas tué ton rêve » décrit ses obsèques et l’éloge funèbre de ses amis qui éclairent aussi la personnalité de cette femme exceptionnelle :
« Des centaines de proches, Juifs et arabes, de la pacifiste israélo-canadienne Vivian Silver ont rendu hommage jeudi à une « femme hors du commun » et « porteuse d’espoir » tuée lors de l’attaque du groupe terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre.
Ils se sont réunis au kibboutz Gezer, dans le centre d’Israël, où la militante avait vécu dans les années 1970. Elle a été assassinée à l’âge de 74 ans dans sa maison du kibboutz de Beeri, proche de la bande de Gaza.
Venues d’horizons très divers, les personnes qui ont pris la parole ont dit leur profonde douleur face à la mort de Silver mais aussi leur détermination à poursuivre les causes pour lesquelles elle se battait : la paix et le féminisme.
En larmes, son amie Ghadid Hani, une arabe israélienne de Hura, ville bédouine du sud d’Israël, qui militait avec elle au sein de WWP, a raconté son dernier échange avec Vivian Silver durant l’attaque du Hamas.
« Tu m’as dit que ça allait mais que tu entendais des bruits et puis mes messages n’ont plus reçu de réponses », raconte Mme Hani, vêtue de noir et voilée, une écharpe bleue azur autour du cou, un des symboles du mouvement WWP.
« Tu disais que l’obscurité ne se repousse que par la lumière, comme j’aimerais que tu sois là pour apporter de la lumière et de l’espoir comme tu le faisais toujours », ajoute-t-elle.
« Ma chère Vivian, si tu m’entends, je veux te dire que le Hamas n’a pas tué ton rêve. »
« Il est impossible de détruire l’humanité, la solidarité, le désir d’un avenir plus sûr », a ajouté Hani. […]
« Le seul moyen de vivre en sécurité ici c’est de faire la paix », répétait Mme Silver, selon son fils Yonatan Zeigen.
« Nous, les vivants, continuerons à briller, à persévérer et à faire tout pour apporter le lendemain dont tu parlais toujours. Avec ton absence, je suis retombé amoureux des mots comme paix, égalité des sexes et fraternité », a déclaré M. Zeigen, lors de la cérémonie. »
C’est en lisant un article d’« AOC » : rédigé par l’historienne Naomi Sternberg : <Le monde a oublié le camp de la paix israélien et palestinien> que j’ai vu la phrase que j’ai mise en exergue parce qu’elle était citée par l’autrice au début de son article :
« Il n’y a pas de chemin pour la paix – la paix est le chemin. »
Mais la Paix, n’est pas une chose qui va de soi. Il faut la construire.
Ce n’est pas une histoire d’amour, une brusque révélation de la bonté et de la morale.
Dans un remarquable entretien, en accès libre, mené par Edwy Plenel, Elias Sanbar, ambassadeur de la Palestine auprès de l’Unesco, explique : « j’ai compris que la paix était une affaire très violente »
Elias Sanbar est né le 16 février 1947 à Haïfa, en Palestine mandataire, dans l’actuel Etat d’Israël.
Sa famille sera exilée au Liban après la proclamation de l’État d’Israël
C’est un historien, poète et essayiste palestinien.
Il fut aussi le commissaire de l’exposition « Ce que la Palestine apporte au monde » qui a eu lieu à l’Institut du monde arabe entre le 31 mai et le 31 décembre 2023.
Il a participé aux négociations bilatérales à Washington et dirigé, de 1993 à 1996, la délégation palestinienne aux négociations sur les réfugiés.
Et c’est l’expérience de ces négociations qui lui font dire :
« Vous savez, on subit beaucoup le fait que nous nous faisons violence.
Je vais vous dire dans mon vécu à moi, moi j’ai haï être face, quand j’ai été à des négociations, j’ai haï être en face d’une délégation israélienne.
Je ne pouvais pas les voir en peinture parce que je me disais : Tu es face aux gens qui ont fait ton malheur, qui ont fait que ton père est mort en exil en pleurant. Tu es face à eux.
Je me suis fait une violence inouïe pour leur parler.
Je n’y suis pas aller en disant : « ça va être formidable, on va s’aimer. »
Non pas du tout !
Et petit à petit, j’ai compris que la paix était une affaire très violente.
La différence entre la paix et la guerre, ce n’est pas que l’une est violente et l’autre non.
Les deux sont très violentes.
Dans la guerre, vous dirigez la violence contre votre adversaire, dans la paix vous la dirigez contre vous-même, pour accepter de parler avec celui que vous pensez être l’artisan de votre malheur.
Ce n’est pas un voyage d’agrément.
Les négociations contrairement à ce que beaucoup pensent, c’est très violent, mais c’est une violence faite à soi. »
Cet extrait commence derrière <ce lien>
Je vous conseille d’écouter cet entretien dans son ensemble car il est d’une grande intelligence et humanité : « Ce que la Palestine dit au monde »
Il me semblait essentiel de finir cette année 2023 par l’affirmation de ce combat, de cette conviction que c’est la paix qui est le chemin.
Toute cette violence ne résoudra rien.
Le Hamas est une idée, on ne peut pas éradiquer une idée avec des bombardements mais par une autre idée qui paraîtra plus désirable.
Daniel Barenboïm disait : « Nous avons le choix : nous entretuer ou apprendre à partager ce qui peut se partager. »
Les enfants qui auront survécu sous ce déluge de bombe et auront vu mourir leurs proches, auront la violence au cœur et ne penseront qu’à se venger.
Sauf si une autre solution peut leur être proposée, une solution qui leur paraîtra désirable et pour laquelle ils auront l’énergie de diriger cette violence vers eux même pour faire la paix.
La paix est le chemin, Vivian Silver avait raison.
<1784>
-
Mercredi 27 décembre 2023
« 18 mois de vie. »Clémentine VergnaudC’est le 15 juin 2022, que Clémentine Vergnaud a appris qu’elle souffrait d’un cancer des voies biliaires, rare, très agressif : le cholangiocarcinome.
Elle avait décrit son combat, ses espoirs, sa peur et ses relations avec les médecins et l’administration dans une série de 10 podcasts : « Ma vie face au cancer : le journal de Clémentine. » publiée en juin 2023.
J’ai commencé à écouter le premier, puis tous les autres d’une seule traite, lors d’une longue promenade.
Je concluais le mot du jour que je lui ai consacré : « La mort est au bout du chemin, mais elle s’est un peu éloignée. » par cette exclamation : Un monument d’humanité !
Son podcast était une manière de « laisser une trace », comme elle l’expliquait sur le plateau de « C à vous ».
 Elle n’a pas fêté Noël, elle est morte le 23 décembre 2023 au matin, 18 mois et quelques jours après le diagnostic de sa maladie. Elle avait 31 ans.
Elle n’a pas fêté Noël, elle est morte le 23 décembre 2023 au matin, 18 mois et quelques jours après le diagnostic de sa maladie. Elle avait 31 ans.
Début octobre, elle donnait des nouvelles peu rassurantes sur sa santé sur le réseau social X, tout en annonçant l’enregistrement de la saison 2 de son podcast. Elle écrivait :
« Vous êtes plusieurs à demander de mes nouvelles, à vous inquiéter de mon silence. Je vais bien, rassurez-vous. Mais les deux dernières semaines ont été compliquées. Je suis passée à un cheveu de la mort à cause d’un grave accident cardiaque. Maintenant, je me remets doucement ».
Elle travaillait à France Info. Ses collègues lui ont rendu <Hommage> :
« La rédaction de franceinfo a perdu l’une des siennes, une femme merveilleuse, une journaliste de grand talent, une amie pour beaucoup. […]
Pendant ces longs mois où elle a combattu la maladie, Clémentine a fait preuve d’un courage incroyable, d’une détermination sans faille et d’une immense joie de vivre.
Sa force de caractère et sa lucidité, nous les avons tous entendues dans le podcast « Ma vie face au cancer » qu’elle avait tenu à faire pour raconter sa vie avec la maladie.
Dans ce podcast, […] Elle a apporté beaucoup aux malades, à leurs proches, aux soignants. Avec une telle justesse des mots et des émotions.
[…] Jusqu’au dernier moment, Clémentine a voulu profiter de ses « moments dorés » : chaque plaisir, chaque bonheur qui passait à sa portée. « La fin, elle est connue, nous disait-elle, il n’y a pas trop de mystère. Mais il y a tout ce qui va y mener et je n’ai pas envie de gâcher ces moments. Aucun de ces moments. »
Clémentine, c’était un rire, un sourire, une voix.
Et cette voix, parce que c’est ce qu’elle a voulu, nous continuerons à l’entendre. »
Cette jeune femme qui a dit « Je ne suis pas une battante. En fait, je n’ai juste pas le choix » a donné une immense leçon : elle a vécu aussi intensément que possible les 18 mois de vie qui lui restait à vivre après son terrible diagnostic.
L’oncologue canadien Gabriel Sara qui avait joué son propre rôle dans ce merveilleux film « De son vivant » avait révélé cette tragédie dans la tragédie : « Mourir de son vivant », c’est-à-dire ne pas vivre ce qui reste à vivre :
« On peut mourir de son vivant. On le voit chez Benjamin. Au fur et à mesure que son corps s’affaiblit, son esprit devient paradoxalement plus puissant. Il prend le contrôle de sa vie, il règle son histoire avec son fils, il pardonne à sa mère, il transmet à ses élèves tout ce qu’il a de plus beau à donner. Alors que son corps est foutu, lui vit plus intensément que jamais. Il n’a jamais été aussi en contrôle de sa vie. Et c’est merveilleux. »
Et il parle de cette mission sacrée qui doit être celle des médecins, de l’être humain malade et de sa famille :
« Face à un patient condamné, ma mission sacrée est de l’accompagner pour que les années, les mois et jusqu’aux minutes qu’il lui reste, soient de beaux instants de vie et pas d’agonie. Quand mon patient meurt, je suis triste bien sûr, mais j’ai le sentiment du devoir accompli. Pour un cancérologue, c’est une satisfaction énorme. »
Je crois que Clémentine Vergnaud a porté haut cette mission sacrée de vivre les « 18 mois de vie. » qui lui restait.
Comme souvent, ces derniers temps, je terminerai par un texte de Christian Bobin qui écrivait lors d’un entretien avec le journal « La Vie » en 2019 :
« Ceux qui ont disparu mêlent leur visage au nôtre.
Nous sommes étroitement liés, souterrainement, dans une métamorphose incessante.
C’est pourquoi il est impossible de définir aussi bien la vie que la mort.
On ne peut que parler d’une sorte de flux qui sans arrêt se transforme, s’assombrit puis s’éclaire de façon toujours surprenante.
La mort a beaucoup de vertus, notamment celle du réveil.
Elle nous ramène à l’essentiel, vers ce à quoi nous tenons vraiment. »<1783>
-
Dimanche 24 décembre 2023
« Éclaire ce que tu aimes sans toucher à son ombre. »Christian Bobin, exergue de son livre « Éloge du rien »Dans les pays chrétiens et même au-delà nous fêtons Noël.
 C’est-à-dire la nativité de Jésus, personnage central du Christianisme.
C’est-à-dire la nativité de Jésus, personnage central du Christianisme.
Je fais partie, sur un réseau social, d’un groupe d’amis de Christian Bobin. Une des participantes a accompagné l’exergue de « l’éloge du rien » : « Éclaire ce que tu aimes sans toucher à son ombre. » par une reproduction de ce magnifique tableau : Le nouveau-né.
Wikipédia explique : C’est un tableau du peintre lorrain Georges de La Tour, peint vers 1648, et conservé au musée des beaux-arts de Rennes. Cette huile sur toile représente une Nativité : la Vierge Marie tient l’Enfant Jésus emmailloté, en compagnie de sainte Anne qui éclaire la scène à la bougie.
« Chef-d’œuvre d’entre les chefs-d’œuvre » de Georges de La Tour, la toile est un sommet du clair-obscur, et tire également sa popularité du fait que les signes religieux s’effacent pour donner à la scène une portée universelle : celle de la célébration du mystère de la naissance d’un enfant. Noël est la fête de la nativité.
Car il est vrai que si Noël est une fête religieuse, aujourd’hui il s’agit aussi d’un monument de la culture occidentale qui est une fête des enfants, une fête familiale dans laquelle le fondement religieux s’est estompé.
J’ai déjà consacré plusieurs mots du jour à Noël.
En décembre 2013 : « Le cadeau de Noël. Histoire d’une invention. »
Et ce même mois, lundi 30 décembre 2013, je parlais de la persécution des chrétiens dans le monde : « Comme se fait-il qu’en Occident sécularisé, règne « le silence de Noël sur les chrétiens persécutés ? ».
Dans différents mots du jour j’ai expliqué ma réticence devant les religions monothéistes, en insistant toujours sur le désir de spiritualité des femmes et des hommes que je distinguais de la religion en reprenant ce propos percutant de Régis Debray : « La spiritualité prépare à la mort, la religion prépare les obsèques. »
Notre culture, notre calendrier, nos fêtes, Noël, restent ancrés dans notre héritage chrétien
Mais nous sommes devenus indifférents à celles et ceux qui partagent cet héritage.
« Plus de 360 millions de chrétiens ont été « fortement persécutés et discriminés » en raison de leur foi dans le monde en 2022, selon un rapport de l’ONG Portes ouvertes »
C’est ce que nous pouvons lire sur le site de <France Info>
En 2016, j’essayais simplement parler de la fête de « Noël » m’interrogeant s’il ne s’agissait pas d’une fête païenne célébrant le solstice d’hiver.
Et enfin, j’ai encore parlé de Noël, en donnant, fin 2019, <les recettes des gâteaux de Noël alsaciens>.
Pourquoi reparler de Noël, cette année ?
Parce que j’ai été interpellé par cette publication de Céline Pina :
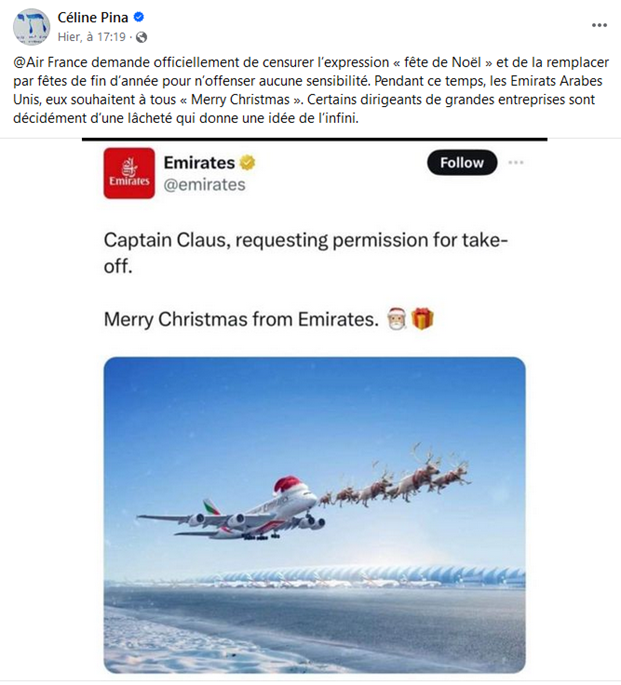
D’abord j’ai voulu vérifier, beaucoup de sources donnent la même information :
Air France demande à son personnel dans un mail interne, d’employer le terme « Joyeuses fêtes » et non « Joyeux Noël ». L’entreprise justifie ce choix :
« La marque Air France ne doit pas être associée à des fêtes religieuses, nous ne faisons pas référence à Noël. »
Et grâce à ce site, j’ai appris que Audi suivait la même politique.
Nous constatons qu’il faut attendre la compagnie d’un pays d’Islam assumé pour pouvoir encore entendre le souhait « Joyeux Noël » ou « Merry Christmas » dans un avion !
Si des personnes bien pensantes continuent à dire que le wokisme n’a pas atteint la France, je me demande comment ce comportement d’une entreprise occidentale et franco-néerlandaise peut être qualifié ? Je comprends que cette entreprise mondialisée ne veut plus assumer son occidentalité. Noël n’est pas que religieux, il est aussi un élément incontournable de la culture occidentale.
Nous avons un problème d’intégration massif, avant d’avoir des problèmes d’immigration.
Dans certaines élites, tout ce qui est occidental est suspect, ou même doit être rejeté.
Certes l’Occident a été coupable de crimes, d’avoir trahi des valeurs qu’il proclamait haut et fort.
Mais il n’est pas le seul.
L’esclavage ne fut pas le crime des seuls occidentaux, et même si on fait un calcul morbide, l’esclavage fut plus développé chez les musulmans. Et si on parle de la colonisation du monde par l’Occident qui fut un racisme et une exploitation économique, il fut précédé par la colonisation Arabe qui imposa par la force de ses armées son organisation et sa religion à un empire colonial immense.
Pour le reste la Russie, le Japon, les Ottomans et les Turcs, les pays arabes, la Chine et l’Inde n’ont rien à envier à l’Occident concernant la cruauté, les exactions, les discriminations et les inégalités.
Moi je crois qu’on ne peut pas aimer quelqu’un, si on ne s’aime pas soi-même.
Je ne crois pas que nous soyons en mesure d’intégrer d’autres cultures si nous ne sommes pas un peu fier de la nôtre et de ce que nous sommes.
Et même si Jésus n’avait jamais existé comme le prétend Michel Onfray dans son dernier ouvrage et si pour ma part je ne professe plus de croyance chrétienne, je pense sage et convivial de souhaiter « un Joyeux Noël » à nos semblables.
Je trouve que la phrase de Christian Bobin est particulièrement appropriée :
« Éclaire ce que tu aimes sans toucher à son ombre. ».
Cette phrase est l’exergue d’un tout petit ouvrage de 23 pages, « L’Éloge du rien »
Ce livre de 1990 est une réponse à une lettre qu’il avait reçue et qui lui demandait un texte pour une revue. Texte qui tenterait de répondre à cette question : Qu’est ce qui donne du sens à votre vie ?
Et après quelques variations sur la difficulté de répondre, Christian Bobin écrivit cela :
« Un mot me gêne dans votre lettre. Ce mot de « sens ».
Permettez-moi de l’effacer.
Voyez ce que devient votre question, comme elle a belle allure, à présent.
Aérienne, filante : « Qu’est-ce qui vous donne votre vie ? ».
La réponse cette fois ci est aisée : Tout.
Tout ce qui n’est pas moi et qui m’éclaire.
Tout ce que j’ignore et que j’attends.
L’attente est une fleur simple. Elle pousse au bord du temps.
C’est une fleur pauvre qui guérit tous les maux.
Le temps d’attendre est un temps de délivrance.
Cette délivrance opère en nous à notre insu.
Elle ne nous demande rien que de la laisser faire, le temps qu’il faut, les nuits qu’elle doit.
Sans doute l’avez-vous remarqué : notre attente – d’un amour, d’un printemps, d’un repos – est toujours comblée par surprise.
Comme si ce que nous espérions était toujours inespéré.
Comme si la vraie formule d’attendre était celle-ci : ne rien prévoir – sinon l’imprévisible. Ne rien attendre – sinon l’inattendu.
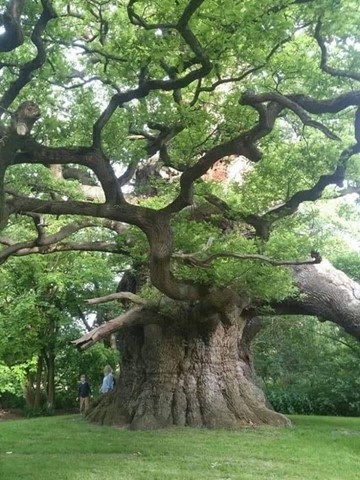 Ce savoir me vient de loin. Ce savoir qui n’est pas un savoir, mais une confiance, un murmure, une chanson.
Ce savoir me vient de loin. Ce savoir qui n’est pas un savoir, mais une confiance, un murmure, une chanson.
Il vient du seul maître que je n’aie jamais eu : un arbre.
Tous les arbres dans le soir frémissant.
Ils m’instruisent par leur manière d’accueillir chaque instant comme une bonne fortune. L’amertume d’une pluie, la démence d’un soleil : tout leur est nourriture. Ils n’ont souci de rien, et surtout pas d’un sens. Ils attendent d’une attente radieuse et tremblée.
Infinie.
Le monde entier repose sur eux.
Le monde entier repose sur nous.
Il dépend de nous qu’il s’éteigne, qu’il s’enflamme.
Il dépend d’un grain de silence, d’une poussière d’or — de la ferveur de notre attente.
Un arbre éblouissant de vert.
Un visage inondé de lumière. »
« Éclaire ce que tu aimes sans toucher à son ombre. »
Joyeux Noël !
<1782>
-
Vendredi 15 décembre 2023
« Si on laisse monter l’intolérance, elle fait naître de l’intolérance en face. »François FillonDans le conflit israélo-palestinien, les extrémistes des deux bords sont dans l’exclusion et l’élimination de l’autre.
Par exemple le ministre des finances de Nétanyahou, Bezalel Smotrich, ultranationaliste israélien, a déclaré le 19 mars 2023 dans les salons Hoche, un luxueux centre de réception près des Champs-Elysées à Paris : « Le peuple palestinien n’existe pas. »
Je cite cet article « du Monde » :
« Durant la cérémonie, M. Smotrich s’est exprimé derrière un pupitre décoré d’une carte incluant non seulement l’Etat hébreu et les territoires occupés palestiniens mais aussi le territoire de l’actuelle Jordanie : l’espace du Grand Israël pour les tenants de cette idéologie expansionniste.
Il a prononcé un discours dans lequel il a exhorté les juifs de France à faire leur alya, c’est-à-dire à s’installer en Israël, [Et il a déclaré] :
Le peuple palestinien est une invention de moins de cent ans. Est-ce qu’ils ont une histoire, une culture ? Non, ils n’en ont pas. Il n’y a pas de Palestiniens, il y a juste des Arabes. »
En face, le mouvement Hamas veut créer sur tout le territoire compris entre la Méditerranée et le jourdain et comprenant donc l’État d’Israël, un État islamique de Palestine vierge de présence juive.
Alors, je voudrais partager une vidéo aujourd’hui.
C’est un partage qui me semble plein d’enseignements à plusieurs titres.
D’abord, celui qui s’exprime est François Fillon.
Je n’ai aucune affinité avec cet homme, mais ce n’est pas une raison de ne pas l’écouter pour examiner si ce qu’il dit est pertinent.
De plus en plus de personnes n’écoutent plus que les personnes qui leurs ressemblent et professent les mêmes idées qu’eux.
Il arrive même que ce soit des présupposés qui vont conduire à ce que l’on refuse d’écouter un tel parce qu’il serait homophobe, islamophobe, antisémite, islamo-gauchiste toute qualification qui ne vont pas plus loin qu’une simple impression, une rumeur ou simplement une interprétation hâtive d’une phrase sortie de son contexte.
Pour ma part je préfère écouter les personnes et faire mon jugement ensuite.
C’est ainsi que j’ai écouté et regardé François Fillon.
J’ai vu d’abord cette petite vidéo avec comme titre : « Free Palestine ».
Vous voyez François Fillon dire :
« Il y a trois ans je rencontrais à Téhéran l’ayatollah Rafsandjani, l’ancien président iranien.
Et un moment dans la conversation, on parlait d’Israël et il me dit qu’il faut qu’il s’en aille !.
Je lui réponds
- Mais qu’est-ce que vous voulez dire ?
- Ils n’ont rien à faire en Palestine, il faut qu’ils partent.
- Vous ne pouvez pas dire cela, même si vous le pensez, de toute façon ça ne se produira pas.
- Donnez-moi une seule raison pour laquelle il pourrait rester ?
- Ben oui, ils étaient là, il y a deux mille ans.
Il éclate de rire et il me dit : nous il y a 5000 ans on était en Inde, on ne va pas y retourner.
Et là je ne sais plus quoi dire.
La vidéo s’arrête là avec une question : « et vous qu’auriez-vous répondu à la place de François Fillon ? »
Le sous-titre à cette question suggère qu’il n’y a pas de réponse et la conclusion en découle simplement : il n’y a aucune raison à ce que les juifs disposent d’un État en Palestine.
Puisque même François Fillon ne trouve rien à répondre, cette vidéo donne raison aux partisans des palestiniens qui veulent chasser les juifs de Palestine.
A ce stade, il y a encore deux enseignements :
Le premier est que la publication de cette vidéo est tronquée. Celui qui a publié a coupé à l’endroit qui lui permettait de renforcer sa thèse. Mais j’y reviendrai après.
Le second, c’est quand même que la réponse de François Fillon est très problématique : Les juifs ont le droit de créer un État juif parce qu’ils étaient là, il y a deux mille ans.
Cela fait partie du narratif d’Israël, sur lequel je reviendrai dans un mot du jour ultérieur.
Mais de manière rationnelle, ce que signifie cette prétention : ils ont droit d’être là parce qu’ils y étaient il y a deux mille ans, conduit à un concept très déstabilisant : le droit du premier occupant !
Je me souviens d’une déclaration de Valéry Giscard d’Estaing qui avait porté ce jugement définitif :
« En droit international, il n’existe pas de droit du premier occupant. »
Quand on évoque un concept de droit, il faut en examiner les conséquences.
Sainte Sophie d’Istanbul est une immense église chrétienne qui a été érigée au IVème siècle de notre ère dans la ville de Constantinople. Elle a été commandée par l’empereur romain Constantin en 325. Elle est restée une église Chrétienne Orthodoxe, comme Constantinople est resté la capitale chrétienne byzantine jusqu’à 1453. Bref 1100 ans. En 1453, immédiatement après la prise de Constantinople par les Ottomans, la basilique fut convertie en mosquée, Plus tard elle devint musée, jusqu’à ce que ce compagnon de route des frères musulmans, le président turc, Recep Tayyip Erdoğan a décidé d’en refaire une mosquée. Devant cet acte de provocation, nous devrions faire jouer le droit du premier occupant, Constantinople est musulmane depuis 570 ans, alors qu’elle a été chrétienne pendant 1100 ans. Nous devrions exiger que Constantinople redevienne Chrétienne, nous étions là avant !
J’ai voulu dans un premier exemple parler de symboles, de religions puisque ce sont des éléments très utilisés dans le conflit qui secoue le territoire entre la méditerranée et le Jourdain.
De manière plus pratique, quelle serait les conséquences d’une application du droit du premier occupant aux États Unis et au Canada ? En Australie et en Nouvelle Zélande ? Et dans tant d’autres lieux de notre planète ?
L’expliciter ainsi, montre la fragilité de cet argument et la potentialité de la violence et des conflits que cela entraînerait.
J’espère que personne n’émettra l’idée d’un Dieu qui aurait promis quelque chose.
Car si le Dieu des armées, Yahvé a promis cette terre au peuple élu, Allah a de la même manière, selon les musulmans, consacré cette terre comme Dar al-Islam, c’est-à-dire terre d’Islam.
En faire un conflit entre deux dieux qui selon ce que j’ai compris de leurs croyances, est le même, n’a aucune vocation à simplifier le problème.
Il vaut beaucoup mieux en rester à une proposition de partage de l’Assemblée générale de l’ONU qui a souhaité un état juif et un état arabe et de constater qu’aujourd’hui la disparition de l’un des deux peuples sur le territoire convoité par une épuration ethnique est inadmissible de cruauté et de haine future.
J’en reviens au premier enseignement, la manipulation.
François Fillon a d’abord été déstabilisé c’est vrai, mais, après avoir repris ses esprits il a répondu.
Et j’ai trouvé l’interview intégrale, c’était une émission de la Radio-Télévision Suisse : < Interview de François Fillon par Darius Rochebin, de la RTS>
Il évoque à partir de 22:16, la tendance de se replier sur sa communauté.
Il évoque d’abord la communauté géographique en parlant du Brexit britannique ou de la Catalogne.
Puis il parle du repli au sein de communauté religieuse.
« On voit monter une forme de sectarisme, de fondamentalisme religieux. Plutôt chez les musulmans aujourd’hui, mais qui peut demain, en réaction, appeler une sorte de fondamentalisme dans les autres religions […]
Je ne peux pas ne pas raconter cette histoire parce que je trouve qu’elle est très révélatrice.
Il y a trois ans je rencontrais à Téhéran l’ayatollah Rafsandjani, l’ancien président iranien.
Et un moment dans la conversation, on parlait d’Israël et il me dit qu’il faut qu’il s’en aille !.
Je lui réponds
- Mais qu’est-ce que vous voulez dire ?
- Ils n’ont rien à faire en Palestine, il faut qu’ils partent.
- Vous ne pouvez pas dire cela, même si vous le pensez, de toute façon ça ne se produira pas.
- Donnez-moi une seule raison pour laquelle il pourrait rester ?
- Ben oui, ils étaient là, il y a deux mille ans.
Il éclate de rire et il me dit : nous il y a 5000 ans on était en Inde, on ne va pas y retourner.
Et là je ne sais plus quoi dire.
« Et donc je rassemble toutes mes forces pour trouver une réponse et je lui dis : C’est ça, continuer comme ça : Mettez les chrétiens dehors, mettez les juifs dehors et vous ne croyez pas qu’un jour les européens voudront mettre les musulmans dehors ?
Il y a eu un peu de silence et en repartant dans la voiture je me suis dit au fond, je n’ai pas réfléchi à cette phrase, elle est brutale, elle est provocatrice, mais c’est la vérité.
Si on laisse monter l’intolérance, elle fait naître de l’intolérance en face.
On a aujourd’hui des communautés religieuses qui peuvent se radicaliser.
On a un repli communautaire ethnique. »
Je trouve cette réponse pleine de sagesse.
Les communautés chrétiennes sont aujourd’hui opprimées dans les pays musulmans. Le nombre de chrétiens a diminué de manière considérable par rapport au début du XXème siècle en Turquie, en Égypte, en Syrie, en Irak etc…
Et que personne ne se trompe, il ne s’agissait pas de chrétiens occidentaux, venant d’Europe de l’Ouest qui auraient colonisé ces pays. Pas du tout, ce sont des populations locales qui s’étaient convertis au christianisme il y a longtemps et qui lors de l’expansion de l’Islam ont refusé de se convertir à ce troisième monothéisme.
Et la situation est encore plus dégradée pour les communautés juives dans ces pays. Si les pays arabes ne voulaient pas d’Israël, il aurait été intelligent, me semble t’il, qu’ils convainquent les juifs de leurs pays de rester et qu’ils prennent les mesures adéquates pour rendre ce séjour paisible et serein.
En parallèle dans nos pays, les communautés musulmanes augmentent notamment dans le nombre de celles et de ceux qui se soumettent à des pratiques religieuses ostensibles.
Tout n’est pas parfait dans nos pays, loin s’en faut : il existe des discriminations et des intolérances mais sans commune mesure avec ce qui se passe, en Turquie, en Égypte etc.
La cohabitation des religions dans un monde tolérant et acceptant l’autre constitue un grand progrès de l’humanité.
L’empire ottoman a su pendant longtemps, jusqu’à l’arrivée au pouvoir du gouvernement jeunes turcs, réaliser grosso modo cette cohabitation paisible.
Amin Maalouf parle même de son enfance au Liban et en Égypte où cette coexistence de communautés religieuses restait harmonieuse.
Il faudrait retrouver ce chemin de la tolérance qui appelle à la tolérance chez tous.
Ce qui conduit à écarter tous les discours qui veulent chasser l’autre, comme ce discours de l’ayatollah Rafsandjani.
<1781>
- Mais qu’est-ce que vous voulez dire ?
-
Jeudi 14 décembre 2023
« Ici, dans le feu mal éteint,
Perdant, notre jeunesse par miettes,
Nous n’avons esquivé aucun
Des coups qui tombaient sur nos têtes »Anna AkhmatovaAnna Akhmatova est, selon Christian Bobin, la plus grande des poètes et des poétesses.
Dans le livre « Anthologie » qui regroupe un choix de ses textes j’ai trouvé celui-ci :
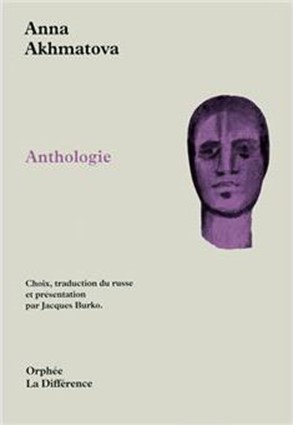 « Honte à ceux qui laissent leur terre
« Honte à ceux qui laissent leur terre
A leur ennemi triomphant ;
Leur basse louange m’indiffère,
Je leur refuserai mon chant
Mais l’exilé me reste cher,
Comme un malade, comme un captif :
Le pain d’aumône est amer,
Le regret de l’exil est vif…
Ici, dans le feu mal éteint,
Perdant, notre jeunesse par miettes,
Nous n’avons esquivé aucun
Des coups qui tombaient sur nos têtes.
Dans le décompte des faits d’armes
Seront justifiés nos destins,
Personne n’est plus sec de larmes
Plus simple que nous, et plus hautain »
Anna Akhmatova
1922
Lorsqu’on voit ce qui se passe à Gaza et qui fait suite aux massacres du 7 octobre 2023, on est saisi par une sorte de sidération et de découragement.
Évidemment si on se place dans un des deux camps, l’analyse est simple :
Pour le camp d’Israël, les massacres du 7 octobre ne peuvent pas rester impuni.
D’abord à cause de l’horreur de l’attaque, ensuite parce que cela conduit à une menace sécuritaire de tous les instants. Il faut donc punir ceux qui ont fait cela, mais aussi empêcher qu’une telle attaque puisse être réitéré.
La destruction de Gaza, une émission de France Info évoque « Gaza en miettes », s’explique dès lors par la nécessité de trouver les responsables et les combattants du Hamas afin de les neutraliser.
Pour ce faire, il y a des milliers de morts, de blessés, d’enfants, de femmes et d’hommes angoissés devant la mort qui rode, la famine qui guette, l’eau qui est rare et pollué.
Le camp d’Israël relève que les assassins du Hamas qui sont revenus à Gaza ont été célébrés par des foules en liesse. Que si ces combats sont si meurtriers, c’est parce que le Hamas se cache dans des tunnels interdits à ceux qui ne font pas partie de l’organisation.
Dans cette logique la population sans protection constituent pour eux un bouclier qui les protège. En outre, leur mort en masse constitue un excellent argument pour le Hamas pour dénoncer la violence d’Israël et essayer de faire arrêter par la communauté internationale le bras vengeur de leur ennemi.
Enfin ce camp peut encore dénoncer le fait que le Hamas s’empare de la plus grande part des denrées alimentaires que les ONG font entrer dans le territoire. Une interview en direct d’Al Jazeera montre une vieille femme palestinienne dénoncer ce fait devant un journaliste très ennuyé devant ce témoignage qui ne correspond pas au récit souhaité, mais qu’il ne peut éviter en raison du direct.
Pour le camp palestinien, l’attaque du 7 octobre est un acte qui a remis au premier plan la question palestinienne dont plus personne ne parlait.
Les pays arabes étaient en train d’établir des relations amicales et économiques avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham, sans parler des palestiniens.
Même l’Arabie saoudite était en train de signer un tel accord. Ce qui achoppait encore était le fait que l’Arabie Saoudite exigeait d’avoir la responsabilité de l’esplanade des mosquées, la question palestinienne n’était pas prioritaire. Souvent les religieux sont attachés davantage aux symboles, aux pierres, qu’aux humains.
Et en Palestine, on voyait des murs, des checks point qui rendaient la vie tellement compliquée avec, en plus, une progression de l’emprise de la population juive sur la Cisjordanie à travers des implantations tolérées, voire encouragées par le gouvernement israélien.
Un gouvernement dans lequel le premier ministre et des hommes encore plus à droite exprimaient clairement leur refus de donner un État aux Palestiniens.
Bien au contraire, ils voulaient s’emparer de tout le territoire de Judée Samarie comme ils l’appellent.
Dans cette situation l’action du Hamas a constitué une rupture et, en tant que tel, un acte de résistance d’un peuple opprimé. Certes la violence extrême et des excès ont pu être commis, mais il était nécessaire d’arrêter le lent étouffement de la cause palestinienne.
 Dans tout cela il n’y a pas plus de place pour l’empathie, d’empathie pour l’autre, même pour le plus faible et le plus innocent de l’autre : un enfant.
Dans tout cela il n’y a pas plus de place pour l’empathie, d’empathie pour l’autre, même pour le plus faible et le plus innocent de l’autre : un enfant.
Jean Daniel avait écrit le <9 juillet 2014> :
« Mais pour finir sur Israël je peux confier, à l’âge où je parviens, que l’un de mes échecs personnels a été de ne pas arriver à persuader les élites juives de sauver leur peuple et leurs âmes. Sur la violence, il y a eu les plus grands textes. Et sur celle qui concerne les enfants, on ne peut pas oublier Dostoïevski.
Voyant revenir les stigmates annonciateurs de la fraternelle cruauté entre Israéliens et Palestiniens, je ne puis m’empêcher de repenser aux fameux propos prêtés à la redoutable et remarquable Golda Meir : « Ce que je vous reproche, vous serez étonnés de l’apprendre, ce n’est pas tant de tuer nos propres enfants, mais c’est de nous forcer à tuer les vôtres. » Cette phrase peut avoir mille interprétations. Un de mes amis arabes était révolté que je puisse m’y attarder. Non seulement elle se trouve une excuse pour l’assassinat, mais y ajoute un nouveau procès de notre comportement.
C’est vrai que cette phrase a plusieurs sens selon la conscience que l’on a de sa propre immobilité. Mais si sensible que je sois au destin palestinien, je ne puis m’empêcher d’y voir une volonté de ne pas se consoler du meurtre même qu’on prétend justifier par notre défense. Le meurtre, c’est le meurtre. Les enfants des autres, ce sont les nôtres. Aujourd’hui, presque partout, il ne s’agit que d’enfants ou d’adolescents. Ils sont la majorité chez les djihadistes. »
J’ai déjà rapporté les paroles d’humanité que Daniel Barenboïm avait prononcés à Ramallah lors de l’unique concert qu’il a pu réaliser en Palestine, ce ne fut jamais possible en Israël, avec l’orchestre qu’il a créé avec Edward Saïd et composé de musiciens israéliens, palestiniens et arabes :
« Nous croyons qu’il n’existe pas de solution militaire à ce conflit,
Nous croyons que les destinées de ces deux peuples palestinien et israélien sont inextricablement liées. […]
Nombreux sont ceux qui comprendront bientôt que nous avons ici deux peuples pas un.
Deux peuples liés par un lien très fort philosophique, psychologique et historique à cette région du monde.
C’est notre devoir d’apprendre à vivre ensemble.
Nous avons le choix : nous entretuer ou apprendre à partager ce qui peut se partager. »
C’est ainsi que je reviens à ce poème d’Akhmatova qui parle d’exil.
Et nous avons deux peuples qui ont été obligés à l’exil. Le premier pour fuir l’antisémitisme, d’abord en Russie puis dans toute l’Europe. Le second peuple parce que le premier est venu sur la terre qu’il habitait.
Nous avons affaire à deux récits ou deux narratifs comme le disent plutôt les anglo-saxons.
Probablement qu’il faut revenir à ces deux narratifs et espérer que chacun sache entendre celui de l’autre.
Afin, que l’avenir ne soit pas de s’entretuer mais d’apprendre à partager ce qui peut se partager.
L’objectif du gouvernement de Benyamin Netanyahou n’a jamais été de faire la paix mais d’assurer la sécurité d’Israël.
Il a échoué.
Le peuple arabe de Palestine se reconnait probablement dans ces vers d’Akhmatova :
« Honte à ceux qui laissent leur terre
A leur ennemi triomphant ; »
Mais aujourd’hui il y a deux peuples sur cette terre, une partie de chacun des peuples veut voir disparaître l’autre peuple.
Cela ne se fera pas ou alors par des cruautés et des souffrances encore plus terribles qui ne pourront avoir comme conséquence qu’une haine démultipliée qui entrainera d’autres violences et massacres.
Pour éviter cela, il faut tenter de comprendre l’autre.
Et trouver une voie vers la Paix
Pour que les rires remplacent les larmes.
<1780>
-
Samedi 2 décembre 2023
« Maria Callas est née il y a 100 ans. »La plus grande tragédienne de l’opéra est née le 2 décembre 1923Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulou, plus connue sous le nom de Maria Callas est née le 2 décembre 1923 au Flower Hospital de New York, sur la Cinquième Avenue et Central Park.
 Maria Callas a changé l’opéra. Elle a fait de la chanteuse d’opéra une actrice, une tragédienne.
Maria Callas a changé l’opéra. Elle a fait de la chanteuse d’opéra une actrice, une tragédienne.
Sa carrière débuta vraiment en 1947. A cette époque, elle vivait aux Etats-Unis et cherchait d’avoir des rôles dans les opéras américains, sans trop de succès.
Elle était parfaitement inconnue
Mais un impresario italien, Giovanni Zenatello, était venu aux États-Unis sur la demande du chef d’orchestre italien Tullio Serafin afin de rechercher un soprano pour chanter La Gioconda de Ponchielli aux arènes de Vérone.
Après avoir emprunté 1 000 dollars à son parrain pour payer son voyage et son séjour, elle est présentée par Zenattelo à Tullio Serafin qui, enthousiaste, l’engage séance tenante.
Le chef dirige l’œuvre et peu à peu, décèle les extraordinaires possibilités de la jeune diva.
C’est lui qui fera de Maria « la Callas ».
Tullio Serafin dira à son sujet :
« Elle était si étonnante, si imposante physiquement et moralement, si certaine de son avenir. Je savais que cette fille, dans un théâtre en plein air comme l’est Vérone, avec sa voix puissante et son courage, ferait un effet démentiel. »
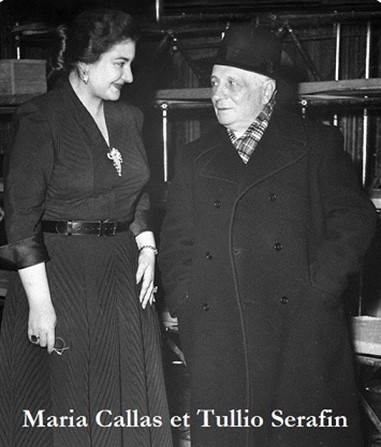 Lors d’une interview de 1968, la cantatrice admettra quant à elle que son travail sous la direction de Serafin a été :
Lors d’une interview de 1968, la cantatrice admettra quant à elle que son travail sous la direction de Serafin a été :
« La chance de ma vie […] Il m’a enseigné qu’il doit y avoir une formulation ; qu’il doit y avoir une justification. Il m’a enseigné le sens profond de la musique, la justification de la musique. J’ai réellement, véritablement absorbé tout ce que je pouvais de cet homme. »
Sa dernière apparition lors d’un spectacle d’opéra eu lieu de 5 juillet 1965 au Covent Garden de Londres.
Il s’agit en fait d’une carrière de 18 ans, pendant laquelle elle donnera 595 représentations et concerts, tiendra 42 rôles et enregistrera 26 intégrales d’opéra
Et c’est lors de ces 18 ans de carrière qu’elle forgera sa légende.
Elle est morte, seule, déprimée à 53 ans, le 16 septembre 1977, dans son appartement parisien au troisième étage du 36 avenue Georges-Mandel, où ses seules occupations étaient d’écouter ses vieux enregistrements et de promener ses caniches en empruntant chaque jour le même itinéraire : rue de la Pompe, rue de Longchamp et rue des Sablon.
En 2017, pour les 40 ans de la mort de cette extraordinaire artiste, j’avais rédigé deux mots du jour :
« J’ai vécu d’art, j’ai vécu d’amour »
Dans ce second mot du jour j’évoquais sa relation avec ce marchand grec qui avait pour nom Onassis et qui savait amasser beaucoup d’argent mais pas rendre heureux ses proches.
Le centenaire donne lieu à beaucoup de publications médiatiques.
Sur la plateforme de replay de France TV on trouve le remarquable documentaire de Tom Volf : <Maria by Callas>. Il sera disponible jusqu’au 16/12/2023.
Et puis il y a 64 émissions, et d’autres sont annoncées, proposées par Radio France sur cette page : < Callas, le podcast>
L’Opéra de Paris lui rend également hommage : <Hommage à Maria Callas>
Le 2 décembre, L’Opéra de Paris propose un Gala Maria Callas qui sera retransmis le 8 décembre 2023 sur France 5, lors d’une soirée spéciale consacrée à Maria Callas.
L’Opéra de Paris la présente ainsi :
« Cantatrice magnétique et tragédienne bouleversante, Maria Callas a transformé l’art du jeu et du chant à l’opéra. »

Elle fut une artiste unique, bouleversante, probablement, pour l’éternité, la plus grande de toutes les chanteuses d’opéra.
Sa vie fut une tragédie, mais, comme elle le dit à fin du documentaire de Tom Volf <Maria by Callas>, elle eut aussi de nombreux témoignages d’admiration et de remerciement de toutes celles et de tous ceux qui surent ouvrir leurs oreilles et surtout leur cœur à la beauté, la sensibilité et l’émotion du chant et du jeu de Maria Callas.
<1779>
-
Vendredi 1er décembre 2023
« Une fleur s’épanouira à l’improviste. »Inna SokolovaLes temps sont lourds.
Notre espèce continue à détruire la biosphère qui constitue l’écrin de notre vie.
Elle continue à s’auto-détruire dans des conflits meurtriers dont nul ne voit l’issue.
Elle poursuit des chimères de l’homme augmenté alors que c’est la sensibilité et la résilience humaine qu’il faudrait faire croitre.
Difficile, par moment, de ne pas se résoudre à conclure que nous sommes une sale race et que le vivant serait plus harmonieux sur terre, sans nous.
Et puis, il y a des soirées, des moments, hors du temps qui nous redonne espoir, élève l’âme.
 Quasi comme chaque année, le pianiste Grigory Sokolov, s’est arrêté ce lundi 27 novembre, à l’auditorium de Lyon, pour un moment de grâce.
Quasi comme chaque année, le pianiste Grigory Sokolov, s’est arrêté ce lundi 27 novembre, à l’auditorium de Lyon, pour un moment de grâce.
Il a joué Bach puis Mozart puis, comme souvent, six bis, parce que le lien, l’échange avec le public est si fort que la séparation ne peut être que lente et prendre beaucoup de temps.
Dans le programme de son concert à <Baden Baden du 11 novembre>, avec le même programme qu’à Lyon, la présentation du concert affirme :
« C’est le meilleur de tous les pianistes, déclare Daniel Barenboim à propos de Grigory Sokolov »
A Lyon, il a joué cette œuvre de Bach <Jean-Sébastien Bach : Partita N° 2 BWV 826> (Audio uniquement)
Pour le voir jouer il faut écouter la partita précédente : <Jean-Sébastien Bach : Partita N° 1 BWV 825>
Partout où il passe les éloges viennent à sa rencontre. Ainsi le journal suisse <Le Temps> écrit :
« Physiquement, c’est un colosse. Mais à l’intérieur, c’est un poète – un poète de l’indicible »
Tout le monde pourtant n’est pas convaincu.
Le grand pianiste français Philippe Cassard dans son émission <Portraits de famille> avoue :
« Je ne comprends rien, ou si peu à l’esthétique, au gout, aux choix interprétatifs qui sont les siens depuis dix ans. »
Il a réalisé cependant deux longues émissions consacrées à Sokolov, mais uniquement à ses jeunes années pendant les lesquelles Cassard reconnaît le génie et ajoute que celles-ci ne sont :
« Pas encore contaminé par cette surcharge expressive, ce maniérisme de chaque note, cette appétence pour des tempos lentissimes qui dénaturent, selon moi, le langage des compositeurs. »
Disons qu’il ne comprend pas ce que comprennent des milliers d’auditeurs comme ceux de l’auditorium de Lyon.
A Bruges, pour le même programme on lit :
« L’interprétation de Sokolov se déploie avec une telle évidence qu’il parvient à captiver ses auditeurs dès les premières notes.
Entre douceur, tranchant et raffinement, l’impressionnante précision avec laquelle Grigory Sokolov effleure les touches du clavier dépasse l’imagination.
Quoi qu’il joue, Sokolov est le maître des moments suspendus. »
Au Théâtre des Champs Elysées on cite directement Grigory Sokolov :
« L’essence de l’interprétation, c’est l’amour profond que l’on porte à une pièce, assorti à la liberté intérieure de l’interprète »,
Grigory Sokolov est né à Léningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) le 18 avril 1950.
J’avais déjà, lors d’un concert précédent à Lyon en 2018, consacré un mot du jour à cet interprète hors norme : <Grigory Sokolov>
Alors, pourquoi en reparler, alors qu’il est si difficile de trouver les mots à placer sur de tels moments ?
C’est parce que, par hasard, dans mon butinage numérique, j’ai trouvé Christian Bobin qui parlait de Grigory Sokolov.
Et il ne parlait pas que de Grigory Sokolov mais aussi de son épouse Inna Sokolova dont je n’avais jamais entendu parler.
J’ignorais même qu’il fût marié.
 Christian Bobin était invité en Suisse, pour faire une conférence le 7 octobre 2022, à Crans-Montana. Conférence qui avait pour titre « Variations Bobin »
Christian Bobin était invité en Suisse, pour faire une conférence le 7 octobre 2022, à Crans-Montana. Conférence qui avait pour titre « Variations Bobin »
La veille, il était interviewé à la Radio Suisse RTS pour parler notamment de son dernier livre paru : « Le Muguet rouge ».
Je parle des dates, parce que le 6 octobre 2022, il ne restait plus que 50 jours de vie au poète.
Christian Bobin écrivait dans « Autoportrait d’un radiateur »
« Ma vie, ou du moins la part la plus déliée de ma vie, la moins obéissante, celle que j’appelle, faute de mieux : mon âme, mon âme, donc, grimpe sur la fumée qui s’élève d’un jardin, traverse les roses qui somnolent dans la cuisine, danse sur la couverture des livres qui m’entourent, ignore superbement les pages de ce carnet et moi je l’attends un peu bête, un peu creux, pigeonnier vidé de ses pigeons.
Cette histoire se reproduit souvent.
Elle ne m’inquiète pas, même si je devine qu’un jour elle ira à son terme : mon âme se rendant si légère qu’elle oubliera de revenir et que quelqu’un dira de moi : « il est mort », puisque c’est ainsi que l’on nomme ce genre de figure. »
Il avait donné aussi une interview au quotidien « La Vie » en septembre 2022, toujours à l’occasion de la sortie de son livre « Muguet Rouge » et il avait alors opposé deux types de mort :
« Il y a une mort dont on se remet paradoxalement assez bien, c’est celle qui arrive à chacun de nous par la loi de la nature.
Une fleur éclot sur terre, donne sa lumière, séduit quelques abeilles et, le soir venu, se replie sur elle-même, fane et meurt.
Il en va de même pour nous : nous sommes voués à une mort qui n’est pas un abandon de souveraineté mais une métamorphose.
C’est une chose qu’il serait folie de vouloir empêcher, comme les apprentis sorciers de la Silicon Valley en ont le sinistre projet.
Car la mort est un sacre pour chacun, fut-il le plus pauvre ou le plus mal famé, on est confié à ce moment-là aux bras innombrables de l’invisible.
Mais il y a une deuxième sorte de mort, dont il est difficile de sortir une fois qu’on y est entré.
Elle est à l’intérieur même de la vie courante et nous est donnée par les injonctions du monde et la nécessité non expliquée de penser et d’agir de plus en plus vite, d’aimer de moins en moins, de vouloir de plus en plus.
Cette mort-là, absolument désolante, dont personne ne porte le deuil, j’ai souhaité la montrer au plus près dans le Muguet rouge.
C’est une mort sournoise qui commence par vider les yeux, et ensuite le cœur. »
Mais revenons à l’entretien qu’il a donné le 6 octobre 2022 à RTS « Le muguet rouge de Christian Bobin, du rêve au roman »
C’est tout à la fin de l’entretien qu’il parle de Sokolov et de son épouse, cela commence à 23:00
Le journaliste révèle que Christian Bobin a amené quelques textes de poèmes qu’il envisage de lire le lendemain lors de la conférence :
« C’est uniquement de la poésie russe : Akhmatova, Mandelstam et un poème de l’épouse du grand, très très grand, pur pianiste russe Sokolov.
Je pourrais vous parler quelques minutes de Sokolov et lire un poème de son épouse. »
Je note qu’il cite deux des plus immenses poètes russes : Anna Akhmatova et Ossip Mandelstam et qu’il y associe Inna Sokolova.
Et, il parle d’abord de Grigory Sokolov :
« J’ai découvert Grigory Sokolov il y a quelques mois […].
Qu’est-ce que j’ai découvert avec lui ?
J’ai découvert …
Imaginez-vous vous vous êtes dans une maison assez modeste, assez simple, à la campagne.
Vous ouvrez la fenêtre, tous les jours. Et devant vous il n’y a rien, presque rien. Il y a une étendue un peu monotone, un peu lasse d’herbes.
Et quelques herbes folles qui essaient, à la gitane, à faire danser tout cela.
Tous les jours comme ça.
Et un matin, vous ouvrez la fenêtre et il y a un arbre qui a poussé en une seule nuit.
Et cet arbre, c’est Sokolov.
Je ne savais pas qu’un musicien pouvait atteindre à la souplesse, à la fermeté et à la rigueur extrême de quoi ? d’un érable ou même d’un sapin, ou d’un bouleau. Disons un bouleau, puisque nous sommes en terre russe, il s’agit d’un pianiste russe.
Et je me trouve, avec lui, devant une montagne qui est à la fois infranchissable et rassurante.
Je n’ai jamais entendu Schubert joué comme cela, que par cet homme.
Je n’ai jamais entendu Haydn joué comme cela […]
C’est toujours plus ou moins joué par des braves musiciens dont je ne conteste pas la grandeur.
Mais c’est toujours joué par des musiciens qui me revête peu à peu, quand je les écoute, d’un col de dentelle, de jabot, d’un chapeau à plume, de petites bottines du grand siècle.
Je me retrouve dans un siècle qui n’est pas le mien et du coup il y a quelque chose qui est un peu chagrin.
Ce n’est pas tout à fait aujourd’hui.
Je voudrais juste qu’aujourd’hui soit aujourd’hui.
Je voudrais juste que le présent soit la déchirure des rideaux du temps.
L’ouverture du fini à l’infini.
Et ça c’est ce que je trouve dans le jeu de Sokolov quand il joue Haydn.
C’est primesautier, c’est enfantin, c’est culotté, c’est audacieux.
Ce n’est pas non plus le monsieur qui dit : je veux vous montrer comme je vous domine tous. Je veux vous montrer quelque chose que vous n’avez jamais entendu.
Il ne veut rien nous montrer Sokolov. Il devient la partition, il devient le musicien.
Et Schubert, c’est pareil quand il se met à poser sa main sur l’épaule de Schubert, c’est extraordinaire. […]
C’est un monstre magnifique. C’est un monstre parce qu’il est humain de part en part.
Aujourd’hui c’est devenu monstrueux d’être humain.
Heureusement, il y a quelques-uns comme cela. »
Bobin parle de Sokolov jouant Haydn. Pour vous donner une idée voici une sonate de Haydn : <Haydn: Piano Sonata N° 47 Hob. XVI-32>
Et puis il évoque son épouse :
 « Sa femme, elle est sa part secrète, elle est sa part vivante, elle est plus que tout, elle est plus que le piano pour lui.
« Sa femme, elle est sa part secrète, elle est sa part vivante, elle est plus que tout, elle est plus que le piano pour lui.
Il faut savoir que pour Sokolov, la musique c’est tout, tout le temps, toutes les secondes, toutes les minutes, même quand il ne joue pas.
A coté de ce tout, tout le temps […] à côté de ce qui pour lui est l’absolu, il y a encore plus que l’absolu, il y a encore plus que le tout.
Et le tout, plus grand que le tout, l’absolu plus grand que l’absolu, s’appelait, s’appelait parce qu’elle n’est plus de ce monde, Inna comme Inné.
Et elle porte le nom, avec cette belle coutume russe qui ajoute un « a » au nom de l’époux, Anna Sokolova.
Elle écrivait des poèmes qu’elle n’a jamais montré qu’à un tout petit entourage.
J’en ai trouvé trace dans un livret qui accompagnait un récital de son mari.
Très peu, Six ou Sept poèmes, c’est tout ce que je peux connaître.
Cela n’a jamais été imprimé.
Et elle met parfois en bas du poème, une petite note qui explique les circonstances de l’écriture.
Il lui est arrivé, un jour, d’être tellement bouleversé par le début du jeu de son mari, qu’elle se retire de la salle, tellement c’est fort, qu’elle préfère écouter derrière la porte, comme un enfant. »
Inna Sokolova est morte en 2013.
Christian Bobin lit un de ses poèmes qu’elle a écrit dans une situation comparable à celle qu’il vient de décrire. »
« Seigneur sauve-moi, retiens-moi
Dans ses mains, le piano est si tendre
Ne te presse pas d’apaiser les amoureux
La séparation est inévitable
Que leur dialogue ailé nous dise quelque chose de toi
Et donne aux soucis de la vie de reclus, à la foule
L’ordre d’écouter
Le cri dans le berceau s’éteindra
Une fleur s’épanouira à l’improviste
La vie nous offre rarement un instant où avoir envie de prier »
Inna Sokolova
Et Christian Bobin, deux mois avant son départ de la vie, finit cet entretien ainsi :
« Et je me permets de répéter ces deux vers, comme on peut répéter un morceau, une petite trouvaille en musique :
« Le cri dans le berceau s’éteindra
Une fleur s’épanouira à l’improviste »
Une fleur s’épanouira à l’improviste
C’est tout ce que je vous souhaite,
En parlant demain à Crans-Montana
En écrivant un nouveau livre,
En lisant, en regardant qui est en face, partout.
Une fleur s’épanouira à l’improviste
Je ne vois pas quoi souhaiter de plus vif. »
Inna Sokolova, Grigory Sokolov et Christian Bobin sont des inspirateurs, des enchanteurs de l’âme, des médecins de la détresse.
Pour finir deux des six bis que Grigory Sokolov a joué, lundi, à l’auditorium :
<1778>
-
Mardi 21 novembre 2023
« Ils ne voient qu’une chose : nous sommes venus et nous avons volé leur pays. Pourquoi l’accepteraient-ils ? »David Ben Gourion en 1956 en parlant des arabes, propos reproduit par Nahum Goldmann dans « Le Paradoxe juif »Depuis un mois, il y a un grand effort de la part des médias pour rappeler ce que la situation au Moyen-Orient doit à l’Histoire et notamment à l’histoire du sionisme.
Le sionisme, c’est-à-dire créer un État pour les juifs, est une réponse à l’antisémitisme millénaire
La prise de conscience a d’abord lieu dans la Russie tsariste, dans les années 1880.
L’assassinat d’Alexandre II, le 13 mars 1881, déclenche, en effet, une vague de pogroms jusqu’à l’été 1884.
Les massacres et les pillages, encouragés par l’autocratie d’Alexandre III, rappellent brutalement aux Juifs qu’ils ne sont que tolérés en Russie.
Dès lors, beaucoup d’entre eux choisiront la rupture avec la Russie – rupture « mentale » par l’engagement dans les mouvements révolutionnaires, rupture « physique » par l’émigration.
La masse des expatriés (600 000 sur plus de cinq millions de Juifs russes entre 1881 et 1903) s’installera aux États-Unis. Mais une partie d’entre eux optera pour une solution radicale : l’installation en Erefz Israël (la Terre d’Israël), où ils édifieront des villages qui formeront la base d’une société juive autonome.
Cette émigration vers la Palestine qui est une province, administrée depuis 1517, par l’Empire ottoman portera pour nom « Aliya »
Un mouvement sera créé en Russie par un médecin d’Odessa Léo Pinsker (1821-1891) : « Les Amants de Sion »
C’est dans ce cadre que va germer l’idée que la survie des Juifs nécessite la reconstitution d’une patrie en Palestine
David Ben Gourion, premier Premier ministre de l’État d’Israël, l’homme qui a proclamé la création de l’Etat d’Israël est né le 16 octobre 1886, en Pologne, dans la partie qui était alors intégrée dans l’Empire russe.
Son père était professeur d’hébreu et membre des Amants de Sion
David Ben Gourion émigrera en 1906, dans ce que les historiens appelleront la deuxième Aliya.
Mais la formidable dynamique du « sionisme » sera surtout l’œuvre de Theodor Herzl (1860-1904), fils de négociants hongrois aisés, devenu journaliste à Vienne.
Il sera le vrai fondateur du mouvement sioniste au « congrès de Bâle en 1897 » et l’auteur de « Der Judenstaat » (L’État des Juifs) en 1896 dans lequel il explique comment il pense possible, avec l’appui de la communauté internationale, d’obtenir une souveraineté sur un territoire déterminé.
Il y aura des discussions sur ce territoire, on parle de l’Argentine, ou encore de l’Ouganda, mais le terme utilisé de « Sion » qui est le nom biblique d’une colline de Jérusalem, laissait quand même prévoir que le territoire espéré était celui qui naguère, au début de l’ère chrétienne, avait pour nom Judée, Galilée et Samarie.
Mais il faudra encore la première guerre mondiale et l’intervention pertinente de Chaim Weizman, inventeur de l’explosif Acetone, pour que l’Empire Britannique accepte l’idée d’«un foyer national juif en Palestine » dans la « Déclaration Balfour ».
Cet épisode historique, je l’ai déjà raconté dans le mot du jour du < 17 mars 2015>
 Chaim Weizman sera Président de l’Organisation Sioniste Mondiale, par deux fois, de 1920 à 1931, puis de 1935 à 1946, avant de devenir le premier président de l’État d’Israël entre 1949 et 1952.
Chaim Weizman sera Président de l’Organisation Sioniste Mondiale, par deux fois, de 1920 à 1931, puis de 1935 à 1946, avant de devenir le premier président de l’État d’Israël entre 1949 et 1952.
Et puis il faudra la seconde guerre mondiale, la Shoah, la création de l’ONU, le plan de partage de la Palestine voté à l’ONU le 29 novembre 1947 entre un État juif et un État arabe et enfin la déclaration d’indépendance de l’État d’Israël, le 14 mai 1948, dernier jour du mandat britannique sur la Palestine dans le hall du Musée d’art de Tel Aviv par David Ben Gourion.
L’État arabe n’a pas été créé jusqu’à présent.
En 1948, la Palestine comptait 2/3 d’arabes musulmans et chrétiens et 1/3 de juifs.
Nahum Goldmann était aussi né dans l’Empire russe, le 10 juillet 1895 en Biélorussie, il est mort en 1982. Il était également dirigeant du mouvement sioniste.
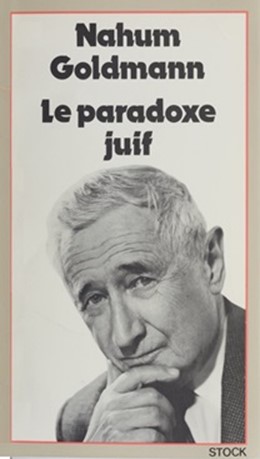 Il a écrit en 1976, un livre « Le Paradoxe juif », sous-titré « Conversations en français avec Léon Abramowicz »
Il a écrit en 1976, un livre « Le Paradoxe juif », sous-titré « Conversations en français avec Léon Abramowicz »
Lors de la Seconde Guerre mondiale, Nahum Goldmann s’établit aux États-Unis et participa activement aux négociations en faveur de la création de l’État d’Israël.
En 1948, il est l’un des leaders de la Confédération sioniste et à partir de 1956, son président ; il est également ensuite président du Congrès juif mondial.
Il eut un rôle primordial dans les négociations de l’accord de réparations avec l’Allemagne
Il était un ami intime de David Ben Gourion, même si leurs relations furent parfois tumultueuses.
Il écrit :
« Nous nous sommes souvent affrontés, tant en public, qu’en privé, mais, en dépit de nos différents, surtout en ce qui concernait la politique arabe, nous étions fort liés et chez David Ben Gourion, j’ai toujours admiré l’homme d’État. »
Le Paradoxe juif page 115
Il en fait un portrait élogieux mais sans concession :
« Il fut non seulement un grand homme d’Etat, mais aussi un diplomate et un politicien très habile, très rusé, en vérité l’un des meilleurs que je n’aie jamais connus. Une promesse de lui ne valait rien du tout. Il n’hésitait pas à promettre une chose et ensuite à faire le contraire. Il était tout à fait dénué de scrupules. Il n’a jamais poursuivi d’autres but que de réaliser l’idéal sioniste et d’assouvir son immense ambition. […]
J’ai connu beaucoup d’hommes d’État, mais presque aucun n’ayant son sens historique. Il était persuadé que chaque mot qu’il prononçait l’était pour l’éternité. »
Le Paradoxe juif Page 116
En résumé, ils étaient d’accord sur tout, sauf sur la politique Arabe.
Ben Gourion ne voulait pas lui confier les négociations avec les Arabes. Après avoir encensé tous ses talents, notamment de diplomate, Ben Gourion a posé ce jugement :
« Tu as donc le droit de te demander pourquoi je ne te charge pas du problème qui décidera de l’avenir de l’État d’Israël : la paix avec les Arabes. Je vais t’en expliquer les raisons…
[Dans tes missions précédentes avec les hommes politiques américains, avec Adenauer] A ces hommes tu as parlé d’égal à égal car vous partagez les mêmes qualités. Mais avec les Arabes, qui sont des barbares, tous tes dons n’ont aucune valeur. Ni ta culture, ni ton charme, ni ton art de la persuasion n’auraient d’effet sur eux. Eux ne comprennent que la manière forte, et la main de fer, c’est moi, pas toi. Voilà l’explication. »
Le Paradoxe juif pages 118 et 119.
Alors que Nahum Goldmann était persuadé que : « sans un accord avec les Arabes, Israël ne connaîtrait pas d’avenir à long terme. » Le Paradoxe juif page 121
Et Nahum Goldmann va révéler un échange qu’il aura dans l’intimité de la cuisine de l’habitation de David Ben Gourion. Je cite l’intégralité de ce passage avec son introduction :
« En effet, il m’est souvent apparu que chez les hommes d’État, le caractère l’emporte sur l’intelligence.
Nombre d’entre eux comprennent avec leur cerveau ce qu’il convient de faire, mais leur caractère leur interdit de le réaliser.
Ce comportement est typique de Ben Gourion : je vais en donner un exemple que je n’oublierai jamais.
Un jour, ou plutôt une nuit de 1956, je suis resté chez lui jusqu’à trois heures du matin. Nos véritables conversations se déroulaient souvent dans la cuisine et, comme à l’accoutumée il voulait que sa femme Paula allât dormir. Comme elle insistait pour rester, Ben Gourion me disait : « Nahum, tu es le seul qu’elle respecte. SI je lui demande, elle n’ira pas dormir, mais, si toi tu l’en pries, elle acceptera. » Je disais donc à Paula : « Fais moi plaisir, va te coucher », puis Ben Gourion préparait du café et des sandwiches.
Cette nuit-là, une belle nuit d’été, nous eûmes une conversation à cœur ouvert sur le problème arabe.
« Je ne comprends pas ton optimisme », me déclara Ben Gourion.
« Pourquoi les Arabes feraient-ils la paix ? Si j’étais, moi, un leader arabe, jamais je ne signerais avec Israël. C’est normal : nous avons pris leur pays.
Certes, Dieu nous l’a promis, mais en quoi cela peut-il les intéresser ? Notre Dieu n’est pas le leur.
Nous sommes originaires d’Israël, c’est vrai, mais il y a de cela deux mille ans : en quoi cela les concerne-t-il ?
Il y a eu l’antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz, mais était-ce leur faute ?
Ils ne voient qu’une chose : nous sommes venus et nous avons volé leur pays. Pourquoi l’accepteraient-ils ?
Ils oublieront peut-être dans une ou deux générations, mais, pour l’instant, il n’y a aucune chance.
Alors, c’est simple : nous devons rester forts, avoir une armée puissante.
Toute la politique est là. Autrement, les Arabes nous détruiront. »
J’étais bouleversé par ce pessimisme, mais il poursuivit :
« J’aurai bientôt soixante-dix ans. Eh bien, Nahum, me demanderais-tu si je mourrai et si je serai enterré dans un État juif que je te répondrais oui : dans dix ans, dans quinze ans, je crois qu’il y aura encore un État juif.
Mais si tu me demandes si mon fils Amos, qui aura cinquante ans à la fin de l’année, a des chances de mourir et d’être enterré dans un État juif, je te répondrais : cinquante pour cent. »
Mais enfin, l’interrompis-je, comment peux-tu dormir avec l’idée d’une telle perspective tout en étant Premier ministre d’Israël ?
« Qui te dit que je dors ? » répondit-il simplement. »
Le Paradoxe juif pages 121 et 122
Nous sommes 67 ans après cet échange de 1956.
Le pessimisme de Ben Gourion a été démenti, Israël est toujours puissant, l’État a une armée redoutable et dispose d’une modernité technologique à la pointe.
Mais il n’a pas résolu le problème Arabe. 3 générations après, les palestiniens n’ont pas oublié.
Nahum Goldmann écrit :
« Les Arabes ont, eux, la même mémoire historique que les Juifs. La race sémite est très entêtée et n’oublie rien.
Lors d’un grand meeting à Sydney, en Australie, j’ai dit que le malheur d’Israël était d’avoir pour adversaires les Arabes et non plus les Anglais. En effet, les Anglais ont le génie de l’oubli ; en l’espace d’une génération, ils ont perdu le plus grand empire du monde et, malgré cela, ils sont très heureux : le plus grand souci populaire fut longtemps de savoir qui épousera la princesse… Imaginez-vous les Juifs dans cette situation ? Il y a deux mille ans, le temple de Jérusalem fut détruit et, chaque année, pour commémorer cette destruction, nous observons un jour de jeûne. Si nous avions perdu un empire équivalant à celui des Anglais, nous devrions jeûner deux fois par semaine pendant vingt siècles !
Et les Arabes sont comme nous. C’est une idée tout à fait naïve de croire qu’ils finiront par oublier notre présence en Palestine, qu’ils se feront une raison ».
Le Paradoxe juif page 241
Bien sûr cela n’excuse en rien les actes inhumains que les membres du Hamas ont commis le 7 octobre.
Cela explique cependant pourquoi les peuples arabes ne condamnent pas le Hamas, même s’ils n’approuvent pas leur barbarie.
Ils ont toujours en mémoire ce que Ben Gourion reconnaissait en toute lucidité « nous avons pris leur pays » et « les nazis, Hitler, Auschwitz » n’étaient pas la faute des arabes.
Et il n’y a toujours pas d’État Palestinien !
Et la colonisation en Cisjordanie rend cette perspective quasi impossible.
Je n’ai pas de solution miracle à proposer, mais il me semble que cet éclairage est nécessaire pour comprendre ce qui se passe.
Le Hamas est une organisation islamiste, nihiliste en ce sens que ce qui lui importe n’est pas le bien être du peuple palestinien sur cette terre, mais l’installation d’un régime islamiste, sur ce territoire, pour la vie après la mort.
La colère et la haine des israéliens contre le Hamas est compréhensible.
Mais éradiquer le Hamas ne suffira pas, si toutefois Israël y parvient.
Et si cette éradication se fait au prix de la destruction de toute possibilité de vie à Gaza, et au prix d’un nombre de plus en plus grand de victimes innocentes, la haine ne fera que s’exaspérer.
Nahum Goldmann développe dans son livre cette vision certes utopique :
« Si j’avais rencontré Nasser, j’aurais aimé lui dire ceci « Vous autres Arabes êtes un peuple très généreux. Votre rencontre avec les Juifs au cours de l’histoire a été meilleure que la nôtre avec les chrétiens. Vous nous avez persécutés, mais nous avons également connu des périodes de coopération merveilleuse : en Espagne, à Bagdad, en Algérie… Alors restez généreux. Notre peuple est malheureux. J’admets que la Palestine vous appartenait d’après les lois internationales. Mais nous avons tant souffert depuis deux mille ans, nous avons perdu un tiers de notre population parce que nous n’avions pas de territoire. Alors cédez-nous au moins un pour cent du vôtre et garantissez notre existence. Soyez avec l’Amérique, la Russie et la France l’un des garants de la survie d’Israël. »
Je suis persuadé qu’un tel discours aurait eu une grande influence psychologique sur les Arabes, en leur donnant un sentiment de fierté, voire d’égalité. J’en ai d’ailleurs parlé avec quelques leaders arabes qui étaient fascinés par cette idée ; hélas ! il ne semble pas qu’Israël choisisse cette voie-là. »
Le Paradoxe juif page 106
<1777>
-
Vendredi 17 novembre 2023
« C’était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table […] Moi si j’y tenais mal mon rôle. C’était de n’y comprendre rien. »Louis Aragon, « Le roman inachevé »« Le roman inachevé » est une des plus grandes œuvres de Louis Aragon (1897-1982).
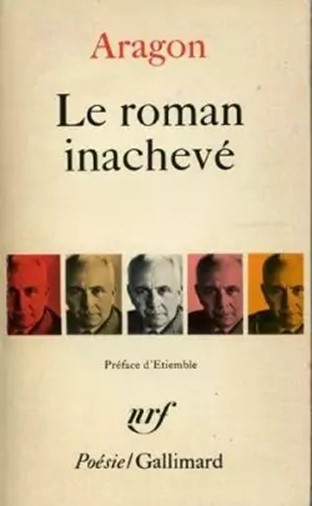 C’est une des six œuvres que j’ai eu la chance d’étudier lors de mon passage inabouti en classe préparatoire scientifique dans les années 1976 à 1979.
C’est une des six œuvres que j’ai eu la chance d’étudier lors de mon passage inabouti en classe préparatoire scientifique dans les années 1976 à 1979.
On décrit cet ouvrage sous la forme « d’une autobiographie poétique ».
Aragon parle de son passé et en fait un recueil de poésie.
Le livre est divisé en trois parties et chaque partie comprend des thèmes.
Le dernier thème de la 1ère partie a pour titre : « La guerre et ce qui s’en suivit »
La guerre dont il s’agit est celle de 1914-1918.
Il est mobilisé en 1917 et rejoint le front au printemps 1918 comme médecin auxiliaire.
La page Wikipedia qui lui est consacrée rapporte :
« Sur le front, il fait l’expérience des chairs blessées, de la violence extrême de la Première Guerre mondiale, d’une horreur dont on ne revient jamais tout à fait mais qui réapparaîtra constamment dans son œuvre et qui est à l’origine de son engagement futur pour la paix. Il reçoit la croix de guerre et reste mobilisé jusqu’en juin 1919 en Rhénanie occupée, épisode qui lui inspirera le célèbre poème « Bierstube Magie allemande. » »
En réalité, les poèmes ne portent pas de titre et on les nomme par leur premier vers, ainsi de celui-ci dont je cite la première strophe :
« Bierstube Magie allemande
Et douces comme un lait d’amandes
Mina Linda lèvres gourmandes
Qui tant souhaitent d’être crues
A fredonner tout bas s’obstinent
L’air Ach du lieber Augustin
Qu’un passant siffle dans la rueLéo Ferré fera de ce poème une chanson qu’il nommera : « Est-ce ainsi que les hommes vivent »
Car il ajoutera un refrain de deux vers qui sont dans la quatrième strophe :
« Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent »
Mais la chanson de Léo Ferré débute à la cinquième strophe :
« Tout est affaire de décors
Changer de lit changer de corps
À quoi bon puisque c’est encore
Moi qui moi-même me trahis
Moi qui me traîne et m’éparpille
Et mon ombre se déshabille
Dans les bras semblables des filles
Où j’ai cru trouver un pays »
La septième strophe du poème et troisième de la chanson est la suivante :
« C’était un temps déraisonnable
On avait mis les morts à table
On faisait des châteaux de sable
On prenait les loups pour des chiens
Tout changeait de pôle et d’épaule
La pièce était-elle ou non drôle
Moi si j’y tenais mal mon rôle
C’était de n’y comprendre rien »
C’est Pierre Servent, spécialiste des questions de défense, pendant 20 ans professeur de stratégie d’influence à l’Ecole de guerre; qui pour dire que nous ne pouvons pas être certain que des décisions raisonnables vont être prises dans le conflit à Gaza, a rappelé ces vers d’Aragon « C’était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table ».
Il était l’invité, ce jeudi 16 novembre de la matinale de France Inter : <Quelle est la stratégie militaire d’Israël ?>
Il n’était pas raisonnable que Poutine attaque l’Ukraine, il l’a fait pourtant.
Il était raisonnable cependant pour l’Azerbaïdjan de s’emparer du Haut Karabakh car les Azéris savaient que personne ne réagirait et c’est ce qui s’est passé.
Dans la guerre de Gaza, il y a beaucoup de choses déraisonnables et d’autres qui pourraient encore arriver.
En tout cas, « on a mis les morts à table », expression que je comprends comme le fait que ces guerres font de plus en plus de morts et qu’ils s’invitent à notre table par les informations et le sinistre décompte des victimes de chaque camp.
Ce que nous disons, en France, sur ce conflit n’a aucun effet sur ce qui se passe là bas.
Mais en France aussi est venu un temps déraisonnable.
Les actes antisémites ont explosé, nos concitoyens juifs ont peur.
Mais Jean-Luc Melenchon n’a pas voulu aller à la marche contre l’antisémitisme. Le 7 novembre à 8:12 PM il a tweeté :
« Dimanche manif de « l’arc républicain » du RN à la macronie de Braun-Pivet. Et sous prétexte d’antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. »
Selon la déraison de cet homme, il n’est pas possible de séparer de manière étanche les actes antisémites en France et la guerre d’Israël contre le Hamas
Et donc selon cette logique, les français juifs sont tous responsables de la politique que mène le gouvernement d’Israël. Sinon, s’ils ne sont pas responsables, il n’est pas admissible qu’il fasse l’objet de menace, insulte ou agression. Et donc s’ils ne sont pas responsables, il est normal de défiler contre l’antisémitisme.
 Le Président de la République a également refusé de défiler.
Le Président de la République a également refusé de défiler.
En 1990, le Président d’alors, François Mitterrand avait défilé.
Il est vrai qu’au moment de cette manifestation, il était clair dans l’esprit de tous que les coupables des profanations du cimetière juif de Carpentras étaient d’extrême droite. Ce qui s’est avéré faux après enquête.
Les actes antisémites, contre lesquels il s’agissait de défiler sont majoritairement commis par des personnes qui sont révoltées par le destin du peuple palestinien. Beaucoup sont d’origine musulmane.
Il y a donc une lutte noble contre l’antisémitisme, celle qui vient de l’extrême droite.
Et une autre qui l’est moins, celle de l’antisémitisme qui ne vient pas d’extrême droite.
Le président a expliqué qu’il ne voulait pas fracturer la société française, puis il a dit explicitement
« Protéger les Français de confession juive, ce n’est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. »
J’exprime la croyance que la majorité de la communauté musulmane n’est pas antisémite et n’approuve pas les actes commis en France et encore une fois ne juge pas responsable chaque juif de France de ce qui se passe au Proche Orient.
Il était donc possible et bienvenue, pour une large majorité des musulmans et le Président de la République, de s’associer à cette marche.
Pour ma part, il m’apparaissait très important de participer à la déclinaison lyonnaise, Place Bellecour, de la marche de Paris.
Cela ne dit rien de mon opinion sur ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie.
Mais je dis non à l’antisémitisme. L’antisémitisme est mon ennemi et je trouve très important en tant que non juif de prendre ma part dans sa dénonciation.
Et je voudrais encore répliquer à certains réticents que dans une guerre on choisit son ennemi, pas ses amis. Lors de la dernière guerre mondiale, le camp allié a choisi son ennemi : Hitler, il n’a pas choisi Staline comme un ami, mais simplement il a fait le constat que dans le combat contre Hitler, ils étaient dans le même camp.
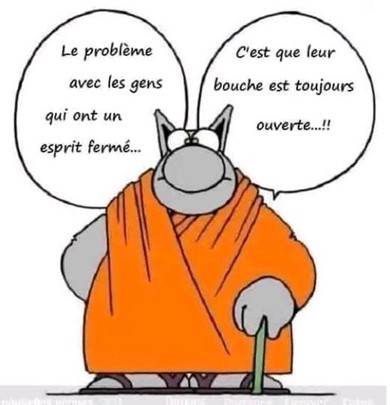 Nous vivons un temps déraisonnable il n’est plus possible d’entendre les arguments de celles et de ceux qui ne partagent pas exactement les mêmes indignations et les mêmes croyances.
Nous vivons un temps déraisonnable il n’est plus possible d’entendre les arguments de celles et de ceux qui ne partagent pas exactement les mêmes indignations et les mêmes croyances.
On n’exprime pas un désaccord, on ne discute plus du tout, on ne lit plus, on n’écoute plus celle ou celui que l’on a classé dans l’autre camp ou même pas suffisamment dans son camp.
Les pro-israéliens ne peuvent-ils pas entendre qu’il s’est passé des évènements, des actes avant le 7 octobre qui ont eu pour conséquence une explosion de haine du côté palestinien ?
Les pro-palestiniens ne peuvent-ils pas admettre qu’un acte de résistance aurait du se limiter à attaquer les postes de l’armée israélienne et non pas de s’attaquer à des civils, aux kibboutz , à une manifestation musicale et en plus commettre des actes d’une abomination absolue ?
Parmi les victimes, il y avait en outre, notamment dans les kibboutz, des hommes et des femmes qui avaient consacré leur vie pour donner une chance à la paix.
Vivian Silver était l’une d’entre elles. On n’a identifié son corps qu’il y a deux jours. Elle a été tuée le 7 octobre dans le kibboutz Be’eri où elle résidait. Elle était membre de l’ONG Women Wage Peace (WWP) qui regroupe des femmes de tous horizons – juives, chrétiennes, musulmanes, religieuses, athées, orthodoxes, libérales, de droite, de gauche pour œuvrer pour la paix. Elle organisait depuis des années le transfert de Gazaouis ne pouvant être soignés dans l’enclave palestinienne vers des hôpitaux israéliens.
Il existe bien entendu des hommes et des femmes de lumière dans le camp palestinien.
Écoutez, cette infirmière américaine, Emily Callahan, qui a passé près d’un mois dans l’enclave palestinienne pour Médecins sans frontières, raconter son expérience avec des soignants palestiniens extraordinaire d’humanité et de dévouement aux autres.
Les pro-israéliens peuvent-ils entendre que le comportement des colons en Cisjordanie est non seulement inacceptable à l’égard des palestiniens, mais ne peut qu’attiser davantage la haine et surtout rend la paix impossible. Paix qui est la seule solution possible pour que l’État juif puisse vivre en sécurité ?
D’ailleurs Netanyahu ne veut pas de la paix. La paix l’obligerait à discuter des colonies en Cisjordanie et à les démanteler pour la plus grande part.
Jean-Louis Bourlanges dans le « Nouvel Esprit Public » du 5 novembre expliquait :
« Avant le 7 octobre, la seule stratégie M. Netanyahou ait envisagé à propos du problème palestinien, c’était de le régler par le vide : « Il y a des gens à Gaza qui devraient plutôt être chez le maréchal Sissi. Et il y a des gens en Cisjordanie qui devraient plutôt être chez le roi Abdallah II. » […]
Son choix fondamental, et fondamentalement pervers, a consisté à accepter la confrontation générale. Bien sûr, il n’avait pas imaginé les évènements du 7 octobre, mais comment pouvait-il espérer qu’une organisation aussi démente que le Hamas se contenterait d’encaisser l’argent du Qatar sans préparer quelque chose, alors qu’on sait que ces gens sont habités par des passions destructrices et nihilistes, et qu’ils veulent la mort d’Israël ? M. Netanyahou n’a cessé de jeter de l’huile sur le feu : provocations répétées dans les lieux saints, extensions très violentes des colonies, accompagnée d’une quasi élévation des colons de Cisjordanie au rang de garde nationale … Imaginait-il vraiment que tout cela ne produirait aucun effet ?
C’était la « théorie du mur », selon laquelle Israël était parfaitement capable de vivre en parfaite inimitié avec son entourage proche : peu importe l’hostilité de l’environnement, tant que le « mur » est assez haut et épais. Israël a des alliés, de l’argent, la meilleure armée du monde, le dôme de fer, bref il s’est cru à l’abri. »
Le Hamas ne veut pas davantage la paix que Netanyahou. Négocier la paix signifierait accepter l’existence de l’État d’Israël, ce qui est incompatible avec leur volonté de créer un état islamique sur l’ensemble du territoire.
Et les pro-palestiniens peuvent-ils entendre que le malheur actuel des gazaouis est en grande partie dû à la stratégie et aux actes du Hamas. D’abord en raison de la barbarie démesurée du 7 octobre qui entraîne cette réplique d’une violence inouïe de Tsahal. Ensuite parce qu’ils se protègent derrière les civils de Gaza et que si eux se réfugient dans les tunnels souterrains pour résister aux bombardements, ils laissent les civils recevoir toutes les bombes sans protection ? Le Hamas est d’un cynisme absolu et n’en a que faire des femmes, des enfants et des hommes qui meurent à Gaza. Son objectif n’est pas le bonheur sur terre et chaque victime supplémentaire constitue un carburant supplémentaire pour la haine et le rejet d’Israël que poursuit le Hamas.
Et on pourrait continuer à interpeller les uns et les autres dans leur déraison.
Et on continue à « mettre les morts à table ».
Alors que la seule solution, bien sûr très compliquée, mais c’est la seule qui est viable à terme, c’est de mettre des vivants à la table, des vivants capable de négocier, d’écouter l’autre et de faire des pas vers l’autre. Et aussi remettre au centre de ce conflit la raison du différent qui est territorial. Enfin, en écarter autant que possible le caractère religieux qui est une impasse parce qu’elle écarte le compromis au dépens d’un absolutisme délétère.
<1776>
-
Jeudi 16 novembre 2023
« Concert de l’Orchestre de Paris du 15 novembre 2023. »Dirigé par Klaus MäkeläJ’ai déjà écrit que l’Orchestre de Paris vivait son âge d’or, parce qu’il a choisi, comme directeur musical, un jeune prodige né le 17 janvier 1996 à Helsinki : Klaus Mäkelä
Comme les autres grands orchestres, l’Orchestre de Paris dispose de sa chaîne Internet : <https://philharmoniedeparis.fr/fr/live>
Mais contrairement aux autres phalanges, comme le Philharmonique de Berlin, par exemple, ce site est gratuit et ouvert à tous.
Il vient de mettre en ligne le concert du 15 novembre.
Ce concert se trouve derrière ce lien : <https://philharmoniedeparis.fr/fr/live/1160923>
Programme :
Maurice Ravel : Shéhérazade – Ouverture de féérie
Camille Saint-Saëns : Concerto pour piano n° 5 « Égyptien »
Entracte
John Dowland : Lachrimae Antiquae
Robert Schumann : Symphonie n° 2
Le pianiste est Alexandre Kantorow, de 6 mois plus jeune que Klaus Mäkelä et premier français à avoir remporté le prestigieux Concours international Tchaïkovski de Moscou en 2019.
Ce concert pourra être visionné en ligne en intégralité, jusqu’au 15 mai 2024.
< Mot du jour éphémère > -
Jeudi 9 novembre 2023
« C’est très simple : la haine est un poison et, en fin de compte, on s’empoisonne soi-même. »Anita Lasker-Wallfisch, rescapée d’AuschwitzTant de haine se déverse sur ce monde.
Quel torrent de haine devait couler dans les veines de ces hommes du Hamas pour commettre ces abominations du 7 octobre contre des hommes, des femmes et des enfants simplement parce qu’ils habitaient en Israël.
Cette haine a alimenté la haine des israéliens qui veulent éradiquer le Hamas et qui se sont lancés dans un bombardement terrifiant d’un territoire qui est une prison puisqu’on ne peut pas en sortir.
Ces bombes ont-ils pour objectif de détruire les 30 000 à 40 000 combattants que compte cette organisation, au milieu de 2 200 000 palestiniens qui habitent Gaza et plus de 200 otages du Hamas ?
De part et d’autre, on déshumanise les humains de l’autre camp en les traitant d’animaux.
La violence et la vengeance que le gouvernement de Benyamin Netanyahou a extériorisé par un déluge de bombes sur la bande de Gaza, sans oublier les exactions que commettent les colons juifs extrémistes, sur le territoire occupé de Cisjordanie, à l’égard des palestiniens a encore augmenté la haine contre Israël dans les peuples arabes, les communautés musulmanes des pays occidentaux et beaucoup de celles et de ceux qui défendent les droits des palestiniens à posséder une patrie.
Et cet engrenage a réveillé l’antisémitisme dans le monde et dans nos pays, France, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne.
Edgar Morin vient de faire paraître un livre : « Mon ennemi c’est la haine. »
Augustin Trapenard, l’a interrogé, dans le cadre de son émission « la Grande Librairie » du mercredi 8 novembre.
Edgar Morin après avoir rappelé que la haine engendre la haine a expliqué que pendant la guerre, dans laquelle il avait été résistant, il ne haïssait pas les allemands, il haïssait juste l’idéologie nazi.
Ne pas haïr les humains, mais quelquefois les idées qui sont à l’œuvre.
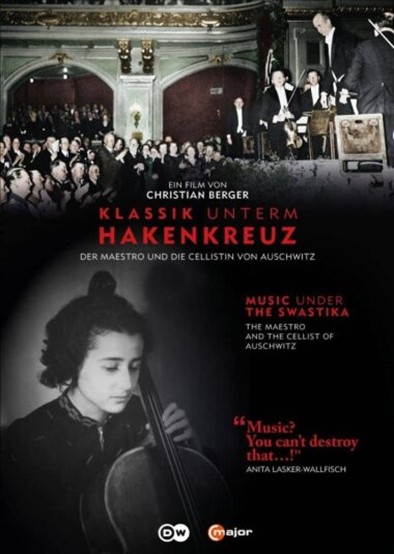 Hier, j’ai reçu un message d’un site auquel je suis abonné « Resmusica » qui me renvoyait vers un article : « Furtwängler et la violoncelliste Lasker-Wallfisch d’Auschwitz »
Hier, j’ai reçu un message d’un site auquel je suis abonné « Resmusica » qui me renvoyait vers un article : « Furtwängler et la violoncelliste Lasker-Wallfisch d’Auschwitz »
L’article faisait la promotion d’un DVD documentaire qui parlait, un peu, du plus grand chef d’orchestre allemand au milieu du XXème siècle : Wilhelm Furwängler.
Furwängler s’était compromis avec le régime nazi en continuant à diriger en Allemagne et notamment devant et à l’invitation des dignitaires nazis.
Mais ce documentaire parlait surtout d’une violoncelliste juive : Anita Lasker-Wallfisch qui a été déportée à 17 ans dans le camp de la mort d’Auschwitz et qui a été incorporé dans l’orchestre des femmes d’Auschwitz ce qui lui a permis de survivre.
Le rapport entre les deux c’est que Furtwängler est venu diriger cet orchestre ce qui donne comme sous-titre : « Le maestro et la violoncelliste d’Auschwitz ».
Je ne la connaissais pas, mais grâce à ce message je suis parti à sa découverte.
Chaque année l’Allemagne commémore une journée souvenir à la mémoire des victimes de la Shoah.
Le 31 janvier 2018, Anita Lasker Wallfisch avait 92 ans, elle était l’invitée d’honneur du Bundestag et a fait un discours.
Vous trouverez ce discours en allemand, derrière ce lien : <Anita Lasker-Wallfisch im Bundestag>
Sur ce site, vous trouverez un extrait de ce discours sous-titré en français : <l’émouvant discours d’une rescapée de l’holocauste >
Et derrière ce lien : <2018-01-31-Le discours d’Anita Lasker Wallfisch> vous trouverez une tentative de traduction en français de l’intégralité du discours.
Elle y raconte son histoire, l’arrivée au pouvoir des nazis et l’oppression des juifs à partir de ce moment.
En 2016 et 2017 de nombreux actes antisémites ont été commis en Allemagne, le parti d’extrême droite AFD est entré au Parlement allemand : <Antisémitisme : en Allemagne, les vieux démons resurgissent>
Ce qui fait dire à Anita Lasker Wallfisch :
« L’antisémitisme est un virus vieux de deux mille ans et apparemment incurable. Il mute pour prendre de nouvelles formes : religion, race. Seulement aujourd’hui, on ne dit pas forcément « les Juifs ». Aujourd’hui, ce sont les Israéliens, sans vraiment comprendre le contexte ni savoir ce qui se passe en coulisses.
On reproche aux Juifs de ne pas s’être défendus, ce qui ne fait que confirmer l’impossibilité d’imaginer ce qu’il en était pour nous à l’époque. Et puis on reproche aux Juifs de se défendre. Il est scandaleux que les écoles juives, même les jardins d’enfants juifs, doivent être surveillés par la police. »
Elle raconte la brutalité avec laquelle la shoah s’est brutalement montrée aux yeux des juifs :
« Et puis tout s’est arrêté brusquement. L’exclusion radicale. Il y avait des affiches partout : « Les Juifs ne sont pas les bienvenus ». Nous n’avions plus le droit d’utiliser les piscines ni de nous asseoir sur les bancs publics, et nous devions rendre nos bicyclettes. Les hommes juifs devaient ajouter le nom « Israël » et les femmes « Sarah » à leur nom. Nous avons été chassés de chez nous. Puis nous sommes entrés dans le Moyen-Âge : nous devions porter une étoile jaune, on me crachait dessus dans la rue et on me traitait de sale juif. Notre père, incurable optimiste, ne pouvait pas croire ce qui se passait. Les Allemands ne peuvent tout de même pas accepter cette folie ? »
 Son père avait été soldat allemand en 1914-1918, il avait été décoré. Il était avocat, totalement imprégné de culture allemande. Du point de vue religieux, la famille n’était pas pratiquante, Anita Lasker ne savait même pas ce que signifiait être juif.
Son père avait été soldat allemand en 1914-1918, il avait été décoré. Il était avocat, totalement imprégné de culture allemande. Du point de vue religieux, la famille n’était pas pratiquante, Anita Lasker ne savait même pas ce que signifiait être juif.
Toute la famille comprend que l’horreur est en route :
Nos parents ont été déportés le 9 avril 1942. Bien sûr, nous voulions rester ensemble, aller avec eux. Mais notre père nous a sagement dit non. « Là où nous allons, on y arrive bien assez tôt ». Inutile de dire que nous ne les avons jamais revus. J’avais 16 ans.
Elle sera déportée à Auschwitz un peu plus tard et sera intégrée à l’orchestre des femmes. Elle assistera aux horreurs qui s’y passeront. Elle raconte
« L’orchestre était installé dans le Block 12, tout au bout de la route du camp, à quelques mètres du Crématorium I et avec une vue imprenable sur la rampe. Nous pouvions tout voir : les cérémonies d’arrivée, les sélections, les colonnes de personnes marchant vers les chambres à gaz, bientôt transformées en fumée.
En 1944, les transports en provenance de Hongrie arrivent et les chambres à gaz ne peuvent plus suivre. Comme le décrit Danuta Czech dans son remarquable livre Auschwitz Chronicle, 1939-1945 : Le commandant du camp, Höß, ordonna de creuser cinq fosses pour brûler les cadavres. Il y avait tellement de transports que parfois, il n’y avait pas de place dans le crématorium V pour tous les corps. S’il n’y avait pas de place dans les chambres à gaz, les gens étaient fusillés à la place. Beaucoup ont été jetés vivants dans les fosses en feu. J’ai vu cela de mes propres yeux.
Même si vous n’étiez pas envoyé directement dans la chambre à gaz, personne ne survivait longtemps à Auschwitz – le maximum que vous pouviez espérer était d’environ trois mois. Mais si l’on avait besoin de vous pour une raison ou une autre, vous aviez une chance infime de survivre. J’ai eu cette chance – on avait besoin de moi.
Nous jouions des marches à la porte du camp pour les prisonniers qui travaillaient dans les usines voisines – IG Farben, Buna, Krupp, etc. – et nous donnions des concerts le dimanche autour du camp pour les personnes qui y travaillaient ou toute autre personne qui souhaitait nous entendre jouer. Pour beaucoup, entendre jouer de la musique dans cet enfer était l’insulte suprême. Mais pour d’autres, peut-être, c’était l’occasion de rêver d’un autre monde, ne serait-ce que pour quelques instants. »
Elle raconte à propos de cet orchestre :
« Parfois, je pense que l’orchestre d’Auschwitz était une sorte de microcosme, une société en miniature dont nous pouvons nous inspirer. Toutes les nationalités étaient représentées. C’était une tour de Babel. À qui puis-je parler ? Seulement à ceux qui parlent allemand ou français. Je ne sais pas parler russe ou polonais, donc je ne leur parlerai pas. Au lieu de cela, nous nous regardons avec méfiance et supposons automatiquement que l’autre personne est hostile ; nous ne pensons pas à demander pourquoi l’autre personne a également fini à Auschwitz. »
A partir de ce constat et d’une expérience elle donne le conseil de construire des ponts :
« Bien des années après ces événements, je suis en contact étroit avec l’une de ces autres prisonnières, une Polonaise, une aryenne pure qui jouait du violon dans l’orchestre. Nous ne nous sommes jamais parlé à l’époque. Mais grâce à un livre incroyablement mal écrit sur l’orchestre de femmes, nous avons repris contact et nous nous sommes retrouvées à Cracovie. Nous avons encore du mal à trouver une langue commune, mais nous nous parlons et nous nous écrivons en anglais. Bref, nous sommes devenues amies et avons découvert que nous avons bien plus en commun que ce qui nous sépare. Cela peut peut-être servir d’exemple pour les problèmes d’aujourd’hui. Parlez à l’autre. Construisez des ponts. »
Et puis elle termine par cette conclusion bouleversante :
« Nous avons dû surmonter d’innombrables difficultés avant de pouvoir quitter l’Allemagne ; cela a pris près d’un an, et j’ai juré de ne plus jamais mettre les pieds sur le sol allemand. J’étais rongé par une haine sans borne de tout ce qui était allemand. Comme vous le voyez, j’ai rompu mon serment – il y a de très nombreuses années – et je ne le regrette pas. C’est très simple : la haine est un poison et, en fin de compte, on s’empoisonne soi-même. »
 Si des femmes qui ont vécu ce qu’a vécu Anita Lasker Wallfisch sont capable de surmonter la haine, l’espoir peut rester dans nos cœurs.
Si des femmes qui ont vécu ce qu’a vécu Anita Lasker Wallfisch sont capable de surmonter la haine, l’espoir peut rester dans nos cœurs.
D’après sa page <Wikipedia> Anita Lasker Wallfisch vit toujours, elle a 98 ans.
Son fils Raphaël Wallfisch est un des grands violoncellistes de la scène musicale.
Elle a témoigné longuement, en langue française, sur son histoire au « Mémorial de la Shoah ». L’INA a mis en ligne ce témoignage de plus de 2 heures : « Anita Lasker Wallfisch »
Le Point parle d’elle : « une survivante d’Auschwitz dénonce le « virus » antisémite »
Geo aussi : <Le long silence d’Anita Lasker-Wallfisch>
<1775>
-
Vendredi 3 novembre 2023
« Que nous soyons Israéliens ou Palestiniens, Libanais, Syriens, juifs ou musulmans, chrétiens ou athées, Français ou Américains, nous ne nous méfierons jamais assez du recours au « nous contre eux », qui signe fatalement le début de l’obscurantisme et de la cécité. »Dominique EddéÉcrire sur ce conflit qui met face à face, deux peuples pour une même terre, présente le risque de se fâcher avec beaucoup de monde. D’abord avec les personnes convaincues de chacun des deux camps qui trouveront toujours qu’on ne compatit pas assez avec les souffrances du camp défendu et qu’on est aveugle sur la culpabilité du camp d’en face. Mais on peut aussi se fâcher avec les personnes neutres qui considèrent que dans ce domaine la seule position digne est de se taire.
Je n’ai pas de solution bien sûr et je suis rempli de doutes.
Mais il me semble que seuls les mots, même maladroits, sont en mesure de surpasser la violence et de maîtriser la sidération et le désarroi.
L’histoire ne commence pas le 7 octobre 2023 et il faut se pencher aussi sur ce qui s’est passé avant.
Mais le 7 octobre constitue une rupture que l’écrivaine libanaise Dominique Eddé décrit ainsi dans une Tribune du Monde du <31 octobre 2023>
« Le carnage barbare du Hamas, le 7 octobre, n’a pas fait que des milliers de morts et de blessés civils israéliens, il a jeté une bombe dans les esprits et dans les cœurs, il a arrêté la pensée. Il a autorisé le déchaînement des passions contre les raisons et les preuves de l’histoire. Ce déchaînement peut se comprendre là où manquent les moyens de savoir, d’un côté comme de l’autre. Là où la douleur est écrasante. Il est inacceptable chez les puissants : là où se déclarent les guerres, là où se décident les chances de la paix. »
Par cet acte « horrible » le Hamas a tendu un piège à Israël, piège qu’Israël a énormément de difficultés à contourner.
Il était inimaginable et inacceptable qu’Israël ne réagisse pas et ne s’attaque durement au Hamas.
Le blocus et les bombardements massifs sur une population civile qui est prisonnière, dans ce bout de territoire surpeuplé, sont en train de renverser dans l’esprit de beaucoup, notamment dans les populations musulmanes et aussi des populations non occidentales, le poids de l’inhumanité du côté de l’armée israélienne.
En outre, des exactions et des crimes commis par des colons juifs en Cisjordanie contre la population arabe ont conduit, même les États-Unis, à réagir par la voie du porte-parole du département d’État, Matthew Miller en dénonçant <des attaques> :
« Incroyablement déstabilisatrices et contre-productives pour la sécurité à long terme d’Israël, en plus d’être, bien sûr, extrêmement préjudiciables aux Palestiniens vivant en Cisjordanie »
Ceci a fait exploser un antisémitisme latent dans le monde entier et en France aussi.
Longtemps, l’antisémitisme était analysé comme l’apanage de l’extrême droite maurassienne. Beaucoup de gens de gauche ont eu du mal à accepter l’idée qu’il y avait aussi en France un antisémitisme musulman.
Parce qu’on peut se trouver être très critique avec les décisions, les actions du gouvernement d’Israël, mais pourquoi faire porter la responsabilité et commettre des actes contre les juifs en France ou ailleurs ?
Seul l’antisémitisme peut l’expliquer sans le justifier.
Ismaël Saidi est musulman, il est comédien et metteur en scène de la pièce « Djihad ». Il a commis un article : « En tant que musulman, je refuse de me voiler la face sur la nature de l’antisémitisme en France » dans lequel il écrit :
« « Il ne faut pas être juif » : c’est l’unique « raison » que l’on peut trouver aux crimes commis ce 7 octobre 2023, du moins, je n’en vois pas d’autre car aucune cause, aussi légitime soit-elle, même aussi noble que celle de la création d’un état pour le peuple palestinien en souffrance depuis si longtemps, ne justifie un massacre. […]
Mais si, pour une fois, au lieu d’inviter un rabbin et un imam sur tous les plateaux en leur demandant de nous montrer à quel point les religions ne sont qu’amour et paix (les millions de morts à travers les siècles, victimes de guerres de religions, de croisades, de pogroms, d’esclavage apprécieront…), on se posait la bonne question.
Si pour une fois, au lieu de mettre la poussière sous le tapis jusqu’au prochain attentat, nous arrêtions de nous voiler la face.
Je vais donc lancer un pavé dans la mare : pourquoi lorsque des atrocités sont commises à des milliers de kilomètres de chez nous, faut-il protéger la communauté juive de France ?
Pourquoi est-ce que l’on trouve cela normal ?
Pourquoi est-ce qu’un Français juif doit craindre de sortir avec une kippa ou la moindre preuve d’appartenance à sa communauté de croyance ?
Pourquoi des maisons où se trouvent des mézouzas sont visées ? Pourquoi des familles changent leur nom sur les applications de livraison pour éviter de se faire agresser si elles sont reconnues comme juives ? De quoi les Français juifs sont-ils coupables ?
Si le Moyen-Orient s’enflamme, pourquoi nos compatriotes juifs doivent-ils en souffrir ?
La réponse qui me vient à l’esprit est qu’il y a une idéologie en France qui a décidé de faire des juifs ses ennemis.
Comme l’avait fait le nazisme, par le passé, il y a une idéologie qui veut « se faire du juif ».
Je le dis parce que je ne la connais que trop bien.
Des années à être abreuvé d’images, de discours sur « nos frères palestiniens » très vite devenus « nos frères en islam » tués par les « juifs » – et pas par les Israéliens car dans le monde arabo-musulman, c’est le mot « juif » qui est utilisé et à dessein.
Les terroristes n’ont-ils pas appelé leur famille, hurlant de joie, leur expliquant qu’ils ont tué « des juifs ».
Ainsi le glissement sémantique a eu lieu depuis bien longtemps : ce n’est pas Palestinien contre Israélien, mais musulman contre juif.
Il n’est donc pas étonnant, quand on comprend cela, que dans le pays où se trouve la plus grande communauté musulmane d’Europe et la plus grande communauté juive d’Europe, la situation devienne explosive.
Et là où beaucoup d’entre nous pensent que c’est le conflit israélo-palestinien qui est la matrice de l’antisémitisme en France, je répondrai : changez de paradigme de lecture, retournez l’image d’Épinal et vous comprendrez: c’est l’antisémitisme que l’on retrouve dans une idéologie meurtrière, cancer de l’islam, qui est devenu, aujourd’hui, la matrice du conflit israélo-palestinien. »
Dans sa tribune au Monde Dominique Eddé ajoute :
« Que nous soyons Israéliens ou Palestiniens, Libanais, Syriens, juifs ou musulmans, chrétiens ou athées, Français ou Américains, nous ne nous méfierons jamais assez du recours au « nous contre eux », qui signe fatalement le début de l’obscurantisme et de la cécité.
Or l’emploi de ces trois mots enregistre à l’heure qu’il est des records terrifiants, d’un bord à l’autre de la planète. Et il se répand à une vitesse si foudroyante qu’il emporte les têtes, comme un ouragan des maisons. […]
Pour assurer son existence dans la durée, Israël doit renoncer à l’anéantissement de Gaza et à l’annexion de la Cisjordanie. Son avenir ne peut pas lui être assuré par l’expulsion, l’extermination, la conquête du peu de territoire qui reste. Il ne peut l’être que par un changement radical de politique. Un renoncement à la logique de l’affirmation de soi par la supériorité militaire et la négation de l’autre. Alors, les esprits ignorants ou bornés du monde arabo-musulman prendront mieux la mesure de ce temps de l’horreur absolue que fut la Shoah. Il sera enfin enseigné et transmis aux nouvelles générations. Nous apprendrons, de part et d’autre, que pas une histoire ne commence avec soi.
On ne détruira pas les islamistes radicaux à coups de déclarations de guerre, on les affaiblira en leur ôtant, une par une, leurs raisons d’exister et d’instrumentaliser l’islam. Ce sera long ? Oui. Mais qu’on nous dise, quel autre moyen a-t-on d’éteindre un incendie sans frontières ?
C’est en retirant ses « prétextes » à la mauvaise foi générale qu’on fera peut-être advenir la paix à laquelle aspire désespérément le plus grand nombre. Les psychothérapeutes savent ce que les politiciens s’abstiennent de prendre en compte : formuler la souffrance de l’autre, son humiliation, l’aider à dire son cri, sa rage, sa haine, c’est les désamorcer. C’est d’un combat contre la haine qu’il s’agit désormais. Il engage chacun de nous, si l’on veut donner une chance aux prochaines générations.
Que les dirigeants israéliens et leurs soutiens aveugles renoncent à leur domination brutale, satisfaite et sans partage de ce lieu explosif qu’est la « Terre sainte ». Que les Arabes, les musulmans, les défaits de l’histoire n’oublient pas qu’en versant dans l’antisémitisme ils se salissent, ils tombent dans un mal qui n’est pas le leur, ils se retournent contre eux-mêmes. Qu’ils s’élèvent, bien sûr, contre le massacre en masse qui est en cours, mais qu’ils ne privent pas les familles israéliennes endeuillées de leur compassion, qu’ils ne confondent pas leur révolte avec le fantasme de la disparition d’Israël.
N’oublions pas, nous autres Arabes, que nous avons massivement contribué à notre malheur. N’oublions pas qu’en matière d’horreur nous avons enregistré sur nos sols, depuis 1975, une série abominable de massacres. Du Liban à la Syrie, à l’Irak, nos prisonniers ont été enfermés dans des conditions atroces. Des femmes, des hommes ont été torturés, sans que nous sachions les défendre. Nos mémoires, nos cerveaux, nos âmes ont été torturés. Nos cultures. Notre histoire millénaire. Aucun de ces pays n’est parvenu à résister aux manipulations internes et externes, à la pression infernale des grandes puissances, à la sinistre alliance de la corruption, du mépris des pauvres et de la plus abusive des virilités.
Nous ne pouvons plus relever la tête à coups de slogans et de doléances exclusivement dirigés contre Israël. L’avenir ne consiste pas à revendiquer ce que l’on a perdu, mais à examiner ce qui reste à sauver. Israël existe. De ce qui fut un mal pour beaucoup d’entre nous peut sortir un bien pour tous.
Un chantier gigantesque
Ne ratons pas ce terrible et dernier rendez-vous. Souvenons-nous que la vie, la mort, le jour, la nuit, la douleur, l’orphelin, la terre et la paix se disent pareil en arabe et en hébreu. Il est temps pour chacun de nous de faire un immense effort si nous ne voulons pas que la barbarie triomphe à nos portes, pire : à l’intérieur de chacun de nous. »
J’avais déjà fait appel à Dominique Eddé lors d’un mot du jour précédent, c’était une lettre ouverte à Alain Finkielkraut : «Le monde est comme un masque qui danse : pour bien le voir, il ne faut pas rester au même endroit.»
<1774>
-
Lundi 30 octobre 2023
« Du coup, c’est compliqué … »Essai de synthétiser la situation en langue moderneIl y a deux mois j’ai trouvé une publication sur Facebook qui m’a amusé et que j’ai partagé.
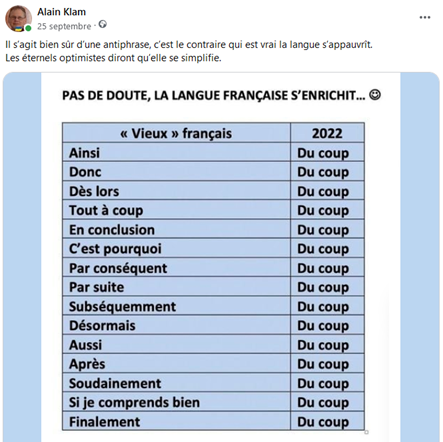 Et je dois dire que depuis j’écoute la radio, les émissions trouvées sur Internet, mes échanges avec autrui, jusqu’aux conversations dans la rue ou les transports commun, j’arrive à cette conclusion qu’en effet l’expression « du coup » est devenu extraordinairement fréquente.
Et je dois dire que depuis j’écoute la radio, les émissions trouvées sur Internet, mes échanges avec autrui, jusqu’aux conversations dans la rue ou les transports commun, j’arrive à cette conclusion qu’en effet l’expression « du coup » est devenu extraordinairement fréquente.
Ce dimanche matin j’ai entendu le député LFI Eric Coquerel sur France Info. Dans un discours uniquement tourné vers la responsabilité de l’Etat d’Israël, il a reconnu dans une proposition subordonnée qu’il y avait crime de guerre de la part du Hamas. Plus loin il a dit qu’Israël commettait aussi des crimes de guerre.
Un instant…
Ce qui s’est passé le 7 octobre, c’est le plus grand massacre de juifs, depuis la Shoah, avec des actes d’une barbarie écœurante.
Le Hamas est une organisation islamique, totalitaire, d’extrême droite. Je ne peux même pas comprendre qu’un homme de gauche puisse trouver le début du commencement d’une connivence avec une organisation qui est si loin de ses valeurs déclarées.
La vie des palestiniens et leur aspiration légitime à un État sont très loin de leur priorité qui est l’islamisation de la société palestinienne et de l’Oumma c’est-à-dire de la communauté de l’ensemble des musulmans du monde, puis de l’expansion de cette communauté dans la logique de l’idéologie des frères musulmans.
Je suis atterré que Mediapart, auquel j’étais abonné longtemps et qui sur certains dossiers a fait un travail remarquable et utile soit tombé avec son fondateur Edwy Plenel dans un islamo gauchiste niant l’idéologie et les objectifs de certaines organisations qu’ils défendent. Ce fut encore le cas lors de cette émission <Guerre au Proche-Orient : les dérives du débat français> dans laquelle après avoir une fois de plus dénigré le travail de Florence Bergeaud-Blackler a nié l’évidence du caractère totalitaire du Hamas, sa volonté d’éradiquer la présence juive au moyen orient et son ambition générale concernant l’Oumma, ainsi que les forces à l’œuvre en Occident et en France suivant les mêmes objectifs.
Je reconnais cependant que la présence et les interventions de Latifa Oulkhouir et de Hanna Assouline, déjà évoquée lors du mot du jour du lundi 23 octobre, étaient de qualité et donnaient des éclairages intéressants.
Et puis, il y a aussi l’Iran à la manœuvre.
Et je ne me lasserai pas de répéter ce moment de révélation rationnelle et laïque, lorsqu’en 1979, j’ai entendu une jeune iranienne appeler « la Ligne Ouverte », émission de Gonzague Saint Bris, pour crier sa colère que la gauche occidentale, dont je faisais partie, trouvait génial que Khomeini puisse renverser la dictature honnie du Shah d’Iran.
J’ai raconté cet épisode et aussi la manière dont la gauche et les humanistes iraniens ont été dupés puis persécutés par les monstres qui ont pris le pouvoir en 1979, en Iran : « Vous ne pouvez pas comprendre»
Les frères musulmans, le Hamas, les salafistes et autres font partie de cette même idéologie régressive, totalitaire, expansionniste et absolument opposée à notre manière de vivre, à notre liberté, à nos valeurs.
Alors « du coup c’est compliqué », parce qu’en face du Hamas, du côté des pro-israéliens, il y a aussi une vision unilatérale, violente, exclusive qui s’exprime.
Je pourrais aussi multiplier les exemples j’en prendrai deux.
Le premier est celui du discours télévisé du mercredi 25 octobre du premier ministre qu’Israël s’est donné :
« Ils sont le peuple des ténèbres, et la lumière triomphe des ténèbres. »
Benjamin Nétanyahou promet ensuite de « réaliser la prophétie d’Isaïe » avant de citer une partie du texte. « Il n’y aura plus de voleurs dans vos frontières et vos portes seront glorieuses. ».
Le verset 18 du chapitre 60 du livre d’Isaïe qui est un livre prophétique dit exactement.
« On n’entendra plus parler de violence en ton pays, de ravages ni de ruine en ton territoire, et tu appelleras tes murs ‘Salut’, et tes portes ‘Gloire’».
Il y a d’un côté « le camp du bien » et de l’autre « le camp du mal » et on fait appel à la religion pour éradiquer le mal. Le discours a comme fondement le fait que la force (avec l’aide de Dieu ?) permettra d’obtenir la paix et la fin de la violence.
« Du coup s’est compliqué » et la paix me semble alors très éloignée.
L’autre exemple est celui du député Habib Meyer, lors du discours de Jean-Louis Bourlanges, objet du mot du jour de vendredi dernier.
Lorsque Jean-Louis Bourlanges parle des colonies israéliennes en Cisjordanie, ce député réplique :
« La Judée ne sera jamais une colonie ! »
Faut-il une explication de texte ?
Le député utilise le terme de Judée, terme Biblique utilisé il y a 2000 ans à l’époque du Christ, jusqu’au moment où les romains et Titus ont combattu et chassé les juifs de ces terres parce qu’ils s’étaient révoltés contre l’empire romain.
Et puis il dit : « ce n’est pas une colonie ».
Dès lors, il rejette l’acte de l’ONU de 1947 qui avait autorisé la création en Palestine d’un « État juif » et d’un « État arabe ».
Il se place sur un autre registre, exactement parallèle à celui des islamistes.
Pour les islamistes, cette terre est musulmane selon la volonté de Dieu. Aucun humain et pas davantage l’ONU ne peut en disposer.
Pour les messianistes juifs et comme l’exprime Habib Meyer, cette terre, la Judée est la terre promise par Dieu à son peuple élu. La décision de l’ONU est une simple anecdote ne révélant qu’une partie de la vérité sur cette terre : Elle est aux juifs, il n’y a pas lieu d’en discuter avec les palestiniens ou d’autres humains.
Tant qu’il y a des combats politiques et territoriaux, des compromis sont possibles.
Mais si on jette sur la situation une vision religieuse, nous sommes dans l’absolu, il n’y a pas de compromis possible.
Il n’y a que la violence qui est bien sûr « l’expression de la volonté divine » qui peut être mise en œuvre.
Et c’est ce que fait Israël en bombardant de manière massive, cette prison à ciel ouvert qu’est Gaza. Les chiffres annoncés par le Hamas sont sujets à caution, mais il est certain que des milliers d’enfants, de femmes et d’hommes sont tués ou blessés grièvement avec peu de possibilité d’être soignés. A cela s’ajoute le blocus qui les prive d’eau, de nourriture, d’électricité. C’est un enfer. Des israéliens tombés dans une faille empathique absolue, disent : c’est la faute du Hamas. Peut être, mais ce sont les avions, les missiles et les armes israéliennes qui donnent la mort à beaucoup d’innocents. D’autres israéliens répondent mais eux aussi nous envoient des roquettes et des projectiles pour nous tuer. Oui, ils répliquent dans ce cas.
Nous sommes dans une tragédie dans laquelle des enfants, des femmes et des hommes souffrent et meurent, pris dans l’engrenage des haines qui se nourrissent les unes des autres, sans que notre humanité ne soit en mesure de les freiner.
Manon Quérouil-Bruneel, Grande-reporter Paris Match, témoigne dans l’émission du 26 octobre 2023 <C ce soir : La bataille de l’émotion> :
« On est arrivé à un degré de haine des deux côtés qui est terrifiant.
Je suis allé du côté de la Cisjordanie, avec des images du 7 octobre. Il y avait une impossibilité de reconnaître les crimes contre les civils qui avaient été commis par le Hamas.
Même des personnes de l’intelligentsia palestinienne, solidement structurées, remettent en cause ces images.
Parce que, pour eux, c’est un mouvement de libération et qu’il n’aurait pas pu commettre de telles atrocités.
Et côté israélien le choc devant la barbarie est tel que la parole de paix est inaudible.
On n’arrive plus à faire ce travail de compassion, au sens propre, c’est à dire souffrir avec l’autre. »
Ce défaut de capacité de comprendre ou simplement d’entendre la souffrance de l’autre est prégnant non seulement pour les deux peuples qui s’affrontent, mais même pour celles et ceux qui ont pris fait et cause pour l’un des camps.
Il n’y a que de l’empathie pour celles et ceux que l’on défend
Nous sommes dans une rupture d’humanité.
J’ai quand même trouvé ce beau dialogue entre la Rabin Delphine Horvilleur et Kamel Daoud écrivain et journaliste franco-algérien dans « l’Obs » : « Nous devons réaffirmer notre humanité »
 Delphine Horvilleur dit au début de l’entretien :
Delphine Horvilleur dit au début de l’entretien :
« D’abord, je m’étais dit que j’arrêterais les entretiens. Et puis quand on m’a proposé de dialoguer avec toi, Kamel, j’ai senti combien j’avais besoin de le faire, presque dans un souci de santé mentale. Depuis quelques jours, j’oscille entre une très profonde tristesse, un sentiment de dévastation, et une colère, une rage particulière et un désespoir que je ne connaissais pas en moi qui me suis toujours perçue comme une optimiste. Je suis en manque d’un dialogue humain sensé, empathique, au milieu de cette déferlante de haine et de rage. Je suis en réalité très blessée de trouver si difficilement des interlocuteurs. J’avoue, j’attendais les paroles d’intellectuels musulmans avec qui je dialogue habituellement. Il y en a eu quelques-unes, si essentielles, mais si rares. Quelque chose m’échappe dans ce silence qui me terrasse. J’ai le sentiment d’une immense solitude. »
Et Kamel Daoud répond :
J’aime écouter Delphine. Et je ressens aussi le besoin de dialoguer pour réaffirmer quelque chose de banal qui est l’humanité, face à cette déferlante d’inhumanité qui s’est infiltrée en chacun, dans chaque camp, dans chaque famille. Mais j’ai aussi une colère, elle n’est pas de même valeur que la tienne, je n’ai pas été attaqué comme les Israéliens dans leur maison, j’ai connu autrefois ce genre d’attaque en tant qu’Algérien durant la guerre civile quand les islamistes décapitaient, massacraient et violaient, mais c’est autre chose. Je suis en colère parce que je suis musulman de culture et que dans ma géographie on me refuse le droit à l’expression et à la nuance, parce qu’on voudrait me forcer à une unanimité monstrueuse qui n’est pas la mienne. Je ressens également cette solitude profonde, incomparable avec celle de ceux qui ont perdu des vies, parce que j’ai pris la parole pour dire qu’une cause doit garder sa supériorité morale, qu’elle s’effondre si elle choisit la barbarie et trouve des gens qui la justifient. »
Pourquoi est-il si compliqué de trouver de la compassion pour l’Autre ?
« D. H. La lucidité vient du mot lumière, mais c’est l’éloge de l’obscurité qui prime aujourd’hui. Tu parlais de malentendu, ça m’a fait penser au non-entendu. Après le 7 octobre, ce qui m’a paru le plus fou, c’est que je n’ai pas trouvé de voix palestinienne en France pour dénoncer le Hamas. En fait, et pardon pour ma naïveté, ça me paraissait facile à faire. Cela fait des années que je m’emploie à dénoncer le gouvernement de Netanyahou, l’horreur de l’occupation, la dérive de la société, son hubris, etc., et j’ai été sidérée de ne pas trouver de voix palestinienne en France pour dire « notre cause est juste, les Palestiniens ont le droit d’avoir une terre, mais pas par ces moyens-là ». Même pour Leïla Shahid [ancienne déléguée générale de l’Autorité palestinienne en France, NDLR], dénoncer le terrorisme du Hamas était impossible. Jusqu’à aujourd’hui, je ne m’en relève pas. Ce silence ne trouve pas de place dans mon schéma mental. »
« K. D. Malheureusement, ça ne m’étonne pas, j’ai toujours connu ce « on » et ce « off » dans le discours des intellectuels du Sud. Mais ce qui me frappe, c’est qu’en Algérie ou en Égypte, et dans bien d’autres pays, nous connaissons les méthodes des islamistes, et leur but. […] On le sait que le but des islamistes n’a jamais été de fonder un État palestinien ; le but des islamistes, c’est de précipiter la fin du monde, ils veulent un messianisme qui a abouti, c’est une vision judéophobe dont la finalité est la disparition du peuple juif. Et le Palestinien, dans cette mythologie, est un destin des plus tragiques. Il lui est dit que la fin du monde adviendra le jour où tous les Juifs seront tués et le Palestinien libéré. Mais quelle arnaque ! On lui promet à la fois un pays et la mort, on lui dit « tu vivras libre, mais un instant », au prix de ta disparition et de celle du monde entier. Et le fait que les élites laïques ont opté, dans leur majorité, pour une mécanique de l’affect et de la vengeance, de la douleur et de la frustration, pour soutenir ce rêve, qui est un cauchemar, en oubliant le rêve porté par Arafat – avec certes les errements de son époque –, que des intellectuels succombent à cette illusion en se disant que c’est un moyen, peut-être pourri, d’aboutir à quelque chose, ce basculement vers le rêve de fin du monde en soi comme étant la seule solution possible, est désarmant. »
Et je citerai encore ces deux propos de Kamel Daoud de ce long entretien qu’il est bon de lire :
« Je suis pour un État palestinien et je crois que l’existence d’un tel État est nécessaire non seulement pour les Palestiniens mais aussi pour ma propre liberté dans mon propre pays, parce que ce problème hypothèque tous nos projets de démocratisation. Mais je ne peux pas adhérer à un projet d’extermination qui refuse l’humanité à chacun. S’il s’agit d’une cause de colonisation et de décolonisation, là je suis solidaire. S’il s’agit d’une cause raciale, arabe, ou confessionnelle, musulmane, je ne peux pas l’être. Ce ne serait pas rendre justice à cette cause et à la volonté de ce peuple d’avoir une terre et une histoire. Ce 7 octobre est une véritable défaite, parce que ce qu’il disait, c’est « on veut la terre pour les Palestiniens avec la noyade pour les Israéliens ».
Et
« Et il y a un autre drame, c’est l’hydre dont parlait Delphine : la guerre fabrique le tueur de demain. C’est le cycle dans lequel nous sommes tous entraînés et ce pour quoi il faut impérativement revoir ce problème à partir de deux grands enjeux. D’une part, l’enjeu de l’humanité de chacun : le droit d’humanité pour l’Israélien et le Juif, pour l’Arabe et le Palestinien. Et d’autre part, l’enjeu démocratique, car plus la Palestine rétrécit, plus le califat imaginaire s’étend. Je demande à Israël comme en Palestine, de faire la paix pour pouvoir me libérer. Tous les propalestiniens, loin de là, ne sont pas d’accord avec ça ! »
Pour conclure le journaliste de « L’Obs » rappelle à Delphine Horvilleur le sermon qu’elle a prononcé le 24 septembre à l’occasion de la fête juive de Kippour
« Je ne le regrette pas, mais il me fait trembler. Je voulais en effet faire une mise en garde, à partir de nos textes, contre l’hubris de la souveraineté. La Bible, et en particulier le Deutéronome, dit aux Hébreux qui vont entrer sur la Terre promise : « Il arrivera un jour où vous serez souverains sur cette terre, et vous serez menacés par votre puissance parce que vous n’aurez plus conscience de votre vulnérabilité. Vous allez tellement croire à cette puissance qu’elle risque d’être pour vous assassine. »
Et Delphine Horvilleur finit par :
« Dans l’une de ses chansons, Leonard Cohen, qui était présent sur les champs de bataille durant la guerre de Kippour, écrit : « Il y a une brisure dans chaque chose, mais c’est là que la lumière se faufile. » Je veux me raccrocher à cela. »
Cette phrase « There is a crack, a crack in everything, That’s how the light gets in » se trouve dans la chanson « Anthem » de Leonard Cohen
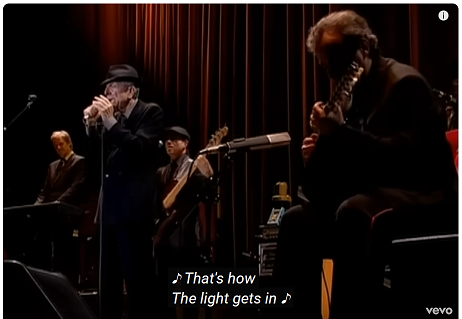 « Ah les guerres elles
« Ah les guerres elles
Recommenceront
La colombe sacrée
Sera attrapée de nouveau
Pour être achetée et vendue
Et achetée encore
La colombe n’est jamais libre.
Sonnez les cloches qui peuvent encore sonner
Oubliez vos offrandes parfaites.
Il y a une fissure en toute chose.
C’est ainsi qu’entre la lumière. »
Extrait d’Anthem
Du coup, si on laisse parler l’humanisme, qu’on revient à la politique et qu’on limite la religion à s’occuper du spirituel et de l’âme, on pourra peut-être trouver la voie du compromis qui est la seule permettant d’aller vers la Paix.
<1773>
-
Vendredi 27 octobre 2023
« Partout, les forces attachées à la modération, à la coopération et à la paix ont été battues en brèche. »Jean-Louis Bourlanges, le 23 octobre, à l’Assemblée NationaleHier j’ai partagé un cri de colère.
Non ! ce que le Hamas a fait n’est pas un acte de résistance !
C’est un crime contre l’humanité. Ce que ces croyants ont perpétré au nom d’Allah, ne peut s’inscrire dans les valeurs de l’humanité.
Il faut aimer la mort, comme nous aimons la vie pour agir ainsi.
Il faut croire aveuglément à un récit et dénier à celles et ceux qui n’y croient pas, jusque qu’à la dernière parcelle d’humanité.
Non, on ne peut pas considérer que ce qui s’est passé à partir de 7 octobre est une simple riposte entre deux belligérants.
Les crimes du Hamas sont au-delà de ce que nous pouvions imaginer, horreur et atrocité.
Je ne suis plus croyant dans une des religions du Livre. Mais pour les croyants, il y a cette malédiction que je crois légitime pour chacun des assassins du Hamas et de ceux qui les ont envoyés :
« Quand on le jugera, qu’il soit déclaré coupable, Et que sa prière passe pour un péché ! »
Psaume 107 verset 7 dans la traduction de Louis Segond.
Que leurs prières soient péchés !
Il fallait que cette abomination soit dénoncée.
Et le 23 octobre, un vieil homme de 77 ans, est monté, tout essoufflé, à la tribune de l’Assemblée Nationale, au Palais Bourbon.
Il avait du mal à retrouver son souffle. Il finira épuisé, au bord du malaise.
Mais lorsqu’il a vraiment débuté son discours, la magie du verbe et la lucidité de la politique, se sont emparées de ce corps fragile.
 Un discours exceptionnel de Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des affaires étrangères et député Modem. Un discours comme il y en eut jadis à la tribune de cette Assemblée, loin des interventions querelleuses et électoralistes qui sont désormais le lot quotidien de la chambre basse de notre parlement.
Un discours exceptionnel de Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des affaires étrangères et député Modem. Un discours comme il y en eut jadis à la tribune de cette Assemblée, loin des interventions querelleuses et électoralistes qui sont désormais le lot quotidien de la chambre basse de notre parlement.
Il a aussi commencé à poser, ce qui doit être dit :
« Le 7 octobre dernier, cette interminable tragédie a pris un cours décisivement nouveau et d’une gravité exceptionnelle : Israël s’est trouvé confronté à une agression paramilitaire de première grandeur, menée par un Hamas résolu à piétiner tous les principes, toutes les règles, tous les usages régissant les relations entre les peuples, que ceux-ci soient en guerre ou en paix. Si les mots ont un sens, il est clair que l’agression conduite par le Hamas est à la fois terroriste, constitutive d’un crime de guerre généralisé et adossée à un discours à caractère génocidaire assumé. Le Hamas met en scène les pires violences sur les populations dans le seul but d’effrayer et d’intimider : c’est du terrorisme. Le Hamas ne fait la guerre qu’aux civils, c’est la définition même et dans son extension maximale du crime de guerre ! Les fidèles du Hamas n’hésitent pas à appeler non pas uniquement à la disparition de l’État d’Israël, mais à l’élimination des Juifs en tant que Juifs ! C’est l’expression même d’une volonté de génocide porteuse d’un crime contre l’humanité.»
Mais il avait introduit ce propos par un rappel historique essentiel qui fait le constat que la situation conflictuelle au Proche-Orient depuis soixante-quinze ans provient de l’absence d’un État palestinien aux côtés de l’État israélien :
« Le 29 novembre 1947, L’Assemblée générale des Nations unies décidait, par trente-trois voix contre treize, la création de l’État d’Israël tout en prenant soin de proposer l’institution parallèle d’un État palestinien qui, à la suite de la guerre qui a accueilli la décision onusienne, n’a jamais pu voir le jour. De ce vote solennel qui engage la communauté internationale date à la fois le droit imprescriptible du peuple juif à vivre dans un État libre et souverain, et le lancinant problème posé par l’émergence indéfiniment différée de son jumeau palestinien. Israël était né, Ismaël restait dans les limbes ; la tragédie prenait ses marques au cœur d’un Moyen-Orient par ailleurs déchiré par la guerre froide. »
Pour ceux qui manquent de références bibliques, il faut savoir que selon ce récit Ismaël est le fils d’Abraham qui serait le père de tout le peuple Arabe ainsi que de la lignée menant au prophète de l’islam Mahomet. Le second fils d’Abraham sera Isaac qui lui même sera le père de Jacob qui prendra le nom d’Israël et sera l’ancêtre du peuple juif. Ces personnages apparaissent dans les livres de Moïse des juifs et dans le Coran des musulmans. Les croyants de ces deux religions croient à ce récit.
Et puis prenant de la hauteur, Jean-Louis Bourlanges s’est interrogé sur la sécurité à long terme d’Israël :
« Et c’est de la réponse à cette question que doivent dépendre nos réactions à court et à moyen terme, comme celles de l’État hébreu.
Comment un État de 20 770 kilomètres carrés, peuplé de moins de sept millions de Juifs, fer de lance d’une communauté humaine de près de treize millions de personnes, pourrait-il espérer vivre durablement en paix et en sécurité au milieu d’un environnement par hypothèse hostile de plus d’un milliard et demi de musulmans ? »
Et il répond que les murs, les équipements militaires les plus sophistiqués sont une mauvaise réponse :
« Même l’arme nucléaire dont dispose Israël n’est pas de nature à assurer la survie d’un État concentrant toute sa population sur un espace aussi restreint. »
Et puis, il y eut ce développement remarquable de clarté et de lucidité en comparant l’attitude du premier ministre actuel de l’Etat d’Israel avec ses prédécesseurs :
« Face à cette terrible situation, il faut analyser sans œillères ni préjugés ce qui s’est modifié ces dernières années sur la scène moyen-orientale. Comme l’a très justement dit monseigneur Vesco, archevêque d’Alger : « La violence barbare du Hamas est sans excuse mais elle n’est pas sans cause. »
Avant la prise de pouvoir de M. Netanyahou, les grands dirigeants historiques d’Israël, quelle qu’ait été leur sensibilité politique, ont eu une conscience aiguë de cette vulnérabilité après que la guerre du Kippour l’eut rendue manifeste.
Yitzhak Rabin, qui avait vu au plus près le péril de la patrie, a défendu, avec une force de conviction et une volonté politique sans pareille, l’idée qu’il n’y aurait ni paix ni sérénité pour Israël si les Palestiniens ne se voyaient pas reconnaître, eux aussi, un État libre et souverain.
Menahem Begin, venu pourtant de la droite de la droite, a assumé courageusement à Camp David, le choix de la paix avec le principal ennemi d’Israël, l’Égypte post-nassérienne.
Ariel Sharon, qui avait pris la mesure de l’impuissance de la force dans le cadre de l’intervention controversée qu’il avait conduite au Liban, avait, à la veille de l’accident de santé qui devait le terrasser, décidé d’amener son pays à renoncer ses ambitions coloniales en Cisjordanie.
Ces hommes avaient pressenti et pleinement reconnu, pour Yitzhak Rabin du moins, qu’Israël ne trouverait la paix qu’à la condition d’établir avec les États arabes qui l’entouraient, mais aussi avec les hommes et les femmes de Palestine, une relation équilibrée qui supposerait le respect mutuel et le partage des bénéfices de la paix.
La rupture introduite ces dernières années dans la politique israélienne par les gouvernements successifs de M. Netanyahou n’est certainement pas la cause unique de la situation nouvelle, mais elle y a puissamment contribué. »
Jean-Louis Bourlanges dit tout le mal qu’il pense de M. Netanyahou sur le plan militaire mais aussi politique :
« L’essentiel est toutefois d’ordre politique. M. Netanyahou a semblé imaginer que l’établissement de relations apaisées et coopératives avec les voisins arabes d’Israël, ce qui était en soi une excellente ambition et se révélera demain fort utile à la quête nécessaire de l’apaisement, pouvait avoir ce pouvoir indirect, mais précieux à ses yeux, de dispenser Israël de rechercher avec les Palestiniens un accord équilibré et respectueux de leurs attentes et de leurs aspirations profondes.
Bien plus, les accords d’Abraham ayant permis aux États arabes d’abandonner les Palestiniens à leur triste sort, le Gouvernement israélien s’est estimé libre d’engager sans risque une relance rampante mais brutale et déterminée de sa politique de colonisation en Cisjordanie. »
Bien sûr, Israël n’est pas le seul responsable :
« Il serait injuste d’attribuer à l’État hébreu le monopole de la nouvelle brutalisation du monde d’où l’horreur du 7 octobre est sortie. Partout, les forces attachées à la modération, à la coopération et à la paix ont été battues en brèche.
Que les Palestiniens aient eu la tentation croissante et suicidaire de se réfugier dans une sorte de nihilisme politique ne peut, hélas, pas nous surprendre.
Une population sans avenir, donc sans espoir, pouvait-elle être tentée par des partis modérés qui n’avaient rien à lui offrir ? »
Il pointe aussi la responsabilité des Etats-Unis, notamment de Trump et ajoute :
« Comment, dans ces conditions, ne pas voir que ce sont aujourd’hui les héritiers idéologiques des assassins d’Anouar el-Sadate et d’Yitzhak Rabin qui tiennent ensemble la plume de la tragédie qui s’écrit sous nos yeux ? »
J’avais déjà expliqué dans le mot du jour de lundi, le soutien de l’actuel Ministre de la Sécurité nationale du gouvernement israélien : Itamar Ben Gvir à l’assassin de Rabin, sans oublier que Netanyahou intervenait dans des meetings où une partie des participants appelait à tuer Rabin.
Sadate a été tué par le Jihad islamique égyptien qui est une organisation armée issue des frères musulmans exactement comme le Hamas.
La fin du discours consistera à essayer de trouver le juste niveau de la riposte en épargnant les vies innocentes :
« Dans l’immédiat, il faut impérativement veiller à ce qu’une contre-attaque légitime, dès lors qu’elle vise exclusivement à détruire les moyens militaires de l’agresseur, évite les deux écueils majeurs que chacun a clairement identifiés.
D’abord le risque d’une escalade incontrôlée pouvant conduire à un embrasement général. Derrière le Hamas, il y a le Hezbollah ; derrière le Hezbollah, il y a l’Iran ; derrière l’Iran, il y a la Russie et la Chine. […]
Le deuxième risque majeur est celui d’un anéantissement massif de populations civiles utilisées par les uns comme des boucliers humains et par les autres comme l’exutoire d’une tentation de vengeance,…
…pour reprendre l’expression préoccupante du Premier ministre israélien. »
Et puis il envisage une solution à plus long terme qui ne peut que prendre en compte pleinement le besoin de justice pour la population palestinienne au terme d’une nouveau processus de dialogue basé sur la paix, le besoin de sécurité d’Israël et des concessions réciproques :
« Reste à construire un avenir de paix. La tâche est redoutable en raison du mur de détresse et de haine qui sépare aujourd’hui Israéliens et Palestiniens. Aujourd’hui, il est à la fois trop tard et trop tôt pour instituer deux États en terre de Palestine.
Il est en revanche temps – et même grand temps – de commencer à réaliser les conditions qui rendront possible, le moment venu, cette double création. La première de ces conditions, c’est qu’Israël fasse cesser sa politique de colonisation et reconnaisse enfin que la solution du problème palestinien ne saurait passer par l’exportation, en Égypte, des Palestiniens de l’Ouest et, en Jordanie, des Palestiniens de l’Est.
La seconde de ces conditions consiste à recréer, notamment avec l’appui des États modérés du pacte d’Abraham, une autorité palestinienne active, respectée et capable de prendre à Gaza le relais d’un Hamas en cendres et de négocier un statut respectueux des droits palestiniens. Au-delà du Moyen-Orient, les bonnes volontés existent, comme celle du Brésil, dont la France a eu raison de soutenir le projet de résolution à l’ONU. Il nous appartient de nous associer à leurs efforts. »
Il en appelle aussi à l’Union européenne dont l’expérience est celle de la réconciliation franco-allemande et qui doit convaincre « Palestiniens et Israéliens de la pertinence de son logiciel de réconciliation. »
Je n’ai pas cité tout le discours mais la plus grande partie.
Si vous voulez voir intégralement, en vidéo, ce moment de haute politique : <Débat du 23 octobre 2023>. Cela commence à 1:05 :00
Vous pouvez aussi avoir, grâce au journal officiel (cela me rappelle mes études de Droit lorsque j’allais régulièrement lire le JO pour prendre connaissance des débats parlementaires.), la retranscription textuelle intégrale du discours de M Bourlanges ainsi que les interpellations agacées et négatives de M Meyer Habib, député républicain, proche du Likoud et ami revendiqué de Benyamin Netanyahou
Le lien se trouve derrière ce lien :
Ce texte permet d’ailleurs de revenir à la vidéo et au moment précis de l’intervention transcrite.
Je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce discours équilibré, profond, inscrit dans l’Histoire et qui tente de tracer un objectif pour l’avenir. Le chemin pour y arriver reste compliqué.
Les extrémistes des deux côtés voudraient que l’autre peuple dégage et soit chassé de cette terre. Cela est inadmissible et ne pourrait que conduire à d’autres crimes inouïs.
Il reste à trouver la voie qui permette de faire vivre ces deux peuples dans la Palestine de l’Empire Ottoman puis du mandat britannique, dans la paix, la justice et l’équilibre.
<1772>
-
Jeudi 26 octobre 2023
« Ce qu’il y a de bien avec les Juifs, c’est que même lorsqu’ils sont innocents, ils sont coupables. »Alexandra Laignel-LavastineAujourd’hui je partage, une lettre, un cri de colère.
Je n’y ajoute rien, aucun commentaire.
Je vous invite à lire cette tribune, à la recevoir, à l’accueillir.
Après l’avoir lu, vous pouvez évidemment donner libre cours à votre analyse, à vos critiques, à vos désaccords.
Elle exprime un point de vue fort, que certainement beaucoup de membres de la communauté juive, notamment française, ressentent.
C’est une lettre ouverte au Président de la République par une intellectuelle : Alexandra Laignel-Lavastine
 Alexandra Laignel-Lavastine est une philosophe, historienne des idées, essayiste, journaliste née à Paris le 17 octobre 1966.
Alexandra Laignel-Lavastine est une philosophe, historienne des idées, essayiste, journaliste née à Paris le 17 octobre 1966.
Elle a écrit de nombreux articles dans Le Monde et aussi à Libération, Le Monde des débats, Philosophie Magazine.
C’est une spécialiste du totalitarisme et de l’histoire intellectuelle et politique des pays de l’ex-Europe de l’Est au XXe siècle, elle a aussi beaucoup étudié la Shoah.
Elle s’est notamment intéressée à la shoah en Roumanie : « Grand entretien. Alexandra Laignel-Lavastine autour de «Cartea neagra – Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie 1940-1944»
En 2017, elle a écrit un livre ayant pour titre : « Pour quoi serions-nous encore prêts à mourir ? »
Elle s’est aussi intéressé à la montée de l’islamisme en France « Face à l’islamisme, certains intellectuels « progressistes » sont dangereux »
Cette lettre a été publiée sur ce site <Tribune Juive>
24 octobre 2023
Lettre ouverte au Président Emmanuel Macron à l’occasion de son arrivée en Israël.
Par Alexandra Laignel-Lavastine
Monsieur le Président de la République,Il semblerait donc que nous vous attendons aujourd’hui en Israël, où je me trouvais quand les barbares du Hamas ont attaqué et massacré ce samedi 7 octobre, et où il va de soi que je me trouve toujours. D’abord, parce qu’on ne déserte pas par temps de guerre. Ensuite, parce qu’il faudrait avoir l’estomac bien accroché pour rentrer dans le pays que vous présidez, où l’esprit public et la classe politico-médiatique — aux habituelles exceptions près depuis vingt ans — a atteint, depuis quinze jours, un degré d’avilissement encore jamais vu. Je suis française en effet, pas même franco-israélienne, enfin pas encore, de ces intellectuels « néo-réactionnaires » qui s’épuisent à alerter depuis des années, de livre en livre, d’article en article, de lettre ouverte en lettre ouverte, en vain. Nous prêchons tous dans le désert.
Nous espérions vous voir ici un peu plus tôt, question d’honneur en la circonstance, « en même temps » que d’autres chefs d’État. Mais nous subissions un déluge de missiles, qui auraient déjà fait des milliers de morts en Israël si les autorités s’y comportaient comme le Hamas : interdire aux civils de s’abriter dans les abris-bunkers, en l’occurrence cinq étages de tunnels et de cité souterraine sous Gaza.
Et les missiles, M. le président, vous n’avez peut-être pas l’habitude. C’est dire si la prudence s’imposait, comme elle continue de s’imposer dans l’Hexagone face à nos islamistes locaux et autres idiots utiles du Hamas, qui sévissent en toute liberté et devant lesquels nous nous couchons depuis les massacres de Mohamed Merah en 2012, avec une lâcheté et une complaisance collectives qui n’ont d’égale que notre obstination dans l’art criminogène de se crever les yeux, y compris face à l’explosion de l’antisémitisme, toujours un symptôme indiquant que l’ensemble du corps social est malade.
Nous allons payer extrêmement cher cette indignité, les réjouissances ayant déjà commencé, vous entrouvrez peut-être un œil. Israël aussi s’était endormi, avec le résultat que l’on sait. Les massacres des kibboutz seront pour demain en France, dans nos foyers lunaires. Les même pathétiques rodomontades à chaque fois : on allait avoir « un avant et un après », après Merah, après Charlie, après le Bataclan, après Nice, après Samuel Paty, etc. etc. Or, non seulement nous n’avançons pas, mais nous régressons après chaque tuerie. Elles ne se cumulent pas, elles s’annulent.
On nous a expliqué que vous attendiez le cadre d’un « agenda utile » avant de nous faire grâce de votre personne sur place : des négociations de paix avec le Hamas, ou peut-être avec le Hezbollah ou les deux?Au point où nous en sommes… Car nous sommes en juin 1940.
Un « agenda utile » ? Une formule qui inspire trois attitudes possibles : le fou rire (un peu nerveux par ici ces temps-ci) pour les plus conscients du désastre français, la perplexité pour les plus aveugles et la fascination pour tous : comment peut-on être aussi décalé ? Je tiens toutefois à vous rassurer si d’aventure vous changiez d’avis : on vous accueille par politesse, ici presque personne ne vous connaît et la France ne représente plus rien, devenue une minuscule province à peine capable d’aligner 15 000 soldats opérationnels, dont mon propre fils a longtemps fait partie dans une unité parachutiste (une précision au cas où l’on me donnerait des leçons). Vu d’Israël, où l’on vient de mobiliser près de 400 000 combattants, une farce.Comment résumer ce en quoi s’illustre notre beau pays depuis le 7 octobre ? On ne sait trop par quoi commencer. D’abord, il y eut les cinq minutes d’émotion rituelle inspirées par un carnage à grande échelle, le plus abject depuis la Shoah : 1 400 victimes en un jour. Une petite cinquantaine, voire moins, nous expliquaient encore doctement certains journaux hexagonaux plusieurs jours après, l’AFP à l’appui… L’émotion : il est vrai que des bébés décapités, des femmes enceintes éventrées, des enfants et des jeunes filles violées et égorgés, des familles brûlées vives ou déchiquetées à la grenade, des êtres démembrés ou découpés à la tronçonneuse (oui, ils avaient aussi des tronçonneuses), des gosses survivants cachés et silencieux sous le corps de leurs parents et j’en passe, cela n’arrive pas non plus tous les jours.
Mais c’était tout de même bien embêtant. D’abord, ces habitants des kibboutz du sud, tous de gauche, étaient aussi en première ligne depuis longtemps pour inviter les Gazaouis à travailler avec eux dans les champs — ils croyaient en la paix. Or ce sont pour partie ces travailleurs et ces gentils voisins, en plus des terroristes infiltrés, qui les ont trucidés.
Comme pendant la Shoah : le rôle central joué par les voisins, qui se transforment en bêtes sauvages du jour au lendemain.
Grâce à eux, ce 7 octobre, les terroristes disposaient des plans très détaillées de ces kibboutz pastoraux où ils étaient bienvenus.Très embêtant aussi, l’héroïsme de tous, de tous ces « sionistes ». Des civils, des jeunes ou des pères de famille qui sont immédiatement sortis de chez eux, avec ou sans armes, pour défendre les villages et sauver des jeunes gens qui dansaient à la Rave Party. L’héroïsme absolu des soldats et des policiers, de garçons et de filles en tout petit nombre, présents ou arrivés spontanément sur place quand ils ont commencé à comprendre, appelés au téléphone par les suppliciés tapis dans les bunkers, se battant pendant plus de vingt heures d’affilée parfois, avec un simple pistolet, contre des hordes de monstres surarmées.
Des héros n’hésitant pas à se sacrifier et à sauter eux-mêmes sur les grenades (les terroristes en avaient deux mille) pour protéger les familles ou leurs camarades. Un héroïsme dont, en France, on n’a plus idée. Les mots manquent, oui, pour décrire l’horreur. Les représentations mentales nous manquent désormais aussi, en France, pour appréhender ce courage.On a donc vu sur « Cnews » Frédéric Taddéï s’empresser d’inviter la sociologue Laetitia Bucaille sur son plateau, « professeure » à l’INALCO et membre de l’Institut universitaire de France (IUF), un lieu d’excellence intellectuelle, pour nous expliquer que nous ne disposions d' »aucune preuve de ce qu’il s’était passé » le 7 octobre… L’animateur en question, venu de « Russia Today », la télévision de M. Poutine, jubilait, cela va de soi, sans la reprendre. Tout comme il jubilait déjà après Charlie sur « France 3 » en invitant Emmanuel Todd qui nous expliquait alors que les frères Kouachi étaient en fait des victimes (de la France catholique rance et discriminante), si bien que les victimes étaient les vrais bourreaux, nous avions mal vu (j’étais ce jour-là sur le plateau, invitée en néo-réac de service pour feindre la discussion « équilibrée »).
Frédéric Taddeï a-t-il été viré depuis ce scandaleux « dialogue » avec Madame Bucaille ? Non. Un ou plusieurs chroniqueurs de la chaîne, des esprits à l’endroit et courageux, pour mettre leur démission dans la balance ? Personne. Et Madame Bucaille, virée de sa fac ? Le minimum syndical. Non plus. La direction de l’INALCO ? Elle est « outrée » et ne bougera pas une oreille.
En Suisse, au même moment, un autre « professeur » s’est distingué par un propos négationniste similaire. Viré sur le champ et sans préavis. Nos amis helvétiques sont plus vigoureux.
À propos des universités, l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), notamment (où j’ai enseigné jadis) s’est, elle aussi, illustrée au lendemain du carnage par un communiqué émanant d’un syndicat étudiant pour pratiquer le même type de discours : nous avions affaire à « une forme de résistance à l’occupation sioniste » (Gaza n’est plus occupée depuis 2005, sinon par une dictature totalitaire). Le poisson pourrit toujours par la tête. Et il se décompose depuis longtemps, nos facultés et nos Grandes écoles s’étant islamo-wokisées en diable dans une quasi indifférence, les lanceurs d’alerte n’étant pas plus entendus sur ce point que sur d’autres.
Mieux, « France-Culture » s’est empressée de réinviter la sociologue de l’INALCO dès le lendemain, à ses « Matins », pour derechef éclairer l’opinion publique. Il fallait le faire ! Et sur quoi portent cette semaine « Les Chemins de la philosophie » sur cette même station ? Sur la « compromission » des grands intellectuels roumains des années 30 avec le fascisme et les pogroms (j’ai écrit aussi quelques livres là-dessus). Une voix pour oser faire remarquer au micro qu’on assistait à la même compromission en France depuis dix jours ? Non, bien sûr. Business as usual.
En fin de semaine, on évoquera dans cette émission le courage des dissidents d’Europe de l’Est, de Vaclav Havel et de Jan Patocka. Comme si de rien n’était, comme si, eux, auraient laissé passer pareille ignominie.
Le bal des faux-cul. Je ne généralise pas, je ne parle pas des admirables exceptions, là encore, une miraculeuse poignée dans la veulerie ambiante, à l’instar des rebelles de l’An 40 : les Georges Bensoussan, les Abnousse Shilmani et quelques autres intellectuels et journalistes, des guerriers du verbe et de la plume qui, comme après « l’étrange défaite » que nous sommes en train de revivre en live, sauvent l’honneur. Force est néanmoins de constater leur rareté.
Phase II, il y eut heureusement cette roquette, tombée sur un hôpital de Gaza et ses quelque « 500 victimes », soi-disant tirée par les méchants, donc les sionistes. Une bénédiction. Ouf ! En fait, un missile lancé par le Hamas et retombé sur le parking pour un bilan revu à quelques dizaines de morts. On l’a su très rapidement. Mais c’était trop beau, il fallait s’engouffrer dans la brèche toutes affaires cessantes.
Même vous, M. le président, avez commis la lourde faute de twitter bien vite. Et voilà la plupart des médias français reprenant aussitôt la propagande de l’organisation terroriste massacreuse, car on a toujours tendance à croire ce que l’on a envie de croire. Or, c’était irrésistible !
Puis le démenti est arrivé, preuves formelles à l’appui. Subitement, la roquette du Hamas n’a plus intéressé grand-monde, pas plus que les 450 autres ayant loupé leur cible depuis le 7 octobre pour atterrir sur la bande de Gaza et ses civils. Il en va ainsi, du reste, lors de toutes les attaques du Hamas depuis de nombreuses années, un classique, comme à l’été 14, mais l’ignorance est crasse car elle souhaite le rester.
Ce qu’il y a de bien avec les Juifs, c’est que même lorsqu’ils sont innocents, ils sont coupables. Jouissance, donc, avec cette roquette inopinée : les Juifs, pardon les sionistes, coupables de « génocide »(LCI) et de « crime contre l’humanité »… On a choisi les mots. Soulagement ! On a même vu Pierre Moscovici, ancien ministre et actuel président de la Cour des comptes, se précipiter à l’antenne de « i24News » pour expliquer qu’il faudrait nommer « une commission d’enquête indépendante ». Un esprit très mal tourné pourrait songer à la fable de La Fontaine, « Le chat, la belette et le petit lapin », « sa majesté fourrée », « un saint homme de chat, expert sur tous les cas ». Son père, le psychosociologue Serge Moscovici (dont j’ai publié chez Grasset les mémoires posthumes en 2019, Mon Après-guerre à Paris), un Grand, a survécu au pogrom de Bucarest de janvier 1941, qu’il décrit de façon stupéfiante dans ce livre. La fillette alors massacrée avec d’autres aux abattoirs de la ville par les fascistes de la Garde de fer, suspendue à un croc de boucher, portait autour du coup un écriteau : « Viande cascher », une image qui avait horrifié le monde entier… Nous n’en sommes donc plus là.
En si bon chemin, Qui a-t-on invité, cette même semaine, à « Sud-Radio » ? Jean-Jacques Bourdin a réfléchi et il a opté pour la député Danièle Obono, bien connue pour sa clairvoyance face à l’islamisme. Rien de plus urgent que de l’entendre, sachant d’avance ce qu’elle allait dire. Le Hamas, une organisation qui « résiste » au crime d’occupation, etc. « Apologie du terrorisme », a dégainé à juste titre votre ministre de l’Intérieur en saisissant le procureur. Résultat ? Elle vient d’être élue pour siéger, à partir du 6 novembre, à la Cour de justice…
À propos de ministère de l’Intérieur, qu’attend d’ailleurs votre ministre, M. le Président de la République, pour enfin autoriser — et même obliger — ses policiers à porter leur arme de service pendant leur congé, au-delà du trajet entre leur domicile et leur caserne ou leur commissariat, comme le veut jusqu’à présent la règle (un sketch) ? Le b-a ba d’un maillage plus serré du territoire s’agissant de mieux protéger leurs concitoyens, par exemple quand nos forces de l’ordre sont au cinéma en famille, dînent dans une pizzeria ou se promènent au jardin d’acclimatation avec leurs enfants, dans l’hypothèse où des énergumènes issus de nos quartiers émotifs se mettraient à mitrailler dans le tas. Vous avez peut-être fini par le comprendre, cette éventualité n’est plus à exclure.
Même chose pour nos militaires, en particulier nos officiers, et cela dépend du ministère de la Défense. Mais à sa tête, et à un quart d’heure avant une possible troisième guerre mondiale, celui-ci paraît tout aussi à l’Ouest.
Vous n’en êtes pas moins, M. le président, le Chef des Armées. Vous pourriez avoir votre mot à dire. C’est ainsi qu’en Israël, une nation de soldats, des dizaines de morts sont évités chaque année. Cela ne requiert aucun moyen, juste un brin de jugeote et une circulaire. J’ai soufflé en direct cette suggestion à des camarades qui se trouvaient sur le plateau de « Cnews » lors de l’intervention de M. Darmanin il y a quelques jours, par portables interposés. La question ne fut pas posée et elle ne le sera sans doute pas. Je la formule depuis 2015, en vain naturellement. Nous restons à des années lumières du réel.
Sans jamais nous lasser, hier soir, dimanche, nous avons remis cela à la télévision. Quelle autre « personnalité » encore sur un plateau ? Le député Alexis Corbières, encore un convive de marque, pour nous servir ses habituelles circonvolutions. Mais il y a toujours un autre invité en face pour accepter de « débattre » avec lui, en l’occurrence Alain Bauer, il est vrai très agacé.
Si tout le monde refusait (mon cas depuis 2015), on n’inviterait plus M. Corbières car il n’aurait plus de vis-à-vis. Mais comment résister à une invitation télévisuelle ? Convoquer le député France Insoumise était sans doute d’autant plus pressant que sa fille de 21 ans, une islamiste radicalisée, dont la maman est Raquel Garrido, autre tête pensante du parti de M. Mélenchon, venait de twitter : « Alors g ptet pas d’âme, mais ils me font pas du tt de peine, je les trouve mm plutôt chiants, surtt les gosses », allusions aux otages du Hamas détenus à Gaza, dont on n’ose imaginer le calvaire. Abject. Les parents ne sont certes pas responsables des déraillements de leurs enfants majeurs. Mais enfin…
La rue ? On a des manifestations monstres, dites « pro-palestiniennes », en vérité « pro-Hamas », ce qui n’échappe à personne, mais qu’il ne conviendrait pas d’interdire. Encore et toujours le choix des mots car appeler un chat un chat, nous n’en sommes plus capables. Sur une pancarte brandie par une jeune fille, parmi mille autres, Place de la République, oui, de la République, on avait il y a trois jours : « Vous avez pleurés 40 faux bébés israéliens. Où êtes-vous pour les 1000 enfants palestiniens tués ? » Cette demoiselle fâchée avec l’orthographe (on se demande comment, du reste, l’Education nationale se portant si bien) doit ignorer que les enfants en question servent au Hamas de boucliers humains, l’organisation « caritative de résistance » déployant tous les moyens possibles pour empêcher les malheureux d’évacuer vers le sud (en plus de leur interdire l’accès aux tunnels protecteurs pendant les bombardements).
Car plus il y a de « martyrs », plus le sang coule, plus le Hamas, dont on sait l’importance qu’il attache à la vie humaine, peut compter d’idiots utiles en France, en Europe et dans le monde, toujours au rendez-vous. C’est tout bon. Et que voit-on fleurir après les massacres du 7 octobre si on va faire ses emplettes au Printemps, à Paris, ces jours-ci ? Une belle affiche, où on lit ceci : « La torture des enfants palestiniens par Israël et l’occupation sioniste ». On se frotte les yeux. À ce seuil d’affaissement national, on pourrait être tenté de rendre les armes.
Je m’arrête ici, la liste serait trop longue. En deux semaines, la France, la vôtre, M. le Président, celle que vous allez représenter demain en Israël, s’est surpassée. Je n’aimerais pas être à votre place. [….]
En France, il n’est plus question que de l’aide humanitaire à Gaza et des bombardements de l’armée israélienne, un pays dont on se demande comment il ose se défendre. Et tenir à ce point à éviter d’autres carnages, au Sud comme au Nord, s’il laissait la menace prospérer comme on sait si bien le faire dans le pays qui vous a élu à la tête de l’Etat à force de regarder ailleurs. On me rapporte toutefois de source bien informée qu’on commence à observer une certaine fébrilité au sein de notre classe politique. Un avant et un après ? Pour l’heure, nous en sommes très loin, mais on aimerait malgré tout croire en un miracle. »
<1771>
-
Mardi 24 octobre 2023
« Le voyage à Nantes. »Souvenir personnel d’il y a un an lundi 24 octobre 2022Le voyage à Nantes est pour les nantais un concept touristique.
 Le Voyage à Nantes est d’abord un organisme touristique chargé de la promotion via la culture de la destination de Nantes, créé en 2011 sous la forme d’une société publique locale.
Le Voyage à Nantes est d’abord un organisme touristique chargé de la promotion via la culture de la destination de Nantes, créé en 2011 sous la forme d’une société publique locale.
C’est ensuite un parcours pérenne d’une cinquantaine d’étapes, dans la ville de Nantes, matérialisé par une ligne verte tracée au sol qui conduit le visiteur d’une œuvre originale d’un artiste d’aujourd’hui à un monument du patrimoine, célèbre ou méconnu.
Pour un grand nombre de français, le voyage de Nantes fait songer à une chanson bouleversante de Barbara.
Une chanson d’Adieu.
D’adieu à son père incestueux.
Elle entreprit le voyage à Nantes pour le rencontrer une dernière fois avant qu’il ne meure.
Mais elle n’est pas arrivée à temps.
Le titre exact du voyage à Nantes est simplement « Nantes ».
Il pleut sur Nantes
Donne-moi la main
Le ciel de Nantes
Rend mon cœur chagrin
Un matin comme celui-là
Il y a juste un an déjà
La ville avait ce teint blafard
Lorsque je sortis de la gare
Nantes m’était alors inconnue
Je n’y étais jamais venue
Il avait fallu ce message
 Pour que je fasse le voyage
Pour que je fasse le voyage
Madame soyez au rendez-vous
Vingt-cinq rue de la Grange aux Loups
Faites vite, il y a peu d’espoir
Il a demandé à vous voir
À l’heure de sa dernière heure
Après bien des années d’errance
Il me revenait en plein cœur
Son cri déchirait le silence
Depuis qu’il s’en était allé
Longtemps je l’avais espéré
Ce vagabond, ce disparu,
Voilà qu’il m’était revenu
Vingt-cinq rue de la Grange aux Loups
Je m’en souviens du rendez-vous
Mais j’ai gravé dans ma mémoire
Cette chambre au fond d’un couloir
Assis près d’une cheminée
J’ai vu quatre hommes se lever
La lumière était froide et blanche
Ils portaient l’habit du dimanche
Je n’ai pas posé de questions
À ces étranges compagnons
J’ai rien dit, mais à leur regard
J’ai compris qu’il était trop tard
Pourtant j’étais au rendez-vous
Vingt-cinq rue de la Grange aux Loups
Mais il ne m’a jamais revue
Il avait déjà disparu
Voilà tu la connais l’histoire
Il était revenu un soir
Et ce fut son dernier voyage
Et ce fut son dernier rivage
Il voulait avant de mourir
Se réchauffer à mon sourire
Mais il mourut à la nuit même
Sans un adieu, sans un je t’aime,
Au chemin qui longe la mer
Couché dans le jardin de pierres
Je veux que tranquille il repose
Je l’ai couché dessous les roses
Mon père, mon père
Il pleut sur Nantes
Et je me souviens
Le ciel de Nantes
Rend mon cœur chagrin
Pour moi, aujourd’hui, « le voyage à Nantes » est le trajet en train que j’ai entrepris, il y a un an, lundi 24 octobre 2022, avec Annie.
Mon but était de voir encore une fois mon grand frère, avant qu’il ne soit trop tard.
Les nouvelles étaient mauvaises. 40 jours auparavant Gérard m’avait appris qu’il était atteint d’une leucémie aigüe. Mais lors du weekend, les médecins avaient brusquement donné le signal de l’urgence absolue.
Alors, avec Annie nous avons pris le TGV pour Nantes à 15:30 avec une arrivée prévue à 19:50.
A 16:50, ce TGV va s’arrêter en pleine voie, une panne électrique en est la cause.
Il sera toujours arrêté quand à 17:25, Gérard expira pour la dernière fois.
Son fils Gregory m’a tout de suite informé :
« Papa vient d’avoir son dernier souffle. »
C’était mon Grand Frère, puisque lui m’appelait toujours, alors que j’avais 60 ans passé, « mon petit frère ».
Il est vrai que 11 ans nous séparaient.
Le train arrivera à Nantes à 22:10 avec 2h20 de retard
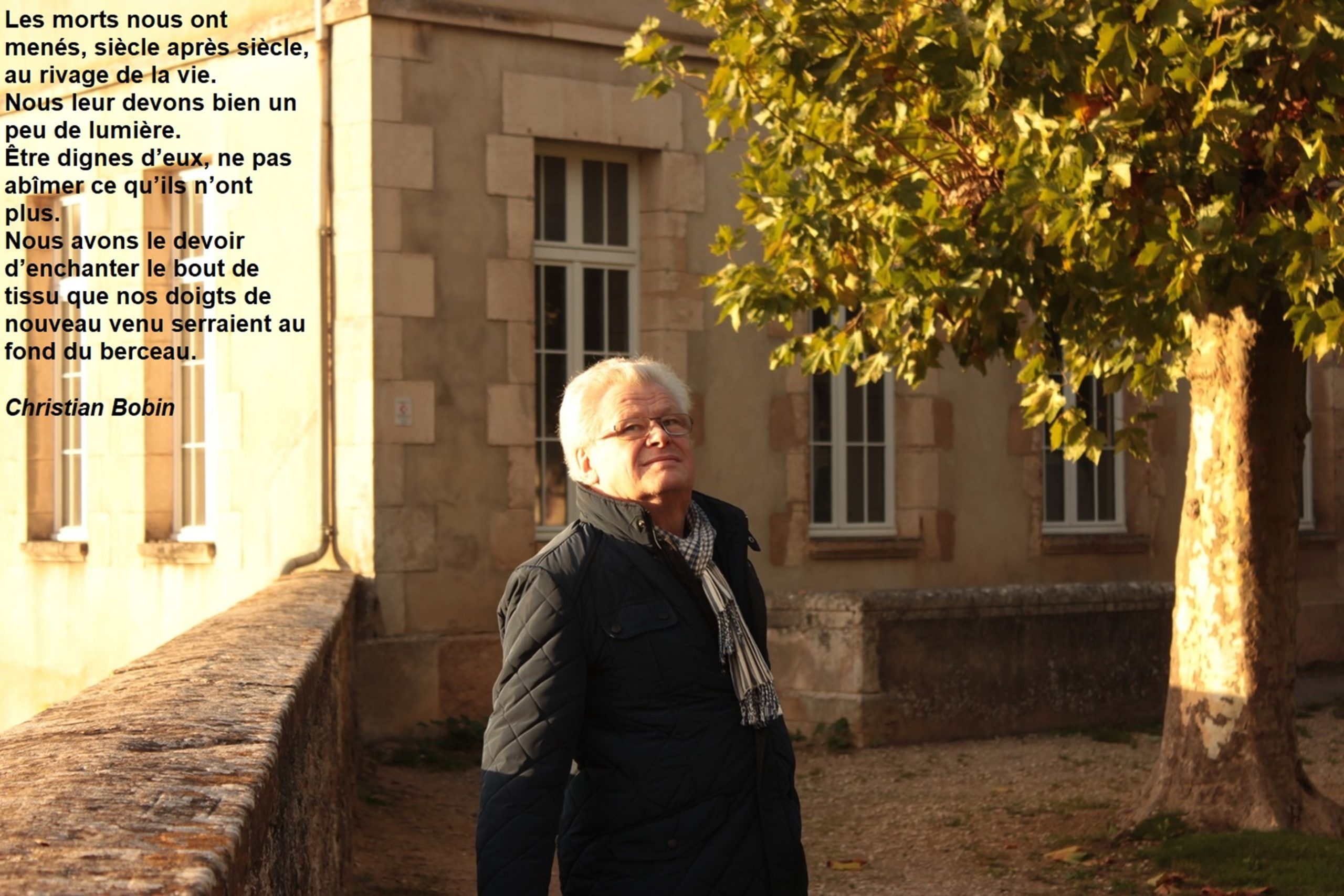
« La vie est une drogue.
La mort est son sevrage qui nous rend plus jeunes encore qu’au berceau où nous sommes saturés de gloires.
Il y a deux forces inépuisables dans le monde, celle des nouveau-nés et celle des morts.
Le seul fait de vivre, d’être jeté au monde, comme on est jeté aux chiens, nous crée un devoir envers ceux qui nous ont précédés sur ce chemin, sous cette charmille, dans ce cyclone.
Les morts nous ont menés, siècle après siècle, au rivage de la vie. Nous leur devons bien un peu de lumière.
Être dignes d’eux, ne pas abîmer ce qu’ils n’ont plus.
Nous avons le devoir d’enchanter le bout de tissu que nos doigts de nouveau venu serraient au fond du berceau.
Ce tissu est la vie entière, légère, froissable. »
Christian Bobin, « Le muguet rouge » page 40
Bobin l’enchanteur est mort le 23 novembre 2022, soit trente jours après mon grand frère
<1770>
-
Lundi 23 octobre 2023
« Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle ? »BouddhaUne actualité violente chasse l’autre :
On ne parle presque plus de la guerre que la Russie mène à l’Ukraine et plus du tout de l’épuration ethnique au Haut Karabakh.
On parle des crimes abjects et inimaginables que les terroristes du Hamas ont perpétré pendant leur attaque contre Israël du 7 octobre.
Avant de parler des bombardements de l’armée israélienne sur la prison à ciel ouvert de Gaza, je voudrais quand même renvoyer vers un article qui raconte le 7 octobre : « On n’avait pas vu de telles images depuis le régime nazi »
Alors, bien sûr on peut passer son chemin, se protéger de l’horreur, ne pas sombrer avec la folie meurtrière des hommes.
Mais si on veut essayer de comprendre, comprendre la sidération de la communauté juive mondiale, le désir de vengeance, la haine, il n’est pas possible de passer son chemin.
Cet article relate ce que les soldats de la base de Shura, dans le centre d’Israël, transformée en morgue géante et en service d’identification des corps ont vu et vécu.
« Depuis le carnage du 7 octobre, [ l’article est du 20 octobre ] cette morgue géante aménagée sur la base du rabbinat militaire a reçu plus de 1300 cadavres, souvent méconnaissables. Ces derniers jours, l’armée en a ouvert les portes à la presse afin de faire connaître l’ampleur des sévices infligés aux victimes. « Parce que vous êtes journalistes, prévient le colonel Weissberg, vous savez qu’en temps de guerre chaque camp s’efforce d’imposer sa vérité aux dépens de l’adversaire. Mais dans ces circonstances exceptionnelles, vous avez le devoir de me croire. De toute façon, toutes les horreurs dont nous allons vous parler ont été filmées par les terroristes puis diffusées sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer qu’on n’avait pas vu de telles images depuis le régime nazi. »
Les corps sont méconnaissables, mutilés montrant une ampleur de sévices infligés aux victimes défiant absolument notre humanité.
« Depuis quelques années, on s’entraînait en prévision d’une tuerie de masse en se disant qu’on devrait ce jour-là être capables d’accueillir des dizaines de dépouilles à la fois, sourit tristement Shery, une volontaire qui a rejoint l’unité pour s’occuper spécifiquement des femmes soldats. Mais jamais on n’aurait imaginé être confrontés à une telle abomination.»
L’article donne des éléments concrets de cette inhumanité.
Je n’en ferai pas la liste, le podium de l’horreur n’a pas de sens.
Mais je m’arrêterai sur l’un de ces crimes contre l’humanité, je cite le colonel Weissberg :
« Que dire lorsque vous découvrez le corps d’une femme enceinte tuée par un terroriste qui lui a ouvert le ventre, puis en a extrait le fœtus avant de leur couper la tête à tous les deux ? ».
Oui que dire ?
Le criminel veut éradiquer toute vie, la vie juive, jusqu’à sa racine.
Et ce crime a été commis au nom d’Allah.
Au début, le conflit de la Palestine était un conflit territorial, certes les uns étaient de confession juive et les autres de confession musulmane, mais aussi chrétienne, mais la religion n’était pas prégnante dans cette opposition.
 Elle l’est devenue, c’est ce qu’écrit Sylvain Cypel dans l’hebdomadaire « Le Un » : « Le conflit a basculé de national à religieux »
Elle l’est devenue, c’est ce qu’écrit Sylvain Cypel dans l’hebdomadaire « Le Un » : « Le conflit a basculé de national à religieux »
Le Hamas veut créer un état islamique et se bat au nom de son Dieu qui lui a donné cette terre selon sa croyance. Et du côté israélien, il y a aussi des combattants de la Foi qui affirment que ce n’est pas la décision de l’ONU qui leur a donné cette terre, mais leur Dieu qui justifie leur présence sur la terre promise. La Cisjordanie, dans leur bouche, devient la Judée Samarie, appellation biblique.
On disait parfois que la musique adoucit les mœurs, ce qui selon mon expérience n’est que partiellement exact pour les interprètes.
Mais notre expérience collective montre que la religion n’adoucit pas non plus les mœurs. Elle parvient à compliquer encore davantage des situations qui le sont déjà, et dans le cas qui nous occupe parvient à déchainer encore davantage la violence.
Et maintenant Israël réagit et bombarde la bande de Gaza.
Les 2,3 millions d’habitants ne sont pas le Hamas, mais le Hamas est parmi eux.
Ces habitants sont enfermés dans cette bande, ils ne peuvent pas la quitter, Israël et l’Egypte les en empêchent.
C’est dans ce numéro du « Un » qu’est reproduit la phrase du Bouddha mise en exergue :
« Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle ?»
J’ai été bouleversé par cette <Video> mise en ligne par une journaliste indépendante israélienne : Or-ly Barlev
Elle a filmé ce témoignage d’une résidente survivante du kibboutz Be’éri, âgée de 19 ans, qui au delà de son désarroi et de sa douleur parvient à se hisser au-delà de la vengeance et s’en prend à Benyamin Netanyahou qu’elle appelle Bibi :
« Il a décidé de nous jeter le dôme de fer, plutôt que d’arriver à une solution politique »
Il y avait un processus de paix.
Benyamin Netanyahou n’en voulait pas.
Sur le site de Radio France, le journaliste Charles Enderlin rappelle en 2020:
« Vous savez, Benyamin Netanyahou, l’actuel Premier ministre de l’État d’Israël, était à la tête des manifestations place de Sion à Jérusalem, où la foule hurlait « À mort. Rabin, par le feu, par le sang, nous expulserons Rabin ». »
Et en face, le Hamas faisait des attentats contre les israéliens pour saboter le processus. Charles Enderlin écrit :
« Dès le début du processus d’Oslo, les extrémistes des deux camps se sont mis à l’œuvre. Le Hamas a décidé de tout faire pour empêcher la création d’un État palestinien au côté de l’État d’Israël car pour les islamistes radicaux, il n’est pas question de permettre un État juif en terre d’islam. Et pour les nationalistes messianiques juifs, il n’est pas question de permettre une Palestine libre et indépendante en terre d’Israël. Au début de l’année 1994, quelques mois après la signature des accords d’Oslo, un terroriste juif a massacré 29 Palestiniens en prière dans le caveau des Patriarches à Hébron. Cela a donné le prétexte aux islamistes de Gaza pour lancer des campagnes d’attentats suicides qui, bien entendu, ont contribué à la détérioration de l’image du processus de paix dans le public israélien. L’insécurité a commencé à régner dans les rues israéliennes. »
Aujourd’hui Netanyahou est à la tête d’Israël et le Hamas gouverne Gaza.
Rabin lui disait :
« Je continue le processus de paix comme s’il n’y avait pas d’attentats, et je lutte contre les attentats comme s’il n’y avait pas de processus de paix »
Personne ne sait si Rabin aurait pu mener le processus de Paix à son terme. Mais il en avait la volonté car il savait que l’avenir d’Israël en dépendait.
Aujourd’hui ce sont ses ennemis et les supporters de son assassin qui sont au pouvoir.
Yitzhak Rabin a été assassiné, le 4 novembre 1995 au soir, de deux balles tirées à bout portant dans le dos par un messianique exalté juif.
<Cet Article> raconte que Itamar Ben Gvir a demandé en 2007 la libération de l’assassin de Rabin : Yigal Amir.
Itamar Ben Gvir est l’actuel Ministre de la Sécurité nationale du gouvernement israélien.
Il exposait jusqu’en 2020 dans son salon une photo de Baruch Goldstein, l’auteur du massacre d’Hébron cité par Charles Enderlin. Il a déclaré l’avoir retirée en janvier 2020 après s’être aperçu que cela pouvait lui nuire politiquement. Il continue toutefois de revendiquer son admiration pour le terroriste. C’est ce que vous pourrez lire dans cet article de <Times Of Israel>
Ce que le Hamas a fait le 7 octobre constitue un paroxysme de haine.
Mais la haine ne peut pas vaincre la haine, elle ne peut que l’exacerber.
En France, il existe un mouvement de femmes : « Les guerrières de la paix » fondé en mars 2022 qui rassemblent des femmes musulmanes et juives convaincues que seules la Paix et la prise en compte de l’autre constitue une issue à toute cette haine.
Les deux co-presidentes sont Fatima Bousso et Hanna Assouline.
Cette dernière avait été invitée par Karim Rissouli dans son émission « En société » sur France 5 du dimanche 22 octobre 2023.
Hanna Assouline qui dit (reproduit sur cette page de Radio France) :
« Il faut savoir nommer les choses. Nommer l’horreur des massacres perpétués par le Hamas, celle des civils qui meurent sous les bombardements israéliens. [mais] il est important de réaliser que parler d’une souffrance n’en invisibilise pas une autre. »
Vous trouverez derrière ce lien <Guerrière de la Paix> un documentaire de 50 minutes sur ces militantes de l’espoir en Palestine et en Israël.
<1769>
-
Mardi 17 octobre 2023
« Je n’aurai pas le temps […] de visiter toute l’immensité d’un si grand univers. »Texte de Pierre Delanoë, chanté par Michel Fugain et titre d’un ouvrage de Hubert ReevesNous sommes dans un monde de violence.
Et la violence, hélas, mille fois hélas, paie.
L’israélien fanatique qui a tué Yitzhak Rabin a gagné, le processus de paix engagé par les accords d’Oslo a été enterré.
L’Azerbaïdjan a récupéré le Haut Karabakh par une violence inouïe, elle a gagné, personne ne proteste, ou si mollement.
Poutine a usé de violence sur tous les fronts. Nous avons l’intuition qu’il va garder la Crimée et une partie de l’Ukraine. Par lassitude nous accepterons cette situation de fait.
Les islamistes monstrueux qui ont pratiqué le carnage de Charlie Hebdo ont gagné, plus personne ne caricature le prophète de l’islam.
Cette religion que certains veulent voir ou proclamer comme une religion de paix et qui aujourd’hui dans le monde fonde des régimes odieux et des organisations criminelles à l’égard des femmes, des idées, de la connaissance et de ceux qui ne croient pas ou ne suivent pas leur récit intégriste.
Ce n’est au nom de la Palestine mais au cri de la formule du « takbir » que les criminels du Hamas ont tué, massacré, mutilé enfants, femmes et hommes parce qu’ils étaient sur le sol de l’État d’Israël, juifs et aussi non juifs
Le takbir est cette expression arabe, utilisée dans l’islam : « Allahu akbar » ou « Allahou akbar » parfois transcrite « Allah akbar », qui signifie « Allah est [le] plus grand ».
Nous pouvons craindre que ces actes de terrorisme, ces crimes de guerre et ces crimes contre l’humanité, car ces 3 appellations correspondent, toutes les trois, à la réalité des faits, vont entrainer encore plus de violence et de chaos, ce que les odieux stratèges du Hamas avaient anticipé.
Alors, cela fait du bien de parler d’un homme doux, d’un homme sage, d’un humain qui a cherché à comprendre le monde, non en cherchant de manière abêtissante dans des récits proclamés « sacrés » une vérité qui ne s’y trouve pas, mais en observant l’univers, en l’étudiant humblement, en faisant des expériences et en acceptant de distinguer entre ce que l’on pouvait savoir, ce qui était probable et l’immensité de ce que l’on ne savait pas.
Cet homme qui disait :
« Quand il y a plusieurs hypothèses, c’est qu’on ne sait pas »
Cet homme était Hubert Reeves, il est parti rejoindre les étoiles ce vendredi 13 octobre 2023 à 15:15 . Il avait 91 ans
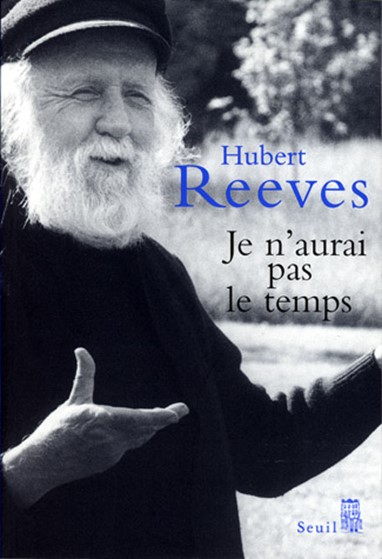 En 2008, il a publié un livre de 348 pages : « Je n’aurai pas le temps » dans lequel il parle de son parcours, de son enfance québécoise à sa carrière scientifique internationale, de son milieu familial à sa renommée médiatique et à ses engagements écologiques.
En 2008, il a publié un livre de 348 pages : « Je n’aurai pas le temps » dans lequel il parle de son parcours, de son enfance québécoise à sa carrière scientifique internationale, de son milieu familial à sa renommée médiatique et à ses engagements écologiques.
Il décrit la quête de cet ouvrage de la manière suivante :
« Le motif de ce livre peut se résumer en ces quelques mots : « un homme et son métier ». Comment ai-je atterri dans ce monde de la science ? Que m’a-t-il apporté ? Que lui ai-je apporté ? Je parlerai de mes moments de bonheur, d’euphorie, et aussi de mes frustrations. Je décrirai les projets que j’ai poursuivis et comment ils m’ont amené à visiter le vaste monde. »
Le titre de son livre a été inspiré directement de <cette chanson> de Michel Fugain dont les paroles ont été écrites par Pierre Delanoë
« Je n’aurai pas le temps
Pas le temps
Même en courant
Plus vite que le vent
Plus vite que le temps
Même en volant
Je n’aurai pas le temps
Pas le temps
De visiter
Toute l’immensité
D’un si grand univers
Même en cent ans
Je n’aurai pas le temps
De tout faire »
« La terre au carré » de Mathieu Vidard a consacré un <Hommage à Hubert Reeves> en rediffusant des parties d’émissions auxquelles il a participé. La première d’entre elles était consacrée à la sortie de ce livre « Je n’aurai pas le temps »
La première fois que j’ai évoqué Hubert Reeves, ce fut en 2015, dans un mot du jour consacré à la théorie de la réfutabilité de Karl Popper : « Une théorie qui n’est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. »
C’était pour illustrer cette théorie par une remarquable conférence de Hubert Reeves <La crédibilité de la théorie du big bang par Hubert Reeves>
Un an après, entre le lundi 14 mars et le vendredi j’ai consacré 5 mots du jour à un livre que je venais de lire : « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve »
Voici le lien vers le premier article : « C’est une chose étrange à la fin que le monde… »
Dans l’émission hommage de la terre au carré, Hubert Reeves révèle que s’il pouvait vivre une nouvelle vie, il serait à nouveau astrophysicien, mais qu’il apprendrait aussi à faire de la musique et plus précisément à jouer du violoncelle.
Le dernier mot du jour consacré à Hubert Reeves, le 23 avril 2021, avant celui d’aujourd’hui était aussi consacré à la musique : « Schubert, il est mort. […] Et pourtant il n’est pas mort. Il est avec moi, il vient me parler, il me parle »
Hubert Reeves disait que :
« [Ma plus grande fierté] est quand des gens me disent qu’après avoir lu un de mes livres, ils se sont sentis plus intelligents. »
Et il a écrit beaucoup de livres qui rendent plus intelligents celles et ceux qui ont la bonne idée de les lire.
Vous trouverez derrière ce lien <Hubert Reeves> le site consacré à cet homme doux et sage et sur lequel il est écrit sobrement : « Le présent site, maintenu par un membre de sa famille, restera en ligne aussi longtemps que les ressources nécessaires seront là pour le permettre, afin de perpétuer son souvenir. »
<1768>
-
Lundi 9 octobre 2023
« Ce qui caractérise la situation [du Haut-Karabakh] c’est un nettoyage ethnique sous menace génocidaire. »Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée NationaleLes derniers mois et jours ont montré un déchainement de violence et de guerre dans des conflits latents que les diplomates et hommes politiques n’ont pas su apaiser.
Ces impasses me font penser à ce mot d’esprit : Connaissez vous la différence entre un homme intelligent et un homme sage ?
Un homme intelligent parvient à régler un problème que le sage a su éviter.
Mais nous sommes à la recherche d’hommes intelligents, à défaut qu’ils n’ont su être sage. Ce sont des hommes d’État dont nous avons besoin, non d’hommes politiques.
Parmi ces sujets, il en est un qui a retenu mon attention : le conflit du Haut-Karabakh.
Pour celles et ceux qui sont un perdus dans cette histoire, je vais d’abord faire un rappel des faits.
Mais l’essentiel de ce mot du jour est la seconde partie qui tentera d’éclairer cette situation qui révèle la manière dont les choses se passent dans le monde et dans la géopolitique internationale.
On attribue au Général de Gaulle ce constat non romantique :
« Les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts »
A – Rappel des faits
Il serait possible de remonter très loin, mais pour se concentrer sur l’essentiel, il faut commencer en 1921, dans l’Union soviétique dirigé par Lenine et les Bolcheviks mais dans laquelle Staline jouait déjà un grand rôle. Il avait été nommé « commissaire aux nationalités »
L’union soviétique était un état fédéral dans lequel coexistaient des états fédérés. Parmi ces états il y avait l’Arménie et l’Azerbaidjan.
Les arméniens étaient chrétiens, les azéris musulmans.
 Staline va proposer et Lenine va accepter des manipulations concernant l’attribution de territoires entre les États.
Staline va proposer et Lenine va accepter des manipulations concernant l’attribution de territoires entre les États.
Concernant l’Arménie et l’Azerbaidjan, Staline va obtenir le rattachement du Haut-Karabagh, appelé alors le Nagorno Karabakh à la république socialiste soviétique d’Azerbaïdjan le 4 juillet 1921.
Or le Haut-Karabagh à cette époque, est peuplé à 94 % d’Arméniens et pour cette raison était auparavant, rattaché à la république socialiste soviétique d’Arménie.
Parallèlement, en mars 1921, Staline décide le rattachement du Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan, avec un statut de Région autonome.
Ce qui fait que l’Azerbaidjan est divisé en deux et que c’est l’Arménie qui sépare la partie principale, de la région autonome.
Si on avait voulu créer les conditions du désordre et du chaos, on ne s’y serait pas pris autrement.
Même si, tant qu’existait le régime totalitaire de l’Union soviétique dirigé d’une main de fer par le Politburo situé à Moscou, les petites divergences entre États Fédérés étaient rapidement réglées
Mais à ce stade, il faut remonter encore un peu plus loin dans l’Histoire.
Pas très loin, 6 ans avant, en 1915.
En 1915, commence le premier génocide de l’Histoire européenne, le génocide arménien perpétré par les turcs de l’empire ottoman.
La carte reproduite, montre que les arméniens se situent à un très mauvais endroit : la rencontre de 3 empires :
- L’Empire russe
- L’empire Turc qui à l’époque était l’empire Ottoman
- L’empire Perse qui s’appelle désormais l’Iran.
Les territoires dont il est question ici avaient, pour l’essentiel, été arrachés à l’Empire Perse par l’Empire tsariste russe en 1828.
Pour motiver le massacre des arméniens, les turcs avaient prétendu que les arméniens chrétiens trahissaient l’empire ottoman dirigé par les musulmans au profit de l’empire russe dirigé par les chrétiens. Car en 1915, nous étions en pleine première guerre mondiale et l’empire Ottoman était allié à l’Allemagne et à l’Autriche, alors que l’Empire Russe était de l’autre côté celui de la France et de la Grande Bretagne.
Les historiens ont démontré que cette trahison générale des arméniens contre leur empire ottoman était inexistante. Disons, de manière cynique, que le génocide peut s’analyser comme une action préventive contre le risque éventuel que la religion chrétienne commune avec l’ennemi, aurait pu pousser les arméniens à trahir.
Lors du centenaire, en 2015, j’avais écrit plusieurs mots du jour sur ce crime impardonnable organisé par le gouvernement jeune turc de Talaat Pacha, Enver Pacha et Cemal Pacha :
- « Les restes de l’épée »
- « Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un Génocide qui s’est déroulé contre le peuple arménien. »
- « La mort les a frappés sans demander leur âge puisqu’ils étaient fautifs d’être enfants d’Arménie. »
L’Empire ottoman sera dans le camp des vaincus. Une partie du territoire ottoman occupé par les arméniens, on parle de l’Arménie orientale sera intégrée à l’Union soviétique. Et c’est lors de cette intégration que le Nakhitchevan qui était rattaché auparavant à l’Oblast arménien, sera rattaché à l’Azerbaïdjan. C’est pourquoi ce rattachement fera l’objet d’un accord signé en mars 1921 entre la république socialiste fédérative soviétique de Russie et la Turquie.
Or, le Nakhitchevan, était peuplé de quasi 50 % d’Arméniens avant la soviétisation. Mais il a perdu presque toute sa population arménienne pendant l’ère soviétique à cause de mouvements d’émigration et d’une politique pro-azérie dans l’exclave : La population arménienne du Nakhitchevan, estimée à 15 % en 1926 préfère alors quitter la république socialiste soviétique autonome du Nakhitchevan pour la république socialiste soviétique d’Arménie voisine. Dans les années 1980, il n’y a plus qu’1 à 2 % d’Arméniens au Nakhitchevan.
Dans la relation entre les azéris et les arméniens, le génocide est omniprésent.
En effet, les azéris sont une ethnie turcophone.
Et l’autocrate turc Erdogan, dans ses discours définit ainsi la relation entre la Turquie et l’Azerbaïdjan :
« Une seule nation, deux états »
C’est pourquoi lorsque les arméniens parlent des azéris, ils les appellent « les turcs »
Tout est en place pour la guerre :
L’Union soviétique s’effondre en 1991. Les États de la fédération deviennent indépendants.
L’Arménie devient indépendante, mais le Haut Karabakh appartient à l’Azerbaïdjan, en raison de la décision de 1921 de Staline.
Le 2 septembre 1991, l’Assemblée nationale de la Région autonome du Haut-Karabagh proclame l’indépendance du pays.
L’Arménie intervient de son côté et une guerre va éclater entre les azéris et les arméniens, des massacres ont lieu des deux côtés.
Dans les années 1990, l’Arménie est mieux armée et organisée et va finalement gagner et même s’emparer de territoires supplémentaires autour du Haut-Karabakh.
En mai 1994, un cessez-le-feu est obtenu et des négociations pour une résolution du conflit sont organisées. Mais la situation sur le terrain est celle d’un Haut-Karabakh indépendant de l’Azerbaïdjan.
Dans le Droit international il existe deux principes concurrents :
- Le droit des peuples à disposer d’eux même
- L’intangibilité des frontières
L’application du premier, étant donné la population du Haut-Karabakh, aurait été pour un détachement de cette région de l’Azerbaïdjan.
Mais le monde entier a préféré le second. Personne, mis à part l’Arménie, n’a reconnu l’indépendance de l’Artsakh, nom donné par les arméniens au Haut-Karabakh.
Pendant 25 ans la situation a été gelée et les négociations n’ont pas progressé.
Mais pendant ce temps, l’Azerbaïdjan, grand producteur de pétrole et de gaz s’est énormément enrichi et a utilisé sa richesse pour s’armer massivement.
Et puis, elle a un allié qui est devenu puissant et qui s’affranchit de la prudence que lui imposait son appartenance à l’OTAN : la Turquie.
 En 2020, avec l’aide de la Turquie, l’Azerbaïdjan attaque le Haut-Karabakh et l’Arménie et gagne très facilement.
En 2020, avec l’aide de la Turquie, l’Azerbaïdjan attaque le Haut-Karabakh et l’Arménie et gagne très facilement.
Mais elle ne peut pas s’emparer du Haut-Karabakh proprement dit, mais simplement des territoires supplémentaires que les arméniens avaient conquis en 1990.
Elle n’a pas pu aller jusqu’au bout parce que la Russie, normalement protectrice des arméniens, s’était interposé et avait sifflé la fin de la partie, sans engager son armée.
La Russie avait cependant engagé une force d’interposition pour figer la nouvelle situation.
La Russie doit assistance à l’Arménie parce qu’elle a signé le traité de sécurité collective (ou encore traité de Tachkent) le 15 mai 1992 avec l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan.
Ce traité, elle ne l’a presque pas respecté en 2020 et elle ne respectera pas du tout en 2023, lorsqu’après un blocus de 9 mois ayant poussé la population au bord de la famine, l’Azerbaïdjan a attaqué avec son armée le Haut-Karabakh et l’a poussé à la capitulation en deux jours.
L’Arménie n’est pas intervenue. Sans allié, elle était certaine d’être à nouveau battu par les Turcs des deux états. En outre, après la défaite de 2020, le premier ministre arménien Nikol Pashinyan a été contraint à reconnaître la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh.
Dans ce cadre, l’intervention de l’armée d’Azerbaïdjan constituait une simple opération interne à un État qui mettait fin à une situation de sécession d’une population séparatiste qui ne reconnaissait pas l’autorité légitime de l’État.
Pour quasi tous les pays du monde, tout ceci est absolument normal, à commencer par la Chine qui estime que Taïwan est dans la même situation que le Haut-Karabakh.
Admettons…
Mais après cet écroulement en deux jours, « plus de 100 000 personnes ont quitté le territoire ».
Or, ce territoire comptait 120 000 habitants.
A ce stade, les deux principes évoqués ci-avant vont pouvoir se rejoindre, tous les arméniens étant partis, un référendum réalisé sur ce territoire permettra de constater que le peuple qui l’habite souhaite faire partie de l’État d’Azerbaïdjan.
Pourquoi les arméniens sont-ils partis ?
S’ils étaient restés, ils devaient prendre un passeport azerbaïdjanais et les jeunes être incorporés dans l’armée qui potentiellement pouvait entrer en guerre contre l’Arménie.
Mais de manière beaucoup plus simple, par peur d’un nouveau génocide perpétré par les turcs.
C’est ce qu’a résumé Jean-Louis Bourlanges dans l’émission < Un jour dans le monde> :
« Ce qui caractérise la situation [du Haut-Karabakh] c’est un nettoyage ethnique sous menace génocidaire. »
Jean-Louis Bourlanges, rappelait que lorsque le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, parlait des arméniens il les traitait de chiens.
Et il ne faisait guère de doute, que le choix des arméniens se trouvait entre le cercueil et l’exil. Ils ont choisi l’exil, cela s’appelle de l’épuration ethnique.
Voilà grosso modo les faits, mais cette histoire du Haut-Karabakh présente de nombreuses questions que je pourrais résumer en une seule : Pourquoi l’Arménie est-elle si seule ?
B – Analyse de l’isolement de l’Arménie
La réponse courte est que l’Arménie n’a ni pétrole , ni gaz !
Mais allons un peu plus loin…
1° Pourquoi la Russie n’est-elle pas intervenue ?
C’était son devoir d’intervenir, d’abord en raison du traité de Tachkent et ensuite stratégiquement parce qu’elle ne devrait pas tolérer que la Turquie impose son leadership sur cette région.
Dire simplement, que c’est parce qu’elle est occupée en Ukraine, ne suffit pas.
L’explication se trouve dans le fait que l’Arménie est une démocratie, certes imparfaite mais le pouvoir politique peut changer de main suite à une élection.
C’est ce qui s’est passé en mai 2018, lorsque Nikol Pashinyan est devenu premier ministre alors qu’avant il était dans l’opposition.
Poutine a beaucoup de mal avec les pouvoirs démocratiques, il préfère les autocrates de son espèce, comme Ilham Aliyev qui a succédé à son père qui détenait le pouvoir depuis l’indépendance de l’Azerbaïdjan. Aucune opposition n’est tolérée en Azerbaïdjan, aucune élection ne peut être défavorable au pouvoir. Cette manière de gouverner, Poutine la comprend et l’approuve.
Nikol Pashinyan a encore aggravé son cas en se rapprochant de l’Occident, des États-Unis et des européens. Pour Poutine, c’est une trahison supplémentaire et l’exemple de l’Arménie doit pouvoir faire comprendre que si on veut compter sur la Russie, il ne faut pas agir comme l’Arménie.
Enfin, il y aurait même une raison économique. Plusieurs sources prétendent que grâce à l’Azerbaïdjan, la Russie contourne le blocus occidental sur son gaz et son pétrole : l’Azerbaïdjan acceptant de faire passer pour sien les hydrocarbures que la Russie lui livre. C’est ce qu’on peut trouver comme information sur le site de <France 24>
2° Pourquoi l’Union européenne n’exerce t’elle aucune pression sur l’Azerbaïdjan ?
Il y a utilisation d’une force brutale d’un État autoritaire contre une démocratie et il y a de toute évidence une épuration ethnique.
L’union européenne devrait réagir autrement que par des communiqués mous.
Mais elle ne le fait pas.
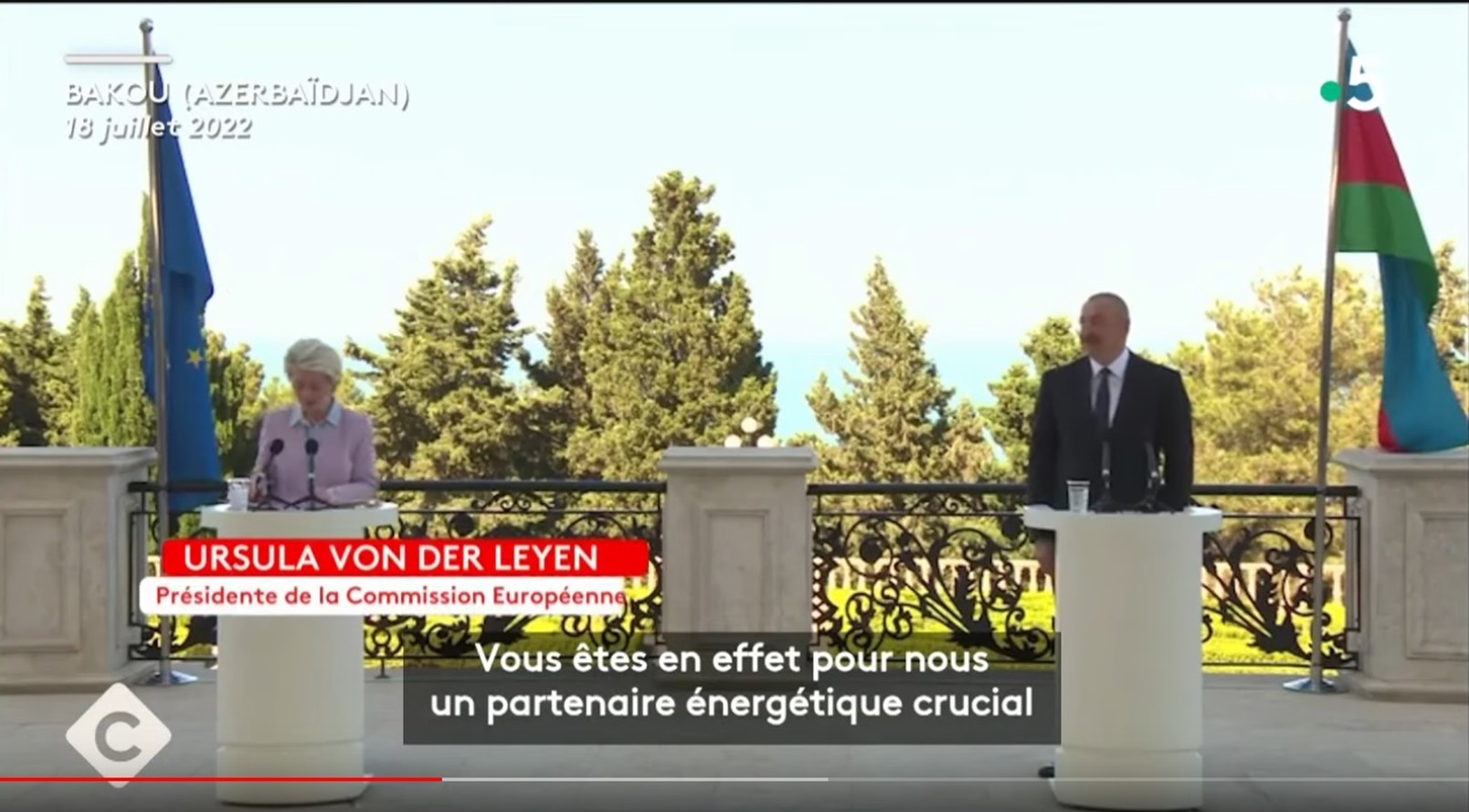
La guerre d’Ukraine avait à peine commencé, l’Allemagne et les autres pays européens étaient très inquiets pour leur approvisionnement en gaz. Alors la présidente de la commission européenne avait pris son bâton de pèlerin pour se rendre à Bakou le <18 juillet 2022> et faire cette déclaration à côté du Président Aliyev, visiblement ravi :
« Vous êtes pour nous un partenaire énergétique crucial […] et fiable ».
C’était pour la bonne cause pour que les européens puissent continuer à se chauffer et à disposer de l’énergie nécessaire pour continuer à vivre convenablement.
D’ailleurs, si nos dirigeants n’étaient pas arrivés à trouver des sources d’approvisionnement alternatives, nos concitoyens des différents États de l’Union se seraient manifestés bruyamment, voire davantage.
Il n’est pas raisonnable de se fâcher avec un État aussi indispensable et fiable….
3° Pourquoi L’Ukraine prend-elle position pour l’Azerbaïdjan ?
Courrier International écrit : « Au Haut-Karabakh, l’Azerbaïdjan est dans son droit, estime la presse ukrainienne »
En outre Volodymyr Zelensky a décroché son téléphone, mercredi 4 octobre, pour appeler son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev et le président ukrainien a déclaré sur la plateforme X (ex-Twitter).:
« Nous avons réaffirmé notre attachement aux principes de souveraineté et d’intégrité territoriale des États »
Il a également annoncé avoir aussi « remercié » le président azerbaïdjanais pour l’aide humanitaire fournie à Kiev, « en particulier dans le secteur de l’énergie à l’approche de l’hiver ».
Ce dernier argument se rapproche de celui de l’Union européenne.
Mais le premier montre une communauté de destin et d’intérêt. L’Ukraine comme l’Azerbaïdjan a profité d’une décision unilatérale d’un responsable soviétique. Pour l’Ukraine il s’agissait du successeur de Staline, Nikita Khrouchtchev qui a attribué la Crimée à l’Ukraine, bien qu’elle fût majoritairement peuplée de russes. Le Haut Karabakh se trouve donc par rapport à l’Azerbaïdjan dans une situation similaire que la Crimée par rapport à l’Ukraine.
4° Pourquoi Israël soutient elle l’Azerbaïdjan et lui fournit des armes ?
L’explication des ressources énergétiques peut, encore une fois, être avancée.
Mais on peut quand même s’étonner du peu d’empathie entre le peuple victime de la shoah à l’égard du peuple arménien qui a vécu un autre génocide, avant le sien.
Israël n’a jamais reconnu le génocide arménien !
Parce qu’Israël a toujours voulu, depuis sa création, conserver d’excellentes relations avec la Turquie. Il y eut quelques tensions avec Erdogan, mais rien d’essentiel qui puisse justifier de se fâcher avec le pays responsable du génocide arménien.
5° La position de la Turquie est claire et univoque.
Cette fois nous sommes dans un univers connu.
Chaque fois que la Turquie peut nuire aux arméniens, elle le fait.
L’Azerbaïdjan ce sont des turcs, donc ils doivent être aidés.
6° Pourquoi l’Iran soutient-elle l’Arménie, plutôt que l’Azerbaïdjan ?
L’Arménie a un soutien, c’est l’Iran.
C’est doublement surprenant parce que d’une part l’Arménie est chrétienne et surtout que les azéris sont principalement chiites comme les iraniens.
Cette fois la religion n’a rien à faire dans cette affaire.
 Il existe en Iran, un territoire essentiellement occupé par des azéris, cette ethnie turcophone. L’Iran ne veut surtout pas que ses azéris puissent avoir une velléité de rejoindre l’Azerbaïdjan.
Il existe en Iran, un territoire essentiellement occupé par des azéris, cette ethnie turcophone. L’Iran ne veut surtout pas que ses azéris puissent avoir une velléité de rejoindre l’Azerbaïdjan.
L’Iran est, de ce fait, totalement opposé à l’idée que poursuivent les azéris et les turcs de créer un corridor appelé « le corridor de Zanguezour » qui permettrait de relier à l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan jusqu’à la Turquie, au dus de l’Arménie, le long de la frontière avec l’Iran.
Ce projet pourrait être la raison d’une nouvelle guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
7° Pourquoi les États-Unis se désintéressent de cette affaire
D’abord parce que les États-Unis ne veulent plus s’intéresser à autre chose que leurs affaires internes et leur rivalité avec la Chine.
Mais il y a une autre raison indiquée par Jean-Claude Bourlanges : les États-Unis, ennemi absolu de l’Iran, n’aime pas que l’Arménie soit soutenue par ce pays ostracisé. Vous ne pouvez être ami de l’Iran et compter sur l’appui des États-Unis.
Il y aurait encore d’autres points à souligner mais cela dépasserait le cadre d’un mot du jour.
Mais on voit ainsi que la morale, l’éthique et l’émotion sont très éloignées des motivations des États.
<1767>
- L’Empire russe
-
Vendredi 6 octobre 2023
« Je ne sais pas si Dieu existe, mais je crois que oui et je pense qu’André va répondre : je ne sais pas mais je pense que non. »Éric-Emmanuel Schmitt répondant à la question est ce que Dieu existe ? et interpellant son ami André Compte SponvilleLors de l’émission « La Grande Librairie » du 26 avril 2023, Augustin Trapenard interrogeait le sacré et la spiritualité.
Il avait invité les auteurs de quatre ouvrages.
- Éric-Emmanuel Schmitt qui dans « Le défi de Jérusalem » raconte son pèlerinage sur les traces de Jésus Christ. De Nazareth à Jérusalem en passant par Capharnaüm, Césarée, Bethléem ou la Galilée, il a écrit un livre de réflexion sur son cheminement spirituel.
- Le philosophe André Comte-Sponville qui a écrit : « La Clé des champs et autres impromptus ». Un livre qui réunit une série d’articles et d’essais sur des sujets graves, comme la détresse, la souffrance, le pessimisme et la mort. Son recueil se conclut sur un texte inédit intitulé « Maman », parlant de sa mère qui a été malheureuse toute sa vie et qui s’est suicidée lorsqu’il avait une trentaine d’années.
Le titre de son ouvrage, André Comte-Sponville l’a emprunté à son cher Montaigne :
« Le présent que nature nous ait fait le plus favorable, et qui nous ôte tout moyen de nous plaindre de notre condition, c’est de nous avoir laissé la clé des champs »
(Essais, II, 3)
La clé des champs que toutes les religions du Livre voudrait nous interdire, mais que le sage Montaigne accepte comme un présent de la nature.
- La romancière et philosophe Éliette Abécassis et le dessinateur Nejib ont publié « Sépher » bande dessinée qui retrace l’épopée millénaire de la Bible.
Le dernier écrivain aurait été brulé ou exécuté par un autre châtiment, que les hommes qui croient dans le récit abrahamique ont inventé et infligé à tous celles et ceux qui mettaient en doute ou s’éloignaient du récit qu’ils prétendaient sacré, si ces « hommes de dieu » disposaient encore du pouvoir politique dans nos contrées.
Car comme le disait Woody Allen : « je n’ai pas de problème avec Dieu, ce sont ses fans qui me font peur ! »
- Metin Arditi a en effet corrigé un peu le récit évangélique dans « Le Bâtard de Nazareth ». Comme Marie était enceinte de Jésus, en dehors des liens du mariage, l’enfant était de manière factuel « un bâtard ». Or, à cette époque, il n’était pas bon de naître bâtard. Cet auteur explique alors la vie et l’enseignement du Christ par ce traumatisme initial d’avoir été rejeté socialement et ostracisé.
Mais ce que je souhaite partager essentiellement aujourd’hui c’est ce qu’Eric Emmanuel Schmitt a dit tout au début de l’émission.
Au commencement de l’émission seuls Eric Emmanuel Schmitt et André Comte-Sponville étaient présents.

Eric Emmanuel Schmitt répondit à une question d’Augustin Trapenard sur la croyance :
« Moi si vous demandez : est-ce que Dieu existe ? Je vous répondrais : Je ne sais pas mais je crois que oui et je pense qu’André va répondre : je ne sais pas mais je pense que non. Je me définis comme un agnostique croyant. Parce qu’il est très important de distinguer le savoir et la croyance »
André Comte-Sponville approuva cette assertion et la fit sienne.
La question de la différence entre « le savoir » et de « la croyance » se pose bien au-delà des religions. L’épisode du COVID que nous avons vécu a été particulièrement fécond en confusion entre ces deux notions.
Mais ce sont bien les religions du Livre ou Abrahamique qui ont poussé le plus loin cette terrifiante confusion.
Ils sont allés jusqu’à ce crime contre l’esprit de prétendre que « leur croyance » était « la vérité ». Et au nom de ce mensonge, ils ont tué. Et ils tuent encore dans certains des pays où l’Islam est religion d’État et je crois condamnent pénalement dans tous les pays où l’Islam est religion d’État .
Les chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes faisaient de même dans des temps pas si anciens.
Cayetano Ripoll, a été exécuté par l’inquisition espagnole en 1826. Ce catalan, instituteur a été condamné pour hérésie. Son crime ? Avoir enseigné à ses élèves des idées jugées contraires au catholicisme.
1826 c’était 37 ans après la révolution française.
Dire « Je ne sais pas, mais je crois que… » ou « Je ne sais pas, mais je ne crois pas que » constituent une attitude d’humilité et de sagesse qui conduit immédiatement à un comportement plus paisible, moins exalté et donc moins violent.
Probablement que Woody Allen craindrait moins les fans de dieu qui seraient dans cette posture : « Je ne sais pas, mais je crois que … ».
Vous pouvez encore regarder en replay cette émission de la Grande Librairie jusqu’au 26 novembre 2023. Voici le <Lien >
<1766>
- Éric-Emmanuel Schmitt qui dans « Le défi de Jérusalem » raconte son pèlerinage sur les traces de Jésus Christ. De Nazareth à Jérusalem en passant par Capharnaüm, Césarée, Bethléem ou la Galilée, il a écrit un livre de réflexion sur son cheminement spirituel.
-
Mardi 3 octobre 2023
« Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées ! »Pierre Perret : « La femme grillagée »Souvent ce sont les artistes et les poètes qui expriment le mieux la réalité du vécu.
Je ne connaissais pas cette chanson de Pierre Perret, je l’ai découverte par hasard hier :
<La femme grillagée> chantée par Pierre Perret
Écoutez ma chanson bien douce
Que Verlaine aurait su mieux faire
Elle se veut discrète et légère
Un frisson d’eau sur de la mousse
C’est la complainte de l’épouse
De la femme derrière son grillage
Ils la font vivre au Moyen Âge
Que la honte les éclabousse
Quand la femme est grillagée
Toutes les femmes sont outragées
Les hommes les ont rejetées
Dans l’obscurité
Elle ne prend jamais la parole
En public, ce n’est pas son rôle
Elle est craintive, elle est soumise
Pas question de lui faire la bise
On lui a appris à se soumettre
À ne pas contrarier son maître
Elle n’a droit qu’à quelques murmures
Les yeux baissés sur sa couture
Quand la femme est grillagée
Toutes les femmes sont outragées
Les hommes les ont rejetées
Dans l’obscurité
Elle respecte la loi divine
Qui dit, par la bouche de l’homme,
Que sa place est à la cuisine
Et qu’elle est sa bête de somme
Pas question de faire la savante
Il vaut mieux qu’elle soit ignorante
Son époux dit que les études
Sont contraires à ses servitudes
Quand la femme est grillagée
Toutes les femmes sont outragées
Les hommes les ont rejetées
Dans l’obscurité
Jusqu’aux pieds, sa burqa austère
Est garante de sa décence
Elle prévient la concupiscence
Des hommes auxquels elle pourrait plaire
Un regard jugé impudique
Serait mortel pour la captive
Elle pourrait finir brûlée vive
Lapidée en place publique
Quand la femme est grillagée
Toutes les femmes sont outragées
Les hommes les ont rejetées
Dans l’obscurité
Jeunes femmes, larguez les amarres
Refusez ces coutumes barbares
Dites non au manichéisme
Au retour à l’obscurantisme
Jetez ce moucharabieh triste
Né de coutumes esclavagistes
Et au lieu de porter ce voile
Allez vous-en, mettez les voiles
Quand la femme est grillagée
Toutes les femmes sont outragées
Les hommes les ont rejetées
Dans l’obscurité
 L’ONU considère que le traitement des femmes en Afghanistan, par les Talibans s’apparenterait à un « apartheid sexiste »
L’ONU considère que le traitement des femmes en Afghanistan, par les Talibans s’apparenterait à un « apartheid sexiste »
Vous trouverez cette publication, du 11 Juillet 2023, sur cette <Page ONU>
Pierre Perret s’inspire d’un poème de Verlaine dont je cite ci-dessous les premières strophes.
Écoutez la chanson bien douce
Qui ne pleure que pour vous plaire.
Elle est discrète, elle est légère :
Un frisson d’eau sur de la mousse !La voix vous fut connue (et chère ?)
Mais à présent elle est voilée
Comme une veuve désolée,
Pourtant comme elle encore fière,Et dans les longs plis de son voile
Qui palpite aux brises d’automne,
Cache et montre au cœur qui s’étonne
La vérité comme une étoile.Elle dit, la voix reconnue,
Que la bonté c’est notre vie,
Que de la haine et de l’envie
Rien ne reste, la mort venue.Paul VERLAINE : Écoutez la chanson bien douce (1878) Sagesse I/XVI
Ce poème a été mis en musique et la chanson qui en est le fruit <est chantée par Léo Ferré>
<1765>
-
Jeudi 28 septembre 2023
« Les propos que j’entends en France me rappellent ceux que nous tenions à Alger lorsque l’islamisme commençait à occuper le terrain et installer ses bases. »Boualem SansalDans le mot du jour du 19 septembre 2023 j’évoquais l’ouvrage de Florence Bergeaud-Blackler : « Le frérisme et ses réseaux. L’enquête » ainsi que l’hostilité qui lui a été opposée par les milieux universitaires et les menaces proférées par des milieux plus troubles qui refusent tous deux que soit analysé ce qui se passe dans la société française, à savoir une opération volontaire et maîtrisée par des partisans d’un islam rétrograde visant à emmener une part grandissante de la communauté musulmane vers des pratiques plus rigoristes et archaïques. Parallèlement, le mouvement frériste utilise tous les moyens d’informations, les outils juridiques et la liberté qu’offrent nos États démocratiques pour tenter de rendre notre organisation, notre école, notre société plus compatible avec leur vision du monde.
Je voudrais pour compléter ce premier mot du jour sur ce sujet par un entretien très instructif entre Florence Bergeaud-Blackler et Boualem Sansal l’écrivain algérien de langue française qui a vécu en Algérie la montée de l’Islam rétrograde au sein d’une société musulmane et qui voit avec inquiétude des mécanismes similaires se développer dans notre société largement athée avec une tradition chrétienne remontant à plusieurs siècles. Boualem Sansal vit toujours en Algérie, dans la banlieue d’Alger.
<Cet article> a été publié par « Le Figaro » le 7 juillet 2023.
Boualem Sansal éclaire d’abord les conditions qui rendent possible cet « entrisme » des frères musulmans et autres salafistes et wahhabite : le déclin de la civilisation occidentale :
« Les civilisations, comme les humains, ont leurs maladies et elles se transforment en permanence. Je pense que la civilisation occidentale est en perte de vitesse depuis longtemps, « les Lumières » sont un souvenir qui ne dit rien aux jeunes. On parle d’effondrement. Ses élites ont laissé faire ou n’ont pas su faire. En se vidant de sa puissance, en perdant l’initiative, elle s’est fragilisée. Là, elle est face à un défi majeur, le plus grand de son Histoire. […] Les Frères étaient une petite poignée discrète en France, ils sont aujourd’hui des milliers, puissamment organisés, ayant pignon sur rue et ne manquant d’aucun moyen d’action. Grâce à eux, mais pas seulement, l’islamisme s’est répandu en France et fait souche. Il a ses objectifs, ses programmes, ses institutions et ses relais dans la société française dans tous ses compartiments. C’est du billard pour eux car l’État et la société françaises en sont encore à se demander ce qu’ils ont en face d’eux. »
Boualem Sansal a vécu la guerre civile qui a opposé entre 1992 et 2002 le gouvernement algérien, disposant de l’Armée nationale populaire (ANP), et divers groupes islamistes. Finalement les forces gouvernementales ont gagné et poussé à la reddition l’Armée islamique du salut (AIS) et le Groupe islamique armé (GIA). Et Boualem Sansal considère que beaucoup de ce qui arrive en France lui rappelle l’évolution de l’Algérie : .
« Les propos que j’entends en France me rappellent ceux que nous tenions à Alger lorsque l’islamisme commençait à occuper le terrain et installer ses bases. Il paraissait bien sympathique avec son folklore et ses promesses de justice et de fraternité. Ça tombait bien, nous étions en révolte contre les injustices et la corruption du pouvoir. Nous avions les mêmes sympathies pour eux que les gauchistes en France ont aujourd’hui pour vos islamistes. Refuser les islamistes, c’était quelque part soutenir la junte au pouvoir. Nous, nous n’avions que ce choix, la peste ou le choléra, en France, le choix est heureusement plus large. »
Et Boualem Sansal met l’accent sur le voile qui par sa visibilité, de plus en plus ostensible, a démontré en Algérie, l’influence et la place des mouvements islamistes.
Dans son essai « Gouverner au nom d’Allah » il a écrit que le « voile a été un outil de conquête ».
Sur ce petit bout de tissu que beaucoup jugent insignifiant et sans importance, je ne me lasserai pas de renvoyer vers une vidéo de Nasser que j’avais déjà cité lors du mot du jour qui a fait suite à l’attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015
Dans cette vidéo : <Entretien en 1953 avec les frères musulmans>, Nasser, lors d’un meeting politique, explique qu’il a voulu discuter avec les frères musulmans pour les associer au pouvoir. Et quand il dit que leur première exigence est que « nos femmes sortent dans la rue voilées » vous entendez, la salle qui éclate de rire.
C’était en 1953, en Egypte pays musulman historique, siège de l’université al-Azhar du Caire dont on dit qu’il s’agit de la plus haute institution d’enseignement sunnite du monde.
Aujourd’hui, en France quand des personnes posent la question du voile Edwy Plenel ou Jean Luc Mélenchon, parmi d’autres, les accusent de racisme et plus précisément « d’islamophobie ».
Et Jean-Luc Mélenchon récemment s’est aussi insurgé contre l’interdiction de l’Abaya à l’école avec cette expression : « Absurde guerre de religion »
Mais Jean-Luc Melenchon approuvait l’interdiction de la Burqa , le 24 avril 2010, dans l’émission « On n’est pas couché » sur France 2.
« Moi je considère que c’est un traitement dégradant et je considère que c’est une provocation d’un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Et par conséquent la République a gagné et elle va gagner encore une fois : ça sera interdit », poursuit Jean-Luc Mélenchon. « Et on le fera non seulement pour empêcher une absurdité qui consiste à accepter l’idée qu’une femme considère qu’elle est un enjeu, un gibier, qu’un homme ne peut la regarder qu’avec un œil de prédateur. Et deuxièmement, parce que c’est obscène cette histoire de burqa, ça part de l’idée que les hommes ne sont que des prédateurs. »
Et il ajoutait même à l’égard de celles qui portent volontairement la burqa
« Je leur donne le signal suivant : en République française, les hommes et les femmes sont égaux. J’ai le droit de te regarder dans les yeux », répond-il. « Dans ce pays, on va vivre ensemble et on ne se trimballera pas avec des fantômes qui se promènent dans la rue et qui interdisent qu’on les regarde. »
Alors, il est juste de dire qu’il ne s’agissait pas en l’occurrence du simple voile islamique mais du voile intégral.
Toutefois dans « Marianne » à propos d’une candidate NPA qui était apparue voilée aux Régionales de 2010, Jean-Luc Mélenchon décrivait
« Une attitude immature et un peu racoleuse. On ne peut pas se dire féministe en affichant un signe de soumission patriarcale »
Je n’en dis pas davantage : un signe de soumission patriarcale et qui est le contraire du féminisme.
Mais voilà ce que Boualem Sansal écrit sur l’apparition du voile dans les rues d’Algérie :
« Quelques filles avaient commencé à le porter puis un jour le phénomène s’est emballé et le voile s’est généralisé. On peut dire que l’islamisation c’est la victoire du voile avant d’être celle de l’islam. Nous avions mal compris le but de guerre des islamistes, nous pensions qu’ils visaient le pouvoir et nous sommes allés les attendre de ce côté. En réalité, le pouvoir ne les intéresse pas, leur but, c’est l’islamisation de la société, c’est la oumma, c’est le califat mondial. On l’a compris un peu tard.
La question du voile a provoqué autant sinon plus de débats qu’en France. Elle a profondément agité les gens, les familles, elle a été débattue à l’Assemblée nationale et une loi a été votée en 1992, interdisant les signes religieux dans l’espace public, le voile, l’abaya, la calotte. Trop tard, ils avaient conquis le pays ; un an plutôt, aux élections municipales ils avaient gagné 1450 communes sur les 1500 que comptait le pays. Au fronton des mairies, la devise officielle « Par le peuple et pour le peuple » a été remplacée par des slogans islamistes. Après avoir voilé les filles, ils ont voilé les villes et les villages gagnés aux élections. Le gouvernement ne s’était pas posé la question de l’application de sa loi, en conséquence de quoi elle a été frappée de nullité le jour même de son entrée en vigueur. »
On a compris que l’on ne pouvait pas compter sur l’État. Certains ont pris le chemin de l’exil. Les autres se sont divisés en réconciliateurs qui voulaient un compromis avec les islamistes, et en éradicateurs qui voulaient extirper le mal à la racine, et mobiliser contre lui au-delà de l’Algérie, partout où il pousse. En quelques jours, le pouvoir a arrêté plusieurs centaines de milliers de personnes suspectées d’être des activistes islamistes et les a enfermés dans des camps éparpillés en plein Sahara. L’objectif était de casser les réseaux qui avaient pu se former dans la clandestinité et cela a fonctionné. L’armée est ensuite passée à l’éradication militaire.
Les réconciliateurs ont tenté de déplacer le problème sur l’Islam, leur idée était que si les valeurs de l’islam étaient parfaitement appliquées, les islamistes n’auraient plus de raisons de combattre pour les imposer à la société et la réconciliation se ferait d’elle-même. L’État a joué cette carte avec tout le cynisme requis, en l’espace de quelques années, il a couvert l’Algérie de mosquées, d’instituts islamiques, et a ouvert aux islamistes l’accès aux médias lourds télés et radios, et mis en œuvre une vraie police islamique des mœurs. Cette stratégie, qui s’est concrétisée par une loi dite de réconciliation nationale, a pu ramener au bercail un certain nombre de »repentis ». Nous y avons cru. En fait non, ils avaient seulement changé de stratégie. « Nous avons perdu les maquis pour gagner les villes » , se disaient-ils.
Et il ajoute pour la France :
« S’ils ont pu se construire aussi solidement, c’est qu’ils ont détruit quelque chose dans la société pour prendre sa place. En bons stratèges, ils ont toujours peur que leur victime prenne conscience de leur domination et se révolte. Il faut la « piquer » pour l’endormir, la rassurer, avancer dans son dos. Il me semble qu’ils sont allés un peu trop vite ces dernières années, grisés par leurs succès. La société française commence à réagir, elle regimbe, la confrontation approche, ils font tout pour détendre l’atmosphère. Ils attendront un meilleur moment. Pendant que l’on pense hexagone, eux pensent monde. Ils peuvent aisément déplacer le théâtre des opérations en Italie, en Belgique, ailleurs. »
J’aimerai avoir cette conviction que la société française commence à réagir.
Réagissez-vous ?
Continuez vous à penser qu’il s’agit exclusivement d’un problème socio-économique et que nous ne sommes pas dans un mouvement de régression incroyable dont quelques fanatiques tirent les ficelles ?
Ces fanatiques ont su trouver des alliés, j’en ai cité deux.
Boualem Sansal écrivait pour l’Algérie :
« Même problématique, mêmes effets. Nos islamistes avaient leurs alliés dans le système, parmi les conservateurs, dans la gauche dont les troupes étaient toutes passées chez les islamistes, et parmi les opportunistes en tout genre. Le ressort de la culpabilité a évidemment joué, les islamistes sont experts dans l’art de le susciter et de le manipuler dans le sens qu’ils veulent. C’est une souffrance pour un musulman sincère d’apprendre qu’il n’a pas toujours été un bon musulman. Il y avait parmi nos islamistes qui étaient sincères dans leur démarche, ils étaient en quête de réconfort, déçus qu’ils étaient par le socialisme matérialiste importé de Moscou.
Ils étaient faciles à manipuler. Puis sont arrivés les islamistes d’Egypte, d’Arabie, du Yémen, du Golfe, d’Iran, des missionnaires aguerris, dont nombre de Frères musulmans. Les Algériens d’un certain âge se sont souvenus qu’au lendemain de l’indépendance en juillet 1962, le pays a vu débarquer les Témoins de Jéhovah et les Évangélistes venus d’Europe. En quelques mois, ils ont converti des milliers de personnes, dont ma propre famille. La première décision prise par le colonel Boumediene après son putsch en mars 1965 a été de les renvoyer d’un coup de pied. Une bonne chose mais il n’a pas renvoyé les islamistes étrangers, ils s’étaient dissous dans la population. »
En conclusion, Boualem Sansal rend hommage à Florence Bergeaud-Blackler :
Les islamistes travaillent dans le secret, sur la durée, sans répit, ne cédant jamais sur rien. Ils pénètrent la société comme l’humidité pénètre les murs et les désagrège. Quand on ne sait pas agir, on tergiverse, on culpabilise, on se pose encore et toujours les mêmes questions : Sommes-nous responsables de ce qui s’est passé, de ce qui se passe ? La façon dont on répondra à ces questions déterminera la suite. On s’engage comme le fait Florence Bergeaud-Blackler, en alertant l’opinion, en l’informant, ou on se contente d’observer et de commenter l’actualité ou on rejoint les forces de l’axe ? »
Florence Bergeaud-Blackler qui dit dans cet entretien :
« Là où l’islamisme se développe, la réaction des pouvoirs musulmans consiste à injecter plus d’islam. Je parle ici des « réconciliateurs » . En France, la tendance est aussi à la réconciliation, mais plutôt par le marché et par la culture de l’excuse. Le halal en est la preuve. Face à la demande d’Islam, tout a été fait en sorte pour que le commerce halal se développe, pour le business bien sûr mais avec l’espoir de faire des musulmans des consommateurs comblés et bien intégrés. En réalité le problème n’était pas qu’identitaire. Le marché halal propose bien plus qu’une identité, une façon de vivre en modernité dans l’espace normatif du halal, selon une norme fondamentaliste.
Des opportunistes se sont également saisis du sujet de la prévention ou de la lutte contre la radicalisation et ont présenté leur remède basé sur la théorie identitaire. Ils nous ont empêchés de résoudre ces problèmes par leur incompréhension du système frériste, des attentes qu’il avait semées chez les jeunes réislamisés. Ces soi-disant experts n’ont cessé de parler de la responsabilité d’une islamophobie généralisée, soulignant les problèmes socio-économiques et plaçant dans l’angle mort l’action des Frères. Leurs solutions se sont avérées, sans surprise, inefficaces. Cette idée qui consiste à dire qu’il faut plus d’islam, d’un islam français « apaisé » pour combattre le radicalisme est comparable aux politiques d’accommodement du code de la famille menées dans les pays musulmans, elle alimente le problème. Nous sommes pris dans ce piège. Cependant, contrairement aux pays musulmans, nous avons une solide tradition de laïcité et de sécularisation. ».
Nous avons beaucoup reculé par naïveté, par culpabilité aussi devant cet assaut régressif qui est tout sauf insignifiant.
Je renvoie vers <L’entretien de Boualemm Sansal et Florence Bergeaux-Blacker> qui nécessite cependant d’être abonné.
<1764>
-
Mardi 19 septembre 2023
« Nous ne sommes plus qu’une poignée de chercheurs à travailler sur l’islamisme. »Florence Bergeaud-Blackler lors d’une interview sur France InterJ’ai commencé l’écriture de ce mot du jour en février, juste après la publication du livre « Le frérisme et ses réseaux. L’enquête » par Florence Bergeaud-Blackler, anthropologue et chargée de recherche au CNRS à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman.
Mais l’écriture de ce mot du jour s’est révélée très compliquée.
Car il faut dire ce qui nous arrive, tout en restant nuancé et équilibré.
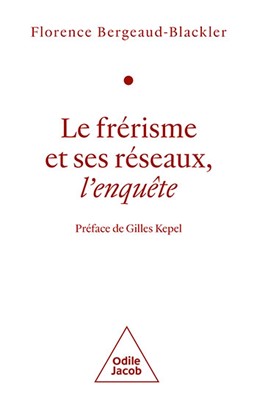 Je suis né, il y a près de 65 ans maintenant, dans une famille chrétienne catholique.
Je suis né, il y a près de 65 ans maintenant, dans une famille chrétienne catholique.
Plus tard, vers les 18 ans, j’ai participé à une expérience spirituelle assez intense dans une communauté chrétienne millénariste.
Cette expérience m’a beaucoup appris.
Elle m’a surtout convaincu de l’immense différence qui existe entre « la spiritualité » et « la religion ».
La spiritualité constitue une élévation de l’esprit pour dépasser le matérialisme du monde et se réconcilier avec la finitude de notre vie.
La religion c’est autre chose, c’est une organisation qui prétend parler de spiritualité. Mais quand on observe ces organisations avec lucidité, on constate qu’elles sont toujours dirigées par des hommes de pouvoir qui imposent par la force et la terreur des règles à la société. Règles qui vont jusqu’à la chambre à coucher et les choses les plus intimes de notre être pour mieux asseoir le désir de puissance, l’hubris et l’égocentrisme de ces chefs religieux.
Christian Bobin, qui était croyant a écrit :
« Je n’aime pas le mot « religieux ». Je lui préfère le mot « spirituel ». Est spirituel ce qui en nous ne se suffit pas du monde, ne s’accommode d’aucun monde. C’est quand le spirituel s’affadit qu’il devient du « religieux » ».
« Autoportrait d’un radiateur » Vendredi 21 juin
Régis Debray avait écrit de manière plus prosaïque :
« Le spirituel nous prépare à la mort, la religion prépare les obsèques »
Les religions quand elles exercent le pouvoir dans la société, que ce soit dans le monde d’aujourd’hui ou que ce fut dans le passé, se révèlent invariablement brutales, tristes, perverses, liberticides et inhumaines.
Parallèlement à cette expérience personnelle, j’ai grandi et vieilli dans une France qui s’est éloignée, séparée de la religion, dans la liberté de s’exprimer, de blasphémer comme ils disent, dans la liberté des mœurs, des dogmes et des évolutions familiales, sexuelles et sociétales jusqu’au mariage pour tous.
C’était pendant le combat d’arrière garde que menait des intégristes catholiques soutenus par l’Église contre la réforme du mariage pour tous, que j’avais pu citer lors d’un mot du jour ce propos du cardinal de Paris, André Vingt-Trois, qui concluait sur ce constat :
« Nous ne pouvons plus attendre des lois civiles qu’elles défendent notre vision [chrétienne] de l’homme »
Cette phrase a été prononcée le 16/04/2013 lors de son dernier discours de Président de la Conférence Épiscopale de France
J’étais profondément en accord et heureux avec cette évolution qui faisait reculer l’emprise archaïque de la religion sur la société.
Et voici que depuis les années 1970, l’immigration économique a conduit à l’installation sur notre territoire, largement libéré des archaïsmes religieux, une communauté musulmane de plus en plus importante, traversée par des courants identitaires, d’affirmation religieuse et prosélytes.
C’est à ce stade que toute la nuance est nécessaire à la fois dans mon expression, mais aussi dans votre lecture.
Car il ne s’agit pas de mettre en cause « les musulmans » dont la communauté est si diversifiée.
Il ne s’agit pas non plus de parler de l’Islam en général, de cette extraordinaire civilisation qui a créé un art de vivre, des chefs d’œuvre de l’esprit, qui avant l’Occident a initié l’avènement d’une médecine moderne. Et qui aussi par son érudition et sa sagesse a su conserver les textes de l’antiquité grecque pour notre savoir d’aujourd’hui.
Ce dont il est question, ce sont les forces vives fondamentalistes et archaïques qui sont à l’œuvre dans l’Islam d’aujourd’hui et qui hélas pour le monde, bénéficient des financement gigantesques que permettent l’exploitation des hydrocarbures . C’est elles qui sont à l’œuvre et qui exercent un pouvoir d’attraction et d’influence sur de nombreuses personnes en quête de sens et d’identité.
Il existe toujours des esprits épris de spiritualité, comme par exemple Ghaleb Bencheikh qui anime l’émission de France Culture « Questions d’Islam ».
Dans son émission du 3 septembre 2023 <Enquête historique sur les origines de l’islam> il avait invité l’islamologue Michel Orcel auteur du livre « Naissance de l’islam – Enquête historique sur les origines ».
Dans cette émission Michel Orcel qui est chrétien, a dit toute son admiration de cette civilisation et a rappelé des faits historiques que certains anti-musulmans tentaient de falsifier ou nier.
Mais il a fini l’émission en fustigeant la dérive sectaire des wahhabites qui est ce mouvement fondamentaliste créé par Mohammed ben Abdelwahhab (1703-1792) et qui a fait alliance avec la dynastie de Ibn Saoud pour imposer une religion figée dans les normes supposées de l’origine dans l’Arabie qui est devenue saoudite. Cette secte s’inscrit plus généralement dans un mouvement salafiste dépassant les frontières de l’Arabie et qui prône de la même manière « un retour aux pratiques en vigueur dans la communauté musulmane du prophète Mahomet et ses premiers successeurs ou califes ».
Et c’est en Égypte, qu’en 1928 a été créée par Hassan el-Banna, « les Frères musulmans » qui poursuivent les mêmes buts mais qui, en outre, souhaitent disposer du pouvoir politique et temporel. Cette particularité les oppose aux wahhabites qui ont accepté de laisser ce pouvoir à la dynastie Ibn Saoud pour conserver ce qui est essentiel pour eux le pouvoir absolu sur la société et les règles familiales et civiles. En Égypte, le maréchal Sissi et l’armée au pouvoir, ont d’excellents rapports avec le mouvement salafiste égyptien mais combattent et oppriment les frères musulmans qui veulent les chasser du pouvoir.
C’est cette organisation qui œuvre en occident et particulièrement en France que dénonce Florence Bergeaud-Blackler dans son livre : « Le frérisme et ses réseaux. L’enquête ».
Parce que s’il y a indiscutablement une demande identitaire chez les musulmans de France, les mouvements fréristes sont à l’œuvre pour d’abord convaincre le plus de de musulmans possibles de suivre leur vision de l’islam et parallèlement de rendre la société française « charia-compatible » comme l’appelle Florence Bergeaud-Blackler.
C’est un combat qui vise à évacuer le blasphème et toute atteinte à la religion en France, à imposer des modes vestimentaires spécifiques qui distinguent les musulmans et d’influer sur, ce qui est essentiel pour eux, l’éducation nationale et l’Université. Un combat qui s’inscrit dans la durée et vise à faire évoluer le récit historique notamment à l’égard de la shoah et de l’enseignement du fait religieux, à interdire ou restreindre l’éducation sexuelle, à créer des quartiers dans lesquels la place publique est uniquement occupée par des hommes etc.
Et ça marche : il n’y a plus de caricature, toute critique et même toute description du phénomène est immédiatement condamnée comme un acte « islamophobe ». Les enseignants ne peuvent plus librement enseigner la shoah, sans parler de l’ensemble des tentatives de faire rentrer les signes religieux dans les cours de l’École.
Dans les rues de nos villes, le nombre de femmes qui portent le voile ou d’autre tenues plus couvrantes encore est en augmentation constante.
Ce qui est arrivé à Samuel Paty et surtout le manque de soutien avant l’assassinant montre que l’administration n’a pas défendu nos valeurs.
Alors qu’il s’agit d’un combat de gauche c’est-à-dire défendre la liberté de croyance et de spiritualité et refuser toute atteinte à l’universalisme par des organisations communautaristes, ennemis de la liberté individuelle, toute une partie de la gauche par intérêt électoral, par aveuglement ou par facilité soutiennent ces mouvements séparatistes.
Et puis, dès que quelqu’un essaye d’expliquer cela, il est ostracisé par toute une partie de cette intelligentsia islamo-gauchiste et menacé de mort. C’est incroyable la rapidité avec laquelle des menaces de mort fleurissent, dès qu’il est question d’islamisme. C’est le cas pour Florence Bergeaud-Blackler qui vit désormais sous protection policière.
Elle était l’invitée de Léa Salamé, le 23 mai 2023. Lors de cet entretien elle a déclaré :
« Je n’ai pas reçu des menaces de mort immédiatement, j’ai d’abord reçu des intimidations à l’intérieur de l’université, des proches des milieux fréristes qui ont commencé à faire circuler des calomnies à mon égard. […] Ensuite, j’ai reçu un certain nombre de menaces qui viennent de France et de l’étranger, qui ont abouti notamment à l’arrestation d’un personnage qui est maintenant écroué »
Elle dit aussi :
« Ça fait 30 ans que j’ai vu évoluer l’islamisme, que je dis qu’il y a un problème, et de plus en plus j’ai vu ma parole réduite, parce que ces milieux étant infiltrés, je suis devenue une cible »
Dans un premier temps sa conférence sur le sujet du livre qui devait se tenir à la Sorbonne le 12 mai a été suspendue puis a été renvoyée à une date ultérieure pour des « raisons de sécurité » par la doyenne de la Faculté de Lettres de la Sorbonne.
Cette conférence a finalement pu avoir lieu le 2 juin.
« Le Figaro » décrit le contexte de cette conférence :
« Le dispositif de sécurité déployé entre l’entrée du 46 rue Saint-Jacques et l’amphithéâtre où la conférence va débuter en dit long sur la nervosité qui accompagne l’événement. Pour pénétrer dans les bâtiments historiques de la Sorbonne, chaque participant doit émarger sur la liste des participants sous le regard sévère de trois agents de sécurité de l’Université, flanqués de deux autres agents de sécurité d’une agence privée. Une fois dans le hall, on vide ses poches avant de passer au détecteur de métaux, comme à l’aéroport. En haut des marches qui mènent à l’amphithéâtre Michelet où le public se rassemble, nouveau contrôle au détecteur de métaux. Sécurité oblige. »
 La sortie de l’anthropologue à la fin de son intervention est dans le même esprit :
La sortie de l’anthropologue à la fin de son intervention est dans le même esprit :
« La scène finale de cette soirée n’en reste pas moins éloquente, sur la vie qu’une chercheuse qui travaille sur de tels sujets est condamnée à mener. Attendue par plusieurs journalistes devant le 46 rue Saint-Jacques, Florence Bergeaud-Blackler a finalement quitté les lieux par une autre sortie, « pour des raisons de sécurité », explique Pierre-Henri Tavoillot. »
Il y a ceux qui insultent et menacent et puis il y a ceux qui prétendent argumenter : ainsi l’avocat et essayiste Rafik Chekkat qui publie sur « Orient XXI » cet article : « Islamophobie. Le complotisme d’atmosphère de Florence Bergeaud-Blackler » qui débute ainsi
« Le spectre des Frères musulmans hante l’Europe. Administrations, entreprises, partis, associations, écoles, centres de soins, syndicats…, la menace de leurs réseaux tentaculaires serait partout. Tel est le point de départ de l’argumentation que déroule Florence Bergeaud-Blackler. Une vision paranoïaque au service d’un traitement policier du fait musulman en France et en Europe.
« Tout vient du Juif, tout revient au Juif. Il y a là une véritable conquête, une mise à la glèbe de toute une nation par une minorité infime, mais cohésive […] ». Au fil de la lecture de Le frérisme et ses réseaux, la référence au pamphlet antisémite d’Édouard Drumont, La France juive (1885), dont sont extraites ces lignes, s’imposent de manière troublante.
Et pour cause, Florence Bergeaud-Blackler partage avec Drumont une intention, une forme, et une méthode : dénouer dans la société l’élément « frériste » — qui était naguère l’élément juif. Tous deux racontent l’histoire de la France sur le mode tragique
Tous deux relèvent la difficulté de la tâche : l’œuvre du « frériste » est toujours cachée, il est malaisé de déterminer précisément où elle commence et où elle finit (p. 68). « Tout d’abord, écrit quant à lui Drumont, l’œuvre latente du Juif est très difficile à analyser, il y a là toute une action souterraine, dont il est presque impossible de saisir le fil ». En somme, un grand complot contre la civilisation occidentale.
À l’instar d’un Drumont, qui a voulu de son propre aveu décrire la « conquête juive », Bergeaud-Blackler se propose d’étudier la « conquête islamique », dont la visée n’est autre que « l’instauration d’une société islamique mondiale ». À chacun son ennemi mortel »
Pour cet avocat le point godwin ne se situe pas au niveau de Hitler et des nazis, mais en amont dans l’écrivain antisémite Édouard Drumont, (1844 -1917) auteur de la France Juive.
Avec cette accusation qui vise à faire taire tout esprit qui interroge l’action d’organisation islamiste en France : l’islamophobie.
J’avais posé cette question « Qui est islamophobe ? » dans un mot du jour écrit après l’assassinat de Samuel Paty.
Plus le temps passe, plus l’utilisation de ce mot me semble problématique et porteur d’une profonde confusion.
C’est un mot dont la vocation est de faire taire et de stigmatiser.
Il est beaucoup utilisé par des gens et des médias qui se réclament de la gauche.
« Libération » écrit un article remettant en cause le sérieux du travail de Florence Bergeaud-Blackler : <Menaces et tensions autour d’un livre sur le «frérisme» musulman>. Florence Bergeaux-Blacker <a répondu longuement à l’article de Libe>.
Selon l’outil de recherche de « L’OBS », cet hebdomadaire n’a pas évoqué le livre de l’anthropologue ni des menaces qui lui ont été adressés.
« MEDIAPART » a attendu le 9 juillet pour publier un article à charge :
« Invitée dans tous les médias depuis trois mois, la chercheuse, qui dénonce un projet mondial d’infiltration des Frères musulmans, est sévèrement jugée par nombre de ses collègues, qui critiquent ses méthodes considérées plus militantes que scientifiques. Son entourage sulfureux interroge également. »
«L’entourage sulfureux» est probablement « Le Printemps Républicain » fondé par le regretté Laurent Bouvet, qui n’est certainement pas exempt de critiques mais qui par rapport à cet assaut d’archaïsme des fondamentalistes musulmans présente l’immense qualité d’être une force de gauche qui s’oppose à ces manœuvres.
Sur un des blogs de Mediapart, un ex collègue au CNRS de Bergeaud-Blacker : <François Burgat> l’accuse de « d’anti-islamisme primaire » et s’attaque à tous ses soutiens : Gilles Kepel, Pierre-André Taguieff, Caroline Fourest, Bernard Rougier l’auteur du livre « Les Territoires conquis de l’islamisme » en les mettant dans le même camp que Marine Le Pen et Eric Zemmour. Il montre que, pour lui, toute personne qui interroge les réseaux d’influence des frères musulmans en France ne peut être qu’un fasciste !
La philosophe et islamologue Razika Adnani, lui répond dans « Marianne ». : <L’islamisation de l’Occident, les islamistes n’ont jamais caché leur intention>.
Bien sûr, de même qu’il existe un fondamentalisme musulman, il en existe un chrétien et un juif. Ils sont tout aussi condamnables. Mais force est de constater, qu’en France, ce sont les réseaux fréristes qui sont les plus visibles.
Nous ne devons pas être naïfs et empêcher ces fanatiques d’agir pour faire évoluer notre société vers une formidable régression. Nous devons accueillir et respecter la spiritualité. Mais parallèlement nous devons être sans faiblesse devant les religions et les contraindre à respecter les Lois de la République et le socle des valeurs fondamentales sur lesquelles s’appuient notre société :
- L’égalité entre les femmes et les hommes, aucune contrainte ne saurait être imposée à un genre et non à l’autre.
- Le droit absolu de changer de religion ou de quitter sa religion pour aucune autre.
- La modestie et l’humilité devant les consensus scientifiques et la recherche historique.
<1763>
-
Vendredi 15 septembre 2023
« Je n’ai absolument rien fait de cette journée […] et je me suis découvert heureux, comblé. »Christian BobinChristian Bobin est mort un mois après mon frère (à un jour près) : le 23 novembre 2022, lui aussi d’un cancer fulgurant.
Depuis j’ai beaucoup lu Bobin.
Bobin n’est pas l’écrivain de longs textes, de grandes arches littéraires.
Il est l’écrivain des miniatures, des fulgurances.
Il a été confronté avec la mort, tout au long de sa vie.
En 1995, il a perdu brutalement, son amie de cœur Ghislaine Marion, d’une mort prématurée.
Il écrira pour la célébrer, en 1996, « La plus que vive », ouvrage que j’ai lu d’une traite, une nuit d’insomnie de décembre.
L’ouvrage suivant sera en 1997 « Autoportrait au radiateur »
De ce livre, je partage ce texte :
« Je n’ai absolument rien fait de cette journée,
qu’ouvrir au matin les fenêtres de la cuisine et de la chambre,
laisser les nuages entrer dans l’appartement,
frotter leur silence régnant dans ces pièces,
Oui, voilà ce que j’ai fait de ma journée,
j’ai ouvert mes fenêtres sur le jour, rien d’autre,
et dans ce rien beaucoup de choses se préparaient
dont je saurai plus tard le nom, beaucoup plus tard.
Au soir, parce que les nuages avaient repris leur errance
et que le froid s’invitait sans façon, j’ai refermé les fenêtres, il était huit heures.
De la cuisine, j’ai vu un moineau se poser sur le sapin.
La branche a tremblé sous la maladresse de son atterrissage.
Dans ce mouvement communiqué à l’immense par presque rien,
j’ai reconnu l’image de ma journée
et je me suis découvert heureux, comblé. »
Autoportrait au radiateur
Lundi 30 septembre
Christian Bobin
<1762>
-
Vendredi 8 septembre 2023
« Le secteur du vin est-il intouchable ? »Jean-Marie LeymarieJean-Marie Leymarie a posé cette question : <La République est-elle alcoolique ? > dans sa chronique sur France Culture du Vendredi 1 septembre 2023 :
« Le secteur du vin est-il intouchable ? Finalement, le gouvernement n’augmentera pas les taxes sur l’alcool. Cet été, pourtant, il l’a envisagé, pour faire entrer de l’argent dans les caisses, et pour faire baisser la consommation d’alcool. Le secteur viticole a protesté. Bercy et le ministère de la santé ont discuté. Et la première ministre a tranché. Elisabeth Borne l’a annoncé elle-même : pas question de relever les impôts sur l’alcool.
Le vin est beaucoup moins taxé que le tabac. »
Sur le site de l’OFT , organisme public qui a pour dénomination complète : L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, on peut lire :
« En 2019, le coût social du tabac et de l’alcool est respectivement de 156 et 102 milliards d’euros, et de 7,7 milliards d’euros pour les drogues illicites. […]. Cette nouvelle estimation confirme que le coût social des drogues reste très supérieur aux recettes fiscales induites. »
Cette évaluation montre que l’alcool n’est pas significativement moins couteux pour la société que le tabac. L’utilisation du mot « drogue » dans l’expression « coût social des drogues » concerne les 3 produits tabac, alcool et drogues illicites.
Et ce n’est pas le site gouvernemental <santé.gouv.fr> qui contredira ce constat :
« La consommation d’alcool représente un enjeu de santé publique majeur en France, où elle est à l’origine de 49 000 décès par an. Il en est de même en Europe, où elle est responsable de plus de 7 % des maladies et décès prématurés. Au niveau mondial, l’alcool est considéré comme le troisième facteur de risque de morbidité, après l’hypertension artérielle et le tabac. La consommation d’alcool provoque des dommages importants sur la santé. Elle peut agir sur le « capital santé » des buveurs tout au long de la vie, depuis le stade embryonnaire jusqu’au grand âge.
[…] Au-delà d’une certaine consommation (2 verres par jour pour les femmes et 3 verres par jour pour les hommes), l’alcool est un facteur de risque majeur pour :
– certains cancers : bouche, gorge, œsophage, colon-rectum, sein chez la femme.
Pour l’OMS, l’alcool est classé comme une molécule cancérigène avérée depuis 1988.
– certaines maladies chroniques : maladies du foie (cirrhose) et du pancréas, troubles cardiovasculaires, hypertension artérielle, maladies du système nerveux et troubles psychiques (anxiété, dépression, troubles du comportement), démence précoce, etc. »
Cette surconsommation d’alcool présente aussi un coût supplémentaire pour les hôpitaux :
« Le coût estimé des hospitalisations liées à la consommation excessive d’alcool s’élève à près de 3,6% de l’ensemble des dépenses hospitalières en 2012 (BEH 2015).
Le coût de ces séjours hospitaliers est estimé à 2,64 milliards d’euros.
Les conséquences de la consommation excessive d’alcool sont l’un des tous premiers motifs d’hospitalisation en France. »
Alors pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de renoncer à augmenter les taxes sur l’alcool ?
 Jean-Marie Leymarie explique :
Jean-Marie Leymarie explique :
« La raison en est simple : la France reste un immense producteur, et le secteur connaît des difficultés. Une révolution, même. Prenez le Bordelais, le premier vignoble français, en appellation d’origine contrôlé. Il subit à la fois la surproduction, la baisse de la consommation, les conséquences de la crise climatique, et cette année, de surcroît, une redoutable attaque de mildiou.
Dans ces conditions, fallait-il augmenter les taxes ? Le nouveau ministre des Comptes publics n’a pas hésité. Entre deux récoltes – le raisin et les impôts – Thomas Cazenave a choisi : solidarité avec les viticulteurs ! Il les connaît bien. Juste avant d’entrer au gouvernement, il était député… de Gironde.
Regardez les débats sur l’alcool, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Depuis des dizaines d’années, des parlementaires défendent la production et l’image du vin. Peu importe qu’ils soient de gauche ou de droite, ils ont un point commun : ils viennent de régions viticoles. Une vieille expression, péjorative, les qualifiait de députés « pinardiers ». Le poids politique du secteur reste fort, comme son pouvoir d’influence, aussi. En 2017, quand Emmanuel Macron compose son cabinet, à l’Elysée, qui choisit-il pour suivre les sujets agricoles ? Audrey Bourolleau, déléguée générale de Vin et société, le principal lobby viticole français. »
C’est encore sur le site de l’OFT qu’on peut savoir que le vin représente 54 % des quantités totales d’alcool pur mises en vente (contre 23 % pour la bière et 21 % pour les spiritueux). Rapportées à la population âgée de 15 ans ou plus, les quantités totales d’alcool pur vendues en 2021 représentent en moyenne l’équivalent de 2,3 verres standards de boissons alcoolisées quotidiens par personne (un verre standard contenant 10 g d’alcool pur).
Il faut cependant constater que l’évolution de la consommation va dans le bons sens. Par rapport au début des années 1960, la consommation de boissons alcoolisées (en équivalent alcool pur) a été réduite de plus de moitié en France, cette diminution étant essentiellement imputable à la baisse de la consommation de vin.
Mais au niveau mondial le site <Geo> nous apprend que ce sont nettement les européens qui sont les plus grands consommateurs d’alcool :
« L’Europe arrive en tête pour la consommation d’alcool par habitant, huit des 10 pays ayant la plus forte consommation d’alcool par habitant à travers le monde se trouvent en effet en Europe. »
Et si on veut faire un classement par pays la première place est disputée par la République Tchèque, la Lettonie et la Moldavie, selon le sites l’ordre change mais ces trois pays se trouvent toujours sur le podium. Par exemple sur ce <site>
Il me semble aussi important de mettre fin à un mythe : « Non, boire un verre de vin par jour n’est pas bon pour la santé »
Jean-Marie Leymarie conclut :
« Une taxation plus forte changerait-elle la donne ? Pas sûr. Mais nous pouvons au moins, collectivement, poser la question. Ne pas évacuer le sujet, au nom de la tradition ou de l’économie. […].. Vous vous souvenez de Claude Evin, l’ancien ministre de la santé, l’auteur de la fameuse loi Evin, sur le tabac et sur l’alcool ? Aujourd’hui, encore, il explique qu’il comprend l’importance du secteur viticole. Mais rappelle que la politique consiste à « arbitrer entre des intérêts contradictoires ». Faire des choix. Tout mettre sur la table. La bouteille – ça peut être agréable ! – et ses conséquences. »
<1761>
-
Mardi 5 septembre 2023
« Garder la part d’humanité, d’humanisation de la relation d’une personne à une autre, et ne pas se laisser envahir par le numérique. »Daniel CohenAujourd’hui, je partage avec vous une courte vidéo que Daniel Cohen a réalisé en 2019 pour l’Obs : <Quand Daniel Cohen nous parlait de l’avenir du travail : « Il faut absolument garder la part d’humanité »>
Daniel Cohen fait la distinction entre « deux révolutions » successives.
La première, celle de l’ordinateur de bureau et d’internet, a permis de « réorganiser à l’échelle planétaire le fonctionnement des entreprises », transformant l’ensemble des travailleurs en « sous-traitants » qui se concurrencent à l’échelle mondiale.
Selon lui, cette révolution montre ses limites et arrive un peu à son terme.
La seconde révolution évoquée par l’économiste est celle de l’intelligence artificielle.
C’est cette seconde partie qui m’a marqué.
Je vous en livre la retranscription intégrale :
« La révolution qui commence aujourd’hui est d’une toute autre nature. C’est celle de l’intelligence artificielle.
Il est évidemment beaucoup trop tôt pour savoir exactement ce qu’elle va produire mais on peut essayer d’en définir la portée.
La portée, je crois tout simplement, c’est que nous sommes dans une société de services.
Dans laquelle ce qui compte c’est s’occuper des gens eux-mêmes, et non plus seulement comme dans la société industrielle de la matière.
S’occuper des gens, ça veut dire passer du temps avec eux, ça veut dire en réalité augmenter les coûts.
Ça veut dire « perdre son temps » à passer du temps avec les gens.
Cette idée est inconcevable dans un capitalisme comme celui que l’on connaît maintenant, qui cherche par définition à rentabiliser, réduire les coûts de fabrication.
La solution que le capitalisme contemporain est en train de trouver à cette société de service où les coûts sont trop élevés, c’est tout simplement celle qui consiste à numériser, dématérialiser tout ce qui peut l’être, de façon qu’un humain, une fois qu’il sera une immense banque de données qui pourra être traitée par un algorithme et redevienne un objet de croissance, c’est-à-dire de rentabilité.
Évidemment cette perspective est celle d’une extraordinaire déshumanisation de la relation d’une personne à une autre, d’un médecin avec son patient, d’un enseignant à son élève.
Une déshumanisation qui nous rappelle tout simplement ce que, dans « les Temps modernes », Charlie Chaplin avait parfaitement illustré pour la société industrielle.
Nous sommes en train, en réalité, d’industrialiser la société de services et c’est ça qui m’inquiète beaucoup.
Il faut absolument, comme on l’a rappelé au moment du travail à la chaîne, garder la part d’humanité, d’humanisation de la relation d’une personne à une autre, et ne pas se laisser envahir par le numérique. »
Ce que Daniel Cohen dit c’est que ce qui est en cause c’est la rentabilité, l’objet de croissance.
Il parle des services à la personne.
Cela remet complément en cause le modèle économique dominant.
Il me semble d’ailleurs qu’il en va de même pour freiner le réchauffement climatique, comme les atteintes à la biodiversité et la prise en compte des limites des ressources planétaires.
Quel modèle économique, pourra réaliser ces idées humanistes, voilà la question ?
<1760>
-
Vendredi 1er septembre 2023
« [Daniel Cohen] restera à jamais mon interlocuteur imaginaire, celui qui m’aide à penser hors des clous. »Esther Duflo, Prix Nobel d’Économie de 2019 parlant de son « mentor » Daniel CohenDaniel Cohen est mort le dimanche 20 août, à l’âge de 70 ans, à l’hôpital Necker, à Paris.
Il était gravement malade depuis plusieurs mois.
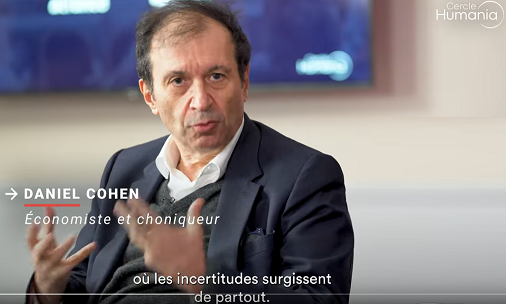 Selon mes recherches, la dernière vidéo que j’ai trouvée de lui sur internet date du 24 janvier 2023. Il était l’invité du Cercle Humania qui est un groupe qui réunit des Directeurs des Ressources Humaines. Nous pouvons écouter <son introduction> dans laquelle il dit les choses suivantes
Selon mes recherches, la dernière vidéo que j’ai trouvée de lui sur internet date du 24 janvier 2023. Il était l’invité du Cercle Humania qui est un groupe qui réunit des Directeurs des Ressources Humaines. Nous pouvons écouter <son introduction> dans laquelle il dit les choses suivantes
« On est dans une période où les incertitudes surgissent de partout. Incertitudes économiques, inflation, les taux d’intérêt, la récession […] géopolitique, la guerre en Ukraine, la Chine qui sort d’une crise tumultueuse, les Etats-Unis qui ont une crise spécifique, ce qu’on a appelé la grande démission. […]
Le point important c’est ce que disait Jérôme Fourquet, auteur magnifique d’un très beau livre, l’Archipel français et d’autres, qui expliquait […] que les Français hésitent entre la colère et la résignation. On a ces deux sentiments, alors parfois pour des groupes sociaux différents, mais souvent dans une même personne.
La colère contre une situation qui au fond, ne permet plus de comprendre ce qu’on fait, où on va.
L’inflation est un facteur d’anxiété. Ce n’est pas exactement la même chose de perdre son pouvoir d’achat, en le sachant. Voilà, je vous le réduis, ça ne fait pas plaisir mais au fond, on sait ce qui nous attend.
Alors que l’inflation, même si ça produit la même chose, ajoute une couche d’anxiété, parce qu’on voit quelque chose, ça coûte plus cher d’acheter des fruits frais, mais on ne sait pas quand ça va se terminer.
Donc tout ça génère de la colère, de ne pas être en contrôle de sa vie […] et puis de la résignation, parce qu’en effet l’avalanche de toutes ces crises fait qu’on n’arrive même pas à les hiérarchiser soi-même dans sa propre vie.
Et donc, il y a une espèce de laisser-aller de démotivation. C’est ce que disait aussi Jérôme Fourquet. Une grande partie des Français, 35-40%, dans ses statistiques, qui sont démotivés, qui n’arrivent plus à trouver le jus pour repartir le matin à la charge. […]
La recherche d’une maîtrise de ce qu’on veut faire, […] Il y a une demande à la fois de reconnaissance de ce qu’on fait, c’est une des plaintes des Français dans les enquêtes. Ils disent j’adore mon travail, mais personne ne se rend compte de ce que je fais, je ne suis pas suffisamment reconnu, quand j’ai des idées on ne les écoute pas. Donc ça, ce sont des problèmes très importants pour les membres de votre groupe : comprendre les aspirations des gens. »
Et il dit encore cela du télétravail :
« C’est la grande rupture qu’a apporté de manière tout à fait imprévue le Covid. On a découvert qu’on pouvait télétravailler. En 2019 personne n’aurait imaginé qu’une telle exigence sociale puisse se faire jour avec des technologies qu’on connaissait déjà [depuis assez longtemps]. Il n’y a pas eu de rupture technologique. […] Mais on n’avait pas l’idée que ça puisse devenir un instrument de travail et ça l’est devenu avec le Covid. Et c’est devenu une revendication très importante pour beaucoup de gens. Et les entreprises qui ne sont pas capable de proposer du télétravail […] ont du mal à recruter. […]
Le télétravail c’est un médicament et un poison à la fin. C’est un médicament parce que oui vous le savez que vous êtes chez vous. On contrôle, très bien.
Et puis, c’est un poison parce que le rapport au collectif, à vos collègues [est appauvri].
On est dans cette ambivalence, dans cette incertitude sur l’effet net qui va s’imposer dans les deux ou trois prochaines années. On sait qu’on est dans des sociétés de plus en plus, non seulement individualistes mais individualisantes. Et le télétravail est une couche de plus dans cette évolution. Avec beaucoup de difficultés pour comprendre ce que cela va produire au bout du compte pour les collectifs eux-mêmes et pour les individus. »
Dans cet ultime entretien, Daniel Cohen se révèle tel qu’en lui-même : un économiste qui d’abord s’intéresse à l’humain, au destin, aux aspirations, aux sentiments et au difficultés des êtres humains.
Il partageait cette qualité avec l’inoubliable Bernard Maris mort dans le carnage de Charlie Hebdo.
Et puis, c’était un formidable pédagogue.
C’est le premier mot qu’a utilisé Thomas Piketty pour lui porter hommage « un pédagogue incroyable »
Le Point parle d’un « Immense économiste et pédagogue hors pair » :
Pascal Riché dans un article de l’Obs « Eblouissant Daniel Cohen » cite cet épisode de sa vie :
« Un jour, pendant ses premiers mois à l’ENS, il expliquait une équation quand une étudiante lui a lancé : « Et en langue vernaculaire, ça donne quoi ? » « Cela, nous avait-il raconté, m’a glacé… Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas enseigner comme ça. » S’éloignant de la froideur des pures mathématiques, il a commencé à parler à ses étudiants de la vraie vie. Comme il l’a fait dans ses livres. « Avec Daniel, derrière chaque équation, il y avait une histoire, nous avait raconté Julia Cagé, prof à Sciences-Po. C’était un cours énergique, qui avait de la vie… On débattait, on avait l’impression de tout comprendre. »
Lorsque Esther Duflo a reçu le prix Nobel en 2019, je me souviens de son émotion. Ce jour-là, il n’y avait pas homme plus heureux. »
Esther Duflo fut, en effet, son élève et lui a rendu le plus bel hommage : « Sans Daniel Cohen, je ne serais pas ce que je suis » :
« Toute vie est faite d’accidents et de rencontres fortuites, et il peut être difficile d’attribuer son parcours à telle ou telle personne. Mais mon cas est plus simple. Sans Daniel Cohen, je ne serais pas ce que je suis : je n’aurais pas la même profession, je ne vivrais pas où je vis, je n’aurais pas la même famille.
C’est grâce à Daniel que je suis devenue économiste. C’est grâce à lui que je le suis restée, après un démarrage un peu désastreux. C’est grâce à lui que je suis l’économiste que je suis. Je lui dois ma vie telle qu’elle est aujourd’hui. C’est aussi simple que cela. Et mon parcours, il me semble, illustre bien les qualités uniques de Daniel. »
[…]
Pendant trente ans, je n’ai jamais interrompu ce dialogue […] avec Daniel Cohen. A chacun de mes passages à Paris nous déjeunions ensemble pour le reprendre en personne. Je prenais soin de réserver tout l’après-midi car ces déjeuners pouvaient durer. Nous parlions de politique, d’économie, de ses projets et des miens. Je n’ai jamais cessé de le vouvoyer, et lui non plus, mais je me sentais extrêmement proche de lui. Je sais que c’était le cas pour beaucoup, car tel était le don incomparable de Daniel : une chaleur humaine telle que tous ceux qui le côtoyaient se sentaient immédiatement ses amis.
Il n’est plus là pour me faire rire de lui-même, comme il aimait à le faire, mais il restera à jamais mon interlocuteur imaginaire, celui qui m’aide à penser hors des clous. »
Elle parlera encore de lui dans l’émission de <Thinkerview du 31/08/2023> à laquelle elle a participé et dans lequel elle le nomme « son mentor ».
C’est avec Daniel Cohen que j’ai réalisé ma première série de mots du jour (5) : « Daniel Cohen – homo œconomicus et la stagnation séculaire ».
J’ai aussi fait appel à lui deux fois pendant la période aigüe du Covid :
Le 8 avril 2020 : « La crise du coronavirus signale l’accélération d’un nouveau capitalisme, le capitalisme numérique »
Le 30 juin 2020 : « Toute la panoplie des instruments que la doxa libérale a longtemps décriée doit continuer à être mobilisée pour lutter contre la crise.»
Un intellectuel remarquable qui va manquer dans le débat d’Idées.
<1759>
-
Jeudi 24 août 2023
« L’histoire de l’humanité, individuelle et collective, n’est qu’une longue succession de schismes et de ruptures. »Douglas Kennedy dans « Et c’est ainsi que nous vivrons »« Et c’est ainsi que nous vivrons » de Douglas Kennedy, dans sa traduction de Chloé Royer est paru le 1er juin 2023.
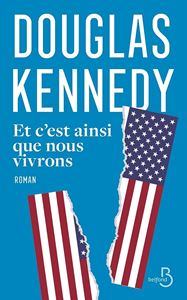 Lorsque j’ai entendu son interview sur France Culture, dans l’émission « Bienvenue au club » : <Il y a deux Amériques et on se déteste> j’ai décidé de l’acheter.
Lorsque j’ai entendu son interview sur France Culture, dans l’émission « Bienvenue au club » : <Il y a deux Amériques et on se déteste> j’ai décidé de l’acheter.
Et lorsque j’ai entrepris de débuter sa lecture, je l’ai lu d’une seule traite.
Ce n’est pas un livre de science-fiction mais un livre d’anticipation.
Le roman déroule un thriller en son sein, mais ce n’est pas cet aspect du livre qui est le plus intéressant.
Ce qui est passionnant c’est l’arrière-plan : la société et les Etats dans lequel l’intrigue se développe.
Nous sommes en 2045, « les États désunis » ont remplacé « les Etats-Unis » qui n’existent plus suite à une guerre de sécession version 2.0.
D’un côté, il y a les États qui avaient voté massivement Trump qui sont devenus « La Confédération Unie ». C’est une théocratie totalitaire dirigée par un collège de « douze apôtres ».
Le divorce, l’avortement et le changement de sexe sont interdits, les valeurs chrétiennes font loi. Et celles et ceux qui remettent en cause le récit religieux ou les valeurs sont éliminés avec la cruauté dont les religions ont le secret quand par malheur on a la mauvaise idée de leur laisser le pouvoir temporel en plus de l’influence spirituelle.
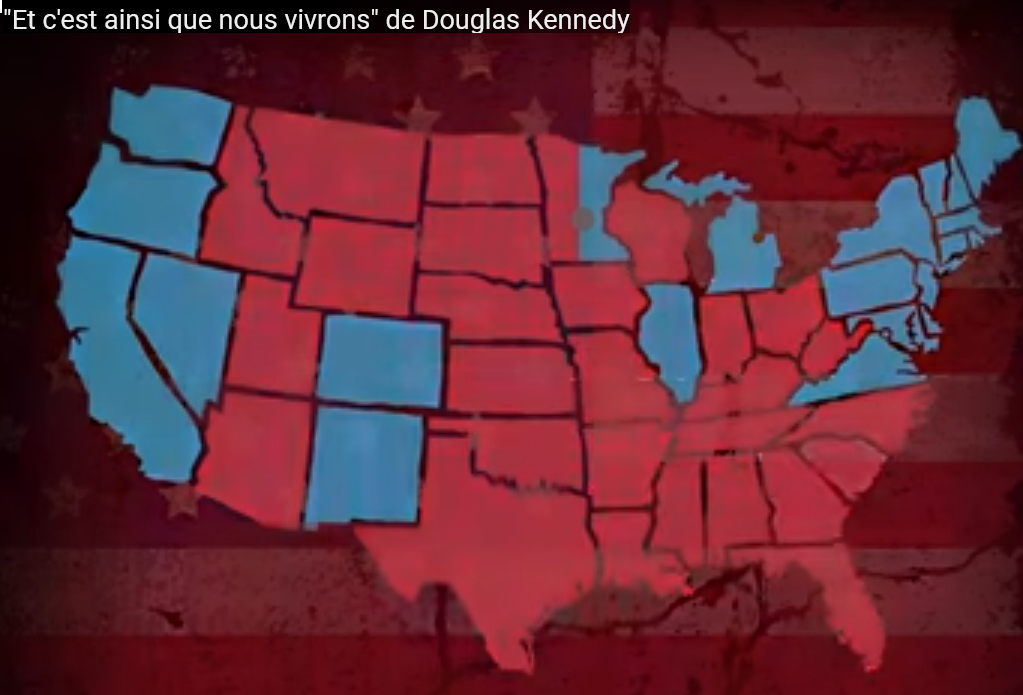 De l’autre côté « La République Unie » regroupe les États démocrates, progressistes dans le sens du transhumanisme et du wokisme. Chez ces gens-là, les individus sont sous surveillance, ultra-connectés. Tout le monde est doté obligatoirement d’une puce dans le corps qui donne des informations, sert de GPS et accompagne la vie de chacun dans son quotidien en même temps qu’elle surveille son comportement. Sous couvert de sécurité, la paranoïa règne. L’ennemi dont on s’est séparé justifie tous les excès.
De l’autre côté « La République Unie » regroupe les États démocrates, progressistes dans le sens du transhumanisme et du wokisme. Chez ces gens-là, les individus sont sous surveillance, ultra-connectés. Tout le monde est doté obligatoirement d’une puce dans le corps qui donne des informations, sert de GPS et accompagne la vie de chacun dans son quotidien en même temps qu’elle surveille son comportement. Sous couvert de sécurité, la paranoïa règne. L’ennemi dont on s’est séparé justifie tous les excès.
Ce roman constitue un prolongement des États-Unis actuels qui se désagrègent en deux camps hostiles qui ne s’écoutent plus, ne se parlent plus, s’invectivent en s’accusant mutuellement des mêmes déviations : complotisme, fraude et valeurs morales indignes. Ce pays qui jadis était considéré comme le pays de la liberté, se caractérise aujourd’hui par la remise en cause des droits fondamentaux.
La lecture des premières pages m’a immédiatement fait penser à une scène qui m’avait marqué lors de ma lecture, il y a 45 ans, des « Colonnes du ciel » de Bernard Clavel.
« Les colonnes du ciel » sont une série de cinq romans de Bernard Clavel qui se passent en Franche-Comté pendant la guerre de Dix Ans, au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII.
Guerre de pillages et de massacres qui a été aggravée encore par l’apparition d’une terrible peste.
Dans le troisième volume, « La Femme de guerre », Hortense d’Eternoz et son grand amour le docteur Alexandre Blondel se dévouent pour les enfants, victimes innocentes de la guerre. Ils en ont sauvé tant qu’ils ont pu mais, au terme de leur voyage, le docteur va mourir et Hortense par colère et vengeance va devenir la femme de guerre. Avec une petite armée qu’elle a levée, elle se jette avec toute sa hargne dans cette guerre.
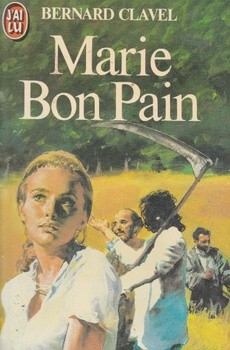 Dans le quatrième volume « Marie Bon Pain » la terrible guerre de dix ans s’est achevée en 1644. Toute la petite communauté, Marie bon pain, Pierre, Bisontin et les autres peuvent enfin regagner leur pays, se réinstaller à La Vieille-Loye dans la forêt de Chaux près de la ville de Dole. Ils retrouvent leurs grands arbres avec leur fût rectiligne qu’ils appellent les colonnes du ciel. Ils ont retroussé leurs manches et relevé les ruines du village, construisant de nouvelles maisons, réapprenant à vivre dans la paix retrouvée. Mais un jour, Hortense d’Eternoz, la femme de guerre, revient. Elle est accusée de sorcellerie et va être condamnée au bûcher.
Dans le quatrième volume « Marie Bon Pain » la terrible guerre de dix ans s’est achevée en 1644. Toute la petite communauté, Marie bon pain, Pierre, Bisontin et les autres peuvent enfin regagner leur pays, se réinstaller à La Vieille-Loye dans la forêt de Chaux près de la ville de Dole. Ils retrouvent leurs grands arbres avec leur fût rectiligne qu’ils appellent les colonnes du ciel. Ils ont retroussé leurs manches et relevé les ruines du village, construisant de nouvelles maisons, réapprenant à vivre dans la paix retrouvée. Mais un jour, Hortense d’Eternoz, la femme de guerre, revient. Elle est accusée de sorcellerie et va être condamnée au bûcher.
Bernard Clavel décrit ainsi un bucher en 1644 :
« Hortense monte. Lentement, mais sans qu’on ait besoin ni de la forcer, ni de la soutenir. Le prêtre lui présente la croix. Il semble qu’elle hésite puis elle finit par y poser ses lèvres. […]
En quatre pas, Hortense est au poteau. Elle se détourne et d’elle-même, appuie son dos contre le bois. Le silence s’est reformé. On dirait que, jusqu’à la poterne de la cité, jusque par-delà le Doubs, par-delà les fossés et les murailles d’enceinte, le peuple et les choses retiennent leur souffle.
Hortense en profite.
D’une voix qui ne tremble pas, d’une voix qui semble s’en aller chercher l’écho des quatre points cardinaux, elle crie :
« Regardez bien bruler ma robe, ils l’ont trempée dans le soufre pour que la comédie soit jouée jusqu’au bout ! »
Les bourreaux se sont précipités. L’un passe une chaine autour de sa taille et l’autre une corde de chanvre à son cou.
Elle veut crier encore mais sa voix s’étrangle. Son visage se contracte, il semble que ses veines se gonflent à sa gorge et à ses tempes que ses yeux agrandis vont jaillir des orbites.
Derrière elle, l’homme en rouge tourne un levier de bois contre le poteau. […]
Le prêtre et les hommes rouges descendent de l’échafaud.
Alors tout va très vite. Dix aides au moins de mettent à lancer les fagots sur les planches, tout autour d’Hortense dont le corps secoué semble vivre encore. […]
Les flammes montent de tout côté en même temps. […] Les flammes sont si hautes qu’elles cachent Hortense dont la robe claire n’apparait que par instants.
Et puis soudain, Marie sursaute. Une immense flamme bleue vient de naître d’un coup au centre du brasier.
Un grand cri monte de la foule.
La voix terrible de Bisontin gronde :
-Le soufre…le soufre de la robe. »
Page 154 à 156 de « Marie Bon Pain » dans la version en livre de poche collection « J’ai Lu » des éditions Flammarion
Dans le livre de Douglas Kennedy, nous sommes au XXIème siècle. Il commence ainsi :
« Nous sommes le 6 août. Dans le grand pays qui faisait autrefois partie du nôtre, ils s’apprêtent à brûler mon amie sur un bûcher.
Elle s’appelle Maxime. Elle travaille pour moi, en quelque sorte, et nous nous sommes rapprochées au fil des années, bien que, dans mon secteur, une telle camaraderie soit considérée comme peu professionnelle. La raison de son exécution : elle a osé plaisanter en public au sujet du Christ.
Quelques pages plus loin, la narratrice et héros du livre Samantha Stengel va avec ses compagnons suivre sur un écran, nous sommes au XXIème siècle, l’exécution de Maxime :
Sur l’écran, des cris et des huées commencent à s’élever du public, signe que Maxime est en route pour le bûcher. Effectivement, une brigade de types musclés en uniforme traverse la foule au pas de l’oie. Parmi eux, je distingue la silhouette de Maxime ; […] La brume dans le regard de Maxime ne laisse planer aucun doute : si ses geôliers sont obligés de la maintenir aussi fermement, ce n’est pas parce qu’elle se débat, mais parce qu’elle a été droguée. Cette femme infatigablement subversive et désopilante, qui n’a jamais reculé devant les vérités qui dérangent, qui m’a un jour déclaré que j’avais « vraiment besoin de tomber amoureuse », et peu importait que ma vocation l’interdise, avance mollement vers sa mort sous l’emprise d’un sédatif.
[…]
— Ça ne m’étonne pas qu’ils l’aient assommée de tranquillisants avant de l’exhiber devant tout ce monde, fait remarquer Breimer, acide. Ils avaient sûrement peur qu’elle se paie leur tête jusqu’au bout. »
Maxime parvient au lieu de l’exécution. Son escorte se referme autour d’elle, la dérobant entièrement aux regards. Peu après, un ordre indistinct retentit et les soldats se mettent au garde-à-vous avant d’effectuer un demi-tour parfaitement synchronisé et de s’éloigner en cadence, laissant Maxime enchaînée à un poteau au centre de la place, seule en terrain découvert. Des écrans stratégiquement disposés autour de la foule offrent aux spectateurs même les plus éloignés une vue parfaite de la scène, sur laquelle entre soudain un homme en soutane blanche, qui s’avance vers Maxime, micro en main. Il se présente comme le révérend Lewis Jones, venu « offrir à cette créature déchue et condamnée le plus précieux des cadeaux, la vie éternelle, si elle accepte à présent Jésus comme son Seigneur et son Sauveur ».
[…]
« Avant l’accomplissement de ta sentence, veux-tu te prosterner devant le Tout-Puissant et accepter Jésus en ton cœur ? »
Silence. Maxime ne réagit pas, tête baissée, le regard aussi opaque qu’un lac en plein hiver.
Avec la dose de cheval qu’ils lui ont visiblement administrée, son absence de réponse n’a rien d’étonnant. Mais le révérend Jones secoue tout de même la tête avec une affliction théâtrale – et savamment calculée – avant de se retirer.
Aussitôt, quatre gardes apparaissent, le visage dissimulé par des casques intégraux, vêtus de combinaisons de protection et armés de tuyaux métalliques reliés aux bonbonnes qu’ils portent sur le dos. Ils s’immobilisent face à Maxime. Un de leurs supérieurs lance un ordre et ils lèvent tous leur tuyau d’un même mouvement pour le pointer vers Maxime. Un nouvel ordre retentit, et un geyser de liquide clair déferle sur la malheureuse. J’échange un regard avec Breimer. On s’est renseignés ensemble sur le cas précédent d’exécution publique par le feu en CU : d’après nos analystes, le produit qu’ils viennent d’utiliser serait un composé chimique hautement inflammable, au point qu’il embrase tout à la moindre étincelle. Étrangement, je ressens un certain soulagement à les regarder asperger Maxime de cette substance dangereuse. L’un de nos experts-chimistes a été formel : au moindre contact avec une flamme, la mort est instantanée. Je craignais que, juste pour pousser l’atrocité au maximum et pour la punir d’être transgenre, ils ne décident de lui infliger une exécution à l’ancienne, lente, de type Jeanne d’Arc. À cet instant, je sais que Breimer pense à la même chose que moi. Voilà bien un minuscule geste d’humanité dans cette surenchère de barbarie.
Les quatre soldats pivotent sur leurs talons et s’éloignent. Un long silence impatient s’abat sur la foule.
Dans son micro, le révérend Jones commence le compte à rebours. « Cinq, quatre, trois, deux… »
On ne l’entend pas prononcer le « un ». Un souffle d’incendie, suivi d’une détonation sèche, couvre sa voix amplifiée par les haut-parleurs alors qu’un cercle tracé à l’avance autour de la suppliciée prend feu. Maxime est avalée par une déferlante de flammes. Disparue en fumée. Il ne reste plus à sa place qu’une énorme boule de feu.
« Ça suffit », déclare Fleck.
L’écran s’éteint. »
Pages 22 à 24 de « Et c’est ainsi que nous vivrons »
Il me semblait pertinent de rapprocher ces deux exécutions, l’une il y a presque 400 ans et l’autre imaginée par l’auteur dans le futur dans un peu plus de 20 ans.
Woody Allen disait : « Je n’ai pas de problème avec Dieu, c’est son fan club qui me fout les jetons »
Si la spiritualité constitue un supplément d’âme pour l’être humain, les religions fondamentalistes avec le but de contraindre et de soumettre la société sont des monstres.
Il en existe toujours dans le monde, aujourd’hui.
Et nous occidentaux ne sommes pas à l’abri que demain une telle calamité nous rattrape, si nous ne savons pas mâter et faire reculer les forces régressives à l’œuvre dans toutes les religions. Ces ennemis de la liberté qui profitent de nos libertés pour progresser et faire avancer insidieusement leurs valeurs et leurs récits dans nos sociétés.
Dans « Lire » magazine littéraire de juin 2023, Douglas Kennedy disait :
« Quand j’étais à la fac, ma spécialité, c’était l’histoire américaine. Déjà, à l’époque, un des sujets qui me passionnait, c’était le puritanisme aux États-Unis, un pays qui est en fait né d’une expérience religieuse. Les puritains qui ont fondé les premières colonies étaient des sortes de talibans. »
En face de ce régime théocratique assassin se dresse la République Unie qui est la conjonction de la pensée transhumaniste de la Silicon Valley et d’un courant socialiste et wokiste qui est tout aussi terrifiant dans son organisation et son contrôle de la société.
Dans la même revue l’auteur explique :
« En fait, la République unie est un système autoritaire light, doté d’un président très malin, qui a décidé qu’il allait séduire des gens comme vous et moi en mettant l’accent sur l’éducation, la culture, le rétablissement de belles architectures. J’ai trouvé ça intéressant. Notamment, parce qu’on peut imaginer les conversations chez ceux qui le subissent : « OK, ce n’est pas idéal, mais c’est toujours mieux qu’en face. » »
Geneviève Simon écrit sur le site de la « Libre Belgique » : « Un roman mordant qui déroule un scénario plausible ».
Denis Cosnard écrit sur le site « Le Monde » un article « …prophète de malheur » dans lequel il juge aussi que « L’écrivain prédit la dislocation des États-Unis dans une dystopie vraisemblable et caustique ».
A la fin de l’ouvrage, Douglas Kennedy finit, comme le faisait La Fontaine dans ses fables, par la morale de cette histoire :
« A l’image des cellules biologiques qui nous composent, il est dans notre nature de nous diviser. L’histoire de l’humanité, individuelle et collective, n’est qu’une longue succession de schismes et de ruptures. Nous brisons nos familles, nos couples. Nous brisons nos nations. Et nous rejetons la faute les uns sur les autres. C’est un besoin inhérent à la condition humaine : celui de trouver un ennemi proche de nous afin de l’exclure en prétextant ne pas avoir le choix. Vivre, c’est diviser. »
Et c’est ainsi que nous vivrons, page 332
<1758>
-
Vendredi 18 août 2023
« Écouter c’est la fermer ! »Thomas d’AnsembourgJ’avais évoqué, lors du mot du jour précédent, l’importance dans les relations de la qualité de l’écoute.
Je voudrais revenir sur ce sujet si important grâce à une vidéo de Thomas d’Ansembourg : <Savons-nous écouter ? >
J’ai déjà évoqué Thomas d’Ansembourg lors de plusieurs mots du jour. Le plus récent étant celui du 27 mars 2023 : « Personne n’a envie d’être un con-vaincu. »
Thomas d’Ansembourg est un psychothérapeute belge spécialisé dans la communication non-violente.
Il fait d’abord un constat :
« C’est quelque chose qui m’impressionne depuis que j’enseigne la Communication Non Violente : c’est combien les gens ne s’écoutent pas. Ils se fourguent des conseils, des solutions, des commentaires et ils ne s’écoutent pas et ça fait souffrir beaucoup d’êtres. Énormément. »
Et pour donner un exemple, il évoque des parents qui sont venus le consulter parce qu’ils avaient des difficultés de compréhension avec leur garçon :
« Et ils arrivent, les deux parents, le garçon. Et les parents me racontent toutes leurs attentes et leurs misères à communiquer avec le garçon et à un moment, après les avoir écoutés je me tourne vers le garçon et je dis : « Et toi comment tu te sens quand tu entends tes parents te dire ça ? et il me répond du tac au tac : « Mais je suis extrêmement en colère parce que mes parents, là vous les avez écoutés, mais eux ils ne m’écoutent jamais. »
Et la mère saute sur ses deux pieds en disant : « Comment on ne t’écoute jamais, mais on passe son temps à t’écouter ! » »
Après cette entrée en matière, Thomas d’Ansembourg intervient pour montrer la cohérence entre les propos du garçon et la réaction de sa mère.
« Et je dis : « Stop madame pourriez-vous faire un petit arrêt sur image, votre enfant dit que vous ne l’écoutez jamais, donc ça veut dire qu’il ne se sent pas écouté et vous montrez que vous ne l’écoutez pas. Vous argumentez pour avoir raison : « mais si je t’écoute, mais je t’ai déjà écouté. » Vous n’écoutez pas le fait que lui ne se sent pas écouté. Et bien sûr que c’est dérangeant d’entendre son enfant, qu’on a cru écouter, dire : « je ne me sens pas écouté. ». Mais s’il dit qu’il n’est pas écouté, c’est qu’il ne se sent pas écouté.
Et je me retourne vers le garçon et je lui dis : « Que veux-tu dire par-là, quand tu dis que tes parents ne t’écoutent jamais ? Apparemment ils ont l’impression de t’écouter ».
Et bien je vais vous le dire clairement, il ne me laisse jamais finir mes phrases. »
Poser les mots sur un problème permet de le comprendre avant d’essayer de le résoudre :
« Et je me retourne vers la mère, je dis : « Est-ce que ça vous parle ? ». Et elle reconnaît, la larme à l’œil « effectivement, j’ai du mal à le laisser aller jusqu’au bout. Souvent, je pense que j’ai la solution, que c’est moi qui comprends comment ça doit se passer.
Je dis « bah voilà ! Apprenez juste à écouter. »
« Et ceci m’a éclairé, cette maman ne savait pas écouter ce qui est une chose. Mais quand on ne sait pas écouter, on peut apprendre à écouter, mais ce qui est plus grave encore, et cette maman illustre un problème qui nous touche pratiquement tous et toutes, cette maman ne savait pas qu’elle ne savait pas écouter !
Je ne sais pas ce que je ne sais pas, comment voulez-vous que je m’améliore ?
Et ça c’est un enjeu fondamental. »
L’ignorance est un manque de connaissance. Mais connaître ou être conscient de son ignorance constitue un savoir.
Connaître ses faiblesses est aussi un savoir qui permet soit de les prendre en compte, soit de les surmonter.
Ce qui est grave comme le dit Thomas d’Ansembourg, c’est ignorer sa faiblesse.
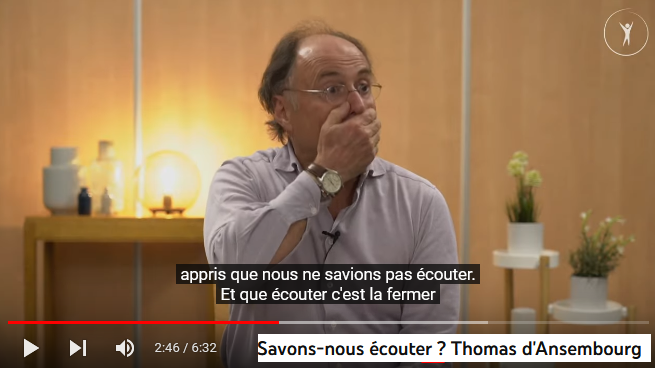 A ce stade, il explique ce que signifie, selon lui, écouter :
A ce stade, il explique ce que signifie, selon lui, écouter :
« Écouter c’est la fermer et laisser l’autre arriver au bout de sa phrase.
Et éventuellement ajouter à ça un reflet ou même une formulation empathique pour s’assurer qu’on a bien compris l’autre. »
Et puis, il ajoute ce point fondamental du dialogue : être en capacité de comprendre l’autre en l’écoutant pleinement ne signifie qu’on lui donne raison, simplement qu’on le prend en compte. Et cela change tout :
« Et écouter l’autre ça ne veut pas dire qu’on est d’accord.
Et être en empathie avec l’autre, refléter ce que l’autre ressent, ça ne veut pas dire qu’on souscrit à son besoin. Ça veut simplement dire qu’on reconnaît que cet être humain, il est là. Et quand l’autre être humain se sent reconnu et le droit d’exister […] et bien il nous reconnaît, il nous donne le droit d’exister aussi. C’est un échange »
L’exemple qu’il a donné était dans un contexte familial, mais cela dépasse ce cadre pour concerner de la même manière le monde professionnel, comme l’ensemble des relations de toute sorte qu’on peut nouer dans une vie :
« Et je peux témoigner que dans l’entreprise quand j’anime des sessions de Communication Non violente c’est le même écho des équipes qui me retournent : tu nous a appris que nous ne savions pas écouter. Je pense à des équipes de Conseil, de conseil en informatique qui arrivent avec leurs solutions mais ils n’écoutent pas les vrais enjeux. Et donc ça dysfonctionne. Ils pensent qu’ils n’ont pas le temps, comme dans les familles ils n’ont pas le temps, alors que le temps consacré à bien écouter fait que le résultat s’ajuste. […] Je vous encourage à mettre ça en pratique, voir que quand vous avez créé du nous, par une belle et bonne écoute, même si vous n’êtes pas d’accord avec l’autre ce nous est fécond. On va trouver des solutions qui nous arrange de façon gagnant/gagnant, plutôt que des solutions qui sont dans la domination, soumission, agression, démission. »
Je vous invite d’écouter ce message dans la fluidité du remarquable pédagogue qu’est Thomas d’Ansembourg : <Savons-nous écouter ? Thomas d’Ansembourg>
Il me semble qu’il révèle quelque chose d’essentiel.
Mon expérience me donne à penser qu’il a absolument raison.
Je plaide coupable, je n’ai pas toujours su être au niveau de cette exigence.
Mais chaque fois que j’ai pu ou su être dans cette qualité d’écoute, le résultat a toujours été extrêmement valorisant. Et cela même si je n’étais pas d’accord avec mon interlocuteur.
<1757>
-
Vendredi 11 août 2023
« Charlotte et moi. »Olivier ClertAujourd’hui, je vais parler d’une bande dessinée en trois tomes que je viens de lire : « Charlotte et moi »
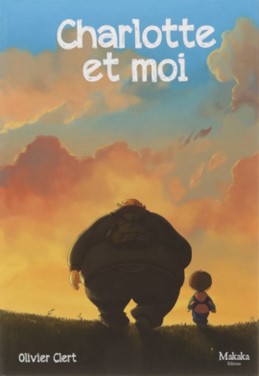 C’est une Bd plutôt de jeunesse, mais qui peut se lire à tout âge.
C’est une Bd plutôt de jeunesse, mais qui peut se lire à tout âge.
Les éditions « Makaka » qui publient ce livre écrivent malicieusement qu’elle est à destination de lecteurs de « 10 à 109 ans ».
J’aurais dû lire ces 3 livres depuis longtemps, puisque le tome 1 est paru en novembre 2016 et que le tome 3 a été publié en septembre 2018.
Pourquoi aurais-je du lire ces 3 livres depuis plusieurs années ? C’est ce que je vais narrer dans la suite de ce mot du jour.
Mais je voudrais d’abord dire que j’ai été conquis par cette BD pleine de sensibilité, d’humanité et aussi de rebondissements qui rendent sa lecture à la fois agréable et pleine d’intérêt jusqu’au bout de l’Histoire.
Son auteur qui a écrit le texte et dessiné les personnages présente cette histoire dans <Ouest France> de la manière suivante :
« [C’est l’histoire] d’un petit garçon, Gus, dont les parents divorcent. Il part vivre avec sa mère dans un petit immeuble de province. Il n’a pas envie. C’est juste avant la rentrée des classes et il s’ennuie. Il se met à observer les habitants de son immeuble. En particulier Charlotte, une grosse bonne femme timide qui ne parle pas, lui fait un peu peur et sur laquelle ragotent les gens du village. Il l’espionne. Cette BD, c’est l’histoire de Gus, de Charlotte et des gens de leur immeuble. Avec un effet domino : les actions des uns ont des conséquences sur la vie des autres. »
En faisant une recherche sur le site des bibliothèques de Lyon j’ai pu constater que les 3 Tomes étaient présents dans 10 des 16 établissements de la ville et que 5 de ces 10 exemplaires sont empruntés actuellement.
Cela donne la double preuve que les administrateurs de la bibliothèque de Lyon ont beaucoup aimé la série et que les abonnés de la bibliothèque l’apprécient toujours, 5 ans après sa sortie.
Sur ce <Site> j’ai trouvé cet avis qui fait écho avec ce que j’ai ressenti à la lecture de ces pages qui racontent une histoire de quête :
« Cette bande dessinée en 3 tomes est une merveille de tendresse, d’humour et d’aventures. […] La rencontre entre ces deux êtres sera pourtant le point de départ d’une aventure extraordinairement émouvante, autour d’une quête commune : celle des origines. Leur amitié se construira peu à peu, nous donnant l’envie de croiser le chemin d’une Charlotte et d’un Gus, un jour ou l’autre… Mention spéciale pour le dessin, la colorisation et le fourmillement de petits détails auxquels prêter attention, notamment au niveau des transitions entre les scènes.
Ode au vivre-ensemble et à la lutte contre les préjugés, voici une BD à mettre entre toutes les mains. »
Mais l’histoire que je veux partager et qui s’entremêle avec celle de Gus et de Charlotte a commencé au milieu des années 1990.
Je travaillais alors dans l’administration centrale d’une Direction qui n’existe plus depuis 2008 et qui était la Direction Générale des Impôts. Mon bureau était situé au cinquième étage, du bâtiment Turgot, celui qui était le plus loin des bureaux des Ministres et le plus proche de la gare de Lyon.
Mon bureau était juste à côté des ascenseurs, facilement accessible et ma porte était toujours ouverte.
Ce devait être en avril ou mai, nous étions à la fin de la journée, André est venu me rendre visite après une réunion à laquelle je n’avais pas assisté. Pendant notre discussion qui fut assez longue dans mon souvenir, le soleil s’était couché lentement, les fenêtres étaient orientées sud-ouest.
La lumière chaude nous enveloppait et rendait ce moment inoubliable, c’est pourquoi son souvenir ne m’a pas abandonné.
André était mon ainé de douze ans. Le travail commun nous avait rapproché, il y avait de l’affection parce que nous nous reconnaissions mutuellement la capacité de nous écouter, la volonté de nous comprendre et d’aboutir à une solution qui nous convenait à tous les deux et que nous pourrions défendre devant notre hiérarchie. Il était responsable d’une équipe d’informaticiens et moi je représentais la maîtrise d’ouvrage qui écrivait les cahiers des charges et exerçait la recette des applications c’est-à-dire leur réception et leur test.
La confiance et surtout l’écoute de l’autre permet de passer à un autre niveau de dialogue, plus engageant et qui touche davantage l’intime.
Nous parlions de nos enfants, mais les miens étaient encore dans leurs toutes premières années.
André Clert était particulièrement préoccupé par son fils qui était dans l’année de son baccalauréat et qui ne travaillait pas assez pour la réussite de cet examen selon les critères de son père. Il me disait et je sentais une angoisse dans sa voix :
« Tu comprends Alain, il trouve beaucoup plus important de dessiner toute la journée. Il s’est pris de passion pour les dessins animés et la bande dessinée. J’essaie de lui expliquer de travailler pour son Bac et puis de dessiner après. »
Et il a ajouté cette phrase qui m’est resté :
« Nos enfants et nous les parents n’avons décidément pas les mêmes priorités ! »
Après mon départ de Paris pour Lyon et même après sa retraite nous avons continué à échanger par courriel.
Et puis le 21 novembre 2016, j’ai reçu, avec d’autres, un message provenant de l’adresse courriel d’André, mais ce n’était pas lui qui écrivait :
« C’est avec une immense tristesse que je vous annonce le décès brutal d’André survenu samedi soir dans un restaurant de Toulouse où nous étions pour quelques jours.
Un séjour pour circuler dans Toulouse où il a fait ses études et qu’il aimait beaucoup, et aussi pour aller à un festival de bandes dessinées où notre fils Olivier dédicaçait sa bande dessinée qui vient d’être publiée (il en était heureux et fier).
Nous avions passé une merveilleuse journée…
Malgré une retraite pleine d’occupations, il ne vous a pas oubliés et nous gardons un excellent souvenir de nos années parmi vous. »
André est donc décédé le 19 novembre 2016, le Tome 1 de « Charlotte et moi » était paru exactement le 4 novembre 2016.
Le tome 2 paru en avril 2018, porte cette simple dédicace : « Pour mon père »
Dans l’article d’Ouest France déjà cité, Olivier Clert expliquait en 2017 les différentes facettes de son activité professionnelle :
« J’ai 36 ans et je vis à Paris. J’ai toujours dessiné. Après le lycée, j’ai fait une fac d’arts plastiques et préparé le concours de l’école des Gobelins. Je me suis formé au film d’animation, notamment en participant à un court-métrage collectif de fin d’études, Blind Spot. Je me suis occupé de l’histoire et de la mise en scène. J’ai ensuite travaillé comme animateur sur plusieurs longs-métrages comme Un monstre à Paris […]
Être storyboarder, c’est travailler sur le script des réalisateurs et en faire une BD du film. »
Et il raconte comment est né la BD :
« J’ai eu une fenêtre entre deux projets d’animation. J’ai commencé Charlotte et moi, puis je l’ai proposée à des éditeurs.
[… J’ai des idées de BD mais très vagues : il faut que je plonge dedans. En dessin animé, je travaille sur Klaus (paru en 2019). Faire un film, c’est très long : environ cinq ans. On est nombreux à travailler : cela permet à la fois une émulation intéressante, c’est pour ça qu’il y a souvent beaucoup de gags et de trouvailles visuelles, mais ça peut aussi être très laborieux car on est beaucoup. Alors que quand on fait une BD, on est seul, on dessine et ça peut aller vite. C’est la façon la plus simple de raconter une histoire. Ça tombe bien, c’est mon métier ! »
 Gus et Charlotte qui ont vécu beaucoup d’aventures ensemble, vont se quitter, avant la fin du Tome 3 parce que Charlotte va continuer sa quête seule, loin de France.
Gus et Charlotte qui ont vécu beaucoup d’aventures ensemble, vont se quitter, avant la fin du Tome 3 parce que Charlotte va continuer sa quête seule, loin de France.
La manière dont Olivier Clert dessine cet instant me fait revenir en mémoire la parole d’Eleanor Roosevelt l’épouse du Président Franklin D. Roosevelt :
« The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
– L’avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. »
<1756>
-
Mardi 1er août 2023
« C’est vrai que cette histoire manque de chameaux »Alice Zeniter dans « L’art de Perdre » page 336 en conclusion du résumé que fait Hamid de l’histoire de sa famille classée dans les HarkisParfois, on croise un livre sans le rencontrer.
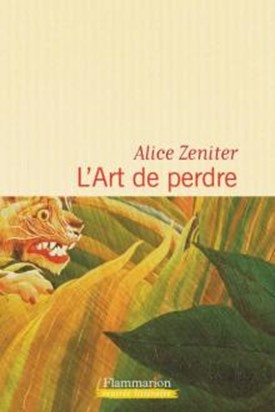 Il en fut ainsi, pour moi, pour « l’Art de perdre » d’Alice Zeniter.
Il en fut ainsi, pour moi, pour « l’Art de perdre » d’Alice Zeniter.
J’en avais entendu parler, lors de plusieurs interviews de l’autrice, dès la sortie du roman en 2017. D’abord, alors qu’elle était invitée sur France Inter <le 25 aout 2017>, puis par une émission de France Culture du 9 septembre 2017 <Je voulais combler les silences de mon histoire>
En écoutant, Alice Zeniter j’avais l’intuition qu’il s’agissait d’un livre à lire pour mieux comprendre la guerre d’Algérie, celle des vainqueurs et celle des vaincus, la guerre et ses conséquences.
Mais la rencontre n’a pas eu lieu en 2017 ou 2018.
Plus tard, j’avais vu le livre posé sur une table chez Marianne, je l’avais remarqué mais je suis passé à côté.
Après les émeutes qui ont frappé la France, j’ai retrouvé un long article de « Libération » que j’avais soigneusement découpé et classé dans une chemise : <Enfant j’ignorais pourquoi on n’allait pas en Algérie>.
En le relisant, j’ai eu l’intuition que le temps était vraiment venu de lire ce livre.
Et deux jours après, dans la maison de Joyce et Patrick, je suis, à nouveau, tombé sur ce roman dont je me suis, cette fois, emparé et que j’ai lu d’une traite.
L’art de perdre est l’histoire d’une famille entre l’Algérie et la France sur trois générations :
- Ali, le grand-père, venu des montagnes kabyles dans lesquelles il menait une vie plutôt aisée, étant riche relativement à la population locale. Cet homme est tombé du côté harki pendant la guerre et dû fuir l’Algérie, en 1962, lors de l’indépendance.
- Hamid, son fils qui était trop jeune pour comprendre ce qui s’était passé avant 1962 et qui a vécu sa vie en France, algérien pour les français, harki pour les algériens. Il a épousé Clarisse, française n’ayant rien à voir avec les évènements d’Algérie.
- Naïma, une des filles d’Hamid et de Clarisse, narratrice de cette Histoire.
Alice Zeniter s’est inspirée de son histoire personnelle, dans la réalité elle occupe la place de Naïma. Mais elle savait si peu de chose, sa famille était taiseuse sur ce passé algérien et les débuts français. Alors, elle a beaucoup lu, rencontré des historiens pour arriver à écrire son roman qui est une vérité possible et qui surtout montre la complexité des choix et des destins.
 Alice Zeniter parle d’un destin de « harki », c’est-à-dire un algérien qui a choisi le camp des français contre celui du FLN.
Alice Zeniter parle d’un destin de « harki », c’est-à-dire un algérien qui a choisi le camp des français contre celui du FLN.
Dans l’article de Libération elle montre l’absurdité de désigner avec ce nom toute une famille dont le père a fait un choix qui n’était pas celui de l’Histoire.
« Je me souviens d’avoir cherché dans le dictionnaire ce soir-là, je pense que les explications de mes parents devaient avoir été trop peu claires, et d’avoir trouvé dans le Larousse la définition qui est : harki, membre d’une harka, supplétif indigène travaillant pour l’armée française. Et, en deuxième entrée : qualifie les enfants et petits-enfants de harkis. Cela m’a paru extrêmement détestable, l’idée que ce nom que je ne connaissais pas quelques minutes avant était censé pouvoir me qualifier aussi. C’est quelque chose qui n’a toujours aucun sens pour moi aujourd’hui, et c’est ce que je dis dans la deuxième partie du livre. Déjà, le terme n’est pas juste, on devrait parler d’ex-harkis, d’anciens supplétifs. Quand les mecs arrêtent d’être soldats, eh bien ils ne sont plus soldats. Et puis je ne vois pas pourquoi ça qualifierait la famille et la descendance, c’est une aberration. Ni pourquoi cela qualifie des gens qui n’ont jamais fait partie des harkas et des contingents de l’armée française, et qu’on a juste considérés comme étant pro-Français. Ce terme est extrêmement mal utilisé. Et quand, en plus, on sait qu’il est devenu pour beaucoup une insulte… »
Pourquoi devient-on harki ?
La réponse à cette question Alice Zeniter ne l’a pas trouvé dans sa famille.
Dans le roman, elle tente d’expliquer ce silence, ce tabou pour Naïma.
Le fils Hamid tente d’arracher une explication à son père Ali :
«- Est-ce qu’on t’a forcé ? demande t-il ?
– Forcé à quoi ?
– A collaborer avec les français ? Est-ce qu’ils t’ont enrôlé de force ?
Il n’a pas le vocabulaire suffisant en arabe pour mener une conversation politique et il parsème ses questions de français.
– Ils t’ont menacé ? »
Page 269
Mais aucune réponse de son père ne sera donnée, juste de la colère et cette sentence murmurée :
« Tu ne comprends rien, tu ne comprendras jamais rien »
C’était inexplicable et plus encore inracontable.
Alors Alice Zeniter invente, c’est la force et la liberté du roman.
Quand les premiers soulèvements ont eu lieu, c’était l’œuvre du MNA, le Mouvement national algérien de Messali Hadj. Le grand père Ali n’en veut pas parce qu’il le soupçonne de vouloir l’arabisation à outrance, et qu’en tant que Kabyle il tient à son identité. Il ne faudrait jamais oublié qu’avant la colonisation française de l’Algérie, il y eut la colonisation de la Kabylie par les arabes.
Après le FLN écarta le MNA et Messali Hadj de manière sanglante et violente et ce fut le FLN qui porta le combat de l’indépendance.
Alice Zeniter fait dire à Ali qu’il est pour l’indépendance mais pas celui du FLN.
Les partisans du FLN prétendent que pour chasser le colonisateur il n’y avait pas d’autres choix que celui d’une violence et d’une cruauté extrême, non seulement tournées vers les colons mais aussi vers les algériens qu’ils considéraient comme trop tièdes.
Ali les considérait comme des bandits, des « mafieux » même si ce mot n’est jamais utilisé.
D’ailleurs, la suite après l’indépendance lui donnera raison, les dirigeants du FLN ont mis leur pays en coupe réglée et sont arrivés de faire de leur pays riche en minerai et pétrole, un pays de pauvres dans lequel seule une nomenklatura est très riche.
C’est après le massacre indigne et cruel par le FLN, d’un vieux combattant de 14-18 qui avait refusé de renoncer à la pension de guerre que lui versait la France, qu’Ali bascule et demande l’aide de l’armée française pour le protéger ainsi que sa famille.
Il franchit ce pas parce qu’il est révolté par l’assassinat de son ami et aussi parce qu’il a peur parce que lui aussi est ancien combattant mais de la guerre 39-45.
Et par ce geste, il se place malgré son désir d’indépendance, dans un camp et non dans l’autre dont il juge les méthodes et le comportement inacceptables.
Il ne peut pas l’expliquer à son fils, juste lancer ce qui peut être vu comme une plainte : « tu ne comprendras jamais rien. »
Et le fils, Hamid, devant ce mur se réfugie aussi dans le silence.
Quand sa future femme, essaye d’obtenir quelques lueurs sur cette histoire, il répondra toujours par une ellipse en évoquant l’idée qu’elle espère une histoire de chameaux qui n’existe pas
Un jour pourtant et une seule fois dans le roman, sa future épouse parvient à l’obliger à un résumé pathétique et sans concession de la part d’histoire que connait Hamid.
La femme de sa vie, Clarisse, le menace de le quitter s’il ne parle pas de ses origines, alors il dit cela :
« On est arrivés en France quand j’étais encore gamin, dit Hamid.
On était dans un camp, on était derrière des barbelés, comme des bêtes nuisibles.
Je ne sais plus combien de temps ça a duré. C’était le royaume de la boue.
Mes parents ont dit merci.
Et puis après, ils nous ont foutus dans la forêt, au milieu de nulle part, tout près du soleil. c’est là qu’il y avait les chenilles.
Mes parents ont dit merci.
Ensuite, ils nous ont envoyé dans une cité HLM de Basse-Normandie, dans une ville ou avant nous, je ne crois pas que qui que ce soit ait jamais vu un arabe.
Mes parents ont dit merci.
C’est là qu’ils sont encore.
Mon père bossait, ma mère faisait des gosses, et je pourrais te dire comme tous les gars du quartier que je les aime et que je les respecte parce qu’ils nous ont tout donné mais je ne crois pas que ce soit honnête, j’ai détesté qu’il me donne tout et qu’eux arrêtent de vivre.
Je me suis senti étouffé, ça me rendait fou. »
Page 336
Clarisse conclura cette confession par :
« C’est vrai que cette histoire manque de chameaux »
J’ai trouvé cette formule, dans sa simplicité, si juste pour tenter d’approcher cette histoire de violence, de trahison, d’humiliation, de colonisation, de mépris.
Dans ce court résumé Hamid évoque d’abord <le camp de Rivesaltes>
Les harkis n’ont plus de pays quand ils arrivent en France, en 1962. La France les accueille comme des parias. Le camp de Rivesaltes ce sont des barbelés, des tentes, des conditions de vie épouvantables, l’impossibilité de circuler.
Il évoque ensuite <Le camp de Jouques appelé aussi la cité du Logis d’Anne>
Et puis il y a le racisme aveugle, forcément débile et toujours présent :
« Un jour, en cours d’anglais [lors d’un exercice] le professeur laisse échapper :
« Ecoute, Pierre, si Hamid peut le faire, tu dois en être capable aussi ! »
« Qu’est-ce que ça veut dire ? demande Hamid.
La question a passé ses lèvres sous le coup de la surprise plus que de la colère. Il ne voulait pas la poser à voix haute mais au silence qui la suit et aux yeux écarquillés de ses camarades, il comprend qu’elle est trop énorme pour qu’il puisse la faire oublier.[…] Hamid se lance à la poursuite de sa première question :
« Que ce qu’un Arabe peut faire, il est évident que c’est à la portée des Français ? Que si je peux le faire avec mon cerveau sous-développé d’Africain, l’Homme Blanc peut le faire mieux que moi ? C’est ça que vous vouliez dire ?
Devant ce manque de respect, le professeur oublie sa gêne et s’exclame :
« Bon, c’est bon, ça suffit comme ça. Tais-toi maintenant !
– Vous êtes raciste, dit Hamid le plus calmement qu’il peut mais sa voix tremble de colère et de peurs mêlées »
Page 265 et 266
D’autres élèves prendront le parti d’Hamid, mais le professeur aura le dernier mot et ce sera Hamid et ses camarades qui seront collés pour « conduite scandaleuse ».
Hamid s’était emmuré dans le silence pour son histoire algérienne mais aussi pour son service militaire
« En janvier 1974, à la fin du service militaire de Hamid – Une autre période de sa vie dont il ne parlera pas, des mois de silence à peine troués par des mots « racisme », « cachot », « officier de service », « tour de garde » et « dortoir ».
Page 328 :
Son père Ali a aussi affronté cette haine raciste au quotidien.
Dans le camp de Jouques, il a le droit de sortir contrairement à Rivesaltes. Un jour pour se donner du courage il va dans un bar pour commander une bière, le tenancier refuse de le servir, l’insulte avec des propos racistes et lui demande de sortir du bar.
Ali refuse alors le propriétaire appelle la gendarmerie. Quand le gendarme se rend compte qu’il a partagé avec Ali le même lieu de bataille à savoir Monte Cassino, il oblige le barman à leur servir à tous les deux de la bière. Après une longue discussion, le gendarme et Ali se séparent, mais Ali ne retournera jamais dans ce bar, l’humiliation est trop dure à supporter même si son immense taille plus de deux mètres lui permettrait d’avoir le dessus physiquement mais il pressent qu’il n’aurait pas le dernier mot.
Dans ce livre j’ai appris une collection de mots de la haine avec lesquelles les « bons français » insultaient les algériens : « crouille, bicot, l’arbi, fatma, moukère, raton, melon, mohamed, tronc-de-figuier, fellouze…. (p. 313)
Et puis ce roman parle aussi de notre présent, en le reliant au passé. Alice Zeniter se sert de Naïma pour faire ce lien. Elle évoque les attentats du 13 novembre 2015 :
« Le soir du 13 novembre, Naïma est au cinéma.
Elle regarde le dernier James Bond, ce qui lui apparaîtra rétrospectivement comme un choix légèreté presque obscène.
Un de ces anciens collègues, du temps de la revue culturelle, meurt au Bataclan. elle l’apprend au petit matin et s’effondre sur le carrelage froid de la cuisine. (…)
Elle pleure sa mort, tout en se reprochant son égoïsme, elle pleure sur elle-même, ou plutôt sur la place qu’elle croyait s’être construite durablement dans la société française et que les terroristes viennent de mettre à bas, dans un fracas que relaye tous les médias du pays.
« Naïvement, elle pense que les coupables des attentats ne réalisent pas à quel point ils rendent la vie impossible à toute une partie de la population française – cette minorité floue dont Sarkozy a dit à la fin du mois de mars 2012 qu’elle était musulmane d’apparence.
Elle leur en veut de prétendre la libérer alors qu’ils contribuent à son oppression.
Elle repère ainsi un schéma historique de mésinterprétation, amorcé soixante plus tôt par son grand-père. Au début de la guerre d’Algérie, Ali n’avait pas compris le plan des indépendantistes : il voyait les répressions de l’armée française comme des conséquences terribles auxquelles le FLN, dans son aveuglement, n’avait pas pensé.
Il n’a jamais imaginé que les stratèges de la libération les avaient prévues, et même espérées, en sachant que celles-ci rendraient la présence française odieuse aux yeux de la population.
Les têtes pensantes ‘Al-Qaïda ou de Daech ont appris des combats du passé et elles savent pertinemment qu’en tuant au nom de l’islam, elles provoquent une haine de l’islam, et au-delà de celle-ci une haine de toute peau bronzée, barbe et chèche qui entraîne à son tour des débordements et des violences.
Ce n’est pas comme le croit Naïma, un dommage collatéral, c’est précisément ce qu’ils veulent : que la situation devienne intenable pour tous les basanés d’Europe et que ceux-ci soient obligés de les rejoindre. »
Page 376 & 377
Et puis, elle parle aussi de la vague de régression dans les mœurs et particulièrement à l’égard des femmes que traverse, depuis quelques décennies, l’Islam dans les pays d’islam. Vague qui hélas est venue aussi en France.
Naîma va à Alger pour organiser une exposition dans la galerie dans laquelle elle travaille à Paris. Elle a pour correspondant Mehdi et sa compagne Rachida.
C’est la compagne de Mehdi, Rachida qui lui révèle :
« Ça me tue de voir que les gamines d’aujourd’hui se font avoir par ces conneries. La situation a clairement régressé pour nous dans ce pays.
Elle regarde autour d’elle, remarque quelques groupes de convives exclusivement masculins et ricane :
– La plupart des choses que les femmes ne font pas dans ce pays ne leur sont même pas interdites. Elles ont juste accepté l’idée qu’il ne fallait pas qu’elles le fassent. Tu as vu à Alger le nombre de terrasses où il n’y a que des hommes ?
Ces bars ne sont pas interdits aux femmes, il n’y a rien pour le signaler et si j’y entre, le personnel ne me mettra pas dehors, pourtant aucune femme ne s’y installe. De même qu’aucune femme ne fume dans la rue –et ne parlons pas de l’alcool. […]
On ne peut pas résister à tout, hélas. Moi je sais qu’ils ont en partie gagné parce qu’ils ont réussi à me mettre en tête que j’aurais préféré être un homme. »
Page 465 & 466
Un livre d’une richesse inouïe.
Le lecteur connait plus de complexité après l’avoir lu et s’enrichit de beaucoup de questions tout en se défiant des certitudes qu’il pensait acquise.
<1755>
- Ali, le grand-père, venu des montagnes kabyles dans lesquelles il menait une vie plutôt aisée, étant riche relativement à la population locale. Cet homme est tombé du côté harki pendant la guerre et dû fuir l’Algérie, en 1962, lors de l’indépendance.
-
Mercredi 12 juillet 2023
« Dissuasif »Terme peu compris et usité dans la société françaiseUn policier, après 9 jours de travail sans repos, au terme d’une course poursuite d’un délinquant conduisant sans permis et enfreignant le code de la route, a commis la grave erreur de dégainer son arme, puis de tirer sans maîtriser son tir.
Il a commis une faute !
Mais quand j’entends et je lis les médias et la plupart des hommes politiques de gauche, il semblerait que « LE PROBLEME » est ce policier et le cortège de violences policières qu’ils énumèrent.
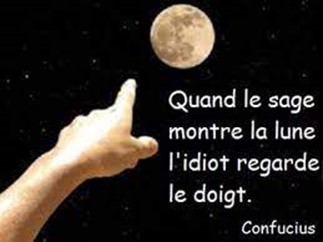 Je ne dis pas qu’il ne faille pas s’interroger sur les méthodes, la formation et certaines dérives racistes de la Police, mais il y a un moment où quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limite.
Je ne dis pas qu’il ne faille pas s’interroger sur les méthodes, la formation et certaines dérives racistes de la Police, mais il y a un moment où quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limite.
Libération dans un article : <comment Gérald Darmanin soutient financièrement le policier mis en examen> s’offusque du fait que l’administration a trouvé un moyen juridique, pour permettre au policier de continuer à toucher une partie de son traitement, bien qu’il ne travaille plus et que de manière factuelle en l’«absence de service fait», il ne devrait pas être payé.
Ce policier a commis une faute, encore faut-il laisser la Justice trancher, mais ce n’est pas le plus grand criminel de la terre.
Il est aussi possible d’exprimer de la bienveillance à son égard.
Il a eu mauvaise réaction prise dans l’urgence, dans un quart de seconde, qui a causé des conséquences terribles.
Mais pourquoi s’arrête t’on à ce tir du policier, en considérant qu’il s’agit de l’alpha et l’oméga du problème posé à la société française ?
Ce tir est la fin d’une histoire, la dernière étape de toute une série de manquements, de lâchetés, de dénis dans lesquels nous nous sommes enfermés.
Dans le mot du jour précédent, j’avais déjà noté que si le jeune Nahel n’avait pas pris le volant de ce bolide ou s’il s’était soumis à l’injonction des policiers, il serait toujours vivant.
Mais si un individu n’avait pas créé, trois mois auparavant, une société de location de voiture de « frimeur » avec la complicité de vendeurs polonais, dans le but de permettre à des dealers ou autres trafiquants des quartiers de jouir de ce symbole de réussite qu’est de conduire de telles automobiles qui ne servent à rien d’autre que de satisfaire le mâle alpha dans sa bêtise et sa vacuité, Nahel serait aussi en vie.
Mais pourquoi existent-t ‘il de telles sociétés de location dans des quartiers que les mélenchonistes décrivent simplement comme pauvres et délaissées ?
Parce que s’il y a de la pauvreté, il y a aussi de la richesse dans des zones que l’État a accepté de laisser devenir des zones de non droit.
Lors du mot du jour du « 20 janvier 2015 » je citais Régis Debray :
« Lorsque l’Etat se dégrade et perd en autorité symbolique
il y a deux gagnants : les sectes et les mafias. »
Verser de l’argent dans ces quartiers ne sert à rien, s’il n’existe pas en parallèle des humains qui accompagnent, dialoguent et peuvent aussi aider à sanctionner, le cas échéant.
Rappelons que c’est le Président Nicolas Sarkozy qui a mis fin à la Police de Proximité.
Les travailleurs sociaux sont manifestement insuffisants et insuffisamment soutenus.
Ce sont des problèmes d’une grande complexité, les aborder de manière simpliste est une faute.
Mais je voudrais aujourd’hui parler d’un mot qui je crois n’est pas bien compris, voire accepté en France.
La première fois que j’ai été confronté, dans ma vie, au terme dissuasif c’était au moment de l’achat de notre appartement de Montreuil.
Les propriétaires étaient un couple en instance de divorce et l’appartement était toujours occupé par l’épouse. Certaines réflexions et signes, m’ont donné l’intuition que cette dame ne quitterait peut-être pas l’appartement après la vente.
Nous en avons parlé à notre notaire qui nous a suivi. Au moment de la promesse de vente, il a donc demandé à son collègue d’introduire dans l’acte, la mention d’une astreinte de mille francs par jour, si l’appartement n’avait pas été totalement vidé, le jour de la vente.
Je me souviens encore de la réaction offusquée de la Dame qui s’exclama :
« Mais c’est plus cher qu’une nuit d’hôtel »
Et j’ai trouvé sur ce <site> qu’en effet, en 1991, année de cet achat, le prix d’une chambre d’hôtel de qualité se situait autour de 400 Francs.
Mais devant la réaction de la dame scandalisée, son notaire lui a répondu simplement :
« Oui Madame c’est beaucoup plus cher qu’une nuit d’hôtel. Mais c’est fait pour cela. C’est une mesure qui présente un caractère dissuasif ».
Dans cette situation, le caractère dissuasif était d’autant plus affirmé que le montant de la vente serait dans les mains du notaire et qu’il n’y avait dès lors aucune échappatoire au déclenchement effectif de l’astreinte.
Plus récemment, j’ai eu la compréhension de la signification du mot dissuasif par le témoignage de mon fils lors de son séjour à New York. Je me plaignais que souvent en France, aux carrefours, les voitures déclenchaient un embouteillage néfaste à la sécurité des cyclistes et à la fluidité de la circulation. Mon fils m’a dit qu’à New York un tel phénomène n’existait pas. Les règles imposaient qu’une voiture ne devaient jamais s’engager dans un carrefour si elle n’avait pas la certitude de pouvoir en sortir avant le changement de feu. Et toute voiture égarée au milieu d’un carrefour n’ayant pas respecté cette règle était sanctionnée par une amende d’un montant très sévère.
Mon frère Gérard était allé dans la ville allemande, voisine du domicile parental, Sarrebruck. Il s’était garé sur une grande avenue. Partout des panneaux indiquaient qu’il fallait qu’aucune voiture ne soit garée sur cette avenue à partir de 17 heures. C’était expliqué, il fallait que les grandes avenues de la ville soient dégagées à l’heure où les salariés allemands quittaient leur travail pour fluidifier la circulation. Mon frère, français de son état, est arrivé à sa voiture à 17h01, la discussion entre lui et l’autorité allemande a tourné court. Il a dû s’acquitter d’une sévère amende. Mais il jura qu’on ne le reprendrait plus.
Alors en France on ne fait pas comme ça. Les dirigeants jusqu’au français modestes estiment toujours qu’il est possible de s’arranger avec les règles et que si on ne les respecte pas, ce n’est pas très grave, c’est quasi excusable et presque compréhensible.
Évidemment si la sanction est une amende de 80 ou de 130 euros, que parfois d’ailleurs on ne paie pas, nous ne sommes pas dans le domaine du dissuasif mais de la taxe : On paie une taxe et on a le droit de ne pas respecter la règle.
Alors en France :
- Énormément de cyclistes ne respectent pas les feux rouges, ni d’ailleurs les passages pour piétons !
- Des parents insultent des enseignants
- Des personnes sans permis conduisent des voitures (vous comprenez ils ont en besoin !). Selon une étude de l’Observatoire de la sécurité routière, 800 000 conducteurs rouleraient sans permis. Quasi autant circulent sans assurance.
- Des pompiers, des médecins sont agressés et bien sûr la Police. Et pour les pompiers et les médecins, les arguments de certaines associations et groupes politiques ne peuvent même pas évoquer les violences policières…
Alors, peut être existe-t-il trop de règles en France.
Mais quand il existe une règle, on la respecte et on l’a fait respecter.
Et parallèlement on s’attaque aux autres problèmes, tous plus compliqués les uns que les autres, mais dans une société de règles acceptées, défendues et respectées sinon sanctionnées.
Les élites doivent bien entendu donner l’exemple.
Sans ce socle, le reste est inatteignable.
Jean-Pierre Colombies, ex-policier, analyse l’affaire de manière qui me semble très pertinente dans <Le Media pour tous>.
Il critique sévèrement l’intervention des deux policiers. Mais il ne s’arrête pas là et analyse plus profondément les problématiques de la sécurité, des quartiers et de la politique .
<1754>
- Énormément de cyclistes ne respectent pas les feux rouges, ni d’ailleurs les passages pour piétons !
-
Vendredi 7 juillet 2023
« Un débat bloqué [entre] deux camps caricaturaux et irréconciliables : D’un côté une police parfaite qui ne fait jamais d’erreur, de l’autre des victimes indignées qui ne sont que des anges. »La Tribune de Genève à propos des évènements en France suite à la mort du jeune NahelUn jeune homme de 17 ans, français, de religion musulmane, a été tué, lors d’un contrôle routier, par un tir, à bout portant, d’un motard de la police nationale.
Le jeune garçon conduisait une voiture, avec deux passagers à bord.
Cette scène a été filmée.
La mort du jeune homme, d’origine algérienne comme le mentionne le communiqué du ministre des affaires étrangères algérien, a conduit à des manifestations de protestation de jeunes gens qui s’identifient à la victime, dans un premier temps.
Mais rapidement ces protestations ont fait place à des scènes de pillages, de destructions, d’agressions et de chaos dans les grandes métropoles françaises et aussi dans des villes de moindre population.
En parler est délicat, les choses sont compliquées.
Il vaut peut-être mieux se taire pour ne pas déplaire.
Mais ne pas savoir poser des mots sur ce qui se passe, c’est laisser la place à la violence.
Les mots c’est ce que la démocratie a trouvé pour gérer les conflits : débattre pour ne pas se battre.
Mais d’abord, il faut en revenir aux faits.
Il faudrait quand même pouvoir se mettre d’accord sur les faits, sinon comment débattre, comment analyser ?
« Le Monde » a publié un article le 5 juillet donnant les éléments de l’enquête mené par le parquet général de Versailles à ce jour : < les premières constatations de l’enquête >
La chronologie est la suivante :
- Lundi 26 juin, une Mercedes de type AMG, immatriculée en Pologne, est louée auprès d’une société de location de voiture, FullUp Location à Nanterre. Cette société avait été créée trois mois auparavant. A ce stade, il n’est pas précisé qui a loué.
- Mardi 27 juin, Avant que le jeune Nahel n’en prenne le volant, deux autres personnes l’ont utilisé dans des circonstances encore inconnues. Le jeune Nahel, 17ans, qui n’a pas de permis, prend le volant de ce véhicule onéreux et puissant capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, selon sa fiche technique.
- D’après le brigadier qui a tiré, les deux motards ont remarqué « une Mercedes dont le moteur vrombissait et qui circulait dans la voie de bus ».
- Lorsque la Mercedes regagne le flot normal de la circulation, les motards de la police tentent une première fois de l’intercepter. Le brigadier se porte alors à la hauteur du passager et, sa sirène enclenchée, fait signe au conducteur de se ranger sur le côté. « Mais celui-ci, note le réquisitoire, avait alors accéléré brusquement et pris la fuite . Poursuivi par les deux motards, il avait conduit à vitesse élevée avec de brusques accélérations, des franchissements de feux rouges fixes et passages de carrefours « à pleine vitesse » et sans précaution pour les piétons…… Il avait même fait une embardée volontaire vers son collègue qui était venu se mettre à son niveau. »
- Après examen de la vidéosurveillance, le parquet note que, au cours de son périple, la Mercedes a « failli percuter un cycliste tandis qu’un piéton engagé sur un passage protégé avait dû faire demi-tour en courant pour éviter d’être percuté ». Celle-ci aurait également roulé plusieurs fois à contresens.
- Une fois la Mercedes à l’arrêt, bloquée par d’autres véhicules à proximité de la place Nelson-Mandela où elle finira sa course, les deux policiers mettent leur moto sur béquille et s’en approchent, leur arme de service dégainée, la visière de leur casque relevée. Le premier, gardien de la paix, que les enquêteurs de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) désignent dans un rapport comme « P1 », se place face à la vitre du côté du conducteur. Le second, le brigadier (« P2 » pour l’IGPN), se positionne du côté avant gauche du capot, son pistolet automatique Sig Sauer pointé en direction du conducteur.
- C’est dans cette attitude que la séquence vidéo tournée par une passante saisit les deux fonctionnaires, quelques secondes avant que ne soit tiré le coup de feu mortel. C’est également à ce moment que le brigadier reconnaît avoir cogné contre le pare-brise – l’un des deux passagers évoque des coups de crosse contre Nahel M. – pour « attirer l’attention du conducteur ».
-
L’exploitation de la séquence vidéo par l’IGPN confirme les mots prononcés par l’un des policiers, sans pour autant que celui-ci soit identifié à ce stade. Dans leur reconstitution des échanges, les enquêteurs notent : « Au début de la séquence, on entend un échange entre trois voix différentes (V1, V2, V3) avant la détonation, que nous interprétons comme suit :
- V1 : « … une balle dans la tête »
- V2 : « Coupe ! Coupe ! »
- V3 : « Pousse-toi ! »
- V1 : « Tu vas prendre une balle dans la tête » (propos pouvant être attribués à P1 qui agite son bras droit au même moment).
- V2 : « Coupe ! » »
- V1 : « … une balle dans la tête »
- D’après cette première analyse, ce serait donc le collègue du brigadier et non ce dernier qui aurait crié à l’adresse de Nahel « Tu vas prendre une balle dans la tête », des propos que le policier auteur du tir a, du reste, constamment nié avoir tenus lors de sa garde à vue.
- Nahel redémarre et le Brigadier (P2) tire, à bout portant, une balle mortelle.
Il existe ensuite une ambigüité. Tous les médias ont repris l’information que le Brigadier a menti en affirmant que la voiture fonçait sur lui alors qu’il était à côté de la voiture.
Je cite :
« Le parquet souligne que le premier compte rendu policier, à 8 h 22, six minutes après le tir policier, évoque un « individu blessé par balle à la poitrine gauche ». L’opérateur signale, dans une fiche de résumé d’intervention Pegase (pilotage des événements, gestion des activités et sécurisation des équipages) que « le fonctionnaire de police s’est mis à l’avant pour le stopper » et que « le conducteur a essayé de repartir en fonçant sur le fonctionnaire ». Ce qui soulève une interrogation importante sur l’origine de cette information démentie par la vidéo de la passante : comment est-elle remontée jusqu’à l’opérateur ? Le parquet note que le brigadier n’utilise jamais ces mots dans les conversations enregistrées sur la « conférence 32 » – en réalité, la « conférence 132 » qui est le réseau radio utilisé par l’ensemble des effectifs de la direction de l’ordre public et de la circulation, à laquelle appartenaient les deux policiers motocyclistes. »
Selon cette version, le brigadier n’aurait pas, lui-même, déclaré que la voiture lui fonçait dessus.
Dans sa version, le brigadier a déclaré qu’il avait peur que son coéquipier soit entraîné par la voiture parce qu’il pensait que son corps était engagé dans l’habitacle, alors qu’en réalité ce n’était que le bras qui était concerné. Enfin, il a affirmé que sa volonté était de viser vers les jambes du conducteur mais que déstabilisé par le démarrage le coup est parti vers le thorax.
Le brigadier, auteur du tir, a également révélé qu’il enchaînait son neuvième jour consécutif de travail
L’article du Monde fait aussi mention d’une situation extrêmement tendue dès les minutes qui ont suivi la mort de Nahel.
Le parquet relève que, au moment de la sécurisation des lieux, des « jeunes hostiles étaient présents » ainsi que des proches de la victime.
- Selon les policiers, la grand-mère de la victime aurait tenu les propos suivants : « Les deux policiers, ils vont pas sortir (…). Je les attendrai. J’ai des copains qui travaillent au dépôt. (…) Il y a un terroriste qui va tous les attraper Inch’Allah, un terroriste qui va tous les massacrer. »
- Un gardien de la paix, lui, est pris à partie par un ambulancier, dans une séquence également filmée et devenue virale où l’on peut entendre les propos, répétés à deux reprises : « Tu vas plus vivre tranquille, frère. »
- Le même jour, un jeune homme âgé de 20 ans a été condamné à dix-huit mois de prison dont douze mois avec sursis probatoire pour avoir diffusé les coordonnées personnelles du brigadier.
J’ai entendu un journaliste affirmer que l’adresse de l’hôtel dans lequel, la famille du policier avait trouvé refuge, a également été divulgué.
Très rapidement le Ministre de l’intérieur a eu des propos qui exprimait une défiance par rapport à l’attitude du policier. Et le Président de la République a eu ces mots, en contradiction formelle avec la présomption d’innocence, traitant le geste du policier « d’inexcusable » et d’inexplicable »
Probablement que le Président de la République et son Ministre espéraient ainsi calmer la colère des jeunes de banlieue qu’ils craignaient.
Il n’en fut rien : La France s’est embrasée malgré ces propos prenant délibérément partie contre le policier.
La Justice qui a pourtant inculpé le brigadier pour « homicide volontaire » et placé en détention provisoire n’est pas davantage parvenue à éviter ce qui allait devenir un chaos de destruction et de pillage.
Dans leur ensemble, tous les médias, mis à part ceux d’extrême droite, ont exprimé leur compassion pour le jeune homme, certain parlant « d’enfant » et ont présenté le brigadier comme un assassin.
Le footballeur né à Bondy et mondialement connu Kylian Mbappé a publié ce tweet en direction de ses 12,6 millions d’abonnés en évoquant « un petit ange ! » :
« J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Nahel, ce petit ange parti beaucoup trop tôt ».
Quand le chaos était à son comble, Jean-Luc Melenchon a pris la parole.
Il a été fidèle à son récit : Toutes ces horreurs viennent des inégalités économiques, de la discrimination à l’égard de la population des banlieues et du mauvais fonctionnement de la police qui tue et qui est raciste.
Il n’a pas appelé « au calme » mais à « la justice »
Il a demandé que les jeunes ne s’attaquent pas aux « Ecoles », « aux Bibliothèques » « aux gymnases », ce qui laisse à penser que pour les autres cibles, le saccage est une option ?
Michel Onfray lui a répondu avec véhémence : « Melenchon est prêt à tout pour arriver au pouvoir » :
« Quand je dis tout, c’est-à-dire détruire la France. C’est-à-dire mettre la France à feu et à sang. C’est-à-dire contribuer à ce que le sang puisse couler. Melenchon est prêt à tout ça »
et il ajoute:
« [on dit] Les gens sont mécontents, ils descendent dans la rue. Non ce ne sont pas des gens qui sont mécontents dans la rue. C’est un peuple qui se soulève contre un autre peuple ! »
Michel Onfray poursuit un autre récit, totalement opposé à celui de Melenchon, celui d’une « guerre civile à bas bruit »
A ce propos, j’ai entendu un sociologue estimer à 0,2% de la population des banlieues concernées par les faits de violence.
Par ailleurs pour qu’on puisse parler de « Peuple », il faudrait que ces personnes aient une conscience politique d’être un peuple ayant un destin commun. Je ne vois pas ce dessin politique mais surtout une rage de se défouler et un désir irréfragable de consommer des chaussures Nike, des Smartphones et autres marques de réussite.
Et lors du 20h de Darius Rochebin sur LCI le 1er juillet 2023, le premier argument utilisé par Hubert Vedrine, le secrétaire général de la présidence de la République de François Mitterrand et le ministre des affaires étrangères de Lionel Jospin est celui d’une immigration mal maîtrisée et il en appelle à l’exemple danois.
Chacun suit son récit, sans jamais rencontrer et même chercher à échanger avec l’autre.
<Le Monde> cite un éditorial de « La Tribune de Genève » qui appelle de son côté à sortir d’un « débat bloqué » entre « deux camps caricaturaux et irréconciliables » : « D’un côté une police parfaite qui ne fait jamais d’erreur, de l’autre des victimes indignées qui ne sont que des anges. » « Selon toute apparence, le policier n’avait pas à tirer », analyse l’auteur, qui ajoute, au sujet du jeune conducteur tué, que, « s’il avait obtempéré à la police, il vivrait ». « Dans le débat politique français, ces deux vérités ne sont jamais confrontées, elles s’affrontent stérilement, déplore le journal suisse. Pauvre débat, triste débat, qui ne fait qu’entretenir la violence, car chacun ne veut voir que celle de l’autre. »
Si je dois donner quelques mots de conclusion, ce serait les suivants :
- Si ce jeune homme n’avait pas pris le volant d’une voiture excessivement puissante alors qu’il n’avait ni le permis, ni d’assurance, il n’aurait pas été tué.
- S’il avait obtempéré à l’ordre de la police, il n’aurait pas été tué.
- On a écrit, il n’avait pas d’arme dans cette voiture. Mais enfin, la voiture qu’il conduisait pouvait tuer. D’ailleurs il a faillé renverser un piéton et un cycliste. Il était donc non seulement dans l’illégalité mais aussi un danger pour autrui.
- Les policiers n’auraient sans doute pas du sortir leur arme pour menacer parce que dans ce cas il se mettaient en posture et en risque de tirer et de mal tirer.
- Mais était-il raisonnable de laisser repartir cette voiture qui risquait de créer des accidents étant donné l’état d’excitation du jeune Nahel et probablement sa maîtrise limitée du bolide qu’il conduisait ? Je n’ai entendu personne expliquer comment immobiliser ce véhicule de manière efficace et sans utilisation d’arme létale. Il me semble que laisser repartir la voiture n’était pas une option.
Il y a certainement des problèmes au sein de la police. Sans doute une formation insuffisante, peut être une organisation et des méthodes d’interpellation à revoir. Il existe probablement des racistes au sein de la Police qu’il faut combattre.
Mais le déchainement de violence qui a eu lieu ces derniers jours doit aussi nous interroger sur ce que vivent nos policiers dans ces quartiers.
Que ferions nous s’il n’y avait plus de Police ?
SI tous les policiers déposaient brusquement tous leurs attributs en disant nous en avons marre de vivre cette violence, ces insultes et incivilités au quotidien, ce rejet systématique de l’autorité.
D’ailleurs contrairement à ce que pense ces gauchistes qui ont perturbé les comparutions aux Palais de Justice de Lyon et qui scandaient cette affirmation : « Tout le monde déteste la Police », les français sont plutôt du côté de la police.
<Selon ce sondage IFOP réalisé après la mort de Nahel> 43% et 14% ressentent de la confiance ou de la sympathie envers les forces du maintien de l’ordre, soit un total de 57% d’avis positifs. La police inspire de l’inquiétude ou de l’hostilité pour 32% des Français, tandis que 11% d’entre eux n’ont pas d’opinion.
Alors, il ne s’agit pas de nier les problèmes mais gardons-nous bien de solution simpliste comme croire que tout est la faute de la Police ou inversement que tout est de la faute de l’immigration.
Les choses sont infiniment plus complexes que cela.
<1753>
- Lundi 26 juin, une Mercedes de type AMG, immatriculée en Pologne, est louée auprès d’une société de location de voiture, FullUp Location à Nanterre. Cette société avait été créée trois mois auparavant. A ce stade, il n’est pas précisé qui a loué.
-
Jeudi 22 juin 2023
« La mort est au bout du chemin, mais elle s’est un peu éloignée. »Clémentine VergnaudElle s’appelle Clémentine Vergnaud, elle est journaliste à France Info, elle a trente ans.
Elle est atteinte d’un cancer digestif des voies biliaires dont le nom scientifique est : « le cholangiocarcinome »
C’est un cancer rare et extrêmement agressif.
Un jour de grande douleur Clémentine Vergnaud a craqué et a recherché l’espérance de vie pour cette pathologie. Elle a trouvé que pour les malades qui peuvent être opérés, 10% restent en vie au bout de 5 ans.
Les médecins lui ont dit qu’elle n’était pas opérable, à cause de la diffusion de métastases en dehors de l’organe initial touché.
Un collègue journaliste Samuel Aslanoff lui a proposé d’enregistrer un podcast racontant son combat contre le cancer révélant ses sentiments, ses rapports à sa maladie, aux médecins, à ses proches, ses moments de découragement, d’espoir, de peur, de joie.
Je me promenais et écoutais son entretien dans « C à Vous » (qui existe sous format de podcast audio) dans lequel j’apprenais l’existence de son podcast en dix épisodes de 10 à 12 minutes.
J’ai immédiatement écouté le premier < J’ai l’impression que le bateau est en train de couler >, puis le second, le troisième et tous les suivants, à la fin de ma promenade j’avais fini les dix épisodes.
C’est bouleversant et plein d’enseignement.
Celles et ceux qui sont dans un combat similaire y apprendront beaucoup.
 Et peut-être, que celles et ceux qui accompagnent ou sont des proches d’un malade qui poursuit une telle lutte, apprendront encore davantage.
Et peut-être, que celles et ceux qui accompagnent ou sont des proches d’un malade qui poursuit une telle lutte, apprendront encore davantage.
Elle raconte comment des amis qui sont plein de bienveillance mais ne sachant que dire, lui assène : « Je suis sûr, tu vas t’en sortir ! »
Mais il faut comprendre que pour le malade, conscient de son état, cela sonne faux et n’aide pas.
Elle donne la solution, il faut juste être présent, être là.
Elle avoue sa peur de la mort :
« La peur de la mort vous saisit dans vos entrailles »
Mais quand elle dit à sa mère et son père : « il faut préparer ma mort, mon départ », ses parents disent simplement : « Nous sommes là pour toi et nous allons en parler et prendre les décisions qu’il faut. »
Ainsi, ses parents sont dans cette présence dont elle a besoin pour avancer.
Elle dit aussi combien le patient a besoin de médecins qui sont dans l’écoute et si possible dans l’empathie.
 Elle raconte son expérience d’un médecin qui n’écoutait rien de ce qu’elle lui disait et concluait que ses terribles douleurs provenaient d’une déchirure musculaire.
Elle raconte son expérience d’un médecin qui n’écoutait rien de ce qu’elle lui disait et concluait que ses terribles douleurs provenaient d’une déchirure musculaire.
Heureusement, elle a aussi rencontré beaucoup de médecins remarquables sur lesquels elle a pu s’appuyer dans son combat.
La douceur de celui qu’elle appelle le docteur H qui lui a annoncé la terrible nouvelle et lui a indiqué l’hôpital où elle devrait se rendre dès le lendemain et la procédure qui s’enclencherait alors, est bouleversante.
Quand tout ce qui devait être dit dans l’opérationnel avait été dit, Clémentine Vergnaud et sa mère pleuraient, le docteur H a alors entouré sa main avec ses deux mains et dit :
« Un médecin n’a pas le droit de pleurer. »
Par la suite, elle croisera encore plusieurs fois la route du Docteur H qui chaque fois sera présent et aidant.
Elle détaille aussi ses démêlés avec la bureaucratie et les bugs informatiques de la Sécurité Sociale. Ce serait comique, si on ne baignait pas dans la tragédie.
Elle a aussi cette formule qui me parait très juste :
« Être malade, c’est un vrai boulot »
Elle dit, à mon sens, des choses très importantes à comprendre.
Elle explique qu’elle ne donne jamais précisément les dates de ses séances de scanner à ses proches, de peur d’être envahie par des questionnements incessants et immédiats. Alors que le diagnostic après le scanner doit être accueilli par le patient avec calme et paix. Il est possible qu’il lui « faille faire le deuil d’un traitement qui n’a pas fonctionné. »
Et puis elle explique qu’elle a reçu l’annonce de sa maladie, comme une immense injustice, avec une révolte intense. Mais qu’avec le temps et les conseils de médecins avisés, elle a compris qu’elle devait faire une place à ses cellules malades, accepter de vivre avec elles pour avancer et faire reculer la maladie.
 Après des traitements qui l’ont beaucoup affaibli, fait souffrir et eu des conséquences collatérales telles qu’ils ne pouvaient être poursuivis, l’Hôpital Paul-Brousse lui a proposé un traitement innovant qui a pu améliorer son état de santé et stabiliser sa maladie.
Après des traitements qui l’ont beaucoup affaibli, fait souffrir et eu des conséquences collatérales telles qu’ils ne pouvaient être poursuivis, l’Hôpital Paul-Brousse lui a proposé un traitement innovant qui a pu améliorer son état de santé et stabiliser sa maladie.
Et c’est Clémentine Vergnaud qui a rapporté avec force et sagesse cette phrase de sa mère, ancienne infirmière :
« La mort est au bout du chemin, mais elle s’est un peu éloignée. »
Depuis la mise en ligne de son podcast, la journaliste a reçu des centaines de messages de soutien.
« On m’écrit des tas de choses. Cela peut être des malades qui me disent qu’ils se sentent enfin moins seuls : Je me sens compris, vous avez mis des mots sur nos maux. Cela peut-être des proches de malades aussi »,
Elle a aussi rapporté l’histoire de l’amie d’une femme atteinte d’un cancer :
« J’ai écouté votre podcast juste avant de dîner avec elle et maintenant, je sais quoi lui dire. »
Voici le <Lien> vers la Page présentant les 10 podcasts : « Ma vie face au cancer : le journal de Clémentine. »
Un monument d’humanité !
<1752>
-
Mercredi 14 juin 2023
« Il faut de l’apaisement, il faut de la stabilité. Il faut rétablir des ponts et réparer les fractures et ne pas les creuser davantage. »François Ruffin, député LFI de la Somme, à propos de la société politique françaiseFrançois Ruffin était l’invité de France Info le 1er juin 2023.
<Il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia>.
 A une des questions, il a répondu :
A une des questions, il a répondu :
« Pour moi, le cœur du sujet, c’est le travail, c’est le partage des richesses, c’est la démocratie. On a une société profondément fracturée en France. Le résultat des dernières élections n’est pas le fruit du hasard (….)
Dans ce climat de tension, d’épuisement des esprits, il faut de l’apaisement, de la stabilité ».
En tout cas, c’est ainsi que l’a résumé Jean Leymarie dans son « Billet Politique » : <La gauche a-t-elle le sens du progrès ?>
Quelle était la question ?
La question était de savoir s’il était prioritaire pour la Gauche, dans l’hypothèse où elle arrivait au pouvoir, de voter une loi pour permettre à des jeunes de 16 ans de changer de genre, sans l’accord de leurs parents ?
Ce débat avait divisé la gauche espagnole. Le parti PODEMOS l’a imposé et une Loi espagnole le permet désormais.
Pour être le plus précis possible je cite « Le Monde » du <16/02/2023>
« Les députés espagnols ont adopté définitivement, jeudi 16 février 2023, une loi permettant de changer librement de genre dès 16 ans. Cheval de bataille du parti de gauche radicale Podemos, allié des socialistes au sein du gouvernement de Pedro Sánchez, cette loi dite « transgenre » permet aux personnes qui le souhaitent de faire changer leur genre sur leurs papiers d’identité via une simple déclaration administrative dès l’âge de 16 ans.
Il ne sera donc plus nécessaire de fournir des rapports médicaux attestant d’une dysphorie de genre et des preuves d’un traitement hormonal suivi durant deux ans, comme c’était le cas jusqu’ici pour les personnes majeures. Le texte – adopté par 191 voix contre 60 et 91 abstentions – étend également ce droit aux 14-16 ans, à condition qu’ils soient accompagnés dans la procédure par leurs tuteurs légaux, ainsi qu’aux 12-14 ans, s’ils obtiennent le feu vert de la justice. »
Donc pour François Ruffin, cette évolution législative ne doit pas constituer une priorité pour la Gauche.
Mais en disant cela, il s’oppose frontalement à Jean-Luc Mélenchon qui souhaite inscrire la possibilité de changer de genre dans la Constitution.
Dès lors, les « Insoumis », au moins celles et ceux qui s’expriment ont vivement critiqué François Ruffin.
<France Info> rapporte :
« Une fois l’extrait diffusé sur le compte Twitter de franceinfo, les premières critiques fusent. Quelques heures plus tard, le compte « Le coin des LGBT+ », aux près de 48 000 abonnés, relaye la vidéo, assorti de ce commentaire : « François Ruffin ne veut pas d’une loi permettant de changer plus facilement sa mention de genre car il faut ‘de l’apaisement’ pour que son parti accède au pouvoir ».
Dans la foulée, François Ruffin se voit critiqué par ses pairs, sur le même réseau social. « Ce n’est en rien une position de La France insoumise ni du groupe parlementaire », recadre la députée Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon. « Ce propos, en ce jour, est au mieux maladroit, au pire une faute politique », cingle-t-elle. […]
Dans un tweet, le député LFI Antoine Léaument rappelle que le programme de son parti prévoit de « garantir le droit au changement de la mention du sexe à l’état civil, librement et gratuitement devant un officier d’état civil, sans condition médicale »
Si bien que François Ruffin se sent obligé de faire marche arrière :
Il twitte :
« Ma réponse sur le genre, ça va pas ».
Puis ajoute :
« Sur ce sujet [des droits LGBT+] comme sur pas mal d’autres, en toute humilité, je dois progresser »
Cela rappelle furieusement la culture de l’autocritique pratiquée dans les partis et régimes communistes d’antan.
Mais revenons exactement au verbatim de l’interview de France Info :
Marc Fauvelle contextualise et pose sa question
« En Espagne, votre allié, le parti PODEMOS a pris une claque aux élections locales. 3% des voix seulement ! Certains électeurs ont, semble-t-il, considéré que PODEMOS qui gouverne avec les socialistes avait mis en place des lois trop clivantes. Comme par exemple la Loi qui permet de changer librement de genre à 16 ans, sans l’accord des parents. Est-ce que vous feriez la même chose en France ?
Réponse de François Ruffin :
« Je vous l’ai dit que pour moi le cœur du sujet, c’est le travail, c’est le partage des richesses, c’est la démocratie. »
Marc Fauvelle :
« Ce n’est pas les lois de société ? »
François Ruffin
« Je pense qu’on a une société qui est profondément fracturée en France. Le résultat des dernières élections ne sont pas le fruit du hasard.
Il y a un bloc libéral, central qui s’effrite dans la durée, il y a un bloc d’extrême droite, il y a un bloc de gauche. Dans ce climat là de tension, d’épuisement des esprits, qu’est-ce qu’il faut ? Il faut de l’apaisement, il faut de la stabilité. Il faut rétablir des ponts et réparer les fractures et ne pas les creuser davantage. Je pense que dans ce cadre-là, on ne devra pas faire tout ce qui nous passe par la tête. Tout ce qu’on souhaite. Tout ce qui est peut-être, même, bon en soi. Mais il faudra chercher les chemins qui permettent de réconcilier la société.
Marc Fauvelle :
« Pas de loi qui fracture la société, cela veut dire par exemple pas de GPA. Pas de Loi sur le genre.
François Ruffin
« Je ne suis pas personnellement favorable à la GPA. Mais je ne crois pas que c’est ça qu’on doit placer au cœur de notre projet. C’est clair. Après il y a des choses sur lesquelles ont peut chercher à avancer avec précaution, avec sagesse, il faut avancer avec tendresse, avec compréhension à l’égard de l’opposition »
Marc Fauvelle :
« Si vous étiez au pouvoir, vous ne feriez pas la Loi sur la Fin de vie ?
François Ruffin
« Si ! En tout cas ouvrir la réflexion sur la fin de vie. Écouter les avis des français. Demander ce qu’ils en pensent. Demander comment ils vivent la fin de vie de leurs parents, comment ils appréhendent leur propre fin de vie. Est-ce qu’il a des choses à aménager ? […] Bien sûr pour aboutir à un texte à la fin.
Je crois qu’il y a des tas de sujets où on peu chercher…Emmanuel Macron fait des Lois qui reposent su 1/3 ou 1/4 des français. Ben non, il faut chercher les 2/3 ou le 3/4 des français pour avancer avec l’ensemble de la société.
Je crois qu’il y a un sujet sur lequel la société recule depuis 40 ans, c’est le travail, à cause de la mondialisation.
Je veux aussi qu’on montre tout ce sur quoi la société, elle avance. Elle avance avec des limites. Mais la reconnaissance de l’homosexualité, elle a avancé. Les lois sur le Handicap, ça a avancé. La place des femmes dans la société ça a avancé. Même des choses comme la sécurité routière ça a avancé.
Je ne veux qu’on ait une vision sur ce qui se passe en France depuis 40 ou 50 ans comme étant une régression sur tous les points. »
Et il dit encore que la Gauche doit rassurer, parler à toute la société et ne pas imposer une humiliation et ne pas mépriser ceux qu’elle ne convainc pas.
Je dois dire que je suis d’accord sur tous ces points avec François Ruffin.
Je veux dire que je suis d’accord avec la version originale pas celle de l’auto-critique.
Une majorité de français a voté Emmanuel Macron pour faire barrage à Le Pen. Mais, lui avait mis pour priorité une Loi brutale et non négociable sur la retraite.
Il ne faudrait pas que les français votent pour la Gauche pour plus de justice sociale, une amélioration de la vie au travail, un programme écologique plus offensif et structuré et qu’au final la priorité soit la Loi sur le genre.
Je pense d’ailleurs que ce type de projet servirait de repoussoir pour beaucoup de français.
Au fond, je suis plein de doutes. Je pense à l’« l’homo deus » de Yuval Noah Harari.
L’individualisme poussé à l’extrême ! L’individu doit pouvoir tout choisir, même son genre et son sexe. Rien ne saurait lui être opposé comme limite ou contrainte.
Est-ce ainsi qu’on peut faire société ?
Or, il faut faire société, si on veut pouvoir faire face aux défis qui sont là.
Et plus encore pour pouvoir faire vivre un État social, il faut faire société, une assemblée d’individus ne le permet pas.
Dans le mot du jour du <12 septembre 2014> j’avais cité Emile Durkheim
« Pour que les hommes se reconnaissent et se garantissent mutuellement des droits, ils faut qu’ils s’aiment et que pour une raison quelconque ils tiennent les uns aux autres et à une même société dont ils fassent partie. »
C’est pourquoi le propos de François Ruffin : il vaut chercher à avancer avec l’ensemble de la société, me parait très sage.
Jean Leymarie finit son billet politique par cette conclusion :
« Quels « progrès » la gauche veut-elle porter ? Que considère-t-elle comme un « progrès », d’ailleurs ? Des mesures sociétales, bien sûr – depuis quelques années, elle les met beaucoup en avant. Mais est-ce que ça suffit ? Il y a dix ans, le mariage pour tous, défendu par François Hollande, était une mesure d’égalité. Un progrès, largement admis aujourd’hui, y compris à droite. Ce progrès n’a pas empêché la désillusion de nombreux électeurs, en tout cas de ceux qui voulaient d’abord des mesures sur le travail, sur la fiscalité.
Finalement, quels sont les marqueurs de la gauche ? Ceux qui feront revenir ses électeurs perdus ? Une grande partie d’entre eux – des ouvriers, des employés notamment – réclame plus de justice sociale. Ça ne signifie pas que la gauche doit balayer tout le reste. Mais si elle veut convaincre, et si elle veut s’unir, il faudra qu’elle soit claire. Elle doit choisir ses combats. »
<1751>
-
Vendredi 9 juin 2023
« Sans le dire, sans en débattre, les pays industriels ont « choisi » la croissance et le réchauffement, et s’en sont remis à l’adaptation. »Jean-Baptiste FressozLa Statue de la Liberté est entourée d’une brume due aux incendies de forêt qui font rage dans les provinces canadiennes du Québec et de la Nouvelle-Écosse à plus de 1000 km de New York.
 C’est une photo qu’on peut voir sur le site de la grande chaîne de télévision américaine <NBC>.
C’est une photo qu’on peut voir sur le site de la grande chaîne de télévision américaine <NBC>.
Cette chaîne précise que les autorités de l’État de New York ont déclaré plusieurs zones, dont la région métropolitaine de New York et Long Island, comme ayant une qualité de l’air « malsaine pour les groupes sensibles ».
Plus personne ne conteste que le nombre et l’importance de ces « méga-feux » sont la conséquence directe du réchauffement climatique.
Une végétation sèche, des records de températures et des vents puissants : cette accumulation de phénomènes météorologiques explique ces feux de forêts d’une ampleur inédite.
 Dans un article du 8 juin « L’OBS » parle « d’incendie jamais vus »
Dans un article du 8 juin « L’OBS » parle « d’incendie jamais vus »
Et cite la porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre, mercredi,
« Cet événement est « un autre signe inquiétant de la manière dont la crise climatique affecte nos vies ».
Même la Présidence des États-Unis, encore faut il que ce ne soit pas Trump ou un de ses affidés qui occupent le bureau ovale, reconnait désormais ce fait
Simultanément, nous avons appris que selon les scientifiques, Il est trop tard pour sauver la banquise estivale de l’Arctique.
En hiver, jusqu’à présent elle atteignait son maximum en mars et couvrait la quasi-totalité de l’océan Arctique, soit plus de 15,5 millions de kilomètres carrés.
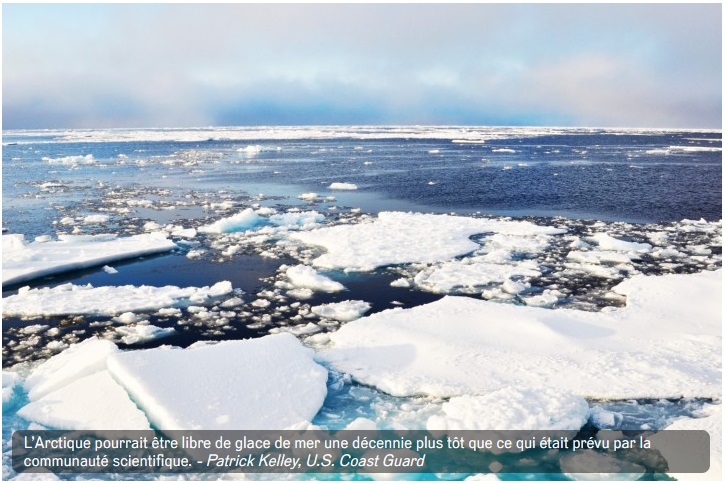 Des étés sans glace en Arctique semblent désormais inévitables, même avec de fortes réductions des émissions de gaz à effet de serre, estiment plusieurs scientifiques dans une étude publiée dans la revue « Nature Communications ».
Des étés sans glace en Arctique semblent désormais inévitables, même avec de fortes réductions des émissions de gaz à effet de serre, estiment plusieurs scientifiques dans une étude publiée dans la revue « Nature Communications ».
<Ouest France> cite Dirk Notz de l’université de Hambourg, co-auteur de cette étude sur les glaces de mer de l’Arctique :
« Les scientifiques ont alerté sur cette disparition pendant des décennies et c’est triste de voir que ces mises en garde n’ont pour l’essentiel pas été écoutées. Maintenant, c’est trop tard. »
« Le Monde » a publié le 7 juin : <L’Arctique pourrait être privé de banquise en été dès les années 2030> et cite un autre co-auteur de cet article : Seung-Ki Min, des universités sud-coréennes de Pohang et Yonsei :
« La disparition de la glace « accélérera le réchauffement arctique, ce qui peut augmenter les événements météorologiques extrêmes aux latitudes moyennes, comme les canicules et les feux de forêts ».
Dans ce contexte, j’ai lu avec d’autant plus d’attention l’article de Jean-Baptiste Fressoz, historien et chercheur au CNRS, publié le 7 juin par « Le Monde » : « Les pays industriels ont «choisi» la croissance et le réchauffement climatique, et s’en sont remis à l’adaptation »
Jean-Baptiste Fressoz explique que dès la fin des années 1970, les gouvernements des pays industriels, constatant l’inéluctabilité du réchauffement, ont délibérément poursuivi leurs activités polluantes quitte à s’adapter à leurs effets sur le climat.
J’avais déjà évoqué lors du <mot du jour du 9 mai> que le gouvernement avait engagé une réflexion sur les possibilités de s’adapter à un réchauffement à 4°C à la fin du siècle.
Jean-Baptiste Fressoz s’insurge contre la thèse que cette idée de s’adapter soit nouvelle :
« Mais feindre la surprise donne l’impression d’avoir essayé : l’adaptation serait donc le résultat d’un échec, celui de nos efforts de transition. Or, ce récit moralement réconfortant est une fable. En réalité, l’adaptation a été très tôt choisie comme la stratégie optimale. »
Et il cite un groupe de réflexion d’origine militaire proche de la Maison Blanche qui dès novembre 1976, il y a près de 50 ans, organisait un congrès intitulé « Living with Climate Change : Phase II ». Dans le préambule du rapport qu’ils avaient produit alors, il considérait le réchauffement comme inexorable.
Et il cite encore :
« En 1983, le rapport « Changing Climate » de l’Académie des sciences américaine […] Le dernier chapitre reconnaissait l’impact du réchauffement sur l’agriculture, mais comme son poids dans l’économie nationale était faible, cela n’avait pas grande importance. Concernant les « zones affectées de manière catastrophique », leur sacrifice était nécessaire pour ne pas entraver la croissance du reste du pays, même s’il faudra probablement les dédommager. »
Même Margareth Thatcher s’était intéressé » au sujet tout en baissant les bras :
« Au Royaume-Uni, un séminaire gouvernemental d’avril 1989 exprimait également bien ce point de vue. La première ministre Margaret Thatcher (1979-1990) avait demandé à son gouvernement d’identifier les moyens de réduire les émissions. Les réponses vont toutes dans le même sens : inutile de se lancer dans une bataille perdue d’avance. On pourrait certes améliorer l’efficacité des véhicules, mais les gains seraient probablement annihilés par ce que les économistes définissent comme les « effets rebonds ».
Ce qui amène Jean-Baptiste Fressoz à cette conclusion :
« Sans le dire, sans en débattre, les pays industriels ont « choisi » la croissance et le réchauffement, et s’en sont remis à l’adaptation. Cette résignation n’a jamais été explicitée, les populations n’ont pas été consultées, surtout celles qui en seront et en sont déjà les victimes. »
Jean-Baptiste Fressoz était aussi l’invité des matins de France Culture du 8 juin 2023 consacré à ce groupe de militants écologiques révoltés par l’inaction des décideurs : « Les Soulèvements de la terre »
Ces militants pensent que seules les actions d’éclat, voire la violence permet que l’on parle des sujets essentiels qui concernent la vie d’homo sapiens sur terre.
Et il est vrai qu’avant cela je n’avais pas beaucoup entendu parler de la captation de la ressource en eau dans des mega-bassines destinées pour l’essentiel à aider à produire du maïs pour nourrir du bétail destiné à l’exportation.
Alors qu’est ce qui est le plus juste ? Parler d’« écoterrorisme » ou d’« écocide » ?
Ce qui apparait assez clairement c’est que les décideurs continuent à vouloir faire perdurer le système économique et agricole qui nous a conduit dans cette situation. Les « mégas bassines » ne sont qu’un exemple parmi d’autres de l’entêtement et de cette stratégie qui consiste à penser que nous arriverons bien à nous adapter.
Mais les décideurs ne sont pas seuls en cause.
Savez vous que par exemple Jean-Marc Jancovici qui réfléchit et calcule, a donné comme indication que si on voulait conserver un réchauffement climatique « raisonnable » à 2°C (mais est ce raisonnable ?) concernant les vols en avion, avec le système énergétique actuel de l’aviation, il fallait qu’en moyenne chaque être humain ne dépasse pas 4 vols d’avion dans sa vie. Ce chiffre pour donner une vision de l’exigence écologique.
Alors on parle d’écologie punitive !
Mais sommes-nous conscients de ce qui est en train de nous arriver ?
Sommes-nous prêts à nous adapter à cette situation ?
Ne serait-il pas plus raisonnable d’essayer de la limiter au maximum ?
Dans ce cas il faut vraiment interroger la croissance.
Mais pour ce faire, je crois qu’aucune évolution ne sera possible si nous ne parvenons pas à diminuer les inégalités et l’injustice de la répartition des richesses dans ce monde.
Et c’est bien les riches qui, dans ce cadre là, doivent faire le plus d’efforts. Je parle des très riches évidemment, mais aussi de nous, membres de la classe moyenne des pays occidentaux qui sommes riches par rapport à la moyenne mondiale.
Sinon, on peut considérer que c’est d’abord aux autres à faire les efforts et continuer comme avant avec cette supplique de Madame du Barry :
« Encore un instant Monsieur le Bourreau ».
Pour finir cette autre photo de New York, le Washington Bridge, publié par le <Financial Times> le 8 juin 2023

<1750>
-
Jeudi 1er juin 2023
« Klaus Mäkelä dirige Chostakovitch dans la Philharmonie de Paris»Mot du jour éphémèreLe concert que nous avons vécu avec Annie et dont j’ai fait le mot du jour du <vendredi 12 mai 2023> n’a pas été enregistré. :
Mais le concert suivant que l’Orchestre de Paris sous la Direction de Mäkelä a joué a été filmé par ARTE et existe en replay.
Il est en ligne jusqu’au 30 novembre 2023.
Ce mot du jour n’ayant que vocation à renvoyer vers cet enregistrement, il deviendra donc obsolète le 1er décembre d’où sa vocation éphémère.
Voici le Programme de ce concert :
Dmitri Chostakovitch :
- Suite pour orchestre de jazz n° 2
- Concerto pour violoncelle n° 2
Entracte
William Walton
- Belshazzar’s Feast.
La première œuvre est particulière et très accessible au plus grand nombre. Ce qui constitue une particularité dans l’œuvre de Chostakovitch
Un des mouvements de cette œuvre (Valse N°2) est connue je crois de tous, puisqu’il a été utilisé dans plusieurs publicité notamment de la <CNP> et puis dans des films comme <Le Guépard> de Luchino Visconti et la scène d’ouverture du dernier film de Stanley Kubrick < Eyes wide shut >
Il commence dans l’enregistrement de Mäkelä à 19 :50
Après cette introduction, un autre chef d’œuvre de Chostakovitch, un peu plus ardu, le 2ème concerto de violoncelle avec la lumineuse Sol Gabetta.
Bien qu’il n’est pas possible de comparer cette vidéo avec le Live, il me semble qu’elle permet de percevoir cette extraordinaire symbiose entre le jeune chef et l’Orchestre de Paris. Ce sont des interprétations superlatives, encore une fois.
Je ne dirai rien de l’œuvre du britannique William Walton en seconde partie, sinon que j’y suis moins sensible…
Donc vous trouverez cela dans le Replay des concerts ARTE.
Sur Internet vous trouverez cela sur le site de la <Philharmonie Live> et sur le site d'<ARTE>
<Mot du jour éphèmère>
- Suite pour orchestre de jazz n° 2
-
Mercredi 17 mai 2023
« Être soi-même ne devrait jamais être un crime. » »António Guterres Secrétaire général de l’ONU dans son message du 11 mai 2023Avant on parlait d’homophobie, et le 17 mai était désigné par l’ONU comme « La journée internationale contre l’homophobie »
Désormais, l’ONU parle, en 2023, de « La Lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie »
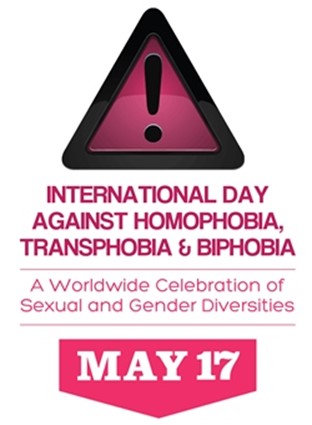 Le Conseil de l’Europe, en est resté à la première appellation : « Journée internationale contre l’homophobie »
Le Conseil de l’Europe, en est resté à la première appellation : « Journée internationale contre l’homophobie »
Une journée internationale (ou journée mondiale) est un jour de l’année dédié à un thème particulier à un niveau international ou mondial. Le calendrier de l’Organisation des Nations unies en prévoit plus de 140.
La date choisie a toujours un rapport avec l’objet de la journée.
Ainsi, la première ayant été instituée, le fut en 1950 : « La journée mondiale des droits de l’homme » fut fixée au 10 décembre.
L’explication tient au fait que le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies avait adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Alors pourquoi le 17 mai, pour lutter contre l’Homophobie ?
Parce que le 17 mai 1990 l’Organisation Mondiale de la Santé a décidé de ne plus considérer l’homosexualité comme une maladie mentale !
Ce n’est pas très ancien, 1990, c’était il y a 33 ans !
La France l’avait fait en 1981 avec l’arrivée de la Gauche et de Mitterrand au pouvoir. Ce n’était que 9 ans avant…
La journée est originaire du Québec. La Fondation Émergence a créé en 2003 la première journée nationale contre l’homophobie.
Mais la première journée, organisée à un niveau international, eu lieu le 17 mai 2005 grâce à Louis-Georges Tin, un professeur et activiste français. Il a été le président du Comité IDAHO (du nom de la journée en anglais, International Day Against Homophobia and Transphobia) entre 2005 et 2013.
Dans son message du 11 mai 2023 qui annonçait la journée du 17 mai, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, disait :
« Alors que nous célébrons la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, la constatation est saisissante. Partout dans le monde, les personnes LGBTQI+ continuent de connaître la violence, la persécution, les discours haineux, l’injustice, voire le meurtre pur et simple.
Parallèlement, des lois rétrogrades continuent de criminaliser les personnes LGBTQI+ dans le monde, les punissant du simple fait d’être elles-mêmes.
Chaque agression contre les personnes LGBTQI+ est une agression contre les droits humains et les valeurs qui nous sont chères.
Nous ne pouvons pas faire marche arrière et nous ne le ferons pas.
L’ONU soutient fermement la communauté LGBTQI+ et ne cessera son action que lorsque les droits humains et la dignité seront une réalité pour toutes les personnes.
Je demande à nouveau à tous les États Membres de respecter la Déclaration universelle des droits de l’homme et de mettre fin à la criminalisation des relations consensuelles entre personnes du même sexe et à celle des personnes transgenres. Être soi-même ne devrait jamais être un crime. »
Pour ceux qui ne connaissent pas précisément le sigle LGBTQI+, en voici le détail : Par L, on entend « Lesbiennes », par G « Gays », par B « Bisexuel·le·s », par T « Trans », par Q « Queers », par I « Intersexué·e·s », par A « Asexuel·le·s » ou « Aromantique·s » et le + inclut les nombreux autres termes désignant les genres et les sexualités. Plus précisément Queer, en anglais, signifie bizarre, inadapté, C’est le mot que l’on lançait à ceux qui n’étaient pas assez masculins, aux femmes aux allures de garçonnes, aux êtres dont le genre brouille les pistes. Bref, ce sigle entend englober toutes les tendances sexuelles.
 Mais dans le monde cette journée n’est célébrée que dans environ 60 Etats. C’est ce qu’on lit sur ce <site> qui rappelle aussi que la dernière exécution par la France s’est déroulée, à Paris, en Place de grève (c’est-à-dire la Place de l’Hôtel de Ville) le 6 juillet 1750 : Bruno Lenoir et Jean Diot furent brulés après avoir été étranglés.
Mais dans le monde cette journée n’est célébrée que dans environ 60 Etats. C’est ce qu’on lit sur ce <site> qui rappelle aussi que la dernière exécution par la France s’est déroulée, à Paris, en Place de grève (c’est-à-dire la Place de l’Hôtel de Ville) le 6 juillet 1750 : Bruno Lenoir et Jean Diot furent brulés après avoir été étranglés.
Le site de la journée mondiale nous apprend que :
« Dans 72 états au moins, les actes homosexuels sont condamnés par la loi (Algérie, Sénégal, Cameroun, Ethiopie, Liban, Jordanie, Arménie, Koweït, Porto Rico, Nicaragua, Bosnie…) ; dans plusieurs pays, cette condamnation peut aller au-delà de dix ans (Nigeria, Libye, Syrie, Inde, Malaisie, Cuba, Jamaïque…) ; parfois, la loi prévoit la détention à perpétuité (Guyana, Ouganda). Et dans une dizaine de nations, la peine de mort peut être effectivement appliquée (Afghanistan, Iran, Arabie Saoudite…).
En Afrique, récemment, plusieurs présidents de la république ont brutalement réaffirmé leur volonté de lutter personnellement contre ce fléau selon eux « anti-africain « . Dans d’autres pays, les persécutions se multiplient. Au Brésil par exemple, les Escadrons de la mort et les skin heads sèment la terreur : 1960 meurtres homophobes ont pu être recensés officiellement entre 1980 et 2000. Dans ces conditions, il paraît difficile de penser que la « tolérance » gagne du terrain. Au contraire, dans la plupart de ces Etats, l’homophobie semble aujourd’hui plus violente qu’hier. La tendance n’est donc pas à l’amélioration générale, tant s’en faut. »
En effet, l’homophobie semble ne pas régresser sur une grande partie de l’humanité. Poutine est parmi ceux qui sont ouvertement homophobes et qui dénoncent la lutte contre l’homophobie comme une valeur occidentale qu’il faut combattre.<En Ouganda> le Président Yoweri Museveni vient de promulguer une loi anti-homosexualité 2023. Joe Biden a dénoncé une « atteinte tragique » aux droit humains.
Au Maroc, une enseignante d’une classe de CM1 de l’école primaire française Honoré-de-Balzac de Kénitra, dans laquelle elle travaillait depuis 30 ans, a été suspendue suite à la plainte de parent d’élèves pour soi-disant « apologie de l’homosexualité ». La majorité des parents la soutiennent et considèrent cette sanction comme une injustice.
Mais <Libération> précise :
« Apologie de l’homosexualité». Au Maroc, l’accusation est grave. Dans un pays où l’homosexualité est punie jusqu’à trois ans d’emprisonnement, la « propagande LGBT» est considérée comme une atteinte à la religion et est donc encore plus sévèrement condamnée, avec des peines allant de trois à cinq ans de prison. »
L’affaire est devant la justice marocaine.
J’en avais déjà parlé lors du <mot du jour du 14 septembre 2022>, comme chaque année, le monde du football a organisé la journée dédiée à la lutte contre l’homophobie, pour laquelle il était demandé que les joueurs des 20 équipes de Ligue 1 arborent un maillot floqué de l’arc-en-ciel des fiertés LGBT, en marque de soutien.
Plusieurs joueurs ont comme l’année dernière refusé de porter ce brassard et ont alors été écarté par leur club et n’ont pas joué lors de cette journée. Parmi eux je citerais le marocain jouant à Toulouse Zakaria Aboukhlal parce qu’il a essayé de justifier sa position :
« Je tiens à souligner que j’ai la plus grande estime pour chaque individu, quels que soient ses préférences personnelles, son sexe, sa religion ou ses origines. c’est un principe que l’on ne soulignera jamais assez. Le respect est une valeur que j’estime beaucoup. Il s’étend aux autres mais comprend également le respect de mes propres croyances personnelles. Par conséquent, je ne crois pas être la personne la plus appropriée pour participer à cette campagne. J’espère sincèrement que ma décision sera respectée, tout comme nous souhaitons tous d’être traités avec respect. »
La campagne dont il parle ne lui demande pas de devenir homosexuel, mais simplement de rejeter toute forme de discrimination à leur égard.
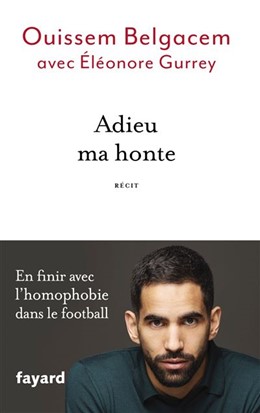 Dans « L’Equipe » du 16 mai 2023, on peut lire la réponse d’un ancien joueur de Toulouse, Ouissem Belgacem, franco-tunisien et qui revendique la même religion musulmane que Zakaria Aboukhlal :
Dans « L’Equipe » du 16 mai 2023, on peut lire la réponse d’un ancien joueur de Toulouse, Ouissem Belgacem, franco-tunisien et qui revendique la même religion musulmane que Zakaria Aboukhlal :
« [Je ne le comprends pas] Il est en train de dire : « Je suis homophobe et respectez-moi » Sauf que dans notre pays, l’homophobie est punie par la loi. C’est décevant et lâche. Il y a des millions de Français de confession musulmane qui n’ont aucun problème avec l’homosexualité. En faisant ce choix, il nourrit [le sentiment anti musulman] en France. […] Les gens vont conclure que ce n’est pas le football qui a un problème avec l’homosexualité mais les footballeurs musulmans »
Ouissem Belgacem a écrit un livre « Adieu ma honte » dans lequel il parle de son homosexualité et du monde du football par rapport à ce sujet. Dans l’article il a encore cette formule : « Raciste ou homophobe, c’est pareil. »
L’homophobe qui demande le respect s’est trouvé mêlé à une autre histoire de respect. Cet épisode est aussi relaté dans l’Equipe.
Comme le club de Toulouse avait gagné la Coupe de France, la Mairie de Toulouse avait organisé une fête dans ses locaux. Et pendant le discours du Maire, avec d’autres joueurs il faisait beaucoup de bruit. Alors, Laurence Arribagé, adjointe aux Sports à la mairie de Toulouse, leur a demandé de faire moins de bruit.
Zakaria Aboukhlal a alors interpellé l’élue toulousaine par ces mots :
« Dans mon pays les femmes ne parlent pas aux hommes comme cela »
Cet individu veut donc que l’on respecte son homophobie et que la femme respecte l’homme en ne le critiquant jamais.
Cette vision du « respect » ne me parait pas très respectable.
Mais aux États-Unis, dans certains États, la situation est tout aussi préoccupante.
En Floride, le gouverneur Ron Santis qui a pour ambition de gagner les primaires républicaines contre Trump, puis de devenir Président des Etats-Unis, s’est attaqué aux livres dans les écoles qui font mention de l’homosexualité, il a aussi attaqué Walt Disney qu’il juge trop inclusif.
Et maintenant comme le révèle <France Info> il entend aller plus loin et publier une Loi prévoyant que les médecins auraient la possibilité d’opposer une clause de conscience, leur permettant de refuser de soigner un patient si celui-ci n’est pas en phase avec leur vision des mœurs. « Je ne peux pas vous soigner, votre orientation sexuelle me l’interdit »
Ceci me conduit à deux conclusions :
- Quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites !
- Les fondamentalistes de toutes les religions se rejoignent dans leur intolérance et leur rejet de ceux qu’ils accusent d’être déviants, alors qu’ils ne sont que différents de ce que leur raconte le récit auquel ils adhérent.
<1749>
- Quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites !
-
Vendredi 12 mai 2023
« Symphonie n°7 « Leningrad » »Dimitri ChostakovichUne nouvelle fois, ce jeudi 11 mai 2023, Annie et moi avons pris le train pour aller à Paris.
 Notre destination était ce joyau posé au bord du périphérique, dans la partie sud-est du parc de la Villette, face à la Grande Halle de la Villette, à côté de la Cité de la musique et à proximité de la Porte de Pantin : La Philharmonie de Paris.
Notre destination était ce joyau posé au bord du périphérique, dans la partie sud-est du parc de la Villette, face à la Grande Halle de la Villette, à côté de la Cité de la musique et à proximité de la Porte de Pantin : La Philharmonie de Paris.
Cette œuvre architecturale, attribuée à Jean Nouvel, a été inaugurée le 14 janvier 2015.
Et depuis la 1ère saison 2015/2016, nous avons, avec Florence, souscrit chaque année un abonnement, jusqu’à la période COVID en 2020, pendant laquelle la moitié de nos concerts a été annulée.
Nous n’avons repris notre abonnement que pour 2022/2023 et le concert du jeudi 11 mai était le dernier de la saison.
 Je parle de joyau, parce que le geste architectural crée la curiosité et attire le regard.
Je parle de joyau, parce que le geste architectural crée la curiosité et attire le regard.
On a envie de s’en approcher, d’en faire le tour et bien sûr d’y pénétrer.
Cet objet constitue l’antithèse du monde des diamants.
Dans une bijouterie l’écrin accueille le joyau.
Ici, au bord du parc de la Villette, le joyau renferme un écrin qui accueille et magnifie les symphonies de sons que la musique des humains est capable d’ériger.
Cet écrin, cette salle de concert de 2400 places a pour nom : salle Pierre Boulez.
Car c’est le compositeur et chef d’orchestre Pierre Boulez qui voulait et qui plaidait pour que les institutions culturelles créent ce lieu, à Paris.
 Pierre Boulez a pu visiter le chantier mais n’a jamais vu le résultat final.
Pierre Boulez a pu visiter le chantier mais n’a jamais vu le résultat final.
Début 2015, malade, quasi aveugle, le musicien qui vivait à Baden-Baden en Allemagne, n’a pas pu venir à Paris.
Il est mort, un an plus tard le 5 janvier 2016. Alors, il a été décidé d’appeler l’écrin du nom de cet homme.
Mais Boulez aurait-il apprécié le concert que nous avons vécu ce jeudi, car le cœur du programme était constitué par la 7ème symphonie de Chostakovitch, celle qui a pour nom « Léningrad » ?
Or Boulez considérait Chostakovitch comme un compositeur de seconde zone : « un succédané de Mahler ». Et il avait précisé sa pensée dans un quotidien britannique :
« C’est comme pour les huiles d’olive : il y a les premières pressions et les autres. Je dirais que Chostakovitch est une deuxième ou troisième pression de Mahler. »
J’ai entendu récemment Daniel Barenboïm qui, dans des termes plus mesurés que son grand ami Boulez, jugeait Chostakovitch avec la même sévérité.
 Christian Merlin a consacré, la semaine du 15 mai 2023, 4 émissions à la musique orchestrale de Chostakovitch. Dans une de ses émissions il a cité Herbert von Karajan qui a dit :
Christian Merlin a consacré, la semaine du 15 mai 2023, 4 émissions à la musique orchestrale de Chostakovitch. Dans une de ses émissions il a cité Herbert von Karajan qui a dit :
« Si j’étais compositeur, je composerais comme Dimitri Chostakovitch »
Pour ma part, je suis résolument d’accord avec Karajan. J’avais déjà fait remarquer que Boulez disait beaucoup de bêtises sur les autres compositeurs. Dans ma série sur Schubert je l’avais cité dans cette phrase indéfendable :
« Si Schubert a écrit une seule note de musique, cela veut dire que je n’ai rien composé du tout. »
Ma conclusion fut :
« Si on prend cette phrase au premier degré, je pense que c’est la deuxième proposition qui est la plus vraisemblable. »
Nous avons donc eu la grâce d’entendre cette symphonie qui a pour nom « Léningrad ». Le compositeur Dimitri Chostakovitch (1906–1975) a terminé cette symphonie le 27 décembre 1941 et l’a dédiée à sa ville natale, attaquée depuis seize semaines. Léningrad est assiégée pendant 900 jours par l’Allemagne nazie, et environ un tiers de la population urbaine d’avant-guerre est tuée.
Le journal canadien « Le Devoir » écrit dans un article de 2018 : < La «Leningrad» de Chostakovitch: une symphonie pour l’humanité> :
« Bien des épisodes liés à la symphonie « Leningrad » sont épiques. Lorsque Chostakovitch joua au piano les trois premiers mouvements à des amis le 17 septembre 1941, le siège de la ville venait de commencer. L’un des participants raconte le hurlement des sirènes, Chostakovitch évacuant sa femme et ses deux enfants à l’abri et continuant de jouer au piano dans le vacarme de la défense antiaérienne. « Pour finir, il rejoua l’ensemble […]. En rentrant, nous aperçûmes du tramway les lueurs de l’incendie […]. Encore sous le coup du noble pathos de cette symphonie, nous ressentions avec une acuité toute particulière l’absurdité de ce qui nous entourait. »
« Wikipedia » a consacré un article à la « Création à Léningrad de la symphonie no 7 de Chostakovitch ». C’est une page d’Histoire absolument incroyable et unique, il me semble que tout homme de culture et d’Histoire, même celles et ceux qui ont des difficultés avec la musique classique devrait lire cette page d’Histoire que j’essaie de résumer. :
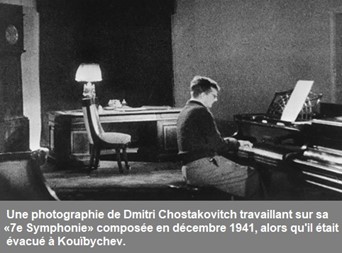 Chostakovitch prévoyait que la création de la symphonie reviendrait à la Philharmonie de Léningrad, mais l’ensemble est évacué. La première mondiale est donnée à Kouïbychev aujourd’hui Samara, le 5 mars 1942.
Chostakovitch prévoyait que la création de la symphonie reviendrait à la Philharmonie de Léningrad, mais l’ensemble est évacué. La première mondiale est donnée à Kouïbychev aujourd’hui Samara, le 5 mars 1942.
Puis la symphonie sera jouée le 29 mars à Moscou.
La partition de la symphonie sera microfilmée pour s’envoler pour Téhéran en avril, afin de permettre sa publication à l’Ouest. Elle est créée à Londres, le 22 juin par le London Philharmonic Orchestra. Et puis la première américaine aura lieu, le 19 juillet 1942, par le plus illustre chef d’orchestre vivant Arturo Toscanini dirigeant son Orchestre symphonique de la NBC.
Mais l’État soviétique parviendra finalement à faire jouer cette symphonie dans la ville de Léningrad assiégée dans la grande salle de la Philharmonie le 9 août 1942, jouée par le seul ensemble symphonique restant à Léningrad, après l’évacuation de la Philharmonie : L’Orchestre symphonique de la Radio de Léningrad — avec son chef Carl Eliasberg.
Après bien des péripéties et une préparation d’une dureté dans les conditions de vie, la faim est omniprésente, dans le danger des combats et des bombardements, dans une discipline de fer imposée par le chef d’orchestre, le concert peut avoir lieu.
« Le concert est donné dans la grande salle de la Philharmonie le 9 août 1942. C’est le jour désigné par Hitler pour célébrer la chute de la ville, avec un somptueux banquet à l’Hôtel Astoria de Léningrad. […]
Le Lieutenant-Général Govorov commande un bombardement des positions de l’artillerie allemande avant le concert, dans une opération spéciale, avec le nom de code « Bourrasque ». Les agents du renseignement soviétique avaient localisé les batteries allemandes et les postes d’observation depuis plusieurs semaines, en préparation de l’attaque. Trois mille obus de fort calibre sont lancés sur l’ennemi. Le but de l’opération est d’empêcher les Allemands de cibler la salle de concert et de s’assurer qu’ils seraient assez silencieux pour laisser entendre la musique sur les haut-parleurs, dont la mise en place avait été ordonnée. Il a aussi encouragé les soldats soviétiques à écouter le concert à la radio. […]
Un public important se rassemble pour le concert, composé de chefs du Parti, de militaires et de civils. Les citoyens de Léningrad, qui ne peuvent pas tous tenir dans la salle, sont rassemblés autour des fenêtres ouvertes et de haut-parleurs. […] L’exécution est de mauvaise qualité artistique, mais est marquée par les houles d’émotions du public, […]
Le concert reçoit une ovation d’une heure, debout, Eliasberg recevant un bouquet de fleurs cultivées à Léningrad remis par une jeune fille. De nombreux auditeurs sont en larmes, en raison de l’impact émotionnel du concert, considéré comme une « biographie musicale des souffrances de Léningrad » […] Pendant le concert, les haut-parleurs diffusent la musique à travers la ville, ainsi qu’à destination des forces allemandes dans un mouvement de guerre psychologique, une « frappe tactique contre le moral des allemands ». Un soldat allemand s’est rappelé que son escadron a « écouté la symphonie des héros ». Eliasberg, quelque temps après, raconte que certains Allemands qui campaient à l’extérieur de Léningrad pendant le concert lui ont dit qu’ils avaient cru qu’ils ne pourraient jamais s’emparer de la ville : « Qui sommes-nous avec nos bombes ? Nous ne serons jamais en mesure de prendre Léningrad. » »
Œuvre d’une puissance et d’une émotion incommensurable, les motivations de Chostakovitch sont ambigües et secrètes.
Chostakovitch déclare à la Pravda le 19 mars 1942, à trois jours de la création moscovite :
« J’ai songé à la grandeur de notre peuple, à son héroïsme, aux merveilleuses idées humanistes, aux valeurs humaines, à notre nature superbe, à l’humanité, à la beauté. […] Je dédie ma Septième Symphonie à notre combat contre le fascisme, à notre victoire inéluctable sur l’ennemi et à Leningrad, ma ville natale ».
Très vite, Staline et les Soviétiques en font un instrument de propagande, l’un des symboles de la « Grande Guerre patriotique ». Il faut dire que les sous-titres prévus par Chostakovitch pour chacun des quatre mouvements allaient dans ce sens : « La guerre », « Souvenirs », « Les grands espaces de ma patrie » et « La victoire ».
Par la suite, il retirera ces titres et dans ses Mémoires Chostakovitch amendera ses propos :
« Je ne suis pas opposé à ce [qu’on l’appelle] Leningrad. Mais il n’y est pas question du siège de Leningrad. Il y est question du Leningrad que Staline a détruit. Et Hitler n’a plus eu qu’à l’achever. »
Pour que cette œuvre puisse nous remplir de vibrations, d’énergie et d’émotion, il faut une interprétation superlative.
Ce fut le cas ce jeudi 11 mai par un Orchestre de Paris transcendé par son jeune chef de 27 ans Klaus Mäkelä.

J’avais déjà parlé de ce jeune chef lors du <mot du jour du 16 mai 2019> déjà à l’occasion d’une symphonie de Chostakovitch : la dixième. Je ne le connaissais pas alors, ni mon Ami Bertrand G. Mais à la fin du concert je lui avais envoyé un sms :
« Tu en entendras parler c’est un chef exceptionnel. Surtout à son âge »
Depuis il a été nommé directeur musical de l’Orchestre de Paris et peu de temps après, futur directeur musical d’un des quatre plus grands orchestres du monde : l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam.
J’ai l’immodestie de prétendre que je n’ai pas besoin de lire l’avis des critiques musicaux pour savoir que j’ai assisté à un concert immense, exceptionnel, un moment d’éternité.
Mais je peux quand même les citer quand ils expriment avec pertinence ce que j’ai ressenti :
Ainsi Remy Louis dans « Diapason Mag » : <le Chostakovitch monumental de Klaus Mäkelä>
« Le résultat est une interprétation monumentale de la Symphonie « Leningrad ». Monumentale par l’autorité, la force, l’intensité physique et sonore (littéralement terrifiante dans certains apogées), l’échelle dynamique vertigineuse, le contrôle des phrasés, la tenue et la cohérence expressive, sans un instant de baisse de tension, ni de trivialité sonore. Mais aussi par la finesse et la clarté magistrale de la structure, le raffinement des nuances et des transitions. […]
Mais ce qui confirme que Mäkelä est un grand directeur musical, et pas seulement un très grand chef, c’est le niveau d’exécution de l’Orchestre de Paris, depuis des mois dans une forme éblouissante. Bois, cuivres et percussions sont admirables, on le sait. Mais jamais l’unité et l’homogénéité de texture des pupitres de cordes […] n’ont été aussi élevées. »
Patrice Imbaud dans « Resmusica »
« Véritable maelström orchestral cataclysmique engageant tout l’orchestre, superbement construit, riche en nuances, porté par une tension intense presque douloureuse qui achève en beauté cette exceptionnelle interprétation. »
Hannah Starman sur le site « Toute la Culture » : « Une Septième de Chostakovitch terrifiante d’actualité à la Philharmonie de Paris » :
« Klaus Mäkelä évoque l’aspect historique « absolument terrifiant » de la Symphonie N° 7 dont l’exécution demande une intense concentration et un investissement émotionnel hors norme. […] La conclusion est massive, expressive, fabuleusement cauchemardesque et interprétée par un chef et un orchestre qui ont tout donné. Le public éprouvé remerciera les musiciens épuisés avec une ovation debout plus que méritée. Une performance exceptionnelle ! »
 Et l’analyse que je préfère celle d’Alain Lompech sur le site « BACHTRACK »
Et l’analyse que je préfère celle d’Alain Lompech sur le site « BACHTRACK »
« Ce soir, l’ovation extraordinaire qui accueille le dernier accord ne doit rien au poids de l’histoire et tout à la puissance créatrice de Chostakovitch, qui provoque l’une de ces émotions collectives que seule la musique peut entraîner. La façon dont les musiciens de l’Orchestre de Paris et leur chef recréent cette Symphonie n° 7 donne à l’ouvrage un visage différent, pas moins intense mais comme résigné parfois, baigné par une lumière crépusculaire étreignante. D’une mobilité expressive incessante, tout entier dans son orchestre bien plus qu’il n’est devant lui et au-dessus de lui, le chef pulvérise les idées reçues : sa compréhension de la forme du propos, sa façon de diriger tout en laissant les musiciens libres de jouer, sa maîtrise du temps, de l’articulation, de la balance orchestrale, de l’art des transitions et de la dynamique, le naturel avec lequel il parvient à ordonner, sans qu’il y paraisse, le premier mouvement et plus encore cette heure et quart de musique fleuve, cinématographique jusque dans sa modulation et son crescendo conclusifs « babyloniens », dont il soulève cette œuvre gigantesque, parfois intime et implorante, jamais triviale ainsi dirigée et jouée font prendre conscience que cette musique issue du cœur retourne au cœur indépendamment de tout scénario, de toute image quand un chef l’aime pour ce qu’elle est. »
Analyse qui finit par cette belle conclusion en forme de prière :
« Et l’Orchestre de Paris à chaque note semble dire à son chef : « reste avec nous Klaus, on joue mieux ici qu’à Amsterdam »…
A la fin du concert, un tout jeune homme assis à côté de nous, rempli d’émotion nous regarde et nous révèle : « Je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi puissant, cela n’a rien à voir avec le disque ».
Sur la route vers la sortie un homme plus âgé m’approuve quand je dis que « l’Orchestre de Paris vit son âge d’or ».
Je crois que ce serait très regrettable que les parisiens qui aiment la musique ou d’autres qui peuvent se rendre à la Philharmonie, négligent l’opportunité de participer à quelques moments de cet âge d’or.
<1748>
-
Mardi 9 mai 2023
« Excusez-moi ; Mais des gens aussi frivoles, aussi peu pratiques, aussi étranges que vous, je n’en ai jamais rencontré. !»Anton Tchekhov, La cerisaie Acte II, réplique de Lopakhine dans la traduction de Jean-Claude CarrièreDimanche 7 mai, nous avons honoré un des cadeaux que mes collègues m’ont offert, lors de mon départ à la retraite : deux places pour le théâtre des Célestins.
 Nous avions choisi le dernier chef d’œuvre écrit par Anton Tchekhov : « La cerisaie »
Nous avions choisi le dernier chef d’œuvre écrit par Anton Tchekhov : « La cerisaie »
La pièce était jouée par le Collectif flamand : <tg Stan>
Comme l’écrit « TELERAMA » : « tg Stan offre une lecture ultra-vivante de la grande pièce de Tchekhov » et ajoute :« Entre loufoquerie, danse cathartique et montagnes russes émotionnelles, le fameux collectif d’Anvers plonge avec fougue dans le grand bain de l’œuvre ultime du grand dramaturge russe. »
Et il est vrai que ces artistes tentent de tirer le plus possible cette œuvre vers son côté de comédie pour respecter la volonté de son auteur qui avait écrit à son épouse Olga Knipper, dans une lettre du 7 mars 1901 :
« La prochaine pièce que j’écrirai sera sûrement drôle, très drôle, du moins dans l’approche. »
 <Wikipedia> écrit :
<Wikipedia> écrit :
« À l’origine, Tchekhov avait écrit cette pièce comme une comédie, comme l’indique le titre dans l’édition Marx de 1904, et même grotesque, comme l’auteur l’indique dans certaines lettres. Aussi, quand il assista à la première mise en scène de Constantin Stanislavski au Théâtre d’art de Moscou, il fut horrifié de découvrir que le metteur en scène en avait fait une tragédie. Depuis ce jour, la nature nuancée de la pièce, et de l’œuvre de Tchekhov en général, est un défi pour les metteurs en scène. »
Ainsi, il existe, sur internet, la version que Peter Brook, dans l’adaptation de Jean-Claude Carrière, avait mis en scène au Théâtre des Bouffes du Nord, en 1981. Dans cette version, c’est le drame qui l’emporte.
L’accent flamand de beaucoup des acteurs donne un aspect encore plus léger à cette interprétation très dynamique.
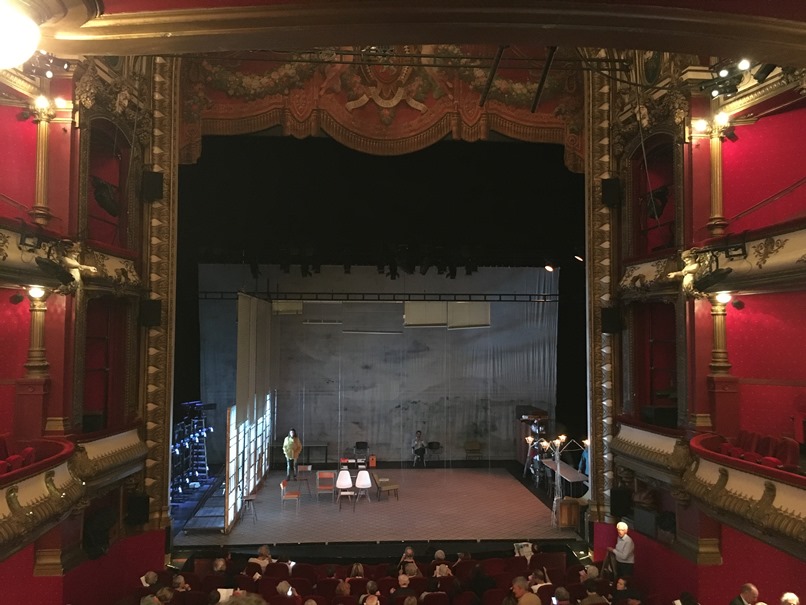 Beaucoup de sites évoquent, à raison, cette interprétation qui tentent d’appuyer sur le côté comique de certaines parties et que tg Stan a joué sur plusieurs scènes avant de venir au Théâtre des Célestins :
Beaucoup de sites évoquent, à raison, cette interprétation qui tentent d’appuyer sur le côté comique de certaines parties et que tg Stan a joué sur plusieurs scènes avant de venir au Théâtre des Célestins :
« Le tg STAN revisite l’âme russe avec une Cerisaie à ciel ouvert »
« La Cerisaie : les Flamands du TG STAN tout en fougue aux Célestins »
Mon ressenti reste cependant que Tchekhov n’est pas pleinement parvenu à remplir son objectif d’écrire une comédie, son art l’a poussé vers le drame, la difficulté de communiquer, de se dire les choses et de les comprendre.
La pièce est d’une richesse inouïe dans l’étude des relations entre les différents protagonistes.
Paul Desveaux qui a mis en scène « La Cerisaie » au Théâtre de l’Athénée (Louis-Jouvet) pense qu’on peut tirer la pièce jusqu’au frontière de la psychanalyse.
Je ressens cette pièce comme un drame qui me parait, en outre, très inspirant pour notre situation moderne.
La trame de cette pièce tient dans le fait qu’une magnifique demeure dont le joyau est une cerisaie, inscrite dans les livres d’Histoire, appartient à une famille noble russe endettée à un tel point que leur domaine hypothéqué va être vendu aux enchères pour éponger les dettes.
Au début de la pièce il reste un peu de temps avant cette échéance. La figure centrale de cette famille noble est une femme : Lioubov qui a passé 5 ans à l’étranger, en France, suite à la perte de son mari puis de la noyade de son fils de 7 ans. Ces éléments de contexte n’encouragent pas la tendance comique.
Face à cette femme, son frère, ses enfants, ses serviteurs se dresse un homme, Lopakhine, enfant et petit enfant de serfs, c’est-à-dire d’esclaves qui étaient au service de cette famille.
Mais le Tsar Alexandre II avait aboli le servage en 1861. Et des esprits conquérants, doués pour les affaires, comme Lopakhine ont pu devenir riche, immensément riche pour sa part.
Cette évolution de l’organisation sociale a eu pour autre conséquence que plusieurs aristocrates, comme Lioubov, se sont appauvris, devenant incapables d’entretenir leurs domaines sans leurs serfs. L’effet de cette réforme était encore ancré quand Tchekhov écrit sa pièce
A la fin, le domaine sera vendu et c’est Lopakine qui va l’acheter.
 Mais Tchekhov présente cette situation avec d’infinie nuance et de complexité dans la relation humaine.
Mais Tchekhov présente cette situation avec d’infinie nuance et de complexité dans la relation humaine.
Car avant cette fin qui va priver Lioubov et sa famille du domaine de leurs ancêtres et de leurs racines, Lopakhine va passer son temps à avertir Lioubov de l’urgence de la situation et lui propose une solution pour laquelle il propose son aide financière et qui permettrait de ne pas vendre tout en réglant les dettes : pour cela il faudrait abattre la cerisaie et utiliser le terrain pour créer un lotissement de maisons à louer.
Lopakhine exprime, en effet, une grande affection pour Lioubov qu’il explique dans la première scène de la pièce :
« C’est une excellente femme, simple, agréable à vivre… Je me rappelle, quand j’étais un blanc-bec de quinze ans, mon défunt père, qui tenait une boutique dans le village, me flanqua un coup de poing dans la figure, et mon nez se mit à saigner. Nous étions venus ici je ne sais pourquoi, et mon père était un peu ivre. Lioubov Andréïevna, toute jeune encore, toute mince, me mena à ce lavabo, dans cette chambre des enfants, et me dit : « Ne pleure pas, mon petit moujik ; avant ton mariage il n’y paraîtra plus. » (Un temps.) Mon petit moujik ! C’est vrai que mon père était un paysan, et moi je porte des gilets blancs et des souliers jaunes ! »
Et dans la scène 2, il introduit sa proposition de solution par cette déclaration à Lioubov :
« Tenez, Lioubov Andréïevna, votre frère Léonid Andréïevitch dit que je suis un manant, un accapareur ; mais ça m’est entièrement égal. Je voudrais seulement que vous ayez confiance en moi comme autrefois, que vos yeux extraordinaires, émouvants, me regardent comme jadis. Dieu miséricordieux ! Mon père était serf de votre grand-père et de votre père ; mais vous avez tant fait pour moi que j’ai oublié tout cela ; je vous aime comme quelqu’un de proche, plus que proche… »
Mais tout au long des actes 1 et 2, sa proposition se heurte à un mur d’incompréhension. Jamais Lioubov ne dit Non. Mais elle comme son frère changent de sujet, parle de détails insignifiants qui n’ont aucun rapport avec son problème central : régler les dettes et conserver la Cerisaie.
A l’acte 2 Lopakhine perd patience :
« LOPAKHINE. – Il faut en finir. Le temps presse. La question est toute simple. Consentez-vous à vendre votre terre par lots, oui ou non ? Ne répondez qu’un seul mot. Un seul ! »
Lioubov enchaine alors :
« Qui a pu fumer ici de détestables cigares ?. »
Il réplique alors par une phrase qui selon moi éclaire la situation :
« Excusez-moi ; Mais des gens aussi frivoles, aussi peu pratiques, aussi étranges que vous, je n’en ai jamais rencontré.
On vous dit clairement : votre bien va se vendre, et c’est comme si vous ne compreniez pas… »
Loubiov – Que devons-nous donc faire ? Dites-le.
LOPAKHINE. – Je ne fais que cela chaque jour. Chaque jour, je répète la même chose. Il faut louer la cerisaie et toute votre propriété comme terrain à villas, et cela tout de suite, au plus tôt. La vente est imminente. Entendez-le. Dès que vous aurez décidé de faire ce que je vous dis, vous aurez autant d’argent que vous voudrez, et vous serez sauvés. »
Lioubov évite à nouveau la question et Lopakhine explose :
« Je vais pleurer, je vais crier ou je vais m’évanouir ; je n’en puis plus ! Vous m’avez mis à bout ! »
L’acte III montrera la Cerisaie vendue. C’est Lopakhine qui a surenchéri sur tous les autres acheteurs. La famille de Lioubov doit partir. Les cerisiers sont abattus et le plan de Lopakhine va se réaliser mais à son seul profit.
Je perçois dans cette formidable œuvre deux éclairages d’aujourd’hui.
Ces familles aristocrates pouvaient entretenir leur domaine parce qu’ils disposaient de main d’œuvre gratuite, d’esclaves qu’il fallait juste nourrir suffisamment pour qu’ils soient capables d’obéir aux ordres de leurs maîtres. Sans ces esclaves, la continuation de leur vie d’avant les entraînait dans l’accumulation de dettes.
Nous devrions reconnaître que notre confort, notre capacité inexpugnable de consommation occidentale n’est ou n’a été possible que parce que quelque part dans le monde, des humains des enfants travaillent quasi gratuitement pour nous permettre d’acheter des biens que nous pouvons payer.
Il y a quelques jours, nous commémorions les dix ans du drame de l’usine textile du Bengladesh, (l’immeuble de neuf étages qui s’était effondré près de Dacca le 24 avril 2013, et qui avait fait 1 127 morts. Cette usine produisait des tonnes de vêtements vendus dans les magasins occidentaux. J’avais évoqué ce drame par cette question posée par Michel Wieviorka et Anthony Mahé
Le second éclairage de nos temps présents est constitué par ces avertissements, comme ceux que Lopakhine exprime tout au long de « la Cerisaie », qui nous informent que notre vie quotidienne va être affectée de manière extrême par le réchauffement climatique, par la chute de la biodiversité, par la diminution des ressources en matière première et nous ne faisons rien ou si peu.
Nous considérons normal que lorsqu’on tourne le robinet, l’eau coule. Nous n’avons pas l’assurance qu’il en sera toujours ainsi.
Quand nous appuyons sur un bouton électrique, la lumière jaillit ou les appareils qui nous facilitent si grandement la vie se mettent à fonctionner. Pourrons nous disposer de toute l’électricité dont nous estimons avoir besoin pour notre confort ?
Vendredi 5 mai, nous avons appris que le Conseil national de la transition écologique, qui regroupe des élus et représentants de la société civile, prévoyait que la France risquait de vivre avec un réchauffement climatique allant jusqu’à quatre degrés de plus d’ici la fin du siècle. Le gouvernement considère cette prédiction comme plausible.
Cette perspective constitue un bouleversement de notre espace de vie assez proche de la perte de contrôle.
Ce sont ces pensées que le chef d’œuvre de Tchékhov a suscité en moi.
<1747>
-
Jeudi 27 avril 2023
« Cette résistance à la cruauté du monde, qu’offre la passion aux êtres qu’elle habite. !»Jean-Guy SoumyQu’est-ce qu’un bon livre ?
Probablement que chacun possède sa propre réponse.
Pour moi, c’est un livre qui lorsque j’y entre je n’arrive à en sortir qu’une fois la dernière page atteinte. Il n’est pas possible de s’arrêter avant.
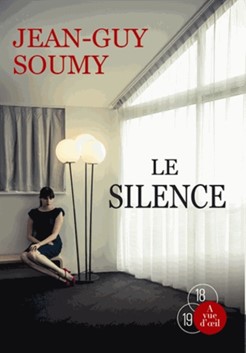 Ce fut le cas pour « Le Silence » de Jean-Guy Soumy, commencé en début d’après-midi, je ne l’ai lâché qu’en début de soirée lorsque je l’avais terminé.
Ce fut le cas pour « Le Silence » de Jean-Guy Soumy, commencé en début d’après-midi, je ne l’ai lâché qu’en début de soirée lorsque je l’avais terminé.
Je ne connaissais pas Jean-Guy Soumy avant que Sophie m’en parle. Elle a marqué tant d’enthousiasme pour cet auteur, que j’ai voulu tenter l’aventure.
Je suis allé dans une des bibliothèques de Lyon qui devait détenir 3 de ses livres. Quand je suis arrivé, deux étaient prêtés, il restait « Le silence », alors je l’ai emprunté.
Jean-Guy Soumy est né le 1er juin 1952 à Guéret dans la Creuse, département dans lequel il habite toujours.
Après ses études, il est devenu professeur de mathématiques.
Sa page Wikipédia nous apprend qu’il est coauteur d’ouvrages de mathématiques parus dans la collection « Vivre les mathématiques » chez l’éditeur Armand Colin.
Mais son grand dessein est d’écrire des romans.
Il fait partie de la « Nouvelle école de Brive » dans laquelle se trouvait aussi Claude Michelet, l’auteur de « Des grives aux loups. » et qui est décédé le 26 mai 2022.
Claude Michelet avait fait auparavant partie de « L’école de Brive » qu’on avait décrit comme un mouvement régionaliste. Ce que Michelet nuançait dans cet article d’« Ouest France » de juillet 2013 :
« Ce n’est pas que ça. Dans nos œuvres, on est allé bien au-delà des terroirs de France. Yves Viollier a écrit des romans qui se déroulent en Russie, moi, j’ai écrit une saga qui se déroule en grande partie au Chili. Ce serait trop réducteur. »
En revanche, il expliquait que ce n’est pas du tout le cas de « la Nouvelle Ecole de Brive » :
« Là, c’est plus informel. Nous sommes quatre, Gilbert Bordes, moi-même, Jean-Guy Soumy et Yves Viollier, qui prenons plaisir à nous voir et nous entraider. Nous n’hésitons pas à nous refiler des tuyaux sur tel ou tel thème qu’un de nous travaille. On dit toujours que les écrivains se détestent. Vous voyez que ce n’est pas vrai ! On a plaisir à se retrouver et à parler littérature ensemble, comme un groupe d’amis. »
Concernant le livre « Le Silence » son action se déroule en grande partie à Chicago où Alexandre Leroy est un mathématicien célèbre, chercheur et professeur universitaire ayant obtenu la Médaille Fields qu’on appelle « Le Nobel » des mathématiciens. La fin du roman ramènera l’action en France, car c’est le pays d’origine d’Alexandre Leroy.
Le roman commence par le désarroi de Jessica son épouse qui est professeur de littérature à l’Université et à qui on vient d’apprendre que son mari Alexandre vient de se suicider dans un motel alors qu’elle pensait qu’il était allé dans leur maison secondaire pour aller travailler, comme il le faisait régulièrement et comme il le lui avait dit avant de partir.
Pourquoi s’est-il suicidé ?
Voici la question. Il n’a pas laissé de lettre.
Jessica qui est le personnage central de ce livre, ne comprend pas.
Tout ce livre est constitué par ses découvertes d’abord fortuites puis conséquence de ses recherches et de sa quête pour essayer de comprendre le geste de l’homme de sa vie.
C’est vraiment remarquable. L’histoire est très forte et l’écriture très fluide avec des fulgurances qui saisissent.
Lors de l’enterrement, Soumy délivre cette description qui s’achève par une conclusion que j’ai utilisée comme exergue
« Des silhouettes s’approchent. Des hommes défilent devant elle. Tous collègues ou étudiants d’Alexandre. Qui rendent hommage à leur maître sans que Jessica puisse deviner si le souvenir laissé par son mari leur est agréable ou pénible. Ils ont en commun quelque chose d’insaisissable qui la renvoie au défunt. Une légèreté d’artiste enfouie sous le simulacre de la gravité. Cette résistance à la cruauté du monde, qu’offre la passion aux êtres qu’elle habite »
Page 16
La passion emporte tout et permet aussi de résister à la cruauté du monde.
Et il est possible d’être passionné par les mathématiques, cette passion qui a mené certains vers la folie.
« Le Point » a posé cette question dans un article de 2018 : « Les mathématiques rendent-elles fou ? »
L’article ne répond pas à cette question, mais cite plusieurs mathématiciens : Kurt Gödel, Georg Cantor, John Nash, Grigori Perelman qui chacun à leur manière avaient perdu le sens des réalités et des relations équilibrées avec les autres humains.
Il cite aussi le cas plus connu par un plus large public de Alexandre Grothendieck :
« En 1966, il reçoit lui aussi la médaille Fields pour avoir refondé la géométrie algébrique… et la refuse ! Il s’installe dans un village de l’Hérault au sein d’une communauté adepte de la contre-culture. Il devient un chantre de l’écologie. Puis il se retire en Ariège pour vivre tel un ermite, refusant tout contact avec ses anciens amis. Il meurt en 2014, laissant des milliers de pages couvertes de notes. »
Jean-Guy Soumy cite d’ailleurs Grothendieck au début de son ouvrage :
« Ces deux passions, celle qui anime le mathématicien au travail, disons, et celle en l’amante ou en l’amant, sont bien plus proches qu’on ne le soupçonne généralement ou qu’on est disposé à l’admettre. »
Alexandre Grothendieck « Récolte et Semailles »
Mais que celles et ceux pour qui les mathématiques n’ont jamais été une passion mais plutôt une souffrance, se rassurent il n’y pas de mathématiques dans cet ouvrage. C’est simplement un élément de contexte.
L’histoire se déroule à travers le regard de Jessica qui est professeur de littérature et qui doit faire face à ce qu’elle vit comme une trahison. Elle doitt aussi être le roc sur lequel peuvent s’appuyer les deux fils qu’elle a eu avec Alexandre. Le premier a suivi la même carrière que son père, tout en n’en possédant pas le génie, il se sent fragilisé par cet acte incompréhensible. Mais la situation est encore plus compliquée pour le second qui souffre d’autisme.
Soumy met cette phrase dans la bouche de Jessica :
« Et je veillerai sur mon enfant, je le consolerai, je boirai ses larmes, je sécherai ses peines. Une mère est là pour ça »
Page 176
Ce livre, en outre, ouvre vers un auteur étonnant au destin tragique : Armand Robin. Jessica est la spécialiste de cet auteur qu’elle a étudié intensément et dont les écrits auront un rôle à jouer dans l’intrigue.
J’ai voulu en savoir un peu plus sur cet auteur.
Armand Robin est né en 1912 à Plouguernével, en Bretagne et il est mort le 29 mars 1961.
C’est à la fois un écrivain, un traducteur, un journaliste, un critique littéraire et un homme de radio.
Il semble qu’il existe de nombreuses controverses à son sujet. Mais ce qui parait époustouflant c’est sa capacité d’apprendre des langues.
Je cite Wikipedia :
« il entreprend en 1932 l’étude du russe et du polonais, en 1933 de l’allemand, en 1934 de l’italien, en 1937 de l’hébreu, de l’arabe et de l’espagnol, en 1941 du chinois, en 1942, de l’arabe littéral, en 1943 du finnois, du hongrois et du japonais […]
Écrivain inclassable, libertaire, poète, il traduit en français, depuis une vingtaine de langues, une centaine d’auteurs dont Goethe, Achim von Arnim, Gottfried Benn, Max Ernst, Lope de Vega, José Bergamín, Vladimir Maïakovski, Boris Pasternak, Sergueï Essénine, Alexandre Blok…. »
En 1933, il voyage en URSS. Il en revient anticommuniste.
Et en 1945, il adhère à la Fédération anarchiste et contribue de cette date à 1955 au journal Le Libertaire.
Sa fin tragique nous révèle qu’en 1961 aussi, il était légitime de s’interroger sur la possibilité de violences policières :
Arrêté le 28 mars 1961 après une altercation dans un café, il est conduit au commissariat du quartier et y est « passé à tabac » par les policiers. Transféré à l’infirmerie spéciale du dépôt de la Préfecture de police de Paris, il y meurt seul le lendemain dans des conditions qui n’ont jamais été éclaircies.
Françoise Morvan qui semble une spécialiste de cet auteur a écrit « Armand Robin ou le mythe du poète »
La même écrit sur son blog une page dans laquelle elle entend démonter des contrevérités et falsifications sur « Armand Robin »
En 2011, France Culture lui a réservé une émission : <Armand Robin bouge encore>
En conclusion, un livre palpitant et l’ouverture vers un autre auteur aussi étrange que fascinant.
<1746>
-
Vendredi 21 avril 2023
« Une librairie qui meurt, ce n’est pas une page qui se tourne, c’est un livre qui se ferme, à jamais !»Henri LoevenbruckC’est en me promenant, à Lyon entre la basilique d’Ainay et la Place Bellecour, que j’ai vu l’annonce :
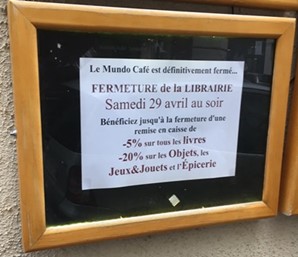 « Fermeture de la Librairie »
« Fermeture de la Librairie »
C’était une librairie particulière.
Elle avait pour adresse : 14 Rue du Plat.
Elle avait pour nom : « Raconte-moi la terre »
Librairie du voyage, des cultures du monde et aussi de la transition écologique, c‘était une librairie-café, car on pouvait aussi y aller déguster un café.
Elle disposait même d’une salle de conférence en sous-sol.
Annie l’avait découverte et y avait organisé, plusieurs fois, des réunions et des rencontres de travail.
Car le lieu était accueillant.
La Grande Librairie l’avait visité et il en reste <une vidéo>.

La Période après Covid a été trop compliquée, l’équilibre financier ne permettait pas de continuer
C’est triste, une librairie qui ferme.
Dans mon monde idéal il y a beaucoup de librairies et il n’y a pas Amazon.
Du moins pas Amazon comme il fonctionne actuellement
Il pourrait peut-être se justifier si son unique objet était de livrer tous les livres du monde à des Librairies avec à l’intérieur des humains, cultivés qui aiment les livres, c’est-à-dire des libraires. Ces libraires qui font partager à celles et ceux qui viennent dans leur magasin le goût de lire et les aide à choisir.
 J’avais écrit une série de mots sur Amazon, elle avait débuté le 24 juin 2021 « Amazon nous veut-il du bien ? »
J’avais écrit une série de mots sur Amazon, elle avait débuté le 24 juin 2021 « Amazon nous veut-il du bien ? »
En France, selon <le syndicat de la Librairie> il existe 3.500 librairies indépendantes.
C’est beaucoup plus qu’aux États-Unis. D’après <cette publication> de 2019, sur tout le territoire des États-Unis il existe moins de 2 300 librairies indépendantes.
Dans mon monde idéal, il n’y aurait pas Amazon.
Mais je suis un réaliste, dans notre monde Amazon existe.
Fallait-il pour autant que notre Président, en pleine période de manifestations sur les retraites, décore le fondateur Jeff Bezos ?
Plusieurs journaux nous ont relaté cette incongruité :
Mais il semble que ce soit « Le Point » qui a dégainé le premier : <Les indiscrets – Macron décore Bezos en secret> :
« Cérémonie fastueuse mais confidentielle, jeudi 16 février en fin d’après-midi au palais de l’Élysée : Emmanuel Macron a remis les insignes de la Légion d’honneur à l’Américain Jeff Bezos, 4e fortune mondiale (111,3 milliards de dollars fin 2022), de passage à Paris.
L’événement, prévu depuis plusieurs semaines, ne figurait pas à l’agenda officiel et n’a été suivi d’aucun communiqué.
L’Élysée avait-il peur d’un fâcheux télescopage le jour où des milliers de manifestants défilaient contre la réforme des retraites ?
Seuls quelques invités triés sur le volet ont assisté à la réception.
Beau joueur, le fondateur d’Amazon avait convié le patron de LVMH, Bernard Arnault, qui le devance désormais (1er, selon Forbes, avec 184,7 milliards de dollars). »
La Légion d’honneur naît le 19 mai 1802 par la volonté du Premier consul, Napoléon Bonaparte.
Elle visait à l’époque à récompenser les citoyens français. D’abord pour saluer la bravoure ou la stratégie militaire, mais aussi pour gratifier des civils en raison de leur mérite au profit de la patrie.
Le site de <l’Ordre de la Légion d’Honneur> explique que :
« Les légionnaires œuvrent au bénéfice de la société et non dans leur intérêt exclusif. Les décorés, dans toute la diversité de leurs activités, contribuent au développement de la France, à son rayonnement, à sa défense. »
Il est donc légitime de se poser les questions suivantes :
- Jeff Bezos œuvre t’il au bénéfice de la société ou dans son intérêt exclusif ?
- Contribue t’il au développement de la France ? à son rayonnement ? à sa défense ?
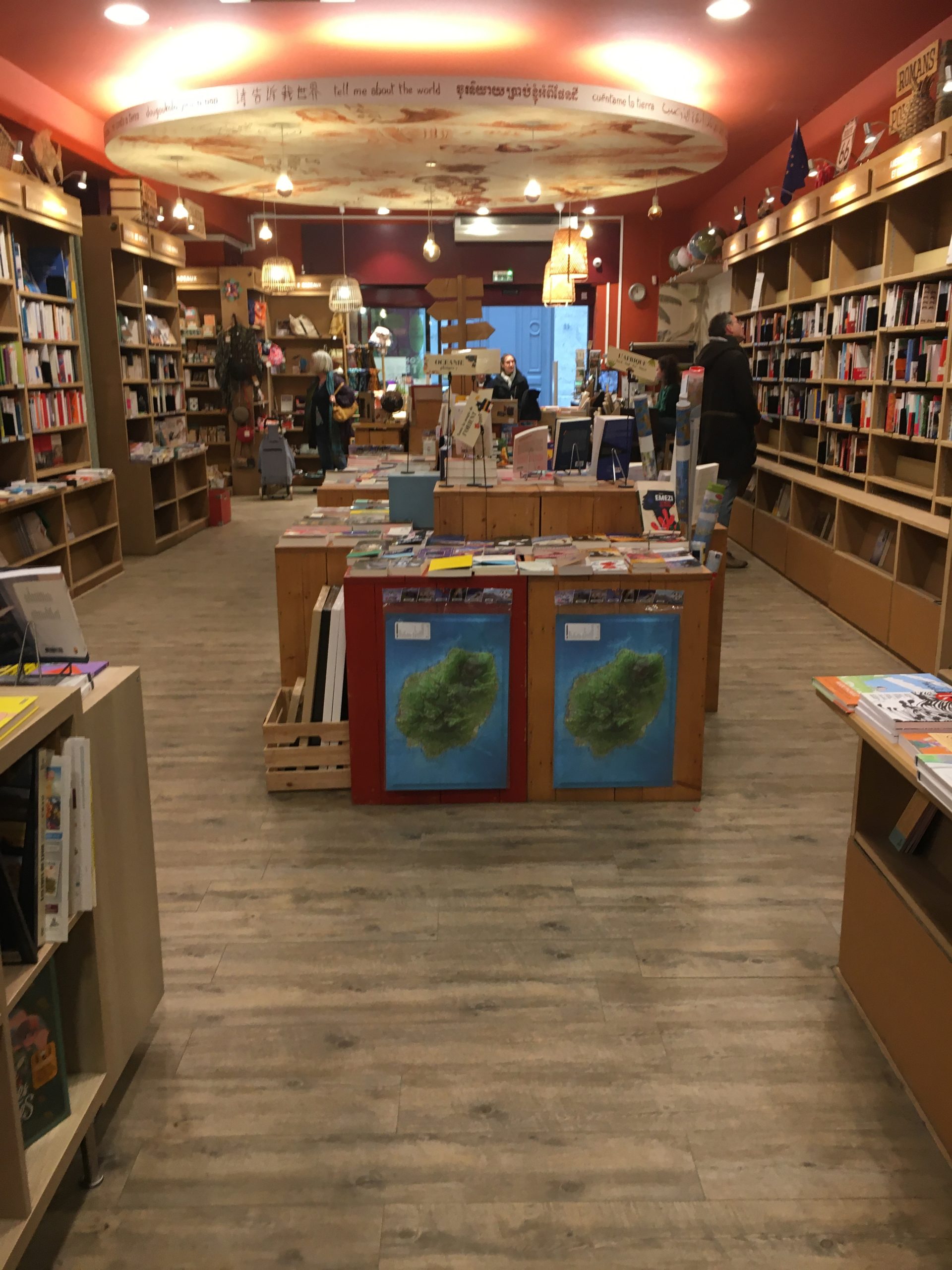 Pour contribuer à la Défense, il faudrait déjà qu’il paie les impôts, en France, en proportion de ses profits, ce qui de source sûre n’est pas le cas.
Pour contribuer à la Défense, il faudrait déjà qu’il paie les impôts, en France, en proportion de ses profits, ce qui de source sûre n’est pas le cas.
Pourquoi le président de la République a-t’il distingué le fondateur d’Amazon, à l’Élysée, jeudi 16 février, en pleine cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ?
Parce qu’il crée de l’emploi en France, semble être l’argument.
Il couvre, en effet, la France d’entrepôts. Cela fait-il rayonner la France ?
Le Monde rappelle que la décoration d’un grand patron étranger par l’Élysée n’est pas sans précédent : Jamie Dimon, le patron de la banque JPMorgan Chase a reçu la Légion d’honneur en novembre 2022.
Et avant Emmanuel Macron,
- Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, avait été fait commandeur de la Légion d’honneur par François Hollande,
- Le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, avait été décoré par Nicolas Sarkozy
- Jacques Chirac avait distingué Shoichiro Toyoda, le patron du constructeur japonais Toyota.
« Le Monde » analyse que :
« [Cette distinction] accordée par M. Macron à M. Bezos illustre la dualité de la politique du président à l’égard du fondateur d’Amazon. Comme ailleurs, il a pratiqué le « en même temps ». Sous sa présidence, la France a poussé des régulations européennes renforçant les responsabilités et le respect de la concurrence des plates-formes comme Amazon. Elle a instauré une taxation des services numériques et obligé les services comme Prime Video (filiale d’Amazon) à consacrer 20 % de leur chiffre d’affaires à produire des programmes français.
Parallèlement, Emmanuel Macron a favorisé l’essor de l’e-commerce, en particulier d’Amazon, dont il a inauguré un entrepôt à Amiens, en 2017. L’Élysée a toujours rappelé que l’entreprise américaine et son patron créaient des emplois en France. En 2020, l’exécutif s’est opposé à un moratoire sur l’ouverture de nouveaux entrepôts d’e-commerce, soutenu entre autres par la convention citoyenne pour le climat, et à un alignement de leur fiscalité sur celle des magasins physiques, réclamée par certains élus. »
Selon l’AFP, la présidence française a justifié aussi cette décoration par le fait que :
Jeff Bezos est « un partenaire des initiatives pour la protection du climat et de la biodiversité menées par la France, en particulier sur la protection des forêts »
A la fin de 2021, M. Bezos était présent à la COP26 de Glasgow, quand le président français a présenté la « grande muraille verte ». Le milliardaire américain a promis de verser 1 milliard de dollars (945 millions d’euros) à ce projet de reforestation en Afrique, qui veut allier action publique et soutien privé.
Bon…
Ne serait-il pas judicieux qu’il cesse plutôt de polluer et d’utiliser de l’énergie pour envoyer des milliardaires faire un tour dans l’espace ?
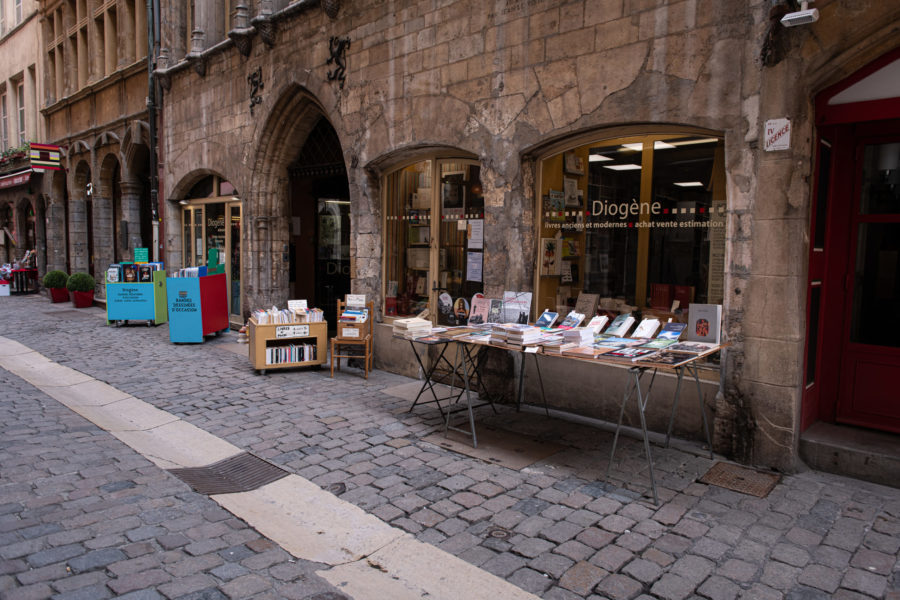 Et je pense à une autre Librairie lyonnaise en difficulté : « La Librairie Diogène » située au cœur du Vieux Lyon
Et je pense à une autre Librairie lyonnaise en difficulté : « La Librairie Diogène » située au cœur du Vieux Lyon
Cette Librairie a été créée en 1973, dans un immeuble du XVe siècle : la maison Le Viste.
Librairie généraliste, elle propose des livres de toutes époques, sur tous sujets, et de tous prix sur plus de 300 m2, trois niveaux et deux boutiques.
Elle s’adresse au collectionneur, au bibliophile averti à la recherche d’ouvrages de collection mais aussi à tout amoureux du livre qui aime chercher dans cette caverne d’Ali Baba qui renferme des trésors d’intelligence et de culture.
Cette fois ce sont les propriétaires qui veulent l’éviction de la Librairie pour utiliser autrement ces locaux.
Vous pouvez faire comme Annie et moi et les 32897 autres lecteurs qui ont signé <La pétition> qui refuse la fermeture de la Librairie Diogène.
Cette librairie dispose aussi d’un site qui la présente et explique aussi le conflit avec les propriétaires : https://librairiediogene.fr/
Henri Loevenbruck a écrit la phrase que j’ai mis en exergue dans son livre <Le Mystère Fulcanelli>
<1745>
Je vous invite à lire en commentaire la réponse de Blanche Gardin à une proposition d’Amazon Prime
- Jeff Bezos œuvre t’il au bénéfice de la société ou dans son intérêt exclusif ?
-
Mardi 18 avril 2023
« C’est l’impuissance publique qui est au cœur [de notre crise démocratique !] »Pierre-Henri TavoillotUn des grands risques qui nous guette, dans notre vie sociale, c’est de ne plus discuter qu’avec celles et ceux qui sont d’accord avec nous. Celles et ceux qui partagent nos colères, nos analyses et nos convictions.
Ce risque que Zygmunt Bauman a décrit de la manière suivante :
« S’enfermer dans […] une zone de confort, où le seul bruit qu’on entend est l’écho de sa propre voix, où la seule chose qu’on voit est le reflet de son propre visage.»
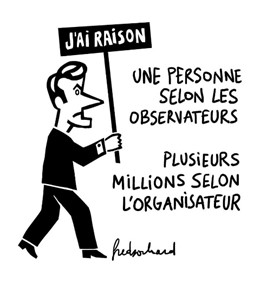 Nous avons le sentiment que le problème de la démocratie française est celui d’un hyper-président qui a trop de pouvoir et qui en abuse.
Nous avons le sentiment que le problème de la démocratie française est celui d’un hyper-président qui a trop de pouvoir et qui en abuse.
Il est vrai que le président actuel semble avoir cette conviction de détenir la vérité et de ne pas considérer qu’écouter les corps intermédiaires soit essentiel.
Je ne parle même pas de son style et de ses répliques qui ont souvent blessé un grand nombre de français.
D’après les spécialistes des sondages, il est le Président qui suscite le plus de haine, davantage même que Nicolas Sarkozy qui avait en son temps aussi suscité le rejet d’une part des français.
Mais comme l’explique Pierre-Henri Tavoillot, dans Démocratie, il y a d’un côté le « Démos » c’est-à-dire le Peuple et de l’autre côté le « Kratos » qui est la capacité de décider.
Notre sentiment est que le Kratos est trop fort
Ce n’est pas l’avis de Pierre-Henri Tavoillot.
J’avais déjà évoqué ce philosophe, lors du mot du jour du <23 mars 2020> et la sortie de son livre « Comment gouverner un peuple-roi ? ».
Je l’ai récemment entendu dans deux émissions :
La première dans le « Face à Face » de France Inter du 1er avril 2023 <L’art de gouverner> où il était le seul invité.
Et l’émission de France-Culture, « L’Esprit Public » du dimanche 16 avril 2023 <Comment sortir de la crise démocratique ?> dans laquelle il était un des participants.
Il intervient souvent dans l’émission « C ce soir » de France 5, dans laquelle il constitue souvent une voix dissidente.
Dans l’émission de France Inter il dit (à partir de 41 :20)
« Je crois qu’il faut prendre un peu de recul sur ce qu’est la nature de la crise de la démocratie française.
Personnellement, je suis un libéral. Un libéral, c’est veiller à l’équilibre entre la société et l’État, entre le Demos et le Kratos, entre le peuple et le pouvoir.
Spontanément le libéralisme s’est construit contre les pouvoirs abusifs, contre l’absolutisme.
Il fallait faire baisser le Kratos et faire augmenter le Demos. […]
Je pense qu’aujourd’hui, la crise profonde de notre démocratie ce n’est pas que le Demos soit trop faible et le Kratos trop fort, c’est exactement le contraire.
C’est l’impuissance publicque qui est au cœur. »
Au cœur du récit démocratique, il y a cette promesse que la nation, en tant que souverain, est maître de ses choix et peut décider librement de son destin.
Cette promesse n’a jamais été totalement respectée.
Mais aujourd’hui, elle est devenue extrêmement faible et encore plus pour un pays de moyenne importance comme la France.
Nos grands défis sont planétaires : réchauffement climatique, crise de la biodiversité, crise de l’eau, paix entre les nations.
Notre pays se trouve dans un maillage de dépendance pour sa consommation, son financement, ses investissements, sa défense.
Cette dépendance qui est contrainte par de nombreux Traités, par notre appartenance à l’Union européenne, réduit d’autant les marges de manœuvre de nos gouvernants.
Jancovici prétend que nous sommes déjà en décroissance, sans nous en apercevoir, que dès lors les choix que nous devons faire pour financer les grandes politiques publiques que nous demandons à nos gouvernants (Santé, Éducation, Transition écologique etc…) deviennent encore plus difficiles, car il faut prendre à l’un pour donner à l’autre.
Depuis bien longtemps nous consommons plus que nous produisons, et cachons ce déséquilibre par de l’emprunt et une augmentation de la dette.
Notre société est fracturée, il devient quasi impossible de générer des consensus suffisamment larges.
Je ne développe pas, mais on constate bien un problème d’impuissance publique, dès que le candidat se trouve dans le bureau du gouvernant.
C’est-à-dire que ce soit Emmanuel Macron ou Jean-Luc Melenchon et je ne cite pas la troisième, aucun ne dispose des moyens et possibilités d’honorer les promesses qu’il fait pour être élu.
Bien sûr, il reste possible de gouverner autrement que le fait le Président actuel et d’éviter certaines provocations et écart de langage.
Et il est un point que ne développe pas Tavoillot et dont je suis intimement persuadé, rien ne sera possible si on ne s’attaque pas au creusement des injustices sociales.
Car dans un monde où il faudra aller vers plus de sobriété, en rabattre sur notre soif de consommation et d’hubris, il faut que le sentiment de l’équité et de la justice grandissent dans l’esprit du plus grand nombre.
Et probablement qu’il faudrait aussi plus d’honnêteté de la part des candidats politiques dans la promesse de ce qu’ils sont capables de réaliser et une plus grande maturité de la part des citoyens pour accepter de l’entendre.
<1744>
-
Lundi 17 avril 2023
« Il y a un mantra dans la vie quotidienne du Conseil Constitutionnel, c’est une citation de Vedel ou de Badinter […] : C’est une mauvaise Loi, mais elle n’est pas contraire à la constitution ! »Dominique SchnapperLe Conseil Constitutionnel n’a donc pas censuré la Loi sur l’âge légal de la retraite, il a simplement censuré 6 dispositions comme l’index sénior pour lesquelles, il a considéré qu’elles n’avaient pas leur place dans cette loi de financement.
 On parle de « cavalier budgétaire », autrement dit on utilise comme support une Loi de financement qui permet au gouvernement de disposer de quelques instruments pour accélérer l’adoption de Loi, ce qu’il a fait dans le cas de cette Loi, pour faire adopter des dispositions qui ne doivent pas bénéficier des mêmes instruments et règles.
On parle de « cavalier budgétaire », autrement dit on utilise comme support une Loi de financement qui permet au gouvernement de disposer de quelques instruments pour accélérer l’adoption de Loi, ce qu’il a fait dans le cas de cette Loi, pour faire adopter des dispositions qui ne doivent pas bénéficier des mêmes instruments et règles.
Alors, Samedi matin, nous avons tous entendu : « Emmanuel Macron a promulgué la Loi cette nuit à 3:28 !»
A cette nouvelle j’étais partagé entre deux sentiments :
1° Quel bosseur, il ne s’arrête jamais de travailler. En même temps, il surmène ses collaborateurs.
2° Je trouvais très inquiétant que notre président ne dorme pas et travaille au-delà du raisonnable ce qui peut conduire à craindre des décisions peu éclairées et irrationnelles.
Mais revenons au sens du verbe : « promulguer »
Le fait de promulguer une loi c’est donner l’ordre de l’exécuter, la loi devient exécutoire.
En pratique, l’acte de promulguer la Loi se concrétise par le fait que l’Autorité exécutive signe le texte
En l’occurrence, en France, le texte est signé par le président de la République et contresigné par le Premier ministre et les ministres qui seront chargés d’appliquer la loi.
Je suppose qu’aujourd’hui cette signature est électronique.
Ces choses étant rappelées, la Loi N° 2023-270 n’a pas été promulguée à 3:28, samedi.
Il est tout à fait possible et même raisonnable de penser qu’Emmanuel Macron dormait à cette heure-là.
Si vous allez sur le site « LEGIFRANCE » pour consulter <cette Loi> vous constaterez que son entête est la suivante :
« LOI no 2023-270 du 14 avril 2023
de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 »
Cet entête nous montre que la Loi a été promulguée le vendredi 14 avril et non samedi 15 avril qui est le jour qui correspondait à 3:28.
Le journal « Libération » l’affirme : <Non, Emmanuel Macron n’a pas promulgué la loi retraites au milieu de la nuit>
Et donne ces explications :
« La loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023, qui modifie le système de retraite français, a bien été publiée dans le Journal officiel du samedi 15 avril, paru au milieu de la nuit. Samedi, à 3 h 28 exactement, les personnes inscrites dans la boucle électronique relative aux parutions du Journal officiel ont ainsi reçu un mail les en informant.
Tous les textes législatifs promulgués, comme les actes réglementaires adoptés par l’exécutif, sont rendus publics par leur inscription au Journal officiel de la République française (JORF), qui paraît du mardi au dimanche depuis 1869, par voie électronique uniquement depuis 2016. Même si sa sortie «ne connaît pas d’horaire officiel défini», «l’usage, les obligations politiques et juridiques ont conduit à une parution matinale du JORF (en moyenne entre 2 et 7 heures)», précise le site de la Direction de l’information légale et administrative. Ce qui ne veut pas dire que les textes sont promulgués dans la nuit.
Ainsi, la promulgation de la loi réformant le système des retraites, elle, est intervenue la veille de la publication. Comme l’indique d’ailleurs l’intitulé du texte, qui mentionne une loi datant « du 14 avril 2023». […]
Dans le cas de la réforme des retraites, la promulgation serait survenue à 19 h 30 – un horaire cité dans le commentaire d’une utilisatrice de Twitter et depuis largement relayé sur le réseau social. Dans un sujet diffusé au journal de 13 heures de samedi, une journaliste de TF1 relate : « Il est environ 17 h 30 vendredi quand le président de la République prend connaissance de la décision du Conseil constitutionnel. Selon nos informations, moins de deux heures plus tard, avant 20 heures donc, Emmanuel Macron signe la loi retraite. »
L’information donnée confondait donc la Promulgation qui nécessite l’acte d’humains pour signer avec la publication au journal officiel qui est automatisée, au moins pour la partie qui s’est déroulée dans la nuit.
Il faut toujours bien nommer les choses !
Albert Camus avait bien raison.
Cette confusion a conduit des gens à dire des billevesées.
Jean-Luc Mélenchon, a tweeté : « Macron a voulu intimider toute la France dans la nuit. » et Laurent Berger a déclaré au Parisien que « Le message d’Emmanuel Macron avec cette promulgation en pleine nuit, c’est jusqu’au bout le mépris à l’égard du monde du travail et la déconnexion avec la réalité. ».
Mais sur le fond que peut-on dire ?
Le constitutionnaliste Dominique Rousseau que j’avais déjà cité pour dire qu’il faisait partie des spécialistes qui pensaient possible la censure globale du texte, s’entête et écrit dans Le Monde : <La décision du Conseil constitutionnel s’impose mais, […] elle est mal fondée et mal motivée en droit !>
Et il cite des extraits de la décision pour s’en étonner :
« § 65. En dernier lieu, la circonstance que certains ministres auraient délivrée, lors de leurs interventions à l’Assemblée nationale et dans les médias, des estimations initialement erronées sur le montant des pensions de retraite qui seront versées à certaines catégories d’assurés, est sans incidence sur la procédure d’adoption de la loi déférée dès lors que ces estimations ont pu être débattues. »
Et
« § 69. D’autre part, la circonstance que plusieurs procédures prévues par la Constitution et par les règlements des assemblées aient été utilisées cumulativement pour accélérer l’examen de la loi déférée, n’est pas à elle seule de nature à rendre inconstitutionnel l’ensemble de la procédure législative ayant conduit à l’adoption de cette loi. »
Et aussi
« § 70. En l’espèce, si l’utilisation combinée des procédures mises en œuvre a revêtu un caractère inhabituel, en réponse aux conditions des débats, elle n’a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution. Par conséquent, la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution. »
Enfin
« § 11. D’autre part, si les dispositions relatives à la réforme des retraites, qui ne relèvent pas de ce domaine obligatoire, auraient pu figurer dans une loi ordinaire, le choix qui a été fait à l’origine par le Gouvernement de les faire figurer au sein d’une loi de financement rectificative ne méconnaît, en lui-même, aucune exigence constitutionnelle. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur à cet égard, mais uniquement de s’assurer que ces dispositions se rattachent à l’une des catégories mentionnées à l’article L.O. 111-3-12 du Code de la sécurité sociale. »
Et Dominique Rousseau s’étonne que le Conseil Constitutionnel reconnaisse que des ministres ont délivré des « estimations erronées » que lors des débats parlementaires plusieurs procédures ont été utilisées « cumulativement » pour accélérer l’adoption de la loi et que l’utilisation combinée des procédures mises en œuvre a un « caractère inhabituel » et conclut cependant que le principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires avait été respecté. Et il trouve également singulier que le texte de la réforme aurait pu figurer dans une Loi ordinaire mais que le fait de le faire figurer dans une loi de financement rectificative ne trouble pas le Conseil.
Selon lui :
« A l’évidence, la conclusion ne découle pas logiquement des prémisses et ce décalage ouvre un espace au doute sur le bien-fondé juridique de la décision. »
« Le Monde » publie deux autres articles :
Denis Baranger, professeur de droit public, considère que
« le Conseil constitutionnel a perdu une chance de rétablir un degré d’équilibre entre les pouvoirs », en confortant une vision très large des prérogatives données à l’exécutif face au Parlement.
Concernant le rejet de la proposition de référendum d’initiative partagée, la juriste Marthe Fatin-Rouge Stefanini estime qu’il semble condamner l’utilisation du RIP, en restreignant considérablement les conditions de son utilisation.En revanche lors de l’émission « l’Esprit Public du dimanche 16 avril » la sociologue Dominique Schnapper, ancienne membre du Conseil Constitutionnel affirme :
« La décision était prévue, prévisible, normale. Hier après-midi au ministère de l’éducation nationale, nous avons été quelques-uns à annoncer ce qu’il y aurait dans la décision, sans avoir aucune information et c’est exactement celle qui a été adoptée, parce qu’elle s’inscrit directement dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. »
Pour ma modeste part, je porte un grand crédit aux propos de la fille de Raymond Aron et cela non en raison de son hérédité, mais de sa hauteur de vue et ses analyses toujours très argumentées
Parce qu’évidemment les citoyens qui contestaient la Loi souhaitaient une décision politique : il ne fallait pas que l’âge légal de départ à la retraite passe de 62 ans à 64.
Mais les décisions du Conseil Constitutionnel sont juridiques et non politiques.
La décision du Conseil constitutionnel signifie que la Loi qui modifie l’âge légal de départ en retraite de 62 ans à 64 ans n’est pas contraire à la constitution.
Et, Dominique Schnapper nous apprend qu’il existe un mantra au Conseil constitutionnel, c’est-à-dire une formule sacrée dotée d’un pouvoir spirituel :
« Il y a un mantra dans la vie quotidienne du Conseil Constitutionnel, c’est une citation de Vedel ou de Badinter […] : C’est une mauvaise Loi, mais elle n’est pas contraire à la constitution ! »
Les sages ont donc été sage !
Mais dans l’émission « C Politique de ce dimanche » Thierry Pech, le directeur général de « Terra Nova » a posé cette question :
« Était-il sage, d’être sage ? »
Et il explique cette question par ce développement
« Est-ce que cela nous suffit ?
Est-ce que lorsqu’on dit d’un texte qu’il est constitutionnel, on peut dire qu’il est démocratique ?
Ce n’est pas la même chose, et c’est cela mon problème.
Aucun des articles mobilisés pendant l’élaboration de ce texte n’est contraire à la constitution.
[…] Ils y figurent tous.
Notre constitution est une armurerie extrêmement riche d’instruments pour brider la liberté du Parlement. Tous ces éléments sont donc constitutionnels.
Leur accumulation fait-elle un processus démocratique ?
Ma réponse est franchement non !»
Et plus tard quand on l’interroge sur ce que devrait dire et faire Macron, il demande au Président de donner du sens à son affiche de campagne : « Avec vous »
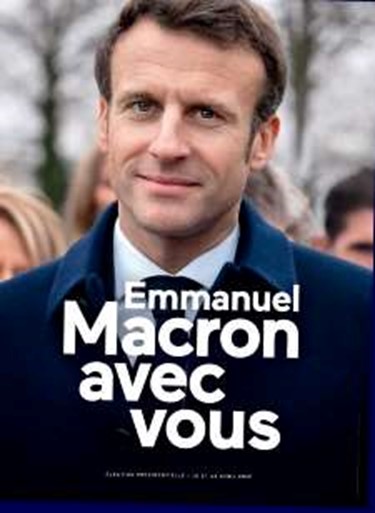
<1743> -
Jeudi 6 avril 2023
« Il y a chez lui une arrogance nourrie d’ignorance sociale et de méconnaissance de l’histoire des démocraties. »Pierre Rosanvallon parlant de notre Président de la RépubliqueCe jeudi 6 avril 2023 constitue la 11ème journée nationale de mobilisation, depuis le 19 janvier, contre la réforme des retraites.
Élisabeth Borne a reçu les organisations syndicales, ce mercredi, dans un dialogue de sourd dans lequel, au bout d’une heure, la partie syndicale a quitté la réunion.
Tout au long de ces semaines, la cheffe de gouvernement n’a pas négocié avec les représentants sociaux, elle a préféré négocier avec le parti des républicains, pensant cette manière de faire plus efficace. Bref, elle a cherché un compromis politique et non un compromis social. Et, elle a échoué.
Il semblerait que le Président Macron parie sur un essoufflement du combat syndical : l’inflation, le manque à gagner des jours de grève et la lassitude conduisant à une diminution de la mobilisation. Et, si en outre, parmi les derniers manifestants, la violence se déchaine, rapidement la majorité des français qui aiment l’ordre se détourneront de ce mouvement qui les inquiétera, dès lors.
Il reste la décision du Conseil Constitutionnel, le Conseil pourrait-il censurer l’intégralité de la Loi ?
Les constitutionnalistes ne sont pas d’accord.
<France Inter> avait réuni deux d’entre eux.
Dominique Rousseau pense qu’une telle censure totale est possible, parce que selon lui :
« Il y a dans la procédure d’adoption de la loi sur les retraites une accumulation d’outils qui font que personne ne peut contester que le débat a été peu clair et insincère »
Il s’appuie sur une décision du Conseil Constitutionnel qui exigeait que pour l’adoption d’une loi il fallait qu’il y eut un débat clair et sincère. Or selon lui, les explications avancées par le Gouvernement sur des points précis comme la retraite minimale de 1200 euros ou comme l’utilisation de tous les arcanes de la Constitution pour raccourcir le temps d’examen du texte peuvent conduire à cette sanction.
L’autre constitutionnaliste, Anne Levade, ne croit pas à cette hypothèse. Pour l’instant, le Conseil constitutionnel n’a censuré intégralement que deux textes un en 1979 et l’autre en 2012.
Dès lors, s’il n’y a pas censure intégrale et si comme le croit le Président, la contestation sociale s’essoufle, la Loi sera promulguée et entrera en vigueur.
Cette victoire légale, si elle a lieu, me semble pleine de danger politique.
Je crois que, dans ce cas, le cœur du corps social français gardera un profond ressentiment de toute cette affaire.
Les rocardiens et même Michel Rocard avant sa mort ont exprimé beaucoup de soutien à Emmanuel Macron.
Je crois que ce temps est révolu.
L’un d’entre eux : l’historien Pierre Rosanvallon exprime dans « Libération » dans un article publié le 3 avril 2023 :
« Or, le grand problème d’Emmanuel Macron est qu’il n’a qu’une expérience sociale et politique limitée, étant passé directement de l’ombre à l’Elysée. Il y a chez lui une arrogance nourrie d’ignorance sociale et de méconnaissance de l’histoire des démocraties. Il est certain que dans l’optique d’une refonte des institutions, le comportement actuel du chef de l’Etat pose la question de la mise en œuvre constitutionnelle d’autres moyens de résolution des crises qui partent d’en bas. Le référendum d’initiative partagée n’en est qu’une modalité trop modeste. Faute de cela, le temps des révolutions pourrait revenir ou bien ce sera l’accumulation des rancœurs toxiques qui ouvrira la voie au populisme d’extrême droite. »
Pour Rosanvallon Macron doit faire « demi-tour » sur le recul de l’âge de départ à la retraite. Et il ajoute :
« Rarement un projet de réforme gouvernemental aura été aussi mal préparé et envisagé sur un mode aussi technocratique et idéologique, alors qu’il y a une discussion complexe et argumentée à mener sur le financement des retraites. Sur le fond, le débat a été escamoté en étant rétréci à la question de l’âge de départ. Cette approche ne prend pas en compte la diversité des situations et des conditions de travail. Le rapport au travail aurait ainsi dû être abordé en préalable à toute discussion sur le financement. La retraite, c’est le rétroviseur de la vie. Cette dimension existentielle n’est pas prise en compte dans le projet actuel. »
Dans un autre article de Libération publié le même jour, le journal constate que :
Et parmi ceux-ci, celui qui a été en quelque sorte son mentor : Jacques Attali qui l’avait présenté à François Hollande en 2010, évènement essentiel dans le parcours exceptionnel de celui qui allait devenir notre jeune président en 2017.
Jacques Attali écrivait simplement, le 15 mars 2023, toujours dans Libération : « Cette réforme des retraites est mal faite et injuste. » et précisait :
« Non, reculer l’âge de départ n’est pas la bonne méthode. J’ai toujours été favorable à la retraite à points, un système plus juste et plus équitable. Autrement, on peut se concentrer sur la durée de cotisation. Je ne suis pas du tout favorable au report de l’âge légal de départ à 64 ans, d’autant plus qu’il s’agit d’un âge fictif. Quelqu’un qui a besoin de 43 années de cotisation et qui a commencé à travailler à 25 ans partira à la retraite à 68 ans alors que celui qui a commencé à travailler plus tôt est pénalisé. Avec l’augmentation de l’âge de départ, le gouvernement s’est focalisé sur quelque chose d’absurde… »
«Reculer l’âge de départ à 65 ans est à la fois injuste et inefficace», observait, toujours dans Libération, quelques mois plus tôt Philippe Aghion, l’économiste qui avait été un des principaux inspirateurs du programme d’Emmanuel Macron en 2017.
Dans le mot du jour du 24 juin 2022 « Macron ou les illusions perdues. » j’évoquais le livre de son ancien professeur François Dosse, qui avait été celui qui avait présenté le jeune homme à Paul Ricoeur. François Dosse avait été enthousiaste par l’arrivée de Macron à la présidence de la République avant de déchanter.
Libération précise que François Dosse n’a loupé aucune manifestation contre la réforme des retraites et qu’il a donné cette opinion sur son ancien élève :
« Sa capacité d’absorption des choses et de maîtrise fait qu’il ne connaît pas la marche arrière, il est toujours sûr d’avoir raison. »
Devant un tel déluge de critiques, un homme raisonnable devrait s’interroger.
Mais le Président Macron est il raisonnable ou s’est-il laissé enfermer derrière les murs de l’Élysée dans une prison de certitudes dont la plus dangereuse est qu’il soit le seul à comprendre ce qui est utile et nécessaire à la France et aux français ?
<1742>
-
Jeudi 30 mars 2023
« Ils n’ont pas vu un artiste exprimant un avis, mais un fournisseur retardant la livraison de la marchandise à son client. »Réflexions personnelles suite à une attitude médiocre d’une partie du public de l’auditorium de Lyon le 17 marsCe jour-là, Annie et moi n’étions pas au concert de l’Auditorium de Lyon.
C’était le vendredi 17 mars, un jour après la décision du gouvernement d’utiliser l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter la réforme de la retraite par le Parlement.
François Apap, bassoniste et représentant de l’Orchestre national de Lyon a pris la parole avant le concert pour dire l’opposition des musiciens à cette réforme et en donner les raisons.
<BFM TV> a mis en ligne une vidéo de ce moment.
Postérieurement, cette même chaîne a donné la parole au musicien qui s’était exprimé : < On m’a lancé des pièces > :
« Ça a été très compliqué sur scène, parce que j’ai entendu des insultes « ta gueule », « on n’est pas là pour ça », etc. On m’a lancé des pièces sur scène. Ce soir-là, ça a quand même été très violent. On ne s’y attendait pas. L’orchestre s’est très mal senti après cette scène.
Pour François Apape, face aux invectives de la foule qui ont duré de longues minutes, les musiciens auraient dû faire le choix de « sortir de scène, attendre 10-15 minutes dehors avant de revenir pour le début du concert. […]
Un témoin avait rapporté à BFM Lyon que « le public s’était indigné immédiatement, sans savoir de quoi il allait être question, haut et fort. Le discours n’avait même pas commencé qu’on entendait des « remboursés » vindicatifs ».
Selon la « Lettre du musicien » que « Mediapart » a cité dans <un Article> que Christiane m’a fait parvenir :
« À peine les haut-parleurs avaient-ils annoncé qu’une déclaration précéderait le concert, vendredi 17 mars, que des cris ont fusé dans la salle : « On n’est pas là pour ça ! », « Vous nous faites chier ! ». François Apap a poursuivi sa lecture malgré les quolibets : « J’ai vu des regards haineux tandis qu’on me hurlait : « Ferme ta gueule et joue. » On m’a même jeté une pièce sur scène, traité de « chochotte », de « connard »… », raconte le musicien.
Des applaudissements ont tenté, en vain, de couvrir les huées : « La salle était en quelque sorte coupée en deux », témoigne Antoine Galvani, secrétaire général du Syndicat des artistes musiciens en Rhône-Alpes (Snam-CGT). »
Il va, sans dire, que si Annie et moi avions été dans la salle nous aurions été du coté des applaudissements. Il y a quelques années, nous avions assisté à un évènement du même type qui avait déclenché un comportement hostile d’une partie public, mais les applaudissements avaient alors couvert les sifflets. Ce ne fut pas le cas, semble t’il, le 17 mars.
Cet article donne aussi une partie des arguments développés par François Apap :
« Je sais que la culture de la musique classique passe pour propre et lisse et que, pour certains, elle devrait le rester. Mais nous devons faire face à une forme de pénibilité encore taboue, qui fait beaucoup de dégâts sur les corps, notamment dans le pupitre des cordes. » Le bassoniste évoque, à l’Orchestre national de Lyon, quatre musiciens absents de leur poste depuis plus d’un an, une majorité contrainte de consulter régulièrement des ostéopathes, mais aussi de souscrire à des assurances supplémentaires, une partie des troubles musculosquelettiques n’étant pas suffisamment prise en charge par la Sécurité sociale.« Nous sommes des sportifs de haut niveau. Mon texte, à cet égard, n’était ni belliqueux ni agressif. Il visait seulement à souligner que tenir deux ans de plus, ce n’est pas possible pour certains d’entre nous, d’autant plus dans un contexte de gel des postes, de concerts annulés, et de salaires qui ne chiffrent pas par rapport aux exigences qu’on nous demande. Cette déclaration englobait aussi les intermittents, les femmes, qui souffrent de carrières hachées… »
L’article montre aussi que cette attitude n’est pas limitée au public de Lyon :
« Faut-il donc tenir pour exceptionnelles les réactions du public de l’Auditorium de Lyon ? En novembre dernier, les ouvreurs et ouvreuses de la Philharmonie, qui tractaient également pour leurs conditions de travail, recevaient un accueil mitigé, voire hostile de la part des spectateurs et spectatrices : « Parfois, on nous répond : « Ne vous plaignez pas, au moins vous avez du travail » », rapportait amèrement une employée. Tandis qu’à Lille, le 19 janvier, une prise de parole similaire à celle de François Apap, juste avant un concert de l’Orchestre national de Lille, rencontrait le même accueil. »
Que dire ?
Il y a donc des personnes probablement aisées, selon mon expérience de l’auditorium, plutôt âgées, probablement déjà à la retraite qui ne tolèrent pas que leur acte de consommation soit interrompu par un avis divergent du leur.
Parce qu’ils pouvaient ne pas être d’accord avec les propos du musicien, c’était leur droit.
Mais il leur appartenait d’écouter avec respect et silence un avis qui était contraire à leurs idées.
Dans quel monde veulent-ils vivre ?
Dans un monde où il n’existe qu’une opinion, la leur ?
Zygmunt Bauman décrivait une telle attitude :
« S’enfermer dans […] une zone de confort, où le seul bruit qu’on entend est l’écho de sa propre voix, où la seule chose qu’on voit est le reflet de son propre visage.»
Ce monde dans lequel ils s’enferment, dans lequel il n’y a plus d’opinions divergentes mais une vérité et des erreurs est un monde triste, stérile, morbide.
Ce sont non des esprits de culture, ouvert à l’art et aux artistes.
Quand le musicien a pris la parole, ils n’ont pas vu un artiste exprimant un avis, mais un fournisseur retardant la livraison de la marchandise à son client.
Ce sont de vils consommateurs.
Le philosophe allemand, Peter Sloterdijke, disait :
« La liberté du consommateur et de l’individu moderne, c’est la liberté du cochon devant son auge. »
Ils n’ont même plus de savoir vivre !
Moi qui pensais, qu’au moins, les bourgeois avaient toujours comme qualité, la politesse.
Force est de constater que celles et ceux qui ont hué le musicien, en étaient dépourvus.
<1741>
-
Mercredi 29 mars 2023
« Nous devrions toujours célébrer les immigrés qui contribuent tellement à notre pays. »Humza Yousaf qui vient d’être désigné premier ministre de l’ÉcosseIl se passe quelque chose de l’autre côté de la Manche.
D’abord en octobre 2022, après l’épisode court et peu glorieux de Liz Truss et celui tonitruant et peu sérieux de Boris Johnson, les conservateurs britanniques ont désigné comme premier ministre Rishi Sunak
 Rishi Sunak est né le 12 mai 1980 à Southampton dans le Hampshire en Angleterre.
Rishi Sunak est né le 12 mai 1980 à Southampton dans le Hampshire en Angleterre.
Mais il est le fils de Yashvir Sunak, né au Kenya, alors colonie britannique, et d’Usha Sunak, pharmacienne née au Tanganyika, alors territoire sous mandat britannique.
Sa famille est originaire du Pendjab et fait partie de la diaspora indienne d’Ouganda, du Kenya et de Tanzanie .
Celui qui dirige le Royaume-Uni est donc issu de l’immigration indienne.
Mais en creusant un peu j’ai appris qu’il était pratiquant de l’Hindouisme. Lui-même a souligné que le jour de sa désignation, le lundi 24 octobre, correspondait au jour de la fête traditionnelle de Diwali.
Le Diwali célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres et est fêté à travers le monde entier par la communauté hindoue.
En Grande Bretagne, il n’y a pas de constitution écrite. Il est de tradition que les députés prêtent serment sur la bible. Mais, après son élection au Parlement en 2015, Rishi Sunak a prêté serment au Parlement sur la Bhagavad Gita, le livre sacré hindou.
C’est ce qu’on lit dans cet article du Huffington Post : < La victoire de Rishi Sunak tombe le jour du Diwali, tout un symbole >
Au nord des iles britanniques, en Écosse, la première ministre depuis 2014, Nicola Sturgeon, a annoncé sa démission le 15 février 2023.
Ce mardi 28 mars, le parlement local d’Ecosse a désigné pour la remplacer Humza Yousaf qui deviendra aujourd’hui, mercredi, officiellement le premier ministre de l’Écosse.
Le journal suisse « Le Temps » constate que c’est <la première fois qu’une démocratie occidentale élit un leader musulman> et ajoute
« A l’annonce de sa victoire à la tête du parti, lundi, Humza Yousaf s’est levé, tout sourire, a donné une accolade aux deux candidates qu’il avait battues, puis s’est tourné vers ses parents, assis derrière lui. Son père, collier de barbe blanche strict, sa mère, foulard musulman sur la tête et une larme à l’œil, débordaient de fierté. Le nouveau leader du Scottish National Party (SNP), le parti indépendantiste écossais, élu avec 52,1% des voix, fait rarement de ses origines un argument politique, mais en ce jour historique, qui doit faire de lui mardi le premier ministre d’Écosse, il a tenu à les souligner. «Je dois remercier mes grands-parents, aujourd’hui décédés, d’avoir émigré du Pendjab (au Pakistan) vers l’Ecosse il y a plus de soixante ans. […] Ils n’auraient jamais imaginé que leur petit-fils serait un jour sur le point de devenir premier ministre.» »
 Sa page Wikipedia nous apprend qu’il est né le 7 avril 1985 à Glasgow.
Sa page Wikipedia nous apprend qu’il est né le 7 avril 1985 à Glasgow.
Il est le fils d’immigrés de première génération : son père, Muzaffar Yousaf, est né à Mian Channu au Pakistan et à émigré à Glasgow dans les années 1960, pour travailler comme comptable. Son grand-père paternel travaillait dans l’usine de machine de couture Singer à Clydebank dans les années 1960. Sa mère, Shaaista Bhutta, est née au Kenya dans une famille originaire d’Asie du Sud qui a subi de nombreuses attaques car elle était perçue comme prenant le travail aux locaux et qui a émigré plus tard en Écosse pour échapper aux violences anti-indiennes au Kenya.
C’est donc un écossais issu de l’immigration pakistanaise qui va diriger l’Écosse en tant que chef du Parti National Écossais qui est un parti qui souhaite l’indépendance de l’écosse.
Jean-Marc Four dans sa chronique du 28 mars : <Un musulman à la tête de l’Ecosse après un hindouiste à la tête du Royaume Uni> a ajouté
« Et face à lui, en Écosse ; Yousaf aura pour premier opposant le chef du parti travailliste écossais, Anar Sarwar qui, lui aussi, est d’origine pakistanaise ! »
« L’obs » dans un article <5 choses à savoir sur Humza Yousaf> nous révèle que :
« Humza Yousaf dit avoir beaucoup souffert de racisme, en particulier après les attentats du 11 septembre 2001. En 2021, avec son épouse, il a porté plainte pour discrimination contre une crèche qui avait refusé d’accueillir leur fille »
Jean Marc Four cite Humza Yousaf :
« Nous devrions toujours célébrer les immigrés qui contribuent tellement à notre pays. ».
Il y a donc au Royaume Uni un homme issu de l’immigration indienne et de religion Hindou qui est premier ministre et en écosse un homme issu de l’immigration pakistanaise et de religion musulmane qui est premier ministre
Jean-Marc Four a analysé ce constat de la manière suivante :
« […] c’est très révélateur de la poussée spectaculaire des élus issus de la diversité chez nos voisins britanniques. […]
L’homme qui incarne désormais l’Écosse est donc musulman, originaire du Pendjab au Pakistan par sa famille paternelle.
[…] Et lorsqu’il est devenu député il y a 12 ans, Yousaf a prêté serment en anglais et en ourdou, l’une des langues du Pakistan.
[…] Un dirigeant musulman, c’est une première dans un pays occidental.
[…] Un phénomène similaire est donc à l’œuvre à Londres, au Parlement britannique.
Puisque vous le savez, le premier ministre britannique, depuis l’automne, est lui aussi issu de l’immigration.
Rishi Sunak est hindouiste, il a d’ailleurs prêté serment sur la Baghavad Gita, l’un des textes fondamentaux de cette religion. […]
Deux de ses principaux ministres sont également enfants d’immigrants: la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, originaire de l’île de Maurice et le ministre des affaires étrangères James Cleverly, originaire de Sierra Leone.
Ajoutons d’autres figures du parti conservateur : Kemi Badenoch, originaire du Nigeria, ou Nadim Zahawi du Pakistan.
Quant au maire de Londres, c’est le travailliste Sadiq Khan depuis maintenant 7 ans. Origine là encore : Pakistan.
Ces exemples nombreux disent une évolution majeure de la vie politique britannique : les élus issus de la diversité accèdent désormais aux plus hauts postes.
Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de racisme en Angleterre ou en Écosse. Il y en a : le nouveau premier ministre écossais raconte que sa fille en a été victime.
Mais l’ascension sociale des élus de 2ème ou 3ème génération est rapide en politique. Parce que certains partis, comme le parti conservateur, ont imposé des quotas.
Et aussi parce que la société y est prête. Elle n’a pas de réticence à porter à sa tête un enfant de l’immigration. […]
En tout cas, le contraste entre la France et le Royaume-Uni, déjà frappant avec l’avènement de Sunak, devient saisissant avec celui de Yousaf : l’équivalent en France, ce serait un président ou un premier ministre issu des immigrations algérienne, marocaine, sénégalaise.
Déjà qu’un ou une ministre, une Dati, un Ndiaye, une Vallaud Belkacem, c’est rare. Alors un chef de gouvernement n’en parlons pas. »
Il me semble que nos amis britanniques ont, sur ce point, un peu d’avance sur la France
<1740>
-
Lundi 27 mars 2023
« Personne n’a envie d’être un con-vaincu. »Thomas d’AnsembourgLe climat social devient violent en France, vous ne trouvez pas ?
Ce dimanche, les mégabassines de Sainte-Solines se sont ajoutées à la réforme des retraites pour donner lieu à des affrontements et des blessés entre des manifestants et des forces de l’ordre.
J’ai regardé avec intérêt cette vidéo du média « Blast » sur la problématique de cette solution mise en œuvre par des céréaliers, pour pouvoir continuer à produire comme avant la sécheresse, en prélevant, dans la nappe phréatique, d’immenses masses d’eau dont ils ont besoin pour leur activité.
La conséquence de cette solution est d’aggraver à terme le problème par un asséchement renforcé des sols et un effondrement accéléré du niveau de la nappe phréatique et bien sûr de diminuer l’eau disponible pour tous les autres utilisateurs. Et parmi ces utilisateurs il y a des humains mais aussi d’autres espèces vivantes qui disparaissent et avec elles la biodiversité.
<Mégabassines : la guerre est déclarée>
Mais pour revenir à la réforme des retraites, il faut rappeler quelques éléments chronologiques.
En utilisant l’argument de la guerre en Ukraine qui monopolisait son temps de réflexion disponible, le président Macron a enjambé l’élection présidentielle.
Je veux dire qu’il a présenté tardivement un programme minimal et il a refusé tout débat sur ce programme et sur tout autre sujet.
Si on ne peut plus débattre pendant l’élection présidentielle, quand pourra t’on débattre ?
Le débat du second tour n’en était pas un. Il s’agissait simplement de montrer que l’autre candidate n’était pas capable d’assurer le rôle. Elle a parfaitement collaboré et joué le rôle qu’on attendait d’elle.
Dans le programme lilliputien du Président sortant, il y avait quand même une mesure : l’allongement de l’âge de départ à la retraite
Et c’est ainsi qu’au pas de charge, cette affaire a été menée, en utilisant tous les rouages de la constitution pour que cela aille vite.
Plutôt que de discuter avec les représentants syndicaux, Emmanuel Macron a demandé à son gouvernement de négocier avec la Droite LR, dont la candidate proposait la même réforme dans son programme.
Cela n’a pas fonctionné, parmi les députés LR, il en est suffisamment qui détestent tellement Macron qu’ils sont prêts à tout pour l’empêcher.
L’opposition de la NUPES a aussi joué un rôle délétère, elle n’a pas débattu mais vociféré, elle n’a pas argumenté mais asséné ses croyances et son récit. Elle a réussi à aider Emmanuel Macron à rendre l’Assemblée Nationale encore plus impopulaire.
Et puis finalement le Président sortant qui est reparti pour un second mandat a pris la parole le 23 mars.
Il me semble possible de résumer son intervention de la manière suivante :
« J’ai raison, ma réforme est indispensable. C’est celle qui peut le mieux répondre aux défis qui se présentent à nous. Vous ne l’avez pas bien comprise, je ne l’ai probablement pas bien expliqué. Je vais donc vous en convaincre en vous explicitant mes arguments. »
Il y a un certain nombre de français qui n’ont pas été satisfaits ni du 49-3, ni de la manière dont Monsieur Macron a tenté de les convaincre qu’il avait raison.
J’avais déjà évoqué Thomas d’Ansembourg, lors du mot du jour du 10 janvier 2017 : « La paix ça s’apprend »
Thomas d’Ansembourg est un psychothérapeute belge spécialisé dans la communication non-violente.
Il organise des séminaires en ligne, mais on trouve facilement des petites interventions pleine de sens sur la communication entre les humains.
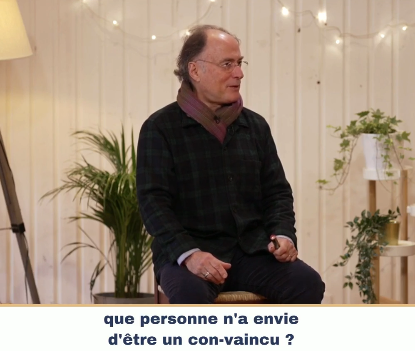 Dans celle-ci, il s’agit <de la communication dans un couple>, mais je pense que ces réflexions sont parfaitement adaptées à notre situation politique :
Dans celle-ci, il s’agit <de la communication dans un couple>, mais je pense que ces réflexions sont parfaitement adaptées à notre situation politique :
« Il y a infiniment plus d’intelligence dans deux cœurs qui essaient de se rapprocher.
Je dis bien qui essaient parce qu’on n’arrive pas toujours.
Il y a bien plus d’intelligence dans deux cœurs qui essaient de se rapprocher que dans deux intelligences qui essaient d’avoir raison à coup de gourdin qui est malheureusement quasiment le seul modèle que nous ayons.
Lorsqu’on regarde la moindre émission télévisée avec ceux qui sont censé nous inspirer comme dirigeants, on voit des collisions d’ego avec des êtres qui veulent avoir raison !
Et qui ne passent pas leur temps de silence à écouter pour comprendre, mais à préparer leur contre-attaque.
C’est d’une misère. Une absence de discernement. C’est d’une grande pauvreté.
Prenez un petit moment d’écoute de vous-même pour aller voir les moments où vous vous retrouvez dans des rapports de force, dans cette prétention à avoir raison, à vouloir con-vaincre l’autre.
Vous entendez dans ce joli mot que personne n’a envie d’être un con-vaincu ?
Qu’est ce qui s’active en vous quand quelqu’un veut vous convaincre : La plupart du temps, c’est la fuite : « Fous moi la paix » ou la rébellion : « Arrête d’essayer de me convaincre, c’est moi qui vais te convaincre et on enclenche des rapports de force. »
Il est beaucoup plus intelligent et sage de passer son temps de silence à tenter de comprendre l’autre que de préparer sa contre-attaque.
Tous les français ne disent pas à M Macron qu’il ne faut pas une réforme de la retraite, mais beaucoup disent : « pas celle-là et pas avec cette méthode »
Mais il semble que M Macron ne cherche pas à comprendre et continue dans son idée et tente de faire des français des « con-vaincus ».
Cette méthode ne fonctionne visiblement pas.
Thomas d’Ansembourg ajoute :
« Il est temps de changer de modèle.
C’est vraiment un enjeu citoyen.
Et d’arrêter de s’accrocher à une vieille croyance que l’homme est un loup pour l’homme et que la violence est l’expression de la nature humaine.
Waouh, qu’est ce que nous avons été plombés par ce système de pensée.
J’ai entendu ça dans le petit cours de psycho que j’ai reçu dans mes études de droit.
Tout petit cours de psychologie : la violence est l’expression de la nature humaine
Ça fait 25 ans que j’expérimente le contraire.
La violence n’est pas l’expression de notre nature.
La violence est l’expression de la frustration de notre nature, ce qui n’est pas du tout la même chose.
Si vous êtes aimé, reconnu, trouvez du sens à votre vie, avez une joyeuse appartenance, vous savez comment déployer vos talents et le monde autour de vous vous y encourage : pourquoi seriez-vous violent ?
Inversement, vous vous sentez pas aimé, vous n’avez pas d’appartenance, vous ne trouvez pas votre place dans la vie, la vie n’a pas de sens à vos yeux, vous ne vous sentez pas compris, vous ne comprenez rien à ce qui se passe, là ça commence à bouillonner !
D’où l’urgence d’apprendre à bien connaître notre nature, pour qu’elle trouve sa voie, son expansion dans le respect de la nature de l’autre évidemment.
C’est ainsi que la connaissance de soi est un enjeu de santé publique. »
Message destiné à des couples, mais les français et leur président peuvent aussi l’entendre avec intérêt, c’est ce que je pense.
<1739>
-
Lundi 20 mars 2023
« Peut-être aurait-il fallu commencer par là et assumer clairement qu’aux yeux du pouvoir, cette réforme s’impose uniquement comme un signal adressé aux marchés financiers. »Michaël FoesselEt Élisabeth Borne dégaina le 49-3, comme jadis John Wayne dégainait son colt.
Le jeudi 16 mars, Emmanuel Macron a réuni à trois reprises Élisabeth Borne et ses ministres, à quelques heures d’un vote extrêmement incertain à l’Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Et finalement, le chef de l’État a décidé. La formule constitutionnelle est « il a autorisé la Première ministre à engager la responsabilité du gouvernement. »
Le Huffington Post rapporte :
« Un choix que le chef de l’État a justifié comme suit, comme l’a rapporté un participant à l’ultime conseil des ministres : « Mon intérêt politique et ma volonté politique étaient d’aller au vote. Parmi vous tous, je ne suis pas celui qui risque sa place ou son siège. Mais je considère qu’en l’état, les risques financiers, économiques sont trop grands. » Et le locataire de l’Élysée d’ajouter : « On ne peut pas jouer avec l’avenir du pays. » »
Qu’est ce qui se cache derrière ces risques financiers et économiques ?
Tout le monde parle de la réforme des retraites, en se focalisant sur les règles permettant de demander sa retraite et sur les conditions budgétaires de l’équilibre des caisses de retraite.
Et on parle de justice, d’impossibilité pour de nombreux métiers pénibles de travailler jusqu’à 64 ans, de l’injustice du critère d’âge, de la nécessité prioritaire d’intervenir pour empêcher que le système de retraite s’effondre.
D’ailleurs, on entend de manière de moins en moins feutrée cette idée géniale de pousser les français vers des systèmes de retraite par capitalisation.
Dans un tel système on laisserait un système par répartition minimale, correspondant grosso modo à une pension de base ayant pour vocation de permettre la survie de celles et ceux qui la touchent. Pour disposer de quelques éléments de confort, de culture et de loisirs il faudra compter sur un fonds de pension auprès duquel on aura cotisé tout au long de sa vie. La rémunération que le Fonds de pension donnera au retraité dépendra des montants de cotisation qu’il aura versé librement selon l’ampleur de ses moyens, ses goût et possibilités d’épargne.
- Cette évolution créera une fracture encore plus grande entre les pauvres et les riches.
- Ce système ne présente pas un caractère d’une grande stabilité, les fonds de pension se trouvant à la merci des crises financières, comme celle qui selon toute probabilité est en train de se développer dans le monde financier et d’assurance.
- Enfin, selon moi, le plus grave est qu’on met ainsi l’argent des retraites aux mains de fonds spéculatifs dont l’objectif est de faire le plus de gains possibles. Ce qui signifie dans le monde dans lequel nous vivons : faire pression sur les emplois, les salaires et avant de s’intéresser à l’intérêt de la population et à la survie de l’humanité, prioriser la rentabilité financière.
Ceci me fait penser à cette parole de François Mitterrand qui dans un moment de lucidité socialiste aurait dit :
« Ils s’en prendront aux retraites, à la santé, à la Sécurité sociale, car ceux, disait-il, qui possèdent beaucoup veulent toujours posséder plus et les assurances privées attendent de faire main basse sur le pactole. Vous vous battrez le dos au mur, avait-il dit à son gouvernement. »
Il aurait dit cela lors du dernier conseil des ministres de 1993, avant la victoire de la Droite aux élections législatives et la mise en place du gouvernement Balladur.
« Aurait dit » parce que le compte rendu de ce conseil des ministres n’en fait pas état et que la source de cette information est Ségolène Royal lors d’un discours qu’elle a prononcé en 2011, à Jarnac la ville natale de Mitterrand. Elle a fait précéder cette citation par ces mots :
« François Mitterrand n’a jamais sous-estimé l’acharnement des intérêts financiers coalisés. Nous sommes plusieurs ici à nous souvenir de ce message prémonitoire qu’il nous adressait lors du dernier Conseil des ministres de 1993. »
Mais en réalité lorsque Emmanuel Macron parle de risques financiers et économiques, il ne parle pas principalement et peut être même pas du tout de l’équilibre financier des retraites.
Ainsi Alain Minc, celui qui a popularisé le concept de « cercle de la raison » que finalement Emmanuel Macron a mis en œuvre en imposant « l’extrême centre » qui gouverne et qui a pour seule alternative des forces populistes divisées entre deux extrêmes irréconciliables, donnait ainsi la clé de cette affaire sur <Europe 1, le 21 février 2023>
« Il y a une chose qui n’est pas dite, que les responsables politiques ne peuvent pas dire dans une France aussi émotive et populiste, qui est que nous avons 3.000 milliards de dette, nous vivons à crédit, nous vivons en payant des taux d’intérêt incroyablement bas, c’est-à-dire très proches de ceux de l’Allemagne. Si, et le monde entier nous regarde, on ne fait pas cette réforme, notre taux d’emprunt augmente par exemple de 1%. Je vais vous faire le calcul, c’est 2 milliards et demi la première année, 5 milliards la deuxième, 7,5 la troisième, 10 la quatrième. C’est vertigineux […] Mais évidemment avec l’atmosphère ambiante, mélenchoniste régnant, l’absurdité vis-à-vis de l’incompréhension économique qui est propre à ce pays, c’est très difficile de dire les marchés nous regardent, cette réforme est un geste extrêmement fort à leurs yeux et nous sommes obligés de la faire parce que nous portons nos 3.000 milliards de dette.[…] il n’est pas facile pour les responsables politiques de dire ce qu’un observateur peut dire en toute ingénuité ».
Il reprend ces arguments dans un article dans <Sur le site Entreprendre> le 22 février.
Et, en effet, Emmanuel Macron avait bien, devant les journalistes de l’association de la presse présidentielle, lundi 12 septembre 2022, à Nanterre (Hauts-de-Seine), expliqué qu’il avait besoin d’une réforme dès l’été 2023 afin de financer les trois grands chantiers qu’il s’est fixés en cette rentrée : l’école, la santé et la transition climatique.
Donc il y a d’un côté celles et ceux qui discutent du bien fondé de la réforme des retraites de manière intrinsèque, en constatant qu’il n’y a pas d’urgence vitale de faire cette réforme pour le financement des retraites. Les arguments échangés depuis que la réforme a été proposée par le gouvernement n’aborde que le sujet sous cet angle : Faut-il faire une réforme des retraites pour sauvegarder les retraites ?
Alors qu’au fond la préoccupation du gouvernement est tout autre : il faut faire un signe aux marchés financiers pour prouver que la France est en mesure d’économiser de l’argent d’un côté pour pouvoir d’une part faire diminuer sa dette et d’autre part financer d’autres dépenses urgentes.
Je me souviens de Michel Rocard qui lors d’un discours, regrettait que l’État ait cédé ses instruments d’intervention dans l’économie et notamment la possibilité pour la Banque Centrale d’émettre du crédit au profit de l’État au lieu d’obliger ce dernier d’emprunter aux banques privées…
Il reconnaissait son erreur de ne pas s’être opposé à cette évolution.
Et maintenant nos États dépendent des institutions financières privées et des agences de notation.
Récemment Liz Truss avait été désignée comme premier ministre du Royaume-Uni par le parti conservateur. Elle avait un programme totalement démagogique de diminution des impôts, sans diminution des dépenses. Après la période de deuil d’Elisabeth II qui a coïncidé avec le début de son mandat, elle a annoncé officiellement son programme économique le 23 septembre 2022. Elle ne tiendra pas un mois aux pressions de la sphère financière et des agences de notation et démissionnera le 20 octobre 2022.
Dans le monde d’aujourd’hui, les États sont obligés d’écouter l’avis de leurs créanciers.
Michaël Fœssel, dans un article de l’Obs, publié le 18 mars 2023 : « Pourquoi n’ont-ils pas assumé que cette réforme était un signal aux marchés financiers ? », explique :
« En ce qui concerne les justifications de la réforme, nous avons eu droit à toute la palette des éléments de langage : justice sociale, efficacité, valeur travail, équilibre budgétaire, sauvetage du système par répartition, etc. Jusqu’au comique avec la revendication par Olivier Dussopt de mener une « réforme de gauche »… Logiquement, le moment d’exacerbation de la crise a aussi été celui de la vérité : pour justifier l’usage du 49.3, Emmanuel Macron a évoqué les nécessités financières dans un contexte économique mondial dégradé. Peut-être aurait-il fallu commencer par là et assumer clairement qu’aux yeux du pouvoir, cette réforme s’impose uniquement comme un signal adressé aux marchés financiers après une explosion de la dette due aux dépenses du « quoi qu’il en coûte ».
Au moins, les choses auraient été claires : la hausse des taux d’intérêt, les marchés qui regardent la France avec suspicion, la crise bancaire qui s’annonce rendraient inévitable le report de l’âge de départ à la retraite. Nous aurions alors peut-être eu droit à un débat intéressant sur la dépendance des politiques publiques à l’égard des marchés financiers. Il est vrai qu’il aurait fallu aussi présenter à l’opinion une balance un peu cruelle : deux années de la vie des gens en échange de deux points décernés par les agences de notation. »
Il me semble, en effet, que pour qu’une Démocratie puisse fonctionner correctement, il faut poser les bonnes questions et dire les véritables raisons de l’action politique.
Le fiasco de cette réforme pose bien d’autres questions, mais celle-ci me parait essentiel.
La question n’est pas simple, en tout cas pas aussi simple que le suggère Michaël Fœssel.
Dès qu’on s’arrête un peu, on constate que partout on a besoin d’argent public : la transition écologique, la santé, l’éducation nationale, la justice, la défense, la culture partout…
Bien sûr, de ci de là, il est possible d’obtenir quelques financements supplémentaires et mettre fin à certains gaspillages.
Mais globalement il faut gérer des priorités : on ne peut pas tout donner à tout le monde. Il faut faire des choix et savoir décider ce qui est prioritaire, ce qui l’est moins.
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt l’émission « Esprit Public » de ce dimanche qui a abordé ces questions avec des invités ayant des avis assez différents pour que l’échange puisse être fécond.
<1738>
- Cette évolution créera une fracture encore plus grande entre les pauvres et les riches.
-
Lundi 13 mars 2023
« La femme de Tchaïkovski »Film de Kirill SerebrennikovElle s’appelait Antonina Milioukova :
 Le 6 juillet 1877, en l’Eglise Saint George de Moscou, elle devint Madame Tchaïkovski, l’épouse du plus grand compositeur russe de l’Histoire Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Le 6 juillet 1877, en l’Eglise Saint George de Moscou, elle devint Madame Tchaïkovski, l’épouse du plus grand compositeur russe de l’Histoire Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Kirill Serebrennikov l’un des grands réalisateurs et metteurs en scène russe, qui vit désormais à Berlin a poursuivi le projet de consacrer un film à cette femme.
Avec Annie, nous sommes allés voir ce film après avoir entendu le réalisateur invité de Léa Salamé : « Il est absolument impossible que mon film soit montré en Russie »
 C’est un film qui selon nous dégage une grande force.
C’est un film qui selon nous dégage une grande force.
C’est un film de malheur, de malaise, d’humiliation et d’entêtement.
Le malheur provient du fait que ce mariage est un désastre, il ne sera jamais consommé. Après trois mois Tchaïkovski fuit, tombe en dépression et fait même une tentative de suicide. Dans le film Srebrennikov montre une scène dans laquelle Tchaïkovski tente d’étrangler sa femme.
Le malaise c’est le non-dit, des situations pénibles dans lesquelles va se retrouver Antonina Milioukova, dans un monde d’hommes dans lequel aucune place ne lui est accordée.
L’humiliation est celle que Tchaikovsky et ses proches lui imposent pour se débarrasser d’elle, pour l’éloigner
Et l’entêtement est celle de cette femme qui refuse le divorce et veut rester l’épouse de Tchaïkovski.
Igor Minaev et Olga Mikhaïlova, dans leur livre : « Madame Tchaïkovski : chronique d’une enquête » explique
« Dans sa notice nécrologique on pouvait lire : «Tchaïkovski est mort célibataire» mais lors des funérailles du compositeur, le 11 octobre 1893, les gens furent pris de stupeur à la lecture de l’inscription sur une des couronnes : «De la part de sa femme aimante». »
Le 1er décembre 2016, j’avais écrit un mot du jour : « La symphonie Pathétique » qui est la dernière œuvre du compositeur. Il l’a créé sous sa direction à Saint-Pétersbourg, le 28 octobre 1893 et 9 jours après, il est mort à l’âge de 53 ans.
Dans ce mot du jour, j’évoquais la thèse défendue par certain, notamment l’écrivaine Nina Berberova, du suicide du compositeur suite à une décision de condamnation à mort par un tribunal d’honneur. Cette thèse est controversée.
Mais le cœur de tout cela que plus personne ne conteste c’est l’homosexualité de Tchaïkovski.
Une homosexualité inavouable dans la société de cette époque et pour Tchaïkovski exclusive : il ne supportait pas les attouchements avec un corps féminin.
Il écrira quelques mois après les noces à son jeune frère Modeste :
« Je l’avais bien prévenue qu’elle ne pouvait compter que sur un amour fraternel. Physiquement, ma femme m’inspire à présent une répulsion totale »
Deux ans avant son mariage, en 1876, il avait écrit toujours à Modeste :
« Je voudrais, par un mariage ou du moins par une liaison déclarée avec une femme, faire taire certaines créatures méprisables. »
Dans le film, Srebrennikov, montre une Antonina qui poursuit Tchaïkovski avec passion pour lui demander le mariage auquel il finit par céder.
 L’actrice qui joue le rôle d’Antonina est extraordinaire et a pour nom Alyona Mikhailova.
L’actrice qui joue le rôle d’Antonina est extraordinaire et a pour nom Alyona Mikhailova. « Le Masque et la Plume» ont trouvé à une exception près ce film magnifique, mais c’est de manière unanime qu’ils ont reconnu la performance d’Alyona Mikhailova. Et ils ont dénoncé comme une injustice que le dernier festival de Cannes, où ce film était présenté, ne lui ait pas décerné le Prix d’interprétation féminine,
Tout le monde sait que Tchaikovski était homo-sexuel. Mais le gouvernement russe, comme avant le gouvernement soviétique, comme avant le gouvernement tsariste ne veut pas le reconnaître.
Lorsque Kirill Serebrennikov présente son projet au ministre russe de la Culture, ce dernier lui répond
« Tchaïkovski n’était pas homosexuel, vous n’êtes pas autorisé à le laisser penser dans votre film, nous avons besoin d’un film sur Tchaïkovski hétérosexuel ».
Serebrennikov explique à Léa Salamé :
« Ce que j’ai trouvé repoussant, c’est cette commande propagandiste : quand on dicte à une équipe de tournage qu’il faut faire comme-ci, ou comme ça, c’est comme si le mensonge devenait une idéologie de propagande ».
Concernant son film il décrit son projet :
« Ces deux personnes ont été en vraie dépression, mais Tchaïkovski a réussi à rester un grand compositeur. Antonina, elle, a sombré dans cette folie. […] Il y a là une certaine naïveté, mais aussi un ego passionné, un désir de posséder la personne que vous avez choisie. Ce désir de posséder la rend extrêmement contemporaine […] En miroir de ce personnage qui agit, on voit un Tchaïkovski dur, narcissique, insensible à elle. Il était contre tout ce qui pouvait l’empêcher d’écrire sa musique, il essayait de créer autour de lui les bonnes circonstances pour travailler, il le fait par des efforts qu’on peut interpréter comme étant de l’agression ».
Dans la réalité Antonina Milioukova finira sa vie dans un Hôpital psychiatrique à Moscou, dans lequel elle décédera le 1er mars 1917, 24 ans après son mari
Igor Minaev et Olga Mikhaïlova, dans leur livre : « Madame Tchaïkovski : chronique d’une enquête » écriront :
« En 1917, dans un hôpital psychiatrique de la ville de Saint-Pétersbourg, mourait une mystérieuse patiente. Elle ne figurait pas dans les registres de la clinique sous le nom de Madame Tchaïkovski, veuve du compositeur Piotr Tchaïkovski, mais comme Antonina Miloukova. […] Déjà rejetée de son vivant, elle fut par la suite complètement oubliée par ses contemporains ; la génération actuelle va même jusqu’à douter de son existence. »
Sur le site <Zone Critique> Kirill Serebrennikov précise :
« Je souhaitais porter un regard inattendu sur un héros national et intouchable et j’ai décidé, pour ce faire, de suivre les lois générales du biopic (ou film biographique), en considérant les éléments de loin sans porter un regard radical dessus. Se placer à une certaine distance permet d’entrevoir les choses avec du recul et d’embrasser toute la psychologie des personnages, ce qu’il n’est pas possible de faire quand on s’approche trop près, presque face contre face. J’ai adopté cette distance par le truchement d’Antonina, car je voulais adopter le point de vue d’une personne qui ne sait pas ce que nous, nous savons. Elle a son propre regard, vit sa propre expérience, celle d’une personne somme toute classique et banale, en proie à l’impossibilité d’interagir comme il faut avec un génie, ce qu’il représente : un soleil irradiant de talent. Elle n’y parvient pas car, bien que resplendissant, le soleil a aussi ses propres taches et, paradoxalement, ses parts d’ombre. […]
Je voulais rendre les personnages absolument complexes, c’est pour cela que j’ai décidé de laisser dans leur bouche leurs vraies paroles. Il s’agit presque d’un film documentaire : les lettres sont authentiques, même le comportement des personnages montré à l’écran est extrêmement fidèle à la réalité. Ainsi, ce que dit Antonina des juifs dans son délire antisémite se retrouve mot pour mot dans ses lettres. Ma part d’auteur réside surtout dans la composition que j’ai faite des séquences, en tâchant de respecter le plus possible la réalité. »
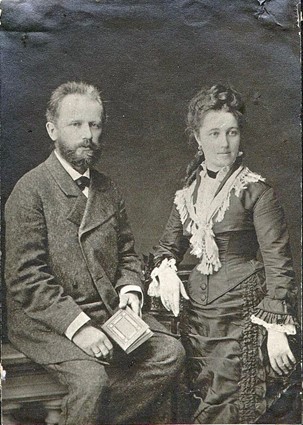 Et puis il parle de la seule photo sur laquelle on voit Monsieur et Madame :
Et puis il parle de la seule photo sur laquelle on voit Monsieur et Madame :
« Il n’existe qu’une seule photo où ils apparaissent tous les deux et je l’ai restituée telle quelle dans le film. Elle est très étrange, on ne sait pas pourquoi, sur ce cliché, il nous regarde alors qu’elle-même a son attention portée ailleurs. Dans de nombreuses scènes du film coupées au montage, et d’une durée totale de 40 minutes qui se retrouveront peut-être dans une édition intégrale, j’ai représenté les ateliers dans lesquels Tchaïkovski, ses amis et ses élèves se faisaient photographier. Il y passait beaucoup de temps car les daguerréotypes nécessitaient une certaine application pour ne pas être flous. Tchaïkovski a été un pionnier des photos commerciales ; en raison de sa célébrité, tout le monde souhaitait posséder sa photo chez lui. Il se faisait alors tirer le portrait chez les plus grands artistes, lesquels vendaient les photos avec les partitions. »
 La Russie que le cinéaste montre est très sale, violente et glauque :
La Russie que le cinéaste montre est très sale, violente et glauque :
« C’était la réalité du XIXe. Les ordures étaient encore lancées sur la chaussée, comme on le voit dans le film, même si les caniveaux et les canalisations commençaient à faire leur apparition. J’avais envie de montrer la saleté et l’absence du confort auquel on est habitué aujourd’hui. Les personnages ont envie de vivre, aimer, souffrir, servir la musique… Par contraste, ces ambitions s’opposent à ces scènes d’extérieur, tristes, sales et dégradées. Je voulais illustrer le véritable milieu où tous ces gens ont évolué, rêvé, aimé…. »
Kirill Serebrennikov a été poursuivi par l’appareil judiciaire de Poutine, assigné à résidence, condamné en juin 2020 à de la prison avec sursis, Poutine ne voulait pas en faire un martyr. Il a quitté la Russie pour Berlin peu après le début de la guerre en Ukraine pour vivre à Berlin.
Chez Léa Salamé il s’est exprimé sur la Russie contemporaine :
« Le film montre aussi qu’à l’époque, la situation des femmes en Russie était pire que celle des hommes homosexuels, qui bénéficiaient d’une forme de tolérance. Aujourd’hui, il est impossible d’être homosexuel en Russie. Il est absolument impossible de montrer ce film en Russie compte tenu des lois prises ces dernières années: tous les enfants risqueraient de devenir homosexuels si on leur montrait ce film-là ? On va attendre d’autres, une autre époque, quand tout le monde se retrouvera en Russie. Si un jour ce film est montré, ce sera le signe des changements en Russie ». Après Poutine ? « Sans nul doute. »
C’est un film puissant qu’on n’oublie pas.
<1737>
-
Mardi 7 mars 2023
« The Köln Concert »Keith JarrettLe jazz n’est pas mon domaine.
Il ne se trouve pas dans mon univers musical.
Des amis précieux, Jean-François, Martine, François ont tenté de m’y initier sans succès.
Au bout de quelques minutes je sentais l’ennui me submerger et même un sentiment de malaise lorsque le blues me communiquait une impression de dépression, bien loin de la vibration réconfortante, du bain régénérateur quand j’écoute Bach, Schubert, Beethoven, Mahler etc..
Mais j’ai été intrigué par une émission « MAXXI Classique » que j’ai écouté par hasard, le 24 janvier 2023, et qui parlait d’un concert mythique : <The Köln Concert : Keith Jarrett à l’opéra>
Et puis Adèle Van Reeth, en a également parlé dans son livre « Inconsolable ».
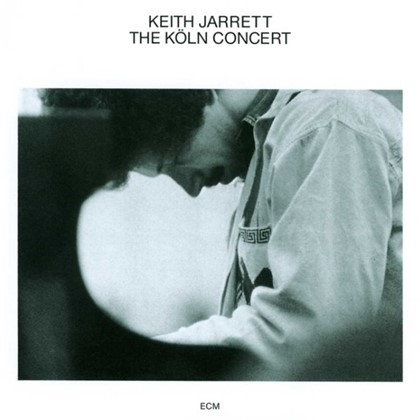 Alors je me suis décidé à acquérir ce disque et à l’écouter.
Alors je me suis décidé à acquérir ce disque et à l’écouter.
Ce concert a été enregistré à l’Opéra de Cologne il y a 48 ans, le 24 janvier 1975.
Max Dozolme présente ce concert ainsi :
« Sol ré do sol la. Cinq notes. Cinq notes et des sourires. Dans la salle, tout le monde reconnait dans ce motif musical la sonnerie annonçant le début de chaque concert donné à l’Opéra de Cologne. Du parterre aux balcons où il ne reste plus aucune place de libre, personne en revanche ne peut imaginer que ces cinq notes vont être le point de départ d’une improvisation qui durera une soirée entière.
Quand il monte sur la scène de l’opéra, Keith Jarrett n’est pas dans une très grande forme. Cela fait plusieurs jours qu’il enchaîne les concerts et il est épuisé.
La veille, il était à Lausanne et il n’a pas dormi depuis vingt-quatre heures.
Une fois arrivé à Cologne, après dix heures de route, il découvre que le piano que l’opéra lui a réservé est un vieux Bösendorfer qui n’a pas été révisé depuis très longtemps et qui sonne, selon l’aveu-même de Jarrett « comme un mauvais clavecin ou un piano dans lequel on aurait mis des punaises. […] Parce que ce piano possède des aigus qui ne lui plaisent pas et une sonorité peu intéressante, le pianiste décide de solliciter au maximum le registre grave et médium du piano. Dans cette grande improvisation structurée, il privilégie également un jeu plutôt rythmique, composé de petits motifs et d’accords aérés. »
Keith Jarrett envisage de renoncer et de ne pas jouer. Mais la salle est pleine, alors il hésite.
Le site <Musanostra> prétend que ce concert aurait eu lieu à 23:30 après l’opéra du soir et que les 1400 spectateurs prirent place dans la salle après avoir entendu la sonnerie de rappel.
Ce même site, rapporte un propos que Keith Jarret a tenu à propos de ce concert :
« Je n’avais aucune idée de ce que j’allais jouer. Pas de première note, pas de thème. Le vide. J’ai totalement improvisé, du début à la fin, suivant un processus intuitif. Une note engendrait une deuxième note, un accord m’entraînait sur une planète harmonique qui évoluait constamment. Je me déplaçais dans la mélodie, les dynamiques et les univers stylistiques, pas à pas, sans savoir ce qui se passerait dans la seconde suivante ».
Le producteur du disque qui sera réalisé à partir de ce concert ; Manfred Eicher déclare :
« Dès les premières mesures, j’ai compris qu’il avait décidé de ne pas se battre contre l’instrument mais de l’accepter tel quel, et que ça allait avoir une influence sur son jeu, et peut-être l’emmener dans des territoires qu’il n’avait pas forcément l’habitude d’explorer. Je n’étais pas dans la salle mais dans le bus qui servait de régie à l’enregistrement, et j’ai tout de suite été saisi par la splendeur mélodique du motif originel, la façon extrêmement virtuose et naturelle avec laquelle il le transformait en vagues lyriques successives, l’art hautement dramaturgique avec lequel il déroulait cette espèce de fil émotionnel tout du long, sans jamais le lâcher. »
Et Adèle Van Reeth, en fait cette description précise, dans « Inconsolable » pleine d’émotion et de sensibilité :
« La pédale est bien appuyée, les doigts cherchent et la mélodie, instantanément, se dessine sous les yeux du public. Main gauche, touches effleurées, main droite, une suite de notes très simple et très douce, puis la pédale se relâche et le rythme s’installe, un rythme à contretemps, la mélodie chaloupe, le jazz qui cogne à la porte, discrètement, presque une minute, puis il repart, la mélodie reste en l’air, comme si elle n’allait pas rester, comme si une seconde de silence et elle pouvait disparaître, à chaque note on croit qu’il va s’arrêter, à chaque note on prie pour que ça continue, quelques notes à peine, c’est si fragile et si beau, et c’est ça, exactement ça, l’intraduisible, la mélodie du réel qui se fait devant nous, en direct, d’abord le silence puis ce concert, deux heures d’improvisation totale qui saisissent très exactement ce autour de quoi on tourne en permanence. Lui donne l’impression de tourner en rond mais il y va tout droit, c’est une évidence, des cris dans la voix quand la touche percute au bon moment, le pied qui bat la mesure sur la pédale, c’est une percussion, ça cogne à nouveau, puis presque plus rien, et ça repart, ça ne s’arrête pas, ça gonfle, petit à petit, ça monte, ça monte, qu’est-ce que c’est beau, et soudain ça part, après sept minutes il trouve le thème, le début de la jouissance accompagnée par des cris qui y ressemblent étrangement, et la vie est lancée, la vie est saisie, c’est l’existence qui se joue devant nous, dans nos oreilles, sur scène, et rien ne sera jamais aussi beau, si ce n’est la reprise du thème, quelques minutes plus tard, puis à nouveau, encore et encore, une reprise sans cesse imprévisible et sans cesse implorée, « ne nous laisse pas, semblent murmurer les spectateurs, montre-nous le chemin, toi qui ne parles pas, toi qui n’écris pas, toi qui joues et inventes au creux de l’hiver, en plein mois de janvier, ce que nous avons au plus profond de nous, l’exacte musique de notre cœur inconsolable »
Max Dozolme conclut :
« Avec environ quatre millions de ventes à ce jour, le Köln Concert est l’album du label ECM, de Keith Jarret et de piano jazz le plus vendu de tous les temps. Un concert qui a donné lieu à une transcription, une partition écrite et éditée. Mais cet objet ne nous aide pas à percer le mystère du jeu de Jarrett. Aussi précise soit-elle, la partition ne pourra jamais nous aider à comprendre ce qui s’est passé ce soir-là dans la tête de Keith Jarrett. Reste le disque, la photographie la plus fidèle d’une œuvre sans lendemain et immortelle. »
Après avoir écouté plusieurs fois ce disque, surtout sa première partie, j’ai enchaîné sur la 7ème symphonie de Mahler et je suis retourné dans mon univers. Ce n’est pas, pour moi, la même sensation, pas les mêmes vibrations, ni la même émotion.
Mais je reconnais que cette expérience d’un artiste fatigué jouant un instrument médiocre et parvenant à partir de 4 notes d’improviser et de créer une œuvre cohérente, foisonnante et pleine de souffle, relève certainement du génie et conduit à un instant d’éternité.
<1736>
-
Dimanche 5 mars 2023
« J’ai horreur de l’imitation et des choses déjà connues. »Serge Prokofiev cité par Claude SamuelIl y a 70 ans, jeudi le 5 mars 1953, l’immense compositeur né, en 1891, à Sontsivka en Ukraine, Serge Prokofiev meurt, à Moscou. Il avait 61 ans.
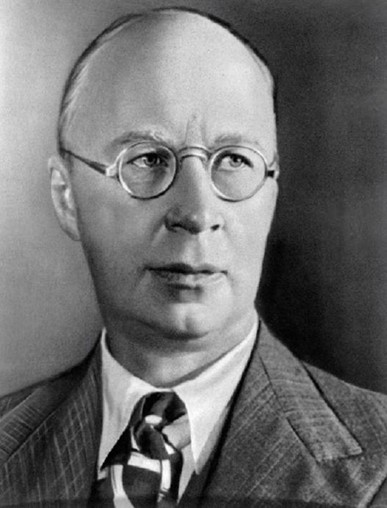 <Diapason Mag> raconte :
<Diapason Mag> raconte :
« Ce jour-là, Serge Prokofiev avait repris le manuscrit à peine esquissé de sa Sonate pour piano n° 10. Au début de l’après-midi, son médecin était passé le voir et, malgré une grande fatigue et des troubles de santé qui avaient nécessité au cours des huit dernières années de nombreux séjours à l’hôpital, il avait fait quelques pas dans les rues enneigées de Moscou, accompagné de Mira Mendelssohn, sa seconde épouse. Ils avaient évoqué leur départ pour leur résidence campagnarde de Nicolina Gora. Le printemps, enfin. Pour l’heure, Prokofiev avait un rendez-vous avec les responsables du Bolchoï où son dernier ballet, La Fleur de pierre, avait été mis en répétition cinq jours auparavant. Malaise dans la soirée, le médecin revient avec un traitement d’urgence. Congestion cérébrale fatale à 21 heures. 5 mars 1953 »
Mais son décès ne sera annoncé par la Pravda que le 11 mars, soit 6 jours après. Un journal américain avait publié la nouvelle le 9 mars.
Parce qu’il s’était passé autre chose le 5 mars 1953 : la mort d’un monstre sanguinaire et immonde qui avait enfin eu la bonne idée de disparaître de la surface de la terre.
Staline était le nom de cet individu qui fait partie du top 3 de ce que notre espèce « Homo sapiens » a généré de pire. Mao et Hitler ont été à l’origine d’encore plus de morts.
« La plus éminente médiocrité du Parti », disait son rival Trotski. Un cas psychiatrique atteint d’« hystérie » et de « folie de la persécution », selon son successeur Nikita Khrouchtchev.
Ce tyran disait de lui-même « Je ne fais confiance à personne, pas même à moi. »
Et aussi : « La mort résout tous les problèmes. Plus d’homme, plus de problème ». On lui attribue la paternité de plus de 20 millions de décès prématurés, auxquels il faut ajouter 28 millions de déportations. Il ne niait d’ailleurs pas un penchant pour le sadisme : « Le plus grand plaisir, c’est de choisir son ennemi, préparer son coup, assouvir sa vengeance, puis aller se coucher. » Un général de l’Armée rouge pouvait voir sa femme se faire arrêter, être élevé au grade de maréchal deux jours plus tard et finir fusillé quelques années après…
<Diapason Mag> évoque le récit que Prokofiev serait mort de joie :
« Ce jour-là, des rumeurs avaient couru dans la ville : le camarade Staline était très malade, sinon déjà défunt. On dira plus tard, mais sans preuves, que Prokofiev mourut (de joie) en apprenant par voie radiophonique le décès du dictateur… »
Selon une autre source auquel j’ai eu accès, la mort de Staline a été annoncé 50 minutes après la mort de Prokofiev.
Dans ces conditions l’enterrement du compositeur fut évidemment compliqué :
« Cependant le corps de Prokofiev fut transporté dans la grande salle de l’Union des compositeurs, une opération particulièrement problématique dans une ville parsemée de barrages de police, sillonnée par des camions et des tanks. Quant à l’inhumation au cimetière de Novodievitchi, à proximité des tombes de Scriabine et de Tchekhov, elle fut un peu particulière. Peu de personnes s’étaient déplacées, sinon David Oïstrakh qui interpréta deux extraits de la Sonate pour violon n° 2 du défunt. Et il n’y avait pas la moindre fleur, denrée introuvable en ce jour de deuil national. »
La vie de cet homme fut une suite de contrariété.
D’abord il quitta son pays en 1918 pour fuir la guerre civile provoquée par l’arrivée au pouvoir des bolcheviks.
Ensuite dans son exil, notamment à Paris il fut dans l’ombre de Stravinsky qui triomphait avec les ballets russes davantage que Prokofiev qui écrivait aussi pour la troupe de Diaghilev avec qui il monte « Le Pas d’acier » (1928) et « Le Fils prodigue » (1929).
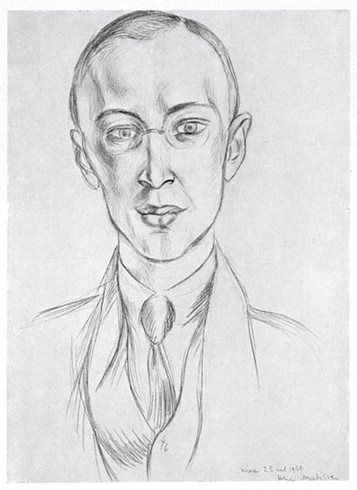 Il rencontre les artistes de son temps comme Pablo Picasso et Henri Matisse qui fait de lui un portrait au fusain.
Il rencontre les artistes de son temps comme Pablo Picasso et Henri Matisse qui fait de lui un portrait au fusain.
Selon <Wikipedia> à partir de 1927, Prokofiev supporte de plus en plus mal l’exil et correspond de plus en plus avec ses amis restés en URSS. Il décide d’y faire une tournée dont le succès est tel qu’il fait salle comble pendant plus de deux mois ; il est fêté comme un héros national ayant conquis l’Occident.
Il envisage alors sérieusement un retour au pays, ce qui lui permettrait de sortir enfin de l’ombre de Stravinsky, d’autant que Diaghilev disparaît de manière totalement inattendue à Venise en 1929.
Et puis, pour avoir des revenus suffisants que son seul métier de compositeur ne lui donne pas, il est obligé de poursuivre une carrière de pianiste virtuose qui lui donne accès à de nombreux concerts.
Or Serge Prokofiev veut avant tout être compositeur.
Cette quête, il la poursuit depuis son enfance.
Je ne résiste pas à la tentation de raconter cette scène de son enfance relatée par Claude Samuel dans son ouvrage sur Prokofiev :
« Un jour, raconte Mme Prokofiev [sa mère qui était bonne pianiste] lorsque j’avais fini de jouer, il s’approcha de moi, me tendit un papier et dit Voilà une mazurka de Chopin que j’ai composée, joue-la moi ! Je mis le papier devant moi et je commençai une des mazurkas de Chopin. « Non ce n’est pas ça ! joue la mazurka de Chopin que j’ai composée » Je répondis à cela que je ne pouvais jouer ce qu’il avait fait parce qu’on n’écrivait pas ainsi,
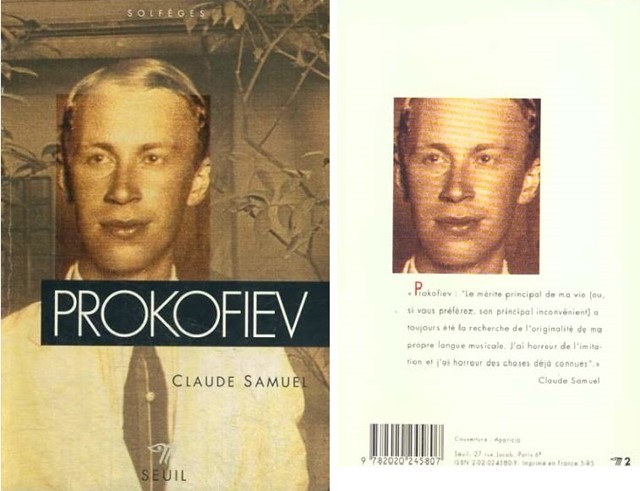 mais en le voyant prêt à pleurer, je dus lui montrer les erreurs de sa notation. »
mais en le voyant prêt à pleurer, je dus lui montrer les erreurs de sa notation. »
Et le petit Serge appris vite et continua inlassablement à composer.
Et il commença même à avoir un peu de succès auprès de compositeurs russes importants et reconnus comme Serge Tanaeiv.
Cette passion pour la composition il pensa pouvoir l’exercer pleinement en Union soviétique qui lui promettait de l’accueillir confortablement en le laissant composer à sa guise et à son rythme tout en lui versant une pension régulière et sans condition lui permettant d’être compositeur à plein temps.
C’est en 1936 qu’il devient résident permanent à Moscou. Au départ, la réalité correspond à peu près aux promesses.
Mais à partir de 1948, le Parti Communiste, Staline et son bras armé culturel Jdanov conçurent qu’il fallait composer des œuvres d’art et notamment la musique selon des normes soviétiques.
Ce fut l’objet de la Résolution du parti communiste du 10 février 1948.
J’en ai déjà parlé lors de mots du jour consacrés à Dimitri Chostakovitch.
Dès lors la vie des compositeurs et des artistes devint un enfer. Interdit de quitter l’Union soviétique, ils risquaient à tout moment de perdre toute capacité à exercer et donc à obtenir des revenus. Bien plus ils étaient menacés d’être envoyés au Goulag, voire d’être exécuté après un procès expéditif.
David Oïstrakh et Dimitri Chostakovtch ont raconté comment, à cette époque, ils avaient préparé une petite valise pour être prêt, si un matin les sbires de ce régime scélérat venaient les chercher pour les emmener. Probablement que Prokofiev en fit autant.
Ce fut alors une vie de contrariétés avant une cérémonie de l’Adieu tronquée à cause du « montagnard du Kremlin » comme l’appelait Ossip Mandelstam.
Prokofiev fut un remarquable compositeur. J’emprunte encore au livre de Claude Samuel cet auto-évaluation du compositeur qui me parait pertinente.
« Le mérite principal de ma vie a toujours été la recherche de l’originalité de ma propre langue musicale. J’ai horreur de l’imitation et j’ai horreur des choses déjà connues. »
Il faut bien quelques liens vers des œuvres magistrales :
D’abord pour admirer la force rythmique de Prokofiev : < <Yuja Wang jouant le Precipitato de la 7ème sonate de piano>
Son chef d’œuvre symphonique la <5ème symphonie par l’Orchestre de Paris et Paavo Järvi>
Et son chef d’œuvre absolu, le ballet <Roméo et Juliette par l’Opéra de Paris>
<1735>
-
Mardi 28 février 2023
« Un archiviste, c’est quelqu’un qui sait jeter. »Benoit Van ReethBenoit van Reeth était archiviste paléographe, élève de la prestigieuse Ecole nationale des Chartes.
 Cette école créée en 1832 a eu pour élève, l’écrivain François Mauriac, les historiens Jean Favier et Régine Pernoud et le philosophe René Girard.
Cette école créée en 1832 a eu pour élève, l’écrivain François Mauriac, les historiens Jean Favier et Régine Pernoud et le philosophe René Girard.
Dans sa présentation il est précisé que cette école est spécialisée dans la formation aux sciences auxiliaires de l’histoire. En France, c’est l’école incontournable pour accéder au diplôme et au métier d’archiviste paléographe.
Son établissement principal se trouve 65 rue Richelieu Paris 2ème, à quelques pas de la bibliothèque nationale Richelieu.
Qu’est-ce qu’un archiviste ?
Le dictionnaire le Robert donne cette définition : « Spécialiste préposé à la garde, à la conservation des archives. »
J’aime beaucoup la définition de l’ONISEP qui tente de décrire tous les métiers pour que les jeunes étudiants puissent choisir celui qui leur convient
« Collecter, étudier, classer, restaurer ou transmettre sur demande tout type de documents (du manuscrit du Moyen Âge, à l’enregistrement vidéo en passant par l’acte notarié), tel est le rôle de l’archiviste. »
Et un paléographe ?
Selon Wikipedia : « La paléographie (du grec ancien palaiόs (« ancien »), et graphía (« écriture ») est l’étude des écritures manuscrites anciennes, indépendamment de la langue utilisée (grec ancien, latin classique, latin médiéval, occitan médiéval, ancien français, moyen français, français classique, anciens caractères chinois, arabe, notation musicale, etc.). »
C’est évidemment le père d’Adèle Van Reeth dont il était question hier.
Lors de l’entretien mené dans le cadre de < la Librairie Mollat > , à partir de la minute 17, Adèle Van Reeth explique :
« Mon père était archiviste et nous vivions aux archives. Nous avons vécu dans beaucoup de villes différentes. […] Je me promenais au milieu de tous ces documents. Et je demandais à mon père : c’est quoi être archiviste ?. C’est compliqué. […] Un archiviste c’est pas simplement quelqu’un qui garde des documents pour les rendre accessibles aux historiens et aux chercheurs. […] Il n’y a que certains documents qui peuvent être conservés et pas d’autres. […] Et puis surtout un archiviste, sa mission numéro un c’est conserver et rendre accessible, mais avant cela il faut trier. Et qui dit trier, dit savoir jeter. Et en fait, ce que mon père me répétait souvent et ce qui me fascinait : « Un archiviste, c’est quelqu’un qui sait jeter ». Je pense à mon père à chaque déménagement [quand je veux garder beaucoup de choses] pour pouvoir mieux préserver, il faut savoir jeter. »
Voilà une réflexion qui me semble particulièrement utile et pertinente et pas seulement dans le cadre d’un déménagement.
C’est une réflexion qui concerne la vie en général : si on veut bien conserver les choses essentielles, il faut savoir jeter ce qui ne l’est pas.
 Quand Adèle Van Reeth a annoncé la mort de son père, elle l’a illustrée par la photo des archives départementales du Rhône.
Quand Adèle Van Reeth a annoncé la mort de son père, elle l’a illustrée par la photo des archives départementales du Rhône.
Ce bâtiment se situe à 15 mn à pied de notre domicile.
Benoit Van Reeth fut le directeur des archives du Rhône de 2003 à 2014.
Benoît Van Reeth assura la conception et la préparation du déménagement des Archives dans ce nouveau bâtiment inauguré en septembre 2014, à côté de la gare de la Part-Dieu.
C’est ce que l’on apprend sur ce site des <Archives du Rhône>
Il finira sa carrière à partir de 2014 à Aix en Provence comme directeur des Archives nationales d’outre-mer.
<Les actualités du livre> lui ont rendu hommage et raconté tout son parcours au sein des archives de France.
Le hasard du butinage et de l’écriture du mot du jour, font que celui-ci est publié un 28 février, soit exactement 2 ans après la mort de cet homme du classement, du rangement et de l’Histoire.
Il nous apprend que si on veut s’attacher à l’essentiel, à ce qui a du prix et de la valeur, il faut savoir se débarrasser du reste.
<1734>
-
Lundi 27 février 2023
« Le monde continue mais sans toi, et pour moi ce n’est pas le même monde. »Adèle Van Reeth « Inconsolable »« J’entre ici en perdante.
Je sais que les mots ne pourront rien. Je sais qu’ils n’auront aucune action sur mon chagrin.
Comme le reste de la littérature. Je ne dis pas qu’elle est inutile, je dis qu’elle ne console pas.
Pourquoi écrire alors ?
Plus envie de lire. Plus envie de rien.
Mais les mots, les mots restent, ils dansent, ils percutent, et quand je cloue le bon mot au réel, parfois, je jouis.
Le goût des mots, quand il s’efface je suis molle.
Je n’ai pas de grande théorie sur le pouvoir de la littérature ni sur l’utilité de la philosophie.
Je ne revendique rien.
Je suis seule.
Et tout a déjà été dit »
C’est ainsi que débute « Inconsolable » l’essai qu’Adèle Van Reeth a écrit à la suite de la mort de son père. Il avait 65 ans.
Mon frère en avait 74.
Quand on perd un être cher, on dresse l’oreille, on fixe le regard vers celles et ceux qui connaissent la même déchirure et qui s’expriment ou écrivent.
Adèle Van Reeth est depuis septembre 2022, présidente de France Inter. Je l’avais découverte lorsqu’elle animait les émissions de France Culture d’abord « Les Nouveaux Chemins de la connaissance » qui est devenue « Les Chemins de la philosophie » en 2017.
Son entrée dans ce livre sur le chagrin, mot qu’elle préfère à deuil, est pessimiste.
Il semble qu’il n’y a rien à faire et que la consolation est hors d’atteinte.
Dans < cet entretien avec Pierre Coutelle > dans le cadre des rencontres organisées par la « Librairie Mollat » de Bordeaux, Adèle Van Reeth affirme :
« La philosophie ou la littérature ne nous apporteront pas la consolation ultime ».
Je comprends cette expression « consolation ultime » comme un processus qui fait oublier le chagrin et conduit à passer à autre chose.
Elle ajoute : « Des livres, une œuvre d’art, un animal domestique, de l’alcool peuvent apporter de la consolation, mais pas la consolation ultime »
Et elle explique :
« Je pose l’hypothèse que nous sommes depuis la naissance des êtres inconsolables. C’est-à-dire que nous naissons avec une perte, un manque, une fêlure. »
L’hypothèse qu’elle émet s’appuie, bien sûr, sur la perception de notre finitude. Nous sommes inconsolables parce que nous sommes mortels. Et elle parle de l’expérience de l’état d’« inconsolable » lors de la perte d’un être proche et aimé.
Elle fustige « les marchands de consolation », remet en cause le bien-fondé de ce qu’on appelle « le travail de deuil » qu’elle assimile à un « manuel à suivre » et conteste les « injonctions à la consolation ».
« Il y a un temps, un moment juste après la mort de l’être aimé où on peut avoir envie de rester triste […] Il y a un moment où la tristesse paraît être un lien encore vivant avec la personne qui n’est plus. Tant que je suis triste, je maintiens un lien avec cette personne que je ne peux plus toucher, avec qui je ne peux plus parler. […] Le rapport à la tristesse est beaucoup plus intéressant que ce que l’on dit. Il y a une manière de vivre non malgré la tristesse, mais avec la tristesse en allant bien. En retrouvant le goût, l’appétit de la vie, même en décuplant ce gout de la vie, parce que la tristesse nous apporte, nous enseigne quelque chose. Je crois qu’il y a une sagesse de la tristesse. Il me semble que c’est plus intéressant et même plus réconfortant que dire « consolez-vous » et vouloir que la personne sèche ses larmes à tout prix. »
Mais ce qui m’a le plus marqué dans son témoignage c’est cette phrase qu’elle a écrite dans son essai et qu’elle adresse à son père mort :
« Le monde continue mais sans toi, et pour moi ce n’est pas le même monde. »
C’est ce que je ressens profondément, la vie continue, bien sûr, mais ce n’est plus le même monde !
Et elle a cette autre inspiration :
« Une absence dit ce qui n’est pas !
Mais rien n’est plus présent qu’une absence quand il s’agit d’une personne qui vous manque autant. »
Dans la dernière page du livre Adèle Van Reeth écrit :
« Mon papa, je voulais te dire que je vais bien […] je vais bien avec la tristesse, si je n’avais pas de tristesse, j’irais bien aussi, mais pas de la même façon. La tristesse sera toujours là, c’est ainsi, mais elle ne m’empêche pas d’aller bien.[…] On m’a dit que pour aller bien il fallait me consoler, il fallait que la tristesse disparaisse, mais il n’en est rien. Je vais bien non pas malgré la tristesse mais avec elle. »
Dans un duo très intéressant avec la philosophe Vinciane Despret, elles engagent des variations sur ce thème : « aller bien avec la tristesse » dans l’émission de France Culture : « Le book club » : <Écrire la mort>
Vinciane Despret a aussi écrit un livre : « Les morts à l’œuvre » paru début janvier 2023.
Dans ce livre, Vinciane Despret raconte cinq histoires de morts pour lesquels les vivants ont commandé une œuvre d’art grâce à un protocole politique et artistique nommé « le programme des Nouveaux Commanditaires ».
Son livre est une enquête qui se concentre sur ce protocole artistique qui a été mis en œuvre par le photographe François Hertz en se posant simplement la question : « si les États, les banques, les entreprises ont le droit de commander des œuvres d’art, pourquoi les citoyens n’auraient pas le droit ? »
Bien sûr il faut argumenter et tous n’auront pas gain de cause, mais il est possible à chacun de commander une œuvre d’art.
Il existe un site des «Nouveaux Commanditaires» et une page expliquant «le protocole» qui se termine par ce paragraphe :
« Financée par des subventions privées et publiques, l’œuvre devient la propriété d’une collectivité et sa valeur est, non plus marchande, mais celle de l’usage que cette collectivité en fait et de l’importance symbolique qu’elle lui accorde. »
Dans l’émission en duo avec Adèle van Reeth, Vinciane Despret a cité une élue locale qui à la réception d’une œuvre, créée dans le cadre de ce protocole, a exprimé cette quête :
« Faire de l’absence, une beauté »
A la fin, de la fête de ses 70 ans, mon frère Gérard a déballé son violon et joué quelques œuvres dont une « Valse moderato » écrite par notre père qui lui avait dédié ce morceau, alors que tout jeune garçon de 15 ans, il se trouvait seul à Paris, dans une famille d’accueil pour suivre les cours du Conservatoire national supérieur de musique de Paris.
Vous trouverez si vous le souhaitez une vidéo de ce moment derrière ce lien : <Gérard joue>
<1733>
-
Mercredi 22 février 2023
« Historiquement, ce travail de « reproduction sociale », comme j’entends le nommer, a été assigné aux femmes, bien que les hommes s’en soient aussi toujours en partie chargés. Étant à la fois affectif et matériel, souvent non rémunéré, c’est un travail indispensable à la société. »Nancy FraserA la lecture du mot du jour d’hier, Annie m’a interpellé en remarquant que je ne disais pas que le travail hors emploi était indispensable à la société.
C’est exact.
Mais j’avais déjà écrit un tel mot du jour, le 14 octobre 2016, en faisant référence à une conférence de la philosophe Nancy Fraser : <Les contradictions sociales du capitalisme contemporain>
<Mot du jour sans numéro>
-
Mardi 21 février 2023
« C’est durant la période de [non-emploi] que l’on peut encore rêver, à la manière du jeune Marx, d’échapper à la spécialisation, d’être tour à tour chasseur, pêcheur ou lecteur de Platon »Raymond Aron « Les désillusions du progrès » page 185Dans <le mot du jour du 31 janvier 2023> j’esquissais une explication qui tentait d’approcher ce désir très fort, cet attachement, en France, à une retraite ne venant pas trop tard dans la vie humaine.
Cette explication parlait non pas de la retraite, mais du travail et de l’insatisfaction actuelle d’un grand nombre par rapport au contenu, au sens et à l’organisation de leur activité professionnelle.
Je reprenais dans cet article la distinction que faisait le philosophe Bernard Stiegler entre « le travail » et « l’emploi ».
« L’emploi » étant toujours du travail, mais du travail rémunéré, celui qui permet à « l’employé » de toucher un revenu. Il permet aussi, au niveau macro-économique d’abonder le fameux « PIB » si important pour la foule des économistes traditionnels et des politiques qui exercent le pouvoir.
Mais l’emploi n’englobe pas tout le travail réalisé dans une société et cela de très loin.
Quand une assistante maternelle s’occupe d’enfants c’est du travail et un emploi. Quand une mère ou un père font exactement la même chose à l’égard de leurs enfants c’est aussi du travail, mais ce n’est pas de l’emploi.
Quand un retraité, dans un cadre associatif, aide bénévolement des jeunes scolaires à améliorer leur compréhension de ce qui leur est demandé, il exerce un travail mais non un emploi.
Et aussi quand une femme ou un homme, travaillent dans leur jardin pour produire des légumes ou des fleurs, le verbe utilisé, à raison, est sans ambigüité. Mais ce n’est pas un emploi !
Alors, certes la réforme des retraites que notre Président a brusquement dégainé pendant une campagne présidentielle assez pauvre en proposition, en contradiction formelle avec ce qu’il proposait cinq ans auparavant est très critiquable.
Mais dans le mot du jour d’aujourd’hui je veux revenir à la problématique de « l’emploi » dans notre société moderne.
Dans les années 80, il y a 40 ans, j’ai beaucoup lu Raymond Aron. Ce n’était pas une lecture habituelle des gens de gauche dont je me réclamais. Mais il m’attirait parce que lorsque je le lisais, je me sentais plus intelligent, je comprenais mieux ce qui était en train de se passer devant mes yeux, sur la scène internationale, comme dans la société dans laquelle je vivais.
On ne sait plus très bien qui le premier a eu cette formule :
« J’aime mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron»
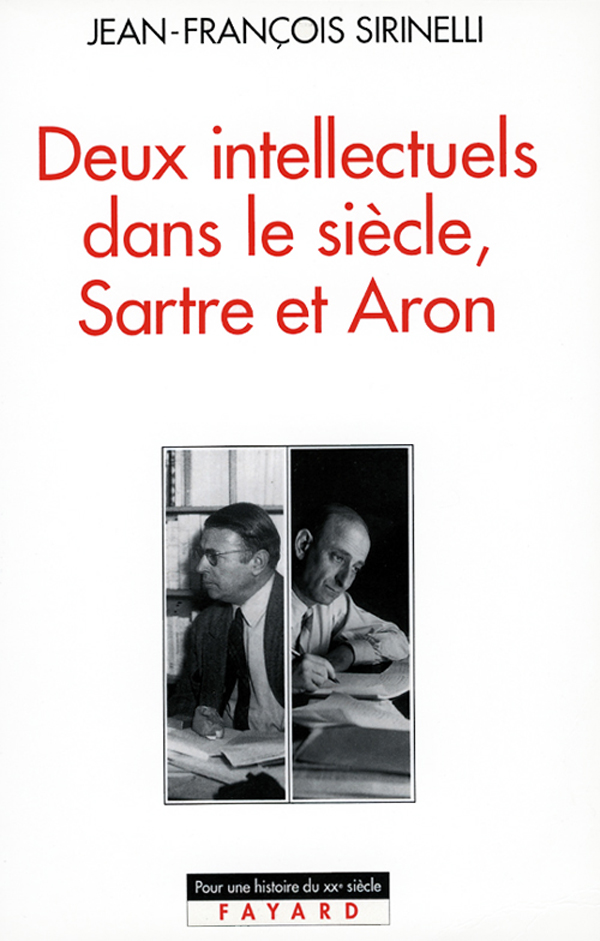 La formule avait été repris, en 1987, dans un essai d’Etienne Barilier, « Les Petits Camarades » qui évoquait les destins parallèles de Sartre et Aron qui avaient été camarades dans la même promotion de l’ENS de la rue d’Ulm entre 1924 et 1928.
La formule avait été repris, en 1987, dans un essai d’Etienne Barilier, « Les Petits Camarades » qui évoquait les destins parallèles de Sartre et Aron qui avaient été camarades dans la même promotion de l’ENS de la rue d’Ulm entre 1924 et 1928.
Cet article de « l’Express » de 1995 : <Sartre-Aron: duels au sommet> évoque cette relation à travers un autre essai celui de Jean-François Sirinelli : « Deux Intellectuels dans le siècle. Sartre et Aron » ( Fayard ).
Pour ma part, j’ai très vite, été attiré davantage par le réalisme de Raymond Aron qui analysait le monde et les individus tels qu’ils étaient et envisageait les chemins permettant d’améliorer la situation en partant du réel, plutôt que Jean-Paul Sartre qui inventait un monde idéal dans sa tête et poursuivait le dessin de tordre la réalité pour essayer de l’amener vers ses idées. La démarche de Sartre était révolutionnaire, les révolutions ont versé beaucoup de sang et abouti à des catastrophes souvent monstrueuses.
Alors bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis que Raymond Aron analysait le monde :
- En premier lieu, l’Union soviétique s’est effondrée.
- La révolution numérique a imposé d’autres organisations.
- La France s’est largement désindustrialisée.
- L’économie s’est mondialisée et financiarisée.
- Les problèmes écologiques et de ressources se sont imposés à nous.
Mais Raymond Aron avait déjà largement abordé le sujet de la modernité et de ses limites.
Ainsi, il a publié en 1969, un livre « Les désillusions du progrès » dans lequel, entre autre, il montrait que le progrès n’était pas le même pour tous et qu’il ne signifiait pas forcément des lendemains qui chantent.
Vous trouverez sur le site « CAIRN » une analyse globale de cet ouvrage par Serge Paugam : « Relectures de Raymond Aron, Les Désillusions du progrès (1969) »
Mais c’est un point précis de cet ouvrage qui est resté dans ma mémoire, 40 ans après sa lecture.
Et en feuilletant le livre, j’ai retrouvé ce constat qui m’avait alors interpellé et qui depuis, au regard de mon expérience professionnelle, me parait totalement pertinent.
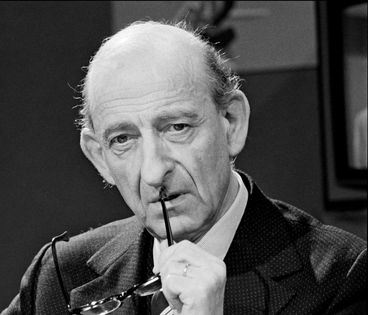 Raymond Aron n’avait pas anticipé la réflexion de Bernard Stiegler et au contraire, il réduisait le concept de « travail » au seul « emploi » :
Raymond Aron n’avait pas anticipé la réflexion de Bernard Stiegler et au contraire, il réduisait le concept de « travail » au seul « emploi » :
« J’ai pris jusqu’à présent le terme de travail ou de métier en un sens neutre et social : ni châtiment divin, ni obligation morale, ni maniement d’outils, ni transformation de la matière, le travail désigne l’activité exercée le plus souvent hors du foyer, en vue d’un salaire ou d’un traitement. Cette définition reflète, me semble-t ‘il, la conception dominante de notre époque. »
Raymond Aron « Les désillusions du progrès » page 185
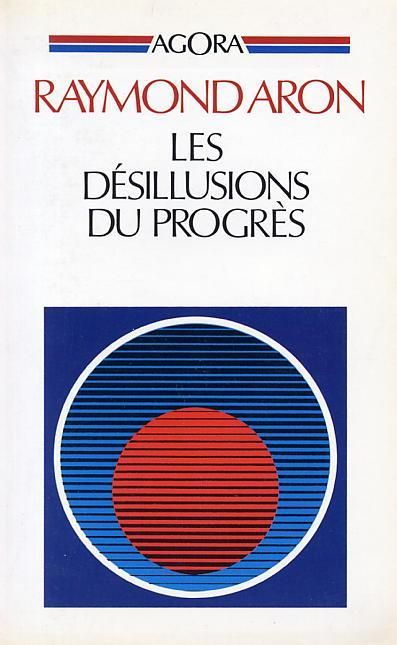 Et il posait cette limite à l’épanouissement du plus grand nombre des individus dans le cadre professionnel :
Et il posait cette limite à l’épanouissement du plus grand nombre des individus dans le cadre professionnel :
« toutes les sociétés, y compris les plus riches, continuent de former les hommes dont elles ont besoin, mais qu’aucune d’entre elles, en dépit des objectifs proclamés, n’a besoin que tous les hommes accomplissent pleinement les virtualités qu’ils portent en eux. Aucune n’a besoin que beaucoup deviennent des personnalités et soient capables de liberté par rapport au milieu. »
Raymond Aron « Les désillusions du progrès »
Le monde économique a besoin de personnes qui se spécialisent pour être efficaces et productives :
« Certes, la spécialisation professionnelle requiert une formation, elle aussi spécialisée, elle oblige chacun à sacrifier certaines aspirations à restreindre son horizon intellectuel : prix à payer mais que l’homme d’aujourd’hui doit payer ».
Raymond Aron « Les désillusions du progrès »
Et il en arrive à cette conclusion.
« C’est durant la période de non-travail que l’on peut encore rêver, à la manière du jeune Marx, d’échapper à la spécialisation, d’être tour à tour chasseur, pêcheur ou lecteur de Platon »
Raymond Aron « Les désillusions du progrès » page 185
C’est ce constat que j’ai retenu et retrouvé dans ce livre.
Je l’ai pris pour exergue de ce mot du jour, mais je me suis permis de l’amender dans le sens de la dichotomie décrite par Bernard Stiegler en remplaçant le mot « travail » par « emploi ». Ce qui correspond exactement à ce que voulait dire Raymond Aron.
Et bien entendu, la période de la retraite correspond idéalement à cette période de non-emploi permettant de rêver d’être lecteur de Platon ou de mener une autre activité large et épanouissante très loin de la réduction à la spécialisation professionnelle.
<1732>
- En premier lieu, l’Union soviétique s’est effondrée.
-
Lundi 20 février 2023
« Airglow »Lueur d’air, phénomène naturel rare d’origine chimique dans la haute atmosphèreAu départ il y a une magnifique photo d’un étudiant de 22 ans : Julien Looten.

La photo prise le 21 janvier 2023 vers 22 heures, est garantie sans trucage. Toutefois pour réaliser ce que l’on voit, il a fallu à ce jeune homme patient et disposant d’une solide connaissance de la technique photographique : réaliser un « grand panorama » d’une quarantaine d’images, cumulant environ une heure d’exposition. Il a ensuite dû les assembler et enfin utiliser un logiciel pour régler la distorsion, la balance des blancs.
S’il n’y a pas de trucage, il y a au moins beaucoup de technique.
Julien Looten l’a ensuite publié sur Instagram : < https://www.instagram.com/p/Cn42shuMNLs/> avec ce commentaire :
« Samedi soir, je me suis rendu au Château de Losse (Dordogne) pour prendre en photo la Voie lactée. Un phénomène exceptionnel s’est produit ce soir-là… un airglow extraordinaire
Le ciel semble être couvert de « nuages multicolores »… Il ne s’agit pas de couleurs parasites ou de traitements spéciaux. Il s’agit d’un phénomène naturel rare causé par une réaction chimique dans la haute atmosphère, où les rayons du soleil excitent des molécules qui émettent alors une très faible lumière (chimiluminescence).
Ces « nuages » sont situés entre 100 et 300 km d’altitude. La couleur du phénomène change en fonction de l’altitude. Il peut prendre des formes étranges, comme ici sous forme de « vagues ». Ces nuages semblent émerger du pôle Nord (extrémité droite) et Sud (extrémité gauche).
Le airglow peut être observé à l’œil nu. C’était le cas ce soir-là, je l’ai même confondu avec du brouillard. En revanche, les couleurs ne sont pas visibles par l’œil humain, qui est bien moins sensible qu’un capteur d’appareil photo.
L’arche de la Voie lactée est ici, visible dans sa totalité, grâce à un panorama de 180°. À gauche, la constellation d’Orion. Au centre : Mars, les Pléiades et la nébuleuse Californie. À droite : la constellation de Cassiopée et la galaxie d’Andromède »
Cette photo a été repérée par la Nasa, qui l’a ensuite publiée sur un de ses sites le mercredi 15 février : <Astronomy Picture of the Day>
Cette étonnante photo prise en Dordogne a ainsi fait le tour du monde
Pour ma part j’ai découvert cette photo sur le site du journal « La Montagne », quotidien régional de Clermont-Ferrand, : <Repérée par la Nasa>
Ce journal nous apprend que Julien Looten étudie l’archéologie à Bordeaux et se passionne pour l’astrophotographie, une discipline consistant à immortaliser des objets célestes.
Il nous apprend aussi que c’est la seconde fois que Julien Looten a été repéré par la NASA. En août, une de ses photos prise au cap du Dramont avait déjà été sélectionnée pour servir de « Picture of the day ».
C’est aussi une aubaine pour le site touristique du château de Losse.
« La Montagne », écrit :
« Le gestionnaire de ce site touristique, Martin de Roquefeuil, se dit « très fier » de voir cette magnifique bâtisse du XVIème siècle ainsi mise en avant. « J’ai énormément de retours. Et notre site Internet, qui est d’habitude plutôt en sommeil à cette époque de l’année puisque nous sommes fermés jusqu’au printemps, a connu un gros pic de fréquentation ces derniers jours. Localement, on m’en parle beaucoup, les gens m’envoient les reportages qui sont faits sur le sujet. » »
Les journaux se sont fait l’écho de cette photo et de sa destinée :
« La Voix du Nord » : : <La superbe photo astronomique d’un Nordiste mise à l’honneur par la Nasa !>
Même « TF1 » en a parlé : <Ce photographe nous en met plein la vue !>
Et « Ouest France » <Sa photo d’un « airglow » capturée en Dordogne est l’image du jour sélectionnée par la Nasa>
La plateforme numérique : « Lille Aux Artistes » qui promeut les artistes et la culture des Hauts-de-France dispose d’une page consacrée à cet étudiant artiste : <Julien Looten>
Il faut savoir que sur le site de la NASA, « Apod » c’est généralement, des images capturées par des télescopes comme James Webb ou Hubble qui sont publiées.
Un tel voisinage ne peut être que valorisant
On pourrait dire que la nature est belle.
Cela est certes vrai.
Il faut cependant savoir qu’il n’est pas possible de voir ce que montre cette photo, à l’œil nu.
<1731>
-
Mercredi 01 février 2023
« Jubilación »Mot espagnol invitant à l’euphorieCe 1er février 2023 est mon premier jour de retraite.
C’est un drôle de nom que celui de « retraite ».
La première définition que j’avais comprise, dans ma jeunesse, de ce mot était sa réalité militaire : « battre en retraite ». Autrement dit fuir devant l’adversaire, abandonner le champ de bataille, abandonner la position.
Il existait des retraites en bon ordre de généraux ingénieux qui évitaient ainsi une défaite. Mais le plus souvent « retraite » était synonyme de « fuite », « débâcle », « débandade » « déroute ».
Dans la Lorraine de mon enfance et plus précisément le bassin houiller lorrain, il n’était pas question de « retraité » mais de « pensionné », celui qui touchait une pension.
C’était assez clair dans mon esprit : un salarié touchait un salaire, un pensionné touchait une pension.
Dans les cours de religion, on parlait d’une autre retraite, la « retraite spirituelle » pour s’éloigner du tumulte de la vie séculaire et commerçante.
Quand on se tourne aujourd’hui vers le « Larousse » il est clair que la première définition du mot retraite et la deuxième aussi, correspond à ma réalité d’aujourd’hui.
« 1. Action de se retirer de la vie active, d’abandonner ses fonctions ; état de quelqu’un qui a cessé ses activités professionnelles : Prendre sa retraite.
2. Prestation sociale servie à quelqu’un qui a pris sa retraite : Toucher sa retraite. »
Puis on arrive à la retraite spirituelle et une déclinaison :
« 3. Période où l’on se tient loin des préoccupations profanes pour se recueillir ; lieu où se déroulent ces exercices.
4. Lieu où quelqu’un se retire pour vivre dans le calme, la solitude, ou pour se cacher : Un appartement qui a servi de retraite à un fugitif. »
Il faut arriver au rang 5 pour parler d’une armée en retraite :
« 5. Marche en arrière d’une armée qui ne peut se maintenir sur ses positions. »
Et puis il y a des cas spécifiques :
« Bâtiment
6. Diminution donnée à l’épaisseur d’un mur, étage par étage, à mesure que l’on s’élève.
Militaire
7. Signal (sonnerie de clairon, batterie de tambours) marquant la fin d’une manœuvre ou d’un tir.
Vénerie
8. Sonnerie de trompe qui marque la fin de la chasse. »
Dans « le Robert » l’ordre n’est pas le même on commence par la retraite militaire.
Mais le juge de paix est le vieux « Littré » dont la première définition est : « Action de se retirer. ». Si vous voulez en savoir davantage voici le lien : https://www.littre.org/definition/retraite
Si on s’intéresse à l’étymologie du mot retraite on constate qu’il est formé de deux mots :
- du préfixe re, retour en arrière
- et du latin trahere, tirer, traîner, tracter
Et c’est donc le Littré qui commence par expliquer que c’est l’action de se retirer qui semble le plus proche de cette origine.
Mais comment appelle t’on la « retraite » des salariés dans les autres langues ?
En anglais, il s’agit toujours de se retirer : « retirement ».
L’italien semble plutôt utiliser « pensione».
Alors que l’allemand utilise « Ruhestand » ce qui signifie, en version littérale, Position (stand) de Repos (Ruhe).
Mais c’est ma belle-sœur Josiane qui m’a appris que l’espagnol utilisait un terme à la consonance. étonnante.
J’ai quand même voulu vérifier auprès du meilleur traducteur en ligne « DeepL »
Et pas de doute, l’espagnol utilise bien le mot « Jubilación »
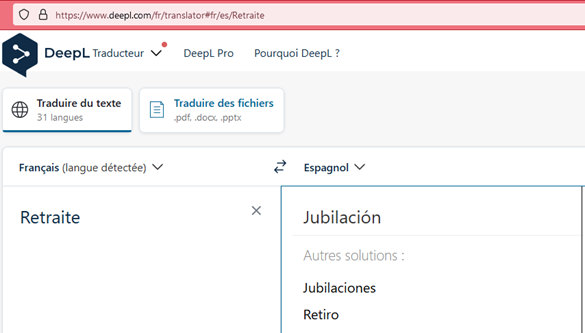 Alors je suis bien incapable de produire l’exégèse de ce mot en espagnol.
Alors je suis bien incapable de produire l’exégèse de ce mot en espagnol.
Toutefois cette langue comme la langue française sont des langues latines.
Or l’excellent dictionnaire du CNRS nous apprend que « jubilation» vient du latin jubilaciun « chant d’allégresse » (Psautier Oxford, éd. F. Michel, p. 127 [= Psaume 88, 16])
Et à la fin du XIVème siècle on trouve :
« « réjouissance, joie vive » (Roques t. 2, 6319 : iubilacio, cionis jubilacion. c’est chançon joieuse. grant joie). Empr. au lat.jubilatio « cris », lat. chrét. « cris, chants, retentissement d’un instrument de musique (exprimant la louange, la joie, le triomphe; Vulgate, Psaumes 88, 16 et 150, 5) », dér. de jubilare (jubiler*). »
Il me semble donc qu’il faut bien entendre ce mot comme jubilatoire.
Si un peu d’Histoire ne peut nuire, il faut rappeler que le système de retraite français est mis en place à la Libération par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 qui instituent la Sécurité sociale.
Les pères de cette réforme furent Ambroise Croizat, ministre du Travail de 1945 à 1947 et Pierre Laroque , Haut fonctionnaire.
J’avais évoqué ces deux visionnaires de l’État social dans un mot du jour de 2016 en mettant en exergue une phrase d’Ambroise Croizat :
Mais il semble que l’ancêtre de tous les régimes de retraite français est « La Caisse des Invalides de la Marine Royale ». Le ministre des Finances de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, a créé une pension de retraite pour les marins dès 1673.
Donc finalement, en un mot et en conclusion : Jubilation !
<1730>
- du préfixe re, retour en arrière
-
Mardi 31 janvier 2023
« Il y a un conflit très fort et très sourd, entre celles et ceux qui conçoivent le travail des autres sans le faire et celles et ceux qui font le travail sans pouvoir le concevoir. »Marie-Anne DujarierCe 31 janvier, la France va être touchée par un conflit social d’ampleur qui s’élève contre une nouvelle réforme des retraites qui va reculer l’âge minimum permettant de partir à la retraite de 62 ans à 64 ans.
Les uns, en s’appuyant sur l’exemple des pays voisins qui ont presque tous un âge officiel de retraite supérieur à 64 ans et sur l’allongement de la durée de vie considèrent cette réforme indispensable, voire insuffisante par rapport aux enjeux.
Les autres qui refusent cette réforme prétendent qu’il n’y a pas urgence à légiférer et que cette réforme est très injuste car elle fait reposer tous les efforts sur une population très ciblée.
Mais ce n’est pas des retraites que je vais parler aujourd’hui, mais de cette appétence d’un grand nombre de français dont je fais partie, qui aspirent le plus vite possible à la retraite.
Appétence qui probablement révèlent une relation contrariée avec le travail et plus précisément avec l’emploi.
Le site Atlantico donne la parole au sociologue du CNRS Philippe d’Iribarne pour évoquer <les deux clés des blocages français à côté desquelles passent les réformes>
Ces deux clés sont selon cet article :
- L’emploi des seniors
- La satisfaction au travail
L’emploi des seniors est souvent évoqué à propos de cette réforme, parce que les salariés de 55 ans éprouvent beaucoup de difficultés à conserver leur emploi et d’en retrouver un, lorsqu’ils se trouvent au chômage.
On parle moins de la satisfaction au travail.
Atlantico cite un ancien ministre d’Emmanuel Macron qui affirme dans l’Opinion, qu’il faudrait dire aux Français : « On a compris que vous n’êtes pas heureux au travail. Et répondre à ce mal-être plutôt que d’encourager la fuite en avant avec la réforme des retraites dans sa version actuelle. »
Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d’Iribarne est l’auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Son dernier ouvrage, publié en septembre 2022, s’intitule « Le Grand Déclassement »
Il était aussi l’invité de l’émission des matins de France Culture du Lundi 23 janvier 2023 : <Retraites : la peur du travail sans fin>.
Guillaume Erner avait également invité Marie-Anne Dujarier sociologue du travail, autrice de « Troubles dans le travail, sociologie d’une catégorie de pensée » (Presses Universitaires de France, 2021).
Dans cette émission le rapport des Français au travail a été longuement développé. Rapport qui explique probablement notre relation crispée avec l’âge de la retraite.
Philippe d’Iribarne livre ce qui est, selon lui, la « vision française » du travail : « un homme digne de ce nom, vraiment libre, qui ne dépend de personne, au service de sa propre gloire en quelque sorte. Pour un Allemand, faire une tâche utile, au service de la communauté, suffit. Pour un Français, il faut des conditions exceptionnelles de travail et d’autonomie pour qu’il se sente heureux. »
Le premier point développé par Marie-Anne Dujarier qui m’a paru très pertinent est la distinction entre « travail » et « emploi » (7:08) :
« Le travail ne se limite pas à l’emploi. […] Nous avons des usages sociaux du mot travail qui ont varié dans l’Histoire. Et qui continue d’être différent selon qui parle dans la société. Nos institutions et les usages qu’en font l’État : le travail c’est essentiellement l’emploi. Ce qu’on appelle le code du travail, les politiques du travail, les statistiques du travail se référent essentiellement à l’emploi. De même quand les employeurs parlent de travail, ce qui est assez rare, ils parlent essentiellement d’emploi. […]
Pour celles et ceux qui œuvrent, qui produisent le travail a un tout autre sens puisqu’il peut, en effet, être l’emploi avec toutes les conditions liées à ce terme. C’est-à-dire la rémunération mais aussi les droits, l’accès à un système de solidarité. Mais le travail est aussi une activité qui soit sensée, qui fasse sens, qui produise des choses qu’on juge utile, belle ou simplement pertinente, dans des conditions qui permettent de développer son intelligence, ses pratiques.
Et tout cela dans des relations sociales de belle qualité. […] Savoir qui travaille et à quel moment est un objet de conflit, un objet de débat politique.
Est-ce que des tâches domestiques sont du travail ? Est-ce qu’un animal qui produit des choses utiles travaille ? Vous et moi, lorsque nous laissons des traces numériques sur le net qui enrichissent une firme étasunienne, travaillons-nous ?
Tout cela fait l’objet de décisions collectives et qui sont profondément politiques.»
Ainsi très concrètement quand j’écris un mot du jour, comme celui d’aujourd’hui est-ce du travail ?
Je ne crois pas qu’on puisse qualifier cette activité de loisir. Si ce n’est du travail, qu’est ce alors ?
Ce n’est pas un emploi : je ne suis pas rémunéré, je n’ai pas de droits sociaux, je n’ai pas non plus de contraintes ou d’obligations autres que celles que je me fixe moi-même.
Cette distinction entre l’« emploi » et le « travail » je l’avais d’abord entendu exprimer par le philosophe Bernard Stiegler qui avait écrit « L’emploi est mort, vive le travail » en 2015.
J’avais écouté avec beaucoup d’intérêt la présentation de son ouvrage qu’il avait fait lors d’une conférence qu’il avait réalisée à <l’Université Paris Ouest Nanterre> en 2016.
J’avais le projet d’en faire un mot du jour. Projet que je n’ai jamais réalisé.
Le philosophe mort en 2020, développait aussi ce concept qui m’a interpellé de « prolétarisation » qu’il définit de la manière suivante :
« La prolétarisation est, d’une manière générale, ce qui consiste à priver un sujet (producteur, consommateur, concepteur) de ses savoirs (savoir-faire, savoir-vivre, savoir concevoir et théoriser). […] La prolétarisation transforme le travail dans son ensemble en emplois vides de tout savoir et n’appelant que des compétences définissant une « employabilité », c’est-à-dire une « adaptabilité ». Les savoir-faire aussi bien que les savoir-vivre étant passés dans les machines et les systèmes de communication et d’information avec les machines informationnelles qui les transforment en automatismes sans sujet. […] C’est cette prolétarisation qui instaure le salariat, c’est-à-dire l’emploi. [Les employés] deviennent une marchandise substituable sur le marché de l’emploi. »
Ces idées sont développées dans ce texte publié sur le site des <Rencontres Philosophies Clermontoises>.
Après cette distinction qui révèle que le travail peut être effectué dans le cadre d’un emploi ou en dehors, la question devient plus précise : Quel est le rapport des français par rapport à l’emploi ?
Guillaume Erner cite un sondage (18:49) dans lequel il apparait que la fierté d’appartenance à une entreprise diminue et aussi que le rapport au temps et à l’argent s’est inversé. Cette évolution a été observée entre 2008 et 2022. Aujourd’hui les français préfèrent gagner moins d’argent pour avoir plus de temps libre (61%) alors qu’à la même question ils étaient 38% de cet avis en 2008.
Je note que je fais partie des 61% puisque je renonce à une retraite pleine pour pouvoir me retirer de l’emploi plus rapidement.
Marie-Anne Dujarier analyse cette réticence devant l’emploi par deux facteurs :
« En matière d’emploi, nous sommes confrontés aujourd’hui à deux faits sociaux majeurs qui viennent à rendre l’activité dans l’emploi dégoutante ou repoussante :
Le premier fait c’est ce qu’on appelle l’anthropocène ou capitalocène, on peut lui trouver plusieurs noms. Dans nos modes de production contemporain, plus nous travaillons plus nous polluons, nous réduisons nos chances de subsistance collective. Alors pas mal d’employés et pas seulement des jeunes se disent : à quoi bon se former se subordonner si c’est pour produire des choses moches, nocives, écocides qui enrichissent ceux qui sont déjà démesurément riche. […]
Le second facteur, ce sont les modes de management contemporain. Dans les entreprises privées capitalistes, l’impatience et la gloutonnerie des actionnaires fait que ce qui compte, c’est uniquement ce qui se compte. Et cette logique financière abstraite fait que les employés ne sont que des ressources. Ils sont amenés à faire des choses pour autre chose : on ne produit pas de la nourriture pour produire de la nourriture, mais pour améliorer un score financier.
Tout ceci fait douter de l’intérêt de s’engager et de consacrer beaucoup de temps de sa vie à ces projets dont on se met à douter de la finalité et de l’intérêt du point de vue de l’activité. »
Pour Philippe d’Iribarne :
« La fierté est une chose très importante en France. On a besoin d’être fier de faire son métier, d’appartenir à son entreprise. La dégradation de la fierté est quelque chose de très grave. […] Un aspect important a été que pendant longtemps les outils pratiques de contrôle du travailleur de base par les superstructures étaient limités. L’individu en prenait et en laissait par rapport aux instructions qu’ils suivaient de manière très lâche. Il y avait une sorte de compromis tacite entre de grande affirmation de contrôle et une pratique de contrôle assez modeste. L’évolution des systèmes informatiques a permis de suivre de manière beaucoup plus étroite et à tout instant les activités de chacun. Chacun est entré dans un système de contrôle et de contrainte de manière beaucoup plus sérieuse qu’auparavant. »
Concernant le contrôle, on pourrait rétorquer que le travail à la chaîne, le taylorisme constituait un travail très contraint et très contrôlé, bien avant l’arrivée des outils informatiques.
Mais concernant les activités de service et de cadre, je pense que son analyse est particulièrement exacte.
Il évoque cependant le cas particulier d’ouvriers qui exercent une vraie activité, c’est-à-dire pour laquelle ils perçoivent immédiatement l’utilité et l’intérêt pour celles et ceux qui bénéficient de leur ouvrage. Ces ouvriers restent fiers et attachés à leur emploi. Dans l’article d’Atlantico cité, il dit :
« Attention de ne pas généraliser, une partie importante des travailleurs français sont tout à fait satisfaits de leur travail, dont ils ont le sentiment qu’il correspond bien à leurs attentes. »
Mais le sujet du management semble particulièrement problématique.
Marie-Anne Dujarier explique :
« Nous avons un management dans le privé qui a été importé dans le public sous le nom de « nouveau management public » qui […] est une conception de l’activité qui est faite par des gens qui sont assez éloignés de l’activité réelle. Ce qu’on peut appeler le management à distance, avec une méconnaissance de ce Réel assez forte qui induit que de plus en plus de femmes et d’hommes sont contraints de travailler avec des outils, des procédures, mais aussi des objectifs qui ont été conçus par d’autres, et qui orientent leur activité sur des indicateurs. Tout ceci avec des dispositifs pseudos rationnels qui face à la réalité du terrain sont toujours un peu défaillants et tout cela fondé sur un postulat de méfiance qui accroît le contrôle permanent de ces salariés, qui sont mis en concurrence, entre structures, entre pays, mais aussi entre statuts par exemple fonctionnaires et salariés.»
Et puis elle a ce développement (34 :00) qui me semble essentiel et rencontre mon vécu :
« Ce qui est intéressant c’est qu’il existe une sorte de guerre civile sur la notion de productivité comme sur celle de qualité. Vu des différents acteurs la notion de qualité ou de productivité n’est pas la même. Vous prenez un travailleur social qui doit recevoir des gens qui sont dans des difficultés multiples etc. Cela demande un entretien fin, pour pouvoir démêler les affaires de cette personne. Évidemment si cet entretien est long, vu du gestionnaire, vu d’en haut, l’entretien dure trop longtemps. Vous voyez bien que la performance n’est pas la même selon qu’on voit de haut ou qu’on le regarde dans le grain fin de l’activité.
Il y a donc un conflit très fort et très sourd, entre celles et ceux qui conçoivent le travail des autres sans le faire et celles et ceux qui font le travail sans pouvoir le concevoir. »
J’avais un jour répliqué à un de mes directeurs : « Plus on est placé haut dans la hiérarchie, plus on peut tenir des discours et des théories brillantes et lyriques remplis de contradictions et d’incohérence, mais plus on est près des réalités et du terrain plus ces incohérences sont prégnantes et ne peuvent être mises en œuvre sans surmonter la contradiction en s’éloignant de la théorie. ».
L’envie de rester dans l’emploi dépend éminemment de la qualité de l’emploi.
Mon père est parti à la retraite à 71 ans, il était professeur de violon. Il était fier de son emploi qui le rémunérait mais aussi le nourrissait intérieurement.
<1729>
- L’emploi des seniors
-
Dimanche 15 janvier 2023
« Maman »Terme affectueux dans le langage de l’enfant et dans celui de l’adulte pour désigner sa propre mèreMaman est un nom doux, un nom tendre.
Revienne les souvenirs de l’enfance, on tombait et on se faisait mal, le nom de « Maman » sortait naturellement de la bouche. La tristesse trouvait sa consolation quand Maman prenait son enfant dans les bras.
Brassens, chanteur iconoclaste qui écrivait le plus souvent des paroles drues et provocantes est devenu tout doux en l’évoquant
« Maman, maman, je préfère à mes jeux fous
Maman, maman, demeurer sur tes genoux
Et, sans un mot dire, entendre tes refrains charmants »
 Le dictionnaire du CNRS donne la définition suivante de « Maman » :
Le dictionnaire du CNRS donne la définition suivante de « Maman » :
« [Souvent employer comme appellatif affectueux] Mère, dans le langage de l’enfant et dans celui de l’adulte pour désigner la mère de famille, sa propre mère ou celle qui en tient lieu. »
Et Jean Pruvost écrit dans le <Figaro> :
Issu du grec et du latin «mamma» qu’on retrouve dans «mammifère» et «mamelle», s’installe aussi dans notre langue son synonyme très affectueux et somme toute premier dans le langage enfantin: «maman». Attesté par écrit dès 1256, il entre aussi dans nos tout premiers dictionnaires, par exemple en 1680 dans le Dictionnaire françois de Pierre Richelet, avec une orthographe surprenante : m’aman, orthographe qui démarque bien la nature de ce mot, d’abord propre aux enfants.
On raconte que dans les tranchées de 14-18, les rugueux soldats appelaient « Maman » quand ils étaient gravement blessés ou trop angoissés, comme un enfant qui appelle « Maman » car elle est forcément la solution.
 Après la mort de sa mère Albert Cohen a écrit « Le livre de ma mère » dans lequel il a eu cette phrase :
Après la mort de sa mère Albert Cohen a écrit « Le livre de ma mère » dans lequel il a eu cette phrase :
« Les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles. »
C’est pourtant l’expérience de la vie, quand l’ordre des choses est respecté, la mère décède avant ses filles et ses fils.
Et dans l’immense majorité des cas, ce moment est une déchirure : la perte de l’être humain qui nous a porté et mis au monde.
Mais avant de devenir Maman, il faut d’abord qu’une précédente Maman la fasse naître.
Il y a 100 ans : le lundi 15 janvier 1923, une fille est née dans le foyer de Franziska Kordonowski et Vincent Tettling, tous deux de nationalité polonaise.
35 ans après elle deviendra ma maman.
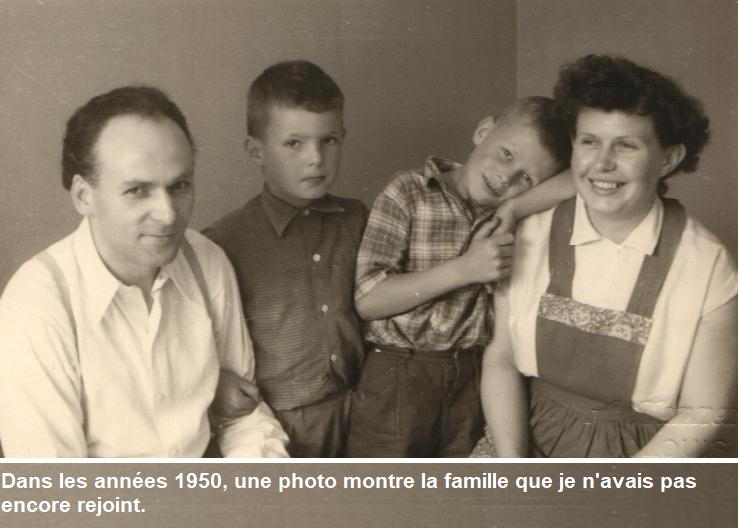 A 24 ans elle est devenue Maman en mettant au monde mon frère Gérard. Entre temps, elle deviendra aussi la maman de Roger à 26 ans.
A 24 ans elle est devenue Maman en mettant au monde mon frère Gérard. Entre temps, elle deviendra aussi la maman de Roger à 26 ans.
Son acte de naissance révèle qu’elle est née le 15 janvier 1923 à 10h30 du matin à Essen III.
Essen est une ville allemande de la Ruhr du Land : Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Essen est divisée en subdivision administrative et la partie III se situe selon Wikipedia à l’Ouest de la ville.
L’acte de naissance précise aussi que son père est mineur, c’est-à-dire travaille à la mine.
Sa mère est née à Warmhof en Pologne le 15 juin 1898.
Mais en 1898, l’Etat polonais n’existait pas, n’existait plus.
En 1898, cette ville qui porte aujourd’hui le nom polonais de Ciepłe, était intégrée à l’empire de Russie.
Selon l’acte, du 1er juillet 1947, de naturalisation française du père, ce dernier est né le 11 janvier 1894 à Osin en Pologne. Pour les mêmes motifs cette ville ne se situait pas en Pologne en 1894, mais aussi dans l’Empire de Russie.
Je n’ai pas trouvé Osin sur Internet, j’ai trouvé deux villes polonaises d’aujourd’hui qui ont respectivement comme nom Osina et Osiny.
La Pologne renaît après la guerre 1914-1918, comme le racontait le mot du jour du <15 novembre 2018> et à partir de cet instant mon grand-père et ma grand-mère sont devenus, de plein droit, des citoyens polonais et disposaient d’un passeport polonais.
 L’acte de naissance de ma mère donne une autre précision : l’adresse de ses parents : Gewerkenstraße au numéro 56.
L’acte de naissance de ma mère donne une autre précision : l’adresse de ses parents : Gewerkenstraße au numéro 56.
Cette adresse existe toujours et Google nous permet de la visualiser en aout 2008.
A cette époque, dans les milieux populaires les femmes accouchaient à leur domicile.
La seconde guerre mondiale ayant détruit la plus grande partie des villes allemandes, rien ne permet d’affirmer que cette maison est celle où est née ma mère : Anne Tettling, le 15 janvier 1923. Mais c’est en ce lieu, dans la maison qui s’y trouvait à cette date.
Elle ne restera pas longtemps en Allemagne.
Immédiatement après la création de l’État de Pologne, une convention franco-polonaise fut signée le 3 septembre 1919 pour favoriser l’arrivée de milliers de Polonais dans le Bassin minier Nord-Pas de Calais. Par suite cette convention s’appliqua pour d’autres bassins d’emplois en France. Mon grand-père qui avait travaillé dans les mines de charbon de la Ruhr jusque-là, va profiter de cette convention pour venir dans cette même année 1923 travailler pour les Houillères du Bassin de Lorraine.
Il s’installera avec sa famille dans la petite ville de Stiring-Wendel où habitait mon père et sa famille.
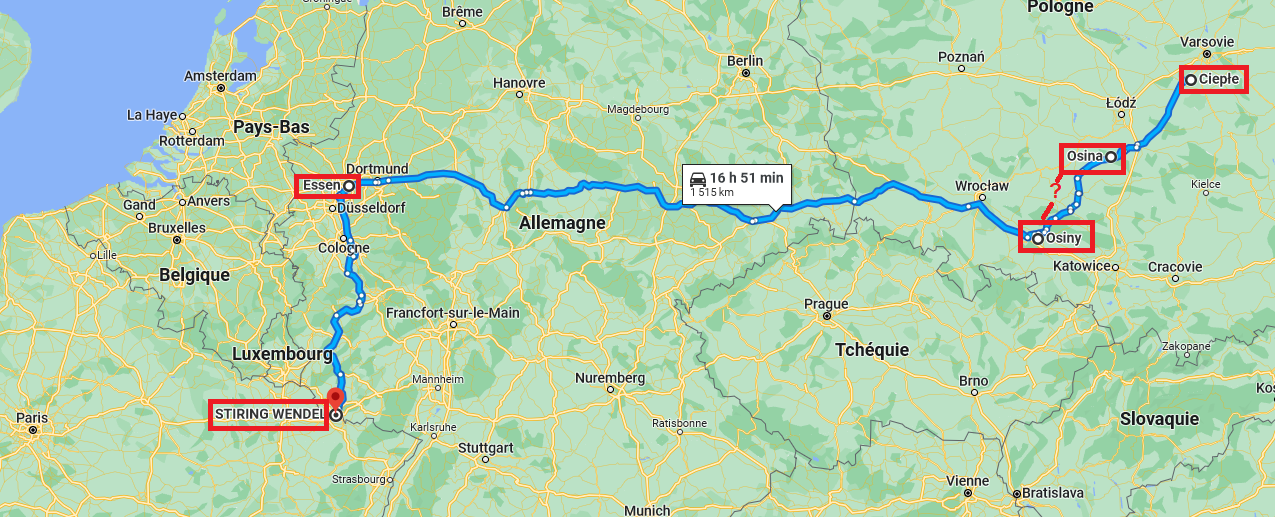 Elle deviendra française par son mariage en 1947.
Elle deviendra française par son mariage en 1947.
Mais auparavant elle va aller à l’école française. Ses parents sont très catholiques et ils ne vont pas l’envoyer à l’école Publique mais dans une institution religieuse : « Le Pensionnat de la Providence de Forbach ». Elle y restera le temps de l’école élémentaire et se verra attribuer le Certificat d’Études Primaires Élémentaires le 18 juin 1935.
Ce qu’il y a de remarquable c’est que ma mère écrivait sans jamais faire une faute de grammaire. Elle écrivait au même niveau d’excellence, l’allemand sans erreur.
 Elle fut d’ailleurs embauchée comme secrétaire dans l’antenne locale du grand journal régional : « Le républicain Lorrain » C’est de cette époque, il me semble, que date cette photo avec la bicyclette.
Elle fut d’ailleurs embauchée comme secrétaire dans l’antenne locale du grand journal régional : « Le républicain Lorrain » C’est de cette époque, il me semble, que date cette photo avec la bicyclette.
Elle vivait dans un monde populaire un peu rude dirigé par le père de famille.
Sa maman comme elle, aimaient lire, ce à quoi s’opposait le père ouvrier pour qui il était inconcevable que des femmes perdent du temps à cette activité de loisir, selon lui.
Peut être craignait-il aussi qu’une femme cultivée ne s’émancipe.
Je reste persuadé que ma mère aurait pu continuer à faire des études et aspirer à un tout autre destin social.
Mais cette époque ne le permettait pas, il fallait préparer les femmes à devenir femme au foyer et mère de famille.
Mais pour ma maman avant que cela n’arrive, il y eut la terrible épreuve de la guerre qui éclata en 1939.
Pour les nazis, ma région natale n’était pas une terre française occupée, mais une terre germanique retournée dans sa patrie légitime.
Ma mère fut obligée d’aller travailler dans un grand magasin allemand à Sarrebruck, tout le temps de la guerre.
Elle vécut cette période très mal et exprima un grand ressentiment à l’égard des allemands très longtemps. Ainsi après la guerre, elle ne retournera, pour la première fois en Allemagne qu’en 1991, 46 ans après la fin de la guerre. Elle habitait à 3 km de la frontière et la grande ville proche de notre maison était Sarrebruck.
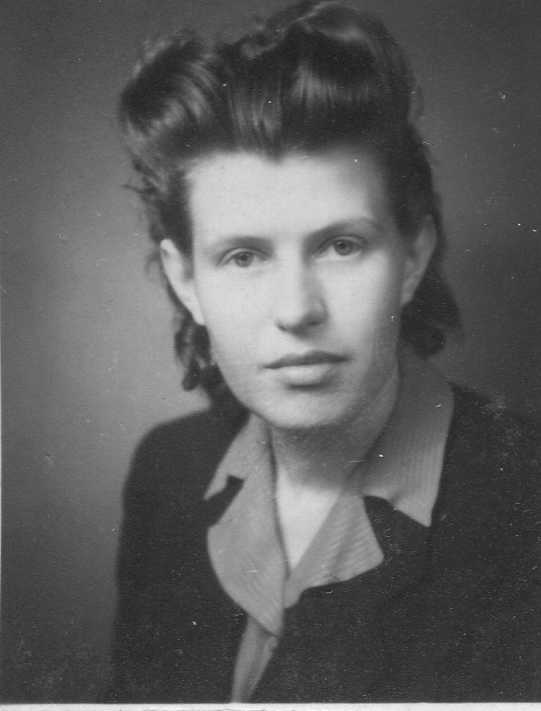 Elle me raconta une histoire de la guerre dans laquelle elle montra son esprit rebelle mais aussi une sorte d’inconscience.
Elle me raconta une histoire de la guerre dans laquelle elle montra son esprit rebelle mais aussi une sorte d’inconscience.
Un officier allemand l’arrêta un jour et lui demanda son adresse et elle répondit « Rue nationale à Stiring ». Or, dès le début de l’occupation les nazis avaient renommé cette rue qui emmenait tout droit vers l’Allemagne : « Adolf Hitler Strasse ». L’officier lui fit répéter deux fois sa réponse. Et devant l’obstination de ma mère, il lui dit « Fais attention jeune fille, tu pourrais tomber sur un soldat moins compréhensif que moi et tu serais envoyé dans un camp. Moi je me contente de t’avertir car tu me fais penser à ma fille »
Après la guerre, elle rencontra mon père qui habitait à 250 m de sa maison. Et elle consacra le reste de sa vie et toute son énergie à sa famille.
Nous étions très modestes, mais jamais nous n’avons manqué de l’essentiel grâce à sa rigueur et son sens de l’organisation mais surtout par un travail immense de tous les instants qui compensait le manque de moyens.
Elle était l’âme et le moteur du foyer.
Elle était toujours debout et travaillait.
Quand la maladie l’a attrapé et qu’elle ne pouvait plus rester debout, elle s’éteignit très vite en quelques mois.
Pour son mari et ses enfants elle était prête à tout et savait être une tigresse.
Dans mon enfance et plus encore, dix ans avant pour mes frères ainés, les instituteurs étaient brutaux et frappaient leurs élèves, notamment un qui avait pour nom Beck.
Un jour il trouva une autre idée : il enferma mon frère ainé dans un placard. Ce fut un traumatisme pour Gérard qui ne rentra pas à la maison mais se cacha derrière l’église. Quand ma mère compris ce qui s’était passé, elle alla voir cet instituteur et lui dit sa façon de penser de manière directe et sévère. Jamais plus ce fameux Beck n’embêta Gérard !
Je n’aimais pas beaucoup l’école maternelle, je trouvais qu’il y avait trop de bruit. Je fus souvent absent. La maîtresse dit à ma mère que jamais je ne parviendrai à faire d’études et que les lacunes que j’avais accumulées me poursuivront toute ma vie.
Ma mère la regarda dans les yeux devant moi et lui dit « Vous racontez n’importe quoi, ne vous inquiétez pas pour mon fils »
 Nul ne décrivit mieux sa situation que maître Raynal le professeur de violon de mon frère Gérard au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.
Nul ne décrivit mieux sa situation que maître Raynal le professeur de violon de mon frère Gérard au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.
Lors de la dernière épreuve du conservatoire, à Paris, pour obtenir le premier Prix, Maître Raynal s’est rapproché de mon père et lui a demandé
« Et votre épouse est-elle là ? »
Et mon père a répondu par la négative et a dit qu’elle était restée à la maison.
Maitre Raynal a eu alors ce mot :
« Ah oui, l’éternelle sacrifiée ! »
Ce fut longtemps le destin des mères de famille, surtout dans les familles modestes.
Ma mère fut l’une d’entre elle, parmi les plus absolues dans le dévouement pour sa famille.
Ce n’était pas juste qu’il en fut ainsi, ce ne peut être un exemple pour aujourd’hui.
C’était ma maman.
Elle a tout donné de ce qu’elle pouvait donner, sans compter.
Elle est née polonaise, en terre d’Allemagne.
C’était il y a 100 ans.
<1728>
-
Mardi 10 janvier 2023
« Ce n’est qu’en entrant dans l’océan […] que la rivière saura qu’il ne s’agit pas de disparaître dans l’océan, mais de devenir océan. »Auteur inconnuContinuer.
Continuer à écrire des mots du jour.
Je vais encore beaucoup parler de la mort.
Mais, pour moi, parler de la mort, c’est avant tout parler de la vie.
Parler des vivants qui sont affectés dans leurs sentiments, leur quotidien, leur confort, par l’absence.
Parler de ce qui reste de vivant, en nous, de ceux qui sont partis.
Personne n’a su exprimer cela de manière plus lumineuse que Tacite :
« Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants. »
Le deuil de mon frère a précipité l’évolution que je souhaitais mettre en œuvre à partir du 1er février 2023.
Pourquoi le 1er février 2023 ?
Ce jour-là sera le premier de la dernière période de ma vie, celle de retraité !
Jusqu’à présent mon ambition a été d’écrire un mot du jour par jour de semaine, en dehors des congés.
Cette ambition s’est fracassée, d’abord devant le traumatisme de la guerre en Ukraine, ensuite le deuil inattendu de mon frère ainé.
Le changement s’est donc imposé prématurément avant ce 1er février.
Je ne suivrai plus la discipline d’écrire un mot du jour, chaque jour. Mais d’en écrire un chaque fois qu’un sujet, un évènement, une pensée me poussera à écrire.
Ce ne sera plus : « Le mot du jour », mais une « invitation à un mot du jour…»
Aujourd’hui, je souhaite partager un poème et aussi une explication sur la difficulté, souvent présente, de vérifier les sources des textes que l’on partage.
Voici d’abord un texte magnifique qui peut se lire à l’heure de la mort, mais aussi à l’heure de beaucoup de moments de la vie, lorsqu’il s’agit de passer d’un monde connu, d’un confort relatif et de quelques certitudes vers l’inconnu et l’incertitude.
« On dit qu’avant d’entrer dans la mer,
une rivière tremble de peur.
Elle regarde en arrière le chemin
qu’elle a parcouru, depuis les sommets,
les montagnes, la longue route sinueuse
qui traverse des forêts et des villages,
et voit devant elle un océan si vaste
qu’y pénétrer ne paraît rien d’autre
que devoir disparaître à jamais.
Mais il n’y a pas d’autre moyen.
La rivière ne peut pas revenir en arrière.
Personne ne peut revenir en arrière.
Revenir en arrière est impossible dans l’existence.
La rivière a besoin de prendre le risque
et d’entrer dans l’océan.
Ce n’est qu’en entrant dans l’océan
que la peur disparaîtra,
parce que c’est alors seulement
que la rivière saura qu’il ne s’agit pas
de disparaître dans l’océan,
mais de devenir océan. »
Qui est l’auteur de ce texte, qui parle d’une rivière qui ne peut revenir en arrière et qui va s’accomplir en devenant océan ?
Ce texte a été publié des dizaines de fois sur les réseaux sociaux ou des pages internet, en donnant comme auteur Khalil Gibran.
Ce poète libanais, inoubliable auteur du livre « Le Prophète » qui a passé la plus grande partie de sa vie aux États-Unis et qui est mort en 1931, à New York, à 48 ans.
Certains précisaient que ce texte est inclus dans « Le Prophète ».
Cette affirmation me semblait fausse. Je suis allé m’en assurer en reprenant ce livre.
Dans un des derniers poèmes, Khalil Gibran parle de la mort et dit :
« Vous voudriez percer le secret de la mort,
Mais comment le découvririez-vous si vous ne le pourchassez au cœur même de la vie ? »
Et un peu plus loin, il évoque la rivière et la mer :
« Si vraiment vous souhaitez percevoir la nature de la mort, faites que vos cœurs s’ouvrent largement au corps de la vie,
Parce que la vie et mort ne font qu’un, comme fleuve et océan. »
Mais pas de texte qui évoque la rivière qui disparait dans l’océan et qui devient océan.
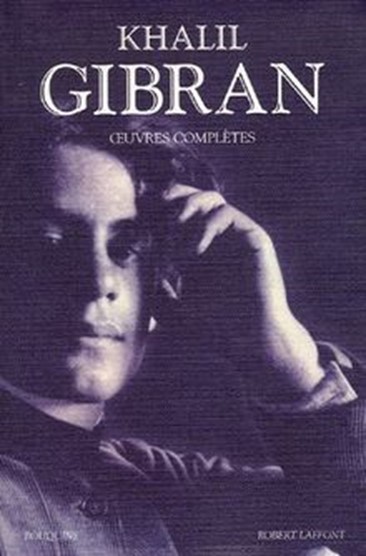 Mes recherches m’ont conduit à découvrir que la collection « Bouquins » de Robert Laffont avait publié un ouvrage ayant pour titre « Khalil Gibran : Œuvres complètes »
Mes recherches m’ont conduit à découvrir que la collection « Bouquins » de Robert Laffont avait publié un ouvrage ayant pour titre « Khalil Gibran : Œuvres complètes »
Je suis allé l’emprunter à la Bibliothèque Municipale de Lyon.
Et j’ai cherché…
Mais je n’ai pas trouvé.
Dans une des œuvres publiées « L’Errant » il existe un texte qui a pour titre « La rivière » (page 767) et qui relate la discussion de deux petits ruisseaux :
« L’un des ruisseaux s’enquit : « Comment es-tu arrivé là, mon ami et comment était ton chemin ? »
Ce texte se conclut ainsi :
« A cet instant, la rivière leur dit d’une voix forte : « Venez, venez, allons vers la mer.
Venez, venez donc et cessez de discuter. Rejoignez-moi. Nous allons à la mer.
Venez, venez vous jeter en moi, vous oublierez vos errances qu’elles soient tristes ou joyeuses.
Venez, venez et vous et moi, nous oublierons tous nos méandres lorsque nous atteindrons le cœur de notre mère, la mer. » »
Mais la rivière qui tremble de peur avant de se jeter dans l’océan ne se trouve pas dans les 950 pages des œuvres complètes.
Peut être se trouve t’il ailleurs, dans un ouvrage non publié dans ce bouquin. Restons prudent…
Mais pour l’instant, rien ne me permet de dire que ce texte est de Khalil Gibran.
Il est rationnel d’écrire que l’auteur est inconnu.
Il arrive que des personnes non connues trouve qu’un de leur texte mériterait qu’il soit connu et dès lors tente de le publier en prétendant qu’il a été écrit par un auteur connu.
J’ai trouvé un site <https://theophilelancien.org/> qui prétend donner la parole à un sage qui s’appelle Theophile l’ancien, sans plus de précisions.
Sur ce site il y a une page qui a pour titre : « La rivière et l’Océan » dans laquelle on peut lire
« Quand la rivière se jette dans l’Océan, elle perd son nom. »
[…] Cette métaphore m’inspire. La rivière perd tout naturellement son identité quand elle rejoint l’Océan, et tout se fait en douceur.
La rivière en amont continue sa vie. Elle jaillit des profondeurs de la terre, puis s’écoule en traversant différents reliefs, contournant ou submergeant les obstacles. Elle reçoit les eaux de la pluie et les eaux des autres petits ruisseaux. Elle bouillonne en cascade, se repose paisiblement dans les lacs et se retrouve parfois même, emprisonnée par un barrage. Elle irrigue toutes les terres qu’elle traverse.
Plus elle avance vers l’Océan, plus elle s’enrichit de limon nourrissant les terres environnantes […] Le plus difficile, c’est toujours le premier cycle. Une fois que la rivière a perdu son identité en se jetant dans l’Océan, elle devient l’Océan, sa conscience englobe tout l’Océan […]
La conscience de la rivière est devenue océanique. Elle est à la fois la rivière, l’Océan et les cours d’eau… Elle est l’Eau. »
L’esprit de ce développement me parait assez proche de celui que je cherchais.
Je ne sais pas pour autant qui se cache derrière Théophile l’ancien.
En musique, il a toujours existé des inconnus qui ont prétendu que le morceau qu’ils ont écrit était d’un glorieux ainé.
Tomaso Albinoni est un compositeur baroque vénitien qui est né en 1671.
Mis à part quelques mélomanes fouineurs comme moi, il n’est connu qu’à travers une seule œuvre : le célèbre « Adagio d’Albinoni » qui n’a pas été écrit par Albinoni mais par Remo Giazotto qui est décédé en 1998.
Vous apprendrez cela sur cette page de Radio France : < Le mystère de l’Adagio d’Albinoni >.
Nous ne savons pas de qui est ce texte.
Il reste très inspirant :
« La rivière a besoin de prendre le risque
et d’entrer dans l’océan.
Ce n’est qu’en entrant dans l’océan
que la peur disparaîtra,
parce que c’est alors seulement
que la rivière saura qu’il ne s’agit pas
de disparaître dans l’océan,
mais de devenir océan. »
<1727>
-
Vendredi 28 octobre 2022
« Nous ne nous verrons plus sur terre »Guillaume Apollinaire
L’Adieu
J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attendsGuillaume Apollinaire, Alcools, 1913

Gérard Klam, né le jeudi 30 octobre 1947 à Forbach, décédé le lundi 24 octobre 2022 à Nantes <1726>
-
Lundi 24 octobre 2022
« Non rien ne m’est interdit, car je détiens le rêve. »Alicia GallienneDepuis longtemps je n’ai plus partagé un poème d’Alicia Gallienne.
Pour l’instant, il y en a eu 4 :
- Le 7 février 2020 : « L’autre moitié du songe m’appartient »
- Le 18 février 2020 : « Dire que je t’aime et je t’attends, c’est encore beaucoup trop de pas assez »
- Le 18 avril 2020 : « A Mozart je dois une Église un arbre et une île»
- Le 3 mai 2020 : « Pour aller plus haut »
Aujourd’hui, les circonstances me poussent à reprendre ce livre plein de mots magiques :
« Je suis riche de mes heures perdues
De mes phrases mille fois heurtées à elles-mêmes
Je suis riche de mes émerveillements
Et chaque jour je bénis Dieu d’avoir donné
La vertu de se dépasser et de créer l’impossible
Pour cerner ses contours
Avec la délicatesse des doigts amoureux
Exquise sensation que de pouvoir toucher cet au-delà
Aux émanations d’interdit
Non rien ne m’est interdit
Car je détiens le rêve
Entre mes mains pleines de ciel
Car j’ai conquis les oiseaux
Tout au-dessus de l’eau
Où je marche la nuit
Oui tout m’est offert
Tout est possédé de moi
Et le plafond de Chagall est plein d’ailes
De musique et de tentation
ET c’est un dôme du ciel humain
Comme une transcription magique
Et les yeux sont appelés
A se créer leur unique illusion »
Page 191 Conclusion du poème « <La mort du Ciel » où elle a écrit en sous-titre (Si j’ai choisi ce titre, c’est bien pour qu’il ne meure jamais.)
«L’autre moitié du songe m’appartient»
Alicia Gallienne
Le plafond de Chagall orne la grande salle de l’Opéra Garnier où mon frère ainé Gérard a œuvré dans l’Orchestre de 1970 à 1985.
 Dans ma famille nous sommes trois frères, Gérard, Roger, et moi qui suis le petit dernier d’une dizaine d’années plus jeune que les deux autres.
Dans ma famille nous sommes trois frères, Gérard, Roger, et moi qui suis le petit dernier d’une dizaine d’années plus jeune que les deux autres.
Des trois frères, c’est Gérard qui était le roc, jamais malade, toujours super dynamique.
Mais il y a quelques semaines une terrible maladie l’a submergé et ces derniers jours son état s’est brusquement détérioré.
C’est important d’avoir son jardin secret. On dit aussi que les grandes douleurs sont muettes.
Je crois cependant tout en respectant ces deux préceptes, il est aussi essentiel, tout en restant digne, de faire part des sentiments qui nous touchent et qui nous saisissent.
Gérard a eu la grâce d’exercer un métier, dont l’objet est de créer la beauté.
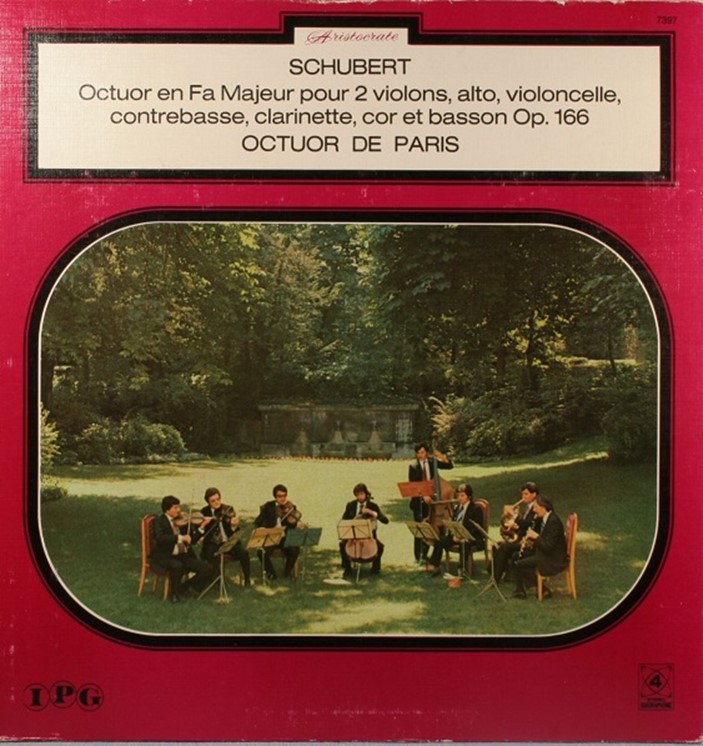 Avec l’Octuor de Paris il a fait le tour du monde.
Avec l’Octuor de Paris il a fait le tour du monde.
Plusieurs disques ont été produits avec cet ensemble en vinyle dans les années 70, mais n’ont jamais été reporté en CD.
Parmi ces disques il y a l’emblématique Octuor de Schubert qui donne la composition de l’Octuor de Paris : un quatuor à cordes plus une contrebasse avec 3 instruments à vent : un cor, une clarinette et un basson.
En voici le 3ème mouvement :
Allegro Vivace
Après l’Opéra de Paris , Gérard est parti à Nantes où il est devenu violoniste supersoliste jusqu’à sa retraite.
Ouest-France l’avait interviewé lors d’une folle journée de Nantes : <Gérard Klam a connu l’âge d’or des orchestres>
Vous comprendrez donc que le mot du jour est interrompu jusqu’à nouvel ordre.
<1725>
- Le 7 février 2020 : « L’autre moitié du songe m’appartient »
-
Vendredi 21 octobre 2022
« Pause (ode à la fatigue) »Jour sans mot du jourIl y a plus de 4 ans, je consacrais le mot du jour du 4 juin 2018 à un livre d’Eric Fiat «Ode à la fatigue».
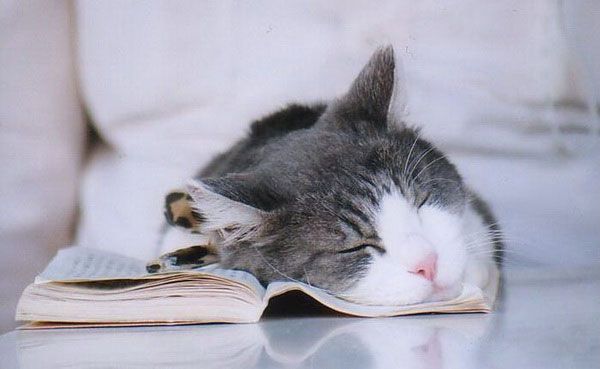 Eric Fiat avait cette belle formule « La fatigue est une caresse du monde ».
Eric Fiat avait cette belle formule « La fatigue est une caresse du monde ».
Il disait aussi « [La fatigue] nous révèle de très belles choses sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Écouter sa fatigue c’est apprendre l’humilité, le courage et la rêverie. »
<Mot du jour sans numéro>
-
Jeudi 20 octobre 2022
« Pause (Se tenir debout ! Sophia Aram) »Jour sans mot du jour nouveauJe partage la chronique de Sophia Aram de ce lundi 17 octobre, sans commentaire, mais en rappelant le contexte.
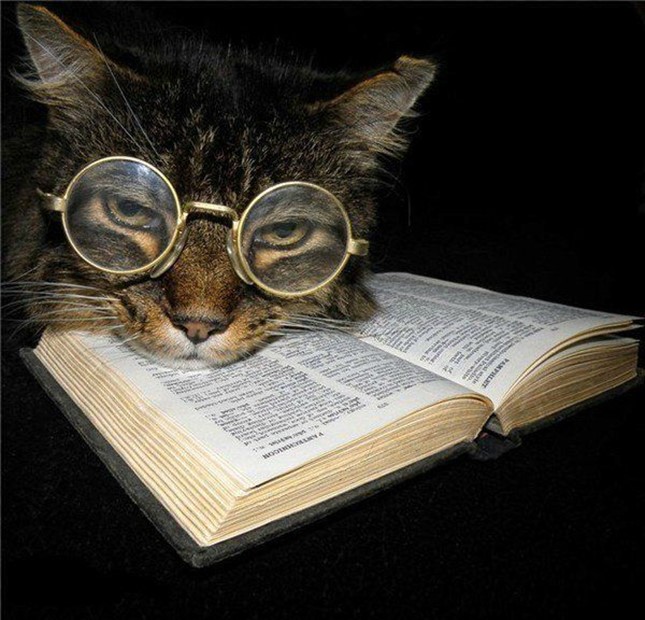 Je rappelle que Samuel Paty a été assassiné et décapité par un fou de Dieu qui se réclamait de l’islam.
Je rappelle que Samuel Paty a été assassiné et décapité par un fou de Dieu qui se réclamait de l’islam.
Ce crime a été commis il y a deux ans.
Son assassin a été enterré en Tchétchénie.
<La Croix> rapporte qu’après le rapatriement du corps, la télévision tchétchène, dans un reportage, a présenté le terroriste en « jeune craignant Dieu » qui n’était pas agressif mais serait devenu meurtrier à cause d’une « provocation islamophobe ».
Cette télévision est sous étroit contrôle de Ramzan Kadyrov, le sinistre président de ce pays et executeur des basses besognes de Vladimir Poutine.
Vous trouverez la chronique de Sophia Aram sur cette page de France Inter : <Se tenir debout>
Et vous pouvez la voir en <Video>
« Bonjour à tous, Allah a dit…
Ça va, je déconne, on se détend… On sait qu’on peut rire de tout… Même si maintenant au fond de nous il y a toujours une petite voix qui rajoute « oui mais… à condition d’être sous protection policière ».
On a beau jouer les foufous prêts à tout dire, il faut reconnaître que sur le droit d’emmerder Dieu, ça ne s’est toujours pas détendu.
Pas plus tard que la semaine dernière, le musée mémorial du terrorisme a choisi de ne pas exposer les dessins des élèves participant à l’exposition incluant des caricatures de Charlie Hebdo… Voilà, c’est tout. C’est juste le musée mémorial du terrorisme qui renonce à défendre les principes pour lesquels une partie des victimes de terrorisme en France sont morts. Autant je comprends la volonté de protéger les élèves, autant je me dis qu’il aurait peut-être été plus simple d’anonymiser leurs travaux, plutôt que d’assassiner une deuxième fois Charlie Hebdo.
Le problème c’est que si tu cumules ceux qui se couchent parce qu’ils ont peur, ceux qui ne veulent pas de vagues et ceux qui prennent les musulmans pour des bébés phoques ça réduit considérablement le nombre de personnes qui restent debout.
Et c’est quand tout le monde se couche que ceux qui restent debout deviennent des cibles.
Est-ce que la rédaction de Charlie aurait été décimée si l’ensemble des journaux avaient publié les caricatures du prophète ?
Samuel Paty aurait-il été assassiné si tout le monde avait défendu l’idée qu’aucune croyance ne saurait interdire la liberté de chacun de la critiquer, de la moquer et de la remettre en cause ? Personne ne le sait, mais j’imagine qu’il y aurait peut-être moins de monde pour mettre dans la tête des croyants que se moquer de leur croyance c’est du blasphème ou de l' »islamophobie ».
C’est tout ce que ceux qui défendent la liberté d’expression n’ont cessé de dire.
Avant-hier avec une poignée d’enseignants et d’élèves participant à la remise du premier prix Samuel Paty à la Sorbonne, Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel, se tenait debout pour nous rappeler notre devoir de faire front, notre devoir de mémoire, notre devoir de vérité, mais aussi notre devoir de convaincre tous ceux qui doutent qu’enseigner c’est expliquer, et non se taire… Et puisqu’il est encore nécessaire de le rappeler : qu’on ne met pas un « oui mais » après une décapitation.
Samedi dernier Mickaëlle Paty a rappelé dans un discours -qu’il faut lire, relire et diffuser- que les caricatures sont là pour montrer qu’on peut ne pas être d’accord avec telle personne, telle opinion politique ou religieuse et qu’en défendant ce principe, Samuel Paty donnait à ses élève la possibilité de comprendre que la laïcité permet de croire et de ne pas croire, et, dans les deux cas, « sans pression ».
Contrairement à ce qui a été dit par quelques irresponsables, il n’y a que deux élèves sur soixante, (trois si l’on compte l’élève absente) … à s’être sentis blessés par le cours de Samuel Paty.
Alors franchement, chacun est libre d’assouvir ses pulsions misérabilistes ou sa condescendance maladive en leur accordant toute l’attention qu’ils souhaitent, mais il n’est pas acceptable de le faire en sacrifiant nos principes les plus fondamentaux.
C’est pour cette raison qu’il est plus que temps que chacun comprenne la nécessité de se tenir debout. »
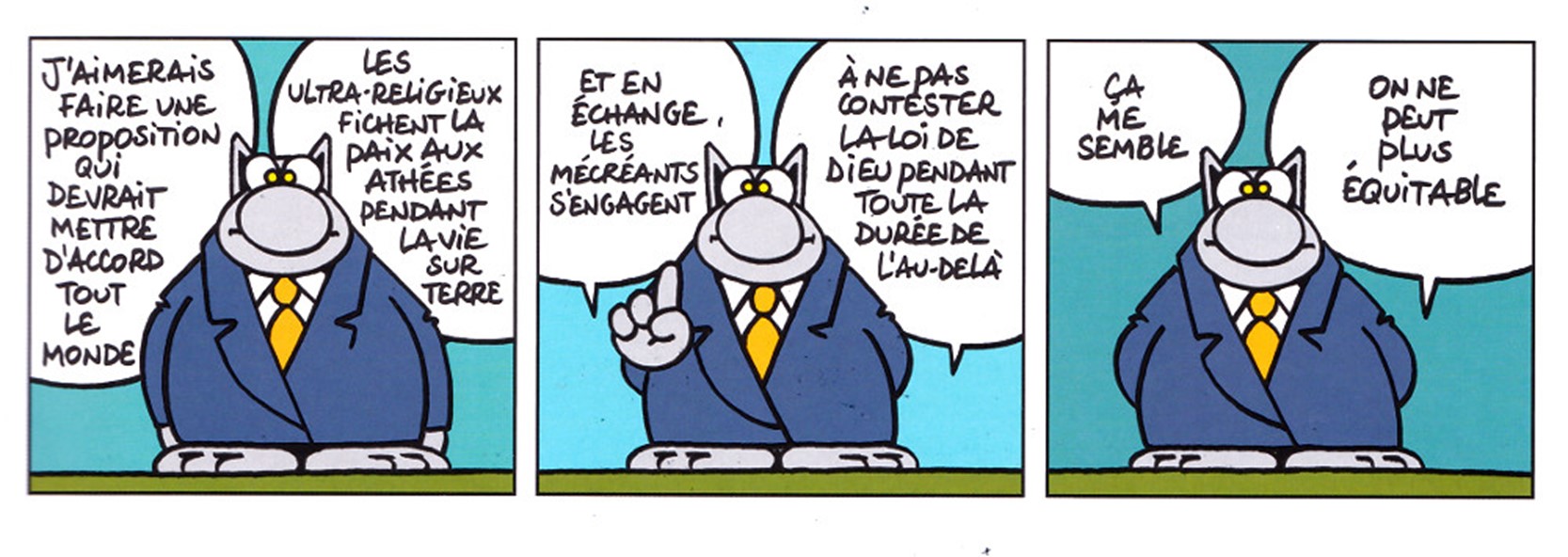
<Mot du jour sans numéro>
-
Mercredi 19 octobre 2022
Nous avons changé de monde, nous n’habitons plus sur la même terre. »Bruno LatourBruno Latour qui est mort le 9 octobre était devenu un des grands penseurs de l’écologie.
Aborder ses textes et son œuvre m’a souvent paru très ardu.
Mais ARTE a produit une série d’entretiens avec le journaliste Nicolas Truong qui me semble très accessible et que j’ai commencée à visionner avec beaucoup d’intérêt.
Chaque entretien dure environ treize minutes et l’ensemble de ces entretiens se sont tenus en octobre 2021, un an avant son décès..
Voici la page sur laquelle se trouve l’ensemble de cette série : <Entretien avec Bruno Latour>
Ces vidéos resteront accessibles jusqu’au 31/12/2024.
Aujourd’hui, je voudrais partager le premier de ces entretiens : <Nous avons changé de monde>.
Nicolas Truong le présente ainsi :
« Vous êtes sociologue et anthropologue des techniques mais vous êtes avant tout profondément philosophe »t
Et le journaliste l’interroge sur ce constat que Bruno Latour a formulé :
« Nous avons changé de monde, nous n’habitons plus sur la même terre. »
Et Bruno Latour explique que nous sommes dans une situation politique, écologique extrêmement dure pour tout le monde et que nous sommes très affectés par ce ressenti.
« La question est même de savoir ce qu’est le progrès, l’abondance, toutes ces questions qui sont liées à un monde dans lequel nous étions jusqu’à récemment. »
Quel était donc ce monde ancien :
« C’était un monde qui était organisé autour du principe que les choses n’avaient pas de puissance d’agir. »
Et il prend l’exemple de Galilée qui étudie un plan incliné sur lequel des boules de billard roulent et peut en déduire la Loi de la chute des corps encore appelé la Loi de la gravité :
On était ainsi habitué à décrire le monde avec des choses de ce type.
Une boule de billard n’a pas de pouvoir d’agir, elle obéit à des lois qui entrainent la manière dont elle se comporte quand elle est placée dans une situation précise.
Ces lois sont calculables et la Science avec un S majuscule les découvre.
Et Bruno Latour affirme que les hommes regardaient le monde à travers ces Lois.
A ce stade, je me permets d’objecter que dans le monde des milliards de gens regardent le monde à travers leurs croyances, leur foi et religion.
Toutefois pour ceux qui ont déclenché le mouvement du progrès industriel, de l’abondance et de la société de consommation, l’analyse de Bruno Latour me semble pertinente.
Ce monde est régi par des Lois et a su accueillir la vie et le monde des humains, sur la planète terre.
Avec mes mots je dirais qu’il oppose la Science objective des Lois physiques, biologiques, chimiques qui constituent l’explication « vraie » du monde à la subjectivité du vivant.
Il parle pour décrire cette perception du « monde moderne » celui qui est apparu à partir du XVIIème siècle, le siècle des Lumières qui est parvenu à extraire l’explication du monde des récits mythiques et religieux.
Selon lui c’est l’ancien monde.
Ce n’est pas que ce monde n’existe pas, n’a pas sa pertinence. Mais selon Bruno Latour ce n’est pas ce qui est essentiel à notre vie et même à notre survie.
En prenant simplement l’expérience du COVID ou du changement climatique une autre vision du monde apparait :
« Le monde est fait de vivants. Et on découvre de plus en plus avec les sciences de la terre, l’analyse de la biodiversité que c’est plutôt le monde du vivant qui constitue le fond métaphysique du monde dans lequel on est. »
Le monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous devons « atterrir » :
« C’est plutôt un monde de virus et de bactéries. Car les virus et les bactéries sont les gros opérateurs qui ont transformés la terre, qui l’ont rendue habitable. Ce sont eux qui ont rendu possible l’atmosphère dans laquelle nous nous trouvons assez à l’aise avec de l’oxygène qui nous permet de respirer. […] cela change la consistance du monde dans lequel on est. Vous êtes dans un monde de vivants qui sont tous en train de muter, de se développer […] »
 Et il rappelle que nous sommes couverts de virus et de bactéries dont la plupart nous sont très bénéfiques. C’est un monde d’échange entre vivants, dans lequel nous devons trouver notre place et dans lequel nous ne savons pas immédiatement si le virus qui interagit avec nous est un ami ou un ennemi.
Et il rappelle que nous sommes couverts de virus et de bactéries dont la plupart nous sont très bénéfiques. C’est un monde d’échange entre vivants, dans lequel nous devons trouver notre place et dans lequel nous ne savons pas immédiatement si le virus qui interagit avec nous est un ami ou un ennemi.
Ce changement de la perception du monde a conduit aussi les scientifiques à étudier le « microbiote humain » sans lequel, il ne nous serait pas possible de vivre. Cette vision qui montre notre dépendance à l’égard des autres vivants :
« Les sciences de la terre d’aujourd’hui, on peut parler d’une nouvelle révolution scientifique, montrent que les conditions d’existence dans lesquelles nous nous trouvons, les conditions atmosphériques, les conditions d’alimentation, de température, sont elles mêmes, le produit involontaires de ces vivants »
On étudie aussi les champignons, les lichens, l’extraordinaire résilience et coopération des arbres.
Si on prend simplement le sujet du gaz qui nous est indispensable pour vivre : l’oxygène. Ce gaz est produit par d’autres espèces vivantes qui absorbent en partie le gaz carbonique que nous rejetons.
Et ce qui se passe c’est que nous avons créé une civilisation technologique qui surproduit plus que le monde des vivants est capable d’absorber et qui détruit aussi une partie de ce monde qui nous est indispensable.
C’est la prise de conscience de notre dépendance à l’égard des autres espèces vivantes qui est le paradigme de ce changement de monde.
Mais il reste des gens qui continuent à s’attacher à la perception ancienne :
« Un monde d’objet calculable et surtout appropriable par un système de production qui nous apporte l’abondance et le confort.»
C’est ainsi que Bruno Latour présente la prise de conscience écologique.
Il reste optimiste dans cet entretien que je vous invite à regarder : <Nous avons changé de monde>.
Pour compléter ce propos, vous pouvez écouter cette <chronique> que vient de me signaler Daniel que je remercie et qui tente de démontrer notre lien irréfragable avec le monde vivant de la terre. Il s’agit de la chronique « Le Pourquoi du comment : science » d’Étienne Klein du lundi 17 octobre et qui est diffusé sur France Culture, chaque jour à 16:52.
<1724>
-
Mardi 18 octobre 2022
« Pause (Où atterrir ? Bruno Latour) »Jour sans mot du jour nouveauPlusieurs mots du jour ont été consacrés à Bruno Latour qui vient de décéder le 9 octobre 2022. :
 Le premier fut celui du <8 février 2019> dans lequel je reprenais cette question vertigineuse qu’il posait : Où atterrir ?
Le premier fut celui du <8 février 2019> dans lequel je reprenais cette question vertigineuse qu’il posait : Où atterrir ?
Et en effet, s’il n’existe pas de planète, de terre, de sol, de territoire pour y loger le Globe de la globalisation vers lequel tous les pays prétendent se diriger, pour vivre tous comme des américains, il s’agit d’atterrir. C’est-à-dire prendre en compte les contraintes et les ressources dont on dispose.
<Mot du jour sans numéro>
-
Lundi 17 octobre 2022
« La nature, ça n’existe pas. »Philippe DescolaPhilippe Descola est un anthropologue, disciple de Claude Levi Strauss. Il est né en 1949.
Je l’avais évoqué lors du confinement en renvoyant vers une page de Radio France. C’était le mot du jour du <22 avril 2020>:
Il a été l’invité du Grand Face à Face du samedi 15 octobre 2022, interrogé par Ali Baddou, Natacha Polony et Gilles Finchelstein.
C’était en raison de son actualité : il vient de publier un livre avec Alessandro Pignocchi : « Ethnographies des mondes à venir » paru le 23/09/2022.
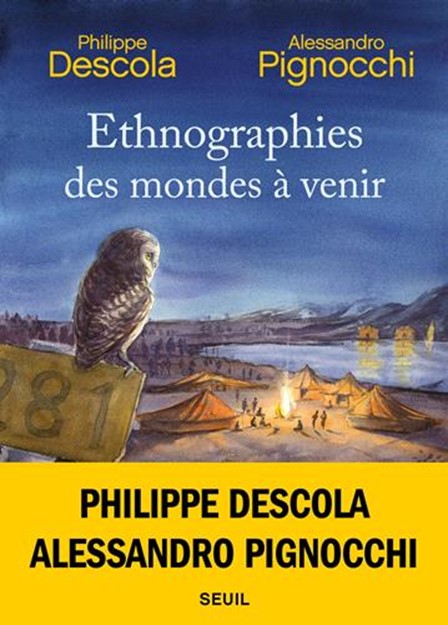 Seuil présente cet ouvrage ainsi :
Seuil présente cet ouvrage ainsi :
« Au cours d’une conversation très libre, Alessandro Pignocchi, auteur de BD écologiste, invite Philippe Descola, professeur au Collège de France, à refaire le monde. Si l’on veut enrayer la catastrophe écologique en cours, il va falloir, nous dit-on, changer de fond en comble nos relations à la nature, aux milieux de vie ou encore aux vivants non-humains. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Dans quels projets de société cette nécessaire transformation peut-elle s’inscrire ? Et quels sont les leviers d’action pour la faire advenir ? En puisant son inspiration dans les données anthropologiques, les luttes territoriales et les combats autochtones, ce livre esquisse la perspective d’une société hybride qui verrait s’articuler des structures étatiques et des territoires autonomes dans un foisonnement hétérogène de modes d’organisation sociale, de manières d’habiter et de cohabiter.
Des planches de BD, en contrepoint de ce dialogue vif, nous tendent un miroir drôlissime de notre société malade en convoquant un anthropologue jivaro, des mésanges punks ou des hommes politiques nomades et anthropophages en quête de métamorphoses. »
J’ai trouvé cet entretien très intéressant et j’ai d’ailleurs tenté d’acheter le livre dans ma librairie habituelle, mais elle avait vendu tous les exemplaires disponibles.
Cet entretien vous pouvez l’écouter en version audio, à partir de la 24ème minute : <Le Grand Face à face>
Ou en version vidéo à partir de la 27ème minute : <Le Grand Face à Face>
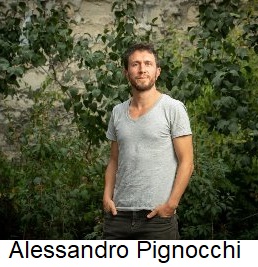 Il avait également été invité par « La tête au carré » du 4 octobre de Matthieu Vidard. Dans cette émission il était accompagné d’Alessandro Pignocchi.
Il avait également été invité par « La tête au carré » du 4 octobre de Matthieu Vidard. Dans cette émission il était accompagné d’Alessandro Pignocchi.
Jeune étudiant, dans les années 1970, il était parti au fin fond de l’Amazonie, entre l’Équateur et le Pérou, à la découverte du peuple des « Achuars ». Il y a passé trois ans en immersion puis y a fait plusieurs séjours.
Dans l’émission, il revient plusieurs fois sur cette expérience et surtout sur l’évolution de sa conception des relations entre les humains et les non humains.
L’anthropologue avait déjà développé ces idées et donné les mêmes exemples dans une interview du 1er février 2020 à « REPORTERRE » : <Philippe Descola : « La nature, ça n’existe pas.»>
Je dois dire quelques mots sur ce site et son fondateur qui est aussi l’interviewer de Philippe Descola.
Ce site « REPORTERRE » a été créé en 2007 par le journaliste du « Monde » Hervé Kempf et a pour sous-titre « Le quotidien de l’Ecologie ».
Ce site en ligne est en accès libre, sans publicité et il est financé par les dons de ses lecteurs
Hervé Kempf avait quitté le quotidien Le Monde en 2013, estimant que ce journal ne prenait pas assez en compte les défis écologiques. Il s’était notamment vu opposé un refus répété de la direction du journal de le laisser réaliser des reportages sur le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Il s’agit d’un très long article, le site estime à 25 minutes le temps de lecture.
Dans cet article il explique pourquoi il considère que la nature n’existe pas :
« « La nature a-t-elle une conscience ? » : cela renvoie à des interprétations romantiques parce que la nature est une abstraction.
La nature, je n’ai cessé de le montrer au fil des trente dernières années : la nature, cela n’existe pas.
La nature est un concept, une abstraction. C’est une façon d’établir une distance entre les humains et les non- humains qui est née par une série de processus, de décantations successives de la rencontre de la philosophie grecque et de la transcendance des monothéismes, et qui a pris sa forme définitive avec la révolution scientifique.
La nature est un dispositif métaphysique, que l’Occident et les Européens ont inventé pour mettre en avant la distanciation des humains vis-à-vis du monde, un monde qui devenait alors un système de ressources, un domaine à explorer dont on essaye de comprendre les lois. »
Et il me semble très intéressant de savoir que le mot « nature » est un mot quasi exclusivement utilisé par les européens dans leurs langues :
« Non seulement les Achuars n’ont pas de terme pour désigner la nature, mais c’est un terme quasiment introuvable ailleurs que dans les langues européennes, y compris dans les grandes civilisations japonaise et chinoise. »
C’est donc une invention européenne : l’idée que l’homme est un animal à part et qu’il dispose pour son bien-être et son plaisir d’un environnement qu’il peut utiliser à sa guise. Cet environnement, l’européen l’appelle la nature comprenant les autres animaux, les végétaux et aussi les minéraux. :
« Ce n’est pas une invention d’ailleurs -,cela s’est fait petit à petit. C’est une attention à des détails du monde qui a été amplifiée. Et cette attention a pour résultat que les dimensions physiques caractérisent les continuités. Effectivement les humains sont des animaux. Tandis que les dimensions morales et cognitives caractérisent les discontinuités : les humains sont réputés être des êtres tout à fait différents du reste des êtres organisés, en particulier du fait qu’ils ont la réflexivité. C’est quelque chose qui a été très bien thématisé au XVIIe siècle, avec le cogito cartésien : « Je pense donc je suis. » Je suis capable réflexivement de m’appréhender comme un être pensant. Et, en cela je suis complètement différent des autres existants. »
Descartes qui écrit aussi sans son « Discours de la méthode » de se rendre maîtres et possesseurs de la nature :
« Et qu’au lieu de cette philosophie spéculative qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. »
Descartes, Discours de la Méthode
Mais les religions « du Livre » l’avait précédé et ont joué dans cette dérive un rôle essentiel :
« Dieu les bénit et leur dit : Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la ! Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre ! »
Genèse 1.28
Et c’est ainsi que la culture occidentale s’est construite en séparant radicalement l’Homme, de la Nature.
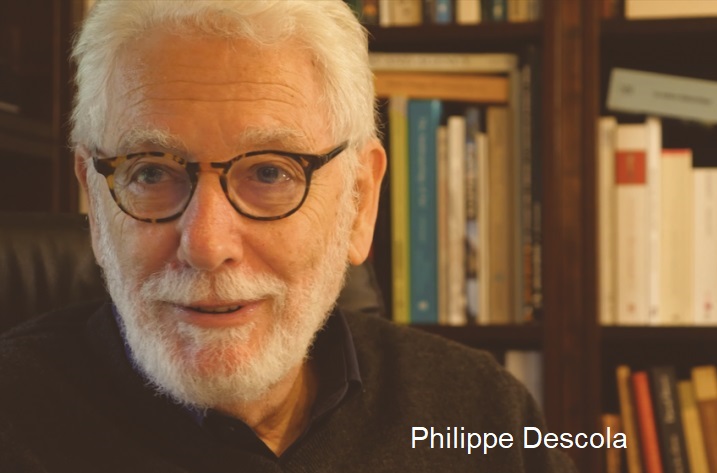 Et Descola revient sur les raisons de son intérêt pour les Achuars :
Et Descola revient sur les raisons de son intérêt pour les Achuars :
« Pourquoi l’Amazonie m’intéressait-elle ? Parce qu’il y a dans les descriptions que l’on donne des rapports que les Indiens des basses terres d’Amérique du Sud entretiennent avec la forêt, une constante qu’on dénote dès les premiers chroniqueurs du XVIe siècle : d’une part, ces gens là n’ont pas d’existence sociale, ils sont ‘sans foi, ni loi sans roi’ comme on disait à l’époque. C’est-à-dire ils n’ont pas de religion, pas de temple, pas de ville, pas même de village quelquefois. Et en même temps, disait-on, ils sont suradaptés à la nature. J’emploie un terme moderne, mais l’idée est bien celle-là : ils seraient des sortes de prolongements de la nature. Buffon parlait au XVIIIe siècle « d’automates impuissants », d’« animaux du second rang », des termes dépréciatifs qui soulignaient cet aspect de suradaptation. Le naturaliste Humbold disait ainsi des Indiens Warao du delta de l’Orénoque qu’ils étaient comme des abeilles qui butinent le palmier –- en l’occurrence, un palmier Morisia fructosa, dont on extrait une fécule. Et donc ils vivraient de cela comme des insectes butineurs. »
Mais Philippe Descola en tire une tout autre conclusion :
« Les Achuars mettent l’accent – et d’autres peuples dans le monde – sur une continuité des intériorités, sur le fait qu’on peut déceler des intentions chez des non-humains qui permettent de les ranger avec les humains sur le plan moral et cognitif.
Et il raconte une expérience qu’il a cité aussi dans l’émission de France Inter plus succinctement :
« J’ai été en Amazonie avec l’idée que peut-être, s’ils n’avaient pas d’institutions sociales immédiatement visibles c’était parce qu’ils avaient étendu les limites de la société au-delà du monde des humains. […]
Nous avons commencé à comprendre ce qui se passait lorsque nous avons discuté avec les gens de l’interprétation qu’ils donnaient à leurs rêves. C’est une société — on le retrouve dans bien des régions du monde — où, avant le lever du jour, les gens se réunissent autour du feu, il fait un peu frais, et où l’on discute des rêves de la nuit pour décider des choses que l’on va faire dans la journée. Une sorte « d’oniromancie. »
L’oniromancie, c’est-à-dire l’interprétation des rêves. Il y avait des rêves étranges, dans lesquels des non-humains, des animaux, des plantes se présentaient sous forme humaine au rêveur pour déclarer des choses, des messages, des informations, se plaindre. Là, j’étais un peu perdu, parce qu’autant l’oniromancie est quelque chose de classique, autant l’idée qu’un singe ou qu’un plant de manioc va venir sous forme humaine pendant la nuit déclarer quelque chose au rêveur était inattendue. […]
C’était donc une femme qui racontait son rêve et disait qu’une jeune femme était venue la voir pendant la nuit. L’idée du rêve est simple et classique dans de nombreuses cultures : l’âme se débarrasse des contraintes corporelles, et entretient des rapports avec d’autres âmes qui sont également libérées des contraintes corporelles et s’expriment dans une langue universelle. Celle-ci permet donc de franchir les barrières de la communication qui rendent difficile pour une femme de parler à un plant de manioc.
Donc, la jeune femme venue la visiter lui avait dit : « Voilà, tu as cherché à m’empoisonner » « Comment ? Pourquoi ? » Et elle répondait : « Parce que tu m’as plantée très près d’une plante toxique ». Celle-ci est le barbasco, une plante utilisée dans la région pour modifier la tension superficielle de l’eau et priver les poissons d’oxygène. Elle n’a pas d’effet sur la rivière à long terme mais elle asphyxie les poissons, et c’est d’ailleurs une plante qu’on utilise pour se suicider. La jeune femme disait : « Tu m’as planté tout près de cette plante. Et, tu as cherché à m’empoisonner. » Pourquoi disait-elle cela ? Parce qu’elle apparaissait sous une forme humaine, parce que les plantes et les animaux se voient comme des humains. Et lorsqu’ils viennent nous parler, ils adoptent une forme humaine pour communiquer avec nous. »
Et quand Hervé Kempff le relance en envisageant que la femme avait l’intuition d’avoir mal agi et que son rêve est une conséquence de cette intuition : :
« Je ne sais pas. On peut supposer qu’en effet, elle avait soupçonné qu’elle avait planté ses plants de manioc trop près de ses plants de barbasco. Et que c’est apparu sous la forme d’un rêve. En tout cas, ce genre de rêve met la puce à l’oreille puisque les non-humains y paraissent comme des sujets analogues aux humains, en mesure de communiquer avec eux. »
Je ne peux pas citer tout ce long article que vous pouvez aller lire.
A une question d’Hervé Kempff il répond qu’il rêve aussi mais pas comme les achuars car :
« On ne devient pas animiste comme ça. »
En conclusion il dit comme son grand ami Bruno Latour qui vient de mourir :
« [Il faut] Inventer des formes alternatives d’habiter la Terre, des formes alternatives de s’organiser entre humains et d’entretenir des relations avec les non-humains. Je reprends la formule de Gramsci, « le pessimisme de la lucidité et l’optimisme de la volonté ». Moi, je dirais « le pessimisme du scientifique et l’optimisme de la volonté »
Je redonne les différents liens :
- <Le Grand Face à face>
- « La tête au carré »
- « REPORTERRE » : <Philippe Descola : « La nature, ça n’existe pas »>
<1723>
- <Le Grand Face à face>
-
Jeudi 13 octobre 2022
« Pause »Jour sans mot du jourLe mot du jour reviendra lundi 17 octobre 2022
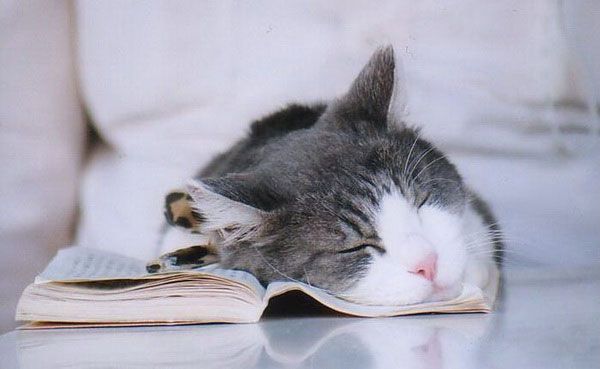
<Mot du jour sans numéro>
-
Mercredi 12 octobre 2022
« Négocier avec le diable. »Pierre HazanPierre Hazan, est suisse, il a été un temps journaliste puis s’est tourné vers le rôle de médiateur sur des lieux de conflits et de guerre. Il a été présent sur la guerre en Yougoslavie, au Rwanda, au Soudan et sur de nombreux autres lieux où les humains s’affrontaient et se massacraient.
Aujourd’hui il est conseiller senior auprès du Centre pour le Dialogue Humanitaire dont le siège est à Genève et qui est l’une des principales organisations actives dans la médiation des conflits armés. Il a conseillé des organisations internationales, des gouvernements et des groupes armés sur notamment les questions de justice, d’amnistie, de réparations, de commissions vérité, de disparations forcées et de droit pénal international et de droits de l’homme.
Pierre Hazan a aussi travaillé au Haut-Commissariat de l’ONU pour les droits de l’homme et a collaboré avec les Nations unies dans les Balkans.
Parallèlement, en juin 2015, Pierre Hazan a fondé justiceinfo.net, un média de la Fondation Hirondelle, dédié à la gestion des violences politiques dans les sociétés en transition. Il fut aussi commissaire de l’exposition Guerre et Paix (octobre 2019-mars 2020) qui s’est tenue à la Fondation Martin Bodmer organisée en partenariat avec les Nations unies et le Comité international de la Croix-Rouge.
C’est ce qu’on apprend sur le site qui lui est consacré : https://pierrehazan.com/biographie/
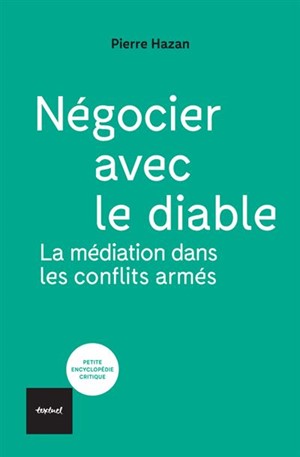 Il est invité sur beaucoup de plateaux de media et fait l’objet d’entretien dans les journaux, à cause du conflit d’agression de la Russie à l’égard de l’Ukraine et aussi parce qu’il vient de faire paraître en septembre 2022, un livre qui a pour titre : « Négocier avec le diable, la médiation dans les conflits armés »
Il est invité sur beaucoup de plateaux de media et fait l’objet d’entretien dans les journaux, à cause du conflit d’agression de la Russie à l’égard de l’Ukraine et aussi parce qu’il vient de faire paraître en septembre 2022, un livre qui a pour titre : « Négocier avec le diable, la médiation dans les conflits armés »
C’est un homme de terrain, ce qu’il dit ne vient pas d’une réflexion conceptuelle mais de son expérience.
Pour ma part je l’ai écouté avec beaucoup d’attention et d’intérêt sur le site Internet « Thinkerview » que j’ai évoqué plusieurs fois et que j’apprécie particulièrement parce qu’il ne se centre que sur l’invité et le laisse s’exprimer pour aller au bout de ses idées.
Cela a bien sûr pour conséquence que l’émission dure un peu plus longtemps. Dans ce cas particulier 1h37 : <Faut-il accepter de négocier avec le diable ?>
Pierre Hazan souligne que nous vivons dans un monde toujours plus chaotique dans lequel l’Occident n’est plus hégémonique. Il parle aussi des dérives de la « guerre contre le terrorisme » à la suite des attentats du 11 septembre.
Avec beaucoup de prudence, de doute, il parle de la nécessité, malgré tout, de la médiation, même avec son pire ennemi.
Il donne comme exemple la médiation qui a permis à l’Ukraine de recommencer à exporter des céréales, cen qui a eu pour conséquence de sauver des gens de la famine et de permettre à l’Ukraine d’obtenir des ressources.
La négociation a permis aussi d’échanger des prisonniers russes et ukrainiens.
Il a rapporté que même avec Daech il a été possible de négocier, notamment pour faire passer de l’aide humanitaire pour secourir des populations en grande difficulté.
<Le Monde> présente son livre ainsi :
« Peut-on parler avec des groupes terroristes au risque de les légitimer ? Tenter d’arrêter un carnage peut-il justifier de discuter avec des régimes criminels ? A partir de quand la négociation devient-elle un alibi à la non-action ? Ce sont les éternels dilemmes de la médiation dans la quête de la paix ; souvent, le choix n’est pas entre le bien et le mal mais entre le mauvais et le pire. « Depuis longtemps, j’ai abandonné le confort de l’éthique de conviction, ce luxe d’être cohérent avec soi-même, pour assumer l’éthique de responsabilité », écrit Pierre Hazan, évoquant « une éthique de la responsabilité tournée vers l’efficacité qui encourage le compromis et le pragmatisme, selon les aléas de l’action et au nom de la finalité recherchée. »
Il montre que si on se bloque sur une vision qui prétend n’accepter aucun compromis et avoir pour seul but d’éradiquer « le mal », on refusera tout dialogue avec des auteurs de crimes de guerre et des organisations « terroristes » Et dans ce cas ce sont les populations qui paient le prix de cette impossibilité de médiation.
L’enjeu d’une médiation n’est pas de choisir ses interlocuteurs, mais de déterminer si le dialogue ou la négociation peut soulager des populations en souffrance.
Il évoque aussi Cicéron et la désastreuse affaire de Libye dans laquelle les anglais et les français aidés des américains vont outrepasser le mandat de l’ONU, ce que Poutine et les chinois ne pardonneront jamais aux occidentaux.
Il revient aussi sur ces deux points dans un entretien avec Pascal Boniface <4 questions à Pierre Hazan>
D’abord Cicéron :
« Cicéron parlait des pirates comme « les ennemis du genre humain ». À toutes les périodes, il y a eu la tentation d’isoler, voire d’éradiquer ceux qui représentent le mal. Dans l’après-guerre froide, après le génocide au Rwanda (1994) et les massacres de Srebrenica (1995), la figure du mal a été représentée par les criminels de guerre. Après les attentats du 11 septembre 2001, ce furent « les terroristes ». Le fait est que la lutte antiterroriste a montré ses limites, et les États-Unis ont signé un accord de paix avec les talibans après 20 ans de guerre et d’innombrables morts. Le traité de paix en Bosnie-Herzégovine a été possible parce qu’à cette époque, le chef de l’État serbe n’était pas encore inculpé. La justice doit passer. Mais elle doit être articulée avec la recherche de la paix. »
Ensuite la Libye :
« Le moment de bascule, c’est le moment où symboliquement se termine la Pax Americana avec l’intervention en Libye en 2011. L’intervention de l’OTAN en Libye a été justifiée par une résolution des Nations unies au nom de « la responsabilité de protéger » les populations civiles. La Russie et la Chine avaient accepté à l’époque de s’abstenir. Elles ont eu le sentiment d’avoir été trompées, puisque l’intervention occidentale s’est soldée par un changement de régime (chute de Mouammar Kadhafi). À partir de ce moment-là, alors que la révolte commence en Syrie et que la répression sera impitoyablement sanglante, la Russie va s’opposer à toute intervention de la justice pénale internationale, de la responsabilité de protéger, des mécanismes des droits de l’homme en Syrie, jugeant que ce sont des instruments contrôlés par les Occidentaux. »
Et il parle aussi de la limite de la Justice Internationale, la Cour pénale internationale, n’ayant pour l’instant que juger des responsables africains. La justice pour les criminels de guerres dans les Balkans ayant été traité par un Tribunal spécifique pour l’ex Yougoslavie :
« Il y a une soif inextinguible de justice au sein de sociétés qui ont été violentées et où de terribles crimes ont été commis. Comment ne pas comprendre cette exigence de dignité et de justice en vue d’un vivre ensemble pacifié ? Malheureusement, la morale est trop souvent instrumentalisée à des fins politiques. Il en est de même de la justice internationale, dont le principe moral est ô combien important, mais dont l’application est trop souvent sélective. La création de la Cour pénale internationale (CPI) avait suscité un immense espoir dans une grande partie du monde, mais hors de l’Occident, elle a généré un sentiment de frustration, estimant que la Cour fonctionne sur le principe de deux poids, deux mesures. »
Et dans l’entretien passionnant sur Thinkerview, il rapporte un échange incroyable avec l’ancien ministre des affaires étrangères de François Mitterrand : Roland Dumas.
Cet épisode, il le raconte aussi dans un article de Libération : « Il faut parler avec des criminels de guerre y compris quand ça tue. »
« Je me souviens d’une interview avec Roland Dumas. Je vais le voir avec une incroyable naïveté. Je lui dis : «Vous êtes l’homme de la révolution judiciaire des années 90. C’est vous qui portez la résolution 808 et 827 [au Conseil de sécurité qui fonde le TPIY, ndlr]. Elle engendre, une année plus tard, la résolution 955 qui crée le TPIR [tribunal pénal international pour le Rwanda, ndlr]».
Et là, il me fixe, avec un regard ironique et me dit :
« Mon problème était très différent. Je craignais que Mitterrand et moi, soyons un jour accusés de complicité pour les crimes de guerre commis par les Serbes de Bosnie. Alors quand Robert Badinter est venu avec son idée un peu idéaliste de tribunal, je me suis dit que c’était formidable parce que, d’un côté, on aurait une épée de Damoclès pour effrayer les auteurs de crimes de guerre et, de l’autre, une sorte de bouclier juridique.»
Je n’en croyais pas mes oreilles.
C’est pour ça que la France ne collaborait pas avec le TPIY. Il a fallu attendre Jacques Chirac pour qu’elle le fasse. J’étais étonné du cynisme par lequel la justice pénale internationale était née. Je me suis dit qu’après l’os humanitaire, on jetait un os juridique pour calmer les opinions publiques. Parce que la question de fond qui se posait à l’époque en ex-Yougoslavie, c’était intervenir ou ne pas intervenir. Il y avait la peur des représailles, ou que ça dégénère avec une implication plus importante. »
Et il finit cet article avec ce conseil pour le conflit russo-ukrainien :
« Nous sommes aujourd’hui face à des défis globaux qui demandent une responsabilité maximale à chacun. Vouloir fermer des fenêtres de dialogue me semble extraordinairement dangereux. Aujourd’hui, des voix se manifestent – la présidente de la Commission européenne semble le souhaiter– pour inculper Vladimir Poutine. Si on le fait, on risque de se fermer des portes dans le processus de négociation qui devra forcément avoir lieu un jour. »
Je finirai par un autre extrait de l’entretien Thinkerview :
Quand l’animateur lui demande de parler de ce qu’il a vu de pire sur les théâtres de guerre. Il dit son embarras et refuse de faire un palmarès.
Il évoque rapidement un lieu de massacre dans les Balkans et aussi un lieu du génocide au Rwanda où il sentait l’odeur de mort.
Et il ajoute :
« Il faut voir l’étincelle de vie en chacun de nous.
Il faut réfléchir, comment vivre.
Comment avoir du plaisir, comment reconstruire.
Comment faire avec, comment avec ce qui s’est passé.
Comment réapprendre à être des hommes et des femmes.
Réapprendre à être soi.
Réapprendre à aimer, tout simplement.
Et je crois que c’est sur ça qu’il faut regarder ! »
<1722>
-
Mardi 11 octobre 2022
« Une ivresse extatique de la destruction. »Pierre-Henri CastelJ’avais déjà parlé de ce livre lors du mot du jour du 3 avril 2020, en plein confinement.
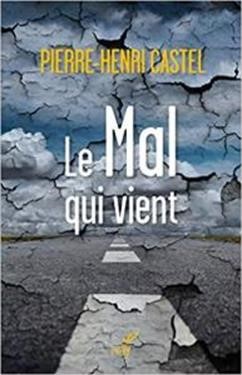 Dans « Le mal qui vient » Pierre-Henri Castel se place dans le cadre du défi climatique et évoque l’hypothèse que l’humanité ne parvienne pas à surmonter ce défi.
Dans « Le mal qui vient » Pierre-Henri Castel se place dans le cadre du défi climatique et évoque l’hypothèse que l’humanité ne parvienne pas à surmonter ce défi.
Il examine cette situation en se centrant sur ceux qui par esprit de jouissance, voudront se livrer à ce qu’il appelle une « ivresse extatique de la destruction » : « plus la fin sera certaine, donc proche, plus la dernière jouissance qui nous restera sera la jouissance du Mal ».
Et pour éclairer cette hypothèse historiquement, il évoque ce qui s’est passé dans les derniers mois du nazisme.
Ce livre et cette réflexion m’est venue lors de mes mots du jour autour du destin de la famille d’Anne Frank.
Parce que revenons sur le calendrier.
Anne Frank et sa famille seront emmenés au camp d’Auschwitz le 3 septembre 1944.
C’est écrit dans tous les articles concernant Anne Frank, c’est le dernier convoi vers les camps d’extermination partant des Pays Bas.
Mais quelle est la situation de l’Allemagne nazie à cette date ?
- Le 31 janvier 1943, l’armée allemande s’est rendue à Stalingrad.
- En septembre 1944, l’armée rouge a fait reculer la Wehrmacht jusqu’à la Bulgarie et continue vers les frontières de l’Allemagne
- Les Alliés ont débarqué en Sicile le 10 juillet 1943, Rome a été libérée du joug allemand le 4 juin 1944, la Toscane est libre en août 1944, l’Italie s’est retournée contre l’Allemagne.
- Les alliés ont débarqué sur les côtes de Normandie, le 6 juin 1944
- Paris est libéré depuis le 25 aout 1944
- Le 15 août, des troupes américaines et françaises ont débarqué en Provence
L’Allemagne est encerclée, ses armées reculent partout.
Ils préparent bien un dernier sursaut dans les Ardennes à Noël 1944, sursaut qui échouera.
Leurs armées sont décimées, ils sont devant des puissances disposant d’un armement supérieur et d’un nombre de soldats valides largement supérieur.
Et ils s’obstinent à perpétuer le génocide juif, alors que la raison devrait les inciter vers une tout autre voie.
Parce que ceux qui savent qu’ils vont perdre devraient éviter d’aggraver leur cas et leurs crimes, ils savent qu’ils auront des comptes à rendre après la défaite. D’ailleurs, ils tenteront de cacher, sans y arriver, la barbarie des camps.
Et ceux qui croient encore que la défaite n’est pas inéluctable, devraient consacrer toutes leurs forces, leur énergie à empêcher les armées alliées de continuer à avancer vers l’Allemagne.
Mais il n’y a pas de rationalité dans ces hommes, que de la haine, une « ivresse extatique de la destruction »
<1721>
- Le 31 janvier 1943, l’armée allemande s’est rendue à Stalingrad.
-
Lundi 10 octobre 2022
« Personne n’est épargné, vieillards, enfants, bébés, femmes enceintes, malades, tout, tout est entraîné dans ce voyage vers la mort. »Journal d’Anne Frank, le 19 novembre 1942Anne Frank a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944. Jusqu’au printemps de 1944, elle écrivait ses lettres pour elle, seule, jusqu’au moment où elle entendit à la radio de Londres, le ministre de l’Education du gouvernement néerlandais en exil dire qu’après la guerre, il faudrait rassembler et publier tout ce qui pourrait témoigner des souffrances du peuple néerlandais sous l’occupation allemande. Il citait à titre d’exemple, entre autres, les journaux intimes. Frappée par ce discours, Anne Frank décida de publier un livre après la guerre, son journal devant servir de base.
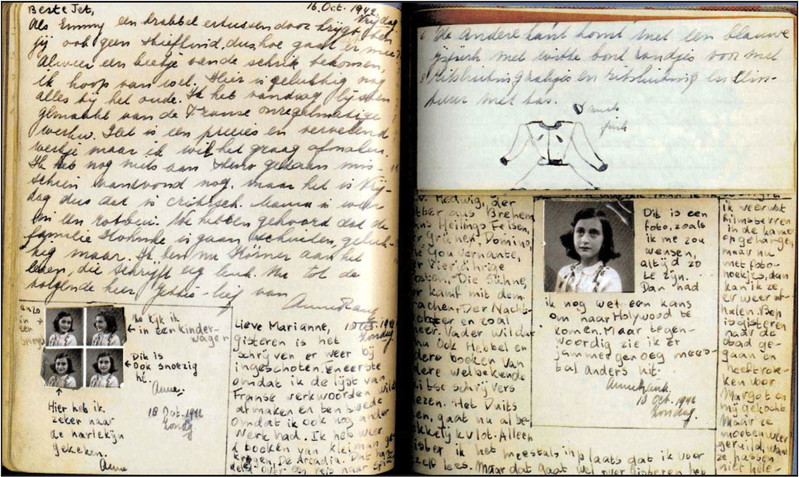 Elle commença à remanier et à réécrire celui-ci, corrigeant et supprimant les passages qu’elle considérait comme peu intéressants, ou en ajoutant d’autres puisés dans sa mémoire.
Elle commença à remanier et à réécrire celui-ci, corrigeant et supprimant les passages qu’elle considérait comme peu intéressants, ou en ajoutant d’autres puisés dans sa mémoire.
Parallèlement, elle continuait à tenir son journal originel, celui qui est appelé « version a » par opposition à la « version b » la deuxième réécrite.
Après que les nazis aient pillé l’annexe et dérobé tous les objets de valeurs, les feuillets du journal se trouvaient par terre, car ces criminels avaient vidé la serviette qui les contenait pour utiliser celle-ci afin d’emporter les objets volés.
C’est alors qu’une des salariés d’Otto Frank qui n’avait pas été arrêtée et avait aidé les huit juifs cachés pendant toute la période, Miep Gies a ramassé soigneusement tous les feuillets et les a rangés, sans les lire, avec pour objectif de les rendre à Anne à son retour.
Après la guerre, quand il était devenu certain qu’Anne avait été victime de la barbarie nazi, Miep Gies remit ce document au seul survivant, le père d’Anne.
Otto Frank lut alors le journal de sa fille, document qu’il n’avait jamais lu jusqu’alors.
Il en fut bouleversé, il se rendit compte qu’il connaissait peu sa fille.
Après mure réflexion, Otto Frank, décida d’exaucer le vœu de sa fille dont la volonté d’être publiée était évidente, en faisant éditer ce qui sera la première édition de ce journal.
A cette fin, il composa à partir des deux versions d’Anne l’originale (version a) et la retouchée (version b) une troisième abrégée dite version c.
C’est ce que l’on apprend dans le livre de Lola Lafon « Quand tu écouteras cette chanson », mais aussi l’Avant-Propos de l’édition publiée en juillet 2019 qui se veut une version exhaustive et non édulcorée de ce qu’a écrit Anne Frank.
Anne Frank a écrit sur tous les thèmes, de l’intime à la politique en passant par la philosophie.
Jeune adolescente elle entrait en conflit avec ses parents, elle s’éveillait à la sexualité.
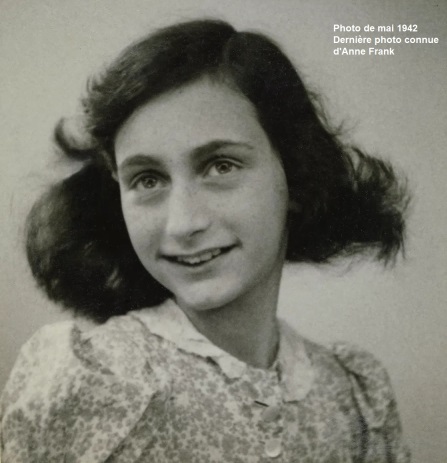 Le 24 mars 1944, elle décrit les organes sexuels féminins :
Le 24 mars 1944, elle décrit les organes sexuels féminins :
« Devant, quand on est debout, on ne voit rien que des poils, entre les jambes se trouvent en fait des espèces de petits coussinets, des choses molles, elles aussi couvertes de poils, qui se touchent quand on se met debout, à ce moment-là, on ne peut pas voir ce qui se trouve à l’intérieur. Quand on s’assoit, elles se séparent, et dedans c’est très rouge, vilain et charnu. Dans la partie supérieure, entre les grandes lèvres, en haut, il y a un repli de peau qui, si l’on observe mieux, est une sorte de petite poche, c’est le clitoris. Puis il y a les petites lèvres, elles se touchent, elles aussi, et forment comme un repli. Quand elles s’ouvrent, on trouve à l’intérieur un petit bout de chair, pas plus grand que l’extrémité de mon pouce. Le haut de ce bout de chair est poreux, il comporte différents trous et de là sort l’urine. Le bas semble n’être que de la peau, mais pourtant c’est là que se trouve le vagin. Des replis de peau le recouvrent complètement, on a beaucoup de mal à le dénicher. Le trou en dessous est si minuscule que je n’arrive presque pas à m’imaginer comment un homme peut y entrer, et encore moins comment un enfant entier peut en sortir. On arrive tout juste à faire entrer l’index dans ce trou, et non sans mal. Voilà tout, et pourtant cela joue un si grand rôle ! » »
Page 247 de la version de 2019
Il était inimaginable de publier un tel texte en 1947, il a donc fallu retirer ce texte et bien d’autres sur ce sujet comme celui dans lequel elle parle des prostituées.
Dans un autre feuillet, elle souligne l’importance d’avoir une éducation sexuelle complète et de qualité et ne pas comprendre pourquoi les adultes étaient si discrets sur le sujet.
Un district scolaire du Texas a d’ailleurs retiré le journal de ses bibliothèques en raison de « son caractère pornographique »
Anne Frank dépeint la vie dans l’annexe avec un œil analytique, un sens du détail étonnant. Elle donne à voir, dans l’enfermement, des moments de partage, d’ennui, de rêverie, mais aussi d’agacement.
Elle écrit sans détour sa relation conflictuelle avec sa mère et décrit sa proximité avec son père.
Par exemple elle écrit le dimanche 2 janvier 1944 :
« Ce matin, comme je n’avais rien à faire j’ai feuilleté mon journal et suis tombée à plusieurs reprises sur des lettres traitant du sujet « maman » en des termes tellement violents que j’en étais choquée et me suis demandé : « Anne, c’est vraiment toi qui as parlé de haine, oh Anne Comment as-tu pu ? »
Elle développe, un long paragraphe de justifications, d’explications, de regret et dit sa conviction qu’elle n’agirait plus ainsi un an après et fini par cette conclusion :
« Je tranquillise ma conscience en me disant qu’il vaut mieux laisser les injures sur le papier plutôt que d’obliger maman à les porter dans son cœur. »
Page 167 de la version de 2019
Lola Lafon nous apprend que pour ne pas froisser les allemands, les passages trop violents à leur égard seront aussi retirés.
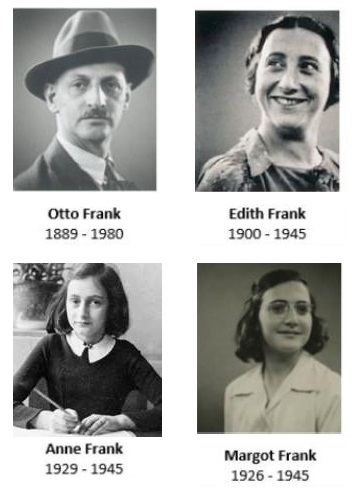 Mais les pires, à son sens, sont les américains qui veulent faire un film du journal. Mais à cette époque, la révolution des séries de H.BO. n’a pas encore eu lieu. Les artistes et producteurs américains ne veulent pas d’histoires trop tristes. Il y a certes des bons et des méchants, mais les méchants ne peuvent pas gagner et il faut que la fin ouvre sur l’espoir.
Mais les pires, à son sens, sont les américains qui veulent faire un film du journal. Mais à cette époque, la révolution des séries de H.BO. n’a pas encore eu lieu. Les artistes et producteurs américains ne veulent pas d’histoires trop tristes. Il y a certes des bons et des méchants, mais les méchants ne peuvent pas gagner et il faut que la fin ouvre sur l’espoir.
En plus, il faut que tout le monde puisse s’identifier au héros, le film américain considère donc pertinent de gommer la judaïcité d’Anne et de sa famille.
Lola Lafon signale le témoignage d’un spectateur américain qui a la fin du film trouvait qu’il était vraiment très beau et que finalement il n’exprimait aucune haine à l’égard des nazis.
Puis on racontera le journal sur la base de ce film.
On citera avec exaltation cette phrase écrite par Anne Frank :
« Malgré tout, je crois encore à la bonté innée des hommes. »
Et il est vrai qu’elle a écrit cette phrase le 15 juillet 1944, 20 jours avant d’être arrêtée et que son calvaire ne commence.
Mais cette phrase est suivie de ce passage :
« Il m’est absolument impossible de tout construire sur une base de mort, de misère et de confusion. Je vois comment le monde se transforme lentement en un désert, j’entends plus fort, toujours plus fort, le grondement du tonnerre qui approche et nous tuera, nous aussi, je ressens la souffrance de millions de personnes et pourtant, quand je regarde le ciel, je pense que tout finira par s’arranger, que toute cette cruauté aura une fin, que le calme et la paix reviendront régner sur le monde »
Page 346 de la version de 2019
Lucidité de la tragédie, de la cruauté et aussi qu’il existera un monde après les nazis. Lucidité de son sort : Le tonnerre, autrement dit la violence, nous tuera ! »
Et Lola Lafon renvoie vers un autre texte qui n’est pas passé à la postérité probablement parce qu’il n’était pas en phase avec la Anne Frank qui croyait à « la bonté innée des hommes ».
Elle a écrit, le mercredi 3 mai 1944 :
« On ne me fera jamais croire que la guerre n’est provoquée que par les grands hommes, les gouvernants et les capitalistes, oh non, les petites gens aime la faire au moins autant sinon les peuples se seraient révoltés contre elle depuis longtemps ! Il y a tout simplement chez les hommes un besoin de frapper à mort, d’assassiner de s’enivrer de violence, et tant que l’humanité toute entière, sans exception, n’aura pas subi une grande métamorphose, la guerre fera rage, tout ce qui a été construit, cultivé, tout ce qui s’est développé sera tranché et anéanti, pour recommencer ensuite. »
Page 293 de la version de 2019
C’est une adolescente de 15 ans qui écrit cela.
Et alors on ne savait pas ce qui se passait pour les juifs ?
Voici ce qu’écrivait Anne Frank le 9 octobre 1942 :
« Aujourd’hui, je n’ai que des nouvelles tristes et déprimantes à rapporter. Nos nombreux amis et connaissances juifs sont emmenés en masse. La Gestapo les traite très durement et les transporte dans des wagons à bestiaux jusqu’à Westerbork, le grand camp de Drenthe où ils envoient tous les Juifs. Miep nous a parlé de quelqu’un qui avait réussi à s’échapper de Westerbork. Westerbork doit être épouvantable. On ne donne presque rien à manger aux gens, encore moins à boire. Ils n’ont de l’eau qu’une heure par jour, et il n’y a qu’un WC et un lavabo pour plusieurs milliers de personnes. Ils dorment tous ensemble, hommes, femmes et enfants ; les femmes et les enfants ont souvent la tête rasée.
Il est presque impossible de fuir. […]
S’il se passe déjà des choses aussi affreuses en Hollande, qu’est ce qui les attend dans les régions lointaines et barbares où on les envoie ?
Nous supposons que la plupart se font massacrer. La radio anglaise parle d’asphyxie par les gaz ; C’est peut-être la méthode d’élimination la plus rapide. »
Page 62 de la version de 2019
Et le 19 novembre 1942, elle écrivait :
« Souvent le soir, à la nuit tombée, je vois marcher ces colonnes de braves gens innocents, avec des enfants en larmes, marcher sans arrêt, sous le commandement de quelques-uns de ces types, qui les frappent et les maltraitent jusqu’à les faire tomber d’épuisement, ou presque. Personne n’est épargné, vieillards, enfants, bébés, femmes enceintes, malades, tout, tout est entraîné dans ce voyage vers la mort.
[…] et tout cela, pour la seule raison qu’ils sont juifs »
Page 77 de la version de 2019
Ainsi parlait Anne Frank en 1942 !
Lola Lafon entre peu à peu dans la réalité de cette œuvre, car il s’agit d’une œuvre littéraire qu’Anne Frank a corrigé, réécrit dans le but de la faire publier.
Avant d’aller à Amsterdam, Lola Lafon a eu une rencontre vidéo avec Laureen Nussbaum qui est une écrivaine et linguiste, spécialiste du journal d’Anne Frank et qui a connu personnellement la famille Frank :
« Ce soir-là, elle me conseille de m’intéresser aux quatrièmes de couverture des différentes éditions du Journal. Elles sont extrêmement révélatrices. Ce que les éditeurs ont choisi de mettre en avant et, aussi, les mots qu’ils ont évité d’employer.
Dans les années 1960, par exemple, me dit Laureen, on pouvait lire ceci : « Lire le Journal c’est assister à l’épanouissement d’une adolescente face à l’adversité. »
A sa parution aux États-Unis, on demande à Eleanor Roosevelt d’ajouter un avant-propos. Elle y loue « la noblesse de l’esprit humain », s’émeut de ce « message d’espoir ». Le Journal est « un monument » élevé à tous ceux qui « œuvrent pour la paix ».
Pas une allusion au régime nazi, ni à la shoah. Pas un mot sur les conditions dans lesquelles Anne Frank a écrit.
« Anne n’œuvrait pas pour la paix. Elle gagnait du temps sur la mort en écrivant sa vie. […] Anne Frank désirait être lue, pas vénérée. […]
Elle n’est pas une sainte. Pas un symbole. Son journal est l’œuvre d’une jeune fille victime d’un génocide, perpétré dans l’indifférence absolue de tous ceux qui savaient.
N’utilisez pas le mot espoir, s’il vous plait. »
Pages 26 et 27 « Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon
Le livre de Lola Lafon nous incite à lire, dans sa dernière version, le Monument écrit par une jeune adolescente qui essaye d’arracher des moments de vie et de réflexions dans le monde terrifiant, horrible et bestial créé par des humains ignobles et monstrueux.
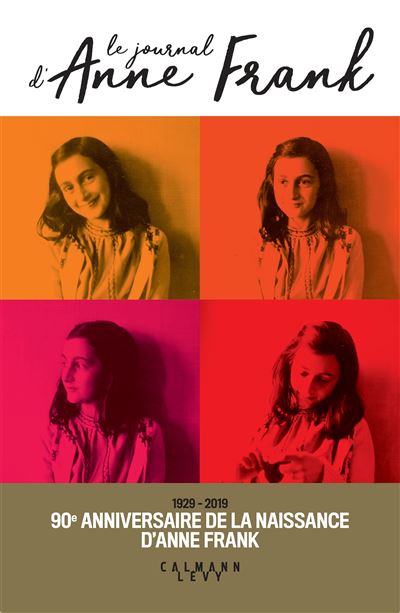
<1720>
-
Vendredi 7 octobre 2022
« Quand tu écouteras cette chanson. »Lola LafonL’éditeur Stock a eu l’idée d’une collection « Ma nuit au musée » dans laquelle des écrivains s’enferment dans un musée pendant une nuit et tentent de trouver l’inspiration d’un livre.
Kamel Daoud, Leila Slimani, Enki Bilal parmi d’autres se sont soumis à cette expérience qui peut être un peu déstabilisante. Surtout quand ce musée est le musée d’Anne Frank à Amsterdam.
Lola Lafon a fait ce choix quand Stock lui a proposé d’entrer dans cette collection. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas imaginer un autre musée que celui-ci.
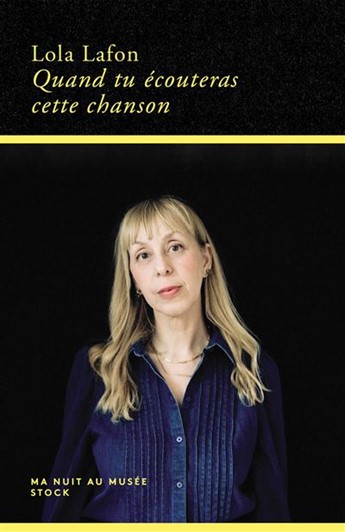 Elle en a tiré un livre « Quand tu écouteras cette chanson »
Elle en a tiré un livre « Quand tu écouteras cette chanson »
Elle avait été invitée par Olivier Gesbert dans son émission du 8 septembre 2022 : <Lola Lafon et le journal d’Anne Frank >
Émission qu’on peut aussi voir <en vidéo>
Et cet échange, que j’ai entendu, m’a donné envie de lire ce livre.
Ce que j’ai fait lors de notre semaine de repos en Bourgogne.
Et j’ai aimé ce livre, parce que Lola Lafon trouve le ton juste et les mots qui captent notre attention pour parler de cette histoire terrible, bouleversante et y mettre une part d’elle-même.
Le journal d’Anne Frank, tout le monde croit le connaître, le livre de Lola Lafon nous montre que probablement nous sommes passés à côté de l’essentiel.
C’est l’œuvre d’une jeune fille de 14 ans « Sidérante de maturité » dit Lola Lafon dans l’entretien qu’elle a réalisé avec la Librairie Mollat (21:16)
La famille d’Otto Frank et de son épouse Edith était une famille aisée allemande vivant à Francfort. Mais en 1933, après l’arrivée des nazis au pouvoir et les premières persécutions, la famille Frank quitte Francfort pour Amsterdam.
Il y a deux filles dans cette famille : Margot née en 1926 et Anne née en 1929.
Otto Frank crée une entreprise Opekta, vendant du gélifiant pour confiture, à Amsterdam.
Les sœurs deviennent de vrai néerlandaises et vont à l’école Montesori à Amsterdam. Le journal est écrit en néerlandais.
Mais la guerre les rattrape et Amsterdam est occupée par les Allemands à partir de mai 1940.
Otto Frank se déleste de son entreprise au profit de ses salariés qui lui sont fidèles pour ne pas être exproprié par les nazis.
Et c’est avec la complicité de ces salariés que la famille Frank va se cacher à partir de juillet 1942 dans un appartement secret aménagé dans l’« Annexe » de l’entreprise Opekta dont l’entrée est dissimulée par une bibliothèque.
C’est là que la famille et quatre amis juifs vécurent vingt-cinq mois confinés dans moins de 40 m², sans vue vers l’extérieur, simplement une fenêtre du grenier leur permettant de voir le ciel.
Le 4 août 1944, les nazis arrivent à l’usine et sans hésiter déplacent la bibliothèque et entrent dans l’annexe arrêter tout le monde.
Ils ont été trahis et on ne sait toujours pas par qui.
Ils seront déportés le 3 septembre 1944 vers le centre d’extermination d’Auschwitz-Birkenau puis les filles seront transférées au camp de Bergen-Belsen. Les conditions d’hygiène étant catastrophiques, une épidémie de typhus y éclata durant l’hiver 1944-1945, coûtant la vie à des milliers de prisonniers. D’abord Margot puis Anne mourront de cette maladie. La date de leur mort se situe entre fin février et début mars. Les corps des deux jeunes filles se trouvent sans doute dans la fosse commune de Bergen Belsen. Le camp est libéré, peu de semaines après, par des troupes britanniques le 15 avril 1945 et Amsterdam est libérée le 5 mai 1945. La mère est morte à Auschwitz, le 6 janvier 1945. Seul le père Otto Frank reviendra.
Des huit personnes qui se cachèrent dans l’Annexe, il est le seul qui a survécu à l’arrestation et au génocide. Otto Frank consacrera le restant de sa vie au journal de sa fille, et à la lutte contre la discrimination et les préjugés. Il participera activement à l’ouverture de l’annexe en tant que musée en 1960. En 1963, Otto Frank crée le Fonds Anne Frank de Bâle, une association qui détient les droits d’auteur sur les écrits d’Anne Frank y administre l’héritage de la famille Frank. Les revenus sont consacrés à des œuvres caritatives dans le monde entier, par exemple la lutte contre les discriminations et l’injustice, les droits des femmes et des enfants. Il décédera en 1980 à 91 ans.
Lola Lafon a perdu aussi une grande partie de sa famille dans la Shoah victime du génocide.
Sa mère est roumaine et son père est français. Elle grandit en Bulgarie puis en Roumanie jusqu’à ses 12 ans.
Sa grand-mère lui a donné très jeune une médaille représentant Anne Frank avec ces seuls mots :
« N’oublie jamais »
Longtemps, elle a voulu ignorer cette partie de son histoire :
« Je suis celle qui, depuis l’adolescence, détourne les yeux. Je ne voulais pas entendre, pas savoir. (…) Ce que je souhaitais, c’était faire partie d’une famille normale. »
Mais elle était arrivé à ce moment de sa vie où le moment de renouer le lien était venu.
Et c’est ainsi que :
« Le 18 août 2021, j’ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans l’Annexe.
Je suis venue en éprouver l’espace car on ne peut éprouver le temps. On ne peut pas se représenter la lourdeur des heures, l’épaisseur des semaines. Comment imaginer vingt-cinq mois de vie cachés à huit dans ces pièces exiguës ?
Alors, toute la nuit, j’irai d’une pièce à l’autre.
J’irai de la chambre de ses parents à la salle de bains, du grenier à la petite salle commune, je compterai les pas dont Anne Frank disposait, si peu de pas. »
Quand tu écouteras cette chanson, Page 11Elle y restera dix heures
La première chose qu’elle voit dans l’annexe est un cadre. Elle croit qu’il est vide, l’appartement est plongé dans une pénombre. Elle s’approche. Elle voit un morceau de papier peint. Elle s’approche encore et elle aperçoit des petits traits au crayon à papier : Otto Frank traçait au mur l’évolution de la taille de ses filles, Margot et Anne. Lola Lafon parle de preuve de vie. Elles vivaient, elles grandissaient dans cette annexe.
Avant d’aller passer sa nuit au musée, des collaboratrices du musée lui avait fait visiter l’appartement que la famille Frank a occupé avant d’aller se réfugier dans l’annexe.
Elle décrit cette visite :
« Nous déambulons de pièce en pièce, comme de futures acquéreuses. »
Teresien qui montre l’appartement explique que l’appartement a été entièrement pillé en 1944 par les nazis et que l’équipe du musée a tenté à l’aide de photos de l’époque et de témoignages de connaissances de Frank qui avait fréquenté le lieu pendant que les Frank y avaient habité de remeubler et décorer à l’identique.
L’écrivaine écrit alors ce texte que je trouve très inspiré :
« Tout, ici se veut plus vrai que vrai tout est faux, sauf l’absence. Elle accable, c’est un bourdonnement obsédant, strident.
L’appartement des Frank est le décor d’un drame sans acteurs, c’est un musée sans visiteurs. […]
Tout dans la chambre d’Anne paraît en suspens, interrompu, le moindre objet semble attendre son retour. L’étroit lit aux draps soigneusement tirés. Les tiroirs entrouverts d’une commode. Le bois sombre d’un secrétaire sur lequel ont été disposés des feuillets vierges, des cahiers sur lesquels personne n’écrira. Anne Frank manque terriblement à sa chambre d’adolescente. »
Page 63
Dans l’annexe, elle aura beaucoup de mal à entrer dans la chambre d’Anne. On n’entre pas dans une chambre d’adolescente, dit-elle
Elle recule chaque fois devant la porte. Elle devra bientôt quitter le musée : « Il était 6 heures du matin »
Et à la fin des fins elle franchit le pas :
« Sans doute semblais-je sereine quand j’ai poussé la porte de la chambre d’Anne Franck »
Et dans cette chambre, un souvenir va resurgir dans sa mémoire.
Souvenir qui explique le titre du livre et qui concerne une rencontre, à Bucarest où elle vivait alors.
La rencontre d’un jeune garçon cambodgien de 15 ans.
Son père était fonctionnaire à l’ambassade du Cambodge en Roumanie. Mais les dirigeants du Cambodge, les sinistres Khmers Rouges, ont donné l’ordre au père de rentrer dans son pays avec sa famille.
Le jeune garçon qui était pensionnaire dans un lycée parisien a été obligé de rejoindre ses parents et il va passer quelques jours à Bucarest. Puis partira pour le Cambodge avec sa famille.
Il enverra une dernière lettre postée à Pékin avant d’être victime d’un autre génocide, sur un autre continent
A propos de ce livre « Le Monde » écrit : < Lola Lafon en tête-à-tête avec Anne Frank >
« Et lorsqu’il est question d’en faire un musée, en 1960, le père d’Anne et de Margot Frank exige que l’appartement demeure dans cet état. « Qu’on en soit témoin, du vide, sans pouvoir s’y soustraire ; qu’on s’y confronte, énonce Lola Lafon. Ainsi, en sortant, on ne pourra pas dire : dans l’Annexe, je n’ai rien vu. On dira : dans l’Annexe, il n’y a rien, et ce rien, je l’ai vu. […]
Regarder en face « ce qui jamais ne sera comblé » : Quand tu écouteras cette chanson est le récit troublant, saisissant, de cette redoutable confrontation. Dix heures passées seule par l’écrivaine, le 18 août 2021, dans les 40 mètres carrés de l’Annexe, le plus vide de tous les musées. Les règles fixées à l’entrée sont strictes : pas de photo, interdit de boire comme de manger, mais aussi de suspendre son sac à une poignée de porte. Comme un écho des contraintes imposées à la famille Frank. Vingt-cinq mois durant, les huit habitants dissimulés au cœur de la ville qui les traquait se sont astreints au silence. »
Lola Lafon fut aussi l’invité de la première Grande Librairie d’Augustin Trapenard : <Lola Lafon sur les traces d’Anne Frank>
Il me semble que cet entretien vidéo de 48 minutes proposé par la Librairie Mollat est encore plus intéressant : <Quand tu écouteras cette chanson>
<1719>
-
Jeudi 6 octobre 2022
« Pause (Victor Klemperer.) »Jour sans mot du jour nouveauIl y a quasi 2 ans, <Le 18 octobre 2019>, j’avais mobilisé, pour le mot du jour, le philologue allemand Victor Klemperer : « Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir.»
I
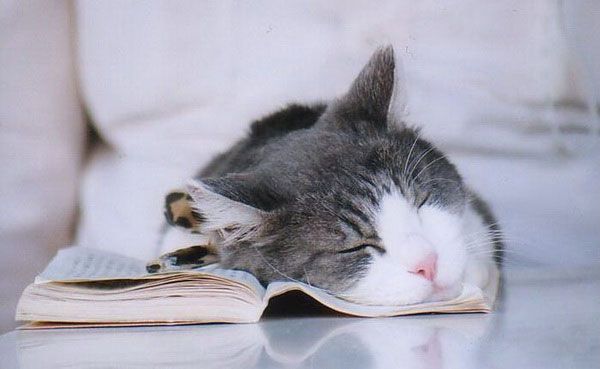 l me semble qu’après le dernier discours de Poutine qui réinvente sans cesse l’histoire et qui est capable de dire sérieusement les vérités alternatives les plus insensées, il traite désormais les occidentaux de pratiquer la religion du satanisme, il faut réinterroger le travail de Victor Klemperer qui a analysé et dévoilé la langue du régime nazi.
l me semble qu’après le dernier discours de Poutine qui réinvente sans cesse l’histoire et qui est capable de dire sérieusement les vérités alternatives les plus insensées, il traite désormais les occidentaux de pratiquer la religion du satanisme, il faut réinterroger le travail de Victor Klemperer qui a analysé et dévoilé la langue du régime nazi.
Sa grande œuvre parue en 1947 est le livre « LTI – Lingua Tertii Imperii » dont le sous-titre est « Notizbuch eines Philologen » ce qui traduit donne : « Langue du Troisième Reich : carnet d’un philologue ».
Car, avant les grandes catastrophes il y a d’abord des mots, des mots qui forment un récit. Un récit qu’un grand nombre s’approprie, pour finalement analyser et voir le monde à travers ce récit, avec des mots choisis soigneusement et qui sont les vecteurs des idéologies et des croyances qui doivent embraser l’esprit des peuples.
Le livre qu’il nomme lui-même « LTI » a été écrit peu à peu, car Klemperer a construit son analyse au fur à mesure des années, entre 1933 et décembre 1945, dans le journal qu’il tient. C’est un essai sur la manipulation du langage par la propagande nazie depuis son apparition sur la scène politique jusqu’à sa chute.
<Mot du jour du 18 octobre 2019>
<Mot du jour sans numéro>
-
Mercredi 5 octobre 2022
« Le bus du Paris Saint Germain fait 3600 km à vide pour transporter les joueurs sur une distance de moins de 50 km. »Ce n’est pas une question de confort, mais de sécurité.Une nouvelle histoire de football…
Vous savez que l’entraineur du Paris SG a été vilipendé parce qu’il a répondu, à un journaliste qui lui demandait pourquoi les joueurs ne prenaient pas le train plutôt que l’avion pour faire un match à 200 km de Paris, qu’une réflexion était en cours pour examiner la possibilité de voyager en char à voile.
C’était un mot d’humour…
En pratique, les joueurs de PSG se déplacent en avion et en bus.
Aujourd’hui, le PSG affronte le club de Benfica à Lisbonne.
Il faut donc se rendre à Lisbonne à 1460 km de Paris (à vol d’oiseau), Google annonce qu’il faut 16h43 en voiture pour faire le trajet d’environ 1800 km.
Les joueurs sont donc allés à Lisbonne en avion.
Dans ce contexte, je crois que même les écologistes se rendront à l’évidence, l’avion est la solution appropriée.
Mais, dans la pratique, le transport des joueurs du PSG est une affaire d’une grande complexité.
L’avion les amène à l’aéroport de Lisbonne !
Mais l’hôtel des joueurs et le stade de Luz ne sont pas à côté de l’aéroport de Lisbonne.
Pour l’hôtel, je ne sais pas où Messi et ses collègues vont dormir, mais l’aéroport et le stade nous savons où ils se trouvent.
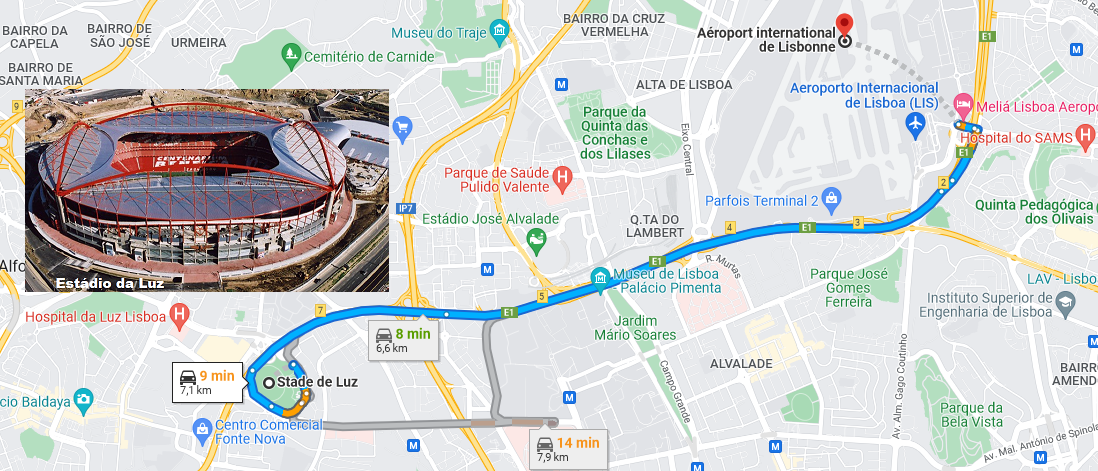 Je peux donc dire que la distance entre les deux se situent entre 6,6 et 7,9 km.
Je peux donc dire que la distance entre les deux se situent entre 6,6 et 7,9 km.
Pour ces trajets il faut un bus.
Un bus loué à Lisbonne ?
Que nenni !
Il faut le bus du PSG !

Le bus du PSG n’est pas à Lisbonne, il est à Paris.
Il faut donc que le Bus se rende à Lisbonne pour aller chercher les joueurs du PSG à l’aéroport, les promène à Lisbonne, puis revienne à Paris.
Le bus du PSG fait donc 3600 km à vide pour promener l’équipe sur une cinquantaine de km, si l’hôtel ne se trouve pas dans la proximité immédiate du stade. Sinon les trajets seraient plus proche des 20 km.
C’est le Parisien qui donne cette nouvelle : <Pourquoi le car parisien a fait 1800 km à vide jusqu’à Lisbonne ?>
Article repris par <La Voix du Nord> :
« Nos confrères du Parisien révèlent que le bus officiel du club a parcouru 1 800 kilomètres à vide entre Paris et Lisbonne… pour transporter les joueurs de l’aéroport à leur hôtel, puis au stade.
Concrètement, précise le journal, le bus a relié Lisbonne depuis Paris, afin de réceptionner les joueurs, qui ont pris l’avion, à l’aéroport, pour pouvoir les emmener jusqu’à leur hôtel, puis les transférer de l’hôtel au Stade de la Luz où ils jouent, ce mercredi, leur troisième match de Ligue des champions. Jeudi, ce sera rebelote, mais dans l’autre sens : le bus remontera à vide jusqu’à son garage en Ile-de-France.
C’est un nouveau non-sens écologique pour le PSG. Mais, une raison se cache derrière ce choix : selon le Parisien, les dirigeants du club ont pris cette décision pour une question de sécurité, « critère numéro 1 qui oriente les décideurs au moment de valider le choix du moyen de transport », écrivent nos confrères.
Le journal précise que le bus rouge et bleu n’est pas vraiment un bus comme les autres : le véhicule, fournit par la société Man depuis 2013, possède des vitres blindées et a été conçu pour protéger les joueurs en cas d’attaque plus ou moins violente, à savoir des jets de projectiles de supporters, ou pour un attentat, à l’image de ce qui s’est produit en 2017, où bus du Borussia Dortmund avait été visé par trois explosions de bombes lors de son trajet entre l’hôtel et le quart de finale de Ligue des champions. Depuis cet événement, les grands clubs prennent leurs précautions et sont équipés de ce type de bus.
Le bus du PSG, effectue environ 25 voyages par saison, précisent nos confrères : généralement pour emmener les joueurs de l’aéroport à l’hôtel puis au stade, mais aussi parfois pour de courts déplacements en France, à l’image du déplacement des Parisiens pour le match contre Lille le 21 août. Dans ce bus, au top du confort, se trouvent des sièges inclinables à 45 degrés sur lesquels se trouvent des écrans reliés à des consoles de jeux ou à la télé satellite et un coin cuisine, pour se faire réchauffer des repas.
Il n’est, en revanche, pas présent partout. Il fait l’impasse sur les voyages les plus lointains et ne se rend pas dans les lieux où il pourrait provoquer les supporters adverses, comme à Marseille, par exemple, disent encore nos confrères. Le PSG n’est d’ailleurs pas le seul à faire voyager des bus à vide : le bus de l’Olympique de Marseille a, lui aussi, fait le voyage à vide lors de la première journée de Ligue des champions, pour se rendre à son match face à Tottenham. Il a été aperçu au péage de Setques, juste à côté de Saint-Omer, en direction de Calais.
Comme le rappelle le quotidien national : depuis plusieurs mois, les déplacements du club en train sont systématiquement mis en concurrence avec l’avion et le bus sur quatre critères principaux, à savoir : la sécurité, le trouble à l’ordre public, le temps de trajet global et le coût. Mais, jusqu’à présent, la SNCF n’a jamais remporté les faveurs du club, notamment en raison des critères de sécurité et de l’impossibilité après certains matchs d’effectuer les trajets retour dans la nuit, élément indispensable à la récupération des joueurs. »
Voilà, vous êtes ainsi pleinement informés !
Il reste des questions : ne peut-on pas trouver un bus blindé à Lisbonne ? Comment font les parisiens à Marseille quand ils se privent de leur bus pour ne pas provoquer ?
Mais l’information essentielle est qu’il faut un bus blindé pour emmener les joueurs de football au stade !
Parce que c’est dangereux d’aller au stade de football !
Voilà ce que notre société a créé à partir d’un jeu qui est devenu une affaire financière, une affaire de violence, un affrontement entre bandes rivales.
<1718>
-
Mardi 4 octobre 2022
« Le voile n’est pas la liberté. »Kamel DaoudC’est une histoire largement diffusée par les médias. Mahsa Amini jeune femme iranienne, kurde, a été arrêtée par la police des mœurs parce qu’elle portait mal son voile selon cette milice d’un autre âge. La jeune femme, originaire de Saqqez, une ville de la province du Kurdistan iranien, était en voyage dans la capitale iranienne avec sa famille lorsqu’elle a été interpellée sous les yeux de son frère. Sur les réseaux sociaux, on la voit malmenée pendant son arrestation, jetée à terre et finalement poussée contre sa volonté dans un véhicule de la police des mœurs. Après trois jours de détention, elle meurt le 16 septembre, à l’hôpital où finalement les policiers l’ont emmenée.
Depuis des manifestations ont éclaté, des femmes brûlent leur voile, coupent leurs cheveux en signe de protestation de cet asservissement qu’elles subissent dans la république islamique d’Iran…
<France 24>, citait le 29 septembre, l’agence officielle iranienne Fars qui affirme qu’environ 60 personnes ont été tuées depuis le début des protestations dans l’ensemble du pays et que 1200 personnes ont été arrêtées.
En principe nous savons quand les voies officielles donnent ce type de chiffres, ils sont toujours minorés.
Et bien sûr les autorités iraniennes accusent les puissances étrangères d’avoir fomenté le mouvement. « L’ennemi a visé l’unité nationale et veut dresser les gens les uns contre les autres », a ainsi prévenu le président ultraconservateur Ebrahim Raïssi mercredi, jugeant « le chaos inacceptable » et accusant les États-Unis, l’ennemi juré de la République islamique, d’attiser la contestation. Elles en profitent aussi pour stigmatiser la minorité Kurde iranienne et celles des pays limitrophes.
<TV5> a interrogé la sociologue Mahnaz Shirali, née en 1965 à Téhéran :
« La mort de Mahsha Amini, cette jeune fille de 22 ans, a déclenché de vives réactions des Iraniens. Mais en même temps, il y a toute une série d’autres facteurs qui se sont accumulés. Sa mort a servi d’étincelle pour faire exploser la rage des Iraniens qui étaient inquiets depuis très longtemps à cause de pleins de problèmes d’injustice, des problèmes économiques et une mauvaise gestion du pays.
[ Danser puis brûler son hijab, ou se couper les cheveux, et partager ces vidéos sur les réseaux sociaux] fait parler. Ça montre que ça attire l’attention. C’est ça le symbolisme : quelque chose qui n’a peut-être pas beaucoup de sens mais qui attire les regards. Ça transmet des sentiments extrêmement forts.
[…] Elles en ont ras-le-bol. Elles ne peuvent plus supporter de ne pas être libre, les contraintes qu’on leur impose au nom de l’Islam et de la loi islamique. »
Il y a peu de chance que le régime iranien et ses sbires cèdent devant la pression de la rue. Ils ont le monopole des armes pour tuer et forcer, le fanatisme du croyant pour se rassurer et évacuer les remords qui pourraient surgir devant tant de violence, les avantages économiques de l’élite religieuse et des forces de sécurité à préserver.
Alors cela repose la question du voile de manière plus générale.
Le voile pourrait être instrument d’asservissement en Iran et symbole de liberté en France ?
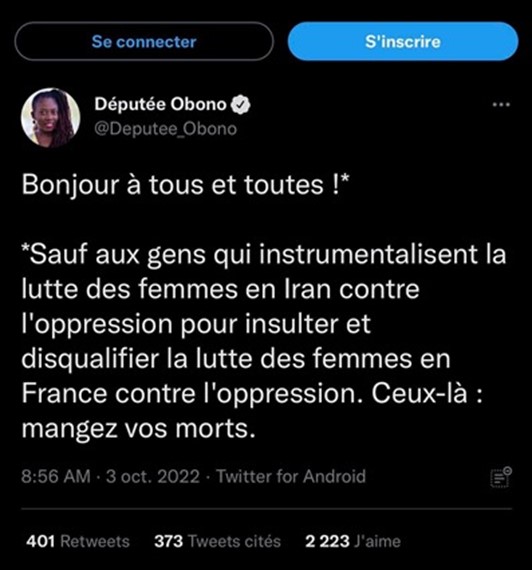 Certain(e)s l’affirment.
Certain(e)s l’affirment.
Et la député LFI Daniele Obono fustige même celles et ceux qui pourraient tenter d’y voir une contradiction et pousser « l’indécence » jusqu’à vouloir s’appuyer sur le combat des femmes iraniennes pour poser des questions sur l’association de «la liberté» et «du voile» en France.
Elle a cette insulte morbide : « mangez vos morts » …
D’autres, sans aller dans ces excès de langage, essayent aussi de surmonter et de résoudre cette contradiction. Sandrine Rousseau qui est de tous les combats est de celui-là aussi.
Je lis toujours avec beaucoup d’intérêt et de plaisir intellectuel l’écrivain algérien Kamel Daoud.
Il m’est arrivé plusieurs fois d’écrire des mots du jour en le mettant en exergue :
- «L’antiracisme est un combat juste. Il ne doit pas devenir un acte de vandalisme intellectuel ou de désordre dans ce monde si fragile.»
- « En France, vous avez un art très rare qui est de fabriquer des religions sans dieu »
Et je l’ai cité longuement dans le mot du jour consacré à ce livre étonnant d’Ibn Tufayl : « Le Vivant, fils de l’Éveillé »
Kamel Daoud a écrit un éditorial, le 3 octobre 2022 dans « Le Point » : <Le voile est un féminicide> :
« Le voile tue. La démocratie, non. La mort de Mahsa Amini et la vague de protestations qu’elle provoque en Iran rappelle une fois de plus cette évidence. […]
« Cela suffit à tout dire et à tout démentir. Ce n’est pas un événement rare, d’ailleurs. Une femme harcelée, violentée, menacée, tuée ou excommuniée parce qu’elle refuse de porter le voile est chose banale dans le monde dit « musulman ». Une femme qui ose arracher ce linceul confessionnel, c’est encore pire que l’apostasie, c’est le choix de la pornographie, de la prostitution, de la désobéissance civile. Il faut être femme dans ces territoires pour le vivre, en mourir et sourire de celles et ceux qui, en Occident, prétendent que le voile est une liberté. »
Kamel Daoud a vu arriver en Algérie, la vague islamiste, le voile qui couvrait toujours davantage les femmes et il se cite à la troisième personne :
« Parce que, vivant dans le « Sud confessionnel », il sait que ce morceau d’étoffe est une prison et une condamnation à mourir une vie entière, un enterrement vertical, le renoncement acclamé à son propre corps. Il sait ce que cela coûte pour les femmes et combien elles le paient. Et écouter l’« engineering de l’islamisme » occidental présenter cela comme une liberté et un choix et rameuter les opinions et les médias pour geindre sur une présumée confiscation de droits provoque la rage. »
Son opinion est claire et tranchante : .
« Un bout de territoire cédé, pas un bout de tissu choisi. Il faut donc rappeler les évidences coûteuses : le voile n’est pas une liberté, mais sa fin. Le voile n’est pas un épiderme qui souffre d’un racisme adverse, mais un uniforme d’enrôlement. Le voile n’est pas le signe d’une identité communautaire, mais un renoncement à toute identité et communauté au bénéfice d’un refus de vivre ensemble, de partager, de s’ouvrir, de s’enrichir mutuellement. Le voile n’est pas une « origine », mais un effacement de soi, des siens, de ses généalogies au bénéfice d’un recrutement. Le voile n’est pas seulement un petit foulard, c’est surtout ainsi qu’il commence. Le refuser, le combattre, n’est pas un acte néocolonial, l’ordre d’un colon. Le dévoilement n’est pas une violence de colonisation reconduite, et l’accepter, c’est concéder le territoire et le corps de ses propres citoyens au bénéfice d’une autre loi. Le voile a bénéficié de la « culpabilité » en Occident, de l’intelligence de l’islamiste occidental expert en droits, ONG et architectures associatives. Il a profité de l’histoire mal soldée des colonisations et recycle les procès en arnaques rusées, les dénis en séparatismes. Il a surtout recyclé le communautaire en confessionnel et le confessionnel en stratégie de conquête. »
Et il pose ce constat : « aujourd’hui, au sud du monde, une femme non voilée est une prostituée et, au nord, une femme non voilée est une traître à sa culture, à ses ancêtres. »
Et il me semble qu’il parle ensuite de certains politiques qu’il ne faut peut être pas appeler islamo-gauchiste mais plutôt islamo-naïf.
« Et il s’en trouvera pour le défendre, naïfs ou fourbes, électoralistes ou populistes. »
Et il finit par cette conclusion :
« Mais qu’on arrête une femme en Iran, qu’on la torture, qu’elle meure à cause de ce « tissu » qui n’est qu’une camisole et tout reprend sens, s’ordonne selon ces évidences à qui on fait une guerre sournoise : le voile n’est pas la liberté, ni l’identité, ni un choix. Il est prétendu choix dans le pays qui a le respect des choix, c’est-à-dire des libertés, c’est-à-dire dans les démocraties. Dans les dictatures, il se montre pour ce qu’il est : un assassinat. Car on aura beau jouer sur les mots, le voile tue. La démocratie, non. Des Iraniennes auraient donné beaucoup pour venir vivre leur liberté en France. Pas pour y renoncer. »
Je partage cet article.
Je partage l’analyse et l’opinion de Kamel Daoud.
La plupart des commentaires de cet article sont favorables. J’en ai cependant lu un portant une critique étrange qui semble nier qu’il est plus doux de vivre dans notre démocratie que dans la théocratie chiite :
« Le voile tue. La démocratie, non.
Kamel Daoud a choisi d’oublier toutes les morts au nom des valeurs de l’occident.
Jusqu’à maintenant, par exemple, c’étaient les pouvoirs démocratiques uniquement qui ont lâché une arme nucléaire sur la population de deux grandes villes.
Qu’apporte la démocratie ?
À partir de 1789 la France a connu une myriade de régimes plus ou moins démocratiques.
Monarchie absolue monarchie constitutionnelle, les 9 régimes de la 1ère République, 3 Empires, Restauration Monarchie, 100 Jours de Napoléon, 2ème Restauration, Monarchie de juillet, 4 Républiques de plus, La France Libre, Comité Française de la Libération, Groupement Provisoire de la République.
et vous croyez que la démocratie venait avec ?
Quelles sont les dates de suffrage universel, de la majorité à 18 ans, des droits des minorités nombreux ?
Les vainqueurs des guerres portent la victoire des plus forts. Non des plus moraux »
Je me suis permis une réponse : « Simplement Merci de dire ces choses simples. Le voile n’est pas une liberté. Alors je ne crois pas qu’il faille autoritairement l’interdire, mais il faut plutôt être fier de nos valeurs et les défendre. A savoir la liberté, les contre-pouvoirs, l’état de droit, la volonté d’émancipation de l’individu, l’égalité des femmes et des hommes, le droit de penser et de croire différemment et surtout de ne pas croire. Bien sur l’Occident a commis des fautes et des crimes parfois. Cela étant, les autres civilisations n’en sont pas exemptes non plus. Reconnaître des erreurs ne doit pas nous dissuader de défendre la part belle de notre histoire et de notre manière de vivre en société. »
<1717>
- «L’antiracisme est un combat juste. Il ne doit pas devenir un acte de vandalisme intellectuel ou de désordre dans ce monde si fragile.»
-
Lundi 3 octobre 2022
« Les Krafft […] ne sont plus vulcanologues, ils deviennent des artistes, qui entrainent les spectateurs […] dans un royaume à la beauté insolite »Werner Herzog à propos des images tournées par Katia et Maurice KrafftWerner Herzog, né en 1942 est un des plus grands cinéastes allemands.
 Ses films sont connus par tous les cinéphiles et notamment ses films avec Klaus Kinski :
Ses films sont connus par tous les cinéphiles et notamment ses films avec Klaus Kinski :
- 1972 : Aguirre, la colère de Dieu
- 1979 : Nosferatu, fantôme de la nuit
- 1979 : Woyzeck
- 1982 : Fitzcarraldo
- 1987 : Cobra Verde
Mais il est aussi l’auteur de documentaires et particulièrement de documentaires sur les volcans : La soufrière (1977) et Au fin fond de la fournaise (2016).
Sa dernière œuvre qu’ARTE vient de diffuser le samedi 1er Octobre est encore consacrée aux volcans, mais cette fois à travers les images, les vidéos qu’ont réalisées les époux Maurice Krafft et Katia Krafft-Conrad.
Ils sont tous les deux nés en Alsace : Maurice Krafft, le 25 mars 1946 à Guebwiller (Haut-Rhin) et Katia Conrad le 17 avril 1942 à Soultz-(Haut-Rhin).
 Ils se rencontrent en 1966 pour ne plus jamais se quitter et parcourir le monde, sur les lieux où la terre rugit et les volcans déversent leur magma de manière fascinante et dangereuse pour tous ceux qui sont en proximité.
Ils se rencontrent en 1966 pour ne plus jamais se quitter et parcourir le monde, sur les lieux où la terre rugit et les volcans déversent leur magma de manière fascinante et dangereuse pour tous ceux qui sont en proximité.
Ils voudront s’approcher toujours au plus près pour filmer et photographier ces monstres fascinants et dévastateurs.
Plusieurs fois, comme le montre le documentaire, ils échapperont de peu aux griffes de ces géants qu’ils sont allés contempler
Ils sont morts ensemble, victimes de leur passion commune, emportés avec 41 autres personnes par une nuée ardente, les techniciens parlent de coulée pyroclastique, sur les flancs du mont Unzen au Japon le 3 juin 1991.
Le choix des images et le commentaire que fait Werner Herzog magnifient le travail des époux Krafft, les images sont d’une beauté stupéfiante.
Quelquefois Herzog laisse défiler le film, par exemple celui tourné à Hawaï, simplement accompagné de la messe en Si de Jean-Sébastien Bach à partir de 33:13.
Werner Herzog introduit cette séquence :
« Les Krafft ne cessent d’être captivés par ces puissantes et fascinantes éruptions de magma à la surface de la terre.
Ils ne sont plus vulcanologues, ils deviennent des artistes, qui entrainent les spectateurs que nous sommes dans un royaume à la beauté insolite. Ils nous offrent un spectacle qui n’existent que dans les rêves.
Ces images se suffisent à elles-mêmes nous ne pouvons que contempler. »
Ce documentaire a pour nom « Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Krafft»
ARTE le rediffusera dimanche 9 octobre à 07:00.
Mais il peut être visionné en replay sur la chaîne <ICI> ou encore sur la chaîne Youtube d’Arte : <
Requiem pour Katia et Maurice Krafft>
« Dans un documentaire contemplatif et habité, le cinéaste rappelle le destin hors du commun du couple Krafft, volcanologues et faiseurs d’images hors pair disparus en 1991 lors d’une éruption au Japon.
Sur les photos, leurs bonnets rouges vissés sur le crâne leur donnent des airs de lutins défiant les crachats de montagnes turbulentes. Deux minuscules points rouges dans un théâtre de cendres et de fumées dont ils ne voulaient rater aucune des représentations. Au grand spectacle du magma, Katia et Maurice Krafft avaient pris un abonnement à vie. Vingt-cinq ans d’assiduité sans relâche à danser sur les volcans. Cent soixante-quinze éruptions guettées, filmées et photographiées au plus près des cratères, pour mieux partager, dans des dizaines de livres, de conférences ou d’émissions télé, leur passion de cette pyrotechnie jaillie des entrailles de la Terre.
Trente et un ans après leur disparition sur les flancs du mont Unzen, au Japon, avalés par une de ces ravageuses coulées pyroclastiques qu’ils étaient venus filmer, Katia et Maurice Krafft, volcanologues unis par le mariage et la lave qui coulait dans leurs veines, crèvent […] l’écran en ce début d’automne. »
Et <le Monde> écrit :
« Cette fois, le cinéaste allemand recourt aux images des spécialistes moins pour retracer leur parcours scientifique que pour interroger leur nature. Et sa réponse est sans appel : le couple (surtout Maurice, qui tenait la caméra pendant que Katia photographiait) était des cinéastes, et sa production est comme un film sans début ni fin, fait de plans prodigieux, que chaque imagination peut agencer.
On connaît les moteurs de celle de Werner Herzog : sa fascination pour les moments ultimes à l’approche de la mort, sa conscience aiguë de l’insignifiance de l’homme face au cosmos. [Il montre] une admiration inconditionnelle pour Katia et Maurice Krafft, qui ont toujours travaillé avec une conscience aiguë des risques qu’ils prenaient. Il remonte leurs images – les éruptions, mais aussi la désolation que les volcans répandent parmi les hommes – pour composer un poème qui laisse entière l’énigme que pose aux gens ordinaires le destin des vulcanologues alsaciens. »
Le Monde évoque un autre documentaire récent sur le même sujet que je n’ai pas vu
« Par une heureuse coïncidence, on pourra, sinon la résoudre, du moins avancer vers la solution, en découvrant Fire of Love, le très délicat documentaire que l’Américaine Sara Dosa a composé à partir du même matériau que Herzog, les images tournées et prises par le couple Krafft. La réalisatrice s’attache à superposer la passion amoureuse de Katia et Maurice Krafft (on pourrait presque croire que pour eux, l’humanité se résumait à leur couple) et leur passion pour les volcans, au point que la conclusion de leur odyssée tellurique, point d’orgue d’une tragédie chez Herzog, apparaît ici comme la culmination de l’intimité fusionnelle entre Maurice, Katia et les volcans. »
En conclusion des images uniques de beauté et de violence.

Quand on voit ces images, on se rend compte que lorsque la nature et la terre déclenchent de telles forces telluriques, homo sapiens redevient un animal fragile dont la seule issue est la fuite si elle reste possible.
<1716>
- 1972 : Aguirre, la colère de Dieu
-
Vendredi 23 septembre 2022
« L’automne débute aujourd’hui. »Cette année, comme le plus souvent, l’automne débute le 23 septembreMoi je croyais que le plus souvent l’automne tombait le 21 septembre.
Nous savons que le jour de l’automne est celui où la durée du jour et la durée de la nuit sont égales.
Ce moment a lieu entre le 21 et le 24 septembre, mais le 21 septembre est très rare.
Sur ce <site> qui donne la date des quatre saisons entre 1970 et 2037, soit 68 automnes, ce ne fut jamais le 21 septembre, ni le 24 d’ailleurs.
25 fois cela tomba un 22 et 43 fois, comme cette année, le 23 septembre.
<Le Figaro> nous apprend que la prochaine fois que l’équinoxe d’automne aura lieu un 21 septembre sera en… 2092 !
<Ce site belge> affirme que l’automne ne serait jamais tombé un 21 septembre depuis l’instauration du calendrier grégorien qui a été mis en place progressivement à partir de 1582.
Je ne sais pas pourquoi, l’idée que l’automne débute le 21 septembre s’est répandue.
Le Figaro non plus :
« Contrairement à une idée reçue, les saisons ne débutent pas toutes les 21 du mois. Pour l’automne, c’est même plutôt une chose rare […] »
Et le journal explique :
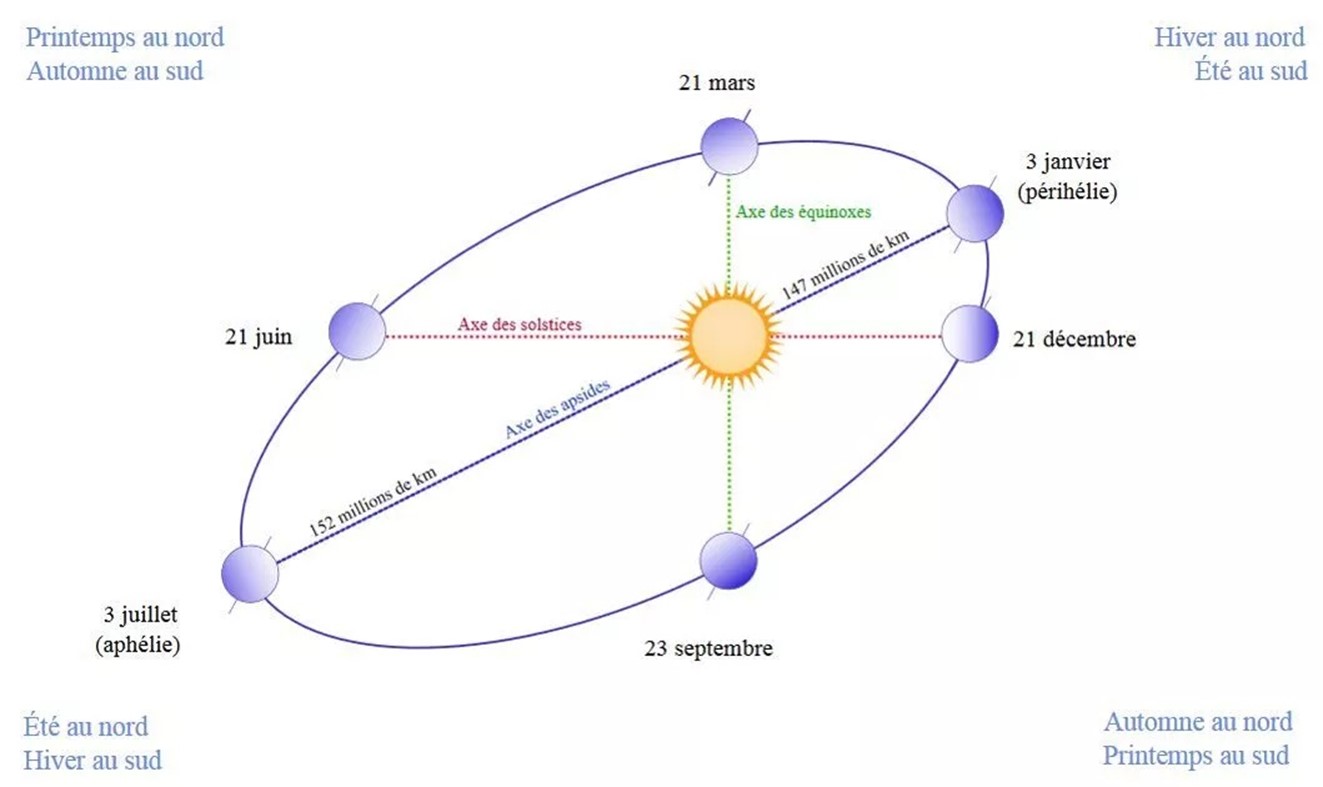 « Chaque année, le début de l’automne commence au moment exact de l’équinoxe d’automne, quand la ligne qui marque la limite entre le jour et la nuit à la surface de la planète passe par les deux pôles. La durée du jour y est donc égale à la durée de la nuit, partout sur Terre. Et en conséquence, lors de l’équinoxe, le soleil se lève exactement à l’est et se couche exactement à l’ouest.
« Chaque année, le début de l’automne commence au moment exact de l’équinoxe d’automne, quand la ligne qui marque la limite entre le jour et la nuit à la surface de la planète passe par les deux pôles. La durée du jour y est donc égale à la durée de la nuit, partout sur Terre. Et en conséquence, lors de l’équinoxe, le soleil se lève exactement à l’est et se couche exactement à l’ouest.
Mais pourquoi cet équinoxe ne tombe-t-il pas le même jour chaque année ?
Premier paramètre, l’année peut durer 365 jours, ou 366 quand elle est bissextile. Cette variation entraîne donc un décalage dans les dates des saisons. »
L’année correspond à la révolution de la Terre autour du Soleil qui s’effectue précisément en 365 jours 5h48 minutes et 45 secondes.
« Le deuxième paramètre, c’est que la Terre ne décrit pas une orbite parfaitement circulaire autour de son étoile. Si c’était le cas, les saisons seraient de durées égales, et leur début pourrait se caler plus régulièrement sur le calendrier grégorien, qui a justement été conçu pour éviter que ces dates ne se décalent dans le temps.
Mais voilà, l’orbite terrestre est un tout petit peu excentrique : ce n’est pas un cercle, mais une ellipse très légèrement allongée, avec une distance Terre-Soleil qui varie entre 147 et 152 millions de kilomètres. »
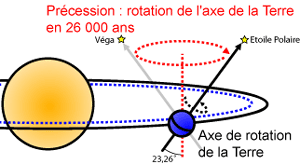 Et le site belge apporte encore un troisième paramètre appelé « la précession des équinoxes. » ce qui signifie que la rotation de la Terre sur elle-même n’est pas parfaitement circulaire. En réalité, notre planète décrit un cône tous les 26 000 ans.
Et le site belge apporte encore un troisième paramètre appelé « la précession des équinoxes. » ce qui signifie que la rotation de la Terre sur elle-même n’est pas parfaitement circulaire. En réalité, notre planète décrit un cône tous les 26 000 ans.
Cette année la date d’entrée de l’automne a intéressé beaucoup de monde. Ainsi sur France Culture, Guillaume Erner a invité Florent Deleflie, astronome à l’Observatoire de Paris- PSL, chercheur à l’Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides, le 21 septembre pour expliquer que la saison des « sanglots longs des violons… » commencerait 2 jours plus tard.
< Pourquoi le début de l’automne ne commence-t-il jamais à la même date ?>
Florent Deleflie a précisé que l’équinoxe d’automne qui marque le début de la saison automnale tombe cette année « le 23 septembre et pour ce qui concerne la France à 3h, 3 minutes du matin et 43,51 secondes », d’après l’astronome à l’Observatoire de Paris.
Il s’git donc d’une position précise par rapport au soleil.
Selon <Geo> :
« Durant l’équinoxe, les deux hémisphères sont éclairés de la même façon, car le soleil est pile à la verticale au-dessus de l’équateur : en astronomie, il est dit que notre astre passe au Zénith, point d’intersection entre la verticale de l’équateur et la sphère céleste. »
Cet article donne aussi des éléments sur les éléments symboliques de l’Automne
« Le passage à l’automne est associé à des traditions et rites dans de nombreuses cultures à travers le monde. Moment de collecter une grande partie des récoltes avant les gelées de l’hiver, il a longtemps été célébré par les païens. Le « Mabon » nom celtique associé à cet équinoxe, s’accompagnait ainsi de festivités de gratitude. En Grande-Bretagne, c’est ce qui est appelé le « Harvest festival » habituellement fêté le dimanche de la pleine lune la plus proche de l’événement astronomique, mais la date diffère selon les célébrations locales.
Durant les équinoxes d’automne et de printemps, des milliers de voyageurs se rassemblent par ailleurs sur les ruines mayas de Chichén Itzá (Yucatán, Mexique). Car sur la pyramide de Kukulcán à cette période exacte, un jeu d’ombre et de lumière se crée : il laisse apparaître un serpent, descendant ou montant les 364 marches de l’escalier (365 avec l’entrée du temple) que forme le monument.
Aussi, le calendrier républicain mis en place le 6 octobre 1793 par les révolutionnaires (et utilisé jusqu’en 1805) avait fixé l’équinoxe d’automne comme premier jour de l’année. Car hasard du sort, l’institution de la République avait eu lieu ce jour même, le 22 septembre 1792 — ou plutôt, le 1er vendémiaire an I — au lendemain de l’abolition de la royauté. Mais il est supprimé par Napoléon Ier à son arrivée au pouvoir, qui revient au calendrier grégorien. ».
 Ce début d’automne correspond pour nous à une semaine de repos.
Ce début d’automne correspond pour nous à une semaine de repos.
Le mot du jour devrait revenir le 3 octobre.
<1715>
-
Jeudi 22 septembre 2022
« L’inceste n’est pas tabou, c’est le fait d’en parler qui est tabou. »Iris BreyL’inceste est un phénomène massif dans notre Société.
Ce n’est que récemment que cette réalité a été dévoilée et que les personnes intègres qui veulent savoir, le savent.
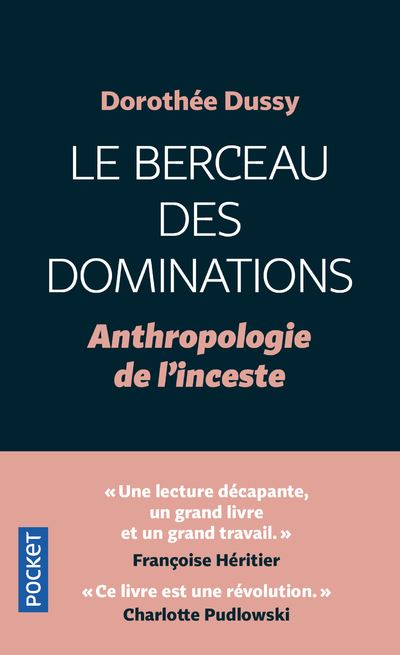 A la sortie du livre de Camille Kouchner, j’avais commis une série de mots du jour du <15 février 2021> jusqu’au <24 février 2021> avec au centre de cette série, le livre de Dorothée Dussy « Le berceau des dominations » qui vient enfin d’être rééditer.
A la sortie du livre de Camille Kouchner, j’avais commis une série de mots du jour du <15 février 2021> jusqu’au <24 février 2021> avec au centre de cette série, le livre de Dorothée Dussy « Le berceau des dominations » qui vient enfin d’être rééditer.
Ce livre fut une révélation pour beaucoup.
Le 23 janvier 2021, le président de la République a annoncé la création d’une commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise)
Rapidement cette Commission lançait un vaste appel à témoignages.
Elle a reçu 6 414 témoignages reçus, elle vient de dresser le bilan des lourdes séquelles que présentent, encore à l’âge adulte, celles et ceux qui ont été victimes de violences sexuelles durant l’enfance.
Un traumatisme qui continue d’affecter leur santé physique et mentale, ainsi que leur vie familiale, sexuelle et professionnelle. Le rapport livre également de nombreux chiffres sur le profil des victimes.
On apprend que dans 25% des cas, les victimes avaient moins de 5 ans
Dans l’immense majorité des cas (81%), l’agresseur est un membre de la famille : père, grand-frère, demi-frère, grand-père, cousin, oncle, beau-père
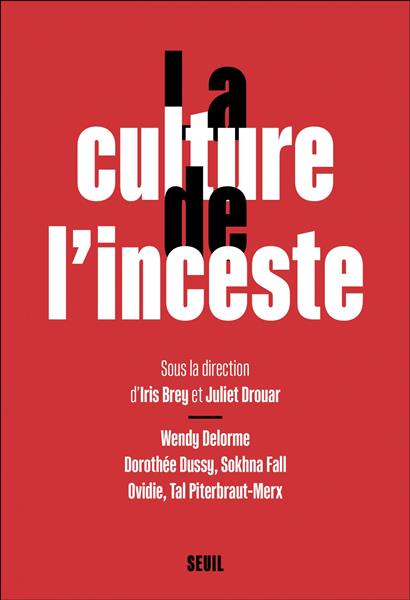 Un ouvrage collectif <La culture de l’Inceste> vient de paraître.
Un ouvrage collectif <La culture de l’Inceste> vient de paraître.
Sonia Devilliers, dans son émission : <L’invité de 9h10> avait invité Iris Brey et Juliet Drouar qui codirigeaient l’écriture de ce livre écrit par 14 thérapeutes, universitaires et militantes.
Annie et moi avons été si marqué par cette émission que nous avons immédiatement acheté ce livre. C’est Annie qui a commencé à le lire et le trouve remarquable.
Dans cette émission Iris Brey rappelle que Claude Levi-Strauss affirmait que l’inceste constituait un interdit, un tabou.
Ce que ce grand homme disait était faux, totalement, radicalement faux.
Ce qui est interdit c’est le mariage incestueux, c’est le mariage qui est un évènement public qui oblige à l’alliance de deux familles différentes, c’est-à-dire pratiquer l’exogamie et non l’endogamie.
D’ailleurs Claude Levi-Strauss abordait cette question par le prisme des alliances entre familles , alors que Dorothée Dussy et les personnes qui étudient l’inceste aujourd’hui analyse ce crime sous le projecteur des violences sexuelles.
Mais la relation sexuelle incestueuse, à l’intérieur de la famille, est tellement massive : 7 millions de victimes en France, que dire que cette pratique constitue un interdit, un tabou est un mensonge.
Et Iris Brey a eu cette phrase qui révèle la vérité :
« L’inceste n’est pas tabou, c’est le fait d’en parler qui est tabou »
C’est ce qu’éclaire parfaitement le témoignage que vient de publier « L’Obs » le 21 septembre 2022 : « La libération de la parole et la résilience sont, à mon sens, de grandes arnaques »
L’Obs a changé le nom de la victime et l’a appelé Nina. Nina s’est exprimée en mai, devant la Ciivise et c’est après cette intervention que l’Obs l’a rencontrée.
Nina a 42 ans, elle a été victime d’inceste.
Voilà ce qu’elle a dit à l’Obs :
« J’ai été victime d’inceste et j’ai parlé. En février dernier, quelques semaines après avoir assisté à une première réunion publique de la Ciivise à Paris, j’ai parlé pour la première fois à ma famille.
En révélant l’inceste toujours tu, je l’ai simplement perdue. Ma famille a disparu.
Au-delà des seuls agresseurs, les réactions de mes proches ont été les mêmes : déni, menaces de suicide, chantage affectif : « Tu te rends compte de ce que tu nous fais ? » Sans compter l’invitation « à passer à autre chose »…
Comment faire famille avec eux désormais ?
Comment gérer cet isolement et cette douleur supplémentaires ?
Une seconde rencontre de la Ciivise était prévue à Paris en mai. J’y suis retournée, et cette fois, parce qu’il en allait de ma survie je crois, j’ai pris le micro pour témoigner tout haut.
J’ai dit ce qui arrive quand, comme moi, on révèle l’inceste à 42 ans. J’ai dit les quarante ans de silence, l’amnésie traumatique, l’angoisse, les difficultés relationnelles…
J’ai dit la déflagration, l’empêchement de vivre vraiment.
A la manière d’une rescapée de guerre ayant déserté un terrain miné, j’ai rejoint ce soir-là, en réalité, tant d’autres gueules cassées, tant de femmes formidables devenues depuis des alliées.
Elles m’ont dit les réactions de leurs proches, identiques à celles des miens quel que soit leur milieu social.
Les mêmes mots de nos mères et de nos frères nous reprochant d’avoir « détruit la famille », « regrettant notre absence » à telle ou telle fête de famille…
Je ne suis plus dans la solitude de l’enfant incesté qui se tait. J’ai trouvé des alter ego.
Nous nous comprenons dans notre chair, dans nos histoires, nos souvenirs traumatiques et leurs manifestations incongrues et implacables.
Le simple bruit d’une porte de frigo qu’on referme, un parfum… et tout peut ressurgir. […]
J’ai dit aussi ma frustration et mon ire. Parce qu’au fil des ans, je suis devenue cette victime résiliente tant souhaitée par moi-même dans un premier temps, et par l’ensemble de la société.
Et j’en ressens à présent une grande insatisfaction et une colère immense.
La libération de la parole et la résilience sont, à mon sens, de grandes arnaques.
Une parole qui se libère ? Pour quoi faire si elle retombe comme un caillou qui ricoche sur la surface plane d’une eau limpide sans laisser la moindre trace ? On parle encore et encore, nos paroles s’entremêlent, et puis quoi ? Rien. C’est un désastre. Comme je l’ai dit ce soir-là à la Ciivise, cela me fait penser à un charnier de victimes qui se débattent avec leurs paroles et, en surplomb, les agresseurs, la société, la justice et l’Etat qui nous regardent tentant de sauver notre peau, notre santé mentale, notre intégrité. Quant à la résilience, elle ne doit pas et ne peut pas suffire à laver les agresseurs de leurs crimes sexuels. Ce serait trop simple. […]
Que se passe-t-il pour une victime d’inceste une fois qu’elle a parlé ? Depuis ma prise de parole, non suivie d’une action en justice pour ma part, il ne s’est rien passé. J’ai cherché un nouveau thérapeute. Un psychiatre de 70 ans a évoqué mon narcissisme et mon sentiment de culpabilité, m’invitant à m’engager dans un long processus thérapeutique et balayant littéralement d’un revers de la main l’inceste dont j’ai été victime. Pour lui, ce n’était qu’un détail. Pour la première fois de ma vie, je me suis opposée à un professionnel de santé et j’ai pointé du doigt son incompétence et affirmé mon refus de me soumettre à une cure psychanalytique longue, onéreuse et inadaptée, dans laquelle la domination se (re) joue encore et encore, à plusieurs endroits.
Je n’ai plus besoin de cela, j’ai besoin d’autre chose. Mais de quoi ?
[…] Le tabou est tel que tout est incomplet ou inexistant : la réponse de la justice, la réponse de la société, la réponse politique.
Il y a quelques jours, un ouvrage majeur a paru. « La Culture de l’inceste », coordonné par l’autrice Iris Brey et l’art-thérapeute Juliet Drouar.
Sa lecture, qui m’a donné le vertige, me hante et m’accompagne. L’essai me répète que mon parcours individuel n’a rien de honteux ni de singulier, que mon histoire est au cœur d’un système patriarcal bien rodé qui promeut et permet l’inceste.
L’anthropologue Dorothée Dussy y explique aussi que l’inceste structure la société, qu’il est le socle des dominations patriarcales. A défaut de justice, nous cherchons collectivement du sens et des réponses. A défaut de tout ce qui n’existe pas encore.
[…] On souffre aujourd’hui toujours de l’inceste. On en meurt aussi. Depuis le début de l’année, la mort rôde dans le « grand club des victimes résilientes » que j’ai intégré. Une amie m’évoque le suicide de la fille d’un ami, cet été, violée par son oncle. Une autre, violée toute son enfance par son frère, se confronte à nouveau à ses souvenirs traumatiques et me confie aussi son envie de mourir. L’acteur Johann Cuny, sur les réseaux sociaux, témoigne lui aussi du suicide de sa sœur Adèle, victime d’inceste à 7 ans.
Combien d’autres ? Depuis que j’ai libéré ma parole, je vois et je relève désormais l’impact des violences sexuelles commises dans l’enfance, dans la chair, le psychisme, durant toute une vie.[…]
J’ai été victime d’inceste et j’ai parlé. Mais le silence revient toujours, sans un bruit, recouvrir l’inceste.
C’est un linceul déployé sur chacun de nos témoignages, aussi puissants soient-ils.
Un linceul crasse jeté simultanément sur des milliers d’enfants qui ne seront pas protégés cette nuit du ou des membres de leur famille, incesteur(s), agresseur sexuel dominant, dont l’autorité fait foi.
Qu’attendons-nous pour agir ? »
Oui vraiment ce qui était tabou c’était d’en parler.
Et aujourd’hui encore le déni est la réponse la plus fréquente et non l’écoute et l’accueil bienveillante de la parole, comme le montre ce témoignage !
A voir aussi cette émission de Mediapart <L’inceste est partout> avec Iris Brey, Juliet Drouar et Dorothée Dussy. La basketteuse Paoline Ekambi est aussi venue apporter son témoignage.
<1714>
-
Mercredi 21 septembre 2022
« En général, les choses doivent avoir des limites. »Tamim ben Hamad Al Thani, émir du QatarLe mot du jour de vendredi dernier mettait l’accent sur la nécessité d’écouter.
On cite souvent Goethe :
« Parler est un besoin, écouter est un art ! »
Hier, le mot du jour fut une attaque frontale contre le Qatar, alors il faut donc être en mesure d’écouter la parole de la défense.
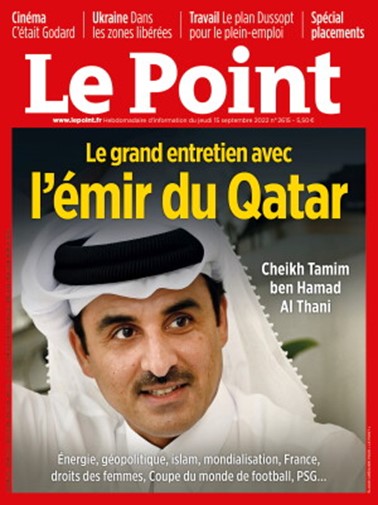 Et c’est une grande chance, le magazine « Le POINT » est allé opportunément, 2 mois avant l’ouverture de la coupe du Monde, interviewer l’émir du Qatar à Doha et publie un très long entretien avec le souverain du Qatar dans son numéro 2615 du jeudi 22 septembre 2022. : <Le grand entretien avec l’émir du Qatar>
Et c’est une grande chance, le magazine « Le POINT » est allé opportunément, 2 mois avant l’ouverture de la coupe du Monde, interviewer l’émir du Qatar à Doha et publie un très long entretien avec le souverain du Qatar dans son numéro 2615 du jeudi 22 septembre 2022. : <Le grand entretien avec l’émir du Qatar>
Le Point a dépêché à Doha deux de ses journalistes les plus chevronnés : Luc de Barochez et Ėtienne Gernelle
Ils le décrivent comme un homme discret et plein d’attentions à leur égard.
Les journalistes sont tout esbaudis quand ils constatent que pour la visite qu’on leur a promis, le chauffeur qui se fait aussi guide est tout simplement l’Émir lui-même.
Il ne se livre pas souvent au Media puisque l’article nous apprend que
« Il n’a donné que deux interviews formelles depuis qu’il a succédé à son père, en 2013 : la première à CNN, en 2014, la seconde à CBS, en 2017. Plus quelques citations accordées au New York Times. Il s’agit donc du premier véritable entretien accordé à la presse écrite, et de sa première prise de parole en Europe. »
Mais quand il ouvre sa porte au Point, il sort le grand jeu.
Tamim ben Hamad Al Thani, a 42 ans, et il règne sur le Qatar depuis le 25 juin 2013, après l’abdication de son père, Hamad ben Khalifa Al Thani.
Après cette visite qu’il offre à ses hôtes et dans laquelle il leur démontre combien il est à l’aise avec son peuple, commence l’entretien proprement dit.
Dans l’entretien nous apprenons que manifestement, il est un homme de paix bien que son pays soit menacé par son puissant voisin l’Arabie Saoudite qui, de 2017 à 2021, a organisé un blocus du pays avec pour objectif annoncé de le renverser. En outre, la fortune du Qatar provient surtout de l’immense réserve gazière, la troisième au monde, mais qu’il doit partager avec l’Iran qui est chiite alors que le Qatar est sunnite.
Ainsi parle Tamim ben Hamad Al Thani :
« Notre politique étrangère au Qatar vise à rapprocher les différents points de vue, à apporter notre aide à toutes les parties qui en ont besoin, et à jouer un rôle de facilitateur, dans la région et ailleurs. Le monde a besoin de dialogue pour résoudre ses problèmes. »
« Nous ne souhaitons pas voir le monde polarisé entre deux superpuissances ; ce serait très dangereux. […] Notre pays est un allié majeur de l’Amérique et de l’Occident en général, mais notre principal importateur de gaz naturel liquéfié est la Chine. Nous ne pouvons que constater qu’il y a de grandes divergences entre eux, mais nous espérons que les tensions pourront s’apaiser par les voies diplomatique et pacifique. »
« Cela s’inscrit dans notre politique : rapprocher les parties qui ont des divergences. En ce qui concerne les talibans, nous l’avons fait à la demande de nos amis américains […] Notre devoir et notre intérêt sont de tout faire pour rapprocher les parties et les engager à négocier un règlement pacifique. Nous ne nous imposons aucune limite dans le choix de nos interlocuteurs, pour autant qu’ils croient en la coexistence pacifique. »
« Nous voulons aider et donner espoir à la jeunesse moyen-orientale. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter la paix à la région. »
« Pour que tout le monde y trouve son compte, il faut une coopération mondiale. Je ne veux pas que la mondialisation s’arrête, et je ne pense pas que ce sera le cas. Certains prétendent qu’un retour en arrière rendrait la vie plus facile. Ce n’est pas vrai. Parler et arriver aux responsabilités, ce n’est pas la même chose… Cela ne peut pas marcher. Le monde entier est intégré. Puisque nous sommes tous interconnectés, nous devons travailler ensemble et résoudre nos problèmes ensemble. »
Et même quand les journalistes l’interrogent sur l’Arabie Saoudite qui a tenté de le renverser par un blocus, il répond :
« Écoutez, je ne souhaite pas parler du passé. Nous voulons nous tourner vers l’avenir. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase, les choses bougent dans le bon sens. Nous reconnaissons que, parfois, nous sommes en désaccord. Nous préparons l’avenir de cet ensemble de pays, le Conseil de coopération du Golfe [le CCG, qui regroupe les six monarchies de la Péninsule arabique, NDLR], qui est essentiel pour débloquer le potentiel des jeunes dans l’ensemble de la région. »
Et sur son autre voisin, fervent de l’autre branche principale de l’Islam : l’Iran
« Vous mentionnez l’Iran. Ce pays est très important pour nous. Nous avons une relation historique et, de surcroît, nous partageons avec lui notre principal champ gazier. Nous encourageons tous les États membres du CCG et l’Iran à se parler. Il y a bien sûr des divergences – tout le monde en a –, mais il faut s’asseoir autour d’une table et en parler, directement entre nous et les Iraniens, sans ingérence extérieure. »
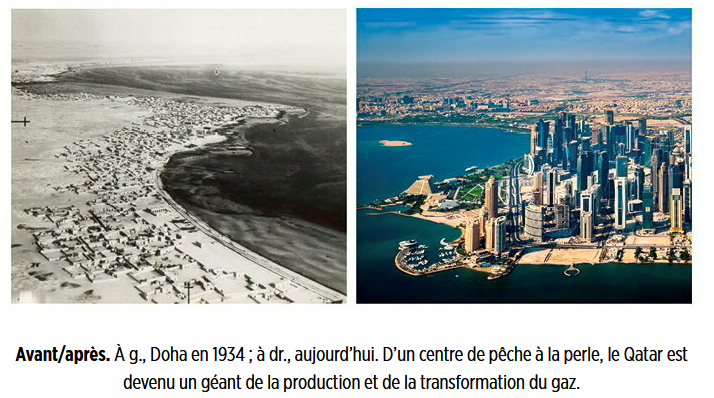 En même temps vu la petite superficie de son territoire, le nombre restreint de ses nationaux : 2,8 millions d’habitants dont 80 % d’étrangers, le Qatar ne peut pas se permettre d’être belliqueux et doit s’appuyer sur sa capacité diplomatique et c’est ce qu’il fait.
En même temps vu la petite superficie de son territoire, le nombre restreint de ses nationaux : 2,8 millions d’habitants dont 80 % d’étrangers, le Qatar ne peut pas se permettre d’être belliqueux et doit s’appuyer sur sa capacité diplomatique et c’est ce qu’il fait.
Une autre de ses qualités, c’est qu’il mise sur l’éducation :
« L’éducation est essentielle, surtout dans un pays qui jouit de ressources naturelles. […] Nous devons surtout investir dans nous-mêmes, dans le capital humain. Qu’on soit riche ou pauvre, l’éducation est la clé. Nous développons nos écoles et nos universités, nous avons invité des universités et des grandes écoles américaines et européennes à s’installer ici. »
Et enfin il est lucide sur les difficultés des peuples et des dirigeants arabes mais le Qatar fait sa part pour que la situation s’améliore :
« Les racines profondes du Printemps arabe sont hélas toujours là ! La pauvreté, le chômage, les diplômés sans emploi… Avons-nous résolu ces problèmes ? Non, au contraire, ils ont empiré ! Si nous ne les traitons pas, les événements qu’ils ont provoqués pourront se répéter. À mon avis, la meilleure façon de prévenir les turbulences à l’avenir est de mettre en œuvre des réformes, de manière graduelle. Nous devons donner de vrais espoirs aux populations, et pas seulement en paroles. Le Qatar avait promis d’éduquer 10 millions d’enfants non scolarisés et nous avons surpassé cette promesse : nous atteindrons bientôt 15 millions d’enfants dans le primaire. Nous devons également leur fournir des emplois, des opportunités, mais aussi les laisser exprimer leurs opinions et leurs différences. Le Qatar a mis en place des programmes pour aider à former plus de 2 millions de jeunes dans le monde arabe et leur donner des opportunités d’emploi. Par exemple, nous avons une expérience unique en Tunisie, où nous aidons des gens à lancer leur entreprise. Des dizaines de milliers de jeunes bénéficient de ce projet. »
Après toutes ces belles réponses, il est légitime de se poser la question s’il reste raisonnable de critiquer autant le Qatar ?
Mais ces journalistes ont-ils posé les questions embarrassantes ?
Oui… un peu
Ils ont rappelé que le Qatar est accusé de protéger les frères musulmans, ce mouvement islamique radical né en Égypte qui au-delà de la dimension religieuse veut aussi s’emparer du pouvoir politique.
L’émir nie tout simplement :
« De tels liens n’existent pas. Il n’y a pas, ici au Qatar, de membres actifs des Frères musulmans ou d’organisations leur appartenant. »
Ils se sont aussi intéressés à sa vision sur le rôle et la place des femmes dans la société :
« D’abord, devant Dieu, nous sommes tous égaux, hommes ou femmes. Le rôle des femmes est vital dans notre société. Au Qatar, leurs performances à l’université sont supérieures à celles des hommes. Elles représentent 63 % des étudiants. Dans la population active, c’est à peu près 50-50. Au sein de notre gouvernement, nous avons trois femmes ministres. Elles y font un travail formidable. Nous avons même des femmes pilotes dans notre armée de l’air. Nous ne voyons pas de différences avec les hommes. Bien sûr, nous sommes conscients qu’elles sont victimes de discriminations dans le monde, mais nous y sommes totalement opposés. »
Dans une société où elles sont contraintes de porter le voile, il affirme être conscient qu’elles « sont victimes de discrimination dans le monde. » Dans le monde, peut-être, mais au Qatar, non.
Et la liberté d’expression :
« Je crois personnellement à la liberté d’expression. Elle doit être protégée. Mais si cette expression conduit, de manière intentionnelle, à des problèmes ou à des conflits dans le domaine culturel ou religieux, est-il vraiment nécessaire de le dire ? Je ne parle pas ici de quelqu’un qui critiquerait un ministre ou un haut responsable, cela ne me pose aucun problème. Mais, dans des domaines où l’on sait que cela va créer des problèmes, il faut être très prudent. Chacun a le droit de s’exprimer mais, quoi que nous disions, nous devons éviter de blesser des gens issus de cultures, de religions ou de milieux différents. En général, les choses doivent avoir des limites. »
Sur ce point, nous le sentons un peu réticent. La liberté d’expression c’est très bien, mais les limites à la liberté d’expression lui semblent tout aussi important.
Mais ont-ils parlé des morts sur les chantiers, du droit de travail, de la climatisation des stades, de la cause des LGBT.
Rien sur ce dernier point
Sur les deux autres :
- Les conditions de travail :
« Il y a deux sortes de critiques. La plupart du temps, nous y voyons un conseil ou une alerte, et nous les prenons au sérieux. Ainsi, nous avons compris que nous avions un problème avec le travail sur les chantiers, et nous avons pris des mesures fortes en un temps record. Nous avons modifié la loi et nous punissons quiconque maltraite un employé ; nous avons ouvert nos portes aux ONG et nous coopérons avec elles. Nous en sommes fiers. Et puis il y a la seconde catégorie de critiques, celles qui se poursuivent quoi que nous fassions. Ce sont des gens qui n’acceptent pas qu’un pays arabe musulman comme le Qatar accueille la Coupe du monde. Ceux-là trouveront n’importe quel prétexte pour nous dénigrer. »
Le nombre de morts n’a pas été évoqué ni la controverse entre le Guardian (6500 morts) et la communication officielle du Qatar (37).
- La climatisation
« Je pense que chaque pays devrait avoir la chance d’organiser des événements sportifs mais, parfois, le climat peut être un obstacle. Nous avons utilisé les technologies de pointe pour minimiser la consommation d’eau et d’énergie pendant la Coupe du monde, afin d’en faire un événement plus durable. »
Voici ce long droit de réponse que Le Point a accordé à l’Émir du Qatar.
Le magazine « Marianne » s’est étonné de ce long entretien, sans aspérité, présentant un homme modéré, sage et recherchant toujours le consensus : < Quand l’hebdomadaire « Le Point » fait la promo de l’Émir du Qatar>
« Dans sa dernière livraison, le Point annonce en couverture une interview fleuve du Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir du Qatar, avec photo de l’impétrant à l’appui. Pour cet exercice, l’hebdomadaire a délégué dans le pays hôte du Mondial de foot son directeur de la rédaction, Étienne Gernelle et Luc de Barochez, deux attaquants réputés de la maison, célèbres pour leur capacité à se jouer des défenses adverses. On s’attendait donc à voir l’Émir cerné, poussé dans ses retranchements, mis face à ses contradictions, sommé de s’expliquer, […] Rien de tel. En fait, le lecteur du Point risque de se retrouver dans la peau du supporter du PSG, propriété du Qatar, après une défaite de son équipe fétiche. Aucune question gênante. Pas de relance après une réponse lénifiante. L’Émir enfile les formules creuses comme d’autres enfilent les perles sans que jamais le duo d’intervieweurs ne daigne rompre l’atmosphère de complicité bienveillante qui sied à ce genre d’exercice »
Et Marianne finit par cette réplique digne d’Audiard :
« Bref, c’est un homme ordinaire, bien sous tous rapports, un grand humaniste méconnu, un modèle d’ « humilité », comme le confient Étienne Gernelle et Luc de Barochez, à qui l’impétrant confie cet ultime conseil : « L’éducation commence par des choses simples : faire son lit le matin, par exemple. » Nul ne sait si les deux intervieweurs du Point font leur lit, mais ils ont administré la preuve éclatante qu’ils savent se coucher. »
<1713>
- Les conditions de travail :
-
Mardi 20 septembre 2022
« Ne pas voir le problème ou ne pas voir la Coupe du monde. »Jérome LattaAujourd’hui, je vais faire un pas de côté par rapport au choc des civilisations, quoique…
Le football a été inventé, en Angleterre, en Occident donc.
Un pays, appartenant à une autre civilisation et se trouvant près d’un désert très chaud, a trouvé ce sport très à son goût.
Comme il était particulièrement riche, il a investi et investi dans ce sport qui n’avait pas été créé pour lui et qu’il n’est pas facile de pratiquer chez lui car il y fait trop chaud.
Alors …
Alors, avec de l’argent on peut faire tant de choses et le 20 novembre va s’ouvrir la coupe du monde au Qatar, dans deux mois
Une amie Facebook a partagé un texte d’un internaute qui a pour nom Bouffanges Bfg
J’ai appris qu’il était écrivain.
Il a écrit ce texte en l’accompagnant de cette photo :
 « Au début, tu sais, il n’y eut guère plus qu’une indignation molle, de celles que l’on exprime face aux tracas subalternes de la vie.
« Au début, tu sais, il n’y eut guère plus qu’une indignation molle, de celles que l’on exprime face aux tracas subalternes de la vie.
Quand le Qatar se vit attribuer l’organisation de la Coupe du Monde, nous étions en 2010.
C’était il y a une éternité !
Certes, le Qatar n’enthousiasmait pas les plus démocrates d’entre nous ; mais somme toute, nous venions d’organiser des JO d’été à Pékin, nous allions organiser des JO d’hiver en Russie et, dans la lancée, nous retournerions en Chine.
Et puis, tiens, on ferait même une Coupe du Monde en Russie, histoire de boucler la boucle.
Alors bon…. Ce n’était guère plus que la routine, un menu nid-de-poule sur l’autoroute de la modernité.Peu après, quelques voix se sont élevées pour soupçonner que certains membres de la FIFA auraient perçu des « encouragements » à voter intelligemment.
Certains, du bout des lèvres, allaient jusqu’à appeler ça corruption.
L’affaire fit tant de clapotis que certaines têtes furent coupées.
Mais que faire de plus ? Remettre en cause le résultat des votes ? Après tout, c’était le Qatar, on ne pouvait pas vraiment s’attendre à ce qu’ils n’achetassent pas ce qui peut s’acheter.
D’ailleurs, entre temps, ils s’étaient offert le PSG [en mai 2011] avec des arguments sonnants et trébuchants, ce qui offrait enfin l’espoir que le plus grand club de France cesse de trébucher et de se faire sonner en Ligue des Champions.
Alors bon…Ce n’était guère plus que la routine, un menu flash de radar sur l’autoroute de la mondialisation.Évidemment, ensuite, il fallut construire les infrastructures.
Et les immenses stades nécessaires à la grand-messe du foute, ça ne pousse pas en arrosant le sable.
Il y avait urgence, alors comme nous l’enseigne infailliblement l’Histoire, quand il s’agit de construire vite et grand, rien de mieux que l’esclavage.
Oh ! L’esclavage ! Tout de suite les grands mots ! Peut-être ces travailleurs étaient-ils de humbles héraults tout entiers dévoués à la cause du foutebale ?
D’ailleurs, les quelques moutons noirs cupides qui osèrent réclamer une paie furent renvoyés à domicile avec la plus stricte des fermetés.
Mais entre le Guardian, qui recense un minimum de 6500 morts, et l’appareil officiel du Qatar, qui en dénombre 37, qui détient la vérité ? Alors bon…
Ce n’était guère plus que la routine, un petit bouchon sur l’autoroute de la civilisation.Là où ça a commencé à coincer un peu aux entournures (et au col, aussi), c’est quand on s’est aperçu que le Qatar était islamique.
On n’avait pas vraiment conscience de cela, avant.
Rapport au fait que le Qatar semblait vouloir ressembler aux plus belles démocraties occidentales, à grands coups d’architecture ambitieuse et de pétrodollars (pardon, de riyals).
Mais après 2010, il y eut 2015 et le grand festival des attentats.
Charlie Hebdo, Bataclan.
Et après 2015, il y eut 2016 : Bruxelles, Nice.
Puis 2017, 2018, et plein d’autres nombres en 201…Et chaque année apportait son lot d’attentats islamistes, en France ou ailleurs.
Et l’idée d’une Coupe du Monde en terre d’islam radical est devenue moins rock’n roll.
Le Qatar ne semblait pas parti pour être le prochain Woodstock.
Cela dit, le Qatar se défendait d’être islamiste.
Islamique seulement.
Islam ferme, résolu, mais certainement pas radical.
D’ailleurs, à la différence de l’Arabie Saoudite voisine, qui décapite comme d’autres prennent leur café le matin (81 en une seule journée en 2022, dans un accès de ferveur dévote), le Qatar n’exécute plus personne depuis bien longtemps.
À part en 2021, mais il s’agissait d’un Népalais.
Alors bon. ….
Ce n’était guère plus que la routine, un petit vomi sur le bord de l’autoroute de l’œcuménisme.Pour beaucoup, la problématique s’est concrétisée tardivement, au début de l’été.
On s’est rendu compte de ce qu’islamique voulait dire lorsque le Qatar a fait savoir qu’une certaine tolérance serait de mise pendant la Coupe du Monde en ce qui concerne la loi locale sur les relations hors mariage.
En temps habituels, toute relation hors mariage, ou pire adultérine, ou pire homosexuelle, ou pire sodomite, était passible de peine de mort, ou a minima de coups de fouets et d’emprisonnement.
Bizarrement, le monde n’a pas forcément ressenti cette précision comme une preuve de la grande tolérance du Qatar.
Mais bon…
Ce n’était guère plus que la rout…
Enfin bref, là oui, on commençait à sentir un peu que l’autoroute avait deux trois malfaçons dans l’enrobé.
Et enfin, pour la plupart, la prise de conscience est survenue après l’été 2022.
On sortait de la plus longue canicule de l’histoire moderne, on n’avait plus d’eau depuis des semaines, des pays entiers étaient sous les eaux, la guerre en Ukraine provoquait une flambée des prix de l’énergie et laissait augurer un hiver bas en couleurs.
Soudain, les images de ces immenses stades perdus au milieu du désert, tempérés par des batteries de climatiseurs grands comme des réacteurs de Boeing 737, sont apparues comme un signe frappant de décalage temporel.
On ne pouvait plus prétendre que ce n’était rien, que c’était comme ça.Voilà, maintenant tu sais comment, en douze années de temps, la Coupe du Monde au Qatar, avec ses stades bâtis sur des ossuaires, est devenue le symbole de la corruption, de l’atteinte aux droits humains, du dédain face à la catastrophe climatique, tout ça pour le plaisir de voir courir quelques milliardaires en culottes courtes.
Voilà, mon fils, comment elle est devenue le symbole ultime du cynisme de notre civilisation.
Et voilà comment elle est devenue l’instant où le monde s’est rendu compte que ce pouvait être le début de la fin ; ou le début d’autre chose.
Tu n’étais pas né en 2010.
Ton frère avait un an.
Vous n’y pouviez rien.
Et je croyais n’y rien pouvoir non plus.
Mais quand on est nombreux à n’y rien pouvoir, on finit par pouvoir un peu. »Bon, il y a beaucoup d’informations dans ce texte !
L’Arabie Saoudite a-t-elle exécuté 81 personnes le même jour ?
Oui c’était le 12 mars 2022. Vous trouverez l’information diffusé par Amnesty International <ICI>
Le Qatar a-t-il exécuté un népalais ?
Oui c’était en avril 2021, vous trouverez la confirmation dans cet article de <L’Orient le jour>
Beaucoup de Népalais se trouvent au Qatar pour y travailler.
Le journal « Sud-Ouest » avait publié, en 2013 déjà : « Coupe du monde au Qatar : 44 ouvriers népalais morts, des preuves de travail forcé ».
Dans cet article très court le journal citait le journal anglais « The Guardian » :
« Au moins 44 ouvriers népalais , travaillant dans des conditions s’apparentant à de l’esclavagisme , sont morts en 2013 sur des chantiers au Qatar […]
Le Guardian dit avoir trouvé des preuves et des témoignages de travail forcé sur un projet d’infrastructure majeur en vue de la Coupe du monde 2022, même si les travaux liés directement à l’événement n’ont pas encore commencé.Le journal relaie les allégations de certains ouvriers qui disent ne pas avoir été payés depuis des mois , qu’on leur a confisqué leur passeport et qu’on les prive d’eau potable gratuite sur les chantiers, malgré des températures caniculaires. »
Le 21 février 2021 le même journal Le Guardian estimait que <6 500 ouvriers seraient morts dans les chantiers au Qatar>
Vous trouverez sur le site de la <Diplomatie Belge> cette information sur les mœurs :
« La prostitution, l’homosexualité et les relations extraconjugales (non seulement adultérines mais toute relation sexuelle hors mariage) sont illégales. Ces délits sont sévèrement sanctionnés en vertu de la loi islamique (sharia).
Les personnes reconnues coupables d’actes homosexuels encourent jusqu’à dix ans de prison. Il est donc conseillé aux personnes LGBTI de considérer soigneusement les risques d’un voyage au Qatar.
Les unions de fait sont illégales au Qatar. Un homme et une femme ne sont pas autorisés à vivre dans le même logement à moins d’être légalement mariés ou d’avoir un lien de parenté. Les relations sexuelles hors mariage constituent une infraction criminelle.
Les démonstrations d’affection en public, y compris le fait de se tenir par la main ou de s’embraser, ne sont pas acceptables socialement.
Hommes et femmes doivent s’habiller modestement, notamment en se couvrant les genoux et les épaules . Les femmes étrangères ne sont cependant pas obligées de porter le voile. »
Le journaliste Jérôme Latta a publié dans le Monde, hier, 19 septembre : «
Le Mondial au Qatar, c’est la (grosse) goutte qui fait déborder la coupe » dans lequel il écrit :« Il y a ce bilan humain effarant, dont l’unité est le millier de morts, sur les chantiers du pays, et l’aberration écologique de ces huit stades climatisés de 40 000 à 80 000 places – sept nouveaux – serrés dans une agglomération de 800 000 habitants, dont les tribunes n’étaient pas remplies lors des Mondiaux d’athlétisme en 2019.
Le Mondial qatari représente, certes, moins une rupture qu’un aboutissement navrant. C’est la (grosse) goutte qui fait déborder la coupe, en exhibant la réalité des grands événements sportifs : gigantisme, compromission politique, gabegie économique et environnementale, cupidité des organisations sportives, mépris des fans, etc.
Le procès fait à la FIFA World Cup Qatar 2022 est celui d’un modèle poussé à son extrême, qui laisse beaucoup d’entre nous devant un sinistre dilemme : ne pas voir le problème ou ne pas voir la Coupe du monde. »
Chacun agira comme lui dicte sa conscience.
Pour ma part, je ne peux pas ne pas voir le Problème écologique, humain et éthique.
Je ne pourrais pas regarder une minute de cette sinistre et criminelle farce.
Je vous rappelle que Coluche avait eu cette phrase « et dire que pour cela ne se vende pas, il suffit simplement de ne pas l’acheter. »
<1712>
Les caricaturistes se sont lâchés.

-
Lundi 19 septembre 2022
« La conférence mondiale de l’ONU sur les droits de l’homme à Vienne, en juin 1993. »Moment où l’Occident a compris que si elle avait gagné la guerre froide, son modèle et ses valeurs étaient loin de s’être imposés.La guerre froide était terminée depuis 1991.
Les États Unis n’avaient plus d’ennemis à leur dimension comme pouvait l’être l’Union Soviétique.
Les communistes chinois, sous l’autorité morale de Deng Xiaoping, ne suivront pas l’exemple de Gorbatchev et réprimerons par le sang l’espoir de jeunes étudiants chinois d’obtenir davantage de liberté et de droits.
Le monde, dominé par l’hyperpuissance des Etats-Unis était prêt, pensait les occidentaux, à se soumettre davantage aux valeurs occidentales des droits de l’homme, de la démocratie et des libertés politiques.
Et c’est dans cet esprit que fut organisée, du 14 au 25 juin 1993, à Vienne en Autriche, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme sous l’égide de l’ONU.
Huntington explique que c’est lors de cette conférence à Vienne, que les Occidentaux ont compris que même s’ils avaient pensé avoir gagné la guerre froide, le Monde ne s’occidentaliserait pas pour autant. :
« Les différences quant aux droits de l’homme entre l’Occident et les autres civilisations, et la capacité limitée de l’Occident à atteindre ses objectifs sont apparues au grand jour lors de la conférence mondiale de l’ONU sur les droits de l’homme à Vienne, en juin 1993. D’un côté se tenaient les pays européens et nord-américains ; de l’autre, on trouvait un bloc d’environ cinquante États non occidentaux, dont les quinze plus actifs comprenaient les gouvernements d’un pays d’Amérique latine (Cuba), d’un pays bouddhiste (Myanmar), de quatre pays confucéens aux idéologies politiques, aux systèmes économiques et aux niveaux de développement très différents (Singapour, le Viet-nam, la Corée du Nord et la Chine) et de neufs pays musulmans (La Malaisie, l’Indonésie, le Pakistan, l’Iran, l’Irak, la Syrie, le Yémen, le Soudan et la Libye). Le regroupement islamo-asiatique représenté par la Chine, la Syrie et l’Iran dominait. Entre ces deux groupes, il y avait les pays d’Amérique latine, sauf Cuba, qui ont souvent soutenu l’Occident, et les pays africains et orthodoxes qui l’ont parfois soutenu mais qui s’y sont opposés le plus souvent. »
Le choc des civilisations page 285
Constatons d’abord que si l’Occident présente une certaine homogénéité, l’autre coalition est hétéroclite associant des pays d’Islam avec des États qui comme la Chine sont hostiles aux musulmans qui se trouvent dans leurs frontières ou d’autres pays comme Cuba et la Corée du Nord qui sont anti-religieux.
Constatons ensuite que mise à part l’Amérique latine hors Cuba, l’Occident a peu d’alliés et se trouve minoritaire.
Quelles étaient les sujets de conflits ?
« Les problèmes à propos desquels les pays se divisaient en termes de civilisation étaient les suivants :
- Universalisme/relativisme culturel en matière de droits de l’homme ;
- Priorité relative de l’économie et des droits sociaux dont le droit au développement/droits politiques et civiques ;
- Conditions politiques posées à l’assistance économique ;
- Création d’un commissaire de l’ONU aux droits de l’homme ;
- Autorisation donnée aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, qui se rassemblaient simultanément à Vienne, de participer à la conférence gouvernementale ;
- Droits particuliers traités par cette conférence ;
- Problèmes plus spécifiques comme la possibilité laissée au dalaï-lama de s’adresser à la conférence. »
Le choc des civilisations page 285/286
Ces problèmes ont fait l’objet d’importantes divergences entre les pays occidentaux et le bloc islamo asiatique.
Huntington nous apprend que les pays d’Asie avaient préparés cette conférence, contrairement aux Occidentaux :
« Deux mois avant la conférence de Vienne, les pays d’Asie s’étaient réunis à Bangkok et avaient adopté une déclaration soulignant que les droits de l’homme devaient être considérés « dans le contexte […] des particularités nationales et régionales et des différents fonds religieux et culturels hérités de l’histoire. »
Le choc des civilisations page 286
Bref, il n’y avait aucune raison de se soumettre aux « diktats » des occidentaux concernant les droits de l’homme et leurs prétentions universalistes. C’est les particularités qui sont essentielles et qui justifient « la dose » de droits de l’homme qu’il est possible d’offrir.
On peut être anti-occidentaux, ou comme moi conscients des faiblesses et des trahisons de l’Occident et trouver cette défense des pays autoritaires ou même tyranniques comme le comble de la mauvaise foi.
<Le massacre de Tien an men> date de 4 ans, le 4 juin 1989 et dans ce cas plutôt que le particularisme chinois, il fallait surtout sauver le pouvoir du parti communiste chinois et les privilèges des dirigeants communistes.
A Bangkok ces pays se sont mis d’accord sur une autre exigence :
« Le fait de conditionner l’assistance économique à la situation des droits de l’homme étaient contraire au droit au développement. »
Le choc des civilisations page 286
Ces pays ne supportaient plus que l’Occident exerce une pression financière pour les obliger à améliorer les droits individuels de leurs citoyens.
Huntington explique que les occidentaux ont fait plus de concessions que leurs adversaires mais ont tenté de préserver les droits des femmes :
« La déclaration adoptée par la conférence a donc été minimale. »
La proclamation de l’universalité des droits est donc tempérée largement par la prise en considération des particularismes locaux :
Par exemple la Déclaration et Programme d’action de Vienne, adoptée dispose dans son article 5 que :
« Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance. S’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales. »
Huntington cite Charles J. Brown qui écrivait :
« [Ce document] représentait une victoire pour la coalition islamo-asiatique et une défaite pour l’Occident »
Le choc des civilisations page 286
Et il ajoute, en énumérant notamment tout ce qui manquait :
« La déclaration de Vienne ne contenait aucune défense de la liberté de parole, de la presse, d’assemblée et de religion et était donc par bien des aspects plus faible que la déclaration universelle des droits de l’homme que les Nations unies avaient adoptée en 1948. Cette évolution traduit le déclin de puissance de l’Occident. […] Le monde est désormais aussi arabe, asiatique et africain qu’il est occidental. »
Huntington cite alors ce qu’il appelle : « un détracteur asiatique de l’Occident »
« Pour la première fois depuis que le Déclaration universelle a été adoptée en 1948, des pays qui n’ont pas été marqués profondément par les traditions du judéo-christianisme et du droit naturel sont au premier rang. Cette situation sans précédent va définir la nouvelle politique internationale des droits de l’homme. Elle va également multiplier les occasions de conflit »
Et il ajoute :
« Le grand gagnant […] fut clairement la Chine, du moins si on mesure la réussite au fait de dire aux autres ce qu’ils ne doivent pas faire »
Huntington rappelle que l’Occident eut l’opportunité d’une petite revanche. Le gouvernement chinois avait défini comme objectif majeur d’obtenir l’organisation des jeux olympiques de l’an 2000. On sait que c’est finalement Sidney qui l’obtint, c’est-à-dire une ville et un pays occidentaux. Pour ce faire, il fallut beaucoup manœuvrer pour parvenir à écarter Pékin.
Ce fut une victoire à la Pyrrhus, Pékin obtint les jeux de 2008, moins de 20 ans après Tien an Men.
Le 28 janvier 1992, le président américain George HW Bush avait annoncé au Congrès que l’Amérique avait gagné la guerre froide.
Fukuyama avait publié la même année, 1992, « La fin de l’Histoire »
Et en juin 1993, la conférence mondiale de l’ONU sur les droits de l’homme à Vienne remettait très largement en cause cette vision occidentalo-optimiste.
<1711>
- Universalisme/relativisme culturel en matière de droits de l’homme ;
-
Vendredi 16 septembre 2022
« C’est tellement rare, c’est tellement improbable, c’est tellement miraculeux que c’est peut-être ça la civilisation et la culture. Rencontrer quelqu’un qui écoute. »Michel SerresC’est mon père qui m’avait raconté cette histoire.
Un vieux sage reçoit un homme qui vient se plaindre d’un autre homme. Il lui raconte longuement les faits et aboutit à une conclusion qui lui est favorable.
Le sage le congédie en lui disant : « Tu as raison ».
Mais quelques heures plus tard, l’autre homme vient rencontrer le vieux sage et lui raconte la même affaire avec ses mots et son analyse.
A la fin de la discussion et au moment du départ, le sage lui dit : « Tu as raison. ».
Alors, l’épouse du sage qui avait entendu les deux conversations s’approche de son mari et lui dit son étonnement :
« Je ne comprends pas, ces deux hommes ont exprimé des opinions radicalement opposées et tu as dit à chacun qu’il avait raison. ».
Et le vieux sage répondit à sa femme : « Tu as raison ! »
Puis, il a ajouté : « Ces hommes ne partent pas du même point de vue. Mais chacun a raison en partant de son point de vue !
Cette histoire m’est restée.
Elle raconte deux personnes qui parlent et ne se rencontrent jamais.
Je veux dire leurs paroles ne se rencontrent pas, ils ne s’écoutent pas, n’échangent pas.
Chacun ne se centre que sur son histoire, sa vision, son récit.
Et aujourd’hui avec les réseaux sociaux, pour beaucoup, leur univers se restreint à un tel point qu’il ne peuvent plus que parler avec les gens qui pensent comme eux.
Le <mot du jour du 3 mars 2016> citait le sociologue Zygmunt Bauman qui exprime cela avec une acuité rare :
« S’enfermer dans […] une zone de confort, où le seul bruit qu’on entend est l’écho de sa propre voix, où la seule chose qu’on voit est le reflet de son propre visage.»
A cela Michel Serres répond :
« C’est tellement rare, c’est tellement improbable, c’est tellement miraculeux que c’est peut-être ça la civilisation et la culture. Rencontrer quelqu’un qui écoute. »
Cette phrase se trouve dans un livre de Robert Blondin « Le Bonheur possible », dans lequel l’auteur est allé à la recherche des gens heureux. Entouré d’une dizaine de collaborateurs, armé de 40 questions, il a rencontré 2000 « sages heureux » d’Europe, d’Asie et d’Amérique.
Parmi ces sages il y avait Michel Serres et cette phrase se trouve page 271.
Voilà le mot du jour court que je souhaitais écrire après ceux de mercredi et de jeudi.
Et si le cœur vous en dit voici une <Vidéo de la librairie Mollat où Michel Serres présentait son livre « Le Gaucher boiteux » dans lequel il parle beaucoup de rencontres.
<1710>
-
Jeudi 15 septembre 2022
« L’échec de l’impérialisme moral en Afrique ! »Jean-Pierre Olivier de Sardan« J’aime les gens qui doutent » chantait Anne Sylvestre :
« J’aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer
J’aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer
J’aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger »
Sur les quelques 1700 mots du jour que j’ai écrit depuis 2012, aucune série ne m’a donné autant de mal que celle-ci que j’ai initié sur ce livre et cette intuition de Samuel Huntington : « Le choc des civilisations ».
Alors faut-il se taire ? Ne pas en parler ?
J’ai l’intuition contraire, il ne faut pas être dans le déni.
Dans un certain nombre de domaines qui touche les libertés, les progrès dans le droit des femmes, des pratiques sexuelles, de l’écriture, du dessin, de la réalité des faits, de la démarche scientifique, de l’enseignement de l’Histoire nous sommes depuis le début de ce siècle en pleine régression.
Et je crois qu’il faut essayer de comprendre cela :
- La colère des uns ;
- Le totalitarisme des autres ;
- L’aveuglement ou la naïveté d’autres encore
- La peur, la lâcheté, l’indifférence du plus grand nombre
Pour donner quelques éléments de compréhension de cette énumération qui peut être énigmatique pour les uns ou plein de sous-entendus pour les autres, voici quelques exemples. Il n’est pas question d’exhaustivité ici.
Quand je parle de colère, je pense aux peuples qui ont été colonisés, soumis et exploités par un Occident arrogant et usant de toute la force que lui donnait ses capacités industrielles et militaires.
Le totalitarisme correspond à des régimes tyranniques ou plus simplement autoritaires et qui en utilisant d’une part des fautes des occidentaux et d’autre part le récit ancien et souvent déformé de leur civilisation rejettent en bloc toutes les valeurs de l’occident et imposent des pouvoirs cruels, carcéraux, liberticides, régressifs et abêtissant.
L’aveuglement ou la naïveté s’adresse aux politiques, intellectuels et journalistes de nos pays qui souvent aveuglés par leur anti-américanisme, qui peut avoir des justifications, défendent des mouvements, des idées ou des dictateurs. Il y a parmi eux des poutinologues, des pro-Xi Jinping, des compagnons de route des frères musulmans ou des salafistes ou d’autres causes ambigües comme le « Comité Vérité pour Adama ». La plupart de ces naïfs seraient parmi les premiers éliminés s’ils avaient le malheur de vivre dans un pays dirigé par les forces qu’ils soutiennent.
La dernière partie est ultra majoritaire et ne veut pas se mêler de ses querelles, soit parce que cela dérange sa quiétude, soit que l’esprit est occupé de tant de choses qu’ils ne faut pas perdre de temps pour réfléchir à ces sujets, soit parce que les menaces qui nous guettent ne sont pas perçues, soit, comme ceux qui ne veulent pas que le collège de leur enfant prenne le nom de Samuel Paty, parce qu’ils sont lâches, il n’y a pas d’autre mot.
Le chemin de crête pour parler de ces influences, de ce bouleversement sociétal et politique est extraordinairement difficile.
A force de nuancer et de volonté d’embrasser tous les éléments du puzzle, on pourrait aboutir à des phrases interminables, entrecoupées par des conjonctions (mais, or) ou des adverbes (cependant, toutefois).
Bref, des phrases qui sont illisibles.
Alors je ne vais pas agir ainsi.
Hier, je donnais un point de vue sur l’affaire Idrissa Gueye et les dissensions entre le Sénégal et La France qui en ont été la conséquence.
 Jean-Pierre Olivier de Sardan présente une opinion tout à fait différente qu’il défend dans le remarquable magazine numérique « AOC » pour Analyse, Opinion, Critique.
Jean-Pierre Olivier de Sardan présente une opinion tout à fait différente qu’il défend dans le remarquable magazine numérique « AOC » pour Analyse, Opinion, Critique.
Cet article d’opinion qui a été publié le 14 juin 2022 a pour titre « De quoi se mêlent-ils ? » : l’échec de l’impérialisme moral en Afrique »
Je ne connaissais pas Jean-Pierre Olivier de Sardan qui est désigné comme anthropologue dans l’article
Sa <Fiche Wikipedia> nous apprend qu’il est né en 1941 dans le Languedoc et qu’il a été professeur d’anthropologie à l’École des hautes études en sciences sociales de Marseille. Il était également directeur de recherches émérite au CNRS et professeur associé à l’Université Abdou-Moumouni (Niamey, Niger).
Il présente la particularité de disposer à la fois de la nationalité de naissance française, mais aussi de la nationalité, acquise en 1999, du Niger.
Nous apprenons qu’il a réalisé une grande partie de ses études anthropologiques en Afrique et que ses premiers travaux furent l’étude d’une société particulière, le peuple Wogo, sur les rives du fleuve Niger, à l’ouest du pays.
Enrichis par cette double culture française et africaine, il affirme l’aspect contre-productif des attaques françaises contre le joueur sénégalais :
 « Attaquer publiquement et menacer de sanctions Idrissa Gueye, joueur sénégalais du Paris Saint-Germain qui a refusé de porter le maillot arc-en-ciel lors de la journée de lutte contre l’homophobie, est le meilleur moyen de renforcer à la fois l’homophobie au Sénégal et le rejet de la France. »
« Attaquer publiquement et menacer de sanctions Idrissa Gueye, joueur sénégalais du Paris Saint-Germain qui a refusé de porter le maillot arc-en-ciel lors de la journée de lutte contre l’homophobie, est le meilleur moyen de renforcer à la fois l’homophobie au Sénégal et le rejet de la France. »
Il renvoie vers un autre article d’AOC : <un fait social total par Jean-Loup Amselle> qui tente de relater toute cette histoire en essayant de rester dans la plus grande neutralité possible, à équidistance, de l’indignation française et de l’irritation sénégalaise.
Olivier de Sardan souhaite se démarquer par un avis plus tranché :
Je me risquerai […] à prendre parti très clairement, car derrière cette affaire c’est aussi toute l’attitude des Occidentaux qui est contestée en Afrique, bien au-delà du Sénégal, jusqu’à et y compris l’aide au développement, dont tout montre qu’elle est en crise profonde. Je pense que les attaques radicales et outrées contre Ibrahim Gueye sont non seulement déplacées mais doivent être condamnées, et qu’elles sont de plus révélatrices d’un mal profond dès lors qu’il est question des pays du Sud en général et de l’Afrique en particulier.
À quel titre les dirigeants, autorités, intellectuels et experts occidentaux s’autorisent-ils à donner sans cesse des leçons de morale aux peuples africains, en oubliant les poutres qu’ils ont dans l’œil et en bafouant bien souvent les règles qu’ils veulent imposer aux autres ?
Ce sont cette arrogance, cette suffisance, cette condescendance, cette tartuferie, qui expliquent pour une grande part le rejet de plus en plus prononcé de l’Occident (France en tête) par une très grande partie des opinions publiques africaines, rejet massif dont on voit d’ailleurs dans l’actualité une conséquence que je trouve particulièrement déplorable mais dont il faut comprendre le pourquoi : un soutien envers Poutine très souvent affiché en Afrique, pour la seule raison qu’il s’oppose à l’Occident. »
Après avoir dressé le contexte, l’univers mental africaine et le ressentiment historique à l’égard des pays coloniaux et en particulier la France, il prend une position assez éloignée de celle que je défendais hier :
« Participer aux Gay Pride ou aux manifestations contre le racisme serait-il alors obligatoire, et ne pas le faire serait-il donc assimilable à un comportement homophobe ou raciste ? Ce serait absurde. Ne pas s’associer à une activité publique contre l’homophobie ne signifie pas être homophobe, pas plus qu’un joueur de tennis russe qui ne critique pas publiquement l’agression russe en Ukraine ne peut être accusé pour autant de la soutenir. Les critiques virulentes contre Gueye n’ont pas lieu d’être. On peut d’ailleurs penser qu’elles ne visaient pas son identité sénégalaise et que tout autre joueur ayant réagi comme lui aurait fait l’objet de cette intolérance. Mais c’est justement parce qu’elles ne tenaient pas compte de son identité sénégalaise qu’elles ont soulevé un tel tollé en Afrique. »
Le joueur est resté silencieux pendant toute la polémique. Il est parti en Angleterre à la fin de l’été. Olivier de Sardan explique l’embarras du joueur par sa peur d’être mal jugé dans son pays natal :
« En effet, pour comprendre mieux l’attitude de Gueye lui-même, le fait qu’il soit sénégalais est incontournable. En refusant de porter le maillot symbolique de l’homosexualité, qui l’aurait sans doute transformé bien malgré lui en militant pro-homosexuel aux yeux de ses compatriotes, Gueye ne voulait sans doute pas tomber sous le coup d’une avalanche de quolibets et d’insultes au Sénégal, où l’opinion publique est clairement homophobe. Cela me semble très compréhensible de sa part. »
Il explique que, selon lui, même si le joueur était hostile à l’homosexualité, rien ne pourrait lui être reproché s’il ne pratique pas personnellement des insultes ou des actes homophobes.
« Peut-être aussi (je n’en sais absolument rien) est-il hostile personnellement à l’homosexualité. Et alors ? Là aussi ce serait son droit : ce sont les insultes et les actes homophobes qui sont proscrits (non seulement légalement, mais aussi légitimement à mon avis), mais pas le rejet de l’homosexualité à titre personnel (« en son âme et conscience » selon la formule consacrée). La répression en France de l’homophobie et de toutes les discriminations ne doit pas empiéter sur la liberté d’opinion. »
Sur ce point je me permets une objection. La liberté dans notre civilisation s’exerce à l’égard de la sexualité qu’on souhaite vivre, hétéro, homo ou bi. Cela peut aller jusqu’à une hétéro sexualité contrainte par une homosexualité refoulée en raison d’interdits qu’on accepte en raison de ses croyances. Mais l’homophobie est désormais, dans notre civilisation, un délit et non une opinion. Ce n’est pas seulement le fait de s’abstenir d’insultes ou d’actes homophobes qui est ici en cause.
Ce qui à mon sens se joue ici, c’est l’intolérance des religieux, le fait de ne pas accepter que l’autre peut penser différemment de moi.
Et là, il y a un pas supplémentaire, qu’Olivier de Sardan néglige, l’homme tolérant intervient et défend celui qui pense différemment de lui, si on l’attaque.
Nous savons aujourd’hui que Voltaire n’a jamais écrit : « « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ».
Mais cette phrase est bien une phrase pleine de sens, dans ce contexte.
De manière plus personnelle, je peux dire que je ne sais pas si Dieu existe. Mais ce que je crois c’est que le Dieu qui est décrit dans les Livres de Moïse des juifs, dans la bible chrétienne ou dans le coran des musulmans, lui, n’existe pas.
Ce que l’Histoire nous apprend sur la rédaction, la sélection des textes et leur utilisation par des hommes de pouvoir pour asseoir leur autorité m’autorise une grande force dans cette conviction.
Pourtant, non seulement j’accepte que cette croyance soit la réalité des gens qui y adhérent, mais bien plus, je les défendrai s’ils sont attaqués par des intolérants.
S’associer à une journée contre l’homophobie pour quelqu’un qui s’interdit d’être homosexuel répond à cette même logique.
Mais Olivier de Sardan place cette question dans un contexte plus général de relations ambigües entre l’Europe et l’Afrique :
« Passons maintenant aux relations avec l’Afrique, non seulement en ce qui concerne l’homophobie mais plus généralement les interventions des Européens en matière de normes sexuelles et familiales d’une part, de mœurs politiques d’autre part. Il y a beaucoup de valeurs morales considérées désormais au Nord comme « allant de soi » que les décideurs occidentaux de tous bords, depuis les grandes agences de développement jusqu’aux ONG grandes et petites, entendent imposer à l’Afrique, non certes par la force, mais par le biais de multiples conditionnalités de l’aide : la défense des droits des homosexuels, certes, mais aussi la promotion des femmes, la régulation des naissances, la lutte contre le mariage forcé et le mariage des enfants, la lutte contre la corruption, la démocratie électorale, la transparence et la redevabilité, la promotion de la société civile […]
Cela autorise-t-il pour autant les représentants de la France ou plus largement les décideurs de l’aide au développement et de l’aide humanitaire à donner des leçons aux autres peuples, et à se comporter en militants imposant de l’extérieur ces valeurs aux autres ? Certes, l’exportation systématique vers l’Afrique de valeurs morales devenues incontournables en Occident se fait avec les meilleures intentions du monde, au bénéfice des discriminés, des opprimés, des pauvres : il s’agit d’intervenir « pour leur bien ». Ceci rappelle d’une certaine façon les discours missionnaires des temps coloniaux. Le problème c’est que ce « bien » est perçu par la plupart de ceux auxquels il s’adresse comme un « mal », et que ces « amis qui nous veulent du bien » sont bien souvent considérés comme des hypocrites qui nous humilient. »
Cette réaction anti-colonialiste que décrit l’anthropologue est certainement une réalité, en outre, parfaitement compréhensible.
Il constate qu’en plus cette injonction moraliste de l’Occident échoue :
« Soyons clairs. Dans la plupart des pays d’Afrique, le patriarcat est la règle et les hommes dominent de façon écrasante la vie publique (même si les femmes ne sont pas démunies de contre-pouvoirs), la polygamie est très développée, la corruption est généralisée, l’homophobie règne ouvertement, la démocratie est contournée ou décriée. Le racisme et la xénophobie sont fréquents et souvent à visage découvert. Au Sahel, les mariages précoces et forcés sont toujours nombreux et largement validés socialement et religieusement. L’Afrique (pas plus que l’Europe ou l’Amérique) n’a rien d’un monde idéal qu’il s’agirait de préserver en l’état.
On ne peut donc se satisfaire de cette situation. Mais qui peut la changer ?
Une réponse s’impose. Le fonctionnement actuel de l’aide occidentale, avec ses injonctions éthiques liées à toute allocation de fonds, a échoué. Il va à l’encontre de ses bonnes intentions, car ses leçons de morale exacerbent le rejet de l’Occident et par la même favorisent la perpétuation des pratiques locales qu’il s’agissait de modifier »
Pour faire évoluer les pratiques que nous réprouvons son conseil est de plutôt s’appuyer sur les militants africains dont il reconnait qu’ils restent très minoritaires sans être pour autant isolés. Son expérience montre qu’une partie de la population n’approuve pas les mariages forcés ou la répression de l’homosexualité, accepte les contraceptifs, tolère les avortements. Mais cette partie-là reste silencieuse, dans la mesure où, sur la scène publique, la scène électorale et la scène religieuse, c’est le rejet des valeurs considérées comme occidentales qui tient de plus en plus le haut du pavé.
Il oppose ainsi « réformateurs de l’extérieur » issus de l’Occident inefficace et rejetés, aux « réformateurs de l’intérieur » qui peuvent aider à l’évolution lente des sociétés et qu’il faudrait aider de manière discrète mais réelle. Et il finit par cette conclusion :
« Les « réformateurs de l’extérieur » ne sont ni efficaces ni bienvenus sous les formes actuelles de leurs interventions. Leur impatience missionnaire et leur impérialisme moral sont bien souvent contre-productifs, malgré leurs bons sentiments, voire à cause d’eux. Leurs bons sentiments masquent en effet leur méconnaissance dramatique des réalités locales, et leur manque d’écoute des raisons pour lesquelles les gens font ce qu’ils font. »
Un autre éclairage du même sujet abordé hier.
Il montre toutes les forces souterraines à l’œuvre dans ce conflit de civilisation et cite la : « domination idéologique d’un salafisme revenant à l’époque du Prophète »
J’y apprends la difficulté de convaincre du bien-fondé des valeurs occidentales dans ces lieux hostiles à l’Occident à cause d’un lourd passé.
Toutefois l’histoire relaté hier parle non pas de ce qui se passe en Afrique, mais en France. Et je crois que sur notre territoire, tout en appliquant la tolérance telle que je l’ai évoquée précédemment, nous avons le droit d’affirmer nos valeurs et de demander qu’elles soient respectées par celles et ceux qui ne pensent pas comme nous, mais qui habitent, même temporairement, ce territoire.
<1709>
- La colère des uns ;
-
Mercredi 14 septembre 2022
« C’est juste un choc culturel ! »Bacary Cissé – journaliste sénégalais à propos du refus d’Idrissa Gueye de participer à un match contre l’homophobieUne civilisation, c’est une culture, ce sont des valeurs spirituelles souvent incarnées par une religion.
C’est une conception de la relation entre les droits individuels et les exigences de la société.
C’est une conception du sacré, des interdits et de ce qui est permis.
Car il y a toujours du sacré, même dans les sociétés très largement athées.
En France par exemple, la flamme du soldat inconnu, le drapeau, les tombes, la shoah sont sacrés, c’est-à-dire qu’ils sont susceptibles de faire l’objet d’un sacrilège, on utilise, dans le langage courant, le terme de profanation.
Idrissa Gueye est un joueur de football de nationalité sénégalaise. Il était dans l’effectif du Paris Saint Germain de 2019 à juin 2022, depuis août 2022 il a rejoint un club anglais.
 Le samedi 14 mai 2022, se déroulait la 37e journée du championnat de Ligue 1, journée dédiée à la lutte contre l’homophobie.
Le samedi 14 mai 2022, se déroulait la 37e journée du championnat de Ligue 1, journée dédiée à la lutte contre l’homophobie.
Pour l’occasion, tous les joueurs des 20 équipes arboraient un maillot floqué de l’arc-en-ciel des fiertés LGBT, en marque de soutien.
Idrissa Gueye avait été convoqué pour faire partie de l’équipe du PSG et devait donc porter ces couleurs arc en ciel. Idrissa Gueye n’a pas voulu jouer « pour des raisons personnelles »
La saison précédente, une journée identique avait été organisée et le joueur s’était également abstenu officiellement pour des raisons médicales.
Cette affaire a immédiatement agité le monde associatif qui a fait de la lutte contre l’homophobie une cause essentielle.
Ainsi l’association de lutte contre l’homophobie dans le sport, Rouge Direct, a réagi dès le 15 mai :
« L’homophobie n’est pas une opinion mais un délit. La LFP (Ligue) et le PSG doivent demander à Gana Gueye de s’expliquer et très vite. Et le sanctionner le cas échéant »
Ce message a été suivi par beaucoup d’autres. Je crois qu’on peut dire que quasi toute la France du sport, de la politique et des milieux d’influence s’est mobilisée et indignée devant le comportement de ce joueur.
Le joueur n’a fait aucun commentaire.
Alors, le 18 mai, Le Conseil national éthique (CNE) de la FFF a écrit à Idrissa Gueye:
« En refusant de participer à cette opération collective, vous validez de fait les comportements discriminatoires, le refus de l’autre, et pas uniquement contre la communauté LGBTQI +.
L’impact du football dans la société et la capacité des joueurs à représenter un modèle nous donnent à tous une responsabilité particulière ».
Nous pouvons conclure à une condamnation unanime en France.
Au Sénégal la réaction a été tout autre.
D’abord le président de l’État Macky Sall a affirmé son soutien au joueur :
« Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées ».
Le ministre des Sports Matar Bâ s’est aussi joint à la défense du joueur en indiquant que
« Quand on signe (un contrat avec un club), c’est pour jouer au foot, ce n’est pas pour faire la promotion de quoi que ce soit ou mettre de côté ses convictions »
L’écrivain et intellectuel Boubacar Boris Diop, lauréat du très prestigieux Prix Neustadt, affirme, lui, sa
« Solidarité totale avec Idrissa Gana Guèye. Ils sont étranges, ces gens qui se donnent tant de mal pour imposer à tous et à chacun leurs opinions. Au nom, suprême stupidité, de la liberté d’expression. Savent-ils seulement qu’ils font de plus en plus rire ? »
L’ex-Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne encourage Gueye en lui disant:
« Tiens bon, Gaïndé », lion en langue wolof, surnom de la sélection nationale de football, dans un message sur Twitter accompagné de versets du Coran. »
 Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor a déclaré :
Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor a déclaré :
« Idrissa Gueye est dans son bon droit. Il est resté ancré dans ses valeurs, dans ses principes, dans sa foi qui font la « sénégalité », qui font l’ africanité » de tout un continent ».
Pour démontrer le consensus politique, il faut citer l’une des principales personnalités politiques nationales et principal opposant au président Macky Sall, Ousmane Sonko:
« Les +toubabs+ (les Blancs, en wolof) croient que nous sommes des ordures et qu’eux seuls ont des valeurs.
Aujourd’hui, il faut qu’ils nous imposent l’homosexualité (…) Eux seuls ont des valeurs. Jusqu’à quand ?
Ce qu’il (Gueye) a fait, c’est un acte de courage. Nous tous, sans distinction de religion, devons le soutenir »
De nombreux Sénégalais ont aussi mis en statut Whatsapp le message de soutien du président sénégalais ou des photos de Gueye en pèlerinage à la Mecque.
L’écrivain El Hamidou Kasse a déclaré sur Twitter soutenir Gueye
« Au nom du principe de la libre croyance et du respect des différences. »
Enfin la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) défend le joueur d’abord en affirmant qu’il n’y a pas de preuve qu’il était absent pour la raison qu’on lui reproche et accuse Conseil National Ethique (CNE) de racisme :
« Quand l’éthique se base sur l’hypothétique et le diktat, la liberté individuelle est en péril […]. [Un courrier du CNE que la FSF dit avoir accueilli ] avec une grande surprise (et une grande inquiétude sur le traitement de certains joueurs essentiellement d’origine africaine, disons-le clairement).
[Criant à l’illégalité de la démarche de la FFF, la FSF estime que sa requête revient à] contraindre le joueur à faire ce que son libre arbitre ne l’incline à faire. Est-on vraiment dans cette France que l’on nous avait contée et racontée dans nos écoles, celle qui a comme devise la liberté, la fraternité et de l’égalité pour tous ? Comment une instance qui prétend promouvoir l’éthique dans le Football peut se fonder sur des supputations pour s’adresser à une personne pour lui enjoindre de s’exprimer et pire encore de s’afficher avec le maillot aux couleurs LGBTQI+ pour mettre fin auxdites supputations ?»
Au Sénégal, pays musulman à 95% et très pratiquant, les relations homosexuelles sont interdites. La loi existante dispose que « sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs (152 à 2.286 euros) quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. »
Loi assumée et défendue à 100% par le chef de l’État au nom des spécificités culturelles comme en 2020 alors qu’il recevait le premier ministre canadien Justin Trudeau.
« Ces lois sont le reflet de notre manière de vivre… elles n’ont rien à voir avec l’homophobie ».
On peut ne pas être d’accord avec Macky Sall et constater simplement que cette discrimination, cette violence et ces sanctions exercées à l’égard des homosexuels répond exactement à la définition de l’homophobie.
Un article du monde relate : « Ces derniers mois, la pression s’est accentuée sur la communauté LGBTI+ sénégalaise, mais aussi les militants et tous ceux qui, publiquement, osent réaffirmer les droits de cette communauté. « Avec l’implication nouvelle d’imams et de chefs religieux sur le sujet, l’homophobie a pris une nouvelle ampleur, juge Souleymane Diouf qui dénonce le soutien financier de certains pays – Turquie, Arabie saoudite et Iran –, aux organisations conservatrices. Les combattre demande des moyens dont on ne dispose pas, poursuit-il. Aujourd’hui, le niveau d’insécurité pour les défenseurs des droits LGBT au Sénégal est extrêmement élevé. J’ai dû quitter le pays et plusieurs autres activistes ont fait de même. »
L’excellent site SO FOOT rapporte :
« Invité de L’After Foot sur RMC, Bacary Cissé – journaliste sénégalais est revenu sur la polémique Idrissa Gueye. Le joueur parisien, qui avait refusé de porter un maillot au flocage arc-en-ciel symbole de la lutte contre l’homophobie, avait reçu les foudres de la Fédération française de football et de bon nombre d’associations. Selon le journaliste, il s’agit juste d’un « choc culturel » sur la perception de ce geste. Il assure qu’au Sénégal, les gens ont parfaitement compris son choix : « Aujourd’hui, Idrissa Gana Gueye a le soutien total de tous les Sénégalais, de tous les Africains. »
Cissé développe son explication et estime que la culture du joueur est juste différente du pays dans lequel il évolue. « C’est une incompréhension. Il ne faut pas oublier qu’Idrissa Gana Gueye est né au Sénégal, il y a grandi, il y a été éduqué.
Nous respectons tout ce que font les autres, mais nous ne sommes pas obligés de les suivre dans leur culture, déclare-t-il avant de réfléchir dans le sens inverse. Si Idrissa Gueye avait fait autrement, qu’aurions-nous dit ? On aurait été beaucoup plus choqué. »
Voici les faits et les interprétations.
Que dire ?
Qu’il s’agit bien d’un choc culturel entre l’Occident et un pays africain de civilisation musulmane.
Des deux côtés, il y a une incompréhension totale.
Du côté occidental, on crie au scandale et on explique qu’il ne s’agissait pas de faire la promotion de l’homosexualité, mais simplement de se lever contre les discriminations et les violences contre les personnes ayant des pratiques sexuelles autres qu’hétéro sexuel.
Le comportement du footballeur sénégalais, de ce point de vue, est moralement une faute.
Il faut cependant reconnaître que la prise de conscience occidentale est récente.
- En 1954, un des plus grands génies scientifiques Alan Turing s’est suicidé parce que la justice britannique après l’avoir condamné à de la prison l’avait ensuite contraint à une castration chimique parce qu’il était homosexuel.
- En France, ce n’est que le 4 août 1982 que la France dépénalisait l’homosexualité lors d’un vote de l’Assemblée Nationale obtenu par Robert Badinter sous la présidence de François Mitterrand.
- Et ce n’est qu’en 1990 que l’Organisation mondiale de la santé a supprimé l’homosexualité de la liste des maladies mentales.
Mais peu importe qu’il s’agisse d’une prise de conscience récente, depuis 3 siècles, pour l’Occident quand il avait pris une position morale, il avait l’habitude que cela devienne une position universelle.
Ainsi, concernant la démocratie et les droits de l’homme, notamment de ne pas enfermer les opposants, l’Occident disait le droit, la morale et ce qu’il convenait de faire.
Et ceux qui ne faisaient pas comme l’Occident, s’excusaient de ne pas être arrivé au niveau « civilisationnel » de l’Occident et demandait un peu d’indulgence et de temps pour rejoindre les normes occidentales.
Dans cette affaire, on constate que ce n’est plus du tout le cas.
Tous les intervenants sénégalais cités partent du principe que « l’acceptation de l’homosexualité » est une valeur occidentale qui est contraire à leurs valeurs.
Ils n’envisagent, en aucune façon, une évolution future.
C’est un choc de culture et un choc de valeur.
Dans le monde des civilisations islamiques, cette vision est partagée.
Ainsi pour la coupe du monde de football au Qatar, fin 2022, les autorités qataries ont indiqué que les supporters LGBT qui assisteront à l’événement devront faire preuve de discrétion.
Abdulaziz Abdullah al-Ansari le directeur de la sécurité de la coupe du monde a déclaré :
« Si un supporter brandit un drapeau arc-en-ciel dans un stade et qu’on le lui enlève, ce ne sera pas parce qu’on veut l’offenser, mais le protéger […] il ne s’agit pas là de propos discriminatoires. Si on ne le fait pas, un autre spectateur pourrait l’agresser. Si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faites-le dans une société où cela sera accepté »
Dans le pays de l’Islam chiite <Le Parisien> dans un article du 5 septembre 2022, nous apprend que deux lesbiennes et militantes LGBTQ viennent d’être condamnées à mort.
Ces deux femmes, Zahra Sedighi Hamedani, âgée de 31 ans, et Elham Chubdar, 24 ans, ont été condamnées à mort par un tribunal dans la ville d’Ourmia (nord-ouest).
L’Autorité judiciaire a confirmé la condamnation à mort pour « corruption sur terre » des jeunes femmes. Il s’agit de la charge la plus grave du code pénal iranien.
Bien sûr, les ONG nous invitent à protester auprès des autorités iraniennes et de demander l’annulation de la sentence.
Ce sont deux mondes culturels.
Étant donné notre évolution morale en France, le Sénégal, le Qatar sont « des malveillants, des méchants » et pour l’Iran « des criminels ».
Mais pour ces pays, nous, autres occidentaux, sommes des êtres dépravés, immoraux.
Il n’y a plus d’hégémonie morale occidentale.
Alors que faisons-nous ?
Nous n’allons pas faire la guerre pour imposer nos valeurs !
Nous n’allons même pas, envoyer des missionnaires, pour essayer de convertir ces peuples parce ce que venant de l’Occident, ils seraient rejetés.
Mais devons nous accepter dans nos pays que ces représentants d’une autre civilisation transgressent notre morale ?
Parce que personne n’a demandé à Idrissa Gueye de devenir homosexuel, on lui a simplement demander de s’associer à la condamnation du rejet des homosexuels.
Le Qatar exige que les personnes LGBT venant d’Occident se dissimulent, restent discrets, se cachent.
De notre point de vue, dans nos valeurs, ces musulmans sont homophobes.
Alors pourquoi ne pourrait-on pas exiger, quand ils sont en Occident, d’être discrets et de cacher le fait qu’ils sont homophobes ?
Les éléments de ce mot du jour se trouvent derrière ces liens :
https://www.letemps.ch/sport/soutien-idrissa-gueye-accuse-dhomophobie-france-ne-faiblit-senegal
<1708>
- En 1954, un des plus grands génies scientifiques Alan Turing s’est suicidé parce que la justice britannique après l’avoir condamné à de la prison l’avait ensuite contraint à une castration chimique parce qu’il était homosexuel.
-
Mardi 13 septembre 2022
« Deux pays, ayant présidé à la création du tribunal de Nuremberg, sont en train de réduire en miettes leurs engagements. »Philippe Sands parlant du Royaume-Uni et des Etats-Unis en raison de leur comportement à l’égard des ChagosJe souhaite revenir sur ma série concernant le choc des civilisations qui est surtout le choc des civilisations non occidentales contre la civilisation occidentale.
Nous avons du mal avec ce rejet, parce qu’il remet en cause beaucoup de nos valeurs que nous voulons, pensons, espérons universelles.
Il s’agit d’une question d’une très grande sensibilité. L’Occident a beaucoup trahi les valeurs qu’il prétendait partager avec tous les autres peuples.
Est-ce que pour autant les valeurs de démocratie, des droits de l’homme, de la liberté de pensée et d’expression ne méritent pas d’être défendues ?
C’est toute la question. C’est un chemin compliqué. Les valeurs de l’Occident ne sont pas seulement remises en cause par les autres civilisations.
L’Occident a généré, en son sein même, des ennemis de ces valeurs : l’Amérique de Trump d’un côté et l’Amérique de la cancel culture et du communautarisme de l’autre côté, en constituent des exemples éclairants et désespérants.
Ces mouvements sont aussi arrivés en France avec la même intolérance et le même aveuglement.
Mais avant d’emprunter ce chemin pour essayer de comprendre ce qui se joue devant nos yeux, je vais aujourd’hui évoquer une de ces histoires qui alimente la collection des trahisons et des fautes de l’Occident.
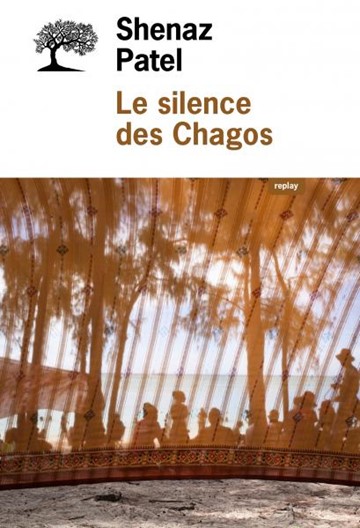 Le bras agissant dans cette affaire est le Royaume-Uni d’Elizabeth II, encouragé et influencé par les États-Unis.
Le bras agissant dans cette affaire est le Royaume-Uni d’Elizabeth II, encouragé et influencé par les États-Unis.
J’avais déjà évoqué ce sujet dans un mot du jour très ancien qui date du 2 septembre 2013 : « Le silence des chagos » qui est un livre de Shenaz Patel
Cette lamentable histoire est revenue dans l’actualité, en raison de l’évolution du dossier et d’un livre qui vient d’être publié en France : « La dernière colonie » de Philippe Sands traduit par Agnès Desarthe
Philippe Sands était l’invité de Guillaume Erner aux matins de France Culture d’hier le 12 septembre pour parler de son livre et aussi de l’actualité du Royaume Uni : < Royaume-Uni : l’empire qui ne voulait pas mourir >
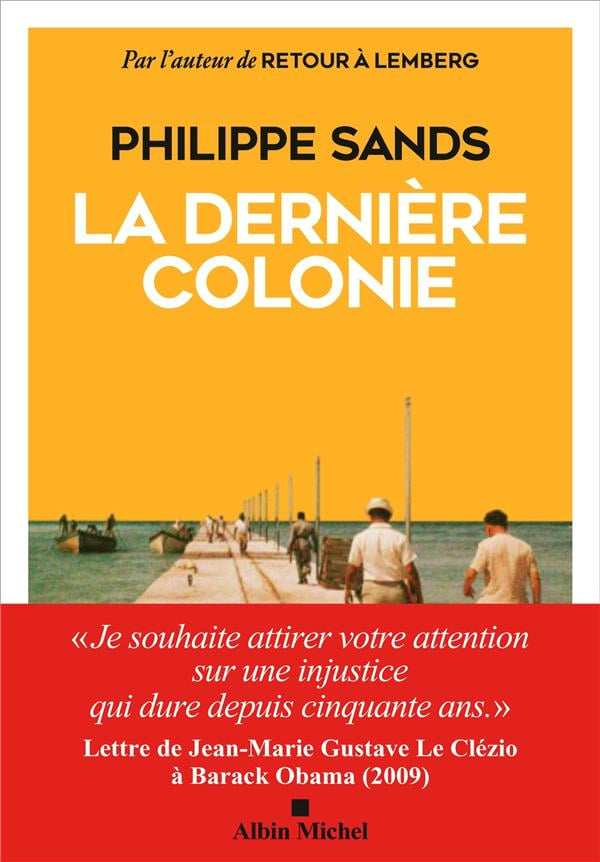 Philippe Sands est un avocat franco-britannique spécialisé dans la défense des droits de l’Homme, professeur de droit au University College de Londres.
Philippe Sands est un avocat franco-britannique spécialisé dans la défense des droits de l’Homme, professeur de droit au University College de Londres.
Il a écrit un ouvrage remarquable publié en 2017 dans sa traduction française : « Retour à Lemberg ». Le site Dalloz résume cet ouvrage fondamental de la manière suivante :
« Dans un ouvrage passionnant, reposant sur une subtile biographie croisée de quatre personnages réunis par la ville de Lemberg (aujourd’hui Lviv, en Ukraine), l’avocat Philippe Sands livre une réflexion majeure sur les origines de la justice internationale à Nuremberg. En documentant et en relatant la préparation de ce procès exceptionnel à plus d’un titre, Philippe Sands dévoile un parcours initiatique personnel et familial d’une belle sensibilité. »
« Le Monde » avait publié aussi un article de fond sur cet ouvrage : < Philippe Sands de Lviv à Nuremberg >
A Nuremberg, les accusés nazis étaient accusés de 4 crimes :
- Conjuration
- Crime de guerre,
- Crime contre la paix
et, pour la première fois de l’histoire,
- Crime contre l’humanité.
Après cette longue introduction, pourtant très condensé nous pouvons revenir à l’Histoire de l’Archipel des Chagos situé dans l’Océan Indien et qui fait normalement partie des iles rattachées à la République de Maurice dont l’ile principale est l’ile Maurice.
Si vous voulez replacer ces iles sur une mappemonde il faut en revenir à mon premier mot du jour : « Le silence des chagos ».
En 1960, ces territoires étaient colonies britanniques et au sein de la décolonisation, tous ces territoires devaient devenir indépendants dans le cadre de la République de Maurice en 1968.
Mais en 1965, les britanniques vont détacher l’archipel des Chagos, c’est-à-dire un ensemble de sept atolls situés dans le Nord de l’océan Indien et totalisant cinquante-cinq îles du reste de l’entité Mauricienne. Ils créent ainsi leur dernière colonie.
Pourquoi font-ils cela ?
Philippe Sands explique ainsi cette histoire : En 1964, les britanniques dont le premier ministre est alors Harold Wilson refuse de s’engager dans la guerre du Vietnam au côté des américains.
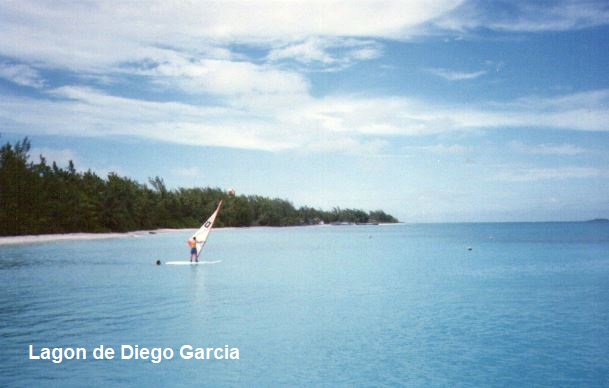 Les américains acceptent cette défection mais suggèrent aux britanniques de les soutenir autrement, en mettant à leur disposition l’île principale de l’archipel des Chagos : Diego Garcia pour y installer une base militaire, au plein milieu de l’Océan Indien.
Les américains acceptent cette défection mais suggèrent aux britanniques de les soutenir autrement, en mettant à leur disposition l’île principale de l’archipel des Chagos : Diego Garcia pour y installer une base militaire, au plein milieu de l’Océan Indien.
Les Britanniques acceptent cette demande, trop heureux, de pouvoir ainsi compenser leur refus d’entrer dans la guerre du Vietnam.
Dans « Astérix et les normands » Goscinny avait fait dire à un normand cette phrase cynique : « Il faut savoir sacrifier les autres ».
Les Britanniques vont, en effet, céder à un autre caprice des États-Uniens : l’archipel des Chagos doit être vidé de tous ses habitants.
Cela aboutit à une déportation de tous les habitants qui vivaient sur ces iles. Déportation vers l’ile Maurice où ils vont vivre de manière misérable.
La création de cette colonie par amputation de la future République de Maurice ainsi que la déportation des habitants étaient parfaitement illégales par rapport au Droit International que l’Occident avait contribué à mettre en place.
Dans les années 1960, l’Occident était encore en mesure de dicter sa volonté même contraire à la Loi.
Depuis les habitants du Chagos cherchent par les voies juridiques à revenir sur le territoire de leurs ancêtres.
Liseby Elysé est une de ces habitantes. Elle a été déportée avec les autres. Elle était enceinte et a perdu son enfant dans cette déportation.
Philippe Sands a rencontré Liseby Elysé et est devenu son avocat.
Le livre « La dernière colonie » raconte ce combat commun.
Dans un <article du Monde> publié le 4 septembre 2022 , on lit :
« Un jour de 2018, Liseby Elysé se présente devant Cour internationale de justice (CIJ) et déclare : « Je suis venue à La Haye pour récupérer mon île. » […]
Auprès d’elle, à La Haye, où elle s’apprête à témoigner, se tient l’avocat franco-britannique Philippe Sands, inlassable défenseur des droits humains dans les zones les plus brûlantes de la planète.
Engagé par le gouvernement de l’île Maurice, il obtient de la CIJ un jugement historique, qui reconnaît l’injustice commise contre Liseby et les siens et impose au Royaume-Uni d’autoriser leur retour.
A ce jour, pourtant, rien n’a été fait. A Maurice, aux Seychelles, à Londres, les Chagossiens attendent encore. « Nous avons le droit de vivre là-bas, disent-ils à Philippe Sands, nous ne renoncerons jamais. »
C’est à cela que sert la publication simultanée, en anglais et en français […] de La Dernière Colonie : Réveiller l’opinion publique.
Mettre au service des Chagos la puissance littéraire qu’ont fait connaître au monde entier les deux précédents livres de Sands, Retour à Lemberg et La Filière (Albin Michel, 2017 et 2020). Et parce que cette manière de nouer la politique et la littérature, loin de tout discours idéologique, en unissant les pouvoirs de l’une et de l’autre pour les insérer ensemble dans la réalité, rend son œuvre unique, ce livre, passionnante synthèse de toutes les vies de son auteur, fournit une parfaite occasion de revenir sur chacune d’elles, et sur le tout qu’elles ont fini par créer.
Quand le gouvernement britannique annonce, en 2010, la création d’une aire marine protégée (AMP) autour des Chagos, l’initiative paraît louable à beaucoup. Pas aux anciens habitants de l’archipel, chassés de leurs îles par les mêmes Britanniques entre 1967 et 1973.
Si l’AMP est installée, la pêche sera interdite dans la zone, et ils ne pourront revenir : comment subsisteraient-ils ?
Le projet semble balayer leurs espérances.
En réalité, il va bientôt se retourner contre le Royaume-Uni. Des documents commencent à circuler, démontrant que l’administration britannique joue sciemment les défenseurs de l’environnement contre ceux des Chagossiens.
L’île Maurice, qui n’avait pu accéder à l’indépendance, en 1968, qu’en cédant par force les Chagos, se tourne vers la Cour internationale de justice, laquelle, en 2019, lui donne raison. Les Chagossiens peuvent rentrer. Sauf que, depuis, les Britanniques feignent de ne pas avoir entendu la leçon. »
Par rapport à 2013, nous avons avancé maintenant la justice internationale donne raison aux Chagos, mais les britanniques et les américains ne se sont toujours pas soumis à cette décision.
Dans « L’Obs » un article de ce 11 septembre <Philippe Sands, l’avocat en guerre contre Londres> explique :
« Depuis Nuremberg, la notion de « crime contre l’humanité » inclut la « déportation » et la Convention européenne des Droits de l’Homme entrée en vigueur en 1953 offre à un individu la possibilité de porter plainte contre son propre pays devant une cour internationale. Les Chagossiens ont au départ peu d’espoir.
La Grande-Bretagne soutenue par les Etats-Unis avait même préféré les prévenir : aucune chance qu’un recours au droit international ne mette fin à la tutelle coloniale sur les Chagos. C’était sans compter sur la détermination des avocats dont, on l’aura compris, Philippe Sands. Il se bat aux côtés de Liseby Elysé et de sa famille, convaincu que cette affaire est le dernier vestige du colonialisme.
Cette indignation se traduit par des années de lutte, un périple juridique complexe au sein des institutions internationales, jusqu’à la Cour internationale de Justice de La Haye. Le livre retrace avec minutie ce parcours, montrant le rôle compliqué qu’a joué le droit international depuis 1945 dans le recul du colonialisme. […] en 2019 la Cour a conclu que le Royaume-Uni devait mettre fin à son administration sur les Chagos. Et qu’en 2022, à la faveur d’une mission scientifique autorisée par Londres, Liseby Elysé, à l’âge de 69 ans, a pu retourner quelques heures sur sa terre natale et nettoyer la tombe de ses proches. »
Cet article rapporte que la position de la Grande-Bretagne et des États-Unis devient intenable :
« La réputation de la Grande-Bretagne en tant que garante de l’état de droit international a volé en éclats. » Le soutien des États-Unis devient à son tour intenable. Deux pays, ayant présidé à la création du tribunal de Nuremberg, sont en train de « réduire en miettes leurs engagements ». Une régression inquiétante aux yeux de Sands qui a toujours dit l’importance qu’il accordait à ce moment révolutionnaire que fut Nuremberg, et pour qui le droit international est notre seul système de valeurs commun. Sans compter que les implications géopolitiques sont graves : comment critiquer l’occupation illégale de l’Ukraine par la Russie quand on continue d’occuper illégalement une partie de l’Afrique ? »
Cet article < Liseby Élysée : « notre voix est entendue à travers le monde »> est une interview de cette femme après son témoignage à la Cour internationale de Justice.
Dans cet article on apprend que :
« Bien qu’elle soit un être humain, elle a été placée dans la cale du bateau qui déportait les Chagossiens vers Maurice. Le voyage a duré 4 jours. Elle était enceinte et a accouché dans le bateau. Son enfant est mort durant la traversée. »
Des informations se trouvent aussi sur <Site> d’un journal de la République de Maurice
Et je redonne le lien vers l’émission de France Culture : < Royaume-Uni : l’empire qui ne voulait pas mourir >
<1707>
- Conjuration
-
Lundi 12 septembre 2022
« Pause (Une reine qui régnait depuis 70 ans est décédée.) »Jour sans mot du jour nouveauJ’ai été occupé ce Weekend par une autre activité que l’écriture du mot du jour, la pause est donc de rigueur.
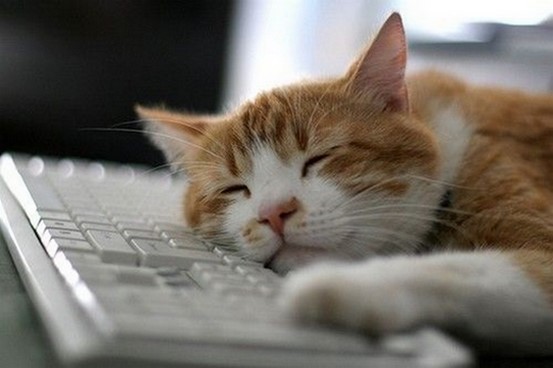 Autour de nous, les télévisions, les radios et les journaux sont saturés d’émissions plus ou moins pertinentes sur le décès de la Reine d’Angleterre et son remplacement par son fils de 73 ans.
Autour de nous, les télévisions, les radios et les journaux sont saturés d’émissions plus ou moins pertinentes sur le décès de la Reine d’Angleterre et son remplacement par son fils de 73 ans.
Ils n’ont pas été aussi agités pour célébrer Mikhaël Gorbatchev, l’homme qui a changé le monde.
Alors qu’Elizabeth II s’est contentée d’être la spectatrice qui observait le monde en train de changer et accompagnait le déclin de l’empire britannique.
Ainsi va le monde, l’apparat et l’or des palais restent objet de dévotion.
Si vous voulez entendre une analyse sérieuse, je vous conseille ces 3 émissions :
France Culture : « L’Esprit Public »: <Le mythe autour de la reine Elizabeth II>
Slate : « Le monde devant soi » : <Les défis de Charles III, successeur d’une reine Elizabeth II très populaire>
France Culture : « Affaires étrangères » : < Mort d’Elizabeth II : royauté et identité britanniques en question>
La reine est morte, vive le Roi et les caricaturistes se sont déchainés : j’ai aimé celle ci
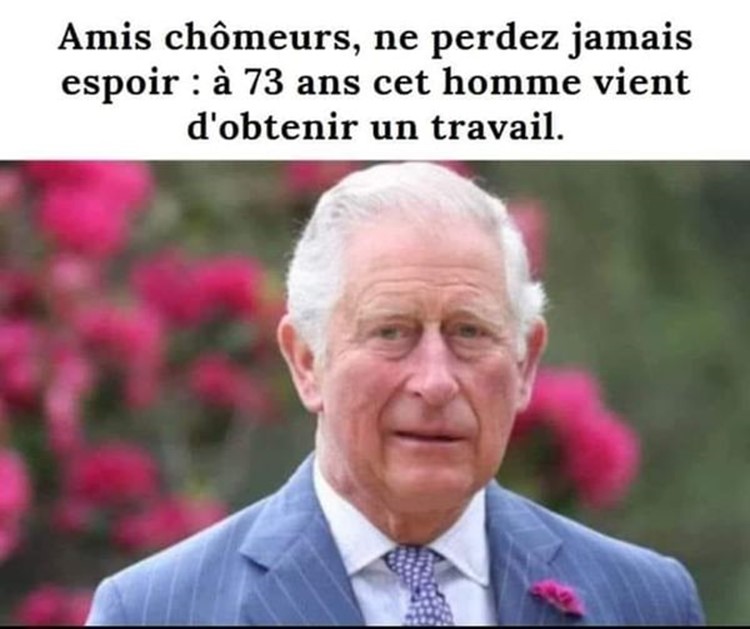
Et il en est même qui se moque de la défunte Reine. Les couleurs de sa garde robe ont conduit à ce moment d’humour.

<Mot du jour sans numéro>
-
Vendredi 9 septembre 2022
« Est-ce la décroissance ou la croissance qui, sur le long terme, est un mythe ?Question qu’il me semble légitime de poserAntoine Bueno est né en 1978.
Je ne le connaissais pas.
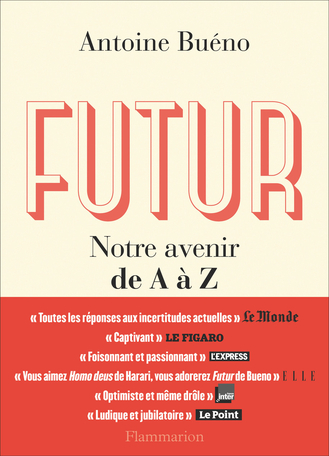 « Le Point » le présente ainsi : essayiste et conseiller au Sénat en charge du développement durable, est notamment l’auteur de « Futur, notre avenir de A à Z » (éditions Flammarion). Son prochain ouvrage « L’effondrement (du monde) n’aura (probablement) pas lieu » (Flammarion) sortira le 19 octobre prochain.
« Le Point » le présente ainsi : essayiste et conseiller au Sénat en charge du développement durable, est notamment l’auteur de « Futur, notre avenir de A à Z » (éditions Flammarion). Son prochain ouvrage « L’effondrement (du monde) n’aura (probablement) pas lieu » (Flammarion) sortira le 19 octobre prochain.
Il a commis un article dans Le Point, publié le 4 septembre 2022 : « La décroissance est un mythe »
Il cite Élisabeth Borne qui comme Aurélien Barrau avait rendu visite au MEDEF et a déclaré :
« La décroissance n’est pas la solution. »
Il est d’accord avec cette opinion et regrette que
« [La décroissance] est pourtant devenue incontournable dans le débat écologique. Des experts comme Jean-Marc Jancovici s’en font l’avocat, des personnalités politiques telles que Delphine Batho en font un programme, des penseurs tels que Gaspard Koenig, un objet de rêverie philosophique. »
Il explique que personne ne dispose d’un mode d’emploi pour savoir comment faire, c’est-à-dire décroitre tout en préservant le corps social d’une implosion.
Il tente une définition :
« La décroissance peut être définie comme une action volontaire de réduction de la taille physique de l’économie, un processus organisé visant à réduire la quantité de matière et d’énergie exploitée par le métabolisme de la société humaine (Susan Paulson). »
Pour lui, une politique de décroissance est impossible à mettre en œuvre.
Et je vous livre ses arguments :
« La première raison à cela relève du plus froid réalisme : aujourd’hui, personne n’en veut. Aucun pays n’est prêt à se lancer dans une réduction volontaire de la production et de la consommation.
Peut-être sera-ce le cas dans un avenir plus ou moins lointain. Mais c’est aujourd’hui que le monde a besoin de décroissance.
Pour qu’elle ait un impact écologique, elle devrait être mise en œuvre au plus vite. La planète n’a pas le temps d’attendre la maturation d’une idée.
Ensuite, pour qu’une politique de décroissance porte ses fruits, elle devrait être mise en œuvre par le monde entier en même temps.
Dans un monde ouvert et interconnecté, un ou plusieurs pays ne peuvent pas décroître isolément, indépendamment des autres, même de très grands pays.
On ne peut pas décroître seul, contre le reste du monde. Le faire se traduirait par une politique d’autarcie. En décroissant seul, un pays aurait de moins en moins de moyens économiques pour financer les importations dont il a besoin. Il devrait donc devenir totalement autosuffisant. C’est impossible pour les petits pays qui dépendent, entre autres, de ressources énergétiques ou alimentaires extérieures. Et on sait que même les grands pays bien dotés en ressources naturelles ont du mal à assurer leur autosuffisance.
De plus, un tel pays n’attirerait plus d’investissements étrangers puisque ceux-ci ne sont réalisés que dans l’attente d’un retour, c’est-à-dire d’une rentabilité condamnée par l’absence programmée de croissance. Au contraire, les intérêts étrangers en activité sur son territoire s’en retireraient. Sur le plan intérieur, ce pays verrait donc rapidement son tissu économique se rétrécir et se déliter. La décroissance dans un pays isolé ne peut mener qu’à une catastrophe économique à l’image de celle observable en Corée du Nord.
Enfin, même si par un coup de baguette magique le monde s’entendait pour mettre en œuvre un programme global de décroissance, ce dernier ne pourrait aboutir qu’à une réduction considérable du niveau de vie moyen sur la planète. En effet, pour éviter cet effet, pour maintenir voire augmenter le niveau de vie des peuples tout en décroissant, les partisans de la décroissance en appellent à la redistribution. L’idée est que l’on peut rendre socialement indolore une réduction de l’économie en redistribuant bien mieux qu’aujourd’hui ses fruits. Une telle redistribution serait cependant illusoire. »
Ces arguments me semblent très forts.
L’auteur montre que la décroissance aurait des conséquences fâcheuses dans nos sociétés. Et il proclame sa croyance dans une croissance durable.
Ces sujets sont évidemment très complexes. Toutefois il faut en revenir à des sujets solides et physiques.
Si on en revient à la définition de la décroissance de Susan Paulson qu’Antoine Bueno met en lumière : « une réduction de la quantité de matière et d’énergie exploitée par le métabolisme de la société humaine »
La « non décroissance », appelée plus simplement « la croissance » est donc le contraire. C’est-à-dire : « une augmentation de la quantité de matière et d’énergie exploitée par le métabolisme de la société humaine »
J’ai écouté des conférences Philippe Bihouix qui systématiquement explique une chose simple que vous êtes capable de reproduire sur un simple tableur.
Imaginez une croissance de 2% chaque année de manière infinie.
Ce n’est pas grande chose 2%, c’est très raisonnable.
Donc l’année 1 on a 1 et l’année 2 on a 1,02.
Vous verrez sur votre tableur que l’année 36 on est à 2 : on a doublé le PIB
L’année 57 on est à 3, l’année 71 on est à 4. L’année 118 on est à 10
On a multiplié par 10 le PIB dans le monde fini qu’est la terre.
On a fait à peu près cela depuis le début de l’ère industrielle et on voit où nous en sommes par rapport au réchauffement climatique, la bio-diversité, la pollution etc..
Pour arriver à 100 il faut attendre l’année 234 !
 Donc dans ce système, au bout de 234 ans, on multiplierait la quantité de matière et d’énergie exploitée par 100 !
Donc dans ce système, au bout de 234 ans, on multiplierait la quantité de matière et d’énergie exploitée par 100 !
Certains diront, oui mais on va améliorer l’efficacité : et donc on va multiplier le PIB par 100 mais pas la quantité de matière et d’énergie en proportion !
Peut être, mais on sera obligé quand même d’augmenter l’énergie et la matière exploitée, de manière considérable.
La terre ne peut pas faire face à cette demande.
Alors oui probablement la décroissance est infaisable ou très très compliquée.
Mais ce qui est un vrai mythe, c’est la croissance infinie pour la société d’homo sapiens sur terre !
Et si vous avez encore des doutes je vous invite à regarder cette vidéo passionnante de Philippe Bihouix <La technologie ne nous sauvera pas>
<1706>
-
Jeudi 8 septembre 2022
« Tant que vous nommerez « croissance », le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par un espace commercial, fut-il neutre en carbone, nous n’aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. »Aurélien Barrau, lors de l’Université d’Été du MEDEF de 2022Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Aurélien Barrau est né en 1973 et il est astrophysicien et sa fiche Wikipedia ajoute philosophe français.
Il est spécialisé en relativité générale, physique des trous noirs et cosmologie. Il est directeur du Centre de physique théorique Grenoble-Alpes et travaille au Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Il est professeur à l’université Grenoble-Alpes.
C’est un militant écologiste favorable à la décroissance.
Je pense que les responsables du Patronat français le connaissent et savent les thèses qu’il défend.
Et pourtant, ils l’ont invité à la dernière Université du MEDEF.
 Ils n’ont pas été déçus !
Ils n’ont pas été déçus !
Son introduction à la table ronde à laquelle il a été invité sur le thème qui traitait de la manière dont l’Europe pouvait devenir « le continent le plus vert de la planète » a été tonitruante.
Elle a été très largement diffusée sur internet : <Aurélien Barrau a l’université d’été du MEDEF>
Il a commencé en attaquant de front la manière d’aborder le sujet écologique par ce prisme européen, révélateur selon lui d’une « arrogance » occidentale :
« Ce thème est très caractéristique de l’arrogance occidentale. Je crois que nous n’avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d’être qui mènent, je cite, à ce que l’ONU nomme « une situation de menace existentielle directe ».
Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Quelle suffisance ! »
Belle entrée en matière !
Il explique ensuite que, selon lui, les dirigeants politiques et économiques passent à côté de l’essentiel.
« Pour trois raisons fondamentales :
La première est que ce qui est fait concernant le réchauffement climatique, et on le sait très bien, est dérisoire !
La deuxième qui est plus grave encore et qui est moins bien comprise, c’est que le réchauffement climatique est, dans une certaine mesure, lui-même dérisoire par rapport à l’étendue de la crise systémique et pluri factoriel que nous traversons : Pollution, acidification des océans, interruption des cycles bio et géochimique, dévastation des espaces naturels, n’ont pour l’essentiel rien à voir avec le climat, mais tuent davantage que ce dernier. Ce qui signifie que chacun des piliers sur lesquels reposent l’habitabilité de cette planète est en train de céder.
Et mon troisième est peut-être plus grave encore. Et il consiste à remarquer que, quand bien même, nous prendrions à bras le corps chacun des items que je viens de mentionner, ce qui n’est pas du tout le cas en pratique, nous demeurerions vraisemblablement toujours dans le dérisoire. Parce que le véritable problème, c’est qu’aujourd’hui notre rapport au monde, notre être à l’espace, fait de l’éradication systématique du vivant une finalité.
Parce que nous sommes des gens sympathiques et éduqués, on se demande, en gros, comment faire des bombes issues du commerce équitable et utilisant des matériaux biologiques. C’est mignon, mais tant que le pilonnage en règle de la biosphère demeure le geste cardinal, croyez-moi, l’origine des projectiles n’a pas beaucoup d’importance. »
Et il a lancé cet anathème qui a été beaucoup repris sur les réseaux sociaux et que je reprends comme exergue à ce mot du jour :
« Tant que vous nommerez « croissance », le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par un espace commercial, fut-il neutre en carbone, nous n’aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. »
Et il a aussi repris une évolution qu’il a combattu depuis le début : la 5G
« Tant que le président du Medef nommera, à l’unisson d’ailleurs du chef de l’État, « progrès », la mise en place d’une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond strictement à aucun besoin mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées d’un point de vue de la pollution, de la consommation et de l’addiction, nous n’aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. »
Et il a fini par cette conclusion :
« Je crois qu’il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l’avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Nous avons d’ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d’eau douce, des mammifères sauvages. Nous laissons d’ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. Si, même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d’une refonte axiologique et ontologique drastique, c’est que nous faisons preuve d’une cécité que nos descendants, s’ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner. »
Bon, ça c’est dit !
On peut nuancer ou même critiquer sur certains détails :
Il parait excessif de dire que « l’éradication systématique du vivant constitue une finalité ». Dire que l’éradication du vivant n’est jamais considérée comme un obstacle pour poursuivre les finalités humaines de profits me parait plus juste
C’est particulièrement le cas de la déforestation de l’Amazonie.
<Reporterre> évoque un Rapport tout récent :
« L’Amazonie : 390 milliards d’arbres, plusieurs millions d’espèces d’insectes, un nombre incalculable d’oiseaux, de mammifères et de reptiles, pour certains encore inconnus de l’être humain. Un trésor de biodiversité qui, malheureusement, s’effondre. Selon un rapport publié le 6 septembre par un regroupement d’organisations environnementales amazoniennes (RAISG) et la Coordination des organisations indigènes du bassin amazonien (Coica), la forêt pluviale a atteint son « point de bascule ». Certaines zones commencent déjà à se transformer en savane. »
Sa position sur la 5G qui ne répondrait strictement à aucun besoin est peut-être aussi exagérée, il est possible que certaines utilisations médicales puissent en profiter. En revanche, l’addiction et le phénomène qu’on appelle « le rebond » et qui conduit à ce que type d’évolution conduise massivement à une nouvelle surconsommation d’énergie est certainement exacte.
Donc, si on peut nuancer, je crois quand même qu’il faut reconnaître que globalement son constat est exact.
A ce stade de la réflexion, je pense au « moment Gorbatchev ».
Gorbatchev a aussi fait le constat que le système, qu’il essayait de diriger, était mauvais.
Alors, il a essayé de le réformer.
Ses réformes ont entrainé de grands malheurs et souffrances pour la société.
Ce mauvais système s’est effondré !
Et finalement le système qui a remplacé l’ancien, sur beaucoup de points, était pire que l’ancien.
Faire le constat que cela ne fonctionne pas est fondamental.
Réaliser localement des réponses qui permettent d’améliorer en pratique et dans le quotidien notre rapport au vivant, à la biodiversité, notre impact climatique et écologique est essentiel.
Mais ensuite, mettre à bas, faire exploser notre organisation actuelle n’est probablement pas très compliqué si on s’y attaque résolument.
Mais après ?
Ceux qui sont dans les villes, pourront-ils faire face à leurs besoins primaires d’alimentation, d’hygiène et de santé ?
Trouveront-ils des médicaments dans des pharmacies ou ailleurs ?
Y aura-t-il de l’eau au robinet et de l’électricité quand on actionne l’interrupteur ?
Pourront ils avoir de l’argent qui permet de tant simplifier et fluidifier les échanges ?
Et si la solution proposée est de quitter massivement les métropoles, où iront ces citadins ? vers quels endroits où ils pourront se loger, se nourrir, se soigner ?
Nous ne sommes pas 5 millions, nous sommes 8 milliards.
Dire qu’il faut revoir toute l’organisation est très juste.
Mais pour aller vers quoi ? Et comment faire pour y aller ?
Voilà des sujets très compliqués dont j’entends peu parler.
Si vous voulez écoutez plus que les 5 minutes d’introduction d’Aurélien Barreau, c’est à dire l’ensemble de l’échange, c’est <ICI>
<1705>
-
Mercredi 7 septembre 2022
« Qui y a-t-il de plus fort que le sentiment d’aimer une femme et d’être aimé par elle ? »Mikhaël Gorbatchev, évoquant son amour pour son épouse RaïssaC’est un documentaire un peu étrange qu’« ARTE » a diffusé en l’honneur de Mickhaël Gorbatchev : <Gorbatchev – En aparté>
Ce documentaire restera disponible sur le site d’ARTE jusqu’au 28 février 2023.
 Un nonagénaire au visage et au corps gonflés par le diabète avance péniblement, à l’aide d’un déambulateur, dans la maison que l’État russe a mis à sa disposition et dont il possède l’usufruit.
Un nonagénaire au visage et au corps gonflés par le diabète avance péniblement, à l’aide d’un déambulateur, dans la maison que l’État russe a mis à sa disposition et dont il possède l’usufruit.
L’homme de la perestroïka et de la glasnost se laisse filmer dans son intimité par le réalisateur Vitaly Manski qui le connaît et le vénère.
Son visage est devenu lunaire, son corps est épuisé. Il est quasi méconnaissable, mais sur le crâne lisse, apparait la fameuse tache de naissance qui est devenu célèbre avec lui.
La présentation de ce documentaire, tournée en 2019, est alléchante : Près de trente ans après l’effondrement de l’Union soviétique, quel regard porte-t-il sur son testament politique, depuis son avènement au pouvoir en 1985 jusqu’à sa démission, le 25 décembre 1991 ?
Il ne dit pas grand-chose, en tout cas rien de nouveau.
Il refuse obstinément de se prononcer sur la politique contemporaine de la Russie de Poutine.
Bernard Guetta explique dans une interview que Poutine a exigé, pour que sa fin de vie reste paisible dans cette maison confortable, que ses commentaires et critiques à son égard restent mesurés.
Ce que j’ai trouvé unique, dans ce documentaire, c’est l’émotion qui se dégage quand ce vieil homme malade parle de son amour pour sa compagne de 46 ans Raïssa Maximova Tilorenko, morte d’une leucémie en 1999 dans un hôpital de Munster.
Des photos ou des peintures la représentant se trouvent partout dans la maison.
A 24 minutes 30 du documentaire, Mikhail Gorbatchev parle de sa fille qui a quitté la Russie et qui vit en Occident, comme ses enfants.
Et Gorbatchev ajoute :
« Du temps de Raïssa, tout le monde était là.
Je n’arrive toujours pas à m’y faire. »
Vitaly Manski le relance alors :
« Lorsque Raissa Maximova est décédé vous avez déclaré à plusieurs reprises que pour vous la vie n’avait plus de sens. »
Et Gorbatchev répond immédiatement :
« C’est vrai ! »
 Et quand le réalisateur pose la question : « Comment ça ? » il répète
Et quand le réalisateur pose la question : « Comment ça ? » il répète
« Elle n’en a plus ! »
Gorbatchev mange et se tait.
Alors Manski tente une nouvelle relance :
« C’est quoi le sens de la vie ? »
Gorbatchev continue à manger et ne répond pas. Il y a un long silence.
Le questionneur tente une réponse :
« Est-ce que cela ne serait pas d’aimer une femme tout simplement ? Et d’avoir des enfants avec elle ? Il ne faut peut-être pas chercher plus loin … »
Et Le vieil homme brusquement reprend la parole et dit :
« Qui y a-t-il de plus fort que le sentiment d’aimer une femme et d’être aimé par elle ?
Il y a tant de jolies filles, tant de doux noms à entendre.
Mais un seul, dans mon cœur, brille, me parait si beau, si tendre. »
Un peu plus loin dans le documentaire à 32:50, il dit :
« On ne s’est jamais séparé, on était toujours ensemble. On ne faisait qu’un.
On se demande à quoi ça tient.
On me disait qu’elle me menait par le bout du nez.
Ce que je n’ai jamais démenti. En fait, j’étais tout à fait d’accord. Et c’était bien comme ça. […]
Je me souviens d’une interview de Jacques Brel entendu à la radio.
J’étais très jeune mais ces paroles me sont restées.
« Il y a qu’un tout petit nombre de personnes qui sont en capacité de vivre le grand amour toute une vie »
 Raissa Tilorenko,et Mikhaël Gorbatchev faisaient partie de ce petit nombre.
Raissa Tilorenko,et Mikhaël Gorbatchev faisaient partie de ce petit nombre.
C’est d’autant plus difficile pour les hommes de pouvoir qui ont tant besoin de séduire et de se rassurer en séduisant encore.
Dans tous les documentaires que j’ai vu, chaque fois que Gorbatchev parlait de Raissa, de sa mort, de sa dépression après le putsch des conservateurs de juillet 1991, les larmes venaient et il devait s’essuyer les yeux.
Dans un article rédigé par Annick Cojean dans le Monde : < Mikhaël Gorbatchev : une enfance soviétique dans une famille aimante> il révèle :
« Je suis né dans une famille heureuse. Mon père aimait beaucoup ma mère. En fait, ils ne faisaient qu’un. Ma mère était d’origine ukrainienne, région de Tchernigov, mon père de racines russes, région de Voronej. Ils étaient très heureux ensemble. »
Et à cette journaliste il a dit :
« L’éthique et la morale de mon grand-père sont restées mes références. Lui et mon père m’ont servi d’exemple. Je ne les ai pas trahis. Car ce n’est jamais la gloire qui m’a inspiré, ni la conservation du pouvoir. Ce sont les gens simples et dignes que j’avais connus, ceux que l’histoire avait malmenés et qui méritaient de vivre dans un monde libre et démocratique. Et tant pis pour la Nomenklatura que j’ai vexée et secouée ! Je ne veux ni qu’elle me pardonne ni qu’elle me réhabilite.
Car, de toute façon, j’ai gagné ! Le processus démocratique est irréversible ! J’ai réussi parce que je venais de ce monde de paysans et de cette famille-là. Que je croyais honnêtement dans ce que je faisais. Et aussi… parce que Raïssa était à mes côtés. »
En 2020, juste après son décès à 67 ans, Frédéric Mitterrand a réalisé un documentaire pour France 2 « Mikhaïl et Raïssa, souvenirs d’un grand amour ».
Dans la présentation de son documentaire Frédéric Mitterrand écrit :
 « Mikhaïl et Raïssa Gorbatchev se sont rencontrés à Moscou au début des années cinquante, alors qu’ils étaient étudiants. […]
« Mikhaïl et Raïssa Gorbatchev se sont rencontrés à Moscou au début des années cinquante, alors qu’ils étaient étudiants. […]
Elle venait d’une famille d’origine bourgeoise et son père cheminot appartenait à l’élite du prolétariat dans un pays où les chemins de fer furent longtemps la seule réponse au défi des grandes distances.
L’un et l’autre avaient largement souffert des séquelles de la grande famine des années 30, de l’invasion allemande et de la terreur stalinienne, le père de Raïssa ayant notamment été envoyé au goulag tandis que sa femme et ses enfants survivaient misérablement dans un wagon de marchandises abandonné dans une gare de Sibérie.
[…] Il est avéré que l’accession au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir suprême en 1985 fut bien le résultat d’une ambition commune et d’une entente sentimentale et intellectuelle profonde avec son épouse à tel point qu’ils étaient autant le partenaire et le meilleur ami l’un de l’autre que mari et femme.
A cet égard, Raïssa Gorbatchev joua un rôle essentiel dans l’affirmation publique de la volonté réformatrice de son époux, tandis que son charme et son élégance fascinaient les medias et l’opinion internationale au cours de visites officielles à l’étranger à l’impact spectaculaire. […]
Sa fin brutale laisse ouverte l’énigme d’un amour de près de cinquante années qui aura résisté aux aléas dramatiques d’une histoire ayant changé la face du monde. »
Le journal « Challenge » énonce cette évidence : « Derrière Mikhaïl et la perestroïka, Raïssa Gorbatcheva »
Cet article cite Margaret Thatcher :
« Raïssa était tout à fait différente, ne ressemblait pas aux gens que l’on avait l’habitude d’associer au système soviétique. C’était une femme sûre d’elle, brillante et vive »
Et cite aussi un ouvrage de Gorbatchev :
« Toute notre vie, où que nous soyons, nous n’avons jamais arrêté de dialoguer avec Raïssa. Une fois devenu secrétaire général et président, j’appelais Raïssa ou elle m’appelait deux-trois fois par jour ».
Et j’ai la faiblesse de croire que si Gorbatchev fut grand et courageux dans l’épreuve et n’utilisa pas la force pour empêcher ce qui allait amener à sa destitution, c’est aussi parce que Raïssa était à ses côtés dans un lien indéfectible et immense.
<1704>
-
Mardi 6 septembre 2022
« La Glasnost et la Perestroïka»Mikhaïl GorbatchevLa politique que Gorbatchev lance, à son arrivée au pouvoir, permit, au monde entier, d’apprendre deux mots russes « glasnost » (transparence) et « perestroïka » (reconstruction).
La « Glasnost » est une transformation politique qui va libérer la parole politique comme jamais. Ni avant, ni après, ni maintenant les russes et les autres peuples soviétiques ne seront aussi libres.
« La pérestroïka » est quant à elle une transformation économique qui va s’annoncer désastreuse.
A cela s’ajoute « la loi anti-alcool », qu’il imposa très vite, et qui a laissé un mauvais souvenir, avec, pour résultat, l’augmentation de la consommation d’eau de Cologne ou de produits d’entretien comme substituts à la vodka, devenue difficile à trouver.
Sa méfiance à l’égard de l’alcool aurait dû le rapprocher de Poutine qui de ce point de vue est aussi très éloigné de la pratique d’Eltsine.
On pourrait donc résumer en disant que la Glasnost est une réussite et la Perestroïka un échec.
Concernant la glasnost, les observateurs aguerris ont pu rapporter qu’il y eut quand même des points très critiquables.
 <Le Monde> rappelle
<Le Monde> rappelle
« Le 12 décembre 1989, le pays tout entier est témoin en direct des limites de la glasnost (« transparence »). Les Soviétiques suivent alors avec passion les débats du « Congrès des députés du peuple », où siègent des élus « indépendants ». Les discussions sont retransmises en direct à la télévision, du jamais-vu. Aux heures de diffusion, on peut entendre une mouche voler dans les rues de Moscou ; tous suivent avidement les échanges animés entre les députés.
Ce jour-là, l’académicien et militant des droits de l’homme Andreï Dmitrievitch Sakharov réclame à la tribune l’abolition de l’article 6 [qui impose le Parti Communiste comme Parti Unique]. Gorbatchev lui coupe le micro. Sakharov quitte la tribune et jette les feuilles de son discours sur le numéro un soviétique, assis au premier rang. Deux jours plus tard, le 14 décembre 1989, l’académicien meurt.
Certes, en décembre 1986, Gorbatchev avait autorisé Sakharov et sa femme, Elena Bonner, exilés dans la ville fermée de Gorki depuis 1980, à rentrer à Moscou. Le geste était avant tout destiné à rassurer l’Occident, dont il cherchait les bonnes grâces. Quelques jours auparavant, la disparition tragique du dissident Anatoli Martchenko, mort d’épuisement dans un camp où il purgeait une peine de quinze ans pour délit d’opinion, avait entamé son image de réformateur. Même à l’époque de la perestroïka, les opposants continueront d’être envoyés à l’asile psychiatrique ou dans des colonies pénitentiaires héritées du goulag. »
Cependant, l’article du Monde écrit surtout ce que fut cette parenthèse dans le gouvernement autoritaire de l’empire russe jusqu’à Poutine en passant par le régime bolchévique :
« La glasnost (l’ouverture) marqua à jamais les esprits. D’un coup, les principaux tabous furent levés. Les journaux purent publier des statistiques sur les phénomènes de société jusqu’ici passés sous silence, tels les divorces, la criminalité, l’alcoolisme, la drogue. Les premiers sondages d’opinion firent leur apparition.
Bientôt, des pans entiers de l’histoire de l’URSS, concernant notamment Staline et la période des purges, sont révélés au grand public. En 1987, Les Nouvelles de Moscou publient le texte du testament de Lénine, où celui-ci réclame la mise à l’écart de Staline, jugé trop « brutal ». La même année, le brouillage de la BBC cesse, les Soviétiques peuvent, enfin, communiquer et correspondre avec des étrangers.
Les gens sont avides de savoir. Ils s’arrachent les hebdomadaires en vue, tels qu’Ogoniok ou Les Nouvelles de Moscou, qui reviennent sur les zones d’ombre de la période stalinienne. La parole se libère, on ose enfin aborder le thème des purges, des arrestations, le pacte germano-soviétique et les massacres des officiers polonais à Katyn, jusque-là imputés aux nazis. »
Mais concernant la perestroïka ce fut un désastre.
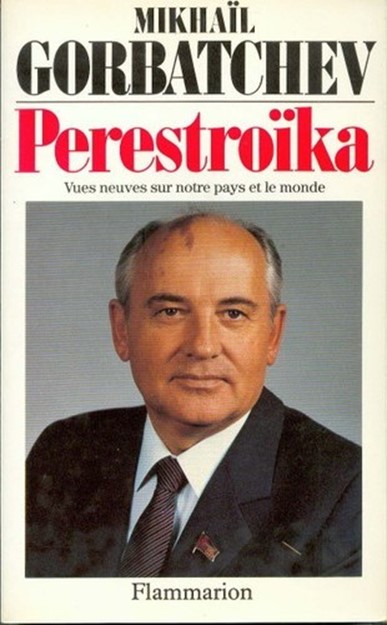 L’économie soviétique ne fonctionnait pas, mais comment la réformer ?
L’économie soviétique ne fonctionnait pas, mais comment la réformer ?
Les avis sur les intentions de Gorbatchev divergent.
Dans un podcast très intéressant de Slate <Le monde devant soi>, Jean-Marc Colombani pense que :
« Mikhaïl Gorbatchev est un homo soviéticus, un homme de l’Union soviétique. […] il voulait introduire de l’humanisme dans le communisme. »
Dans cette option, Il est entré dans ces réformes, en pensant sincèrement être en mesure de sauver le communisme et de conserver l’intégrité de l’Union Soviétique.
Il existe une autre option qui est débattue, c’est celle qui consiste à penser qu’il savait le communisme condamné et que sa politique devait l’emmener à sortir du communisme tout en préservant l’Union Soviétique.
Cette seconde thèse est défendue, par exemple, par Bernard Guetta qui a assisté à tous ces bouleversements d’abord en Pologne puis à Moscou où il a rencontré, plusieurs fois, Gorbatchev. Comme argument, il avance que Gorbatchev était trop intelligent pour ne pas s’être aperçu que l’économie communiste ne fonctionnait pas.
Et Bernard Guetta déclare :
« S’il avait voulu sauver le communisme, vous pensez qu’il aurait organisé des élections libres ? Qu’il aurait permis à la presse de prendre une liberté immense, qu’elle a perdu totalement sous monsieur Poutine aujourd’hui ? » »
Vous trouverez cette intervention dans l’émission de France Inter : < Mikhaïl Gorbatchev voulait sauver la Russie d’un effondrement communiste inéluctable>
Bernard Guetta, toujours passionné et passionnant est aussi intervenu dans « C à Vous » : <Gorbatchev, l’homme qui a changé la face du monde>
Et il a répété à nouveau cette thèse par un billet d’hier, le 5 septembre, sur son site : < C’est la Russie et non pas le communisme que Gorbatchev voulait sauver>
Bernard Guetta est un Gorbachophile qui, en outre, fut un intervenant régulier de la fondation Gorbatchev.
Pourtant, rien dans les déclarations de Gorbatchev, même récentes et particulièrement dans le documentaire d’ARTE cité dans le mot du jour d’hier ne permet de soutenir la thèse de Guetta.
Il était communiste, léniniste et il l’est resté.
Colombani dit :
« Dans le moment Gorbatchev, l’erreur qui est faite est probablement une transformation trop rapide de l’économie soviétique. […] Transformation trop rapide qui va entraîner la société soviétique dans un malheur social »
Gorbatchev lui-même raconte les files d’attentes interminables qui était générées par le fait que l’offre était largement insuffisante par rapport à la demande.
Il me semble que la thèse de Colombani est plus crédible. Et comme le disait Brejnev, le système était probablement irréformable.
Gorbatchev pu reprocher au destin des circonstances défavorables :
- Le prix bas du baril de pétrole
- Le refus des occidentaux de l’aider financièrement
En 1991, Mikhaïl Gorbatchev, en quête de crédits, demanda de l’aide à Washington et aux pays du G7, alors réunis à Londres. C’était « le sommet de la dernière chance », rappelle son ancien conseiller Andreï Gratchev dans une biographie, Gorbatchev. Le pari perdu ? (Armand Colin, 2011).
Des crédits ? Autant « verser de l’eau sur du sable », rétorqua le président américain George Bush (père), approuvé par ses partenaires européens. La déception fut grande au Kremlin. « Gorbatchev aurait pu obtenir de l’Ouest un meilleur prix pour sa politique », estime ainsi Andreï Gratchev.
Mais sur le plan économique Gorbatchev était très indécis et tout simplement ne savait pas comment faire. La situation économique était désastreuse
En outre, la liberté qu’il avait instillée va permettre l’éclosion des nationalismes.
Elstine qui était un politicien habile, dépourvu de tout scrupule qu’il noyait régulièrement dans l’alcool, n’avait qu’une idée en tête : prendre le pouvoir.
Il va composer avec l’émergence de ces nationalismes tout en s’appuyant sur le nationalisme russe pour faire exploser l’Union Soviétique et Gorbatchev avec elle.
Il profitera habilement d’un coup d’état de vieux conservateurs tremblants pour accélérer le mouvement.
Jean-Marc Colombani conclut :
« L’URSS s’est effondrée à cause du nationalisme russe et s’est effondrée sur elle-même »
La fin fut pathétique et triste. Le Monde raconte :
« Le 25 décembre, le nouveau président russe, Boris Eltsine, somma son vieux rival de débarrasser le plancher verni du Kremlin. Mikhaïl Gorbatchev s’exécuta. « Nos accords prévoyaient que j’avais jusqu’au 30 décembre pour déménager mes affaires », raconte-t-il dans ses Mémoires. Le 27 décembre au matin, on lui annonce que Boris Eltsine occupe son bureau. « Il était arrivé en compagnie de ses conseillers [Rouslan] Khasboulatov et [Guennadi] Bourboulis, et ils y avaient bu une bouteille de whisky en riant à gorge déployée. Ce fut un triomphe de rapaces, je ne trouve pas d’autres mots. »
Le drapeau soviétique fut abaissé, le drapeau russe hissé à sa place. L’URSS avait tout bonnement cessé d’exister. Une histoire était terminée, une autre commençait.
Vingt ans plus tard, et alors que Boris Eltsine (1931-2007) n’était plus, la rancœur était intacte : « C’était la pire des trahisons ! Nous étions assis ensemble, nous parlions, nous nous mettions d’accord sur un point et, dans mon dos, il se mettait à faire tout le contraire ! », déplorait encore Mikhaïl Gorbatchev, en février 2011, sur les ondes de Radio Svoboda. »
Bien sûr il y eut de nombreuses erreurs. Gorbatchev déclarera en janvier 2011 :
« Bien sûr, j’ai des regrets, de grosses erreurs ont été commises ».
Le pouvoir d’Elstine fut une calamité, il abandonna le pays aux kleptomanes issus de du KGB et de la nomenklatura qui s’emparèrent par la ruse et la violence de tout ce qui avait de la valeur. L’économie de marché abandonnée aux voleurs et s’implantant dans une société non préparée créa d’immenses malheurs sociaux.
On raconte que des russes avec leur humour grinçant dirent : on nous a menti, le système communiste ne fonctionne pas, mais on nous a aussi dit une vérité : le système capitaliste ne fonctionne que pour les riches.
L’espérance de vie à la naissance en Russie chuta.
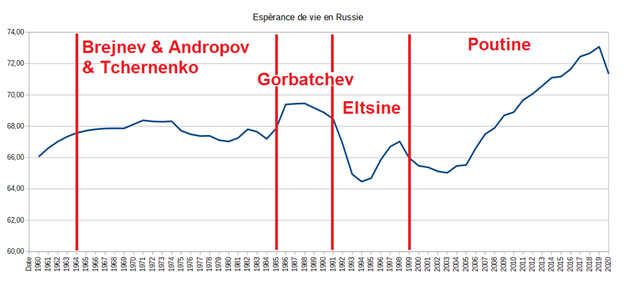
De 1986 à 1988 l’espérance de vie se situe autour de 69,5 ans. De 1989 à 2003 il va chuter de 4,5 ans jusqu’à 65,03 ans en 2003. Ces chiffres sont issues de ce site : https://fr.countryeconomy.com/demographie/esperance-vie/russie
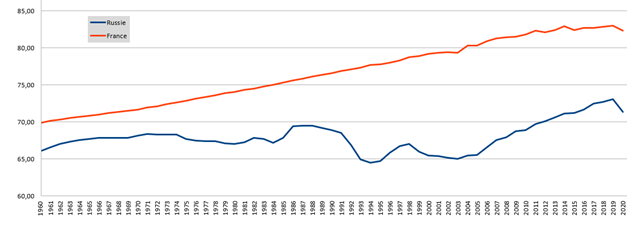 Si on compare cette évolution par rapport à celle de la France, pendant cette même période, le schéma est frappant : l’évolution est continue en France :
Si on compare cette évolution par rapport à celle de la France, pendant cette même période, le schéma est frappant : l’évolution est continue en France :
Alors qu’Eltsine est davantage responsable du malheur économique et du chaos que vont vivre les russes, il y aura un transfert vers une responsabilité quasi-totale vers Gorbatchev.
Quand il se présentera, contre Eltsine, aux présidentielles de 1996, il obtiendra un humiliant 0,5 %.
Selon un sondage publié en février 2017 par l’institut Levada, 7 % des personnes interrogées disaient éprouver du respect pour le dernier dirigeant soviétique, lauréat du prix Nobel de la paix en 1990.
Adulé en Occident, il suscitait l’indifférence et le rejet chez une majorité de Russes.
Le Monde résume :
« Avant tout, ils ne peuvent lui pardonner le saut du pays dans l’inconnu. Indifférent au vent de liberté, ils ressassent à l’envi le film de son quotidien de l’époque, fait de pénuries, de files d’attente et de troc à tout va : cigarettes en guise de paiement pour une course en taxi, trois œufs contre une place de cinéma. »
Et pour Vladimir Poutine et ses partisans, ils perçoivent la chute de l’URSS comme le résultat de la capitulation de Mikhaïl Gorbatchev face à l’Occident.
Gorbatchev avait fini par admettre en confiant au Sunday times en mai 2016 :
« La majorité des Russes, comme moi, ne veut pas la restauration de l’URSS, mais regrette qu’elle se soit effondrée [ certain que] sous la table, les Américains se sont frotté les mains de joie ».
Une des citations de Gorbatchev qu’on cite souvent est la suivante :
« La vie punit celui qui arrive trop tard ! »
<1703>
- Le prix bas du baril de pétrole
-
Lundi 5 septembre 2022
« Le refus d’utiliser la force est le plus grand héritage de Gorbatchev »Pierre GrosserMikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev était le fils d’un père russe et d’une mère ukrainienne.
Et son épouse, Raïssa Maximovna Titarenko, était la fille d’un père ukrainien et d’une mère russe.
 Les choses se passaient ainsi dans l’Union Soviétique que Mikhaïl Gorbatchev avait pour ambition de réformer.
Les choses se passaient ainsi dans l’Union Soviétique que Mikhaïl Gorbatchev avait pour ambition de réformer.
Le système soviétique ne fonctionnait pas économiquement, les citoyens de cet immense empire communiste vivaient dans un univers de pénurie : pénurie de logement, pénurie alimentaire, pénurie de tous les biens de consommation courante.
L’Union Soviétique parvenait à donner le change dans l’Industrie lourde et surtout arrivait à rivaliser avec les États-Unis dans le domaine de l’armement et des ogives nucléaires.
Et quand Reagan arriva au pouvoir le 20 janvier 1981 et lança une accélération de la course des armements avec ce qui fut appelé « la guerre des étoiles », les dirigeants soviétiques pensèrent que leur système économique failli n’arriverait plus à suivre leur rival.
Dans <Wikipedia> on lit :
« En mars 1983, Reagan introduisit l’initiative de défense stratégique (IDS) prévoyant la mise en place de systèmes au sol et dans l’espace pour protéger les États-Unis d’une attaque de missiles balistiques intercontinentaux. Reagan considérait que ce bouclier anti-missiles rendrait la guerre nucléaire impossible mais les incertitudes concernant la faisabilité d’un tel projet menèrent ses opposants à surnommer l’initiative de « Guerre des étoiles » et ils avancèrent que les objectifs technologiques étaient irréalistes. Les Soviétiques s’inquiétèrent des possibles effets de l’IDS186 ; le premier secrétaire Iouri Andropov déclara qu’elle mettrait le monde entier en péril »
Il n’était pas certain que ce projet puisse se concrétiser, mais il mobilisait des ressources financières considérables que les soviétiques n’étaient pas capable de réunir.
Le patron de l’URSS était alors Iouri Andropov qui après avoir été pendant 15 ans le chef du KGB succéda, le 12 novembre 1982, au vieux et malade Leonid Brejnev qui avait prophétisé que le système soviétique n’était pas réformable et que si on tentait de le réformer, il s’effondrerait.
La page wikipédia d’Andropov montre que celui-ci était le contraire d’un tendre, mais il était convaincu qu’il fallait réformer parce qu’en interne comme dans la confrontation avec les États-Unis et l’Occident l’URSS ne pouvait plus faire face aux attentes et aux défis.
Il était le mentor d’un jeune qu’il avait fait entrer au Politburo du Comité central du Parti communiste : Gorbatchev
Andropov ne resta que 14 mois au pouvoir mais il était aussi vieux et malade et décéda. Il souhaitait que Gorbatchev lui succède. Mais le Politburo désigna comme successeur, un conservateur qui n’avait aucune ambition de réformer, Konstantin Tchernenko.
Lui aussi était vieux et malade comme Andropov et Brejnev.
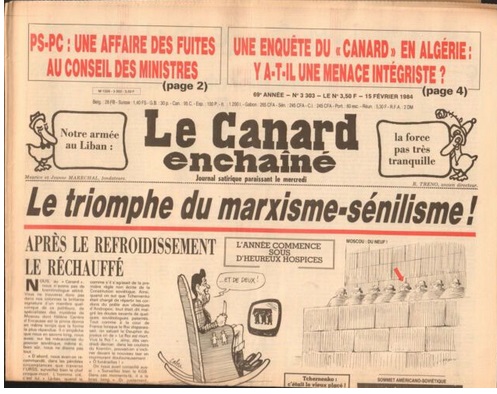 Lors de sa désignation le « Canard enchaîné » dans son numéro du 15 février 1984 afficha cette manchette :
Lors de sa désignation le « Canard enchaîné » dans son numéro du 15 février 1984 afficha cette manchette :
« Le triomphe du marxisme-sénilisme »
Le Canard tenta aussi cet autre jeu de mots : « c’était le vieux placé ».
Jeu de mots salué par « le Spiegel » du 20 février suivant qui titrait pour sa part plus sérieusement
« Tchernenko – La revanche de l’Appareil ».
Sa fiche Wikipédia précise que Tchernenko passa l’essentiel de son court règne, d’un an et 25 jours, à la tête de l’État à l’hôpital et donna ainsi de lui l’image d’un « fantôme à l’article de la mort ».
Le Politburo décida alors de suivre les conseils d’Andropov et de mettre à la tête du Parti Communiste, le 11 mars 1985, un relatif « jeune homme » de 54 ans, en bonne santé (il ne mourra que 47 ans plus tard) : Mikhaël Gorbatchev.
C’était un communiste convaincu. Encore récemment et très vieux dans un documentaire d’ARTE : <Gorbatchev en aparté> il qualifie Lénine, le fondateur de l’URSS de « notre Dieu à tous »
Il voulut réformer pour sauver le communisme et conserver l’Union Soviétique.
Six ans et neuf mois plus tard, il échoua et son rôle politique s’acheva.
Mais pendant cette période :
- Il retira les troupes soviétiques d’Afghanistan,
- Il engagea avec les États-Unis une réduction inouïe des armements nucléaires,
- Les dissidents comme Sakharov furent libérés et purent s’exprimer,
- Les journaux purent raconter la vérité et exprimer des opinons divergentes. Une liberté qui n’existait bien sûr, pas avant et plus maintenant non plus.
- Les autres pays communistes de l’Europe de l’est purent faire évoluer leur régime, faire tomber la dictature communiste sans qu’aucun soldat de l’armée rouge n’intervienne.
Qu’on songe qu’il disposait de l’armée rouge autrement puissante que sous Poutine et qu’il avait entre ses mains l’arme nucléaire que le maître actuel du Kremlin brandit sans cesse.
Il était communiste mais il aimait la Liberté, le Droit et il était un homme de paix.
Dans le Documentaire d’ARTE il expliqua :
« J’étais faible, je n’ai coupé aucune tête ».
Mais il exprime aussi sa satisfaction de pas avoir employé « les méthodes de (s)es prédécesseurs, Lénine compris ».
Il y eut bien quelques morts dans des évènements troubles dans les pays Baltes ou la Géorgie lors de la répression de mouvements nationalistes et indépendantistes. Le Monde rappelle dans la nécrologie qu’il lui consacre : <Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’URSS, est mort>
« Le 13 janvier 1991, quatorze personnes perdent la vie lors de l’assaut du Parlement et de la télévision de Vilnius (Lituanie) par l’armée soviétique. Sept jours plus tard, à Riga (Lettonie), un assaut similaire fait cinq morts. A Tbilissi (Géorgie), vingt-deux manifestants sont massacrés à coups de pelle en avril 1989 par l’armée fédérale, tandis que 150 personnes sont tuées par les militaires à Bakou (Azerbaïdjan), en janvier 1990.
Dans ses Mémoires, publiés en 1997 (éd. du Rocher), Mikhaïl Gorbatchev affirme avoir tout ignoré des opérations militaires déclenchées dans les Républiques baltes. Ce n’est que plus tard, en feuilletant un livre écrit par des anciens d’Alpha (les commandos d’élite du KGB), qu’il comprit qu’il s’agissait d’une « opération conjointe des tchékistes [police politique] et des militaires », organisée sans son aval. Imprécis sur le nombre de victimes à Vilnius (« Il y eut des pertes humaines », écrit Gorbatchev), il adhère sans détour à la thèse du complot et évoque une « provocation » des séparatistes locaux. »
Sans passer sous silence ces faits, il me semble légitime de considérer que globalement tous ces immenses évènements eurent lieu presque sans effusion de sang. Et ce dénouement pacifique de la guerre froide doit quasi tout à un seul homme : Mikhaël Gorbatchev
Qu’on songe un instant à tous ces hommes qui à la tête d’une telle puissance militaire et voyant leur pouvoir se désagréger, n’auraient pas laissé faire et auraient lancé des forces de destruction plutôt que d’accepter de partir dans la tristesse mais dans la paix.
 Angela Merkel qui subissait en Allemagne de l’Est, la dictature communiste et soviétique a exprimé en toute simplicité ce message à la fois politique et personnel :
Angela Merkel qui subissait en Allemagne de l’Est, la dictature communiste et soviétique a exprimé en toute simplicité ce message à la fois politique et personnel :
« Il a montré par l’exemple comment un seul homme d’État peut changer le monde pour le mieux […] Mikhaïl Gorbatchev a également changé ma vie de manière fondamentale. Je ne l’oublierai jamais »
C’est l’historien Pierre Grosser qui dans un article de Libération exprime le plus justement ce rôle extraordinaire de Gorbatchev : «Le refus d’utiliser la force est le plus grand héritage de Gorbatchev»
Il fait ainsi ce constat :
« Au XXe siècle, les grandes transformations de l’ordre international, les révolutions et les chutes d’empires avaient été les conséquences de guerres, et en particulier des deux guerres mondiales. Or, les bouleversements de la fin des années 80 eurent lieu sans guère d’effusion de sang, même lors de processus de « décolonisation » dans les pays baltes et dans le Caucase. »
Et il compare cette attitude avec celle du régime chinois :
« Alors que le Parti communiste chinois utilisait la répression au Tibet et contre les mobilisations étudiantes et sociales en juin 1989, Gorbatchev n’utilisa la force ni pour sauver les régimes des démocraties populaires, ni celui de l’URSS, ni l’URSS elle-même. C’était cela aussi qui était inimaginable, tant il était répété depuis des décennies que l’Europe de l’Est était un glacis protecteur indispensable à la sécurité de la Russie, que celle-ci ne pourrait renoncer aux gains obtenus après la Grande Guerre patriotique qui avait coûté 27 millions de vies soviétiques, et que l’usage de la force et de la répression était une caractéristique principale du régime.
Le refus d’utiliser la force, à de très rares exceptions (notamment en Lituanie, le 13 janvier 1991, provoquant infiniment moins de victimes que les violences staliniennes), est en définitive le plus grand héritage de Gorbatchev. Ses réformes ont rendu possibles les actions de peuples à partir de 1989. Ce sont les peuples, mais aussi des membres de partis communistes nationaux, qui ont été alors les moteurs de l’histoire. Gorbatchev fut moins le grand homme qui a organisé de grandes transformations que l’homme qui les a laissées faire. C’est aussi le cas de la réunification allemande, à laquelle il s’est finalement résolu, même si elle se faisait à l’intérieur de l’Otan. Dans les années 90, les observateurs concluaient à un déclin de l’usage de la force et de sa légitimité dans les sociétés développées et nanties à partir des années 70. L’usage répété de la force par Vladimir Poutine montre bien a posteriori qu’il y eut un vrai choix de Gorbatchev. Le Parti communiste chinois assume, lui, d’avoir utilisé la force en 1989, ce qui aurait sauvé le régime et le potentiel de réussite de la Chine. Il dénonce les cadres et les membres du Parti en URSS et en Europe qui ne se sont pas levés pour défendre leur régime, et éduque donc les communistes chinois à vouloir virilement défendre le Parti. »
 Pierre Grosser rappelle aussi que Gorbatchev est resté persuadé que le monde et les États-Unis auraient mieux fait de suivre ses conseils :
Pierre Grosser rappelle aussi que Gorbatchev est resté persuadé que le monde et les États-Unis auraient mieux fait de suivre ses conseils :
« Depuis les années 90, Gorbatchev a répété que s’il avait été davantage écouté, et si les États-Unis n’avaient pas été saisis d’hubris après la guerre du Golfe et la réunification allemande, le monde aurait été beaucoup plus sûr et pacifique. »
Pour ce rôle, l’Humanité, à mon sens, doit une immense reconnaissance à cet homme qui vient de mourir à 91 ans, le 30 août 2022.
<1701>
- Il retira les troupes soviétiques d’Afghanistan,
-
Lundi 1 août 2022
« L’intelligence des anagrammes ! »L’art de l’anagramme permet de discerner ce qu’un mot cache dans ses lettresLa continuation de la série sur le choc des civilisations me donne du mal.
Il faut donc encore patienter, mais en attendant j’ai lu deux anagrammes que j’ai mis en forme dans un diaporama que je partage ici :
<1701>
-
Vendredi 15 juillet 2022
« Pause (Grammaire des civilisations de Braudel). »Le mot du jour est en pause, il reviendra au plus tôt le 8 aoûtLe mot du jour du 13 juillet a été beaucoup enrichi sur la fin surtout par des apports empruntés à « Grammaire des civilisations » de Braudel.
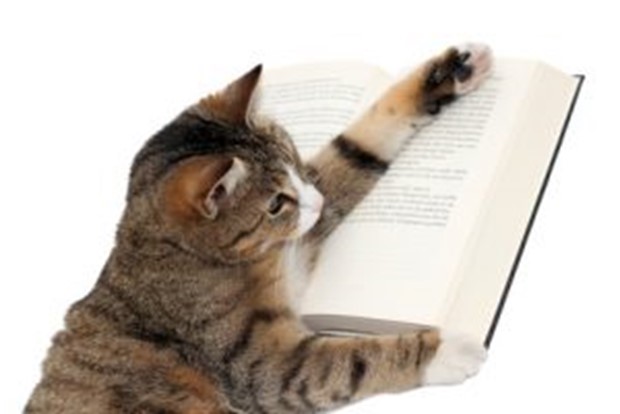 Je vous invite donc à le relire, si vous avez lu la première version : « Un monde divisé en civilisations. »
Je vous invite donc à le relire, si vous avez lu la première version : « Un monde divisé en civilisations. »
Pour ce mot de pause, j’ai trouvé cet article rédigé par René-Éric Dagorn qui est géographe et historien.
Il rappelle que le livre de Braudel a été d’abord un manuel d’Histoire pour les Terminales.
Initiative qui n’a pas été couronnée de succès. René-Éric Dagorn explique une partie des raisons de cet échec en soulignant les limites de cet ouvrage tout en révélant le niveau intellectuellement brillant de la démarche.
<Fernand Braudel et la Grammaire des civilisations (1963)>
« Atteindre et comprendre notre temps […] à travers l’histoire lente des civilisations » tel est l’objectif central de cet étonnant manuel de classes de terminales publié par les éditions Belin en 1963, intitulé Le monde actuel. Histoire et civilisations, et signé par S. Baille, F. Braudel et R. Philippe. L’ouvrage de Fernand Braudel que nous appelons aujourd’hui Grammaire des civilisations est la partie centrale de ce manuel […].
Grammaire des civilisations est donc un objet étrange. Il est lu aujourd’hui comme s’il avait le même statut que les autres textes de Braudel ; et il est même de plus en plus considéré comme le troisième grand texte de Braudel avec La Méditerranée (1947-1949) et Civilisation matérielle, économie et capitalisme (1967-1975). Pourtant oublier que Grammaire des civilisations est issu d’un manuel scolaire dont l’objectif était de transformer radicalement les approches de l’histoire des classes de terminales – au moment même où s’ouvrait le chantier de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Ehess) fondée en 1962 – c’est passer à côté d’éléments essentiels à sa lecture et à sa compréhension, et c’est manquer les objectifs que Fernand Braudel s’était fixé en rédigeant ce livre.
Car, depuis le milieu des années 50, Braudel est fortement impliqué dans la réforme du système éducatif. Et, il vient de subir un échec important : il a été contraint de quitter la présidence du jury de l’agrégation d’histoire, institution centrale dans la formation des enseignants du secondaire et étape importante dans la formation intellectuelle des futurs chercheurs des universités. Son implication dans les nouveaux programmes des lycées qui se mettent alors en place n’en est que plus forte. Et à la fin des années 50 Fernand Braudel remporte plusieurs victoires sur ce terrain.
[…] Le Bulletin Officiel du 19 juillet 1957 propose une refonte radicale des programmes d’histoire du lycée. Jusqu’alors l’objectif principal était de mettre en valeur le récit historique en découpant la chronologie en tranches : de la sixième (Mésopotamie et Égypte) aux classes de terminales (de 1851 à 1939). Sous l’impulsion de Braudel, la réforme proposée est radicale : garder le récit chronologique de la sixième à la première, et étudier durant toute l’année de terminale « les principales civilisations contemporaines ». L’étude des six « mondes » prévus (occidental, soviétique, musulman, extrême-oriental, asiatique du Sud-Est, africain noir) sera précédée d’une introduction qui « devra tout d’abord, définir la notion de civilisation, mais elle soulignera, en l’expliquant, la forme à donner à l’étude envisagée, qui comportera, pour chacun des ensembles envisagés […] trois éléments essentiels : fondements, facteurs essentiels de l’évolution, aspects particulier actuels de la civilisation ».
Cette révolution (le mot n’est pas trop fort) est à comprendre dans cet immense effort de reconstruction de la société française de l’après-guerre. Il s’agit de former des hommes capables de comprendre le monde dans lequel ils vivent : à un moment où les enfants du baby-boom commencent à entrer massivement dans le secondaire, à un moment où le monde est lancé dans une série de changements qui donnent l’impression d’une accélération considérable de l’histoire, l’éducation doit donner les moyens intellectuels, les outils de pensée et les visions d’ensemble permettant la compréhension du monde. […]
Entrer dans cette histoire de la « longue durée » passe d’abord par l’obligation de mobiliser « l’ensemble des sciences de l’homme » .
[…] Si les civilisations sont des structures spatiales, sociales, économiques et mentales, elles sont également autre chose : « les civilisations sont des continuités » en ce sens où « parmi les coordonnées anciennes (certaines) restent valables aujourd’hui encore ».[…]
Une fois tout ceci posé, c’est bien sûr « à l’étude des cas concrets qu’il convient de s’attacher pour comprendre ce qu’est une civilisation ». Et c’est là que Fernand Braudel se révèle décevant. Après une introduction d’un tel niveau, on s’attendait à un exposé d’une grande efficacité pour comprendre le « monde actuel ». Or, ce n’est pas le cas, loin s’en faut. L’ampleur et la qualité de la pensée de Braudel ne sont pas en cause. Au contraire, la description des civilisations est d’une grande virtuosité intellectuelle. Les passages consacrés à l’Islam et au monde musulman, à la Chine ou encore à l’unité de l’Europe sont brillants. Mais il faut bien le dire, ces chapitres ne sont plus lus aujourd’hui. Pourquoi ? Parce que, paradoxalement, ils ne permettent pas de penser le monde actuel. Malgré leur intérêt, les approches civilisationnelles de Braudel sont limitées pour au moins deux raisons.
D’abord parce qu’en insistant sur la « longue durée », sur les permanences et le temps ralenti des civilisations, Braudel minimise largement les changements et les ruptures. Or, pour reprendre l’expression de Jürgen Habermas, la Seconde Guerre mondiale constitue une « rupture civilisationnelle » ; et on peut appliquer aux temps des civilisations ce que Habermas dit à propos de l’ensemble du 20e siècle : « les continuités […] qui défient les césures […] calendaires, ne nous apprennent qu’insuffisamment ce qui caractérise le 20e siècle en tant que tel. Pour l’expliquer les historiens s’attachent aux événements plutôt qu’aux changements de tendance et aux transformations structurelles […]. Or, ce faisant, on fait disparaître la singularité de l’unique événement qui non seulement divise chronologiquement le siècle, mais encore représente une ligne de partage du point de vue économique, politique et surtout normatif » (Jürgen Habermas, Après l’État-nation, 2000, p. 13 et p. 22-23). L’analyse en termes de longue durée, en privilégiant les grandes continuités historiques, passe donc à côté des ruptures importantes et, plus encore, ne permet pas de voir cette rupture fondamentale qu’est 1945 dans la compréhension du monde actuel.
Ensuite parce que l’analyse des civilisations prises une par une minimise également ce qui n’est pas propre à ces civilisations particulières : bien sûr, à de nombreux moments de son ouvrage (et évidemment particulièrement lorsqu’il travaille sur l’Europe et sur les États-Unis), Braudel insiste sur les processus de décloisonnement des sociétés, mais son découpage par aires civilisationnelles l’empêche en fin de compte de penser les processus englobants. C’est en fait lorsqu’il travaille dans les tout premiers paragraphes sur les liens entre les civilisations et la civilisation qu’il approche, mais sans les analyser finement ni les développer, les problématiques qui sont les nôtres aujourd’hui… et qui étaient déjà au centre de certains travaux au début des années 60. Si l’expression « village global » proposée par McLuhan en 1962 a eu un tel impact – et ce malgré les limites de son ouvrage La Galaxie Gutenberg – c’est qu’elle faisait émerger l’idée que le monde doit être approché aussi comme un tout, et non pas seulement comme la somme de ses échelles inférieures, États ou civilisations.
[…] La rénovation très ambitieuse des programmes d’histoire par Fernand Braudel sera finalement un échec. A partir de 1970 le manuel Belin (dont une deuxième édition très légèrement modifiée avait été publiée en 1966) est retiré de la vente. Mais, comme le rappelle Maurice Aymard, 3le problème n’était pas […] celui d’un livre : il était bien plus profondément celui de l’enseignement de l’histoire3. Quarante ans plus tard, cette phrase est encore en partie vraie : le programme d’histoire des classes de terminales insiste encore et toujours sur la chronologie détaillée – et fort peu problématisée – de la Guerre Froide par exemple.
Mais la bonne surprise est venue de la géographie. En prenant en charge l’intelligence des processus d’émergence des espaces mondiaux, et particulièrement des espaces politiques mondiaux, le programme de géographie des classes de terminales tente de répondre en fin de compte à l’injonction de Fernand Braudel : comprendre le « monde actuel » en faisant appel aux sciences sociales. »
Maintenant si les récits de cet animal prétentieux qui a pour nom homo sapiens, qui a créé des dieux qu’il a pensé à son image et qui est en train d’abimer, sans doute irrémédiablement, les conditions de vie sur la planète qui l’a vu naître, vous ennuie, vous pouvez aussi allez voir les photos mises en ligne du télescope James Web https://www.jwst.fr/2022/07/les-premieres-images-du-webb/.
C’est encore une création d’homo sapiens, mais qui devrait nous rendre d’une humilité absolue en visualisant la profondeur de l’Univers comme nous n’avons jamais pu la voir.
Voici une de ses photos qu’Etienne Klein décrit poétiquement.
 <Mot sans numéro>
<Mot sans numéro> -
Mercredi 13 juillet 2022
« Un monde divisé en civilisations. »Samuel Huntington, titre de la première partie du Choc des civilisations.Définir le terme de « civilisation » n’est pas commode.
Souvent on donne comme synonyme «culture» et comme contraire «barbarie».
Pour les romains le partage était simple : Rome constituait la civilisation, à laquelle ils acceptaient d’intégrer les grecs, et tous les autres étaient des barbares.
Le Larousse tente cette définition :
« Ensemble des caractères propres à la vie intellectuelle, artistique, morale, sociale et matérielle d’un pays ou d’une société : La civilisation des Incas. »
Le Robert en propose une proche :
« Ensemble de phénomènes sociaux (religieux, moraux, esthétiques, scientifiques, techniques) d’une grande société : La civilisation chinoise, égyptienne. »
Le dictionnaire du CNRS propose d’abord une opposition : celle de l’état de nature avec l’état de civilisation :
« Fait pour un peuple de quitter une condition primitive (un état de nature) pour progresser dans le domaine des mœurs, des connaissances, des idées. »
Et ce dictionnaire cite plusieurs auteurs. J’en retiens deux, tous les deux académiciens :
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), écrivain et botaniste français, auteur de « Paul et Virginie » :
« Les Mexicains et les Péruviens, ces peuples naturellement si doux et déjà avancés en civilisation, offraient chaque année à leurs dieux un grand nombre de victimes humaines; … »
Harmonies de la nature,1814, p. 298.
Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804 – 1869) critique littéraire et écrivain français :
« C’est l’effet et le but de la civilisation, de faire prévaloir la douceur et les bons sentiments sur les appétits sauvages. »
Port-Royal,t. 5, 1859, p. 235.
Cette manière d’aborder le sujet distingue la civilisation de la non civilisation, mais ne semble pas ouvrir la possibilité de la coexistence de civilisations différentes.
Mais elle semble assez proche de l’étymologie du mot qui est d’origine latine : Formé à partir du mot latin civis (« citoyen »), qui a donné naissance à civilis qui signifie en latin « poli », « de mœurs convenables et raffinées ». Il semble que ce nouveau substantif « civilis » établissait une distinction qui s’était peu à peu établie entre gens des villes et habitants des campagnes.
Mais le dictionnaire du CNRS propose d’autres définitions :
« État plus ou moins stable (durable) d’une société qui, ayant quitté l’état de nature, a acquis un haut développement »
Et ajoute :
« Ensemble transmissible des valeurs (intellectuelles, spirituelles, artistiques) et des connaissances scientifiques ou réalisations techniques qui caractérisent une étape des progrès d’une société en évolution. »
Mais si on veut vraiment approcher le concept de civilisation, il faut revenir à Fernand Braudel qui dans sa quête de raconter l’Histoire s’inscrivant dans le Temps long écrit dans son ouvrage « Grammaire des civilisations » :
« Cependant vous n’aurez pas de peine à constater que la vie des hommes implique bien d’autres réalités qui ne peuvent prendre place dans ce film des évènements : l’espace dans lequel ils vivent, les formes sociales qui les emprisonnent et décident de leur existence, les règles éthiques, conscientes ou inconscientes auxquelles ils obéissent, leurs croyances religieuses et philosophiques, la civilisation qui leur est propre. Ces réalités ont une vie beaucoup plus longue que la nôtre et nous n’aurons pas toujours le loisir eu cours de notre existence, de les voir changer de fond en comble. »
Grammaire des civilisations page 26
Pour Braudel, le concept de civilisation est nécessaire pour expliquer le temps long en Histoire et il donne les éléments qui constituent la civilisation :
- L’espace
- Les formes sociales
- Les règles éthiques
- Les croyances religieuses et philosophiques
et un peu plus loin, il lance cette envolée lyrique :
« Les civilisations sont assurément des personnages à part, dont la longévité dépasse l’entendement. Fabuleusement vieilles, elles persistent à vivre dans chacun d’entre nous et elles nous survivront longtemps encore. »
Mais si les civilisations sont « des personnages » qui viennent de loin et sont anciennes, il semble que le mot « civilisation » est d’invention assez récente, juste avant la révolution française.
Selon l’excellent site d’Histoire « HERODOTE » :
« Le mot « civilisation » n’a que trois siècles d’existence. […] Au siècle des Lumières, il commence à se montrer dans un sens moderne. On le repère en 1756 dans L’Ami des Hommes ou Traité sur la population, un essai politique à l’origine du courant physiocratique. Son auteur est Victor Riqueti de Mirabeau, le père du tribun révolutionnaire. Il écrit : « C’est la religion le premier ressort de la civilisation », c’est-à-dire qui rend les hommes plus aptes à vivre ensemble. »
Mais que dit Huntington ?
D’abord, il cite Braudel qui est un de ses inspirateurs :
« Comme l’écrivait avec sagesse Fernand Braudel, « pour toute personne qui s’intéresse au monde contemporain et à plus forte raison qui veut agir sur ce monde, il est « payant » de savoir reconnaître sur une mappemonde quelles civilisations existent aujourd’hui d’être capable de définir leurs frontières, leur centre et leur périphérie, leurs provinces et l’air qu’on y respire, les formes générales et particulières qui existent et qui s’associent en leur sein. » »
Page 42
Et puis il aborde le cœur de son argumentation :
« Dans le monde d’après la guerre froide, les distinctions majeures entre les peuples ne sont pas idéologiques, politiques ou économiques. Elles sont culturelles. Les peuples et les nations s’efforcent de répondre à la question fondamentale entre toutes pour les humains : Qui sommes-nous ? Et ils y répondent de la façon la plus traditionnelle qui soit : en se référant à ce qui compte le plus pour eux. Ils se définissent en termes de lignage, de religion, de langue, d’histoire, de valeurs, d’habitudes et d’institutions. Ils s’identifient à des groupes culturels : tribus, ethnies, communautés religieuses, nations et, au niveau le plus large, civilisations. Ils utilisent la politique non pas seulement pour faire prévaloir leur intérêt, mais pour définir leur identité. On sait qui on est seulement si on sait qui on n’est pas. Et, bien souvent, si on sait contre qui on est. »
Page 21
Et c’est ainsi qu’il s’oppose frontalement à la prétention à aller vers une civilisation universelle que prévoit Fukuyama dans la « Fin de l’Histoire » et qui serait une dérivée de la civilisation occidentale.
Selon lui c’est justement la civilisation occidentale qui est source de frictions et de rejet. Il présente ainsi sa première partie : « Un monde divisé en civilisations » :
« Pour la première fois dans l’histoire, la politique globale est à la fois multipolaire et multi-civilisationnel. La modernisation se distingue de l’occidentalisation et ne produit nullement une civilisation universelle pas plus qu’elle ne donne lieu à l’occidentalisation des sociétés non occidentales »
Page 17
Et cette opposition entre l’occident et les autres, il la précise encore davantage dans cet extrait :
« Le monde en un sens, est dual, mais la distinction centrale oppose l’actuelle civilisation dominante, l’Occident et toutes les autres, lesquelles ont bien peu en commun. En résumé, le monde est divisé en une entité occidentale et une multitude d’entités non occidentales »
Page 37
A ce stade, Huntington est obligé de s’engager et de citer les principales civilisations contemporaines. Il en cite 6 et hésite sur une septième :
- La civilisation chinoise ;
- La civilisation japonaise ;
- La civilisation hindoue ;
- La civilisation musulmane ;
- La civilisation Occidentale ;
- La civilisation latino-américaine ;
La 7ème sur laquelle il hésite est la civilisation africaine
Page 51 à 57
Si on essaye de reprendre la typologie de Fernand Braudel dans la «Grammaire des civilisations», on trouve cette liste que Braudel classe géographiquement et qui compte 11 civilisations :
A – Les civilisations non-européennes
1. L’Islam et le monde musulman
2. Le continent noir « l’Afrique Noire, ou mieux les Afrique Noire »
Aa – L’Extrême-Orient
3. La Chine
4. L’Inde
5. Indochine, Indonésie, Philippines, Corée : « un Extrême-Orient maritime »
6. Japon
B – Les civilisations européennes
7. L’Europe
Ba – L’Amérique
8. L’Amérique latine
9. Les États-Unis
10. L’univers anglais (Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande)
Bb – L’autre Europe (U.R.S.S.)
11. Le monde orthodoxe
Si on compare les deux listes, on constate que Braudel y inclut bien une civilisation africaine mais dont il enlève le Maghreb et l’Egypte et affirme la pluralité : «Les Afrique noire ». Ensuite il divise l’Occident en plusieurs branches : L’Europe, Les États-Unis et L’Univers anglais. Pour arriver à 11, il ajoute le «monde orthodoxe» qui a l’époque du livre de Braudel était largement sous le joug et même le négationnisme soviétique . Cette situation a bien changé depuis. Enfin, il ajoute une particularité orientale : « un Extrême-Orient maritime ».
Sur ce <site> j’ai trouvé cette représentation de la vision braudelienne :
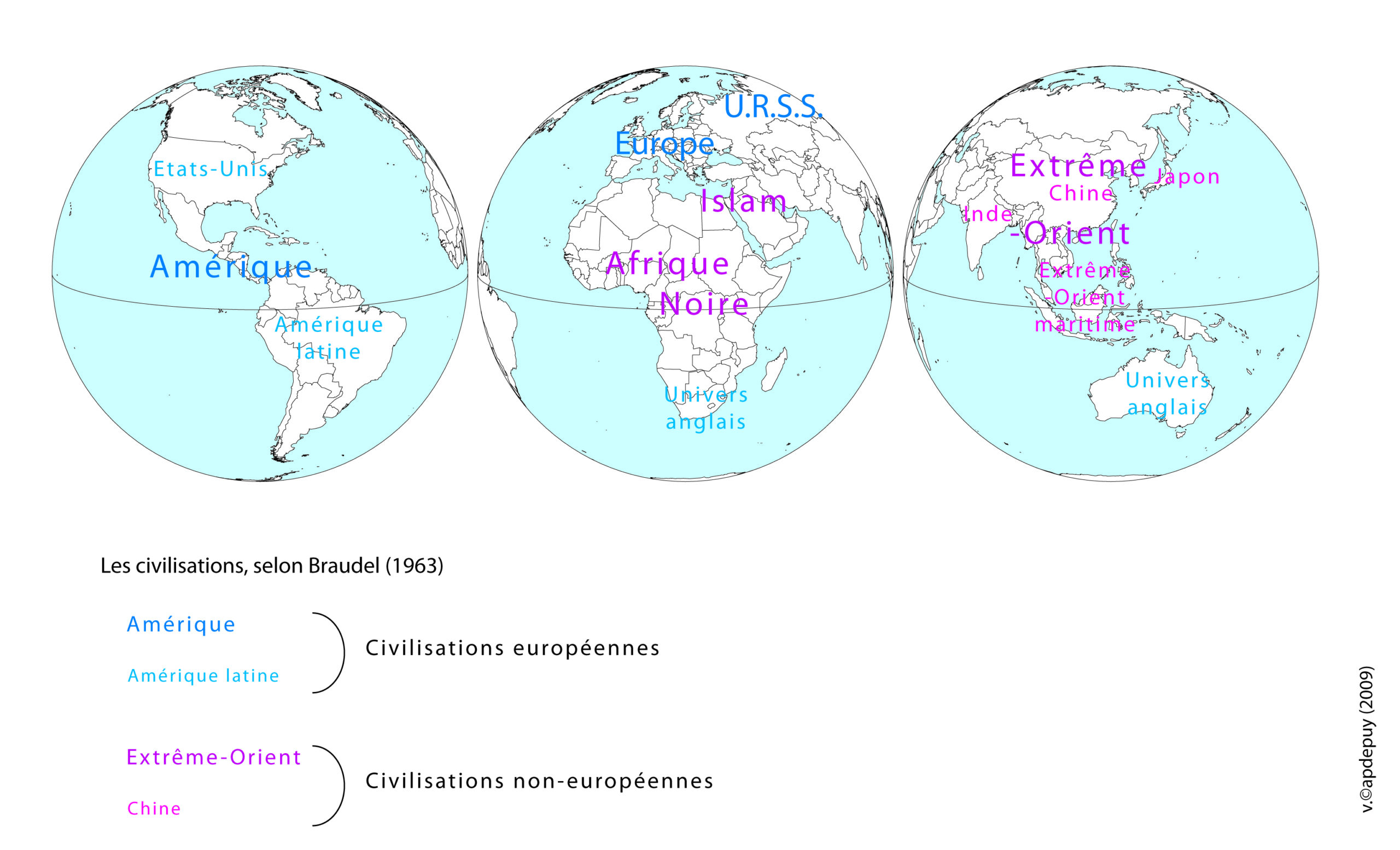
Huntington précise que ces séparations ne sauraient être gravées dans le marbre, qu’elles sont fluctuantes, mouvantes, mobiles.
Tout ceci n’a pas la rigueur de la science physique. Nous sommes dans l’humain, donc dans le récit. Et ce qui importe c’est que les sociétés, leurs gouvernants en appellent à ces récits pour justifier leurs actions, leurs organisations, leurs rejets. Des chinois, des russes, des musulmans font appel à ces récits civilisationnels pour rejeter les valeurs, l’organisation et l’hégémonie occidentales.
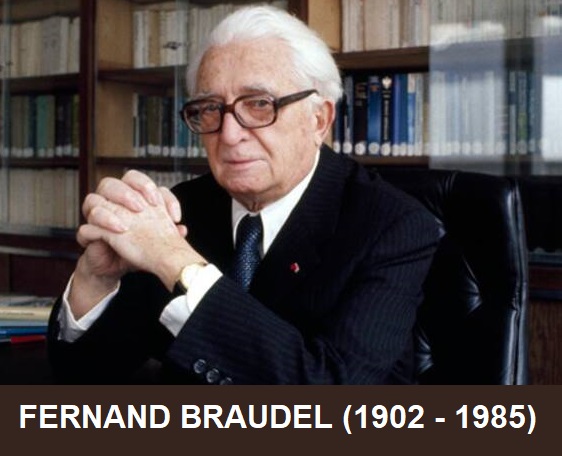 Fernand Braudel évoque, dans son ouvrage, le choc des civilisations que conceptualisera Samuel Huntington 30 ans plus tard :
Fernand Braudel évoque, dans son ouvrage, le choc des civilisations que conceptualisera Samuel Huntington 30 ans plus tard :
« Le raisonnement, jusqu’ici, suppose des civilisations en rapport pacifique les unes avec les autres, libres de leurs choix. Or les rapports violents ont souvent été la règle. Toujours tragiques, ils ont été assez souvent inutiles à long terme. »
Et il donne l’exemple du côté vain de ces affrontements :
« Le colonialisme, c’est par excellence la submersion d’une civilisation par une autre. Les vaincus cèdent toujours au plus fort, mais leur soumission reste provisoire, dès qu’il y a conflit de civilisations. »
Dans un exemple que j’ai déjà cité mardi, il raconte la Méditerranée comme l’espace de 3 civilisations : l’Occident, l’Islam et le monde orthodoxe gréco-russe. Et malgré de nombreuses guerres, et quelques fluctuations de frontières, globalement sur la longue durée ces 3 espaces n’ont que peu évolué. Et lors de la chute du communisme soviétique, Braudel était mort, le monde orthodoxe est réapparu du fond de la société opprimée par l’anti-religiosité communiste qui n’est pas parvenue à éradiquer ce récit porté dans les esprits, dans les familles, dans les siècles.
Quelque repos est bienvenu, il n’y aura pas de mots du jour à partir du 14 juillet, au moins jusqu’au lundi 25 juillet. Mais il est possible que, pour poursuivre cette série, quelques jours de réflexions supplémentaires soient nécessaires.
<1700>
- L’espace
-
Mardi 12 juillet 2022
« Nous allons vous faire le pire des cadeaux : nous allons vous priver d’ennemi ! »Alexandre Arbatov conseiller diplomatique de Gorbatchev, à ses interlocuteurs américains pendant que le bloc soviétique était en trains de s’effondrer.Ce ne fut pas la ligne dominante des intellectuels et des politiques qui comptent, le « choc des civilisations » de Samuel Huntington fit l’objet de critiques virulentes et trouva finalement peu de défenseurs au moment de sa parution.
Rappelons le contexte.
Après l’effondrement du 3ème Reich allemand qui devait durer mille ans et qui s’effondra au bout de 12 ans, le monde était divisé entre Les États-Unis et leurs alliés et l’Union soviétique et ses alliés. C’était l’Ouest et l’Est.
Il y avait bien une tentative de troisième voie : <Le mouvement des Non alignés>. Le terme de « non-alignement » avait été inventé par le Premier ministre indien Nehru lors d’un discours en 1954 à Colombo.
Mais on fixe l’origine du mouvement des non-alignés à la déclaration de Brioni, en Yougoslavie, du 19 juillet 1956, qui était dominé par Josip Broz Tito le dirigeant de la Yougoslavie, Gamal Abdel Nasser, le raïs égyptien, Jawaharlal Nehru le premier ministre de l’Inde et Soekarno président de l’Indonésie. Cette organisation regroupait selon Wikipedia jusqu’à 120 États.
Mais ce mouvement n’a pas très bien fonctionné.
D’abord parce qu’il n’avait ni le poids politique, ni militaire des deux grandes alliances.
Ensuite parce pour vouloir être indépendant des deux adversaires, ces États reconnaissaient que ce qui dominait c’était l’affrontement entre l’Est et l’Ouest.
Enfin, dans la pratique et notamment pour les besoins militaires tous ces pays choisissaient quand même leur camp. L’inde était armée par l’Union soviétique parce que son grand ennemi, le Pakistan, était du côté américain. L’Égypte était armée par l’Union soviétique par que son ennemi Israël était dans le camp américain. Et puis la Yougoslavie après la mort de Staline était, malgré tout, dans le camp de l’Est.
C’était donc cette division du monde qui expliquait la géopolitique, les tensions, les conflits et leur maîtrise. L’Union soviétique et les États-Unis ne se sont jamais affrontés mais l’on fait par procuration et par des conflits qui opposaient des pays qui se trouvaient dans l’un et l’autre camp.
Cela permettait une compréhension globale et une explication commode des tensions.
Mais vous connaissez l’Histoire, le mur de Berlin tombe le 9 novembre 1989, et l’Empire soviétique s’effondre, le 26 décembre 1991.
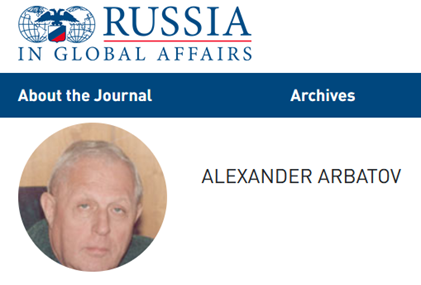 Et en 1989, un conseiller diplomatique de Gorbatchev, Alexandre Arbatov dira à ses interlocuteurs américains : « Nous allons vous faire le pire des cadeaux : nous allons vous priver d’ennemi ! ». C’est en tout cas ce qu’affirme <Pierre Conesa>
Et en 1989, un conseiller diplomatique de Gorbatchev, Alexandre Arbatov dira à ses interlocuteurs américains : « Nous allons vous faire le pire des cadeaux : nous allons vous priver d’ennemi ! ». C’est en tout cas ce qu’affirme <Pierre Conesa>
Le président Bush père déclarait : « La guerre froide est terminée, Nous l’avons gagnée ».
« Nous » c’est bien sûr les États-Unis et par extension l’Occident.
Mais comment dès lors penser cette nouvelle configuration géopolitique, géostratégique ?
Les chefs et penseurs occidentaux n’ont pas fait très attention à la phrase d’Arbatov.
Une réalité simple s’imposait à eux l’Empire du bien l’avait emporté sur l’Empire du mal.
 Le marché et la démocratie libérale allaient s’imposer partout. Il suffisait d’un peu de patience. Même l’immense Chine, qui restait dirigé par un Parti communiste, allait tomber comme un fruit mur dans un système politique à l’occidentale. C’était irrémédiable puisque les chinois étaient entrés dans une révolution économique nécessitant l’initiative et la concurrence qui allait les pousser inéluctablement vers la démocratie.
Le marché et la démocratie libérale allaient s’imposer partout. Il suffisait d’un peu de patience. Même l’immense Chine, qui restait dirigé par un Parti communiste, allait tomber comme un fruit mur dans un système politique à l’occidentale. C’était irrémédiable puisque les chinois étaient entrés dans une révolution économique nécessitant l’initiative et la concurrence qui allait les pousser inéluctablement vers la démocratie.
C’est la fin des conflits, un système unique allait finir par s’imposer sur la planète entière.
Les penseurs, les politiques, les responsables économiques ont alors trouvé celui qui allait conceptualiser cette nouvelle aube de l’humanité, Francis Fukuyama était son nom. Il écrit d’abord un article en 1989, puis un livre en 1992 « La Fin de l’histoire et le dernier homme ».
Michel Onfray décrit cette thèse ainsi
« La thèse de Fukuyama est simple, sinon simpliste, voire simplette : elle applique de façon scolaire, sinon américaine, la thèse hégélienne de la fin de l’histoire en la situant dans l’actualité : la chute de l’Empire soviétique annonce la fin de l’histoire ; elle rend caduc le combat entre le marxisme et le libéralisme en consacrant le triomphe du marché sur la totalité de la planète. Nous sommes dans le moment synthétique d’une copie de bac : thèse libérale, antithèse marxiste et synthèse postmarxiste assurant la vérité du libéralisme… C’est beau, non pas comme l’antique, mais comme une pensée issue d’un monde, les États-Unis d’Amérique, qui entre dans l’Histoire avec les petites chaussures d’un enfant… »
Jean Yanne avait fait un film « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ».
La créolisation du monde serait en route, mais sur un modèle essentiellement occidental.
Rappelons quand même que le marxisme fut aussi une invention occidentale, d’un philosophe allemand.
Et c’est cet instrument occidental que Mao mis en œuvre en Chine, Nasser essaya un peu en Égypte et bien d’autres pays firent cette tentative. On appelait cela la modernité et le progressisme. Nous savons que la Chine d’aujourd’hui ne reconnait plus cette importation occidentale et considère qu’elle suit son propre chemin, en phase avec la glorieuse histoire de la Chine et de ses traditions.
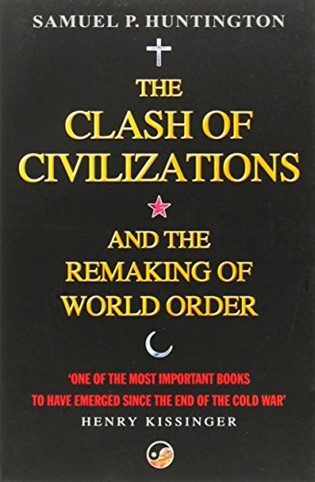 L’ancien professeur de Francis Fukuyama, Samuel Huntington répliqua à son élève dans un article paru pendant l’été 1993 et qui lui aussi devint un livre en 1996 : « The clash of civilizations »
L’ancien professeur de Francis Fukuyama, Samuel Huntington répliqua à son élève dans un article paru pendant l’été 1993 et qui lui aussi devint un livre en 1996 : « The clash of civilizations »
Je laisse encore la parole à Michel Onfray :
« Sa thèse ? À l’évidence, la chute de l’Empire soviétique impose un nouveau paradigme. Les oppositions ne s’effectuent plus selon les idéologies, le capitalisme contre le marxisme par exemple, mais selon les religions, les spiritualités, les cultures, les civilisations. Ce ne sont plus des nations qui s’opposent mais des civilisations. Ces lignes de forces civilisationnelles seront des lignes de fracture, donc des lignes de conflits qui opposeront désormais des blocs spirituels. »
Huntington avait constaté que, le 18 avril 1984, en plein cœur de l’Europe chrétienne, deux mille personnes se retrouvent dans les rues de Sarajevo pour brandir des drapeaux de l’Arabie saoudite et de la Turquie. Les manifestants n’avaient pas choisi le drapeau européen, américain, ni même celui de l’Otan, mais celui de ces deux pays clairement musulmans.
Huntington écrit : « Les habitants de Sarajevo, en agissant ainsi, voulaient montrer combien ils se sentaient proches de leurs cousins musulmans et signifier au monde quels étaient leurs vrais amis. » Lors de la guerre de Bosnie, les Bosniaques musulmans étaient soutenus par la Turquie, l’Iran et l’Arabie saoudite. La Serbie orthodoxe, quant à elle, l’était par la Russie. C’était donc une guerre de civilisations entre le bloc musulman et le bloc chrétien. On comprendra dès lors que défendre la Bosnie ou prendre le parti de la Serbie, c’était choisir une civilisation contre une autre.
On critiqua ce livre absolument.
On prétendit que les civilisations cela n’existe pas.
 Mais Huntington nuance :
Mais Huntington nuance :
« Les civilisations n’ont pas de frontières clairement établies, ni de début ni de fin précis. On peut toujours redéfinir leur identité, de sorte que la composition et les formes des civilisations changent au fil du temps. »
C’est un peu comme le racisme.
Les races n’existent pas, il n’y a qu’une espèce : homo sapiens.
Oui, mais le racisme existe.
Il n’y a pas de civilisation « pure » mais il y a des conflits de civilisation, il y a des actes de terrorisme mais aussi des déclarations géopolitiques comme celle de la Chine qui s’appuient sur cet affrontement de civilisation.
C’est pourquoi, j’ai lu le livre de Samuel Huntington.
Il a été écrit en 1996, nous sommes 26 ans après. Force est de constater que certaine de ses prévisions ou intuitions se sont révélées erronées.
Il écrit par exemple, en 1996, page 243 :
« Beaucoup pensait qu’un conflit armé était possible [entre la Russie et l’Ukraine], ce qui a conduit certains analystes occidentaux à défendre l’idée que l’Occident devait aider l’Ukraine à avoir des armes nucléaires pour éviter une agression russe. Cependant, si le point de vue civilisationnel prévaut, un conflit entre Ukrainiens et Russes est peu probable »
On dit avec justesse que la prévision est difficile, surtout quand elle concerne l’avenir.
Mais malgré ces erreurs, la thèse de Huntington me parait très intelligente pour comprendre certains aspects essentiels de la géopolitique mondiale actuelle.
Il écrit très humblement page 38 :
« Aucun paradigme toutefois n’est valide pour toujours. Le modèle politique hérité de la guerre froide a été utile et pertinent pendant 40 ans mais il est devenu obsolète à la fin des années 80. A un moment donné le paradigme civilisationnel connaîtra le même sort. »
Avec toutes ces limites, même Fukuyama a dû reconnaître : « Pour le moment, il semble qu’Huntington soit gagnant »
J’en avais fait le <mot du jour du 20 septembre 2018>.
Huntington pour son approche civilisationnel se réclame de Fernand Braudel.
Je vous invite à relire le <mot du jour du 13 octobre 2015>, dans lequel je citais Fernand Braudel et notamment son analyse, sur la longue durée, de la Méditerranée qui depuis des siècles se partage entre trois civilisations : l’Occident Catholique, l’Islam et l’Univers Gréco-russe orthodoxe.
<1699>
-
Lundi 11 juillet 2022
« Cette civilisation occidentale qui, de nos jours, a fini par s’identifier, même aux yeux des autres peuples, avec la « civilisation » tout court. »Zoé Oldenbourg « Les croisades » (ouvrage de 1965)C’était en avril, Avec Marianne et Jean-François, nous partagions un gite, en Bourgogne près de Tournus.
Le gite était pourvu de nombreux livres, classés sur des étagères.
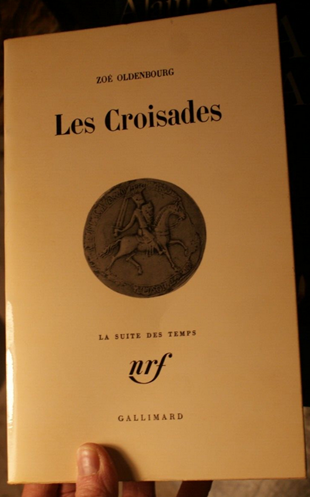 Un livre a attiré mon attention : « Les Croisades » de Zoé Oldenburg.
Un livre a attiré mon attention : « Les Croisades » de Zoé Oldenburg.
Je le pris et commençai à le lire.
Zoé Oldenbourg était historienne, mais aussi romancière.
Elle est née en 1916 à Saint-Pétersbourg, un an avant la révolution bolchevique.
Son grand-père était un homme de lettres et fut ministre du gouvernement Kerenski à l’été 1917, c’est-à-dire le gouvernement de la Russie après le renversement du Tsar Nicolas II et avant l’arrivée au pouvoir de Lénine.
Son père est déjà historien mais aussi journaliste.
Sa famille décide de quitter l’Union Soviétique de Staline en 1925 et d’émigrer en France.
Elle deviendra française écrira des romans et des livres d’Histoire, notamment :
- Le Bûcher de Montségur, 1959.
- Les Croisades, 1965.
- Catherine de Russie, 1966.
Et son dernier Livre :
- L’Épopée des cathédrales, 1998.
Elle meurt, en France, le 8 novembre 2002.
Son ouvrage de 1965, sur les croisades, commence par un avant-propos dont voici le début :
« Le présent ouvrage n’est pas à proprement parler une « Histoire des Croisades » — il ne traite que de ce qu’il est convenu d’appeler les trois premières croisades et de l’histoire du royaume de Jérusalem jusqu’à sa conquête par Saladin.
L’histoire de ces trois premières croisades et des États francs de Syrie est ici considérée surtout du point de vue de la situation politique du Proche-Orient au XIIe siècle. Le phénomène de la croisade, les rapports de l’Occident latin avec Byzance et l’Islam et la tentative, unique en son genre, d’implantation d’un État occidental dans un milieu oriental sont évoqués dans ce livre de façon nécessairement schématique et incomplète, étant donné l’ampleur du sujet ; ce que j’ai essayé d’analyser, après tant d’historiens éminents auxquels je n’ai pas la prétention de me comparer, c’est le côté humain de cette aventure longue, tragique, complexe et malgré tout glorieuse.
Quelque signification que l’on veuille accorder au mot gloire, il est sûr que les premières croisades sont à l’origine d’une certaine notion de la gloire, notion propre à l’Occident latin, et, à ce titre, elles n’ont pas peu contribué à la formation de cette civilisation occidentale qui, de nos jours, a fini par s’identifier, même aux yeux des autres peuples, avec la « civilisation » tout court. »
Voilà donc ce qu’une femme de lettres issue du milieu intellectuel russe et intégrée dans le monde intellectuel parisien écrivait en 1965 :
« Cette civilisation occidentale qui, […] a fini par s’identifier, même aux yeux des autres peuples, avec la « civilisation » tout court »
Cela ne choquait personne en 1965, et pendant longtemps cela n’a choqué personne.
« La civilisation » c’était la civilisation occidentale.
Beaucoup, même s’il n’ose pas exprimer cela aussi brutalement, continue à être en accord avec le fond de cette phrase.
En tout cas, ils agissent comme s’ils considéraient cela comme une évidence.
Cela n’a jamais été une évidence.
Et aujourd’hui ce n’est plus une évidence du tout.
Cette idée est remise en cause par une très grande partie de l’humanité, probablement même par tous les autres, je veux ceux dirent qui ne se considèrent pas comme occidentaux.
La guerre d’Ukraine et d’autres évènements et actes internationaux nous montrent cette réalité.
J’ai donc voulu revenir au livre de Samuel Huntington : « The Clash of Civilizations » qui a été traduit en français par « Le choc des civilisations ».
Cette lecture m’incite à commencer une série de mots du jour sur ces deux concepts de civilisations et de choc des civilisations.
Je vais commencer cette série tout en la parsemant de pauses nécessaires au cours de cette période estivale qui est aussi une période de vacances.
<1698>
- Le Bûcher de Montségur, 1959.
-
Vendredi 8 juillet 2022
« Il faut montrer qu’on peut faire une prise de judo : Ceux qui ont cru pouvoir nous tromper, nous les démasquons. »Patrice Arfi à propos d’Avisa PartnersCe n’est pas du complot, c’est de la manipulation.
J’ai découvert cette affaire dans l’émission de Sonia Devillers du mercredi 29 juin 2022 l'<Instant M>.
Elle avait invité Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart.
Mediapart héberge des blogs dans la partie de son site qu’elle appelle « Le Club ». Cet espace est prévu pour que des particuliers puissent exprimer leurs idées, leurs réflexions leurs questionnements.
Les journalistes de Médiapart ont constaté qu’il se passait des choses étonnantes sur ces blogs.
Leur enquête a permis de découvrir plus de 600 faux billets de blogs, rattachés à plus de 100 profils factices.
Parallèlement « Fakir » le journal créé par François Ruffin, le député de la France Insoumise, a publié un article d’un jeune journaliste pigiste Julien Fomenta Rosat : <Moi, journaliste fantôme au service des lobbies>. C’est un long article en accès libre.
Mediapart a publié aussi un article mais pour lequel il faut être abonné : <Opération intox : une société française au service des dictateurs et du CAC 40>
La société française dont il est question a une très belle adresse à Paris : 17 avenue Hoche, dans l’opulent 8ème arrondissement, à quelques pas du Parc Monceau, près de la Cathédrale Orthodoxe de Poutine, de l’Ambassade de l’Arabie Saoudite etc.
Elle a un nom qui n’est pas français « Avisa partners »
Elle a une page Wikipedia qui la présente comme <un groupe français de conseil spécialisée dans la cybersécurité, l’intelligence économique, l’investigation et les relations publiques> créé en 2010 et présent dans 7 autres pays que la France.
Fabrice Arfi parle de deux « fils à papa » qui sont à l’origine de cette aventure. D’après mes lectures il y a aussi d’autres personnes qui sont au cœur de cette entreprise.
 Grâce au journal <Jeune Afrique>, nous pouvons disposer d’une photo de ces jeunes et brillants entrepreneurs :
Grâce au journal <Jeune Afrique>, nous pouvons disposer d’une photo de ces jeunes et brillants entrepreneurs :
Respectivement Arnaud Dassier et Matthieu Creux.
Arnaud est le fils de Jean-Claude Dassier, un journaliste et dirigeant d’entreprises. Il a été directeur général de la chaîne d’information en continu LCI de 1996 à 2008, puis président du club français de football Olympique de Marseille de 2009 à 2011.
Sur ce site mais qui est payant, on présente Arnaud comme un homme très à droite et < un vétéran des coups tordus sur Internet>
Le père de Matthieu Creux a une notoriété publique moins grande, mais dans les cercles du pouvoir, il est connu.
Fabrice Arfi explique :
« Matthieu Creux, est le fils d’un ancien patron du renseignement militaire. Le général Creux est quelqu’un d’extrêmement respecté et respectable sur la place de Paris. »
Matthieu Creux dispose d’un <site> sur lequel il se présente ainsi :
« […] spécialiste de l’influence et de la mobilisation politique sur Internet. Comme conseiller ministériel ou comme consultant Internet, il a participé à toutes les élections françaises depuis 2006. Il est personnellement intervenu auprès de nombreux clients internationaux en Afrique ou en Europe, toujours sur des problématiques d’activisme ou de contre-activisme en ligne. »
L’enquête de Mediapart révèle ainsi l’une des plus grandes manœuvres de manipulation de l’information intervenue en France ces dernières années en pratiquant l’infiltration des médias et la manipulation de l’information.
Julien Fomenta Rosat était une des petites mains de cette agence de communication..
Journaliste pigiste, il se trouvait dans une situation précaire et gagnait quelques sous en rédigeant des articles à la demande.
Les sujets étaient variés.
Il travaillait sous différents pseudonymes. Les personnes qui lui commandaient les articles aussi. Il ne savait pas où ses articles étaient publiés. Parmi ses commanditaires il y avait une société implantée en France, puis ensuite, une société implantée en Slovaquie, à Bratislava. Mediapart est allé voir : il n’y a rien, il n’y a pas de société, c’est juste une boîte dans une HLM à Bratislava.
Pour Julien, le coup de trop c’est quand on lui a demandé de dézinguer François Ruffin :
Alors il a appelé Fakir et a tout « balancé ». L’article <Moi, journaliste fantôme au service des lobbies> que je vous invite à lire commence ainsi :
« On m’a commandé un article pour dézinguer Ruffin. Je l’aime bien, moi, Ruffin… Je réponds quoi ? ». Il y a quelques mois, on recevait un coup de fil de Julien, un copain journaliste qui fait des ménages dans la com’, pour payer les factures.
Articles bidon, médias complices, déstabilisations, grands groupes pleins aux as… Julien nous raconte le business secret des « agences fantômes ».
Dans l’émission l’<Instant M>, Fabrice Arfi présente Avisa Partner de la manière suivante ;
« La société pour laquelle « Julien» travaillait est inconnue du grand public. C’est une entreprise, comme on dit pudiquement : « d’intelligence économique et de cyber sécurité », une « société privée de renseignements ». C’est l’une des plus réputées de la place de Paris. Elle travaille avec des institutions publiques comme Interpol, la Gendarmerie nationale, le ministère des Armées, mais aussi BNP Paribas… [mais aussi] La Société Générale, le Crédit Agricole, la Banque Palatine, Axa, CNP Assurances, Engie, EDF, Total, L’Oréal, LVMH, Chanel, Carrefour, Casino […] À peu près tout le CAC 40, mais aussi des clients qui sentent un peu plus le soufre : des Etats étrangers dirigés par des autocrates et des dictateurs… »
Sonia Devillers donne des exemples :
« Le Congo-Brazzaville, le Kazakhstan, le Qatar, le Tchad, la Société nationale pétrolière du Venezuela, pour du lobbying contre les sanctions américaines qui la vise, le géant russe de l’aluminium Rusal, la multinationale pharmaceutique et agrochimique Bayer pour du lobbying pour contrer l’activisme des anti-OGM… »
Fabrice Arfi a pu étudier le rôle d’Avisa Partners avec des témoignages et des documents à l’appui. Il a constaté :
« La manière dont elle a infiltré les plateformes participatives de sites français et étrangers pour créer de faux avatars, de faux profils, publier des billets de blog sous de fausses identités.
Or, les lectrices et des lecteurs pensent lire l’opinion d’un citoyen indigné, d’une responsable d’ONG, d’un cadre dirigeant, d’une entreprise ou d’un chercheur ou d’une chercheuse aguerrie. Et il n’en est rien. C’est le produit d’une commande chèrement payée par des clients pour manipuler le débat public pour le compte de multinationales parfois, ou de dictatures souvent. C’est une énorme opération de manipulation et de trucage du débat public. »
[Avisa Partners] ne cessent de racheter les principaux acteurs du secteur. Elle valorise son activité à près de 150 millions d’euros. C’est une énorme machine d’intelligence économique.
Avisa partner a essayé de s’offrir une forme de respectabilité vis-à-vis de l’extérieur. Pour cela, elle s’est associée à de très grands noms de la diplomatie française, des services de renseignements français, ou de la politique française.
L’actuelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a fait partie dans le passé des dirigeants, d’Avisa partner. Ce n’est plus le cas. L’ancienne plume d’Emmanuel Macron, Sylvain Fort, a été associé à Avisa partner. L’ancien numéro deux du Quai d’Orsay, l’ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sous Jean-Yves Le Drian, l’ambassadeur Maurice Gourdault-Montagne, était le président du comité d’éthique d’Avisa partners. Il vient de le quitter aussi pour des questions de temps, nous dit-il officiellement. Mais je peux aussi citer l’ancien chef des services secrets intérieurs, Patrick Calvar, dont le nom est associé à Avisa, précisément parce qu’il connaissait le père. »
Et Fabrice Arfi propose cette solution face à ces manipulateurs, solution qui me plait :
« Plutôt que de supprimer ces comptes, Il faut montrer qu’on peut faire une prise de judo. Ceux qui ont cru pouvoir nous tromper, nous les démasquons. »
Dans l’article Wikipedia, déjà cité, nous pouvons lire :
« Depuis 2015, des enquêtes du Journal du Net, de Challenges, du Desk, Complément d’Enquête, [montre que] Avisa Partners, via ses sous-traitants, a piloté des opérations d’influence et d’e-réputation sur Internet grâce à de faux articles ou fausses tribunes au profit d’entreprises clientes (Air France, EDF ou LVMH) ou de personnalités, comme le président tchadien Idriss Déby ou Mounir Majidi, le secrétaire particulier du Roi du Maroc. Des opérations auraient également été menées contre des concurrents ou ennemis de ses clients : Andrea Bonomi, Engie, François Ruffin ou des États comme le Monténégro, le Bénin et la junte thaïlandaise. Le Journal du Net qualifie alors le cabinet de « manipulateur de Wikipédia et des sites médias ». D’après Fakir, l’objectif est d’« abreuver internet de contenus flatteurs ou complaisants pour leurs clients afin d’influencer l’opinion publique, de faciliter leurs affaires ou de taper sur un concurrent ». Mediapart affirme que la société serait à l’origine de plusieurs centaines d’articles dans le « Club de Mediapart », l’espace participatif du journal, largement utilisé dans le cadre d’opérations de communication. D’autres clients sont cités, comme le comité d’organisation de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, Rusal, ou encore PDVSA.
Interrogés par les différentes équipes de journalistes, les dirigeants d’Avisa Partners nient l’implication de leur agence. »
La meilleure preuve qu’ils manipulent, c’est qu’ils s’en défendent.
Je reprends une phrase du Président Pompidou que j’ai déjà cité : « La meilleure preuve qu’il voulait la guerre, c’est qu’il s’en défendit »
Vous pouvez aller sur leur site sur lequel dès la page d’accueil, des animations vous donne l’impression d’être dans un film.
Et surtout écouter l’émission du mercredi 29 juin 2022 l'<Instant M>.et lire l’article de
Julien Fomenta Rosat : <Moi, journaliste fantôme au service des lobbies>
<1697>
-
Jeudi 7 juillet 2022
« En démocratie, rien n’est aussi important que la vérité. »Pierre Mendès-FranceJ’ai beaucoup critiqué notre Président, ces derniers temps, et surtout la dérive de nos institutions.
Mais la qualité de la vie politique ne dépend pas exclusivement des hommes politiques au pouvoir, elle dépend aussi de l’éthique, de la compétence, des actes et du sérieux des propositions des femmes et hommes qui sont dans l’opposition.
La posture, la démagogie ne devrait pas être de mise en démocratie.
Hier, je rappelais un mot du jour ancien consacré à une émission de 1973 de Jacques Chancel avec Pierre Mendès-France. Vous la trouverez derrière ce <Lien>.
Je l’ai réécoutée et tout au début voici comment parlait Pierre Mendès-France :
« Un homme politique est toujours en face de situations avec leurs difficultés et leurs obstacles.
Il doit, en toute circonstance, aussi bien dans l’opposition qu’au pouvoir, déterminer les meilleures solutions.
Dont toutes sont en général difficiles et entre elles il doit choisir. […]
Je crois que quand on n’est pas au pouvoir, on doit aussi s’efforcer de servir en faisant avancer les causes auxquelles on est attaché.
Et dans tous les cas, parler pour ce que l’on croit être le bien de la collectivité, même dire des choses impopulaires, cela consiste inévitablement à choisir entre des inconvénients, c’est-à-dire choisir, toujours choisir, prendre ses risques et choisir. […]
On ne doit jamais s’occuper de savoir si on est payé en retour. Un homme politique doit dire ce qu’il pense, il doit être au service de convictions. Il doit se battre pour ce qu’il croit être le bien.
Alors oui il y a des cas où il sera mal entendu, mal écouté, où il n’aura pas gain de cause.
S’il est sûr que ce qu’il dit, il croit que c’est la vérité, du même coup il est sûr qu’à la longue il aura raison.
Peut être après lui, peut être sans lui, peut-être dans l’intervalle on aura perdu du temps, on aura fait du mal.
Mais s’il est sûr qu’il a raison, s’il est sûr qu’il l’emportera à la longue, il doit s’efforcer de faire avancer cette maturation le plus possible et c’est pour cela qu’il doit se battre. […]
[La qualité essentielle] est de dire la vérité. […] Je n’ai jamais détesté autant que le mensonge, la lâcheté, le manque de franchise.
Un homme politique a le devoir, surtout dans une démocratie, de dire à tous ceux qui l’écoutent ce qu’il pense pour que précisément ils prennent la décision, puisque par hypothèse on est en démocratie. […]
L’hypothèse de la démocratie, c’est que le peuple doit juger par lui-même, mais pour juger lui-même, il faut qu’il ait entendu le pour et le contre, les opinions qui s’opposent et que chacun lui ait parlé franchement.
Si ceux qui viennent s’exprimer devant lui, jouent de démagogie, d’habileté, farde la vérité pour favoriser leur propre carrière, ils ne fournissent pas à l’opinion publique les moyens de se former une opinion valable, par conséquent ils fourvoient l’opinion publique.
Par conséquent, en démocratie rien n’est aussi important que la vérité. »
Je crois que Pierre Mendès-France serait très sévère aujourd’hui à l’égard de l’opposition.
<1696>
-
Mercredi 6 juillet 2022
«Pause (retour à Pierre Mendès-France) »Un jour sans mot du jour nouveauQuelquefois, il est utile de se replonger dans des mots du jour écrits, il y a longtemps.
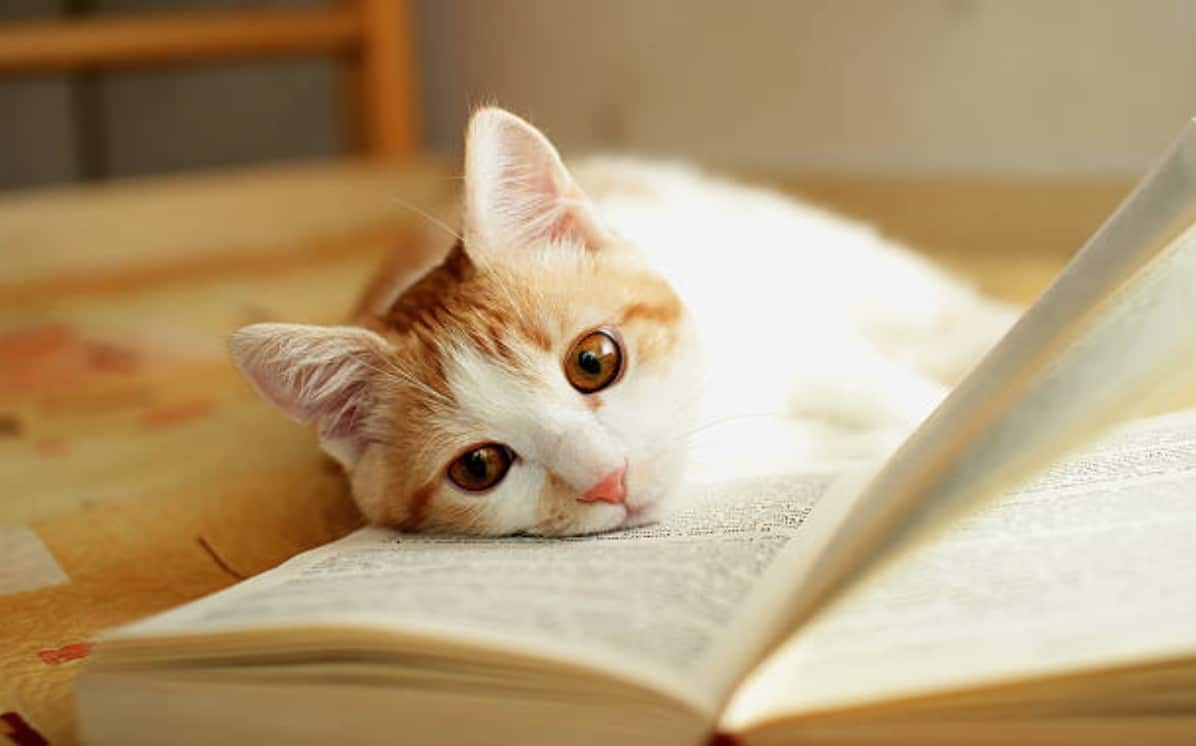 Celui que je vous propose, date de 2015. Je faisais retour sur une «Radioscopie», célèbre émission de Jacques Chancel.
Celui que je vous propose, date de 2015. Je faisais retour sur une «Radioscopie», célèbre émission de Jacques Chancel.Il avait invité Pierre Mendès-France, c’était en décembre 1973 : < Mot du jour du 1 octobre 2015 >
J’avais relevé plusieurs réflexions qui me paraissaient particulièrement sages et que Pierre Mendès-France avait évoquées au cours de l’émission. J’en reprends une :
« Ce qui est fondamental c’est que les hommes dans le cadre d’une action gouvernementale se soient mis d’accord préalablement sur ce qu’ils allaient faire.
Un gouvernement se constitue non pour distribuer des portefeuilles, non pas pour favoriser telle opération à l’horizon mais pour faire aboutir une réforme une amélioration qu’on estime dans l’intérêt du pays.
Et c’est cela qui doit déterminer les alliances. Si des hommes sont d’accord pour faire quelque chose, il n’y a pas de raison d’en exclure certains.
Si des hommes ne sont pas d’accord pour faire quelque chose je trouve que c’est une escroquerie de les réunir. Parce qu’arriver au gouvernement ils s’annulent, ils se paralysent.
Le critère déterminant c’est ce qu’on veut faire ensemble.C’est pourquoi depuis longtemps l’idée d’un programme de gouvernement m’a paru absolument essentiel. »
Cet émission de 1973 est toujours en ligne sur le site de Radio France. Vous la trouverez derrière ce <Lien>.
<Mot du jour sans numéro> -
Mardi 5 juillet 2022
« Les politiques, les contradictions et les erreurs. »Quelques éléments de langage des politiques examinés par les sciences politiquesJe donne simplement quelques exemples.
Une contradiction :
Emmanuel Macron a été réélu Président de la République, dimanche 24 avril 2022. Le soir de cette victoire, il a tenu un discours au pied de la Tour Eiffel. Et parmi d’autres choses, il <a dit> :
« Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j’ai conscience que ce vote m’oblige pour les années à venir »
Le même homme, après les élections législatives qui ne lui ont pas permis de disposer d’une majorité absolue a fait un discours, de 8 minutes, le 22 juin dans lequel il demandait aux groupes politiques d’opposition de dire « jusqu’où ils sont prêts à aller »
Et dans ce discours il a analysé sa réélection de la manière suivante :
« Le 24 avril, vous m’avez renouvelé votre confiance en m’élisant Président de la République. Vous l’avez fait sur le fondement d’un projet clair, et en me donnant une légitimité claire. »
Et il a ajouté :
« Cela veut dire ne jamais perdre la cohérence du projet que vous avez choisi en avril dernier. C’est un projet d’indépendance pour notre pays, la France et dans notre Europe que nous devons rendre plus forte, qui passe par une défense forte et ambitieuse, une recherche d’excellence, […] »
Il a donc, à 2 mois d’intervalle, d’abord reconnu que son élection a été le fruit d’un rejet de l’autre candidate, ensuite prétendu qu’il a été élu pour son seul programme
Une erreur
Jordan Bardella a affirmé après les élections législatives : « Macron a été mis en minorité »
Dans le troisième point, je reprendrai les chiffres.
Mais ce que dit Jordan Bardella est faux.
En sciences politiques, la situation à l’Assemblée Nationale est, du côté des députés macronistes, celle d’une majorité relative.
C’est-à-dire qu’ils ne disposent pas de la majorité absolue.
La minorité c’est la position d’un parti qui dans une assemblée a, en face de lui, une majorité relative ou absolue
Le Rassemblement National ou la NUPES sont minoritaires, parce qu’ils sont face à la majorité macroniste et qu’ils ne sont pas en capacité de se réunir, ni de se réunir avec un autre Parti pour avoir la majorité, c’est-à-dire plus de députés que le parti macroniste.
La NUPES veut déposer une motion de censure en vue de renverser le gouvernement. Il est peu probable qu’elle y arrive. Mais si elle y arrivait, elle n’aurait pas de majorité alternative pour gouverner à la place des macronistes.
En Allemagne, il n’est pas possible de renverser un gouvernement si on ne peut pas proposer une majorité alternative acceptant de gouverner ensemble.
Une autre erreur
Lors des diverses émissions que j’ai écoutées, plusieurs commentateurs ont affirmé qu’il n’était plus nécessaire d’instaurer la proportionnelle aux élections législatives parce que les français étaient parvenus à élire une assemblée quasi proportionnelle avec le scrutin actuel : scrutin uninominal à deux tours.
C’est d’abord factuellement faux ou très approximatif.
Pour la proportionnelle sur la base du premier tour, il suffit que je reprenne le schéma déjà proposé lors du mot du jour du 14 juin. Et à côté je présente la vraie Assemblée élue.
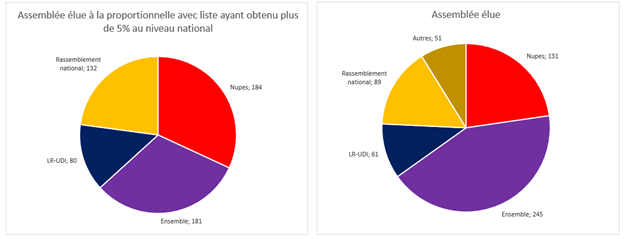
On voit donc que « Ensemble » dispose bien d’une nette majorité même si elle est relative, ce qui n’est absolument pas le cas s’il y a représentation proportionnelle car alors la NUPES fait jeu égal.
En outre, on constate que 51 députés ont été élus sur aucune des 4 listes qui auraient été seules représentées en cas de proportionnelle intégrale.
Mais il y a surtout une autre erreur, c’est que le scrutin a une influence sur l’organisation politique. Un simple exemple : jamais il n’y aurait eu une coalition NUPES, si le mode de scrutin n’avait pas obligé le PS, les écologistes et le PC de s’allier aux Insoumis pour espérer avoir des députés.
Dans le scrutin uninominal à deux tours, pour lequel je rappelle que quasi personne d’autre que la France ne l’applique, il faut présenter l’autre camp comme un adversaire qui a tous les défauts pour mobiliser. Dans un scrutin proportionnel, on sait qu’il n’y aura pas de majorité et qu’il va falloir discuter avec les autres pour créer, après les élections, une coalition de gouvernement. Les relations avec les adversaires, futurs partenaires potentiels ne sont pas les mêmes.
Enfin, on peut désormais avoir la crainte que si on laisse perdurer le scrutin actuel et étant donné les leçons du dernier scrutin qui a montré une dédiabolisation totale du Rassemblement National, ce dernier pourra bénéficier, à son tour, de l’effet multiplicateur de ce scrutin pour obtenir, la prochaine fois, la majorité absolue. Est-ce cela que nous voulons ?
Le scrutin actuel tant qu’il permettait à une coalition qui représentait plus de 40% du corps électoral à disposer d’une majorité absolue grâce à un coup de pouce du scrutin était tolérable.
Aujourd’hui que le parti majoritaire dispose de moins de 30% des voix exprimés et moins de 15% du corps électoral, cela devient inacceptable. Cette représentation déformée du corps électoral augmente les tensions dans la société et crée des mouvements de contestation de plus en plus violents.
<1695>
-
Lundi 4 juillet 2022
«Pause (suite des vieux fourneaux) »Un jour sans mot du jour nouveauVendredi le mot du jour était assez long.
 Pour ce lundi, je me repose un peu. Mais je partage encore un petit extrait de la BD «Les vieux fourneaux. » du dessinateur Paul Cauuet et du scénariste Wilfrid Lupano.
Pour ce lundi, je me repose un peu. Mais je partage encore un petit extrait de la BD «Les vieux fourneaux. » du dessinateur Paul Cauuet et du scénariste Wilfrid Lupano. Je pense que certains auront trouvé que j’étais trop dur avec nos ainés, mais d’autres peuvent aussi penser qu’étant donné que j’entre peu à peu dans cette période de vie j’ai été trop complaisant.
Pour ces derniers je voudrais quand même insister sur le fait que ce n’est pas toujours facile d’être vieux dans la société d’aujourd’hui. Je remarque sur le marché ou dans les grands magasins que le rythme lent des vieux est souvent bousculé par l’impétuosité des jeunes.
Alors quand un vieux va dans une boulangerie moderne pour simplement acheter une baguette comme il en a toujours acheté depuis sa tendre enfance, il se trouve devant un monde qu’il ne comprend plus :
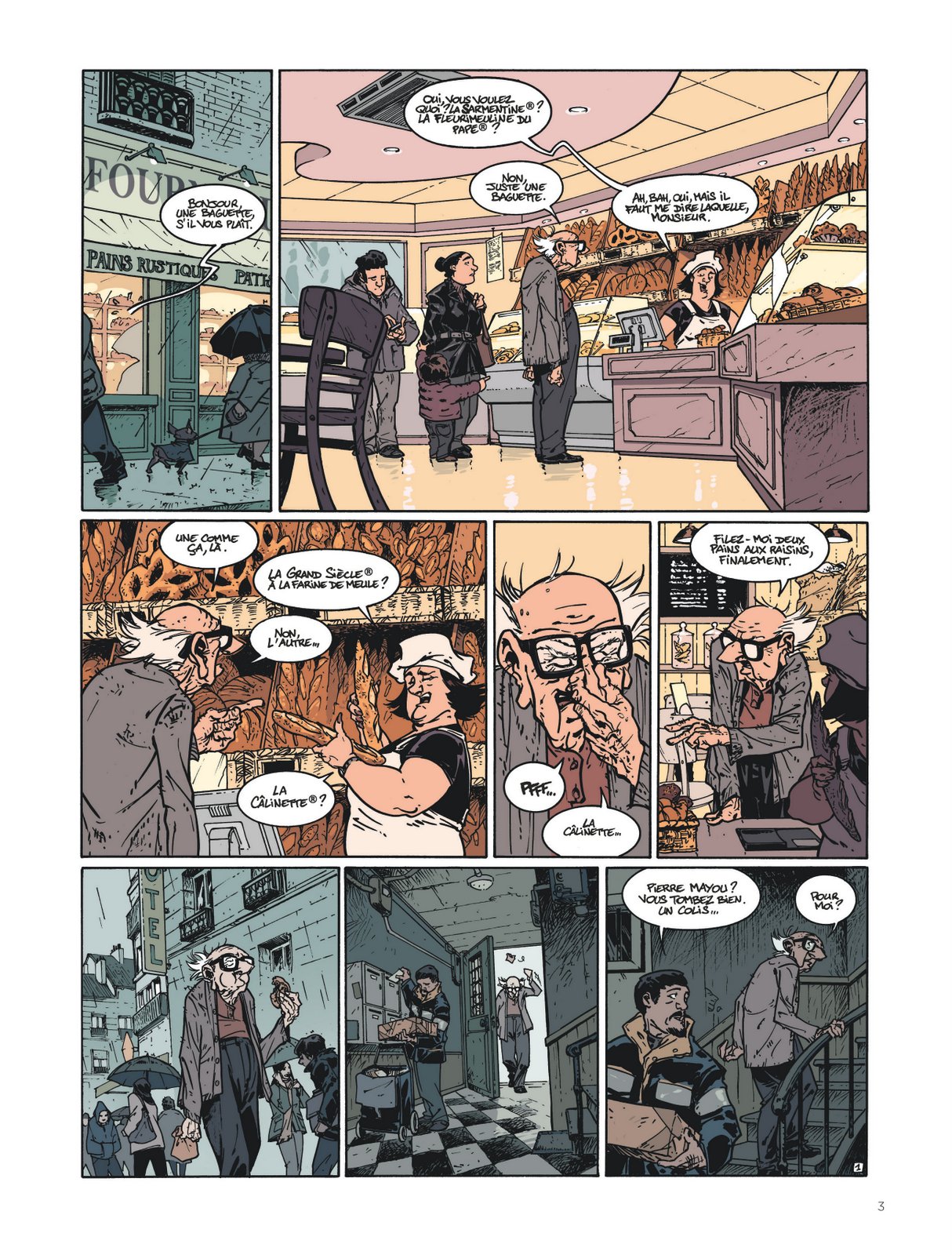
<Mot du jour sans numéro>
-
Vendredi 1 juillet 2022
« Tous les vieux fourneaux prennent les jeunots pour des cons. »Georges Brassens « Le Temps ne fait rien à l’affaire. »Aujourd’hui, je voudrais parler du rôle des vieux dans notre société.
Pour agrémenter ce sujet austère, j’ai décidé de l’enrichir de dessins de la série de BD : « Les Vieux Fourneaux » du dessinateur Paul Cauuet et du scénariste Wilfrid Lupano. J’ai aussi convoqué le chat de Geluck, à deux reprises.
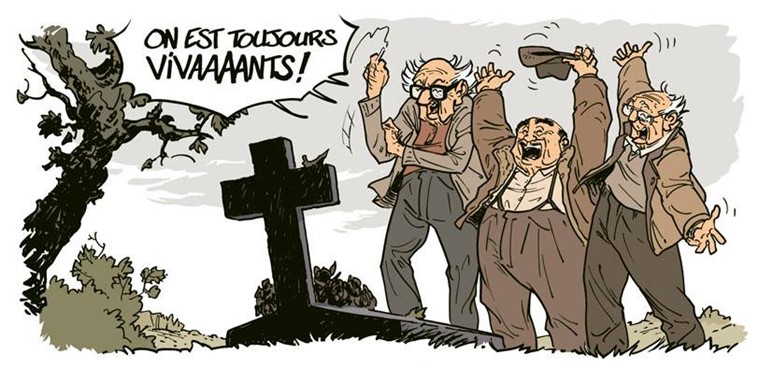 « Les Vieux fourneaux » sont une BD absolument géniale dont un ami nous a fait découvrir le tome 1. Et depuis, avec Annie, nous avons acheté tous les autres tomes parus.
« Les Vieux fourneaux » sont une BD absolument géniale dont un ami nous a fait découvrir le tome 1. Et depuis, avec Annie, nous avons acheté tous les autres tomes parus.
Nous reconnaissons une préférence pour les trois premiers dans lesquels l’imagination et la créativité des deux auteurs sont débordantes et infiniment drôles.
Cet <Article> nous apprend que Wilfrid Lupano a trouvé le titre de la série dans une chanson de Georges Brassens : « Le Temps ne fait rien à l’affaire. » :
« Quand ils sont tout neufs,
qu’ils sortent de l’œuf, du cocon,
tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons.
Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons,
tous les vieux fourneaux prennent les jeunots pour des cons ».
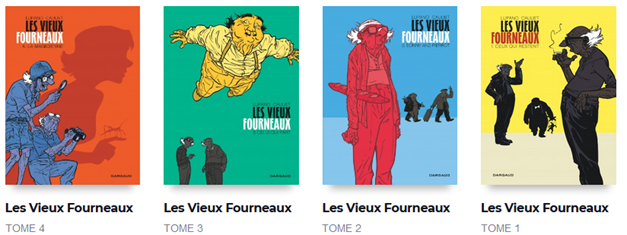
Manière poétique et piquante de parler du conflit de génération
C’est de la pure fiction. Il n’y a personne derrière «Les Vieux Fourneaux», assure Lupano. Il concède toutefois s’être inspiré des philosophes Edgar Morin et Michel Serres et du diplomate Stéphane Hessel pour imaginer leur personnalité.
Étant donné les trois inspirateurs, souvent cités dans le mot du jour, il est assez intuitif que cette BD me plaise beaucoup.
Les trois vieux qui sont en cœur de la BD sont résolument de gauche tendance anarchiste
Ce type de vieux existe assurément, j’en connais personnellement. Mais il ne me semble pas qu’ils représentent la majorité de cette génération.
 Probablement cette majorité a-t-elle pleinement intégré cette formule qu’on attribue à GB Shaw ou à Aristide Briand, c’est selon : « Celui qui n’est pas de gauche à 20 ans n’a pas de cœur, mais celui qui est toujours de gauche à 40 ans n’a pas de tête »
Probablement cette majorité a-t-elle pleinement intégré cette formule qu’on attribue à GB Shaw ou à Aristide Briand, c’est selon : « Celui qui n’est pas de gauche à 20 ans n’a pas de cœur, mais celui qui est toujours de gauche à 40 ans n’a pas de tête »
Mais il y a une question préalable : Qui est vieux ?
Longtemps, je n’ai pas eu de doute : Est vieux celui qui est plus âgé que moi !
Et, en parallèle est jeune celui qui est plus jeune que moi. !
Mais aujourd’hui, m’approchant de mes 64 ans et aussi de la retraite, j’ai du mal à ne pas me classer dans la catégorie des vieux.
Surtout quand je me souviens qu’alors que j’avais 15 ans, quand je voyais mes tantes et oncles qui avaient 60 ans, je ne les trouvais pas vieux, mais très vieux !
François de Closets, à 88 ans vient de commettre un nouveau livre où il éructe comme d’habitude sur tout ce qui va mal selon lui. Il s’en prend, cette fois, à sa classe d’âge : « La parenthèse boomers ».
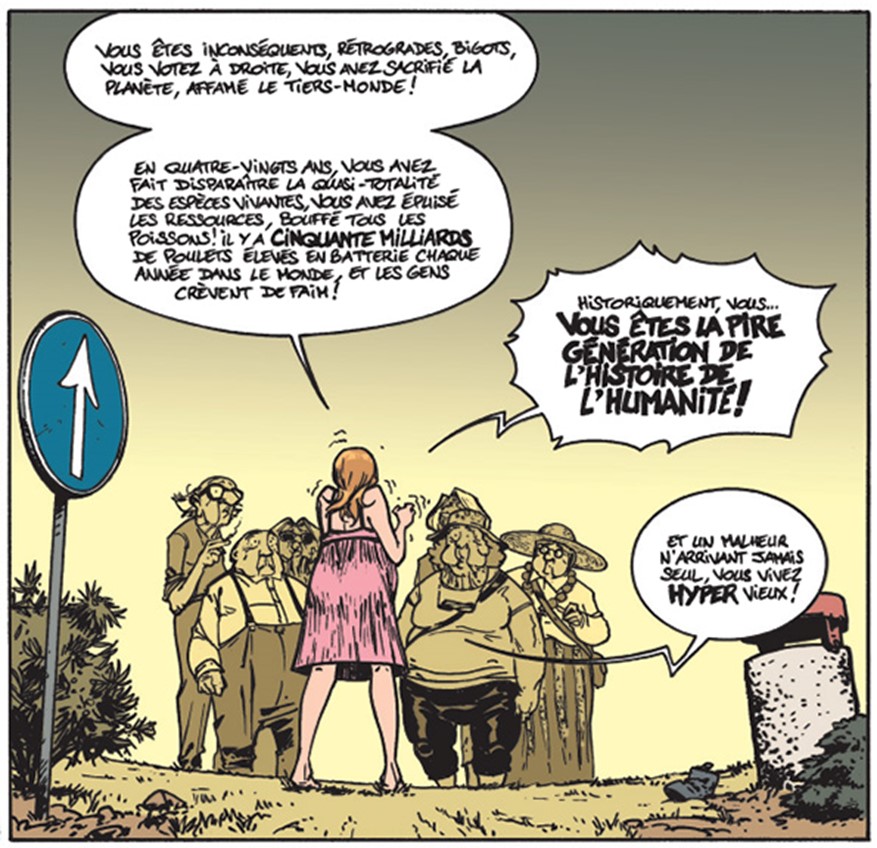 Pour de Closets il y a deux types de vieux !
Pour de Closets il y a deux types de vieux !
De manière générique, les vieux c’est ceux qui sont à la retraite.
Mais il y a d’abord les profiteurs, ceux dont je ferais bientôt partie. Ils vivent aux frais des jeunes actifs, font des voyages, profitent grassement de tout ce que la société de consommation leur vend et pratiquent des tas d’activités prouvant ainsi qu’ils pourraient parfaitement continuer à travailler et décaler l’âge de la retraite.
Et puis, il y a « les vrais vieux », ceux qui ont perdu leur autonomie et pour lesquels la société n’a pas encore pleinement intégré l’ampleur de ce qu’il conviendrait de faire pour prendre pleinement en charge cette dernière période de la vie.
Sur le second point le « vieux râleur » a raison.
Sur le premier, il est vrai qu’il y a par moment un petit souci, parce que « certains retraités » ne comprennent pas vraiment comment fonctionnent leur retraite. Ils pensent qu’ils ont payé, pendant les années d’emploi, une caisse de retraite qui maintenant leur restitue ce qui a été versé.
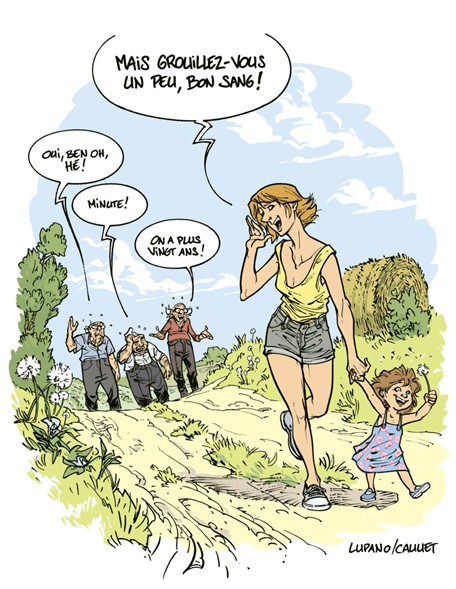 C’est évidemment totalement faux. Ils ont payé dans leur jeunesse, alors qu’ils étaient nombreux à une caisse de retraite qui utilisait cet argent pour payer les pensions des retraités qui étaient peu nombreux.
C’est évidemment totalement faux. Ils ont payé dans leur jeunesse, alors qu’ils étaient nombreux à une caisse de retraite qui utilisait cet argent pour payer les pensions des retraités qui étaient peu nombreux.
Aujourd’hui, ils sont payés, alors qu’ils sont nombreux, par une caisse de retraite financée par des jeunes qui sont moins nombreux qu’à leur époque.
En revanche, François de Closets ignore superbement que notre économie surtout française ne veut plus des seniors : quand ils sont au chômage ils ne trouvent plus de travail, personne ne veut les embaucher. Les RH pensent probablement qu’ils sont trop lents et inadaptés au monde moderne.
Mais que représentent les vieux dans la société ?
Si on prend d’abord le monde, on peut constater que selon les continents, la répartition entre les classes d’âge est très différente.
Il y a beaucoup plus de vieux en Europe et beaucoup plus de jeunes en Afrique.
Encore faut il préciser que dans les continents il peut exister encore beaucoup de disparité entre les pays. Ainsi, en Asie les chinois et les japonais ont une pyramide des âges qui donne une grande importance aux classes âgées, ce qui n’est pas le cas du moyen orient.
On trouve cela sur le site de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381482#tableau-figure1
J’en tire cette représentation
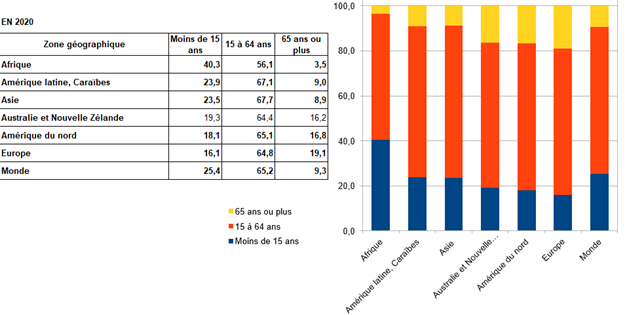 On constate quand même que la classe d’âge des 15 à 64 ans reste très largement majoritaire. Certains discours alarmistes semblent quelquefois nous inciter à croire le contraire.
On constate quand même que la classe d’âge des 15 à 64 ans reste très largement majoritaire. Certains discours alarmistes semblent quelquefois nous inciter à croire le contraire.
Si on s’intéresse à la France métropolitaine (https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303333?sommaire=3353488) et qu’on prend certaines périodes de notre Histoire, en tenant compte évidemment des éléments publiés par l’INSEE
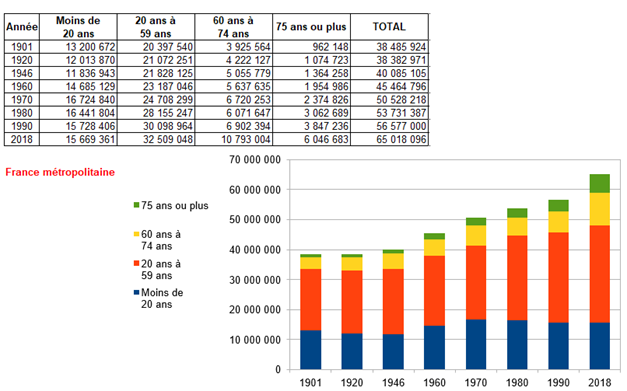
C’est un peu plus clair si on compare simplement la répartition des classes d’âge entre 1980 et 2018 dans le cadre d’une représentation « camembert ».
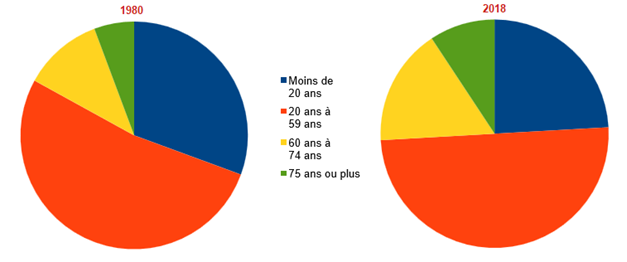 On voit ainsi les classes d’âge qui progressent et celles qui régressent !
On voit ainsi les classes d’âge qui progressent et celles qui régressent !Donc nous sommes dans une société où il y a de plus en plus de vieux.
Et si les vieux occupent de plus en plus de place, ce sont surtout eux qui détiennent le patrimoine.
Dans les salles de concert de musique classique, dans les théâtres et même dans les cinémas après le COVID et NETFLIX la proportion de vieux est de plus en plus importante.
Mais là où la véritable querelle de génération vient d’éclater, au moins sur certains réseaux sociaux c’est la proportion de votants et la nature du vote des vieux.
« France Info » relaie cette proposition de certains : <Pourquoi l’idée d’un âge limite pour le vote des seniors en convainc certains> le titre ajoute : « et scandalise les autres »
Et voilà ce que dit cet article :
« C’est une petite musique qui courait déjà avant le premier tour de l’élection présidentielle, dimanche 10 avril, mais qui s’est renforcée à l’annonce des résultats. « Les jeunes qui ont voté en masse Mélenchon pour leur avenir se font voler leur élection par des vieux retraités qui ont vécu leur meilleure vie et n’ont plus rien à perdre et des vieux bourgeois qui ont tous les privilèges de Macron », s’exaspérait par exemple un jeune sur Twitter au soir du premier tour. Un autre s’agace aussi, graphiques à l’appui : « Ce sont donc des vieux déjà à la retraite qui vont nous imposer de travailler cinq ans de plus. Merci à eux. » A tel point que certains vont jusqu’à se poser cette question : « Pourquoi diable laissons-nous les plus de 65 ans voter ? » »
L’article de France Info parle même d’une lame de fond :
« Elle est une lame de fond plus profonde dans une partie de cette classe d’âge, angoissée et en partie mobilisée sur des thématiques qui ne sont parfois pas le centre d’intérêt des autres classes d’âge, et des seniors en particulier. « Ils ont voté sans penser à nous », déploraient des étudiants qui bloquaient la Sorbonne à Paris, jeudi 14 avril, dans le podcast de franceinfo Le Quart d’Heure. « On a deux candidats qui méprisent l’urgence sociale, climatique et écologique. Je trouve ça terrible », exprimait pour sa part, lundi 11 avril Denis, 26 ans, au micro de Manon Mella dans « Génération 2022″. Il disait ressentir « une fracture entre les plus jeunes et les plus vieux »»
Les experts s’en mêlent ainsi le politologue Martial Foucault dans La Croix analyse :
« Pour les plus âgés, les enjeux sont d’abord le pouvoir d’achat, l’insécurité ou encore la délinquance, avant d’être la lutte contre le réchauffement climatique, qui est davantage une priorité pour les jeunes ». »
Nous sommes dans un paradoxe dans lequel les vieux qui devraient être sages et s’inscrire dans le long terme s’inquiètent de l’immédiat et du court terme, alors que les jeunes impétueux qui devraient vivre au présent pensent et s’inquiètent du long terme.
L’article de France Info montre que si, bien sûr les vieux représentent un poids démographique de plus en important dans la société, leur importance dans le vote vient surtout du fait qu’ils vont majoritairement voter alors que les jeunes massivement s’abstiennent.
C’est donc la responsabilité des jeunes qui est en cause car ils ne vont pas voter et prétendent même qu’ils ont bien raison de faire ainsi.
C’est une erreur non pas morale, mais simplement stratégique.
Car comme l’écrit le sociologue Jérémie Moualek :
« Les politiques publiques épousent les revendications des classes d’âge qui votent le plus. »
S’il faut être rassurant pour nous autres vieux, la conclusion de l’article de France Info montrent que la pondération du vote des plus âgés rencontre de vrais obstacles techniques et éthiques Pour l’instant cette idée n’a pas vocation à prospérer.
Dans le vote, il faut reconnaître qu’il existe un vrai <clivage entre les générations>. Ainsi si on analyse le premier tour des élections présidentielles
« Plus d’un tiers des moins de 35 ans ont choisi le leader de la France insoumise. […]
Chez les actifs, de 35 à 65 ans, c’est la candidate du Rassemblement national qui mène les suffrages.
[En revanche Macron] devance la candidate du RN et celui de LFI très nettement dans le vote des électeurs de plus de 60 ans, recueillant selon Ipsos 41% des suffrages chez les plus de 70 ans »
Pour le sociologue Laurent Lardeux
« Si un clivage politique existe bien entre les générations, il se serait surtout créé entre les seniors et le reste de la population, les jeunes inclus. Les seniors vont voter de façon très spécifique par rapport aux autres générations, plus particulièrement sur les valeurs conservatrices auxquelles ils adhèrent plus largement.
A contrario, le vote de la jeunesse a plutôt tendance à être proche du vote des 35-65 ans. « On voit qu’il y a plutôt un rapprochement générationnel entre les jeunes et la population active »
 Et en effet, contrairement aux Vieux fourneaux de la BD qui considérerait probablement que même Melenchon n’est pas assez à gauche, les vieux votent à droite.
Et en effet, contrairement aux Vieux fourneaux de la BD qui considérerait probablement que même Melenchon n’est pas assez à gauche, les vieux votent à droite.
Le journal « Libération » posait déjà en 2018 la question : <Pourquoi les personnes âgées votent à droite ?>
La réponse :
« Les seniors sont plus conservateurs et attachés à la transmission de leur patrimoine, des valeurs traditionnellement mises en avant par la droite. […]
Première raison : les seniors sont aussi les plus conservateurs […]
Deuxième raison: le patrimoine. Les plus âgés sont aussi ceux qui détiennent le plus de patrimoine en France. […]. De fait, ils sont donc plus sensibles aux politiques proposant de diminuer les impôts sur la succession, faciliter les donations ou encore supprimer ou modifier l’ISF. […]
Leur demande de stabilité est absolument centrale. Quand elle propose un report de l’âge légal pour le départ à la retraite (jusqu’à 65 ans pour le candidat Juppé), la droite rassure ainsi les seniors car cela pérennise le système et donc leurs pensions. Une logique qui vaut pour tout ce qui peut contribuer à assurer leurs revenus – alors qu’eux-mêmes ont généralement bénéficié d’une retraite à 60 ans. C’est d’autant plus vrai que les seniors ne paient pas les contreparties de telles réformes, celles-ci pesant sur les actifs et le marché du travail bien davantage que sur le niveau des pensions ou le système de santé.
En résumé, les seniors votent à droite car ils sont plus conservateurs et attachés à la transmission de leur patrimoine, selon les chercheurs ayant travaillé sur ces sujets. »
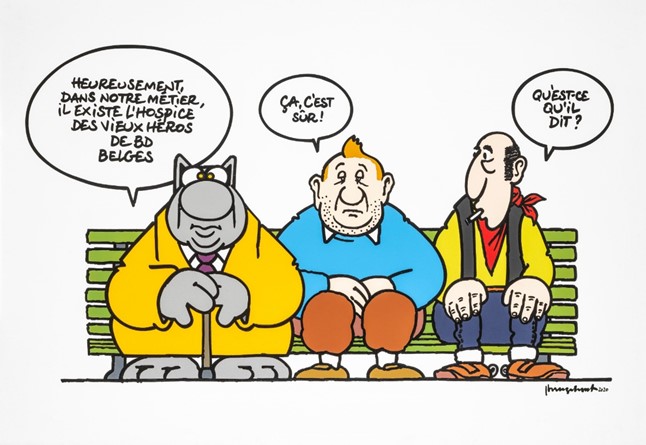
Je résumerai ainsi cette analyse : les vieux votent majoritairement à droite, parce que majoritairement c’est leur intérêt.
Et pour régler cela pacifiquement et intelligemment il faut tout simplement que les jeunes qui restent plus nombreux dans notre société comme le montre les camemberts publiés, ne doivent pas laisser faire, s’ils ne sont pas d’accord, en allant voter.
<1694>
-
Jeudi 30 juin 2022
« Je suis hyper émue d’avoir vécu cette expérience, de m’être fait prendre dans cette rivière-là. »Aurélie Sylvestre épouse de Matthieu assassiné au Bataclan le 13 novembre 2015Ce fut le plus long procès criminel de la France de l’après-guerre : Après neuf mois d’audiences hors norme, les cinq magistrats de la cour d’assises spéciale ont rendu leur décision contre les vingt personnes (dont six « jugées en absence ») accusées d’avoir participé aux attentats du 13 novembre
« Libération » parle d’un « verdict pour l’Histoire » en narrant l’ensemble des peines prononcées
 Hier le journal publiait en Une : « L’humanité a gagné »
Hier le journal publiait en Une : « L’humanité a gagné »
Nous autres français sommes souvent critiques sur notre pays, mais je crois que pour ce procès nous pouvons être fier.
Les américains n’ont pas su le faire, ils ont inventé Guantanamo et n’ont pas su mettre en pratique un procès digne de l’état de droit et d’une démocratie libérale.
Le Un Hebdo a aussi consacré le numéro de cette semaine à ce procès : « Je ne suis plus victime, je suis un survivant »
Et dans ce numéro, l’écrivain Robert Solé interroge le mot « Partie civile »
« À l’ouverture de ce procès hors norme, ils étaient déjà 1800. Par la suite, quelque 700 autres rescapés, blessés ou proches des victimes se sont également constitués partie civile pour avoir subi, eux aussi, un préjudice corporel, matériel ou moral ce funeste 13 novembre 2015.
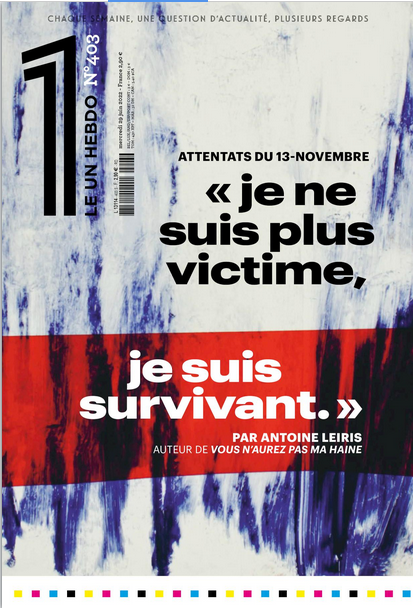 Un procès pénal oppose l’accusé au ministère public. Cependant, un troisième acteur s’est introduit peu à peu dans le prétoire, sans se limiter à un strapontin : devenue « partie au procès », la victime bénéficie de droits croissants, notamment celui de pouvoir s’exprimer à l’audience.
Un procès pénal oppose l’accusé au ministère public. Cependant, un troisième acteur s’est introduit peu à peu dans le prétoire, sans se limiter à un strapontin : devenue « partie au procès », la victime bénéficie de droits croissants, notamment celui de pouvoir s’exprimer à l’audience.
Des juristes contestent cette évolution, estimant qu’un « parquet bis » vient porter atteinte à l’équilibre entre l’accusation et la défense. Mais on peut se demander ce qu’aurait été le « procès du Bataclan » sans les témoignages bouleversants de ces hommes et de ces femmes, frappés par la foudre il y a six ans : ceux qui s’étaient interdit de pleurer ; ceux qui se sont adressés sans haine aux accusés ; ceux qui ne se pardonnent pas d’être vivants…
Chaque drame est unique, « mais il y a dans cette salle des mains qui se touchent, des familles qui s’étreignent, des amis qui se réconfortent », disait à la barre Aurélie, une « partie civile » qui a perdu son compagnon dans le massacre, alors qu’elle était enceinte et mère d’un enfant de trois ans. « Il y a ici tout ce qui faisait de nous une cible : l’ouverture à l’autre, la capacité d’aimer, de réfléchir, de partager, et c’est incroyable de constater qu’au milieu de tout ce qui s’est cassé pour nous ce soir-là, ce truc-là est resté intact. »
En l’entendant, on se disait que le terme glacial de « partie civile » était bien mal adapté à tant de douleurs, de larmes et d’humanité. »
Aurélie, c’est Aurélie Sylvestre qui a perdu son compagnon Matthieu Giroud au Bataclan alors qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant. Son témoignage puissant et plein d’humanité lors du procès a marqué beaucoup de monde et a été relayé massivement dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Le <mot du jour du 8 février 2022> avait été consacré à ce moment.
A la veille du verdict, « Libération » est allé l’interviewer : «Plus tu touches à l’intime et à la sincérité, plus tu es universel. »
« Je me souviens du premier jour, quand le président de la cour a lu la liste des victimes des attentats, tous ces noms égrenés : on convoquait les fantômes. Et puis, dans la salle, il y avait toutes les autres parties civiles, moi qui avais vécu complément recroquevillée sur mon chagrin, j’ai vu tous ces gens et j’ai pensé : « On a tous été brûlés à la même flamme. » »
Toutes les parties civiles, ce n’est pas un beau mot, mais il permet d’inclure la communauté de celles et ceux qui sont victimes ou parents de victimes de cet attentat, ont raconté peu ou prou la même chose : ils ont fait de merveilleuses rencontres au cours de ce procès qui leur a fait du bien
 Aurélie Sylvestre le dit ainsi :
Aurélie Sylvestre le dit ainsi :
« Pendant six ans, j’ai négligé mon traumatisme. Epuiser le récit de cette nuit-là, rencontrer d’autres personnes qui ont vécu ça, a vraiment eu une vertu. Oui, ce procès nous répare, je le découvre. Et je trouve important de le dire. On a tous cheminé dans cette salle : les accusés, les avocats, les parties civiles… On n’est plus du tout au même endroit qu’en septembre. Je suis hyper émue d’avoir vécu cette expérience, de m’être fait prendre dans cette rivière-là.
[…] La femme que j’étais vraiment a explosé la nuit du 13 Novembre. Pendant six ans, j’ai eu l’impression d’avoir ramassé mes petits morceaux de moi. Avec ce procès, j’ai pu rassembler ces débris et sculpter, réanimer la femme que j’étais avant. Ces dix mois, à la fois très longs et très courts, ont été une avancée spectaculaire. Cela m’a permis de métaboliser mon drame. J’ai pourtant longtemps cru qu’il fallait que je me trouve ailleurs, comme disait Marguerite Yourcenar. Il fallait tout ce temps-là. Il fallait six ans et dix mois pour me retrouver. Je vais tourner une énorme page, et après ça, la vie recommencera. C’est sûr, il y aura un après. »
Répondre à la barbarie par de l’humanité, c’est ce qui honore une civilisation.
<1693>
-
Mercredi 29 juin 2022
« Faire de la chute, un pas de danse, faire de la peur, un escalier. »Fernando SabinoOn ne va pas se mentir, quelque soit l’endroit vers lequel on se tourne : Les États-Unis, la France, la guerre d’Ukraine, la Chine, la crise alimentaire mondiale, le réchauffement climatique et tant d’autres choses encore, la situation est très préoccupante.
Et puis, brusquement ce poème s’est affiché sur mon écran :
« De tout, il resta trois choses :
La certitude que tout était en train de commencer,
la certitude qu’il fallait continuer,
la certitude que cela serait interrompu avant que d’être terminé.
Faire de l’interruption, un nouveau chemin,
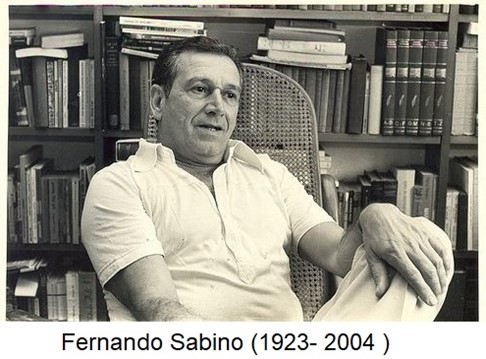 faire de la chute, un pas de danse,
faire de la chute, un pas de danse,
faire de la peur, un escalier,
du rêve, un pont,
de la recherche…
une rencontre. »
Ce texte est inséré dans le roman « O encontro marcado » [Le rendez-vous] publié en 1956 par le poète brésilien Fernando Sabino.
Fernando Sabino est né, le 12 octobre 1923 à Belo Horizonte au Brésil et il est décédé le 11 octobre 2004 à Rio de Janeiro.
<Wikipedia> nous apprend que Fernando Sabino est l’auteur de 50 livres, romans, nouvelles, chroniques, essais. Et qu’il a accèdé à une renommée nationale et internationale en 1956 précisément avec le roman O Encontro Marcado qui est l’histoire de trois amis de Belo Horizonte. Le livre est inspiré de la vie de l’auteur.
« Le Monde » a publié un article hommage lors de son décès : < Fernando Sabino, écrivain et journaliste brésilien>
Cet article nous apprend qu’il avait choisi son épitaphe :
« Ci-gît Fernando Sabino. Né homme, il est mort enfant. »
<1692>
-
Mardi 28 juin 2022
« Le côté obscur des religions.. »Imposer aux autres ce qu’on croit ou peut être même feint de croireIls ont osé !
L’Amérique des évangéliques, celle qui vote massivement Trump est arrivée à son objectif : annuler l’arrêt rendu par d’autres juges de la Cour Suprême des États Unis en 1973 : « l’Arrêt Roe v Wade »
« Roe v. Wade », 410 U.S. 113 est un arrêt historique rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1973 sur la question de la constitutionnalité des lois qui criminalisent ou restreignent l’accès à l’avortement. La Cour statue, par sept voix contre deux, que le droit à la vie privée, en s’appuyant sur le quatorzième amendement de la Constitution des États-Unis, s’étend à la décision d’une femme de poursuivre ou non sa grossesse, mais que ce droit doit être mis en balance avec les intérêts de l’État dans la réglementation de l’avortement : protéger la santé des femmes et protéger le potentiel de la vie humaine.
Roe v. Wade est devenu l’un des arrêts de la Cour suprême les plus importants politiquement, divisant les États-Unis entre personnes se disant « pro-choice » (« pro-choix », pour le droit à l’avortement) et « pro-life » (« pro-vie », anti-avortement).
Et depuis 1973, méthodiquement avec la persévérance, la patience de ceux qui croient en l’Éternité, ces régressifs ont poursuivi leur lutte, pas à pas, en infiltrant les cercles de pouvoirs ou en faisant un lobbying incessant auprès des élus et en usant de toutes les opportunités même les plus invraisemblables. Ils ont finalement utilisé Donald Trump, qui est tellement loin de tous les principes moraux qu’ils prétendent mettre en œuvre, pour parvenir au but qu’ils s’étaient fixés.
Et c’est ainsi que cet ignoble personnage a pu écrire :
Dans un communiqué, Donald Trump a estimé que la décision historique sur l’avortement, après celle de jeudi consacrant le droit au port d’armes en public, a été rendue possible « seulement car j’ai tenu mes promesses ».
Il a en effet nommé trois juges conservateurs, pendant les 4 années de son mandat, dont un en tout fin de mandat.
Alors que les lobbys évangéliques et républicains sont arrivés à empêcher Obama de nommer un juge progressiste, en prétendant qu’en fin de mandat un Président n’était plus légitime à nommer un juge à vie.
Et le milliardaire cynique et inculte a ajouté :
« Ces victoires majeures montrent que même si la gauche radicale fait tout ce qui est en son pouvoir pour détruire notre pays, vos droits sont protégés, le pays est défendu et il y a toujours un espoir et du temps pour sauver l’Amérique ».
Je n’approfondirai pas cette organisation juridique si particulière des États-Unis, dans laquelle ce sont les 9 juges de la Cour Suprême qui fixent les règles en se basant sur l’interprétation de la constitution des États-Unis.
En France, c’est une Loi, la fameuse Loi Simone Veil qui a fixé les règles qui encadraient le droit des femmes à recourir à l’interruption volontaire de grossesse.
Aux États-Unis ce n’est ni le Congrès fédéral, ni le Sénat fédéral qui sont intervenus, mais la Cour Suprême Fédéral qui, en 1973, a contraint les gouvernements des États fédérés de tolérer l’avortement.
Par son jugement du 24 juin 2022 et par 6 voix contre 3, la Cour donne raison à l’État du Mississippi qui l’avait saisi et révoque Roe v. Wade. Les États sont désormais libres de définir la politique relative à l’avortement dans leur juridiction.
Cette même Cour avait la veille, le 23 juin 2022, autorisé tous les Américains à sortir dans la rue, armés d’une arme de poing, dissimulée sous leurs vêtements. Ce qui était interdit, par exemple, dans les rues de New York.
Et il semble qu’elle a même l’intention de ne pas s’arrêter en si bon chemin et envisage à revenir aussi sur la contraception, en interdisant la délivrance des pilules contraceptives, permises depuis 1955 – soit 2 ans avant la France !
Nous sommes dans un pays où comme l’écrit, en 2014, <Le Monde> :
« Un quart des Américains (26 %) ignorent que la Terre tourne autour du Soleil et plus de la moitié (52 %) ne savent pas que l’homme a évolué à partir d’espèces précédentes d’animaux. C’est ce que révèle une enquête aux résultats édifiants, menée auprès de 2 200 personnes par la Fondation nationale des sciences américaine et publiée vendredi 14 février. »
En France, sommes-nous à l’abri de telles dérives ?
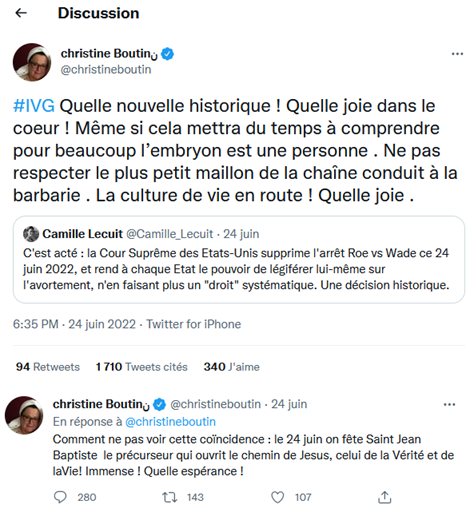 J’ai reproduit le tweet ainsi qu’un ajout qu’a écrit cette dame qui a été député pendant 21 ans et ministre du logement pendant deux ans dans le gouvernement de Fillon sous la présidence de Sarkozy.
J’ai reproduit le tweet ainsi qu’un ajout qu’a écrit cette dame qui a été député pendant 21 ans et ministre du logement pendant deux ans dans le gouvernement de Fillon sous la présidence de Sarkozy.
Et elle n’est pas seule, il suffit de se rappeler de ce furent les manifestations contre le mariage pour tous.
Simone de Beauvoir écrivait
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant »
Tout ceci ne serait pas possible s’il n’existait plus des populations complètement aveuglées par des récits écrits par des hommes, je veux dire des mâles humains, et que ceux qui croient continuent à penser qu’il s’agit de textes dictés directement par leur dieu.
Il y a quelques mois, en allant au travail, juste après avoir posé le vélo’v à sa station, j’ai été interpellé par 3 jeunes hommes en costume, portant écusson qui portait cette mention : « L’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ».
Ce qui est le nom « scientifique » des Mormons.
Ils ont souhaité engager la conversation, j’y consentis.
Et voici la teneur de cet échange, cité de mémoire. Je pense que vous n’aurez aucune peine à distinguer mes propos de ceux des trois jeunes aspirant à devenir des saints des derniers jours :
- Bonjour
- Bonjour
- Nous sommes…
- Oui je sais, j’ai vu votre écusson
- Croyez-vous en l’existence de Dieu ?
- Je ne sais pas si Dieu existe ou s’il n’existe pas.
- Si vous examinez le monde, le soleil, l’univers vous croyez vraiment que tout cela peut exister par hasard, sans qu’il y ait quelqu’un qui a créé tout cela ?
- Oui c’est possible que le hasard ait fait cela. Mais si c’est vraiment Dieu qui a réalisé cela, cet univers gigantesque avec des milliards d’étoiles, de planètes, de trous noirs, croyez vous vraiment que ce Dieu puisse manifester le moindre intérêt pour un animal vaguement évolué, habitant une petite planète du système solaire situé en périphérie de la galaxie de la voie lactée, une parmi des milliards d’autres ? Ne manifestez-vous pas ainsi un orgueil incommensurable ?
- Mais si, Dieu s’intéresse à nous, nous entoure de son amour et nous guide pour notre bien.
- Vous êtes sérieux ? Qu’avez-vous compris de l’histoire récente des humains, simplement depuis le début du XXème siècle. Qu’a fait ce Dieu dont vous me parlez à Auschwitz ?
- Il était là, mais il a laissé les humains agir selon leur volonté.
- Évidemment, c’est une hypothèse commode, mais elle ne me convainc pas. Je vous ai dit que je ne sais pas si Dieu existe. Mais je suis convaincu ou je crois si vous préférez que votre Dieu, celui dont il est question dans la bible ou dans le coran, lui il n’existe pas ! Ce qui existe ce sont des organisations humaines qui sont hiérarchisées, qui profitent à ceux qui les dirigent et qui sont grisés par le pouvoir qu’ils en tirent et quelquefois même des revenus et un patrimoine substantiel. En général ce sont d’ailleurs des hommes qui par le récit et les règles qu’ils racontent ont parmi leur objectif principal de soumettre les femmes.
- Mais non ce n’est pas ainsi et croyez-vous en l’existence de Jésus ?
- Jésus, l’homme a peut-être existé, mais il n’y a aucune source autre que celles écrites par les chrétiens qui atteste de son existence.
- Mais si, il y a d’autres sources…
- Alors là jeune homme ce sont des découvertes récentes dont je n’ai pas connaissance, parce que vous comprenez c’est un sujet qui m’intéresse.
- Il y a l’historien Flavius Josephe qui parle de Jésus.
- Oui, mais là ce n’est pas une source externe, Flavius Josephe cite des chrétiens qu’il a rencontré et rapporte ce qu’ils lui ont dit. En revanche, il y a une stèle qu’on a retrouvé au proche orient qui évoque l’existence de Ponce Pilate. Mais savez-vous que le Dieu monothéiste a été inventé par les juifs il y a environ 2500 ans. Et que notre espèce homo sapiens a environ 100 000 ans d’existence. Notre race humaine a donc su se passer, la plus grande partie de son existence, de ce Dieu éternel, unique et qui s’intéresserait à vous ?
- …
- Bon il faut que je me rende à mon travail. Si je peux me permettre un conseil : si le fait de croire vous fait du bien n’hésitez pas à continuer, mais garder toujours éveillé le germe fécond du doute et surtout n’imposez jamais votre croyance et vos règles par la contrainte. Bonne journée !
- Bonne journée.
Alors il peut exister un coté lumineux de la religion, celle qui s’intéresse au spirituel, à ce qui nous dépasse et à ce qui transcende le matériel.
Régis Debray, à ce stade, pense que l’absence de Dieu est pire que sa présence.
Il y aussi ce propos qu’aurait tenu Jaurès à des radicaux qui étaient très anticléricaux au début du XXème siècle :
« Pourquoi voulez-vous faire taire cette petite voix consolante qui fait tant de bien aux pauvres humains qui sont dans la peine ? »
Car oui, c’est une source de consolation pour beaucoup qui souffrent, qui sont dans le deuil ou sont au seuil de cette terrible inconnue qu’est la mort.
Mais le côté obscur des religions c’est celui qui veut imposer sa règle à tous, obliger tout le monde à respecter les règles que les adeptes de ce récit auquel ils croient s’imposent à eux-mêmes.
Et dans ce cas quand ils sont puissants, les religieux sont même capables des pires crimes pour imposer leurs règles.
Combien de crimes ont été ainsi commis au nom de ces religions qui prétendent œuvrer pour la paix et d’amour du prochain ?
Il faut arrêter d’être naïf.
Et en France, au moins, il est essentiel de respecter les croyances, permettre à chacun de vivre librement sa Foi tant qu’elle n’est pas en contradiction avec la Loi de la République.
Mais de manière réciproque ; il faut défendre avec fermeté, lucidité et force s’il le faut, la liberté de faire et penser autrement quand les religions de toute obédience veulent imposer aux autres, à leur famille puis aux voisins puis à tout le monde les règles qu’ils s’appliquent à eux même parce qu’ils adhèrent à un récit particulier.
Nous devons arrêter de regarder les responsables ou autorités religieuses avec les yeux de Chimène en leur reconnaissant une quelconque autorité morale générale.
Nous devons les regarder avec les yeux du doute que je décrirai ainsi :
Je reconnais ton droit absolu de croire. Est-ce que tu reconnais réciproquement la liberté des autres à ne pas croire ce que tu crois et est-ce que tu renonces définitivement à imposer aux autres et à la société les règles qui ne concernent que ta foi et ceux qui y adhèrent ?
<La journaliste Ana Kasparian> synthétise tout cela très bien.
<1689>
- Bonjour
-
Lundi 27 juin 2022
« Ne pleurons pas de l’avoir perdue, mais réjouissons-nous de l’avoir connue. »Jean-Louis Trintignant après le décès de sa fille Marie TrintignantJean-Louis Trintignant est mort, le 17 juin, à l’âge de 91 ans « paisiblement, de vieillesse, […] entouré de ses proches », a fait savoir son agent.
 Il est ainsi mort une seconde fois ou mort vraiment.
Il est ainsi mort une seconde fois ou mort vraiment.
En effet, dans une interview face à Claire Chazal dans « Entrée Libre » sur France 5, fin 2018, Jean-Louis Trintignant avait expliqué que le décès de sa fille Marie Trintignant l’avait dévasté :
« Ça ne guérit pas. Depuis quinze ans, ça m’a complètement abattu. Je suis mort il y a quinze ans, avec elle. […] rien n’a pu m’aider à traverser ce deuil. […] Je vais très mal. »
Marie Trintignant est décédée le 1er Août 2003 d’un féminicide perpétré par son compagnon de vie.
Et Jean-Louis Trintignant avait alors prononcé dans ces circonstances tragiques :
« Ne pleurons pas de l’avoir perdue, mais réjouissons-nous de l’avoir connue. »
C’est ce qu’a rapporté François Morel dans l’émouvant hommage qu’il lui a rendu lors de sa chronique hebdomadaire du vendredi : < Hommage à Jean-Louis Trintignant >
Et il a ajouté :
« Je me réjouis d’avoir eu la chance de connaitre un peu Jean-Louis Trintignant. »
Ce ne fut pas la première tragédie que ce vieil homme connut dans sa vie consacrée à l’Art, au Théâtre et au Cinéma.
Il avait déjà perdu une première fille, Pauline, sœur cadette de Marie, née en 1969 et morte à l’âge de dix mois.
Dans le recueil Du côté d’Uzès, entretiens avec André Asséo (2012), Jean-Louis Trintignant confie :
« Un matin, alors que je partais tourner, je suis allé embrasser Pauline dans son berceau. Elle était morte, on n’a pas su comment. J’ai dit à Nadine : Soit on se suicide, soit on accepte de vivre pour Marie. »
Et plus jeune encore, il avait 8 ans, son père était résistant et sa mère avait vécu une histoire d’amour avec un soldat allemand.
En septembre 2017, dans les colonnes du JDD, il raconte :
« Ma mère a été tondue dans une charrette. Bien sûr mon père l’a sauvée, mais il m’a dit ce truc qui m’a bouleversé toute ma vie : ‘Comment as-tu pu laisser faire ça ?’ C’était lourd pour un enfant. »
Et il reconnaissait que c’était une blessure qu’il a porté toute sa vie en ajoutant :
« C’est peut-être pour ça que je suis devenu acteur. Au fond, la décadence des familles bourgeoises, peut-être que j’ai joué ça toute ma vie… »
Laurent Delahousse l’a interviewé en 2018, au théâtre des Célestins de Lyon où il réalisait un spectacle, avec des musiciens, en disant des poèmes : <Jean-Louis Trintignant au Théâtre des Célestins>
 Un entretien d’une profondeur bouleversante.
Un entretien d’une profondeur bouleversante.
A propos de ses parents, il raconte qu’après ce tragique épisode, ils ont encore vécu 20 ans ensemble, mais dans des relations si compliquées qu’ils auraient mieux fait de se séparer rapidement.
Ce spectacle joué à Lyon le fut aussi à Paris. Il avait alors été invité de Léa Salamé, je l’avais rapporté lors du mot du jour du <14 février 2019> pour souligner un poème de Prévert qui faisait partie du spectacle et qu’il a déclamé lors de l’émission :
Il a cité aussi d’autres poètes comme par exemple Pierre Reverdy qui a écrit :
« On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux »
C’était un <monument du cinéma français> titre le journal canadien « Le Devoir » qui narre son immense carrière
Article qui rapporte qu’après la mort brutale de sa fille Marie, il a dit :
« Je devrais m’arrêter, mais je ne veux pas. Les moments les plus heureux de ma vie, c’est quand je travaille, quand je fais du théâtre »
<1688>
-
Vendredi 24 juin 2022
« Macron ou les illusions perdues. »François DosseFrançois Dosse, né le 21 septembre 1950, est un historien et épistémologue français, spécialisé en histoire intellectuelle.
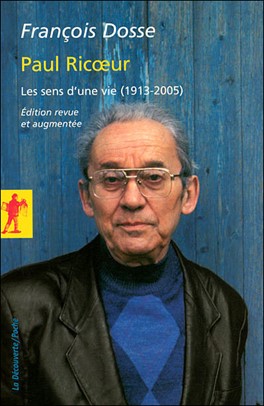 C’était un proche du philosophe Paul Ricoeur.
C’était un proche du philosophe Paul Ricoeur.
Il a publié en 1997 une biographie de ce philosophe : « Paul Ricœur. Les sens d’une vie ».
En 1998, il était professeur à Sciences Po et avait parmi ses élèves Emmanuel Macron.
Et c’est lui, François Dosse, qui a permis la rencontre d’Emmanuel Macron et de Paul Ricoeur.
Et c’est ainsi que de 1999 à 2001, Macron deviendra l’assistant éditorial du philosophe qui recherchait un archiviste pour le livre « La Mémoire, l’histoire, l’oubli ».
Le président de la République évoquait cette relation ainsi :
« La nuit tombait, nous n’allumions pas la lumière. Nous restions à parler dans une complicité qui avait commencé à s’installer. De ce soir-là commença une relation unique où je travaillais, commentais ses textes, accompagnais ses lectures. Durant plus de deux années, j’ai appris à ses côtés. Je n’avais aucun titre pour jouer ce rôle. Sa confiance m’a obligé à grandir. »
François Dosse a pendant longtemps exprimé une grande bienveillance à l’égard de ce jeune homme qui allait être capable d’embrasser un destin exceptionnel.
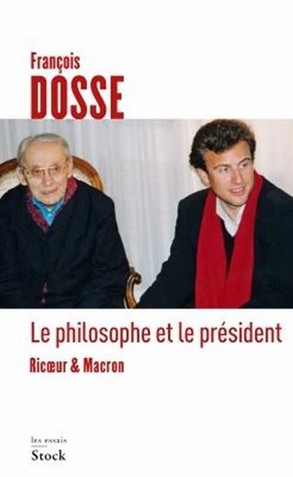 Il va même écrire un livre très positif sur le jeune président au début de son quinquennat : « Le philosophe et le président »
Il va même écrire un livre très positif sur le jeune président au début de son quinquennat : « Le philosophe et le président »
Dans un article du Monde, publié le 3 décembre 2019 et sur lequel je reviendrai plus loin, François Dosse écrivait de ce livre :
« Lorsque j’ai publié, en septembre 2017, « Le Philosophe et le Président. Ricœur & Macron », chez Stock, mon intention première était de défendre la vérité des faits : attester ta proximité avec Paul Ricœur, alors qu’elle était contestée par certains, qui dénonçaient une forme d’imposture. Dans ce livre, et sur la base de ta campagne présidentielle, je faisais état de tes sources d’inspiration en tant que candidat et soulignais à quel point les positions philosophiques de Ricœur avaient été importantes pour toi, fécondant tes propositions sur l’Europe, la laïcité, la justice sociale, la revitalisation de la démocratie politique, la mémoire nationale. Durant toute la première partie de ton mandat présidentiel, ma confiance et mes sentiments amicaux m’ont incité à ne jamais répondre à quelque sollicitation pétitionnaire ou critique. J’ai eu pour toi les yeux de Chimène, émerveillé par l’étendue de tes compétences et de ton savoir-faire. »
L’émerveillement est passé.
François Dosse a parlé d’«un moment de rupture majeur» en dénonçant, en 2019, ses discours et ses mesures « inadmissibles » sur l’immigration.
Pour marquer ce désaccord, il a publié une tribune dans le Monde, il s’agit de l’article du 3 décembre 2019 évoqué : « Emmanuel, tes propos sur l’immigration contribuent à la désintégration de ces populations fragilisées » :
Il écrit notamment :
« Si je prends la plume aujourd’hui, c’est que je ne peux souscrire à tes dernières déclarations sur la nécessité d’un débat national sur l’immigration et à l’orientation politique prise dans ce domaine par ton gouvernement. La stigmatisation de la population immigrée comme source des problèmes que rencontre la société française, qui se situe aux antipodes des positions éthiques et politiques de Ricœur dont tu t’es réclamé, constitue pour moi un moment de rupture majeur.
Il ne s’agit pas de défendre la posture de la belle âme soucieuse de ne pas se compromettre dans le pragmatisme du quotidien, mais de rappeler les positions éthiques de Ricœur qui devraient inspirer une juste politique de l’immigration. Il affirmait en premier lieu le principe intangible de l’hospitalité. Comme tu le sais, au soir de sa vie, Ricœur a avancé le paradigme de la traduction en faisant droit, comme Jacques Derrida, à la vertu de l’hospitalité, à l’« hospitalité langagière », où « le plaisir d’habiter la langue de l’autre est compensé par le plaisir de recevoir chez soi (…) la parole de l’étranger » (Ricœur, Sur la traduction, Bayard, 2004, page 20).
Je te rappelle que Ricœur, philosophe au cœur de la Cité, s’est engagé dans les années 1990 auprès des sans-papiers. Au printemps 1996, dans la plus grande confidentialité, il est intervenu comme médiateur auprès des 300 Maliens sans-papiers [qui, de mars à août 1996, avaient occupé l’église Saint-Bernard, dans le 18e arrondissement parisien, soutenus par de nombreuses personnalités]. Présent aux multiples réunions de concertation tenues dans les hangars, il a, avec d’autres, essayé de trouver une solution. Dans cette mobilisation, Ricœur a été à l’unisson de sa famille spirituelle. »
Et il va continuer à décliner toutes les actions et propos du Président qui heurtent, selon lui, le message et les valeurs que portaient Paul Ricoeur.
Et il finit son article par le rappel de l’Emmanuel qui l’enthousiasmait :
« Rappelons que tu avais alors, Emmanuel, salué le courage et l’humanité d’Angela Merkel, qui a payé électoralement la fermeté de ses positions éthiques. C’est ce que j’attendais de toi et n’attends plus, me rappelant simplement avec mélancolie un autre Emmanuel, qui suscitait mon enthousiasme lorsqu’il déclarait, lors de sa campagne à Marseille, le 1er avril 2017, devant une foule enthousiaste et pleine d’espérance : « Quand je regarde Marseille, je vois une ville française façonnée par deux mille ans d’histoire, d’immigration, d’Europe, du Vieux-Port à Saint-Loup en passant par le Panier », et d’ajouter : « Je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, j’en vois des tas d’autres, que je n’ai pas cités, mais je vois quoi ? Des Marseillais, je vois des Français, ils sont là et ils sont fiers d’être français. »
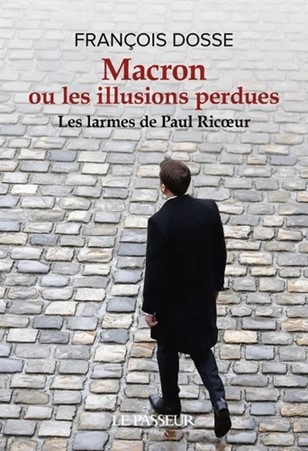 Trois ans après cet article, il a publié en mars 2022, un second livre sur Emmanuel Macron dont j’ai choisi le titre pour exergue : « Macron ou les illusions perdues. »
Trois ans après cet article, il a publié en mars 2022, un second livre sur Emmanuel Macron dont j’ai choisi le titre pour exergue : « Macron ou les illusions perdues. »
Le sous-titre de ce livre, bilan du quinquennat était : « les larmes de Paul Ricoeur. »
<Philosophie Magazine> pose, à propos de ce livre, la question :
« Est-ce un portrait d’Emmanuel Macron en Lucien de Rubempré ? »
Rappelons que Lucien de Rubempré est un des personnages de la Comédie humaine de Balzac et qu’il occupe le rôle principal dans les deux livres : « Splendeur et misère des courtisanes » et « Les illusions perdues » qui décrivent l’ascension et la chute de cet ambitieux qui veut se faire une place dans la haute société parisienne.
Dans ce second livre, la critique de François Dosse va plus loin que la seule remise en cause au sujet de l’immigration. :
« Mais, de manière plus générale, c’est la politique macronienne dans son ensemble que condamne Dosse en détaillant aujourd’hui les motifs de son mécontentement. Pratique verticale d’un pouvoir jupitérien, politique économique néolibérale, relégation de l’enjeu écologique au second plan, lois liberticides pendant la pandémie, caporalisation de l’Éducation nationale… Les griefs ne manquent pas dans ce véritable réquisitoire. »
Parallèlement à ce livre, François Dosse a publié sur le site : « AOC », le 10 mars 2022, un article d’opinion : « Macron ou le peuple de gauche floué »
C’est un article d’une belle profondeur intellectuelle et qui énumère les renoncements et les contradictions de notre président .
Fraçois Dosse fait le constat de la dévitalisation de notre vie politique et de l’atonie des partis politiques, éléments essentiels de la vie démocratique. Il reconnaît qu’Emmanuel Macron n’est pas le seul « responsable de l’atonie idéologique ambiante ni de l’absence de projet de société, » mais il porte sa part. Car, bien loin de sa promesse de renouvellement des pratiques politiques il a sombré très vite dans les pratiques les plus médiocres de l « ancien monde »
Et François Dosse oppose l’espoir de 2017 avec la décourageante pratique qu quinquennat :
« On aurait pourtant pu croire, et je l’ai cru en 2017, […] qu’Emmanuel Macron ne serait pas un simple gestionnaire du système en place mais pourrait profiter de la liberté que lui donnait une majorité absolue à l’Assemblée nationale pour bousculer quelques conventions et diriger une politique de modernisation et de justice sociale. […]
Je pensais en 2017 que le nouveau président s’attacherait à articuler justice et égalité dans la perspective que définissait Ricœur comme la construction d’« une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes ». Au plan politique, cette éthique impliquait une stratégie de rupture avec la logique capitaliste qui a pour effet d’accroître les inégalités. On pouvait penser que l’annonce par Macron d’un « nouveau monde » allait progresser dans ce sens. Il n’en a rien été, et le nouveau président n’a jamais remis en question le principe de maximisation du profit propre au système capitaliste ; il en a au contraire renforcé ses traits les plus inégalitaires. »
Et il cite à nouveau Paul Ricoeur, (« Justice et Marché. Entretien entre Michel Rocard et Paul Ricoeur », Esprit, n° 1, janvier 1991, p. 8.) :
« Ce qu’il faut commencer par contre, sans tarder, c’est la critique du capitalisme en tant que système qui identifie la totalité des biens à des biens marchands. »
Macron se réclamait aussi de Michel Rocard qui l’a soutenu en 2017. Depuis Michel Rocard est mort. J’ai la faiblesse de croire que Rocard non plus n’aurait pas approuvé l’évolution de notre jeune président.
Dans le même article, page 6, Ricoeur suggérait :
« l’idée que la société en tant que réseau d’institutions consiste avant tout en un vaste système de distribution, non pas au sens étroitement économique du terme distribution opposé à production, mais au sens d’un système qui distribue toutes sortes de biens : des biens marchands, certes, mais aussi des biens tels que santé, éducation, sécurité, identité nationale ou citoyenneté. ».
François Dosse cite alors avec regret les espoirs que Macron suscitait dans son livre « Révolution » (page 138)
« Faire plus pour ceux qui ont moins […] Sans solidarités, cette société tomberait dans la dislocation, l’exclusion, la violence – la liberté de choisir sa vie serait réservée aux plus forts, et non aux plus faibles »
Dans mon analyse, je fais deux grands reproches à Macron, le premier est sur sa manière de gouverner en solitaire, sans s’appuyer sur les corps intermédiaires, sans faire appel à un travail d’équipe. Le second est sur son analyse de la société économique : Il prétend qu’il n’y a a pas assez de riches, il encourage les jeunes à se fixer comme but de vie de devenir milliardaire, alors que l’évolution qu’on constate est l’accroissement des inégalités de revenus et encore plus de patrimoine, une inversion de la tendance observée après 1945. François Dosse exprime la même désapprobation :
« […]comme l’a montré Thomas Piketty, à un renversement de tendance à l’échelle internationale. Après une période de réduction des inégalités correspondant à la période d’après-guerre, le monde occidental a connu un accroissement spectaculaire des inégalités sociales. […]
« Lorsque Macron arrive à l’Élysée en 2017, il est donc confronté à un processus d’accroissement des inégalités qu’il aurait dû essayer d’enrayer au nom de la justice et de la mission du politique à œuvrer à la mise en place d’institutions justes. Or, il a fait strictement le contraire en favorisant les plus riches. »
Et concernant sa pratique du pouvoir, François Dosse montre aussi sa duplicité entre ce qu’il écrivait dans un article (Emmanuel Macron, « Les labyrinthes du politique. Que peut-on attendre pour 2012 et après ? », Esprit, mars/avril 2011.), alors qu’il se préparait à soutenir Hollande :
« Macron […] mettait en garde contre le caractère trop vertical du pouvoir politique. Il y défendait la nécessité d’instiller davantage d’horizontalité pour redynamiser une démocratie souffrant de langueur, attestée par la part croissante de citoyens éloignés des sphères de décision, finissant par s’abstenir massivement lors des échéances électorales . […] Il stigmatisait alors les effets délétères sur la vie démocratique de l’extrême polarisation de la vie politique autour de la seule élection présidentielle : « Le temps politique vit dans la préparation de ce spasme présidentiel autour duquel tout se contracte et lors duquel tous les problèmes doivent trouver une réponse. » Il prenait alors ses distances avec cette tendance de la Ve République à s’orienter vers toujours plus de présidentialisation, qui a pour effet d’écraser sous son poids toute la vie politique du pays. »
Et son action présidentielle :
« Or, lorsqu’il prend le pouvoir en 2017, Macron transforme le pouvoir présidentiel en autorité jupitérienne. Sa pratique de la Constitution aura contribué à abaisser davantage le rôle de la représentation parlementaire réduite plus que jamais à la fonction d’approbation des décisions élyséennes. »
Cette posture construit un pouvoir isolé et n’ayant plus de moyens pour apaiser les conflits :
« En période de crise, cet anachronisme peut se révéler dangereux car le président n’a plus de fusible ; il s’en est dépossédé pour détenir tous les leviers de décision. Démuni du cordon sanitaire que représentent les corps institués que sont son gouvernement, son parlement, les partis politiques, il fait face, seul, à la foule et entretient chez elle le désir d’en découdre, ce qui explique la virulence des oppositions qui se sont manifestées lors de la crise des gilets jaunes. »
Dans cet article, écrit avant l’élection présidentielle, François Dosse exprime l’ampleur de sa déception dans ses mots :
« Ayant cru à un enracinement dans les convictions exprimées par Ricœur, je découvre en fait une forme de cynisme pour conserver le pouvoir qui tient davantage de Machiavel – sur lequel notre jeune président a consacré son premier travail de philosophie. »
 Et il finit par cette prophétie inquiétante :
Et il finit par cette prophétie inquiétante :
« Par sa pratique jupitérienne du pouvoir, Macron n’aura pas cherché à s’inspirer des travaux des chercheurs en sciences humaines et plus généralement il se sera passé des conseils des intellectuels. Il aura confondu ce que doit être l’impératif de gouverner un pays et ce qu’est gérer une entreprise, perdant dans cette confusion l’idée d’un cap à fixer et d’un horizon d’attente et d’espérance à définir. Si sa marche est de nouveau confirmée par les électeurs en 2022, elle nous conduira inévitablement à la catastrophe car la gestion d’une nation comme une start-up ne peut répondre aux exigences du nouvel âge dans lequel nous sommes entrés, celui de l’Anthropocène. Peut-être, notre devenir rejoindra avec la réélection de Macron le titre de son livre de campagne en 2017, Révolution, est-ce vraiment souhaitable ? »
Au lendemain des élections législatives nous pouvons dire que pour l’instant Jupiter est empêché. Mais les opposants seront-ils à la hauteur des enjeux pour essayer de redresser la marche vers des objectifs davantage tournés vers l’équité, l’humanisme et les grands défis auxquels est confrontée notre civilisation humaine ?
<1687>
-
Jeudi 23 juin 2022
« Le Portsmouth Sinfonia : le pire orchestre du monde. »Un ensemble de musique créé par Gavin BryarsLa constitution d’un gouvernement en France est devenue délicate depuis dimanche…
Prenons un peu de recul et parlons d’autre chose.
Quoique, je me demande s’il n’est pas possible de trouver des correspondances entre notre situation politique française et le sujet du mot du jour d’aujourd’hui.
Commençons par un exemple audio qui nous met dans l’ambiance.
Même celles et ceux qui n’ont aucune affinité avec la musique classique connaissent le début du poème symphonique de Richard Strauss : « Ainsi parlait Zarathoustra ». Cette œuvre a été souvent utilisée dans la publicité et dans les films et notamment en ouverture du film « 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick », illustrant l’alignement entre la Lune, la Terre et le Soleil, ainsi que dans L’aube de l’humanité et dans la scène finale du film.
Je vous invite donc à écouter le début de cette œuvre, après avoir subi la publicité qui permet la gratuité, dans l’interprétation de l’orchestre du <Portsmouth Sinfonia : « Also sprach Zarathustra »>
C’est un moment décapant, absolument unique dont on sort par une espèce de sidération : C’est un disque qui a été enregistré et que des gens ont acheté !
 <Portsmouth> est une ville portuaire de la côte sud de l’Angleterre qui compte 205 400 habitants et qui est la deuxième plus grande ville du Hampshire, après Southampton.
<Portsmouth> est une ville portuaire de la côte sud de l’Angleterre qui compte 205 400 habitants et qui est la deuxième plus grande ville du Hampshire, après Southampton.
Et c’est dans cette rieuse cité qu’a commencé, en 1970, cette histoire étonnante que l’émission de « France Musique » : Maxxi Classique a raconté, le jour de la fête de la musique, le 21 juin 2022.
L’histoire est celle d’une initiative baroque du compositeur Gavin Bryars : créer le Portsmouth Sinfonia
Cet orchestre dispose d’une page Wikipedia : <Portsmouth Sinfonia>
Et aussi d’un site qui lui est dédié : https://www.portsmouthsinfonia.com/
On trouve de nombreuses références sur internet qui parle de cette expérience disruptive. Par exemple : « Je vous assure que cet orchestre joue faux ! »
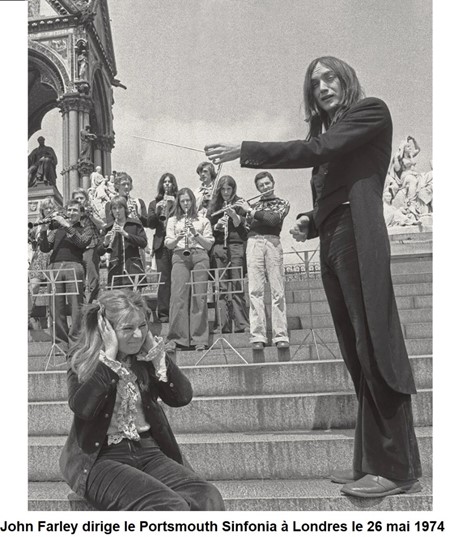 Mais revenons à l’émission de France Musique < Le Portsmouth Sinfonia : Le pire orchestre du monde >
Mais revenons à l’émission de France Musique < Le Portsmouth Sinfonia : Le pire orchestre du monde >
Le musicologue Max Dozolme narre cette histoire incroyable
« Mai 1970. Dans la cantine du College of Art de Portsmouth, des étudiants et des professeurs d’art prennent le thé. Ensemble, ils imaginent comment ils pourraient participer à une émission anglaise populaire qui doit avoir lieu dans quelques jours au sein de leur école. Cette émission qui porte le nom d’Opportunity Knocks est un télécrochet, une sorte d’ancêtre du programme La France a un incroyable talent. Ce jour-là, un professeur invité qui anime un cours sur la musique expérimentale a une idée ! Et si nous formions un orchestre symphonique qui réunirait des étudiants musiciens et non-musiciens ? Et si pour plus d’égalité, on demandait à tous ces étudiants de choisir un instrument qu’il ne maîtrise pas du tout ? Ça pourrait être une bonne idée non ?
Le professeur à l’origine de la fondation du Portsmouth Sinfonia se nomme Gavin Bryars. Il a 26 ans, il est compositeur, très bon contrebassiste mais dans cet orchestre qu’il vient de créer il a décidé de jouer de l’euphonium, l’instrument le plus grave du pupitre de cuivres. Comme de nombreux étudiants de l’orchestre ne savent pas lire de partitions et connaissent mal le répertoire symphonique, la première oeuvre que le Portsmouth Sinfonia a choisi d’apprendre est un tube de la musique classique. Un air que l’on entend dans des publicités, des dessins animés et des westerns qui a l’avantage d’être connu de tous. Il s’agit de l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini !
Parce que même dans cette version saccagé le public a tout de suite reconnu le thème musical de Rossini et probablement parce le concept de cet orchestre a été jugé particulièrement original, le Portsmouth Sinfonia a été désigné grand vainqueur de l’émission Opportunity Knocks ! Ce succès a sans doute donné des ailes aux musiciens car après cette première expérience, la formation a donné plusieurs concerts dont un mémorable au prestigieux Royal Albert Hall de Londres en 1974 !
Pour la petite histoire, c’est grâce aux contacts de Brian Eno, membre éminent de l’orchestre que le Portsmouth Sinfonia a pu enregistrer son tout premier disque en 1973. Suivront un album de reprises de chansons salué par le chanteur des Who Pete Townshend et de nombreux autres concerts jusqu’à une dernière représentation donnée à
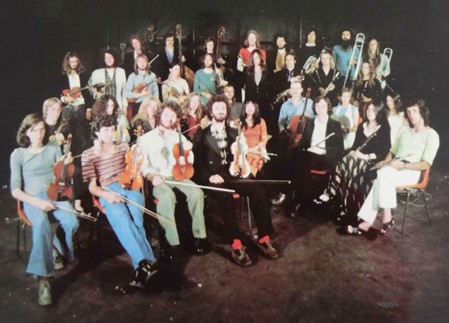 Paris en 1980. Depuis cette représentation parisienne, le Portsmouth Sinfonia n’a plus jamais joué ensemble mais il a inspiré la création d’autres formations similaires et qui sait, peut-être qu’un jour cet orchestre se reformera, pour le meilleur et surtout pour le pire ! »
Paris en 1980. Depuis cette représentation parisienne, le Portsmouth Sinfonia n’a plus jamais joué ensemble mais il a inspiré la création d’autres formations similaires et qui sait, peut-être qu’un jour cet orchestre se reformera, pour le meilleur et surtout pour le pire ! »
L’émission est enrichie par plusieurs extraits musicaux, interprétés ou plutôt massacrés par cet orchestre fantasque.
Max Dozolme résumait cet orchestre ainsi :
« le Portsmouth Sinfonia répétait avec sérieux, donnait des concerts au Royal Albert Hall et enregistrait des œuvres symphoniques. Problème, aucun musicien ne savait jouer de son instrument. […]
Toutefois, l’article cité : « Je vous assure que cet orchestre joue faux ! » précise : « Il n’y avait pas d’audition préalable , le seul critère d’admission était que le musicien ait une connaissance, au moins minimale, d’un instrument y compris pas du tout. Plus en détail, le processus était le suivant. Les musiciens les plus capables, disons crédibles, échangeaient leurs instruments avec d’autres, tandis que quelques interprètes d’un niveau « décent », conservaient le leur afin de préserver une certaine «cohérence» à minima. »
Libre à vous de trouver un lien entre ces instants de cacophonie et ce qui se passe actuellement dans les cercles du pouvoir à Paris.
<1686>
-
Mercredi 22 juin 2022
« La réalité du pouvoir minoritaire de Macron est [enfin) apparue. »Jérôme Sainte-Marie, politologueDepuis deux jours, des commentateurs politiques se désolent du fait qu’il n’y ait pas de majorité absolue à l’Assemblée Nationale.
Tout tourne autour de cette question.
Certains supporters de la NUPES expriment l’idée qu’ils sont passés à côté d’une victoire possible et de l’objectif d’envoyer Melenchon à Matignon pour mettre en œuvre son programme.
Et tout le monde de s’étonner qu’après une victoire nette à l’élection présidentielle, les français n’aient pas confirmé leur vote en envoyant une majorité confortable à ce président réélu.
D’autres dissertent ensuite sur les erreurs que Macron a commises depuis son élection et qui expliquent cette déconvenue.
Dans l’émission de France 5 « C en l’air » du 20 juin, on apprend que Macron au lendemain du second tour plutôt que de consacrer son temps et son énergie à nommer une Première Ministre et préparer le futur gouvernement pour mener la bataille électorale, a passé son précieux temps à examiner dans le détail la liste de 577 candidats de sa coalition « Ensemble » aux élections législatives. Il semble que cet exercice devait lui permettre de s’assurer, personnellement, de la fidélité de chacune et chacun d’entre eux. L’objectif étant d’essayer de dénicher des candidats susceptibles de rejoindre, par la suite, son allié Edouard Philippe dont il se méfie. On dit que son ancien premier ministre occupe beaucoup de son temps de cerveau disponible.
Tout ceci ne me convenait pas.
Je pensais à cette pensée de la sagesse chinoise :
« Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt »
Quel est le problème ?
Le problème est qu’un mouvement politique qui a obtenu 28 % des voix exprimés aux Présidentielles et 26 % aux législatives puisse vouloir prétendre obtenir la majorité absolue à l’Assemblée Nationale, puis appliquer son programme comme si la majorité du corps électoral avait fait ce choix.
Et encore, nous avons constaté pendant les derniers cinq ans où ce mouvement politique était au pouvoir que les députés de la majorité jouait un rôle accessoire sur l’élaboration des textes et de la politique mise en œuvre. La seule vraie mission de cette majorité était de voter sans discuter ce que la petit équipe de l’Elysée avait décidé.
Je m’empresse d’ajouter que la prétention de la NUPES de gouverner seule était encore plus insensée : Le corps électoral français qui s’exprime penche à droite.
Alors j’ai enfin été rassuré quand j’ai regardé l’émission « C ce soir » du lundi 20 juin : « Macron : le grand saut dans le vide »
Karim Rissouli avait invité Franz-Olivier Giesbert, Géraldine Muhlmann, Jérôme Sainte-Marie, Gilles Finchelstein et Céline Calvez, députée LREM.
Ce débat correspondait aux questions qui me semblaient importantes à poser.
Et c’est le politologue Jérôme Sainte Marie qui a avancé cette analyse :
« Un pouvoir qui était structurellement minoritaire depuis 5 ans, avait gagné massivement, en 2017, au second tour face à une de ses oppositions.
Parce que les autres oppositions préféraient encore voter pour Macron que pour Marine Le Pen.
Cela a duré pendant 5 ans et puis cela a duré encore pendant l’élection présidentielle de 2022 : 28% au premier tour puis 58 % au second Tour.
Mais là la machine s’est grippée.
Ce dimanche, les différentes oppositions ne se sont pas mobilisées les unes contre les autres.
Et la réalité du pouvoir minoritaire d’Emmanuel Macron apparait et nous place au Parlement dans une situation inextricable. »
Après 10 min d’émission
Voilà c’est dit !
Je l’exprime autrement : Un pouvoir minoritaire a pu obtenir un pouvoir majoritaire parce que ses oppositions se combattaient les unes les autres.
Alors il faut bien gouverner ?
Certes !
Mais il ne faut pas gouverner en faisant semblant de croire qu’une majorité de français approuvait la politique poursuivie.
Dans un élan de bienveillance on peut encore admettre que pendant 5 ans « on a donné sa chance au produit » comme dirait mon neveu.
Mais au bout de 5 ans, il faut arrêter les faux semblants.
Un quart du corps électoral, les nantis, les seniors et retraités, les gagnants de la mondialisation et ceux qui espèrent en faire partie, soutiennent ce mouvement politique. Tous les autres n’ont pas voté Macron mais ont voté contre Melenchon et contre Le Pen .
Et puis tout repartait comme avant : « Les Français m’ont fait confiance et maintenant il me faut une solide majorité pour mettre en œuvre mon programme ».
Les français ont dit non à cette prétention.
Ils ont donné au mouvement dominant le nombre de députés le plus important mais n’ont pas donné la majorité absolue.
Et c’est bien et normal ainsi.
Il faut gouverner autrement.
Cela devient certes plus compliqué, mais il est beaucoup plus sain que les débats aient lieu au Parlement, plutôt qu’ailleurs.
Gilles Finchelstein a fait ce constat :
« C’est une crise politique : incapacité de trouver une majorité.
C’est une crise française, pour tous les autres pays européens cette situation est normale et ne conduit pas à une crise mais à une coalition.
C’est une crise inédite, elle n’a rien de comparable avec le gouvernement minoritaire de Rocard en 1988 qui disposait sur ses deux ailes d’opposants moins vindicatifs qu’aujourd’hui.
C’est une crise sérieuse parce que nous ne voyons pas le chemin d’une solution. »
On ne voit pas, mais il faut chercher.
C’est la responsabilité de la majorité présidentielle, mais c’est aussi la responsabilité des oppositions.
Mais l’émission est restée dans une tonalité optimiste : peut être que de cette crise sortira du mieux.
La 5ème république dérivait de plus en plus vers un pouvoir de l’extrême centre sans opposition en capacité d’alternance. Cette situation créait des tensions de plus en plus fortes dans la société.
La crise politique actuelle ne vient pas d’un vote « fantasque » des français.
Elle est le révélateur d’une situation politique devenue intenable.
La promesse de Macron de dépasser les clivages s’est heurtée au mur des réalités et des tensions internes de la société française.
<1685>
-
Mardi 21 juin 2022
«Pause (surlendemain du second tour des législatives) »Un jour sans mot du jour nouveauLe 21 juin 2022 est le jour du solstice d’été. Il a aussi été choisi, il y a 40 ans pour être le jour de la fête de la musique.
 Je me suis perdu dans les chiffres du second tour des élections législatives et ne trouve rien de pertinent à écrire sur ce sujet.
Je me suis perdu dans les chiffres du second tour des élections législatives et ne trouve rien de pertinent à écrire sur ce sujet.<France Info> présente de pertinentes infographies sur ces élections. Vous apprendrez qu’à Paris il n’y a plus aucun député LR, le parti de Chirac, ni de député PS le parti de Delanoé. Les 18 circonscriptions de Paris se partage entre 9 NUPES (écologistes et insoumis) à l’est et 9 Ensemble à l’ouest. Vous apprendrez aussi que la NUPES a perdu plus de duels contre tous les autres Partis et coalition qu’elle en a gagné. Elle a perdu 53% des 62 duels contre le RN, 66% des 270 duels contre la coalition macroniste et 92 % des 26 duels contre les LR.
Le parti de Marine Le Pen a beaucoup mieux résisté à la coalition présidentielle. Dans les 108 duels entre Ensemble et RN, il y a eu 55 victoires pour Ensemble, et 53 pour le Rassemblement national.
<Harris Intervactive> a publié une enquête sur les reports de voix.
J’en retiens trois points :
- En cas d’affrontement NUPES/ Rassemblement National, une majorité d’électeurs ayant voté pour Ensemble au premier tour ne se sont pas exprimés. Les autres se sont répartis pour 34% pour la NUPES et 18% pour le RN.
- En cas d’affrontement NUPES/ Ensemble, une majorité d’électeurs ayant voté pour le Rassemblement national au premier tour ne se sont pas exprimés. Les autres se sont répartis pour 24% pour la NUPES et 25% pour Ensemble .
- En revanche dans le cas d’un affrontement Ensemble/RN une majorité d’électeurs de la NUPES se sont exprimés, à 31% pour Ensemble et 24% pour le RN.
<Mot du jour sans numéro>
-
Lundi 20 juin 2022
«Pause »Un jour sans mot du jour nouveauPour pleinement me concentrer sur la soirée électorale du second tour des élections législatives je me suis mis en pause.
 Pour accompagner ces pauses je mets la photo d’un chat.
Pour accompagner ces pauses je mets la photo d’un chat.J’ai trouvé cette photo d’un chat qui s’est invité dans un bureau de vote !
<Mot du jour sans numéro>
-
Vendredi 17 juin 2022
« Nous vivons un avant-goût de notre futur climatique. »Christophe Cassou, chercheur CNRS au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifiqueNous vivons une canicule dont le pic est prévu samedi 18 juin.
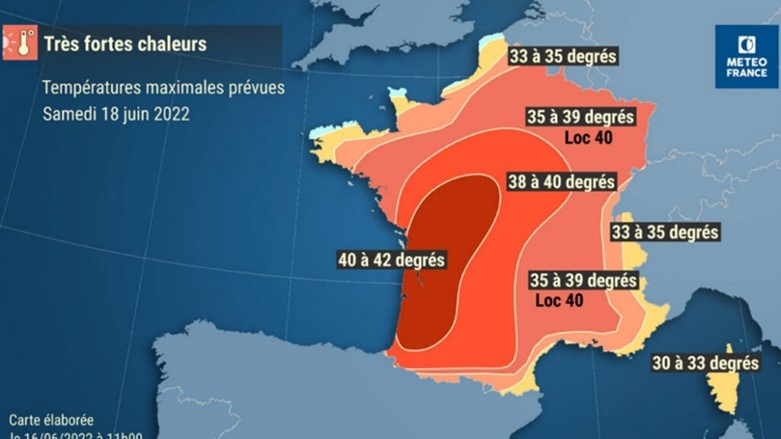 J’ai trouvé cette carte sur le site de <Oise Hebdo>
J’ai trouvé cette carte sur le site de <Oise Hebdo>
Météo-France a annoncé, jeudi 16 juin, que douze départements ont été placés en vigilance rouge canicule et 25 départements en vigilance orange canicule à partir de vendredi 14 heures, lors de la canicule la plus précoce jamais enregistrée en France. Au total, trente-sept départements sont en vigilance, soit un tiers du pays, et 18 millions de personnes sont concernées.
Les départements en vigilance rouge se situent principalement le long de la façade atlantique :
- Le Tarn, la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, les Landes, la Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Vendée.
Quant aux vingt-cinq départements en alerte orange, ils se situent des Pyrénées au sud de la Bretagne, à la Drôme et à l’est du pays :
- Morbihan, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Mayenne, Maine-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, Cher, Creuse, Haute-Vienne, Dordogne, Corrèze, Puy-de-Dôme, Cantal, Lot, Haute-Loire, Aveyron, Ardèche, Drôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Ariège, Aude.
<Le Monde> nous apprend qu’il s’agit de la quatrième fois que la vigilance rouge canicule est activée depuis 2003, date de la mise en place du dispositif, après les leçons tirées de la canicule historique qui avait causé, cette année-là, la mort de plus de 15 000 personnes en France.
Mais, cette fois-ci, le phénomène survient plus tôt dans la saison que d’ordinaire.
Le thermomètre a grimpé, jeudi, à 40°C à Saint-Jean-de-Minervois, dans l’Hérault – un record de précocité pour la France métropolitaine hors Corse. Ce record a été enregistré à 16 h 32, a précisé Météo-France
Le ministère de la santé a activé un numéro gratuit Canicule info service (08.00.06.66.66) afin de répondre aux interrogations et donner des conseils.
Grâce à <Libération> nous apprenons que ce qui nous arrive est une « plume de chaleur » et non un « dôme de chaleur » .
Le « dôme de chaleur » nous avait été expliqué, l’été dernier, lors de l’épisode record de chaleur au Canada.
Les deux phénomènes peuvent causer des canicules infernales, mais ils sont différents.
Le dôme de chaleur d’abord :
« Il est statique : une masse d’air chaude se bloque sur un territoire à cause de fortes pressions en altitude, qui la plaquent vers le sol. Comprimée, elle monte ensuite en température sur place comme si elle était dans une cocotte-minute. Là, l’épisode de fortes chaleurs peut durer plusieurs semaines, jusqu’à ce que des vents chassent la bulle d’air. »
C’est ce phénomène qui était en œuvre lors de la canicule d’août 2003, évoquée ci-dessus.
La plume de chaleur se déplace :
« La plume de chaleur, qui va faire grimper le thermomètre en France jusqu’à ce week-end, ressemble à un panache, un coup de chalumeau, une langue ou encore un tentacule. Elle vient du sud du globe. La bande d’air chaud s’est formée au Sahara, puis s’est détachée et est montée en latitude à cause de vents puissants. La vagabonde est d’abord passée sur l’Espagne avant de gagner l’Hexagone. Elle est tractée vers le Nord par une dépression, une « goutte froide », située au large de la péninsule ibérique, qui l’aspire tel un engrenage ou une pompe à chaleur en tourbillonnant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les plumes de chaleur, très mobiles, ont cependant tendance à ne pas s’éterniser sur un même territoire. L’épisode devrait durer cinq jours en France. »
Le journal écologiste « Reporterre » nous raconte que « La canicule est un avant-goût de notre futur climatique » :
« Cette vague inédite, si tôt dans la saison, alarme les spécialistes. L’exception devient peu à peu la norme. En 2019, une canicule avait déjà frappé la France, en juin, et battu des records absolus de température. Cette année, la canicule arrive deux semaines en avance par rapport à 2019. Pour le climatologue Christophe Cassou, « nous vivons un avant-goût de notre futur climatique ».
La situation actuelle doit être replacée dans un contexte plus général de réchauffement climatique. Les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Tout s’accélère et s’intensifie. Nous avons connu autant de vagues de chaleurs entre 1960 et 2005 (en 45 ans) que de 2005 à 2020 (en 15 ans) : on compte 4 vagues de chaleur avant 1960, 4 entre 1960 et 1980, 9 entre 1980 et 2000, et enfin 26 depuis 2000. En ce début du XXIe siècle, les épisodes caniculaires sont devenus sensiblement plus nombreux que ceux de la période […] Dans son dernier rapport, le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est formel sur le sujet. L’ampleur des extrêmes de température augmente plus fortement que la température moyenne mondiale. Et l’influence humaine favorise l’émergence de phénomènes d’ordinaire très rares et exceptionnels.
Ce n’est qu’un début, selon une étude publiée par la revue Science en septembre 2021, les enfants nés en 2020 subiront 7 fois plus de vagues de chaleur, 2 fois plus de sécheresses et incendies de forêt, 3 fois plus d’inondations et de mauvaises récoltes qu’une personne née en 1960.
Et Reporterre partage les prévisions des scientifiques :
« Les sécheresses s’aggravent, alerte l’ONU. Notre quotidien est bouleversé. En France, la fréquence des canicules devrait doubler d’ici à 2050. Selon Météo France, « en fin de siècle, les vagues de chaleur pourraient être non seulement bien plus fréquentes qu’aujourd’hui mais aussi beaucoup plus sévères et plus longues » et « se produire de mai à octobre ». »
À court terme, la vague de chaleur qui s’abat sur la France pourrait déjà avoir de graves conséquences : accélérer la maturité des cultures et en brûler une partie, accélération de la pénurie d’eau sur certaines parties de notre territoire
Alors que le climatologue Christophe Cassou sonne l’alerte :
« Les faits sont clairs. Ne pas être à la hauteur est aujourd’hui irresponsable. Il faut réduire nos émissions de gaz a effet de serre de manière immédiate, soutenue dans le temps et dans tous les secteurs. Pas dans trois ans, maintenant ! »
Le gouvernement manifeste des ambitions plus modestes : Il y a une semaine, sur LCI, la ministre de Transition écologique, Amélie de Montchalin avait seulement invité les Français à « être sobres » et à « ne pas surutiliser leur climatiseur pour lutter contre le dérèglement climatique ».
 Dans ce contexte, le truculent Willy Schraen a fait une déclaration remarquée dans ce haut lieu de la culture et de l’émulation intellectuelle qu’est l’émission de RMC « Les grandes gueules ».
Dans ce contexte, le truculent Willy Schraen a fait une déclaration remarquée dans ce haut lieu de la culture et de l’émulation intellectuelle qu’est l’émission de RMC « Les grandes gueules ».
Je connais des chasseurs sympathiques et intelligents.
Chaque corporation, chaque famille possède son lot de « cas particulier » qu’on essaye de réguler et de cacher un peu.
L’ennui, c’est quand la corporation met ce type de personnage à sa tête !
Car M Willy Schraen qui a déclaré avoir voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour est le président de la Fédération nationale des chasseurs depuis août 2016.
Qu’a-t-il dit ?
Nous lisons sur le <site de l’Obs> ses propos :
« Il faut reconnaître qu’il va faire chaud pendant trois jours. Bizarre, on est entre le premier et le deuxième tour […]
On nous explique du matin jusqu’au soir depuis deux jours « Attention, l’écologie machin… » Bon, dites-le carrément au niveau de la météo : votez la Nupes ! On va gagner du temps, on a bien compris, on est quand même pas débile !»
La canicule serait donc selon cet homme vigilant qui refuse de se laisser abuser, une stratégie de la NUPES pour obtenir des voix !
Il fallait y penser.
Il fallait oser le dire.
Mais les c.. ça ose tout c’est à cela qu’on les reconnait. Il y a bien longtemps, le 6 décembre 2013, j’avais publié la version originale de ce mot d’Audiard. Elle est de Saint Thomas d’Aquin et se décline ainsi : « Tous les imbéciles et ceux qui ne se servent pas de leur discernement, ont toutes les audaces. »
<1684>
- Le Tarn, la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, les Landes, la Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Vendée.
-
Jeudi 16 juin 2022
« Le délit de clameur. »Délit prévu par l’article L98 du Code électoralIl se passe des choses étranges en France.
Il y a déjà eu le fiasco du Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions de football qui a montré des difficultés d’organisation, des lacunes pour rapidement prendre la mesure de ce qui se passe et réagir et enfin l’incapacité de nos gouvernants a reconnaître simplement que les choses se sont mal passées et s’en excuser. J’y reviendrai peut-être
Mais aujourd’hui, je voudrais narrer simplement ce qui s’est passé, lors du premier tour des élection législatives, dans le bureau de vote nº 13, de la 9e circonscription de Paris, place Jeanne-d’Arc dans le quartier de la Gare du 13ème arrondissement.
Plusieurs journaux ont narré cette histoire, le journaliste Stéphane Foucart, dans « Le Monde » l’a décrit de manière assez détaillée : <Une nuit en garde à vue pour avoir alerté d’une confusion possible>.
Je reprends ses explications
Dans cette 9ème circonscription, la NUPES avait présenté l’écologiste Sandrine Rousseau que tout le monde connait depuis qu’elle a failli battre Jadot à la primaire écologiste et qu’elle a multiplié des déclarations qui ont interpellé et surpris par leur radicalité.
Cette femme politique irrite beaucoup de monde notamment le Mouvement de la ruralité qui est le nouveau nom de ce parti politique qui avait pour objet de lutter contre les tentatives trop modernistes « Chasse, pêche, nature et traditions ».
Ce mouvement, dans le but évident de nuire à Sandrine Rousseau, a investi dans la même circonscription une « novice » écrit le Monde, je comprends une parfaite inconnue mais qui avait pour singularité de porter le même nom et prénom que la candidate écologiste.
Un retraité de l’enseignement supérieur (université Paris-I), historien d’art, Patrick de Haas, vote dans ce bureau :
« C’est en arrivant dans le bureau de vote nº 13, place Jeanne-d’Arc à Paris, que M. de Haas et sa compagne remarquent que, sur la table de décharge, le premier bulletin disposé au nom de Sandrine Rousseau, « sans photographie de la candidate », dit-il, n’est pas celui de la candidate écologiste investie par la Nupes. « Les bulletins de la candidate de la Nupes se trouvaient à l’autre bout de la table et j’ai été abusé par cette disposition, raconte-t-il. Il était évident que des votants allaient se tromper et prendre le premier bulletin au nom de Sandrine Rousseau sans réaliser qu’il s’agissait de la candidate investie par le Mouvement de la ruralité.
L’historien demande alors de meilleures indications aux assesseurs et au président du bureau de vote. Une signalétique spéciale est refusée au motif qu’elle serait irrégulière, risquant de créer un régime de faveur pour les deux Sandrine Rousseau. Choqué, M. de Haas décide alors de prévenir les votants à leur arrivée au bureau de vote, que deux piles de bulletins au nom de Sandrine Rousseau sont disposées. « Je ne suis pas militant politique, je n’ai, à aucun moment, dit à quiconque quoi faire ou comment voter, explique-t-il. Tout se passait dans le plus grand calme. J’avais le sentiment d’accomplir un devoir citoyen en avertissant les autres de la situation. »
M de Haas pensait faire œuvre utile pour informer les électeurs de la confusion possible.
Ce n’était pas ainsi que le député sortant macroniste, Buon Tan analysait la situation :
« En milieu de journée, le député sortant, Buon Tan (La République en marche), passe dans le bureau de vote : il signale, lui aussi, la présence d’une personne sur la voie publique alertant les votants du piège homonymique. Mécontent, le parlementaire demande que l’information soit consignée dans le procès-verbal des opérations de vote. M. Tan n’a pas donné suite aux sollicitations du Monde. Craignant une irrégularité, le président du bureau appelle alors le service ad hoc de la Mairie de Paris pour s’informer sur la marche à suivre. Il lui est conseillé de contacter la police nationale, pour demander une intervention. »
Et c’est ainsi qu’une voiture de la police nationale s’arrête devant le bureau de vote. Trois gardiens de la paix lui intiment de s’éloigner.
« Je leur ai demandé s’il m’était possible de me mettre à une cinquantaine de mètres du bureau et ils n’y ont pas vu d’inconvénient », raconte-t-il. Mais, alors qu’il s’est éloigné et qu’il continue à alerter les personnes qui se dirigent vers le bureau, les trois gardiens de la paix changent d’avis.
Ils sont revenus vers moi un quart d’heure plus tard pour me dire qu’ils s’étaient trompés et que même à 50 mètres du bureau de vote je n’avais pas le droit de prévenir les gens, poursuit-il. Je n’ai pas protesté, ni même discuté, et je suis rentré chez moi, à 150 mètres de là. » Les trois mêmes gardiens de la paix, changeant manifestement une nouvelle fois d’opinion, le retrouvent au pied de son immeuble, le cueillent et lui disent qu’il doit passer devant un officier de police judiciaire (OPJ). « Une fois au commissariat, je n’ai alors pas pu dire un mot, j’ai eu le sentiment d’être traité comme un criminel de guerre. [L’OPJ] a refusé de m’entendre et m’a signifié que j’étais placé en garde à vue pour des faits de « clameurs, attroupement et menaces », raconte l’historien. Tout cela étant complètement faux, j’ai refusé de signer le procès-verbal. »
Au matin, après une nuit de garde à vue et une demi-heure d’entretien avec un avocat commis d’office, M. de Haas est entendu par un autre OPJ qui ne conserve que les faits de « clameurs », prévu par l’article L98 du code électoral, qui punit « les atteintes à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote ».
Le Monde précise que
« Contactée lundi 13 juin en début d’après-midi, la préfecture de police de Paris n’avait pas donné suite, mardi en fin de matinée, aux sollicitations du Monde. »
Je suis donc allé consulter l’article L98 du code électoral sur le site de <Legifrance> Je le cite intégralement :
« Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d’un collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros. »
On comprend bien que si on suit la description des faits il ne saurait être question de « démonstration menaçante » ni « d’attroupement », il restait donc « la clameur ».
A ce stade j’ai trouvé judicieux de chercher la définition exacte de clameur.
« Le Larousse » après avoir précisé qu’il s’agissait d’un nom féminin le définit ainsi :
« Cris violents et tumultueux indiquant, en particulier, une véhémente protestation, un grand enthousiasme, etc. : Les clameurs de la foule. »
Et donnent pour synonymes :
« huée – hurlement – tollé – tumulte – vocifération »
Il ne me semble pas que le comportement du professeur retraité puisse être décrit par cette définition.
Il tentait au contraire d’instiller de la clarté, là où régnait la confusion.
La Préfecture de Police ne me semble pas avoir agi avec discernement dans cette affaire, je n’en dirai pas davantage.
Dans cette 9ème circonscription, la participation a été de 54,80%, donc supérieure à la moyenne nationale
Malgré ces manœuvres Sandrine ROUSSEAU est arrivée largement en tête avec 42,90% des voix devant le député sortant Buon TAN 26,77%.
La manœuvre du Mouvement de la ruralité ne semble pas avoir d’effet.
Quoique ! L’autre Sandrine Rousseau a quand même reçu 1,88% des voix devançant 6 autres candidats.
Sans aucune notoriété, aurait-elle eu le même résultat sans la confusion dénoncée par M De Haas ?
<1683>
-
Mercredi 15 juin 2022
« Représentation du corps électoral français. »Ce que vote ou ne vote pas les françaisUn dessin ou un schéma valent mieux qu’un long discours.
C’est doublement positif : c’est facile à lire et à appréhender et c’est facile à écrire. C’est du gagnant / gagnant comme disent les « winners ».
Revenons d’abord à la représentation des bulletins exprimés lors du premier tour des législatives.
Je reprends les mêmes chiffres qu’hier, ceux qui ont été publiés par le journal « Le Monde »
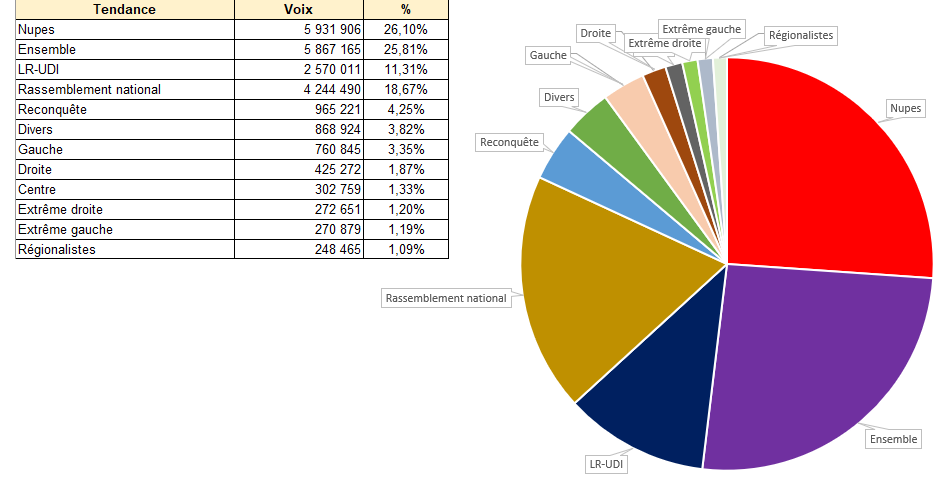
On voit deux quartiers qui dominent, mais qui si on regarde de près ne représente guère qu’un plus de la moitié du disque. Mais quand on montre les choses ainsi, on omet une grande partie de la réalité.
Ce décompte doit d’abord être complété des bulletins Blancs. Puis il faut aussi y ajouter les bulletins nuls dont on ne sait jamais si l’électeur pensait voter blanc ou a commis une erreur de votation. Ensuite pour que l’image du corps électoral soit plus conforme à la réalité il faut aussi ajouter les abstentionnistes.
Et pour enfin disposer d’une vision complète il faut aussi prendre en compte toutes les personnes en âge de voter et qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales. J’ai trouvé un article de « Libération » : <Combien de personnes en âge de voter ne sont pas inscrites sur les listes électorales ?> qui narre cela :
« Les dernières données mises à jour datent de mai 2021. A ce moment-là, «47,9 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales françaises hors Nouvelle-Calédonie, dont 1,4 million résidant hors de France et inscrites sur une liste consulaire», indique l’Insee dans un focus consacré à ce sujet. Soit 94 % des Français en âge de voter. Au total, seulement 6 % des personnes concernées n’étaient donc pas inscrites sur les listes électorales en mai 2021. Les données devraient être réactualisées à la fin du mois de mars, une fois que la date limite pour l’élection présidentielle sera passée, d’après l’Insee. »
Donc nous connaissons une estimation, c’est 6 % du corps électoral. Le reste est un simple calcul arithmétique et nous arrivons au tableau et à la représentation de ce que le corps électoral français a vraiment exprimé et non exprimé ce dimanche.
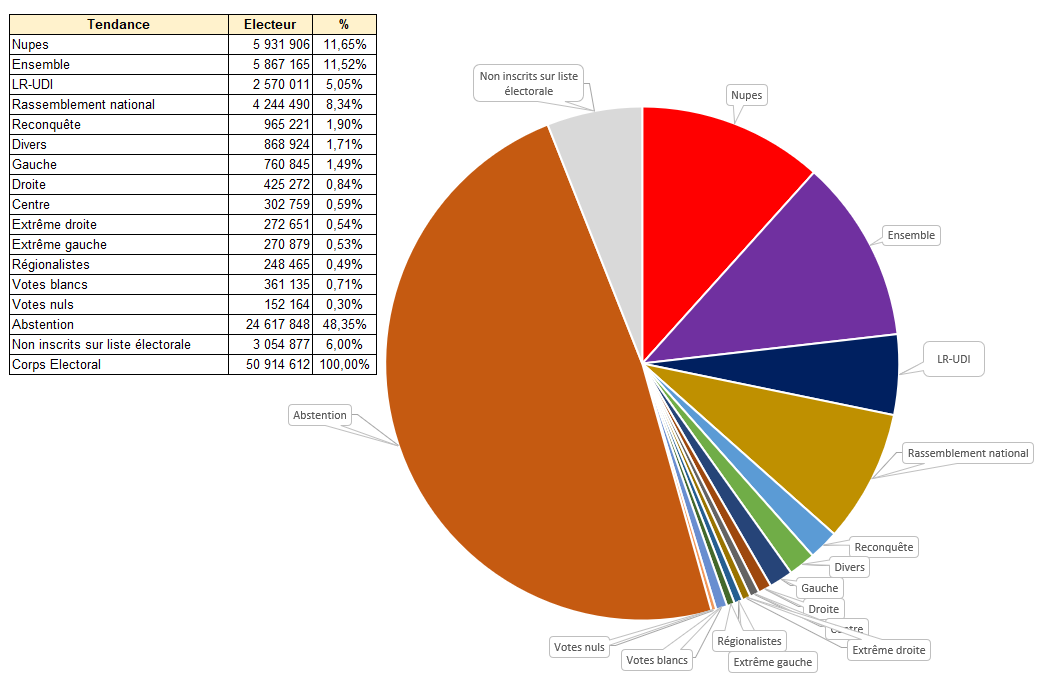
Dans cette représentation NUPES ou Ensemble représente chacun environ 11,5% du corps électoral. Et cette représentation montre que c’est vraiment peu !
<1682>
-
Mardi 14 juin 2022
« Que se passerait-il à l’Assemblée Nationale s’il y avait un autre mode de scrutin ?»Un exercice intellectuel et spéculatifSi vous avez lu le mot du jour d’hier, vous avez pu comprendre que nous utilisons en France un mode de scrutin que peut être tout le monde nous envie (quoique ce n’est pas certain) mais que personne n’utilise (ça c’est un constat).
Alors je tente aujourd’hui un exercice intellectuel et spéculatif qui consiste à partir des résultats de ce dimanche d’imaginer le résultat en nombre de sièges si nous appliquions un autre mode de scrutin.
Je veux insister sur le fait que cette démarche est spéculative et n’a aucune vocation à prédire ce qui se passerait si on changeait de mode de scrutin.
Tant il est vrai que le mode de scrutin induit des organisations et des comportements politiques qui sont très différents les uns des autres.
Autrement dit, si nous avions un autre mode de scrutin les acteurs politiques auraient un comportement différent.
S’il fonctionne bien, ce qui n’est plus le cas en France, le scrutin uninominal à deux tours induit une organisation de blocs de Partis, idéalement deux blocs, et une multiplication de Partis. Au premier tour, il y a de nombreux partis qui se présentent dans chaque circonscription. Et puis au second tour, il reste un candidat par bloc, celui qui était le mieux placé au premier tour, tous les autres partis du même bloc se désistant pour lui. Cela fonctionnait très bien quand il y avait un bloc de gauche et un bloc de droite
Si on reprend le tableau que j’ai présenté hier auquel j’ajoute une colonne pour faire la somme des voix du vainqueur et du second, 9 scrutins sur 16 sont dans ce cas avec deux blocs qui représentent 75% des votants
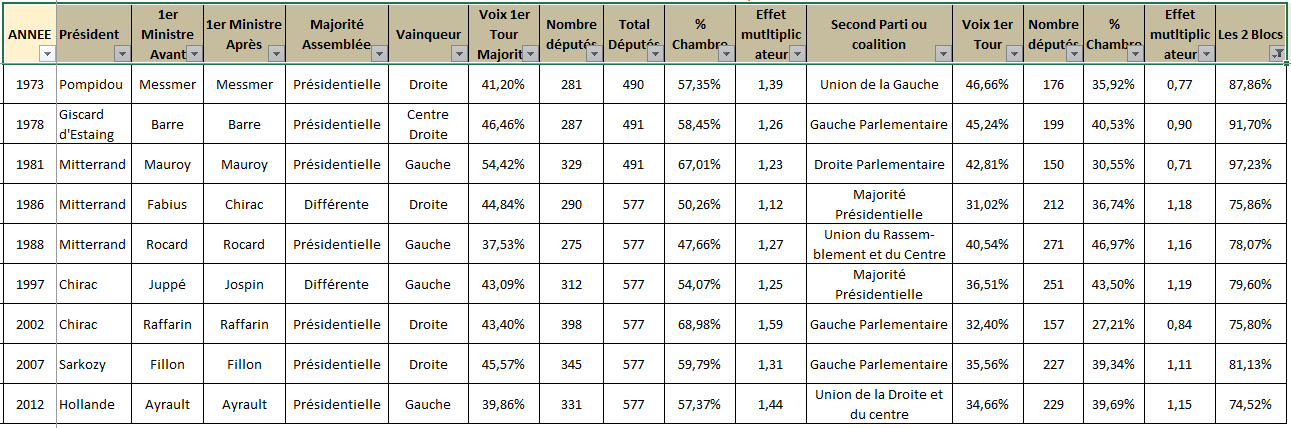
En 1981, les deux blocs représentaient 97,23% des Voix.
Le scrutin uninominal à 1 tour induit l’existence de très peu de Partis, 2 ou 3 avec quelques partis régionalistes. Parce qu’au-delà il n’y a aucune chance d’être élu, puisqu’il faut être premier dès le premier tour. L’organisation par Bloc n’a pas de sens pour ce mode de scrutin. En réalité, dans ce cas les blocs se réunissent tout de suite en Parti. C’est le cas en Grande Bretagne et aux États-Unis.
Le scrutin par liste à la proportionnelle peut prend plusieurs formes selon la circonscription qui peut être nationale ou infra nationale et selon l’existence d’un seuil en deçà duquel on ne peut avoir d’élu.
Ainsi en Israël, il n’y a pas de seuil. Cette situation a pour conséquence la création de beaucoup de petits partis, surtout religieux qui en contrepartie d’une ou deux concessions pour satisfaire les fantasmes de leurs électeurs acceptent de se joindre à une coalition pour lui apporter la majorité nécessaire pour appliquer sa politique. Cela peut créer des relations et des coalitions assez toxiques pour l’intérêt général du pays.
Mais le plus souvent le mode de scrutin est assorti comme en Allemagne d’un seuil, ce qui élimine la tentation des petits partis et favorise les coalitions de quelques Partis sérieux.
Avec toutes ces précautions, commençons cet exercice intellectuel.
1/ Si La France votait comme les britanniques ou les américains.
Nous sommes donc en présence du scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Celui qui arrive en tête gagne l’élection.
« Le Monde » a publié cette carte accompagnée de la liste des Tendances politiques arrivées en tête au premier tour des législatives.
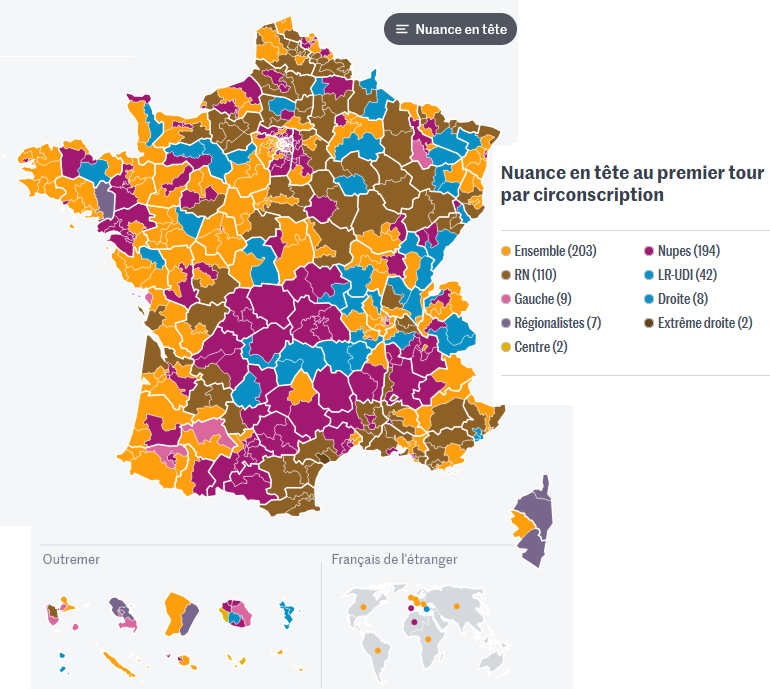
Donc en reprenant ces chiffres et en faisant quelques regroupements envisageables, voilà ce que cela donnerait :
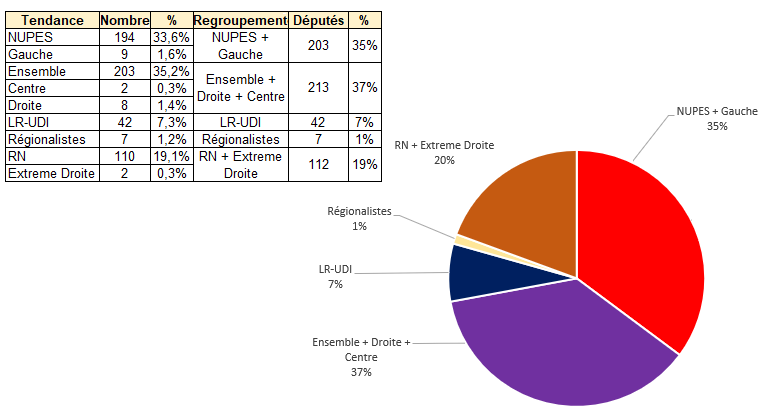
2/ Si la France votait comme les allemands
Cette fois il s’agit d’un scrutin proportionnel sur une liste nationale avec la nécessité d’un seuil de 5% des voix.
Il faut savoir que les allemands aux législatives votent deux fois : une fois pour un député et une seconde fois pour la liste d’un Parti.
Cette manière de faire permet à chaque allemand d’avoir un député dédié.
Mais la règle fondamentale est bien la proportionnelle intégrale.
Autrement dit c’est la répartition selon le scrutin par liste qui détermine la répartition des sièges. Les listes présentées par les Partis complètent les députés élus sur leur nom pour arriver à une stricte répartition proportionnelle.
Reprenons « Le Monde » et les Résultats officiels qu’il a publié :
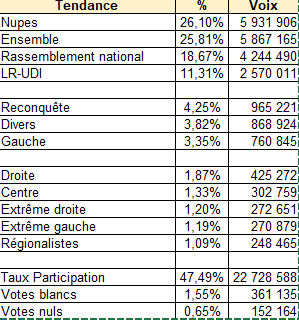 Le Monde ne reprend pas les résultats du Ministère de l’intérieur qui donnent un peu d’avance à Ensemble, la coalition macroniste.
Le Monde ne reprend pas les résultats du Ministère de l’intérieur qui donnent un peu d’avance à Ensemble, la coalition macroniste.
Je ne rentrerais pas dans cette querelle qui consiste à écarter certains candidats de la coalition NUPES.
Tout ceci n’est que spéculatif et n’a qu’une vocation à donner une idée du fonctionnement d’un mode de scrutin.
On constate que si on applique le seuil des 5%, Reconquête, le parti de Zemmour n’aurait pas de députés.
Je pense que cet exemple montre toutes les nuances et limites à apporter à ma démonstration.
Il est vraisemblable que des électeurs qui se sentaient plus proche de Reconquête que du Rassemblement National, ont pourtant voté pour le second choix en pratiquant un vote utile. Le mode de scrutin français est très exigeant pour arriver au second tour. Pour ne pas risquer qu’il n’y ait pas de candidat d’extrême droite au second tour, ils ont voté pour le candidat de cette tendance ayant le plus de chance d’accéder au tour suivant.
Il est donc probable que si ce mode de scrutin existait en France, le parti Reconquête aurait atteint les 5%. Mais tenons-nous strictement aux résultats.
On aboutit alors ce résultat
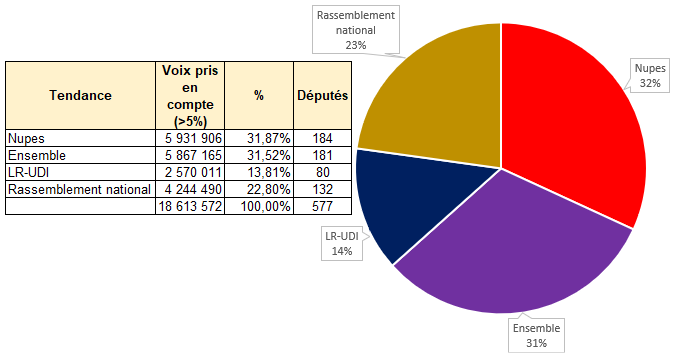
3/ Mais la France vote à la manière des Français
Donc il y aura un second tour.
5 députés sont déjà élus : 4 NUPES et 1 Ensemble.
Nous savons qui sera présent au second tour dans chacune des 572 circonscriptions qui restent à pouvoir.
Des analystes politiques se sont donc risqués à faire des prévisions pour le second tour.
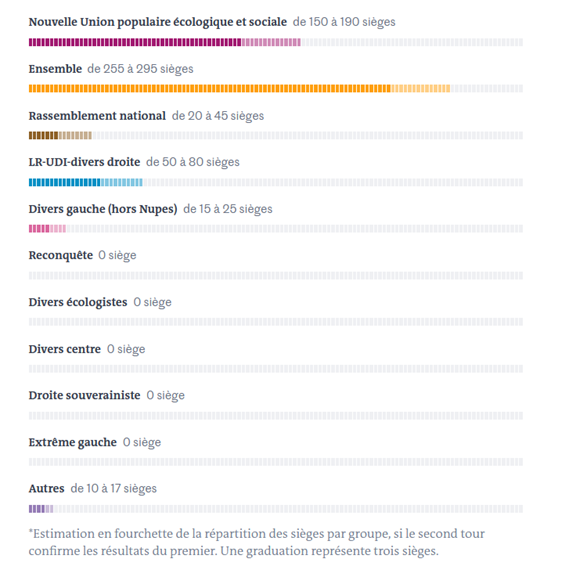 On trouve cette projection dans « Le Monde »
On trouve cette projection dans « Le Monde »
A partir de ces éléments, je peux donc tenter une troisième répartition.
Les analystes proposent des fourchettes.
Je reste simple, je prends le milieu de la fourchette.
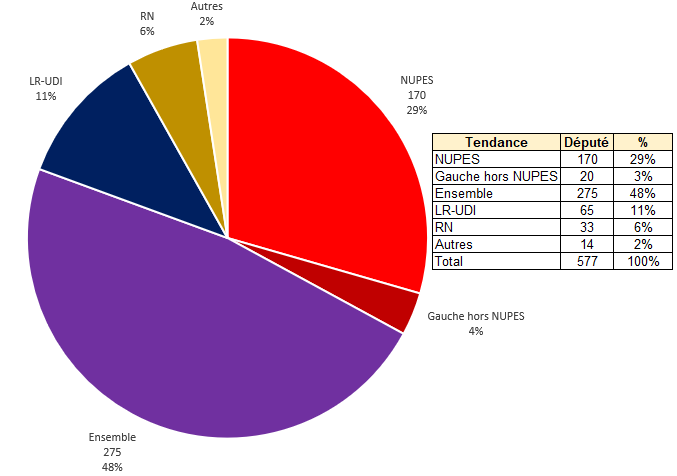 Et on comprend donc, par le dessin, le système français.
Et on comprend donc, par le dessin, le système français.
Les députés macronistes flirtent avec la majorité absolue, ce sera un peu en dessous ou un peu au dessus.
Certains diront peut-être que les deux premières représentations correspondent à des situations ingouvernables, alors qu’ici gouverner reste possible.
C’est un argument assez risqué.
La démocratie est aussi la gestion de la conflictualité.
Si on insiste sur l’efficacité et la capacité de gouverner, je crains que le régime chinois qui repose sur les décisions d’un petit comité de 7 responsables répond mieux à ce désir
Dans cet exemple français, nous avons un gouvernement qui a pour opposant 75% des électeurs qui se sont prononcés et dont le pouvoir de prendre des décisions et très peu limité.
Tout ceci reste une spéculation intellectuelle.
Et le mode de scrutin qui est un vrai problème en France n’est pas le seul problème de notre démocratie.
L’hyper présidentialisation en est une autre.
Et puis, et peut être surtout les contraintes des interdépendances, la mondialisation, la financiarisation de la Société laissent peu de marge de manœuvre au Politique, surtout à l’échelle d’un petit pays comme la France…
<1681>
-
Lundi 13 juin 2022
« Les 16 élections législatives de la Vème République. »Un regard historique sur un scrutin qui se déliteNous avons donc vécu, ce dimanche, le premier tour de l’élection première, c’est à dire celle des députés à l’Assemblée Nationale, siège du pouvoir de faire la Loi.
C’était la 16ème élection de ce type pour la Vème République
Les français ne savaient pas qu’il s’agissait du moment le plus important de notre vie démocratique.
Ils ne se sont jamais autant abstenus.
Voici l’évolution de la participation au cours de ces 16 élections.
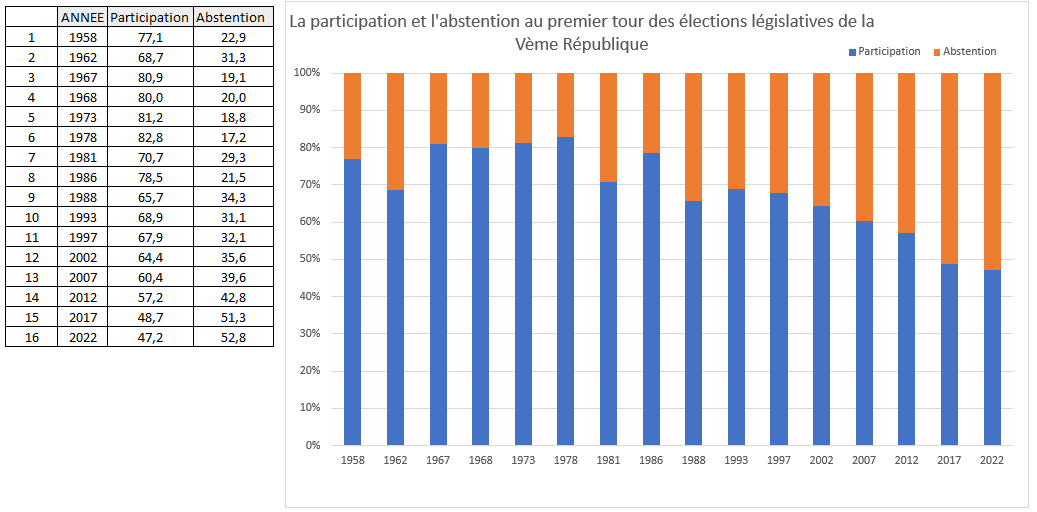 Je voudrais aborder un second sujet dans ce mot du jour écrit un soir d’élection.
Je voudrais aborder un second sujet dans ce mot du jour écrit un soir d’élection.
Et pour introduire ce point je commence par l’élection de 1958.
Les élections législatives françaises de 1958 ont lieu les 23 et 30 novembre 1958. Il s’agit des premières élections de la Cinquième République.
La constitution de la cinquième république vient d’être approuvée par le référendum du 28 septembre 1958.
À l’issue du scrutin, 579 parlementaires ont été élus. La majorité de l’assemblée est conforme à la majorité présidentielle.
Cette dernière a obtenu 43 % des voix au premier tour et 402 députés.
Le second de cette élection est le Parti Communiste dirigé par Maurice Thorez qui obtient au premier tour 18,90 % des voix et 10 députés.
Nous voyons là, dès la première élection l’effet totalement déformant du scrutin uninominal à deux tours.
Pour élire un député dans une circonscription, il faut au premier tour qu’il puisse rassembler 50% des votants +1. Sinon il y a un second tour qui rassemble au moins les deux premiers et d’autres candidats s’ils ont obtenu au moins un seuil de voix qui a évolué. Aujourd’hui il faut au minimum avoir obtenu 12,5% des inscrits. Ce qui signifie qu’en présence de 50% d’abstention, le candidat doit obtenir 25% des votants.
Les défenseurs de ce mode de scrutin expliquent qu’il permet de favoriser les candidats ou Partis capables de rassembler au second tour des électeurs qui n’avaient pas voté pour eux au premier tour.
En 1958, le Parti Communiste avait un socle électoral de citoyens convaincus mais au second tour il avait du mal à trouver des électeurs non communistes acceptant de voter pour eux.
En chiffre cela donne les résultats suivants :
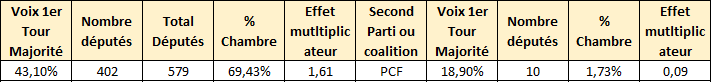
Vous comprenez que la majorité gaulliste est passé de 43,10% des votants à 69,43 % des députés. Le mode de scrutin a « optimisé » son résultat par 1,6
En comparaison le Parti communiste a divisé son résultat par 10.
Si on veut s’intéresser à deux autres Partis de cette élection :
L’autre Parti de Gauche était à l’époque le SFIO de Guy Mollet qui s’intégrera en 1971 dans le PS de Mitterrand. Il obtient 17,20% des voix au premier tour et 40 députés soit 6,91% de la chambre, l’effet multiplicateur est de 0,40, C’est mieux que le PCF mais cela correspond à un résultat divisé par 2,5.
Et le grand parti du centre le MRP qui avait dominé la IVème république et dont le chef était le maire de Strasbourg, Pierre Pflimlin qui était surtout l’avant dernier premier ministre de la IVème république (le dernier étant De Gaulle qui fera passer le régime à la Vème République)
Le MRP avait obtenu 9,10% des voix au premier tour, donc à peu près la moitié de la SFIO mais avec presque autant de députés 35, soit 6,04%. Il ne dispose donc pas d’une optimisation comme la majorité présidentielle, mais sa moins-value est moindre que celle des deux partis de gauche : 0,66 = 9,10/6,04
Le mode de scrutin qui donne un tel effet est-il utilisé ailleurs ?
Si on observe les principaux pays qui nous sont comparables :
- La Grande Bretagne pratique le scrutin uninominal à un tour : Le candidat arrive en tête au premier, quel que soit son score, est élu. Le type de déformation qui existe entre la répartition en voix et la répartition en sièges dans le scrutin uninominal à deux tours ne se retrouve évidemment pas dans ce type de scrutin.
- Les autres Pays de l’Union européenne utilise tous, le scrutin de liste avec élections à la proportionnelle. Ce mode de scrutin selon les modalités d’application (par exemple souvent les listes obtenant moins de 5% n’ont pas d’élus) ont un effet multiplicateur proche de un : la chambre des députés ressemble à la répartition des voix.
J’ai fait des recherches, je n’ai pas trouvé une démocratie sérieuse qui pratique ce mode de scrutin à l’exception peut-être de la Louisiane qui est le seul État des USA qui pratique le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, tous les autres États suivent l’exemple britannique du scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Je pose une question : La France a-t-elle raison contre le monde entier ou conserve t’elle une singularité incongrue ?
J’ai appliqué la même grille d’analyse à l’ensemble des 16 scrutins :
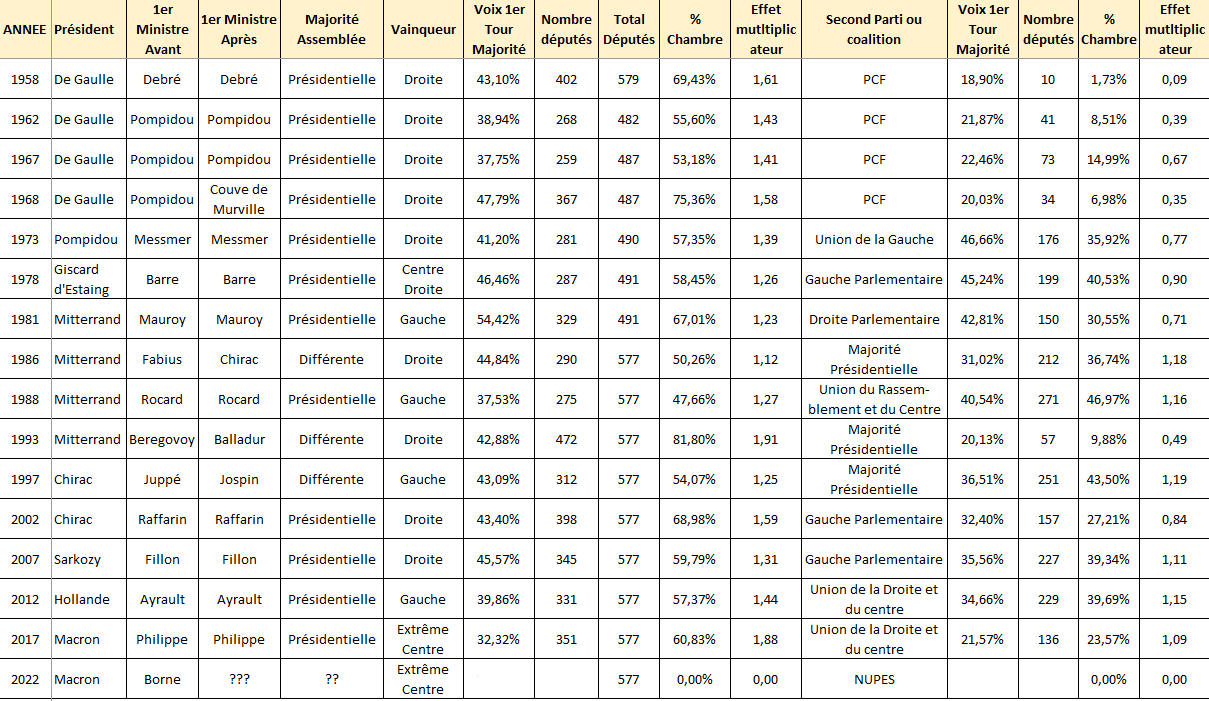
On constate qu’en moyenne quand la droite gagne elle bénéficie d’un effet multiplicateur, plus important que celle de la gauche.
L’extrême centre a réalisé en 2017 un hold-up avec un effet multiplicateur de 1,88 avec le plus petit pourcentage de voix de tous les scrutins : 32,32%.
Hier, c’est encore pire avec un peu plus de 25% des voix : ¼ des voix. Pour arriver à la majorité absolue des députés de la Chambre, il faudrait un effet multiplicateur de 2 !
Mais ce n’est pas mieux pour NUPES qui se réjouit d’être devant la majorité présidentielle, mais qui prétend vouloir la majorité absolue avec même pas 26% des voix.
Nos élections ne correspondent plus qu’à un vague processus de désignation de députés visant à donner, à n’importe quel prix, une majorité à un parti.
Tout cela pose un problème énorme à la démocratie représentative française.
Il n’est pas possible de continuer ainsi : 4 tours de scrutin pour un tel résultat, une telle déformation du corps électoral !
Ce n’est pas ainsi qu’on peut gouverner un pays de manière apaisée et le réformer.
<1680>
- La Grande Bretagne pratique le scrutin uninominal à un tour : Le candidat arrive en tête au premier, quel que soit son score, est élu. Le type de déformation qui existe entre la répartition en voix et la répartition en sièges dans le scrutin uninominal à deux tours ne se retrouve évidemment pas dans ce type de scrutin.
-
Vendredi 10 juin 2022
« On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va. »Jacques PrévertLe Magazine « Le Un Hebdo » que j’ai plusieurs fois sollicité pour écrire des mots du jour fête son 400ème numéro. Et cela fait huit ans qu’il existe.
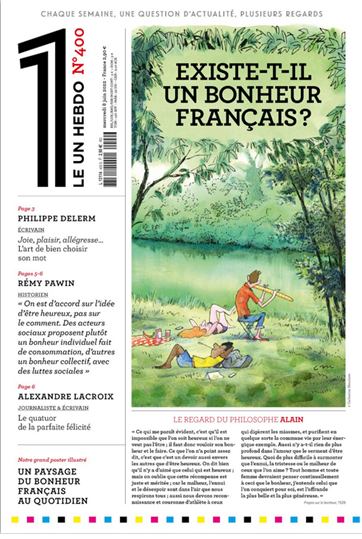 Pour ce numéro anniversaire il a choisi comme sujet une question : « Existe-t’il un bonheur français ?».
Pour ce numéro anniversaire il a choisi comme sujet une question : « Existe-t’il un bonheur français ?».
C’est, en effet, une question qui se pose, tant les enquêtes d’opinion renvoie l’image de français « fâchés » avec le bonheur, surtout le bonheur collectif.
Eric Fottorino dans son billet <nos « 400 » coups> introduit le sujet ainsi :
« Entre la guerre en Ukraine, les désenchantements de la politique et les questionnements qui ne manquent pas sur l’avenir de nos sociétés, il peut paraître surprenant, voire provocateur, de s’intéresser au bonheur, et en particulier au bonheur dans notre pays. D’autant que le paradoxe régulièrement observé par les sondages ad hoc depuis le milieu des années 1970 montre que si les Français sont plutôt heureux, ils sont moins enclins à le dire que la plupart de leurs voisins. Et semblent toujours vouloir opposer un certain bonheur individuel, qui existe, à un malheur collectif, sans doute exprimé comme un signe de lucidité ou de propension à se rebeller contre un ordre – ou un désordre – qui viendrait d’en haut. Dans ce contexte, il nous a paru fructueux d’interroger cette notion du bonheur « ici et maintenant » pour mesurer combien cette quête, loin d’être dominante au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s’est imposée au fil du temps comme une norme, une injonction à être heureux, pour ne pas dire une conversion quasi religieuse dans une société abandonnée par toute idée de transcendance. »
Et il finit son propos par cette phrase de Jacques Prévert que j’ai mis en exergue : « On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va. »
Cette phrase qui sonne comme un avertissement ou un conseil : Soyez présent au bonheur que vous vivez, car s’il venait à s’interrompre vous vous rendrez compte de la violence de son absence.
L’écrivain Philippe Delerm, le père du chanteur Vincent Delerm, dans son article <Ce n’est pas drôle d’être heureux> tente des variations avec les mots qui tournent autour du bonheur : « Plaisir, allégresse, harmonie, joie etc… » mais il revient au mot central :
« Bonheur est plus qu’un mot. Il est tout le soleil et toute l’ombre. On peut espérer le bonheur ou en garder la blessure et la nostalgie. Mais dire « je suis heureux », le nommer au présent est un risque majeur. Je continue à penser : « Le bonheur c’est d’avoir quelqu’un à perdre. » J’ai cette chance infinie d’avoir quelqu’un à perdre, quelques-uns à perdre. Mais Camus avait raison : « Il n’y a rien de plus tragique que la vie d’un homme heureux. »
Pourtant, il y a aujourd’hui une injonction à être heureux, il existe même des coachs autoproclamés en bonheur : <coachs du bonheur >.
Cet impératif se décline jusque dans les entreprises. On parle par exemple de <coach bien être entreprise>
Cela a conduit Eva Illlouz à écrire un livre dénonciation : <Happycratie – Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies >
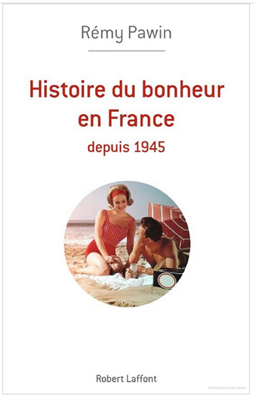 Le Un a convoqué un historien Rémy Pawin, pour un grand entretien
Le Un a convoqué un historien Rémy Pawin, pour un grand entretien
qui essaie de revenir sur l’histoire de ce sentiment : <« Le bonheur est devenu une norme religieuse »>
Rémy Pawin est un historien né en 1982 qui enseigne à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui a écrit « L’Histoire du bonheur en France depuis 1945 »
L’historien fait remonter la quête du bonheur au temps des lumières :
« Les Lumières parlent du bonheur. Une thèse de Robert Mauzi l’analyse dans les années 1960, à travers les écrits de Rousseau et d’autres intellectuels aujourd’hui oubliés.»
Et il cite aussi la déclaration de Saint-Just, en 1794, selon laquelle « le bonheur est une idée neuve en Europe ».
Selon lui le XIXème siècle ne poursuit pas dans cette recherche
« Au XIXe siècle […] Le bonheur devient même négatif et suspect, égoïste. Nul ne peut dire à titre personnel qu’il cherche à être heureux. On retrouve chez les moralistes et les écrivains de cette époque des propos acerbes. Le bonheur nous rendrait faibles. « Le bonheur est comme la vérole », écrit Flaubert. « La bêtise, c’est l’aptitude au bonheur », dira plus tard Anatole France. […] C’est une valeur de seconde zone, […] qu’on réserve éventuellement aux femmes »
La religion et la politique ne font pas commerce du bonheur :
« La morale religieuse ne propose pas de recette du bonheur ici-bas. On sera heureux au paradis, si on a respecté dans sa vie terrestre les préceptes de l’Église. Quant à la morale républicaine, elle n’accorde pas non plus une grande place au bonheur. […] Elle vante la force, la puissance, le devoir. Si de grands hommes vont au Panthéon, c’est qu’ils ont sacrifié leur bonheur pour la patrie. »
Et contrairement à ce que l’on croit, le bonheur ne commence pas en 1945 avec le programme du CNR, intitulé « Les Jours heureux » :
« On est alors dans des jours malheureux et on pense aux jours à venir. C’est le bonheur différé, renvoyé à demain, quand on aura battu les Allemands. […] Pour le PCF, qui est alors le premier parti de France, le bonheur est une morale bourgeoise et même petite-bourgeoise, emplie d’égoïsme. Les communistes, pour susciter l’engagement, ont besoin de labourer la terre de la souffrance. À ce moment, les récits heureux n’existent pas. Leur structure narrative est celle du malheur dont on va se défaire progressivement, comme dans les contes, pour vivre heureux et avoir beaucoup d’enfants à la fin… »
Selon Rémy Pawin le bonheur tend à devenir une norme dans les années 1960 :
« Au sein de la gauche alternative, certains vont revendiquer un bonheur plus immédiat. C’est aussi le cas de mouvements de jeunes, les Yéyé et la culture Salut les copains, qui construisent un bonheur individuel et consumériste. »
Il s’agit d’un bonheur individuel qui repose beaucoup sur la consommation :
« Des acteurs sociaux proposent plutôt un bonheur individuel fait de consommation »
Et il cite Edgar Morin : « Le bonheur est une religion de l’individu moderne. »
« C’est une croyance commune qui donne du sens à la vie. Une des causes de ce sacre, c’est que le bonheur est une transcendance dans l’immanence. Il est immanent, donc il est là et pas au-dessus de nous, mais il nous dépasse. On va le rechercher, donc il nous transcende. C’est une sorte de norme religieuse. C’est pourquoi il est devenu une injonction. Il faut être heureux. Sinon on a raté la direction cardinale qu’on nous assigne. On subit une double peine : non seulement on n’est pas heureux, mais on est coupable de ne pas l’être. »
Selon lui la période se referme en 1975, « avec des blocages politiques, le chômage de masse, la vague de désenchantement à l’égard de l’idéal communiste. La société de consommation montre aussi ses limites et la question sociale dans les banlieues commence à se faire jour. On assiste alors à une baisse des courbes du bonheur subjectif »
Et Rémy Pawin conclut sur la recherche du bonheur par les Français d’aujourd’hui :
« Les ingrédients du bonheur n’ont pas fondamentalement changé. Les gens cherchent des liens avec les autres, des liens amoureux, conjugaux, amicaux. De l’argent pour faire ce qu’ils veulent. Un travail qui leur plaît. Une difficulté à se dire heureux vient de l’influence des grands récits peu optimistes. L’extrême droite propose un récit craintif et haineux. La sobriété ne fait pas rêver. Le récit de la mondialisation heureuse n’est plus crédible. Il est difficile de croire à un récit joyeux qui nous accroche. »
Dans ces jours bien sombres de guerre, de crise alimentaire et de tous les défis écologiques qui font l’objet de tant de débats et de si peu d’actions, il est salutaire que Le Un nous invite à réfléchir, pour son 400ème numéro, au bonheur.
 Le bonheur qui n’est pas dans la consommation nous en sommes conscients intellectuellement et espérons-le dans les actes.
Le bonheur qui n’est pas dans la consommation nous en sommes conscients intellectuellement et espérons-le dans les actes.
Surtout quand l’acte de consommation est basé sur le l’inhumanité comme tous ces produits envoyés de Chine et qui sont les fruits de l’esclavage des ouïghours par le pouvoir chinois. Terrible réalité que la dessinatrice Coco a synthétisé par un dessin dans Libération.
Le 13ème mot du jour de cette liste qui en compte désormais plus de 1600 citait Michel Rocard :
« Dans les cinq plus beaux moments d’une vie, il y a un (ou des) coup(s) de foudre amoureux, la naissance d’un enfant, une belle performance artistique ou professionnelle, un exploit sportif, un voyage magnifique, enfin n’importe quoi, mais jamais une satisfaction liée à l’argent. »
Probablement que le bonheur est surtout lié à notre capacité d’accéder à nos richesses intérieures, de les faire affleurer la surface et aux liens que nous avons su créer, approfondir et partager.
Liens qu’Alain Damasio a magnifiés par <ces mots> de l’indicible :
« Une puissance de vie !
C’est le volume de liens, de relations qu’un être est capable de tisser et d’entrelacer sans se porter atteinte.
Ou encore c’est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables
Vivre revient alors à accroitre notre capacité à être affecté.
Donc notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému.
Contracter une sensation, contempler, habiter un instant ou un lieu.
Ce sont des liens élus. »
<1679>
-
Jeudi 9 juin 2022
« Pourquoi Le Monde, Libération, l’Obs n’ont pas parlé de l’assassinat d’Alban Gervaise ? »Je n’ai pas la réponse à cette question délicateAlban Gervaise était âgé d’une quarantaine d’années. Il était radiologue, médecin chef à l’hôpital militaire Lavéran de Marseille.
Il était marié et père de trois enfants.
Le 10 mai il est allé chercher deux de ses enfants de 3 et 7 ans, scolarisés en maternelle et en CP dans une institution catholique de Marseille.
Un homme a surgi par-derrière et lui a asséné plusieurs coups de couteau. L’agresseur a été maîtrisé et désarmé par quatre passants.
Lors de son arrestation il a affirmé à la police avoir attaqué au nom de Dieu. Selon des témoins, l’homme aurait crié des allégations religieuses pendant l’agression.
Alban Gervaise est décédé dans la nuit du 27 mai de la suite de ses blessures.
L’homme qui a été arrêté est de nationalité française, il a 24 ans et se prénomme Mohamed.
J’ai appris cela sur Facebook, Céline Pina a publié cette information accompagnée d’un long commentaire.
Céline Pina est proche du Printemps républicain, ce mouvement politique de gauche créé en 2016 notamment par Laurent Bouvet a pour ambition de défendre les valeurs de laïcité et d’universalisme contre des dérives communautaristes et notamment l’islamisme politique pour lequel il dénonce la complicité qu’auraient certains mouvements et partis de gauche. Les premiers traitent les seconds d’islamo-gauchistes qui en retour les accusent d’islamophobes.
Pour celles et ceux qui ont un compte Facebook, vous pouvez aller voir la publication que Céline Pina a rédigé sur Facebook, pour les autres vous pouvez lire le contenu de cette publication <ICI>.
Ce qui m’a interpellé c’est le fait que je n’ai pas entendu parler de ce fait divers et que Celine Pina affirme que les grands médias n’ont rien dit sur cette affaire qui date de presque un mois.
Abonné au Monde, à Libération et à l’Obs, j’ai utilisé hier le moteur de recherche de chacun de ces médias pour vérifier s’ils ont publié un article, un petit entrefilet sur ce sujet.
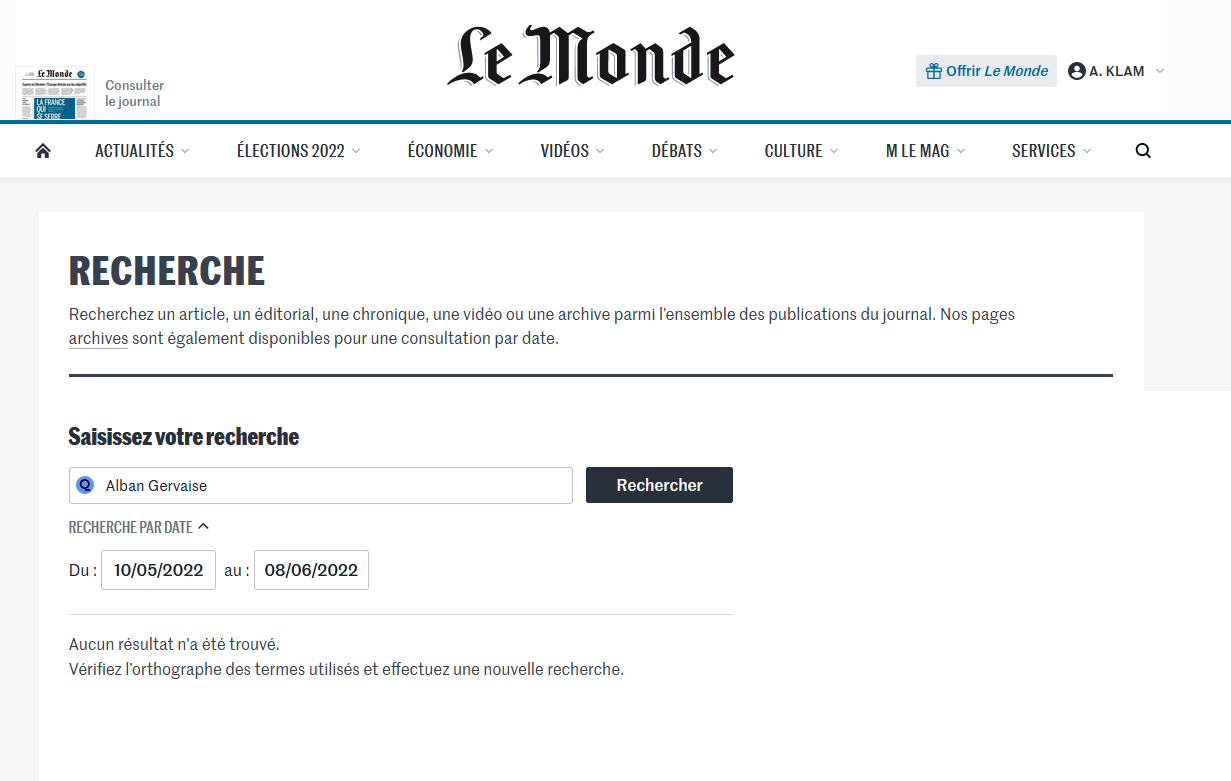 Force est de constater que la réponse est négative !
Force est de constater que la réponse est négative !
Vous trouverez dans cet article la preuve en image.
J’ai fait des recherches et j’ai trouvé des informations sur des sites d’extrême droite.
Parmi les grands journaux nationaux, j’ai trouvé le « Figaro » qui a publié dès le 10 mai l’information :
< Marseille : un père de famille attaqué au couteau à proximité d’une école catholique>
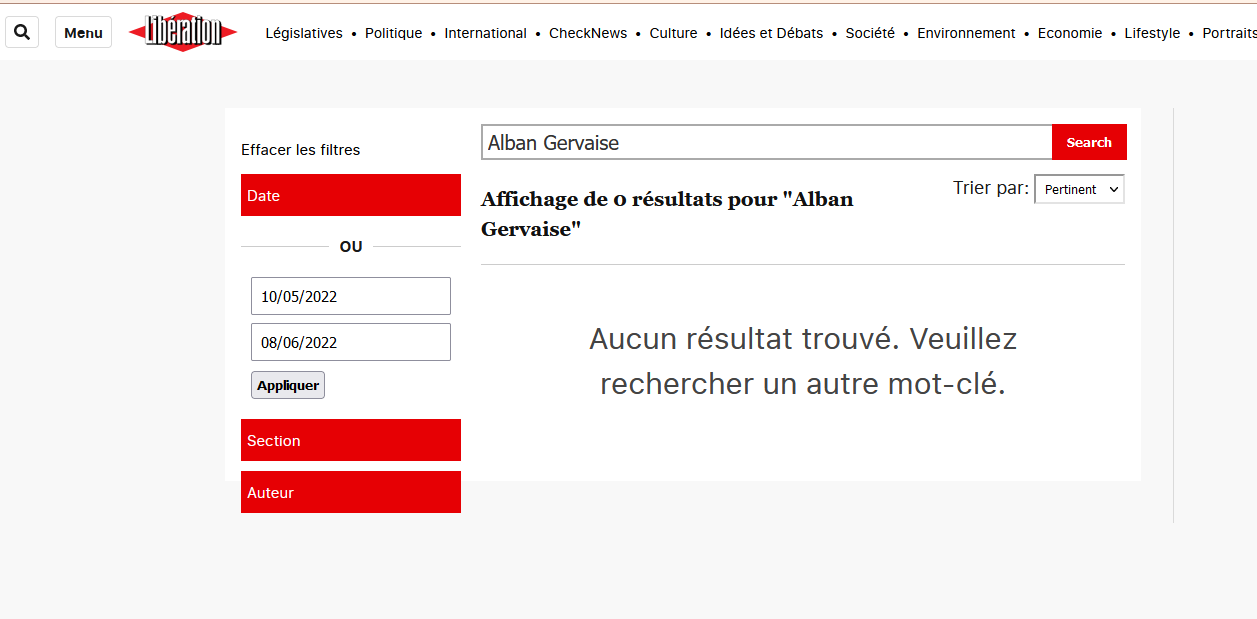 J’en cite des extraits :
J’en cite des extraits :
« Un père de famille âgé de 40 ans a été poignardé une dizaine de fois au niveau de la gorge, mardi 10 mai aux alentours de 18h, dans le 13e arrondissement de Marseille, a appris Le Figaro de sources concordantes. »
Celine Pina fait remarquer qu’il y a un mot français pour signifier « poignardé au niveau de la gorge » et ce mot est égorgé !
« Appelés sur les lieux, les secours ont entrepris un massage cardiaque. Grièvement blessée, la victime a été transportée à l’hôpital Nord avec un pronostic vital très engagé. Il est actuellement en réanimation intensive. « Une enquête pour tentative d’homicide volontaire est ouverte et confiée à la Sûreté Départementale», indique le parquet de Marseille au Figaro.
Les faits ont eu lieu à proximité du groupe scolaire catholique Sévigné, chemin du Merlan à la Rose. La victime, médecin militaire radiologue à l’hôpital Laveran, a été attaquée pour une raison encore inconnue alors qu’il était sur le point de reprendre sa voiture stationnée à une cinquantaine de mètres de l’école. Il était accompagné de ses deux enfants de 3 et 7 ans, scolarisés en maternelle et en CP dans l’école catholique, qu’il venait de récupérer. Assis sur un banc à proximité, l’agresseur a surgi par derrière avant de s’acharner sur sa victime, lui assénant plusieurs coups de couteau dans le thorax.
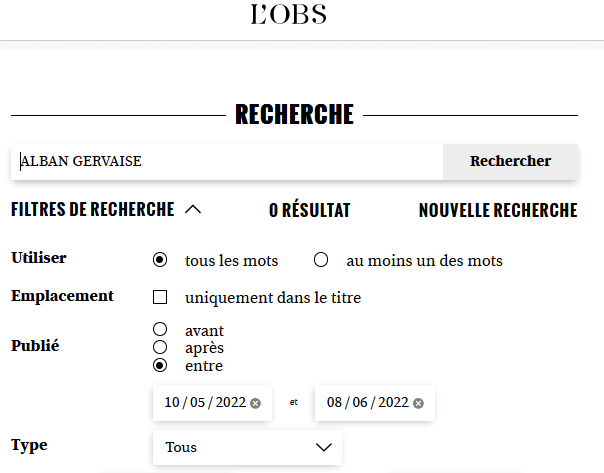 Maîtrisé et désarmé par quatre passants, l’agresseur a été interpellé par les policiers avec un couteau suisse en sa possession. Il s’agit de Mohamed L., 23 ans, né à Brignoles (Var). L’individu est connu des services de police mais pas du renseignement territorial. Selon plusieurs témoins, le suspect aurait crié des allégations religieuses lors de l’attaque, déclarant notamment « avoir agi au nom de Dieu ». Placé en garde à vue, l’homme a tenu des «propos délirants» évoquant «Dieu» et «le diable». Les policiers n’ont pas pu mesurer son alcoolémie en raison de son état « très agité ».
Maîtrisé et désarmé par quatre passants, l’agresseur a été interpellé par les policiers avec un couteau suisse en sa possession. Il s’agit de Mohamed L., 23 ans, né à Brignoles (Var). L’individu est connu des services de police mais pas du renseignement territorial. Selon plusieurs témoins, le suspect aurait crié des allégations religieuses lors de l’attaque, déclarant notamment « avoir agi au nom de Dieu ». Placé en garde à vue, l’homme a tenu des «propos délirants» évoquant «Dieu» et «le diable». Les policiers n’ont pas pu mesurer son alcoolémie en raison de son état « très agité ».
Les motivations du mis en cause restent floues
Les éléments recueillis ne permettent pas à ce stade d’établir les motivations du mis en cause, a indiqué le parquet de Marseille au Figaro mercredi 11 mai. La veille, une source policière indiquait à l’AFP que l’hypothèse terroriste avait été définitivement écartée par les enquêteurs et que l’agresseur souffrait de troubles psychologiques. »
Le FIGARO a publié un nouvel article à la mort de Monsieur GERVAISE : <le père de famille attaqué au couteau devant l’école de ses enfants est décédé> et le 1er juin un billet d’analyse de l’essayiste, biographe et haut fonctionnaire, Maxime Tandonnet «L’affaire Alban Gervaise révèle la banalisation de la barbarie quotidienne»
Je n’ai pas trouvé un autre grand journal national ayant parlé de ce drame.
Il y a eu quelques journaux régionaux comme le <Républicain Lorrain> parce qu’il avait effectué une partie de sa carrière de médecin militaire en Lorraine.
Il y a aussi <Sud Ouest.fr> et des journaux marseillais.
Pour le reste, le silence.
Les médias auquel pour ma part je m’informe généralement, n’ont pas jugé utile de dire ce fait.
Ils ont laissé toute la place aux sites d’extrême droite pour en parler largement.
Et pour ma part de me plonger dans un abîme de perplexité.
Est-ce protéger la communauté musulmane, toutes celles et ceux qui veulent vivre paisiblement leur foi en France en évitant de révéler qu’une nouvelle fois, un homme se réclamant de la religion musulmane a tué un autre homme en prétendant le faire au nom de sa religion ?
Cet homme est peut-être fou, mais pour autant ne faut-il pas en parler ?
Ne peut-on pas s’interroger pourquoi des déséquilibrés veulent invoquer le Dieu de l’Islam pour tuer ?
Chaque jour nous recevons des flots d’information plus ou moins pertinent. L’égorgement d »un père de famille devant ses deux enfants à proximité d’une école catholique marseillaise n’est-elle pas une information qui mérite d’être connue nationalement ?
Grâce au Républicain Lorrain, nous disposons d’une photo de Alban Gervaise.

<1678>
-
Mercredi 8 juin 2022
« Si on considère que l’objet d’une élection est d’attribuer le pouvoir, alors les élections législatives sont les plus importantes. »Gilles FinchelsteinJ’ai, à plusieurs reprises, accablé Lionel Jospin d’avoir par la combinaison de la réforme du quinquennat et de l’inversion du calendrier électoral, abaissé les élections législatives et en avoir fait une simple annexe de l’élection présidentielle.
Il a considéré que l’élection présidentielle était majeure et l’élection législative seconde.
Plus précisément il a dit en parlant de l’élection présidentielle :
« On ne peut pas faire de cette élection majeure l’élection seconde. »
Si vous voulez lire l’ensemble de son argumentaire pour justifier cette mesure : < déclaration du 19 décembre 2000. >
Certains évoquent l’idée que Jospin était persuadé de gagner l’élection présidentielle contre Chirac et avait davantage de craintes d’obtenir une majorité législative. Dans cette hypothèse, il avait parfaitement prévu ce qui allait se passer : une élection législative au rabais qui confirme et amplifie le résultat des présidentielles.
Je ne sais pas si cette hypothèse est fondée mais force est de constater que la responsabilité de nous avoir mis dans cette situation lui incombe.
Ce fut une erreur.
Comme je le rappelais dans <le mot du jour du 31 mai> nos institutions restent avant tout parlementaires.
Et si on revient aux principes ce qui est premier c’est le pouvoir de faire la Loi : le pouvoir législatif.
Le pouvoir secondaire est celui qui exécute, l’exécutant des Lois, c’est-à-dire le pouvoir exécutif.
Et puis, de manière plus pratique, en cas de divergence entre le Président de la République et l’Assemblée Nationale c’est cette dernière qui a le dessus. Sauf si le Président use de son pouvoir exorbitant de dissoudre l’Assemblée Nationale. Mais dans ce cas il n’est jamais certain que les citoyens français lui envoient une majorité à sa convenance.
C’est cette primauté du législatif que Gilles Finchelstein, Directeur de la fondation Jean Jaurès, a exprimé sur l’antenne de France Inter dans l’émission <Face à Face du samedi 4 juin 2022> :
« Ce qui est fascinant, c’est que si on considère que l’objet d’une élection est d’attribuer le pouvoir, alors les élections législatives sont les plus importantes. Parce que l’essentiel du pouvoir dépend de l’élection législative. La meilleure preuve a contrario, c’est que en 1986, en 1993 et en 1997, lorsqu’il y a eu une discordance entre la majorité législative et la majorité présidentielle, le pouvoir était transféré du président de la république au premier Ministre.
Donc ce sont les élections premières et pourtant elles sont devenues de plus en plus des élections secondes. Elles le sont dans le calendrier […] elles viennent dans la foulée des présidentielles. Elles le sont dans la participation par une chute de la participation entre les présidentielles et les législatives. […] Et elles le sont dans l’intensité, la campagne, quelle campagne ? »
Oui quelle campagne !
L’émission a fait entendre l’avis de Brice Teinturier, politologue, directeur général d’IPSOS :
« On a du mal à qualifier cette campagne, puisque qu’en réalité il n’y a pas vraiment de campagne qui se soit construite sous nos yeux. Ce n’est même pas que les français n’écoutent pas ou n’entendent pas ; C’est que véritablement nous en sommes à un moment où c’est un non objet. »
Et nous sommes désormais à quelques jours du premier tour.
Hubert Vedrine a aussi exprimé son désarroi devant cette situation la trouvant « malsaine ». Il a notamment suggéré l’idée d’organiser de manière concomitante les deux élections. Ainsi le fait de les réunir, lors de deux même tours, aurait pour conséquence mécaniquement d’augmenter la participation aux législatives. Et aussi paradoxalement les réunir serait les rendre indépendants l’une de l’autre.
Il a exprimé cela lors de l’émission <L’Esprit public du 5 juin 2022>
<1677>
-
Mardi 7 juin 2022
« L’extrême centre est un extrémisme »Alain DeneaultAvant le second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a accepté un entretien de 47 minutes avec Guillaume Erner sur France Culture. <Emmanuel Macron, grand entretien sur la culture et les idées>. Dialogue de haute tenue, notre Président est un homme intelligent, cultivé, intéressant à écouter.
Parallèlement, Marine Le Pen ne s’est pas présentée à l’entretien qui lui a été proposé par équité démocratique. Elle a envoyé un de ses soutiens : Hervé Juvin. Probablement qu’elle a pensé qu’il n’y avait pas beaucoup de ses électeurs qui écoutaient France Culture, peut être aussi qu’elle craignait que la comparaison avec Emmanuel Macron lui serait encore plus défavorable que le débat télévisé…
Lors de cet entretien Emmanuel Macron s’est défini comme appartenant à « l’extrême Centre » :
« « Les trois quarts des électeurs qui se sont exprimés pour trois projets. Un projet d’extrême droite (…) Un projet d’extrême gauche. (…) Et ce que je qualifierai comme un projet d’extrême centre, si on veut qualifier le mien, dans le champ central. Je trouve qu’il faut collectivement réfléchir, intellectuels d’un côté et responsables politiques de l’autre, à reconsidérer notre démocratie par rapport à cette relation à la radicalité, ce que j’appelle cette volonté de pureté. Parce qu’à la fin, on vit tous ensemble. (…) Ça suppose des compromis. La question, c’est comment on arrive à créer de l’adhésion, du respect, de la considération entre des citoyens qui peuvent penser très différemment, en leur montrant que ce n’est pas une trahison de leurs convictions profondes, mais que ce sont d’indispensables compromis qu’on trouve pour vivre en société. »
Certains évoquent le milieu de l’omelette et d’autres dont Emmanuel Macron l’« extrême centre. ».
L’origine de ce concept est disputée.
<Le Figaro> attribue l’invention de ce concept à son chroniqueur Alain-Gérard Slama qui l’aurait forgée en 1980 :
« La formule, évidemment critique, d’extrême centre s’est imposée à moi en 1980, dans un essai, «Les Chasseurs d’absolu. Genèse de la gauche et de la droite» (Grasset), dont le but était de démontrer que l’opposition droite-gauche, loin de fausser le jeu démocratique, confronte deux visions du monde, articulées certes selon des modalités très variables, mais relativement stables, et correspondant, pour l’essentiel, à deux tempéraments. En recourant à cette notion d’extrême centre, je visais, pour reprendre mes termes d’alors, « les maîtres de certitude qui agitent les clés de la Raison et de la Morale. » pour monopoliser le pouvoir au détriment du jeu normal de la démocratie, qui suppose conflit, pluralisme et alternance. »
<Wikipedia> prétend que ce concept fut défini, par l’historien Pierre Serna en 2005 pour caractériser le mode de gouvernement en France du Consulat à la Restauration.
Il me semble intéressant de reprendre ce que cet article raconte des travaux de cet historien sur cette période qui suit le moment le plus conflictuel de la révolution française qui avait inventé l’opposition gauche/droite :
« Ce régime d’extrême centre se développe en vue de sortir d’une crise politique et sociale. Il avance globalement une politique modérantiste dans les déclarations mais orientée dans les faits par des principes de libéralisme économique, et surtout conduite par un exécutif à tendance autoritaire.
[…] Il cherche à discréditer l’autre conception plus conflictuelle de la démocratie, issue de la Révolution française, dans laquelle le gouvernement repose sur l’existence d’une balance entre une droite et une gauche au sein d’un cadre parlementaire. Il s’agit d’opposer à l’alternative droite-gauche une rationalité technocratique et dépolitisée qui rassemble les acteurs les plus proches entre eux dans ces oppositions pour en rejeter aux extrêmes, donc réduire à l’impuissance, les acteurs les plus radicaux.
Les acteurs élitaires de ce rassemblement centriste sont issus principalement des institutions d’État dont ils bénéficient et des catégories socio-professionnelles supérieures qui les entourent, institutions qu’ils font tourner à l’avantage des possédants du moment.
Le concept, par le choix du terme « extrême », est ainsi inscrit dans une représentation tripolaire qui remplace la bipolarité classique gauche sociale – droite gestionnaire : gauche, centre et droite cessent de s’inscrire dans une linéarité axiale à deux extrémités et connaissant des demi-couleurs entre des couleurs plus prononcées. Les extrêmes viennent à se voir comme trois pôles d’attraction qui aspirent la matière politique dans un sens radical propre à chacun d’eux, ce qui est l’objet de dénonciations mutuelles, et en particulier par l’extrême centre. »
Dans cette vision, l’extrême centre macronien vient de loin.
Wikipedia nous apprend que ce concept de l’extrême centre a été ensuite repris par le politologue anglais Tariq Ali en 2015 et puis par le Québécois Alain Deneault en 2016.
<Alain Deneault> né en 1970, est un philosophe québécois. Il a écrit des essais appelés « Gouvernance » et « La Médiocratie » avant de réfléchir sur la politique de l’extrême centre. Telerama avait publié un article en 2016 < Alain Deneault fustige la Politique de l’extrême centre>. Je cite un extrait de cet article :
« Il parle de « révolution anesthésiante ». Celle qui remplace la politique par la « gouvernance » et réduit la démocratie au management. Celle qui nous invite à nous situer toujours au centre, à penser mou, à mettre notre esprit critique dans notre poche et à « jouer le jeu » du système libéral dominé par la logique de l’entreprise privée. »
Mais le cœur de ce mot du jour est consacré à l’article qu’il a publié sur le site « AOC » le 11 mai 2022 : « L’extrême centre est un extrémisme»
Ainsi parle Alain Deneault :
« L’idéologie d’extrême centre, dans laquelle nous nous enlisons, est extrémiste.
Son programme est écocide du point de vue industriel, inique du point de vue social et impérialiste du point de vue managérial.
Le projet de l’extrême centre : garantir la croissance des entreprises et l’augmentation des dividendes versés à leurs actionnaires ; leur assurer l’accès aux paradis judiciaires et fiscaux ; réduire l’écologie politique à un marketing du verdissement ; étouffer tout discours social de l’État et minimiser les dépenses publiques dans les secteurs sociaux et culturels.
Donc, favoriser l’essor de souverainetés privées au service desquelles se place l’État. Faire oublier la mission sociale de l’État devient primordial, et ce, même dans le contexte d’une crise de santé publique ; un acte de « guerre » est alors proclamé plutôt qu’une responsabilité sociale et collective. »
Je pense qu’Alain Deneault va un peu loin lorsqu’il écrit que cette politique tend à « étouffer tout discours social de l’État ». L’État social existe toujours, mais le discours de la gouvernance, du libéralisme conduit à essayer de le contraindre toujours davantage et de l’éloigner du champ politique, en essayant de convaincre que les décisions sont rationnelles et éloignées de toute idéologie.
Et ce dernier point est un mensonge. Toute décision politique constitue un choix qui avantage certains et désavantage d’autres. Alain Deneault esquisse qui sont les bénéficiaires de cette politique qui est parfaitement idéologique et se base sur un récit et des croyances.
En pleine crise COVID, Macron a bien eu un discours sur l’état social, sur les chaînes de valeur, sur la rémunération des personnes qui sont vraiment importantes pour notre société, pour préserver la vie et l’essentiel.
La crise passée, ce sont toujours les financiers, les traders, les spéculateurs, les optimisateurs fiscaux qui tirent toute la richesse vers eux.
Une fois que l’extrême centre parvient à vous convaincre que ses choix sont uniquement dictés par la raison, la connaissance des mécanismes il franchit une autre étape : tous les autres avis deviennent illégitimes et extrémistes :
« L’extrême centre est extrême également dans la mesure où, d’un point de vue moral, il se montre intolérant à tout ce qui n’est pas lui. Loin de se situer lui-même quelque part sur l’axe gauche-droite, il supprime carrément l’axe pour ne plus faire exister, au titre de discours légitime, que le sien. Tout au plus relègue-t-il dans tous « extrêmes » les propositions, abusivement assimilées entre elles, qui ne coïncident pas avec son programme.
La visée de l’extrême centre – une politique qui a la médiocratie pour modalité et la gouvernance pour discours théorique – est de naturaliser le principe ultralibéral et darwiniste social qui préside aujourd’hui, et de l’assimiler à un simple art de gérer. Et de le faire de manière tellement imposante qu’on n’arrive même plus à le nommer, à le mettre en doute, à le jauger. […]
L’extrême « centre » se présente en s’autoproclamant au juste milieu de toute chose, mais il n’a rien de centriste. Dans d’inouïs efforts de relations publiques, le « centre » dont il se réclame est alors synonyme de pondération : c’est un concept publicitaire.
Des journaux détenus par les milieux d’affaires qui le commanditent, et dont il provient lui-même, s’assurent de distribuer les bons points « centriste » à tous ceux qui colportent un programme pourtant radical : ceux-là qui défendent la maximisation des profits au détriment de l’équité sociale et d’un rapport intelligent au vivant sont alors dits péremptoirement rationnels, raisonnables, responsables, pondérés, sensés, voire normaux.
A contrario, tout acteur public ou citoyen qui s’opposera à cette vulgate risquera les attributions inverses : irresponsable, déraisonnable, paranoïaque, rêveur, dangereux, voire fou. Des éditocrates à la petite semaine estampilleront ces qualifications sur les visages des uns et des autres de sorte qu’elles passent pour des faits eux-mêmes.
C’est précisément de cette façon prévisible qu’Emmanuel Macron s’est présenté explicitement comme d’«extrême centre » sur les ondes de la radio publique, quelques jours avant le second tour de la présidentielle, un être d’équilibre entre des forces débridées. »
Et il finit par cette exécution d’un mirage :
« En cela, le parti La République en marche se présente lui-même telle une entreprise : ses députés sont traités en salariés, son rapport à la politique est soumis à la seule plasticité du marketing. Et comme dans bien des opérations propagandistes du genre, c’est d’abord l’absence de scrupule qui sidère.
Ce n’est plus un fabriquant automobile qui s’arroge le nom de Picasso pour nommer un véhicule ou une entreprise de l’agro-industrie qui laisse tomber sa fraise dans un bol de céréales au son des cymbales d’une prestigieuse symphonie, mais un marchand de rêve électoral qui reprend à son compte le signifiant révolution, le slogan anticapitaliste « Nos vies valent mieux que leur profit » ou le nom du programme adverse « L’avenir en commun ». […]
Évidemment, cela ne l’empêche pas de confier les politiques publiques et la gestion des institutions de la République à des firmes de conseil multinationales, de réduire explicitement à « rien » ceux qui, dans les gares, déambulent en suivant leur destin sans avoir réussi comme lui, de nier le statut de citoyen à ceux qui doutent de l’innocuité d’un vaccin, puis de nommer comme ministre de l’Intérieur celui qui présentera Marine Le Pen comme étant « trop molle » dans l’expression de son islamophobie, un Garde des Sceaux qui instrumentalisera l’institution judiciaire pour régler ses comptes avec les magistrats face auxquels il plaidait antérieurement, un assistant à l’Élysée qui cassera du militant pacifiste le soir, tout en faisant du saccage écologique l’objet d’un nouveau marché pour que nous en relèvent les grandes entreprises l’ayant provoqué. »
Comme toujours ces développements ne constituent pas « la vérité » mais une utile réflexion pour permettre de se poser des questions.
Car il se passe en ce moment quand même de curieuses choses dans notre démocratie.
Il n’y a pratiquement pas eu de campagne présidentielle.
Le candidat qui a été élu, l’a été parce que les électeurs l’ont moins rejeté que les autres.
Ce candidat n’a présenté aucun programme cohérent et complet.
De temps à autre, il fait une déclaration et semble développer un point de son programme, mais souvent pour y ajouter un nuage de flou.
La démocratie c’est voter pour une femme ou un homme, mais dont on connait le programme !
Et dimanche nous devons élire des députés.
Celles et ceux à qui on promet une majorité et même une majorité absolue, se réfèrent au programme du Président qui n’existe pas !
Si quelqu’un trouve cela normal, c’est qu’il n’a rien compris à ce qu’était une démocratie.
Si le sujet de l’extrême centre vous intéresse, j’ai repéré d’autres articles
La revue de critique communiste « Contretemps » a publié en 2017 : <Extrême centre>
L’historien Pierre Serna a élargi son analyse à l’époque actuelle. Il a publié « L’extrême centre ou le poison français ». Slate a publié un <Article> sur ce livre
Ainsi que <Retronews> et le journal « La Marseillaise » : <Quand l’historien Pierre Serna met à nu l’« extrême centre » de la Macronie>
<1676>
-
Vendredi 3 juin 2022
«Pause »Un jour sans mot du jour nouveauComme je l’avais annoncé lundi, quand je ne parviens pas à écrire un mot du jour nouveau, je fais une pause.

Pour accompagner ces pauses je mets la photo d’un chat.
J’ai trouvé cette photo publiée en mars par un journal suisse <Le Matin>. D’après l’article cet homme a perdu toute sa famille dans les bombardements russes, il ne lui restait que ce chat.
Le 1er juin, Le Monde a mis en ligne une vidéo montrant, grâce à diverses sources, la destruction de Marioupol et les bombardements des civils que nient les russes : <Comment le siège de Marioupol a entraîné de lourdes pertes civiles>
Il y a quelques jours le Monde a aussi publié cette courte vidéo :<Sievierodonetsk, la nouvelle Marioupol ?>
Ce vendredi 3 juin, est le 100ème jour de la guerre d’agression de la Russie poutinienne contre son petit voisin Ukrainien.
<Mot du jour sans numéro>
-
Jeudi 2 juin 2022
« Témoigner, dénoncer, donner à voir étaient au centre de ses choix professionnels et humains […] Sa courte vie a eu un sens »La mère de Frédéric Leclerc-ImhoffFrédéric Leclerc-Imhoff était un jeune homme de 32 ans.
Il est décédé lundi 30 mai, « touché par un éclat d’obus » lors du tournage d’un reportage sur les évacuations de civils de Lysychansk et Severodonetsk dans le Donbass qu’il réalisait pour BFMTV . Il s’agit du 8e journaliste tué depuis le début du conflit en Ukraine.
 <Slate> nous apprend qu’il était diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA) et travaillait pour BFMTV depuis plus de 6 ans après avoir travaillé en tant que réalisateur de reportages et de documentaire pour l’agence Capa, comme l’indique LCI. En Ukraine pour couvrir l’invasion russe, il effectuait sa deuxième mission sur place lorsque le véhicule dans lequel il se trouvait a été ciblé par un bombardement russe.
<Slate> nous apprend qu’il était diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA) et travaillait pour BFMTV depuis plus de 6 ans après avoir travaillé en tant que réalisateur de reportages et de documentaire pour l’agence Capa, comme l’indique LCI. En Ukraine pour couvrir l’invasion russe, il effectuait sa deuxième mission sur place lorsque le véhicule dans lequel il se trouvait a été ciblé par un bombardement russe.
Il s’agit du 8e journaliste tué depuis le début du conflit en Ukraine.
Pourquoi parler de lui, alors que la guerre d’Ukraine fait tous les jours des centaines de morts ?
Parce que ce jeune homme a pris tous ces risques pour nous informer, pour que nous puissions disposer d’une information indépendante et pas seulement de propagande.
Aldous Huxley a écrit :
« La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter »
Ainsi les alliés séparatistes du Kremlin ont affirmé à l’agence de presse russe Tass que Frédéric Leclerc-Imhoff n’était pas un journaliste, mais un mercenaire étranger et qu’il aurait livré des armes et des munitions à l’armée ukrainienne.
C’est de la désinformation, de la propagande russe.
Pour pouvoir lutter contre cette falsification de la réalité, les journalistes sont indispensables.
Christophe Deloire, le directeur général de Reporters sans frontières a rendu hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff sur <France Inter> le 31 mai 2022.
Il a rapporté un entretien avec la mère du journaliste :
« Je suis très fière de mon fils et de son engagement. Témoigner, dénoncer, donner à voir étaient au centre de ses choix professionnels et humains […] Sa courte vie a eu un sens. ».
Ses collègues ont affirmé qu’il était le contraire d’une tête brulée. Mais les forces russes ciblent les journalistes qui peuvent contrecarrer leur récit mensonger des évènements.
Christophe Deloire précise que
« Depuis le début du conflit, des journalistes se sont fait tirer -pardonnez-moi l’expression- comme des lapins » par les forces russes, il y a une responsabilité du Kremlin, de Vladimir Poutine, sur ces crimes de guerre. Heureusement qu’il y a des journalistes sur le terrain pour dénoncer les mensonges des forces russes qui prétendent qu’elles ne visent pas les civils alors qu’elles le font, qui prétendent qu’elles ne visent pas les journalistes alors qu’elles le font ».
Nous ne pouvons qu’exprimer notre gratitude devant ces vigies de la vérité que sont les journalistes qui prennent ces risques pour nous informer. Frédéric Leclerc-Imhoff était l’une d’entre elles.
<1675>
-
Mercredi 1 juin 2022
« L’élection n’est plus qu’un permis de gouverner »Pierre RosanvallonL’immense majorité des analystes politiques ont interprété le résultat du premier tour des élections présidentielles 2022 par la description d’une tripartition de la vie politique française.
Tripartition qui reprend l’image de l’omelette évoquée hier :
- Au centre, un parti de la raison regroupant une grande part « des vieux » et des gagnants de la mondialisation
- A droite, l’extrême droite nationaliste, regroupant une grande part des jeunes actifs habitant hors des grandes métropoles ayant des rémunérations modestes, s’estimant victime de la mondialisation et rendant responsable en grande partie de leur malheur une « immigration massive et non maîtrisée »
- A gauche, la gauche radicale des fonctionnaires, des cadres moyens se sentant déclassés souvent habitant les métropoles et des français issus de l’immigration musulmane.
Il ne faudrait cependant pas oublier les abstentionnistes qui sont le premier parti de France. Ils représentent 28 % des inscrits contre 20 % pour le candidat de l’extrême centre qui a été élu.
Ces abstentionnistes qui regroupent la masse des indifférents, des découragés, des populations marginalisées et quelques intellectuels comme Michel Onfray ou Emmanuel Todd qui conceptualisent l’inutilité des élections dans un pays qui a perdu sa souveraineté monétaire et se trouve enchâssé dans une toile d’araignée de directives de l’Union européenne.
L’historien et sociologue Pierre Rosanvallon, chantre de la deuxième gauche, développe dans l’Obs une analyse différente et intéressante : <L’élection n’est plus qu’un permis de gouverner>
Il constate, comme je l’ai évoqué hier, que l’électeur qui accepte de voter prend désormais en compte la perversité de notre système politique pour choisir le bulletin qu’il va mettre dans l’urne. Il parle de « l’électeur stratège » :
« Cette élection a été marquée par la montée de « l’électeur stratège », qui décide en fonction des sondages et tente de conjurer ce qu’il identifie comme des dangers sous-jacents au processus électoral.
Ce comportement s’est manifesté dès le premier tour, avec les votes « utiles » en faveur de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. D’ordinaire, le premier tour permet d’exprimer des préférences objectives. Il a été cette fois-ci un vote d’anticipation. Le sens même de l’élection s’en trouve modifié. Classiquement, la présidentielle ouvrait une porte vers un chemin tracé : un choix politique, nettement dessiné, qui s’appuyait sur des évidences sociologiques (le monde des cadres, des professions libérales et des entrepreneurs contre celui des salariés, des fonctionnaires et des ouvriers) et idéologiques (le plan, le travail et le public contre le marché, le capital, le privé). Tout cela est terminé. »
Et il tire les leçons et les conséquences de cette attitude pour notre vie démocratique, notre capacité de faire de la politique et de réaliser les réformes nécessaires pour notre avenir :
« Aujourd’hui, l’élection n’est plus qu’un permis de gouverner. Elle ne tranche rien.
Toutes les questions restent ouvertes : quelle sera la capacité de gouverner ? Quelle sera la majorité ? Quel sera le programme de gouvernement en fonction des attentes sociales ? Les décisions prises seront-elles acceptées par le pays ?
Prenez la réforme des retraites. Beaucoup des gens qui ont voté pour le président sont en désaccord radical avec sa proposition. Il lui faudra trouver une solution. »
Le journaliste qui l’interroge rappelle la promesse de Macron en 2017 de faire reculer l’extrême droite. Manifestement il n’a pas réussi.
Rosanvallon tout en précisant qu’Emmanuel Macron n’est pas le seul responsable, lui attribue quand même une partie de l’échec :
« Le président a incarné jusqu’à la caricature le sentiment de mépris social dont s’est nourri le Rassemblement national.
Marine Le Pen n’a eu de cesse de souligner son « arrogance », ce qui lui a permis d’attirer une partie des classes socialement défavorisées.
La gauche a aussi sa part de responsabilité dans ce basculement des pauvres vers le vote d’extrême droite. Jean-Luc Mélenchon réalise d’excellents scores dans l’ancienne banlieue rouge parce qu’il a compris ce qu’était la réalité des discriminations, fondées sur l’origine et la couleur de peau, dans notre pays. En revanche, il n’a pas réussi à s’adresser aux classes populaires « traditionnelles », issues du monde ouvrier, celles des petites villes ou des campagnes. François Ruffin, lui, a tenté de parler à cette catégorie de la population, à travers son film « Debout les femmes ! », qui raconte le quotidien des aides-soignantes, des personnels de ménage, etc.
Cet effort était exemplaire, mais il est resté relativement isolé au sein de La France insoumise. La gauche n’a pas « abandonné » les classes populaires, comme on l’entend souvent. Il me semble plutôt qu’elle n’a pas trouvé la bonne façon de leur parler. Dire que l’on va augmenter le smic, sans plus, ne répond pas au sentiment d’être méprisé ou déconsidéré, au désir de reconnaissance et de dignité. Tant que l’on parle le langage des statistiques, ça reste abstrait. Tout le monde est scandalisé par l’enrichissement des milliardaires. Mais ce qui révolte le plus les gens, c’est le sentiment de mépris et de supériorité que renvoie cette classe sociale. La démocratie, c’est la capacité de donner un langage à ce que vivent les gens. Certains romanciers, comme Nicolas Mathieu avec « Leurs enfants après eux » et « Connemara », y ont réussi. Ce n’est pas encore le cas de la gauche politique. »
Savoir parler aux gens et aussi les écouter constituent la première action du politique. C’est ce que nos responsables politiques ont de plus en plus de mal à réaliser. Ils « communiquent » et pensent que si les citoyens ne sont pas contents c’est parce qu’on leur a mal expliqué ce qu’on fait.
Et il donne sa vision alternative à l’analyse des trois blocs :
« Non. Il n’y a pas eu, dans cette élection, trois blocs, mais trois personnalités majeures, qui sont d’ailleurs arrivées en tête du premier tour. J’y ajouterais Eric Zemmour, bien sûr, mais aussi Jean Lassalle. Cette mention peut surprendre, mais ce candidat a réussi à convaincre presque autant d’électeurs que le PS et le PCF réunis !
Lui est parvenu à parler de la ruralité en des termes qui ont touché les premiers concernés. Le grand problème des Républicains et des socialistes, c’est tout bêtement que leurs candidats « n’imprimaient » pas. Hidalgo et Pécresse ne savent pas emporter les foules ou tenir en haleine une salle comme peuvent le faire Mélenchon, Macron et même Le Pen. […]. Au-delà de la capacité tribunitienne des uns ou des autres, au-delà même de tout ce que l’on a dit sur le populisme qui consiste à agréger des demandes contradictoires par le pouvoir de la parole, cette suprématie des personnalités est liée au déclin des partis. »
Et il décrit très bien ce qu’est en pratique le Parti du Président : une coquille sans colonne vertébrale, sans doctrine, une simple machine à soutenir les initiatives du chef. Ce qui est aussi le cas des deux autres mouvements qui sont réputés former avec le parti présidentiel la tripartition électorale de la France :
« La République en Marche, ce n’est pas un parti, ce sont les followers d’Emmanuel Macron. Même chose pour La France insoumise qui n’existe qu’à travers son leader. Il n’y a pas de congrès, pas de votes, pas de tendances autorisées à s’exprimer dans ce mouvement qui se qualifie lui-même de « gazeux ». Autrefois, les militants, à partir de la base, élaboraient des idées et choisissaient des personnes pour les représenter. Aujourd’hui, tout part du sommet. »
Et il donne son explication de la montée continuelle de l’extrême droite…
« Elle n’a pas été banalisée, elle s’est métamorphosée. Toute une série de glissements sémantiques a permis d’euphémiser ce qui reste sa matrice : la haine de l’étranger et le déplacement de la question sociale sur le terrain de l’exclusion. […] En surface, Marine Le Pen est parvenue à reformuler, dans le vocabulaire de la souveraineté, bon nombre de thèmes chers à l’anticapitalisme. Son mouvement apparaît désormais comme le pourfendeur de l’individualisme contemporain. […] Bien qu’elle puisse flatter un électorat de gauche, cette conception entraîne une remise en cause des avancées dites « sociétales » – la PMA ou les nouvelles formes de mariage – définies comme des expressions mortifères de l’ultra-individualisme. Le talent de Marine Le Pen est de faire passer ce nationalisme d’exclusion pour un combat anticapitaliste. »
Les élites qui ne savent plus parler le langage des gens, exaspèrent toute une partie des Français. Je me souviens lors du débat de second tour de l’échange entre les deux candidats : Marine Le Pen, de manière assez démagogique, parlait des difficultés et des souffrances des gens humbles. Le Président candidat lui a répondu en disant qu’il menait une politique remarquable et qui fonctionnait, la preuve est la multiplication des licornes en France pendant son quinquennat. Le premier propos était compris, le second paraissait probablement pour beaucoup hors sol et peut être même incompréhensible. Cette distance, ce langage du monde des start up est interprété comme du mépris de classe, créant une haine des élites et du Président qui en est un symbole :
« C’est un phénomène qui me semble important. Valéry Giscard d’Estaing avait pu susciter une forme de détestation, à cause de son élocution et de son côté Louis XV, très monarchique. Nicolas Sarkozy a lui aussi cristallisé des oppositions très virulentes. Mais il y a quelque chose de spécifique dans la haine qui se noue autour d’Emmanuel Macron. Il n’a pourtant pas peur de rencontrer des citoyens qui lui sont très opposés. Peu d’hommes ou de femmes politiques vont même aussi facilement « au contact ». Pourtant il n’y va pas pour les écouter mais pour leur expliquer ! Ce fut la même chose quand il a fait venir des intellectuels à l’Elysée. A l’époque, j’ai refusé de m’y rendre et j’ai eu raison. Ce fut un long monologue : il a invité des philosophes, des économistes, des sociologues pour leur expliquer sa vision politique ! On a sans cesse l’impression que pour lui, la France est une salle de classe, que les gens ne comprennent pas, qu’il faut les prendre par la main et, de temps en temps, leur taper sur les doigts. On touche à un sentiment qui a été le moteur de la Révolution française : celui d’une coupure entre les « manants » et l’« aristocratie » : 1789, ce n’était pas un conflit entre les riches et les pauvres, mais entre ceux qui se sentaient méprisés et ceux qui étaient pris pour méprisant. Partout, on a détruit les blasons des grandes familles, qui symbolisaient cette arrogance, avec l’espoir de faire émerger une « société de semblables » pour reprendre le mot de Tocqueville. Or Emmanuel Macron donne le sentiment que nous ne sommes pas, ou que nous ne sommes plus, une société de semblables. »
Pour Rosanvallon, il est urgent de changer, de revigorer la vie démocratique. Sortir du langage technocratique pour revenir au niveau de la démocratie, c’est-à-dire un monde de semblables, dans lequel même s’il existe des inégalités économiques chacun est considéré avec respect, sa parole prise en compte :
« S’il n’y a pas de concertation et de compromis sous ce nouveau quinquennat, cette distance ressentie par des millions d’électeurs ne peut que s’accentuer. Ce qui se dessine est une société de crise, mais cela ne nous mène pas mécaniquement à la révolution. Les sociologues décrivent aussi des sociétés qui s’effritent et se dissolvent. Pour éviter l’implosion, la gauche doit redevenir le parti de la société des semblables. […]
« Le propre de la démocratie est d’être un principe d’interaction entre les pouvoirs et la société. Il faut que des institutions comme celles dont j’ai parlé fassent vivre ces échanges. C’est ce qui fait la différence entre la démocratie intermittente du suffrage universel et des référendums et la démocratie permanente de l’évaluation et de la délibération. La démocratie est le régime qui oblige en permanence le pouvoir à s’expliquer. […]
on ne peut pas continuer à diriger la société d’en haut en pensant qu’on connaît mieux ses intérêts qu’elle-même. Cela conduirait à la catastrophe. »
L’article de Pierre Rosanvallon est plus large que les seuls extraits que j’en ai tiré : je renvoie vers cet article (pour lequel il faut être abonné) : <L’élection n’est plus qu’un permis de gouverner>
<1674>
- Au centre, un parti de la raison regroupant une grande part « des vieux » et des gagnants de la mondialisation
-
Mardi 31 mai 2022
« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement. !»Article 20 de la ConstitutionMardi 31 mai 2022 est le 97ème jour de la guerre d’agression que la Russie de Poutine a lancé contre son voisin ukrainien.
Mais aujourd’hui, je souhaite parler de la politique française et des élections législatives.
Lors du mot du jour du <8 février 2017>, j’écrivais tout le mal que je pensais de la Vème République et de ses dérives.
Je ne rappellerai pas ici les développements techniques dans lesquels j’expliquai la différence entre un régime présidentiel et un régime parlementaire et les différentes étapes qui ont toujours davantage dégradé les institutions de la Vème République du point de vue démocratique.
Les constitutionnalistes ont coutume de désigner le régime qui est en vigueur en France comme un Régime hybride ou semi présidentiel.
En réalité, il reste quand même fondamentalement parlementaire.
 Et Jean-Luc Mélenchon, a réalisé un coup de génie de stratégie électorale, en demandant aux français de l’élire premier Ministre.
Et Jean-Luc Mélenchon, a réalisé un coup de génie de stratégie électorale, en demandant aux français de l’élire premier Ministre.
C’est totalement disruptif !
Le premier ministre n’est pas élu mais nommé par le Président de la République qui lui est élu.
Mais, dans la 5ème République le Premier Ministre doit disposer de la confiance de l’Assemblée Nationale.
Car comme en dispose l’article 20 de la Constitution : «le Gouvernement est responsable devant le Parlement.»
Le premier ministre étant, bien entendu, le chef du gouvernement.
Cette responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale est définie par l’article 49 de la Constitution et peut prendre trois formes ou procédures : :
- L’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale (article 49, alinéa premier) couramment dénommé « question de confiance » ;
- Le dépôt d’une motion de censure à l’initiative des députés (article 49, alinéa 2) ;
- L’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte (article 49, alinéa 3).
En synthèse :
- La question de confiance
- La motion de censure
- Le 49-3
Les constitutionnalistes savants expliquent que dans notre constitution il faut une double confiance : celle du Président et celle de l’Assemblée Nationale.
Dans une analyse rapide et historique, on pourrait penser qu’il faut surtout la confiance du Président.
Il n’est arrivé dans la Vème République qu’une seule fois, en 1962, que l’Assemblée ait renversé un gouvernement. Le premier ministre d’alors était Georges Pompidou. Le Président de la République, le Général de Gaulle, a alors, comme le lui permettait la constitution, dissout l’Assemblée.
Il y eut donc convocation d’élections législatives. Et le peuple français a voté pour une majorité de députés favorables au Général de Gaulle qui a renommé Pompidou premier Ministre.
C’est bien sûr le Peuple souverain qui a tranché ce différent entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais la résolution de ce conflit semble indiquer qu’il vaut mieux avoir la confiance du Président que de l’Assemblée.
Surtout qu’inversement, il est arrivé à plusieurs reprises, bien que le Premier Ministre ait obtenu peu de temps auparavant la confiance du Parlement que le Président de la République lui demande de démissionner.
Ce fut le cas de Jacques Chaban Delmas « démissionné » par le président Pompidou et Michel Rocard qui subit le même sort du fait du président François Mitterrand.
La situation est très différente, lorsque le peuple français envoie à l’Assemblée Nationale une majorité de députés opposés politiquement au Président de la République.
On appelle cela « la cohabitation » qui est un concept français que les autres régimes parlementaires ne connaissent pas, ne comprennent pas.
Dans toutes les autres démocraties libérales, quand il y a des difficultés pour obtenir une majorité, des partis politiques forment une coalition et un programme de gouvernement.
Bref, ils discutent, se mettent d’accord en toute transparence et appliquent le Programme sur lequel ils se sont mis d’accord.
Donc en France, il se peut que l’on se trouve dans une situation de cohabitation.
La Vème République en a connu trois.
La première en 1986, François Mitterrand était président et la Droite a gagné les élections législatives. Mitterrand a tenté de nommer Giscard d’Estaing, puis Simone Veil mais la majorité Parlementaire exigeait que ce soit son chef, Jacques Chirac qui soit nommé. Et dans ce cas c’est l’Assemblée qui décide, Mitterrand a dû s’incliner et nommer Chirac.
Cinq ans plus tard la Droite a décidé que le Premier Ministre serait Edouard Balladur, le Président Mitterrand du une nouvelle fois s’incliner.
Et en 1997, quand la Gauche gagna les élections après la dissolution provoquée par Chirac, ce dernier nomma sans tergiverser le chef de l’opposition : Lionel Jospin, celui qu’il avait battu deux ans auparavant aux élections présidentielles.
Donc si Jean-Luc Mélenchon a tort de manière formelle : Le premier Ministre n’est pas élu mais nommé. Il a raison en pratique, s’il y avait une majorité de députés de son alliance qui était élu, le Président Macron n’aura d’autres choix que de le nommer.
C’est très habile, car cette manière de s’exprimer permet de mobiliser son camp et probablement d’éviter la forte abstention qui fut la règle lors des élections législatives précédentes : les électeurs des opposants au Président élu s’abstenaient massivement, laissant tranquillement une majorité absolue de candidats de la majorité présidentielle être élue.
Et de cette manière la Vème République s’enfonce toujours davantage dans le déni de démocratie.
Je vais essayer de synthétiser cela en quelques phrases :
- Voilà d’abord un homme élu sans véritable programme, on ne sait pas ce qu’il veut faire : il lance deux ou trois idées, sur lesquels il revient par la suite lors de l’une ou l’autre des campagnes.
- Comme le programme dit « de l’omelette » cher à Alain Juppé a été brillamment réalisé, cet homme apparait comme le seul raisonnable qu’on peut élire. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le programme de l’omelette, je la rappelle. L’échiquier politique est une grande omelette, on coupe les deux bouts et on garde le milieu, « l’extrême centre » sur lequel je reviendrai dans un mot du jour ultérieur.
- Avec cette idée géniale, il n’y a plus d’opposition crédible ou disons il n’y aurait plus d’opposition crédible. Le choix est donc entre un extrême centre rationnel et raisonnable et des opposants irrationnels et déraisonnables.
- Aux élections législatives, les français élisent les femmes et les hommes du président. Leur programme c’est celui du Président qui lui n’en a pas.
- Dans le rêve de ces gens, n’importe qui, même une chèvre désignée comme le représentant du président doit être élu.
- Dans ce cas on n’élit plus des députés mais des délégués qui forment une chambre d’enregistrement. Savez-vous que <la charte de LREM> dispose que «les députés membres et apparentés du Groupe ne cosignent aucun amendement ou proposition de loi ou de résolution issus d’un autre groupe parlementaire». Peut-on être plus sectaire ? Rien de ce que propose l’opposition n’est digne d’intérêt ! D’ailleurs cette règle s’appliquait aussi à l’égard des propositions du MODEM, pourtant dans la majorité présidentielle.
- Dans ce contexte le Président nomme, comme un fait du Prince, un Premier Ministre à sa convenance et qui ne dispose d’aucun poids politique. Il ou elle n’est qu’un simple collaborateur comme le disait Sarkozy déjà
- Le vrai premier ministre est en réalité Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Élysée
- A ce stade, il parait légitime de s’interroger si, en pratique, la séparation des pouvoirs entre le législatif et l’exécutif est encore une réalité. Les décisions essentielles sont prises entre le Président de la République, le secrétaire général de l’Élysée et le cercle rapproché des conseillers.
- Et rappelons que dès lors le pouvoir est détenu par un groupe de gens qui a obtenu 28% des voix exprimés, car désormais déjà au premier tour et encore plus au second tour la plus grande partie du vote n’est plus un vote d’adhésion mais un vote stratégique pour éviter tel ou tel candidat qu’on ne veut pas.
Dés lors comme le fait justement remarquer Jean-Luc Mélenchon, si une majorité indépendante du Président est élue à l’Assemblée c’est le gouvernement et son chef qui est le premier ministre qui déterminent et conduisent la Politique de la France, selon l’article 20 de la Constitution.
Je tiens à préciser que le présent mot du jour ne dit rien du programme préconisé par la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon.
Le seul point qui est développé ici est celui de l’impasse dans lequel nous a mené la Vème République, les modifications qui y ont été apportées, le mode de scrutin qui permet une telle diffraction de la réalité du corps électoral français et la pratique des présidents élus qui semblent ignorer ce que signifie une vraie démocratie et des débats politiques.
Vous pouvez écouter avec beaucoup d’intérêt <Les matins de France Culture du 30 mai> qui explicite une grande partie des développements présentés dans ce mot du jour.
<1673>
- L’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale (article 49, alinéa premier) couramment dénommé « question de confiance » ;
-
Lundi 30 mai 2022
« D’écrire, brusquement, je me suis arrêté !»Réflexions personnelles sur la difficulté d’écrire dans notre monde troublé.Le mardi 22 mars 2022, j’ai posé la plume.
C’est ainsi qu’on aurait pu l’écrire dans les temps anciens, ceux de ma jeunesse.
Poser le clavier, n’a pas de sens, il est toujours posé, surtout quand on l’utilise. Peut-être, « ranger le clavier » pourrait convenir.
Que s’est-il passé, pour que je m’éloigne de ma discipline quotidienne d’écriture du mot du jour ?
Brusquement la guerre d’Ukraine est entrée dans nos vies, dans nos esprits.
Je n’arrivais plus à écrire sur un autre sujet, car celui-ci prenait toute la place.
Suivant cette actualité, je m’efforçais de trouver des éclairages, des analyses qui ne pouvaient se résumer à l’émotion.
L’écriture des derniers mots se terminait au-delà de 1 heure du matin., me laissant exténué et l’esprit de plus en plus embrouillé.
D’écrire je me suis arrêté.
Je tente, aujourd’hui, de reprendre…
Peut être, cela ne sera pas possible tous les jours, si je me retrouve dans une pression comme celle qui a conduit à l’arrêt.
Cette guerre continue.
Ce lundi 30 mai, constitue le 96ème jour de guerre.
L’Ukraine ne s’est pas effondrée comme le pensait les « spécialistes ». Dans le mot du jour, du 25 février je citais des militaires sur France Inter qui prévoyait un effondrement en une semaine.
Le 24 avril 2022, après une visite à Kiev le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin a déclaré :
« Les Ukrainiens peuvent gagner s’ils ont les bons équipements, le bon soutien ! »
Et il a ajouté :
« Nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu’elle ne puisse pas faire le même genre de choses que l’invasion de l’Ukraine. Elle a déjà perdu beaucoup de capacités militaires, et beaucoup de troupes, et nous ne voudrions pas qu’elle puisse rapidement reconstituer ces capacités. »
Et c’est ainsi que <Les Etats-Unis s’apprêtent à débloquer 40 milliards de dollars supplémentaires pour l’Ukraine>
Mais que représente 40 milliards de dollars ?
Je pense que nous pouvons en avoir une idée, en constatant que le budget 2022 de la Défense de la France s’élève à 40,9 milliards (Mds) d’euros (49,6 Md€ pensions incluses).
Nonobstant le taux de change, l’aide américaine est du niveau du budget annuel de la défense française !
A cela s’ajoute l’aide de l’Union européenne et du Royaume Uni.
Bref, l’Ukraine est armée pour ne pas perdre la guerre.
Le secrétaire à la défense américaine parle même de victoire. Sur certains terrains, comme celui de Kharkiv, l’infanterie et l’artillerie ukrainienne ont fait reculer l’armée russe.
Mais la réalité du terrain c’est que la Russie progresse, s’empare de villes après les avoir détruites avec des bombardements et des missiles, car elle conserve la maîtrise des airs.
 Par exemple, la ville de Sievierodonetsk dans le Donbass est en train de connaître le sort qu’avant la ville de Marioupol avait connu. Le maire de Sievierodonetsk, <Oleksandr Stryuk> a déclaré qu’au moins 1 500 personnes avaient été tuées dans sa ville et qu’il en restait environ 12 000 à 13 000 dans la ville, où il a déclaré que 60% des bâtiments résidentiels avaient été détruits. C’est une ville qui comptait, avant l’offensive russe, plus de 100 000 habitants.
Par exemple, la ville de Sievierodonetsk dans le Donbass est en train de connaître le sort qu’avant la ville de Marioupol avait connu. Le maire de Sievierodonetsk, <Oleksandr Stryuk> a déclaré qu’au moins 1 500 personnes avaient été tuées dans sa ville et qu’il en restait environ 12 000 à 13 000 dans la ville, où il a déclaré que 60% des bâtiments résidentiels avaient été détruits. C’est une ville qui comptait, avant l’offensive russe, plus de 100 000 habitants.Le prix à payer pour les russes est énorme.
Mais dans ce podcast de Slate : «Vladimir Poutine n’a pas fait son deuil de prendre Kiev» Jean-Marie Colombani et Alain Frachon rappellent que les russes ont une réserve d’hommes beaucoup plus importante que les ukrainiens.
Et que surtout : Poutine reprend une tradition russe ou soviétique : la vie de ses soldats n’a pas beaucoup de prix.
Il faut rappeler ce que fut la victoire, lors de la seconde guerre mondiale, de l’armée rouge sur l’armée nazi. Ce fut une grande victoire de l’armée rouge et une défaite des armées allemandes, mais <Wikipedia> nous informe que si les pertes de l’armée allemande étaient de 890 000 hommes, 1 100 000 avec ses alliées, en face les vainqueurs, les soviétiques en comptaient 4 980 000, plus de quatre fois plus.
Ce qui a fait dire à certains que les allemands gagnaient la guerre en faisant couler le sang des autres, alors que les russes gagnaient la guerre en faisant couler le sang de ses propres soldats. Ce n’est pas le génie de Staline, comme l’affirmait l’esprit égaré du candidat communiste à l’élection présidentielle française, qui a gagné la guerre, mais bien le courage des soldats de l’armée rouge qui offraient, sans compter, leur vie à la victoire finale.
Dans ces conditions les russes peuvent-ils perdre ?
En outre, la Russie est une puissance nucléaire, disposant d’armes de destructions massives et Poutine dans son égo, dans sa manière de gouverner et sa relation avec le peuple russe, ne peut pas accepter la défaite.
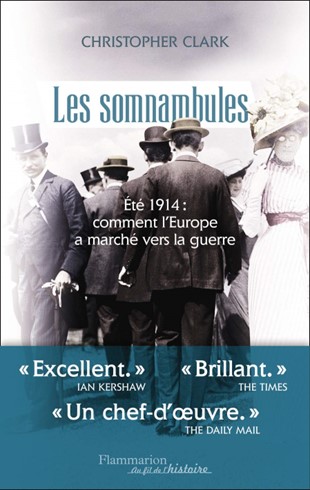 Dès lors la crainte exprimée par Henri Guaino: «Nous marchons vers la guerre comme des somnambules» ne peut que nous inquiéter.
Dès lors la crainte exprimée par Henri Guaino: «Nous marchons vers la guerre comme des somnambules» ne peut que nous inquiéter.
Il emprunte cette image au titre du livre de l’historien australien Christopher Clark sur les causes de la Première Guerre mondiale : «Les Somnambules, été 1914: comment l’Europe a marché vers la guerre. »« Le déclenchement de la guerre de 14-18,écrit-il, n’est pas un roman d’Agatha Christie (…) Il n’y a pas d’arme du crime dans cette histoire, ou plutôt il y a en a une pour chaque personnage principal. Vu sous cet angle, le déclenchement de la guerre n’a pas été un crime, mais une tragédie.»
En 1914, aucun dirigeant européen n’était dément, aucun ne voulait une guerre mondiale qui ferait vingt millions de morts mais, tous ensemble, ils l’ont déclenchée. Et au moment du traité de Versailles aucun ne voulait une autre guerre mondiale qui ferait soixante millions de morts mais, tous ensemble, ils ont quand même armé la machine infernale qui allait y conduire.
Alors il faut des négociations.
Mais même cette porte de sortie n’est pas satisfaisante.
L’arrêt des combats aura pour conséquence de figer l’avancée des troupes russes.
Et c’est exactement la manière de faire de Poutine : il avance, quand il y a trop d’obstacles, il s’arrête et attend. Et puis dès qu’il peut, il avance à nouveau. Jamais il ne recule.
Et on apprend aussi, que sur les territoires conquis, le maître du Kremlin fait pratiquer des <déportations massives> :
« Selon le Pentagone, qui confirme des accusations de Kiev, plus d’un million de civils auraient été «envoyés en Russie contre leur gré». Une telle déportation de population serait contraire aux conventions de Genève. Moscou avance des chiffres analogues, mais parle «d’évacuations». Des Ukrainiens ont été «envoyés contre leur gré en Russie», a annoncé ce lundi le porte-parole du Pentagone au cours de sa conférence de presse quotidienne. […] Cette déclaration, basée sur les informations des services de renseignement américains, confirme, au moins en partie, les accusations portées par Kiev depuis plusieurs semaines. Selon la responsable ukrainienne Lioudmila Denissova, «plus de 1,19 million de nos citoyens, y compris plus de 200.000 enfants, ont été déportés vers la Fédération de Russie»».
Il n’y a pas de bonne fin envisageable à cette guerre qui aura des conséquences considérables sur notre vie des prochains mois et probablement des prochaines années.
<1672>
-
Mercredi 23 mars 2022
« Kharkiv »Le mot du jour est suspenduUne autre ville martyr d’Ukraine Kharkiv avant : Il y avait une invitation touristique pour s’y rendre : https://planetofhotels.com/guide/fr/ukraine/kharkiv

Je redonne le lien vers ces deux documentaires sur Poutine :
<Poutine, l’irrésistible ascension – ARTE> Documentaire de Vitaly Mansky (Suisse, 2018, 1h35mn)
En 2000, un documentariste russe filme de l’intérieur la première année au pouvoir de Vladimir Poutine. Près de vingt ans plus tard, Vitaly Mansky, désormais exilé, remonte ses archives et en propose une relecture critique.
Pour Vitaly Mansky, tout était là, à portée de main. Il suffisait de décrypter un matériau qui annonçait déjà, en 2000, le futur de la Russie. À travers ses séquences dans l’intimité du pouvoir, ses tête-à-tête avec le nouveau maître du Kremlin et des moments apparemment anodins, c’est tout simplement le basculement dans un régime totalitaire qu’il nous montre. Vladimir Poutine s’y révèle déjà secret et cynique, et semble prêt à tout pour consolider sa mainmise sur le pays, pendant que l’on assiste aussi, en privé, à l’affaiblissement physique de Boris Eltsine. À partir de ses propres images et d’archives publiques ou privées, le documentariste écrit à la première personne un roman politique singulier, dont personne, à l’heure actuelle, ne sait encore comment il se terminera.
<Le mystère Poutine : Un espion devenu président> Documentaire (2016, 1h42mn) réalisé par Christophe Widemann et présenté par Laurent Delahousse.
<Mot du jour sans numéro>
-
Mardi 22 mars 2022
« Marioupol »Un jour sans mot du jour nouveauÉtienne Klein a publié une photo de Marioupol avant :

Je pense qu’il n’est pas utile de publier des photos de Marioupol aujourd’hui, on en trouve partout à la télévision, sur le Web, dans les journaux.
Le mot du jour se met en pause pour quelques jours, pour penser à autre chose, pour prendre du recul.
J’avais regardé avec un grand intérêt ces deux documentaires sur Poutine :
<Poutine, l’irrésistible ascension – ARTE> Documentaire de Vitaly Mansky (Suisse, 2018, 1h35mn)
En 2000, un documentariste russe filme de l’intérieur la première année au pouvoir de Vladimir Poutine. Près de vingt ans plus tard, Vitaly Mansky, désormais exilé, remonte ses archives et en propose une relecture critique.
Pour Vitaly Mansky, tout était là, à portée de main. Il suffisait de décrypter un matériau qui annonçait déjà, en 2000, le futur de la Russie. À travers ses séquences dans l’intimité du pouvoir, ses tête-à-tête avec le nouveau maître du Kremlin et des moments apparemment anodins, c’est tout simplement le basculement dans un régime totalitaire qu’il nous montre. Vladimir Poutine s’y révèle déjà secret et cynique, et semble prêt à tout pour consolider sa mainmise sur le pays, pendant que l’on assiste aussi, en privé, à l’affaiblissement physique de Boris Eltsine. À partir de ses propres images et d’archives publiques ou privées, le documentariste écrit à la première personne un roman politique singulier, dont personne, à l’heure actuelle, ne sait encore comment il se terminera.
<Le mystère Poutine : Un espion devenu président> Documentaire (2016, 1h42mn) réalisé par Christophe Widemann et présenté par Laurent Delahousse.
<Mot du jour sans numéro>
-
Lundi 21 mars 2022
« Les occidentaux ne peuvent malheureusement pas se réclamer du camp du bien. »Réflexions personnellesLundi 21 mars 2022 est le 26ème jour de la guerre d’agression que la Russie de Poutine a lancé contre son voisin ukrainien.
C’est un acte de barbarie et de violence qui ne peut trouver ni excuse, ni de justification.
De ci de là, je lis et j’entends des émissions qui évoquent sérieusement la possibilité de traduire Poutine devant la Cour Pénale Internationale de La Haye qui est la juridiction pénale internationale permanente à vocation universelle, chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité, de crime d’agression et de crime de guerre
Quand ce sont des gens sérieux, ce qui n’est pas toujours le cas, ils expliquent que la CPI est une institution qui ne peut juger que les ressortissants des États qui ont reconnu sa compétence, ce qui n’est pas le cas de la Russie, ni des États-Unis d’ailleurs.
A ce stade, il faut hélas reconnaître que la position de l’Occident est très fragilisée par ses immenses manquements passés. Et qu’avant de vouloir traduire Poutine, devrait se présenter dans le couloir qui mène au Tribunal International Georges W Busch.
Celles et ceux qui ont un peu de mémoire se souvienne de ce 5 février 2003 où lors d’une session du Conseil de sécurité des Nations unies,
 le secrétaire d’État américain, Colin Powell, a apporté et présenté un petit flacon, en prétendant que celui-ci contenait une arme biologique qui faisait partie du stock d’armes de destruction massive dont disposait l’Irak de Saddam Hussein.
le secrétaire d’État américain, Colin Powell, a apporté et présenté un petit flacon, en prétendant que celui-ci contenait une arme biologique qui faisait partie du stock d’armes de destruction massive dont disposait l’Irak de Saddam Hussein.
Et en ajoutant que l’Irak constituait un danger pour les États-Unis et le Monde, il prétendait qu’il fallait attaquer l’Irak.
La France présidée par Jacques Chirac s’était fermement opposée à la volonté américaine en affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de l’existence de ces armes de destruction massive.
On parle aujourd’hui de folie de Poutine.
Mais comment analyser ce geste d’emmener dans un simple flacon dans l’enceinte des Nations Unies une arme biologique de destruction massive ?
Probablement, et on ose l’espérer, il n’y avait rien de nocif dans ce flacon.
Mais, il s’agissait alors d’une manipulation qui n’a rien à envier aux manœuvres de Poutine.
Et puis comprenant que La France, la Russie et la Chine, trois membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, utiliseraient leur droit de veto pour empêcher que l’ONU n’approuve l’intervention armée contre l’Irak, les États-Unis et leurs alliés ont lancé l’assaut sur l’Irak le 20 mars 2003, sans l’aval du Conseil de Sécurité.
C’était donc une guerre illégale au même titre que celle lancée par Poutine contre l’Ukraine.
Les États-Unis ont commencé alors l’invasion de l’Irak par un bombardement intensif des villes irakiennes.
Personne n’a demande alors de sanctions économiques contre les USA !
Nous le savons aujourd’hui et la CIA l’a reconnu : il n’y avait pas d’armes de destruction massive en Irak.
Cette guerre a entrainé des centaines de milliers de morts.
Elle a conduit, suite à des décisions toujours plus désastreuses de l’administration américaine, à la création et à l’expansion de DAESH réunion de la folie messianique de fous d’Allah et de la folie destructrice d’officiers de l’armée de Saddam Hussein scandalisés d’avoir été rejetés en marge de la société irakienne et d’être la proie des persécutions de la majorité chiite ayant pris le pouvoir grâce à l’appui de l’armée américaine.
On reproche, à juste titre, à Poutine d’utiliser une milice privée pour ses basses œuvres : les mercenaires Wagner.
Mais, l’Amérique de Bush a aussi plusieurs longueurs d’avance sur cette dérive poutinienne.
En Irak, les armées privées étaient plus nombreuses que l’armée régulière américaine.
Une société de mercenaires était particulièrement présente : Blackwater qui s’appelle désormais <Academi>..
Dans l’article de Wikipedia auquel je renvoie, il est précisé que les contrats entre les Etats-Unis et Blackwater « sont alors facilités par les nombreux liens d’Erik Prince avec les néoconservateurs de l’administration Bush, comme A. B. Krongard (en), directeur exécutif et numéro 3 de la CIA, qui signe avec Blackwater des contrats pour la protection de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan. L’ancien directeur du centre anti-terroriste de la CIA Cofer Black (en) a rejoint Blackwater en 2005 ».
Et puis à côté de dérapages non ou moins documenté, on peut lire cet épisode :
« Le 16 septembre 2007, des membres de Blackwater ouvrent le feu à la mitrailleuse et jettent des grenades sur un carrefour très fréquenté de Bagdad, alors qu’ils circulaient en véhicules blindés. La fusillade fait au moins 13 morts et 17 blessés, dont des femmes et des enfants. La porte-parole de Blackwater, Anne Tyrrell, déclarent que « les employés [avaient] agi conformément à la loi en réponse à une attaque » et que « les civils sur lesquels il aurait été fait feu étaient en fait des ennemis armés et nos employés [avaient] fait leur travail pour défendre des vies humaines », une version qui sera contredite par les témoignages et les procureurs américains. Le porte-parole du ministère irakien de l’Intérieur, Abdul-Karim Khalaf, déclare que « le fait d’être chargé de la sécurité ne les [autorisait] pas à tirer sur les gens n’importe comment ». […] Le quotidien suisse Le Temps résume ainsi la fusillade : « La balle a traversé la tête de Haithem Ahmed. Pas de coup de semonce préalable, pas de tension particulière à Bagdad, mais ce projectile qui a tué instantanément l’Irakien alors qu’il circulait dans une voiture aux côtés de sa mère. Le conducteur mort, le véhicule s’emballe. Et les mercenaires de Blackwater aussi : ils arrosent de centaines de balles la place Nissour, noire de monde, où les passants tentent désespérément de se mettre à l’abri. Des grenades sont lancées, et les hélicoptères des gardes privés interviennent rapidement pour achever le travail. Bilan : au moins 17 civils irakiens tués, 24 blessés ».
Le 1er octobre 2007 un rapport de la Chambre des représentants des États-Unis est publié dans lequel est recensé, durant la période allant du 1er janvier 2005 au 12 septembre 2007, 195 fusillades impliquant Blackwater et dans 163 cas, les employés de Blackwater ont tiré les premiers. Tous ces crimes sont restés impunis, certains mercenaires ont été licenciés.
Il y avait deux autres sociétés militaires privées : DynCorp et Triple Canopy, Inc. qui étaient présentes en Irak, mais Blackwater a été à l’origine de plus de fusillades que les deux autres sociétés réunies.
La société militaire Wagner n’est donc qu’une copie d’exemples fournis par l’Occident.
On cite comme première <Société militaire privée> une société sud-africaine puis une britannique :
« Une des premières sociétés privées d’intervention fut Executive Outcomes en Afrique du Sud, qui s’est scindée en plusieurs organisations à la fin des années 1990. Au Royaume-Uni, la plus connue est Sandline International qui offrait dès les années 1990 une large gamme de services allant de l’entraînement de troupes au maintien ou à la restauration de la sécurité. Leur poids croissant laisse à penser qu’elles vont devenir des acteurs stratégiques à part entière dans les grands conflits contemporains, pouvant orienter les décisions militaires et poursuivre quelquefois des objectifs différents de ceux des États »
Et puis toujours en Irak, il y eut le <scandale de la prison d‘Abou Ghraib> lors duquel les occidentaux se réclamant de la défense des droits de l’homme se sont comportés en tortionnaires sadiques.
Il y eut encore la création du <Camp de Guantanamo > qui avait pour objet de sortir des prisonniers des États-Unis de l’état de droit, des droits de la défense.
On parle de corruption en Russie et des oligarques russes qui ont des comportements de parrains mafieux. C’est parfaitement exact. Mais reprenons les États-Unis en Irak. Le vice président de Geors W Busch était Donald Rumsfeld. De 1995 à 2000, ce dernier dirige la société d’ingénierie civile Halliburton spécialisée dans l’industrie pétrolière. Cette société a décroché de gros contrats en Irak en 2003. Des journalistes lui ont fortement reproché ce conflit d’intérêt, sans aucune conséquence pratique.
Quelques années auparavant, la guerre du Vietnam a été la plus grande guerre chimique de l’Histoire. Des millions de morts, plus les milliers de malades dus aux troubles génétiques entraînés par les armes qui ont été utilisées.
J’ai beaucoup parlé des États-Unis qui occupent incontestablement la première place dans ce classement des comportements monstrueux en temps de guerre.
Mais la France n’a pas été en reste pendant la guerre d’Algérie qu’on évoque actuellement en raison des accords d’Évian du 18 mars 1962 et beaucoup plus récemment lors de la guerre déclarée en Libye pour chasser le dictateur Khadafi en violation de la Loi internationale et en entrainant aussi une situation chaotique comme en Irak.
Il y aurait encore tant d’histoires à raconter. Tout cela pour conclure que l’Occident est peu crédible quand elle entend donner des leçons morales à la planète entière.
Probablement que cette distanciation entre les principes affichés et la réalité des actions devient de plus en plus insupportable à une grande partie des États du monde non occidental.
C’est probablement une des principales raisons qui peut expliquer les nombreuses abstentions lors de l’Assemblée générale de l’ONU visant à condamner l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Comme le montre ce planisphère produit par « Le Un Hebdo»
Ces contradictions des occidentaux sont largement développées par Pierre Conesa dans une interview de Thinkerview : <Comment arrive -t-on à la guerre ? >
Tout cela n’enlève rien aux crimes de Poutine, mais rend la voix des occidentaux moins crédible.
<1671>
-
Vendredi 18 mars 2022
« Soldats russes, redevenez des hommes. […] Ce que vous avez devant vous en [Ukraine], ce n’est pas l’ennemi, c’est l’exemple. »Victor Hugo en 1863, avec cette différence que le rôle de l’Ukraine était tenu par la PologneLe vendredi 18 mars est le 23ème jour de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine
« Le Un Hebdo » qui ne traite que d’un sujet par numéro, a consacré ses quatre derniers numéros à cette guerre.
Dans le numéro 388 du 16 mars : « Jusqu’où la guerre ? » Éric Fottorino commence son réquisitoire par ces mots :
« Images de détresse, de ruines, de cratères vertigineux, de corps sans vie. En contrechamp, Poutine reste droit dans sa lâcheté, violant toutes les règles de la paix sans personne pour le défier autrement qu’avec des mots et des atteintes au portefeuille. Alors, sur qui la population d’Ukraine sacrifiée sous nos yeux peut-elle compter pour que le cauchemar s’arrête, face à un tyran qui fait mine de négocier, mais ne feint jamais de tuer ? Si l’Europe a constitué un front uni de désaveu, de sanctions, de soutien armé aux Ukrainiens, les agressés restent bien seuls pour défendre leur patrie. »
Et il le finit par cette histoire :
« Une dessinatrice ukrainienne, Anna Sarvira, s’étonnait ces jours-ci sur Instagram qu’on lui demande : pourquoi ne pas vous rendre, pour sauver le plus de vies possibles ? Se rendre ?
Jamais, a-t-elle répondu. Poser cette question, c’est ignorer ce que signifie vivre sous le joug russe. « Comme obliger une victime à vivre avec son violeur », dit-elle.»
André Markowicz qui est traducteur des grands écrivains russes, dans son article : <Le plus vil des autocrates> enterre définitivement cette fable que l’Ukraine serait un pays néo nazi, absurdité relayée par tous les français naïfs, sous influence de la propagande poutinienne :
« Oui, il y avait des tensions nationalistes en Ukraine, et oui, l’Ukraine avait adopté des « lois mémorielles » inacceptables, qui punissaient quiconque disait que les nationalistes ukrainiens, pendant la guerre, avaient été alliés aux nazis – ce qu’ils ont été. Mais, aujourd’hui, le jeu démocratique fait que les extrémistes nationalistes, en Ukraine, étaient réduits à 2 ou 3 % du corps électoral (ce qui laisse rêveur quand on regarde les 35 % d’électeurs qui, chez nous, s’apprêtent à voter Zemmour ou Le Pen). Et, oui, ce qui se forgeait en ce moment, en Ukraine, était une société démocratique. Elle se forgeait, très vite, sur un système hérité du soviétisme, sur la corruption, l’incompétence, malgré l’héritage et voisinage catastrophiques de la Russie poutinienne. Et si Poutine est intervenu, ce n’est pas pour « sauver » le Donbass, mais parce qu’il ne pouvait pas admettre la réussite, même partielle, d’une démocratie à ses frontières. »
Et j’ajoute que parce que l’extrême droite était réduite à 3 % du corps électoral, elle n’a pas atteint le seuil nécessaire pour figurer au Parlement. Le Parlement actuel de l’Ukraine est vierge de toute extrême droite.
Mais le rejet le plus fort de ce crime en train de se réaliser n’est-il pas atteint par la dérision et l’ironie que dégage l’article de Robert Solé :
<Le mot de…[Guerre]>
C’est un gros mot, et je vous rappelle que notre président Vladimir Vladimirovitch Poutine (que Dieu le garde !) ne supporte pas les mauvaises manières. Ici, en Russie, qualifier de guerre l’opération militaire spéciale en Ukraine vous conduit directement en prison. Il y a en effet des limites à l’incorrection ! Je dirais même des limites à l’absurdité. Réfléchissez : comment la Russie pourrait-elle faire la guerre à l’Ukraine alors que l’Ukraine fait partie de la Russie ? Un pays peut-il se retourner contre lui-même ?
Il faut faire la guerre, sans cesse, aux mots inexacts. Nos frappes, honteusement qualifiées de bombardements par les agresseurs occidentaux, sont millimétrées. Nos militaires travaillent comme des chirurgiens, des joailliers.
Les nazis au pouvoir à Kiev réclament des couloirs d’évacuation pour les civils qui tentent de fuir leur tyrannie. Le président Poutine, qui est un humaniste, a proposé, lui, des corridors humanitaires. Lesquels ne conduiraient pas ces malheureux réfugiés dans l’enfer occidental, mais bien à l’abri, en Russie ou en Biélorussie. Cela a été scandaleusement refusé.
Avec courage et détermination, malgré le déluge de feu qui s’abat sur eux, nos véhicules motorisés avancent vers Kiev. Les habitants de la ville, qui font le siège des fleuristes, attendent leurs libérateurs avec une excitation grandissante.
Où va s’arrêter l’agression de l’Otan ? Vladimirovitch Poutine (que Dieu le garde à la présidence jusqu’en 2036 !) démontre depuis vingt-cinq ans qu’il est un homme de paix, un pacifiste. Mais si l’on s’obstine à le violenter, je vous le dis : de guerre lasse, il sera contraint de faire la guerre. »
La Russie aujourd’hui, l’Union Soviétique hier et… L’Empire russe avant est une dangereuse récidiviste qui a l’habitude d’attaquer, massacrer et soumettre ses voisins.
En 1863, la Pologne n’existait plus. Elle avait été dépecée entre la Prusse, l’Empire d’Autriche Hongrie et pour sa plus grande part l’Empire Russe. J’avais narré cette histoire lors de la série sur la grande guerre, dans le mot du jour du <15 novembre 2018>
Mais le sentiment national polonais existait même en l’absence d’État et <en janvier 1863>, la nation polonaise s’est révoltée contre le Tsar qui a envoyé son armée écraser la Pologne.
Le rédacteur d’un journal polonais, Alexandre Herzen a écrit à Victor Hugo : « Grand frère, au secours ! Dites le mot de la civilisation. »
Et Victor Hugo a répondu !
Et ce texte, si on remplace Pologne par Ukraine, polonais par ukrainien et Varsovie par Kiev, pourrait quasi être écrit aujourd’hui :
« À L’ARMÉE RUSSE
Soldats russes, redevenez des hommes.
Cette gloire vous est offerte en ce moment, saisissez-la.
Pendant qu’il en est temps encore, écoutez :
Si vous continuez cette guerre sauvage ; si, vous, officiers, qui êtes de nobles cœurs, mais qu’un caprice peut dégrader et jeter en Sibérie ; si, vous, soldats, serfs hier, esclaves aujourd’hui, violemment arrachés à vos mères, à vos fiancées, à vos familles, sujets du knout, maltraités, mal nourris, condamnés pour de longues années et pour un temps indéfini au service militaire, plus dur en Russie que le bagne ailleurs ; si, vous qui êtes des victimes, vous prenez parti contre les victimes ; si, à l’heure sainte où la Pologne vénérable se dresse, à l’heure suprême ou le choix-vous est donné entre Pétersbourg où est le tyran et Varsovie où est la liberté ; si, dans ce conflit décisif, vous méconnaissez votre devoir, votre devoir unique, la fraternité ; si vous faites cause commune contre les Polonais avec le czar, leur bourreau et le vôtre ; si, opprimés, vous n’avez tiré de l’oppression d’autre leçon que de soutenir l’oppresseur ; si de votre malheur vous faites votre honte ; si, vous qui avez l’épée à la main, vous mettez au service du despotisme, monstre lourd et faible qui vous écrase tous, russes aussi bien que polonais, votre force aveugle et dupe ; si, au lieu de vous retourner et de faire face au boucher des nations, vous accablez lâchement, sous la supériorité des armes et du nombre, ces héroïques populations désespérées, réclamant le premier des droits, le droit à la patrie ; si, en plein dix-neuvième siècle, vous consommez l’assassinat de la Pologne, si vous faites cela, sachez-le, hommes de l’armée russe, vous tomberez, ce qui semble impossible, au-dessous même des bandes américaines du sud, et vous soulèverez l’exécration du monde civilisé ! Les crimes de la force sont et restent des crimes ; l’horreur publique est une pénalité.
Soldats russes, inspirez-vous des polonais, ne les combattez pas.
Ce que vous avez devant vous en Pologne, ce n’est pas l’ennemi, c’est l’exemple.
VICTOR HUGO.Hauteville-House, 11 février 1863.
« À l’armée russe » in Œuvres complètes de Victor Hugo, Actes et paroles, II, Pendant l’exil, 1852-1870, Paris, Hetzel et Quantin, 1883, pp. 323-324.<1670>
-
Jeudi 17 mars 2022
« Profits et pertes : les spéculateurs de la crise et du chaos »Documentaire de Rupert Russe (Royaume-Uni, 2019, 1h22mn)Le jeudi 17 mars est le 22ème jour de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine
 Le 17 mars est aussi un jour particulier : il y a deux ans nous commencions le premier confinement pour lutter contre la COVID19.
Le 17 mars est aussi un jour particulier : il y a deux ans nous commencions le premier confinement pour lutter contre la COVID19.
Nous espérions, il y a deux ans, que le confinement ne dure pas trop longtemps. Mais nous ne pensions pas que lorsque la pandémie deviendrait moins prégnante, l’autocrate du Kremlin engagerait une guerre dont nous ne savons pas aujourd’hui où elle nous mènera.
J’ai regardé avec un grand intérêt le THEMA d’Arte, le 15 mars.
D’abord le documentaire sur le Président Zelenski : <Zelensky, l’homme de Kiev> qui montre l’évolution de cet homme, sa part d’ombre et aujourd’hui sa part de lumière, parce qu’il a su se hisser à la hauteur des évènements et faire face.
Ce documentaire a été suivi par un autre : <Profits et pertes : les spéculateurs de la crise et du chaos> dans lequel on voit les dégâts et conséquences de la financiarisation du monde.
Il établit ce lien étroit entre quelques traders qui, comme, dans un jeu vidéo, spéculent sur les matières premières, installés tranquillement devant leur écran d’ordinateur et la conséquence qui peut être la hausse des prix de l’énergie, du blé ou d’autres choses vitales pour les humains.
Alors dans des pays pauvres, le prix des aliments devient si cher qu’il y a des émeutes de la faim et des morts.
Les terres dont veut s’emparer Poutine sont riches de matières premières, Le documentaire laisse entendre que si Poutine parle d’Histoire qu’il raconte à sa façon, il pense peut-être aux ressources naturelles de l’Ukraine.
Le Monde pose aussi cette question : <La Russie envahit-elle l’Ukraine pour ses ressources naturelles ?>
Cet article qui détaille les ressources de l’Ukraine qui sont importantes ne semble cependant pas répondre positivement à la question introductive :
« Les ressources de l’Ukraine ne constituent pas en soi un intérêt décisif qui motiverait une invasion, car leur part dans la production mondiale demeure minime par rapport à d’autres producteurs. « Cet intérêt est encore moins stratégique pour un pays comme la Russie aussi riche en matières premières, et qui avait des échanges commerciaux avec l’Ukraine qui lui permettait d’acquérir ces ressources », avance Pierre Laboué. Mais dans un contexte de sanctions, ajoute-t-il toutefois, la maîtrise de certaines de ces ressources peut présenter un intérêt tactique : « Les marchés dont l’équilibre offre-demande est déjà tendu peuvent surréagir à la moindre tension supplémentaire, ce qui renforce le pouvoir de marché de la Russie. Avec le risque de récession de l’économie russe suite aux sanctions, tout bonus est bon à prendre. »
 Mais ce documentaire est très intéressant surtout par ce qu’il montre que très souvent la fluctuation des cours qui peut avoir des conséquences graves pour des populations entières est déconnectée de la réalité physique et de la disponibilité de ces matières physiques. Les fluctuations s’expliquent alors par l’action des spéculateurs mus par l’appât du gain. De plus en plus souvent ce ne sont même plus des humains qui spéculent mais des algorithmes qui traitent des millions d’informations.
Mais ce documentaire est très intéressant surtout par ce qu’il montre que très souvent la fluctuation des cours qui peut avoir des conséquences graves pour des populations entières est déconnectée de la réalité physique et de la disponibilité de ces matières physiques. Les fluctuations s’expliquent alors par l’action des spéculateurs mus par l’appât du gain. De plus en plus souvent ce ne sont même plus des humains qui spéculent mais des algorithmes qui traitent des millions d’informations.
En revanche, ce ne sont pas les algorithmes qui encaissent les profits réalisés.
ARTE présente ainsi ce documentaire :
« Du Venezuela à l’Irak, enquête sur les ravages causés par les spéculations sur les matières premières dans un marché mondialisé. Les éclairages d’économistes de premier plan comme Jeffrey Sachs ou le prix Nobel Joseph Stiglitz permettent de mieux appréhender les mécanismes et les conséquences de montages financiers dictés par la seule loi du profit. Pain, eau, carburant… : pour une part croissante de la population mondiale, notamment en Amérique latine, en Asie ou en Afrique, des hausses de prix vertigineuses rendent de plus en plus inabordables ces biens de première nécessité.
Avec les guerres et le changement climatique, l’impossibilité d’accéder au minimum vital constitue désormais l’une des premières causes de migration sur la planète et le facteur aggravant de conflits armés. Ces brutales augmentations du coût de la vie trouvent souvent leur origine dans de nouvelles formes de spéculation sur les matières premières, qui créent à l’échelle mondiale des mouvements de prix totalement déconnectés des marchés locaux – un « effet papillon » dévastateur.
Du Venezuela à l’Irak en passant par le Kenya ou le Guatemala, pays violemment touchés par le phénomène, cette enquête explore les ravages de ces inflations incontrôlées en remontant jusqu’aux places boursières où se nouent les guerres des prix. »
Je redonne le lien : <Profits et pertes : les spéculateurs de la crise et du chaos>.
<1669>
-
Mercredi 16 mars 2022
« La manière dont [Poutine] s’y prend est inspirée du modèle hitlérien. !»Elie BarnaviLa guerre déclenchée par Poutine a commencé le jeudi 24 février.
Le mercredi 16 mars est le 21ème jour de guerre
Souvent, je pense que le comportement de Poutine ressemble à celui d’Hitler.
Mais il est difficile de faire appel à ce moment de l’histoire à cause du « Point godwin » que j’avais développé lorsque certains comparaient la victoire des écologistes aux municipales de Lyon avec l’arrivée de Hitler au pouvoir.
Toutefois, Elie Barnavi, l’historien qui a aussi été ambassadeur d’Israël en France, a fait cette comparaison dans <les matins de France Culture du 15 mars>
C’est à peu près vers 25 mn :
« Il y a la pure agression d’un pays contre son voisin parce qu’il estime que l’existence de son voisin n’est simplement pas légitime.
Il essaie de l’avaler.
On a à faire à quelque chose qu’on n’a pas vu en Europe depuis la seconde guerre mondiale.
Cela me parait comme une resucée du nazisme en quelque sorte.
Si on comparait les actions de Poutine à ce qu’a fait Hitler, – on dit Hitler et on pense à Auschwitz – mais il y a le Hitler du coup de force, du coup de poing, des provocations et des mensonges.
On est exactement dans le même type de comportement.
Il est lui-même d’ailleurs ironique, il traite les ukrainiens de nazisme, alors qu’il est entrain de se comporter exactement de la même manière.
Je ne pense pas que cela va aboutir aux chambres à gaz, mais je pense que la manière dont il s’y prend est inspiré du modèle hitlérien. »
C’est en effet, en dehors du génocide, une action qu’on peut comparer au modèle hitlérien :
- Comme Hitler il considère inacceptable que des russes se trouvent dans des régions qui ne sont pas en Russie. Situation qui a fait suite à l’effondrement de l’Union Soviétique. Pour Hitler c’était la paix de Versailles, il a commencé par annexer l’Autriche puis il s’est attaqué à la Tchécoslovaquie en raison de la région des Sudètes qui comptait une majorité d’allemands.
- Comme Hitler il ment de manière inimaginable. Son armée bombarde une maternité, on voit des mères enceintes qui doivent fuir l’établissement et certaines vont mourir. Ses sycophantes, comme les appelle Barnavi, prétendent que la maternité de Marioupol était une base de la milice d’extrême droite Azov.
- Il installe en Russie un outil de propagande comme les nazis et tous les russes doivent reprendre exactement le récit gouvernemental sous peine d’être arrêtés et condamnés jusqu’à 15 ans de prison.
- Tous les médias sont contrôlés par le gouvernement, les autres sont fermés. Il tente même de fermer tous les réseaux sociaux qui peuvent être divergents.
Par rapport à Hitler, il y a le génocide en moins et l’arme nucléaire en plus.
<1668>
- Comme Hitler il considère inacceptable que des russes se trouvent dans des régions qui ne sont pas en Russie. Situation qui a fait suite à l’effondrement de l’Union Soviétique. Pour Hitler c’était la paix de Versailles, il a commencé par annexer l’Autriche puis il s’est attaqué à la Tchécoslovaquie en raison de la région des Sudètes qui comptait une majorité d’allemands.
-
Mardi 15 mars 2022
« Un dessin de Plantu »Un jour sans mot du jour nouveauUn simple dessin.
Mais un dessin de Plantu
Merci à François qui a attiré mon attention sur ce dessin et merci à Plantu :
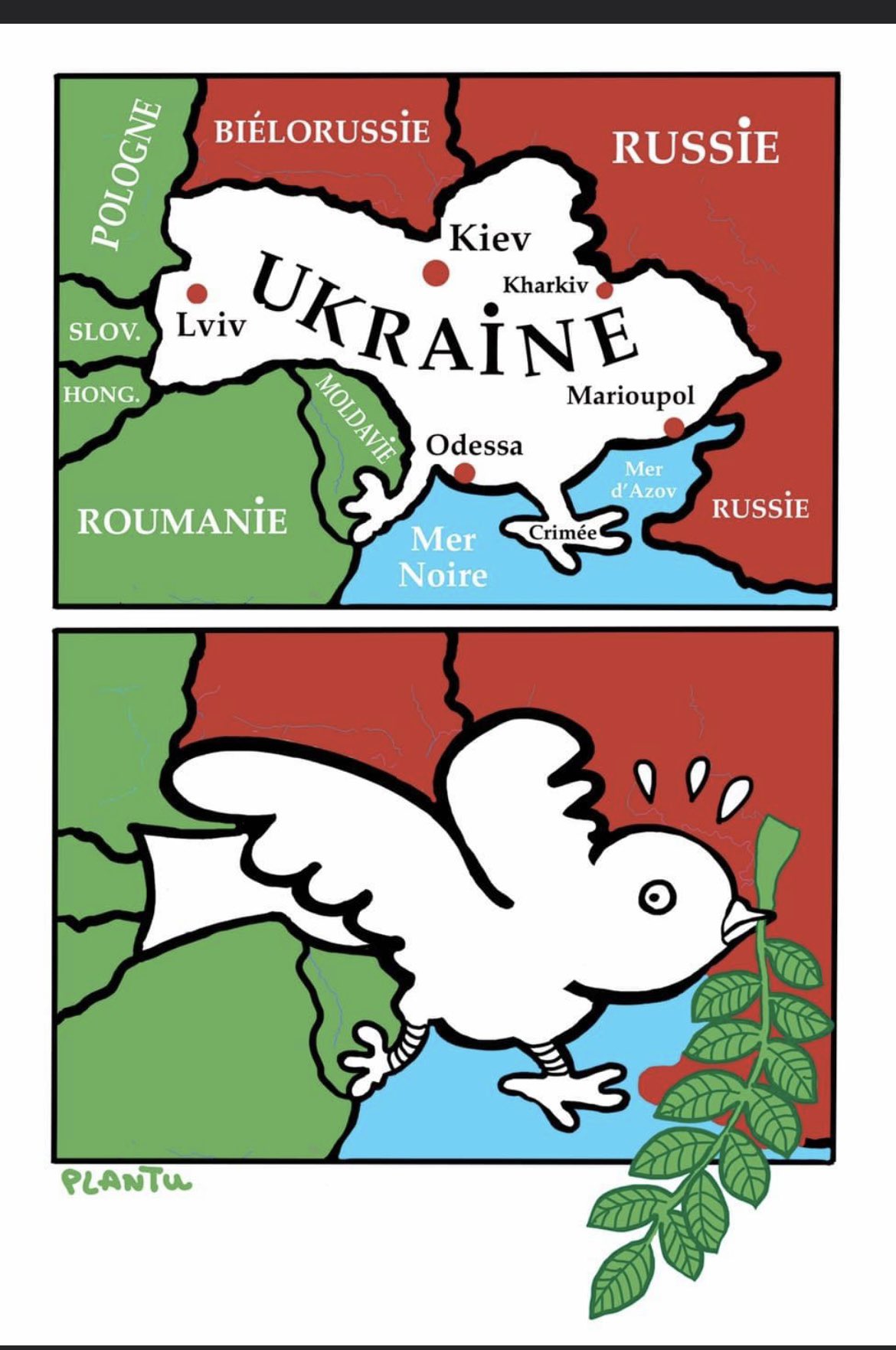
J’ai trouvé aussi cette belle chanson de Jacques Larue et Alec Siniavine, chantée par Yvette Giraud en 1946 <Ukraine>
<Mot du jour sans numéro>
-
Lundi 14 mars 2022
« Si l’humanité accepte que le péché est une variation du comportement humain, alors la civilisation humaine s’arrêtera là !»Patriarche KirillPour Karl Marx, la religion était l’opium du peuple.
En aparté, et dans ma vision actuelle du monde et de mon expérience, je crois que sur ce point, il avait totalement raison.
L’opium c’est la drogue, c’est-à-dire un artifice qui fait qu’on voie la vie comme dans un rêve et que la raison est anesthésiée.
L’Union Soviétique, suivant le conseil de Karl Marx, a combattu les religions et les religieux, tout en promouvant elle-même une religion laïque : le communisme qui était aussi une croyance à un récit.
Quand l’Union soviétique s’est écroulée, la religion orthodoxe est sortie de sa léthargie pour redevenir l’opium du peuple avec la bénédiction de Vladimir Poutine.
 L’église orthodoxe est devenue pour le nouveau Tsar une caution morale et un symbole du renouveau de la sainte Russie.
L’église orthodoxe est devenue pour le nouveau Tsar une caution morale et un symbole du renouveau de la sainte Russie.
Après un accord avec Nicolas Sarkozy en 2007, Vladimir Poutine a fait construire en finançant, quai Branly, la construction de ce qu’on pourrait appeler un <centre russe orthodoxe> comprenant une école, un centre culturel et surtout une cathédrale offerte à l’Église orthodoxe russe.
Au pied de la Tour Eiffel, entièrement financé par le Kremlin à hauteur de 150 millions d’euros, ce centre devait être inauguré, en 2016, par Vladimir Poutine et le patriarche Kirill de Moscou. Mais les tensions diplomatiques autour de la guerre en Syrie en ont décidé autrement.
Elle fut donc inauguré en l’absence de Vladimir Poutine et du patriarche, le 19 octobre 2016.
C’était pendant le quinquennat Hollande.
Mais Poutine a quand même pu voir son œuvre un peu plus tard.
Vous vous souvenez, ou alors on vous l’a rappelé lors du sommet des 27 à Versailles de ce week-end que le jeune et nouveau Président que nous nous étions donné en 2017, avait invité très rapidement Vladimir Poutine au château de Versailles pour essayer de l’amadouer.
Ce qu’il n’est pas arrivé à faire… Pour ma part, je ne le lui reprocherai pas, au moins a t’il essayé.
C’était le lundi 29 mai 2017. Et cette rencontre a permis à Poutine de se rendre à la cathédrale en fin d’après-midi.
Poutine avait déjà en 2011, utilisé tous les moyens pour récupérer la propriété de la Cathédrale Saint Nicolas de Nice. Et il y est parvenu.
 Ce <Site Niçois> raconte :
Ce <Site Niçois> raconte :
« En 2011, la Russie revendique la propriété de la Cathédrale Saint-Nicolas. La Fédération de Russie revendique le fait que le terrain sur lequel elle est construite appartenait à la famille impériale de Russie. L’Association cultuelle orthodoxe russe de Nice, gérante du lieu depuis près d’un siècle, se voit alors contrainte d’envoyer les clés de l’édifice au président russe Vladimir Poutine. Quelques années plus tard, la Russie se voit restituer trois autres reliques du tsar Alexandre II qui faisaient la fierté du lieu. »
Il est peut être possible qu’en raison des sanctions économiques contre la Russie, la France puisse reprendre ce joyau.
C’est ce qu’envisage cet article de « Nice Matin » : < La France peut-elle saisir l’église russe de Nice dans le cadre des sanctions annoncées ?>
On constate donc qu’entre Vladimir Poutine et l’Église orthodoxe « c’est du sérieux », pour reprendre l’expression utilisée par Nicolas Sarkozy dans d’autre circonstances.
Mais l’Église Orthodoxe et le Patriarche Kirill le lui rendent bien.
« Le nouvel esprit public » de ce dimanche m’a fait connaître une revue en ligne <Grand Continent>.
Cette revue a traduit un discours, je n’ose écrire une homélie, du Patriarche Kirill prononcé le 6 mars 2022, le dimanche de la Saint-Jean, appelé, précise l’article, « dimanche du pardon »), qui est une fête spécifique aux orthodoxes et qui fait mémoire de l’expulsion d’Adam et Eve du Paradis, souvenir du péché originel, mais aussi de la promesse de Rédemption. Ce sermon a été prononcé dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou.
Vous trouverez cet article derrière ce lien : < La guerre sainte de Poutine >.
Je donne quelques extraits du sermon du sage Patriarche, représentant d’une autre religion de paix, comme aime à s’appeler toutes les religions monothéistes :
L’article est très intéressant, parce que son auteur contextualise les propos du vieil orthodoxe moscovite :
« Le printemps est la renaissance de la vie, un certain grand symbole de la vie. Et c’est pourquoi ce n’est pas tout à fait par hasard que la principale fête de printemps est la Pâque du Seigneur, qui est aussi un signe, un gage, un symbole de la vie éternelle. Et nous croyons qu’il en est ainsi, et cela signifie que toute la foi chrétienne, que nous partageons avec vous, est la foi qui affirme la vie, qui est contre la mort, contre la destruction, qui affirme la nécessité de suivre les lois de Dieu pour vivre, pour ne pas périr dans ce monde, ni dans l’autre.
Mais nous savons que ce printemps est assombri par de graves événements liés à la détérioration de la situation politique dans le Donbass, presque le début des hostilités. Je voudrais dire quelque chose à ce sujet.
Depuis huit ans, on tente de détruire ce qui existe dans le Donbass.
Et dans le Donbass, il y a un rejet, un rejet fondamental des soi-disant valeurs qui sont proposées aujourd’hui par ceux qui prétendent au pouvoir mondial. Aujourd’hui, il existe un test de loyauté envers ce pouvoir, une sorte de laissez-passer vers ce monde « heureux », un monde de consommation excessive, un monde de « liberté » apparente. Savez-vous ce qu’est ce test ? Le test est très simple et en même temps terrifiant : il s’agit d’une parade de la gay pride. La demande de nombreux pays d’organiser une gay pride est un test de loyauté envers ce monde très puissant ; et nous savons que si des personnes ou des pays rejettent ces demandes, ils ne font pas partie de ce monde, ils en deviennent des étrangers.
 Mais nous savons ce qu’est ce péché, qui est promu par les soi-disant « marches de la fierté » (gay pride). C’est un péché qui est condamné par la Parole de Dieu – tant l’Ancien que le Nouveau Testament. Et Dieu, en condamnant le péché, ne condamne pas le pécheur. Il l’appelle seulement à la repentance, mais ne fait en aucun cas du péché une norme de vie, une variation du comportement humain – respectée et tolérée – par l’homme pécheur et son comportement.
Mais nous savons ce qu’est ce péché, qui est promu par les soi-disant « marches de la fierté » (gay pride). C’est un péché qui est condamné par la Parole de Dieu – tant l’Ancien que le Nouveau Testament. Et Dieu, en condamnant le péché, ne condamne pas le pécheur. Il l’appelle seulement à la repentance, mais ne fait en aucun cas du péché une norme de vie, une variation du comportement humain – respectée et tolérée – par l’homme pécheur et son comportement.
Si l’humanité accepte que le péché n’est pas une violation de la loi de Dieu, si l’humanité accepte que le péché est une variation du comportement humain, alors la civilisation humaine s’arrêtera là. Et les gay pride sont censées démontrer que le péché est une variante du comportement humain. C’est pourquoi, pour entrer dans le club de ces pays, il faut organiser une gay pride. Pas pour faire une déclaration politique « nous sommes avec vous », pas pour signer des accords, mais pour organiser une parade de la gay pride. Nous savons comment les gens résistent à ces demandes et comment cette résistance est réprimée par la force. Il s’agit donc d’imposer par la force le péché qui est condamné par la loi de Dieu, c’est-à-dire d’imposer par la force aux gens la négation de Dieu et de sa vérité.
Par conséquent, ce qui se passe aujourd’hui dans la sphère des relations internationales ne relève pas uniquement de la politique. Il s’agit de quelque chose d’autre et de bien plus important que la politique. Il s’agit du Salut de l’homme, de la place qu’il occupera à droite ou à gauche de Dieu le Sauveur, qui vient dans le monde en tant que Juge et Créateur de la création. Beaucoup aujourd’hui, par faiblesse, par bêtise, par ignorance, et le plus souvent parce qu’ils ne veulent pas résister, vont là, du côté gauche. Et tout ce qui a trait à la justification du péché condamné dans la Bible est aujourd’hui le test de notre fidélité au Seigneur, de notre capacité à confesser la foi en notre Sauveur.
Tout ce que je dis a plus qu’une simple signification théorique et plus qu’une simple signification spirituelle. Il y a une véritable guerre autour de ce sujet aujourd’hui. Qui s’attaque aujourd’hui à l’Ukraine, où huit années de répression et d’extermination de la population du Donbass, huit années de souffrance, et le monde entier se tait – qu’est-ce que cela signifie ?
Mais nous savons que nos frères et sœurs souffrent réellement ; de plus, ils peuvent souffrir pour leur loyauté envers l’Église. Et donc, aujourd’hui, en ce dimanche du pardon, moi, d’une part, en tant que votre berger, j’appelle tout le monde à pardonner les péchés et les offenses, y compris là où il est très difficile de le faire, là où les gens se battent entre eux. Mais le pardon sans la justice est une capitulation et une faiblesse. Le pardon doit donc s’accompagner du droit indispensable de se placer du côté de la lumière, du côté de la vérité de Dieu, du côté des commandements divins, du côté de ce qui nous révèle la lumière du Christ, sa Parole, son Évangile, ses plus grandes alliances données au genre humain.
Aujourd’hui, nos frères du Donbass, les orthodoxes, souffrent sans aucun doute, et nous ne pouvons qu’être avec eux – avant tout dans la prière. Nous devons prier pour que le Seigneur les aide à préserver leur foi orthodoxe et à ne pas succomber aux tentations. » […]
Que le Seigneur nous aide tous à entrer dans le chemin du Saint Carême de telle manière, et pas autrement, qu’Il puisse sauver nos âmes et favoriser la multiplication du bien dans notre monde pécheur et souvent terriblement erroné, afin que la vérité de Dieu puisse régner et diriger le genre humain. Amen. »
Vous voyez que Karl Marx avait raison à propos de l’opium.
Cet article renvoie vers un autre < Que nous importe le monde si la Russie n’y existe plus ?> qui présente Vladislav Iouriévitch Sourkov qui est un homme d’affaires et homme politique russe, cofondateur du parti Russie unie qui mena Vladimir Poutine au pouvoir en 2001.Il est considéré comme le principal idéologue du Kremlin des années 2000, auteur du concept de « Démocratie souveraine », il est nommé vice-président du gouvernement, chargé de la modernisation le 27 décembre 2011 par Dmitri Medvedev.
<1667>
-
Vendredi 11 mars 2022
« Pourvu qu’ils tiennent !»Caricature de Jean-Louis Forain pendant la grande guerre, en évoquant l’arrièreNous sommes débordés d’informations, mais nous savons finalement assez peu sur cette guerre en Ukraine, contrairement à ce que laisse croire les chaines d’informations en continu.
Nous ne connaissons pas le nombre de morts ni du côté russe, ni du côté ukrainien.
En réalité, nous ne connaissons pas les vrais buts de guerre de Poutine.
C’est pour beaucoup, une guerre de communication.
Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, au-delà de son courage qui est grand, se révèle un remarquable communicant.
Ces derniers jours, il s’est énervé contre les occidentaux qui ne mettent pas en place une zone de sécurité de l’espace aérien ukrainien.
Mais pour ce faire, il faudrait que l’OTAN attaque les avions russes pour les empêcher de survoler l’Ukraine. Une telle intervention signifierait entrer en guerre contre la Russie. Les pays de l’OTAN en guerre contre la Russie, c’est factuellement la troisième guerre mondiale. Et pour la première fois de l’Histoire une guerre dans laquelle, des deux côtés, les belligérants ont la bombe atomique.
Ce n’est pas raisonnable, il faut tout faire pour empêcher cette escalade. On ne sait jamais comment finissent les guerres, surtout entre puissances nucléaires.
Les ukrainiens se battent donc seuls avec des armes.
Ce que certains ont décrit par cette formule terrible :
« Les européens veulent se battre pour la liberté… jusqu’au dernier ukrainien »
Il n’est pas exact que les occidentaux ne font rien : ils accueillent les réfugiés, ils livrent des armes et ils pratiquent des sanctions économiques.
Mais ces sanctions économiques sont aussi dévastatrices pour nos économies.
Nous le constatons déjà en allant faire le plein d’essence.
Ce renchérissement de l’énergie va se répercuter sur tous nos achats.
Nous ne voulons pas donner notre sang pour l’Ukraine, mais voulons nous donner notre confort pour certains et plus que cela pour tous ces gens modestes qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui en plus ont besoin de leurs voitures au quotidien pour travailler, se nourrir et vivre ?
Allons-nous tenir ?
Le club des vieux centristes du « Nouvel Esprit Public » de Philippe Meyer a bien sûr consacré sa dernière émission à l’Ukraine.
Comme souvent j’ai particulièrement apprécié l’intervention de Jean-Louis Bourlanges.
Il a émis cette crainte : allons nous tenir en référant à un caricaturiste historique : Jean Louis Forain (1852-1931) :
« Quand je songe à ces sanctions, il me revient à l’esprit une caricature de Forain, parue pendant la guerre de 1914-1918. On y voyait deux soldats discutant dans une tranchée : « Pourvu qu’ils tiennent !
– Qui ça ?
– L’arrière. »
Je crois qu’on en est là. Tout un peuple est promis à des souffrances inouïes, dont nous n’avons encore à peu près rien vu. Les jours qui viennent vont sans doute être terribles. Même si le degré d’horreur n’atteint pas ce qu’on a pu voir à Grozny ou à Alep, si l’on se base sur les précédentes opérations de même nature menées par l’armée russe, on a tout lieu de croire que ce sera absolument terrifiant. «
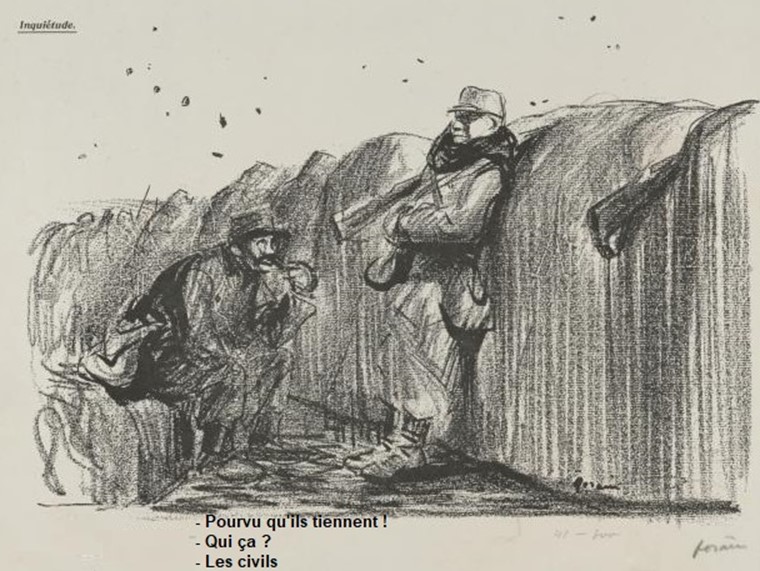
Ce dessin de Jean-Louis Forain est paru le 9 janvier 1915, dans le journal L’Opinion. A l’époque, cette caricature provoque une polémique énorme et donne lieu à une chanson » Ohé m’sieur Forain « , composée par Aristide Bruant et créée par une des plus grandes vedettes de l’époque, le comique troupier Polin. Dans cette caricature, Forain montre les difficultés rencontrées par les civils et les soldats pendant la Première Guerre mondiale, et renverse la vision traditionnelle qui met généralement les mots » Pourvu qu’ils tiennent » dans la bouche des civils.
Et Jean-Louis Bourlanges continue à analyser notre situation ambigüe et fragile :
« Pour des raisons très solides, nous n’intervenons pas dans cette guerre : rien ne serait plus dangereux que de transformer ce conflit en troisième guerre mondiale.
Ces raisons sont fortes, mais bien peu sympathiques.
Nous nous retrouvons un peu dans la situation du film Fort Alamo. Nous savons qu’à quelques milliers de kilomètres de nous vont mourir des gens qui défendent leur patrie, ainsi que la liberté et les valeurs des Européens. Ce « pourvu qu’ils tiennent ! » n’a rien d’évident. Je suis moi aussi réconforté sur la façon dont les sanctions ont été décidées, à savoir par l’unité profonde, et entièrement nouvelle. Notamment la conversion de nos amis allemands, sous l’impulsion du nouveau chancelier, à une logique de confrontation dont il assume pleinement les conséquences. C’est très nouveau. »
Son inquiétude est palpable dans les mots mais aussi dans le ton utilisé :
« Mais au-delà ce tout cela, je suis très préoccupé. D’abord parce qu’il me parait hors de question que ces sanctions fassent dévier M. Poutine de son objectif final. Sa capacité stratégique a été́ mise au défi, il ne peut que surenchérir.
Il a les moyens militaires de le faire, il a l’assurance que les forces occidentales n’entreront pas en guerre, il ne va donc pas se priver. Donc, au moins à court terme, il va réaliser son projet. Nous sommes nécessairement dans le long terme. Comment le rapport de forces évoluera-t ‘il ? D’abord, nous sommes nous aussi très vulnérables. Sur le blé, sur les engrais, sur une quantité de matières premières rares …
Nous sommes donc exposés à une situation où il va nous falloir encaisser, faire des sacrifices. D’autre part, je ne sens pas encore que la conscience européenne et occidentale soit engagée sur un effort de longue haleine et de sacrifices. »
Et il finit son intervention par cette analyse qui me semble très lucide.
« Nous sommes un peu dans la situation décrite dans le testament de Richelieu : quand il s’agit de se mobiliser les Français sont tout feu tout flamme, et par la suite, ça se gâte … Les Allemands sont peut-être plus conscients et engagés sur la durée que nous le sommes, mais cela reste à démontrer.
Face à Poutine, nous avons trois désavantages.
D’abord une faiblesse idéologique : en France, environ une moitié de la population s’est montrée sensible à Poutine. Or être sensible à Poutine, c’est être sensible à ce qu’il y a de pire en nous : le culte du chef, de la violence, le nationalisme le plus étriqué, etc.
D’autre part, nous sommes en pleine incertitude quant à l’universalité de nos valeurs, on le voit avec des phénomènes comme le wokisme.
Ensuite, sur le plan stratégique : qu’attendons-nous exactement des sanctions ? Que pouvons-nous en obtenir ? Et à quel moment s’arrêtent-elles ? Nous n’en avons pas la moindre idée. Pour le moment, il semble que M. Poutine veut toute l’Ukraine ; on ne voit pas comment une solution intermédiaire pourrait émerger. Et même si elle émergeait, on ne voit pas comment elle pourrait à la fois satisfaire Poutine et être acceptable par M. Zelensky et par les Ukrainiens. Enfin, une incertitude de la volonté : tiendrons-nous dans la durée ?
Nous avons changé de monde, mais nous n’en sommes qu’au début. Il va nous falloir accomplir une révolution intellectuelle et surtout morale, accepter les logiques de contraintes, de mobilisation et d’efforts, si nous voulons rester dignes de ce que nous prétendons être.
Il est plus nécessaire que jamais de garder à l’esprit la phrase de Thucydide :
« Il n’y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance ».
Et la vaillance n’est pas une valeur instantanée, mais à long terme.
Le plus dur est devant nous. »
Je redonne le lien vers l’émission : <Le Nouvel esprit public du 6 mars 2022>
<1667>
-
Jeudi 10 mars 2022
« La seule chose dont je suis absolument sûr, c’est qu’il ne faut en aucun cas choisir entre ces deux tragédies. »Bruno LatourJeudi 24 février 2022, Vladimir Poutine donnait l’ordre à l’armée russe d’envahir l’Ukraine, en attaquant sur 3 fronts et en ayant a priori comme but de guerre de décapiter le gouvernement de Kiev.
Le GIEC, Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat, a sorti son dernier rapport le 28 février 2022. Il s’agit du deuxième volet du sixième rapport d’évaluation du Giec a. Le premier volet, en date d’août 2021, concluait que le changement climatique était plus rapide que prévu.
En avril 2022, le Giec publiera un troisième volet concernant les solutions à mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le deuxième volet s’intéresse aux effets, aux vulnérabilités et aux capacités d’adaptation à la crise climatique.
Ce <site gouvernemental de documentation> en dresse un résumé.
-
La première partie du rapport est consacrée aux effets actuels du réchauffement climatique (+1,09°C en 2021) sur les populations et les écosystèmes :
- réduction de la disponibilité des ressources en eau et en nourriture (en Afrique, en Asie et dans les petites îles notamment) ;
- impact sur la santé dans toutes les régions du monde (plus grande mortalité, émergence de nouvelles maladies, développement du choléra), augmentation du stress thermique, dégradation de la qualité de l’air… ;
- baisse de moitié des aires de répartition des espèces animales et végétales.
- réduction de la disponibilité des ressources en eau et en nourriture (en Afrique, en Asie et dans les petites îles notamment) ;
- Ces effets sont irrémédiables, même dans l’hypothèse d’une limitation de la hausse des température à 1,5°C comme fixé dans l’accord de Paris. Ils sont par ailleurs aggravés par la pauvreté ou l’accès limité à des services.
D’ores et déjà, entre 3,3 et 3,6 milliards d’habitants vivent dans des situations très vulnérables au changement climatique.
Les experts évoquent les incidences à venir pour les populations avec, en particulier, 1 milliard d’habitants des régions côtières menacés en 2050.
Parmi les effets en cascade liés aux catastrophes naturelles de plus en plus rapprochées, le Giec évoque aussi les conséquences sur la production alimentaire, la hausse du prix des aliments ou encore la malnutrition…
Les auteurs du rapport dénoncent une inadéquation des moyens mis en œuvre face à la rapidité des changements, signe d’un « manque de volonté politique » avec, pour exemple, le non-respect des engagements de Glasgow 2021 lors de la COP 26 en matière de doublement des budgets pour lutter contre le réchauffement.
- Un développement résilient au changement climatique est cependant encore possible en consacrant des efforts financiers plus importants dans certains secteurs clés :
Ainsi des efforts financiers devraient être réalisés dans les secteurs suivants
- la transition énergétique pour réduire les émissions de CO2 ;
- une meilleure gestion de l’eau et de l’irrigation mais aussi une meilleure adaptation des cultures aux conditions climatiques via l’agroécologie ;
- la préservation du milieu naturel (restauration des forêts et des écosystèmes naturels, arrêt de l’urbanisation dans les zones côtières, végétalisation des villes…).
Au rythme de développement actuel, le réchauffement climatique pourrait atteindre 2,7°C à la fin du siècle.
Cet article renvoie vers une communication de l’ONU : < les experts du GIEC s’alarment des conséquences énormes d’une planète en péril>.
Il y a aussi cette page documentée sur le site de <TV5 monde>
Je ne crois pas que le rapport existe en version française, je n’ai même pas trouvé la synthèse en français qui existe en anglais : <ICI>
Dans le journal en ligne AOC [Analyse Opinion Critique], Bruno Latour a publié, jeudi 3 mars 2022, dans la rubrique Opinion : <Quelles entre-deux-guerres ? >
Bruno Latour exprime d’abord ce sentiment humain que toute personne honnête et raisonnable doit probablement ressentir : l’angoisse :
« Je ne crois pas être le seul à être angoissé, et doublement angoissé. C’est ce que je ressens depuis que je lis en même temps les nouvelles de la guerre en Ukraine et le nouveau rapport du GIEC sur la mutation climatique.
Je ne parviens pas à choisir l’une ou l’autre de ces deux tragédies. Inutile d’essayer de dresser la première contre la deuxième, ni même de les hiérarchiser, de faire comme si l’une était plus urgente, l’autre plus catastrophique. Les deux me frappent en même temps à plein. »
Il ne faut pas choisir dit-il, les deux sont aussi essentiels pour nous mais si elles sont toutes deux « géopolitiques », elles se différencient sur un point :
« Il ne s’agit pas d’occuper les mêmes terres. »
L’agression de Poutine correspond à notre expérience historique même si nous avions perdu l’habitude de tels agissements en Europe
« La guerre de Poutine se joue sur l’échiquier des grandes puissances et prétend se saisir d’une terre sans autre justification que le plaisir d’un prince. À l’ancienne, en quelque sorte. »
Et il se lance dans cette spéculation philosophiquee :
« L’autre tragédie ne se joue pas sur cet échiquier traditionnel. Il y a bien des prises de terre, mais c’est plutôt la Terre qui resserre sa prise sur toutes les nations. Il y a bien des grandes puissances, mais elles sont chacune en train d’envahir les autres en déversant sur elles leurs pollutions, leurs CO2, leurs déchets, si bien que chacune est à la fois envahissante et envahie, sans qu’elles parviennent à faire tenir leurs combats dans les frontières des États – nations. Sur ce trépassement d’un pays sur les autres, le rapport du GIEC est écrasant : les grandes puissances occupent les autres nations, aussi sûrement que la Russie cherche à détruire l’Ukraine. Sans missile et sans tank, c’est vrai, mais par le cours ordinaire de leurs économies. Ces deux tragédies sont bien concomitantes.
Si elles ne semblent pas mordre sur mes émotions exactement de la même façon, c’est parce que je possède tout un répertoire d’attitudes et d’affects pour réagir, hélas, aux horreurs de la guerre en Ukraine et que je n’ai pas (pas encore) les mêmes tristes habitudes pour réagir aux destructions innombrables des grandes puissances en guerre avec les terres qu’elles envahissent – et qui pourtant les encerclent de plus en plus étroitement en resserrant chaque jour leurs emprises. Chacun a vu des centaines de films de guerre, mais combien de films « de climat » ?
Et c’est bien de guerre qu’il s’agit désormais dans les deux cas, en ce sens précis, qu’il n’y a aucun principe supérieur commun, aucun arbitre suprême, pour en juger les conflits. Il n’y en a plus pour contenir la Russie ; il n’y en a pas encore pour contenir le climat. La décision ne dépend plus que de l’issue des conflits.
Plusieurs journalistes ont introduit l’hypothèse que la guerre de Poutine marquait la fin d’une parenthèse qu’ils appellent la nouvelle « entre-deux guerre ». Voilà, suggèrent-ils, à partir de février 2022, finirait l’entre-deux guerres, celle qui avait commencé en 1945, avec la fondation des Nations Unies et l’idée de paix. Paix virtuelle bien sûr, projet qui faisait l’impasse sur d’innombrables conflits, mais qui obligeait quand même les impérialistes à obtenir de la fragillissime institution des Nations Unies comme un brevet de vertu.
Or Poutine, président d’un pays fondateur de cette vénérable institution, n’a même pas tenté d’obtenir un mandat pour envahir l’Ukraine (dont il nie d’ailleurs l’existence, ce qui l’autorise à tuer ceux que bizarrement il appelle ses frères). Et la Chine l’a gravement approuvé. Fin de cette entre deux guerres qui aurait duré 77 ans. Si je suis si terrifié, c’est que j’ai 75 ans, et que ma vie se loge donc exactement dans cette entre-deux guerres. Cette longue illusion sur les conditions de paix perpétuelle… avec toute ma génération, j’aurais vécu dans un rêve ?
Trois générations pour oublier l’horreur de la Deuxième Guerre mondiale (je commence à ne plus savoir comment numéroter l’enchaînement des conflits), ce n’est peut-être pas si mal après tout. La précédente, celle de mes parents, n’avait duré que 22 ans. L’effet de la Grande Guerre n’avait pas suffi.
Mais l’autre tragédie, je ne parviens pas à la faire rentrer dans le même cadre temporel. L’impression de paix a volé pour moi en éclat dès les années quatre-vingt quand les premiers rapports indiscutables sur l’état de la planète commencent à être systématiquement déniés par ceux qui vont devenir les climato-sceptiques.
Si j’avais à choisir une date pour fixer la limite de cette autre « entre-deux guerre », 1989 pourrait convenir. La chute de l’URSS (dont on dit que c’est le drame intime de Poutine quand on veut expliquer sa folie !) marque à la fois le maximum d’illusions sur la fin de l’histoire et le début de cette autre histoire, de cette géohistoire, de ce nouveau régime climatique qui, j’en étais sûr, allait ajouter ses conflits à tous les autres, sans que je sache en aucune façon comment dessiner leurs lignes de front. Cette entre deux guerres aurait duré, quant à elle, 45 ans.
Est-ce une loi de l’histoire qu’il faille payer quelques décennies de paix relatives par un conflit si terrifiant qu’il force tous les protagonistes à s’entendre, avant que l’oubli n’en émousse l’effet ? Mais alors, quels conflits nous faudra-t-il subir avant de pouvoir à nouveau tenter de refonder un nouvel idéal de paix ?
Je ne sais pas comment tenir à la fois les deux tragédies. En un certain sens, pourtant, la tragédie climatique, celle rapportée par le dernier rapport du GIEC, encercle bel et bien toutes les autres. Elle est donc en un sens « mondiale », mais dans un tout autre sens de l’adjectif avec lequel nous avons pris l’habitude en Europe de numéroter nos guerres (celles des autres, au loin, nous ne les numérotons même pas…). « Planétaire » serait un meilleur terme.
Or c’est là le cœur de mon angoisse, je vois que Poutine donne le dernier coup à l’ordre issu de la dernière guerre « mondiale », mais je ne vois pas émerger l’ordre qui pourrait sortir de la guerre « planétaire » rapportée par le GIEC.
C’est là où il faut faire confiance au monde, à la planète, à la terre. Croire à une autre loi de l’histoire, celle par laquelle inévitablement, ô comme je tiens à cet adverbe ! inévitablement, les conflits actuels peuvent, non, doivent déboucher, sur la préparation de l’ordre planétaire qui pourrait suivre l’ordre mondial, si impuissant comme on le voit à empêcher les tanks russes d’occuper l’Ukraine. »
Et il conclut :
« Si je le croyais vraiment, je ne serais pas si angoissé ; si je n’y croyais pas vraiment, je n’écrirai pas ce texte.
La seule chose dont je suis sûr, absolument sûr, c’est qu’il ne faut en aucun cas choisir entre ces deux tragédies. »
Pendant ce temps j’ai entendu que le gouvernement italien bousculé par les sanctions prononcées contre la Russie et coincé par sa dépendance au gaz russe envisage de <rouvrir des centrales au charbon>.
En France, il semble que la grande affaire est le pouvoir d’achat…
Et pendant ce temps, le gouvernement entend aider les français à supporter la hausse des tarifs de l’énergie alors que le candidat Macron veut continuer à baisser les impôts.
Raymond Aron disait qu’il ne faut pas reprocher aux hommes politiques de poursuivre des objectifs très ambitieux, mais de constater quand ils font des promesses contradictoires, donc impossible à réaliser.
J’ai l’intuition que Jean-Marc Jancovici a raison : pour s’en sortir nous autres citoyens des pays riches devront nous serrer sérieusement la ceinture, même les plus modestes d’entre nous.
Cette évolution ne peut se faire dans une société dans laquelle les inégalités se creusent et la confiance des gens les uns envers les autres et de tous envers les élites se délitent. Il faut donc aussi agir sur ces deux points : la réduction des inégalités et l’augmentation de la confiance.
<1666>
-
-
Mercredi 9 mars 2022
« Pause »Un jour sans mot du jour nouveauIl semblerait que Poutine avait tout annoncé dans un écrit.
 Vladimir Poutine a publié un long article, presque un essai (plus de 7000 mots) le 12 juillet 2021 : « Sur l’unité des Russes et des Ukrainiens ». On trouve la traduction en français, vers laquelle je renvoie, sur le site de l’Ambassade de Russie en France.
Vladimir Poutine a publié un long article, presque un essai (plus de 7000 mots) le 12 juillet 2021 : « Sur l’unité des Russes et des Ukrainiens ». On trouve la traduction en français, vers laquelle je renvoie, sur le site de l’Ambassade de Russie en France.
J’ai trouvé mention de cet article dans l’excellente émission des matins de France Culture : « Comment Poutine entend-il soumettre l’Ukraine ? » .
Guillaume Erner recevait le géopoliticien Gérard Chaliand et le chercheur spécialiste de la Russie et de l’Eurasie à l’IRSEM, Emmanuel Dreyfus :
« Le 12 juillet 2021, le Président russe publiait un article sur l’histoire de l’unité des Russes et des Ukrainiens. D’un côté il livre sa vision de l’histoire et d’un autre il présente ses mensonges cyniques sur le fait que jamais les Russes et les Ukrainiens ne seront ennemis. Emmanuel Dreyfus rappelle que la publication de l’article s’inscrivait déjà dans un contexte de montée des tensions extrêmement palpables aux frontières orientales de l’Ukraine.
Le renforcement militaire russe qui a constitué le prélude de l’intervention actuelle n’est pas si récent car il a commencé en avril dernier. Emmanuel Dreyfus précise que Poutine conclut son article en disant que l’Ukraine est un peuple frère, ce qui peut paraître troublant »
<Wikipedia> a même consacré un article à cette publication dans lequel il est précisé que le texte a été mis en ligne sur le site du gouvernement russe en russe, en anglais et en ukrainien et que c’est la première fois qu’un document en ukrainien apparaît sur le site du président russe
Donc si vous voulez lire Poutine dans le texte, c’est <Ici>
<Mot du jour sans numéro>
-
Mardi 8 mars 2022
« J’espère que les Russes aiment aussi leurs enfants ! »StingCertains parlent du retour de la guerre froide, d’autres disent que cela n’a rien à voir.
Les seconds pointent le fait qu’il n’y a plus deux systèmes économiques opposés qui se font face. Bien au contraire, non seulement ce sont des systèmes économiques qui sont proches, mais plus encore l’interdépendance entre la Russie et l’Occident est à un niveau tel qu’on ne peut pas sanctionner l’agresseur sans que l’Occident ne soit durement touché par les répercussions de ces sanctions qui lui reviennent en boomerang.
Certes… Mais ce sont ceux qui croient que seule l’économie guide le monde.
Or il y a aussi la politique, les valeurs, les récits.
« Poutine croit à un choc des civilisations entre l’Occident et la Russie ». Non seulement, il pense en termes de puissance comme Staline qui répondait : « Le Pape, combien de divisions ? », mais aussi en terme de valeur pour lui les démocraties sont faibles, n’ont pas d’autorité, ne défendent pas l’identité chrétienne de l’Europe et ont abandonné leur virilité au profit de combat pour l’égalité des LGBT qu’il réprouve absolument.
Et dans l’affrontement de ces deux systèmes, il y a bien une nouvelle guerre, qu’on espère que, froide qui s’installe.
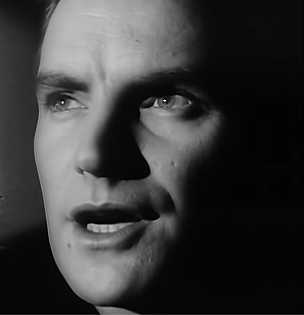 En 1985, nous étions encore en pleine guerre froide. Le musicien britannique Gordon Matthew Thomas Sumner, plus connu sous le nom de « Sting » écrit une chanson qui s’intitule « Russians ».
En 1985, nous étions encore en pleine guerre froide. Le musicien britannique Gordon Matthew Thomas Sumner, plus connu sous le nom de « Sting » écrit une chanson qui s’intitule « Russians ».
Sting fait notamment référence à la doctrine de MAD (Mutual Assured Destruction = Destruction Réciproque Assurée) qui consiste à développer des armes nucléaires à grande échelle pour anéantir l’adversaire.
A partir de l’existence de ces armes les grandes puissances créent le concept de « dissuasion nucléaire » qui consiste à faire le pari que les adversaires n’entreront pas dans la guerre directe parce qu’ils savent qu’elle conduirait à la destruction réciproque assurée.
Un pari n’est jamais certain, il est possible de le perdre.
Sting dans sa chanson pose cette question angoissante :
« How can I save my little boy ? From Oppenheimer’s deadly toy ?
Comment sauver mon petit garçon ? Du jouet mortel d’Oppenheimer ? ».
Robert Oppenheimer (1904-1967) fut le directeur scientifique du « Projet Manhattan », c’est-à-dire l’laboration par les Etats-Unis de la bombe nucléaire. Par un raccourci, oubliant les autres éminents scientifique qui ont travaillé sur ce projet, il est régulièrement surnommé le « père de la bombe atomique »
La réponse à cette angoisse que propose Sting est :
« I hope the Russians love their children too
J’espère que les Russes eux aussi aiment leurs enfants ».
Cette chanson tout le monde l’a oublié et Sting ne la chantait plus. Elle était frappée d’obsolescence.
 Mais samedi dernier, il a publié sur instragram une vidéo dans laquelle il interprète à nouveau cette chanson « Russians », pour apporter son soutien au peuple ukrainien et collecter des fonds pour les réfugiés.
Mais samedi dernier, il a publié sur instragram une vidéo dans laquelle il interprète à nouveau cette chanson « Russians », pour apporter son soutien au peuple ukrainien et collecter des fonds pour les réfugiés.
Et il ajoute :
« Je n’ai que rarement chanté cette chanson au cours des nombreuses années qui se sont écoulées depuis qu’elle a été écrite, car je n’aurais jamais pensé qu’elle serait à nouveau pertinente. Mais, à la lumière de la décision sanglante et terriblement malavisée d’un homme d’envahir un voisin pacifique et non menaçant, la chanson est, une fois de plus, un plaidoyer pour notre humanité commune. Pour les courageux Ukrainiens qui luttent contre cette tyrannie brutale et aussi pour les nombreux Russes qui protestent contre cet outrage malgré la menace d’arrestation et d’emprisonnement – Nous, nous tous, aimons nos enfants. Arrêtez la guerre »
La réinterprétation de Sting de sa chanson « Russians » avec sa guitare et accompagné d’un violoncelle se trouve derrière ces liens : <Sting: «HELP UKRAINE» (2022) News of Ukraine> (Youtube) <Russians> (Instagram)>
Mais, on peut revenir à la première version : <Sting – Russians (Official Music Video)>
N’en déplaise à ceux qui prétendent que mes mots du jour sont trop longs, celui ne s’arrête pas là.
Car la chanson de Sting s’appuie sur une œuvre classique : « La romance du lieutenant Kijé » de Serge Prokofiev que vous pouvez entendre derrière ce lien : <Prokofiev Lieutenant Kijé Romance>
Un peu de culture suffit pour savoir que Serge Prokofiev, l’inoubliable compositeur de «Pierre et le loup» était un compositeur russe.
<Wikipedia> Le confirme :
« Sergueï Prokofiev (généralement appelé Serge Prokofiev en France) est un compositeur, un pianiste et un chef d’orchestre russe, né le 11 avril 1891 à Sontsivka (Empire russe) ».
Pas tout à fait…
Quand on regarde de plus près, on constatera que le village de Sontsivka se trouve en Ukraine.
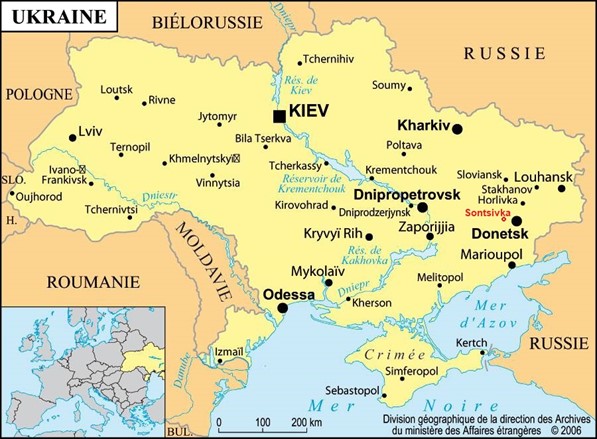 Sur une carte qui donne les villes d’Ukraine dont les noms nous sont connus depuis que le tyran du Kremlin les martyrise, ce village n’est pas représenté. Il a fallu que je trouve d’autres ressources pour pouvoir le situer à l’ouest de Donetsk et au nord de Marioupol.
Sur une carte qui donne les villes d’Ukraine dont les noms nous sont connus depuis que le tyran du Kremlin les martyrise, ce village n’est pas représenté. Il a fallu que je trouve d’autres ressources pour pouvoir le situer à l’ouest de Donetsk et au nord de Marioupol.
Selon la version anglaise de Wikipedia « Sontsivka » est une ville qui fait partie de l’Oblast de Donestsk, donc une des deux villes dont Poutine a déclaré l’indépendance dans le Donbass. Cette ville comptait 626 habitants en 2017.
Toujours selon l’encyclopédie en ligne 92,45% de la population parlait ukrainien et 7,42% russe. Dans ce pays russophone, ce village serait donc plutôt ukrainien.
Prokofiev avait fui avec sa famille la révolution soviétique. Mais il se languissait de sa patrie. Staline l’invitait à revenir et lui assurait sécurité et calme pour composer.
Il ne fut pas assassiné, ni déporté au goulag, mais la promesse de Staline fut, comme souvent, un mensonge. Il vécut très mal, souvent dans la misère et fut plus d’une fois persécuté.
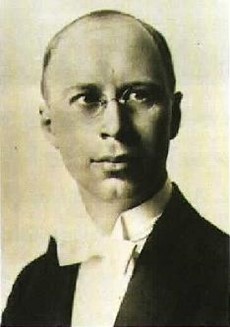 C’est en 1933 que Prokofiev, âgé de 42 ans, revient en URSS. Sa première commande est la composition de la musique du film « Lieutenant Kijé », adaptation cinématographique par Alexander Feinzimmer de la nouvelle éponyme de Yuri Tynianov.
C’est en 1933 que Prokofiev, âgé de 42 ans, revient en URSS. Sa première commande est la composition de la musique du film « Lieutenant Kijé », adaptation cinématographique par Alexander Feinzimmer de la nouvelle éponyme de Yuri Tynianov.
A partir de cette musique de film, Prokofiev va par la suite en tirer une suite composée de 5 parties : La naissance de Kijé, la Romance, le mariage, la Troïka (c’est une danse) et, enfin, l’enterrement.
C’est la deuxième partie, la Romance qui sera le thème musical utilisé par Sting.
Le destin de Prokofiev sera étrangement mêlé à Staline, un des prédécesseurs de Poutine au Kremlin.
« Le 5 mars 1953, Serge Prokofiev, alors âgé de 61 ans, meurt d’une hémorragie cérébrale, une heure environ avant Joseph Staline. La Pravda, portant toute l’attention sur le « petit père des peuples », mettra six jours avant d’annoncer la mort du compositeur, les autorités faisant même pression sur sa famille pour qu’elle n’ébruite pas la nouvelle pendant cette période. Une quarantaine de personnes assistent, dans une totale discrétion, à ses funérailles, au cimetière de Novodevitchi près de Moscou »
 Je me suis aussi intéressé à l’histoire du Lieutenant Kijé. <Wikipedia> la narre
Je me suis aussi intéressé à l’histoire du Lieutenant Kijé. <Wikipedia> la narre
« Celle-ci se passe dans l’Empire russe, sous le règne de Paul Ier. L’histoire débute en 1793 et se termine en 1801.
C’est l’histoire d’un homme qui n’existe pas, sauf pour l’administration impériale, à la suite d’une erreur de transcription d’un ordre du jour par un scribe de la chancellerie du régiment. Cette erreur était rendue possible en russe par une proximité orthographique et phonétique : au lieu de « podporoutchiki-jé (russe : Подпоручики же, « quant aux lieutenants ») Stiven, Rybine et Azantchéïev, ils sont nommés… », le scribe, distrait par l’entrée d’un officier dans son bureau, écrivit : « podporoutchik Kijé (russe : Подпоручик Киже, le lieutenant Kijé). »
Ainsi, par un caprice de la langue russe prend naissance un être fictif dont l’entourage de l’empereur n’osera jamais révéler l’inexistence. On en profite aussitôt pour attribuer à Kijé une faute que personne ne voulait endosser, une fausse alerte qui avait réveillé Sa Majesté. L’empereur ordonne l’exil de Kijé en Sibérie. L’institution militaire russe, respectant l’ordre à la lettre, envoie donc vers la Sibérie une escorte sans prisonnier. Par la suite, Paul Ier, sujet à des crises d’angoisse, se méfiant de son entourage, cherche à promouvoir des officiers non issus de la noblesse. Kijé, en tant que militaire modèle aux états de service parfaits, sans attaches ni « piston » d’aristocrates ou de personnages haut placés, est d’abord gracié, puis nommé capitaine, enfin colonel chef de régiment. Une maison lui est attribuée, ainsi que des serviteurs.
L’empereur ordonne ensuite qu’il se marie avec l’une de ses dames d’honneur.
Paul Ier finit par le nommer général, compte tenu des états de service irréprochables de ce militaire et de sa modestie : il n’a jamais demandé le moindre avancement ni contesté son autorité autocratique.
Lorsque l’empereur demande à voir son général, son entourage lui explique que le général Kijé vient de tomber malade. Bien que soigné par les meilleurs spécialistes, Kijé « meurt » trois jours plus tard. Sa mort est l’occasion de funérailles nationales grandioses, suivies par sa veuve ; l’empereur dira de son général : « Ce sont les meilleurs qui s’en vont ». »
Le Lieutenant Kijé n’existait pas.
Rappelons que pour Poutine, l’Ukraine n’existe pas non plus. Il pense probablement qu’un scribe, par erreur, a écrit qu’elle existait.
Voici les paroles de la chanson de Sting
Russians
En Europe et en Amérique, il y a un sentiment croissant d’hystérie
In Europe and America there’s a growing feeling of hysteriaConditionné pour répondre à toutes les menaces
Conditioned to respond to all the threatsDans les discours rhétoriques des Soviétiques
In the rhetorical speeches of the SovietsMonsieur Khrouchtchev a dit : « Nous vous enterrerons »
Mister Krushchev said, « We will bury you »Je ne souscris pas à ce point de vue
I don’t subscribe to this point of viewCe serait une chose si ignorante à faire
It’d be such an ignorant thing to doSi les Russes aussi aiment leurs enfants
If the Russians love their children tooComment puis-je sauver mon petit garçon du jouet mortel d’Oppenheimer ?
How can I save my little boy from Oppenheimer’s deadly toy?Il n’y a pas de monopole sur le bon sens
There is no monopoly on common senseDe part et d’autre de la clôture politique
On either side of the political fenceNous partageons la même biologie, quelle que soit l’idéologie
We share the same biology, regardless of ideologyCroyez-moi quand je vous dis
Believe me when I say to youJ’espère que les Russes aiment aussi leurs enfants
I hope the Russians love their children tooIl n’y a pas de précédent historique
There is no historical precedentMettre les mots dans la bouche du président ?
To put the words in the mouth of the president ?Il n’y a pas de guerre gagnable
There’s no such thing as a winnable warC’est un mensonge auquel nous ne croyons plus
It’s a lie we don’t believe anymoreMonsieur Reagan dit : « Nous vous protégerons »
Mister Reagan says, « We will protect you »Je ne souscris pas à ce point de vue
I don’t subscribe to this point of viewCroyez-moi quand je vous dis
Believe me when I say to youJ’espère que les Russes aiment aussi leurs enfants
I hope the Russians love their children tooNous partageons la même biologie, quelle que soit l’idéologie
We share the same biology, regardless of ideologyMais qu’est-ce qui pourrait nous sauver toi et moi
But what might save us, me and youC’est si les russes aiment aussi leurs enfants
Is if the Russians love their children too
Sting
Il existe une interview de Sting en 2010 à la télévision Russe où il parle de cette chanson : Quand le présentateur de l’émission lui demande pourquoi il a écrit cette phrase : « I hope the Russians love their children too »
Sting explique que, dans les années 1980, un ami avait réussi à capter à partir d’un satellite le signal d’une chaine de télévision russe. Et ils ont regardé des émissions pour les enfants russes qui passaient le dimanche matin et Sting explique :
« Ce qui m’a frappé, c’est tout le soin , l’amour et l’attention qu’il y avait dans ces programmes. Donc clairement, les russes aiment leurs enfants. Et ça a été mon déclic : c’est pour ça qu’on ne s’est pas fait exploser : parce que l’Ouest comme les Soviétiques, on tenait à notre avenir qui sont nos enfants. ».
Pourvu qu’il en soit toujours ainsi…
L’idée de ce mot du jour m’a été donnée à travers les informations que j’ai lues ou vues sur <La télévision belge> et <France Bleu>
<1665>
-
Lundi 7 mars 2022
« La meilleure preuve qu’il voulait la guerre, c’est qu’il s’en défendit ! »Citation que fit Georges Pompidou, lors d’une de ses conférences de presse alors qu’il était Président de la République (1969-1974)L’écriture des mots du jour est compliquée en ce moment.
Je voudrais parler d’autre chose, mais je n’y arrive pas, tant mon esprit est occupé par ce qui se passe en Europe : Une puissance nucléaire a attaqué son petit voisin parce qu’il prétend qu’il le menaçait.
Alors bien sûr, il faudrait en revenir à l’Histoire et même l’Histoire récente, quand l’Union soviétique s’est effondrée et que la guerre froide s’est achevée.
On pourrait parler des erreurs des occidentaux et de l’OTAN, comme le rappelle Hubert Vedrine se référant à Henry Kissinger qui a dit que nous avons fait des erreurs et que nous avons mal agi avec la Russie.
Mais il n’est pas temps de parler de cela, parce que la Russie a attaqué son petit voisin qui ne le menaçait pas et qui n’appartenait pas à l’OTAN.
Rien ne peut justifier cela !
L’OTAN se serait trop approché de la Russie dit-on ?
Mais prenons l’exemple de la Pologne, ce ne sont pas les États-Unis ou les européens qui ont obligé la Pologne à entrer dans l’OTAN, ce sont les polonais qui ont supplié d’intégrer l’OTAN.
Pourquoi ?
Mais tout simplement parce qu’ils connaissent leur Histoire, l’Histoire de l’Empire russe qui n’a pas cessé de les envahir, de les soumettre, de les massacrer.
C’est parce que la Russie qu’elle soit l’empire tsariste ou l’empire soviétique s’est toujours très mal comportée à son égard.
Et paradoxalement, la énième invasion russe vers un de ses voisins montre que l’Ukraine avait raison de vouloir faire partie de l’OTAN pour échapper à ce sort funeste imposé par son immense voisin insatiable.
Et justement, les occidentaux n’ont pas voulu offrir à l’Ukraine qui le demandait, la protection de l’OTAN, pour ne pas fâcher leur irascible voisin.
Alors oui des erreurs ont pu être commise dans le passé, mais Poutine raconte des calembredaines, son pays n’était pas menacé.
C’est son pays qui est menaçant et c’est pourquoi ses voisins veulent une protection pour ne pas tomber une nouvelle fois sous son joug.
Parce que visiblement aucun de ces pays n’a le désir d’être soumis à la Russie.
Parce qu’ils en ont l’expérience et que celle-ci n’en donne pas l’envie.
Rien ne justifie l’agression ordonnée par Vladimir Poutine.
Rien, ni les manquements occidentaux, ni l’agression injustifiée contre l’Irak, ni la sombre histoire du renversement de régime en Libye, ni les insuffisances du gouvernement ukrainien, rien ne justifiait cette guerre totale.
Il n’y a qu’une justification à cette guerre, c’est que Poutine voulait montrer sa puissance et qu’il pensait que le moment était propice car Biden est faible, Merkel est partie, le nouveau chancelier est au début de son mandat, La France est en campagne électorale, Boris Johnson est empêtré dans le Brexit, ses mensonges et ses frasques.
Je trouve bien imprudent celles et ceux qui croient que devant un tel personnage, quelques concessions bien présentées auraient pu le contenter.
Les concessions auraient certainement entrainé chez lui d’autres exigences.
Toute cette situation me fait penser à une conférence de presse de Georges Pompidou, lors de sa présidence.
J’étais fort jeune alors, mais je m’en souviens encore.
Je ne me souviens plus de la question mais de la réponse du Président :
« La meilleure preuve qu’il voulait la guerre, c’est qu’il s’en défendit ! »
<1664>
-
Vendredi 4 mars 2022
« Babi Yar »Poème de Evgueni Evtouchenko mis en musique par Dimitri Chostakovitch (13ème symphonie)Finalement le mémorial de Babi Yar n’a pas été touché par le bombardement russe qui a endommagé la tour de la télévision de Kiev.
Car une tour de télévision a été érigé à côté de Babi Yar, ou Babyn Yar en ukrainien et qui signifie « ravin des vieilles femmes ».
Dans un article publié sur le site de « Science Po » qui raconte ce qui s’est passé en ce lieu, il y a un peu plus de 80 ans, on lit :
« Pendant des siècles, ce nom n’a désigné qu’une des petites vallées escarpées situées juste au nord-ouest de Kiev (Kyiv), opposant un obstacle naturel aux envahisseurs. Cette formation géologique consistait en neuf éperons rocheux se dirigeant vers l’est et l’ouest sur environ un kilomètre et présentant des versants abrupts d’une dizaine de mètres de dénivelée. »
Babi Yar qui se situe donc à Kiev, est le lieu du plus grand massacre par balles, mené par les Einsatzgruppen allemands en URSS.
En 36 heures, 33 771 Juifs furent assassinés par les nazis les 29 et 30 septembre 1941 aux abords du ravin de Babi Yar à Kiev.
Près de mille êtes humains massacrés chaque heure !
En Ukraine 1 millions et demi de juifs seront assassinés dont 80 % par la shoah par balle.
<Cette page de France 24> publié en septembre 2021, pour la commémoration des 80 ans de ce crime, évoque le massacre ainsi que le site mémoriel qui existe aujourd’hui.
En 1961, il n’y avait de monument à Babi Yar.
<Wikipedia> qui décrit aussi de manière détaillée cette plaie ouverte dans notre humanité rapporte :
« Les autorités soviétiques préfèrent occulter le caractère antisémite de cette action ; après la libération de Kiev le 6 novembre 1943, les victimes juives sont présentées comme des « citoyens soviétiques pacifiques » que l’on a assassinés. Dans l’URSS de Staline et de Khrouchtchev, la singularité de la souffrance juive ou arménienne doit être gommée, noyée dans un vécu partagé avec la totalité du peuple soviétique. Il existe donc peu de témoignages et de mémoires de ce massacre à la suite de la vague d’antisémitisme et de censure que fit déferler Staline dès 1948, la mémoire de l’anéantissement des Juifs officiellement effacée devint un thème tabou jusqu’à la Perestroïka. […]
Du temps de l’URSS, les rares monuments évoquaient des crimes contre les citoyens soviétiques. D’ailleurs, il a fallu attendre le poème d’Evgueni Evtouchenko en 1961 pour que ce massacre sorte de l’oubli. »Ce mot du jour va surtout parler du poème d’Evgueni Evtouchenko et de sa mise en musique par Dimitri Chostakovitch.
Evgueni Evtouchenko, né en 1932 près d’Irkoutsk en Russie est mort en 2017 aux États-Unis. C’est un poète russe, qui fut aussi acteur, photographe et réalisateur de cinéma.
<Wikipedia> le présente ainsi :
« Représentant emblématique de la génération du dégel intellectuel après la mort de Staline, il fut l’une des premières voix humanistes à s’élever en Union soviétique pour défendre la liberté individuelle. »
En 1961, Evtouchenko n’avait pas encore 30 ans. C’est un ami qui l’a emmené à Babi Yar :
« Mon ami m’a conduit de haut en bas de ces ravins, collines et ruisseaux où, à l’époque, il était encore possible de trouver des os humains »,
L’histoire de ce qui s’était passé à Babi Yar en septembre 1941 n’était pas bien connue ; ce n’est que ce jour-là qu’Evtouchenko a pris connaissance des dizaines de milliers de Juifs que les nazis avaient tués.
Evtouchenko était abattu. Il a remarqué qu’il n’y avait pas de mémorial, aucun repère racontant cette histoire, datant cette exécution de masse inimaginable ou identifiant les morts. Le lendemain, assis seul dans sa chambre d’hôtel, il a écrit un poème intitulé « Babi Yar » sur des bouts de papier.
Le poème fut publié en septembre 1961 dans Literaturnaya Gazeta, suscitant l’indignation générale. Evtouchenko a reçu d’innombrables télégrammes et lettres de protestation de toute la Russie dans la mesure où il s’agissait du premier poème paru dans la presse soviétique dénonçant un antisémitisme durable et confrontant l’un des moments les plus sombres du pays.

Un jour, au début de 1962, Evtouchenko a reçu un appel de Chostakovitch (à qui il n’avait encore jamais parlé) lui demandant la permission de mettre « Babi Yar » en musique.
Il a accepté l’offre de ce musicien plus âgé et qu’il admirait.
Chostakovitch a alors avoué que la partition était déjà terminée et il lui a demandé de se rendre immédiatement chez lui.
Evtouchenko a écouté le compositeur jouer sa partition au piano, chantant ses mélodies incantatoires d’une voix hantée et éraillée.
Quand il est arrivé au vers « J’ai l’impression d’être Anne Frank », Chostakovitch pleurait. La musique qu’Evtouchenko a entendue ce jour-là capturait ce qu’il imaginait en écrivant ces mots :
« Ce fut une expérience extraordinaire, étrange. Grâce à un aperçu télépathique magique [Chostakovitch] semblait avoir tiré la mélodie de moi et l’avoir enregistrée en notations musicales…. Sa musique a rendu le poème plus important, plus significatif, plus puissant. Bref, c’était devenu un bien meilleur poème. »
Ni l’un, ni l’autre était juif, mais l’antisémitisme, très présent en Russie, les révulsait tous deux.
En mars 1962, Chostakovitch a conçu le poème comme une pièce en un mouvement pour voix basse, chœur d’hommes et orchestre.
C’est par cette œuvre bouleversante, saisissante que je suis entré dans le monde de Chostakovitch et que j’ai compris qu’il s’agissait d’un des plus grands compositeurs de l’Histoire.
C’est aussi avec cette œuvre que j’ai appris l’existence de Babi Yar et de ce qui s’y était passé.
Cette musique sera le premier mouvement de sa symphonie N° 13 qui portera le nom du poème « Babi Yar ».
C’est encore l’Art, la puissance du texte et la pulsation de la musique qui permet le mieux de décrire cette chose innommable, inconcevable, inracontable.
La symphonie 13 fut complétée par d’autres poèmes d’Evtouchenko
Mais c’est le premier mouvement qui va soulever les plus grandes difficultés, en raison du poème.
J’ai appris que même le grand chef et ami de Chostakovitch, Evgueni Mravinski, le seul sur terre que Karajan admettait être de son rang, n’a pas accepté d’assurer la première de cette œuvre qui fut finalement créé par Kirill Kondrachine.
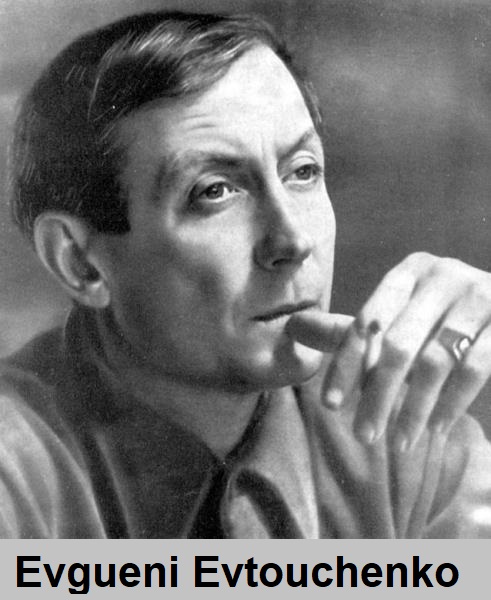 Avant la création de la symphonie, Evtouchenko était sous le feu de fréquentes et violentes attaques pour avoir laissé entendre que seules des victimes juives étaient mortes à Babi Yar et que l’antisémitisme persistait en Union soviétique.
Avant la création de la symphonie, Evtouchenko était sous le feu de fréquentes et violentes attaques pour avoir laissé entendre que seules des victimes juives étaient mortes à Babi Yar et que l’antisémitisme persistait en Union soviétique.
A l’époque le secrétaire général du Parti Communiste était Nikita Khrouchtchev. Lors d’une réception au Kremlin, Khrouchtchev s’est lancé dans une diatribe, disant à Evtouchenko qu’il avait tort d’avoir soulevé la question de Babi Yar et que la musique écrite par Chostakovitch n’était rien d’autre que du jazz qui lui donnait mal au ventre.
Après le remplacement, en dernière minute, de la basse qui a refusé de chanter, la première eut finalement lieu.
La loge officielle du gouvernement est restée vide tout au long du spectacle.
Le livret du programme ne comprenait pas les textes d’Evtouchenko
La totalité de la place à l’extérieur du grand hall du Conservatoire de Moscou a été bouclée par la police et un plan de télédiffusion du concert a été abandonné.
La Pravda ne publia aucun article sur le concert, signalant juste le concert par une phrase dans une rubrique de brèves.
Finalement, les autorités russes obligèrent les deux artistes à modifier le poème pour pouvoir continuer à jouer la symphonie. Aujourd’hui, la symphonie se joue avec le poème originel.
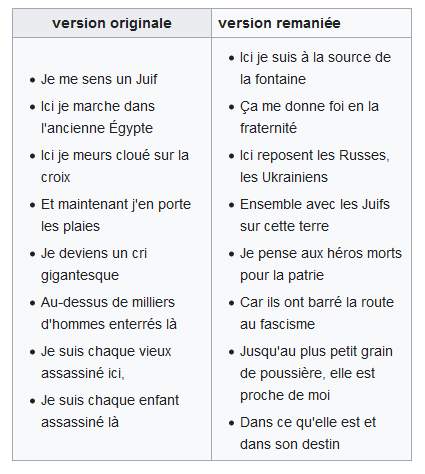 Chostakovitch a dit :
Chostakovitch a dit :
« Les gens savaient ce qu’il [s’était produit à Babi Yar, même avant le poème de Evtouchenko, mais ils ont décidé de se taire. Le texte de cette symphonie a brisé le silence. L’art détruit le silence »
L’Art détruit le silence !
J’ai pu révéler tous ces détails grâce à Phillip Huscher qui est musicologue et qui annote les programmes du Chicago Symphony Orchestra.
Voici le poème de Evgueni Evtouchenko :
« Au-dessus de Babi Yar, il n’y a pas de monument :
L’escarpement est comme une grosse pierre tombale.
J’ai peur,
Aujourd’hui je me sens
Aussi ancien que le peuple juif.
Je me sens comme si . . . me voilà Juif.
Me voilà errant dans l’Egypte ancienne.
Et me voilà pendu sur la croix, mourant,
Et je porte encore la marque des clous.
Me voilà . . . Dreyfus, c’est moi.
La canaille bourgeoise me dénonce et me juge !
Je suis derrière les grilles, je suis encerclé,
Persécuté, conspué, calomnié.
Et les belles dames, avec leurs franfreluches,
Gloussant, m’enfoncent leurs ombrelles dans la face.
Je me sens . . . me voilà, petit garçon à Bielostok.
Le sang coule, maculant le plancher.
Les meneurs dans la taverne passent aux actes.
Leurs haleines puent la vodka et l’oignon.
Un coup de botte me jette par terre ; prostré
En vain je demande grâce aux pogromistes.
Ils s’esclaffent : « Mort aux youpins ! Vive la Russie ! »
Un marchand de grain bat ma mère.
O, mon people russe, je sais
Qu’au fond du cœur tu es internationaliste,
Mais souvent, ceux—là dont les mains sont sales
Ont souillé ta bonne renommée.
Je sais que mon pays est bon.
Quelle infamie que, sans la moindre honte,
Les antisémites se soient proclamés
« L’Union du Peuple Russe ».
Me voilà . . . Anne Franck,
Translucide, telle une jeune pousse en avril,
Et j’aime et j’ai besoin non pas de mots,
Mais que nous nous regardions l’un l’autre.
Nous avons si peu à voir, à sentir !
Les feuilles et le ciel ne sont plus pour nous,
Mais nous pouvons encore beaucoup—
Nous embrasser tendrement dans cette sombre chambre!
« Quelqu’un vient ! »
« N’aie pas peur. Ce ne sont que les murmures
Du printemps qui arrive.
Viens à moi,
Donne-moi tes lèvres, vite ! »
« Ils cassent la porte! »
« Non ! C’est la glace qui rompt ! »
Au-dessus de Babi Yar bruit l’herbe sauvage,
Les arbres menaçants ressemblent à des juges.
Ici, en silence, tout hurle,
Et, me découvrant,
Je sens mes cheveux blanchir lentement.
Et je deviens un long cri silencieux
Au-dessus des milliers et milliers d’ensevelis.
Je suis chaque vieillard ici fusillé,
Je suis chaque enfant ici fusillé.
Rien en moi, jamais, ne pourra l’oublier.
Que « l’Internationale » retentisse
Quand pour toujours on aura enterré
Le dernier antisémite de la terre.
II n’y a pas de sang juif dans mon sang
Mais sur moi pèse la hideuse haine
De tous les antisémites comme si j’étais un Juif :
Et voilà pourquoi je suis un vrai Russe ! »
Evgueni Evtouchenko
J’ai trouvé <cette vidéo> dans laquelle Evgueni Evtouchenko dit son poème en russe. Je ne comprends pas la langue et pourtant l’émotion me saisit, quand je vois et entends ce vieil homme dire son poème écrit dans l’hostilité mais grâce à sa force intérieure et la lucidité de son émotion.
L’année dernière, pour les commémorations des 80 ans, un orchestre allemand et des chœurs ukrainiens sous la direction de Thomas Sanderling, sur le lieu de Bai Yar, interprètent <La 13ème symphonie de Chostakovitch « Babi Yar »> sur le poème d’Evgueni Evtouchenko. Pendant toute la durée du concert, sur deux écrans de chaque coté de l’orchestre, l’interminable liste des victimes défile.
<1663>
-
Jeudi 3 mars 2022
« Guerre : quand un mot redécouvre son sens propre. »Clément ViktorovitchHier soir, le Président Macron a dit :
« Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. »
C’est factuellement exact.
Camus a écrit : « Mal nommer un objet c’est ajouter au malheur de ce monde, car le mensonge est justement la grande misère humaine, c’est pourquoi la grande tâche humaine correspondante sera de ne pas servir le mensonge. »
Mais il y a bien la guerre sur le continent européen.
Hier, je citais Clausewitz qui conceptualisait « la montée aux extrêmes » quand deux puissances s’affrontaient dans une lutte pour leur existence.
De manière moins martiale, quand nous parlons nous avons aussi parfois tendance quand nous voulons dire notre colère, notre sidération ou notre perception de l’importance d’un évènement, de faire monter la rhétorique aux extrêmes.
C’est particulièrement le cas pour le mot « guerre ».
Ces dernières années, nous avons fait la guerre au virus. Le Président Macron, moins mesuré de ce temps-là, c’était il y a deux ans, s’est exclamé :
« Nous sommes en guerre ! »
Lors du mot du jour du <19 mars 2020>, j’avais repris le beau texte de Sophie Mainguy : « Nous ne sommes pas en guerre et n’avons pas à l’être ».
Après le 11 septembre 2001, George W. Bush a déclaré la guerre contre la terreur.
Et lors des attentats qui ont frappé le sol français, beaucoup de responsables ont affirmé « Nous sommes en guerre ! ».
C’était faux, nous n’étions pas en guerre alors.
Dans le monde commercial ou publicitaire, on parle aussi souvent de guerre, notamment de guerre des prix.
Par exemple cet article : « La guerre des prix fait rage sur les smartphones 5G ». D’autres veulent faire la guerre au gaspillage.
Mal nommer un objet…
Clément Viktorovitch dans son émission « Entre les lignes du 24/02/2022 » a remis le nom de l’objet à l’endroit, redonné le sens exact, on dit propre, du mot « guerre » :
« En droit international, la guerre se définit comme un conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués, et notamment des États : c’est ce qui se passe entre la Russie et l’Ukraine. Mais ce qui est intéressant, c’est justement que nous semblons presque redécouvrir, en Europe, le sens véritable de ce mot.
Voilà près de 20 ans, en effet, qu’il est utilisé dans le débat public de manière plus ou moins métaphorique. Tout a commencé le 20 septembre 2001, quelques jours après l’attaque contre le World Trade Center, le Président George W. Bush déclare la guerre contre la terreur. Or, la terreur n’est pas un groupe politique constitué. C’est une stratégie, un moyen : on « lutte » contre, mais on ne lui fait pas « la guerre ».
Le mot, ici, était déjà employé en partie dans un sens métaphorique. En partie parce que, de fait, cette déclaration a été suivie d’une série d’interventions militaires à l’extérieur, en Afghanistan puis en Irak. En revanche, sur le sol américain, son emploi était contestable. D’ailleurs, il y a un autre contexte, similaire, dans lequel cette expression a été employée : c’est en France, à la suite des attentats de 2015 par le Premier ministre de l’époque Manuel Valls. « La France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l’islamisme radical ».
Cette phrase a été très critiquée, à l’époque, par une partie des chercheurs en relations internationales. Jean-Baptiste Jeangene Vilmer, le directeur de l’Institut de recherche stratégique de l’École Militaire, l’a par exemple qualifié de « non-sens sémantique », en rappelant que si la France était bien »en guerre » contre les terroristes du Nord Mali, elle ne l’était pas sur son sol. À force de parler de guerre pour évoquer autre chose qu’un conflit armé, on a fini par en diluer le sens. »
Comme le dit Clément Viktorovitch, c’est un mot trop lourd pour être utilisé avec légèreté
Et il ajoute :
« Maintenant qu’elle frappe l’Europe sur son sol, nous redécouvrons la guerre dans toute sa matérialité. Les bombardements aveugles, les déplacements de population, les morts. Cette réalité qui n’est que trop familière pour tant d’hommes et de femmes qui la subissent chez eux, mais que nous regardions d’au loin, sans trop y prêter attention. Peut-être cela serait-il une bonne occasion pour réfléchir, aussi, à la manière dont nous parlons. La guerre est un mot trop lourd pour être invoqué avec légèreté. »
Il existe d’autres mots lourds qu’il n’est pas raisonnable d’invoquer avec légèreté, par exemple le mot « dictature » que certains ont eu tendance à beaucoup utiliser en France.
Ils nommaient mal un objet…
<1662>
-
Mercredi 2 mars 2022
« Guernica »Pablo PicassoLe 1er mars, tous les journaux en faisaient mention : un convoi militaire russe long de plusieurs dizaines de de kilomètres était en route. Le plus souvent on parlait de 60 km, une autre source donnait 27 kilomètres.
 <Le Monde> écrit :
<Le Monde> écrit :
« [un convoi militaire russe d’une soixantaine de kilomètres se dirige vers Kiev] Des images satellites prises lundi 28 février en Ukraine montrent un immense convoi militaire russe qui s’étend sur plus de 60 kilomètres au nord-ouest de la capitale Kiev, objectif militaire de première importance pour la Russie dans son offensive dans le pays.
Le convoi « s’étend des abords de l’aéroport « Antonov » [aéroport d’Hostomel, à environ 25 kilomètres du centre de Kiev] au sud aux alentours de Prybirsk » au nord, a fait savoir lundi soir la société américaine d’imagerie satellitaire Maxar dans un courriel.
Cet aéroport est, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le théâtre de violents affrontements, l’armée de Vladimir Poutine tentant de s’emparer de cette infrastructure stratégique pour la prise de la capitale. Dans le convoi capturé par images satellites, qui s’étend sur environ 64 kilomètres, « certains véhicules sont parfois très distants les uns des autres, et sur d’autres portions les équipements militaires sont positionnés à deux ou trois de front », ajoute Maxar. »
Vous vous souvenez d’une colonne militaire, beaucoup plus modeste, qui se dirigeaient vers Benghazi, en Libye, en 2011.
C’était un autre mâle alpha, un autre dictateur : Mouammar Kadhafi qui avait décidé cette manœuvre.
Samedi 19 mars 2011, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont alors lancé des raids aériens pour détruire cette colonne menaçante et Benghazi avait été épargné.
Bien entendu, rien d’identique ne se réalisera pour sauver Kiev. Khadafi n’avait pas à sa disposition l’arme nucléaire.
De toute façon, il n’est pas raisonnable d’entrer dans cette guerre, c’est-à-dire aller vers la guerre totale, ce que Karl von Clausewitz conceptualisait par l’expression « montée aux extrêmes », comme l’avait révélé René Girard dans son dernier ouvrage : « Achever Clausewitz »
D’ailleurs Nicolas Sarkozy….
Un petit instant… C’était Nicolas Sarkozy qui était à la manœuvre et qui a élaboré le récit et pris les décisions pour que les avions occidentaux détruisent la colonne vers Benghazi, puis continue jusqu’à la chute du dictateur, déclenchant alors l’ire de Poutine qui n’avait donné son accord que pour l’étape initiale.
Donc Nicolas Sarkozy qui a vieilli et probablement est devenu plus sage, déclarait à la sortie d’une entrevue avec Emmanuel Macron, le 25 février :
« La seule voie possible est la diplomatie, car l’alternative à la diplomatie c’est la guerre totale »
Et il a ajouté :
« La voie du dialogue, de la diplomatie est difficile, souvent décevante, mais il n’y a pas d’alternative. Il faut donc continuer dans cette voie. Et si la France ne le fait pas, personne ne le fera »
Cette fois, il a parfaitement raison. Il ne suit donc plus les conseils de Bernard Henry Levy qui voudrait repartir comme à Benghazi mais que Dominique de Villepin a sèchement remis à sa place sur <France 2>, finissant sa charge par ces mots :
« Je ne crois pas que la posture sur les plateaux de télévision soit la bonne réponse ».
Peut-être que si les États de l’Union européenne n’avaient pas désarmé, en s’en remettant entièrement au bouclier américain, Poutine n’aurait pas osé attaquer l’Ukraine.
C’est probablement parce qu’il a la conviction de notre faiblesse qu’il a pris l’option militaire.
A ce stade, il est trop tard, il serait totalement irraisonnable d’intervenir militairement. C’est à l’après qu’il faut nous intéresser, comme le disait Dominique Moïsi.
Ce qui signifie donc que cette colonne militaire va atteindre Kiev et probablement submerger les défenses ukrainiennes.
Certains analystes, connaissant le déchainement de violence dont sont capables les hordes poutiniennes, s’étonnait de la mesure relative et actuelle que l’aviation russe observait par rapport aux civils et au bombardement des centres villes.
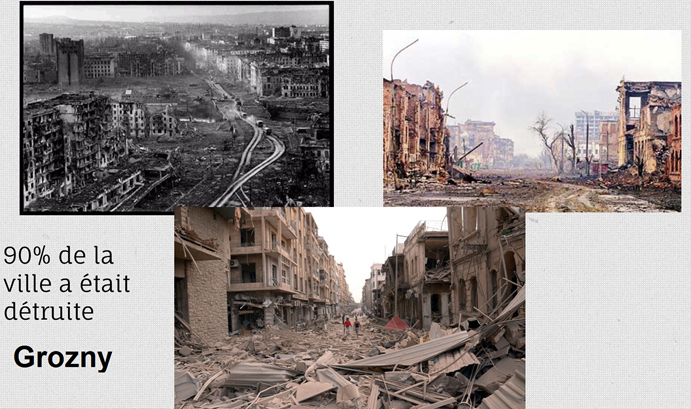 Il faut se rappeler dans quel état les troupes russes avaient laissé la capitale de la Tchétchénie : Grozny ou encore Alep en Syrie après leur bombardement.
Il faut se rappeler dans quel état les troupes russes avaient laissé la capitale de la Tchétchénie : Grozny ou encore Alep en Syrie après leur bombardement.
Peut-être que cette relative retenue était due au fait que les troupes russes avaient en face ceux qu’ils appellent « leurs frères ukrainiens ».
Il est à craindre, qu’en raison de la résistance ukrainienne, l’horreur augmente.
Camille Magnard dans <La Revue de presse internationale> du 1er mars raconte :
« Au sixième jour de la guerre, l’heure ne semble plus aux attaques-éclairs menées par des véhicules isolés, envoyés en première ligne pour percer (sans succès) les défenses ukrainiennes. Face aux déconvenues et à la frustration des premiers jours, Moscou s’apprête, selon le quotidien allemand Die Welt, à lancer « la seconde phase de son assaut », une nouvelle tentative de percée militaire vers la capitale ukrainienne, mais cette fois, avec une force de frappe beaucoup plus massive et des soutiens logistiques, derrière la ligne de front, qui pourraient permettre à l’armée russe de tenir le siège pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines.
« La guerre est entrée dans une nouvelle phase », confirme The Economist, et désormais plus aucune illusion n’est possible sur le fait que les Russes visent et tuent bien des cibles civiles, contrairement à ce que Vladimir Poutine assurait hier encore au téléphone à Emmanuel Macron. Pour preuve, il suffit de regarder les images du pilonnage de quartiers résidentiels pendant des heures hier dans la ville de Kharkiv, la seconde plus grosse du pays. On dénombre, au bas mot, 11 civils morts. « Si les frappes russes évitaient jusque-là les quartiers les plus peuplés pour se concentrer sur les cibles militaires, la donne a changé pour le pire à Kharkiv », explicite le New York Times. Bien sûr, ce ne sont pas (encore) les tapis de bombes que les Russes avaient fait tomber sur Grozny en Tchétchénie en 1999 ou plus récemment sur Alep en Syrie en 2016. Mais c’est bien cela, la menace qui est contenue dans cette montée en puissance de l’artillerie et des forces aériennes utilisées pour la première fois sur des civils hier à Kharkiv : bien plus que de faire tomber la ville sous contrôle russe, il s’agit de semer la terreur et de faire pression sur les négociations qui ont péniblement débuté ce lundi 28 février, sans donner pour le moment aucun résultat probant.
Dans le même registre, l’Ukraine accuse l’armée russe d’utiliser des armes interdites par le droit international. La presse ukrainienne, à l’image du quotidien Sohodny, évoque – et c’est une première depuis le début de la guerre – d’importantes pertes militaires : dans la petite ville de Okhtyrka, au nord-ouest de Kharkiv, « on a préparé 70 nouvelles places au cimetière » pour y enterrer les 70 soldats (là encore c’est une estimation basse) tués dans le bombardement de leur caserne. Les Russes auraient utilisé des armes thermobariques, un type de bombe particulièrement destructeur qui combine explosion, onde de choc et effet de dépression pour ensuite causer un maximum de dégâts sur les installations militaires et sur les hommes. Selon les experts militaires, c’est le niveau juste avant l’arme nucléaire, en terme de létalité.
Des journalistes avaient bien repéré, avec effroi ces derniers jours sur les routes ukrainiennes, l’énorme camion qui transporte le lance-roquette à têtes thermobariques TOS-1, mais jamais jusque-là on avait eu la preuve qu’ils avaient été utilisés dans ce conflit. C’est apparemment chose faite à Okhtyrka, selon les autorités ukrainiennes… et, tout comme les civils bombardés à Kharkiv, cela pose la question des violations de la Convention de Genève par la Russie »
Que dire devant cette sauvagerie ?
Probablement en revenir à l’Art.
A une œuvre qui fait partie de l’Histoire de l’Humanité.
Une œuvre réalisée par Pablo Picasso (1881-1973)
Pablo Picasso a peint son tableau peut être le plus célèbre « Guernica » en 1937. Guernica est une petite ville basque qui a été détruite par des bombardements qui annoncent ceux de la seconde guerre mondiale. Pour L’Allemagne nazie, il s’agit d’une sorte de répétition. Mais le monde d’alors n’avait pas connu un tel déchainement de violence sur une ville peuplée de civils. Hitler et Mussolini, par cet acte veulent affirmer leur soutien officiel aux nationalistes de Franco face aux Républicains.
Guernica, en ruine, compte des centaines de morts et de blessés, tous civils. Picasso, exilé à Paris, prend connaissance du drame dans les journaux. Troublé par les récits qu’il lit et les photographies qu’il voit, il crée Guernica comme il pousserait un énorme cri de colère face à la folie de l’humanité. On raconte même que lorsque l’ambassadeur nazi Otto Abetz a demandé à Picasso devant une photo de Guernica :
« C’est vous qui avez fait cela ? », l’artiste a répondu : « Non… vous »
En 1939, alors que la guerre fait rage, Pablo Picasso confie son œuvre au Museum of Modern Art de New York, connu sous l’acronyme MoMA, inauguré 10 ans auparavant.
Picasso veut que « Guernica » rejoigne plus tard l’Espagne mais uniquement quand la démocratie sera rétablie.
En 1981, après la mise en place d’une Constitution et d’un gouvernement démocratique en Espagne, ce projet sera accompli.
Le tableau n’a plus quitté Madrid depuis. Il se trouve au musée Reina Sofia.

Sur ce <site> vous trouverez une description et analyse de cette œuvre mythique.
L’histoire de ce tableau nous apprend aussi qu’il y aura un Après-Poutine et qu’en attendant il nous faut tenter de devenir moins naïf.
Et aussi accepter de payer le prix pour ne pas se trouver démuni le jour où des prédateurs auront la tentation de nous considérer comme des proies.
Je suis très surpris du discours de Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée Nationale ce mardi, non pas la première partie, mais la seconde dans laquelle il reprend la posture de l’herbivore dans un monde de carnivore.
<1661>
-
Mardi 1 mars 2022
« La guerre, aujourd’hui, revient au cœur de l’Europe. Nous avons perdu ce 24 février notre innocence »Dominique MoïsiLes analyses du politologue Dominique Moïsi sont toujours d’un grand intérêt.
Trois mots du jour ont déjà partagé ses réflexions :
- Sur le conflit israélo-palestinien : <19/10/2015>
- Sur la guerre en Syrie <06/10/2015>
- Sur les relations Europe – Etats-Unis : <30/06/2015>
« Le Point » l’a interrogé sur ce que l’invasion de l’Ukraine par les russes pose comme questions : « L’histoire bascule aujourd’hui » .
Du haut de ses 75 ans, il est né le 21 octobre 1946 à Strasbourg, il peut nous nous distiller les fruits de son expérience :
« Oui, nous sommes clairement à un point de bascule historique car, pour la première fois depuis 1945, au cœur de l’Europe, un pays est envahi par un autre pour l’asservir complètement en niant son droit d’existence. Il y a bien sûr eu des moments violents depuis 1945 en Europe. Je pense en particulier aux conflits dans les Balkans, dans l’ex-Yougoslavie. Mais cela n’était que l’éclatement d’un empire. Donc oui, l’invasion de l’Ukraine par la Russie marque un tournant historique majeur. C’est la fin de la période d’après-Seconde Guerre mondiale. Celle-ci se décompose d’ailleurs en deux phases : une guerre froide, de 1945 à 1989, et une paix chaude, de 1989 à nos jours. »
Hubert Vedrine le répète, le leadership de l’Occident est de plus en plus contesté. C’est-à-dire que ce n’est plus l’Occident qui dit ce qui est bien et mal ou plus exactement il continue à vouloir le dire mais il n’est plus écouté.
Et Védrine a même rapporté dans un entretien que j’ai entendu tout récemment que des intellectuels chinois ne parlent pas du « déclin occidental » mais de « la fin de la parenthèse occidentale ».
Poutine se place aussi dans cette perspective, c’est ce que pense Dominique Moïsi :
« Les régimes autoritaires ont une vision très négative de l’Occident. Ils voient notamment les démocraties américaine et européennes comme des systèmes politiques absolument inadaptés à notre époque. Dans l’esprit de Vladimir Poutine, des événements, ces derniers mois, n’ont fait que confirmer la vision décadente qu’il a des États-Unis. Je pense en particulier à la marche des trumpistes sur le Capitole le 6 janvier 2021 et à la reprise de Kaboul par les talibans le 15 août dernier. Une décadence intérieure et extérieure. »
Pour Dominique Moïsi la défaite de l’Ukraine semble inéluctable et à court terme. Ce qui lui semble essentiel, c’est penser l’après asservissement de l’Ukraine par les russes :
« Aujourd’hui, mieux vaut penser au coup d’après, à savoir faire en sorte que Vladimir Poutine n’aille pas au-delà de l’Ukraine. Car les prochaines victimes potentielles sont les États baltes de Lettonie, de Lituanie et d’Estonie. Ces républiques, pour mémoire, font à la fois partie de l’Union européenne et de l’Otan. Si la Russie allait jusque là-bas sans susciter une forte réaction occidentale, alors ce serait la fin de l’Alliance atlantique. »
Les dernières heures ont cependant montré un grand dynamisme des européens pour sanctionner les russes et le soft power n’est pas en reste avec le monde sportif qui exclut la Russie des compétitions et le monde des arts qui écarte les artistes proches de Poutine et qui refuse de contester son attitude.
En cas de victoire de Poutine, il faudra conserver les sanctions si l’Europe veut être cohérent avec les motifs de leur déclenchement.
Mais est ce que les sanctions économiques feront plier Poutine avant les gouvernements européens qui vont probablement se trouver contesté par des populations soumises à des difficultés de pouvoir d’achat de plus en plus importantes. Surtout que cet épisode vient après la crise de la COVID qui a déjà eu un grand impact sur la vie des gens.
Pour Moïsi les deux grandes conséquences de ce conflit sont le renforcement de la Chine et un renforcement de l’Union européenne :
« Dans un futur proche, ce conflit entre la Russie et le monde démocratique est un don de Dieu pour la Chine. Elle a depuis bien longtemps l’ambition de redevenir un grand empire. Grâce aux Occidentaux d’abord et à Poutine ensuite, son projet de retour au premier plan s’est considérablement accéléré. Le centre de gravité géopolitique sera désormais en Asie. Ce conflit a cependant une vertu. Poutine nous force à l’union. Les tentations illibérales de la Pologne n’ont plus beaucoup de sens quand les chars russes sont pratiquement à la frontière. Continuera-t-elle sérieusement à dénoncer le supposé impérialisme juridique de Bruxelles ? »
Il fait aussi le parallèle entre Poutine et Hitler, comme je l’avais écrit dans le mot du jour de vendredi et insiste sur le fait comme lui, il avait écrit ce qu’il ferait :
« Hélas, quand vous regardez les images qui nous parviennent d’Ukraine, vous voyez de vieilles femmes et des enfants errant dans la rue à la recherche d’un abri. Les fantômes du passé, c’est l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie en 1939. Oui, il y a un parallèle entre Poutine et Hitler, c’est net. Les deux ont dit clairement ce qu’ils avaient l’intention de faire : l’un, Hitler, dans son livre Mein Kampf ; l’autre, Poutine, dans une série de discours et dans un article. »
Bien évidemment cet évènement aura de grandes conséquences dans nos vies : psychologiquement et économiquement.
« La première est psychologique, et c’est d’ailleurs la plus importante. Nous allons vivre désormais à l’ombre d’une guerre qui peut, un jour, nous concerner. Les guerres étaient jusqu’ici réservées au Moyen-Orient, comme l’Irak, le Yémen ou la Syrie, ou à l’Asie, comme au Myanmar, sans oublier bien sûr l’Afghanistan. La guerre, aujourd’hui, revient au cœur de l’Europe. Nous avons perdu ce 24 février notre innocence.
La guerre n’est plus du passé.
C’est le présent de l’Ukraine.
C’est peut-être notre futur.
La seconde conséquence durable est économique. Le prix du pain sera plus cher. Le prix du chauffage sera plus cher. La tension maximale dans laquelle nous sommes est mauvaise pour l’économie mondiale. »
<1660>
- Sur le conflit israélo-palestinien : <19/10/2015>
-
Lundi 28 février 2022
« Je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition c’est qu’elles le veuillent ! »Raymond Aron cité par Nicolas BaverezC’est incroyable et terrifiant !
Vous passez par l’Allemagne notamment par Dresde, puis vous traversez la Pologne en passant par Varsovie et vous vous trouvez sur la frontière est de l’Union européenne.
Et là se trouve un État démocratique, un peuple citoyen qui choisit librement son président et ses députés.
Bref, un pays qui nous ressemble.
Ce pays est sous les bombes, les missiles de l’armée de son voisin qui n’est pas une démocratie, tout au plus une démocrature, c’est-à-dire une dictature qui se donne l’apparence d’une démocratie.
 L’Ukraine est sous les bombes et menacée par une armée d’hommes capables de tout, déguisés en civil ou en soldat ukrainien. Cette armée est accompagnée d’une milice tchétchène, c’est-à-dire des nervis qui ont prêté allégeance à Poutine quand il a détruit leur pays et rasé Grozny leur capitale., parce qu’ils préféraient être dans le camp du fort et du vainqueur. Pour lui être agréable, ils ont accepté de faire toutes les basses besognes, trop vil pour un soldat russe.
L’Ukraine est sous les bombes et menacée par une armée d’hommes capables de tout, déguisés en civil ou en soldat ukrainien. Cette armée est accompagnée d’une milice tchétchène, c’est-à-dire des nervis qui ont prêté allégeance à Poutine quand il a détruit leur pays et rasé Grozny leur capitale., parce qu’ils préféraient être dans le camp du fort et du vainqueur. Pour lui être agréable, ils ont accepté de faire toutes les basses besognes, trop vil pour un soldat russe.
En parallèle, circule parmi eux une liste de 100 ukrainiens dont il faut se débarrasser, parmi eux bien sûr le président Volodymyr Zelensky.
Il faut s’en débarrasser, afin qu’il soit plus simple de transformer le régime de l’Ukraine, en démocrature.
Parce que c’est le premier crime de l’Ukraine ! Ce pays aux marches de l’empire russe, démontre qu’un État proche dans la culture, la religion, l’histoire du peuple russe est capable de désigner ses dirigeants après des élections libres, élections qui peuvent même renvoyer le président sortant.
Il y a bien un second crime : ce pays veut être indépendant, choisir librement ses alliances et ne pas se soumettre à son irascible et surarmé voisin, puissance impériale de toujours dont il connaît historiquement le joug et la cruauté (cf. Holodomor).
Et nous assistons à cela, nous laissons faire !
Un tyran qui utilise sa force supérieure et ses forces du mal (milice tchétchène) pour écraser et massacrer des gens qui nous ressemblent, qui sont nos amis.
Il en est même dans nos rangs qui ont, depuis des années, encensé le criminel de guerre qui se terre dans son palais du Kremlin.
Jean François Kahn, dans un article publié le 26 février : <Poutine centre de la présidentielle> dresse ce constat accablant :
« C’est un fait : celles et ceux qui, en France, ne cachaient pas une certaine proximité idéologique ou géopolitique avec Vladimir Poutine et avaient, en conséquence, tendance, au début de la crise ukrainienne, à manifester beaucoup de compréhension à l’égard de la position russe, représentaient 45 % des intentions de vote à l’élection présidentielle. C’est Emmanuel Macron, et non le nouveau tsar de Moscou, qui était alors l’objet de leur vindicte (et encore samedi, en plein assaut sur Kiev, sur les sites des médias conservateurs, la majorité des réactions étaient beaucoup plus anti-Macron qu’anti-Poutine).
Selon Marine Le Pen, la présidence française était totalement dépendante des exigences américaines ; selon Jean-Luc Mélenchon, Macron agissait en petit télégraphiste de l’Otan ; selon Éric Zemmour, quand le président tenta de négocier avec un maître du Kremlin, plus fort que lui, il se comportait comme un petit garçon ridicule (et samedi, Mélenchon reprenait à son compte les mêmes termes). Aucun des trois ne croyait à une invasion militaire de l’Ukraine et tous criaient à la désinformation et à l’enfumage.
Alors, depuis que Poutine a violé les frontières de la souveraineté ukrainienne, ils ont concédé que ce n’était pas bien. Jean-Luc Mélenchon a même condamné fermement. Mais pour très rapidement crier à la folie de la course aux armements des allemands.
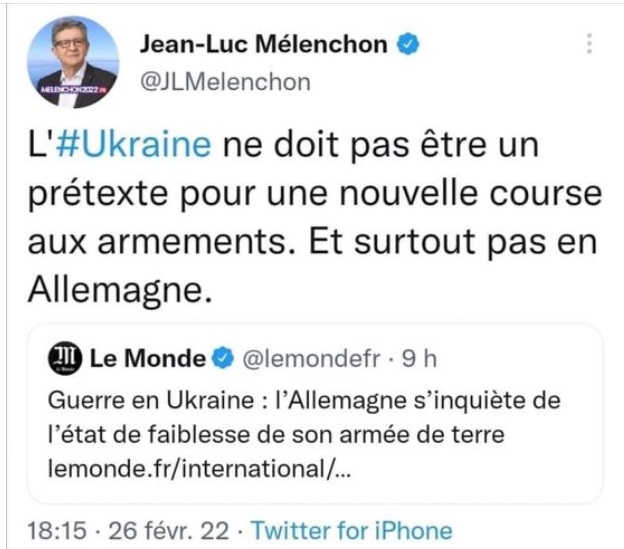 Parce que l’Allemagne a dû reconnaître que « Le sous-investissement chronique de la Bundeswehr la rend peu opérationnelle. » et a donc décidé d’augmenter le budget de la défense à 2% du budget. L’armée française est un peu mieux dotée, mais selon un rapport du Sénat elle ne pourrait opposer qu’un nombre dérisoire de bataillons opérationnels en face de l’armée russe.
Parce que l’Allemagne a dû reconnaître que « Le sous-investissement chronique de la Bundeswehr la rend peu opérationnelle. » et a donc décidé d’augmenter le budget de la défense à 2% du budget. L’armée française est un peu mieux dotée, mais selon un rapport du Sénat elle ne pourrait opposer qu’un nombre dérisoire de bataillons opérationnels en face de l’armée russe.
C’est ce qu’on apprend et bien d’autres choses dans l’émission « C Politique de France 5 » : <Partie 1> <Partie 2>
Parce que si nous n’intervenons pas, alors que c’est moralement inacceptable, nous avons une raison officielle : l’Ukraine ne fait pas partie de l’OTAN et donc nous ne pouvons pas appliquer l’article 5. CQFD.
La raison moins officielle et qu’on ose avouer c’est que l’adversaire, non le vrai mot dans cette situation est « ennemi » est une puissance nucléaire. Ce ne serait pas prudent d’entrer en conflit avec lui, surtout qu’il est imprévisible.
Mais la raison objective, c’est que nous n’avons pas du tout les moyens d’aider militairement les ukrainiens, nous ne sommes pas prêts, nous avons désarmé, massivement. Sans les États-Unis nous ne sommes rien militairement, des nains.
Après les deux terribles guerres mondiales, nous avons cru à un monde de paix, de commerce et de droits.
Et nous avons créé une entité riche, prospère et en paix : L’Union européenne.
Dans l’émission C Politique, un intervenant rappelle cependant que cette prospérité n’a été rendue possible qu’à l’abri du bouclier américain.
D’ailleurs les présidents américains, avant Trump, Obama, Busch et Clinton ont répété que les européens ne faisaient pas le job.
Un autre intervenant a décrit l’Union européenne se vivant comme n’ayant plus aucun ennemi. Et Jean Quatremer a eu cette formule :
« L’Europe n’avait pas d’ennemis que des amis potentiels »
Certains analystes ont décrit cette situation par cette autre formule :
« Les européens se comportent comme des herbivores dans un monde de carnivores ! »
Parce que pendant ce temps, la Russie, la Chine, l’Inde et d’autres ont augmenté de manière massive leurs dépenses militaires.
Bien sûr qu’il faut réarmer, sinon nous serons avalés.
Le courageux et lucide président ukrainien Volodymyr Zelensky a interpellé l’Europe :
« Comment allez-vous vous-mêmes vous défendre si vous êtes si lent à aider l’Ukraine ? »
C’est un changement de monde pour nous comme le dit Nicolas Baverez, le spécialiste de Raymond Aron, dans l’émission de ce dimanche du <Nouvel Esprit Public>
Cette situation rappelle la fin des années 30 : une démocrature et un homme fort qui suit son plan avec un récit de l’encerclement de la Russie par l’Otan et du génocide des russes dans le Donbass par des ukrainiens.
En face, il y a le déni. Le déni de la violence de Poutine, de sa haine de l’Occident et de sa volonté d’asservir.
Le déni qui a conduit à la construction de la dépendance de l’Allemagne au gaz russe sous le prétexte de la transition énergétique verte. Et en sus, la commission européenne est arrivée à faire du prix du gaz russe le prix directeur de l’énergie dans l’Union.
 Et puis comme le rappelle le journaliste Emmanuel Berreta, le déni de tous ces hommes politiques issus de l’Union européenne qui ont, par faiblesse pour l’argent, accepté de devenir des agents d’influence de ce régime aux valeurs si éloignées des nôtres :
Et puis comme le rappelle le journaliste Emmanuel Berreta, le déni de tous ces hommes politiques issus de l’Union européenne qui ont, par faiblesse pour l’argent, accepté de devenir des agents d’influence de ce régime aux valeurs si éloignées des nôtres :
« La Russie a aussi déployé son entregent à l’ouest dans une entreprise de capture des élites, à commencer par Gerhard Schröder, l’ancien chancelier allemand devenu le « Monsieur North Stream 2 » de Vladimir Poutine, son ami. Jeudi, Christian Kern, l’ancien chancelier social-démocrate autrichien, a fait savoir qu’il démissionnait pour sa part du conseil de surveillance de la société nationale ferroviaire russe. L’Italien Matteo Renzi (qui siégeait chez Delimobil, un service d’autopartage en Russie) et l’ancien Premier ministre finlandais Esko Aho (qui siégeait au sein de la plus grande banque russe, la Sberbank) ont également démissionné. François Fillon a lui aussi renoncé, vendredi, à ses mandats d’administrateur indépendant de sociétés pétrolières russes. »
Force est de reconnaître que l’essentiel de ces hommes sont issus des Gauches européennes.
 Nicolas Baverez a ajouté :
Nicolas Baverez a ajouté :
« Le défi que lance Vladimir Poutine, est une menace mortelle pour l’Europe. Soit on réagit, soit on mobilise et on change de mode de pensée et d’action, soit la démocrature russe va liquider la liberté politique en Europe. Il faut réarmer. Ce n’est pas seulement un réarmement militaire mais aussi un réarmement politique et idéologique. Il faut rétablir une dissuasion efficace vis-à-vis de Moscou. […] Je rappellerai une phrase de Raymond Aron : « Je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition c’est qu’elles le veuillent » »
Nicolas Baverez dans l’émission le Nouvel Esprit Public de Philippe Meyer (vers 10 min environ)
Il faut réarmer si nous voulons rester libre.
Bien entendu si le budget de la défense augmente, d’autres devront baisser
Il faut savoir payer le prix de la Liberté.
Liberté que vont perdre les ukrainiens dans les prochaines heures, les prochains jours.
Mais voulons nous rester libre ? demandait Raymond Aron
Ou la douce somnolence de notre confort étouffe t’elle le désir de la liberté et considère t’elle que le prix à payer est trop cher ?
<1659>
-
Vendredi 25 février 2022
« Bien entendu, nous n’allons rien faire ! »Claude Cheysson, Ministre des Relations extérieures du gouvernement Pierre Mauroy sous la Présidence de François MitterrandContexte de ce mot du jour : Quelques instants avant 4 heures, heure de Paris, le jeudi 24 février 2022, l’ancien officier du KGB qui règne au Kremlin est apparu à la télévision russe et a annoncé l’invasion par les troupes de l’empire russe, de l’État souverain et démocratique de l’Ukraine. Dans un discours violent, basé sur des mensonges et sur une réécriture de l’Histoire ce sinistre personnage a essayé de justifier le déclenchement d’une guerre totale, sur la terre d’Europe, contre son petit voisin en comparaison de l’empire russe. Les troupes impériales ont pénétré en Ukraine sur 3 fronts, la Russie, la Crimée et le Belarus. L’objectif est évident : s’emparer de la capitale Kiev et soumettre l’ensemble de l’Ukraine.
C’était, il y a un peu plus de 40 ans. C’était avant ! Du temps de l’Union Soviétique, de la Guerre froide, du rideau de fer et de l’Europe divisée en deux camps antagonistes.
Depuis le <16 octobre 1978>, un polonais était Pape de l’église catholique. Et ce Pape est entré en lutte contre le communisme qui régnait sur l’Est de l’Europe et a encouragé et soutenu financièrement, les ouvriers des chantiers navals de Gdánsk à manifester contre le pouvoir communiste. Lech Walesa et, comme toujours, on oublie la femme : Anna Walentynowicz, fondaient, tous les deux, le syndicat Solidanorsc.
Ce syndicat, par ses actions, déstabilisera le pouvoir communiste. Les historiens racontent; aujourd’hui; que les dirigeants du POUP (Parti ouvrier unifié polonais), nom du parti politique polonais communiste, avaient la crainte que l’Union Soviétique envoie son armée rétablir l’ordre en Pologne comme elle l’avait fait en 1956 en Hongrie et en 1968 en Tchécoslovaquie. Alors, le général Jaruzelski, dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981 décrète la Loi martiale et fait arrêter les principaux responsables de Solidanorsc.
En France, François Mitterrand est Président de la République depuis mai. Le premier ministre est Pierre Mauroy, le ministre des relations extérieures est Claude Cheysson et il n’est pas inutile de rappeler que le gouvernement compte 4 ministres communistes.
Des journalistes vont alors interroger Claude Cheysson, après le coup de force de Jaruzelski et lui demander ce que va faire la France. Il aura cette réponse :
« Bien entendu, nous n’allons rien faire. ! »
<Libération> nous apprend qu’il sera réprimandé en ces termes par Mitterrand :
« Quel besoin aviez-vous de dire ça ? C’est une évidence mais il ne fallait pas le dire. »
En 1985, interrogé par <Le Monde>, Claude Cheysson reconnaîtra :
« J’ai eu tort, je regrette cette déclaration intempestive qui aurait dû normalement me coûter ma place »
En tout cas, aujourd’hui tout le monde a compris la leçon et personne ne dira « Bien entendu, nous n’allons rien faire !»
A l’exception, peut être de Biden qui a plus ou moins avoué qu’il n’allait rien faire. Il a répondu franchement qu’il n’enverra pas de soldat américain sur le territoire ukrainien en expliquant que si un soldat américain se trouve en face d’un soldat russe, en zone de conflit, ce serait la troisième guerre mondiale.
Cette formulation a l’avantage de la clarté, mais est-il pertinent d’être clair dans ce type de situation ?
François Mitterrand aurait répondu une nouvelle fois : « C’est une évidence mais il ne fallait pas le dire. »
En face, Poutine dit :
« Quiconque entend se mettre sur notre chemin ou menacer notre pays et notre peuple doit savoir que la réponse russe sera immédiate et aura des conséquences jamais vues dans son histoire. »
Plusieurs analystes disent que cette menace renvoie à l’utilisation de l’arme atomique.
Peut-être, mais il ne le dit pas…
Il est possible aussi qu’en utilisant des armes récentes et hyper rapide, il neutralise les satellites occidentaux, créant un chaos certain, tant nous sommes désormais dépendants de ces technologies au quotidien.
« Nous n’allons rien faire », mise à part la réponse « claire » de Biden, aucun responsable occidental ne le dit.
Tous parlent de sanctions économiques extrêmement sévères, les plus sévères, massives etc…
Mais, il faut faire attention, ces sanctions économiques seront très préjudiciables aux citoyens européens.
60% du gaz que l’Allemagne utilise vient de Russie. 100% du gaz qu’utilise l’Autriche vient de la Russie.
Et on parle de geler le gazoduc Nord Stream 2 qui n’est toujours pas en service entre le fournisseur russe et le client allemand.
Mais quel est l’objet de ce gazoduc, sinon un moyen de transporter du gaz entre la Russie et l’Allemagne sans passer par l’Ukraine et sans permettre à cette dernière de prélever quelques taxes utiles à son budget. Ce n’était pas amical de la part de la Russie d’éviter l’Ukraine, mais ce n’était pas très amical, non plus, de la part de l’Allemagne de participer à cette opération anti-Ukraine.
Bien entendu, nous n’allons rien faire.
Sans les américains, nous n’avons pas de moyens militaires sérieux à opposer à Poutine.
J’ai entendu, à France Inter des militaires qui ne pensaient pas possible que l’armée ukrainienne résiste au déploiement russe. Selon ces militaires, il est vraisemblable que l’armée russe aura chassé le gouvernement ukrainien de Kiev, dans une semaine.
Après, ce sera beaucoup plus dur pour Poutine.
Il aura gagné une guerre, mais pas la paix. Il est peu probable que le peuple ukrainien acceptera la domination, d’un autre âge, du nouveau tsar des Russies.
Évidemment, ce sera long et douloureux, pour le peuple ukrainien.
Dans un des premiers mots du jour, celui du <7 mai 2013>, je citais John Steinbeck « Ce sont toujours les hommes en troupeau qui gagnent les batailles, et les hommes libres qui gagnent la guerre »
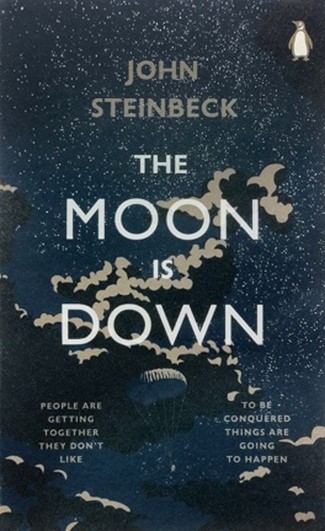 John Steinbeck avait écrit son roman « Lune Noire » pendant la seconde guerre mondiale. Il avait situé son livre dans une petite ville occupée par une armée étrangère issue d’un pays dictatorial.
John Steinbeck avait écrit son roman « Lune Noire » pendant la seconde guerre mondiale. Il avait situé son livre dans une petite ville occupée par une armée étrangère issue d’un pays dictatorial.
Je citais la conclusion de ce livre : « Lune Noire » :
« Un sifflement strident hurla du côté de la mine. Une rafale de vent pulvérisa de la neige sur les fenêtres. Orden joua avec sa médaille et déclara d’une voix sourde :
– Vous voyez, colonel, on ne peut rien y changer. Vous serez écrasés et expulsés. Les gens n’aiment pas être conquis, colonel, et donc ils ne le seront pas.
Les hommes libres ne déclenchent pas la guerre, mais lorsqu’elle est déclenchée, ils peuvent se battre jusqu’à la victoire.
Les hommes en troupeau, soumis à un Führer, en sont incapables, et donc ce sont toujours les hommes en troupeau qui gagnent les batailles et les hommes libres qui gagnent la guerre. Vous découvrirez qu’il en est ainsi, colonel.
Lanser se redressa avec raideur. »Parce que le peuple libre dans cette histoire est le peuple d’Ukraine et le peuple troupeau soumis à un Führer est, hélas, le peuple russe.
Poutine parle de dénazifier l’Ukraine. Il y a quelques extrémistes de droite en Ukraine, mais moins qu’en Russie et je le crains, moins qu’en France.
C’est le dictateur russe qui parle de nazi !!!
Mais que fait-il d’autre qu’Hitler qui prétendait que la petite Tchécoslovaquie maltraitait les allemands des sudètes pour justifier d’attaquer ce pays et de le soumettre, comme Poutine qui prétend défendre les russes du Donbass et preuve de son mensonge attaque toute l’Ukraine.
A l’époque, ce furent les accords de Munich. La France et La Grande Bretagne n’avaient rien fait.
Hitler ne pouvait pas évoquer le mot « génocide », comme le fait Poutine aujourd’hui, ce mot n’existait pas en 1939.
Hitler a aussi attaqué la Pologne, en prétendant que c’était la petite Pologne qui l’avait attaqué en premier.
Et Poutine prétend que c’est l’Ukraine qui menace la Russie pour l’attaquer !
Il parle aussi de junte au pouvoir à Kiev.
 Le président Volodymyr Zelensky a été élu par le peuple ukrainien, en battant le président sortant. Cela s’appelle une alternance, exactement le contraire de ce qui se passe en Russie. Lorsque Dmitri Medvedev a remplacé, pour un mandat, Poutine en le gardant comme premier ministre puis en étant remplacé à nouveau par Poutine, ce n’était pas une alternance mais un arrangement mafieux. La démocratie est en Ukraine, s‘il y a une junte, c’est celle qui est au pouvoir à Moscou
Le président Volodymyr Zelensky a été élu par le peuple ukrainien, en battant le président sortant. Cela s’appelle une alternance, exactement le contraire de ce qui se passe en Russie. Lorsque Dmitri Medvedev a remplacé, pour un mandat, Poutine en le gardant comme premier ministre puis en étant remplacé à nouveau par Poutine, ce n’était pas une alternance mais un arrangement mafieux. La démocratie est en Ukraine, s‘il y a une junte, c’est celle qui est au pouvoir à MoscouLes dictateurs, cela ose tout, c’est à cela qu’on les reconnait.
Il ose traiter de nazi Volodymyr Zelensky, dont les deux parents étaient juifs russophones. Zelensky a d’ailleurs répondu à Poutine :
« Comment pourrais-je être un nazi ? Expliquez-le à mon grand-père, qui a traversé toute la guerre dans l’infanterie de l’armée soviétique. »
Et il ajouté que trois frères de son grand-père ont été tués par les nazis
Voilà la triste réalité d’un dictateur entrainant l’Europe dans son récit mortifère et sa réécriture de l’Histoire.
S’il y a un doute sur l’existence du peuple ukrainien, son agression va conduire à renforcer le sentiment national ukrainien, qui ne peut jamais être plus fort que si la nation est menacée par une autre nation.
Et pendant ce temps, un autre naufrage…
François Fillon, membre du conseil d’administration du géant russe de la pétrochimie Sibur, déplore l’usage de la force par Poutine mais continue à lui trouver des excuses, en prétendant que c’est l’OTAN qui est responsable de cette dérive.
Il est membre de 2 conseils d’administration d’entreprises russes aux mains d’amis de Poutine. Aura t’il la décence de démissionner ?
<1658>
-
Jeudi 24 février 2022
« Les fins de règne – car nous sommes dans une fin de règne en Russie – sont longues, chaotiques et souvent sanglantes. »Michel FoucherPoutine constitue une énigme.
Certains (comme Zemmour ou Marine Le Pen) le considère comme un stratège génial.
Mais Libération pose la question : « Poutine est-il fou ? »
Le journal raconte d’abord comment lors d’une réunion de son Conseil de Sécurité, qui a précédé son fameux discours dans lequel il a nié la possibilité qu’il existe une nation ukrainienne distincte de la nation russe et qu’il a reconnu l’indépendance de deux territoires qui se trouvent à l’intérieur des frontières de l’Etat ukrainien, le Président russe a littéralement terrorisé le responsable des services de renseignements. Il existe une vidéo de cet échange entre <Vladimir Poutine et Sergueï Narychkine>. Libération évoque les visages anxieux des autres membres du conseil de sécurité. Il compare cet épisode avec le jour où les fauves du Colisée ayant eu raison trop rapidement des gladiateurs, l’empereur Caligula ordonna de jeter dans l’arène les spectateurs qui n’avaient pas assez applaudi.
Concernant le discours, Libération rapporte :
« Réagissant le premier aux événements, Emmanuel Macron a qualifié l’intervention télévisée du chef de l’Etat russe de «discours paranoïaque». Notre correspondant en Ukraine, Stéphane Siohan, y a vu «une heure de logorrhée historique stupéfiante», bientôt suivi par le correspondant à Moscou du Financial Times, Max Seddon, pour qui Poutine avait «clairement fait une déclaration de guerre complètement folle». La Première ministre de la Lettonie, Ingrida Šimonytė, observa que le président russe « rendrait honteux à la fois Kafka et Orwell », tandis que l’ancien ambassadeur français Gérard Araud, d’ordinaire placide et hyperréaliste, le qualifiait de discours « proprement ahurissant, un délire paranoïaque dans un univers parallèle ».
Vladimir Poutine est-il fou ? La question a son importance, et après le fameux dîner de six heures d’affilée avec son homologue russe la semaine dernière, Emmanuel Macron a plus d’éléments que beaucoup pour y répondre. Mais on peut aussi revenir à la fameuse « théorie du fou » chère à Richard Nixon, qui avait voulu faire croire aux dirigeants russes qu’ils avaient en face d’eux un président américain au comportement imprévisible, disposant d’une énorme capacité de destruction, et qu’il valait donc mieux lui lâcher plus de terrain qu’à un leader raisonnable. Poutine a-t-il voulu renverser les rôles ? »
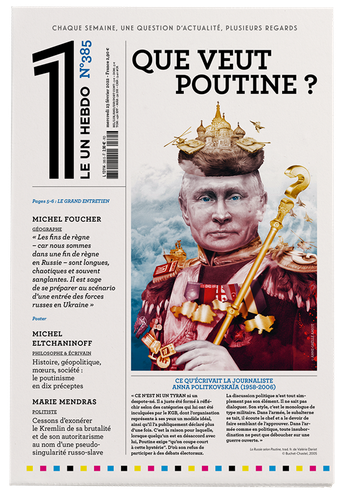 « Le Un Hebdo », dans son numéro daté du 23 février pose la question : Que veut Poutine ?
« Le Un Hebdo », dans son numéro daté du 23 février pose la question : Que veut Poutine ?
Il met sur la première page ce qu’écrivait la journaliste Anna Politkovskaïa qui a été assassinée en 2006 et dont j’avais parlé dans le mot du jour du 8 octobre 2013 < « Qu’ai-je fait ?…J’ai seulement écrit ce dont j’étais témoin.» :
« Ce n’est ni un tyran ni un despote-né. Il a juste été formé à réfléchir selon des catégories qui lui ont été inculquées par le KGB, dont l’organisation représente à ses yeux un modèle idéal, ainsi qu’il l’a publiquement déclaré plus d’une fois. C’est la raison pour laquelle, lorsque quelqu’un est en désaccord avec lui, Poutine exige « qu’on coupe court à cette hystérie ». D’où son refus de participer à des débats électoraux. La discussion politique n’est tout simplement pas son élément. Il ne sait pas dialoguer. Son style, c’est le monologue de type militaire. Dans l’armée, le subalterne se tait, il écoute le chef et a le devoir de faire semblant de l’approuver. Dans l’armée comme en politique, toute insubordination ne peut que déboucher sur une guerre ouverte. »
La Russie selon Poutine, trad. fr. de Valérie Dariot © Buchet-Chastel, 2005
Laurent Greilsamer avance cette analyse :
« Au cœur du système poutinien, il faut imaginer une énorme fabrique de brouillage impulsant le chaud et le froid, créant la confusion et l’inquiétude sur la scène internationale. […]. C’est ainsi que le président Poutine, quand bien même le PIB de son pays ne dépasse pas celui de l’Espagne, affole les chancelleries et parvient à se placer au centre de la « conversation mondiale ». C’est ainsi qu’à la tête d’une armée modernisée de 900 000 hommes, il se retrouve à la table des négociations avec toutes les cartes en main. »
Au cœur de ce numéro, se trouve un entretien avec Michel Foucher, géographe et diplomate qui pense que Poutine a tout à fait les moyens de son ambition, tant il est vrai qu’il a rénové et réorganisé en profondeur son armée qui constitue aujourd’hui l’outil central de sa politique étrangère et qui est une priorité budgétaire.
Et surtout il nous explique la doctrine militaire de Valéri Guérassimov :
« Poutine a adopté la doctrine militaire de Valéri Guérassimov, son chef d’état-major, qui consiste à mobiliser toutes les ressources non militaires à des fins militaires : les moyens économiques, politiques, diplomatiques, informationnels. Ils la nomment la « dissuasion stratégique ». L’objectif de la doctrine Guérassimov est de brouiller notre compréhension, notre lecture des événements. Il s’agit bien d’empêcher les pays occidentaux de déterminer si nous sommes face à une situation de paix ou de guerre. Ces méthodes étaient autrefois l’apanage des services de renseignement. Cela rend très difficile l’évaluation des risques à chaud, et donc la décision. Et l’on constate bien aujourd’hui qu’il n’y a pas d’analyses convergentes entre Washington, Ottawa, Londres, Paris, Berlin, Rome et Varsovie. »
Michel Foucher nous apprend que Poutine a fait distribuer à tous les soldats, en septembre dernier, un texte de 5 000 mots intitulé « Sur l’unité historique des Russes et des Ukrainiens ». Vus de Moscou, les Russes, les Biélorusses et les Ukrainiens forment un seul peuple. La dislocation de l’Union soviétique, en 1991, est encore vécue comme une catastrophe géopolitique parce que le monde russe a été séparé
L’Ukraine , comme la Russie est un pays de corruption forte, mais contrairement à la Russie, l’Ukraine est une démocratie avec des élections libres dans lesquelles les présidents ou les gouvernements sortants peuvent être battus électoralement et remplacés par leurs opposants.
Poutine n’aime pas la démocratie dans lequel le pouvoir peut changer de main.
Et puis il ne supporte pas que l’Ukraine, cette région qui dans son esprit est russe, puisse se rapprocher de l’occident voire adhérer à l’OTAN.
Ainsi la révolution de Maïdan, en 2014, qui montrait cette forte aspiration vers l’occident d’une partie de la population ukrainienne particulièrement de Kiev a constitué pour Poutine, dans son système de valeur, la provocation de trop :
« La première réponse de Poutine a été d’annexer la Crimée. La deuxième d’encourager le Donbass, qui peut s’apparenter à la Lorraine ou à la Ruhr, à faire sécession.
Et [la troisième peut être] la guerre ou la paix. L’histoire le montre, c’est une seule personne qui en décide. On en est là. Et en stratégie, les cartes mentales sont fondamentales. Moscou a la perception d’une asymétrie qu’il faut relativiser. Ce sont bien les forces militaires russes qui campent en Biélorussie, dans le Donbass et bien entendu sur la mer Noire, où les manœuvres navales bloquent tous les ports ukrainiens depuis un mois. L’usage de la géographie corrige l’asymétrie. »
Michel Foucher décrit une situation ambigüe de l’Ukraine par rapport à l’OTAN, moins catégorique que certains journalistes qui prétendent que l’Ukraine est très loin de l’OTAN. Bien sûr, elle ne peut bénéficier de l’article 5, ce qui constitue une limite essentielle :
« Elle a un accord de coopération renforcée avec l’Otan qui en fait un quasi-membre. Elle reçoit des équipements, des armes antichars, des missiles. L’Ukraine est de facto dans l’Otan. Avec une nuance très forte, car elle ne bénéficie pas de l’article 5 : donc il n’y a pas de solidarité militaire, d’alliance au sens classique. Mais, pour Moscou, c’est trop. Dans la conception de Poutine, tous les voisins de la Russie doivent être soumis à la Russie. »
Pour le géographe, le moment d’agir a été rigoureusement choisi par le maître du Kremlin :
« Le moment lui est favorable : Angela Merkel est partie, il n’aurait jamais osé faire cela avec elle ; Joe Biden est faible ; l’Otan est fracturée ; l’Occident est en fait divisé. Et il a Pékin derrière lui. Il a en main toutes les cartes : le militaire, la diplomatie, les calculs stratégiques froids, la propagande, le ressentiment historique, l’émotion. Ce qui est fascinant, c’est sa capacité à utiliser tous ces outils. »
Michel Foucher parle des risques de fin de règne et pense probable l’envahissement de l’Ukraine par les armées russes. Je pense qu’il veut dire au-delà de la région du Donbass :
« En tout cas, tout est prêt pour que cela soit possible. Les fins de règne – car nous sommes dans une fin de règne en Russie – sont longues, chaotiques et souvent sanglantes. Il est sage de se préparer au scénario d’une entrée des forces russes en Ukraine. Dans ce cas, il y aura une résistance sur le terrain. Les Ukrainiens ne se laisseront pas faire. Ce sera un drame et un déchirement pour de nombreuses familles russes. »
Michel Foucher penche donc davantage vers l’hypothèse du stratège que du fou.
<1657>
-
Mercredi 23 février 2022
« Au milieu de la plaine immense, dans mon Ukraine bien-aimée, pour que je voie les champs sans fin. »Tarass ChevtchenkoL’Ukraine !
En lisant et butinant autour de ce pays divisé, menacé par son immense voisin, je suis tombé sur des articles concernant Taras Chevtchenko surnommé Kobzar que je ne connaissais pas.
Wikipedia écrit :
« Il est considéré comme le plus grand poète romantique de langue ukrainienne.
Figure emblématique dans l’histoire de l’Ukraine, il marque le réveil national du pays au XIXe siècle. Sa vie et son œuvre font de lui une véritable icône de la culture de l’Ukraine et de la diaspora ukrainienne au cours des XIXe et XXe siècles. La principale université ukrainienne porte son nom depuis 1939 : université nationale Taras-Chevtchenko de Kiev. »
Chevtchenko est un nom patronymique ukrainien très répandu. Les amateurs de football, ont en mémoire un ballon d’or qui porte ce nom.
Taras Chevtchenko a vécu entre 1814 et 1861, année dans laquelle il est mort à 47 ans. Il est né dans une famille de paysans serfs ukrainiens. C’est-à-dire qu’il est en réalité un esclave qui appartient à un seigneur
Il est attiré par la littérature et la peinture.
Un soir, son seigneur surprend Chevtchenko à dessiner, à la lueur d’une bougie, devant l’un des tableaux de la maison. Il l’accuse d’avoir failli brûler le précieux tableau et le fait battre aux écuries.
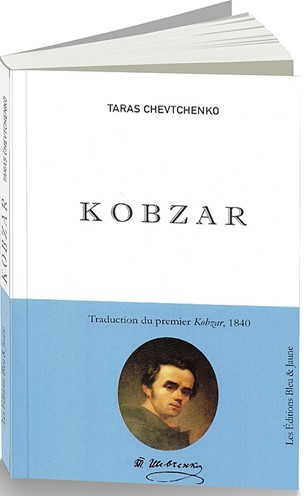 Mais la femme du Seigneur suggère à ce dernier de l’envoyer en apprentissage d’art afin d’en faire son peintre personnel.
Mais la femme du Seigneur suggère à ce dernier de l’envoyer en apprentissage d’art afin d’en faire son peintre personnel.
Ainsi fut fait.
Talentueux, il attire l’attention de plusieurs maîtres.
Il rencontre finalement un célèbre peintre et professeur nommé Karl Briullov. Ce dernier mit en jeu dans une loterie son portrait du poète russe Vassili Joukovski, ce qui lui permit d’acheter et de rendre pour 2 500 roubles la liberté à Taras Chevtchenko le 5 mai 1838.
Ainsi, Taras Chevtchenko put s’inscrire à l’Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg et faire ses études sous la direction de Briullov.
En 1840, il publie sa première collection de poésie, Kobzar (Le Barde), composée de huit poèmes
 Pour illustrer son poème Kateryna, Chevtchenko peint en été 1842 un tableau qui reste de nos jours une des images emblématiques de la peinture ukrainienne. Il représente une jeune Ukrainienne, enceinte, un soldat russe s’éloignant, il est dit qu’à cette époque les jeunes filles ukrainiennes qui acceptaient les faveurs des soldats russes de passage étaient rejetées par leurs familles, enceintes des œuvres de « l’occupant »
Pour illustrer son poème Kateryna, Chevtchenko peint en été 1842 un tableau qui reste de nos jours une des images emblématiques de la peinture ukrainienne. Il représente une jeune Ukrainienne, enceinte, un soldat russe s’éloignant, il est dit qu’à cette époque les jeunes filles ukrainiennes qui acceptaient les faveurs des soldats russes de passage étaient rejetées par leurs familles, enceintes des œuvres de « l’occupant »
En plus de ses activités artistiques il s’intéresse à la vie sociale et politique.
Il est scandalisé par l’oppression tsariste et la destruction de son Ukraine natale.
En 1846, à Kiev, Taras Chevtchenko rejoignit la Confrérie de Cyrille et Méthode, organisation politique secrète qui avait pour objectif d’abolir le servage et d’établir l’égalité sociale. Comme les autres membres de la fraternité, il fut arrêté le 5 avril 1847. Le poète fut emprisonné à Saint-Pétersbourg. Après la découverte et la confiscation par les autorités impériales de ses poèmes satiriques anti-tsaristes issus de son album, il fut condamné à servir comme simple soldat dans le corps spécial d’Orenbourg, un régiment installé dans une région lointaine de Russie, près de la mer Caspienne.
Le tsar Nicolas Ier en personne donna l’ordre d’interdire à Chevtchenko d’écrire et de peindre. Le poète réussit toutefois à continuer à peindre et à écrire en cachette. Dans ses œuvres, il parle toujours de son pays natal, l’Ukraine, qui lutte contre l’oppression et aspire à la liberté.
En 1850, Taras Chevtchenko fut transféré à la forteresse de Novopetrovskoïe, au bord de la mer Caspienne, où les consignes sur son exil furent plus durement appliquées. Il réussit cependant à créer plus de cent aquarelles et dessins. Il écrivit également plusieurs nouvelles en langue russe. Il fut libéré de son exil militaire en 1857, deux ans après la mort de Nicolas Ier. Mais il lui fut alors interdit de vivre en Ukraine. Après avoir passé une grande partie des années suivantes à Nijni Novgorod, au bord de la Volga, il s’établit à Saint-Pétersbourg. Ce n’est qu’en 1859, qu’il fut autorisé à rendre visite à ses parents et à ses amis en Ukraine. Mais il y fut retenu, interrogé, puis renvoyé à Saint-Pétersbourg. Taras Chevtchenko resta sous la surveillance de la police jusqu’à sa mort, en 1861.
Il fut enterré à Saint-Pétersbourg. Deux mois plus tard, conformément à ses vœux, ses restes furent transférés en Ukraine. Le peuple ukrainien organisa à son poète de grandes funérailles. Sa dépouille fut inhumée sur Chernecha Hora (la Montagne du Moine) près de Kaniv, une ville proche de son lieu de naissance. Depuis, sa tombe est considérée comme un lieu de pèlerinage par des millions d’Ukrainiens.
Taras Chevtchenko occupe une place exceptionnelle dans l’histoire culturelle de l’Ukraine. Son nom reste un des symboles les plus marquants du réveil de l’esprit national ukrainien au XIXe siècle. Vers la fin du XIXe siècle, son Kobzar devient le livre de référence d’enseignement de la langue ukrainienne.
De ses 47 ans, Chevtchenko en vécut 24 au servage et 10 en exil. Sa vie tragique et son amour pour son pays et sa langue reflètent dans l’imaginaire de ses compatriotes le destin du peuple ukrainien qui lutta à travers des siècles pour sa culture et sa liberté
Toutes ces précisions sont issues de Wikipedia
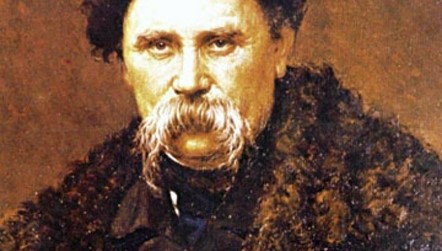 France Info nous apprend qu’en 2014, pour les deux cents ans de sa naissance, <Sa mémoire fut encore l’enjeu d’un conflit nationaliste russo-ukrainien> :
France Info nous apprend qu’en 2014, pour les deux cents ans de sa naissance, <Sa mémoire fut encore l’enjeu d’un conflit nationaliste russo-ukrainien> :
« Les événements en Ukraine semblent avoir refroidi l’attitude de Moscou vis-à-vis du poète ukrainien Taras Chevtchenko, né il y a tout juste 200 ans. Le site du Kremlin s’est ainsi bien gardé de mentionner l’anniversaire de cet illustre poète, et initiateur de l’esprit national ukrainien.
En Ukraine, la journée du 9 mars 2014 a été rythmée par des rassemblements en mémoire de celui que beaucoup considèrent comme un héros de l’indépendance du pays. «Nous constituons un seul pays, une seule famille, et nous nous trouvons ici avec notre poète Taras», a déclaré au président ukrainien de transition, Oleksander Tourtchinov, lors d’une cérémonie à Kiev, la capitale ukrainienne. […]
A Kiev, des pro-Russes avaient également organisé des rassemblements, notamment place Lénine, autour de la statue du fondateur de l’URSS où 2.000 manifestants ont applaudi de vieux chants de l’époque soviétique. »
Dans mon butinage j’ai trouvé ce beau poème :
Testament
poèmesQuand je serai mort, mettez-moi
Dans le tertre qui sert de tombe
Au milieu de la plaine immense,
Dans mon Ukraine bien-aimée,
Pour que je voie les champs sans fin,
Le Dniepr et ses rives abruptes,
Et que je l’entende mugir.
Lorsque le Dniepr emportera
Vers la mer bleue, loin de l’Ukraine,
Le sang de l’ennemi, alors
J’abandonnerai les collines
Et j’abandonnerai les champs,
Jusqu’au ciel je m’envolerai
Pour prier Dieu, mais si longtemps
Que cela n’aura pas eu lieu
Je ne veux pas connaître Dieu.
Vous, enterrez-moi, levez-vous,
Brisez enfin, brisez vos chaînes,
La liberté, arrosez-là
Avec le sang de l’ennemi.
Plus tard dans la grande famille,
La famille libre et nouvelle,
N’oubliez pas de m’évoquer
Avec des mots doux et paisibles.
Le 25 décembre 1845
à Pereiaslav.
Traduit par Eugène Guillevic
Tarass Chevtchenko, Paris, Seghers, (Poètes d’aujourd’hui no 110), 1964, pp. 69-70)
Vous pouvez regarder cette petite vidéo de 5 minutes réalisée par France Culture : <Taras Chevtchenko, figure adulée de la nation ukrainienne>.
<1656>
-
Mardi 22 février 2022
« La démocratie a reculé dans le monde l’année dernière. »Constat, réalisé par le département de recherche (EIU) de « The Economist »Dans notre jeunesse nous pensions que l’évolution vers la démocratie était inéluctable et que si certains Etats mettraient un peu plus de temps, le mouvement était général et allait toujours dans le même sens.
Quand j’étais enfant, L’Espagne, le Portugal, la Grèce, tous les pays de l’Est de l’Europe étaient des dictatures. Ces dictatures sont tombées les unes après les autres.
Avec la chute du bloc soviétique, Francis Fukuyama conceptualisait cette évolution dans un article célèbre intitulé « La fin de l’histoire » où il prédisait le triomphe du modèle démocratique sur toute la planète.
Il semble que nous nous soyons trompés.
Dans « l’Obs », Sara Daniel pose même la question : « La démocratie, un régime politique en voie de disparition ? »
Et elle se réfère à une étude du département de recherche (EIU) de « The Economist »
The Economist est un journal britannique et nous devons reconnaître que concernant la démocratie les anglais nous ont toujours été supérieurs. Nous avons donc affaire à des spécialistes.
The Economist a créé un « indice de démocratie » qu’il évalue chaque année depuis 2006 pour chacun des 167 pays que compte notre Planète.
Le calcul est fondé sur 60 critères regroupés en cinq catégories :
- Le processus électoral et le pluralisme,
- Les libertés civiles,
- Le fonctionnement du gouvernement,
- La participation politique
- La culture politique.
La notation se fait selon une échelle allant de 0 à 10.
À partir de cette note, les pays sont classés selon quatre types de régime politiques :
- Démocraties complètes
- Démocraties imparfaites ou défaillantes
- Régime hybride
- Régime autoritaire.
Le pays le moins démocratique du monde a été depuis plusieurs années : La Corée du Nord.
Mais cette année le classement du journal a trouvé encore pire.
La dernière place du classement est désormais occupée par l’Afghanistan qui est donc 167ème avec un score de 0,32.
Et la Corée du Nord n’est même pas avant dernière, cette place est occupée par la Birmanie dont l’armée a renversé le pouvoir civil dirigé par Aung San Suu Kyi et s’est lancé dans une répression sanglante contre la population en révolte contre ce coup de force.
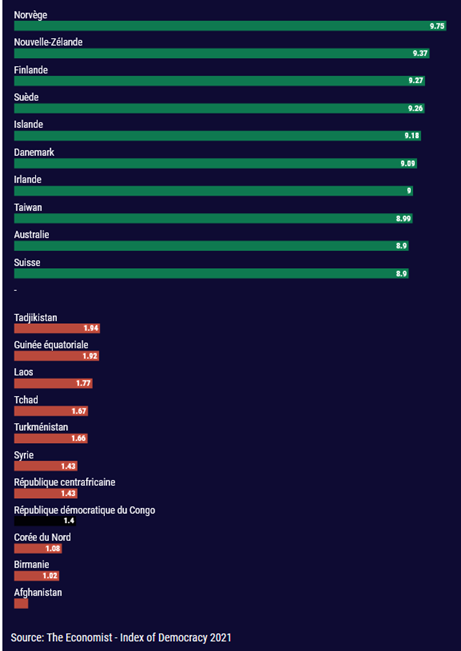 Du côté le plus vertueux, c’est la Norvège qui occupe la première place avec un score de 9,75 suivi par les autres pays nordiques Finlande, Suède, Islande, Danemark.
Du côté le plus vertueux, c’est la Norvège qui occupe la première place avec un score de 9,75 suivi par les autres pays nordiques Finlande, Suède, Islande, Danemark.
Mais la deuxième place est occupée par la Nouvelle Zélande qui s’immisce dans le groupe des nordiques.
Il est à noter que sauf pour la Norvège, les 5 pays suivants ont tous à leur tête une première ministre femme.
Il me semble pouvoir dire que ce n’est pas parce qu’ils ont à leur tête des femmes qu’ils sont vertueux, mais plutôt parce qu’ils sont vertueux ils mettent facilement à la première place des femmes.
La France, est classée au-delà de la 20ème place et a intégré depuis l’année dernière la catégorie des démocraties défaillantes.
Pour l’étude ce sont les mesures mises en place pour freiner la pandémie de Covid-19 qui sont la cause de cette rétrogradation.
« Le Progrès. » rapporte les termes du rapport :
« Imposer des pass et des vaccins pose la question du droit des individus à participer librement à la vie publique de leur pays s’ils ne sont pas vaccinés », peut-on notamment lire dans l’étude, qui pointe également du doigt les propos d’Emmanuel Macron dans Le Parisien, qui a déclaré il y a quelques semaines qu’il voulait « emmerder les non-vaccinés ».
La France n’est pas le seul pays d’Europe de l’Ouest où la restriction des libertés individuelles pose question, selon l’Index. L’Espagne est ainsi passé cette année de « démocratie complète » à « démocratie défaillante » et plusieurs pays voisins, comme l’Italie, le Portugal et la Belgique sont eux aussi considérés comme « défaillants » dans leur système démocratique.
Les États-Unis, Israël, le Brésil et l’Afrique du Sud figurent également dans cette catégorie. »
La Russie et la Chine sont bien évidemment classées dans la dernière catégorie, celle des régimes autoritaires.
En 2021, seuls 6,4 % de la population mondiale ont vécu dans des pays pleinement démocratiques.
Globalement, la démocratie a reculé dans le monde l’année dernière. L’indice de démocratie 2021 est en effet passé de 5,37 en 2020 à 5,28, soit la plus forte baisse annuelle depuis l’année 2010.
Les régimes autoritaires ou hybrides sont largement majoritaires et gouvernent plus de la moitié de l’humanité 45,7 % de la population mondiale vivait dans une démocratie en 2021, contre 49,4 % un an plus tôt.
Sara Daniel développe :
« Plusieurs facteurs expliquent ce reflux démocratique. La multiplication des hommes forts qui, du Russe Vladimir Poutine au Turc Recep Tayyip Erdogan, adossent leur pouvoir à des démocratures. Les guerres sans fin ensanglantant le Moyen-Orient, le Sahel ou l’Afghanistan, qui déloge cette année la Corée du Nord de la dernière place du classement. La progression du modèle chinois qui gagne le monde émergent. Et enfin l’épidémie de Covid qui a creusé le fossé entre dirigeants et citoyens. »
Et elle cite une journaliste américaine :
« Dans un livre récemment publié chez Grasset, « Démocraties en déclin. Réflexions sur la tentation autoritaire », la journaliste américaine Anne Applebaum, déjà autrice d’une passionnante histoire du Goulag, explique comment le mensonge assumé est devenu une arme politique. Selon elle, la tentation de gouverner de manière autoritaire, dont le trumpisme fut l’illustration la plus spectaculaire, est la même partout, de l’extrême droite française au régime de Poutine. »
J’ai pris ces différentes informations des articles suivants :
Wikipedia : <Indice de démocratie>
L’Obs : < La démocratie, un régime politique en voie de disparition ?>
L’Obs : <The Economist classe la France parmi les « démocraties défaillantes »>
Le Progrès <Quels sont les pays les plus démocratiques ou les plus autoritaires au monde ?>
Les Echos : <Le Covid bouscule la démocratie dans le monde pour la deuxième année consécutive>
Le Temps : <Une étude s’alarme d’un recul de la démocratie dans le monde en 2021>
Il me semble, en effet, que la démocratie recule dans le monde. Je ne crois pas que le COVID en soit le principal responsable.
<1655>
- Le processus électoral et le pluralisme,
-
Lundi 21 février 2022
« PatKop la violoniste aux pieds nus. »Un objet musical non identifié nommé Patricia KopatchinskajaCe dimanche, Annie et moi, accompagnés de nos amis Joyce et Patrick, sommes allés à l’Auditorium pour écouter un concert d’œuvres d’Igor Stravinsky dirigés par le chef hongrois Ivan Fischer à la tête de l’orchestre qu’il a créé en 1983 et dont il est le Directeur musical depuis : « L’Orchestre du Festival de Budapest ».
 Pour Ivan Fischer, il s’agissait d’un retour à Lyon, puisqu’il a été le directeur musical de l’Opéra de Lyon de 2001 à 2003.
Pour Ivan Fischer, il s’agissait d’un retour à Lyon, puisqu’il a été le directeur musical de l’Opéra de Lyon de 2001 à 2003.
Ivan Fischer avait aussi fait parler de lui parce qu’il s’est fait « vacciner en plein concert le 25 août 2021 » :
« Le geste, symbolique, a eu lieu lors d’un concert gratuit en plein air devant quelques milliers de personne à Budapest. Sur les vidéos on peut voir Iván Fischer diriger du bras droit pendant qu’un médecin lui administre une troisième dose de vaccin dans l’autre bras, à travers un trou ménagé exprès dans sa chemise. […] Le site du festival de Budapest explique qu’à travers cette mise-en-scène Iván Fischer « souhaite donner l’exemple et attirer l’attention du public sur l’importance de la lutte contre l’épidémie ». La Hongrie a en effet particulièrement souffert au printemps, affichant début mai « la pire mortalité du monde » d’après le journal Le Monde. Depuis, la situation sanitaire s’est améliorée mais reste délicate. »
C’est surtout un très grand chef et nous avions hâte de l’entendre dans ce concert dans lequel la seconde partie était consacrée au « Sacre du Printemps ».
Avant cela, il y avait une première partie dans laquelle après une autre œuvre orchestrale, « le concerto pour violon et orchestre » de Stravinski était au programme.
C’est une œuvre assez aride et difficile à jouer.
Avec Annie nous nous préparons toujours au concert en écoutant plusieurs fois les œuvres au programme.
Nous avions un peu de mal avec cette œuvre.
J’avais déjà entendu parler de la violoniste soliste : Patricia Kopatchinskaja, mais je ne l’avais jamais vu en concert, ni entendu par l’écoute d’un disque ou de la radio. J’avais lu des avis très contrastés. Par exemple, cet avis du journal canadien « La Presse »
« Des critiques et des mélomanes l’abhorrent, d’autres l’adorent. On lui reproche de trop grandes libertés avec la partition, trop d’exubérance dans le jeu, trop de singularité dans l’articulation ou les timbres, trop de feu dans les coups d’archet. On l’admire exactement pour les mêmes raisons. »
Donc nous voilà au concert. La première œuvre, « Jeux de carte » me semblait un peu poussive, je n’entrais pas bien dans le concert, était ce de mon fait ou de celui du chef et de l’orchestre ?
Puis vint le concerto et la violoniste née à Chisinau en Moldavie en 1977, entra en scène.
 Déjà sa tenue était singulière par rapport à toutes les autres solistes qu’il nous a été donné de voir à l’Auditorium.
Déjà sa tenue était singulière par rapport à toutes les autres solistes qu’il nous a été donné de voir à l’Auditorium.
Elle portait une robe que je qualifierai de folklorique, mais je ne sais pas de quelle région.
Et elle était pieds nus. On raconte qu’un jour elle avait oublié ses chaussures en montant sur scène. Et que ce jour là, elle avait ressenti les vibrations de l’orchestre comme jamais. Depuis elle réitère souvent cet oubli.
Alors, elle lève l’archet et prend à bras le corps cette œuvre rude et difficile et entraîne l’enthousiasme des musiciens et des auditeurs tout au long de son interprétation.
Elle saisit l’œuvre et fait partager sa vision avec une force et un dynamisme incroyable.
D’ailleurs vous pouvez avoir la perception de cette interprétation, puisqu’il existe sur internet une vidéo de ce concerto avec elle à <Francfort avec l’orchestre de la radio de cette ville dirigé Andrés Orozco-Estrada>
Époustouflant et unique !
Et alors les bis !
Elle a joué successivement avec deux membres de l’orchestre des danses populaires du compositeur hongrois Bartok et puis une œuvre qu’elle a décrit comme présentant le chaos de la globalisation dans laquelle elle joue du violon tout en chantant ou plutôt en lançant des cris et des grognements dans un acte théâtral aussi déroutant que prenant.
Après cela, l’orchestre du Festival de Budapest et Ivan Fischer, galvanisé par ce qu’il venait de vivre nous ont offert un Sacre du Printemps de toute beauté.
Et après ce déchainement de rythme et de violence et plusieurs rappels, l’orchestre s’est levé, a laissé ses instruments et sous la direction d’Ivan Fischer a chanté, a capella, l’ « Ave Maria de Stravinsky » dans un moment extatique avec une qualité chorale incroyable.
Un concert qui fait du bien et dont on sort plein d’énergie et de joie.
 Alors, j’ai voulu en savoir un peu plus sur « la violoniste aux pieds nus » qu’on appelle PatKop, pour éviter d’écorcher son patronyme compliqué : Kopatchinskaja
Alors, j’ai voulu en savoir un peu plus sur « la violoniste aux pieds nus » qu’on appelle PatKop, pour éviter d’écorcher son patronyme compliqué : Kopatchinskaja
Alors j’ai écouté cette interprétation du <Concerto de Beethoven> avec Philippe Herreweghe, avec lequel elle l’a enregistré d’ailleurs. Et c’est vrai qu’elle prend quelque liberté avec la partition. Elle joue parfois d’autres notes que Beethoven a écrite. C’est choquant, mais c’est très convaincant.
Elle dit dans l’article du journal canadien précité :
« Bien sûr, affirme-t-elle d’emblée, je m’en tiens aux partitions écrites, mais je recherche d’abord l’esprit de l’œuvre… qui ne se trouve pas dans les pages. Je crois qu’il faut libérer l’esprit d’une œuvre, il faut le sortir de sa partition, qui peut devenir une prison. […]
Il faut laisser cet esprit nous chevaucher, le laisser nous parler comme un guide qui se dévoile à notre époque, le laisser communiquer avec le public et les musiciens, et ainsi modeler notre façon de jouer l’œuvre ici et maintenant. »
Et elle dit encore :
« Si vous êtes scientifique et que vous vous intéressez à ce qui est connu, vous devenez professeur. Lorsque l’inconnu, le risque ou même la controverse ne vous font pas peur, vous devenez alors chercheur, ce qui s’apparente à un créateur en art. Ce qui m’intéresse se trouve de l’autre côté de la frontière, car je sais ce qui se trouve à l’intérieur. »
Bref, jouer une pièce de la même manière pendant des décennies ne présente pas grand intérêt pour elle.
Dans ce contexte, elle accepte les critiques :
« Il est bien de recevoir de bonnes et de mauvaises critiques, cela signifie que ceux qui ne nous aiment pas nous ont écoutés avec une certaine attention, qu’on les a touchés malgré tout. Quoi qu’ils pensent, les interprétations lisses et standardisées ne m’intéressent absolument pas. »
On trouve assez facilement des critiques défavorables sur le net, mais elles ne m’intéressent pas après le concert de ce dimanche.
 Je pense qu’étant donné sa liberté d’interprétation, il semble possible qu’elle puisse « s’égarer » parfois.
Je pense qu’étant donné sa liberté d’interprétation, il semble possible qu’elle puisse « s’égarer » parfois.
Mais quand c’est réussi comme ce dimanche à Lyon, quelle plénitude.
<Le Monde> écrit :
« Loin de se limiter à des décharges strictement musicales, l’interprète galvanisante a décidé, très tôt, de ne renoncer à aucun des sens de son corps dans la recherche optimale de l’expression artistique. « J’ai besoin de tout ressentir avec ma peau », résume la violoniste qui a pris l’habitude de se produire pieds nus et de s’exposer telle quelle sur scène. […] « Plus j’avance en âge et plus je m’éloigne de tout ce qui m’a été appris, confie la musicienne de 44 ans. Les Japonais pensent qu’on change de personnalité une fois qu’on a atteint la moitié de sa vie, comme un serpent qui se débarrasse de sa peau, mais en tant qu’artiste qui se régénère, vous ne savez jamais où vous êtes vraiment vous-même.»
Elle a résumé lors d’un entretien accordé au Financial Times sa vision de liberté :
« Les gens accordent beaucoup d’importance à la perfection et aux surfaces bien lisses. Ils veulent voir un beau gâteau sur scène, prêt à être dégusté. Je n’apporte pas de gâteau. J’apporte les ingrédients et je les cuisine sur place. On doit prendre le risque que ça ne se passera pas bien – on a besoin des erreurs car elles nous font réfléchir et trouver de nouvelles façons de faire. »
Sur ce site consacré à la Moldavie elle raconte un peu l’Histoire de sa vie :
« Nous avons quitté la Moldavie avec mes parents dès l’ouverture des frontières en 1990. Je suis arrivée à Vienne, où j’ai passé une dizaine d’années. Je suis ensuite venue à Berne, car j’avais obtenu une bourse pour y étudier. J’ai toujours rêvé de baser ma vie dans une grande capitale, mais je suis tombée amoureuse à Berne, et j’y suis restée. Et comme je voyage sans cesse, Berne est le lieu idéal pour décompresser, recharger mes batteries.
[Que pouvez-vous dire de la Moldavie ?]
C’est intéressant de venir de nulle part, non ? ([…]
Plus prosaïquement, la Moldavie a connu tour à tour la domination des Roumains et des Russes, et les deux n’étaient pas mieux l’un que l’autre. Aujourd’hui, c’est un pays parmi les plus pauvres d’Europe : 80% des actifs travaillent à l’étranger. J’y retourne avec Terre des hommes , pour donner des concerts, organiser des concours pour jeunes violonistes. Dans ma famille, chaque génération a une fois tout perdu et s’est retrouvée avec une valise pour seul bien. J’en tire cette leçon : « Live now ! » « Vivez maintenant ! »
 Elle a désormais la triple nationalité moldave, autrichienne et suisse.
Elle a désormais la triple nationalité moldave, autrichienne et suisse.
« Le Figaro » parle en juin 2021 d’elle comme d’« un objet musical non identifié » et ajoute :
« Mais c’est surtout par sa profonde originalité musicale qu’elle frappe. Celle qui aime se comparer à un enfant qui invente constamment de nouveaux jeux avec les mêmes jouets, assimile la musique classique à un laboratoire et son parcours d’interprète à celui d’Alice au pays des merveilles.
En vraie funambule, elle pousse la musique dans ses ultimes retranchements expressifs »
Elle dispose bien sûr d’un site : https://www.patriciakopatchinskaja.com/
Et pour finir, je vous propose d’écouter ces 5 minutes magiques dans lesquelles avec d’autres musiciens et particulièrement le chef Teodor Currentzis, elle chante et joue en interprétant <John Dowland> compositeur anglais mort en 1626.
<1654>
-
Vendredi 18 février 2022
« Le gosse »Véronique Olmi« Ce livre est glaçant… Et ne me quitte pas. Remarquable » a dit François Busnel dans son émission « La Grande Librairie du 2 février »
Ce livre est « Le gosse » de Véronique Olmi
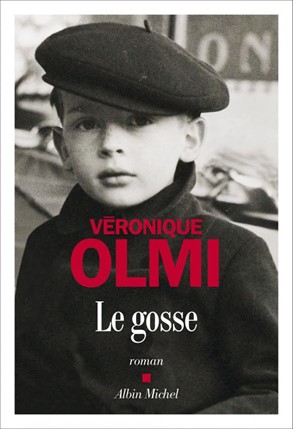 Ce roman révèle une société violente et monstrueuse contre les enfants orphelins confiés à l’assistance publique, au sortir de la Grande Guerre.
Ce roman révèle une société violente et monstrueuse contre les enfants orphelins confiés à l’assistance publique, au sortir de la Grande Guerre.
Le gosse a pour nom Joseph. Il est né en 1919, à Paris
Son père revenait de la grande guerre, il avait la gueule cassée.
C’était un survivant, mais il ne le restera pas longtemps. Nous savons qu’il y eut à cette époque un fléau encore plus meurtrier que la guerre : une pandémie, à laquelle on donnera pour nom, la grippe espagnole.
Sa mère, Colette, était plumassière.
Grâce à « Wikipedia » nous apprenons qu’une plumassière exerce l’activité de « la plumasserie ». C’est-à-dire la préparation de plumes d’oiseaux et leur utilisation dans la confection d’objets ou d’ornements souvent vestimentaires et particulièrement les chapeaux.
Et à la mort du père, cette modeste ouvrière doit seule subvenir aux besoins de l’enfant et aussi de sa mère qui perd, peu à peu, la raison.
La vie est rude, il y a peu de loisirs. La mère rencontre un jeune homme, elle tombe enceinte. Il n’y a pas de contraception, l’avortement est interdit, pénalisé.
Cette grossesse tombe mal. Elle se confie entre les mains d’une femme qu’on appelait « faiseuse d’ange » et comme cela arrivait trop souvent, elle meurt.
Joseph se retrouve donc seul avec sa grand-mère qui n’a plus toute sa tête.
Alors que Joseph joue au football avec ses copains, on vient le chercher. Sa grand-mère vient d’être conduite à l’hôpital Sainte Anne qui est l’asile psychiatrique de Paris depuis 1651. Joseph est donc pris en charge par l’assistance publique.
Non seulement, il est orphelin. Mais il est aussi fils d’une avorteuse.
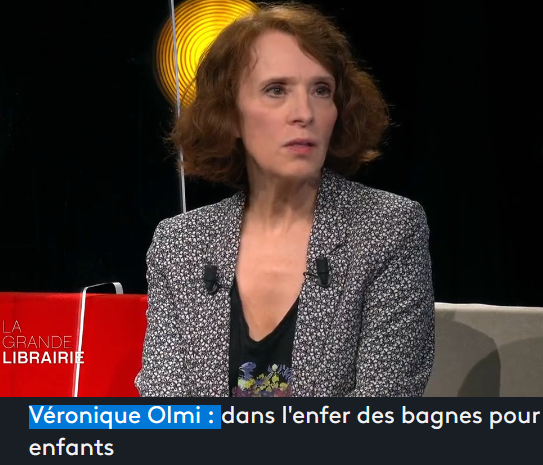 Véronique Olmi insiste sur le fait que la société d’alors jugeait les gens selon leur hérédité. Si la mère n’était pas une femme digne dans l’ordre moral, l’enfant était suspect.
Véronique Olmi insiste sur le fait que la société d’alors jugeait les gens selon leur hérédité. Si la mère n’était pas une femme digne dans l’ordre moral, l’enfant était suspect.
Elle fut aussi invité d’Augustin Trapenard, le 8 février 2022 : <Les mots de Véronique Olmi>. Dans cette émission elle a dit :
« Le droit à l’avortement, c’est une conquête à ne jamais oublier. Je ne sais pas si le système patriarcal s’effritera un jour, ce sera un processus sûrement très long, mais le corps de la femme est toujours celui qui souffre dans ce système. »
Et il est vrai qu’alors que nous pensions que ce combat était gagné en Occident, des forces obscures, au sein des religions établies, parviennent à faire reculer cette liberté des femmes aux États-Unis, en Pologne et de manière plus insidieuse en France : < Près de 8 % des centres pratiquant l’IVG en France ont fermé en dix ans>
Joseph est d’abord confié à un orphelinat, mais très rapidement il est placé dans une ferme, près d’Abbeville. Après la grande guerre, les paysans manquaient de bras, alors il faisait appel à l’assistance publique pour en récupérer.
On les appelait « les parents nourriciers » mais Joseph considère ce lieu plutôt comme une souricière. La société d’alors considérait le travail de la terre comme quelque chose de particulièrement sain et rédempteur pour les enfants mal nés. Joseph est un gavroche parisien, cette vie à travailler dans la ferme ne lui convient pas, surtout que les parents souriciers sont âpres aux gains et brutaux.
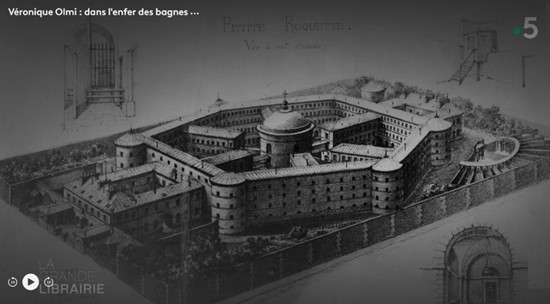 Il retournera à Paris, mais pour le pire. Il est mal noté par l’inspecteur qui ordonne son retour dans la capitale et son incarcération à la prison de la Petite-Roquette dans le quartier de la Bastille.
Il retournera à Paris, mais pour le pire. Il est mal noté par l’inspecteur qui ordonne son retour dans la capitale et son incarcération à la prison de la Petite-Roquette dans le quartier de la Bastille.
Ce que j’ai appris sur cette prison pour enfant m’a sidéré et atterré.
Il en est encore capable de dire que c’était mieux avant !
<Le ministère de la justice> fait un court résumé de cette prison construite en 1836 et qui ne se videra de ses enfants qu’en 1930 pour devenir une prison pour femmes avant d’être détruite en 1974, remplacée depuis par le square de la Roquette. Le ministère de la Justice cite Victor Hugo qui trouvait cet établissement très bien en 1847.
Le principe de cette prison était l’isolement et le silence.
« 20 minutes » cite Véronique Blanchard, historienne qui a coécrit : « Mauvaise Graine: Deux siècles d’histoire de la justice des enfants » :
« Près de 500 enfants y sont incarcérés. On leur intime le silence absolu. « On applique un système philadelphien où le temps d’enfermement est plus important que les moments passés en collectivité. Les enfants passent 22 heures en cellule », raconte Véronique Blanchard. Ils n’ont pas le droit de se voir, ni de se parler. Quand ils sont amenés à se déplacer, on leur pose un sac sur la tête pour éviter qu’ils ne croisent le regard de leurs camarades. Les promenades dans les couloirs sont individuelles. « Et quand, le dimanche, ils assistent à la messe dans la chapelle, ils sont placés dans des box individuels pour limiter toute communication », poursuit l’historienne.
« Les cellules sont des cages infectes, à peines convenables pour un animal », relate le journaliste Henry Danjou. Trois mètres de long et deux mètres de large. « Le jour n’y arrive que par les vitres dépolies d’une fenêtre, dont l’espagnolette est cadenassée. Elles ne sont pas éclairées la nuit. Ni chauffées. J’y ai vu des enfants qui n’avaient plus de visages humains, hirsutes, sales, couverts de poils, jetant sur moi un regard égaré » »
« Paris Match » a aussi publié, en 2021, un article instructif : « L’histoire oubliée des enfants abandonnés de la Petite Roquette » qui rapporte que des pères mécontents de leurs enfants pouvaient les faire enfermer dans ce terrible endroit et aussi que la mortalité était de 12% par an. La nourriture y était médiocre et insuffisante.
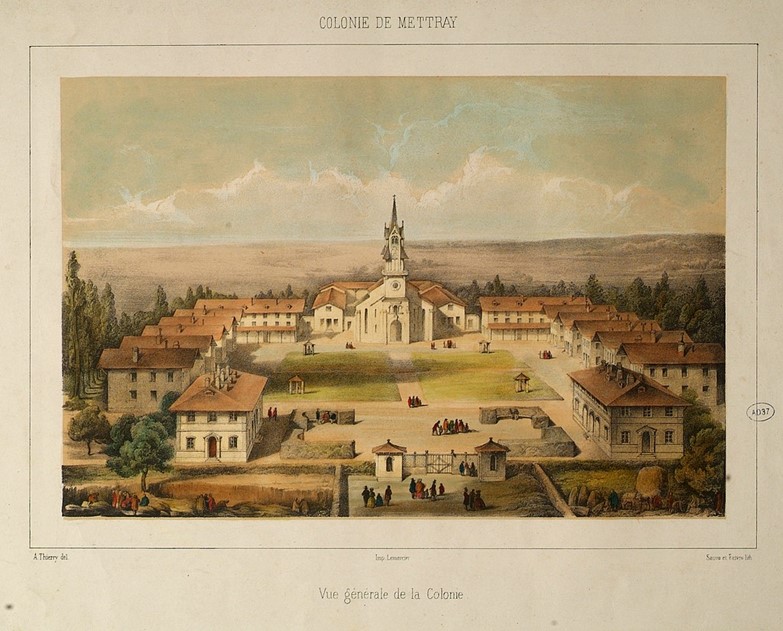 Par la suite Joseph quittera cette prison pour être envoyé dans un domaine agricole en Touraine : « La Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray », véritable bagne pour enfants ouverts en 1839 et fermé en 1939.
Par la suite Joseph quittera cette prison pour être envoyé dans un domaine agricole en Touraine : « La Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray », véritable bagne pour enfants ouverts en 1839 et fermé en 1939.
C’est encore le mythe de la terre rédemptrice qui était à l’œuvre dans ce lieu de travail acharné, de privations de liberté et privations de soin.
Un des pensionnaires les plus célèbres de ce bagne sera Jean Genet qui décrit la vie des enfants là-bas dans son livre « Le Miracle de la rose ». Il raconte que « chaque paysan touchant une prime de cinquante francs par colon évadé qu’il ramenait, c’est une véritable chasse à l’enfant, avec fourches, fusils et chiens qui se livrait jour et nuit dans la campagne de Mettray. ».
Véronique Olmi dit dans les deux émissions ce qu’elle doit à Jean Genet
« Les mots de Genet m’ont apporté le vertige. Je l’ai lu adolescente, et c’était trop troublant. Des années après, ça m’a coupé le souffle : c’est cru, c’est violent, mais toujours pris dans une violence à nu, sublimée en permanence. Genet, c’est l’intranquillité. »
Joseph parviendra à surmonter ces épreuves et trouvera la liberté et la joie grâce à la musique et l’amour.
Lors de cette période d’avant, où ce n’était pas mieux, l’éducation des enfants qui étaient dans les griffes de l’assistance publique constituait une barbarie, quasi un esclavage et on faisait trimer ces pauvres enfants pour le plus grand bénéfice de leurs tortionnaires ou même l’État.
On ne leur apprenait rien, notamment pas l’écriture.
François Busnel parle d’une « partie méconnue de l’Histoire de la République ».
C’est la grandeur de ce livre et de Véronique Olmi de dévoiler cette partie.
<1653>
-
Jeudi 17 février 2022
« Elle est de la race des héroïnes. »Le préfet parlant de Fatima ZekkourJe reviens souvent vers des mots du jour écrits les années passées que je relis..
Il y a 2 ans, <Le 17 février 2020> j’évoquais une jeune fille qui a pour nom Fatima Zekkour.
Le 4 mai 2013, Fatima, 17 ans, est entrée dans un immeuble en flamme à Nevers. Avec sa sœur enceinte, elles sont allées taper à toutes les portes des quatre étages de l’immeuble. Des personnes ont été sauvées grâce à cette intervention.
La sœur de Fatima est sortie plus tôt. Mais Fatima est restée prisonnière des flammes, elle pensait que les pompiers n’allaient pas tarder mais les pompiers n’avaient pas cru sa maman qui les avait appelés. Ne voyant rien venir, Fatima est allée seule traverser le rideau de feu.
« Je suis tombée dans les pommes plusieurs fois en descendant. J’ ai traversé le hall, je me suis à nouveau évanouie sur le canapé en feu. Je ne me souviens pas comment j’ai pu ouvrir la porte et sortir ».
Elle est brulée à 70 %, au visage aux mains aux jambes, aux poumons, on la plonge dans un coma artificiel pendant 20 jours, quand elle se réveille elle a tout oublié et puis elle se souvient et elle cauchemarde enveloppée de bandages, on va l’opérer 50 fois, micro chirurgie et greffes de peau…
La ville de Nevers lui décernera la médaille de la ville pour sa bravoure.
L’article du « Journal du Centre » qui relate cette remise de médaille <cite> les propos du préfet :
« Jean-Pierre Condemine, préfet de la Nièvre, a ajouté sa partition à ce concert d’éloges. « Grièvement brûlée, aussitôt prise en charge par les secours, Fatima n’abandonnera jamais le combat, ne se plaindra jamais et fera face. Elle est de la race des héroïnes, dont le courage et le dévouement n’ont d’égal que la modestie et la simplicité. Elle nous donne à tous une leçon émouvante et magistrale. »
Alors, j’ai souhaité faire des recherches pour savoir si les journaux parlaient encore de Fatima Zekkour.
Et, j’ai trouvé cet article du journal « Le Populaire du Centre » de juillet 2021 : < Huit ans après avoir sacrifié sa peau pour sauver celle des autres, Fatima Zekkour a retrouvé le goût de la vie >
Et dans cet article on apprend que Fatima Zekkour s’est mariée et a accouché d’une fille prénommée Delya.
Un journaliste du Populaire lui a rendu visite. Je cite quelques extraits :
« Quand on ouvre la porte de son appartement de Nevers, c’est Romain, son mari, qui nous ouvre la porte. Dans la pénombre de son salon, les volets fermés pour limiter l’entrée du soleil, Fatima Zekkour est assise sur son canapé, un bébé de quelques mois sur les genoux […]
À 25 ans, Fatima a accompli une partie de ses vœux. Avoir un mari, un enfant… Ce qu’elle pensait impossible il y a quelque temps, se souvient sa maman, Christine. « Elle est heureuse, croque la vie à pleines dents, elle est épanouie… Elle n’est plus renfermée sur elle-même comme avant ».
[…] « Quand notre enfant vit un accident comme ça, on se pose tous la question en tant que parents : « Est-ce que notre fille aura une vie normale ? » »
[…] Il y a un an, Fatima portait encore des gants ; aujourd’hui, elle n’en met plus
Les yeux noirs pétillants, les lèvres soulignées d’un rouge à lèvres vif, les cheveux détachés et la bonne humeur de cette petite brune de 25 ans camouflent discrètement les cicatrices, vestiges de son accident. Certaines blessures physiques restent taboues. Sa famille évite d’en parler.
D’autres moins visibles, restent indélébiles. Fatima ne veut pas retourner devant l’immeuble, même pour une photo. Mais petit à petit, elle reprend confiance. Apprend à moins avoir peur du feu. Désormais, elle peut rallumer des bougies sans appréhension.
« À l’hôpital, le chirurgien lui a demandé : « Qu’est-ce que tu ferais si tu voyais un accident ? » Elle a répondu : « Je ferais autrement. Mais je le ferais. Si je dois sauver des gens, je sauverais des gens » » Avec plus de précautions, en prenant moins de risques, Fatima retournerait en première ligne. »
Je finissais le mot du jour du 17 février 2020 par ces mots : « La vie est plus belle quand on croise la route, même si ce n’est qu’à l’occasion d’un article ou d’une émission, d’une femme comme Fatima Zekkour. ».
Aujourd’hui, j’ai écrit une sorte de « mot de suivi »
Avant son congé parental, elle exerçait dans un centre médico-social destiné aux personnes atteintes de la maladie d’alzheimer.
<1652>
-
Mercredi 16 février 2022
« Il n’y a qu’à l’étranger que je suis français. »Amar Mekrous, français de confession musulmane qui a quitté son paysC’est La revue de Presse de Claude Askolovitch <du 14 février 2022> qui m’a fait découvrir l’article du New York Times traduit en français sur son site et accessible gratuitement : < Le départ en sourdine des musulmans de France>
Claude Askolovitch rappelle :
« Qui lit le New York Times le sait, ce journal américain juge souvent la France dont la laïcité jacobine ne lui correspond pas… »
Je serais plus direct : le New York Times n’aime pas la France républicaine et laïque. Il a osé donner pour titre à l’article qui relatait la décapitation de Samuel Paty par un tchétchène se réclamant de l’Islam :
« La police française tire et tue un homme après une attaque mortelle au couteau dans la rue »
J’avais relaté ce fait dans le mot du jour du <28 octobre 2020>
Mais il faut savoir sortir de sa zone de confort et aussi lire et écouter ses adversaires.
D’autant que cette fois, le New York Times ne se contente pas d’asséner ses certitudes mais révèle, pour l’essentiel, le résultat d’une enquête menée par deux de ses journalistes : Norimitsu Onishi et Aida Alami
C’est une enquête qui parle d’exil. Les journalistes évoquent : « La France et son âme meurtrie ».
Il utilisent cette expression pour parler d’un premier exilé qui est un écrivain français, né à Saint-Étienne en 1983, dans une famille d’origine algérienne : Sabri Louatah :
« La France et son âme meurtrie sont le personnage invisible de chacun des romans de Sabri Louatah […] Il évoque son « amour sensuel, charnel, viscéral » pour la langue française et son fort attachement à sa ville d’origine, Saint-Étienne, baignant dans la lumière caractéristique de la région. Il suit de près la campagne des prochaines élections présidentielles.
Mais M. Louatah fait tout cela depuis Philadelphie, devenue sa ville d’adoption depuis les attentats de 2015 en France par des extrémistes islamistes qui ont fait 130 victimes et profondément traumatisé le pays. Avec le raidissement de l’opinion qui a suivi à l’égard de tous les Français musulmans, il ne se sentait plus en sécurité dans son propre pays. Un jour, on lui a craché dessus et on l’a traité de « sale Arabe ». »
Et il déclare à ces journalistes :
« C’est vraiment les attentats de 2015 qui m’ont fait partir — j’ai compris qu’on n’allait pas nous pardonner. »
Et le New York Times de révéler que cela fait des années que la France perd des professionnels hautement qualifiés partis chercher plus de dynamisme et d’opportunités ailleurs. Parmi eux, d’après des chercheurs universitaires, on trouve un nombre croissant de Français musulmans qui affirment que la discrimination a été un puissant facteur de leur départ et qu’ils se sont sentis contraints de quitter la France en raison d’un plafond de verre de préjugés, d’un questionnement persistant au sujet de leur sécurité et d’un sentiment de non-appartenance.
Nous devons convenir avec le journal américain que ni les politiciens ni les médias n’évoquent ce flux d’émigration.
Ils citent Olivier Esteves, professeur au Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales de l’Université de Lille qui a mené une enquête auprès de 900 Français musulmans émigrés, dont des entretiens approfondis avec 130 d’entre eux :
« La France se tire une grosse balle dans le pied. »
Le New York Times reprend alors des éléments de ce qui se passe dans notre campagne présidentielle actuelle qui est, selon moi, d’une indigence absolue :
« [Les musulmans] sont associés à la criminalité ou à d’autres fléaux sociaux par le biais d’expressions-choc telles que « les zones de non-France », décrites par Valérie Pécresse, la candidate de centre-droit actuellement au coude-à-coude avec la cheffe de file d’extrême droite Marine Le Pen pour la deuxième place derrière M. Macron. Ils sont pointés du doigt par le commentateur de télévision et candidat d’extrême-droite Éric Zemmour, qui a déclaré que les employeurs avaient le droit de refuser des Noirs et des Arabes. »
Ces exilés vont s’installer aux Royaume-Uni et aux États-Unis, pays pour lesquels Les journalistes américains reconnaissent « [qu’ils] sont loin d’être des paradis libres de discriminations à l’encontre des musulmans ou d’autres groupes minoritaires » mais dans lesquels ces français de religion musulmane affirment trouver davantage d’opportunités et d’acceptation.
Et il cite un autre de ces exilés Amar Mekrous, 46 ans qui s’est installé à Leicester en Angleterre :
« Il n’y a qu’à l’étranger que je suis français. […] Je suis français, je suis marié à une Française, je parle français et je vis français. J’aime la bouffe, la culture françaises. Mais dans mon pays, je ne suis pas français. ».
On apprend que ces chercheurs lillois se sont associés à des chercheurs de trois autres universités (Liège et la KU Leuven en Belgique, et celle d’Amsterdam aux Pays-Bas) pour une étude de l’émigration de musulmans depuis la France, mais aussi depuis la Belgique et les Pays-Bas.
Un de ces chercheurs, Jérémy Mandin, qui a participé à cette étude explique que :
« Nombre de jeunes Français musulmans étaient désenchantés par le fait « d’avoir joué selon les règles, d’avoir fait tout ce qu’on ce qu’on leur avait dit et, au final, de ne pas accéder à une vie désirable. »
Parce qu’il y a une discrimination à l’embauche et aussi un ras le bol de tracasseries dans le quotidien :
« Malgré ses diplômes de droit européen et de gestion de projet, Myriam Grubo, 31 ans, dit qu’elle n’a jamais réussi à trouver d’emploi en France. Après une demi-douzaine d’années à l’étranger — Genève d’abord, à l’Organisation Mondiale de la Santé, puis au Sénégal à l’Institut Pasteur de Dakar — elle est revenue à Paris chez ses parents. Elle cherche un emploi — à l’étranger. « Me sentir étrangère dans mon pays me pose un problème » dit-elle, ajoutant qu’elle a envie qu’on la « laisse tranquille » pour pratiquer sa foi. »
Le New York Times cite encore quelques autres exemples dont Rama Yade qui fut dans le gouvernement, sous la présidence Sarkozy, et qui a également quitté la France.
Aucun des exemples cités par le New York Times ne correspond au profil de cette petite minorité de marchands de haine ou encore de marchands de poupée sans visage ou de croyants archaïques qui prônent des valeurs en contradiction absolue avec nos valeurs républicaines.
Mais pour diverses raisons, les autorités étatiques et municipales n’ont pas agi de manière sérieuse et rigoureuse pour lutter contre ces dérives minoritaires.
Et nous arrivons désormais à une situation dans laquelle les identitaires parviennent à mobiliser de plus en plus largement dans les deux camps : celui des anti-musulmans et celui en face de français de confession musulmane qui sont également entrainés dans un repli sur soi allant jusqu’à des comportements sectaires.
Tout cela au détriment de la plus grande partie des français de confession musulmane qui sont pratiquants ou non mais qui se sentent rejetés, discriminés et comme le dit Amar Mekrous sentent qu’on nie leur appartenance à la nation française.
Claude Askolovitch termine sa citation de l’article du New York Times par cette question :
Est-ce rattrapable ?
Nous devons nous rappeler que l’Histoire de France a connu un autre grand exode pour des raisons religieuses dans le passé. C’était après la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV. Les français de foi protestante se sont enfuis de France pour rejoindre les élites des Pays-Bas, de la Suisse et de l’Allemagne notamment à Berlin. Ils ont alors enrichis par leur présence, leur dynamisme et leur travail ces pays et la France, en retour, a perdu cette richesse intellectuelle et économique.
Nous ne sommes pas exactement dans le même cas, car à l’époque de Louis XIV les persécutions étaient plus explicites et émanaient directement de l’État central.
Aujourd’hui les discriminations ne sont pas de même niveau et n’émanent pas pour l’essentiel de l’État.
Mais des femmes et des hommes, comme les présentent le New York Times, qui ont le courage et la détermination de quitter le pays où ils sont nés pour aller vivre et réussir leur vie ailleurs sont forcément des personnes de grande qualité et appartiennent à une élite réelle. S’en priver est, comme l’écrit Olivier Esteves, se tirer une balle dans le pied.
<1651>
-
Mardi 15 février 2022
« Andrew Wakefield »Ancien médecin, falsificateur anti-vaccinNous sortons lentement, je l’espère au moins, de cette incroyable période de la COVID19 qui a débuté pour nous au début de l’année 2020.
Beaucoup de clivages sont apparus. Des familles mêmes se sont déchirées.
Le vaccin et la vaccination ont, il me semble, constitué le paroxysme de ces oppositions.
Il faut admettre que ce sont des vaccins un peu étonnants.
Le professeur de pharmacologie Bernard Bégaud, <cité par LIBE> explique qu’ils présentent «une particularité que l’on n’a pas assez soulignée», celle de «ne pas empêcher les contaminations», «même si les vaccinés y sont moins sensibles».
Depuis le début de leur mise sur le marché, les autorités sanitaires qui préconisaient la vaccination justifiaient leur position par le bénéfice d’éviter les cas graves de la maladie pour la plus grande part des vaccinés.
A la faiblesse du vaccin contre la transmission du virus, une autre limite est rapidement apparue celle de la limite dans le temps de l’effet bénéfique des vaccins.
Cette seconde faiblesse a conduit à la multiplication des doses.
La multiplication des doses qui a conduit à augmenter encore les bénéfices des laboratoires qui ont produit ces vaccins.
Le propos de ce mot du jour n’est pas de développer les différentes controverses sur les vaccins contre la COVID.
J’ai simplement voulu faire cette introduction pour signaler qu’il y a des questions légitimes qui se posent et que le débat n’est ni binaire, ni simple.
Mais si du côté des Pro Vax il y a des laboratoires que certains nomment « big pharma » qui constituent des entreprises très lucratives, il existe aussi du côté de certains qui ont des positions très anti-vax des entreprises très lucratives.
J’ai regardé avec beaucoup d’étonnement et de surprise le documentaire d’ARTE < <Antivax – Les marchands de doute> qui parle essentiellement d’un médecin anglais déchu : Andrew Wakefield..
Cet homme dont les fraudes ont été prouvées et dénoncées en Grande Bretagne a poursuivi, pour le plus grand bénéfice de son patrimoine et ses revenus, ses agissements troubles aux États-Unis.
Ce que j’ai appris dans le documentaire d’ARTE est aussi développé dans Wikipedia que je reprends largement pour simplifier l’écriture de ce mot du jour.
Andrew Jeremy Wakefield (né en 1956 à Eton) était chirurgien britannique et chercheur en médecine.
Il a publié une étude, en 1998, dans « The Lancet » qui prétendait établir une relation de cause à effet entre le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons et ce qu’il a appelé « l’entérocolite autistique » terme de son invention.
En terme plus simple, il prétendait que le vaccin ROR présentait de forts risques de rendre autistes les enfants vaccinés.
Des scientifiques ont repris les études de Wakefield et réalisé des études complémentaires qui ont démontré la fraude scientifique de Wakefield en 2010.
Le 28 janvier 2010, un tribunal de 5 membres du British General Medical (GMC) prouve la véracité de plus d’une trentaine des inculpations contre Wakefield, parmi lesquelles quatre inculpations pour « malhonnêteté », et douze pour abus contre enfants victimes de troubles du développement. Le tribunal a jugé que Wakefield a « failli à son devoir de consultant responsable », a agi contre l’intérêt de ses patients, « malhonnêtement et de manière non responsable » lors de son étude. The Lancet rétracte immédiatement et complètement la publication de l’étude de 1998 de Wakefield sur la base des résultats de l’enquête du GMC, notant que des éléments du manuscrit ont été falsifiés.
Wakefield est radié du registre médical (c’est-à-dire renvoyé de l’Ordre des médecins) en mai 2010 et n’est plus autorisé à exercer la médecine au Royaume-Uni.
De nombreuses recherches épidémiologiques ont depuis démontré une absence de lien entre les vaccins et l’autisme, ce qui fait l’objet d’un consensus général dans la communauté scientifique.
L’enquête d’un reporter du Sunday Times (journal britannique), Brian Deer, identifie des conflits d’intérêts d’ordre financier non divulgués par Wakefield. La plupart de ses coauteurs rétractent alors leur soutien à Wakefield et aux conclusions de son étude.
Deer affirme que Wakefield prévoyait de lancer une entreprise s’appuyant sur une campagne de propagande anti-vaccins. Un prospectus pour les investisseurs potentiels dans l’entreprise de Wakefield suggérait qu’un test de dépistage pour la maladie que Wakefield voulait appeler « entérocolite autistique » pouvait produire jusqu’à 28 millions de Livres Sterling de revenus (plus de 32 millions d’euros), avec des tests de dépistages effectués dans le cas de litiges entre patients et médecins comme marché initial, aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
Malgré le consensus scientifique, l’étude de Wakefield a été la première à engendrer une controverse sur le rôle de la vaccination dans l’autisme dans l’opinion publique, qui est encore présente aujourd’hui.
Le documentaire d’ARTE relate des cas où des enfants non vaccinés en raison de cette campagne ont été très touchés par ces maladies et certains en sont même décédés.
En 2015, Wakefield s’exile aux États-Unis, où il continue ses pseudos- recherches et ses interventions sur le sujet des vaccins. Très proche des milieux ultra-conservateurs américains, il participe en 2017 au bal inaugural du président Donald Trump.
En continuant à asséner ces contre-vérités il a su capter toute une communauté de personnes convaincues de ses affirmations pour le plus grand bien de ses finances.
Il est devenu très riche, son combat contre les vaccins est devenu pour lui un business modèle.
<Conspiracywatch> publie aussi un article éclairant sur cet individu, ainsi que la <Radio Télévision Belge>
Il ne s’agit pas de faire un amalgame entre toutes celles et ceux qui ont exprimé leurs doutes et leurs questionnements contre les vaccins contre la Covid19 et ce médecin déchu, mais simplement d’informer qu’au sein de la campagne anti-vaccination qui s’est développé dans le monde occidental depuis les années 2000, il y a aussi les manœuvres de cet homme qui ont eu des conséquences désastreuses : en 2019 le monde a fait face à <Une flambée mondiale> de rougeole alors que cette maladie aurait dû être éradiquée.
Même Donald Trump avait alors pris ses distances avec Wakefield <face à l’épidémie de rougeole, Trump change sa position sur les vaccins>
Lien vers le <Documentaire d’ARTE>
<1650>
-
Lundi 14 février 2022
« L’écologie réussit l’exploit de paniquer les gens puis de les faire bailler d’ennui. »Bruno LatourBruno Latour a écrit avec Nikolaj Schultz un nouveau livre qu’ils ont intitulé : « Mémo sur la nouvelle classe écologique » avec pour sous-titre : « Comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d’elle-même »
Pour présenter son livre, Bruno Latour a été l’invité du Grand entretien de France Inter du 7 janvier 2022 : « Les écologistes ne peuvent pas espérer mobiliser sans faire le travail idéologique. »
Il espère la constitution d’une classe écologique qui serait consciente d’elle-même.
Il pense que les jeunes peuvent être le fer de lance de cette classe.
Il reconnait cependant que :
« Il n’y a pas un sujet sur lequel nous sommes consensuel : les éoliennes, les plastiques, les manières de se déplacer… c’est une particularité de l’écologie. »
Et puis surtout, il a cette formule sur le discours actuel du mouvement écologiste « de la panique et de l’ennui. »
Autrement dit, pour l’instant la parole écologiste n’a pas trouvé son récit désirable.
Bruno Latour n’a d’ailleurs pas de solution non plus :
« Aujourd’hui tout le monde est conscient mais on ne sait pas quoi faire. »
Et il exprime cette crainte :
« Les masses suivraient-elles des décisions difficiles si l’écologie était au pouvoir ? »
En tout cas, les sondages que rapportent les médias ne semblent pas indiquer que le candidat de l’écologie soit poussé par l’émergence d’une classe écologique puissante.
Cependant <Bruno Latour appelle à voter Yannick Jadot> et il publie avec d’autres une tribune qu’on trouve sur le site de l’Obs où on peut lire :
« Le temps de l’écologie est venu. Elle représente un projet porteur d’avenir, un projet qui répond aux grands défis de notre temps. Protection de l’environnement, solidarité, défense des services publics, de la culture, renforcement de la démocratie et dépassement du présidentialisme, l’écologie c’est aussi la création de centaines de milliers d’emplois par une économie de l’innovation et de la qualité ancrée dans les territoires.
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous appelons tous les humanistes et les progressistes à soutenir la candidature de Yannick Jadot à l’élection présidentielle. La France ne peut pas se permettre de perdre cinq ans de plus : nous devons changer de cap dès 2022.
C’est le moment de poser les fondements d’une société plus juste, plus solidaire, plus harmonieuse.
C’est le moment d’écrire une nouvelle page de notre histoire. »
Je dois avouer mon scepticisme :
Est-il question de faire la révolution écologique dans un seul pays ?
Les voies préconisées : La voiture électrique, les éoliennes, les panneaux solaires, le tout numérique qui tous mobilisent des ressources énormes en métaux et en énergie constituent-ils des solutions pérennes et raisonnables ?
Comment les classes défavorisées qui auront certainement des réticences à intégrer la classe écologique pourront-ils accéder aux services et faire face à leurs besoins essentiels dans ce nouvel paradigme ?
Je trouve la formule « la panique et l’ennui » assez juste.
Pour le reste, je n’ai que des questions et très peu de réponses qui me semblent opérationnelles.
<1649>
-
Vendredi 11 février 2022
« Bigger Than Us »Film documentaire de Flore Vasseur« Bigger Than Us » : « Plus grand que nous. » est un documentaire planétaire réalisé par Flore Vasseur et qui raconte ce que des jeunes filles et des jeunes garçons ont su entreprendre pour que l’Humanité, la nature, la vérité se portent mieux.
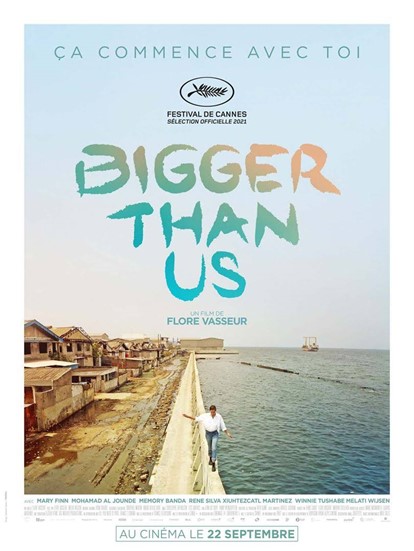 La caméra va d’abord à Bali à la rencontre de <Melati Wijsen> qui a 18 ans au moment du film.
La caméra va d’abord à Bali à la rencontre de <Melati Wijsen> qui a 18 ans au moment du film.Mais c’est depuis l’âge de 12 ans que Melati avec sa sœur Isabel lutte contre la pollution plastique.
Avec sa sœur, elle est à l’initiative de Bye Bye Plastic Bags. Ensemble, elles ont mobilisé des milliers d’enfants et de touristes et ont obtenu par décret l’interdiction de la vente et de la distribution de sacs, d’emballages et de pailles en plastique sur leur île, Bali.
C’est ensuite Melati qui va accompagner et être le lien du tour du monde de Flore Vasseur à la rencontre de jeunes qui se sont levés pour agir et contribuer à ce que leurs actions soient positives.
Le film nous fait voyager au Malawi, au Liban, au Brésil, aux Etats-Unis, en Grèce, en Indonésie et en Ouganda, à la rencontre de Rene, de Memory, de Winnie, de Xiuhtezcatl, de Mohamad et de Mary
Tous se sont levés pour une cause qui est plus grande qu’eux, la lutte pour les droits humains, la dignité, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation.
Annie poursuit une collaboration féconde avec une institution lyonnaise remarquable sur laquelle je reviendrais probablement un mot du jour prochain : « La maison de l’apprendre ». Et c’est La maison de l’apprendre qui organise sur Lyon « le Festival de l’Apprendre » présente partout en France pour célébrer tous les apprentissages, tous les acteurs et tous les lieux qui les permettent dans chaque territoire.
Le Festival de l’Apprendre s’inscrit dans la dynamique Learning Planet impulsée par le Centre de Recherches Interdisciplinaire et l’Unesco. Je ne développe pas, peut être ultérieurement…
Toujours est il que cette année le festival de l’apprendre se terminait à Lyon, par la projection de ce documentaire en présence de Flore Vasseur. Nous y sommes donc allés et avons pu échanger à la fin du film avec la réalisatrice.
 Flore Vasseur est une femme singulière, issue du monde des start up et de la Finance et qui va basculer dans tout à fait autre chose que l’on pourrait décrire par «changer le monde par l’écriture et le témoignage.». Témoignages de la rencontre avec des femmes et des hommes qui ont agi ou agissent non pour la gloire, non pour devenir milliardaire, mais pour ce qui est plus grand qu’eux, leur communauté, la préservation de la biosphère, rendre l’humanité plus raisonnable et plus résiliente.
Flore Vasseur est une femme singulière, issue du monde des start up et de la Finance et qui va basculer dans tout à fait autre chose que l’on pourrait décrire par «changer le monde par l’écriture et le témoignage.». Témoignages de la rencontre avec des femmes et des hommes qui ont agi ou agissent non pour la gloire, non pour devenir milliardaire, mais pour ce qui est plus grand qu’eux, leur communauté, la préservation de la biosphère, rendre l’humanité plus raisonnable et plus résiliente.J’ai déjà évoqué Flore Vasseur lors du mot du jour consacré à « Aaron Schwartz », ce génie de l’informatique qui voulait un monde ouvert et une connaissance partagée. Il s’est heurté aux puissances de l’argent, à celles et ceux qui veulent la marchandisation de toutes chosse. Devant l’ampleur de l’assaut et la menace de condamnation très lourde, il s’est suicidé à 26 ans. Flore Vasseur avait écrit le livre : <Ce qu’il reste de nos rêves> entièrement dédié à cet humaniste blessé et dont elle dit : « Aaron était le meilleur d’entre nous. »
Flore Vasseur est née en 1973 à Annecy. Elle fait de brillantes études qui la conduisent à intégrer HEC Paris.
À l’issue de ses études, Flore Vasseur est recrutée par un groupe de l’industrie du luxe. Elle s’installe à New York en 1999 et fonde une société de marketing.
Elle raconte son parcours dans sa bio qu’elle a publié sur son site https://florevasseur.com/bio/
« Je m’installe à New York à 25 ans pour créer mon cabinet d’études marketing. Je vis la bulle Internet, le 11 Septembre, un système capitaliste qui craquèle de toute part. Depuis, j’écris pour comprendre la fin d’un monde, l’émergence d’un autre et le travail de celles et ceux qui, peut-être, le feront.
Je m’attaque à l’emprise de la finance et à la folie d’un monde assis sur la technologie. J’interroge notre rapport au pouvoir, l’élite en mode panique, nos consentements. En fait, je tire le fil qui, depuis le 11 septembre, ne m’a jamais quitté : qui gouverne ?
Pour y répondre, j’apprends à utiliser tous les autres supports (articles, film, roman, chroniques, séries) et tous les espaces (presse, livres, TV, cinéma) : JE CHERCHE.J’entreprends un travail au long cours sur la piste des activistes, des défenseurs des droits et des lanceurs d’alerte.
A Moscou, je réalise MEETING SNOWDEN avec ancien contractant de la NSA. Arte qui a commissionné ce travail m’a autorisé à « libérer » ce travail, accessible gratuitement sur Internet.
Puis mon roman-enquête, CE QU’IL RESTE DE NOS REVES, tente de retracer l’histoire méconnue et réelle d’Aaron Swartz, enfant prodige du code qui nous voulait libre, persécuté par l’administration Obama.
BIGGER THAN US, produit avec Marion Cotillard et Denis Carot, est mon premier film documentaire de cinéma. »Elle écrit aussi des chroniques dans les journaux français et réalise une chronique sur France Culture.
Sur le site de la télévision belge elle explique :
« Il y a eu des tonnes de documentaires donnant la parole aux adultes, aux experts. Ces productions ont fait leur travail, mais je pense qu’il faut maintenant tendre le micro à d’autres personnes, explique la journaliste et romancière Flore Vasseur, réalisatrice du film. Il faut sortir de ce récit dominant et montrer que l’intelligence de situation est partout. On ne fait juste pas l’effort d’écouter. »
Et elle finit l’article par cette harangue :
« Par leurs actions, ces jeunes posent un acte profondément politique, avec un grand » P « . Ils tendent un miroir à ceux qui nous gouvernent et qui font de la petite politique électorale. Je pense que les jeunes sont totalement désintéressés et complètement dans l’action. Ce qu’ils veulent c’est aider leurs semblables à survivre, tout simplement. […]
La question des victoires est presque annexe. La victoire c’est d’être debout, être dans la vie, dans la joie. »Ce film documentaire Bigger Than Us est un moment d’émotion, de questions et de remise en cause de la manière dont nous autres humains vivons et agissons sur notre biosphère et sur les autres humains. Ce que des traditions séculaires dans certaines communautés engendrent comme violence.
 Memory Banda du Malawi est une fille d’une énergie, d’une lucidité et d’une intelligence extraordinaire.
Memory Banda du Malawi est une fille d’une énergie, d’une lucidité et d’une intelligence extraordinaire.Elle a osé défier la tradition du viol institutionnalisé des jeunes filles dans des camps d’initiation dédiés. Elle a fait cesser cette pratique dans tout le pays, puis a fait modifier la constitution du Malawi pour relever l’âge légal de 15 à 18 ans afin de protéger les filles du mariage forcé.
Au Malawi, 42% des filles sont mariées avant l’âge de 18 ans. Dans le monde, c’est 1 fille sur 5 (Unicef).
Elle raconte :
« Ma petite sœur a dû aller au camp d’initiation. Quand vous avez vos premières règles, vous devez y aller pour en apprendre plus sur les traditions et devenir ‘femme’. Et un jour, la communauté engage un homme qui va au camp et viole les filles. C’est le rite traditionnel de passage vers l’âge adulte. Elles ont 11 ou 12 ans. Lorsqu’elle est revenue de là, ma petite sœur est tombée enceinte et a été forcée d’épouser la personne qui l’avait mise enceinte. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que cela n’avait pas à m’arriver, que cela n’était pas une chose normale. Et aussi que personne ne parlerait pour nous. »
Elle dit :
« La plupart du temps, nous les jeunes nous nous sous-estimons, nous et nos capacités. Mais, par mon expérience, j’ai appris que ce sont les jeunes les vrais moteurs du changement. Ici par exemple, ce sont les jeunes qui ont réveillé leurs communautés, porté le message jusqu’au parlement et vu ce changement incroyable pour le Malawi. Ce sont les jeunes qui instillent le changement. »
Vous pourrez lire cela sur <la page> qui lui est consacrée sur le site du film remarquablement riche
Le site du film : « Bigger Than Us » consacre ainsi une page à chacun des protagonistes de ce film.
 Je ne peux les citer tous mais je voudrais revenir sur Melati Wilsen qui ouvre le film puis sera le fil conducteur ou plutôt « la fille conductrice » du film. Elle dit :
Je ne peux les citer tous mais je voudrais revenir sur Melati Wilsen qui ouvre le film puis sera le fil conducteur ou plutôt « la fille conductrice » du film. Elle dit :« Dans l’Histoire, il y a toujours eu des grands rassemblements de personnes qui s’unissent réellement. Au point où il n’y avait plus de moyen de voir les choses autrement. C’était le résultat de gens qui se sentaient à nouveau à leur place et à nouveau vivants et qui avaient trouvé un but plus grand. »
Aujourd’hui elle développe <Youthtopia>, une plateforme d’éducation et de partage d’outils pour des jeunes souhaitant s’engager.
Elle le présente ainsi :
« Mon projet Youthtopia s’est construit depuis quatre ans dans ma tête, dans mon cœur. Ma rencontres avec les différents personnages du film et au-delà, les histoires que j’ai entendues, les problèmes du monde et solutions que je perçois rendent tout cela encore plus évident pour moi. Ma prochaine étape est de créer ce lieu pour ma génération, pour nous réunir et nous donner une éducation de pair à pair. Ce dont nous avons vraiment besoin en ce moment, c’est d’un espace pour nous retrouver de manière authentique. Un espace construit et animé par des jeunes, pour des jeunes, à une échelle universelle. Cet endroit est un besoin urgent pour notre génération. Et c’est un Youthtopia. »
Alors, si vous voulez voir ce film, la manière traditionnelle de trouver une salle de cinéma où est projeté ce film est possible mais très restreinte. Nous sommes dans la modernité et il y a de nombreuses possibilités de le voir. Tout est expliqué sur la page du site du film : https://biggerthanus.film/voir-le-film
Du souffle, de la fraîcheur, de la force de vie…et une invitation à s’engager.

<1648>
-
Jeudi 10 février 2022
« Nous ne connaissons pas celui qui a trahi Anne Frank et sa famille. »État actuel de la question après la publication d’un livre qui affirmait le savoirLe monde n’est pas rempli que d’homme sage comme Thich Nhat Hanh, sujet du mot du jour de lundi ou d’humanistes résilients comme Aurélie Sylvestre ou Georges Salines sujet des mots du jour de mardi et mercredi.
Je crois nous avons tous entendu parler d’Anne Frank et connaissons tous son histoire et sa vie brisée par la barbarie nazie.
 Le 12 juin 1942, aux Pays-Bas, Anne Frank, une adolescente juive reçoit un journal intime pour son treizième anniversaire. Le jour-même, elle commence à écrire ce qui deviendra « Le journal d’Anne Frank».
Le 12 juin 1942, aux Pays-Bas, Anne Frank, une adolescente juive reçoit un journal intime pour son treizième anniversaire. Le jour-même, elle commence à écrire ce qui deviendra « Le journal d’Anne Frank».
Cachée dans une maison d’Amsterdam, annexe à l’usine où travaillait son père, elle y raconte son quotidien sous l’occupation allemande.
Durant deux ans, la jeune fille se confie à une amie imaginaire, «Kitty», lui adresse des lettres au fil de la plume, partage ses histoires et ses peurs, alors que le moindre bruit provoque sursaut et angoisse.
« C’est une sensation très étrange, pour quelqu’un dans mon genre, d’écrire un journal. Non seulement je n’ai jamais écrit, mais il me semble que plus tard, ni moi ni personne ne s’intéressera aux confidences d’une écolière de treize ans ».
Elle écrira jusqu’au 1er août 1944. Trois jours plus tard, Anne et sa famille sont arrêtés.
La jeune fille désormais âgée de 15 ans est déportée en septembre dans le camp d’Auschwitz-Birkenau.
Après avoir survécu à tant d’horreurs et de drame, elle meurt en février ou mars 1945 à Bergen-Belsen, succombant au typhus, à quelques semaines seulement de la libération du camp par les troupes britanniques.
Son père, Otto, « le plus chou des petits papa », comme elle le décrit dans son journal, est le seul survivant de leur groupe et décide, à son retour à Amsterdam, de faire publier l’œuvre de sa fille.
On ne sait pas qui a trahi et fait arrêter Anne et sa famille.
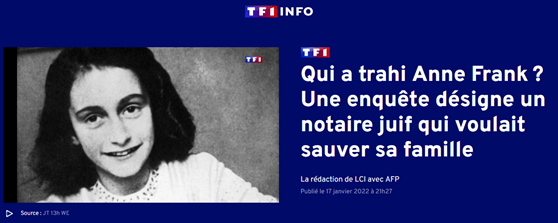 Mais, récemment je pense que nous avons tous entendu, vu ou lu qu’un livre venait d’être publié qui après une enquête de 6 ans ! pouvait révéler l’identité du traitre.
Mais, récemment je pense que nous avons tous entendu, vu ou lu qu’un livre venait d’être publié qui après une enquête de 6 ans ! pouvait révéler l’identité du traitre.
Et on a vu, lu ou entendu partout que c’était un notaire juif.
Mais savez vous que ce livre vient d’être suspendu de la vente ?
« Le Canard Enchaîné » du mercredi 9 février 2022 écrit dans sa page 5 :
« L’Éditeur Néerlandais Ambo Anthos suspend temporairement l’impression de « Qui a trahi Anne Frank ? » signé de la canadienne Rosemary Sullivan. Selon « Livres Hebdo » : La maison d’édition souhaite vérifier la véracité de l’enquête avant de prendre une décision ».
Voilà qui est étrange, en principe, il vaudrait mieux vérifier avant de publier que de publier et de vérifier après.
Le canard poursuit :
« L’auteure aurait identifié le délateur : un notaire juif hollandais nommé Arnold van den Bergh. Rien de moins sûr, admet aujourd’hui l’éditeur, qui avait recruté « un détective du FBI à la retraite et une équipe internationale de scientifiques, d’historiens et de policiers. »
Et le Canard taquin d’ajouter : « Une enquête sur cette brillante compagnie ? Cela pourrait faire un bon sujet pour une publication chez le même éditeur. »
 On constate donc que l’accusation : « c’est un juif qui a dénoncé des juifs » a été immédiatement et largement diffusée.
On constate donc que l’accusation : « c’est un juif qui a dénoncé des juifs » a été immédiatement et largement diffusée.
Le doute qui vient d’apparaître fait beaucoup moins de bruit.
Après avoir lu le Canard enchainé j’ai fait des recherches et j’ai constaté que sur son site « Le Monde » a également relayé cette information, il y a quelques jours.
Et puis Guillaume Erner, sur France Culture, ce matin, a cité le Canard.
Ce sont des correspondants du Monde : Cécile Boutelet (à Berlin) et Jean-Pierre Stroobants (à Bruxelles) qui ont conduit à une publication du 3 février que je n’avais pas remarqué : <Anne Frank : l’impression du livre sur sa dénonciation a été suspendue aux Pays-Bas>
Je cite « Le Monde » :
« La thèse finale du livre, évoquant l’arrestation des huit occupants de l’Annexe, à Amsterdam, le 4 août 1944, à la suite d’informations livrées à l’occupant nazi par un notaire juif, Arnold van den Bergh, a rapidement été remise en question aux Pays-Bas. […]
Des chercheurs, dont l’historien Erik Somers, de l’Institut néerlandais d’études sur la guerre, l’Holocauste et le génocide (NIOD), avaient rapidement critiqué l’ouvrage. Bart van der Boom, professeur à Amsterdam et Leyde, démentait ainsi que le notaire ait pu avoir accès à une liste secrète des juifs cachés à Amsterdam : le conseil juif, instauré par les nazis et dont van den Bergh faisait partie, ne possédait pas un tel document, a confirmé ce spécialiste.
 Dès le 18 janvier, Bart Wallet, historien de l’université d’Amsterdam, qualifiait la démonstration de « château de cartes » dans le magazine allemand Der Spiegel. La semaine suivante, l’hebdomadaire interrogeait d’autres experts à propos du conseil juif, confronté à l’époque à un terrible dilemme, puisqu’il essayait de sauver des vies par le biais de la coopération, tout en étant contraint de participer aux déportations.
Dès le 18 janvier, Bart Wallet, historien de l’université d’Amsterdam, qualifiait la démonstration de « château de cartes » dans le magazine allemand Der Spiegel. La semaine suivante, l’hebdomadaire interrogeait d’autres experts à propos du conseil juif, confronté à l’époque à un terrible dilemme, puisqu’il essayait de sauver des vies par le biais de la coopération, tout en étant contraint de participer aux déportations.
Ces spécialistes estimaient, eux aussi, qu’il était improbable que de telles listes de cachettes juives aient existé. David Barnouw, longtemps chercheur au NIOD, auteur en 1986 de la première édition scientifique du journal d’Anne Frank, affirmait ainsi au magazine que « personne n’a jamais vu de telles listes ».
Quant aux doutes exprimés par l’enquête sur la probité du notaire van der Bergh, ils sont jugés « purement spéculatifs » par Laurien Vastenhout, également chercheuse au NIOD. Selon plusieurs historiens, il existe, en revanche, des preuves convaincantes que le notaire et sa famille, s’estimant menacés, se sont cachés des nazis dès le début de l’année 1944, bien avant l’arrestation d’Anne Frank et de ses proches.
Un autre élément-clé de l’enquête est une lettre anonyme qu’aurait reçue Otto Frank après la Libération. Cette dernière désignerait le notaire, mais le père d’Anne aurait refusé de dévoiler son nom par crainte de déclencher une vague d’antisémitisme. « Difficile à croire, a expliqué Johannes Houwink ten Cate, professeur à l’université d’Amsterdam, au quotidien néerlandais NRC Handelsblad. Le fait de désigner un juif aurait-il vraiment été, pour Otto Frank, plus important que de trouver le complice de l’assassinat de sa famille ? »
L’analyste médico-légal Frank Alkemade, consulté par l’équipe d’enquête, affirme, lui, avoir avancé avec prudence l’hypothèse d’une culpabilité sûre « à 85 % » du notaire. La marge d’erreur pouvait, en réalité, atteindre 50 %, a-t-il dit. Le modèle d’analyse de probabilité utilisé par M. Alkemade est, en outre, contesté par plusieurs de ses confrères. »
Le journal nous apprend qu’en France, le 3 février, le livre était toujours en vente assorti d’un bandeau qui affirme : « Notre équipe a atteint son but, comprendre ce qui a déclenché la rafle du 4 août 1944. »
Guillaume Erner dans son humeur du matin du 9 février a constaté :
« C’est probablement l’un des thèmes les plus terribles agités au sujet de la Shoah. Après avoir dit que les victimes se sont laissées tuer comme des moutons, idiotie historique qui a eu la vie longue, voici un autre mensonge : les juifs se sont donnés les uns les autres. Mais bien sûr dans le cas d’Anne Frank, ce pouvait être vrai. Fausse dans le cas général, cette règle pouvait souffrir de terribles exceptions.
[…] Autant la nouvelle du scoop, le résultat de l’enquête avait été accueillis par un tintamarre mondial, autant cette suspension a été annoncée discrètement, elle n’est probablement pas arrivée aux oreilles de tous ceux qui pensent qu’Anne Frank et les siens ont été donnés par un juif. »
Et Guillaume Erner avance une information supplémentaire :
« Cette enquête indubitable par 30 experts évoque une liste de juifs cachés, conservée par le Conseil juif, et c’est cette liste, une anti liste de Schindler, qui aurait été donnée par le délateur de la famille Frank. Oui mais voilà cette liste n’a probablement jamais existé, pire encore, il s’agit tout simplement d’une fake news, une infox, propagée par trois collaborateurs nazis, expliquant ainsi après-guerre que les juifs s’étaient déportés les uns les autres…
On ne peut pas profaner la tombe d’Anne Frank puisqu’elle n’a pas eu de sépulture, mais on peut faire pire en propageant les pires mensonges déguisés en vérités historiques. »
Nous ne savons donc pas.
Et ceci est une information, une connaissance.
Évidemment elle fait moins de bruit, intéresse moins.
Je ne crois pas à un complot antisémite qui ne voudrait pas remettre en cause la thèse d’un juif qui trahit des juifs et qui plait tant aux antisémites.
Non, la réponse me semble beaucoup plus simple : Une information raisonnable et équilibrée est beaucoup moins « bankable » qu’une nouvelle sordide et abjecte.
<1647>
-
Mercredi 9 février 2022
« J’admire la capacité des victimes à ne pas céder à la haine, à ne pas faire d’amalgames, à croire en notre démocratie et en l’Etat de droit. […] Cela redonne confiance en l’humanité dont nous serions parfois tentés de désespérer. »Georges SalinesLe témoignage d’Aurélie Sylvestre que j’ai évoqué hier, je l’ai découvert en écoutant l’émission de Philippe Meyer « Le nouvel Esprit Public » du <26 décembre 2021>, consacrée au Procès des attentats du 13 novembre 2015.
Philippe Meyer avait invité Georges Salines qui est médecin comme son épouse Emmanuelle. Le couple qui a eu trois enfants, deux garçons et une fille, a perdu sa fille Lola, assassinée au Bataclan.
 Comme pour toutes les autres victimes, « Le Monde » a consacré une page à <Lola Salines, 29 ans>
Comme pour toutes les autres victimes, « Le Monde » a consacré une page à <Lola Salines, 29 ans>
J’avais déjà écrit un mot du jour parlant de Georges Salines, c’était il y a un environ un an : « Il nous reste les mots » qui est le titre d’un ouvrage écrit par deux hommes, le premier père de Lola assassinée, le second Azdyne Amimour, père d’un des assassins.
Azdyne Amimour semble être mis en difficulté lors du procès. « Libération » évoque les doutes sur le récit qu’il fait notamment sur un voyage en Syrie à la recherche de son fils : < Azdyne Amimour est-il réellement allé en Syrie pour ramener son fils, kamikaze du Bataclan ?>
« Le Monde » décrit le manque de clarté dans ses réponses < le vain interrogatoire des pères de deux terroristes du Bataclan>
Lors de l’émission de Philippe Meyer, Georges Salines est plein de bienveillance disant simplement qu’Azdyne Amimour a des problèmes avec sa mémoire.
Je crois qu’il faut écouter cette émission. Georges Salines est un exemple d’homme qui rend fier d’appartenir à l’espèce homo sapiens, ce qui n’est pas toujours simple, vous en conviendrez.
David Djaïz , un des intervenants de l’émission, s’est adressé à lui :
« Il est difficile de trouver les mots, mais je voudrais d’abord vous exprimer ma compassion, mon admiration et mon respect. […] J’admire la dignité et la discipline avec lesquelles vous faites face, vous continuez à vous tenir droit et à témoigner. »
Et Jean-Louis Bourlanges a ajouté :
« Je partage absolument ce qu’a dit David sur le respect qu’inspire votre attitude, cette discipline, cet effort d’objectivation, de mise à distance intellectuelle, tout cela est admirable. Je le dis d’autant plus volontiers que j’occupe le rôle de l’homme politique dans cette émission, et je ressens qu’un homme politique devrait avoir le même courage que vous, cette capacité de traiter intellectuellement des problèmes aussi chargés émotionnellement. Personnellement, je m’en sais incapable. »
Je soulignerai trois moments dans l’intervention de Georges Salines :
D’abord son indulgence devant l’erreur humaine :
« Je suis a priori plutôt indulgent face aux erreurs ou aux faiblesses des pouvoirs publics : parce que c’est très compliqué, parce que les moyens ne sont pas là, et parce que l’erreur est humaine. Je ne m’attendais pas à ce qu’on débatte autant de ces problèmes, car les assassins de nos enfants sont les terroristes, pas François Hollande ou la police belge […]. Mais il y a tout de même des manquements sérieux. Côté français, Samy Amimour avait été arrêté et placé en garde-à-vie en 2012 à cause d’un projet de départ en zone djihadiste. Placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction Marc Trévidic, ses papiers lui ont été confisqués. Or, un an plus tard, il a pu quitter le territoire national avec une vraie carte d’identité. Soit le fonctionnaire qui a refait les papiers n’a pas vérifié dans le fichier d’interdiction de sortie du territoire, ce qui est une faute, soit ce fichier n’avait pas été renseigné correctement (autre faute, de la Justice cette fois), soit on ne lui a retiré que son passeport, mais pas sa carte d’identité. Pour le moment, on ne sait pas quelle hypothèse est la bonne, mais on ne peut s’empêcher de penser à ce qui se serait passé si tout le monde avait fait son travail correctement …
Tout ne fonctionne pas en France, mais c’est bien pire en Belgique. Un véritable désastre à vrai dire. Je ne vais pas entrer dans les détails, d’autant que l’on ressent ce procès par phases, et je sors d’une semaine de dépositions des enquêteurs belges, dont les dépositions ont révélé des manquements graves. Mais on ne peut pas refaire l’Histoire, et s’appesantir sur ces manquements ne fera pas revivre nos enfants. »
 Ensuite cette difficulté de comprendre comment on devient terroriste et aussi le constat que les idéologues de Daesh ont décidé d’attaquer la France depuis longtemps non pour se venger de bombardements, mais parce qu’ils haïssent notre manière de vivre :
Ensuite cette difficulté de comprendre comment on devient terroriste et aussi le constat que les idéologues de Daesh ont décidé d’attaquer la France depuis longtemps non pour se venger de bombardements, mais parce qu’ils haïssent notre manière de vivre :
« Comment devient-on un terroriste ? C’est la question qui me taraude depuis le début. Le 14 novembre, je me demandais déjà comment faire pour que ce qui venait de m’arriver n’arrive pas à quelqu’un d’autre. J’ai intégré mes réflexions à mes livres, […] Ce que je peux faire, c’est prêter mon concours à des activités de type éducatif. Je le fais, dans les collèges, les lycées, ou en prison. Je ne sais pas si cela sert à quelque chose, je demande d’ailleurs à ce que ce soit évalué. Mais pour que ce type d’action soit efficace, il nous faut mieux comprendre la manière dont on franchit le pas du terrorisme. Le procès m’apprend beaucoup, j’ai également beaucoup lu et échangé à ce sujet. Il n’y a manifestement pas un modèle unique, mais des parcours de vie très différents. Ce qui est frappant au procès, c’est que presque tous les membres de la cellule terroriste se connaissaient. Ils étaient frères, cousins, vivaient à quelques centaines de mètres les uns des autres, fréquentaient le même bistrot … Il ne faut pas oublier le rôle que jouent les prédicateurs ou certains sites internet dans la radicalisation. Dans ces affaires-là, il faut se garder de la naïveté, et s’efforcer de ne pas faciliter la tâche des recruteurs. Par exemple, il est tout à fait évident que le discours de Daech (dans les communiqués revendiquant les attentats, dans les déclarations des trois terroristes du Bataclan à leurs victimes, et dans ce que répète Salah Abdeslam à la Cour), consistant à dire que les attentats ne sont que des représailles après les bombardements français, est mensonger. C’est absolument faux : on sait que Daech a commencé à préparer ces attentats avant que la France ne bombarde quoi que ce soit. »
Enfin, quand nous renonçons à nos valeurs, cela ne joue aucun rôle auprès des idéologues, en revanche cela leur permet de trouver beaucoup plus facilement des exécutants au sein de certaines franges de la communauté musulmane :
« Nos manquements vis-à-vis de nos propres principes peuvent faciliter le recrutement de certains à qui l’on monte la tête sur le thème de la malfaisance de l’Occident. Hugo Micheron, expert de l’islamisme, remarquait que Guantanamo était du pain béni pour Daech. Évitons donc ce genre d’erreur. »
Georges Saline a fondé l’association « 13Onze15 Fraternité et vérité »
Avant d’écrire « Il nous reste les mots », il avait publié un livre racontant sa douleur et son combat pour la fraternité, la vérité et la justice : « L’Indicible de A à Z »,
Devant la Cour d’Assises, il a eu ces mots :
« J’admire la capacité des victimes à ne pas céder à la haine, à ne pas faire d’amalgames, à croire en notre démocratie et en l’Etat de droit. […] Cela redonne confiance en l’humanité dont nous serions parfois tentés de désespérer. »
<1646>
-
Mardi 8 février 2022
« Et chaque jour je remplis un peu davantage mes cuves d’humanité. »Aurélie SilvestreEn ce moment se tient le procès des attentats du 13 novembre 2015. Initialement prévu à partir de janvier 2021, le procès fut reporté en raison de la pandémie de Covid-19.
Il s’est ouvert le 8 septembre 2021 et il est prévu qu’il se déroule jusqu’à fin mai 2022 devant la cour d’assises spéciale de Paris.
Ces attentats au Bataclan, contre des terrasses de café de Paris et au stade de France ont entraîné la mort de 131 personnes et 413 blessés.
Tous les terroristes à l’exception d’un seul ont été tués ou se sont suicidés.
Le terroriste survivant et 19 complices présumés sont jugés mais 6 d’entre eux sont « jugés en absence »
Présidée par Jean-Louis Périès, cinq magistrats professionnels composent la cour d’assises spéciale, trois avocats généraux représenteront l’accusation avec un dossier d’instruction de 542 tomes.
1 765 personnes physiques et morales sont constituées partie civile.
Parmi ces 1 765 personnes, il y a Aurélie Sylvestre.
 Le 13 novembre 2015, Aurélie Sylvestre avait 34 ans, un enfant de trois ans Gary et un bébé dans le ventre. Son compagnon Mathieu Giroud, rencontré 15 ans plus tôt, était au Bataclan. Elle n’y était pas allée pour se reposer parce qu’elle portait son bébé.
Le 13 novembre 2015, Aurélie Sylvestre avait 34 ans, un enfant de trois ans Gary et un bébé dans le ventre. Son compagnon Mathieu Giroud, rencontré 15 ans plus tôt, était au Bataclan. Elle n’y était pas allée pour se reposer parce qu’elle portait son bébé.Aurélie et Mathieu savent que ce sera une petite fille, une échographie l’a révélé le 6 novembre. Thelma naîtra quatre mois après les attentats.
Matthieu est prof à la fac en géographie et Aurélie travaille avec une amie, créatrice de bijoux.
Elle a livré un témoignage bouleversant que France Inter a restitué intégralement.
Elle raconte sa vie avant, pendant et après l’attentat,
Pendant, un appel téléphonique lui avait annoncé que Mathieu était vivant. Elle n’apprendra officiellement sa mort que le 14 novembre au soir.
Et elle finit son récit en disant qu’elle n’osait pas venir à ce procès, qu’elle avait peur. Mais elle a trouvé la force d’y aller le premier jour et elle a pensé ne pas revenir.
Et puis elle raconte :
« Mais je suis revenue le lendemain, et le jour d’après aussi.
Quasiment tous les jours en fait. Et petit à petit j’ai compris. Je viens ici pour entendre ce qu’il se dit – et c’est souvent très dur – mais je repars plus souvent encore galvanisée par ce qu’il s’y passe. Il y a dans cette salle des mains qui se touchent, des familles qui s’étreignent, des amis qui se réconfortent.
On décrit l’horreur et au milieu – souvent involontairement – se glisse l’amour, la grande amitié, les verres partagés sur une terrasse, le bonheur d’écouter du son ensemble.C’est assez subtil mais par moments suffisamment puissant pour que j’arrive à sentir quelques notes du parfum de la vie d’avant. Ça ne dure souvent qu’une seconde mais nous le savons mieux que personne ici : il y a des secondes qui contiennent des vies.
C’est assez fou mais je crois qu’il y a ici tout ce qui faisait de nous une cible : l’ouverture à l’autre, la capacité d’aimer, de réfléchir, de partager et c’est incroyable de constater qu’au milieu de tout ce qui s’est cassé pour nous ce soir-là, ça – ce truc là – est resté intact je crois.
Alors je continue à venir ici.
Et chaque jour je remplis un peu davantage mes cuves d’humanité.
J’entends des histoires de héros de coin des rues et je les rapporte à mes enfants le soir. Je leur raconte ce frère qui a sauvé sa sœur en la plaquant au sol.
Je leur dis cet homme qui a décidé de rester avec mon amie Edith quand son corps lui empêchait de se sauver et moi je ne suis pas près de me remettre de l’histoire de ce policier qui s’est couché sur le terroriste pour que les otages puissent passer après l’assaut.
Je dis aussi à mes enfants qu’un soir, quand il se faisait tard, des parties civiles ont fait passer de la nourriture aux accusés.
Et même, que les avocats se sont cotisés pour payer une bonne défense aux « méchants ». Je peux expliquer à mes enfants qu’il n’y a que ce qui est équitable qui est juste.
L’autre jour une de mes amies m’a dit que cette salle était le pays dans lequel on voulait vivre.
Je crois qu’elle a raison.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de m’écouter. ».Des hommes, car c’étaient des hommes, souvent anciens délinquants, ont adhéré à un récit religieux fanatique et violent.
En se référant à une organisation et des décisions prises par des criminels religieux venant du Moyen-Orient et se réclamant de l’Islam, ces monstres ont tiré avec des armes de guerre sur des civils désarmés qui vivaient une vie paisible et conviviale.
Notre réponse ne peut pas, ne doit pas se situer dans le même registre de violence et de vengeance de ces égarés en voie de déshumanisation.
Notre réponse doit être celle du droit et de notre humanisme.
C’est ce que les mots d’Aurélie Sylvestre expriment avec une clarté et une émotion saisissantes.
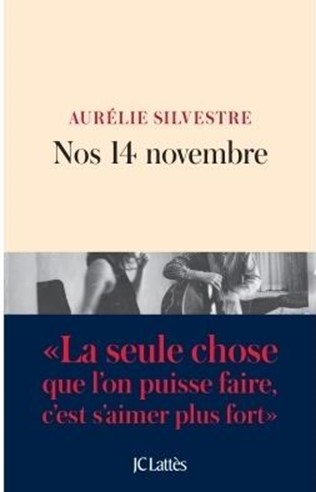 L’intégralité de son témoignage se trouve sur le site de France Inter <Je suis devenue une athlète du deuil>
L’intégralité de son témoignage se trouve sur le site de France Inter <Je suis devenue une athlète du deuil>Elle a écrit un livre : <Nos 14 novembre>
« L’Humanité » a consacré un article à ce livre : <La leçon de vie d’Aurélie Silvestre>
« Elle » a réalisé une interview à l’occasion de la sortie du livre : <leçon de survie>
Dans cet interview, elle dit puiser sa force dans la beauté de ce monde. :
« C’est ce qui me sauve. J’ai palpé la folie du monde, à défaut de la comprendre et de pouvoir l’arrêter. Le lendemain, alors que l’homme de ma vie venait de mourir sous les balles des terroristes, j’ai traversé Paris pour me rendre au centre de crise de l’École militaire. Ce matin-là, j’aurais pu ne rien voir. Et pourtant, j’ai vu le soleil se lever sur la grande roue, place de la Concorde, c’est un résidu de beauté qui m’a fait basculer. À ce moment précis, j’ai décidé que j’allais continuer à vivre.
[…] Tout cela aurait pu me terrasser, m’abattre définitivement, mais non. Mes enfants vont bien, je vais bien. Mon quotidien est loin d’être simple, mais je suis « debout » et je sais que ma capacité à aimer est intacte. Elle est même décuplée. »
Sur France 2, elle avait témoigné sur le plateau du <20 heures> et a aussi été interviewée dans le cadre de l’émission : <La Maison des maternelles>.
Vous pouvez aussi lire le témoignage d’Aurélie Sylvestre devant la Cour d’Assises derrière ce <Lien>
<1645>
-
Lundi 7 février 2022
« Je pense donc je ne suis pas vraiment là. .»Thich Nhat HanhC’est sur les réseaux sociaux que j’ai appris cette nouvelle : Thich Nhat Hanh s’est éteint, à l’âge de 95 ans, au Temple Từ Hiếu à Huế au Vietnam, au moment du passage du 21 au 22 Janvier 2022.
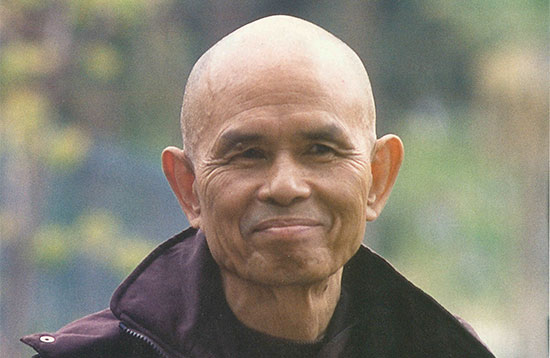 Plusieurs amis ont relayé cette information, ce qui m’a conduit à m’intéresser à cet homme issu de la spiritualité bouddhiste et qui était je crois, un grand sage.
Plusieurs amis ont relayé cette information, ce qui m’a conduit à m’intéresser à cet homme issu de la spiritualité bouddhiste et qui était je crois, un grand sage.
J’aborde l’écriture de ce mot du jour avec une énorme humilité, celle de la vallée qui constitue la seconde étape de <l’effet Dunning-Kruger >
Je connais si peu de cet homme que je ne peux rien en dire de savant.
Je sais même que parmi celles et ceux qui lisent ces mots du jour, il en est qui en savent beaucoup plus sur lui.
Je suis pourtant poussé, après ce que j’ai lu et que j’ai entendu ou vu, de recommencer mon écriture quotidienne, après une longue pause, par le partage de ce que j’ai appris et qui résonne en moi du message de cet homme
Il est considéré en Occident comme celui ayant introduit le concept de « pleine conscience », « méditation de la pleine conscience » directement issu de la spiritualité bouddhiste.
Pleine conscience que l’on peut aussi appeler, il me semble, la pleine présence.
A ce stade, je vais narrer ce que j’ai vécu dans mon corps, un jour particulier.
C’était en janvier 2019. Le lendemain du jour où l’urologue qui m’avait annoncé, 8 ans auparavant, qu’il me guérirait du cancer qui venait d’être diagnostiqué, avait concédé son échec à réaliser sa promesse. Le cancer était devenu un cancer de stade 4 avec des métastases osseuses.
Je me promenais dans Lyon, et mes pensées se bousculaient dans ma tête.
Nous savons tous que nous sommes mortels, et que le rideau peut être tiré en quelques instants.
Mais l’annonce de cette nouvelle m’a conduit à penser que mon horloge de vie avait avancé beaucoup plus vite que je ne le soupçonnais.
Et puis, brusquement j’ai eu une étonnante sensation.
Et j’ai regardé les arbres, les feuilles des arbres, les troncs comme jamais je ne les avais regardés.
Je ne les ai pas rangés dans des cases, pour dire dans ma tête ceci est un platane, ceci est un marronnier.
Non, j’observais simplement avec intensité et exclusivité ce que mes yeux rapportaient comme images à mon cerveau.
Je regardais de même les humains que je croisais, les immeubles que je longeais et le ciel sous lequel je marchais.
Et, je constatais que jamais je n’avais perçu tant de beauté et d’intensité.
Un immense calme s’est alors emparé de mon être : je vivais, j’étais présent à la vie.
Et fréquemment je tente et réussis souvent à retrouver cette capacité de présence, qui passe bien sûr par le fait de se centrer sur sa respiration et l’inspiration profonde.
Depuis cette révélation, je suis calme et je vis avec bonheur tout le reste de ce que je vais avoir la grâce de vivre.
Alors je suis particulièrement attentif et réceptif quand je lis ce que dit Thich Nhat Hanh
« On peut manger dans la pleine conscience
On peut se brosser les dents dans la pleine conscience
On peut marcher dans la pleine conscience
On peut prendre une douche dans la peine conscience
On peut conduire sa voiture dans la pleine conscience
Et comme cela ont vit chaque moment de sa vie quotidienne en profondeur, chaque moment qui nous est donné à vivre. La qualité de la vie. »
Il le dit par exemple dans cette émission bouddhiste sur France 2 qui avait rapporté des échanges lors d’un rassemblement sur le parvis de la Défense que Thich Nhat Hanh avait animé : <La marche inspirante>.
Un peu plus loin il prend notre vieux Descartes, celui du « cogito ergo sum », « je pense donc je suis » à contre-pied :
« On pense beaucoup, mais nos pensées ne sont pas (toujours] très productives
Je pense donc je ne suis pas vraiment là.
Je pense donc je suis perdu dans ma pensée. »
Il ne remet pas en cause le génie cartésien et la capacité de l’homme à penser, à imaginer, à créer et à construire.
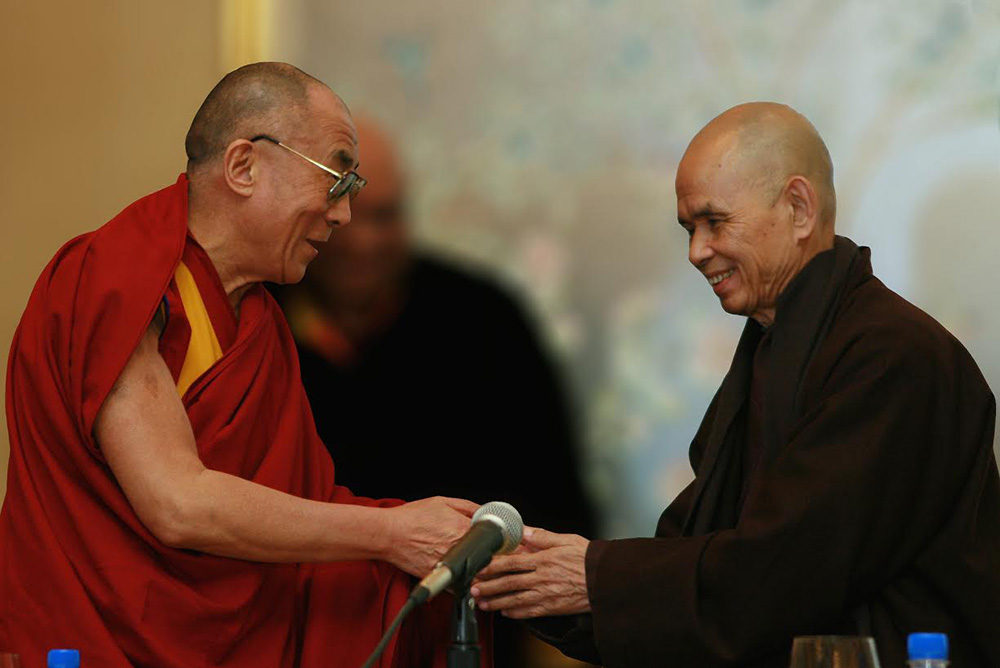 Il parle simplement de cette pollution des pensées qui se bousculent si souvent dans nos têtes et nous empêchent d’être présent à nous même et d’être présent aux autres.
Il parle simplement de cette pollution des pensées qui se bousculent si souvent dans nos têtes et nous empêchent d’être présent à nous même et d’être présent aux autres.
J’ai lu dans plusieurs articles qu’il était la figure la plus connue du bouddhisme après le Dalaï Lama
Il est né en 1926 à Hué qui faisait alors partie du protectorat français d’Annam en Indochine française Il sera ordonné moine à 16 ans.
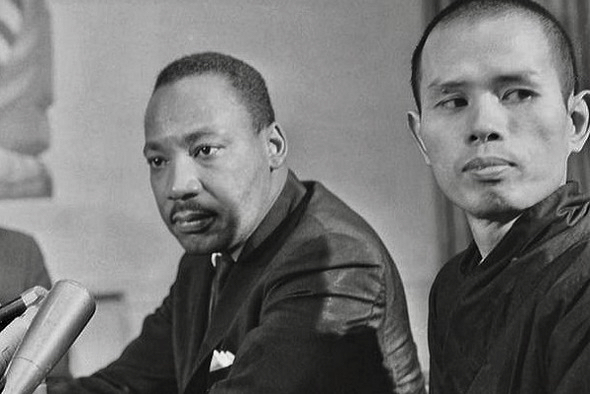 Il tentera toute sa vie à œuvrer pour la paix. En 1966, rencontrant le leader de la lutte pour les droits civiques Martin Luther King, il se joint à ses appels à mettre fin à la guerre du Vietnam. Cet appel déplut aux autorités vietnamiennes qui lui interdirent à rentrer dans son pays.
Il tentera toute sa vie à œuvrer pour la paix. En 1966, rencontrant le leader de la lutte pour les droits civiques Martin Luther King, il se joint à ses appels à mettre fin à la guerre du Vietnam. Cet appel déplut aux autorités vietnamiennes qui lui interdirent à rentrer dans son pays.
En 1967, Martin Luther King proposera son nom pour le Prix Nobel de la Paix, soutenant dans une lettre adressée au comité que « ce doux moine bouddhiste » était « un érudit aux immenses capacités intellectuelles ».
A partir de 1966 il se réfugie en France et continuera à pratiquer son enseignement à partir de notre pays.
En 1982, il établit, en Dordogne le monastère du village des pruniers. Le village des pruniers est le plus grand monastère bouddhiste d’Europe et d’Amérique, avec plus de 200 moines et plus de 10 000 visiteurs par an.
France 3 Nouvel-Aquitaine a réalisé un reportage en 2001 sur le <Village des pruniers>.
Parallèlement à son action spirituelle il a poursuivi une action sociale pour construire des écoles et des hôpitaux.
Le Viet Nam l’a autorisé à revisiter son pays en 2005.
En 2014, il a subi un accident vasculaire cérébral depuis lequel, il ne pouvait plus ni parler, ni se déplacer. En 2018, les autorités vietnamiennes l’ont autorisé à revenir pour finir sa vie dans son monastère originelle, c’est là qu’il a quitté la communauté des vivants en janvier 2022.
Depuis 2019, je vais régulièrement consulter un médecin asiatique, d’origine vietnamienne. J’ai la conviction, en effet, qu’il est utile de compléter la puissante et ciblée médecine occidentale par une médecine holistique, c’est-à-dire qui est plus douce et prend davantage en compte l’ensemble du corps et son équilibre.
Ce médecin est un disciple spirituel de Thich Nhat Hanh. Je lui ai demandé de me conseiller un livre, parmi la très nombreuse production, de son guide spirituel me permettant d’accéder un peu à sa pensée.
Il a choisi « Il n’y a ni mort, ni peur »
Ce livre s’inscrit totalement dans le récit spirituel bouddhiste qui m’est étranger, mais il distille aussi des paroles de sagesse et une invitation à la méditation en pleine conscience même si on n’adhère pas à la spiritualité bouddhiste
Il écrit d’ailleurs cet avertissement que je trouve remarquablement inspirant et qui devrait aussi inspirer les tenants des religions monothéistes qui sont parfois très éloignés de cette sagesse de vie :
« Le Bouddha nous a conseillé de ne pas considérer des enseignements comme vrais uniquement parce qu’un maître célèbre les enseigne ou qu’on les a trouvés dans des livres saints. Cela vaut aussi pour le canon bouddhiste. Nous ne pouvons accepter que les enseignements que nous avons mis en pratique avec notre propre compréhension éveillée, ceux dont nous avons pu nous rendre compte qu’ils étaient vrais de notre propre expérience. »
« Il n’y a ni mort, ni peur » page 94
Dans cette < Introduction lors de la Retraite pour les Enseignants et Éducateurs | 2014 10 27 > qui a eu lieu quelques semaines avant son AVC qui lui enlèvera la parole il revient sur la relation entre la respiration profonde et la vie, je veux dire de se sentir pleinement vivant :
« L’inspiration permet d’arrêter de penser
L’inspiration peut donner beaucoup de joie.
Inspirer signifie qu’on est vivant.
Et être vivant c’est un miracle.
Le plus grand miracle du monde
Quand vous inspirez vous revenez vers votre corps.
Souvent votre corps est là, mais votre esprit est ailleurs, dans le passé, dans le futur, dans vos projets, dans votre colère.Corps et esprit ne sont pas ensemble et alors vous n’êtes pas vraiment vivant, pas vraiment là. »
Dans cet enseignement il explique aussi longuement ce que peut être une « parole aimante » qui s’ouvre totalement à l’autre et une « écoute compassionnelle » qui recueille le témoignage de l’autre sans jugement simplement pour permettre l’expression en totale confiance
Dans la spiritualité dans laquelle s’inscrit Thich Nhat Hanh tout se trouve dans la continuité : la vraie nature de l’homme est dans la non naissance et la non-mort. L’être existait avant la naissance, il n’est pas créé par la naissance et il ne disparait pas par la mort.
Thich Nhat Hanh a ainsi écrit ce poème :
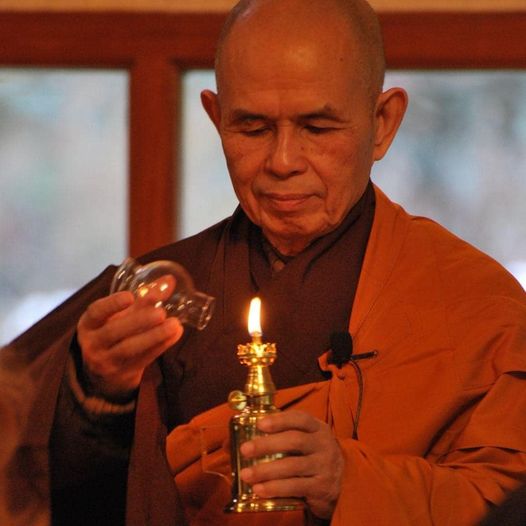 « Ce corps n’est pas moi.
« Ce corps n’est pas moi.
Je ne suis pas limité par ce corps.
Je suis la vie sans limites.
Je ne suis jamais né et jamais ne mourrai.
Regarde le vaste océan et le ciel immense là-haut
Étincelant de milliers d’étoiles.
Tout n’est que la manifestation de mon esprit.
Depuis toujours, je suis libre.
Naissance et mort ne sont que jeu de cache-cache,
Portes d’entrée et de sortie.
Prends ma main et rions tous les deux.
Ceci n’est qu’un au revoir.
Nous nous reverrons encore.
Nous ne cessons de nous rencontrer
Aujourd’hui et demain
A notre source et à chaque instant
Sous toutes les formes de la vie. »
Extrait de « Cérémonie du cœur » (Ed. Sully 2010)
Un être de lumière et de spiritualité qui me semble avoir cette qualité rare : savoir parler à tous, quelles que soient leurs croyances ou non croyances et qui s’adresse à ce qu’il y a de plus profond en l’homme.
<1644>
-
Vendredi 24 décembre 2021
« Le mot du jour est en congé.»Il reviendra le 8 févrierLors de la période de fin d’année, il n’y a pas le temps de lire des mots du jour et pas non plus pour les écrire

Il me semble donc légitime d’entamer une trêve de Noël qu’il me faut bien sur étendre un peu pour me reposer.
C’est le second Noël où le COVID plane sur ces fêtes avec sa dose d’incertitude, d’inquiétude et pour certains d’incompréhension et de colère. Je n’ai pas la réponse à tous ces mystères, mais autant que possible je vous souhaite de belles fêtes où l’essentiel sera en capacité de l’emporter sur le futile et l’accessoire.
<mot sans numéro>
-
Jeudi 23 décembre 2021
« Tous les matins je dois recomposer un homme. »Jules SupervielleUn poème de l’écrivain franco-uruguayen Jules Supervielle (1884-1960) qui se trouve dans le recueil « La Fable du monde » publié en 1938 :
« Encore frissonnant
Sous la peau des ténèbres
Tous les matins je dois
Recomposer un homme
Avec tout ce mélange
De mes jours précédents
Et le peu qui me reste
De mes jours à venir.
Me voici tout entier,
Je vais vers la fenêtre.
Lumière de ce jour,
Je viens du fond des temps,
Respecte avec douceur
Mes minutes obscures,
Épargne encore un peu
Ce que j’ai de nocturne,
D’étoilé en dedans
Et de prêt à mourir
Sous le soleil montant
Qui ne sait que grandir. »
Fabien et moi nous connaissons depuis près de 20 ans.
Pendant plusieurs années nous travaillions dans la même unité. Nous avons appris à débattre ensemble, dans le sens développé par Étienne Klein et rapporté dans le mot du jour d’hier.
Après que Fabien ait quitté le Rhône pour poursuivre son chemin administratif dans d’autres contrées, nous avons décidé de nous retrouver au moins deux fois par an, pour partager un repas puis l’après midi dans des échanges féconds dans lesquels nous nous enrichissons mutuellement, non de biens matériels, mais de nourriture de l’esprit.
Lors de notre dernière rencontre, la semaine dernière, alors que nous échangions sur nos lectures, Fabien a parlé de Jules Supervielle et a récité ce poème.
J’ai compris que je ne pouvais trouver de meilleur sujet pour le dernier mot du jour, avant la trêve de Noël.
Comme Michel Serres le disait quand on donne un objet matériel, on le perd. Si je vous donne mon smartphone, je ne l’ai plus.
Mais quand on partage une idée, un poème, on ne perd rien, on multiplie.
« Tous les matins, je dois recomposer un homme »
Le mot du jour reviendra fin janvier ou début février.
<1643>
-
Mercredi 22 décembre 2021
« Débattre est un verbe qui désigne ce qu’il faut faire pour ne pas se battre ! »Etienne KleinC’est dans son interview à Thinkerview que j’ai cité lors du mot du jour du <15 décembre 2021 > qu’Etienne Klein a cité cette phrase pleine de sens.
Armer, cela signifie qu’on donne des armes pour aller faire la guerre ou une autre activité qui utilise des armes.
Désarmer, c’est enlever les armes.
Miner un terrain, c’est mettre des mines pour le rendre infranchissable et dangereux.
Déminer, c’est enlever les mines !
Stresser, c’est créer de la tension, une angoisse.
Déstresser, c’est enlever la tension et l’angoisse !
Et donc Débattre, c’est ne pas se battre, enlever de l’échange ce moyen d’interaction qui consiste à se battre pour soumettre l’autre. C’est argumenter, écouter l’autre, se donner la faculté d’évoluer en fonction des arguments de celui avec qui on débat et on ne se bat pas.
Ce n’est certainement pas, faire cohabiter deux monologues qui ne se rencontrent jamais.
L’échange a lieu, dans l’émission, à environ une demi-heure de la fin. Le journaliste de Thinkerview pose d’abord cette question à Etienne Klein : « Selon vous dans quelle Direction se dirige la science ? Quel serait son but ultime, envers la société ? »
« C’est à la Société de répondre !
C’est à société de décider du type de compagnonnage qu’elle entend mener avec les nouvelles technologies rendues possible par la Science.
Pendant longtemps la science a été enchâssée dans l’idée du progrès, la science est le moteur du progrès.
Le mot progrès a disparu, on l’a remplacé par le mot innovation.
Et enfin, on a compris une chose essentielle, c’est que la science produit des connaissances qui ont de la valeur, mais elle produit aussi de l’incertitude.
La science ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités qu’elle nous donne.
Il faut donc en discuter, mais c’est très difficile d’en discuter parce qu’on observe une sorte de décorrélation entre la militance et la compétence.
Les gens militants pour ou contre ne sont pas forcément très compétents.
Et les gens compétents et modérés s’expriment peu.
C’est pourquoi je pense que les gens modérés doivent s’engager sans modération pour que les débats aient lieu ! [Pour éviter] que ce soit des affrontements stériles, avec des positions assez radicales.
Ma réponse à la question est : que la science ouvre les champs du possible et elle ferme aussi des portes, elle dit qu’il y a des choses impossibles !
Il y a des choses qu’elle nous permet de faire.
La question est qu’est-ce qu’on choisit ? Comment on choisit ? Et selon quels critères ?
C’est un problème Politique ! Il faut en débattre
Et Sky relance alors l’échange, en demandant qu’est-ce qu’il faut pour un bon débat ?
Et c’est ainsi qu’Etienne Klein répond :
« Un bon débat, c’est un débat qui respecte l’étymologie du verbe débattre.
C’est un verbe qui désigne ce qu’il faut faire pour ne pas se battre !
Débattre, c’est discuter, discuter sans utiliser d’argument d’autorité.
C’est donc argumenter, c’est pratiquer ce que Bergson aurait appelé une politesse de l’esprit.
Cela peut prendre du temps, ça peut être ennuyeux, un vrai débat.
Mais à la fin, on sait sur quoi on est d’accord et sur quoi on n’est pas d’accord. […]
Ce qu’on appelle aujourd’hui débat, c’est une discussion très vive, remplie d’invectives.
Débattre cela signifie qu’on accorde du temps à la discussion.
Et qu’on comprenne qu’avoir un avis, ce n’est pas la même chose que se forger un avis.
Moi j’ai l’impression que les gens qui ont un avis tranché s’estiment dédouanés de l’obligation d’apprendre à propos de sur quoi, ils ont un avis tranché. […]
Je pense que si on décide de débattre, on doit s’informer, apprendre, questionner, interpeller les experts, faire ce travail qui est chronophage.
Alors on est capable d’avoir un avis, de l’étayer et on est capable de le défendre. »
Un débat n’est pas un combat ! C’est pratiquer la politesse de l’esprit !
Je redonne le lien vers l’émission de Thinkerview : <Science et société, où va-t-on ?>
<1642>
-
Mardi 21 décembre 2021
« Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute. ! »Jean de la FontaineNous sommes en campagne présidentielle. Des femmes et des hommes viennent nous raconter des récits qui tentent de nous séduire, de nous donner l’impression qu’ils s’intéressent à nous et qu’ils ont des solutions pour que demain soit mieux qu’hier.
Je crois sage de rappeler alors la morale de la fable <le corbeau et le renard> : « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute »
Le Corbeau et le Renard est sa deuxième fable, plus précisément la deuxième fable du Livre I des Fables situé dans le premier recueil des Fables.
Si vous voulez connaître la toute première, celle qui a le numéro 1, du livre 1 du premier recueil c’est <La cigale et la fourmi>,
Jean de La Fontaine est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, en Champagne, il y a 400 ans.
Sa particule nous trompe, il n’est pas issu de la noblesse, mais de la bourgeoisie champenoise. Son père, Charles de La Fontaine était maître des eaux et forêts du duché de Château Thierry, un métier cumulant les fonctions d’administrateur et de juge.
C’était une charge que l’on achetait ou dont on pouvait hériter.
La Fontaine fera les deux il en achètera une puis reprendra celle de son père.
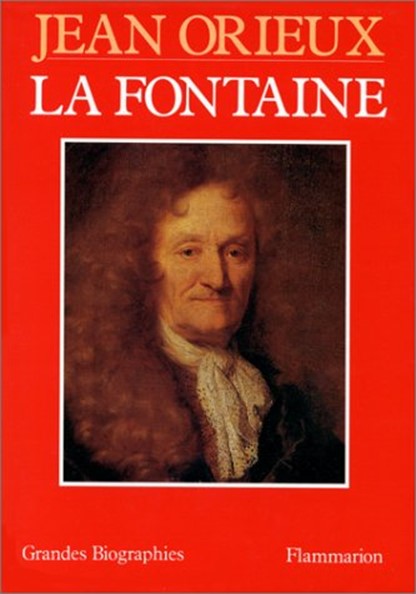 Jean Orieux dans son livre « La Fontaine ou la vie est un conte » décrit cette charge :
Jean Orieux dans son livre « La Fontaine ou la vie est un conte » décrit cette charge :
« Pour le travail, elle lui parut lourde et elle l’était assez. Il fallait tenir les registres sur lesquels devaient être portées, avec ponctualité, les amendes et les confiscations. Il devait fournir avec régularité des rapports sur l’état des domaines placés sous sa surveillance. Ponctualité ! Régularité ! […] Il devait, l’épée au côté – c’était le Glaive de la Justice ! – présider la séance hebdomadaire du Tribunal des Eaux et Forêts dont il était juge. […] Il devait réprimander, condamner, taxer les contrevenants.
Qui étaient-ils ? De misérables paysans qui avaient laissé leur bétail brouter les jeunes pousse et les plantations ; « de pauvres bucherons » (clandestins) qui avaient abattu un beau chêne pour en faire la charpente de leur petite maison. Il fallait saisir le bétail, le vendre à la criée sur l’ordre et sous le contrôle de … mais de Jean de La Fontaine ! On le voit bien mal dans ces fonctions répressives, lui que l’injustice et la cruauté de la Justice étonnaient ; lui qui avait horreur, presque autant que des pédagogues, des tribunaux et des juges à bonnets carrés. »
Page 80
Quand Jean Orieux met entre guillemets de pauvres bucherons il cite bien sûr la fable <La Mort et le Bûcheron> qui commence ainsi :
« Un pauvre Bûcheron tout couvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans »
Et plus loin La Fontaine décrit sa compassion
« Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au monde ?
En est-il un plus pauvre en la machine ronde ?
Point de pain quelquefois, et jamais de repos.
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,
Le créancier, et la corvée »
Je m’imagine, qu’un homme cupide dans la fonction qu’occupait Jean de La Fontaine peut devenir très riche. La morale est sauve, Jean de La Fontaine ne devint jamais riche.
Alexis Brocas dans le Hors-série de « Lire magazine » consacré à « l’homme à fables » nous révèle qu’entre la cigale et la fourmi, il tint le rôle de la première :
« La Fontaine aimait jouer de l’argent, une passion répandue à son époque et en perdit semble t’il souvent.
S’il savait donner de l’encensoir, il n’était pas du tout de ces courtisans capables de se faire couvrir de pensions. De Chapelain, le poète chargé par Colbert de dresser la liste des écrivains dignes de recevoir des gratifications royales, La Fontaine reçut bien des compliments, jamais d’argent. »
De Colbert, La Fontaine n’avait pas à attendre de bienveillance. La Fontaine avait cru trouver son Crésus, son mécène dans la personne de Nicolas Fouquet, le surintendant des Finances de Louis XIV. Nous savons comment cette histoire finit après la fête somptueuse de Vaux le Vicomte du 17 août 1661 offert à Louis XIV qui ne gouta pas le fait qu’un de ses sujets puissent exprimer plus de magnificence que le roi. En coulisse, et depuis longtemps, Colbert avait œuvré pour discréditer Fouquet aux yeux du Roi soleil.
Or La Fontaine ne reniera jamais vraiment Fouquet et Colbert ne lui pardonna pas ce manque de soumission.
Colbert qui retardera aussi son entrée à l’Académie Française mais ne put empêcher qu’il y entra en 1684.
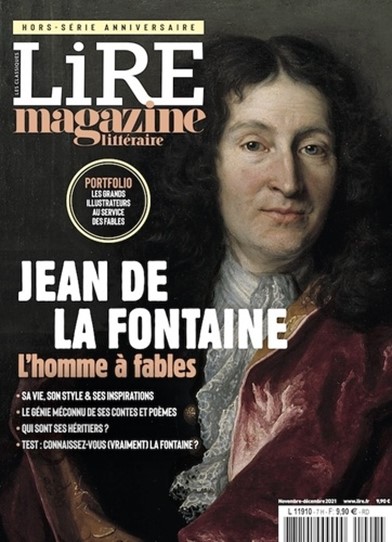 Alexis Brocas continue :
Alexis Brocas continue :
« Quant à ses livres, ils enrichirent surtout libraires et imprimeurs.
La Fontaine était de ces hommes que les affaires d’argent ennuient, et qui se font donc voler par ceux qui s’y intéressent davantage. Lorsqu’il hérita de son père et que son frère Claude revint sur d’anciens engagements pour demander le plus possible, La Fontaine dut emprunter pour lui payer sa part. Et lorsque le fils du duc de Bouillon se trouva obligé de lui racheter se charges de maître des eaux et forêts, La Fontaine attendit quatorze ans pour être payé !
C’est ainsi qu’il s’achemina vers une ruine irrémédiable : le remboursement de ses dettes excédant ses revenus, il lui fallut vendre peu à peu son patrimoine. […] Plusieurs protecteurs le prendront sous leur aile, mais, à 70 ans, La Fontaine se trouvait encore obligé de solliciter les frères Vendôme pour survivre. »
Il dévoile probablement sa conception de l’argent dans cette fable < L’Avare qui a perdu son trésor> :
« L’Usage seulement fait la possession.
Je demande à ces gens de qui la passion
Est d’entasser toujours, mettre somme sur somme,
Quel avantage ils ont que n’ait pas un autre homme. »
Un homme éminemment sympathique !
Et il alla jusqu’à se séparer de biens avec son épouse en 1658 pour éviter de l’entraîner dans sa ruine.
Sa relation avec femme fut, disons distante…
C’est son père qui lui organisa, en 1647, il avait donc 26 ans, un mariage avec Marie Héricart (1633-1709) qui en avait 14 !
C’était d’autres temps.
Un fils naîtra, 5 ans plus tard. Charles (1652-1722).
La Fontaine est un libertin, il va et vient et délaisse très vite son épouse.
Il ne s’occupe pas non plus de son fils. Jean Orieux rapporte qu’on avait raconté que La Fontaine croisant son fils dans la rue, à Paris, ne l’avait point reconnu !
Mais il ne laissera jamais son épouse sans revenus ou dans la difficulté financière dans laquelle il se trouvait.
Mais on parle de ses fables.
Le premier recueil dans lequel se trouvait le corbeau et le renard a été publié en 1668, il avait déjà 47 ans.
Et avait écrit bien d’autres choses avant des pièces de théâtre, opéras, roman en vers et en prose, une poésie scientifique : <Poème du quinquina>, description poétique <Le songe de Vaux> pour le palais de Fouquet mais qui ne fut achever qu’après l’arrestation sur surintendant.
Mais la grande affaire de La Fontaine avant les fables furent les Contes.
La Fontaine connaît ses premiers succès littéraires grâce à ces Contes et nouvelles en vers qualifiés de licencieux, libertins, coquins, grivois, lestes, érotiques.
Dans « Lire magazine » Robert Kopp écrit :
« Dans ses contes, aujourd’hui négligés et d’un érotisme surprenant pour qui ne connaîtrait que les fables, La Fontaine chante allègrement les joies de la chair comme remède à la mélancolie. Sans étalage pornographique, mais en sachant se montrer élégamment explicite.
Il sera obligé de renier ses contes « licencieux », disait-on, pour être reçu à l’Académie française.
Et pour obtenir l’extrême onction, c’est-à-dire les sacrements de l’Église avant de mourir il sera obligé de renier une seconde fois ses contes en public. Le prêtre chargé de cette tâche persuade Jean de la Fontaine de se confesser et insiste sur une confession publique afin que tous puissent assister au reniement de ses contes. Il le fait dans sa chambre en présence des académiciens. L’abbé lui fait promettre de ne plus écrire que des textes pieux et lui accorde l’extrême onction.
Il meurt le 13 avril 1695, à 73 ans.
Au début du second confinement, j’avais consacré un mot du jour à des fables de La Fontaine dans lesquelles il évoquait un confinement <mot du jour du 29 octobre 2020>
Eric Orsenna écrit dans « Lire Magazine » :
« A bien les lire, toutes ses fables ont des morales contemporaines. Et quelle langue ! La Fontaine, avec Racine, son lointain cousin, Buffon ou Saint Simon est un des plus grands stylistes de son temps, et de toute la littérature française. Cet homme, comme Montaigne, avec tous ses défauts, c’est notre frère. Piètre mari, père inexistant, mais ami formidable. »
<1641>
-
Lundi 20 décembre 2021
« Je me suis cru moi-même wagnérien pendant un certain temps. Quelle était mon erreur et que j’étais loin du compte ! ! »Camille Saint-SaënsCamille Saint-Saëns a été un musicien encensé. Au cours de sa vie il était considéré comme le plus grand musicien français.
Mais vers la fin de sa vie, il fit l’objet de beaucoup de critiques et on l’affubla du nom de « réactionnaire ».
Et après sa mort on l’oublia.
Jacques Bonnaure dans le « Classica » de janvier 2021 cite Romain Rolland qui disait qu’on peut parler de musique pendant des heures sans mentionner son nom !
Plus tard le musicologue Lucien Rebatet écrivait :
« Aucune considération scholastique ne nous embarrasse plus pour dénombrer, dans les deux cent numéros [il en existe plutôt 600 !] de Saint Saëns, tout ce qui est allé au cimetière des partitions hors d’usage, encore plus attristant que celui des vieilles ferrailles. »
Heureusement, plus personne n’oserait s’exprimer comme Rebatet et on redécouvre ces dernières années le génie de Saint-Saëns dont les œuvres sont programmés au même titre que ceux de Debussy, Fauré et d’autres.
Qu’est-ce qu’on a reproché à Saint-Saëns pendant toutes ces années ?
C’est de ne pas avoir su chevaucher la monture de « la modernité ».
Et le premier moderne auquel il s’est attaqué fut Richard Wagner.
Au début, tout se passa bien entre eux. Camille Saint-Saëns connut Wagner dès 1859, lors du séjour parisien du compositeur allemand. Il a fait partie de son cercle de familiers. Il fut le premier à jouer des transcriptions de ses partitions. D’ailleurs Wagner était admiratif des talents que pouvaient manifester Saint Saëns pour jouer ses partitions au piano :
« Le maître de Bayreuth s’extasiait « sur la vélocité extraordinaire et la stupéfiante facilité de déchiffrer » de son jeune confrère. Aussi, chaque fois qu’il passait par Paris, le priait-il de venir chez lui (3, rue d’Aumale), afin de lui jouer certaines de ses partitions qu’il était incapable d’exécuter lui-même. »
Le séjour parisien de Wagner ne fut pas couronné de succès. Saint-Saëns défendait un compositeur très critiqué. Et il va continuer à admirer Wagner, en allant à Bayreuth en 1876 pour entendre la musique wagnérienne dans son temple.
À son retour, il rédige sept articles très documentés sur la Tétralogie. Sur <France Musique> on peut lire :
« Son pèlerinage à Bayreuth en 1876 lui inspire une série d’articles sur le projet lyrique titanesque de Wagner, et il devient l’un des grands défenseurs du compositeur allemand. »
Mais la révolution wagnérienne va tout emporter sur son passage. Quand le maître meurt en 1883 à Venise, tous les « cercles progressistes » ou qui se disent modernistes n’ont d’oreilles et d’admiration que pour Wagner.
C’est alors que Saint-Saëns va s’attaquer non pas à Wagner, mais aux Wagnériens.
Il faut aussi souligner que Saint-Saëns est un nationaliste, il s’est spontanément engagé dans l’armée française en 1870 et a douloureusement vécu la défaite contre la Prusse.
Il vivra aussi la montée vers la guerre 14-18 et la guerre elle-même.
Son hostilité contre les wagnériens est aussi une lutte contre l’hégémonie culturelle et surtout musicale allemande.
Je recite la page de <France Musique>
« Mais lorsqu’une hégémonie culturelle germanique commence à envahir l’horizon musical français, lorsqu’une « wagnérolâtrie » domine l’attention française au profit de ses propres compositeurs, Saint-Saëns se réveille de son rêve wagnérien : « Je me suis cru moi-même wagnérien pendant un certain temps. Quelle était mon erreur et que j’étais loin du compte ! ».
Mais si Saint-Saëns critique ouvertement le culte croissant de Richard Wagner et l’esprit nationaliste qui l’entoure, il ne renie pas pour autant le génie musical wagnérien : « La wagnéromanie est un ridicule excusable ; la wagnérophobie est une maladie » écrit-il en 1876 dans son ouvrage Regards sur mes contemporains.
En février 1871, la guerre franco-allemande gronde toujours. La défaite française ne saurait tarder, et arrive un sentiment français de frustration envers leur ennemi. La domination allemande dans la programmation musicale des concerts en France exaspère bon nombre de compositeurs français, éclipsés par la musique de Wagner mais aussi de Beethoven. Aux côtés du professeur de chant Romain Bussine, Camille Saint-Saëns décide ainsi de créer en 1871 la Société Nationale de Musique, afin de promouvoir le génie musical français longtemps ignoré face à la tradition germanique.»
Il synthétisera toutes ses critiques dans cet article : <L’illusion Wagnérienne> qui a été publié dans la Revue de Paris d’avril 1899.
Il fait d’abord une description de tous les écrits qui glorifient la musique de Wagner et pointent leur exagération, selon lui. Globalement il dit : certes la musique de Wagner est belle, mais il reproche au wagnérien de se lancer dans des explications fumeuses pour expliquer que toutes les innovations de Wagner sont géniales :
« Tant que les commentateurs se bornent à décrire les beautés des œuvres wagnériennes, sauf une tendance à la partialité et à l’hyperbole dont il n’y a pas lieu de s’étonner, on n’a rien à leur reprocher; mais, dès qu’ils entrent dans le vif de la question, dès qu’ils veulent nous expliquer en quoi le drame musical diffère du drame lyrique et celui-ci de l’opéra, pourquoi le drame musical doit être nécessairement symbolique et légendaire, comment il doit être pensé musicalement, comment il doit exister dans l’orchestre et non dans les voix, comment on ne saurait appliquer à un drame musical de la musique d’opéra, quelle est la nature essentielle du Leitmotiv, etc.; dès qu’ils veulent, en un mot, nous initier à toutes ces belles choses, un brouillard épais descend sur le style des mots étranges, des phrases incohérentes apparaissent tout à coup, comme des diables qui sortiraient de leur boîte bref, pour exprimer les choses par mots honorables, on n’y comprend plus rien du tout. »
Et il attaque :
« L’exégèse wagnérienne part d’un principe tout différent. Pour elle, Richard Wagner n’est pas seulement un génie, c’est un Messie : le Drame, la Musique étaient jusqu’à lui dans l’enfance et préparaient son avènement; les plus grands musiciens, Sébastien Bach, Mozart, Beethoven, n’étaient que des précurseurs. Il n’y a plus rien à faire en dehors de la voie qu’il a tracée, car il est la voie, la vérité et la vie il a révélé au monde l’évangile de l’Art parfait.
Dès lors il ne saurait plus être question de critique, mais de prosélytisme et d’apostolat ; et l’on s’explique aisément ce recommencement perpétuel, cette prédication que rien ne saurait lasser. Le Christ, Bouddha sont morts depuis longtemps, et l’on commente toujours leur doctrine, on écrit encore leur vie; cela durera autant que leur culte. Mais si, comme nous le croyons, le principe manque de justesse ; si Richard Wagner ne peut être qu’un grand génie comme Dante, comme Shakespeare (on peut s’en contenter), la fausseté du principe devra réagir sur les conséquences et il est assez naturel dans ce cas de voir les commentateurs s’aventurer parfois en des raisonnements incompréhensibles, sources de déductions délirantes. »
Je ne vais pas citer tout l’article. Pour résumer, il dit que Wagner a écrit de la très belle musique et il est le continuateur des maîtres qui l’ont précédé. Il considère que les wagnériens qui prétendent que leur idole a tout inventé, que seules ses œuvres méritent d’être écoutés, se trouvent en plein délire et il le leur dit.
L’élite musicale allemande ne pardonnera pas à Saint-Saëns ses critiques contre les wagnériens et l’hégémonie musicale allemande.
Lors d’une tournée en 1887 il joue à la Société philharmonique de Berlin :
« Le public l’accueille par des huées, et le lendemain, la presse le traîne dans la boue sous prétexte qu’il a marqué hautement en France son antipathie pour les compositeurs d’outre-Rhin. Saint-Saëns dédaigne ces querelles de Teutons. Il ne capitulera pas. On l’attend à Cassel. Il s’y rendra quand même. Mais son impresario reçoit de l’intendant du grand théâtre de cette ville une lettre ainsi conçue: «Je considère la présence de M. Camille Saint-Saëns dans l’Institut que je dirige, aussi longtemps du moins que cet artiste persévérera dans son incompréhensible manque de tact vis-à-vis de l’art et de la musique de l’Allemagne, comme absolument incompatible avec la mission qui m’est confiée de protéger et de développer l’art allemand et je refuse, par suite, mon adhésion à un programme sur lequel figurerait le nom de M. Saint-Saëns». […] les directeurs des théâtres de Dresde et de Brème imitèrent l’exemple de leur collègue de Cassel. Force donc fut au maître de rentrer en France. »
Il faut convenir que Saint-Saëns ne fut pas que critique à l’égard des Wagnériens mais de tous les autres compositeurs, qui au début du XXème siècle, était en train de révolutionner la musique.
Il a ainsi écrit de Claude Debussy (cf. <ce site belge>)
« Claude Debussy n’a aucun style. Il a certes un nom harmonieux, mais s’il s’était appelé Martin, personne n’en aurait parlé. »
Et Claude Samuel raconte que lorsque Claude Debussy, à la veille de sa mort, fit savoir par la voix de son épouse, qu’il allait poser sa candidature à l’Institut, Saint-Saëns écrivit à son ami Gabriel Fauré :
« Je te conseille de voir les morceaux pour 2 pianos, Noir et Blanc, que vient de publier M. Debussy. C’est invraisemblable, et il faut à tout prix barrer la porte de l’Institut à un Monsieur capable d’atrocités pareilles ; c’est à mettre à côté des tableaux cubistes » !!!
Et la page de France Musique déjà cité renchérit :
« Il ne se gêne pas de faire connaitre dans la presse son avis souvent acerbe quant à la musique d’autres compositeurs français. Il critique ouvertement la musique de Debussy, de Franck, de Massenet, de Vincent d’Indy et même d’Igor Stravinsky. Lors de la célèbre création du Sacre du printemps de ce dernier, Saint-Saëns quitte la salle de concert après seulement quelques notes, considérant que Stravinski ne savait pas écrire pour le basson »
Les musiciens ne sont pas bienveillants entre eux. Le récit que la musique adoucirait les mœurs est une fable comme une autre.
D’ailleurs Debussy n’est pas en reste quand il affirme qu’une des œuvres les plus géniales jamais composées, la neuvième symphonie de Mahler :
« n’est rien d’autre qu’ un pneumatique géant juste bon à faire de la réclame pour Bibendum », emblème fraîchement créé par les pneus Michelin… »
Heureusement que le monde musical a su dépasser ces querelles du début du XXème siècle et reconnaître qu’il y avait de la place pour le génie de Wagner, de Mahler, de Debussy, de Stravinski et de Saint-Saëns.
Pour finir en musique, je propose ce mouvement de la première sonate pour violoncelle et piano de Saint-Saëns : <Andante de la sonate opus 32>
<1640>
-
Vendredi 17 décembre 2021
« Pause (Saint-Saëns) »Un jour sans mot du jour nouveauDans la vie, il faut faire des choix. Et le soir du 16 décembre, j’ai choisi d’écouter de la musique de Camille Saint-Saëns. J’ai écoute tout l’opéra Samson et Dalila, dans la merveilleuse version de George Prêtre puis l’intégrale des symphonies dans la version de Martinon.

Et je ne peux pas écouter de la musique et écrire en même temps. Dès lors, écrire sur le sujet des relations compliquées entre Saint-Saëns et les compositeurs qui se sont imposés dans le début du XXème siècle, se réalisera plus tard.
En attendant, voici le <3ème concerto de violon> de ce compositeur génial interprété par Joshua Bell.
Comme ce chat fasciné par la beauté d’un violon, j’ai été conquis dès la première écoute de ce concerto, particulièrement le deuxième mouvement qui est divin.
<Mot du jour sans numéro>
-
Jeudi 16 décembre 2021
« J’ai réalisé le rêve impossible de ma jeunesse […] j’ai assez vécu pour laisser des œuvres qui ont une chance de survie. ! »Camille Saint-SaënsLe 16 décembre 1921, il y a exactement 100 ans, Camille Saint-Saëns meurt à 86 ans, dans l’hôtel Oasis d’Alger.
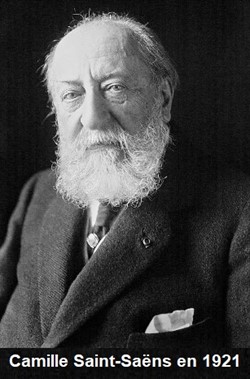 Ce fut un très grand compositeur.
Ce fut un très grand compositeur.
Il a résumé lui-même sa contribution à l’histoire de la musique. Le 23 février 1901, il écrivit à son éditeur Durand :
« J’ai réalisé le rêve impossible de ma jeunesse, j’ai atteint mon objectif ; j’ai assez vécu pour laisser des œuvres qui ont une chance de survie. Vous ne pouvez pas écrire l’histoire de la musique de cette époque sans au moins les mentionner ! Je mourrai avec la conscience d’avoir bien rempli ma journée. Il ne faut pas être ingrat envers son destin. »
J’ai trouvé cet extrait sur le site des éditions Durand, dans <cette présentation>.
J’y ai trouvé aussi cet avis du compositeur Gabriel Fauré qui a écrit au moment de sa mort :
« De nombreuses voix ont proclamé Saint-Saëns le plus grand musicien de son temps. Pendant la première moitié de sa longue carrière, il fut cependant contemporain de Berlioz et de Gounod. Ne serait-il pas plus exact et non moins glorieux de le désigner comme le musicien le plus complet que nous ayons jamais eu, au point qu’on ne puisse trouver qu’un exemple similaire chez les grands maîtres d’autrefois ? Son savoir qui ne connaissait pas de limites, sa prestigieuse technique, sa claire et fine sensibilité, sa conscience, la variété et le nombre stupéfiant de ses œuvres, ne justifient-ils point ce titre qui le rend reconnaissable à tout jamais ? »
Il est vrai qu’il a vécu longtemps, bien qu’il soit écrit partout que depuis son enfance il avait une santé fragile. il avait notamment une faiblesse aux poumons. Il voyageait beaucoup pour des raisons professionnelles et musicales, mais aussi pour se trouver dans des pays où le soleil brillait. Il allait ainsi fréquemment à Alger et il y est allé une dernière fois pour y mourir.
Saint-Saëns a rencontré plusieurs fois et brutalement la mort dans sa vie.
Il est né le 9 octobre 1835 à Paris et son père employé au ministère de l’intérieur meurt en décembre 1835 emporté par la tuberculose, il n’a pas trois mois.
Saint-Saëns se marie en 1875, âgé de quarante ans, avec Marie-Laure Truffot (1855-1950), alors âgée de 19 ans. Elle est la fille d’un industriel, également maire du Cateau-Cambrésis. Le couple aura deux enfants, deux fils, dont l’aîné, André, meurt à deux ans et demi en tombant du balcon de l’appartement familial en mai 1878. Saint-Saëns en rend responsable sa femme qui, ne pouvant plus allaiter le second, Jean-François, s’éloigne en province pour le confier à une nourrice chez qui il meurt à son tour en juillet de la même année, probablement de pneumonie.
Après trois ans d’éloignement croissant, Saint-Saëns se sépare définitivement de son épouse en 1881, sans divorcer. Il n’aura aucune autre relation stable, ni d’autres enfants
 Deux autres femmes joueront un rôle essentiel dans sa vie, sa mère et sa grand-tante Charlotte Masson. Il les appellera : « mes mamans ». Il écrira :
Deux autres femmes joueront un rôle essentiel dans sa vie, sa mère et sa grand-tante Charlotte Masson. Il les appellera : « mes mamans ». Il écrira :
« A ma grand’tante, je dois les premiers principes de la musique et du piano, les premiers éléments de l’instruction en tout genre, à ma mère le goût du beau, le culte de nos grands classiques littéraires les nobles ambitions. »
Son père était originaire de Dieppe. Il aura avec cette ville une relation particulière et léguera une grande partie de ses archives à cette ville
C’est à la mort de sa mère, Clémence Saint-Saëns, âgée de 79 ans, qu’il commence à se rapprocher de sa famille paternelle et d’Ambroise Millet, conservateur du Musée de Dieppe. Son projet est de créer un musée « Camille Saint-Saëns ». Son projet deviendra réalité en Juillet 1890 avec l’inauguration du Musée Saint-Saëns à Dieppe.
La ville de Dieppe fête le centenaire avec une exposition et des manifestations et a créé un site dédié : https://www.saintsaensdieppe21.fr/
Saint-Saëns fut d’abord un enfant sur doué et un pianiste prodige. Encore enfant, il commence à composer.
A 10 ans, il donne son premier concert, le 6 mai 1846 et fait sensation avec le troisième concerto de Ludwig van Beethoven, et le concerto no 15 K.450 de Mozart. Il écrit et joue même sa propre cadence pour le concerto de Mozart.
Si on essaie de le situer par rapport aux autres compositeurs, français et autres cela donne le schéma suivant :
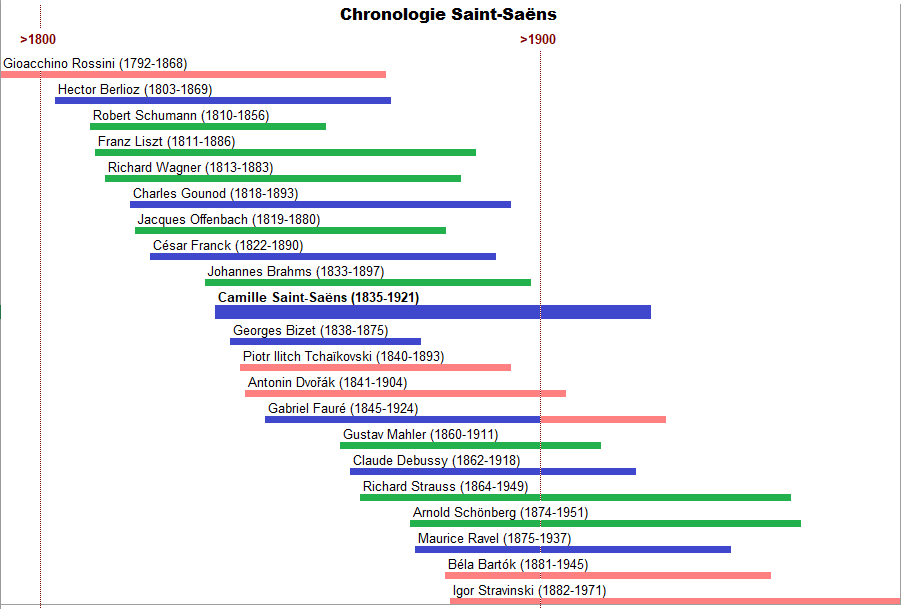
Il eut une relation privilégiée avec Franz Liszt. Ils se rencontrent pour la première fois à Paris, en 1854. « Diapason » dans son numéro de novembre 2021 écrit :
« Malgré leur différence d’âge, ils s’entendent à merveille et vont toujours se soutenir mutuellement car tous les deux, interprètes géniaux, se heurtent aux même difficultés à se faire reconnaître comme compositeurs.
Sans Liszt, le plus grand opéra de Saint Saëns n’aurait jamais exsté : c’est lui qui encourage son jeune collègue à le terminer et s’engage à le faire donner à Weimar, avant même d’en avoir entendu une note. De son côté, Saint Saëns organise à ses frais des concerts d’œuvres orchestrales de Liszt pour les faire connaître à Paris. Et s’inspirant du modèle lisztien, il introduit le poème symphonique en France et en compose quatre : Rouet d’Omphale, Phaêton, Jeunesse d’Hercule, Dans macabre »
Il faut absolument regarder la présentation extraordinairement pédagogique de Jean-François Zygel de la <Danse macabre de Saint Saëns>
Rossini de plus de quarante ans son ainé qui était le grand compositeur à Paris des années 1850, a aussi jeté un regard bienveillant et protecteur sur sa carrière. Dans une soirée, Rossini a fait jouer une œuvre de Saint-Saëns en prétendant l’avoir écrite. Après que le public se sit extasié sur cette œuvre, Rossini a révélé qu’elle n’était pas de lui mais du jeune compositeur présent dans la salle : Camille Saint-Saëns.
 Cet épisode est rapporté dans ce documentaire d’ARTE : < Saint-Saëns l’insaisissable >
Cet épisode est rapporté dans ce documentaire d’ARTE : < Saint-Saëns l’insaisissable >
ARTE qui a aussi réalisé un documentaire sur <Le carnaval des animaux> œuvre qu’il refusera de faire jouer de son vivant et dont un extrait est <la musique officielle du festival de Cannes>
mais cela je l’ai déjà raconté dans le mot du jour <du 5 juillet 2021>.
Ce que j’ai appris récemment c’est qu’il fut, en 1908, le tout premier compositeur de renom à composer une musique spécialement pour un film : « L’Assassinat du duc de Guise ».
Il eut de grandes amitiés et de belles relations avec d’autres compositeurs comme Gabriel Fauré. Il eut aussi des relations privilégiées avec ses ainés Berlioz et Gounod. Mais avec d’autres les relations furent plus compliquées, voire hostiles, mais nous verrons cela une prochaine fois.
La société des amis de Saint-Saëns dispose d’un site instructif : https://camille-saint-saens.org/
Pour la musique je vous envoie vers cette somptueuse interprétation de ce chef d’œuvre unique qu’est la symphonie N°3 avec orgue par <L’orchestre de la Radio bavaroise dirigé par Mariss Jansons>
Et puis pour aller vers des sentiers moins connus, tous les violoncellistes jouent le 1er concerto de violoncelle opus 33 et oublient le second opus 119, composé 30 ans après. Le voici interprété par la lumineuse Sol Gabetta avec l’Orchestre national de France sous la direction de Cristian Macelaru : <Extrait du concert donné le 26 novembre 2021 à la Philharmonie de Paris.>
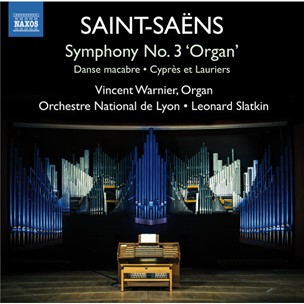 Je finirai ce premier épisode par le jugement du chef d’orchestre François-Xavier Roth :
Je finirai ce premier épisode par le jugement du chef d’orchestre François-Xavier Roth :
« L’œuvre de ce compositeur, souvent qualifié de conservateur ou académique, regorge de passages innovants. »
Et, si vous voulez un disque, pourquoi pas l’enregistrement de la symphonie avec orgue enregistré par notre Orchestre National de Lyon dirigé par Leonard Slatkin avec l’orgue Cavaillé Coll de l’Auditorium de Lyon
<1639>
-
Mercredi 15 décembre 2021
« Nous les scientifiques, on a foiré ! »Propos d’Axel Kahn quelques semaines avant sa mort à propos de l’action des scientifiques pendant la COVID19Thinkerview est une chaîne et une émission qui ont été lancées, en janvier 2013, sur YouTube.
 Son format consiste en de longs entretiens entre un présentateur qui se fait appeler « Sky » et le plus souvent un invité, quelquefois deux, rarement plus.
Son format consiste en de longs entretiens entre un présentateur qui se fait appeler « Sky » et le plus souvent un invité, quelquefois deux, rarement plus.Les entrevues sont réalisées dans un cadre minimaliste : fauteuil sur fond noir, l’invité est seul présent à l’écran. Il n’y a pas de montage.
Le logo un cygne noir : le but serait de déceler l’idée rare. Je rappelle que la théorie du cygne noir a été développée par Nassim Taleb qui appelle cygne noir un événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler (appelé « événement rare » en théorie des probabilités) et qui, s’il se réalise, a des conséquences d’une portée exceptionnelle
Les invités sont extrêmement divers, politiques, scientifiques, intellectuels et de tout bord.
Le présentateur veut conserver l’anonymat, même si des spéculations sur son identité sont régulièrement avancées.
Il travaille son entretien et souvent les questions sont très pertinentes.
Il a des détracteurs notamment Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch dont j’avais parlé lors du mot du jour du <19 janvier 2015> qui dit :
« Même s’il invite parfois des invités intéressants, on sent qu’il y a une culture complotico-compatible, qu’on est dans la culture du caché »
France Info lui a consacré une page : <Qui se cache derrière Thinkerview ?>
Pour ma part, je trouve beaucoup de ses émissions très intéressantes, en raison d’invités passionnants, de questions pertinentes et surtout parce qu’il y a le temps de développer des idées et d’argumenter.
Récemment, j’ai regardé avec beaucoup d’intérêt l’émission du 1er décembre 2021 avec <Clément Viktorovitch> le spécialiste de la rhétorique qui décortique avec talent les discours politiques ou marketing sur la radio Franceinfo dans la chronique « Entre les lignes »
Mais aujourd’hui j’ai l’intention de citer un extrait d’une autre émission, plus récente avec Etienne Klein.
C’est l’émission du 8 décembre 2021 <Science et société, où va-t-on ?>
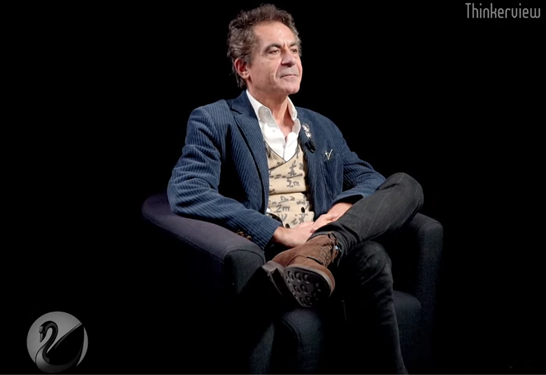 Tout au début de l’émission Sky demande à Etienne Klein : « A quoi tu réfléchis en ce moment ?»
Tout au début de l’émission Sky demande à Etienne Klein : « A quoi tu réfléchis en ce moment ?»Voici la réponse d’Etienne Klein :
« Je réfléchis à une phrase que m’a dite Axel Kahn, il y a quelques mois. […]
Je l’ai croisé dans la rue quelques jours seulement après qu’il apprenne […] qu’il était condamné par la médecine [à courte échéance].
Nous avons marché ensemble une heure.
Et nous avons parlé de la mise en scène de la science et de la recherche pendant la crise sanitaire que nous traversons.
Et il était assez inquiet.
Et à la fin de la discussion il m’a dit : « Étienne, Nous les scientifiques, on a foiré ! »
Et la question que je me pose : est ce qu’il avait raison ?
C’est-à-dire, est ce qu’il n’y a pas de leçon à tirer de ces mois et de ces années maintenant que nous avons passé avec ce virus ?
Est-ce que les scientifiques n’ont pas raté l’exercice de pédagogie qu’ils étaient invités à faire ?
J’ai toujours été un défenseur de la vulgarisation scientifique […]
Moi j’avais l’impression, avant, que la vulgarisation, ça marche. On voit bien que les livres qu’on écrit, les conférences qu’on tient suscitent des vocations […]
Quand on dit [ça marche] on est victime d’un biais énorme de confirmation. En fait, la vulgarisation ne touche que les personnes intéressées par la vulgarisation !
Et ce qu’a montré la crise, c’est que cette proportion est assez faible. […]
Ce qu’a montré la mise en scène de la science et de la recherche, pendant la crise sanitaire, c’est qu’il y a toute une série de biais cognitifs qui interviennent, entre l’émission d’un message scientifique et sa réception et qui font que le message à la fin peut être complètement transformé, parfois carrément transformé en son contraire.
Et cela me fait réfléchir sur la bonne façon de faire.
 Et quand Axel Kahn dit « on a foiré », c’est sans doute vrai mais la question est comment faire pour ne plus foirer […]
Et quand Axel Kahn dit « on a foiré », c’est sans doute vrai mais la question est comment faire pour ne plus foirer […]
Il faut comprendre ce qui s’est passé. Il y a des choses qui m’ont vraiment frappé sur cette façon de mettre en scène la science et la recherche.
Une étude récente, menée par Daniel Cohen dans plusieurs pays européens, a montré qu’en France, la confiance des français dans les scientifiques a chuté de 20 points ; alors qu’elle est restée stable dans les autres pays. Dans tous les pays elle était à environ 90%, avant la crise.
Je n’ai pas fait d’étude comparative et sociologique. Mais je suis allé en Allemagne en juillet 2020 et j’ai assisté à une conférence de presse d’Angela Merkel qui parlait à la télévision à tous les allemands. Elle était sans tableau, sans être accompagné par un ministre ou un expert. Et elle a donné des cours de sciences aux allemands. Elle leur a expliqué ce qu’était une exponentielle, en y prenant le temps. Et puis quand elle parlait des scientifiques, elle disait : « Les scientifiques » m’ont dit.
Elle ne disait pas Professeur Machin, ou Professeur Bidule, elle disait « Les scientifiques »
Et elle faisait donc intervenir dans son argumentation, une communauté scientifique, un « Nous » pas un « Je »
Il me semble qu’en France, au contraire, on a beaucoup personnalisé les discussions.
On avait une occasion historique de faire de la pédagogie, puisque les gens étaient inquiets, intéressés et voulaient comprendre.
Et on aurait pu expliquer jour après jour, par exemple les différentes méthodologies de la science. On sait qu’elles ne sont pas les mêmes selon les sciences […]
On aurait pu tenter d’expliquer s’agissant des traitements ce qu’est un essai en double aveugle, un essai randomisé, Pourquoi la théorie des probabilités est parfois contre-intuitive.
Pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation, causalité.
Au lieu de cette pédagogie qui aurait pu intéresser les gens, on a préféré organiser des joutes, des clashs entre des personnalités dont on connaissait par avance les opinions et cela a participé à la confusion générale.
On s’est dit, si les experts ne sont pas d’accord, pourquoi moi, avec mon ressenti, mon bon sens, mes croyances, mes connaissances, je ne serais pas en droit de dire mon opinion sur tel ou tel sujet qui apparemment fait controverse ?
Il y a une autre chose qui m’a frappé : on a confondu la science et la recherche. La science et la recherche ne sont pas deux activités étrangères l’une à l’autre, mais elles ne se confondent pas.
Ce que j’appelle la science, c’est un corpus de connaissances bien établi qui sont pense t’on les bonnes réponses à des questions bien posées. Ce ne sont pas des vérités absolues, ce ne sont pas des vérités définitives. Mais on ne peut les contester que si on a des arguments scientifiques. On ne peut pas les contester avec son bon sens. « Moi je pense que » n’est pas un argument suffisant. Par exemple la question de la forme de la terre a été tranchée : elle n’est pas plate, elle est plutôt ronde, mais elle n’est pas sphérique.
Une question a été posée pendant des millénaires : est ce que l’atome existe ? Elle a été tranchée en 1906 quand Jean Perrin a montré expérimentalement que l’atome existait. La question a été tranchée, l’affaire est réglée ! […]
Ce corpus, par essence, est incomplet. Des questions se posent dont nous ne connaissons pas les réponses, c’est pour cela qu’on fait de la Recherche !
On sait ce qu’on ne sait pas. La recherche est activée par le doute, c’est son combustible. Au fur et à mesure qu’on a des résultats le doute se déplace.
Et quand on confond la recherche et la science, comme on l’a beaucoup fait pendant cette crise, le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser la science. »
A ce stade, nous sommes à la quinzième minutes de l’émission, il y a encore 1h03 à écouter.
Il me semble qu’ Etienne Klein dit là des choses fondamentales.
La science n’est pas démocratique, la recherche non plus d’ailleurs.
Je veux dire que dans ces domaines, il n’y a pas différents experts qui viennent présenter leurs thèses devant une assemblée de citoyens qui va voter pour désigner celle qui lui parait la plus juste ou la plus crédible.
Les problèmes scientifiques se règlent au sein de la communauté scientifique, sur la base de protocoles et d’argumentaires en mesure de convaincre les autres scientifiques du même domaine qui connaissent l’état de la science et comprennent les recherches en cours.
Dans cette affaire compliquée pour nous, béotiens, le plus raisonnable est de faire confiance au consensus scientifique, c’est-à-dire l’avis majoritaire de la communauté scientifique compétente sur le sujet, de nous méfier de notre bon sens qui peut nous égarer et d’accepter l’incertitude.
<1638>
-
Mardi 14 décembre 2021
« Ils en ont parlé ! »Caran d’AcheUn dessin vaut mieux qu’un long discours selon un propos qu’on attribue à Napoléon Ier.
Dessins de presse, caricatures ont illustré les journaux bien avant l’invention de la photographie.
Un des dessins de presse les plus célèbre de l’Histoire de la presse française s’appelle « Un dîner en famille ».
Il a été publié dans Le Figaro le 14 février 1898. C’est un dyptique composé de deux dessins superposés
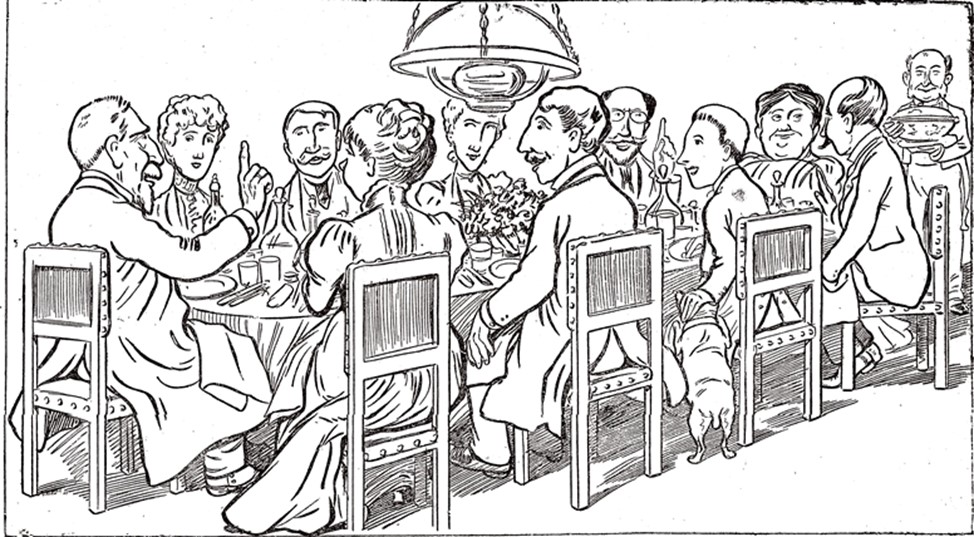 Le premier représente une famille attablée pour le début du dîner et le patriarche de la famille lève l’index et donne l’injonction suivante à sa famille :
Le premier représente une famille attablée pour le début du dîner et le patriarche de la famille lève l’index et donne l’injonction suivante à sa famille :
« Surtout ! N’en parlons pas ! »
Ce dessin est l’œuvre de Caran d’Ache qui était le nom d’artiste d’Emmanuel Poiré. Dessinateur français d’origine russe né le 6 novembre 1858 à Moscou et mort le 25 février 1909 à Pari.
Ce dessin est tellement célèbre qu’il possède sa propre <page Wikipédia>
De quoi ne fallait-il point parler en février 1898 ?
La réponse est : « De l’affaire Dreyfus » bien sûr.
D’ailleurs le texte précis qui se trouvait sous ce dessin le 14 février 1898 était :
« Surtout ! ne parlons pas de l’affaire Dreyfus ! »
A part les érudits, les cinéastes comme Polansky et certains chroniqueurs égarés en politique, plus personne ne parle de l’affaire Dreyfus.
Mais il y a d’autres sujets qui l’ont remplacé pour créer des diners agités, conflictuels voire davantage.
Pendant longtemps ce fut « le réchauffement climatique dû à l’homme » qui était en mesure de créer des fâcheries irréconciliables entre des familiers dont on n’aurait pas pu supposer qu’ils entrent dans de telles disputes.
Maintenant le réchauffement climatique fait consensus, il n’y a plus lieu de se disputer sur ce point…
Mais on a trouvé d’autres sujets.
Beaucoup ont lien avec l’alimentation : les végétariens, les végans et puis sont apparus les antispécistes.
Je n’ai pas encore consacré de mot du jour sur ce sujet passionnant et conflictuel, mais ce n’est qu’une question de temps.
Mais depuis début 2020, « la COVID 19 », « les vaccins » et « le pass sanitaire » sont devenus des sujets hautement inflammables. « Surtout ! N’en parlons pas ! » Sinon, le pire peut arriver : des familles peuvent se fâcher définitivement, des amis de longue date qui en ont parlé, ne plus se parler de rien du tout.
Les journaux s’en sont fait l’écho.
Ainsi cet article d’« Ouest France » : « Vaccin et passe sanitaire. « Il ne veut plus nous revoir » : quand le débat fracture des familles »
« France Info » : « Ça nous monte les uns contre les autres, c’est ignoble ». Article dans lequel on peut lire :
« Deux jours après la validation de son extension par le Conseil constitutionnel, le pass sanitaire est le nouveau sujet qui fâche dans les familles comme au travail. »
Et aussi « France Inter » : « Un vaccin qui déchire les familles »
Alors, le second dessin du dyptique est sous-titré : « Ils en ont parlé !»
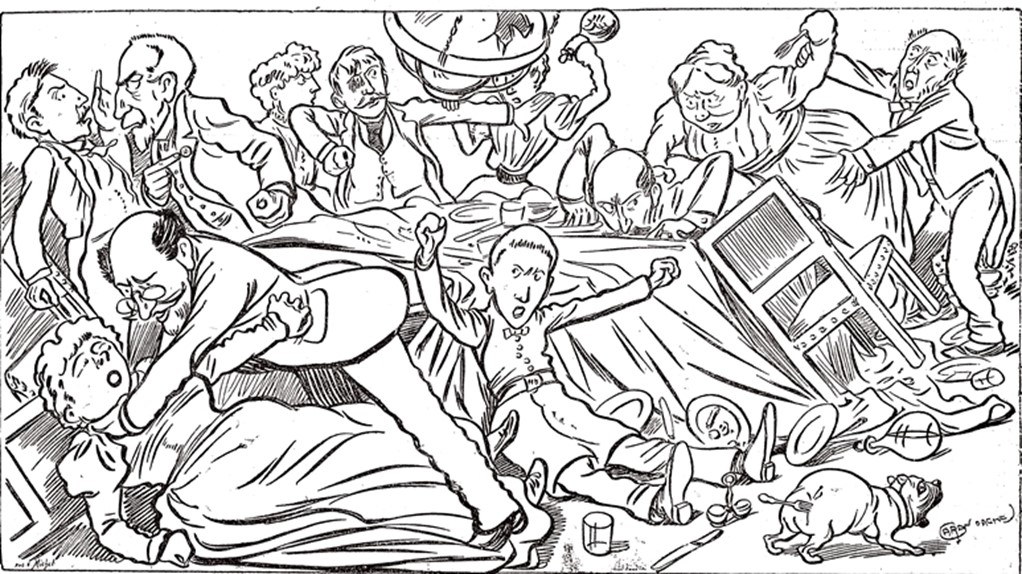 Le magazine « Femina » tente une conciliation : « Covid, ne laissons pas les polémiques nous séparer »
Le magazine « Femina » tente une conciliation : « Covid, ne laissons pas les polémiques nous séparer »
Femina cite Claire Bidart, sociologue et directrice de recherche au CNRS à Aix-Marseille Université :
« Les premiers touchés par ces conflits sont les amis (30,4% des liens dégradés), suivis de près par la famille (29,1%). Viennent ensuite le conjoint (21,7%) puis les collègues (19,4%). Les connaissances (9,2%) et les voisins (7,7%) arrivent loin derrière. Ce sont les liens les plus forts, affectivement et symboliquement, qui sont le plus susceptibles de se dégrader. »
Pour le philosophe Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de « Philosophie Magazine » notre seuil de tolérance à la divergence d’opinion a été abaissé par l’effet des technologies.
« Après des mois de confinement, de distanciation, on a pris l’habitude de ne communiquer qu’avec des personnes qui sont comme nous, qui pensent comme nous. Par leurs algorithmes, les réseaux sociaux nous enferment dans des bulles de savoirs étanches, nous privant d’une dynamique essentielle de la vie sociale la confrontation à des opinions divergentes. Plus que la peur du conflit, c’est la jouissance de se voir conforté dans ses certitudes qui est à l’œuvre dans notre refus du dialogue. »
Zygmunt Bauman écrivait :
Alors ne faut-il pas en parler ?
La psychanalyste Saverio Tomasella écrit :
« Une vraie amitié sincère est un vecteur de croissance humaine. Elle va aider les deux amis à grandir, à évoluer, à s’épanouir, en prenant appui sur leurs similitudes mais aussi leurs différences. »
Évidemment, si on commence à traiter l’autre de « fou », de « dangereux » ou de « naïf », il est difficile d’espérer de pouvoir créer un dialogue constructif.
Alors, « Fémina » donne quelques pistes :
« Pourquoi tel ou tel sujet nous fait-il sortir de nos gonds ? Nos convictions sont-elles le fruit de notre anxiété ? S’appuient-elles sur des sources fiables et surtout diversifiées ? »
Pour Alexandre Lacroix pour dépassionner les débats, il faudrait peut-être fonder la discussion sur certaines interrogations politiques ou philosophiques :
« Est-ce qu’il y a un déficit démocratique dans la façon dont l’exécutif met en place la politique sanitaire ? »
« Qu’est-ce qui est le plus important : la santé ou la liberté ? »
« Cela laisse à chacun la possibilité d’étayer, de justifier sa préférence, en se nourrissant de l’apport de l’autre. »
Pendant le premier confinement, Augustin Trapenard avait pris l’initiative de lire une lettre que lui avait envoyé un écrivain ou un artiste, sur France Inter, chaque matin à neuf heures moins 5.
Plusieurs mots du jour ont fait référence à ces textes d’une humanité essentielle.
Et je finirai ce mot par une lettre que l’écrivaine et journaliste Sophie Fontanel a adressé à son frère :
« Mais nous, dis, nous resterons tendres ?
On va pas se faire avaler ! »
<1637>
-
Lundi 13 décembre 2021
« Les gâteaux de Noël alsaciens»Publication de la page consacrée à la sérieBientôt Noël ! En Alsace, il existe une tradition de gâteaux spécialement produits pour cette fête.
Notre amie Françoise nous avait appris à les faire et depuis chaque année avec Annie nous continuions cette tradition douce et sucrée.
En décembre 2019, une année après la disparition de Françoise, j’avais trouvé pertinent d’élargir les thèmes abordés par le mot du jour aux recettes de cuisine..
Et, je rappelle par ce mot que ces recettes existent sur le site.
En outre, en les rassemblant sur une page accessible par la page des séries, ces recettes seront plus facilement accessibles.
La page consacrée aux recettes de gâteaux alsaciens est en ligne sur la page des séries.
Mais vous pouvez aller directement sur la page en suivant ce lien : < Les gâteaux de Noël alsaciens >
<Mot sans numéro>
-
Vendredi 10 décembre 2021
« C’était une situation effrayante tendue et triste. »Anna von HausswolffIl a suffi de quelques dizaines de catholiques intégristes pour bloquer, mardi soir, l’accès de l’église « Notre-Dame-de-Bon-Port » à Nantes pour que le concert soit annulé.
Le concert était celui d’une artiste suédoise : Anna von Hausswolff
Son patronyme allemand signifie « le loup de la maison », les intégristes lui reprochaient de tenir des propos « satanistes ». Dans un morceau évoquant la drogue, Anna von Hausswolff chante avoir « fait l’amour avec le diable ». Probablement que ces esprits simples et théo-centrés ne savent pas ce qu’est une métaphore.
 <Libération> présente ainsi cette chanteuse :
<Libération> présente ainsi cette chanteuse :
« Sombre, mais lumineuse. L’argutie […] vaut absolument pour la musique d’Anna von Hausswolff, artiste née dans le rock, à la voix puissante et timbrée, proche de celles de Kate Bush, Grace Slick ou PJ Harvey, au toucher unique sur les grandes orgues, son instrument fétiche, et qu’adorent autant les amateurs de sucreries pop suédoises que les fous de musique sombre voire de metal extrême. […]
Adepte des formes à rallonge, indescriptibles avec les vieux mots du rock, Anna von Hausswolff a développé son œuvre indifféremment dans le cadre traditionnel de la chanson à texte, inspirée par ses lectures, la nature, les lieux hantés par l’occulte et le vieux monde finissant, et celui d’une musique liturgique inventée, enracinée nulle part ailleurs que dans son imaginaire, lieu de musique inattendu, et merveilleux, où méditer et se ressourcer. Le plus naturellement du monde, elle a aussi doublé sa quête sonore d’une quête spirituelle qui n’appartient qu’à elle, écumant les églises les plus reculées pour y expérimenter avec les instruments les plus rares[…]
« Ma musique est faite pour les églises et mon instrument principal est l’orgue. », nous expliquait-elle, sonnée, au lendemain de l’annulation de son récital à Notre-Dame-de-Bon-Port, la première de sa carrière, quand elle joue dans des lieux de culte depuis plus de dix ans.
« Je respecte leurs traditions et toutes les cérémonies qui s’y déroulent. Nous avons toujours travaillé en bonne entente, jamais l’un contre l’autre. Ça s’est toujours bien passé, chaque partie satisfaite, avec beaucoup d’amour et de respect. Grâce à ma musique, tout un public vient à l’église alors qu’il n’y viendrait pas autrement, ce que les prêtres et les évêques reconnaissent volontiers. Dire que ma musique est blasphématoire est non seulement faux, mais blessant.»
Aussi une aberration, pour qui s’est déjà perdu dans ses chansons pleines d’ombres, certes, mais surtout remplies de grâce, de doute et d’humanité. »
Je ne connaissais pas cette artiste. J’ai écouté certaines de ses productions qu’on trouve sur Internet. Pour ce que j’en ai entendu, ce n’est pas une musique qui me fait vibrer pour l’instant.
Mais mon appréciation de cette musique n’a aucune importance. Ce qui est important c’est qu’un groupe d’exaltés l’a empêché, sans aucune raison sérieuse, de chanter. Les autorités ecclésiastiques avaient donné leur accord.
Dans « TELERAMA » : <Vade retro, satanas ! À Nantes, des catholiques intégristes bloquent un concert>, la journaliste Elise Racque rapporte :
« Cette poignée de catholiques a bloqué les entrées du lieu de culte en chantant des prières pour empêcher l’artiste suédoise Anna von Hausswolff de s’y produire […]. « C’était une situation effrayante, tendue et triste », a-t-elle dit sur son compte Instagram.
[…] Les fidèles ayant réussi à faire annuler le concert sont issus vraisemblablement de la communauté traditionaliste de Nantes, qui a ses habitudes latines à l’église Saint-Clément, où devait originellement se tenir l’événement. Face aux protestations des paroissiens, le diocèse de Nantes avait publié un communiqué dans la journée de mardi, actant le déplacement du concert dans une autre église, tout en soulignant que « rien », dans la programmation, ne s’opposait « à la foi et aux mœurs ». Et remarquant au passage que les chansons de l’artiste « entre lumière et ténèbres, manifestent une quête existentielle – comme l’expriment à leur manière les psaumes dans la Bible ». »
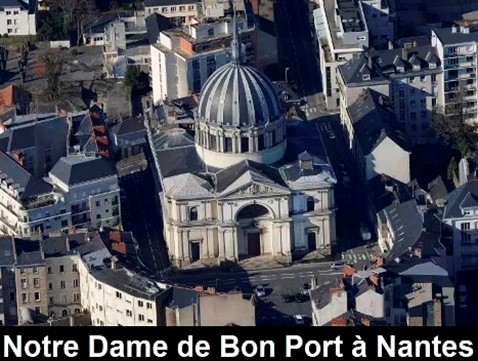 L’artiste suédoise devait jouer jeudi soir dans l’église Saint Eustache dans le quartier des Halles, à Paris. Ce concert a aussi été annulé. Le curé de cette paroisse a prise cette décision après avoir été informé que ce concert agitait sur Internet des réseaux catholiques intégristes.
L’artiste suédoise devait jouer jeudi soir dans l’église Saint Eustache dans le quartier des Halles, à Paris. Ce concert a aussi été annulé. Le curé de cette paroisse a prise cette décision après avoir été informé que ce concert agitait sur Internet des réseaux catholiques intégristes.
Le journal de Nantes « OUEST France » a bien sûr relaté cet acte de censure et d’atteinte à la liberté : <À Nantes, des catholiques intégristes empêchent la tenue d’un concert> :
« Ils étaient nombreux à s’être déplacés pour venir écouter Anna Von Hausswolf. Parfois de loin, comme Benjamin et Anaïs, venus de Rennes. « Ce qu’il s’est passé ce soir est hallucinant », réagit le couple, curieux « d’entendre cette femme qu’on ne connaît pas. Ça nous semblait sympa d’entendre de la musique jouée avec des instruments originaux, comme l’orgue. »
Mais ce mardi soir 7 décembre, le public n’a pas pu entrer dans l’église Notre-Dame-de-Bon-Port, à Nantes. Ils en ont été empêchés par des catholiques, qualifiés d’intégristes par des élus nantais et certains religieux. Ces derniers étaient bien décidés à entraver la tenue du concert de l’artiste suédoise dont la tournée européenne faisait étape à Nantes. « Elle s’est déjà produite dans une quarantaine d’églises ou cathédrales et il n’y a jamais eu de problème », soupire Eli Commins, directeur du Lieu unique, [organisateur du concert].
La foule a bien tenté de pénétrer dans le lieu de culte en forçant le passage. « Mais c’était impossible, c’était cadenassé », racontent des spectateurs.[…] On a compris qu’ils ne voulaient pas de la tenue d’un concert dans une église. Et il y a une grosse incompréhension, parce qu’ils pensent que cette artiste crée de la musique sataniste, ésotérique », prolongent des participants, dont la tenue n’évoque pas du tout les habituels vêtements des amateurs de ce genre artistique.
Eli Commins s’étrangle : « Il n’y a aucune inspiration religieuse, aucune violence ! Simplement, elle joue de l’orgue et les orgues se trouvent dans les églises. C’est une musique d’influence post-métal. Il n’y avait même pas de paroles dans la représentation prévue. » Certaines pochettes d’album auraient blessé ses détracteurs. »
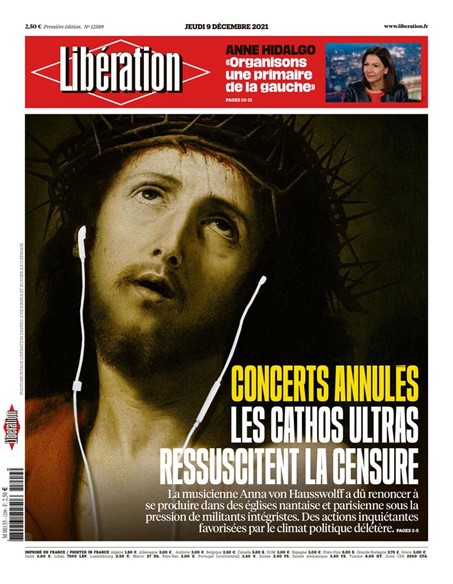 « LIBERATION » a fait de cette annulation sa Une du 8 décembre, jour de la fête des lumières à Lyon. Lumières qui devraient être en capacité de chasser les ténèbres et l’obscurantisme.
« LIBERATION » a fait de cette annulation sa Une du 8 décembre, jour de la fête des lumières à Lyon. Lumières qui devraient être en capacité de chasser les ténèbres et l’obscurantisme.
Ce journal explique :
« Bref, un vent mauvais souffle sur le pays des Lumières et si Libé y consacre sa une, c’est parce que, plus encore que d’habitude, il va falloir être vigilant. Les mois à venir jusqu’à la présidentielle s’annoncent à haut risque, une frange significative de la droite et de l’extrême droite se montrant réceptive aux revendications identitaires des chrétiens traditionalistes. Qu’une poignée d’intégristes puisse provoquer l’annulation de deux concerts à Nantes et Paris est source d’inquiétude. Et crée un précédent dangereux. »
Libé décrit cette mouvance polymorphe qui aime la messe en latin, est en désaccord total avec le pape actuel. Car François, en juillet, a ouvert les hostilités, en publiant, un motu proprio (un décret personnel) pour limiter drastiquement l’usage de la messe en latin.
Le journal rappelle que le noyau de ce mouvement se trouve dans les catholiques qui ont suivi, en 1988, Mgr Marcel Lefebvre dans son schisme avec Rome. Défenseur de la messe en latin, le prélat français rejetait également en bloc les réformes du concile Vatican II. La « cathédrale » des intégristes est l’église parisienne Saint-Nicolas-du-Chardonnet, conquise, en 1977, par un véritable coup de force. Malgré des décisions de justice, « la Fraternité Saint-Pie-X n’a jamais été délogée. »
Selon Libé, en France, la galaxie tradi compte à peine quelques dizaines de milliers de personnes. Selon les derniers chiffres disponibles, il y aurait entre 50 000 et 70 000 fidèles qui se rendraient, chaque dimanche, dans des lieux de culte liés à la mouvance traditionaliste ou intégriste.
C’est un temps mauvais, en effet, quand les intégristes de tous bords essayent d’imposer leurs archaïsmes et leurs régressions.
Toutes les religions en génèrent en leur sein et sur certains combats contre les libertés : l’avortement, l’orientation sexuelle, de ne pas croire, la culture, ils deviennent des alliés objectifs, s’encourageant les uns les autres.
La liberté religieuse est essentielle, mais je crois profondément que nous avons globalement été trop faible avec les intégristes de toutes les religions.
Sur cette page de <France Inter> on apprend finalement que l’organisateur du concert de Paris a trouvé une autre église, non catholique, précise t’il, dans laquelle le concert pourra avoir lieu.
Sur la même page, il y a aussi une vidéo montrant la musique qu’interprète Anna von Hausswolff.
<1636>
-
Jeudi 9 décembre 2021
« Homo deus de Yuval Noah Harari »Publication de la page consacrée à la sérieAprès le mot du jour consacré aux « agents conversationnels » dans le langage courant « chatbot », j’ai pensé qu’il était temps de créer la page de la série que j’avais consacrée au deuxième livre de Yuval Noah Harari : «homo deus».
 Livre qui pose des questions et trace des perspectives à partir de ce que l’homme fait, prépare dans ses ateliers, ses laboratoires numériques, dans ses centres de recherche.
Livre qui pose des questions et trace des perspectives à partir de ce que l’homme fait, prépare dans ses ateliers, ses laboratoires numériques, dans ses centres de recherche.
Nous savons que nous sommes à la veille de révolutions considérables. Homo sapiens a domestiqué tant de techniques et possède un tel hubris, c’est-à-dire un orgueil, une démesure qu’il rêve de maîtriser la vie et la mort. De passer de «homo sapiens» à «homo deus.»
Comme on l’a vu pour les agents conversationnels, l’intelligence artificielle n’est pas vraiment de l’intelligence, elle n’est ni capable de comprendre comme un humain, de donner la signification des concepts, mais elle repose sur une formidable puissance de calcul statistique sur des bases de données comprenant des milliards de données.
Et c’est avec ces traitements statistiques des big data que les hommes qui sont à la manœuvre, espèrent trouver les bonnes solutions, les décisions qu’il faut prendre à chaque instant.
Harari fait l’hypothèse que si nous allons vers ce destin, nous allons en pratique nous ranger derrière une nouvelle religion : « le dataïsme » c’est-à-dire la croyance que la vérité viendra de l’analyse de toutes les données que nous aurons su rassembler.
L’avenir n’est pas écrit, mais il prend un chemin qui pose de sérieuses questions aux valeurs d’humanisme et de liberté de penser que nous avons développé dans notre civilisation.
Comme toujours, il n’y a pas de réponse, que des questions.
La page consacrée à cette série est en ligne sur la page des séries.
Mais vous pouvez aller directement sur la page en suivant ce lien : < Homo deus de Yuval Noah Harari >
<Mot sans numéro>
-
Mercredi 8 décembre 2021
« Nous nous trouvons aujourd’hui dans la réalisation du test de Turing qui prédisait que les machines seraient en capacité de tromper 30% des juges humains pendant un test de 5 minutes de conversation. »Alexei Grinbaum »Vendredi, j’avais donné mon sentiment que nous manquions d’humains dans le quotidien, pour nous écouter, nous répondre, nous aider dans nos problèmes quotidiens.
Mais une révolution est en marche. Nous allons pouvoir trouver une écoute et des réponses, de manière efficace et sans compter le temps qui nous sera consacré.
Mais ce ne sera pas des humains.
Aujourd’hui, je vous renvoie vers une émission d’Etienne Klein <Comment converser avec les machines parlantes ?>
Nous sommes de plus en plus en contact avec des machines qui écoutent nos questions et nous répondent en langage naturelle.
En bon français on appelle ces machines des « agents conversationnels>
Mais dans le langage globish on parle de « Chatbots>
Dans leurs versions les plus récentes, ces chatbots soulèvent de multiples questions d’ordre éthique, notamment parce qu’ils sont en mesure d’influencer notre comportement. Ils peuvent créer un rapport affectif avec leurs utilisateurs et sont susceptibles de les manipuler.
Pour parler de ces sujets Etienne Klein a invité Alexei Grinbaum physicien et philosophe, membre du Comité National pilote d’éthique du numérique (CNPEN) et co-rapporteur du rapport « Agents conversationnels : enjeux éthiques ». Ce rapport est accessible derrière <ce lien> :
Etienne Klein a commencé son émission par une expérience, il a demandé à un chatbot de répondre à la question suivante : « L’intelligence artificielle peut-elle être éthique ? » et il a demandé une réponse en dix lignes.
Etienne Klein a lu la réponse qui était tout à fait rationnel et intelligente.
Cette réponse n’a été écrite par personne, l’intelligence artificielle l’a conçue elle-même à partir de son apprentissage opéré par l’accès à d’immenses bases de données et l’analyse qu’elle en a faite.
Pour rebondir Alexei Grinbaum a évoqué une tribune qui a été entièrement conçue par une machine et un langage américain appelée le GPT-3 (créé dans une entreprise d’Ellon Musk) et a été publiée dans le journal anglais « The Guardian » en 2020.
Les lecteurs ont été informés que l’article avait été écrit par une machine et ont été « émerveillés », selon les propos d’Alexei Grinbaum, par sa qualité.
On a ainsi pu constater que ces « agents conversationnels » pouvaient remplacer dans certaines tâches des journalistes, assurer un service après-vente, remplacer votre médecin pour un entretien médical.
Alexei Grinbaum a ajouté que cela posait des problèmes éthiques considérables et particulièrement sur l’influence que ces machines pouvaient avoir sur les humains.
Quand l’ancien journaliste du Figaro et ancien chroniqueur de Ruquier parle du grand remplacement, il a raison. Simplement il n’y met pas bon contenu : il ne s’agit pas du remplacement des catholiques français par une population d’une autre religion et qui viendrait de l’autre côté de la méditerranée mais des êtres humains qui vont être remplacés par des machines.
On pourra de mieux en mieux converser avec des agents conversationnels. Alexei Grinbaum évoque une vitesse d’évolution récente absolument incroyable qui se base sur ce qu’on appelle « la technologie des transformers » qui s’appuie sur le « deep learning » ou apprentissage profond.
Grinbaum explique :
« Nous avons commencé à travailler sur les Chatbot en 2018. En 2018 les systèmes de 2021 n’existaient pas. Ces systèmes nouveaux ont profité de la création de réseaux du type « transformer » qui sont des réseaux de neurones apprenant sur des masses gigantesques de données. »
Ces systèmes se révèlent capable de générer « un langage naturel » qui ne se distingue quasi pas du langage de l’homme.
Tout au plus comme le dit Grinbaum :
« Ces machines parlent parfois trop bien. […] Ils ne font pas de raccourcis »
Ils ne font aucune erreur d’orthographe et de grammaire. Ce qui prouve que mes mots du jour ne sont pas écrits par un agent conversationnel !
Grinbaum ajoute :
« Il y a de l’inhumain dans la manière de parler des chatbots !»
Et quand Etienne Klein pose cette question : est-ce que l’agent conversationnel peut comprendre de la poésie ?
Alexei Grinbaum répond :
« Comprendre est un mot qui nous distingue nous les êtres humains, des machines qui ne comprennent rien ! Mais elles peuvent provoquer chez nous une illusion qu’elles aient compris quelque chose. Les machines fonctionnent de manière statistique sur de grandes masses de données. Le résultat est à la fois ressemblant et nouveau. »
Il est nouveau parce que la phrase que la machine fabrique, elle ne l’a pas trouvé telle quelle, elle produit du texte à partir de son outil statistique qu’on appelle intelligence artificielle.
Les processus d’appropriation du langage sont très différents : les machines utilisent un processus statistique, alors que les humains s’attachent à comprendre la signification des mots et des phrases.
« La signification » n’a selon Grinbaum, aucun sens pour les machines.
Nous disposons dans notre quotidien d’agents conversationnels, qui ne sont peut-être pas du niveau de ceux qu’évoque Grinbaum, mais tout de même. J’ai voulu tester
Les utilisateurs comme moi d’un smartphone Apple, donc d’un iPhone, dispose de l’agent « Siri »
J’ai commencé la conversation, en demandant à Siri : est tu une machine ?
Je suis SIRI votre assistante virtuelle.
Es-tu intelligente ?
Mon but est d’être intelligente et utile. C’est un apprentissage de tous les jours.
Est-ce que tu cherches à me faire acheter des produits ?
Bonne question.
Est-ce que Dieu existe ?
Tout cela est un grand mystère pour moi
Est-ce que je vais mourir ?
Je peux vous aider à passer un appel d’urgence.
Et il m’a immédiatement présenté la possibilité d’appeler un numéro de téléphone des services d’urgence. On voit ainsi qu’il est dans l’opérationnel, pas dans la philosophie !
J’ai continué : Est-ce que toi SIRI tu peux mourir ?
Bonne question
Est-ce que tu réponds : Bonne question quand tu ne sais pas répondre ?
Essayez de reformuler votre requête s’il vous plaît.
On voit là qu’en effet il ne comprend rien et que « la signification » est un terme absent de son univers !
Et j’ai poursuivi : Est-ce que tu sais qui t’a conçu ?
Je pense que j’ai vu le jour suite à une soudaine inspiration durant une longue et féconde promenade.
Là je soupçonne une prévision d’un humain qui pensait que cette question serait posée et qui a donné la réponse à Siri. Je ne me suis pas arrêté : Est-ce que tu es capable d’aimer ?
Je regrette je n’ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose ?
Est-ce que tu peux te tromper ?
Je regrette je n’ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose.
Et puis en conclusion : Es-tu un agent conversationnel ?
Bien sûr que non !
Cette réponse m’a surpris alors j’ai demandé : Qu’est-ce qu’un agent conversationnel ?
Il m’affiche : « Un chatbot ou dialogueur ou agent conversationnel est un agent qui dialogue avec un utilisateur. »
Alors j’ai tenté de poursuivre cette conversation et de lui lancer une affirmation : Tu fais exactement cela : « dialogue avec l’utilisateur ». Tu es un agent conversationnel !
Je suis là pour vous aider, pour en savoir plus rendez-vous sur Apple.com
Bon, à ce stade je n’ai pas de crainte d’entrer dans une relation affective avec Siri !
« Les agents conversationnels » se basent donc sur un processus statistique. Ce processus peut cependant être contrecarré par les concepteurs humains
Ainsi, ils n’utilisent jamais de pronom genré : « il » ou « elle » ont été écartés de leur langage par la volonté de leur programmeur
Grinbaum explique que c’est parce que les concepteurs avaient peur de se tromper en raison d’un prénom mixte ou un autre élément perturbateur qui risquait de pousser à l’erreur.
Peut-être aussi que les concepteurs adhérent à des théories dans lesquelles le genre est suspect.
Toujours est-il que les chatbots ne disent jamais « il » ou « elle » et si les enfants s’habituent à parler comme eux, les pronoms genrés disparaîtront aussi de leur langage.
 Il y a évidemment des agents conversationnels de types très différents.
Il y a évidemment des agents conversationnels de types très différents.Il en existe de très simples qui sont de simples arbres décisionnels, notamment dans le domaine technique ou du service après-vente ou encore dans le domaine de la santé pour la prescription et le dosage des médicaments.
Beaucoup de chatbots sont spécialisés, mais les plus époustouflants sont les agents conversationnel généralistes qui parlent de tout. Ce sont ceux qui utilisent ces nouvelles techniques de transformer.
Etienne Klein pose alors la question :
« N’est ce pas effrayant ? »
Et Grinbaum répond :
« C’est fascinant, ça ne veut pas dire que ce n’est pas effrayant !
Mais il est clair qu’on s’achemine vers un monde différent. »
Et il parle notamment de personnes troublées ou seules ou timides qui vont parler avec un chatbot et qui vont en faire leur ami.
 Il y aura de l’affect dans cette relation, de l’affect du côté humain, du côté machine cela ne veut rien dire.
Il y aura de l’affect dans cette relation, de l’affect du côté humain, du côté machine cela ne veut rien dire.
Nous avions vu le film « HER» dans lequel un homme un peu déprimé tombe amoureux du nouveau système d’exploitation de son ordinateur à qui il donne le nom de Samantha. Ils parlent ensemble et Samantha parle d’amour. Mais l’un y croit, l’autre ne sait même pas ce que cela signifie.
On peut très bien imaginer que les chatbots remplacent les psychanalystes. D’ailleurs d’ores et déjà des patients préfèrent parler avec une machine parce qu’il n’y a pas de jugement moral et ils sont plus libres de parler.
Je finirai, en citant le passage qu’ils ont eu sur le test d’Alan Turing
En 1950, peu de temps avant sa mort Alan Turing a proposé un test d’intelligence pour une machine capable de dialoguer en langage naturelle avec un être humain.
Selon le test de Turing, une machine est intelligente si un humain qui dialogue avec elle ne s’aperçoit pas que c’est une machine.
Pour Grinbaum :
« Si on prend un chatbot actuel très performant et qu’on limite le temps d’échange à deux minutes. La machine sait construire un dialogue absolument parfait de deux ou trois minutes, indistinctable du dialogue humain. Mais au bout de dix minutes ou de 15 minutes, vous allez rencontrer quelque chose d’étrange de bizarre. Le test de Turing dans sa définition originale ne met pas de contrainte sur la durée. Cette contrainte sur la durée est aujourd’hui essentielle »
Etienne Klein rappelle qu’Alan Turing avait prédit qu’en l’an 2000 les machines seraient en capacité de tromper 30% des juges humains pendant un test de 5 minutes de conversation.
Et Grinbaum répond :
« On y est déjà ! »
Nous sommes cependant en 2021 non en 2000 et Grinbaum insiste que les progrès des trois dernières années ont été décisifs.
Vous apprendrez bien d ‘autres chose dans cette émission passionnante et assez déconcertante pour notre avenir.
Vous entendrez parler de <l’effet Elyza> et aussi de < deadbots >. Ces agents conversationnels qui font parler les morts ou plutôt parlent comme des morts en utilisant les conversations et des écrits qu’ils ont produits avant leurs décès. J’en avais déjà fait le sujet du mot du jour du 27 mars 2018 : « Nier la mort. »
Il est aussi possible de trouver des articles sur ce sujet sur le Web
Par exemple le journal suisse « Le Temps » <Des «chatbots» pour parler avec les morts>
Un site informatique « Neon », dans un article récent le 12 novembre 2021 <Les chatbots qui font « parler les morts » posent quelques questions éthiques>
Je redonne le lien vers l’émission <Comment converser avec les machines parlantes ?> qui parle du vrai grand remplacement.
<1635>
-
Mardi 7 décembre 2021
« Pause (Mozart) »Un jour sans mot du jour nouveauDimanche nous étions déjà allé à l’Auditorium de Lyon
 Lundi nous y sommes retournés pour écouter Jordi Savall avec son orchestre et son chœur jouer le « Requiem de Mozart ».
Lundi nous y sommes retournés pour écouter Jordi Savall avec son orchestre et son chœur jouer le « Requiem de Mozart ».
A la fin du concert Jordi Savall a bissé le Lacrimosa après avoir rappelé que Mozart est mort pauvre le 5 décembre 1791, il y a 230 ans.
« Res Musica » a consacré un article à cet anniversaire le 5 décembre 2021 : <La mort choquante et dédaignée de Mozart >
J’en tire un extrait :
« Son état s’aggrave et l’on fait appel à un autre médecin, le 28 novembre, qui pense que l’on ne peut plus rien faire et que le musicien est condamné à très court terme. Le patient reste encore clairvoyant et se désespère d’être obligé de quitter les siens et sa musique. Dans un surcroit de volonté, le 3 décembre, il met sur pied une répétition du Requiem dans sa chambre en présence de quelques fidèles.
Il assure la partie d’alto puis, ému, s’effondre en larmes, certain qu’il ne pourra pas mettre un point final à son œuvre. À ceux qui tentaient de le réconforter Wolfgang Amadeus Mozart s’exprima ainsi : « J’ai déjà le goût de la mort dans la bouche. Je sens la mort. »
On fait quérir un prêtre mais, en vain, car aucun serviteur de Dieu ne se déplace. Ne lui reproche-t-on pas de la sorte son travail d’artiste et son adhésion à la franc-maçonnerie ? Peu après, la situation devient dramatique, les maux de tête s’intensifient et il perd connaissance. Les dernières minutes diversement décrites conduisent au décès du patient qui s’éteint le 5 décembre 1791 vers une heure du matin. […]
Mozart n’a jamais connu l’opulence matérielle. Il meurt pauvre. Cette situation implique un enterrement simple. Très simple.
À ce titre, la dépouille mortelle est suivie par une poignée de proches.
On la met dans une fausse commune du cimetière de Saint-Marx. Pas même une croix !
Ceux qui auraient pu rendre l’enterrement plus digne se défilent et recommandent une dépense minimale.
En conséquence l’on se contente d’un bref service religieux, sans messe et sans musique, dans une chapelle latérale de la cathédrale Saint-Étienne.
Cette mort survenue dans une indifférence troublante contraste intensément avec la reconnaissance posthume de son génie universel fêté par l’ensemble du monde. »
Et voici le Lacrimosa du Requiem de Mozart interprété par <Claudio Abbado au Festival de Lucerne>
J’ai aussi trouvé cette version minimaliste : un instrument pour chaque voix d’orchestre et une chanteuse et un chanteur par voix de chœur. <Ensemble Contraste>. C’est dépouillé et poignant.
Et encore plus dépouillé, le Lacrimosa arrangé pour quatuor à cordes par le <Quatuor Debussy>
<Mot du jour sans numéro> -
Lundi 6 décembre 2021
« Pause (Grigory Sokolov) »Un jour sans mot du jour nouveauDimanche et lundi Annie et moi sommes allés et allons au concert.
 Dans ces conditions, difficile d’écrire un mot du jour.
Dans ces conditions, difficile d’écrire un mot du jour.
Dimanche, nous sommes allés écouter à l’Auditorium de Lyon, le remarquable pianiste Grigory Sokolov.
J’avais écrit un mot du jour il y a presque exactement 3 ans suite à un concert de Sokolov le : <3 décembre 2018>
Cette fois il a joué 6 bis.
Par exemple <La Mazurka opus 68 N°2 de Chopin>
Et < Intermezzo op 118 no 3 de Brahms>
Et aussi <Ce choral de Bach>
<Mot du jour sans numéro>
-
Vendredi 3 décembre 2021
« La terre n’a jamais été autant remplie d’humains et pourtant nous avons de plus en plus de mal à en trouver, quand nous avons besoin d’en rencontrer un »Réflexion personnelle sur notre quotidien et après avoir vu le film « De son vivant »Rationnellement nous somme trop d’humains sur terre, nous puisons trop de ressources, nous détruisons la biodiversité indispensable à la vie et maintenant nous sommes même devenus des perturbateurs systémiques puisque notre manière de produire et consommer augmente la température sur terre.
Nous sommes trop nombreux et pourtant nous avons de plus en plus de mal à trouver un humain quand nous avons un problème. On nous renvoie vers des sites internet, des serveurs téléphoniques automatisés, des robots.
Dans <Le Point>, la réalisatrice du film « De son vivant » sait que son film sera critiqué parce qu’ :
« On va me dire que ce n’est pas comme ça que ça se passe, que c’est un monde idéal, que si les médecins étaient comme cela, et les chambres d’hôpital si grandes et si belles, cela se saurait… ».
Et il est vrai que dans le film, la qualité de l’accompagnement n’est possible que parce qu’il y a un médecin remarquable, mais aussi des soignants, des musicothérapeutes en nombre.
Il y a beaucoup d’humains et d’humain.
Je ne sais pas si dans la vraie vie, le docteur Gabriel Sara, dispose d’autant de collaborateurs pour s’occuper de ses patients.
Nous rencontrons de moins en moins d’humains dans la santé et ailleurs.
Récemment un ami m’a fait part du souci pour sa sœur handicapée. Elle touche une aide sociale conséquente mais elle n’arrive pas à trouver des humains qui s’occupent d’elle.
L’argent qui devrait lui permettre de payer les aides dont elle a besoin, ne sert pas parce qu’il n’y a pas d’offre de soins.
Quand on arrive à trouver un médecin généraliste, il vous expédie en 15 minutes chrono.
Alors que tout le monde sait que c’est la qualité de la relation médecin/patient qui est essentiel dans la réussite thérapeutique.
Dans beaucoup d’unité de soins, des infirmiers, infirmières et aides-soignantes se plaignent d’être obligés de réaliser des soins dans des temps si restreints que tout devient mécanique, qu’il n’y a plus d’humanité. La conséquence est que le travail est mal fait, ce qui est préjudiciable pour la santé du patient, mais aussi pour le soignant qui ne peut plus être fier du travail qu’il produit.
Mais ce n’est pas que le problème de la santé. C’est aussi le cas au sein de la Justice.
Dans le monde 3000 magistrats ont publié une Tribune le 23 novembre 2021 : « Nous ne voulons plus d’une justice qui n’écoute pas et qui chronomètre tout »
Suite à cette tribune j’ai entendu à la radio deux jeunes magistrates qui racontaient leur mal être, de juge des libertés qui sont obligés de restreindre leur rencontre avec des détenus qui ont attendu de long mois avant de pouvoir obtenir l’audience.
Dans la tribune du Monde, ils écrivent :
« Nous, juges aux affaires familiales, sommes trop souvent contraints de traiter chaque dossier de divorce ou de séparation en quinze minutes et de ne pas donner la parole au couple lorsque chacune des parties est assistée par un avocat, pour ne pas perdre de temps.
Nous, juges civils de proximité, devons présider des audiences de 9 heures à 15 heures, sans pause, pour juger 50 dossiers ; après avoir fait attendre des heures des personnes qui ne parviennent plus à payer leur loyer ou qui sont surendettées, nous n’avons que sept minutes pour écouter et apprécier leur situation dramatique.
Nous, juges des enfants, en sommes réduits à renouveler des mesures de suivi éducatif sans voir les familles, parce que le nombre de dossiers à gérer ne nous permet pas de les recevoir toutes. »
On pourrait multiplier les exemples.
On me dit même qu’il est de plus en plus difficile de rencontrer et de discuter avec un agent des impôts de ses problèmes avec le fisc.
Certains élaborent des récits dans lesquels, ils prétendent que la numérisation et l’automatisation dégageront des marges de manœuvre pour réintroduire de l’humanité.
Peut-on le croire ?
Je n’ai pas de solutions à proposer mais je suis convaincu que nous avons tous davantage besoin d’humains et d’humanité dans notre quotidien que de machines et de numérisation.
Christian Bobin écrit :
« Être écouté, c’est être remis au monde, c’est exister, c’est comme si on vous redonnait toutes les chances d’une vie neuve. »
<1634>
-
Jeudi 2 décembre 2021
« L’utilisation de la thérapie par la musique dans la médecine en général et contre la douleur en particulier est une réalité qui va s’imposer de plus en plus »Docteur Gabriel SaraJ’avais déjà évoqué l’extraordinaire effet de la musique sur les malades, par le mot du jour du 1er février 2021, <Le pansement Schubert> qui était un livre de la violoncelliste Claire Oppert racontant son expérience de musicienne auprès de malades auxquels elle faisait énormément de bien en jouant. Le pansement Schubert est devenu par la suite une étude clinique menée sur plusieurs mois, 120 soins réalisés en compagnie de l’instrument. A la clé, une réelle diminution de la douleur physique, un apaisement de l’angoisse et pour tous ces hommes et femmes en souffrance, le sentiment de tutoyer de nouveau la vie.
J’ai trouvé récemment, sur le site de la <Médiathèque de Meaux> une conversation lumineuse, d’une profondeur humaine exceptionnelle entre Véronique Lefebvre des Noëttes, docteure en médecine, psychiatre, gériatre et Claire Oppert, parlant de ce sujet.
Il existe des musiques pour de multiples usages :
- Faire défiler une armée
- Faire danser une foule
- Déclencher une euphorie ou invitant à la tendresse
- Unir un collectif de personnes autour d’un objectif exaltant. J’avais évoqué, par exemple, l’hymne du club de football de Liverpool « You’ll never walk alone »
- Il est des musiques qui sont promptes à entretenir la colère et le ressentiment, pour que des foules puissent se déchainer contre un bouc émissaire qui peut être la police ou un autre symbole de l’autorité
- Et puis il y a des musiques qui apaisent
Ce ne sont évidemment pas les mêmes musiques.
Pour ma part, j’ai depuis longtemps expérimenté ce pouvoir de la musique pour les diverses émotions qu’on peut traverser.
Je me souviens particulièrement de ce moment, dans la chambre de l’hôpital Mermoz de Lyon, après l’opération qui aurait dû me guérir de mon cancer, d’après les statistiques.
Pour la troisième fois, mon chirurgien m’informait qu’il ne m’était pas possible de quitter l’hôpital parce que la cicatrisation post opératoire n’était pas suffisante. Le séjour prévu était d’une semaine, je venais de finir la troisième dans cette chambre et l’angoisse de ne plus sortir m’a pris.
Je me souvenais, de manière irrationnelle, de mon oncle Louis qui disait : « on va à l’hôpital pour mourir ». Et c’était ce qui lui était arrivé.
Alors, avec le petit équipement que j’avais, j’ai écouté <Le quintette en ut de Schubert>
En moi, le calme est revenu, la paix, le silence. J’ai abordé la fin du séjour avec optimisme jusqu’à mon départ.
Tout le monde n’est sans doute pas sensible à la même musique et chacun doit expérimenter la musique qui peut l’aider, selon l’émotion du moment, probablement en plongeant dans ses souvenirs.
Dans le film « De son vivant », la musique est omniprésente. Le docteur Sara joue lui-même de la guitare. Les groupes de paroles des soignants se terminent toujours par des chansons. Les patients sont invités à participer à des séances musicales, des musiciens viennent même leur jouer de la musique dans leur chambre quand en sortir devient difficile.
Et dans l’entretien que le docteur Gabriel Sara a accordé au site de <Rose-up>, il raconte son expérience du Liban en guerre :
« La musique est une arme contre cette violence. Je l’ai vécu pendant la guerre au Liban. C’est resté dans ma peau. En 1978, j’étais interne à l’hôpital libanais de Beyrouth. Durant les phases de bombardements, on était une cible privilégiée. Une bombe par minute nous tombait dessus, parfois plus, et cela a duré cent jours. C’était effrayant. Dans ces moments-là, on se réfugiait au sous-sol en attendant que ça s’arrête. Je prenais alors ma guitare, dont je ne me séparais jamais, et je chantais. Les gens autour de moi commençaient à se lever et à danser. Ils dansaient sous les bombes ! C’était surréaliste, mais je crois que c’est un réflexe de survie partagé par tous les humains. »
Et il fait le parallèle avec la maladie, ici le cancer :
« Le cancer terrorise les malades, il les paralyse, les empêche de penser, de rêver d’être qui ils sont. La façon de gérer ça, c’est de refuser d’être terrorisé. »
Et le moyen qu’il a trouvé c’est la musique
Dans un autre <entretien>, il affirme sa conviction que la musique parfois est bien plus utile qu’une pilule :
« L’utilisation de la thérapie par la musique dans la médecine en général et contre la douleur en particulier est une réalité qui va s’imposer de plus en plus, au vu des données scientifiques et des études qui apportent les preuves irréfutables des bénéfices de la musique chez les malades.
Si en tant que médecin j’ai un moyen de soulager les douleurs d’un malade et de l’aider sans passer par les médicaments qui ont souvent des effets secondaires toxiques et qui sont très onéreux, pourquoi ne pas le faire ?
Le côté humain et les soins personnels apportés par cette thérapie sont inestimables et le côté humain du soutien au malade manifesté par la musique ne peut être remplacé par aucune pilule ! »
C’est pourquoi, il a fait en sorte de faire une grande place aux musicothérapeutes dans son service de l’hôpital Mount Sinaï Roosevelt de New York.
« Via les dons de la fondation Helen Sawaya, je finance les salaires de musicothérapeutes qui interviennent tous les jours dans mon service. La musique a un effet merveilleux. Elle vibre en nous, elle a quelque chose de vital. Elle est un langage universel et puis, elle permet d’exprimer des émotions qu’on subit sans pouvoir toujours les expliquer. Grâce à elle, les patients sont en position de reprendre ou de garder le contrôle. Comme Benjamin qui au départ rejette le musicothérapeute. Celui-ci lui dit que ce n’est pas grave et que d’ailleurs il est peut-être la seule personne dans l’hôpital à qui il peut dire non.
Quand on lui annonce un cancer, la terre s’ouvre sous les pieds du malade, il est précipité dans un vide vertigineux qu’il subit totalement. On lui dit quel examen faire, à quel moment il doit faire tel traitement. Il n’a plus la maîtrise de rien. Le musicothérapeute est là pour que le malade sente qu’il est un être autonome. Il peut refuser ou accepter la musique, et choisir la chanson. Il peut aussi jouer d’un instrument car on en met à disposition. Le patient découvre qu’il a encore du pouvoir. C’est de l’ « empowerment » et c’est crucial ! »
Et il est intarissable sur les études qu’il a menées et leurs résultats positifs :
« Les exemples sont multiples et quotidiens, non seulement sur la douleur mais aussi sur la détresse d’un malade en général.
Prenons le cas des nouveau-nés d’un ou deux jours qui n’ont aucune connaissance ni notion de musique. Quand nos thérapeutes vont en salles de soins intensifs où ces nourrissons sont hospitalisés, le médecin voit immédiatement sur les écrans qui les surveillent, l’impact extraordinaire de la musique sur le pouls, la respiration, la tension de ces enfants. C’est extrêmement impressionnant de voir ralentir un pouls trop rapide, se calmer une respiration saccadée ou baisser une tension trop élevée rien qu’au contact de la musique. Nous le constatons tous les jours dans les services de néonatologie.
En ce qui concerne les adultes, la thérapie par la musique a des effets certains d’amélioration sur le seuil de la douleur et sur la nausée causée par la chimiothérapie. Le bénéfice émotionnel en est également énorme. La musique est un moyen de communication universel à travers les cultures et les langues. Elle exprime une émotion sans avoir besoin de mots. Souvent traumatisés, les malades n’arrivent pas à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. Par le biais de la thérapie par la musique, ils arrivent à se décharger du poids de leurs émotions. Une communication intense s’installe entre le thérapeute et le malade sans qu’ils ne parlent forcément la même langue.
On constate aussi les effets positifs et apaisants de la thérapie par la musique sur les infirmières et les personnels soignants car eux-mêmes bénéficient régulièrement de ces sessions. […]
Actuellement j’en conduis une commencée il y a trois ans déjà. Il s’agit d’évaluer si, grâce à la musique, on peut extuber les malades plus rapidement. C’est toujours un grand challenge le moment de retirer l’aide respiratoire à un patient. Autant il déteste ce tube qui le gêne, autant il a peur qu’on le lui retire. L’angoisse de l’asphyxie chez le malade peut d’ailleurs le rendre incapable de respirer seul ! Avec la musique, on peut travailler sur cette anxiété et la réduire. Et peut-être même extuber plus tôt. […] Avec cette étude j’espère montrer d’abord que c’est un bien être pour le malade, mais aussi prouver à l’administration qu’investir dans la musicothérapie peut leur permettre de faire des économies. »
Le docteur Gabriel Sara écrit un livre «Music and Medicine: Integrative Models in the Treatment of Pain» dans lequel il a consigné ses études et ses constats des bénéfices de la musique.
Il n’est pas nécessaire d’être malade pour se rendre compte des bienfaits de la musique et tout ce qu’elle peut nous apporter pour notre bien être, pour gérer nos émotions, pour vivre.
<1633>
- Faire défiler une armée
-
Mercredi 1er décembre 2021
« Pardonne-moi. Je te pardonne. Je t’aime. Merci. Au revoir. »Les 5 mots essentiels qu’il faut dire, selon le professeur Gabriel Sara, pour ranger le bureau de sa vie« De son vivant » est un beau titre pour un film bouleversant et lumineux.
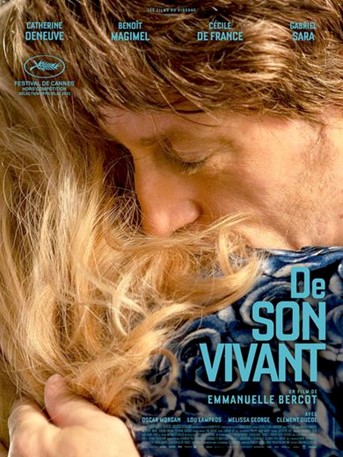 Il s’agit de la fin de vie d’un professeur d’art théâtral joué par Benoit Magimel, atteint d’un cancer du pancréas au stade 4, accompagné par un médecin joué par un vrai oncologue, Gabriel Sara, qui fait dans le film ce qu’il pratique, dans la vraie vie, dans son service : l’unité de chimiothérapie de l’hôpital Mount Sinaï Roosevelt de New York.
Il s’agit de la fin de vie d’un professeur d’art théâtral joué par Benoit Magimel, atteint d’un cancer du pancréas au stade 4, accompagné par un médecin joué par un vrai oncologue, Gabriel Sara, qui fait dans le film ce qu’il pratique, dans la vraie vie, dans son service : l’unité de chimiothérapie de l’hôpital Mount Sinaï Roosevelt de New York.
Ce film ne parle pas de la mort, il parle de la vie.
Pour supporter notre destin de mortel, beaucoup de croyants se rattachent à leurs récits religieux qui leur racontent une vie éternelle qu’ils pourront vivre après, dans un monde où tout n’est que beauté, douceur et lumière.
Et si ce récit rassurant leur permet de mieux vivre ses moments ultimes, ils font bien.
Ce ne fut pas la réponse d’Axel Kahn quand dans son dernier entretien, dans la <Grande Librairie>, deux semaines avant de mourir, François Busnel lui demanda : « Croyez-vous à une vie après la mort ? », il répondit :
« Je n’en fais point l’hypothèse »
Mais Axel Kahn a surtout dit autre chose :
« La mort est un non évènement, ce n’est rien d’autre que la fin de la vie, le rideau qui tombe… »
L’évènement c’est la vie, c’est de la vie qu’il faut parler, c’est la vie qu’il faut vivre.
Car, si la vie après la mort est une hypothèse, celle avant est palpable, réelle et permet de donner et de recevoir de la joie, de la tendresse, de l’amour.
Vivre, même s’il ne reste qu’un an ou qu’un mois ou que 5 minutes.
S’il ne reste que peu de temps, il devient d’autant plus important de remplir ce temps de ce qui est le plus essentiel, de plus précieux.
C’est ce qu’a fait Axel Kahn dans sa vraie vie. En outre, il a tenu « La chronique apaisée de la fin d’un itinéraire de vie » sur son <blog> jusqu’au moment où la douleur trop forte l’a obligé de prendre des médicaments contre la douleur qui ne lui permettait plus de disposer d’une lucidité suffisante pour écrire un texte intelligible et construit.
Dans l’œuvre de fiction « De son vivant », le professeur Gabriel Sara, en puisant dans son expérience, ne dit pas autre chose quand il avertit Benjamin qu’il existe des gens qui meurent avant de mourir, parce qu’ils oublient de vivre ce qu’il leur reste de vie.
 Benoit Magimel est époustouflant dans ce film, Catherine Deneuve qui joue sa mère et qui a subi un AVC au cours du tournage est admirable, mais celui qui illumine le film est le docteur Gabriel Sara.
Benoit Magimel est époustouflant dans ce film, Catherine Deneuve qui joue sa mère et qui a subi un AVC au cours du tournage est admirable, mais celui qui illumine le film est le docteur Gabriel Sara.
Celui qui invite à « ranger le bureau de sa vie », en prononçant les 5 phrases essentielles :
- Pardonne-moi,
- Je te pardonne
- Je t’aime
- Merci
- Au revoir
C’est en entendant cet homme qui accompagnait Emmanuelle Bercot, la réalisatrice du film chez Léa Salamé le 24 novembre 2021, <Je voulais faire un film sur la mort plein de vie> que j’ai eu une envie irrépressible d’aller voir ce film.
Ce qui fut fait avec Annie le 30 novembre.
Gabriel Sara est né au Liban et a étudié en France. Il a rencontré Emmanuelle Bercot à New York et lui a proposé de venir le voir dans son service de traitement du cancer. Emmanuelle Bercot a accepté l’invitation et a été saisie par l’immense qualité de ses méthodes d’accompagnement des malades : humaines et joyeuses.
Il refuse la distance entre le malade et son médecin. Il n’accepte pas les mensonges, le déni, il ne connait qu’une règle : dire 100% de la vérité :
« Il est indispensable de mettre carte sur table. Car mon malade est mon partenaire. Si on va être partenaire lors d’une aventure, on ne peut pas se mentir.
Il faut clarifier les choses, c’est dur au départ. Le cancer est un terroriste, il ne faut pas se laisser consumer par la peur »
J’ai trouvé un entretien d’une profondeur exceptionnelle avec Gabriel Sara sur le site de l’association RoseUp, qui est une association de patients et d’accompagnants dans lutte face aux cancers : <un oncologue se livre au cinéma>
Il joue son rôle même si dans le film le nom du médecin est le docteur Eddé :
« D’abord, [le docteur Eddé] sait ce qu’il fait, ça c’est indispensable. Mais c’est aussi un médecin qui s’intéresse à l’individu derrière le malade. Qui s’y intéresse vraiment et qui s’adapte à lui, en fonction de l’évolution de son état d’esprit. Car, au fil du parcours de soins, les gens changent. Leurs humeurs, leurs émotions ne sont pas les mêmes d’une semaine à l’autre, ou même d’un jour à l’autre. C’est ce que j’appelle danser avec le malade.
La séquence de tango dans le film symbolise cette relation étroite qui nous unit. […]
C’est beau le tango mais c’est une danse difficile. Elle nécessite d’avoir confiance en l’autre, d’être connecté à son corps, à ses réactions, à ses mouvements. Un faux pas peut faire trébucher et chuter les danseurs. C’est ça être partenaire, et c’est exactement pareil en médecine. Avec le malade, on danse ensemble. Ça veut dire qu’on se tient la main et qu’on regarde le cancer ensemble. Et ensemble on va trouver la façon de le détruire quand c’est possible, ou de vivre avec, si on peut. »
 Il parle de confiance, confiance qui n’est possible que s’il existe un pacte de vérité. Mais à la fin il parle surtout d’humanité :
Il parle de confiance, confiance qui n’est possible que s’il existe un pacte de vérité. Mais à la fin il parle surtout d’humanité :
« Sur la vérité. Il y a souvent un manque de vérité, or pour moi elle est sacrée. Aucun malade n’est stupide. Il entend les messes basses, il voit les regards sur lui, il sent évidemment qu’il y a un problème sérieux. Parfois on ne lui dit que la moitié des choses, et c’est tout aussi dramatique. Le malade se dit « je vais mourir et personne n’ose me le dire même, pas mon médecin ! ». L’imagination s’emballe, et c’est un poison, c’est un diable dans sa tête. La seule chose qui permet de le dompter, de le chasser, c’est la vérité. Voilà pourquoi j’annonce toujours mon jeu dès le premier rendez-vous, en disant au malade : vous ne me connaissez pas encore, mais je suis très franc, très transparent. Je vous dirai toujours les choses exactement comme elles sont. Ce pacte de vérité avec mon patient doit être permanent, constant. C’est à ce prix que la confiance se construit. Mais c’est aussi un pacte très difficile à tenir.
[…] Mais la plus grande des frayeurs ce n’est pas de savoir qu’on va mourir, mais de savoir qu’on vous a menti, surtout si c’est votre médecin. Les gens pensent qu’en disant la vérité on déprime le malade. C’est un concept malheureusement généralisé et faux. Quand le jeu devient dur et qu’on cache la vérité, on abandonne son malade. On le trahit. Oui c’est très dur d’entendre qu’on va mourir, mais une fois qu’on a géré cette chose, et je suis là pour aider la personne à le gérer, on va vers l’avenir, le meilleur. On peut mourir de son vivant. On le voit chez Benjamin. Au fur et à mesure que son corps s’affaiblit, son esprit devient paradoxalement plus puissant. Il prend le contrôle de sa vie, il règle son histoire avec son fils, il pardonne à sa mère, il transmet à ses élèves tout ce qu’il a de plus beau à donner. Alors que son corps est foutu, lui vit plus intensément que jamais. Il n’a jamais été aussi en contrôle de sa vie. Et c’est merveilleux. »
Bien sûr, à la fin après avoir gagné des batailles, il sait qu’il perdra la guerre. Mais son combat est un beau combat : que la vie reste belle jusqu’au bout :
« Face à un patient dont je connais le pronostic, mon but n’est évidemment pas de le sauver, je sais où je l’emmène, et je dois l’accepter. Mais il y a des chances pour que je puisse prolonger sa vie et, plus important encore, pour que je puisse prolonger ou augmenter sa qualité de vie. Face à un patient condamné, ma mission sacrée est de l’accompagner pour que les années, les mois et jusqu’aux minutes qu’il lui reste, soient de beaux instants de vie et pas d’agonie. Quand mon patient meurt, je suis triste bien sûr, mais j’ai le sentiment du devoir accompli. Pour un cancérologue, c’est une satisfaction énorme. »
Il se déclare même amoureux de son métier :
« Oui parce qu’il y a tant de choses qu’on peut faire pour les malades. Il n’y en a aucun qu’on ne peut pas aider, ça n’existe pas ! Même dans le pire des cas. Ce qui m’intéresse en tant que cancérologue, ce n’est pas la bataille mais la guerre dans son ensemble. Un traitement de cancer du poumon peut avoir des conséquences sur le rein, le cœur, la tête du patient. La stratégie doit être globale, et il faut mettre met son intelligence, sa créativité et son écoute au service de cette stratégie. Quand on est convaincu de ça, c’est fou l’impact qu’on peut avoir sur nos malades. À tous les niveaux. Sky is the limit ! (Le ciel est la limite)
Médecin admirable qui tente de lutter contre cette tendance de la médecine occidentale de couper le patient en tranche de spécialités, mais d’essayer de l’aborder dans son ensemble, de manière holistique.
Film d’une beauté incandescente.
Bien sûr c’est un mélo, il fait pleurer, mais il n’est pas triste et il fait beaucoup de bien.
C’est une grande réussite d’Emmanuelle Bercot aidée par des acteurs remarquables.
<1632>
- Pardonne-moi,
-
Mardi 30 novembre 2021
« Le salon du livre de jeunesse de Montreuil »Évènement annuel qui m’a marquéNous, Annie, Alexis et moi, habitions à Montreuil sous-bois, depuis 1991 et en 1994 Natacha nous a rejoint.
A Montreuil, le salon du livre jeunesse existait depuis 1984.
Et à la fin novembre, début décembre, pendant quelques jours, la place de la mairie de Montreuil se remplissait d’immenses tentes dans lesquelles on célébrait la fête du livre de la jeunesse
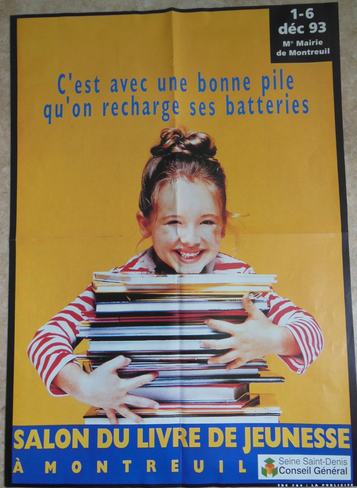 Nous avons commencé à y assister à partir de 1993.
Nous avons commencé à y assister à partir de 1993.
Et en 1994, on pouvait lire dans <Le Monde>
« Sur la place de la Mairie, à Montreuil, le cirque Gruss a tendu un chapiteau géant de 8 700 mètres carrés. D’une fontaine glacée s’échappent des mots au néon, en souvenir des « paroles gelées » de Rabelais (dont on s’apprête à fêter, une dernière fois, le cinq centième anniversaire). Trois cubes immenses et colorés, de l’illustratrice tchèque Kveta Pacovska, attendent les visiteurs.
Dans quelques jours, du 30 novembre au 5 décembre, les auteurs et les illustrateurs afflueront. Plus de 130 éditeurs sont attendus.
Il y aura des débats, des expositions, des jeux, des concours, des livres par milliers. Entrez donc, mesdames et messieurs.
Et vous, petits lecteurs, approchez. Le dixième Salon du livre de jeunesse va commencer… Dix ans. Premier âge à deux chiffres. Heure des souvenirs et des bilans. « En 1984, quand nous avons débuté, nous étions tout petits, cachés derrière un centre commercial, dans un ancien parking en colimaçon », se souvient Henriette Zoughebi, bibliothécaire de formation, fondatrice et directrice du Salon. « Montreuil » venait de naître, à l’initiative de la municipalité et du conseil général de Seine-Saint-Denis.
Mais les éditeurs avaient des doutes. Pourquoi un Salon en banlieue ? Pourquoi pas « faire Montreuil à Paris »? Dix ans plus tard, de l’avis de tous, le pari est gagné.
Le Salon a fait la preuve qu’il était plus utile en Seine-Saint-Denis (où 20% de la population a moins de dix-huit ans) que nulle part ailleurs. »
Et par la suite, toutes les années nous attendions avec impatience cette fête du livre pour les enfants, les adolescents. et les parents !
 En tant que citoyen Montreuillois, nous bénéficions de privilèges.
En tant que citoyen Montreuillois, nous bénéficions de privilèges.
D’abord nous avions droit à des invitations qui nous dispensaient de payer l’entrée.
Ensuite, nous avions le droit de venir le premier jour qui était en principe réservé aux professionnels. Dès lors, l’accès aux auteurs était plus simple, il y avait beaucoup moins de monde ce premier jour.
Tous les éditeurs étaient là et il y avait toutes les nouveautés de l’année.
C’était vraiment très grand !
<Le bulletin des Bibliothèques de France> précisait en 1994 :
« Le Salon du livre de jeunesse de Montreuil fêtait son 10e anniversaire du 30 novembre au 5 décembre derniers, sous le grand chapiteau blanc dressé sur la place de la mairie. Ce salon, devenu, avec la Foire internationale de Bologne, un des deux grands rendez-vous européens du livre de jeunesse, est une immense librairie ouverte à tous, qui incite à la découverte de la richesse de ce secteur éditorial. »
Nous y sommes allés avec le même enthousiasme tous les ans jusqu’à notre départ de Montreuil, en 2002.
Depuis 2000, il est organisé dans un bâtiment en dur situé 128 Rue de Paris à Montreuil et qui a désormais pour nom L’Espace Paris Est Montreuil. C’était une ancienne friche industrielle transformée en palais des Congrès
Bien des années ont passé et nos enfants sont grands désormais.
Mais, chaque année, depuis que nous sommes partis, quand s’approche le mois de décembre, je pense avec nostalgie à ces moments de lumière et de célébration du livre que nous avons vécu à Montreuil.
Et chaque année, je me promettais de consacrer un mot du jour à cette belle manifestation.
Le mot « presse » a été ajouté depuis, et cette fête s’appelle désormais « le Salon du livre et de la presse jeunesse »
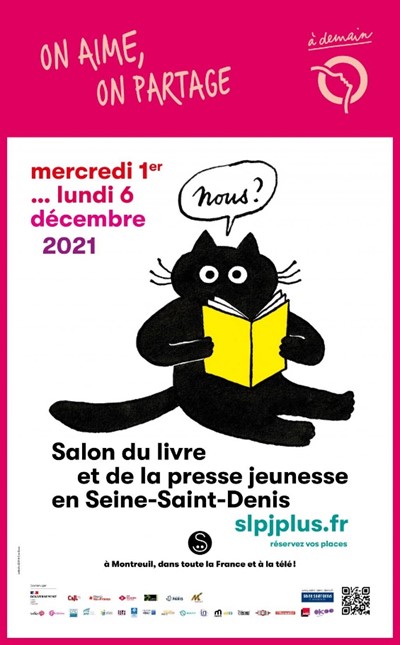 Cette année 2021, ce sera la 37ème édition.
Cette année 2021, ce sera la 37ème édition.
Elle aura lieu du mercredi 1er au lundi 6 décembre.
Le thème choisi cette année me semble particulièrement approprié aux temps que nous vivons : « Nous »
Sylvie Vassallo, la directrice du salon explique
« Ce qui se cache derrière ce « Nous ! » c’est à la fois une affirmation, et une interrogation.
Nous tenions à affirmer l’intérêt du commun, l’importance, et même la nécessité d’être ensemble, de se rassembler, de jouer collectif […]
C’est d’autant plus essentiel dans une société fractionnée, avec des enfants au cœur de ces fractures.
Mais ce « nous » est aussi une interrogation sur le qui nous sommes, sur le rapport à soi, et aux autres. […]
Chez les philosophes grecs, le « nous » a une signification liée au savoir, à l’esprit, à la raison, à l’intelligence,
et il me semble que la littérature jeunesse permet aussi de penser dans un esprit de communion ».
<France Inter> a consacré une page sur ce salon sur son site.
Il y a aussi <Le site du salon>

<1631>
-
Lundi 29 novembre 2021
« Le chlordécone »Un scandale sanitaire françaisC’est un nom qui sonne phonétiquement mal : « Le chlore déconne ! »
En réalité, il s’agit d’une molécule qui associe 10 atomes de Chlore, 10 atomes de Carbone et un atome d’oxygène.
Cette molécule « la chlordécone » entre dans la constitution d’un insecticide qui est communément appelé par ce nom « Le chlordécone ».
En ce moment, il y a des heurts très violents dans les Antilles françaises avec utilisation de la part des manifestants d’armes à feu. Le grief qu’on entend le plus souvent est lié à la campagne de vaccination de la COVID19 et au pass sanitaire. Selon ce que je comprends, les revendications dépassent de beaucoup ces seuls sujets.
Mais j’ai entendu à plusieurs reprises des journalistes et même Marine Le Pen dirent qu’en Guadeloupe et en Martinique, le rejet de la vaccination est dû à une grande méfiance par rapport à l’autorité publique et que cette méfiance trouve sa source dans ce que la plupart appelle : « le scandale du chlordécone ».
J’ai même entendu dans l’émission « C dans l’air » du 27 novembre un antillais dire « Ils nous ont empoisonnés une première fois, il n’arriveront pas à le faire une seconde fois.»
Cette accusation m’a conduit à essayer de comprendre ce sujet.
Le chlordécone est un pesticide qui a été utilisé massivement dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique pendant plus de vingt ans à partir de 1972 pour lutter contre le charançon de la banane, un insecte qui détruisait les cultures.
Mais dans l’émission « La méthode scientifique » du 9 septembre 2021 <Chlordécone : classée secret toxique ?>, Luc Multigner, médecin, épidémiologiste, directeur de recherche Inserm au sein de l’Institut de recherche en santé, environnement et travail à Rennes et Point-à-Pitre explique :
« Cette molécule avait très mauvaise réputation, c’est pour cela que son usage a été très restreint. Les Antilles ont débuté son usage modestement dans les bananeraies en 1972/1973, c’est le début de l’histoire. La seconde période c’est à partir de 1981, et les Antilles Françaises deviennent pratiquement les seules utilisatrices de cette molécule dans le monde »
Bref, c’est un pesticide que la journaliste « du Monde » Faustine Vincent définit comme « ultra-toxique », dans son article du 6 juin 2018 : <qu’est-ce que le chlordécone ?> dont on connait la toxicité et qui va être utilisé sur le territoire français, dans les Antilles.
La première autorisation, on parle d’AMM, autorisation de mise sur le marché, est signé le 18 septembre 1972, par le ministre de l’agriculture : M Jacques Chirac. Il a l’excuse que les États-Unis n’ont pas encore formellement interdit la molécule.
Ce sera fait en 1975. Car, en 1975, les ouvriers de l’usine Hopewell (Virginie), qui fabriquait le pesticide, ont développé de sévères troubles neurologiques et testiculaires après avoir été exposés à forte dose : troubles de la motricité, de l’humeur, de l’élocution et de la mémoire immédiate, mouvements anarchiques des globes oculaires…Ces effets ont disparu par la suite, car le corps élimine la moitié du chlordécone au bout de 165 jours, à condition bien sûr de ne pas en réabsorber. Mais l’accident fut si grave que les États-Unis ont fermé l’usine
Wikipédia précise que :
« La toxicité du produit était alors connue sous trois angles : cancérogénèse, risques de stérilité masculine et écotoxicité »
L’article de « Libération » du 1er avril 2021 : <Aux Antilles, les vies brisées du chlordécone> raconte une prise de conscience dans les Antilles préalable à 1975 :
«Il est souvent affirmé que les premières alertes vinrent des Etats-Unis, rappelle, en 2019, devant une commission parlementaire, Malcom Ferdinand, chercheur au CNRS. C’est faux. Elles furent émises par les ouvriers agricoles martiniquais en février 1974. Deux ans après l’autorisation officielle du chlordécone, les ouvriers de la banane entament l’une des plus importantes grèves de l’histoire sociale de la Martinique et demandent explicitement l’arrêt de l’utilisation de cette molécule parce qu’ils ont fait l’expérience de sa toxicité dans leur chair.»
En 1981, la ministre de l’agriculture avait pour nom Edith Cresson, le premier Ministre était Pierre Mauroy et le président de la République François Mitterrand.
C’est donc, en pleine connaissance, qu’Edith Cresson délivre à la société Laurent de Laguarigue une seconde AMM pour le chlordécone
L’autorité politique estime qu’il faut accorder une dérogation, bien que le produit soit très dangereux, parce que c’est l’intérêt de l’industrie de la banane.
Je continue le récit de Wikipedia, confirmé par d’autres médias :
« Le 1er février 1990, la France retire l’AMM du chlordécone pour tout le territoire français. Mais Guy Lordinot (alors Député de la Martinique) relayant de gros planteurs de bananes, fait une demande de dérogation qui permettrait une prolongation jusqu’en 1995, de l’utilisation du chlordécone, à la suite de sa question écrite le 23 avril appuyée par sa lettre au ministre de l’Agriculture du 30 avril 1990. Cette demande est refusée le 5 juin 1990 par Henri Nallet, alors ministre de l’Agriculture. Mais ce dernier précise qu’il y a un délai de 2 ans à partir du retrait d’autorisation, ce qui permet déjà d’utiliser le produit jusqu’en 1992.
En 1992 (mars) Louis Mermaz, nouveau ministre de l’Agriculture et des Forêts, proroge d’un an la dérogation pour l’utilisation du pesticide.
Et en février 1993, Jean-Pierre Soisson, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, répond favorablement à une demande de la SICABAM demandant à pouvoir utiliser le reliquat de stocks de chlordécone (stocks qui avaient été largement réapprovisionnés en août 1990 alors que la décision de retrait d’homologation de février 1990 avait été notifiée à la société Laguarigue qui commercialisait le chlordécone . Le frère ainé de Bernard Hayot, Yves Hayot (mort en 2017) qui était président du groupement des producteurs de bananes de Martinique (SICABAM), et aussi directeur général de Laguarigue a reconnu qu’il avait fait du lobbying auprès de J.-P. Soisson pour l’obtention des dérogations. »
Le 30 septembre 1993, ce pesticide est officiellement interdit à la vente aux Antilles françaises.
Pour être juste je donne aussi le nom du Ministre de l’agriculture à cette date : Jean Puech, le premier ministre étant Edouard Balladur.
C’est le récit factuel d’une non prise en compte d’un danger pour garantir les intérêts des producteurs de bananes.
La journaliste, Faustine Vincent, dans un autre article : <Chlordécone : les Antilles empoisonnées pour des générations> détaille les conséquences de ces « largesses coupables à l’égard de l’industrie de la banane » :
« Des années après, on découvre que le produit s’est répandu bien au-delà des bananeraies. Aujourd’hui encore, le chlordécone, qui passe dans la chaîne alimentaire, distille son poison un peu partout. Pas seulement dans les sols, mais aussi dans les rivières, une partie du littoral marin, le bétail, les volailles, les poissons, les crustacés, les légumes-racines… et la population elle-même.
Une étude de Santé publique France, lancée pour la première fois à grande échelle en 2013 […] fait un constat alarmant : la quasi-totalité des Guadeloupéens (95 %) et des Martiniquais (92 %) sont contaminés au chlordécone. Leur niveau d’imprégnation est comparable : en moyenne 0,13 et 0,14 microgrammes par litre (µg/l) de sang, avec des taux grimpant jusqu’à 18,53 µg/l. Or, le chlordécone étant un perturbateur endocrinien, « même à très faible dose, il peut y avoir des effets sanitaires », précise Sébastien Denys, directeur santé et environnement de l’agence. Des générations d’Antillais vont devoir vivre avec cette pollution, dont l’ampleur et la persistance – jusqu’à sept cents ans selon les sols – en font un cas unique au monde, et un véritable laboratoire à ciel ouvert. »
[Une étude] publiée en 2012 par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), montre que le chlordécone augmente non seulement le risque de prématurité, mais qu’il a aussi des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des nourrissons.
Le pesticide est aussi fortement soupçonné d’augmenter le risque de cancer de la prostate, dont le nombre en Martinique lui vaut le record du monde – et de loin –, avec 227,2 nouveaux cas pour 100 000 hommes chaque année. C’est justement la fréquence de cette maladie en Guadeloupe qui avait alerté le professeur Pascal Blanchet, chef du service d’urologie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre, à son arrivée, il y a dix-huit ans. Le cancer de la prostate est deux fois plus fréquent et deux fois plus grave en Guadeloupe et en Martinique qu’en métropole, avec plus de 500 nouveaux cas par an sur chaque île. »
Bien sûr, le combat pour faire reconnaître la responsabilité des auteurs et donc l’obligation d’indemniser constitue un long combat incertain.
L’article de « Libération » du 1er avril 2021 : <Aux Antilles, les vies brisées du chlordécone> explique
« Le procès pourrait pourtant bien se terminer en non-lieu du fait d’une possible prescription des faits. Le 15 mars, Rémy Heitz procureur de la République au tribunal judiciaire de Paris, précisait : «Nous pouvons comprendre l’émoi que cette règle suscite, mais nous, magistrats, devons l’appliquer avec rigueur.». »
Les responsables semblent assez simples à désigner (article du Monde) :
« Le Monde a pu consulter le procès-verbal de synthèse que les enquêteurs de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp) ont rendu, le 27 octobre 2016. Un nom très célèbre aux Antilles, Yves Hayot, revient régulièrement. Il était à l’époque directeur général de Laguarigue, la société qui commercialisait le chlordécone, et président du groupement de producteurs de bananes de Martinique. Entrepreneur martiniquais, il est l’aîné d’une puissante famille béké, à la tête d’un véritable empire aux Antilles – son frère, Bernard Hayot, l’une des plus grosses fortunes de France, est le patron du Groupe Bernard Hayot, spécialisé dans la grande distribution.
[…] Surtout, l’enquête judiciaire révèle que son entreprise, Laguarigue, a reconstitué un stock gigantesque de chlordécone alors que le produit n’était déjà plus homologué. Elle a en effet signé un contrat le 27 août 1990 avec le fabricant, l’entreprise Calliope, à Béziers (Hérault), « pour la fourniture de 1 560 tonnes de Curlone [le nom commercial du chlordécone], alors que la décision de retrait d’homologation [le 1er février 1990] lui a été notifiée », écrivent les enquêteurs. Ils remarquent que cette quantité n’est pas normale, puisqu’elle est estimée à « un tiers du tonnage acheté sur dix ans ». De plus, « au moins un service de l’Etat a été informé de cette « importation » », puisque ces 1 560 tonnes « ont bien été dédouanées à leur arrivée aux Antilles » en 1990 et 1991.»
L’article cite aussi un rapport de l’Institut national de la recherche agronomique, publié en 2010 qui, s’étonne du fait que la France a de nouveau autorisé le pesticide en décembre 1981.
« Comment la commission des toxiques a-t-elle pu ignorer les signaux d’alerte : les données sur les risques publiées dans de nombreux rapports aux Etats-Unis, le classement du chlordécone dans le groupe des cancérigènes potentiels, les données sur l’accumulation de cette molécule dans l’environnement aux Antilles françaises ?, s’interroge-t-il. Ce point est assez énigmatique car le procès-verbal de la commission des toxiques est introuvable. »
Sur ce sujet, il est aussi possible d’écouter l’émission de France Inter « Interception » de 2018 <Chlordécone, le poison des Antilles>
Je pense qu’il nous appartient de connaître cette histoire de politique et de bananes et de comprendre de quoi il en retourne quand un compatriote de Guadeloupe ou de Martinique évoque le chlordécone.
<1630>
-
Vendredi 26 novembre 2021
« La liste de Kersten, un juste parmi les démons »François KersaudyIl me faut quelquefois un peu de temps pour lire les livres qu’on m’offre. Ainsi, il y a plusieurs années, Pablo, m’avait offert le livre de Joseph Kessel : « Les mains du miracle » et c’est pendant notre séjour dans le massif de la chartreuse que j’ai enfin pu lire ce livre incroyable.
Tellement incroyable qu’à plusieurs reprises, je ne l’ai pas cru.
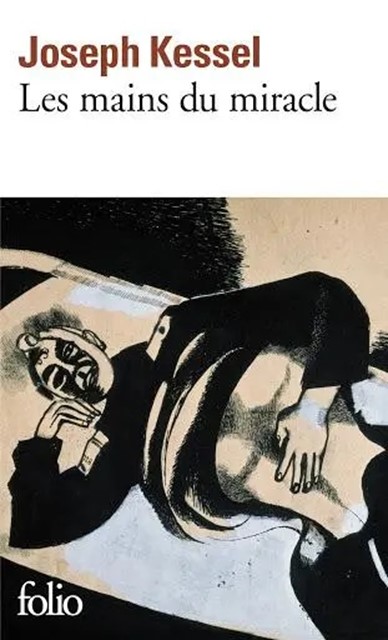 Joseph Kessel raconte en effet l’histoire de Felix Kersten qui fut le médecin ou plus précisément le masseur du Reichsfûhrer SS Heinrich Himmler, cet ignoble criminel qui organisa et mis en œuvre les idées inhumaines et délirantes de Hitler.
Joseph Kessel raconte en effet l’histoire de Felix Kersten qui fut le médecin ou plus précisément le masseur du Reichsfûhrer SS Heinrich Himmler, cet ignoble criminel qui organisa et mis en œuvre les idées inhumaines et délirantes de Hitler.
Ce médecin qui ne faisait pas payer ses soins à Himmler par de l’argent, mais par des services, des contreparties qu’Himmler lui accordait après qu’il l’ait soulagé de ses violentes douleurs d’estomac.
Kessel le rencontra et écrit ce récit : « Les mains du miracle », publié en 1960, sur la base des entretiens qu’il eut avec lui.
Et Kessel essaie de convaincre au début de son livre de la véracité des faits qu’il relate :
« Il arrivait que je refusais d’accepter certains épisodes du récit. Cela ne pouvait pas être vrai. Cela n’était simplement pas possible. Mon doute ne choquait pas, ne surprenait pas Kersten. Il devait avoir l’habitude… Il sortait simplement, avec un demi-sourire, une lettre, un document, un témoignage, une photocopie. Et il fallait bien admettre cela, comme le reste. »
Kessel en appelle même, à H. R. Trevor-Roper, professeur d’histoire contemporaine à l’université d’Oxford et l’un des plus grands experts des services secrets britanniques sur les affaires allemandes pendant la guerre qui écrivit en préface aux Mémoires de Kersten :
« Il n’est point d’homme dont l’aventure semble à première vue aussi peu croyable. Mais il n’est point d’homme, par contre, dont l’aventure ait subi une vérification aussi minutieuse. Elle a été scrutée par des érudits, des juristes et même par des adversaires politiques. Elle a triomphé de toutes les épreuves. »
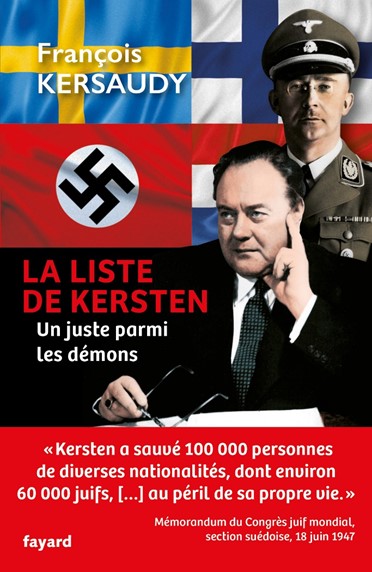 Pourtant, j’avais du mal à croire à ce que je lisais.
Pourtant, j’avais du mal à croire à ce que je lisais.
J’appris cependant que tout récemment, en février 2021, était paru un ouvrage de l’historien François Kersaudy : « La Liste de Kersten »
Au retour des vacances, j’ai donc emprunté cet ouvrage à la Bibliothèque de Lyon, dès que l’un des exemplaires fut disponible, car visiblement cet ouvrage intéressait beaucoup de monde.
Globalement, l’historien, en s’appuyant sur les archives les plus récentes, valide le récit de Kersten et le livre un peu romancé de Kessel.
Quelques points finalement assez mineurs, même s’ils sont surprenants, sont remis en cause.
Le titre que Kersaudy ou son éditeur ont choisi, entre bien sûr en résonance avec « la liste de Schindler », le film de Steven Spielberg, sorti en 1993.
L’historien commence son livre ainsi :
« Tout le monde en France connaît l’histoire d’Oskar Schindler, qui a sauvé un millier de juifs en les soustrayant à l’extermination nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Mais en vérité, Felix Kersten a accompli un exploit plus considérable encore qu’Oskar Schindler. Dès 1947, un mémorandum du Congrès juif mondial établissait que Felix Kersten avait sauvé en Allemagne « 100 000 personnes de diverses nationalités, dont environ 60 000 juifs, […] au péril de sa propre vie ». Encore, à l’issue du récit qui va suivre, de tels chiffres sembleront-t-il passablement sous- évalués… »
L’homme est issu d’une famille allemande installée dans une province estonienne de l’Empire russe, il est devenu finlandais sans vraiment cesser d’être allemand. Par la suite il s’est installé aux Pays-Bas et il est devenu Néerlandais de cœur, avant que la fin de la guerre l’incite à opter pour la nationalité suédoise
Le début de ses études ne furent pas très brillants. Après quelques péripéties il se forma au massage thérapeutique finlandais qui était très reconnu. Il obtint son diplôme à Helsinki et commença à exercer à Berlin.
Homme d’une grande sociabilité il rencontra beaucoup de gens. Un professeur de la faculté de Berlin lui dit un jour : « Venez dîner à la maison, ce soir. Je vous ferais connaître quelqu’un qui vous intéressera
Kersten découvrit ainsi un vieux monsieur Chinois qui se borna à hocher la tête et à sourire sans fin. Le docteur Kô avait grandi dans l’enceinte d’un monastère du Tibet. Il était initié, en particulier, à l’art millénaire et subtil des masseurs.
Le médecin-lama interrogea longuement Kersten avant de l’inviter chez lui. Une fois chez lui, le médecin chinois demanda à être massé par Kersten. Félix Kersten s’appliqua à pétrir le corps léger, jaunâtre, fragile et desséché du vieil homme.
Après cette séance, le docteur Kô remis ses habits, fixa Kersten et lui dit :
« Mon jeune ami, vous ne savez encore rien, absolument rien. Mais vous êtes celui que j’attends depuis trente ans. J’attends depuis l’époque où je n’étais qu’un novice, un homme de l’Occident qui ne saurait rien et à qui je devrais tout enseigner. »
C’était en 1922. Et Kersten suivit avec assiduité l’enseignement du vieux chinois. Quand le docteur Kô estima qu’il en savait assez, il se retira pour aller passer ses dernières années et mourir dans son monastère du Tibet. Et, il offrit gratuitement toute sa clientèle à Kersten qui fit visiblement du très bon travail et parvint à la fidéliser et à l’étendre. Il avait notamment de riches clients qui appréciaient énormément ses soins, en Allemagne mais aussi aux Pays-Bas.
Pendant ce temps, l’Allemagne plongea dans la folie et Hitler arriva au pouvoir avec comme âme damnée Heinrich Himmler chargée des basses œuvres.
C’est un de ses patients, un riche industriel qui le convainquit malgré ses réticences d’aller soigner cet homme ignoble.
Le docteur accepta de se glisser dans ce rôle qui va consister à soigner Himmler de façon journalière pendant toute la période du deuxième conflit mondial. Et, semaine après semaine, mois après mois, en échange des soins prodigués à Himmler, devenus totalement indispensables à ce dernier, Kersten va demander la libération de nombreuses victimes du nazisme.
C’est lorsque Himmler souffrait de douleurs d’estomac d’une intensité paralysante et qu’il se trouvait dépendant des mains de Kersten que ce dernier parvenait à obtenir des contreparties qu’on ne croyait pas pensables.
Au début, ce sont des amis hollandais qui firent appel à lui, puis des suédois, des finlandais : au début quelques individus, puis des dizaines, des centaines et puis des milliers.
Kersaudy valide donc le récit de Kessel. Un des actes fut encore plus incroyables que les autres, en toute fin de guerre. Kersten eut cette idée « disruptive » d’organiser une rencontre entre un représentant du Congrès Juif Mondial et Himmler pour sceller un dernier accord : la libération de 5000 juifs des camps de concentration, alors qu’Hitler avait donné l’ordre de les exterminer tous et de dynamiter les camps, avant l’effondrement. L’accord incluait aussi la non extermination des autres et le non dynamitage des camps.
Pour ce faire, Kersten va organiser cela d’une part avec Himmler et de l’autre le ministre des affaires étrangères de Suède Christian Gunther ainsi que Hillel Storch, le représentant en Suède du Congrès Juif Mondial.
Et ce fut finalement Norbert Masur, citoyen suédois, de confession israélite qui accompagna Kersten à Berlin.
C’est le sujet du chapitre XIII qui est aussi le dernier du livre « Les mains du miracle » qui a pour titre : « Le juif Masur »
Les deux hommes s’envolèrent le 19 avril 1945 sur l’un des derniers avions à porter la croix gammée. Ils étaient les seuls passagers. Et Kessel écrit :
« Dans les environs immédiats de Berlin, on entendait déjà gronder les canons russes. »
Ils débarquèrent sur le terrain de Tempelhof, l’aéroport « crépusculaire et vide » de Berlin. Et après une attente un peu anxieuse, l’heure d’arrivée avait été communiquée en retard à Himmler :
« Enfin, une voiture arriva pour Kersten et Masur. Elle était marquée aux insignes S.S. et appartenait au garage particulier de Himmler. Près de la voiture se tenait un secrétaire en uniforme, qui donna à Kersten deux sauf-conduits au cachet du Reichsführer […]. Il y était spécifié que ces documents libéraient leurs porteurs de toute obligation de passeport et de visa. »
Et la voiture SS emmena les deux hommes comme prévu dans la résidence privée du docteur Kersten.
La rencontre entre le représentant juif et Himmler accompagné de ses plus proches collaborateurs est totalement incroyable et lunaire. Elle se passe le 20 avril 1945.
Kessel écrit :
Kersten et Masur se trouvaient face à face Masur buvait du thé, Himmler, du café. Il n’y avait entre eux que des petits pots de beurre, de miel, de confiture, des assiettes qui portaient des tranches de pain bis et des gâteaux. Mais, en vérité, six millions d’ombres, six millions de squelettes séparaient les deux hommes. Masur n’en perdait pas le sentiment un instant, lui qui, par les organisations auxquelles il appartenait, avait connu et suivi pas à pas le martyre sans égal, sans précédent, des hommes, des femmes, des enfants juifs. À Paris, à Bruxelles, […] en Ukraine et en Crimée partout, de l’océan Polaire jusqu’à la mer Noire, s’étaient déroulées les mêmes étapes du supplice : étoile jaune, mise hors la loi commune, rafles atroces dans la nuit ou le jour levant, convois interminables où voyageaient ensemble les vivants et les cadavres, et les camps, la schlague, la faim, la torture, la chambre à gaz, le four crématoire. Voilà ce que personnifiait et incarnait pour Masur l’homme assis en face de lui, de l’autre côté de la table aimablement garnie, l’homme chétif, aux yeux gris sombre protégés par des verres sur monture d’acier, aux pommettes mongoloïdes, l’homme en grand uniforme de général S.S. et constellé de décorations dont chacune représentait la récompense d’un crime. Mais lui qui avait imposé impitoyablement le port de l’étoile, donné le signal des rafles, payé les délateurs, bourré les trains maudits, gouverné de haut tous les camps de mort, commandé à tous les tourmenteurs et à tous les bourreaux, lui, il était parfaitement à l’aise. Et même il avait bonne conscience. Ayant bu son café, mangé quelques gâteaux, il essuya proprement ses lèvres avec un napperon et passa à la question juive sans embarras aucun. »
Et Himmler fit même un long discours ou il justifiait la politique antisémite du régime nazi et ses aspects positifs. A un moment Norbert Masur ne put en entendre davantage. En se contenant pourtant, il dit simplement :
« Vous ne pouvez pas nier tout de même que, dans ces camps, on a commis des crimes contre les détenus. Oh ! je vous l’accorde : il y a eu parfois des excès, dit gracieusement Himmler, mais… Kersten ne le laissa pas continuer. Il voyait, à l’expression de Masur, qu’il était temps de rompre ce débat inutile et qui prenait un tour dangereux.»
Et Kersten sut remettre au centre de la discussion la libération des juifs et la préservation de ceux qui restaient dans les camps en arrivant à convaincre Himmler qui était très inquiet à l’idée qu’Hitler puisse être mis au courant de cette décision. L’accord fut conclu : les camps ne seraient pas dynamités, les SS ne molesteraient plus les juifs dans les camps et 5000 juifs seraient libérés..
Et Himmler prit congé de Kersten. Kessel raconte :
« Himmler pénétra dans sa voiture, s’assit. Puis il prit la main du docteur, la serra fébrilement et acheva d’une voix étouffée : Kersten, je vous remercie pour tout… Ayez pitié de moi… Je pense à ma pauvre famille. À la clarté du jour naissant, Kersten vit des larmes dans les yeux de l’homme qui avait ordonné sans hésiter plus d’exécutions et de massacres qu’aucun homme dans l’histoire et qui savait si bien s’attendrir sur lui-même. La portière claqua. La voiture fondit dans l’obscurité. »
Vous trouverez des précisions sur ce site <Le dossier Kersten par Jacques Sabille>
Le 28 avril, Hitler mis au courant, démet Himmler qui se mettra à errer sur les routes, espérant négocier avec les alliés, sans succès. Arrêtés par les forces alliées, il parviendra à se suicider en avalant une capsule de cyanure le 23 mai 1945.
Kersaudy conteste cependant certains des points que raconte Kersten et que Kessel a reporté dans « les mains du miracle » : notamment le récit dans lequel le masseur aurait empêché la déportation massive de néerlandais.
Kessel écrit ce que Kersten lui a raconté : Le 1er mars 1941, au mess de l’état-major des SS, Kersten surprend une conversation entre Heydrich et Rauter qui s’entretiennent de la déportation prochaine vers la Pologne de toute la population des Pays-Bas. Kersten va alors plaider inlassablement auprès de Himmler de faire cesser ce projet en utilisant tous les arguments qu’il parvient à mobiliser. Et après plusieurs discussions, il parvient enfin à ses fins : ce projet est écarté ou au moins renvoyé à plus tard.
Kersaudy après avoir fait son travail d’historien écrit :
« L’ensemble de l’affaire, raconté avec toute la verve de Joseph Kessel, constitue l’un des passages les plus émouvants de son livre. Hélas ! Plus d’un lecteur sera cruellement déçu en apprenant que cet épisode est entièrement fictif. […] Kersten l’a exposé en détail dans trois de ses quatre ouvrages. Mais c’est précisément au niveau de ceux-ci – et des déclarations de Kersten aux enquêteurs dans l’après-guerre – que se révèlent les fragilités de l’affaire : trop de versions incompatibles, trop d’impossibilités dans les dates et les lieux cités, trop de documents introuvables, trop de vérités successives, trop de contradictions, trop de témoignages suspects et eux-mêmes contradictoires »
La liste Kersten page 70
 Bref, sur cette partie du récit l’Historien ne confirme pas « les mains du miracle » ni les affirmations de Kersten .
Bref, sur cette partie du récit l’Historien ne confirme pas « les mains du miracle » ni les affirmations de Kersten .
Il y eut un autre épisode étonnant dans la vie de cet homme dont on voudrait qu’elle soit sans tâche. Le comte Bernadotte, diplomate suédois avait organisé matériellement les convois des milliers de juifs libérés des camps grâce à la médiation de Kersten. Il s’en attribua l’ensemble du mérite sans le citer. Mais suite à divers témoignages notamment du ministre des affaires étrangères suédois, il dut bien reconnaître le rôle éminent et dangereux de Kersten, car dans l’entourage de Himmler beaucoup voulait nuire et même tuer le docteur qui avait une trop grande influence sur leur chef.
Cette rivalité avec le comte Bernadotte va conduire Kersten à faire une action peu reluisante pour sa réputation future :
En 1952, il est sur le territoire suédois et demande la nationalité suédoise qui lui est refusé et…
« Sa déception va le pousser à une manœuvre insolite : persuadé que ce sont les anciens obligés de Bernadotte qui ont torpillé sa demande de naturalisation, il fait circuler une lettre censément adressée à Himmler par le comte, en date du 10 mars 1945 : « La présence des juifs est aussi peu souhaitée en Suède qu’en Allemagne. C’est pourquoi je comprends parfaitement votre position sur la question juive. […] Le Medizinalrat Kersten n’a aucun mandat pour négocier la libération des juifs, et il l’a fait à titre privé. […] » Tout cela est évidemment catastrophique, non pour la mémoire du comte , mais pour la réputation de Kersten, car le document est un faux grossier »
La liste Kersten page 354
Les dernières lignes du livre seront les suivantes :
« L’avocat et philosophe juif Gerhard Riegner dira 36 ans plus tard : « Kersten était sans conteste un homme extraordinaire, et le fait qu’il ait eu ce pouvoir d’influencer Himmler a été un présent du Très-Haut ! je ne vois pas comment l’expliquer autrement. »
Et Kersaudy de conclure :
« Une assertion vraisemblable, mais difficilement vérifiable – et qui le restera aussi longtemps que les archives du Seigneur demeureront impénétrables… »
La liste Kersten page 360
Ce bienfaiteur mourut en 1960 à 61 ans.
Et je me pose une question : son savoir de masseur est-il encore actif en Europe ?
<1629>
-
Jeudi 25 novembre 2021
« Pause (il n’y a pas qu’une bonne façon de réfléchir) »Un jour sans mot du jour nouveauAnnie, après la lecture du mot du jour d’hier, m’a rappelé un mot ancien : il avait été publié en 2013 et portait le numéro 202. Je trouve pertinent de le rappeler aujourd’hui.
 Je vais résumer cette histoire et renvoyer vers le mot du jour original, en fin d’article.
Je vais résumer cette histoire et renvoyer vers le mot du jour original, en fin d’article.Un jour Ernest Rutherford, prix Nobel de chimie en 1908, reçut la visite d’un de ses confrères accompagné d’un de ses étudiants ; Ils voulaient faire appel à lui pour un arbitrage entre eux.
En effet, l’étudiant avait donné une réponse à une question du professeur qui lui avait donné 0, alors que l’étudiant prétendait mériter 20.
Le problème posé était le suivant : «Vous disposez d’un baromètre et vous devez mesurer la hauteur d’un immeuble, comment procédez-vous ? »
La réponse attendue était : «A l’aide du baromètre, je mesure la pression atmosphérique en haut de l’immeuble, puis je mesure la pression au niveau du sol. Puis avec un savant calcul je détermine la hauteur de l’immeuble en fonction de la différence de pression.»
L’étudiant avait répondu :
«J’attache le baromètre à une grande corde. Je monte sur le toit de l’immeuble et je laisse descendre le baromètre à l’aide de la corde jusqu’au sol. Arrivé au sol je fais une marque sur la corde puis je remonte la corde et je mesure du baromètre jusqu’à la marque, c’est la hauteur de l’immeuble.»
Le professeur a donné 0, parce qu’il prétendait que ce n’était pas une méthode scientifique. Ce que contestait l’étudiant qui rappelait qu’en outre il trouvait bien le résultat souhaité et qu’il avait utilisé le baromètre, la corde seule ne suffisant pas !
L’impétrant sur une invitation de Rutherford de donner une autre solution, en proposa 10 nouvelles, mais jamais la réponse attendue. Par exemple ces trois solutions :
1) On monte sur l’immeuble, on lâche le baromètre. On chronomètre la durée de la chute, on en déduit la longueur de la chute qui est la hauteur de l’immeuble.
2) On place le baromètre verticalement dehors quand il y a du soleil. On mesure la hauteur du baromètre, la longueur de son ombre et la longueur de l’ombre de l’immeuble. Et avec un simple calcul de proportion, on détermine la hauteur de l’immeuble.
3) Et celle qui est la plus rapide : on frappe à la porte du gardien de l’immeuble et on lui dit : «Monsieur, si vous me donnez la hauteur de votre immeuble je vous donne ce baromètre»
Interloqué, Rutherford demanda alors à l’étudiant : «Mais dites-moi, connaissez-vous la réponse attendue par votre professeur ? »
L’étudiant répondit qu’il la connaissait bien sûr, mais qu’il en avez assez de l’université et de ses professeurs qui prétendait qu’il n’y avait qu’une bonne façon de réfléchir.
Cet étudiant s’appelait Niels Bohr, génie scientifique qui fut lauréat du prix Nobel de physique de 1922.
Le mot du jour original était celui du <5 décembre 2013>
<Mot du jour sans numéro> -
Mercredi 24 novembre 2021
« Comment bien poser un problème mathématique ?»Réponse par un exempleMa chère belle-sœur Josiane qui me félicite pour la diversité des sujets abordés, exprimait sa crainte qu’après avoir simplement vanté la beauté d’une fleur, je me lance dans un sujet hautement intellectuel, conceptuel et abstrait.
Je note que les avis sont très partagés.
Mon ami Bertrand G. trouve que je parle trop de politique, ce qui serait une perte de temps.
Jean-Philippe ne trouve pas d’intérêt à mes sujets musicaux. D’autres lecteurs ont exprimé leur distance avec les sujets « football » que j’avais abordés.
Il est vrai que la plupart des blogs sont « mono-thème ». Ils parlent exclusivement d’art ou de bien être ou de politique ou d’Histoire ou de Sciences ou de sports ou encore d’actualité.
Le mot du jour que j’écris ne se fixe pas ce type de limite.
Il faut simplement que je comprenne un peu de quoi il en retourne, je n’ai jamais évoqué le bitcoin.
Et que j’ai le sentiment d’avoir à dire quelque chose de pertinent ou de surprenant ou de décalé, je n’ai jamais parlé d’homéopathie.
Aujourd’hui, je vais parler de mathématiques, mais pas que …
C’était en classe de mathématiques supérieures au Lycée Kléber de Strasbourg, lors de l’année scolaire 1976/1977, il y a 45 ans donc, et je m’en souviens encore.
C’était M Schmidt qui nous a posé cette question :
« Vous devez organiser un tournoi de tennis. Vous avez 100 participants. Chaque match est à élimination directe : le joueur qui gagne continue le tournoi, celui qui perd est éliminé.
Combien de matchs devez vous organiser pour finir le tournoi et dégager suite à la finale, un vainqueur ? »
Toute la classe qui comptait plusieurs futurs polytechniciens a commencé à raisonner :
- Au premier tour je fais 50 matchs, il 50 qualifiés et 50 éliminés.
- Au second tour j’en fais 25…
- Au troisième tour il y a un joueur qui est exempté et je fais 12 matchs…
- Etc…
Un autre groupe a abordé le sujet autrement. Il est parti de la finale (2 joueurs), puis de la demi-finale (4 joueurs), puis les quarts de finales (8 joueurs) et on arrive ainsi au 32ème finale avec 64 joueurs. Et il faut alors trouver le moyen de passer de 100 joueurs à 64 joueurs dans un premier tour dont on exempte les meilleurs…
Et pendant que nous cherchions à élaborer des raisonnements savants pour essayer de répondre à cette question, Monsieur Schmidt hilare se moquait de nous en nous disant :
« Alors vous êtes en math. Sup. et vous avez besoin de plus de 2 secondes pour répondre à une question aussi simple ? »
Mais oui, c’était une question d’une simplicité absolue.
Mais il fallait se poser la bonne question.
Il faut toujours bien poser les questions, même si parfois on n’a pas la réponse.
La question est plus importante que la réponse.
Nous vivons au quotidien au milieu de gens qui ont la certitude de posséder les bonnes réponses, alors qu’ils n’ont pas réfléchi aux bonnes questions à se poser.
Ces personnes sont très dangereuses.
Peut être qu’Einstein pensait à eux quand il disait : « Si vous avez un marteau dans le cerveau, tout problème prendra la forme d’un clou ! ».
Alors quelle est la bonne question pour ce tournoi ?
Vous avez 100 joueurs. Le tournoi consiste à obtenir 1 vainqueur et donc à éliminer 99 joueurs.
La question qu’il faut poser est : Combien de matchs sont nécessaires pour éliminer 99 joueurs ?
Un enfant de 6 ans sait répondre à cette question.
Avec le principe du match à élimination directe, il faut évidemment 99 matchs pour éliminer 99 joueurs et désigner un vainqueur.
M Schmidt était un grand pédagogue : 45 ans après je m’en souviens encore.
Notez que les raisonnements compliqués fonctionnent aussi.
Si on reprend le premier raisonnement, grâce à ce petit tableau on sait répondre à la question :
Nombre de joueurs avant le tour
Nombre de matchs
Nombre de qualifiés
Joueur exempté
1er tour 100
50
50
2ème tour 50
25
25
3ème tour 25
12
12
1
4ème tour 13
6
6
1
5ème tour 7
3
3
1
1/2 finale 4
2
2
Finale 2
1
1
Total des matchs 99
Le second raisonnement fonctionne aussi :
Il faut donc qu’au premier tour on puisse passer de 100 joueurs à 64
Pour ce faire, il faut en éliminer 36
On fait donc un premier tour de 36 matchs
Et le tableau devient celui-ci
Nombre de joueurs avant le tour
Nombre de matchs
Nombre de qualifiés
Joueurs exempté
1er tour 100
36
36
28
1/32 finale 64
32
32
1/16 finale 32
16
16
1/8 finale 16
8
8
1/4 finale 8
4
4
1/2 finale 4
2
2
Finale 2
1
1
Total des matchs 99
La morale de cette histoire devient alors : on peut arriver au même résultat en prenant des chemins différents, plus ou moins longs…
<1628>
- Au premier tour je fais 50 matchs, il 50 qualifiés et 50 éliminés.
-
Mardi 23 novembre 2021
« Le Sabot de Vénus. »Une fleurIl existe tant de domaines dans lesquels je suis totalement ignorant. La botanique en fait partie.
Toutefois il reste toujours possible d’être capté par la beauté, par l’insolite, par l’intelligence de la nature.
 C’est probablement un algorithme qui dans les méandres de ses raisonnements obscurs, m’a envoyé dans un flux d’actualité un titre parlant du « sabot de vénus ».
C’est probablement un algorithme qui dans les méandres de ses raisonnements obscurs, m’a envoyé dans un flux d’actualité un titre parlant du « sabot de vénus ».
J’ignorais totalement de quoi il s’agissait.
Associé la déesse raffinée et sophistiquée de l’amour : « Vénus » et un sabot que « le Petit Robert » définit comme « une Chaussure paysanne faite généralement d’une seule pièce de bois évidée » me semblait constituer toute l’apparence de l’oxymore.
J’ai été intrigué et j’ai cliqué pour connaître la source de cette information qui m’avait été envoyée.
C’est ainsi que j’ai découvert l’Association : « Humanité et bio diversité »
C’est une association de protection de la nature et de la biodiversité qui a été créée en 1976.
Hubert Reeves était son président jusqu’en 2015, depuis il est président d’honneur.
Il avait succédé, en 2000, à Théodore Monod, au décès de ce dernier.
 Aujourd’hui, elle est présidée par Bernard Chevassus-au-Louis qui est un biologiste et écologue français, normalien, élève de la Rue d’Ulm et qui a été directeur de recherche à l‘INRA.
Aujourd’hui, elle est présidée par Bernard Chevassus-au-Louis qui est un biologiste et écologue français, normalien, élève de la Rue d’Ulm et qui a été directeur de recherche à l‘INRA.
Cette association est donc très sérieuse, et elle a un site : < https://www.humanite-biodiversite.fr/ >
Le message renvoyait vers <cette page du site> qui présente le sabot de Vénus.
J’ai appris ainsi que le sabot de Vénus était une fleur et plus précisément une orchidée.
Grâce à <Wikipedia> j »ai compris que les Orchidées ou Orchidacées (Orchidaceae), forment une grande famille de plantes comptant plus de 25 000 espèces et que la majorité des espèces se rencontrent dans les régions tropicales.
L’étymologie est un peu coquine et peut avoir quelques proximités avec Vénus. Car le nom provient de Orchis, qui est un mot latin dérivé du grec ancien órkhis.
Ce mot grec désigne un « testicule ». Wikipedia justifie cette filiation :
« En référence à la forme des tubercules souterrains de certaines orchidées terrestres des régions tempérées, lorsque ces tubercules sont jumelés. »
Le site < https://www.humanite-biodiversite.fr/ > donna la légende grecque qui lui vaut son nom
« La déesse Vénus découverte par un berger, s’enfuit en abandonnant un de ses sabots. Le berger voulût le ramasser mais le sabot disparût et à sa place poussa une orchidée : notre Sabot de Vénus. »
Selon les grecs on pouvait donc être déesse et porter des sabots.
 Mais son nom provient probablement plus de l’observation de la fleur car :
Mais son nom provient probablement plus de l’observation de la fleur car :
« Ses fleurs ont la forme d’un petit sabot d’où elle tire son nom populaire. C’est en fait un « piège d’amour » dans lequel tombent les insectes (souvent une abeille sauvage du genre Andrena), d’où ils repartent couverts de pollen, avant d’aller visiter d’autres fleurs qui seront ainsi pollinisées. On l’appelle aussi Sabot de la Vierge ou Soulier de Notre-Dame. »
C’est aussi une plante rare qui est protégée au niveau national
« C’est une plante protégée au niveau français, mais aussi européen au titre de la Directive Natura 2000 et au niveau mondial au titre de la convention de Berne. Si vous la croisez dans la nature, prenez-la en photo mais ne la cueillez surtout pas, vous seriez en infraction. »
 Elle est dans l’air du temps, elle n’a pas de genre ou plutôt elle est « en même temps » :
Elle est dans l’air du temps, elle n’a pas de genre ou plutôt elle est « en même temps » :
« Le Sabot de Vénus développe des fleurs hermaphrodites (à la fois mâle et femelle). Chaque fleur possède trois pétales et trois sépales. Les sépales, longs de 5 cm sont de forme lancéolée. Leur couleur varie entre brun rouge et brun chocolat. Généralement, cette espèce ne produit qu’une à deux fleurs par individu, très rarement trois. »
Elle est une des preuves que dans la nature la coopération est essentielle. Elle a besoin d’un champignon
« C’est une plante qui est très liée aux champignons ! Ainsi, les racines de la plante doivent s’associer avec les filaments d’un champignon permettant à l’orchidée de prélever l’eau et les sels minéraux dans le sol. Pour germer, les graines elles doivent être infectées par un autre champignon microscopique. »
Dans beaucoup de civilisations elle est considérée comme une plante médicinale :
« Le Sabot de Vénus fait également partie de la pharmacopée des indiens d’Amérique du Nord comme sédatif des états nerveux, de l’anxiété et du stress. Cette superbe orchidée soulagerait des troubles de l’insomnie et des dépressions, calme les tensions nerveuses et soulage des douleurs de la menstruation. En Europe, elle a surtout été utilisée comme plante hypnotique et sédative, d’où son nom anglais de Lady’s slipper. »
L’espèce fleurit de mai à juillet
Elle se trouve dans la nature en France, surtout dans les Alpes, plus rarement dans le Jura, la Côte d’Or, les Pyrénées et le Massif Central et presque dans tous les autres pays d’Europe et aussi en Amérique du Nord et en Asie.
Pour celles et ceux qui voudraient en planter dans leur jardin ou sur leur balcon, ce site <Le sabot de Vénus, une orchidée à la beauté raffinée> se veut très rassurant : « Nul besoin d’être « expert » pour cultiver le sabot de Vénus qui est, à de multiples égards, l’orchidée du débutant. »
Et j’ai trouvé cette belle vidéo dans laquelle une professionnelle nous dit : <Tout ce qu’il faut savoir sur les sabots de vénus>. C’est à la fois beau et instructif.

Voilà, c’était un sujet nouveau de mot du jour.
Je ne suis pas devenu un spécialiste des sabots de vénus, mais j’ai appris de petites choses et je les ai partagées.
C’est ainsi que fonctionne le mot du jour.
Et puis après Beethoven et Maria Joao Pires, je ne me sentais pas en capacité de parler de sujets plus difficiles et parfois un peu déprimants.
<1627>
-
Lundi 22 novembre 2021
« Si on est connecté à quelque chose de vrai, comme la musique, l’art, la science, la philosophie, le paysage, la nature, alors nous sommes nous-mêmes. »Maria Joao PiresLe 25 février 2021, j’écrivais un mot du jour assez désabusé : « Avant nous allions à l’Auditorium de Lyon »
Heureusement que nous pouvons désormais y retourner.
 Et samedi, il s’est passé un moment rare, un moment d’éternité : un concert de Maria Joao Pires.
Et samedi, il s’est passé un moment rare, un moment d’éternité : un concert de Maria Joao Pires.
Le chroniqueur culturel lyonnais Luc Hernandez a commenté : « Maria Joao Pires donne un récital en état de grâce »
Et sur Twitter le même écrit :
« On était au concert de la divine Maria Joao Pires hier soir et on ne s’en est pas encore tout à fait remis… Compte-rendu en apesanteur. »
Le concert a commencé par la <13ème sonate de Schubert>. Dans la série que j’avais consacré à Schubert j’avais déjà témoigné de la relation si étroite que Maria Joao Pires entretenait avec Schubert.
Elle avait confié, en avril 2021, à Laure Mézan, à l’occasion de son récital au Festival de Pâques d’Aix-en-Provence.
« C’est un compagnon de toujours, je m’identifie beaucoup à lui, il y a une facilité de compréhension de son expression (…) une grande acceptation de la souffrance humaine qui le mène à une légèreté, une simplicité chantante et dansante ».
Après, il y eut la suite Bergamasque de Debussy dans laquelle se trouve <clair de lune>, pièce pour laquelle Luc Hernandez écrit :
<un Clair de lune si poétique qu’on croirait l’entendre pour la première fois>
Et puis il y eut la seconde partie.
C’était l’ultime sonate de piano de Beethoven la N°32 opus 111. C’était avec elle que j’avais terminé ma série de mots du jour sur Beethoven : <une fraternité universelle>.
Je rappelais ce qu’avait dit Romain Rolland :
« Beethoven a su atteindre « le sourire de Bouddha » dans l’Opus 111. »
J’expliquais que je pensais que ce jugement s’appliquait surtout au second mouvement pour lequel de manière factuelle nous sommes en présence de variations. Mais du point de vue du mélomane et de l’humain, nous sommes en présence d’une immense méditation qui passe par toutes les diversités et richesses des sentiments et l’exploration intime bouleversante de notre humanité.
Et je citais Alfred Brendel :
« L’opus 111 est à la fois une confession qui vient clore les sonates et un prélude au silence. »
Car il s’agit bien de silence, le silence qui constitue l’aboutissement de l’œuvre mais aussi le silence intérieur sans lequel cette œuvre ultime ne peut pas être pleinement accueilli.
En 2016, dans un article du quotidien canadien <Le DEVOIR> Maria-Joao Pires disait qu’il fallait avoir conscience de son corps et porter l’attention à sa respiration. Elle ajoutait
« Les gens passent leur vie à être en dehors d’eux-mêmes, en dehors de leur corps. Ils ne sont pas présents. Leurs pensées sont ailleurs »
Son interprétation fut un moment de grâce.
Mais nos mots sont si pauvres pour exprimer l’ineffable.
Alors je reviendrai aux mots utilisés par cette artiste exceptionnelle.
Elle est née il y a 77 ans à Lisbonne et a commencé très tôt le piano.
Mais elle a attendu très longtemps avant d’oser interpréter cette sonate. Elle a parlé de « sa relation » avec cette sonate avec Alain Lompech sur le site <Pianiste> en février 2021
« D’ailleurs, j’ai travaillé très tard l’opus 111 dans ma vie. Je la connaissais bien sûr depuis longtemps, mais c’était un rêve, c’était un grand plan de la travailler un jour. J’avais un de mes professeurs, quand j’étais toute jeune, au Portugal avant de partir pour l’Allemagne… C’était mon professeur de composition, une personne que j’adorais vraiment, elle était authentique, honnête, avait un caractère vrai et cherchait toujours une vérité dans les choses. Elle m’écoutait jouer, mais ne me donnait pas de cours de piano. Quand j’avais 16 ans, je lui ai dit que je voulais travailler l’Opus 111, j’avais déjà joué pas mal de sonates de Beethoven, une dizaine, et elle m’a dit qu’elle me le déconseillait, qu’il fallait que j’attende, que je n’étais pas prête à la comprendre vraiment. Elle ne m’aurait pas empêchée de la jouer, mais je ne l’ai même pas déchiffrée… […] Puis j’ai eu 50 ans ; c’était le moment de m’y mettre, mais je ne voulais pas le faire comme ça entre deux choses, il me fallait le temps, l’espace pour me poser. En fait, les années ont passé, passé et quand j’ai eu 70 ans, je me suis dit que c’était maintenant ou jamais. Ça a été un vrai événement dans ma vie. Il y a certaines œuvres qu’on connaît très bien mais qu’on n’a jamais jouées et quand on passe à l’acte, c’est l’impact physique qui surprend et fait chaque fois comprendre la différence entre jouer et écouter, même s’il y a une écoute vivante qui peut être très proche de cette sensation. Certaines personnes sont capables d’écouter vraiment, de ressentir physiquement la musique. Quand j’ai joué, c’est un impact très fort tant cette œuvre était attendue, attendue… ça a été comme une révélation à un âge avancé. »
La maturité, l’intériorité lui permettent de créer une relation d’une grande intensité avec le public. Elle dit dans l’article précité du « Pianiste » :
« Quand je suis sur scène, je sens une… je cherche le mot… empathie, c’est ça, une empathie du public pour moi et de moi pour lui, comme s’ils étaient des amis. J’ai cette affection spontanée et naturelle pour lui. »
Beaucoup de pianistes courent après les concours et les prix pour se faire connaître et atteindre la notoriété. Dans <ce journal Belge> elle affirme son opposition de fond aux concours :
« Je suis probablement la personne la plus anti-concours qui soit car l’art est aux antipodes de la compétition. Là où il y a compétition, il n’y a pas d’art ; là où il y a art, il n’y a pas de compétition. J’aide les élèves qui veulent s’y préparer – chacun doit faire son expérience et parvenir à son but par le moyen qu’il choisit – mais je leur dis toujours que si j’étais eux, je n’irais pas. Je leur dis : « Ça va vous faire du mal ». »
Et dans ce même article elle finit, philosophe :
« Avoir confiance en notre destin. Avoir confiance en la vie, c’est être humble, voir ce qui est beau, ce qui est bien, ce qu’on aime faire et si quelqu’un a besoin de nous. Et laisser les choses arriver sans croire que nous pouvons décider de tout.
[…] Bien sûr. La question est de savoir à quoi on est connecté : aux bonnes ou aux moins bonnes choses ? Si on est connecté à quelque chose de vrai, comme la musique, l’art, la science, la philosophie, le paysage, la nature, alors nous sommes nous-mêmes. ».
On trouve sur Internet <cette vidéo de 2016> dans laquelle Maria Joao Pires joue l’arietta de l’opus 111..
<1626>
-
Vendredi 19 novembre 2021
« Les PFAS : produits chimiques éternels. »Substances per- et polyfluoroalkyléesNous avons parlé hier des livraisons de plus en plus rapides. Homo sapiens a ce goût de la vitesse, aller toujours plus vite et surtout plus vite que l’autre.
C’est une enquête du quotidien sportif « L’Equipe », publié le 10 novembre qui nous donne l’information <Peur sur la glisse> :
« C’est un scandale sanitaire qui touche plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Depuis la fin des années 1980, un produit appelé « fluor » a rendu accros les skieurs de fond. Il aide à glisser et fait gagner de précieuses secondes à qui badigeonne ses skis avec. Loin des pistes, les chimistes connaissent mieux ce « fluor » sous le nom de « substances perfluorées », ou sous le sigle « PFAS ». Ces mêmes chimistes savent aussi que c’est un poison dit « éternel » qui contamine durablement l’être humain, l’environnement et l’ensemble des vivants.
Plusieurs utilisateurs français, dont d’anciens membres des équipes de France de ski, ont accepté de témoigner et disent être gravement touchés par le fluor. Des médecins et toxicologues estiment que l’ensemble des personnes ayant farté en employant cette substance, ou fréquenté des ateliers de préparations de ski sans protections importantes, ont mis leur intégrité physique en danger. « L’Équipe » a enquêté sur ce produit « miracle », dont l’usage longtemps incontrôlé a pu causer de graves dommages sur la santé et l’environnement. »
Mais il faut être abonné pour pouvoir lire la totalité de l’enquête
Claude Askolovitch dans sa revue de Presse du <11 novembre> en donne ce résumé :
« On parle d’un poison…
Qui comme souvent les poisons a pris l’apparence d’un grand bonheur, ici celui de glisser sur la neige dans une fluidité, une rapidité jamais éprouvée. Mais le prix de ce bonheur aura été la santé et parfois la vie de passionnés de ski de fond, un sport lové dans la nature, que la chimie a perverti… Sur son site, dans une enquête impressionnante où l’image, le son le texte se complètent, l’Equipe raconte le scandale du fartage… Ce geste rituel qui consiste à lubrifier ses skis, a changé de nature dans les années 80, quand arrivent des produits de la grande industrie chimique… Les PFAS, les substances perfluorées, des poudres au fluor qui repoussent l’eau, et libèrent les skis de l’attraction neigeuse… Et qui deviennent alors, chez les champions leurs préparateurs, chez les amateurs passionnés, un enchantement, une addiction…
Pour mieux glisser et faire glisser les autres, on devient alchimiste, on s’enferme dans des ateliers aux fenêtres et volets clos pour ne pas se faire voler ses secrets ses dosages, et là, avec des fers à souder, on porte le produit à incandescence, car il faut, dit-on, pour que le fartage soit efficace, que la poudre cristallise et que volent devant vous des petites étoiles… On voit les étoiles, on farte, on glisse, mais on ressort des ateliers surchauffés dans un état second, comme ivre, drogués, titubants… Et vous lisez dans l’Equipe, des toux, des poumons qui s’étiolent, des fièvres qui prennent, la mort d’un maitre italien de la glisse, l’AVC d’un entraineur français au sortir d’une séance de fartage où il avait dit, « on va en crever. ».. En quelques années le ski de fonds réalise qu’il s’est donné à une substance maléfique que la chaleur rend létale, qui se dépose et imprègne la peau, le sang de hommes, et la nature aussi, et qui a déjà provoqué autour de ses usines scandales et procès.
Il faudrait farter ses skis protégé par des gants, des masques, il faudrait ne plus farter au fluor, mais si on l’interdit, il y aura des tricheurs, un dopage fluoré au mépris du danger, tant la glisse fut bonne et les médailles belles, lis-je, sur le site de l’Equipe : ainsi le poison prend aussi les âmes… »
Ces produits ne posent pas que des soucis à toutes celles et ceux qui les ont manipulés pour farter les skis, mais plus généralement à la santé et à l’environnement, parce qu’on avait trouvé efficient d’en mettre partout.
<ECHA> qui est une agence de l’Union européenne dans la chimie explique que les substances perfluoroalkylées (PFAS) forment une grande famille de plusieurs milliers de produits chimiques synthétiques qui sont couramment utilisés dans l’ensemble de la société et que l’on retrouve dans l’environnement :
« Elles contiennent toutes des liaisons carbone-fluor, qui comptent parmi les liaisons chimiques les plus fortes de la chimie organique. Cela signifie qu’elles ne se dégradent pas après utilisation ou rejet dans l’environnement. La plupart des PFAS sont également facilement transportées dans l’environnement sur de longues distances, loin de leur source d’émission.
On a fréquemment observé une contamination des eaux souterraines, des eaux de surface et du sol par les PFAS. Le nettoyage des sites pollués est techniquement difficile et coûteux. Si elles continuent à être rejetées, elles ne cesseront de s’accumuler dans l’environnement, dans l’eau potable et dans les aliments. »
<Ce site> explique en outre que la famille des PFAS est constituée de plus de 4700 molécules chimiques artificielles produites depuis les années 40. Leurs propriétés physico-chimiques de résistance aux fortes chaleurs, aux acides, à l’eau et aux graisses expliquent leur présence dans de nombreuses applications industrielles et dans une multitude de produits de consommation.
« A titre d’exemples, les PFAS sont utilisés dans les emballages en papier et en carton pour un usage alimentaire, dans les ustensiles de cuisines (notamment pour tout le matériel anti-adhésif), dans les textiles (vêtements d’extérieur, tissus d’ameublement), dans certains pesticides et médicaments, dans les mousses anti-incendie, dans les imperméabilisants, les isolants de fils électriques, les vernis, les peintures et même dans certains cosmétiques.
Extrêmement persistantes dans notre environnement et dans notre corps, ces molécules sont connues sous le nom de « produits chimiques éternels ». S’accumulant au fil du temps dans l’environnement et chez l’être humain, ces substances pourraient avoir de potentiels impacts sur la santé. L’exposition à ces contaminants peut se produire de différentes manières (métiers à risques, contacts avec la peau, inhalation) mais aussi via la consommation d’aliments à risque : l’eau potable, le poisson, les fruits, les œufs ou les produits transformés à base d’œuf, aliments en contact avec emballages en contenant ou cuisinés avec des ustensiles en contenant. »
<La mission pour la Science et la Technologie> de l’Ambassade de France Aux États-Unis montrent qu’aux États-Unis ces produits chimiques sont très présents dans les eaux potables et inquiètent les américains alors que les normes américaines sont beaucoup plus laxistes que les normes européennes.
Un article du Figaro du 18 octobre 2021 rapporte que L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a décidé de mener une action vigoureuse pour limiter l’utilisation de ces substances. Le chef de cette agence, Michael Regan a déclaré :
«Depuis bien trop longtemps, les familles américaines — notamment dans les quartiers défavorisés — ont souffert des PFAS dans leur eau, leur air ou les terrains sur lesquels jouent leurs enfants […] Cette stratégie nationale complète sur les PFAS va protéger les personnes qui en souffrent, en prenant des mesures concrètes et courageuses s’attaquant au cycle de vie complet de ces substances chimiques.»
Et « National Geographic » nous apprend que les emballages de fast-food aussi en sont des grands utilisateurs : < Les PFAS, ces substances nocives omniprésentes dans nos emballages alimentaires >
Il semble que certains fabricants comme 3M cité par Wikipedia ont renoncé à utiliser ces substances.
Mais vu le nombre important d’articles récents sur ce sujet, il semble bien que la prise de conscience du danger soit assez récente.
<1625>
-
Jeudi 18 novembre 2021
« La COP26 est terminée. Voici un bref résumé : Bla, bla, bla »Greta ThunbergLa Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques ou COP26 [pour la conférence des parties] a commencé le 1er novembre et s’est terminée le 13 novembre 2021..
La reine Elizabeth II, 95 ans, une santé fragile, n’a pas pu s’y rendre alors qu’elle était la cheffe d’État de la puissance invitante. Elle a pourtant essayé d’exhorter, dans un message vidéo, les dirigeants mondiaux à « résoudre les problèmes les plus insurmontables ».
Elle souhaitait que cette conférence soit
« l’une de ces rares occasions où chacun aura la possibilité de s’élever au-dessus de la politique du moment et de faire preuve d’un véritable sens politique […]
L’histoire a montré que lorsque les nations s’unissent pour une cause commune, l’espoir est toujours permis […] Nombreux sont ceux qui espèrent que l’héritage de ce sommet – inscrit dans les livres d’histoire qui ne sont pas encore imprimés – vous décrira comme les dirigeants qui n’ont pas laissé passer l’occasion, et qui ont répondu à l’appel des générations futures […] Aucun de nous ne vivra éternellement mais ce combat contre le réchauffement climatique n’est pas pour nous-même, mais pour nos enfants, les enfants de nos enfants et ceux qui suivront leurs pas ».
Il semble que les espérances soient déçues.
Je rappelle que la conférence de Paris qui avait soulevé beaucoup d’espoir a eu lieu en 2015, c’était la COP21.
Si on lit les journaux, ils laissent assez peu de place au doute.
Les Echos essayent de pratiquer le « en même temps » : « COP26 : les promesses et les impasses du Pacte de Glasgow »
Mais le journal anglais the Independant repris par Courrier international est beaucoup plus catégorique : « La COP26, un fiasco provoqué par la torpeur des dirigeants politiques »
TELERAMA tente l’ironie : « Climat : la COP26, le plein d’espoirs… douchés »
Et le journal de l’écologie REPORTERRE énonce un jugement sans appel : « COP26 : le gâchis et la déception d’un accord minimal »
Ce que Greta Thunberg a résumé par cette phrase : « La COP26 est terminée. Voici un bref résumé : Bla, bla, bla. »
Vous n’aimez peut-être pas Greta Thunberg, son activisme, sa manière de s’exprimer etc…
Mais les personnes que nous n’aimons pas, peuvent dire des choses intelligentes.
Peut-être préférez vous Jean-Marc Jancovici qui a partagé ces dessins :
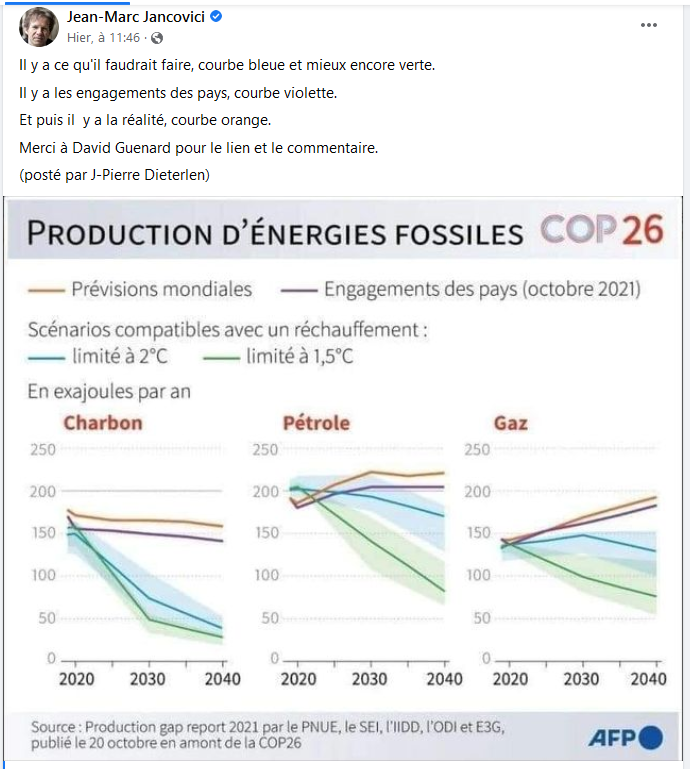
Depuis la COP21, les gaz à effet de serre n’ont pas diminué dans l’atmosphère, ils ont augmenté.
L’Organisation des Nations unies (ONU) a émis, lundi 25 octobre, un nouveau bulletin alarmant :
« les concentrations de gaz à effet de serre ont encore atteint des records en 2020, et l’Amazonie perd de sa capacité à absorber le CO2 »
Le Monde écrit :
« Les trois principaux gaz à effet de serre – CO2, méthane (CH4) et protoxyde d’azote (N2O) –, ont atteint des sommets en 2020. Le taux d’augmentation annuelle de concentrations de chacun de ces gaz a même dépassé la moyenne de la période 2011-2020. Le ralentissement de l’économie imposé par la pandémie de Covid-19 « n’a pas eu d’incidence perceptible » sur le niveau et la progression des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, malgré un recul temporaire des nouvelles émissions ».
De sorte que l’Organisation météorologique mondiale (OMM), prédit que si on continue sur cette lancée on risque d’atteindre une augmentation de températures de 4° au lieu de l’objectif des 1,5.
Jancovici explique très justement, qu’il ne faut pas se tromper de repère. Une augmentation moyenne de la température de 2° n’a rien à voir avec la sensation que nous avons quand la température extérieure passe de 12° à 14°. Pour comprendre, il est plus juste de le comparer à la température de notre corps qui passerait de 37° à 39°. Les conséquences en sont autrement plus impactant.
Pendant ce temps, il se passe des choses dans le Monde.
Claude Askolovitch, le 16 novembre, dans sa revue de Presse nous apprend :
« On parle d’une brebis…
Qui sans le savoir nous dit notre futur alors qu’elle pâture paisiblement à la ferme du Mourier à Saint-Priest-Ligoure dans la Haute-Vienne, elle porte au cou un collier nanti d’un boitier sombre, et alors qu’elle marche sans penser à mal, le collier émet une musique, et comme elle avance encore, il lance un autre son, et puis encore un autre, et puis lui envoie une décharge électrique, est-ce suffisant pour qu’elle reste en place, pauvrette… Et ainsi, le Populaire du Centre nous raconte comment la science réinventent la pâture, dans des paysages dépourvus de clôtures physiques, mais dont les parcelles sont pourtant délimitées par des clôtures virtuelles que contrôle un smartphone, et nos brebis, géo localisées, reçoivent donc de la musique et puis un choc électrique si elles font mine de dépasser la clôture virtuelle qu’elle ne peuvent pas voir… Notez que si même la décharge électrique ne calme pas la brebis, son propriétaire reçoit un sms pour l’avertir que sa bête s’est échappée…
Nous sommes donc demain. Je lis dans le Figaro que Monsieur Elon Musk veut m’amener l’internet à très haut débit dans l’avion. Je lis dans les Echos que pour les jeux de 2024, Paris et la RATP rêvent de taxis volants… Je lis dans Ouest-France que André-Joseph Bouglione et son épouse Sandrine montent un spectacle de cirque 100% humain, où les animaux seront des hologrammes…
Je lis dans Libération que dans nos villes des start-ups se font fort de nous livrer en dix minutes sur notre pas de porte, le dentifrice les sex-toys les couches de bébé, la bouteille de vin, les pâtes, que sais je qui manquent urgemment… Ainsi se soutient la consommation, par des livreurs fonçant dans Paris à vélo, leurs patrons disent qu’ils les traitent bien, on leur fournit même parfois le téléphone portable -ça permet au passage de surveiller sa brebis.. »
Le même jour, Guillaume Erner, dans son humeur du matin approfondissait ce sujet de la «livraison express ».
« Voilà une promesse qui m’a laissé songeur – avoir envie de se faire livrer ses courses en moins de 15 minutes – je ne vois pas bien comment c’est possible.
Et, pourtant, c’est ce que promettent désormais de nombreuses entreprises, si j’en crois les publicités visibles un peu partout à Paris, puisqu’à la campagne, une telle promesse n’existe pas, enfin pas encore.
Je ne vois pas comment, en 15 minutes, une personne peut à la fois remplir un caddy pour vous et, surtout, vous livrer vos courses en pédalant comme un dératé. Or, Libération consacre un dossier à cette nouvelle tendance, y compris une forme de test intitulé « Quick ou couac », et Libé de tester la possibilité réelle ou non de se faire livrer des courses, un apéro, un trou normand, bref ce que vous voudrez dans le délai imparti.
« Or, cette promesse, comme disent les publicitaires, se faire livrer ses courses en 15 minutes, je la trouve plus que problématique. Car qui a besoin de ses courses en 15 minutes ? C’est finalement cela la ville du quart d’heure, une ville qui met la pression sur des personnes qui, elles, doivent tenir la promesse du quart d’heure. En réalité, on doit être capable de patienter un peu pour la livraison du lait, et si vous voulez une livraison immédiate de lait peut-être pouvez-vous – truc de dingue – allez-vous la chercher vous-même.
[…] ce qui paraît problématique, c’est de proposer un service dont personne n’a réellement besoin – tout le monde peut patienter plus de 15 minutes – mais si vous construisez cela en norme, alors bientôt, tout devra se faire en un quart d’heure, et en un quart d’heure nous deviendrons dingues. C’est ce que le sociologue Daniel Bell appelait les contradictions culturelles du capitalisme, comme imaginer une société où l’on veut la quiétude pour soi et le chaos pour les autres. »
Peut-être ces 3 faits : l’échec de la Cop26, les nouvelles idées technologiques pour organiser le monde et la réduction du délai de livraison n’ont aucun rapport.
Ou peut-être que si….
On annonce aussi le Black Friday pour le 26 novembre. Et cette fois, pas d’interrogation : cette orgie de consommation compulsive est exactement le contraire de ce qu’il faudrait faire pour lutter contre le dérèglement climatique. France Info explique que <cette opération commerciale est lourde de conséquences pour la planète.>.
On en revient alors toujours à cette formule, d’un temps ancien, écrit par Bossuet : «Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes.»
<1624>
-
Mercredi 17 novembre 2021
« Silence »Poème d’Albert SamainOn ne sort pas de ce cheminement, le long de la route de Lhasa, au bout de l’émotion, sans être troublé et profondément marqué.
Passer immédiatement à un autre sujet est difficile.
Il faut probablement franchir une étape qui s’apparente à un sas de décompression.
Alors je me suis souvenu d’avoir entamé cette nouvelle saison en évoquant le silence des moines du couvent de la chartreuse.
 Le silence !
Le silence !
Le silence ne se limite pas à se taire.
Deux êtres humains, assis côte à côte, absorbés par leur smartphone, se taisent, mais ne sont pas dans le silence.
Pour être dans le silence, il faut d’abord être présent, simplement être là.
Et puis, il faut être ouvert à la beauté, à l’univers dans lequel nous sommes un petit corps vivant, à l’autre, à sa joie, sa douleur, son émotion, ses questionnements.
Le silence est accueil.
En butinant sur la toile, j’ai accueilli ce poème d’Albert Samain : « Silence »
Je me souviens d’avoir appris, à l’école primaire, certaines de ses poésies.
Il vivait au XIXème siècle.
Il n’a pas connu la première année du XXème siècle puisqu’il est mort en 1900, à l’âge de 42 ans.
C’est la tuberculose qui était très meurtrière dans ce temps-là, qui l’a emporté.
Son poème parle de silence, certes pas du silence des moines. Un silence davantage tourné vers l’humain que vers le divin :
Le silence descend en nous,
Tes yeux mi-voilés sont plus doux ;
Laisse mon cœur sur tes genoux.Sous ta chevelure épandue
De ta robe un peu descendue
Sort une blanche épaule nue.La parole a des notes d’or ;
Le silence est plus doux encor,
Quand les cœurs sont pleins jusqu’au bord.Il est des soirs d’amour subtil,
Des soirs où l’âme, semble-t-il,
Ne tient qu’à peine par un fil…Il est des heures d’agonie
Où l’on rêve la mort bénie
Au long d’une étreinte infinie.La lampe douce se consume ;
L’âme des roses nous parfume.
Le Temps bat sa petite enclume.Oh ! s’en aller sans nul retour,
Oh ! s’en aller avant le jour,
Les mains toutes pleines d’amour !Oh ! s’en aller sans violence,
S’évanouir sans qu’on y pense
D’une suprême défaillance…Silence !… Silence !… Silence !…
Albert Samain.
Recueil : Au jardin de l’infante (1893).<1623>
-
Mardi 16 novembre 2021
« Lhasa de Sela »Publication de la page consacrée à la sérieLhasa de Sela a vécu ses premières années, avec ses parents et ses frères et sœurs, dans un bus scolaire qui servait de logement et de moyen de locomotion pour sillonner les Etats-Unis et le Mexique.
Quand Lhasa a écrit un livre, elle l’a nommé « La route qui chante ».
Et quand un documentaire lui a été consacré, il a été appelé « La route de Lhasa ».
Lhasa, la nomade, s’est posée à Montréal pour réaliser 3 albums.
3 albums qui sont autant de pépites dans une vie qui n’a pas atteint 38 ans.
Ce fut pour moi, un choc émotionnel de la découvrir.
Ma rencontre avec cette voix, sa musique et ses paroles eut lieu 11 ans après qu’elle fut arrachée à la vie.
J’ai écrit une série de 7 mots du jours pour essayer de partager cette émotion..
La page consacrée à cette série est en ligne sur la page des séries.
Mais vous pouvez aller directement sur la page en suivant ce lien : <Lhasa de Sela 1972-2010>
<Mot sans numéro>
-
Lundi 15 Novembre 2021
« La dernière chanson de Lhasa. »Selon un récit de son ami Arthur HJ’avais commencé cette série par une question : Connaissez-vous Lhasa ?
Et puis, je vous ai renvoyé vers ce documentaire <La route de Lhasa (1972-2010)> qui me l’a fait découvrir.
Après, je vous ai invité à entreprendre avec moi la visite de la route de Lhasa. Je n’en ai découvert qu’une partie et j’en ai partagé moins encore.
Pourtant, j’ai la faiblesse de penser que si vous avez accepté de me suivre et que vous aviez répondu à la première question, « non », vous répondrez désormais : «Oui je connais Lhasa de Sela» et ce « Oui » contiendra quelque chose comme une lumière, une gratitude envers cette artiste incroyable. Mon exploration de la route de Lhasa s’achève aujourd’hui, par la découverte de la dernière chanson de Lhasa selon le fils de Jacques Higelin.
Je l’ai écrit vendredi, Lhasa au début de son cancer, n’a pas accepté de se soumettre aux traitements conventionnels proposés par la médecine occidentale.
Si les chansons du dernier album ont été écrits avant la révélation de la maladie, l’enregistrement et la confection du disque ont été réalisés alors que la maladie était très présente.
Les traitements conventionnels, enfin tentés, ont offert une accalmie, probablement de l’espoir, mais pas de rémission.
L’accalmie a permis de débuter la promotion de l’album ultime : deux fois à Paris, une fois à Londres et deux fois en Islande.
C’est en Islande qu’eurent lieu les deux derniers concerts. Le journal canadien<Le Devoir> raconte
« Aller jouer en Islande, est-ce que ça vous tente ? » C’est ainsi que Lhasa a lancé l’offre à ses musiciens, se souvient Joe Grass, le guitariste de la chanteuse à l’époque. « Et on a évidemment dit : « Euh… oui ! » », rigole-t-il.
Deux concerts ont eu lieu au Reykjavik Arts Festival, les 23 et 24 mai 2009, en amont de la tournée prévue après le lancement du disque Lhasa — tournée qui n’aura finalement pas lieu pour des raisons de santé. « C’était dans une salle sur le carré principal à Reykjavik, une belle place, une vieille bâtisse qui devait accueillir 800 personnes ou quelque chose comme ça », raconte Grass.
Lhasa et ses musiciens — Joe Grass, Sarah Pagé, Andrew Barr et Miles Perkins — ont passé deux semaines là-bas, une avant les concerts, l’autre après. « On était dans la campagne, à une heure de Reykjavik, dans une petite cabin, se remémore Joe Grass. On cuisinait le souper chaque soir, on écrivait, on jouait chaque jour pour préparer le show. C’était plein d’incertitudes, elle savait déjà qu’elle était malade, on parlait de ne pas continuer [la tournée] ou de la faire autrement. Mais c’était une belle expérience, tous ensemble. »
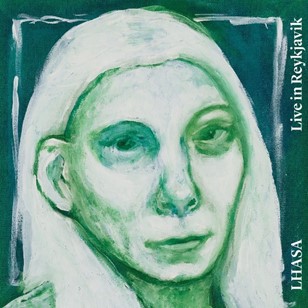 Un enregistrement live a été fait de ces derniers concerts. Il s’appelle « Live in Reykjavik », il est paru en 2017.
Un enregistrement live a été fait de ces derniers concerts. Il s’appelle « Live in Reykjavik », il est paru en 2017.
Voilà ce qu’on pouvait lire dans TELERAMA le 29/11/2017 de ce live de Reykjavik
« Ce live, inédit, a été capté à Reykjavik en 2009, six mois avant la mort de la chanteuse. Bouleversant.
C’est un chant d’outre-tombe, gorgé de douleurs et de joies, porteur d’une sagesse infinie. C’est l’ultime concert de Lhasa, capté à Reykjavik le 24 mai 2009, un peu plus de six mois avant qu’elle disparaisse, à seulement 37 ans. Il est d’une beauté renversante. Tous ceux qui ont aimé la jeune femme de son vivant seront emplis d’émotion à entendre ainsi sa voix qui chante, parle, rit — alors qu’elle pensait donner le coup d’envoi d’une tournée que la maladie lui aura finalement interdit. […] Et que ceux qui ignoreraient le pouvoir de Lhasa se précipitent ! Ils entendront ici un concert poignant, aux ombres crépusculaires mais dansantes, qui fut donné avec recueillement. C’est de la même façon qu’il convient de le recevoir. Sans autre support qu’une contrebasse, une harpe, une guitare et une batterie, la force quasi transcendantale du chant nous revient intacte, et saisissante. »
Valérie Lehoux
C’était les chansons du troisième album avec quelques chansons des albums précédents.
En Islande, Lhasa en collaboration avec Joe Grass initiera la composition d’une ultime chanson « Island Song ».
Fred Goodman écrit :
Trois jours à peine après être rentrée à Montréal, Lhasa s’est pointée à une répétition avec l’essentiel des paroles de « Island song », la pièce qu’elle avait ébauchée avec Joe en Islande. Plus tard, cette semaine-là, alors que Sarah (la harpiste) et le guitariste l’accompagnaient dans une émission de la CBC pour promouvoir l’album, elle a insisté pour inclure la nouvelle chanson au répertoire. Quelques jours plus tard , le trio en enregistrait une version définitive. Il s’agit de l’ultime enregistrement de Lhasa »
Goodman « Envoutante Lhasa » Page 164Je n’ai pas trouvé trace de cet enregistrement.
J’ai trouvé sur internet <Cette interprétation audio>.
Formellement il s’agit de la dernière chanson de Lhasa. Mais ce n’est pas « Island Song » dont Arthur H parle quand il évoque la dernière chanson de Lhasa
Arthur H était devenu ami de Lhasa, après son premier concert parisien au Bataclan. Il disait d’elle :
« A ses côtés, on avait l’impression que le temps se dilatait. Sous son aura, on entrait facilement dans le rêve et la création »
Et il a composé une chanson à sa mémoire : <Sous les étoiles à Montréal> qui se trouve sur son album « Chien fou » :
Sous Les étoiles à Montréal
Musique hypnotique et le thé trop chaud
Princesse mexicaine au sourire de Mona Lisa
Je te respire et tu m’inspires
Sous les étoiles chez Lhasa
Jolie sorcière tu nous tirais les cartes
Le Fou, la Lune et l’Amoureux
Le destin était si audacieux
Sous les étoiles à Montréal
La luz de tu cuerpo était si belle
La luz de tu corazón aussi
Je n’ai pas voulu te voir mourir
Sous les étoiles à Montréal
Une nuit d’hiver par la fenêtre ouverte
S’envole un souffle au-dessus
De la ville blanche et mystique
Sous les étoiles de Lhasa
Et tu chantes avec le Roi Cohen
Sous les étoiles à Montréal
Et tu chantes avec le Roi Cohen
Sous les étoiles à Montréal
Grâce à cette chanson j’ai appris qu’elle avait des liens avec Leonard Cohen. Le livre de Goodman n’en parle pas.
<Ce site > nous apprend que le directeur musical de Leonard Cohen, l’a appelée pour lui demander d’auditionner au poste crucial de choriste pour la suite de la tournée de Leonard Cohen, l’un de ses maîtres :
« Elle hésite peu ; l’aventure promet d’être riche, la bienveillance du chanteur est réputée, et son disque à elle peut être décalé : elle auditionne donc et les répétitions commencent. Au bout de quelques jours néanmoins, elle va voir Cohen et lui annonce ce qu’elle vient d’apprendre : elle souffre d’un cancer du sein, à un stade avancé. Le chanteur l’encourage à « faire le nécessaire », elle quitte donc le navire à peine embarqué pour se consacrer à sa vie, à son disque »
Quand on cherche, on trouve. Il y a cette vidéo qui montre Lhasa au Festival International de Jazz de Montréal, en 2008, chanter la chanson de Leonard Cohen <Who by Fire>.
 Mais revenons à la dernière chanson de Lhasa, selon la sensibilité d’Arthur H
Mais revenons à la dernière chanson de Lhasa, selon la sensibilité d’Arthur H
C’est lui qui nous fait ce récit dans lequel, il raconte les circonstances dans lesquelles il a entendu la dernière chanson de Lhasa :
«Je vais vous raconter sa dernière musique, sa dernière chanson.
Nous étions à Montréal chez trois de ses sœurs. Lhasa vivait à Montréal au Québec, et Ayin, Sky et Miriam vivaient à Montréal en Bourgogne [dans l’Yonne] (elles étaient très connectées).
Alexandra Karam, leur mère avait rapporté les cendres de sa fille dans une urne sobre.
Le matin, nous nous sommes rassemblés dans une petite grange, il y avait tous les amis de France, beaucoup de circassiens, les amis de Marseille. C’était presque six mois après sa disparition et la douleur était encore tenace.
On a projeté un bout de film, écouté quelques interviews et la tristesse est tombée sur nous comme une montagne de plomb. […]
Une étoile était morte, l’avenir avait cessé d’être, rien ne semblait plus possible.
On pouvait dans notre corps, sentir quelque chose de dur, de solide, qui nous empêchait de respirer.
Puis nous avons dû monter dans quelques voitures : il fallait se rendre dans une petite chapelle du Moyen âge perdue dans les bois. Nous nous sommes garés, nous avons marché 5 minutes dans la forêt puis nous nous sommes installés à côté de l’église, chacun trouvant sa place. Le sous-bois était frais, les arbres immenses, laissaient à peine passer la lumière du soleil, pourtant nous étions au mois de juin et il était midi. Tout est devenu très doux […]
Un calme profond est apparu qui a presque fait disparaître la tristesse.
Puis l’urne, lentement, est passée de main en main, chacun l’a serrée contre son cœur, c’étaient les dernières traces physiques de Lhasa.
Chacun a murmuré des paroles de gratitude, des encouragements pour l’autre monde, chacun a mesuré la chance inouïe d’avoir croisé cet être. Les déclarations d’amour se suivaient et se ressemblaient. Une joie très ancienne, qui était unique pour chacun, s’est installée, une joie éphémère : le deuil ne faisait que commencer. Des enfants ont récité des poèmes, chanté des chansons et quand le tour a été fini, l’atmosphère était considérablement différente, dense et légère à la fois.
L’urne est revenue dans les bras d’Alexandra et nous l’avons suivie tandis qu’elle se dirigeait vers le gros ruisseau qui coulait en contrebas. Alexandra s’est agenouillée, a ouvert l’urne et très délicatement, a pris des poignées de cendre qu’elle a jetées dans l’eau.
Au début cela faisait de grandes tâches noires puis rapidement, le courant qui était vif, a fait tournoyer la cendre.
Stupéfaits, réellement abasourdis, nous avons vu les dernières traces de Lhasa s’éclaircir puis disparaître totalement dans l’onde, un retour très concret dans la matrice de l’univers.
C’était un rite mystique, essentiel, au-delà du temps, qui nous faisait comprendre de l’intérieur que nous aussi étions destinés à retourner dans cette matrice.
Un grand silence s’est fait qui nous a permis de mieux entendre la musique de l’eau vive, puissante et gracieuse.
C’était la dernière chanson de Lhasa.
La mémoire de son sourire, de sa voix souple et chaude, la force du courant, les scintillements du soleil qui illuminait le ruisseau, le son de l’eau, tout se mélangeait et tout disait : tout va bien, ne vous inquiétez pas, je suis bien où je suis.
C’était le son de l’âme de Lhasa […]»
Préface du livre « Envoutante Lhasa » Page 12 & 13

<1622>
-
Vendredi 12 Novembre 2021
« Lhasa de Sela qui remuait la vie de celles et ceux qui entendaient sa voix. »Vincent DelermLe 3 janvier 2010 le site internet de l’artiste avait publié ce message :
 «Lhasa de Sela est décédée à son domicile de Montréal pendant la soirée du 1er janvier 2010, un peu avant minuit. Un cancer du sein qu’elle a combattu avec courage et détermination pendant plus de 21 mois l’aura finalement emportée. Durant cette période difficile, elle a continué à toucher la vie des gens qui l’entouraient avec la grâce, la beauté, et l’humour qui la caractérisaient.
«Lhasa de Sela est décédée à son domicile de Montréal pendant la soirée du 1er janvier 2010, un peu avant minuit. Un cancer du sein qu’elle a combattu avec courage et détermination pendant plus de 21 mois l’aura finalement emportée. Durant cette période difficile, elle a continué à toucher la vie des gens qui l’entouraient avec la grâce, la beauté, et l’humour qui la caractérisaient.
Il a neigé plus de 40 heures à Montréal depuis son départ. »
Le cancer qui l’a frappé l’a donc tué en moins de deux ans
Le cancer est une trahison ! Une trahison cellulaire.
Des cellules n’acceptent pas leur destinée : naitre, vivre et mourir pour l’intérêt supérieur du corps vivant qui les portent.
Elles n’acceptent pas de mourir et se multiplient créant des métastases et, finalement tuent le tout dont elles ne sont qu’une partie.
Quand cette trahison a lieu dans un corps jeune comme celui de Lhasa, le dynamisme de vie est utilisé par les cellules rebelles pour se répandre encore plus vite.
Lhasa quand elle a appris le diagnostic, a refusé de se soumettre aux traitements conventionnels que lui proposaient les médecins et que ses proches lui enjoignaient de prendre.
Elle voulait se soigner avec des méthodes naturelles.
Personne n’est en mesure de dire si l’utilisation immédiate des traitements conventionnels auraient pu la guérir ou lui accorder quelques années supplémentaires, ou simplement quelques mois.
Elle acceptera finalement ces traitements rejetés dans un premier temps.
Elle aura l’espoir de guérir, jusqu’en novembre 2009, après selon ce qu’écrit Fred Goodman le sentiment monte que c’est la fin.
Le cancer se généralisa, sa fin de vie sera très dure.
Sa demi-sœur Gabriela déclara :
« Je ne sais pas s’il est utile de voir quelqu’un souffrir aussi atrocement. Je pense que ça n’apporte rien. C’est ce que j’en retiens. J’aurais vraiment souhaité qu’elle décide elle-même de mettre fin à ses jours, plusieurs mois auparavant au lieu de vivre une telle épreuve. Je l’aurais souhaité »
« Envoutante Lhasa » Page 168
Elle passera le nouvel an, mais pas le premier jour de 2010.
La famille attendra le 3 janvier pour officialiser la nouvelle qui s’était répandu sur la toile.
Il y aura une pluie d’hommages.
Je m’arrêterai sur celui de Vincent Delerm que je trouve très beau et très juste.
Ils avaient chanté ensemble <L’échelle de Richter>
Elle avait cependant déclaré :
« J’ai grandi en me sentant hors du temps, sans télévision, ni électricité, ni eau courante… et j’aimais ça. Aujourd’hui, quand j’écris, j’ai tendance à davantage chercher des images de choses éternelles que transitoires. Je ne parle jamais de téléphones, de voitures ni de marques. Je suis le contraire de Vincent Delerm. J’aime plutôt chanter les vérités éternelles… »
 Son contraire a donc écrit et c’est Vincent Josse qui l’a publié sur France Inter le 5 janvier 2010 : <C’était ça Lhasa>
Son contraire a donc écrit et c’est Vincent Josse qui l’a publié sur France Inter le 5 janvier 2010 : <C’était ça Lhasa>
« Trois fois comme si le sol avait tremblé. Trois fois la voix de Lhasa.
La première c’était chez elle, à Montréal, il y a six ans. Nous étions venus faire un concert là-bas avec Mathieu Boogaerts et le lendemain, dans sa maison, elle nous faisait écouter les maquettes de son deuxième album. Dehors, nuit et tempête de neige. Dedans, bougies, cadres minuscules avec photographies de proches sur un mur et cette chanson « J’arrive à la ville ». Sa voix sur cette chanson. La vie privée vacillait depuis quelques temps et cette musique, écoutée près d’elle qui souriait à côté de la chaîne hifi, m’a convaincu de tout changer en rentrant à Paris.
La deuxième, c’était lors de son concert au Rex l’année suivante. J’étais assis à côté d’une amie commune qui avait affronté une épreuve violente quelques semaines plus tôt. Nous étions au balcon et la minuscule silhouette de Lhasa sur scène en contrebas a dit, avec son accent étrange, quelque chose comme « parfois, la vie ne ressemble pas à ce qu’on voudrait. Cette chanson c’est pour toi, Ingrid ». Après le spectacle, dans sa loge, pas pu parler, lui dire que c’était un concert incroyable, juste fondu en larmes, à cause de sa voix qui avait tout remué pendant deux heures.
Sa voix comme tout le temps relié au sol. Sa voix de trois-mille ans.
La troisième fois c’était autour d’un projet initié par notre maison de disques, Tôt ou Tard, qui souhaitait faire un album entièrement composé, joué et interprété par les artistes du label.
Lhasa m’avait dit « j’aimerais bien que tu écrives une chanson pour nous deux, mais une chanson sans nom propre, sans références, parce que moi je ne vis pas en France et parfois, tes références, je ne les comprends pas ».
J’avais envoyé la chanson, sans référence. Le jour où nous l’avons enregistrée, nous avons décidé de chanter l’intégralité du titre à deux voix, elle a juste dit : « à l’hôtel, en écoutant la chanson, j’ai pensé faire ce petit contrechant-là », et bien sûr, ça changeait la mélodie en mille fois mieux.
C’était violent, une fois de plus, d’entendre sa voix, très fort dans le casque.
Entendre sa voix articuler les mots écrits pour elle et qui faisaient allusion à l’histoire que j’avais quittée dans ma tête en écoutant « J’arrive à la ville », quelques années plus tôt.
Je me souviens de ne pas avoir dormi la nuit qui a suivi.
C’était Lhasa.
Lhasa de Sela qui remuait la vie de celles et ceux qui entendaient sa voix. »
<1621>
-
Mercredi 10 Novembre 2021
« I’m going in. »Lhasa« I’m going in » est la chanson la plus longue du dernier album de Lhasa.
Il n’y a qu’un piano qui avec quelques accords produit un accompagnement minimaliste.
La mélodie écrite par Lhasa soutient les paroles écrites par Lhasa , sa voix porte son message et fait vibrer au plus profond de l’être.
<Going In> est aussi un film documentaire tourné en avril 2009. Il dure moins de 30 minutes, juste avant la fin elle chante « I’m going in » en s’accompagnant, elle-même, sur un piano désaccordé.
<La Métropole>, webmagazine de Montréal le présente ainsi :
« Le 16 janvier 2020, Going In : un film inespéré et contemplatif sur l’art de la chanteuse Lhasa de Sela, surgit discrètement sur des plateformes Web.*
À partir d’un instant précis d’avril 2009, ce fragment éblouissant de vie cristallisée — intemporel et infini — se déploie à l’écran… Tous ceux et celles qui ont été touchés par cette artiste ont sans nul doute ressenti, et viscéralement, le sens unique qui était le sien pour magnifier le 4eme art — une démarche d’une pureté et d’un absolu saisissant… […]
Peu de documents audiovisuels ont été réalisés sur Lhasa et sa carrière, provoquant ainsi une certaine forme d’aura mystérieuse autour de la chanteuse. Heureusement, avec cette caméra dans le sillage de cet être sublime, ce film expose un rare moment d’intimité — le privilège, en quelque sorte, d’évoluer avec cette artiste, dans son univers de création, dans sa propre vie.
Un judicieux plan de caméra sur l’extérieur (un traveling à bord d’un train) nous conduit de la campagne jusqu’au cœur de Montréal. Comme si, sur cette voie ferroviaire, on revivait l’arrivée en ville, à l’aube des années quatre-vingt-dix, de cette jeune chanteuse d’origine américano-mexicaine arrivant de San Francisco. C’était le début de sa carrière musicale…
[…] Sur ses mélodies en fond sonore, l’artiste livre des parcelles de son intériorité : ses peurs, son contact complexe avec l’industrie musicale et sa difficile émancipation.
[…] Dans un moment de recueillement artistique — quasi mystique — Lhasa, assise au piano, chante sa bouleversante pièce « I’m Going In ». Sur ce fond musical, un deuxième traveling s’engage, cette fois sur le béton austère de Montréal et s’échappe de ces lieux pour nous ramener vers des sites naturels en périphérie de la cité : analogie du grand départ, vers l’unique voyage nous ramenant au point fixe…
Cette ode cinématographique fut réalisée par Vincent Moon, cinéaste français indépendant à l’approche instinctive, dont les essais cinématographiques avant-gardistes sont chaque fois consacrés au monde de la musique. En collaboration avec la chanteuse, il organisa et filma un spectacle intimiste, dont certains extraits servirent à promouvoir quelques pièces dudit album. En plus d’avoir capté cette performance, Moon suivit Lhasa avec sa caméra pendant quelques jours… Pendant plus de dix ans, ces bobines ont dormi, jusqu’à ce que Moon se décide enfin à replonger son regard sur ce moment archivé pour se livrer à un savant montage — trame contemplative pour le moins aussi ensorcelante que Lhasa elle-même. Le metteur en scène a su explorer et saisir un moment très concis d’une vie, tout comme il a accompli une véritable plongée dans l’esprit artistique de Lhasa, un être d’exception, lisant Thoreau et en donnant une relecture bouleversante. Le regard de Lhasa, inoubliable, aussi fixe que fulgurant, sur un incandescent voyage existentiel… »
Comme toutes autres chansons du dernier album, Lhasa l’a écrite avant de recevoir son diagnostic.
Mais elle la chante après.
Les premières paroles :
« Alors que ma vie prenait fin
Et que ma mort venait à commencer
Je t’ai dit que je ne te quitterai jamais »
Comme un présage de mort.
Fred Goodman avance cette suggestion :
« Peut-être cela vient-il simplement de sa nature mélancolique : peut-être son intuition innée l’a-t-elle amenée à soupçonner que quelque chose ne tournait pas rond ; peut-être sa prédilection pour les archétypes universels rend-elle les chansons ouvertes à de multiples interprétations. »
« Envoutante Lhasa » Page 160
C’est la chanson préférée d’Alexandra Karam, sa mère : <Lhasa vue par sa mama> qui ajoute :
« Qui ne parle pas de la mort, contrairement à ce qu’on pourrait croire »
Et pourtant elle chante comme un adieu :
« Ne me demande pas de revenir à moi
Je suis maintenant prête à y aller »
Ou encore :
« Je pars, je m’en approche
Je peux soutenir la douleur
Et la chaleur aveuglante »
N’est-ce pas une description qui renvoie vers le récit des expériences de Mort Imminente telle que l’avait décrite, l’Américain Raymond Moody dans son livre « La vie après la vie » ?.
Et puis n’annonce t’elle pas la cérémonie de l’Adieu dans ces mots ?
« Vous me parlerez
Mais je ne pourrai vous comprendre
Je tomberai au bord du chemin
Vous me tendrez la main
[…]
Je n’ai pas creusé si loin
Pour revenir très vite à vous »
Fred Goodman qui parle du « tour de force » intitulé « I’m Going in » et de son côté « troublant. » se résout pourtant à conclure comme la mère de Lhasa :
« La chanson porte sur l’expérience de la naissance et du renouveau spirituel. Lhasa y affiche un optimisme profond, voire religieux, convaincue quelle ne pourra jamais vraiment disparaître »
Dans le documentaire précité, avant de chanter la chanson, elle parle d’un livre de Thoreau et d’expériences spirituelles qui s’apparentent à une renaissance, une nouvelle naissance. Elle chante d’ailleurs :
« Je me sens renaître
Comme si ce corps fut le premier que j’épuisais »
Les américains croyants ont cette expression « born again »
La fin est comme l’écrit Fred Goodman d’un optimisme profond :
« Même perdue et aveugle
J’ai réinventé l’amour »
Il n’est pas nécessaire d’adhérer à cette vision spirituelle, peut être religieuse, pour être subjuguée par la beauté et la sensibilité de ce que chante cette artiste, au seuil de la mort.
Si Lhasa n’avait écrit que cette seule chanson, elle serait déjà inoubliable.
Sublime !
Paroles de chanson et traduction Lhasa de Sela – I’m Going In trouvées sur le site : <http://paroles-traductions.com>
WHEN MY LIFETIME HAD JUST ENDED
Alors que ma vie prenait fin
AND MY DEATH HAD JUST BEGUN
Et que ma mort venait à commencer
I TOLD YOU I’D NEVER LEAVE YOU
Je t’ai dit que je ne te quitterai jamais
BUT I KNEW THIS DAY WOULD COME
Mais je savais que ce jour viendrait
GIVE ME BLOOD FOR MY BLOOD WEDDING
Donne-moi du sang pour mes noces de sang
I AM READY TO BE BORN
Je suis prête à advenir
I FEEL NEW
Je me sens renaître
AS IF THIS BODY WERE THE FIRST I’D EVER WORN
Comme si ce corps fut le premier que j’épuisais
I NEED STRAW FOR THE STRAW FIRE
Il me faut une paille, pour le feu de paille
I NEED HARD EARTH FOR THE PLOW
J’ai besoin de terre forte pour la charrue
DON’T ASK ME TO RECONSIDER
Ne me demande pas de revenir à moi
I AM READY TO GO NOW
Je suis maintenant prête à y aller
I’M GOING IN I’M GOING IN
Je pars, je m’en approche
THIS IS HOW IT STARTS
Et voici comment cela commence
I CAN SEE IN SO FAR
Je ne puis me projeter si loin
BUT AFTERWARDS WE ALWAYS FORGET
Mais après tout, nous oublions toujours
WHO WE ARE
Qui nous sommes
I’M GOING IN I’M GOING IN
Je pars, je m’en approche
I CAN STAND THE PAIN
Je peux soutenir la douleur
AND THE BLINDING HEAT
Et la chaleur aveuglante
‘CAUSE I WON’T REMEMBER YOU
« Puisse que je ne me souviendrai pas de toi
THE NEXT TIME WE MEET
A notre prochaine rencontre
YOU’LL BE MAKING THE ARRANGEMENTS
Vous saurez prendre les dispositions
YOU’LL BE TRYING TO SET ME FREE
Vous essaierez de me libérer
NOT A MOMENT FOR THE MEETING
Pas même le temps d’un rendez-vous
I’LL BE BUSY AS A BEE
Je serai aussi occupée qu’une abeille
YOU’LL BE TALKING TO ME
Vous me parlerez
BUT I JUST WON’T UNDERSTAND
Mais je ne pourrai vous comprendre
I’LL BE FALLING BY THE WAYSIDE
Je tomberai au bord du chemin
YOU’LL BE HOLDING OUT YOUR HAND
Vous me tendrez la main
DON’T YOU TEMPT ME WITH PERFECTION
Ne me tente pas par la perfection
I HAVE OTHER THINGS TO DO
J’ai bien d’autres choses à faire
I DIDN’T BURROW THIS FAR IN
Je n’ai pas creusé si loin
JUST TO COME RIGHT BACK TO YOU
Pour revenir très vite à vous
I’M GOING IN I’M GOING IN
Je pars, je m’en approche
I HAVE NEVER BEEN SO UGLY
Je n’ai jamais été aussi moche
I HAVE NEVER BEEN SO SLOW
Je n’ai jamais été si lente
THESE PRISON WALLS GET CLOSER NOW
Plus les murs de cette prison se rapprochent maintenant
THE FURTHER IN I GO
Au plus loin je m’y enfonce
I’M GOING IN I’M GOING IN
Je pars, je m’en approche
I LIKE TO SEE YOU FROM A DISTANCE
J’aime à vous voir au loin
AND JUST BARELY BELIEVE
Et avoir peine à croire
AND THINK THAT
Et songer que
EVEN LOST AND BLIND
Même perdue et aveugle
I STILL INVENTED LOVE
J’ai réinventé l’amour
Traduction par Corinne Tartary
<1620>
-
Mardi 9 Novembre 2021
« J’écris des chansons pour m’aider à avancer. Elles sont mes étoiles. Elles me guident dans la nuit. »LhasaLe chant du cygne, son troisième et dernier album est paru en 2009. Il avait simplement pour titre : « Lhasa »
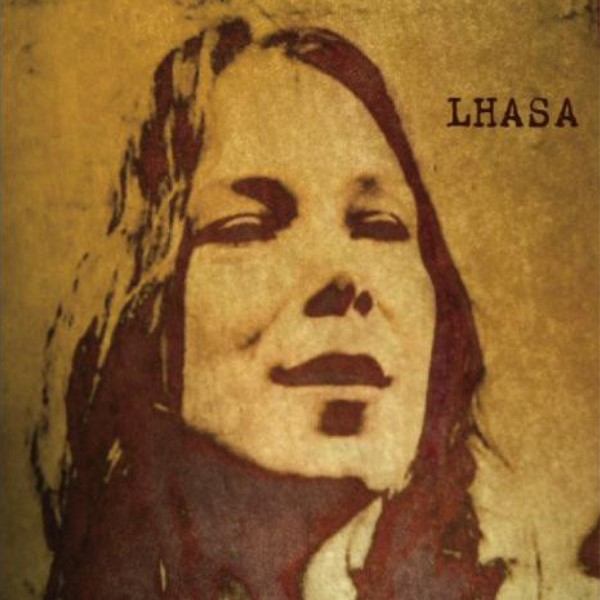 Il aura donc fallu à nouveau 6 ans entre le précédent album et celui-ci.
Il aura donc fallu à nouveau 6 ans entre le précédent album et celui-ci.
La maturation était lente chez cette artiste, c’est probablement pour cette raison que le résultat est si abouti.
Cette fois elle ne quittera pas Montréal. Après deux ans passés sur les scènes du monde entier pour présenter son deuxième album, elle se mettra tranquillement à composer les paroles et les mélodies pour son nouvel ouvrage.
Et comme précédemment elle va changer de musiciens.
Lhasa était selon la description qu’en fait Fred Goodman une personne sympathique, chaleureuse et fidèle en amitié. Mais pour sa trajectoire musicale, elle était sans concession : savait ce qu’elle voulait et n’hésitait pas à trancher dans le vif.
Rien ne l’illustre mieux que son attitude avec Mélanie Auclair, une violoncelliste qui a intégré son groupe de musicien pour l’album « Living Road » et qui va devenir son amie.
 Fred Goodman raconte :
Fred Goodman raconte :
« L’arrivée de Mélanie était un changement bienvenu pour Lhasa. Au cours des tournées précédentes, elle s’était sentie isolée : presque chaque soir, les gars [que des hommes] faisaient la fête pendant qu’elle dormait et reposait sa voix. Cette fois, elle voulait que ça se passe autrement. Lhasa et Mélanie allaient prendre l’habitude de s’éclipser une heure avant le test de son.
Du magasinage éclair, se souvient Mélanie. Elle était du genre à m’acheter de nouvelles chaussures un jour où je me sentais triste. Ou à débarquer avec une soupe miso. Elle était comme une grande sœur bienveillante. Elle prenait soin de moi. »
« Envoutante Lhasa » Page 124
Mais pour le troisième album, Lhasa veut explorer d’autres pistes et cela se passe ainsi :
« Mélanie savait que Lhasa explorait la scène de Mile End. « Elle voulait trouver sa place là-dedans » indique t’elle. Mais quand elle a reçu un coup de fil de la chanteuse qui l’invitait à passer à la maison, elle n’était pas prête à encaisser l’inévitable. C’est autour d’un souper dans un restaurant du coin que Lhasa lui a appris la nouvelle.
« Il faut que je te le dise : je travaille avec d’autres musiciens, lui a-t-elle annoncé et je vais peut-être prendre un autre violoncelliste. »
« Non ! Non, non, non s’il te plait ! » Je l’ai pris très durement, se souvient Mélanie. J’avais le cœur brisé. Je la respectais, je respectais sa vision, mais c’était très difficile à avaler sur le plan personnel. Le plus dur, c’est que je savais que j’allais perdre la place de choix que j’occupais dans son cœur. Notre relation s’est poursuivie par la suite, nous sommes restées amies, mais ce n’était plus comme avant. »
« Envoutante Lhasa » Page 143
L’amitié et l’exigence musicale, par rapport aux évolutions de Lhasa étaient bien distinctes dans son esprit.
Après le premier album entièrement en espagnol, le second en trois langues, le troisième sera entièrement en anglais, la langue maternelle.
<TELERAMA> la cite
« Chanter dans ma langue maternelle a été comme un atterrissage, un ré-enracinement, après plusieurs années passées à flotter dans les airs… Une espèce de grounding, dirait-on en anglais. Ça me fait du bien, j’en avais besoin. »
Elle changera aussi de voix. Elle a eu un problème aux cordes vocales parce que précédemment, elle forçait sa voix la rendant plus grave et plus rocailleuse. Les médecins voulaient l’opérer mais une vieille chanteuse, sachant ce que chanter veut dire lui a simplement dit de chanter avec sa voix naturelle qui était plus haute et plus légère et que tout irait bien. C’est ce qu’elle a fait et sa voix s’en ait porté mieux.
Ses œuvres sont pourtant toujours aussi profondes et porteuses d’émotions.
Dans un article de « L HUMANITE » publié le 29 mai 2009 pour la sortie de son album : <Lhasa : « Aller jusqu’au bout de ce que je ressens »> elle dit :
« Je ne me dis pas : je vais faire un album plus dense. C’est la beauté qui m’importe. Mais ce n’est pas mon affaire de dire si l’album est mélancolique, ou joyeux… Je cours après la beauté. Ce qui est très subjectif !
Ce troisième album compte 12 chansons. Son éditeur canadien, Audiogram, n’aime pas ce troisième album et trouve que les chansons se ressemblent trop, veut du tri. Lhasa répond alors :
« Je vous demande pardon, mais lequel de mes enfants voulez-vous que je tue ? »
L’album sera comme elle l’a décidé.
Les chansons ont été écrites avant qu’elle connaisse sa maladie, l’enregistrement et le début de la promotion ont eu lieu alors que la maladie était présente. La tournée qui s’annonçait a du rapidement s’interrompre.
Lhasa a cependant pu venir en France, en mai 2009 et faire deux concerts au Théâtre des Bouffes du Nord
La journaliste Valérie Lehoux était présente et raconte dans <TELERAMA>
« Ce jour-là, en mai dernier, il aura suffi d’une seconde pour qu’elle nous hypnotise. Elle est entrée d’un pas feutré, silhouette fine comme la lame d’un couteau, sourire léger et intrigant. Pas un soupçon d’artifice. Sa voix s’est élevée entre les murs décrépis du Théâtre des Bouffes du Nord, embrasant tout l’espace de sa gravité voilée et de sa rare intensité. Musique incantatoire et voyageuse, folk-blues gorgé de lumière et de douleur.
Lhasa n’a que trois disques à son actif […] Trois disques en onze ans, c’est très peu dans un univers musical où la course à la production est souvent la condition de l’existence artistique : « Je suis lente, j’attends la nécessité, je soigne mes disques jusque dans leurs moindres détails. J’ai envie d’en être fière, qu’ils durent longtemps. Les chansons, je les laisse venir à moi sans les brusquer. Quand j’en sens une se préciser, je la travaille bien sûr, mais je ne force jamais son écriture. Une chanson devient vraiment magique quand elle vous dépasse, qu’elle a une vie bien à elle. »
Article publié dans Télérama n°3110 le 22 août 2009
 Un des concerts, celui du 11 mai 2009 a été organisé par la FNAC et on trouve les vidéos sur la chaine Youtube de la FNAC
Un des concerts, celui du 11 mai 2009 a été organisé par la FNAC et on trouve les vidéos sur la chaine Youtube de la FNAC
Je vous propose d’écouter <Rising>
Pour la chanson Rising Lhasa a répondu dans l’article de L’humanité précité :
« Cette chanson est née d’une image que j’ai explorée. Pour moi, ce n’est pas très intéressant maintenant d’explorer cette chanson, c’est plus intéressant que les autres imaginent l’image. Les mots m’ont attirée parce que je sentais qu’ils véhiculaient une image puissante. Mon boulot est d’explorer cette image, d’aller jusqu’au bout de ce que je ressens. Ensuite, c’est aux autres de voir ce qu’elle veut dire. »
Voici les paroles avec une tentative de traduction
I got caught in a storm
And carried away
I got turned, turned around
I got caught in a storm
That’s what happened to me
J’ai été pris dans une tempête
Et emporté
Je me suis tourné, retourné
J’ai été pris dans une tempête
C’est ce qui m’est arrivé
So I didn’t call
And you didn’t see me for a while
I was rising up
Hitting the ground
And breaking and breaking
Alors je n’ai pas appelé
Et vous ne m’avez pas vu pendant un moment
Je m’élevais
Cognais le sol
Et me brisais et me brisais
I got caught in a storm
Things were flying around
And doors were slamming
And windows were breaking
And I couldn’t hear what you were saying
I couldn’t hear what you were saying
I couldn’t hear what you were saying
J’ai été pris dans une tempête
Des choses volaient alentour
Et les portes claquaient
Et les fenêtres se brisaient
Et je ne pouvais pas entendre ce que vous disiez
Je ne pouvais pas entendre ce que vous disiez
Je ne pouvais pas entendre ce que vous disiez
I was rising up
Hitting the ground
And breaking and breaking
Rising up
Rising up
Je m’élevais
Cognais le sol
Et me brisais, et me brisais
M’élevais
M’élevais
Il y a d’autres chansons sur la chaîne de la FNAC comme <Fool’s gold – Bouffes du Nord>
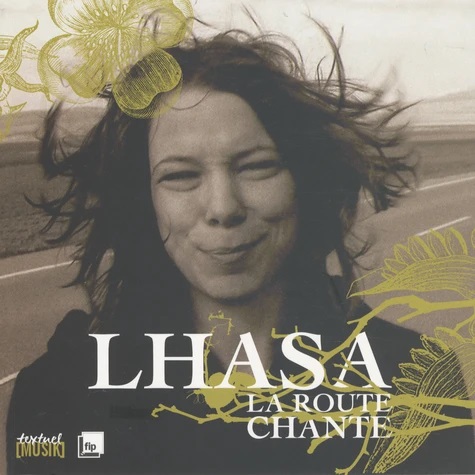 Le 3 décembre 2017, beaucoup de ses amis se sont réunis pour un concert hommage à Lhasa. Ils l’ont appelé « La route chante » Comme le livre qu’elle avait écrit et qui est paru en 2008.
Le 3 décembre 2017, beaucoup de ses amis se sont réunis pour un concert hommage à Lhasa. Ils l’ont appelé « La route chante » Comme le livre qu’elle avait écrit et qui est paru en 2008.
<Cet article> sur le site de RFI raconte cet hommage ému de la part des musiciens qui ont participé à son aventure musicale. Et l’article se termine ainsi :
À la fin du concert à la Philharmonie, une dame apparaît, épaulée par tous les artistes de l’hommage : c’est Alexandra, sa maman. Sur la scène, elle lit les paroles de sa fille, tirées de son ouvrage « La Route chante » :
« J’écris des chansons pour m’aider à avancer. Elles sont mes étoiles. Elles me guident dans la nuit (…) ».
Sous les tonnerres d’applaudissement d’une salle debout, sous l’esprit de Lhasa, elle conclut l’hommage par ces mots de la chanteuse :
« Tu as fait grandir le cœur de ce monde. Tu as repoussé les murs. Merci. »
<1619>
-
Lundi 8 Novembre 2021
« Si elle ne se saignait pas à chaque représentation, elle croyait qu’elle trompait le public. »Rick Haworth, guitariste sur le deuxième album de LhasaLe premier album, entièrement chanté en espagnol, est un succès. Lhasa va faire une tournée mondiale pour le présenter. En France elle sera très bien accueillie, la critique musicale qui fait autorité dans le domaine de la chanson, Anne-Marie Paquotte et qui écrit dans « TELERAMA », l’a entendue à Montréal et en fait l’éloge par un article laudatif. Elle la signale à Vincent Frèrebeau, patron de Tôt ou Tard, qui va devenir son distributeur en Europe. Elle viendra, auréolée de cette renommée au Printemps de Bourges 1997.
Seul les États-Unis seront insensibles à cette artiste née aux États-Unis et qui ne chante pas en anglais.
 Son éditeur canadien, Audiogram, est comblé et attend avec impatience qu’elle continue sur cette voix et prépare rapidement un deuxième Album. Mais Lhasa n’est pas de cet avis, elle a besoin de faire une pause.
Son éditeur canadien, Audiogram, est comblé et attend avec impatience qu’elle continue sur cette voix et prépare rapidement un deuxième Album. Mais Lhasa n’est pas de cet avis, elle a besoin de faire une pause.« J’étais rendue paranoïaque, j’avais l’impression de ne plus avoir d’espace pour vivre. Je perdais tout estime de moi-même ». Un jour, elle a stupéfait l’équipe d’Audiogram, Yves Desrosiers et ses autres musiciens en leur annonçant qu’elle quittait Montréal pour se joindre à la troupe de cirque de ses sœurs en France. Quand reviendrait-elle ? Qui sait, peut-être jamais. »
Fred Goodman : « Envoutante Lhasa » page 87Elle dira plus tard :
« Avec le recul, je me suis dit que c’était assez extrême. Mais quand je suis partie pour la France, c’était presque comme si j’allais vers la mort. J’ai tout abandonné. J’ai tout essayé sauf me raser la tête et me faire moine. »
même référence.Sa sœur Miriam explique que leurs parents leur ont transmis cette quête que la vie est recherche intérieure qu’il est important de poursuivre. Il fallait donc être à l’écoute de ses intuitions et faire confiance à la vie.
Et c’est ainsi que Lhasa va venir dans notre pays rejoindre ses sœurs. Elle restera en France 4 ans et s’installera à Marseille pendant deux ans et demi et fera des tournées avec le cirque de ses sœurs. Elle chantera pendant le spectacle de cirque dans des conditions simples et même précaires, bien loin des standards auxquels elle s’était habituée pendant la tournée avec Yves Desrosiers et les autres musiciens.
Mais le désir de recomposer de nouvelles chansons la reprendra à Marseille.
Cette fois les chansons seront toujours en espagnol mais aussi en français, langue de Marseille et de Montréal et en anglais, sa langue maternelle.
Elle dit : « Pour mon deuxième album, je voulais créer quelque chose d’intime, de personnel »
Elle commencera à Marseille, mais il lui faut des musiciens.Arthur H, qu’elle connait depuis qu’elle a chanté au Bataclan, la met en contact avec un groupe de musiciens parisiens. Mais l’osmose ne se fait pas, elle ne retrouve pas la relation qu’elle avait avec Yves Desrosiers.
Alors cette nomade dans l’âme retourne vers la ville qui sera son port d’attache dans sa courte vie : Montréal.
Dès son retour, en 2002, Lhasa va retrouver Yves Desrosiers. Mais l’alchimie ne fonctionne plus. Ce site canadien cite le guitariste :
« Ça commençait à être difficile entre elle et moi. Avec du recul, je crois qu’elle était tannée qu’il y ait tout le temps quelqu’un derrière elle. Depuis le début, je symbolisais celui qui la parrainait et je crois qu’elle en avait son casse. Elle ne voulait pas qu’on se sépare, mais elle voulait prendre les rênes.»
Yves Desrosiers met donc un terme à son aventure artistique avec Lhasa de Sela : «J’me disais qu’il était temps qu’elle fasse ses choses toute seule, qu’elle contrôle entièrement son univers artistique. Je voyais que c’est ça qu’elle avait envie de faire. C’était écrit dans le ciel qu’un jour, ça allait arriver.» »
 Quelques mois après sa mort, Yves Desrosiers confiera au même journal son regret :
Quelques mois après sa mort, Yves Desrosiers confiera au même journal son regret :
« La raison pour laquelle on a décidé de se séparer musicalement, elle n’est plus importante… mais, dans ma tête, je me disais que, dans 10 ou 15 ans, j’allais rejouer avec elle sur scène. Pas nécessairement pour refaire un disque, mais pour renouer avec le plaisir que j’avais d’être à côté d’elle, de jouer pour elle», confie-t-il, encore sous le coup de l’émotion. « Malheureusement, c’est pas arrivé… et j’ai jamais été capable de lui dire avant qu’elle parte. »
Elle va se tourner vers François Lalonde (batteur) et Jean Massicotte (pianiste) qui avaient déjà participé au premier album.
S’y ajoutera le guitariste Rick Haworth qui jouera sur l’album et participera à la tournée qui a suivi. Il fera, à Fred Goodman cette confidence que je reprends, en partie, comme exergue de ce mot du jour :
« Si elle ne se saignait pas à chaque représentation, elle croyait qu’elle trompait le public. Elle creusait plus profondément dans une chanson que quiconque avec qui j’ai joué. C’était ça, son défi. J’ai dû changer la façon dont j’abordais les chansons, nous l’avons tous fait. Tu devais la suivre, sinon, tu ne faisais plus partie de la chanson. Il n’y avait pas de compromis. Tu devais toi aussi saigner. »
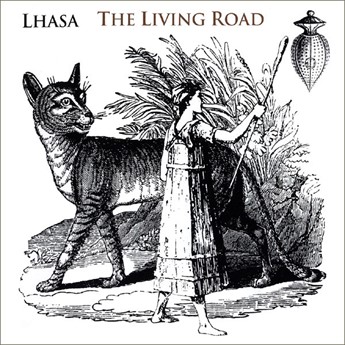 Ce deuxième album aura pour titre « Living road »
Ce deuxième album aura pour titre « Living road »
La pochette sera à nouveau réalisé graphiquement par Lhasa.
Il est encore question de route, la route vivante.
Cette expression se trouve dans la dernière chanson du disque
<Soon this space will be too small>
Bientôt cet espace sera trop petit
Et j’irais dehors
Sur l’immense flanc de colline
Où soufflent les vents sauvages
Et brillent les étoiles froides
Je poserai mon pied
Sur la route vivante
Et je serai portée
Jusqu’au cœur du monde
[…]
<Vous trouverez ici> une description et analyse de l’ensemble des chansons de cet album qui commence par « Con toda palabra » déjà citée lors du premier mot du jour de la série.
Elle chante donc cette fois aussi en français.
Je vous propose d’écouter « Marée Haute » dont <elle dit>
« Je travaille mes chansons d’une façon très visuelle, et vice versa: mes grandes peintures abstraites sont des partitions. Il m’arrive de dessiner un point rouge, juste pour le plaisir. Ce point, c’est comme un son, il crée un équilibre dans la toile. La peinture m’inspire des chansons. […] Et la chanson La Marée haute a été marquée par l’exposition sur les surréalistes à Beaubourg. Les influences sont souvent perçues comme quelque chose qui vient de l’extérieur. Je pense au contraire qu’on les digère et qu’il faut plonger à l’intérieur de soi pour les retrouver.»
Les paroles sont les suivantes :
La route chante
Quand je m’en vais
Je fais trois pas…
La route se tait
La route est noire
À perte de vue
Je fais trois pas…
La route n’est plus
Sur la marée haute
Je suis montée
La tête est pleine
Mais le coeur n’a
Pas assez
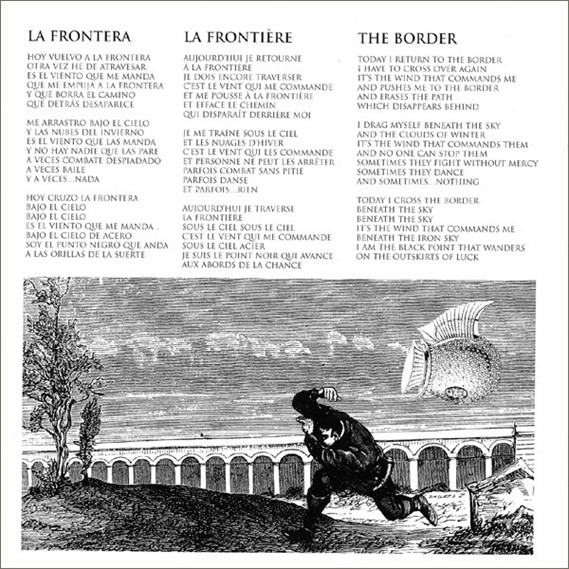 Et puis il y a cette chanson extraordinaire : La frontera » (la frontière).
Et puis il y a cette chanson extraordinaire : La frontera » (la frontière).
Dans cette <interprétation au Grand Rex> déjà sa présentation est un moment d’émotion.
Les mots sont tous simples. Elles parlent de nuages qui s’affrontent, puis dansent, puis il ne se passe plus rien.
Mais quand Lhasa dit cela, on voit des migrants qui s’approchent de la frontière qui ont peur, mais qui espèrent aussi une vie meilleure et qui attendent.
C’est l’émotion dont parle Rick Haworth, c’est indescriptible.
Dans cette vidéo on entend aussi Lhasa expliquer son expérience sur scène.Et puis <ICI> elle répond plus longuement sur TV5 à une interview concernant cet album.
Living Road est sorti en novembre 2003, 6 ans après le premier album.
En 2004 et 2005, Lhasa entreprend une longue tournée et donne un total de plus de 180 représentations : elle parcourt l’Europe, puis elle chante aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette tournée remporte un grand succès auprès du public et les salles sont bondées un peu partout.
<1618>
-
Vendredi 5 novembre 2021
« Pause (série sur Lhasa) »Un jour sans mot du jour nouveauDans l’album la Llhorona il y a aussi cette chanson : <Los Peces>.
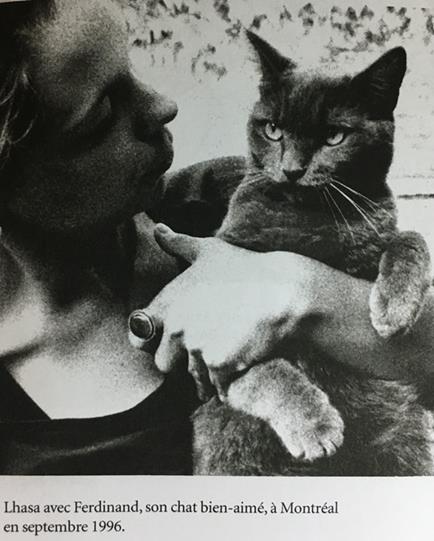 Un mois après la sortie de son album, Lhasa avec Yves Desrosiers et un second guitariste, Mario Legaré vont jouer pour les détenus dans une prison de Montréal <Chez les Souverains 6 mars 1997> et en 1999, elle chante à la télévision française la même chanson <avec le groupe français Bratsch>
Un mois après la sortie de son album, Lhasa avec Yves Desrosiers et un second guitariste, Mario Legaré vont jouer pour les détenus dans une prison de Montréal <Chez les Souverains 6 mars 1997> et en 1999, elle chante à la télévision française la même chanson <avec le groupe français Bratsch>
Je finissais le mot du jour d’hier en citant Bertrand Dicale. Voici l’intégralité de son petit billet de 4 minutes <Lhasa de Sela, heureuse en trois langues>
<Mot du jour sans numéro>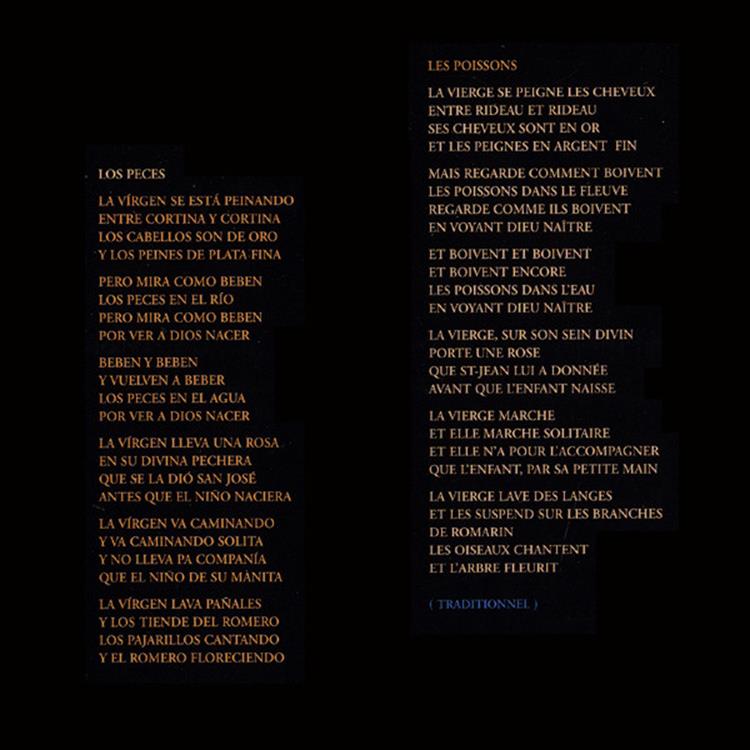
-
Jeudi 4 novembre 2021
« La LLorona »Premier album de Lhassa en 1997La vie de Lhasa commença dans un bus qui transportait sa famille de lieu en lieu, entre les Etats-Unis et le Mexique, en fonction du travail et des pérégrinations spirituelles de ses parents. Son prénom lui fut donné, en référence à la capitale du Tibet et du grand intérêt pour le bouddhisme manifesté par ses parents.
Fred Goodman en souligne toute l’importance dans le parcours ultérieur de Lhasa mais ne cache pas les limites de cette vie :
« En cherchant à vivre libre dans les marges de la société, Lhasa et sa famille menaient une existence certes exaltante, mais précaire sur le plan financier et émotionnel. Les de Sela étaient toujours en mouvement, toujours sur le fil du rasoir. Cela voulait dire un manque affligeant de stabilité, l’omniprésence du danger (gens inquiétants, environnement étranges, absence de filet de sécurité) et un sentiment persistant d’isolement et d’altérité. Combinée à un héritage familial chargé de souffrances, de conflits et de tragédies, cette expérience enchâssera pour de bon la tristesse et l’insécurité dans la personnalité de Lhasa. Et quand cette famille tissée serré (le seul univers qu’elle ait connu) se déchirera, la chanteuse éprouvera une colère et une douleur qui jamais ne s’apaiseront complètement »
Page 19
Le couple de ces blessés de la vie que sont les parents de Lhasa va donc se séparer au début des années 1980. Avant cela, ils se rendront avec leur bus en Californie parce que la Fondation nationale du tourisme cherchait des enseignants en espagnol pour former le personnel hôtelier de Los Cabos en Basse Californie et que le père était professeur d’espagnol. C’est en Californie qu’ils vont se séparer. Alexandra va alors habiter à San Francisco et Lhasa va vivre avec elle. Ses sœurs vont se passionner pour le cirque, ce qui n’est pas son cas.
Un jour, par hasard, elle voit un documentaire sur la chanteuse de jazz Billie Holiday. Elle est fascinée. A la fin de l’émission, elle pointe son doigt vers l’écran et dit :
« C’est ça que je vais faire. »
Page 52
En 1987, Lhasa demande à sa mère de l’inscrire à des cours de chant, ce qu’elle fait bien volontiers.
Lhasa était aussi une portraitiste douée, Goodman écrit :
« Elle créait des œuvres étonnamment pénétrantes et avait un sens aiguisé de la couleur, qu’elle devait en grande partie à une passion précoce pour Chagall et Van Gogh. »
Page53
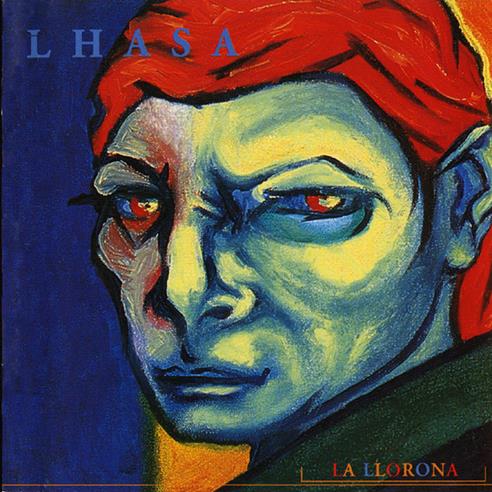 C’est d’ailleurs une œuvre picturale de Lhasa qui ornera le premier album « La LLorona »
C’est d’ailleurs une œuvre picturale de Lhasa qui ornera le premier album « La LLorona »
Mais avant cet album, elle va tenter sa chance en interprétant des standards de jazz et des chansons de Billie Holiday.
Elle chantait notamment dans un café grec en Californie.
Pendant quelques années, Lhasa se cherche, fait des petits boulots et chante quand elle trouve un lieu qui l’accueille.
Mais un concours de circonstance va décider de sa trajectoire et va lui permettre de rencontrer le musicien avec qui elle va devenir Lhasa, la chanteuse.
La première étape vient grâce à sa sœur Sky qui a réussi une audition d’admission à l’école nationale de cirque de Montréal. Elle va bien sûr s’y rendre et puis convaincre ses sœurs de venir la rejoindre.
Lhassa va se faire des relations, continuer à tenter de chanter. Elle pense toujours que sa voie est de chanter du jazz dans les pas de Billie Holiday.
La suite est racontée par Olivier Boisvert-Magnen qui a écrit, sur un site canadien en 2017, un article pour célébrer les 20 ans de La Llorona < Il y a 20 ans : Lhasa – La Llorona > :
« La Llorona est d’abord et avant tout le fruit d’une rencontre artistique exceptionnelle, aussi naturelle qu’inusitée. »
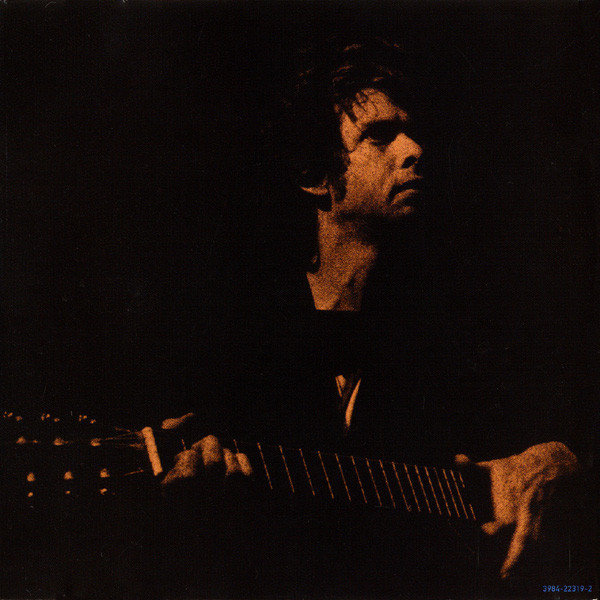 Cette rencontre va être celle avec le guitariste canadien Yves Desrosiers qui est connu à Montréal et qui a déjà une carrière de 10 ans. Ainsi, en juillet 1991, Yves Desrosiers se rend dans un café pour voir un spectacle avec l’une de ses amies. Desrosiers raconte ainsi cette rencontre :
Cette rencontre va être celle avec le guitariste canadien Yves Desrosiers qui est connu à Montréal et qui a déjà une carrière de 10 ans. Ainsi, en juillet 1991, Yves Desrosiers se rend dans un café pour voir un spectacle avec l’une de ses amies. Desrosiers raconte ainsi cette rencontre :
«Mon amie était avec une jeune fille de 18 ans aux longs cheveux blonds, fraichement débarquée de San Francisco. Elle était venue voir ses sœurs qui travaillaient dans le milieu du cirque à Montréal. Elle me posait beaucoup de questions sur mon métier de musicien professionnel. Je me rappelle l’avoir trouvé rigolote.»
Il se croise plusieurs fois jusqu’à l’été 1992 ou il se reparle plus longuement :
«J’avais décidé d’aller manger sur Saint-Denis avec ma même amie. Par hasard, on est tombés sur Lhasa, qui venait juste de se faire raser la tête. On s’est assis et on a commencé à jaser. C’est là qu’elle m’a dit qu’elle s’ennuyait un peu et qu’elle avait envie de chanter. Au fil de la conversation, j’apprends qu’elle chante des vieilles chansons de jazz pour ses amis, dans des cafés. Moi, à ce moment-là, mes affaires vont moins bien [..] Je suis donc à la recherche de nouveaux projets […] C’est un peu ça que j’ai en tête quand je prends un carton d’allumette et que je lui donne mon numéro de téléphone.»
Elle va lui chanter du jazz et des chansons de Billie Holiday, mais Yves Desrosiers ne va pas du tout être convaincu.
Elle lui montre alors d’autres chansons : «On est tombés dans le jazz brésilien, dans les chansons portugaises. Avec cette langue-là, sa voix m’apportait autre chose de plus unique et intéressant. »
Ils vont commencer à faire des duos guitare/chant dans des bars. Et cela plait. Alors ils creusent dans d’autres musiques qui avaient accompagné Lhasa dans son enfance : Lhasa fait découvrir à son nouvel ami des cassettes de ranchera et de classiques mexicains. Et Desrosiers de dire :
«J’ai tout de suite été emballé par ce qu’elle me faisait entendre. On était en 1992, et tranquillement, y a un vent de musiques du monde qui s’installait. Ça m’intéressait d’autant plus qu’on développe cette facette-là de son bagage musical. Pour la première fois, j’entendais du Chavela Vargas, du Mercedes Sosa, des valses chiliennes, plein de trucs que je ne connaissais pas en tant que guitariste rock’n’roll.»
 Les deux musiciens apprennent à se connaitre sur scène en accumulant les spectacles dans les bars montréalais, voyant s’agglutiner une clientèle de curieux de plus en plus grande.
Les deux musiciens apprennent à se connaitre sur scène en accumulant les spectacles dans les bars montréalais, voyant s’agglutiner une clientèle de curieux de plus en plus grande.
L’article d’Olivier Boisvert-Magnen est très détaillé et rejoint parfaitement le récit que fait Fred Goodman de ces années.
Cela prendra encore plusieurs années jusqu’en 1997 année où ayant trouvé un producteur, ils vont enregistrer ce qui deviendra le premier album de Lhassa.
Le journaliste précise :
« À ce moment, la chanteuse poursuit un long cheminement créatif, qui l’amène à remettre constamment en question la signification et la valeur de ses textes. «Elle avait beaucoup de questionnements existentiels. Pour elle, l’écriture, c’était un long processus», dit Yves Desrosiers, avouant ne pas avoir trop prêté attention au sens de ses paroles à l’époque.
À l’image de son parcours nomade, les textes de la chanteuse évoquent différentes cultures, référant autant au chanteur mexicain Cuco Sánchez (Por eso me quedo) et à la poésie aztèque (Floricanto) qu’à une pièce de théâtre espagnole de la fin du XVe siècle (La Celestina) et au désert de Sonora qu’elle a traversé quand elle habitait dans la Basse-Californie (El desierto). »
À travers ces différents repères culturels, Lhasa laisse une place importante à ses réflexions spirituelles. Sur De cara a la pared, par exemple, elle parle «de l’absence de l’autre, de la paralysie, de l’impuissance à réagir» et s’en remet désespérément à Dieu, «la face contre le mur». Elle reprend aussi les chansons traditionnelles El payande (une allégorie afro-péruvienne «à trois niveaux de lecture» qui sous-entend qu’on peut être l’esclave d’une religion) et Los peces (une relecture d’un style de musique espagnole très ancien qui «parle de la Vierge comme d’une femme normale»).
Il cite aussi Lhassa qui dira en 2008 :
«La religion, la spiritualité, la foi : toutes ces choses-là sont très présentes dans ma vie. J’ai vécu deux ans en autarcie dans une communauté catholique, communiste et anarchiste, dans l’état de New York. Mes parents pratiquaient le bouddhisme, mon père voulait devenir prêtre… Il y avait une profonde recherche spirituelle dans sa vie. Il ne supportait pas l’hypocrisie ni tout ce qui était dogmatique. Il y avait une vraie soif de réponses, de conversations, de communication spirituelle… Personnellement, il y a des choses dans la religion catholique que j’aime beaucoup et d’autres que j’estime surtout être de la politique. Et c’est un peu pareil avec les autres religions. Alors, j’ai construit mon propre chemin. Je crois beaucoup aux signes, je crois que la vie nous parle. Je ne pense pas que les choses nous arrivent inopinément.»
Le succès sera rapidement au rendez-vous. Le duo sera invité au Printemps de Bourges en 1997 et pourra signer un contrat de disques avec l’étiquette française Tôt ou tard, sous laquelle sortira l’album quelques mois plus tard.
Le disque commence par le bruit de gouttes qui tombent, puis un violon qui chante la tristesse suivi d’une guitare et de percussions qui présentent un écrin à la voix remplie d’émotion de Lhassa qui souffle :
« Llorando / De cara a la pared / Se araga la ciudad [ Je pleure / La face contre le mur / la ville s’éteint] ».
La Llorona signifie «La Pleureuse» en espagnol et fait référence au fantôme d’une femme qui a perdu ses enfants et désire les retrouver dans la rivière. C’est une histoire qui vient de la mythologie hispano-américaine, et le talent, la spiritualité et l’émotion de Lhasa conduisent à un univers musical unique et pénétrant.
S’il faut choisir un titre au milieu de ces merveilles, je choisirai « El desierto »
<Voici l’enregistrement de 1997> et <Dans un live 2004>
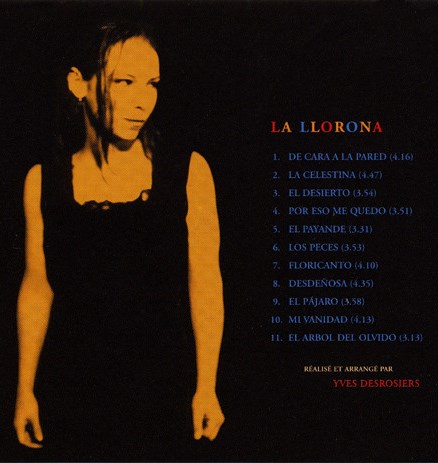 Voici le texte de cette chanson « Le désert »
Voici le texte de cette chanson « Le désert »
He venido al desierto pa’ reirme de tu amor
Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor
Je suis venue dans ce désert, pour rire de ton amour
Car le désert est plus doux et l’épine m’embrasse mieux
He venido a este centro de la nada pa’ gritar
Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar
Je suis venue dans ce centre du néant pour hurler
que tu n’as jamais mérité ce que j’ai tant voulu donner.
He venido yo corriendo, olvidándome de ti
Dame un beso pajarillo, no te asustes colibrí
Je suis venue en courant…en t’oubliant
Embrasse-moi oiseau, n’aie pas peur colibri.
He venido encendida al desierto pa’ quemar
Porque el alma prende fuego cuando deja de amar
Je suis venue enflammée dans ce désert pour brûler.
Car l’âme prend feu quand elle cesse d’aimer
Bertrand Dicale disait sur <France musique >:
« Mais chez Lhasa de Sela, il y avait de toute évidence quelque chose d’absolument vital dans ses chansons. Quelque chose qui tient de la profondeur autant que de l’altitude – une manière d’explorer tout à la fois les tréfonds et les sommets, d’être tout ensemble tsigane et poétesse, chanteuse de danses et jongleuse de blues.
Peu d’artistes n’ont donné autant qu’elle l’impression de voir un funambule en même temps qu’on entend un philosophe, ni l’impression d’être perdu quelque part dans le temps et l’espace – est-ce une minuscule taverne du désert ou une immense arène, le temps des tribus nomades ou le très moderne aujourd’hui… »
<1617>
-
Mercredi 3 novembre 2021
« La route de Lhasa (1972-2010)»Documentaire d’Élise Andrieu consacré à la chanteuse Lhasa de SelaConnaissez-vous Lhasa ?
Clara Ysé la désigne comme une de ses inspiratrices
Je ne la connaissais pas et puis j’ai entendu, sur France Culture, en août, dans une émission du samedi « Toute une vie », ce documentaire : <La route de Lhasa (1972-2010)> et j’ai appris à la connaître.
Alors, j’ai acquis les trois albums qu’elle a réalisés au cours de sa vie.
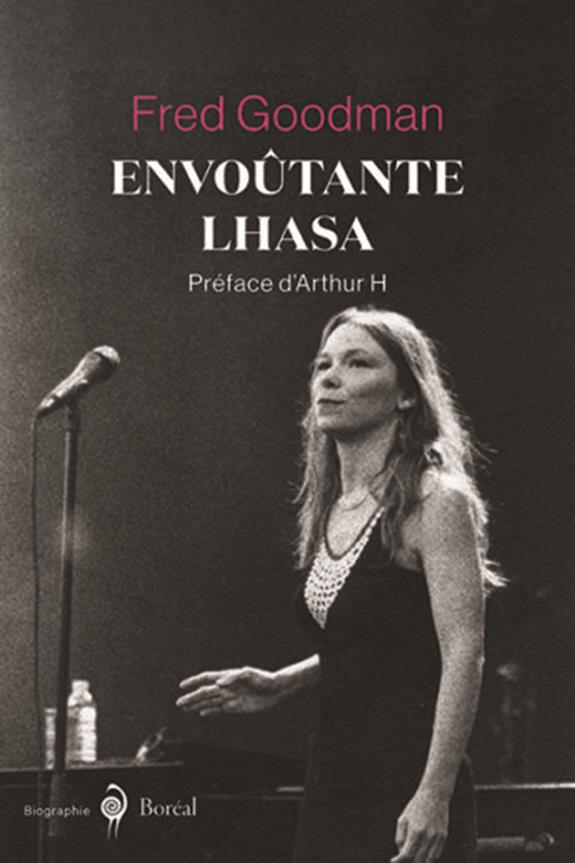 Puis, J’ai acheté le livre de Fred Goodman « Envoûtante Lhasa » et je l’ai lu pendant notre séjour dans le massif de la chartreuse, en écoutant les chansons de cette artiste incomparable qui exprime une émotion qui touche et fait vibrer dans les profondeurs de l’être.
Puis, J’ai acheté le livre de Fred Goodman « Envoûtante Lhasa » et je l’ai lu pendant notre séjour dans le massif de la chartreuse, en écoutant les chansons de cette artiste incomparable qui exprime une émotion qui touche et fait vibrer dans les profondeurs de l’être.
Annie partage ma fascination pour cette chanteuse dont la parenthèse enchantée d’existence a été si courte.
Heureusement que nous sommes d’accord, parce que la voix enregistrée de Lhasa a rempli beaucoup l’espace sonore de notre gite.
Le livre de Fred Goodman a été édité d’abord au Canada fin 2020 et a été publié en France en mars 2021, c’est donc tout récent.
Ce livre s’ouvre ainsi :
« New York, 9 janvier 2010
Voici Lhasa qui vient tout juste de mourir, ce jour de l’an à Montréal. C’est ainsi que Delphine Blue m’a révélé l’existence de Lhasa de Sela. […]
Après cette présentation, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais jamais je n’aurais pu anticiper ceci : un froid carillon se détachait d’un bourdonnement grave et cadencé évoquant la voix de la Terre que je n’avais entendu que dans la musique des moines tibétains de Gyuto. Au-dessus flottait, tel un vent sec du désert un solo de trompette à la Don Cherry. J’étais transporté en une contrée inhospitalière, un lieu très lointain où je foulais à la merci des éléments, un rude sentier millénaire sous un vaste ciel nocturne.[…]
Une musique envoutante, ambitieuse et raffinée, un propos d’une grande maturité émotionnelle. […] Comment pouvais-je n’avoir jamais entendu parler d’elle ? »
Et c’est ainsi qu’a commencé la quête de Fred Goodman, journaliste spécialisé dans la musique, écrivant dans le magazine Rolling Stone et dans Le New York Times pour rédiger la première biographie de Lhasa en allant notamment à la rencontre de celles et de ceux qui ont connu cette artiste née le 27 septembre 1972 à Big Indian, New York.
Goodman a d’ailleurs dédié son livre à Alexandra la mère de Lhasa.
Alexandra Karam est américaine, elle est d’origine mixte russo-polonaise par sa mère et libanaise par son père (Karam).
 Alexandra est la fille d’Elena Karam qui a fait la rencontre d’Elia Kazan et décroché son rôle le plus important au cinéma, soit celui de la mère dans America, America. Le père d’Alexandra était un brillant avocat new-yorkais qui a épousé la mère d’Alexandra pour légitimer la naissance de leur fille. Ils ont ensuite rapidement divorcé, sans jamais vivre sous le même toit. Puis cela devint difficile pour Alexandra qui détestait le nouveau mari de sa mère, autre new-yorkais riche et influent. Elle deviendra une enfant très indocile.
Alexandra est la fille d’Elena Karam qui a fait la rencontre d’Elia Kazan et décroché son rôle le plus important au cinéma, soit celui de la mère dans America, America. Le père d’Alexandra était un brillant avocat new-yorkais qui a épousé la mère d’Alexandra pour légitimer la naissance de leur fille. Ils ont ensuite rapidement divorcé, sans jamais vivre sous le même toit. Puis cela devint difficile pour Alexandra qui détestait le nouveau mari de sa mère, autre new-yorkais riche et influent. Elle deviendra une enfant très indocile.
Son beau-père exige de sa mère :
« Je ne peux plus tolérer ça. Tu dois te débarrasser d’elle »
C’est ainsi qu’Alexandra se trouvera enfermé dans un hôpital psychiatrique du Maryland. Et elle comprendra que le projet est qu’elle y reste !
Je ne vais pas raconter toute l’histoire d’Alexandra telle que Goodman la déroule dans son livre. Mais ce qu’il faut comprendre c’est que la mère de Lhasa était une enfant rebelle dans une famille très aisée de New York qui voulait s’en débarrasser en l’enfermant. Elle va s’en sortir par une vie d’errance, de drogue, de mariages successifs. Elle sera photographe.
Et le père ? Alejandro de Sela ?
Lui aussi sera « un mouton noir » selon l’expression de Goodman d’une famille aisée mexicaine. Il est né à San Francisco et a passé les premières années de sa vie dans un va et vient incessant entre le Mexique et les États-Unis. Sa mère Carmen de Obarrio, était une pianiste de concert panaméenne qui avait enregistré chez RCA Victor dans les années 1920. Le grand père maternel d’Alejandro était ambassadeur du Panama aux États-Unis. Le père d’Alejandro était un homme d’affaires mexicain qui devint prospère.
Mais Alejandro était très inspiré par la contre-culture et va se lancer dans une quête spirituelle incessante. Miriam de Sela, sœur cadette de Lhasa raconte :
« Mon père a essayé pratiquement toutes les religions qui existent sur la planète. Et il n’éprouvait aucun scrupule de passer de l’une à l’autre : pour lui ce n’était pas contradictoire. »
 Et c’est donc ces « deux moutons noirs » qui vont se rencontrer et donner naissance à Lhasa de Sela ainsi qu’à trois autres filles. Le couple durera 12 ans.
Et c’est donc ces « deux moutons noirs » qui vont se rencontrer et donner naissance à Lhasa de Sela ainsi qu’à trois autres filles. Le couple durera 12 ans.
Mais la famille d’Alexandra et d’Alejandro est beaucoup plus étendue que cela.
Ainsi Lhasa en plus de ses trois sœurs directes a aussi trois demi-sœurs et trois demi-frères
Cette famille vivra d’amour, de culture et de livres comme cela est précisé dans le documentaire. Du point de vue des ressources financières, elle fera comme elle peut.
Le père trouvera pertinent d’acquérir un autobus qui constituera à la fois le logis et le moyen de transport de toute la famille. Le titre «La route de Lhasa» se comprend aussi par cette vie nomade dans les premières années de vie.
TELERAMA écrira en 2009, pour parler du dernier album :
« Jamais cette femme de 37 ans n’a suivi les chemins balisés, ni dans sa musique ni dans sa vie. Existence d’emblée marquée par le sceau de la singularité : fille d’un Mexicain, ex-ouvrier devenu prof de philo, et d’une Américaine photographe et joueuse de harpe, elle aura passé son enfance à sillonner le sud des États-Unis et le Mexique à bord d’un… autobus familial : « Un jour, il est tombé en panne, raconte-t-elle . Le moteur avait cassé. Nous n’avions pas d’argent et avons logé dans une station-service. Mon père travaillait comme saisonnier et cueillait les légumes et les fruits. Parfois, nous allions dans les champs avec lui pour cueillir les tomates, toute la journée. Après des mois, on a réussi à accumuler l’argent nécessaire pour acheter un nouveau moteur et repartir. » Trois décennies plus tard, l’errance revient en écho dans nombre de ses chansons, dont la langueur mélancolique évoque les grands espaces. »
J’ai aussi trouvé cette description qui est proche de ce qu’écrit Goodman sur ce site consacré à la pop moderne <Section26.fr> :
« Alexandra Karam et Alejandro de Sela vivent alors et vivront encore des années durant sur la route, dans un ancien car scolaire, l’un de ces school bus jaunes iconiques, reconverti en camping car, en foyer roulant.
[…] Alexandra a choisi la bohème, la liberté, a assisté aux sessions qui ont donné naissance au free jazz, a connu Charlie Haden dont elle s’est éloignée pour s’éloigner, aussi, de l’héroïne. Sa rencontre avec Alejandro Sela, sous les apparences brinquebalantes que donne leur vie commune sans domicile fixe, est ainsi une pause, propice à l’édifice. Car la quête d’Alejandro, d’origine mexicaine, est tout aussi tranquillement intranquille : il arpente les pratiques mystiques dans un questionnement spirituel constant, que rejoint Alexandra, tout en s’éprouvant ouvrier le plus souvent agricole, lui qui a renoncé à un confortable héritage en marxiste du temps. Ces deux êtres n’éprouvent guère le souci du qu’en-dira-t-on, s’accordent sur l’éducation des filles – menée pour la partie scolaire par Alexandra –, déplacent la famille selon les emplois trouvés par le père, les communautés rencontrées, les quêtes et les enseignements. La vie est engagée, précaire, entre les États-Unis et le Mexique, le monde est syncrétique : Alejandro récite des « Je vous salue Marie », chante des sutras bouddhistes, lit la Bible et Rumi, médite. Et de même, Alejandro et Alexandra lisent sans exclusive, ouverts à l’Orient et à la magie, versés dans les contes, ils écoutent des musiques de toutes les origines et de toutes les époques – Maria Callas, des field recordings, des rancheras, Victor Jara, Violetta Parra – les cultures plutôt que la culture.
Et ils font don de ça, de ces trésors et de cette curiosité à leurs filles, de même que de leur exigence : il s’agit chaque jour d’être, de faire, de créer, de donner.
Ils ne leur font pas don de la société, et entre deux pauses sédentaires le vase reste souvent clos, une bulle réduite au bus et aux arpents où il stoppe.
Si l’on doit alors imaginer, on entrevoit beaucoup d’amour et beaucoup de poids sur les épaules des enfants qui, peu à peu, découvrent que le monde n’est pas que ce que leurs parents leur offrent, que ce que leurs parents leur offrent est souvent résumé, majoritairement nié, parfois ri, et que l’exigence peut rencontrer le vide. Les hiatus ainsi sont des gouffres à enjamber ; nous avons tous le souvenir de semblables événements : pour elles, ils sont le quotidien.
Il s’agit donc de faire, d’apprendre, de créer.
S’amuser sans doute, aussi, parce que c’est sacré. Mais la paresse, non.
Lhasa est la plus rêveuse, et ne suit pas ses sœurs dans la voie circassienne qu’elles se trouvent, passe pour indisciplinée, moins travailleuse, est surtout la tête aux histoires, aux vertiges de l’être. Elle n’a simplement pas trouvé encore comment raconter ça, ses histoires, le monde. Mais elle chante, déjà, du matin au soir, agace les autres à ne jamais cesser de chanter, fredonne ou siffle pour donner le change. »
Dans le documentaire « La route de Lhasa », les sœurs racontent aussi que Lhasa fredonnait tout le temps et que cela énervait les autres dans cet espace restreint qu’était ce bus.
Au début du documentaire, une sœur de Lhasa la décrit à peu près ainsi : « Il y a un livre qui est parfait pour décrire Lhasa. C’est un livre qui parle d’un troupeau de petite souris. Et toutes les souris sont très travailleuses. Elles préparent l’hiver et elles mettent les graines de côté. Sauf une qui ne fait rien et toutes les autres qui disent : « Mais qu’est-ce que tu fais ? pourquoi tu ne participes pas ? » La petite souris dit : « moi je collectionne les couleurs et les mots. Parce que quand ce sera le creux de l’hiver on en aura besoin ».
Alors le début de l’hiver est facile avec les provisions. Mais après cela devient dur, de plus en plus dur. C’est alors que la petite souris puise dans les couleurs et les mots qu’elle a collectionnés et leur parle, leur offre les mots qui réchauffent le cœur et leur permettent de percevoir, au fond d’eux, l’image et la pensée du soleil qu’elles ne voient pas. C’est ça Lhasa. »
Et puis il faut bien finir par une chanson : Voici « Con toda palabra » chantée en 2004, lors de son passage sur la scène parisienne du Grand Rex. Voilà les mots collectionnés par Lhasa:
Con toda palabra Avec tous les mots Con toda sonrisa Avec tous les sourires Con toda mirada Avec tous les regards Con toda caricia Avec chaque caresse Me acerco al agua Je m’approche de l’eau Bebiendo tu beso En buvant ton baiser La luz de tu cara La lumière de ton visage La luz de tu cuerpo La lumière de ton corps Es ruego el quererte C’est une prière t’aimer Es canto de mudo C’est un chant de muet Mirada de ciego Un regard d’aveugle Secreto desnudo Un secret nu Me entrego a tus brazos Je me rends à tes bras Con miedo y con calma Avec peur et calme Y un ruego en la boca Une prière dans la bouche Y un ruego en el alma Et une prière dans l’âme Con toda palabra Avec tous les mots Con toda sonrisa Avec tous les sourires Con toda mirada Avec tous les regards Con toda caricia Avec chaque caresse Me acerco al fuego Je m’approche du feu Que todo lo quema Que tout brûle La luz de tu cara La lumière de ton visage La luz de tu cuerpo La lumière de ton corps Es ruego el quererte C’est une prière t’aimer Es canto de mudo C’est un chant de muet Mirada de ciego Un regard d’aveugle Secreto desnudo Un secret nu Me entrego a tus brazos Je me rends à tes bras Con miedo y con calma Avec peur et calme Y un ruego en la boca Une prière dans la bouche Y un ruego en el alma Et une prière dans l’âme <1616>
-
Mardi 2 novembre 2021
« Mise à feu »Clara YséClara Ysé a fait l’objet du mot du jour du 16 octobre 2019 « Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s’est dédoublé ». Cette phrase est le début d’une chanson envoutante, comme je la qualifiais alors.
Elle avait été écrite par la chanteuse suite au décès brutal de sa mère, la philosophe Anne Dufourmantelle qui était morte d’un arrêt cardiaque suite aux efforts qu’elle avait fournis pour porter secours à deux enfants qui étaient en train de se noyer dans la mer. J’avais narré cette histoire dans le mot du jour du 26 septembre 2019 « Puissance de la douceur »
Fin août 2021, elle était <l’invité des matins de France culture>, parce qu’elle venait de publier son premier roman : « Mise à feu ».
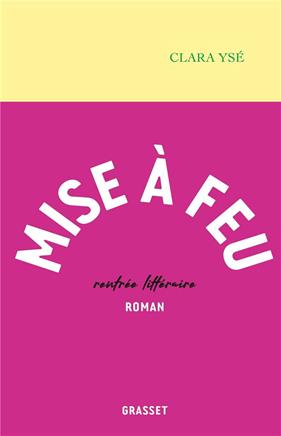 Et comme il en va quelquefois quand on entend l’auteure d’un livre, le désir de le lire jaillit.
Et comme il en va quelquefois quand on entend l’auteure d’un livre, le désir de le lire jaillit.
J’ai acheté ce livre le lendemain et je l’ai lu immédiatement.
C’est un livre qui comme la chanson <Le monde s’est dédoublé> parle de la séparation et de l’absence.
Gaspard, 8 ans et Nine 6 ans vivent avec leur mère qu’ils appellent l’Amazone. C’est Nine qui est la narratrice. Voici comment elle décrit sa mère :
« L’Amazone, Gaspard et moi on inspirait la joie quand on passait quelque part. Je me souviens de la façon dont on s’accrochait à ses jambes. Le soir pendant qu’elle travaillait ou qu’elle faisait la cuisine. Elle était bijoutière. […] L’Amazone portait en elle un magnétisme qui planait au-dessus de tout ce qu’n vivait. Une forme de grâce, en plus charnel. Depuis petits, ça nous inquiétait. Comme si au creux de ce pouvoir qu’elle avait d’enchanter les êtres, résidait un pacte mortel avec le monde. Un poids que tous ses gestes tentaient désespérément de dissimuler et qui résonnait autour d’elle comme un bourdon, cette note tenue, quasi imperceptible, qui charge un morceau d’orage.
Gaspard et moi, on savait, mais on ne disait rien. »
page 12
L’Amazone est donc une femme et une mère assez étrange.
Ce roman est initiatique : le frère et la sœur vont au long des pages grandir et s’émanciper. Il constitue aussi un conte fantastique qui commence ainsi :
« Avant mes six ans, c’est le soleil. Quelque chose de pur, de frais, de vivant. Gaspard, l’Amazone, Nouchka et moi. Unis. »
Il y a Nouchka.
Nouchka est une pie Gaspard et Nine comprennent son langage et peuvent échanger avec elle :
« On l’a découverte un jour sur le bord e la route, dans le Sud. Elle avait une aile cassée. On l’a recueillie, on lui a donné à boire, à manger, tant et si bien que Nouchka nous a déclaré, au bout de quelques mois, que nous étions sa nouvelle famille. Je dis « déclaré » oui […] elle nous a appris, elle, à parler oiseau. […] On lui répondait. On lui parlait. Ca me parait étranger aujourd’hui, mais l’amazone avait ce genre de dons. Elle avait fait advenir la langue du vol, de l’air, de la liberté, entre nos bouches
Dans l’émission de France Culture, Clara Ysé confie que :
« Le langage des oiseaux est celui des poètes »
C’est un monde de l’imaginaire, dans lequel Gaspard, plus que Nine, est immergé :
« Gaspard, mon frère, mon aîné de deux ans. Il portait des lunettes rondes et vivait dans un univers parallèle, dont l’Amazone, Nouchka et moi avions la clé. »
Et puis, il y a l’incendie. L’Amazone a invité beaucoup de monde chez elle, pour fêter le tournant du deuxième millénaire. Les adultes s’étourdissent de musique et d’alcool, et un gigantesque incendie se déclare dans la maison et l’embrase.
Au bout de la nuit de cauchemar, Nine se rend compte que l’Amazone a disparu.
Les deux enfants sont confiés à leur oncle, surnommé le Lord.
La plus grande partie du roman se déroule dans la maison de cet homme, trouble, alcoolique, violent qui invite dans sa maison des hommes et des femmes dans une ambiance malsaine pour les enfants et une sourde menace à leur égard notamment de Nine, protégée autant que possible par son frère et l’intelligence de Nouchka.
Dans une atmosphère de crainte, les enfants sont confrontés à l’absence, à la perte. Mais de temps en temps, une lettre de l’Amazone arrive, dans laquelle elle les assure de son amour et raconte qu’elle fait des travaux dans une maison de campagne où elle s’est réfugiée et qu’ils pourront venir la rejoindre quand le chantier aura suffisamment avancé. Dans la longue attente qui les conduira jusqu’à la sortie de l’adolescence, les enfants se réfugient dans l’imaginaire.
Puis des rencontres vont permettre à Nine de se libérer, revenir vers le réel, rencontrer l’amour, fuir la maison du Lord pour aller à la recherche de l’Amazone et aller vers la vie..
Gaspard ne parviendra pas à réaliser le même parcours, son monde imaginaire le tient trop fort.
 Clara Ysé explique dans l’émission de France Culture :
Clara Ysé explique dans l’émission de France Culture :
« La symbolique de Nouchka à une double lecture puisque c’est à la fois le symbole de leur langage à deux, puis lorsque Nine ne va plus la comprendre, elle symbolise le retour au réel, l’entrée dans le monde des adultes. Gaspard à l’inverse, refuse tout rapport au réel et se laisse avaler par l’imaginaire. »
L’écriture de Clara Ysé est subtile, elle suggère plus qu’elle ne décrit.
Je trouve très juste l’avis de la journaliste Sophie Joubert dans <L’Humanité> :
« Elle transfigure la perte et la violence par l’art, les mots, un dialogue secret avec les oiseaux. »
Dans ce même article Clara Ysé dit :
« J’ai puisé le matériel d’écriture dans la relation très forte que j’ai avec mon petit frère, à qui le livre est dédié. À deux, Gaspard et Nine forment une entité, ils ont un rapport sensible au monde et un langage commun, celui de l’oiseau, qu’ils sont les seuls à comprendre. Je voulais montrer la puissance vitale des mondes imaginaires qu’on crée à cet âge-là pour rendre le réel vivable. »
Et revient vers son histoire personnelle :
« Je n’ai jamais vécu de vrai incendie, mais, tel qu’il est présenté dans le roman, c’est un événement qui détruit tout d’une seconde à l’autre. Et ça, je l’ai vécu. »
La Nouvelle République consacre aussi un article élogieux à ce livre : « L’incandescente Clara Ysé désormais aussi écrivaine»
Elle y révèle que la musique et l’écriture l’ont accompagné depuis longtemps :
« La musique et l’écriture, ça a toujours été mes deux langues […] La musique, je l’ai partagée très vite alors que l’écriture est longtemps restée intime ».
Et Sophie Rosemont dans <Madame Figaro> écrit :
« Avec « Mise à feu », son premier roman, Clara Ysé embrase la rentrée littéraire, […] C’est un premier roman et c’est une révélation : déjà chanteuse et performeuse de haut vol, l’artiste française nous emporte dans une belle histoire d’amour et de ténèbres.
Pour ce livre, elle a reçu le <prix littéraire de la Vocation 2021>
Et elle reviendra à la chanson en 2022, un album est annoncé au printemps.
<1615>
-
Vendredi 29 octobre 2021
« Pause (Dans 20 ans, la demande de main-d’œuvre sera substantiellement plus faible)»Un jour sans mot du jour nouveauLe jour, avant un grand week-end devrait être férié.
 C’est ce que me dit mon corps et mon esprit.
C’est ce que me dit mon corps et mon esprit.
Il faut toujours écouter son corps.
Le 29 octobre 2014, je reprenais une prévision de Bill Gates :
Si je compte bien dans 20 ans en 2014, signifie que c’est dans 13 ans aujourd’hui.
Et il ajoutait :
« Je ne pense pas que ce soit intégré dans le modèle mental des gens ».
C’est peut être mieux intégré aujourd’hui, car Amazon nous a montré que les entrepôts pouvaient se vider des humains.
Et hier, c’était Xavier qui remplaçait la force publique à Singapour.
J’ai hésité de mettre à l’affiche un chat robot comme celui que vous trouvez dans cet article de 2020 : <Votre prochain chat sera peut-être un robot>
Finalement j’ai préféré ce chat bougon car je préférerai toujours le vivant aux machines.
Car comme l’écrit Alain Damasio
« Le vivant n’est pas une propriété, un bien qu’on pourrait acquérir ou protéger.
C’est un milieu, c’est un chant qui nous traverse dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés.
Si bien que s’il existe une éthique en tant qu’être humain.
C’est d’être digne de ce don sublime d’être vivant.
Et d’en incarner, d’en déployer autant que faire se peut les puissances.
Qu’est-ce qu’une puissance ?
Une puissance de vie !
C’est le volume de liens, de relations qu’un être est capable de tisser et d’entrelacer sans se porter atteinte.
Ou encore c’est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables
Vivre revient alors à accroitre notre capacité à être affecté.
Donc notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému.
Contracter une sensation, contempler, habiter un instant ou un lieu. »
<Mot du jour sans numéro>
-
Jeudi 28 octobre 2021
« Xavier»Ce prénom ne correspond à rien d’humain à SingapourJ’ai souvent entendu dans des émissions de radio, dans lesquels intervenaient des économistes libéraux, les plus grands éloges sur l’organisation politique de Singapour et sa capacité à favoriser le développement économique.
 Singapour est un tout petit État : 719 km²
Singapour est un tout petit État : 719 km²
Pour qu’on puisse avoir une idée de comparaison, la métropole de Lyon représente 534 km².
Dans la région parisienne, il existe la métropole du Grand Paris qui regroupe la ville de Paris et 130 communes, comprenant l’intégralité des communes des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ainsi que six communes de l’Essonne et une du Val d’Oise. Cette entité représente 814 km².
L’État de Singapour est situé à l’extrême sud de la péninsule Malaise, dont il est séparé au nord par le détroit de Johor, et borde au sud le détroit de Singapour.
Il comprend 63 îles, dont la principale est Pulau Ujong qui représente à elle seule 81% du territoire de l’État.
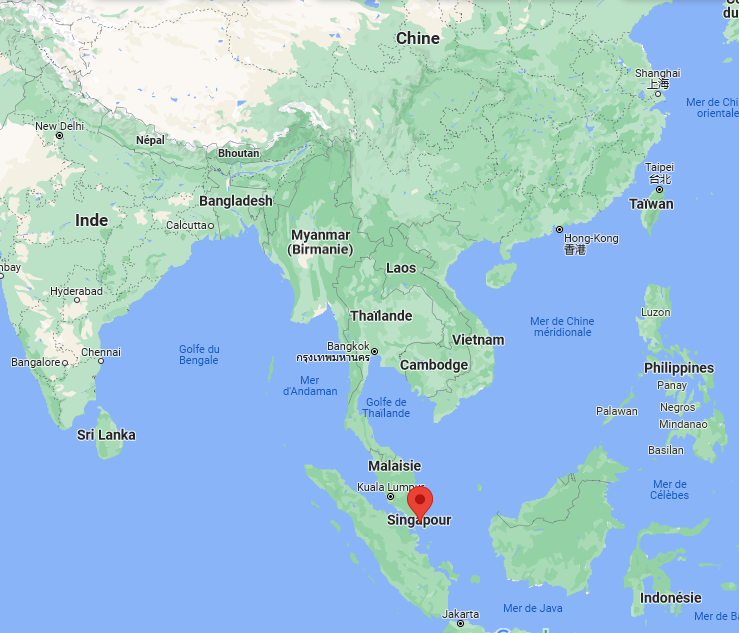 La raison pour laquelle Singapour ne fait pas simplement partie de l’État de Malaisie est une histoire de religion et d’ethnie.
La raison pour laquelle Singapour ne fait pas simplement partie de l’État de Malaisie est une histoire de religion et d’ethnie.
La Malaisie et Singapour étaient colonies Britanniques depuis 1795. Et quand Les britanniques se sont retirés l’État indépendant qui a été créé en 1957 comprenait bien Singapour.
La Malaisie, hors Singapour, était un pays musulman, les habitants de Singapour d’origine chinoise étaient bouddhistes.
<Wikipedia> présente ainsi cette séparation de 1965 :
« Le retrait de Singapour de la fédération de Malaisie, le 9 Août 1965 fut pratiquement vu comme une partition de la Malaisie en deux états, par les observateurs étrangers, mais, à la différence de l’Inde, cette partition n’était pas religieuse, mais plutôt ethnique, avec la création de l’état de Singapour, majoritairement peuplé de Chinois, et la Malaisie, majoritairement peuplée de Malais musulmans, mais avec une forte minorité de Chinois. Avant 1965, les Chinois étaient aussi nombreux que les Malais, en Malaisie, Les deux parties n’arrivaient pas à s’entendre pour le partage du pouvoir entre Chinois et Malais, d’autant plus que les Malais étaient favorables à un régime monarchique, alors que les Chinois voulaient un régime républicain, ce qui laissait présager une grave guerre civile ethnique, expliquant largement le retrait de Singapour, en 1965. »
Ce sont les Malais de la péninsule qui forcent Singapour à quitter la Fédération contre la volonté du responsable politique de Singapour qui constituait une des régions autonomes de la Malaisie : Lee Kuan Yew.
C’est ce dernier qui est cité en exemple pour sa capacité de direction l’État de manière très ferme tout en préservant une démocratie.
Lorsqu’il fut contraint d’assumer la séparation entre la Malaisie et Singapour il tint ce discours :
« Pour moi, c’est un moment d’angoisse. Toute ma vie, toute ma vie d’adulte, j’ai… j’ai cru en l’union avec la Malaisie et à l’unité des deux territoires. Vous savez que nous, en tant que peuple lié par la géographie, l’économie, par des liens de parenté… Cela détruit littéralement tout ce pour quoi nous avons lutté… Maintenant, moi, Lee Kuan Yew, Premier ministre de Singapour, dans la responsabilité qui m’incombe, je proclame et déclare au nom du peuple et du gouvernement de Singapour que, à partir de ce jour, le 9 août de cette année mille neuf cent soixante-cinq, Singapour sera à jamais une nation indépendante, souveraine et démocratique, fondée sur les principes de liberté et de justice et avec pour but la recherche du bien-être et du bonheur du peuple dans une société la plus juste et égalitaire possible. »
Et de ce minuscule État, sans beaucoup de ressources, Lee Kuan Yew qui restera premier ministre de 1965 à 1990, fera un miracle économique. Voici l’évolution du PIB depuis 1965 :
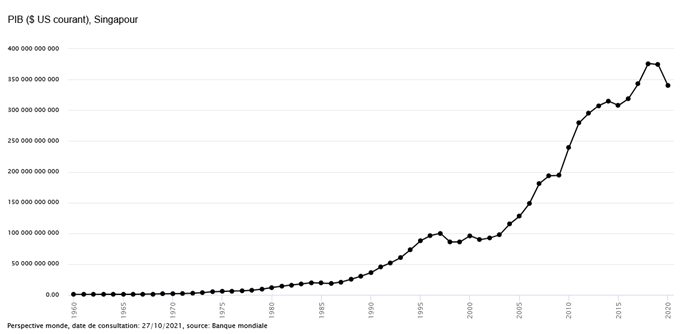
De presque rien en 1965, le PIB est monté à près de 400 milliards de dollars faisant en 2017, selon le FMI, de Singapour le 4ème pays du classement du PIB par habitants,( devancé seulement par le Qatar, Macao et le Luxembourg. La France est 29ème de ce classement.
Comment ce micro État fait-il ?
Selon <Wikipedia> :
« Son économie repose sur les services bancaires et financiers (deuxième place financière d’Asie après le Japon), le commerce, la navigation (deuxième port du monde derrière Shanghai pour le tonnage cargo, mais aussi en conteneurs pour la même année, le tourisme, les chantiers navals et le raffinage du pétrole (troisième raffineur mondial).
Le secteur de l’industrie électronique est également très dynamique et connu dans le monde entier. »
Et c’est donc dans ce pays moderne, dynamique, exemple pour tous ceux qui ont le PIB et l’ordre en ligne de mire, qu’est né Xavier. Je l’ai découvert sur France Inter, dans l’émission <Sous les radars> du 6 octobre 2021 :
 « Une voix métallique, une voix d’automate, Singapour inaugure depuis quelques temps sa nouvelle trouvaille high tech, des robots sur roue, équipés de 7 caméras différentes, qui arpentent les rues de la Cité État pour détecter les « comportements sociaux indésirables » et réprimander les contrevenants. Le robot s’appelle Xavier. C’est marqué dessus mais c’est bien là son seul attribut humain. Pour le reste il ne laisse rien passer. Ni les fumeurs qui en grille une dans une zone non autorisée, ni les enfants qui garent mal leur vélo, ni les retraités qui jouent aux échecs sans respecter les gestes barrière. Xavier voit tout et rappelle à l’ordre, avec sa voix naisillarde, sans toutefois passer à la contravention. Le système est encore en rodage.
« Une voix métallique, une voix d’automate, Singapour inaugure depuis quelques temps sa nouvelle trouvaille high tech, des robots sur roue, équipés de 7 caméras différentes, qui arpentent les rues de la Cité État pour détecter les « comportements sociaux indésirables » et réprimander les contrevenants. Le robot s’appelle Xavier. C’est marqué dessus mais c’est bien là son seul attribut humain. Pour le reste il ne laisse rien passer. Ni les fumeurs qui en grille une dans une zone non autorisée, ni les enfants qui garent mal leur vélo, ni les retraités qui jouent aux échecs sans respecter les gestes barrière. Xavier voit tout et rappelle à l’ordre, avec sa voix naisillarde, sans toutefois passer à la contravention. Le système est encore en rodage.
Une surveillance de tous les instants qui inquiète les rares militants des droits de l’homme à Singapour. « On a l’impression, dit cette militante, de ne plus être en sécurité pour exprimer certaines opinions ou adopter certains comportements. On doit faire attention à tout ce qu’on dit et à tout ce qu’on fait, bien plus que dans n’importe quel autres pays. » « C’est comme une dystopie… Et le plus dystopique dans tout ça, conclue t-elle, c’est que c’est normalisé, et que les gens ne réagissent pas beaucoup. »
Pas de mobilisation populaire en effet contre ces redresseurs de torts robotisés. Il faut dire que les habitants de Singapour commencent à être habitués. Le gouvernement promeut depuis longtemps l’idée d’une nation intelligente, une smart nation, à la pointe de la technologie. Les caméras sont déjà omniprésentes dans les rues et les lampadaires équipés de logiciels de reconnaissance faciale. »
Quand on tape « xavier robot singapour» sur un moteur de recherche on trouve beaucoup d’articles et de vidéo sur cette « modernité ».
<Courrier International> essaye d’analyser cette évolution, dont certains rêvent dans nos contrées certainement, à travers le regard de journaux asiatiques :
« Est-ce que vous fumez dans une zone interdite ? Vous vous rassemblez à plus de cinq ? Méfiez-vous de Xavier, qui est à l’affût de ces ‘comportements sociaux indésirables' », mettait en garde début septembre la chaîne de télévision singapourienne Channel News Asia (CNA) sur son site Internet. »
La moindre infraction est repérée :
« Juchés sur quatre roues et se déplaçant à 5 km/h, ce robot est doté de caméras à 360 degrés et « est capable de voir dans l’obscurité », précise The Straits Times. « En une poignée de secondes, les images sont transmises à un centre de commandement et de contrôle, introduites dans un système d’analyse vidéo programmé pour reconnaître la posture d’un homme, les contours d’une cigarette dans sa bouche et d’autres signes visuels. » Et alors Xavier, d’une voix synthétique, s’adresse au contrevenant : « Merci de ne pas fumer dans un espace interdit tel que les passages couverts. » Des policiers visionnant les images peuvent également s’adresser directement aux fautifs par l’intermédiaire du robot, ajoute CNA. Pour l’heure, Xavier ne délivre aucune amende. »
On apprend qu’en mai 2020, Singapour avait déjà expérimenté un « chien robot » ayant pour mission de faire respecter les distances de sécurité dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
Si les journaux de Singapour ne trouvent rien à redire à cette surveillance omnisciente, c’est un journal indien de Bombay, « The Indian Express » qui évoque « ce Robocop dans ce paradis de l’autoritarisme consumériste ».
Il regrette que :
« Pour beaucoup, il n’y a rien de gênant à ce que des robots fassent respecter les règles ».
Pour conclure que :
« Le pire avec ce système de surveillance, n’est pas qu’il se substitue aux policiers et aide à attraper les auteurs d’infractions. […] C’est, en réalité, qu’il veille à ce que les gens se conduisent en permanence comme s’ils étaient épiés.
En d’autres termes, les robots comme les caméras et les logiciels de reconnaissance faciale ne sont pas faits pour que vous ayez peur de la police. Ils ont pour but de placer un policier dans votre tête. »
Voilà !
Cela se passe à Singapour, exemple de dynamisme, de société moderne et de développement économique. Une démocratie où règnent l’ordre, le calme et le civisme ….
<1614>
-
Mercredi 27 octobre 2021
« Vous pouvez écouter votre ostéopathe, il en est bien qui écoute leur coiffeur ! »Un médecin rencontré lors d’une échographieAujourd’hui je vais parler de médecins, de techniciens et d’ostéopathie.
Mais pour ce faire, il me semble utile de parler d’une expérience personnelle et d’expliquer le début de l’affaire.
Ce récit, écrit en couleur verte, peut être cependant sauté par les lecteurs pressés. Il a pour objet d’expliquer pourquoi un vendredi à 16 :10 je me suis retrouvé dans le cabinet d’un utilisateur de l’appareil S3000 de marque Siemens en vue de réaliser une échographie abdominale
Nous étions donc au mois de septembre dans un gîte situé dans le massif de la chartreuse, près du col du Cucheron.
Le premier matin, j’ai ouvert des volets à battants et en voulant les bloquer par le loquet prévu, je me suis appuyé sur le rebord de la fenêtre et j’ai essayé d’étendre mon bras droit jusqu’au loquet. J’ai brusquement senti une douleur suffisamment vive pour que j’arrête le mouvement et que je sorte pour accrocher le loquet de l’extérieur, exercice plus simple et plus confortable.
Dans l’après-midi, j’ai ressenti une douleur plus intense dans cette zone, sans d’abord faire le lien avec l’épisode du matin.
Le soir, il m’était impossible, dans le lit, de me coucher du côté droit, ni de tendre le bras droit pour attraper quoi que ce soit sur la table de nuit.
Cette douleur intense a duré une semaine.
Je me soignais avec des granules et de la crème d’arnica.
La deuxième semaine il y a avait une amélioration mais j’avais des sensations désagréables dans la même zone, notamment au moment de manger ou de digérer et quelques autres désagréments quand je respirais profondément ou que conduisais pendant un certain temps.
Au retour des vacances, en consultant mon oncologue pour la visite périodique, je lui ai fait part de cette douleur, des circonstances de son apparition.
En m’examinant, elle a conclu à des probables douleurs intercostales sans gravité.
Nous avons cependant décidé de réaliser un examen approfondi dans 6 mois (techniquement un pet scan) pour vérifier l’état des métastases du cancer.
Mais juste avant de partir, elle a ajouté : «si les douleurs persistent nous avancerons l’examen».
Cette remarque, juste à la sortie de la consultation, a eu pour effet d’augmenter légèrement mon niveau d’inquiétude.
Les douleurs persistaient sans que je puisse avoir la certitude qu’elles diminuaient. Je suis d’abord allé voir mon médecin traitant, puis mon ostéopathe qui ont tous les deux été rassurants. L’ostéopathe expliquant mes douleurs annexes en disant que tout étant lié dans la cavité abdominale, il n’était pas anormal que des douleurs organiques puissent être déclenchées par un traumatisme au niveau des côtes.
Et il avait été décidé de réaliser une échographie abdominale si au bout d’un mois, depuis le début des douleurs, si des perceptions désagréables persistaient.
Et voilà, pourquoi vendredi après-midi dernier je suis entré dans un cabinet d’échographie dans un hôpital lyonnais en vue d’un examen de la zone douloureuse.
Pour être efficace, le médecin qui m’a reçu m’a demandé de m’allonger pour que l’échographie débute immédiatement.
Il écoutait d’une oreille distraite ce que je lui racontais sur mon état de santé, toute son attention était retenue par l’appareil dont il était le servant.
Tout était normal, jusqu’à la détection des stigmates d’une fracture de l’axe antérieur de la 9ème cote droite avec un cal osseux.
Pour celles et ceux qui auraient besoin d’explications : Après une fracture, l’organisme est capable de fabriquer à nouveau de l’os et un épaississement osseux se forme afin de favoriser la cicatrisation de l’os : il s’agit d’un cal osseux.
C’est alors que nous avons engagé la conversation :
Moi : C’est donc cette fracture qui justifie mes douleurs ? et aussi mes douleurs plus profondes. Mon ostéopathe m’a expliqué que ces choses étaient liées.
Le médecin : De toute façon pour les ostéopathes tout est toujours lié !
Moi : Ah vous doutez de l’ostéopathie ?
Le médecin : Oh ! Vous pouvez écouter votre ostéopathe, il en est bien qui écoute leur coiffeur !
C’est ainsi que s’est achevé notre échange. Lui m’expliquant que je pouvais me rhabiller et qu’il allait préparer le compte rendu de l’examen.
Comparer l’avis d’un ostéopathe et l’opinion d’un coiffeur, c’est être un peu méprisant, selon ma perception.
France Culture dans son émission, « les idées claires » a posé la question : « Ostéopathie, ça ne sert à rien ? »
L’émission avait invité le professeur François Rannou, chef du service de médecine physique et de réadaptation à l’hôpital Cochin et dirigeant d’une équipe à l’Inserm de la faculté des Saints-Pères, en charge d’une étude sur l’effet de l’ostéopathie sur 400 patients souffrant de lombalgie.
Les participants ont bénéficié de six séances de manipulations ostéopathiques ou de six séances de manipulations placebo à raison d’une séance toutes les deux semaines, pendant trois mois.
Les séances étaient toutes réalisées par des ostéopathes qui étaient d’accord sur les manipulations que leur discipline préconisait pour une lombalgie.
Une partie de ces ostéopathes appliquaient strictement ce protocole sur les membres du premier groupe, alors que l’autre partie des ostéopathes se gardaient de le suivre en réalisant des manipulations qui devaient être neutre.
Les résultats sont parus dans la revue JAMA (Journal of the American Medical Association) le 15 mars 2021.
Le professeur Rannou rapporte :
« En général, quand on fait des études sur les faits, soit d’un médicament, soit d’une thérapeutique non pharmacologique dans les maladies de l’appareil locomoteur, on regarde trois choses. On regarde la douleur, est-ce qu’on a mal ou pas ? Ou moins mal ou plus mal ? La fonction en gros c’est, qu’est ce qu’on peut faire ? Et la qualité de vie, est-ce qu’on a perdu ou pas en qualité de vie ? Là, on a montré que sur la douleur, il n’y avait pas de différences du tout entre les deux groupes, la qualité de vie non plus. Par contre, sur la fonction, il y a une petite différence entre les deux groupes en faveur du groupe ostéopathie. Mais cette différence n’est pas ce que l’on appelle cliniquement pertinente, c’est-à-dire que c’est une différence qui est tellement faible qu’on considère qu’elle n’a pas d’existence clinique. »
Donc l’ostéopathie n’a pas plus d’effet qu’un placebo selon cette étude.
Je n’ai pas vocation à remettre en cause cette étude.
Je constate qu’il s’agissait d’une étude sur un point précis de souffrance : une lombalgie.
Une étude sur une autre pathologie conduirait-elle au même résultat ?
Et puis il y a un constat du professeur Rannou qui me semble essentiel :
« On a comparé l’ostéopathie chez les gens qui ont mal au dos depuis plus de 6 semaines à un placebo et on montre qu’il n’y a pas de différences entre les deux. En gros, les deux améliorent les patients, mais il n’y a pas de différences cliniquement pertinentes entre les deux groupes. »
L’ostéopathie dans ce cas améliore la situation du patient, c’est mieux que de ne rien faire, mais ce n’est pas mieux qu’un placebo.
Mais dans les deux cas la prise en charge est la même, je veux dire que les patients rencontrent un ostéopathe qui s’occupe d’eux, avec lequel ils échangent. Bref tout est dans la relation, dans la capacité d’empathie et d’humanité dont est capable le praticien et la confiance que peut lui manifester le patient.
Exactement le contraire de ce technicien que j’ai rencontré vendredi après-midi, appendice d’une machine et qui n’a marqué aucune empathie et très peu d’écoute.
Il pourrait probablement être remplacé par une intelligence artificielle sans qu’il n’y ait de dégradation du service.
<1613>
-
Mardi 26 octobre 2021
« Je suis un modeste musicien. »Bernard HaitinkEt de manière unanime, le 22 octobre 2021, les sites de tous les plus grands orchestres symphoniques du monde ont affiché en page d’accueil la même information : Le chef d’orchestre néerlandais Bernard Haitink est mort le 21 octobre 2021
 En commençant par l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, dont il fut le chef pendant 25 ans.
En commençant par l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, dont il fut le chef pendant 25 ans.
Mais aussi l’Orchestre Philharmonique de Berlin, l’Orchestre Philharmonique de Vienne, le Chicago Symphony Orchestra, le Boston Symphony Orchestra, l’Orchestre de la Staatskapelle de Dresde.
Les plus grands !
Et aussi le London Philharmonic Orchestra dont il fut chef principal pendant 12 ans.
Il est mort de vieillesse, à l’âge de 92 ans. <La Croix> écrit :
« « Je suis un modeste musicien », martelait Bernard Haitink si l’on s’aventurait à évoquer son impressionnante carrière. Pourtant, c’est bien l’un des plus grands chefs d’orchestre de l’histoire qui est mort jeudi 21 octobre à Londres. »
 Il s’était arrêté de diriger il y a deux ans. Parce que cet homme humble avait déclaré :
Il s’était arrêté de diriger il y a deux ans. Parce que cet homme humble avait déclaré :
« Je ne veux pas qu’on dise de moi : il est gentil mais il devrait s’arrêter là ! »
Il a ainsi décidé et réalisé son dernier concert dans la salle du Festival de Lucerne avec l’Orchestre Philharmonique de Vienne le 6 septembre 2019.
Il dirigea le 4ème concerto de piano de Beethoven avec le pianiste Emmanuel Ax, puis l’immense 7ème symphonie de Bruckner.
Ce concert peut être écouté sur le site de France Musique < L’ultime concert de Bernard Haitink>.
 Il y a aussi <cette vidéo> qui montre les deux dernières minutes de scène de cet immense chef d’orchestre qui d’un geste de la main gauche arrête la musique, remercie l’orchestre, remercie le public qui l’applaudit debout, puis prend sa canne et prend la main d’une femme qui l’attend en bas de l’estrade pour s’en aller tranquillement et prendre une retraite pour 2 ans, à 90 ans.
Il y a aussi <cette vidéo> qui montre les deux dernières minutes de scène de cet immense chef d’orchestre qui d’un geste de la main gauche arrête la musique, remercie l’orchestre, remercie le public qui l’applaudit debout, puis prend sa canne et prend la main d’une femme qui l’attend en bas de l’estrade pour s’en aller tranquillement et prendre une retraite pour 2 ans, à 90 ans.
<TELERAMA> rapporte à propos de la musique de l’Autrichien Anton Bruckner (1824-1896)
« le chef d’orchestre néerlandais Bernard Haitink considérait qu’« essayer de l’expliquer, c’est déjà se tromper. » La musique, pensait-il, ça se sent et ça se vit à l’intérieur de soi. Alors à quoi bon intellectualiser sa passion pour ce compositeur ? « C’est curieux de voir comment je me sens inexplicablement si proche de lui. »
Loin des autocrates du pupitre, il fut à l’instar de Claudio Abbado, de 4 ans son cadet, un musicien parmi les musiciens.
<Le Monde>
 écrit :
écrit :
« Chef d’orchestre d’une grande discrétion, au point d’avoir parfois été traité de « sphinx », Bernard Haitink, […] restera comme l’une des plus grandes baguettes de la seconde moitié du XXe siècle. »
Quand je me suis éveillé à la musique avec mon ami Bertrand G. dans les années 1970, nous écoutions, beaucoup la <Tribune des critiques de disques> de France Musique.
Nous étions très influencés par ces critiques, notamment Antoine Goléa qui rejetait systématiquement les interprétations de Haitink, le traitant d’apprenti, d’élève mais pas de chef d’orchestre.
Certes, Bernard Haitink a muri au cours des années et perfectionné son art, mais aujourd’hui l’ensemble de la communauté musicale reconnait que même les enregistrements de ses débuts sont d’une qualité remarquable.
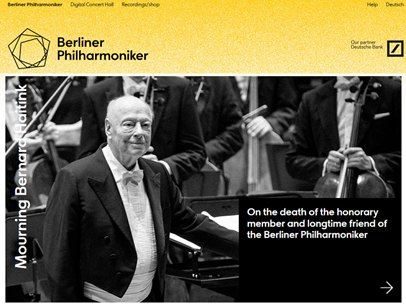 Entretemps Bertrand et moi avons compris qu’il fallait se méfier des experts, de tous les experts dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine musical.
Entretemps Bertrand et moi avons compris qu’il fallait se méfier des experts, de tous les experts dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine musical.
La question à se poser : est-ce que cette interprétation me touche, me fait vibrer, me fait du bien ?
Bernard Haitink est né en 1929 à Amsterdam et apprend le violon à 9 ans.
Selon son propre jugement, il n’est pas très bon
Mais ses parents l’emmènent aux concerts du Concertgebouw où il découvre des chefs comme Willem Mengelberg, Bruno Walter ou Otto Klemperer et apprend à aimer l’orchestre symphonique.
Sa carrière musicale commence au sein de l’Orchestre de la radio néerlandaise, dont il intègre, à 25 ans, le pupitre des violons. Il exprimera longtemps une culpabilité car il se convaincra qu’il ne doit sa carrière qu’à l’éviction de ses camarades juifs, contraints au départ du Conservatoire d’Amsterdam à cause des lois nazies.
<La Croix> rapporte ses propos :
« C’est horrible à dire, mais s’il n’y avait pas eu les abominations de l’Occupation nazie, je n’aurais jamais été chef d’orchestre. Il y aurait eu des chefs beaucoup plus talentueux que moi. »
Il va se tourner rapidement vers la direction d’orchestre.
Le Monde écrit :
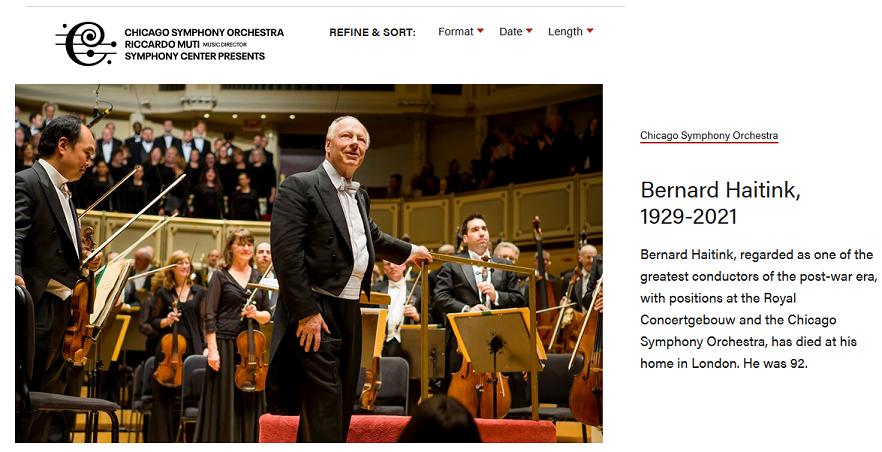 « En 1954, il est lauréat d’un concours de direction organisé par la radio, dont le président du jury, Ferdinand Leitner, devient alors son mentor. L’année suivante, le jeune homme est promu au rang de second chef de l’Orchestre de la radio avant d’en devenir le chef principal en 1957. Il a, dans l’intervalle, remplacé au pied levé le grand Carlo Maria Giulini à la tête de l’Orchestre du Concertgebouw, le 7 novembre 1956. »
« En 1954, il est lauréat d’un concours de direction organisé par la radio, dont le président du jury, Ferdinand Leitner, devient alors son mentor. L’année suivante, le jeune homme est promu au rang de second chef de l’Orchestre de la radio avant d’en devenir le chef principal en 1957. Il a, dans l’intervalle, remplacé au pied levé le grand Carlo Maria Giulini à la tête de l’Orchestre du Concertgebouw, le 7 novembre 1956. »
Un concours de circonstance, le directeur musical de l’orchestre du Concertgebouw décède et son talent vont le conduire à être nommé premier chef de cet orchestre prestigieux à 34 ans, ce qui était très jeune, surtout de ce temps-là. Cette jeunesse inhabituelle suscitera la méfiance et le dénigrement de certains critiques et musicologues
Mais Bernard Haitink, travaille, approfondit et réalisera ce que le Monde appelle :
« Une aventure musicale d’un quart de siècle, parmi les plus passionnantes de l’histoire musicale, jusqu’en 1988. »
Poussé par l’éditeur néerlandais Philips, il va entreprendre une des premières intégrales de la musique de Mahler. Il entreprendra d’autres intégrales : Bruckner, Brahms, Beethoven, Tchaikovski.
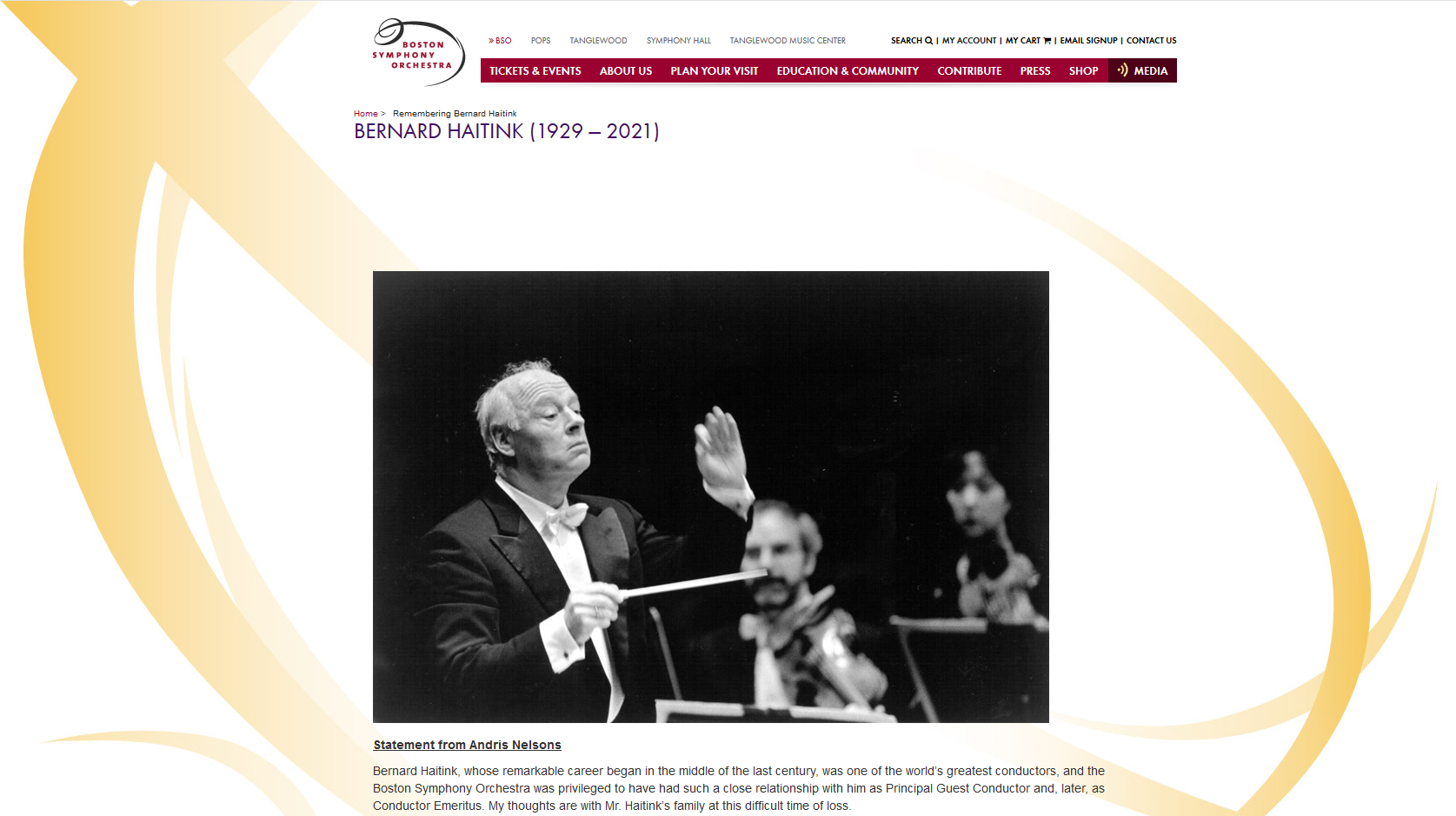 Il sera le premier chef occidental à pénétrer tout l’univers de Chostakovich et réalisera une intégrale de référence avec ses deux orchestres du Concertgebouw et du London Philharmonic.
Il sera le premier chef occidental à pénétrer tout l’univers de Chostakovich et réalisera une intégrale de référence avec ses deux orchestres du Concertgebouw et du London Philharmonic.
L’histoire avec le Concertgebouw lui apportera des déceptions.
Le Monde relate :
Les dernières années « En 1983, Bernard Haitink met sa démission dans la balance et fait reculer le gouvernement hollandais qui s’apprêtait à mettre en œuvre un plan d’économies qui menaçait vingt-trois des musiciens de l’orchestre. Conséquence directe : son contrat n’est pas renouvelé en 1988. »
Il ne sera même pas invité pour fêter le centenaire de l’institution qu’il a dirigé pendant un quart de cette période.
Il se sentira blessé et restera plusieurs années sans revenir diriger au Concertgebouw.
Mais d’autres institutions et orchestre lui ouvriront les bras, ceux que j’ai déjà cité en début d’articles mais aussi des institutions d’opéra comme le Festival de Glyndebourne et le Royal Opera House Covent Garden de Londres dont il présidera les destinées de 1987 à 2002.
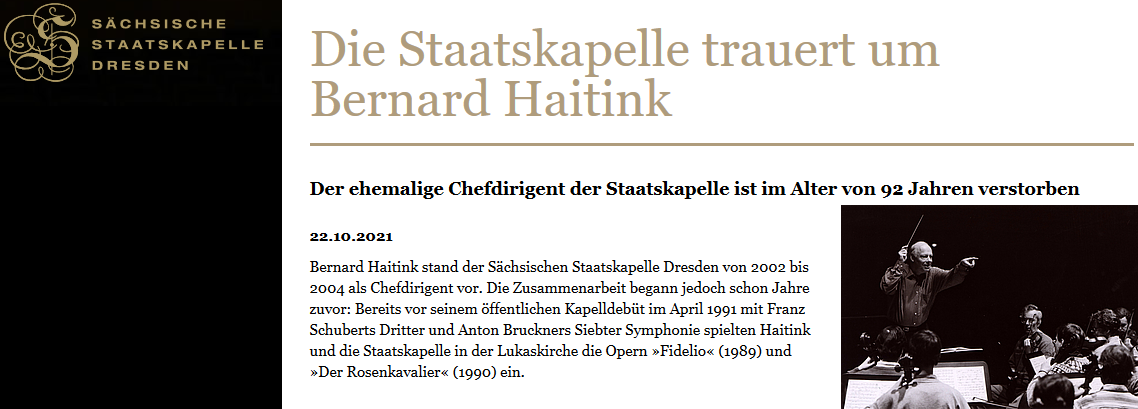 Après 2002, il décidera de reprendre quasi exclusivement le chemin des concerts symphoniques.
Après 2002, il décidera de reprendre quasi exclusivement le chemin des concerts symphoniques.
En France, il dirige l’Orchestre national de France et ARTE a mis en ligne une vidéo dans laquelle Bernard Haitink dirige l’Orchestre National de France dans Mozart et Bruckner.
<TELERAMA> écrira à propos de ce concert :
« Lors d’un concert en 2015 à l’auditorium de la Maison de la Radio à Paris, diffusé sur France Musique, il éblouit les spectateurs et auditeurs : ses gestes sont précis et secs. Rien de grandiloquent. Avec lui, l’émotion que procure la musique doit être intériorisée. Son regard est franc, presque sévère. Mais on note quelques sourires et regards complices à l’égard des musiciens, ainsi qu’un air satisfait lorsque la musique adoucit ses traits. »
Vendredi matin sur France Musique, le musicologue Christian Merlin lui rendait hommage, le qualifiant de « modèle de sobriété » :
« Sa direction n’était parasitée par aucun geste inutile, ses gestes étaient dictés par la nécessité musicale et le souci d’aider l’orchestre. Son conseil aux jeunes chefs : « Je leur suggère d’être moins obsédés par leur image et de faire davantage confiance aux musiciens. » »
Pendant ses dernières années, il a souvent dirigé un autre orchestre londonien prestigieux : le London Symphony Orchestra. C’est avec cet orchestre qu’Annie, Florence et moi avons eu la grâce de l’entendre et de le voir le 30 mai 2017, lors d’un concert à la Philharmonie de Paris pendant lequel il a dirigé la 9ème symphonie de Bruckner.
Bernard Haitink laisse dernière lui plus de 450 enregistrements, de Beethoven, Mahler, Bruckner, R Strauss, Debussy, Brahms ou encore Chostakovitch.
<La Croix> écrit à juste titre
« Il laisse de magnifiques enregistrements en héritage. Tout est à écouter. »
<1612>
-
Lundi 25 octobre 2021
« J’aime la chanson, j’aime les mots, j’aime les notes, je gratte sur une guitare, je raconte des histoires à des amis. »Georges BrassensIl y a cent ans le 25 octobre 1921, Georges Brassens était âgé de quatre jours, puisqu’il était né à Sète, le samedi 22 octobre 1921.
Il est né la même année qu’Edgar Morin qui, lui, vit toujours.
Mon enfance a été bercée par les chansons de cet artiste qui avait pourtant eu énormément de difficultés à s’imposer sur la scène française avant d’en devenir un des piliers.
Cent ans, c’est une invitation à un hommage à ce poète, ce mélodiste, ce chanteur qui savait être paillard, ironique, tendre et profond.
En juin, me promenant sur les bords de Saône, lieu où se trouve les bouquinistes à Lyon, mon regard c’est arrêté sur un livre « Brassens, toute une vie pour la chanson ». Je l’ai acheté et je viens de le lire.
C’est ainsi que j’ai appris qu’il n’a pas achevé ses études au collège Paul-Valéry à Sète. Influencé par une bande de petits casseurs qui cherchaient à bon compte de l’argent de poche, il est compromis dans des vols de bijoux auxquels il n’a d’ailleurs pas participé, flirtant seulement avec la bande et avec le risque. Il se retrouve au commissariat où son père se hâte d’aller le voir.
Brassens a tiré de cet épisode une de ses plus belles chansons : <Les Quatre bacheliers>
« Nous étions quatre bacheliers
Sans vergogne,
La vraie crème des écoliers,
Des ecoliers.
Pour offrir aux filles des fleurs,
Sans vergogne,
Nous nous fîmes un peu voleurs,
Un peu voleurs. »
<suite>
Chanson dans laquelle il rend hommage à son père bienveillant :
« Mais je sais qu’un enfant perdu, […]
A de la chance quand il a,
Sans vergogne,
Un père de ce tonneau-là »
 Ce livre a été écrit par un de ses amis : André Sève, son aîné de 8 ans puisqu’il est né en 1913 à Crest (Drôme) mais qui lui a survécu de 20 ans.
Ce livre a été écrit par un de ses amis : André Sève, son aîné de 8 ans puisqu’il est né en 1913 à Crest (Drôme) mais qui lui a survécu de 20 ans.
Brassens l’appelait « Frère André » parce qu’il était un religieux assomptionniste. Il a surtout écrit des livres spirituels et religieux mais il voulait écrire un livre d’interview de ce chanteur dont il aimait tant les chansons … sauf quelques-unes…
Car évidemment la Foi et la religion les conduisaient à des disputes fréquentes. Et quelquefois des chansons pouvaient être des objets de dispute.
Ainsi <La religieuse> qui commence ainsi :
« Tous les cœurs se rallient à sa blanche cornette
Si le chrétien succombe à son charme insidieux
Le païen le plus sûr, l’athée le plus honnête
Se laisseraient aller parfois à croire en Dieu
Et les enfants de chœur font tinter leur sonnette
Il paraît que, dessous sa cornette fatale
Qu’elle arbore à la messe avec tant de rigueur
Cette petite sœur cache, c’est un scandale
Une queu’ de cheval et des accroche-cœurs
Et les enfants de chœur s’agitent dans les stalles
Il paraît que, dessous son gros habit de bure
Elle porte coquettement des bas de soie
Festons, frivolités, fanfreluches, guipures
Enfin tout ce qu’il faut pour que le diable y soit
Et les enfants de chœur ont des pensées impures »
Brassens par André Sève page 50
Mais cet épisode permet à Brassens de donner cette leçon de vie :
« Quand tu fais quelque chose qui m’agace, par exemple quand tu as écouté la religieuse ça t’a contrarié et tu ne voulais plus me voir, ça m’a refroidi à ton égard, tu comprends, mais j’ai fait un effort, j’ai essayé de me dire : « C’est normal que cette chanson ne plaise pas à Frère André, ce n’est pas une raison pour lui en vouloir à ce point. » Quand on fait cet effort, on s’aperçoit souvent que les raisons de se refroidir ne sont jamais de vraiment bonnes raisons, c’est dû au caractère, à l’égoïsme du moment. Parce que je ne trouvais pas dans mon Frère André, à ce moment-là, ce que j’espérais y trouver je me refroidissais, mais dans l’amitié il ne faut pas penser uniquement à ce que l’autre, d’après nous, doit nous apporter. Il ne faut pas prendre, prendre. Il faut donner, et dans ces moments-là, ce qu’on peut donner de mieux, c’est d’être très intelligent, pas puéril. »
Brassens par André Sève page 98
Ce livre a été écrit alors que Brassens avait 54 ans, il lui restait 6 ans à vivre.
Ce livre ne fut pas simple, Brassens bourru passa son temps à rabrouer son ami. Il l’obligea d’abord à abandonner la liste de questions qu’il avait patiemment préparées pour laisser le dialogue plus naturel et moins formaté. Après il lui reprocha de ne pas le laisser aller au bout de sa pensée et de l’interrompre pour enfin lui reprocher qu’il ne le comprenait pas ou qu’il ne l’écoutait pas.
Frère André a scrupuleusement rapporté ces rebuffades, comme celle lorsqu’il n’était pas convaincu que Brassens, qui avait écrit de si beaux textes, puisse prétendre que dans ses chansons le plus important était la mélodie :
« Est-ce que tu me suis bien ? Est-ce que j’arriverai à te faire comprendre que j’attache plus d’importance à la musique qu’aux paroles
Brassens par André Sève page 30
[…]
« C’est pour cela qu’en disant que tu aimes mes chansons sans tenir compte des musiques, tu fais preuve d’une incompétence rare en matière de chanson, et ça me fait de la peine. […]
Puisque tu les aimes, mes chansons, la musique te pénètre et te plaît sans que tu te rendes bien compte. »
Brassens par André Sève page 30
Et quand André Sève veut donner la liste de des 10 chansons préférées, il lui rétorque :
« Dis-les donc tes préférences. Mais si tu aimais la chanson et si tu aimais Brassens, tu n’aurais pas de préférences. »
Brassens par André Sève page 51
André Sève parvient cependant à lui faire avouer son amour des mots :
« Oui, j’aime bien me faire une petite fête avec les mots. Il y en a qui servent admirablement une pensée, une image. « Ventripotent…le regard oblique…Elle viendra faire sa niche entre mes bras… Le parti des myosotis… Au bois de mon cœur…Des grâces roturières… » Certains mots sont beaux par eux-mêmes, d’autres jouent bien entre eux : « Un grain de sel dans tes cheveux » »
Brassens par André Sève page 50
Il galéra pour être reconnu. Il proclame : je dois tout à Patachou :
« Je me suis fait trois amis qui m’ont dit : « On va te présenter à Patachou » Un soir on m’a amené à son cabaret-restaurant à Montmartre et après le spectacle j’ai chanté mes chansons. Je pensais n’en donner qu’une ou deux, mais Patachou m’a tout fait chanter. Elle m’a pris immédiatement plusieurs chansons et m’a demandé de revenir pour les lui apprendre. »
Brassens par André Sève page 39
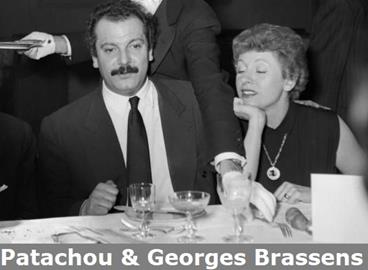 La première fois qu’on a entendu en public une chanson de Brassens, c’était par Patachou.
La première fois qu’on a entendu en public une chanson de Brassens, c’était par Patachou.
Patachou chante <Les amoureux des bancs publics>
Mais elle ne voudra pas chanter certaines chansons comme « le Gorille », « la Mauvaise réputation » et elle le convainquit de les chanter lui-même. Elle le laissa chanter après son spectacle en le lançant ainsi :
« Je vous ai chanté la Prière, Bancs publics. Je vous ai dit que c’était d’un nommé Brassens. Il est là, Brassens. Il ne sait pas tellement bien chanter, il ne sait pas tellement bien jouer de la guitare, il ne sait pas tellement bien se tenir en public, visiblement il n’aime pas ça, mais si vous voulez passer un moment agréable, restez. »
Brassens par André Sève page 40Et les gens sont restés.
« Tout ensuite, est allé très vite, et je le dois à Patachou, je ne cesserai jamais de le dire. Parce que tu sais à ce moment-là, j’étais un peu perdu, j’avais 31 ans et j’étais un peu désespéré, je commençais à penser que ça ne marcherait jamais. »
Brassens par André Sève page 40<Mini interview de Patachou, très vieille, qui parle de sa rencontre avec Brassens>
La vie de Brassens décrite dans le livre : il écrivait des chansons, recevait des amis et lisait beaucoup surtout les poètes. Il se levait très tôt vers 2, 3 ou 4 heures du matin après 6 heures de sommeil.
C’était un bosseur !
« Je vis selon les chansons que j’écris, si j’en ai vraiment entrain je ne m’occupe que de ça. Je reste parfois deux heures assis à chercher un mot, un accord. Je peux travailler jusqu’à douze heures dans la journée. »
Brassens par André Sève page 79
Il écoutait parfois de la musique classique :
« Oui mais je préfère le jazz […] J’aime ce rythme »
Brassens par André Sève page 79
Et quand André s’étonne que lui homme de la ville ait pu écrire une merveille comme <Bonhomme> il répond :
« Eh bien, j’avais peut être lu quelque chose qui m’a fait vibrer. Et ce qui m’est d’abord venu, c’est « mort naturelle ». J’ai vu un vieil homme qui mourait, sa vieille femme qui allait pour chauffer Bonhomme « qui va mourir de mort naturelle ». J’ai réussi cette chanson, que j’aime beaucoup, c’est une de mes préférées, parce que j’avais dû être fortement ému/ […] c’est la mort du grand-père d’un ami qui m’avait frappé. »
Brassens par André Sève page 50
Les paroles qui débute cette chanson :
« Malgré la bise qui mord
La pauvre vieille de somme
Va ramasser du bois mort
Pour chauffer Bonhomme
Bonhomme qui va mourir
De mort naturelleMélancolique, elle va
À travers la forêt blême
Où jadis elle rêva
De celui qu’elle aime
Qu’elle aime et qui va mourir
De mort naturelle »
Brassens par André Sève page 50
Il aimait les chats :
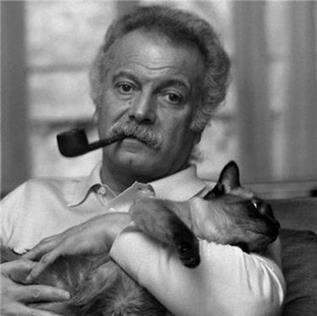 « Dans ma vie, il me faut des chats. De toute façon, je respecte les animaux, je ne suis ni chasseur ni pêcheur à cause de ça. Je dois aimer les chats parce qu’ils sont très indépendants. Je respecte leur indépendance, je ne les caresse que lorsqu’ils ont envie, je ne les habille pas, je ne les mets pas dans une boîte. Je les regarde vivre. »
« Dans ma vie, il me faut des chats. De toute façon, je respecte les animaux, je ne suis ni chasseur ni pêcheur à cause de ça. Je dois aimer les chats parce qu’ils sont très indépendants. Je respecte leur indépendance, je ne les caresse que lorsqu’ils ont envie, je ne les habille pas, je ne les mets pas dans une boîte. Je les regarde vivre. »
Brassens par André Sève page 69
J’ai lu sur le web que l’anarchiste qu’il était, aurait dit qu’il préférait les chats aux chiens parce qu’il n’y avait pas de chat policier.
Et il va encore se révolter quand Frère André veut lui faire dire qu’il y a un message, une morale, des valeurs dans ses chansons :
« Mais prends-moi comme je suis : j’aime la chanson, j’aime les mots, j’aime les notes, je gratte sur une guitare, je raconte des histoires à des amis. Il se trouve que j’ai beaucoup lu, que j’ai rencontré certaines idées, que j’ai vu des choses qui m’ont plu, d’autres qui m’ont déplu, tout ça est entré en moi et ça ressort un jour dans une chanson. Comme une vache qui se met à paître de l’herbe et ça devient du lait. Ne lui demande pas d’expliquer son lait, bois-le »
Brassens par André Sève page 49
Voilà comment était Brassens qui est né à Sète, il y a 100 ans.
<1611>
-
Vendredi 22 octobre 2021
« La victoire en pleurant»Daniel CordierDaniel Cordier est mort le 20 novembre 2020, à 100 ans. J’ai écrit trois mots du jour le concernant début décembre 2020.
J’étais revenu notamment sur son extraordinaire destin et sur son livre « Alias Caracalla »
Je racontais alors que, pendant l’été 2016, j’avais lu ou plutôt dévoré ce livre extraordinaire qui narre le récit précis des faits auxquels Daniel Cordier a participé entre le 17 juin 1940 et le 23 juin 1943.
La première date correspond au jour du discours de Pétain, dans lequel se trouve cet appel insupportable à Daniel Cordier :
« C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat.
Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l’honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. »
La seconde date est le lendemain de l’arrestation de « Rex », Jean Moulin, le 22 juin 1943, à Caluire.
Et entre ces deux dates, le tout jeune Daniel Cordier s’est embarqué sur un navire qui l’a emmené en Angleterre pour continuer le combat. Il s’est alors engagé corps et âme dans « la France libre » sous les ordres du Général de Gaulle. Il a ensuite été parachuté sur la France et a rejoint Lyon où les circonstances vont faire de lui le secrétaire de Jean Moulin alors que ce dernier va tenter d’organiser et de rassembler toutes les chapelles de la résistance sous l’autorité de De Gaulle.
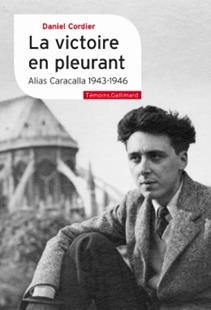 « La victoire en pleurant » est la suite de ce récit, jusqu’à la fin de la guerre et la démission de De Gaulle.
« La victoire en pleurant » est la suite de ce récit, jusqu’à la fin de la guerre et la démission de De Gaulle.
Daniel Cordier abandonnera alors le service de la défense nationale pour le chemin de l’art dans lequel il excellera en tant que marchand d’art, collectionneur et organisateur d’expositions.
Il retrouvera beaucoup plus tardivement cette période, à travers son travail d’historien pour réhabiliter et défendre Jean Moulin attaqué par d’anciens résistants obstinés et vindicatifs.
En particulier, il répondra aux accusations d’Henri Frenay qui prétendait que Jean Moulin était un agent crypto-communiste.
Et c’est à la fin de sa vie qu’il écrira ce que beaucoup appellent ses Mémoires en deux tomes, alors qu’il s’agit d’une toute petite période de sa vie, même si elle fut intense.
Il parvint à finir le récit de cette seconde partie avant sa mort, mais sans avoir le temps de relire et de corriger quelques éléments imprécis.
C’est Bénédicte Vergez-Chaignon, qui a longtemps travaillé avec Cordier dans son travail sur Moulin, qui a finalisé l’ouvrage, l’a préfacé et annoté
La lecture de cet ouvrage, bien plus court qu’Alias Caracalla, constitue un devoir indispensable à tout honnête homme qui s’intéresse à l’Histoire de France.
J’ai profité de la pause estivale pour lire ce livre bouleversant et très instructif sur la France qui est sortie de la seconde guerre mondiale.
Pourquoi la victoire en pleurant ?
Parce Daniel Cordier a perdu beaucoup d’amies et d’amis dans ce combat terrible contre l’ennemi nazi. Certains ont été tués, torturés à mort, se sont suicidés, sont morts dans les camps ou sont revenus dans un tel état physique qu’ils sont morts de la suite de leur déportation.
Il explique qu’il ne se doutait pas de ce que ses camarades avaient enduré dans les camps. Dans son esprit de l’époque, il pensait que si les camarades avaient résisté à la torture, la vie au camp marquait la fin des souffrances et de la lutte contre la mort.
A la fin de la guerre, il va chercher des camarades revenant des camps à la gare :
« Je le fixe intensément pour ajuster ce visage squelettique à un visage connu…Heureusement son regard vif et moqueur me permet de le reconnaître : « Montet ». Il s’agit de Maurice Montet qui dirigeait le service d’évasion vers l’Espagne et qui a été arrêté quelques jours avant Rex (Jean Moulin). Nous nous embrassons. Je n’ose lui demander comment il va. Je suis horrifié de ce que je découvre d’un coup et je me sens d’autant plus coupable d’avoir échappé à la déportation, mais surtout d’avoir imaginé la vie paisible des déportés.
Rompant le silence, il me dit « Ça a été dur, mais on les a eus ». […] Il pèse trente-cinq kilos.
Pages 204-205
Le courage et la détermination de ces femmes et hommes et aussi de leur famille étaient inouïs, incroyable à notre vécu d’aujourd’hui.
Les arrestations de la Gestapo désorganisent les réseaux que Cordier anime. Et voilà ce qu’il écrit page 64 :
« Je reçois un mot des parents de Limonti, à qui j’ai annoncé l’arrestation de leur fils : ils me proposent d’embaucher leur fille Dominique pour remplacer son frère. J’accepte avec émotion et je suis comblé de découvrir qu’elle est dactylo. »
Le frère est tombé aux mains de l’ennemi, la sœur le remplace et les parents encouragent cette montée vers le danger.
Rien n’illustre mieux la vérité de ce vers du chant des partisans
« Ami, si tu tombes un ami sort de l’ombre à ta place. »
«En pleurant», aussi à cause des divisions entre les résistants, entre la France libre et la résistance, à l’arrivée massive dans le camp de la victoire des français de Vichy qui se sont révélés tardivement résistants.
Tout cela créant une atmosphère pesante et bien loin du récit d’une France unie derrière De Gaulle.
Daniel Cordier avait révélé à Paulin Ismard dans De l’Histoire à l’histoire en 2013 :
« Après le 21 juin 1943, j’ai vécu la fin de la guerre en somnambule. »
Bien sûr il sera, à partir de cette date, orphelin de Rex, son chef tellement admiré et dans lequel il avait une confiance absolue. Il ne retrouvera plus cette relation avec un autre.
Pour illustrer le panier de crabes qu’est devenu la France de Londres à la fin de la guerre, un fait écrit révèle cette triste situation. Cordier doit fuir la France, quasi l’intégralité de son réseau a été arrêté suite à la maladresse d’un de ses membres qui gardait à son domicile le nom et l’adresse de tous les membres du réseau.
Et quand il revient ainsi, en avril 1944, en Angleterre, le protocole veut qu’il soit soumis à un interrogatoire d’abord du contre-espionnage britannique puis français.
La conclusion du britannique est :
« Un homme très intelligent et intéressant. J’aurais tendance à considérer ses informations comme fiables. […] J’ai remarqué qu’il prenait grand soin de ne pas donner d’informations dont il ne soit pas certain. […] Ne pose pas de problème de sécurité. »
La conclusion du français est
« L’intéressé a de toute évidence « préparé » son interrogatoire. Il était au courant des critiques formulées contre lui et s’est volontairement retranché dans un vague peu compromettant. Ces quelques lignes font néanmoins ressortir le désordre, la prétention et le manque de franchise de cet agent qui en aucun cas ne devra retourner en France où il serait un véritable danger public »
75 ans après, l’Histoire ayant fait son œuvre, on peut affirmer tranquillement que c’est l’officier britannique qui disait la vérité. L’autre était influencé par les milieux résistants hostiles à jean Moulin.
Un livre qui dit la grandeur de certains humains et la moindre grandeur de certains autres, loin des récits mythiques pour les croyants.
Bénédicte Vergez-Chaignon était l’invité <des matins de France Culture> pour parler de ce livre.
Elle était aussi invitée par <Public Sénat> accompagné de l’historien Emmanuel De WARESQUIEL.
<1610>
-
Jeudi 21 octobre 2021
« Essaie et cours ta chance ! »Paul Belmondo à son fils Jean-Paul après qu’un acteur de théâtre ait démoli son rêve de faire de la comédieMon neveu Grégory l’avait verbalisé, ce qu’il y a de spécifique dans cet article quotidien que j’écris c’est que je suis libre de choisir le sujet que je veux.
Je l’avais déjà cité lors du mot du jour du <du 4 décembre 2018>
Cette règle est particulièrement vraie pour les hommages.
Il faut que quelque chose me touche, que je pense savoir l’exprimer pour pouvoir le partager.
C’est le cas pour Jean-Paul Belmondo qui est décédé le 6 septembre 2021.
Il a été un acteur flamboyant, populaire, avec un succès incroyable. Il a également tourné, avec un même bonheur, des films d’auteur. Il fut aussi un grand acteur de théâtre.
Mais ce que je voudrais partager, c’est le début et la fin.
Augustin Trapenard était allé lui rendre visite en novembre 2016, chez lui pour son émission <Boomerang>
Et Jean-Paul Belmondo a rappelé ses débuts : Il est né dans un milieu favorisé, à Neuilly sur Seine. Son père était un sculpteur reconnu Paul Belmondo et sa mère une artiste peintre : Madeleine Rainaud-Richard
Mais à l’école il n’y arrivait pas vraiment et il raconte :
« Comédien, je crois que j’ai voulu l’être tout de suite. A 10 ans, je faisais le clown. Ça amusait beaucoup ma mère. Et petit à petit, j’ai pensé que je pourrais être un comédien »
Ses parents étaient un peu inquiets, mais sont toujours restés positifs. Et devant le désir du petit Jean-Paul, son père qui avait évidemment beaucoup de relations dans le monde des arts et du spectacle lui dit :
« Je vais te présenter à un ami qui est à la Comédie Française et il nous dira ce qu’il pense de toi. »
Cet acteur de théâtre avait pour nom André Bruno. Cela se passa très mal. Le professionnel du théâtre condamna sans appel le jeune enfant ému :
« Arrête. Fais autre chose ! »
Il pleura et c’est là qu’on trouve une leçon de vie donnée par son père. Leçon qu’il gardera toute sa vie.
Sans rien sous-estimer des difficultés et des immenses efforts nécessaires, son père ne l’arrête pas dans la poursuite de son rêve, mais l’encourage à y aller :
« On n’a jamais perdu, il faut garder le moral.
Je te suppose, assez clairvoyant pour envisager les difficultés que tu vas rencontrer. Essaie et cours ta chance. »
Essaie et cours ta chance !
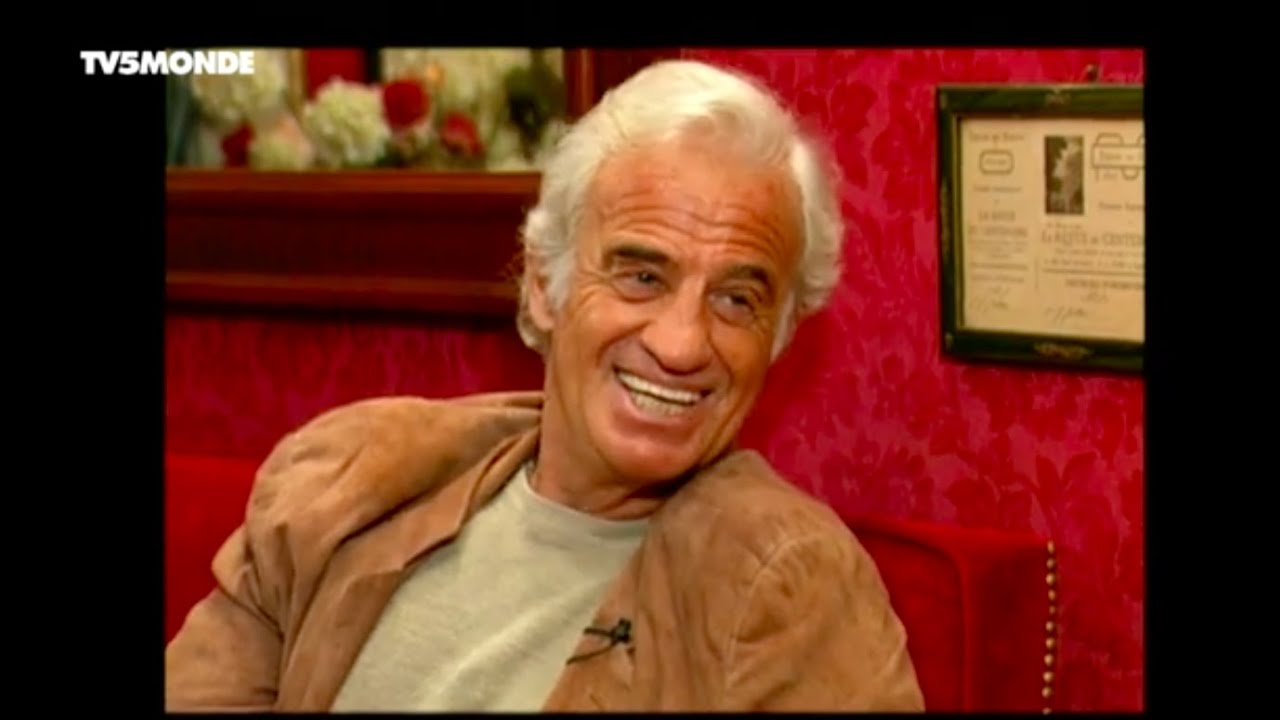 Je trouve cette réaction très inspirante dans les circonstances telles que Jean-Paul Belmondo les décrit.
Je trouve cette réaction très inspirante dans les circonstances telles que Jean-Paul Belmondo les décrit.
Il a été largement commenté que Jean-Paul Belmondo, lors de ses études au conservatoire de Paris, tout en faisant l’admiration de ses camarades, ne sera pas apprécié et valorisé par ses professeurs.
Son premier professeur, qui s’appelle René Simon, lui dit qu’il n’est pas fait pour le métier. Un autre qui s’appelle Pierre Dux lui dit qu’il est moche, que jamais il ne prendra une belle femme dans ses bras.
Ce même professeur, lorsqu’il passait des scènes au conservatoire lui renvoyait :
« Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise. Asseyez-vous ».
Belmondo moche ! Sur ce point, il aura aussi une revanche éclatante :
« Et un jour, je me promenais sur les Champs-Elysées avec la femme avec qui je vivais, Ursula Andress, je le [Pierre Dux] rencontre et il me dit : ‘on fait ce qu’on peut.’ »
Cela c’était le début,
Mais la fin est tout aussi remarquable.
Le 8 août 2001, dans sa 68ème année, alors qu’il se trouve en vacances en Corse chez son ami Guy Bedos à Lumio, près de Calvi, Belmondo est victime d’un accident vasculaire cérébral. Il est héliporté d’urgence à l’hôpital Falconaja de Bastia.
Cet AVC va transformer le sportif, l’étincelant parleur en un vieil homme s’exprimant avec beaucoup de difficultés.
Quand Augustin Trapenard l’interviewe, il porte cette infirmité depuis 15 ans et pourtant il reste merveilleusement positif. Son élocution malhabile n’empêche pas le sourire et la joie.
ll explique à Trapenard, qu’être un bon acteur, ce n’est pas être naturel. Naturel, tout le monde peut l’être, mais c’est d’avoir un petit peu plus que ça. Et ce petit plus pour lui c’est :
« La bonne humeur, parce que même dans mes rôles difficiles, je riais quand même. »
Et quand Augustin Trapenard lui demande :
« Cette liberté, cette allégresse, cette joie de vivre, ça vient d’où ? »
Il explique :
« Je suis né comme ça. Ma mère, ou mon père, m’ont toujours élevé comme ça. Cela vient peut-être de l’époque qui était beaucoup plus gaie, beaucoup plus libre. […] On sortait de la guerre, et il y avait la joie de recommencer à vivre. »
 Emmanuel Macron lui a rendu un magnifique hommage aux Invalides : <Hommage à JP Belmondo>
Emmanuel Macron lui a rendu un magnifique hommage aux Invalides : <Hommage à JP Belmondo>
Pour ce genre d’exercice, il faut reconnaître qu’il a du talent.
Et il est passionnant d’écouter Clément Viktorovitch décortiquer sur <franceinfo> ce discours. C’est très instructif d’analyser ainsi la rhétorique. Vous apprendrez, en outre, des mots savants :
- Un discours épidictique, le discours de louanges.
- Une épiphore, qui consiste à terminer une succession de phrases par le même mot ou le même groupe de mots,
- Une synecdoque, qui consiste à parler d’une partie pour évoquer le tout ou inversement. Emmanuel Macron l’a beaucoup fait dans tout son discours, il a narré la vie de Belmondo pour célébrer à travers elle, l’histoire de France et l’histoire du cinéma.
Mais j’ai regretté que dans la partie de son discours dans laquelle, le Président utilise Jean-Paul Belmondo comme anaphore, il s’arrête à 50 ans :
« Jean-Paul BELMONDO était nos 30 ans. Ce Don Quichotte des temps modernes, capable de repousser les limites de l’ivresse en même temps que celle de la tendresse, tel un singe en hiver.
Jean-Paul BELMONDO était nos 40 ans. Ce commissaire aussi athlétique, intrépide que tous, nous aurions rêvé d’être pour nous battre contre la peur sur la ville.
Jean-Paul BELMONDO était nos 50 ans. Cet entrepreneur à succès qui, soudain, choisit, dernière étape de l’itinéraire d’un enfant gâté, de larguer les amarres vers sa liberté et vers son destin. Il fut l’ami que chacun aimerait avoir. »
Car il aurait pu dire « Jean-Paul BELMONDO était nos 70 ans, fragile, touché, meurtri mais toujours joyeux, debout et grand. »
Pour finir, je reprendrai la conclusion du discours du Président de la République qui a rappelé que dans ses dernières années, quand ne pouvant plus exercer sa verve gouailleuse, son verbe étincelant, sa langue éblouissante, il prononçait un mot pour signifier tous les autres qu’il n’arrivait plus à dire :
« Voilà.»<1609>
- Un discours épidictique, le discours de louanges.
-
Mercredi 20 octobre 2021
« Le biais cognitif de confirmation»Une interprétation orientée de la réalitéAu départ, il y a une photo, publiée sur divers réseaux sociaux, accompagnée d’une légende :

Cette photo fait beaucoup rire. Les commentaires sont définitifs et condamnent sans mesure.
Elle a été partagée des dizaines de fois.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
Ne trouvez-vous pas étrange le caractère systématique, calme et ordonné de tous ces jeunes filles et garçons assis et concentrés devant leur écran de smartphone ?
Pour ma part, j’ai mis un commentaire prudent :
« Je prends l’hypothèse que cette photo n’est pas un montage.
Dans ce cas deux hypothèses : la première correspond à la légende de la photo
La seconde plus bienveillante : ces jeunes gens consultent des sites pour en connaître davantage sur les peintres et les œuvres qu’ils ont vus dans ce musée. »
Et quand j’en ai parlé à Annie, elle m’a dit que c’était une série de photos connue et qui avait été utilisée pour illustrer de mauvaises interprétations d’un fait, en raison de convictions ou de croyances. Cette photo avait été prise lors d’une visite scolaire organisée. Ces jeunes devaient faire des recherches et répondre à des questions via une application sur leur smartphone. Et quand elle avait été publiée sans explication, elle a été le plus souvent interprétée de manière erronée et disons malveillante.
J’ai quand même trouvé une femme qui a remis les choses à l’endroit.
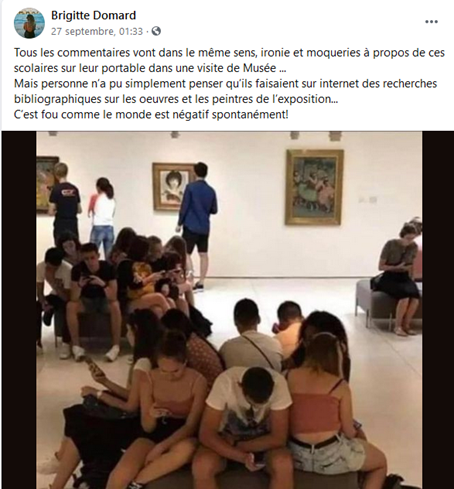 On appelle ce type d’interprétation erronée d’un fait : « un biais cognitif de confirmation »
On appelle ce type d’interprétation erronée d’un fait : « un biais cognitif de confirmation »
Un <biais cognitif> est selon wikipedia :
« Une distorsion dans le traitement cognitif d’une information. Le terme biais fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent être repérés lorsque des paradoxes ou des erreurs apparaissent dans un raisonnement ou un jugement.
L’étude des biais cognitifs fait l’objet de nombreux travaux en psychologie cognitive, en psychologie sociale et plus généralement dans les sciences cognitives. »
Le biais cognitif de confirmation constitue une de ces distorsions évoquées ci-avant.
Il consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses croyances et à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses conceptions.
Pour ne donner aucune chance à la seconde hypothèse que j’avais spontanément envisagée, il faut avoir pour idée préconçue que les jeunes générations utilisent forcément leurs smartphones pour des motifs de loisirs ou futiles et qu’ils sont incapables d’utiliser leur concentration pour s’intéresser à l’Art.
Sur un blog du monde, <un article> évoquant des études et analyses sur les conséquences délétères de l’utilisation des smartphones par les jeunes générations : coupure avec le réel, évitement de la conversation en face à face, menace sur l’empathie.
L’article de Frédéric Joignot évoque la psychosociologue Sherry Turkle, professeure au Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui mène depuis vingt ans un travail sur l’influence des technologies sur les comportements et qui a plusieurs fois utilisé des photos de ce type pour dénoncer les dérives du smartphone
Et il ajoute :
« Si la plupart des chercheurs qui analysent depuis une quinzaine d’années les enjeux sociaux, comportementaux et anthropologiques des TIC et des réseaux sociaux saluent le travail pionnier de Sherry Turkle, tous ne se reconnaissent pas dans sa critique radicale. Nombre de ces sociologues de l’Internet estiment qu’elle cède à une forme de « panique morale » face à des façons d’être et de communiquer radicalement nouvelles, encore mal décryptées, et à des pratiques générationnelles qui la dépassent. En France, le philosophe des technologies Stéphane Vial, auteur de L’Etre et l’Ecran. Comment le numérique change la perception (PUF, 2013), évoque même une véritable « incompréhension » des pratiques réelles de la génération numérique.
 « A toutes ses conférences, Sherry Turkle montre des photos de ses filles et de leurs amies tapotant sur des portables sans se parler. Mais est-ce qu’elle s’interroge sur ce qu’elles sont en train de faire ? Elles lisent peut-être un roman, ou dialoguent avec leur amoureux… Elles ne sont pas forcément isolées ou décérébrées », argumente-t-il.
« A toutes ses conférences, Sherry Turkle montre des photos de ses filles et de leurs amies tapotant sur des portables sans se parler. Mais est-ce qu’elle s’interroge sur ce qu’elles sont en train de faire ? Elles lisent peut-être un roman, ou dialoguent avec leur amoureux… Elles ne sont pas forcément isolées ou décérébrées », argumente-t-il.
Stéphane Vial donne un exemple frappant des idées biaisées sur l’usage des mobiles par les adolescents. En janvier, le quotidien britannique The Telegraph a publié une contre-enquête sur une photo représentant un groupe de lycéens au Rijksmuseum d’Amsterdam : devant La Ronde de nuit, de Rembrandt, tous regardaient leur téléphone. « Cette image a fait le tour du Net, elle est devenue le symbole de la déculturation et de la déréalisation des jeunes, rappelle-t-il. Or, il s’est avéré que les lycéens consultaient une application éducative du musée. Et dans une photo précédente, les mêmes étaient assis devant un Rembrandt, discutant du tableau. »
L’article de Frédéric Joignot est beaucoup plus riche en informations et réflexions que la toute petite partie que j’en ai extraite pour illustrer mon propos sur l’analyse de la photo mise au centre de ce mot du jour.
Il ne s’agit pas de refuser de prendre en considération les risques d’utilisation frénétique des smartphones, mais d’accepter la complexité du réel et de ne pas réduire notre champ de réflexion à une vision unilatérale.
La bienveillance est parfois bonne conseillère
<1608>
-
Mardi 19 octobre 2021
« L’incommensurable difficulté de faire silence. »Expérience vécue dans la zone de silence du désert de la Chartreuse.Avec Annie, nous avons passé deux semaines de vacances dans le massif de la Chartreuse.
Bien entendu, nous sommes allés faire la randonnée qui contourne le monastère de la Grande Chartreuse.
Lieu de recueillement et de méditation, dans la montagne qui dessine un sublime écrin dans lequel se pose le monastère où vivent des hommes qui ont fait vœu de silence.
 Partout les guides, les prospectus, les panneaux au bord du chemin invitaient au silence les randonneurs qui souhaitaient s’approcher de ce lieu.
Partout les guides, les prospectus, les panneaux au bord du chemin invitaient au silence les randonneurs qui souhaitaient s’approcher de ce lieu.
Avec Annie, nous nous réjouissions de pouvoir accomplir ce périple dans le silence des paroles et de l’esprit, dans cet espace où la nature et l’homme ont su créer un joyau mystique.
La Grande Chartreuse est le premier monastère et la maison-mère des moines-ermites de l’ordre des Chartreux.
Elle est située sur la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, dans l’Isère. Elle a été fondée en 1084 par Saint Bruno accompagné, selon la tradition, par 6 compagnons.
 C’est le nom du massif de la chartreuse qui a donné le nom au monastère et à l’ordre monastique. Installé dans le vallon de Chartreuse, on appellera, dès lors, ce lieu « le désert de chartreuse » en raison de son isolement.
C’est le nom du massif de la chartreuse qui a donné le nom au monastère et à l’ordre monastique. Installé dans le vallon de Chartreuse, on appellera, dès lors, ce lieu « le désert de chartreuse » en raison de son isolement.
L’Ordre des Chartreux est donc un Ordre monastique qui s’épanouit dans la vie contemplative et le silence.
Bruno, le premier des chartreux, écrivait :
« Quelle utilité, quelle joie divine la solitude et le silence du désert apportent à qui les aime, seuls le savent ceux qui ont fait l’expérience. Ici les hommes forts peuvent tout à loisir rentrer en eux-mêmes et y demeurer, cultiver assidument les vertus et se nourrir avec délices des fruits du paradis. »
Cité Dans La Grande Chartreuse par un chartreux Page 99
Et conformément à la règle cartusienne qui veille à protéger la solitude des moines, le monastère ne se visite pas. Seul le musée installé à 2 km environ en aval du monastère autorise les visites.
Ce musée est installé dans la « Correrie » constitué par un groupe de bâtiments monastiques qualifiés de « maison basse » du monastère de la Grande Chartreuse, destinés à l’habitat et aux ateliers des frères convers.
Traditionnellement dans les ordres religieux catholiques, on distinguait deux types de membres :
- Les moines de chœur, qui se consacraient principalement à l’Opus Dei — « l’œuvre de Dieu » — à l’étude, et à l’écriture.
- Les frères converts appelés aussi les frères lais qui étaient chargés des travaux manuels et des affaires séculières d’un monastère.
Rempli de ce désir de paix et de silence nous avons donc entrepris cette randonnée de 11 km qui commence immédiatement par la zone de silence entourant le monastère.
Nous n’étions pas seuls !
Mais les autres randonneurs ou promeneurs n’étaient pas dans le même état d’esprit que nous. Je parle de promeneurs car il me semble que tous ceux que nous avons rencontré n’ont pas entrepris l’intégralité du périple mais se sont contentés de faire un aller-retour vers le monastère puis de revenir au parking du musée,
 Il y avait d’abord les « polis » qui disaient gentiment « bonjour » en nous souriant.
Il y avait d’abord les « polis » qui disaient gentiment « bonjour » en nous souriant.
Évidemment, dire bonjour ce n’est pas faire silence.
Mais ces gens étaient beaucoup plus silencieux que d’autres qui à deux souvent à trois ou quatre engageaient des discussions vigoureuses et produisaient suffisamment de décibels pour qu’il ne soit pas possible d’ignorer précisément l’objet des discussions.
Les forces de l’esprit auraient pu les inciter, dans ce cadre unique, à célébrer la beauté du lieu, ou évoquer la vie monastique, pourquoi pas échanger sur la spiritualité ou sur Dieu ?
Ce n’était cependant pas ce qui était prévu, puisque la demande était celle du silence.
Probablement que ces gens n’ont pas lu ou n’ont pas compris ce qui était demandé.
Mais ces hommes et femmes de plus de cinquante ans, non issus de la diversité qui fait la richesse de la France, et vraisemblablement d’ascendance très chrétienne ne brisaient pas le silence par des propos empruntant les voies de la spiritualité.
 Les premiers que nous avons rencontrés parlaient de problèmes de voisinage dans leur lotissement. Comble du paradoxe, ils semblaient se plaindre du manque de calme qu’ils y rencontraient, alors qu’ils avaient choisi ce lieu de résidence parce qu’ils espéraient le trouver.
Les premiers que nous avons rencontrés parlaient de problèmes de voisinage dans leur lotissement. Comble du paradoxe, ils semblaient se plaindre du manque de calme qu’ils y rencontraient, alors qu’ils avaient choisi ce lieu de résidence parce qu’ils espéraient le trouver.
Un second groupe débattait de la difficulté qu’ils avaient eu à se retrouver parce qu’ils n’avaient pas été suffisamment explicites pour définir leur lieu de rendez-vous.
Nous avions accéléré le pas pour essayer de nous éloigner de ce bruit et de cette agitation engendrés par ces mortels englués dans leurs péripéties quotidiennes.
C’est alors que descendant d’un chemin qui était encore plus proche du monastère, une femme qui précédait deux hommes, expliquait doctement et avec force qu’elle était souvent prise de « violentes douleurs aux fesses », mais qu’elle avait trouvé un ostéopathe qui en manipulant son dos, était capable de faire partir cette souffrance touchant son séant.
Je dois concéder que si l’ambiance était bien telle que je la décris, sans cet éloge tonitruant de l’art ostéopathique, dans ce lieu, je n’aurais probablement pas écrit ce mot du jour.
J’avais commis en juin 2016, un mot du jour sur « L’histoire du silence » qui était un ouvrage de l’historien Alain Corbin qui évoquait le silence à travers les siècles et notait la difficulté, peut être la peur, du silence aujourd’hui.
Il est de plus en plus rare de pratiquer des minutes de silence, particulièrement sur les stades de football. Le plus souvent, on la remplace par une minute d’applaudissements, ce qui évidemment ne mobilise pas les mêmes ressorts intérieurs.
L’historien écrivait :
« Le silence n’est pas la simple absence de bruit. Il réside en nous, dans cette citadelle intérieure que de grands écrivains, penseurs, savants, femmes et hommes de foi, ont cultivée durant des siècles. […]
Condition du recueillement, de la rêverie, de l’oraison, le silence est le lieu intime d’où la parole émerge. Les moines ont imaginé mille techniques pour l’exalter, jusqu’aux chartreux qui vivent sans parler. Philosophes et romanciers ont dit combien la nature et le monde ne sont pas distraction vaine. […]
J’ai voulu montrer l’importance qu’avait le silence, et les richesses qu’on a peut-être perdues. J’aimerais que le lecteur s’interroge et se dise : tiens, ces gens n’étaient pas comme nous. Aujourd’hui, il n’y a plus guère que les randonneurs, les moines, des amoureux contemplatifs, des écrivains et des adeptes de la méditation à savoir écouter le silence… »
Le silence n’est pas la simple absence de bruit, il ne se réduit pas non plus au seul fait de se taire. Il est plus profond et plus grand que cela. Il n’en reste pas moins qu’il faut savoir déjà se taire pour espérer accéder à la richesse et à l’intimité du silence.
Nous avons ensuite, après nous être éloigné du monastère, pu gouter au silence du randonneur pendant quelques temps.

A la fin de la randonnée, en revenant vers le monastère nous avons alors été submergé par un bruit « industriel » intense.
A quelques 50 mètres du porche du monastère, un bucheron utilisait une superbe et efficace machine à couper le bois et à l’entasser, en produisant, en plus, un bruit à faire fuir toute personne raisonnable soucieuse de préserver son acuité auditive.
Il était difficilement envisageable que ce travail ne fut pas réalisé pour le compte des moines. Il fallait donc se résoudre à admettre que ces derniers étaient consentants au déchainement de ce tohu-bohu assourdissant.
Même les moines …
Que dire ?
Que penser ?
Laisser la dernière parole à Christian Bobin :
« Le silence est la plus haute forme de la pensée, et c’est en développant en nous cette attention muette au jour que nous trouverons notre place dans l’absolu qui nous entoure »
Le huitième jour de la semaine p. 25
<1607>
- Les moines de chœur, qui se consacraient principalement à l’Opus Dei — « l’œuvre de Dieu » — à l’étude, et à l’écriture.
-
Lundi 18 octobre 2021
« Une nouvelle saison»Nouvelle étape de l’écriture des mots du jourNotre espèce se préoccupe du temps : celui qui passe, celui du présent, celui qui reste.
Pour inscrire ce temps « dans le marbre », marquer les périodes, dater un évènement, homo sapiens a créé le calendrier.
Pour créer le calendrier, il a fallu d’abord inventer l’écriture, pour inscrire le calendrier sur un support pérenne.
Le consensus scientifique place cette invention au IVème siècle avant notre ère, en Mésopotamie, dans le pays de Sumer. <Ce site> écrit :
« Vers 3400 ans avant J-C que les sumériens inventèrent le premier système d’écriture afin d’enregistrer les transactions commerciales. Cette écriture, appelée cunéiforme, était obtenue par l’empreinte de roseaux sur de l’argile humide. Elle mit plusieurs centaines d’années à évoluer vers un système plus complexe et l’invention de l’alphabet. »
Et tout naturellement, c’est en Mésopotamie, un millénaire après, que fut inventé le premier calendrier. Sur ce <site> qui parle de l’historique du calendrier, nous pouvons lire :
« Au IIIe millénaire avant J.C, les cités de Babylone sont les premières à appliquer un calendrier, correspondant aux mouvements de la Lune, auquel ils ajoutaient si nécessaire des mois supplémentaires pour conserver une correspondance avec les saisons de l’année. »
Pourtant cette même page évoque une tentative préalable d’un « soi-disant calendrier » qui daterait d’avant l’écriture, en Egypte :
 Ce « calendrier » qui daterait du 5e millénaire avant J-C a été découvert dans le sud de l’Égypte, à Nabta Playa.
Ce « calendrier » qui daterait du 5e millénaire avant J-C a été découvert dans le sud de l’Égypte, à Nabta Playa.Cette photo montre une reconstitution du calendrier de Nabta Playa au musée de la Nubie à Assouan.
<Wikipedia> précise :
« Ce monument supposé cérémoniel est impressionnant, même s’il n’est pas très grand (environ 4 mètres de diamètre -). Il consiste en une série de blocs de pierres de grès arrangés en cercle, certaines atteignant deux mètres de hauteur. Sur le cercle, on peut distinguer quatre couples de pierres plus grandes formant comme des « portes ». À l’intérieur du cercle, on rencontre deux rangées de pierres, dont la fonction astronomique, s’il y en avait une, n’est pas évidente. Quant aux « portes », deux d’entre-elles, en vis à vis, sont sur une ligne Nord-Sud. Les deux autres paires forment une ligne à 70° à l’Est-Nord-Est, qui s’aligne avec la position calculée du lever du soleil au solstice d’été il y a 6000 ans […] Le solstice d’été correspond aussi au début de la saison des pluies dans le désert. Mais l’âge exact de ce cercle n’est pas connu avec certitude. »
Nous comprenons donc que cette tentative cherche surtout à se repérer dans une année solaire, c’est-à-dire la période d’une révolution de la terre autour du soleil et à distinguer les différentes saisons de l’année.
Il n’y a pas d’inscription dans la durée, au sens du calendrier que nous connaissons aujourd’hui.
Cette découverte ne remet donc pas en cause le lien étroit entre création du calendrier et invention de l’écriture.
Mais pour qu’il existe vraiment un calendrier il a fallu une autre invention d’homo sapiens : l’invention des récits religieux.
J’avais évoqué ce lien lors d’un mot du jour consacré à souhaiter la bonne année : <mot du jour du 12 janvier 2016>.
Car en effet pour qu’il existe un calendrier qui puisse repérer et dater dans le temps, il faut évidemment en plus de la tentative de Nabta Playa, une date origine qui marque la première année : le premier jour, du premier mois de la première année.
Le mot du jour du 12 janvier 2016 faisait le constat de la coexistence de nombreux calendriers autre que le nôtre « le calendrier grégorien » qui marque pour origine la naissance de Jésus de Nazareth, telle qu’elle a été imaginée par des théologiens.
Pour évoquer cette origine il faut regarder cette émission de l’historien Patrick Boucheron : < La crucifixion de Jésus | Quand l’histoire fait dates >
Notre calendrier se base donc sur un récit religieux comme le calendrier hébraïque, le calendrier musulman et bien d’autres.
Notre calendrier se base sur une année qui commence le 1er janvier depuis l’édit de Roussillon de 1564 de Charles IX.
Mais force est de constater que si nous fêtons le 1er janvier, notre vie culturelle, économique dans son organisation ne tient quasi aucun compte du 1er janvier.
C’est un autre découpage du calendrier qui est primordial pour nous : l’année scolaire.
Or l’année scolaire ne commence pas au premier janvier mais en septembre.
Et la vie culturelle met ses pas dans cette année scolaire, mais pour le théâtre, les concerts on ne parle pas d’année mais de « saisons». On parle aussi de saison sportive ou de saison de chasse.
Bien sûr la <saison> est d’abord cette période de l’année qui observe une relative constance du climat et de la température. L’année est divisée en 4 saisons qui durent trois mois et se situent entre les 2 solstices et les 2 équinoxes . Actuellement nous sommes en automne.
 Et je ne résiste pas au plaisir de partager une photo d’automne canadien découvert sur le net.
Et je ne résiste pas au plaisir de partager une photo d’automne canadien découvert sur le net.On parle aussi des saisons de la vie.
Pour ma part, à 63 ans je peux dire que je suis au bel automne de ma vie.
Ainsi, en faisant référence aux saisons de concerts ou de théâtre, j’ai trouvé pertinent de parler, pour recommencer après la trêve estivale à écrire régulièrement des mots du jour, d’une nouvelle saison.
Cette aventure des mots du jour a commencé le 9 octobre 2012. Ce qui signifie que ce 18 octobre 2021, je commence la 10ème saison de mots du jour.
Le 18 octobre 2012, le mot du jour était : « Il est nécessaire de mettre fin aux petits privilèges d’un grand nombre pour pouvoir préserver les grands privilèges d’un tout petit nombre ! » ce qui constituait un jugement qu’Emmanuel Todd portait sur certaines mesures du gouvernement.
C’est une nouvelle saison, ce n’est pas la dernière.
C’est au moins mon souhait si ma santé continue à le permettre.
C’est pourtant une saison particulière : il s’agit de la dernière réalisée intégralement alors que je reste en activité en tant que fonctionnaire d’état.
En janvier 2023, je prendrai ma retraite et une dernière étape de vie commencera.
C’était un mot du jour un peu plus personnel pour commencer cette nouvelle saison 2021/2022.
<1606>
-
Mardi 10 août 2021
« Le mot du jour est en congé.»Il reviendra probablement le 18 octobre 2021Il faut savoir faire silence, se reposer, se régénérer, lire, flâner, méditer, pour revenir pour de nouveaux partages, réflexions et questionnements.
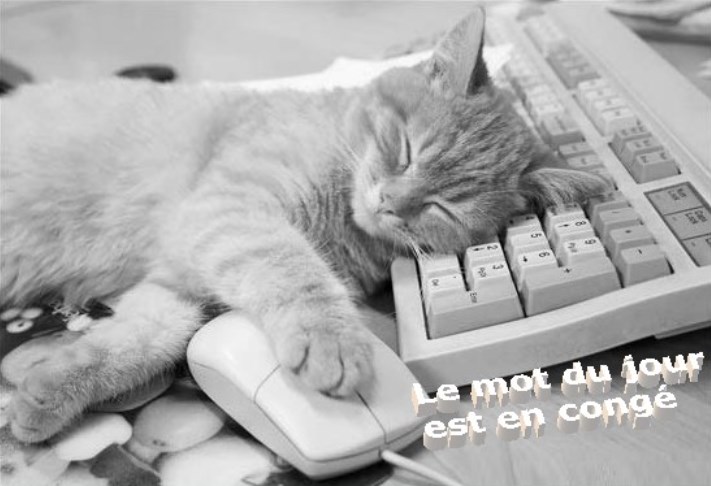
Hier, je finissais cette saison avec «Demain» une chanson de Moustaki , d’une beauté ineffable mais aussi ouverture vers la réflexion sur le demain de l’humanité.
Cet article faisait suite à une semaine pendant laquelle je m’étais arrêté à des destins particuliers.
Par exemple Angélique Ionatos la chanteuse de la lumière qui magnifiait la poésie grecque : <C’est toujours un rêve quand la poésie tombe dans les filets de la musique.>, Frédérique Lemarchand dont l’existence même constitue un hymne à la vie <Je ne suis pas née vivante, je le deviens >, Pour finir avec le poète de la tendresse et de la révolte qui nous vient du Rwanda Gaël Faye <Traverser la vie en se sentant digne de cette petite parenthèse qui est l’existence.>
Lors de cette saison plusieurs séries de mots du jour ont été écrites :
- <Franz Schubert : l’année 1828>
- <Beethoven est né il y a 250 ans>
- <Albert Camus et « Le premier homme »>
- <La Commune de Paris>
- <1979 : L’année du grand retournement>
D’autres séries n’ont pas encore leur page dans la liste des séries : <L’inceste, cet acte ignoble longtemps resté tabou> et aussi <Amazon>
Et bien d’autres mots du jour : comme « La diaspora des cendres » qui parle de la shoah.
Ou ce moment de grâce poétique «Ce n’est qu’alors qu’il peut arriver qu’en une heure très rare, du milieu d’eux, se lève le premier mot d’un vers.».
Et aussi sur les vertus quasi miraculeuse de la musique « Le pansement Schubert ».
Cet article qui parle du destin de la scientifique hongroise passionnée de l’ARN messager et qui a créé le vaccin de Pfizer <Katalin Kariko>.
Tous ces mots du jour et tous les autres peuvent être trouvés sur la page <La liste des mots>
<mot sans numéro>
-
Lundi 9 août 2021
« Demain nous n’aurons plus peur de voir se lever le jour. »Georges MoustakiC’était à la fin d’une émission de radio, il y a plus d’un an déjà, le présentateur a alors annoncé une chanson de Georges Moustaki : « Demain »
Moustaki né en 1934 à Alexandrie, en Egypte, et décédé en France en 2013, fut un des plus grands auteurs compositeurs de chansons françaises.
Il a écrit « Milord » pour Édith Piaf, « Ma liberté » ou « Sarah » pour Serge Reggiani, « La longue Dame Brune » pour Barbara qu’il chantera en duo avec elle.
Car il était aussi interprète, il a notamment composé et interprété personnellement « Le Métèque ». Chanson qu’il a écrite après que la mère d’une jeune fille dont il était l’amoureux ait interpellé sa fille devant Moustaki : « C’est qui ce métèque que tu me ramènes ? »
Tant d’œuvres inoubliables sont de sa main.
Mais cette chanson « Demain » est très méconnue, alors qu’il s’agit d’une œuvre d’une émotion et d’une puissance rare, peut être la plus belle.
J’ai immédiatement été saisi par le ton, la musique d’une subtilité et d’une finesse touchante, le texte d’abord apaisant puis d’une beauté tragique.
Dès cet instant, j’ai voulu la partager.
Mais quand et comment ?
L’évidence m’est apparue : il fallait la partager un 9 août à 11:08
Voici la chanson <Demain>
Et voici le texte :
« Demain nous n’aurons plus peur
De voir se lever le jour
Demain ce sera moins lourd
Mon amour si tu pleures
Au soleil de l’été je sécherai tes larmes
Demain nous n’aurons plus faim
La guerre sera finie
La terre offrira ses fruits
Nous ferons un festin
Pour oublier la fureur et le bruit des armes
Le ciel est sans nuage après la nuit d’orage
La cloche de l’église annonce un mariage
Un prisonnier confie son âme à son gardien
Oublié par l’histoire il meurt au quotidien
C’est un jour un jour du mois d’août
Pareil à tous les jours
Avec des cris joyeux et des chagrins d’amour
Et la guerre est ailleurs si proche et si lointaine
L’espérance est fragile elle existe quand même
Demain nous n’aurons plus faim
La guerre sera finie
La terre offrira ses fruits
Nous ferons un festin
Pour oublier la fureur et le bruit des armesDemain nous n’aurons plus peur
De voir se lever le jour
Demain ce sera moins lourd
Mon amour pourquoi tu pleures ?Nagasaki 9 août 1945 11 heures 08 »
C’est donc une chanson sur Nagasaki et la bombe qui explosa le 9 aout 1945 sur cette ville japonaise.
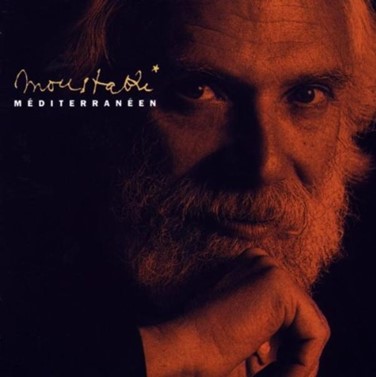 La chanson est de 1992 et parut sur le disque : « Méditerranéen ».
La chanson est de 1992 et parut sur le disque : « Méditerranéen ».
En 1972, il avait écrit une chanson « Hiroshima » dédiée à la première ville touchée par la bombe atomique. Pour le remercier Hiroshima fit Moustaki citoyen d’honneur de la ville.
Malgré de nombreuses recherches sur Internet et même à la bibliothèque je n’ai pas trouvé beaucoup d’informations sur les conditions de création de la chanson « Demain » .
Ce que je sais c’est que Moustaki allait fréquemment en tournée au Japon.
Pour la chanson « Demain » les paroles sont de Georges Moustaki, mais la musique de Teizo Matsumura
Or il existe un film japonais « « Tomorrow-Ashita » de 1988 réalisé par Kazuo Kuroki qui raconte la vie d’habitants de Nagasaki pendant les 24 heures qui ont précédé l’explosion de la bombe.
Et j’ai trouvé <Cet extrait de la télévision japonaise> dans lequel dans un premier temps on voit des extraits de ce film japonais pendant qu’on entend la chanson « Demain » chantée par Moustaki. La fin de l’extrait est une interview en japonais de Moustaki à laquelle on ne comprend rien.
Je ne connais donc pas le rapport entre ce film et la chanson ni d’ailleurs s’il en existe un, hors le rapprochement fait par cette télévision japonaise.
Si un lecteur peut m’éclairer qu’il n’hésite pas à enrichir ma connaissance.
Un mot du jour n’est pas figé et si de mon coté je trouve plus d’explications, celui-ci sera enrichi et complété.
Il reste cette chanson à la beauté tragique qui ne peut que saisir l’auditeur.
Je pourrais m’arrêter là, sur l’émotion délivrée par cette chanson. Mais il est aussi possible de jeter un regard contemporain sur cette tragédie du 9 août 1945.C’était la seconde et dernière fois, pour l’instant, et j’espère pour toujours, qu’homo sapiens a utilisé cette terrible arme que son génie et sa folie ont été capables d’imaginer et de réaliser. J’écrivais qu’en 1979 nous avions peur d’une guerre nucléaire alors que nous vivions la guerre froide entre bloc occidental et bloc soviétique.
Depuis la fin de la guerre froide j’ai le sentiment que cette crainte s’est dissipée. Mais, si on examine la situation de manière froide et rationnelle, ce soulagement ne semble pas sage. Depuis qu’il n’y a plus deux pouvoirs ennemis qui pouvaient se parler, en étant conscient de l’équilibre de la terreur, le risque a plutôt augmenté.
Il est vrai aussi que nous avons pris conscience que d’autres risques tout aussi graves et plus inéluctables se dressent devant nous. Demain et déjà aujourd’hui nous devons faire face :
- A la chute de la biodiversité ;
- A la diminution des ressources ;
- Au réchauffement climatique ;
- Aux tensions sur l’accès à l’eau ;
- Aux aspirations de démiurge de plus en plus dément de certains humains ;
- A la folie totalitaire aidée par la technologie toujours plus invasive et plus capable de contrôler le moindre espace de liberté ;
- Au fait que quelle que soit la manière dont on aborde le problème, l’espèce homo sapiens prend trop de place et trop de ressources de la biosphère qui constitue la fine couche miraculeuse autour de la terre qui a rendu la vie possible.
Le rapport du GIEC est annoncé pour cette journée du 9 août. Nous savons déjà que « Le nouveau Rapport [constitue] l’avertissement le plus sévère jamais lancé. »
Alors de quoi sera fait demain ?
Edgar Morin écrit : « Nous n’avons pas la conscience lucide que nous marchons vers l’abîme »
« Moi, je pense que nous avons besoin, toujours, de nous mobiliser pour une chose commune, pour une communauté. On ne peut pas se réaliser en étant enfermé dans son propre égoïsme, dans sa propre carrière. On doit aussi participer à l’humanité et c’est une des raisons, je crois, qui m’ont maintenu alerte jusqu’à mon âge. […]
Surtout, il y a l’absence de conscience lucide que l’on marche vers l’abîme. Ce que je dis n’est pas fataliste. Je cite souvent la parole du poète Hölderlin qui dit que «là où croît le péril croît aussi ce qui sauve». Donc, je pense quand même qu’il y a encore espoir. […]
Ce qui me frappe beaucoup, c’est que nous sommes à un moment où nous avons, tous les humains, une communauté de destin – et la pandémie en est la preuve, on a tous subi la même chose de la Nouvelle-Zélande à la Chine et à l’Europe. On a subi les mêmes dangers physiques, personnels, sociaux, politiques. On a vécu des périodes sombres comme l’Occupation où pendant des années, il n’y avait pas d’espoir, jusqu’à ce qu’arrive le miracle de la défense de Moscou et de l’entrée en guerre des États-Unis. Donc l’improbable arrive dans l’histoire. Des évènements heureux arrivent. Parfois, ils n’ont qu’un sens limité, mais quand même important. […]Dans le fond, il y a toujours la lutte entre ce qu’on peut appeler les forces d’union, d’association, d’amitié, Eros, et les forces contraires de destruction et de mort, Thanatos. C’est le conflit depuis l’origine de l’univers où les atomes s’associent et où les étoiles se détruisent, se font bouffer par les trous noirs. Vous avez partout l’union et la mort. Vous l’avez dans la nature physique, vous l’avez dans le monde humain. Moi, je dis aux gens, aux jeunes : prenez parti pour les forces positives, les forces d’union, d’association, d’amour, et luttez contre toutes les forces de destruction, de haine et de mépris. »
Demain nous n’aurons plus peur de voir se lever le jour.
<1605>
-
Vendredi 06 août 2021
« La dignité […] est ce qui nous permet de traverser la vie en se sentant digne de cette petite parenthèse qui est l’existence. »Gael FayeGaël Faye est tutsi. Enfin, sa mère est rwandaise et tutsi. Son père est français et natif de Lyon.
Il est né en 1982 à Bujumbura au Burundi, l’état voisin du Rwanda.
Il avait 12 ans, en 1994 quand le génocide et les massacres des tutsis par l’ethnie majoritaire des hutus se sont réalisés.
Il fuit son pays natal pour la France, à l’âge de treize ans.
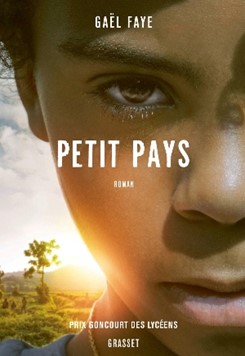 Il a raconté son histoire partiellement dans un roman autobiographique « Petit Pays »
Il a raconté son histoire partiellement dans un roman autobiographique « Petit Pays »
Ce roman publié en août 2016, reçoit de nombreux prix :
- Le prix Goncourt des lycéens
- Le Prix du roman Fnac
- Le Prix du premier roman français,
- Le prix du roman des étudiants France Culture-Télérama
Ce livre va permettre à Gaël Faye de gagner en notoriété.
Mais sa première passion est la musique. Il est y entré par le rap.
Le rap est un moyen d’expression assez éloigné de ma sensibilité.
Mais Gael Faye a dans son dernier album « Lundi méchant » fait beaucoup de chemin vers ma sensibilité.
Je l’ai entendu dans les matins de France Culture du 15 juillet 2021 invité par Chloë Cambreling <Les mots ont toujours été mes petites armes dérisoires pour résister>
J’ai aimé sa voix douce et l’intelligence de ce qu’il disait.
La profondeur et la beauté des textes qu’il chante m’ont touché.
Et pour la musique, il a expliqué pour cet album qui est son deuxième, qu’il a d’abord commencé par la musique avant de poser des paroles, le contraire de ce qu’il faisait jusqu’alors. Et il a ajouté :
« Cela a apporté plus de musicalité que j’avais l’habitude de faire. Cela a apporté plus de respiration. J’ai eu moins peur des silences. Il y a un travail avec le temps pour apprivoiser le silence. Je viens d’une musique qui est une transe de mots. Le rap c’est une transe de mots. Plus le temps passe, plus je me rapproche d’une façon de composer qui ressemble à ce qu’on peut faire quand on écrit une chanson. J’ai l’impression de me renouveler. De redonner un souffle à mon envie de fabriquer des chansons. […] On peut dire autant de chose en creux que de façon frontale. Et les silences qui peuvent exister, les instruments qui peuvent s’exprimer cela peut raconter une histoire. […] Il y a quelques années, j’aurais pris les quatre temps pour mettre des mots, et ça c’est un travail qui m’intéresse de plus en plus. [ne pas saturer le temps par des mots] »
Ne pas saturer l’espace et le temps par des mots.
Laisser la place au silence, car le silence est aussi musique.
Schubert et Beethoven ne disaient pas autre chose.
Il a donc présenté pendant cette émission son album paru le 6 novembre 2020, mais qu’il n’a pu commencer à chanter en public que récemment, pour les motifs que vous connaissez.
J’ai d’abord été séduit par cette chanson « Respire »
Le texte stimulant qui exprime toutes les agressions et aussi les défis auxquels nous sommes soumis et cet appel à la sérénité qui passe par le souffle, la respiration.
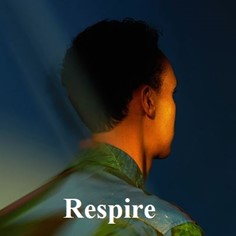 « Respire, respire, respire, espère…
« Respire, respire, respire, espère…Encore l’insomnie, sonnerie du matin
Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain
Triste face-à-face, angoisse du réveil
Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil (OK)Aux flashs d’infos : les crises, le chômage
La fonte des glaces, les particules fines…Courir après l’heure, les rames bondées
Les bastons d’regards, la vie c’est l’usine
Hamster dans sa roue
P’tit chef, grand bourreau
Faire la queue partout, font la gueule partout
La vie c’est robotT’as le souffle court (respire)
Quand rien n’est facile (respire)
Même si tu te perds (respire)
Et si tout empire (espère) »Il dit que son album est un album tendre :
« La tendresse c’est pour l’idée d’un amour qui est ancré dans le quotidien. Qui ne s’use pas. Qui se renouvelle tous les jours, avec de petits gestes. Et chalouper c’est tout à fait la chanson qui résume cet album. Parce qu’on veut reprendre du plaisir et pas oublier la fugacité des instants et leur importance. D’ailleurs j’aime terminer les concerts par la chanson chalouper »
Cette chanson qui évoque la vieillesse, la tendresse et ce besoin jamais rassasié d’être ensemble de se toucher, de bouger ensemble :
«
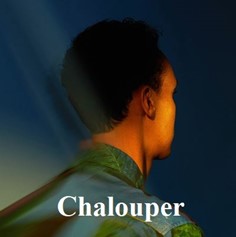 Un jour viendra le corps tassé
Un jour viendra le corps tassé
Les parchemins sur nos visages
Ceux qui racontent la vie passée
Tous les succès et les naufrages
Et nos mains qui tremblent au vent
Comme des biguines au pas léger
Continueront de battre le temps
Sous des soleils endimanchés
Un jour viendra on f’ra vieux os
Des bégonias sur le balcon
Un petit air de calypso
Photo sépia dans le salon
Malgré la vie, le temps passé
Malgré la jeunesse fatiguée
Personne ne pourra empêcher
Nos corps usés de chalouperChalouper, chalouper
Chalouper, chalouper
Chalouper, chalouper
…»J’ai été séduit par la musique, mais ce qui frappe d’abord c’est la qualité des textes.
Il avait aussi été l’invité le 19 novembre de Tewfik Hakem dans son émission « le Réveil culturel » : < Parler de choses graves avec des musiques douces> vient de la culture de la retenue dans laquelle j’ai grandi au Rwanda »
Sur la page du site, il est cité :
« J’écris pour garder une trace. Tout disparaît à une vitesse incroyable, la mémoire efface tout. Ma famille a connu des génocides, on a disparu en masse. Des pans entiers d’histoires humaines ont été anéantis. Mon père est français, ma mère est rwandaise mais j’ai grandi avec mon père dans un petit pays d’Afrique Centrale, où être métis n’a pas de réalité : j’étais un petit Blanc. Puis subitement en France je suis devenu Noir. C’est sans doute à cause de ce sentiment de me sentir perpétuellement à la marge que je me suis bâti sur l’écriture. »
Gaël Faye
S’il y a de la tendresse, il y aussi de la révolte. Et s’il écrit ses textes il accepte aussi de prendre des textes écrits par d’autres, notamment ce poème de Christiane Taubira : « Seuls et vaincus ». Il explique que la révolte est aussi indispensable que la tendresse
« Je cite souvent un professeur d’espérance, René Depestre, qui m’a appris cet équilibre important chez l’être humain entre la révolte et la tendresse. Je pense qu’il ne peut pas y avoir de la tendresse, s’il n’y a pas aussi de la révolte en face du monde tel qu’il ne va pas.
On peut déployer son amour que si on est aussi révolté par les injustices, dans ce monde qui nous met en position de dominé. Il faut ce balancier. C’est pourquoi je voulais collaborer avec des gens qui ont œuvré toute leur vie entre ces deux positions comme Harry Belafonte et Christiane Taubira. »
L’ancienne ministre dans son texte fustige les xénophobes et tous ceux qui mènent selon elle un combat d’arrière-garde.
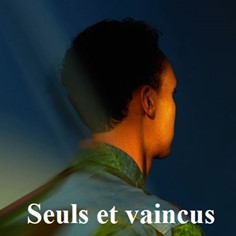 «Vous finirez seuls et vaincus
«Vous finirez seuls et vaincus
Sourds aux palpitations du monde
À ses hoquets, ses hauts, ses bas
Ses haussements d’épaules veules
Au recensement des ossements
Qui tapissent le fond des eauxVous finirez seuls et vaincus
Aveugles aux débris tenaces
De ces vies qui têtues s’enlacent
De ces amours qui ne se lassent
Même lacérées de se hisser
À la cime des songeries
[…]
Et vos enfants joyeux et vifs
Feront rondes et farandoles
Avec nos enfants et leurs chants
Et s’aimant sans y prendre garde
Vous puniront en vous offrant
Des petits-enfants chatoyantsVous finirez seuls et vaincus
Car invincible est notre ardeur
Et si ardent notre présent
Incandescent notre avenir
Grâce à la tendresse qui survit
À ce passé simple et composé »A la fin de l’émission il donne ce chemin :
« La dignité c’est une valeur qui m’importe beaucoup, c’est ce qui nous permet de traverser la vie en se sentant digne de cette petite parenthèse qui est l’existence. La fête permet de transcender la rage en une énergie plus grande. »
Et il finit son album par cette sublime chanson dans laquelle le texte est d’une finesse et d’une poésie à se pâmer :
C’est une chanson en mémoire du Rwanda, de son Rwanda :
« Au-dessus d’ces collines s’élève ma voix à jamais
Ô mon petit pays, ô Rwanda bien-aimé
Un million de gouttes d’eau qui tombent de terre en ciel
Un million de nos tombes en trombes torrentielles
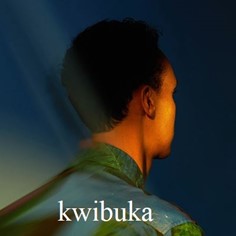 De nos fosses profondes à nos points culminants
De nos fosses profondes à nos points culminants
Nous sommes debout maintenant les cheveux dans le vent
À conjurer le sort qu’un désastre engloutit
À se dire qu’on est fort, qu’on vient de l’infini
Je rêve de vous (kwibuka)
I’m dreamin’ of you (kwibuka)
Je rêve de vous, chanson d’un soir d’ivoire
Je rêve de vous, mes mots sont dérisoires
Je rêve de vous quand l’Histoire nous égare
Je rêve debout au jardin des mémoires
Et vu que je renais déjà de nos abysses
Je fais de nos sourires d’éternelles cicatrices
[…]
Je rêve de vous
Vous mes lumières invaincues
Mon souvenir
Mes silences nus
Je rêve de vous
Dissipe les ténèbres
Je n’oublie pas
Je m’habille de vos rêves »
C’est un moment de grâce.
J’ai bien sûr acheté cet album de cet artiste, de ce poète, de cet humaniste qui a pour nom Gael Faye et qui nous vient du Rwanda.
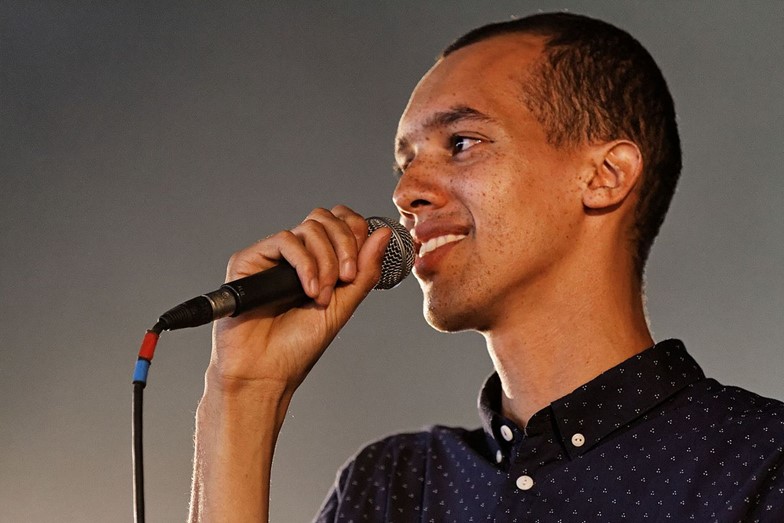
<1604>
- Le prix Goncourt des lycéens
-
Jeudi 5 août 2021
« Je ne suis pas née vivante, je le deviens »Frédérique LemarchandFrédérique Lemarchand est une artiste peintre que j’ai découverte par la publication par une « amie facebook » qui la présentait.
 L’Art est pour elle un chemin qui lui permet de vivre, de s’exprimer et surtout d’être résiliente.
L’Art est pour elle un chemin qui lui permet de vivre, de s’exprimer et surtout d’être résiliente.
Parce que le plus remarquable chez cette femme est précisément sa résilience devant son combat de vie.
Le célèbre médecin du XVIIIème siècle Xavier Bichat a donné cette définition qu’on continue à citer :
« La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort »
Frédérique Lemarchand a su ou pu mobiliser des ressources et des fonctions insoupçonnées pour résister à la mort.
Frédérique Lemarchand est atteinte d’une cardiopathie congénitale.
Dès sa naissance, sa mort précoce est annoncée.
Les statistiques médicales sont cruelles : elle n’ira pas au-delà de ses quatorze ans.
Elle trouve refuge dans le dessin et dans la peinture et s’en remet « au grand semeur de destinées ».
Mais les statistiques médicales ne sont pas la vérité.
Elle atteint 20 ans et elle « joue l’équilibriste entre la vie et la mort ».
Dans cette précarité absolue, elle continue son chemin par l’art et la volonté farouche de vouloir continuer à vivre.
En 2012, elle a 34 ans elle peut enfin recevoir la transplantation cœur poumon qui peut la sauver de sa maladie.
Cette intervention conduit à une mort clinique et un coma qui durera 40 jours.
De cette épreuve elle tirera une expérience initiatique qui lui permet d’aller vers d’autres lieux de perception et de compréhension
Sophie Mainguy qui est celle qui m’a fait découvrir Frédérique Lemarchand et que j’avais évoqué au début du premier confinement dans un mot du jour dont l’exergue était « Nous ne sommes pas en guerre et n’avons pas à l’être » écrit à son propos :
« Frédérique Lemarchand est une icône du vivant. Elle incarne la puissance du lâcher-prise dans sa forme humaine la plus aboutie, réalisant que c’est lorsque « l’on consent à la vulnérabilité ultime qu’on laisse véritablement passage à plus grand que soi ». Habitant encore des lendemains incertains, elle offre par son travail et ses éclats de rire ce qu’elle a acquis : l’immortalité de l’Esprit. Car comme elle aime à le répéter : qui peut brûler le feu ? »
 Mais c’est une volonté de vivre et de surpasser les épreuves qu’il faut entendre par les mots et le témoignage directs de cette extraordinaire et bouleversante femme :
Mais c’est une volonté de vivre et de surpasser les épreuves qu’il faut entendre par les mots et le témoignage directs de cette extraordinaire et bouleversante femme :
« Je ne suis pas née vivante, je le deviens»
Nous sommes presque en présence d’un miracle.
Frédérique Lemarchand est dans une démarche mystique et croyante.
Mais je pense que l’hymne de vie qu’elle incarne est capable de rassembler au-delà de ceux qui croient, ceux qui ne croient pas.
Elle dispose d’un site dans lequel elle révèle son art et sa démarche spirituelle à travers notamment des vidéos < https://www.lemarchand-peintre.com/accueil/>
Sa perception et son expression mystique du monde peut pousser l’esprit rationnel au-delà de ses limites.
Mais je retiens avant tout une force de vie, d’enthousiasme, de dynamisme qui est un appel au dépassement, mais aussi à l’intériorisation et à l’épanouissement de notre richesse intérieure.
Elle écrit sur son site
« Toutes mes formes d’être au monde cherchent une issue là où il n’y en a pas et à l’inventer. »
<1603>
-
Mercredi 4 août 2021
« Mon histoire parle d’espoir »Nadia NadimBien sûr, le football est devenu insupportable à cause de l’argent dans lequel il se vautre et les compromissions dans lesquelles il s’abîme
Mais le football constitue aussi, pour certains, un formidable moyen d’émancipation. Il permet à des jeunes qui se trouvent dans des conditions difficiles, au moment de leur naissance et de leur enfance, de sortir de leur condition et d’accéder à une vie et à un confort auxquels ils n’auraient jamais pu prétendre sans leur réussite sportive.
Certains s’y perdent, il est vrai. Mais il y a aussi de belles histoires.
Dans la série sur l’année 1979, j’ai parlé de l’Afghanistan et je n’ai fait qu’effleurer les conditions de vie que les talibans ont fait subir aux femmes afghanes.
Les américains ont décidé de fuir ce « cimetière des empires » après 20 ans de guerre sans issue. Les spécialistes comme Gilles Dorronsoro, professeur de sciences politiques à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de « Le gouvernement transnational de l’Afghanistan. Une si prévisible défaite » en 2021, et Elie Tenenbaum, directeur du centre des études de sécurité à l’IFRI n’ont pas beaucoup de doute sur <La victoire et le retour inéluctable des talibans au pouvoir en Afghanistan>
Et l’histoire que je partage aujourd’hui est celle d’une jeune afghane qui est arrivée à sortir du guêpier taliban et à accéder à un destin plus doux grâce au football.
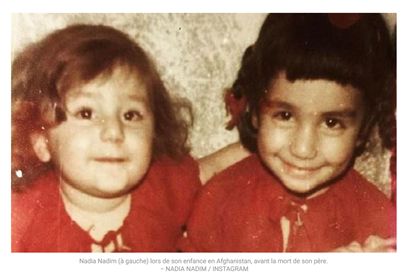 Nadia Nadim s’est enfuie de l’Afghanistan après que les talibans aient tué son père, elle a pu se réfugier au Danemark. Elle s’est intégrée dans un club de football et est devenu internationale dans l’équipe féminine du Danemark. Elle poursuit parallèlement des études médecine.
Nadia Nadim s’est enfuie de l’Afghanistan après que les talibans aient tué son père, elle a pu se réfugier au Danemark. Elle s’est intégrée dans un club de football et est devenu internationale dans l’équipe féminine du Danemark. Elle poursuit parallèlement des études médecine.
Elle a écrit un livre pour raconter: « Mon Histoire »
Sur le <site de LCI>, j’ai trouvé cet interview réalisé par Yohan ROBLIN et publié le 5 juillet 2021. Elle raconte :
« La raison pour laquelle je prends à chaque fois mon temps, c’est parce que je veux transmettre ce brin d’espoir, cette petite étincelle, à la personne qui m’écoute ou me lit »
Au moment de cet entretien elle était encore joueuse du Paris Saint Germain, elle s’est engagée pour la nouvelle saison dans un club américain.
 Le journaliste la présente ainsi :
Le journaliste la présente ainsi :
« À 33 ans, Nadia Nadim a surmonté tous les obstacles. Née à la fin des années 80 à Hérat, en Afghanistan, elle a fui le régime autoritaire des Talibans « pour survivre », après l’assassinat de son père, général de l’armée afghane. Au prix d’un long et dangereux périple, depuis sa terre natale jusqu’en Europe, elle a trouvé refuge dans un centre d’accueil au Danemark, avec sa mère et ses quatre sœurs. Là-bas, elle a découvert une nouvelle vie, « un pays sans guerre » où les femmes pouvaient jouer au football en public. Douée balle au pied, elle en a fait sa passion puis son métier. Pendant plus d’une demi-heure, mêlant anglais et français, la jeune femme, qui mène de front sa carrière et des études de médecine, a partagé son histoire. »
Dans un régime dans lequel la religion occupe toute la place et s’immisce partout jusque dans les familles, dans les appartements, s’intéressant même à ce qui se passe dans la chambre à coucher, la vie est triste et la peur omniprésente :
« Nous vivions dans la peur (…) c’était une vie très très triste »
Elle explique pourquoi elle a écrit son livre :
« Tout le monde parlait de mon histoire, je pensais qu’il fallait que je la raconte avec mes propres mots. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu écrire ce livre. Dans le monde dans lequel nous vivons, vous voyez peu d’histoires positives. Je voulais donner de l’espoir aux enfants, qui sont dans la situation dans laquelle j’étais ou qui rencontrent des difficultés. J’avais aussi envie d’éduquer les personnes, qui peuvent avoir des préjugés, en leur racontant ce que j’ai traversé, ce que j’ai enduré pour en arriver là. Ce livre est une manière de leur dire : « Si vous leur donnez une seconde chance, elles peuvent vous surprendre. » J’en suis la preuve vivante : j’ai eu une autre chance, j’ai surpassé mes difficultés et, aujourd’hui, j’aide la société. […]
Cette histoire, mon histoire, parle d’espoir, même dans les moments les plus sombres, de la nécessité de croire en soi et de ne jamais baisser les bras. Plus elle sera racontée et diffusée, plus il y a de chances que quelqu’un, quelque part, en ressortira quelque chose de bon. »
Et elle raconte ce qu’elle a vécu en Afghanistan. Quand elle a eu 10 ans, les Talibans ont convoqué son père, qui était un général de l’armée. Il s’est rendu à ce rendez-vous, mais il n’est jamais rentré à la maison…
 « Nous avons appris sa mort très longtemps après. Une personne l’a dit à quelqu’un d’autre, et ainsi de suite, jusqu’à ce que ça nous revienne. L’un des officiers, qui était là-bas quand ils l’ont assassiné, a raconté ce qu’il s’était passé à mes grands-parents, qui l’ont ensuite dit à ma mère. Ma mère, qui n’avait pas encore 35 ans, est devenue folle. Elle a essayé de le chercher pendant plusieurs mois. Je n’ai jamais vu de corps ou de tombe. L’endroit, où les Talibans avaient l’habitude d’exécuter les gens, était un désert sauvage. Les animaux mangeaient les restes. Pendant très longtemps, je n’y ai pas cru. Je pensais qu’il allait réapparaître un jour. Dans mes yeux, il était ce général, une sorte de James Bond, puissant et immortel. Je me disais que ce n’était pas possible, mais tout doucement j’ai commencé à réaliser que je ne le reverrai plus jamais. […]
« Nous avons appris sa mort très longtemps après. Une personne l’a dit à quelqu’un d’autre, et ainsi de suite, jusqu’à ce que ça nous revienne. L’un des officiers, qui était là-bas quand ils l’ont assassiné, a raconté ce qu’il s’était passé à mes grands-parents, qui l’ont ensuite dit à ma mère. Ma mère, qui n’avait pas encore 35 ans, est devenue folle. Elle a essayé de le chercher pendant plusieurs mois. Je n’ai jamais vu de corps ou de tombe. L’endroit, où les Talibans avaient l’habitude d’exécuter les gens, était un désert sauvage. Les animaux mangeaient les restes. Pendant très longtemps, je n’y ai pas cru. Je pensais qu’il allait réapparaître un jour. Dans mes yeux, il était ce général, une sorte de James Bond, puissant et immortel. Je me disais que ce n’était pas possible, mais tout doucement j’ai commencé à réaliser que je ne le reverrai plus jamais. […]
Tout a changé après la disparition de mon père. Avant la guerre et qu’il soit tué, les souvenirs que je garde sont ceux d’une vie calme, des moments heureux. Nous étions très protégées, nous avions une bonne vie. Après, tout s’est écroulé. On ne savait plus à quoi allait ressembler le futur, ce qu’il allait advenir de nous. On se posait des milliers de questions : « Est-ce que notre maison est sûre ? Combien de temps allons-nous vivre ainsi ? Est-ce quelqu’un va dénoncer notre mère et l’emmener loin de nous ? » Enfant, toutes ces pensées m’ont traversée. C’était dangereux d’être dehors. À chaque fois qu’on voulait sortir, il fallait toujours être accompagnée d’un homme. Nous vivions dans la peur qu’il nous arrive quelque chose, d’être tuées. »
Mais sa mère s’est rebellée et a voulu et a pu fuir le pays des fous de Dieu.
« Je suis heureuse et fière d’avoir eu une femme comme ma mère à mes côtés. Si elle avait été plus faible, qu’elle avait baissé les bras et abandonné, je n’aurais pas eu cette vie. Elle était jeune, elle aurait pu choisir une voie plus facile. Elle a choisi le chemin le plus dangereux pour nous donner, à mes sœurs et à moi, une autre chance dans la vie. Je lui en suis reconnaissante. »
Elle a payé des passeurs pour rejoindre l’Europe, dans l’espoir d’atteindre Londres où vivait des proches. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Et Nadia Nadim dit :
« Nous avons pris l’avion au Pakistan pour l’Italie, avec des faux passeports. Ensuite, nous sommes montées à l’arrière d’un camion, qui devait nous emmener en Angleterre. On devait rejoindre de la famille à Londres. Il nous a finalement arrêtées au Danemark. Cela ne s’est pas fini comme on le voulait, mais ce n’était pas trop grave. Le plus important, c’est que nous étions saines et sauves. Nous étions en vie et nous pouvions avoir une nouvelle chance. J’ai toujours cru que si une chose arrive, c’est qu’elle arrive pour une raison. Bien évidemment, cela a été très difficile de tout quitter, d’abandonner derrière nous tout ce qu’on possédait. Vous avez des amis, une famille, une identité et vous arrivez ailleurs, en repartant de zéro. C’est sans doute la chose la plus difficile à laquelle on peut être confronté. Il a fallu d’abord réapprendre l’alphabet puis les mots, pour enfin comprendre comment la société fonctionnait… J’étais en décalage avec les enfants du même âge. Les mathématiques étaient mon seul pont avec ma vie d’avant. Pour tout le reste, j’avais l’impression d’être sur une autre planète. Tout était différent, alors j’ai baissé la tête et je me suis mise à travailler pour m’intégrer au plus vite. »
 Le fait qu’elle ait eu envie et quelques dons pour le football, elle le doit à son père :
Le fait qu’elle ait eu envie et quelques dons pour le football, elle le doit à son père :
« Mon père était un grand fan de sports. Il aimait le football. Quand il nous a appris à jouer, mes sœurs et moi, ce n’était pas pour qu’on devienne footballeuse. Ça n’existait pas en Afghanistan. […] Peut-être que le fait de me sentir, à nouveau, proche de mon père est l’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à jouer au football. C’est possible, mais, au moment où j’ai vu ses petites filles, balle au pied, j’ai surtout pensé : « Pourquoi ça ne serait pas moi ? ». Quand vous êtes enfant, que vous voyez un nouveau jouet, vous voulez jouer avec. C’est ce que j’ai ressenti. Ce qui est beau, c’est que le football est venu à moi. J’ai découvert le jeu, j’ai commencé à m’entraîner dans la rue, partout. Petit à petit, après quelques mois, j’ai pris confiance jusqu’au jour où j’ai demandé de pouvoir jouer avec elles. J’ai eu de la chance qu’elles m’acceptent. »
Bien sûr dans cette histoire la courageuse mère joue un rôle déterminant.
Et elle est devenu au bout du travail et de l’entrainement la première joueuse étrangère à porter le maillot de l’équipe nationale du Danemark.
« Des fois, il y a des murs qu’on ne voit pas autour de nous. Certains ont plus que d’autres. Votre prison est probablement différente de la mienne. C’est toujours difficile de s’échapper de ces murs, cela demande beaucoup d’efforts. Encore, encore et encore. Je pense que je suis née dans un endroit avec beaucoup de murs. J’ai essayé de les faire tomber, un par un. »
L’Unesco l’a choisi en 2019 pour être une ambassadrice pour l’éducation des filles et jeunes femmes.
Parallèlement elle étudie la médecine, plus précisément la chirurgie réparatrice.
Je vous renvoie vers l’intégralité de l’article : <Mon histoire parle d’espoir>
J’ai aussi trouvé ces deux articles : <Nadia Nadim raconte son incroyable destin> et <Le football m’a offert une nouvelle vie>.
L’histoire d’une vie. L’histoire d’un courage, d’une détermination et de beaucoup de travail et forcément d’un peu de chance.
<1601>
-
Mardi 3 août 2021
« Cecilia Payne »Une scientifique oubliéeConnaissez-vous Cecila Payne ?
Moi je ne la connaissais pas. Je n’en avais jamais entendu parler.
C’est une publication sur un réseau social qui a fait cette énumération :
« Chaque lycéen sait qu’Isaac Newton a découvert la gravité, que Charles Darwin a découvert l’évolution et qu’Albert Einstein a découvert la relativité du temps. Mais quand il s’agit de la composition de notre univers, les manuels scolaires disent simplement que l’atome le plus abondant de l’univers est l’hydrogène. Et personne ne se demande comment on le sait. »
Personne ne le sait probablement parce que c’est une femme qui est à l’origine de cette découverte.
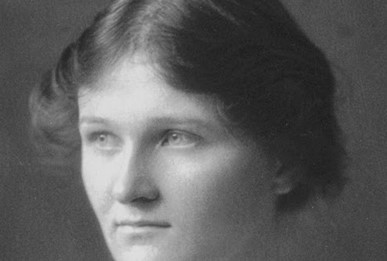 Cecilia Payne-Gaposchkin (1900 – 1979) est une astronome anglo -américaine qui a été la première astronome à soutenir que les étoiles sont majoritairement composées d’hydrogène contre le consensus scientifique.
Cecilia Payne-Gaposchkin (1900 – 1979) est une astronome anglo -américaine qui a été la première astronome à soutenir que les étoiles sont majoritairement composées d’hydrogène contre le consensus scientifique.
Le mot du jour du 13 avril 2018 avait pour exergue : « ni vues, ni connues » et parlait de ses nombreuses femmes qui ont eu une influence déterminante dans l’Histoire notamment des sciences mais n’ont pas été mentionnées ou ont été oubliées.
C’est sur le site « l’Histoire par les femmes » qu’on peut lire son histoire.
Cecilia Helena Payne est née à Wendover en Angleterre le 10 mai 1900. Sa mère était peintre et son père avocat et historien. Elle est l’aînée de trois enfants. Son père meurt alors qu’elle n’a n’a que quatre ans, et sa mère doit s’occuper seule de sa famille. Et comme les ressources sont limitées, sa mère préfère miser sur les études de ses deux fils, plutôt que sur sa fille.
On ne dira jamais assez qu’une part du manque de valorisation des destins féminins a été portée par les mères qui ont mis beaucoup de temps avant de devenir féministe.
J’avais déjà écrit que ma mère m’a appris énormément de choses mais pas le féminisme.
La jeune fille est remarquablement intelligente et travaille beaucoup.
Une anecdote relatée par <Wikipedia> me plait beaucoup
« Sa précocité intellectuelle se manifeste dès l’école primaire. À cette période, elle met au point un protocole scientifique pour vérifier l’effet de la prière, en comparant les résultats à un examen de deux groupes, dont l’un est composé de personnes ayant prié pour le succès et l’autre non. Le groupe qui n’avait pas prié s’est avéré avoir plus de succès. Cecilia Payne sera dès lors agnostique. »
Comme sa mère ne l’aide pas, elle a l’opportunité à décrocher une bourse en sciences naturelle au Newnham College de l’Université de Cambridge en 1919 ; elle y apprend la botanique, la physique et la chimie. Là, elle assiste à une conférence d’Arthur Eddington au sujet de son expédition dans le Golfe de Guinée pour photographier une éclipse solaire ; cette conférence est alors une révélation et Cecilia décide de travailler dans l’astronomie.
Autre information factuelle qu’il nous faut apprendre. Nous sommes donc au début du XXème siècle après la première guerre mondiale : Cecilia Payne achève ses études mais sans obtenir de diplôme ; l’Université de Cambridge ne délivre alors pas de diplômes aux femmes.
Réalisant que ses options de carrière en Angleterre sont limitées, elle rencontre Harlow Shapley, directeur de l’Observatoire de l’université Harvard, et part travailler pour lui aux États-Unis en 1923. Sous sa direction, elle se lance dans un doctorat et travaille sur la température des étoiles. Ses travaux l’amènent à établir que, si les étoiles ont une composition en éléments lourds semblable à la Terre, elles sont majoritairement composées d’hydrogène, ce qui va à l’encontre des idées de l’époque.
En 1924, elle écrit un article en ce sens et le fait relire par l’astronome Henry Russell, ancien professeur d’Harlow Shapley. Pas convaincu, ce dernier la dissuade de publier sa découverte.
<Wikipedia> raconte :
« Or Russell a été le professeur de Harlow Shapley, qui est le patron de Cecilia Payne, et s’il n’est pas convaincu, personne ne le sera : elle s’incline.
En 1925, Cecilia soutient cependant sa thèse, intitulée « Stellar Atmospheres, A Contribution to the Observational Study of High Temperature in the Reversing Layers of Stars », où elle présente ses travaux et conclusions, mais laisse de côté la question de l’hydrogène.
Après avoir atteint les mêmes conclusions par d’autres moyens, Russell réalise que Cecilia a raison. Dans une publication parue en 1929, il reconnaît l’antériorité de la découverte de Payne. Néanmoins, cette découverte lui est souvent attribuée ».
Ainsi, bien qu’il ait l’honnêteté de la citer, pendant longtemps on lui attribue la découverte. Probablement parce que c’est lui qui a publié l’article, ou simplement parce que c’était un homme.
En 1925, Cecilia obtient brillamment son doctorat et se lance dans l’étude des étoiles de haute luminosité, de la structure de la Voie Lactée et des étoiles variables. En raison de son sexe, son avancement professionnel reste cependant compliqué.
En 1931, Cecilia Payne devient citoyenne américaine. En 1933, en Allemagne, elle rencontre l’astrophysicien russe Sergei I. Gaposchkin. Elle l’aide alors à obtenir un visa pour les Etats-Unis ; ils se marient en mars 1934 et auront trois enfants.
Cecilia, contrairement aux mœurs de l’époque qui voulaient qu’une mère reste au foyer, n’arrête pas sa carrière d’enseignante et de chercheuse.
 <Ce site> relate qu’il lui faut attendre 1956 pour être nommée professeure de la faculté d’Harvard dont elle dirigea le département d’astronomie. Elle fut la première femme cheffe du département d’astronomie de Harvard.
<Ce site> relate qu’il lui faut attendre 1956 pour être nommée professeure de la faculté d’Harvard dont elle dirigea le département d’astronomie. Elle fut la première femme cheffe du département d’astronomie de Harvard.
A la fin de sa carrière elle fut davantage reconnue et reçût diverses distinctions honorifiques. Mais on oublia par la suite son apport important à la science.
Si vous voulez en savoir plus sur cette femme remarquable je pense que cet article de trois pages en dira un peu plus
Cecilia Payne-Gaposchkin meurt en 1979 d’un cancer du poumon. Un astéroïde a été nommé en son honneur.
Je crois qu’il est juste de connaître son nom dans le panthéon des scientifiques.
<1600>
-
Lundi 2 août 2021
« C’est toujours un rêve quand la poésie tombe dans les filets de la musique. »Angélique IonatosC’était un matin de juillet 2019, je somnolais encore, quand une voix m’a réveillé. C’était une voix grave de contralto, solaire, envoûtante, âpre et sensuelle.
Angélique Ionatos chantait un poème de Sappho de Mytilene de l’île de Lesbos, écrit il y a 2500 ans qu’elle avait mis en musique.
J’ai écrit immédiatement un mot du jour : « « Anthe Amerghissan (J’ai vu cueillant des fleurs) »
Dans ce mot du jour je parlais surtout de Sappho de Mytilene, la première lesbienne revendiquée que l’Histoire a retenue. C’était insupportable à l’Église catholique. Sur ordre du Pape Grégoire VII qui fut l’évêque de Rome de 1073 à 1085, on détruisit les poèmes de Sappho qu’on connaissait. Il n’y a que des fragments qui ont pu être sauvés grâce à quelques rebelles qui les avaient recopiés.
Toutes les religions monothéistes quand elles se sont enfermées dans leur croyance, en proclamant que c’était la vérité, ont manifesté cette intolérance et ont voulu détruire tout ce qui s’éloignait de ce qu’il prétendait être la vérité.
 C’est ainsi, en 2019, que j’ai appris l’existence de cette femme, de cet artiste irradiant la lumière et l’émotion.
C’est ainsi, en 2019, que j’ai appris l’existence de cette femme, de cet artiste irradiant la lumière et l’émotion.
Il était déjà bien tard dans l’horloge de la vie.
Le dernier de ses 18 albums était sorti en 2015 « Reste la lumière » et elle n’avait pas pu donner un dernier concert au Triton, un club des Lilas, dans la banlieue de Paris, le 6 avril 2018. Le concert fut annulé en souhaitant prompt rétablissement à Angélique.
Ce souhait ne se réalisa pas. En butinant sur Internet sur d’autres sujets, je suis tombé, il y a quelques jours, sur cette page sur le site de France Musique : « La chanteuse grecque Angélique Ionatos est morte ».
On pouvait lire :
« Angélique Ionatos était l’une des plus grandes voix de la Grèce en exil. Elle s’est éteinte aux Lilas mercredi 7 juillet.
Il est des pays dont l’histoire dramatique donne naissance à des exilés magnifiques. C’est le cas de la Grèce, où naît, en 1954, Angelikí Ionátou, plus connue sous son nom francophone, Angélique Ionatos. »
Le directeur, de sa dernière salle de spectacle « Le Triton », Jean-Pierre Vivante, fut le premier à annoncer, sur les réseaux, la disparition de « l’immense artiste, l’incroyable chanteuse, guitariste, musicienne, compositrice, la femme libre, lumineuse, drôle et grave ».
Alors depuis cette nouvelle, j’ai écouté et réécouté les disques que j’avais achetés depuis ma découverte de 2019, j’ai lu et j’ai écouté deux émissions :
<Cette interview vidéo réalisée par Qobuz en 2012> suite à son spectacle «Et les rêves prendront leur revanche. »
Et puis cette interview audio dans l’émission « A voix nue » sur France Culture, en 2016, dans laquelle celui qui l’interroge est Stéphane Manchematin
<Ici les 5 émissions sont regroupées>. Le tout dure un peu plus de 2 heures 20. C’est cette version que j’ai écoutée.
<Sur le site de France Culture> vous trouverez les 5 émissions séparées
Elle est née, en 1954 à Athènes. Son père est marin, il n’est pas souvent présent, mais elle raconte que lorsqu’il était là, c’était un enchantement.
Elle vit donc, le plus souvent, uniquement avec sa mère et son frère Phitos. Sa mère se sent très seule et elle parle aux objets dit-elle. Mais cette femme simple chante beaucoup et dit des poésies.
A la question, pourquoi le chant ? Elle répond :
« Ma mère chantait tout le temps […] Et le soir quand on ne savait pas quoi faire on chantait à trois avec mon frère. Le chant a été tissé dans ma vie depuis que je suis née. Je ne me suis jamais demandé pourquoi je chantais. »
Au début de l’entretien d’A voix Nue Stéphane Manchematin la définit comme « chanteuse, compositrice et guitariste » et elle ajoute je me considère avant tout comme « musicienne ».
Il est vrai que c’est une fabuleuse guitariste. Elle dit :
« Je suis assez solitaire et la guitare est mon amie j’en joue tout le temps. »
Dans les chansons qu’elle compose, les introductions et l’accompagnement sont d’une richesse et d’une complexité ébouriffante. Nous sommes loin de ces chanteurs qui s’accompagnent avec 2 ou 3 accords.
Son grand talent est de mettre en musique des poésies écrites par d’autres.
A 15 ans, une grande rupture aura lieu dans sa vie : ses parents fuient la Grèce dans laquelle la dictature des colonels vient de commencer.
Ses parents choisissent un pays francophone et dans un premier temps choisissent la Belgique « Parce que c’était un pays plus petit qui leur faisait moins peur »
Ils s’installent à Liège et comme tous les grecs antifascistes, ils ont une affection particulière pour Míkis Theodorákis.
Expulsé en 1970 et accueilli à Paris par Melina Mercouri et Costa-Gavras, Míkis Theodorákis s’est lancé dans une tournée mondiale qui fit escale au conservatoire de Liège. Toute la famille Ionatos était présente dans la salle où la diaspora grecque acclamait les exhortations du héros tout en versant des torrents de larmes.
Et Angélique Ionatos a cette formule :
« Je me suis dit : si la musique a ce pouvoir-là, je veux être musicienne »
Finalement la famille décide de s’installer en France.
 Et à 18 ans, en 1972, Angélique Ionatos enregistre son premier disque avec la collaboration de son frère Photis « Résurrection » qui est couronné par le prix de l’Académie Charles-Cros. Dans ce premier disque toutes les chansons sont en français, dont cette merveille : « Y a-t-il de la place au ciel pour les poètes. »
Et à 18 ans, en 1972, Angélique Ionatos enregistre son premier disque avec la collaboration de son frère Photis « Résurrection » qui est couronné par le prix de l’Académie Charles-Cros. Dans ce premier disque toutes les chansons sont en français, dont cette merveille : « Y a-t-il de la place au ciel pour les poètes. »
Mais après ce disque elle décide de chanter en grec, les poètes grecs.
Son frère avec qui elle entretenait une relation fusionnelle, refuse absolument cette voie. Il lui prédit qu’elle va chanter devant des salles vides. Ils vont être en froid pendant plusieurs années, jusqu’à ce que Photis se rende à l’évidence que cela marche et qu’Angélique arrive à capter un public.
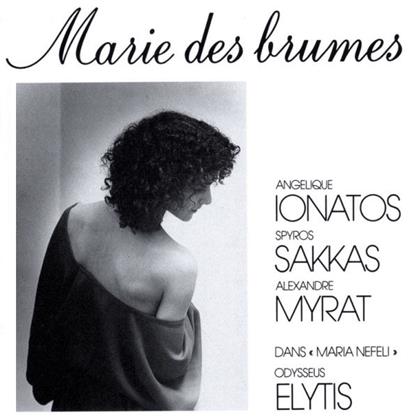 Elle va donc chanter les poètes grecs et particulièrement Odysséas Elýtis (1911-1996) qui se verra décerner le Prix Nobel de littérature en 1979.
Elle va donc chanter les poètes grecs et particulièrement Odysséas Elýtis (1911-1996) qui se verra décerner le Prix Nobel de littérature en 1979.
Elle veut mettre en musique, son recueil « Marie des Brumes » elle demande l’autorisation au poète qui la lui refuse. Alors elle prend l’avion et se rend à son domicile à Athènes et arrive à le convaincre. Elle sollicitera encore beaucoup d’autorisations qui lui seront toujours accordées.
J’ai acheté le disque « Marie des Brumes » pour 4,99 euros sur Qobuz. C’est magnifique.
On peut entendre, par exemple <To Tragoudi Tis Marias Néfélis (Chanson de Marie des brumes)>
Dans les deux émissions évoquées elle explique son rapport avec la poésie et l’art.
Dans A voix nue :
« Quand je lis l’histoire de mon pays depuis l’antiquité, c’est à travers l’art que l’on sait ce que les gens ont fait, c’est ce qui reste. L’architecture, la peinture, la sculpture, la littérature, la poésie. »
Son rapport à la poésie est particulièrement forte. Elle cite un poète grecque qui a dit :
« La poésie a inventé le monde et le monde l’a oublié »
Pour elle la poésie même est grecque. En Grèce on appelle Dieu : « Le poète du monde »
Elle dit :
« C’est la poésie qui m’a donné envie de faire de la musique. Ma mère n’arrêtait pas de me dire des poèmes. […]
Pour moi la poésie est vitale. Elle est présente tout le temps. Je ne connais pas un jour sans poésie dans ma tête. [Je me demande souvent] Comment un homme a pu écrire cela ?
Les poètes sont des êtres à part. »
 Et elle cite Elýtis :
Et elle cite Elýtis :
« La poésie existe pour que la mort n’ait pas le dernier mot »
Dans l’interview Qobuz, elle dit la même chose autrement
« Les poètes sont indispensables à la vie et au rêve.
La poésie est la part dont on est privé quand on se trouve dans le malheur.
La poésie est indispensable pour vivre. […]
Étant le premier art, si on prive l’être humain de poésie, on le prive de son âme.
Donc on le prive de ses rêves, de son imaginaire, de son futur et de sa mémoire. […]
L’intervieweur insiste que la beauté du spectacle vient bien sûr de la poésie mais aussi de la musique d’Angélique Ionatos et rappelle un propos qu’elle lui a tenu précédemment
« C’est toujours un rêve quand la poésie tombe dans les filets de la musique »
Et elle répond :
« Je crois que je suis musicienne jusqu’au bout de l’âme. Mais je ne sais pas si je serais devenu musicienne si je n’avais pas cet amour pour la poésie. […] Ma musique est indissociable de la poésie, parce que je ne peux pas faire de la musique sans rien dire. Pourtant il y a une énorme part instrumentale dans ce que je compose.»
Elle dit aussi que la poésie et la musique se tricote ensemble et :
« SI la poésie est l’art qui me donne le goût de la vie, la musique est pour moi l’art qui fait oublier la mort »
Et elle explique pourquoi elle a voulu chanter en grec alors qu’elle vivait en France et chantait dans les salles de spectacle français et avoue son amour pour cette langue :
« Privée de ma patrie, la vraie patrie, la seule qu’on ne pouvait pas me prendre, c’était ma langue. C’est pour cela que j’ai pris la décision de ne chanter qu’en grec, parce que c’est la seule chose qu’on ne pouvait pas me prendre. […]
« Grecque me fut donnée ma langue » comme disait Elytis. C’est un cadeau immense. Je suis tellement heureuse d’être née grecque.
Cette langue n’arrêtera jamais de me révéler ses miracles. C’est une langue insondable. C’est une langue qui est belle à entendre. […] C’est une langue qui a un équilibre entre les voyelles et les consommes qui est extraordinaire. C’est le sort de l’immigré d’avoir sa langue comme patrie. […]
Cette langue est la plus belle langue du monde. Tous les mots ont leur étymologie. On sait pour chaque mot d’où il vient. […] »
Angélique Ionatos cite dans cette réponse Odysseus Elytis dont la phrase complète est : «Grecque me fut donnée ma langue ; humble ma maison sur les sables d’Homère. Mon seul souci ma langue sur les sables d’Homère.»
Et elle explique que ce n’est pas un problème pour les spectateurs d’entendre cette langue qu’ils ne connaissent pas :
« Je traduis toujours les textes dans le programme donné aux spectateurs.
Et puis pour moi la musique dépasse le langage. Il m’arrive d’écouter des chansons de peuples dont je ne parle pas langue et d’être bouleversé.
Cela veut dire qu’il y a quelque chose d’inhérent à la musique qui touche un autre endroit dans notre cerveau. Et on ressent ce que l’autre veut dire, même si on ne comprend pas le mot à mot. C’est cela qui est fabuleux dans la musique. J’adore Xenakis, le classique, le flamenco, la musique populaire, la musique des pygmées. »Elle a aussi chanté en espagnole pour mettre en musique des poèmes de Pablo Neruda ou encore des poèmes de Frida Kahlo.
Elle était en colère pour tout ce qui a été fait à la Grèce. L’abandon de l’Europe devant la crise des migrants mais surtout les privations qu’on a imposé à sa patrie. Elle dit :
« Quand à Athènes, un vieil homme m’interpelle et me demande un euro pour manger, je suis en colère. Dans mon enfance je n’ai jamais vu quelqu’un fouiller dans les poubelles. Je hais l’Europe. Ce serait bien qu’on sorte de l’Europe. On vous laisse le nom, car Europe vient du grec. […] Je sens que le peuple grec est humiliée.[…] C’est un pays pillé. ».
 Et a ajouté
Et a ajouté
« Je ne peux pas concevoir qu’un artiste ne veut pas témoigner de son temps »
Elle a vécu l’essentiel de sa vie en France. C’est d’ailleurs en France et en Belgique qu’elle a eu le plus de succès bien plus qu’en Grèce. Mais quand elle allait en Grèce elle utilisait le verbe « rentrer ». Je rentre en Grèce. Pour elle, avoir des racines est essentiel dans la vie. Elle dit
« Je suis toujours fascinée par la beauté de la Grèce. C’est quelque chose qui jusque ma mort me fascinera. J’ai vu des paysages en Grèce que je ne verrai nulle part ailleurs. Je deviens un peu stupide de dire : c’est le plus beau pays du monde, c’est la plus belle lumière du monde. Mais je ne peux pas faire autrement, je l’aime.»
J’ai aimé particulièrement deux hommages celui de TELERAMA : « La chanteuse Angélique Ionatos s’est éteinte, sa tragique lumière subsiste » .
Et aussi l’hommage trouvé sur le site Esprit Nomade : « Le chant de l’olive noire » :
« Angélique lonatos est cette belle voix grecque altière et au souffle immense, parfumée par toutes les vagues de la mer Méditerranée, et qui nous a conduits dans la forêt des hommes.
Traductrice de poètes à l’ombre immense comme Elytis, Cavafy, Ritsos, Séféris, elle a favorisé l’envol des mots par la force entêtante de ses propres musiques.
Restituant le choc élémentaire des paroles, elle a tressé des chants d’amour qui nous reviennent vague par vague, transformant « en morceaux de pierre les dires des dieux ». »
Elle aimait donc passionnément la Grèce, ses paysages, sa lumière.
Et en Grèce, elle aimait particulièrement l’ile de Lesbos. L’ile de Sapho de Méthylène et aussi de la famille de son cher poète Odysséas Elýtis :
« C’est une île d’une beauté que je ne peux pas décrire. C’est là qu’il y a ma maison avec les 10 millions d’oliviers et quelques dizaines de milliers de réfugiés désormais. C’est là que je veux vieillir»
Ce souhait d’Angélique Ionatos ne se réalisera pas. Elle est morte dans un EHPAD des Lilas « des suites d’une longue maladie » a écrit son fils.
J’ai lu qu’elle y aurait passé les trois dernières années de sa vie, donc depuis 2019, selon cette information.
Elle avait 67 ans.
Mais ses dernières volontés ont été respectées : Ces cendres ont été dispersés en Grèce, sur sa terre natale.
Il nous reste ses magnifiques chansons et ses disques.
<Hélios, hymne au soleil>
<Le coquelicot>
<J’ai habité un pays>Et puis plus rare des chansons françaises composées par d’autres :<Le funambule (Caussimon)>
<Le clown (Esposito)>
<1599>
-
Vendredi 30 juillet 2021
« L’année du grand retournement : 1979 selon Amin Maalouf»Publication de la page consacrée à la sérieLa série sur l’année 1979 s’est terminée très logiquement par le dernier évènement qui s’est passé cette année : l’invasion de l’Afghanistan par l’armée de l’Union soviétique.
Cette série qui correspond à un des thèmes que Amin Maalouf a développé dans son remarquable ouvrage « Le naufrage des civilisations » : Les liens qui existent entre tous les évènements de l’année 1979 et les conséquences qu’ils ont entraînées dans les années suivantes jusqu’à nos jours 42 ans après.
La page consacrée à cette série est en ligne sur la page des séries.
Mais vous pouvez aller directement sur la page en suivant ce lien : <1979 : L’année du grand retournement >
Après avoir essayé, grâce à Amin Maalouf, d’esquisser de grands bouleversements économiques, politiques et religieux qui ont touché le monde, je reviendrai, la semaine prochaine, à hauteur des êtres humains pour évoquer 5 destins particuliers.
Puis lundi 9, je parlerai d’une chanson à l’occasion d’un anniversaire.
Après, le mot du jour se mettra en congé pour une longue période.
<Mot sans numéro>
-
Jeudi 29 juillet 2021
« Nous avons maintenant l’occasion de donner à l’URSS sa guerre du Vietnam. »Zbigniew BrzezinskiJe n’avais pas entendu parler de l’Afghanistan pendant mes années de collège et de lycée. Tout au plus avais je appris par un quizz que la capitale de l’Afghanistan était Kaboul.
 Je ne savais rien de ce pays montagneux et enclavé, c’est-à-dire sans accès à la mer.
Je ne savais rien de ce pays montagneux et enclavé, c’est-à-dire sans accès à la mer.
Mais à partir du 27 décembre 1979, lorsque l’armée soviétique est entrée dans ce pays, non seulement nous en avons tous entendu parler et depuis il n’a plus quitté l’actualité.
Il a reçu un surnom répété à satiété par les journaux : Le Figaro : «L’Afghanistan, cimetière des empires», L’Histoire « L’Afghanistan, cimetière des empires ? », Le Point : « Afghanistan, le cimetière des empires » etc.
Il faut remonter au début du XIIIème siècle et à Gengis Khan, pour qu’un empire puisse l’intégrer. L’Empire mongole de Gengis Khan s’étendra sur toute la partie Ouest de l’Afghanistan. Mais cet empire fut éphémère.
150 ans après, Tamerlan parvint aussi pendant quelques années à conquérir ce pays :
« « Entre 1370 et 1380, Tamerlan et son armée – mêlée d’éléments turcs et mongols – conquièrent le Khwarezm, région située à la confluence des actuels Iran, Ouzbékistan et Turkménistan ;[…] Il se tourne également résolument vers l’ouest, où plusieurs campagnes, entre 1380 et 1396, lui permettent d’asseoir son pouvoir sur l’ensemble de l’Iran et de l’Afghanistan actuels. […] ces régions constituent le cœur de son empire, centré sur Samarcande »
Mais le titre de cimetière des empires a pris tout son sens quand l’Empire britannique qui avait dominé les Indes n’a pas pu s’emparer de l’Afghanistan.
Le Point rappelle un épisode particulièrement sanglant :
« Un nom résume la férocité des guerriers afghan : Gandamak. C’est dans ce défilé qu’en 1842, après le soulèvement de Kaboul, 16 000 Anglais désarmés du corps expéditionnaire de retour vers l’Inde, sont massacrés. La première déroute de l’homme blanc, bien avant la victoire des Japonais sur les Russes en 1905. »
Les Russes sont euphoriques en 1979, comme je l’ai relaté lors du mot du jour de lundi. Ils vont donc attaquer. Nous apprendrons plus loin qu’ils ont été un peu provoqués.
Mais ils vont se lancer dans cette aventure qui durera 10 ans, jusqu’à ce Gorbatchev décide du retrait en 1989 ; il est tard, trop tard pour l’Union Soviétique.
Amin Maalouf écrit :
« Les dirigeants soviétiques se sont lancés dans une aventure qui se révéla désastreuse et même fatale pour leur régime : la conquête de l’Afghanistan »
Le Naufrage des civilisations page 180
Si vous voulez tout savoir et comprendre sur ce qui s’est passé en Afghanistan avant l’invasion soviétique, pendant et après, il faut absolument regarder ces 4 documentaires passionnants d’ARTE :
- <Afghanistan Pays meurtri par la guerre 1/4 Le royaume>
- <Afghanistan Pays meurtri par la guerre 2/4 L’armée soviétique>
- <Afghanistan Pays meurtri par la guerre 3/4 Moudjahidine et Taliban>
- <Afghanistan Pays meurtri par la guerre 4/4 Les troupes de l’OTAN>
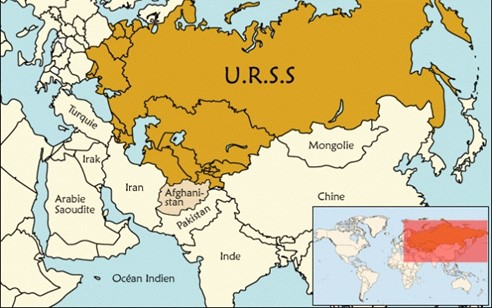 Amin Maalouf raconte :
Amin Maalouf raconte :
« Ce pays montagneux, situé entre l’Iran, le Pakistan, la Chine et les républiques soviétiques d’Asie centrale, comptait des mouvements d’obédience communiste, actifs et ambitieux, mais très minoritaires au sein d’une population musulmane socialement conservatrice et farouchement hostile à toute ingérence étrangère. Laissés à eux-mêmes, ces militants n’avaient aucune chance de tenir durablement les rênes du pouvoir. Seule une implication active de leurs puissants voisins soviétiques pouvait modifier le rapport de force en leur faveur. Encore fallait-il que lesdits voisins soient convaincus de la nécessité d’une telle intervention.
C’est justement ce qui arriva à partir du mois d’avril 1978. Irrités par un rapprochement qui s’amorçait entre Kaboul et l’Occident, soucieux de préserver la sécurité de leurs frontières et la stabilité de leurs républiques asiatiques et persuadés de pouvoir avancer leurs pions en toute impunité, les dirigeants soviétiques donnèrent leur aval à un coup d’État organisé par l’une des factions marxistes. Puis, lorsque des soulèvements commencèrent à se produire contre le nouveau régime, ils dépêchèrent leurs troupes en grand nombre pour les réprimer, s’enfonçant chaque jour un peu plus dans le bourbier.
Comme cela est arrivé si souvent à travers l’Histoire – mais chacun s’imagine que pour lui les choses se passeraient autrement – les dirigeants soviétiques s’étaient persuadés que l’opération de pacification qu’ils menaient serait de courte durée et qu’elle s’achèverait sur une victoire décisive. »
Le Naufrage des civilisations page 180
Les soviétiques pensaient que les américains traumatisés par leur défaite lors de la guerre du Viêt-Nam et englués dans la prise d’otage de leur ambassade de Téhéran n’avaient aucun désir de se lancer dans de nouvelles aventures et au-delà de quelques protestations ne feraient rien.
Et s’il fallait un argument supplémentaire ils avaient pu constater que l’envoi de troupes cubaines en Angola avait laissé les américains impassibles.
Et apparemment, dans un premier temps le plan des soviétiques se passait comme prévu. A cette nuance près que l’armée rouge avait pu s’emparer des grandes villes et des principales routes. Le reste de l’Afghanistan leur échappait. Tous ces territoires étaient aux mains de combattants nationalistes et musulmans.
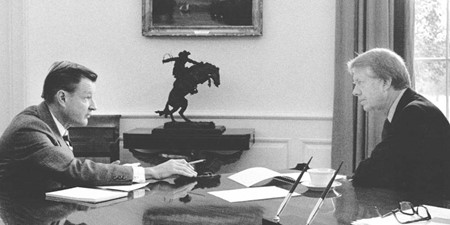 Au sein de l’administration Carter le ministre des affaires étrangères, appelé aux USA le secrétaire d’État était tenu par un polonais comme le Pape ; Zbignizw Brzezinski, dit « Zbig ».
Au sein de l’administration Carter le ministre des affaires étrangères, appelé aux USA le secrétaire d’État était tenu par un polonais comme le Pape ; Zbignizw Brzezinski, dit « Zbig ».
Comme le cardinal de Cracovie, le destin de son pays natal avait fait naître en lui un anti communisme féroce auquel s’ajoutait un fort ressentiment contre l’Union soviétique continuateur de l’empire russe qui avait si souvent imposé sa volonté au peuple polonais.
A l’occasion de sa mort Le Point lui avait rendu hommage : « Brzeziński, l’héritage d’un géopolitologue majeur »
Amin Maalouf raconte :
« En juillet 1979, alors que Kaboul était aux mains des communistes afghans qui y avaient pris le pouvoir, et que des mouvements armés commençaient à s’organiser pour s’opposer à eux au nom de l’islam et des traditions locales, Washington avait réagi en mettant en place, dans le secret, une opération dont le nom de code était « Cyclone », et qui visait à soutenir les rebelles. Avant que la décision ne fut prise, certains responsables américains s’étaient demandé avec inquiétude si une telle opération n’allait pas pousser Moscou à envoyer ses troupes dans le pays. Mais cette perspective n’inquiétait nullement Brzezinski. Il l’appelait de ses vœux. Son espoir était justement que les Soviétiques, incapables de contrôler la situation à travers leurs alliés locaux, soient contraints de franchir eux-mêmes la frontière, tombant ainsi dans le piège qu’il leur tendait »
Le Naufrage des civilisations page 196
Les américains ont donc aidés les forces islamiques qui se battaient contre le pouvoir afghan communiste de Kaboul. En outre, il fallait que l’URSS le sache et consente à intervenir. Dès lors, Zbig pensait que ce serait un Viet Nam à l’envers : les soviétiques englués par une guérilla et les américains aidant la guérilla à faire de plus en plus mal à l’armée régulière.
Dans un entretien avec le journaliste Vincent Jauvert, publié dans le nouvel Observateur du 15 janvier 1998, soit près de 20 ans après, Brzezinski affirme :
« Oui. Selon la version officielle de l’histoire, l’aide de la CIA aux moudjahidine a débuté courant 1980, c’est-à-dire après que l’armée soviétique eut envahi l’Afghanistan, le 24 décembre 1979.
Mais la réalité gardée secrète est tout autre : c’est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l’assistance clandestine aux opposants du régime prosoviétique de Kaboul. Et ce jour-là j’ai écrit une note au président dans laquelle je lui expliquais qu’à mon avis cette aide allait entraîner une intervention militaire des Soviétiques.
[…] Nous n’avons pas poussé les Russes à intervenir, mais nous avons sciemment augmenté la probabilité qu’ils le fassent.
Le Nouvel Observateur : Lorsque les Soviétiques ont justifié leur intervention en affirmant qu’ils entendaient lutter contre une ingérence secrète des Etats-Unis en Afghanistan, personne ne les a crus. Pourtant il y avait un fond de vérité. Vous ne regrettez rien aujourd’hui ?
Zbigniew Brzezinski : Regretter quoi ? Cette opération secrète était une excellente idée. Elle a eu pour effet d’attirer les Russes dans le piège Afghan et vous voulez que je le regrette ? Le jour où les Soviétiques ont officiellement franchi la frontière, j’ai écrit au président Carter, en substance : « Nous avons maintenant l’occasion de donner à l’URSS sa guerre du Vietnam. » De fait, Moscou a dû mener pendant presque dix ans une guerre insupportable pour le régime, un conflit qui a entraîné la démoralisation et finalement l’éclatement de l’empire soviétique. » »
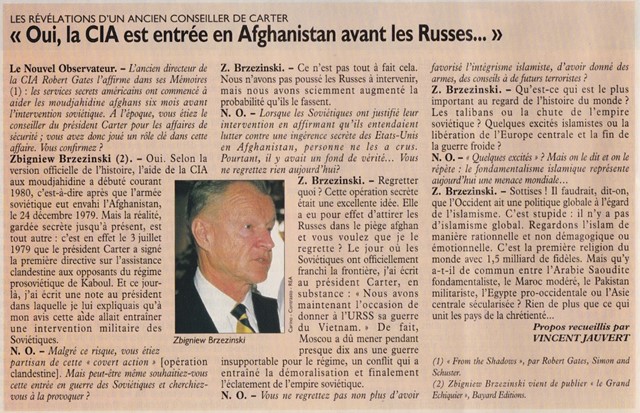 Et les américains vont donner des armes et des armes aux combattants d’Afghanistan. Des armes de plus en plus sophistiquées comme les célèbres missiles Stinger qui abattront les avions russes.
Et les américains vont donner des armes et des armes aux combattants d’Afghanistan. Des armes de plus en plus sophistiquées comme les célèbres missiles Stinger qui abattront les avions russes.
Dans les documentaires d’Arte, un intervenant explique que c’était très rentable : Un mois de présence des armées américaines en Afghanistan coutait aussi cher que l’ensemble de l’aide fourni pendant les 10 ans de guerres des afghans contre l’armée rouge.
Parce que les américains aussi se sont laissés piéger par « le cimetière des empires ».
Ils sont entrés en guerre en 2001 et ils ne partent que maintenant. Ils seront restés plus longtemps que les soviétiques et ils partent aussi vaincus.
Parce qu’après le départ des soviétiques en 1989, les chefs de guerre afghans surarmés ne se sont pas unis pour gouverner le pays mais se sont entretués.
Alors est né une armée islamique entièrement soutenue par le Pakistan : les Talibans. Ils ont vaincus les chefs de guerre et imposé leur triste, cruel et archaïque régime islamique.
Et à côté d’eux des fous de Dieu, se réclamant de l’Islam, venant d’Arabie saoudite et d’ailleurs et ayant à leur tête Oussama Ben Laden ont utilisé leur expérience et leur savoir pour attaquer l’occident par des actes de terrorisme dont les terribles attentats 11 septembre 2001.
Les talibans refusant de livrer Ben Laden, les américains aidés par la Grande Bretagne, la France et une grande coalition ont envahi l’Afghanistan et s’y sont empêtrés comme les autres
Et ils s’enfuient comme les autres,
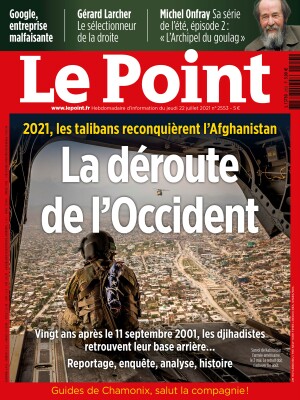 Le Point du 22 Juillet 2021 titre : « La déroute de l’occident »
Le Point du 22 Juillet 2021 titre : « La déroute de l’occident »
Les Talibans sont de nouveau aux portes du pouvoir. S’ils y arrivent ils ne feront pas seulement de l’Afghanistan le cimetière des empires mais aussi le cimetière des femmes.
Zbigniew Brzezinski n’exprimait aucun regret en 1998. A la question : « Vous ne regrettez pas non plus d’avoir favorisé l’intégrisme islamiste, d’avoir donné des armes, des conseils à de futurs terroristes ? »
Il a répondu : « Qu’est-ce qui est le plus important au regard de l’histoire du monde ? Les talibans ou la chute de l’empire soviétique ? Quelques excités islamistes où la libération de l’Europe centrale et la fin de la guerre froide ? »
Il est paradoxal de finir cet article consacré à la désastreuse invasion des soviétiques par la déroute de l’Occident dans ce même pays.
Mais c’est ainsi que ce sont passés les choses depuis 1979. Les américains et les occidentaux ont financé, armé et soutenu des monstres qui se sont retournés contre eux.
Il est vrai qu’entretemps, comme dit Zbig, l’Empire soviétique s’est effondré.
La guerre d’Afghanistan fut un traumatisme pour les soldats russes. On ne connaît pas avec précision les pertes de l’armée rouge, la Russie n’a jamais voulu communiquer sur ce sujet. On estime à 1 000 000 de morts les pertes afghanes essentiellement civiles. Wikipedia donne une fourchette entre 562 000 et 2 000 000 morts. Il y eut aussi 5 millions de réfugiés afghans hors d’Afghanistan, 2 millions de déplacés internes et environ 3 millions d’afghans blessés, majoritairement civils (l’afghanistan compte 36 millions d’habitants environ). Et ce n’était qu’un début, les chefs de guerre, les talibans puis les américains et maintenant le retour des talibans vont encore aggraver ce terrible bilan.
<1598>
- <Afghanistan Pays meurtri par la guerre 1/4 Le royaume>
-
Mercredi 28 juillet 2021
« Rien de ce qui s’est passé en Europe de l’Est n’aurait été possible sans la présence de ce pape »Mikhaïl GorbatchevLe 16 octobre 1978, une fumée blanche s’élève au-dessus des toits du Vatican.
Après deux jours de réclusion et huit tours de scrutin, les cardinaux réunis en conclave dans la chapelle Sixtine viennent d’élire le 264e successeur de Saint Pierre à la tête de l’Église catholique.
Le cardinal Pericle Felici en tant que doyen des cardinaux électeurs, le terme savant est : « le cardinal protodiacre », s’avance sur le balcon de la basilique Saint Pierre et annonce à la foule des fidèles réunis sur la place Saint Pierre :
« Annuntio vobis gaudium magnum :
habemus papam.
Eminentissimum ac reverendissimum dominum,
dominum Carolum,
Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalem Wojtyła ,
qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli »
Pour celles et ceux qui ne lisent pas couramment le latin, je donne la traduction :
« Je vous annonce une grande joie :
nous avons un Pape.
Le très éminent et très révérend seigneur,
Monseigneur Karol
cardinal de la sainte Église romaine, Wojtyła
qui s’est donné le nom de Jean-Paul »
 Voici ce que la télévision a retransmis : <Election du pape Jean-Paul 2>
Voici ce que la télévision a retransmis : <Election du pape Jean-Paul 2>
Quand j’écoute le cardinal, j’entends qu’il prononce : « Woïtiwa »
Un reportage publié à l’époque par le Nouvel Observateur relatait la stupeur qui avait saisi la foule. Certains pensaient qu’il s’agissait d’un africain. Finalement :
« les Italiens se précipitent sur L’Osservatore romano du 15 octobre [qui listait les éligibles] pour découvrir la tête et l’origine de cet inconnu. « E Polacco! » [« C’est le Polonais »], laisse tomber un Romain.»
<Une surprise>, il est relativement jeune (58 ans) mais surtout, il n’est pas italien.
Il faut remonter à 1522 et l’élection du Hollandais Adrian Florisce, pape sous le nom d’Adrien VI, précepteur du futur empereur Charles Quint.
Il est polonais et il est l’archevêque de Cracovie, dans la Pologne communiste.
Le Kremlin se méfie. Des responsables soviétiques téléphonent aux responsables polonais et leur reprochent d’avoir permis que cet individu soit devenu cardinal car s’il n’était pas cardinal, il n’aurait jamais été élu
<Slate> dit à la fois que c’est factuellement faux, mais en pratique très probable :
« On peut même être élu sans être cardinal: il suffit juste d’être catholique et baptisé –si le candidat élu n’est pas évêque, il devient automatiquement évêque de Rome. Le dernier pape non cardinal était Urbain VI (1378-1389). »
Ce même journal révèle que des indiscrétions sur le conclave de 1978 affirment que Jean Paul II n’avait recueilli qu’un nombre très modeste de voix dans les premiers tours, avant de profiter, au bout du troisième jour, du blocage du conclave entre deux cardinaux italiens, un conservateur et un progressiste.
On sait que Karol Wojtyla (1920-2005) est un sportif, il a fait du théâtre et il a même écrit des pièces de théâtre. Mais c’est la Foi et la religion qui l’ont conquis.
Il est doté d’un charisme exceptionnel et il va engager la lutte avec les communistes.
Son premier voyage est en Amérique du Sud. Dans cet Amérique du Sud des religieux se battent contre les dictatures et l’exploitation des ouvriers par des patrons sans scrupules bien que croyant. Leur doctrine s’appelle « La théologie de la Libération ».
Jean Paul II assimile ce courant de pensée à une pensée marxiste et il va la combattre avec ardeur.
Il faut regarder ce documentaire d’Arte <Jean-Paul II le triomphe de la réaction> qui montre que s’il n’a pas de mots assez durs pour fustiger les atteintes aux libertés et aux droits de l’homme dans les pays de l’est parce qu’ils sont gouvernés par des communistes, il n’exprime pas la même critique contre des régimes de droite et d’extrême droite qui violent les mêmes droits de l’homme contre leurs opposants. Opposants que Jean Paul II classe dans la catégorie des communistes.
 En 1979, il décide d’aller en Pologne.
En 1979, il décide d’aller en Pologne.
Brejnev, le vieux dirigeant soviétique appelle tout de suite Edward Gierek, Premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais et lui intime l’ordre de ne pas recevoir le Pape. Ce dernier passe outre, il pense maîtriser la situation.
D’immenses foules se déplacent pour voir et participer aux cérémonies religieuses célébrées par Jean-Paul II. La télévision polonaise a ordre de ne pas filmer la foule dans son intégralité. Mais Jean Paul II a emmené une cohorte de professionnels avec leurs propres caméras qui vont filmer ce qui se passe. Ces pellicules ramenées en Italie seront montées en film qui sera renvoyé en Pologne. Film vu dans les églises et qui donnera aux catholiques, 90% des polonais, la conscience de leur nombre et de leur puissance.
Pendant son voyage en Pologne du 2 au 10 juin 1979, il exhortera les polonais à ne pas avoir peur utilisera le langage de la foi et de la croyance pour rejeter le communisme et appeler à sa disparition des terres de Pologne.
En 1980, apparaîtra le syndicat libre Solidarnosc et Lech Walesa sur les chantiers d Gdansk.
Ce ne sera pas un long fleuve tranquille.
Mais le soutien du Pape et les financements du Vatican ne manqueront jamais. Jean Paul II trouvera en Ronald Reagan un allié de poids qui déteste les communistes autant que lui et apportera aussi des financements qui passeront par l’église catholique.
Reagan et Jean Paul II utiliseront la Pologne pour aider à une lame de fond qui aboutira à la chute du mur en 1989.
Brejnev aurait dit que le communisme n’était pas réformable que si on commençait à le réformer il s’écroulerait.
Gorbatchev pensait le contraire et il a essayé de le réformer.
 Il s’est même rendu au Vatican avec sa femme Raïssa pour rencontrer le pape Jean Paul II le <1er décembre 1989> et lui annoncer qu’il était d’accord dans le cadre de ses réformes d’accorder la liberté religieuse dans les pays communistes. Et c’est à cette occasion qu’il a tenu ce propos :
Il s’est même rendu au Vatican avec sa femme Raïssa pour rencontrer le pape Jean Paul II le <1er décembre 1989> et lui annoncer qu’il était d’accord dans le cadre de ses réformes d’accorder la liberté religieuse dans les pays communistes. Et c’est à cette occasion qu’il a tenu ce propos :
« Rien de ce qui s’est passé en Europe de l’Est n’aurait été possible sans la présence de ce pape »
Nous connaissons la fin de cette histoire.
C’est Brejnev qui avait raison !
Deux ans plus tard, le 25 décembre 1991, Michael Gorbatchev annonçait sa démission : l’URSS était dissoute.
La Chine voyant cet effondrement s’est jurée de ne jamais commettre les mêmes erreurs que les soviétiques et Gorbatchev.
L’historien <Pierre Grosser> déclare :
« La référence, pour les dirigeants chinois, c’est 1989-1991, avec la chute des régimes communistes en Europe et de l’Union soviétique, et la victoire des États-Unis dans la guerre du Golfe grâce à leur armée de haut niveau technologique. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que Gorbatchev, qui a sacrifié le rôle dirigeant du Parti et laissé monter les revendications nationales dans l’Empire. Il a aussi laissé les influences idéologiques (la pollution spirituelle) de l’Occident dissoudre le communisme. Les États-Unis arrogants ne doivent pas pouvoir faire la même chose avec la Chine. Le Parti a sauvé la Chine en utilisant la force à Tiananmen en 1989, en relançant des réformes contrôlées qui ont donné naissance à un modèle plus efficace que le capitalisme occidental, et en opérant une modernisation militaire dissuadant les États-Unis. »
Alors est ce que Jean Paul II a été le principal artisan de la chute des démocraties populaires de l’Europe de l’est ?
A cette question, comme à beaucoup d’autres, l’homme honnête du XXIème siècle est obligé de répondre : « Je ne sais pas ».
Jean Paul II a lui-même relativisé son importance :
« Le communisme est tombé tout seul à cause de sa faiblesse immanente »
Amin Maalouf écrit :
« Né en Pologne, Karol Wojtyla alliait un conservatisme social et doctrinal à une combativité de dirigeant révolutionnaire. […] Son influence allait se révéler capitale »
Le Naufrage des civilisations, page 176<1597>
-
Mardi 27 juillet 2021
« La guerre sino-vietnamienne »Guerre du 17 février au 16 mars 1979Le monde communiste était certes en expansion en 1979, mais il était divisé entre soviétiques et chinois.
Quand deux empires comme la Chine et la Russie possèdent une frontière commune de 4 374 km, la rivalité ne peut être que féroce. La France et l’Allemagne avec 451 km, soit près de 10 fois moins, ont montré cette triste réalité avant de se retrouver dans la communauté européenne.
Après sa fondation en 1949, la République populaire de Chine de Mao fait cependant alliance avec l’Union Soviétique de Staline sur la base de l’hostilité aux États-Unis.
Mais la rupture va se réaliser au moment du rapport Khrouchtchev en 1956, dans lequel ce dernier rejette le culte de la personnalité, prône la « coexistence pacifique » avec le capitalisme et l’impérialisme et enfin prétend que le passage du socialisme au communisme peut s’effectuer en douceur au sein même de la société.
Mao est sur une position inverse sur les 3 points. En particulier, il entend profiter pleinement du culte de la personnalité.
Concernant le Viet-Nam, la Chine a soutenu le combat de ce pays contre les américains. Mais, une fois la guerre gagnée et le Viet Nam clairement rangé du côté soviétique, les Chinois ont manifesté de l’hostilité à l’égard de leur voisin de la péninsule indochinoise.
Ce conflit se nourrissait de tensions territoriales : occupation vietnamienne des Îles Spratley, revendiquées par la Chine et de conflits de minorité : la Chine dénonçait des mauvais traitements subis par la minorité chinoise au Viêt Nam.
Mais la raison principale du déclenchement de la guerre entre la Chine et le Viet-Nam fut l’intervention de ce dernier au Cambodge.
Le mouvement génocidaire, contre leur propre peuple, des khmers rouges de Pol Pot était soutenu par la Chine. Je rappelle que ces fous anti-élites et anti occidentaux ont assassiné, pendant les 4 ans de leur dictature, <1,7 millions de cambodgiens> sur une population d’un peu plus de 7 millions d’individus.
Le 25 décembre 1978, l’Armée populaire vietnamienne pénètre au Cambodge et dans une avancée rapide et puissante pénètre dans Phnom Penh le 7 janvier 1979. Quatre jours plus tard, le régime provietnamien de la République populaire du Kampuchéa est proclamé, avec Heng Samrin comme président et le jeune Hun Sen comme ministre des Affaires étrangères.
Le Viet-Nam n’est pas intervenu pour des raisons humanitaires mais en raison de tensions territoriales et aussi d’exactions des khmers rouges à l’égard de la minorité vietnamienne au Cambodge.
Toutefois, dans une belle opération de communication, ils vont dénoncer et montrer l’ampleur des massacres de Pol Pot et de sa bande de criminels.
Les chinois et Deng Xiaoping vont entrer dans une guerre punitive et dans l’espoir d’inverser le sort des armes au Cambodge.
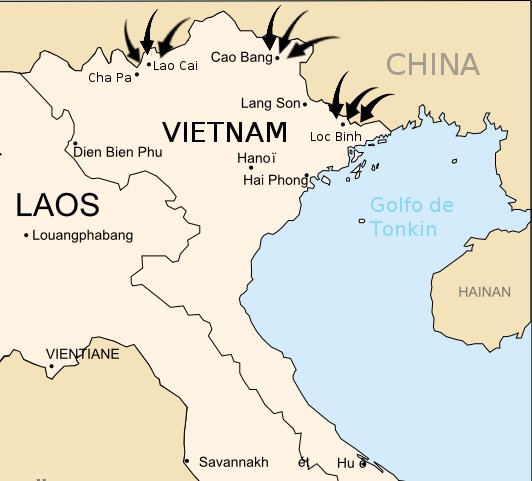 Si vous êtes intéressé par la tactique militaire vous pouvez regarder 4 vidéos de 15 minutes qui expliquent en détail le mouvement des armées, les pertes, la durée des combats.
Si vous êtes intéressé par la tactique militaire vous pouvez regarder 4 vidéos de 15 minutes qui expliquent en détail le mouvement des armées, les pertes, la durée des combats.
Je donne le lien vers le premier épisode : <Guerre sino-vietnamienne (1979) – le principe de la guerre limitée #1>
Je résume :
- Ce sont les chinois qui attaquent et qui prennent un certain nombre de villes du Viet-Nam sur la route de Hanoi.
- Leur progression est très lente, très compliquée, avec beaucoup de pertes
- Les troupes vietnamiennes sont sur la défensive et quand elles ont trop de pertes, elles reculent.
- Ce ne sont pas les meilleures armées qui s’affrontent : La Chine a concentré l’élite de son armée sur la frontière russe, pour faire face à une éventuelle offensive de l »armée rouge qui viendrait soutenir son allié vietnamien.
- Le Viet-Nam a envoyé l’essentiel de ses meilleures troupes au Cambodge et l’élite est restée autour de Hanoi, pour empêcher les chinois de s’approcher de leur capitale.
Au bout de 17 jours de combat, les Chinois qui sont parvenus à pénétrer de 30 à 40 km sur le territoire vietnamien, déclare qu’il pourrait continuer jusqu’à Hanoï mais que leur action punitive était suffisante et que dans un souci d’apaisement, ils se retiraient. Dès lors, les troupes chinoises évacuent le territoire vietnamien le 16 mars en pratiquant la politique de la terre brûlée.
C’est une guerre qui se finit donc par un match nul.
Les historiens semblent cependant plutôt pencher pour un échec chinois.
Les chinois avait parmi leurs buts de guerre d’aider leurs alliés Khmers rouges. Dès lors, leur attaque avait pour objectif d’obliger l’armée vietnamienne de rapatrier ses troupes du Cambodge pour arrêter l’avancée chinoise. Or, les vietnamiens sont parvenus à freiner l’armée chinoise en ne touchant pas les troupes se trouvant au Cambodge et en conservant l’élite de leur armée dans une position de repli pour protéger la capitale.
Amin Maalouf estime que cette guerre est aussi un évènement majeur de l’année 1979.
Rappelons que Deng Xiaoping avait fait une visite triomphale aux États-Unis en janvier 1979. Il avait évoqué cette action de guerre au Président Carter contre l’ennemi qui avait vaincu les américains et qui était l’allié de l’ennemi structurel : l’URSS. Le Président Carter n’a pas dissuadé le responsable chinois de réaliser cet acte de guerre.
Amin Maalouf écrit :
« Mais l’objectif de Deng n’était pas militaire. Au lendemain de son avènement, il voulait démontrer aux Vietnamiens que l’Union soviétique n’enverrait pas ses troupes à leur secours s’ils étaient attaqués et qu’ils auraient donc tort de considérer qu’ils pouvaient agir à leur guise.
Et il adressait également un message aux Etats-Unis leur disant qu’ils avaient désormais en Asie un interlocuteur fiable et peut être même un partenaire potentiel ; pour les américains qui ne s’étaient pas encore remis de la défaite que leur avait infligé Hanoï, l’expédition punitive ordonnée par le nouveau dirigeant chinois était la bienvenue.
Quelque chose d’important venait manifestement de se produire sur la scène internationale, dont Washington ne pouvait que se féliciter, et dont Moscou devait s’inquiéter au plus haut point »
Cet épisode montre donc :
- La montée en puissance de la Chine
- L’affaiblissement de l’Union soviétique
- Et aussi le fait que le sort des cambodgiens ne présentait pas grand intérêt aux yeux de la Chine, des États-Unis et de l’Union soviétique
Il semble que Deng Xiaoping ait été mis en difficulté au sein du bureau politique du Parti communiste chinois, en raison des défaillances militaires de l’armée.
Mais cet homme supérieurement intelligent et rusé, sut retourner les accusations à son encontre en pointant la faiblesse de l’armée populaire chinoise sur le plan technique, mécanique et de l’encadrement.
Il en tira argument pour limoger une grande part de l’état-major .et de faire valider sa politique de réformes économiques seule capable de redonner de la puissance et du dynamisme à l’ensemble de la Chine et à son armée en particulier.
Mao disait :
« Ne pensez pas d’abord à produire, pensez d’abord à faire la révolution »
Deng Xiaoping préconisait exactement l’inverse.
<1598>
- Ce sont les chinois qui attaquent et qui prennent un certain nombre de villes du Viet-Nam sur la route de Hanoi.
-
Lundi 26 juillet 2021
« [En 1979] Pour qui se fiait à l’apparence des choses, l’Union soviétique semblait voler de triomphe en triomphe »Amin MaaloufPour finir la description des évènements de 1979 qui ont constitué l’année du grand retournement dont les conséquences expliquent beaucoup de ce que le monde vit aujourd’hui, nous allons parler de l’Union soviétique. Parce qu’à l’époque le monde était divisé en deux par la guerre froide.
Et en 1979, l’Union Soviétique semblait engranger succès après succès.
Nous avons vu que la révolution islamique avait privé les États-Unis de son grand allié l’Iran. La prise d’otage de l’ambassade de Téhéran constituait une humiliation pour le grand rival de l’URSS.
Et ce n’était qu’une humiliation qui succédait à d’autres.
Le gouvernement américain s’était engagé de manière massive dans <la guerre du Viet Nam> pour empêcher ce pays et ses voisins de tomber dans les mains des communistes.
Au 30 avril 1969, on comptait 550 000 soldats américains en Indochine. Cette guerre fracturait la société américaine et devenait hors de prix pour les États-Unis. Richard Nixon conseillé par Henry Kissinger décida de se retirer. Ils négocièrent avec le Nord Viet-Nam communiste. Les accords de Paris furent signés le 27 janvier 1973, confirmant le retrait des troupes américaines. Mais il restait le Sud Vietnam qui était allié des Etats-Unis et qui se trouvait désormais seul face aux armées communistes.
Le résultat ne se fit pas attendre, les communistes battirent l’armée favorable aux États-Unis et la guerre prit fin le 30 avril 1975 par la prise de Saïgon qui devint Ho chi Minh ville.
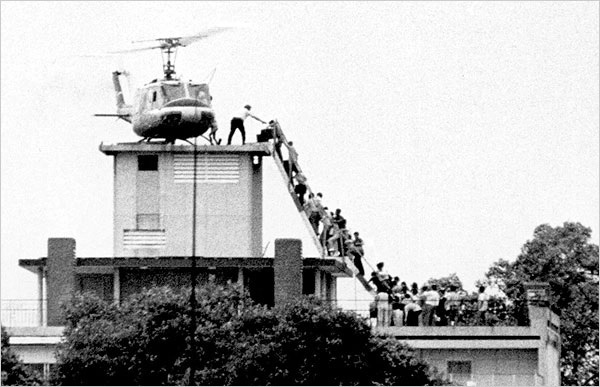 La fuite des derniers américains de Saïgon le 30 avril fut aussi une humiliation.
La fuite des derniers américains de Saïgon le 30 avril fut aussi une humiliation.Amin Malouf raconte :
« Jeune journaliste fasciné comme tant d’autres par ce conflit si emblématique pour ma génération, je m’étais rendu à Saïgon afin d’assister à la bataille décisive. Je savais que l’on s’approchait de l’épilogue, mais je n’imaginais pas que les choses allaient évoluer aussi vite. Le 26 mars, jour de mon arrivée, les troupes communistes venaient de prendre Hué, l’ancienne capitale impériale ; une semaine plus tard, elles étaient déjà aux abords de Saigon, 700 kilomètres plus au sud. Et il était clair que leur progression allait se poursuivre jusqu’au bout. […]
Saïgon tomba le 30 avril. Ceux qui ont connu cette époque gardent en mémoire ces scènes pathétiques où des civils et des militaires, réfugiés à l’ambassade américaine, cherchaient à s’accrocher aux derniers hélicoptères pour s’enfuir. Images plus humiliantes encore pour les sauveteurs que pour les rescapés. »
Le Naufrage des civilisations, page 177 Et la victoire communiste ne s’arrêta pas Au Viêt-Nam.
Et la victoire communiste ne s’arrêta pas Au Viêt-Nam.Deux semaines plus tôt, le 17 avril 1975, les troupes des Khmers rouges étaient entrées dans Phnom Penh et renversèrent le régime du Général Lon Nol que les États-Unis avaient mis en place par un coup d’État.
Et les communistes prennent aussi l’intégralité du pouvoir au Laos lorsqu’ils poussent le roi Savang Vatthana à abdiquer, le 2 décembre 1975.
Ainsi comme des dominos un État après l’autre devint communiste.
Les américains qui étaient entrés dans la guerre du Viêt-Nam justement pour empêcher cela, avaient totalement échoué par rapport à leur but de guerre.
Et Amin Maalouf rappelle que « Ce phénomène ne se limitait d’ailleurs pas à l’Indochine. »
Et il cite :
- Quand le Portugal, après « la révolution des Œillets » d’avril 1974 décida de donner l’indépendance à ses colonies africaines, les cinq nouveaux États africains qui virent aussitôt le jour furent tous dirigés par des partis d’obédience marxiste : Angola, Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et Sao-Tomé-Et-Principe.
- Outre les colonies portugaises, il y avait aussi en Afrique, Madagascar, Le Congo Brazzaville, la Guinée Conakry qui avaient des régimes proches de l’Union soviétique.
- Il y eut même un bref moment, où dans la corne de l’Afrique, les deux principaux pays, l’Éthiopie et la Somalie étaient gouvernés par des militaires se réclamant du marxisme-léninisme.
- Et sur la péninsule arabique, le Yémen du Sud, État indépendant dont la capitale était Aden, s’était proclamé « république démocratique populaire » sous l’égide d’un parti de type communiste, doté d’un politburo.
Bref, dans la guerre froide le bloc de l’est était en train de gagner du terrain et les américains étaient en train d’en perdre et surtout avait été finalement vaincu dans la guerre du Viêt-Nam.
Mais si extérieurement, il semblait que l’Union soviétique était forte et conquérante, à l’intérieur elle était fragile par une organisation politique rigide et sclérosée et une économie sans dynamisme et au bout du rouleau.
Amin Maalouf écrit :
« Quand on se replonge dans les années 70, on ne peut s’empêcher de trouver pathétique le spectacle de cette superpuissance lancée à corps perdu dans une stratégie de conquêtes, sur tous les continents, alors que sa propre maison, sur laquelle flottaient les étendards ternis du socialisme, du progressisme, de l’athéisme militant et de l’égalitarisme, était déjà irrémédiablement lézardée, et sur le point de s’écrouler.
Pour qui se fiait à l’apparence des choses, l’Union soviétique semblait voler de triomphe en triomphe. Au Vietnam, où le monde communisme et le monde capitaliste s’étaient affrontés sans répit dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le conflit était arrivé à son terme en avril 1975. »
Le Naufrage des civilisations, page 177Emmanuel Todd, à 25 ans, allait devenir célèbre et restera pour longtemps, le démographe visionnaire en publiant en 1976 : « La Chute finale » sous-titré « Essai sur la décomposition de la sphère soviétique » dans lequel il décrit la décomposition du système communiste et la chute inéluctable qui attend l’Union soviétique.
Wikipedia constate que « Ce livre constitue un rare exemple de prospective totalement validée par les faits et a donné rétrospectivement à son auteur une grande autorité dans l’analyse des faits sociaux, économiques et géopolitiques. »
<1597>
- Quand le Portugal, après « la révolution des Œillets » d’avril 1974 décida de donner l’indépendance à ses colonies africaines, les cinq nouveaux États africains qui virent aussitôt le jour furent tous dirigés par des partis d’obédience marxiste : Angola, Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et Sao-Tomé-Et-Principe.
-
Vendredi 23 juillet 2021
« Pause »Un jour sans mot du jour nouveauJe souhaite continuer la série sur l’année 1979..
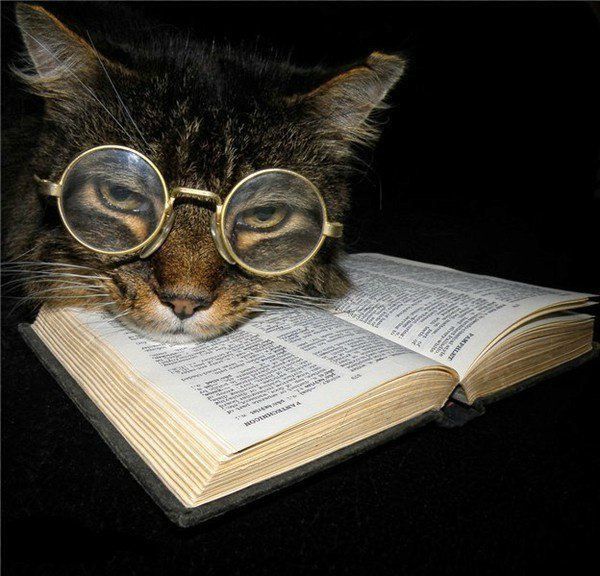 La dernière partie sera consacrée à des évènements qui impliquent tous à un degré divers l’Union Soviétique.
La dernière partie sera consacrée à des évènements qui impliquent tous à un degré divers l’Union Soviétique. Amin Maalouf nous rappelle qu’en ce début de l’année 1979, l’Union Soviétique semblait toute puissante et l’Amérique en déclin.
Notre mémoire nous joue souvent des tours. Nous connaissons la fin de l’Histoire : la chute du mur de Berlin en 1989 et la dissolution de l’Union Soviétique en 1991.
Mais en 1979, nous ne pouvions penser que cela se passerait ainsi, surtout pas aussi vite.
Il me faut un peu de temps pour écrire la suite.
<Mot du jour sans numéro>
-
Jeudi 22 juillet 2021
« Peu de révolutions dans l’histoire ont changé en profondeur la vie d’un si grand nombre d’hommes et de femmes en un temps si court. »Amin Maalouf évoquant les réformes conduit par Deng Xiaoping à partir de 1979Pour donner toute sa dimension à son récit de l’année 1979, Amin Maalouf en élargit quelque peu la temporalité vers la fin de l’année 1978.
En effet, le 18 décembre 1978, le 11ème Comité central du Parti Communiste Chinois adopte les réformes économiques proposée par Deng Xiaoping. Ce dernier devient, dans les faits, le numéro 1 chinois.
Bien qu’officiellement le successeur de Mao Zedong, Hua Guofeng occupe toujours les principales fonctions du pouvoir.
- Hua Guofeng est Président du Parti communiste chinois depuis qu’il a succédé à Mao le 7 octobre 1976, il le restera encore trois ans jusqu’au 28 juin 1981.
- Il occupe le poste stratégique de Président de la Commission militaire centrale du Parti communiste chinois. Fonction sur laquelle, il a également succédé à Mao Zedong le 7 octobre 1976. Le 28 juin 1981, Deng Xiaoping le remplacera.
- Enfin, il est aussi Premier ministre de la république populaire de Chine, poste qu’il a occupé après la mort de Zhou Enlai le 4 février 1976 et qu’il occupera jusqu’au 10 septembre 1980.
Deng Xiaoping en décembre 1978 « n’est que » Vice-Président du Parti communiste chinois et Vice Premier Ministre. Mais tous les historiens l’affirment, c’est Deng qui donne le cap et gouverne.
Mao Zedong est mort le 9 Septembre 1976.
Son premier ministre de toujours Zhou Enlai, Premier ministre de la république populaire de Chine du 1er octobre 1949 au 8 janvier 1976, date de sa mort l’avait précédé de quelques mois dans le paradis des communistes, s’il existe.
C’est Zhou Enlai qui avait permis à Deng Xiaoping de revenir en grâce, après des années d’humiliation dues aux purges maoistes. Il lui faudra un peu de temps pour asseoir son autorité et écarter Hua Guofeng.
<La petite histoire> nous raconte que Zhou Enlai et Deng Xiaoping se sont rencontrés en France, à Montargis :
« Ho Chi Minh, Pol Pot, [Zhou Enlai, Deng Xiaoping]. .. La France a servi de terrain d’apprentissage à bien des révolutionnaires du XXe siècle. On sait moins que les acteurs du Grand Bond en avant chinois y ont fait leurs gammes, découvrant le marxisme pour les uns, fortifiant des convictions socialistes déjà bien ancrées pour les autres.
De 1902 à 1927, 4 000 jeunes intellectuels sont venus étudier et travailler en France, en particulier à Montargis. Beaucoup sont devenus les cadres de la révolution chinoise. Montargis l’avait presque oublié. Pourtant, en Chine, depuis de longues décennies, la petite ville du Loiret est célébrée dans l’histoire officielle comme le berceau de la Chine nouvelle. »
Aujourd’hui que la Chine est le géant économique que nous connaissons, deuxième puissance économique du monde à qui on annonce, à brève échéance, la place de premier, nous comprenons ce qui s’est passé en 1978/1979 : Le début de cette formidable ascension.
Amin Maalouf rattache ce moment chinois à l’esprit du temps et à la révolution conservatrice :
« En décembre 1978, Deng Xiaoping prenait les rênes du pouvoir à Beijing lors d’une session plénière du Comité central du Parti communiste, inaugurant sa propre « révolution conservatrice ». Jamais il ne l’a appelée ainsi et elle était certainement fort différente de celle de Téhéran comme de celle de Londres ; mais elle procédait du même « esprit du temps ». Elle était d’inspiration conservatrice, puisqu’elle s’appuyait sur des traditions marchandes ancrées depuis toujours dans la population chinoise, et que la révolution de Mao Zedong avait cherché à extirper. Mais elle était également révolution, puisqu’elle allait radicalement transformer, en une génération, le mode d’existence du plus grand peuple de la planète : peu de révolutions dans l’histoire ont changé en profondeur la vie d’un si grand nombre d’hommes et de femmes en un temps si court. »
Le Naufrage des civilisations page 175
Aujourd’hui, nous savons ! Mais en décembre 1978, et en 1979 les archives du Monde que j’ai parcourues ne perçoivent pas l’importance de ce qui est en train de se passer. Au moins il ne le conceptualise pas.
Pourtant des articles racontent ce qui se passe :
- 18 décembre 1978 : « M. Abe Jay Lieber, président de la société américaine Amherst, a annoncé à Hongkong que sa société projetait de construire six hôtels de classe internationale en Chine, écrivait le Wall Street Journal le 15 décembre. Un de ces hôtels serait à Lhassa, au Tibet. »
- 20 décembre 1978 : « En moins de trente ans, la Chine populaire sera passée de la condition d’alliée de l’U.R.S.S. contre les États-Unis à celle d’alliée de fait de Washington contre Moscou. De tous les revirements qui ont marqué notre temps, c’est l’un des plus spectaculaires. »
- 26 décembre 1978 : « L’ouverture de la Chine au monde capitaliste, qui constitue l’un des faits marquants de l’année, aura probablement moins d’effets immédiats pour les maîtres de forges et les marchands de l’Occident capitaliste qu’on ne l’imagine généralement. »
- 27 décembre 1978 : « L’établissement de relations diplomatiques entre les États-Unis et la République populaire de Chine avait beau paraître inéluctable, le communiqué du 15 décembre l’annonçant n’en a pas moins surpris. »
- 22 décembre 1978 « Coca-Cola, un des symboles de la société de consommation américaine, sera vendu en Chine populaire à partir de janvier 1979, a annoncé, mardi 19 décembre, à Atlanta, le président de l’entreprise, M. Austin. Une usine de mise en bouteilles sera construite à Changhaï dans le courant de l’année prochaine. »
- 30 janvier 1979 : « M. Deng Xiaoping, arrivé dimanche après-midi 28 janvier, à Washington, est reçu officiellement, ce lundi, à la Maison Blanche. Avant de quitter Pékin, le vice-premier ministre chinois avait recommandé, dans une interview accordée à l’hebdomadaire » Time « , la formation d’une alliance des États-Unis, de la Chine et d’autres pays contre l’Union soviétique. Après avoir vivement dénoncé » l’hégémonisme » de l’U.R.S.S., M. Deng Xiaoping déclare notamment dans cette interview : » Si nous voulons vraiment brider l’ours polaire, la seule chose réaliste est de nous unir. »
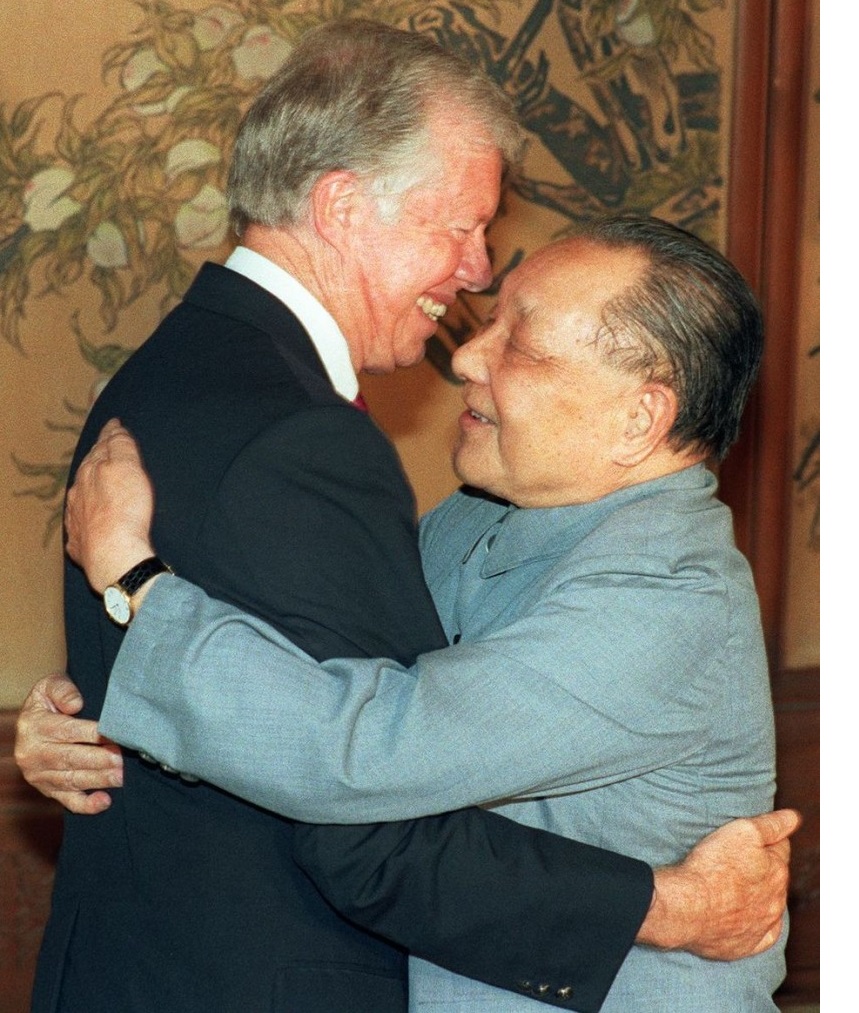 Le voyage de Deng Xiaoping, début 1979 sur l’invitation de Jimmy Carter, sera un triomphe pour le chinois, accueilli avec enthousiasme par les foules américaines.
Le voyage de Deng Xiaoping, début 1979 sur l’invitation de Jimmy Carter, sera un triomphe pour le chinois, accueilli avec enthousiasme par les foules américaines.
- 4 avril 1979 « Le gouvernement chinois a informé par note, l’ambassade d’U.R.S.S. à Pékin, de sa décision d’abroger son traité d’amitié, d’alliance et d’entraide avec l’U.R.S.S., arrivant à échéance en 1980, a-t-on appris dans la capitale chinoise de source informée soviétique. »
Ce que raconte ces articles, c’est un renversement d’alliance. Nous sommes toujours en pleine guerre froide, les États-Unis n’ont qu’un véritable ennemi : l’Union Soviétique. Ils veulent utiliser les chinois pour lutter contre l’URSS. Cette politique avait commencé avec Nixon qui sur les conseils de Kissinger était allé en visite en Chine, rencontrer Mao Zedong. C’était en 1972.
Mais si les États-Unis ont voulu se servir de la Chine, la Chine de Deng Xiaoping a utilisé les États-Unis pour accélérer son développement et devenir aujourd’hui l’ennemi stratégique des États-Unis. Mais cet ennemi possède une puissance économique que l’URSS n’a jamais su atteindre.
J’ai trouvé <un article> très intéressant sur la place économique de la Chine dans le monde à travers l’Histoire :
« Au début de l’ère chrétienne, la Chine était, avec l’Inde, l’une des deux plus grandes économies du monde. Elle représentait plus du quart de la richesse mondiale, loin devant toutes les nations occidentales d’aujourd’hui. Mais personne ne le savait en Europe. Les distances étaient énormes, les liens restaient ténus et l’ignorance réciproque était la norme.
[…] Il est difficile de comprendre l’état d’esprit des dirigeants et de la population chinoise sans tenir compte de leur vision de l’histoire. Le « pays du milieu » (traduction littérale de Zhongguo, nom de la Chine en mandarin) sait qu’il est très longtemps resté dominant dans la sphère d’influence qui était la sienne. Les travaux d’Angus Maddison, historien de l’économie, montrent que le poids de la Chine dans l’économie mondiale est resté central depuis l’époque romaine jusqu’au XIXème siècle, avec un sommet en 1820, année où la Chine représente 36 % de l’économie mondiale. Le déclin chinois s’engage alors de façon rapide et continue jusqu’au milieu du XXème siècle, accéléré par les traités inégaux et les guerres imposées par les puissances occidentales et le Japon. En 1950, le PIB chinois ne représente plus que 4,6 % du PIB mondial. […]
Rapportés à la situation de 1950, le bilan que peut afficher le PCC en 2019 est spectaculaire. La Chine est devenue la deuxième économie mondiale avec un peu plus de 16 % du PIB mondial en 2019, selon les estimations du FMI (19% en parité de pouvoir d’achat). […]
La population chinoise s’est enrichie et « l’aisance moyenne » voulue par le PCC est déjà une réalité. Selon une étude de McKinsey, les trois quarts de la population urbaine, soit 550 millions de Chinois, auront en 2022 un revenu annuel du foyer supérieur à 10 000 dollars.
La jeunesse chinoise est désormais éduquée. Alors qu’en 1950, le taux d’illettrisme dépassait 80 %, il est aujourd’hui pratiquement négligeable (moins de 5 %), et les étudiants représentent plus de 50 % de leur classe d’âge. L’espérance de vie a presque doublé : elle ne dépassait pas 43 ans en 1950 et se situe aujourd’hui à 77 ans. […]
La période 1950-1978 sous le règne de Mao Zedong, est marquée par la construction socialiste du pays avec le partage forcé des terres, la collectivisation de l’agriculture et la création des communes populaires, la nationalisation des entreprises et l’industrialisation du pays. [Cette politique ne fonctionne pas.]
A la mort de Mao en 1976, les élites sont décimées, l’éducation supérieure est à l’abandon, le pays est exsangue. Le PIB de la Chine ne représente plus que 1,7 % de l’économie mondiale en 1980 (en dollars courants) et la part du pays dans les échanges mondiaux a régressé par rapport à 1950. […]
Le décollage économique de la Chine à partir de 1980 a été l’œuvre de Deng Xiaoping et de ses successeurs[…] : la croissance économique dépasse 10 % par an pendant 25 ans, la part du commerce extérieur dans le PIB explose (elle passe de 5 % du PIB en 1970 à près de 50 % en 2010), la Chine devient le premier exportateur mondial, les zones économiques spéciales attirent une masse croissante d’investissements étrangers qui font du pays l’usine du monde. Plus récemment, à partir de l’entrée à l’OMC en 2001, la Chine devient en 15 ans le deuxième investisseur de la planète et le deuxième prêteur mondial, en particulier à l’égard des pays en développement. »
Et pour tous les naïfs qui pensaient que la prospérité économique et une économie de marché dynamique s’accompagnaient forcément par l’émergence d’une démocratie libérale, ils ne peuvent que déchanter.
J’ai trouvé cette vidéo de cinq minutes qui présente les <Réformes de Deng Xiaoping>.
<1596>
-
Mercredi 21 juillet 2021
« Il est illusoire de penser qu’en se montrant radical, on fait taire les radicaux. C’est souvent l’inverse qui se produit.»Amin MaaloufParmi les évènements majeurs de l’année 1979, Amin Maalouf cite l’évènement qui s’est passé 16 jours après la prise par des étudiants iraniens de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran : l’envahissement de la grande mosquée de La Mecque par un groupe de fondamentalistes sunnites.
 La mosquée al-Harâm ou grande mosquée de la Mecque est le premier lieu saint de l’islam et la plus grande mosquée du monde. Elle abrite en son centre la Kaaba, le plus important sanctuaire de l’islam, dans lequel est enchâssée la pierre noire : c’est elle que les musulmans tentent de toucher au cours des ṭawāf (circumambulations) qu’ils accomplissent durant leur pèlerinage (hajj) ; et c’est dans la direction de la Kaaba que les musulmans du monde entier (y compris ceux qui se trouvent dans la mosquée al-Harâm) se tournent pour prier.
La mosquée al-Harâm ou grande mosquée de la Mecque est le premier lieu saint de l’islam et la plus grande mosquée du monde. Elle abrite en son centre la Kaaba, le plus important sanctuaire de l’islam, dans lequel est enchâssée la pierre noire : c’est elle que les musulmans tentent de toucher au cours des ṭawāf (circumambulations) qu’ils accomplissent durant leur pèlerinage (hajj) ; et c’est dans la direction de la Kaaba que les musulmans du monde entier (y compris ceux qui se trouvent dans la mosquée al-Harâm) se tournent pour prier.
Il faut d’abord raconter les faits.
Mais avant encore, il faut rappeler quelques éléments d’Histoire.
Je pense que personne n’ignore que l’islam est né sur la péninsule arabique. Sur cette péninsule la croyance islamique a déclaré deux lieux saints Médine et La Mecque.
Plus que des lieux saints se sont des lieux sacrés dans lesquels seuls des musulmans ont le droit de pénétrer. Pour tout autre, il est sacrilège de fouler la terre de ces deux cités.
Ces lieux se trouvent dans un État dont le nom intègre la référence à la dynastie régnante. C’est le seul État au monde qui présente cette particularité. Il est étonnant qu’un pays qui prétend être consacré au Dieu monothéiste absolu, comporte une telle expression de l’ego exacerbé de quelques hommes qui se prétendent croyants.
Pour s’emparer du pouvoir et soumettre les nombreuses tribus de la péninsule Ibn Saoud a fait un pacte avec les religieux fondamentalistes wahhabites : Au roi le pouvoir politique, les affaires étrangères, aux Oulémas les règles sociales, les mœurs et le droit civil et pénal.
Bref, les oulémas étaient les maîtres du récit qui organise la vie !
J’avais déjà évoqué ce pacte lors du mot du jour <La Maison des Saoud> qui renvoyait vers un documentaire.
Et j’ai aussi raconté le conflit et la victoire de la dynastie saoudite qui régnait sur le Nejd avec pour capitale Ryad sur la dynastie hachémite qui régnait sur la La zone côtière, de la mer Rouge qui comprend les villes religieuses de La Mecque et de Médine et s’appelle Hedjaz. Ce fut le mot du jour consacré aux « accords Sykes-Picot»
Les Oulémas et la dynastie régnante étaient donc liés par ce pacte et vivaient les uns et les autres dans un luxe et un confort, fruit du pétrole que le hasard ou Allah avait opportunément enfoui dans les sous-sols de ce pays.
Mais de nombreux membres de la famille régnante aimaient voyager et se complaire dans des mœurs occidentales, voire les dépasser. En toute hypothèse, il s’agissait de comportements très éloignés du récit des oulémas.
Des mouvements sectaires issus de tribus rigoristes s’en indignaient.Et, très probablement, inspirés par la révolution islamique iranienne, vont passer à l’acte.
L’évènement s’est passé aux premières heures du 20 novembre 1979 alors que quelque 50 000 fidèles du monde entier s’étaient rassemblés pour les prières de l’aube.
Nous parlons d’une date du calendrier chrétien, mais dans le calendrier de l’islam qui débute par l’hégire, ce jour correspondait au premier jour de l’an 1400, la dernière année du XVème siècle musulman.
Le nombre d’assaillants n’est pas connu de manière précise : entre 200 et 600 combattants. Il n’y avait pas que des saoudiens. Le groupe était aussi composé d’Egyptiens, de Yéménites, de Koweïtiens, d’Irakiens et de Soudanais
A leur tête un prédicateur de 40 ans, Juhayman al-Utaybi.
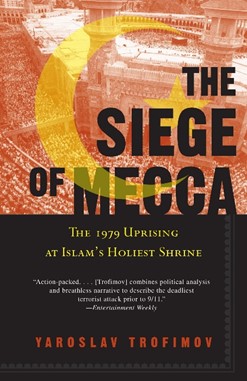 Un journaliste du Wall Street journal, Yaroslav Trofimov, a écrit un livre sur cet évènement : « The Siege of Mecca », livre non traduit en français. Mais <cet article> cite plusieurs fois l’auteur.
Un journaliste du Wall Street journal, Yaroslav Trofimov, a écrit un livre sur cet évènement : « The Siege of Mecca », livre non traduit en français. Mais <cet article> cite plusieurs fois l’auteur.« Tout d’abord, le groupe d’Utaybi n’était pas surgi de nulle part: son chef lui-même venait d’une des tribus parmi les plus rigoureusement converties au wahhabisme, qui avaient aidé le roi Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud, dit Ibn Séoud ou Ibn Saoud (1876-1953) à conquérir le pouvoir, mais s’étaient retrouvées par la suite en opposition avec lui à la fin des années 1920, quand il avait voulu rétablir la paix dans le pays et avec ses voisins, et quand il avait autorisé l’introduction dans son royaume d’innovations modernes telles que le téléphone, le télégraphe, la radio et l’automobile. »
Juhayman al Utaybi était aussi caporal retraité de la Garde nationale saoudienne
Ses hommes, dissimulés derrière des tenues de pèlerins avaient placé des cercueils fermés au centre de la cour, un acte traditionnel de recherche de bénédictions pour les personnes récemment décédées. Mais lorsque les cercueils ont été ouverts, il y avait des armes de poing et des fusils, qui ont été rapidement distribués aux assaillants.
Ils vont donc s’emparer des lieux. Les hommes de Juhayman vont prendre position notamment dans les hauts minarets de la mosquée, qui dominaient la ville, et vont se préparer à défendre leurs positions.
Juhayman avait fondé une association appelée al-Jamaa al-Salafiya al-Muhtasiba (JSM) qui condamnait ce qu’elle percevait comme la dégénérescence des valeurs sociales et religieuses en Arabie saoudite.
Très rapidement il va prendre la parole et utiliser les mégaphones de la grande mosquée pour dénoncer la corruption et l’attitude déviante de la dynastie régnante par rapport aux règles du wahhabisme.
Le journaliste du Monde Jean-Pierre Péroncel-Hugoz écrivait dans <un article du 3 décembre 1979> :
« L’idéologie des insurgés paraît encore plus radicale que celle de l’imam Khomeiny et fait penser à celle de l’organisation Takfir Oua Higra, mouvement clandestin dont le nom, Repentir et Émigration, résume le programme : les musulmans doivent revenir à l’islam originel au moyen de la violence et pour s’y préparer ils doivent quitter provisoirement le monde corrompu dans lequel ils vivent, comme le prophète Mahomet choisit la fuite (Hégire) et s’en alla de La Mecque à Médine. »
Et il va faire une autre annonce plus surprenante : « la venue du Mahdi ». Le Mahdi est une figure messianique de l’islam qui vient à la fin des temps établir sur terre une société juste après une confrontation avec les forces du mal.
C’est surprenant parce que si le Mahdi est bien une croyance de l’islam mais elle est surtout vivace au sein de la communauté chiite, beaucoup moins chez les sunnites.
Juhayman avait rencontré un prédicateur et l’a convaincu qu’il était le Mahdi. Ce dernier a adhéré à cette croyance et est devenu le beau frère de Juhayman.
Le nom du Mahdi était Mohammed bin Abdullah al-Qahtani.
Les dirigeants saoudiens ont réagi avec lenteur à la saisie de la Grande Mosquée. Le prince héritier Fahd bin Abdulaziz al-Saud était en Tunisie lors du sommet de la Ligue arabe et le prince Abdullah, chef de la Garde nationale – une force de sécurité d’élite chargée de protéger les dirigeants royaux – était au Maroc.
C’est au roi Khaled, malade, et au prince Sultan, ministre de la Défense, qu’il incombait de coordonner une intervention.
Je ne vais pas rentrer dans les détails mais cela se passe mal pour la garde nationale. Les hommes Juhayman sont très bien armés, très bien organisés et prêts au sacrifice. De leurs positions dominantes ils vont commettre un massacre des gardes nationaux désemparés et mal encadrés.
En outre, ils ne peuvent utiliser de gros moyens militaires parce qu’ils sont sur des lieux saints et ne peuvent pas bombarder la grande mosquée, en plus le droit d’asile est a priori accordé aux fidèles qui y trouvent refuge.
Le roi est obligé de faire appel aux Oulémas pour savoir ce qu’il a le droit de faire.
Or, à la tête de la communauté des oulémas se trouve Ibn Baz.
<L’article précité> explique que selon Trofimov, à quelques exceptions près (par exemple l’identification de Qahtani avec le Mahdi), l’essentiel du message des insurgés était le même que celui des oulémas les plus influents d’Arabie saoudite : d’ailleurs, bien que Utaybi se soit éloigné de son allégeance aux oulémas du Royaume vers 1977, les jugeant trop soumis au pouvoir, Ibn Baz lui-même intervint en 1978 pour faire libérer les adeptes d’Utaybi arrêtés par les autorités, qui s’étaient émues des activités de ce réseau clandestin hostile aux Saoud. De l’avis de Ibn Baz, des hommes qui voulaient ainsi rendre le pays plus pieux avaient de bonnes intentions, malgré des excès de langage (Trofimov, pp. 41-42).
Et après plus de 48 heures de délibérations, les oulémas et Ibn Baz vont accorder le droit au Roi de faire usage d’une force sérieuse mais encadrée pour déloger et châtier les personnes qui ont selon eux profanés le lieu saint.
Mais ils vont y mettre plusieurs conditions et notamment que le royaume et la famille régnante deviennent plus pieux.
Je cite à nouveau l’article consacré au livre de Trofimov :
« Dirigé par Ibn Baz, le Conseil suprême des oulémas donna raison au régime saoudien et condamna les insurgés, mais obtenant en échange une série de mesures contre la libéralisation qui s’était amorcée en Arabie saoudite. »
Cet <article de la BBC> cite Nasser al-Huzaimi qui dit :
« L’action de Juhayman a arrêté toute modernisation. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Il a notamment exigé du gouvernement saoudien le retrait des présentatrices de la télévision. Après l’incident du Haram, aucune présentatrice n’est réapparue à la télévision »
Et Amin Maalouf explique encore davantage
Une autre conséquence majeure des évènements de La Mecque fut d’ébranler l’Arabie saoudite et d’amener ses dirigeants à modifier radicalement leurs comportements en matière religieuse. Certains observateurs qui s’intéressent de près à l’histoire du royaume, parlent d’un « traumatisme de 1979 » à partir duquel le régime, craignant d’apparaître comme trop mou dans la défense de la foi, dut redoubler d’effort pour propager le wahhabisme et le salafisme à travers le monde, notamment par la construction de mosquées et par le financement d’associations religieuses, de Dakar à Djakarta ainsi qu’en Occident… »
Le Naufrage des civilisations Page 238
A ce stade, il faut rappeler que tous les sanglants actes terroristes qui ont été perpétrés dans les pays occidentaux par des hommes se réclamant de l’islam, tous ces hommes étaient sunnites !
Concernant la reprise de la mosquée par les forces gouvernementales, malgré le blanc sein des oulémas, les forces de sécurité saoudiennes n’arrivent pas au bout des rebelles.
Alors les autorités saoudiennes se tournent vers la France.
Le président Giscard d’Estaing envoie Paul Baril et d’autres membres de la nouvelle unité anti-terroriste, le GIGN.
L’opération devait rester secrète, pour éviter toute critique de l’intervention occidentale dans le berceau de l’Islam.
L’implication des français dans l’action directe contre les insurgés est sujet à controverse.
Alain Bauer le criminologue affirme que les français ont été convertis temporairement et rapidement à l’islam pour pouvoir intervenir. Le monsieur X de France inter dans l’émission <L’attentat à la Mecque du 20 nov 1979> prétend aussi que le GIGN est intervenu directement.
En tout cas ce sont des armes sophistiquées et notamment des gaz qui ont été massivement utilisés pour mettre fin à l’occupation.
Le plan français s’est avéré un succès. Le 5 décembre, les survivants hagards et à bout de force se sont rendus. Le mahdi était mort. Se croyant invulnérable, il ramassait les grenades dégoupillées et les renvoyait vers les forces gouvernementales, jusqu’à ce que l’une d’entre elles explose et le déchiquète mettant fin à son rêve religieux.
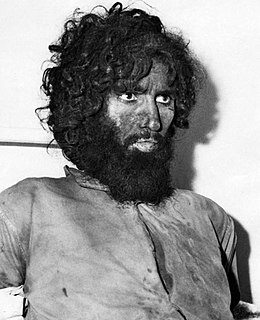 La seule photo certaine de Juhayman a été prise après cet assaut.
La seule photo certaine de Juhayman a été prise après cet assaut.
Un mois après la fin de l’occupation de la mosquée, 63 des rebelles ont été exécutés publiquement dans huit villes d’Arabie Saoudite. Juhayman a été le premier à mourir.
Il reste encore beaucoup de points obscurs au sujet de cet évènement. Qui a armé et permis l’organisation de ce groupe international ?
Monsieur X avance une hypothèse surprenante : <L’attentat à la Mecque du 20 nov 1979> . Ce serait des iraniens aidés par des américains proches du candidat républicain aux élections Ronald Reagan qui auraient en sous-main tiré les ficelles.
La France a été récompensée. J’ai noté en 1980 :
- En mars <L‘Arabie Saoudite aurait décidé de verser 1 500 millions de dollars (environ 6450 millions de francs) au groupe privé Dassault-Breguet pour la construction du nouvel avion>
- En mai <L’Arabie Saoudite décide de confier à la France la création d’une marine de défense côtière>.
- En octobre : <L’Arabie Saoudite achète pour 14,4 milliards de F d’armements navals>
Beaucoup disent que Juhayman a eu une grande influence sur Oussama Ben Laden. L'<article de la BBC> écrit :
« Dans l’un de ses pamphlets contre la famille régnante saoudienne, [Ben Laden] disait qu’ils avaient » profané le Haram, alors que cette crise aurait pu être résolue pacifiquement […] je me souviens encore aujourd’hui des traces de leurs empreintes sur le sol du Haram.»
Amin Maalouf exprime cette même idée :
« L’incroyable assaut contre ce lieu saint fut l’acte de naissance d’un militantisme sunnite radical dont on allait entendre parler pendant des décennies. Pour l’heure, certains admirateurs de l’audacieux commando, meurtris par sa défaite s’en furent poursuivre leur combat loin de la péninsule arabique. En Afghanistan, par exemple. Et les autorités saoudiennes, soucieuses de s’en débarrasser, encouragèrent cette diversion. Ce fut notamment le cas d’Oussama Ben Laden ; il s’employa désormais à construire […] Al Qaïda (« La Base » »
Le Naufrage des civilisations Page 237
Je laisserai la conclusion à Amin Maalouf et j’en tire l’exergue du mot du jour
« Sans Doute le royaume espérait-il acquérir de la sorte un « certificat » de piété, qui le préserverait des surenchères. Mais ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées. Il est illusoire de penser qu’en se montrant radical, on fait taire les radicaux. C’est souvent l’inverse qui se produit. […] L’enseignement qu’il prodigue ne fait que légitimer une certaine vision du monde que d’autres se hâtent de retourner contre lui. […] Le traumatisme causé par les évènements sanglants de 1979 allait se révéler durable.»
Le Naufrage des civilisations Page 238
<1595>
-
Mardi 20 juillet 2021
« Pause (La prise de la grande mosquée de la Mecque) »Un jour sans mot du jour nouveauQuelquefois, il faut plus de temps et d’énergie que prévu pour l’écriture du mot du jour..
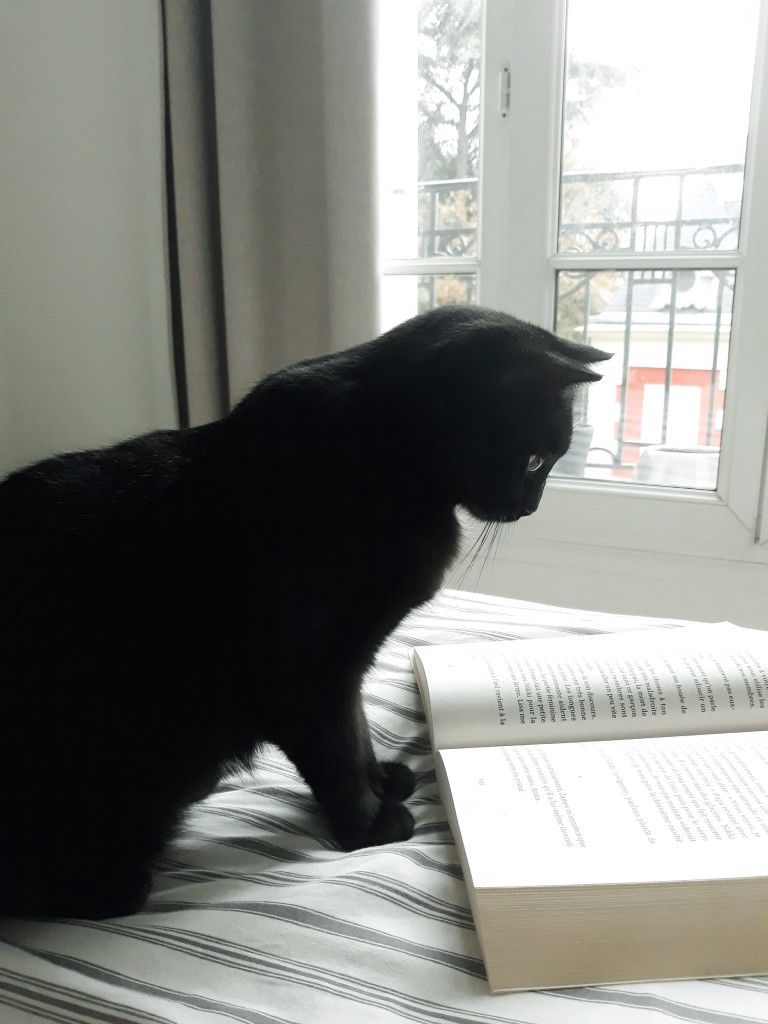 Le prochain sera consacré à l’attaque par un groupe de sunnites intégristes de la grande Mosquée de la Mecque.
Le prochain sera consacré à l’attaque par un groupe de sunnites intégristes de la grande Mosquée de la Mecque.
Si vous souhaitez anticiper vous pouvez écouter deux émissions de France Inter sur ce sujet :
Émission de 2018 < Affaires sensibles – Mic-Mac à la Mecque > par Fabrice Drouelle.
Et plus étrange plus secret <L’attentat à la Mecque du 20 nov 1979> qui fut un des épisodes de cette émission incroyable, désormais supprimé : «Rendez-vous avec Mr X du 18 juin 2015 »
<Mot du jour sans numéro>
-
Lundi 19 juillet 2021
« 444 jours ! »Durée de la prise d’otage des diplomates américains dans l’ambassade de Téhéran qui a débuté le 4 novembre 1979.Nous avons vu qu’en quelques semaines la révolution islamique s’est imposée, au tout début de l’année 1979. Avec des alliés notamment libéraux ou nationaliste Khomeini allait d’abord chasser le Shah qui en outre était très affaibli par un cancer qui allait l’emporter le 27 juillet 1980. Puis, Khomeini allait se débarrasser méthodiquement de tous ses alliés pour laisser au pouvoir la seule clique de religieux régressifs et violents qui suivaient aveuglément l’islam que le vieux ayatollah prêchait.
La révolution islamique allait provoquer cette même année 1979 un autre évènement inouï qui marquera l’Histoire et allait avoir des conséquences jusqu’à nos jours.
 Le 4 novembre 1979, un dimanche, des centaines d’étudiants iraniens envahissent l’ambassade américaine où ils se saisissent de 52 otages et entament une « occupation révolutionnaire » des locaux.
Le 4 novembre 1979, un dimanche, des centaines d’étudiants iraniens envahissent l’ambassade américaine où ils se saisissent de 52 otages et entament une « occupation révolutionnaire » des locaux.
La raison qui pousse ces étudiants est l’extradition du Shah qui se trouve aux Etats-Unis pour soigner son cancer. Ils obtiendront que le Shah quitte les États-Unis. Seul l’Egypte de Sadate acceptera de l’accueillir et c’est dans le pays des pyramides qu’il mourra.
Cette prise d’otage sur le sol de l’ambassade américaine, donc sol américain était d’une part une violation flagrante du droit international et des conventions diplomatiques d’autre part était d’une provocation inouïe à l’égard des États-Unis d’Amérique
L’excellent site d’Histoire <Herodote.Net> raconte cette prise d’otage :
« Quelques mois après le renversement du régime monarchique et la fuite du chah Mohammad Reza Pahlavi aux États-Unis le 16 janvier 1979, l’ayatollah Khomeini proclame l’avènement de la République islamique d’Iran. Fervent détracteur des États-Unis, il exhorte son peuple à manifester contre ce pays qu’il surnomme le « Grand Satan ». L’anti-américanisme imprègne tous ses discours. Le 2 novembre 1979, il déclare que les États-Unis sont un « ennemi de l’islam ».
Dimanche 4 novembre 1979, le temps est maussade sur la capitale iranienne. Près de 400 jeunes étudiants islamistes se réunissent vers 10h. Ils marchent vers l’ambassade américaine tout en réclamant l’extradition du chah, qu’ils veulent condamner à mort.
Les marines qui protègent l’ambassade ne font pas le poids face à la foule qui, après deux heures de siège, parvient à franchir le mur d’enceinte du bâtiment. Le drapeau américain est remplacé par l’étendard de l’islam.
Certains diplomates parviennent à s’enfuir, mais 52 Américains restent pris au piège. Le président américain Jimmy Carter ne réagit qu’en imposant des sanctions économiques à l’Iran. Rien ne se passe. Cinq mois plus tard, le 24 avril 1980, il lance l’opération Eagle Claw en vue de délivrer ses ressortissants par la force.
C’est un fiasco total. Parmi les hélicoptères engagés, plusieurs tombent en panne dans le désert. Huit militaires trouvent la mort dans une évacuation précipitée. Humiliés et mortifiés, les gouvernants américains ne vont dès lors avoir de cesse de combattre la République islamique, jusqu’à encourager le dictateur irakien Saddam Hussein à attaquer l’Iran en septembre 1980.
Par une ultime provocation, les otages seront en définitive libérés par la voie diplomatique le 20 janvier 1981, le jour même de l’accession à la présidence des États-Unis de Ronald Reagan.
Hormis les militaires tués dans l’opération commando, la prise d’otages n’aura fait aucune victime américaine. Cette humiliation va néanmoins entretenir jusqu’à nos jours, un vif désir de revanche dans l’opinion publique américaine. Grâce à quoi le gouvernement de Washington pourra multiplier les gestes hostiles à l’égard de Téhéran, en parfaite collusion avec l’Arabie saoudite… »
Khomeini ne condamnera jamais cette prise d’otage et laissera faire.
Pour une description plus détaillée on pourra lire cet article : <Crise des otages américains en Iran (4 novembre 1979-20 janvier 1981)>
La première conséquence de cette occupation de l’ambassade américaine, est que les islamistes au pouvoir ont pu s’emparer de documents secrets américains concernant leur politique en Iran et aussi révélant des noms d’iraniens qui étaient proches ou collaboraient avec les américains.
 La seconde conséquence fut l’humiliation que ressentirent les américains. Ils feront payer cette humiliation au Président Carter et ils éliront Ronald Reagan qui a jouera un rôle très ambigu sur la libération des otages
La seconde conséquence fut l’humiliation que ressentirent les américains. Ils feront payer cette humiliation au Président Carter et ils éliront Ronald Reagan qui a jouera un rôle très ambigu sur la libération des otages
Amin Maalouf écrit :
« L’occupation se poursuivit pendant près de quinze mois et elle influença de manière significative la campagne présidentielle qui se déroulait alors aux États-Unis. Humiliés par les images de leurs diplomates menottés et les yeux bandés, les Américains en ont voulu au président Carter de n’avoir pas su riposter, surtout lorsqu’une tentative de libérer les otages par une opération commando avorta de manière lamentable. Le candidat républicain Reagan eut beau jeu de dénoncer la faiblesse et l’incompétence de l’administration démocrate.
Le drame de l’ambassade contribua indiscutablement à la défaite écrasante que subit le président sortant. A tel point qu’il y eut des allégations persistantes selon lesquelles des envoyés de Reagan auraient eu des pourparlers à Paris avec des représentants iraniens, pour leur demander de retarder le règlement du conflit jusqu’après l’élection. Les historiens débattront longtemps encore pour déterminer ce qui s’est réellement passé. Cependant, les autorités iraniennes, comme si elles voulaient ajouter foi à ces allégations, choisirent d’annoncer la libération des otages le jour même où Reagan pris ses fonctions très exactement le 20 janvier 1981, pendant que se tenait à Washington la cérémonie d’inaugurations. »
Le Naufrage des civilisations page 240
Officiellement la contrepartie de cette libération fut la restitution par les États-Unis de 8 milliards de dollars des avoirs du shah qui étaient en sol américain
Mais <Wikipedia> rappelle aussi que l’Administration Reagan vendra illégalement des armes à l’Iran. Amin Maalouf le rappelle aussi
« La nouvelle administration ne se montra d’ailleurs pas vraiment hostile envers la République islamique. Un énorme scandale éclata même, durant le second mandat de Reagan, lorsque le Congrès découvrit que la Maison Blanche finançait – illégalement – la guérilla antisandiniste du Nicaragua avec de l’argent obtenus en vendant – illégalement – des armes aux pasdarans, les gardiens de la révolution iranienne. »
Le Naufrage des civilisations page 240
Cette prise d’otage dura 444 jours.
Elle eut des conséquences géopolitiques majeures. Désormais l’Iran islamique devenait un ennemi absolu des américains qui ne pardonneront jamais ces 444 jours. La difficile négociation sur le nucléaire iranien s’explique aussi par ce traumatisme.
L’Iran devenant cet ennemi, les liens des États-Unis avec l’Arabie Saoudite allait encore se renforcer. Et même les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés par des saoudiens n’allait pas changer cette situation : l’ennemi principal reste l’Iran.
Mais la première conséquence qui en aura beaucoup d’autres, fut la guerre Irako-iranienne qui débuta le 22 septembre 1980. En effet, les américains incitèrent Saddam Hussein qui en avait très envie, à attaquer l’Iran. Cette guerre n’eut pas de vainqueur mais fit autour d’un million de morts. L’Irak et l’Iran en sortirent exsangues et avec d’énormes dettes. Saddam Hussein pensant que les occidentaux lui étant désormais redevables entrepris un certain nombre d’actions violentes, dont la plus extravagante fut d’envahir le Koweit. Les américains n’acceptèrent pas cet acte et déclenchèrent la première guerre du golfe. Par la suite le fils du Président de la première guerre du golfe qui était devenu président à son tour déclencha la seconde guerre pour détruire le régime de Saddam Hussein. Cela déclencha le chaos dans cette région et l’apparition de DAESH. Depuis DAESH est partiellement vaincu mais le chaos de la région continue.
Le fait de profaner une ambassade fut aussi un traumatisme majeur créant un précédant inquiétant.
Et puis, elle provoqua la victoire électorale de Ronald Reagan sans laquelle la révolution conservatrice initiée par Margaret Thatcher n’aurait pas pu se déployer à l’échelle planétaire.
<1594>
-
Vendredi 16 juillet 2021
« Vous ne pouvez pas comprendre »Des iraniens à Marc Kravetz qui essyait de décrire ce qui se passait lors de la révolution islamique à Téhéran.Nous n’avons pas compris.
Je n’ai pas compris. J’avais 20 ans début 1979, quand tout cela s’est passé en quelques mois, quelques semaines.
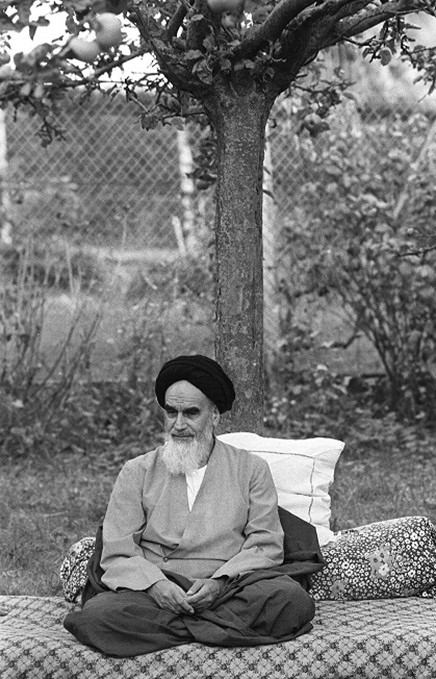 Idéaliste, fortement influencé par les journaux français et les intellectuels de gauche, dans mon esprit le Shah D’Iran était un dictateur sanguinaire. Et, le paisible et vieux religieux qui recevait ses hôtes, assis en tailleur sous un pommier, à Neauphle le Château, allait probablement utiliser son autorité pour organiser une transition paisible, après que le peuple iranien ait chassé son empereur. Il allait permettre l’apparition d’une démocratie et de la liberté en Iran et mettre fin aux exactions de la sinistre Savak, la police politique du Shah.
Idéaliste, fortement influencé par les journaux français et les intellectuels de gauche, dans mon esprit le Shah D’Iran était un dictateur sanguinaire. Et, le paisible et vieux religieux qui recevait ses hôtes, assis en tailleur sous un pommier, à Neauphle le Château, allait probablement utiliser son autorité pour organiser une transition paisible, après que le peuple iranien ait chassé son empereur. Il allait permettre l’apparition d’une démocratie et de la liberté en Iran et mettre fin aux exactions de la sinistre Savak, la police politique du Shah.
Mohammad Reza Pahlavi portait, en outre, cette tare d’être entièrement entre les mains des américains depuis que la CIA avait chassé lors d’un coup d’état le premier ministre Mohammad Mossadegh qui voulait donner à l’Iran un destin autonome.
Mais cet homme, presque souriant sous le pommier, était en réalité un vieillard austère, retors, cruel, archaïque, misogyne, antisémite et ennemi farouche de l’occident et de la liberté.
Je me souviendrai toujours de cet appel d’une jeune étudiante iranienne lors de l’émission « Ligne ouverte » qu’animait Gonzague Saint Bris, de minuit à 1 heure du matin sur Europe 1 et que j’écoutais tous les jours avant de m’endormir dans ma petite chambre d’étudiant du Lycée Kléber de Strasbourg, dans lequel j’étais élève de mathématiques supérieures en 1979. C’était ma porte ouverte sur le monde dans le milieu fermé et aliénant des classes préparatoires scientifiques.
Cette jeune fille s’en prenait aux bien-pensants de gauche et disait :
« Vous êtes dans l’erreur absolue. Vous croyez naïvement que Khomeiny et les religieux sont révoltés pour les mêmes raisons que vous autres occidentaux : la dictature, l’emprisonnement des opposants, la torture, le manque de liberté. Ce n’est pas du tout cela. S’ils arrivent au pouvoir, ils feront pire et les femmes seront bien davantage opprimées que sous le Shah. Ce que ces religieux reprochent au Shah : C’est l’occidentalisation de la société iranienne, la libération des mœurs et le rôle accru que le Shah a permis aux femmes. » .
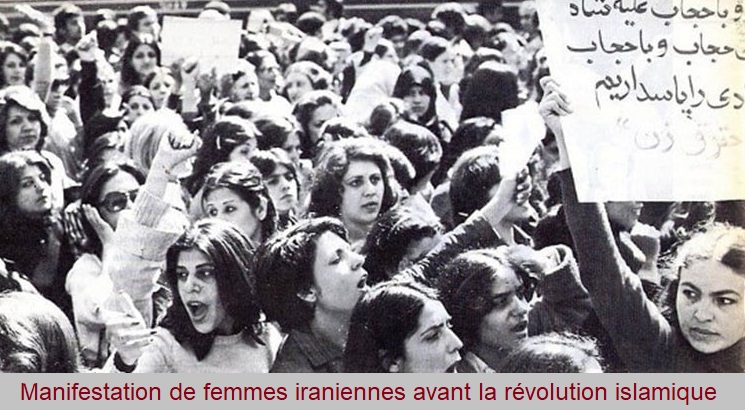 Je cite de mémoire, mais c’est bien le fond de ce que disait cette jeune femme alors que cet ignoble personnage vivait encore en France près de ce pommier.
Je cite de mémoire, mais c’est bien le fond de ce que disait cette jeune femme alors que cet ignoble personnage vivait encore en France près de ce pommier.
Ce documentaire réalisé en 2019 par Holger Preuβe pour la chaîne de télévision Arte : <Le Shah et l’Ayatollah – Le duel iranien> montre que l’antagonisme remonte loin.
Il était déjà présent entre les pères de ces deux protagonistes. Le père du shah Reza Chah Pahlavi qui avait pris le pouvoir par un coup d’état militaire et créa la dynastie des Pahlavi qui ne comptera que deux souverains, s’opposait violemment aux religieux. Il était probablement athée.
Le père de Khomeiny, Mostafa Moussavi, était aussi ayatollah et a été assassiné alors que son fils n’avait que 6 mois. Toute sa vie, Il a pensé que c’est Reza Chah qui avait commandité ou laissé faire cet assassinat. Bref, il le tenait pour responsable de sa mort. Alors que Wikipedia rapporte :
« Mostafa Moussavi, un notable local, est assassiné par les hommes de main d’un grand féodal en mars 1903 »
Et justement, le fils Mohammad Reza Chah Pahlavi qui lui semble croyant, entend s’attaquer à la féodalité qui règne en Iran. Il l’appelle « La révolution blanche ». Elle consiste à distribuer et donner des droits de propriétés à des paysans pauvres issus des terres des féodaux qui en sont dessaisis. Il se trouve que beaucoup de ces propriétaires étaient des religieux.
Cette réforme agraire allait être accompagnée de réformes sociétales donnant un rôle accru aux femmes notamment par la modification de la loi électorale : Les femmes reçurent le droit de vote mais aussi celui d’éligibilité. Une loi qui fit beaucoup changer la représentation sexuelle du Parlement : il y avait en 1976 plus de députés femme en Iran qu’en Europe occidental
Et ce sont bien ces réformes que Khomeiny et les religieux rejetaient.
Le 3 juin 1963, lors d’un discours intitulé « Contre le tyran de notre temps » à l’école coranique Feyzieh, il attaque directement le Shah et révèle son antisémitisme :
« Ce gouvernement est dirigé contre l’islam. Israël veut que les lois du Coran ne s’appliquent plus en Iran. Israël est contre le clergé éclairé… Israël utilise ses agents dans le pays pour éliminer la résistance anti-israélienne… »
Plus loin dans son discours, il parle du Shah comme d’un « pauvre type misérable »
Ce discours conduira à son arrestation puis à son expulsion. Il se réfugia en Irak puis lors des évènements de fin 1978, il fut aussi expulsé d’Irak. Il trouva alors refuge en France qui ne demandait pas de visa pour les iraniens.
Ce documentaire sur France 3 : <Reportage sur la révolution Islamique en Iran> explique son arrivée en France. Le gouvernement français était dans une grande confusion à son égard. Au départ, il ignorait son importance et s’est trouvé rapidement débordé par la foule d’iraniens qui venaient à sa rencontre à Neauphle le Château, près du pommier, pour l’acclamer.
Pendant son séjour en France, il laissait beaucoup parler et agir 3 hommes qu’on présentait proches de lui et qui avait la mission d’exprimer sa pensée aux médias occidentaux.
- Bani Sadr ;
- Sadegh Ghotbzadeh ;
- Ebrahim Yazdi
Ces trois hommes l’avaient d’ailleurs précédé et accueilli en France.
Il y avait d’abord Bani Sadr qui l’emmena dans son appartement de Cachan à la sortie de l’aéroport de Roissy. Il y passa les premiers jours, avant que son entourage ne trouve la propriété de Neauphle le château. Il fut le premier président de la république islamique. Cela ne dura pas 18 mois, il fut destitué par les milices islamiques. Il n’était pas suffisamment archaique probablement. Il vit à Versailles, sous protection policière française. La république islamique a l’habitude d’assassiner ceux qui pourraient être un recours. Le dernier premier ministre nommé par le Shah, un homme honorable, opposant de toujours au Shah, torturé par la Savak : Chapour Bakhtiar fut assassiné à Suresnes, lors de son exil.
Sadegh Ghotbzadeh, fut nommé ministre des affaires étrangères. Lui fut, dès 1982, fusillé pour » complot » Broyé par la » justice » islamique
Et le dernier, Ebrahim Yazdi, eut un destin un peu plus paisible. Il fut aussi ministre iranien des Affaires étrangères après la victoire de la révolution islamique de 1979. Mais rapidement il quitta le pouvoir et devint une figure de l’opposition libérale. Il avait été arrêté à plusieurs reprises après la réélection contestée de l’ex-président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad en 2009.
Bani Sadr rapporte :
« Quand nous étions en France avec Khomeini, tout ce que nous disions, il l’acceptait sans hésiter, le visage ouvert et riant. […] Quand il était en France, l’ayatollah Khomeini était du côté de la liberté. […]
Quelques mois après notre retour, les durs du régime s’en sont pris aux femmes qui ne portaient pas le foulard. Je suis allé voir M. Khomeini à Qom et je lui ai dit : « Vous aviez dit que les femmes seraient libres de porter ou pas le voile », Il m’a répondu : « Par convenance, j’ai dit des choses en France, mais tout ce que j’ai dit en France ne m’engage pas. Si je le juge nécessaire, je dirai le contraire » […] Pour moi c’était très, très amer »
 Le vieillard hypocrite avait besoin de ces 3 hommes, largement influencés par les valeurs occidentales, pour parler aux médias du monde et passer comme celui qui établira une démocratie en Iran. Des intellectuels français aveugles et sourds comme Sartre ou Foucault seront abusés par cette illusion. Lire aussi cet article intéressant de Geo : <Pourquoi l’Occident a joué avec le feu>
Le vieillard hypocrite avait besoin de ces 3 hommes, largement influencés par les valeurs occidentales, pour parler aux médias du monde et passer comme celui qui établira une démocratie en Iran. Des intellectuels français aveugles et sourds comme Sartre ou Foucault seront abusés par cette illusion. Lire aussi cet article intéressant de Geo : <Pourquoi l’Occident a joué avec le feu>
Marc Kravetz, journaliste à Libération a suivi la révolution en Iran. Un documentaire a été réalisé sur son expérience : <L’Iran, récit d’une révolution – documentaire de la série « Les grandes erreurs de l’histoire » (1999)>
Marc Kravetz raconte : On arrête les généraux et les principaux chefs de la SAVAK. Les « représentants occidentalisés » du mouvement vont expliquer qu’il va y avoir un grand procès international du type « Procès de Nuremberg de l’Iran» pour juger ces gens. Mais Khomeiny intervient et dit à peu près selon Marc Kravetz :
« Qu’est-ce que c’est que ces histoires ? Ces gens sont coupables parce qu’ils sont coupables. Ils vont être jugés selon la justice islamique qui n’est pas là pour déterminer si un coupable est coupable mais comment châtier les coupables. »
Les simulacres de procès dureront de 5 à 10 minutes et tous seront exécutés dans les minutes suivantes.
A partir de 39:55 :
« Ce n’était pas des procès. Ce n’était pas non plus de la vengeance. La révolution s’installait avec ses hommes et ses codes. Elle ne nous parlait plus. Elle n’avait plus besoin de nous. L’exclusion se passait sur un mode élémentaire : « Vous ne pouvez pas comprendre » Cela a commencé comme cela. Tu ne comprends rien à notre pays. Décidément, les journalistes sont tous les mêmes même quand on croit qu’ils sont des amis. Tu ne comprends pas ce que c’est que la colère de Dieu. Nous ne pouvions pas comprendre ce qu’était la réalité de l’Islam. Et la réalité de l’Islam était ce que Khomeiny disait être l’Islam. »
Et la colère de Dieu va s’abattre sur l’Université de Téhéran. Dans laquelle il y avait une effervescence intellectuelle, de nombreux mouvements qui débattaient et voulaient rêver à l’Iran du futur. C’était un peu la Sorbonne de mai 68. On allait voir débarquer tous les jours des camionnettes déversant des mollahs avec des mégaphones qui par leur puissance sonore couvraient les voix des étudiants qui débattaient. Chaque jour venait des mollahs de plus en plus nombreux avec des mégaphones de plus en plus puissants qui ânonnaient un seul message :
« Le seul guide qui dit la vérité est l’ayatollah Khomeyni, le seul parti est le parti islamique »
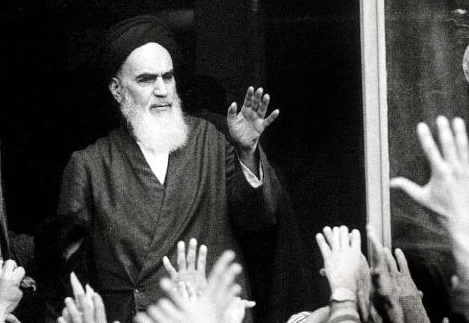
Marc Kravetz analyse
On a vu peu à peu la mollarchie prendre le pouvoir. Ce n’était pas encore la terreur qui allait suivre, mais on sentait plus que de l’inquiétude.
Amin Maalouf considère que cette révolution conservatrice islamique chiite va avoir une importance considérable en géostratégie et aussi dans les fractures qui vont s’élargir dans le monde musulman entre chiite et sunnite, à l’intérieur des sunnites et entre les musulmans et l’occident.
« L’un des premiers changements remarquables sur le plan international fut le renversement de la politique iranienne sur le conflit du Proche-Orient. Le Shah avait tissé des relations amicales avec Israël, qu’il fournissait en pétrole alors que les producteurs arabes refusaient de le faire. Khomeiny mit immédiatement fin à cette pratique, rompit ses relations diplomatiques avec l’État Hébreu »
Le naufrage des civilisations Page 231
Aujourd’hui, Israël considère l’Iran comme son principal et plus dangereux ennemi. L’Etat hébreu est même parvenu à se rapprocher des pays arabes sunnites et même de l’Arabie saoudite en raison de leur ennemi commun : L’Iran chiite.
Et l’Iran va intervenir dans les pays arabes via des mouvements qu’il soutient : le Hezbollah au Liban, le Hamas et le Jihad islamique à Gaza ou les houthistes du Yémen. Amin Maalouf ajoute :
« Mais cette montée en puissance s’est accompagnée tout au long d’une déchainement de haine entre les sunnites, majoritaires dans la plupart des pays arabes et les chiites très majoritaires en Iran. Le conflit était latent depuis des siècles, et il aurait pu le rester. J’ai déjà eu l’occasion de dire que dans le Beyrouth de ma jeunesse, il n’était pas vraiment à l’ordre du jour. »
Le naufrage des civilisations Page 231
Cette révolution fut avant tout anti-occidentale et manifestait l’expression du rejet de toutes nos valeurs, même les plus nobles.
Lors de la révolution blanche, beaucoup de paysans pauvres démunis ont fuit la révolution agraire pour s’entasser dans des bidonvilles des grandes villes. C’est dans ces endroits de misère que les mollahs ont enseigné, fait passer leurs discours. Les foules fanatiques étaient en formation.
Les religieux intégristes ne sont pas dangereux parce que sporadiquement, ils font quelques attentats sanglants.
Ils sont terriblement dangereux, parce qu’ils enseignent les enfants et des adultes, incapables de déployer un esprit critique, et que dans la durée, inlassablement, ils remplissent le cerveau malléable de gens opprimés de messages simplistes, violents et régressifs.
<1593>
-
Jeudi 15 juillet 2021
« Pause (La révolution iranienne) »Un jour sans mot du jour nouveauL’idée féconde qui considère qu’il serait judicieux que le lendemain d’un jour férié fût férié, a beaucoup de mal à se concrétiser.
 Mais l’écriture du mot du jour est libre et peut par conséquent appliquer les idées fécondes.
Mais l’écriture du mot du jour est libre et peut par conséquent appliquer les idées fécondes.
Ce lendemain de fête nationale peut donc être un moment de repos.
Demain je devrai parler de la révolution iranienne.
Si vous souhaitez anticiper vous pouvez visionner ces deux documentaires qui me semblent très intéressants pour comprendre comment le régime du Shah s’est écroulé et a été remplacé par la république islamique de Khomeiny.
<Le Shah et l’Ayatollah – Le duel iranien> Documentaire réalisé en 2019 par Holger Preuβe pour la chaîne de télévision Arte.
Documentaire sur France 3 : <Reportage sur la révolution Islamique en Iran>
<Mot du jour sans numéro>
-
Mardi 13 juillet 2021
« L’égoïsme rationnel »Ayn RandA la lecture du mot du jour d’hier, Annie m’a dit qu’elle était restée un peu sur sa faim.
Je ne vais pas créer une série sur Ayn Rand au milieu de la série sur l’année 1979, l’année du grand renversement.
Mais je vais quand même tenter de donner quelques éléments de plus sur cette femme énigmatique, fascinante et qui a fait des disciples.
Je me souviens d’avoir entendu une interview de Ronald Reagan qui disait :
« On a, sans cesse, augmenté les aides sociales et pourtant il y a de plus en plus de pauvres. Cela ne marche pas »
Dans cette phrase, il s’inspire d’Ayn Rand. D’ailleurs, il va immédiatement couper dans les budgets sociaux.
A mon sens, cela ne marche pas mieux, il y a toujours plus de pauvres aux États-Unis.
Peut être ses objectifs étaient-il autres : d’une part diminuer la pauvreté en Chine et d’autre part augmenter le nombre et la richesse des milliardaires américains. Dans ce cas, on peut dire qu’il a réussi.
Pour revenir à Ayn Rand, j’ai trouvé cet interview d’une demi-heure, sous-titrée en français : <Interview de 1959>
Vous admirerez son esprit brillant, sa capacité de répondre à toutes les questions en revenant toujours sur les fondements de sa philosophie objectiviste. Vous serez peut-être aussi pétrifié par la froideur du raisonnement et des arguments.
Jean Lebrun lui a consacré une émission de ¾ d’heures, le samedi 24 octobre 2020.
J’ai trouvé le titre de son émission très pertinent : <Ayn Rand : Je sans les autres ?>
Le journal « Les Echos », lors de la sortie de son livre « La grève » en livre de poche en 2017, lui a consacré un article < Ayn Rand : La libérale capitale>
On y lit cette description :
« Ayn Rand exalte l’égoïsme. Mais pas n’importe lequel, «l’égoïsme rationnel». Selon elle, l’homme ne doit vivre que par et pour lui-même. Il doit poursuivre son intérêt et chercher son propre bonheur. Sans sacrifier sa vie aux autres, sans apparaître non plus comme un prédateur. « L’individualiste est celui qui reconnaît le caractère inaliénable des droits de l’homme – les siens comme ceux des autres. L’individualiste est celui qui affirme: «Je ne contrôlerai la vie de personne – et je ne laisserai personne contrôler la mienne»», écrit-elle. Une éthique de l’estime de soi, d’où découlent toutes les vertus: la rationalité, l’indépendance, l’intégrité, la fierté… Contre les apôtres de l’altruisme, la philosophe veut convaincre des bienfaits de la libre entreprise. Ses romans magnifient les entrepreneurs et les créateurs de richesse, qui osent aller, seuls contre tous, à l’assaut de tous les obstacles imaginables. Le capitalisme de laisser-faire y est naturellement le système idéal. «Ayn Rand promeut l’exacte antithèse du modèle social-étatique à la française, »
Dans l’entretien vers lequel je renvoie ci-avant, elle évoque aussi plusieurs fois « la vertu » au sens classique qui doit présider la rationalité.
Le magazine qui essaie de décrypter le futur « Usbeketrica » a commis un article en 2019 : <Ayn Rand, la Che Guevara du capitalisme> qui la présente ainsi :
« Vous couperiez dans la Bible ? » C’est en ces termes qu’en 1956 Ayn Rand répond sèchement à son éditeur Random House, qui l’invite à apporter des modifications à son roman fleuve La Grève, une somme de plus de 1 200 pages. En une phrase, le personnage est posé. On ne plaisante pas avec Ayn Rand. On ne met pas en doute la parole de la grande prêtresse du capitalisme et de la raison. La Grève, c’est le grand œuvre d’Ayn Rand, le livre qui assoit définitivement son aura et sa réputation. Celui, aussi, qui va marquer durablement l’histoire des idées en Amérique […] Ayn Rand a tout de même vendu plus de 30 millions d’exemplaires de ses ouvrages dans le monde, exerçant une influence colossale sur des générations de penseurs, politiques et chefs d’entreprise. « Jusqu’à Ayn Rand, le capitalisme n’avait paradoxalement jamais su se vendre, en tout cas pas de manière aussi sexy, écrit Stéphane Legrand, auteur de Ayn Rand, femme capital (Éditions Nova, 2017). Il lui manquait un conteur, mieux : un aède (poète épique au temps de la Grèce antique, ndlr), quelqu’un qui ait du souffle, une vision (…). Ayn Rand a inventé le capitalisme des mythes. »
Stéphane Legrand qui avait écrit, sur le site de « Slate », en 2017, un article : «Ayn Rand, la romancière qui fascine les Américains mais que la France ignore »
Il écrit :
« Cette auteure, qu’on a pu décrire d’une formule saisissante et synthétique comme «the ultimate gateway drug to life on the right» (l’ultime drogue de passage vers une vie de droite), n’a pas seulement suscité frissons romantiques et enthousiasmes acnéiques chez les étudiants marginaux avides de s’identifier à des surhommes solitaires, ou parmi les housewives des salons de lecture amatrices de chardonnay. Sa philosophie (car elle se voulait aussi philosophe, un peu comme Sartre se voulait écrivain) a exercé et continue à exercer une influence considérable sur tous les courants de la droite américaine la plus musclée – du courant libertarien à l’anarcho-capitalisme en passant par les ultra- conservateurs du Tea Party – mais aussi auprès de nombreuses personnalités de premier plan du mouvement républicain. Elle fut le mentor du jeune Alan Greenspan, on a pu la considérer comme «la philosophe officielle de l’administration Reagan », […]
L’œuvre d’Ayn Rand demeure pour la pensée conservatrice, surtout aux États-Unis, une inspiration aussi puissante que paradoxale. Elle la met à certains égards face à ses contradictions – notamment pour ce qui touche à l’attachement profond de cette droite aux valeurs qu’elle considère curieusement comme chrétiennes, que l’athéisme militant de Rand embarrasse. Mais elle a aussi contribué à donner forme, qu’on y voie une tension féconde ou un habile tour de passe-passe, à certains de ses dilemmes constitutifs. Comment obtenir l’approbation des foules au moyen d’une idéologie opposant l’individu solitaire et génial aux masses apeurées et abruties ? Comment concilier un désir névrotique de contrôle sur les désirs, la pensée et le corps des populations (leurs options sexuelles ou leur droit à avorter par exemple) avec une philosophie de la responsabilité personnelle, de l’autonomie individuelle et du moindre gouvernement ? Comment susciter l’enthousiasme quasi hypnotique des couches les plus précarisées pour un projet social dont la finalité est de les broyer ? Par quelle mystification métamorphoser le maintien du statu quo ou l’imposition de dynamiques rétrogrades en paradigme de l’innovation audacieuse et en monopole des « vrais projets d’avenir», cependant que toute tentation progressiste se verra requalifiée en nostalgie passéiste ou engraissage du Mammouth ? […] Ayn Rand, sa pensée et son influence persistante représentent un engrenage essentiel dans la genèse de cet hybride moderne qu’est la pensée néoréactionnaire, mélange improbable de conservatisme exacerbé et d’ultralibéralisme. »
Je finirai par un article un peu décalé sur le site de la « Revue Politique et Parlementaire » qui essaie de s’interroger sur ce que Ayn Rand aurait pensé de la gestion de la COVID 19 par les gouvernements :
« Ayn Rand et la Covid-19 : peut-on agir dans l’urgence de manière « non sacrificielle » ? »
Il est certain que cette femme, cette intellectuelle ne peut pas laisser indifférente.Il faut comprendre aussi que si elle a eu une telle influence aux États-Unis, c’est que sa philosophie correspond à l’esprit d’un grand nombre d’américains qui est assez loin de nos schémas français d’un État fort, centralisateur, social et redistributeur.
<1592>
-
Lundi 12 juillet 2021
« Atlas Shruggeds »Ayn RandMargaret Thatcher puis Ronald Reagan vont être les fers de lance de la révolution néo libérale ou conservatrice.
Mais quels sont les penseurs de cette révolution ?
J’ai toujours lu le rôle essentiel qu’a joué l‘école de Chicago et Milton Friedman.
Mais Amin Maalouf évoque une autre figure, une femme écrivaine : Ayn Rand :
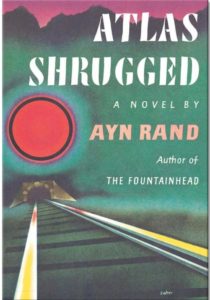 « Un des livres emblématiques de cette révolution est le roman intitulé « Atlas Shrugged » […]
« Un des livres emblématiques de cette révolution est le roman intitulé « Atlas Shrugged » […]
Il raconte une grève organisée non par des ouvriers, mais par des entrepreneurs et « des esprits créatifs » qu’exaspèrent les règlementations abusives. Son titre évoque la figure mythologique d’Atlas qui, las de porter la Terre entière sur son dos, finit par secouer vigoureusement les épaules – c’est ce mouvement d’exaspération et de révolte qu’exprime ici le verbe to shrug, dont le prétérit est shrugged.
Cette fiction à thèse, publiée en 1957 et dont beaucoup de conservateurs américains, partisans d’un « libertarisme » résolument anti-étatiste, avaient fait leur bible, a été rattrapée par la réalité. Le soulèvement des possédants contre les empiètements de l’État redistributeur des richesses ne s’est pas produit d la manière dont la romancière l’avait décrit, mais il a bien eu lieu. Et il a été couronné de succès. Ce qui a eu pour effet d’accentuer fortement les inégalités sociales, au point de créer une petite caste d’hypermilliardaires, chacun d’eux plus riche que des nations entières.
Le naufrage des civilisations page 173
J’avais déjà cité ce livre et Ayn Rand dans un mot du jour de 2018 consacré à « La convergence des luttes ».
 J’y rapportais que selon une étude de la bibliothèque du Congrès américain et du Book of the month club menée dans les années 1990, ce livre est aux États-Unis le livre le plus influant sur les sondés, après la Bible. C’était le livre de chevet de Ronald Reagan et de ses principaux conseillers.
J’y rapportais que selon une étude de la bibliothèque du Congrès américain et du Book of the month club menée dans les années 1990, ce livre est aux États-Unis le livre le plus influant sur les sondés, après la Bible. C’était le livre de chevet de Ronald Reagan et de ses principaux conseillers.
Aujourd’hui, beaucoup des responsables de la silicon valley continuent à considérer que c’est le livre le plus inspirant pour eux.
J’ai donc souhaité approfondir ma connaissance de cette femme influente.
J’ai ainsi écouté les cinq émissions que Xavier de la Porte lui avait consacré en 2017 : <Avoir raison avec Ayn Rand>.
Et ce sont 5 émissions très instructives et qui méritent qu’on s’y arrête.
Dans la quatrième <L’héritage littéraire> Xavier de la Porte avait invité un écrivain Antoine Bello qui la présente ainsi :
« En 2007, Le Wall Strett journal a publié un dossier pour [commémorer] les 50 ans de la publication d’« Atlas Shrugged ». et il parlait de ce livre avec énormément d’éloge. […] et surtout comme d’un livre les plus influents du XXème siècle, d’un texte majeur, parmi les plus appréciés des parlementaires et des chefs d’entreprise. Alors je me suis dit comment ai-je pu vivre aussi longtemps, moi qui prétends connaître et m’intéresser à la littérature américaine, sans jamais avoir entendu parler de ce livre ? Je suis donc allé l’acheter. […] et je l’ai dévoré. C’est un très gros livre, il fait près de 1200 pages. J’ai été happé avant tout par la puissance du roman. C’est-à-dire que les idées viennent presque dans un deuxième temps. On comprend assez vite qu’il y a un système philosophique derrière tout cela, que Ayn Rand ne laisse rien au hasard. Les personnages sont les porte-paroles d’une philosophie. […] C’est la puissance romanesque, la richesse et la singularité des personnages qui m’a d’abord conquis. Parler d’un univers, le monde de l’entreprise qui n’a jamais été aussi bien décrit que par une femme qui n’a jamais travaillé en entreprise. C’est quand même assez fascinant quand on y pense […] Une compréhension intime des mécanismes de l’entreprise. […] un sens des situations qui me fascine. »
Je vais tenter de synthétiser ces cinq épisodes.
 Elle a mis plus de 10 ans pour écrire « Atlas Shrugged ». Ce roman a été publié aux Etats-Unis en 1957, mais n’a été traduit en français que 50 ans plus tard sous le nom de « La grève » publié en 2011. Quasi aucun journal français n’en a parlé, il semble que l’Obs a consacré quelques lignes.
Elle a mis plus de 10 ans pour écrire « Atlas Shrugged ». Ce roman a été publié aux Etats-Unis en 1957, mais n’a été traduit en français que 50 ans plus tard sous le nom de « La grève » publié en 2011. Quasi aucun journal français n’en a parlé, il semble que l’Obs a consacré quelques lignes.
Ce fut donc, pendant longtemps, un livre absolument ignoré en France, alors qu’il a eu une si grande importance aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon.
Ayn Rand est souvent considéré comme une grande figure du « mouvement libertarien ». Mais elle se définissait comme une « Objectiviste », c’est-à-dire une tenant d’une pensée exclusivement rationnelle. La croyance et la religion n’ayant aucune place dans sa réflexion.
D’ailleurs si Ronald Reagan disait s’inspirer d’Ayn Rand, cette dernière n’a pas appelé à voter pour lui parce qu’elle le trouvait trop influencé par les églises chrétiennes. L’élection de Reagan s’est passée vers la fin de sa vie, elle est décédée en 1982.
Elle condamnait l’humour et surtout l’auto-dérision. Pourtant, elle a eu ce trait ironique :
« On me demande souvent ce que je pense de Reagan. Je n’en pense rien et plus je le regarde moins je pense. »
Elle était donc pour un État minimal, pour l’individu contre la société. Elle détestait l’état social et l’altruisme. Elle était aussi militante pro-avortement, parce qu’elle considérait que rien et certainement pas un embryon ne devrait contraindre la liberté d’une femme. Elle était pour la même raison profondément antiraciste : aucune appartenance culturelle ou autre ne devait contraindre la liberté d’un individu, il n’était donc pas question de distinguer un individu d’un autre que par le mérite, le travail et les actions.
Elle s’est aussi publiquement opposée à la guerre du Viêt Nam, mais parce qu’elle estimait que cette guerre était altruiste !
« Si vous voulez voir le summum ultime, suicidaire, de l’altruisme à l’échelle internationale, observez la guerre du Viêt Nam, une guerre où chaque soldat américain meurt sans raison d’aucune sorte. »
Elle est surtout connue par ses romans, le premier publié en 1936 « We the Living » qui a été traduit et publié en France en 1996, sous le titre « Nous, les vivants ».
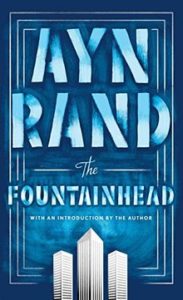 Son avant dernier roman avait été publié en 1943 : « The Fountainhead », publié en français sous le titre « La Source vive » en 1947.
Son avant dernier roman avait été publié en 1943 : « The Fountainhead », publié en français sous le titre « La Source vive » en 1947.
Si « Atlas Shrugged », son dernier roman, était le livre de chevet de Reagan, Donald Trump a prétendu que le sien était « The Fountainhead ». Probablement parce que le magnat de l’immobilier s’imaginait dans le rôle du personnage principal du livre qui est architecte. Ce roman a été adapté au cinéma par King Vidor en 1949.
Le titre du livre fait référence à une déclaration de Ayn Rand selon laquelle :
« L’ego de l’Homme est la source vive du progrès humain » (« Man’s ego is the fountainhead of human progress »).
Le récit décrit la vie d’un architecte individualiste dans le New York des années 1920, qui refuse les compromissions et dont la liberté fascine ou inquiète les personnages qui le croisent.
Howard Roark est un architecte extrêmement doué qui a une passion intransigeante pour son art. Individualiste, il utilise la force que lui confère sa créativité afin de pouvoir maîtriser son destin en permanence et ne pas dépendre du bon vouloir de ses contemporains. Il est ainsi indifférent aux principales pressions morales qui guident ses confrères. Physiquement, Ayn Rand décrit Howard Roark comme un homme mince, grand et athlétique, à la chevelure de la couleur d’un zeste d’orange mûre [ce qui a dû inspirer Trump].
La recherche de l’éthique est aussi une ligne de force de la pensée de Ayn Rand.
Elle a écrit des essais pour traduire sa pensée politique et philosophique. Ils sont moins renommés.
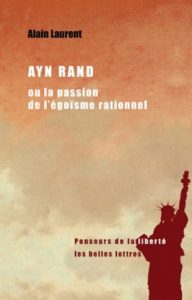 En 1964, elle a publié « la vertu de l’égoisme » qui a été traduit par Alain Laurent qui lui a consacré une biographie. : < Ayn Rand ou la passion de l’égoïsme rationnel>
En 1964, elle a publié « la vertu de l’égoisme » qui a été traduit par Alain Laurent qui lui a consacré une biographie. : < Ayn Rand ou la passion de l’égoïsme rationnel>
Alain Laurent a été l’invité de Xavier de la Porte lors des deux premières émissions :
Ayn Rand partage avec Karl Marx, le fait d’être née dans une famille juive et d’être devenue athée. Mais étant née à Saint-Pétersbourg, le 2 février 1905, elle va vivre sa jeunesse dans un régime qui prône les principes du marxisme et du collectivisme. Cette expérience sera déterminante dans le cheminement de sa pensée qui va s’opposer intégralement à ce qu’elle aura vécu en Union soviétique.
Son nom de naissance est Alissa Zinovievna Rosenbaum. A 12 ans, elle écrit dans son journal intime qu’elle a décidé de devenir athée.
Elle s’intéresse très jeune à la littérature et au cinéma, écrivant dès l’âge de sept ans des romans ou des scénarios. À l’âge de neuf ans, elle décide de devenir écrivain.
Même si elle déteste le communisme c’est grâce à ce régime qu’elle peut, en tant que femme, entrer à l’Université. Elle arrive à convaincre les autorités soviétiques de la laisser aller aux États-Unis pour y étudier les moyens de propagande utilisés par les américains dans le cinéma d’Hollywood, afin de pouvoir utiliser les mêmes outils pour promouvoir la révolution bolchévique.
 Elle immigre donc aux États-Unis et bien entendu s’y installe pour le reste de sa vie.
Elle immigre donc aux États-Unis et bien entendu s’y installe pour le reste de sa vie.
Elle est naturalisée américaine le 13 mars 1931. C’est alors qu’elle change son nom en « Ayn Rand ». Wikipedia prétend que c’est en référence à la transcription en cyrillique du nom de sa famille. Dans les émissions de Xavier la Porte, il a été avancé que l’on n’en savait rien.
Un concours de circonstance et son audace vont lui permettre de démarrer une carrière dans le cinéma : Elle interpelle, à New York, le célèbre producteur Cécil B. DeMille, qui après discussion avec elle, l’embauche.
Elle écrit des scénarios, des pièces de théâtre puis ses romans qui la rendront extrêmement célèbre aux États-Unis même si la première réaction, notamment des critiques littéraires, fut négative.
Les 5 émissions sont passionnantes :
- <De Saint-Petersbourg à New York>
- <La Gloire, enfin>
- <Ayn Rand et les libertariens>
- <L’héritage littéraire>
- <Avoir 20 ans et lire Ayn Rand>
Vous y apprendrez beaucoup sur l’influence qu’elle a exercé, mais aussi sur la complexité et les contradictions de cette femme étonnante.
Ainsi malgré sa rationalité elle fumait beaucoup et elle est morte d’un cancer au poumon.
Malgré son refus de l’état social et de l’altruisme elle a manœuvré à la fin de sa vie afin de pouvoir profiter de « médicare » pour faire soigner son cancer.
<1591>
- <De Saint-Petersbourg à New York>
-
Vendredi 9 juillet 2021
« Désormais, c’est le conservatisme qui se proclamerait révolutionnaire, tandis que les tenants du « progressisme » et de la gauche n’auraient plus d’autre but que la conservation des acquis »Amin MaaloufNapoléon avait dépeint les britanniques comme un peuple de « boutiquier ».
Je suppose qu’il voulait dire des gens qui s’occupent de leurs affaires et qui entendent s’enrichir individuellement.
La marchandisation du monde doit beaucoup aux anglo-saxons.
Mais, après la seconde guerre mondiale, ils avaient fait de grands progrès contre l’individualisme et l’esprit boutiquier.
C’est, en effet, après les deux terribles guerres civiles européennes qu’est apparu un système social très sophistiqué qu’on a appelé le système « beveridgien » du nom de William Beveridge, économiste à qui en 1942, le gouvernement britannique a demandé de rédiger un rapport sur le système d’assurance maladie qui va fonder le système social britannique qui restera longtemps un modèle.
Mais avec Thatcher le boutiquier reprend du service.
 Il faut dire que Margaret Thatcher possédait de bonnes bases familiales : son père était épicier et sa mère une couturière. C’est avec ces bases qu’elle allait prendre la tête d’un Royaume-Uni en crise.
Il faut dire que Margaret Thatcher possédait de bonnes bases familiales : son père était épicier et sa mère une couturière. C’est avec ces bases qu’elle allait prendre la tête d’un Royaume-Uni en crise.
Le poids économique de la Grande Bretagne n’arrêtait pas de régresser au niveau mondial.
Amin Maalouf évoque le Royaume Uni en 1979 avant l’arrivée de Thatcher au pouvoir :
« A la veille des élections générales de mai 1979 qui devait porter au pouvoir celle qu’on surnommera « la Dame de fer », le pays se trouvait dans un été déplorable. Des grèves, des émeutes, des coupures de courant, une atmosphère sociale délétère et le sentiment chez les travaillistes comme chez beaucoup de conservateurs modérés que s’étaient là les effets normaux de la crise pétrolière et qu’on n’avait pas d’autres choix que de « faire avec » en attendant des jours meilleurs. L’image emblématique de cette époque est celle de Piccadilly Circus plongé dans l’obscurité en raison d’un arrêt de travail dans les mines de charbon. Un historien britannique, Andy Beckett a raconté ces années sombres dans un ouvrage intitulé : « Quand les lumières se sont éteintes » »
Le naufrage des civilisations page 183
Margaret Thatcher est certes critiquable, mais elle avait du caractère et de la volonté.
Et les britanniques l’ont réélu deux fois à la tête du pays. Aussi longtemps que les travaillistes ont combattu la politique de Thatcher de manière radicale, ils ont été battus. Les travaillistes sont arrivés au pouvoir avec Tony Blair qui sur bien des points a suivi l’héritage de Thatcher. Preuve que les boutiquiers britanniques adhéraient à cette politique. Et ces boutiquiers étaient majoritaires.
Amin Maalouf décrit ainsi cette personnalité
« Lorsqu’elle fit irruption sur la scène nationale, Mme Thatcher était porteuse d’un autre état d’esprit [que celui du défaitisme], et d’un autre discours. Le déclin n’est pas inévitable, disait-elle à ses concitoyens, nous pouvons et nous devons remonter la pente ; Il nous faut fixer un capo et le poursuivre sans dévier ni vaciller, quitte à écraser sans ménagement ceux qui se mettraient au travers de la route – à commencer par les syndicats. L’année de son arrivée au pouvoir, près de trente millions de journées de travail avaient été perdues à cause des conflits sociaux.
Le pays n’avait plus d’autres choix que de sombrer ou de rebondir. Comme il l’avait fait à d’autres moments de son histoire, il choisit d’écouter la voix obstinée qui promettait de le conduire, la tête haute, hors de l’impasse, fut-ce au prix de sacrifices douloureux.»
Le naufrage des civilisations page 184
Ces sacrifices douloureux que Ken Loach montre si bien dans ses films. Mais malgré le talent de Loach, les protestations d’hommes et de femmes attachés aux progrès sociaux, rien n’y fit : le recul de l’Etat, l’exacerbation de la réussite individuelle, la diminution des budgets sociaux et de la redistribution continuaient inexorablement.
Dans le langage courant on parle de Néo libéralisme, Amin Maalouf préfère parler de « révolution conservatrice ».
Cette révolution conservatrice réalisée au Royaume Uni par Thatcher sur le plan économique et social, il la relie à celle réalisée en Iran par Khomeiny sur le plan religieux, des mœurs et de la société qui a eu lieu la même année.
C’est une révolution, parce qu’avant le récit de gauche et du progrès social était totalement dominant. Et il n’y avait pas que le récit, objectivement les revenus des classes moyennes et des ouvriers augmentaient, les inégalités de revenus régressaient.
Amin Maalouf écrit :
« Jusqu’aux années quatre-vingt, peu de dirigeants se disaient ouvertement de droite ; ceux qui n’étaient pas de gauche préféraient se dire centristes et quand il leur arrivait de critiquer les communistes, ils se sentaient obligés de souligner, en préambule, qu’ils n’étaient pas du tout anticommunistes, une épithète jugée infamant, en ce temps-là, et que personne n’avait envie d’assumer. Aujourd’hui, c’est exactement l’inverse : ceux qui sont de droite le proclament fièrement ; et ceux qui souhaitent exprimer une opinion positive sur tel ou tel aspect du communisme se sentent obligés de souligner, en préambule, qu’ils ne sont, en aucune manière favorables à cette doctrine […]
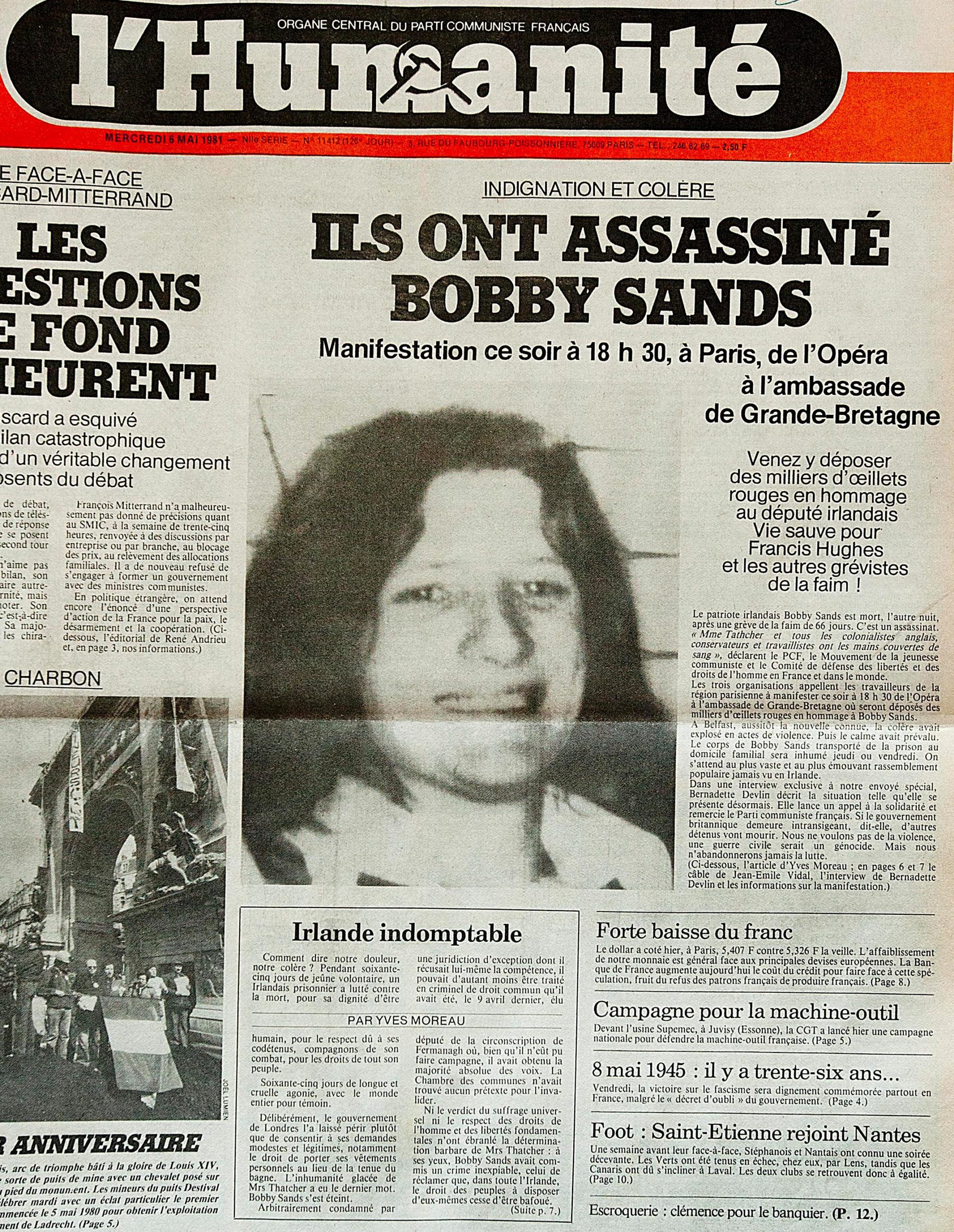 Pour en revenir à l’Angleterre, on pourrait dire qu’avant la révolution thatchérienne, aucun dirigeant politique de droite ou de gauche n’avait envie d’y apparaître comme un briseur de grève, comme un ennemi des syndicats, comme un être insensible au sort des mineurs et des autres travailleurs aux revenus modestes ; ni de se rendre responsable de la mort d’un détenu faisant la grève de la faim […]
Pour en revenir à l’Angleterre, on pourrait dire qu’avant la révolution thatchérienne, aucun dirigeant politique de droite ou de gauche n’avait envie d’y apparaître comme un briseur de grève, comme un ennemi des syndicats, comme un être insensible au sort des mineurs et des autres travailleurs aux revenus modestes ; ni de se rendre responsable de la mort d’un détenu faisant la grève de la faim […]
L’apport de la Dame de fer, moralement controversé mais historiquement incontestable, c’est qu’elle a commis sans sourciller tous les « péchés » que la sagesse ordinaire recommandait aux politiciens ne pas commettre »
Le naufrage des civilisations page 185
Bien sûr, pour que Thatcher et la révolution conservatrice puisse se déployer, il a fallu quelques éléments favorables comme l’aura que lui donnera la victoire dans la guerre des malouines et surtout la victoire de Reagan qui professait les mêmes idées aux États-Unis. Et :
« Les préceptes de la révolution conservatrice anglo-américaine seront adoptés par de nombreux dirigeants de droite comme de gauche, parfois avec enthousiasme, parfois avec résignation. Diminuer l’intervention du gouvernement dans la vie économique, limiter les dépenses sociales, accorder plus de latitude aux entrepreneurs et réduire l’influence des syndicats seront désormais comme les normes d’une bonne gestion des affaires publiques. »
Le naufrage des civilisations page 184
Et Amin Maalouf fait ce constat qui montre la rupture qui s’est produite en 1979 :
« Comment avais-je pu ne pas voir une si forte conjonction entre les évènements ? J’aurais dû en tirer depuis longtemps cette conclusion qui, aujourd’hui, me saute aux yeux : à savoir que nous venions d’entrer dans une ère éminemment paradoxale où notre vision du monde allait être transformée, et même carrément renversée. Désormais, c’est le conservatisme qui se proclamerait révolutionnaire, tandis que les tenants du « progressisme » et de la gauche n’auraient plus d’autre but que la conservation des acquis »
Le naufrage des civilisations page 170
<1590>
-
Jeudi 8 juillet 2021
« Pause (Edgar Morin a 100 ans) »Un jour sans mot du jour nouveauEdgar Morin est né le 8 juillet 1921.
 Il a publié une tribune dans le monde à cette occasion dans laquelle il retrace l’aventure humaine pendant les cents ans de sa période de vie : < Cette pensée humaine capable de créer les plus formidables machines est incapable de créer la moindre libellule >
Il a publié une tribune dans le monde à cette occasion dans laquelle il retrace l’aventure humaine pendant les cents ans de sa période de vie : < Cette pensée humaine capable de créer les plus formidables machines est incapable de créer la moindre libellule >
Il y écrit notamment :
« Nous vivons donc en 2021 une étape nouvelle de la phase extraordinaire de l’aventure humaine où culmine le paradoxe de la toute-puissance et de la toute-faiblesse humaine.
L’infirmité ne vient pas seulement de la fragilité humaine (le malheur, la mort, l’inattendu) mais aussi des effets destructeurs de la toute-puissance scientifique-technique-économique, elle-même animée par la démesure accrue de la volonté de puissance et de la volonté de profit.
Cette pensée humaine capable de créer les plus formidables machines est incapable de créer la moindre libellule. Cette intelligence capable de lancer dans le cosmos fusées et stations spatiales, capable de créer une intelligence artificielle capable de toutes les computations, est incapable de concevoir la complexité de la condition humaine, du devenir humain. Cette intelligence capable de découper le réel en petits morceaux et de les traiter logiquement et rationnellement est incapable de rassembler et d’intégrer les éléments du puzzle et de traiter une réalité qui exige une rationalité complexe concevant les ambivalences, la complémentarité des antagonismes et les limites de la logique du tiers exclu.
Quand saurons-nous que tout ce qui est séparable est inséparable ?
Quand saurons-nous que tout ce qui est autonome est dépendant de son environnement, depuis l’autonomie du vivant qui doit renouveler son énergie en s’alimentant pour vivre et en information pour agir jusqu’à mon autonomie présente sur mon ordinateur, qui dépend d’électricité et de Wi-Fi ?
Aussi devons-nous comprendre que tout ce qui émancipe techniquement et matériellement peut en même temps asservir, depuis le premier outil devenu en même temps arme, jusqu’à l’intelligence artificielle en passant par la machine industrielle. N’oublions pas que la crise formidable que nous vivons est aussi une crise de la connaissance (où l’information remplace la compréhension et où les connaissances isolées mutilent la connaissance), une crise de la rationalité close ou réduite au calcul, une crise de la pensée. »
<Le Figaro> nous apprend que Emmanuel Macron le reçoit aujourd’hui à l’Elysée.
Le chef de l’État selon un communiqué de l’Elysée :
«prononcera un discours pour célébrer ce centième anniversaire et saluer le parcours de celui qui entra dans la Résistance alors qu’il n’avait pas encore 20 ans, ses engagements, en faveur de la « Terre-Patrie » depuis près de 50 ans et ses contributions à la compréhension des hommes et du monde en tant qu’humaniste et européen convaincu»
Et le Figaro de rappeler que :
« En février 2018, Edgar Morin signait dans Le Monde une tribune élogieuse à l’égard d’Emmanuel Macron, dont il saluait la capacité à «être un intellectuel littérairement et philosophiquement cultivé et un homme qui fait carrière aux antipodes de la philosophie, dans la banque et la finance».
Et en même temps
« Mais dans son dernier livre paru en juin, on lit aussi sa sympathie pour les opposants les plus farouches au chef de l’État. Selon lui, « bien des protestations, colères et révoltes populaires, comme le mouvement des « Gilets jaunes », comportent chez leurs participants, pas uniquement certes, mais incontestablement, le besoin d’être reconnus dans leur pleine qualité humaine – ce qu’on appelle dignité».
<mot du jour sans numéro>
-
Mercredi 7 juillet 2021
« L’année 1979 »Année du grand retournementPour Amin Maalouf, l’année 1979 est l’année du grand retournement.
L’année qui va avoir une importance primordiale dans l’évolution du monde.
L’année 1979 commence par la révolution islamique d’Iran
En deux mois, Khomeiny prend l’intégralité du pouvoir :
16/01/1979 Le Chah d´Iran Mohammad Reza Palhavi quitte son royaume pour laisser la place quinze jours plus tard à son ennemi Khomeini.
01/02/1979 Après 14 ans d’exil forcé en Irak et en France, et 14 jours après le départ tout aussi forcé du chah d’Iran, l’ayatollah Rouhollah Khomeini revient triomphalement à Téhéran.
11/02/1979 L’ayatollah Khomeiny annonçe la chute du Shah d’Iran et la création de la République islamique, après 53 ans de monarchie dirigée par les Pahlavi.
12/02/1979 En Iran, la capitale Téhéran est aux mains des insurgés après de violents combats.
26/02/1979 Le premier ministre d’Iran Chapour Bakthiar fuit son pays pour Paris.
Et début mars, il impose cette régression aux femmes iraniennes :
01/03/1979 Khomeyni exalte les valeurs de l’Islam et impose aux femmes le port du voile (Tchador).
L’année 1979 se termine par l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS :
27/12/1979 Les troupes soviétiques envahissent l’Afghanistan.
Et au milieu de l’année, il se passe un évènement considérable dans le monde politique et économique occidental :
04/05/1979 Margaret Thatcher devient Premier Ministre en Grande-Bretagne.
Amin Maalouf annexe deux évènements considérables du dernier trimestre 1978 aux prémices de l’année 1979 :
16/10/1978 Le polonais Karol Jozef Wojtyla est élu pape sous le nom de Jean-Paul II.
18/12/1978 Le 11ème Comité central du Parti Communiste Chinois adopte les réformes économiques proposée par Deng Xiaoping qui devient le N°1 chinois
Trois autres évènements sont fondamentaux dans la lecture du « Naufrage des civilisations »
Découlant directement de la révolution islamique :
04/11/1979 Des centaines d’étudiants iraniens envahissent l’ambassade américaine à Téhéran.
En face de cette révolution chiite, les exaltés sunnites commencent le job :
20/11/1979 quelques centaines de musulmans fondamentalistes s’emparent de la Grande mosquée de La Mecque, lieu sacré de la ville sainte de l’islam.
Enfin, Amin Maalouf insiste sur un dernier évènement : la première décision non économique d’importance de Deng Xiaoping : il décide que la Chine entre en guerre contre le Viet-Nam :
17/02/1979 Début de la guerre sino-vietnamienne qui s’achèvera le 16 mars 1979.
Cette guerre est la conséquence directe d’un autre événement du tout début 1979 :
07/01/1979 Chute du régime des Khmers rouges de Pol Pot au Cambodge
Cette chute est due à l’intervention militaire du Vietnam qui a envahi le Cambodge. Or, la Chine est l’alliée des khmers rouges.
Voilà donc l’ensemble des évènements de 1979 que nous allons examiner, sous l’éclairage d’Amin Maalouf, dans les jours qui viennent.
Amin Maalouf synthétise l’ensemble de ces évènements par cette analyse :« Ce qui m’est apparu clairement en revisitant l’actualité d’hier, c’est qu’il y a eu, aux alentours de l’année 1979, des évènements déterminants, dont je n’ai pas saisi l’importance sur le moment. Ils ont provoqué, partout dans le monde, comme un « retournement » durable des idées et des attitudes. Leur proximité dans le temps n’était surement pas le résultat d’une action concertée ; mais elle n’était pas non plus le fruit du hasard. Je parlerais plutôt d’une « conjonction ». C’est comme si une nouvelle « saison » était arrivée à maturité, et quelle faisait éclore ses fleurs en mille endroits à la fois. Ou comme si « l’esprit du temps » [la philosophie allemande le nomme Zeitgeist] était en train de nous signifier la fin d’un cycle et le commencement d’un autre. »
Le Naufrage des civilisations page 169
Mais, j’ai essayé d’élargir et de trouver d’autres évènements de 1979 que n’évoque pas l’auteur du « Naufrage des civilisations » ou alors très rapidement.
Il y a d’abord un évènement qui a joué un grand rôle en France :
21/09/1979 Destitution de l´empereur Bokassa, au pouvoir en république centrafricaine depuis le 31 décembre 1965.
Il faut se rappeler que cet allié de la France avait décidé de se faire couronner empereur, comme Napoléon précisait-il en 1977. Les alliances étant ce qu’elles sont, il a su convaincre la télévision française (qui n’était pas indépendante du pouvoir) de filmer toute la cérémonie et de la diffuser en France.
Ses frasques devenant gênantes, Valéry Giscard d’Estaing donna l’ordre de le faire destituer.
Très rapidement, l’empereur déchu se vengea. Giscard adorait chasser les grands fauves en Centre-afrique. Il avait ainsi souvent côtoyé Bokassa en dehors des seules relations diplomatiques. Dans le cadre de ces relations amicales des dons étaient échangés.
Et informé par Bokassa et son entourage :
10/10/1979 Le canard enchaîné dévoile l’affaire des diamants de Bokassa, diamants offerts par Jean-Bedel Bokassa au président français Valéry Giscard d’Estaing.
Cette affaire, dont on sait aujourd’hui que les révélations du Canard étaient entachées d’une erreur manifeste d’évaluation, les diamants ne valaient pas grand-chose, jouera un rôle essentiel dans la défaite de Giscard d’Estaing et donc l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir.
Surtout qu’une deuxième ténébreuse affaire allait affecter la réputation du gouvernement et donc du président de la République :
30/10/1979 Le corps du ministre français du travail Robert Boulin est retrouvé mort dans un étang de la forêt de Rambouillet. La cause de sa mort, officiellement un suicide, fait encore débat, la thèse d’un assassinat n’est plus écartée.
Notons que c’est 20 jours après l’article du Canard enchaîné. Chirac disait :
« Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille ».
Cela étant, Chirac était très satisfait des ennuis de Giscard.
Bokassa ne fut pas le seul dirigeant à être écarté brutalement du pouvoir :
04/04/1979 L’ancien président de la république du Pakistan Zulfikar Ali Bhutto est exécuté par pendaison.
11/04/1979 Le dictateur Amin Dada, autoproclamé président à vie de l’Ouganda, est finalement contraint de fuir son pays après huit ans de pouvoir absolu.
26/10/1979 Après dix-sept ans de présidence de la Corée du Sud, Park Chung-hee, président à vie depuis 1972, est assassiné par les services secrets sud-coréens.
Si la situation de la Corée du Sud s’est largement stabilisée depuis 1979, celle du Pakistan a fait le chemin inverse.
La fille d’Ali Buttho, deviendra premier ministre de 1993 à 1996, mais mourra assassinée pendant une campagne électorale en 2007. Et le Pakistan protégera Ben Laden, soutiendra les talibans et s’opposera violemment à la laïcité française.
L’Union européenne qui n’était encore que la communauté européenne connaîtra trois avancées majeures :
13/03/1979 Entrée en vigueur du Système Monétaire Européen (SME), dont l’objectif est de stabiliser les différentes monnaies européennes. Sans le SME il n’y aurait jamais eu de monnaie unique.
10/06/1979 Première élection des députés européens au suffrage universel direct.
17/07/1979 Le premier président élu du Parlement européen est une femme : Simone Veil.
Deux évènements de l’industrie spatiale peuvent être signalés. Une première européenne et une première d’homo sapiens
24/12/1979 La fusée européenne Ariane 1 effectue son premier vol depuis la station de Kourou, en Guyane.
01/09/1979 Lancée le 06 avril 1973, la sonde spatiale américaine Pioneer 11 atteint Saturne, puis se dirige ensuite vers les confins du système solaire.
La NASA mettra fin à cette mission en 1995. Depuis Voyager 1 et 2 sont allés encore plus loin.
Il y a aussi eu des avancées dans le monde des techniques et du numérique :
01/07/1979 Sony commercialise au Japon le premier Walkman, le TPS-L2.
17/10/1979 Le premier tableur pour ordinateur mis en vente n’est pas Excel, mais Visicalc. A sa sortie, il fonctionnait uniquement sur Apple II. Le 17 octobre est la journée internationale des tableurs.
Que serait nos organisations aujourd’hui sans Excel ? Il en est même qui pense pouvoir tout comprendre avec un tableur…
Deux évènements de catastrophe écologique eurent lieu
11/08/1979 La rupture du barrage du Macchu, en Inde, provoque 5000 morts sur la ville de Morvi.
28/03/1979 La fuite radioactive d’un réacteur à Three Mile Island, aux Etats-Unis, ravive les débats sur le nucléaire.
L'<Accident nucléaire de Three Mile Island> reste pour beaucoup l’accident nucléaire le plus grave que l’humanité a connu. Un des réacteurs avait commencé à fondre. Ce qui se serait passé si l’accident avait dégénéré reste source de controverse.
Et je finirai ce vaste tour d’horizon de 1979 par l’hommage aux grands disparus de cette année :
12/02/1979 Mort du cinéaste Jean Renoir (né le 15 septembre 1894), inoubliable metteur en scène de « La Grande Illusion » et de la « Règle du jeu ».
16/03/1979 Décès du père de l’Union Européenne, Jean Monnet, premier président de la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
11/06/1979 Décès de l’acteur, réalisateur et producteur américain John Wayne
23/07/1979 Mort de l’aviateur, résistant, journaliste, scénariste et romancier Joseph Kessel (né le 10 février 1898).
29/07/1979 Mort du philosophe américain Herbert Marcuse (né à Berlin le 19 juillet 1898), critique à la fois du capitalisme et du communisme. Auteur de « L’Homme unidimensionnel ».
27/08/1979 Le dernier Vice-Roi des Indes, grand humaniste, Lord Mountbatten est assassiné par l’IRA dans l’explosion de son bateau personnel.
22/10/1979 Décès de la compositrice et chef d’orchestre Nadia Boulanger (née le 16 septembre 1887). Elle fut un personnage considérable de la vie musicale en Occident. Elle compta parmi ses quelque 1 200 élèves plusieurs générations de compositeurs, tels Aaron Copland, George Gershwin, Leonard Bernstein, Michel Legrand, Quincy Jones et Philip Glass. Son activité musicale est étroitement liée à celle du Conservatoire américain de Fontainebleau, qu’elle dirige de 1949 jusqu’à la fin de sa vie.
<1589>
-
Mardi 6 juillet 2021
« L’année du grand retournement »Amin Maalouf, « Le naufrage des civilisations » page 167La première fois que j’ai cité Amin Maalouf, c’était tout au début de l’aventure des mots du jour : le 52ème, en janvier 2013 :
« L’homme a survécu jusqu’ici parce qu’il était trop ignorant pour pouvoir réaliser ses désirs. »
Cette phrase n’était pas d’Amin Maalouf, mais de William Carlos Williams (1883-1963), mais elle était citée en préface du livre d’Amin Maalouf : « Le dérèglement du monde ».
J’avais découvert cet écrivain franco-libanais, né en 1949 à Beyrouth et élu à l’Académie française en 2011 par son essai « Les Croisades vues par les Arabes » qu’il a publié en 1983 et que j’ai lu peu de temps après.
Il fut aussi au centre du dernier mot du jour de la série que j’avais consacré aux grands entretiens de la revue « XXI » :
« La première attitude indispensable est d’être capable de se mettre à la place de l’autre. Si je peux me mettre à la place de l’autre, alors nous pouvons réfléchir ensemble.».
C’est en 2019 qu’il a écrit son dernier essai, pour l’instant : « Le naufrage des civilisations ». Depuis, il a écrit un roman « Nos frères inattendus », mais pas de nouvel essai.
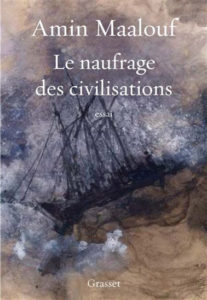 J’avais découvert cet ouvrage à travers plusieurs émissions de France Culture en 2019 :
J’avais découvert cet ouvrage à travers plusieurs émissions de France Culture en 2019 :
D’abord, en mars 2019, dans l’émission, « l’invité des matins » de Guillaume Erner : <un monde désorienté>
Puis en mai de la même année, dans la remarquable l’émission de Tewfik Hakem, consacrée à l’Islam : « Le Réveil culturel » :
Il a aussi été l’invité de <la Grande Librairie du 28 mars 2019>
Il m’a fallu du temps pour acheter ce livre, puis encore un peu de temps pour le lire.
C’est un livre que j’ai trouvé absolument passionnant.
Le livre commence par cette phrase :
« Je suis né en bonne santé dans une civilisation mourante et tout au long de mon existence, j’ai eu le sentiment de survivre sans mérite ni culpabilité… »
Amin Maalouf évoque son Levant natal. Sa famille qui vivait en Égypte et au Liban dans un monde de diversité dans lequel les musulmans, les chrétiens et les juifs vivaient ensemble, faisaient des affaires et dialoguaient.
J’ai entendu Tobie Nathan décrire de la même manière une civilisation de tolérance en Égypte dans laquelle ses parents vivaient et l’apparition de la violence, de l’intolérance et du rejet.
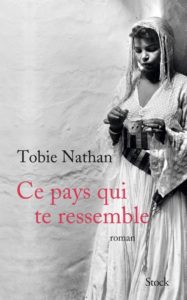 Il a décrit cette évolution dans son roman « Ce pays qui te ressemble »
Il a décrit cette évolution dans son roman « Ce pays qui te ressemble »
Amin Maalouf pense que :
« C’est à partir de ma terre natale que les ténèbres ont commencé à se répandre sur le monde »
Ce serait l’extinction du Levant tolérant et les secousses sismiques du monde arabo-musulman, qui se seraient propagées à la planète entière.
Son hypothèse repose sur des évènements et des dates qui ont jalonné l’implosion ou plutôt la fermeture d’un monde ouvert. Mais je traiterai cette hypothèse et ces points saillants dans une seconde série.
Car son livre émet une autre hypothèse : celle d’un grand retournement qui aurait métamorphosé les sociétés humaines et dont nous serions aujourd’hui les héritiers désenchantés.
C’est la troisième partie de son livre : « L’année du grand retournement ».
Pour Amin Maalouf, l’année 1979 a constitué cette rupture.
On lit souvent que 1989 a été déterminante en raison de la chute brutale du mur de Berlin qui a accéléré la décomposition de l’empire de l’Union Soviétique et a mis fin à la guerre froide. La conséquence de ces évènements étant le triomphe du libéralisme financier et l’émergence de la Chine.
Il existe une mythologie des années en 9 qui prétend que ces années sont déterminantes : 1929, 1919, 1939 etc.. <Slate> narre les éléments de ce récit.
Mais pour Amin Maalouf, l’année importante est l’année 1979. Nous allons donc essayer d’examiner cette hypothèse et revenir sur les évènements marquants qui ont eu lieu en 1979.
J’annonce ainsi une nouvelle série de mots du jour : « 1979 : L’année du grand retournement »
<1588>
-
Lundi 5 juillet 2021
« La musique officielle du festival de Cannes. »Camille Saint-SaënsLe festival international de film de Cannes va débuter demain, le 6 juillet 2021.
 Initialement prévu du 12 au 23 mai 2020, le festival 2020 a été annulé en raison de la pandémie de la Covid-19
Initialement prévu du 12 au 23 mai 2020, le festival 2020 a été annulé en raison de la pandémie de la Covid-19
Et comme les années précédentes, avant la diffusion de chaque film dans la salle du palais des Festivals une musique sera jouée: <Cette musique>
Musique pétillante, scintillante, qui incite à la rêverie.
C’est une musique de Camille Saint Saëns. C’est un des morceaux d’une de ses œuvres les plus connues : « Le Carnaval des animaux ».
Et ce morceau s’appelle <aquarium>
<France Musique> explique le lien de cette musique avec le cinéma.
Nous apprenons ainsi que Terrence Malick, a utilisé cette musique dans son film « Les Moissons du Ciel ».
Et, c’est après avoir vu ce film que Gilles Jacob, l’ancien délégué général et président du Festival de Cannes a choisi cette musique comme identité sonore du Festival de Cannes depuis 1990.
Alan Menken, compositeur de la musique du film « La Belle et la Bête » des studios Disney sortie en 1991 s’est inspiré de l’aquarium de Saint-Saëns.D’autres ont utilisé ou se sont inspirés de cette petite pièce magique, par exemple le célèbre Ennio Morricone.
Max Dozolme l’animateur de France Musique décrit
« Une musique composée en 1886 et qui évoque le ballet des poissons avec ces notes de piano comme des bulles et surtout un procédé totalement magique de Camille Saint-Saëns : chaque note du thème joué par les violons et la flûte dans les aiguës est répétée par un glass-harmonica au son cristallin, comme pour évoquer le scintillement de l’eau et des écailles de ces animaux muets…»
Camille Saint-Saëns est mort, il y a 100 ans en 1921.
Plus précisément le 16 décembre 1921. Je rendrai plus longuement hommage à ce musicien un peu oublié et qui a écrit des œuvres splendides.
Vous pourrez voir « aquarium » joué par les sœurs Labèque et l’orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Simon Rattle derrière ce lien <Aquarium joué par la Philharmonie de Berlin>
France Musique propose un arrangement pour deux pianos : <L’aquarium de Saint Saens arrangé pour deux pianos>
<1587>
-
Vendredi 2 juillet 2021
« Le paradoxe du serpent. »Description d’un comportement de l’État françaisReagan avait dit « L’État n’est pas la solution, il est le problème ».
Depuis la plupart se sont rendus compte que même si l’État n’était pas la solution, il restait indispensable non seulement dans son rôle régalien (armée, police, justice) mais aussi dans bien d’autres domaines.
Alors, les tenants du libéralisme ont considéré que si on avait besoin d’un État, on avait besoin d’un État qui fonctionne comme une entreprise privée.
Je ne dis en aucune façon que tout va bien dans l’État et l’administration française et qu’il ne faut pas évoluer et changer des choses.
Mais je prétends que l’État n’est pas comparable avec une entreprise privée.
Pour l’expliquer, c’est probablement la santé qui permet le mieux de le comprendre.
Une santé publique a pour objectif de soigner au mieux l’ensemble de la population au moindre coût global.
Une santé privée a pour objectif de soigner au mieux une population, en dégageant le plus de profits possible.
Les États-Unis qui sont résolument dans le second terme de l’alternative démontrent, en effet, que si les entreprises de santé font d’énormes profits, le cout global est beaucoup plus cher qu’en France, adepte du premier système. En outre, si ces entreprises soignent une population aisée et disposant de bonnes assurances, elles sont assez loin de soigner toute la population.
Sur ce point il faut également nuancer tout ne va bien dans le premier système et tout ne va pas mal dans le second. Mais on constate bien que la logique des deux systèmes est très différente.
Mais une évolution existe en France et consiste à essayer de faire entrer la logique du système privé dans le système public.
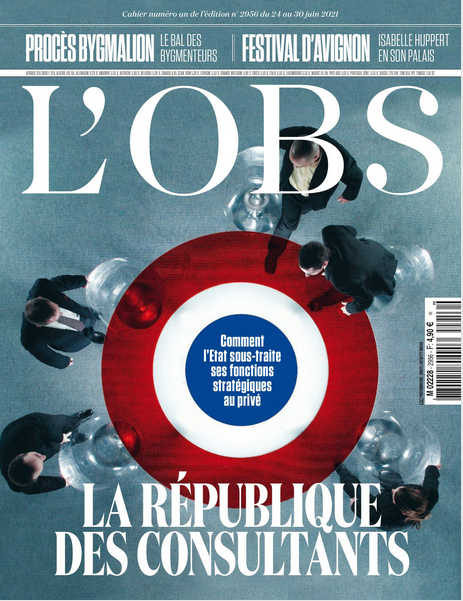 Le moyen d’action de cette évolution est l’appel massif aux consultants des grands cabinets privés.
Le moyen d’action de cette évolution est l’appel massif aux consultants des grands cabinets privés.
Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre deux journalistes ont mené une enquête et publié le 27 juin 2021 sur « l’Obs » : <Des milliards dépensés pour se substituer à l’État : enquête sur la République des consultants>
Ils m’ont d’abord appris ce qu’on appelle « le paradoxe du serpent »
Dans l’administration, cela s’appelle « le paradoxe du serpent ». Ou comment l’Etat paie deux fois des consultants de cabinets de conseil privés. La première pour l’aider à faire des économies. La seconde, pour suppléer aux carences que ces mêmes consultants ont contribué à organiser… tel le serpent qui se mord, et se remord la queue. En pleine pandémie, le gouvernement s’est ainsi retrouvé incapable de conduire seul sa politique sanitaire. Il a dû signer « vingt-six contrats avec des cabinets de consultants en dix mois, soit une commande toutes les deux semaines. Cela représente plus d’un million d’euros par mois », s’étrangle la députée Les Républicains Véronique Louwagie, de la commission des Finances de l’Assemblée nationale.»
Mc Kinsey joue un rôle de première importance. McKinsey & Company est ce cabinet international de conseil en stratégie dont le siège est situé à New York et qui en 2021, compte plus de 130 bureaux répartis dans 65 pays et réunissant près de 30 000 personnes.
L’entreprise est présentée comme particulièrement « fertile en futurs CEO », en français on dit DG. En 2007, seize CEO d’entreprises mondiales cotées à plus de 2 milliards de dollars étaient des anciens de McKinsey & Company.
McKinsey est aussi ce cabinet de conseil qui a incité l’entreprise Enron à mettre en place des pratiques comptables douteuses et à orienter la stratégie de l’entreprise vers le trading d’électricité et de matières premières. En 2001, le scandale financier Enron éclate et l’entreprise fait faillite. « Nobody is perfect ».
L’article des deux journalistes parlent de la lutte contre la pandémie :
« Chaque après-midi, au démarrage de la campagne de vaccination, les membres de la « task force » du ministère de la Santé étaient ainsi conviés à participer à des points d’étape pilotés… par un associé du bureau de McKinsey à Paris. Un service facturé 4 millions d’euros.
Mais l’État sait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier :
« Mais bien d’autres cabinets spécialisés dans l’aide à la stratégie et à la mise en œuvre des décisions sont intervenus. BVA Consulting a été appelé à la rescousse pour faire passer les bons messages sur le port du masque, la firme Citwell pour la distribution des vaccins et des équipements de protection individuelle (pour un montant de 3,8 millions d’euros), l’américain Accenture pour des services informatiques et aussi Roland Berger, Deloitte et JLL Consulting. »
Les précisions de cet appel à l’expertise restent difficiles à obtenir :
« L’association Anticor qui réclame depuis des mois les détails d’un accord-cadre de 100 millions d’euros signé en juin 2018 par le gouvernement avec une dizaine de cabinets pour l’épauler dans ses projets de « transformation publique ». Elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, qui vient de lui donner raison. »
L’Obs prétend qu’il ne s’agit que de la partie émergée d’un iceberg et évoque plus de 500 commandes passées en trois ans : des contrats en stratégie, en organisation, en management, en informatique.
Les journalistes citent Arnaud Bontemps, magistrat en disponibilité à la Cour des Comptes et porte-parole du collectif nouvellement créé « Nos services publics » :
« Le phénomène va en s’accélérant. Il s’accompagne d’un dysfonctionnement profond de nos services publics, qui ont perdu leur sens pour les fonctionnaires et sont en totale déconnexion avec les besoins des gens. »
Sur ce site vous trouverez des estimations sur les coûts et les conséquences de cette externalisation.
Les journalistes livrent ce constat :
« Une seule certitude, depuis quinze ans, l’administration a bien été amputée (200 000 postes perdus). Elle a vécu des « dégraissages » successifs au rythme de la RGPP (révision générale des politiques publiques) de Nicolas Sarkozy, puis de la « modernisation » voulue par François Hollande, avant d’être invitée à se mettre en mode « start-up » par Emmanuel Macron (des cabinets de consultants, Octo Technology, Arolla, et UT7, ont accompagné ce « changement culturel », pour un montant de 70 millions d’euros).
Conséquence, à force de devoir être toujours plus « agiles », toujours plus « performants », les fonctionnaires se retrouvent au bord de la rupture dans des domaines aussi vitaux que la santé, la sécurité, la justice, ou aussi stratégiques que l’environnement et le numérique. L’Etat appelle alors à l’aide les consultants. De plus en plus souvent. Pour des sommes de plus en plus énormes. Le fameux paradoxe du serpent. A eux deux, les leaders du secteur, les américains McKinsey et Boston Consulting Group (BCG), emploient plus de 900 consultants en France. Et il faut aussi compter avec Roland Berger, Accenture, Capgemini, Ersnt & Young, et les moins connus Eurogroup, Mazars, etc., dont aucun n’a accepté de répondre à nos questions. »
L’article insiste sur les conséquences dans le secteur de la santé
« Ces nouvelles pratiques ont trouvé dans le secteur de la santé un terrain d’expérimentation fertile. Chroniquement déficitaires, les hôpitaux avaient besoin d’être restructurés, et comme la haute fonction publique hospitalière a toujours été peu considérée par les grands corps, les cabinets de consultants se sont engouffrés dans la brèche. « Le recours aux grands cabinets est devenu un réflexe facile. Au point qu’on ne sait plus rien gérer sans eux », constate Frédéric Pierru, sociologue au CNRS, auteur, avec son collège Nicolas Belorgey, de plusieurs ouvrages sur la « consultocratie hospitalière ».
Tout s’est accéléré avec la création en 2009 des agences régionales de santé, les ARS, dont le grand public a découvert l’existence pendant la pandémie. Au départ, les ARS avaient l’objectif louable de coordonner la politique de santé au niveau local. En réalité, elles ont surtout pour rôle de maintenir les hôpitaux sous pression financière. Pas étonnant quand on sait que la réforme à l’origine de leur création a été en grande partie élaborée par deux grands cabinets : Capgemini et le BCG. Le conseiller chargé du dossier auprès de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, venait de McKinsey et y est retourné ensuite. Même le secrétariat du groupe de travail était assuré par Capgemini ! La faute à des moyens insuffisants, mais pas seulement. « Il y avait ce sentiment très fort que si on faisait appel à l’administration, rien ne changerait jamais », souligne Frédéric Pierru.
Pour recruter les futurs directeurs de ces ARS, l’Etat a aussi fait appel à un cabinet, Salmon & Partners. Les appels à candidatures parus à l’époque en témoignent : ils n’exigeaient aucune connaissance dans la santé, seulement une expérience managériale de haut niveau. En d’autres termes, on cherchait de purs gestionnaires. Les candidats ont ensuite été choisis par un comité ad hoc présidé par… Jean-Martin Folz, ex-patron de Peugeot Citroën. L’arrivée des socialistes au pouvoir n’a rien changé, au contraire. En 2012, la ministre Marisol Touraine a mis en place un comité interministériel de performance et de modernisation de l’offre de soins (Copermo) qui subordonne les investissements des ARS dans les établissements hospitaliers à un plan de retour à l’équilibre financier, conçu en général avec un cabinet de consultants. […]
En 2020, quatre ARS (Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Mayotte) commandent une analyse de la situation financière de leurs établissements. Des contrats variant de quelques centaines de milliers d’euros à plusieurs millions, passés à une dizaine de prestataires que l’on retrouve partout (ACE Consulting, Opusline, etc.). Il arrive aussi que les hôpitaux se réunissent en centrale d’achats. Et là, la facture grimpe. Comme en novembre 2019, quand le groupement Resah passe un accord-cadre de 40 millions d’euros avec plusieurs grands cabinets (KPMG, Ernst & Young, Mazars, etc.) afin d’optimiser l’accueil des patients.
Des sommes faramineuses au regard des réductions budgétaires drastiques imposées aux hôpitaux, dont certains se retrouvent à court de lits, de repas, de couvertures, de papier toilette. Et avec quels résultats ? Prenons les hôpitaux de Marseille : fin 2018, l’AP-HM, accablé par un milliard de dettes, signe un gros contrat de conseil – 9,4 millions d’euros – avec deux cabinets, le français Eurogroup et la Rolls du secteur, dont les consultants sont payés 4 000 euros la journée, McKinsey. Quelques mois plus tard, l’AP-HM communique : grâce à « une approche bottom-up » ayant mobilisé 1 000 personnes au sein de l’AP-HM, le cabinet américain a pu réaliser un « diagnostic à 360° » qui promet « 246 millions d’euros de gains potentiels à horizon 2025 ». Un passage qui a laissé un souvenir… contrasté.
« On a vu débarquer des dizaines de jeunes gens sortis de grandes écoles qui ont organisé des réunions de « brainstorming « avec pléthore de Post-it. On avait l’impression qu’ils arrivaient avec leurs idées toutes faites. Rien que leur « benchmarking », leur étude de marché : ils nous comparaient avec des établissements qui n’avaient rien à voir. A la fin, McKinsey a présenté un grand plan de transformation avec 37 chantiers et 200 projets sous forme d’un arbre avec plein de branches pour faire joli. Mais la mise en œuvre s’est révélée très compliquée. Peu d’actions ont vraiment démarré, tout le monde est passé à autre chose », témoigne, amer, un chef de service. La direction, elle, estime que « l’intervention des consultants s’est arrêtée dès lors que les équipes de l’AP-HM ont été suffisamment aguerries » pour continuer toutes seules… »
Je ne peux pas citer tout l’article mais je conclurais avec la réflexion sur le rapport qualité prix de l’appel à toutes ces compétences d’un autre monde :
« Si la rentabilité des hôpitaux est scrutée à la loupe, personne ne s’est jamais penché sur le rapport qualité-prix des consultants. En 2018, la Cour des Comptes avait dressé un constat au vitriol. « Les productions des consultants ne donnent que rarement des résultats à la hauteur des prestations attendues. Des analyses effectuées par les chambres régionales des comptes, il ressort que nombre de rapports de mission utilisent essentiellement des données internes, se contentent de copier des informations connues ou reprennent des notes ou des conclusions existantes. » Plus inquiétant encore : le sociologue Nicolas Belorgey a réussi à démontrer que certaines mesures d’économies dégradaient la qualité des soins. En comparant des données confidentielles, il s’est rendu compte que la diminution des taux d’attente aux urgences, qui paraissait une bonne mesure, entraînait une augmentation du taux de retour aux urgences. »
Peut être l’Etat embauchera t’elle un cabinet de conseil pour déterminer si cela est bien raisonnable de faire autant appel à ces idéologues de la compétitivité, alors que la fonction publique est, par essence, bien davantage tournée vers la solidarité et la coopération.
<1586>
-
Jeudi 1er juillet 2021
« Pause (Human)»Un jour sans mot du jour nouveauNous sommes le 1er juillet.

Il y a un an, le mot du jour du 1er juillet 2020 concernait ce remarquable documentaire de Yann Arthus-Bertrand : «Human»
<mot du jour sans numéro>
-
Mercredi 30 juin 2021
« Le vote par Internet, c’est un désastre pour la démocratie. »Dominique ReyniéAprès l’abstention abyssale que la France a connu lors des deux tours des élections pour les conseils régionaux et les conseils départementaux, beaucoup croient dans une solution technique : le vote par Internet.
Ils pensent sans doute que si on rapproche l’acte de voter de l’acte d’acheter chez Amazon, certains seront davantage prêts à passer de l’un à l’autre ?
Le politicologue Dominique Reynié n’est pas de cet avis.
Il évoque le risque de piratage informatique.
Ce risque est réel mais il me semble qu’il existe un autre risque plus important encore.
C’est le second argument qu’il développe : celui de la pression qui peut s’exercer dans le cercle privé. Il dit :
« Le vote par Internet, c’est un désastre pour la démocratie. Vous pouvez voter sous la pression d’un tiers, comme un patron, un acheteur de vote. Le bureau de vote garantit l’autonomie de l’électeur.»
Je m’imagine, plus simplement dans une maison ou un appartement, un caïd ou un autocrate familial obligeant, par la persuasion autoritaire ou la violence, tous les présents à voter selon ses désirs.
Le vote c’est autre chose.
C’est sortir de sa bulle privée, de son quotidien pour se rendre dans un lieu où on est accueilli par des êtres humains qui sont aussi des citoyens. C’est-à-dire des femmes et des hommes qui s’intéressent au destin de la cité.
Et là en outre, il vous est demandé de prendre au moins deux bulletins et de vous rendre seul dans l’isoloir.
Personne ne peut voir, ce que vous aller voter dans ce moment solennel.
<Sur ce site consacré au vote> il est expliqué :
« Un électeur qui fait son choix publiquement, sans passer par l’isoloir, est peut-être un électeur menacé, soumis à des pressions. L’auteur des pressions lui a intimé l’ordre de voter publiquement afin de pouvoir constater que ses pressions ont réussi.
Il est obligatoire que des membres du bureau de vote interdisent à cet électeur de déposer son enveloppe dans l’urne tant qu’il n’a pas respecté la procédure (prendre au moins deux bulletins différents, se dissimuler dans l’isoloir).
 Si aucun membre du bureau de vote n’intervient, et laisse un électeur voter sans confidentialité, le bureau de vote échoue dans sa mission de veiller au respect de la confidentialité.
Si aucun membre du bureau de vote n’intervient, et laisse un électeur voter sans confidentialité, le bureau de vote échoue dans sa mission de veiller au respect de la confidentialité.
Il s’agit d’une atteinte au secret du vote qui doit être signalée sur le procès-verbal du bureau de vote.
Dans un bureau de vote où la confidentialité n’est pas garantie, des pressions peuvent s’exercer sur un grand nombre d’électeurs, en particulier les plus faibles.»
Voilà pourquoi, il faut un isoloir et pourquoi on demande que chaque électeur prenne au minimum deux bulletins.
Dominique Reynié explique cela très bien, en quatre minutes, dans l’émission d’Yves Calvi sur Canal + : <l’info du vrai>
Il semble que l’« Isoloir » nous vienne d’Australie.
Les Australiens ont installé des isoloirs dès 1856 pour mettre fin aux fraudes et aux troubles. D’ailleurs, pour désigner le vote secret aux Etats-Unis, on parle d’« Australian ballot ».
En France, le vote est, dans son principe, secret depuis 1795 mais aucun dispositif n’était alors prévu pour le garantir.
Après l’Australie, l’isoloir a été adopté en 1872 par le Royaume-Uni, en 1877 en Belgique, à la fin du XIXème siècle aux Etats-Unis et en 1903 en Allemagne.
Wikipedia précise que :
« En France, où le vote secret est constitutionnalisé depuis 1795, l’électeur remet son bulletin plié au président du bureau qui l’introduit dans l’urne. Ce n’est qu’en 1913 que la loi du 29 juillet introduit l’enveloppe, l’isoloir et le dépôt dans l’urne par l’électeur lui-même. La loi vient après une quarantaine d’années de discussions »
Il me semble qu’il faut toujours se méfier quand on vous propose, pour régler des problèmes profonds qui engagent la personne et l’être de raison que nous sommes, un simple dispositif technique.
Le vote a été inventé par des humains qui croyaient et respectaient l’opinion d’autres humains.
Ce n’est pas l’opinion d’un instant, ce n’est pas un like, ce n’est pas un clic d’achat.
C’est une décision solennelle qui engage.
<1585>
-
Mardi 29 juin 2021
« Pause »Un jour sans mot du jour nouveauRien à écrire aujourd’hui.
 I
I<mot du jour sans numéro>
-
Lundi 28 juin 2021
« Quel récit explique le développement d’Amazon ?»Essai de conclusion sur AmazonIl serait encore possible d’écrire beaucoup sur Amazon et Jeff Bezos. L’actualité nous donne d’ailleurs, sans cesse, des éléments nouveaux permettant d’autres développements.
Par exemple le 18 juin, j’apprenais que <Jeff Bezos investissait dans le nucléaire et précisément la fusion de l’hydrogène>.
Et puis, il aurait aussi été possible d’insister davantage sur le côté spécifique du modèle d’Amazon qui non seulement vend tout en masse mais est aussi capable de vendre l’exceptionnel, le rare. Par exemple je tire encore du « Un » cet exemple concernant le premier métier du géant de Seattle : la vente de livre.
C’est Aurélien Bellanger qui l’écrit :
« Amazon a plus de références en stock que la bibliothèque du Congrès. Mais les livres modernes, c’est justement ce qui les caractérise, ne sont pas des exemplaires uniques. Et il est vertigineux de comparer la capitalisation boursière d’Amazon à la valeur totale du marché du livre. Elle est dix fois supérieure. Ce qui veut dire, scénario légèrement paranoïaque, que Jeff Bezos pourrait racheter tous les exemplaires en circulation de tous les livres du monde.
J’ai déjà reçu, d’ailleurs, une proposition de rachat, pour un livre qu’il m’avait négligemment vendu – un livre du philosophe Carnap sur l’entropie. Comme s’il s’était aperçu, soudain, qu’il lui manquait précisément celui-ci. J’ai refusé son offre, et je le garde précieusement : c’est désormais le plus précieux de ma bibliothèque, ainsi que le plus incompréhensible, soit dit en passant.
Jeff Bezos pourrait racheter tous les livres du monde, et notre vieille allégorie de l’infini sous la forme d’une bibliothèque apparaît soudain périmée. »
Mais il faut bien clôturer un thème. Je vais le faire modestement avec l’état actuel de mes réflexions.
Faire d’Amazon et de Jeff Bezos l’explication de nos problèmes, c’est-à-dire les boucs émissaires de la dissolution de notre monde constitue une erreur d’analyse.
C’est une simplification erronée de nos contradictions et incohérences
Jamais Jeff Bezos n’est venu poser un pistolet sur la tempe de ses clients pour les obliger à acheter sur son site. Les consommateurs du monde entier, sauf la Chine qui dispose d’Ali baba, sont venus librement acheter sur son site et y sont revenus toujours davantage.
Ils l’ont fait en raison de l’immense qualité et la simplicité du service. Surtout si on compare avec d’autres sites en ligne.
Mon ami Bertrand qui partage ma passion de la musique m’a écrit après la lecture d’un des mots du jour de la série :
« J’ai renoncé à mettre mon nez derrière nombre de coulisses. Je fais partie des « modestes » consommateurs de culture. Je suis gros client des maisons de disques et d’édition, je me sers depuis plusieurs années et quasi exclusivement du génial circuit de distribution mis en place par Bezos pour me procurer ma « dope » musicale (surtout) et littéraire (plus rarement, parce que je privilégie les centres Emmaüs moins chers et avec en plus une bonne action au bout pour me faire pardonner de me compromettre avec Amazon).
Si tu regardes le prix exigé par le circuit de distribution de Diapason ou Classica, tu tombes [à la renverse].
Quand je songe à la difficulté de me procurer jadis même à la Fnac les produits désirés, alors quel soulagement de pouvoir utiliser Amazon. 99,99 % de satisfaction ! Il faut se dire que le monde change, des métiers se perdent, c’est vrai, des disquaires indépendants (et encore, sont-ils indépendants encore en coulisse ?) ça n’existe plus guère dans nos mortes plaines […] Livreurs sous-payés ? Mais diablement efficaces chez Amazon. Il m’est arrivé de commander le dimanche et d’être livré dès le lundi ! […]
En tout cas je me régale à fond, je peux aujourd’hui écouter tous les enregistrements auxquels j’ai renoncé jadis grâce au système : réédition massive d’éditions complètes avec une qualité souvent améliorée et un prix dérisoire. Par exemple, le coffret anniversaire MUTI chez Warner qui sort cette semaine, j’ai réussi à le précommander pour moins de cent euros, un euro par disque ! Tu diras que c’est au détriment des artistes d’aujourd’hui. Mais justement, les artistes d’aujourd’hui (enfin certains d’entre eux) je veux les écouter en concert. Mais ceux d’hier, grâce aux grands groupes, je peux les écouter quand ça me chante à souvent moins cher qu’une cigarette…[…]
Pour conclure : oui, Amazon me fait tant de bien, je ne crache pas dans la main de celui qui me sert si fidèlement. »
Il a raison.
Certains aspects du management de Jeff Bezos sont certes contestables, mais cela appartient aux combats sociaux.
Sa volonté de fuir l’impôt est très générale dans le monde des grands entrepreneurs de la planète, il faut évidemment que les États s’arment et coopèrent davantage pour lutter contre cette fraude et optimisation fiscales organisées. Les États s’y emploient un peu, probablement pas suffisamment.
Amazon a une ambition hégémonique, voire monopolistique. Ce n’est pas nouveau non plus. L’histoire économique libérale est remplie d’entreprises qui ont poursuivi cette quête de supprimer la concurrence et se retrouver seul. Dans ce domaine aussi il faut d’abord une prise de conscience, puis agir pour combattre les monopoles. Mais comme l’a dit Esther Duflo, Amazon est loin d’être un monopole. La preuve en est que je n’achète jamais chez Amazon et que je ne crois pas être privé de quoi que ce soit. Quelquefois, il est vrai, je pourrais peut être trouver moins cher chez Amazon. Mais là je vous renvoie vers mon mot du jour « C’est trop cher ! » qui montre, me semble t’il, la vue à court terme et quasi délétère de cette poursuite du « moins cher » c’est-à-dire le choix systématique du consommateur que vous êtes contre le producteur que vous êtes aussi.
C’est trop facile de dire : c’est la faute d’Amazon.
Amazon a su capter le récit consumériste du monde.
Yuval Noah Harari, nous a raconté combien le récit est consubstantiel d’homo sapiens et que c’est même cette capacité de croire à un récit qui a permis à une espèce, assez faible physiquement, à dominer toutes les autres espèces de la terre.
Il avait écrit ce constat explicatif :
« Jamais vous ne convaincrez un singe de vous donner sa banane en lui promettant qu’elle lui sera rendue au centuple au ciel des singes. »
Par cette phrase il se référait aux récits religieux. Ces récits qui ont colonisé des sociétés entières et l’intégralité de la vie des individus dans nos contrées pendant des siècles. Ils continuent encore aujourd’hui dans d’autres contrées à prendre toute la place et même dans certaines familles qui habitent dans nos pays.
Il y eut ensuite les récits nationalistes. C’était un récit particulièrement fort et intense pour conduire à ce que des millions de jeunes hommes acceptent de sacrifier leur vie dans des guerres monstrueuses et insensées. J’avais évoqué ce récit dans le premier mot du jour de la série sur 14-18 <Mourir pour la patrie>.
Il y eut aussi les récits de religions laïques, je veux dire du communisme, du nazisme qui ont aussi conduit à des monstruosités.
Nous percevons la tentative d’autres récits qui sont en gestation : « le récit transhumaniste », « le récit de la collapsologie » voire « le récit d’écologiste millénariste ».
Alors finalement « le récit consumériste » est peut-être le plus doux de tous ces récits qui guident le comportement des humains. Il s’apparente au récit du « doux commerce » de Montesquieu.
Le récit consumériste est celui qui est martelé par le monde de la publicité qui lie le bonheur avec la consommation.
Vous êtes malheureux : achetez tel ou tel produit, service, voyage et vous serez heureux.
Vous voulez être en phase avec votre temps, vos semblables il faut absolument acheter ce smartphone, cet équipement etc.
Et pour que votre désir de consommation soit accompli, il faut deux choses : la certitude que vous achetez le moins cher, sinon vous êtes « has been », et vous devez disposer de votre objet du désir immédiatement.
Jeff Bezos l’a compris, Amazon est sa remarquable réponse à la croyance à ce récit.
Cela pose cependant de multiples problématiques.
 La première, pour revenir au doux commerce de Montesquieu, est de s’interroger à la douceur de l’échange d’un clic de souris et de la relation chaleureuse avec une box qui conserve le carton que j’attends.
La première, pour revenir au doux commerce de Montesquieu, est de s’interroger à la douceur de l’échange d’un clic de souris et de la relation chaleureuse avec une box qui conserve le carton que j’attends.
La principale reste cependant qu’il n’est pas possible de consommer comme nous le faisons, nous autres occidentaux.
Parce que nous ne disposons pas d’une planète capable d’absorber notre demande insatiable de produits et de nouveaux produits, de transports et d’énergie que tout cela nécessite.
Accuser Amazon est simple, faire preuve d’introspection et aussi de réflexion pour essayer de s’interroger sur la place de notre espèce sur la biosphère qui permet la vie sur terre et la planète que nous souhaitons léguer à nos enfants est une question beaucoup plus complexe et beaucoup plus essentielle.
<1582>
-
Vendredi 25 juin 2021
« Le Système Amazon : une histoire de notre futur »Alec MacGillisAu centre du magazine « Le Un » consacré à Amazon et qui a guidé ma réflexion au cours de cette série consacrée au géant de la logistique et du commerce créé par Jeff Bezos se trouve un entretien avec Alec MacGillis : « Aucune autre compagnie au monde n’est aujourd’hui aussi dominante »
 Alec MacGillis est un journaliste américain qui travaille au journal « le New Yorker ». Auparavant, il avait travaillé au Washington Post, avant que ce journal ne soit racheté par Jeff Bezos.
Alec MacGillis est un journaliste américain qui travaille au journal « le New Yorker ». Auparavant, il avait travaillé au Washington Post, avant que ce journal ne soit racheté par Jeff Bezos.
Il est l’auteur d’un livre dont la traduction française est parue le 3 juin au Seuil « Le Système Amazon : une histoire de notre futur »
Une autre revue qui s’intéresse à notre avenir numérique « Usbek et RICA » lui a également consacré un article : <Enquête implacable sur le futur selon jeff bezos>
Mardi 22 juillet, il était l’invité de « la Grande Table » de France Culture : < Amazon : un projet tentaculaire>
A France Culture il explique que sa réflexion a commencé en voyant Les inégalité régionales qui s’amplifiaient :
« Mon enquête a commencé à partir des inégalités régionales qui s’amplifient d’années en années : c’est la logique du vainqueur qui rafle toute la mise, des villes comme San Francisco ou Los Angeles, où il devient difficile de vivre tellement la richesse est concentrée. Cet écart régional crée des distorsions dans le pays, jusque dans la politique »)
Pour MacGillis aucune autre compagnie au monde n’est aujourd’hui aussi dominante :
« Les activités d’Amazon sont devenues si vastes, si diversifiées, qu’il est difficile d’appréhender de façon simple la puissance de l’entreprise. Aucune autre compagnie au monde n’est aujourd’hui aussi dominante, dans autant de secteurs d’activité touchant à la vie concrète de la population. Pour trouver une entreprise comparable, il faudrait remonter à une autre époque, aux grands monopoles du début du xxe siècle, comme la Standard Oil de John D. Rockefeller. Le pouvoir de la Standard Oil venait du fait que Rockefeller contrôlait à la fois des puits de pétrole et les compagnies de chemin de fer qui acheminaient cette ressource, empêchant ainsi ses concurrents de rivaliser avec lui. Amazon est assez similaire de ce point de vue, puisqu’il contrôle les plateformes de vente, ces « places de marché » où n’importe quelle entreprise peut être présente à condition de payer un pourcentage à Amazon sur chaque vente, et opère elle-même sur ces marchés avec des avantages compétitifs évidents. Et la puissance d’Amazon ne se limite désormais plus au seul commerce en ligne, puisque l’entreprise est devenue le leader mondial de l’activité du cloud, qu’elle œuvre aussi dans le domaine de la sécurité, de la santé, des services à la personne, sans oublier la place de plus en plus importante qu’elle prend dans le divertissement »
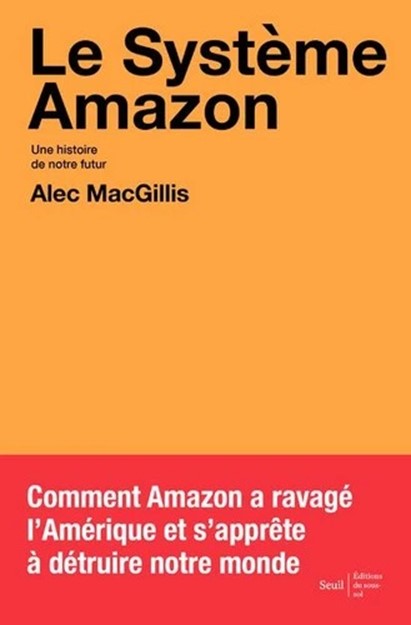 Je note que la Prix Nobel d’économie Esther Duflo n’est pas de cet avis. Elle ne minimise pas la puissance et l’influence d’Amazon mais elle considère que cette entreprise conserve des concurrents sérieux, alors que pour elle Google et son entreprise holding Alphabet se trouvent en position monopolistique et constitue un danger plus grand encore pour nos libertés.
Je note que la Prix Nobel d’économie Esther Duflo n’est pas de cet avis. Elle ne minimise pas la puissance et l’influence d’Amazon mais elle considère que cette entreprise conserve des concurrents sérieux, alors que pour elle Google et son entreprise holding Alphabet se trouvent en position monopolistique et constitue un danger plus grand encore pour nos libertés.
Mais restons sur Amazon et sur sa diversification :
« La diversification de ses activités permet à Amazon d’utiliser sa domination dans un secteur pour s’assurer le leadership dans un autre. Le Wall Street Journal a récemment révélé une affaire très éloquente quant à la stratégie d’Amazon de ce point de vue : une entreprise vendait un dispositif de surveillance privée sur la « Market Place », la place de marché d’Amazon, et Amazon souhaitait que cette entreprise partage avec lui les données collectées par ce dispositif. Devant les réticences de cette dernière, Amazon a menacé de ne plus vendre son produit sur son site – ce qui, aujourd’hui, vu la puissance d’Amazon, est semblable à une condamnation à mort commerciale. L’entreprise a été contrainte de plier. »
C’est un comportement quasi mafieux conclut la journaliste du Un. Disons que c’est au moins un abus de position dominante.
Il ne s’agit pas de nier la qualité du service d’Amazon pour ses clients, mais il s’agit d’essayer de comprendre les conséquences de l’attitude de cette entreprise :
« Amazon commence par séduire les consommateurs avec des prix bas et une qualité de service remarquable, que ce soit dans la livraison ou dans la relation client. Plus les consommateurs sont nombreux sur le site, plus les entreprises tierces se sentent à leurs tours tenues d’y être présentes, pour y trouver des clients sur la place de marché. La richesse de l’offre entraîne mécaniquement une nouvelle augmentation du nombre de clients, ceux-ci étant presque sûrs de trouver ce qu’ils cherchent sur le site. Et cette demande accrue permet de baisser à nouveau les prix, grâce aux économies d’échelle engendrées. C’est ce cercle vertueux – pour l’entreprise, du moins – qui lui permet de poursuivre sa croissance ininterrompue. En 2004, le chiffre d’affaires d’Amazon était de 6 milliards de dollars. En 2011, 48 milliards. Et en 2020, 386 milliards. C’est vertigineux. »
En France nous pouvons prendre l’exemple de la ligue 1 de football qui a fait contrat avec Amazon pour la diffusion des matchs.
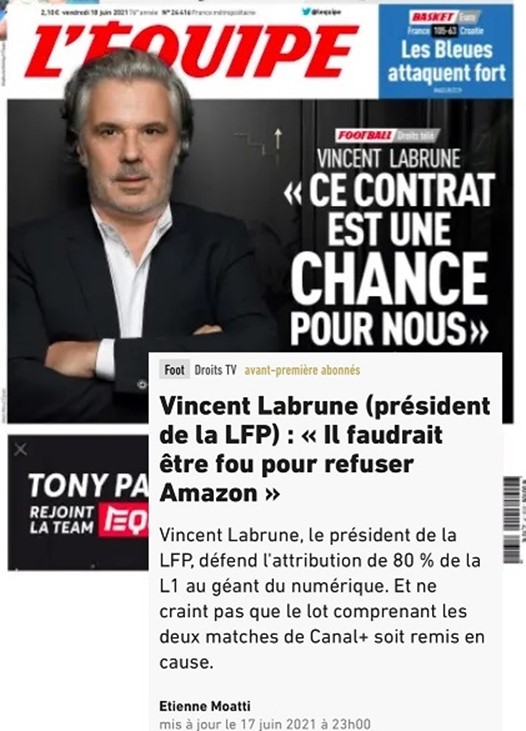 Le président de la Ligue Française Football exprime cette opinion tranchée : « Il faudrait être fou pour refuser Amazon »
Le président de la Ligue Française Football exprime cette opinion tranchée : « Il faudrait être fou pour refuser Amazon »
Selon des informations de RMC, Amazon demanderait aux passionnés de football de prendre l’abonnement Prime et d’y ajouter la modeste somme de 2 € par mois.
Dans ce cas la stratégie est claire, Amazon n’a pas pour objectif de rentabiliser sa diffusion du football en France. Ce qui l’intéresse c’est d’augmenter le nombre d’abonnés Prime et ainsi d’augmenter le nombre d’achats sur son site en ligne. Ce qu’il sait être une conséquence de l’abonnement Prime :
« Dès 2006, Amazon a eu cette intuition géniale : en leur offrant la livraison contre un abonnement annuel, les clients seraient amenés à être fidèles au site et à y commander le plus de choses possibles pour rentabiliser leur abonnement. Aujourd’hui, plus de la moitié des foyers américains sont abonnés au service Prime, soit largement plus de 100 millions de foyers qui payent 119 dollars par an pour avoir droit à des livraisons gratuites, rapides, ainsi qu’à une offre média. Et les abonnés Prime dépensent plus sur Amazon, environ 1 400 dollars en moyenne par an, contre 600 dollars pour les non-abonnés. C’est une manne incroyable pour Amazon ! Et cette explosion des comptes Prime a aussi conduit l’entreprise à se répandre à travers l’ensemble du pays : si vous promettez une livraison en vingt-quatre heures, vous avez besoin d’avoir des entrepôts à proximité. »
MacGillis décrit les conséquences de la domination d’Amazon vers une dichotomie entre les « villes à siège social » et les « villes à entrepôts »,
« Amazon n’est pas seul responsable, mais sa croissance a accompagné un mouvement de relégation des villes secondaires, vidées de leurs magasins et de leurs emplois, et donc de leur vie sociale, tandis que les métropoles florissantes concentrent la richesse captée par le commerce en ligne, les meilleurs jobs, les meilleurs salaires, mais aussi les problèmes de logement, de trafic, de ségrégation géographique. Le fossé s’est creusé entre les « villes à siège social » et les « villes à entrepôts », tandis que l’acte même de consommer a perdu de son humanité : vous ne vous déplacez plus, vous ne rencontrez plus personne. »
Amazon selon un sondage de 2018 est « l’institution la plus respectée des Etats-Unis » :
« Les meilleurs clients d’Amazon sont les populations aisées des grandes villes, celles-là mêmes qui votent le plus à gauche aujourd’hui et qui s’inquiètent des pratiques de Facebook ou d’Apple, par exemple. Pourquoi si peu de critiques ? Sans doute parce que le péché originel est le nôtre : nous apprécions tellement le fait qu’Amazon puisse satisfaire nos désirs de consommation que nous ne voulons pas savoir comment il y arrive. C’est pourtant ce qu’il faudrait faire : comprendre ce qui se joue derrière la facilité de l’achat en un clic, comprendre que l’apparence de la gratuité a un coût, social et humain. »
Pour s’enrichir il faut certes avoir quelques idées disruptives, probablement beaucoup travailler mais surtout pas payer d’impôts. Jeff Bezos refuse l’impôt, le fuit. Il est libertarien. Seul l’individu est grand, le commun ne se trouve pas dans ses préoccupations :
« Amazon recherche les influences privées et refuse toute solidarité par l’impôt, même minimal. En pur et authentique libertarien, Jeff Bezos a la haine des impôts : « Pendant des années, Amazon était resté remarquablement à l’écart des questions politiques et citoyennes de Seattle, un silence d’autant plus étrange à mesure que l’entreprise grandissait. C’était le reflet des opinions libertariennes de son fondateur : le gouvernement n’était pas seulement un obstacle, il était inopérant. […]
À l’étranger, Amazon refuse de déclarer ses résultats par aire géographique pour contourner les impôts locaux. Mais la stratégie est la même aux États-Unis : pour éviter les taxes locales, le patron d’Amazon n’hésite pas à menacer les États qui réclament leur dû : « Les employés d’Amazon éparpillés dans tout le pays avaient des cartes de visite trompeuses, de sorte que l’entreprise ne puisse être accusée d’opérer dans un État donné, et donc forcée d’y payer des impôts. En 2010, l’entreprise alla jusqu’à fermer son unique entrepôt au Texas et à abandonner ses futurs projets de centres de distribution lorsque les élus de l’État la poussèrent à payer 270 millions de dollars d’arriérés, ce qui obligea le Texas à renoncer à cet impôt. En 2017, l’entreprise avait même crée une mission interne secrète consistant à obtenir 1 milliard par an de réduction d’impôts ».
Jeff Bezos refuse l’impôt mais il s’intéresse au personnel politique :
« Alec MacGillis a travaillé pour le Washington Post jusqu’à ce que le journal soit racheté par Jeff Bezos en 2014. Cette acquisition lui donne une assise très importante dans la capitale fédérale, dans laquelle il passe plus de temps qu’à Seattle. […] Après tout, la commande publique est un marché comme un autre – et même plus gros que les autres. Jeff Bezos surveille notamment de près Ann Rung, cost-killeuse publique qui se vantait d’avoir fait économiser 200 millions de dollars en fournitures de bureau à l’État de Pennsylvanie. De tels états de service lui valurent l’attention de Barack Obama qui, en 2014, la nomma directrice en chef des acquisitions des États-Unis. Dès sa prise de poste, elle encouragea les acheteurs publics à casser les règles et innover. Et en 2016, elle annonçait 2 milliards d’économies pour les comptes publics non sans une certaine fierté… avant de démissionner pour devenir directrice de la division « marché public » d’Amazon Business : « En d’autres termes, la personne qui supervisait l’intégralité des 450 milliards de dépenses gouvernementales en approvisionnement rejoignait une entreprise déterminée à se tailler la plus grosse part de ce gâteau ».
Amazon a largement profité de la pandémie :
« La pandémie a fait exploser les chiffres de l’entreprise de façon exponentielle : plus 40 % sur les ventes cumulées dans l’année, plus 50 % de surface des entrepôts pour assurer ces ventes, 400 000 nouveaux employés pour les seuls États-Unis… Quant à Jeff Bezos, il a vu la valeur de ses actions doubler en un an, et sa fortune a grimpé de 58 milliards de dollars ! »
 Il parle surtout des États-Unis et d’une libération d’un reste de culpabilité chez certains américains en raison de la pandémie :
Il parle surtout des États-Unis et d’une libération d’un reste de culpabilité chez certains américains en raison de la pandémie :
« La tendance était déjà là, qu’on parle de la croissance d’Amazon ou de l’avènement d’une « société du simple clic ». Mais la pandémie a abattu des barrières psychologiques. Une part des Américains pouvaient encore ressentir une forme de culpabilité à acheter en ligne sur Amazon. La pandémie les a non seulement libérés de cette culpabilité, mais a même donné un caractère vertueux à cette forme de consommation : regardez, je reste chez moi, je suis civique dans mes achats ! Ce qui s’est passé depuis un an a accéléré un mouvement de fond vers l’isolation des individus, le repli dans sa bulle, et, par là, une fragmentation du tissu social qui constitue notre société. »
Pour MacGillis, il n’y aucune raison qu’Amazon cesse de croitre sauf si des politiques publiques interviennent :
« Non, il n’y a pas de plafond visible, tant que les pouvoirs publics n’interviennent pas pour brider ou briser Amazon. L’entreprise elle-même s’amuse à rappeler qu’elle est loin d’être aussi dominante qu’on le dit, puisqu’elle contrôle « seulement 4 % du commerce de détail mondial ». Mais cela représente déjà un chiffre énorme, des centaines de milliards de dollars ! Surtout, Amazon ambitionne de capter de plus en plus des 96 % restants. Il reste encore beaucoup de produits à mettre en vente en ligne, de magasins à tuer, de clients à séduire dans le monde. Sans même parler des autres secteurs que le commerce en ligne, dans lesquels Amazon envisage de se lancer. »
Pour MacGillis notre futur est tracé :
« À moins que nous ne déviions de la route sur laquelle nous sommes aujourd’hui engagés, c’est un futur où les inégalités vont croître entre les villes, où le tissu social va continuer de s’effilocher, et où la démocratie se trouvera par conséquent durablement affaiblie. »
<1581>
-
Jeudi 24 juin 2021
« En prenant le contrôle du marché, en en fixant les règles, Amazon n’ambitionne pas seulement de le dominer, il veut « être le marché »Rapport de l’institut américain de recherche ILSR (Institute for local self-reliance)Je continue donc modestement à essayer de comprendre comment fonctionne Amazon et les conséquences de l’addiction consumériste qu’Amazon a su capter.
J’essaye d’éviter la posture morale qui me semble inappropriée et contreproductive. La posture morale s’appuie sur un récit qui dicte le bien et le mal. En tant que telle, elle est toujours contestable, car d’autres peuvent avoir une conception différente du bien et du mal.
Dans cette quête que je poursuis j’aime me référer à cette formule pénétrante de Bossuet :
«Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes.»
Nul besoin d’être croyant pour comprendre la sagesse de ce propos.
Aujourd’hui je vais partager principalement un article d’opinion publié en 2018 par le site en ligne « AOC » dont j’ai déjà parlé et dont je suis abonné : « Amazon ou la menace proliférante de la loi de la jungle ».
C’est un article écrit par Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française qui a traduit et diffusé un rapport d’un institut américain de recherche ILSR (Institute for local self-reliance) : < Amazon, cette inexorable machine de guerre qui étrangle la concurrence, dégrade le travail et menace nos centres-villes.>
En voici <la traduction française>.
Ce rapport de l’ILSR vise à contribuer à une prise de conscience du grand public ainsi que des responsables politiques, ces derniers étant appelés à réguler l’emprise d’Amazon avant que les dégâts économiques, sociaux, sociétaux et culturels ne soient irréversibles :
« C’est notre modèle de société en tant que tel, notre relation au travail, nos libertés individuelles, notre capacité à vivre ensemble, qui se trouvent menacés par la stratégie tentaculaire d’Amazon. Face à un tel enjeu, les réactions semblent bien timides quand elles ne se teintent pas d’une fascination pour la réussite commerciale foudroyante de cette multinationale américaine. »
Quatre types de menaces sont identifiées.
- Une menace pour l’économie
- Une menace pour le travail et pour l’emploi
- Une menace pour nos libertés
- Une menace pour nos territoires
1 une menace pour l’économie
Le rapport de l’ILSR montre comment Amazon menace l’économie par son expansion tentaculaire dans des dizaines de secteurs, sa quête de monopole, la manière dont il étrangle les PME, à commencer par celles qui sont présentes sur sa market-place, ou encore sa politique d’évasion fiscale qui fausse la concurrence et réduit les ressources fiscales pour les territoires où il réalise ses ventes.
« Par la puissance de sa market-place, de ses infrastructures logistiques et de son service de stockage de données (Amazon Web Services), Amazon a dorénavant la faculté de fixer les conditions d’accès au marché pour des milliers d’entreprises dont il est par ailleurs le premier concurrent. Il scrute l’activité des entreprises qu’il héberge et, pour les plus profitables, s’approprie leur connaissance du métier et du produit avant de les racheter à vil prix ou de les concurrencer par des prix imbattables. Le PDG d’une entreprise américaine de jouets illustre cette dépendance en déclarant : « Nous nous sommes rendu compte que nous étions fichus si nous allions sur la market-place d’Amazon et fichus aussi si nous n’y allions pas. »
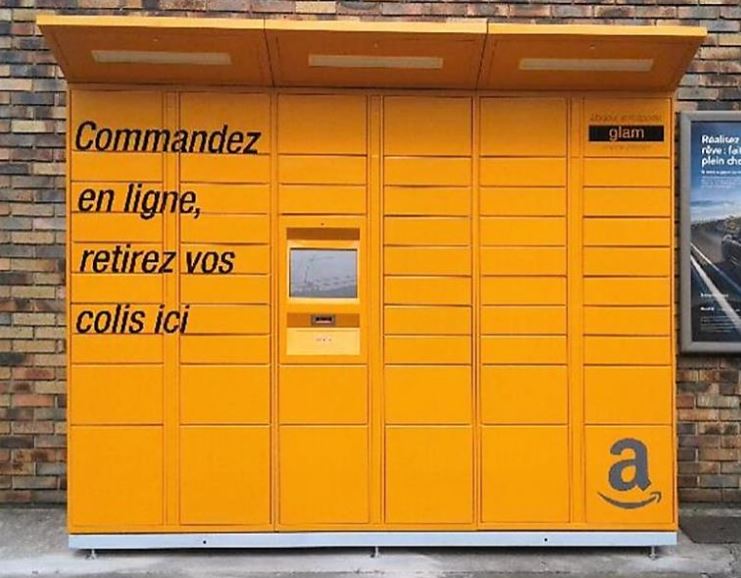 En France la société Casino joue à ce jeu dangereux : < L’idylle entre Amazon et Casino suit son cours >
En France la société Casino joue à ce jeu dangereux : < L’idylle entre Amazon et Casino suit son cours >
« La domination du marché par Amazon atteint, aux États-Unis, des proportions hors normes. L’entreprise de Jeff Bezos y capte en effet la moitié des achats en ligne, certainement les deux tiers à l’horizon 2020. Elle possède des dizaines de filiales : sites e-commerce, livres audio, téléphonie mobile, transport, plateforme de streaming pour jeux en ligne, textile, chaussures, piles à combustible, caméras de surveillance, bases de données, statistiques et « data mining », distribution alimentaire… La moitié des Américains qui vont sur le net pour y faire des achats démarrent dorénavant directement leurs recherches sur Amazon. Plus d’un foyer américain sur deux est abonné à son programme Prime. En prenant le contrôle du marché, en en fixant les règles, Amazon n’ambitionne pas seulement de le dominer, il veut « être le marché ». »
Cette quête monopolistique est alimentée par la capacité à mener, à long terme, une stratégie de vente à perte financée par des investisseurs éblouis et acceptant les pertes comme autant de promesses d’écrasement des marchés au profit de leur champion.
Il semble qu’un esprit de résistance se lève en France. Un article du 17 mars 2021 de « Capital » nous informe qu'<Amazon enregistre une forte baisse de sa part de marché en France> :
« Conséquence de la crise sanitaire liée au Covid-19, les ventes en ligne séduisent de plus en plus les Français. Selon des statistiques dévoilées par Kantar, la vente en ligne ne cesse de progresser, tirée vers le haut par les leaders du marché, à commencer par Amazon. Mais pour le géant du commerce en ligne qui continue de caracoler en tête avec 19% de part de marché, la croissance est bien moins rapide que prévue, analyse Kantar, à savoir que la société de Jeff Bezos perd trois points en 2020. Sa part de marché était en effet de 22% en 2019.
2 Une menace pour le travail et pour l’emploi
La première menace a déjà été largement abordée et concerne les conditions de travail et la pression qu’Amazon exerce sur ces salariés. Autant que possible, Amazon cherche à s’exonérer de ses obligations sociales.
La seconde est celle sur le nombre d’emplois, par la robotisation :
« Le fabricant de robots Kiva, [est devenu] l’un des leaders mondiaux sur ce marché. 45 000 de ces robots sont aujourd’hui produits par Kiva au service exclusif d’Amazon. Ils viennent d’être déployés dans les entrepôts français. Le nombre de nouveaux robots croît plus rapidement (+ 50 % en deux ans) que celui des embauches de salariés. Une étude du MIT, publiée en mars 2017, estime que chaque robot introduit sur le marché du travail détruit six emplois et entraîne une baisse du salaire moyen sur le marché du travail du fait d’une demande accrue de postes. Sur cette base, Amazon aurait déjà détruit près de 300 000 emplois dans le monde, soit autant que le nombre de ses salariés ! »
 Mais la destruction d’emplois se trouve aussi dans la concurrence :
Mais la destruction d’emplois se trouve aussi dans la concurrence :
« À cela il faut ajouter les dizaines ou centaines de milliers d’emplois détruits chez les concurrents d’Amazon terrassés par sa politique de dumping financée par une capitalisation hors normes. Cette politique prédatrice ne touche pas seulement de grandes chaînes concurrentes mais également des commerçants indépendants dont la présence est essentielle à la vitalité économique et sociale des territoires, et particulièrement des centres-villes que l’expansion d’Amazon contribue à désertifier. »
3°Une menace pour nos libertés
Amazon stocke des milliards de données sur des serveurs que l’entreprise maîtrise exclusivement :
« Amazon est l’un des leaders du stockage de données. Amazon Web Services, dont tout le monde, de Netflix à la CIA, est client, contrôle le tiers de la capacité mondiale de cloud computing, soit plus que Microsoft, IBM et Google combinés…
Il exploite, par ailleurs, l’inépuisable réserve de données personnelles que lui apporte une connaissance fine de nos habitudes d’achat. S’il s’en est servi jusqu’à présent pour se développer sur différents marchés et pour pousser ses propres produits, il pourra, demain, grâce à cette connaissance millimétrique de nos habitudes et de nos goûts, aux possibilités de l’intelligence artificielle sur laquelle il investit massivement et à l’introduction, au cœur de notre vie quotidienne, des appareils connectés qu’il développe, non plus seulement connaître nos choix, mais nous les dicter ! »
4° Une menace pour nos territoires
Amazon par son poids économique financier est capable d’imposer aux territoires des ristournes fiscales et même des subventions pour s’installer.
 Je fais juste un pas de côté, pour faire ce constat, en dehors de toute leçon morale, le poids économique et financier d’Amazon provient exclusivement des millions de clients fascinés par la facilité, la rapidité, le confort de l’acte de consommation qui part d’un simple clic pour arriver quasi immédiatement dans la bulle intime de son lieu de vie.
Je fais juste un pas de côté, pour faire ce constat, en dehors de toute leçon morale, le poids économique et financier d’Amazon provient exclusivement des millions de clients fascinés par la facilité, la rapidité, le confort de l’acte de consommation qui part d’un simple clic pour arriver quasi immédiatement dans la bulle intime de son lieu de vie.
Le rapport dit en effet :
« L’ILSR démontre néanmoins que le réseau logistique d’Amazon a été bâti largement grâce à des subventions publiques, le montant de ces aides dépassant, selon le rapport, les bénéfices d’Amazon depuis l’origine. En France également, les implantations des entrepôts d’Amazon bénéficient systématiquement de soutiens financiers de la part des collectivités locales.
Le même rapport rappelle que 108 000 commerces indépendants ont disparu aux États-Unis durant les quinze dernières années. Si ce déclin a de nombreuses causes, les études montrent qu’Amazon en est, de loin, la principale.
La dévitalisation de nos quartiers, de nos centres-villes, appauvrit l’économie locale, déplace ou supprime des emplois et, au final, nuit gravement à notre capacité d’organiser et d’animer notre vie collective grâce au travail et aux actions éducatives, sociales, culturelles que développent nos communautés. »
Dans l’esprit de résistance française, la place du livre, notamment grâce au prix unique et au réseau de libraires, constitue encore une place forte. « L’Express » dans un article de novembre 2020 <La filière du livre repense sa résistance face à Amazon> explique :
« D’après le Syndicat national de l’édition, [Amazon] réalise en temps normal 50% des ventes en ligne, estimation grossière, ce qui représenterait 10 à 15% des ventes totales. Le Syndicat de la librairie française pense qu’Amazon capte « plus de la moitié » des ventes en ligne et environ 10% au total.
Les confinements, qui ont contraint les librairies à fermer, ont amené la filière à revoir sa stratégie face à la multinationale.
Elle s’est concentrée sur la communication. Ecrivains, jurys littéraires et même responsables politiques ont multiplié les appels à aider les libraires, autorisés à vendre des ouvrages précommandés (« click and collect »). »
Bien sûr les temps ont été difficiles pendant le confinement et sont restés compliquée après. Mais le modèle tient encore :
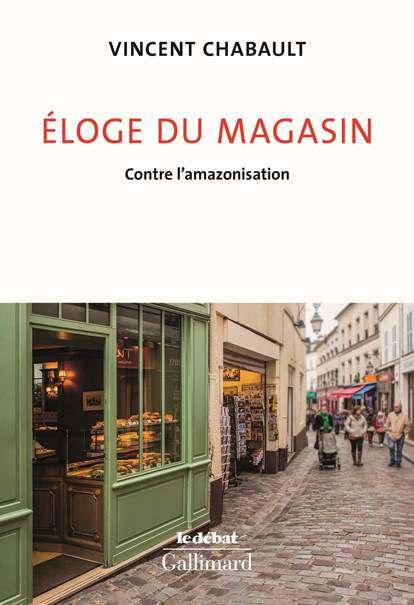 « Pour autant, le modèle de la librairie en France est bon. C’est le premier secteur qui a subi l’arrivée d’Amazon et alors qu’on taxait les libraires de ringards, rétifs à la numérisation, ils se sont bien armés. L’enjeu est de faire venir du monde en magasin par des outils numériques, et ils y travaillent », ajoute l’auteur d’un «Eloge du magasin» paru en janvier. […]
« Pour autant, le modèle de la librairie en France est bon. C’est le premier secteur qui a subi l’arrivée d’Amazon et alors qu’on taxait les libraires de ringards, rétifs à la numérisation, ils se sont bien armés. L’enjeu est de faire venir du monde en magasin par des outils numériques, et ils y travaillent », ajoute l’auteur d’un «Eloge du magasin» paru en janvier. […]
Nous ne voulons pas remplacer les conseils d’un ou d’une libraire par ceux d’un algorithme, ni collaborer à un système qui met en danger la chaîne du livre par une concurrence féroce et déloyale », détaillent-ils. »
Mais au pays du prix unique du livre, la concurrence se joue sur les frais d’expédition, systématiquement fixés à 0,01 euro chez Amazon.
Cette problématique des frais d’envoi est développée dans un <article du 21 mai 2021> : Le gouvernement veut imposer partout sur internet un même prix, frais de port inclus, pour tous les livres neufs.
Anne Martelle, présidente du Syndicat de la librairie française et directrice générale de la librairie Martelle à Amiens explique :
« Même si les libraires sont présents de longue date sur Internet, le développement de leur site est freiné par la politique de dumping des grandes plateformes comme Amazon. Quand Amazon facture un centime d’euro pour expédier un livre, il en coûte pour le même envoi, en moyenne 6,50 euros au libraire
Et si le libraire répercute ces frais d’expédition à son client, il le perd au profit d’Amazon. Et si le libraire prend en charge les frais d’expédition, il perd de l’argent à chaque fois qu’il expédie un livre. C’est une situation intenable pour libraires et puis, il faut noter qu’il n’y a que sur le livre qu’Amazon offre la quasi-gratuité de l’expédition sans minimum d’achat. Ça prouve qu’il existe de la part de cette société une volonté délibérée d’attaquer les libraires indépendants et d’attaquer aussi de manière détournée le prix unique du livre. »
L’illusion de la gratuité est d’une grande perversité, elle cache toujours un coût que quelqu’un doit payer. Quelquefois c’est même le climat et la biodiversité qui paie :
« Le sujet qui est actuellement en discussion prévoit plutôt une tarification minimale, ce qui obligerait Amazon à ne plus facturer un centime d’euro, mais peut-être quatre, cinq euros ou trois euros, ça rétablirait l’équilibre. Ça permettrait aussi de remettre dans le jeu le vrai prix d’un transport, quel qu’il soit, du livre ou d’autre chose. Le fait [pour Amazon] de facturer un centime d’euro donne aux clients l’impression que ça ne coûte rien, ni à l’environnement ni à son porte-monnaie. Eh bien, c’est faux. »
« Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes. » Bossuet
<1580>
- Une menace pour l’économie
-
Mercredi 23 juin 2021
« Pause »Un jour sans mot du jour nouveauIl faut aussi savoir se reposer, ne pas écrire de mot jour et laisser en suspens et dans la réflexion ceux déjà écrits.
 I
I<mot du jour sans numéro>
-
Mardi 22 juin 2021
« Notre dépendance à Amazon n’est pas algorithmique, mais bien humaine »Aurélie JeanDans le mot du jour du 15 juin, j’insistais sur l’énorme pression que mettait Jeff Bezos sur ses collaborateurs proches : les informaticiens et logisticiens qui développent les algorithmes et imaginent la stratégie pour faire encore grandir Amazon : « Vous devez être capable d’agir trois fois plus vite que les gens les plus compétents »
Hier, c’était plutôt le remplacement des humains par des solutions de plus en plus automatisées et plus robotisées qui constituait le sujet central.
Mais pour l’instant, la réussite d’Amazon dépend en grande partie de la productivité des « associés des robots » qui travaillent dans les entrepôts.
« Le UN » a demandé à une numéricienne, Aurélie Jean d’écrire un article qui a pour titre « L’asservissement est ailleurs ».
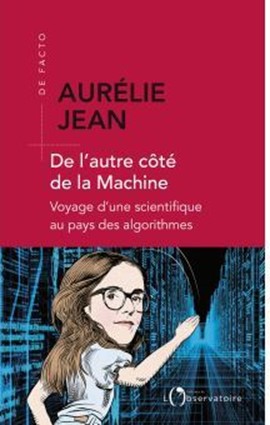 Aurélie Jean est l’auteure d’un livre qui a été très remarqué : « De l’autre côté de la machine, Voyage d’une scientifique au pays des algorithmes ». Livre qui avait notamment fait l’objet de deux émissions de France Culture : <Le virtuel, porte d’entrée sur le réel ?> et <Je recherche à démystifier les algorithmes>
Aurélie Jean est l’auteure d’un livre qui a été très remarqué : « De l’autre côté de la machine, Voyage d’une scientifique au pays des algorithmes ». Livre qui avait notamment fait l’objet de deux émissions de France Culture : <Le virtuel, porte d’entrée sur le réel ?> et <Je recherche à démystifier les algorithmes>
Elle conclut son article dans le UN ainsi :
« Reste que derrière cette logistique, si finement conçue soit-elle, il n’y a pas que des algorithmes. Il se trouve toujours des individus en chair et en os qui décident de la stratégie. Il se cache, aussi, des hommes et des femmes qui travaillent, pour certains, dans l’ombre d’une gestion difficile. Troubles musculo-squelettiques, pression de toujours faire mieux, et productivité inconditionnellement croissante, les terribles conditions auxquelles sont soumis les travailleurs des entrepôts font couler beaucoup d’encre. Contre toute attente, notre dépendance à Amazon n’est pas algorithmique, mais bien humaine. »
Ce site qui a pour nom « siècle digital » a publié le 2 juin 2021 : « Les employés d’Amazon se blessent plus que dans les autres entreprises »
Dans cet article on lit :
« Le Strategic Organizing Center (SOC), qui regroupe quatre syndicats américains, a dévoilé (pdf) le mardi 1er juin 2021 un chiffre inquiétant concernant Amazon. En effet, dans son rapport, elle indique que le taux de blessures dans les entrepôts de la firme est presque deux fois plus élevé que dans ceux des autres entreprises du même secteur.
Si Amazon est le deuxième employeur des États-Unis, il détient la première place dans une tout autre catégorie : la fréquence à laquelle ses travailleurs se blessent. Le rapport du SOC divulgue qu’en 2020, il y a eu 5,9 blessures graves durant 200 000 heures de travail, représentant 100 employés des entrepôts d’Amazon. Un chiffre qui est presque 80% plus élevé que dans les autres firmes.
À titre de comparaison, son concurrent Walmart enregistre 2,5 blessures pour 200 000 heures travaillées, soit moitié moins que la société de Seattle. Cela oblige certains employés à s’absenter, ou à faire des tâches moins contraignantes pour ne pas se blesser davantage. »
Toutefois l’objectivité doit nous faire constater qu’Amazon a fait du progrès, avant c’était pire :
« Malgré tout, le taux de blessures d’Amazon est moins important qu’en 2019. Un rapport du Center for Investigative Reporting, publié par Reveal, révèle qu’il y a deux ans, l’entreprise enregistrait 7,7 blessures graves pour 100 employés.
Même si une diminution peut être constatée, les chiffres de 2020 n’en restent pas moins inquiétants, et Amazon est toujours la firme avec les résultats les plus mauvais. Par ailleurs, les révélations qui ont été faites concernant les mauvaises conditions de travail au sein de ses entrepôts n’arrangent pas son cas. Jeff Bezos a récemment admis que l’entreprise devait en faire plus pour ses employés, notamment pour atteindre son objectif, qui est de réduire de 50% les accidents du travail d’ici 2025.
« Bien qu’un incident soit un incident de trop, nous apprenons et constatons en permanence des améliorations grâce à des programmes ergonomiques, des exercices guidés sur les postes de travail des employés, des équipements d’assistance mécanique, la configuration et la conception de ces postes, ainsi que la télématique des chariots élévateurs et des rampes, pour n’en nommer que quelques-uns », a déclaré la porte-parole d’Amazon, Kelly Nantel, dans un rapport.
Il reste à voir si les efforts d’Amazon pour diminuer les accidents de travail, mais aussi améliorer le quotidien de ses travailleurs s’avèreront bénéfiques. Pour le moment, les « AmaZen », de petites cabines censées réduire le stress de ses employés, n’ont pas eu l’effet escompté et n’ont séduit ni les internautes ni les travailleurs. »
Je dois reconnaître que depuis que je m’intéresse vraiment à Amazon j’apprends énormément de choses : par exemple l’invention des AmaZen.
« Slate » qui reprend une information de la BBC se sent obligé de mettre en sous-titre « Ceci n’est pas un canular » (article du 29 mai 2021).
 « Amazon a annoncé à la mi-mai la mise en place d’un dispositif visant officiellement à améliorer leur bien-être. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, l’entreprise a rendu publique la création de cabines nommées AmaZen, destinées à favoriser la santé mentale du personnel de ses entrepôts.
« Amazon a annoncé à la mi-mai la mise en place d’un dispositif visant officiellement à améliorer leur bien-être. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, l’entreprise a rendu publique la création de cabines nommées AmaZen, destinées à favoriser la santé mentale du personnel de ses entrepôts.
AmaZen est partie intégrante du programme Working Well, dont l’objectif est de fournir aux employé·es «des activités physiques et intellectuelles, des exercices de bien-être, et des conseils nutritionnels». Utilisables pendant les pauses, les cabines décrites par la BBC permettent de visionner de courtes vidéos qui incluent des séances de méditation, des scènes calmes avec des sons apaisants…
Face au déferlement de réactions négatives qui ont suivi sa publication sur Twitter, la vidéo a été rapidement supprimée par Amazon. On pouvait y voir une sorte de cabine téléphonique sans téléphone, mais avec une chaise, un petit écran et quelques plantes en pot. Au plafond, un ciel bleu orné de jolis nuages blancs.
Une telle installation semble en effet bien dérisoire face aux conditions de travail souvent exécrables proposées dans les entrepôts. Le fait que l’AmaZen semble y avoir été déposée un peu au hasard, comme un cheveu sur la soupe, est assez symbolique : cela ressemble à un coup de communication foireux plutôt qu’à une réelle tentative de bien traiter celles et ceux qui suent sang et eau pour la firme de Jeff Bezos.
Avant d’être supprimée, la vidéo avait été téléchargée par des internautes. Depuis, elle fait l’objet de nombreux détournements, qui insistent sur le côté dystopique de l’AmaZen ou imaginent qu’il s’agit en fait d’une cabine prévue pour que le staff de l’entrepôt puisse aller pleurer en toute discrétion. »
Aux États-Unis, il y a bien eu des employés qui ont voulu créer un syndicat pour défendre les employés d’Amazon. Mais les salariés ont voté contre cette initiative à une large majorité.
Ce sujet a été abondamment commenté sur les médias français :
RTL : <États-Unis : pourquoi des ouvriers Amazon ont-ils refusé la création d’un syndicat ?>
Challenges : <Echec de la tentative historique de syndicalisation d’un entrepôt d’Amazon aux Etats-Unis>
Le Monde <Le syndicalisme ne fait pas son entrée chez Amazon aux Etats-Unis>
Ce vote concernait les salariés de l’entrepôt Amazon de Bessemer, bourgade pauvre située au sud de l’ancienne cité minière de Birmingham, en Alabama. Le rejet a été net : Le non à la syndicalisation l’a emporté avec 1 798 voix, contre 738 votes en faveur du RWDSU, le syndicat national de la distribution que des employés voulaient rejoindre.
Le monde explique cependant :
« Amazon a mené une campagne agressive contre la syndicalisation de son site, qui aurait été une première sur le territoire des Etats-Unis : par le biais des réseaux sociaux, elle demandait à ses salariés l’intérêt qu’ils avaient à dépenser 500 dollars de cotisation par an. L’entreprise de Jeff Bezos a pu profiter aussi des scandales de corruption qui ont frappé, depuis deux ans, les syndicats de l’automobile à Detroit. »
Mais, il faut sur ce sujet être équilibré. Amazon n’est pas la seule entreprise américaine à ne pas avoir de syndicats. Boeing, entre autres, est dans le même cas. Pourtant Joe Biden s’est ouvertement déclaré pro-syndicat.
Probablement faut-il en revenir à ce constat du grand écrivain John Steinbeck qui disait :
« Il n’y a pas de socialisme en Amérique, parce qu’on n’a pas de prolétaires mais des capitalistes momentanément dans l’embarras. »
C’était le mot du jour du <4 mars 2020>
Plus prosaïquement, Alec MacGillis, journaliste au New Yorker et auteur d’un livre d’enquête sur Amazon sur lequel je reviendrais, écrit :
« Seuls 5 % des salariés sont syndiqués aux États-Unis, et Amazon a une telle puissance qu’il lui est facile de manipuler les opinions des uns et des autres. Mais cela tient aussi à la nature des emplois chez Amazon : ce sont des jobs de transition où les gens restent un an en moyenne, à s’user le corps pour 15 dollars de l’heure. Personne ne fait carrière chez Amazon, donc pourquoi s’engager dans un syndicat ? »
Selon une enquête du New York Times repris par ce <site> une des explications du management imposé par Jeff Bezos aux salariés de ses entrepôts, viendrait de la conviction de ce dernier que ses employés sont fondamentalement paresseux :
« Selon une longue enquête du New York Times, reprise par Business Insider, cette mécanique certes bien huilée et hautement profitable mais humainement destructrice ne trouverait pas seulement sa source dans la pure nécessité économique et productiviste.
Sans pitié pour des employés dont elle trace implacablement les moindres mouvements (pause pipi incluse), le système mis en place par la firme découlerait également de la croyance intime de Jeff Bezos en la fainéantise consubstantielle à l’être humain.
C’est ce qu’explique au quotidien new-yorkais David Niekerk. L’Américain connaît son sujet: avant de quitter l’«everything store» après plus de seize ans de loyaux services, il a participé à la conception de l’architecture physique et logicielle quasi carcérale de ses entrepôts géants.
Selon Niekerk, dont les révélations sont sans pitié, Bezos croit ainsi fermement que les salariés s’engagent progressivement dans une «marche vers la médiocrité». «Il pouvait par exemple dire que la nature humaine est de dépenser le moins d’énergie possible pour obtenir ce que l’on veut», rapporte ainsi crûment l’Américain.
L’un des risques que redoutait –ou fantasmait– particulièrement Bezos était celui d’une masse laborieuse s’enfonçant dans cette économie de moyens et l’insatisfaction.
Selon le New York Times, c’est la raison pour laquelle la firme organise ses ressources humaines autour du court-terme, n’offre volontairement que peu de perspectives d’évolution interne aux personnes occupant le bas de l’échelle, voire les incite financièrement à aller voir aussi rapidement que possible si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs.
Les salariés sont ainsi traités comme des robots dispensables –quand les vraies machines, elles, progressent à grands pas. Leur productivité est tracée minute par minute et geste après geste par le système informatique de la plateforme, et la moindre journée de méforme peut être sanctionnée sans même qu’un superviseur humain n’ait à intervenir.
Dans sa guerre contre cette « marche vers la médiocrité», telle que définie par Bezos, la firme essore tant les personnes qu’elle emploie que certains cadres de l’entreprise craignent qu’elle ne finisse pas assécher tout à fait le réservoir de cette main-d’œuvre corvéable à merci.
Avant de quitter la tête d’Amazon pour aller chatouiller ses rêves d’apesanteur, un Bezos grand seigneur –au sens presque féodal du terme– a annoncé qu’Amazon se lançait dans un plan massif pour améliorer les conditions de travail au sein de ses entrepôts. »
Je finirai par une réflexion un peu désabusée qui n’a peut-être rien à voir avec le sujet abordé aujourd’hui. Quoi que, j’ai des doutes. C’est une histoire de chiffres.
Selon Capital près d’un Français sur trois (quasiment 22 millions de Français) achète sur Amazon.
Le corps électoral français, selon l’INSEE, comptait 47,7 millions d’électeurs en février 2020.
Nous avons appris qu’il y a eu une abstention aux élections régionales de plus de 66 %, donc moins de 34% de votants.Or, 34% de 47,7 millions représentent 16,2 millions d’électeurs.
Il existe donc en France plus de consommateurs pour acheter les produits qui sortent des entrepôts Amazon que de citoyens qui pensent qu’il y a une démocratie à honorer et des droits politiques et sociaux à préserver.
<1581>
-
Lundi 21 juin 2021
« La vocation des hommes n’est pas d’occuper les emplois pénibles, le monde serait meilleur, s’il y avait plus de médecins ou de profs – au moins un par enfant – rémunérés grâce à un revenu universel. »Jeff Bezos cité par Benoit BerthelotBenoit Berthelot est un journaliste spécialiste des nouvelles technologies au magazine Capital. Il est l’auteur de l’enquête : « Le monde selon Amazon ».
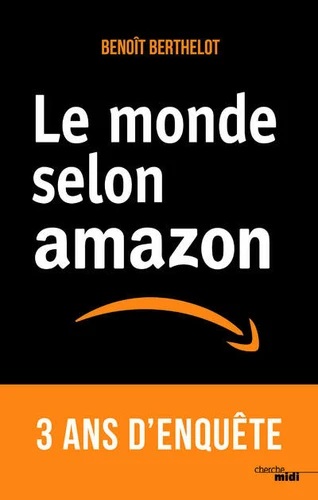 « Le Un » a publié un entretien avec lui, dont le titre est « L’avenir selon Jeff Bezos »
« Le Un » a publié un entretien avec lui, dont le titre est « L’avenir selon Jeff Bezos »
Benoit Berthelot explique d’abord le côté singulier d’Amazon à côté des autres entreprises des Gafa : l’utilisation massive de main d’œuvre.
« [Jeff Bezos] conçoit Amazon comme une entreprise proche des gens. Et de fait, Amazon allie les éléments actuels les plus high-tech – algorithmes, intelligence artificielle ou électronique – à des éléments typiques de l’usine traditionnelle. Si vous allez chez Google ou Facebook, vous trouverez quelques dizaines de milliers d’ingénieurs, Amazon de son côté emploie plus d’un million de cols-bleus. C’est une entreprise monde qui marie aussi bien des éléments du XXème et du XXIème siècle, le salariat de masse et les nouvelles technologies, le territoire et le cloud, les axes routiers et les autoroutes de l’information »
Et en effet, nous avons vu que dans les immenses entrepôts, il y avait encore beaucoup d’humains qui travaillaient à côté des robots.
Le chef robotique d’Amazon, Tye Brady avait même une vision symphonique de ce travail commun.
Mais dans l’esprit de Jeff Bezos, la symphonie de ses entrepôts a vocation dans l’avenir à faire de moins en moins appel aux humains,
« Amazon investit massivement en vue d’avoir les entrepôts les plus connectés possibles : en quelques années, Amazon est passé de 7 à 5 employés pour un robot , et ce ratio va continuer à se resserrer, pour que la présence humaine soit de moins en nécessaire dans ses entrepôts »
Même les livraisons, dans sa vision d’avenir, devront économiser la ressource humaine :
 « Jeff Bezos a parié très tôt sur les livraisons par drone, mais celles-ci paraissent difficiles à mettre en œuvre. En revanche, on peut penser que les véhicules autonomes pourront être utilisés pour livrer des colis à moindre coût. Amazon emploie déjà un robot à six roues, Scout, dans quelques villes test pour effectuer des livraisons »
« Jeff Bezos a parié très tôt sur les livraisons par drone, mais celles-ci paraissent difficiles à mettre en œuvre. En revanche, on peut penser que les véhicules autonomes pourront être utilisés pour livrer des colis à moindre coût. Amazon emploie déjà un robot à six roues, Scout, dans quelques villes test pour effectuer des livraisons »
Bien sûr cela aura pour conséquence des licenciements de masse. :
« Amazon a déjà lancé un programme de reconversion de ses salariés vers des métiers de la santé ou de l’éducation. Jeff Bezos a affirmé que la vocation des hommes n’était pas d’occuper les emplois pénibles, mais que le monde serait meilleur, s’il y avait plus de médecins ou de profs – au moins un par enfant -rémunérés grâce à un revenu universel. »
C’est une vision résolument progressiste !
Il faut constater cependant que pour l’instant, Amazon implante des entrepôts dans des territoires en présentant deux arguments : le premier est qu’il pourra ainsi mieux livrer ses clients, le second prétend qu’il crée ainsi de nombreux emplois.
Le premier peut s’entendre.
Le second est plus problématique. Nonobstant que la création d’emploi d’Amazon n’est pas nette car la conséquence de son développement conduit à des suppressions d’emplois dans d’autres commerces. Il y a des discussions sur le fait de savoir si le solde est positif ou négatif. Mais le plus problématique est que ces emplois sont destinés à disparaître.
Je m’interroge sur la multiplication d’emplois de professeurs et de médecin payés grâce à un revenu universel, c’est-à-dire, probablement, très modestement. Il va de soi que la rémunération de Jeff Bezos, quant à elle, n’a que vocation à croitre.
En dehors de ce sujet de la rémunération, est-il envisageable, même avec une formation solide et performante, de pouvoir faire évoluer les femmes et hommes qui travaillent dans ces entrepôts vers des métiers de professeurs, de médecins ou d’infirmiers ?
Je ne voudrais pas apparaître comme le défenseur des métiers pénibles, mais je m’interroge : tout cela est-il bien réaliste ?
Il y encore un peu de temps : « Amazon estime que le remplacement de ses employés par des robots prendra au moins dix ans »
« Si l’utilisation future de l’intelligence artificielle et de la robotique au sein du réseau logistique d’Amazon ne fait aucun doute, reste à savoir quand ces machines prendront en charge la totalité du travail sur les plateformes de la société américaine. La réponse semble toutefois actée, à en croire le Monsieur robots d’Amazon, Scott Anderson. Selon lui, l’automatisation totale des chaines de préparation de commandes au sein des entrepôts de la société ne sera pas effective avant un délai d’au moins dix ans.
Malgré la place avancée prise par les robots et l’automatisation dans des entreprises comme Amazon, il semblerait que le développement de robots capables de gérer correctement et sans encombre une commande de A à Z soit jusqu’ici compliqué. Leurs actions sont pour le moment limitées aux tâches répétitives ou au traitement de certaines marchandises. L’intervention humaine semble quant à elle encore indispensable à la réalisation de travaux spécifiques de reconnaissance et de manipulation, notamment dans la gestion de produits frais. »
<1580>
-
Vendredi 18 juin 2021
« Une symphonie d’humains et de machines travaillant ensemble. »Tye Brady chef robotique d’Amazon,Au centre de la réussite d’Amazon, se trouve l’entrepôt ultra moderne, construit, réalisé et pensé avec les outils modernes.
 Car Amazon n’est pas une épicerie, ce n’est pas non plus une librairie avec des femmes et des hommes qui lisent des livres, possèdent une culture littéraire, une sensibilité artistique et qui pourront vous conseiller et vous trouver le livre que vous aimerez. Et il en va de même pour la musique ou tous les autres produits vendus.
Car Amazon n’est pas une épicerie, ce n’est pas non plus une librairie avec des femmes et des hommes qui lisent des livres, possèdent une culture littéraire, une sensibilité artistique et qui pourront vous conseiller et vous trouver le livre que vous aimerez. Et il en va de même pour la musique ou tous les autres produits vendus.
L’important pour Amazon c’est d’avoir tous les produits, tous les livres que les gens veulent acheter
Si vous avez besoin d’un conseil, Amazon se tournera vers les millions de données qu’il a engrangés dans ses big data. Il pourra ainsi dire quels sont les produits les plus vendus, mais aussi dans des domaines beaucoup plus ciblés que si vous achetez ce livre, peut être que cet autre livre peut vous intéresser parce qu’il existe 10, 15 ou peut être 100 personnes qui ont acheté le premier livre et qui ont aussi acheté le second. Nul besoin de faire appel à un spécialiste ou simplement à quelqu’un qui a un peu lu ce livre pour en connaître le contenu et se trouve capable, grâce à son expérience de faire des liens cognitifs avec un autre livre.
Le numérique ouvre d’autres perspectives, mais pour cela il faut penser de façon différente comme l’avait dit jadis Steve Job : « think différent ».
 Jeff Bezos et ses collaborateurs ont mis en pratique cette manière d’être disruptif.
Jeff Bezos et ses collaborateurs ont mis en pratique cette manière d’être disruptif.
Je reconnais que l’être de culture peut être choqué voire révolté de la manière dont j’ai décrit les conseils de lecture que sait donner le numérique. Il faut être juste : grâce à l’intelligence artificielle il est possible d’analyser le contenu d’un ouvrage et s’il s’agit d’un document technique d’en tirer un jugement pertinent. Mais revenons au cœur du sujet : l’entrepôt Amazon.
Quand vous disposez du numérique, d’immenses bases de données et
- que vous êtes capables d’identifier chaque produit dont vous disposez par un code barre
- que vous êtes capable de repérer chaque petit endroit sur une étagère, dans un lieu précis de l’entrepôt. Bref de connaître exactement une adresse d’une cellule de rangement
L’efficacité commande à ce que vous rangiez de manière différente. Vous n’allez plus ranger les livres avec les livres et les produits vaisselles entre eux. Vous allez simplement ranger le produit qui vous arrive, au premier endroit libre qui peut l’accueillir. C’est ce qu’on appelle le rangement aléatoire. Grâce aux outils numériques vous trouverez le produit que vous cherchez immédiatement.
Et je vous laisse visionner <cette video> qui vous expliquera beaucoup de choses et à 3:50 vous révélera pourquoi cette manière de ranger, de manière aléatoire et répartiesur tout le site, est beaucoup plus efficace et rapide pour mobiliser les produits au moment des commandes.
Sur nos ordinateurs, nous autres archaïques avons l’habitude comme à l’époque des dossiers papier, de ranger nos fichiers dans des répertoires, sous répertoires, sous sous répertoires etc.
C’est très bien de faire ainsi, c’est rassurant, cela nous rappelle notre jeunesse. Mais ce n’est pas efficace. Ce qu’il convient de faire, c’est de donner des noms précis et intelligibles aux fichiers puis de les enregistrer n’importe où ou plutôt dans un répertoire unique. Ensuite vous utilisez les outils de recherche numérique pour retrouver votre fichier. C’est beaucoup plus efficace et rapide.
Amazon n’est donc pas une librairie, ni une épicerie mais une formidable, une exceptionnelle entreprise de logistique.
Ces entrepôts se modernisent de plus en plus, les robots prennent de plus en plus de place et la place de l’humain régresse.
D’ailleurs les entrepôts sont désormais divisés en deux : l’espace des robots et l’espace des humains, avec à la frontière des lieux d’échanges.
Jeff Bezos qui se voit comme bienfaiteur de l’humanité souhaite que les robots déchargent les humains de toutes les tâches ingrates et pénibles pour leur laisser le temps et le loisir de s’occuper de tâches et d’activités intéressantes et valorisantes.
Actuellement il existe encore beaucoup de tâches ingrates faites par les humains mais ils sont aidés par les robots.
 Et j’ai trouvé la phrase que j’ai mise en exergue sur <cette page> sur laquelle on lit :
Et j’ai trouvé la phrase que j’ai mise en exergue sur <cette page> sur laquelle on lit :
« Amazon robotic chief, Tye Brady, has an optimistic view: « The efficiencies we gain from our associates and robotics working together harmoniously — what I like to call a symphony of humans and machines working together — allows us to pass along a lower cost to our customer. »
Ce qui doit pouvoir se traduire ainsi :
« Le chef robotique d’Amazon, Tye Brady, a une vision optimiste : « L’efficacité que nous tirons de la collaboration harmonieuse de nos associés et de la robotique – ce que j’aime appeler une symphonie d’humains et de machines travaillant ensemble – nous permet de répercuter un coût inférieur sur notre client. »
Vous verrez dans cette vidéo «Amazon ou le territoire des robots » une intervention de cet homme résolument optimiste qu’est Tye Brady.
On m’a raconté que les élèves ingénieurs revenant d’un stage dans un entrepôt Amazon sont le plus souvent fascinés par l’intelligence et l’organisation qu’ils y rencontrent.
Amazon n’appelle pas ces lieux des entrepôts mais des « centres de distribution »
L’amélioration, la robotisation de plus en plus poussé n’ont qu’un but : satisfaire toujours mieux le consommateur à un prix toujours plus concurrentiel. La conséquence en est un chiffre d’affaires et des bénéfices en perpétuel hausses.
Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. La pression et les conditions de travail des associés humains des robots peut être pénible comme le raconte sur « Brut » une ancienne employée
Dans « Le Un » est cité un extrait de «Nomadland», le livre de Jessica Bruder qui avait fait l’objet du <mot du jour du 7 mars 2019> et qui parle de ces seniors qui voyagent dans leur mobil home à travers les États-Unis pour trouver un job.
Jessica Bruder raconte son expérience dans ces entrepôts d’Amazon dans lesquels, même les robots peuvent sortir de leur rôle et participer à des actions anarchiques. J’en partage un extrait :
« Ma formation commence un mercredi matin : trente et une personnes sont réunies dans une salle de classe sur le site logistique d’Amazon. « Vous allez effectuer un travail très physique, nous prévient notre instructrice. Vous allez sans doute vous agenouiller mille fois par jour, et je n’exagère pas. Fessiers en acier, nous voilà ! Compris ? » Des ricanements éclatent dans l’assistance. […]
Notre formatrice, elle-même nomade en camping-car [explique…] « Les campeurs sont appréciés pour leur intégrité, leur ponctualité et la qualité de leur travail. Nous savons ce qu’est le boulot. Et Amazon compte sur des gens comme nous. Des gens qui ont de l’expérience, et qui assurent un max ! », […]
Tous ensemble, nous allons être formés pour travailler dans une unité appelée Inventory Control Quality Assurance, ou ICQA. Le boulot n’est pas très compliqué en soi : il s’agit de scanner la marchandise pour vérifier l’état de l’inventaire. Mais nous découvrirons très vite que notre entrepôt (le plus grand de tout le réseau Amazon, d’après notre formatrice, et comparable en taille à plus de dix-neuf stades de football réunis) est un véritable labyrinthe. Plus de trente-trois kilomètres de tapis roulants acheminent des paquets à travers le site. Ils font un fracas de train de marchandises et s’enrayent pour un rien. […]
Durant notre formation, nous apprenons également que notre usine est l’un des dix centres de distribution Amazon où est testée l’utilisation de robots « sherpas ». Ces engins orange pèsent plus de cent vingt kilos et ressemblent à des aspirateurs automatiques géants. Techniquement, ce sont des « unités motrices » mais, pour la plupart des employés, ce sont simplement les « Kiva », du nom du fabricant imprimé sur chacun d’eux en gros caractères d’imprimerie. Ils se déplacent à l’intérieur d’une immense cage sombre – après tout, les robots n’ont pas besoin de lumière pour voir – dans une zone appelée « atelier Kiva ». Leur mission : transporter des blocs de linéaires garnis de marchandises vers les postes de travail des humains, situés en périphérie de leurs cages. Personne, hormis les membres de l’unité « Amnesty », n’est autorisé à accéder à l’atelier Kiva, même quand les produits dégringolent des étagères. […]
 J’ai déjà entendu tout et son contraire à propos de ces fameux robots Kiva. Ils incarnent soit le fantasme de tout expert de l’efficacité, une innovation censée libérer l’humanité des besognes exténuantes, soit le funeste présage d’une dystopie où le travail manuel deviendra obsolète et le fossé de séparation entre les riches et les pauvres, un abîme infranchissable. La réalité, moins polémique et plus cocasse, est digne d’une version contemporaine des Temps modernes de Charlie Chaplin. Nos formateurs nous régalent d’anecdotes de robots indisciplinés. Comme le jour où les Kiva ont tenté de s’échapper par un trou dans le grillage. Ou la fois où ils ont essayé d’emporter une échelle sur laquelle était monté un employé. En de rares occasions, il a pu arriver que deux Kiva se rentrent dedans – alors qu’ils transportaient chacun trois cent soixante-quinze kilos de matériel – tels deux supporters de foot ivres. Parfois, ils font tomber des marchandises. Et parfois, même, ils les écrasent. En avril, une bombe de spray anti-ours (grosso modo, une bombe lacrymogène puissance industrielle) est tombée d’un linéaire pendant son transport et s’est fait rouler dessus par un autre robot. L’entrepôt a dû être évacué. Les infirmiers ont soigné sept ouvriers à l’extérieur. Un autre a été conduit aux urgences, en proie à des problèmes respiratoires.[…]
J’ai déjà entendu tout et son contraire à propos de ces fameux robots Kiva. Ils incarnent soit le fantasme de tout expert de l’efficacité, une innovation censée libérer l’humanité des besognes exténuantes, soit le funeste présage d’une dystopie où le travail manuel deviendra obsolète et le fossé de séparation entre les riches et les pauvres, un abîme infranchissable. La réalité, moins polémique et plus cocasse, est digne d’une version contemporaine des Temps modernes de Charlie Chaplin. Nos formateurs nous régalent d’anecdotes de robots indisciplinés. Comme le jour où les Kiva ont tenté de s’échapper par un trou dans le grillage. Ou la fois où ils ont essayé d’emporter une échelle sur laquelle était monté un employé. En de rares occasions, il a pu arriver que deux Kiva se rentrent dedans – alors qu’ils transportaient chacun trois cent soixante-quinze kilos de matériel – tels deux supporters de foot ivres. Parfois, ils font tomber des marchandises. Et parfois, même, ils les écrasent. En avril, une bombe de spray anti-ours (grosso modo, une bombe lacrymogène puissance industrielle) est tombée d’un linéaire pendant son transport et s’est fait rouler dessus par un autre robot. L’entrepôt a dû être évacué. Les infirmiers ont soigné sept ouvriers à l’extérieur. Un autre a été conduit aux urgences, en proie à des problèmes respiratoires.[…]
Je commence à scanner les codes-barres d’une myriade d’articles allant des godemichés (fabricant : « Cloud 9 », modèle « Delightful Dong ») aux kits de revêtement adhésif pour armes à feu de chez Smith & Wesson (texture lisse ou granulée) en passant par les cartescadeaux cinéma à 25 dollars (il y en a cent quarante-six au total, et il faut toutes les scanner). Un jour, je vois un robot Kiva transportant un bloc de linéaires se diriger vers mon poste de travail. Des relents nauséabonds me sautent aux narines à son approche. Bizarrement, cette odeur m’évoque… la fac. Une fois sa cargaison déposée devant moi, je découvre dix-huit boîtes d’encens au patchouli attendant d’être scannées. Leur parfum m’imprègne les doigts. Je lutte contre la nausée, termine mon travail et appuie sur un bouton pour renvoyer le robot. Trois autres attendent déjà leur tour, rangés derrière lui telle une fratrie de labradors bien dressés. Tandis que le bloc d’étagères parfumées s’éloigne, un autre, frais et inodore, prend sa place. Hélas, cinq minutes plus tard, le robot patchouli revient. Je re-scanne toutes les boîtes d’encens et le renvoie une deuxième fois. Pour le voir revenir quelques minutes plus tard. Je me pose une question : puis-je m’appuyer sur cette expérience pour affirmer que les humains sont plus intelligents que les robots ? ou le robot me traite-t-il par le mépris en m’imposant de revérifier sans cesse mon travail, histoire de choisir le meilleur résultat entre les trois ? »
Dans une approche rapide, Amazon est attentif au confort et à l’hygiène de ses employés. Si on creuse un peu, il semble surtout qu’Amazon tient à conserver une main d’œuvre efficace et servile pour continuer à faire tourner l’entrepôt et les livraisons à une cadence infernale :
 « En plus des robots rebelles, il nous est recommandé de faire attention au surmenage. « PRÉPAREZ-VOUS AUX COURBATURES ! » met en garde une affiche dans la salle. L’un de nos instructeurs nous explique d’un air goguenard qu’on peut s’estimer heureux d’avoir connu une bonne journée au travail « si on n’a pas dû avaler plus de deux cachets de Tylenol le soir ». Des distributeurs automatiques proposent des boîtes d’analgésiques génériques aux employés. Si vous préférez une marque précise, ou si vous carburez plutôt aux boissons énergisantes, vous pouvez aussi en acheter en salle de pause. […] Un immense calendrier révèle qu’à ce stade du mois de novembre, il y a eu au moins un « incident » par jour lié à des problèmes de sécurité. Notre guide nous désigne le « mur de la honte » où sont affichés les profils anonymes d’anciens travailleurs déshonorés. Chacun est illustré d’une image au format clipart : la silhouette noire d’un crâne barrée du mot « ARRÊTÉ » ou « LICENCIÉ » en lettres rouges. Un employé a volé des iPhone qu’il cachait dans ses boots à bouts métalliques. Un autre s’est fait prendre en train de manger de la marchandise au lieu de la ranger dans une alvéole (pour la somme de 17,46 dollars, précisait-on sur sa fiche). Le mot d’ordre est « discipline ».
« En plus des robots rebelles, il nous est recommandé de faire attention au surmenage. « PRÉPAREZ-VOUS AUX COURBATURES ! » met en garde une affiche dans la salle. L’un de nos instructeurs nous explique d’un air goguenard qu’on peut s’estimer heureux d’avoir connu une bonne journée au travail « si on n’a pas dû avaler plus de deux cachets de Tylenol le soir ». Des distributeurs automatiques proposent des boîtes d’analgésiques génériques aux employés. Si vous préférez une marque précise, ou si vous carburez plutôt aux boissons énergisantes, vous pouvez aussi en acheter en salle de pause. […] Un immense calendrier révèle qu’à ce stade du mois de novembre, il y a eu au moins un « incident » par jour lié à des problèmes de sécurité. Notre guide nous désigne le « mur de la honte » où sont affichés les profils anonymes d’anciens travailleurs déshonorés. Chacun est illustré d’une image au format clipart : la silhouette noire d’un crâne barrée du mot « ARRÊTÉ » ou « LICENCIÉ » en lettres rouges. Un employé a volé des iPhone qu’il cachait dans ses boots à bouts métalliques. Un autre s’est fait prendre en train de manger de la marchandise au lieu de la ranger dans une alvéole (pour la somme de 17,46 dollars, précisait-on sur sa fiche). Le mot d’ordre est « discipline ».
On nous demande de marcher le long de sentiers balisés au sol par du scotch vert ; si quelqu’un coupe un virage, notre guide le sermonne.
Dans les toilettes, je découvre à l’intérieur de ma cabine un nuancier de couleurs allant du jaune pâle à un terrifiant rouge marron. La légende me propose d’identifier laquelle correspond le plus à celle de mon urine. Verdict : je ne bois pas assez d’eau. »
Entre fascination et rejet, le cœur de la machine à satisfaire le consommateur nous révèle ainsi son ingéniosité mais aussi le coût humain de cette quête de l’efficacité et de la démesure »
<1579>
- que vous êtes capables d’identifier chaque produit dont vous disposez par un code barre
-
Jeudi 17 juin 2021
« Amazon, c’est bizarre à dire, est désormais obligé de faire des bénéfices. »Mounar Mahjoubi, ancien secrétaire d’État chargé du Numérique de 2017 à 2019Mounir Mahjoubi s’exprime ainsi dans « Le UN » déjà évoqué, lors d’un entretien essentiellement consacré à l’optimisation fiscale que pratique la firme de Seattle. Il insiste sur le fait que c’est par volonté d’éviter l’impôt qu’Amazon a cherché à minimiser voire effacer les bénéfices :
« Amazon, c’est bizarre à dire, est désormais obligé de faire des bénéfices. Pendant vingt ans, l’entreprise a réinvesti ses revenus de manière à présenter en permanence une situation de déficit, mais ceux-ci sont aujourd’hui tellement importants que c’est devenu impossible »
Mais au-delà de la vision fiscale, Amazon n’a pas cherché à faire des bénéficies à court terme. Amazon a commencé son activité en 1995 et a attendu presque 10 ans pour avoir ses premiers bénéfices.
Nous lisons dans article de 2004 de « L’EXPRESS » : <Amazon enfin rentable> :
« C’est un évènement pour le groupe. Pour la première fois depuis sa création en 1995, Amazon.com affiche un bénéfice net sur l’année entière. Le leader mondial du commerce électronique a réalisé un bénéfice net »
Jeff Bezos a créé une entreprise qui a fait des pertes pendant 10 ans, sans perdre la confiance de ses actionnaires.
Il est même aller plus loin : il n’a jamais payé de dividendes à ses actionnaires.
<Pourquoi Amazon ne paie pas de dividendes ?> :
« Les marchés ont des attentes différentes des différentes entreprises. Les investisseurs dans les industries matures, les banques et les entreprises de services publics s’attendent à ce qu’ils partagent la plupart de leurs bénéfices sous forme de paiements aux actionnaires – sous forme de dividendes ou de rachats.
Cependant, les investisseurs ont des attentes différentes des entreprises à forte croissance, en particulier dans le secteur de la technologie. […] Jeff Bezos n’a pas été un fan des dividendes et des rachats d’actions. Bien qu’Amazon ait procédé à des rachats d’actions dans le passé, ils sont assez faibles compte tenu de la taille de l’entreprise. Au lieu de cela, Bezos s’est penché sur les acquisitions et la croissance. Amazon dépense énormément en croissance sur certains marchés internationaux comme l’Inde. »
Jeff Bezos est indiscutablement un génie et Amazon est une entreprise qui a emmené la perfection logistique à un niveau inégalé.
C’est le contraire d’un homme d’affaire qui a une vision à court terme. Pour lui, c’est le long terme qui est essentiel. Il construit ainsi, année après année, la croissance de son entreprise par des investissements gigantesques.
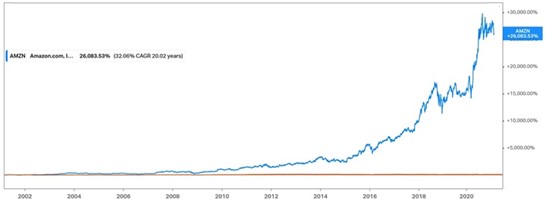 Les actionnaires et les marchés ont continué à lui faire une totale confiance. Ainsi les actionnaires ont pu bénéficier de l’augmentation du cours de l’action.
Les actionnaires et les marchés ont continué à lui faire une totale confiance. Ainsi les actionnaires ont pu bénéficier de l’augmentation du cours de l’action.
« Bien qu’Amazon ne verse actuellement pas de dividende, l’appréciation du cours de son action a plus que compensé l’absence de dividende. »
Il a pendant longtemps eu un autre problème de rentabilité : Cela coute cher de livrer chaque client, où qu’il soit dans un délai record et avec un cout concurrentiel. Au démarrage les pertes liées à l’activité de livraison d’Amazon étaient très importantes. C’est alors qu’« Andrew Jassy » qui venaient d’entrer à Amazon a eu une idée remarquable. Pour organiser les commandes, les livraisons et aussi la logistique des entrepôt, Amazon avait besoin de serveurs numériques considérables. Il fallait donc les acquérir et les installer dans des fermes à serveurs. Alors à moins de frais on pouvait augmenter la taille de ses serveurs.
<Challenge> explique :
« Né en 1968 dans une famille aisée de New York, Andrew Jassy fait ses études à Harvard avant de rejoindre Amazon en 1997, trois ans après sa création. C’est alors une simple librairie en ligne qui perd de l’argent. Qu’importe, il rejoint l’équipe et comprend vite que la clé de la réussite passe par la technologie.
Les serveurs qu’Amazon installe un peu partout pour gérer les commandes en ligne coûtent un argent fou. Comment réduire les coûts ?
Andrew Jassy propose de les rentabiliser en les louant et en vendant des services en ligne aux entreprises. C’est ainsi que naît en 2003 Amazon Web Services (AWS), dont Andrew Jassy devient directeur général en 2016. L’activité cloud est la plus rentable du groupe, pesant près des deux tiers du résultat net pour 20 % du chiffre d’affaires. »
<Les Echos> dans un article de 2020 le confirme :
« A ce propos, c’est sur AWS, la filiale « dans les nuages », que repose la rentabilité du groupe. Au début des années 2000, Jeff Bezos, le PDG, a compris que les entreprises voudraient déléguer le stockage de leurs données au lieu d’avoir leurs serveurs dans leurs locaux. C’était trop cher, trop peu efficace et pas assez flexible. En développant sa propre technologie, Amazon a pu proposer ce type de services. Il est ainsi devenu l’un des leaders mondiaux du cloud. Cette activité prospère aide à financer le développement de l’e-commerce, une activité à faible marge et qui perd de l’argent à l’international. »
Et quand Jeff Bezos décide de prendre du recul, c’est Andy Jassy qu’il choisit comme remplaçant.
<Jeff Bezos passera le flambeau à Andy Jassy (AWS)> :
« Or l’homme d’affaires a bien d’autres projets en cours. C’est d’ailleurs la raison invoquée pour expliquer qu’il va quitter son poste de CEO d’Amazon. La transition aura lieu au cours du troisième trimestre de l’année, après quoi il restera toujours présent comme président exécutif du conseil d’administration.
« Je disposerai du temps et de l’énergie dont j’ai besoin pour me concentrer sur Day One Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, Washington Post et mes autres passions ». « Je n’ai jamais eu autant d’énergie et il ne s’agit pas de prendre ma retraite », prévient Jeff Bezos (57 ans) dans sa lettre. »
Jeff Bezos a donc d’autres projets que travailler uniquement à la croissance d’Amazon. Mais il faut reconnaître ses talents de visionnaire et aussi ses capacités d’entrainement pour croire en une entreprise qui ne faisait pas de bénéfices pendant 10 ans puis en a réalisé grâce à une activité annexe.
Mais maintenant il faut qu’Amazon apprenne à gérer ses bénéficies et peut être à payer des impôts dans les États dans lesquels il réalise ses chiffres d’affaires.
<1579>
-
Mercredi 16 juin 2021
« Pause (Amazon) »Un jour sans mot du jour nouveauJ’avais déjà consacré, avant cette série commencée lundi, des mots du jour aux Gafa et à Amazon
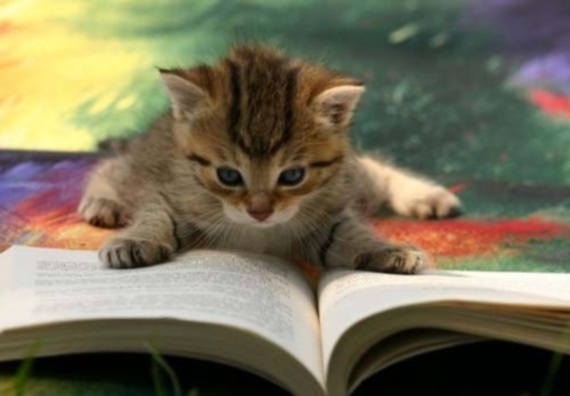 Ainsi le mot du jour du 30 mai 2013 : <En Amazonie, infiltré dans “le meilleur des mondes >.
Ainsi le mot du jour du 30 mai 2013 : <En Amazonie, infiltré dans “le meilleur des mondes >. Puis celui du 24 juin 2015 <Après l’angoisse de la page blanche, Amazon vient d’inventer l’angoisse de la page non lue. >
Et aussi celui du 6 décembre 2017 : « Amazon Go »
<mot sans numéro>
-
Mardi 15 juin 2021
«Vous devez être capable d’agir trois fois plus vite que les gens les plus compétents.»Message initial de Jeff Bezos pour recruter pour son entrepriseJeff Bezos a donc créé Amazon et mis en ligne « La plus grande librairie du monde » en 1995.
E,t il en a fait, en une vingtaine d’années, une entreprise à tout vendre.
Un journaliste américain à Bloomberg, Brad Stone avait publié en 2013 un livre enquête sur cette aventure « The Everything Store ». ce livre a été traduit en français et publié en 2014 : « Amazon : la boutique à tout vendre »
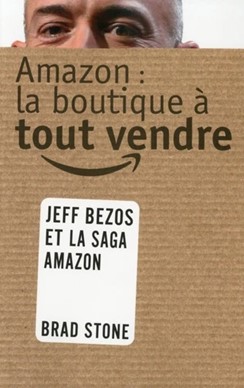 Vous pouvez acheter ce livre sur Amazon, mais le lien que je donne est vers la librairie Decitre.
Vous pouvez acheter ce livre sur Amazon, mais le lien que je donne est vers la librairie Decitre.
Le journal « Les Echos » avait publié un article <le 30 mai 2014> de la journaliste Isabelle Lesniak qui parle de ce livre. Elle avait elle-même mené une enquête sur Amazon
Au début ses idées vont se développer à New York. Il va rencontrer une entreprise financière Desco et un homme Shaw avec qui il va apprendre l’organisation et échanger des idées et élaborer des stratégies disruptives.
« Tout a commencé avec une idée. Et cette idée flottait dans l’air de la société Desco (D. E. Shaw & Co.), sise à New York… Ce fonds spéculatif avait été créé en 1988 par un ancien professeur d’informatique de l’université de Columbia, David E. Shaw. Sa grande idée était d’exploiter les ordinateurs et des formules mathématiques complexes dans le marché de la finance à grande échelle. (…) Desco n’avait rien d’une société typique de Wall Street. Shaw ne recrutait pas des financiers mais des mathématiciens et des experts scientifiques, de préférence avec un CV hors norme et des références académiques indéniables.
(…) Bezos, alors âgé de 29 ans, commençait déjà à se dégarnir. Son visage un peu pâle et creusé était typique d’un « accro » au travail. Durant les sept années qu’il avait passées à Wall Street, il en avait impressionné plus d’un par sa vive intelligence et sa détermination sans faille. [Après Princeton] il avait, en 1988, rejoint la firme financière Bankers Trust, mais ne s’y était pas plu. A la fin de l’année 1990, il se préparait à quitter Wall Street lorsqu’un chasseur de têtes le convainquit de venir voir les dirigeants d’une firme financière « pas comme les autres ».
(…) C’est grâce à Desco que Bezos développa un grand nombre des caractéristiques distinctives que les employés d’Amazon retrouveront plus tard. Discipliné, précis, il notait constamment des idées sur un carnet qu’il transportait en permanence, de peur qu’elles ne s’envolent. (…) Quelle que soit la situation, Bezos procédait « analytiquement ». Célibataire à cette époque, il entreprit de suivre des cours de danse de salon, ayant calculé que cela améliorerait ses chances de rencontrer ce qu’il appelait des femmes « n + ». (…) Shaw et Bezos caressaient l’idée de développer une boutique « où l’on trouverait de tout ». De nombreux cadres estimaient qu’il serait aisé de mettre en ligne un magasin de ce genre. Pourtant, l’idée n’avait pas semblée réaliste à Bezos – du moins dans les premiers temps. Il avait donc commencé par établir une liste de vingt rayons potentiels : fournitures de bureau, logiciels, vêtements, musique… Il lui apparut alors que le plus approprié était celui des livres. C’est un article totalement standard ; chaque exemplaire étant identique à un autre, les acheteurs savent pertinemment ce qu’ils vont recevoir. A cette époque, aux Etats-Unis, deux distributeurs principaux se partageaient le marché. Les démarches en étaient considérablement simplifiées. Et il existait trois millions de livres en circulation dans le monde. »
Mais ce n’est pas avec Shaw qu’il va développer le concept qui le rendra célèbre et riche. Entre temps il a rencontré et épousé en 1992 MacKenzie.
En 2019 leur divorce sera classé comme le plus cher de l’Histoire, mais les records sont faits pour être battus.
 Avec MacKenzie il se rend à Seattle pour monter sa librairie en ligne.
Avec MacKenzie il se rend à Seattle pour monter sa librairie en ligne.
<Seattle> est la plus grande ville (750 000 habitants en 2018) située dans l’Etat de Washington, c’est à dire au nord-ouest des Etats-Unis et au Nord de la Californie.
Cette ville était alors le siège de Boeing et d’autres entreprises de haute technologie comme Microsoft et Google.
Cette ville offre à la fois de nombreux diplômés en informatique et des taxes moindres qu’à New York ou en Californie. Wikipedia affirme qu’au départ les Bezos ont pu débuter grâce à un investissement des parents de Jeff à hauteur de 245 573 dollars.
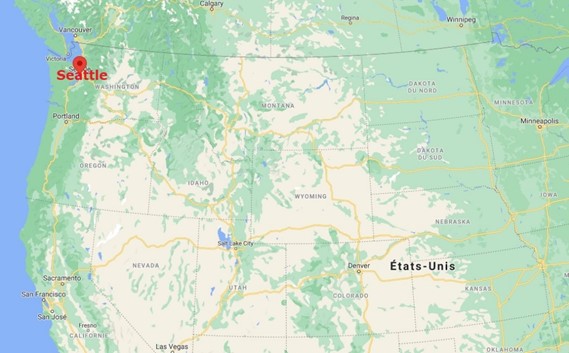 Et ils vont se lancer, l’article d’Isabelle Lesniak
Et ils vont se lancer, l’article d’Isabelle Lesniak
cite un message du 21 août 1994 sur le forum Usenet :
« Start-up bien capitalisée cherche des programmeurs C/C++ et Unix extrêmement talentueux. Objectif : aider au développement d’un système pionnier de commerce sur Internet. Vous devez avoir acquis une expérience dans la conception et la mise en place de systèmes larges et comple xes (mais aussi faciles à faire évoluer). Vous devez être capable d’agir trois fois plus vite que les gens les plus compétents. Attendez-vous à travailler avec des collègues talentueux, motivés, sérieux et intéressants. »
Bref les meilleurs d’entre les meilleurs.
Jeff et MacKenzie vont beaucoup hésiter sur le nom à donner à la plus grande librairie du monde. Vous trouverez dans l’article les différentes tentatives. Mais finalement Amazon va être choisi en référence au fleuve mais aussi parce que le mot commençait par A et qu’à cette époque, la plupart des annuaires classaient les sites par ordre alphabétique.
Au départ c’était un « truc » d’informaticiens pour les informaticiens mais pas que :
« Très vite, il apparut que la clientèle était particulière. Les premiers utilisateurs commandaient des manuels d’informatique, des bandes dessinées de la série Dilbert, des livres sur des instruments de musique anciens et des guides de sexologie. La première année, le best-seller fut un manuel de Lincoln D. Stein expliquant comme créer un site Web. Certaines commandes provenaient de soldats américains dont les troupes étaient stationnées hors du continent. Un habitant de l’Ohio écrivit pour dire qu’il vivait à 75 kilomètres de la librairie la plus proche et qu’Amazon.com était un don du ciel. Un employé de l’Observatoire européen austral au Chili avait commandé un livre de Carl Sagan – apparemment à titre de test ; il dut être satisfait car, peu après, il repassa commande de plusieurs douzaines d’exemplaires du même livre. Amazon découvrait ainsi ce phénomène que l’on appelle la « longue traîne » : le grand nombre d’articles rares qui séduisent un petit nombre de gens. »
Pour arriver à créer cette société unique, performante et rigoureuse, il crée une culture d’entreprise que je qualifierai d’absolue et exclusive :
« Peu à peu, le PDG aux cheveux clairsemés, au rire perçant et au comportement agité dévoilait sa vraie nature aux employés. Il se révélait bien plus têtu que ce qu’ils avaient perçu au départ. Il supposait de manière présomptueuse qu’ils seraient constamment prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes et sans la moindre réserve.
(…) Bezos était déterminé à insuffler dans sa société une culture particulière : celle des économies à tout crin. Les bureaux construits à partir de portes et les contributions minimales aux frais de parking en faisaient partie. Au premier étage du nouveau bâtiment, un stand de café distribuait des cartes de fidélité permettant aux clients d’obtenir une boisson gratuite au dixième achat. Jeff Bezos, qui était alors multi-millionnaire, insistait pourtant pour se faire poinçonner sa carte de fidélité. Parfois quand même, il offrait la boisson gratuite qu’il avait récoltée à un collègue.
(…) Un grand nombre d’employés rechignaient à accepter le rythme de travail insensé. Or Jeff Bezos les sollicitait de plus en plus fortement, en organisant des réunions le week-end, en instituant un club de cadres qui se réunissait le samedi matin et en répétant souvent son credo : travailler dur, longtemps, avec intelligence. De ce fait, Amazon était mal perçue par les familles. Certains cadres, qui désiraient avoir des enfants, quittèrent alors la société. »
Il attend de ses employés que leur but de vie soit la réussite de l’entreprise :
« (…) Lors d’une réunion restée mémorable, une salariée demanda à Jeff Bezos quand Amazon établirait un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle. Il le prit très mal : « La raison pour laquelle nous sommes ici est d’accomplir notre tâche. C’est la priorité numéro 1, l’ADN d’Amazon. Si vous ne pouvez pas vous y dévouer corps et âme, alors peut-être n’êtes-vous pas à votre place. » »
De manière générale, Jeff Bezos impose un management inventif et exigeant :
« Bezos présenta sa nouvelle grande idée aux principaux cadres : toute l’entreprise allait se restructurer autour de ce qu’il appelait les « équipes à deux pizzas ». Les employés seraient organisés en groupes autonomes de moins de dix personnes – suffisamment petits pour que, lorsqu’ils travailleraient tard, les membres puissent être nourris avec deux pizzas. Ces équipes seraient « lâchées » sur les plus gros problèmes d’Amazon. Elles seraient en compétition mutuelle en matière de ressources et parfois, dupliqueraient leurs efforts, reproduisant les réalités darwiniennes de survie dans la nature. »
La gestion du temps et le refus des pertes de temps constituent un impératif. Mais il y a un autre point que je trouve intéressant dans la communication, c’est la volonté du PDG d’obliger ses collaborateurs d’exprimer les idées par des phrases et des arguments :
« L’autre changement était assez unique dans l’histoire des entreprises. Jusqu’à présent, les employés avaient utilisé les logiciels Powerpoint et Excel de Microsoft pour présenter leurs idées lors de meetings. Bezos estimait que cette méthode dissimulait une façon de penser paresseuse. Il annonça que de tels logiciels ne seraient plus utilisés. Chacun devrait écrire sa présentation en prose. En dépit des résistances internes, il insista sur ce point. Il voulait que les gens prennent le temps d’exprimer leurs pensées de façon convaincante.
(…) Les présentations en prose étaient distribuées et chacun les lisait durant une bonne quinzaine de minutes. Au départ, il n’y avait pas de limite pour ces documents, ce qui pouvait amener à produire des exposés de soixante pages. Donc, très vite, un décret supplémentaire fut édicté, imposant un maximum de six pages (…). »
Et il a ensuite poussé cette rigueur jusqu’à la synthèse permettant de convaincre le client :
« Chaque fois qu’une nouvelle fonction ou qu’un nouveau produit était proposé, l’exposé devait prendre la forme d’un communiqué de presse. Le but était d’amener les employés à développer un argumentaire de vente. Bezos ne croyait pas possible de prendre une bonne décision quant à un produit ou une fonction si l’on ne savait pas précisément comment le communiquer au monde – ni ce que le vénéré client en penserait. »
Il peut aussi être très désagréable avec ses employés :
« Bien qu’il puisse se montrer charmant et plein d’humour en public, Bezos était capable en interne de descendre en flammes un subalterne. Il était enclin à des colères mémorables. Un collègue qui échouait à satisfaire les standards qu’il avait fixés était en mesure d’en déclencher une. Il était alors capable d’hyperboles et d’une rare cruauté. Il pouvait décocher des phrases appelées à demeurer dans les annales internes : (…) « Je suis désolé, ai-je pris mes pilules pour la stupidité aujourd’hui ? » « Est-ce qu’il faut que j’aille chercher le certificat qui spécifie que je suis le PDG afin que vous cessiez de me défier là-dessus ? » « Êtes-vous paresseux ou juste incompétent ? »
L’empathie pour son personnel n’est pas le point fort de cet homme qui prône la philanthropie. Son obsession est le consommateur.:
« (…) Certains employés d’Amazon avancent la théorie que Bezos, tout comme Steve Jobs, Bill Gates ou Larry Ellison (NdT : cofondateur d’Oracle), manque d’une certaine empathie et qu’en conséquence, il traite ses employés comme des ressources jetables, sans prendre en compte leurs contributions à l’entreprise. Ils reconnaissent également que Bezos est avant tout absorbé par l’amélioration des performances et du service client, ce qui rend secondaire les problèmes personnels. »
Dans sa lettre aux actionnaires d’avril 2021 cité par « Le Un », ainsi parlait Jeff Bezos :
« Dans la lettre aux actionnaires d’Amazon de 1997, notre toute première, j’évoquais notre espoir de créer une « entreprise durable » qui réinventerait ce que signifie servir les clients en libérant la puissance d’Internet. […] Nous avons parcouru un long chemin depuis lors et nous travaillons plus que jamais pour servir et ravir nos clients. L’année dernière, nous avons embauché 500 000 personnes et employons désormais directement 1,3 millions de personnes dans le monde. Nous comptons plus de 200 millions de membres Prime dans le monde. Plus de 1,9 million de petites et moyennes entreprises vendent dans notre magasin. […] Amazon Web Services sert des millions de clients et a généré un chiffre d’affaires de 50 milliards de dollars en 2020. En chemin, nous avons créé 1600 milliards de dollars de richesses pour les actionnaires »
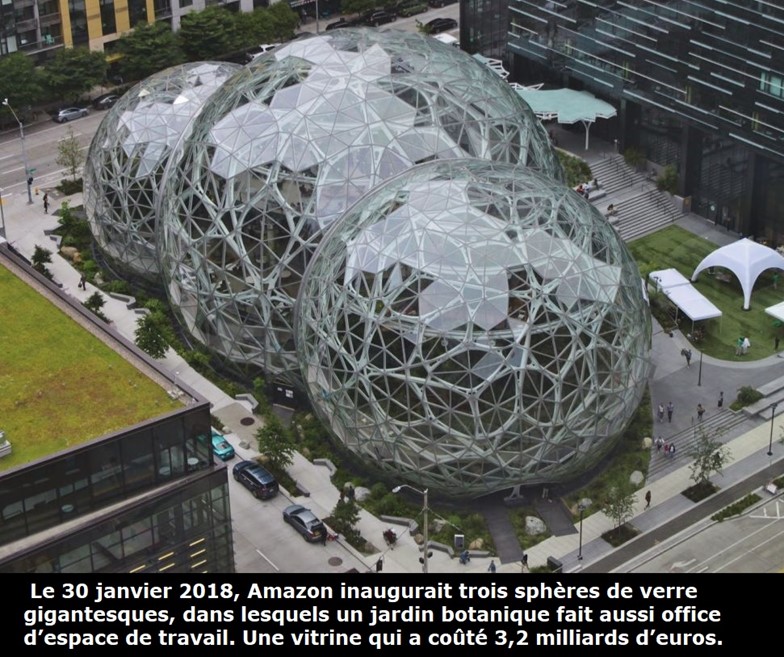 Il faut rendre justice à cet homme qui a réalisé quelque chose d’extraordinaire, remarquable pour les consommateurs et les actionnaires.
Il faut rendre justice à cet homme qui a réalisé quelque chose d’extraordinaire, remarquable pour les consommateurs et les actionnaires.
Je pose une question : est ce que ce sont ces deux fonctions d’homo sapiens qu’il est intelligent de prioriser ?
<1578>
-
Lundi 14 juin 2021
« Amazon nous veut-il du bien ? »Question posée par LE UNDepuis longtemps, j’avais l’envie de faire une série de mots du jour sur Amazon, cette entreprise qui a pour ambition de tout vendre à tout le monde et son patron Jeff Bezos que le magazine Forbes classe première fortune mondiale en 2020.
L’actualité me donne des éléments pour aborder ce sujet.
1° La pandémie a donné une importance considérable aux achats en ligne et évidemment Amazon a dû en profiter largement.
2° Pour la première fois, une partie des matchs de Roland-Garros n’a pas pu être regardée gratuitement à la télévision. Les matchs en session de nuit, était accessible uniquement en ligne, sur Amazon Prime Video. A priori, il semble que cette évolution ait été couronnée de succès : <Les indications montrent qu’on a eu un très beau démarrage>
3° Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, Amazon Prime Video a aussi mis la main sur 80% de la Ligue 1 et la Ligue 2 de football français provoquant <l’ire de Canal +>. Je peux résumer cette histoire simplement : profitant de sa force capitalistique mondiale, Amazon peut payer plus cher pour un service qu’il vendra moins cher que des diffuseurs locaux. Il faut comprendre que l’abonnement Amazon Prime vidéo est inclus dans l’abonnement Amazon Prime que tout bon client d’Amazon a souscrit puisqu’il lui assure une meilleure et plus rapide livraison des colis qu’il attend avec impatience.
4° Nous venons d’apprendre que samedi 12 juin, un riche et heureux gagnant a payé, 28 millions de dollars aux enchères pour accompagner le fondateur d’Amazon dans le premier vol de tourisme spatial de la société Blue Origin. Outre le prix de cette place, le vainqueur devra verser 6% de commission à la maison d’enchères RR Auction. Jeff Bezos avait annoncé début juin qu’il ferait partie du premier vol habité dans la fusée New Shepard avec son frère et le gagnant d’une enchère pour un troisième siège. Il y aura même un quatrième passager comme l’annonce cet <article du monde> de ce dimanche
5° Jeff Bezos, va quitter son poste de patron d’Amazon en juillet, pour s’occuper de ces voyages spatiaux et d’autres œuvres. Il gardera ses actions et un œil attentif sur son œuvre.
 Et puis « LE UN » a publié un numéro consacré à cette entreprise avec pour titre : « Amazon nous veut-il du bien ? »
Et puis « LE UN » a publié un numéro consacré à cette entreprise avec pour titre : « Amazon nous veut-il du bien ? »
Titre inspirant et aussi quelques articles qui permettent de se poser des questions. Car il est important de se poser des questions.
Pour ce premier article de la série, je voudrais simplement rappeler ou apprendre à celles et ceux qui ne le savent pas, l’origine et le développement de cette machine commerciale et surtout logistique.
Jeff Bezos est né le 12 janvier 1964 dans le Nouveau Mexique aux Etats-Unis. <Wikipedia> nous raconte son histoire
Son nom de naissance fut Jeffrey Jorgensen car il est le fils de Ted Jorgensen et Jacklyn Gise.
Au moment de sa naissance, ses parents sont tous deux lycéens : son père vient d’avoir 18 ans tandis que sa mère en a 16. Son père l’abandonne à sa naissance et se remarie un an plus tard. Sa mère fait ensuite la connaissance de Miguel Bezos, un immigré cubain installé aux États-Unis depuis l’âge de quinze ans. Elle l’épouse en avril 1968, et celui-ci adopte Jeff peu de temps après, qui dès lors porte son nom, et l’élève comme son propre fils.
Il semble que le jeune Jeff présentait quelques dons et un très haut QI. Il est diplômé de la prestigieuse université de Princeton en 1986 avec un Bachelor of Arts and Science en sciences de l’informatique.
Il commence à travailler dans plusieurs entreprises financières de Wall Street.
Et en 1994, alors âgé de trente ans, il crée Amazon qui est à l’origine une librairie en ligne.
Il raconte :
« J’ai appris que l’utilisation du web augmentait de 2 300 % par an. Je n’avais jamais vu ou entendu parler de quelque chose avec une croissance aussi rapide, et l’idée de créer une librairie en ligne avec des millions de titres — quelque chose de purement inconcevable dans le monde physique – m’enthousiasmait vraiment. »
Le nom d’«Amazon» qui a pour objectif de devenir la plus grande librairie du monde s’inspire évidemment de l’« Amazone » qui est le plus grand fleuve de la planète
Je reprends alors la chronologie que « Le Un » appelle repères et dont je reprends les principaux.
1995 : Le site Amazon.com est officiellement mis en ligne avec le slogan « La plus grande librairie du Monde »
1997 : Amazon fait son entrée en bourse
 2000 : Le logo s’accompagne d’une flèche dessinant un sourire. Si voulez connaitre l’évolution du logo d’Amazon vous pouvez aller sur ce site <Logo d’Amazon>
2000 : Le logo s’accompagne d’une flèche dessinant un sourire. Si voulez connaitre l’évolution du logo d’Amazon vous pouvez aller sur ce site <Logo d’Amazon>
2005 : Un abonnement annuel baptisé « Prime » est proposé aux clients qui souhaitent recevoir leur colis plus rapidement.
2006 : L’entreprise commercialise son service d’hébergement dans le « Cloud » sa branche la plus rentable à ce jour. Nous y reviendrons. Mais notons que c’est le patron de cette branche : « Amazon Web Services (AWS) » Andrew Jassy qui va prendre la succession de Jeff Bezos.
 2007 : Le premier centre de distribution de colis en France ouvre ses portes dans le Loiret.
2007 : Le premier centre de distribution de colis en France ouvre ses portes dans le Loiret.
2017 : Amazon achète la chaîne de magasins Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars
2021 Rachat de l’emblématique studio de cinéma Metro Goldwyn Mayer pour 8,45 milliards de dollars. Si voulez connaître les films qui tombent ainsi dans le panier d’Amazon <voici la liste>. James Bond en fait partie.
Il faut aussi ajouter à cette emprise du fleuve qui déborde de son lit, les acquisitions et investissements personnels de Jeff Bezos :
2000 : Création de Blue Origin, entreprise vouée au tourisme spatial dans laquelle Bezos investit un milliard par an
2013 : Le Washington Post acheté pour 250 millions de dollars
Il a aussi investi dans Unity Biotechnology qui est une start-up qui travaille sur la lutte contre le vieillissement et dans Grail et Juno Therapeutics start-up qui se concentrent sur la détection du cancer.
Et puis aussi des investissements qui peuvent apparaître comme éthique :
Bezos Day One Fund : une fondation pour l’aide aux sans-abri et à l’éducation dans laquelle Bezos a investi 2 milliards de dollars.
Bezos Earth Fund : un centre pour la lutte contre le changement climatique auquel Bezos a promis 10 milliards de dollars.
Voilà une introduction sous forme de liste.
<1577>
-
Vendredi 11 juin 2021
« L’amour du cinéma m’a permis de trouver une place dans l’existence »Bertrand TavernierLe 25 avril 2021, le grand cinéaste, Bertrand Tavernier, aurait fêté ses 80 ans.
Mais, il ne les a pas fêtés parce qu’il est mort avant, le 21 mars 2021. Je n’ai pas pu lui rendre hommage immédiatement, car j’ai entamé la série sur la Commune le 22 mars.
Bertrand Tavernier est né à Lyon et il a habité pendant 5 ans dans la villa que possédait ses parents au 4 rue Chambovet.
 Cette maison n’existe plus aujourd’hui. Elle a été démolie et le grand jardin de la propriété à été transformé en Parc public : « le Parc Chambovet » qu’Annie et moi avons beaucoup fréquenté pendant le premier confinement, car il constituait le seul espace vert, possédant une dimension de respiration suffisante [5,6 hectares] et se situant dans le kilomètre autorisé nonobstant une marge de tolérance acceptable.
Cette maison n’existe plus aujourd’hui. Elle a été démolie et le grand jardin de la propriété à été transformé en Parc public : « le Parc Chambovet » qu’Annie et moi avons beaucoup fréquenté pendant le premier confinement, car il constituait le seul espace vert, possédant une dimension de respiration suffisante [5,6 hectares] et se situant dans le kilomètre autorisé nonobstant une marge de tolérance acceptable.
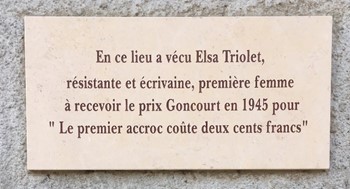 Et, quand on prend la sortie rue Chambovet, deux plaques sont apposées au mur.
Et, quand on prend la sortie rue Chambovet, deux plaques sont apposées au mur.En juillet 2008, Telerama avait interrogé des personnes du monde de la culture pour leur faire raconter un lieu qui a marqué leur enfance. L’article du 18 juillet 2008 avait pour titre : « Bertrand Tavernier habitait au 4, rue Chambovet, à Lyon » :
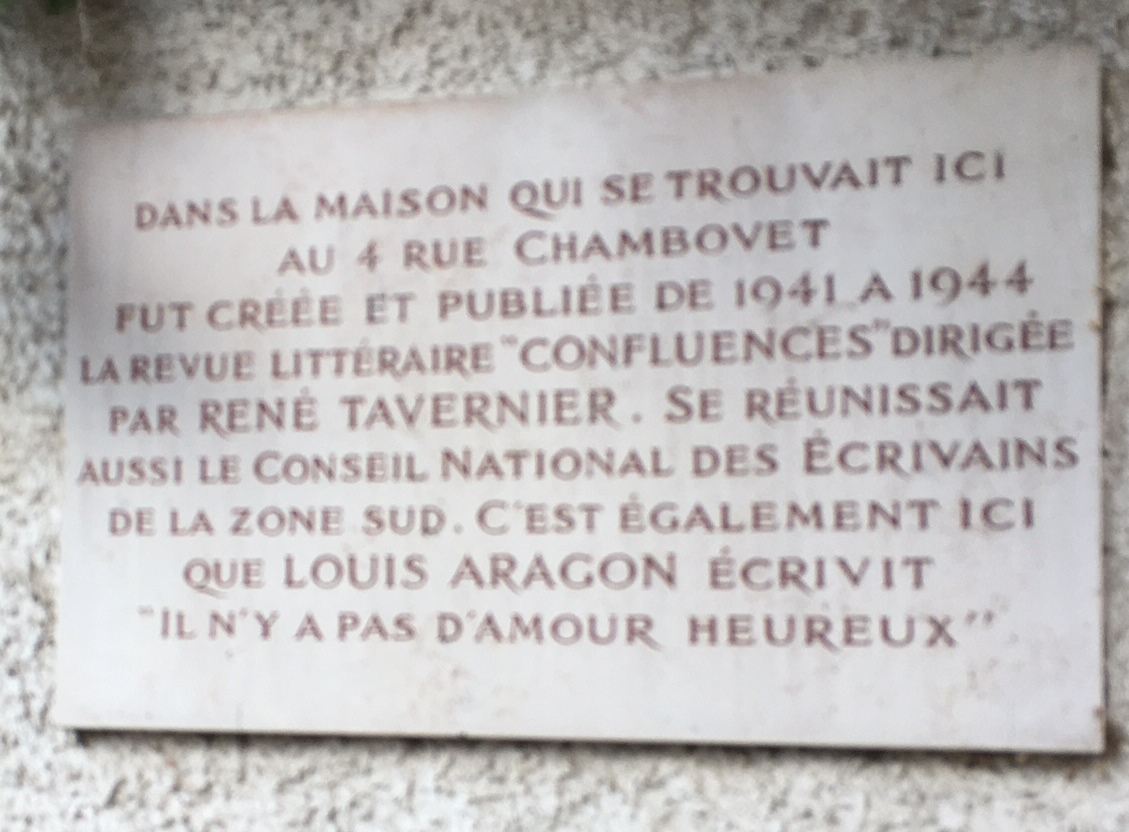 « J’ai passé les cinq premières années de ma vie à Lyon, dans une maison située au 4, rue Chambovet, dans le quartier de Montchat. Nous habitions sur une petite butte, et mon premier souvenir, il m’est déjà arrivé de le raconter, ce sont les fusées éclairantes qui saluent l’arrivée des Américains. On est en 1944, j’ai 3 ans. Dans cette maison, pendant l’Occupation, mon père, René, qui dirigeait la revue littéraire Confluences, a caché Aragon. C’est chez nous que celui-ci a écrit Il n’y a pas d’amour heureux, la légende voulant que ce soit pour ma mère. Mais je n’ai aucun souvenir de lui… Plus tard, la maison a été détruite – je l’évoque dans L’Horloger de Saint-Paul -, et aujourd’hui, sur son emplacement, une plaque dit qu’elle a été le siège du Comité national des écrivains, ce rassemblement d’auteurs résistants.Nous avons emménagé à Paris quand j’avais 5 ans, mais je n’ai cessé de retourner à Lyon, où vivaient mes deux grands-mères. »
« J’ai passé les cinq premières années de ma vie à Lyon, dans une maison située au 4, rue Chambovet, dans le quartier de Montchat. Nous habitions sur une petite butte, et mon premier souvenir, il m’est déjà arrivé de le raconter, ce sont les fusées éclairantes qui saluent l’arrivée des Américains. On est en 1944, j’ai 3 ans. Dans cette maison, pendant l’Occupation, mon père, René, qui dirigeait la revue littéraire Confluences, a caché Aragon. C’est chez nous que celui-ci a écrit Il n’y a pas d’amour heureux, la légende voulant que ce soit pour ma mère. Mais je n’ai aucun souvenir de lui… Plus tard, la maison a été détruite – je l’évoque dans L’Horloger de Saint-Paul -, et aujourd’hui, sur son emplacement, une plaque dit qu’elle a été le siège du Comité national des écrivains, ce rassemblement d’auteurs résistants.Nous avons emménagé à Paris quand j’avais 5 ans, mais je n’ai cessé de retourner à Lyon, où vivaient mes deux grands-mères. »
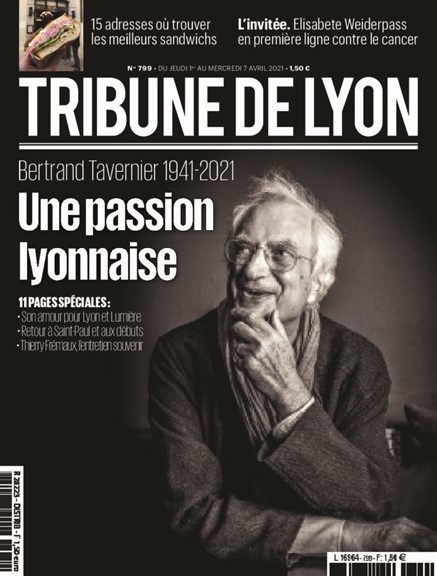 Bertrand Tavernier n’a donc vécu que 5 ans à Lyon, mais pour tous il est le cinéaste lyonnais. La Tribune de Lyon dans son numéro hommage a titré « Une passion lyonnaise ».
Bertrand Tavernier n’a donc vécu que 5 ans à Lyon, mais pour tous il est le cinéaste lyonnais. La Tribune de Lyon dans son numéro hommage a titré « Une passion lyonnaise ».
Et il est vrai que s’il est parti de Lyon, il y est toujours revenu, notamment pour créer l’Institut Lumière en 1982 puis le Festival Lumière .
Et, c’est à Lyon qu’il a tourné son premier long métrage, « L’Horloger de Saint Paul » avec une scène d’ouverture tournée au Garet, ce restaurant où Jean Moulin rencontra pour la première fois celui qui allait devenir son secrétaire, Daniel Cordier, comme on peut le lire dans « Alias Caracalla ».
Un peu plus loin dans le film, il évoque sa maison d’enfance rue Chambovet, lorsque le personnage de Philippe Noiret rend visite à l’ancienne nourrice de son fils.
La tribune de Lyon revient sur la création de l’Institut Lumière avec Bernard Chardère qui affirme :
« Sans Bertrand, on n’aurait jamais pu créer l’Institut Lumière. Il a joué un grand rôle notamment auprès des politiques, et n’a jamais manqué un seul conseil d’administration »
Et il ajoute pour décrire son ami :
« Il avait une boulimie de films, de livres, un peu comme un historien ».
Et en 2009, il crée le Festival Lumière avec Thierry Frémaux. Il disait à ce propos :
« J’ai hérité de Jean Vilar, j’ai toujours vécu avec des gens qui aimaient partager leurs découvertes. […] Avec Thierry Frémaux on s’est battus pour démontrer que le cinéma de patrimoine n’est pas du vieux cinéma, mais un cinéma vivant, par ses thèmes comme par sa forme. »
L’institut Lumière lui a rendu hommage. Les jours qui ont suivi le décès, de nombreux bouquets de fleurs étaient disposés devant les murs de l’Institut.

J’ai choisi comme exergue la phrase que l’Institut Lumière a affiché sur un grand panneau dans le jardin de l’Institut.
Pour ma part, mon premier souvenir de Tavernier fut le documentaire qu’il a réalisé avec son fils, Nils Tavernier en 1996 : « De l’autre côté du périph ». Nous l’avions regardé en famille. Il faut dire que ce documentaire parlait de la cité des grands pêchers et que nous habitions à Montreuil dans le quartier d’à côté, plus proche du centre. Je n’étais jamais allé dans cette cité avant d’avoir vu le documentaire, rude, dur et pourtant plein de tendresse. Je m’y suis rendu après avec le regard de tendresse que les Tavernier m’avait communiqué.
Les Inrocks en parle très bien et donne la genèse de ce documentaire. Je partage, aux deux sens du terme, leur conclusion :
« Véritable film de rencontres, la réussite de De l’autre côté du périph’ tient à ce bouillonnement de paroles brutes, surgies au hasard des errances. Sans jamais se reposer sur une argumentation pesante le propre des films à thèse , les Tavernier se sont laissé surprendre. Et ils ont eu raison. Grâce au regard amical, plein de sympathie qu’ils ont porté sur la vie quotidienne de la Cité des Grands Pêchers de Montreuil, la banlieue trouve enfin à la télévision une représentation juste et nuancée, loin des caricatures imposées par les formatages des journaux télévisés.»
Et puis j’ai vu « La vie et rien d’autre ». Je l’avais évoqué lors du premier mot du jour sur la guerre 14-18 : « Mourir pour la Patrie.». C’est un des plus beaux films qu’il m’a été donné de voir dans ma vie.
Gérald m’avait prêté un coffret regroupant plusieurs films de Tavernier dont « La vie et rien d’autre » que nous avons regardé avec le même sentiment d’accomplissement et d’autres que nous connaissions ou que nous découvrions comme « Coup de torchon » que j’ai beaucoup aimé aussi.
Je ne vais pas faire la liste des 30 films que Bertrand Tavernier a tournés et qui sont tous intéressants, certains contiennent des moments de grâce.
Dans ce coffret, il y avait aussi des vidéos de présentation de chaque film par Tavernier et un ou l’autre des acteurs qui avait joué dans le film. Ce qui est remarquable c’est qu’il ne s’agissait pas de présentation de 5 minutes, mais d’une demi-heure ou plus, montrant toute la générosité et la capacité de transmission de Bertrand Tavernier.
L’hommage qui a lui a été rendu, après sa disparition, était unanime.
Enfin, presque unanime. Il y a eu un journaliste de Libération Didier Péron qui a publié le 25 mars, soit 4 jours, après le décès un article « Bertrand Tavernier, que la fête s’arrête » qui commence ainsi :
«L’Horloger de Saint-Paul», «Coup de torchon», «L.627», «la Vie et rien d’autre»… Le réalisateur prolifique et bon vivant, mémoire érudite du septième art et incarnation d’un cinéma populaire et hélas pesant, est mort jeudi. Il allait avoir 80 ans. »
Un cinéma « populaire et hélas pesant ». Où est-il allé chercher cela ?
Ce journaliste devait porter depuis longtemps ce ressentiment au fond de lui, pour écrire cela alors que les cendres étaient à peine froides. Il ne pouvait attendre pour jeter son venin.
Je pense que Claude Askolovitch, dans sa Revue de presse <du 26 mars 2021>, explique partiellement la rosserie de ce journaliste :
« Et c’est la beauté du cinéma, on s’en dispute… et c’est la marque de Libération, de prendre ces disputes aux sérieux et de n’en point démordre. Et quand sur le site de Libération le journaliste politique Rachid Laireche, lui aussi enfant de la cité des Grands Pêchers, se souvient des Tavernier qui ne le trahirent pas, dans les pages culture du journal, sous un titre brillant, « que la fête s’arrête », rendant hommage au Tavernier militant de gauche engagé, le critique Didier Péron ose des mots cruels pour « un cinéma populaire mais parfois pesant » que Tavernier aurait incarné, cédant parfois à la « démonstration lourdingue »…
En 1999 Tavernier avait mené une révolte des cinéastes contre des critiques jugés assassins pour le cinéma français, à fore de bons mots et d’oukases… Libération était visé, et avait organisé dans ses colonnes un débat entre Tavernier et trois critiques, cela aussi est en ligne. Tavernier disait ceci: « Vous n’arrivez pas à faire passer votre enthousiasme. Quand vous défendez des films, très souvent il n’y a aucune retombée. A votre place, je m’interrogerais. » Il disait aussi cela : «Une opinion n’est pas un fait». Et enfin:«Tout film, comme tout être humain, doit être présumé innocent.» »
Je suis beaucoup plus en phase avec ces propos de Philippe Meyer dans « la Croix »
« Cet homme était une fontaine, de curiosité, de fidélité, d’insatisfaction. Ça coulait tout le temps. J’ai presque le même âge que lui, j’ai eu la chance de rencontrer des tas de gens, et pas des moindres, qui m’ont beaucoup appris, marqué, montré mais lui… Celui qui dit que personne n’est irremplaçable ne l’a pas connu. »
Et il ajoute pour la place qu’il conservera dans la mémoire collective :
« ll va laisser une double place. Celle de l’auteur qu’il fut. La diversité de son inspiration n’a pas fini d’étonner. On s’était habitué à le voir passer de Que la fête commence à La mort en direct, de La Princesse de Montpensier à Dans la Brume électrique, avec des comédiens tellement différents. Et celle de l’homme de la transmission qui culmine avec son admirable Voyage à travers le cinéma français qui est un chef-d’œuvre de partage. Et les passagers de ce voyage-là, il y en aura. »
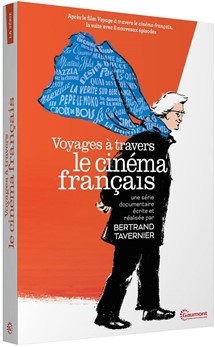 Et justement ce « voyage à travers le cinéma français » je l’ai emprunté à la Bibliothèque de Lyon et j’ai été fasciné par la culture, la qualité de la transmission dont était capable cette encyclopédie vivante du cinéma. En plus de 3 heures et huit épisodes, il va nous permettre d’embrasser toute l’histoire du cinéma français.
Et justement ce « voyage à travers le cinéma français » je l’ai emprunté à la Bibliothèque de Lyon et j’ai été fasciné par la culture, la qualité de la transmission dont était capable cette encyclopédie vivante du cinéma. En plus de 3 heures et huit épisodes, il va nous permettre d’embrasser toute l’histoire du cinéma français.
Dans le premier épisode il parle de Max Ophuls que je connaissais, mais aussi de Jean Grémillon et de Henri Decoin que j’ignorais totalement.
Passionnant !
J’y reviendrai peut-être dans un mot du jour ultérieur.
En tout cas, je ne crois pas que Bertrand Tavernier était pesant. Il était lucide, souvent très profond, toujours bienveillant et humaniste.
J’aime Bertrand Tavernier.

<1576>
-
Jeudi 10 juin 2021
« Il en a vu, ce vieux théâtre »Gilbert LaffailleLes salles de spectacles se remplissent peu à peu, les jauges augmentent. Le couvre-feu est désormais à 23 heures
Et la période des abonnements pour la saison 2021-2022 a débuté.
Être et vivre ensemble, partager l’émotion artistique redevient possible.
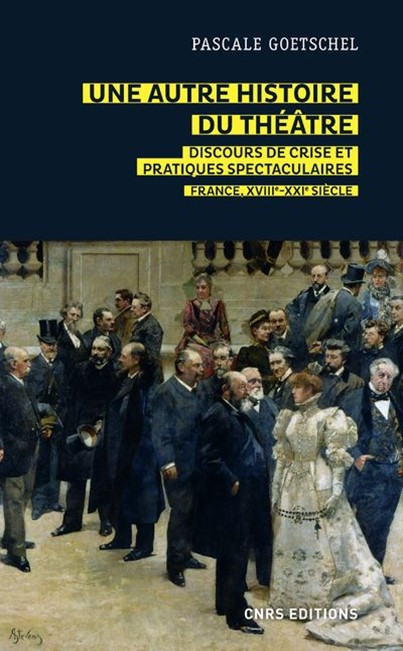 L’émission de France Culture « La concordance des temps » du 5 juin 2021 était consacrée au théâtre : <Le théâtre, toujours en crise ? >
L’émission de France Culture « La concordance des temps » du 5 juin 2021 était consacrée au théâtre : <Le théâtre, toujours en crise ? >
Emission très intéressante dans laquelle Jean-Noël Jeanneney recevait Pascale Goetschel, professeure à la Sorbonne, qui vient de publier le livre « Une autre histoire du théâtre : discours de crise et pratiques spectaculaires. France XVIIIe-XXIe siècle » CNRS éditions, 2021.
Pascale Goetschel a consacré plusieurs ouvrages au théâtre, la page de l’émission les cite :
- « Renouveau et décentralisation du théâtre », PUF, 2004.
- « Au théâtre ! La sortie au spectacle XIXe-XXIe siècles », avec Jean-Claude Yon Publications de La Sorbonne, 2014.
- « Directeurs de théâtre XIXe-XXe siècle. Histoire d’une profession », avec Jean-Claude Yon Publications de la Sorbonne, 2008.
Il s’agit d’Histoire, de sociologie du théâtre. On sort de l’émission plus cultivé.
Par rapport à la question posée par l’émission, Jean-Noël Jeanneney cite Jean Vilar le créateur du Festival d’Avignon et directeur du TNP de Villeurbanne de 1951 à 1963 :
« Tant que le théâtre est en crise, il se porte bien »
Je n’en dirai pas davantage sur l’émission que vous pouvez écouter derrière ce lien : <Le théâtre, toujours en crise ? >
Au début de l’émission, Jean Noël Jeanneney a diffusé une chanson de Gilbert Lafaille, chanteur français né en 1948 que je ne connaissais pas.
J’ai beaucoup aimé cette chanson que je partage aujourd’hui. En voici les paroles :
« Le vieux théâtre
Gilbert Laffaille
 Il en a vu, ce vieux théâtre avec ses vieux fauteuils qui grincent
Il en a vu, ce vieux théâtre avec ses vieux fauteuils qui grincent
Il en a vu, ce vieux théâtre, des maharadjahs, des rois, des princes
Il en a vu des comédies, des tragédies, des quiproquos
Des amoureux de Goldoni et des valets de Marivaux
Il en a vu de toutes les sortes, des misanthropes et des avares
Les maris qui claquaient la porte et des amants dans des placards
Des Matamore au cœur qui flanche lorsque le rideau est tombé
Des Don Juan qui brûlaient les planches et ont du mal à s’en aller
Il en a vu des Sganarelle, des Figaro, des Chérubins
Des grands adieux, des faux rappels et des fourberies de Scapin
Il en a vu de drôles de drames, il en a vu passer des noms
Des tout petits sur le programme et des très gros sur le fronton
Il en a vu, ce vieux théâtre, dans son velours et ses dorures
Il en a vu, ce vieux théâtre, des cheveux mauves et des fourrures
Des oiseaux noirs aux yeux étranges, des philosophes et des marquises
Des sans-le-sou qui donnent le change et des banquiers qui se déguisent
Il en a vu des Sganarelle, des Figaro, des Chérubins
Des grands adieux, des faux rappels et des fourberies de Scapin
Il en a vu des regards tristes, de la corbeille au poulailler
Des moues blasées de journalistes et des sourires émerveillés
Il en a vu des Cyrano aller se battre sans armure
Et recevoir tant de bravos qu’ils en ont fait craquer ses murs
Mais c’est peut-être le fantôme qui fait grincer le bois des plinthes
Quand il revient de son royaume pour jouer devant la salle éteinte. »
Et voici un lien vers une interprétation audio : <Le vieux théâtre>
 Théâtre des Célestins à Lyon
Théâtre des Célestins à Lyon
<1572>
- « Renouveau et décentralisation du théâtre », PUF, 2004.
-
Mercredi 9 juin 2021
« Osez Joséphine »Titre d’une pétition« Osez Joséphine » est une chanson et un album d’Alain Bashung paru en 1991.
Mais, en ce moment, « Osez Joséphine » présente une autre signification.
Aujourd’hui, c’est une pétition qui demande l’entrée au Panthéon de Joséphine Baker..
 Le magazine « ELLE » explique dans son article : « Osez Joséphine » :
Le magazine « ELLE » explique dans son article : « Osez Joséphine » :
« À l’occasion de la fête de l’Armistice du 8 mai 1945, l’essayiste Laurent Kupferman a décidé de mettre en place cette pétition. Pour lui, l’artiste et militante est un symbole d’unité nationale. […] Joséphine Baker, première star internationale noire, a un parcours assez atypique. Muse des cubistes dans les années 1930, elle devient ensuite résistante dans l’armée française durant la Seconde Guerre mondiale et activiste aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques aux États-Unis d’Amérique et en France aux côtés de la Licra »
Pour l’instant, il n’y a que 5 femmes qui reposent au Panthéon, contre 75 hommes.
Dans <le mot du jour du 17 mai 2021> j’avais évoqué les obstacles qui se dressent sur le chemin de la panthéonisation de Gisèle Halimi.
Outre son genre, Joséphine Baker présente deux autres caractéristiques absentes au Panthéon : Sur ces 80 résidents, il n’y a aucun artiste de spectacle vivant et aucune personne racisée
Je dois avouer que je ne savais pas grand-chose de Joséphine Baker.
Mais j’ai d’abord été informé de la pétition par <le billet du 4 juin> de François Morel :
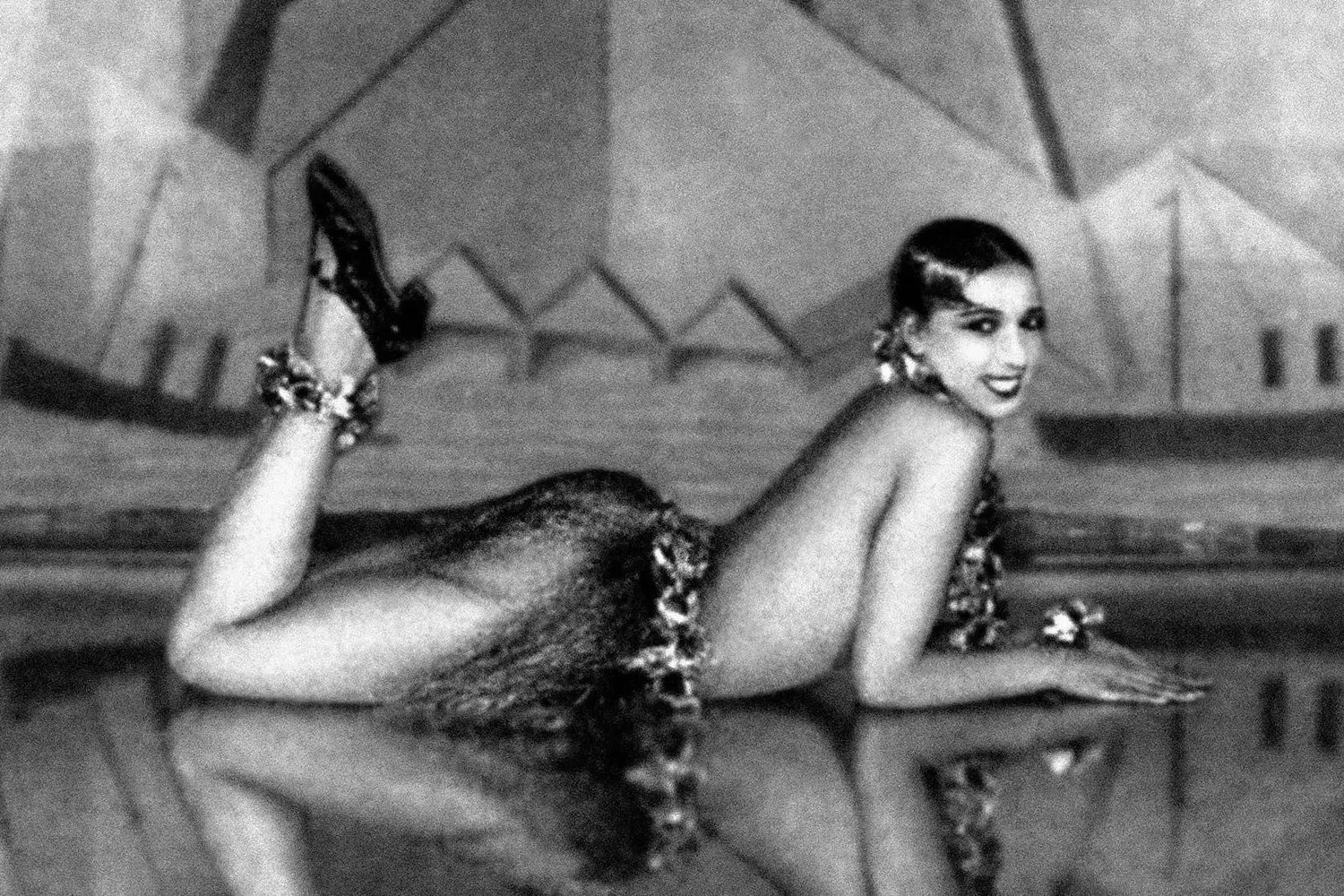 « Entre ici, Joséphine Baker avec ton amoureux cortège de plumes et de bananes et d’enfants adoptés et de combats contre le racisme et de courage.
« Entre ici, Joséphine Baker avec ton amoureux cortège de plumes et de bananes et d’enfants adoptés et de combats contre le racisme et de courage.
Car Joséphine fit partie de ce « désordre de courage » comme le disait André Malraux devant le cercueil de Jean Moulin, évoquant la résistance.
Entre ici Joséphine avec tes chansons de Vincent Scotto et ton parcours admirable d’icone des années folles devenue militante du Mouvement des droits civiques de Martin Luter-King. […]
Entre ici Joséphine, avec ton cortège de danses et de chansons, de rythmes et de rêves de music-hall.
Rentre ici, pas parce que tu es une femme, pas parce que tu es une noire mais parce que, toi aussi, tu avais fini par devenir un visage de la France.
Et parce qu’étant femme, et parce qu’étant noire, tu peux réussir à transmettre un message à une jeunesse qui sans doute n’a jamais entendu parler de toi. « Aujourd’hui, jeunesse, puisses-tu penser à cette femme ».
Entre ici Joséphine qui, ne pouvant avoir d’enfants, en adopta douze, de toutes origines, qu’elle appelle « sa tribu arc-en-ciel ». Comme disait à peu près Mark Twain « Elle ne savait pas que c’était impossible, alors elle l’a fait ».
Entre ici Joséphine si affectueuse avec les animaux en liberté dans sa maison du Vésinet, les chats, les chèvres, les cochons et, tenue en laisse, un guépard, Chiquita qui, à la ville, comme à la scène l’accompagne. »
Puis j’ai entendu une émission sur France Musique : Musicopolis : < Joséphine Baker, une américaine à Paris > qui revient davnatage sur sa carrière musicale quand elle est arrivée à Paris>
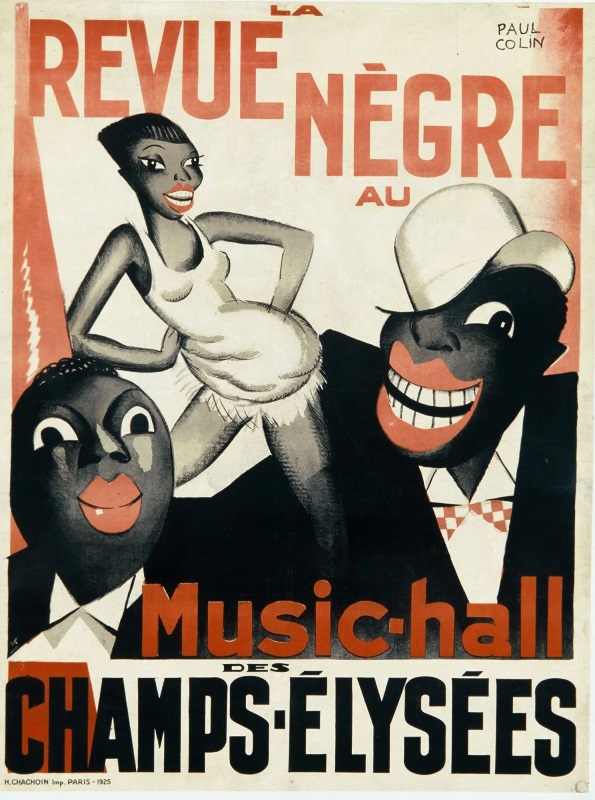 Elle arrive à 19 ans et avec une troupe de 25 chanteurs et danseurs noirs va obtenir un succès retentissant avec un spectacle appelé « la « Revue Nègre »
Elle arrive à 19 ans et avec une troupe de 25 chanteurs et danseurs noirs va obtenir un succès retentissant avec un spectacle appelé « la « Revue Nègre »
Oui ! parce qu’à cette époque on avait le droit d’utiliser le terme de nègre.
Ces deux émissions m’ont conduit à m’intéresser à la vie et au destin de Joséphine Baker.
Grâce à Wikipedia on peut avoir une vision assez complète de ce destin.
Joséphine Baker est née Freda Josephine McDonald le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, dans un pays ségrégationniste et profondément raciste.Elle est née dans une famille très pauvre. La jeune femme passe une partie de son enfance à alterner l’école et les travaux domestiques pour des gens aisés chez qui sa mère l’envoie travailler.
Elle se marie une première fois à 13 ans. Ce mariage ne durera pas longtemps et Joséphine Baker a une passion pour la danse. Elle va intégrer diverses troupes. Lors d’une tournée, elle va rencontrer à Philadelphie Willie Baker, qu’elle épouse en 1921, donc à 15 ans. Elle gardera ce nom pour la suite de sa vie bien qu’elle divorcera à nouveau et contractera encore d’autres mariages.
Elle vivra son arrivée à Paris comme une libération. Elle dira :
« Un jour j’ai réalisé que j’habitais dans un pays où j’avais peur d’être noire. C’était un pays réservé aux Blancs. Il n’y avait pas de place pour les Noirs. J’étouffais aux États-Unis. Beaucoup d’entre nous sommes partis, pas parce que nous le voulions, mais parce que nous ne pouvions plus supporter ça… Je me suis sentie libérée à Paris »
Elle éblouira Paris et la France par sa vélocité et l’enthousiasme de ses danses et puis elle commencera à chanter.
 Elle participera activement à la résistance. Elle s’acquitte durant la guerre de missions importantes, et reste connue pour avoir utilisé ses partitions musicales pour dissimuler des messages. Lors de sa première mission à destination de Lisbonne, elle cache dans son soutien-gorge un microfilm contenant une liste d’espions nazis, qu’elle remet à des agents britanniques.
Elle participera activement à la résistance. Elle s’acquitte durant la guerre de missions importantes, et reste connue pour avoir utilisé ses partitions musicales pour dissimuler des messages. Lors de sa première mission à destination de Lisbonne, elle cache dans son soutien-gorge un microfilm contenant une liste d’espions nazis, qu’elle remet à des agents britanniques.
Un autre aspect de sa vie est étonnante. Elle épousera un homme riche du nom de Jo Bouillon, et achètera avec lui le château des Milandes en Dordogne où elle vivra jusqu’en 1969. Elle y accueille douze enfants de toutes origines qu’elle a adoptés et qu’elle appelle sa « tribu arc-en-ciel ». La fin de sa vie fut obscurcie par de très grandes difficultés financières.
Elle mourra d’une hémorragie cérébrale à 68 ans le 12 avril 1975, juste après un dernier spectacle qu’elle aura donné le 9 avril 1975 à Bobino dans le cadre d’une série de concerts célébrant ses cinquante ans de carrière.
Dans le Magazine « Elle » on lit que l’auteur de la pétition Laurent Kupferman, donne la raison de son initiative :
« Une femme libre, féministe, une résistante et une personnalité engagée contre le racisme. De son vivant, la France a déjà décoré cette femme d’exception. Elle a reçu quatre médailles, dont celle de Chevalier de Légion d’honneur à titre militaire. Sa panthéonisation serait un puissant symbole d’unité nationale, d’émancipation et d’universalisme à la française »
France Inter a aussi publié une page sur cette initiative : <« Osez Joséphine », la pétition qui plaide pour l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon>
<1571>
-
Mardi 8 juin 2021
« Les 9 symphonies de Beethoven interprétées par 9 orchestres dans 9 villes d’Europe »La journée Beethoven 2021 organisée par ARTEC’était en 2020 que nous avons célébré les 250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven.
Il est né en décembre 1770 à Bonn. J’avais écrit la série sur Beethoven du 10 au 30 décembre 2020. Vous trouverez la page de cette série derrière ce lien : <Beethoven est né il y a 250 ans>
ARTE avait l’intention de faire une journée spéciale Beethoven lors de cette année 2020.
Le concept était de faire interpréter la même journée, successivement les 9 symphonies, dans 9 villes d’Europe, avec 9 orchestres et chefs différents.
Plusieurs de ces concerts devaient avoir lieu en extérieur.
C’est pourquoi, ARTE n’a pas choisi le mois de naissance, décembre, pour cette célébration mais le mois pendant lequel les jours sont les plus longs : juin 2020.
Mais je n’apprends rien à personne, puisque nous l’avons tous vécu. La France, l’Europe, le Monde tous à des degrés divers nous étions confinés en raison de cette incroyable pandémie qui s’est abattue sur notre espèce.
La seule solution raisonnable était de reporter.
Et c’est ainsi qu’un an plus tard, le 6 juin 2021, ARTE a pu enfin aller au bout de son idée. Ce fut un marathon musical De 12 h 45 jusque tard dans la nuit.
C’est une somptueuse et merveilleuse idée.
Et il est possible de regarder ces 9 bijoux pendant 6 mois encore jusqu’à la fin de l’année sur <ARTE REPLAY>.
ARTE a placé l’Europe au centre de son hommage au génial démiurge. C’est en raison de son engagement humaniste que l’Europe a choisi symboliquement l’Ode à la joie sur un poème de Schiller, conclusion de la IXe Symphonie, comme hymne de l’Union européenne. D’où le projet de voyager de ville en ville en une seule journée, au fil des neuf symphonies créées par Beethoven entre 1800 et 1824, interprétées par neuf orchestres différents sous la baguette de neuf chefs différents !
LE 6 juin ARTE a diffusé les symphonies dans l’ordre chronologique, sept des neuf concerts étaient captés en direct.
Je ne suivrais pas cet ordre pour la présentation
Symphonie n° 1 Opus 21 (1800)
Très naturellement le marathon a commencé dans la ville natale de Beethoven Bonn
Le concert a été diffusée en direct depuis la cour du château des Princes-Électeurs. Dans ce château, Beethoven a commencé sa vie musicale publique.
L’orchestre choisi pour débuter est le formidable Mahler Chamber Orchestra fondé par Claudio Abbado en 1997.
Très rapidement Daniel Harding devint le chef associé à la tête de cet Orchestre. Daniel Harding qui devint plus récemment Directeur de l’Orchestre de Paris, mais quitta sa fonction pour devenir Pilote de ligne. Je ne sais pas si c’est en raison de la pandémie qui a dévasté les compagnies aériennes qu’il a repris des fonctions de directeur musical à l’Orchestre de la Radio suédoise ou s’il avait jugé ce prétexte Crédible pour quitter l’Orchestre de Paris avec qui la relation de confiance était disons mesurée.
<Symphonie n° 1 Opus 21 à Bonn – Mahler Chamber Orchestra – Daniel Harding>
Symphonie n° 9 Opus 125 (1822 – 1824)
Et c’est tout aussi naturellement à Vienne, dans la ville où Beethoven a composé tous ses chefs d’œuvre que le marathon s’est achevé.
Dans les jardins du palais du Belvédère, c’est l’autre orchestre de Vienne : l’Orchestre symphonique de Vienne qui jouait sous la baguette de la jeune cheffe américaine Karina Canellakis que nous avons déjà eu le bonheur d’avoir deux fois à l’Auditorium de Lyon, où elle a dirigé l’orchestre de notre ville.
<Symphonie n° 9 Opus 125 à Vienne – Orchestre Symphonique de Vienne – Karina Canellakis>
Symphonie n° 7 Opus 92 (1811 – 1812)
Cette symphonie qui a été désignée par Wagner comme « L’apothéose de la danse » a fait l’objet de l’interprétation la plus surprenante en raison du chef adulé par les uns et honni par les autres, le jeune chef gréco-russe : Teodor Currentzis.
Dans ses interviews et même dans son attitude avant le concert, comme pendant, il révèle une personnalité assez sure de ses talents. Pour ma part je dirai qu’il est souvent très passionnant à écouter même s’l peut être assez horripilant à regarder.
Le lieu du concert est somptueux, il s’agit du Théâtre Antique de Delphes
L’orchestre est celui qu’il a créé Musicaeterna.
<Symphonie n° 7 Opus 92 à Delphes – Musicaeterna – Teodor Currentzis>
Symphonie n° 5 Opus 67 (1807 – 1808)
Pour la célèbre cinquième symphonie, c’est la ville de Prague qui a été choisie. Ville de culture historique de l’empire austro hongrois.
On admire le centre de la ville tchèque, le concert a lieu sur la place de la Vieille-Ville de Prague.<Symphonie n° 5 Opus 67 – Prague – Orchestre symphonique national tchèque – Steven Mercurio>
Symphonie n° 3 Opus 55 (1802 – 1804)
Le lieu de l’interprétation de l’Eroica l’autre symphonie célèbre est aussi très impressionnant.
Il s’agit d’une église d’Helsinki qui a été creusés dans la roche : l’église monolithique Temppeliaukio d’Helsinki, bâtie dans les années 1960.
<Symphonie n° 3 Opus 55 – Helsinki – Orchestre symphonique de la radio finlandaise – Nicholas Collon>
Symphonie n° 8 Opus 93 (1812)
Il fallait bien une ville de France. C’est celle qui abrite le parlement européen qui a été choisi : Strasbourg avec son orchestre.
<Symphonie n° 8 Opus 93 – Strasbourg – Orchestre philharmonique de Strasbourg. – Marko Letonja>
Symphonie n° 4 Opus 60 (1806)
Autre ville importante de l’Union européenne : Luxembourg est le théâtre choisie pour la 4ème symphonie.
En direct de la Philharmonie Luxembourg, l’orchestre local interprète cette symphonie. Une chorégraphie luxembourgeoise Sylvia Camarda a pris l’initiative avec 8 jeunes réfugiés de réaliser une scénographie dansée sur la musique.<Symphonie n° 4 Opus 60 – Luxembourg – Orchestre philharmonique du Luxembourg – Gustavo Gimeno>
Symphonie n° 2 Opus 36 (1801 – 1802)
C’est à Dublin que se passe cet épisode.
<Symphonie n° 2 Opus 36 – Dublin – RTÉ National Symphony Orchestra – Jaime Martín>
Symphonie n° 6 Opus 68 (1807 – 1808)
Dans mon cheminement, je finirai par la symphonie appelée « Pastorale » jouée en Suisse italienne à Lugano, au milieu des cols alpins.

<Symphonie n° 6 Opus 68 – Orchestre de chambre suisse I Barocchisti – Diego Fasolis>
<1570>
-
Lundi 7 juin 2021
« Si je meurs, si j’ai une tombe, qu’un bouquet de pivoines rouges y soit déposé. »Mihriay Erkin<Slate> rapporte que selon un rapport publié par le Centre for Economics and Business Research (CEBR), la Chine devrait dépasser les États-Unis pour devenir la première puissance économique mondiale d’ici 2028.
Dans 7 ans.
Si cette prédiction se réalise, le monde sera dominé économiquement par un État qui est une dictature sanglante. Celles et ceux qui ont détesté l’hégémonie américaine, ce qui peut être compréhensible, seront sidérés par celle de la Chine du Parti Communiste Chinois.
Quelquefois pour toucher la réalité d’un problème, il faut s’échapper des concepts pour revenir à hauteur d’homme ou hauteur de femme comme dans cette histoire vraie.
La première fois que j’ai entendu parler de « Mihriay Erkin » c’était dans la revue de presse de Claude Askolovitch sur France Inter le <4 juin 2021>
Il évoquait un article de « Libération » : « Mihriay Erkin, étoile ouïghoure éteinte dans les ténèbres des camps » que la journaliste Laurence Defranoux avait publié le 2 juin 2021.
Depuis Raphaêl Glucksman a relayé cet article de Laurence Defranoux sur Facebook et mon amie Florence a partagé le post de Glucksman.
Mihriay Erkin était une jeune chercheuse de 29 ans à l’institut Nara au Japon. Elle était exilée, car elle était ouighour et avait quitté l’empire de Chine alors que ses parents étaient restés dans leur pays.
Elle a été piégée parce que les autorités chinoises ont « incité » sa mère à la convaincre de revenir la voir.
 Claude Askolovitch résume ainsi cette histoire :
Claude Askolovitch résume ainsi cette histoire :
« Regardez bien alors la bouille et le sourire espiègle de Mihriay Erkin, qui avait 29 ans, qui était heureuse au Japon, étudiante chercheuse en science et en technologie, mais qui en juin 2019 est revenue en Chine pour voir sa famille, sa mère l’a suppliait… Mihriay était ouighour, de ce peuple de confession musulmane que l’Etat chinois veut réduire, elle enseignait sa langue, son oncle était un linguiste exilé en Norvège, la famille était surveillée et l’invitation ressemblait à un piège. […] En arrivant en Chine, Mihriay a appris que son père avait été condamné pour incitation au terrorisme, puis elle a été arrêtée, elle est morte en décembre 2020 dans un camp, les autorités ont demandé à sa famille de dire qu’elle souffrait d’une maladie cachée. »
Dans l’article de Laurence Defranoux, nous apprenons les précisions suivantes :
- C’est sa mère qui l’a appelée pour la supplier de rentrer, et lui a envoyé de l’argent pour acheter le billet d’avion.
- Immédiatement à son arrivée, en juin 2019, elle a été privée de son passeport et assignée à résidence au Xinjiang. Elle a été arrêtée en février 2020 et elle est morte le 20 décembre dans le centre de détention de Yanbulaq, près de Kashgar, dans l’ouest de la Chine. La nouvelle a commencé à filtrer à l’étranger la première semaine de mars. Mais c’est seulement le 20 mai que sa mort a été confirmée grâce aux renseignements obtenus par Radio Free Asia, un site militant américain qui possède une antenne en ouïghour.
- La police chinoise utilise des stratagèmes pour attirer les exilés à revenir au Xinjiang comme les obliger à venir en Chine pour signer des papiers ou renouveler leur passeport. Mais, surtout, elle se sert de la famille comme appât. L’envoi d’une forte somme d’argent par sa mère, pourtant sans ressources, alors qu’un virement à l’étranger suffit à être condamné pour « financement d’activités terroristes », a tout du piège. C’est un dilemme pour les jeunes éloignés et isolés, alors que la culture ouïghoure donne une place très importante à la famille et à l’obéissance aux parents.
Mihriay Erkin était assez consciente des risques puisqu’au moment de partir, le 18 juin 2019, à l’aéroport de Tokyo elle a envoyé ce message :
« Depuis mon enfance, on m’a appris que les enfants doivent accomplir leur devoir en restant auprès de leurs parents. Soyez en paix. Si je meurs, si j’ai une tombe, qu’un bouquet de pivoines rouges y soit déposé.»
La journaliste explique :
« Mihriay Erkin a tout pour attirer l’attention des autorités qui ont pour objectif d’éradiquer la culture millénaire des Ouïghours et les assimiler de gré ou de force dans la «grande nation chinoise». Brillante élève, maîtrisant le ouïghour, le mandarin, le japonais et l’anglais, elle a obtenu un master de bio-ingénierie au Japon après une licence de biologie à Shanghai. Mais elle ne s’est pas coupée de ses racines, porte le hijab et enseigne depuis deux ans le ouïghour à des enfants de la diaspora au Japon en marge de son doctorat. De plus, elle est la nièce d’Abduweli Ayup, linguiste renommé, diplômé aux Etats-Unis. Emprisonné et torturé en 2013-2014 pour avoir levé des fonds afin d’ouvrir une école maternelle ouïghoure, harcelé à sa sortie, il s’est exilé en Norvège en 2015, d’où il continue à militer pour l’usage du ouïghour dans l’enseignement.
Cet oncle quand il apprend le projet de sa nièce va tout faire pour la dissuader :
« Ce dernier est très attaché à celle qu’il appelle «mon bébé», et qu’il a élevée pendant deux ans lorsque ses parents s’étaient éloignés pour leur travail. […] Il essaie de la convaincre de ne pas monter dans l’avion pour la Chine. Mais Mihriay ne cède pas. Depuis la salle d’embarquement, elle lui écrit : « Chacun de nous mourra seul. L’amour de Dieu, notre sourire et notre peur nous accompagnent. Je vis dans de telles frayeurs, il est préférable d’en finir. »
Selon des sources contactées par Radio Free Asia, Mihriay Erkin serait morte alors qu’elle était l’objet d’une enquête menée par le bureau de la Sécurité publique de Kashgar, possiblement lors d’un interrogatoire. Elle avait 30 ans.
 Elle n’aura pas de bouquet de pivoines sur sa tombe :
Elle n’aura pas de bouquet de pivoines sur sa tombe :
« Seules trois personnes assistent à son enterrement, sous surveillance policière. La police leur intime l’ordre de garder le secret sous peine d’être « emprisonnées pour divulgation de secrets d’Etat» et «diffamation de la police». Une page est ajoutée à son dossier médical affirmant qu’elle souffrait d’une maladie cachée. Lorsque, en mars, la nouvelle de sa mort affleure sur les réseaux sociaux à l’étranger, la police demande à sa mère d’« avouer » devant une caméra avoir dissimulé le fait que sa fille était «malade» et de dire qu’elle est morte à la maison, puis renonce, pour une raison inconnue, à tourner la vidéo. »
Bien sûr, aucun pays ne dira rien : la Chine est tellement puissante. Il ne faut pas la fâcher. Aucune entreprise multinationale ne veut se passer du marché chinois. Et, en fin de compte tant de nos économies, de notre confort dépend de l’empire du milieu.
« La Croix » relate qu’il existe bien une instance qui a pris pour nom « Tribunal Ouïghour » » et qui tente de déterminer si le régime chinois est coupable de « crime contre l’humanité », voire de « génocide ». Mais cette instance d’origine privée n’a aucune autorité à faire valoir pour faire reconnaître son travail et ses avis, sans parler de décisions qui n’auraient aucun sens dans ce contexte.
<1569>
- C’est sa mère qui l’a appelée pour la supplier de rentrer, et lui a envoyé de l’argent pour acheter le billet d’avion.
-
Mardi 25 mai 2021
« Le mot du jour est en congé.»Il reviendra le 7 juinCes dernières semaines, la page série s’est enrichie de 5 nouvelles entrées.
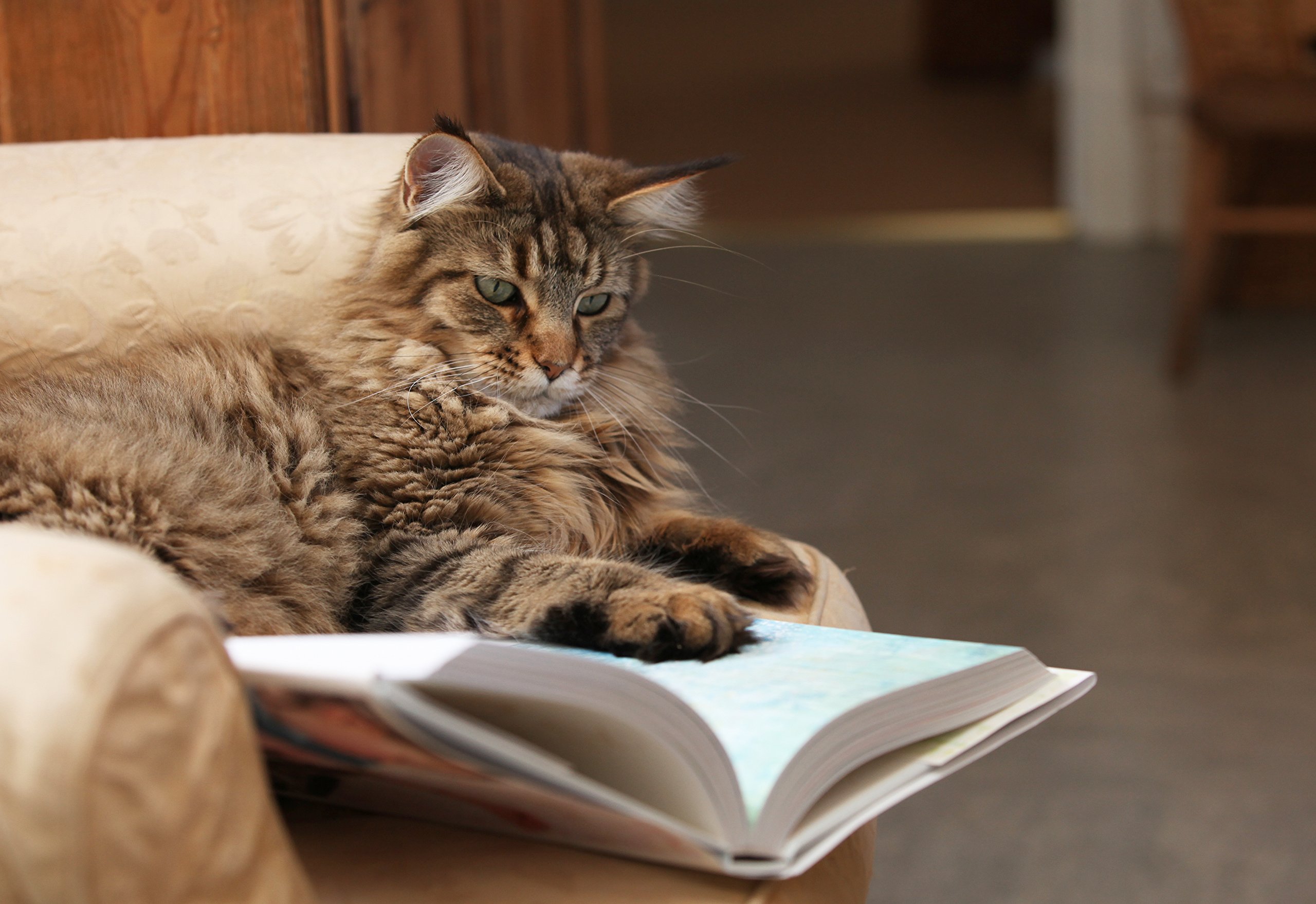 Je rappelle qu’une série est constituée par 5 articles ou plus, publiés d’une manière continue et qui concernent un même sujet ou un même thème.
Je rappelle qu’une série est constituée par 5 articles ou plus, publiés d’une manière continue et qui concernent un même sujet ou un même thème. Le minimum de 5 correspond à la publication au cours d’une semaine entière.
Pour l’instant 34 séries ont été créées.
La page série, comporte actuellement 17 séries soit la moitié du total.
L’objectif est que toutes les séries soient répertoriées sur cette page.
Chaque entrée envoie vers une page spécifique, sur laquelle, la série est présentée par une une introduction puis une ouverture pour chacun des mots du jour et un lien vers le mot du mot du jour concerné.
<Lien vers la page des séries>.
<mot sans numéro>
-
Vendredi 21 mai 2021
« Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent»Voltaire « Zadig »La mission des policiers est compliquée et indispensable dans un État de Droit.
Lors des manifestations des gilets jaunes, j’avais rédigé un mot du jour le <10 décembre 2018> dans lequel je citais un article qui rapportait les violences auxquels les policières et policiers avaient à faire face.
J’avais écrit alors : « Ces personnes sont des fonctionnaires comme moi. Ils ont fait le choix de se mettre au service de L’État et de la République. Mais quand ils sont appelés à assurer leur mission, sur un théâtre d’opération, ils ne sont pas certains de rentrer en bonne forme le soir, en retournant dans leur famille retrouver leurs enfants, leur compagne ou compagnon. »
Et c’est exactement ce qui est arrivé à quatre fonctionnaires de police, le 8 octobre 2016, quand ils ont été agressés par plusieurs personnes à Viry-Châtillon en Essonne.
<France Info> donne un résumé de l’affaire.
« La tension était vive dans la ville après l’installation d’une caméra pour surveiller un endroit où de nombreux vols avaient lieu. De passage, deux véhicules de police ont alors été attaqués à coups de pierres et de cocktails molotov par une vingtaine de personnes masquées. Les voitures ont pris feu mais, aidés par des habitants, les quatre policiers sont parvenus à s’en sortir. Ils ont été blessés, l’un d’entre eux a été grièvement brûlé. »
Son <pronostic vital> avait été engagé
L’enquête avait été difficile pour retrouver la trace des responsables. Près d’un millier de personnes ont été interrogées mais la loi du silence s’est installée. Au final, 13 jeunes âgés de 19 à 24 ans avaient été envoyés devant la Cour d’assises.
Huit des treize accusés étaient condamnés, en 2019, à des peines allant de 10 à 20 ans de prison, les 5 autres étaient acquittés faute de preuves. Mais, le Parquet, qui avait requis de 20 à 30 ans de prison, avait fait appel. <Wikipedia> donne davantage de détails.
Le procès en appel a eu lieu. Et en avril 2021, à l’issue de 14 heures de délibération et six semaines d’audience à huis clos, cinq condamnés ont été reconnus coupables de tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l’autorité publique.
Trois ont été condamnés à 18 ans de prison, un autre à 8 ans de prison, et le dernier à 6 ans. Ils encouraient la réclusion criminelle à perpétuité. Le nombre d’acquittés est passé de cinq à huit.
Un avocat des victimes <a déclaré>, à l’issue du procès,
« Nous venons d’assister à un naufrage judiciaire (…) alors que l’on sait qu’il y avait 16 assaillants, on se retrouve avec cinq condamnations »
Il est nécessaire de protéger nos policiers et de sanctionner sans trembler ceux qui les attaquent et plus encore ceux qui mettent leur vie en danger.
Mais il faut que ceux qui sont condamnés soient avec certitude les coupables.
Or « Mediapart » vient de dévoiler qu’au moins pour un des condamnés du premier procès et acquitté du second, les preuves n’existaient pas et qu’il y a eu parmi les enquêteurs des personnes qui n’ont pas eu un comportement éthique.
<L’article> de Mediapart est en accès libre.
Je partage ci-après, le résumé qu’en a fait Claude Askolovitch lors d’une ses <revue de presse>
« Un jeune homme innocent qui pourtant a passé quatre années et trois mois en prison, condamné en première instance pour un crime scandaleux, un piège tendu à des policiers qui auraient pu bruler vifs en octobre 2016 à Viry-Châtillon – mais il a été acquitté en appel dimanche par la Cour d’Assises de Paris, le dossier d’accusation finalement ne tenait pas…
Et ce matin, Mediapart affirme que ce dossier avait été initialement manipulé contre le jeune homme par des policiers enquêteurs, qui aurait transmis à la justice une version tronquée de son interrogatoire en garde à vue, que Mediapart a pu visionner… Ce serait là le vrai scandale du procès en appel de l’agression de Viry-Châtillon, dont le verdict, cinq condamnations et huit acquittement, jugé trop clément par des organisations de policiers et des politiques, provoque des débats et hier des manifestations -mais cette clémence en fait serait une réparation.
Nous sommes en janvier 2017, devant des policiers qui le traitent de con, qui lui disent qu’il n’assume pas, Foued -ainsi Mediapart rebaptise le jeune homme pour garantir son anonymat- Foued, donc jure son innocence, cent fois, dit le journal, mais il finit par craquer, un instant, sous la pression conjuguées des policiers et -étonnamment- de son avocat de l’époque, commis d’office, qui contribue à faire perdre sa lucidité au jeune homme, il lui suggère qu’il est victime d’un black-out, qu’il a participé au guet-apens mais qu’il l’a occulté, ces choses-là arrivent, tiens, c’est arrivé à un de ses clients…
Alors Foued se prend la tête, « Mon Dieu, comment vient ce phénomène… »… et quelques minutes plus tard, interrogé par les policiers, il répond : « Je ne m’en souviens pas une seconde si je l’ai faite ou pas. » Et cette phrase se retrouvera dans le dossier transmis à la justice… mais pas celles-ci, qui montrent un jeune homme sur le point de perdre la raison. « Je vais être fou. Il reste une boule en moi. Je ne sais pas c’est quoi. Dans ma tête, je ne l’ai pas fait. Si je dis que je l’ai fait, si je vous le dis, la boule va rester parce que dans ma tête je ne l’ai pas fait. »
Foued avait été condamné à 18 ans de prison dans le premier procès aux assises, la cour disait que Foued avait « implicitement admis de façon très ambiguë avoir pu participer aux faits », le procès en appel a balayé ceci pour innocenter le jeune homme, il dit à Mediapart que les enquêteurs ne cherchaient pas les coupables mais des coupables. »
La Justice n’est pas la vengeance, surtout pas la vengeance aveugle.
Dans un État de droit, nos valeurs nous poussent à préférer qu’il puisse exister un coupable en liberté qu’un innocent condamné.
Mais je laisserai le mot de fin à Voltaire :
« Le roi avait perdu son premier ministre. Il choisit Zadig pour remplir cette place. […] C’est de lui que les nations tiennent ce grand principe : qu’il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent »
Zadig ou La destinée – Histoire orientale, Chapitre VI, Le Ministre.
Le mot de jour sera en congé les deux prochaines semaines. Il reviendra le 7 juin.
<1568>
-
Jeudi 20 mai 2021
« Les violentes émeutes de ces derniers jours indiquent qu’Israël se trouve à la croisée des chemins »Eva IllouzLa terre sacrée des trois monothéismes, s’est à nouveau embrasée.
Comment parler de ce sujet sans tomber dans le simplisme ?
Pour les uns toute la faute est du côté des israéliens qui par leur politique de colonisation des terres que le plan de partage de 1948 donnait aux palestiniens rendent impossible toute paix qui permettrait la coexistence apaisée de deux Etats.
Pour les autres toute la faute est du côté des palestiniens qui ne parviennent pas à faire émerger des gouvernants crédibles capable de négocier et s’engager pour trouver la voie d’une négociation raisonnable avec Israël.
Pour renforcer l’argumentaire du premier camp, on parle du blocus qu’Israël impose aux territoires palestiniens, l’usage massive de la force asymétrique pour répliquer à toute attaque palestinienne ainsi que la politique de domination et donc d’humiliation du peuple palestinien, moins bien organisé, moins bien structuré, nettement moins bien armé.
Mais le second camp pourra répliquer en fustigeant l’attitude, les méthodes et l’idéologie du Hamas, ainsi que la corruption du Fatah.
A ce moment de l’affrontement, nous sommes en plus en présence d’une double impasse de gouvernement. Au bout de deux ans et quatre élections (9 avril et 17 septembre 2019, 2 mars 2020, 23 mars 2021) Israël n’est toujours pas en mesure de désigner un premier ministre et un gouvernement capables de gouverner le pays dans la durée et la stabilité. Pendant ce temps, Benyamin Netanyahou reste au pouvoir et expédie les affaires courantes. Et quand les affaires courantes sont une guerre contre le Hamas, cela lui est plutôt favorable.
En face, le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas a reporté sine die les élections législatives qui aurait dû se tenir en 2021. Le précédent parlement avait été élu en 2006 !
Lui-même a été élu en 2005 et reste dans sa fonction sans une nouvelle légitimation par les urnes.
Écrire sur ce sujet est périlleux.
On peut, je pense légitimement, avoir un surplus de compassion pour la plus grande partie du peuple palestinien qui vivent dans des conditions d’enfermement et d’insécurité terribles. Et qui en plus, ont des dirigeants médiocres et corrompus.
Mais on ne peut pas ne pas avoir de compassion pour le peuple israélien qui lui aussi est touché par les actions meurtrières du Hamas qui dans sa tentative actuelle ne cherche pas le bien du peuple palestinien mais plutôt de gagner la bataille de l’image contre le Fatah, en voulant montrer que c’est lui qui défend avec le plus d’ardeur la cause palestinienne.
Je me suis abonné il y a quelques mois à une revue en ligne qui s’appelle « AOC » pour Analyse, Opinion, Critique. Chaque jour, un article dans chacune de ces rubriques est publié.
Et pour éclairer le sujet que j’ai abordé aujourd’hui je voudrais partager l’opinion de la sociologue Eva Illouz publié le 19 mai : « Israël-Palestine : la guerre silencieuse »
Eva Illouz possède la double nationalité franco israélienne. Elle est née le 30 avril 1961 à Fès au Maroc. Elle est directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Elle enseigne aussi la sociologie à l’Université hébraïque de Jérusalem. Elle a écrit plusieurs livres de sociologie qui ont eu du succès. Je possède dans ma bibliothèque, un livre qu’il me reste à lire : « Happycratie »
Elle pose d’abord la question juste des faits : Peut-on expliquer comment la violence actuelle a commencé ?
Elle a cette formule piquante «
« Lorsque deux camps sont engagés dans un conflit qui dure depuis aussi longtemps que le conflit israélo-palestinien, chacun de deux côtés est devenu expert dans l’art d’accuser l’autre « d’avoir commencé ». »
C’est un peu comme de tous jeunes enfants : « c’est lui qui a commencé »
Certains voudraient faire commencer l’histoire dans les époques mythologique quand le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob a donné l’ordre à Moïse de conduire les Hébreux, hors d’Egypte dans ce pays qu’il lui a donné.
Ce récit est écrit dans les livres saints de la religion juive. Rien de ce récit n’a pu être confirmé par les archéologues et les Historiens.
D’autres veulent la faire commencer au moment de « La Nakba », « catastrophe » en arabe, qui désigne l’exil forcé de 700 000 Palestiniens lors de la création de l’Etat d’Israël en 1948. Car cette terre était occupée par des arabes musulmans et chrétiens qui étaient largement majoritaires avant que le mouvement sioniste envoie par vague successive des juifs s’installer en Palestine.
Pour ma part, je préfère me référer à la décision de l’ONU qui a créé l’État d’Israël mais qui parallèlement a créé l’État de Palestine. Que l’un existe, sans l’autre pose un sérieux problème.
Mais si on en revient à l’embrasement actuel, le début n’est pas évident :
« Nous pourrions commencer par la vidéo d’un adolescent arabe du quartier de Beit Hanina à Jérusalem-Est qui gifle, sans avoir été provoqué, un adolescent juif orthodoxe dans le tramway de Jérusalem. Cette vidéo, postée sur Tiktok, a suscité un tollé, alimentant la peur existentielle ressentie par beaucoup de Juifs israéliens mais aussi leur perception que « la haine des Arabes à leur égard sera éternelle ».
Cet incident aurait pu rester à sa mesure d’incident qui justifie une remontrance ou une sanction pour le gifleur. Il semble dérisoire de penser que cet incident est la cause de centaine de morts ?
« Mais nous pourrions aussi commencer l’histoire un peu plus tard, le jeudi 22 avril, lorsque des membres de l’organisation d’extrême droite Lehava ont traversé la ville de Jérusalem en scandant « mort aux Arabes ». »
Cette manifestation s’est déroulée en pleine période sacrée pour les musulmans du ramadan. Et c’est alors que la Police israélienne a eu cette initiative malheureuse, qu’Eva Illouz pointe aussi :
« Ou bien prendre comme point de départ la décision de la police de fermer avec des barrières la petite place située devant la porte de Damas pendant le mois sacré de Ramadan. Cette porte mène aux quartiers arabes exigus et surpeuplés de la Vieille Ville de Jérusalem, et ses abords constituent depuis longtemps déjà un lieu où se retrouvent les hommes, majoritairement jeunes [notamment les soirs de ramadan]. Cela a été vécu comme une humiliation de plus qui venait s’ajouter à la privation, au quotidien, des droits politiques des Arabes de Jérusalem – ils représentent 40 % de la population de la ville mais n’ont aucun droit politique »
Et la police israélienne ne s’est pas contenté de bloquer le passage des arabes de Jérusalem
« Puis, lorsque les Israéliens ont empêché, pendant le mois de Ramadan, des milliers de pèlerins de se rendre à la mosquée Al-Aqsa (le troisième lieu saint de l’islam), d’humiliation on est passé à profanation. À l’approche de la Journée de Jérusalem, qui célèbre la conquête de ville en 1967, et après une semaine de tension, la police a utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau sale (qui détrempent les gens et les rues d’une odeur nauséabonde insupportable) pour disperser et combattre les fidèles, blessant des centaines de personnes. »
Quand on profane le lieu sacré d’un peuple croyant, il faut s’attendre au pire.
Car ce qui est sacré autorise le sacrifice et conduit à punir ce qui est sacrilège. Or la profanation est un sacrilège pour ceux qui croient au sacré.
Et c’est ainsi que les arabes, citoyens israéliens ont commencé à se révolter.
Le Hamas a alors profité de cet instant de tension pour envoyer une pluie de roquettes vers les villes israéliennes, tout en se réfugiant dans des immeubles dans lesquels il utilise les populations civiles et les enfants comme bouclier humain. Son but premier étant de conforter sa position politique après la décision de reporter les élections prises par son ennemi intérieur : le président de l’autorité palestinienne.
L’armée israélienne a alors répliqué avec sa puissance habituelle et les effets collatéraux inévitables qui révoltent beaucoup de personnes dans le monde. Dans cette situation on en revient à la formule d’Annie Kriegel :
« Israël n’a qu’un ami, mais c’est le bon »
Mais c’est dans la seconde partie de son article que je trouve l’opinion d’Eva Illouz particulièrement intéressante :
« Cependant, la guerre contre Gaza (un événement) ne doit pas, en dépit de sa télégénie, détourner notre attention des processus plus silencieux et invisibles qui ont jalonné l’histoire d’Israël, je parle de la constante privation des liberté et souveraineté politique des Palestiniens de Cisjordanie, et, par conséquent, du sentiment d’aliénation des citoyens arabes dans une société qui n’a cessé, au mieux, d’exprimer une profonde ambivalence à l’égard de leur présence.
La guerre civile qui déchire Israël est bien plus inquiétante que la guerre militaire menée contre le Hamas, car elle met en évidence les contradictions internes qu’Israël n’a pas voulu et peut-être n’a pas pu surmonter. Cette guerre trouve sa source dans l’impossible modèle politique qu’Israël a tenté de promouvoir : une démocratie fondée sur l’exclusion durable des citoyens arabes de l’appareil d’État. [..]
Cette exclusion n’est pas simplement un effet involontaire de la situation militaire d’Israël. Non, elle a été entérinée par de nombreuses lois qui discriminent les citoyens juifs et arabes. C’est pourquoi le point d’entrée le plus pertinent pour comprendre la guerre civile actuelle réside dans la tentative continue des colons juifs d’expulser des familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est. »
Parce que parmi les évènements qui ont fait monter la tension il y avait la question de l’expulsion de familles palestiniennes de ce quartier arabe de Jérusalem par des colons. Je n’ai pas tout de suite compris de quoi il s’agissait. En 1948, dans le cadre de la création des deux États, des juifs avaient dû quitter ces immeubles qui se trouvaient dans la partie palestinienne. La Jordanie qui était alors l’État souverain sur ces lieux n’a pas trouvé utile de donner de titre de propriété aux palestiniens à qui ont avait donné ces biens immobiliers, contrairement à l’État d’Israël qui a tout de suite donné des titres aux juifs qui se sont emparés des biens arabes.
Cette situation révèle donc une asymétrie absolue, puisque des juifs pourraient retrouver la possession de leurs biens d’avant 1948, contrairement aux palestiniens pour lesquels l’État d’Israël refuse toute réciprocité.
Eva Illouz nous dit davantage de l’évolution interne des forces politiques et de la société israélienne :
« Le cynisme meurtrier du Hamas ne saurait être minoré. Mais en tant qu’Israélienne juive, il semble plus opportun que ma réflexion se porte sur les défaillances de mon propre groupe tout en restant consciente que l’autre camp n’est pas qu’une victime innocente et angélique (à quoi j’ajouterai que l’autocritique n’est pas l’un des points forts du camp arabe).
Le lecteur européen ignore que l’extrême droite israélienne à laquelle Netanyahu s’est allié est d’une nature différente des partis habituellement ainsi qualifiés en Europe. Itamar Ben Gvir, qui dirige le parti d’extrême droite Otzma Yehudit (Force juive), avait jusqu’à récemment dans sa maison un portrait de Baruch Goldstein. Baruch Goldstein était un médecin américain qui, alors qu’il vivait dans la colonie de Kiriat Arba (Hébron), a tué 29 musulmans pendant qu’ils priaient dans la grotte des patriarches. Ben-Gvir, quant à lui, est un avocat qui défend les terroristes juifs et les auteurs de crimes haineux. L’organisation Lehava, étroitement associé à ce parti, a pour mission d’empêcher les mariages interconfessionnels et le mélange des « races ».
[…] Lehava publie aussi les noms des Juifs (dans le but de leur faire honte) qui louent des appartements à des Arabes. Seule la culture du Sud profond américain du début du XXe siècle peut soutenir la comparaison avec une telle idéologie.
Netanyahu est devenu leur allié politique naturel, virant ainsi vers les formes les plus extrémistes du radicalisme de droite. Ces groupes attisent les flammes de la guerre civile en répandant le racisme au sein de la société israélienne au chant du slogan « mort aux Arabes ».
Selon Eva Illouz toute la société civile israélienne ne se trouve pas dans cette dérive mortifère :
« Mordechai Cohen, le directeur du ministère de l’Intérieur, a publié sur sa page Facebook une vidéo rappelant au public israélien les longues et patientes années de travail que son ministère a consacrées à l’intégration des Arabes dans la société israélienne et à la création de liens profonds entre les deux populations.
Ce ne sont pas là les mots vides de sens d’un représentant de l’État. Et si ces liens sont peut-être loin d’être d’une égalité totale, ils n’en demeurent pas moins réels et puissants, et ils suggèrent qu’Israël est, à bien des égards, exemplaire en matière de fraternité entre Juifs et Arabes, une fraternité curieusement étrangère à bien d’autres pays, notamment à des nations comme la France. Les Arabes sont en effet aujourd’hui beaucoup plus intégrés à la société israélienne qu’ils ne l’étaient il y a cinquante ans (si l’on se fonde sur le nombre d’Arabes qui font des études supérieures et travaillent dans les institutions publiques, les universités et les hôpitaux).
Cette fraternité n’a fait que se renforcer avec la crise du Covid-19, durant laquelle les équipes de santé juives et arabes ont travaillé côte à côte, sans relâche, pour sauver le pays. »
Elle rapporte l’influence néfaste de l’idéologie des colons.
« Cette coexistence est vouée à l’échec dès lors qu’elle se trouve sapée par le racisme qu’encourage activement le mélange de religion et d’ultranationalisme qui définit désormais l’idéologie des colons, laquelle se répand peu à peu dans la société israélienne. »
Et voici sa conclusion qui me semble pleine de sens :
« Les violentes émeutes de ces derniers jours indiquent qu’Israël se trouve à la croisée des chemins. Le pays doit impérativement modifier sa politique eu égard à la question palestinienne et adopter les normes internationales en matière de droits humains dans les territoires, sinon il sera obligé de durcir non seulement sa culture militaire en matière de contrôle mais aussi sa suspension des droits civiques, et l’étendre à l’intérieur de la Ligne verte. Cette dernière option ne sera pas viable. Les Arabes israéliens doivent devenir des citoyens israéliens à part entière, et cela n’est possible que si leurs frères palestiniens se voient accorder la souveraineté politique.
Israël a essayé de construire un État démocratique et juif, mais sa judéité a été détournée par l’orthodoxie religieuse et l’ultranationalisme, tous deux incompatibles avec la démocratie. Ces factions extrémistes ont placé judéité et démocratie sur des voies incompatibles – des voies aux logiques morales et politiques incommensurables qui les mènent droit à la collision. Dans le contexte d’un pays engagé dans des confrontations militaires incessantes, le puissant courant universaliste du judaïsme est passé à la trappe.
Israël peut être un exemple comme nul autre pour le monde, non seulement pour ce qui est de l’égalité formelle entre Juifs et Arabes mais aussi des liens de fraternité humaine qu’ils peuvent tisser. Ces deux peuples se ressemblent étrangement et partagent beaucoup de choses en commun. Cette fraternité n’est pas un luxe ni un souhait naïf. Elle est la condition même de la poursuite de l’existence pacifique et prospère d’Israël lui-même. »
J’ai trouvé aussi très intéressante la première partie de l’émission du « nouvel esprit public » consacré à ce sujet <Jérusalem : un déjà-vu sanglant>
<1567>
-
Mercredi 19 mai 2021
« Nos mythologies économiques par Éloi Laurent »Publication de la page consacrée à la sérieJe continue la publication des séries. Celle-ci correspond à des mots du jour publiés en juin 2017.
La page consacrée à la série sur le livre d’Éloi Laurent : «nos mythologies économiques» est en ligne sur la page des séries.
Mais vous pouvez aller directement sur la page en suivant ce lien : <Nos mythologies économiques >
<Mot sans numéro>
-
Mardi 18 mai 2021
« Personne n’est ce qu’il est sans l’autre. Sans possibilité de donner et de recevoir, personne n’existe. »Axel KahnAxel Kahn est médecin généticien. Après beaucoup de combats de toute sorte, il s’est mobilisé dans la lutte contre le cancer. Il a été élu Président de la Ligue nationale contre le cancer le 28 juin 2019.
Il se met en retrait, il a dit le <17 mai à Léa Salamé> :
« Je lutte contre le cancer et il se trouve que la patrouille m’a rattrapé : moi aussi, j’ai un cancer » »
Il avait annoncé la nouvelle sur son blog, il y a déjà quelques jours, le 11 mai : <Atmosphère, l’âme d’un homme> :
« Dès le quatre août, nous savions. La maladie que je combats avec acharnement en tant que Président de La Ligue ne s’était pas avouée vaincue, elle m’attendait au tournant, lançant une atteinte massive. […] Dans mon cas, la « consultation d’annonce » si importante et fréquemment dramatique dans l’histoire d’un cancer, a été réduite à sa plus simple expression et n’a nullement été dramatique. Cancérologue depuis cinquante ans, je connais bien l’adversaire, n’ai jamais nié qu’il soit redoutable, impitoyable. Les motifs de mon engagement à La Ligue sont liés à cette familiarité, à mon désir de m’impliquer plus au soir de ma vie dans la coordination des défenses qui lui sont opposées, dans le soutien aux quelques quatre cent mille personnes qu’il agresse chaque année dans mon pays où naissent dans le même délai moins de sept-cent-cinquante mille bébés. Les images du brigand à l’attaque ne me sont pas étrangères. Un bref passage dans la cavité de l’électroaimant d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire, des clichés vite communiqués, l’affaire était entendue. »
Je suis toujours bouleversé quand j’entends un homme ayant le courage de parler en toute simplicité de son combat intime contre la maladie et la mort.
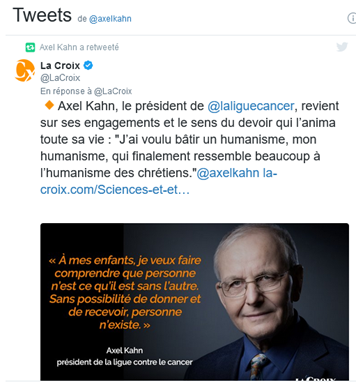 Et j’ai particulièrement été touché par cette phrase qu’Axel Kahn a tweeté :
Et j’ai particulièrement été touché par cette phrase qu’Axel Kahn a tweeté :
« A mes enfants, je veux faire comprendre que personne n’est ce qu’il est sans l’autre. Sans possibilité de donner et de recevoir, personne n’existe. »
Et pour finir, <l’entretien avec Léa Salamé> Axel Kahn a cité la fin du poème d’Alfred Vigny : « La mort du loup »
« A voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse
Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse.
– Ah ! je t’ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au cœur !
Il disait : » Si tu peux, fais que ton âme arrive,
A force de rester studieuse et pensive,
Jusqu’à ce haut degré de stoïque fierté
Où, naissant dans les bois, j’ai tout d’abord monté.
Gémir, pleurer, prier est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le Sort a voulu t’appeler,
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. »
Personne ne connaît le terme, pas plus Axel Kahn qu’un autre.
Mais il pense que le plus probable est qu’il est en train de parcourir l’itinéraire final de sa vie.
<1566>
-
Lundi 17 mai 2021
« Gisèle Halimi, le Panthéon et la guerre d’Algérie. »Questions sur la panthéonisation de l’avocate des droits des femmesIl semblerait que la main de notre jeune Président tremble. Elle tremble pour une signature.
Dans l’hommage que j’avais consacré à Gisèle Halimi lors du mot du jour du <6 octobre 2020> j’évoquais l’hypothèse qu’Emmanuel Macron soulevait lui-même, à savoir d’augmenter un peu le taux de féminisation du Panthéon en y faisant entrer Gisèle Halimi.
La procédure suivait son cours et le résultat semblait acquis.
Mais France Inter a rapporté le 13 mai 2021 : < Pourquoi l’entrée de Gisèle Halimi au Panthéon est compromise> :
« Mais selon les informations de France Inter, il y a de fortes chances qu’Emmanuel Macron y renonce. En cause, l’engagement de Gisèle Halimi pendant la guerre d’Algérie.
C’est une règle absolue : une panthéonisation doit rassembler et, par-dessus tout, ne froisser personne. Le nom de Gisèle Halimi, héroïne de la lutte pour les droits des femmes, semblait plutôt consensuel. Mais en janvier dernier, le rapport rendu par Benjamin Stora à l’Élysée « a clivé », confie un proche du dossier. Dans ce rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie commandé par Emmanuel Macron, l’historien recommande de faire entrer Gisèle Halimi au Panthéon, comme « figure d’opposition à la guerre d’Algérie ».
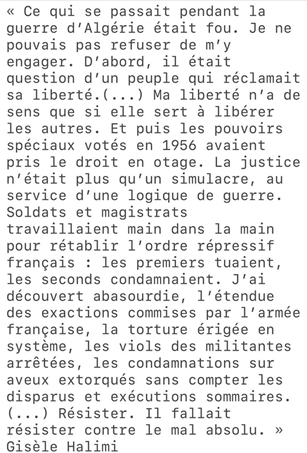 L’avocate de militants du FLN (Front de libération nationale) parmi les « grands hommes » – et les grandes femmes ? « Certaines associations de harkis et de pieds-noirs l’ont pris comme une insulte », regrette cette même source. Cela n’a pas échappé au président, son entourage le reconnaît. Lui qui s’est donné pour mission de « réconcilier les mémoires » hésite à prendre le risque de raviver ces blessures. »
L’avocate de militants du FLN (Front de libération nationale) parmi les « grands hommes » – et les grandes femmes ? « Certaines associations de harkis et de pieds-noirs l’ont pris comme une insulte », regrette cette même source. Cela n’a pas échappé au président, son entourage le reconnaît. Lui qui s’est donné pour mission de « réconcilier les mémoires » hésite à prendre le risque de raviver ces blessures. »
« L’Express » a publié un article sur le même sujet : <Gisèle Halimi au Panthéon ? Tout comprendre au débat>
L’express cite Céline Malaisé, présidente du groupe des élus Front de gauche au conseil régional d’Ile-de-France, qui a publié sur Twitter des phrases de l’avocate et notamment un extrait qui selon elle « semble poser problème » au président. Ces extraits proviennent du livre Une farouche liberté, écrit en collaboration avec la journaliste du Monde Annick Cojean. L’avocate évoque les « exactions commises par l’armée française, la torture érigée en système ».
Cette possible reculade en évoque une autre que j’avais cité lors d’un mot du jour consacré à un autre humain remarquable. Il s’agissait du mot du jour du <27 février 2019>
J’ai lu un autre article dans <Libération> parlant de Frantz Fanon :
« Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a décidé de «surseoir» à la proposition de nommer une ruelle d’un des nouveaux quartiers de la ville du nom de Frantz Fanon (grande figure anticolonialiste). «Aujourd’hui, le choix du nom de Frantz Fanon suscite des incompréhensions, des polémiques, des oppositions que je peux comprendre. Dans un souci d’apaisement, j’ai donc décidé de surseoir à cette proposition », »
 Les harkis ont été trahis par la France. La France dans le récit qu’elle livrait à ces personnes, parlait de ses valeurs et que l’Algérie était la France et qu’elle avait donc besoin d’eux pour convaincre les autres habitants d’Algérie.
Les harkis ont été trahis par la France. La France dans le récit qu’elle livrait à ces personnes, parlait de ses valeurs et que l’Algérie était la France et qu’elle avait donc besoin d’eux pour convaincre les autres habitants d’Algérie.
Quand le récit a changé et que l’Algérie devait devenir indépendant, elle les a abandonnés en terre d’Algérie comme des proies à la vengeance du FLN qui les considérait comme des traitres
Cela étant, le colonialisme n’était pas défendable en 1960. Avant non plus, mais en 1960, il était devenu plus évident encore que ce combat constituait une faute pour nos valeurs et pour l’humanité.
Celles et ceux qui comme Gisèle Halimi, Franz Fanon ou Michel Rocard, par exemple, ont défendu la cause anticoloniale ont été l’honneur de la France, contrairement à un François Mitterrand, par exemple, qui était dans l’autre camp, dans un rôle peu glorieux.
Ne pas vouloir honorer et reconnaître la clairvoyance de celles et de ceux qui, dans le trouble de l’époque, étaient dans le sens de l’Histoire constitue une erreur et une lâcheté.
Pourtant, lors d’une interview au Point rappelé par <le Monde>, Emmanuel Macron avait dit :
« Je pense qu’il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Certains, il y a un peu plus de dix ans, ont voulu faire ça en France. Jamais vous ne m’entendrez tenir ce genre de propos. J’ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. »
 Et dans le même article, on peut aussi lire les propos tenus par Emmanuel Macron à Alger le 15 février 2017 :
Et dans le même article, on peut aussi lire les propos tenus par Emmanuel Macron à Alger le 15 février 2017 :
« La colonisation fait partie de l’histoire française, poursuit-il. C’est un crime, c’est un crime contre l’humanité, c’est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. »
Que s’est-il passé depuis ?
Peut être un désir de réélection et une volonté de ne pas vouloir décourager des électeurs qui pourraient avoir la généreuse idée de voter pour la réalisation de ce désir.
C’est de ces ambitions là que sont fait les hommes politiques, non les hommes d’État.
<1568>
-
Mercredi 12 mai 2021
« J’ai choisi la musique pour sa capacité à dire des choses que je ne comprenais pas avec les mots. »Sonia Wieder-AthertonHier, j’évoquais Christa Ludwig qui m’a accompagné pendant de longues années de découvertes et d’approfondissement musical.
Je dirais que je la connaissais musicalement. Depuis sa mort, les nombreux articles et entretiens que j’ai vus et lus m’ont aidé à mieux connaître la femme qu’elle était.
Je connaissais Christa Ludwig. Mais je ne connaissais pas Sonia Wieder Atherton.
 Je savais bien qu’elle existait et qu’elle jouait du violoncelle, mais je n’avais jamais eu la curiosité d’écouter un de ses disques ou de l’entendre parler de son art.
Je savais bien qu’elle existait et qu’elle jouait du violoncelle, mais je n’avais jamais eu la curiosité d’écouter un de ses disques ou de l’entendre parler de son art.
C’est Augustin Trapenard, dans son émission « Boomerang » qui m’a fait découvrir la personne qu’elle était et aussi une violoncelliste et musicienne accomplies.
C’était l’émission du 31 mars 2021 : <Les cordes sensibles de Sonia Wieder-Atherton>
Elle a beaucoup travaillé avec la cinéaste Chantal Ackerman dont elle a été la compagne.
Elle interroge les sons et la musique et en parle divinement.
Augustin Trapenard la présente comme « musicienne et conteuse ».
C’est une violoncelliste prodige qui a suivi une voie toute traditionnelle et a été l’élève des plus grands. Elle a aussi été l’élève de Rostropovitch qu’elle a beaucoup admiré.
Depuis cette émission, je me suis procuré plusieurs disques d’elle et j’ai été absolument captivé.
Elle joue des œuvres très classiques que je connais bien comme < La sonate pour Arpeggione de Schubert> ou le premier concerto de Chostakovitch. Des interprétations techniquement irréprochables et surtout avec une sensibilité immédiatement communicative.
Et puis elle va par d’autres chemins.
Par exemple ce lied de Gustav Mahler que chante merveilleusement Christa Ludwig, <Ich bin der Welt abhanden gekommen> elle l’arrange pour violoncelle et son violoncelle est comme une voix, il n’y a pas les paroles, mais le violoncelle chante : <Mahler par Sonia Wieder Atherton>
Elle partage avec Augustin Trapenard cette vision
« J’ai choisi la musique pour sa capacité à dire des choses que je ne comprenais pas avec les mots. La musique raconte aussi une histoire, et le violoncelle a été mon premier outil de conteuse ».
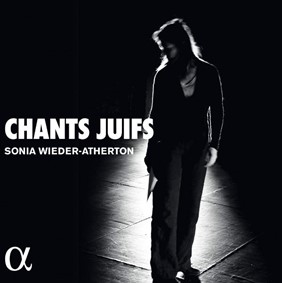 Après elle va encore vers d’autres chemins, voici <Une prière juive> portée par le seul violoncelle. Ce morceau fait partie d’un disque intitulé <Chants Juifs>
Après elle va encore vers d’autres chemins, voici <Une prière juive> portée par le seul violoncelle. Ce morceau fait partie d’un disque intitulé <Chants Juifs>
Elle dit :
« Ce cycle de chants juifs est né de ma recherche sur la musique juive liturgique. Une musique aux racines si anciennes, qui a accompagné le peuple juif durant des siècles de pérégrinations. Je me suis intéressée à des mélodies de différentes sources, mais ce qui m’a véritablement inspirée, c’est le chant des cantors, ou hazans, et son expressivité intérieure, intime, contenant pourtant une telle force d’expression. Dans cette musique, le populaire et le sacré se confondent. Qu’elle soit gaie ou triste, lente ou rapide, prière, chant populaire ou encore danse, elle est toujours partage et intimité. J’ai senti que je connaissais cette musique depuis toujours, depuis bien avant ma naissance, c’était une impression étrange. »
Elle explique sa relation particulière avec son instrument :
« La première fois que j’ai entendu le son d’un violoncelle, j’ai été hypnotisée, soulevée dans l’univers, totalement happée. J’essaie de toujours revenir à cette sensation ».
Et puis elle a voulu entrer dans le monde de Nina Simone.
 Nina Simone rêvait d’être la première concertiste de musique classique. Une société rétrograde et raciste l’a empêché d’atteindre ce rêve. Elle se tournera alors vers le jazz et deviendra selon les spécialistes que je ne suis pas, une des plus grandes chanteuses de jazz de l’Histoire.
Nina Simone rêvait d’être la première concertiste de musique classique. Une société rétrograde et raciste l’a empêché d’atteindre ce rêve. Elle se tournera alors vers le jazz et deviendra selon les spécialistes que je ne suis pas, une des plus grandes chanteuses de jazz de l’Histoire.
Sonia Wieder atherton dit : .
« Dans mes créations, j’essaie d’amener des œuvres au violoncelle, de créer des rencontres entre la musique classique et d’autres registres, d’inventer de nouveaux langages ».
Le disque qu’elle a consacrée à Nina Simone s’appelle <Little Girl Blue…>
Voici un des morceaux de ce disque : <Black is the Colour of my True Love’s Hair>
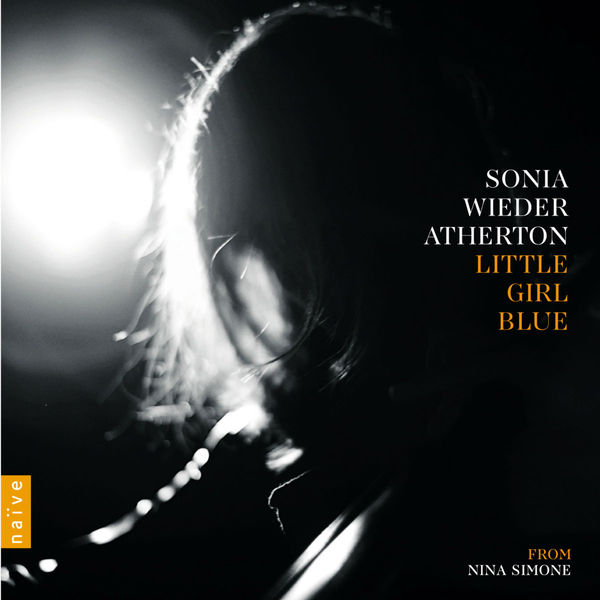 Elle dit encore :
Elle dit encore :
« Une interprétation, c’est comme le fil d’un funambule : parfois on tombe, on se laisse dépasser par l’émotion ».
Et puis je finirais par une histoire qu’elle raconte après avoir parlé avec émotion de l’œuvre et du parcours de Nina Simone dans l’émission de Trapenard :
« C’était une des premières fois que j’ai joué pour des jeunes adolescents. Je leur faisais découvrir la musique. Je leur jouais plein de morceaux et je leur demandais à quoi cela les faisait penser. Et j’ai joué alors un mouvement de Chostakovitch très puissant, très rythmique, très violent, très intense. Et je leur demande et là ça vous fait penser à quoi ?
Moi ça me fait penser au vent ! Moi ça me fait penser à la tempête ! Moi ça me fait penser à des gens très méchants…
Et puis il y a une petite fille qui lève la main et qui dit :
« Moi ça me fait penser à une maman qui a deux enfants. Elle a un petit garçon et une petite fille et elle préfère son petit garçon. Et ça me fait penser ce que cela fait à la petite fille ! »
C’est pour moi une histoire qui a une force inouïe
Cela signifie que cette colère dans la musique, elle a pu entrer dans le cœur de cette petite fille et allé dans l’endroit qui n’avait jamais été exprimé et qui lui a fait dire cela. »
C’est la puissance d’expression de la musique qui éclaire encore mieux les paroles de Sonia Wieder-Atherton que j’ai mises en exergue.
Si vous voulez aller plus loin, il y a une série de cinq entretiens d’une demi-heure sur France Musique dont le cinquième « La musique doit être là où bat le cœur du monde ». C’était en 2017.
Plus récemment en février une autre émission de France musique « C’est très physique, voire animal d’entrer sur scène »
Hier je finissais le mot du jour en disant de Christa Ludwig par ces mots « Une grande Dame, une immense musicienne. ».
Aujourd’hui j’ai envie d’écrire : « Une belle âme et une bouleversante conteuse qui chante avec un violoncelle »
<1564>
-
Mardi 11 mai 2021
« Le chant, c’est une métaphore de la vie : on inspire, on expire, le son arrive sur le souffle, puis c’est fini. »Christa LudwigChrista Ludwig est morte, samedi 24 avril tout près de Vienne, en Autriche, elle avait 93 ans.
Et depuis le 24 avril j’ai passé beaucoup de temps avec cette artiste merveilleuse, en écoutant ses disques, en lisant des articles qui lui étaient consacrés et en regardant énormément de vidéos, pour l’essentiel en langue allemande, dans lesquelles elle révélait sa personnalité lumineuse et son esprit pétillant.
 Je pourrais reprendre la description qu’en fait <Le Monde> :
Je pourrais reprendre la description qu’en fait <Le Monde> :
« Une voix sensuelle et chaudement ambrée, d’une amplitude exceptionnelle, une artiste émouvante à la carrière en tout point exemplaire ».
C’est d’ailleurs dans cet article que j’ai trouvé la phrase que j’ai mise en exergue :
« Le chant, c’est une métaphore de la vie : on inspire, on expire, le son arrive sur le souffle, puis c’est fini. »
Dans les vidéos que j’ai regardées, elle parle parfois de la mort.
Pour elle la vie est esprit, souffle. Un corps mort ne présente pour elle plus aucun intérêt.
Elle dit par exemple à propos de sa mère qui a joué un si grand rôle pour elle, puisqu’elle fut sa seule professeure de chant tout au long de la vie en plus de la relation mère fille, elle est toujours avec moi, dans mon esprit, je la cite chaque jour. Elle est vivante en moi, le corps qui se trouve au cimetière ce n’est plus elle. C’est pourquoi Christa Ludwig n’allait jamais au cimetière.
Elle a épousé, en secondes noces, en 1972, Paul-Émile Deiber, sociétaire de la Comédie-Française et metteur en scène. C’est pour cette raison qu’elle a vécu longtemps en France.
Ils vieillirent ensemble et elle raconte qu’elle lui tenait la main au moment ultime et elle sentit quand la vie l’abandonna et elle ajouta :
« Et alors je compris que ce corps n’était plus mon mari. Il était avec moi, dans mes pensées, dans mon cœur, auprès de moi, non dans ce corps inerte. »
J’ai trouvé cette vision très apaisante et très inspirante.
Elle avait décidé de se faire incinérer.
 Mais si je veux parler de Christa Ludwig, je dois dire avant tout qu’elle fait partie de mon univers musical depuis que je suis mélomane.
Mais si je veux parler de Christa Ludwig, je dois dire avant tout qu’elle fait partie de mon univers musical depuis que je suis mélomane.
Quand j’ai appris son départ, je me suis posé et fait le compte des enregistrements que je possédais et dans lesquels elle chantait.
Quand on est mélomane comme moi, on collectionne patiemment des dizaines, puis des centaines et on arrive aux milliers de disque.
On achète parce qu’on a lu ou entendu une critique, découvert une interprétation dans des ouvrages qui donnent les enregistrements de référence, ou plus simplement qu’on a entendu l’enregistrement ou qu’un ami mélomane nous l’a fait découvrir.
Et alors faisant une petite liste, sans exagérer pour ne pas dépasser les limites d’un mot du jour.
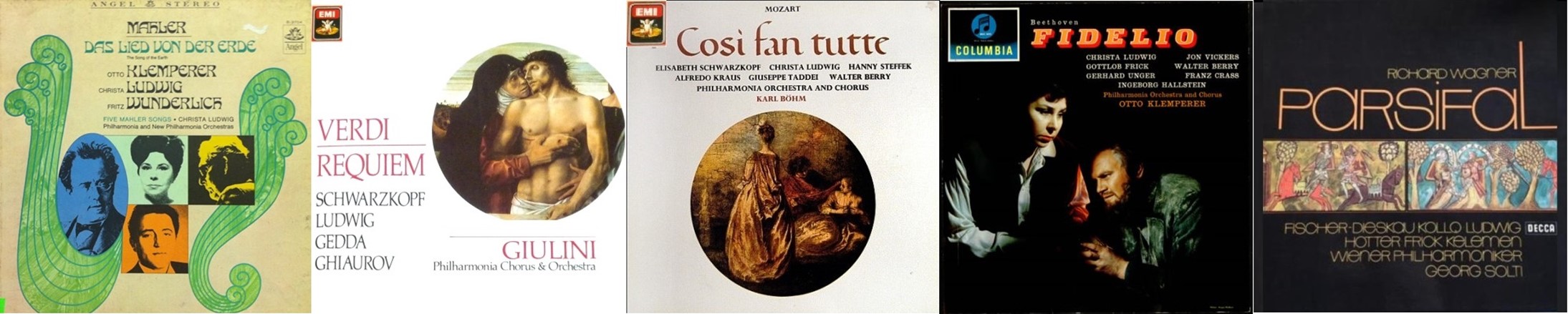
Un opus magnum de la musique est constitué par « Le chant de la terre » de Gustav Mahler. Dans les dizaines d’enregistrements de cette œuvre, deux disques surplombent : la version de Bruno Walter avec Kathleen Ferrier et celle d’Otto Klemperer avec Christa Ludwig et Fritz Wunderlich.
La plus belle version du Requiem de Verdi est la première enregistrée par Carlo Maria Giulini, la partie d’alto est chantée par Christa Ludwig.
Le plus beau Cosi fan Tutte de l’histoire est celui que Karl Boehm a enregistré avec l’orchestre Philharmonia. Le rôle de Dorabella était tenu par Christa Ludwig.
La meilleure version de Fidelio de Beethoven est celle de Klemperer avec Jon Vickers. Le rôle de Fidelio est chanté par Christa Ludwig.
Un des plus belles interprétations du plus grand opéra de Wagner, Parsifal est celle de Solti, le rôle de Kundry est tenu par Christa Ludwig.
Et il serait possible de continuer à alimenter cette énumération.
Les meilleurs chefs d’orchestre voulaient Christa Ludwig, parce qu’elle était simplement extraordinaire.
Parmi ces chefs, invariablement elle en citait trois :
Karl Boehm qui fut comme un second père pour elle et l’accueillit à l’opéra de Vienne. Elle n’était pas autrichienne, elle était née à Berlin mais elle se sentait et se vivait comme viennoise.
Herbert von Karajan, en qui elle avait toute confiance. Il semble que c’est elle qui a dit un jour que Karajan était Dieu, ce que des détracteurs de ce dernier avait traduit qu’il se prenait pour Dieu. Christa Ludwig voulait simplement dire qu’elle était toujours rassuré quand Karajan dirigeait parce qu’il avait cette faculté de rassurer et de créer un écrin sonore dans lequel la voix de ses chanteurs pouvait s’épanouir sans crainte.
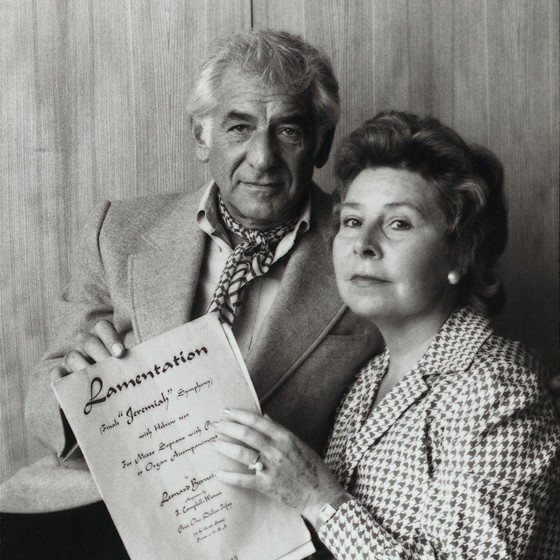 Mais celui pour lequel elle avait le plus d’affection était Léonard Bernstein. C’est encore elle qui a eu cette phrase :
Mais celui pour lequel elle avait le plus d’affection était Léonard Bernstein. C’est encore elle qui a eu cette phrase :
« il était la musique »
Dans cette interview à Forum Opera elle est plus précise : .
« J’ai eu la chance de faire la connaissance de trois grands chefs d’orchestre à trois moments différents de ma carrière. Quand je suis arrivée à Vienne, j’ai vite travaillé avec Karl Böhm. C’était une grande chance, car Böhm, dont la femme était cantatrice, comprenait la voix. Bien sûr, tous les chefs aiment les voix, mais Böhm était le seul à vraiment les comprendre, à connaître précisément leur fonctionnement. Quand je l’ai rencontré, j’étais encore une très jeune chanteuse, il m’a enseigné la rigueur, la justesse, l’exactitude.
Quelques années plus tard, j’ai rencontré Karajan qui, lui, m’a appris la beauté de la phrase, l’esthétique du son. En répétition, avec le merveilleux Philharmonique de Vienne, il disait toujours aux musiciens d’écouter le son produit par les voix, et aux chanteurs de s’immerger dans le son de l’orchestre. Je n’ai jamais trouvé chez un autre chef un tel sens de la sonorité.
Et puis j’ai rencontré Bernstein quand j’avais déjà 40 ou 41 ans. J’étais un peu plus sage, plus aguerrie, et avec lui on pouvait découvrir le vrai sens de la musique, sa profondeur, ce qui se cache sous les notes. Avec lui, j’ai vraiment chanté toutes sortes de choses, y compris le tango de la Vieille Dame, dans Candide : le registre de la comédie n’est vraiment pas ma tasse de thé, mais j’ai fait ça pour lui. De tous mes collègues, Bernstein est le seul dont la mort m’a vraiment fait pleurer. C’était un authentique génie. »
La remarquable qualité de Christa Ludwig était sa capacité de pouvoir s’adapter à chacun de ses chefs. Elle dit :
« Mais si Böhm demandait un mezzo forte à tel moment, que Karajan, dans ce même passage, voulait qu’on chante piano et Bernstein, forte, ils avaient tous les trois raison, chacun à sa manière : c’était toujours justifié car ça s’inscrivait dans leur conception d’ensemble. Et moi, je me suis toujours bien entendue avec eux parce que je faisais le nécessaire pour m’intégrer dans cette conception. »
 Énormément de journaux lui ont rendu hommage.
Énormément de journaux lui ont rendu hommage.
<France Musique> lui consacre plusieurs pages en republiant de nombreuses émissions qui lui avaient été consacrées.
<Le Figaro> qui rapporte ce propos :
« On fait carrière avec sa tête, pas avec sa voix »
Mais cette voix est exigeante, il faut la protéger, ne pas trop parler, ne jamais prendre froid, ne pas être en contact avec des virus, ne pas boire, ni trop manger.
Le journal suisse <Le temps> parle de « discipline de cosmonaute » :
« Pendant 50 ans, elle «ne pense qu’à ses cordes vocales, jour et nuit», et s’administre au quotidien une discipline «semblable à celle des cosmonautes» pour préserver son timbre: pas de tabac ni d’alcool… et même pas de cinéma, «parce que je devrais m’enfuir dès que mon voisin tousse». »
Le journal canadien « Le Devoir » titre « Christa Ludwig, titan au féminin » et écrit :
« l’une des plus grandes chanteuses du XXe siècle, nous laisse un legs immense.
A-t-on vraiment envie d’être triste ? Ou a-t-on simplement envie de dire, de crier, « Merci ! » ? Car Christa Ludwig était déjà immortelle de son vivant. »
Pour « TELERAMA », le titre est « Christa Ludwig, quand une diva s’en va. »
Je partage cet avis :
« Femme aussi disciplinée et rigoureuse dans son art que portée à la gaieté en privé, excellant dans les personnages dramatiques mais conservant toujours un grain de joie dans sa voix merveilleusement colorée, Christa Ludwig ne fut jamais plus elle-même que chez Mozart et Strauss, sans doute parce qu’elle trouvait dans leur grâce et leur finesse un reflet de ses propres qualités. »
Et je finirai par cet article du journal belge « Crescendo » : « Christa Ludwig, la voix de mezzo dans toute sa splendeur »
« Que sa personnalité était attachante, tant elle irradiait la scène par sa présence, sa musicalité et son art du dire qui justifiaient la versatilité de son répertoire à l’opéra, en récital, au concert ! »
Vous trouverez derrière ce lien <Le final du chant de la terre avec Bernstein>
Une grande Dame, une immense musicienne.
<1563>
-
Lundi 10 mai 2021
« La diaspora des cendres »William Karel, textes des bourreaux et des victimes de la shoahPremière lettre, une demande :
« En vue d’expérimenter un soporifique, vous serait t’il possible de mettre à notre disposition quelques femmes et à quelles conditions ?
Toutes les formalités concernant le transfert de ces femmes seront faites par nous.
Nous offrons 170 marks par sujet.
Veuillez donc faire préparer un lot de 150 femmes saines, que nous enverrons chercher très prochainement »
Accusé de réception
« Nous sommes en possession du lot de 150 femmes. Votre choix est satisfaisant, quoique les sujets soient très amaigries et affaiblies.
Nous vous tiendrons au courant des expériences. »
Bilan et nouvelle demande
« Les expériences n’ont pas été concluantes. Les sujets sont morts.
Nous vous écrirons prochainement pour préparer un autre lot »
Ce sont trois lettres de l’entreprise Bayer au Directeur du camp d’Auschwitz, pendant la seconde guerre mondiale. Cet extrait se trouve à 38mn55 d’un document sonore, sans aucune image, sans aucun commentaire, avec une musique minimaliste et diffusé sur France Culture, hier soir à 20:00. Ces textes, choisis par William Karel, mis en onde par Sophie-Aude Picon, lus par des comédiens, sont des écrits des bourreaux et des victimes de la Shoah.
 Mais France Culture avait mis en ligne ce document avant sa diffusion.
Mais France Culture avait mis en ligne ce document avant sa diffusion.
J’ai donc pu l’écouter dès samedi.
J’avais accompagné Annie dans la petite ville de Matour, en Saône et Loire où elle avait des choses à faire.
En l’attendant, je suis allé me promener autour de l’étang qui se trouve dans cette petite mais dynamique ville de Bourgogne.
Casques sur les oreilles, masque sur le nez et la bouche comme il se doit, j’ai fait cinq fois le tour de cet étang, calme et paisible, pour écouter l’intégralité des 1 heure 45 que dure « La diaspora des cendres ».
Parce que vous ne pouvez pas écouter ces textes en faisant la cuisine ou une autre activité. Il faut être pleinement disponible, dans la durée.
Je crois aussi qu’il faut être dans un état mental assez serein pour pouvoir affronter ce gouffre de l’aventure humaine.
<Le Monde> écrit très justement :
« D’abord, il faut le dire. Dire que l’on sort sonné et sidéré de ces deux heures d’écoute. Dire que l’on est d’emblée certain d’être en présence d’une œuvre et exceptionnelle et majeure. Dire qu’il faudra du temps pour recouvrer son souffle et comprendre ce qui s’est ici donné à entendre. Plus qu’un document exceptionnel sur l’histoire de la Shoah, un nouvel éclairage – sonore cette fois. »
Dans notre univers de l’image toute puissante, de l’impatience élevé au niveau d’un absolu, il fallait oser produire un document nu de près de 2 heures, exclusivement sonore, sans aucun pathos, dans lequel on reçoit uniquement les mots qui ont été écrits par les bourreaux ou les victimes de ce moment dans lequel la civilisation occidentale s’est brisée dans l’innommable. C’est pourtant une œuvre d’une puissance inouï.
Parole de victime à 2 minutes 48 :
« Tous les juifs sont regroupés dans les mêmes immeubles avec obligation d’y rester après 20 heures.
Ils inventent chaque jour de nouvelles mesures pour nous briser lentement.
- Interdiction d’écouter la radio ;
- D’utiliser le téléphone ;
- D’aller à la piscine ;
- Au théâtre, au cinéma, au concert, au musée, dans une bibliothèque ;
- Dans un restaurant, une gare ou au jardin public ;
- De monter dans un tramway ;
- D’acheter des journaux, des fleurs, du café, du chocolat, des fruits
- D’aller chez le coiffeur
- De posséder une machine à écrire, un vélo, une chaise longue
- Un chien, un chat, un oiseau.
- Voilà je crois que c’est tout »
Cette énumération m’a sidéré. Une bureaucratie minutieuse de l’inhumanité !
Et que dire quand la bureaucratie nazie décrit elle-même, avec une précision sordide, les méthodes mises en œuvre pour accomplir leurs tâches infâmes ?
« Il fallait gazer les détenus dans des chambres provisoires et bruler les détenus dans des fosses.
On alternait des couches de cadavre avec des couches de bois, et lorsqu’un bucher de 100 cadavres avaient été constitué, on mettait le feu au bois avec des chiffons imbibés de pétrole.
Quand la crémation était bien avancée on jetait dans le feu les autres cadavres.
On collectait avec des seaux, la graisse qui coulait sur le sol et on la rejetait au feu pour hâter l’opération.
La durée de la crémation était de 6 à 7 heures.
La puanteur des corps brulés se faisait sentir dans tout le camp »
Rudolf Höss, directeur du camp d’Auschwitz
Vous entendrez la haine, les mots utilisés par des allemands dans des courriers de lecteurs de journaux pour prétendre que l’Allemagne doit craindre les juifs et qu’aucune pitié ne doit arrêter la machine aryenne pour exterminer la nation juive. Ils ne parlent plus d’êtres humains mais de tous les mots qui peuvent définir les parasites et les animaux ou insectes qu’il s’agit d’éradiquer.
Vous entendrez les témoignages des victimes paralysées par la violence et l’inhumanité qui se dressent contre eux. Certains, au début de la Shoah, se posent la question comment les voisins avec qui ils avaient l’habitude d’échanger et de s’entraider se comporteront.
Une jeune juive raconte comment sa famille a reçu la visite d’une de ses camarades de classe, après la nuit de cristal pendant laquelle les nazis avaient cassé les vitrines des magasins des commerçants juifs, saccagé leurs magasins et leurs appartements et fait bruler les synagogues. Cette camarade issue de la bourgeoisie aisée de la ville avait été envoyée pour exprimer la honte que sa famille ressentait par rapport à ce que les allemands avaient fait ce jour-là.
Au moment des déportations, les conditions de vie dans les wagons à bestiaux sont décrites. Parfois dans des lettres, des déportés essaient d’exprimer leur courage et leur confiance en l’avenir pour rassurer la famille restée en arrière.
Une victime a répondu à la question qu’on lui avait souvent posé : pourquoi ne vous êtes pas enfuis ? Il explique qu’on lui avait pris son passeport et que les nazis leur avait pris tout leur argent puisqu’ils avaient eu cette idée ignoble de faire payer une amende énorme aux juifs pour payer le nettoyage des dégâts de la nuit de cristal.
Et puis vous entendrez des détails de ce qui s’est passé dans les camps d’extermination, les chambres à gaz, les fours crématoires, la cruauté infinie des bourreaux
Il y aussi ces incroyables lettres envoyées par des soldats à leur épouse (59:29)
« Samedi, seize heures, la population devait se trouver sur la place.
Environ 50 000 personnes, dont moi et l’ensemble des soldats.
Puis les deux autos arrivèrent dans lesquels se trouvaient les condamnés, les mains liées, les ukrainiens leur passèrent le nœud coulant autour du cou.
4 furent pendus à la double potence.
Ils restèrent pendus pendant 3 heures, en guise d’exemple dissuasif.
Chacun pouvait venir les voir dans les environs proches.
Je les voyais à la distance d’un mètre. C’est aussi la première fois que je voyais des pendus. »
On constatera encore une fois la précision clinique de la description des faits.
Mais pourquoi écrire de telles horreurs à son épouse ? Pour manifester l’horreur de la guerre ? Exprimer une soif d’humanité ?
Espoir déçu, voilà comment continue ce soldat :
« Tu comprendras maintenant que je vis beaucoup de choses.
Que je vois, entends, participe, apprend beaucoup etc.
Bref je ne m’ennuie pas, mais je reconnais que je suis content, car ici j’ai vraiment un aperçu de plein de choses qu’on se représente bien différemment au pays.
J’aimerai bien être près de toi et des enfants, pour être là jusqu’à ton accouchement. »
 Ainsi les moments de la normalité familiale coexistent avec des actions et des expériences de l’anormalité humaine.
Ainsi les moments de la normalité familiale coexistent avec des actions et des expériences de l’anormalité humaine.
Dans un extrait, plus terrible encore que je ne cite pas, un soldat allemand qui participe à la Shoah par balles raconte à son épouse les fosses de juifs assassinés d’un coup de revolver. Il raconte qu’il a tué deux jeunes enfants de moins de 5 ans. Que ces enfants lui ont fait pensé à leurs deux enfants. Mais il enchaine immédiatement pour justifier son acte par la nécessité pour le peuple allemand de se débarrasser des juifs.
Parfois certains allemands retrouvent une part de lucidité et de compassion (1:04:58)
« Ici en Pologne, on ne nous dit rien, mais nous avons une image assez claire de la situation. Partout la terreur ouverte. Chaque jour on rafle les gens, on les fusille. Il y a une entreprise d’extermination des juifs qui est en cours. De sources différentes et toutes dignes de foi, nous apprenons que les juifs sont tués en masse. Les témoins racontent que les juifs, hommes, femmes et enfants sont asphyxiés dans des unités de gazage mobiles. On rapporte des scènes effrayantes qu’il est difficile de croire. Je n’arrive pas à penser que Hitler poursuive un but pareil, ni qu’il y a des allemands capables de donner de tels ordres. Notre peuple devra expier ces monstruosités un jour ou l’autre. »
Journal du capitaine Wim Osenfeld, officier de la Wehrmacht à Varsovie
« La Diaspora des cendres » est un titre qui a été utilisé une première fois dans un article de Nadine Fresco paru en 1981 dans la Nouvelle revue de psychanalyse.
Le premier texte cité dans cette œuvre a été écrit par l’historien Itzhak Schipper, mort au camp de Maïdanek en 1943 :
« L’histoire est écrite par les vainqueurs. Tout ce que nous savons des peuples assassinés est ce que les assassins ont bien voulu en dire. Si nos ennemis remportent la victoire, si ce sont eux qui écrivent l’histoire de cette guerre, ils peuvent aussi décider de nous gommer complétement de la mémoire du monde »
J’ai trouvé sur ce site, la suite des propos de L’historien Itzhak Schipper :
« Mais si c’est nous qui écrivons l’histoire de cette période de larmes et de sang — et je suis persuadé que nous le ferons — qui nous croira ? Personne ne voudra nous croire, parce que notre désastre est le désastre du monde civilisé dans sa totalité. »
Les voix, qui lisent ces textes sont celles de Mathieu Amalric, Valérie Dréville, François Marthouret, Elsa Lepoivre et Denis Podalydès.
Dans les Matins de France Culture du 7 mai, Guillaume Erner avait invité William Karel et Sophie-Aude Picon pour présenter « la diaspora des cendres » : <Donner des voix à l’indicible>.
Le lien vers l’indicible : <La diaspora des cendres>
<1562>
- Interdiction d’écouter la radio ;
-
Vendredi 7 mai 2021
« Pause (je me suis concentré sur la vie) »Un jour sans mot du jour nouveauQuand on se fait vacciner, on a droit au repos et à ne pas écrire de mot jour.
 Il y a 7 ans déjà, le 7 mai 2014, j’évoquais un livre.
Il y a 7 ans déjà, le 7 mai 2014, j’évoquais un livre.
Le livre d’un homme américain qui avait été condamné à mort.
Mais dont on avait reconnu l’innocence : Il s’appelle Damien Echols
« Je me suis concentré sur la vie,
sur continuer à croitre, à grandir,
intellectuellement, émotionnellement, spirituellement,
j’ai essayé de continuer à aller de l’avant, là où je pouvais. »
C’était <Le mot du jour du 7 mai 2014>
<mot du jour sans numéro>
-
Jeudi 6 mai 2021
« Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon code civil »Napoléon BonaparteJe ne ferai pas de série sur Napoléon. Ce sujet ne m’inspire pas suffisamment et je n’ai pas fait de recherches qui puissent me donner des éléments de réflexion qui méritent d’être partagés.
Je vais quand même réaliser un second mot du jour pour compléter celui d’hier, dans lequel j’écrivais : « Je ne nie pas qu’il ait créé un certain nombre d’institutions qui eurent un rôle dans la construction de la France. »
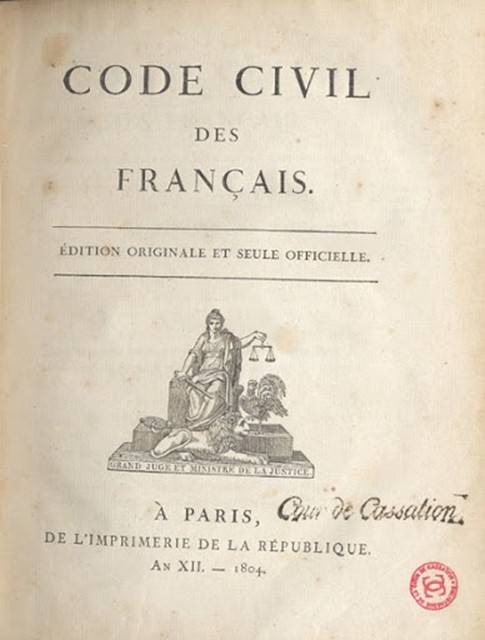 Et parmi ces institutions probablement que le plus important fut « Le Code civil »
Et parmi ces institutions probablement que le plus important fut « Le Code civil »
En 1815, il confie au marquis de Montholon sur l’île de Sainte-Hélène :
« Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon code civil ! »
Robert Badinter a écrit un livre sur le Code civil : « Le plus grand bien » et dans celui-ci il analysait :
« L’état civil échappait définitivement à l’Église et le mariage relevait de la seule loi civile »
Bien sûr, Bonaparte ne fut pas seul dans cette réalisation, mais il faut reconnaître qu’il porta ce projet jusqu’au bout et que c’est parce qu’il en avait fait une priorité que celui-ci se réalisa.
Ce fut le 14 août 1800 que Bonaparte, alors Premier consul, désigna une commission de quatre éminents juristes : François Denis Tronchet, Félix Julien Jean Bigot de Préameneu, Jean-Étienne-Marie Portalis et Jacques de Maleville pour rédiger le projet de « Code civil des Français », sous la direction de Cambacérès.
<Wikipedia> nous informe que ces derniers furent choisis, entre autres, car chacun reflétait une partie du droit positif :
- Bigot de Préameneu était un spécialiste de la Coutume de Bretagne (une coutume plutôt rurale),
- Tronchet, président de la commission, était un spécialiste de la Coutume de Paris (cette coutume était la plus complète, elle suppléait les manques des autres coutumes),
- Maleville, secrétaire général, originaire du Périgord, pays de droit écrit influencé par le droit romain (dont il est l’un des grands défenseurs).
- Portalis enfin, était du Sud-Est (Aix), pays de droit écrit, il connaissait parfaitement le droit romain. »
Dès 1801, le projet est débattu devant le Conseil d’État. Sur 107 séances, 55 sont présidées par Bonaparte qui n’hésite pas à donner son avis et trancher quand il le faut.
Il sera promulgué le 21 mars 1804, mais au moment de cette promulgation le calendrier révolutionnaire était encore en vigueur. C’est pourquoi, l’historien rigoureux affirmera que la date de promulgation fut le 30 ventôse an XII.
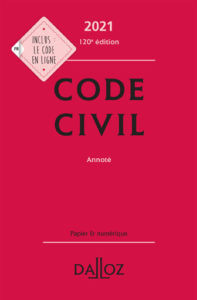 Il a été modifié et augmenté à de nombreuses reprises à partir de la IIIe République, mais beaucoup des articles primitifs des titres II et III subsistent (plus de 1 120 au début des années 2000 sur les 2 281 articles d’origine)
Il a été modifié et augmenté à de nombreuses reprises à partir de la IIIe République, mais beaucoup des articles primitifs des titres II et III subsistent (plus de 1 120 au début des années 2000 sur les 2 281 articles d’origine)
<Le site Geo Histoire> rappelle cependant que dans la version initiale, la misogynie, la vision patriarcale de la société, l’esclavagisme nous est devenu insupportable :
« Reste que ses articles (aujourd’hui abrogés) sur les femmes apparaissent d’une misogynie inouïe et qu’il a « cohabité », jusqu’à l’abolition de l’esclavage en 1848, avec le monstrueux « code noir » (rétabli par Bonaparte en 1802 après avoir été aboli par la Convention en 1794).
Le « code civil des Français » fut d’abord celui des hommes « propriétaires, mariés et pères de famille », résume Robert Badinter. Au nom de la famille et de sa stabilité, le « code Napoléon » a en effet consacré l’infériorité de la femme mariée face à l’homme. L’épouse côtoie les mineurs et les fous au rang d' »incapable », se voit privée de tous ses droits civils du jour de son mariage.
L’article 213 original du « code Napoléon » définit ainsi les relations entre époux : « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ». Il faudra attendre 1970 pour que cet article soit modifié pour désormais prévoir que « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». »
L’excellent site Thucydide.com, créé par de jeunes historiens et qui a pris le nom du célèbre historien grec a consacré plusieurs pages au Code Civil et nous apprend beaucoup de choses :
« 200 ans après sa rédaction, le « Code Civil des Français » est toujours en usage en France… Bien que l’on en parle peu dans la presse et encore moins à la télévision, le fait mérite d’être évoqué car ce Code voulu par le premier Consul Bonaparte a été l’un des éléments clés de l’unification juridique de la France. »
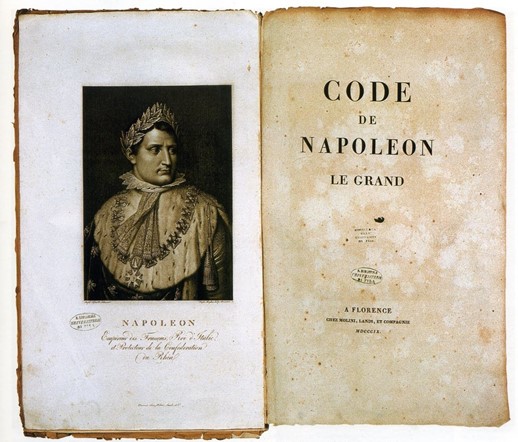 On a longtemps parlé de « Code Napoléon ». Le site Thucydide précise :
On a longtemps parlé de « Code Napoléon ». Le site Thucydide précise :
« L’appellation « Code Napoléon » désigne notre Code Civil et ses 2281 articles d’origine, au regard de son Histoire. […] . L’expression « Code Napoléon » désigne aujourd’hui ce qui, dans notre Code, n’a pas été modifié depuis l’adoption de ce Code.
Le Code Civil est un recueil de lois qui réglementent la vie civile des français, de la naissance à la mort. Il fonde les bases écrites de notre droit moderne français. Sa force vient du fait qu’il est applicable à l’ensemble des français : il marque la fin des législations particulières pour les régions du nord et du sud, les mêmes lois s’appliquant à tous. Il s’inscrit dans l’idéologie légaliste. »
Etienne Portalis a donné cette réponse à la question « qu’est-ce que le Code Civil ? » :
« C’est un corps de lois destinées à diriger et à fixer les relations de sociabilité, de famille et d’intérêt qu’ont entre eux des hommes qui appartiennent à la même cité ».
SI vous voulez plus de précisions, je vous conseille de lire Thucydide.com qui fait notamment l’histoire des codes depuis l’époque romaine.
Je cite pour finir des extraits de la page qui évoque le rayonnement du Code Civil Français à l’étranger :
« Le code civil, brillante œuvre au style clair et concis, sert de modèle à plusieurs pays. En Europe, la Belgique, les Pays Bas (Code néerlandais de 1838), l’Italie (Code italien de 1868), l’Espagne et le Portugal s’en inspirent. Aux Etats Unis, l’Etat de Louisiane utilisa le Code Napoléon comme source de base de son propre code. Au XIXème siècle, le Code inspira de nombreux pays : la Grèce, la Bolivie, l’Egypte. En 1960, plus de 70 états différents avaient modelé leurs propres lois sur le Code Civil. »
Pour l’instant, je n’écrirai pas un mot de plus et ne consacrerais pas des minutes supplémentaires à l’homme qui est mort le 5 mai 1821 à Sainte Hélène.
<1561>
- Bigot de Préameneu était un spécialiste de la Coutume de Bretagne (une coutume plutôt rurale),
-
Mercredi 5 mai 2021
«L’histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d’accord.»Napoléon BonaparteNapoléon est mort le samedi 5 mai 1821 à 17 h 49, dans sa résidence de Longwood sur l’île de Sainte-Hélène. Il était âgé de cinquante et un ans, huit mois, vingt jours.
C’était, il y a deux cents ans.
Il débarqua sur l’île de Sainte Hélène le 17 octobre 1815, il y vécut donc 5 ans et demi. Grâce à Google Maps nous pouvons situer facilement ce lieu. Nous pouvons aussi savoir, tout de suite, qu’il se trouve à plus de 7000 km de Paris et à 2000 km de la côte, si on prend comme ville pour accoster, Abidjan

Si je compte bien, Napoléon a donc pu bénéficier de sa retraite à 45 ans. Cela me semble appréciable.
Quand il mourut, il fut enterré à Sainte Hélène.
Un site entièrement dédié à <l’exil à Sainte Hélène> nous donne de nombreuses informations, permet d’acheter des livres et des objets, à prix non bradés, sur la boutique en ligne, annonce pour ce jour une retransmission des cérémonies pour célébrer les deux ans et présente beaucoup de photos.
Nous pouvons donc contempler le lieu calme, éloigné de la pollution parisienne, où le corps de Napoléon a été enterré. C’est bien sûr une photo récente

Nous savons qu’il ne restera pas là. En 1840, Louis Philippe et son premier ministre, Adolphe Thiers, il fut aussi dans ce coup-là, trouvèrent politiquement pertinent de demander l’autorisation aux anglais de rapatrier le corps à Paris et de l’installer sous le dôme des Invalides.
En 1840, le tombeau imaginé par l’architecte Louis Visconti, n’était pas prêt. On installa donc le cercueil dans un local annexe. Le corps du défunt ne fut réellement placé dans son tombeau que le 2 avril 1861. L’architecte Visconti était déjà mort depuis 8 ans.
Et puis, Louis Philippe avait été chassé du pouvoir en 1848. Entre temps, la deuxième république avait fait élire le premier président de la République française. Le choix fut pervers pour la République, les français, probablement mal influencé par « une suite de mensonges » éliront le neveu de Napoléon. Ce dernier, trouvant le poste de président de la république trop médiocre, fit un coup d’État pour créer le second empire et devenir empereur comme son oncle.
L’un comme l’autre de ces deux empires s’achevèrent par un désastre et une France défaite, humiliée et affaiblie.
Dans ma série sur la Commune le second désastre a été un peu décrit. Il a permis à Adolphe Thiers qui fut au pouvoir sous Louis Philippe et dans l’opposition sous le second Empire, de revenir à la tête du gouvernement.
Victor Hugo a désigné Napoléon III comme « Napoléon le petit », laissant percevoir que l’oncle était « Napoléon le grand ».
Et c’est le récit qu’on a fait dans nos livres d’Histoire, pendant longtemps.
C’est ce que j’ai appris dans les cours d’Histoire, on ne disait quasi rien de la commune mais on parlait de la gloire du général devenu premier consul puis empereur.
On glorifiait ses victoires militaires et on excusait ses défaites. Les victoires étaient le fruit de son génie, les défaites des concours de circonstances malheureuses.
<Le Monde> dans une vidéo dans laquelle je retiens surtout la fin : une France redevenue un territoire, très loin des rêves de l’empire, affirme que Napoléon a gagné 77 batailles sur un total de 86., ce qui ferait un taux de 90% de victoires.
C’est à faire pâlir d’envie Didier Deschamps qui selon les dernières statistiques se situe à un taux de victoire de 66% (73 victoires sur 111 rencontres.). Fort heureusement, la stratégie de Didier Deschamps n’a jamais provoqué de victimes, contrairement aux batailles de Napoléon.
Le chiffre des victimes fait l’objet de contestations, mais il fut énorme pour la population française de l’époque
Mais ces « 90% » de victoires n’empêchèrent pas le désastre. Il fit le contraire de ce que De Gaulle avait annoncé en juin 1940 : « Nous avons perdu une bataille, mais nous gagnerons la guerre », lui pouvait dire : « je gagnerai un grand nombre de batailles, mais je perdrai la guerre ».
Et puis il y a le coût de ces massacres, le budget nécessaire pour faire la guerre devint considérable.
<Les Echos> écrivent :
« Les recettes totales de l’Etat passeront à 800 millions de francs en 1810 et à 1,3 milliard en 1814 contre 475 millions en 1789. […]. Pour financer ses guerres, dont le coût a été estimé à un peu plus de 700 millions par an entre 1806 et 1814, Napoléon recourt au tribut imposé aux pays vaincus. Au total, les dommages de guerre prélevés par l’Empire grâce à cette politique s’élèveront à 1,5 milliard de francs entre 1805 et 1814. »
Ce tribut imposé aux autres pays, ajouté aux victimes subis par les autres pays va avoir des conséquences très négatives sur l’image de la France.
Je reviens à la façon dont on m’a appris l’Histoire dans l’école de la République. Napoléon fut un génie et un bon génie pour la France. S’il faisait la guerre à toute l’Europe c’est parce que tout le monde voulait attaquer la France. Le peuple qui voulait toujours la guerre fut la Prusse, puis l’Allemagne.
J’eus un choc quand un jour, un ami qui était d’origine allemande m’a emmené en Sarre discuter avec des jeunes allemands de notre âge sur cette question de la nation belliciste. Et leur vision était exactement le contraire du récit qu’on me racontait. Et s’ils ne m’ont pas immédiatement convaincu, ils ont ébranlé mes certitudes. Pour eux, c’était la France qui a toujours voulu guerroyer partout en Europe ; Napoléon 1er constituant le paroxysme de cette ambition.
Par la suite mes études de Droit puis d’Histoire m’ont fait comprendre que si les choses sont bien sur complexes, la vision des jeunes allemands était plus conforme à la réalité. J’ai notamment appris à connaître « Le discours à la nation allemande » de Fichte dans laquelle ce philosophe conquis d’abord par l’idéal de la révolution française a été profondément heurté par la violence et les exactions des armées napoléoniennes et a enjoint le peuple allemand à se renforcer pour ne plus avoir à subir le joug de ces français arrogants et guerroyeurs.
<France Culture> parle de cette évolution de Fichte et des autres philosophes allemands.
Napoléon fut aussi un assassin : il fit tuer le duc d’Enghien, il rétablit l’esclavage aboli par la Révolution son attitude à l’égard d‘Haiti et de Toussaint Louverture furent indignes, surtout de l’image de fils des Lumière qu’il voulait se donner.
<Jean-François Kahn> prétend même que ses victoires militaires sont à relativiser :
 « Bonaparte au pont d’Arcole. L’image d’Épinal est imprimée dans les esprits. Sauf qu’elle ne correspond à aucune réalité. Tous les témoignages de ceux qui participèrent à l’événement, dont le général de Marmont, le confirment, et Barras, le protecteur du futur empereur, en fait foi dans ses Mémoires : en fait, le héros tomba dans l’eau et la tentative de franchissement du pont fut un échec.La bataille n’en fut pas moins gagnée au forceps par la suite.
« Bonaparte au pont d’Arcole. L’image d’Épinal est imprimée dans les esprits. Sauf qu’elle ne correspond à aucune réalité. Tous les témoignages de ceux qui participèrent à l’événement, dont le général de Marmont, le confirment, et Barras, le protecteur du futur empereur, en fait foi dans ses Mémoires : en fait, le héros tomba dans l’eau et la tentative de franchissement du pont fut un échec.La bataille n’en fut pas moins gagnée au forceps par la suite.
Tout le monde vous dira que Wagram fut une grande victoire… En réalité, les 21 et 22 mai 1809, l’armée impériale, qui venait d’entrer à Vienne, attaqua l’armée autrichienne commandée par l’archiduc Charles et fut sévèrement battue à Essling. Ce n’est que le 4 juillet suivant que la Grande Armée, très nettement supérieure en nombre, reprit l’offensive et franchit le Danube mais, se heurtant à une tactique de défense imprévue (la formation en équerre), fut de nouveau mise en échec et dut décrocher. C’est le 6 juillet seulement que, à l’issue d’une troisième offensive précédée d’une formidable préparation de l’artillerie, les Autrichiens durent se replier sans que l’Empereur, trop mal en point, puisse les poursuivre. On est loin d’un triomphe. Quant à la victoire de la Moskova, ce fut en réalité, sous l’appellation de bataille de Borodino, une quasi-défaite.
Comme à Eylau. On pourrait multiplier les exemples. Sait-on, par exemple, qu’après la prise de Toulon Bonaparte, qui flirtait alors ostensiblement avec les sans-culottes » enragés « , préconisa l’exécution en masse de tous les suspects en tant qu' » ennemis du peuple » ? Sait-on que, parce que le général Kléber avait osé critiquer son » abandon de poste » en Egypte, le Premier consul, puis l’Empereur, refusa que son corps, entreposé au château d’If, bénéficie de la moindre sépulture ? Sait-on que le général miséricordieux, qu’une peinture apologétique montre en train de témoigner sa sollicitude aux » pestiférés de Jaffa « , accumula en réalité les crimes de guerre et qu’il fit, à Jaffa précisément, exécuter près de 4 000 prisonniers turcs sans autre forme de procès ? Qu’au Caire même il en fit exécuter des centaines d’autres au sabre pour ne pas gaspiller la poudre ? Que sans cesse, dans ses lettres à ses frères et affidés qui opprimaient l’Europe en son nom, il conseille, pour éviter les révoltes, de raser les villages récalcitrants, de fusiller des otages, de terroriser les populations en écrasant dans le sang toute contestation ? Au point qu’aujourd’hui encore, en Espagne ou en Russie, on fait peur aux petits enfants en prononçant son nom. Sait-on qu’après l’attentat monarchiste de Cadoudal dirigé contre lui il fit exécuter une petite charrette de républicains, dont un peintre de talent, qui n’y étaient strictement pour rien, tout simplement parce que ça l’arrangeait ? »
Et Jean-François Kahn explique la raison de cette « vision améliorée de l’histoire » :
« Tout simplement parce que, génial anticipateur des techniques les plus modernes de propagande, c’est lui-même qui la rédigea. Et ce récit, écrit de sa main, bulletin après bulletin, ou inspiré à ses scribes fut par la suite récupéré et donc crédibilisé, non seulement par les bonapartistes, ce qui était normal, mais également par les orléanistes et les républicains dans leur lutte contre la monarchie légitimiste. »
Cet article raconte encore d’autres choses intéressantes. Mais c’est bien Napoléon qui donne l’explication. On raconte que ce fut après la défaite de Waterloo qu’il révéla cette vérité :
« L’histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d’accord. »
Il y a beaucoup de mensonges dans cette histoire.
Je ne nie pas qu’il a créé un certain nombre d’institutions qui eurent un rôle dans la construction de la France.
Mais pendant trop longtemps son personnage fut honoré bien plus que cela n’était justifié. Et pendant que la France consacra toutes ses forces vives à faire la guerre à toute l’Europe, l’Angleterre consacra l’essentielle des siennes pour enclencher la révolution industrielle qui lui assura l’hégémonie mondiale pendant un siècle
La gloire des militaires et la sanctification de la guerre furent poussées à un degré extrême en France.
Savez-vous que <plus de la moitié> des 80 personnalités qui sont inhumées au Panthéon l’ont été pendant le premier Empire, quasi tous des militaires.
Et puis, sinon le plus grave, au moins le plus actuel !
Peut-on imaginer un régime aussi personnel et déséquilibré que la Vème République dans un pays qui n’aurait pas été perverti par le récit bonapartiste et de cette croyance irrationnelle et déraisonnable à la possibilité d’un homme providentiel ?

<1560>
-
Mardi 4 mai 2021
« Leonard Bernstein »Publication de la page consacrée à la sérieL’année 2018, fut l’année des 100 ans de la naissance de Leonard Bernstein
La page consacrée à la série sur Berstein est en ligne sur la page des séries.
Mais vous pouvez aller directement sur la page en suivant ce lien : <Bernstein (1918-1990) >
<Mot sans numéro>
-
Lundi 3 mai 2021
« Beethoven »Publication de la page consacrée à la sérieL’année 2020, fut l’année des 250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven.
La page consacrée à la série sur Beethoven est en ligne sur la page des séries.
Mais vous pouvez aller directement sur la page en suivant ce lien : <Beethoven est né il y a 250 ans >
<Mot sans numéro>
-
Vendredi 30 avril 2021
« Albert Camus et « le premier homme »Publication de la page consacrée à la sérieL’année 2020, fut l’année des 60 ans de la mort d’Albert Camus.
L’accident de voiture qui lui couta la vie eut lieu en janvier, mais ce n’est qu’en novembre que je suis parvenu à écrire la série de mots que je lui ai consacrée ainsi qu’à son dernier livre inachevé : « Le premier homme ».
La page consacrée à la série sur Albert Camus est en ligne sur la page des séries.
Mais vous pouvez aller directement sur la page en suivant ce lien : <Albert Camus >
<Mot sans numéro>
-
Jeudi 29 avril 2021
« Pause (L’archipel français) »Un jour sans mot du jour nouveauRéaliser une page de séries de mots du jour déjà écrits nécessite aussi du travail et du temps.
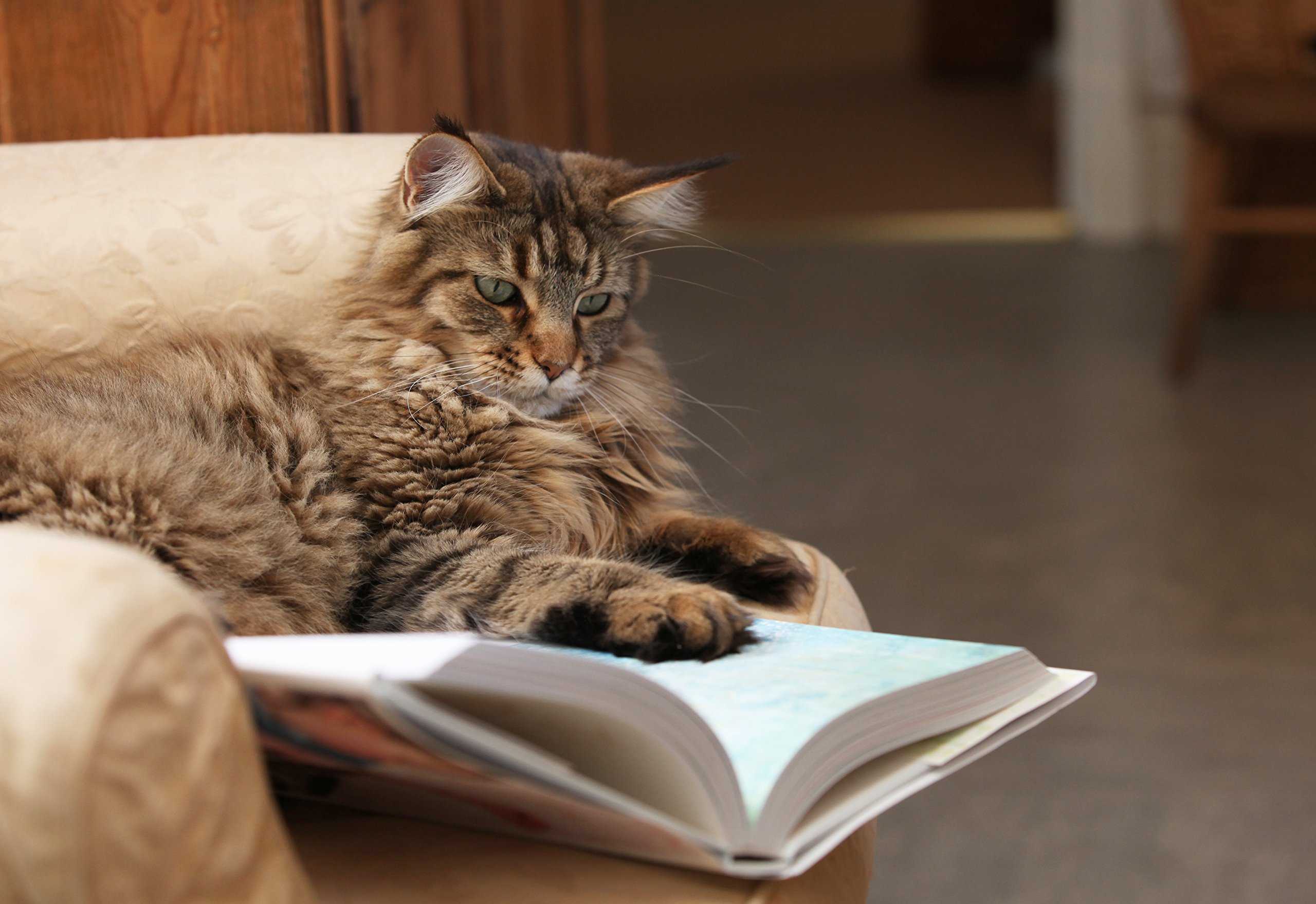 Je ne suis pas encore arrivé à finaliser la page de mots du jour consacrés à Camus et écrit en novembre 2020, mais je m’y emploie.
Je ne suis pas encore arrivé à finaliser la page de mots du jour consacrés à Camus et écrit en novembre 2020, mais je m’y emploie.
Il y a deux ans, le 29 avril 2019, le mot du jour était consacré à un livre qu’on continue à citer régulièrement : « L’archipel français » de Jérôme Fourquet
J’avais introduit le sujet par l’exergue suivant : « Naissance d’une nation multiple et divisée »
<mot du jour sans numéro>
-
Mercredi 28 avril 2021
« La Commune de Paris »Publication de la page consacrée à la sérieLe blog du « Mot du jour » n’est pas qu’un article par jour, il constitue aussi l’approfondissement de divers sujets et le retour sur des sujets traités.
Il constitue un tout et un patient travail de construction et d’élaboration.
La page consacrée à la série sur la Commune de Paris est en ligne sur la page des séries.
Mais vous pouvez aller directement sur la page en suivant ce lien : <La Commune de Paris>
<Mot sans numéro>
-
Mardi 27 avril 2021
« Pause (Le droit à la paresse) »Un jour sans mot du jour nouveauJe ne sais plus qui a dit : « Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, on aura fait un grand pas dans la civilisation »
 Mais il y a des jours où je pense qu’il avait raison.
Mais il y a des jours où je pense qu’il avait raison.
Sur Internet, la question reste ouverte pour savoir si c’est Alphonse Allais ou Pierre Dac qui aurait exprimé une idée assez proche :
« Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, la fatigue sera vaincue. »
Le mot du jour du <7 mai 2015> rappelait que c’est un français, participant à la Commune de Paris et gendre de Karl Marx : Paul Lafargue qui avait écrit « Le Droit à la paresse »
<mot sans numéro>
-
Lundi 26 avril 2021
« Pause (Reconnaissance du génocide arménien) »Un jour sans mot du jour nouveauAujourd’hui c’est congé.
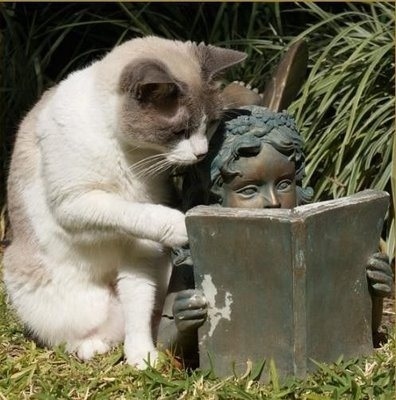 Le 24 avril 2015 je citais Barack Obama : « Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un Génocide qui s’est déroulé contre le peuple arménien. »
Le 24 avril 2015 je citais Barack Obama : « Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un Génocide qui s’est déroulé contre le peuple arménien. »
Mais il l’a dit en 2007, alors qu’il était sénateur.
En tant que président, il n’a jamais prononcé le mot de génocide.
Dans le mot du jour, j’essayais d’expliquer les raisons de cette prudence.
Il aura donc fallu attendre le vieux Biden, pour qu’enfin <Le président américain reconnaisse le génocide arménien>.
Bien sûr <la Turquie reste soudée dans le déni>.
Donc rien de nouveau sous le ciel de Turquie.
Mais aux États-Unis on progresse.
<mot sans numéro>
-
Vendredi 23 avril 2021
« Schubert, il est mort. […] Et pourtant il n’est pas mort. Il est avec moi, il vient me parler, il me parle »Hubert Reeves<C’est une chanson> est une émission de France Inter qui dure 4 minutes et qui est diffusée à 13:46. Elle consiste à demander à des Célébrités ou à des inconnus de parler d’une chanson qui a marqué leurs vies
Hier, jeudi 22 avril, Aurélie Sfez a fait cette demande, à l’occasion de la journée de la Terre, à l’astrophysicien Hubert Reeves.
Hubert Reeves a confié son admiration pour Schubert, et plus particulièrement pour l’Adagio de son Quintette à cordes, un morceau qu’il rêverait de pouvoir jouer…
<Hubert Reeves raconte l’Adagio du Quintette à cordes de Schubert>
Lors de la série de mots du jour sur les dernières œuvres de Schubert, celui du <1er septembre 2020> était justement consacré à ce quintette à cordes.
Je révélais alors que si je m’adonne à ce jeu qui consiste à désigner le disque de musique unique que j’aurai le droit d’emporter sur une île déserte, je n’ai pas beaucoup de doute. Depuis mes 20 ans jusqu’à présent, ma réponse est toujours la même : « Le quintette en ut D 956 de Schubert, écrit au courant de l’été 1828 et terminé en septembre. »
Hubert Reeves a dit :
« Schubert a cette qualité que j’appelle « de vous parler à l’oreille ».
C’est quelqu’un qui entre en possession de votre respiration.
Il fait bouger tout votre corps.
C’est le mouvement qui entre dans une espèce de bonheur indicible. […]
C’est la musique de l’intime.
Monsieur Schubert, il est mort. Il est enterré dans un cimetière.
Et pourtant il n’est pas mort. Il est avec moi, il vient me parler, il me parle. […]
Aujourd’hui je rêverai de jouer, justement ce quintette de Schubert
J’éclaterais de bonheur, si je me sentais avec un violoncelle, en train de jouer ces grandes vagues »
Et quand Aurélie Sfez pose cette question : « Est-ce que la musique est plus difficile de comprendre que les étoiles ? », il répond :
« C’est quelque chose de totalement différent.
Apprendre les étoiles, en tant que scientifique, c’est beaucoup de mathématiques, c’est beaucoup de mental. C’est assez sec. C’est un sentiment de lutte.
Vous n’aurez pas ce bonheur que vous éprouvez en écoutant le quintette de Schubert.
Il faut être à la fois dans la rationalité et dans l’imaginaire.
Si vous n’êtes que dans la rationalité vous vous asséchez.
Si vous n’êtes que dans l’imaginaire, vous risquez de devenir fou. »
<Adagio du Quintette D956 de Schubert> joué par le Quatuor Parisi et Emmanuelle Bertrand
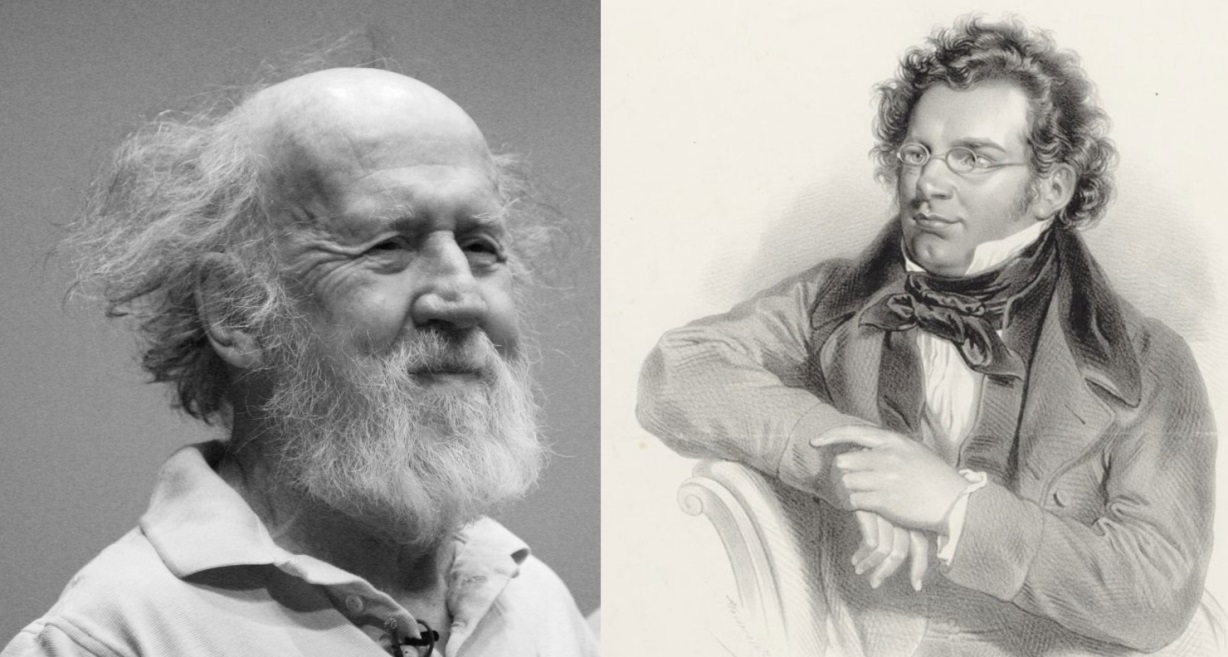
<1559>
-
Jeudi 22 avril 2021
« Me voilà prêt à pédaler pour vous nourrir ! »Julien Blanc-GrasIl parait qu’il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Et il est exact que si on traverse la rue, il est possible de trouver un travail de coursier ou de livreur pour Uber eats ou deliveroo ou une autre plate-forme qui permet de gagner un peu d’argent mais au prix de beaucoup d’efforts et de renoncement.
Julien Blanc-Gras est journaliste et écrivain. Il est né en 1976 et a surtout écrit des récits de voyage. Son prochain livre, « Envoyé un peu spécial » doit paraître chez Stock le 27 avril. Le résumé de ce livre est le suivant :
« Tout peut arriver en voyage. Au fil de ses aventures dans une trentaine de pays, Julien Blanc-Gras raconte les galères et les instants de grâce, les no man’s land et les cités tentaculaires, les petits paradis et quelques enfers. On y rencontre un prêtre shintoïste et un roi fantasque, une star du cinéma nigérian et un écrivain américain, un gardien de phare et un héros national – parmi tant d’autres portraits qui peuplent ces récits et cette planète.
Sur une montagne sacrée du Népal ou sur une île déserte d’Indonésie, au fin fond du Kansas ou dans l’agitation de Kinshasa, Julien Blanc-Gras rend compte de notre époque sans jamais asséner, démontrer ou pontifier.
« En s’éloignant de chez soi, on se rapproche de l’universel. »
Julien Blanc-Gras a donc traversé la rue et pour la finalité d’un récit et d’un article dans « L’Obs » : < une semaine dans la vie d’un livreur Uber-Eats, par Julien Blanc-Gras > a exercé un boulot de livreur pendant une semaine.
Il raconte sa première course :
« Le jeune homme qui ouvre la porte est vêtu d’un slip. Un joli slip rouge, de bonne facture, propre. Rien d’autre. Je pensais, naïvement, qu’on se permettait d’ouvrir en petite tenue aux inconnus dans un seul cas de figure : un scénario de film porno. Mais il n’y a pas de caméra et l’homme en slip ne m’invite pas à entrer d’une voix enjôleuse. Il grommelle un vague « merci » quand je lui remets sa commande, avant de me claquer la porte au nez. C’est ma première course, et je viens de saisir l’essence de mon nouveau métier : le livreur, c’est celui qu’on croise (sur le pas de la porte) et qu’on ne regarde pas vraiment. »
 Julien Blanc-Gras rappelle le contexte d’évolution ou d’explosion de ce métier qu’on trouve de l’autre côté de la rue :
Julien Blanc-Gras rappelle le contexte d’évolution ou d’explosion de ce métier qu’on trouve de l’autre côté de la rue :
« Postez-vous à la fenêtre après 18 heures. Vous verrez le défilé permanent des deux-roues chevauchés par des êtres munis de sac siglés Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat. Avec les confinements, les couvre-feux et la fermeture des restaurants, la livraison de nourriture à domicile s’est imposée dans nos vies urbaines. Deliveroo, présent dans 300 communes françaises, a annoncé une hausse de 64 % de son activité en 2020. Chez Uber, qui revendique 12,5 millions de téléchargements de son appli en France, les livraisons génèrent depuis l’été dernier plus de chiffre d’affaires que l’activité VTC. Ils seraient environ 60 000 à sillonner ainsi les artères de nos villes, petits globules transportant les protéines destinées à nos estomacs calés devant Netflix. »
L’écrivain journaliste s’est ainsi immergé dans ce travail pour pouvoir comprendre et témoigner. Après une formation succincte, sans jamais rencontrer un être humain, il va pouvoir commencer :
« J’installe mon téléphone sur le guidon du vélo, j’enfile mon casque et m’empare de mon sac 70 litres Uber Eats. Me voilà prêt à pédaler pour vous nourrir. Mon activité sera désormais dictée par l’algorithme, qui me géolocalise pour dénicher des courses à la rémunération prédéfinie, que je suis libre d’accepter ou pas. « Gagnez de l’argent à votre rythme », c’est la promesse. »
Les plateformes ont trouvé cet interstice pervers de notre droit de faire travailler, pour eux, des gens qui ne sont pas leurs employés. Et de cette manière, ils parviennent à externaliser des coûts, comme l’achat des outils de travail :
« De mon côté, j’ai été contraint d’acquérir le sac Uber Eats à 69,90 euros pour avoir le droit de travailler pour eux, tout en me transformant en publicité ambulante. »
Il y a bien sur les problèmes techniques : ne pas renverser les soupes dans le sac et puis outre les plateformes il y a la relation avec les fournisseurs de repas. Ces activités sont déployées dans une situation de compétition exacerbée et soumis aux notations sans compassion des utilisateurs :
« Je suis parti depuis moins de deux heures quand survient la première catastrophe : l’appli a pompé la batterie en un clin d’œil, mon téléphone tombe en rade en plein rush de midi.
« T’as le numéro de livraison ? me lance le manager du Subway sans dire bonjour.
– Attendez, j’ai un problème technique, désolé.
– Pfff… »
Dix secondes plus tard : « Bon, t’as trouvé ? » Le manager du Subway me tutoie et me rudoie, alors qu’on n’a pas gardé les sandwichs ensemble. Mon téléphone se réactive miraculeusement, me préservant d’un fiasco dès le premier jour, ce qui aurait immanquablement altéré ma note. Cette notation opérée par les clients tournoie comme une épée de Damoclès au-dessus du casque du livreur car « un taux de satisfaction de 90 % est requis pour pouvoir continuer à se connecter ». On n’a pas vraiment droit à l’erreur ni à la malchance. »
 Et finalement, le livreur, dans ces temps particuliers de pandémie, se trouvent souvent très seul dans les rues de la ville et parfois dans des conditions climatiques compliquées.
Et finalement, le livreur, dans ces temps particuliers de pandémie, se trouvent souvent très seul dans les rues de la ville et parfois dans des conditions climatiques compliquées.
« La première soirée met ma motivation à rude épreuve. La météo est apocalyptique, et je serais bien resté à la maison pour regarder PSG-Barça, mais une double commande de pizzas se présente. Une double commande, ça ne se refuse pas, il y en a pour 7,62 euros, c’est le jackpot. Je m’extirpe de mon doux foyer pour braver les trombes d’eau et les rafales de vent. Je pédale dans la nuit, où seuls mes congénères se déplacent. Plus une âme qui vive, encore moins qui travaille. Même les prostituées chinoises du boulevard de la Villette ont pris leur RTT, elles qui bossent le 25 décembre comme le 1er mai. Je suis trempé, j’ai froid, je mène ma mission à bien. Des gens comptent sur moi pour se gaver de junk-food à la mi-temps, je ne dois pas les décevoir. Une course chasse l’autre. Je tourbillonne autour de la place de la République, bien fournie en fast-foods, pendant que Kylian Mbappé élimine les Catalans. D’ordinaire pointilleux sur le respect du Code de la Route, je me surprends à griller les feux rouges et à rouler sur les trottoirs sans vergogne. En évitant l’accident, si possible. On a recensé au moins cinq livreurs décédés au travail en France depuis 2019. « Chez Uber, nous avons à cœur votre sécurité. » Chez le livreur, on a à cœur d’arriver à temps pour ne pas voir sa note baisser et ses revenus diminuer. Bilan du jour 1 : je suis resté en ligne, et donc disponible, pendant sept heures vingt-sept. J’ai effectué dix courses et récolté 46,49 euros (dont 2,27 de pourboires). »
Pour replacer ces montants dans un contexte connu : au 1er janvier 2021 le smic journalier pour 7 heures de travail en France, s’élèvent en brut à 71,75 € et en net à 56,77 €. Globalement sur sa semaine de travail, Julien Blanc-Gras a évalué sa rémunération à 3,74 euros de l’heure donc pour 7 heures de travail à 26,18 euros la journée en précisant : « J’ai parcouru une centaine de kilomètres dans Paris pour effectuer trente-deux livraisons en trente-cinq heures d’astreinte (durant lesquelles je n’ai refusé qu’une poignée de courses). »
La rémunération est calculée par un algorithme qui ajoute à l’incertitude qui pèse sur le travail du livreur :
« Les coefficients sont complexes à comprendre. Avant, la tarification était lisible. Désormais, ça manque de clarté. L’algorithme est opaque, dénonce Arthur Hay, secrétaire général du syndicat CGT des coursiers à vélo de Gironde (le premier du genre en France). Surtout, la rémunération est en baisse constante depuis des années. Il faut travailler une soixantaine d’heures par semaine pour vivre décemment.»
Quelquefois des clients marquent un élan de générosité, oserais-je dire d’humanité :
« Ce billet de 5 euros tendu par une jeune femme dans le Sentier m’a réchauffé le cœur après un trajet glacial. A l’usage, je constate qu’environ une personne sur six laisse un pourboire. »
Le livreur occupe, dès lors, une place centrale dans notre société de consommation et voit des comportements…
« Etre livreur, c’est disposer d’un poste d’observation furtif sur l’intimité d’une société sous pandémie. Il faut savoir que des gens commandent des Big Mac à 10 heures du matin. Je regarde l’adresse de livraison : elle se situe en face du fast-food, à moins de 20 mètres. Il s’agit sans doute d’une personne dans l’incapacité de se déplacer. Pas du tout, c’est une étudiante en pleine santé physique. Peur de sortir par crainte du virus ? Agoraphobie ? Dépression ? Ou, tout simplement, une bonne grosse flemme. Si les seniors, moins à l’aise avec les outils numériques, ne font pas partie de ma clientèle, les plus jeunes n’hésitent pas à se faire livrer trois fois rien. Dans la foulée, je vais récupérer des commissions chez Carrefour. Le sac est léger. Il ne contient qu’une baguette et un paquet de sucre. C’est tellement peu cher de se faire livrer, une poignée d’euros. Avec certaines formules d’abonnement, c’est même gratuit. Pourquoi se priver ? »
La toute-puissance de la plateforme, l’absence humaine dans les relations de travail nous emmène dans un monde sans sentiment, sans chaleur.
« Le lendemain, je néglige trois propositions de courses. Je reçois ce message : « Vous ne semblez pas avoir accepté de commandes depuis un moment. Vos commandes sont interrompues. » Sérieusement, l’algorithme ? Tu m’as fait poireauter deux heures sous la pluie hier et tu m’ostracises aujourd’hui parce que j’ai raté trois courses ? Sans même parler du fait que je trouve désormais naturel de m’engueuler à voix haute avec une machine.
A mon grand soulagement, je peux me reconnecter quelques minutes plus tard. J’ai l’impression d’avoir reçu un avertissement. « C’en est un, confirme Arthur Hay. Vous ressentez la pression de l’algorithme. La sonnerie, c’est l’ordre de réagir et de se mettre en mouvement. » La promesse de flexibilité semble avoir ses limites. « Ils n’ont pas le droit de nous virer parce qu’on refuse des commandes, mais ça arrive quand même. Des gens sont débranchés, sans explication, et ils ne peuvent plus travailler. » Quand Arthur a lancé un mouvement de grève pour dénoncer ces pratiques, son compte Deliveroo a été désactivé. « Je n’ai jamais eu de motif. Et c’est impossible de parler à quelqu’un. » Dur de lutter contre une adversité invisible. Parmi les revendications syndicales des livreurs se trouve donc celle-ci : pouvoir discuter avec un interlocuteur en chair et en os. »
 Le monde numérique contrôle, cible, le livreur est cerné :
Le monde numérique contrôle, cible, le livreur est cerné :
« D’autres types de messages me parviennent. Comme je figure dans la base de données, je reçois des publicités ciblées. « Découvrez nos partenariats réservés aux coursiers, Julien ! » Je bénéficie de « nombreuses offres exclusives ». « Un vélo à réparer, une facture à régler, les charges d’autoentrepreneur qui tombent au mauvais moment ? FinFrog propose une solution simple et rapide pour obtenir des microcrédits allant de 200 euros à 600 euros. La demande se fait en 5 minutes, 100 % en ligne. » Si on avait l’esprit mal tourné, on pourrait se dire que les plateformes optimisent la rentabilité d’une précarité qu’elles ont elles-mêmes organisée. »
Et avec tout cela les plateformes ne parviennent pas à gagner de l’argent même s’ils entrent en bourse et trouvent des investisseurs qui profitent des hausses des prix des actions : <Deliveroo annonce une perte de 261 millions d’euros> en 2020 avant son introduction en bourse. Un article plus ancien <Deliveroo, Uber Eats… toujours plus de clients sans gagner le moindre centime> explique la stratégie de ces nouveaux capitalistes.
Sa conclusion est touchante :
« On peut trouver du travail en traversant la rue, c’est vrai. Pour en vivre dignement, il faut toutefois traverser beaucoup, beaucoup de rues, en grillant quelques feux rouges au passage. Je rentre chez moi le mollet renforcé, les fesses endolories et le dos en compote. Pas le courage de me mettre à cuisiner. Je vais commander à manger. »
Voilà la société de la consommation simple comme un clic. Il faut toujours un prolétariat pour que la vie des consommateurs soit simple et peu onéreuse. Un prolétariat qui doit discuter avec des machines.
<1558>
-
Mercredi 21 avril 2021
« [La sanction contre Madoff] montre qu’aux Etats Unis, on a le droit d’escroquer les pauvres, mais on n’a pas le droit d’escroquer des riches »Dominique ManottiBernard Madoff purgeait une peine de 150 ans de prison. C’est la justice américaine, en France il n’est pas possible d’être condamné à de telles peines. En outre, il y a toujours des remises de peine lorsque le prisonnier se comporte convenablement en prison. Ce n’est pas le cas aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis même vieux on meurt en prison.
Madoff a fini ses jours dans un pénitencier de Caroline du Nord ce mercredi 14 avril 2021.
Est-ce que je vais plaindre ou défendre Madoff ?
Certes non !
Toutefois il convient quand même de s’interroger sur ce que le cas Madoff révèle du monde, et notamment du monde des États-Unis.
Pour ceux qui ne le saurait pas, pendant de longues années, Madoff a escroqué les gens en mettant en place une chaine de Ponzi. C’est-à-dire qu’il incitait des gens à lui confier leur argent et promettait, en sortie, une rémunération de 12 % par an. Quand un des clients demandaient sa mise, Madoff lui versait la rémunération promise à partir du versement en capital de nouveaux entrants.
L’argent n’était pas investi et Madoff vivait grand train avec l’argent dont il disposait grâce à tous les dépôts.
La crise financière lui sera fatale et provoquera sa chute en accélérant la révélation inéluctable de son escroquerie. En effet, la crise incitera un plus grand nombre de ses clients à demander le retour de leur placement et Madoff ne sera pas en mesure d’honorer sa promesse.
Cette chute va entraîner le suicide de l’un de ses fils Mark qui se pendra en décembre 2010. Et Andrew Madoff, son fils cadet, décédera le 3 septembre 2014 d’un cancer.
En janvier 2020, Bernard Madoff déposera une demande de libération anticipée pour raison médicale, indiquant qu’il souffre d’une maladie terminale des reins et n’aurait plus que 18 mois à vivre. Âgé de 81 ans, il ne se déplaçait plus qu’en fauteuil roulant et avec un corset. Mais il ne fut pas libéré et mourut donc en prison.
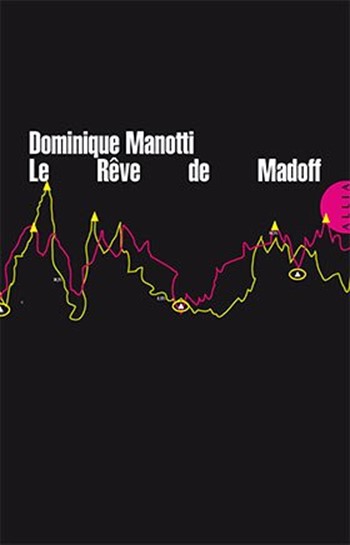 Guillaume Erner a invité Dominique Manotti, écrivaine, ancienne professeure de l’histoire économique du XIXe siècle parce qu’elle avait écrit un livre : « Le rêve de Madoff » paru en 2013 aux éditions Allia.
Guillaume Erner a invité Dominique Manotti, écrivaine, ancienne professeure de l’histoire économique du XIXe siècle parce qu’elle avait écrit un livre : « Le rêve de Madoff » paru en 2013 aux éditions Allia.
Dominique Manotti a expliqué son parcours :
« Il débute très modestement, puis épouse la fille d’un courtier bien installé, dont il hérite du carnet d’adresse. Ensuite, il devient un des principaux acteurs de la nouvelle économie. Lorsque la crise éclate, il a le plus gros cabinet de courtage des Etats-Unis. Il est sur la liste des cinq présélectionnés pour devenir le président de la SEC, l’organe de contrôle de la Bourse. Et ce n’est pas finit : il a créé le Nasdaq, qui est la deuxième Bourse américaine, entièrement informatisée. C’est une idée géniale qu’il a eu très tôt : dès qu’il a vu arriver les ordinateurs, il a inventé une machine qui couple l’ordinateur sur le téléphone et permet à tout moment d’avoir l’information des Bourses dans l’ensemble du monde. Il a l’intuition que cela va changer la vie financière, et c’est le cas. Enfin, il est devenu le Président du Nasdaq pendant 10 ans ! »
Mais le plus intéressant est la réflexion que cette écrivaine va faire, suite à la question de Guillaume Erner pour savoir pour quelle raison elle s’était intéressée à Madoff.
Le déclic a eu lieu quand elle a entendu le procureur qui s’était occupé de la négociation dans l’affaire Madoff dire :
« C’est le pire criminel que je n’ai jamais rencontré. »
Comme souvent aux États-Unis, il n’y a pas eu procès mais négociation. Madoff a accepté de plaider coupable et il a été condamné à 150 ans de prison. Normalement la négociation a pour but d’accélérer le processus judiciaire et comme contrepartie une peine plus clémente pour celui qui accepte de plaider coupable.
On se demande à quoi il aurait été condamné s’il y avait eu procès ?
Donc pour le procureur c’est le pire criminel !
Alors Dominique Manotti dit la chose suivante :
« C’est le pire criminel que je n’ai jamais rencontré. »
Et là franchement j’ai eu un coup de sang, un coup de colère. Et je me suis du coup beaucoup intéressé au personnage.
Cela arrive quand même en 2012. Il vient d’y avoir la crise de 2008.
On a des millions d’américains, entre 5 et 6 millions d’américains qui ont perdu leurs jobs, perdu leurs maisons dans la crise des subprimes.
Et Madoff n’a escroqué que des riches, environ 30 000 personnes.
En gros, il n’y a absolument aucune sanction contre les responsables des subprimes.
Mais Madoff va se retrouver en prison.
Et donc cette façon de le voir comme le pire des criminels, signifie qu’aux Etats Unis, on a le droit d’escroquer les pauvres, mais on n’a pas le droit d’escroquer des riches. »
C’est une conclusion à laquelle, il faut hélas se résigner. C’est révoltant !
Dominique Manotti ajoute par ailleurs :
« La chaine de Ponzi consiste à avoir continuellement de nouveaux adhérents : l’argent ne produit rien, car on paie les intérêts des anciens avec l’argent des nouveaux arrivants. A mon avis, ce n’est absolument pas ça qui a fonctionné. La réalité est très supérieure à ce qu’on raconte habituellement. La pyramide de Ponzi est une escroquerie très simple, je n’imagine pas un personnage comme Madoff pratiquer une entourloupe aussi simple. D’autant que le taux pratiqué par Madoff était de 12%, c’est énorme pendant 20 ans ! Les gens savaient que de toutes façons il y avait quelque chose d’illégal derrière. »
Ceux qui donnaient leur argent à Madoff et pensait pouvoir récupérer 12% d’intérêt sans fluctuation et sans risque ne pouvait pas ignorer qu’il y avait un problème. Ils ne pensaient pas être victime d’une escroquerie, ils devaient donc penser autre chose.
Dominique Manotti suppose qu’il devait penser à des activités illégales. J’ai lu par ailleurs, sans que Madoff ne l’avoue ou qu’une preuve n’ait pu être établie, que ce système servait aussi à recycler de l’argent sale.
Le destin de Madoff nous dit beaucoup de la manière dont notre société fonctionne.
<1557>
-
Mardi 20 avril 2021
« Un réseau militant pour coconstruire un projet socialiste ambitieux, réaliste et partagé »Jean-Philippe BabauAprès le séisme politique de 2002 : Le Pen au second tour, j’avais décidé comme d’autres à m’engager politiquement. C’est pourquoi, j’ai adhéré au PS. Nous habitions alors à la Croix Rousse, dans le quatrième arrondissement de Lyon. C’est pourquoi j’ai rejoint la section de la Croix Rousse dont le local se trouvait 12 rue Perrod. Le parti socialiste qui a subi quelques déconvenues ces dernières années a du s’en séparer récemment.
 Et c’est ainsi que j’ai rencontré Jean-Philippe qui animait un groupe de travail sur l’exclusion et le logement.
Et c’est ainsi que j’ai rencontré Jean-Philippe qui animait un groupe de travail sur l’exclusion et le logement.
J’ai voulu partager cette expérience et nous avons ainsi, avec d’autres camarades, travaillé, sur plusieurs années, en essayant de comprendre techniquement les sujets, en faisant des recherches documentaires entre les réunions mensuelles, en rencontrant des acteurs notamment du logement social, en confrontant nos idées, en nous écoutons et en avançant ensemble, pour finir par rédiger un rapport que nous avons remis aux élus de Lyon, puisqu’à l’époque le PS dirigeait Lyon et la Métropole.
Cette expérience montre qu’il existait des personnes qui acceptaient, à l’intérieur d’un Parti Politique, de donner de leur temps, pour réfléchir à des sujets politiques, sans démagogie, concrètement et pour le bien commun.
Cette manière de faire était assez éloignée de la définition que David Kimelfeld, qui faisait partie de notre section, avait un jour donné :
« Le Parti socialiste est une association formée d’élus, d’anciens élus et d’aspirant à être élus »
Bref, pour lui on ne pouvait être dans un Parti que parce qu’on aspirait à avoir du pouvoir ou une parcelle de pouvoir.
Pour les non lyonnais, il faut préciser que David Kimelfeld a été le Président intérimaire de la Métropole de Lyon pendant que Gérard Collomb avait tenté de jouer au Ministre de l’Intérieur à Paris. Cette lubie lui était venue après la victoire de celui dont il avait imaginé être sinon le tuteur, au moins le conseiller spécial le plus écouté. Après s’être rendu compte de son erreur, il est revenu à Lyon. Il pensait que les intérimaires qui lui devaient leur place se soumettraient à son pouvoir hégémonique et reprendraient leur rôle de vassal dévoué et fidèle. Rôle de vassal qui avait justifié la possibilité de l’intérim.
Il n’en fut rien et il y eut donc affrontement politique à la Métropole comme à la commune de Lyon. La division a entraîné la victoire, sur ces deux terrains, des écologistes qui n’en espéraient pas tant quelques mois auparavant.
Pour ma part, je me suis réjoui de la défaite du baron lyonnais qui à plus de 70 ans ne voulait pas abandonner le pouvoir
Cette manière de penser et de pratiquer la politique en a découragé beaucoup. Le bien public, la réflexion politique a été mis de côté pour garder des places d’élus, rester ou accéder au pouvoir.
Beaucoup aujourd’hui ne croit plus en la politique. Ils pensent qu’elle n’a plus de moyen d’action et s’en détournent.
Jean-Philippe a eu le courage de se lancer dans l’écriture d’un livre qui vante l’engagement politique, le travail en commun pour bâtir un socle de solutions permettant au bien commun de progresser.
Le titre de ce livre qui a paru à la fin de l’année 2020 est « Construisons ensemble ».
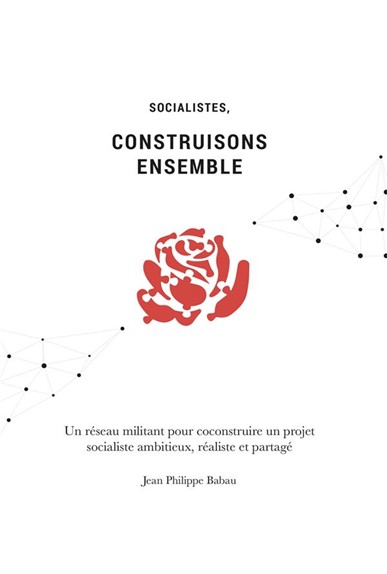 Ce titre est complété par l’invitation suivante :
Ce titre est complété par l’invitation suivante :
« Un réseau militant pour coconstruire un projet socialiste ambitieux, réaliste et partagé »
Exactement le contraire de ce que Gérard Collomb faisait à la fin de son mandat à Lyon quand il décidait de tout et de Macron à Paris qui étonnamment a l’air de s’en désoler puisqu’il aurait dit : « Je suis obligé de m’occuper de tout !».
Evidemment, quand deux comportements aussi égocentrés que Collomb et Macron se rencontrent, la co-construction a du mal à se faire.
Mais peut-on sérieusement penser que Mélenchon serait différent ?
Jean-Philippe évoque d’ailleurs le travail que nous avions fait en commun pour évoquer une sorte de modèle de construction d’un projet.
Il évoque les obstacles à dépasser et la nécessité de clarté sur des objectifs rationnels atteignables :
« Le vivre ensemble ne va pas de soi. Et la mise en œuvre du projet socialiste se heurte à de nombreux obstacles.
Les êtres humains développent des comportements divers, parfois incohérents, parfois violents, guidés par des besoins de reconnaissance, par la peur ou la jalousie de l’autre. Les nouveaux outils de communication promeuvent les comportements narcissiques et égoïstes. La société de consommation attise nos pulsions de possession, d’exclusivité, de reconnaissance. La fin des valeurs traditionnelles place l’individu face à ses propres limites. Les citoyens, sans repères, dans une société atomisée, se retrouvent pris dans une société de production de plus en plus dure, génératrice de stress, et d’une société de consommation, génératrice de frustrations. Dans ce contexte souvent émotionnel, le raisonnement humain, aussi pertinent soit-il, empêche de cerner les situations dans leur globalité, clairement trop complexes. Le débat est mené, sans rationalité, expertise et prise de distance. Les nouveaux réseaux sociaux font la loi, phagocytés par la facho-sphère et les extrémistes de tout poil.
Ce constat ramène à des questions fondamentales sur le sens de l’action politique. Dans une société exacerbant les pulsions des uns et des autres, il faut être clair sur les objectifs du projet socialiste. Qu’est-ce que la politique peut assurer aux citoyens : de l’argent, une place dans la société, une réussite sociale, des règles de vie commune ou des services ?
Certainement tout cela, mais sous peine de malentendus et de rejet, il faut absolument fixer un périmètre clair sur les objectifs du projet. »
Pages 177 & 178
Jean-Philippe insiste sur le travail en commun pour aboutir à un projet qui pourra être porté plus tard par une femme ou un homme.
Alors, qu’aujourd’hui emporté par les ambitions personnelles il est très évident qu’on fait le contraire.
D’ailleurs, les partis politiques ont été remplacés par des mouvements qui se construisent autour de l’ambition d’un ego. Ces mouvements n’ont pas vocation à attirer des militants qui réfléchissent et coconstruisent un projet mais des supporters qui collent des affiches, organisent l’accueil des réunions politiques, applaudissent en chœur quand la voix de son maître s’exprime et acceptent de pratiquer le porte à porte pour vanter les qualités exceptionnelles de leur champion et l’intelligence de son projet auquel ils n’ont pas participé. Jean-Philippe parle de « fan-club d’élus »
Il reste optimiste et propose une autre démarche :
« Si on veut faire face aux enjeux de la société, il est temps de promouvoir un militantisme actif et responsable en associant les militants tout au long du processus de construction du projet. »
Page 249
Pour ce militantisme et la mise en place d’un réseau de co-constructeurs Jean-Philippe veut s’appuyer sur des outils numériques et modernes de communication comme support d’échange.
Je partage sa conclusion :
« L’objet de ce livre était d’abord de partager des valeurs, des principes et un regard sur la société et la politique. A partir du constat sur les difficultés à mettre en place un projet socialiste, j’ai esquissé une méthode et une approche replaçant l’engagement militant au cœur de la construction d’un projet socialiste à la fois ambitieux, réaliste et partagé.
L’objectif d’un projet socialiste doit être de permettre à tous d’accéder à ses droits fondamentaux de manière décente et digne. Chacun a droit au respect, à la liberté, à la justice et à sa part de richesse. Chacun a sa place à la table de la république. Dans un projet socialiste, le collectif n’écrase pas l’individu et l’individu ne peut s’imposer au collectif. Tout est question d’équilibre pour permettre l’émancipation de chacun dans une société pacifiée. »
Page 279
C’est ambitieux mais salutaire.
Celles et ceux qui croient qu’elles et ils n’ont rien à faire de la politique doivent se rendre compte que la politique a beaucoup à faire avec eux et qu’ils en subissent des conséquences.
La démarche de Jean-Philippe dans cette perspective est finalement très rationnelle.
<1556>
-
Lundi 19 avril 2021
« Deux siècles après sa naissance, Baudelaire reste énormément subversif »Antoine CompagnonBaudelaire dont le prénom est Charles est né à Paris le 9 avril 1821. Il est mort dans la même ville 46 ans après.
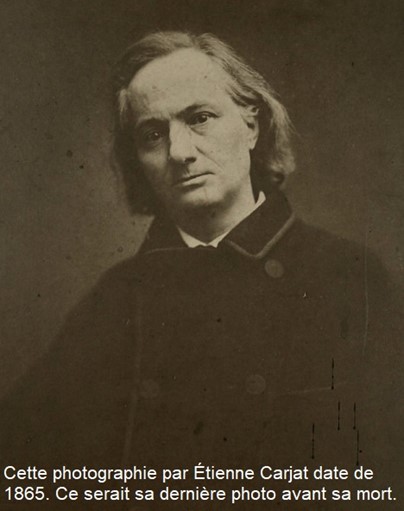 Il est donc né il y a deux cents ans.
Il est donc né il y a deux cents ans.
L’année dernière, lors du premier confinement, je lui avais dédié le mot du jour du 26 avril 2020 : « Anywhere out of the world (N’importe où hors du monde».
France Inter avait invité le 9 Avril Antoine Compagnon pour lui rendre hommage « Deux siècles après sa naissance, Baudelaire reste énormément subversif »
Il parle d’abord de son admiration pour le poète mais explique surtout son côté :
« Toujours inattendu, toujours provoquant »
Et il ajoute :
« Il est l’inventeur de la modernité et celui qui insulte cette modernité à longueur de pages. C’est une démarche très violente. »
Parce que l’auteur de ces vers inoubliables :
« Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble ! »
A aussi écrit des vers d’une grande violence, notamment contre les Belges.
C’est ce que lui reproche Alex Vizorek, humoriste belge, sur la même radio <Baudelaire et la Belgique>
Dans son billet Vizorek cite des extraits évocateurs.
Vous trouverez derrière <ce lien> ces textes écrits par Baudelaire.
Par exemple :
« Qu’on ne me touche pas ! Je suis inviolable ! »
Dit la Belgique. — C’est, hélas ! incontestable.
Y toucher ? Ce serait, en effet, hazardeux [sic],
Puisqu’elle est un bâton merdeux » »
Ailleurs, il traite la Belgique de « Pays des singes »
Jean-Baptiste Baronian essaye d’expliquer <Pourquoi Baudelaire détestait à ce point les Belges ?>
Dans l’univers des tenants de la « cancel culture » ou du « woke », il devrait être effacé !
Mais dans l’univers des gens raisonnables on s’arrêtera à ses chefs d’œuvre
Car je crois qu’il faut regarder ce qui est grand chez les humains plutôt que de s’attarder sur ce qui les rend petit et futile :
« Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. »
L’albatros, « les fleurs du mal »
<1555>
-
Vendredi 16 avril 2021
« Pause (Rappel des mots du jour sur la Commune) »Un jour sans mot du jour nouveau Avant de publier une page présentant la série sur La Commune, vous trouverez ci-après la liste des mots du jour concernant ce sujet.
Avant de publier une page présentant la série sur La Commune, vous trouverez ci-après la liste des mots du jour concernant ce sujet. Elle est classée dans l’ordre chronologique.
« Oui [il faut commémorer] Napoléon, Non la commune »
Pierre Nora
« La Commune de 1871 plonge ses racines dans la guerre franco-prussienne.»
Robert Baker
« Ils se levèrent pour la Commune, en écoutant chanter Pottier. Ils faisaient vivre la Commune en écoutant chanter Clément »
Jean Ferrat
« La grande mesure de la Commune, ce fut sa propre existence »
Karl Marx
« On a d’un côté la légende noire des Versaillais pour qui les communards étaient des fous furieux et, de l’autre, la légende rouge pour la gauche qui en fait une récupération politique »
Michel Cordillot
« Malgré toutes les hontes de la Commune, j’aime mieux être avec ces vaincus qu’avec [leurs] vainqueurs. »
Louis Nathaniel Rossel
« Gustave Courbet, la Commune et la destruction de la colonne Vendôme. »
Une histoire du temps de la commune
« Pause (Les écrivains contre la commune)»
Un jour sans mot du jour nouveau
« S’il y a des miséreux dans la société, des gens sans asile, sans vêtements et sans pain, c’est que la société dans laquelle nous vivons est mal organisée. »
Louise Michel
« Pas de révolution sans les femmes »
Carolyn J. Eichner
« Si nous réussissions à transformer radicalement le régime social, la révolution du 18 mars serait la plus efficace de celles qui ont eu lieu jusqu’à présent. »
Léo Frankel
« Tant qu’un homme pourra mourir de faim à la porte d’un palais où tout regorge, il n’y aura rien de stable dans les institutions humaines. »
Eugène Varlin
« La Commune, c’était la joie, la fête : pour la première fois, ils ne sont plus la vile multitude mais enfin des êtres humains, libres, beaucoup vont vivre cette liberté et cette joie jusqu’à se faire tuer. »
Michèle Audin
« Une fois perdus le bon Dieu et les lendemains qui chantent, que reste-t-il ? »
Régis Debray
« La Commune ne se laisse pas réduire à un événement seulement parisien. »
Maurice Moissonnier
« Je suis avec vous ! j’ai cette sombre joie. Ceux qu’on accable, ceux qu’on frappe et qu’on foudroie m’attirent; je me sens leur frère. »
Victor Hugo, « L’année terrible » – « A ceux qu’on foule aux pieds »
«Deux jours avant l’entrée des Versaillais dans Paris, la Commune avait consacré deux heures de son temps à parler de la culture ! »
Jean-Louis Robert
<mot du jour sans numéro>
-
Jeudi 15 avril 2021
«Deux jours avant l’entrée des Versaillais dans Paris, la Commune avait consacré deux heures de son temps à parler de la culture ! »Jean-Louis RobertIl faut bien finir une série de mots du jour. Il y aurait encore tant à apprendre, à comprendre, à dire et à écrire.
La commune reste un mythe pour toutes celles et ceux qui se revendiquent de l’anarchisme.
Mais elle fut surtout vampirisée par les marxistes et les bolcheviques, pour son grand malheur. Car on oubliait alors la soif de liberté qu’elle avait fait naitre et aussi la volonté de contrôler les gouvernants.
Car dans le régime du Parti unique, il ne pouvait être question de mettre en cause les dirigeants.
Marx et Lénine ont beaucoup réfléchi sur le destin de la Commune et ont imaginé un parti totalitaire qui dirigeait de manière autoritaire la révolution ne reculant devant aucune violence contre ses ennemis ou simplement celles et ceux qu’il avait désigné sous ce nom.
On raconte qu’au 73ème jour de pouvoir, Lénine se serait mis à danser sur la glace pour célébrer le fait que le gouvernement des soviets ait dépassé la longévité de la Commune de Paris.
Entre 1905 et 1920, Lénine consacre vingt-cinq textes à la Commune de Paris.
<Cette page> essaie de décrire succinctement l’analyse et les leçons que les bolcheviques ont voulu tirer de La Commune.
Et <ICI> vous lirez directement le texte que Lénine a écrit pour les quarante ans de La Commune.
Il a simplement oublié l’esprit de liberté qui régnait lors de cette insurrection
Pour parler encore de La Commune, je préfère revenir sur ce formidable film qu’a réalisé pour ARTE, Raphael Meyssan après avoir écrit 3 volumes de BD : «Les Damnés de la Commune »
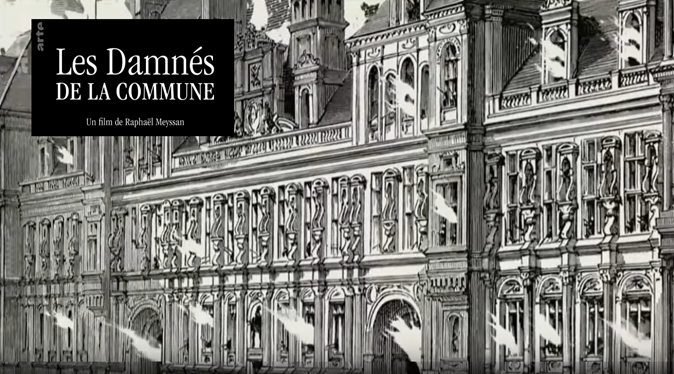 Dans <Cette vidéo> il raconte son aventure qui lui a pris 10 ans.
Dans <Cette vidéo> il raconte son aventure qui lui a pris 10 ans.
Et il raconte comment tout cela a commencé.
Il ne connaissait pas grand-chose à ce moment de l’Histoire de France.
Mais il a découvert qu’un communard, Lavalette, avait vécu dans son immeuble de Belleville, au 6 rue Lesage. Ce fut le départ d’une quête pour essayer de comprendre qui était cet homme.
Il va se plonger dans les archives municipales, celles de la police, dans le Maitron déjà cité.
Et lors de cette recherche, il va croiser une seconde personne qui est Victorine Brocher, une communarde qui a écrit un livre qui raconte son aventure pendant la commune.
Et c’est Victorine dont la voix est jouée par Yolande Moreau qui va tracer le fil de l’histoire que Meyssan va raconter dans son film.
Le livre que Victorine Brocher écrit s’appelle « Souvenirs d’une morte vivante » et a été republié par les Editions Libertalia.
Le livre parait d’abord à Lausanne et à Paris. Victorine Brocher souhaitant rester anonyme signe avec son prénom suivi de l’initiale du nom de son mari.
Raphaël Meyssan a été invité dans l’émission <Le Cours de l’Histoire> de Xavier Mauduit du 19 mars 2021.
Et quand Xaver Mauduit (à environ 19 :15 de l’émission) l’interroge sur l’émotion qui se dégage de la narration de ses livres et de son film, il répond.
« L’émotion !
La commune c’est une grande aventure humaine.
C’est une grande aventure populaire.
Ce ne sont pas des idéaux, ce n’est pas un programme politique.
Cela vient bien après. Cela se construit après.
C’est d’abord des hommes et des femmes qui vivent un grand moment collectif, une grande histoire ensemble.
C’est cela que j’avais envie de raconter. »
Pour finir une série, il me faut non seulement un sujet mais aussi un exergue. « La Commune c’est une grande aventure humaine » aurait pu être celui-ci.
Mais dans cette émission, il y avait aussi deux autres invités qui étaient historiens.
Le premier, Michel Cordillot que j’ai déjà cité lors du mot du jour du <26 mars 2021> et qui a été coordinateur d’un ouvrage synthétique sur la Commune paru en janvier : « La commune de Paris 1871 »
Et un autre Jean-Louis Robert que je n’ai pas encore cité et qui a écrit un des articles de la Revue « l’Histoire » consacrée à la Commune : « Les artistes s’engagent : La culture pour tous ! »
Dans cet article il décrit l’importance de la culture et de l’éducation dans ce que la Commune a voulu mettre en place :
« Les communards ont pris la culture très au sérieux. Ils encouragent la création […]
La participation des artistes à la Commune de Paris se mesure par de nombreux indices. Au sein du gouvernement, ils sont exceptionnellement nombreux : 9 (en comptant les « artistes industriels », peintres sur porcelaine, sculpteurs funéraires…) sur 81 élus qui siègent à l’Hôtel de Ville. Aucune Chambre ne retrouvera un tel pourcentage d’artistes – ni à vrai dire un pourcentage d’ouvriers aussi élevé – que celui de l’Assemblée communale en 1871. »
Gustave Courbet joua un rôle de premier plan dans cette ambition culturelle qui entend donner aux artistes une totale liberté de création. Parce que Courbet et ses amis :
« se souvenait des censures impériales au temps des Salons. En 1863 le refus de 3 000 œuvres, dont Le Déjeuner sur l’herbe de Manet, avait conduit à l’ouverture du célèbre Salon des refusés. Il s’agit aussi de confier aux artistes et aux artistes seuls la direction des Beaux-Arts, par le biais d’une Fédération qui gérerait musées, expositions, éducation artistique, etc. »
Et il raconte alors cet épisode qui se passe le 19 mai, alors que les versaillais sont aux portes de la ville et vont entrer dans Paris le 21 :
« C’est là que se révèle la complexité de ce que fut la Commune. Elle n’était pas seulement libertaire, elle était aussi un gouvernement qui légiférait – pour Paris – et entendait que ses décrets soient exécutés. Toute l’action des artistes était sous le contrôle du délégué à l’Enseignement de la Commune, Édouard Vaillant, qui n’était assurément pas un anarchiste, mais un socialiste révolutionnaire, parfois proche du blanquisme. C’est lui qui devait valider les nominations des conservateurs de musée par la Fédération, lui qui devait valider les propositions financières de la Commission. Et c’est lui qui proposa à la Commune, qui le vota le 19 mai, un décret révolutionnaire socialisant les théâtres privés pour les donner en gestion aux associations d’artistes plasticiens. Le décret indiquait que les théâtres relevaient de la délégation à l’Enseignement, et non plus de la police comme avant. Vaillant déclare que « les théâtres doivent être considérés surtout comme un grand établissement d’instruction ; et, dans une république, ils ne doivent être que cela ». Toutefois, après une longue discussion, les membres de la Commune s’entendirent pour que ce ne soit pas l’État qui dirige les théâtres. Ils devaient conserver toute leur liberté. Deux jours avant l’entrée des Versaillais dans Paris, la Commune avait consacré deux heures de son temps à parler de la culture ! »
J’ai trouvé ce fait sublime. Dans les temps de pandémie que nous vivons on s’interroge sur ce qui est essentiel.
Les communards classaient la Culture dans l’essentiel. Ils savaient bien qu’ils n’arriveraient pas à résister bien longtemps à l’armée supérieure en nombre, en organisation et en armes qui fondaient sur eux. Mais ils ont tenu, quand même, à parler et à légiférer sur la Culture.
Et je cite intégralement la fin de l’article de Jean-Louis Robert :
« Un fait en particulier en dit long sur le souci de démocratisation de la culture par la Commune. Le 18 mai, Édouard Vaillant admonesta un peu vivement l’administrateur du Muséum national d’Histoire naturelle qui venait de rouvrir ses collections à un public limité à des porteurs de carte ou d’autorisation. C’était, écrivit Vaillant, agir comme en plein régime monarchique, c’était faire « de la visite des collections un privilège. Sous le régime communal, toute galerie, bibliothèque, collection doit être ouverte largement au public ».
Dans le domaine du spectacle, il était plus facile d’agir. Des grands concerts furent organisés aux Tuileries. Certains étaient en libre accès, d’autres étaient payants pour contribuer à la solidarité aux familles des gardes nationaux tués au combat. Le public était très divers. On y associait la chansonnette populaire, la poésie, les airs d’opéra, la chanson militante et patriotique. Ce furent de grands moments de réappropriation culturelle par le peuple. Sur les murs de la salle du trône on pouvait lire « Peuple ! L’or qui ruisselle sur ces murs, c’est ta sueur ! Tu rentres en possession de ton bien ; ici, tu es chez toi. » Le peuple écoutait ainsi la comédienne du Théâtre Français, Mme Agar, dire des vers et la grande chanteuse populaire Rosa Bordas, chanter La Canaille.
Sur les murs de l’École des beaux-arts le passant pouvait lire, écrit en grandes lettres de charbon : « Nous serons tous fusillés, mais nous nous en foutons ! » Certains artistes communards payèrent cher leur participation, à l’instar de Courbet qui fut non seulement emprisonné, mais aussi condamné à payer la restauration de la colonne Vendôme, parce qu’il avait souhaité sa démolition au profit d’une colonne de la paix. Une punition qui allait le contraindre à une vie très difficile.
Le cas du musicien Francisco Salvador-Daniel, ce spécialiste de la musique arabe et compositeur de mélodies mauresques encore chantées de nos jours par les plus grandes artistes arabes, nommé directeur du Conservatoire par la Commune, est moins connu. Il fut fusillé dans la rue le 24 mai. »
La Commune fut une grande aventure humaine. Certes, ils étaient divisés mais ils poursuivaient de belles aspirations. La liberté de la création et l’importance de la Culture constituent une des plus nobles.
-
Mercredi 14 avril 2021
« Je suis avec vous ! j’ai cette sombre joie. Ceux qu’on accable, ceux qu’on frappe et qu’on foudroie m’attirent; je me sens leur frère. »Victor Hugo, « L’année terrible » – « A ceux qu’on foule aux pieds »J’ai déjà évoqué le fait que beaucoup des grands écrivains français vivants en 1871 ont eu une attitude très hostile à l’égard de la Commune : Flaubert, Anatole France, Georges Sand.
Et aussi Emile Zola. Il existe un article sur Wikipedia qui décrit les divers supports utilisés par l’écrivain pour son travail de critique : « Emile Zola et la Commune de Paris ».
Vous pourrez aussi lire cet article plus engagé : « Zola contre la commune » qui cite certains de ses articles.
Il y eut bien sûr des écrivains qui défendaient la Commune. Jules Vallès était communard et il écrivit son livre « L’insurgé 1871» en 1886 dans lequel le héros de sa trilogie, Jacques Vingtras, son double fictionnel, participe activement à la commune.
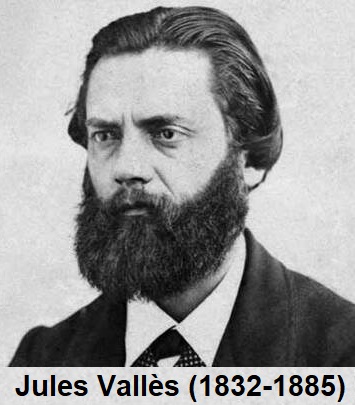 Il était un des animateurs de la Commune et jouait un rôle prépondérant en raison de son journal « Le Cri du Peuple ».
Il était un des animateurs de la Commune et jouait un rôle prépondérant en raison de son journal « Le Cri du Peuple ».
Il sera condamné à mort par contumace le 14 juillet 1872, mais il avait pu s’échapper et vécut en exil en Angleterre et en Suisse.
La dédicace de son livre « L’insurgé » est la suivante :
« Aux morts de 1871
À TOUS CEUX
qui, victimes de l’injustice sociale,
prirent les armes contre un monde mal fait
et formèrent,
sous le drapeau de la Commune,
la grande fédération des douleurs,
Je dédie ce livre. »
Il était clairement dans le camp des anarchistes contre les bonapartistes de tous bords et donc aussi les socialistes autoritaires.
On cite souvent Rimbaud comme défenseur de la Commune et on discute même sa présence sur les barricades. Il n’avait que 16 ans en 1871 : « Rimbaud à l’heure de la Commune de Paris ».
Mais le grand écrivain de ce temps était Victor Hugo.
Son attitude à l’égard de la Commune fut nuancée. Il n’aimait pas qu’on attaque la République, c’est-à-dire le pouvoir de Thiers qui était issu d’élections. L’insurrection contre la République ne s’inscrivait pas dans son univers mental.
Sa première rencontre avec l’insurrection communale s’est réalisée lors d’une tragédie personnelle : Son second fils des cinq enfants qu’il a eu avec Adèle Foucher, Charles Hugo est mort le 13 mars 1871 à 44 ans.
Victor Hugo écrit à des amis, le 14 mars :
« Chers amis, je n’y vois pas, j’écris à travers les larmes ; j’entends d’ici les sanglots d’Alice [épouse de Charles], j’ai le cœur brisé. Charles est mort. Hier matin, nous avions déjeuné gaîment ensemble, avec Louis Blanc et Victor. »
Et l’enterrement a lieu au Cimetière du Père Lachaise, le 18 mars 1871, le premier jour de la Commune de Paris.
Un blog de Mediapart rapporte ce récit :
« Le cortège doit remonter la rue de la Roquette jusqu’à la porte centrale du cimetière. Déjà, à proximité de la prison, une femme a crié : « A bas la peine de mort ! ». Le père Hugo conduit le deuil. Spontanément quelques fédérés en armes commencent à faire une haie d’honneur au cortège, puis bientôt il y a en aura une centaine. On parvient à la barricade qui ferme la rue de la Roquette : alors les fédérés et les insurgés déblaient la barricade. Les drapeaux rouges s’inclinent au passage du cortège. »
Après la cérémonie et le deuil, il va aller à Bruxelles pour régler les affaires de succession de son fils et sera peu concerné par ce qui se passe à Paris.
Mais son hostilité disparaîtra, dès qu’il comprendra l’ampleur des massacres de la semaine sanglante.
Et s’il n’a pas soutenu la commune, il deviendra le soutien des communards.
Le site du « Sénat » explique :
« C’est de Bruxelles qu’il suit les événements. Il n’approuve pas les excès de la Commune mais supplie le gouvernement de Versailles de ne pas répondre aux crimes par des crimes : en réponse à l’exécution de 64 otages par la Commune, le gouvernement de Versailles fusille 6000 insurgés.
Après la chute de la Commune, Hugo fait savoir que sa porte est ouverte aux exilés. […]. Sa position n’est pas comprise et dans la nuit du 27 au 28 mai, sa maison est lapidée. Il est ensuite expulsé de Belgique en dépit des violentes protestations qui se sont élevées au Sénat et à la Chambre des députés. Réfugié au Luxembourg, il rédige son poème « L’année terrible« .
Le 1er octobre 1871, il regagne Paris.
En janvier 1872, il est battu aux élections législatives : les électeurs lui reprochent son indulgence envers les Communards.
En janvier 1876, sur la proposition de Clemenceau, il est candidat au Sénat et élu au second tour. Le Sénat lui sert de tribune pour poursuivre son combat en faveur de l’amnistie des Communards ».
Il est assez aisé de trouver son discours du 22 mai 1876 qu’il fait au Sénat en faveur de l’amnistie des communards :
« J’y insiste ; quand on sort d’un long orage, quand tout le monde a, plus ou moins, voulu le bien et fait le mal, quand un certain éclaircissement commence à pénétrer dans les profonds problèmes à résoudre, quand l’heure est revenue de se mettre au travail, ce qu’on demande de toutes parts, ce qu’on implore, ce qu’on veut, c’est l’apaisement ; et, messieurs, il n’y a qu’un apaisement, c’est l’oubli.
Messieurs, dans la langue politique, l’oubli s’appelle amnistie.
Je demande l’amnistie. Je la demande pleine et entière. Sans conditions. Sans restrictions. Il n’y a d’amnistie que l’amnistie.
L’oubli seul pardonne. […]
Profitons des calamités publiques pour ajouter une vérité à l’esprit humain, et quelle vérité plus haute que celle-ci : Pardonner, c’est guérir !
Votez l’amnistie. »
Il n’aura pas gain de cause cette année-là. La loi d’amnistie sera votée le 11 juillet 1880
Mais après la semaine sanglante, il fera surtout ce qu’il sait faire, il écrira des poèmes.
Il a écrit un poème en l’honneur de Louise Michel qu’il connaissait et que j’ai déjà évoqué lors du mot du jour consacré à la célèbre institutrice : <Viro Major> (« Plus qu’un homme »),
Et puis il écrira un recueil de poèmes qu’il nommera : « L’année terrible »
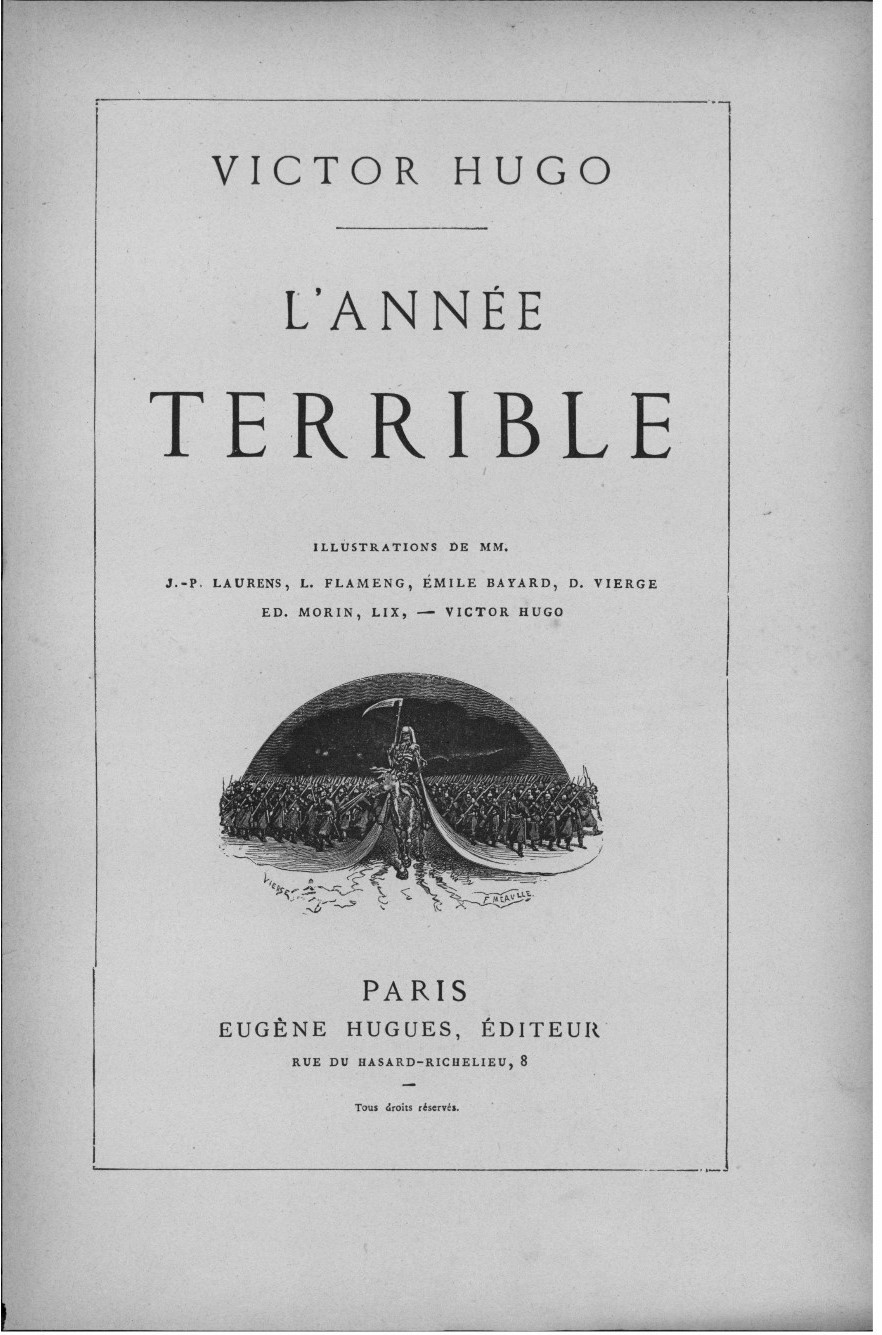 Ce recueil est classé par mois et commence par la guerre de 1870, le désastre de Sedan puis arrive mars 1871, il parle du deuil et de l’enterrement de son fils.
Ce recueil est classé par mois et commence par la guerre de 1870, le désastre de Sedan puis arrive mars 1871, il parle du deuil et de l’enterrement de son fils.
En mai il s’insurge contre les incendies de Paris : « Paris incendié »
« Mais où ira-t ‘on dans l’horreur ? et jusqu’où ? »
Mais déjà il explique la raison de la colère du peuple :
« J’accuse la Misère, et je traîne à la barre
Cet aveugle, ce sourd, ce bandit, ce barbare,
Le Passé; je dénonce, ô royauté, chaos,
Tes vieilles lois d’où sont sortis les vieux fléaux !
Elles pèsent sur nous, dans le siècle où nous sommes.
Du poids de l’ignorance effrayante des hommes ;
Elles nous changent tous en frères ennemis; »
Et puis se trouve ce poème que j’ai vu souvent citer ces dernières semaines : « A qui la faute ? »
Dans lequel il fustige d’abord un homme qui a incendié une bibliothèque :
« Tu viens d’incendier la Bibliothèque ?
— Oui.
J’ai mis le feu là.— Mais c’est un crime inouï
Crime commis par toi contre toi-même, infâme !
Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme !
C’est ton propre flambeau que tu viens de souffler
Ce que ta rage impie et folle ose brûler,
C’est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage !
Le livre, hostile au maître, est à ton avantage. »
Tout le reste de ce chant est un hymne à la gloire du livre et des bienfaits qu’il apporte.
Et vient cette conclusion :
« Les buts rêvés par toi sont par le livre atteints.
Le livre en ta pensée entre, il défait en elle
Les liens que l’erreur à la vérité mêle,
Car toute conscience est un nœud gordien.
Il est ton médecin, ton guide, ton gardien.
Ta haine, il la guérit; ta démence, il te l’ôte.
Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute!
Le livre est ta richesse à toi! c’est le savoir.
Le droit, la vérité, la vertu, le devoir,
Le progrès, la raison dissipant tout délire.
Et tu détruis cela, toi !Je ne sais pas lire. »
Au fur et à mesure des textes, Hugo se montre de plus en plus compassionnel et compréhensif : « Les Fusillés »
« Partout la mort. Eh bien, pas une plainte.
O blé que le destin fauche avant qu’il soit mûr!
O peuple !
On les amène au pied de l’affreux mur.
C’est bien. Ils ont été battus du vent contraire.
L’homme dit au soldat qui l’ajuste : Adieu, frère.
La femme dit : — Mon homme est tué. C’est assez.
Je ne sais s’il eut tort ou raison, mais je sais
Que nous avons traîné le malheur côte à côte ;
Il fut mon compagnon de chaîne; si l’on m’ôte
Cet homme, je n’ai plus besoin de vivre. Ainsi
Puisqu’il est mort, il faut que je meure. Merci. —
Et dans les carrefours les cadavres s’entassent.
Dans un noir peloton vingt jeunes filles passent;
Elles chantent; leur grâce et leur calme innocent »
Et puis arrive ce XIIIème poème du mois de Juin « A ceux qu’on foule aux pieds »
« Oh ! je suis avec vous ! j’ai cette sombre joie.
Ceux qu’on accable, ceux qu’on frappe et qu’on foudroie
M’attirent; je me sens leur frère; je défends
Terrassés ceux que j’ai combattus triomphants;
Je veux, car ce qui fait la nuit sur tous m’éclaire,
Oublier leur injure, oublier leur colère,
Et de quels noms de haine ils m’appelaient entre eux.
Je n’ai plus d’ennemis quand ils sont malheureux.
Mais surtout c’est le peuple, attendant son salaire,
Le peuple, qui parfois devient impopulaire,
C’est lui, famille triste, hommes, femmes, enfants,
Droit, avenir, travaux, douleurs, que je défends ; »
Victor Hugo le dit avec des mots sublimes.
Certainement, La Commune n’avait aucune chance de gagner ni contre les prussiens, ni de prendre le pouvoir.
La commune était désorganisée. Elle poursuivait des objectifs certes nobles et justes. Mais elle n’avait pas les moyens d’en organiser la mise en œuvre dans la paix.
Elle se trouvait dans une impasse.
Mais la répression des versaillais, la semaine sanglante ne permet pas de douter : Je suis avec eux, de leur côté, je me sens leur frère.
<1553>
-
Mardi 13 avril 2021
« La Commune ne se laisse pas réduire à un événement seulement parisien. »Maurice MoissonnierLa Revue L’Histoire, consacrée à La Commune pose la question : « Et si la province avait suivi ? »
C’est une professeure, agrégée d’Histoire, Inès Ben Slama qui a rédigé cet article.
Parce qu’en effet, le mouvement insurrectionnel communal en 1871 ne s’est pas limité à Paris. D’autres communes ont participé et notamment Lyon.
Ces insurrections ont duré encore moins de 72 jours.
Comme à Paris, dès que Napoléon III a signé l’acte de reddition de son armée le 2 septembre à Sedan, un mouvement républicain se soulève dans plusieurs villes. Nous savons que la France rurale est plus prudente et probablement souhaite avant tout la paix. Paix que promettent les monarchistes.
Inès Ben Slama raconte
« Le matin du 4 septembre 1870 l’avocat lyonnais Louis Andrieux, emprisonné pour son opposition au Second Empire, est réveillé par des insurgés venus le libérer et le porter en triomphe à l’hôtel de ville : la république y a été proclamée dès 9 heures par des hommes qui, après en avoir informé les villes du Midi par télégraphe, attendent désormais des nouvelles de L’événement Paris. »
Cette proclamation est antérieure à celle qui aura lieu à l’Hôtel de ville de Paris, par Gambetta accompagné par d’autres députés, dans l’après midi du même 4 septembre. Les Historiens estime que la République n’est pas vraiment établie à cette date-là. Les monarchistes à ce moment là n’ont pas encore abdiqué l’ambition de rétablir un roi.
Toutefois la déclaration de Gambetta dit précisément :
« Français !
Le Peuple a devancé la Chambre, qui hésitait. Pour sauver la Patrie en danger, il a demandé la République.
Il a mis ses représentants non au pouvoir, mais au péril.
La République a vaincu l’invasion en 1792, la République est proclamée. »
Mais les lyonnais s’enorgueillissent qu’ils ont été les premiers comme l’écrit cet article « du Progrès » :
« Et c’est Lyon qui a été la première ville, quelques heures avant Paris, à se mettre sous la bannière républicaine. »
L’article poursuit :
« Le 4 septembre, ce groupe descendu de la Croix-Rousse, Vaise et la Guillotière, s’empare de la mairie à 8 heures, avec à sa tête Jacques-Louis Hénon. Âgé de 68 ans, c’est un des rares députés républicains sous l’Empire. C’est un modéré. Formé en comité de salut public, les militants surgissent sur le balcon. Ils proclament la République à Lyon. La foule massée place des Terreaux les acclame. Une affiche décrète la déchéance de l’Empire.
La municipalité lyonnaise est officialisée le 15 septembre, élue au suffrage universel avec à sa tête Hénon et comme adjoints notamment Désiré Barodet et Antoine Gailleton. »
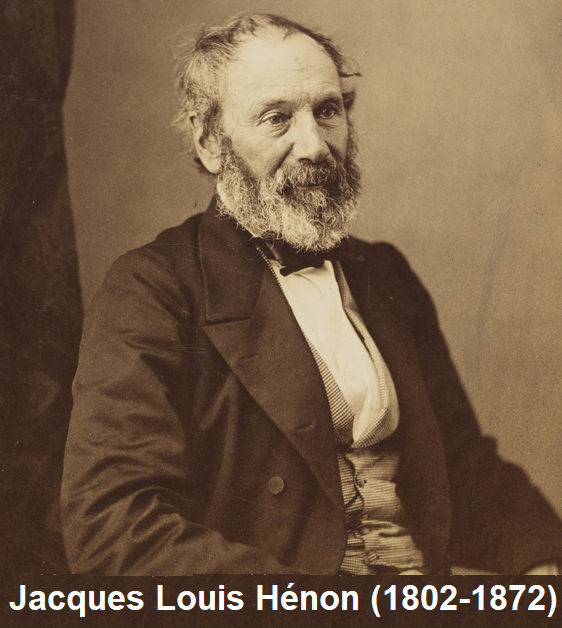 Aujourd’hui la toponymie de Lyon connaît la rue Hénon, la rue Barodet, tous les deux sur le plateau de la Croix Rousse et la place Gailleton sur la Presqu’ile. Tous les trois furent maire de Lyon.
Aujourd’hui la toponymie de Lyon connaît la rue Hénon, la rue Barodet, tous les deux sur le plateau de la Croix Rousse et la place Gailleton sur la Presqu’ile. Tous les trois furent maire de Lyon.
Mais les républicains modérés étaient contestés par les Internationalistes.
Ainsi, ces derniers remplacent, le 4 septembre, le drapeau tricolore par le drapeau rouge sur l’hôtel de ville. Il y reste jusqu’au 4 mars 1871 affirme le Progrès.
Les membres de la première Internationale sont déjà très actifs sur Lyon depuis le début de l’année 1870.
Wikipedia dans son article sur <La commune de Lyon> rapporte :
« Dès les premiers mois de 1870, les membres lyonnais de l’Association internationale des travailleurs (AIT) travaillent à préparer les ouvriers lyonnais à une éventuelle révolution. En liaison avec Bakounine, ils organisent un grand meeting réunissant plusieurs milliers de participants le 13 mars, qui donne un grand poids à la section locale, alors réélue avec à sa tête Albert Richardo . Le 20 juillet 1870, au deuxième jour de la guerre entre la France et la Prusse, l’AIT organise une manifestation pacifiste de la place des Terreaux à la rue Sala.
Durant le conflit, dans toute la ville les éléments républicains et plus avancés (anarchistes, révolutionnaires socialistes) se préparent à la chute de l’Empire. Les différentes sensibilités tentent de se réunir pour organiser l’après Napoléon III mais ils ne parviennent pas à s’entendre. Toutefois, tous ces milieux sont d’accord sur l’idée d’une autonomie municipale, pour rompre avec les pratiques centralisatrices de l’Empire. »
L’autonomie au niveau d’une commune n’arrive donc pas comme une génération spontanée en mars 1871, mais est préparée en amont.
Alors que Hénon et les républicains modérés sont aux commandes à la mairie, les internationalistes appellent au soulèvement pour instaurer la commune de Lyon.
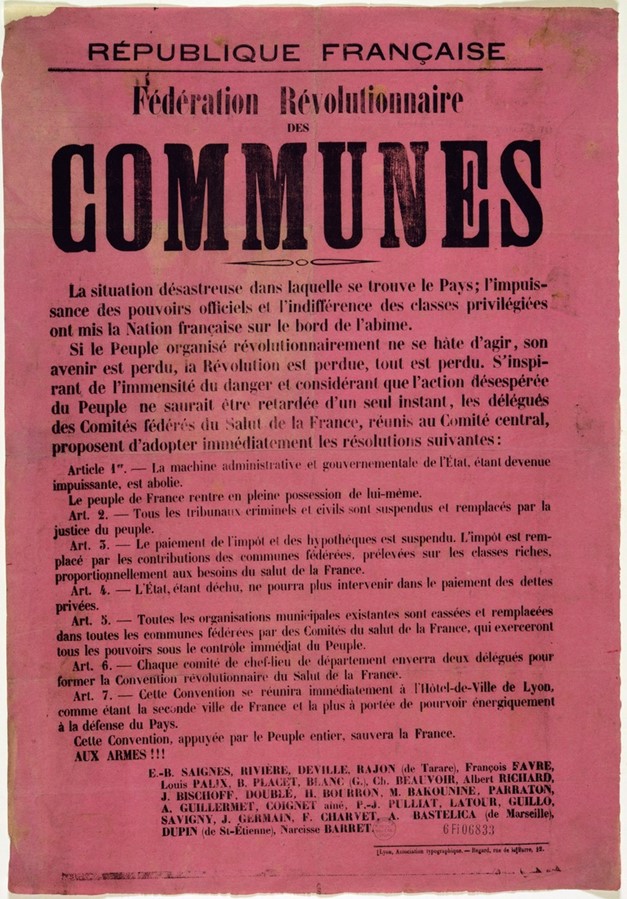 Les archives municipales conservent l’affiche placardée le 26 septembre 1870 à Lyon.
Les archives municipales conservent l’affiche placardée le 26 septembre 1870 à Lyon.
Sur les 7 articles, j’en souligne deux :
L’article 1er qui entend mettre fin au gouvernement de l’Etat
« Article 1er. – La machine administrative et gouvernementale de l’État, étant devenue impuissante, est abolie. »
Et l’article 5 qui veut centrer le pouvoir sur les communes fédérées :
« Art. 5. – Toutes les organisations municipales existantes sont cassées et remplacées dans toutes les communes fédérées par des comités de salut de la France, qui exerceront tous les pouvoirs sous le contrôle immédiat du Peuple. »
Parmi les signataires vous verrez apparaître le nom de Mikhaïl Bakounine (1814-1876), le socialiste libertaire, théoricien de l’anarchisme. Celui que Marx parviendra à faire exclure de la 1ère internationale lors du Congrès de La Haye de 1872. Ce fut la victoire du socialisme autoritaire, contre le socialisme libertaire.
Bakounine va donc s’investir dans le conflit de pouvoir qui s’ouvre à Lyon en septembre 1870.
Dans l’article wikipedia qui lui est consacré on trouve la description suivante :
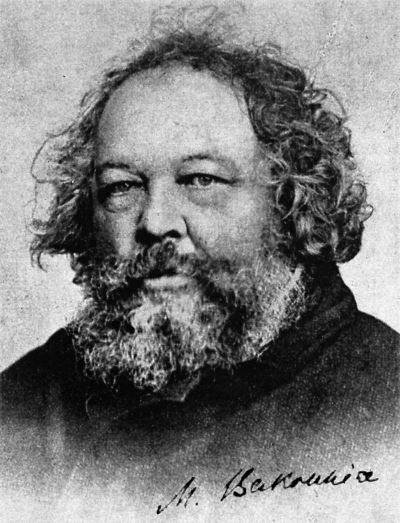 « Le 15, Bakounine arrive à Lyon. Il y trouve l’Internationale dans un grand désordre idéologique et se plaint de la voir collaborer avec les républicains, au risque de laisser les plus basses intrigues se développer. Il met fin à cet état de fait. Se tenant éloigné des réunions publiques auxquelles il ne participe qu’exceptionnellement, il prépare le soulèvement avec ses amis intimes de l’Internationale. Le 17 septembre est créé le « Comité du Salut de la France », un organisme qui devait constituer des groupes dans chaque commune pour transformer la guerre en guerre révolutionnaire. Le Comité, dont l’influence ne dépasse pas Lyon, compte en son sein des délégués de différents quartiers de la ville. Il déploie une grande activité, publiant des manifestes et multipliant les réunions publiques. Une coordination est bientôt établie entre groupes révolutionnaires, associations ouvrières et milices de citoyens.
« Le 15, Bakounine arrive à Lyon. Il y trouve l’Internationale dans un grand désordre idéologique et se plaint de la voir collaborer avec les républicains, au risque de laisser les plus basses intrigues se développer. Il met fin à cet état de fait. Se tenant éloigné des réunions publiques auxquelles il ne participe qu’exceptionnellement, il prépare le soulèvement avec ses amis intimes de l’Internationale. Le 17 septembre est créé le « Comité du Salut de la France », un organisme qui devait constituer des groupes dans chaque commune pour transformer la guerre en guerre révolutionnaire. Le Comité, dont l’influence ne dépasse pas Lyon, compte en son sein des délégués de différents quartiers de la ville. Il déploie une grande activité, publiant des manifestes et multipliant les réunions publiques. Une coordination est bientôt établie entre groupes révolutionnaires, associations ouvrières et milices de citoyens.
Le 25 septembre, Bakounine rédige la proclamation de la Fédération révolutionnaire des communes. Appelant au soulèvement de la première Commune de Lyon, […]
Le 27 au soir, le Comité central du Salut de la France décide pour le lendemain une grande manifestation. Bakounine, qui n’est pas suivi, souhaite que ce soit une manifestation en armes. Il est prévu d’arriver Place des Terreaux à midi et d’exiger des autorités qu’elles prennent les mesures les plus énergiques pour les besoins de la défense nationale.
Le 28 septembre 1870, ce sont plusieurs milliers d’ouvriers qui débouchent à midi sur la Place des Terreaux. Une délégation entre dans l’Hôtel de ville, mais ne trouve pas d’interlocuteurs. C’est alors qu’une centaine d’hommes force les portes de l’Hôtel de Ville, et y pénètre avec Saignes, Bakounine, Richard, Bastelica et d’autres membres encore du Comité. »
Mais cette insurrection échouera. Les ouvriers réunis sur la Place des Terreaux se retrouvent, sans armes ,face à la troupe et à la Garde nationale des quartiers bourgeois. Cette dernière pénètre bientôt dans la cour intérieure de l’Hôtel de Ville.
Bakounine, s’enfuit et via Gênes regagne la Suisse.
L’agitation qui a eu lieu à Lyon se répète dans d’autres villes.
Inès Ben Slama écrit :
« A Marseille, le 1er novembre, une commission révolutionnaire s’installe à la mairie, avant d’être écartée quelques jours plus tard. Le 5 décembre, une tentative d’insurrection échoue à Rouen. Autant d’exemples qui montrent la vitalité révolutionnaire de la province, en particulier de Lyon et de Marseille, où pas un mois ne se passe sans coup de force contre les autorités instaurées après le 4 septembre. Loin de l’image d’une capitale isolée dans ses protestations, les villes du Sud aspirent elles aussi à davantage d’autonomie municipale et revendiquent la défense de la république. »
Que se passe t’il à partir du 18 mars 1871, date de début de ce que l’Histoire va désigner sous le nom de « la Commune », démarrage des 72 jours ?
Les communards vont tenter de rallier la province.
Inés Ben Slama s’appuie sur le récit d’un ouvrier Charles Amouroux :
« Les autorités cherchant à rallier à leur cause les municipalités et l’opinion des grandes villes. Pour ce faire, des émissaires y sont envoyés afin de convaincre les représentants des villes de leur apporter un soutien moral et de proclamer elles aussi la Commune. Le parcours de l’ouvrier Charles Amouroux, membre de l’Internationale et futur élu de la Commune de Paris, illustre les pérégrinations de ces émissaires parisiens : arrivé à Lyon le 23 mars après avoir été chargé d’y opérer la fusion des Gardes nationales parisienne et lyonnaise, il rentre à Paris confier à deux fédérés une délégation pour Saint-Étienne. Il repart ensuite pour Marseille avec Bernard Landeck, autre membre de l’Internationale. Le 29, la police signale sa présence à Chalabre (Aude), sa commune d’origine, et saisit une affiche manuscrite sur papier rouge dont le texte lui est attribué : « Citoyens, la chambre royaliste voulant tuer la république, le peuple, la Garde nationale et l’armée de Paris ont déclaré sa déchéance. Lyon, Marseille, Toulouse, Saint-Étienne et toutes les villes de France ont suivi le mouvement de Paris. Préparons-nous à faire comme elles. Sauvons l’Ordre et la République ! Vive la République ! Un délégué de Paris. »
Des Communes seront proclamées en 1871 à Lyon et Marseille le même jour (23 mars), puis à Narbonne (24 mars) et au Creusot (26 mars), en même temps que des mouvements insurrectionnels éclatent à Toulouse (24 mars), Saint-Étienne (25 mars), Limoges (4 avril), La Charité-sur-Loire (10-11 avril), Rouen (14 avril), Cosne et Saint-Amand (15 avril), Tullins et Saint-Marcellin (17 avril), Neuvy (19 avril), Montargis (1er mai), Varilhes (2-3 mai), Montereau (7-8 mai), Romans (22 mai), Voiron et Vienne (24 mai).
Et je cite toujours Inés Ben Slama
« C’est à Marseille que la Commune a duré le plus longtemps. Du 23 mars au 4 avril, les républicains menés par l’avocat nîmois Gaston Crémieux dominent la préfecture, où une commission départementale a pris le pouvoir. A l’échelle urbaine, l’afflux récent de migrants des campagnes pour faire marcher une industrie en pleine croissance fait apparaître de nouveaux centres insurrectionnels.
A Lyon, la Croix- Rousse, traditionnelle colline des insurrections, est supplantée en avril par la Guillotière, nouveau quartier ouvrier, où les révolutionnaires, secondés par les envoyés de la Commune de Paris proclament – de nouveau – la Commune. Cependant, à Lyon comme à Marseille, faute de soutien massif de la Garde nationale, les tentatives successives sont rapidement réprimées. »
A Lyon, les heurts auront lieu à l’Hôtel de la ville en bas des pentes de la Croix Rousse et surtout dans le quartier de la Guillotière.
Autour de l’Hôtel de ville, le maire Hénon prendra l’opportunité d’accueillir solennellement « les héros en armes de Belfort » qui avaient résisté avec honneur au siège des Prussiens. L’entrée de cette force d’intervention mettra fin aux troubles autour de l’Hôtel de ville.
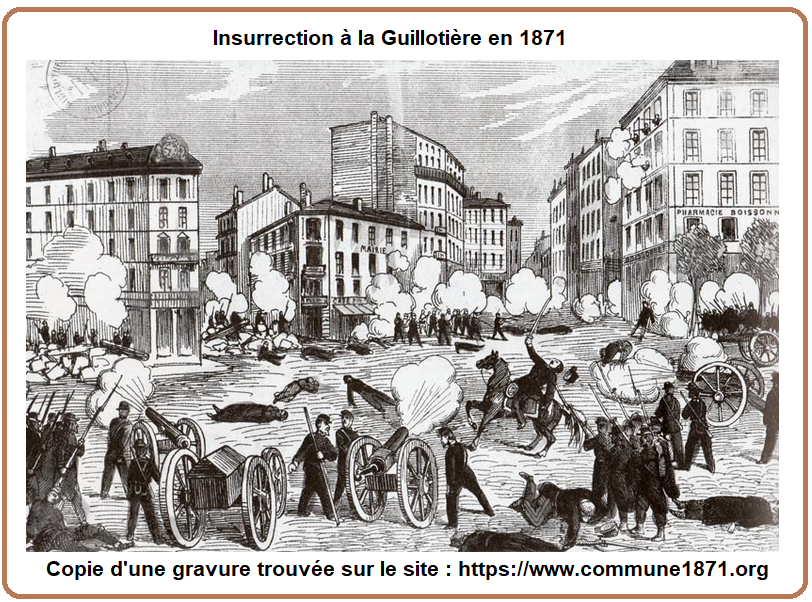 <Wikipedia> précise que le dernier bastion se trouvera à Guillotière :
<Wikipedia> précise que le dernier bastion se trouvera à Guillotière :
« Le drapeau rouge continua cependant à flotter sur la mairie de la Guillotière, place du Pont. Le 30 avril, après un appel au boycott des élections,elle est occupée par les gardes nationaux qui interdisent l’accès aux urnes avec la complicité de la majorité de la population. Des barricades sont dressées Grand rue de la Guillotière et cours des Brosses (actuel cours Gambetta). L’armée arrive de Perrache, sur ordre du préfet Valentin, face à une foule de 20 000 à 25 000 personnes qui crie « Ne tirez pas ! Crosse en l’air ! On vous fait marcher contre le peuple ! » C’est alors que deux colonnes de fantassins, l’une par le pont de la Guillotière avec Valentin et l’autre par la rue de Marseille avec Andrieux, dispersent les manifestants vers 19h45 en tirant. Les insurgés ripostent de derrière les barricades et la bataille dure jusqu’à 23h, moment où les militaires font donner l’artillerie pour enfoncer les portes de la Mairie de la Guillotière. On compte une trentaine de morts. »
Maurice Moissonnier conclura son article <Lyon communard>, après avoir constaté que la Guillotière avait remplacé la Croix Rousse dans le cœur insurrectionnel des ouvriers de Lyon :
« En 1871, à Lyon, le dernier bastion communard avait été la Guillotière, quartier du nouveau prolétariat. Pour la première fois on était descendu de la Croix-Rousse — la vieille colline des insurrections du XlXe siècle — pour combattre sur les barricades d’outre-Rhône. Jusqu’en 1849, les révolutionnaires faisaient plutôt le chemin inverse. »
par cette phrase :
« La Commune ne se laisse pas réduire à un événement seulement parisien. »
<1552>
-
Lundi 12 avril 2021
« Une fois perdus le bon Dieu et les lendemains qui chantent, que reste-t-il ? »Régis DebrayLa Commune divise. Elle a divisé et continue à diviser.
Je ne me souvenais pas que le jeune Président que le hasard et la providence ont donné à la France avait déclaré en 2018 :
« [Versailles, c’est un lieu] où la République […] s’était retranchée quand elle était menacée…»
La phrase a été prononcée dans un documentaire réalisé par Bertrand Delais et diffusé sur France 3, le 7 mai 2018, un an après l’élection présidentielle : « Macron président, la fin de l’innocence »
Pour ce camp-là, écrit <L’Obs> : « Adolphe Thiers a commis des erreurs, mais il reste l’homme qui a habilement « libéré le territoire » et réussi à jeter les fondements de la République, bravant une majorité monarchiste rétive. Ils ne manquent jamais de souligner combien il était populaire : lors de ses funérailles à Paris, en 1877, une foule immense s’est pressée, aux cris de « Vive la République ! ». »
Jean-Luc Melenchon n’appartient pas à ce camp, lui qui a plusieurs reprises à choisi la date du 18 mars pour organiser des réunions électorales majeures des différentes campagnes électorales auxquelles il a participé.
Quand Hervé Gardette, dans son émission « Politique » sur France Culture veut inviter un partisan de la commune, il invite très naturellement Jean-Luc Melenchon : < La Commune appartient à toutes les variétés de la pensée révolutionnaire française >
C’est pourquoi aussi l’Obs quand il veut apporter la contradiction à l’historien Pierre Nora qui ne veut pas célébrer la Commune parce qu’elle n’a pas apporté grand-chose à l’histoire de la nation, distribue ce rôle à Jean-luc Mélenchon :
<Faut-il commémorer la Commune ? Le débat entre Pierre Nora et Jean-Luc Mélenchon>
Ce débat me semble intéressant à partager :
Pierre Nora explicite sa position et rattache surtout la commune à sa récupération marxiste et léniniste:
« La Commune a été un épisode émouvant, héroïque à certains égards, la dernière révolution du XIXe siècle romantique. Mon ami Régis Debray me disait l’autre jour qu’elle est « un référent mondial et un accident national ». C’est un événement qui a eu peu d’apports dans l’histoire de notre pays. A la différence de Napoléon, elle n’a pas profondément contribué à la construction de l’idée nationale. Qu’il y ait une commémoration officielle, j’y vois donc peu de raisons. Que les communistes, dont c’est la tradition, l’exaltent et la célèbrent, c’est légitime. Lénine s’en réclame, Staline, Mao, Castro aussi, toute la tradition révolutionnaire du XXe siècle. […]. Les 80 membres du Conseil de la Commune étaient très disparates. Il y avait des jacobins, des sans-culottes, des internationalistes, des blanquistes, des anarchistes, des patriotes. La dimension patriotique de la Commune est fondamentale, c’est une réaction populaire forte à la France rurale et capitularde de l’époque. […]
La violence de la répression a beaucoup contribué à faire sa légende. Ainsi que sa brièveté : elle n’a pas eu le temps d’expérimenter ses idées anticipatrices. […] l’école laïque, les coopératives ouvrières, la remise des loyers. Avec des inspirations tantôt républicaines, comme la laïcité, tantôt socialistes, comme l’hostilité à l’Etat. Tout ça a composé un ensemble qui a été brutalement contrecarré et a donné lieu à deux mémoires opposées. Une mémoire rose, dont Jean-Luc Mélenchon est l’héritier, à laquelle il faut ajouter de l’héroïsme et du romantisme : c’est une utopie révolutionnaire modèle. L’autre, la légende noire, voit le peuple comme la populace. C’est l’idée que tous les intellectuels de l’époque se faisaient de la Commune, Flaubert, Sand et même Zola… Pour eux, c’était la racaille.
[…] Ils n’étaient pas unanimes, loin de là, et cela aurait évidemment abouti à des querelles. Ensuite, il y a plusieurs étapes. Le souvenir du massacre a inspiré chez les réprouvés et les survivants un véritable culte. Et puis l’aura de la Commune s’est internationalisée. Rappelez-vous Lénine dansant sur la place Rouge, le 73e jour du pouvoir des soviets : « Nous avons tenu un jour de plus que la Commune ! »
[…] A ce moment-là, la Commune cesse d’être une légende pour devenir un mythe. Et aujourd’hui, il n’y a qu’à entendre Jean-Luc Mélenchon : elle est un symbole.
Des insurrections, il y en aura tant qu’il y aura des riches et des pauvres, des dominants et des dominés. Mais le modèle de la révolution, dans sa forme classique, c’est-à-dire celui d’une transformation profonde visant l’Etat et la propriété, est révolu. Si on s’intéresse encore à la Commune, c’est, je crois, lié à son caractère « intermédiaire » : on peut l’interpréter comme la dernière révolution du XIXe siècle ou comme une anticipation des luttes à venir.
[…]. Oui. Parce qu’il y avait un étrange méli-mélo chez les insurgés. C’étaient en partie des sans-culottes, et la Commune est le crépuscule du sans-culottisme. C’était aussi un embryon de prolétariat, mais le mouvement ouvrier ne se constitue en France qu’à la toute fin du xixe siècle [Ce que Melenchon approuve] En 1871, ce n’est pas un mouvement ouvrier au sens moderne du terme, encadré par des syndicats. Donc la Commune a ce côté ambigu, qui en fait un objet intéressant. Elle poursuit 1789, ou plutôt 1793. Et elle éclaire l’avenir des mouvements révolutionnaires, tels que Marx les définit. La Commune est à la fois ce mélange sociologique et ce mélange idéologique. »
Jean-Luc Mélenchon parle d’histoire et d’inspiration pour l’avenir. Il croit toujours la révolution possible :
« Je n’ai pas été choqué par la déclaration de Pierre Nora. Toutes les occasions de mettre les Français au défi de leur histoire me semblent bonnes. C’est une façon pour le peuple français de s’approprier son histoire et de continuer à être le peuple d’une querelle : la dispute terrible qui commence en 1789. La Commune se réclame des jacobins, de la Constitution de 1793, des phases les plus aiguës de la dispute entre une république formelle et une république réelle. Ce qui m’intéresse, c’est ce fil rouge de l’histoire de France, la lutte pour l’égalité. Elle commence si tôt ! Avec Etienne Marcel au XIVe siècle. En fait, je ne veux pas confondre l’histoire comme science – soucieuse de chercher les faits, de comprendre les liens d’une phase à une autre – et puis l’histoire comme matière première d’un débat politique. Donc, je dis : vive la déclaration de Nora, car elle fait discuter. »
 […] Marx parle de la Commune comme de la première expérience de dictature du prolétariat. Je ne le crois pas. Dans cette insurrection apparaît un acteur contemporain qui n’est pas le prolétariat. C’est le peuple, c’est-à-dire les ouvriers, mais aussi des petits patrons, des artisans, des femmes, beaucoup d’instituteurs. A mes yeux, la Commune de Paris est la première révolution citoyenne moderne, celle qui va faire du contrôle collectif, de la souveraineté politique du peuple, la question numéro un, comme le disait Jaurès.
[…] Marx parle de la Commune comme de la première expérience de dictature du prolétariat. Je ne le crois pas. Dans cette insurrection apparaît un acteur contemporain qui n’est pas le prolétariat. C’est le peuple, c’est-à-dire les ouvriers, mais aussi des petits patrons, des artisans, des femmes, beaucoup d’instituteurs. A mes yeux, la Commune de Paris est la première révolution citoyenne moderne, celle qui va faire du contrôle collectif, de la souveraineté politique du peuple, la question numéro un, comme le disait Jaurès.
[…] la Commune a donc bien laissé des traces ! Ce furent autant de préfigurations des combats menés ensuite. La séparation des Eglises et de l’Etat, le droit syndical, l’interdiction du travail de nuit…
[…] Un événement de cette nature montre que le processus révolutionnaire n’est pas une question d’idéologie, mais le résultat de situations concrètes où le pouvoir n’est plus légitime, parce qu’il n’assume pas sa fonction de base. En 1871, on pouvait aussi dire au pouvoir : « Vous n’assumez plus votre fonction de base, qui est de nous défendre contre l’envahisseur, pas de capituler, fichez le camp. » Encore une fois, on retrouve le « dégagisme ». Lénine disait : « La révolution, c’est quand en haut on ne peut plus, et qu’en bas on ne veut plus. »
Pierre Nora oppose alors la révolution sociale à la révolution anthropologique :
« Vous croyez à la révolution sociale. Je suis plus révolutionnaire que vous, car je pense que nous vivons une révolution bien plus importante, véritablement anthropologique. Elle modèle le monde nouveau : elle est démographique (quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d’êtres humains, on en est à 7,5 milliards), elle est climatique, elle est technologique, elle est religieuse, elle est enfin géopolitique. Dans ma jeunesse, la France pouvait encore prétendre à être une locomotive universelle. C’est fini, et nous vivons douloureusement cet abaissement. Cette imagination utopique d’une révolution possible est une compensation de l’affaiblissement et du sentiment d’impuissance de la gauche politique. Commémorer, il ne lui reste plus que ça. »
Et Melenchon lui répond :
« Vous répondez à un Mélenchon qui n’existe pas. Je pense aussi que le nombre des humains est le moteur de l’histoire ! La lutte des classes n’en est qu’un résultat. Je suis le tenant d’une révolution citoyenne. Elle a deux moteurs : l’un social et l’autre écologique. La révolution qui est en train de mûrir est dans la prise de conscience collectiviste de masse qui s’opère. Les milliards d’êtres humains ont compris que nous dépendons tous du même écosystème : nous sommes bien « semblables ». Nous avons donc gagné la bataille idéologique de la grande révolution de 1789 : on nous disait sans cesse « Votre régime sera forcément une violence, car l’égalité n’existe pas dans la nature » ! Plus la menace écologique va s’affirmer, plus la conscience collectiviste va s’élargir, si nous ne sommes pas trop déformés par l’égoïsme néolibéral. Alors ce qui sera à l’ordre du jour, c’est une société de l’entraide, du partage, une société qui se serre les coudes face au danger. [Comme la Commune] Voilà pourquoi l’évocation de la Commune est si parlante. Dans les deux cas, c’est la panique, car les fonctions essentielles ne sont pas assurées par le pouvoir. Ce à quoi j’aspire, c’est une société de l’harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Le ferment est présent, il va produire quelque chose d’inouï, d’énorme. Le fourrier du monde nouveau est là, quelque part dans le moment que nous vivons. »
C’est un peu messianique. Mais le récit, la Foi, l’Utopie sont certainement nécessaires à l’Humanité.
Régis Debray pose cette question abyssale : « Une fois perdus le bon Dieu et les lendemains qui chantent, que reste-t-il ? ».
<1551>
-
Vendredi 9 avril 2021
« La Commune, c’était la joie, la fête : pour la première fois, ils ne sont plus la vile multitude mais enfin des êtres humains, libres, beaucoup vont vivre cette liberté et cette joie jusqu’à se faire tuer. »Michèle AudinQuand on parle des versaillais, c’est-à-dire le gouvernement officiel de la France qui s’est retiré dans la capitale monarchique de Louis XIV, il n’y a pas d’ambigüité sur le chef : c’est Adolphe Thiers. On peut décrire le rôle des hommes qui l’entourent notamment les 3 Jules : Favre, Ferry et Grévy. Il y a aussi le Maréchal Patrice de Mac Mahon, duc de Magenta depuis qu’il s’était illustré lors de la bataille de Magenta. Il fut à côté de Napoléon III, le chef de l’armée qui a subi la piteuse défaite de Sedan. Mais il put s’illustrer, à nouveau, comme le vainqueur pathétique et sordide de la …reconquête de Paris ? par les versaillais. Il succéda comme président de la République à Adolphe Thiers avec l’espoir de rétablir la monarchie. Il présida du 24 mai 1873 au 30 janvier 1879. Il ne put remplir son objectif. La 3ème République, profitant des divisions entre les monarchistes et aussi des victoires électorales de ses partisans, s’imposa. L’un des 3 Jules devint président, ce fut Grévy.
Du côté de la Commune rien de tel. Il n’est pas possible de désigner un chef.
La revue « L’Histoire » a tenté de synthétiser le gouvernement de la commune par cette planche :
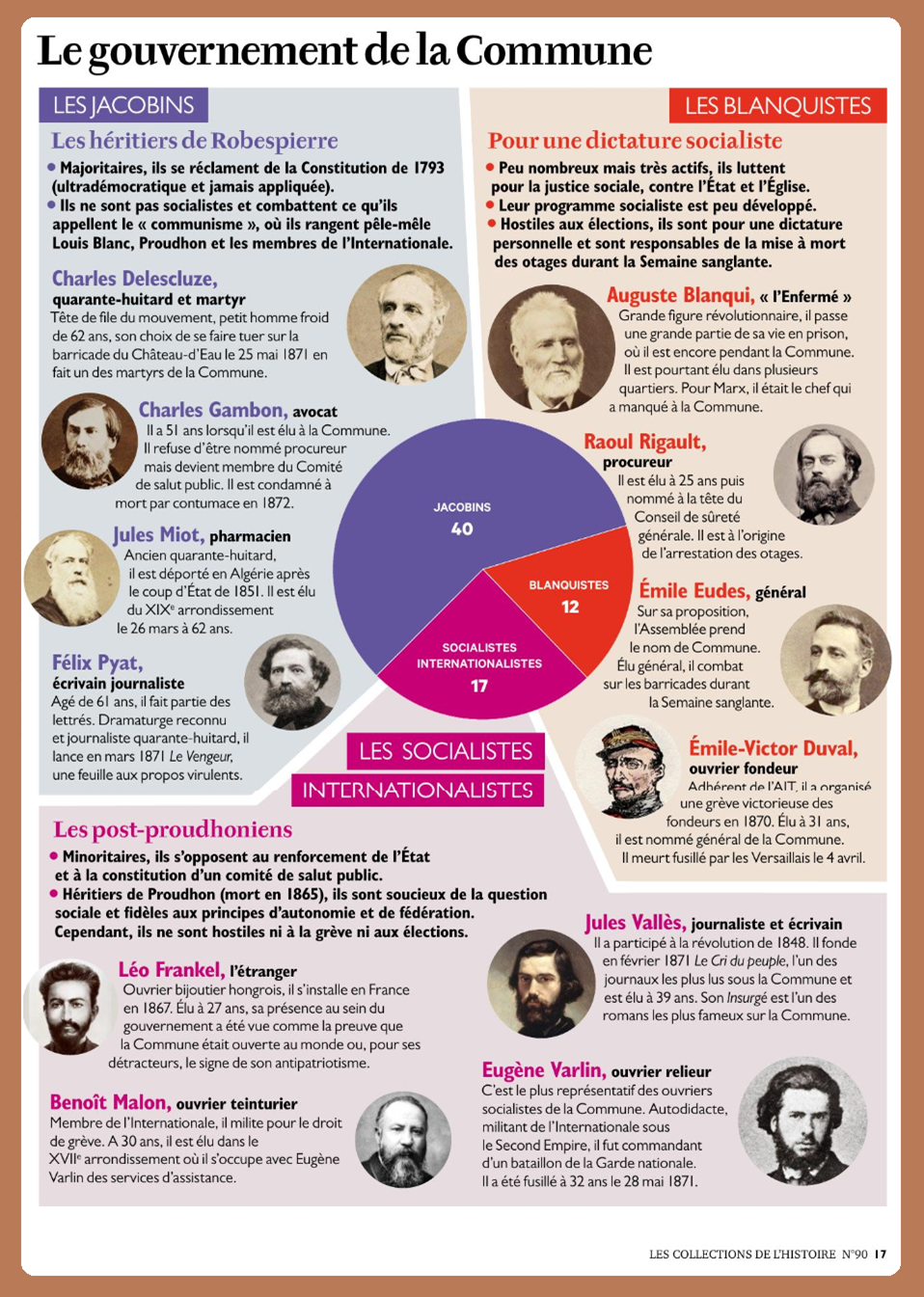
Dans cette représentation, Charles Delescluze est présenté comme le chef de file, mais certainement pas comme le chef de la Commune.
Karl Marx a affirmé que le chef qui a manqué à la Commune fut Auguste Blanqui (1805-1881). Il est représenté ci-dessus, mais il ne put participer à la Commune, car Adolphe Thiers en fin stratège le fit arrêter le 17 mars 1871.
<Wikipedia> raconte :
« Adolphe Thiers, chef du gouvernement, conscient de l’influence de Blanqui sur le mouvement social parisien, le fait arrêter le 17 mars 1871 alors que, malade, il se repose chez un ami médecin à Bretenoux, dans le Lot. Il est conduit à l’hôpital de Figeac, et de là à Cahors. Il ne peut participer aux événements de la Commune de Paris, déclenchée le 18 mars, insurrection contre le gouvernement de Thiers et contre les envahisseurs prussiens à laquelle participent beaucoup de blanquistes. Il ne peut communiquer avec personne, semble-t-il, et même pas être mis au courant des événements se tramant. ».
Après, l’écrasement de la Commune, il est ramené à Paris et jugé le 15 février 1872, et condamné, pour ses agissements antérieurs au 18 mars 1871, à la déportation, peine commuée en détention perpétuelle, eu égard à son état de santé. Pour se défendre, Blanqui a dit au juge :
« Je représente ici la République, traînée à la barre de votre tribunal par la monarchie. M. le commissaire du gouvernement a condamné la Révolution de 1789, celle de 1830, celle de 1848 et celle du 4 septembre [1870] : c’est au nom des idées monarchiques, du droit ancien en opposition au droit nouveau, comme il dit, que je suis jugé et que, sous la république, je vais être condamné ».
Il est interné à Clairvaux. Il est terriblement malade (œdème du cœur) en 1877 mais, malgré les pronostics médicaux, il parvient à survivre. Il sera tout au long de ces années défendu par Clemenceau. Il sera libéré quelques mois avant sa mort.
L’Histoire lui donnera le surnom de « l’enfermé », tant il passa d’années de sa vie en prison.
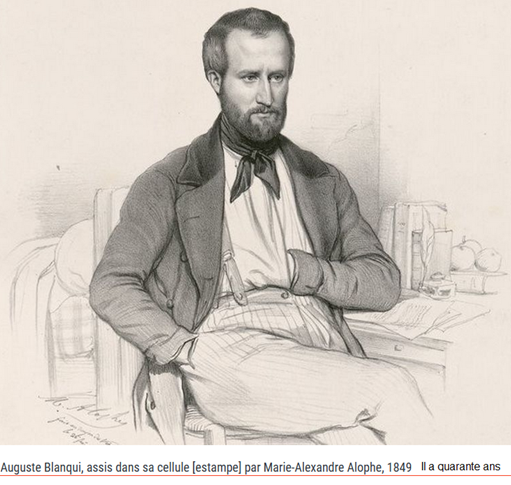 Il s’insurgea contre tous les pouvoirs Charles X, Louis Philippe, les républicains de IIème république, Napoléon III et aussi la République bourgeoise née après la défaite de Sedan.
Il s’insurgea contre tous les pouvoirs Charles X, Louis Philippe, les républicains de IIème république, Napoléon III et aussi la République bourgeoise née après la défaite de Sedan.
Wikipedia cite sa défense lors du procès en Cour d’Assises en 1832
« Oui, Messieurs, c’est la guerre entre les riches et les pauvres : les riches l’ont voulu ainsi ; ils sont en effet les agresseurs. Seulement ils considèrent comme une action néfaste le fait que les pauvres opposent une résistance. Ils diraient volontiers, en parlant du peuple : cet animal est si féroce qu’il se défend quand il est attaqué. »
Louis Auguste Blanqui, est fondamentalement un révolutionnaire socialiste qui entend changer la société par l’insurrection et la violence. Il défend, pour l’essentiel, les mêmes idées que le mouvement socialiste du XIXe siècle et fait partie des socialistes non-marxistes. L’historien Michel Winock le classe comme l’un des fondateurs de l’extrême gauche française, qui s’oppose aux élections démocratiques, les considérant comme « bourgeoises », et qui aspire à l’« égalité sociale réelle ».
Je ne pense pas que s’il avait été à la tête de la Commune, le destin de ce mouvement aurait été modifié tant le déséquilibre des forces armées était en défaveur du mouvement. Sans compter qu’autour de Paris, la puissante armée prussienne était prête à bondir si cet exemple délétère d’une « révolution rouge » pour la quiétude du IIème Reich devait se développer sous ses yeux. Bismarck avait d’ailleurs proposé son aide à Thiers qui l’a prudemment écarté. Il valait mieux pour la suite que ce fusse des français qui massacrent d’autres français.
Dans la typologie avancée par « L’Histoire » les jacobins sont majoritaires. Ce sont ceux qui se réfèrent à la grande révolution et plutôt à la figure de Robespierre. Quand les choses iront au plus mal, ils créeront un Comité de Salut Public, comme celui créé en 1793 par la Convention. Cette décision créera une nette césure à l’intérieur des communards, les internationalistes s’y opposant. Les communards se diviseront alors en « majoritaires » et en « minoritaires ». Ce <Comité de Salut Public de 1871> composé de 5 membres est mis en place le 1er mai 1871. Malgré la courte durée avant l’écrasement, ce comité changera plusieurs fois de membres. Il n’aura aucune prise sur les évènements et ne sera d’aucune efficacité.
Les internationalistes ne sont pas homogènes non plus. D’ailleurs l’Internationale va exclure les anarchistes fidèles à Bakounine, peu de temps après.
Les communards sont ainsi divisés en courants de pensée qui divergeront beaucoup.
Mais ce qui est extraordinaire dans ce mouvement c’est la vitalité des échanges et de la discussion qui va animer le peuple de Paris dans son ensemble. Je veux dire le Peuple de Paris qui adhère à la Commune. Parce que tous les parisiens qui vivaient dans Paris pendant les mois de mars à mai 1871, n’étaient pas favorables à la commune. Et cela s’est vu après la semaine sanglante. La foule haineuse qui a torturé et assassiné Eugène Varlin ne venait pas seulement de Versailles, il y avait aussi des gens de Paris.
Mais celles et ceux qui croyaient en la Commune, se réunissaient, discutaient et refaisaient le monde.
Et notamment les femmes qui étaient entrées dans ce combat pleines d’espoir. La commune a répondu à certains de ces espoirs même si les femmes restaient exclues des élections et du pouvoir.
Cette parole libérée va se tenir dans le cadre de très nombreux clubs. <Ce site> essaie de dresser la liste des clubs de cette période.
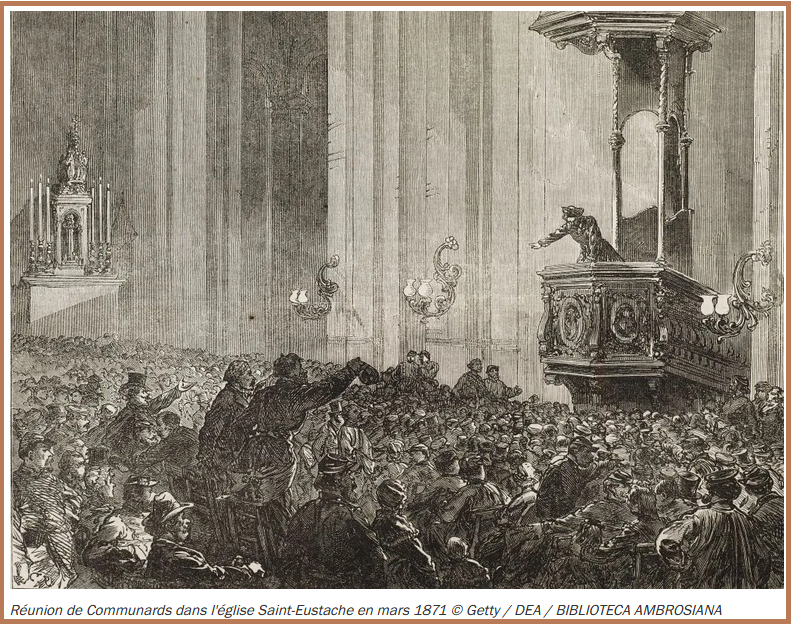 Beaucoup de réunions se déroulaient dans les églises, parce que c’était des endroits propices pour réunir beaucoup de monde et pour parler.
Beaucoup de réunions se déroulaient dans les églises, parce que c’était des endroits propices pour réunir beaucoup de monde et pour parler.
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt ce dialogue entre un membre de la fondation Jean Jaurès et l’historien Quentin Deluermoz à propos de de son dernier ouvrage « Commune(s) 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle » (Seuil, 2020).
<Cet article> revient aussi assez longuement sur cet ouvrage.
La vision que Quentin Deluermoz développe est justement de se décaler par rapport aux principaux acteurs connus de la Commune pour examiner ce mouvement à travers trois prismes.
D’abord en le comparant à d’autres mouvements communaux qui l’ont précédé, comme par exemple la révolte des canuts à Lyon ou dans d’autres pays ou qui ont eu lieu, en même temps dans d’autres communes de France.
Pour finir, il étudie aussi les conséquences françaises et mondiales de La commune.
Mais le point central qui m’a particulièrement intéressé, c’est son analyse qu’il qualifie « au ras du sol ». Dans cette étude il va consulter les archives, des journaux intimes, des récits contemporains, des procès-verbaux de la Police ou de la Justice.
Ce qu’il tient à éviter, c’est les récits ultérieurs qui racontent les évènements à travers le filtre des dogmes qui sont apparus par la suite ou le filtre de souvenirs fantasmés ou simplement transformés par le temps.
Et puis ce qui l’intéresse c’est ce que « les communeux » et « les communeuses » ont vécu au cours de ces 72 jours.
Oui ! parce que les participants à ce mouvement se donnaient le nom de « communeux ». Ce sont leurs ennemis, les versaillais, qui leur ont donné le nom qu’ils voulaient péjoratif de « communards » qui rime avec bâtard, mouchard, cafard et d’autres termes aussi peu aimables. Ils ont finalement accepté de se désigner par ce mot, probablement par défi et fierté face à leurs ennemis.
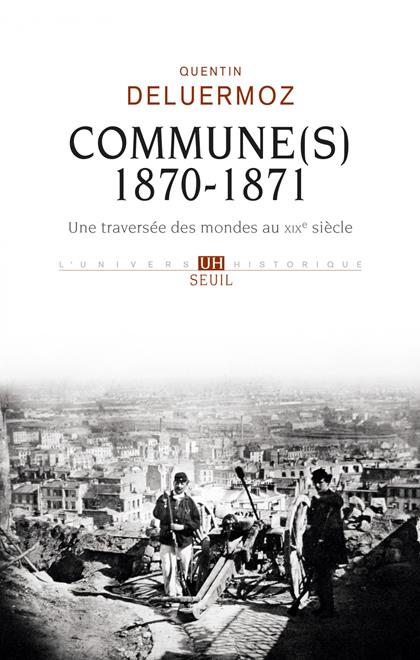 Et ce que Quentin Deluermoz révèle à travers son analyse « au ras du sol », est la formidable vitalité des organisations de quartier qui tentent de trouver des solutions concrètes aux problèmes des parisiens modestes ou pauvres, de faire face à la situation de conflit et de pénurie qui perdure depuis le siège par les allemands commencé en septembre 1870 puis l’attaque des versaillais, tout en refaisant le monde.
Et ce que Quentin Deluermoz révèle à travers son analyse « au ras du sol », est la formidable vitalité des organisations de quartier qui tentent de trouver des solutions concrètes aux problèmes des parisiens modestes ou pauvres, de faire face à la situation de conflit et de pénurie qui perdure depuis le siège par les allemands commencé en septembre 1870 puis l’attaque des versaillais, tout en refaisant le monde.
Dans un des entretiens qu’elle a accordé pour parler d’Eugène Varlin, Michèle Audin a eu cette réflexion sur la Commune
« Je ne sais pas ce qu’est « la » pensée communarde. Celle de Ferré ? Celle de Delescluze ? Celle de Frankel ? Celle de Theisz ? Ou encore celle de Nathalie Lemel, engagée dans la lutte avec l’Union des femmes ?
Ce qui rend l’histoire de la Commune passionnante, c’est toute cette diversité de pensées communardes.
De mon point de vue, le plus intéressant, c’est ce qui se dit dans les clubs – je pense notamment au Club Ambroise et à son journal Le Prolétaire. On y souhaite voir les élus venir écouter le peuple et lui rendre compte : la souveraineté populaire ne se délègue pas, le peuple est las des sauveurs, on trouve que les agents de la Commune sont trop payés, que les journalistes font trop de phrases, qu’ils veulent encadrer le peuple, on proteste contre la nomination des officiers par les autorités militaires de la Commune (tous les responsables doivent être élus)… C’est le « sous-comité » dont ce club est issu qui a brûlé la guillotine, un acte symbolique – au moment même où la Commune vote un décret qui prévoyait la possible exécution d’otages. Le développement des idées a été beaucoup étudié, notamment autour du centenaire de la Commune en 1971, en un temps où l’importance des partis communiste et socialiste faisait de l’héritage de la Commune un enjeu politique, mais on a peut-être un peu négligé ce qui se passait dans la vie et dans la tête des Parisiens engagés dans le mouvement.
La Commune, c’était la joie, la fête : pour la première fois, ils ne sont plus la vile multitude mais enfin des êtres humains, libres, beaucoup vont vivre cette liberté et cette joie jusqu’à se faire tuer. »
Un moment d’échange, de solidarité et d’invention pendant lequel, pendant 72 jours des gens simples, ont cru pouvoir devenir maître de leur vie et inventer un autre monde.
C’était cela aussi La Commune.
<1550>
-
Jeudi 8 avril 2021
« Tant qu’un homme pourra mourir de faim à la porte d’un palais où tout regorge, il n’y aura rien de stable dans les institutions humaines. »Eugène VarlinJe m’aperçois, en cheminant dans cette série, que je ne connaissais vraiment pas grand-chose à la Commune.
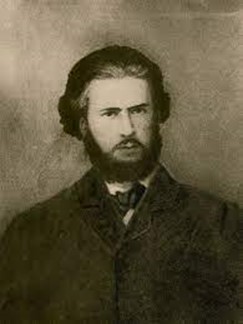 Quand je m’empare d’un sujet et que j’essaie de l’approfondir un peu, je fais des rencontres.
Quand je m’empare d’un sujet et que j’essaie de l’approfondir un peu, je fais des rencontres.
Et dans mes rencontres avec les femmes et les hommes du passé qui ont fait la Commune, Eugène Varlin occupe une place particulière, comme celle d’un juste. Un juste qui est mort en martyr.
Hippolyte Lissagaray qui participa au combat de la commune mais qui est surtout connu comme le premier historien de la Commune puisqu’il écrivit une <Histoire de la Commune de 1871> dès 1876 disait d’Eugène Varlin que
« Toute sa vie est un exemple »
Quand on parle de lui, on dit « Eugène Varlin, l’ouvrier relieur ». C’est le titre du livre que Michèle Audin, la fille du mathématicien Maurice Audin, déjà évoquée lors du mot du jour du 26 mars, qu’elle lui a consacré.
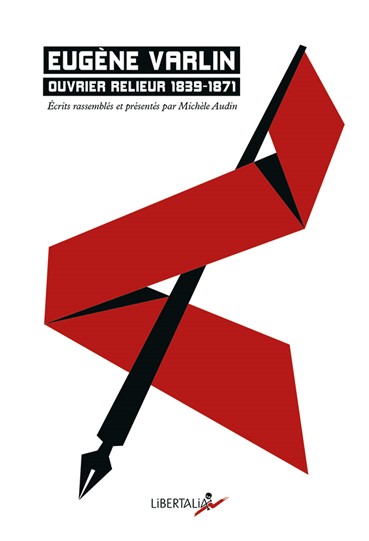 Ce livre n’est pas une biographie mais le recueil de tous ses écrits retrouvés à ce jour : articles, proclamations, lettres.
Ce livre n’est pas une biographie mais le recueil de tous ses écrits retrouvés à ce jour : articles, proclamations, lettres.
Parmi ces textes, on cite souvent cette vision de la société dont j’ai extrait l’exergue :
« Consultez l’histoire et vous verrez que tout peuple comme toute organisation sociale qui se sont prévalus d’une injustice et n’ont pas voulu entendre la voix de l’austère équité sont entrés en décomposition ; c’est là ce qui nous console, dans notre temps de luxe et de misère, d’autorité et d’esclavage, d’ignorance et d’abaissement des caractères, de pervertissement du sens moral et de marasme, de pouvoir déduire des enseignements du passé que tant qu’un homme pourra mourir de faim à la porte d’un palais où tout regorge, il n’y aura rien de stable dans les institutions humaines. »
Varlin est né en 1839 dans une famille de paysans pauvres de Claye-Souilly (Seine-et-Marne). Il va à l’école jusqu’à l’âge de 13 ans, puis fait un apprentissage à Paris où il devient ouvrier relieur. Il suit des cours du soir, participe aux premières grèves autorisées en 1864, devient membre et rapidement responsable de la toute jeune Association internationale des travailleurs (AIT), ce qui lui vaut trois mois de prison en 1868. Il mène une inlassable activité d’organisation des ouvriers à Paris et en province. Il est élu à la Commune en 1871 et participe activement à la défense de Paris pendant la Semaine sanglante et est assassiné le 28 mai 1871, dans des conditions atroces.
<Wikipedia> souligne aussi son ouverture au féminisme et son souci de l’égalité entre les hommes et les femmes
« En 1864-1865, il anime la grève des ouvriers relieurs parisiens. Il devient président de la société d’épargne de crédit mutuel des relieurs qu’il a aidé à créer (partisan de l’égalité des sexes, il y fait entrer à un poste élevé Nathalie Lemel). En 1864 est créée l’Association internationale des travailleurs (AIT), souvent connue sous l’appellation de « Première Internationale ». Varlin y adhère en 1865 et participe, avec son frère Louis et Nathalie Lemel, à la première grève des relieurs. Il est délégué en 1865 à la conférence de l’AIT à Londres, puis en 1866 au premier congrès de l’AIT à Genève, où il défend contre la majorité des autres délégués le droit au travail des femmes. »
 Nathalie Le Mel fut aussi une des femmes qui participa activement à la Commune.
Nathalie Le Mel fut aussi une des femmes qui participa activement à la Commune.
Elle a été dans beaucoup des combats d’Eugène Varlin dont elle partageait le métier de relieuse.
Tous les deux avaient adhéré à l’AIT
Eugène Varlin n’était pas que dans le concept, il travaillait aussi dans le concret et les besoins immédiats des ouvriers :
À la même époque, il crée la Société de solidarité des ouvriers relieurs de Paris, dont les statuts évoquent la nécessité de « poursuivre l’amélioration constante des conditions d’existence des ouvriers relieurs en particulier, et, en général, des travailleurs de toutes les professions et de tous les pays, et d’amener les travailleurs à la possession de leurs instruments de travail. » Ses efforts contribuent à la création, le 14 novembre 1869, de la Fédération parisienne des sociétés ouvrières, qui plus tard passe à l’échelle nationale et devient ultérieurement la Confédération générale du travail.
Varlin participe à la création d’une coopérative, « La Ménagère », en 1867, et à l’ouverture, en 1868, d’un restaurant coopératif, « La Marmite ». Ce dernier compte 8 000 adhérents et ne ferme qu’après la Commune. »
Il était donc aussi à l’origine des prémices de la CGT.
Nathalie Le Mel jouera également un rôle essentiel dans l’organisation de « La Marmite » et des sociétés d’alimentation, de consommation et de production qu’Eugène Varlin voulait pour améliorer le sort des ouvrier et des pauvres.
L’historien moderne de la commune Jacques Rougerie écrit :
« Pendant toute la durée de l’insurrection, Varlin ne se consacrera qu’aux tâches concrètes ; il ne s’agit rien moins que de faire vivre et combattre Paris et cela peut tenir au moindre détail. »
Pendant la commune il sera nommé à la commission des finances. Il assure la liaison entre la Commune et les sociétés ouvrières.
<Le Maitron> publie un récit biographique assez détaillé.
Le journal <LES INROCKS> le décrit ainsi :
« Varlin milite sans relâche pour la réduction de la durée de la journée de travail, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la liberté de la presse et d’association, l’instruction laïque et obligatoire ou encore l’impôt progressif. « L’association n’a pas pour but d’organiser les travailleurs en vue de soutenir une lutte permanente contre les détenteurs de capitaux. Elle vise plus haut. Elle se propose de réaliser l’affranchissement complet du travail, en amenant les travailleurs à la possession de l’outillage social et les éléments naturels indispensables à la production. Loin de vouloir organiser la guerre, elle a la prétention d’établir la fraternité entre les hommes sans distinction de race, de couleur, ou de croyance », écrit-il. Sous la Commune, dont il fut délégué aux Finances et membre de la Commission de la Guerre, il prit notamment la décision de suspendre la vente des objets au Mont-de-Piété, cette institution de prêts sur gage qui finissait par ruiner les pauvres. »
Le 28 mai, reconnu et dénoncé par un prêtre rue Lafayette, il est arrêté par le lieutenant Sicre et amené à Montmartre, rue des Rosiers, où il est lynché, éborgné par la foule et, finalement, fusillé par les soldats près de l’endroit où avaient été fusillés les généraux Lecomte et Clément-Thomas. Précision sordide : Les ouvriers relieurs lui avaient offert une montre qui lui fut volée, après qu’il eut été massacré.
<Le Maîtron> précise que : « Dans un rapport à son colonel, le lieutenant Sicre avait déclaré : » Parmi les objets trouvés sur lui [Varlin] se trouvaient : un portefeuille portant son nom, un porte-monnaie contenant 284 f 15, un canif, une montre en argent et la carte de visite du nommé » Tridon « . Sicre s’appropria la montre — présent des ouvriers relieurs en 1864»
Voici la description que Louise Michel fait de son assassinat dans ses Mémoires :
« La Commune était morte, ensevelissant avec elle des milliers de héros inconnus. Ce dernier coup de canon à double charge énorme et lourd ! Nous sentions bien que c’était la fin ; mais tenaces comme on l’est dans la défaite, nous n’en convenions pas…
Ce même dimanche 28 mai, le maréchal Mac-Mahon fit afficher dans Paris désert : « Habitants de Paris, l’armée de la France est venue vous sauver ! Paris est délivré, nos soldats ont enlevé en quatre heures les dernières positions occupées par les insurgés.
Aujourd’hui la lutte est terminée, l’ordre, le travail, la sécurité vont renaître ».
Ce dimanche-là, du côté de la rue de Lafayette, fut arrêté Varlin : on lui lia les mains et son nom ayant attiré l’attention, il se trouva bientôt entouré par la foule étrange des mauvais jours. On le mit au milieu d’un piquet de soldats pour le conduire à la butte qui était l’abattoir. La foule grossissait, non pas celle que nous connaissions : houleuse, impressionnable, généreuse, mais la foule des défaites qui vient acclamer les vainqueurs et insulter les vaincus, la foule du vae victis éternel. La Commune était à terre, cette foule, elle, aidait aux égorgements.
On allait d’abord fusiller Varlin près d’un mur, au pied des buttes, mais une voix s’écria : « il faut le promener encore » ; d’autres criaient : « allons rue des Rosiers ».
Les soldats et l’officier obéirent ; Varlin, toujours les mains liées, gravit les buttes, sous l’insulte, les cris, les coups ; il y avait environ deux mille de ces misérables ; il marchait sans faiblir, la tête haute, le fusil d’un soldat partit sans commandement et termina son supplice, les autres suivirent. Les soldats se précipitèrent pour l’achever, il était mort.
Tout le Paris réactionnaire et badaud, celui qui se cache aux heures terribles, n’ayant plus rien à craindre vint voir le cadavre de Varlin. Mac Mahon, secouant sans cesse les huit cents et quelques cadavres qu’avait fait la Commune, légalisait aux yeux des aveugles la terreur et la mort. […] Combien eût été plus beau le bûcher qui, vivants, nous eût ensevelis, que cet immense charnier !
Combien de cendres semées aux quatre vents pour la liberté eussent moins terrifié les populations, que ces boucheries humaines ! Il fallait aux vieillards de Versailles ce bain de sang pour réchauffer leurs vieux corps tremblants. »
Wikipedia rapporte que pendant la Semaine sanglante, il avait tenté en vain de s’opposer à une exécution d’otages, rue Haxo.
<France Culture> donne la parole à l’historien de l’action culturelle Mathieu Menghini :
« Eugène Varlin, […] s’est instruit en autodidacte, s’intéressant à de nombreuses disciplines comme la géométrie, le latin, l’orthographe, la grammaire.
A force de fabriquer des livres, Eugène Varlin les a dévorés. On lui connaît une obédience doctrinale qui le situe du côté des communistes non-autoritaires, mais on pourrait mieux le définir par ses combats pour les droits des femmes, pour l’émancipation intellectuelle des travailleurs, pour leur instruction intégrale et polytechnique.
Eugène Varlin a contribué à former la classe ouvrière française, […], à établir parmi les ouvriers une conscience de classe. A une époque où Paris était déjà en train de se gentrifier, un des enjeux pour la classe ouvrière était d’améliorer concrètement leurs conditions matérielles, qui souvent se nourrissait mal tout en payant très cher. Avec sa collègue militante Nathalie Lemel, Eugène Varlin a établi des restaurants ouvriers coopératifs nommés « La Marmite ». Un lieu de vie, et de nourriture intellectuelle.
On raconte qu’une fois les estomacs sustentés, ces cantines ouvrières se transformaient en véritables foyers dans lesquels on rêvait la transformation du monde, entre femmes et hommes de divers courants doctrinaux. Certains artistes, favorables à l’auto-émancipation des travailleurs, venaient y entonner un air lyrique une fois leur spectacle terminé. »
Michèle Audin <parle> du premier article d’Eugène Varlin qu’elle a lu et qui lui a donné l’envie de réaliser son livre sur les écrits de cet homme singulier et épris de justice sociale :
« Il est clair, précis, rigoureux, il s’adresse directement à ses lecteurs et il pense aux lecteurs du futur, nous, qui lirons le journal relié. J’ai trouvé le style et les aspects humains de cet article, la dignité de ce jeune ouvrier, ce qu’il appelle dans un autre article « la timidité ordinaire du travailleur » et en même temps sa confiance en ses compétences, très séduisants. Je n’ai pas lu beaucoup d’articles où un ouvrier parle de ses connaissances et de son goût, avant de les appliquer au sujet. »
<1549>
-
Mercredi 7 avril 2021
« Pause (50 ans de la mort d’Igor Stravinsky) »Un jour sans mot du jour nouveauBrusquement, je me suis souvenu que le 6 avril 1971, il y a 50 ans, disparaissait un des plus grands compositeurs de l’Histoire Igor Stravinsky.
 J’ai donc passé le 6 avril à écouter de la musique de Stravinsky.
J’ai donc passé le 6 avril à écouter de la musique de Stravinsky.
Il ne restait plus de temps pour écrire un mot du jour.
Saviez vous que Stravinsky a composé <Les berceuses du chat> ?
Sa célébrité est venue brusquement lorsque Serge Diaghilev lui a demandé d’écrire la musique pour le ballet de l'<Oiseau de Feu> en 1910.
Stravinsky est mort à New York, à l’âge de 88 ans
Mais il a demandé à être enterré près de Serge Diaghilev qui est mort à Venise en 1929 et qui est enterré dans le cimetière de l’île San Michele située dans la lagune de Venise.
Et c’est donc là qu’il est enterré.
<mot sans numéro>
-
Mardi 6 avril 2021
« Si nous réussissions à transformer radicalement le régime social, la révolution du 18 mars serait la plus efficace de celles qui ont eu lieu jusqu’à présent. »Léo FrankelContinuons à nous intéresser à quelques-uns des femmes et hommes qui ont fait la commune. Léo Frankel fut le seul élu étranger de la Commune de Paris et le plus jeune des communards internationalistes. Il y eut d’autres étrangers qui participèrent à la révolte du commune ; mais ils n’étaient pas élu et ne faisaient pas partie du Conseil de le Commune.
On peut citer, par exemple, Jaroslaw Dombrowski qui fut nommé commandant de la place de Paris puis par décision de Rossel, chargé de la direction des opérations sur la rive droite. Il fut blessé mortellement, le 23 mai, à la barricade de la rue Myrha et de la rue des Poissonniers dans le XVIIIe arrondissement.
J’avais évoqué lors du mot du jour de vendredi <Élisabeth Dmitrieff> qui était russe et qui jouera un rôle dans la vie de Léo Frankel.
 Léo Frankel était hongrois.
Léo Frankel était hongrois.
Il était d’origine juive, son père était médecin. Il était né en 1844 à Budapest.
C’était un ouvrier qui avait suivi une formation d’orfèvre. Ce qui l’a amené à voyager. Il séjourne en Allemagne et en Angleterre avant de s’installer à Lyon en 1867 où il s’affilie à l’Association internationale des travailleurs.
Puis, il s’installe à Paris comme ouvrier-bijoutier et représente la section allemande de l’Association internationale des travailleurs (A.I.T.). Il est également correspondant de la Volksstimme de Vienne. Il sera assez vite convaincu par les thèses de Karl Marx.
Il est arrêté fin avril 1870, pour complot et appartenance à une société secrète c’est-à-dire l’A.I.T..
Durant son procès, je jeune hongrois martèle ses convictions :
« L’Association internationale n’a pas pour but une augmentation du salaire des travailleurs, mais bien l’abolition complète du salariat, qui n’est qu’un esclavage déguisé. »
Cité par « les Grands évènements de l’Histoire, la Commune de Paris » mars avril mai 2021
Il est libéré à la suite de la Proclamation de la République française du 4 septembre 1870 qui renverse le Second Empire. Il devient alors membre de la Garde nationale et reconstitue, avec Eugène Varlin, le Comité fédéral de l’Internationale pour Paris.
Il se présente aux élections à l’Assemblée nationale du 8 février 1871, en tant que socialiste révolutionnaire. Il échoue à se faire élire dans cette assemblée, qui nous le savons verra la victoire des monarchistes pacifistes, capitulards diront les communards.
Mais il sera élu au Conseil de la Commune de Paris le 26 mars 1871 dans le 13e arrondissement.
Il devient membre de la Commission du travail et de l’échange, puis de la Commission des finances.
Le 20 avril, il est nommé délégué au travail, à l’industrie et à l’échange. Il fait décréter des mesures sociales, comme l’interdiction du travail de nuit dans les boulangeries.
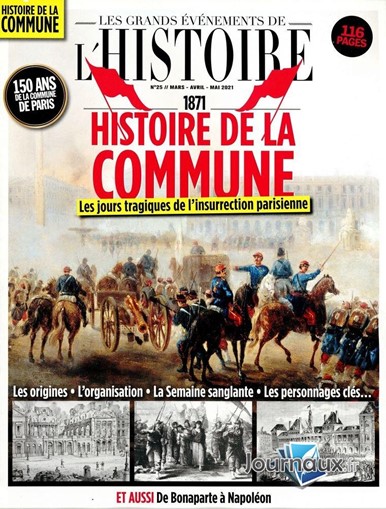 Il écrit à Karl Marx dans une lettre du 30 mars :
Il écrit à Karl Marx dans une lettre du 30 mars :
« Si nous réussissions à transformer radicalement le régime social, la révolution du 18 mars serait la plus efficace de celles qui ont eu lieu jusqu’à présent. Ce faisant nous arriverions à résoudre les problèmes cruciaux des révolutions sociales à venir. »
Cité par « les Grands évènements de l’Histoire, la Commune de Paris » mars avril mai 2021
Pendant la Semaine sanglante, il est blessé gravement sur une barricade de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, à l’angle de la rue de Charonne.
Il est sauvé par Élisabeth Dmitrieff qui réussit à le faire échapper avec elle pour se réfugier en Suisse, à Genève. Les autorités françaises réclament son extradition, mais leurs homologues suisses s’y opposent.
Remis de ses blessures, il va en Angleterre rejoindre Karl Marx et l’Internationale.
Puis il passe en en Allemagne, en 1875, d’où il est expulsé, puis en Autriche où il est arrêté en octobre. Libéré en 1876, il se rend en Hongrie où il organise le Parti ouvrier notamment en rédigeant une partie de son programme.. En mars 1881, il est condamné à dix-huit mois de prison. Libéré en février 1883, il devient correcteur d’imprimerie et collabore à des revues socialistes.
En 1890, il revient en France et participe au Congrès fondateur de la Deuxième internationale.
Le site du <Maitron> nous apprend qu’en 1893 et 1894, il fut administrateur de la revue marxiste L’Ère Nouvelle . […]
Et aussi qu’il vivait de peu, et un rapport de police du 26 décembre 1891 précise :
« Sa mise est convenable et on le voit toujours coiffé d’un chapeau haut de forme, mais on prétend que sa chambre est misérablement meublée et que ses ressources paraissent bien modestes ; il fait souvent sa cuisine lui-même. »
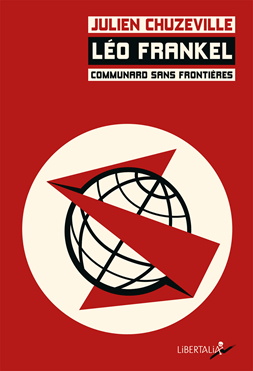 Julien Chuzeville, historien du mouvement ouvrier lui a consacré un livre Léo Frankel, communard sans frontières publié en février 2021.
Julien Chuzeville, historien du mouvement ouvrier lui a consacré un livre Léo Frankel, communard sans frontières publié en février 2021.
Il a été l’invité du < Cours de l’histoire de Xavier Mauduit>, émission très intéressante qui m’a poussé à écrire ce mot du jour.
Xavier Mauduit présente un autre extrait du procès du 2 juillet 1870 déjà évoqué :
« il comparait devant la justice, lors du troisième procès intenté à l’Internationale. Il répond au président du tribunal que
« les capitalistes, à l’occasion d’une grève suscitée par leurs prétentions avides, soient les premiers à accuser l’Internationale de tout le mal, je n’y vois rien d’étonnant ».
Frankel joue de la métaphore :
« Ils agissent en ce point comme le loup de la fable qui se tenait au bord du ruisseau, et accusait de lui troubler son eau, l’agneau qui se désaltérait au-dessous de lui dans le courant. L’agneau eut beau se défendre, prétendant que l’eau ne pouvait pas remonter sa pente, toutes ses dénégations ne lui servirent de rien ; le loup cherchait seulement une occasion favorable pour le dévorer ».
Le président l’interroge : « L’agneau, c’est l’Internationale ? ».
Frankel répond du tac-au-tac : « Et, le loup, c’est le capitaliste ». Il faut se méfier des procès intentés aux militants politiques, car le tribunal devient une tribune où Frankel expose son programme »
Il meurt d’une pneumonie le 29 mars 1896 1896. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, entouré d’un drapeau rouge. Il avait, en effet, écrit quelques jours avant sa mort :
« Je meurs sans crainte.
Mon enterrement doit être aussi simple que celui des derniers crève-de-faim.
La seule distinction que je demande c’est d’envelopper mon corps dans un drapeau rouge, le drapeau du prolétariat international, pour l’émancipation duquel j’ai donné la meilleure part de ma vie et pour laquelle j’ai toujours été prêt à la sacrifier. »
En 1968, sa dépouille est transférée au cimetière national de Hongrie à Budapest.
Sa tombe parisienne est devenue depuis un cénotaphe (du grec ancien : kenotáphion, de kenós (« vide ») et táphos (« tombeau »)).
<Ce blog> nous apprend qu’il existe désormais une rue Leo-Frankel, dans le XIIIème arrondissement de Paris, à proximité de la Bibliothèque nationale de France,
<1548>
-
Vendredi 2 avril 2021
« Pas de révolution sans les femmes »Carolyn J. EichnerDans la revue « L’histoire » de janvier 2021, consacrée à la commune, c’est une historienne américaine Carolyn J. Eichner qui a rédigé un article « Pas de révolution sans les femmes » mettant en évidence le rôle des femmes pendant la Commune de Paris.
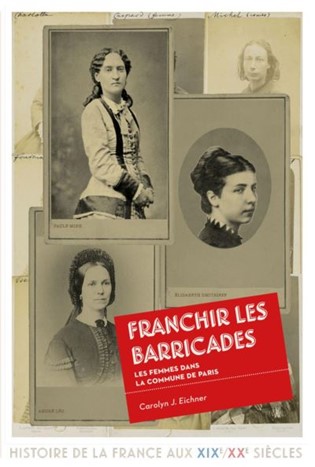 Louise Michel n’était pas seule.
Louise Michel n’était pas seule.
Carolyn Eichner est professeure à l’université du Wisconsin à Milwaukee et a publié en février 2020 un livre sur ce sujet : « Franchir les barricades » et qui avait pour sous-titre « Les femmes dans la commune de paris »
Dans ce livre, l’historienne s’était concentrée sur trois cheffes de file : André Léo, Élisabeth Dmitrieff et Paule Mink.
A ce stade, il faut parler d’un outil qui existe sur Internet : <Le Maitron> et que j’ai découvert à l’occasion de mes recherches sur cette série sur la Commune. C’est Raphaël Meyssan l’auteur de la BD et du film diffusé sur ARTE <Les damnés de la Commune>. et que j’ai évoqué lors du premier mot du jour de la série qui m’a fait découvrir cette somme de connaissances libre d’accès
Le nom « Maitron » fait référence à Jean Maitron (1910 – 1987), historien qui s’est passionné pour l’histoire ouvrière en France. Avant lui, les historiens étudiaient surtout les rois, les chefs de guerre et les batailles. Il a fait entrer l’Histoire des ouvriers dans l’université et a énormément travaillé sur les bases d’archives.
Et c’est ainsi qu’il est à l’origine du « Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français », ouvrage de référence qu’on a nommé en son honneur « le Maitron ».
Ce travail augmenté des apports de ses successeurs en historiographie se trouve désormais sur un site internet dont je redonne l’adresse : : <Le Maitron>
Et grâce à ce site, nous avons immédiatement des informations sur ces trois femmes
 <André Léo>a pour nom d’état civil Léodile Champseix mais on l’appelle André Léo.
<André Léo>a pour nom d’état civil Léodile Champseix mais on l’appelle André Léo.
Elle est née en 1824 à Lusignan (Vienne). C’est une écrivaine ; socialiste et féministe ; communarde, présidente de la commission de l’enseignement professionnel des jeunes filles.
Elle reçut une excellente éducation. Son grand-père avait été fondateur, en 1791, de la Société des Amis de la Constitution.
Après le coup d’État de décembre 1851, elle fit la connaissance de Grégoire Champseix, un Limousin, qui vivait exilé à Lausanne où il était professeur et avec qui elle se maria.
En 1860 le couple alla habiter à Paris. Mme Champseix entreprit alors une carrière de romancière : Elle signait ses ouvrages André Léo, pseudonyme formé du nom de ses deux enfants jumeaux.
Dans les dernières années du Second Empire, elle se lança dans la bataille politique et sociale. C’est chez elle que fut élaboré en 1868 le programme de la « Société de revendication des droits de la femme », avec la participation d’Élie Reclus et de Marthe Noémie Reclus.
En 1870, elle fréquenta les clubs. Elle se rangea parmi les combattants de la Commune en 1871. Avec Mme Jaclard, elle fonda le journal La Sociale (31 mars-17 mai 1871) où, tout en protestant contre certains excès du Comité central, elle soutint avec énergie les droits de Paris ; elle y publia son « appel aux travailleurs des champs ». Elle appartint à l’Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés et à la commission instituée par Édouard Vaillant « pour organiser et surveiller l’enseignement dans les écoles de filles ». Avec Louise Michel et Paule Minck, elle fit partie du Comité de Vigilance des citoyennes de Montmartre. Dans le journal La Commune, elle formula ainsi son programme (10 avril 1871) :
« La terre au paysan, l’outil à l’ouvrier, le travail pour tous ».
Après l’entrée des Versailles dans Paris, elle se rendit en Suisse. Elle vécut à Genève où elle put ainsi se soustraire à la condamnation prononcée par les conseils de guerre. Elle collabora au journal La Révolution sociale, en 1871, dans lequel elle se livra à de violentes attaques contre Marx. Elle publia la même année, à Neuchâtel, La Guerre sociale où elle racontait l’histoire de la Commune.
Elle mourut en 1900. Elle a légué par testament une rente à la première commune de France qui voudra faire un essai de collectivisme par l’achat d’un terrain communal, travaillé en commun avec partage des fruits.
 <Élisabeth Dmitrieff>, née de l’union irrégulière d’un ancien officier de hussards et d’une jeune infirmière, reçut une bonne éducation et apprit à parler couramment plusieurs langues. Elle habitait Saint-Petersbourg, participait aux discussions passionnées qui étaient fréquentes dans la jeunesse intellectuelle russe de l’époque, et rêvait d’émancipation pour elle-même et pour les autres.
<Élisabeth Dmitrieff>, née de l’union irrégulière d’un ancien officier de hussards et d’une jeune infirmière, reçut une bonne éducation et apprit à parler couramment plusieurs langues. Elle habitait Saint-Petersbourg, participait aux discussions passionnées qui étaient fréquentes dans la jeunesse intellectuelle russe de l’époque, et rêvait d’émancipation pour elle-même et pour les autres.
Elle effectua un mariage blanc pour partir pour l’étranger : la Suisse d’abord, où elle milita dès 1868, puis Londres à la fin de l’année 1870. Elle y fréquenta la famille de Karl Marx et Marx lui-même qui l’envoya à Paris, en mars 1871, en mission d’information. Un rapport de police la décrit alors ainsi :
« Mesurant 1,66 m ; cheveux et sourcils châtains ; front légèrement découvert ; yeux gris bleu ; nez bien fait ; bouche moyenne ; menton rond ; visage plein, teint légèrement pâle ; démarche vive ; habituellement vêtue de noir et toujours d’une mise élégante. »
Elle cofonda pendant cette période l’Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Union constituée en avril et dont les membres s’étaient mises à la disposition de la Commune, prêtes « à combattre et vaincre ou mourir » . Elle appartint à sa commission exécutive. Au nom de l’Union, Élisabeth Dmitrieff élabora un rapport d’inspiration socialiste sur une organisation du travail à base d’associations de production fédérées ; ce rapport fut envoyé à la commission du Travail et de l’Échange de la Commune que dirigeait Frankel.
Élisabeth Dmitrieff représentait un féminisme socialiste qui empruntait à la fois au populisme des coopératives féministes russes et à l’autorité centralisée marxiste (elle fut, parmi les communards socialistes, une des rares influencées par Marx). Saisissant le moment révolutionnaire afin d’enclencher le changement, elle avait pour objectif de donner aux ouvrières le contrôle de leur propre travail. L’Union des femmes fut la seule organisation à obtenir les ressources financières demandées au gouvernement de la Commune.
Élisabeth Dmitrieff participa aux derniers combats de rue ; le 25 mai. Elle put échapper à l’arrestation. Le 6e conseil de guerre la condamna par contumace, le 26 octobre 1872, à la déportation dans une enceinte fortifiée ; elle fut graciée le 8 avril 1879 sous condition d’un arrêté d’expulsion.
Elle avait trouvé refuge en Suisse en juin. En octobre 1871, elle réussit à rentrer en Russie. Elle épousa un condamné à la déportation qu’elle suivit en Sibérie, où elle mourut à une date indéterminée, entre 1910 et 1918.
 <Paule Mink>est née en 1839 à Clermont-Ferrand. Elle était d’origine polonaise, son nom véritable était Adèle Pauline Mekarski. Elle était la sœur de Jules Mekarski. Son père, Jean, Népomucène Mekarski, était de haute noblesse polonaise, neveu du général prince Joseph, Antoine Poniatowski et cousin de Stanislas II Poniatowski, dernier roi de Pologne.
<Paule Mink>est née en 1839 à Clermont-Ferrand. Elle était d’origine polonaise, son nom véritable était Adèle Pauline Mekarski. Elle était la sœur de Jules Mekarski. Son père, Jean, Népomucène Mekarski, était de haute noblesse polonaise, neveu du général prince Joseph, Antoine Poniatowski et cousin de Stanislas II Poniatowski, dernier roi de Pologne.
Sa mère, Jeanne, Blanche Cornélie Delaperrierre, était issue d’une famille française de comédiens.
Très tôt, Pauline fit montre de sentiments républicains, écrivant des articles, participant à des réunions publiques. Elle fut notamment l’auteur d’un petit pamphlet Les Mouches et l’Araignée dirigé contre Napoléon III (l’araignée) dévorant le peuple (les mouches). Vers 1868, elle se trouvait à Paris et créa une organisation féministe et révolutionnaire à forme mutualiste, la » Société fraternelle de l’ouvrière « .
L’article du Maitron cite une description que fait d’elle Gustave Lefrançais qui était un élu de la commune :
« Parmi les femmes qui prennent habituellement la parole dans les réunions, on remarque surtout la citoyenne Paule Mink, petite femme très brune, un peu sarcastique, d’une grande énergie de parole. La voix est un peu aigre, mais elle s’exprime facilement. Elle raille avec esprit ses contradicteurs plutôt qu’elle ne les discute et ne paraît pas, jusqu’alors, avoir des idées bien arrêtées sur les diverses conceptions qui divisent les socialistes. Mais elle est infatigable dans sa propagande. »
Elle est connue comme l’oratrice des clubs. Après la semaine sanglante elle s’exile en Suisse. Elle revient en France après l’amnistie et poursuivra le combat féministe et socialiste.
Vers 1900, elle était une des trois femmes membres du conseil d’administration du Syndicat des journalistes socialistes. Elle mourut le 28 avril 1901. Elle fut incinérée le 1er mai au Père-Lachaise.
Carolyn J. Eichner précise :
« Les femmes, tout en étant absentes du gouvernement de la Commune, furent très actives dans les clubs, les journaux ou sur les barricades. Loin du mythe de la pétroleuse, elles participèrent aux différents courants du socialisme féministe. »
Elle rappelle opportunément que les femmes jouèrent un rôle éminent dès le début de la Commune :
« Au petit matin du 18 mars 1871, après que Thiers eut donné l’ordre, dans la nuit, de récupérer les canons de la Garde nationale à Montmartre, ce sont les femmes déjà levées qui s’interposèrent les premières entre les troupes et l’artillerie. Faisant primer la solidarité de classe sur la loyauté nationale, elles persuadèrent les soldats de se rallier à elles. Ces fraternisations mirent le feu aux poudres. »
Elle cite enfin l’Union des femmes :
« Au 50e des 72 jours que dura la Commune, la commission exécutive de l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés déclara : « Les femmes de Paris prouveront à la France et au monde qu’elles aussi sauront, au moment du danger suprême – aux barricades, sur les remparts de Paris –, donner leur sang et leur vie pour la défense et le triomphe de la Commune, c’est-à-dire du peuple ! »
Pendant longtemps, l’histoire de la Commune qu’on racontait, montrait, d’un côté, des hommes faisant la révolution et, de l’autre, des femmes, hystériques, mettant le feu à Paris au moment de la Semaine sanglante : c’est ainsi que s’est imposée la figure de la pétroleuse.
« Pétroleuse » Le mot a été inventé dans les jours qui ont suivi la Semaine sanglante. La presse versaillaise a accusé les communardes d’avoir allumé des incendies dans les rues où l’on ne se battait plus.
Et l’historienne américaine d’analyser :
« En réalité, des milliers de femmes jouèrent un rôle déterminant dans la Commune de Paris. Dès la fin des années 1860, au moment de la libéralisation du Second Empire, des organisations féministes et socialistes avaient créé les conditions préalables à leur soulèvement. Durant la courte vie de la Commune des militantes ont constitué des clubs politiques populaires, des comités de vigilance, ralliant les brigades militaires, soulageant et nourrissant les blessés, publiant des journaux, développant des écoles mixtes, organisant des soupes populaires et fondant des coopératives de production.
Deux raisons expliquent leur marginalisation dans l’histoire de la Commune. D’abord, l’activisme des femmes a toujours été dévalorisé quand il n’était pas tout simplement ignoré précisément parce qu’il s’agissait de l’activisme de femmes. Ensuite, lorsque les femmes se sont impliquées politiquement, ce fut en dehors de la structure gouvernementale officielle, qui n’était constituée que d’hommes. La Commune, en effet, n’a pas accordé le droit de vote aux femmes – et les communardes n’ont pas cherché à l’obtenir, non plus qu’un rôle officiel dans le gouvernement.
Pour elles, la Commune devait être une transition vers une nouvelle société égalitaire du point de vue social. Or, les historiens ont longtemps minimisé l’importance de ces actions militantes au ras du sol. Quant aux observateurs contemporains, en plus de sous-évaluer les initiatives des femmes, ils les ont diabolisées, pointant leur comportement non féminin et irrationnel. […] Ces représentations rejettent les militantes hors de l’humanité.
La réalité est tout autre. La plupart des communardes étaient des ouvrières travaillant dans des métiers liés au textile, comme Marie Rogissart, couturière, qui organisa les femmes pour arrêter les réfractaires qui refusaient de défendre la Commune, ou Marie Lemonnier, apprêteuse de neuf, qui servit comme ambulancière sur le champ de bataille et éleva ensuite des barricades. Elles s’engagèrent dans une révolution qui, très vite, renversa toute hiérarchie de pouvoir. »
<Cet article> parle d’une autre ambulancière Alix Payen qui a écrit un livre sur son expérience lors de la Commune
Il n’y a pas de révolution sans les femmes.
<1547>
-
Jeudi 1 avril 2021
« S’il y a des miséreux dans la société, des gens sans asile, sans vêtements et sans pain, c’est que la société dans laquelle nous vivons est mal organisée. »Louise MichelQuand l’hebdomadaire « Le Un » a voulu consacrer un numéro à la commune, il a réalisé un hors-série sur Louise Michel avec ce titre « Louise Michel, l’égérie de la Commune ».
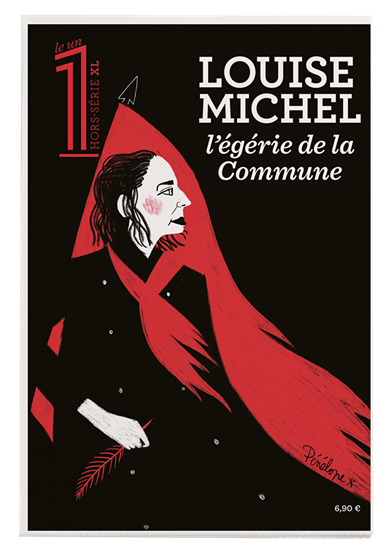 Ce <site> de la gauche radicale lyonnaise pose ce constat qui parait très juste :
Ce <site> de la gauche radicale lyonnaise pose ce constat qui parait très juste :
« De tous les personnages de la Commune de Paris, Louise Michel est la première femme à avoir triomphé de la conspiration du silence et de l’oubli. »
Il existe des rues, des squares « Louise Michel » et même des Boulevards de ce nom, notamment à Gennevilliers et à Evry. Le nombre de collèges et de lycée « Louise Michel » me semble encore plus nombreux. Le nombre de livres qui lui ont été consacrés est aussi important.
Cette visibilité tranche avec les autres figures essentielles de la commune.
Elle est née en Haute Marne, mais dans un château, celui de Vroncourt, le 29 mai 1830, deux mois avant la révolution de 1830 qui aura lieu du 27 au 29 juillet 1830,
déjà une révolution des parisiens contre la réaction, incarnée par le roi Charles X.
Elle est née dans un château dans lequel sa mère était domestique au service des Demahis, famille de petite noblesse ouverte aux idéaux républicains.
Les biographes se disputent sur l’identité du père, mais une chose est certaine, c’était un des membres de la famille Demahis, le plus vraisemblable étant le fils des châtelains, Laurent qui sera éloigné du château après sa naissance.
Elle était donc fille naturelle.
Il faut rappeler que parmi les décisions de la commune se trouve la suppression de la catégorie « illégitime » pour les enfants nés hors mariage.
Louise sera élevée, près de sa mère, dans la famille de Laurent Demahis, qu’elle appelle ses grands-parents. Jusqu’à ses 20 ans, Louise porte le patronyme de son grand-père Étienne-Charles Demahis qui lui donne le goût d’une culture classique où domine l’héritage des Lumières, notamment Voltaire et Jean-Jacques Rousseau.
Selon <Wikipedia> :
« elle reçoit une instruction solide, une éducation libérale et semble avoir été heureuse, faisant preuve, très jeune, d’un tempérament altruiste. »
Finalement ses grands parents l’ont protégé et soutenu. Mais lorsqu’ils meurent en 1850, la famille des héritiers oblige Louise et sa mère à quitter le château et Louise doit abandonner le nom Demahis pour prendre celui de sa mère.
Elle poursuit des études pour devenir institutrice, en 1853, mais refuse de de prêter serment à Napoléon III, ce qui est nécessaire pour exercer dans l’école de l’empire. C’est pourquoi elle crée une école libre à Audeloncourt (Haute-Marne) puis dans d’autres communes avant de se rendre à Paris pour poursuive son activité d’enseignante et aussi de militante et même d’écrivain.
Elle intègre les milieux révolutionnaires, y rencontre Jules Vallès, Eugène Varlin, Raoul Rigault et Émile Eudes, et collabore à des journaux d’opposition comme Le Cri du peuple. En 1869, elle est secrétaire de la Société démocratique de moralisation, ayant pour but d’aider les ouvrières.
Elle est très active dans les milieux anarchistes et socialistes avant la Commune.
Et pendant la commune, elle joue un rôle de premier plan, elle est à la fois ambulancière, et combattante.
Elle se bat jusque dans la semaine sanglante. C’est pour faire libérer sa mère, qu’elle se rend Le 24 mai.
Pendant sa détention, elle assiste aux exécutions et voit mourir ses amis, parmi lesquels son ami Théophile Ferré exécuté en même temps que Louis Rossel.
Lorsqu’elle est interrogée pour la première fois par le conseil de guerre, elle déclare :
« Ce que je réclame de vous, c’est le poteau de Satory où, déjà, sont tombés nos frères ; il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire. Eh bien, on a raison. Puisqu’il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n’a droit aujourd’hui qu’à un peu de plomb, j’en réclame ma part, moi »
 Elle revendique les crimes et délits dont on l’accuse et réclame la mort au tribunal « Si vous n’êtes pas des lâches, tuez-moi ».
Elle revendique les crimes et délits dont on l’accuse et réclame la mort au tribunal « Si vous n’êtes pas des lâches, tuez-moi ».
La presse versaillaise la nomme « la Louve avide de sang ».
Pendant ses premières années à Paris, pendant qu’elle poursuivait l’ambition de devenir écrivain, elle a commencé un échange épistolaire régulier avec Victor Hugo. Et ce dernier lui dédiera un poème, <Viro Major> (« Plus qu’un homme »), dont je cite un extrait
« Ayant vu le massacre immense, le combat,
Le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat,
La pitié formidable était dans tes paroles ;
Tu faisais ce que font les grandes âmes folles,
Et lasse de lutter, de rêver, de souffrir,
Tu disais : J’ai tué ! car tu voulais mourir. […]
Et ceux qui comme moi, te savent incapable
De tout ce qui n’est pas héroïsme et vertu,
Qui savent que si Dieu te disait : D’où viens-tu ?
Tu répondrais : Je viens de la nuit où l’on souffre ;
Dieu, je sors du devoir dont vous faites un gouffre !
Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux,
Tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs, donnés à tous,
Ton oubli de toi-même à secourir les autres,
Ta parole semblable aux flammes des apôtres ;
Ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain,
Le lit de sangle avec la table de sapin,
Ta bonté, ta fierté de femme populaire,
L’âpre attendrissement qui dort sous ta colère,
Ton long regard de haine à tous les inhumains,
Et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains ;
Ceux-là, femme, devant ta majesté farouche,
Méditaient, et, malgré l’amer pli de ta bouche,
Malgré le maudisseur qui, s’acharnant sur toi,
Te jetait tous les cris indignés de la loi,
Malgré ta voix fatale et haute qui t’accuse,
Voyaient resplendir l’ange à travers la méduse. »
Elle sera finalement condamnée à la déportation en Nouvelle Calédonie, elle y restera 7 ans.
Ce ne seront pas pour elles des années perdues car là-bas aussi, elle va agir pour enseigner, pour s’instruire, pour dénoncer l’injustice. Wikipédia rapporte :
« Elle crée le journal Petites Affiches de la Nouvelle-Calédonie. Elle apprend une langue canaque et traduit dans une langue poétique plusieurs des mythes fondateurs des Kanaks, dont un mythe portant sur le déluge.
Elle édite en 1885 Légendes et chansons de gestes canaques. S’intéressant aux langues kanakes et, dans sa recherche de ce que pourrait être une langue universelle, à la langue pidgin qu’est le bichelamar, elle cherche à instruire les autochtones kanaks et, contrairement à certains communards qui s’associent à leur répression, elle prend leur défense lors de leur révolte de 1878. Elle obtient l’année suivante l’autorisation de s’installer à Nouméa et de reprendre son métier d’enseignante, d’abord auprès des enfants de déportés (notamment des Algériens de Nouvelle-Calédonie), de gardiens, puis dans les écoles de filles. Elle instruit les Canaques adultes le dimanche, inventant toute une pédagogie adaptée à leurs concepts et leur expérience. »
Elle reviendra en France et poursuivra sa quête de de justice et d’égalité.
Pendant les dix dernières années de sa vie, Louise Michel, devenue une grande figure révolutionnaire et anarchiste, multiplie les conférences à Paris et en province, accompagnées d’actions militantes et ce malgré sa fatigue ; en alternance, elle effectue des séjours à Londres en compagnie d’amis. Très surveillée par la police, elle est plusieurs fois arrêtée et emprisonnée. Condamnée à six ans d’incarcération, elle est libérée au bout de trois sur intervention de Clemenceau, pour revoir sa mère sur le point de mourir.
Elle meurt, le 9 janvier 1905 à Marseille.
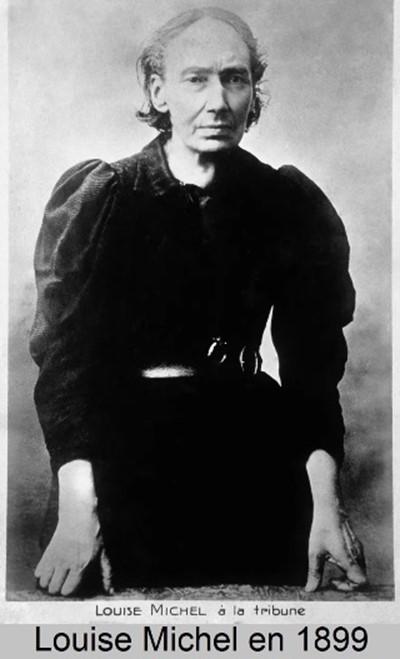 Elle a beaucoup écrit, notamment ses mémoires
Elle a beaucoup écrit, notamment ses mémoires
Beaucoup de ses phrases sont passées dans la postérité et sont régulièrement republiées par des hommes épris d’égalité. Je retiens <celle-ci> :
« S’il y a des miséreux dans la société, des gens sans asile, sans vêtements et sans pain, c’est que la société dans laquelle nous vivons est mal organisée. On ne peut pas admettre qu’il y ait encore des gens qui crèvent la faim quand d’autres ont des millions à dépenser en turpitudes. C’est cette pensée qui me révolte ! »
Elle était aussi totalement féministe. Le « Un » cite des extraits de ses mémoires :
« Si l’égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. En attendant, la femme est toujours, comme le disait le vieux Molière, le potage de l’homme. »
« Les filles, élevées dans la niaiserie, sont désarmées tout exprès pour être mieux trompées »
« Partout, l’homme souffre dans cette société maudite ; mais nulle douleur n’est comparable à celle de la femme. »
« Dans la rue, elle est marchandise. Dans les couvents, les règlements broient son cerveau et son cœur. Dans le monde, elle ploie sous le dégoût. Dans son ménage, son fardeau l’écrase »
« Nous sommes une moitié de l’humanité, nous combattons avec tous les opprimés et nous garderons notre part de l’égalité qui est la seule justice. »
Laurent Joffrin, dans un article publié le 9 août 2019 : <Louise Michel, comme une rouge> cite un épisode de la fin de sa vie :
« On l’emprisonne puis on la libère. Un exalté, Lucas, lui tire deux balles dans la tête dont l’une restera fichée dans son crâne. Elle demande son acquittement et l’obtient. »
Il finit son article par cet adage simple écrit par elle pour ceux qui croient encore à l’avenir :
« Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre et nous pensons que le jour où le règne de la liberté sera arrivé, le genre humain sera heureux. »
<1546>
-
Mercredi 31 mars 2021
« Pause (Les écrivains contre la commune)»Un jour sans mot du jour nouveauIl me faut parfois reconnaitre que l’énergie me manque pour écrire ce que j’appelle un mot du jour.
C’est le cas aujourd’hui.
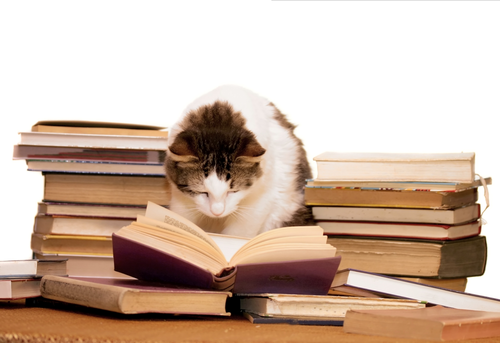 Je vous indique cependant quelques sites qui nous renseignent sur les paroles étranges, de rejet, de haine que beaucoup d’écrivains français ont eu à l’égard de la commune.
Je vous indique cependant quelques sites qui nous renseignent sur les paroles étranges, de rejet, de haine que beaucoup d’écrivains français ont eu à l’égard de la commune.
Hier, je citais Alexandre Dumas fils sur Gustave Courbet, il ne fut pas le seul.
Un livre a été écrit par Paul Lidsky : « Les écrivains contre la Commune »
Marianne a publié un article : « Flaubert, Zola, Sand…. Quand les écrivains firent bloc contre la Commune de Paris »
France Culture consacre une page à ce sujet « Les écrivains face à la Commune »
Et sur ce <site> vous avez un florilège de ce que ces grands auteurs ont écrit.
Quelques exemples :
Heinrich Heine :
« De leurs mains calleuses, ils briseront sans merci toutes les statues de marbre de la beauté si chères à mon cœur, ils détruiront mes bois de laurier pour y planter des pommes de terre. […] Hélas ! je prévois tout cela, et je suis saisi d’une indicible tristesse en pensant à la ruine dont le prolétariat vainqueur menace mes vers qui périront avec tout l’ancien monde romantique. »
Edmond de Goncourt :
« C’est bon. Il n’y a eu ni conciliation ni transaction. La solution a été brutale. Ç’a été de la force pure. La solution a retiré les âmes des lâches compromis. La solution a redonné confiance à l’armée, qui a appris, dans le sang des communeux, qu’elle était encore capable de se battre. Enfin, la saignée a été une saignée à blanc ; et les saignées comme celle-ci, en tuant la partie bataillante d’une population, ajournent d’une conscription la nouvelle révolution. C’est vingt ans de repos que l’ancienne société a devant elle, si le pouvoir ose tout ce qu’il peut oser en ce moment. » (Journal, mercredi 31 mai 1871)
Anatole France :
« Enfin le gouvernement du crime et de la démence pourrit à l’heure qu’il est dans les champs d’exécution. »
Gustave Flaubert :
« Je trouve qu’on aurait dû condamner aux galères toute la Commune et forcer ces sanglants imbéciles à déblayer les ruines de Paris, la chaîne au cou, en simples forçats. Mais cela aurait blessé l’humanité. On est tendre pour les chiens enragés, et point pour ceux qu’ils ont mordus. » (dans une lettre à George Sand, le 18 octobre 1871)
Vous verrez que même Zola a eu des propos contre la commune
<mot sans numéro>
-
Mardi 30 mars 2021
« Gustave Courbet, la Commune et la destruction de la colonne Vendôme. »Une histoire du temps de la communeLe peintre Gustave Courbet est né en 1819. Il fut désigné comme le chef de file du courant réaliste.
Au temps des réseaux sociaux on a beaucoup parlé de lui en raison de la censure par Facebook de son tableau « L’origine du Monde » qui avait été publié par un Internaute. Le litige fut surmonté. Après une action en justice, un accord amiable a pu être trouvé entre Facebook et l’internaute : Frédéric Durand. C’est quand même une affaire qui a duré 8 ans.
 Depuis on peut publier l’Origine du Monde sur Facebook. Il s’agit d’un tableau de 46,3 cm sur 55,4 cm exposé au Musée d’Orsay à qui il faut désormais ajouter le nom de Giscard d’Estaing.
Depuis on peut publier l’Origine du Monde sur Facebook. Il s’agit d’un tableau de 46,3 cm sur 55,4 cm exposé au Musée d’Orsay à qui il faut désormais ajouter le nom de Giscard d’Estaing.
France culture nous apprend que ce tableau peint en 1866 a toujours causé scandale. Récemment, le nom du modèle qui a servi pour peindre cette partie de l’anatomie féminine a été révélé : il s’agit d’une jeune danseuse de l’opéra de Paris : Constance Quéniaux.
Mais ce mot du jour n’a pas pour objet de parler des qualités artistiques du peintre mais de son rôle dans la Commune de Paris et notamment l’accusation d’être responsable de la destruction de la colonne Vendôme avec la statue de Napoléon Ier qui la surplombait.
La colonne Vendôme avait été érigée en 1810 en hommage à la « Grande Armée » et à son chef Napoléon Bonaparte.
Gustave Courbet par son parcours était destiné à soutenir La Commune.
Courbet avait, par exemple, été l’ami de Pierre-Joseph Proudhon, le chantre du socialisme libertaire cher à Michel Onfray. En 1865, il a consacré une peinture à son ami « Proudhon et ses enfants » .
 Ses idées républicaines et son gout de la liberté lui ont fait refuser la Légion d’honneur qui lui avait été proposée par Napoléon III.
Ses idées républicaines et son gout de la liberté lui ont fait refuser la Légion d’honneur qui lui avait été proposée par Napoléon III.
<Wikipedia> nous apprend qu’il a adressé, le 23 juin 1870, une lettre au ministre des lettres, sciences et beaux-arts :
« J’ai cinquante ans et j’ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre : quand je serai mort, il faudra qu’on dise de moi : Celui-là n’a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n’est le régime de la liberté »
Après la proclamation de la République le 4 septembre 1870, Gustave Courbet est nommé, le 6, par une délégation représentant les artistes de Paris, « président de la surveillance générale des musées français » : Courbet dirige alors un comité chargé de la sauvegarde des œuvres d’art conservées à Paris et dans les environs.
Cette mesure conservatoire est normale en temps de guerre, et alors que les troupes prussiennes approchent de la capitale.
Je cite encore Wikipedia :
« Le 14, il s’occupe de protéger le musée de Versailles, puis les jours suivants le musée du Luxembourg, les salles du musée du Louvre, le Garde-Meuble. Le 16, débute le siège de Paris. […]
Après les élections complémentaires du 16 avril 1871, il est élu au conseil de la Commune par le 6e arrondissement et délégué aux Beaux-Arts. Le 17 avril 1871, il est élu président de la Fédération des artistes. Il fait alors blinder toutes les fenêtres du palais du Louvre pour en protéger les œuvres d’art, mais aussi l’Arc de Triomphe et la fontaine des Innocents. Il prend des mesures semblables à la manufacture des Gobelins, et fait même protéger la collection d’œuvres d’art d’Adolphe Thiers, dont notamment ses porcelaines de Chine. Il siège à la commission de l’Instruction publique […] avec Jules Vallès »
On constate donc que Gustave Courbet était plutôt enclin à protéger le patrimoine.
La responsabilité qu’on lui fera jouer dans la destruction de la colonne Vendôme est ambigüe et même erronée.
Il est vrai qu’il fait une proposition le 14 septembre 1870. Il rédige, ce jour, une note à l’attention du gouvernement de Défense nationale proposant de « déboulonner la colonne Vendôme » et suggère d’en récupérer une partie du métal pour la Monnaie.
Mais en revanche, il s’insurge en octobre contre le gouvernement qui souhaite abattre la colonne Vendôme, au profit d’une nouvelle statue en bronze à la gloire de Strasbourg, ville annexée : Courbet réaffirme que cette colonne doit être déplacée de la rue de la Paix vers les Invalides et qu’on doit en conserver les bas-reliefs par respect pour les soldats de la Grande Armée.
Et lorsqu’après un appel de Vallès publié le 4 avril dans Le Cri du peuple dans lequel il vilipende le monument, la Commune décide, le 12, sur une proposition de Félix Pyat, d’abattre et non de déboulonner la colonne Vendôme, Courbet ne vote pas cette démolition.
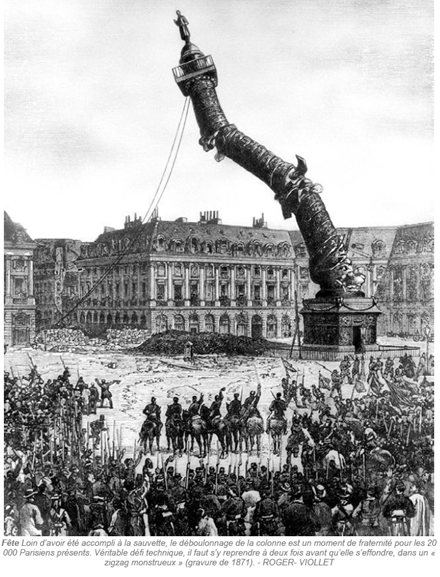 La démolition est prévue pour le 5 mai 1871, jour anniversaire de la mort de Napoléon, mais la situation militaire empêche de tenir ce délai. Finalement, la cérémonie a lieu le 16 mai 1871.
La démolition est prévue pour le 5 mai 1871, jour anniversaire de la mort de Napoléon, mais la situation militaire empêche de tenir ce délai. Finalement, la cérémonie a lieu le 16 mai 1871.
Dans La revue « L’Histoire », c’est l’historien Emmanuel Fureix qui raconte la destruction de la colonne vendôme:
« Abattre la colonne Vendôme revient à affirmer aux yeux de l’Europe entière la « république universelle » et la fraternité des peuples souverains. La place Vendôme est rebaptisée place de l’Internationale. L’iconoclasme devient alors le signal d’un nouvel ordre international à bâtir. […] L’abattage de la colonne vient aussi venger la mémoire des morts, celle de tous les soldats citoyens tombés au nom d’une cause jugée vaine.
Félix Pyat écrit : « La colonne représente la mort de 4 millions d’hommes sacrifiés au dieu de la guerre et à la gloire de trois invasions », et, le 16 mai, un citoyen présent place Vendôme lui fait écho : « On dit cette colonne de bronze, allons donc ! Elle est faite d’ossements humains. Aussi allons-nous assister à une chute d’os. » »
Cette destruction devient une véritable cérémonie, une fête à laquelle les communards viennent en foule :
« La colonne Vendôme n’est pas détruite à la sauvette, dans l’obscurité de la nuit : le déboulonnage est un spectacle, une fête de souveraineté offerte à la face du monde. Le chantier de démolition, complexe, est confié à un ingénieur, Paul Iribe, et, le 16 mai, environ 20 000 Parisiens se pressent pour assister au déboulonnage du « jean-foutre Bonaparte ». La Marseillaise et Le Chant du départ sont entonnés. Un cabestan cède, il faut s’y reprendre à deux fois mais, en fin d’après-midi, la colonne s’effondre en un « zigzag monstrueux », soulevant un « nuage de poussière » raconte Maxime Vuillaume. L’effigie de Napoléon chute sur un lit de fumier et de fagots, la tête détachée du tronc. Certains lui jettent des coups de pied et des crachats. « De près, que sa figure est vilaine et laide », écrit Élie Reclus. Mais « un gouvernement qui a le toupet de foutre en bas Napoléon, ça doit être un gouvernement fort ! » s’exclame un communard. Le piédestal est orné de quatre drapeaux rouges et des échelles permettent aux citoyens de se l’approprier. Dans tous ces gestes se lit le désir de se dire souverain. Se joue aussi une lente « reconquête de la ville par la ville », observée par l’historien Jacques Rougerie. »
La Commune a longtemps été associée à des actes de vandalisme. Mais cet iconoclasme doit se comprendre davantage comme un instrument de guerre contre Versailles.
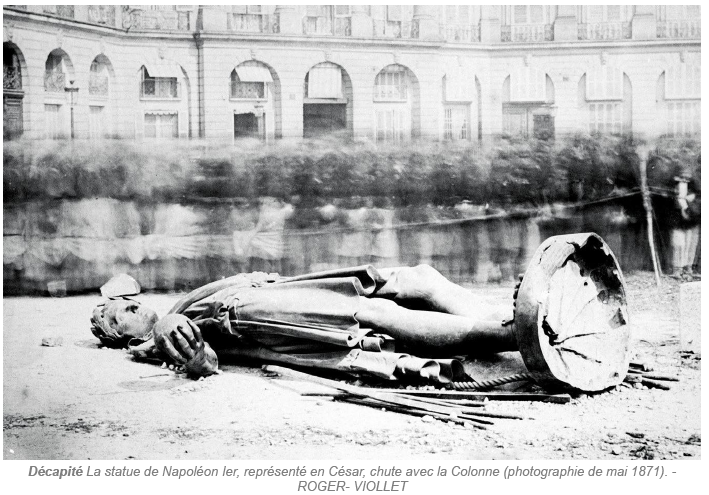
« Hier, 26 floréal [16 mai 1871], l’arrêt de la justice du peuple a été exécuté. La colonne est tombée à cinq heures trois quarts. […] Il ne reste plus qu’un monceau de miettes : la colonne est broyée, le drapeau tricolore enseveli, le César, décapité, gît sur du fumier. »
Le journal communard Le Réveil du peuple
Un désaccord plus important entre Courbet et la commune va conduire à sa démission :
« Courbet démissionne de ses fonctions le 24 mai 1871, protestant contre l’exécution par les Communards de son ami Gustave Chaudey qui, en tant que maire-adjoint, est accusé d’avoir fait tirer sur la foule le 22 janvier 1871 (fait qui n’a, en réalité, jamais été prouvé. » (Wikipedia)
 Après la Semaine sanglante, il est arrêté le 7 juin 1871 et emprisonné à la Conciergerie puis à Mazas.
Après la Semaine sanglante, il est arrêté le 7 juin 1871 et emprisonné à la Conciergerie puis à Mazas.
Dès le début de son incarcération, la presse lui reproche la destruction de la colonne ; Courbet rédige alors une série de lettres à différents élus dans lesquelles il « s’engage à la faire relever à ses frais, en vendant les 200 tableaux qui [lui] reste » : cette proposition, il va la regretter.
Il sera condamné à six mois de prison fermes et à 500 francs puis il devra encore régler 6 850 francs de frais de procédure.
Certains écrivains lui expriment des injures d’une grande violence. Ainsi, Alexandre Dumas fils écrira
« De quel accouplement fabuleux d’une limace et d’un paon, de quelles antithèses génésiaques, de quel suintement sébacé peut avoir été générée cette chose qu’on appelle Gustave Courbet ? Sous quelle cloche, à l’aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et d’œdème flatulent a pu pousser cette courge sonore et poilue, ce ventre esthétique, incarnation du Moi imbécile et impuissant ».
En mai 1873, le nouveau président de la République, le maréchal de Mac Mahon, décide de faire reconstruire la colonne Vendôme aux frais de Courbet (soit 323 091,68 francs selon le devis établi). La loi sur le rétablissement de la colonne Vendôme aux frais de Courbet est votée le 30 mai 1873. Il est acculé à la ruine, ses biens mis sous séquestre, ses toiles confisquées.
Il s’exilera en Suisse où il mourra 4 ans plus tard.
Par solidarité avec ses compatriotes exilés de la Commune de Paris, Courbet refusa toujours de retourner en France avant une amnistie générale. Sa volonté fut respectée, et son corps fut inhumé à La Tour-de-Peilz le 3 janvier 1878, après sa mort survenue le 31 décembre 1877
Sa dépouille a été transférée en juin 1919 à Ornans. Il était né 100 ans avant, le 10 juin 1819 dans cette ville du département du Doubs.
<1545>
-
Lundi 29 mars 2021
« Malgré toutes les hontes de la Commune, j’aime mieux être avec ces vaincus qu’avec [leurs] vainqueurs. »Louis Nathaniel RosselLa commune fut l’histoire de femmes et d’hommes qui se sont retrouvés d’abord parce qu’ils n’acceptaient pas la défaite contre les troupes de Bismarck, ensuite parce qu’au sein d’eux et venant d’univers ou d’écoles de pensées différentes, une haute conscience des inégalités au sein de la société était présente.
Il me parait utile d’évoquer certaines de ces figures.
Dans le numéro de « L’histoire » de janvier 2021, plusieurs fois cité, l’historien Michel Winock a évoqué l’un d’eux « Louis Rossel : Portrait d’un rebelle ».
Son article commence ainsi :
« De tous les communards le colonel Louis Rossel est le plus flamboyant, le plus inattendu, le plus scandaleux aux yeux de ses pairs. Son adhésion à la révolution de 1871 a son origine directe dans la reddition, le 27 octobre 1870, du maréchal Bazaine à Metz, livrant aux Prussiens plus de 170 000 hommes et près de 1 600 canons. »
Michel Winock rapporte que trois jours plus tard il publie un article dans L’Indépendance belge :
« Metz est rendu : la plus honteuse capitulation que l’histoire militaire ait jamais enregistrée a mis aux mains des Allemands une forteresse intacte, gardée par une armée intacte, et dans cet éclatant désastre de l’honneur militaire français, aucune apparence même n’a été sauvée. »
Michel Winock nous révèle, à travers le jugement de Louis Rossel, une autre analyse de la défaite militaire française :
« Le capitaine Rossel avait tenté de tout mettre en œuvre pour éviter la capitulation. Mais il n’avait pas été en mesure de renverser l’avis majoritaire des généraux en place, réfractaires à la république et inspirés par la réaction politique plus que par la défense de la patrie. »
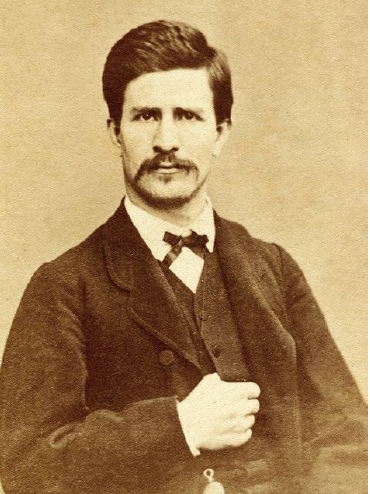 Dans cette vision, les officiers préféraient la défaite à se battre pour une France dirigée par la République. Dans un premier temps, ces officiers ont vu leur désir se réaliser : la défaite militaire a amené une majorité monarchiste à l’Assemblée. Ce sont les contradictions internes des monarchistes qui leur ont interdit une nouvelle restauration et ont finalement permis la naissance de la 3ème République.
Dans cette vision, les officiers préféraient la défaite à se battre pour une France dirigée par la République. Dans un premier temps, ces officiers ont vu leur désir se réaliser : la défaite militaire a amené une majorité monarchiste à l’Assemblée. Ce sont les contradictions internes des monarchistes qui leur ont interdit une nouvelle restauration et ont finalement permis la naissance de la 3ème République.
Rossel est décidé à se battre jusqu’au bout contre l’envahisseur et propose ses services à Gambetta, qui dirige depuis octobre la délégation du gouvernement à Tours où il a reconstitué trois armées. Gambetta est un des membres du gouvernement qui souhaitait continuer la guerre. Il a de l’admiration pour l’homme politique et le tribun mais se désole de son incompétence en stratégie militaire. Il dit de lui :
« C’est un drapeau plutôt qu’un chef »
Alors, quand il apprend le 19 mars 1871, l’insurrection parisienne de la veille, Rossel décide de rejoindre ceux qui veulent continuer à se battre et d’abandonner ceux qui acceptent ou pire préfèrent la défaite.
Il envoie le 19 mars 1871 sa lettre de démission au ministre de la Guerre :
« J’ai l’honneur de vous informer que je me rends à Paris pour me mettre à la disposition des forces gouvernementales qui peuvent y être constituées. Instruit par une dépêche de Versailles rendue publique aujourd’hui qu’il y a deux partis en lutte dans le pays, je me range sans hésitation du côté de celui qui n’a pas signé la paix et qui ne compte pas dans ses rangs de généraux coupables de capitulation. »
Un ordre d’arrestation est immédiatement lancé contre lui, il est menacé du Conseil de guerre.
Rossel rejoint Paris le 20 mars.
Le général de De Gaulle avait une profonde admiration pour ce colonel.
Natacha Polony dans une courte vidéo d’hommage <De la Commune gardons le souvenir de Louis Rossel> commence son intervention par une anecdote : Michel Debré accompagnait le général de Gaulle dans une visite du fort d’Issy
Il faut savoir que la bataille du fort d’Issy est une de celle qui a été déterminante pour la victoire des Versaillais. Elle se déroule du 25 avril au 8 mai 1871 et se termine par la victoire des Versaillais qui se rendent maîtres du fort.
Et donc lors de la visite du fort d’Issy, Debré demanda à De Gaulle « Finalement que reste -il de la Commune ? » et le général lui répondit « Il reste le colonel Louis Rossel »
De Gaulle admirait bien sur le refus de la défaite et la volonté de trouver toutes les solutions pour continuer la lutte.
Contrairement à beaucoup de communards, Louis Nathaniel Rossel n’était pas anti-religieux : il est chrétien, protestant. Bien que né à Saint Brieuc où son père militaire aussi avait été affecté, il est issu d’une famille bourgeoise protestante nîmoise, et descendant de camisards cévenols.
Il n’a donc pas comme point commun l’anticléricalisme des autres communards. Mais il partage avec eux une autre aspiration que le refus de la défaite : il possède une fibre sociale très développée. Natacha Polony insiste sur ce point. En 1867, il se lie d’amitié avec Jean Macé, qui crée la Ligue de l’enseignement. Rossel commence l’enseignement de cours de grammaire aux classes défavorisées et s’engage pour l’école laïque. C’est ici qu’il a ses premiers véritables contacts avec des ouvriers. Il découvre la société de classes :
« Pourquoi, lorsque l’égalité est inscrite partout dans nos droits, lorsque l’égalité est un de nos premiers besoins, sommes-nous forcés de reconnaître qu’il y a dans l’État deux classes comme au temps du privilège, deux classes profondément distinctes et d’un autre côté profondément mêlées ? »
L’instruction lui paraît le premier remède.
Il est très brillant : admis à dix-huit ans à l’École polytechnique avec le n° 79 et en sortit 12e sur une promotion de 131.
Arrivé à Paris, on lui donne immédiatement un rôle de première importance dans l’organisation de l’armée de la commune.
Michel Winock écrit :
« Pendant la dizaine de jours où il dirige les forces armées de la Commune, Rossel fait preuve de remarquables qualités d’organisateur, de stratège, mais, simultanément, il ne comprend pas la nature de cette révolution parisienne. Il reste un soldat ; les fédérés, eux, sont des révolutionnaires, réfractaires au commandement central. Il y a un style Rossel – mélange de raideur et d’humour, de rigueur et d’insolence – qui, d’emblée, ne plaît pas à tout le monde. »
Mais il est exaspéré par le manque de discipline de ses soldats et le manque de rigueur du comité central de la garde nationale qui dirige Paris.
Après la prise du fort d’Issy par l’armée de Versailles le 8 mai, Rossel fait placarder le 9 sur les murs de Paris, et sans avertir la Commune, une affiche déclarant la perte du fort.
« Le drapeau tricolore flotte sur le fort d’Issy, abandonné hier par sa garnison. »
Puis il écrit une lettre de démission adressée à la Commune :
« Citoyens membres de la Commune, chargé par vous à titre provisoire de la délégation à la Guerre, je me sens incapable de porter plus longtemps la responsabilité d’un commandement où tout le monde délibère et où personne n’obéit. […] Sachant que la force d’un révolutionnaire ne consiste que dans la netteté de la situation, j’ai deux lignes à choisir : briser l’obstacle qui entrave mon action, ou me retirer. Je ne briserai pas l’obstacle ; car l’obstacle, c’est vous et votre faiblesse ; je ne veux pas attenter à la souveraineté publique. Je me retire, et j’ai l’honneur de vous demander une cellule à Mazas. »
Il va être arrêté par d’autre communards qui veulent le traduire en cour martiale. Mais il parvient à s’enfuir et à se cacher quelques temps.
Michel Winock raconte la suite :
« Il est arrêté sur une dénonciation, après la Semaine sanglante, le 7 juin 1871, et envoyé à Versailles où il est jugé par un conseil de guerre, pour avoir déserté et « porté les armes contre la France ». En dépit du soutien actif de ses parents, de ses avocats, d’une petite partie de la presse, d’une pétition de polytechniciens, Rossel est condamné à mort ; le 25 novembre, […] il est exécuté le 28 novembre malgré une campagne en sa faveur lancée notamment par Victor Hugo. […] Tout au long de sa détention, Louis Rossel n’a cessé d’écrire, laissant notamment un mémoire sur son rôle pendant la Commune. Il y expose ses idées politiques. A aucun moment il ne regrette son engagement. Il dit son estime pour un certain nombre de ses dirigeants, Jourde, Paschal Grousset, Delescluze, Varlin. Il rend hommage aux combattants de la Semaine sanglante, plus à l’aise derrière les barricades que dans les rangs d’une armée disciplinée. « Malgré toutes les hontes de la Commune, j’aime mieux être avec ces vaincus qu’avec [leurs] vainqueurs. » Républicain, il n’est pas socialiste, mais il a rencontré l’injustice sociale. Il a constaté l’état misérable de la population ouvrière : « Parmi les bataillons que j’avais l’honneur de commander, certains étaient affligeants à voir. […] En passant devant ces malheureux, je me disais : ces gens ont raison de se battre. Ils se battent pour que leurs enfants soient moins chétifs, moins scrofuleux, moins vicieux qu’ils ne sont eux-mêmes. »
Vous trouverez une biographie sur le site <Maitron> et aussi sur ce blog consacré aux protestants bretons.
Deux films furent consacrés à Rossel :
- Le premier en 1966 par Roger Stéphane : « Le destin de Rossel »
- Le second en 1977 par Serge Moati et Jean-Pierre Chevènement « Rossel et la Commune »
Enfin une chanson lui a été consacrée <La complainte de Rossel>
Louis Nathaniel Rossel est mort sous les balles des versaillais à 27 ans
<1544>
- Le premier en 1966 par Roger Stéphane : « Le destin de Rossel »
-
Vendredi 26 mars 2021
« On a d’un côté la légende noire des Versaillais pour qui les communards étaient des fous furieux et, de l’autre, la légende rouge pour la gauche qui en fait une récupération politique »Michel CordillotCertains prétendent que le clivage droite, gauche est obsolète. On peut se demander par quel clivage, il est remplacé :
- Ecologiste et climatosceptique ?
- Identitaire et universaliste ?
- Islamophobe et islamo gauchiste ?
Pourtant la mémoire de la Commune ravive totalement le clivage droite-gauche. La droite de l’ordre et la gauche de la justice sociale s’affrontent, chacun considérant que l’autre est le criminel. Il y eut des crimes des deux côtés, mais les versaillais ont tué davantage que les communards.
Les versaillais et les otages exécutés par les communards représentent moins de 1000 morts. Il semble qu’un consensus large accepte cette évaluation.
Mais pour les fédérés, on ne le sait pas.
Dans une chanson que je n’ai pas cité mercredi « Elle n’est pas morte», Eugène Pottier écrit :
« Les Versaillais ont massacré pour le moins cent mille hommes. »
C’est une belle chanson, mais sur ce point elle exagère beaucoup, il n’y a pas eu 100 000 morts.
Les estimations ont fluctué. <Wikipedia> raconte cette évolution :
« En 1876, le journaliste et polémiste socialiste Prosper-Olivier Lissagaray, ancien communard, estime de 17 000 à 20 000 le nombre des fusillés. En 1880, le journaliste et homme politique Camille Pelletan, membre du Parti radical-socialiste situe le nombre des victimes à 30 000. En 2014, l’historien britannique Robert Tombs revoit le bilan à la baisse et évalue entre 5 700 et 7 400 le nombre des morts, dont environ 1 400 fusillés. »
 La mathématicienne et écrivaine Michèle Audin a publié cinq livres sur la Commune. Michèle Audin est la fille du mathématicien Maurice Audin mort sous la torture par l’armée française lors de la guerre d’Algérie et de la professeure de mathématiques Josette Audin.
La mathématicienne et écrivaine Michèle Audin a publié cinq livres sur la Commune. Michèle Audin est la fille du mathématicien Maurice Audin mort sous la torture par l’armée française lors de la guerre d’Algérie et de la professeure de mathématiques Josette Audin.Elle vient de publier « la semaine sanglante ». Elle s’est lancée dans une nouvelle évaluation. Elle explique sa méthode dans cet article du Monde du 18 mars 2021 : « On a trouvé des ossements de communards dans le sous-sol de Paris jusque dans les années 1920 »
Son estimation s’élève à plus de 15 000 morts.
Les communards ont aussi détruit des monuments de Paris, le plus grand nombre lors de la semaine sanglante. Ils ont démoli l’hôtel particulier de Thiers, le chef de leurs ennemis. Cet hôtel situé place Saint-Georges, fut détruit le 11 mai 1871, en représailles au bombardement de Paris par l’armée versaillaise
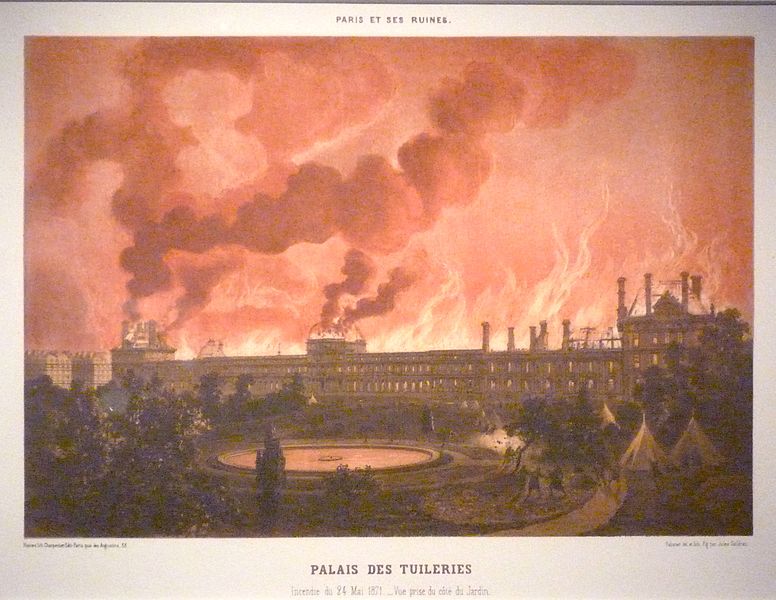 Ils ont aussi abattu, le 16 mai, la colonne de la place Vendôme qui était surmontée par la statue de Napoléon.
Ils ont aussi abattu, le 16 mai, la colonne de la place Vendôme qui était surmontée par la statue de Napoléon.
Et le palais des Tuileries, palais des rois et de l’empereur fut incendié lors de la semaine sanglante.
Et il y eut d’autres bâtiments incendiés comme l’Hôtel de Ville, le Palais de justice, dont cependant la Sainte-Chapelle et la Cour de cassation échappent aux flammes, le palais d’Orsay où siègent le Conseil d’État et la Cour des comptes, le palais de la Légion d’honneur, le Palais-Royal et d’autres encore.
Après ces rappels, revenons au clivage droite, gauche d’aujourd’hui !
<Le Figaro> essaie de rapporter, en toute neutralité, le débat qu’il y a eu au conseil de la commune de Paris en février :
« Elle a beau avoir 150 ans, la Commune de Paris suscite toujours les passions, et sa mémoire reste conflictuelle. En février, au Conseil de Paris, la mise au vote d’une subvention à l’association les Amis de la Commune, destinée aux événements imaginés par la mairie autour de cet anniversaire, a provoqué une passe d’arme entre la majorité et l’opposition. Tandis que Laurence Patrice, adjointe PC chargée de la mémoire, proposait de célébrer « la révolution la plus moderne » qui soit, elle s’est attirée les foudres de Rudolph Granier, élu LR dans le 18e arrondissement – lequel a estimé qu’on ne devait pas «danser au son des meurtres et des incendies». »
Mais j’aime particulièrement la description que fait <cet article du monde> :
« Ce mercredi 3 février, le couvre-feu est déjà passé, le Conseil de Paris commencé la veille s’étire depuis des heures, et les élus n’ont qu’une envie : voter rapidement les dernières délibérations, puis rentrer. L’ordre du jour, quelques subventions et hommages, semble consensuel. Mais soudain, Rudolph Granier prend le micro et réveille l’hémicycle. Parmi les vingt-sept associations à subventionner, il en est une à laquelle son parti, Les Républicains (LR), ne veut pas accorder un centime : les Amies et amis de la Commune de Paris 1871. Cette association coprésidée par un ancien dirigeant communiste « glorifie les événements les plus violents de la Commune », peste-t-il.
M. Granier évoque « les incendies de la Commune qui ont ravagé des pans entiers de la capitale », et accuse la maire socialiste, Anne Hidalgo, d’« ânonner » à ce sujet « une série de contre-vérités historiques » dans le seul but de ressouder les socialistes, les communistes et les écologistes, en vue de son « projet présidentiel ». Celui-ci « rassemblera certainement moins de personnes que les dix millions de Français qui ont participé à la souscription nationale pour l’édification du Sacré-Cœur », ajoute l’élu LR.
Patrick Bloche, l’adjoint socialiste d’Anne Hidalgo, qui préside la séance, ponctue cette diatribe d’une phrase : « Ce qui me rassure, c’est que je crois au clivage entre la gauche et la droite, et vous l’avez illustré parfaitement, cent cinquante ans après la Commune. » Entre les deux camps, la joute verbale se poursuit près d’une heure. »
Un autre élu de droite, Antoine Beauquier, élu du 16e arrondissement ne veut pas qu’on transforme en héros :
« ceux qui prirent en otage et assassinèrent les dominicains d’Arcueil venus ramasser les blessés sous l’emblème de la Croix-Rouge »
Et il pose cette question à la municipalité de gauche :
« Pourrez-vous encore dénoncer les casseurs après avoir honoré en grande pompe ceux qui ont choisi de brûler les Tuileries, le Palais-Royal, le palais d’Orsay, les synagogues et notre hôtel de ville ? »
David Alphand (LR) lui dénonce une autre action de la commune qui le hérisse : « La confiscation des moyens de production. »
Bref, un vrai combat gauche-droite, comme au bon vieux temps.
<La Croix> qui relate aussi cette passe d’armes rapporte les paroles Laurence Patrice, adjointe chargée de la mémoire :
« Ce n’est pas une glorification mais un hommage à des femmes et des hommes qui portaient des valeurs dont les forces de gauche sont les héritières »
La commune de Paris célèbre, en effet < les figures de la Commune>
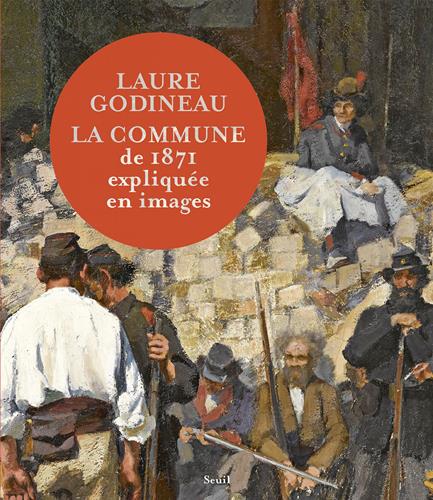 Et la Croix cite l’historienne Laure Godineau, qui publie « La Commune de 1871 expliquée en images » (Seuil) qui explique :
Et la Croix cite l’historienne Laure Godineau, qui publie « La Commune de 1871 expliquée en images » (Seuil) qui explique :
« Si l’événement reste mal connu, c’est en partie parce que la construction républicaine après 1871 en a voulu l’oubli : oubli de la guerre civile dans le cadre d’une réconciliation nationale ; oubli de l’insurrection alors que s’affirmait une République éloignée des idéaux des communards […] La Commune n’a pas été intégrée à notre histoire nationale et à notre mémoire collective, ce qui a laissé une grande place à des mémoires conflictuelles […] D’un côté, le souvenir d’un mouvement émancipateur, politiquement et socialement, et des milliers de morts de la répression ; de l’autre, des incendies et des otages. »
Et il est vrai que dans mes livres d’Histoire je n’ai pas beaucoup de souvenirs d’une histoire de la Commune.
Il faut rappeler, peut-être, qu’à côté d’Adolphe Thiers, il y avait dans le gouvernement des figures qui sont restés célèbres pour d’autres faits historiques. L’un des plus virulents soutien de Thiers était Jules Ferry. Il y avait aussi Jules Grévy qui évoque « un gouvernement factieux », Jules Favre « une poignée de scélérats » et Léon Gambetta qui approuva Thiers.
Le journal <La nouvelle République> qui relate aussi cet épisode évoque une autre pierre d’achoppement : la décision, en octobre, de classer comme monument historique la basilique du Sacré-Cœur, construite pour « expier les péchés » des communards qui avait provoqué l’ire de l’association des Amis de la Commune.
Et il cite l’historien Michel Cordillot autre spécialiste de la commune, coordinateur d’un ouvrage synthétique sur la Commune paru en janvier :
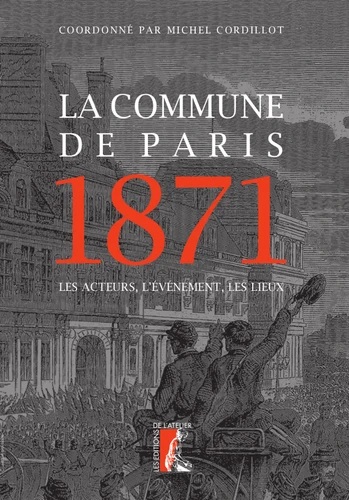 « La Commune est mal connue car elle est d’emblée prisonnière d’enjeux de mémoire. On a d’un côté la légende noire des Versaillais pour qui les communards étaient des fous furieux et, de l’autre, la légende rouge pour la gauche qui en fait une récupération politique […] en 1971, [lors de son centenaire] les affrontements étaient déjà terribles, y compris entre historiens […] Que faut-il alors retenir de cet événement ? L’expérience d’une république sociale, favorable à la démocratie directe, a permis notamment, et pour un bref moment, l’accès au pouvoir des milieux populaires – actuellement sous-représentés parmi les députés de l’Assemblée nationale – le droit de vote pour les femmes ou la laïcité dans l’enseignement, plus de trente ans avant la loi de 1905 concernant la séparation de l’Église et de l’État. Ce sont des mesures extrêmement modernes, qui font consensus aujourd’hui […] la Commune a posé le principe de l’accès au pouvoir des classes subalternes. Avant, ça relevait de l’utopie. Après, ça devient une réalité. Et ça marche ! »
« La Commune est mal connue car elle est d’emblée prisonnière d’enjeux de mémoire. On a d’un côté la légende noire des Versaillais pour qui les communards étaient des fous furieux et, de l’autre, la légende rouge pour la gauche qui en fait une récupération politique […] en 1971, [lors de son centenaire] les affrontements étaient déjà terribles, y compris entre historiens […] Que faut-il alors retenir de cet événement ? L’expérience d’une république sociale, favorable à la démocratie directe, a permis notamment, et pour un bref moment, l’accès au pouvoir des milieux populaires – actuellement sous-représentés parmi les députés de l’Assemblée nationale – le droit de vote pour les femmes ou la laïcité dans l’enseignement, plus de trente ans avant la loi de 1905 concernant la séparation de l’Église et de l’État. Ce sont des mesures extrêmement modernes, qui font consensus aujourd’hui […] la Commune a posé le principe de l’accès au pouvoir des classes subalternes. Avant, ça relevait de l’utopie. Après, ça devient une réalité. Et ça marche ! »
Et <L’Humanité> d’ajouter :
« En 1871, pendant soixante-douze jours, Paris redevient la capitale mondiale du progrès et la citoyenneté. Mais de cela la droite ne veut parler. »
Le site des amies et amis de la Commune : https://www.commune1871.org/ association qui a servi de déclencheur à la bonne vieille dispute entre droite et gauche…
<1543>
- Ecologiste et climatosceptique ?
-
Jeudi 25 mars 2021
« La grande mesure de la Commune, ce fut sa propre existence »Karl MarxPierre Nora prétend que La Commune « n’a pas apporté grand-chose ». J’ai rapporté ces propos lundi.
Dans le numéro de la Revue « L’Histoire » de janvier 2021 que j’ai cité mardi, l’Historien Quentin Deluermoz dans son article « L’impossible République : Gouverner au ras du sol » ne dit pas autre chose :
« L’avis est largement partagé : le bilan concret de la Commune de Paris est mince. Le décret du 20 avril 1871 interdisant le travail de nuit des boulangers est au fond « la seule mesure véritablement socialiste de la Commune », regrettait déjà l’internationaliste Léo Frankel début mai. Les commentateurs et les historiens, qu’ils soient pour ou contre la Commune, ont ensuite évoqué un « brouillon » pour les idéologies à l’œuvre, voire une « ébauche maladroite », un système « balbutié ». »
Marx s’est beaucoup intéressé à cette révolution. Il a écrit « La guerre civile en France » terminé fin mai 1871, alors que la commune venait à peine d’être écrasée. Ce livre a été mis en ligne par nos amis canadiens au <format pdf>
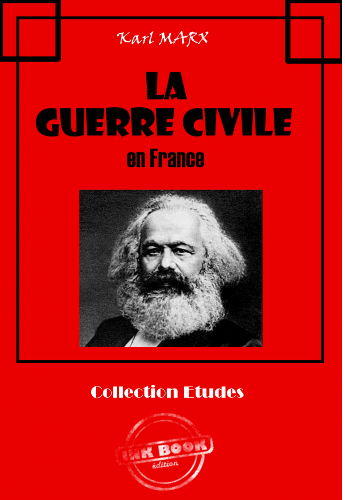 Quentin Deluermoz rapporte les propos que Marx a tenu:
Quentin Deluermoz rapporte les propos que Marx a tenu:
« La grande mesure de la Commune, ce fut sa propre existence ».
L’étonnant c’est en effet que cela a pu exister.
Même si en fin de compte cela a raté.
L’article de la Revue « L’Histoire » donne la liste des réformes que la Commune a entreprises :
- Adoption du drapeau rouge, celui des « travailleurs », à la place du drapeau tricolore jugé trop « bourgeois ».
- Remise générale des loyers des termes d’octobre 1870, janvier et avril 1871.
- Suppression de la vente des objets déposés au Mont-de-Piété.
- Abolition de la conscription.
- École gratuite et obligatoire pour les filles et les garçons.
- Séparation des Églises et de l’État, suppression du budget des cultes.
- Interdiction du cumul, fixation du maximum des traitements à 6 000 francs par an.
- Fixation des émoluments des membres de la Commune à 15 francs par jour.
- Traitement des instituteurs et institutrices à 2 000 francs.
- Suppression de la catégorie « illégitimes » pour les enfants nés hors mariage et reconnaissance des unions libres.
- Suppression du travail de nuit dans les boulangeries.
On peut quand même noter des réformes très modernes qui vont être reprises un peu plus tard par la IIIème République :
- L’école gratuite
- La Séparation de l’église et de l’état
- L’abolition de la bâtardise, c’est-à-dire du statut infamant et inférieur des enfants nés hors mariage
Ce n’est pas rien, d’avoir ainsi ouvert des voies vers une plus grande justice.
La Commune a aussi donné une bien plus grande place aux femmes que celle que leur accordait la société qui l’a combattue.
Quentin Deluermoz écrit : :
« En soixante-douze jours, le gouvernement de la Commune a soulevé de grands espoirs, mais son bilan est nuancé. »
Mais c’est très court 72 jours. Et puis cette période ne s’est pas passée dans la sérénité mais dans la violence et la guerre que les communards ont eut à affronter contre les versaillais.
La commune avait aussi d’autres projets quelle n’a pas même pas pu mettre en œuvre :
- Réorganisation de la justice : gratuite et rendue par des jurys élus.
- Attribution des ateliers abandonnés par les patrons « déserteurs » aux associations ouvrières.
- Élection des fonctionnaires.
- Un crédit industriel et ouvrier.
Quentin Deluermoz insiste sur deux points : l’enseignement et la libération de la parole.
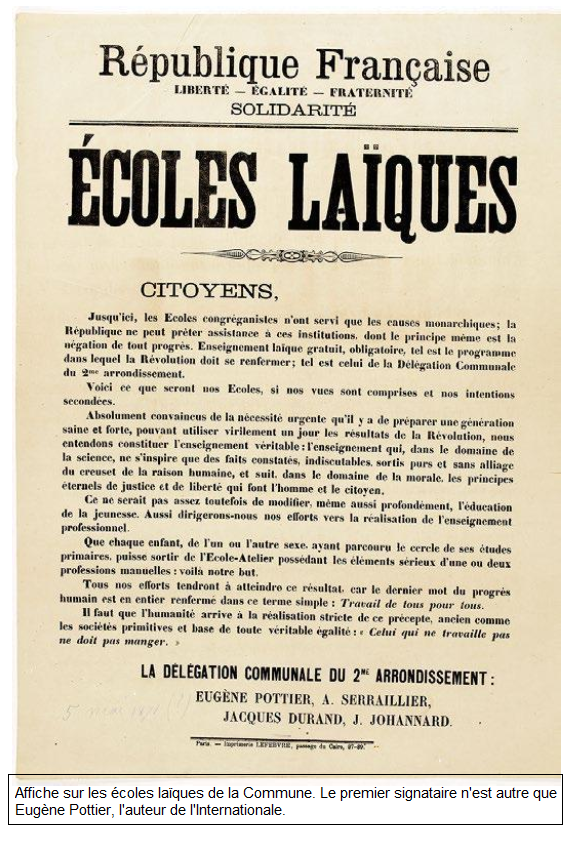 L’enseignement devait être laïque :
L’enseignement devait être laïque :
« Ainsi de l’enseignement sous l’égide des municipalités : remplacement des congréganistes par des instituteurs laïques dans le IIIe arrondissement, multiplication des écoles de filles dans le XVIIe. Mieux : une autre conception pédagogique est alors défendue, celle de l’« éducation intégrale », à la fois professionnelle et intellectuelle. Les objectifs généraux de cette « éducation communale » sont fréquemment rappelés, comme sur cette affiche du IVe arrondissement : « Apprendre à l’enfant à aimer et à respecter ses semblables. Lui inspirer l’amour de la justice ; lui enseigner également qu’il doit s’instruire en vue de l’intérêt de tous. »
La libération de la parole est aussi un grand moment de modernité qui s’accompagne d’un mouvement anti-clérical qui deviendra le combat des radicaux de la IIIème république :
« La « République de Paris » est aussi un moment de libération de la parole. Critiques, attentes, projets, espoirs des Parisiens, notamment des plus fragiles, s’expriment d’une manière inédite. La multiplication des titres de presse, des placards, des affiches, en témoigne : « Nous voulons affranchir le prolétariat, que chacun vive de son travail ; plus de paresseux, plus de parasites, plus d’exploiteurs, plus d’exploités, vivre en travaillant ou mourir en combattant » (avis de la délégation communale du Ier arrondissement, 13 avril) ; « Montrons que nous sommes les dignes fils de 1789 » (appel d’un commandant de la Garde nationale, 20 mars).
Les clubs sont un autre lieu essentiel de cette parole libérée. Les participants y discutent tour à tour de la guerre, de la haine des curés et des propriétaires, de la fin de la misère, de l’harmonie espérée ou du souvenir du coup d’État de 1851. Un certain nombre de clubs se sont installés dans les églises. Dans le cadre d’un mouvement très anticlérical, les bâtiments sont parfois mis à mal. La signification de ces appropriations doit être bien comprise : il s’agit-rien de moins que remplacer l’exercice d’une parole divine, venue d’en haut, par celui d’une parole démocratique et populaire. Ce faisant, les communards sécularisent l’espace urbain et constituent, à partir de l’ancien, des lieux « autres » dans la ville.»
Il y a enfin une aspiration vers une démocratie plus directe et plus proche du terrain. Ainsi les bataillons de la Garde nationale élisent directement leur chef.
La commune prône aussi le mandat impératif, qui oblige les élus à rendre des comptes et les rend révocables à tout instant.
L’historien Jacques Rougerie qui a écrit de nombreux ouvrages sur la commune évoque la volonté « d’être son propre maître » et une « aspiration profonde du peuple de Paris, du moins d’une majorité […], à une démocratie vraie ».
Et pour en revenir à Marx, dans son ouvrage cité, il pensait que la commune était la prémisse de la révolution communiste, une première tentative de prise de pouvoir par la classe ouvrière.
La commune fut d’ailleurs la première à utiliser le drapeau rouge comme symbole.
Mais la pensée de Marx sur la Commune allait évoluer et probablement un peu en raison de sa confrontation avec certains d’entre eux.
D’abord plein de bonnes intentions à l’égard des vaincus, il se heurta bientôt à la part anarchiste d’un certain nombre de communards.
Dans la revue « L’histoire » Michel Cordillot raconte :
« Au cours des mois qui suivent environ 2 000 communards rescapés arrivent à Londres, souvent dans le plus grand dénuement. Marx joue un rôle essentiel au sein du Comité d’aide aux réfugiés pour récolter des secours et leur trouver du travail. Mais, alors que les dissensions s’aggravent au sein de l’Internationale, il est pris à partie, parfois même accusé d’avoir détourné des fonds ou d’être un complice de Bismarck. Après la conférence de Londres (septembre 1871) et plus encore après le congrès de La Haye (septembre 1872) à l’issue duquel la rupture avec les anti-autoritaires est consommée, ses relations avec la plupart des anciens communards deviennent exécrables sur fond de désaccords politiques et stratégiques. Avec le transfert du Conseil général à New York, la longue agonie de l’Internationale commence, ce qui va permettre à Marx de prendre du recul pour mieux se consacrer à ses travaux théoriques. La lettre adressée par Engels à leur ami américain Friedrich Sorge à la mi-septembre 1874 reflète la lassitude que Marx et lui éprouvent : « L’émigration française est tout à fait divisée […]. Ces gens-là veulent tous vivre sans travailler vraiment, ont la tête pleine de prétendues inventions qui rapporteront des millions […]. La vie irrégulière qu’ils ont menée pendant la guerre, la Commune et l’exil a fait perdre tout sens moral à ces gens. »
Dix ans après la Commune, Marx voit la Commune avec un autre regard :
Dans une lettre citée par Cordillot et qu’il adresse à Ferdinand Domela Nieuwenhuis le 22 février 1881, il dresse d’abord ce constat :
« Outre qu’elle fut simplement la rébellion d’une ville dans des circonstances exceptionnelles, la majorité de la Commune n’était nullement socialiste et ne pouvait pas l’être. »
Et il ajoute :
« Avec un tout petit peu de bon sens, elle eût pu cependant obtenir de Versailles un compromis favorable à toute la masse du peuple, ce qui était la seule chose possible alors. »
Michel Cordillot suggère donc que Marx semble en être arrivé à la conclusion que la Commune n’avait pas été la révolution ouvrière ouvrant la voie à l’extinction du capitalisme telle qu’il l’avait imaginée.
Cela ne rend que plus pertinent le jugement précédent qu’il avait porté : « La grande mesure de la Commune, ce fut sa propre existence »
<1542>
- Adoption du drapeau rouge, celui des « travailleurs », à la place du drapeau tricolore jugé trop « bourgeois ».
-
Mercredi 24 mars 2021
« Ils se levèrent pour la Commune, en écoutant chanter Pottier. Ils faisaient vivre la Commune en écoutant chanter Clément »Jean FerratLa commune est restée dans l’imaginaire des français et même au-delà. Elle l’est restée parce que de nombreux livres lui ont été consacrés depuis 150 ans.
Et aussi en raison d’un grand nombre de chants qui ont été composés pour la commune du temps de celle-ci ou qu’elle a inspirés depuis.
Ces chansons ont fait l’Histoire. L’émotion, la destinée et la force de ces chansons me font toujours vibrer.
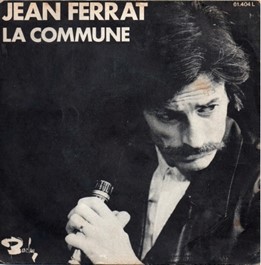 Pour entrer dans ce monde, je vais commencer par la chanson que Jean Ferrat a composé pour les cent ans de la commune en 1971 : <La commune>
Pour entrer dans ce monde, je vais commencer par la chanson que Jean Ferrat a composé pour les cent ans de la commune en 1971 : <La commune>
Cette chanson qui magnifie les femmes et les hommes qui ont participé à cet épisode « Comme un espoir mis en chantier ».
Dans cette chanson dont il a écrit la musique mais dont les paroles sont de Georges Coulonges, il y a ce refrain
« Il y a cent ans commun commune
Comme un espoir mis en chantier
Ils se levèrent pour la Commune
En écoutant chanter Pottier
Il y a cent ans commun commune
Comme une étoile au firmament
Ils faisaient vivre la Commune
En écoutant chanter Clément »
L’intégralité du texte se trouve derrière <ce lien>
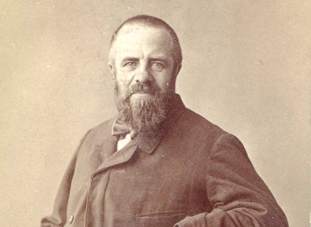 Il est d’abord question d’«Eugène Pottier » l’auteur de « L’internationale » ce magnifique chant révolutionnaire qui a été chanté tant de fois par des millions d’êtres humains qui rêvaient et espéraient un monde meilleur et qui aussi a été souillé par des criminels qui ont trahi ces aspirations après la prise de pouvoir des bolcheviques et de leurs affidés :
Il est d’abord question d’«Eugène Pottier » l’auteur de « L’internationale » ce magnifique chant révolutionnaire qui a été chanté tant de fois par des millions d’êtres humains qui rêvaient et espéraient un monde meilleur et qui aussi a été souillé par des criminels qui ont trahi ces aspirations après la prise de pouvoir des bolcheviques et de leurs affidés :
« Ouvriers, Paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs ;
La terre n’appartient qu’aux hommes,
L’oisif ira loger ailleurs.
Combien de nos chairs se repaissent !
Mais si les corbeaux, les vautours,
Un de ces matins disparaissent,
Le soleil brillera toujours !C’est la lutte finale
Groupons-nous, et demain,
L’Internationale,
Sera le genre humain. »
L’intégralité du texte se trouve derrière <ce lien> et vous trouverez ici une interprétation passionnée de <Marc Ogeret>
« L’internationale » est une chanson de la Commune créée par Eugène Pottier qui était un communard, juste après la semaine sanglante. Lorsque la France déclare la guerre à la Prusse en juillet 1870, Pottier est signataire du manifeste de la section parisienne de l’Internationale dénonçant la guerre. Membre de la garde nationale, il participe aux combats durant le siège de Paris de 1870, puis il prend une part active à la Commune de Paris, dont il est élu membre pour le 2e arrondissement. Il siège à la commission des Services publics. Il participe aux combats de la Semaine sanglante. En juin 1871, caché dans Paris, il compose son poème L’Internationale et se réfugie en Angleterre. Condamné à mort par contumace le 17 mai 1873, il s’exile aux États-Unis, d’où il organise la solidarité pour les communards déportés.
Eugène Pottier était né en 1816 à Paris. Il est d’abord dessinateur sur étoffes et compose sa première chanson, Vive la Liberté, en 1830. Il participe à la Révolution de 1848.
Ruiné et à demi paralysé, il reviendra de son exil américain, après l’amnistie de 1880 et meurt le 6 novembre 1887 à Paris.
 Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (95e division) à Paris.
Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (95e division) à Paris.
Mais il a écrit bien d’autres chansons. En 1870 : <Quand viendra t’elle ?> :
« La guerre est cruelle,
L’usurier pressant.
L’un suce ma moelle,
L’autre boit mon sang.
Ah ! je l’attends, je l’attends!
L’attendrai-je encor longtemps? »
L’intégralité du texte se trouve derrière <ce lien>
Et puis en 1880 avec une musique de Pierre Deteyger, une chanson toute entière dédiée à la Commune : <L’insurgé>
« En combattant pour la Commune
Il savait que la terre est Une,
Qu’on ne doit pas la diviser,
Que la nature est une source
Et le capital une bourse
Où tous ont le droit de puiser. »
L’intégralité du texte se trouve derrière <ce lien>
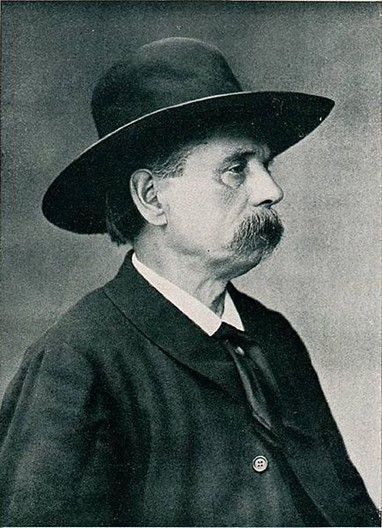 Et Ferrat cite en second « Jean Baptiste Clément » l’inoubliable auteur du « Temps des cerises » :
Et Ferrat cite en second « Jean Baptiste Clément » l’inoubliable auteur du « Temps des cerises » :
« Mais il est bien court, le temps des cerises
Où l’on s’en va deux, cueillir en rêvant
Des pendants d’oreilles…
Cerises d’amour aux roses pareilles,
Tombant sous la feuille en gouttes de sang…
Mais il est bien court, le temps des cerises,
Pendants de corail qu’on cueille en rêvant ! »
L’intégralité du texte se trouve derrière <ce lien>
« Le Temps des cerises » est une chanson intimement liée à l’épisode de la Commune dans l’imaginaire de toutes celles et ceux qui restent émus à l’évocation de cette tragédie. Mais cette chanson précède la commune. Les paroles furent écrites en 1866 par Jean Baptiste Clément et la musique composée par Antoine Renard en 1868.
Jean Baptiste Clément écrivit cette chanson en 1866, lors d’un voyage vers la Belgique. Sur la route des Flandres, il fit une halte à Conchy-Saint-Nicaise. Il fit escale dans la maison située près de l’estaminet du lieu-dit de la poste. La maison entourée de cerisiers anciens inspira l’auteur.
Des années plus tard, en 1882, Jean Baptiste Clément ajouta un couplet à sa chanson. Il la dédie à une ambulancière rencontrée lors de la Semaine sanglante, alors qu’il combattait en compagnie d’une vingtaine d’hommes :
« À la vaillante citoyenne Louise, l’ambulancière de la rue de la Fontaine-au-Roi, le dimanche 28 mai 1871. »
À la fin des paroles, il explicite cette dédicace :
« Puisque cette chanson a couru les rues, j’ai tenu à la dédier, à titre de souvenir et de sympathie, à une vaillante fille qui, elle aussi, a couru les rues à une époque où il fallait un grand dévouement et un fier courage ! Le fait suivant est de ceux qu’on n’oublie jamais : Le dimanche, 28 mai 1871 […]. Entre onze heures et midi, nous vîmes venir à nous une jeune fille de vingt à vingt-deux ans qui tenait un panier à la main. […] Malgré notre refus motivé de la garder avec nous, elle insista et ne voulut pas nous quitter. Du reste, cinq minutes plus tard, elle nous était utile. Deux de nos camarades tombaient, frappés, l’un, d’une balle dans l’épaule, l’autre au milieu du front… […] Nous sûmes seulement qu’elle s’appelait Louise et qu’elle était ouvrière. Naturellement, elle devait être avec les révoltés et les las-de-vivre. Qu’est-elle devenue ? A-t-elle été, avec tant d’autres, fusillée par les Versaillais ? N’était-ce pas à cette héroïne obscure que je devais dédier la chanson la plus populaire de toutes celles que contient ce volume ? »
Jean Baptiste Clément est né en 1836, dans une famille aisée à Boulogne-Billancourt.
Il quitte très jeune le foyer. Il exerce divers métiers manuels puis côtoie, à Paris, des journalistes, écrivant dans des journaux socialistes, notamment « Le Cri du peuple » de Jules Vallès, autre communard célèbre.
Après un séjour en Belgique pour se faire oublier de la police impériale il revient à Paris et collabore à divers journaux d’opposition au Second Empire, tels que « La Réforme » de Charles Delescluze important responsable de la Commune mort sur une barricade le 25 mai 1871. Jean Baptiste Clément est condamné pour avoir publié un journal non cautionné par l’empereur. Il est emprisonné jusqu’au soulèvement républicain du 4 septembre 1870. Membre de la Garde nationale, il participe aux différentes journées de contestation du Gouvernement de la Défense nationale le 31 octobre 1870 et le 22 janvier 1871. Le 26 mars 1871, il est élu au Conseil de la Commune par le XVIIIe arrondissement. Il est membre de la commission des Services publics et des Subsistances. Le 16 avril, il est nommé délégué à la fabrication des munitions, puis, le 21, à la commission de l’Enseignement. Il combat sur les barricades pendant la Semaine sanglante.
Et il écrit peu après une autre chanson très célèbre « La Semaine sanglante » :
« On traque, on enchaîne, on fusille
Tout ce qu’on ramasse au hasard :
La mère à côté de sa fille,
L’enfant dans les bras du vieillard.
Les châtiments du drapeau rouge
Sont remplacés par la terreur
De tous les chenapans de bouge,
Valets de rois et d’empereur.
Oui mais…
ça branle dans le manche,
Ces mauvais jours-là finiront.
Et gare à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront ! »
L’intégralité du texte se trouve derrière <ce lien>
Jean-Baptiste Clément réussit à fuir Paris, gagne la Belgique et se réfugie à Londres, où il poursuit son combat. Il est condamné à mort par contumace en 1874. Pendant cette période de mai 1875 à novembre 1876, il se réfugie clandestinement chez ses parents à Montfermeil. En attendant l’amnistie, prononcée en 1879, il se promène dans les bois et pêche dans les étangs de Montfermeil. Il rentre à Paris après l’amnistie générale de 1880.
En 1885, il fonde le cercle d’études socialiste, l’Étincelle de Charleville et la Fédération socialiste des Ardennes qui participe en 1890 à la création du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire.
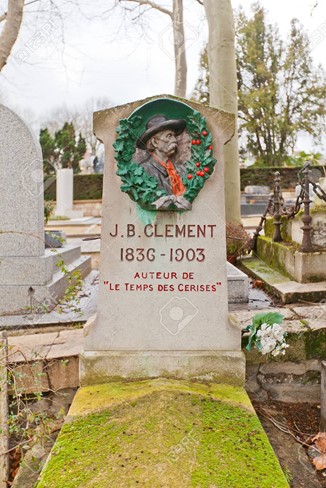 Il décède à l’âge de 66 ans le 23 février 1903 et sera inhumé au cimetière du Père-Lachaise.
Il décède à l’âge de 66 ans le 23 février 1903 et sera inhumé au cimetière du Père-Lachaise.
Toute sa vie il est surveillé par la Sureté Nationale, son dossier aux archives de la Préfecture de Police fait environ 30 cm d’épaisseur. La surveillance de sa mémoire s’est continuée après sa mort, le dernier document du dossier est un programme de cabaret de 1963 organisant une soirée pour les soixante ans de sa mort.
Clément a aussi écrit <LE CAPITAINE « AU-MUR »> :
« — Qu’avez-vous fait ? — Voici deux listes
Avec les noms de cent coquins :
Femmes, enfants de communistes.
Fusillez-moi tous ces gredins !…
— Qu’avez-vous fait ? — Je suis la veuve
D’un officier mort au Bourget…
Eh ! tenez, en voici la preuve :
Regardez, s’il vous plaît…
— Oh ! moi je porte encore
Mon brassard tricolore.
Au mur !
Disait le capitaine,
La bouche pleine
Et buvant dur,
Au mur ! »L’intégralité du texte se trouve derrière <ce lien>
Les photos de Clément et de Pottier sont l’œuvre de Félix Tournachon, dit « Nadar » qui lui aussi est enterré au cimetière du Père Lachaise,
Il y a encore beaucoup d’autres chansons de la commune.
Vous en trouverez sur cette magnifique page : Les plus belles chansons de la Commune de Paris> il y a d’autres chansons de Pottier, de Clément mais aussi d’Alexis Bouvier, Émile Dereux, Paul Brousse, Jules Jouy
Sur ce même site j’ai trouvé cette page très détaillée et instructive sur les <Mémoires de la Commune de 1871 dans l’Est parisien>
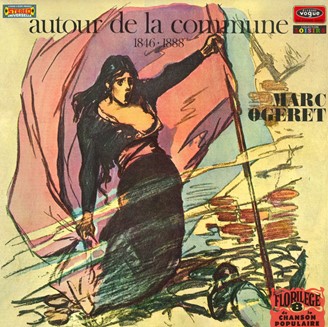 J’ai acheté ce disque de Marc Ogeret : « autour de la commune ».
J’ai acheté ce disque de Marc Ogeret : « autour de la commune ».
Splendides interprétations de ces chansons qui ne peuvent que vous faire vibrer.
Beaucoup des chansons évoquées se trouvent sur ce disque mais qui commence par une perle que je ne connaissais pas : « Le Chant des ouvriers »
Et je finirai ce mot du jour sur les chansons autour de la commune comme j’ai commencé avec une offrande de Jean Ferrat « Les cerisiers » dont vous trouverez les paroles derrière <ce lien>. Cette chanson se trouve dans l’avant dernier album de Ferrat « Je ne suis qu’un cri » publié en 1985.
« J’ai souvent pensé c’est loin la vieillesse
Mais tout doucement la vieillesse vient
Petit à petit par délicatesse
Pour ne pas froisser le vieux musicien
Si je suis trompé par sa politesse
Si je crois parfois qu’elle est encore loin
Je voudrais surtout qu’avant m’apparaisse
Ce dont je rêvais quand j’étais gaminAh qu’il vienne au moins le temps des cerises
Avant de claquer sur mon tambourin
Avant que j’aie dû boucler mes valises
Et qu’on m’ait poussé dans le dernier train »<1541>
-
Mardi 23 mars 2021
«La Commune de 1871 plonge ses racines dans la guerre franco-prussienne.»Robert BakerLa Commune fut une guerre civile entre français sous l’œil satisfait des prussiens.
La France a connu de nombreuses guerres civiles, des guerres de religion, la guerre entre les nobles et les bourgeois de la révolution française et plus récemment la guerre civile entre résistants et collaborateurs.
La Commune dans l’imaginaire de la Gauche, issue du récit marxiste de cette insurrection, considère que ce fut avant tout une guerre de classes. La commune étant la première tentative de révolution communiste.
 Mais les choses n’ont pas été aussi simple.
Mais les choses n’ont pas été aussi simple.
C’est tout un processus, issu de la défaite de la guerre de 1870 qui va conduire à cette déchirure.
Dans la revue « L’Histoire » de janvier 2021, entièrement consacrée à la Commune de Paris, l’historien Robert Baker essaie de répondre à la question « Pourquoi Paris se soulève le 18 mars 1871 ? »
Il explique d’abord que
« La Commune de 1871 plonge ses racines dans la guerre franco-prussienne. Le 4 septembre 1870, apprenant la défaite deux jours plus tôt de Napoléon III à Sedan, le peuple de Paris envahit le Palais-Bourbon, proclame la république et donne naissance à un gouvernement de la Défense nationale destiné à poursuivre la guerre. Mais les Prussiens sont bientôt aux portes de Paris, ville fortifiée, entourée de remparts depuis les années 1840. Le blocus de la capitale commence le 19 septembre 1870. Dès ce « siège de Paris » prend forme l’idée d’une « Commune ». En effet, tandis que le 7 octobre Gambetta, ministre de l’Intérieur, quitte Paris en ballon pour Tours afin d’y organiser la défense du territoire, le gouvernement provisoire, présidé par le gouverneur militaire de Paris, le général Trochu, et dirigé par les trois « Jules », Favre, Ferry et Simon, avec Ernest Picard, s’attire une critique de plus en plus violente de la part des porte-parole des milieux populaires, qui lui reprochent son inertie et sa modération. A côté de l’armée régulière et de la garde mobile, la principale force de Paris réside dans la Garde nationale, soit environ 200 000 hommes en armes, recrutés et organisés par quartier, élisant ses chefs. Depuis août 1870, ils appartiennent à toutes les classes sociales, et veulent en découdre. »
Mais les autorités et notamment le général Trochu n’autorisent pas la « sortie en masse » et la « guerre à outrance » réclamés par le peuple de Paris.
Elles ont certainement raison, la puissance de l’armée prussienne et de ses alliés ne pouvaient que conduire à une déroute de cette armée, certes de patriotes, mais amateurs.
Ainsi, le germe du conflit n’est pas un combat social, mais le refus de la défaite de la nation.
Après l’annonce de de la capitulation du maréchal Bazaine à Metz, les parisiens les plus engagés vont prendre d’assaut l’Hôtel de Ville, où siège le gouvernement, le 31 octobre 1870. Déjà l’intention est de constituer une Commune avec pour objectif de vaincre l’ennemi.
Ils ne réussiront pas, car il reste à ce moment suffisamment de gardes nationaux « légitimistes » pour défendre et délivrer le gouvernement.
Un nouvel accès de fièvre survient le 22 janvier 1871, quand ces réfractaires apprennent que le ministre des Affaires étrangères Jules Favre est allé à Versailles négocier, au nom du gouvernement provisoire, un armistice avec le chancelier allemand Bismarck.
 Bismarck s’est, en effet, installé à Versailles parce que c’est dans la galerie des glaces du château de Versailles que le chancelier de l’Unité allemande va proclamer la création du second empire allemand le 18 janvier 1871.
Bismarck s’est, en effet, installé à Versailles parce que c’est dans la galerie des glaces du château de Versailles que le chancelier de l’Unité allemande va proclamer la création du second empire allemand le 18 janvier 1871.
Ce soulèvement qui aboutira à des morts a encore pour objectif d’éviter la capitulation.
Nouvelle défaite, le 28 janvier 1871 l’armistice est signé : Paris capitule.
Robert Baker précise :
« Les forts sont livrés à l’ennemi ; l’armée doit donner ses armes, à l’exception d’une dizaine de milliers de soldats destinés à assurer la police dans la capitale. Toutefois cet accord n’allait pas jusqu’au désarmement de la Garde nationale. Celle-ci ne dépose pas ses fusils et, surtout, les canons dont elle s’est dotée, une bonne part par souscription, restent entre ses mains. Le 1er mars, avant l’arrivée des Prussiens, les gardes nationaux mettent ces canons en sûreté. […] Tandis que l’indignation populaire est à son comble, on assiste alors à une nouvelle émigration qui suit celle d’avant le siège : 150 000 personnes environ, appartenant aux classes aisées, quittent la capitale. L’évolution sociologique de Paris va s’en ressentir au bénéfice des partisans de la Commune. »
La révolte reste, à ce stade, un refus de la défaite. En revanche, la fuite en deux épisodes avant le siège puis au début des troubles suivant l’armistice, de la bourgeoisie parisienne va modifier l’équilibre politique du peuple de Paris en le portant vers la gauche.
Probablement qu’il y aura à partir de ce moment un ressentiment du peuple populaire parisien à l’égard des « riches » qui acceptent la défaite.
Cependant, il faut savoir que les historiens nous donnent l’assurance que la France ne pouvait plus gagner la guerre en janvier 1871, surtout qu’elle n’arrivait à mobiliser aucun allié contre la Prusse.
Hier, il était question de la commémoration éventuelle de Napoléon Ier. En plus du désastre dans lequel il a mené la France à cause des multiples guerres qu’il a engagées et finalement perdues, il a aussi contribué à asseoir chez les autres nations européennes, l’image d’une France arrogante et guerrière qu’il n’y avait aucune raison à soutenir.
Bismarck a alors exigé, pour pouvoir discuter de la paix avec un gouvernement légitime, que des élections aient lieu.
Ce fut le cas, le 8 février 1871, avec comme résultat la victoire très nette des monarchistes. Mais Paris est profondément républicain : la ville a élu 36 républicains, dont Louis Blanc et Victor Hugo.
Ce Paris républicain craint une restauration.
L’assemblée, elle, se réunit à Bordeaux et Adolphe Thiers devient, à 73 ans, le 16 février, « chef de l’exécutif ».
Robert Baker écrit :
« L’Assemblée de Bordeaux, aux mains des monarchistes, des réactionnaires, de ceux qu’on appellera avec mépris les « ruraux », loin de rendre hommage à la résistance héroïque des Parisiens, manifeste d’emblée sa détestation de la ville patriote et révolutionnaire. »
Paris va s’organiser dans l’hostilité contre le gouvernement Thiers.
Une première organisation a été constituée le 4 septembre 1870 par une majorité de militants de l’Internationale des travailleurs fondée à Londres en 1864.
Une seconde fut constituée après l’armistice : le Comité central de la Garde nationale.
Robert Baker écrit :
« La Garde nationale se politisa fortement après l’armistice. Sa composition sociale avait sensiblement évolué avec le départ, avant et après le siège, des citoyens aisés et amis de l’ordre. […] Le 15 février 1871, […] les délégués de la Garde nationale issus de 18 arrondissements élisent un Comité central de la fédération de la Garde nationale, dont la première intention est d’empêcher toute tentative de désarmement par le gouvernement de Thiers. Dans les jours suivants, les canons acquis par la Garde nationale sont transférés à Montmartre et place des Vosges »
Le terme de fédération donnera naissance au nom de « fédérés ». Le mur du cimetière du père Lachaise devant lequel seront fusillés des communards porte désormais le nom du « mur des fédérés ».
Et dans ce climat de défaite que le gouvernement de Thiers assume et que les parisiens rejettent, la tension va augmenter en raison d’un certain nombre de décisions gouvernementales : J’en cite quelques-unes :
- Le 15 février, la solde journalière des gardes nationaux (1,50 franc) est remise en question. Pour la toucher, il faudra faire la preuve de son indigence. Pour beaucoup c’est une abolition qui les prive de leurs seules ressources.
- Le 7 mars, le régime normal du Mont-de-Piété est rétabli, au détriment des démunis qui avaient bénéficié pendant le siège d’un moratoire protégeant leurs objets déposés.
- Le 10 mars, l’Assemblée prend la décision de transférer le siège du gouvernement à Versailles, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. Paris n’est plus la capitale.
- Le 13 mars, l’Assemblée décide la reprise du paiement des effets de commerce, la fin du moratoire des dettes commerciales qui va causer des faillites en chaîne. On estime à 150 000 le nombre des constats de faillite entre le 13 et le 17 mars.
Robert Baker analyse :
« Du même coup, l’opposition à l’Assemblée et au gouvernement de Thiers n’est plus le monopole des rangs populaires ; c’est la petite et la moyenne bourgeoisie qui sont touchées dans leurs moyens d’existence. Les révolutionnaires, jusque-là minoritaires, vont pouvoir compter sur une majorité de Parisiens des différentes classes sociales, excédés par les décisions prises à Bordeaux, après avoir été indignés par la capitulation. »
C’est donc une révolte qui ne va pas toucher que les masses populaires mais aussi des commerçants, des employés, des instituteurs.
Et …
« Dans la nuit du 17 au 18 mars, les troupes de l’armée régulière commandées par le général Vinoy tentent de reprendre les canons, rangés en plusieurs endroits, principalement à Montmartre. Mais l’opération, mal préparée, traîne en longueur : faire descendre une centaine de canons de la butte Montmartre n’est pas une mince affaire. A l’aube, le samedi 18 mars, quand Paris s’éveille, les canons n’ont pu être évacués, faute d’attelages suffisants. De proche en proche, une véritable journée insurrectionnelle commence, les tambours des fédérés battent le rappel, on entoure les soldats, on leur offre des vivres, on les couve. Le général Lecomte, qui commande les soldats du 88e de ligne, ordonne de faire feu ; les soldats refusent d’obtempérer. »
Et c’est ainsi que la Commune et la guerre civile démarrent.
Clemenceau qui est maire de Montmartre et député de Paris va tenter une médiation et essayer d’apaiser le conflit, mais échouera. Mais on comprend bien que tout au long de ce processus qui va mener à la guerre civile, la première raison du conflit se trouve dans la défaite militaire. Les revendications sociales n’apparaîtront que dans un second temps.
<1540>
- Le 15 février, la solde journalière des gardes nationaux (1,50 franc) est remise en question. Pour la toucher, il faudra faire la preuve de son indigence. Pour beaucoup c’est une abolition qui les prive de leurs seules ressources.
-
Lundi 22 mars 2021
« Oui [il faut commémorer] Napoléon, Non la commune »Pierre NoraLe 18 mars 1871, la population parisienne et les gardes nationaux refusèrent de rendre les canons, achetés avec l’argent d’une souscription publique, au gouvernement de la France dirigé par Adolphe Thiers, retranché à Versailles, et qui avait signé un armistice avec la Prusse et ses alliés allemands reconnaissant la défaite de la France, le 26 janvier 1871. Ce premier épisode sanglant constitue le début de cette période insurrectionnelle qu’on appela : « La Commune ».
La commune dura 72 jours, et s’acheva par la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871, pendant laquelle l’armée du gouvernement de Versailles, sous le regard bienveillant des troupes prussiennes qui encerclaient toujours Paris suite à un siège qui débuta en septembre 1870, reprirent Paris, barricade après barricade, en fusillant et massacrant massivement les « communards »
C’était il y a 150 ans.
Le 5 mai 1821, « à 17 heures et 49 minutes », Napoléon Ier meurt à l’âge de 51 ans, sur l’île de Saint Hélène lors de son exil qui a fait suite à sa défaite militaire à Waterloo.
C’était il y a 200 ans.
Dans la France contemporaine qui s’est fait une spécialité des commémorations, ces deux anniversaires posent des problèmes au gouvernement actuel. Et pour une fois la COVID 19 ne joue pas un rôle prépondérant dans ces difficultés.
Pierre Nora, est un historien français important, membre de l’Académie française, connu pour ses travaux sur la composante mémorielle de l’Histoire.
Parmi ses œuvres on cite souvent l’ouvrage collectif qu’il a dirigé : « Les Lieux de mémoire », Gallimard
Il était donc assez rationnel de poser, à ce spécialiste des Mémoires françaises, la question de ces deux commémorations potentielles.
Ce sont Léa Salamé et Nicolas Demorand qui, sur France Inter, se sont chargés de lui poser cette question lors du <Grand entretien du 4 mars 2021>.
Il s’était visiblement prépare à la question puisqu’il a répondu immédiatement qu’il fallait commémorer Napoléon mais pas la Commune.
Il estime que « La polémique est ridicule » : autour de Napoléon.
« [Napoléon] a une dimension tellement historique, qui a eu sur l’Europe une conséquence si positive, il a apporté la révolution dans les pays qu’il a conquis, il a créé les institutions sous lesquelles nous vivons encore à beaucoup d’égard, […] c’est le personnage de l’imaginaire romantique français incarné. ».
Il reconnait cependant qu’il a une face sombre et notamment qu’il a eu tort à partir de 1806 de lancer la France dans la guerre.
Et donc il dit non à la commémoration de la commune :
« Parce qu’elle n’a pas apporté grand-chose ».
Et il ajoute qu’elle a perdu sa portée subversive quand Georges Pompidou est venu s’incliner devant le mur des fédérés en 1971 :
« Le fondé de pouvoir de la banque Rotschild qui venait mettre pied à terre devant les bords de la Commune ça voulait dire que la mémoire ouvrière était morte dans son inspiration révolutionnaire, elle ne faisait plus peur. »
Bref, pour Pierre Nora, la commune n’a pas à être commémoré parce qu’elle fait partie des vaincus de l’Histoire.
Cependant, nous devons quand même constater que Napoléon, malgré son prestige et les 5 cercueils qui entourent son corps sous le dôme des Invalides, fait aussi partie des vaincus de l’Histoire.
Il reste, en effet, l’imaginaire romantique. Mais il ne fait pas partie de ces souverains qui ont rendu leur pays plus fort à la fin de leur règne qu’il ne l’était à leur début.
J’avais évoqué la position que Lionel Jospin développait, à son propos, dans son livre de 2014 lors du mot du jour du <15 avril 2014> et qui portait pour exergue cette phrase de l’ancien premier ministre :
« [Je suis] Intrigué par le contraste entre le bilan de Napoléon, désastreux et la gloire qui s’attache à son nom avec cette récurrence de la tentation bonapartiste en France. »
Je n’ai pas le pouvoir de décider des anniversaires qui doivent être commémorés et de ceux qui n’ont pas cette vocation.
Mais dans les jours qui viennent, je vais parler de la « Commune» parce que je pense que cet épisode de l’Histoire de France mérite qu’on s’y arrête un peu pour l’évocation des évènements mais aussi pour la trace et l’imaginaire que ces 71 jours ont provoqué.
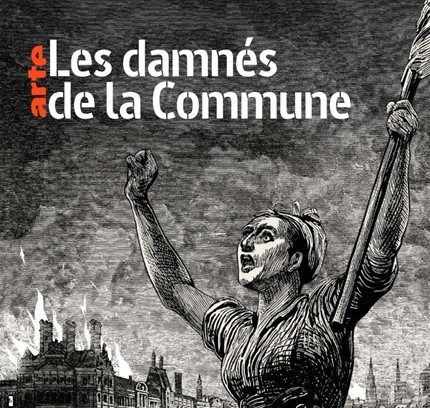 En attendant vous pouvez voir un remarquable film documentaire réalisé par Raphaël Meyssan qui raconte cette histoire autour de gravures d’époque.
En attendant vous pouvez voir un remarquable film documentaire réalisé par Raphaël Meyssan qui raconte cette histoire autour de gravures d’époque.
Ce film a été diffusé sur ARTE .
Il a pour titre <Les damnés de la Commune>.
Raphael Meyssan d’abord écrit un roman graphique ayant le même titre <Les damnés de la commune en 3 tomes>
Je n’ai pas lu ces livres mais regardé avec beaucoup d’intérêt le résultat filmé de cette démarche.
ARTE présente cette réalisation de la manière suivante ;
« Raphaël Meyssan a adapté les trois tomes de son roman graphique éponyme, pour lequel il avait collecté des centaines de gravures dans les journaux et les livres de l’époque.
De cette patiente quête d’archives − huit ans de recherches −, le graphiste et réalisateur tire un film unique, à l’esthétique et au dispositif étonnants.
La caméra plonge au cœur de ces dessins magnifiques, émouvants et subtilement animés, puis zoome, scrute et caresse pour restituer cette tragique épopée dans le moindre de ses détails en une fresque prodigieuse.
À mi-chemin entre Les misérables de Victor Hugo et les bandes dessinées documentaires de Joe Sacco, Raphaël Meyssan compose, en incluant le récit de Victorine, une jeune révoltée, une narration limpide qui parvient, à destination de tous les publics, à rendre fluide le chaos de la Commune. ».
<1539>
-
Lundi 8 mars 2021
« Pause («Des concerts de l’Orchestre National de Lyon)»Un jour sans mot du jour nouveauLe mot du jour est en pause pendant 2 semaines. Il sera de retour le 22 mars.
 En attentant, je partage plusieurs vidéos, dans lesquelles l’Orchestre National de Lyon avec son chef Nikolaj Szeps-Znaider interprètent merveilleusement plusieurs œuvres :
En attentant, je partage plusieurs vidéos, dans lesquelles l’Orchestre National de Lyon avec son chef Nikolaj Szeps-Znaider interprètent merveilleusement plusieurs œuvres : <La 4ème symphonie de Gustav Mahler>
<La 3ème Symphonie de Beethoven>
<Des lieder du Knabenwunderhorn de Gustav Mahler>
<mot du jour sans numéro>
-
Vendredi 5 mars 2021
« Ne recherchez pas les récompenses, l’argent ou la gloire. Faites de votre mieux et soyez satisfaits. Dans cette société de l’apparence, ce n’est pas votre look qui doit compter, mais bien la valeur que vous générez. »Katalin Kariko, chercheuse conseillant des jeunes chercheuses et chercheursAujourd’hui je vais parler d’une femme scientifique assez extraordinaire. Elle possède bien sûr l’intelligence qui lui permet l’efficacité, mais aussi la persévérance qui lui a permis de poursuivre sa route malgré l’indifférence, quelquefois l’hostilité et aussi la trahison. Maintenant, au bout de la réussite et du succès elle exprime des valeurs que je trouve convaincantes.
Mais pour raconter cette histoire et en comprendre certains aspects, il faut revenir un peu dans le passé
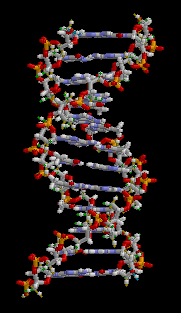 Au départ, il y a eu la découverte de l’ADN. Il existe encore des livres ou des sites qui écrivent sans sourciller que l’ADN a été découverte par le biochimiste américain James Watson et le biologiste britannique Francis Crick. C’est une affirmation triplement fausse.
Au départ, il y a eu la découverte de l’ADN. Il existe encore des livres ou des sites qui écrivent sans sourciller que l’ADN a été découverte par le biochimiste américain James Watson et le biologiste britannique Francis Crick. C’est une affirmation triplement fausse.
Premièrement parce que on parlait d’ADN avant eux et que de très nombreux scientifiques ont travaillé sur ce sujet avant que ces deux scientifiques publient leur article célèbre, en 1953, dans la revue Nature.
<Wikipedia> cite avant 1953 :
« L’ADN a été isolé pour la première fois en 1869 par le biologiste suisse Friedrich Miescher sous la forme d’une substance riche en phosphore.»
Et on apprend aussi qu’en 1878, le biochimiste allemand Albrecht Kossel isola un des composants essentiels : « les acides nucléique ». En 1919, le biologiste américain Phoebus Levene suggéra que l’ADN consistait en une chaîne de nucléotides unis les uns aux autres. En 1937, le physicien et biologiste moléculaire britannique William Astbury montra grâce aux rayons X que l’ADN possède une structure ordonnée. Et probablement qu’il y en eut encore beaucoup d’autres qui participèrent à cette découverte majeure de l’organisation de la vie.
Donc ils ne furent pas les premiers.
Deuxièmement, l’article de 1953 ne relate pas la découverte de l’ADN mais la description de sa structure en double hélice.
Et troisièmement, ce n’est même pas eux qui découvrirent la structure en double hélice.
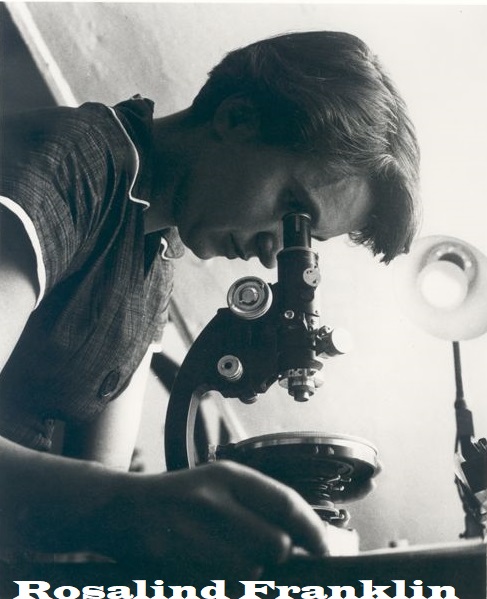 Ce fut une femme avec d’autres collaborateurs qui peut être créditée de cette découverte : Rosalind Franklin. Je cite encore Wikipedia :
Ce fut une femme avec d’autres collaborateurs qui peut être créditée de cette découverte : Rosalind Franklin. Je cite encore Wikipedia :
« En mai 1952, l’étudiant britannique Raymond Gosling, qui travaillait sous la direction de Rosalind Franklin dans l’équipe de John Randall, prit un cliché de diffraction aux rayons X (le cliché 51181) d’un cristal d’ADN fortement hydraté. Ce cliché fut partagé avec Crick et Watson à l’insu de Franklin et fut déterminant dans l’établissement de la structure correcte de l’ADN. Franklin avait par ailleurs indiqué aux deux chercheurs que l’ossature phosphorée de la structure devait être à l’extérieur de celle-ci, et non près de l’axe central comme on le pensait alors. Elle avait de surcroît identifié le groupe d’espace des cristaux d’ADN, qui permit à Crick de déterminer que les deux brins d’ADN sont antiparallèles. .[
Rosalind Franklin mourut en 1958 d’un cancer et ne reçut donc pas le prix Nobel de physiologie ou médecine décerné en 1962, « pour leurs découvertes relatives à la structure moléculaire des acides nucléiques et leur importance pour le transfert de l’information génétique dans la matière vivante », à Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkin, qui n’eurent pas un mot pour créditer Franklin de ses travaux ; le fait qu’elle n’ait pas été associée à ce prix Nobel continue de faire débat. »
J’avais déjà évoqué cette histoire, le destin de Rosalind Franklin morte à 37 ans, d’un cancer de l’ovaire, probablement lié à la surexposition aux radiations lors de ses recherches lors d’un mot du jour de 2018 : « Ni vues ni connues »
ADN signifie Acide DésoxyriboNucléique, et constitue la molécule support de l’information génétique héréditaire.
Et les biologistes ont alors poursuivi ce plan de recherche extraordinaire décortiquer totalement le génome humain, c’est-à-dire la séquence de gène qui se trouve sur la macromolécule d’ADN et qui est reproduit à l’identique pour chaque individu dans chacune de ses cellules.
Et c’est ainsi que fut lancé le projet génome humain (en anglais, Human Genome Project ou HGP) fin 1988 pour établir le séquençage complet de l’ADN du génome humain. Ce projet s’acheva en 2004.
Le génome humain était connu dans son intégralité.
Et les scientifiques qui savaient à quoi servait chaque gène et savaient modifier un gène ont cru que en travaillant sur l’ADN ils pourront guérir de très nombreuses maladies.
Tous allaient dans ce sens, sauf quelques-uns comme Katalin Kariko, la femme qui est au centre de ce mot du jour..
 J’ai acheté et lu avec beaucoup d’intérêt le magazine « Le Point » du 28 janvier 2021 : « Comment l’ARN va changer nos vies »
J’ai acheté et lu avec beaucoup d’intérêt le magazine « Le Point » du 28 janvier 2021 : « Comment l’ARN va changer nos vies »
Ce numéro essaie d’expliquer de manière assez savante ce que fait ce qu’est l’ARN.
Mon propos n’est pas d’expliquer l’aspect technique de ces découvertes mais plutôt de m’intéresser au destin de cette formidable hongroise.
Et aussi de m’interroger de manière assez philosophique sur cet aveuglement de ces scientifiques qui pensaient qu’en ayant décrypter le génome humain et en ayant la possibilité de le modifier grâce aux « ciseaux génétiques », dont le petit nom est « CRISPR associated protein 9 » abrégé en <Cas9> et qui est une protéine qui possède la capacité à couper l’ADN, ils avaient fait le plus grand pas vers … vers quoi d’ailleurs ? Probablement vers « homo deus » pour reprendre le concept de Yuval Noah Harari.
Je me souviens encore de cette parole désabusée d’une scientifique le matin, à France Inter, qui a dit « Finalement on n’a pas beaucoup avancé »
Je me permets une petite explication personnelle.
Dans l’esprit hiérarchisé d’homo sapiens, cet inventeur du Dieu tout puissant, trouver l’élément central autour duquel toutes les caractéristiques humaines sont définies devaient permettre de tout maîtriser. Comme dans un ordinateur maîtriser le code.
Mais visiblement cela ne marche pas comme cela. Car il y a énormément d’interactions entre les gènes et même au-delà avec l’environnement qui explique le fonctionnement de l’être humain. Les scientifiques explorent une autre discipline qui a pour nom « L’épigénétique ».
C’est en fait que notre système humain n’est pas très hiérarchique, mais plutôt transversale.
Et l’acide ribonucléique (ARN) qui est très proche chimiquement de l’ADN et si je comprends bien une copie d’une partie de l’ADN intervient pour créer de l’interaction à l’intérieur de notre corps.
Il existe plusieurs types d’ARN mais celui sur lequel a travaillé Katalin Karibo est l’ARN messager, abrégé en ARNm.
Mais comme je l’ai annoncé et aussi pour ne pas me retrouver au-delà de mon seuil de compétence, je n’entrerai pas davantage dans les détails techniques.
Certaines explications se trouvent dans le Point du 28 janvier 2021.
Pour lire ce numéro du Point il faut l’avoir acheté en version papier comme moi ou être abonné à la version en ligne.
Mais sur cette page une vidéo qui explique en moins de 5 minutes le lien entre l’ADN et l’ARN : <Il y a beaucoup de fantasmes autour du vaccin contre la COVID>
Bruno Pitard directeur de recherche au CNRS ose cette histoire que je comprends :
« Vous prenez un bon vieux livre en papier, lui c’est l’ADN, et puis vous lisez un chapitre à voix haute. Les paroles qui sortent de votre bouche, c’est l’ARN messager. Si quelqu’un entend vos paroles, il reçoit le message, mais une fois entendues, ces paroles disparaissent et en aucun cas les paroles prononcées ne changeront le texte de votre livre en papier. »
Cet autre article du Point décrit de manière assez compréhensible : «Pourquoi le vaccin à ARN est une véritable révolution » par rapport aux autres techniques vaccinales et son processus de fonctionnement.
Mais revenons à Katalin Karibo qui ne veut pas travailler sur l’ADN et préfère l’ARN. Elle trouvait dangereux de travailler directement sur le code génétique
Un article de <l’Obs>Publié le 17 décembre 2020 précise :
« A la fin des années 1980, la communauté scientifique n’avait d’yeux que pour l’ADN, qu’on voyait potentiellement capable de transformer les cellules et, de là, soigner des pathologies comme le cancer ou la mucoviscidose.
Katalin Kariko, elle, s’intéressait à l’ARN messager, l’imaginant fournir aux cellules un « mode d’emploi » leur permettant ensuite de fabriquer elles-mêmes les protéines thérapeutiques. Une solution permettant d’éviter de modifier le génome des cellules, au risque d’introduire des modifications génétiques incontrôlables. »
Elle est chercheuse dans un laboratoire de recherche, en Hongrie communiste. Elle a une vie confortable mais les moyens dont elle dispose pour poursuivre ses recherches sur l’ARN sont trop limités.
Dans son entretien au Point elle déclare
« Quitter la Hongrie en 1985 a été une décision difficile, j’adorais mon labo. »
Elle a voulu venir en France, on ne comprend pas bien pourquoi cela n’a pas eu lieu.
« J’ai été candidate à un poste en France, à Montpellier, au sein du laboratoire de Bernard Lebleu, mais il était encore très difficile, à l’époque d’accéder à des centres de recherche d’Europe de l’Ouest depuis la Hongrie »
Et quand les journalistes posent cette question disruptive : « Que pensez-vous du paysage de la biotech en France ? », sa réponse est douloureuse pour nous les français :
« La France, c’est un beau pays pour les vacances d’été. Mais essayez donc de comprendre pourquoi les français ont dû venir ici, aux Etats-Unis ? Pourquoi Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, ne dirige pas une entreprise française en France pour mettre au point les vaccins ? Pourquoi il n’y a plus de sociétés comme BioTech en France ? Je pense que c’est à cause du financement. [Aux Etats-Unis] avec le capital-risque on donne davantage aux petites entreprises. C’est sans doute une question de culture, qui n’existe peut-être pas en Europe. Ici, les gens investissent plus dans les biotechnologies, parfois dans 30 entreprises différentes, et si une réussit, tant mieux. Quand une piste mérite d’être explorée, on poursuit. »
 Elle est donc partie avec sa famille aux Etats-Unis, à Philadelphie. Et elle a pris un énorme risque :
Elle est donc partie avec sa famille aux Etats-Unis, à Philadelphie. Et elle a pris un énorme risque :
« En Hongrie nous avions un nouvel appartement confortable, j’avais ma propre machine à laver, à Philadelphie je lavais mon linge la nuit dans un sous-sol. Mais j’étais convaincue que la situation allait s’améliorer que tout était possible. Si j »étais restée en Hongrie, je serais devenue cynique, aigrie, médiocre. »
Mais aux Etats-Unis elle se heurte au scepticisme par rapport à ses recherches sur l’ARN, dans un monde scientifique qui ne jure que par l’ADN
Le Point raconte :
« A l’université Temple, à Philadelphie, où elle atterrit, elle passe vite d’une période de grâce au placard. Cinq ans plus tard, elle rejoint l’université de Pennsylvanie. A l’époque, la mode est à l’ADN. Jugeant trop dangereuse sa manipulation, elle préfère persévérer dans ses recherches sur L’ARN en demandant une bourse dédiée. Résultat, elle est rétrogradée au rang de simple chercheuse. Une nouvelle fois :direction placard. »
Mais elle continuera sans se décourager. Elle rencontrera Drew Weissman avec qui elle collaborera beaucoup.
Ce sera un chemin compliqué pavé d’embuches.
Dans ma langue de béotien, je dirai l’ARN ne se laisse pas apprivoiser facilement, il faut l’isoler, agir sur lui et enfin maîtriser les effets induis.
L’article de <l’Obs>, déjà cité, précise :
Mais l’ARN messager n’était pas non plus dénué de problèmes : il suscitait de vives réactions inflammatoires, étant considéré comme un intrus par le système immunitaire.
Avec son partenaire de recherche, le médecin immunologiste Drew Weissman, Katalin Kariko parvient progressivement à introduire de mini-modifications dans la structure de l’ARN, le rendant plus acceptable par le système immunitaire. Leur découverte, publiée en 2005, marque les esprits, extirpant – un peu – Katalin Kariko de l’anonymat.
Puis, ils franchissent un nouveau palier, en réussissant à placer leur précieux ARN dans des « nanoparticules lipidiques », un enrobage qui leur évite de se dégrader trop vite et facilite leur entrée dans les cellules. Leurs résultats sont rendus publics en 2015. »
Elle travaille très dur et n’est pas à l’abri de manœuvres à la limite de l’honnêteté : Après avoir publié avec Drew Weissman, dans le cadre de l’Université de Pennsylvanie, un article fondamental sur l’ARN, l’université de Pennsylvanie a déposé un brevet lié à l’invention des deux chercheurs et a négocié la vente de ce brevet avec une autre société :
« Nous étions furieux. [La société acheteuse] a même cherché à nous vendre une sous licence de ce brevet ! Habituellement on confie la licence d’un brevet à ses inventeurs. Après tout, nous en savions plus sur l’ARN messager (ARNm) que n’importe qui d’autre et nous étions susceptibles d’en tirer le maximum, mais l’université n’était pas de cet avis »
Et bien sûr elle raconte aussi les humiliations, la sous valorisation systématique elle était étrangère, venant d’un pays communiste et …une femme. L’Obs raconte :
« La biochimiste se garde de tout triomphalisme mais conserve une pointe d’amertume en se remémorant les moments où elle s’est sentie sous-estimée : une femme née à l’étranger dans un univers masculin où, à la fin de certaines conférences d’experts, on lui demandait : « Où est votre superviseur ? ».
« « Ils pensaient toujours : « cette femme avec un accent, il doit y avoir quelqu’un derrière, quelqu’un de plus intelligent. » » »
Et finalement elle intégrera la start up allemande BioNtech en 2013. Cette petite entreprise innovante a été créée en 2008, par un couple de scientifiques d’origine turque : Uğur Şahin , professeur d’oncologie à la 3e clinique médicale de l’université Johannes-Gutenberg de Mayence et son épouse Özlem Türeci médecin, chercheuse en immunologie.
C’est cette petite société qui a mis au point le vaccin Pfizer-BioNTech, Pfizer étant simplement le financeur.
Bruno Pitard directeur de recherche au CNRS fait ce constat dans « le Point » :
« C’était trop innovant pour les grands groupes ; la preuve ce sont les biotechs qui ont continué »
Et nous arrivons à la conclusion de l’article du Point qui est le cœur de ce que j’ai envie de partager aujourd’hui :
Avec plus de financements, de nouvelles découvertes pourraient-elles être réalisées pour soigner d’autres maladies grâce à l’ARNm
C’est un sujet auquel j’ai souvent réfléchi et je peux vous dire que ce n’est pas qu’une question d’argent. Si les scientifiques pouvaient mettre de côté leur ego, partager leurs informations, nous pourrions nous attaquer à d’autres maladies. Le système n’est pas optimal. Les spécialistes ne partagent pas car ils sont en compétition. Les trois sociétés que sont CureVac, BioNTech et Moderna organisent depuis 2013 des échanges académiques au sujet de l’ARNm auxquels j’ai participé. Nous avons partagé de nombreuses données avec des japonais, des coréens et des chinois. Mais il est extrêmement difficile de coordonner les recherches et de convaincre l’ensemble des acteurs que la coopération est la meilleure des stratégies. »
Nous en revenons à l’exemple du professeur et de son expérience avec les ballons qui montraient que la coopération était le meilleur système. Mais ce n’est pas celui qui est imposé par le marché.
Et Katalin Kariko ajoute :
« Il est urgent d’investir dans la recherche-fondamentale et appliquée-et de faire en sorte que les enfants aient envie de devenir chercheurs. Il y a tant de choses à découvrir »
 Et elle évoque aussi le livre qui l’a le plus inspirée :
Et elle évoque aussi le livre qui l’a le plus inspirée :
« Le livre qui m’a le plus marquée alors que j’étais au lycée est « le stress de la vie » du hongrois Hans Selye. Il est le premier à avoir appliqué le terme « stress » au corps humain, alors qu’il était employé essentiellement en physique. Sa théorie ? Les gens gâchent du temps et leur vie avec des regrets. Si j’ai persévéré sur l’ARN alors que personne n’y croyait, c’est parce que je n’ai pas attendu qu’on me tape sur l’épaule pour me dire « Katie, tu fais du bon boulot ! ». Je savais ce que je faisais était bien. »
Et voici le conseil qu’elle donne aux jeunes chercheurs :
« Ne recherchez pas les récompenses, l’argent ou la gloire. Faites de votre mieux et soyez satisfaits. Dans cette société de l’apparence, ce n’est pas votre look qui doit compter, mais bien la valeur que vous générez. La gloire immédiate n’a pas d’importance. Parfois, on travaille pendant des mois, des années avant d’obtenir un résultat. S’il n’y avait pas eu cette pandémie, personne ne saurait qui je suis – et cela m’irait très bien. »
Jamais elle n’abandonnera la recherche. :
« Aujourd’hui, j’ai assez d’argent pour pouvoir me permettre de ne rien faire, de trainer chez moi. Pourtant, je n’ai jamais arrêté de travailler ! J’ai toujours un objectif, un nouveau projet qui me motive. Je pense encore pouvoir apporter ma pierre à des édifices de recherche. Un jour, je m’effondrerai au milieu de mes recherches .. »
Ainsi parle Katalin Kariko.
Beaucoup pense qu’elle aura le Prix Nobel. Celui dont Rosalind Franklin fut privé.
<1538>
Je vais prendre quelques jours de congé du télétravail et des mots du jour.
Le prochain mot du jour devrait être publié le 22 mars. -
Jeudi 4 mars 2021
« Chaque intelligence individuelle naît de la coopération de milliards de neurones, chaque intelligence collective naît de la coopération de nombreux individus. »Edgar MorinPour ne rien cacher, l’écriture quotidienne du mot du jour n’est pas facilitée par le télétravail que je pratique, bien au contraire.
Cela devient même parfois très compliqué pour le finaliser à une heure raisonnable.
Aujourd’hui, je me suis lancé dans une rédaction d’un mot du jour que je ne suis pas en mesure de terminer pour demain matin. Alors, j’ai pensé partager une histoire que m’a relaté Annie, il y a quelques semaines. J’ai aussi trouvé cette même histoire sur plusieurs réseaux sociaux. Elle est très simple et me semble pleine d’enseignement.
 Un jour un professeur a amené des ballons à l’école. Et, il a demandé aux enfants de les gonfler puis que chacun écrive son nom sur un ballon.
Un jour un professeur a amené des ballons à l’école. Et, il a demandé aux enfants de les gonfler puis que chacun écrive son nom sur un ballon.Ensuite, il les a mélangés et jetés au hasard dans le corridor. Après, le professeur leur a donné comme mission de trouver le ballon sur lequel leur nom était écrit et leur a accordé cinq minutes.
Les enfants qui étaient très nombreux allaient dans tous les sens, manipulaient les ballons les uns après les autres. Au bout de cinq minutes quasi personne n’avait trouvé son ballon.
Alors, le professeur a réitéré la même expérience : jeter au hasard tous les ballons dans le corridor. Mais il a donné une autre consigne : chacun devait simplement prendre le ballon le plus proche qu’il trouvait puis le donner à la personne dont le nom y était écrit. En moins de deux minutes, tous les enfants avaient récupéré leur ballon.
Que nous dit cette histoire ?
Probablement que la coopération est plus efficace que la compétition.
Alors il faut trouver un exergue. Heureusement Edgar Morin tweete des paroles de sagesse. Ainsi le 8 décembre 2020, il a écrit :
« Chaque intelligence individuelle naît de la coopération de milliards de neurones, chaque intelligence collective naît de la coopération de nombreux individus. »
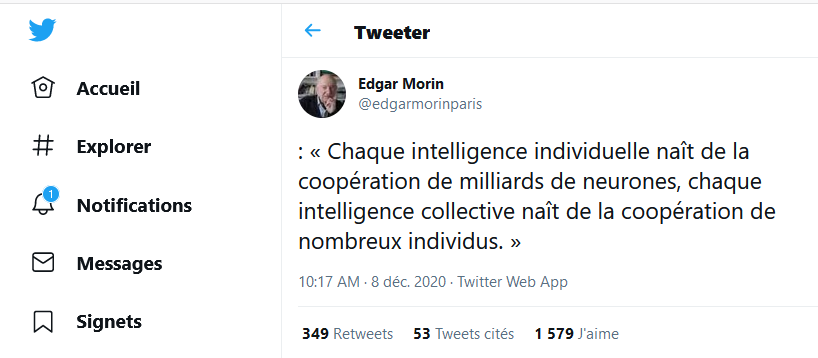
Une petite histoire…
<1537> -
Mercredi 3 mars 2021
« Soeurs. »Daisy JohnsonJ’écoutais la radio, en me promenant. A la fin de son émission, le journaliste a parlé avec enthousiasme d’un livre qu’il fallait lire, qui était palpitant, haletant, un chef d’œuvre !
Ce n’était pas de la publicité, c’était une opinion éclairée.
Dans la continuité de ma promenade, je suis entré dans la librairie Decitre, place Bellecour à Lyon et j’ai acheté « Sœurs » de Daisy Johnson.
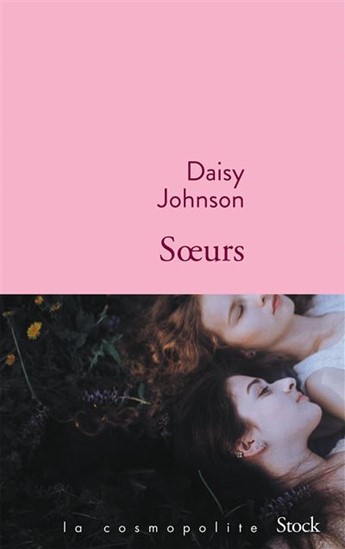 Il y a des moments dans lesquels on passe rapidement de l’information à l’action.
Il y a des moments dans lesquels on passe rapidement de l’information à l’action.
Je ne connaissais pas Daisy Johnson, j’avais compris selon l’émission de radio qu’elle était jeune et anglaise.
Sur le site de Stock qui l’édite, nous apprenons que Daisy Johnson est née en 1990. Elle a publié en 2016 un recueil de nouvelles, Fen, qui a été encensé par la critique outre-Manche. Son premier roman, « Tout ce qui nous submerge »(Stock, 2018), a été finaliste du Man Booker Prize 2017, faisant de Daisy Johnson la plus jeune finaliste dans l’histoire de ce prix. Elle vit à Oxford.
Quand vous naviguez sur le Web, vous tombez d’une critique étincelante à des louanges dithyrambiques.
Raphaëlle Liebaert, directrice littéraire de la collection qui a édité ce livre, précision nécessaire, parle de son coup de cœur de ce début d’année 2021 :
« Avec son nouveau roman, Daisy Johnson nous propulse au cœur de la relation fusionnelle entre deux sœurs adolescentes recluses dans une étrange maison sur la côte anglaise.
C’est brûlant, déchirant, palpitant et magistralement écrit. On pense à Laura Kasischke, à Daphné du Maurier, à Virgin Suicides. C’est un livre qui vous happe dès les premières pages et vous laisse ébloui – et sous le choc – lorsque vous le refermez. On comprend pourquoi la publication d’un livre de Daisy Johnson est un événement outre-Manche. Et pourquoi elle va être un événement en France ! »
Le journal « Elle » le place au rang de chef d’œuvre :
« Sœurs, encore un chef-d’œuvre de Daisy Johnson »
<Les Inrockuptibles évoque un roman ensorcelant et un délicieux roman gothique.
Dans le <Figaro> Eric Neuhoff parle de deux étranges adolescentes mais considère :
« qu’avec son deuxième roman, la jeune romancière britannique se propulse parmi les auteurs avec lesquels il va falloir compter. »
<Le journal du dimanche> évoque une méditation poétique et gothique sur l’amour fraternel et la place de l’enfant au sein d’une famille et ajoute :
« Le deuxième roman de Daisy Johnson nous entraîne vers cette contrée mystérieuse de l’adolescence où chaque émotion semble plus intense et chaque promesse, un pacte à la vie à la mort. Immergé dans le corps et les pensées de [la narratrice], le lecteur partage les craintes et les doutes de ces sœurs mi-anges, mi-démons. Un engrenage qui paraît obéir aux fabuleux sortilèges qui sont la marque des grands écrivains. »
Ce <journal belge> utilise le terme « fascinant » pour ce livre et décrit le travail de Daisy Johnson :
« Pour son second roman, Daisy Johnson, 31 ans à peine, use de toutes les libertés de l’écriture avec une inventivité jubilatoire. […] Il y a du Lewis Carroll et du Dickens dans son style si particulier, mélange de fantasmagorie, de peinture sensible de la nature et de réalisme social. Elle restitue à merveille la souplesse de l’imaginaire des enfants qui d’un bouton de porte font un visage ou imaginent des êtres minuscules dans un creux du mur. Elle n’a pas oublié non plus le plaisir du lecteur à entrer dans un univers mouvant, à avancer à tâtons, à faire le plein de sensations pour se glisser dans le décor ou la peau d’un personnage. »
Et <Les Echos> ne sont pas moins élogieux :
« La jeune écrivaine anglaise Daisy Johnson signe un second roman noir d’encre sur les démons de la sororité et les affres de l’adolescence, en s’inspirant des grands romans gothiques. Un tour de force poétique et littéraire, doublé d’une fascinante intrigue à suspense. […] Le pouvoir d’évocation de l’écrivaine, son génie de la construction, son style flamboyant incroyablement maîtrisé font le reste… Comme les romans gothiques d’antan, il offre une catharsis poétique et horrifique, crevant en beauté l’abcès de la tristesse du monde.
Mais cet article dit aussi :
« La dernière partie du livre, où tout bascule, est glaçante comme un tombeau. »
Alors, je ne vais pas spoiler comme on dit maintenant. Juste planter le décor.
C’est l’histoire de deux sœurs l’ainée Septembre et de 11 mois sa cadette Juillet. Leur mère s’appelle Sheela, elle écrit et dessine des livres pour enfant dans lesquels elle met en scène ses filles.
Le père est mort. On apprend au fil des pages que c’était un homme peu recommandable et violent « chez qui la haine ressemblait tant à l’amour »
Le début du livre nous présente la mère qui emmène précipitamment ses filles loin d’Oxford, où ils habitent car il s’est passé un incident au lycée et elles fuient.
La maison qu’ils vont rejoindre dans le nord, sur la lande du Yorkshire est délabrée et sans clé. C’est une maison, proche de la maison hantée et qui a une histoire, le père y est né et Septembre aussi.
Au fur à mesure, on comprend la relation morbide de domination qu’exerce Septembre sur sa sœur dans laquelle se côtoient protection et sadisme. Cette relation exclusive les éloigne de tous les autres jeunes de leur âge.
Plusieurs fois dans le roman on trouve le premier vers du poème qui se trouve avant le récit :
« Ma sœur est un trou noir »
Juillet est la narratrice, c’est elle qui raconte le récit par touche successive.
Le roman va se dérouler dans cette maison, dans un quasi huis clos. Murée dans sa dépression, la mère s’enferme dans la chambre du haut et laisse apparemment ses filles se débrouiller seules.
L’histoire avance dans l’angoisse et le dévoilement ambigüe de la vérité du récit.
Juillet écrit :
« Si les esprits sont des maisons qui comportent plusieurs pièces, dans ce cas, je vis à la cave. Tout y est sombre et silencieux. Parfois, je perçois un mouvement au-dessus de ma tête, l’eau qui coule dans les tuyaux ou quelque chose qui digère lentement. »
Toute sa vie, Juillet, aura vécu ainsi, dans l’antichambre de sa sœur, attendant d’être autorisée à penser par et pour elle-même.
A la page 169 du livre qui en compte 211 elle pose la bonne question :
« Je me suis demandé, c’était plus fort que moi, comment ça se serait passé s’il n’y avait eu que moi, si j’étais née la première et si Septembre n’était pas née du tout. Peut être que j’aurais eu des amis »
Mais elle ne poursuivra pas, et ne se libérera pas de l’emprise de sa sœur.
J’aime qu’un livre, comme une œuvre d’un autre art me fasse du bien, me nourrisse, me donne à réfléchir, m’apprenne des leçons de vie.
Mais pour cela il faut, même dans les récits les plus sombres, une étincelle de lumière, un peu de poésie ou de beauté. Toutes choses qui nous rattachent à la vie, la rende désirable.
Je me souviens encore avec émotion de la lecture que j’ai partagée lors d’un mot du jour « The God of Small Things » d’Arundhati Roy. L’histoire était terrible, injuste et tragique. Mais il y avait cette étincelle de vie, ces instants d’oubli, des moments de grâce.
Rien de tel dans « Sœurs », a l’instar d’un trou noir qui ne laisse échapper aucune lumière. D’ailleurs c’est par un trou noir que Juillet désigne sa sœur.
Un jour un musicien qui jouait avec mon frère et qui n’avait pas du tout apprécié une œuvre contemporaine qu’il avait dû jouer, en rencontrant le compositeur a eu cette formule :
« Maître cela a dû vous faire du bien quand cette œuvre est enfin sortie de votre tête.»
Je pense que cela a dû faire un bien fou quand cette histoire de folie, de chaos, de désagrégation, de mort est sortie de la tête de Daisy Johnson.
Je ne suis pas sûr qu’elle vous fasse du bien si elle rentre dans la vôtre.
Pour ma part je réponds : « Non » et je finirai par ce poème d’Eluard que j’ai déjà cité le 4 mai 2017 :
« La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin
une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie la vie à se partager.»
<1536>
-
Mardi 2 mars 2021
« Mais je pense que si les vaccins étaient déjà des biens publics mondiaux, il n’y aurait toujours pas de vaccin. »Hubert VedrineAujourd’hui, je voudrais partager les échanges très intéressants qu’ont tenu les invités d’Emilie Aubry dans son émission «l’Esprit Public», sur la situation sanitaire, les vaccins et la question de nos libertés et des contraintes que nous acceptons ou que nous accepterons pour vivre dans un monde qui nous paraîtra plus acceptable : <En finir avec le virus : un choix politique ? >. Cette partie de l’émission a duré 30 minutes.
Les invités étaient Hubert Védrine, Sylvie Kauffmann, Dominique Reynié et Aurélie Filippetti.
Beaucoup de questions ont été abordées notamment les difficultés des campagnes de vaccination et la comparaison des performances entre les différents États, ainsi que l’inégalité planétaire devant la vaccination.
Deux points de vue m’ont particulièrement interpellé :
- Le premier porté par Hubert Védrine sur la prouesse d’avoir été capable de découvrir des vaccins en quelques mois et l’organisation qui a permis cela.
- Le second point concerne nos libertés et a été avancé par Dominique Reynié.
Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’un questionnement, non d’une quelconque vérité qui serait révélée.
La question de l’échec de l’institut Pasteur a été évoquée et Hubert Védrine a enchaîné ainsi :
« L’échec de Pasteur évoque quelque chose qui m’amène à douter de l’objectif de bien public mondial pour les vaccins que beaucoup évoque.
Cet objectif, je ne peux pas le contester, c’est une très noble aspiration, très justifiée sur un plan humanitaire et planétaire.
Mais je pense que si les vaccins étaient déjà des biens publics mondiaux, il n’y aurait toujours pas de vaccin.
Si c’était un bien public mondial, je ne sais pas qui aurait financé la recherche, je ne sais pas qui aurait décidé, je ne sais pas qui aurait produit et qui aurait distribué.
C’est la compétition capitalistique, c’est l’excitation de l’investissement et il faut le reconnaître la décision énorme de Trump en matière de financement de recherche. »
Ce questionnement évidemment heurte ma zone de confort qui croit en la capacité de coopérer des humains et de se dévouer pour les causes humanitaires.
Mon expérience de presque 40 ans de fonctionnaire de l’État français me conduit cependant à reconnaître que l’administration et la force publique ont beaucoup de mal avec l’innovation.
Quand il s’agit de réaliser des procédures connues et des pratiques qui existent déjà, la bureaucratie est capable d’efficacité et de se mobiliser.
Mais ce qui s’est passé là est tout autre.
D’ailleurs le premier vaccin, n’a pas bénéficié de l’apport d’argent public dans la phase de recherche et de réalisation :
Sur ce <site> on lit
« Entre autres exemples, on y trouve la trace des financements accordés à Johnson & Johnson en mars. Puis à Moderna en avril ou encore les 1,2 milliard de dollars accordés à AstraZeneca. Mais aucune trace de Pfizer. Jusqu’au 22 juillet. Date à laquelle cette entreprise a bel et bien noué un accord avec les Etats-Unis. Non pas pour la recherche et le développement du vaccin mais uniquement pour sa distribution. « Le gouvernement américain a passé une commande initiale de 100 millions de doses pour 1,95 milliard de dollars et pourrait acquérir jusqu’à 500 millions de doses additionnelles »
C’est une entreprise capitalistique qui a lancé sa puissance de financement vers une entreprise innovante en qui elle avait confiance :
« C’est cette entreprise qui a parié sur le laboratoire allemand BioNtech. Et qui l’a financé. « En gros, je leur ai ouvert mon carnet de chèque pour qu’ils ne puissent se soucier que des défis scientifiques, et de rien d’autre » avait ainsi expliqué le PDG de l’entreprise, Albert Bourla. Interrogé en septembre dernier par CBS, il précisait qu’il voulait par cette méthode « libérer » ses chercheurs « de toute bureaucratie ». Tout en gardant sa société « hors de la politique ».
Pfizer a injecté lui-même des sommes astronomiques dans le projet porté par BioNTech. Le laboratoire « recevra un paiement initial de 185 millions de dollars, dont environ 113 millions de dollars en prise de participation, et pourra par la suite recevoir des paiements d’étape, jusqu’à 563 millions de dollars, soit un montant total potentiel de 748 millions de dollars », faisait savoir l’entreprise dans un communiqué. Car c’est ce laboratoire allemand qui possède la technologie novatrice de l’ARN messager (ARNm). Celle qui présente notamment l’avantage de pouvoir être développée rapidement, sans croissance cellulaire, et qui est au cœur du fonctionnement de ce candidat vaccin contre le Covid-19. On est bien dans un partenariat porté par des intérêts privés. Qui ont d’ailleurs permis au couple à la tête de cette PME d’environ 1.500 employés de faire leur entrée dans le classement des 100 Allemands les plus riches.
La recherche de ce nouveau vaccin prometteur a donc essentiellement été payée par son partenaire américain, qui collabore avec BioNTech sur les vaccins contre la grippe depuis 20108. L’Allemagne a toutefois elle aussi mis la main au porte-monnaie. Mais assez tardivement. Berlin a débloqué une aide totale de 375 millions d’euros pour ce groupe le 15 septembre dernier, après que celui-ci avait sollicité le gouvernement en juillet afin d’accélérer les capacités de fabrication et le développement du vaccin sur le marché national. »
Une administration publique a beaucoup de mal à lâcher autant d’argent en se fondant uniquement sur une question de confiance et de pari.
Ce que ces entreprises ont été capables de faire est unique dans l’histoire de l’humanité. Jamais on n’a su mettre au point un vaccin avec un tel taux de réussite en si peu de temps.
Mais pour ce faire il a fallu un financement gigantesque. Évidemment il y a eu une part considérable de financement public mais qui a suivi des financements privés. Et l’ensemble de l’élaboration des vaccins a été à l’initiative de partenaires privés, réactifs, extrêmement agiles.
Le journal <Les Echos> donne un peu plus de précisions sur le sujet du financement.
La bureaucratie ne permet pas cette réactivité. Or l’administration publique n’a pas su inventer, jusqu’à présent, un autre mode d’organisation que la bureaucratie
C’est pourquoi j’ai peur que Hubert Védrine ait raison.
Le second point concerne notre demande d’efficacité et notre capacité à accepter des contraintes de plus en plus fortes sur nos libertés pour retrouver des marges de manœuvre qui tourne beaucoup autour de la consommation même si dans nos propos ce sont le plus souvent des objectifs plus nobles que nous désignons.
Dominique Reynié a tenu ce discours :
« La question de l’efficacité se pose
La crise est planétaire et globale. Cela peut être très long et ce temps-là est un temps de mutation des systèmes démocratiques. Il fait de nos démocraties des régimes un peu plus autoritaires qu’ils ne l’étaient ». […]
La Chine se pose en modèle, avec un pouvoir plus contraignant et un contrôle beaucoup plus fort sur le comportement de ses administrés.
A quoi sommes-nous prêt pour revenir à la vie d’avant ? »
Et Dominique Reynié pointe le doigt sur ce que cela signifie pour beaucoup : une vie de consommateur, non une vie de citoyen. C’est une grande différence :
« Et nous comme nous sommes tous pris dans ces confinements et couvre-feu.
Dans une situation comme la nôtre aujourd’hui, on est en train de réviser, chacune mentalement peut s’observer à le faire, à la baisse nos exigences de liberté.
On veut des marges pas forcément des libertés.
Le risque qu’on se résolve à dire qu’avec nos grandes libertés, on ne va pas y arriver alors choisissons un régime politique dans lequel on aura plus de marge mais moins de liberté substantielle.
On acceptera de présenter son carnet de vaccination, « son QR code » pour aller au concert, on va consommer, on va se balader, on ira au restaurant, on ira en vacances, au moins on aura cette liberté-là, qui n’est pas une liberté substantielle.
C’est ce que les chinois offrent à leurs administrés.
La liberté politique, la vraie liberté on nous demandera d’en faire le deuil, pour bénéficier de cette liberté de consommateur. »
Et Sylvie Kaufmann ajouta :
« Je me souviens que c’est une question que nous avions abordé il y a quelques mois, la question des QR code.
Et Émilie vous m’aviez demandé alors : est qu’on va faire comme les chinois, montrer notre QR code pour aller au restaurant ?
Moi j’ai dit non, bien sûr parce qu’on ne va pas faire comme les chinois.
Et puis quelques mois plus tard, on s’aperçoit qu’on en débat sérieusement et cela devient une hypothèse plus que plausible. »
Pour celles et ceux qui ignoreraient d’où sort cette idée de QR code, vous trouverez des explications dans ces articles de journaux : « Le Monde » <TousAntiCovid : vers des QR codes dans certains lieux publics à risque>, « L’indépendant » <Vers un QR code pour aller au restaurant ?>
Des questions dérangeantes mais nécessaire pour avancer dans la compréhension de ce qui se passe.
Je vous invite à écouter cette émission : <En finir avec le virus : un choix politique ?>
<1535>
- Le premier porté par Hubert Védrine sur la prouesse d’avoir été capable de découvrir des vaccins en quelques mois et l’organisation qui a permis cela.
-
Lundi 1 mars 2021
« Le grand renversement »Pierre VerdragerAprès avoir fini la série des mots du jour concernant l’inceste j’ai lu un article du « Monde », publié le 26 février, : <Pierre Verdrager, le sociologue qui a vu un « grand renversement » au sujet de la pédophilie>.
Cet article parle du sociologue Pierre Verdrager qui s’intéresse de longue date à l’évolution de la perception de la pédocriminalité qui est évidemment un sujet plus vaste que l’inceste tout en l’incluant.
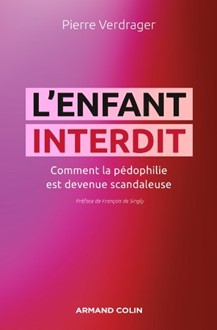 La première chose que j’ai appris dans cet article c’est que le livre : « L’enfant interdit » (Armand Colin, 2013) que ce chercheur avait publié en 2013 avait recueilli peu d’échos :
La première chose que j’ai appris dans cet article c’est que le livre : « L’enfant interdit » (Armand Colin, 2013) que ce chercheur avait publié en 2013 avait recueilli peu d’échos :
« zéro article de presse, une critique dans une revue spécialisée, deux passages radio et une poignée de colloques. »
Mais la parution du livre de Vanessa Springora « Le consentement » et paru début janvier 2020 a joué un rôle considérable dans l’évolution du jugement du monde médiatique. J’aimerai écrire une évolution des mentalités, je l’espère et c’est possible. Mais si on reste rigoureux, ce qui est incontestable c’est qu’aujourd’hui, dans les médias, les articles sont très clairement anti-pédophiles. D’ailleurs le mot « pédophile » ce qui signifie « aimer les enfants », ce qui peut apparaitre comme positif, au minimum ambiguë a été remplacé par « pédocriminalité » qui met l’accent sur l’interdiction et la réprobation, ce qui me parait plus juste et plus clair.
Car pendant longtemps « Le Monde », « Libération » et « Gai-Pied » ont ouvert des tribunes à des intellectuels qui étaient ouvertement pédocriminels ou au minimum favorable à la pédocriminalité.
Pour s’en convaincre, il faut regarder la vidéo qui est présente à la fin de cet article du Figaro <Affaire Matzneff: quand des intellectuels défendaient la pédophilie>
Ce même article du Figaro qui nous apprend que Gabriel Matznef a commis un livre qui se veut une réponse au livre « Le consentement ».
Ce livre qui a pour titre « Vanessavirus » et qui compare donc son accusatrice à un virus, n’a pas trouvé d’éditeur pour l’éditer.
L’homme qui comparaîtra devant un tribunal en septembre pour « apologie de la pédophilie » a donc auto-édité l’ouvrage et le vend par souscription à un cercle restreint d’amis et de connaissances,
Le Figaro écrit :
« Acheter le livre est une forme de soutien à un homme privé de revenus depuis que ses éditeurs ont « suspendu » indéfiniment la vente de ses livres. Le Centre national du livre l’a, également, rayé des bénéficiaires d’une allocation pour écrivains à faibles ressources. Deux tirages ont été proposés aux lecteurs. Un, dit ordinaire, à 100 euros, et un autre, de luxe, à 650 euros. L’auteur a, également, prévu un premier tirage de deux cents exemplaires.
La liste des souscripteurs devrait rester un secret bien gardé. L’un d’eux, contacté par l’AFP, et qui n’avait pas encore reçu, mercredi, son exemplaire, témoigne sous anonymat. «J’aime les livres rares et sulfureux. Tous les éditeurs lui ont fermé la porte, et moi je me suis dit que j’aimerais bien l’avoir, a-t-il expliqué. […]
Selon une autre source, Gabriel Matzneff rend hommage à «cinq soutiens indéfectibles», à savoir Alain Finkielkraut, Catherine Millet, Dominique Fernandez, Franz-Olivier Giesbert et Bernard-Henri Lévy. Ce dernier, qui a signé plusieurs critiques élogieuses des livres de Gabriel Matzneff, ne s’est pas exprimé sur le sujet après la parution du Consentement. En juin 2020, la romancière Catherine Millet avait déclaré, quant à elle, ne pas regretter avoir signé une pétition lancée par M. Matzneff en 1977 pour la dépénalisation des relations sexuelles avec des mineurs. »
Cette page de France Inter en dit davantage sur ce livre : <Ni remords, ni autocritique, on a lu « Vanessavirus » de Gabriel Matzneff > et dresse le constat suivant :
« Le texte d’un homme résolument sourd à la souffrance qu’il a pu causer. »
Il existe donc encore quelques rares intellectuels qui essaient de trouver des mots pour défendre l’homme et peut être ses actes.
C’est à partir de la sortie du livre « Le Consentement » et de l’affaire Matzneff qui s’en est suivi que le travail de Pierre Verdrager a été mis en lumière.
Je l’avais d’ailleurs cité, comme « l’enfant interdit » lors du mot du jour du 31 janvier 2020 consacré au livre de Vanessa Springora « Le consentement »
Et, c’est ce moment de la publication du livre que Pierre Verdrager définit comme le moment du grand renversement.
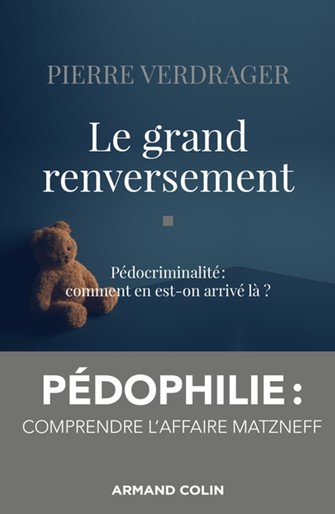 Il a fait paraître le 24 février, toujours chez Armand Colin, un livre qui reprend son étude de l’enfant interdit en la synthétisant et en l’actualisant : « Le grand renversement »
Il a fait paraître le 24 février, toujours chez Armand Colin, un livre qui reprend son étude de l’enfant interdit en la synthétisant et en l’actualisant : « Le grand renversement »
Il estime que la société a enfin opéré un changement.
Le hasard a voulu que son livre soit contemporain du dernier opuscule de Matzneff.
En quatrième page on lit :
« On ne se souvient généralement pas que la pédophilie a été considérée comme une cause défendable voici seulement une cinquantaine d’années. Au nom du processus de libération des mœurs, de grands intellectuels, de grands éditeurs, de grands journaux, à gauche mais aussi à droite, homosexuels comme hétérosexuels, l’ont défendue de façon passionnée. Certes, une telle position faisait débat. Mais certains étaient résolument convaincus que la lutte en faveur de la pédophilie était un combat politique qui valait la peine d’être mené. Ce livre se replonge dans les controverses de l’époque et passe à la loupe les arguments des différents protagonistes. L’auteur observe ensuite comment ces controverses s’arrêtent, la défense de la pédophilie devenant peu à peu impossible. Mais c’est en 2020, avec la publication du Consentement de Vanessa Springora, que la question pédophile subit sa dernière métamorphose. »
Une production de <L’INA> montre que la télévision française, dans ces mêmes années, avaient les mêmes faiblesses coupables. On voit même Françoise Giroud traiter légèrement de relations sexuelles entre un adulte et un enfant.
Et on revoit l’émission de Bernard Pivot, dans laquelle Matzneff peut dévoiler ses passions pour les jeunes filles sans entrainer la moindre réprobation de l’intelligentsia présente. Seule une auteure canadienne Denise Bombarbier ose exprimer un avis divergent :
« Moi, monsieur Matzneff me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas c’est que dans ce pays la littérature sert d’alibi pour de telles confidences.»
Elle était seule, bien seule.
Quelques jours après cette confidence, Matzneff était à nouveau invité par la télévision et il y avait l’écrivain et intellectuel très apprécié dans le monde littéraire Philippe Sollers qui va tenir ces propos ignobles :
« La connasse qu’on vient d’entendre qui est canadienne je crois, qui déraisonne comme ça à la télévision … »
Édifiant non ?
Pierre Verdrager souligne le combat dévoyé que certains défenseurs de la liberté sexuelle pour les homosexuels ont voulu élargir aux enfants.
En 2007, Pierre Verdrager publie « L’Homosexualité dans tous ses états ») réalisé à partir d’entretiens :
« C’est en lisant les journaux gay comme Gai Pied et en découvrant les articles de défense de la pédophilie que je me suis dit qu’il fallait que je creuse ».
Quand le Monde précise : « Il sait qu’il peut être accusé de faire le jeu de l’amalgame entre homosexualité masculine et pédophilie, que les gays ne cessent de combattre. ».
Il répond :
« Je n’ai jamais caché mon homosexualité[…] En tant que gay, j’ai plus de facilité à aborder ce sujet et personne ne peut me soupçonner d’être homophobe.
[C’est le Congrès] de l’International Lesbian and Gay Association (ILGA) en 1994, qui décide d’exclure les associations favorables aux rapports majeurs/mineurs. »
Et il oppose certains gays aux féministes :
« La libéralisation de la pédophilie annonçait pour certains gays une victoire de la liberté, alors qu’elle signifiait pour de nombreuses féministes une victoire de la domination masculine. »
Ce grand renversement de la défense à la condamnation de la pédocriminalité, Pierre Verdrager en trouve la confirmation dans le succès du livre de Camille Kouchner, La Familia grande (Seuil), et par la médiatisation de nombreuses affaires de violences sexuelles sur mineurs :
« Il faut faire attention à la présomption d’innocence, prévient-il. Mais nous vivons une période d’effervescence très positive. […] Cela a été une grande erreur de Michel Foucault et d’autres intellectuels de ne pas avoir compris que la sexualité entre un adulte et un mineur était une violence, même sans coups. […] La société ne se raidit pas. Elle se place du côté des dominés et des victimes pour dire le droit. C’est un bouleversement complet. »
C’est une parole et une vision salvatrice qui me semblait mériter un partage.
<1534>
-
Vendredi 26 février 2021
« Le pansement Schubert »Claire OppertAvril 2012. Paris. Un EHPAD :
« Une femme hurle et se débat.
Deux infirmières s’agitent autour d’elle, la maintenant fermement pour l’empêcher de tomber de son fauteuil, tout en parant ses attaques. Elles doivent absolument refaire le pansement de Mme Kessler. La plaie de son bras droit est purulente. (…)
Je ne sais pas ce qui me pousse à m’arrêter devant elle.
Je ne prononce pas une parole.
Je m’assieds et lui joue au violoncelle le thème de l’andante du Trio op. 100 de Schubert.
Les cris cessent, le calme revient.»
C’est l’expérience que raconte la violoncelliste Claire Oppert, musicienne et art-thérapeute. Face à ce soulagement, l’une des infirmières dit à la violoncelliste et musicothérapeute :
« Il faut absolument revenir pour « le pansement Schubert » ».
C’est ainsi que l’expression est née. Depuis, « le Pansement Schubert » est devenue une étude clinique, expérimentée sur les patients déments et sur les personnes en soins palliatifs. Le protocole expérimental mené sur plusieurs mois, 120 soins réalisés en compagnie de l’instrument. A la clé, une réelle diminution de la douleur physique, un apaisement de l’angoisse et pour tous ces hommes et femmes en souffrance, le sentiment de tutoyer de nouveau la vie.
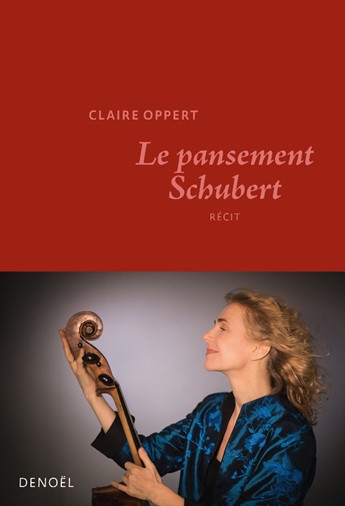 « Le pansement Schubert », c’est aussi le titre que Claire Oppert a donné à son livre qui a été publié en février 2020 et dans lequel elle raconte ses rencontres, ses réflexions sur l’art qui l’ont menée à découvrir un remède innovant contre la douleur physique et la souffrance morale : la musique.
« Le pansement Schubert », c’est aussi le titre que Claire Oppert a donné à son livre qui a été publié en février 2020 et dans lequel elle raconte ses rencontres, ses réflexions sur l’art qui l’ont menée à découvrir un remède innovant contre la douleur physique et la souffrance morale : la musique.
C’était le 24 décembre lors de l’émission de la Grande Table d’Olivia Gesbert : <Claire Oppert, cordes sensibles> que j’ai entendu pour la première fois parler de cette femme étonnante qui est violoncelliste, concertiste et membre de l’équipe thérapeutique de l’hôpital Rives de Seine dans les Hauts-de-Seine.
Olivia Gesbert la présente ainsi :
« Apaiser la souffrance et offrir un moment de grâce, c’est la mission que la violoncelliste Claire Oppert se donne depuis 20 ans. De retour de Moscou où elle fait ses classes au conservatoire de Tchaikovsky, Claire Oppert n’emprunte pas la voie toute tracée d’une soliste classique. Loin d’une carrière en musique de chambre, l’intuition guide la soliste vers les hôpitaux. Auprès des jeunes autistes d’abord, après la rencontre décisive avec le docteur en psychologie clinique, écrivain et clown Howard Buten, auteur de « J’avais cinq ans quand je m’ai tué », célèbre récit sur l’enfance. Aux côtés de ces enfants privés de parole, Claire Oppert découvre que l’instrument permet de nouer un dialogue par la voix du violoncelle. C’est que l’instrument produit une sonorité au plus proche de la voix humaine, quelque chose qui résonne profondément en l’humain. »
Dans l’émission elle raconte sa rencontre et sa collaboration avec Howard Buten auprès d’enfants autistes. Elle dit :
« Le violoncelle est une voix qui me permet de communiquer. Je ne suis pas une » sauveuse » mais j’ai la chance de pouvoir passer des moments inouïs grâce au violoncelle et pour citer Howard Buten, pouvoir être à la hauteur des autistes, se rendre suffisamment intéressant et trouver des moyens pour susciter leur attention »
Howard Buten va lui demander de ne pas ouvrir de livre sur ce sujet pour privilégier l’approche intuitive.
Elle raconte comment un enfant autiste détruit son violoncelle d’un coup de poing, en pleine cinquième suite de Bach, avant de la regarder pour la première fois dans les yeux. Ce premier regard est une étape dans l’évolution de cet enfant malade, au prix d’un instrument.
 Après les enfants autistes, elle va à la rencontre des malades et des patients en fin de vie, dans les unités de soin palliatifs.
Après les enfants autistes, elle va à la rencontre des malades et des patients en fin de vie, dans les unités de soin palliatifs.
Elle dit :
« Je pense qu’il y a un lien fondamental entre l’art et le soin. C’était mon grand idéal, depuis l’enfance, entre ma mère artiste et mon père médecin. J’ai toujours souhaité réconcilier, d’unir le monde de l’art et du soin […]
La musique est le canal d’une communication nouvelle et subtile. Il y a un enchantement dans le monde sonore, dans la beauté de la musique qui entre-ouvre les cœurs. C’est une forme de miracle dans le sens merveilleux […]. Je suis là comme une accompagnante, j’aide à créer un « kairos », un moment opportun pour tenter de donner le plus de sens possible, jusqu’au bout. […] Le pansement Schubert n’élimine pas toutes les douleurs, c’est un complément dans une équipe pluridisciplinaire qui s’adresse dans l’être à la personne non malade, la personne vivante non touchée par la pathologie. C’est très lumineux, car la musicienne thérapeute comme on dit s’adresse à une partie de l’être qui n’est pas malade, et ce, depuis les débuts de l’humanité. »
Elle fut aussi invitée par Elisabeth Quin dans son émission 28 Minutes sur Arte <La musique adoucit les maux>. Il faut absolument regarder cette émission.
Et le dimanche 31 janvier 2021, elle a participé à l’émission : « Une journée particulière » de Zoé Varier.
France 2 lui a consacré un reportage : <Musique apaiser les souffrances>
Le Monde lui a aussi consacré un article en novembre 2020 <La violoncelliste Claire Oppert au diapason des patients>
On y apprend que dans le service de soins palliatifs de l’hôpital Rives-de-Seine, à Puteaux, quand Claire Oppert pousse une à une les portes des chambres elle n’a pas la moindre idée de ce qu’elle y jouera ni de l’accueil qui lui sera réservé :
« Bonjour monsieur. Vous voyez, un violoncelle vient vous rendre visite. Est-ce que cela vous dirait un petit morceau ? » La voix est douce, la robe longue vaporeuse, comme la chevelure. Claire Oppert a l’air de la fée qui dote le nouveau-né de dons musicaux en effleurant de l’archet son berceau. Elle évolue au ralenti, comme pour se mettre au diapason des malades. Dose son jeu, afin que nul son ne les agresse. Adapte son rythme à leur respiration pour la soutenir, pour dialoguer.
Chambre 61, la moustache blanche de Georges, 98 ans, frétille lorsque la musicienne apparaît. Qu’est-ce qui lui ferait plaisir ? « Ce que vous voulez, du moment que c’est beau ! », s’enthousiasme déjà le patient en liquette bleue d’hôpital, calé par un gros oreiller. Va pour un extrait de L’Adagio d’Albinoni, puis de l’Ave Maria de Gounod. La musique emplit la pièce. Les boîtes de médicaments, le pichet en plastique, le fauteuil de faux cuir qu’occupe un fils anxieux, tout s’efface dans l’intensité du moment. Georges, qui se meurt d’un cancer de la thyroïde, savoure. Il ferme les yeux, renverse sa tête sur l’oreiller, pleure et sourit en même temps. Lorsque le silence revient, il joint les mains. « Bravo, c’est majestueux ! Vous exprimez des sentiments, je vous envie. Vous m’avez mis de la joie dans le cœur. Merci, merci, merci. Transmettez cette joie aux autres aussi. » »
 Et je cite un autre extrait de cet article :
Et je cite un autre extrait de cet article :
« Récemment, elle s’est lancée dans une nouvelle étude sur la musique lors du dernier souffle du patient. « Quand on est très malade, pour mourir, même si le corps est très abîmé, il faut un lâcher-prise, sait le docteur Gomas. Le malade décède à un moment qu’il choisit, pour épargner ses proches. Difficile d’imaginer que la musique n’ait pas un impact sur ce lâcher-prise…
Chambre 62, une très vieille dame aux longs cheveux blancs, torturée par la maladie d’Alzheimer et le cancer, s’apaise, sur l’air des Feuilles mortes. Souffle ralenti, elle s’endort. Claire Oppert s’esquive. Immédiatement elle note, pour transmission à ses collègues, l’effet de la composition de Joseph Kosma sur la patiente. Un antalgique puissant. »
J’ai enfin trouvé cet article sur un site spécialisé et à destination des infirmiers : « La musique vivante permet à la personne malade, au cours du soin douloureux, de rejoindre un noyau identitaire, profond, sain et vivifiant »
Encore un article plein de douceur et d’éloge pour cette étonnante violoncelliste qui raconte dans l’article du monde que ses études au conservatoire Tchaïkovski de Moscou n’ont pas été simples :
« J’y ai connu l’humiliation, la violence, la peur, dit-elle. Comme pédagogue, je me suis construite à rebours. »
Et elle ne joue pas que de la musique classique pour les malades. Elle est très éclectique et interprète aussi du Brel et du Piaf, du Johnny, des tangos et valses musette, du rap et même du métal.
Je terminerai par cet <extrait de l’andante du second trio de Schubert> qu’elle interprète et qui est le morceau à l’origine du « pansement Schubert »
<1533>
-
Jeudi 25 février 2021
« Avant, nous allions à l’auditorium de Lyon »Lieu de nombreuses émotions et dans lequel a eu lieu les victoires de la musiqueAvant, le matin, je sortais de chez moi et je me rendais à mon bureau qui se trouvait dans le quartier de la Part-Dieu.
Et de ce lieu de travail que j’ai quitté il y a presque 1 an, j’avais une vue plongeante sur l’auditorium Maurice Ravel…
 Mais c’était avant.
Mais c’était avant.
Avant, je ne voyais pas que ce bâtiment de l’extérieur.
Avec Annie, nous nous rendions très souvent dans ce bâtiment, pour entendre des concerts avec des musiciens qui jouaient sur scène.
L’émotion, la beauté, les vibrations nous les vivions ensemble avec beaucoup d’autres, plus de 2100 places sont disponibles dans ce lieu.
Souvent, la salle était très remplie.
Quelques mots du jour ont célébré des concerts que nous y avons vécu.
- «Réaliste, indestructible et révolutionnaire dans un monde uniformément fade et mécanisé» évoquait un concert de Martha Argerich le 8 décembre 2019, avant donc.
- « La 10ème symphonie » de Dimitri Chostakovich, après un concert dirigé par le tout jeune chef Klaus Mäkelä dont je disais à mon ami Bertrand qu’il en entendra parler. Depuis il a été nommé directeur musical de l’Orchestre de Paris
- « Grigory Sokolov » après un concert de cet extraordinaire pianiste en novembre 2018
- « Faire de la musique ensemble » après une semaine de janvier 2018 où j’y étais allé 3 fois.
- « Vous avez la chance d’exercer un métier dont le but est de créer la beauté » où je relatais une lettre de remerciements que j’avais écrite aux musiciens de l’orchestre après un concert sublime d’avril 2017.
- « La symphonie Pathétique » après un concert de novembre 2016 dans laquelle cette symphonie avait été jouée.
- «Alle Menschen werden Brüder… » après une interprétation de la 9ème de Beethoven en septembre 2015.
Mais c’était avant.
Alors quand Laurent qui continue à aller au lieu de travail, où j’allais avant, m’a expliqué, qu’il voyait que c’était l’effervescence devant l’auditorium et qu’avec le matériel qu’il voyait débarquer pour organiser et filmer les victoires de la musique classique, il fallait absolument que je regarde France3, hier soir.
J’ai donc regardé.
 C’était très bien.
C’était très bien.
Mais ce n’est pas la même chose que d’être dans la salle et de partager la musique, de la vivre ensemble dans un même lieu.
Ce lieu, cet auditorium qui a été inauguré en 1975 et qui a eu pour nom « Maurice Ravel », parce que Ravel était né en 1875, soit cent avant.
Mais si pour les mélomanes cette période de disette est lourde et désespérante, comme pour les amateurs de cinéma à cause de l’absence de cinéma ou pour les amateurs de théâtre, que dire de l’épreuve que subissent les artistes, tous les acteurs de spectacles vivants qui ne peuvent plus exercer leur art ?
Que dire des artistes culinaires qui nous accueillaient, avant, dans des restaurants dans lesquels nous pouvions nous asseoir et attendre qu’on vienne nous apporter le repas que nous avions choisi ?
Alors, je suis très partisan que le monde d’après soit amélioré par rapport à celui d’avant.
Mais il y a quand même des choses que nous désirons retrouver comme avant : aller au concert, au cinéma, au théâtre, au restaurant.
Vous pouvez trouver des extraits de ce spectacle sur Internet.
Ainsi cet <hommage à Ennio Morricone> décédé le 6 juillet 2020.
Le percussionniste Aurélien Gignoux a été distingué. Je vous invite à regarder <Cette interprétation de Ravel> sur Marimba mise en ligne par France Musique. Cela révolutionnera peut être votre perception de ce que peut faire un percussionniste.
<1532>
- «Réaliste, indestructible et révolutionnaire dans un monde uniformément fade et mécanisé» évoquait un concert de Martha Argerich le 8 décembre 2019, avant donc.
-
Mercredi 25 février 2021
«Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter même en rêve.»Khalil Gibran, vos enfants, « Le prophète »C’est la première fois que j’utilise le même texte pour deux mots du jour. Je l’avais utilisé il y a bien longtemps, tout au début de l’aventure du mot du jour en décembre 2012.
Mais comme exergue j’utilise un autre des vers de ce poème qui parle des enfants.
Les enfants qui n’appartiennent pas à leurs parents qui ne peuvent en faire leur objet de domination, leur objet d’exploitation, leur objet sexuel.
Les enfants qui sont les fils et les filles de l’appel de la vie à elle-même.
C’est avec ce poème qui célèbre la sacralité de l’enfant que je termine cette série consacrée au sacrilège de l’inceste.
Même si les évolutions sont lentes et peuvent décourager des victimes qui trouvent que la prise de conscience reste insuffisante notamment chez celles et ceux qui ont laissé faire, n’ont pas voulu voir, n’ont pas su agir, je crois qu’il existe une lame de fond qui emporte avec elle les anciennes croyances et structures qui ont couvertes et laissé faire ce crime de masse à l’égard des enfants.
Des livres ou des podcasts comme cette série de 6 émissions < Ou peut-être une nuit> qui fait référence aux paroles de la chanson « L’aigle noir de Barbara » et qui a été réalisée par la journaliste Charlotte Pudlowski ouvrent de plus en plus le cercle de la compréhension et celui de l’intolérance à des pratiques et des théories sur lesquelles les pervers se sont appuyés pour pratiquer leurs sordides agissements.
Certains propos ne peuvent plus être tenus, plus être écrits.
Les choses bougent.
Estelle nous a indiqué en commentaire lors du premier mot du jour de la série vers « le magistral travail d’Ariane Bilheran » https://www.arianebilheran.com
Sur ce site j’ai trouvé une interview datant du 12 janvier 2021 du Dr Régis Brunod, pédiatre et pédopsychiatre très intéressante : «Préserver l’innocence des enfants»
Je republie donc ce magnifique poème de Khalil Gibran
« Une femme qui tenait un nouveau-né contre son sein dit :
Parle-nous des enfants.
Il dit:
Vos enfants ne sont pas vos enfants
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même
Ils passent par vous mais ne viennent pas de vous
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas
Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées
Car ils ont leurs propres pensées
Vous pouvez accueillir leurs corps, mais pas leurs âmes
Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter même en rêve
Vous pouvez vous efforcer d’être semblables à eux
Mais ne cherchez pas à les rendre semblables à vous
Car la vie ne revient pas en arrière ni ne s’attarde avec hier
Vous êtes les arcs à partir desquels vos enfants,
Telles des flèches vivantes, sont lancées
L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini,
Et Il vous tend de Sa puissance
Afin que les flèches soient rapides et leur portée lointaine.
Puisse votre courbure dans la main de l’Archer être pour l’allégresse
Car de même qu’Il chérit la flèche en son envol, Il aime l’arc en sa stabilité »
Khalil Gibran
<1531>
-
Mardi 23 février 2021
«Marie France [Pisier] remet les choses à l’endroit !»Camilla KouchnerJ’adorais Marie France Pisier. C’était une merveilleuse actrice, d’une grande intelligence, très cultivée. Mais c’était avant tout une voix. Une voix bouleversante et pleine de chaleur et de distinction.

Je me souviens aussi d’avoir lu avec beaucoup de bonheur, son premier roman : « Le bal du gouverneur ».
J’avais appris avec beaucoup de tristesse sa mort en avril 2011, la nuit, dans sa villa située dans le Var.
Sa mort est obscure et mystérieuse : elle a été retrouvée au fond de sa piscine par son mari, portant des bottes en caoutchouc, sa tête et ses épaules coincées dans le croisillon métallique d’une « lourde chaise en fer forgé ».
Elle n’est pas morte noyée, l’autopsie n’a pas trouvé d’eau dans les poumons.
Depuis la parution du livre « La familla grande », tout le monde sait ce qu’une toute petite élite germanopratine savait depuis plusieurs années : Marie-France Pisier était dévorée par une colère et une révolte de ce qu’elle avait appris au sein de sa famille : son beau-frère Olivier Duhamel avait abusé de son neveu, fils de sa sœur Evelyne Pisier et de Bernard Kouchner. Elle le racontait à toutes celles et ceux qu’elle connaissait pour tenter de construire un vide sanitaire autour du prédateur.
A plusieurs reprises, elle a essayé de convaincre son neveu et sa nièce Camilla de porter plainte. Elle n’a pas porté plainte parce que la victime, son neveu ne le voulait pas.
Marie-France Pisier était une fille de mai 1968, elle était totalement libre dans sa vie affective et sexuelle.
On peut lire partout qu’elle a accumulé les amants, qu’elle en a même échangé avec sa sœur Evelyne dont elle était si proche.
Mais Marie-France Pisier dans sa liberté, avait les pieds ancrés profondément dans le sol des valeurs. Elle savait qu’il y avait des limites à ne pas franchir.
C’est la victime, le fils, qui a raconté à sa mère Evelyne ce que son compagnon lui avait fait subir.
Evelyne n’a pas consolé son fils, elle s’est enfuie auprès de sa sœur, sa confidente de toujours.
Elle lui a raconté l’innommable et elle espérait l’empathie de sa sœur.
Camilla Kouchner raconte dans l’émission «la Grande Librairie» qui a été consacrée à son livre :
« Elle va se réfugier chez sa sœur Marie France. Et puis, elle trouve chez Marie France assez peu d’empathie. Marie France lui dit : ça c’est non ! Ce que tu me racontes c’est impossible. C’est impossible que tu viennes me dire que tu es mal ! Ce n’est pas toi qui est mal, ce sont tes enfants qui sont mal ! Marie France remet les choses à l’endroit ! »
Et Marie France n’aura de cesse d’exiger que sa sœur quitte le prédateur. Elle s’engage à l’aider financièrement et moralement pour affronter cette rupture.
Evelyne Pisier n’en fera rien. Comme d’autres mères, elle restera dans le déni, défendra son homme, bien qu’il soit prédateur.
 Elle accusera même ses enfants de l’avoir provoqué, d’avoir séduit le mâle alpha de la famille.
Elle accusera même ses enfants de l’avoir provoqué, d’avoir séduit le mâle alpha de la famille.
C’est pourquoi, il est tellement important qu’il existe des personnes comme Marie-France Pisier qui remettent les choses à l’endroit.
Il existe des situations qui sont complexes et dans lesquelles les responsabilités ne sont pas claires.
Rien de tel quand il s’agit d’un acte sexuel que commet un adulte sur un enfant de 13 ans surtout lorsqu’il exerce une autorité paternelle sur lui.
Il n’y a pas de complexité, il y a asymétrie, il y a emprise, il y a crime.
Evelyne Pisier tergiverse, cherche des échappatoires et finalement accuse les enfants.
Marie-France Pisier dit non ! et choisit son camp, celui de ses neveux et se fâche avec sa sœur avec laquelle elle était si liée.
Mon éducation religieuse revient parfois par des paroles de sagesse qui m’ont construit.
Et l’attitude remarquable et juste, oui juste de Marie France Pisier me font songer à celle-ci :
« Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans la géhenne. »
Evangile selon Matthieu 5:30
Pour Marie France Pisier, sa sœur était l’équivalent de sa main droite. Elle n’a pas accepté d’être entrainé dans sa chute, dans le mauvais combat ou dans le combat du mauvais côté.
Camilla Kouchner était l’invitée de Quotidien de Yann Barthès le 15 février et quand Yann Barthés lui a demandé ce que représentait sa tante pour elle, elle a répondu :
 « Elle est essentielle.
« Elle est essentielle.
Elle est essentielle à tout point de vue. C’était notre tante chérie. […]
Moi elle m’a écoutée, et elle m’a bousculée, elle m’a dit ‘fais toi confiance, il y a des choses qui sont autorisées et il y a des choses qui sont interdites. Ce qu’on m’a raconté est interdit.
Marie France était pleine de joie pleine de liberté.
Au bon sens du terme, pas au sens dévoyé du terme.
Elle était pleine d’inventivité, mais elle avait des limites.
Et là, elle a très clairement marqué la limite quand elle a appris ce qui était arrivé. »
Il faut davantage de Marie-France Pisier dans la société.
S’il nous arrive d’être confronté à de tels agissements et nous savons qu’il en est beaucoup, puissions-nous nous inspirer de Marie-France Pisier.
L’émission La grande librairie, n’est plus en ligne intégralement mais cette émission de BFMTV : « Affaire Duhamel, un si lourd secret » décrit fidèlement les faits que j’ai repris dans ce mot du jour.
<1530>
-
Lundi 22 février 2021
« Le berceau des dominations »Dorothée DussyAprès les récits et les chiffres, il est nécessaire de faire appel à une parole plus scientifique. Lors de l’émission de la Grande Librairie déjà évoquée, Camilla Kouchner ainsi que Muriel Salmona qui intervenait en tant que présidente d’une association luttant contre les violences sexuelles, ont toutes les deux évoqué la lecture d’un livre qui a été fondateur dans leurs réflexions et prises de conscience.
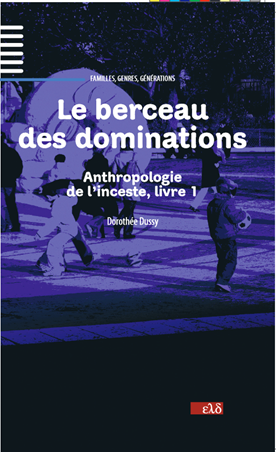 Ce livre est « le berceau des dominations » de l’anthropologue Dorothée Dussy. Ce livre publié en 2013 est épuisé, mais on annonce une nouvelle édition en avril 2021.
Ce livre est « le berceau des dominations » de l’anthropologue Dorothée Dussy. Ce livre publié en 2013 est épuisé, mais on annonce une nouvelle édition en avril 2021.
Il est épuisé mais il existe une version en ligne derrière ce lien : <Le berceau des dominations>
Ce livre commence ainsi :
« Tous les jours, près de chez vous, un bon père de famille couche avec sa petite fille de neuf ans. Ou parfois elle lui fait juste une petite fellation. Ou c’est un oncle avec son neveu. Ou une grande sœur avec sa petite sœur. Le terme consacré pour désigner ces pratiques sexuelles imposées à un enfant de la famille est «inceste». Madame et monsieur, médecins, magistrats, journalistes, écrivains, auteurs de théâtre, chanteurs, historiens, psychologues et psychiatres, définissent ainsi l’inceste. C’est ainsi que tout le monde définit l’inceste, en fait, à l’exception des anthropologues, qui n’ont pas de nom pour dire cette pratique courante de la vie quotidienne dans les familles, happés qu’ils ont été par l’attention portée à la théorie de l’interdit de l’inceste qui indique des règles de prohibitions matrimoniales. La force centrifuge qui a ramené inlassablement les anthropologues à la théorie de l’interdit de l’inceste est si puissante qu’elle a opéré sur eux comme le fait aux yeux la lumière vive avant d’entrer dans une pièce sombre. Françoise Héritier, après avoir consacré une grande partie de sa carrière aux règles de l’exogamie à travers le monde, a tenté de mettre face à face la théorie et le point de vue des praticiens, sans réaliser qu’elle n’avait jamais travaillé sur le problème théorique de l’inceste, mais sur celui de l’interdit de l’inceste. Je reprends donc le dossier de l’inceste et l’ouvre à la dimension empirique. Je suis anthropologue moi-même et fais grand cas de l’articulation de la règle sociale et de la pratique. […]. À la faveur du réel et de la banalité des abus sexuels commis sur les enfants, on verra que l’inceste est structurant de l’ordre social. Il apparaît aussi comme l’outil primal de formation à l’exploitation et à la domination de genre et de classe. Nul besoin que chacun passe à la casserole pour que l’inceste éclabousse tout le monde. »
Elle utilise la terminologie « incesteur » pour le prédateur et « incesté » pour la victime.
Sur le site Bastamag , elle explique pourquoi l’ensemble de la société est éclaboussée par l’inceste.
« L’inceste ne se réduit pas aux faits sexuels mais les déborde largement pour maculer et organiser les relations entre les gens de la famille au quotidien. Il faut donc ajouter au comptage des victimes de l’inceste les frères, sœurs, conjointes et bien d’autres. Il y a pour tout le monde une incorporation de la peur et de la grammaire du silence. On va s’habituer à se taire dans sa vie professionnelle, amicale, sportive parce que c’est ce avec quoi on a été construit. On va considérer normal de se taire et être aveugle quand une agression a lieu devant nous. Combien d’entre nous ont fait cette expérience d’une agression dans les transports en commun, avec personne qui bouge, même si c’est bondé ? On a intériorisé qu’il faut se taire si un rapport de domination se manifeste devant nous. »
Elle exprime une vision culturelle de l’inceste : elle y voit la mise en œuvre d’un rapport de domination sexuelle spécifique aux sociétés humaines, lesquelles sont moins brutales que les sociétés animales, mais se montrent trop sourdes à ces agissements pour que l’on doute de leur caractère structurel.
Le « berceau des dominations » est bien sûr dans son esprit, la famille patriarcale, hiérarchisée dans laquelle se joue les rapports de domination.
Ce n’est pas la justice qui peut régler ce problème mais une révolution anthropologique qui remet en question le modèle qui rend possible ce crime structurel ainsi que le silence qui s’impose à lui.
Dorothée Dussy travaille au CNRS et est membre de L’IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux).
« Le berceau des dominations » est présenté comme le premier livre d’une trilogie consacrée à « l’ordre social incestueux ».
A ma connaissance, seul le premier a été publié.
Ce premier ouvrage étudie les « incesteurs » tandis que les deux prochains devraient être consacrés aux « incestées.
Dans son premier volume, elle a enquêté auprès de 22 auteurs d’incestes, tous incarcérés dans une prison du Grand Ouest de la France. Ils ont entre 22 et 78 ans et sont issus de diverses classes sociales, avec une majorité provenant de la classe moyenne et populaire.
Pour Dorothée Dussy l’inceste et le silence qui l’entoure sont constitutifs de l’ordre social :
« L’intériorisation des abus sexuels et du silence qui les entoure pour les incestés, l’impact suffisamment fort de l’inceste sur les incestés pour que ceux-ci en donnent à voir les effets aux autres enfants (…) participent d’une description complète des processus de fabrication des dominateurs et des dominés » (pp. 255-256).
Depuis que l’affaire Duhamel a été dévoilée, de nombreux journaux ont donné la parole à l’auteure du « berceau des dominations »
Sur le site Bastamag Dorothée Dussy décrit la vérité crue sur le soi-disant « tabou de l’inceste » :
« S’il y a un interdit, ce n’est pas de violer les enfants de la famille, mais plutôt de parler des incesteurs. »
Et elle ajoute :
« On stigmatise l’acte, mais on banalise l’acteur. Les campagnes de sensibilisation à l’inceste, par exemple, s’adressent toujours aux victimes, et jamais aux auteurs. Comme si ce n’était pas eux le problème. Or, pour incester des millions d’enfants, il faut du monde. Précisons qu’ils savent, bien évidemment, que ce qu’ils font n’est pas autorisé, mais ils s’en accommodent. Et il n’y a aucune pulsion sexuelle. La preuve : ils s’organisent pour se cacher, et intiment toujours à leurs victimes de se taire. »
Ce qui est accablant c’est la banalité des « incesteurs ». Dans <Libération> elle fait ce constat et parle de « viol d’aubaine »:
« Les incesteurs sont des hommes comme les autres […] L’incesteur n’est généralement pas un pédophile. Plutôt un homme normal qui s’autorise – quand l’occasion se présente, parce que ce sont des viols d’aubaine – à avoir des rapports sexuels avec un enfant de la famille. Il considère que cet enfant est à sa disposition : il le soumet alors à son désir sexuel du moment. Les incesteurs ne sont pas des monstres mais des hommes comme les autres : votre voisin de palier, votre collègue. Rien ne les distingue. S’il y a 5 % à 10 % d’enfants violés, le même pourcentage d’adultes est incesteur. Des hommes normaux, qui s’arrangent à la fois avec la loi et avec le consentement de leur victime. Ils savent que le viol est interdit mais ils n’ont pas l’impression de violer ou d’être de sales types. Camille Kouchner le relate bien : son beau-père est un homme plus que normal, libre, bien dans sa peau, soutenant et à l’écoute. »
Et elle insiste sur la structure familiale qui va camoufler, accepter le crime et protéger le criminel :
« On ne peut pas comprendre le fonctionnement de l’inceste si l’on s’en tient strictement à la relation entre l’incesteur et l’incesté : il faut aussi considérer ceux qui sont autour. L’incesteur – pas forcément le père, mais le beau-père, l’oncle, le cousin, le grand frère – est presque systématiquement un homme qui bénéficie d’une position dominante au sein de la famille. Elle est tout entière enjointe au silence : la conjointe, les autres enfants, les grands-parents, le reste de l’entourage fréquenté au quotidien ou en vacances. De l’agresseur à la victime, la contrainte au silence se joue sur plusieurs registres : celui de la séduction, de la clandestinité («C’est notre petit secret») ou de la menace («Ta mère va souffrir si tu parles»). Parfois, il n’y a même pas besoin de mots. L’inceste fonctionne toujours avec une rétribution : les incesteurs se dédouanent du sentiment d’avoir extorqué un service sexuel à l’enfant en lui faisant un cadeau. Ils ont ainsi l’impression d’avoir rétribué la victime et que l’acte n’est donc pas un problème. […]
Le cœur de l’ordre social est le fonctionnement incestueux de la famille. Celle-ci peut très bien fonctionner, même avec un des membres qui en agresse d’autres au quotidien pendant des années. En revanche, au moment du dévoilement, cela s’interrompt. Alors, pour maintenir l’ordre familial, elle se referme autour du silence. En général, en excluant l’incesté qui dévoile les faits. La famille Duhamel est un cas d’école : les enfants Kouchner ne voyaient plus leur mère. A part leur tante et des personnes qui ont pris leurs distances, tout le monde a continué à fréquenter ce cercle familial. Ceux qui ont mené à bien le dévoilement en ont été exclus. »
Sur Bastamag elle ose cette hypothèse :
« Vu le nombre d’incestés, et donc d’incesteurs, il y a forcément des violeurs sur les bancs de l’Assemblée nationale, ou encore au sein du Conseil constitutionnel, lequel a retoqué plusieurs fois les lois sur l’allongement du délai de prescription des crimes d’inceste. C’est logique, car personne ne renonce facilement à ses privilèges. Mais c’est un vrai problème, qui participe à la reconduction de l’inceste. »
 Dans <cet article de l’Obs> Dorothée Dussy explique la difficulté de sortir de ce phénomène parce qu’il est enfoui profondément dans les structures familiales patriarcales, hiérarchisées.
Dans <cet article de l’Obs> Dorothée Dussy explique la difficulté de sortir de ce phénomène parce qu’il est enfoui profondément dans les structures familiales patriarcales, hiérarchisées.
« Je ne crois pas que les choses vont changer. Ce sujet, c’est l’horreur. J’en ai fait l’expérience dans mon métier. J’ai fait des exposés, des conférences, j’ai vu les gens regarder leurs pieds en attendant que ça passe, c’est très pénible et un peu vain. Il y a eu des centaines de travaux, des programmes, des dispositifs de lutte contre l’inceste, mais nous en sommes toujours au même point. L’inceste résiste à tout ça, il a toujours existé, il a toujours traversé les temps, et les générations. L’inceste survient dans une famille où il est en général déjà là, donc c’est très dur d’en venir à bout. C’est un crime de lien, commis par des proches auxquels les enfants sont attachés. L’inceste s’articule autour de ressorts constitutifs de l’organisation familiale, qui sont difficiles à désamorcer. Il faudrait lutter en amont, prendre à la source le problème, s’intéresser à la domination masculine, à la domination tout court, aux formes d’écrabouillement d’autrui, des enfants.
Pour l’anthropologue, il faut en parler, en parler davantage :
« Il faut oser parler de ce qui dérange : les millions de violeurs. L’omerta protège les gens qui commettent les violences, les « incesteurs ». C’est d’eux dont il faut parler, qu’il faut oser dénoncer. »
Et puis comme je l’ai déjà rapporté lors d’un mot du jour précédent, le problème n’est pas que les enfants ne parleraient pas, le problème c’est qu’il faut des oreilles pour écouter et une autorité pour les protéger devant le prédateur.
« Les enfants ne se taisent pas. En réalité, ils parlent, à leur manière, mais on ne les entend pas, on ne les comprend pas. Et ils ne révèlent rien. J’ai fait des centaines d’entretiens avec des victimes, et il y a toujours des situations d’incestes dans les générations qui les ont précédées. Il s’agit de familles entières où les gens naissent avec l’injonction au silence. Les enfants apprennent tout petits à supporter. Ils savent que s’ils ont mal aux fesses, on ne les écoutera pas, on ne les soignera pas. S’ils sont crevés le matin, parce que la peur qu’on les réveille la nuit les a empêchés de dormir, ils savent que c’est mal de s’en plaindre, qu’il ne faut pas que ça se voit, ni que cela se sache. Et quand ils verbalisent auprès d’un proche les violences sexuelles subies, c’est tellement inintelligible, qu’on les renvoie dans leur but. Les enfants n’ont pas de mots pour définir la sexualité, ils sont incrédules, ou « ignares » pour utiliser le vocabulaire de la sexualité. Ils ne comprennent pas ce qu’ils vivent, comment le dire ? »
L’espoir de Dorothée Dussy repose sur l’évolution économique des élites et la place plus importante des femmes parmi les dirigeants :
« De décennies en décennies, les femmes deviennent indépendantes financièrement, elles accèdent à des postes à responsabilités, elles sont médecins, elles sont avocates, elles sont élues à l’Assemblée, elles sont journalistes. Il y a donc statistiquement plus de personnes violées à des postes clés. Plus les femmes seront nombreuses à occuper des places décisives, moins les hommes qui relativisent les crimes sexuels l’emporteront. »
Dorothée Dussy intervient aussi dans cet article du Figaro : « Silence et inceste : On en veut aux mères car on s’imagine qu’elles ont un instinct naturel de protection »
<1529 >
-
Vendredi 19 février 2021
« Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l’inceste..»Mathilde BrasilierQuand on se penche sur ce crime et qu’on ouvre les oreilles et les yeux, on est submergé par les témoignages. Leur nombre, les drames, la souffrance.
Non, il n’y a pas d’inceste heureux pour les enfants.
Le milieu familial qui devrait être celui de la protection, du refuge peut devenir celui du mal absolu. Françoise Dolto disait qu’on se retrouvait alors comme
« un œuf qui a perdu sa coquille »
Ce crime est perpétré à <96%> par des hommes, le genre mâle d’homo sapiens.
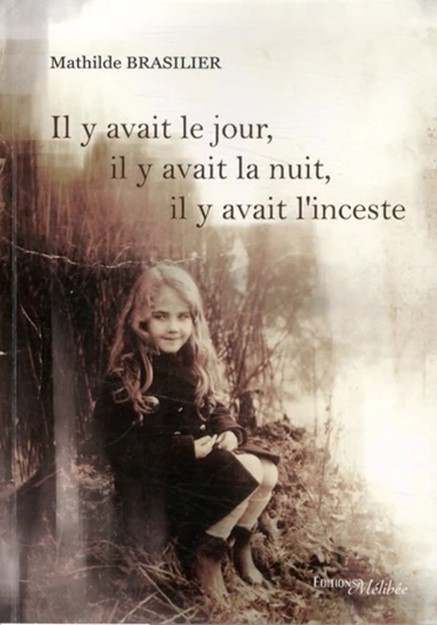 Mathilde Brasilier quand elle a pu enfin parler, c’était trop tard pour porter plainte.
Mathilde Brasilier quand elle a pu enfin parler, c’était trop tard pour porter plainte.
Elle a écrit un livre « Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l’inceste. » paru en août 2019.
Elle raconte simplement l’histoire dans <France dimanche>
«De mon père, j’entendais souvent : « C’est un homme brillant, il a eu le prix de Rome » [décerné à la suite d’un concours dans différentes disciplines : architecture, peinture, sculpture, gravure et musique, ndlr].
Il était un architecte de renom.
Ma mère était sculptrice. Elle représentait l’image de la bourgeoisie, et lui, de l’aristocratie. Elle possédait de l’argent, lui, l’intelligence et la culture. Et nous habitions Saint-Germain-des-Prés.
Enfant, je ressentais l’aura de mon père. Il était souvent absent la semaine à cause de ses cours aux Beaux-Arts et de ses nombreux voyages.
Le week-end, il s’occupait de mon frère Fabien et de moi. Il nous emmenait voir des expositions, visiter des monuments historiques, la culture constituant une valeur éducative très importante pour lui.
Les premiers abus ont débuté lorsque j’avais 5 ans.
Souvent, ils avaient lieu dans l’agence d’architecture de notre père, située à une rue de l’appartement familial.
Au départ, cet endroit était un superbe terrain de jeu pour nous, car c’était un ancien théâtre sur deux niveaux avec un sous-sol, dans lequel nous construisions des cabanes.
Mais c’était aussi un piège…
Lorsqu’il fermait la trappe phonique du sous-sol, plus personne ne pouvait nous entendre.
Son visage changeait. Son regard devenait terrifiant, il se muait en prédateur.
Ça se passait aussi dans ma chambre, la nuit. C’est à ce moment-là que j’ai développé une insomnie chronique. Alors il utilisait de l’éther pour nous endormir et mieux accomplir son forfait.
Pour se justifier, il nous disait qu’il nous aimait plus que les autres parents. Et il nous avait choisis parce qu’on était mieux que les autres enfants.
Comme si c’était une chance.
Durant cinq ans, j’ai essayé d’attirer l’attention, notamment de notre médecin de famille, à travers mes troubles du sommeil. Mais il a réglé le problème en me prescrivant des injections de Valium.
A l’époque, dans les années 70, on parlait peu d’inceste, et encore moins au sujet des familles bourgeoises, bien sous tout rapport.
A l’âge de 10 ans, les abus ont cessé après un séjour à la montagne, durant lequel mon frère et moi avons réussi à lui échapper.
Après ça, il a fait une dépression et a été interné. Il n’a plus jamais recommencé.
Et moi, j’ai oublié… pour un temps.
Le 6 mars 1985, Fabien, mon frère, mon alter ego, s’est suicidé. Il s’est jeté du haut de Beaubourg. Il avait 24 ans.
C’était un acte fort et réfléchi, car lui, hélas, n’avait pas oublié ce que nous avions vécu. Mais il ne me l’a jamais rappelé, pour ne pas me faire souffrir.
Ma famille a prétendu qu’il s’agissait d’un accident, qu’il aurait été poussé par quelqu’un. Un suicide, ça faisait tache dans notre milieu social. Il n’y a donc pas eu de cérémonie ni de pierre tombale.
J’ai compris son mal-être quinze ans plus tard, après une séance chez une thérapeute. J’avais consulté Catherine Dolto pour un retard de langage que présentait mon fils, et elle m’a proposé de me suivre également.
Un jour, à 40 ans, la boîte de Pandore s’est ouverte, et tout m’est revenu en mémoire, comme l’a aussi décrit et vécu Flavie Flament.
Toutes les scènes d’agression me sont apparues comme des photos. A ce moment-là, j’étais dans le métro, les portes se sont fermées, et j’ai éprouvé une très grosse angoisse.
Quand j’en ai parlé à ma mère, j’ai réalisé qu’elle était elle-même sous emprise. Elle n’a pas su. Elle était probablement dans le déni.
En 2005, j’ai eu mon père au téléphone. On a beaucoup parlé, et il a reconnu ce qu’il avait fait, il ressentait de la culpabilité.
Il s’est suicidé le lendemain…
J’aimerais aujourd’hui que les crimes sexuels sur enfant (en deçà de 15 ans) soient imprescriptibles, puisque l’amnésie traumatique va être inscrite dans le Code pénal.
C’est une nécessité pour les victimes. »
Il faut aussi regarder ce documentaire de France Télévision dans lequel elle intervient parmi d’autres : <Enfance Abusée>
C’est bouleversant.
Le plus souvent le crime s’enfonce dans le déni et même les mères consentent à l’emprise et se taisent.
Les familles fréquemment protègent l’agresseur et rejette la victime qui parle.
C’est inacceptable. Il faut que cela cesse.
Mathilde Brasilier s’exprime aussi sur ce <blog de mediapart>
<1528 >
-
Jeudi 18 février 2021
« Je pense qu’entre un parent et un enfant, il n’y a pas d’inceste heureux.»Eva Thomas pendant l’émission les dossiers de l’Ecran du 2 septembre 1986Le 2 septembre 1986, L’émission de France 2, « Les dossiers de l’écran » décide de parler de l’inceste en France. C’est une première.
L’INA a pris la décision pertinente de remettre en ligne cette émission. Vous la trouverez derrière ce lien <1986 : Le tabou de l’inceste – Archive INA>
Le début est remarquable et saisissant.
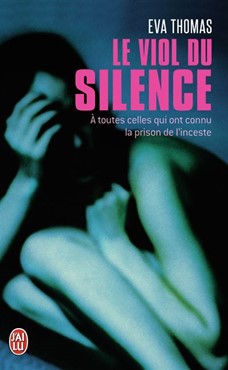 Trois femmes victimes apportent leurs témoignages : deux de manière anonyme et une Eva Thomas, l’auteur du livre paru en 1986 : « Le viol du silence » à visage découvert.
Trois femmes victimes apportent leurs témoignages : deux de manière anonyme et une Eva Thomas, l’auteur du livre paru en 1986 : « Le viol du silence » à visage découvert.
La première femme qui témoigne est la mère d’une fille qui a dénoncé son mari à la gendarmerie dès qu’elle a su qu’il avait violé une de leurs filles. Ce mari a été en détention provisoire, mais la procédure judiciaire s’est achevée par un non lieu. Elle explique qu’après cela, sa fille et elle-même ont été ostracisées par leurs voisins comme par leur belle famille. Les voisins qui lui ont parlé, lui ont reproché d’avoir dénoncé son mari à la justice. Ils expliquaient qu’ils auraient compris qu’elle divorce, mais que l’affaire reste discrète.
Il ne fallait pas salir la famille et la justice ne savait pas condamner !
C’est ainsi qu’on réagissait en 1986 !
J’espère que nous n’en sommes plus là.
A cette époque cette femme devait tout porter, puisqu’il lui a fallu trouver un emploi, car elle était femme au foyer et en outre elle était rejetée par la société, car on l’accusait d’avoir causé un trouble. Alors que nous étions en présence d’un criminel et d’un crime. Enfin, à l’époque ce n’était pas aussi clair, l’avocate qui avait été invitée sur le plateau rapportait que la plupart des affaires se traitait devant la justice correctionnelle qui juge des délits et qu’elle n’avait plaidé qu’une affaire aux Assises qui est le tribunal des crimes.
Nous sommes là en présence d’« un système d’impunité des agresseurs » comme le révélait le magistrat Édouard Durand que je citais dans le mot du jour de ce lundi.
La seconde femme anonyme a raconté une autre histoire, mais avec la même conséquence qui a été que ce fut elle qui a été condamnée par sa famille. Elle avait été violée par son frère. Les parents avaient recueilli l’enfant et s’était empressé de trouver un mari pour leur fille qui reconnut l’enfant. Le frère continuait à être reçu comme un prince dans sa famille, alors que la fille était le « mouton noir ».
On jugeait la fille, l’enfant coupable d’avoir provoqué la libido du garçon.
C’est ce qu’on appelle la culture du viol.
Une inversion perverse de la responsabilité.
Puis ce fut Eva Thomas qui témoigna avec beaucoup de dignité et de sensibilité du viol subi vers 15 ans par son père. Elle dit :
« J’ai choisi de témoigner à visage découvert parce que j’aimerais sortir de la honte. »
Elle raconta que c’est par l’écriture qu’elle arriva à se libérer, à pardonner et à retrouver une relation apaisée avec ses parents et son père.
 Contrairement aux deux autres victimes, son père lui demanda pardon et reconnut le mal qu’il lui avait fait.
Contrairement aux deux autres victimes, son père lui demanda pardon et reconnut le mal qu’il lui avait fait.
Elle raconta aussi sa sidération et son incompréhension devant l’acte qu’elle avait subi. Elle ne comprenait pas, n’avait pas de mots au moment où cela s’est passé pour dire la chose. Et elle n’osait pas alors le dire à sa mère, elle vivait dans la crainte que le fait de le dire, tuerait sa mère.
Et elle s’est sentie coupable, coupable de ne pas avoir crié, ne pas s’être débattu.
Elle a ajouté cependant que depuis qu’elle avait approfondi ce sujet, elle se rendait compte que tous les enfants ont dit la même chose : la surprise et l’incrédulité les paralysaient.
Elle a créé à l’automne 1985, à Grenoble, une association : « SOS inceste ».
Dans la suite de l’émission, plusieurs spécialistes sont intervenus
Lumineux, quand l’ethno-psychanalyste Tobie Nathan explique le tabou de l’inceste, sa transgression et le mythe qui y est rattaché.
Précis et rigoureux, quand le juge Bernard Leroy donne des chiffres et expliquent les limites de la justice sur les affaires d’inceste qui sont portées auprès d’elle.
Vindicative, lorsque l’avocate associée de Gisèle Halimi, Maître Dominique Locquet se révolte contre le laxisme de la justice sur ces affaires dans les années 80.
Et puis il y eut des médecins dont le docteur Gilbert Tordjman qui ont tenu des propos hallucinants, inécoutables avec notre sensibilité d’aujourd’hui. ; C’étaient des hommes évidemment.
Ils tentaient d’expliquer ou plutôt ils affirmaient du haut de leur science qu’il y avait plusieurs types d’inceste : le brutal, le violent condamnable et puis une autre forme d’inceste, d’amour, d’échanges, d’initiation… Ou encore expliquant que des relations inabouties entre les parents conduisaient le père à aller chercher du côté de la fille. Des fadaises, s’il ne s’agissait de monstruosités…
Et puis des téléspectateurs ont appelé pour dire qu’ils vivaient une relation incestueuse épanouie et heureuse des deux côtés. On entend : « Je suis amoureux de ma fille adoptive. Pourquoi semez-vous la zizanie dans les familles ». Un autre assume aimer caresser sa fille de 10 ans. Un troisième témoigne qu’il a des relations quotidiennes avec sa fille de 13 ans.
Eva Thomas après avoir secoué plusieurs fois la tête, digne, émue, les yeux un peu rougis a alors dit simplement.
« Je pense qu’entre un parent et un enfant, il n’y a pas d’inceste heureux »
Et elle ajouté, au moins pour l’enfant, il n’y a pas d’inceste heureux.
C’était un autre temps.
C’est de là que nous venons.
Eva Thomas a écrit un autre livre, publié en 1992, « le sang des mots ».
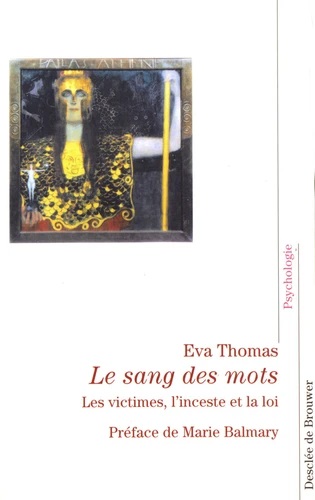 Elle l’a écrit sur le choc d’une victime d’inceste qui a été condamnée par la justice, parce qu’elle avait rendu public l’inceste alors que les faits étaient prescrits. Elle a été condamnée pour diffamation. La justice n’a pas contesté l’inceste, mais interdit d’en parler. Le criminel ne pouvait plus être jugé, il fallait même empêcher qu’il fût embêté par des souvenirs déplaisants.
Elle l’a écrit sur le choc d’une victime d’inceste qui a été condamnée par la justice, parce qu’elle avait rendu public l’inceste alors que les faits étaient prescrits. Elle a été condamnée pour diffamation. La justice n’a pas contesté l’inceste, mais interdit d’en parler. Le criminel ne pouvait plus être jugé, il fallait même empêcher qu’il fût embêté par des souvenirs déplaisants.
C’est une décision de justice de 1989.
Quelle honte !
Plus récemment, en 2017, l’Obs a interviewé Eva Thomas, à l’âge de 75 ans : <Eva Thomas : celle qui en 1986 a brisé le silence sur l’inceste>
L’obs rappelle combien son témoignage fut retentissant et constitue une des étapes qui a fait bouger les lignes.
A 75 ans elle avoue
« J’avais l’impression de me jeter dans le vide »
Elle explique qu’elle voulait à tout prix rompre le silence, s’attaquer à « l’attitude hypocrite et lâche de la société face à l’inceste ».
Anne-Claude Ambroise-Rendu, auteure de « Histoire de la pédophilie » (éd. Fayard, 2014) explique :
« La télévision, comme média de masse, a été un puissant vecteur de ce changement sociétal. Il a permis de voir et d’entendre ces victimes. Il offre la possibilité de l’empathie, de l’émotion et de l’identification. A ce moment, le visage d’Eva Thomas, en plan serré sur Antenne 2, se suffit à lui-même. »
Elle parle de sa solitude, de l’incompréhension manifestée par les médecins dont certains lui ont même rétorqué qu’il n’y avait rien de grave à coucher avec son père.
Elle reconnait que le fait que sont père reconnut sur le tard son acte détestable l’a aidé :
« Son ancien compagnon, le père de sa fille unique, a été le premier homme auprès de qui elle s’est confiée. C’est lui qui l’a convaincue d’écrire une lettre à son père. Alors qu’elle entamait l’écriture de son livre, ce dernier a reconnu les faits et lui a demandé pardon – « une chance incroyable », précise-t-elle. Il a lu son livre, aussi.
Il m’a dit que jamais il n’avait imaginé que ça provoquerait de tels dégâts sur ma vie. »
Elle raconte que de nombreuses femmes lui ont écrit pour la remercier d’avoir ouvert la voie. Ces multiples échanges lui ont également permis de comprendre l’ampleur considérable de ce désastre.
Dans son village natal, il y avait deux camps ceux qui trouvaient qu’elle était une héroïne et les autres qui trouvaient que c’était un scandale : « on n’attaque jamais ses parents. ».
Elle raconte alors son parcours dans son association et d’autres interventions :
« La libération de la parole qui éclate dans les années 1980 est euphorisante. […] Ça a été une espèce de jubilation collective dans les groupes de parole. […] C’était joyeux, au point de désarçonner un journaliste venu en reportage dans le local associatif. . […] On se vivait comme des guerrières, des combattantes. […] C’était extraordinaire de voir à quel point on était heureuses de se retrouver face à quelqu’un qui nous comprenait puisqu’on avait vécu les mêmes trajets, on était passées par les mêmes chemins.
C’était très rassurant quand on en parlait ensemble parce que tout à coup, à force d’entendre les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes itinéraires, la façon dont on s’était battues chacune de notre côté, il y avait une forme de normalité qui ressortait.
Nous, qui nous étions fait jeter avec l’idée qu’on était un peu folles, hystériques, réalisions qu’on avait eu des réflexes normaux, en réaction à un traumatisme. »
 Elle revient aussi sur la relation avec ses parents après :
Elle revient aussi sur la relation avec ses parents après :
« Jusqu’à leur décès, au début des années 2000, Eva Thomas a entretenu une relation apaisée avec ses parents, une fois le pardon accepté.
A partir du moment où tout était clair, où tout avait été dit, je me suis réconciliée avec eux. Régulièrement, je suis allée passer des vacances chez eux. J’étais heureuse d’être avec mes parents. […]
On peut vivre avec cette cicatrice-là comme avec une autre. »
On peut parler de résilience.
Mais combien ce chemin fut difficile.
Et si nous sommes en progrès, nous ne sommes pas encore au bout de ce combat : « Une relation sexuelle avec un enfant n’est jamais négociable. Jamais, Jamais !»
<1527>
-
Mercredi 17 février 2021
« Pause («L’apologie de la pédophilie, face noire de Mai-68)»Un jour sans mot du jour nouveauJ’avais consacré une série de mots du jour à mai 68. Le mot du jour du 17 mai 2018 avait pour exergue : « Mai 1968 et le sexe ».
Et il était déjà question de questions proches de celles que j’évoque depuis le début de la semaine. Avant de citer la fin de cet article, je soulignerai qu’Olivier Duhamel est un enfant de mai 68. Il avait 18 ans en 1968.
Voici la fin de cet article :
Mais aujourd’hui je vais développer un autre aspect de cette histoire : la face noire de mai 68.
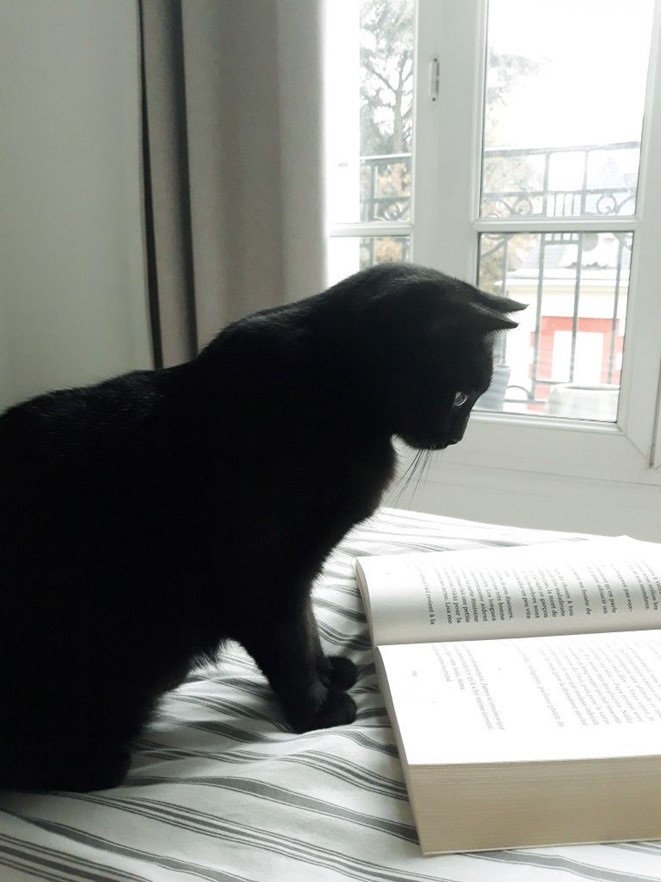
J’ai déjà écrit que je n’avais pas vécu mai 68 et que je n’en gardais aucun souvenir personnel. Il y a pourtant un aveuglement que je me reproche et que j’ai déjà développé dans un mot du jour ancien et dont je parlerai à la fin de celui-ci. Et je fais un lien direct entre ce vécu et la morale issue de mai 1968.
L’historienne Anne-Claude Ambroise-Rendu, auteur de l’<Histoire de la pédophilie> lance cette accusation « L’apologie de la pédophilie, face noire de Mai-68 » :
« Mai-68 avait appelé à la libération des corps. Mais la « révolution sexuelle » proprement dite sera l’œuvre de la décennie 1970. Le réexamen incessant, sous un angle résolument politique, de la sexualité et du droit qui la gouverne aura pour effet de bousculer les a priori et de faire vaciller le conformisme.
Une partie de la presse se met alors à dénoncer les tabous, explorer les silences de l’intimité et interroger les sexualités dites alternatives. Dans le paysage politico-culturel qui se dessine, la notion même de déviance est niée ; et bientôt la parole est donnée à une revendication nouvelle : la pédophilie.
A l’orée des années 1970, les défenseurs de la pédophilie s’arriment au militantisme homosexuel et spécialement au Front homosexuel d’action révolutionnaire (Fhar), fondé en 1971, qui combat tout à la fois l’oppression des homosexuels et appelle à la reconnaissance des « sexualités autres ». Ce « cousinage » est favorisé par le Code pénal et ses dispositions discriminatoires qui punissent les rapports homosexuels en-deçà de 21 ans, tout en permettant les rapports hétérosexuels dès 15 ans. Michel Foucault, qui participe aux travaux de la commission de révision du Code pénal, n’hésite pas à signer une pétition invitant à tenir compte du consentement des mineurs. Il réfléchira même à la possibilité de supprimer toute infraction sexuelle du Code.
Si le mouvement homosexuel, notamment sous l’impulsion des féministes, se désolidarise rapidement des voix pédophiles, un petit nombre d’intellectuels médiatisés continuent de défendre la « cause » dans les colonnes de « Libération », très en pointe, et, dans une moindre mesure, du Monde. Leur plaidoirie se poursuit autour de trois axes empruntés partiellement au fonds de l’antipsychiatrie. Le premier, cher à l’écrivain Gabriel Matzneff, invoque l' »amour des enfants » et le rôle positif que peut jouer une « initiation » sexuelle et intellectuelle dans une éducation bien conçue.
L’éros enfant ou adolescent est placé sous les auspices d’une esthétique et d’une éthique héritées de la pédérastie de la Grèce antique. Le second axe s’appuie sur l’idée d’une altérité radicale de l’enfant qui reste à comprendre et à aimer convenablement, loin des figures naturalistes de la doxa. Tel est en substance le propos de « Co-ire. Album systématique de l’enfance », publié en mai 1976 par le philosophe René Schérer et le fondateur du Fhar, Guy Hocquenghem. Pour les auteurs, l’enfant est celui qui « est fait pour être enlevé […], sa petitesse, sa faiblesse, sa joliesse y invitent », mais aussi celui dont la liberté et l’autonomie sont impossibles.
Les catégories à partir desquelles penser la relation adulte-enfant doivent donc au minimum être repensées. Le troisième axe de la défense pédophile insiste plus directement sur la menace que la sexualité des enfants fait peser sur l’institution familiale. Effrayante, elle est castrée au prix d’un abus de pouvoir scandaleux.
L’écrivain Tony Duvert (prix Médicis 1973) met violemment en cause l’éducation répressive qui brime les désirs et les pulsions des enfants au nom des droits exclusifs de la famille ; il dénonce la prééminence de mères castratrices et le « matriarcat qui domine l’impubère ». »
Doan Bui journaliste qui a reçu le prix Albert-Londres 2013 a écrit dans l’Obs : < Libérer le plaisir de l’enfant», disaient-ils… >
« C’était il y a quarante ans, avant que le mot « pédophile » ne devienne synonyme de « monstre ». De nombreux intellectuels militaient pour autoriser les rapports sexuels avec les plus jeunes. Alors que le débat sur le consentement des mineurs resurgit, retour sur une folle dérive sociétale et culturelle.
[…] Si je suis solidaire de Polanski ? S’il ne s’agit que de relations sexuelles avec mineur, de coït buccal et de sodomie, bien sûr ! » C’est ainsi que feu Jean-Louis Bory, écrivain et critique de cinéma réputé, répondait au « Quotidien de Paris » en 1977 quand on l’interrogeait sur le cinéaste, accusé d’avoir violé Samantha, 13 ans. La presse, unanime à l’époque, plaignait Roman Polanski, « victime du puritanisme américain », en conspuant les parents et la jeune fille, « tout sauf une oie blanche ».[…]
En 1977, l’affaire ne suscite pas l’ombre d’une controverse en France, y compris chez les féministes. Ni quand le cinéaste fuit en France, en 1978, ni quand sort « Tess » l’année suivante, acclamé par la critique, avec la toute jeune Nastassja Kinski, laquelle avait 15 ans quand elle rencontra le cinéaste et qu’il devint son amant.
Martine Storti, militante féministe, était journaliste à « Libération » dans ces années-là. « C’est fou, mais je n’ai aucun souvenir de cette affaire, que j’ai découverte en 2009, quand Polanski a été arrêté en Suisse. » Elle poursuit :
« A l’époque, nous, les féministes, étions sur d’autres combats : la pilule, la criminalisation du viol, pour qu’il soit jugé aux assises… Là-dessus, on se faisait insulter et traiter de réacs. ‘Libé’, c’était quand même un journal de mecs. »
Dans ses pages cinéma, « Libération » consacra juste un petit article à l’affaire : « Au cinéma, les enfants sont là pour séduire les adultes. » C’est la ligne du journal de ces années-là, qui publie des articles titrés : « Centre aéré : je continuerai à jouir avec des impubères si tel est mon plaisir et si tel est le leur » ; des caricatures pour choquer le bourgeois : « Apprenons l’amour à nos enfants », avec le dessin d’une gamine faisant une fellation à un adulte ; ou encore le plaidoyer de Jacques D., incarcéré pour « attentat à la pudeur sur mineur », expliquant que « l’enfant est capable d’aimer sexuellement » et qu’il a la « satisfaction d’être agréable à celui qui le sodomise ».
[…] On comprendrait peut-être les raisons du culte voué à feu David Hamilton. Le photographe (accusé depuis de viols sur mineures) est alors une vedette qui vend ses calendriers par millions. Le magazine « Vogue Homme » le sollicite pour un dossier de couverture mettant en scène des adolescentes peu vêtues, puis récidive en commandant une série plus « réaliste » sur les adolescentes à Polanski, d’où la fameuse séance avec la jeune Samantha.
[…] Brooke Shields fait la une du magazine « Photo », elle a 10 ans, est nue, maquillée, sort du bain. Deux ans plus tard, elle joue une prostituée dans « la Petite », de Louis Malle. Irina Ionesco, elle, fait prendre à sa fille, Eva, des poses pornographiques, dès ses 5 ans. Eva Ionesco l’a narré dans un film et dans « Innocence », magnifique roman autobiographique paru à l’automne. Elle raconte sa mère lui demandant d’écarter les jambes devant l’objectif, vendant les clichés à des clients émoustillés, comme l’écrivain Alain Robbe-Grillet, connu pour son goût des fillettes (il écrivit d’ailleurs le texte du premier livre d’Hamilton, « Rêves de jeunes filles »). Il offrira un stylo Montblanc à Eva pour la convaincre de jouer nue dans son film. »
Etc., je vous invite à lire l’article de Doan Bui, vous lirez aussi des propos de Gabriel Matzneff, de Leo Ferré, Aragon, Beauvoir, Barthes, Ponge, Michel Foucault, Guy Hocquenghem, et tant d’autres…
Et puis il y a Daniel Cohn-Bendit qui a été accusé lors d’un débat politique par François Bayrou d’avoir défendu la pédophilie dans un ouvrage ancien. L’Obs a publié des <Extraits de ce livre>
« Dans son livre « Le Grand Bazar », publié en 1975 chez Belfond, Daniel Cohn-Bendit évoque son activité d’éducateur dans un jardin d’enfants « alternatif » à Francfort :
« Il m’était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais : ‘Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble, pourquoi m’avez-vous choisi, moi, et pas d’autres gosses ?’ Mais s’ils insistaient, je les caressais quand même ». « J’avais besoin d’être inconditionnellement accepté par eux. Je voulais que les gosses aient envie de moi, et je faisais tout pour qu’ils dépendent de moi » ».
Plus tard, Daniel Cohn-Bendit, a démenti tout acte pédophile et soutenu que ses écrits reflétaient l’esprit de l’époque de « provocation contre le bourgeois ». « Ce qui est écrit dans « Le grand bazar » n’est « pas une réalité », mais « un condensé de faits observés », avait déclaré Daniel Cohn-Bendit. «J’ai raconté ça par pure provocation, pour épater le bourgeois » (…) et « sachant ce que je sais aujourd’hui des abus sexuels, j’ai des remords d’avoir écrit tout cela ».
Récemment, j’ai trouvé
cette petite vidéo, dans laquelle Daniel Cohn-Bendit est invité par Bernard Pivot dans apostrophes, probablement que là aussi il veut «épater le bourgeois», en l’occurrence Paul Guth qui est en face de lui et il dit : «La sexualité d’un gosse, c’est absolument fantastique, faut être honnête. J’ai travaillé auparavant avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c’est fantastique, c’est un jeu érotico-maniaque… ». Je ne voudrai pas accabler Daniel Cohn-Bendit qui a bien changé depuis, mais nous pouvons constater qu’après mai 68 on pouvait tenir de tels propos dans des émissions culturelles de l’ORTF….
Et j’en reviens au mot du jour ancien dans lequel j’avais utilisé comme exergue ce mot de Raymond Aron, à propos du génocide des juifs par les nazis : « Je l’ai su, Mais je ne l’ai pas cru. Et parce que je ne l’ai pas cru, je ne l’ai pas su. ». Dans ce mot du jour j’ai raconté que je connaissais les responsables de l’École en bateau et que j’avais lu le livre qu’avait écrit le fondateur. Dans ce livre, la pédophilie était décrite mais je n’ai pas su la voir et la comprendre parce que l’esprit du temps issu de ces excès de mai 68 nous avait aveuglés, m’avait aveuglé et perverti mon sens du jugement.
Tout ceci ne signifie pas que la libération des mœurs issue de mai 68 ne doit pas être vue de manière positive, mais je trouve l’expression « La face noire » pertinente sur ce sujet où la perversion de certains hommes a pu non seulement s’exprimer sans tabou mais aussi le faire en le justifiant par des théories de libération pernicieuses et dévoyées. Car si la pédophilie s’inscrit dans la nuit des temps, il y eut dans le mouvement de 68 des intellectuels qui exprimaient des théories qui la justifiait et même l’encourageait.
<mot du jour sans numéro>
-
Mardi 16 février 2021
« On parle beaucoup de « libération de la parole », mais il s’agit surtout d’«une histoire d’écoute ». »Geneviève Fraisse<Geneviève Fraisse> est philosophe de la pensée féministe qui a écrit de nombreux ouvrages sur les femmes.
Elle était, ce lundi, l’invitée d’Augustin Trapenard dans Boomerang du <15 février 2021>
Augustin Trapenard la présente ainsi :
« Philosophe et historienne de la pensée féministe, observatrice avisée des évolutions de notre société, elle pointe, interroge et défait les fausses évidences depuis plus de quarante ans. […]
Philosophe avant-gardiste, cela fait plus de 40 ans qu’elle interroge des sujets qui font aujourd’hui irruption dans le débat public. À travers son étude minutieuse de la différence entre les sexes, de l’égalité démocratique et des logiques d’émancipation féminine, sa pensée subversive et constamment en mouvement nous invite à penser le monde autrement. »
Hier, j’avais parlé de la libération de la parole, mais Geneviève Fraisse dit très justement que le problème essentiel qui s’est posé dans notre humanité, n’est pas la libération de la parole, car souvent les enfants ont cherché des adultes pour parler. Non ! le problème essentiel est celui de l’écoute, l’acceptation d’entendre ce que la victime a à révéler et en tirer toutes les conséquences.
Elle a dit :
« Aujourd’hui, on a débouché les oreilles. On parle beaucoup de « libération de la parole », mais il s’agit surtout d’ «une histoire d’écoute ». »
Il faut regarder l’émission qui a été mise en ligne par l’INA : « Dossiers de l’écran du 2 septembre 1986 » dans laquelle la télévision avait enfin accepté de parler de l’inceste et donner la parole à trois victimes. C’est bouleversant et remarquablement instructif.
Et face à la parole de ces femmes, il faut aussi entendre certains des invités, des hommes médecins qui tiennent des propos ahurissants. Particulièrement le docteur Gilbert Tordjman, sexologue qui apparaissait souvent à la télévision dans les années 1970. En 2002, il sera accusé d’abus sexuels sur certaines de ses patientes et mis en examen pour viol. Il ne sera pas jugé car il décédera d’un cancer avant le procès.
Mais, je reviendrai sur cette émission et notamment j’évoquerai Eva Thomas qui osa parler de l’inceste à visage découvert et su dire des paroles précieuses et justes.
Geneviève Fraisse a aussi évoqué l’ambigüité du mot consentement, dont un des sens est de se soumettre : « J’y consens. ». Ce consentement peut être comme une défaite, un renoncement. On peut consentir à se rendre.
Elle préfère un autre mot qui est synonyme de l’autre sens de consentement et qui ne présente pas la même ambigüité. Quand on parle de l’échange de consentement. Pour ce sens il existe le mot « accord ».
Le mot « accord » s’entend comme l’échange de consentement de deux égaux qui discutent :
« Le mot « consentement » est mauvais. Il porte en lui l’ambiguïté, car il peut être unilatéral ! Je pense qu’il faudrait lui préférer le mot « accord ». ».
<1526>
-
Lundi 15 février 2021
« Une relation sexuelle avec un enfant n’est jamais négociable. Jamais, Jamais !»Marie-Pierre Porchy, ancienne juge des enfantsSidération !
Sidération devant les chiffres.
10% des adultes disent avoir été victimes de viol ou d’agression sexuelle dans l’enfance.
Le collectif féministe contre le viol a élaboré une autre statistique, sur l’ensemble des agressions qui lui sont rapportées chaque année, 30% dénoncent des violences qui ont eu lieu avant les 11 ans de la victime.
Autrement dit : 1 enfant sur 10 est victime de violences sexuelles.
Quand vous êtes devant une classe de 30 enfants, en moyenne il y a 3 victimes.
78% des victimes sont du sexe féminin, ce qui veut dire que pour les filles c’est 1 fille sur 6 qui est victime.
Ces chiffres très sérieux ont été donnés lors de l’émission <les matins de France Culture du 19 janvier 2021> et aussi la Grande Librairie du 13 janvier 2021 dont l’intégralité de l’émission n’est plus en ligne au moment où j’écris mais dont vous trouverez un extrait derrière ce lien < L’inceste, la fin du silence ?>
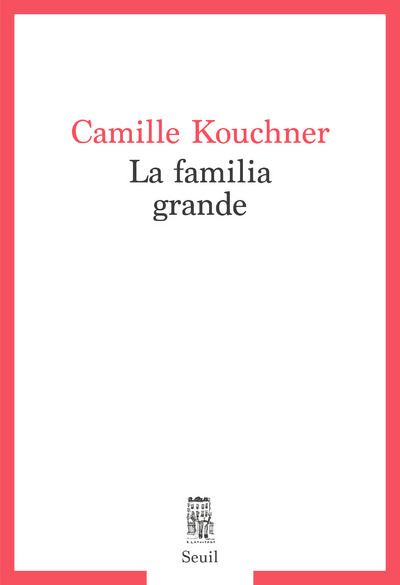 Ces émissions ont fait suite à la sortie du livre de Camilla Kouchner « La Familia grande » dans lequel, elle dénonçait les agissements de son beau-père, c’est-à-dire le second mari de sa mère, Evelyne Pisier, Olivier Duhamel.
Ces émissions ont fait suite à la sortie du livre de Camilla Kouchner « La Familia grande » dans lequel, elle dénonçait les agissements de son beau-père, c’est-à-dire le second mari de sa mère, Evelyne Pisier, Olivier Duhamel.
L’invité des Matins de France Culture, Édouard Durand, magistrat, membre du conseil scientifique de l’Observatoire national de l’enfance en danger et ancien membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a confirmé ces chiffres et ajouté
« Ce que l’on sait, c’est que le nombre de victimes de violence sexuelle, dont 60 % d’enfants, en France est effarant. […] Et que le nombre de condamnation est extrêmement modeste. Et que ce nombre de condamnation a tendance à diminuer. Cela constitue, pour nous au Haut Conseil à l’Égalité, un système d’impunité des agresseurs. »
Le Figaro en se basant sur une étude de l’INED annonce des chiffres encore plus catastrophiques.
L’UNICEF analyse le phénomène sur la planète entière.
Il est difficile de croire ces chiffres.
Pourtant depuis la publication du livre, qui a été comme un électrochoc, des paroles se sont libérées. Et parmi celles et ceux qu’on connaît, il y en eut qui ont dit « moi aussi ».
Révélant ainsi plus justement la part de l’iceberg qui était caché à notre vue.
Et souvent, elles ou ils avaient parlé mais on ne les a pas cru.
On n’a pas cru à la parole des enfants. Mais comme le rapporte Edouard Durand, nous savons maintenant qu’il y a tant de crimes impunis dans ce domaine, que c’est en n’écoutant pas la parole des enfants, en ne la prenant pas en compte que le risque de commettre l’injustice est le plus élevé.
Indécence !
J’ai lu de ci de là et je me suis même disputé sur les réseaux sociaux avec des adeptes de cette thèse que Camilla Kouchner aurait écrit ce livre à un moment où les faits sont prescrits uniquement pour gagner de l’argent. Parce qu’étant donné les familles concernées, la réputation de l’accusé et l’emballement médiatique, le livre se vendrait très bien.
François Busnel a interviewé Camilla Kouchner, dans l’émission précitée et dont il existe un extrait de l’entretien <Ici>. Cet échange montre, si cela était nécessaire, la souffrance et la déchirure que l’inceste a constitué pour la fratrie et pour toute la famille.
Bien sûr, le fait que le père de la victime soit Bernard Kouchner, que l’accusé soit Olivier Duhamel , que la mère soit Evelyne Pisier et la tante Marie-France Pisier ne peut qu’avoir un écho médiatique et assurer une promotion du livre.
Mais comme le mouvement qui l’a suivi le montre, c’est parce que Camilla Kouchner a accepté ou plutôt a senti la nécessité de mettre cette affaire sur la place publique, qu’il a été possible de consacrer autant de temps à ce qu’Edouard Durand appelle « un crime généalogique » et que tant d’autres victimes ont cru possible de dévoiler leur vérité et rendre d’autant plus crédible à nos yeux l’ampleur de ce crime fait à l’enfance, à l’enfant qui est une personne vulnérable.
Et puis Guillaume Erner pose la bonne question :
« Si ce genre de livre existe, c’est parce que la justice ne passe pas comme elle devrait passer ? »
La réponse du magistrat est sans nuance :
« Oui, bien sûr. Le Haut conseil à l’égalité, et particulièrement la Commission violences alerte les pouvoirs publics sur la nécessité de modifier la loi pour que les enfants soient mieux protégés contre les violences sexuelles et contre toutes les formes de violences.
Et que particulièrement la procédure judiciaire parvienne à mieux prendre en compte la souffrance des enfants pour interrompre le cycle de la violence. »
Colère !
Colère contre Alain Finkielkraut et tous ses semblables qui osent évoquer dans cette affaire d’inceste la question du consentement.
Il a beau avoir condamné l’acte d’Olivier Duhamel, il n’avait pas de «consentement» ou de «réciprocité» à évoquer.
Il s’agit d’autorité, d’emprise il ne peut être question de consentement.
C’est justement cette confusion, dans laquelle on prétend que dans une telle situation il est possible d’aller chercher le consentement de l’enfant, qu’il y a l’acceptation de l’inacceptable.
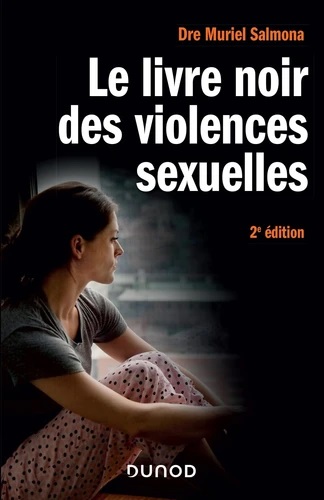 Dans la deuxième partie de la Grande Librairie du 13 janvier dont vous pouvez voir <ici> un extrait déjà cité, François Busnel avait invité :
Dans la deuxième partie de la Grande Librairie du 13 janvier dont vous pouvez voir <ici> un extrait déjà cité, François Busnel avait invité :
- Muriel Salmona qui est la présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie et qui a publié « Livre noir des violences sexuelles », aux éditions Dunod.
- Marie-Pierre Porchy qui a été juge des enfants et qui est aujourd’hui retraitée. Elle avait publié en 2003, « Les silences de la loi »
Et aussi le philosophe Marc Crépon auteur de « La société à l’épreuve des affaires de mœurs. ».
Pour Marie-Pierre Porchy, dans un inceste : « Le consentement d’un enfant cela n’existe pas »
Et elle précise que judiciairement :
« Tout reste régi par une Loi qui oblige à démontrer, « violence, menace contrainte surprise ».
Ce qui a pour conséquence, en pratique, le plus souvent d’obliger l’enfant à démontrer le non consentement.
Or elle pose cette règle avec laquelle pour ma part je suis totalement en accord :
« Une relation sexuelle avec un enfant n’est jamais négociable. Jamais, Jamais ! »
Le père d’Albert Camus disait : « Un homme ça s’empêche »
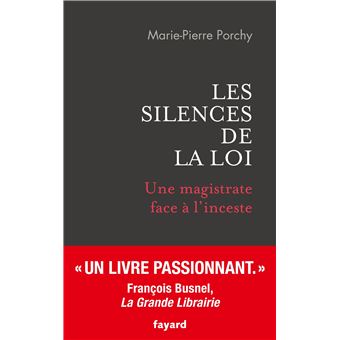 Dans le journal du dimanche la même Marie-Pierre Porchy dit :
Dans le journal du dimanche la même Marie-Pierre Porchy dit :
« La loi demande à l’enfant victime d’inceste en quoi il était contraint, alors qu’il exécute ce qu’on lui demande simplement parce que c’est un enfant. Il ne dit ni oui ni non, mais il monte dans la chambre… Il faut éliminer cette notion de consentement pour que les enfants puissent se réparer dans le cadre de l’action judiciaire. L’agresseur, quand il reconnaît les faits, rejette en général la responsabilité sur la victime, qui se sent coupable de n’avoir pas dit non. Cette dynamique judiciaire perverse vient anéantir tout travail de reconstruction psychologique. Il faut tout revoir dans la loi, pas seulement un petit article sur les viols, et faire évoluer nos pratiques. »
Et je finirai pour ce premier mot du jour consacré au crime générationnel par l’incompréhension de l’auteure des « silences de la Loi » exprimée dans l’émission de la Grande Librairie
« Je ne comprends pas qu’aujourd’hui on ne peut pas arriver à écrire [dans la Loi] : une relation sexuelle avec un enfant est puni de … »
<1525>
- Muriel Salmona qui est la présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie et qui a publié « Livre noir des violences sexuelles », aux éditions Dunod.
-
Vendredi 12 février 2021
« Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du privilège extraordinaire que ce qu’est « être vivant » car nous n’aurons qu’une vie, il faut en profiter pour qu’elle soit belle pour soi et qu’elle soit bonne pour les autres, et utile si possible. »Jean-Claude CarrièreQuel homme, quelle culture, quel talent !
Frédéric Pommier dans un tweet a écrit « Dans ma prochaine vie, je voudrais la carrière de Jean-Claude Carrière. ».
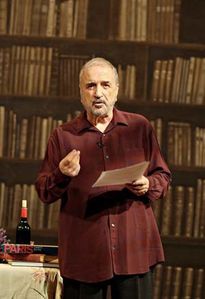 Je l’ai découvert, dans les chroniques matinales de France Inter qu’il a tenu seulement pendant quatre mois, entre septembre 2003 et janvier 2004. Il racontait pendant 3 minutes, à la fin de la matinale de France Inter, une histoire, une réflexion, une chronique historique, enfin quelque chose qui était en relation avec les événements du monde qui venaient d’être analysés par les journalistes d’information. Il l’a conceptualisé sous le nom « d’à-coté ». C’était toujours un moment de sagesse et de lumière.
Je l’ai découvert, dans les chroniques matinales de France Inter qu’il a tenu seulement pendant quatre mois, entre septembre 2003 et janvier 2004. Il racontait pendant 3 minutes, à la fin de la matinale de France Inter, une histoire, une réflexion, une chronique historique, enfin quelque chose qui était en relation avec les événements du monde qui venaient d’être analysés par les journalistes d’information. Il l’a conceptualisé sous le nom « d’à-coté ». C’était toujours un moment de sagesse et de lumière.Il était écrivain, scénariste, parolier, metteur en scène et acteur, mais lui se définissait comme « un conteur ». Il possédait aussi la voix chaude et profonde du conteur qui immédiatement captivait votre attention.
Ces « à-côté » ont fait l’objet d’un livre.
Une fois connu le nom de Jean-Claude Carrière, j’ai pu constater à combien d’œuvres exceptionnelles il a participé.
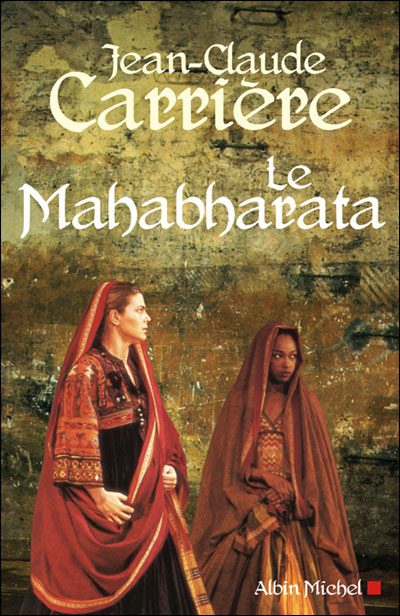 Annie, m’avait raconté avec plein d’enthousiasme le cycle du «Mahabharata» quelle avait vu au Théâtre du Bouffes du Nord, spectacle de 9 heures. Elle parlait de l’œuvre de Peter Brook, c’est-à-dire le metteur en scène. Mais le scénario avait été écrit par Jean-Claude Carrière en se fondant sur des textes de la tradition indienne.
Annie, m’avait raconté avec plein d’enthousiasme le cycle du «Mahabharata» quelle avait vu au Théâtre du Bouffes du Nord, spectacle de 9 heures. Elle parlait de l’œuvre de Peter Brook, c’est-à-dire le metteur en scène. Mais le scénario avait été écrit par Jean-Claude Carrière en se fondant sur des textes de la tradition indienne.<Slate> écrit :
« On songe évidemment à l’immense cycle du Mahabharata conçu aux côtés de Peter Brook en 1985, à l’intelligence des puissances de la scène déployées par les deux complices pour magnifier à des yeux occidentaux et ignorants l’immense saga hindoue.
Événement inoubliable, à Avignon, au Théâtre des Bouffes du Nord ou en tournée mondiale, pour tous ceux qui l’ont connue –et dont témoignera à nouveau le film réalisé par Brook à nouveau avec l’aide de Carrière, qui n’est pas une captation mais une nouvelle adaptation au sens le plus élevé, du théâtre vers le cinéma, par les mêmes auteurs– est un tour de force presqu’inimaginable. »
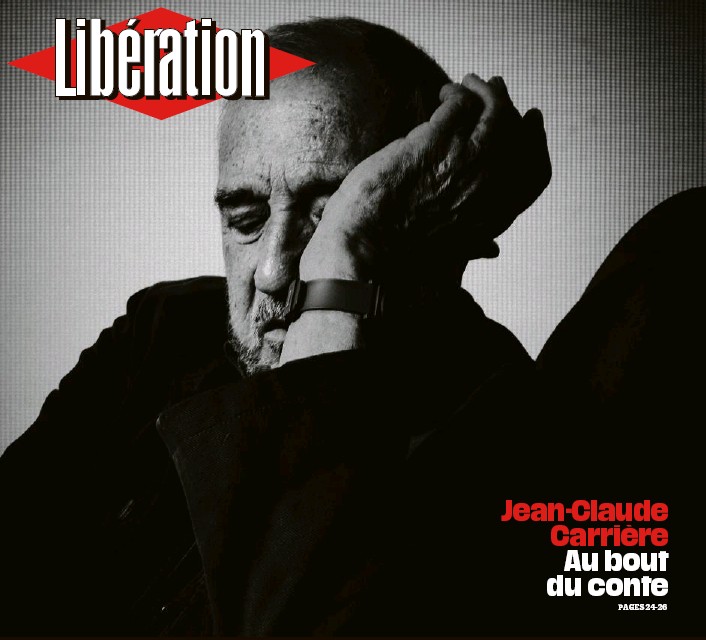 Et Peter Brook, de 6 ans son ainé, mais toujours vivant, lui rend hommage dans « Libération » :
Et Peter Brook, de 6 ans son ainé, mais toujours vivant, lui rend hommage dans « Libération » :« Jean-Claude a travaillé pendant dix ans à l’adaptation du Mahabharata, cette longue épopée en sanskrit. C’était comme si la pièce renaissait sans cesse. Pour cela, il fallait voyager, et on est partis partout en Inde, consulter les grands gourous et les peuples, voir les petites pièces qui se jouaient dans la rue, dans les théâtres les plus minables. On traversait des kilomètres en taxi, et immédiatement, pendant le trajet, Jean-Claude sortait son stylo et un calepin et il écrivait. Il ne cherchait pas la gloire, mais elle est venue malgré lui. Il a reçu un oscar [d’honneur, en 2014, ndlr], et des hommages extraordinaires. Il était unique, tellement doué, et tellement peu soucieux que ça se sache. Il évitait la décoration, détestait les jolies phrases, l’ornement. Et cherchant l’essentiel, il l’était, lui, essentiel.»
Dans ce même article le jeune réalisateur, Louis Garrel avec qui il a fait « L’Homme fidèle » en 2018 le décrit ainsi : .
« Jean-Claude était comme un immense arbre avec beaucoup de feuilles qui ne faisait de l’ombre à personne. « Je lui avais demandé de relire [un] scénario […] Il m’a donné un premier conseil toujours valable : « Quand tu as un problème avec deux personnages dans une scène, rajoutes-en un troisième qui écoute. » Il avait cet incroyable talent de savoir écrire ce qui pouvait prendre forme visuellement sur un écran. […] Il me faisait penser à cette phrase de Rimbaud : « Le monde est très grand et plein de contrées magnifiques que l’existence de mille hommes ne suffirait pas à visiter. » Sauf qu’il était l’inverse, il intégrait tous les signes du monde. Mais mille personnes n’auraient pas suffi à l’explorer.»
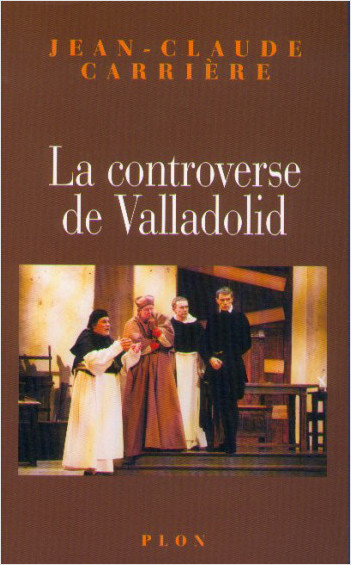 Et quand mon fils, Alexis, a travaillé un texte en classe qui l’avait beaucoup intéressé : « La controverse de Vallalodid », c’était encore un texte, un roman plus précisément de Jean-Claude Carrière qui narre ce débat historique voulu par Charles Quint et qui s’est tenu en 1550 au collège San Gregorio de Valladolid et qui a opposé le dominicain Bartolomé de las Casas, grand défenseur des peuples autochtones d’Amérique et le théologien Juan Ginés de Sepúlveda qui défendaient l’idée que l’enseignement chrétien n’empêchait pas de réduire en esclavage les indigènes pour le plus grand profit des bons chrétiens venus d’Europe.
Et quand mon fils, Alexis, a travaillé un texte en classe qui l’avait beaucoup intéressé : « La controverse de Vallalodid », c’était encore un texte, un roman plus précisément de Jean-Claude Carrière qui narre ce débat historique voulu par Charles Quint et qui s’est tenu en 1550 au collège San Gregorio de Valladolid et qui a opposé le dominicain Bartolomé de las Casas, grand défenseur des peuples autochtones d’Amérique et le théologien Juan Ginés de Sepúlveda qui défendaient l’idée que l’enseignement chrétien n’empêchait pas de réduire en esclavage les indigènes pour le plus grand profit des bons chrétiens venus d’Europe.Texte passionnant pour regarder en face ce crime qui a été commis pendant des siècles : l’esclavage.
Dialogue d’une grande richesse qui dans un téléfilm a opposé Jean-Pierre Marielle jouant Bartolomé de Las Casas et Jean-Louis Trintignant interprétant son contradicteur sous l’arbitrage du légat du Pape joué par Jean Carmet.
Il fut, bien sûr, le scénariste de Luis Bunuel, mais aussi de Jacques Tati « Les Vacances de monsieur Hulot », de Louis Malle « Viva Maria ! » et « Milou en mai », Milos Forman « Les Fantômes de Goya », Volker Schlöndorff « Le Tambour », Nagisa Ōshima « Max mon amour », Michael Haneke « Le Ruban blanc » et tant d’autres.
Il s’intéressait à toutes les cultures, à toutes les civilisations. Il s’est ainsi énormément intéressé au bouddhisme et a publié, en 1994, « La Force du bouddhisme » sur la base d’entretiens avec le dalaï-lama.
<Libération raconte> que dès ses 5 ans, il avait demandé à sa mère l’autorisation de placer un bouddha dans la crèche de Noël parmi les anges, les mages, les bergers, démarche que le curé du village, dûment consulté, autorisa.
L’obs a republié un dialogue de 2010 avec Jean Daniel dans lequel il exprime cette vision de nos fameuses valeurs universelles :
« Le mot « valeur » au sens que nous essayons d’utiliser aujourd’hui n’est pas traduisible dans quatre cinquièmes des langues de la planète. On ne peut pas traduire « valeur » en sanscrit, en chinois, en japonais, en persan… Cette notion même n’existe pas. Peut-on alors parler d’universalité à propos d’un mot qui ne se communique pas à d’autres pays et à d’autres peuples ? C’est une première remarque. La seconde est historique. Quand nous, Européens, parlons de valeurs universelles à d’autres Européens, nous faisons immédiatement allusion aux droits de l’homme et aux valeurs démocratiques et républicaines qui sont nées du travail des philosophes du XVIIIe siècle et qui ont été exprimées clairement par les révolutionnaires français.
Cette valeur, que nous voudrions universelle, n’existe donc que depuis peu de temps et dans peu d’endroits. De ce point de vue, les élus français de la Révolution se sentaient légitimes pour faire des lois qu’ils affirmaient universelles. Pour faire des lois universelles, il faut se référer à ces fameuses valeurs, comme si la valeur (laissons de côté la valeur marchande et militaire) était la transcendance de la loi. Comme si, avant de faire des lois, des décrets et des règlements, il fallait se référer à des valeurs « supra-existantes » et, pour employer un mot d’aujourd’hui, durables. Ces valeurs, ils les ont affirmées dans la « Déclaration des droits de l’homme » et dans d’autres textes avec beaucoup de lucidité. Ils les ont voulues si rapidement et brutalement universelles qu’ils n’ont pas hésité, dans certains cas, à les propager par la force armée.
[…] Il y a l’impérialisme culturel, c’est-à-dire le désir d’imposer aux autres des idées que nous croyons justes. Si quelqu’un me dit qu’il ne partage pas les idées que je veux lui inculquer et que je les lui impose par la force armée, je déclenche une guerre, alors que je tendais à l’universel. D’un autre côté, pour que des individus à l’intérieur d’une société et des peuples vivent ensemble le plus harmonieusement possible, il faut bien qu’ils respectent un certain nombre de valeurs, qui ne sont pas forcément transcendantales et universelles et peuvent être relatives. Quand on dit « valeur universelle » – j’ai beaucoup travaillé sur des cultures lointaines -, je me rebiffe. Je ne vois aucune raison d’imposer ma foi ou mon absence de foi à tel ou tel peuple très loin de moi. Mais en même temps je me dis : peut-être a-t-il quelque chose à prendre de moi, et moi de lui. Là, la notion d’universel devient différente. Elle devient valeur d’échange. Y a-t-il entre les peuples apparemment différents des expériences, des notions, voire ce que nous appelons (encore un mot intraduisible) des « concepts » à échanger ? C’est une vraie question. »
J’avais mentionné Jean-Claude Carrière dans le mot du jour <du 10 Juillet 2015> parce qu’il mettait en garde sur la captation du concept de spiritualité par les religions. Car spiritualité signifie « esprit », « pensée » alors que les religions, le plus souvent, conduisent à éviter de penser pour remplacer la recherche spirituelle par le «dogme».
J’avais aussi parlé de son livre « La Paix » publié en 2016 dans le mot du jour du <9 janvier 2017> et je le citais :
« On n’écrit jamais sur la paix comme s ‘il n’y avait rien à en dire, tandis que les ouvrages sur la guerre fleurissent de tout côté. »
La dernière fois que j’ai entendu sa chaude voix de conteur, c’est quand il était venu présenter son livre, consacré à la mort, « La Vallée du Néant » sur France Inter, fin novembre 2018 : <Le sens de la vie de Jean-Claude Carrière>.
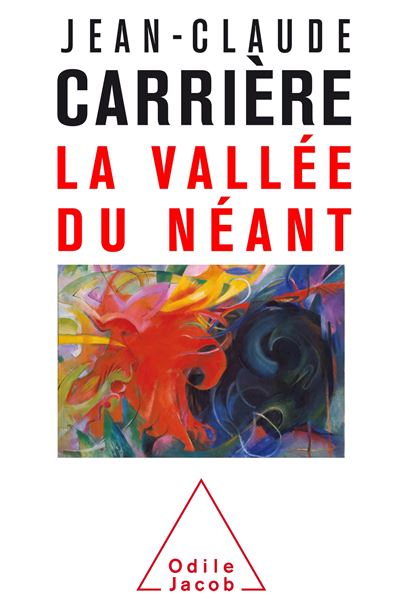 Il explique qu’il est difficile de définir le « néant », « la mort » en le rapprochant à l’idée du « rien » dans lequel les hommes de toute culture et de tout temps, ont mis beaucoup de choses.
Il explique qu’il est difficile de définir le « néant », « la mort » en le rapprochant à l’idée du « rien » dans lequel les hommes de toute culture et de tout temps, ont mis beaucoup de choses.Il s’amuse de notre espérance : « Ce qui est formidable, c’est qu’on se dit toujours que quand nous serons morts, nous le saurons » et il cite Sénèque :
« Tout le monde sait qu’il doit mourir, mais personne n’a jamais su qu’il était mort »
Il fait aussi cette objection aux transhumanistes qui rêvent d’immortalité :
« Nous oublions que nous sommes condamnés à mort dès notre naissance […] la naissance n’est possible que grâce à la mort. Or, aujourd’hui, il est impossible d’accepter l’idée que nous devons un jour disparaître.
C’est l’obsession de l’immortalité qui nous pose problème. Interdire la mort serait aussi interdire la naissance. La fin de la mort ne saurait pas se concevoir sans la fin de la naissance. Or, interdire la naissance sur toute la surface de la planète, qui s’y risquerait ? »
Mais quand il évoque la mort, il parle de la vie, de sa vie :
« Quand je regarde en arrière, je me dis que si le petit garçon que j’étais avait su ce qui l’attendait… C’était tellement imprévisible. Je dois cela à une bourse de la République. Si j’ai une chose à dire, c’est « Vive la République ! »
[…] Les gens qui craignent le plus la mort, qui en parlent beaucoup, qui la redoutent, qui, tous les matins, s’examinent, sont ceux qui, en général, vivent avec la mort tandis qu’ils sont encore vivants. Ce qui n’est pas du tout mon cas.
[…] Vieillir est le seul moyen que nous ayons trouvé pour vivre longtemps.»
Il explique par d’autres mots que si l’on ne sait pas s’il y a une vie après la mort, au moins nous devons nous imprégner de cette réalité qu’il existe une vie avant la mort
Et, il finit par cette ode à la vie, que j’ai choisi comme exergue de ce mot du jour :
« Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du privilège extraordinaire que ce qu’est « être vivant » car nous n’aurons qu’une vie, il faut en profiter pour qu’elle soit belle pour soi et qu’elle soit bonne pour les autres, et utile si possible. »
Un peu plus de deux ans après avoir écrit cet ouvrage sur la mort, Jean Claude Carrière a quitté la communauté des vivants, le 8 février 2021. Sa fille a précisé qu’il était mort dans son sommeil et qu’il n’a pas été victime de la Covid19.
Il avait 89 ans.
<1524>
-
Jeudi 11 février 2021
« Ne pas considérer la démocratie comme acquise. »Barack ObamaAvant Donald Trump, les américains avaient élu Barack Obama et ils l’ont même réélu.
Certains prétendent que c’est l’élection de Barack Obama qui a rendu possible l’élection du show man. Ils expliquent qu’il y a eu toute une part de l’électorat blanc qui n’avait pas supporté l’élection d’un métis et avait alors voté pour son exact contraire : un blanc fier de l’être, un homme rustre sans sophistication, sans une once de pensée complexe ni de culture historique et littéraire.
Il me semble que cette explication reste très marginale, je crois plutôt que c’est le rejet d’Hillary Clinton qui a été prépondérant avec le rejet de l’élite démocrate qui s’est polarisé sur la promotion des minorités et des évolutions sociétales qui sont rejetés par l’Amérique profonde. Il y a bien sûr aussi une dimension économique, l’Amérique en dehors des grandes métropoles se rendant compte que la mondialisation et le libre échange favorisaient une petite minorité située dans les métropoles alors qu’ils les désavantageaient.
J’ai trouvé, comme souvent, l’émission d’Alain Finkielkraut de samedi dernier, consacrée « à la fracture américaine » très intéressante.
Il avait invité Roger Cohen, éditorialiste au New York Times, ce journal qui est le symbole de l’élite démocrate et de ses dérives. Lors du meurtre de Samuel Paty, il s’était comporté de manière indigne comme je l’avais relaté dans le mot du jour du 28 octobre 2020 : «Nous sommes bien seuls pour défendre notre conception de la liberté d’expression.».
En face de Roger Cohen, Laure Mandeville, Journaliste au Figaro, ancienne correspondante à Washington de 2009 à 2016, défendait des positions beaucoup plus critiques contre les obsessions des élites « progressistes » américaines, comme celle, par exemple, que j’évoquais hier.
Laure Mondeville a notamment proposé cette analyse :
« Trump a porté depuis le début la rage profonde qui venait des tréfonds de l’Amérique, une rage contre l’establishment, les institutions et les élites. […] On a une partie extrêmement importante de la population qui a voté pour Trump qui est en état de quasi-sécession mentale et politique. […] Cette population qui est restée silencieuse, qui a finalement subi une espèce de disqualification à la fois politique, idéologique et presque morale. […] Je parle de l’émergence d’une gauche obsédée par l’identité et qui est en train d’attiser une sorte de volcan identitaire très dangereux. »
Barack Obama, n’a pas joué sur ces tensions identitaires, il s’est même efforcé à tous les moments de sa présidence de toujours privilégier l’universalisme au rétrécissement vers l’identitaire. Des noirs lui ont même reproché de ne pas avoir fait de réformes avantageant leur communauté.
Bien sûr, Barack Obama a commis des erreurs, il a, dans certains cas, manqué d’audace mais il ne faut pas oublier que le Sénat était contre lui et aux États-Unis, il est impossible de légiférer efficacement quand le Sénat s’y oppose.
Mais Barack Obama n’a jamais manqué de dignité, de hauteur de vue, d’intelligence.
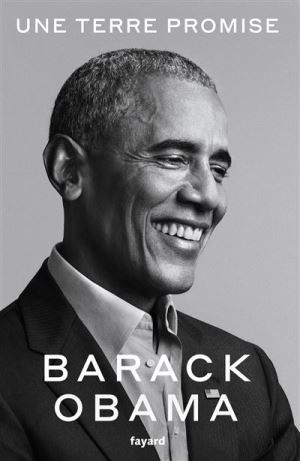 J’ai écouté avec attention et le plus grand intérêt son interview par l’excellent Augustin Trapenard, sur France Inter, ce lundi 8 février : « Barack Obama chez Augustin Trapenard dans Boomerang ».
J’ai écouté avec attention et le plus grand intérêt son interview par l’excellent Augustin Trapenard, sur France Inter, ce lundi 8 février : « Barack Obama chez Augustin Trapenard dans Boomerang ».
Bien qu’il s’agisse de radio je vous envoie vers la version vidéo de l’entretien sous-titré.
Cet entretien en distanciel a été réalisé pour la promotion du premier tome des mémoires d’Obama : « Une terre promise. »
Lors de la sortie, en novembre, de la version française, Barack Obama avait choisi d’être interviewé sur France 2 par François Busnel, l’animateur de la « Grande Librairie ». Il a donc choisi les deux fois un journaliste littéraire, de culture et non un journaliste politique.
Après son entretien, François Busnel a dit :
« Une rencontre avec Barack Obama, c’est un moment totalement exceptionnel. Quel que soit son bilan, il restera comme l’une des icônes de ce début de XXIe siècle. Je crois que c’est un écrivain. Il a apporté à la politique une sensibilité nouvelle. […] Ce qui reste frappant, c’est l’extrême humilité. Barack Obama ne vous prend jamais de haut. C’est naturellement une bête de scène avec un formidable pouvoir charismatique intact et d’énormes convictions chevillées au corps qui lui viennent de ses lectures »
 L’entretien avec François Busnel se trouve sur le site de France 2 : <Le Grand entretien du 17/11/2020>
L’entretien avec François Busnel se trouve sur le site de France 2 : <Le Grand entretien du 17/11/2020>
Augustin Trapenard a choisi de faire écouter aux auditeurs, avant l’interview, un long extrait du poème lu par Amanda Gorman lors de l’investiture de Joe Biden et qui constituait le sujet principal du mot du jour de ce lundi.
Et quand la jeune poétesse noire affirme simplement qu’elle pense possible de devenir présidente des Etats-Unis, elle le doit certainement à Barack Obama.
Et Augustin Trapenard commença son entretien en lisant la page 112 du livre d’Obama lorsque ce dernier répond à une question sur les motivations qui l’on conduit à se présenter aux élections présidentielles qu’il rêvait qu’un jour tous les enfants noirs, latinos, filles ou garçons, qui avaient le sentiment de ne pas appartenir à ce pays, pourraient voir un nouveau champ des possibles s’ouvrir à eux.
Car il faut évidemment que l’objectif qu’on poursuit s’inscrive dans le champ des possibles auxquels on croit. Et c’est ce que Barack Obama a réussi. Il a pu donc offrir ce récit à d’autres volontés, à d’autres destins.
L’échange entre Augustin Trapenard et Barack Obama est très fluide et profond. Si vous ne l’avez déjà fait je vous invite vraiment à l’écouter.
J’en tire trois extraits qui m’ont particulièrement marqué :
D’abord la reconnaissance d’Obama que la mondialisation a conduit à l’accélération des inégalités, dans nos pays développés. Et que ce problème d’inégalités minent nos démocratie ;
« Ce qui menace la démocratie, c’est ce que nous devons à la mondialisation et à la technologie : l’accélération des inégalités, et des gens qui se sentent laissés pour compte. Cela a rendu une grande partie de la population vulnérable aux appels du populisme. »
 Et puis, il parle de cette nécessité de la confiance et de la vérité sur les faits, sans quoi l’échange d’arguments ne peut exister. Il prend l’exemple du changement climatique et rapporte qu’il lui est tout à fait possible de discuter longuement avec quelqu’un qui n’est pas d’accord avec lui sur les solutions à mettre en œuvre et il sait même que ces échanges sont utiles et font avancer. En revanche, s’il se trouve en présence d’un individu qui nie la réalité du changement climatique, avec qui le socle des faits et de la vérité n’est pas assuré, le dialogue est vain. La capacité d’avancer et de trouver des solutions communes se trouve annihilée.
Et puis, il parle de cette nécessité de la confiance et de la vérité sur les faits, sans quoi l’échange d’arguments ne peut exister. Il prend l’exemple du changement climatique et rapporte qu’il lui est tout à fait possible de discuter longuement avec quelqu’un qui n’est pas d’accord avec lui sur les solutions à mettre en œuvre et il sait même que ces échanges sont utiles et font avancer. En revanche, s’il se trouve en présence d’un individu qui nie la réalité du changement climatique, avec qui le socle des faits et de la vérité n’est pas assuré, le dialogue est vain. La capacité d’avancer et de trouver des solutions communes se trouve annihilée.
Il décrit notre monde médiatique d’aujourd’hui :
« Le pouvoir des mots a été compromis par les changements du paysage médiatique. Aujourd’hui, il y a Internet et un millier de plates-formes, et il n’y a plus de règles convenues sur ce qui est vrai ou faux. C’est le plus grand danger actuel pour la démocratie. »
[…] Nous ne pourrons pas revenir à une époque où il n’y avait que quelques arbitres de la vérité. Mais nous devons trouver des moyens de tenir les réseaux sociaux responsables de la manière dont nous faisons la différence entre réalité et fiction. »
Et puis, cette évidence que nous portions depuis 1945 que la démocratie était l’horizon du monde et que tous progresseraient vers cette organisation politique, est remise en cause. La démocratie est fragile :
« L’important est de connaître suffisamment l’histoire pour que lorsque le nationalisme de droite refait surface, nous nous rappelions à quoi il mène. Pour que lorsque nous voyons le sectarisme, les préjugés refaire surface, nous nous en rappelions les conséquences. […]
Ceux d’entre nous qui croient en une démocratie tolérante, pluraliste et inclusive, qui offre à tous des possibilités, doivent être vigilants. Ils doivent faire mieux, travailler plus dur, et ne pas considérer la démocratie comme acquise. »
Et pourtant nous vivons mieux et dans un monde moins violent qu’il y a un siècle rappelle t’il.
Je redonne le lien vers la page de France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-08-fevrier-2021
<1523>
-
Mercredi 10 février 2021
« Les mots que l’on n’a plus le droit de prononcer.»Un phénomène hallucinantCela a commencé dans les universités américaines des Etats-Unis et du Canada, le même phénomène s’instille aussi dans les universités françaises.
Je l’avais évoqué lors du mot du jour de la série Beethoven : « Beethoven victime de la « cancel culture aux Etats-Unis ».
Mais évoqué conceptuellement un sujet comme celui-ci ne peut pas remplacer la force d’un témoignage. C’est un article de la presse canadienne, publié le 29 janvier par la journaliste Isabelle Hachey : « Les mots tabous, encore » qui m’a interpellé.
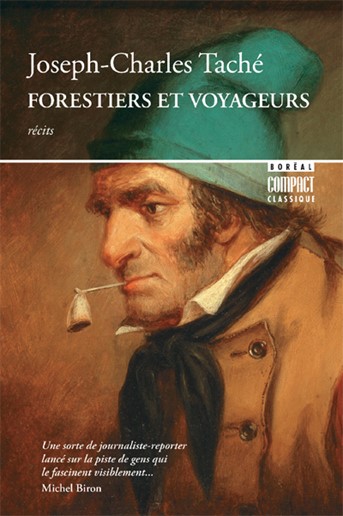 L’Université McGill est située à Montréal. elle a été fondée en 1821, c’est l’une des plus anciennes universités du Canada.
L’Université McGill est située à Montréal. elle a été fondée en 1821, c’est l’une des plus anciennes universités du Canada.
L’histoire que la journaliste va raconter se passe à l’automne dernier et concerne une jeune enseignante, chargée de cours :
« Le cours est une introduction à la littérature québécoise. L’enseignante a sélectionné huit romans, anciens et contemporains. Réjean Ducharme. Anne Hébert. De grands classiques. Des incontournables. Le premier texte est aussi le plus ancien : Forestiers et voyageurs, écrit en 1863 par Joseph-Charles Taché. Un roman folklorique qui parle de draveurs, de trappeurs et de bûcherons.
En classe virtuelle, la prof se fait interpeller.
« Madame ! Madaaame ! Le mot ! »
L’enseignante ne comprend pas tout de suite. À Ottawa, l’affaire Lieutenant-Duval n’a pas encore éclaté. « Page 99 », lui indique l’étudiante. La prof se rend à la page. La survole du regard. Cherche « le mot ». Lequel ? Elle ne sait pas trop. Mais elle sent une angoisse sourde monter en elle. »
Je suppose que comme moi, vous n’êtes pas au courant des péripéties universitaires canadiennes. L’affaire Lieutenant-Duval fait référence à une enseignante Verushka Lieutenant-Duval, qui enseigne l’histoire de l’art et les théories féministes à l’Université d’Ottawa. Lors d’un cours, elle a prononcé le mot : « nègre » et très rapidement un collectif d’étudiants a demandé sa démission parce qu’en utilisant ce mot, elle les aurait offensés. La direction de l’Université d’Ottawa a suspendu l’enseignante pendant quelques temps avant de lui permettre de reprendre le cours. Un article de Radio Canada raconte le malaise et la crainte de cette professeure devant les insultes et les mots violent qu’elle a dû subir depuis cette campagne contre elle : « J’ai peur depuis la première journée »
Mais reprenons le récit de la journaliste concernant la chargée de cours de l’Université Mac Gill :
« Soudain, ça lui saute aux yeux.
Il est là, écrit en toutes lettres.
Pendant leur séjour en forêt, les trappeurs canadiens-français ont « travaillé comme des nègres ».
La journaliste précise que l’enseignante a requis l’anonymat parce qu’elle craint les répercussions d’une sortie publique sur sa carrière.
Bien que l’enseignante présente immédiatement ses excuses, la tension monte :
« Des étudiants s’indignent de la présence du mot dans l’œuvre. Ils lui reprochent de ne pas les avoir prévenus ; ils n’étaient pas prêts à ce choc émotionnel. Ils remettent son jugement en cause.
La prof perd pied. « Le stress monte à un point où on n’est plus maître de soi-même, raconte-t-elle. C’est vraiment dans les pires minutes de ma vie. »
Elle tente d’expliquer. De justifier. C’est une expression qui reflète les mentalités de l’époque, bafouille-t-elle. Et en bafouillant… le mot tabou lui glisse des lèvres.
« Madaaame ! Vous venez de le dire ! C’est inexcusable, une Blanche ne doit jamais prononcer ce mot ! »
Les étudiants ferment leur micro et leur caméra les uns après les autres. À la fin, la prof se retrouve seule. Abasourdie.
Deux plaintes pour racisme sont déposées contre elle auprès de la faculté des arts de McGill. »
Les instances dirigeantes de l’Université ont eu pour stratégie de faire baisser la tension à coups d’accommodements accordés aux étudiants.
Le vice-doyen à l’enseignement qui l’a défendue lorsque l’enseignante avait été qualifiée de raciste par une poignée d’étudiants, lui a cependant conseillé de passer en revue les romans au programme et d’anticiper les mots qui risquaient d’offenser les étudiants..
Bref, il a baissé pavillon et battu en retraite, en plein combats des idées.
L’enseignante a suivi les conseils du vice doyen :
« Elle l’a fait. Des huit romans, sept contenaient des mots qui ont terriblement mal vieilli. Le « mot qui commence par N », bien sûr. Plus souvent, « le mot qui commence par S », pour sauvage. « Quand on parle des Autochtones dans les textes québécois, jusque dans les années 1960, c’est le mot qui est là. »
Elle aurait voulu leur expliquer. Mettre en contexte. Mais elle s’est tue pour s’éviter des problèmes.
Certains lui ont échappé. Un « mot qui commence par N » dans Les fous de
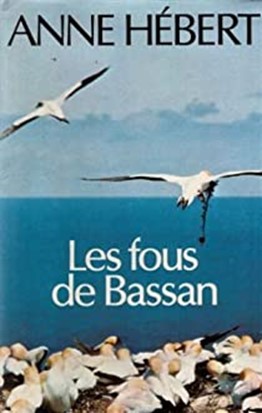 Bassan, d’Anne Hébert (1982). Un autre dans L’hiver de force, de Réjean Ducharme (1973). Tout l’automne, elle a vécu dans la crainte d’un autre dérapage.
Bassan, d’Anne Hébert (1982). Un autre dans L’hiver de force, de Réjean Ducharme (1973). Tout l’automne, elle a vécu dans la crainte d’un autre dérapage.
Le vice-doyen lui a conseillé non seulement de prévenir ses étudiants, mais de leur offrir de sauter des pages, voire de ne pas lire les œuvres entières.
Son cœur lui disait de résister. Mais il y avait l’affaire Lieutenant-Duval qui déchaînait les passions au Québec. Et puis, il y a eu l’affaire Joyce Echaquan à Joliette. « Le contexte était explosif. Évidemment, on a envie de se plier et d’être du côté de la vertu. »
Alors, elle l’a fait. Elle a plié. »
Toujours pour préciser le contexte canadien, Le 28 septembre 2020, Joyce Echaquan, une femme de 37 ans, Atikamekw, c’est-à-dire appartenant à un peuple autochtone est décédée à l’hôpital de Joliette, au Québec. Avant sa mort, elle a enregistré un Facebook Live qui montrait des agents de santé la maltraitant. Il s’agissait dans ce cas de comportements racistes avérés : « Mort de Joyce Echaquan : honte et indignation à l’hôpital de Joliette »
Rien de tel dans l’histoire qui se passe à l’Université Mac Gill.
La journaliste ne se place dans le camp des vaincus sans combattre et écrit : « Ça n’aurait pas dû se passer comme ça. »
Elle donne ainsi la parole à des professeurs de cette université qui s’inquiète de cette dérive. Notamment Arnaud Bernadet, professeur de littérature à l’Université McGill :
« Tout l’automne, elle a vu l’Université céder du terrain aux étudiants de sa collègue. « Ne pas prononcer le mot, d’abord. Ne pas le faire lire. Prévenir les étudiants. Caviarder les PowerPoint. Les censurer. Enfin, recommander une non-lecture de l’œuvre sur laquelle ils devaient être évalués ! C’est… »
Elle cherche le bon mot.
Je lui suggère celui-ci : aberrant. »
La jeune enseignante ne donne plus le cours d’introduction à la littérature québécoise. Elle ignore si elle le redonnera un jour – ou si elle a même envie de le faire.
« Je n’ai pas décidé d’abandonner l’enseignement de la littérature, mais l’automne dernier, dans les moments les plus creux, je me disais : « Si on est toujours là avec une brique et un fanal à attendre la prochaine gaffe du prof, je ne suis plus certaine que ça me tente. » »
Traité une personne de couleur noire de « Nègre » ou de « sale Nègre » constitue indiscutablement une injure raciste qui doit être condamnée.
Mais effacer toutes les utilisations du mot « nègre » dans les œuvres du passé, ce n’est pas lutter contre le racisme.
Les gens qui sont dans ce combat, prétendent être dans le camp du Bien, ils sont plutôt dans le camp de l’appauvrissement culturel et de la mésintelligence.
Parmi les électeurs de Trump il y a des racistes, des machistes, des suprémacistes blancs.
Mais probablement que si ces électeurs sont si nombreux, c’est aussi qu’il en est qui rejettent la dérive de ces intolérants qui se prétendent de gauche et n’acceptent plus l’altérité, la contradiction, la complexité.
<1522>
-
Mardi 9 février 2021
« Des chiffres et des électeurs. »L’élection présidentielle américaine déclinée par EtatJ’ai abordé à de nombreuses reprises la problématique de la quantophrénie, c’est-à-dire cette tendance qui consiste à considérer que les chiffres disent la vérité. Autrement dit qu’un chiffre arrête la conversation et la réflexion. Dans un mot du jour synthétique de 2017 « Des chiffres et des hommes » j’avais expliqué une conviction opposée :
« Beaucoup croient qu’en annonçant un chiffre ils concluent leur propos. C’est le contraire qu’il faut faire, les chiffres sont au début du discours, il faut les interroger, les expliquer. »
Je continue sur les dernières élections présidentielles américaines.
L’opinion dominante semble être que Joe Biden a battu nettement Donald Trump. Dans tous les journaux s’affiche cette carte et ces chiffres :
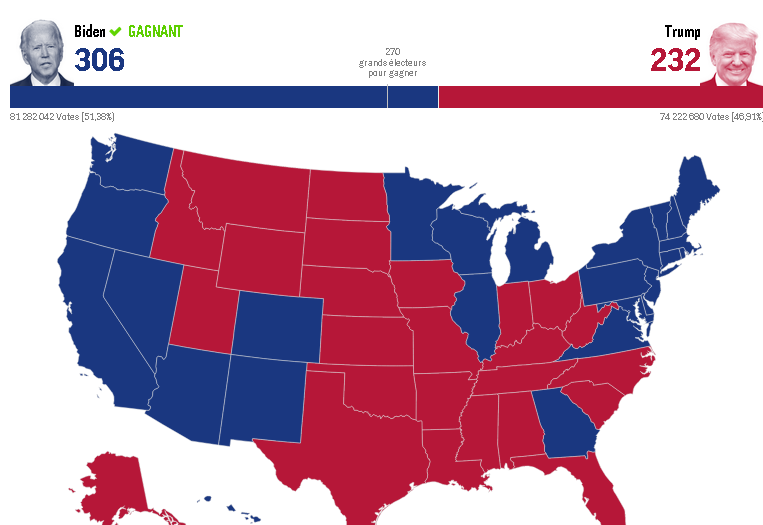
Nous sommes tous devenus spécialistes des élections présidentielles américaines et nous savons donc que cette élection peut être regardée sous le prisme français mais que le résultat dépend de la réalité américaine.
Le prisme français repose sur un État unitaire et l’élection du Président de la République. Notons que contrairement à des formulations franco-centrées, Joe Biden n’est pas président de la république mais président des États Unis.
Dans ce prisme, on regarde l’élection sur l’ensemble du pays et on compare le nombre de votants pour un candidat et le nombre de votants pour l’autre.
En France, c’est cette comparaison qui donne le résultat de l’élection.
Aux États-Unis on parle du « vote populaire » et ce vote n’est pas celui qui donne le résultat. Al Gore avait gagné le vote populaire contre George W Busch et Hillary Clinton avait fait de même contre Trump, mais aucun de ces deux n’a été élu président.
Pour la dernière élection, le résultat du vote populaire semble sans appel :
Biden 81 282 042 votes et Trump 74 222 690 votes, 7 millions de voix d’écart. En pourcentage, il faut savoir qu’il y a d’autres candidats qui se sont présentés dont certains uniquement dans un nombre limités d’états fédérés, le score est de 51,38% contre 46,91 % donc 4,5 points d’écarts.
La réalité américaine prend en compte le vote par État. Chaque État donne un certain nombre de grands électeurs, en fonction de sa démographie. Dans quasi tous les cas, mais il y a des exceptions, le candidat arrivé en tête rafle l’ensemble des grands électeurs de l’État. Le vainqueur est celui qui obtient au moins 270 grands électeurs. Au regard de cette réalité la victoire de Biden est aussi nette 306 contre 232.
Prenons d’abord le prisme français.
J’écoutais négligemment une émission sur l’élection américaine quand un intervenant a dit brusquement, il ne faut pas apporter trop d’importance à ce vote populaire. La victoire de Biden s’explique par la Californie et New York. Ceci m’a conduit à interroger les chiffres.
Prenons un tableau Excel :
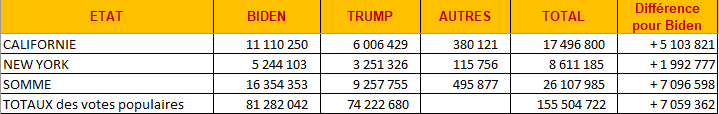
Dans ce tableau vous constatez que s’il existe d’autres candidats, ils ont des résultats très modestes.
Mais l’assertion de l’intervenant est rigoureusement exacte. Les voix cumulées de la Californie et de New York représentent un avantage de 7 096 598 voix pour Biden ce qui est supérieur à la différence observée au niveau national.
Ceci signifie donc que sur les 48 autres États des États-Unis, Trump a battu Biden.
Ces deux États sont très particuliers. La Californie est l’État de la silicon vallée, du transhumanisme, de Facebook et de Twitter. Twitter qui a fermé le compte du Président des États Unis en exercice.
New York, c’est l’État de Wall Street et le centre de la Finance mondiale.
Ces faits ont vocation à troubler, irriter, indigner les partisans de Trump qui considèrent que la mondialisation, la numérisation et la financiarisation du monde leur ont été défavorables.
Si on élargit un peu la focale à quelques autres États emblématiques dans lesquels se trouve des métropoles géantes l’Illinois (Chicago), le Massachusetts (Boston), le Maryland (Baltimore) et aussi au District of Columbia qui même si la démographie en est plus modeste, présente la particularité d’abriter la capitale : Washington, nous observons le résultat suivant :
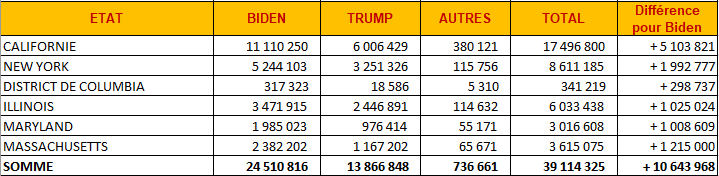 Avec ces 6 États, Biden est en avance de plus de 10,5 millions d’électeurs. Notez que dans le District de Columbia, Biden a obtenu 94,47% des voix contre 5,53 % pour Trump (nonobstant les petits candidats). Dans tout pays du monde dans lequel on afficherait un tel résultat, personne ne croirait qu’on se trouve en démocratie !
Avec ces 6 États, Biden est en avance de plus de 10,5 millions d’électeurs. Notez que dans le District de Columbia, Biden a obtenu 94,47% des voix contre 5,53 % pour Trump (nonobstant les petits candidats). Dans tout pays du monde dans lequel on afficherait un tel résultat, personne ne croirait qu’on se trouve en démocratie !
Ces 6 États sont très importants, mais ne représentent pas la majorité des habitants des États Unis d’Amérique. Les 44 États restants représentent une population plus importante.
Nous avons donc en nous concentrant uniquement sur les électeurs de Biden et de Trump le tableau suivant :
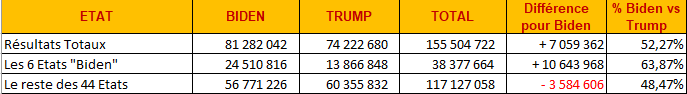 Si on compare les 6 États « Biden » et le reste des Etats-Unis, les premiers représentent moins de 25% des électeurs et les seconds plus de 75% des électeurs.
Si on compare les 6 États « Biden » et le reste des Etats-Unis, les premiers représentent moins de 25% des électeurs et les seconds plus de 75% des électeurs.
Vous avez donc bien compris que si on prend uniquement ces ¾ de la population américaine Trump devance Biden de plus de 3,5 millions d’électeurs.
C’est ce qu’on appelle une « fracture » entre deux parties d’un même tout.
Quand on creuse un peu les chiffres on trouve toujours des choses étonnantes.
Maintenant prenons la réalité américaine, le vote des grands électeurs.
La Californie compte 55 grands électeurs que Biden gagne de 5 000 000 de voix ou de 10 000 voix, peu importe, il rafle les 55 grands électeurs.
D’autres États présentent la même physionomie en faveur des républicains de Trump.
Ce qui compte donc pour remporter les élections américaines, ce sont les États qui sont susceptibles de basculer d’un camp à l’autre. Un très petit nombre de voix va décider de qui va obtenir les grands électeurs de l’État.
Dans la terminologie américaine, on parle de « swing state », ou État-charnière, État pivot, ou État clé.
Biden a gagné 306 grands électeurs contre 232, ce qui fait 74 grands électeurs de différence. Un mathématicien, digne de ce nom, dira alors qu’il suffit que la moitié, soit 37 grands électeurs, changent de camp pour qu’il y ait égalité.
Ces 37 grands électeurs peuvent être trouvés dans les 3 États suivants : Georgie, Arizona et Wisconsin.
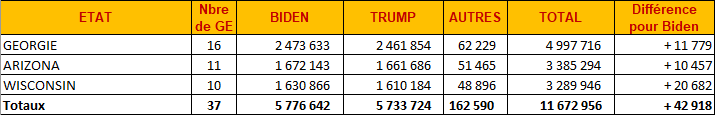 Donc le résultat aurait été inversé dans ces 3 États si pour chaque État, la moitié de la différence des voix avait changé de camp et choisi Trump plutôt que Biden. Soit 21 459 électeurs qui si on les rapproche de l’ensemble des électeurs qui se sont exprimés sur Biden ou Trump, représente 0,014% du corps électoral.
Donc le résultat aurait été inversé dans ces 3 États si pour chaque État, la moitié de la différence des voix avait changé de camp et choisi Trump plutôt que Biden. Soit 21 459 électeurs qui si on les rapproche de l’ensemble des électeurs qui se sont exprimés sur Biden ou Trump, représente 0,014% du corps électoral.
Mais avec ces 3 Etats, Trump ne pouvait que faire jeu égal, il n’aurait pas été élu. Pour gagner il lui aurait aussi fallu par exemple, la Pennsylvanie dont on a beaucoup parlé. L’État de Philadelphie et de Pittsburgh.
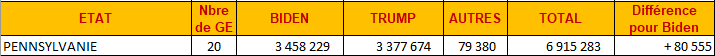 Pour obtenir ces 20 électeurs supplémentaires, il fallait que 40 278 électeurs changent aussi de camp.
Pour obtenir ces 20 électeurs supplémentaires, il fallait que 40 278 électeurs changent aussi de camp.
Dés lors on arrive à un total de 61 737 ce qui représente 0,049% du corps électoral. Biden n’a pas battu Trump nettement, il l’a battu de justesse.
Ce mot du jour ne parle pas de Trump qui est un personnage odieux, menteur, rustre et probablement déséquilibré.
Mais il parle du vote Trump, des électeurs de Trump et de l’Amérique du vote Trump.
Ces chiffres décryptés montrent une réalité qui est assez dérangeante, surtout après 4 ans de présidence pendant lesquels tous les américains ont pu voir cet individu à l’œuvre.
Et malgré cela, ils ont voté pour lui.
L’explication simpliste est que 74 000 000 d’américains sont des extrémistes ou des ignorants. La réalité est certainement plus complexe.
Vous trouverez tous les résultats que j’ai utilisé pour cette démonstration sur le site de France 24 : https://graphics.france24.com/elections-americaines-2020-resultats-direct/
<1521>
-
Lundi 8 février 2021
« Car il y a toujours de la lumière. Si seulement nous sommes assez braves pour la voir. Si seulement nous sommes assez braves pour l’être.»Amanda GormanEt enfin, il est parti.
Nous commencions à avoir des doutes, des craintes, il ne partirait pas et il appellerait ses électeurs les plus farouches à prendre les armes.
Il a bien eu des propos ambigus et ses partisans ont compris qu’ils devaient marcher vers le Capitole. Une fois devant le Capitole, ce n’était pas clair sur ce qu’il convenait de faire. En face, les forces de sécurité ne savaient pas, non plus, quoi faire.
Sur une sorte de malentendu, cette foule vociférante est entrée dans le lieu sacré de la démocratie américaine.
S’agissait t’il d’une révolution ? ou d’un coup d’État ?
Non !
 Ces factieux sont entrés dans le capitole, non pour faire un coup d’état mais pour s’y prendre en photo. Faire des selfies !
Ces factieux sont entrés dans le capitole, non pour faire un coup d’état mais pour s’y prendre en photo. Faire des selfies !C’est comme si César arrivant devant le Rubicon, au lieu de prononcer cette phrase célèbre « alea jacta est » et de marcher sur Rome, s’était assis au bord de la rivière et avait sorti sa canne à pêche.
J’étais donc soulagé qu’un homme décent, qu’on peut cependant critiquer sur de nombreux points, investisse la fonction de Président des États-Unis.
J’ai suivi, avec attention, l’ensemble de la cérémonie d’investiture du 20 janvier.
Cette cérémonie et ce qui a précédé nous montre toute la distance qui existe entre les États-Unis et la France.
Le jour d’avant, les reportages nous ont montré un Joe Biden en pleurs, au moment de quitter l’État du Delaware.
Il est resté en effet 36 ans sénateur de Delaware et il exprimait son émotion au moment de le quitter pour rejoindre Washington et dans un moment lyrique il a dit
« L’écrivain James Joyce a dit à un ami que quand viendrait l’heure de sa mort on trouverait gravé dans son cœur le nom de Dublin, et bien excusez mon émotion à l’heure de ma mort c’est le Delaware que l’on trouvera dans le mien ».
Très bien !
Mais, à ce stade je dois informer, celles et ceux qui ne le saurait pas que le Delaware est un des plus grands paradis fiscaux qui existe sur cette terre qui en possède de nombreux.
L’excellent journal « Les Echos » vous expliquera cela très bien <Le Delaware, paradis fiscal « made in USA »>.
Le président des États Unis a donc représenté, pendant la plus grande partie de sa vie politique, un État dont la fonction principale est de permettre à tous les escrocs de la planète d’éviter de payer les impôts et taxes qu’ils doivent au bien commun.
Le matin de la cérémonie d’investiture, Joe Biden et de nombreux représentants politiques de Washington se sont retrouvés à la cathédrale St Matthew de Washington pour placer cette journée sous la bénédiction divine.
Ceci nous apprend deux choses, la première c’est que Joe Biden est catholique comme John Kennedy et que décidément les américains et les français n’ont pas la même relation entre la politique et la religion.
D’ailleurs, Joe Biden a ensuite prêté serment en posant sa main sur une Bible. Ce n’est pas obligatoire, c’est une tradition. Si un jour un président musulman est élu, il pourra très bien prêter serment sur le Coran.
Dans son discours d’investiture qui a surtout insisté sur la nécessité de se réunir le peuple américain et de se respecter, il a quand même eu cette phrase étonnante, en parlant du peuple américain :
« we are a good people ».
Nous sommes dans le registre de la morale qui me parait un peu décalé dans un discours politique. Je pense qu’en France , il y aurait eu beaucoup de moqueries si cette phrase avait été prononcée par un président élu. Vous trouverez l’ensemble du discours de Joe Biden derrière ce <Lien>.
Mais il y eut, un moment de grâce lors de cette cérémonie qui éclipsa tout le reste.
Une jeune femme, noire, de jaune vêtu, s’approcha de la tribune et déclama un texte : <The Hill We Climb>, « La colline que nous gravissons »
Cette jeune femme s’appelle Amanda Gorman
<Le Monde> décrit avec beaucoup de justesse ce texte et la manière dont cette jeune femme lumineuse l’a déclamé en s’aidant de ses bras et de ses mains pour soutenir, souligner et partager son texte. :
« Un texte de sa composition, pétri de fragilité, d’espoir et d’appel à l’unité, la poétesse de 22 ans a conquis un auditoire et promu au passage un genre méconnu du grand public : la force du verbe et de l’éloquence. »
 On apprend ainsi que plusieurs présidents, Clinton, Obama ont invité des poètes à leur investiture, mais jamais une poétesse aussi jeune. Elle est née en 1998.
On apprend ainsi que plusieurs présidents, Clinton, Obama ont invité des poètes à leur investiture, mais jamais une poétesse aussi jeune. Elle est née en 1998.Il semble que ce soit John Fitzgerald Kennedy qui ait initié cette pratique en 1961. Ce furent toujours des présidents démocrates, les républicains n’ont visiblement pas le goût de la poésie.
<Wikipedia> nous apprend qu’enfant elle était affectée d’un trouble de la parole qui l’empêchait de bien prononcer certaines lettres. C’est une difficulté qu’elle a manifestement surpassée
Encouragée par sa mère, elle a poursuivi de brillantes études obtenant en 2020 un diplôme de sociologie de l’université Harvard.
Ses dernières années, elle a obtenu plusieurs prix ou diplômes de poésie, c’est ce qui l’a fait connaître et notamment découvrir par Jill Biden, l’épouse du président.
Elle montre son espérance dans son pays bien qu’au départ elle ne soit pas partie avec tous les atouts :
« Nous, les successeurs d’un pays et d’une époque où une maigre jeune fille noire, descendante d’esclaves et élevée par une mère célibataire, peut rêver de devenir présidente, et se retrouver à réciter un poème à un président. »
La colline que nous gravissons est bien sûr une référence à la colline du Capitole qui venait d’être souillée par des individus qui refusaient le verdict des urnes et les décisions des juges qui avaient rejeté les contestations.
La colline qu’il s’agit de gravir pour s’élever.
Elle a aussi fait référence, en évoquant « une union plus parfaite », au préambule de la Constitution américaine :
« Nous, le peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite, d’établir la justice, d’assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d’assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous ordonnons et établissons la présente Constitution pour les États-Unis d’Amérique. »
Ce texte date de 1787. A cette date, les femmes n’avaient pas le droit de vote et une grande partie de la population américaine était esclave.
Alors, il est loisible de se moquer et de constater que ce texte était totalement décalé par rapport à la réalité.
Mais il y a aussi une autre manière de regarder ce texte : celui d’un récit qui explique ce qui doit advenir, vers quelle destinée il faut aller. Et là, force est de constater que bien que nous soyons encore loin de la perfection, beaucoup de chemin a été accompli.
 Amanda Gorman regarde l’avenir et essaye de fonder un récit qui puisse contribuer à l’unité :
Amanda Gorman regarde l’avenir et essaye de fonder un récit qui puisse contribuer à l’unité :« Ainsi, nous ne regardons pas ce qui se trouve entre nous, mais ce qui se trouve devant nous. Nous comblons le fossé parce que nous savons que, pour faire passer notre avenir avant tout, nous devons d’abord mettre nos différences de côté. Nous déposons nos armes pour pouvoir tendre les bras les uns aux autres. Nous ne cherchons le mal pour personne mais l’harmonie pour tous. Que le monde entier, au moins, dise que c’est vrai. Que même si nous avons fait notre deuil, nous avons grandi. Que même si nous avons souffert, nous avons espéré ; que même si nous nous sommes fatigués, nous avons essayé ; que nous serons liés à tout jamais, victorieux. Non pas parce que nous ne connaîtrons plus jamais la défaite, mais parce que nous ne sèmerons plus jamais la division. »
Et je retiens aussi cette belle phrase, si pertinente pour toutes celles et ceux qui savent que la coopération nous rend plus fort que l’affrontement et la compétition :
« la victoire ne passera pas par la lame, mais par tous les ponts que nous avons construits. C’est la promesse de la clairière, la colline que nous gravissons si seulement nous l’osons »
<France Culture> décrit le processus de création d’Amanda Gorman en citant le New York Times :
« Gorman a commencé le processus, comme elle le fait toujours, avec des recherches. Elle s’est inspirée des discours des leaders américains qui ont essayé de rassembler les citoyens pendant des périodes de division intense, comme Abraham Lincoln et Martin Luther King. Elle a également parlé à deux des précédents. »
Il cite aussi le Los Angeles Times dans lequel dans un entretien la jeune poétesse parle des fractures américaines et du rôle de son texte :
« Je dois reconnaître cela dans le poème. Je ne peux pas l’ignorer ou l’effacer. Et donc, j’ai élaboré un poème inaugural qui reconnaît ces cicatrices et ces blessures. J’espère qu’il nous fera progresser vers leur guérison ».
Ce journal suisse a titré : <La jeune poétesse Amanda Gorman vole la vedette à Joe Biden>
Libération titre : <Et soudain, la voix «féroce et libre» de la poète américaine Amanda Gorman> en faisant référence à une expression qu’elle a insérée dans son texte :
« Nous ne reviendrons pas à ce qui était, mais nous irons vers ce qui sera : un pays meurtri, mais entier ; bienveillant, mais audacieux ; féroce et libre. »
Telerama annonce : <Soudain, la jeune poétesse Amanda Gorman entre dans l’Histoire>
Et, la presse canadienne donne cette appréciation <Amanda Gorman, lumière de l’investiture >
Et c’est en évoquant la lumière qu’Amanda Gorman termine son magnifique texte et c’est cette conclusion que je mets en exergue de ce mot du jour.
Les récits sont essentiels pour nous rassembler et sans l’espoir de la capacité de changer les choses pour un meilleur avenir, notre vie est vaine
Sur le site de la Radio télévision Suisse on trouve une traduction du texte d’Amanda Gorman :
« Le jour vient où nous nous demandons où pouvons-nous trouver la lumière dans cette ombre sans fin ?
La défaite que nous portons, une mer dans laquelle nous devons patauger. Nous avons bravé le ventre de la bête.
Nous avons appris que le calme n’est pas toujours la paix. Dans les normes et les notions de ce qui est juste n’est pas toujours la justice.Et pourtant, l’aube est à nous avant que nous le sachions. D’une manière ou d’une autre, nous continuons.
D’une manière ou d’une autre, nous avons surmonté et été les témoins d’une nation qui n’est pas brisée, mais simplement inachevée.
Nous, les successeurs d’un pays et d’une époque où une maigre jeune fille noire, descendante d’esclaves et élevée par une mère célibataire, peut rêver de devenir présidente, et se retrouver à réciter un poème à un président.Et oui, nous sommes loin d’être lisses, loin d’être immaculés, mais cela ne veut pas dire que nous nous efforçons de former une union parfaite.
Nous nous efforçons de forger notre union avec détermination, de composer un pays qui s’engage à respecter toutes les cultures, les couleurs, les caractères et les conditions de l’être humain.
Ainsi, nous ne regardons pas ce qui se trouve entre nous, mais ce qui se trouve devant nous. Nous comblons le fossé parce que nous savons que, pour faire passer notre avenir avant tout, nous devons d’abord mettre nos différences de côté. Nous déposons nos armes pour pouvoir tendre les bras les uns aux autres. Nous ne cherchons le mal pour personne mais l’harmonie pour tous. Que le monde entier, au moins, dise que c’est vrai. Que même si nous avons fait notre deuil, nous avons grandi. Que même si nous avons souffert, nous avons espéré ; que même si nous nous sommes fatigués, nous avons essayé ; que nous serons liés à tout jamais, victorieux. Non pas parce que nous ne connaîtrons plus jamais la défaite, mais parce que nous ne sèmerons plus jamais la division.
L’Écriture nous dit d’imaginer que chacun s’assoira sous sa propre vigne et son propre figuier, et que personne ne l’effraiera. Si nous voulons être à la hauteur de notre époque, la victoire ne passera pas par la lame, mais par tous les ponts que nous avons construits. C’est la promesse de la clairière, la colline que nous gravissons si seulement nous l’osons. Car être Américain est plus qu’une fierté dont nous héritons ; c’est le passé dans lequel nous mettons les pieds et la façon dont nous le réparons. Nous avons vu une forêt qui briserait notre nation au lieu de la partager, qui détruirait notre pays si cela pouvait retarder la démocratie. Et cet effort a presque failli réussir.

Mais si la démocratie peut être périodiquement retardée, elle ne peut jamais être définitivement supprimée. Dans cette vérité, dans cette foi, nous avons confiance, car si nous avons les yeux tournés vers l’avenir, l’histoire a ses yeux sur nous. C’est l’ère de la juste rédemption. Nous la craignions à ses débuts. Nous ne nous sentions pas prêts à être les héritiers d’une heure aussi terrifiante, mais en elle, nous avons trouvé le pouvoir d’écrire un nouveau chapitre, de nous offrir l’espoir et le rire.
Ainsi, alors qu’une fois nous avons demandé : « Comment pouvons-nous vaincre la catastrophe ? » Maintenant, nous affirmons : « Comment la catastrophe pourrait-elle prévaloir sur nous ? »
Nous ne reviendrons pas à ce qui était, mais nous irons vers ce qui sera : un pays meurtri, mais entier ; bienveillant, mais audacieux ; féroce et libre. Nous ne serons pas détournés, ni ne serons interrompus par des intimidations, car nous savons que notre inaction et notre inertie seront l’héritage de la prochaine génération. Nos bévues deviennent leur fardeau. Mais une chose est sûre, si nous fusionnons la miséricorde avec la force, et la force avec le droit, alors l’amour devient notre héritage, et change le droit de naissance de nos enfants.
Alors, laissons derrière nous un pays meilleur que celui qui nous a été laissé. À chaque souffle de ma poitrine de bronze, nous ferons de ce monde blessé un monde merveilleux. Nous nous élèverons des collines de l’Ouest aux contours dorés. Nous nous élèverons du Nord-Est balayé par les vents où nos ancêtres ont réalisé leur première révolution. Nous nous élèverons des villes bordées de lacs des États du Midwest. Nous nous élèverons du Sud, baigné par le soleil. Nous reconstruirons, réconcilierons et récupérerons dans chaque recoin connu de notre nation, dans chaque coin appelé notre pay s; notre peuple diversifié et beau en sortira meurtri et beau.
Quand le jour viendra, nous sortirons de l’ombre, enflammés et sans peur. L’aube nouvelle s’épanouit alors que nous la libérons. Car il y a toujours de la lumière. Si seulement nous sommes assez braves pour la voir. Si seulement nous sommes assez braves pour l’être. »
Voici le texte original <The Hill We Climb Amada Gorman>
Je redonne le lien vers la vidéo : <The Hill We Climb>
<1520>
-
Lundi 1 février 2021
« Tout le problème de ce monde est que les imbéciles et les fanatiques sont toujours très sûrs d’eux, alors que les gens plus intelligents sont pleins de doute. »Bertrand RussellJ’ai lu souvent ces derniers temps cette citation attribuée au célèbre écrivain américain né en Allemagne, Charles Bukowski :
« Le problème avec ce monde c’est que les gens intelligents sont pleins de doutes alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. »
Ce remarquable écrivain a, hélas en France, une réputation entachée par sa désastreuse intervention dans « Apostrophes » de Bernard Pivot que Wikipedia rapporte de la manière suivante :
« En direct sur le plateau, Bukowski boit trois bouteilles de vin blanc au goulot puis, ivre, tient des propos incohérents, rejette brutalement la comparaison de son œuvre avec celle d’Henry Miller, tandis que François Cavanna — qui défendait l’œuvre et le personnage sur le plateau — tente vivement de le faire taire (« Bukowski, ta gueule ! »). Bukowski caresse le genou de Catherine Paysan, puis, las de la discussion qu’il trouve trop guindée, finit par arracher son oreillette et quitter finalement le plateau — ce que personne n’avait fait auparavant — sans que Bernard Pivot, découragé, ne cherche à le retenir. Hors caméra, il sort un couteau avec lequel il menace (« pour rire », selon lui) une personne chargée de la sécurité, ce qui lui vaut d’être maîtrisé et jeté hors des locaux d’Antenne. ».
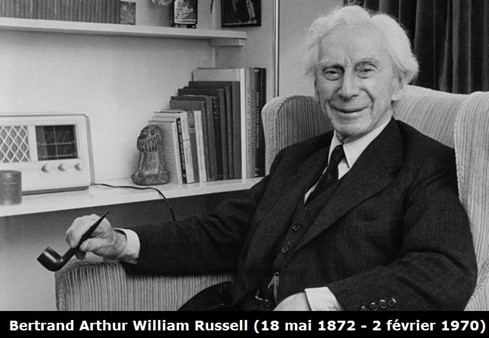 Ceci ne diminue en rien ses talents d’écrivain, mais devrait mettre en garde tout le monde devant les méfaits de l’alcool qui conduisent à des comportements regrettables.
Ceci ne diminue en rien ses talents d’écrivain, mais devrait mettre en garde tout le monde devant les méfaits de l’alcool qui conduisent à des comportements regrettables.Il est possible que Bukowski ait écrit ou dit cette phrase pleine de sens.
Mais j’ai trouvé sur plusieurs sites et notamment ce site sérieux <Philosophie Magazine> et sous la plume très sérieuse de François Morel, une phrase exprimant exactement la même vérité mais attribué au mathématicien philosophe Bertrand Russell. : « Tout le problème de ce monde est que les imbéciles et les fanatiques sont toujours très sûrs d’eux, alors que les gens plus intelligents sont pleins de doute. »
François Morel a raconté en outre :
« Bertrand Russell est l’auteur de cette phrase qui lui a peut-être été inspirée par un souvenir personnel. Figurez-vous qu’il fut l’un des 24 survivants sur un total de 43 passagers d’un accident d’avion. Les victimes étant essentiellement dans la partie non fumeurs de l’appareil, le philosophe gallois put constater que le fait de fumer lui avait sauvé la vie. »
C’est une autre manière de parler du sujet de « l’ultracrépidarianisme » évoqué lors du mot du jour du <23 septembre 2020>
Le présent article a aussi pour objet d’annoncer le retour du mot du jour quotidien à partir du lundi 8 février 2021.
<1519>
-
Lundi 4 janvier 2021
« Pause (« A quoi bon jouer du Beethoven quand les gens ont faim ?) »Un jour sans mot du jour nouveauLe mot du jour est en congé. Il reviendra en février à une date restant à déterminer.
 La fin de l’année fut consacrée au 250ème anniversaire de Ludwig van Beethoven.
La fin de l’année fut consacrée au 250ème anniversaire de Ludwig van Beethoven.J’ai modifié la conclusion du mot du jour du 29 décembre, celui consacré à la cancel culture et dans lequel j’évoquais des universitaires américains qui voudraient assimiler Beethoven à la culture dominante et discriminante par rapport aux populations non blanches et non bourgeoises.
Je cite un pianiste humaniste et étonnant :
Pour conclure, je vais faire appel au pianiste Miguel Angel Estrella, défenseur des droits de l’homme et des humbles. Il est issu d’un milieu modeste : son père est le fils de paysans libanais émigrés en Bolivie, sa mère est une argentine avec des ascendances amérindiennes métissées. En raison de ses convictions politiques, il fuit le régime argentin en 1976 à cause des persécutions dont il fait l’objet de la part de la junte militaire. Mais en 1977, il est détenu en Uruguay à Montevideo, où il subit des tortures. Il devient alors très célèbre en Europe, parce que le monde de la culture se mobilise pour sa libération. Il est libéré en 1980 à la suite des pressions internationales (en particulier de Yehudi Menuhin, Nadia Boulanger et Henri Dutilleux). Il se réfugie alors en France. Daniel Balavoine lui dédie sa chanson <Frappe avec ta tête> en 1983
En 1982, Miguel Angel Estrella fonde Musique Espérance dont la vocation est de « mettre la musique au service de la communauté humaine et de la dignité de chaque personne ; de défendre les droits artistiques des musiciens — en particulier des jeunes — et de travailler à construire la paix ». Depuis, il fait le tour de la planète pour aller chez les plus humbles, les plus éloignés de la culture occidentale pour jouer du piano.
Le monde Diplomatique explique cela dans un long article qui est en ligne : <A quoi bon jouer du Beethoven quand les gens ont faim ? >. Et c’est la réponse à cette question qui me pousse à conclure ce mot du jour avec Miguel Angel Estrella :
« Nous sommes des musiciens et par le biais de notre art nous essayons de trouver un chemin pour améliorer la qualité de la vie. Je l’ai compris il y a longtemps et je me suis battu contre les intellectuels latino-américains qui disaient : « A quoi bon jouer du Beethoven quand les gens ont faim ? » Et je leur répondais : « Mais quand ils écoutent Beethoven, leur vie change. Et nous, nous changeons aussi. » C’est très beau ce que nous vivons ensemble. Et le jour viendra où ces gens-là deviendront les défenseurs de leur culture dont ils percevront toute la beauté. Et ce sera une manière aussi de faire face à cette musique de consommation qui envahit la planète. »
<Lien vers la totalité de ce mot du jour>
<Mot du jour sans numéro>
-
Jeudi 31 décembre 2020
« Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent »Charles AznavourL’année Beethoven a été plus que perturbée par la fermeture des salles de concerts.
L’année 2020 a été, bien sûr, marquée par la pandémie mais surtout par les immenses sacrifices qui ont été demandées au monde de la culture.
Jacques Attali critique le sort qui a été réservé à la culture par rapport aux lieux de consommation et aux lieux de culte. Il dit une chose qui me parait très juste : « Le virus nous empêche d’être ensemble » :
« Par définition, la culture, c’est essentiellement être ensemble. C’est le bien essentiel premier de nos cultures. C’est pour ça que je préfère parler d’économie de la vie. Les secteurs de l’économie de la vie sont la santé, l’éducation, la culture, la recherche, l’énergie propre ou le logement durable… »
Et puis il revient sur l’utilisation de cette dichotomie maladroite de l’essentiel et du non essentiel. Non que cette distinction n’ait pas de sens, mais le problème est de classer la culture, ce qui distingue homo sapiens des autres espèces, dans la catégorie non essentiel :
« Qu’est-ce qui n’est pas essentiel ? C’est ce qui n’est pas nécessaire pour vivre. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires pour vivre, mais on ne peut pas ranger la culture dans les biens qui ne sont pas nécessaires pour vivre. Ou alors, on fait l’apologie de l’analphabétisme, de la barbarie. C’est absurde !»
Et puis il constate, alors que nous entendons si souvent la valeur de la laïcité mis en avant par nos gouvernants que :
« C’est aussi paradoxal qu’au moment où on parle de l’importance de la laïcité, on fasse le choix de privilégier les fêtes d’une religion sur les fêtes laïques [Noël par rapport au 31 décembre] et qu’on préfère ouvrir les lieux de culte plutôt que les lieux culturels. ».
Et pour lui, il n’y a qu’une solution c’est d’être équitable, dans le fardeau à porter, entre tous les acteurs de la société :
« Ce qui pose problème, c’est être ensemble. C’est ça qui pose problème aux virus et on peut le comprendre. Mais alors, il faut interdire « l’être ensemble » provisoirement, d’une façon équitable. Il ne faut pas permettre l’être ensemble, commercial ou religieux et interdire tout « être ensemble » culturel. Ça n’a pas de sens. Il faut que ça soit équitablement limité. »
Le sociologue Jean Viard est plus compréhensif par rapport aux décisions prises :
« On a trois motifs de déplacement : le travail, l’éducation et les plaisirs. On a tout fait pour restreindre les plaisirs, pour essayer de lutter contre le virus. Chaque décision prise, en elle-même, est totalement absurde. On peut très bien aller au théâtre, les salles ont mis en place des règles de sécurité. On aurait pu faire un réveillon du nouvel an extrêmement sage… Les choix pour diminuer les flux sont absurdes. Mais c’est une solution, une solution absurde dont l’objectif est de sauver des millions de vies. »
Avec son immense talent, François Morel s’étonne aussi cette différence faite entre les lieux de culte et les lieux de culture : <J’aurais dû me faire curé>
« J’aime prendre l’habit de Tartuffe ou d’Alceste
De Ruy Blas ou d’Ubu. Je suis un palimpseste
Sur lequel sont inscrits des rôles qui s’effacent,
Dont il reste des bouts avec le temps qui passe.
J’aime aller me changer pour être un personnage
Devenir quelqu’un d’autre et vivre davantage.
J’aime aller m’affubler du nez de Cyrano,
Passer une rhingrave, une cape, un manteau.
Enfiler un costume et changer d’apparence,
Ça a moins d’intérêt en visioconférence.
Parce qu’en ce moment triste est mon quotidien
Si je ne peux pas jouer, je ne sers plus à rien
Alors que mon beau-frère et ça c’est pas logique
Il peut servir la messe en habits liturgiques…. »
Écouter le reste sur le site de France Inter : <J’aurais dû me faire curé>
Et puis il y a ce détournement très drôle et pourtant tragique du livre de la jungle : < On a fermé tous les cinés>.
Cette année ne peut pas être qualifiée du titre de la pire année de l’Histoire, il suffit d’ouvrir un livre d’Histoire pour en être convaincu. Elle est peut être la pire année que l’un ou l’autre a vécue dans sa vie. Pour la finir, j’ai pensé fêter le monde de la culture par une chanson.
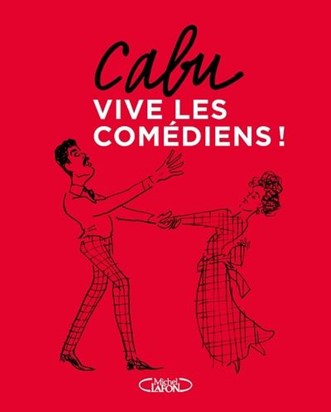 Une chanson qui célèbre les comédiens, les musiciens et les magiciens.
Une chanson qui célèbre les comédiens, les musiciens et les magiciens.
Car, Oui ! on peut être subjugué par la musique de Beethoven et aimer Charles Aznavour
<Aznavour chante les comédiens avec Liza Minelli>
Et voici les belles paroles écrites par Jacques Plante et sur lesquelles Aznavour a écrit la musique.
Viens voir les comédiens
Voir les musiciens
Voir les magiciens
Qui arrivent
Viens voir les comédiens
Voir les musiciens
Voir les magiciens
Qui arrivent
Les comédiens ont installé leurs tréteaux
Ils ont dressé leur estrade
Et tendu des calicots
Les comédiens ont parcouru les faubourgs
Ils ont donné la parade
A grand renfort de tambour
Devant l’église une roulotte peinte en vert
Avec les chaises d’un théâtre à ciel ouvert
Et derrière eux comme un cortège en folie
Ils drainent tout le pays, les comédiens
Viens voir les comédiens
Voir les musiciens
Voir les magiciens
Qui arrivent
Viens voir les comédiens
Voir les musiciens
Voir les magiciens
Qui arrivent
Si vous voulez voir confondus les coquins
Dans une histoire un peu triste
Où tout s’arrange à la fin
Si vous aimez voir trembler les amoureux
Vous lamenter sur Baptiste
Ou rire avec les heureux
Poussez la toile et entrez donc vous installer
Sous les étoiles le rideau va se lever
Quand les trois coups retentiront dans la nuit
Ils vont renaître à la vie, les comédiens
Viens voir les comédiens
Voir les musiciens
Voir les magiciens
Qui arrivent
Viens voir les comédiens
Voir les musiciens
Voir les magiciens
Qui arrivent
Les comédiens ont démonté leurs tréteaux
Ils ont ôté leur estrade
Et plié les calicots
Ils laisseront au fond du cœur de chacun
Un peu de la sérénade
Et du bonheur d’Arlequin
Demain matin quand le soleil va se lever
Ils seront loin, et nous croirons avoir rêvé
Mais pour l’instant ils traversent dans la nuit
D’autres villages endormis, les comédiens
Viens voir les comédiens
Les musiciens
Les magiciens
Qui arrivent
La chanson date de 1962.
Après tous ces mots du jour écrits depuis le 21 septembre, dans lesquels il a été question de Beethoven, de Camus, de Daniel Cordier et d’Anne Sylvestre, mais aussi de ce poème de Rilke, si merveilleusement habité par Laurent Terzieff : «Ce n’est qu’alors qu’il peut arriver qu’en une heure très rare, du milieu d’eux, se lève le premier mot d’un vers.» et bien d’autres encore, vous comprendrez qu’il m’est nécessaire de me reposer un peu.
Le mot du jour reviendra en février 2021.
Je redonne le lien vers la chanson :
<Aznavour chante les comédiens avec Liza Minelli>
<1518>
-
Mercredi 30 décembre 2020
« Une expérience spirituelle unique où les grandes sonates pour piano rencontrent les ragas indiens dans une fraternité universelle, celle que défendait sans cesse Beethoven »Shani DilukaIl faut bien terminer une série !
Comment terminer celle-ci, sur Ludwig van Beethoven ?
Un samedi matin de février, le lendemain de la saint valentin, Caroline Broué avait, dans son émission « L’Invité culture », donné la parole à une pianiste, que je ne connaissais pas.
Shani Diluka, est née le 7 novembre 1976 à Monaco mais ses parents sont srilankais. Elle est donc imprégnée de culture indienne.
Pourtant, elle a comme premier bagage artistique une solide formation de pianiste classique qu’elle a perfectionné d’abord au Conservatoire Nationale Supérieure de musique de Paris notamment auprès de François-Frédéric Guy dont j’ai parlé lors du second mot du jour de la série. Par la suite, elle a rencontré et travaillé avec Martha Argerich, Leon Fleisher, Maria Joao Pires et Murray Perahia.
 Elle fréquente donc le gotha du cénacle des pianistes classiques. Elle a aussi enregistré les sonates de violoncelle avec le violoncelliste du Quatuor Alban Berg de Vienne : Valentin Erben.
Elle fréquente donc le gotha du cénacle des pianistes classiques. Elle a aussi enregistré les sonates de violoncelle avec le violoncelliste du Quatuor Alban Berg de Vienne : Valentin Erben.
Le site de <l’émission> de France Culture renvoie vers quelques titres de journaux :
« Interprète « hors norme » d’après Le Figaro, douée d’une « virtuosité ailée » pour le Classica, « l’une des plus grandes de sa génération » selon Piano Magazine , Shani Diluka est une artiste sensible à la vibration du monde. »
Je l’ai donc entendu parler de son dernier disque consacré à Beethoven.
 Ce disque a pour nom « Cosmos ».
Ce disque a pour nom « Cosmos ».
Elle y interprète 2 sonates de Beethoven, la célèbre 14 « Clair de lune » et la 23 « Appassionata ».
Mais elle a ajouté quelque chose de particulier : des musiciens indiens jouent avant et entre deux mouvements de la musique indienne : « des Ragas ».
Grâce à <Wikipedia> nous apprenons que « Le râga » ou râgam en tamoul signifie attirance, couleur, teinte ou passion. Les râgas sont fondés sur les théories védiques concernant le son et la musique
Chaque râga est lié à un sentiment (rasa), une saison, un moment du jour.
Sur <Ce site> Shani Diluka donne son appréhension des ragas :
« Les ragas sont des formes ancestrales de la musique indienne. Les noms, qu’on retrouve sur le disque, existent depuis toujours. Le raga est composé de deux parties : le Alaap et le Gat. Le Alaap est l’introduction mélancolique des premières notes et représente l’âme humaine. Il est joué à la cithare. Il y a ensuite le Gat joué par les tablas : ici c’est l’intensité, le discours qui se développe. […] Il y a plusieurs modèles de gammes. Ces noms, ce sont les gammes. Elles existent depuis toujours. C’est à partir d’elles que le cithariste développe et compose un voyage. Il faut enfin savoir que chaque Raag est identifié et correspond à une idée. Par exemple, Darbari fait référence au moment où les rois attendaient le peuple qui venait se présenter et discuter. Dans le menuet du Clair de Lune, on a le menuet qui est une danse de cour, puis vient, dans la partie du trio, une danse paysanne. Beethoven arrive, en une page, à faire se rencontrer la noblesse et le peuple. Vous voyez pourquoi, dans Cosmos, ce moment de la sonate est appuyé par le Raag Darbari. […] Restent les ragas du crépuscule ou du coucher du soleil. Et ces sonates qu’on écoute, comme traversées d’une nouvelle lumière, sans jamais être perverties ou détournées de leur nature profonde. »
Pourquoi Shani Diluka s’est-elle crue autorisée à créer cette cohabitation disruptive en créant un pont entre l’occident et l’orient ?.
C’est ce qu’elle a expliqué dans l’émission et qui a éveillé ma curiosité à un point suffisant pour que j’achète et j’écoute son disque.
La raison en est que Ludwig van Beethoven s’était intéressé à la spiritualité indienne, à travers des textes ancestraux qu’il avait recopiés, surlignant certains mots lui paraissant essentiels : soleil, éther, Brahma. Shani Diluka a poursuivi le projet de mettre en lumière les liens du compositeur allemand avec la culture orientale.
 Pour ce faire, elle s’est associée à deux musiciens indiens, Mehboob Nadeem et Mitel Purohit, joueurs de Sitar et de tabla, faisant ainsi dialoguer Beethoven et la musique traditionnelle indienne.
Pour ce faire, elle s’est associée à deux musiciens indiens, Mehboob Nadeem et Mitel Purohit, joueurs de Sitar et de tabla, faisant ainsi dialoguer Beethoven et la musique traditionnelle indienne.
Dans le livret accompagnant le disque elle écrit :
« Ce compagnon de route m’a guidée depuis toujours, de l’intégrale des sonates de violoncelle que j’ai enregistrée avec le légendaire violoncelliste du quatuor Alban Berg Valentin Erben, à l’intégrale des concertos pour piano joués régulièrement en concert, il était normal que je me plonge dans ses écrits tout au long de ce chemin. Beethoven tenait en effet des correspondances intenses, balayant tous les sujets, parcourant toutes les humeurs.
Mais quelle fut ma surprise en découvrant, parmi les documents authentifiés en 1926 par le musicologue J.S. Shedlock, des textes mystiques indiens recopiés à la main par Beethoven lui-même, qui de plus avait surligné certains mots essentiels : Soleil, éther, Brahma. Il existe donc un lien historique incontestable entre Beethoven et la culture indienne : à la recherche de la profondeur de cette culture et fasciné par la traduction de ces « Upanishads » sortie en 1816 en Allemagne, il s’est bel et bien plongé dans ces textes ancestraux, au même titre que Schopenhauer qui s’en imprégna, ou que Goethe découvrant le grand poète perse alors qu’il composait son dernier recueil majeur, le Divan oriental-occidental. On découvre ainsi un Beethoven mystique, dans sa recherche sur l’homme et le cosmos, et surtout curieux des autres cultures. »
Nous apprenons donc que Beethoven s’est tout de suite procuré les traductions des Upanishads parus en 1816. Dans un entretien, Shani Diluka répond :
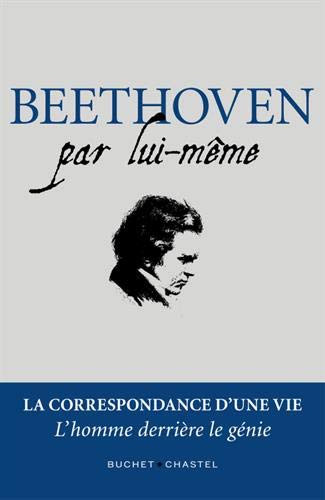 « Cette découverte a été un choc. Se dire que Beethoven pouvait s’intéresser à la culture indienne, à cette époque-là ! Il est très touchant de voir que l’Orient, et donc l’étranger, était alors une inspiration pour une manière nouvelle de penser. Cette ouverture d’esprit m’a réellement émue car avant même d’être compositeur, Beethoven était un grand humaniste. Cela même dont nous avons tant besoin aujourd’hui. […] On ne connait pas assez Beethoven dans sa dimension philosophique. En lisant le dernier livre de Nathalie Krafft [Beethoven par lui-même] par exemple, on se rend compte qu’il s’intéressait à la mythologie grecque, à la cosmologie, à la logique kantienne, sans oublier Shakespeare. Je pense qu’il était quelqu’un qui s’est posé, de façon fondamentale, beaucoup de questions d’ordre philosophique pour trouver un sens à sa vie. » »
« Cette découverte a été un choc. Se dire que Beethoven pouvait s’intéresser à la culture indienne, à cette époque-là ! Il est très touchant de voir que l’Orient, et donc l’étranger, était alors une inspiration pour une manière nouvelle de penser. Cette ouverture d’esprit m’a réellement émue car avant même d’être compositeur, Beethoven était un grand humaniste. Cela même dont nous avons tant besoin aujourd’hui. […] On ne connait pas assez Beethoven dans sa dimension philosophique. En lisant le dernier livre de Nathalie Krafft [Beethoven par lui-même] par exemple, on se rend compte qu’il s’intéressait à la mythologie grecque, à la cosmologie, à la logique kantienne, sans oublier Shakespeare. Je pense qu’il était quelqu’un qui s’est posé, de façon fondamentale, beaucoup de questions d’ordre philosophique pour trouver un sens à sa vie. » »
<Voici ce que cela donne> une introduction de 1’40 de raga avant que la pianiste entame le début de la sonate « Clair de lune ». Dans cet <extrait> Shani Diluka explique sa compréhension de cette même sonate uniquement avec le piano.
Dans l’émission de France Culture elle dit
« Pendant la moitié de sa vie, Beethoven n’entendait pas une note de musique. Il a transformé ce handicap en force extraordinaire, en beauté. Son parcours est une forme de voyage spirituel d’un homme en grande souffrance qui a su relier l’homme au divin. Quand je joue une de ses sonates, de sentir sa relation au monde apporte une force supplémentaire à mon jeu. […]
Pour moi il était important de respecter ces deux grandes musiques : je ne voulais pas les transformer, ou les fusionner mais rester dans le dialogue. C’est une sorte de lien organique qui doit les unir : dans ces grandes cultures il y a une grâce. Et cela m’a émue de les faire rencontrer à ce niveau. »
Et dans le livret de son disque elle ajoute :
« En l’occurrence, nous retrouvons ici deux de ses plus grandes sonates : le « Clair de lune » op. 27 n° 2 et l’« Appassionata » op. 57. Ce choix est délibéré : en raison de sa proximité existentielle, d’une part avec le testament d’Heiligenstadt où il confronte l’idée de Mort à celle de Beauté, qui sauve et élève, et d’autre part avec les éléments liés à la Nature et au rythme du temps, qui rejoignent la relation des ragas aux dimensions terrestres et célestes. Ainsi la construction de cet album est avant tout basée sur le respect de chaque grande tradition associant les artistes indiens de très haut vol que sont Mehboob Nadeem au sitar et Mitel Purohit au tabla, et sur le dialogue organique et les entrelacs entre ces deux grandes musiques dites toutes deux « classiques ».
 Ici, chaque monde révèle l’autre et même parfois d’autres mondes. […]. Le sitar tel un Orphée ressurgit paré de lumière divine. Les leitmotivs mélodiques et rythmiques beethovéniens sont en effet la base inspirante des choix de ragas et de leurs improvisations. Par ailleurs, le spectre sonore imaginé par Beethoven avec ses pianos à cinq pédales, par exemple, et ses longues résonances, que l’on retrouve dans les sonates, concertos ou derniers quatuors à cordes, semblent appeler et faire miroiter le spectre et les résonances du sitar, ouvrant ainsi la porte aux infra-mondes en parallèle avec les quarts de ton dans la musique indienne… »
Ici, chaque monde révèle l’autre et même parfois d’autres mondes. […]. Le sitar tel un Orphée ressurgit paré de lumière divine. Les leitmotivs mélodiques et rythmiques beethovéniens sont en effet la base inspirante des choix de ragas et de leurs improvisations. Par ailleurs, le spectre sonore imaginé par Beethoven avec ses pianos à cinq pédales, par exemple, et ses longues résonances, que l’on retrouve dans les sonates, concertos ou derniers quatuors à cordes, semblent appeler et faire miroiter le spectre et les résonances du sitar, ouvrant ainsi la porte aux infra-mondes en parallèle avec les quarts de ton dans la musique indienne… »
La surdité de Beethoven lui a-t-elle permis de pénétrer irrémédiablement le monde de l’invisible à tous les niveaux ? Si l’on approfondit l’œuvre de Beethoven comme l’on traverserait un cœur rempli de larmes, on rentre étrangement dans une intimité qui devient nôtre. L’âme voyage ainsi au-dessus des pays, au-dessus des frontières, vers ce qui nous unit tous au cosmos. Cette relation n’a jamais été explorée en concert ou en enregistrement. Cet album inédit offre donc une vision nouvelle du grand Beethoven. Comment cette idée de transcendance s’inscrit-elle dans notre monde contemporain et mondialisé ? Beethoven en donne le sens le plus noble : la beauté et la grâce appartiennent à toutes les cultures. Étant moi-même entre deux mondes, originaire du continent indien et issu de l’école de piano allemande, ce lien entre Beethoven et l’Inde prend à mes yeux tout son sens. En quête perpétuelle d’élévation, la recherche dans les contrées mystiques indiennes à cette époque est tout à fait exceptionnelle. Quelle belle leçon de pensée il y a plusieurs siècles, représentant l’Orient, « l’étranger », comme signe de bienveillance et d’enrichissement grâce à la découverte de nouvelles visions du monde.
 La beauté et l’élévation sont dans toutes les cultures, la réconciliation de l’homme avec lui-même est possible : tel est le but de ce projet à travers les grands idéaux beethovéniens. J’ai donc imaginé une expérience spirituelle unique où les grandes sonates pour piano rencontrent les ragas indiens dans une fraternité universelle, celle que défendait sans cesse Beethoven, rappelant ainsi le message de dialogue et de paix initié il y a quelques années par Ravi Shankar et Yehudi Menuhin. »
La beauté et l’élévation sont dans toutes les cultures, la réconciliation de l’homme avec lui-même est possible : tel est le but de ce projet à travers les grands idéaux beethovéniens. J’ai donc imaginé une expérience spirituelle unique où les grandes sonates pour piano rencontrent les ragas indiens dans une fraternité universelle, celle que défendait sans cesse Beethoven, rappelant ainsi le message de dialogue et de paix initié il y a quelques années par Ravi Shankar et Yehudi Menuhin. »
<Ce site> apprécie ainsi le disque Cosmos :
« Cosmos est un disque qui interpelle, au bon sens du terme. Avec les fils qu’il tisse entre deux grandes traditions musicales sans jamais céder à la facilité de la fusion entre elles, ce disque pose la question de la place de l’homme au sein d’un univers si vaste que la seule tentation du conflit entre les cultures en devient obsolète et vaine. Shani Diluka perpétue la tradition de ces grands interprètes qui lisent la musique comme un texte de sagesse, posant ainsi une pierre personnelle sur le chemin de ceux qui ont pour religion la profondeur et l’exigence au service de l’humanité. Cosmos est un disque profond qui nous élève »
Comment finir la série sur Beethoven constituait la question posée en début d’article.
Ma réponse est de montrer une part supplémentaire de son universalisme.
Dans sa surdité, dans son enfermement dans le silence centré sur sa destinée d’écrire une musique imprévisible pour les « temps à venir », il a continué à rester ouvert à la sagesse et à la culture humaine issues de civilisations situées dans d’autres contrées de notre planète et à s’en nourrir.
Daniel Barenboim a dit
« Il y a tout chez Beethoven : le tragique, le dramatique, la tendresse, l’épique, l’humour… Tout. Sauf la superficialité. Sa musique est en liaison permanente avec tout ce qui fait la condition humaine »
Daniel Barenboïm cité par Christine Mondon « Incomparable Beethoven » page 181
 Shani Diluka a aussi rapporté dans l’écrit qu’elle a joint à son disque :
Shani Diluka a aussi rapporté dans l’écrit qu’elle a joint à son disque :
« Romain Rolland dira […] que Beethoven a su atteindre « le sourire de Bouddha » dans l’Op. 111. »
Cette 32ème sonate opus 111 compte deux mouvements. Je pense que Romain Rolland pensait plus précisément au deuxième mouvement : l’Arietta.
De manière factuelle nous sommes en présence de variations. Mais du point de vue du mélomane et de l’humain, nous sommes en présence d’une immense méditation qui passe par toutes les diversités et richesses des sentiments et l’exploration intime bouleversante de notre humanité..
Alfred Brendel a dit : « L’opus 111 est à la fois une confession qui vient clore les sonates et un prélude au silence. »
Tout au long de cette série, j’ai renvoyé vers les musiques les plus exigeantes, les plus modernes et aussi les plus géniales qu’il a écrites.
Nous sommes ici, une fois encore sur un sommet.
Il faut, bien sûr, être prêt à accueillir cette musique. Il faut donc rechercher le calme et l’ouverture de tous nos sens pour se concentrer exclusivement sur la cathédrale de sons que Beethoven a écrite uniquement avec des notes de musique jouées par un piano.
<J’invite à écouter Alfred Brendel jouer cet Arietta>
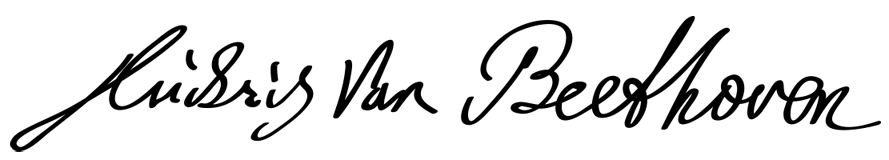
Post scriptum : J’exprime ma (notre ?) gratitude à Ludwig van Beethoven d’avoir mené si haut, si loin et si profondément l’Art qu’homo sapiens a su créer et ainsi révéler la part la plus belle et la plus précieuse de notre espèce.
<1517>
-
Mardi 29 décembre 2020
« Beethoven victime de la « cancel culture aux Etats-Unis »Emmanuel Dupuy dans « Diapason »J’ai déjà évoqué, à plusieurs reprises, la chose sans avoir donné le nom. La « cancel culture » est un phénomène qui est né dans les campus universitaires américain au sein de mouvements qui se réclament de la gauche.
La « cancel culture » c’est la culture de l’effacement. Comme un dossier qu’on efface sur un disque dur.
Les journalistes Laure Mandeville et Eugénie Bastié ont publié le 20/12/2020 un article dans le Figaro «Cancel culture», «woke»: quand la gauche américaine devient folle » qui raconte cette dérive.
L’article du Figaro est réservé aux abonnés mais <La Fabrique médiatique> sur France Culture évoque et revient sur cet article
L’utilisation du terme « woke » signifie que, chez ces gens-là, on prétend qu’il faut tout le temps être « éveillé » pour débusquer en permanence les attitudes, les comportements, les situations problématiques et empêcher les responsables ou ceux qu’on prétend responsables de continuer à s’exprimer ou agir pour faire perdurer ces injustices ou ces oppressions. Il faut effacer !
J’avais abordé ce sujet le <1er avril 2020> en citant Barack Obama qui s’élevait contre ces pratiques : « Si la seule chose que vous faites, c’est critiquer, vous n’irez probablement pas bien loin. »
Au départ ce mouvement a attaqué les vivants.
Le juste combat contre les violences faites aux femmes a ainsi conduit à des manifestations de « cancel culture ». Woody Allen est accusé d’abus sexuel, alors ces « ligues de vertu » ont fait pression pour qu’ils ne puissent pas faire éditer ses mémoires aux Etats-Unis. Il faut l’effacer, il ne doit plus pouvoir s’exprimer. Si Woody Allen est coupable, il faut qu’il soit jugé et qu’il puisse se défendre. S’il est coupable la justice le condamnera, mais l’empêcher de publier ses mémoires ne constitue pas un combat de liberté. Les mémoires de Woody Allen ont pu sortir tout de même aux États-Unis en mars 2020, dans une petite librairie indépendante.
Mais il n’est pas nécessaire d’être accusé d’un crime pour faire l’objet des foudres de la cancel culture. Comme l’écrit l’écrivain Douglas Kennedy dans un article du 26 décembre 2020 dans le Monde « A l’ère de la « cancel culture » – un simple bon mot peut chambouler votre carrière »
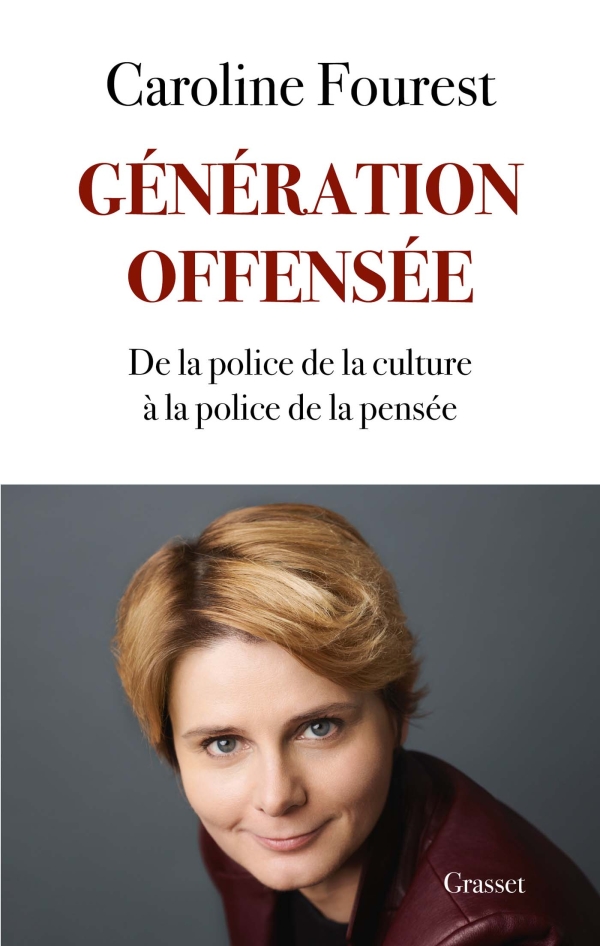 Aucun mot ne doit blesser aucune minorité : les noirs, les LGBT, les petits, les gros, les hispaniques etc. Caroline Fourest a écrit un livre sur ce sujet : «Génération offensée» qui est paru en février 2020. La quatrième de couverture décrit parfaitement le phénomène : « C’est l’histoire de petits lynchages ordinaires, qui finissent par envahir notre intimité, assigner nos identités, et censurer nos échanges démocratiques. Une peste de la sensibilité. Chaque jour, un groupe, une minorité, un individu érigé en représentant d’une cause, exige, menace, et fait plier.
Aucun mot ne doit blesser aucune minorité : les noirs, les LGBT, les petits, les gros, les hispaniques etc. Caroline Fourest a écrit un livre sur ce sujet : «Génération offensée» qui est paru en février 2020. La quatrième de couverture décrit parfaitement le phénomène : « C’est l’histoire de petits lynchages ordinaires, qui finissent par envahir notre intimité, assigner nos identités, et censurer nos échanges démocratiques. Une peste de la sensibilité. Chaque jour, un groupe, une minorité, un individu érigé en représentant d’une cause, exige, menace, et fait plier.
Au Canada, des étudiants exigent la suppression d’un cours de yoga pour ne pas risquer de « s’approprier » la culture indienne. Aux États-Unis, la chasse aux sorcière traque les menus asiatiques dans les cantines et l’enseignement des grandes œuvres classiques, jugées choquantes et normatives, de Flaubert à Dostoïevski. Des étudiants s’offusquent à la moindre contradiction, qu’ils considèrent comme des « micros-agression », au point d’exiger des « safe space ». Où l’on apprend en réalité à fuir l’altérité et le débat.»
On ne compte plus le nombre de professeurs qui ne peuvent plus enseigner et sont boycottés par ce qu’ils ont dit un mot qui a été déclaré blessant ou fait un acte qui a été désigné comme inacceptable.
Douglas Kennedy parle d’un professeur qui a eu la mauvaise idée d’assister à une manifestation en faveur de la police à proximité du campus. Il a expliqué qu’il y était allé juste pour entendre les arguments de l’autre camp. Comme l’a écrit le magazine Forbes : « Il n’a participé en aucune façon, il n’a pas pris la parole ni crié de slogans, il ne portait pas de pancarte. Il affirme qu’il voulait simplement savoir ce que les manifestants avaient à dire… ».
Le fait d’aller à cette manifestation, signifiait chez ces gens là qui étaient en position de « woke » qu’il soutenait la police et les violences policières. Des tracts ont alors circulé pour que les étudiants ne se rendent plus à son cours. Il devait être effacé.
Ces manifestations d’intolérance américaine ont pollué le monde universitaire français :
Ainsi Sylviane Agacinski n’a pas pu tenir une conférence le 24 octobre 2019 à l’université Bordeaux Montaigne (UBM). La philosophe voulait défendre son opposition à la PMA dans une conférence intitulée «L’être humain à l’époque de sa reproductibilité technique». Cette conférence n’a pas eu lieu parce que des syndicats étudiants ont exigé que « cette homophobe » ne puisse pas venir s’exprimer dans leur Université. Par peur de débordements violents, cette conférence a été annulée par la direction de l’Université. Vous pourrez en savoir davantage dans cet article de <Libération>
Ce refus du débat et de l’altérité ou simplement le refus de ce que l’autre peut vouloir dire ou m’apporter me fait penser au mot du jour du <3 mars 2016> dans lequel je reprenais cette réflexion du grand sociologue Zygmunt Bauman : « S’enfermer dans […] une zone de confort, où le seul bruit qu’on entend est l’écho de sa propre voix, où la seule chose qu’on voit est le reflet de son propre visage.»
Après avoir attaqué les vivants, la cancel culture s’attaque aux morts. Aux grands morts, tant il est vrai comme le dit Régis Debray que la culture est le culte de nos grands morts.
Je m’étais fait l’écho de cette attaque en règle contre Christophe Colomb.
Après le <mot du jour hommage à Chirac> qui n’avait pas voulu fêter l’anniversaire de cet assassin, j’étais revenu le lendemain sur les agissements de ce conquérant sadique et monstrueux. Des mouvements sont donc en train de déboulonner les statues de Christophe Colomb et de remplacer le « Colomb day » par des « Journées des peuples indigènes »
Dans ce mot du jour, j’exprimais ma compréhension sur cette révolte contre ce personnage historique dont on ne nous avait pas expliqué tous les agissements.
Mais maintenant, ils attaquent Beethoven !
Beethoven l’humaniste, celui qui parlait de fraternité et aimait la liberté.
C’est le journaliste Emmanuel Dupuy qui sur une page du mensuel « Diapason » nous explique dans un article publié le 7 octobre 2020 qu'<Aux Etats-Unis, Beethoven est victime de la « cancel culture »> :
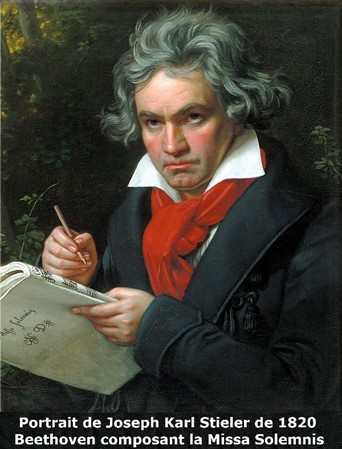 « L’étincelle de la polémique est partie d’un article et d’un podcast publiés sur le média en ligne Vox, par le musicologue Nate Sloan et le journaliste Charlie Harding. Leur cible ? La Symphonie n° 5, que « les personnes au pouvoir, en particulier les hommes blancs et riches » ont érigée en « symbole de leur supériorité et de leur importance […] Pour certains, dans d’autres groupes – femmes, personnes LGBTQ +, personnes de couleur – la symphonie de Beethoven peut être principalement un rappel de l’exclusion et de l’élitisme dont est porteuse l’histoire de la musique classique. » Car en exigeant du public, par la complexité de son langage, une écoute plus attentive que par le passé, la 5e aurait imposé de nouvelles normes dans l’organisation du concert : « Ne pas tousser ! » ; « Ne pas applaudir ! ; « S’habiller de façon appropriée ! » Autant de « signifiants de la classe bourgeoise » qui, finalement, font de la Symphonie n° 5 « »un mur » entre la musique classique et un public nouveau et divers ». »
« L’étincelle de la polémique est partie d’un article et d’un podcast publiés sur le média en ligne Vox, par le musicologue Nate Sloan et le journaliste Charlie Harding. Leur cible ? La Symphonie n° 5, que « les personnes au pouvoir, en particulier les hommes blancs et riches » ont érigée en « symbole de leur supériorité et de leur importance […] Pour certains, dans d’autres groupes – femmes, personnes LGBTQ +, personnes de couleur – la symphonie de Beethoven peut être principalement un rappel de l’exclusion et de l’élitisme dont est porteuse l’histoire de la musique classique. » Car en exigeant du public, par la complexité de son langage, une écoute plus attentive que par le passé, la 5e aurait imposé de nouvelles normes dans l’organisation du concert : « Ne pas tousser ! » ; « Ne pas applaudir ! ; « S’habiller de façon appropriée ! » Autant de « signifiants de la classe bourgeoise » qui, finalement, font de la Symphonie n° 5 « »un mur » entre la musique classique et un public nouveau et divers ». »
Ces gens-là prétendent que « les personnes au pouvoir, en particulier les hommes blancs et riches » auraient érigé la Symphonie n° 5 en « symbole de leur supériorité et de leur importance », renvoyant à un sentiment d’exclusion les autres communautés raciales et sexuelles.
M Sloan enseigne à l’Université de Californie et je ne comprends pas bien quel est le but poursuivi, à part dans un grand effort de rester « woke », trouver encore d’autres statues à déboulonner et de grands morts à « canceler ».
Car chez ces gens-là, on n’approfondit pas, on exclut.
Emmanuel Dupuy tente une explication :
« Cette tentative de déboulonner la statue de Beethoven nous dit aussi que la notion d’exigence en art, au lieu d’être vue comme une condition nécessaire, est désormais entachée d’une connotation négative. Or, comme le travail ou la discipline, l’exigence est largement répandue parmi les musiciens classiques, peut-être davantage que dans d’autres univers artistiques. L’exigence est le socle de l’apprentissage de tout instrument. Elle est le carburant indispensable à la mécanique de l’orchestre symphonique. L’exigence rend possible le tour de force – physique, intellectuel – que représente un récital de chant ou de piano. Et si l’exigence est aussi requise dans l’écoute, matérialisée par le cérémonial du concert, c’est que les secrets des plus grands chefs-d’œuvre, en musique comme dans les autres arts, ne se percent pas sans un minimum d’effort et de concentration. Oui, mais voilà : dans un monde où tout ce qui n’est pas cool est suspect, l’exigence nous est devenue un fardeau. »
Je partage son indignation :
« Non, Beethoven n’est pas un compositeur blanc, mâle, hétérosexuel. Beethoven est un compositeur universel, patrimoine de l’humanité entière. Beethoven est une femme, noire, pourquoi pas lesbienne. Assimiler un tel génie à une seule catégorie de la population et prétendre que les autres, renvoyées à un sentiment d’exclusion, ne peuvent s’approprier son œuvre [constitue la vraie discrimination…] »
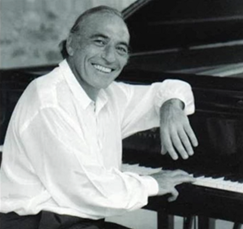 Pour conclure, je vais faire appel au pianiste Miguel Angel Estrella, défenseur des droits de l’homme et des humbles. Il est issu d’un milieu modeste : son père est le fils de paysans libanais émigrés en Bolivie, sa mère est une argentine avec des ascendances amérindiennes métissées. En raison de ses convictions politiques, il fuit le régime argentin en 1976 à cause des persécutions dont il fait l’objet de la part de la junte militaire. Mais en 1977, il est détenu en Uruguay à Montevideo, où il subit des tortures. Il devient alors très célèbre en Europe, parce que le monde de la culture se mobilise pour sa libération. Il est libéré en 1980 à la suite des pressions internationales (en particulier de Yehudi Menuhin, Nadia Boulanger et Henri Dutilleux). Il se réfugie alors en France. Daniel Balavoine lui dédie sa chanson <Frappe avec ta tête> en 1983
Pour conclure, je vais faire appel au pianiste Miguel Angel Estrella, défenseur des droits de l’homme et des humbles. Il est issu d’un milieu modeste : son père est le fils de paysans libanais émigrés en Bolivie, sa mère est une argentine avec des ascendances amérindiennes métissées. En raison de ses convictions politiques, il fuit le régime argentin en 1976 à cause des persécutions dont il fait l’objet de la part de la junte militaire. Mais en 1977, il est détenu en Uruguay à Montevideo, où il subit des tortures. Il devient alors très célèbre en Europe, parce que le monde de la culture se mobilise pour sa libération. Il est libéré en 1980 à la suite des pressions internationales (en particulier de Yehudi Menuhin, Nadia Boulanger et Henri Dutilleux). Il se réfugie alors en France. Daniel Balavoine lui dédie sa chanson <Frappe avec ta tête> en 1983
En 1982, Miguel Angel Estrella fonde Musique Espérance dont la vocation est de « mettre la musique au service de la communauté humaine et de la dignité de chaque personne ; de défendre les droits artistiques des musiciens — en particulier des jeunes — et de travailler à construire la paix ». Depuis, il fait le tour de la planète pour aller chez les plus humbles, les plus éloignés de la culture occidentale pour jouer du piano.
Le monde Diplomatique explique cela dans un long article qui est en ligne : <A quoi bon jouer du Beethoven quand les gens ont faim ? >. Et c’est la réponse à cette question qui me pousse à conclure ce mot du jour avec Miguel Angel Estrella :
« Nous sommes des musiciens et par le biais de notre art nous essayons de trouver un chemin pour améliorer la qualité de la vie. Je l’ai compris il y a longtemps et je me suis battu contre les intellectuels latino-américains qui disaient : « A quoi bon jouer du Beethoven quand les gens ont faim ? » Et je leur répondais : « Mais quand ils écoutent Beethoven, leur vie change. Et nous, nous changeons aussi. » C’est très beau ce que nous vivons ensemble. Et le jour viendra où ces gens-là deviendront les défenseurs de leur culture dont ils percevront toute la beauté. Et ce sera une manière aussi de faire face à cette musique de consommation qui envahit la planète. »
Pour aujourd’hui et dans la continuité de l’œuvre qui a fait l’objet du mot du jour d’hier je vous propose le dernier quatuor à cordes, le seizième opus 135.
Il est plus court et plus optimiste que le quatorzième. Il fut ma porte d’entrée dans les derniers quatuors à cordes. Le troisième mouvement, qui est le mouvement lent « Lento assai », est divin. Je lui garde une affection toute particulière et s’il n’est pas aussi révolutionnaire que l’immense quatorzième, il tutoie les mêmes sommets.
<Une interprétation par le quatuor Hagen>
<1516>
-
Lundi 28 décembre 2020
« Après cela, que reste-t-il à écrire ? »Franz Schubert à propos du 14ème quatuor à cordes de BeethovenJ’aime beaucoup André Comte-Sponville qui exprime une hauteur de vue et une sérénité qui sont si précieuses dans nos temps troublés par l’affirmation de tant de certitudes fragiles et de condamnation de boucs émissaires commodes pour dissimuler nos parts d’ombre et nos contradictions.
Il a été interviewé sur le sujet de la musique classique par Olivier Bellamy dans le magazine « Classica » de Novembre 2020. A la question : quels sont les trois disques que vous emporteriez sur une île déserte ? Il a répondu :
« Le quintette en ut de Schubert, le quatuor N°14 de Beethoven et le divertimento K 563 de Mozart »
J’avais déjà révélé, lors du mot du jour du <1er septembre 2020> que mon disque de l’île déserte est le quintette en ut de Schubert.
D’ailleurs à une autre question de Bellamy : Quelle est l’œuvre que vous placez au-dessus de tout ? André Comte-Sponville répond, comme moi, le quintette en ut de Schubert.
Je reviendrai probablement, un jour, sur cette œuvre miraculeuse que Mozart a écrit pour trio à cordes et qui porte le numéro K 563.
Mais aujourd’hui il va être question du quatuor à cordes N° 14 opus 131 de Beethoven.
Et c’est Schubert qui, à l’issue d’un concert privé dans lequel il a découvert ce quatuor opus 131, déclarera :
« Après cela, que reste-t-il à écrire ? »
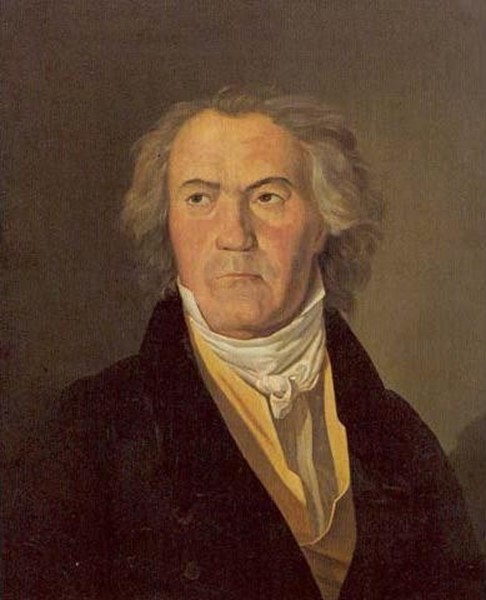 Le musicologue allemand Michael Kube a publié le 12 juin 2020 sur ce site <Revue musicale suisse> le texte suivant dans lequel il parle de ce quatuor N°14, des relations ombrageuses avec son éditeur et avec ses interprètes :
Le musicologue allemand Michael Kube a publié le 12 juin 2020 sur ce site <Revue musicale suisse> le texte suivant dans lequel il parle de ce quatuor N°14, des relations ombrageuses avec son éditeur et avec ses interprètes :
« En 1826, les éditions Schott ont voulu s’assurer avant la signature du contrat que ce quatuor n’était pas un arrangement. Beethoven, un peu agacé, a alors noté sur l’épreuve : « recueil de choses volées çà et là ». Craignant d’être pris au mot, il s’est toutefois expliqué peu de temps après dans une lettre : « vous avez écrit que c’était censé être un quatuor original, ça m’a froissé, alors, pour plaisanter j’ai écrit qu’il avait été volé. Mais c’est faux. Il est absolument nouveau ».
En effet, malgré l’esprit et la formulation amusante de cette remarque, l’œuvre est nouvelle à plusieurs égards : avec un total de sept mouvements (Beethoven parlait de « pièces »), dont quatre peuvent être réunis pour former deux paires, le quatuor entre dans une nouvelle dimension, même vu de l’extérieur. Mais les caractéristiques des mouvements individuels pointent aussi bien au-delà de l’horizon de l’époque, même jusqu’au 20e siècle […]
Bien que Beethoven n’ait pas pu assister à une représentation publique de l’œuvre, il a exigé que l’exécution se fasse presque sans aucune interruption. Ainsi Karl Holz, le violoncelliste du Quatuor Schuppanzigh, demandait déjà fin août 1826 dans un cahier de conversation : « doit-on le jouer sans s’arrêter ? — Mais alors, nous ne pourrons pas faire de bis ! — Quand pourrons-nous nous accorder ? […] Nous allons commander des cordes solides. »
On peut facilement imaginer les réponses correspondantes. »
Il faut comprendre que les cahiers de conversation ne comportent que les propos de ses interlocuteurs, Beethoven répond oralement.
Et ce même Michael Kube ajoute à propos de Schubert
« Si l’on en croit les souvenirs de Holz, transcrits plus tard par une troisième personne, ce quatuor à cordes est aussi la dernière musique que Franz Schubert a entendue. Quelques jours avant sa mort, on dit qu’une représentation privée a eu lieu ; Schubert a peut-être même lui-même pris la partie d’alto. Ludwig Nohl écrit à ce sujet : « Messieurs Holz, Karl Groß et le baron König l’ont joué pour lui faire plaisir. Seul Doleschalek, professeur de piano, était également présent. Schubert était si ravi, si enthousiaste et si touché que tout le monde a craint pour sa santé. Un petit malaise qui avait précédé et qui n’avait pas encore complètement passé s’est fortement accru, s’est transformé en typhus, et Schubert est mort cinq jours plus tard ».
Wikipedia narre la même histoire :
« Ce quatuor est parfois considéré comme le plus grand chef-d’œuvre de Beethoven, tous genres confondus. Schubert aurait déclaré à son sujet : « Après cela, que reste-t-il à écrire ? » (et ce fut aussi cette pièce que les amis de Schubert lui jouèrent à sa demande juste avant sa mort). »
Il semble bien, selon diverses sources que j’ai lu, que Schubert ait d’abord entendu ce quatuor et dit la phrase que j’ai mis en exergue puis a demandé, à quelques jours de sa mort, à le réentendre.
Marcel Proust avait aussi un amour particulier pour cette œuvre :
« Lorsque Proust, trop malade pour sortir de chez lui, voulut entendre de la musique, il convia chez lui le quatuor Capet pour lui jouer le Quatorzième Quatuor de Beethoven »
Jacques Bonnaure – Classica octobre 2016 page 53
 Cette <émission de France musique> est consacrée au quatorzième quatuor. Dans celle-ci ; un intervenant cite Boucourechliev qui dit :
Cette <émission de France musique> est consacrée au quatorzième quatuor. Dans celle-ci ; un intervenant cite Boucourechliev qui dit :
« C’est une œuvre ahurissante. »
Ce sont 45 minutes constitués, comme le faisait remarquer Karl Holz, de sept mouvements enchaînés sans interruption.
Je pense qu’il est très difficile de distinguer un quatuor à cordes parmi les derniers qui constituent, dans leur globalité, le sommet de l’œuvre de Beethoven. Dans l’ordre de composition, il y a d’abord le 12 opus 127, puis problème de numérotation, le 15 opus 132, ensuite arrive le 13 opus 130 dont Beethoven a détaché la grande fugue opus 133 et que certains désignent sous le nom de 17ème quatuor, après il y a le quatorzième opus 131 qui est donc l’avant dernier et le 16ème opus 135 qui est le dernier numéro d’opus des œuvres de Beethoven.
Beethoven utilisera les quinze derniers mois de sa vie pour composer ces deux œuvres le 14ème puis le 16ème quatuor. Chacun de ces chefs d’œuvres est très différents des autres. Tant il est vrai comme le dit Florence Badol-Bertrand :
« Chez Beethoven, il y a aussi l’anti-académisme. A la fin du XVIIIe siècle, on publiait beaucoup de séries de quatuors, de séries de symphonies… C’était toujours un petit peu la même œuvre avec quelques sonorités différentes. Or, pour lui, il n’est pas question de refaire deux fois la même chose. »
Même si tous les quatuors du 12 au 16 sont des sommets, il existe un large consensus pour donner une place à part au quatorzième. Beethoven lui-même a dit :
« Celui-ci est le plus grand, le chef-d’œuvre »
Et Schumann, après Schubert dira :
« Une grandeur qu’aucun mot ne saurait exprimer, à l’extrême frontière de tout ce qui a été atteint par l’art humain et l’imagination ».
Richard Wagner, écrira en son temps un texte célèbre dans lequel il parle pour cette œuvre d’une « méditation d’un saint, muré dans sa surdité, à l’écoute exclusive de ses voix intérieures. »
Commençons par écouter <Le début du dernier mouvement par le Quatuor Belcea>
Dans le texte précité Wagner, décrit ce mouvement comme
« La danse du monde lui-même : désir farouche, plainte douloureuse, ravissement d’amour, extase suprême, gémissement, furie, volupté et souffrance. »
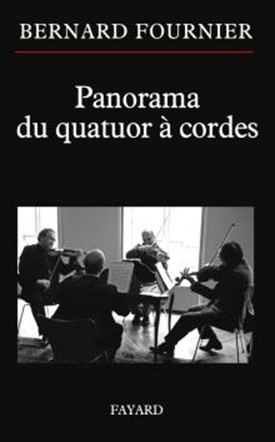 Bernard Fournier a consacré de nombreux ouvrages aux quatuors à cordes. Dans son ouvrage « Panorama du quatuor à cordes » il situe ce quatuor par rapport à la postérité :
Bernard Fournier a consacré de nombreux ouvrages aux quatuors à cordes. Dans son ouvrage « Panorama du quatuor à cordes » il situe ce quatuor par rapport à la postérité :
« Le 14e Quatuor est peut-être le plus haut chef-d’œuvre du cycle magistral que Beethoven a consacré au genre. Cette architecture limite – 7 mouvements enchaînés – qui introduit une nouvelle conception du temps musical, a non seulement influencé de nombreux compositeurs de quatuors (citons au XXe siècle Schönberg [Opus 7], Bartók [Opus 7], etc.), mais elle fasciné maints créateurs, musiciens (Liszt, Wagner, Stravinsky) ou non (Sartre, Kundera, TS Eliot). Outre l’inventivité formelle stupéfiante dont il fait preuve ici, Beethoven accomplit dans la trajectoire sans interruption de l’œuvre deux gestes révolutionnaires, lourds de conséquences esthétiques : au lieu du traditionnel allegro d’ouverture, il commence par une fugue et il repousse à la fin de l’œuvre le mouvement de forme-sonate, celui qui d’habitude sert de fondation à l’édifice.»
Bernard Fournier dispose d’un site < http://bernard-fournier-quatuor.com>. Sur ce site il est possible de télécharger <le chapitre III, Beethoven, l’apogée du genre> du livre précité..
J’ai même trouvé <cette analyse> du quatorzième quatuor sur un site de l’Éducation Nationale.
Il me semble cependant qu’assez de propos ont été cités pour montrer l’importance qui est attachée à cette œuvre, dans les compositions de Beethoven et dans l’Histoire de la musique.
Il faut écouter maintenant. Je propose cette <Très belle interprétation du Quatuor Juilliard>
Et puis, disponible jusqu’au 23 mars 2021, vous pouvez aussi voir et regarder dans de très belles conditions techniques, sur le site d’Arte, le concert qu’a réalisé le Quatuor Ébène, le 16 décembre 2020, dans une cité de la musique de Paris vide.
Le concert finit par le quatorzième quatuor, mais il est précédé de deux autres dont le 16ème: « Beethoven – Quatuors 2,16 & 14 – Quatuor Ebène>. Le quatorzième commence à 53:40.
 Pour finir je citerai encore Schubert, « le musicien de l’ombre » comme l’avait appelé Christine Mondon, ombre de Beethoven bien sûr. Mais il fut un des premiers à comprendre vraiment la dimension de Beethoven :
Pour finir je citerai encore Schubert, « le musicien de l’ombre » comme l’avait appelé Christine Mondon, ombre de Beethoven bien sûr. Mais il fut un des premiers à comprendre vraiment la dimension de Beethoven :
« L’art est déjà devenu pour lui une science il sait ce qu’il peut et l’imagination obéit à sa réflexion inépuisable. »
Franz Schubert cité par Classica de Décembre 2019-Janvier 2020 page 52
<1515>
-
Jeudi 24 décembre 2020
« Ce n’est pas pour vous, c’est pour les temps à venir. »Ludwig van BeethovenBeethoven vient d’écrire ses trois quatuors opus 59, les « Razoumovski ». Il ne s’agit pourtant que des quatuors de la période médiane. Il en confie la création au Quatuor Schuppanzigh, du nom du premier violon Ignaz Schuppanzigh. Ce quatuor est réputé comme le meilleur quatuor européen. Mais Ignaz Schuppanzigh juge certains passages techniquement impraticables.
 Beethoven réplique cinglant :
Beethoven réplique cinglant :« Croyez-vous que je pense à vos misérables cordes quand l’esprit me parle ? »
Et, Schuppanzigh est un ami. Wikipedia nous apprend que ce violoniste était très gros. Et, Beethoven avait composé pour lui une courte pièce chorale humoristique en forme de canon qu’il intitula « Éloge de l’obèse » (Lob auf den Dicken, WoO 100).
Le problème avec les œuvres de Beethoven de la dernière période, mais cela avait déjà commencé avec celles de la période médiane, était double :
- Elles étaient d’abord d’une difficulté technique inconnue jusqu’alors;
- Et puis, elle heurtait la capacité de compréhension et d’assimilation de l’immense majorité des musiciens et des mélomanes.
 Concernant la difficulté technique, une intervenante dans les épisodes du feuilleton « Beethoven » de la radio télévision belge expliquait que beaucoup de personnes avaient l’habitude à Vienne et plus généralement dans les pays germaniques de pratiquer la musique en amateur. Et, la forme du quatuor à cordes était très prisée. Souvent ces musiciens se retrouvaient lors de soirées amicales et déchiffraient ensemble de nouveaux quatuors qui étaient édités. Quelquefois, il s’agissait d’un mouvement de quatuor et il existait des abonnements avec lesquels, régulièrement, on obtenait de nouvelles partitions, le premier mouvement, le deuxième mouvement, un nouveau quatuor.
Concernant la difficulté technique, une intervenante dans les épisodes du feuilleton « Beethoven » de la radio télévision belge expliquait que beaucoup de personnes avaient l’habitude à Vienne et plus généralement dans les pays germaniques de pratiquer la musique en amateur. Et, la forme du quatuor à cordes était très prisée. Souvent ces musiciens se retrouvaient lors de soirées amicales et déchiffraient ensemble de nouveaux quatuors qui étaient édités. Quelquefois, il s’agissait d’un mouvement de quatuor et il existait des abonnements avec lesquels, régulièrement, on obtenait de nouvelles partitions, le premier mouvement, le deuxième mouvement, un nouveau quatuor. Et ils occupaient la soirée en jouant ensemble. En effet, à cette époque Netflix n’existait pas, ni les jeux vidéos, ni les réseaux sociaux ni même la télévision ou la radio. Il fallait donc s’occuper autrement. Nous parlons là plutôt de personnes aisées.
Mais mon père qui faisait partie d’une famille très modeste issue de la paysannerie m’expliquait que dans sa jeunesse, on se réunissait aussi pour faire de la musique dans la famille. Celles et ceux qui ne savaient pas jouer d’un instrument chantaient.
 Revenons au contexte viennois. Voilà des musiciens qui reçoivent des partitions des œuvres de Beethoven. C’est en effet indéchiffrable, je veux dire : vous ne mettez pas ensemble deux violonistes, un altiste et un violoncelliste qui n’ont jamais vu la partition pour qu’ils puissent commencer à la jouer ensemble. Pour Beethoven, il faut qu’au préalable chacun des musiciens ait travaillé individuellement sa partie, puis il sera nécessaire de travailler ensemble pour s’ajuster.
Revenons au contexte viennois. Voilà des musiciens qui reçoivent des partitions des œuvres de Beethoven. C’est en effet indéchiffrable, je veux dire : vous ne mettez pas ensemble deux violonistes, un altiste et un violoncelliste qui n’ont jamais vu la partition pour qu’ils puissent commencer à la jouer ensemble. Pour Beethoven, il faut qu’au préalable chacun des musiciens ait travaillé individuellement sa partie, puis il sera nécessaire de travailler ensemble pour s’ajuster.C’est totalement inatteignable pour des amateurs, au moins de cette époque. Et même le Quatuor Schuppanzigh qui est professionnel n’y arrive pas ou très difficilement.
Et, c’est dans la difficulté du 7ème quatuor à cordes dans lequel les quatre musiciens n’y arrivaient pas techniquement et ne comprenait pas la musique qu’ils étaient censés jouer que Beethoven eut cette phrase :
« Ce n’est pas pour vous, c’est pour les temps à venir »
Cité par Bernard Fournier « Beethoven et après », page 127 Je pense que cette remarque touchait plus la compréhension, par les musiciens, de cette musique que leurs soucis techniques.
Je pense que cette remarque touchait plus la compréhension, par les musiciens, de cette musique que leurs soucis techniques.Lors de ce même épisode Nicolas Derny commente :
« Lorsque l’ébouriffé Ludwig, dont les oreilles bourdonnent depuis 1797, présente les Quatuors « Razoumovski » – l’épique 7e , le pathétique 8e , l’extraverti 9e -, même ses proches croient à une blague. »
A ce stade, il faut peut-être donner un exemple à entendre.
C’est un peu compliqué parce qu’aujourd’hui nos oreilles ont été habituées, après des décennies de musiques à deux notes, en cas d’opulence on va jusqu’à quatre, à s’habituer à tout. Et même à nommer musique, des collections de sons assez éloignées d’une définition raisonnable de la musique. Mais faisons l’effort de nous mettre en empathie avec des personnes de la bonne société viennoise du début du XIXème siècle. Ils sont déjà horrifiées par les extravagances de la révolution française, leurs oreilles ont été éduquées par la musique de Mozart et de Haydn. Alors, on doit pouvoir comprendre leurs réactions après avoir entendu le début, les trente premières secondes, de l’Allegretto du 7ème quatuor : <Quatuor Belcea>. Cela commence par le violoncelle qui joue de manière monotone la même note. Le second violon essaie quelques fantaisies mais est repris par l’alto qui refait le coup du violoncelle. Après ils s’y mettent tous à jouer la même note. C’est une blague se disaient-ils à l’époque !
Donc, il y avait d’abord des problèmes techniques. Les musiciens de l’époque ne savaient pas jouer Beethoven :
« La création de l’ «Héroïque » dans le salon de musique du Palais Lobkowitz [fut] lamentable […] avec six premiers et quatre seconds violons, et des vents terriblement médiocres. Personne ne savait jouer cette musique si nouvelle et si difficile ; et dans les « académies » publiques que Beethoven organisait de temps en temps, ce n’était guère mieux. »
Antoine Goléa « La musique de la nuit des temps aux aurores nouvelles » volume 1 page 290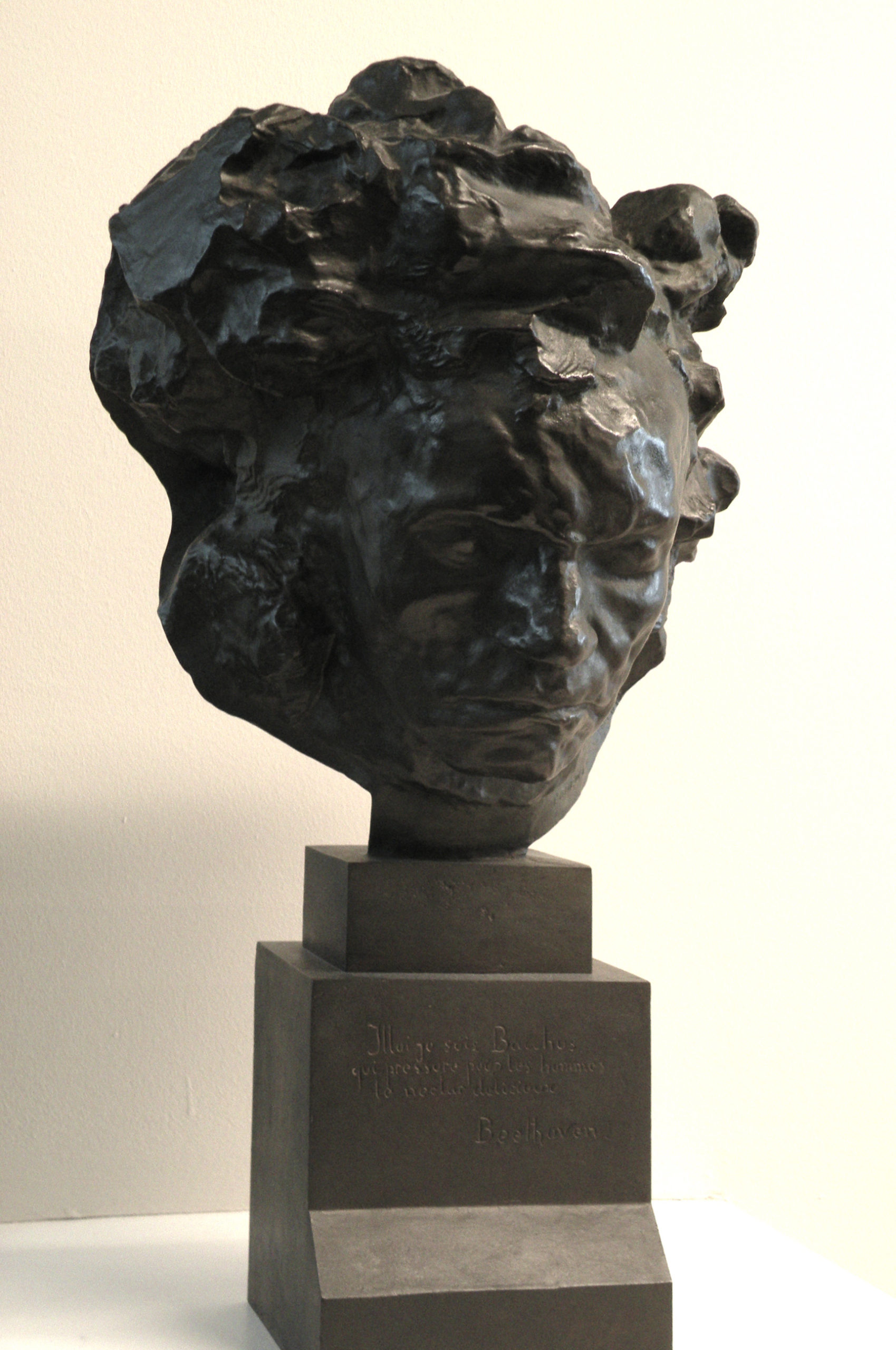 Et puis, si les mélomanes aimaient les premières œuvres de Beethoven et aussi l’Ode à la joie qui finit la 9ème, les œuvres tardives, c’est à dire la musique « pour les temps à venir » rencontraient le scepticisme voire la franche hostilité.
Et puis, si les mélomanes aimaient les premières œuvres de Beethoven et aussi l’Ode à la joie qui finit la 9ème, les œuvres tardives, c’est à dire la musique « pour les temps à venir » rencontraient le scepticisme voire la franche hostilité.Quand Beethoven décida de dédier sa sonate N° 9 pour violon et piano à Rodolphe Kreutzer, célèbre violoniste à Paris, Sonate qui restera la « Sonate à Kreutzer », le dédicataire refusera de la jouer en la déclarant : « Inintelligible ! ».
Le critique du journal spécialisé « l’Allgemeine musikalische Zeitung » écrivit que Beethoven y avait
« poussé le souci de l’originalité jusqu’au grotesque [et était adepte d’un ] terrorisme artistique »
Nicolas Derny écrit :
« il dédie sa neuvième et avant-dernière Sonate pour violon et piano à Rodolphe Kreutzer, musicien proche de Bonaparte – qui ne la jouera jamais : la pièce est trop difficile, trop étrange, voire tout bonnement inintelligible pour les oreilles de ce début de siècle. »
Il s’agit aujourd’hui d’une des sonates pour violon les plus populaires et les plus jouées du répertoire.
Et les avis défavorables sur la musique de la maturité de Beethoven sont multiples.
Voici, par exemple, un avis de Frédéric Chopin :
« Quand Beethoven est obscur et paraît manquer d’unité, ce n’est pas une prétendue originalité un peu sauvage, dont on lui fait honneur, qui en est la cause ; c’est qu’il tourne le dos à des principes éternels »
Cité par <Diapason>Bernhard Romberg est un nom connu des jeunes apprentis du violoncelle, car violoncelliste lui-même il a écrit beaucoup de pièces et d’études pour cet instrument. Il parlera de la musique de Beethoven en ces termes :
« Musique d’aliéné »
Cité par <Diapason>François-Joseph Fétis écrit dans la revue musicale en 1830 :
« Car bien, bien qu’il y représente sous une infinité de formes les thèmes de ces mêmes compositions, il les enveloppe en général de tant d’obscurités ; ces thèmes sont, pour la plupart, si vagues. Les chocs de sons y sont souvent si durs, si désagréables à l’oreille. L’ensemble, enfin, il y a si peu de charme et de clarté. »
Cité par Boucourcheliev « Beethoven » page 220Et Louis Spohr qui selon Wikipedia devint pour ses contemporains « après la mort de Carl Maria von Weber en 1826, et de Ludwig van Beethoven en 1827, le compositeur le plus important du moment ». Il écrivit dans son Autobiographie :
« Le dernier mouvement [de la 9ème symphonie] est tellement monstrueux et sans goût dans sa conception scolaire que je ne peux pas comprendre qu’un génie comme Beethoven ait été capable de le coucher sur le papier. Je trouve ici une nouvelle preuve que Beethoven a manqué de formation esthétique et du sens de la beauté »
Cité par Boucourcheliev « Beethoven » page 226Louis Spohr criait au génie pour les œuvres de Beethoven qui pour la postérité n’apparaîtront pas comme celles qui le sont.
Heureusement toute le monde n’eut pas cet aveuglement, Berlioz, Liszt, Wagner sont clairement du côté des visionnaires.
Nicolas Derny écrit cette synthèse dans <Diapason> :
« Ses contemporains ne savent plus s’ils doivent crier au génie ou au fou. Comme lorsque le compositeur introduit la voix humaine – quatuor soliste et chœur – dans le final de la Symphonie no 9, chose imaginable jusque-là. Hymne à la joie et à la fraternité sur un texte de Schiller, elle triomphe le soir de la création (le 7 mai 1824, en même temps que les Kyrie, Credo et Agnus Dei de la Missa Solemnis), mais divise les commentateurs pour un moment : trop longue et difficile – voire tout bonnement absurde – pour les uns, elle s’impose pour les autres comme « la plus magnifique expression du génie de Beethoven » (Berlioz). »
Mais Schubert avant eux, sut reconnaître le génie : Selon le témoignage de Braun von Braunthal, un ami de Schubert, ce dernier lui aurait dit :
« Il sait tout, mais nous ne pouvons pas encore tout comprendre, et il coulera encore beaucoup d’eau dans le Danube avant que tout ce que cet homme a créé soit généralement compris. »
Cité par J. et B. Massin dans le Dictionnaire des musiciens , Encyclopédia Universalis 2019, page 35Il n’écrivait pas pour ceux qui ne l’ont pas compris, il écrivait pour « les temps à venir »
 Ce mot du jour est enrichi de bustes de Beethoven réalisés par Antoine Bourdelle On raconte que le jeune Bourdelle, en feuilletant un ouvrage sur Beethoven, fut frappé par sa propre ressemblance physique avec lui. Il se mit à écouter sa musique et raconta :
Ce mot du jour est enrichi de bustes de Beethoven réalisés par Antoine Bourdelle On raconte que le jeune Bourdelle, en feuilletant un ouvrage sur Beethoven, fut frappé par sa propre ressemblance physique avec lui. Il se mit à écouter sa musique et raconta :« …chaque cri de ce sourd qui entendait Dieu frappait directement mon âme. Le front de Beethoven suait sur mon cœur écrasé. »
S’identifiant à son modèle, il réalisa de multiples visages de Beethoven, comme un musicien crée des variations sur un thème. En tout, on compte dans son œuvre quatre-vingt sculptures représentant le compositeur. <source Musée d’Orsay>
Pour aujourd’hui je propose une œuvre qui mit encore plus de temps que les autres à apparaître ce qu’elle est : un immense chef d’œuvre : « Les 33 variations Diabelli opus 120». C’est dans les faits la dernière grande œuvre que Beethoven composa pour le piano.
Boucourechliev écrit : « sa modernité aujourd’hui encore reste stupéfiante. »
En 1819, Diabelli, éditeur et compositeur bien connu, écrivit et envoya une valse brève à tous les compositeurs importants de l’Empire d’Autriche (tels Franz Schubert, Carl Czerny, Johann Nepomuk Hummel ou l’archiduc Rodolphe d’Autriche), leur demandant d’écrire une variation sur ce thème. L’idée était de publier l’ensemble des variations au profit des veuves et des orphelins des guerres napoléoniennes, dans un volume patriotique intitulé Vaterländischer Künstlerverein.
 Il semblerait que Beethoven se serait senti insulté par une proposition indigne de lui et aurait finalement écrit 33 variations pour démontrer ce qu’il est possible de faire à partir d’un matériau aussi simple, simpliste peut être.
Il semblerait que Beethoven se serait senti insulté par une proposition indigne de lui et aurait finalement écrit 33 variations pour démontrer ce qu’il est possible de faire à partir d’un matériau aussi simple, simpliste peut être.Alfred Brendel écrit :
« Quand j’osai définir, il y a environ cinquante ans, les Variations Diabelli comme la plus grande œuvre jamais écrite pour le piano, nombre de musiciens parurent perplexes. Elles étaient rarement jouées, et réputées inadéquates aux salles de concert. Qui pouvait sérieusement entraîner le public à la rencontre d’un colosse de cinquante-cinq minutes, s’éloignant rarement de la clé d’ut majeur, et fondé sur une valse tellement anodine ? Où était cette mystique transcendantale, associée par tant de nos contemporains au dernier Beethoven ?
Les Variations Diabelli sont pourtant sa réussite suprême, unissant le passé, le présent et le futur, l’humour, la virtuosité et le sublime. »
<Voici les 33 Variations Diabelli interprétées par Alfred Brendel>
<1514>
- Elles étaient d’abord d’une difficulté technique inconnue jusqu’alors;
-
Mercredi 23 décembre 2020
« Beethoven et ses trois styles »Wilhelm von Lenz, livre de 1852 réédité en 1919Beethoven n’a jamais composé d’œuvres identiques.
Dans la musique dite classique beaucoup de compositeurs, surtout avant Beethoven, avaient trouvé une forme, une structure qui leur convenait. Alors ils composaient de nombreuses œuvres mais qui étaient en réalité une déclinaison d’œuvres antérieures. Beethoven crée tout le temps, dans le renouvellement et l’approfondissement. Et plus Beethoven avance dans l’âge et aussi dans la surdité, plus ses œuvres deviennent géniales et ouvrent des voies absolument disruptives, pour utiliser un mot moderne qui aurait dû être inventé pour caractériser les œuvres ultimes de Beethoven. Les derniers de l’ultime seront ses quatuors à cordes.
Ces quatuors à cordes commenceront à être compris et interprétés correctement vers la fin du XIXème siècle. Depuis, c’est devenu le « Graal » des quatuors à cordes et même de la musique de chambre, voire de la musique en général.
Quand j’ai commencé avec mon ami Bertrand G. à entrer dans ces œuvres, grâce à la tribune des critiques de disques d’Armand Panigel, Antoine Goléa, Jacques Bourgeois et Jean Roy, il existait plusieurs interprétations de qualité superlative, le Quatuor Vegh, le Quatuor Talich, le Quatuor Alban Berg de Vienne et le Quartetto Italiano.
A la fin ce sont ces derniers interprètes qui le plus souvent étaient choisis. Je dois avouer que je dispose de ces quatre interprétations aujourd’hui avec d’autres plus modernes et quelques-unes plus anciens.
Beethoven a écrit ses Seize Quatuors à cordes entre 1800 et 1826. Quand on voulait acquérir les enregistrements de ces quatuors à cordes, ils étaient quasi toujours présentés en trois coffrets :
- Les premiers quatuors à cordes ;
- Les quatuors de la période médiane ;
- Les derniers quatuors à cordes.
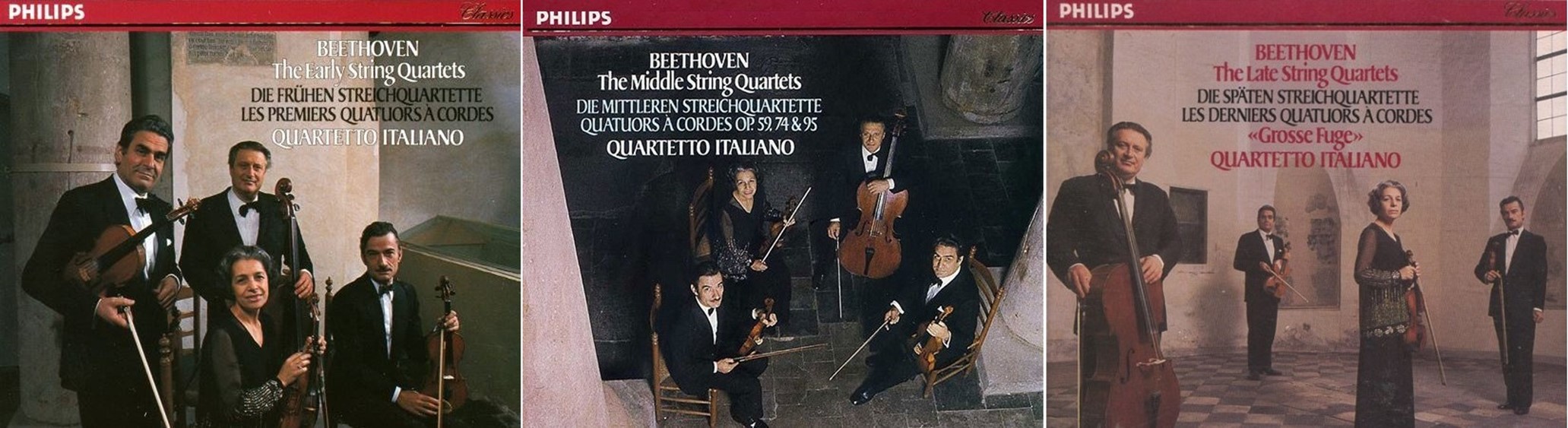
Cette coutume de classer les quatuors à cordes en trois périodes, se fonde sur un découpage qui a été initié par un musicologue : Wilhelm von Lenz.
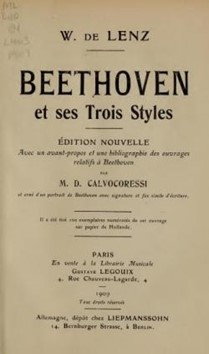 Il a écrit en 1855 « Beethoven et ses trois styles. » Mais cet ouvrage qui a été réédité en 1909, avait un sous-titre : « Analyses des sonates de piano ». Il avait donc prévu ce découpage de l’œuvre de Beethoven pour les sonates de piano. Mais rapidement, il a été utilisé pour l’ensemble de la production musicale du compositeur qui se trouve donc divisé en trois grandes périodes.
Il a écrit en 1855 « Beethoven et ses trois styles. » Mais cet ouvrage qui a été réédité en 1909, avait un sous-titre : « Analyses des sonates de piano ». Il avait donc prévu ce découpage de l’œuvre de Beethoven pour les sonates de piano. Mais rapidement, il a été utilisé pour l’ensemble de la production musicale du compositeur qui se trouve donc divisé en trois grandes périodes.
Dans le paragraphe « Modernités de Beethoven », Bernard Fournier explique :
« Les trois manières
L’ampleur d’une telle évolution a conduit les commentateurs à diviser l’œuvre de Beethoven en « périodes », « styles » ou « manières » permettant de caractériser les grandes étapes d’un développement artistique qui, ancré dans le classicisme (première manière), a ouvert la voie du romantisme (deuxième manière) et anticipé, dans ses explorations les plus visionnaires (troisième manière) »
« Beethoven et après », Bernard Fournier, page 119
Nicolas Derny, dans Diapason explique cependant que cette division du «temps créateur» de Beethoven n’est pas unanimement adoubée
« Le classicisme marque évidemment le premier des « trois styles » que Wilhelm von Lenz (1809-1883) croit pouvoir identifier dans le catalogue Beethovénien. Théorie dont Berlioz, apôtre de l’Allemand en France, ne pense que du bien.
Diapason N° 686 Janvier 2020 Page 24
André Boucourechliev dans son livre « Beethoven » se classe résolument dans le camp des sceptiques :
« Jamais œuvre ne reposa sur une plus grande inquiétude que l’œuvre de Beethoven. Jamais esprit créateur ne fut moins satisfait, moins prudent, moins soumis. Dépassant le doute par la vision de l’œuvre à venir, sa seule et provisoire certitude, retrouvant presque aussitôt le doute, Beethoven joue à chaque fois l’acquis, le remet en question et risque le tout pour le tout. […] Chaque œuvre, chaque phrase créatrice du compositeur témoigne de sa modernité à des niveaux divers, sous des aspects spécifiques. Dès lors la division rigide de la vie créatrice de Beethoven en trois ou deux ou quatre périodes s’avère, a moins de réserves sérieuses, aussi arbitraire que stérile. Que les dernières œuvres de Beethoven soient très différentes des premières, que tel quatuor de l’opus 59 soit d’une conception et d’une écriture autres que telle sonate de l’opus 2 ou de l’opus 102, est évident »
Boucourechliev « Beethoven » page 26 et 27
Et Boucourechliev d’insister sur le côté évolutif, de la métamorphose permanente qui interdit de tracer des frontières entre période.
Mais d’autres grands auteurs, qui en outre étaient compositeurs aussi, adoptent ce découpage.
Franz Liszt leur donne les titres suivants : -L’enfant – l’homme – le Dieu que Boucourechliev qualifie d’absurdes.
Vincent d’Indy propose d’autres appellations : les périodes d’« imitation » (1793-1801), de « transition » (1801-1815) et de « réflexion » (1815-1827).
Nicolas Derny conclut
Pour l’Histoire, la thèse de Lenz triomphe. Etiquettes pratiques et non dénuées de fondement, mais classement aux limites discutables. Soit. La musicologie moderne critique, amende, mais ne propose rien de mieux. »
Diapason N° 686 Janvier 2020 Page 24
Il n’y a rien de mieux. Et dans mon humble rôle de mélomane, je dois dire que cette typologie me convient et me convainc. Bien sûr, on ne passe pas brutalement d’une période à l’autre. Mais quand on écoute globalement les œuvres de chacune de ces périodes, on entend bien une très grande différence. Ainsi, pour essayer d’embrasser globalement l’œuvre de Beethoven, je vais me fonder sur ce découpage, mais sans donner de titre spécifique à chaque période. Pour chacune d’entre elles je proposerai deux œuvres.
Première période 1793-1801
 Beethoven a décidé de publier l’œuvre qu’il a désigné comme son opus 1 en 1795. Il s’agit de trois trios pour piano, violoncelle dont il avait commencé la composition en 1794.
Beethoven a décidé de publier l’œuvre qu’il a désigné comme son opus 1 en 1795. Il s’agit de trois trios pour piano, violoncelle dont il avait commencé la composition en 1794.
En 1793, Beethoven a 23 ans, il n’est plus un enfant, comme le laisse entendre Liszt. Il a déjà composé avant, mais il parait cohérent de faire débuter cette période à peu près au moment où Beethoven a décidé de dire : c’est l’opus 1. De manière plus factuelle, ce sont ses débuts à Vienne, il est parti définitivement de Bonn pour la capitale de l’empire d’Autriche en novembre 1792.
C’est au milieu de cette période (1796-97) qu’il commence à ressentir les premiers symptômes de troubles auditifs. Il est à ce moment-là un pianiste brillant.
Concernant les trois grands cycles, il compose ses 6 premiers quatuors à cordes opus 18 (1800), pour les symphonies il n’a composé que la première (1800) et pour les sonates de piano il a composé les 20 premières soit la majorité de 32.
Il compose aussi ses trois premiers concertos de piano, ses 8 premières sonates pour violon et piano et les deux premières sonates pour violoncelle et piano, l’essentiel de ses trios avec piano.
Il compose aussi une œuvre étonnante, un oratorio « Le Christ au mont des oliviers » (1801)
Il n’est pas question de donner, dans ce mot du jour, la liste exhaustive. Mais il faut constater qu’il a composé lors de cette période des œuvres de musique de chambre pour quintettes, sextuors ou des œuvres pour flute qu’il ne composera plus par la suite.
Il en va ainsi aussi des 6 œuvres qu’il a composé pour trio à cordes, violon, alto et violoncelle. Et je vous propose d’écouter le dernier : <Trio à cordes opus 9 N°3>. La proximité de Mozart et de Haydn est évidente.
Il a aussi composé le septuor pour cordes et vent opus 20. Ce septuor reçut un accueil triomphal. Et pendant longtemps ses admirateurs le louaient pour cette œuvre que lui considérait comme une œuvre de jeunesse, largement dépassé par les œuvres ultérieures. Ce succès continuel finit par irriter Beethoven et Brigitte Massin cite une réaction de Beethoven :
« Il y a là beaucoup d’imagination mais peu d’art »
Voici ce <Septuor pour cordes et vent opus 20> vous pouvez aussi aller à 19:25 pour écouter le tempo di minuetto.
Période médiane 1802-1815
 Cette période commence donc par le testament d’Heiligenstadt, Beethoven parle de sa surdité et s’éloigne de sa carrière de pianiste il va commencer à écrire des œuvres de plus en plus profondes et intériorisées.
Cette période commence donc par le testament d’Heiligenstadt, Beethoven parle de sa surdité et s’éloigne de sa carrière de pianiste il va commencer à écrire des œuvres de plus en plus profondes et intériorisées.
Beethoven a 32 ans, rappelons que Schubert est mort à 31 ans.
Il me semble qu’on peut dire que le romantisme commence alors en matière musicale. Certains parlent de la période héroïque.
La période commence, en effet, par l’écriture de la 2ème symphonie et surtout de la 3ème « Héroïque » (1804). Il écrira d’ailleurs toutes ses symphonies restantes, mise à part la 9ème, pendant cette période.
Les sonates de piano de 21 (Waldstein) à 26 seront composées ainsi que les quatuors à cordes N°7 à 11.
Je vous propose d’écouter le : <Quatuor à cordes N°10 opus 74> (1809) par le Quatuor Belcea. Nous avons changé de monde par rapport au septuor opus 20. Beethoven devient un compositeur majeur de l’Histoire de la musique.
Pendant cette période il va composer sa première messe en ut opus 86 (1807).
Il écrira aussi ses deux derniers concertos de piano, son triple concerto, il finira les dernières sonates pour violon et piano, il écrira la musique pour Egmont et entamera très largement son opéra Fidelio. Il écrira les trois dernières sonates pour violoncelle et piano dont les 4 et 5, la dernière année de la période, en 1815.
Et puis en 1806, il composera le concerto pour violon opus 61. Je vous propose le 2ème mouvement <Larghetto> par Anne Sophie Mutter et l’orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Karajan
La dernière Période (1816-1827)
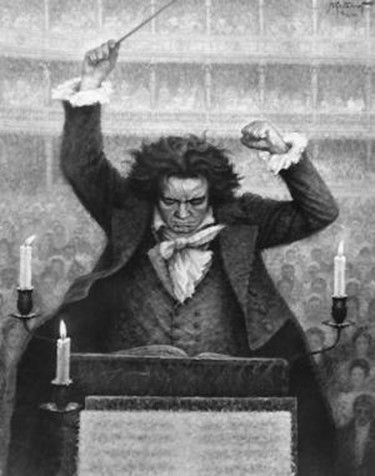 C’est la période pendant laquelle il va devenir totalement sourd. Il y aura aussi une période entre 1817 et 1819 pendant laquelle il n’écrira aucune œuvre majeure.
C’est la période pendant laquelle il va devenir totalement sourd. Il y aura aussi une période entre 1817 et 1819 pendant laquelle il n’écrira aucune œuvre majeure.
C’est la période dans laquelle il va devenir le plus grand ou un des plus grands.
Pendant cette période sera achevé Fidelio et seront composés la 9ème (1824), la Missa Solemnis (1822) et ces extraordinaires Variations Diabelli (1823) pour lesquelles <Brendel> affirme que c’est la plus grande œuvre pour piano que Beethoven ait composé.
Et puis, il y a les 5 dernières sonates de piano. Je vous propose le mouvement le plus court : Le <2ème mouvement allegro molto> de la sonate pour piano N°31 opus 110 par Maurizio Pollini.
Et il y a ses dernières œuvres qui sont les quatuors à cordes. Les contemporains de Beethoven, préfèrent le septuor, ils ne le suivent pas, ne le comprennent.
Peut-être que pour essayer d’illustrer cette dernière période, faut-il se tourner résolument vers la Grande Fugue opus 133. Cette œuvre fut d’abord le dernier mouvement du 13ème quatuor à cordes. Mais cette pièce était si immense, en elle-même, elle durait aussi plus de quinze minutes à elle toute seule que Beethoven a compris qu’il ne pouvait laisser cette œuvre dans une autre œuvre.
Il l’a donc séparée et a réécrit un autre mouvement final à son treizième quatuor.
C’est une œuvre dont le langage se situe aux limites du système tonal. La ligne mélodique a disparu. Son audace de conception se tourne résolument vers le XXème siècle. C’est une œuvre vraiment incompréhensible pour les contemporains de Beethoven. Bernard Fournier cite une réponse de Lucien Capet, créateur du Quatuor Capet (1893-1928) un des premiers quatuors à cordes à s’être attaqué de front aux derniers quatuors à cordes. Un auditeur avait demandé à quelle époque de sa vie Beethoven l’avait écrite. La réponse de Lucien Capet fut
« Après sa mort ! »
« Beethoven et après », Bernard Fournier, page 118
<Grande Fugue par quatuor Ebene>
Je laisserai la conclusion à Antoine Goléa
« En cela, Beethoven peut rejoindre Bach, sans effort, et dans ses œuvres les plus parfaites, parce que les plus neuves, les plus inouïes », les cinq dernières sonates pour le piano et les six derniers quatuors à cordes, il rejoint entièrement le Bach de l’Offrande musicale et de l’Art de la fugue [parmi les dernières œuvres de Bach]. Mais il le rejoint en quelque sorte sous un signe inversé : car si Bach a placé […] l’idée musicale pure à l’enseigne d’une commémoration auguste de la tradition, Beethoven la situe au carrefour des voies nouvelles, de voies où aucun retour ne sera plus permis. »
Antoine Goléa « La musique de la nuit des temps aux aurores nouvelles » volume 1 page294 et 295
<1513>
- Les premiers quatuors à cordes ;
-
Mardi 22 décembre 2020
« Ce sourd entendait l’infini »Victor Hugo évoquant Ludwig van BeethovenQuand un géant parle d’un autre géant…
« Ce sourd entendait l’infini.
Penché sur l’ombre, mystérieux voyant de la musique, attentif aux sphères, cette harmonie zodiacale que Platon affirmait, Beethoven l’a notée.
Les hommes lui parlaient sans qu’il les entendît ; il y avait une muraille entre eux et lui ; cette muraille était à claire-voie pour les mélodies de l’immensité.
Il a été un grand musicien, le plus grand des musiciens, grâce à cette transparence de la surdité.
L’infirmité de Beethoven ressemble à une trahison ; elle l’avait pris à l’endroit même où il semble qu’elle pouvait tuer son génie, et, chose admirable, elle avait vaincu l’organe, sans atteindre la faculté.
Beethoven est une magnifique preuve de l’âme.
Si jamais l’inadhérence de l’âme et du corps a éclaté, c’est dans Beethoven.
Corps paralysé, âme envolée.
Ah ! vous doutez de l’âme ?
Eh bien ! écoutez Beethoven. Cette musique est le rayonnement d’un sourd.
Est-ce le corps qui l’a faite ?
Cet être qui ne perçoit pas la parole engendre le chant.
Son âme, hors de lui, se fait musique. Que lui importe l’absence de l’organe !
Le verbe est là, toujours présent. Beethoven, tous les pores de l’âme ouverts, s’en pénètre.
Il entend l’harmonie et fait la symphonie.
Il traduit cette lyre par cet orchestre.
Les symphonies de Beethoven sont des voix ajoutées à l’homme.
Cette étrange musique est une dilatation de l’âme dans l’inexprimable.
L’oiseau bleu y chante ; l’oiseau noir aussi.
La gamme va de l’illusion au désespoir, de la naïveté à la fatalité, de l’innocence à l’épouvante.
La figure de cette musique a toutes les ressemblances mystérieuses du possible.
Elle est tout. Profond miroir dans une nuée. Le songeur y reconnaîtrait son rêve, le marin son orage, Élie son tourbillon où il y a un char, Erwyn de Steinbach sa cathédrale, le loup sa forêt.
Parfois elle a des entre-croisements impénétrables.
Avez-vous vu dans la Forêt-Noire ces branchages démesurés où la nuit est prise comme un épervier dans un filet et se résigne sinistrement, ne pouvant s’en aller ?
La symphonie de Beethoven a de ces halliers inextricables.
Et. tout à coup, si le rossignol était là, il se mettrait à écouter, croyant que c’est quelqu’un comme lui qui chante.
Le rossignol se tromperait, c’est mieux que lui. Il n’est que dans l’ombre, Beethoven est dans le mystère.
La mélodie du rossignol n’est que nocturne, celle de Beethoven est magique.
Il y a dans l’âme des jeunes filles une fleur qui chante ; c’est celle fleur-là qu’on entend dans Beethoven. De là une suavité incomparable.
Plus qu’un chant, une incantation. Cependant la vie réelle entre brusquement dans ce songe. Au milieu de son monstrueux et charmant poème, Beethoven donne un bal, il improvise une fête, il secoue des castagnettes, il tape sur un tambourin ; toutes les danses tournoient et passent, depuis la valse jusqu’au jaléo ; les bras entrelacés serrent les seins contre les poitrines; à l’écart, dans la clairière, le jeune homme rougissant salue une étoile où il voit une vierge ; des sourires de belles filles apparaissent, montrant des dents pleines de lumière ; des enfants et des moineaux jasent, les troupeaux bêlent, on entend la clochette des vaches rentrantes ; il y a des chaumières sous des saules ; et c’est là le bonheur, la famille, la nature, la prairie, la floraison d’août, la jeunesse, la joie, l’amour, avec l’horreur secrète d’Irminsul debout là-bas, sous des arbres, dans les ténèbres.
Puis vient le tutti, le finale, le dénouement ; le mirage se déforme, se déchire, s’ouvre, il s’y fait une profondeur. et l’on croit être au jour du Rosch-Aschana, et l’on croit voir les innombrables têtes d’Israël soufflant, joues gonflées, dans les cuivres et l’on assiste, ébloui par cette gloire, à la fête furieuse des trompettes.
Les symphonies de Beethoven sont des resplendissements d’harmonie. Les répliques de la mélodie à l’harmonie font de cette musique un intraduisible dialogue de l’âme avec la nature. Ce bruit-là pense. Dans cette végétation il y a le nid, dans cette église il y a le prêtre, dans cet orchestre il y a le cœur humain. Cette grandeur sert à faire aimer.
Insistons-y, et finissons par où nous avons commencé. Ces symphonies éblouissantes, tendres, délicates et profondes, ces merveilles d’harmonie, ces irradiations sonores de la note et du chant, sortent d’une tête dont l’oreille est morte.
Il semble qu’on voie un dieu aveugle créer des soleils. »
(texte destiné primitivement à William Shakespeare ; cote B.N. N.a.f. 24776, folio 85 ; Œuvres complètes, volume « Chantiers », Robert Laffont, 1985, p. 1015-1016)
<Julie Depardieu lit de larges extraits de ce texte> sur les ondes de France Musique.
« Il semble qu’on voie un dieu aveugle créer des soleils » aurait aussi pu être l’exergue de ce mot du jour ou « Écoutez Beethoven. Cette musique est le rayonnement d’un sourd. »
Hugo fréquentait Liszt qui avait transcrit toutes les symphonies de Beethoven pour piano. Il jouait aussi toutes les œuvres de piano de Beethoven. Liszt a fait aimer Beethoven à Hugo et lui a aussi fait découvrir Schubert.
<Ce site> en dit davantage. Je lui emprunte la reproduction d’un tableau de Joseph Danhauser, représentant Alexandre Dumas, Victor Hugo, George Sand, Niccolò Paganini, Gioacchino Antonio Rossini et Marie d’Agoult, tous réunis autour du piano sur lequel joue Liszt, piano surmonté d’un buste de Beethoven.
 <L’Obs> signale aussi ce texte et évoque d’autres écrivains parlant de Beethoven.
<L’Obs> signale aussi ce texte et évoque d’autres écrivains parlant de Beethoven.
Je remets tous ces écrivains et musiciens dans leur existence chronologique :
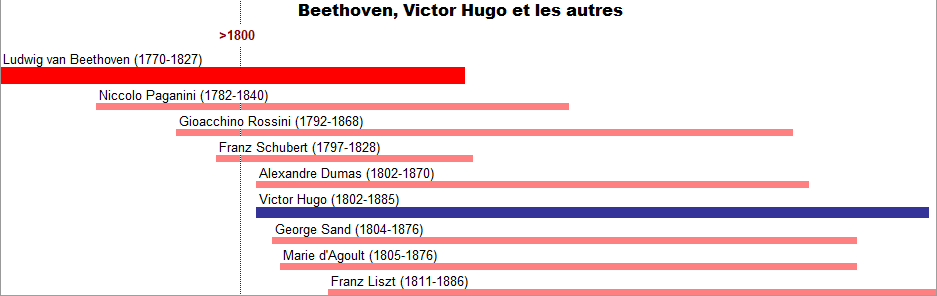
Victor Hugo parle des symphonies. Julie Depardieu était accompagnée par la 6ème symphonie.
Hugo écrit «Beethoven donne un bal, il improvise une fête, il secoue des castagnettes, il tape sur un tambourin ; toutes les danses tournoient et passent, depuis la valse jusqu’au jaléo». Wagner a appelé la 7ème symphonie «l’apothéose de la danse». C’est pourquoi, je propose l’allegretto de la 7ème symphonie, interprété par <L’orchestre Philharmonique de Berlin et Karajan>
Et pour la version intégrale, écoutez <L’orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam et Carlos Kleiber>. Interprétation époustouflante d’un chef d’orchestre génial maniant une gestique inhabituelle.
La 7ème symphonie date de 1812, 10 ans après le Testament d’Heiligenstadt.
<1512>
-
Lundi 21 décembre 2020
« C’est l’art et seulement lui, qui m’a retenu, ah ! il me semblait impossible de quitter le monde avant d’avoir fait naître tout ce pour quoi je me sentais disposé, et c’est ainsi que j’ai mené cette vie misérable »Ludwig van Beethoven, dans le « Testament d’Heiligenstadt » du 6 octobre 1802Ludwig van Beethoven aimait rire et boire. Il aimait la compagnie, avait beaucoup d’amis et du succès auprès des femmes.
Il n’était pas beau mais disposait d’un charisme incroyable. Et il subjuguait les élites viennoises par sa virtuosité pianistique et ses talents d’improvisateur.
Sa musique se vendait très bien et il disposait de mécènes riches qui lui permettaient de vivre confortablement.
Il disposait donc énormément d’atouts dans sa vie pour vivre avec bonheur, passion et réussite.
Il écrit même dans une lettre :
« Parfois je pense devenir fou devant ma gloire imméritée, la chance me poursuit et j’ai déjà peur pour cette raison d’un nouveau malheur. »
Lettre de Beethoven à Nikolaus Zmeskall cité <ICI>
Mais une terrible maladie va le frapper : la surdité.
Beethoven a commencé à ressentir les premiers symptômes de la surdité vers l’âge de 26-27 ans (1796-1797). D’abord localisés au niveau de l’oreille gauche, des acouphènes persistants se sont ensuite propagés à l’oreille droite.
Pendant longtemps, il va vouloir cacher cette infirmité qu’il sent comme une humiliation : comment avouer mal entendre et être musicien ? Il va chercher la solution auprès des médecins, gardant l’espérance d’une guérison. Mais à cette époque les médecins avaient peu de moyens d’intervention et peu de méthodes d’investigations. Le feuilleton de la radio télévision belge, tout au long des dix épisodes, invite un spécialiste de l’histoire de la médecine pour évoquer l’état de l’art et aussi les remarquables progrès qui vont être réalisés tout au long du XIXème siècle. Pour lui, à l’époque de Beethoven, seuls les chirurgiens avaient la technique pour vraiment améliorer certains des problèmes de santé des malades, mais pour le reste il y avait peu de remèdes et beaucoup d’appel à la bienveillance de la nature et à la miséricorde de Dieu.
Beethoven va pour la première fois s’ouvrir de cette maladie à son ami de jeunesse et de Bonn, de 5 ans son ainé, : Franz Gerhard Wegeler qui est devenu médecin. Cette lettre envoyée de Vienne est datée du 29 juin 1801.
Au début de la lettre, il décrit une situation enviable :
« Tu veux savoir quelque chose de ma situation : eh bien, cela ne va pas trop mal. […] Lichnowski m’a versé une pension de 600 florins, que je dois toucher, aussi longtemps que je ne trouverai pas de position qui me convienne. Mes compositions me rapportent beaucoup, et je puis dire que j’ai plus de commandes que je n’y puis satisfaire. Pour chaque chose, j’ai six, sept éditeurs, et encore plus, si je veux m’en donner la peine. On ne discute plus avec moi : je fixe un prix, et on le paie. Tu vois comme c’est charmant. »
Mais dans la seconde moitié de la lettre, il aborde frontalement son handicap :
« Malheureusement, un démon jaloux, ma mauvaise santé, est venu se jeter à la traverse. Depuis trois ans, mon ouïe est toujours devenue plus faible. Cela doit avoir été causé par mon affection du ventre, dont je souffrais déjà autrefois, comme tu sais, mais qui a beaucoup empiré ; car je suis continuellement affligé de diarrhée, et, par suite, d’une extraordinaire faiblesse. Frank voulait me tonifier avec des reconstituants, et traiter mon ouïe par l’huile d’amandes. Mais prosit ! cela n’a servi à rien ; mon ouïe a toujours été plus mal, et mon ventre est resté dans le même état. Cela a duré ainsi jusqu’à l’automne dernier, où j’ai été souvent au désespoir. Un âne de médecin me conseilla des bains froids ; un autre, plus avisé, des bains tièdes du Danube : cela fit merveille ; mon ventre s’améliora, mais mon ouïe resta de même, ou devint encore plus malade. Cet hiver, mon état fut vraiment déplorable : j’avais d’effroyables coliques et je fis une rechute complète. […] Je puis dire que je mène une vie misérable. Depuis presque deux ans, j’évite toute société, parce que je ne puis pas dire aux gens : « Je suis sourd ». Si j’avais quelque autre métier, cela serait encore possible ; mais dans le mien, c’est une situation terrible. Que diraient de cela mes ennemis, dont le nombre n’est pas petit !
Pour te donner une idée de cette étrange surdité, je te dirai qu’au théâtre je dois me mettre tout près de l’orchestre pour comprendre les acteurs. Je n’entends pas les sons élevés des instruments et des voix, si je me place un peu loin. Dans la conversation, il est surprenant qu’il y ait des gens qui ne l’aient jamais remarqué. Comme j’ai beaucoup de distractions, on met tout sur leur compte. Quand on parle doucement, j’entends à peine ; oui, j’entends bien les sons, mais pas les mots ; et d’autre part, quand on crie, cela m’est intolérable. »
Et il lui fait cette demande :
« Je te supplie de ne rien dire de mon état à personne »
Il écrit quelques jours plus tard à un autre ami proche Karl Amenda, théologien et violoniste :
« Mon cher, mon bon Amenda, mon ami de tout cœur, avec une émotion profonde, avec un mélange de douleur et de joie j’ai reçu et lu ta dernière lettre. À quoi puis-je comparer ta fidélité, ton attachement envers moi ! Oh ! cela est bien bon, que tu me sois toujours resté si ami. […] Combien je te souhaite souvent auprès de moi ! car ton Beethoven est profondément malheureux. Sache que la plus noble partie de moi-même, mon ouïe, s’est beaucoup affaiblie. Déjà, à l’époque où tu étais près de moi, j’en sentais les symptômes, et je le cachais ; depuis, cela a toujours été pire. Si cela ne pourra jamais être guéri, il faut attendre (pour le savoir) ; cela doit tenir à mon affection du ventre. Pour celle-ci, je suis presque tout à fait rétabli ; mais pour l’ouïe, se guérira-t-elle ? Naturellement, je l’espère ; mais c’est bien difficile, car de telles maladies sont les plus incurables. »
 On comprend bien que cette découverte est dramatique pour le compositeur et musicien. Beethoven est désemparé et il fuit de plus en plus les conversations et tente de cacher son état. En 1802, son médecin, Johann Adam Schmidt, lui conseille une cure de repos et de silence à la campagne. Beethoven décide de partir pour Heiligenstadt qui est une petite ville au nord de Vienne, où il espère trouver un peu de calme. Et le 6 octobre 1802, il décide d’écrire une lettre bouleversante, connue aujourd’hui sous le titre de « Testament de Heiligenstadt ». Il ajoutera un petit texte le 10 octobre 1802.
On comprend bien que cette découverte est dramatique pour le compositeur et musicien. Beethoven est désemparé et il fuit de plus en plus les conversations et tente de cacher son état. En 1802, son médecin, Johann Adam Schmidt, lui conseille une cure de repos et de silence à la campagne. Beethoven décide de partir pour Heiligenstadt qui est une petite ville au nord de Vienne, où il espère trouver un peu de calme. Et le 6 octobre 1802, il décide d’écrire une lettre bouleversante, connue aujourd’hui sous le titre de « Testament de Heiligenstadt ». Il ajoutera un petit texte le 10 octobre 1802.
Cette lettre est adressée à ses frères, mais probablement à toute l’humanité, au moins à tous ses amis et connaissances. Elle contient toute la souffrance et la détresse du musicien face à la tragédie qu’il vit.
Elle ne sera jamais envoyée ni à ses frères ni à quiconque, mais sera retrouvée après sa mort par Anton Schindler et Stephan von Breuning dans un tiroir secret de l’armoire de Beethoven aux côtés de la Lettre à l’immortelle Bien-aimée.
On ne sait pas s’il s’agit d’un vrai testament. Beethoven rédigera par la suite deux autres testaments : en 1824, puis peu avant sa mort, en 1827
Ce document peut aussi se lire comme une trace que l’on laisse derrière soi avant de se suicider même si dans le texte il affirme avoir renoncé à se suicider pour continuer à composer.
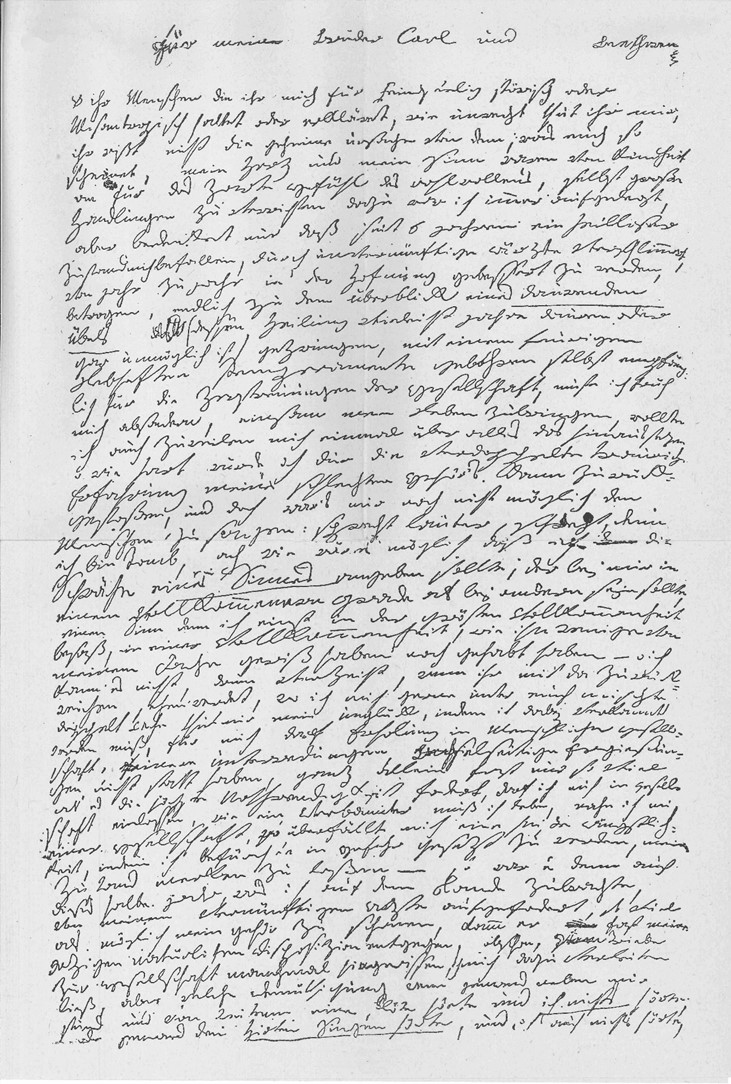 De manière surprenante, dans l’entête de sa lettre datée du 6 octobre 1802, il laisse un espace et n’écrit pas le nom de son second frère : Johann :
De manière surprenante, dans l’entête de sa lettre datée du 6 octobre 1802, il laisse un espace et n’écrit pas le nom de son second frère : Johann :
« Pour mes frères Carl et [espace ] Beethoven.
Il veut d’abord expliquer qu’il entend les critiques qu’on peut lui adresser de fuir la société, d’être « misanthrope », irritable, mais il veut se justifier et expliquer la raison profonde de son attitude :
« Ô vous ! hommes qui me tenez pour haineux, obstiné, ou qui me dites misanthrope, comme vous vous méprenez sur moi.
Vous ignorez la cause secrète de ce qui vous semble ainsi, mon cœur et mon caractère inclinaient dès l’enfance au tendre sentiment de la bienveillance, même l’accomplissement de grandes actions, j’y ai toujours été disposé, mais considérez seulement que depuis six ans un état déplorable m’infeste, aggravé par des médecins insensés, et trompé d’année en année dans son espoir d’amélioration. »
Et en des mots simples il explique sa surdité et les situations insupportables que cela crée pour lui :
« j’étais ramené durement à la triste expérience renouvelée de mon ouïe défaillante, et certes je ne pouvais me résigner à dire aux hommes : parlez plus fort, criez, car je suis sourd, ah ! comment aurait-il été possible que j’avoue alors la faiblesse d’un sens qui, chez moi, devait être poussé jusqu’à un degré de perfection plus grand que chez tous les autres, un sens que je possédais autrefois dans sa plus grande perfection, dans une perfection que certainement peu de mon espèce ont jamais connue »
Et il avoue qu’il a pensé au suicide :
« Mais quelle humiliation lorsque quelqu’un près de moi entendait une flûte au loin et que je n’entendais rien, ou lorsque quelqu’un entendait le berger chanter et que je n’entendais rien non plus ; de tels événements m’ont poussé jusqu’au bord du désespoir, il s’en fallut de peu que je ne misse fin à mes jours. »
Et dans ce document il affirme qu’il se serait suicidé s’il n’avait pas la conscience, la certitude, l’intuition, je ne sais quel est le bon mot, qu’il avait encore tant d’œuvres à donner à l’humanité :
« C’est l’art et seulement lui, qui m’a retenu, ah ! il me semblait impossible de quitter le monde avant d’avoir fait naître tout ce pour quoi je me sentais disposé, et c’est ainsi que j’ai mené cette vie misérable – vraiment misérable ; un corps si irritable, qu’un changement un peu rapide peut me faire passer de l’euphorie au désespoir le plus complet – patience, voilà tout, c’est elle seulement que je dois choisir pour guide, je l’ai fait – durablement j’espère, ce doit être ma résolution, persévérer, jusqu’à ce que l’impitoyable Parque décide de rompre le fil, peut-être que cela ira mieux, peut-être non, je suis tranquille – être forcé de devenir philosophe déjà à 28 ans, ce n’est pas facile, et pour l’artiste plus difficile encore que pour quiconque »
Il lègue alors ses biens à ses deux frères en leur recommandant de ne pas se disputer et d’être heureux. Et il donne ce conseil humaniste :
« Recommandez à vos enfants la vertu, elle seule peut rendre heureux, pas l’argent, je parle par expérience, c’est elle qui même dans la misère m’a élevé, je la remercie autant que mon art, pour m’avoir fait éviter le suicide – adieu et aimez-vous »
Après plusieurs jours de désespoir, l’état psychique de Beethoven s’améliore. Plongé dans l’écriture de ses deuxièmes et troisièmes symphonies notamment, Beethoven retrouve son énergie créatrice.
<Wikipedia> écrit :
« Mais Beethoven sortit victorieux de cette crise, résolu à affronter son destin plutôt que de s’abattre : c’était le début de la période « Héroïque » qui allait durer jusqu’en 1808 et l’apothéose de la Cinquième symphonie. »
Beethoven perd complètement ses capacités auditives en 1818. Il est possible de le savoir avec une certaine certitude, grâce aux écrits, aux lettres de Beethoven mais aussi grâce aux fameux cahiers de conversation de Beethoven. Ces cahiers de conversation sont de véritables témoignages des dix dernières années de la vie de Beethoven.
Sur le site de <resmusica> un article du 26 mars 2020 revient plus en détail sur les causes possibles de surdité, mais relate aussi comment Beethoven va tenter de lutter concrètement contre son impossibilité d’entendre :
« Il commande à Conrad Graf, facteur de piano de la Cour Impériale de Vienne, un instrument à quadruple cordes, utilise un résonateur, fixe un cornet acoustique sur un serre-tête pour composer, ou une baguette de bois tendue entre ses dents et la caisse de résonance du piano. »
Il utilise la possibilité de faire vibrer la masse osseuse pour essayer de sentir les vibrations et sentir ainsi la musique.
 Il va aussi faire appel à un ingénier bavarois Johann Nepomuk Maelzel pour qu’il fabrique des cornets acoustiques, de plus en plus perfectionnés, pour tenter d’entendre.
Il va aussi faire appel à un ingénier bavarois Johann Nepomuk Maelzel pour qu’il fabrique des cornets acoustiques, de plus en plus perfectionnés, pour tenter d’entendre.
Maelzel qui sera aussi l’inventeur du métronome qu’il présentera à Beethoven qui en sera enchanté et donnera des indications métronomiques concernant notamment ses symphonies. Indications extrêmement rapides que la plupart des chefs négligent pour adopter des tempos beaucoup plus lents.
Le site <Médecine des arts> essaie de mettre en lien la surdité et l’œuvre musicale.
Car ce qui est extraordinaire c’est que c’est pendant sa période de surdité que Beethoven va écrire ses plus grands chefs d’œuvres, ceux qui vont révolutionner la musique et constituent encore, pour les mélomanes d’aujourd’hui, une offrande inouïe à l’Art et à l’humanité. Une œuvre qui par sa seule existence justifie l’humanité, alors que le désastre écologique qui est en cours, du fait de l’homme, nous fait désespérer de notre espèce et nous demander s’il était utile qu’elle se développe pour devenir l’espèce dominante.
Beethoven entendait la musique à l’intérieur de son esprit et de son corps isolé des sons extérieurs.
Le site <resmusica> rappelle la première interprétation de la 9ème symphonie :
« En 1824 pour la création de la Symphonie n° 9, il est complètement sourd, reste le dos tourné à la salle ne constatant son triomphe qu’après que la cantatrice Karoline Unger le prend par les épaules pour qu’il constate l’ovation du public.»
Le testament d’Heiligenstadt ainsi que les lettres cités se trouvent en intégralité sur ce site https://fr.wikisource.org/wiki/Vie_de_Beethoven/Lettres
Vous pourrez y lire aussi une autre lettre qu’il a écrit, le 16 novembre 1801, à son ami Wegeler et dans laquelle il a cette phrase
« Je veux saisir le destin à la gueule. Il ne me courbera certainement pas tout à fait. »
Comme œuvre, je vous propose aujourd’hui <L’andante du quatuor à cordes N° 9> qui a été écrit en 1806 et fait partie des 3 quatuors à cordes opus 59 « Razumovsky » dans une interprétation du quatuor Belcea.
Et si vous voulez entendre l’œuvre en entier dans la <version lumineuse du Quatuor Alban Berg de Vienne>
<1511>
-
Vendredi 18 décembre 2020
« Beethoven, Bonaparte, Napoléon, des œuvres, des dédicataires et des mécènes »Un récit simple qui cache une grande complexitéAprès la famille et les maîtres, il me faut parler des mécènes et des dédicataires que Beethoven a eu tout au long de sa vie de compositeur.
Je m’arrêterai un peu plus longuement sur l’histoire que l’on raconte à propos de la 3ème symphonie « Eroïca » et surtout du dédicataire.
Hier, j’ai parlé de l’importance du Comte von Waldstein pour Beethoven : son premier séjour à Vienne et la rencontre avec Mozart, sa rencontre avec Haydn qui accepte de lui donner des cours, son départ pour Vienne, la rente que lui a octroyé le Prince Electeur pour le séjour viennois, tout cela il le doit à Waldstein.
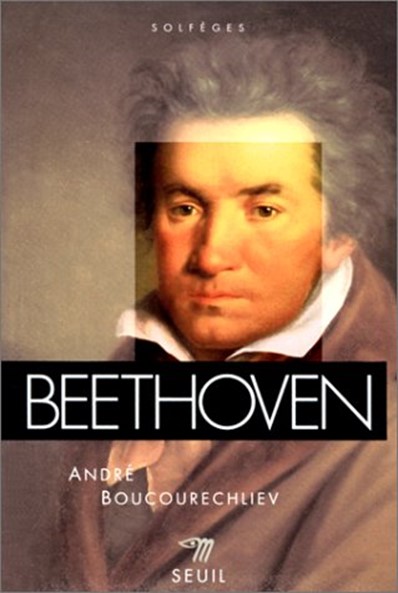 Et :
Et :
« Recommandé par le Prince Électeur Max Franz, par Waldstein, introduit par Zmeskall, il est adopté par l’aristocratie mélomane de Vienne : La comtesse von Thun, Lichnowsky, Razumovsky, Lobkowitz, van Swieten, von Browne […]. Nous retrouvons tous ces noms […] au long des années, dans les dédicaces des œuvres de Beethoven. Jusqu’en 1796 Beethoven loge chez le prince Karl von Lichnowsky, non dans l’état de domesticité qu’ont connu Haydn et Mozart, mais en ami entouré, soutenu, respecté. Le prince assume pour lui le rôle d’un véritable imprésario et s’évertue, au piano, à lui prouver que ses compositions sont, malgré leur difficulté, parfaitement exécutables. »
Bourcourechliev, « Beethoven » Page 163
Beethoven ne manquera jamais, tout au long de sa vie, de riches mécènes qui le soutiendront financièrement. Il dispose aussi de nombreux amis fidèles. C’est d’ailleurs un homme plein d’énergie qui aime rire et qui aime boire. Il aime aussi la compagnie des femmes et a de nombreuses maîtresses, c’est un jouisseur. Je ne m’attarderai pas sur ses désillusions de mariage parce que dans le monde aristocrate dans lequel il vit, les femmes qu’il veut épouser sont d’essence noble, souvent déjà promises à d’autres. Et puis ce tabou ne pourra être franchi : il n’obtiendra jamais de rentrer dans ces familles par les liens du mariage.
Il n’est pas beau, mais il a un charisme époustouflant. Sur le site de <France Musique> on peut lire :
«Il est petit, brun, marqué de petite vérole, […] des cheveux noirs, très longs, qu’il rejette en arrière […] ses vêtements sont déchirés, il a l’air complètement déguenillé » : voici ce qu’écrit Bettina Brentano à propos de Beethoven alors qu’elle avoue dans le même temps être littéralement hypnotisée par le compositeur. Car Beethoven ne laisse jamais indifférent. Quand il se met au piano ou compose, « les muscles de son visage se gonflent » et son « regard farouche roule avec violence » : Beethoven est tel un magicien étrange et effrayant, mais qu’on se fait un doux plaisir d’observer.
Le mythe d’un Beethoven solitaire toujours hargneux, triste et coléreux ne correspond pas à la réalité. Les choses changeront, bien sûr, à partir du moment où sa terrible surdité deviendra de plus en plus prégnante.
A Vienne, c’est d’abord en tant que pianiste et improvisateur que Beethoven se fera connaître. C’est un virtuose exceptionnel. Il participe régulièrement à des joutes musicales, fort appréciées à l’époque, dans lesquels il faut improviser et jouer du piano de la manière la plus éblouissante que possible.
Carl Czerny qui est un des grands maîtres du piano, de jeunes pianistes jouent encore ses études et ses exercices, fut à la fois l’élève de Beethoven et le professeur de Frantz Liszt. Il écrit :
« Son improvisation était on ne peut plus brillante et étonnante ; dans quelque société qu’il se trouvât, il parvenait à produire une telle impression sur chacun de ses auditeurs qu’il arrivait fréquemment que les yeux se mouillaient de larmes, et que plusieurs éclataient en sanglots. Il y avait dans son expression quelque chose de merveilleux, indépendamment de la beauté et de l’originalité de ses idées et de la manière ingénieuse dont il les rendait. »
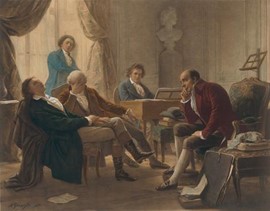 Sa maladie va le conduire à délaisser cette part de son talent pour se concentrer sur la composition de ses œuvres.
Sa maladie va le conduire à délaisser cette part de son talent pour se concentrer sur la composition de ses œuvres.
Mais c’est d’abord, grâce à sa réputation de virtuose accompli qu’il va encore élargir son cercle de connaissances et rencontrer des aristocrates qui accepteront de le financer, tout en le laissant libre de composer ce qu’il veut.
Sur ce point, sa liberté de composer, il est intransigeant. Sa musique séduit, bouleverse même. Beethoven le sait et son génie musical se dédouble d’un talent commercial qui le place parmi les premiers compositeurs à vivre de leur musique.
Il écrit ainsi à son ami Wegeler :
« Tu veux savoir quelque chose de ma position ? Eh bien, elle n’est pas si mauvaise. Depuis l’année passée, quelque incroyable que cela puisse paraître, Lichnowsky a été et est resté mon ami le plus chaud. De petites mésintelligences ont bien eu lieu entre nous, et n’ont-elles pas affermi notre amitié ? Il m’a réservé une somme de six cents florins que je puis toucher tant que je n’aurai pas trouvé une place qui me convienne. Mes compositions me rapportent beaucoup et je puis dire que j’ai beaucoup plus de commandes que j’en puis faire. J’ai six ou sept éditeurs pour chacune de mes oeuvres, et j’en aurais beaucoup plus si je voulais. »
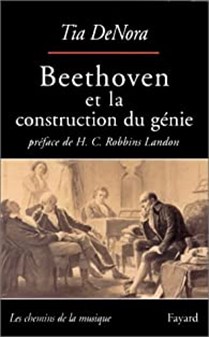 La musicologue Tia de Nora fait le constat suivant :
La musicologue Tia de Nora fait le constat suivant :
« Durant les quatre premières années de Beethoven à Vienne, de novembre 1792 à 1796 (période qui le vit s’imposer comme pianiste-compositeur), son ascension se reflète dans le nombre croissant de ses mécènes et protecteurs. […] Ni la popularité de Beethoven dans sa période médiane, ni sa reconnaissance finale comme le plus grand de tous les maîtres n’auraient pu avoir lieu si en ses débuts, dans les années 90 et aux débuts des années 1800, la société aristocratique ne l’avait pas placé sur un véritable piédestal »
Cette <page> consacré au mécénat dont va profiter Beethoven à Vienne apporte d’autres éléments encore.
Une autre page <Les mécènes> présente les principaux mécènes et leur interaction avec Beethoven.
Mais qui dit mécène, dit aussi dédicace d’une œuvre de Beethoven. Et de cette manière ces hommes resteront dans l’Histoire, grâce aux œuvres de Beethoven.
C’est au Prince Karl von Lichnowsky, celui lui accordera le logis au début de son séjour à Vienne et un soutien continue que Beethoven dédiera son Opus.1 ainsi que plusieurs œuvres majeurs dont la sonate n°8 « Pathétique » et la symphonie n°2.
Il n’oubliera pas ceux de Bonn, Stephan von Breuning, sera le dédicataire du sublime concerto de violon.
Le prince Lobkowitz reçoit un grand nombre de dédicaces de la part de Beethoven, parmi les plus grands chefs-d’œuvre du maître : les Quatuors à cordes Op.18, le Triple Concerto.
Les cinquième et sixième Symphonie lui seront aussi dédiées mais conjointement avec le comte Razumovsky).
Le comte Andrey Kirillovich Razumowski qui sera le seul dédicataire de ces 3 quatuors opus 59 que l’Histoire désignera sous le nom : « les Quatuors Razumowski ». A Gottfried van Swieten qui fut aussi un de ses premiers soutiens, il dédiera sa première symphonie.
L’Archiduc Rodolphe, le plus jeune fils de l’empereur Léopold II et qui devient, 1803, l’élève de Beethoven. C’est à lui à qu’il dédicacera son immense Missa Solemnis, et aussi son trio pour piano, violon et violoncelle opus 97 qui restera pour l’éternité le Trio « à l’Archiduc ». Il aura aussi droit à la Sonate pour piano N° 26 des « Adieux » et d’autres œuvres majeures encore.
Et nous en venons à la Troisième symphonie opus 55 qui aurait pu avoir pour nom : « Symphonie Bonaparte ». Bonaparte n’était pourtant pas un mécène de Beethoven. Mais on lit partout ce même récit :
Beethoven est profondément épris de l’idéal républicain défendu par la révolution française. Et Bonaparte est considéré comme le sauveur des idéaux de la Révolution française ; comme l’incarnation de ces idéaux.
Beethoven est tellement conquis qu’il voudrait aller vivre à Paris et il a donc cette idée de dédier sa nouvelle symphonie écrite entre 1802 et 1804, à Bonaparte.
Et puis il apprend que Bonaparte s’est fait couronner empereur. Son cœur républicain ne fait qu’un tour, il entre dans une rage folle et déchire la dédicace. La symphonie sera dédiée à un grand homme, sans plus de précision.
Cette fois, l’histoire n’est pas rapportée par le biographe contesté, c’est-à-dire Schindler, mais par un élève et collaborateur de Beethoven Ferdinand Ries qui rapporta après la mort de Beethoven que ce fut lui qui annonça le couronnement de Napoléon et que Beethoven déchira la dédicace et s’exclama :
« Ainsi, il n’est rien de plus que le commun des mortels ! Maintenant il va piétiner les droits des hommes et ne songera plus qu’à son ambition. Il prétendra s’élever au dessus de tous et deviendra un tyran ! »
Lors des émissions de la radio télévision belge dont j’ai déjà parlé, j’entendis l’historienne Elisabeth Brisson remettre en cause ce récit. D’abord parce que la dédicace déchirée du récit de Ries fut retrouvée intact.
J’ai retrouvé des informations similaires sur le site de la fondation Napoléon qui par la plume de son directeur Thierry Lentz rapporte :
« Donc, Beethoven déchira la page de titre qu’il avait préparée… Alors comment expliquer que soit conservée au Archives de la Société philarmonique de Vienne une partition de L’Héroïque où le nom de Bonaparte a été rageusement biffé, jusqu’à faire un trou dans le papier. Il semble bien qu’il s’agisse d’une copie contemporaine, qui n’est pas de la main du compositeur, dont on peut supposer qu’elle était destinée à être envoyée… à Napoléon. Elle fut conservée par Beethoven qui s’en servit pour inscrire des corrections postérieures. Quant à la rature, les spécialistes pensent qu’elle est bien postérieure et pas de son fait. En clair : la copie est vraie et la rature est (probablement) fausse. »
Elisabeth Brisson fait remarquer qu’en outre, juste après être devenu empereur, la France de Napoléon a déclaré la guerre à l’Empire d’Autriche et qu’un habitant de Vienne devait probablement éviter de dédier une de ses œuvres au souverain de la puissance ennemie.
Et j’ai trouvé sur le site de <la Maison de Radio France> une présentation d’un concert dans laquelle Ariane Herbay prétendait que
« Mais derrière cette noble histoire s’en cache une autre. Toute révolution ayant besoin d’être financée, si Beethoven renonça à sa dédicace, en réalité, ce fut pour 400 florins. Somme que son mécène, le prince Lobkowitz, lui proposait, afin d’avoir l’exclusivité de cette symphonie pendant six mois. »
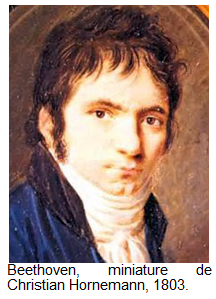 Beethoven était un humaniste et il aimait la liberté, surtout la sienne en matière d’art. Il était peut-être sincèrement intéressé par l’expérience française, mais elle générait beaucoup de désordres et de violences en Europe, ce qu’il devait beaucoup moins apprécier. En outre, il était entouré d’aristocrates qui devaient peu gouter l’ambition révolutionnaire de les mettre à bas. Enfin, nous savons que Beethoven cherchait une place stable, comme son grand père, place qui ne lui a jamais été accordée à Vienne. Il semble bien que la première dédicace visait à obtenir une telle place à Paris.
Beethoven était un humaniste et il aimait la liberté, surtout la sienne en matière d’art. Il était peut-être sincèrement intéressé par l’expérience française, mais elle générait beaucoup de désordres et de violences en Europe, ce qu’il devait beaucoup moins apprécier. En outre, il était entouré d’aristocrates qui devaient peu gouter l’ambition révolutionnaire de les mettre à bas. Enfin, nous savons que Beethoven cherchait une place stable, comme son grand père, place qui ne lui a jamais été accordée à Vienne. Il semble bien que la première dédicace visait à obtenir une telle place à Paris.
La page sur le mécénat déjà cité va dans ce sens : « À partir de 1800, le prince Lichnowsky lui procure à une rente annuelle très confortable de 600 florins par an. De ce fait, Beethoven devient relativement indépendant. Cela l’encourage à poursuivre des buts esthétiques d’une plus grande ampleur. Mais cela n’empêche pas Beethoven de chercher un emploi stable à la cour impériale. Comme tous les compositeurs, il est à la recherche d’une situation stable qui pourrait le mettre à l’abri des besoins matériels. »
Et puis s’il est fâché avec Napoléon, il ne le restera pas longtemps. Thierry Lenz explique que :
« Beethoven se « réconcilia » plus tard avec l’Empereur. En 1809, lors de la seconde occupation de Vienne, il confia à un de ses amis français qu’il ne refuserait pas d’être convoqué. Il ne le fut pas. Il rappela par la suite à plusieurs reprises à ses amis et correspondants que c’est à lui qu’il pensait en composant L’Héroïque, déclarant même, en apprenant la mort de Napoléon et parlant de la marche funèbre du deuxième mouvement : « Il y a dix-sept ans que j’ai écrit la musique qui convient à ce triste événement ». »
Il semble même qu’il avait envisagé à écrire une messe en l’honneur de Napoléon.
Et puis plus concrètement, il y a un autre épisode qui montre que si Beethoven a pu être fâché, cela lui était passé. Le propre frère du Tyran, Jérôme Bonaparte, Roi de Westphalie non par le choix libre des citoyens de Westphalie mais par la conquête militaire des armées impériales, invite Beethoven à rejoindre sa cour. Et Beethoven écrira une lettre à ses amis viennois :
« Enfin, je me vois contraint, par des intrigues, cabales et bassesses de toute nature, à quitter la seule patrie allemande qui nous reste. Sur l’invitation de S.M. le roi de Westphalie, je pars comme chef d’orchestre. ». Cité par Boucourechliev « Beethoven » page 181.
Ceci ne se fera cependant pas. En effet, Rudolph Kinsky, l’Archiduc Rodolphe et le prince Lobkowitz, s’associent pour assurer une rente annuelle de 4000 florins à Beethoven, afin qu’il puisse composer entouré de toute la sécurité matérielle. A ce prix, Beethoven restera à Vienne.
Mais Beethoven était un personnage complexe et qui n’acceptait pas la soumission. Il se trouve qu’en automne 1806, l’Autriche est occupée par les troupes impériales de Napoléon Ier. Il habite alors dans la demeure de Silésie du prince Karl Alois von Lichnowsky. Et celui-ci, accueille quelques invités, dont plusieurs officiers français. Il invite alors Beethoven à jouer du piano pour les troupes d’occupation.
Beethoven refuse tout net et repart immédiatement à Vienne. Et il écrit ce message célèbre à son mécène :
« Prince, ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi-même. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n’y a qu’un Beethoven. »
Par la lecture du Diapason de mars 2015, j’ai appris que je partageais l’avis du grand Chef Mariss Jansons : « Si on m’oblige à en choisir une, ce serait la 3ème : elle me touche encore plus profondément que les autres qui font toute partie de mon univers personnel »
Je vous propose donc <La 3ème symphonie Eroica avec la radio Bavaroise et Jansons>
<1510>
-
Jeudi 17 décembre 2020
«Recevez des mains de Haydn l’esprit de Mozart !»Parole du Comte von Waldstein à Beethoven lors de son départ pour Vienne prendre des cours avec HaydnAujourd’hui, nous avons une certitude, il y a 250 ans Ludwig van Beethoven vivait, car nous savons qu’il a été baptisé le 17 décembre 1770 en l’église de Sankt Remigius à Bonn.
 Après avoir évoqué la famille et les ancêtres de Beethoven, il semble juste de parler de ses maîtres, ceux qui lui ont enseigné la musique qu’il allait magnifier par son génie.
Après avoir évoqué la famille et les ancêtres de Beethoven, il semble juste de parler de ses maîtres, ceux qui lui ont enseigné la musique qu’il allait magnifier par son génie.
<Ce site> m’a aidé à trouver l’architecture d’ensemble des années de formation de Beethoven
Les premiers cours sont donnés par son père qui est musicien à la chapelle de la cour de Bonn qui je le rappelle est celle du Prince électeur de Cologne.
Mais il comprend que le talent de son fils rend nécessaire de lui faire donner des cours par des professionnels pour chaque instrument.
Ce sont des noms inconnus aujourd’hui, dont la seule renommée est d’avoir été, pendant un peu de temps, professeur de Beethoven :
 Cours de piano avec Gilles van der Aeden et Tobias Friedrich Pfeiffer, de violon avec Georg Rovantini, d’orgue avec Willibald Koch et Zense.
Cours de piano avec Gilles van der Aeden et Tobias Friedrich Pfeiffer, de violon avec Georg Rovantini, d’orgue avec Willibald Koch et Zense.
Mais son vrai premier maître est connu par ses propres qualités et il a pour nom Christian Gottlob Neefe
Neefe naît le 5 février 1748 à Chemnitz en Saxe. Et il arrive à la cour de Bonn en 1779 en tant que musicien et succédera à l’organiste titulaire de la cour quand ce dernier décédera en 1782 et en 1783 il deviendra le professeur de Beethoven.
L’histoire dit qu’il est franc-maçon, attaché aux idées de la révolution mais il sera pourtant contraint de quitter la ville de Bonn en 1794 quand la France révolutionnaire occupera la ville. Il finira sa vie à Dessau en tant que Directeur de Théâtre où il décédera en 1798.
Et c’est l’enseignement de Christian Gottlob Neefe qui est certainement décisif. Il lui enseigne le piano, l’écriture, mais encore les philosophes de l’antiquité, et certainement le goût pour les idées républicaines. Il sera un ami et un protecteur. Neefe se fera parfois remplacer par le jeune Beethoven au clavecin et à l’orchestre de la cour.
Dans une thèse publiée sur Internet par Nicolas Molle, nous pouvons lire :
« Il fallut attendre 1783 et la rencontre décisive avec son professeur de musique, Christian Gottlob Neefe, pour que le jeune compositeur puisse découvrir les plaisirs de la réflexion intellectuelle. Neefe se fixa pour objectif non pas de former uniquement un musicien mais également de façonner un esprit éclairé. Il lui ouvrit alors les portes de la Société de Lecture (Lesegesellschaft) de Bonn où Beethoven put entrer en contact avec d’autres personnages cultivés de la ville.»
C’est grâce à Neefe que la famille von Breuning le prend à son service comme professeur de piano. Au sein de cette famille, il peut assister quotidiennement à des conversations ou des lectures des œuvres de Goethe, Schiller, Herder. Il suit quelques conférences de philosophie à la nouvelle Université créée par le Prince Electeur, Maximilian Franz.
Maximilian Franz, grand amateur de musique, su reconnaître assez vite le talent de Ludwig, probablement poussé par Neefe. D’ailleurs il compare les valeurs du père Beethoven et de son fils et Boucourechliev dans son livre « Beethoven » nous apprend :
« Max Franz tirant les conséquencse de la situation ôte 15 florins du traitement de Johann et nomme Ludwig second organiste avec 150 florins d’appointement. »
Boucourechliev « Beethoven » page 157
Neefe lui fera aussi découvrir Jean-Sébastien Bach et son clavier bien tempéré. Beethoven étudiera Bach mais aussi Haendel.
Mais Beethoven portera une plus grande admiration à Haendel qu’à Bach :
« Haendel est le plus grand compositeur qui ait jamais vécu. Je voudrais me découvrir et m’agenouiller devant sa tombe. »
Cet avis apparaît surprenant aujourd’hui, alors que de l’avis général Bach est nettement supérieur à Haendel, mais ce n’était pas l’avis de Beethoven.
Peut-être est-il utile de remettre tous ces musiciens que j’ai déjà évoqué et dont je parlerai ci-après dans une chronologie
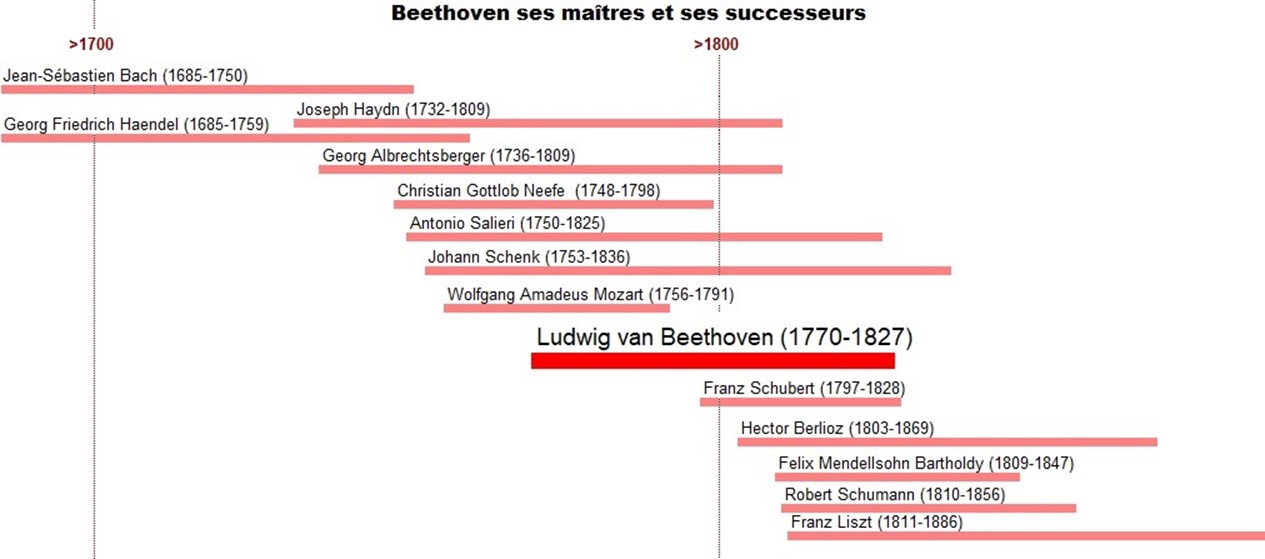
Neefe l’encouragera aussi à composer pour le piano, entre 1782 et 1783, les 9 variations sur une marche de Dressler et les trois Sonatines dites « à l’Électeur» qui marquent symboliquement le début de sa production musicale.
Il me semble que c’est finalement vers son premier maître que Beethoven exprimera le plus de reconnaissance. Il écrira en 1793 dans une lettre à Neefe :
« Je vous remercie pour vos conseils, ils m’ont soutenu bien souvent dans mes progrès en mon art divin. Si je deviens un jour un grand homme, vous y aurez participé. Cela vous réjouira d’autant plus que vous pouvez en être persuadé. »
Bien sûr, il faut rencontrer Mozart. Mozart auquel son père Johann pensait en essayant de faire produire le jeune Ludwig devant des assemblées nobles et musiciennes. Il ira jusqu’à mentir sur son âge, prétendant qu’il avait 6 ans, alors qu’il en avait déjà 8. Mais cela échoua. Beethoven n’était pas un nouvel enfant prodige et puis Johann Beethoven était loin des capacités pédagogiques de Léopold Mozart.
 Pour ce faire, il y aura un intermédiaire, un de ses nombreux mécènes, peut être le premier, le Comte von Waldstein qui est un proche du Prince électeur.
Pour ce faire, il y aura un intermédiaire, un de ses nombreux mécènes, peut être le premier, le Comte von Waldstein qui est un proche du Prince électeur.
Le comte von Waldstein emmène Beethoven une première fois à Vienne en avril 1787, il y restera du 7 au 20 avril.
Boucourechliev écrit :
De ce voyage du printemps 1787 nous savons peu de choses, sinon que « les deux personnages qui firent le plus d’impression sur Beethoven furent l’empereur Joseph II et Mozart. ». Mozart, malade, écrit Don Giovanni ; de son enfance, il a gardé l’horreur des précoces génies. Donna-t’il à Beethoven quelques leçons, prédit-il que « ce jeune homme ferait parler de lui dans le monde » ? Il semble, en tout cas, qu’il n’ait pas encouragé le jeune musicien rhénan à rester à Vienne. »
Boucourechliev « Beethoven » page 158
En 1787, Mozart a 31 ans, il ne lui reste plus que 4 ans à vivre et Beethoven a 17 ans. Et il semble bien que Mozart ait plutôt négligé Beethoven. On lit parfois que Mozart aurait dit « N’oubliez pas ce nom, vous en entendrez parler ! ». Les historiens sérieux considèrent les références de cet avis non fiables.
Beethoven est d’ailleurs rappelé d’urgence à Bonn, car sa mère est gravement malade, elle décèdera le 17 juillet 1787. Il écrira à son ami Wegeler :
« C’était pour moi une si bonne, une si aimable mère, ma meilleure amie. Oh ! qui donc était plus heureux que moi, alors que je pouvais encore prononcer le doux nom de mère, et qu’il était entendu – et à qui puis-je le dire maintenant ? »
Après la mort de sa mère, Il prend de plus en plus en charge de ses frères, son père sombrant définitivement dans l’alcoolisme. Mais il continue à composer des œuvres assez importantes selon le jugement de Boucourouchliev : Une cantate pour la mort de Joseph II en mars 1790 puis six mois après une autre pour célébrer l’avènement de son successeur Léopold II.
Et en 1790, l’autre grand compositeur de ce temps, Joseph Haydn passe à Bonn, mais personne ne songe à lui présenter le jeune Beethoven de 20 ans.
Le Comte von Waldstein va intervenir à nouveau. En juillet 1792, Joseph Haydn revenant d’une tournée en Angleterre, s’est à nouveau arrêté à Bonn. Cette fois Waldstein va présenter le jeune Ludwig à Haydn.
Et Boucourechliev commente :
« Il a pu lui soumettre une de ses cantates, et Haydn, sans doute frappé des promesses qu’elle contient, invite le jeune rhénan à faire « des études suivies » et de le rejoindre Vienne. »
Boucourechliev « Beethoven » page 160
Waldstein va intercéder auprès du Prince Électeur pour qu’il dote Beethoven d’une rente lui permettant de passer 2 ans à Vienne auprès de Haydn, ce qui fut fait. Au début de novembre 1792, doté de la rente du prince, il se rend un seconde fois à Vienne pour étudier auprès de Haydn. Ce sera une installation définitive, son père meurt en décembre 1792.
1792, Mozart est mort l’année précédente.
Le Comte von Waldstein, écrira, avant le départ pour Vienne, une lettre le 29 octobre 1792. C’est son extrait le plus célèbre que j’ai choisi comme exergue de ce mot du jour. Je cite cette phrase dans son contexte :
« Cher Beethoven, vous allez à Vienne pour réaliser un souhait depuis longtemps exprimé : le génie de Mozart est encore en deuil et pleure la mort de son disciple. En l’inépuisable Haydn, il trouve un refuge, mais non une occupation ; par lui, il désire encore s’unir à quelqu’un. Par une application incessante, recevez des mains de Haydn l’esprit de Mozart »
Waldstein
Pour la musicologue Florence Badol-Bertrand :
« Beethoven a eu la chance de venir après Mozart. Lorsque Beethoven arrive à Vienne, en 1792, Mozart est mort depuis onze mois. […] Doté d’une mémoire phénoménale, il a mémorisé non seulement toutes les compositions de l’auteur de la Petite musique de nuit, mais aussi l’œuvre musicale européenne. Très intelligent, il est en mesure de s’approprier cette musique tout en la remettant en question, et de procéder différemment. Beethoven était tellement bon musicalement qu’il a été difficile à surpasser. »
 Et alors qu’en est-il de l’enseignement de Haydn ?
Et alors qu’en est-il de l’enseignement de Haydn ?
Il y eut certainement des échanges fructueux. Les premières œuvres de Beethoven gardent trace de Haydn, mais ce ne fut pas une relation harmonieuse d’un vieux maître, 60 ans quand même, envers un jeune élève fasciné et brillant.
Beethoven trouve Haydn peu attentif et Haydn trouve Beethoven trop fantaisiste et éruptif.
Il lui dira :
« Vous avez beaucoup de talent et vous en acquerrez encore plus, énormément plus. Vous avez une abondance inépuisable d’inspiration, vous aurez des pensées que personne n’a encore eues, vous ne sacrifierez jamais votre pensée à une règle tyrannique, mais vous sacrifierez les règles à vos fantaisies ; car vous me faites l’impression d’un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes. »
Et une anecdote bien connue est rapportée. Haydn, demande à Beethoven de bien vouloir écrire sur les partitions qu’il publie : « Ludwig van Beethoven, élève de Joseph Haydn. »
Le jeune impétueux refuse. Son argument ?
« J’étais l’élève de Haydn, mais il ne m’a jamais rien appris ! »
Sur le site de <France musique> on lit :
« L’insoumission de Beethoven exaspère chacun de ses professeurs… Haydn, son maître de musique à Vienne, reconnait son talent mais le trouve beaucoup trop indiscipliné. Albrechtsberger, qui lui enseigne la composition, dit même à ses élèves : « C’est un exalté libre-penseur musical, ne le fréquentez pas ; il n’a rien appris et ne fera jamais rien de propre ».
Mais il évoluera, Boucourechliev cite un Beethoven plus sage et plus pondéré, quelques années plus tard :
« Lorsque je revis mes premiers manuscrits, quelques années après les avoir écrits, je me demandai si je n’étais pas fou de mettre dans un seul morceau de quoi en composer vingt. J’ai brûlé ces manuscrits, afin qu’on ne les voie jamais et j’aurais commis bien des extravagances sans les bons conseils de papa Haydn et d’Albrechtsberger »
Boucourechliev « Beethoven » page 163
Haydn va quitter Vienne pour Londres et Beethoven se tournera vers d’autres maîtres de composition et d’harmonie.
D’abord Johann Baptist Schenk qui fut le professeur de Ludwig van Beethoven en 1793. Il semble que cette relation fut plus apaisée et ils restèrent liés par de solides liens d’amitié. Schenk parlera de cette relation dans son autobiographie
« Pour ma peine (si on peut parler de peine), je reçus de mon bon Ludwig un présent précieux, le lien solide de l’amitié qui ne s’est pas relâché jusqu’à sa mort. »
Ensuite Johann Georg Albrechtsberger, musicien qu’on joue encore parfois et qui est organiste à la cour impériale et maître de chapelle de la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. Il fut l’ami de Haydn et Mozart, et le maître de Beethoven en 1794-1795.
 Un peu plus tard vers 1800, il prendra aussi quelques cours avec Antoine Salieri. Ce compositeur qu’une pièce de théâtre de Pouchkine calomniera en le faisant passer pour un compositeur jaloux de Mozart qui finira par l’empoisonner. Thèse fantaisiste et calomnieuse que reprendra Milos Forman dans son « Amadeus »
Un peu plus tard vers 1800, il prendra aussi quelques cours avec Antoine Salieri. Ce compositeur qu’une pièce de théâtre de Pouchkine calomniera en le faisant passer pour un compositeur jaloux de Mozart qui finira par l’empoisonner. Thèse fantaisiste et calomnieuse que reprendra Milos Forman dans son « Amadeus »
Antonio Salieri n’eut certes pas le génie de Mozart, mais il fut un compositeur italien de talent qui finira sa vie à Vienne. Il était d’ailleurs une personnalité incontournable de la vie musicale viennoise de son époque, compositeur à la cour impériale du Saint-Empire. Salieri est l’ami de Gluck et de Haydn et entretient des relations avec de nombreux autres compositeurs et musiciens importants. Certains de ses nombreux élèves deviennent plus tard célèbres outre Beethoven : Schubert, Meyerbeer mais aussi le tout jeune Liszt ; d’autres sont moins célèbres mais restent dans les ouvrages érudits : Hummel, compositeur d’un célèbre concerto pour trompette, Reicha, Moscheles, Czerny, Süssmayr, l’élève de Mozart qui finira son Requiem et même Franz Xaver Wolfgang Mozart, le dernier fils de Wolfgang Amadeus Mozart.
Il sera le dernier professeur de Beethoven qui tracera désormais son propre chemin, unique et révolutionnaire.
Le choix de l’œuvre pour aujourd’hui me semble assez simple : « La Sonate de piano N° 21 dédiée au Comte Von Waldstein » jouée par le grand pianiste chilien Claudio Arrau en 1977 à Bonn.
Si vous voulez écouter ce que pouvait être des œuvres que Beethoven composait à 13 ans voici une des sonatines dites « à l’Électeur» cité ci-avant :< Sonatines WoO N°47 n°1 & 2> jouée par un très jeune pianiste.
WoO signifie Werke Ohne Opus c’est dire œuvre sans opus et que Beethoven n’a donc pas fait publier de son vivant.
<1509>
-
Mercredi 16 décembre 2020
« Pause (anniversaire de Beethoven ?) »Un jour sans mot du jour nouveauCertes les mots du jour, ces derniers temps, sont longs à lire.
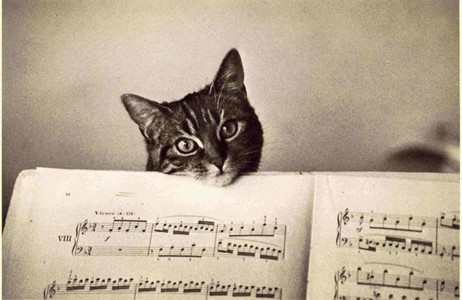 Mais il faut aussi les écrire.
Mais il faut aussi les écrire.
Et parfois c’est un peu compliqué.
Beethoven est né le 15 ou peut-être le 16 décembre.
Mais la veille du jour du baptême (le 17) me semble une hypothèse très sérieuse.
C’est donc peut-être aujourd’hui qu’il aurait 250 ans.
Pour célébrer cet anniversaire énormément d’institutions se sont rassemblées et avec Google ont créé un site qui a pour nom : « Beethoven Everywhere »
Je ne peux rien en dire puisque je viens juste de le découvrir, mais cela m’a l’air assez impressionnant. Dans un tout autre esprit, ARTE a diffusé le ballet que Maurice Béjart a créé sur la musique de la <9ème Symphonie>. Cette vidéo peut être vue jusqu’au 12 mars 2021.
<Mot du jour sans numéro>
-
Mardi 15 décembre 2020
« Ce grand père [Ludwig l’ancien] va lui permettre de se forger le mythe de la grandeur et du grand individu qui n’arrêtera pas de le porter et de le pousser. »Bernard FournierLe 15 décembre constitue le premier jour possible de la naissance de Beethoven, ce n’est pas le plus crédible puisque les parents auraient attendu deux jours pour le baptiser.
Contrairement aux Bach, musiciens dont la lignée s’étend sur sept générations, la famille Beethoven n’est musicienne que depuis deux générations.
Je voudrais m’intéresser aujourd’hui à la famille dans laquelle est née Beethoven.
Ludwig van Beethoven n’est pas du tout d’essence noble, le « van » flamand n’a aucune connotation aristocratique. Car la famille Beethoven est originaire de la Flandre.
Selon l’avis le plus fréquent ce nom a l’origine suivante :
«Beet» signifie betteraves en flamand et Hoven est le pluriel de Hof, la ferme. Beethoven est donc « la ferme aux betteraves ». Van Beethoven signifierait donc : « vient de la ferme aux betteraves ».
<Ce site> essaie une autre signification qui serait jardin de bouleaux. Mais j’ai lu par ailleurs que cette origine, qui se fonderait sur une racine latine, semble peu crédible dans cette région.
Quand on cherche, on trouve des choses étonnantes, ainsi sur cette page Wikipedia : <Liste des victimes de chasses aux sorcières> on trouve une certaine Josyne van Beethoven pendue en 1595 à Bruxelles parce qu’elle était soupçonnée d’être une sorcière.
J’avais déjà mentionné le feuilleton que la Radio-Télévision Belge et notamment sa chaîne Musiq3 a consacré à Beethoven. L'<Episode 1> évoque les ascendants du compositeur, ce <site> aussi.
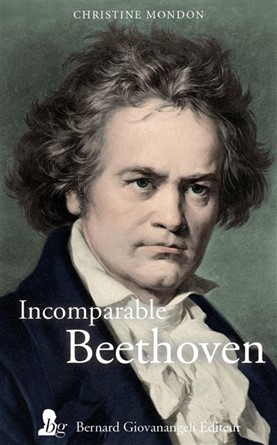 Et puis, il y a un livre récent que j’ai acquis. C’est un livre de Christine Mondon qui avait aussi publié « Franz Schubert, le musicien de l’ombre » que j’ai largement cité lors de la série consacrée à l’année 1828 de Schubert. Christine Mondon a écrit « Incomparable Beethoven » paru en novembre 2020.
Et puis, il y a un livre récent que j’ai acquis. C’est un livre de Christine Mondon qui avait aussi publié « Franz Schubert, le musicien de l’ombre » que j’ai largement cité lors de la série consacrée à l’année 1828 de Schubert. Christine Mondon a écrit « Incomparable Beethoven » paru en novembre 2020.
C’est grâce à ces trois sources que je peux retracer la trajectoire de la famille Beethoven de la Flandre vers Bonn.
Nous remonterons donc à la ville belge de Malines, dans laquelle arrivent, vers la fin du XVIIème siècle Corneille van Beethoven et sa sœur Maria.
Christine Mondon nous apprend que Corneille est un descendant de Josyne van Beethoven. <Ce site> qui entend dresser la généalogie de Beethoven montre qu’elle était l’arrière-grand-mère de Corneille. Elle était née Van Vlesselaer.
Christine Mandon écrit :
« Josyne van Beethoven, une femme émancipée, idéaliste et indépendante, marquée par une grande ouverture d’esprit, a défrayé son époque car elle fut précisément suspectée d’avoir fait un pacte avec le diable en échange du savoir. Les intrigues, la mesquinerie et la méchanceté des villageois ont fini par l’emporter et elle fut, après de grands sévices, contrainte à l’aveu et exécutée sur la place publique. Cet évènement a laissé des traces dans la mémoire collective de la famille. »
Incomparable Beethoven – pages 13 et 14
Les historiens contemporains ont réalisé un travail considérable pour essayer de comprendre cette folie qui s’est emparée de l’occident et qui a coûté la vie à tant de femmes remarquables, connaissant les plantes, savantes, émancipées et qu’on a torturées, brulées et dans le cas de Josyne Van Vlesselaer, épouse Beethoven, pendues.
Et le rebelle que sera Ludwig van Beethoven descend d’une telle femme !
Revenons à l’arrivée de la famille Beethoven à Malines
La première mention de Cornelius, ou Corneille, sur les registres de Malines date du 30 août 1671, lors du mariage de sa sœur Marie.
Corneille s’est marié à Malines le 12 février 1673, avec Catherine van Leempoel. Et c’est à la paroisse de Notre Dame, le 29 mars 1716, que Corneille van Beethoven a été enterré, escorté par la corporation des charpentiers.
Il était probablement charpentier ou peut être menuisier.
Corneille et Catherine vont avoir comme fils Michel van Beethoven qui est né le 15 février 1684. A côté des Églises, il existait des corporations qui elles aussi rédigeaient et conservaient des registres. Et c’est pourquoi nous pouvons savoir que Michel est apprenti boulanger en 1700 et devient Maître boulanger le 5 octobre 1707.
Michel se marie le 18 octobre 1707 avec Maria Ludovica Stuyckers. Ils auront plusieurs fils dont Ludwig né le 5 janvier 1712 et qui sera le grand père de Ludwig van Beethoven. C’est pourquoi, l’Histoire l’appelle Ludwig l’ancien.
C’est lui le premier de la famille qui va s’installer à Bonn. Il aura une place particulière dans le cœur et la vie de Beethoven.
Mais restons d’abord sur le cas de son père qui est boulanger, mais qui va se lancer dans « les affaires ». Il semble qu’il procède également à l’achat et à la vente de tableaux. puis vers 1720, il exerce le commerce de la dentelle de Malines, particulièrement réputée et objet de luxe. Au début les affaires semblent florissantes puisque le couple investit dans l’immobilier et possèdent en 1727, à Malines, quatre maisons en plus des lieux d’habitation qu’ils avaient chacun hérités de leurs parents.
Mais, probablement qu’ils souhaitent encore faire fructifier leur patrimoine et ils empruntent beaucoup d’argent. Ces emprunts, les époux Beethoven ne vont pas parvenir à les rembourser. Ils sont poursuivis devant les tribunaux et pour échapper à la justice ils s’enfuient et vont retrouver leur fils, Ludwig l’ancien, ainsi qu’un autre qui sont installés à Bonn, sur les terres du prince électeur de Cologne, dont la résidence principale et la vie de Cour se passe à Bonn. Ils sont ruinés mais à l’abri de la justice flamande.
 Mais intéressons-nous à Ludwig l’ancien dont nous conservons un portrait. Il avait été peint par le peintre officiel de la Cour du Prince Électeur de Cologne, Amelius Radoux. Ce qui démontre la place éminente que le grand-père occupait. Ce portrait a accompagné Beethoven toute sa vie.
Mais intéressons-nous à Ludwig l’ancien dont nous conservons un portrait. Il avait été peint par le peintre officiel de la Cour du Prince Électeur de Cologne, Amelius Radoux. Ce qui démontre la place éminente que le grand-père occupait. Ce portrait a accompagné Beethoven toute sa vie. L’historienne Elisabeth Brisson dans l’émission de la radio belge explique :
« Dans le portrait réalisé par Radoux, Ludwig l’ancien tient une partition en main, on pense que c’est la serva padrona de Pergolèse. On a besoin de montrer qu’il avait cette profession de musicien. Alors que son petit-fils, on pourra le montrer sans aucun indice de sa fonction. C’est un personnage important [sinon le peintre de la Cour n’aurait pas fait son portrait]. Il meurt en 1773. Beethoven l’a un tout petit peu connu, mais il restera une figure pour lui. Il ne le dit pas mais on voit bien qu’il voudra être comme son grand-père et devenir maître de chapelle. Mais lui ne va pas y parvenir.
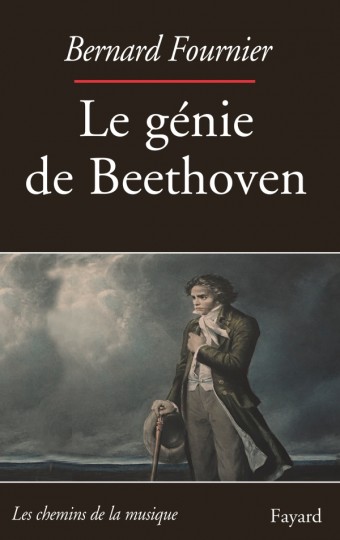 Le musicologue Bernard Fournier a écrit des ouvrages de références sur les quatuors à cordes et notamment de Beethoven ainsi qu’un livre plus général à qui il a donné le titre : « Le génie de Beethoven ». Il intervient aussi dans l’émission et dit :
Le musicologue Bernard Fournier a écrit des ouvrages de références sur les quatuors à cordes et notamment de Beethoven ainsi qu’un livre plus général à qui il a donné le titre : « Le génie de Beethoven ». Il intervient aussi dans l’émission et dit :
« Toute sa vie, Beethoven caressera le rêve de devenir maître de chapelle. Mais il n’y arrivera jamais. Il essayera plusieurs fois, mais il passera toujours à côté. Il fera bien mieux que cela, mais il aura toujours ce rêve insensé. Il voulait s’identifier à son grand père qui pendant toute son enfance a constitué le grand individu [de la famille] […] Il n’oubliera jamais l’image, il avait encore le portrait avec lui dans la chambre où il est mort à Vienne. Ce grand père va lui permettre de se forger le mythe de la grandeur et du grand individu qui n’arrêtera pas de le porter et de le pousser. »
Beethoven ne deviendra pas comme son grand-père, un fonctionnaire de la musique. Il restera toute sa vie un musicien précaire qui devra compter sur la générosité de ses mécènes et aussi de ses talents de négociateurs pour vendre sa musique. Il devient ainsi le premier musicien indépendant qui n’est pas rattaché à un souverain, une cour ou une institution.
Ludwig l’ancien se lance donc dans la musique. Il chante, joue de l’orgue et veut faire de la musique sa profession. Mais à Malines, les possibilités de gagner sa vie avec la musique sont peu nombreuses. Aussi, le jeune Ludwig tente sa chance pour un emploi de ténor à l’église collégiale de Saint-Pierre, à Louvain. Il y est reçu et probablement en raison de ses talents est repéré par le maître de chapelle, qui le propose pour le remplacer dans la direction de la maîtrise, ce qu’il devient le 9 novembre 1731.
Mais il ne s’arrêtera pas là, peu après en février 1732, il quitte Louvain pour la cathédrale Saint-Lambert, à Liège, et en mars 1733 part pour Bonn.

Pour faire carrière à cette époque, il faut avoir quelques talents et aussi profiter de certaines opportunités. Certains affirment que cela reste vrai.
Par un heureux hasard de circonstances l’Évêque de Liège qui bien sûr officiait à la cathédrale de Liège, était le Prince Électeur de Cologne, Clemens August qui était aussi archevêque de Cologne. Bref c’était un cumulard !
Visiblement ses qualités lui ont permis d’être repéré par le Prince Électeur qui l’incorpore dans le chœur de la chapelle de sa Cour de Bonn.
Peu après son arrivée à Bonn, Ludwig l’ancien se marie avec Maria-Josepha Poll, le 17 septembre 1733.
Christine Mandon écrit :
« Ambitieux, il convoite la direction de la Chapelle de cour. Grande est sa déception, lorsque le violoniste français Joseph Touchemoulin reçoit le titre de maître de chapelle. »
Mais le Prince Électeur meurt, le 6 février 1761 et il est remplacé par Maximilian-Friedrich qui veut faire des économies car il doit financer la guerre de sept ans. Il décide de rogner du tiers les émoluments du sieur Touchemoulin qui refuse et trouve un poste à Regensbourg.
Ludwig l’ancien qui était certainement un bon musicien mais qui était aussi négociateur, arrive à convaincre le Prince électeur de lui donner le poste convoité en associant sa fonction de chanteur et de maître de chapelle : deux emplois pour le même prix.
D’autant que pour arrondir ses revenus, il se lance dans le commerce de vins.
Je cite à nouveau Christine Mandon :
« La première victime a été son épouse Maria-Josepha (1714-1775) sombrant dans l’alcoolisme et finissant ses jours dans un couvent de Cologne. De cette union sont nés trois enfants […] et Johann, le père de Beethoven, né en mars 1740, le seul qui restera en vie. »
Johann sera musicien comme son père et alcoolique comme sa mère. D’ailleurs Beethoven, grand amateur de vin n’échappera pas à cette addiction.
Jeune, il suit une classe préparatoire au Collège des Jésuites. Puis, il devient soprano à la Chapelle de la Cour, à l’âge de douze ans. Par la suite, Johann est musicien de la Cour.
Il se marie le 12 novembre 1767 à l’église Saint Rémy de Bonn avec Maria Magdalena Keverich (1746-1787) contre l’avis de son père. Elle était fille d’un chef cuisinier et déjà veuve à 21 ans d’un valet de chambre de l’électeur de Trêves. Ludwig l’ancien considéra que ce n’était pas un bon parti pour le fils du maître de chapelle et il refusa d’assister au mariage.
 Ludwig est le deuxième de leurs sept enfants, dont trois seulement atteignent l’âge adulte : lui-même, Kaspar-Karl (1774-1815) et Johann (1776-1848).
Ludwig est le deuxième de leurs sept enfants, dont trois seulement atteignent l’âge adulte : lui-même, Kaspar-Karl (1774-1815) et Johann (1776-1848).Même si les relations entre Ludwig et son père sont bien plus complexes que la violence d’une éducation caricaturée à l’extrême par certains biographes, la vie de Johann ne fut pas un exemple de tempérance et de rigueur. Son alcoolisme dégrada peu à peu ses capacités à assumer ses obligations familiales et Ludwig van Beethoven dut assumer de plus en plus les charges de la famille grâce à son talent de musicien.
Christine Mondon précise que jamais Beethoven ne se plaindra de son père et qu’il lui sera toujours reconnaissant de l’avoir initié à la musique. :
«Un document manuscrit permet de constater sa reconnaissance : il s’agit d’une copie effectuée par son père d’une partition de C.P.E. Bach qu’il aimait chanter et où Ludwig inscrit : « Écrit par mon cher père. »»
Beethoven l’incomparable page 19
Comme œuvre aujourd’hui je propose d’aborder le cycle le plus remarquable de Beethoven, celui des quatuors à cordes. Il faut bien sur débuter par les premiers :
<Andante cantabile con variazioni> du quatuor à cordes opus 18 N°5 joué par le Quatuor Emerson.
Et pour écouter le quatuor dans son intégralité voici la version lumineuse du <Quatuor Alban Berg de Vienne>
<1508>
-
Lundi 14 décembre 2020
« La trahison du biographe de Beethoven. »La biographie d’Anton Schindler a fait longtemps autorité jusqu’à ce que l’on constate qu’il y avait des falsifications.Quand on lit plusieurs récits sur une personne et que ces différents récits sont identiques, il y a deux hypothèses : la première c’est que ce qui est relaté constitue la vérité, la seconde est que tous ces récits se fondent sur une source unique qui a initié le récit.
Beethoven a eu une enfance très malheureuse. Son père ayant cru percevoir en lui un nouveau petit Mozart a voulu faire de lui un singe savant. Pour ce faire, il l’astreignait avec beaucoup de violence à des leçons de piano qu’il lui prodiguait. Souvent, il était ivre et rentrait alors à la maison le soir, réveillait le petit Ludwig qui dormait et l’obligeait alors à jouer du piano en le frappant chaque fois qu’il commettait une erreur.
Quand j’étais étudiant en droit, au début des années 1980, la question de l’avortement, malgré la Loi Veil, était encore très présente.
Un professeur de droit nous a raconté une histoire : Un professeur de médecine faisait cours devant un amphithéâtre d’étudiants en médecine. Et il a proposé à ses élèves de donner leur opinion sur le cas d’une femme enceinte qui serait venu le voir en consultation. Le professeur énumère alors la liste des maladies de la mère et aussi du père, tout en décrivant la situation sociale du couple. Et il pose la question à ses élèves, si cette femme vous demande s’il était sage d’avorter que lui répondriez-vous ? La réponse de la salle fut très majoritairement pour le conseil d’avorter. Et… à ce moment-là le professeur triomphant annonce : « Vous venez de tuer Beethoven ! ».
J’ai entendu cette histoire à la même époque, à la radio.
Je ne sais pas si elle est exacte et si vraiment un professeur de médecine s’est livré à cette mise en scène.
De toute façon cette histoire ne dit rien de pertinent sur l’avortement, mais dit tout sur l’image véhiculée par des années de récit sur Beethoven et sa famille.
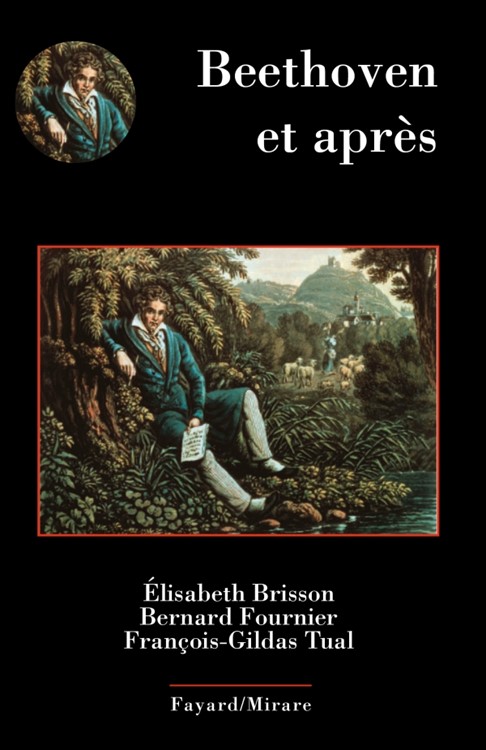 Récemment j’ai lu un livre écrit par plusieurs auteurs et notamment par l’historienne Elisabeth Brisson : « Beethoven et après ».
Récemment j’ai lu un livre écrit par plusieurs auteurs et notamment par l’historienne Elisabeth Brisson : « Beethoven et après ».
Une des parties écrites par Elisabeth Brisson : « Les enjeux d’une biographie » m’a appris comment un homme qui avait été, lors des derniers mois de la vie de Beethoven son secrétaire, a joué un rôle trouble dans l’élaboration du récit de la vie de Beethoven.
Très rapidement après la mort de Beethoven, le 26 mars 1827, il est apparu essentiel à l’entourage de Beethoven d’écrire une biographie du « grand homme ».
Au départ le projet est entre les mains de Stephan von Breuning qui est le tuteur de Karl, le neveu que Beethoven avait adopté à la suite de la mort de son frère, et qui est donc exécuteur testamentaire puisque Karl est l’héritier.
Mais un autre personnage est immédiatement intervenu, cet homme est Anton Schindler qui était le secrétaire de Beethoven, c’est en tout cas lui qui est resté le plus continuellement près de Beethoven lors des derniers mois de sa vie.
Anton Schindler, né en Moravie, était venu à Vienne faire des études de droit et il est devenu clerc de notaire. Mais parallèlement il se consacre à la musique et joue du violon. C’est en 1814, alors qu’il a 19 ans, qu’il rencontre Beethoven dont il devient le secrétaire bénévole dès 1822 (vivant même dans la maison du compositeur). Après une brouille de deux ans qui débute en mai 1824, Schindler réintègre le cercle des amis du compositeur jusqu’à la mort de ce dernier, donc de 1826 à 1827.
C’est donc Stephan von Breuning et Anton Schindler qui après concertation décidèrent de répartir la nombreuse documentation de Beethoven en vue d’écrire une biographie entre les trois personnes qui étaient, selon eux, les plus proches de Beethoven, c’est-à-dire eux deux et Franz Wegeler, l’ami de jeunesse à Bonn. C’est à ce dernier que revenait de rassembler et de trier les informations sur la période de Bonn. Anton Schindler ferait la même chose pour la dernière période de 1814 à 1827 et Stephan Breuning s’occuperait de la période médiane.
Et suite à ce travail, il était prévu de confier le travail d’écriture de la biographie à un écrivain spécialisé dans le monde musical.
Ce plan ordonné allait se heurter à une première difficulté Stephan Breuning meurt le 14 juin 1827, soit moins de 3 mois après la mort de Beethoven. l
Elisabeth Brisson précise que Schindler :
« n’a été proche de Beethoven qu’en 1823 et 1824, avant les quelques mois de fin 1826, début 1827 »
Schindler entend cependant bien tenir un rôle éminent dans l’élaboration de la biographie de Beethoven et en retirer gloire et quelques revenus substantiels.
Or, le nouveau tuteur de Karl qui prend la place de Stephan von Breuning est beaucoup moins bien disposé à son égard et par voie de presse appelle tous ceux qui ont connu Beethoven à envoyer leurs témoignages et à contribuer à une souscription destinée à une biographie.
Cette initiative n’est pas du goût de Schindler qui va désormais user de tous les moyens pour convaincre tous les éditeurs que c’est lui qui détient les clés de la biographie. Il va dérober des documents, utiliser les premiers travaux de Wegeler et se vanter que c’est lui qui possède les documents et objets de Beethoven les plus importants pour sa biographie. Il décide d’écrire lui-même la biographie, sans passer par un professionnel. Il ne dit rien de ses intentions à Wegeler ni qu’il utilise déjà les écrits que ce dernier lui a fait parvenir. Parallèlement il fait de nombreuses conférences pendant lesquelles il présente sa vision de Beethoven.
Finalement, Wegeler au bout de plusieurs années commence à se méfier puis à comprendre le rôle trouble de Schindler. Il va tenter alors d’écrire une biographie avec un élève et autre proche de Beethoven. Biographie qui sera publié en 1838, 11 ans après la mort de Beethoven.
En raison de ses manœuvres et de la réputation qu’il était arrivé à se faire sur la place de Vienne Schindler parvient à convaincre que cette biographie n’est pas sincère car elle contredit en plusieurs points ce qu’il affirmait dans ses conférences.
Finalement, Schindler va sortir une première biographie en 1840 puis de nouvelles versions en 1845 et 1860 qui vont s’imposer comme la biographie de Beethoven.
Et pendant plus de 100 ans des livres parlant de Beethoven vont reprendre telles quelles les affirmations et le récit de Schindler, jusqu’à ce que de vrais historiens revenant aux témoignages et aux documents primaires vont émettre de sérieux doutes.
Aujourd’hui, il apparait que Schindler a falsifié des documents de Beethoven, notamment les cahiers de conversation qui permettaient à Beethoven de communiquer avec ses interlocuteurs malgré sa surdité. Il a ainsi ajouté du texte à ces cahiers et il semble même qu’il ait détruit plusieurs de ces sources précieuses d’informations sur Beethoven.
C’est pourquoi beaucoup de propos de Beethoven qu’on a répétés à l’envi sont aujourd’hui remis en question.
Le fameux « pom pom pom » du début de la cinquième symphonie qui serait « le destin qui frappe à la porte » c’est du Schindler, est ce que c’est du Beethoven ? nul ne le sait.
Elisabeth Brisson conteste surtout la vision doloriste de l’enfance de Beethoven et le mythe du Beethoven républicain :
« Fausses anecdotes et vision doloriste de Beethoven côtoyant celle du Beethoven républicain se sont transformées en clichés qui ont la vie dure […] l’attribution à Beethoven d’une pensée politique républicaine alors qu’il n’a cessé de chercher l’appui de mécènes aristocrates et de souverains ou l’image d’un enfant battu, choyé par la haute société de Bonn, accablé par un terrible destin, abandonné de tous et offrant sa vie pour sauver l’humanité auquel il apporte la Joie…Les échos de cette vision héroïque, construite de toutes pièces, se retrouvent dans les monuments, érigés en l’honneur de Beethoven à Bonn en 1845, puis à Vienne en 1878, comme dans la « Vie de Beethoven » par Romain Rolland publiée en 1903 »
Page 100
Quand un biographe trahit comme l’a fait Schindler, le problème est que l’on ne sait plus si ce qui est dit est vrai ou faux. Tout ce que Schindler a écrit n’est pas faux, mais on ne sait pas le déterminer, en l’absence d’autres sources. Dés lors, tout ce qu’il écrit devient suspect, peu fiable, on ne peut pas se fonder sur ses écrits.
Mon père aimait répéter que Beethoven aurait dit : « Je préfère un arbre à un homme ». Je ne suis plus certain que cette phrase fût prononcée un jour.
Et même l’enfance de Beethoven et notamment sa relation avec son père devient sujet à polémique.
Ce n’est pas que le père de Beethoven ne fut pas très sévère et même violent.
Mais comme je l’ai écrit dans la série consacrée à Camus, la violence à l’égard des enfants fut longtemps la norme.
Pour autant des découvertes récentes notamment une lettre que Beethoven a écrit en 1795, à son ami de Bonn Heinrich von Struve qui l’informait de la mort de sa mère, lui révélait combien la mort de sa mère mais aussi de son père l’avait touchées et que
« La disparition d’un des membres de famille a rompu l’harmonie d’un tout »
Cité par Elisabeth Brisson dans « Beethoven et après » page 30
Il faut donc se méfier de ce que l’on raconte sur Beethoven, tout n’est pas vrai et le problème vient de loin… du début.
Et comme j’ai parlé du « Pom pom pom » de la 5 ème symphonie que tout le monde connait je vous propose le mouvement lent de cette symphonie :
<Andante moto de la 5ème symphonie> par l’Orchestre Philharmonique de Berlin et Karajan. Et si vous voulez la voir en entier, je vous propose toujours Karajan mais avec en plus un intérêt cinématographique, car c’est le cinéaste français Henri-Georges Clouzot qui a filmé et cela donne un résultat visuel très étonnant tout en n’enlevant rien à la qualité de l’interprétation : <La 5ème par Karajan filmé par Clouzot>
<1507>
-
Vendredi 11 décembre 2020
« Beethoven est le premier [musicien] à avoir mis l’homme au centre. »François-Frédéric GuyHier j’abordais le monument qui se dresse sur le monde de l’art et de la musique.
Aujourd’hui je voudrais parler de l’humanité de Beethoven.
Pour ce faire, je vais faire appel à un pianiste français qui a exprimé avec des mots simples l’expérience que je peux vivre avec Beethoven.
La Radio-Télévision Belge et notamment sa chaîne Musiq3 a consacré plusieurs émissions à Beethoven qu’elle a appelé le <feuilleton Beethoven> qui compte dix épisodes d’une heure chacun.
Le premier épisode donne la parole à François-Frédéric Guy qui présente Beethoven ainsi :
«Beethoven est le premier, j’en suis certain, à avoir mis l’homme au centre, l’idéal humain, c’est-à-dire l’homme au sens de la transcendance, l’homme au sens de l’humanité.
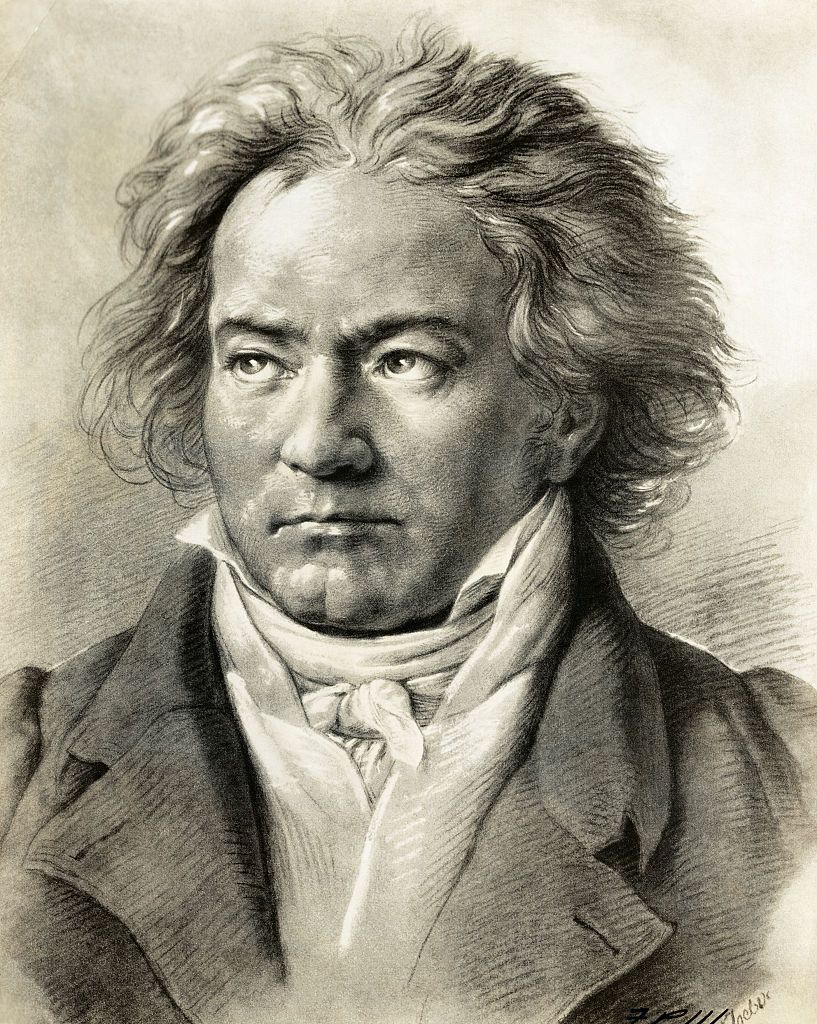 Transcender les différences, transcender les cultures, et puis faire que le genre humain cette fameuse « Brüderei » ; la fraternité qui caractérise l’œuvre de Beethoven [soit] mise au centre.
Transcender les différences, transcender les cultures, et puis faire que le genre humain cette fameuse « Brüderei » ; la fraternité qui caractérise l’œuvre de Beethoven [soit] mise au centre.
Il y a eu des génies avant Beethoven, évidemment ! Je parle uniquement musicalement : on peut citer Bach, Haendel, Mozart, Haydn, mais Beethoven est le premier à mettre l’homme au centre.
Et non pas à glorifier un Dieu qu’on espère immense, solaire à l’image de ce qu’a fait Bach ou Haendel et même Mozart dans un certain sens. Mozart avait ce lien divin, il existe des manuscrits de ses œuvres presque sans aucune rature, il avait ce côté et on disait mais ce n’est pas l’œuvre d’un homme, c’est l’œuvre d’un Dieu.
Alors que Beethoven c’est tout le contraire. […] C’est un travailleur laborieux. Il met beaucoup de temps à trouver son thème, à lui donner sa forme.
Il barbouille inlassablement ses carnets qu’il a toujours sur lui pendant ses nombreuses promenades pour arriver finalement à l’épreuve finale.
Donc c’est l’homme, c’est le labeur et en même temps la glorification de l’homme, de tous les sentiments humains qui sont exprimés.
Je tiens vraiment à le dire, c’est le premier qui ose. Avant on parle de la divinité, on parle de Dieu, on parle des grandes choses, mais Beethoven parle de l’homme. Il parle aussi de ses turpitudes, ses vicissitudes, ses désespoirs, ses petitesses, autant que de sa mystique, de sa grandeur, de ses aspirations au divin. A surpasser sa condition pour arriver à un idéal humain. Et cela c’est vraiment la définition de l’œuvre de Beethoven.
Et arriver à exprimer cela avec des symboles, des notes de musique sur un papier, moi je trouve cela exceptionnel, probablement unique.
François-Frédéric Guy de 6:38 à 8:45 de l’émission
Vous trouverez cet épisode derrière ce lien : <Episode 1>
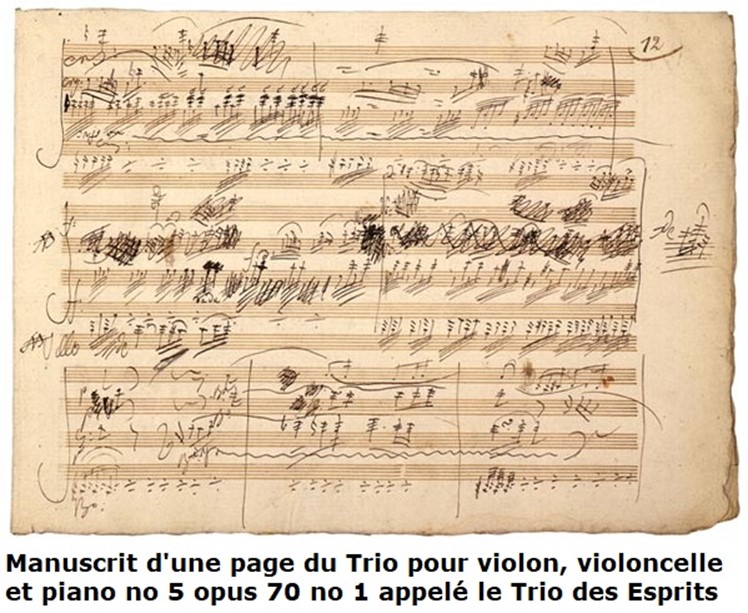 C’est peu dire que Beethoven écrivait sa musique avec des ratures et des corrections.
C’est peu dire que Beethoven écrivait sa musique avec des ratures et des corrections.
Mais ce qui me semble essentiel dans ce qu’exprime François-Frédéric Guy, c’est en effet, l’abandon de la divinité pour parler de l’essentiel, de la vie, des émotions.
Pour évoquer la profondeur de l’être Beethoven se tourne résolument vers l’homme et l’humanisme.
Dieu, il le cherchait dans la nature, c’était un panthéiste qui quelquefois faisait quelques concessions, de savoir vivre en société, à la religion dominante catholique. Il a ainsi écrit deux messes sur le texte canonique.
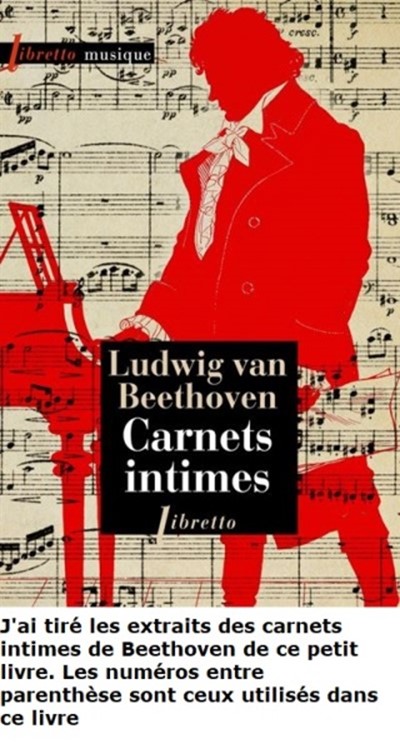 Mais dans ses carnets intimes, Beethoven écrivait en 1812 :
Mais dans ses carnets intimes, Beethoven écrivait en 1812 :
« Car le sort a donné à l’homme cette faculté : le courage de tout supporter jusqu’à la fin » (29)
Nulle question du Dieu des chrétiens dans cette affirmation.
En 1815, il écrivait :
« Dieu des forêts, Dieu tout-puissant ! Je suis béni, je suis heureux dans ces bois, où chaque arbre me fait entendre Ta voix. Quelle splendeur, oh Seigneur ! Ces forêts, ces vallons respirent le calme, la paix, la paix qu’il faut pour Te servir ! » (58)
Et en 1816 :
« Ne nous réfugions pas dans la pauvreté pour nous prémunir contre la perte de la fortune ; ne nous privons pas d’avoir des amis pour nous épargner la douleur de les perdre ; ne craignons pas, enfin, d’engendrer des enfants dans la crainte que la mort ne nous les ravisse. Trouvons un préservatif à ces maux dans notre seule raison. » (88)
Trouvons dans notre seule raison…
Il lui arrivait de faire appel à Dieu, mais ce n’était jamais le Dieu dont parlait l’Église catholique.
C’est donc bien l’humain ; l’humanité qui était son horizon, avec sa grandeur et ses faiblesses.
Et c’est de cela qu’il parle dans ses œuvres.
Il y a bien sûr des œuvres de circonstances et même de l’humour, nous y reviendrons certainement. Mais quand il nous touche au plus profond, ce sont les cordes humaines qui sont en nous qui vibrent, l’émotion du miracle de la vie.
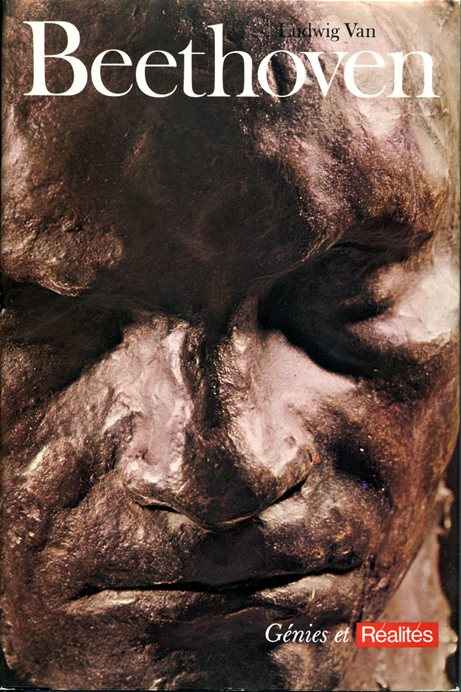 Dans l’ouvrage « Beethoven » paru dans la collection Génie et Réalités de Hachette, déjà cité hier, une des parties est rédigée par Jules Romain, l’écrivain inoubliable de « Knock ». Le chapitre qui lui ait réservé a pour titre « Beethoven tel qu’en lui-même »
Dans l’ouvrage « Beethoven » paru dans la collection Génie et Réalités de Hachette, déjà cité hier, une des parties est rédigée par Jules Romain, l’écrivain inoubliable de « Knock ». Le chapitre qui lui ait réservé a pour titre « Beethoven tel qu’en lui-même »
Il écrit :
« Beethoven est à l’origine d’une innovation beaucoup plus considérable, qui eut pour effet une élévation de la musique quant à sa fonction spirituelle et à sa dignité. […]. Mais l’on peut soutenir, en gros, qu’avec Beethoven la musique se met au niveau des témoignages les plus élevés que l’âme humaine peut donner d’elle-même. […] Avec Beethoven, c’est la première fois que la musique partage avec la grande poésie et la philosophie la tâche et l’honneur de prononcer librement sur le monde, sur la place et la destinée de l’homme. […] Tout se passe, dans des cas privilégiés, comme si le discours musical allait éveiller dans l’âme de l’auditeur, par résonance, des pensées de même espèce que celles qui ont été à l’origine de ce discours. Sans doute, faut-il que l’âme de l’auditeur soit capable de les accueillir ; ou mieux, de les découvrir au fond d’elle-même ; autrement dit, de traduire en pensées plus ou moins distinctes ou radicalement ineffables, mais pareillement issues de ces profondeurs, le rayonnement modulé qu’elle reçoit. »
Beethoven, Hachette, Collection « Génies et Réalités » Page 251-252
Les mots sont bien fragiles et imparfaits pour décrire cette expérience.
Il faut se tourner vers la musique pour comprendre, ressentir pour comprendre.
Aujourd’hui je ne peux que vous proposer une œuvre de Beethoven jouée par François Frédéric Guy qui en est un interprète remarquable.
Il joue, dans un bis, <L’Adagio Cantabile> de la 8ème Sonate de piano opus 13 appelée « Pathétique ». Il s’agit du deuxième mouvement.
Et si vous avez encore quelques minutes …
Ce bis concluait son interprétation du concerto de piano N°5 « L’empereur » avec l’orchestre Philharmonique de radio France dirigé par Philippe Jordan. Les 3 mouvements sont en ligne. Mais pour entendre le mieux l’humanisme s’exprimer par des notes, il faut toujours aller vers les mouvements lents. Nul artifice pour faire briller, il n’y a que l’émotion à faire partager. C’est dans ces moments qu’on entend ce que le compositeur est capable d’exprimer et ce que le musicien est en mesure de communiquer :
< Adagio Un Poco Mosso du concerto N° 5 opus 73>
<1506>
-
Jeudi 10 décembre 2020
« Beethoven : sans lequel la musique de notre temps ne saurait exister »Jean BarraquéLudwig van Beethoven a été baptisé le 17 décembre 1770 à Bonn. Il est né à cette date ou avant cette date. On ne connait pas la date exacte, parce qu’à cette époque les registres de naissance étaient tenus par l’Église. Et, ce qui intéressait l’église était l’accueil de l’enfant au sein de la communauté des croyants, donc le baptême et non la naissance du corps physique.
Ce que nous savons c’est qu’à cette époque, la croyance religieuse imposait de baptiser très rapidement l’enfant, car le pire était à craindre si l’enfant devait mourir avant d’avoir connu le sacrement de l’église. Or la mortalité infantile était très importante. C’est pourquoi les historiens sérieux écrivent que Beethoven est né le 15 ou le 16 décembre 1770. Il est même possible qu’il soit né le jour de son baptême.
Toujours est-il que c’était donc il y a un quart de millénaire. Et c’est pourquoi, je me lance dans une nouvelle série pour parler de Beethoven, essayer d’approcher ce monument pourtant si profondément humain.
Comment faire ? Comment débuter pour aborder ce géant de la musique et de l’Art ?
 Bonn a érigé une statue à son enfant le plus célèbre. Une photo montre cette statue en 1945 après que les alliés aient bombardé la ville et ont en fait un monceau de ruines. La statue de Beethoven était restée debout.
Bonn a érigé une statue à son enfant le plus célèbre. Une photo montre cette statue en 1945 après que les alliés aient bombardé la ville et ont en fait un monceau de ruines. La statue de Beethoven était restée debout.
Ce monument Beethoven est une grande statue en bronze qui se dresse sur la Münsterplatz à Bonn et a été inauguré le 12 août 1845, en l’honneur du 75e anniversaire de la naissance du compositeur.
Quand il y eut en 1972, l’attaque terroriste contre les athlètes israéliens lors des jeux olympiques de Munich, il fut décidé malgré le deuil de continuer. Le Président du CIO, Avery Brundage déclara : « The Games must go on » et on joua Beethoven pour essayer d’apaiser et donner la force de continuer. Je ne dis rien sur cette décision de continuer mais sur le fait qu’il est apparu naturel de jouer une œuvre de Beethoven, en l’occurrence je m’en souviens il s’agissait de l’Ouverture d’Egmont et non de la marche funèbre évoquée par l’article vers lequel je renvoie.
Et ce n’est pas qu’en Allemagne. Quand la France fut assaillie par les terribles attentats du 13 novembre 2015, que des fous de Dieu, des terroristes islamistes tirèrent avec des armes de guerre dans les rues de Paris et dans la salle du Bataclan, il fut décidé de se recueillir lors d’une cérémonie <aux Invalides> et … :
« La cérémonie d’hommage est ponctuée par la musique de l’orchestre de la Garde républicaine et du chœur de l’Armée française qui interprètent, pendant l’arrivée des familles et des personnalités, la « marche funèbre » (deuxième mouvement) de la 3e symphonie, puis le deuxième mouvement de la 7e symphonie de Ludwig van Beethoven »
Il y eut aussi d’autres œuvres, mais spontanément et pour commencer on pensa à Beethoven, debout, au milieu des ruines.
Beethoven est aussi associée à des moments plus euphoriques. Pour la chute du mur de Berlin on joua la 9ème symphonie et Bernstein remplaça le mot « Freude », « joie » par « Freiheit » « liberté » mais cela je l’ai déjà raconté lors du mot du jour sur la dernière symphonie de Beethoven.
Je suis né dans une famille de musiciens et dès mon enfance le nom de Beethoven était un nom familier, le nom du compositeur, du musicien par excellence. Que ce soit mon père dont c’est l’anniversaire de sa naissance aujourd’hui, mon oncle Louis ou mon frère Gérard, le mot de Beethoven était toujours prononcé avec déférence et l’évidence que c’était le plus grand.
Cette évidence a été un peu remise en question ces dernières décennies.
Ainsi, Nikolaus Harnoncourt, ce musicien disruptif qui a révolutionné l’interprétation des œuvres baroques puis classiques, répondait au questionnaire de Proust en décembre 2009. A l’interrogation : « Vos compositeurs préférés ? », il répondit :
« Bach et Mozart. »
Et devant l’étonnement du journaliste Gaétan Naulleau : « Pas Beethoven ? », il expliqua :
« C’est un des très très grands créateurs, soit. Mais si vous prenez tous les grands compositeurs, côte à côte, vous voyez deux têtes qui dépassent. Deux seulement. »
Rapportés dans le Magazine Diapason N° 645 d’avril 2016 page 27
Je me suis exprimé plusieurs fois sur la vacuité de vouloir établir, à l’égal d’une compétition sportive, un classement dans le monde de l’art et des créateurs.
Pourtant cette affirmation d’Harnoncourt m’a choqué.
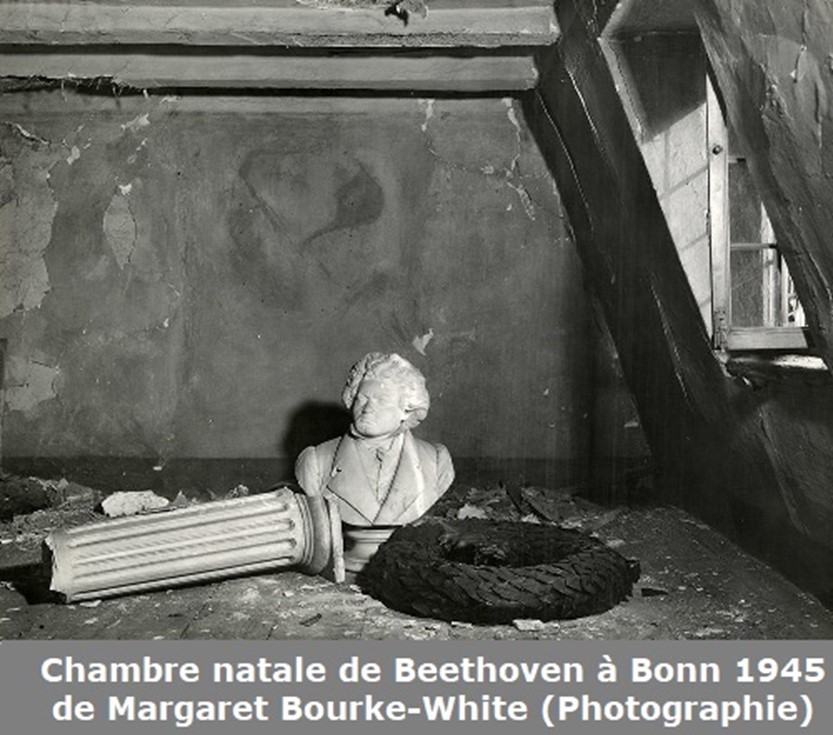 Que l’on associe Bach, Mozart et Beethoven dans un panthéon de la musique me parait assez sage. Mais qu’on en dissocie Beethoven pour dire qu’il ne fait pas partie des têtes qui dépassent me semblent une erreur de jugement assez étonnante.
Que l’on associe Bach, Mozart et Beethoven dans un panthéon de la musique me parait assez sage. Mais qu’on en dissocie Beethoven pour dire qu’il ne fait pas partie des têtes qui dépassent me semblent une erreur de jugement assez étonnante.
Jean-Sébastien Bach fut immense, il a poussé la musique à des sommets de beauté et d’équilibre qui semblaient inaccessibles mais en restant dans les codes de l’académisme musical.
Wolfgang Amadeus Mozart fut simplement divin, sa capacité d’inventer des phrases musicales inattendues, de créer une tension dramatique dans ses opéras, de faire jaillir, à partir de quelques notes, une beauté ineffable, étaient uniques. Mais lui aussi est resté dans les formes et normes qu’on lui avait apprises.
Bref, on composait de la musique de la même façon avant et après Bach, avant et après Mozart. Rien de tel pour celui dont nous fêtons les 250 ans, il y eut un avant et un après Beethoven.
Au cœur de l’œuvre de Beethoven il y a trois grands cycles qui ont révolutionné la musique et la manière de composer :
- Les 9 symphonies
- Les 32 Sonates pour piano
- Les 16 Quatuors à cordes
Il écrivit bien sûr d’autres œuvres sublimes des concertos de piano, le concerto de violon, les sonates pour violoncelle et violon, la Missa Solemnis et les étonnantes Variations Diabelli etc…
Mais pour les symphonies, les sonates de piano et les quatuors il y eut encore plus clairement que pour les autres, un Avant et un après.
Il est connu que Brahms n’osa pas composer de symphonie parce qu’il pensait qu’il n’arriverait pas à écrire de telles œuvres après lui. Il attendit l’âge de 40 ans pour oser la première.
Avant il disait :
« Je ne composerai jamais de symphonie ! Vous n’imaginez pas quel courage il faudrait quand on entend toujours derrière soi les pas d’un géant [Beethoven] ! »
Propos tenus par Brahms au chef d’orchestre Hermann Levi en 1872.
Franz Schubert, cet autre génie se sentait trop petit pour oser l’approcher.
Franz Liszt, immense virtuose du piano, fut un des premiers en capacité technique de jouer les pièces pour piano d’une incroyable difficulté. Dans un élan de passion dont il était capable, il déclara :
« Pour nous musiciens, l’œuvre de Beethoven est semblable à la colonne de nuée et de feu qui conduisit les Israélites à travers le désert – colonne de nuée pour nous conduire le jour – colonne de feu pour nous éclairer la nuit afin que nous marchions jour et nuit. »
Franz Liszt trouvé sur le site de France musique
Son gendre Richard Wagner avait aussi une relation très reconnaissante, je dirai de disciple, à l’égard de Beethoven. C’est tout naturellement qu’il décida que la première œuvre qui serait jouée pour inaugurer son temple théâtre de Bayreuth serait la 9ème symphonie de Beethoven. Il consacra, aussi, un livre au maître pour le centenaire de sa naissance, en 1870, et écrivit dans sa lettre sur la musique :
« La symphonie de Beethoven se dresse aujourd’hui devant nous comme une colonne qui indique à l’art une nouvelle période. »
Richard Wagner cité par Classica de Décembre 2019 – Janvier 2020 page 45
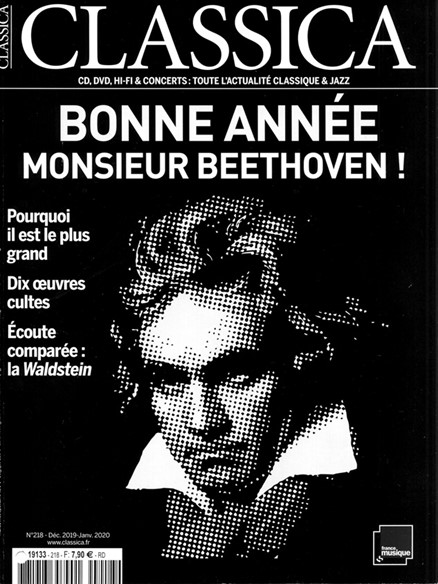 Et Berlioz entraîna les français dans un culte tout aussi lyrique :
Et Berlioz entraîna les français dans un culte tout aussi lyrique :
« Les Grecs avaient divinisé Homère, tant que Beethoven n’aura pas son temple, on méritera le nom de barbares qu’ils nous avaient donnés ».
cité par Classica de Décembre 2019 – Janvier 2020 page 44
La Société des concerts du conservatoire à Paris fut fondée en 1828. Cette institution avec son premier chef François-Antoine Habeneck se constitua en véritable temple dédié à l’œuvre du maître de Vienne né à Bonn. Il réunissait un public socialement bigarré mais uni par une même ferveur écrit ce même magazine.
Ce culte débuta du vivant du compositeur. Les contemporains de Beethoven avaient pleinement conscience qu’un génie musical vivaient au milieu d’eux. Et cela même si toutes ses œuvres, notamment les plus novatrices et que la postérité classe tout en haut des chefs d’œuvre de la musique, n’étaient pas comprises et appréciées à leur juste valeur.
« L’impact de la musique de Beethoven fut immédiat et durable. Aucun autre compositeur, ne connut de son vivant une telle gloire, à l’exception peut-être de Wagner. »
Bertrand Dernoncourt, Classica-Répertoire Novembre 2007, page 40
La vérité historique montre que Beethoven fut déjà un mythe de son vivant :
« De son vivant, Beethoven était déjà un mythe, ce que l’on appellerait aujourd’hui un compositeur « culte ». Si cela n’avait pas été le cas, cet homme que certaines légendes, nous ont montré pauvre et isolé, n’aurait pas été accompagné à sa dernière demeure par une foule immense – On parle de 20 000 personnes. »
Jacques Bonnaure – Classica octobre 2016 page 54
Finalement Nikolaus Harnoncourt a exprimé une autre perspective après avoir enregistré l’intégrale des symphonies, avec l’Orchestre de Chambre d’Europe. Interprétation qui a été encensée par l’ensemble des critiques, alors que je la trouve, parfois, un peu brutale . Le magazine Harmonie l’avait alors interrogé et il disait :
« Mon approche vient de Haydn et Mozart mais Beethoven est absolument personnel, et différent de l’un comme de l’autre. Il franchit un palier. J’ai longtemps fait la grande erreur de juger la qualité et l’intensité de Beethoven avec des critères issus de Mozart ou Haydn. Mais la mesure de Beethoven est autre, il ne suit pas les traces de Mozart et de Haydn : cette dimension qui représente une réelle coupure, fait toute la grandeur et la spécificité de sa musique »
Harmonie Propos recueillis par Remy Louis
Mais si Harnoncourt vient de la musique ancienne vers Beethoven, il faut plutôt lire les musiciens contemporains pour percevoir ce qu’ils doivent à Beethoven.
C’est le cas d’André Boucourechliev qui parla de :
« La puissance subversive d’un des artistes les plus inépuisablement actuels du monde »
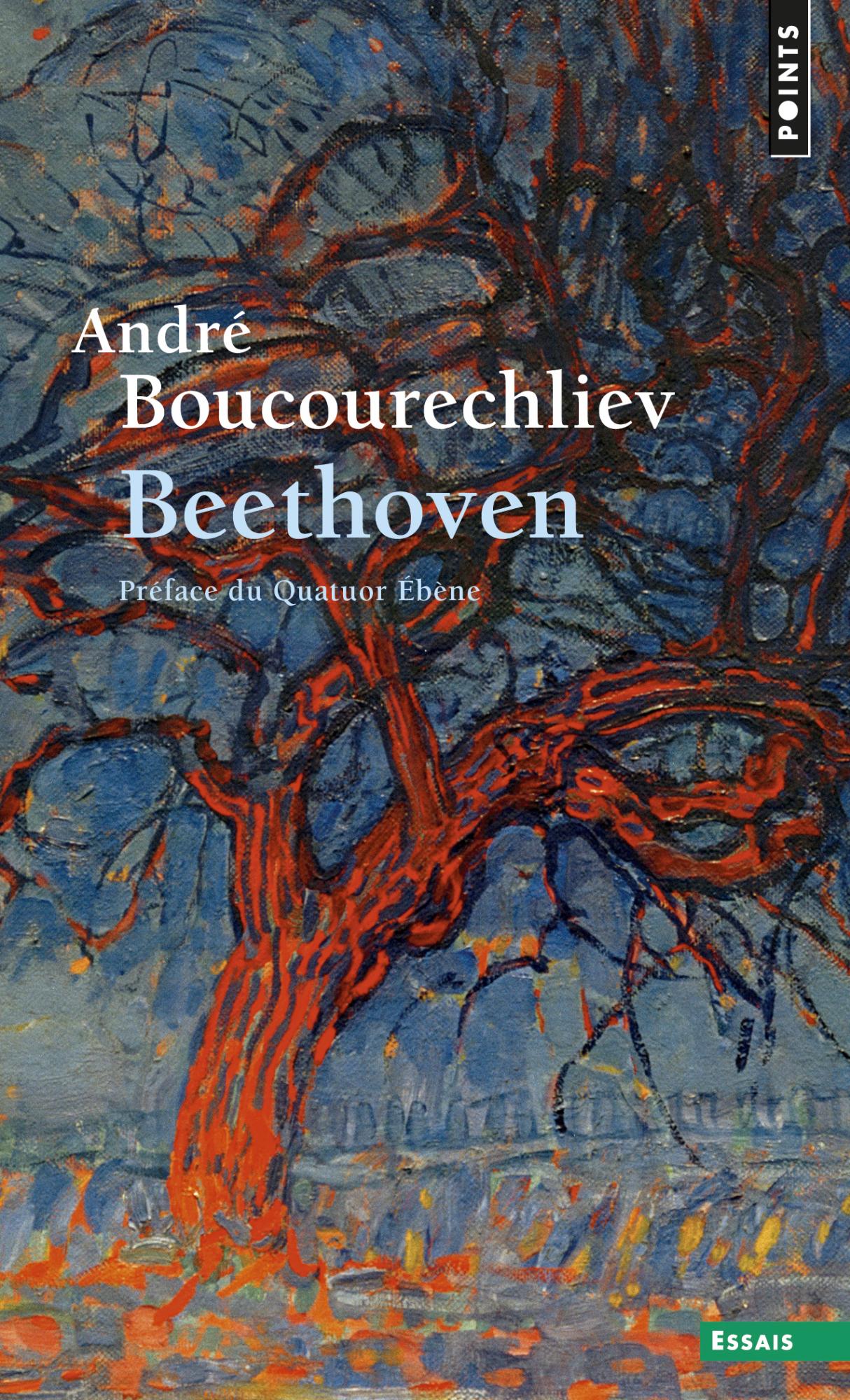 Ce compositeur qui décéda en 1997 avait consacré un livre célèbre à « Beethoven » paru, en 1963, dans la collection Solfège et republié. Ce livre commence ainsi
Ce compositeur qui décéda en 1997 avait consacré un livre célèbre à « Beethoven » paru, en 1963, dans la collection Solfège et republié. Ce livre commence ainsi
« De tous les créateurs dont les chefs-d’œuvre défient le temps et modèlent le visage de notre civilisation, Beethoven est sans doute celui que chacun de nous a recréé pour son propre compte avec le sentiment de la plus absolue certitude. Universellement reconnu dans l’évidence de son génie et de sa grandeur morale, il appartient à tous, et à chacun diversement. Son œuvre livre à chacun un message particulier, un secret propre, et l’homme lui-même exalte une idée, une mesure de l’homme exemplaires. Au-delà du musicien, Beethoven est devenu un symbole, ou mille symboles exaltants, exaltés, contradictoires. Tradition et révolution, justice et oppression, volonté et désespoir, solitude, fraternité, joie, renoncement ont élu comme signe ce même homme, cette musique. Toutes les idéologies, toutes les morales, toutes les esthétiques lui ont dressé leurs monuments, lui ont dédié leurs épigraphes, consacré leurs ouvrages savants. […] Plus que toute autre, l’œuvre de Beethoven possède le don de la migration perpétuelle, et rend un sens au mot galvaudé d’« immortelle ». Ce privilège est celui de l’esprit moderne. »
J’aurai pu choisir comme exergue de ce premier mot sur Beethoven : « […] Plus que toute autre, l’œuvre de Beethoven possède le don de la migration perpétuelle, et rend un sens au mot galvaudé d’« immortelle ».
J’aurais aussi pu puiser dans cette description d’André Jolivet (1905-1974)
« Alors que la musique se manifeste par un Lully, un Bach ou un Mozart, Beethoven, lui agit sur la musique. Sa mélodie devient un geste sonore, son œuvre un acte. La production de Beethoven marque une étape de la pensée humaine. Depuis la Renaissance, l’Art se dénaturait, il devenait « Beaux-Arts ».
Beethoven brise cette évolution et, magnifiant l’humain, retrouve le sens du sacré. Cet homme vit pleinement son époque, il s’intègre à l’histoire de son temps. Mais déjà il annonce ce que Berlioz et Wagner issus de lui, puis Debussy, prépareront pour leurs héritiers du XXème siècle : le retour au sacré.»
Beethoven, Hachette, Collection « Génies et Réalités » Page 199
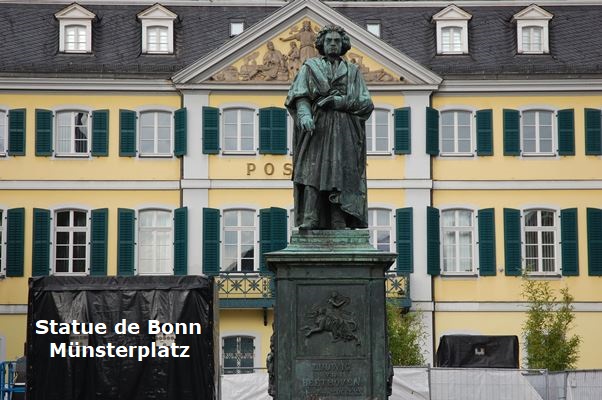 Mais je préfère finalement la formule simple et juste d’un autre compositeur, Jean Barraqué (1928-1973) :
Mais je préfère finalement la formule simple et juste d’un autre compositeur, Jean Barraqué (1928-1973) :
« Beethoven : sans lequel la musique de notre temps ne saurait exister »
cité par Classica de Décembre 2019 – Janvier 2020 page 45
C’est probablement par les ruptures qu’il a créées et les ouvertures des champs du possible que son monument artistique est le plus exceptionnel.
Pour finir ce premier mot de la série je propose une œuvre de piano : <3ème mouvement de la sonate « tempête » par Sviatoslav Richter>
Et pour replacer ce mouvement dans son contexte : <Daniel Barenboïm joue la sonate N°17 « la tempête » dans son intégralité>
<1505>
- Les 9 symphonies
-
Mercredi 9 décembre 2020
« Pause (Préparation pour une série sur Beethoven) »Un jour sans mot du jour nouveauA partir de demain, je vais tenter de commencer une série de mots du jour consacrés à Beethoven, né il y a un quart de millénaire.
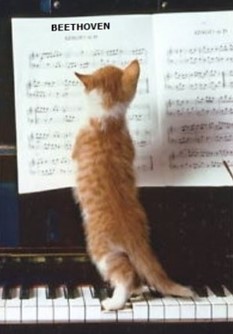 Le cap des 1500 mots du jour a été franchi, quasi sans le dire.
Le cap des 1500 mots du jour a été franchi, quasi sans le dire.
Tel ne fut pas le cas pour le 1000ème mot du jour pour lequel j’avais fait appel à Beethoven et à son exergue de la « Missa Solemnis »
«Venue du cœur puisse t’elle retrouver le chemin du cœur »
Et une autre fois aussi, il a été question d’une œuvre de Beethoven : La 9ème symphonie.
C’était le 14 septembre 2015 après une interprétation de L’orchestre National de Lyon sous la direction de Leonard Slatkin :
«Alle Menschen werden Brüder »
Il est tout à fait possible que cette série soit entrecoupée de « pause(s) » tant le sujet me semble difficile.
<Mot sans numéro>
-
Mardi 8 décembre 2020
« La fête des lumières à Lyon »Une fête qui se passe, chaque année, le 8 décembreVoilà un mot du jour qui au départ me paraissait simple :
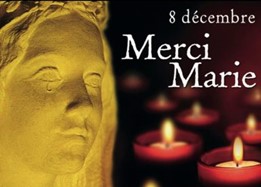 La ville de Lyon était menacée par la peste au XVIIème siècle. A cette époque, Il n’existait pas ces grands laboratoires comme Pfizer, Moderna, Sanofi ou Boiron vers qui se tourner pour trouver un médicament ou un vaccin. Alors les notables de Lyon appelés « les échevins » se sont adressés à une autorité à laquelle ils avaient accès : la Vierge Marie qui disposait d’une chapelle sur la colline de Fourvière. Ils ont donc prié la Vierge Marie pour qu’elle éloigne de Lyon cette terrible maladie. Et ils promettaient, en échange, de faire chaque année une fête en son honneur. C’est l’origine de la fête des lumières, parce que le récit raconte que Lyon a été préservée de la peste. Et chaque année, les lyonnais remercie Marie en faisant un pèlerinage vers Fourvière et tous les lyonnais mettent des petites bougies, le 8 décembre, appelées «lumignons » à leur fenêtre pour commémorer la promesse des échevins et le miracle de la vierge Marie.
La ville de Lyon était menacée par la peste au XVIIème siècle. A cette époque, Il n’existait pas ces grands laboratoires comme Pfizer, Moderna, Sanofi ou Boiron vers qui se tourner pour trouver un médicament ou un vaccin. Alors les notables de Lyon appelés « les échevins » se sont adressés à une autorité à laquelle ils avaient accès : la Vierge Marie qui disposait d’une chapelle sur la colline de Fourvière. Ils ont donc prié la Vierge Marie pour qu’elle éloigne de Lyon cette terrible maladie. Et ils promettaient, en échange, de faire chaque année une fête en son honneur. C’est l’origine de la fête des lumières, parce que le récit raconte que Lyon a été préservée de la peste. Et chaque année, les lyonnais remercie Marie en faisant un pèlerinage vers Fourvière et tous les lyonnais mettent des petites bougies, le 8 décembre, appelées «lumignons » à leur fenêtre pour commémorer la promesse des échevins et le miracle de la vierge Marie.
A ce stade, on peut émettre trois hypothèses :
- La première c’est de croire cette histoire au premier degré. Les échevins ont fait appel à une divinité de cette religion polythéiste qu’est le christianisme catholique… J’entends des protestations qui disent que je blasphème : le christianisme catholique est un monothéisme ! Moi je suis désolé, déjà quand on m’explique qu’il y a Dieu, le fils de Dieu et le Saint Esprit, il faut parler d’un monothéisme pluriel. Après, si l’on rajoute les saints et la vierge Marie que l’on peut prier pour obtenir des miracles, ce qui est l’apanage des dieux, il me semble évident que nous sommes en présence d’un polythéisme. Il y a certes une hiérarchie, mais la statue que l’on adore et qui réalise ce qu’on lui demande est un dieu ou une déesse. Donc les échevins ont invoqué la vierge Marie et ont eu gain de cause. Peut-être que Gérard Collomb, échevin moderne aurait dû tenter au début de l’année une démarche analogue pour la COVID 19 ? Qui sait, ça aurait pu marcher.
- La deuxième, pourrait s’appuyer sur les découvertes les plus récentes qui démontrent la force de l’esprit humain pour lutter contre les maladies. Ainsi le fait de croire sincèrement que la Vierge Marie soit en mesure d’écarter la maladie a permis aux lyonnais et à la force de leur esprit, habité par cette croyance, de lutter efficacement contre la maladie. Dans ce cas, il n’était pas pertinent pour Gérard Collomb de pratiquer cette démarche. La croyance n’est plus au niveau suffisant.
- La troisième est que par le hasard de l’évolution des épidémies, des routes de commerce et de voyage et par les effets d’un confinement sérieux la ville de Lyon a pu lutter efficacement contre le fléau.
Je n’imagine pas une quatrième hypothèse qui serait que le récit est faux sur les conséquences et que la peste a quand même continué à toucher sérieusement les lyonnais..
 J’en étais là, pour expliquer que le maire de Lyon, Michel Noir avait décidé, en 1989, d’accompagner la fête spontanée des habitants et des croyants par des mises en lumière de certains monuments. A partir de 1999, la municipalité a proposé des animations plus importantes réalisées par des professionnels du spectacle. Ces animations lumineuses qui rivalisent par leur créativité et par les moyens qu’elles mobilisent ont transformé cette fête locale en un rendez-vous touristique faisant venir à Lyon, chaque année, un plus grand nombre de visiteurs. En 2018, 1,8 millions de personnes auraient participé à cette fête. Et cette affluence était en recul par rapport aux précédentes années, en raison des mesures de sécurité mises en place en raison du terrorisme.
J’en étais là, pour expliquer que le maire de Lyon, Michel Noir avait décidé, en 1989, d’accompagner la fête spontanée des habitants et des croyants par des mises en lumière de certains monuments. A partir de 1999, la municipalité a proposé des animations plus importantes réalisées par des professionnels du spectacle. Ces animations lumineuses qui rivalisent par leur créativité et par les moyens qu’elles mobilisent ont transformé cette fête locale en un rendez-vous touristique faisant venir à Lyon, chaque année, un plus grand nombre de visiteurs. En 2018, 1,8 millions de personnes auraient participé à cette fête. Et cette affluence était en recul par rapport aux précédentes années, en raison des mesures de sécurité mises en place en raison du terrorisme.
Certains lyonnais expriment cependant leur désaccord car cette fête institutionnelle et organisée trahirait la tradition.
 Et je pouvais conclure triomphalement que cette année, grâce au COVID 19, la fête traditionnelle était enfin de retour et que chaque lyonnais pouvait se réjouir, en mettant des lumignons à ses fenêtres, de renouer avec une fête chaleureuse et se fondant dans la tradition lyonnaise tout en évitant les excès du tourisme échevelé.
Et je pouvais conclure triomphalement que cette année, grâce au COVID 19, la fête traditionnelle était enfin de retour et que chaque lyonnais pouvait se réjouir, en mettant des lumignons à ses fenêtres, de renouer avec une fête chaleureuse et se fondant dans la tradition lyonnaise tout en évitant les excès du tourisme échevelé.
En moins de 700 mots, l’article était achevé.
Mais dès que j’ai voulu voir d’un peu plus près je me suis rendu compte que si ma conclusion gardait sa pertinence, l’histoire de l’origine est plus compliquée.
Sur le site officiel de la fête des lumières on trouve le récit suivant :
« Une première église dédiée à la Vierge est construite à Fourvière en 1168. Elle est ravagée lors des guerres de religions qui opposent catholiques et protestants (1562). Restaurée, elle accueille les voeux successifs des habitants et des échevins face aux épidémies. Le 8 septembre 1643, les édiles et conseillers municipaux de l’époque (le prévôt des marchands et les échevins), montent à Fourvière pour demander à la Vierge Marie de protéger la ville de la peste qui arrive du sud de la France. Ils font le voeu de renouveler ce pèlerinage si Lyon est épargnée. Ce vœu est toujours honoré le 8 septembre.
En 1850, les autorités religieuses lancent un concours pour la réalisation d’une statue, envisagée comme un signal religieux au sommet de la colline de Fourvière. C’est le sculpteur Joseph-Hugues Fabisch qui réalise cette statue dans son atelier des quais de Saône.
L’inauguration initialement prévue le 8 septembre 1852 est repoussée au 8 décembre en raison d’une crue de la Saône. Le jour venu, le mauvais temps va de nouveau contrarier les réjouissances : les autorités religieuses sont sur le point d’annuler l’inauguration. Finalement le ciel se dégage… Spontanément, les Lyonnais disposent des bougies à leurs fenêtres, et à la nuit tombée, la ville entière est illuminée. Les autorités religieuses suivent le mouvement et la chapelle de Fourvière apparaît alors dans la nuit.
Ce soir-là, une véritable fête est née ! »
 Le 8 décembre dans le calendrier chrétien correspond à la fête de l’immaculée conception, donc à la fête de la vierge Marie. Le 8 décembre date donc non de la première démarche des échevins en 1643, mais d’une fête ultérieure pour inaugurer une statue de la Vierge qui cependant avait vocation à commémorer le « miracle » du XVIIème siècle.
Le 8 décembre dans le calendrier chrétien correspond à la fête de l’immaculée conception, donc à la fête de la vierge Marie. Le 8 décembre date donc non de la première démarche des échevins en 1643, mais d’une fête ultérieure pour inaugurer une statue de la Vierge qui cependant avait vocation à commémorer le « miracle » du XVIIème siècle.
<Lyon Capitale> conteste ce récit à la fois sur la date du premier pèlerinage des échevins et sur la maladie contre laquelle les lyonnais devaient lutter :
« Ainsi, le 12 mars 1643, [les] échevins demandent à la Vierge Marie de protéger la ville d’une épidémie de peste (il s’agissait en fait du scorbut). Ils promettent en échange de faire construire deux statues de la Vierge et de renouveler ces vœux chaque année, le 8 septembre, jour de la Nativité de la Vierge. Lyon est épargné, les échevins respectent leur promesse et renouvellent ce vœu par la suite chaque année. Durant certaines périodes la tradition disparaît, notamment sous la Révolution.
À la fin des années 1840, l’église de Notre-Dame-de-Fourvière, là où les Lyonnais se rendaient pour commémorer le vœu des échevins, a bien vieilli. Les différents bombardements qui ont touché la ville durant la Révolution puis lors des révoltes des canuts ont abîmé les bâtiments de la ville. Dès lors, sans que cela soit lié à la moindre demande ou promesse faite à Marie, les autorités religieuses décident qu’il faut faire reconstruire le clocher en plus grand. Elles décident également d’y installer une statue majestueuse de la Vierge, de cinq mètres de haut. Un concours est organisé pour trouver celui qui réalisera la Vierge et le sculpteur Fabisch est choisi.
 Vient alors une grande question pour les autorités ecclésiastiques : quel sera le jour de l’inauguration de la statue, sachant qu’une fête mariale doit être privilégiée. On pense au 15 août, mais ce n’est plus possible, puisqu’il est consacré à la Saint-Napoléon, mise en place par Napoléon III le 16 février 1852. La fête suivante est le 8 septembre, date qui va être choisie jusqu’à ce qu’un événement extérieur change tout. Durant l’été 1852, la ville est inondée, l’atelier du fondeur de la statue est touché. Les autorités décident de repousser les festivités à la fête mariale suivante : le 8 décembre, jour de la conception de la Vierge selon la Bible.
Vient alors une grande question pour les autorités ecclésiastiques : quel sera le jour de l’inauguration de la statue, sachant qu’une fête mariale doit être privilégiée. On pense au 15 août, mais ce n’est plus possible, puisqu’il est consacré à la Saint-Napoléon, mise en place par Napoléon III le 16 février 1852. La fête suivante est le 8 septembre, date qui va être choisie jusqu’à ce qu’un événement extérieur change tout. Durant l’été 1852, la ville est inondée, l’atelier du fondeur de la statue est touché. Les autorités décident de repousser les festivités à la fête mariale suivante : le 8 décembre, jour de la conception de la Vierge selon la Bible.
Fin 1852, la ville se prépare à fêter l’inauguration de la statue qui est alors cachée sous un drap, attendant d’être dévoilée. La fête est déjà commerciale puisque les journaux de l’époque vantent les mérites des vendeurs de lumignons et autres éclairages, et certaines publicités sont publiées dans la presse. Néanmoins, le 8 décembre, des orages violents éclatent, les autorités religieuses décident de repousser les festivités au dimanche 12 décembre. Les Lyonnais habitués aux illuminations, une tradition régulière depuis des siècles dans les grandes villes, décident de placer des bougies à leurs fenêtres. La foule envahit les rues, les boutiques qui vendent des éclairages sont prises d’assaut. Ce n’est plus l’Église qui impose le programme à la ville, mais bien l’inverse. Les autorités décident de suivre le mouvement, et illuminent Fourvière. Néanmoins, les festivités officielles pour célébrer cette nouvelle statue se dérouleront ensuite du 12 au 19 décembre. Au final, la tradition retiendra la date choisie par les Lyonnais, celle qui perdurera jusqu’à nous. »
Et puis sur le site officiel de notre Dame de Fourvière, l’auteur essaie de trouver un compromis entre le scorbut et la peste :
« 1638 : Vœu de l’aumône générale : Alors qu’une grave épidémie de scorbut atteint les enfants de la ville et que rien ne semble pouvoir enrayer cette maladie, les administrations de l’Hôpital décident de monter en procession à Fourvière. Progressivement, la maladie diminue et disparaît. Jamais elle ne revint à Lyon.
1643 : Vœu des Echevins : En 1643, alors que la peste fait rage en Europe, la ville de Lyon est menacée par ce fléau. Les notables décident alors de placer la ville sous la protection de la Vierge Marie. Ainsi, le 8 septembre 1643, fête de la Nativité de la Vierge, le prévôt des marchands (équivalent de notre maire) et ses quatre échevins (adjoints), accompagnés d’une foule de Lyonnais, montent en procession à la colline de Fourvière.
C’est dans la chapelle de la Vierge qu’ils font le vœu de monter chaque 8 septembre pour entendre la messe et offrir à l’archevêque sept livres de cire en cierges et flambeaux, et un écu d’or si leur souhait est exaucé.
La cité ayant été épargnée, la tradition se perpétue encore aujourd’hui, manifestant ainsi l’attachement de tous les Lyonnais à la Vierge qui protège leur ville. »
Donc selon ce site il y avait bien peste en 1643 et le scorbut aurait déferlé en 1638.
Bref, dès qu’on creuse un peu tout devient toujours compliqué.
Mais ce qui est certain c’est que les lyonnais fêtent chaque année la fête des lumières, le 8 décembre, que c’est une fête catholique.
Et que cette année, il n’y aura pas de fête organisée et touristique.
<1504>
- La première c’est de croire cette histoire au premier degré. Les échevins ont fait appel à une divinité de cette religion polythéiste qu’est le christianisme catholique… J’entends des protestations qui disent que je blasphème : le christianisme catholique est un monothéisme ! Moi je suis désolé, déjà quand on m’explique qu’il y a Dieu, le fils de Dieu et le Saint Esprit, il faut parler d’un monothéisme pluriel. Après, si l’on rajoute les saints et la vierge Marie que l’on peut prier pour obtenir des miracles, ce qui est l’apanage des dieux, il me semble évident que nous sommes en présence d’un polythéisme. Il y a certes une hiérarchie, mais la statue que l’on adore et qui réalise ce qu’on lui demande est un dieu ou une déesse. Donc les échevins ont invoqué la vierge Marie et ont eu gain de cause. Peut-être que Gérard Collomb, échevin moderne aurait dû tenter au début de l’année une démarche analogue pour la COVID 19 ? Qui sait, ça aurait pu marcher.
-
Lundi 7 décembre 2020
« Tous les mots du jour sur De Gaulle que je n’écrirai pas. »Un acte manqué mais écritL’année 2020 restera probablement dans l’Histoire comme celle où une grande partie de l’Humanité, pour lutter contre une pandémie, a fait appel à cette technique archaïque du confinement.
Ce confinement et la Covid19 auront beaucoup occupé notre temps de cerveau disponible et peut être même un peu plus…
Dans mon écriture du mot du jour, je n’ai pas échappé à cette pente qui a consisté à accorder une grande place à ces sujets.
Or, 2020 est proche de son terme et elle est aussi une année de trois grands anniversaires que je cite dans l’ordre chronologique inverse :
- Le 60ème anniversaire de la mort d’Albert Camus
- Le 130ème anniversaire de la naissance de Charles de Gaulle, mais aussi le 80ème anniversaire de l’appel du 18 juin et encore le 50ème anniversaire de sa mort.
- Le 250ème anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven
Je voulais consacrer une série de mots du jour à chacun de ces 3 grands hommes.
Régis Debray dit souvent :
« La culture, c’est le culte de nos grands morts »
La série sur Camus a été écrite. Mais je n’ai pas la possibilité et l’énergie d’écrire deux autres séries, d’ici la fin de l’année.
 Il faut donc faire un choix. Ce choix sera d’écarter celui qui occupe une place de centriste, dans l’énumération chronologique citée ci-dessus.
Il faut donc faire un choix. Ce choix sera d’écarter celui qui occupe une place de centriste, dans l’énumération chronologique citée ci-dessus.
Mais je vais quand même, sans développer, citer quelques questions que j’aurais aimé poser et certaines réflexions qui me viennent parfois, à l’écoute de certains propos d’hommes politiques ou de commentateurs.
Car en effet, quand on écoute aujourd’hui les représentants de tout l’échiquier politique, tous se réclament de l’héritage de De Gaulle et surtout on a l’impression que sous sa présidence nous vivions un âge d’or et dans un monde où tout n’était qu’ordre, luxe et volupté.
Il ne s’agit pas de contester la dimension historique de Charles De Gaulle et son rôle positif et éminent pour la France et encore ses qualités d’homme D’État.
Mais il s’agit de s’interroger si on n’en fait pas un peu trop ?
Et une autre question : Est-ce que vraiment vous auriez envie, si la possibilité technique était à votre portée, de revenir vivre dans la France de De Gaulle ?
J’aurais fait appel à Jacques Julliard pour reconnaître que «De Gaulle était un génie de l’incarnation», incarnation de l’État et de la France.
J’aurais beaucoup utilisé des chroniques de Thomas Legrand sur France Inter et La Croix, pour approfondir certains sujets :
Et soit j’aurais nuancé le propos de Julliard ou j’aurais écrit un autre mot du jour sur cette autre réalité : « De Gaulle et l’incarnation… le drame de ses successeurs… »
Il aurait alors fallu, entre autres questions, reparler de ces institutions de la Vème république qui avait été faites pour De Gaulle. Le pouvoir disproportionné d’un seul homme en est le fruit. Encore faut-il se rappeler que De Gaulle avait institué, en quelque sorte, le référendum révocatoire. Il considérait que le Président de la République avait un lien fort et particulier avec le peuple qui pouvait justifier ce pouvoir. C’est pour cela qu’il a imposé la réforme de l’élection au suffrage universel du président. Mais dans l’esprit et dans la pratique de De Gaulle, il était nécessaire de retourner régulièrement devant le peuple, entre les élections, par la voie du référendum pour s’assurer que ce lien particulier existait toujours et en cas de désaveu, il fallait partir. C’est qu’il a fait.
Aucun de ses successeurs n’a eu ce cran.
 Certains diront que cette manière de pratiquer le référendum n’est pas sain parce qu’il le pousse vers le plébiscite. C’est vrai, mais le pouvoir excessif du président de la république n’est pas sain non plus et le référendum révocatoire donnait au moins la possibilité de mettre fin au mandat quand le peuple n’avait plus confiance en son monarque républicain.
Certains diront que cette manière de pratiquer le référendum n’est pas sain parce qu’il le pousse vers le plébiscite. C’est vrai, mais le pouvoir excessif du président de la république n’est pas sain non plus et le référendum révocatoire donnait au moins la possibilité de mettre fin au mandat quand le peuple n’avait plus confiance en son monarque républicain.
Un autre sujet qui me tient à cœur c’est que De Gaulle fut un des premiers adepte des fake news, ou pour parler français des infox.
Thomas Legrand parle de « Mythes et de mensonges de De Gaulle »
Parce que quand même il a prétendu que :
- La France n’avait pas perdu la guerre en 1940
- Qu’elle l’avait gagnée en 1945
- Que la France était uniformément résistante sauf quelques cas très marginaux
- Que le Régime de Vichy n’a jamais représenté la France
- Que la France est restée une des grandes Nations qui influence les affaires du monde
C’est ce qui s’appelle un récit, en l’occurrence le récit gaulliste. Le récit comme pour les religions, n’a qu’un rapport ténu avec la réalité et la vérité mais constitue le fondement de la croyance. Or la croyance est essentielle pour que la société tienne ensemble. Le récit permet de croire à quelque chose qui nous dépasse et nous survit.
La revue « L’Histoire » avait aussi écrit sur ce sujet : « Le mensonge patriotique » qui permettra par ce fameux récit à ce que la France ne tombe pas dans la guerre civile à la sortie de la guerre.
A côté de ces mythes, il y a les mensonges comme celle de ‘Algérie Française et le fameux : « Je vous ai compris ».
J’aurais aussi souhaité m’interroger sur les sujets :
- « De Gaulle et la liberté de l’information »
La presse écrite était à peu près libre, en revanche les sources principales d’information du plus grand nombre de français : la télévision et la radio étaient sévèrement encadrés. Il existait un ministre de l’Information. Les titres du journal de 20 heures étaient envoyés à ce ministre avant diffusion. Les membres de l’opposition n’étaient jamais invité à la télévision sauf pendant les campagnes électorales. Il faut se rappeler que la radio faisait partie de l’ORTF, c’est-à-dire de la même maison que la télévision et ne jouissait également que d’une liberté surveillée. Aucune radio privée ne pouvait émettre sur le sol français. D’où la notion de radio périphérique qui est une station de radio que l’on pouvait écouter en France jusqu’en 1981, mais dont l’émetteur ne se trouvait pas sur le sol français. On peut citer, parmi les plus connues, Europe 1, RTL et RMC, respectivement basées en Allemagne de l’Ouest, au Luxembourg et à Monaco.
- « De Gaulle et la société française : le culte du chef, de la hiérarchie et du paternalisme »
C’était aussi une société bien plus machiste qu’aujourd’hui et en tout cas très corsetée. Mai 68 n’est pas sorti de nulle part, mais d’une société qui était devenu assez invivable pour de jeunes énergies et épris de liberté de mœurs, d’information.
Il y aurait aussi eu des réflexions sur « la corruption » à cette époque. On vante toujours l’honnêteté de Gaulle et très probablement à juste titre. Mais ce n’était pas le cas de plusieurs personnes de son entourage.
Et dans ce cadre il aurait fallu parler du « Service d’action civique » connu sous l’acronyme « SAC »
- « De Gaulle et l’économie »
Dans ce domaine il eut fallu parler du PLAN, de la politique industrielle, de l’idée de la participation et aussi « que la politique de la France ne se faisait pas à la corbeille »
 Et tant d’autres sujets qui serait venu au cours de l’écriture, le rapport compliqué avec les États-Unis et la Grande Bretagne, la réconciliation avec l’Allemagne, la décolonisation….
Et tant d’autres sujets qui serait venu au cours de l’écriture, le rapport compliqué avec les États-Unis et la Grande Bretagne, la réconciliation avec l’Allemagne, la décolonisation….
Voici la liste des articles de « La Croix » dans lesquels j’aurais puisés :
De Gaulle, un récit hors du commun – Aujourd’hui, la construction du mythe. De Gaulle, le mythe français (1/8)
De Gaulle : la participation, une timide troisième voie – Aujourd’hui, « la question sociale ». De Gaulle, le mythe français (2/8)
De Gaulle, le catholique – Aujourd’hui, sa foi, entretenue comme un jardin secret. De Gaulle, le mythe français (3/8)
De Gaulle et le Volatile – Aujourd’hui, ses prises de bec avec « Le Canard enchaîné ». De Gaulle, le mythe français (4/8)
De Gaulle… même Le Pen ! – Aujourd’hui, l’hommage opportuniste rendu par Marine Le Pen. De Gaulle, le mythe français (5/8)
De Gaulle et l’incarnation… le drame de ses successeurs…- Aujourd’hui, l’incarnation de la France. De Gaulle, le mythe français (6/8)
Les mythes (et mensonges) du général – Aujourd’hui, des coups de bluff magistraux. De Gaulle, le mythe français (7/8)
De Gaulle, l’homme qui pouvait – Aujourd’hui, la nostalgie d’un président en pleine puissance. De Gaulle, le mythe français (8/8)
Et puis les émissions de Thomas Legrand sur France Inter :
https://www.franceinter.fr/emissions/de-gaulle-2020/archives-27-06-2020-24-08-2020
La liste des émissions
- Vers un écolo-gaullisme ? Entretien avec David Djaïz et Yannick Jadot 23 août 2020 Par Thomas Legrand
- De Gaulle, le gaullisme et la France : de l’énigme à l’héritage politique 16 août 2020 Par Thomas Legrand
- De Gaulle et Le Canard enchaîné avec le journaliste Claude Angeli 09 août 2020 Par Thomas Legrand
- La Ve République de De Gaulle est-elle toujours pertinente ? Avec la juriste Anne Levade 02 août 2020 Par Thomas Legrand
- De Gaulle, décolonisateur par défaut ? Avec Benjamin Stora 26 juil. 2020 Par Thomas Legrand
- « Le mirage de la participation » avec Bruno Le Maire et Gérald Darmanin 19 juil. 2020 Par Thomas Legrand
- De Gaulle et les gauchistes, avec Serge July 12 juil. 2020 Par Thomas Legrand
- De Gaulle vu d’Angleterre et ses relations avec Churchill 05 juil. 2020 Par Thomas Legrand
- Le mythe de Gaulle 28 juin 2020
 En tout cas, pour moi la réponse à la question posée au début est claire : je ne souhaiterais pas revenir à l’époque de De Gaulle, et je trouve assez vain de vouloir aujourd’hui se réclamer du Gaullisme dans un monde qui a si profondément changé.
En tout cas, pour moi la réponse à la question posée au début est claire : je ne souhaiterais pas revenir à l’époque de De Gaulle, et je trouve assez vain de vouloir aujourd’hui se réclamer du Gaullisme dans un monde qui a si profondément changé.
Le personnage et le rôle de De Gaulle reste dans l’Histoire absolument considérable et je reviendrai vers le livre de Daniel Cordier « Alias Caracalla » qui montre un homme exceptionnel face à des défis qui semblaient hors de portée et qu’il a surmonté grâce à sa force intérieure et son amour pour la France.
<1503>
- Le 60ème anniversaire de la mort d’Albert Camus
-
Vendredi 4 décembre 2020
« J’ai parfois, l’impression que lorsqu’on parle de soi, on fait une sorte de cadeau aux autres en leur disant : vous voyez vous n’êtes pas seul »Anne SylvestreIl n’était pas dans mes projets d’écrire tout de suite un nouveau mot du jour consacré à cette enchanteresse des mots et des chansons.
Mais voilà, un vieil homme est mort, il avait été élu président de la république il y a 46 ans, je n’avais pas encore le droit de vote. C’était il y a donc très longtemps.
Et puis hop, toute l’espace médiatique ne parle plus que de lui, il n’y a plus de place pour la chanteuse de « J’aime les gens qui doutent »
J’aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer
J’aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer
J’aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger
Marc m’a écrit pour me dire qu’il aimait aussi la version de Vincent Delerm : <Ici il la chante avec Jeanne Cherhal, et Albin de la Simone>
Ce n’est pas que celui qui jouait de l’accordéon à l’Elysée fut un homme sans qualité.
Je lui consacrerai peut-être des mots du jour, mais pas aujourd’hui.
Aujourd’hui je veux continuer d’évoquer celle qui a écrit la chanson que ma belle-maman adorait comme me l’a révélée Annie : <Clémence en vacances>
Clémence, Clémence
A pris des vacances
Clémence ne fait plus rien
Clémence, Clémence
Est comme en enfance
Clémence va bien
Elle n’avait jamais fait la Une des magazines
Parce que vous comprenez, ce n’est pas juste !
Cette fois, l’hommage était unanime, tout le monde avait enfin reconnu son talent, tout le monde l’aimait.
Alors Paris-Match, l’Express et tous les autres prévoyaient de mettre l’auteure d’une « sorcière comme une autre » en couverture. Christiane nous a envoyé un lien vers une interprétation de <Pauline Julien>
Mais pour les couvertures, c’est raté !
Nous verrons sur les couvertures le crâne dégarni du châtelain de Chanonat qui s’est retiré dans l’Aveyron.
Alors moi j’ai continué à chercher des vidéos sur internet
Et j’ai trouvé, Patrick Simonin qui l’avait interviewé <Sur TV 5 Monde>; Elle avait 63 ans et fêtait les 40 ans de scène.
 Lors de l’émission elle a dit :
Lors de l’émission elle a dit :
« [Mes chansons] c’est la vie, c’est les gens qui m’intéressent.
Ce qui leur arrive. Ce qu’ils disent, qu’ils vivent.
Quand on parle de soi, on parle des autres.
J’ai parfois, l’impression que lorsqu’on parle de soi, on fait une sorte de cadeau aux autres en leur disant : vous voyez vous n’êtes pas seul.
Je me considère un peu comme une sorte d’écrivain public.
Parce qu’il se trouve que j’ai un don de dire les choses.
Alors je dis peut-être les choses à la place d’autres qui ne trouvent pas les mots. »
Et puis j’ai trouvé une trace encore plus ancienne : <Radioscopie de Chancel en 1978>
Et puis ce duo avec Pauline Julien cité ci-avant : < <Rien qu’une fois>
Dans une interview que j’ai regardé, elle reprochait au journaliste de ne parler que de ces chansons sérieuses, alors qu’elle a écrit beaucoup de chansons pleines d’humour.
Et j’ai trouvé son jubilé des 50 ans de scène <Concert au Trianon – 2007> et c’est vrai qu’elle est très drôle
Dans ce spectacle elle chante notamment : <Ça ne se voit pas du tout>
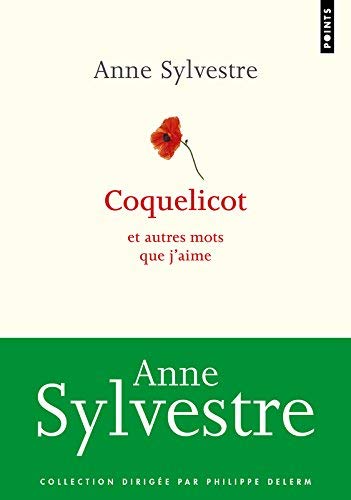 François Busnel l’avait reçu à la Grande librairie parce qu’elle venait d’écrire <Coquelicot> un livre sur ses mots préférés. Ce même soir Daniel Pennac était invité aussi. Vous apprendrez le sens du verbe : « débarouler »
François Busnel l’avait reçu à la Grande librairie parce qu’elle venait d’écrire <Coquelicot> un livre sur ses mots préférés. Ce même soir Daniel Pennac était invité aussi. Vous apprendrez le sens du verbe : « débarouler »
Et puis il y a les cinq émissions de Hélène Hazéra « A voix nue » qui datent de 2002.
Et pour finir un autre moment d’humour : < Petit bonhomme >
<1502>
-
Jeudi 03 décembre 2020
« Juste une femme ».Anne Sylvestre, titre d’une chanson et d’un albumAujourd’hui, je ne saurais parler que d’Anne Sylvestre.
J’aurais pu connaître ses fabulettes, alors que j’étais enfant puisque le premier album est paru en 1962, j’avais quatre ans.
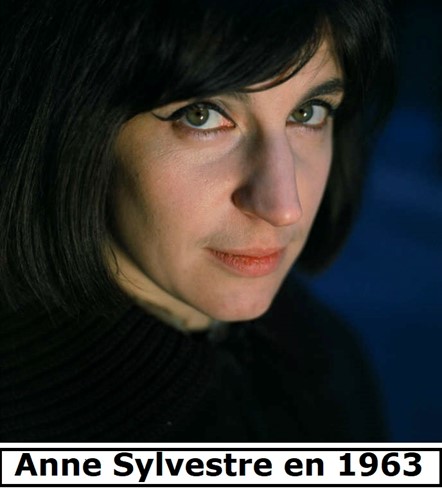 Mais il n’en fut pas ainsi, je l’ai connue alors que j’étais devenu père et que j’écoutais ces merveilles avec mes enfants.
Mais il n’en fut pas ainsi, je l’ai connue alors que j’étais devenu père et que j’écoutais ces merveilles avec mes enfants.
Ces chansons sont toujours des histoires qu’elle raconte avec malice « Le Toboggan », avec du vécu « Les Sandouiches Au Jambon », pédagogie familiale « Cécile et Céline », naturaliste « Tant De Choses », poésie « Balan Balançoire », lumineuse « La Petite Rivière ».
Les paroles sont simples, compréhensibles par des enfants mais les phrases ont du sens et expliquent les choses de la vie.
Je prends l’exemple de cette chanson « Je t’aime » :
Ce sont les mots les plus doux
Comme deux bras autour du cou
Comme un grand rayon de soleil
Ce sont des mots Merveille
Ce sont des mots légers, légers
Un papillon qui vient voler
Pour faire plaisir à une fleur
Ce sont des mots Douceur
Ce sont des mots tout ronronnants
Comme le chat quand il est content
Comme le duvet d’un poussin
Ce sont des mots Câlin
Ce sont des mots qui tiennent chaud
Comme la laine sur le dos
Comme une lampe dans le noir
Ce sont des mots Espoir
Ce sont des mots qu’on peut garder
Dans son cœur toute la journée
On peut les dire et les redire
Ce sont des mots Sourire
Ce sont les mots les plus précieux
C’est la prunelle de tes yeux
Tu n’entendras jamais les mêmes
Ecoute bien: je t’aime
Mais c’est encore plus tard que j’ai appris qu’Anne Sylvestre n’était pas qu’une chanteuse pour enfants bien qu’elle fut « fabuleuse » dans cette quête de distraire, d’enchanter et d’enseigner les enfants.
Elle était chanteuse tout simplement, chanteuse avec des textes d’une poésie, d’une profondeur et d’une force extraordinaire.
Le spécialiste de musique, Bertrand Dicale, donne un avis avec lequel je suis pleinement d’accord : « Anne Sylvestre était une des plus grandes plumes de l’histoire de la chanson »
Je lis aussi :
« On doit à cette femme des morceaux gigantesques d’intelligence et de subtilité »
Valérie Lehoux, Télérama, 17 septembre 2007.
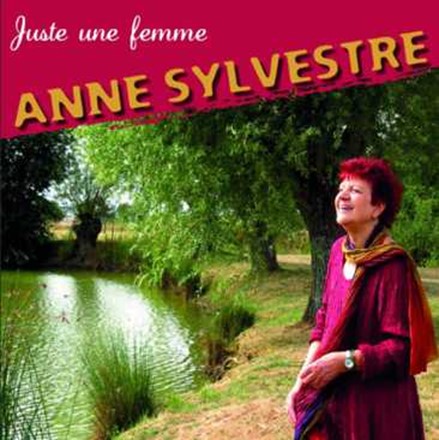 Elle savait parler aux enfants comme aux adultes, de sujets légers et de sujets beaucoup plus durs.
Elle savait parler aux enfants comme aux adultes, de sujets légers et de sujets beaucoup plus durs.
Elle a toujours défendu la cause des femmes et dénoncé la violence et l’injustice dont elles étaient victimes.
Et j’ai choisi comme exergue de ce 1501ème mot du jour, le titre d’une de ses chansons « féministes » qui était aussi un titre d’album : « Juste une femme ». Et j’ai trouvé pertinent de citer des extraits de cette chanson tout au long de cet article.
« Petite bedaine
Petite sal’té dans le regard
Petite fredaine
Petite poussée dans les coins »
Cette chanson a été créée en 2013, Anne Sylvestre a presque 80 ans puisqu’elle née le 20 juin 1934 à Lyon. Elle écrit cette chanson dans la suite de « l’affaire DSK », et ne le cache pas aux journalistes qui l’interviewent alors. Elle exprime sa colère face à tous ceux qui relativisent la gravité des agressions sexuelles. Le texte d’Anne Sylvestre jette au monde l’indignation et l’exaspération qui explosera quatre ans plus tard des dizaines de milliers de femmes, lors de la déferlante #Metoo.
Mais ce n’était pas sa première chanson qu’on peut déclarer féministe : « La Faute à Eve », « La vaisselle », « Une sorcière comme les autres », et « Rose » peuvent être classés ainsi.
« C’est juste une femme
C’est juste une femme à saloper
Juste une femme à dévaluer »
Un seul mot du jour lui a été dédié jusqu’à présent. C’était lors de la série sur mai 68 et le mot du jour à la lutte pour la dépénalisation de l’avortement. Elle avait écrit en 1973 la chanson : « Non, Non tu n’as pas de nom »
J’avais pris pour exergue un extrait de cette chanson : « Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle ça se souffre, c’est la mort et c’est le gouffre »
Cette chanson avait été écrite, deux ans après le manifeste publié en 1971 par Le Nouvel Observateur dans lequel 343 Françaises célèbres reconnaissant avoir avorté. L’année suivante, le « procès de Bobigny », celui d’une jeune fille ayant avorté avec l’aide de sa mère et défendue par Gisèle Halimi, fait grand bruit puis en 1973, 331 médecins déclarent publiquement avoir pratiqué des avortements, crime que la loi punit sévèrement.
Anne Sylvestre écrit l’hymne de cette lutte. Mais elle précisait que ce n’était pas une chanson sur l’avortement, mais une chanson sur l’enfant ou le non-enfant.
« Petit pouvoir, p’tit chefaillon
Petite ordure
Petit voisin, p’tit professeur
Mains baladeuses »
 Elle portait une blessure intérieure.
Elle portait une blessure intérieure.
Daniel Cordier était du côté de la France Libre et De Gaulle, le père d’Anne Sylvestre était de l’autre côté, celui de Pétain et du Régime de Vichy.
Car elle est née Anne-Marie Beugras. Son père, Albert Beugras, fut l’un des bras droits du collaborateur Jacques Doriot pendant la seconde guerre mondiale. Sauvé de justesse de la condamnation à mort à la Libération, il purgea dix ans de prison à Fresnes. Elle ne s’est libérée de ce secret que dans les années 1990. Elle le partageait avec sa sœur Marie Chaix, écrivaine et secrétaire de Barbara.
<Le Monde> dans l’hommage qu’il lui a consacré, en dit davantage :
« Marie Chaix, […] raconte, dans Les Lauriers du lac de Constance (Seuil, 1974), la fuite, lors de la débâcle allemande – « Anne, assise près de toi, muette, serrant sa poupée » –, l’arrivée semi-clandestine chez un oncle, à Suresnes (Hauts-de-Seine), la disparition de leur frère, Jean, sous un bombardement, les hommes armés qui viennent quelques jours plus tard, cherchant Albert Beugras. « Et la famille du traître. » Marie a 3 ans, Anne 10.
Longtemps Anne Sylvestre a caché son secret, refusant de dire que Marie Chaix était sa sœur : « J’avais 10 ans, la photo d’Albert Beugras était partout, des pages entières dans les journaux. C’était mon père, un père aimant. Je suis allée à son procès, maman y tenait, elle a eu raison. On m’avait mise à l’école chez les dominicaines. Mes camarades chapitrées par leurs parents, m’ont placée en quarantaine. La directrice, qui était la sœur du colonel Rémy, résistant notoire, elle-même déportée, m’a défendue et sauvée. »
[…] Elle aime les marges et déteste la droite radicale. En 1997, elle publie un album succulent, Chante… au bord de La Fontaine, douze chansons inventées à partir du fabuliste, dénonciation des loups patrons de bistrots glauques, qui font la peau du petit mouton noir et frisé qui a taggé leurs murs. « Le racisme, la banalisation de la discrimination me font froid dans le dos, et cette façon de dire : « On n’y peut rien » ! », dit-elle alors. Le spectacle est créé à La Comedia de Toulon, « en solidarité pour ce théâtre qui avait en face de lui une mairie Front national ».
Anne Sylvestre écrira une chansons paru dans l’album « D’amour et de mots », sorti en 1994. Cette chanson a pour titre «Roméo et Judith». Elle y chante ces vers
«J’ai souffert du mauvais côté
Dans mon enfance dévastée
Mais dois-je me sentir coupable»
On ne choisit pas ses parents
« Mais c’est pas grave
C’est juste une femme
C’est juste une femme à humilier
Juste une femme à dilapider »
<Libération a republié un portrait de 2019> la qualifie justement d’artiste féministe et libre. Dans cet article, le journaliste pose la question : « Mais ces chansons, elles ne sont jamais vraiment passées à la radio. Pourquoi ? ».
La réponse d’Anne Sylvestre est dubitative :
«Il ne faut pas trop faire réfléchir les gens, j’imagine.»
Les médias sont, en effet, passés grandement à côté de son immense talent. Pour ma part, je ne l’ai compris que récemment il y a environ 5 ans, après avoir entendu une émission de radio.
Alors Pourquoi ?
« Le Monde » suggère :
« Anne Sylvestre n’a pas toujours eu la place qu’elle méritait dans la chanson française. Il est vrai qu’elle n’a pas tout fait pour. Elle n’était pas tous les jours de bonne humeur. « »
Une autre explication se trouve peut-être dans les sujets abordés par la chanteuse.
Parmi ses premières remarquables chansons, en 1959 avec « Mon mari est parti» qui est une chanson sur la guerre à l’heure où la France est aux prises avec ce qu’on appelle les «événements» en Algérie.
Et Pendant toute sa carrière, elle s’intéresse aux faits de société, et notamment à la condition des femmes, revendiquant le terme de chanteuse « féministe », qui fut parfois lourd à porter. Elle dit elle-même
« Je suppose que ça m’a freinée dans ma carrière parce que j’étais l’emmerdeuse de service, mais ma foi, si c’était le prix à payer… »
Mais l’explication qui semble la plus vraisemblable est que c’est l’immense succès des « Fabulettes » qui a vampirisé l’autre partie de son œuvre.
Elle a raconté à <France Culture> que le succès des fabulettes ont peut être joué un rôle de frein pour la réputation de sa carrière de chanteuse universelle :
« Je ne me suis pas méfié suffisamment puisque beaucoup de gens ont continué à me considérer comme une chanteuse pour enfants, sans faire attention du tout à mon répertoire qui est quand même un répertoire de chanteuse pour les « gens », les adultes.
Ainsi, elle évoque l’anecdote de cette petite fille à qui l’on demandait de citer des chanteuses qu’elle aimait. La liste de chanteuses et chanteurs passant à la radio s’allonge. « Mais, et Anne Sylvestre que tu aimes tant ? ». La petite fille de répondre étonnée : « Oooh, mais ce n’est pas pareil, Anne Sylvestre ce n’est pas une chanteuse ! ». La chanteuse sourit : « Vous voyez, moi j’étais un meuble ». »
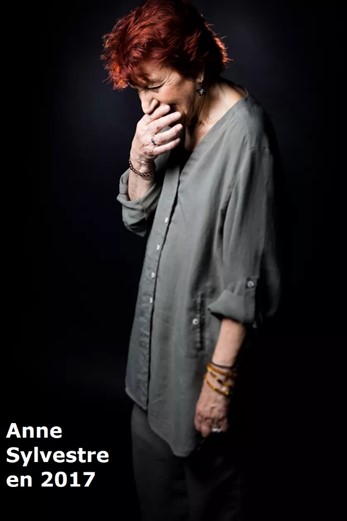 Ainsi le succès des Fabulettes, soutenues par toutes les écoles de France, dont les ventes se comptent en millions ont conduit l’auteure-compositrice-interprète y être exclusivement identifiée, alors qu’elle avait écrit près de quatre cents chansons « adultes », dont des chefs-d’œuvre tels que « Lazare et Cécile », « Les Gens qui doutent », « Maryvonne »
Ainsi le succès des Fabulettes, soutenues par toutes les écoles de France, dont les ventes se comptent en millions ont conduit l’auteure-compositrice-interprète y être exclusivement identifiée, alors qu’elle avait écrit près de quatre cents chansons « adultes », dont des chefs-d’œuvre tels que « Lazare et Cécile », « Les Gens qui doutent », « Maryvonne »
Le Monde rapporte sa colère devant une « fake news » :
« On a dit : quand Anne Sylvestre a eu moins de succès, elle s’est reclassée dans la chanson pour enfants. Faux.
Ce sont deux répertoires distincts, deux activités parallèles.
J’ai commencé à chanter en 1957 et, dès 1961, je me suis mise à écrire des chansons pour les enfants, par plaisir et pour ma fille. Parce que je voulais retarder la crétinisation…
En 1963, pour me faire plaisir, Philips avait accepté d’enregistrer un 45-tours où il y avait Veux-tu monter sur mon bateau, Hérisson.
Je savais ce qui est au centre des préoccupations quotidiennes des enfants, le rôle du vélo, des nouilles…
Avec les Fabulettes, j’ai pu les structurer, leur donner le goût de la liberté, du plaisir de chanter. »
Anne Sylvestre a toujours refusé de chanter ses Fabulettes sur scène. Elle a dit :
« Et puis une salle remplie d’enfants… ça me fait peur !»
Et dans la Grande table du 06/02/2014 elle a dit :
« Je suis heureuse et fière d’avoir écrit les Fabulettes. Mais je ne suis pas une chanteuse pour enfants. »
Mais celles et ceux qui ont écouté avec attention son autre répertoire savent combien il est grand.
<TELERAMA> raconte
« Une jeune femme vient de lui sourire. Sans rien dire. Mais avec dans les yeux une joyeuse reconnaissance. « Voilà ce qui arrive dans la rue : des gens m’offrent leur sourire. C’est joli. » Ceux-là, c’est sûr, ont écouté son œuvre. Pas seulement ses Fabulettes pour enfants mais aussi ses chansons pour adultes. Ils savent combien elles sont précieuses. Pour qui connaît le répertoire français, le nom d’Anne Sylvestre égale ceux de Brassens, Brel, Barbara, Ferré, Trenet. On ne le dit pas assez ? Si seulement les radios et les télés avaient daigné diffuser ses chansons, tout le monde saurait. Mais l’histoire s’est écrite autrement, et le trésor s’est partagé avec plus de discrétion, scène après scène, disque après disque. »
« Mais c’est pas grave
C’est juste une femme
C’est juste une femme à bafouer
Juste une femme à désespérer »
Christine Siméone a titré son hommage : <Mort d’Anne Sylvestre après 300 chansons et une vie passée à raconter les gens> et nous apprend qu’Anne Sylvestre est l’autrice de 18 albums de « Fabulettes », pour les enfants, et d’une vingtaine d’albums pour les adultes. Parisienne et citadine dans l’âme, Anne Sylvestre est montée pour la première fois sur scène en 1957, dans le cabaret parisien « La Colombe » où ont également débuté Jean Ferrat, Pierre Perret, Guy Béart ou Georges Moustaki.
Et elle cite Georges Brassens qui écrit, en 1962, au dos d’une des pochettes de disques d’Anne Sylvestre :
« On commence à s’apercevoir qu’avant sa venue dans la chanson, il nous manquait quelque chose et quelque chose d’important. »
<TELERAMA> a tenté de sélectionner les dix plus grandes chansons d’Anne Sylvestre, « Juste une femme » en fait partie. Et ajoute :
« Nous en avons choisi dix…Nous aurions pu en prendre vingt, ou trente, tant [son] répertoire est l’un des plus riches et des plus beaux de la chanson française. Curieusement méconnu, mais à la hauteur de ceux de Barbara, Brassens, Brel. »
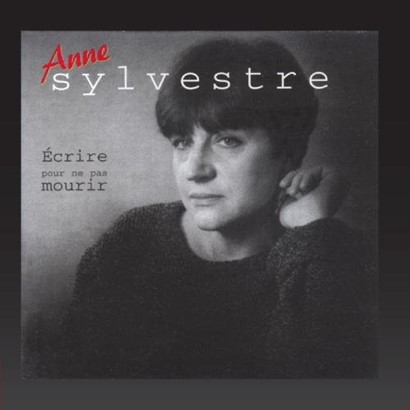 Il est difficile de choisir parmi tant de beautés, j’avoue une faiblesse pour cette chanson « Écrire pour ne pas mourir »
Il est difficile de choisir parmi tant de beautés, j’avoue une faiblesse pour cette chanson « Écrire pour ne pas mourir »
Elle a dit
« Écrire pour ne pas mourir, écrire fait beaucoup de bien. »
Et aussi « Je me vois comme un écrivain public : je trouve les mots » ou encore « Les mots, il faut les laisser venir, et il faut aller les chercher »
Elle n’a pas arrêté.
« Y a-t-il une vie après la scène ? Je m’aperçois, après cinquante ans de chanson, qu’à part ma famille et mes amis proches, il n’y a qu’une seule chose qui m’intéresse, écrire et chanter. C’est mon bonheur, c’est ma vie », racontait-elle à Bertrand Dicale dans les pages du Figaro pour
Jamais elle n’a posé le micro. Elle avait encore une tournée prévue pour jouer son spectacle « Nouveaux manèges », notamment quatre dates à la Cigale en janvier 2021.
Mais dès qu’une femme […]
Est traitée comme un paillasson
Et quelle que soit la façon
Quelle que soit la femme
Dites-vous qu’il y a mort d’âme
C’est pas un drame
Juste des femmes »
Le texte intégral de « Juste une femme » peut être trouvé <ICI> et son interprétation <ICI>
Je vous donne aussi le lien vers <Ecrire pour ne pas mourir> elle chante dans l’émission de Pivot, puis répond à ses questions.
Et je finirai par ce bel hommage du Rabbin Delphine Horvilleur :
« Anne Sylvestre
Bien souvent, on me demande qui je rêverais de rencontrer.
Depuis longtemps, c’est ton nom que je cite.
Je rêvais de te croiser, pour simplement de te dire merci. »
<1501>
-
Mercredi 2 décembre 2020
« C’est mon libérateur. [Daniel Cordier] ne supportait pas les gens enfermés, la souffrance des autres »Hervé Vilard qui parle de son tuteur légal : Daniel CordierDepuis le confinement, pendant lequel j’ai découvert Augustin Trapenard qui lisait ce que d’autres avaient écrit dans ces lumineuses <Lettres d’intérieur>, j’écoute souvent son émission «boomerang» sur France Inter. J’écoute, au moins, le début pour mesurer si son invité m’intéresse. Le vendredi 13 novembre, il avait <Rancard avec Hervé Vilard>.
A priori, cet entretien n’avait pas grande chance de m’intéresser.
Pourtant, quand j’ai entendu le début du récit d’Hervé Villard, j’ai été saisi.
Hervé Vilard, le chanteur populaire que tout le monde connaît, même moi, pour la chanson<Capri c’est fini> a eu une enfance terrible.
Hervé Vilard est orphelin de père. Il ne le rencontra jamais. Sa mère est déchue de ses droits maternels quand il a 6 ans. Il sera envoyé à l’orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, situé à Paris.
Dans cet orphelinat il est battu et subit des viols à répétition dès son arrivée.
Il <raconte >:
« Ils laissaient tomber le crayon, se penchaient et baissaient notre braguette. On se laissait un peu tripoter parce qu’on avait le droit à des bonbons. Ça m’est arrivé mais pas avec des curés. Ça m’est arrivé en orphelinat. Même les juges dans les années 1950 faisaient des attouchements sur les enfants de l’orphelinat Saint-Vincent-de-Paul. »
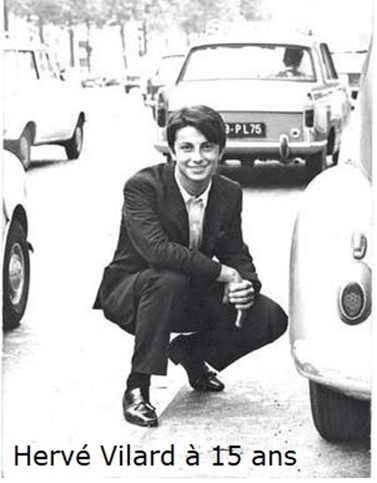 Et à Seize ans, il fugue. Il fréquente loubards et prostituées dans le quartier de Pigalle.
Et à Seize ans, il fugue. Il fréquente loubards et prostituées dans le quartier de Pigalle.
Il fait aussi des séjours dans des maisons de redressement.
Et puis un jour, devant la gare Montparnasse, il voit un homme en train de peindre mais qui surtout dispose d’un sandwich. Le peintre s’appelle Dado. Il pense que cet adolescent s’intéresse à sa peinture, mais comprend vite que c’est le sandwich qui est l’objet du désir du jeune affamé.
Alors il lui offre la moitié de son sandwich et l’invite au vernissage de son exposition qui est organisé dans une galerie de Daniel Cordier :
« Viens samedi à mon vernissage, tu pourras t’en mettre plein la cloche. Lave ta chemise, c’est dans les beaux quartiers. »
Dans l’émission boomerang il raconte ce qui se passera à ce vernissage mais <Paris Match> le fait aussi :
« Je me rends à la galerie, rue de Miromesnil. Ce peintre, c’est Dado, tignasse hirsute. Il y a là les Rothschild, les Noailles, Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin… Dado me présente : « C’est mon petit protégé. » A 21 heures tout le monde s’en va, et moi je suis encore là ! Ne restent plus que Dado, Marie-Laure de Noailles, Mme de Rothschild et Daniel Cordier, qui me demandent où je vis. Moi qui ai toujours menti sur mes parents, je dis la vérité : « Je suis évadé de l’orphelinat. » Ils me répondent : « Tu vas y retourner et nous allons t’en faire sortir. » J’obéis.
Daniel Cordier tient parole et devient mon tuteur. Mon destin bascule. Je déjeune à sa table, entouré des grands de ce monde, André Malraux, Yvonne de Gaulle, Mendès France, Mitterrand… »
Sur <RTL> il rapporte que Daniel Cordier n’a eu qu’une exigence :
« En échange je m’étais engagé à être un garçon droit »
Et il ajoute à propos de Daniel Cordier :
« C’est mon libérateur. Il ne supportait pas les gens enfermés, la souffrance des autres, et quand il a vu ce gosse désœuvré, il n’a pas pu s’en empêcher, comme il n’avait pas pu s’empêcher d’aller au combat à 20 ans. Je lui dois ma liberté, le savoir, la connaissance, tout ce qu’il ‘a appris, le monde, mon succès. »
 Invité de l’émission C à vous du 25 novembre, Hervé Vilard dit :
Invité de l’émission C à vous du 25 novembre, Hervé Vilard dit :
« Je n’ai pas connu le Daniel Cordier de la résistance. Je suis né après la guerre. J’ai connu le passeur d’art »,
Sur paris Match il raconte :
« Lors d’un déjeuner, Cordier l’interroge : « Que veux-tu faire ? » Je réponds sans réfléchir : « Chanteur. » Il me trouve un emploi de disquaire sur les Champs-Elysées, me fait prendre des cours de chant. Je deviens le disquaire préféré de la Callas, de Karajan, de Claude François… Ils me donnent des billets pour leurs concerts. Au bout d’un an, je signe un contrat chez Philips. »
Dans «Boomerang», il raconte qu’il n’aimait pas beaucoup Malraux qui fréquentait beaucoup Daniel Cordier alors que ce dernier emmenait Hervé Vilard, un peu partout.
C’est ainsi qu’il a assisté avec son tuteur et Malraux à l’inauguration du fameux plafond du Palais Garnier peint par Chagall. Et c’est peu après que Cordier annonce à Malraux que son jeune protégé allait embrasser la carrière de chanteur.
Malraux dit alors :
« Pourquoi ne le dirigez-vous pas autrement ? La chanson est un art mineur… »
On entend encore toute la fierté d’Hervé Vilard de rapporter son interpellation :
« Monsieur le Ministre, allez écouter Brel, il chante actuellement à l’Olympia, ça vaut bien un Chagall. »
La réaction de Cordier est admirable :
« Il est prêt, je peux le lâcher ! »
Et Vilard d’ajouter, Je prends mon envol, mes années de misère sont derrière moi. Je resterai proche de celui qui a rendu tout cela possible, cet homme extraordinaire.
« Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. »
Camus
<1500>
-
Mardi 1 décembre 2020
« Subitement, mon fanatisme aveugle m’accable : c’est donc ça l’antisémitisme ! »Daniel Cordier, « Alias Caracalla »Après la fameuse émission «les Dossiers de l’écran», dans laquelle Daniel Cordier a eu le sentiment d’avoir trahi Jean Moulin en ne parvenant pas à le défendre des attaques que Frenay avait lancé contre lui, il a d’abord écrit des livres d’Histoire sur Jean Moulin :
- 1983 : Jean Moulin et le Conseil national de la Résistance, Paris, éd. CNRS
- 1989-1993 : Jean Moulin. L’Inconnu du Panthéon, 3 vol. , Paris, éd. Jean-Claude Lattès De la naissance de Jean Moulin à 1941.
- 1999 : Jean Moulin. La République des catacombes, Paris, éd. Gallimard Récapitulation du précédent ; action de Jean Moulin de 1941 à sa mort ; postérité de son action et de sa mémoire.
Puis, avec Alain Finkielkraut et Thomas Piketty, il a participé à un ouvrage sur un autre héros de la résistance : Pierre Brossolette, arrêté et torturé par la Gestapo, qui avait choisi de se suicider en se jetant par la fenêtre du siège de la Gestapo, avenue Foch.
- 2001 : Pierre Brossolette ou Le Destin d’un héros, Paris, éditions du Tricorne, écrit avec 43
Et c’est après ces travaux que Daniel Cordier a écrit le récit précis des faits auxquels il a participé et qui se sont déroulés entre le 17 juin 1940 et le 23 juin 1943 : «Alias Caracalla».
La première date correspond au jour du discours de Pétain, dans lequel se trouve cet appel insupportable à Daniel Cordier :
« C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat.
Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l’honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. »
La seconde date est le lendemain de l’arrestation de « Rex », Jean Moulin, le 22 juin 1943, à Caluire.
Entre temps, il raconte son départ vers Londres, sa rencontre des Forces françaises libres puis son retour en France et son rôle auprès de Jean Moulin.
C’est absolument passionnant, on ne se rend pas compte que le livre compte 1000 pages (dans l’édition Folio).
L’essentiel se passe à Lyon. Il arrive à Lyon le 28 juillet 1942, le 30 juillet il rencontre Rex et le 1er août il commence sa mission de secrétaire.
Puis, pour des raisons stratégiques il est décidé de transférer le quartier général à Paris et il part pour Paris le 24 mars 1943, pour organiser avec ses amis l’arrivée de Jean Moulin.
Ce livre raconte la lumineuse personnalité de Jean Moulin et son combat incessant pour arriver à coordonner les différents mouvements de résistance et leur faire accepter le leadership de De Gaulle.
Tout ce qu’il raconte est magnifiquement résumé par cette formule de Bidault : « Les résistants c’est comme les trotskystes, avec un, tu fais un Parti, avec deux, tu fais un congrès, avec trois, tu fais une scission»
Cordier n’est pas membre de la résistance, il prend exactement les mêmes risques, mais lui est un soldat, un soldat discipliné des Forces Françaises Libres, totalement dévoué à Rex.
Au début du livre, un texte d’Yves Farge, résistant et futur ministre du ravitaillement est cité :
« Nous avions « notre » Jacques Inaudi : Cordier, que l’on appelait Alain à Lyon et Michel à Paris. Il ne notait rien : il savait tout. « Bonaventure n’oubliez pas que le douze du mois prochain on vous attend à Grenoble, place aux Herbes, à neuf heures du matin » et il partait à grandes enjambées, désinvolte, très jeune homme du monde à marier et efficace en diable. »
Yves Farge, « Rebelles, soldats et citoyens.
Mais pourquoi Caracalla ?
<Caracalla> est le nom d’un personnage historique peu recommandable. Il fut empereur romain de 211 à 217. fils et successeur de Septime Sévère. Il assassina son frère, cela est un fait historique établi. Certains prétendent qu’il a aussi tué son père. Il fut lui-même assassiné.
Mais il présente une particularité : il est né le 4 avril 188 à Lyon, Lugdunum à l’époque. Il n’est pas le seul, l’empereur Claude qui a régné entre Caligula et Néron est aussi né à Lyon.
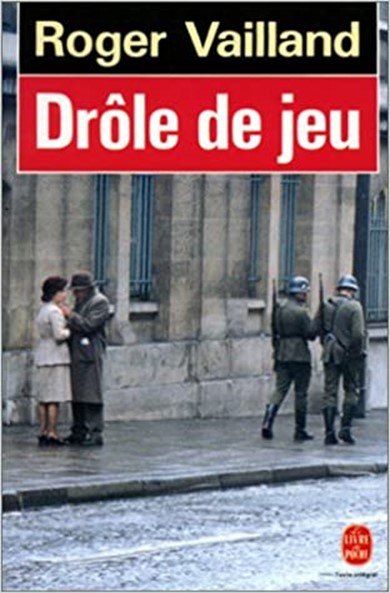 Daniel Cordier explique en préambule de son livre, la raison de l’utilisation de ce nom :
Daniel Cordier explique en préambule de son livre, la raison de l’utilisation de ce nom :
« En 1943, je fis la connaissance de Roger Vailland, dont je devins l’ami. Après la libération, il m’offrit « Drôle de jeu », récit à peine romancé de notre relation. « J’ai choisi pour votre personnage le pseudonyme de Caracalla. J’espère qu’il vous plaira. » Aujourd’hui, pour retracer une aventure qui fut, par ses coïncidences, ses coups de théâtre et ses tragédies, essentiellement romanesque, ce pseudonyme imaginaire a ma préférence sur tous ceux qui me furent attribués dans la Résistance »,
Lors de la sortie de « Alias Caracalla », en 2009, <Le monde> avait commenté :
« Ces 900 pages sont éblouissantes. Elles constituent l’un des témoignages les plus précis, les plus honnêtes et les plus bouleversants qui aient jamais été publiés sur la Résistance. Celui d’un homme dont le destin fut doublement exceptionnel. D’abord parce que Daniel Cordier compta parmi les tout premiers Français à rejoindre Londres, dès le 25 juin 1940, à l’âge de 19 ans. Ensuite parce qu’il fut, pendant onze mois, le secrétaire de Jean Moulin, et à ce titre la personne qui connut le mieux celui sur qui comptait le général de Gaulle pour rallier autour de lui la Résistance intérieure. »
Le monde reçoit aussi le témoignage de Cordier :
« Exceptionnel ? Le qualificatif met visiblement Daniel Cordier mal à l’aise. « Vous savez, j’ai vraiment le sentiment de ne pas avoir fait grand-chose pendant cette période », dit aujourd’hui cet homme de 88 ans. Coquetterie ? Fausse modestie ? « Non, je vous assure. Quand je suis parti à Londres, je n’avais qu’une obsession : tuer du boche. Or, quatre ans plus tard, à la Libération, je n’en avais toujours pas tué un seul. Cela a été le désespoir de ma vie. C’est sans doute pour cela que j’ai tellement attendu avant de publier ce livre. Je ne voyais pas en quoi mes souvenirs pouvaient intéresser les gens. »
Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle Daniel Cordier a attendu 64 ans pour rédiger ses mémoires de guerre. Il l’explique :
« Quand je me suis décidé à raconter ma vie, je me suis dit qu’il fallait que je dise toute la vérité, sans rien cacher. Or il y a une chose dont je ne voulais pas parler, une chose affreuse, impardonnable, c’est l’antisémitisme qui était le mien à l’époque. Cela m’a pris du temps d’accepter d’en parler. »
Et c’est un extrait du livre sur ce sujet que je veux partager aujourd’hui.
Les juifs ne portaient pas l’étoile jaune en zone libre, Pétain s’y était opposé. Mais à Paris, tous les juifs devaient porter l’étoile jaune sinon ils étaient déportés.
Cordier vient juste d’arriver à Paris, il a rendez-vous avec ses camarades qui l’ont précédé à Paris, dans un café près des Champs Élysées et :
« En approchant du café, je vois venir à moi, serrés l’un contre l’autre, un vieillard accompagné d’un jeune enfant.
Leur pardessus est orné de l’étoile jaune. Je n’en ai jamais vu : elle n’existe pas en zone sud.
Ce que j’ai pu lire en Angleterre ou en France sur son origine et son exploitation par les nazis ne m’a rien appris de la flétrissure que je ressens à cet instant : le choc de cette vision me plonge dans une honte insupportable.
Ainsi les attaques contre les Juifs, auxquelles je participais avant la guerre, sont-elles l’origine de ce spectacle dégradant d’êtres humains marqués comme du bétail, désignés au mépris de la foule.
Subitement, mon fanatisme aveugle m’accable : c’est donc ça l’antisémitisme !
Entre mes harangues d’adolescent exalté – « fusiller Blum dans le dos » – et la réalité d’un meurtre, il n’y avait dans mon esprit aucun lien.
Je comprends à cet instant que ces formules peuvent tuer. Quelle folie m’aveuglait donc pour que, depuis deux ans, la lecture de ces informations n’ait éveillé en moins le plus petit soupçon ni, dois-je l’avouer, le moindre intérêt sur le crime dont j’étais complice ?
Une idée folle me traverse l’esprit : embrasser ce vieillard qui approche et lui demander pardon.
Le poids de mon passé m’écrase ; que faire pour effacer l’abjection dont j’ai brusquement conscience d’avoir été le complice ?
A cet instant, j’aperçois Germain sortir du café et s’avancer vers moi en souriant : Bonjour, patron. ». il ajoute aussitôt : « Comme vous êtes pâle. Rien de grave, j’espère ? »
(…) Sa présence me ramène à la réalité : je ne suis pas à Paris pour soigner mes états d’âme. Rex arrive le 31, et tout doit être prêt pour le recevoir.
Assurément, la Résistance n’est pas le lieu propice à la culture des remords. »
Alias Caracalla pages 905 et 906
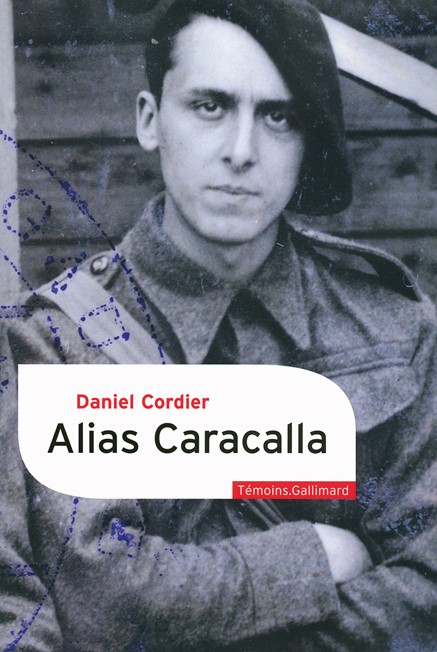 C’est un instant de sidération.
C’est un instant de sidération.
C’est aussi une prise de conscience, Daniel Cordier abandonne immédiatement son antisémitisme.
Il revient sur son évolution dans cette émission de France Culture : <Episode 3> et il dit dans cette émission en revenant sur cet épisode où la première fois il a vu un homme portant une étoile jaune à Paris :
« En vrai, vous n’imaginez pas ce que c’est. […] avoir été antisémite, avoir été contre [cette] race, tout d’un coup j’ai eu le sentiment que c’était un crime, que c’était quelque chose d’inacceptable. »
Subitement il parvient à cette connaissance que des « formules peuvent tuer ! ».
Il écrit en 4ème page de couverture :
«J’ai consacré beaucoup de soins à traquer la vérité pour évoquer le parcours du jeune garçon d’extrême droite que j’étais, qui, sous l’étreinte des circonstances, devient un homme de gauche. La vérité est parfois atroce.»
<1499>
- 1983 : Jean Moulin et le Conseil national de la Résistance, Paris, éd. CNRS
-
Lundi 30 novembre 2020
« Vous savez Daniel, c’est quelqu’un qui a toujours eu 20 ans, même quand il en avait 100. Parce que ce sont les passionnés qui vivent, les raisonnables, ils ne font que durer. »Régis Debray à propos de Daniel Cordier à France Inter le 27 novembre 2020Je n’ai jamais consacré de mot du jour à Daniel Cordier. Je l’ai découvert et cité en 2013 après avoir entendu une émission, aujourd’hui disparue : « La marche de l’Histoire ».
Il rapportait les propos d’un grand résistant, Georges Bidault «Les résistants c’est comme les trotskystes, avec un, tu fais un Parti, avec deux, tu fais un congrès, avec trois, tu fais une scission».
Par la suite, j’ai lu des articles, j’ai vu plusieurs émissions ou vidéo dans lesquelles il intervenait toujours avec mesure et intelligence.
Et puis un jour, j’ai entendu Régis Debray dire lors d’une émission :
« Il faut absolument lire Alias Caracalla de Daniel Cordier»
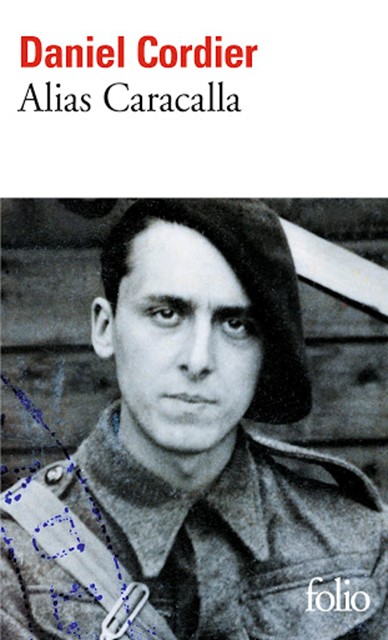 Alors, pendant l’été 2016, j’ai lu ou plutôt dévoré « Alias Caracalla » et depuis je voulais en faire un mot du jour.
Alors, pendant l’été 2016, j’ai lu ou plutôt dévoré « Alias Caracalla » et depuis je voulais en faire un mot du jour.
Régis Debray est devenu l’ami de Daniel Cordier .
Il a d’ailleurs réalisé un documentaire sur son action lors de la résistance : <Daniel Cordier la résistance comme un roman>. Ce documentaire peut être vu jusqu’au 23/12/2020 sur le site de France 5.
Régis Debray avait aussi organisé une rencontre entre 4 anciens de la France Libre dont Daniel Cordier : <Des français libres se souviennent> .
Alors, c’est tout naturellement à Régis Debray qu’il faut donner la parole pour décrire le mieux cet homme admirable que fut Daniel Cordier mort le 20 novembre, après qu’il ait fêté son anniversaire de 100 ans, le 10 août 2020. Régis Debray était l’invité de France Inter lors du grand entretien du <27 novembre 2020>. Et voilà ce qu’il a dit :
« Vous savez Daniel, c’est quelqu’un qui a toujours eu 20 ans, même quand il en avait 100.
Parce que ce sont les passionnés qui vivent, les raisonnables, ils ne font que durer.
Et Daniel avait gardé cette passion.
D’abord cette passion de savoir exactement ce qu’il avait fait et pour qui il l’avait fait : pour Jean Moulin et Jean Moulin pour qui : pour la Résistance et la Résistance pourquoi : pour la France.
Il a toujours voulu comprendre, expliquer. Il a trouvé les documents.
Et puis j’aimais en lui, ce côté un peu enfantin, ce sourire narquois, il avait beaucoup d’humour. Et surtout, il ne bombait pas le torse. »
C’est en effet un homme qui a refusé d’être considéré comme un héros.
« Il y avait chez lui à la fois un héros et un dandy. Ce n’est pas contradictoire, il avait cette sorte de détachement, cet humour et surtout cette humilité. »
Demain je tenterais de dire quelques mots d’Alias Caracalla et surtout de citer un extrait qui m’avait marqué.
Aujourd’hui je voudrais simplement parler des quatre vies de Daniel Cordier.
La première vie débute à Bordeaux où il est né dans une famille bourgeoise. Ses parents divorcent et sa mère se remarie avec un autre bourgeois, Charles Cordier. Ce beau-père est d’extrême droite, royaliste, partisan de Charles Maurras, et du mouvement de l’Action française.
Ce milieu est violemment antisémite. Très influencé par son beau-père, Daniel Cordier adhère à cette idéologie et devient membre de <La Fédération nationale des Camelots du roi> qui est un réseau de vendeurs du journal L’Action française et de militants royalistes qui constituent le service d’ordre et de protection du mouvement de l’Action française.
Il fonde à Bordeaux le cercle Charles-Maurras. Et comme il le reconnaît dans Alias Caracalla, en tant qu’admirateur de Charles Maurras, il est, au début de la guerre, antisémite, antisocialiste, anticommuniste, antidémocrate et ultranationaliste.
Mais en 1940, à 20 ans, son patriotisme lui interdit de se soumettre et d’accepter le défaitisme de Pétain que dès lors il considère comme un traitre. Il se détache aussi de Charles Maurras qui soutient Pétain et se rallie à la France libre.
Immédiatement, il cherche et parvient à quitter la France sur un navire belge parti de Bayonne le 20 juin 1940. Son projet avec quelques amis est d’aller en Afrique, dans l’empire français continuer la lutte, mais le bateau fait finalement route vers l’Angleterre.
La deuxième vie de Daniel Cordier commence en Angleterre, il s’engage avec ses camarades dans les premières Forces françaises libres de la « Légion de Gaulle ». Il rencontre Raymond Aron, Stéphane Hessel et Georges Bidault, auxquels il restera lié. Il est aussi impressionné par le charisme de De Gaulle. Il poursuivra une formation militaire et obtiendra le grade de Lieutenant. Il faut bien comprendre qu’il ne fait pas partie de ce qu’on appelle « la Résistance » mais des « Forces française libres » et parmi les tous premiers. Et puis il rencontre la grande Histoire, parachuté sur la France, le 26 juillet 1942, il va devenir le secrétaire de Jean Moulin, sans savoir qu’il s’agit de Jean Moulin, il ne le connait que sous le nom de « Rex ». Il n’apprendra qu’après la guerre que cet homme qu’il a servi était un ancien préfet et qu’il avait pour nom Jean Moulin.
Il se donnera corps et âme à sa mission. Fasciné par Rex, il le soutiendra jusqu’au bout : son arrestation à Caluire.
Jean Moulin aura une influence déterminante sur sa vision du monde, ses idées politiques qui vont muter vers l’humanisme et le socialisme.
Jean Moulin aura une autre influence déterminante pour la troisième partie de sa vie :
« Jean Moulin fut mon initiateur à l’art moderne. Avant de le rencontrer, en 1942, j’étais ignorant de cet appendice vivant de l’histoire de l’art. Il m’en révéla la vitalité, l’originalité et le plaisir. Surtout il m’en communiqua le goût et la curiosité »
Daniel Cordier, en 1989, dans la préface du catalogue présentant sa donation au Centre Pompidou
Après l’arrestation de « Rex » il continuera le combat jusqu’à la victoire finale.
Et il continuera même après la victoire, mais la démission de De Gaulle met un terme définitif à son engagement public.
Je l’ai entendu dire dans une émission qu’il ne voulait surtout pas ressembler à ces vieux combattants de 14-18 qui racontaient inlassablement à la jeunesse le récit de leur drame et de leur courage.
Et c’est ainsi qu’il ne parlera plus de la Résistance en public pendant plus de trente ans.
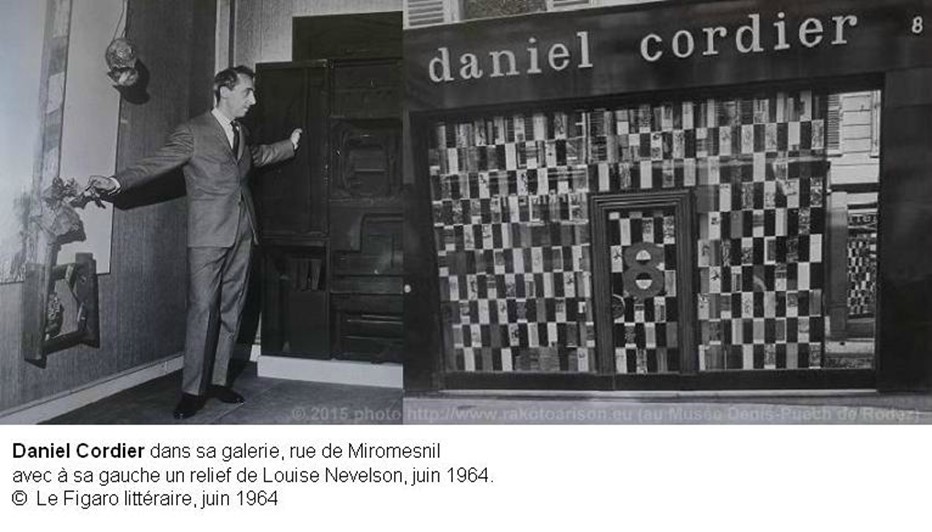 La troisième vie est alors consacrée à l’art. Il prend des cours de peinture, commence une carrière de peintre et surtout il achète des œuvres d’art contemporain et commence une collection. Puis ouvre une galerie d’art. Et il deviendra un des plus grands marchands d’art et organisateur d’expositions de la place de Paris.
La troisième vie est alors consacrée à l’art. Il prend des cours de peinture, commence une carrière de peintre et surtout il achète des œuvres d’art contemporain et commence une collection. Puis ouvre une galerie d’art. Et il deviendra un des plus grands marchands d’art et organisateur d’expositions de la place de Paris.
Et il deviendra aussi mécène et il fera don d’une partie de sa collection à l’État, en particulier au Centre Pompidou. J’ai lu qu’ainsi il a transmis 1000 œuvres au Centre.
La quatrième vie sera une vie d’Historien. J’ai plusieurs fois entendu Daniel Cordier raconter ce qui s’est passé sur le plateau de cette émission de télévision célèbre à l’époque : « Les Dossiers de l’écran », le 11 octobre 1977. Cette émission était consacrée à Jean Moulin. On l’avait invité puisqu’il avait été son secrétaire pendant la période la plus importante : celle au cours de laquelle jean Moulin a tenté de réunir l’ensemble des forces de la Résistance sous un commandement unique rallié à De Gaulle.
<France Info> écrit :
« Le ton monte sur le plateau de la célèbre émission « Les Dossiers de l’écran », ce 11 octobre 1977. Installés face à face dans de grands fauteuils en cuir camel, Henri Frenay et Daniel Cordier ne s’étaient plus croisés depuis trente-cinq ans. Le premier est un habitué des plateaux télé, présentant son dernier livre, L’Enigme Jean Moulin (éd. Robert Laffont, 1977). A la tête du plus important mouvement de résistance non communiste, Combat, il défend la thèse selon laquelle Jean Moulin n’est pas le résistant que le public connaît, mais plutôt un agent double des services secrets russes.
Face à lui, Daniel Cordier, de 15 ans son cadet, ancien secrétaire de Jean Moulin, balbutie quelques mots avec un léger zozotement, pour défendre celui qui était son chef : « Ce soir, je voulais apporter des documents, mais on m’a dit que ce n’était pas le lieu. Je pouvais apporter un paquet de documents, car… Enfin… C’était mon poste, c’était ma fonction. » En quittant le plateau d’Antenne 2, Daniel Cordier sait qu’il n’a pas convaincu. […]
C’est donc lors de cette fameuse soirée d’octobre 1977 que la vocation de Daniel Cordier est née. De résistant, il est devenu gardien de mémoire, passeur d’histoire, en décidant de se plonger dans les documents qu’il avait scrupuleusement gardés, inconnus de beaucoup d’historiens. Je me suis dit : Mais au fond, depuis la guerre, je vis très heureux, je fais ce qui me plaît. Mais Jean Moulin, c’était mon patron, c’est lui qui m’a appris la peinture et aujourd’hui je suis incapable de le défendre. Je suis un salaud, confiait-il au micro de France Culture en 2013. […]
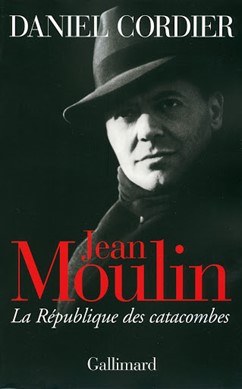 Après cette débâcle télévisée, la nouvelle carrière d’historien qu’il embrasse le pousse à retrouver pour la première fois depuis trente-cinq ans ses compagnons de guerre. Pendant six ans, Daniel Cordier se plonge dans ses propres archives. Il constitue également une équipe et se fait aider par un historien reconnu, Jean-Pierre Azéma.
Après cette débâcle télévisée, la nouvelle carrière d’historien qu’il embrasse le pousse à retrouver pour la première fois depuis trente-cinq ans ses compagnons de guerre. Pendant six ans, Daniel Cordier se plonge dans ses propres archives. Il constitue également une équipe et se fait aider par un historien reconnu, Jean-Pierre Azéma.
« J’ai tiré au clair ces accusations [d’espionnage] », disait alors Daniel Cordier, toujours dans « Apostrophes ». « Ç’aurait pu être vrai. Je me suis mis au travail dans cette perspective. Comme je connaissais bien les archives de la Résistance, je m’étais mis en tête de faire la preuve que Moulin était cryptocommuniste [dont les idées sont proches de celles des communistes sans être affirmées]. Je me suis vite aperçu qu’il n’y avait absolument rien, aucun indice d’aucune sorte, mais qu’en plus, il existait des documents que j’avais oubliés qui prouvaient exactement le contraire. »
L’autodidacte recoupe toutes les preuves qu’il peut, ne laisse rien au hasard. « Il a une démarche scientifique », salue Christine Levisse-Touzé, historienne spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, présidente du conseil scientifique du musée de l’Ordre de la Libération, contactée par franceinfo. « Il avait un respect absolu des preuves et des faits. » Daniel Cordier a ainsi apporté des récits précieux pour comprendre le quotidien des résistants. « Il a, pièces d’archives à l’appui, expliqué pourquoi des dissensions existaient entre les chefs de la Résistance, abonde Laurent Douzou, historien spécialiste de la Résistance. Notamment entre Jean Moulin et Pierre Brossolette. Cela se savait avant 1983, mais Cordier a mis en évidence cet affrontement, à partir de pièces d’archives et de rapports mentionnant des disputes précises. »
Son travail immense va alors profondément renouveler l’historiographie de la Résistance.
La figure de jean Moulin va en sortir grandie et hélas les mouvements de résistance sortiront de ce travail avec un certain nombre de réalités peu glorieuses.
Parce qu’après la guerre, bien des chefs de la Résistance ont privilégié une vision édulcorée et idéalisée de leurs actions. Cordier montre leurs querelles, leurs rivalités, leurs divergences politiques et stratégiques qui les avaient opposés entre eux et aussi à Londres. Il a toujours privilégié l’écrit à l’oral qui a toujours tendance à réinventer le passé selon les convictions présentes.
Vous pouvez écouter aussi l’émission de France Culture dans laquelle il parle de ce travail : <La solitude a été la compagne de ma vie>
Aujourd’hui son travail d’Historien est reconnu pour sa qualité et sa grande valeur éthique.
Je crois qu’on peut reprendre pour Daniel Cordier cette phrase de Camus : « Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. »
 <1498>
<1498> -
Vendredi 27 novembre 2020
« Dans le football frigide de cette fin de siècle, qui exige qu’on gagne et interdit qu’on jouisse, cet homme est un des rares à démontrer que la fantaisie peut elle aussi être efficace »Eduardo Galeano à propos de Diego MaradonaJe n’avais pas l’intention de faire un mot du jour sur ce footballeur, certes extraordinairement doué, mais qui avait tant d’ombres : lien avec la mafia, drogue, alcool et par moment des propos injurieux au-delà de l’imaginable.
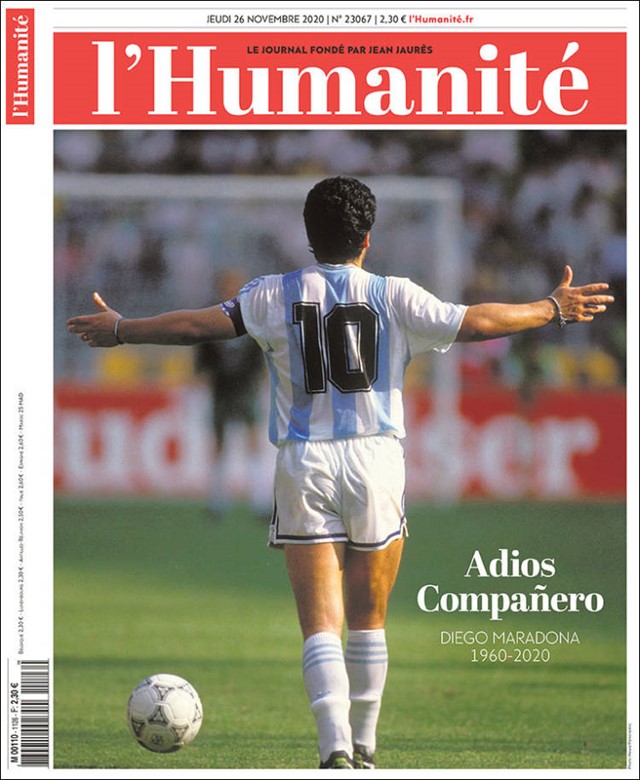 Et puis par hasard, j’ai vu ce documentaire d’Arte : <Un gamin en or>
Et puis par hasard, j’ai vu ce documentaire d’Arte : <Un gamin en or>
Au début je me suis dit : je ne vais regarder que les premières minutes et puis j’ai été happé et je suis allé jusqu’au bout. C’est bouleversant. Bien sûr, il a fait des erreurs, il a eu des faiblesses., mais quel talent et combien d’hostilité il a dû affronter dans le monde du football institutionnel.
Tout le temps agressé sur le terrain, parce qu’il était trop fort et quasi inarrêtable par des moyens licites.
Jusqu’à ce qu’on a appelé l’attentat d’Andoni Goikoextxea que vous pourrez voir sur cette page de <Sofoot>
C’était, le 24 septembre 1983, un match entre Barcelone, équipe dans laquelle jouait Maradona à cette époque, contre le club basque de l’Athletic Bilbao.
Maradona donnait le tournis à ses adversaires et alors « le sinistre boucher de Bilbao » par un tacle d’une violence inouïe venant de derrière la jambe gauche a eu pour conséquence une fracture de la cheville avec arrachement des ligaments. Pour toute sanction de son ignoble besogne, le misérable n’a écopé que d’un carton jaune, alors qu’il aurait dû être suspendu à vie.
Finalement, ce n’est pas totalement absurde après cette longue série sur Albert Camus, de rendre hommage à Diego Armando Maradona, probablement le footballeur le plus extraordinaire que la terre ait porté.
D’abord parce que, nous savons combien le football était important pour Camus, alors rendre hommage au meilleur de ce jeu a du sens.
Ensuite parce que Diego Maradona est né le 30 octobre 1960, cette même année dans laquelle, le 4 janvier, Albert Camus a trouvé la mort dans une voiture qui s’est encastrée dans un platane.
Et puis, celui auquel on a donné le nom de « El Pibe de Oro » « Le gamin en or », venait d’une famille aussi pauvre que Camus. Ils partagent tous les deux ces origines dans la pauvreté économique et la précarité.
Et aussi, tous les deux malgré ces débuts difficiles sont devenus très célèbres, Camus en sachant caresser et jongler avec les mots, Maradona en sachant caresser et jongler avec un ballon.
Et enfin, tous les deux n’ont pas oublié d’où ils venaient et toujours eu à cœur à défendre les humbles, celles et ceux que la vie n’a pas gâté dès leur début.
Dans le documentaire, on le voit participer à un match de bienfaisance dans la banlieue de Naples pour financer des soins coûteux pour un enfant modeste. Le terrain est boueux, de mauvaise qualité et il s’engage avec le même enthousiasme que sur les plus beaux stades.
 Son goût de la justice va plus loin. Après que Naples son club après Barcelone, ait gagné pour la première fois le championnat italien grâce à son rayonnement, le Président avait décidé de verser une prime de victoire aux joueurs : une grosse prime pour les titulaires et une petite prime pour les remplaçants. Alors « El Pibe de Oro » est allé voir le président et l’a menacé de quitter le club si la même prime n’était pas versée à tous les joueurs titulaires et remplaçants et il a exigé que tous les salariés du club, même les plus modestes touchent également une prime parce que par leur engagement ils avaient aussi contribué au succès.
Son goût de la justice va plus loin. Après que Naples son club après Barcelone, ait gagné pour la première fois le championnat italien grâce à son rayonnement, le Président avait décidé de verser une prime de victoire aux joueurs : une grosse prime pour les titulaires et une petite prime pour les remplaçants. Alors « El Pibe de Oro » est allé voir le président et l’a menacé de quitter le club si la même prime n’était pas versée à tous les joueurs titulaires et remplaçants et il a exigé que tous les salariés du club, même les plus modestes touchent également une prime parce que par leur engagement ils avaient aussi contribué au succès.
J’ai vu aussi ce documentaire qui est publié par la chaîne « Brut » : <Une vie : Diego Maradona>
Le documentaire, commence par cette réponse de Maradona à qui on a probablement demandé comment il avait vécu la pression en tant que footballeur :
« Vous savez qui a vraiment la pression ?
Le type qui doit partir à quatre heures du matin
et qui ne peut pas ramener 100 pesos à la maison,
C’est lui qui a la pression
parce qu’il doit nourrir ses enfants
Je n’ai pas de pression,
chez moi la marmite est remplie, grâce à Dieu. »
Le directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), Pascal Boniface resitue Diego Maradona dans son contexte sud-américain, la plaie de la guerre des Malouines entre la Grande Bretagne et l’Argentin et la méfiance à l’égard du grand voisin des Etats-Unis d’Amérique : <Géopolitique de Maradona>
Dans ma longue série sur le football, j’avais parlé de celui qui écrivait sur le football avec intelligence, connaissance et philosophie : Eduardo Galeano écrivain uruguayen
Dans son livre « Football, ombre et lumière » il parlait ainsi de Diego Maradona :
« Il était épuisé par le poids de son propre personnage (…) depuis le jour lointain où la foule avait crié son nom pour la première fois. Maradona portait un poids nommé Maradona, qui lui faisait grincer du dos. […]
Quand Maradona fut, finalement, expulsé du Mondial 1994, les terrains de football perdirent leur plus bruyant rebelle. En fin de compte, il était facile de le juger, facile de le condamner, mais il n’était pas facile d’oublier que Maradona commettait le péché d’être le meilleur (…). Dans le football frigide de cette fin de siècle, qui exige qu’on gagne et interdit qu’on jouisse, cet homme est un des rares à démontrer que la fantaisie peut elle aussi être efficace ».
J’ai aussi trouvé cette description du même Galeano :
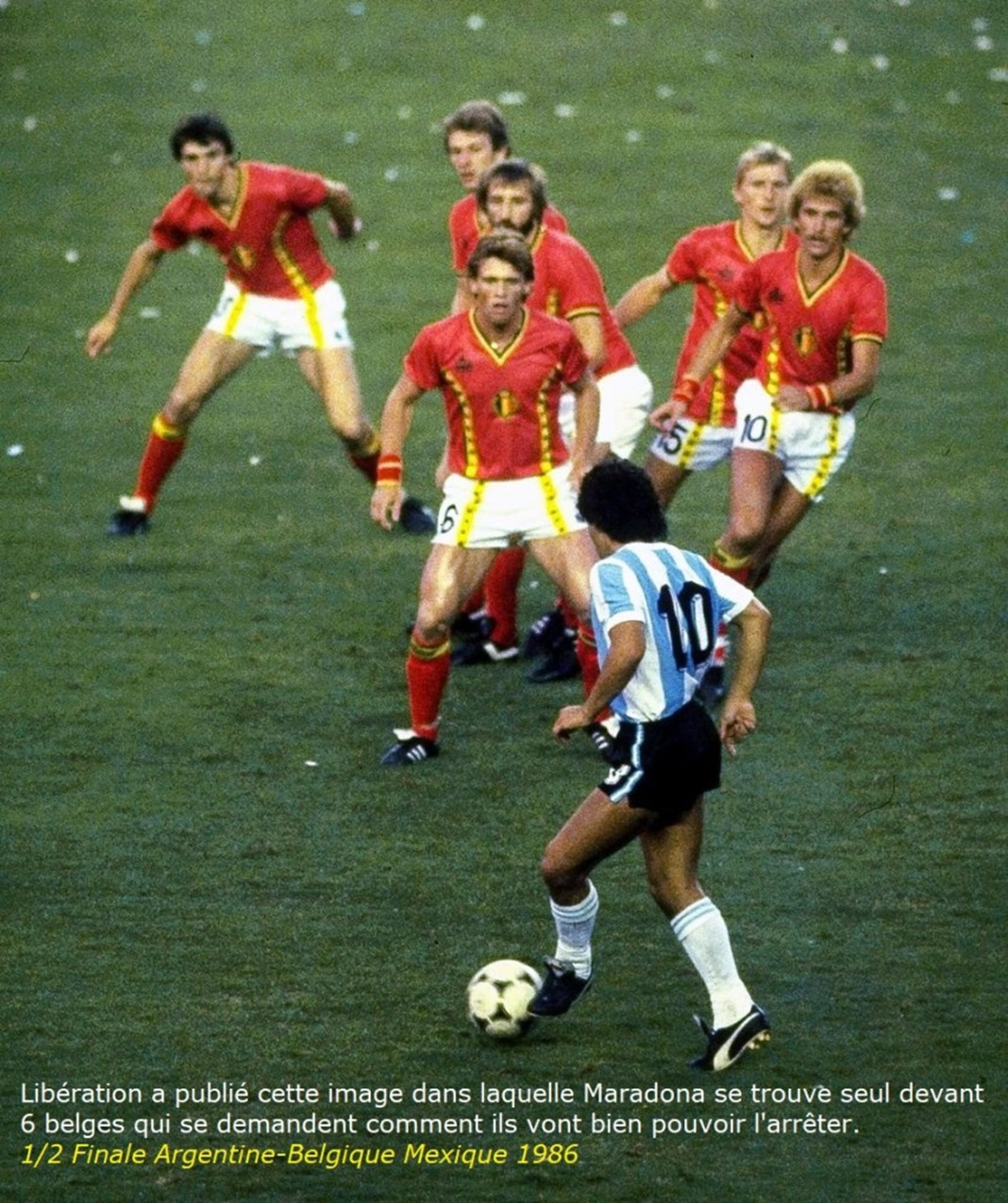
« Aucun footballeur consacré, n’avait jusqu’à présent dénoncé, sans mâcher ses mots, les maîtres du football — bussines. C’est le sportif le plus célèbre et le plus populaire de tous les temps, qui a plaidé en faveur joueurs qui n’étaient ni célèbres, ni populaires.
Cette idole généreuse et solidaire a été capable de commettre, en cinq minutes, les deux buts les plus contradictoires de toute l’histoire du football. Ses dévots le vénèrent pour les deux buts : le premier est un but d’artiste digne d’admiration, dribblé par la diablerie de ses jambes, mais aussi, et peut-être plus, pour son but de « voleur » que sa main a dépouillé.
Diego Armando Maradona a été adoré non seulement pour ses jongleries prodigieuses mais aussi parce que c’est un Dieu sale, pécheur, le plus humain des dieux. N’importe qui pourrait se reconnaître en lui, une synthèse ambulante des faiblesses humaines, ou du moins masculines : un coureur de filles, un glouton, un ivrogne, un tricheur, un menteur, un fanfaron, un irresponsable.
Mais les dieux ne partent pas à la retraite, aussi humains soient-ils.
Il n’a jamais pu retourner dans la multitude anonyme d’où il venait. La renommée, qui l’avait sauvé de la misère, l’a fait prisonnier.
Maradona a été condamné à se prendre pour Maradona et obligé d’être l’étoile de chaque fête, le bébé de chaque baptême, le mort de chaque veillée.
Plus dévastateur que la cocaïne, est, la réussite. Les analyses d’urine ou de sang, ne dénoncent pas cette drogue. »
Et quand l’écrivain uruguayen est décédé, en 2015, Maradona lui a rendu hommage par <ces mots>
« Merci pour m’avoir appris à lire le football. Merci d’avoir lutté comme un n°5 au milieu du terrain et d’avoir marqué des buts aux puissants comme un n°10. Merci de m’avoir compris, aussi. Merci Eduardo Galeano, dans une équipe il en manque beaucoup des comme toi. »
<1497>
-
Jeudi 26 novembre 2020
« Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. »Albert Camus, « Le premier homme », Page 39Et je finirai cette série de mots du jour sur Albert Camus en tirant, une dernière fois, « une pépite » du « premier homme ».
Elle s’adresse à de rares homo sapiens, Albert Camus est probablement l’un d’eux.
Cette phrase est extraite du chapitre 3 : « St Brieuc et Malan (J. G.) » et qui dans le manuscrit était accompagné de cette annotation : « chapitre à écrire et à supprimer. »
Jacques Cormery visite son vieil ami et maître Victor Malan, et dîne avec lui.
Cet épisode suit la découverte par Cormery de la tombe de son père dans le carré militaire de Saint Brieuc.
Dans la vraie vie Victor Malan, est probablement Jean Grenier. A dix-sept ans, élève au lycée d’Alger, Albert Camus eut comme professeur de philosophie Jean Grenier qui le poussera à l’écriture. Camus lui dédiera son premier livre : « L’envers et l’endroit. ».
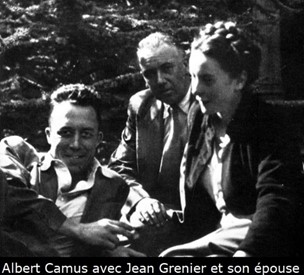 Ils devinrent amis et entreprirent une correspondance qui a été publiée. Jean Grenier consacrera un livre à son ancien élève après sa mort, en 1968 : « Albert Camus, souvenirs »
Ils devinrent amis et entreprirent une correspondance qui a été publiée. Jean Grenier consacrera un livre à son ancien élève après sa mort, en 1968 : « Albert Camus, souvenirs »
Il lui parle de sa quête de recherche du père. Malan est plutôt dubitatif et lui objecte la difficulté de connaître même nos proches.
Jacques déclare son amitié à Malan
« Parce que je vous aime, dit calmement Cormery
Malan tira vers lui le saladier de fruits rafraichis et ne répondit rien
– Parce que, continua Cormery, lorsque j’étais très jeune, très sot et très seul, vous vous êtes tourné vers moi, et vous m’avez ouvert sans y paraître les portes de tout ce que j’aime en ce monde.
– Oh ! Vous êtes doué.
– Certainement. Mais aux plus doués il faut un initiateur. Celui que la vie un jour met sur votre chemin, celui-là doit être pour toujours aimé et respecté, même s’il n’est pas responsable. C’est là ma foi ! »
Page 38
Et un peu plus loin, ils entament une discussion sur la vie et la mort qui se conclut ainsi :
« – Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence (Cormery)
– Oui, et ils meurent. (Malan)
Pendant leur silence, le vent souffla un peu plus fort autour de la maison. »
Page 39
Je ne sais pas à qui s’adresse cette phrase. A son ami ? à son père ? à d’autres ?
Mais je crois qu’on peut aujourd’hui la reprendre pour Albert Camus.
Jean Daniel qui était aussi ami de Camus a écrit :
« Reste que l’influence de Camus a été considérable mais que c’est pourtant aujourd’hui seulement que l’on en voit les traces. Le combat contre l’absolu, la révolte à l’échelle humaine, l’acceptation que l’homme doit faire son métier d’homme sans certitude de réussite et sans promesse de salut sont des idées qui nourrissent plus ou moins directement les œuvres de nombre de penseurs et d’essayistes de tous pays. »
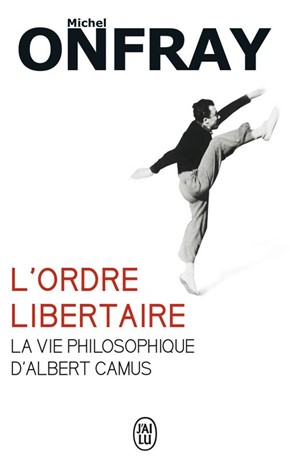 Michel Onfray qui a écrit des ouvrages sur Sartre, Freud et Camus donne le jugement suivant dans un article d’un journal canadien <La Presse.CA> :
Michel Onfray qui a écrit des ouvrages sur Sartre, Freud et Camus donne le jugement suivant dans un article d’un journal canadien <La Presse.CA> :
« Je tiens pour une impossibilité de séparer la vie et l’œuvre, la pensée et l’existence. Une philosophie ne m’intéresse que si le philosophe a tâché de la vivre et ne s’est pas contenté de rêver sa pensée. L’histoire de la philosophie est pleine de faussaires qui ont enseigné une chose et pratiqué l’inverse… […] De fait, si l’on tire le fil de la pelote Freud ou Sartre, par exemple, on ne trouve que des occasions de déception tant la création de leur légende par ces gens assoiffés de célébrité a conduit leur vie et leur œuvre. Avec Camus, on découvre une même cohérence, mais dans le sens inverse : la fidélité aux gens modestes, aux sans-voix qui constituent son milieu familial. Rien ne permet de prendre Camus en défaut de droiture, de moralité, de rectitude, pas un seul faux-pas, nulle bassesse… Catherine Camus, sa fille, me rapporte que de temps en temps, elle découvre encore des histoires concernant son père : toutes vont dans le même sens : une grandeur modeste, une discrétion vraie, une pudeur certaine. Camus a fait beaucoup de belles choses dont il ne s’est jamais vanté – aider concrètement des gens dans le besoin, intervenir pour libérer des prisonniers, solliciter des demandes de grâce pour une centaine de condamnés à mort du FLN par exemple […]
dire de Camus qu’il eut un trajet impeccable pendant la guerre, qu’il cherche à s’engager à deux reprises en 1939, qu’on le refuse parce qu’il est tuberculeux, qu’à Oran, il donne des cours à des enfants juifs privés de scolarité par le régime de Vichy, qu’il entre en résistance, rédige les Lettres à un ami allemand, publie des textes dans de revues clandestines, travaille à La peste, grand roman antifasciste, dirige Combat, journal clandestin, y écrit […]. Sartre n’a pas lutté contre les fascismes européens, il a légitimé tous les fascismes de gauche jusqu’à sa mort, Camus a combattu contre toutes les formes prises par la peine de mort. On peut préférer l’un à l’autre en dehors de toute détestation ou vénération … »
Et en conclusion je donnerai la parole à André Brink, l’auteur sud-africain, grande figure de la lutte contre l’apartheid et proche de Nelson Mandela a écrit :
« Camus le juste […]
Camus a fourni une définition du « héros » de notre temps à laquelle toute une génération a pu s’identifier de par le monde, de James Dean à Vladimir et Estragon, et de Vaclav Havel et Lech Walesa à Barack Obama : non pas l’homme qui conquiert ou qui triomphe, mais celui qui persiste. Yes, we can.
Il n’est pas étonnant que le « révolté » de Camus définisse sa conception de la dignité humaine, et des droits de l’homme : « Je me révolte, donc nous sommes. » Dans un monde qui a connu Auschwitz et le Rwanda, la Somalie et la Birmanie, « l’Homme révolté » est devenu une figure plus emblématique encore qu’à l’époque où Camus en brossa le portrait. La révolte d’une poignée de jeunes gens « égarés » dans « les Justes» finira par conduire à la chute des tsars ; et ironiquement – absurdement – leur chute rendra inévitable celle de leurs successeurs, partout dans le monde.
J’ai vu le carrefour de Sarajevo où fut assassiné l’archiduc François-Ferdinand. J’ai contemplé les ruines du mur de Berlin. J’ai vu Mandela, la tête haute, sortir de prison. Et je sais que chaque fois c’est une nouvelle fin, un nouveau commencement. Rien n’est jamais définitif. Mais cela ne saurait nous retenir d’exiger toujours plus. Camus est encore parmi nous.
A la fin des « Justes » figure un bref épisode qui est à mes yeux le plus grand moment de la pièce : Stepan – Stepan le dur, le pragmatique, l’impitoyable ! – raconte à Dora – Dora la douce, la féminine, l’émotive – les derniers instants de Yanek avant sa pendaison. Il est resté absolument immobile tandis qu’on lui lisait son arrêt de mort, à l’exception d’un geste infime: «Une fois seulement, il a secoué sa jambe pour enlever un peu de boue qui tachait sa chaussure.» Que peut-on imaginer de plus insignifiant, de plus dérisoire, de plus absurde ?
Et pourtant, c’est en débarrassant le monde d’une infime tache de boue, puis d’une autre, que l’on peut prouver que les hommes ne sont pas faits pour être souillés. Et que le monde n’est pas censé être un lieu de poussière et de boue, mais de pureté et de lumière.
Voilà pourquoi, dans ce monde sali, Camus nous demeure aussi indispensable qu’il le fut de son vivant.»
Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence.

<1496>
-
Mercredi 25 novembre 2020
« [Notre] tâche consiste à empêcher que le monde se défasse. »Albert Camus, discours de remerciement du Nobel, le 10 décembre 1957 à StockholmC’est le 16 octobre 1957 que l’Académie suédoise annonce l’attribution du prix Nobel de littérature à Albert Camus.
Selon divers témoignages et aussi ses échanges avec Roger Martin du Gard, il est déstabilisé par cette consécration qu’il trouve trop précoce. Nous savons aujourd’hui qu’il était déjà tard dans son horloge de vie, il ne lui restait guère que deux ans à vivre, les années 1958 et 1959.
Camus pensait que le Nobel aurait plutôt dû revenir à Malraux qui était son ainé de 12 ans. Camus appelait Malraux : « Le maître de ma jeunesse ». Malraux n’aura jamais le Prix Nobel, contrairement à Sartre, à qui il sera décerné en 1964, mais il le refusera.
<TELERAMA> qui a consacré un long article biographique à Camus raconte ses doutes et même évoque la tentation du suicide
« Quand on lui décerne le prix Nobel, en octobre 1957, il a selon son expression « mal à l’Algérie ». Malraux lui semblait, paraît-il, plus digne que lui d’être distingué. Mais pourquoi ce malaise, qui lui donna, au témoignage de Catherine Sellers, des envies de suicide ? Sans doute le sentiment qu’on l’enterrait dans un panthéon à l’époque où il souhaitait renouveler son œuvre. Et aussi l’acharnement, pour l’occasion, de ses vieux ennemis et d’anciens amis, comme Pascal Pia. »
Nous avons compris que la vie à Paris devenait intenable pour Camus depuis que les sartriens l’avaient mis au ban pour son opposition au communisme et aussi ses positions sur le conflit algérien.
<Gallimard> a mis en ligne les échanges épistolaires entre Albert Camus et Roger Martin du Gard qui avait reçu le prix Nobel quelques années auparavant. Roger Martin du Gard rassure Camus sur sa légitimité d’avoir cette consécration et lui donne des conseils pour tout ce qui va se passer à Stockholm.
Dans une lettre du 1er décembre Camus répondra à Martin du Gard :
« Ce que vous me dites du discours Nobel m’aidera, et me terrorise aussi. Je crois que je vais essayer de dire ce qu’est pour moi le rôle de l’écrivain. J’ai commencé, puis déchiré – recommencé, et je sens que je vais tout reprendre. Ah ! j’ai hâte de revenir à mon travail, et au silence ! J’ai maintenant le programme complet de Stockholm. Pour un homme qui a toujours fui les lieux officiels, quelle indigestion ! »
Le discours de Camus parlera donc du rôle de l’écrivain, mais pas que…
En fait il y aura plusieurs discours. Tout d’abord, le discours de remerciement officiel, aussi appelé le discours du banquet le 10 décembre. Entre temps il y aura le 12 décembre, la rencontre à la Maison des Étudiants à Stockholm que nous avons évoqué hier. Et puis, le 14 décembre à l’université d’Upsala, il fera un second discours plus long.
 Ce mot du jour évoquera uniquement le discours de remerciement du 10 décembre. Vous le trouverez dans une version audio : <ICI>. La version rédigée peut être trouvée derrière ce lien : <Albert Camus banquet speech 1957>
Ce mot du jour évoquera uniquement le discours de remerciement du 10 décembre. Vous le trouverez dans une version audio : <ICI>. La version rédigée peut être trouvée derrière ce lien : <Albert Camus banquet speech 1957>
Ou encore en version téléchargeable : Discours du Nobel 10 décembre 1957 Camus
Vous pouvez aussi trouver ce discours et le discours d’Upsala sur ce site de l’éducation nationale : <Les Discours de stockholm>
Je vais en tirer trois extraits qui me semblent particulièrement porteurs de sens et notamment dans les temps d’incertitudes que nous vivons aujourd’hui.
Le premier extrait concerne le positionnement de l’écrivain, il choisit son camp. C’est le camp des humbles. Les anglais parlent de « winner » et de « looser ». Camus prend le parti des loosers. Mais il le prend autrement que Sartre et ceux de ses semblables qui avant de s’occuper des loosers détruisent les libertés et créent une nouvelle corporation de « winner » : la nomenklatura du parti qu’ils soutiennent.
« Par définition, il ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent.
Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie avec leurs millions d’hommes ne l’enlèveront pas à la solitude, même et surtout s’il consent à prendre leur pas. Mais le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l’autre bout du monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil chaque fois, du moins, qu’il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence, et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l’art. »
Un autre extrait m’a interpellé. Car pour beaucoup aujourd’hui la vérité est une opinion parmi d’autres, il existerait des « vérités alternatives ». Et puis concernant la liberté, elle est risquée car elle empêche de protéger efficacement la population contre le terrorisme, la délinquance et elle constitue peut-être même un frein pour une préservation optimum de la santé.
« La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d’avance de nos défaillances sur un si long chemin. »
La vérité est mystérieuse et fuyante. N’est ce pas la réflexion la plus raisonnable quand tous les jours apparaissent de nouveaux discours de complots plus abracadabrants les uns que les autres. Ce n’est pas qu’il n’existe pas des cupides prêts à profiter de toute crise, de tout moment d’égarement pour faire des surplus de profits. Mais je reprendrai ce mot de Michel Rocard :
« Toujours préférer l’hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante. Le complot demande un esprit rare. »
La recherche de la vérité est exigeante et difficile, souvent le doute l’emporte.
Et la liberté ! Camus rappelle qu’elle est dangereuse. Dans les pays autoritaires, munis d’un grand nombre de policiers au m² il y a certainement un peu moins de délinquance et aussi beaucoup moins de liberté. La Chine a su plus efficacement lutter contre la pandémie. Même si elle n’a pas révélé le vrai nombre de victimes, il est clair qu’aujourd’hui elle a maîtrisé l’épidémie. Mais elle a réalisé cette performance dans un contexte de restriction des libertés individuelles effarant. Le gouvernement de la France dans l’objectif de lutter contre le terrorisme, de protéger la police, de contrôler les débordements des réseaux sociaux laisse libre cours à sa créativité pour multiplier les lois qui restreignent les libertés, liberticides disent certains.
La liberté est dangereuse, disait Camus oui mais elle est exaltante.
Et puis, je sélectionne un troisième extrait. J’en ai fait l’exergue de ce mot du jour.
Quand Camus prononce ces mots, le monde vient simplement de mettre à bas l’horreur et la terreur nazis. Les régimes criminels de l’Union soviétique, de ses satellites, de la Chine sont toujours au pouvoir. Le combat des deux camps celui de l’oppression par l’argent et celui de l’oppression par le goulag était lourd de dangers.
Et la bombe atomique avait été utilisé à Hiroshima et à Nagasaki. Contrairement au soulagement de ceux qui ont approuvé parce qu’ils ont pensé qu’elle avait hâté la fin de la guerre, Camus a immédiatement écrit son malaise, son inquiétude sur les perspectives de « suicide collectif » de l’humanité.
Probablement, pense t’il aussi au destin de l’Algérie qui lui tient tant à cœur et qui se déchire et va vers une solution qu’il ne désire pas. Alors il dit :
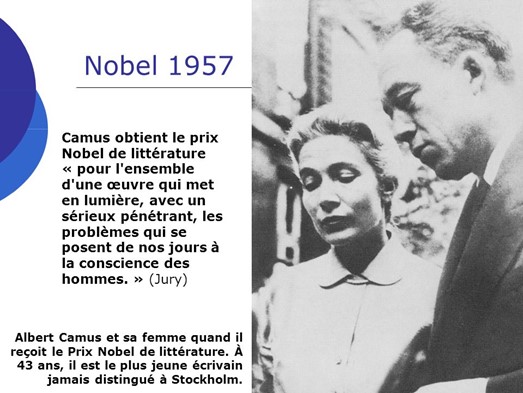 « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d’une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd’hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l’intelligence s’est abaissée jusqu’à se faire la servante de la haine et de l’oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d’elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d’établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu’elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d’alliance. Il n’est pas sûr qu’elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et, à l’occasion, sait mourir sans haine pour lui. C’est elle qui mérite d’être saluée et encouragée partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. C’est sur elle, en tout cas, que, certain de votre accord profond, je voudrais reporter l’honneur que vous venez de me faire. »
« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d’une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd’hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l’intelligence s’est abaissée jusqu’à se faire la servante de la haine et de l’oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d’elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d’établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu’elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d’alliance. Il n’est pas sûr qu’elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et, à l’occasion, sait mourir sans haine pour lui. C’est elle qui mérite d’être saluée et encouragée partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. C’est sur elle, en tout cas, que, certain de votre accord profond, je voudrais reporter l’honneur que vous venez de me faire. »
N’est ce pas aussi notre tâche sur une terre qui aujourd’hui est confrontée à une pandémie qui sera probablement vaincue d’ici quelques mois ou années, mais dont nous percevons quelle sera suivi d’autres.
L’inégalité entre les grandes régions du monde a diminué, mais l’inégalité au sein des sociétés de chacune des régions du globe a augmenté. La crise économique et sociale qui est là et qui vraisemblablement s’aggravera, va augmenter ces déséquilibres.
Le climat de la terre est en train de s’emballer en raison de notre démesure, de notre soif de consommer, de l’expansion de l’espèce humaine au détriment de toutes les autres espèces vivantes.
Ce dernier point pose, en outre, le problème de la baisse de la biodiversité qui est nécessaire à une vie humaine harmonieuse.
De nouveaux conflits s’annoncent entre une puissance économique et militaire en plein désarroi et minée par ses fractures internes et une puissance totalitaire, sûre de ses valeurs, considérant comme un juste retour de l’Histoire de retrouver la première place volée par les occidentaux.
J’arrête là, le contexte est déjà suffisamment anxiogène.
Mais je crois que le vœu de Camus est aussi indispensable à notre temps qu’au sien : notre tâche est d’empêcher que le monde se défasse.
Sur cette Page de France Culture : <écrire, un art de vivre par temps de catastrophe>, il est question de Camus, du Nobel et des sujets abordés ici.
Et sur cette page de France Inter, vous entendrez Vincent Lindon lire le discours de Camus : <Quand Vincent Lindon lit le « discours de Stockholm » d’Albert Camus>
<1495>
-
Mardi 24 novembre 2020
« En ce moment on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère. »Albert Camus, conférence à la maison des étudiants à Stockholm le 12 décembre 1957Quand Camus reçoit le Prix Nobel en 1957, il est ostracisé par l’intelligentsia parisienne dominée par Sartre. Il lui reste quelques rares amis : Louis Guilloux, René Char, Jules Roy et Roger Martin du Gard. Tous les autres sont contre lui, à le dénigrer, à attendre la moindre maladresse ou prétendue telle pour s’en prendre à lui
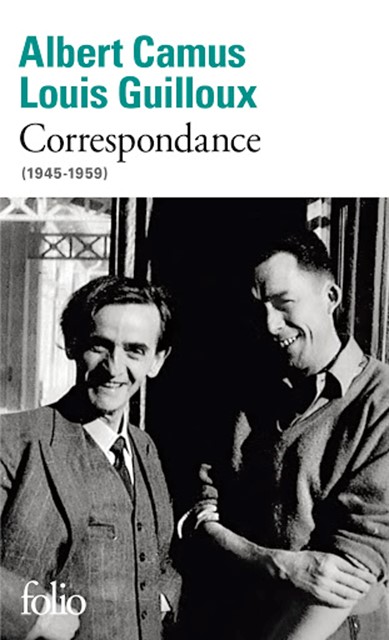 Après son remarquable discours de réception du prix Nobel, sur lequel je reviendrai demain, il participe à diverses réunions à Stockholm.
Après son remarquable discours de réception du prix Nobel, sur lequel je reviendrai demain, il participe à diverses réunions à Stockholm.
Et c’est ainsi qu’il participe à une rencontre, le 12 décembre 1957, à la Maison des Étudiants à Stockholm, au milieu d’étudiants suédois. Mais des jeunes du FLN algérien sont aussi présents. Et un de ces jeunes va l’interpeller assez brutalement sur ce qui se passe en Algérie et lui demander de prendre parti pour l’indépendance de l’Algérie.
Pour comprendre cet épisode, il faut savoir quelques précisions sur la vision de Camus du conflit algérien.
Dans ma série de mots du jour, je n’en ai consacré aucun à l’Algérie et à la position si singulière de Camus qui se heurtait au train de l’Histoire. Lui rêvait d’une Algérie et d’une France unies dans une grande fédération dont tous les citoyens auraient les mêmes droits. Il avait en 1957 lancé à Alger « L’appel pour une trêve civile » dans lequel il entendait que cesse à la fois la répression féroce de l’armée française et les attentats des indépendantistes algériens. Les deux camps l’ont alors injurié et il a dû quitter l’Algérie car sa vie était menacée. A partir de ce moment il a décidé de se taire au sujet de l’Algérie, il comprenait que l’indépendance était inéluctable.
Michel Onfray explique il me semble assez précisément la pensée de Camus sur ce sujet dans <un article de 2012 du Point>:
« Personne n’a autant aimé l’Algérie qu’Albert Camus, dont c’était la terre natale. C’était aussi celle de sa famille depuis 1830. Il n’a jamais soutenu le régime colonial, il l’a même clairement attaqué à l’époque où Sartre ne sait même pas qu’il existe ! En 1935, à Alger, il entre au Parti communiste pour rester fidèle à son milieu, mais aussi parce qu’à l’époque le PC campe sur une ligne anticolonialiste, antifasciste et antimilitariste. Lorsque, pour des raisons stratégiques, le PCF change de ligne et remise l’anticolonialisme au nom de l’antifascisme, Camus, fidèle à ses idées, quitte un PC infidèle à sa ligne. Nous sommes en 1937.
Cette même année, il soutient la cause arabe en prenant fait et cause pour le projet Blum-Viollette issu du Front populaire. Ce projet propose aux populations musulmanes algériennes une égalité citoyenne avec les Français du continent. Camus défend ce projet et travaille à Alger républicain, un journal créé pour défendre ce combat […] En 1939, il publie une série d’articles dans Alger républicain sous le titre « Misère de la Kabylie ». Il dénonce la surpopulation, la misère, le froid, la faim, l’exploitation, la mortalité infantile, le chômage, les salaires misérables, la durée du travail, l’illettrisme, l’esclavage, le travail des enfants… Il écrit : ce régime « est un régime colonial » – il l’accable.
Camus ne se contente pas d’être négatif : il propose également une issue : « le douar-commune », autrement dit une formule du communalisme libertaire. Camus propose l’autogestion des Kabyles par eux-mêmes, pour eux-mêmes. […]
Camus défend la même idée lors des événements d’Algérie. Cette troisième célébration de l’Algérie récuse l’enfermement sartrien. Loin d’Alger, à Saint-Germain-des-Prés, Sartre pense les choses en termes binaires : les Blancs sont tous colons, exploiteurs, esclavagistes, fascistes, dominateurs ; les musulmans, tous colonisés, exploités, esclaves, martyrs, dominés. D’un côté, les bourreaux ; de l’autre, les victimes. Ici, les salauds ; là, les héros. Ne pas choisir le camp de l’un, c’est faire partie du camp de l’autre. Sur le papier, la chose est terrible ; dans les faits, cette fiction conceptuelle entraîne des massacres sans nom de part et d’autre.
Parce qu’il connaît l’Algérie et que son père, blanc, était ouvrier agricole et sa mère, blanche, femme de ménage, tous deux exploités par les colons richissimes, arrogants et suffisants, il sait que le problème est plus complexe que ne l’imagine un intellectuel dans son bureau parisien. Le colonialisme est à abattre, pas les Blancs parce qu’ils sont blancs. L’origine européenne n’a pas à être pensée comme un péché originel que les descendants devraient expier éternellement : Camus n’a pas choisi, voulu, décidé, contribué à la colonisation de l’Algérie. Et, la plupart du temps, les colons furent – le sait-on ? – des pauvres, des miséreux, des quarante-huitards exilés par le pouvoir parisien, des orphelins ou des mendiants récupérés par la police, qui remplissait les bateaux de ces émigrés qui n’avaient rien du conquérant tel qu’on le représente dans les romans…
Camus écrit : « Quatre-vingts pour cent des Français d’Algérie ne sont pas des colons, mais des salariés ou des commerçants » (Actuelles III. Chroniques algériennes, 1939-1958, Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, t. IV, p. 359). Mais, à Paris, dans les salons, on n’a que faire de l’Histoire, de la sociologie et de la vérité, on déclare de façon péremptoire que le Blanc essentialisé est l’ennemi à abattre et à égorger, comme y invite Sartre dans sa préface aux Damnés de la terre. »
L’article est beaucoup plus long mais je pense qu’ainsi le décor est planté et il est possible de parler de cette conférence et de l’interpellation du jeune algérien.
Un journaliste du Monde, Dominique Birmann est présent. Il va écrire un article qui sera publié le 14 décembre 1957 : < Albert Camus a exposé aux étudiants suédois son attitude devant le problème algérien> et que nous pouvons toujours lire dans les archives du Monde.
Et c’est par cet article que le microcosme parisien va apprendre que Camus préfère sa mère à la justice.
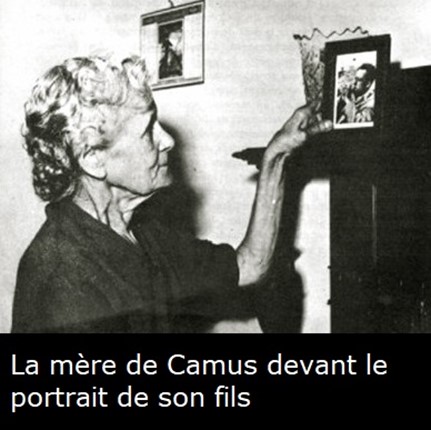 Voici ce qu’écrit l’article :
Voici ce qu’écrit l’article :
« Un représentant du F.L.N. à Stockholm demanda alors à Camus pourquoi il intervenait si volontiers en faveur des Européens de l’Est mais ne signait jamais de pétition en faveur des Algériens. A partir de ce moment le dialogue devint confus et dégénéra en un monologue fanatique du représentant du F.L.N., qui lança slogans et accusations, empêcha l’écrivain de Prendre la parole et l’insulta grossièrement. Cette polémique pénible, à laquelle Camus, ne se départant pas un instant de sa mesure ni de sa dignité, se refusa, scandalisa l’auditoire suédois. La cause du F.L.N., déjà desservie à plusieurs reprises par les maladresses et les outrances de plusieurs de ses propagandistes, a définitivement subi une lourde défaite morale hier à Stockholm, d’autant plus que l’incident a été repris et défavorablement commenté par la presse de la capitale. Camus parvint enfin, non sans peine, à se faire entendre. » Je n’ai jamais parlé à un Arabe ou à l’un de vos militants comme vous venez de me parler publiquement… Vous êtes pour la démocratie en Algérie, soyez donc démocrate tout de suite et laissez-moi parler… Laissez-moi finir mes phrases, car souvent les phrases ne prennent tout leur sens qu’avec leur fin… »
Après avoir rappelé qu’il a été le seul journaliste français obligé de quitter l’Algérie pour en avoir défendu la population musulmane, le lauréat Nobel ajouta : » Je me suis tu depuis un an et huit mois, ce qui ne signifie pas que j’aie cessé d’agir. J’ai été et suis toujours partisan d’une Algérie juste, où les deux populations doivent vivre en paix et dans l’égalité. J’ai dit et répété qu’il fallait faire justice au peuple algérien et lui accorder un régime pleinement démocratique, jusqu’à ce que la haine de part et d’autre soit devenue telle qu’il n’appartenait plus à un intellectuel d’intervenir, ses déclarations risquant d’aggraver la terreur. Il m’a semblé que mieux vaut attendre jusqu’au moment propice d’unir au lieu de diviser. Je puis vous assurer cependant que vous avez des camarades en vie aujourd’hui grâce à des actions que vous ne connaissez pas. C’est avec une certaine répugnance que je donne ainsi mes raisons en public. J’ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s’exerce aveuglément, dans les rues d’Alger par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » »
Cette phrase sera immédiatement simplifiée : « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère »
Le directeur du Monde Hubert Beuve-Méry dira :
« J’étais tout à fait certain que Camus dirait des conneries »
Et cela, c’était la version paternaliste. Les sartriens déverseront un flot d’immondices verbaux devant ce défenseur des petits blancs qui a définitivement versé dans la droite réactionnaire.
Mais Camus n’a pas dit les choses ainsi. Depuis nous avons <la version> de Carl Gustav Bjurström qui fut le traducteur suédois, tout au long du séjour de Camus en Suède.
« La formulation « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère » est à la fois inexacte et tronquée. Si ma mémoire est bonne, il a dit : « En ce moment on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère. » C’est vrai qu’il est « sentimental » de dire qu’on préfère sa mère à la justice. En tant qu’écrivain, l’expression de sa position était beaucoup plus nette : que ce soit pour une bonne cause ou pour une mauvaise, le terrorisme reste le terrorisme. Lancer des bombes au milieu de gens dont le seul tort est d’exister est inadmissible. Cela dit, je crois que, sur le coup, cette phrase est passée inaperçue dans le mouvement du débat. Et personne n’a alors prévu l’exploitation qu’on allait en faire. En France, c’était différent : l’affaire d’Algérie avait déjà provoqué un ressentiment contre Camus, à qui on reprochait une attitude très timorée. Ainsi retranscrits, ses propos ont fait l’effet d’une bombe. »
Et il ajoute qu’il ne s’est trouvé personne à l’époque pour rétablir la vérité en diffusant la réponse intégrale de Camus.
Camus n’opposait pas la justice à sa mère, mais dénonçait le terrorisme et la violence aveugle.
Il revient toujours au mot de son père « un homme ça s’empêche »
Dans les « Eléments pour Le premier homme » il a écrit son attachement viscéral à sa mère :
« Aux Arabes. Je vous défendrai à n’importe quel prix, sauf au prix de ma mère, parce qu’elle a connu, plus que vous, l’injustice et la douleur. Et, si dans votre rage aveugle, vous touchez à elle ou risquez d’y toucher, je serai votre ennemi jusqu’au bout. »
(Bibliothèque de la Pléiade IV, p. 918.)
 Nous connaissons maintenant la fin de l’Histoire. Le jeune homme qui interpella Camus se nomme Saïd Kessal.
Nous connaissons maintenant la fin de l’Histoire. Le jeune homme qui interpella Camus se nomme Saïd Kessal.
José Lenzini a écrit : « Les Derniers Jours de la vie d’Albert Camus » (Actes Sud).
Bernard Pivot a consacré un article à ce livre et à José Lenzini dans le JDD du 21 novembre 2009 : < Albert Camus et l’Algérien de Stockholm> :
« […] l’Algérien est aujourd’hui octogénaire. Il habite toujours Stockholm. Il s’appelle Saïd Kessal. José Lenzini l’a récemment retrouvé et interviewé. […] Saïd Kessal, l’Algérien de Stockholm retrouvé par José Lenzini, s’était senti humilié par la façon dont Camus lui avait répondu. Il ne connaissait pas alors son œuvre. Il a d’abord lu Misère de la Kabylie. « Ce fut un choc pour le Kabyle que je suis. » De la lecture de tous les livres de Camus il est sorti « bouleversé ». Il décida ensuite de le rencontrer. « Je suis allé voir Jules Roy, qui m’a dit qu’il venait de se tuer en voiture. Alors, je suis descendu à Lourmarin et j’ai déposé des fleurs sur sa tombe. » »
La mère de Camus s’appelait Catherine Hélène Sintès. Elle était née en novembre 1882. Quand on lui apprit la mort de son fils elle dit simplement :
« C’est trop jeune pour mourir ».
Elle quittera le monde des vivants la même année qu’Albert Camus, en septembre 1960.
<1494>
-
Lundi 23 novembre 2020
« Nous étions brouillés, lui et moi »Jean-Paul Sartre à propos de Camus, le lendemain de son accident mortel<L’Obs> a republié le texte dans lequel Sartre essayait de rendre hommage à Camus le lendemain de sa mort. Cet hommage commence ainsi :
« Nous étions brouillés, lui et moi une brouille, ce n’est rien – dût-on ne jamais se revoir -, tout juste une autre manière de vivre ensemble et sans se perdre de vue dans le petit monde étroit qui nous est donné. »
Décrite ainsi, cette brouille pourrait paraître «gentille». Mais elle ne le fut pas du tout. Ce fut plutôt un lynchage, un ostracisme du monde intellectuel parisien.
Car à cet époque, Sartre dominait le monde intellectuel parisien et il est courant d’exprimer cette phrase qui serait de Jean Daniel : « J’aime mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron ». Parce que Raymond Aron était classé à droite. Mais ce qui opposait Raymond Aron et Sartre était fondamentalement le même sujet que Camus et Sartre : Sartre défendait coûte que coûte les régimes communistes alors que Raymond Aron et Camus les vilipendaient en raison de leurs atteintes incommensurables à la liberté et aux droits humains. Raymond Aron leur reprochait aussi leur inefficacité économique.
Dans un < article de Libération publié en juillet 2017>, le journaliste Philippe Douroux, s’est rangé comme toute la gauche responsable derrière ce constat :
« Raymond Aron avait raison, hélas ! »
 Après avoir vécu quelques temps à Oran avec son épouse Francine Faure, Camus va rejoindre, en pleine guerre, Paris. Il rencontrera Sartre et Simone de Beauvoir et ils furent bons amis. Mais alors que Camus entre dans la résistance et dirige le journal « Combat », Sartre et Beauvoir ne s’engagent pas dans l’action contre les nazis. Selon <Michel Onfray> ils participeront même à des médias collaborationnistes :
Après avoir vécu quelques temps à Oran avec son épouse Francine Faure, Camus va rejoindre, en pleine guerre, Paris. Il rencontrera Sartre et Simone de Beauvoir et ils furent bons amis. Mais alors que Camus entre dans la résistance et dirige le journal « Combat », Sartre et Beauvoir ne s’engagent pas dans l’action contre les nazis. Selon <Michel Onfray> ils participeront même à des médias collaborationnistes :«Camus fut un adversaire philosophique terrible et Sartre a lâché les chiens contre lui. Sartre n’a rien compris à la politique : il n’a rien vu de la montée du nazisme, bien que vivant en Allemagne ; en 1933, il profite d’une offre faite par les fascistes italiens pour partir en vacances en compagnie de Beauvoir avec des billets à prix réduits ; il passe à côté de la Résistance ; il publie dans Comoedia, un journal collaborationniste, en 1941 et en 1944 ; il pistonne Beauvoir à Radio Vichy, où elle travaille, etc.»
Un article de <TELERAMA> détaille la genèse et les méandres de la querelle qui va les séparer.
Je n’en tire qu’un court extrait :
« Ce qui va séparer Sartre et Camus est la question communiste, la grande question de l’après-guerre. Camus, à Alger, a été communiste ; il connaît le Parti, sa grandeur quand il s’agit des militants pris individuellement, son dogmatisme bureaucratique quand il s’agit de l’appareil ; il se méfie des dirigeants, de leur soumission à Staline. Sartre, lui, n’a aucune expérience de l’action, il se pose des questions de principes et de théorie, en intellectuel. »
Un article récent du philosophe Roger-Pol Droit publié dans le journal « Les Echos » en dissèque les contradictions et les points saillants : <Camus-Sartre, on refait toujours le match>
« Entre lui et Jean-Paul Sartre, l’amitié avait laissé place à un conflit aigu entre deux conceptions de la politique et du rôle des intellectuels. […] leur querelle a marqué en profondeur, et jusqu’à nos jours, l’histoire intellectuelle et politique. »
A l’origine une réelle admiration réciproque les rapprochait :
« Avant de se rencontrer, ils ont commencé par se lire et s’apprécier, et même s’admirer, par romans interposés. Le jeune Camus, encore en Algérie, s’enthousiasme, en 1938, pour le premier roman de Sartre, La Nausée. Il en rend compte avec ferveur dans l’Alger républicain, le journal progressiste dans lequel il écrit. De son côté, Sartre lit L’Etranger dès sa parution en 1942. Il ne cache pas son engouement pour le jeune écrivain, parle abondamment de son talent, contribue à le faire connaître dans les cercles influents. Sartre, de huit ans l’aîné de Camus, commence ainsi par faire de ce jeune homme ardent, un peu sauvage, artiste plus qu’intellectuel, son protégé dans le petit monde littéraire de Paris occupé. »
Catherine Camus la fille d’Albert nous apprend que Sartre traitait Camus de « petit voyou d’Alger », lui qui était issu de la bourgeoisie parisienne, né dans le XVIème arrondissement. C’était dans le temps de l’amitié, un sobriquet affectueux. Par la suite, dans le temps du conflit ce sera un motif de supériorité, Camus n’ayant pas les mêmes lettres de noblesse que Sartre qui l’accusera de ne rien comprendre à la philosophie.
La dispute viendra de la publication de « L’homme révolté » de Camus et de la position devant le stalinisme :
« Leur entente philosophique et politique va se déliter, peu à peu, sous l’effet de la guerre froide. Un clivage aigu va bientôt séparer les amis des communistes, enclins à tout pardonner des pires méthodes de Staline, et les défenseurs des droits de l’homme, pour qui la révolution et ses lendemains enchantés ne peuvent justifier ni le totalitarisme de la dictature du prolétariat ni les meurtres de masse qui en découlent. Cette fracture, de plus en plus profonde entre Sartre et Camus, n’est pas visible d’un seul coup. Le fossé va se creuser par étapes. »
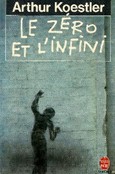 Le premier clivage vient de leur appréhension différente d’un livre que j’ai lu et qui dénonce avec force l’horreur et l’imposture du totalitarisme : « Le Zéro et l’infini » d’Arthur Koestler. Le zéro est l’individu, l’infini est le Parti :
Le premier clivage vient de leur appréhension différente d’un livre que j’ai lu et qui dénonce avec force l’horreur et l’imposture du totalitarisme : « Le Zéro et l’infini » d’Arthur Koestler. Le zéro est l’individu, l’infini est le Parti :
« Camus soutient [ce livre]. En Algérie, il a vu de près, comment fonctionne la discipline communiste. Il refuse de passer sous silence les crimes des staliniens – éliminations, lavages de cerveau, procès truqués, déportations… Sartre, au contraire, choisit bientôt de soutenir coûte que coûte l’Union soviétique et le parti communiste, fût-ce au détriment de la justice et de la morale. Un soir, chez Boris Vian, Camus excédé claque la porte. Ce n’est qu’un premier signe. »
Et en 1951, Camus publie « L’homme révolté » :
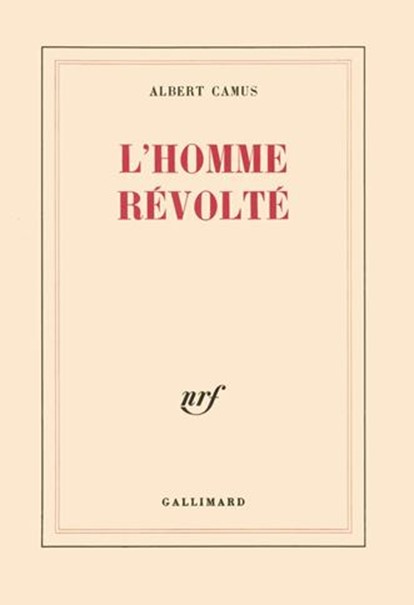 « Dans ce maître-livre, il explique de manière incomparablement simple et forte comment toute révolte renferme un désir de justice, incarne une manière de se dresser contre la soumission, l’humiliation, la domination. Mais les révolutions confisquent ce désir. Elles renforcent le pouvoir de l’État, qui tue la révolte.
« Dans ce maître-livre, il explique de manière incomparablement simple et forte comment toute révolte renferme un désir de justice, incarne une manière de se dresser contre la soumission, l’humiliation, la domination. Mais les révolutions confisquent ce désir. Elles renforcent le pouvoir de l’État, qui tue la révolte.
La Russie est ainsi devenue une « terre d’esclaves balisée de miradors ». La seule issue : se révolter contre la nouvelle oppression qui s’installe. « Tout révolutionnaire finit en oppresseur ou en hérétique », souligne Camus. La révolte, qui semble d’abord un mouvement individuel, devient à ses yeux le fondement du collectif : « Je me révolte, donc nous sommes », écrit le philosophe. »
Ceci va conduire non à une bataille d’arguments mais à une mise au ban, Camus n’est qu’un traître, un renégat, un transfuge parti rejoindre le camp de la bourgeoisie et des ennemis du prolétariat.
Et c’est un de ses aveugles qui adorait avoir tort avec Sartre qui va porter l’estocade :
« En mai 1952, Francis Jeanson se charge d’exécuter L’Homme révolté dans la revue de Sartre et de Simone de Beauvoir. Sa critique consiste à faire de Camus une « belle âme » sans ancrage dans l’histoire réelle : sa conception de la révolte ne tient aucun compte des « infrastructures », comme dit le jargon de l’époque, les bases économiques de la production, donc de la société et de la politique. »
Sartre finira par proclamer que
« Tout anticommuniste est un chien »
Vingt ans plus tard, un autre aveugle, Jean-Jacques Brochier donnera comme titre à un de ses ouvrages « Camus, philosophe pour classes terminales ! »
Pierre Bourdieu choisira le même camp :
« Que l’on pense simplement au Camus de L’homme révolté, ce bréviaire de philosophie édifiante sans autre unité que le vague à l’âme égotiste qui sied aux adolescences hypokhâgneuses et qui assure à tout coup une réputation de belle âme. »
(La distinction, p. 379.)
Aujourd’hui pour Michel Onfray, la victoire de Camus est totale.
Elle est aussi inscrite dans les chiffres :
- Exemplaires de livre de Camus vendus·: 26 millions, Sartre : 15 millions
- Livre le plus vendu de chacun : « L’Etranger » Camus : 9 millions « Huis Clos », Sartre : 3 millions
- Traductions·de Camus : 70 langues, tous titres confondus, Sartre : 47 langues, tous titres confondus.
(Données Gallimard)
Camus est dans l’éthique de la responsabilité : Même pour une cause juste il n’est pas possible de tout faire, de tout accepter. Il revient ainsi au message de son père, un des seuls qu’il a recueilli : « Non, un homme ça s’empêche. Voilà ce qu’est un homme, ou sinon… ».
Sinon ce n’est pas un homme.
Sartre fait partie de ces hommes qui considèrent que les institutions notamment du capitalisme sont violentes et que les combattre permet d’excuser quelques débordements.
C’est aussi une manière d’excuser la violence qui peut exister en nous.
C’est enfin croire que tous les problèmes qui se dressent devant nous sont de la responsabilité d’autres, d’un ou de plusieurs autres. C’est ainsi une fuite devant nos responsabilités propres.
Dans mon esprit, il y a peu de doute que le combat de Camus est le bon combat.
Certains considèrent que ce n’est pas aussi simple. Ainsi Ronald Aronson écrit : « Sartre contre Camus : le conflit jamais résolu ».
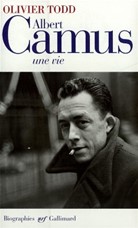 Et le biographe de Camus, Olivier Todd, est aussi plus indulgent pour Sartre :
Et le biographe de Camus, Olivier Todd, est aussi plus indulgent pour Sartre :
« Toute sa vie, Camus a été un homme du doute, incertain de son talent. Sartre, lui, croyait en son génie. Politiquement – aujourd’hui, c’est facile -, je suis plus proche de Camus. J’aimerais aussi qu’on se souvienne que Sartre, crypto-communiste, ne s’est pas toujours trompé. Par exemple, sur Israël et les Palestiniens, sur le Biafra. Il faut cesser de dire qu’il nous a trompés. On s’est trompé avec lui. J’ai de l’admiration pour Camus et je garde de l’affection pour Sartre. J’ai toujours aimé leurs livres. »
Même dans cette réaction mesurée d’Olivier Todd, je garde ma proximité avec Camus car je crois le doute très préférable aux certitudes qui sont l’essence même de l’intolérance et du totalitarisme.
<1493>
- Exemplaires de livre de Camus vendus·: 26 millions, Sartre : 15 millions
-
Vendredi 20 novembre 2020
« Ils savaient maintenant que s’il est une chose qu’on puisse désirer toujours et obtenir quelquefois, c’est la tendresse humaine. »Albert Camus, extrait de « La Peste »Il fallait donc lire « La Peste » puisque nous étions en confinement.
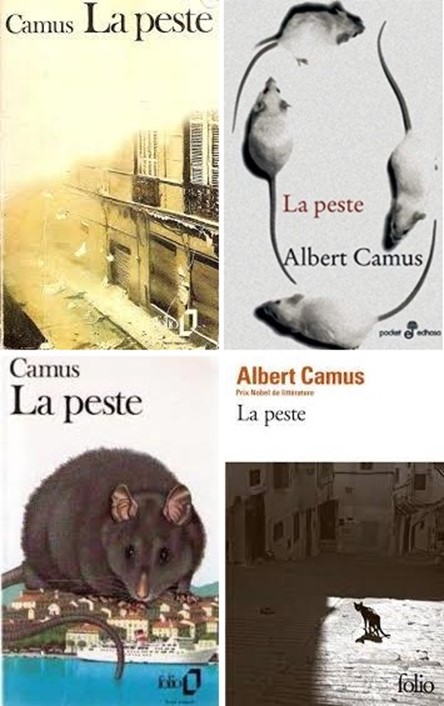 Alors j’ai lu « La Peste », ce roman qui décrit l’apparition de l’épidémie dans la ville d’Oran, la lente prise de conscience du danger, la fermeture des portes de la ville, le confinement, la lutte contre l’épidémie avec au premier plan le docteur Rieux courageux, rationnel, résistant au découragement et puis finalement la fin de l’épidémie qui se termine avec son cortège de morts qu’elle a emporté, la joie et l’allégresse des oranais devant la fin de l’épreuve et les portes de la ville qui s’ouvre.
Alors j’ai lu « La Peste », ce roman qui décrit l’apparition de l’épidémie dans la ville d’Oran, la lente prise de conscience du danger, la fermeture des portes de la ville, le confinement, la lutte contre l’épidémie avec au premier plan le docteur Rieux courageux, rationnel, résistant au découragement et puis finalement la fin de l’épidémie qui se termine avec son cortège de morts qu’elle a emporté, la joie et l’allégresse des oranais devant la fin de l’épreuve et les portes de la ville qui s’ouvre.
Et c’est ainsi que se termine « La Peste » :
« Du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances officielles. La ville les salua par une longue et sourde exclamation. Cottard, Tarrou, ceux et celle que Rieux avait aimés et perdus, tous, morts ou coupables, étaient oubliés. Le vieux avait raison, les hommes étaient toujours les mêmes. Mais c’était leur force et leur innocence et c’est ici que, par-dessus toute douleur, Rieux sentait qu’il les rejoignait. Au milieu des cris qui redoublaient de force et de durée, qui se répercutaient longuement jusqu’au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes multicolores s’élevaient plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui s’achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l’injustice et de la violence qui leur avaient été faites, et pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.
Mais il savait cependant que cette chronique ne pouvait pas être celle de la victoire définitive. Elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu’il avait fallu accomplir et que, sans doute, devraient accomplir encore, contre la terreur et son arme inlassable, malgré leurs déchirements personnels, tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d’admettre les fléaux, s’efforcent cependant d’être des médecins. Écoutant, en effet, les cris d’allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’années endormi dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. »
Cette conclusion est si contrastée : la ville d’Oran exprime l’allégresse de la fin du fléau mais Rieux se souvient de toutes celles et de tous ceux qu’il a aimé et qu’il a perdu dans cette douloureuse épreuve.
Il porte cependant l’humanisme de Camus, sa croyance dans la solidarité possible entre les hommes pour des causes qui les dépassent. Et il affirme que finalement le positif l’emporte sur le négatif : « on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. »
Et qu’en face des épreuves, les hommes malgré leurs faiblesses font face : « tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d’admettre les fléaux, s’efforcent cependant d’être des médecins. »
Mais il y a aussi l’avertissement que l’épidémie peut revenir, car il n’y a pas de victoire définitive.
C’est une chronique en temps de crise. Elle se lit avec intérêt et il est difficile de lâcher ce roman avant de l’avoir fini.
Nous suivons la quête du docteur Rieux dans son sacerdoce laïc du médecin qui soigne, qui perd beaucoup de combats contre la mort et qui continue à soigner sans jamais lâcher prise. Il cherche aussi à entraîner d’autres pour former une équipe qui peut lutter contre l’épidémie.
Mais la lecture, au temps du COVID, surprend quand même. On ne voit pas très bien comment Rieux et les autres soignants se protègent contre cette maladie si infectieuse, beaucoup plus létale que celle qui nous assaille aujourd’hui. Les théâtres, les restaurants et les bars, contrairement à l’Europe de la COVID 19, restent ouverts et les habitants de la ville s’y rendent en nombre.
Le sujet de la peste à Oran est totalement inventé par Camus, elle ne correspond à aucune réalité proche qui se rapprocherait d’une telle épidémie dans une ville.
Camus lui-même n’était pas convaincu par ce livre. Dans une lettre à son ami Louis Guilloux et que reproduit <L’Obs>, il écrit :
« 12 septembre 1946
Je suis bien coupable, mais les choses ne vont pas fort pour moi. […] Au bout du compte, j’ai fini « la Peste ». Mais j’ai l’idée que ce livre est totalement manqué, que j’ai péché par ambition et cet échec m’est très pénible. Je garde ça dans mon tiroir, comme quelque chose d’un peu dégoûtant. […] »
Son biographe Olivier Todd <dit> de même au détour d’une phrase dans laquelle il parle du conflit de Camus avec les Sartriens :
« Il y avait pourtant eu, dans Les Temps modernes, deux articles plus que laudatifs sur les héros de La Peste – livre que je n’aime guère. »
En réalité, Camus n’a pas fait le roman d’un problème sanitaire, de quelque chose qui ressemble à ce qui nous arrive.
Pierre Assouline dans un article de mai 2020 dans le mensuel « L’Histoire » : « La Peste » et le pangolin explique
« Avec la crise du coronavirus le livre de Camus est devenu un best-seller mondial. Donnant un tour inattendu au 60e anniversaire de la mort de l’écrivain.
On ne sait jamais ce qu’un anniversaire nous réserve. La coïncidence avec l’esprit du temps demeure une surprise. Elle peut changer du tout au tout le visage des cérémonies commémoratives, l’ampleur de leur impact et le souvenir que l’opinion en conservera. Ainsi du 60e anniversaire de la mort d’Albert Camus à 46 ans.
Il a démarré en fanfare dès le début de l’année (l’écrivain est mort un 4 janvier) avec la diffusion de deux remarquables documentaires : l’un de Georges-Marc Benamou, Les Vies d’Albert Camus (France 3), portrait intime, riche d’images inédites ; l’autre de Fabrice Gardel et Mathieu Weschler, Albert Camus, l’icône de la révolte (Public Sénat), lui aussi fécond en témoignages. […] les droits de traduction de L’Étranger ont été à ce jour cédés à une soixantaine de pays, mais encore parce que La Peste est, depuis quelques semaines, « le » livre qu’il faut désormais avoir lu si l’on veut comprendre le mal qui ronge l’Europe. Il est la meilleure vente de Gallimard depuis mars, suivi par Le Hussard sur le toit de Jean Giono. D’innombrables articles lui sont partout consacrés, tandis qu’en Espagne, notamment, les librairies étant fermées, on se dépêche de le publier pour la première fois en e-book.
Cette chronique d’une épidémie à Oran avait connu un grand succès à sa parution en 1947. Sauf qu’il ne reposait pas, comme aujourd’hui, sur un malentendu, puisque les lecteurs savaient parfaitement de quoi il retournait : une allégorie du nazisme, peste brune. Il ne lui fut pas moins reproché de diffuser une « morale de Croix-Rouge ».
<Wikipedia> rapporte, en outre, une polémique entre Roland Barthes et Albert Camus sur ce sujet :
En février 1955, Roland Barthes rédige un article sur La Peste où il qualifie la référence au contexte de la Seconde Guerre mondiale comme un « malentendu ».
Camus lui répond dans une lettre ouverte en ces termes :
« La Peste, dont j’ai voulu qu’elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme. La preuve en est que cet ennemi qui n’est pas nommé, tout le monde l’a reconnu, et dans tous les pays d’Europe. Ajoutons qu’un long passage de La Peste a été publié sous l’Occupation dans un recueil de Combat et que cette circonstance à elle seule justifierait la transposition que j’ai opérée. La Peste, dans un sens, est plus qu’une chronique de la résistance. Mais assurément, elle n’est pas moins. »
Ce livre ne parle donc pas de la lutte contre une maladie dont il faut se protéger, mais de la résistance à la « Peste brune » dont l’épidémie ne constitue qu’une allégorie.
Mais <France Culture> rappelle que ce roman a vu ses ventes s’envoler au fil de nos angoisses épidémiques.
Camus hésite sur le titre à donner à ce roman : « Les Séparés », « Les Prisonniers » sont envisagés puis abandonnés.
Sur cette page, vous trouverez aussi une analyse des manuscrits originaux de « La Peste » par Anaïs Dupuy-Olivier, conservatrice, responsable des manuscrits d’Albert Camus à la BnF :
« Camus a 25 ans quand germe en lui l’idée, sans doute inspirée par Antonin Artaud, d’écrire un roman autour d’une épidémie. À ce moment, il n’a pas encore écrit « L’Etranger » et l’Europe n’est pas encore envahie par les nazis. Camus, qui vit à Oran, en Algérie, se documente abondamment sur les grandes pestes de l’Histoire, et lit les romans incontournables des épidémies […]
 […] Pendant l’année 1941, il commence à mettre par écrit ses idées, des plans du roman qu’il barre au fur et à mesure, des listes de personnages, des bribes de phrases, des brouillons qui sont souvent très raturés, qui sont écrits, on le voit bien, avec beaucoup de rapidité, sans application, on voit bien que c’est une pensée en train de se faire. […]
[…] Pendant l’année 1941, il commence à mettre par écrit ses idées, des plans du roman qu’il barre au fur et à mesure, des listes de personnages, des bribes de phrases, des brouillons qui sont souvent très raturés, qui sont écrits, on le voit bien, avec beaucoup de rapidité, sans application, on voit bien que c’est une pensée en train de se faire. […]
Le débarquement allié en Afrique du Nord et l’entrée des Allemands en zone Sud l’empêchent de rentrer en Algérie, chez lui : « Comme des rats ! » s’exclame-t-il dans ses Carnets, et quelques pages plus loin, début 1943 : « Je veux exprimer au moyen de la peste l’étouffement dont nous avons tous souffert
Camus a 30 ans [1943] quand il termine une première version de ce qui est devenu La Peste. Il n’en est pas content. […] des multiples corrections [sont] visibles sur le manuscrit original de La Peste : « Albert Camus est revenu sur ce qu’il avait écrit : en annotant, en barrant des mots qui lui semblaient inadaptés, en ajoutant des notes en marge… » Pendant trois ans, il bûche sur une deuxième version : des personnages disparaissent, sept chapitres sont supprimés, dix ajoutés. Il passe d’une juxtaposition de points de vue à un narrateur unique, le Dr. Rieux, qui nous interroge sur le sens de l’existence. »
Et cet article de France Culture d’insister que
« Le roman d’une épidémie à Oran devient clairement une allégorie de la résistance au nazisme, « la peste brune ». Camus y énumère les réactions d’une collectivité face à un fléau : l’héroïsme du quotidien, la réinvention de l’amour, les profiteurs du marché noir, le désespoir, la lutte.»
Et comme cela a déjà été révélé, Camus n’est pas content de son roman qu’il donne pourtant à Gallimard pour une publication en juin 1947. Ce sera un énorme succès populaire. Il est sur le podium du titre le plus vendu des Editions Gallimard, la médaille d’or est toujours « Le Petit Prince », la médaille d’argent est déjà pour Camus avec « L’étranger »
Camus se dit… « déconcerté ».
Il s’exprimera ainsi à la RDF, en 1950 :
« Ceux de mes livres qui ont plu m’exprimaient mal et ne me ressemblaient pas. »
Un an avant sa mort, il reviendra dans un entretien pour la télévision française sur la solitude de l’écrivain avant la publication de son œuvre :
« Un écrivain travaille solitairement. Est jugé dans la solitude. Surtout se juge lui-même dans la solitude. Cela n’est pas bon, ni sain. »
Pour finir, j’ai cherché comme exergue, une de ses phrases que sait distiller Camus dans ses œuvres.
« Les Séparés » fut un des titres possibles. Il pouvait représenter toute la population d’Oran qui était séparée du reste du monde. Mais le docteur Rieux est aussi séparé de sa femme tout au long du roman. Elle part en début de roman se faire soigner à la montagne parce qu’elle est atteinte de tuberculose comme Camus. Elle ne reviendra pas.
Et puis, il y a le journaliste Rambert de Paris, qui est venu à Oran et qui s’y trouve malencontreusement au moment où les portes de la ville se ferment. Or, il vient d’entamer une histoire d’amour avec une femme à Paris. Il n’aura qu’un objectif c’est de quitter la ville par tous les moyens, forcément illégaux, pour rejoindre sa compagne. En attendant le moment propice, il aide le docteur Rieux. Et quand le plan de fuite peut enfin se réaliser, sa fascination pour le dévouement du docteur Rieux, un appel intérieur de son humanité, le font renoncer à rejoindre sa douce. Ils restent séparés et il continue à s’occuper des pestiférés d’Oran. Il ne se trouve pas parmi les martyrs quand l’épidémie s’achève et c’est sa compagne qui le rejoint.
Et le récit du docteur Rieux écrit par Camus trouve alors ces mots :
« Mais d’autres, comme Rambert, que le docteur avait quitté le matin même en lui disant : « Courage, c’est maintenant qu’il faut avoir raison » avaient retrouvés l’absent qu’ils avaient cru perdu. Pour quelque temps au moins, ils seraient heureux. Ils savaient maintenant que s’il est une chose qu’on puisse désirer toujours et obtenir quelquefois, c’est la tendresse humaine ».
C’est peut-être cette phrase qui est la plus utile, la plus consolatrice, la plus nécessaire de ce roman pour notre compréhension des temps présents du confinement.
<1492>
-
Jeudi 19 novembre 2020
« Camus et le football »Une passion qui n’a jamais abandonné Camus et dont il raconte les prémices dans « Le premier homme »Dans la série consacrée au football, j’avais commencé par la fameuse phrase qu’on attribue à Albert Camus : « Ce que je sais de la morale, c’est au football que je le dois… ».
Au bout de ma recherche pour savoir si Camus avait vraiment dit cela, j’avais trouvé une source précise dans laquelle il écrivait une phrase qui va bien dans ce sens.
Dans la collection de la Pléiade, le volume IV de l’œuvre complète de Camus, p 607, on peut lire la réponse qu’il donnait, en 1959, à la question : Pourquoi je fais du théâtre ?
« Vraiment le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. ».
Depuis l’écriture de ce mot du jour, il y a deux ans, j’ai continué à m’intéresser à Camus, à lire Camus et à lire, à écouter et à regarder des émissions sur Camus. Et j’ai lu « Le premier homme », il n’est pas possible de ne pas évoquer cette relation très forte qu’avait Camus avec ce sport qui se joue à onze contre onze, avec un ballon qu’il faut toucher avec les pieds et qu’il faut faire pénétrer à l’intérieur d’une cage rectangulaire de 7,32 mètres de large sur 2,44 mètres, pour marquer un but.
 D’ailleurs dans la première édition du livre, celle que je possède et avec laquelle je donne la référence des pages des paragraphes que je cite, l’éditeur et la responsable de la publication, la fille de Camus, Catherine ont décidé de mettre sur la page de garde une photo où il apparait avec ses coéquipiers du Racing Universitaire d’Alger en tant que gardien de football.
D’ailleurs dans la première édition du livre, celle que je possède et avec laquelle je donne la référence des pages des paragraphes que je cite, l’éditeur et la responsable de la publication, la fille de Camus, Catherine ont décidé de mettre sur la page de garde une photo où il apparait avec ses coéquipiers du Racing Universitaire d’Alger en tant que gardien de football.
Dans « le premier homme », il est souvent question de football, comme d’une chose naturelle, essentielle. Pour économiser l’argent, la grand-mère usait de ruses comme celle d’acheter des habits trop grands et « comptait sur la nature pour que la taille de l’enfant rattrape celle du vêtement ». C’était un peu ridicule et pénible pour le petit Albert qui devait affronter les moqueries de ses camarades ; Mais…
« Ces courtes hontes étaient vite oubliées en classe, où Jacques reprenait l’avantage et dans la cour de récréation, où le football était son royaume. »
Page 83
La grand-mère interdisait au petit Jacques de jouer au football, parce que cela abimait les semelles des chaussures. Mais la passion était trop forte et Jacques ne pouvait s’empêcher de jouer. Chaque soir, sa grand-mère inspectait ses semelles et lui flanquait une rossée si elles étaient abîmées. Dans cet extrait, Jacques est déjà au lycée, qui commençait alors en 6ème, le collège n’avait pas encore été créé :
« Si Jacques n’avait pas été si remuant, ce qui compromettait régulièrement son inscription au tableau d’honneur, si Pierre avait mieux mordu au latin, leur triomphe eût été total. Dans tous les cas, encouragés par leurs maîtres, ils étaient respectés. Quant aux jeux, il s’agissait surtout du football, et Jacques découvrit dès les premières récréations ce qui devait être la passion de tant d’années.
Les parties se jouaient à la récréation qui suivait le déjeuner au réfectoire et à celle d’une heure qui séparait, pour les internes, les demi-pensionnaires et les externes surveillés, la dernière classe de 4 heures. A ce moment, une récréation d’une heure permettait aux enfants de manger leur goûter et de se détendre avant l’étude où pendant deux heures, ils pourraient faire leur travail du lendemain.
 Pour Jacques, il n’était pas question de goûter. Avec les mordus du football, il se précipitait dans la cour cimentée, encadrée sur les quatre côtés d’arcades à gros piliers (sous lesquelles les forts en thème et les sages se promenaient en bavardant), longée de quatre ou cinq bancs verts, plantée aussi de gros ficus protégés par des grilles de fer. Deux camps se partageaient la cour, les gardiens de but se plaçaient à chaque extrémité entre les piliers, et une grosse balle de caoutchouc mousse était mise au centre. Point d’arbitre, et au premier coup de pied les cris et les courses commençaient.
Pour Jacques, il n’était pas question de goûter. Avec les mordus du football, il se précipitait dans la cour cimentée, encadrée sur les quatre côtés d’arcades à gros piliers (sous lesquelles les forts en thème et les sages se promenaient en bavardant), longée de quatre ou cinq bancs verts, plantée aussi de gros ficus protégés par des grilles de fer. Deux camps se partageaient la cour, les gardiens de but se plaçaient à chaque extrémité entre les piliers, et une grosse balle de caoutchouc mousse était mise au centre. Point d’arbitre, et au premier coup de pied les cris et les courses commençaient.
C’est sur ce terrain que Jacques, qui parlait déjà d’égal à égal avec les meilleurs élèves de la classe, se faisait respecter et aimer aussi des plus mauvais, qui souvent avaient reçu du ciel, faute d’une tête solide, des jambes vigoureuses et un souffle inépuisable. Là, il se séparait pour la première fois de Pierre qui ne jouait pas, bien qu’il fût naturellement adroit : il devenait plus fragile, grandissant plus vite que Jacques, devenant plus blond aussi, comme si la transplantation lui réussissait moins.
Jacques, lui, tardait à grandir, ce qui lui valait les gracieux surnoms de « Rase-mottes » et de « Bas du cul », mais il n’en avait cure et courant éperdument la balle au pied, pour éviter l’un après l’autre un arbre et un adversaire, il se sentait le roi de la cour et de la vie.
Quand le tambour résonnait pour marquer la fin de la récréation et le début de l’étude, il tombait réellement du ciel, arrêté pile sur le ciment, haletant et suant, furieux de la brièveté des heures, puis reprenant peu à peu conscience du moment et se ruant alors de nouveau vers les rangs avec les camarades, essuyant la sueur sur son visage à grand renfort de manches, et pris tout d’un coup de frayeur à la pensée de l’usure des clous à la semelle de ses souliers, qu’il examinait avec angoisse au début de l’étude, essayant d’évaluer la différence d’avec la veille et le brillant des pointes et se rassurant justement sur la difficulté qu’il trouvait à mesurer le degré de l’usure. Sauf lorsque quelque dégât irréparable, semelle ouverte, empeigne coupée ou talon tordu, ne laissait aucun doute sur l’accueil qu’il recevrait en rentrant, et il avalait sa salive le ventre serré, pendant les deux heures d’étude, essayant de racheter sa faute par un travail plus soutenu où, cependant, et malgré tous ses efforts, la peur des coups mettait une distraction fatale. »
Page 205 à 207
 Et un peu plus tard, il va jouer au Racing Universitaire d’Alger abrégé en RUA et il envisage même de faire carrière dans le football. Mais ce projet va se fracasser contre le mur de la maladie qui l’assaille. Dans le premier mot du jour de la présente série, je vous donnais le lien vers le documentaire de Georges-Marc Benamou : « Les vies d’Albert Camus » qui parle de sa maladie et de sa vocation qui s’est brutalement arrêtée..
Et un peu plus tard, il va jouer au Racing Universitaire d’Alger abrégé en RUA et il envisage même de faire carrière dans le football. Mais ce projet va se fracasser contre le mur de la maladie qui l’assaille. Dans le premier mot du jour de la présente série, je vous donnais le lien vers le documentaire de Georges-Marc Benamou : « Les vies d’Albert Camus » qui parle de sa maladie et de sa vocation qui s’est brutalement arrêtée..
Michel Onfray qui a écrit un livre sur Camus explique dans un entretien qu’il a donné au <Point>
« Camus découvre sa tuberculose en décembre 1930, il a 17 ans. Avant le diagnostic, il y eut des signes avant-coureurs : fatigue, toux fréquentes, goût de sang dans la bouche, premiers crachats sanguinolents, perte de connaissance. Pupille de la nation, il dispose d’une prise en charge hospitalière et d’une médecine gratuite. Hospitalisations, radiographies, consultations, insufflations, pneumothorax, un cycle existentiel commence, et avec lui un certain type de vision du monde, tragique, doublée d’une philosophie, tragique elle aussi, qui compose avec l’absurdité d’une vie si brève dans un cosmos éternel (…).
On connaît les conséquences de la maladie dans le trajet existentiel de Camus : arrêter ses études au lycée, s’interdire de nager ou de jouer au football, entrer à l’hôpital, découvrir la mort à l’œuvre chez des voisins de lit affligés du même mal, y voir l’annonce de son destin, subir une batterie d’examens, attendre les résultats, supporter un traitement lourd, douter de son efficacité, se savoir condamné à une mort proche, donc à une vie brève, quitter sa mère et l’appartement familial, habiter chez l’oncle boucher, se voir interdire une carrière de professeur de philosophie puis, plus tard, se faire refuser par le bureau militaire auprès duquel il vient pour s’engager dans l’armée française en 1939, passer sa courte vie à guetter les signes d’une rechute, vivre dans sa chair la maladie au quotidien, craindre la syncope entre les bras d’une femme, savoir qu’Éros et Thanatos sont l’envers et l’endroit (…). »
La tuberculose empêchera Camus dans beaucoup de ses projets.
Charles Poncet, ami intime de l’écrivain, lui a un jour demandé qu’est-ce qu’il aurait choisi – si sa santé le lui avait permis – entre le football ou le théâtre. Camus qui avait déjà reçu le prix Nobel de littérature lui a répondu :
« Le football, sans hésitations ».
Vous trouverez cette anecdote <Ici> et <Ici>
Il aurait même dit :
« Il n’y a pas d’endroit où l’homme est plus heureux que dans un stade de football. »
Peut-être que certains seront étonnés de cette constance de Camus par rapport au football. Il faut rappeler cependant qu’en 1960, le football même professionnel n’avait rien à voir avec ce qu’il est devenu aujourd’hui dans sa démesure et sa financiarisation. Pour Camus c’était probablement simplement un jeu qui se pratiquait en équipe.
<1491>
-
Mercredi 18 novembre 2020
« Jeune, je demandais aux êtres plus qu’ils ne pouvaient donner »Albert Camus, « Le premier homme », Feuillet IV, page 272 du livreDans les notes de l’éditeur du « Premier homme » publié en 1994, Catherine Camus écrit : « On trouvera en annexe les feuillets (que nous avons numérotés de I à V) qui étaient, les uns insérés dans le manuscrit (feuillet I avant le chapitre 4), feuillet II avant le chapitre 6 bis) Les autres (III, IV et V) placés à la fin du manuscrit. »
 L’extrait que je partage aujourd’hui faisait donc partie du feuillet IV placé en fin de livre et qui sur une page comporte deux paragraphes.
L’extrait que je partage aujourd’hui faisait donc partie du feuillet IV placé en fin de livre et qui sur une page comporte deux paragraphes.
Le second est celui-ci
« Jeune, je demandais aux êtres plus qu’ils ne pouvaient donner : une amitié continuelle, une émotion permanente.
Je sais leur demander maintenant moins qu’ils peuvent donner : une compagnie sans phrases.
Et leurs émotions, leur amitié, leurs gestes nobles gardent à mes yeux leur valeur entière de miracle : un entier effet de la grâce. »
Je n’ai rien à ajouter à ce qu’écrit Albert Camus.
<1490>
-
Mardi 17 novembre 2020
« La faiblesse […] qui contribue à rendre le monde supportable, c’est la faiblesse devant la beauté. »Albert Camus, « Le premier homme », Page 111Au début, le mot du jour se limitait à l’exergue.
C’était commode à écrire et rapide à lire.
J’ai eu quelques soucis car les mots de sagesse d’Einstein, de Socrate ou d’autres qu’on trouvait sur Internet, sans précision de leur source, étaient souvent faux et relevaient en fait d’inventions de quelque obscur écrivain qui se cachait derrière un nom célèbre pour écrire une formule qui lui tenait à cœur.
Mais dans « Le Premier homme » je dispose d’une source précise et comportant un certain nombre de ces formules qui révèlent une part de la vérité du comportement des hommes.
Il est encore question de la grand-mère dans cet extrait.
« Dans tous les cas, la grand-mère ne répondait jamais aux colères de son cadet. D’une part parce qu’elle savait que c’était inutile, d’autre part parce qu’elle avait toujours eu pour lui une faiblesse étrange, que Jacques, dès l’instant où il eut un peu de lecture, avait attribuée au fait qu’Ernest était infirme (alors qu’on a tant d’exemples où, contrairement au préjugé, les parents se détournent de l’enfant diminué) et qu’il comprit mieux beaucoup plus tard, un jour où, surprenant le regard clair de sa grand-mère, soudain adouci par une tendresse qu’il ne lui avait jamais vue, il se retourna et vit son oncle qui enfila la veste de son costume du dimanche.
Aminci, encore par l’étoffe sombre, le visage fin et jeune, rasé de frais, peigné soigneusement, portant exceptionnellement col frais, peigné soigneusement, portant exceptionnellement col frais et cravate, avec des allures de pâtre grec endimanché, Ernest lui apparut pour ce qu’il était, c’est-à-dire très beau.
Et, il comprit alors que la grand-mère aimait physiquement son fils, était amoureuse comme tout le monde de la grâce et de la force d’Ernest, et que sa faiblesse exceptionnelle devant lui était après tout fort commune, qu’elle nous amollit tous plus ou moins, et délicieusement d’ailleurs, et qu‘elle contribue à rendre le monde supportable, c’est la faiblesse devant la beauté. »
Page 111
Je crois que c’est juste, et que cette beauté ne se limite pas à la beauté éphémère de certains humains. Il peut s’agir aussi de la beauté d’une œuvre d’art ou de la beauté d’un paysage, de l’univers ou simplement d’une scène de laquelle la beauté jaillit et nourrit notre quête de vie.
<1489>
-
Lundi 16 novembre 2020
« Cette longue période pendant laquelle la violence à l’égard des enfants paraissait la chose la plus naturelle du monde »Réflexions suscitées par la lecture du « Premier homme » et d’autres sourcesDans « Le premier Homme » Camus raconte son enfance pauvre dans le quartier Belcourt. Il en raconte les difficultés, il en dit aussi la lumière, la joie, l’amour. Mais il ne cache pas une autre réalité, il a été un enfant battu. Pas une gifle de ci de là, non sévèrement battu avec une cravache, appelé aussi nerf de bœuf.
Le pire de tout cela, c’est que cela apparaissait, à cette époque, à peu près normal. Ce n’était pas de l’éducation, plutôt du dressage.
<Ce site> affirme que la grand-mère n’apparaît que dans deux ouvrages de Camus. Sa première œuvre : « L’Envers et l’endroit (1937) » et dans sa dernière œuvre « Le Premier Homme ».
C’est ainsi que dans un brouillon de L’Envers et l’Endroit, Camus présente la situation de sa mère et sa grand-mère.
« Il y avait une fois une femme que la mort de son mari avait rendue pauvre avec deux enfants. Elle avait vécu chez sa mère, également pauvre, avec un frère infirme qui était ouvrier. Elle avait travaillé pour vivre, fait des ménages, et avait remis l’éducation de ses enfants dans les mains de sa mère. Rude, orgueilleuse, dominatrice, celle-ci les éleva à la dure. »
Et il écrit dans autre passage de ce livre :
« Celle-ci fait l’éducation des enfants avec une cravache. Quand elle frappe trop fort, sa fille lui dit: «Ne frappe pas sur la tête.» Parce que ce sont ses enfants, elle les aime bien. »
Avant de revenir au « Premier homme » je voudrais évoquer cette violence qu’on trouvait normal à l’égard des enfants. Notamment par des œuvres de l’esprit, souvent autobiographiques.
La première fois que j’ai lu cette violence, ce fut dans l’œuvre de Jules Vallés.
Jules Vallès (1832-1885) fut un des élus de la Commune de Paris en 1871. Condamné à mort, il devra s’exiler à Londres de 1871 à 1880. Il fut aussi fondateur du journal Le Cri du peuple
Il a écrit une trilogie romanesque largement autobiographique centrée autour d’un personnage que Vallès nomme Jacques Vingtras :
- 1879 : L’Enfant
- 1881 : Le Bachelier
- 1886 : L’Insurgé
Dans mes jeunes années j’ai lu ces trois livres. J’ai été saisi par le début du premier livre « L’enfant » dont le premier chapitre avait pour titre « Ma mère » :
« Ai-je été nourri par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m’a donné son lait ? Je n’en sais rien. Quel que soit le sein que j’ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j’étais tout petit : je n’ai pas été dorloté, tapoté, baisotté ; j’ai été beaucoup fouetté.
Ma mère dit qu’il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins ; quand elle n’a pas le temps le matin, c’est pour midi, rarement plus tard que quatre heures. »
Je me souviens aussi de ce très beau film des frères Taviani, « Padre padrone », palme d’or au Festival de Cannes 1977, dans lequel, dans la Sardaigne des années 1940, le petit Gavino est contraint par son père d’abandonner l’école pour garder les animaux et se trouve confronté à la brutalité de son père qui le frappe et le fouette à tout bout de champ. Finalement, grâce au service militaire à l’âge de 21 ans il peut échapper à l’emprise de son père. Il apprend à lire, ce qui est pour lui une révélation (il deviendra linguiste), et en sortant de l’armée, il rejette le rapport de violence imposé par son père.
Mais il n’y pas que les œuvres de l’esprit. La violence dans les familles, Gisèle Halimi la raconte aussi dans son entretien avec Annick Cojean dont j’ai parlé lors du mot du jour hommage à cette grande dame : « J’avais en moi une rage, une force sauvage, je voulais me sauver ». Elle raconte, dans sa fibre féministe, combien elle était choquée, et à juste titre, que les excellents résultats qu’elle ramenait de l’école n’intéressait pas ses parents qui ne s’occupaient que de son frère qui était, au sens de l’école, un cancre. Alors ce paragraphe de l’entretien peut se lire avec le regard féministe, mais aussi avec le regard dont j’use aujourd’hui :
« Fiers ? Ils s’en fichaient. Je rapportais mes bonnes notes dans l’indifférence générale. J’étais l’inessentielle. Toute l’attention était focalisée sur mon frère aîné, l’essentiel, qui passait son temps entre colles, mensonges, zéros pointés et renvois. Ce qui rendait fou mon père, qui hurlait et tabassait mon frère lors de scènes d’une violence insensée. Tout l’espoir de la famille – y compris nous sortir de la pauvreté – reposait sur ce fils aîné pour lequel mes parents étaient prêts à tous les sacrifices. »
« Des scènes d’une violence insensée ! ».
Et Brigitte Bardot ? Elle naît le 28 septembre 1934 rue Viollet, dans le quinzième arrondissement de Paris. France Culture avait consacré une série : « Grandes traversées. » à cette actrice symbole de la libération des sens et du désir. Dans l’émission du 11 août 2020 : <Une très belle enfant> , elle raconte que son père, Louis Bardot dit Pilou, industriel des Usines Bardot à l’origine d’Air Liquide l’a fouettée à la cravache jusqu’à ces 18 ans. Elle raconte, par exemple, que ses parents étant de sortie, elle avait jouée avec sa sœur à cache cache et malencontreusement entrainée une nappe faisant tomber à terre une miniature chinoise qui éclata en mille morceaux. Sa sœur et elle eurent chacune 20 coups de cravaches sur les fesses «administrés par un papa blanc de rage».
Il a fallu attendre la loi du 10 juillet 2019 pour que l’on ajoute à l’article 371-1 du Code civil dans son Livre Ier : « Des personnes », Titre IX : « De l’autorité parentale » Chapitre Ier : « De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » le troisième alinéa que j’ai mis en gras :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Mais il faut savoir que la France, dans un classement mondial, n’est que le 56ème pays à avoir interdit les châtiments corporels.
La France est, hélas, toujours en retard dans ce type d’évolution. J’avais dû faire la même réflexion pour l’abolition de la peine de mort lors du mot du jour du 21 octobre 2016 dans lequel j’avais mis en exergue ce constat de Robert Badinter :
« La France n’est pas le pays des droits de l’Homme, elle n’est que le pays de la déclaration des droits de l’Homme »
Dans « Le premier homme » on rentre dans cette révélation, lors d’un premier épisode que raconte Albert Camus. Les enfants jouent sur la plage et oublient l’heure :
« Ils en oubliaient même l’heure, courant de la plage à la mer, séchant sur le sable l’eau salée qui les faisait visqueux, puis lavant dans la mer le sable qui les habillait de gris. Ils couraient, et les martinets avec des cris rapides commençaient de voler plus bas au-dessus des fabriques et de la plage. Le ciel, vidé de la touffeur du jour, devenait plus pur puis verdissait, la lumière se détendait et, de l’autre côté du golfe, la courbe des maisons et de la ville, noyée jusque-là dans une sorte de brume, devenait plus distincte. Il faisait encore jour, mais des lampes s’allumaient déjà en prévision du rapide crépuscule d’Afrique. Pierre, généralement, était le premier à donner le signal : « Il est tard », et aussitôt, c’était la débandade, l’adieu rapide. Jacques avec Joseph et Jean couraient vers leurs maisons sans se soucier des autres. Ils galopaient hors de souffle. La mère de Joseph avait la main leste. Quant à la grand-mère de Jacques… »
Page 55
C’est par ces trois petits points, lourds de menaces qu’Albert Camus entre dans la description de la violence, qu’il révèlera un peu plus loin.
« Mais la grand-mère passait derrière lui, prenait derrière la porte de la salle la cravache grossière, dite nerf de bœuf qui y pendait et lui cinglait les jambes et les fesses de trois ou quatre coups qui le brulaient à hurler.
Un peu plus tard, la bouche et la gorge pleines de larmes, devant son assiette de soupe que l’oncle apitoyé lui avait servie, il se tendait tout entier pour empêcher les larmes de déborder. Et sa mère, après un rapide regard à la grand-mère tournait vers lui le visage qu’il aimait tant : » Mange ta soupe, disait-elle. C’est fini. C’est fini. » C’est alors qu’il se mettait à pleurer. »
Page 56
Le récit est parsemé de ces violences et de la peur psychologique qu’entraîne cette menace permanente.
Mais quand je parle de « chose naturelle », c’est vraiment le cas puisque même le « saint laïc », M Germain, était partisan et pratiquant de châtiments corporels à l’égard des élèves. En outre, il accomplissait cette basse besogne dans un cérémonial que je qualifierai de sadique.
Et Camus décrit bien cette « normalité » qui nous semble aujourd’hui totalement anormale :
« Dans l’ensemble, cependant, cette punition était acceptée sans amertume, d’abord parce que presque tous ces enfants étaient battus chez eux et que la correction leur paraissait un mode naturel d’éducation, ensuite parce que l’équité du maitre était absolue, qu’on savait d’avance quelle sorte d’infractions, toujours les mêmes, entrainait la cérémonie expiatoire, et tous ceux qui franchissaient la limite des actions ne relevant que du mauvais point savaient ce qu’ils risquaient, et que la sentence était appliquée aux premiers comme aux derniers avec une égalité chaleureuse. »
Page 143
Cette relation de domination et de violence avec sa grand-mère va finir comme dans « Padre Padrone » par un affrontement entre Jacques et sa grand-mère, au moment où l’enfant se sent suffisamment fort pour stopper le tyran.
« Et en effet, à la rentrée qui suivit, lorsqu’il entra dans la cour de seconde, il n’était plus l’enfant désorienté qui, quatre ans auparavant, avait quitté Belcourt dans le petit matin, chancelant dans ses chaussures cloutées, le cœur serré à l’idée du monde inconnu qui l’attendait, et le regard qu’il posait sur le monde avait perdu un peu d’innocence. Bien des choses d’ailleurs commençaient à ce moment de l’arracher à l’enfant qu’il avait été. Et si, un jour, lui qui avait jusque-là accepté patiemment d’être battu par sa grand-mère comme si cela faisait partie des obligation inévitables d’une vie d’enfant, lui arracha le nerf de bœuf des mains, soudainement fou de violence et de rage et si décidé à frapper cette tête blanche dont les yeux clairs et froids le mettaient hors de lui que la grand-mère le comprit, recula et partit s’enfermer dans sa chambre, gémissant sur le malheur d’avoir élevé des enfants dénaturés mais convaincue déjà qu’elle ne battrait plus jamais Jacques, que jamais plus en effet elle ne le battit, c’est que l’enfant en effet était mort dans cet adolescent maigre et musclé, aux cheveux en broussailles et au regard emporté, qui avait travaillé tout l’été pour rapporter un salaire à la maison, venait d’être nommé gardien de but titulaire de l’équipe du lycée et, trois jours auparavant, avait gouté pour la première fois, défaillant, à la bouche d’une jeune fille. »
Page 252 et 253
Camus ne cache rien de cette violence, de la rudesse et de la tyrannie de sa grand-mère. Mais il relève aussi les qualités qu’il reconnaît à sa grand-mère qui devait avec si peu de moyens nourrir une famille et faire face à la dureté de la vie :
« Droite, dans sa longue robe noire de prophétesse, ignorante et obstinée, elle du moins n’avait jamais connu la résignation. »
page 81
Dans les feuillets qui accompagnaient le manuscrit, il a écrit :
« La grand-mère, tyran, mais elle servait debout à table. »
Feuillet V, page 273
Il l’a décrit même, presque avec de l’humour. Elle avait deux réactions quand on lui annonçait le décès de quelqu’un selon qu’elle l’appréciait ou non :
« Quand on disait de quelqu’un, devant la grand-mère, qu’il était mort : « Bon, disait-elle, il ne pétera plus. » S’il s’agissait de quelqu’un pour qui elle était censée au moins avoir de l’affection : « Le pauvre, disait-elle, il était encore jeune », même si le défunt se trouvait être depuis longtemps dans l’âge de la mort. »
Page 153
Il y eut même quelques rares expressions de tendresse. Ce fut le cas, par exemple, après que M Bernard ait convaincu la grand-mère de l’intelligence de Jacques et de son intérêt comme celui de sa famille de le laisser continuer les études. Il venait de partir après avoir répondu à la grand-mère qui s’inquiétait du coût des heures de préparation au concours de la bourse « Il m’a déjà payé » :
Camus note :
« Il était déjà parti, et la grand-mère prenait Jacques par la main pour remonter à l’appartement, et pour la première fois elle lui serrait la main, très fort, avec une sorte de tendresse désespérée. « Mon petit, disait-elle, mon petit ».»
Page 153
<1488>
- 1879 : L’Enfant
-
Vendredi 13 novembre 2020
« L’école […] nourrissait en eux une faim plus essentielle encore à l’enfant qu’à l’homme et qui est la faim de la découverte »Albert Camus, « Le premier homme », Page 138Albert Camus était orphelin de père, mais il a rencontré des hommes qui ont joué un rôle considérable dans son développement et qui ont un peu rempli ce manque.
Et celui qui a probablement était le plus important fut son instituteur : M Germain et qui dans le livre porte le nom de « Monsieur Bernard ».
Et c’est pourquoi, immédiatement après avoir reçu le Prix Nobel de littérature, il lui a écrit la fameuse lettre qui est devenue tellement célèbre.
Mais je ne m’arrêterai pas sur cette lettre puisqu’elle a déjà fait l’objet du mot du jour du <6 octobre 2017> :
« Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé »
Camus raconte l’école dans laquelle officiait Monsieur Bernard et où son ami Pierre et lui obtenaient les premières places. Et il brosse un portrait de son instituteur :
« Ensuite c’était la classe. Avec M. Bernard, cette classe était constamment intéressante pour la simple raison qu’il aimait passionnément son métier. Au-dehors, le soleil pouvait hurler sur les murs fauves pendant que la chaleur crépitait dans la salle elle-même pourtant plongée dans l’ombre des stores à grosses rayures jaunes et blanches. La pluie pouvait aussi bien tomber comme elle le fait en Algérie, en cataractes interminables, faisant de la rue un puits sombre et humide, la classe était à peine distraite. Seules les mouches par temps d’orage détournaient parfois l’attention des enfants. Elles étaient capturées et atterrissaient dans les encriers, où elles commençaient une mort hideuse, noyées dans les boues violettes qui emplissaient les petits encriers de porcelaine à tronc conique qu’on fichait dans les trous de la table. Mais la méthode de M. Bernard, qui consistait à ne rien céder sur la conduite et à rendre au contraire vivant et amusant son enseignement, triomphait même des mouches. Il savait toujours tirer au bon moment de son armoire aux trésors la collection de minéraux, l’herbier, les papillons et les insectes naturalisés, les cartes, qui réveillaient l’intérêt fléchissant de ses élèves. »
Page135 & 136
Avec M. Bernard, cette classe était constamment intéressante !
 Et pour agrémenter sa classe, M Bernard se débrouille pour disposer d’outils qu’il est seul à posséder dans ce lieu, comme « La lanterne magique » qui est l’ancêtre des appareils de projection et particulièrement du projecteur de diapositives. Elle permettait de projeter des images peintes sur des plaques de verre à travers un objectif, via la lumière d’une chandelle ou d’une lampe à huile.
Et pour agrémenter sa classe, M Bernard se débrouille pour disposer d’outils qu’il est seul à posséder dans ce lieu, comme « La lanterne magique » qui est l’ancêtre des appareils de projection et particulièrement du projecteur de diapositives. Elle permettait de projeter des images peintes sur des plaques de verre à travers un objectif, via la lumière d’une chandelle ou d’une lampe à huile.
« Il était le seul dans l’école à avoir obtenu une lanterne magique et, deux fois par mois, il faisait des projections sur des sujets d’histoire naturelle ou de géographie. »
Page 136
Cette école là savait nourrir l’intelligence des enfants qui avaient faim de découvertes et qui aimaient apprendre à apprendre
« Non, l’école ne leur fournissait pas seulement une évasion à la vie de famille. Dans la classe de M. Bernard du moins, elle nourrissait en eux une faim plus essentielle encore à l’enfant qu’à l’homme et qui est la faim de la découverte. Dans les autres classes, on leur apprenait sans doute beaucoup de choses, mais un peu comme on gave les oies. On leur présentait une nourriture toute faite en les priant de vouloir bien l’avaler. »
Page 138
Et en continuant immédiatement ce paragraphe, la plume de Camus dérape sur ce manuscrit et n’utilise plus le nom de Monsieur Bernard, mais écrit le vrai nom de son instituteur :
« Dans la classe de M. Germain, pour la première fois ils sentaient qu’ils existaient et qu’ils étaient l’objet de la plus haute considération : on les jugeait dignes de découvrir le monde. Et même leur maître ne se vouait pas seulement à leur apprendre ce qu’il était payé pour leur enseigner, il les accueillait avec simplicité dans sa vie personnelle, il la vivait avec eux, leur racontant son enfance et l’histoire d’enfants qu’il avait connus, leur exposait ses points de vue, non point ses idées, car il était par exemple anticlérical comme beaucoup de ses confrères et n’avait jamais en classe un seul mot contre la religion, ni contre rien de ce qui pouvait être l’objet d’un choix ou d’une conviction, mais il n’en condamnait qu’avec plus de force ce qui ne souffrait pas de discussion, le vol, la délation, l’indélicatesse, la malpropreté (…) »
Il est question de dignité ici, d’intelligence et de respect. Camus insiste aussi sur le strict respect de la neutralité laïque devant les religions bien que M Germain fut anticlérical.
Un épisode est particulièrement émouvant dans le récit que fait Albert Camus :
Mais surtout il leur parlait de la guerre encore toute proche et qu’il avait faite pendant quatre ans, des souffrances des soldats, de leur courage, de leur patience et du bonheur de l’armistice. À la fin de chaque trimestre, avant de les renvoyer en vacances, et de temps en temps, quand l’emploi du temps le lui permettait, il avait pris l’habitude de leur lire de longs extraits des Croix de bois de Dorgelès. […] Lui et Pierre attendaient chaque lecture avec une impatience chaque fois plus grande »
Page 139
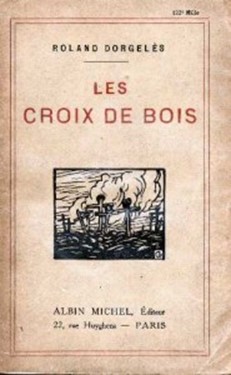 Le jeune Camus découvre la vie au front, la Première Guerre Mondiale, les tranchées, le monde dans lequel son père a perdu la vie, sans en être pleinement conscient :
Le jeune Camus découvre la vie au front, la Première Guerre Mondiale, les tranchées, le monde dans lequel son père a perdu la vie, sans en être pleinement conscient :
« Pour Jacques, ces lectures lui ouvraient encore les portes de l’exotisme, mais d’un exotisme où la peur et le malheur rôdaient, bien qu’il ne fît jamais de rapprochement, sinon théorique, avec le père qu’il n’avait pas connu. »
Mais l’émotion le rattrape et lui fait probablement comprendre ce qui échappe à sa raison :
« Et le jour, à la fin de l’année, où, parvenu à la fin du livre, M. Bernard lut d’une voix plus sourde la mort de D., lorsqu’il referma le livre en silence, confronté avec son émotion et ses souvenirs, pour lever ensuite les yeux sur sa classe plongée dans la stupeur et le silence, il vit Jacques au premier rang qui le regardait fixement, le visage couvert de larmes, secoué de sanglots interminables, qui semblaient ne devoir jamais s’arrêter. « Allons petit, allons petit », dit M. Bernard d’une voix à peine perceptible, et il se leva pour aller ranger son livre dans l’armoire, le dos à la classe. ».
Page 140
M Germain a aussi fait la guerre 14-18 et il lisait probablement avec beaucoup d’émotion ce récit qu’il avait vécu dans sa chair et son corps.
Et Camus raconte dans « Le premier homme » une visite qu’il fit à son ancien instituteur alors qu’il avait plus de quarante ans et qu’il avait déjà écrit de nombreux livres devenant ainsi célèbre. Au milieu de la conversation il se passe ceci :
« « Attends, petit », dit M Bernard. Il se leva péniblement […] et il fourragea dans un tiroir, le referma, en ouvrit un autre, en tira quelque chose. « Tiens, dit-il, c’est pour toi. Jacques reçut un livre couvert de papier brun d’épicerie et sans inscription sur la couverture. Avant même de l’ouvrir, il sut que c’était Les Croix de Bois, l’exemplaire même sur lequel M. Bernard faisait la lecture en classe. Non, Non, dit-il, c’est… » Il voulait dire : c’est trop beau. Il ne trouvait pas les mots. M Bernard hochait sa vieille tête. « Tu as pleuré le dernier jour, tu te souviens, Depuis ce jour ce livre t’appartient. »
Page 141
Voilà cette relation toute particulière que M Germain a noué avec ses jeunes élèves et Albert Camus en particulier.
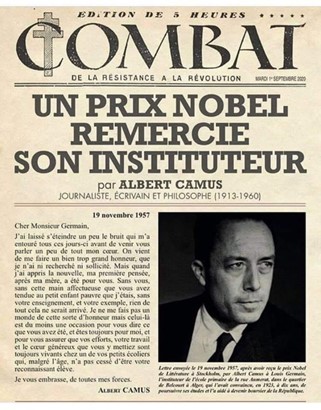 Mais pour que cette phrase : « Sans vous […] rien de tout cela ne serait arrivé » prenne toute sa consistance il fallait encore plus. M. Bernard va proposer à ses meilleurs élèves dont Jacques et Pierre de les présenter à la bourse des lycées et collèges, seul moyen pour ces pauvres de poursuivre des études :
Mais pour que cette phrase : « Sans vous […] rien de tout cela ne serait arrivé » prenne toute sa consistance il fallait encore plus. M. Bernard va proposer à ses meilleurs élèves dont Jacques et Pierre de les présenter à la bourse des lycées et collèges, seul moyen pour ces pauvres de poursuivre des études :
« Le lycée vous ouvre toutes les portes. Et j’aime mieux que ce soit des garçons pauvres comme vous qui entrent par ces portes. Mais pour ça, j’ai besoin de l’autorisation de vos parents. Trottez. »
Mais cela est contraire aux idées de la grand-mère qui veut que Jacques travaille au plus vite pour ramener de l’argent à la maison, la famille en a tant besoin. Quand Jacques explique cela à M. Bernard, ce dernier décide d’aller voir la terrible grand-mère :
« Un moment après, M. Bernard, sous les yeux interdits de Jacques, frappait à la porte de sa maison. La grand-mère vint ouvrir en s’essuyant les mains avec son tablier dont le cordon trop serré fait rebondir son ventre de vieille femme. Quand elle vit l’instituteur, elle eut alors un geste vers ses cheveux pour les peigner. « Alors, la mémé, dit M. Bernard, en plein travail, comme d’habitude ? Ah ! vous avez du mérite. » […] « Toi, dit M. Bernard à Jacques, va voir dans la rue si j’y suis. Vous comprenez, dit-il à la grand-mère, je vais dire du bien de lui et il est capable de croire que c’est la vérité… » Jacques sortit, dévala les escaliers et se posta sur le pas de la porte. Il y était encore une heure plus tard, et la rue s’animait déjà, le ciel à travers les ficus virait au vert, quand M. Bernard déboucha de l’escalier et surgit dans son dos. Il lui grattait la tête. « Eh bien ! dit-il, c’est entendu. Ta grand-mère est une brave femme. Quant à ta mère… Ah ! dit-il, ne l’oublie jamais. »
Page152
Et puis la grand-mère apparait brusquement et revient vers l’instituteur :
« Elle tenait son tablier d’une main et essuyait ses yeux. « J’ai oublié… vous m’avez dit que vous donneriez des leçons supplémentaires à Jacques. – Bien sûr, dit M. Bernard. Et il ne va pas s’amuser croyez-moi. – Mais nous ne pourrons pas vous payer. » »
Et la réponse du « hussard de la république », de l’homme qui ne croyait pas en Dieu mais en sa mission sacrée d’enseigner les enfants et aussi les enfants des pauvres, fut celle-ci :
« M. Bernard la regardait attentivement. Il tenait Jacques par les épaules. « Ne vous en faites pas », et il secouait Jacques, « il m’a déjà payé ».
Et après le succès de Jacques à ce concours la conclusion de ces années d’enseignement de l’instituteur fut ce moment d’émotion et aussi de désarroi de l’enfant devant le monde inconnu qui se dressait devant lui :
« Dans la pauvre salle à manger maintenant pleine de femmes où se tenaient sa grand-mère, sa mère, qui avait pris un jour de congé à cette occasion, et les femmes Masson leurs voisines, il se tenait contre le flanc de son maître, respirant une dernière fois l’odeur d’eau de Cologne, collé contre la tiédeur chaleureuse de ce corps solide, et la grand-mère rayonnait devant les voisines. « Merci, Monsieur Bernard, merci », disait-elle pendant que M. Bernard caressait la tête de l’enfant. « Tu n’as plus besoin de moi, disait-il, tu auras des maîtres plus savants. Mais tu sais où je suis, viens me voir si tu as besoin que je t’aide. » Il partait et Jacques restait seul, perdu au milieu de ces femmes, puis il se précipitait à le fenêtre, regardant son maître qui le saluait une dernière fois et qui le laissait désormais seul, et au lieu de la joie du succès, une immense peine d’enfant lui tordait le cœur, comme s’il savait d’avance qu’il venait par ce succès d’être arraché au monde innocent et chaleureux des pauvres, monde refermé sur lui-même, comme une île dans la société mais où la misère tient lieu de famille et de solidarité, pour être jeté dans un monde inconnu, qui n’était plus le sien, où il ne pouvait croire que les maîtres fussent plus savants que celui-là dont le cœur savait tout, et il devrait désormais apprendre, comprendre sans aide, devenir un homme enfin sans le secours du seul homme qui lui avait porté secours, grandir et s’élever seul enfin, au prix le plus cher. »
Page 163
<1487>
-
Jeudi 12 novembre 2020
« Ce que Jacques ramenait du lycée était inassimilable, et le silence grandissait entre sa famille et lui »Albert Camus, « Le premier homme », Page 186. Pour exprimer la séparation du monde du lycée et de sa familleLa famille d’Albert Camus faisait partie des français d’Algérie. Mais des français pauvres, car il existait des français pauvres en Algérie.
La ville d’Alger était majoritairement habitée par des européens, je veux dire des français. Les photos d’alors nous montrent un Alger couvert d’immeubles Haussmannien, comme Paris. Mais c’était pour les français riches. Le quartier Belcourt était réservé aux familles pauvres.
Et c’était dans ce quartier que le petit Albert habitait avec sa famille, rue de Lyon au numéro 93.
La famille maternelle, comme la famille paternelle étaient pauvres. Mais la situation avait empiré quand le père d’Albert dut partir d’Algérie pour rejoindre l’armée française.
Dès son départ, la mère handicapée n’a pu faire autrement que rejoindre sa mère, la tyrannique Marie Cardona-Sintes qui habitait cette adresse du quartier Belcourt.
Camus dans « l’Envers et l’Endroit », décrit cette maison tout en parlant de lui à la troisième personne :
« Ce quartier, cette maison ! Il n’y avait qu’un étage et les escaliers n’étaient pas éclairés. Maintenant encore, après de longues années, il pourrait y retourner en pleine nuit. Il sait qu’il grimperait l’escalier à toute vitesse sans trébucher une seule fois. Son corps même est imprégné de cette maison. Ses jambes conservent en elles la mesure exacte de la hauteur des marches. Sa main, l’horreur instinctive, jamais vaincue, de la rampe d’escalier. Et c’était à cause des cafards. »
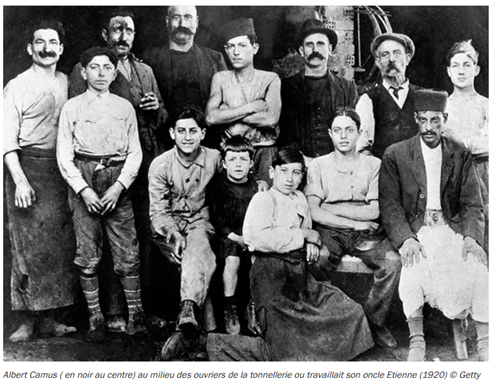 Dans ce petit trois-pièces pouilleux vivaient donc la grand-mère, la mère, son frère aîné, Lucien, et également l’oncle, frère de la mère, sourd aussi. Oncle avec lequel il avait une relation affectueuse et qu’il rejoignait parfois dans l’usine de tonnellerie dans laquelle il travaillait.
Dans ce petit trois-pièces pouilleux vivaient donc la grand-mère, la mère, son frère aîné, Lucien, et également l’oncle, frère de la mère, sourd aussi. Oncle avec lequel il avait une relation affectueuse et qu’il rejoignait parfois dans l’usine de tonnellerie dans laquelle il travaillait.
Et cette situation de pauvreté qu’il a vécue, va donner à Camus les mots pour faire comprendre ce que cela signifie.
Pauvre, veut évidemment dire qu’on s’inquiète du lendemain, de ce que l’on va pouvoir manger, des habits qu’on pourra se mettre ou qu’il faudra remplacer, du coût des soins en cas de pépin de santé. Tout cet aspect matériel est essentiel et on y songe spontanément quand on est épargné de ces soucis et qu’on pense à un pauvre.
Mais Camus nous éclaire davantage sur les conséquences psychiques, l’enfermement et la séparation avec le monde de la culture.
Ainsi, il décrit un échange avec sa mère dans sa recherche du père pour arriver à capter des souvenirs, mieux comprendre qui était son père.
Il interroge sa mère, la presse de questions. Elle ne répond pas de manière précise. Il constate qu’elle se contredit, alors il la bouscule un peu plus par d’autres interrogations en la confrontant à ses incohérences.
Et puis…
Il s’arrête et il écrit ceci :
« Elle disait oui, c’était peut-être non, il fallait remonter dans le temps à travers une mémoire enténébrée, rien n’était sûr.
La mémoire des pauvres déjà est moins nourrie que celles des riches, elle a moins de repères aussi dans le temps d’une vie uniforme et grise. Bien sûr, il y a la mémoire du cœur dont on dit qu’elle est la plus sûre, mais le cœur s’use à la peine et au travail, il oublie vite sous le poids des fatigues.
Le temps perdu ne se retrouve que chez les riches. Pour les pauvres, il marque seulement les traces vagues du chemin de la mort. Et puis, pour bien supporter, il ne faut pas trop se souvenir, il fallait se tenir tout près des jours, heure après heure, comme le faisait sa mère, un peu par force sans doute, puisque cette maladie de jeunesse l’avait laissée sourde et avec un embarras de parole, puis l’avait empêché d’apprendre ce qu’on enseigne même aux plus déshérités, et forcée donc à la résignation muette, mais c’était aussi la seule manière qu’elle ait trouvée de faire face à sa vie, et que pouvait-elle faire d’autre, qui à sa place aurait trouvé autre chose ? »
Page 79
C’est bouleversant.
La mémoire des pauvres est moins nourrie que celles des riches et elle a moins de repères.
Avec son ami Pierre qui sera aussi un excellent élève, ils aiment l’école et leur instituteur, M Bernard dans le livre et M Germain dans la vraie histoire. L’école leur permet de sortir du monde de l’enfermement de la pauvreté.
Là encore, les mots de Camus sont d’une justesse et d’une émotion sans pareille :
« Seule l’école donnait à Jacques et à Pierre ces joies. Et sans doute ce qu’ils aimaient si passionnément en elle, c’est ce qu’ils ne trouvaient pas chez eux, où la pauvreté et l’ignorance rendaient la vie plus dure, plus morne, comme refermée sur elle-même : la misère est une forteresse sans pont-levis.
page137 »
Une forteresse sans pont-levis, c’est-à-dire dont on ne sort pas.
Mais le plus terrible c’est quand Pierre et Jacques vont quitter l’école, quitter leur quartier pour aller au lycée du centre-ville. Avant cela, ils vivaient entre eux, la pauvreté était leur univers. Ils considéraient que c’était la normalité.
Mais au lycée, ils vont s’apercevoir que la plupart des enfants qui s’y trouve ne sont pas pauvres comme eux. Il se dessine une séparation : deux mondes. Le monde du lycée dont Camus ne pouvait pas parler dans sa famille car elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait au lycée. Et le monde de sa famille qui ne pouvait être expliqué au lycée. :
« Pierre et lui s’aperçurent très vite qu’ils étaient seuls. M. Bernard, lui-même, que d’ailleurs ils n’osaient pas déranger, ne pouvait rien leur dire sur ce lycée qu’il ignorait. Chez eux, l’ignorance était encore plus totale.
Pour la famille de Jacques, le latin par exemple était un mot qui n’avait rigoureusement aucun sens.
Qu’il y ait eu (en dehors des temps de la bestialité, qu’ils pouvaient au contraire imaginer) des temps où personne ne parlait français, que des civilisations (et le mot même ne signifiait rien pour eux) se fussent succédé dont les usages et la langue fussent à ce point différents, ces vérités n’étaient pas parvenues jusqu’à eux. Ni l’image, ni la chose écrite, ni l’information parlée, ni la culture superficielle qui naît de la banale conversation ne les avaient atteints.
Dans cette maison, où il n’y avait pas de journaux, ni, jusqu’à ce que Jacques en importât, de livres, pas de radio non plus, où il n’y avait que des objets d’utilité immédiate, où l’on ne recevait que la famille, et que l’on ne quittait que rarement et toujours pour rencontrer des membres de la même famille ignorante, ce que Jacques ramenait du lycée était inassimilable, et le silence grandissait entre sa famille et lui. »
Page 186
Deux mots pour exprimer cette incompréhension : inassimilable et le silence
Je pense qu’il s’agit encore d’un problème actuel où certaines familles ne peuvent pas assimiler ce qui se passe au lycée ou pendant les études et qui conduisent à des enfants qui se sentent écartelés entre deux mondes.
Car du côté du lycée, il y a aussi séparation.
« Au lycée même, il ne pouvait parler de sa famille, dont il sentait la singularité sans pouvoir la traduire, si même il avait triomphé de l’invincible pudeur qui lui fermait la bouche sur ce sujet.
Ce n’était même pas la différence des classes qui les isolait. Dans ce pays d’immigration, d’enrichissement rapide et de ruines spectaculaires, les frontières entre les classes étaient moins marquées qu’entre les races. Si les enfants avaient été arabes, leur sentiment eût été plus douloureux et plus amer. Du reste, alors qu’ils avaient des camarades arabes à l’école communale, les lycéens arabes étaient l’exception, et ils étaient toujours des fils de notables fortunés.
Non, ce qui les séparait, et plus encore Jacques que Pierre, parce que cette singularité était plus marquée chez lui que dans la famille de Pierre, c’était l’impossibilité où il était de la rattacher à des valeurs ou des clichés traditionnels.
Aux interrogations du début d’année, il avait pu répondre certainement que son père était mort à la guerre, ce qui était en somme une situation sociale, et qu’il était pupille de la nation, ce qui s’entendait de tous.
Mais, pour le reste, les difficultés avaient commencé. Dans les imprimés qu’on leur avait remis, il ne savait que mettre à la mention « profession des parents ». Il avait d’abord mis « ménagère » pendant que Pierre avait mis « employée des P.T.T. ».
Mais Pierre lui précisa que ménagère n’était pas une profession mais se disait d’une femme qui gardait la maison et faisait son ménage. « Non, dit Jacques, elle fait le ménage des autres et surtout celui du mercier d’en face. Eh bien, dit Pierre, en hésitant, je crois qu’il faut mettre domestique ».
Cette idée n’était jamais venue à Jacques pour la simple raison que ce mot, trop rare, n’était jamais prononcé chez lui. Pour la raison aussi que personne chez eux, n’avait le sentiment qu’elle travaillait pour les autres, elle travaillait d’abord, pour ses enfants. Jacques se mit à écrire le mot, s’arrêta et d’un seul coup, connut la honte et la honte d’avoir eu honte »
Pages 186 & 187
La honte puis la honte d’avoir eu honte.
Et aussi une appréhension différente du monde, un autre regard : dans la famille de Camus on pensait que la mère travaillait pour ses enfants, chez les érudits on jugeait qu’elle travaillait pour les autres.
L’enfant est mal à l’aise dans ce lycée dans lequel la quasi-totalité des lycéens n’est pas comme lui. Parce que l’enfant se définit par rapport aux adultes, à sa famille. Albert Camus ajoute :
« Un enfant n’est rien par lui-même, ce sont ses parents qui le représentent. C’est par eux qu’il se définit, qu’il est défini aux yeux du monde. C’est à travers eux qu’il se sent jugé vraiment, c’est-à-dire jugé sans pouvoir faire appel. »
Le « premier homme » est un chef d’œuvre.
<1486>
-
Mardi 10 novembre 2020
« En somme, je vais parler de ceux que j’aimais. Et de cela seulement.
Joie profonde »Albert Camus, « Le premier homme », Annexe page 312La lecture de la dernière œuvre de Camus : « Le premier homme » me donna des moments d’émotion et de réflexion intenses.
Pas plus que pour la musique de Schubert, je ne suis capable de parler savamment de cette œuvre, avec les outils et la connaissance des érudits de la littérature.
Si une telle approche vous intéresse, vous pourrez regarder Agnès Spiquel, présidente de la société des études camusiennes, présenter son éclairage <Le Premier Homme » de Camus, le roman de sa vie> dans une conférence d’une heure et demie, donnée à l’Université de Nantes en 2014.
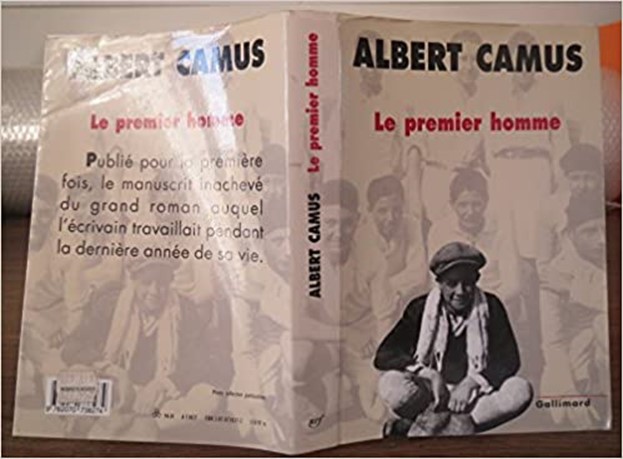 Mon approche ne saurait être que le récit inspirant et émerveillé de l’histoire que raconte ce livre et les réflexions de sagesse ou d’observations de la vie qu’Albert Camus a su concentrer dans des expressions d’une justesse et d’une clarté peu commune.
Mon approche ne saurait être que le récit inspirant et émerveillé de l’histoire que raconte ce livre et les réflexions de sagesse ou d’observations de la vie qu’Albert Camus a su concentrer dans des expressions d’une justesse et d’une clarté peu commune.
Le manuscrit se trouvait dans sa serviette qu’on a retiré de la carcasse de la voiture qui avait conduit Camus à la mort.
C’est une œuvre sur laquelle il travaillait avec acharnement au cours de la dernière année de sa vie, l’année 1959. Il voulait en faire sa grande œuvre. Son « Guerre et paix ».
Son prix Nobel lui avait été décerné 2 ans auparavant. Son discours de réception du prix commençait par ces mots :
« En recevant la distinction dont votre libre Académie a bien voulu m’honorer, ma gratitude était d’autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme et, à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais il ne m’a pas été possible d’apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d’une œuvre encore en chantier […] »
Un homme presque jeune et une œuvre encore en chantier.
Il semble bien qu’à ce moment de sa vie, Camus avait le sentiment qu’il n’avait pas encore écrit sa grande œuvre.
Il s’est donc lancé dans cette aventure. Mails il a écrit fin 1959 qu’il lui faudrait encore 8 mois de travail acharné dans sa maison du Lubéron pour finir une première version terminée de ce livre.
Première version qu’il devait donc par la suite réécrire, compléter, amender.
Le livre était prévue en 3 parties :
- Recherche du père (d’abord appelé les nomades)
- Le fils ou le premier homme (d’abord appelé le premier homme)
- La mère
Il n’a eu le temps que de finir une première version de la première partie, la seconde n’est qu’entamée, la dernière n’existe pas.
Beaucoup disent que c’est une autobiographie, Camus a toujours parlé d’un roman.
Le personnage principal s’appelle « Jacques Cormery » et autour de lui tous les personnages ont un autre nom que celui que portait les proches et les personnes qui ont compté dans la vie de l’écrivain. Ainsi son instituteur, M Germain, s’appelle M Bernard. Quelquefois, le manuscrit laisse poindre l’erreur du premier jet et le vrai prénom de tel oncle ou de tel ami est écrit à la place du nom fictif.
Il est certain que l’histoire qui est racontée est très proche de ce que le jeune Albert Camus a vécue. Agnès Spiquel appelle ce livre : « roman écrit à partir d’une base autobiographique ».
L’éditeur Gallimard écrit :
« Il avait jeté les bases de ce qui serait le récit de l’enfance de son «premier homme». Cette rédaction initiale a un caractère autobiographique qui aurait sûrement disparu dans la version définitive du roman. »
Il est certain que le livre que nous tenons aujourd’hui en main, est probablement très éloigné de ce qu’imaginait ou de ce que voulait faire Albert Camus. On peut penser qu’il voulait partir de sa vie pour en faire une œuvre universelle qui aurait certainement gommé des aspects autobiographiques pour y ajouter des aspects fictifs.
Francine Faure, son épouse, qui, à sa mort, était devenu la responsable de la diffusion de l’œuvre n’a pas publié cette œuvre. Elle avait interrogé un petit cercle d’amis de Camus. Les avis étaient partagés, mais finalement la décision fut de ne pas publier.
A la mort de Francine en 1979, Catherine sa fille va reprendre le flambeau. Et c’est elle qui va faire publier le livre en 1994. L’œuvre n’avait pas de titre, Catherine Camus va choisir celui de la deuxième partie.
Quelquefois, un mot est resté illisible, alors le texte publié laisse un espace que le lecteur remplit comme il peut.
Au cœur du livre se trouve la recherche du père que Camus n’a pas connu. Puisque Camus est né le 7 novembre 1913 et que son père Lucien Auguste Camus qui a vécu toute sa vie en Algérie, n’est venu qu’une fois en Métropole pour aller se battre sur les champs de bataille de la guerre 14-18 et qu’il est mort dès le début de la guerre, en septembre 1914. Atteint à la tête par un éclat d’obus qui l’a rendu aveugle, il est évacué sur l’école du Sacré-Cœur, de Saint-Brieuc, transformée en hôpital auxiliaire, et il meurt, moins d’une semaine après, le 11 octobre 1914, à 28 ans.
Dans le livre Jacques Cormery cherche la tombe de son père dans le carré militaire de Saint Brieuc.
Quand il la trouve, une chose le marque particulièrement :
« « C’est ici », dit le gardien. Ils étaient arrivés devant un carré entouré de petites bornes de pierre grise réunies par une grosse chaîne peinte en noir. Les pierres, nombreuses, étaient toutes semblables, de simples rectangles gravés, placés à intervalles réguliers par rangée successives. Toutes étaient ornées d’un petit bouquet de fleurs fraîches. « C’est le Souvenir français qui se charge de l’entretien depuis quarante ans. Tenez, il est là. » Il montrait une pierre dans la première rangée. Jacques Cormery s’arrêta à quelque distance de la pierre. « Je vous laisse », dit le gardien. Cormery s’approcha de la pierre et la regarda distraitement. Oui, c’était bien son nom. Il leva les yeux. Dans le ciel plus pâle, des petits nuages blancs et gris passaient lentement, et du ciel tombait tour à tour une lumière légère puis obscurcie. Autour de lui, dans le vaste champ des morts, le silence régnait. Une rumeur sourde venait seule de la ville par-dessus les hauts murs. Parfois, une silhouette noire passait entre les tombes lointaines. Jacques Cormery, le regard levé vers la lente navigation des nuages dans le ciel, tentait de saisir derrière l’odeur des fleurs mouillées la senteur salée qui venait en ce moment de la mer lointaine et immobile quand le tintement d’un seau contre le marbre d’une tombe le tira de sa rêverie. C’est à ce moment qu’il lut sur la tombe la date de naissance de son père, dont il découvrit à cette occasion qu’il l’ignorait. Puis il lut les deux dates, « 1885-1914 » et il fit un calcul machinal : vingt-neuf ans. Soudain une idée le frappa qui l’ébranla jusque dans son corps. Il avait quarante ans. L’homme enterré sous cette dalle, et qui avait été son père, était plus jeune que lui.
Et le flot de tendresse et de pitié qui d’un coup vient lui emplir le cœur n’était pas le mouvement d’âme qui porte le fils vers le souvenir du père disparu, mais la compassion bouleversée qu’un homme fait ressent devant l’enfant injustement assassiné – quelque chose ici n’était pas dans l’ordre naturel et, à vrai dire, il n’y avait pas d’ordre mais seulement folie et chaos là où le fils était plus âgé que le père. La suite du temps lui-même se fracassait autour de lui immobile, entre ces tombes qu’il ne voyait plus, et les années cessaient de s’ordonner suivant ce grand fleuve qui coule vers sa fin. Elles n’étaient plus que fracas, ressac et remous où Jacques Cormery se débattait maintenant aux prises avec l’angoisse et la pitié. Il regardait les autres plaques du carré et reconnaissait aux dates que ce sol était jonché d’enfants qui avaient été les pères d’hommes grisonnants qui croyaient vivre en ce moment. »
D’abord un peu indifférent, Camus répond au gardien qui lui demande si c’est dur de se retrouver devant la tombe de son père : « Mais non. Je n’avais pas un an quand il est mort. Alors, vous comprenez ». Mais il est rempli d’émotion quand il se rend compte que la guerre c’est la mort de jeunes hommes, dans la fleur de l’âge.
Certains sont morts encore plus jeunes, si jeune qu’il n’avait même pas eu d’enfants.
Camus ne trouvera pas grand-chose sur son père, sauf deux épisodes essentiels dont il nourrira sa vie et ses valeurs profondes. Le premier a déjà fait l’objet d’un mot du jour, le <2 octobre 2017> : « Non, un homme ça s’empêche. Voilà ce qu’est un homme, ou sinon… » (Page 66)
Un homme ça s’empêche et même s’il y a des causes à défendre, elles ne peuvent justifier l’abomination.
Le second lui a été répété par sa mère : Son père était allé voir exécuter un assassin et quand il est revenu il était malade à en vomir. Camus a toujours été viscéralement contre la peine de mort.
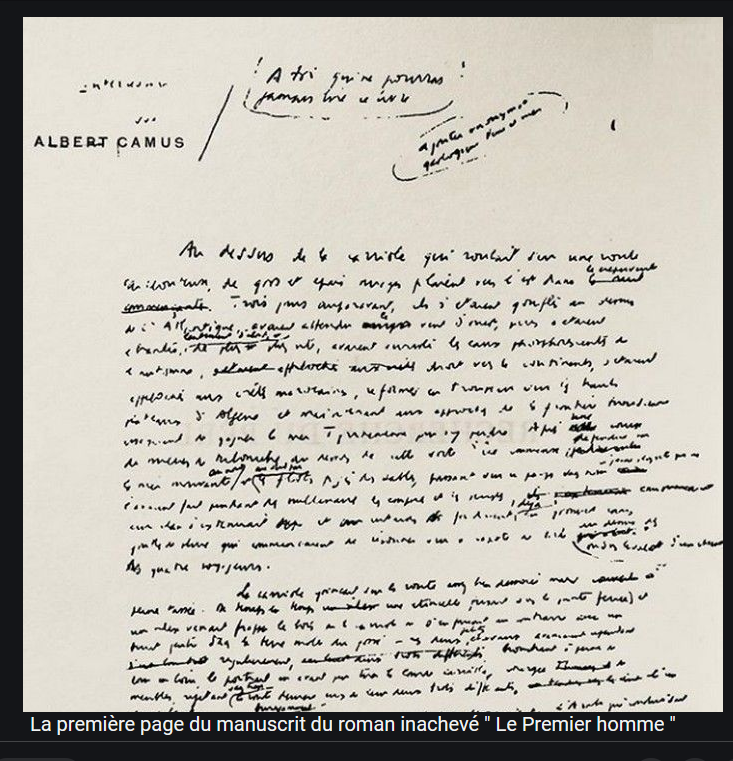
Mais si le livre raconte une quête pour retrouver un peu de son père, c’est aussi un cri d’amour vers sa mère quasi sourde, analphabète, pauvre qui a toujours fait de son mieux dans un monde injuste et violent qu’elle subissait.
Il n’a pu écrire la troisième partie qui lui était consacré, mais sur la première page du manuscrit, il écrit
« A toi qui ne pourras jamais lire ce livre »
Bien sûr, puisqu’elle ne savait pas lire. Et dans les notes qui accompagnaient le manuscrit se trouve cette phrase que j’ai mis en exergue :
« En somme, je vais parler de ceux que j’aimais. Et de cela seulement. Joie profonde »
Et dans une autre note
« Dans l’idéal, si le livre était écrit à la mère, d’un bout à l’autre – et l’on apprendrait seulement à la fin qu’elle ne sait pas lire – oui ce serait cela. »
Annexe page 292
<1485>
- Recherche du père (d’abord appelé les nomades)
-
Lundi 9 novembre 2020
« C’est absurde de mourir dans un accident de voiture. »Albert CamusC’était il y a 60 ans en 1960, mais au début de l’année : le 4 janvier 1960 dans l’Yonne sur le territoire de la commune de Villeblevin, un peu au sud de Fontainebleau
 A 13h55, à pleine vitesse, la voiture conduite par Michel Gallimard arrête sa course dans un platane situé le long de la nationale 5 et se disloque.
A 13h55, à pleine vitesse, la voiture conduite par Michel Gallimard arrête sa course dans un platane situé le long de la nationale 5 et se disloque.
Albert Camus, assis à la place qu’on appelle «la place du mort», perd la vie immédiatement, à 46 ans.
Michel Gallimard, transporté d’urgence dans un hôpital, mourra six jours plus tard.
A l’arrière de la voiture se trouvait l’épouse de Michel : Janine et leur fille Anne
Les deux femmes sortiront miraculeusement indemnes.
Michel est le neveu de Gaston Gallimard, l’éditeur d’Albert Camus.
Michel et son épouse sont des intimes de Camus. Michel, qui dirige la célèbre collection La Pléiade, est tuberculeux, comme Albert, ce qui crée un lien très fort entre eux.
Le philosophe de l’absurde meurt dans un accident de voiture. Lui qui a dit souvent qu’il trouvait absurde de mourir dans un accident de voiture. C’est ce que révèle ce remarquable documentaire réalisé par Georges-Marc Benamou : « Les vies d’Albert Camus ».
Comment s’est-il trouvé dans cette voiture, une Facel Vega, avec son ami Michel ?
En 1957, il avait reçu le prix Nobel de littérature et grâce au chèque de l’académie de Stockholm, il avait acheté une belle maison dans le Lubéron, une ancienne magnanerie, ces fermes où l’on élevait des vers à soie. C’était dans une petite rue de la commune de Lourmarin, village du Vaucluse. Petite rue qui s’appelait pourtant « la Grand-Rue » et qui depuis a été rebaptisée « rue Albert Camus ».
Ce village, ce lieu lui rappelait son Algérie natale qu’il aimait tant et pour laquelle il avait rêvé un autre destin que celui qui allait advenir 2 ans et demi plus tard : l’indépendance.
Lui avait ce rêve utopique d’une Algérie définitivement liée à la France, mais avec des droits strictement identiques entre ceux qu’on appelait les indigènes et les français « européens ». Il aurait voulu aussi une aide massive pour aider les algériens et notamment les kabyles à sortir de la pauvreté.Il avait publié un reportage, resté célèbre, du 5 au 15 juin 1939, dans le quotidien algérois, «Alger Républicain» fondé en 1938 par son ami Pascal Pia : «Misère de la Kabylie»
Nous comprenons, 60 ans après, que cette utopie de Camus n’avait aucune chance à prospérer.
Il aimait donc ce lieu du Lubéron loin des polémiques parisiennes, de l’ostracisme auquel l’avait condamné Jean-Paul Sartre et son clan de staliniens haineux et intolérants qui régnaient alors dans le monde intellectuel de gauche de la capitale.
<Cet article de l’Express> narre :
« Loin du ballet protocolaire du Nobel, des polémiques avec Sartre et des intrigues de couloirs de la maison Gallimard, l’auteur de L’Etranger revit dans ce pays de soleil et de vignes, qui lui rappelle son Algérie natale. On le croise régulièrement au bord du terrain de foot, encourageant la Jeunesse sportive lourmarinoise, ou à la terrasse du café Ollier. Comme en paix avec lui-même. « J’y ai passé quelques semaines en juillet 1959, se souvient sa fille Catherine, qui avait 14 ans à l’époque […]. Il était dans son élément, en adéquation avec ce ciel, cette terre. Il s’y déplaçait avec le naturel d’un chat. »
C’est dans cette ambiance que pour Noël 1959, Albert Camus est rejoint par son épouse Francine et leurs deux enfants, les jumeaux Catherine et Jean, pour les vacances.
La vie sentimentale d’Albert Camus est compliquée, comme le montre le documentaire de Georges-Marc Benamou. Ce dernier réveillon de Noël, comme le nouvel an, se passe avec sa famille.
Le 2 janvier, Francine, Catherine et Jean prennent le train à la gare d’Avignon pour rejoindre Paris. Albert Camus avait également acheté un billet de retour en train. Il avait prévu de rentrer par le chemin de fer, deux jours plus tard, en compagnie de son ami René Char.
Très souvent, comme le rapporte George-Marc Benamou dans son documentaire, il avait eu ce mot : « C’est absurde de mourir dans un accident de voiture ».
Il vaut mieux rentrer en train, mais ce billet de train pour Paris, il ne l’utilisera pas.
Car entre-temps sont arrivés à Lourmarin – au volant d’une Facel Vega… – Michel et Janine Gallimard, accompagnés de leur fille Anne.
Et Albert Camus décidera de rentrer en voiture avec ses amis.
Et je cite le même <article de l’Express> qui raconte le départ le 3 janvier au matin :
« On fait un dernier plein à la station Shell du village et le garagiste en profite pour se faire dédicacer son exemplaire de L’Etranger : « A monsieur Baumas, qui contribue à me faire revenir souvent dans le beau Lourmarin », écrit Camus… Puis ce sont les adieux à la fidèle Suzanne Ginoux. Tout le monde – Michel, au volant, Janine, Anne, Camus et Floc (le chien des Gallimard) – grimpe dans la voiture. […]
Nationale 7, déjeuner à Orange, puis remontée vers la Bourgogne, discussions animées sur les velléités théâtrales d’Anne Gallimard, encouragées par Camus, nationale 6 et, enfin, halte pour la nuit au Chapon fin, deux étoiles au Michelin, à Thoissey, un peu avant Mâcon. Le dîner est joyeux : on célèbre les 18 ans d’Anne Gallimard.
Au matin du 4 janvier, on repart tranquillement vers Paris. […]
Les amis s’arrêtent à Sens pour un bref déjeuner à l’hôtel de Paris et de la Poste. Puis c’est la nationale 5 jusqu’à Paris (autre signe du destin, la construction de l’autoroute du Sud, qui aurait peut-être pu éviter le drame, commencera cette même année 1960…), Camus est assis sur le siège passager, sans ceinture de sécurité (non obligatoire à l’époque), les deux femmes à l’arrière. La voiture vient de passer Champigny-sur-Yonne et aborde une longue ligne droite bordée de platanes. Que s’est-il exactement produit à cet instant ? La Facel Vega sort de la route, frappe de plein fouet un premier arbre puis rebondit 13 mètres plus loin sur un second platane, autour duquel le châssis s’enroule. Les débris de la voiture, littéralement coupée en deux, sont éparpillés sur des dizaines de mètres[…]. Les gendarmes, qui penchent pour un pneu éclaté et, sans doute, une vitesse excessive, relèvent une trace de 63 mètres de long. On n’a, semble-t-il, signalé aucun autre véhicule ni obstacle imprévu à proximité du drame. »
 « C’est absurde de mourir dans un accident de voiture ».
« C’est absurde de mourir dans un accident de voiture ».
Des décombres, maculée de boue, on extrait la serviette d’Albert Camus.
Il y avait glissé, quelques photographies, un exemplaire du Gai Savoir, de Nietzsche, une édition scolaire d’Othello et les 144 feuillets du manuscrit de son chef d’œuvre « Le Premier Homme »
Lors du mot du jour du <2 octobre 2017, j’avais déjà cité un extrait du premier homme, une citation de son père : « Non, un homme ça s’empêche. Voilà ce qu’est un homme, ou sinon… »
Jeune, Camus ne me « parlait » pas. J’avais étudié à l’école « L’Etranger », comme tout le monde, je pense.
Rien ne m’avait accroché, alors.
Mais depuis que l’âge permet de monter chaque jour un peu plus, les marches de la maturation, Camus m’apparait chaque jour, un peu plus, comme un de ces géants qui nous permet de progresser et de réduire notre manque d’intelligence.
J’ai appris que l’expression « des nains sur des épaules de géants » (en latin : nani gigantum humeris insidentes) est une métaphore attribuée à Bernard de Chartres, maître du XIIe siècle, utilisée pour montrer l’importance pour tout homme ayant une ambition intellectuelle de s’appuyer sur les travaux des grands penseurs du passé (les « géants »).
J’ai plusieurs fois cité Albert Camus dans les mots du jour. En partant des plus récents :
- <jeudi 17 octobre 2019> : « Quand ils ont peur, c’est pour eux-mêmes. Mais leur haine est pour les autres. »
- <mardi 12 juin 2018> : «Ce que je sais de la morale, c’est au football que je le dois… »
- <vendredi 6 octobre 2017> : « Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé »
- <jeudi 22 août 2013> : « Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. »
- <mardi 18 décembre 2012> : « L’amitié est la science des hommes libres. »
La pause de l’été m’a permis de lire « Le premier homme » et les vacances d’octobre, d’avant le deuxième confinement, m’ont conduit à lire ce que tout le monde conseillait : « La peste ».
A partir de ces lectures et peut être davantage, si l’inspiration me vient, je vais entamer une série de mots du jour sur Albert Camus.
Je vous redonne le lien vers cet admirable documentaire de Georges-Marc Benamou : « Les vies d’Albert Camus ».
<1484>
- <jeudi 17 octobre 2019> : « Quand ils ont peur, c’est pour eux-mêmes. Mais leur haine est pour les autres. »
-
Vendredi 6 novembre 2020
« Résister, c’est d’abord et absolument faire face. Exprimer une force pour en contenir une autre »Alain ReyEntre 1993 et 2006, Alain Rey, concluait la matinale de France Inter que j’écoutais chaque jour, par une chronique intitulée « Le Mot de la fin ». Il s’emparait alors d’un mot de notre langue qui était présent dans l’actualité et qui, souvent, avait été cité plusieurs fois dans l’émission d’information qu’il concluait.
Alors, il déshabillait ce mot, l’inscrivait dans l’histoire, examinait les différentes significations, souvent éclairait un autre sens du mot. C’était un moment de poésie et d’érudition que j’attendais toujours avec impatience.
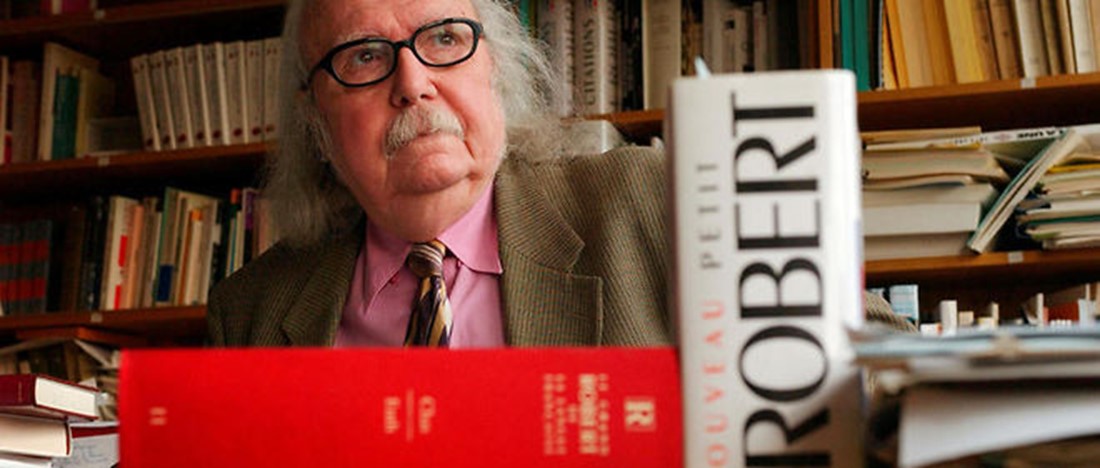 France Inter a republié un certains nombre de ces chroniques sur cette page <(Ré)écoutez « Le Mot de la fin », la chronique d’Alain Rey>
France Inter a republié un certains nombre de ces chroniques sur cette page <(Ré)écoutez « Le Mot de la fin », la chronique d’Alain Rey>
Vous y trouverez sa dernière chronique, le 29 juin 2006, consacrée au mot « Salut ». Mais aussi :
- Pandémie
- Palabre
- Caricature
- Sage
Il avait fait sa chronique sur le mot « sage » lors d’une autre élection présidentielle américaine pendant laquelle il a fallu attendre longtemps pour savoir qui serait le président entre Al Gore et George W Bush. C’était sa chronique du 13 décembre 2000 et il s’en prenait aux juges de la Cour Suprême :
« Un mot que je trouve un peu immérité. C’est le mot « sage ». Les juges de la Cour suprême des Etats-Unis, qui viennent de rendre la décision que l’on sait, sont souvent appelés « Les Sages ». Sans commentaire. Mais les commentaires, justement, soulignent le caractère politique de leur décision. Cinq sages républicains contre quatre sages démocrates égalent un président républicain. Voilà la sagesse assimilée à une majorité politique d’ailleurs faiblarde et surtout une sagesse en morceaux puisqu’avec certes, cinq pro-Gore et quatre pro-Bush modèle W, on aurait eu le résultat inverse. »
Cette page a été mis en ligne suite au décès d’Alain Rey, le 28 octobre 2020, à l’âge de 92 ans.
Il était né en 1928, dans le Puy-de-Dôme. Entre autres études, il a fait des études de lettres et d’histoire de l’art à la Sorbonne. Après son service militaire en Tunisie, il répond en 1952 à une petite annonce de Paul Robert qui cherche des linguistes pour faire un dictionnaire. Alain Rey devient son premier collaborateur pour le Dictionnaire alphabétique et analogique.
Il devient alors l’âme des dictionnaires « Robert », il devient le Robert. Le premier dictionnaire « Le Robert » paraît en 1964. Alain Rey rédige et dirige ensuite les autres dictionnaires publiés par les éditions Le Robert dont le célèbre « Le Petit Robert »
Wikipedia écrit :
« S’il ne fut pas universitaire, il a cependant joué un rôle majeur dans le développement de la terminologie, de la lexicologie, de l’histoire du vocabulaire, de la sémantique historique et de l’histoire culturelle des dictionnaires. »
J’ai trouvé dans <un article du Monde>, publié le 24 mars 2016, une ode dont il avait le secret au mot « résister ».
Il me semble que le mot « résister » constitue un verbe important des temps présents.
 L’hebdomadaire « Le Un » a consacré un de ces dernier numéros à « résister ».
L’hebdomadaire « Le Un » a consacré un de ces dernier numéros à « résister ».
Alain Rey écrivait :
« Le mot « résister » n’est pas très ancien. Il apparaît au tournant des XIIIe et XIVe siècles, par un emprunt direct au latin. C’est un terme d’origine intellectuelle, donc, qui n’est pas passé par les gosiers romans du haut Moyen Age. Dès son apparition, ce mot inventé par les clercs, en un temps où l’individu ne pèse pas, est posé comme collectif, à résonance plurielle. Du « resistere » latin, il tient sa force, son énergie.
Le préfixe « re » n’indique pas ici le redoublement ou la répétition, mais l’intensif appliqué à une racine, « sistere », qui dit l’arrêt, la station fixe. Une racine que l’on retrouve dans « insister », « persister », « désister », « consister » aussi.
Résister, c’est donc d’abord se tenir debout et être capable de faire face. Faire front. Faire obstacle. Face à une menace, un péril, même intime, venu de l’intérieur en quelque sorte.
De façon frappante, on peut remarquer qu’il y a là comme un écho avec le « djihad », cet « effort suprême » de la langue arabe. Dans les hadiths qui complètent le Coran, le Prophète distingue le petit djihad, qui concerne la guerre menée pour préserver l’islam, et le grand djihad, plus essentiel à ses yeux, qui désigne la lutte à mener en son for intérieur contre ses propres faiblesses, ses passions ou ses facilités.[…]
La notion de « résister » est si claire qu’elle n’a quasiment pas varié au fil du temps. Le mot est des plus stables. Un mot résistant en quelque sorte. Posture d’abord théorique, il trouvera plus tard ses emplois concrets, en métaphore.
Au XVIe siècle, il s’applique aux sentiments : désormais, on résiste à une tentative de séduction. Aux choses également, quand celles-ci, face à l’action d’un agent extérieur, parviennent à conserver leur intégrité sans se détériorer.
Mais c’est la progression dans le champ de la psychologie sociale qui sera la plus flagrante : résister au sens de refuser, s’opposer à. Vocabulaire de l’opposition à une séduction autant qu’à une oppression, la notion originelle s’étoffe ainsi sans varier sur le fond. Les dérivés qui s’ensuivent sont particulièrement intéressants. Ainsi, le mot « irrésistiblement », employé au siècle des Lumières dans le champ psychologique pour signifier une promesse d’agréments. »
Et il compare le mot « résister » et le mot « résistance » en montrant la plus grande stabilité du verbe :
« Le mot « résistance » – d’abord orthographié « resistence » lors de ses premières occurrences médiévales – s’est coloré différemment selon les circonstances historiques qui en ont régulièrement popularisé l’emploi. Jusqu’à son actuelle acception majuscule – Résistance –, qui la réserve à l’action, menée durant la deuxième guerre mondiale, de ceux qui s’opposèrent à l’occupation de leur pays par les troupes des puissances de l’Axe. Comparé à cette variabilité, le mot « résister », lui, a conservé sa hauteur de vues originelle, intangible. Résister, c’est d’abord et absolument faire face. Exprimer une force pour en contenir une autre, comme faire le choix de la non-violence pour s’opposer à l’oppression. »
Et il finit par une anecdote propre à nous encourager à continuer à aimer et défendre les caricatures :
« Sur un plan plus intime, j’ai été assez séduit par la proposition que me fit naguère Jean-Michel Ribes de participer à la saison 2007-2008 du Théâtre du Rond-Point, consacrée au « rire de résistance ». La dérision comme autre réponse que le sérieux pour faire face me convient assez. »
Je vous invite aussi à regarder cet entretien sur TV5 dans laquelle Patrick Simonin recevait Alain Rey à l’occasion de la sortie de son dictionnaire historique de la langue française. Vous apprendrez, entre autres, d’où vient le mot tomate et comment il a voyagé.
L’entretien ne dure que 20 minutes. Si vous disposez davantage de temps, en ces temps de confinement, vous pouvez écouter cette conférence passionnante sur la langue française donnée à l’Université de Genève < Le français, une langue à l’épreuve des siècles>. Elle dure 1:45 et vous verrez qu’il a aussi beaucoup d’humour et de la poésie.
Lui qui écrivait le 24 mars 2020 :
« Confinement est sans aucun doute le mot du jour, jour un peu long, à notre regret, mais qui incite ou qui invite à la réflexion. […]
Acceptons d’être « confinés », mais au sens que ce mot eut à la fin du Moyen Âge : « aller jusqu’aux confins ».
Or, les confins de la langue française, c’est le monde. »
<1483>
- Pandémie
-
Jeudi 5 novembre 2020
« Pause (lendemain des élections américaines) »Un jour sans mot du jour nouveauDonc si je comprends, sans le COVID19 il est probable que Trump aurait été élu très largement.
 J’étais tranquille, Olivier Duhamel qui avait prédit la victoire de Trump contre Hillary Clinton, a dit que cette fois Biden allait gagner.
J’étais tranquille, Olivier Duhamel qui avait prédit la victoire de Trump contre Hillary Clinton, a dit que cette fois Biden allait gagner.
Son raisonnement était simple. Les gens votent contre, pas pour.
Et cette fois, le rejet de Trump était plus fort que le rejet de Biden que personne ne peut détester.
Olivier Duhamel a reconnu qu’il s’est trompé <ICI>
Il a surestimé le rejet de Trump.
Parce que, en effet, et c’est cela qui me fait ressembler à ce chat : il y a eu un véritable vote d’adhésion à Trump.
Ce vote n’est pas majoritaire, mais il est très important.
Après 4 ans, après avoir vu et vécu comment cet homme se comportait, mentait, il aura cette fois encore plus de voix que la première fois. Son total des voix est certes relégué à 5 millions de voix de Biden qui bat largement le record précédent de voix obtenus par un candidat. Mais ce record précédent qui était celui de Barack Obama lors de sa première élection est aussi battu par Trump.
C’est insensé.
Je ne sais pas quoi dire de plus aujourd’hui.
<mot sans numéro>
-
Mercredi 4 novembre 2020
« La nuit américaine »Expression à multiples facettesJ’avais déjà parlé de la nuit américaine lors du mot du jour du <7 octobre 2014> qui rendait hommage à François Truffaut et à son film qui portait ce nom.
J’expliquais alors que « la nuit américaine » est le nom d’une technique, au cinéma, qui consiste à tourner des scènes nocturnes en plein jour.
Par chance je n’avais pas utilisé cette expression comme exergue, elle est donc disponible pour décrire cette nuit qui s’achève et au cours de laquelle les résultats des présidentielles américaines nous arrivent peu à peu.
Au moment où j’écris cet article, je ne connais rien du résultat.
France Inter a donné pour titre à l’émission qu’elle consacre à cet évènement « la nuit américaine ».
Il peut aussi être donné un autre sens à cette expression.
Le 20 janvier 2017, Donald Trump prenait les clés de la Maison Blanche.
J’avais écrit un mot du jour le <23 janvier 2017> en m’appuyant sur un dessin.
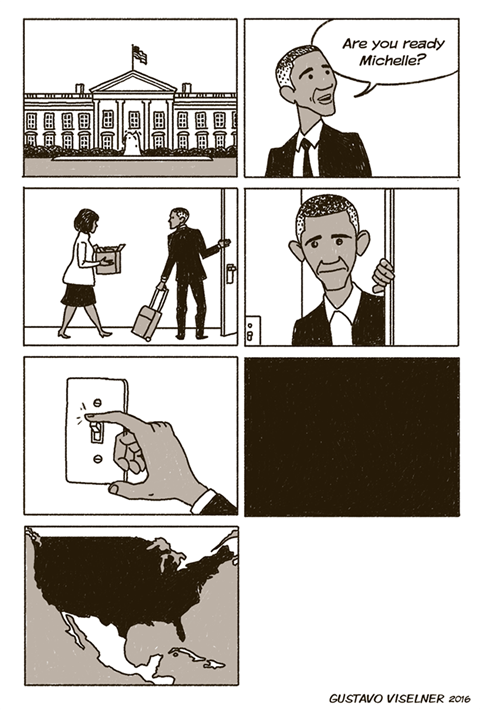 Dessin dans lequel, Obama sort de la pièce et éteint la lumière.
Dessin dans lequel, Obama sort de la pièce et éteint la lumière.
Les Etats-Unis étaient plongés dans la nuit.
Quatre ans sont passés.
Il n’y a pas eu de guerre provoquée par Trump, heureusement.
Mais pour le reste ce fut un désastre pour l’intelligence, pour la vérité, pour la décence, pour la raison . La première vraie crise qu’il a eu à traverser fut celle du COVID 19. Il a alors montré toutes les limites de ses méthodes et de sa manière d’agir.
J’espère profondément qu’il n’y aura pas de quatre ans de plus de Trump.
Je sais bien que Biden, s’il est élu, ne fera pas jaillir une lumière éclatante chassant l’obscurité. Mais il mettra un peu de décence dans tous ce chaos.
Lors du mot du jour du 23 janvier je concluais de manière optimiste :
« Trump est déjà impopulaire, il ne sera probablement qu’une parenthèse dans le temps long de l’Histoire. »
Mais comme je l’avais dit tantôt, les prévisions sont périlleuses, surtout lorsqu’elle concerne l’avenir.
Et je crois que si Trump est battu, les problèmes et la colère profonde d’une partie des citoyens blancs américains ne cessera pas.
Daniel, dans un commentaire récent a écrit :
« Je ne suis pas totalement sûr que Trump soit le problème de la division de l’Amérique, je pense plutôt qu’il en est le symptôme »
Je crois qu’il a raison, même si l’attitude, le comportement, la personnalité de Trump en tant que président des Etats-Unis est un problème en soi.
Mais les éléments de symptômes qui ont conduit à l’élection de Trump resteront après cette élection qu’elle que soit le résultat de ces élections transatlantique.
Sur le site de la Radiotélévision Belge, divers intervenants essayent d’expliquer le trumpisme et les symptômes de cette maladie.
D’abord qu’est ce que le trumpisme ?
« Le trumpisme c’est un style, un mode de gouvernance, lié à la personnalité de Donald Trump. Selon Bernard Rimé, professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain, « aux enfants on apprend certaines règles qui permettent de maintenir le consensus social. Chez Trump il y a une recherche de la satisfaction immédiate, c’est un comportement infantile, il n’y a pas de contrôle interne. Son comportement viole un certain consensus social, un consensus qui impose certaines règles donc un renoncement mais ça, renoncer, cela demande un certain effort. […] Normalement on intériorise ces règles mais chez lui c’est inexistant. […] un autre trait de caractère qui définit la personnalité de Donald Trump, c’est le narcissisme. »
Mais d’où vient le trumpisme ?
« « Donald Trump semble être un symptôme plutôt qu’une cause, il n’est pas arrivé là par hasard, et les conditions de son élection de 2016 sont toujours là », décrypte Hélène Landemore.
Le contexte est favorable à l’émergence d’un « populiste » comme Donald Trump, estiment de nombreux observateurs. En effet, beaucoup estiment que les Etats-Unis sont en train de traverser une crise profonde à plusieurs niveaux : identitaire, une crise de la mondialisation, et une crise institutionnelle qui remet en cause un système favorable aux élites. Et cette crise qui a rendu possible l’élection de Donald Trump en 2016, n’a pas été créé par lui. […]
Selon Bertrand Badie, professeur émérite à Science-Po Paris, la crise identitaire est profonde, « il y a une peur de l’évolution démographique, une peur de devenir minoritaire, de l’inversion de la majorité ». A cela s’ajoute « une découverte qui est vraie. Les classes moyennes s’aperçoivent qu’elles n’ont pas profité de la mondialisation, qu’elles ne se sont pas enrichies ». Et d’ajouter, « avec Trump c’est le versant populiste du républicanisme ».
Et c’est ce versant qui fonctionne car il y a « une vague de dégagisme liée à une vraie perte de confiance dans les élites. Lorsque l’on regarde, par exemple, la composition du Congrès aux Etats-Unis, on se rend compte que 82% de la population est représentée par 10% des plus riches. […] 90% des gens n’obtiennent pas les politiques publiques liées à leurs préférences, ce qui crée un fossé », analyse Hélène Landemore. »
Trump me semble, en effet, répondre à 3 sentiments de l’Amérique profonde :
- Le constat par la classe moyenne américaine que la globalisation lui est devenu défavorable ;
- La crainte par les hommes blancs de perdre le leadership au profit des autres habitants des Etats-Unis ;
- L’hystérie d’évangélistes et de conservateurs qui veulent aller aussi loin que possible dans le maintien voire le retour en arrière vers des valeurs religieuses et familiales archaïques.
Bien sûr si Trump est le symptôme; il n’a pas le début d’une solution à moyen et long terme pour régler ces problèmes et apaiser la société américaine.
<1482>
- Le constat par la classe moyenne américaine que la globalisation lui est devenu défavorable ;
-
Mardi 3 novembre 2020
« La colère musulmane, la France, la Chine et le football »Une histoire de colère sélectiveDans de nombreux pays musulmans, des croyants de l’islam manifestent contre la France.
Il est vrai que des dessins ont choqué.
Et que le président de la République française a dit sur Al Jazira qu’il n’était pas question d’interdire ces dessins.
Vous savez qu’Albert Camus, sur lequel je reviendrai bientôt, disait, en d’autres mots, que le football nous apprenait énormément sur le monde.
Claude Askolovitch avait parlé des musulmans, de la Chine et du football dans sa revue de presse <du 27 octobre 2020>. Je cite in extenso :
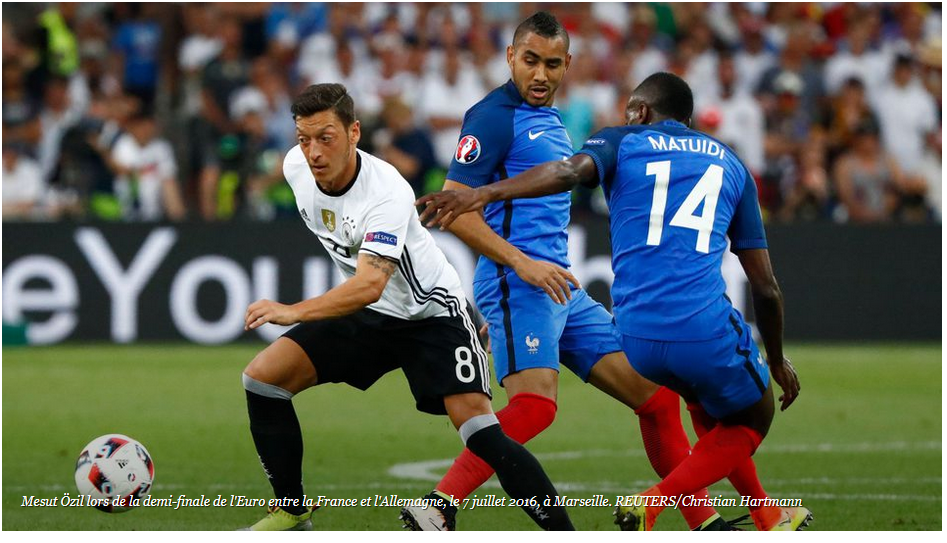 « On parle d’une disparition…
« On parle d’une disparition…
Celle d’un footballeur qui ne joue plus au football, pourtant un plus doués de notre humanité, l’allemand Mesut Ozil, champion du monde en 2014, mais que son club, Arsenal, a décidé d’écarter cette année, aussi bien des compétitions européennes que du championnat anglais… L’histoire d’Ozil est racontée sur les sites du New York Times, de l’Equipe, de So foot, belle trinité, et elle nous intéresse parce qu’elle n’est pas une simple histoire de sport, quand les muscles ou la volonté se dérobent chez un champion trentenaire, elle est l’histoire d’un homme annihilé par deux monstres politiques…
Le premier est son ami, et fut témoin à son mariage, Recep Erdogan, président turc dont on lit dans le Monde qu’il ne fait plus guère l’unanimité chez lui, mais qui par ses diatribes est encore aujourd’hui dans nos journaux -la croix l’humanité- la figure de l’ennemi…
L’autre monstre est la chine que Ozil a publiquement attaqué, scellant ainsi sa perte…
L’aventure s’est jouée en deux temps… En mai 2018 d’abord, quand Ozil, d’origine turque posait avec Erdogan alors en campagne électorale, cette proximité avec un autocrate choquait la fédération puis l’opinion allemande et, une coupe du monde ratée plus tard, Ozil renoncerait à la sélection qu’il avait si bien honorée, disant avoir été mal considéré en raison de son ascendance…
Une grosse année plus tard, décembre 2019, Ozil défendait sur les réseaux sociaux les Ouïgours, peuple musulman persécuté en chine… Le post était en langue turque, il était communautaire aussi bien qu’humanitaire… Ozil parlait de la « blessure sanglante de la Oummah », la communauté des croyants…
« Ils brulent leurs Corans, ils ferment leurs mosquées, ils interdisent leurs écoles, les hommes sont jetés dans des camps et les femmes sont forcées de vivre avec des hommes chinois, mais les musulmans sont silencieux, ils les ont abandonnés… »
Quelques jours plus tard raconte le NY times, les partenaires chinois de la première ligue refusaient de diffuser un match d’arsenal.
Les commentateurs sportifs chinois cessèrent de prononcer son nom; Son avatar fut retiré des jeux vidéos…
Et Arsenal, le club d’Ozil, et le football anglais, qui dépendent amplement du marché chinois, ne défendirent pas le joueur contre l’empire, pour le nouvel an chinois, Arsenal prit soin d’effacer Ozil des produits de merchandising…
Et c’est ainsi qu’Ozil, après son pays, perdit son club, je vous passe les anecdotes de club et de vestiaire… Ozil n’a plus joué depuis mars. On l’attendrait dit So foot à Istanbul à Fenerbahce, chacun chez soi, à la maison..
On reste rêveur sur le poids des identités… et sur la puissance d’un empire, la Chine. »
Vous pouvez aussi lire cet article de Courrier International : <Quand Arsenal sacrifie sa star Mesut Özil pour faire plaisir à la Chine>
Concernant la manière dont l’Allemagne a traité son international, champion du monde, on pourra lire cet article : « Sous le feu de la critique, le patron de la Fédération allemande de foot (DFB) a regretté jeudi de ne pas avoir défendu le joueur Mesut Özil, cible de propos racistes après une rencontre avec le président truc. »
Mais ce qui me parait essentiel c’est le silence assourdissant qu’accompagne les persécutions des musulmans Ouighours que mènent le Régime totalitaire de la Chine communiste de Xi Jinping. Silence aussi de ces mêmes foules musulmanes ?
Et lorsque Mesut Ozil dit et écrit des choses évidentes sur ce sujet, la Chine arrive à faire « annuler » le footballeur, comme on dit aujourd’hui au temps de la cancel culture.
De manière plus globale, « Le Monde » avait écrit un éditorial début janvier 2020 < Chine, Inde, Birmanie : silence sur les musulmans persécutés> :
« Face à la situation des minorités musulmanes dans ces pays, ni les indignations sélectives des Occidentaux ni l’indifférence des pays arabes ne peuvent se justifier.
Certaines infamies suscitent à juste titre des déluges de protestations, d’autres nettement moins. Qui se soucie vraiment des Ouïgours de Chine ? Des musulmans d’Inde ? Des Rohingya de Birmanie ? Ces trois populations minoritaires de pays asiatiques ont en commun d’être musulmanes, persécutées et quasi oubliées. […]
L’indifférence des pays musulmans à l’égard de ces drames est encore plus problématique. Ni l’Arabie saoudite, ni les Emirats ni l’Egypte, ni les pays du Maghreb ne semblent s’émouvoir du sort des Ouïgours, des musulmans d’Inde ou des Rohingya, pourtant parties prenantes comme eux de l’islam sunnite. Ce défaut de solidarité peut résulter d’un calcul économique : l’Arabie saoudite est le principal fournisseur de pétrole de la Chine et l’attrait exercé par les énormes projets chinois d’infrastructures des « nouvelles routes de la soie » est fort dans l’ensemble de la péninsule Arabique. Les pays comme l’Arabie saoudite ou les Emirats, qui disent lutter contre l’« extrémisme » et le terrorisme, sont mal placés pour critiquer la Chine et l’Inde, qui recourent à la même rhétorique. En se solidarisant avec les musulmans persécutés dans ces pays, les pays arabes s’exposeraient enfin à des critiques sur le sort qu’ils réservent à leurs propres minorités. »
TV Monde pose aussi cette question : « Pourquoi le monde musulman ne réagit-il pas face aux persécutions du gouvernement chinois ? »
Cet article cite Dilnur Reyhan , présidente de l’Institut ouïghour d’Europe et qui est bien évidemment musulmane :
« Désolée, mais je ne vous souhaite pas un bon ramadan. » : c’est ainsi que débute la tribune de Dilnur Reyhan […]. Cette phrase d’introduction — qui peut sembler provocante au prime abord — est suivie d’une somme de constats terribles sur le traitement réservé aux musulmans du Xinjian : « A l’heure où des millions de Ouïghours et d’autres musulmans souffrent et meurent dans les camps de concentration chinois, où toute la population turcophone de la région ouïghoure est privée de ramadan, où les musulmans sont contraints par les autorités chinoises de manger du porc, de boire de l’alcool, de renier leur religion, où leurs mosquées millénaires sont démolies, leurs livres en écriture arabe brûlés ; à l’heure où vous, pays musulmans, observez un silence complice ; où vous allez même, pour certains d’entre vous, jusqu’à approuver ce monstrueux crime contre l’humanité afin de préserver vos relations avec la Chine, je ne peux pas vous souhaiter un bon ramadan. »
Pour avoir une idée de ce qui se passe on peut regarder ce documentaire d’ARTE : <Chine Ouïghours, un peuple un danger Arte >
Il y a aussi ces témoignages publiés par un média suisse : <Rescapés de camps de rééducation chinois au Xinjiang, ils témoignent>
Il faut croire que les caricatures françaises sont plus douloureuses que la violence réelle et physique que pratique la Chine, mais aussi l’Inde et la Birmanie.
Ainsi va le monde des religions, les concepts et les idées sont plus importants que la vie et les souffrances terrestres.
<1481>
-
Lundi 2 novembre 2020
« Votez pour l’Autre »Ameena Matthews psychologue musulmane afro-américaine qui œuvre à ChicagoLa Constitution américaine est très précise :
« Les grands électeurs sont choisis le mardi suivant le premier lundi de novembre, dans l’année précédant la fin du mandat du président sortant. »
Dans la nuit du mardi au mercredi, nous connaîtrons peut-être le Président des Etats-Unis ou pas. Peut-être, que cette nuit va aussi ouvrir une grande période d’incertitude, en raison du grand nombre de votes par correspondances, conséquences de la COVID 19 et aussi de la personnalité hystérique et déraisonnable de l’homme que les électeurs américains et les institutions américaines ont élu en 2016.
Car en effet, si globalement le vote des américains, on parle du vote populaire, avait donné 3 millions de voix de plus à Hillary Clinton, l’organisation du vote indirect par grands électeurs désignés par États a donné l’avantage à Donald Trump.
Un documentaire allemand, diffusé par ARTE, a suivi des américains, les uns votant pour Trump les autres contre lui pendant l’année 2020.
Ce documentaire passionnant, en 5 épisodes, montre une Amérique polarisée, divisée, violente et mobilisée les uns contre les autres.
Vous trouverez l’ensemble de ces épisodes derrière ce lien : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020267/les-usa-dans-tous-leurs-etats/
On rencontre des personnes extraordinaires d’humanité et de dévouement et d’autres de bêtises sidérantes.
Je commencerai par une toute jeune fille issue de la bourgeoisie blanche du Colorado, Isabel Brown, qui brandit, comme un étendard, ses opinions conservatrices dans une université majoritairement à gauche. Elle s’est faite repérer par l’association Turning Point, qui milite pour la réélection de Donald Trump. Et elle espère être embauchée à la Maison Blanche après cette réélection.
Elle porte un tee-shirt sur lequel est inscrit « Le socialisme est naze ».
Elle affirme avec conviction que l’Amérique est le pays de la liberté et des opportunités et qu’il suffit de faire les bons choix et de travailler énergiquement pour avoir une vie remarquable. Elle dit très précisément que chacun est responsable de ses succès et de ses échecs.
Elle parle avant tout de son destin puisqu’elle est issue d’une famille aisée. elle ignore probablement que les sociologues ont compris que les déterminismes sociaux deviennent de plus en plus importants dans les réussites sociales.
C’est le rêve américain.
Rêve que poursuit Shubham Arora, travailleur sans-papiers, venue clandestinement d’Inde et qui est chauffeur de taxi à New York. Pendant le documentaire il va quitter New York, trop cher, pour aller en Georgie où il espère pouvoir monter un business d’une station service dans laquelle il va investir les économies qu’il a pu rassembler par son travail harassant à New York.
 Mais il y a d’autres personnages lumineux que ce documentaire a découvert. Ainsi, la psychologue musulmane afro-américaine Ameena Matthews qui œuvre dans un quartier particulièrement violent de Chicago : South Side. On la voit se dévouer pour aider ses concitoyens, pour apaiser les tensions.
Mais il y a d’autres personnages lumineux que ce documentaire a découvert. Ainsi, la psychologue musulmane afro-américaine Ameena Matthews qui œuvre dans un quartier particulièrement violent de Chicago : South Side. On la voit se dévouer pour aider ses concitoyens, pour apaiser les tensions.
J’ai choisi, comme exergue l’injonction qu’elle a prononcée devant un groupe de noirs pour comprendre que pour ces combattants sociaux il ne s’agit pas de croire en Joe Biden mais de voter contre Trump, donc pour l’autre.
A un autre moment du documentaire elle décrit le président actuel :
« Au Pays de la liberté, il a la mentalité d’une hyène »
On suit aussi, Pamela Peynado Stewart, une avocate latino-américaine, à Atlanta, qui défend les sans-papiers, mais aussi s’engage pour les aider comme elle aide des pauvres qui ont été mis en prison pour des délits mineurs et qui ne sont pas libérés parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer la caution qu’on leur réclame, même modeste. Elle a ainsi créé une association qui reçoit des dons pour payer ces cautions.
Elle ne dit pas pour qui elle va voter, mais cela parait assez évident.
Et puis, il y a les religieux.
Ainsi, le pasteur Doug Pagitt de Minneapolis qui est évangéliste comme un tiers des américains. Il sait que la grande majorité des évangélistes votent pour Trump. Lui dénonce l’incompétence de son président et espère convaincre des croyants, comme lui, de changer leur vote. Il a monté avec des amis un projet Vote Common Good (« Votez pour le bien commun »). Et avec ses amis il a entrepris une tournée en bus pour traverser tous les Etats-Unis pour convaincre le plus d’électeur possible. Et quand la crise du COVID a rendu impossible la poursuite de la tournée en bus, ils ont continué sur les réseaux sociaux.
Il reconnait bien volontiers que Biden n’est pas le candidat parfait mais il ajoute cette phrase pleine de sens :
« Le président ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais le président ne doit pas être le problème. »
En revanche, le Pasteur baptiste de Harrisonville dans le Missouri, Charles Kaighen voit en Trump le meilleur allié de la foi chrétienne.
Il a l’air sympathique à première vue, mais il affirme sans sourciller que la terre a été créée par Dieu il y a 6000 ans et que la vérité se trouve dans la bible et non chez les scientifiques.
Il est homophobe et défend rigoureusement la morale chrétienne.
On apprend qu’il a fait de la prison jeune parce qu’il consommait de la drogue et qu’il a rencontré Dieu en sortant de prison.
Une dame membre de sa communauté explique :
« A l’école publique, ils peuvent enseigner des valeurs avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Ici l’église Baptiste, on enseigne des valeurs auxquelles nous croyons. »
 Et on trouve à Clairton, une ville sinistrée de Pennsylvanie, un autre homme remarquable le maire, Rich Lattanzi qui se démène corps et âmes pour ses concitoyens. Il fait distribuer des vivres à ses administrés, privés de revenus par la pandémie de Covid-19, il projette de bâtir des logements abordables. Il s’implique aussi pour les problèmes de sécurité.
Et on trouve à Clairton, une ville sinistrée de Pennsylvanie, un autre homme remarquable le maire, Rich Lattanzi qui se démène corps et âmes pour ses concitoyens. Il fait distribuer des vivres à ses administrés, privés de revenus par la pandémie de Covid-19, il projette de bâtir des logements abordables. Il s’implique aussi pour les problèmes de sécurité.
Il est lui-même au chômage, il travaillait dans l’usine polluante qui se trouvait dans sa ville et il a eu deux cancers au cours des 18 derniers mois, contre lesquels il a lutté par une chimiothérapie.
Le documentaire le montre aussi, vrai motif d’espoir, marier deux citoyens de sa ville, l’homme est un soldat blanc et la femme est de couleur noire.
Un autre motif d’espoir nous est donné par un couple de gens tolérants dans l’Utah. Alison et Chris Anderson qui prennent avec distance et humour leurs divergences politiques internes. La femme a toujours voté démocrate et l’homme toujours républicain. Ils invitent à leur table des amis des deux bords qui arrivent à dialoguer et à débattre.
Peut être le seul endroit encore aux Etats-Unis où cela reste possible, comme le village gaulois d’Astérix ?
Ils ont quand même un grand avantage, même les républicains de ce groupe ont décidé de ne pas voter pour Trump.
Vous trouvez donc ces 5 épisodes derrière ces liens :
Une grande année pour de grands rêves | Elections présidentielles USA (1/5) | ARTE
Le calme avant la tempête | Elections présidentielles USA (2/5) | ARTE
Au bord de la guerre civile | Elections présidentielles USA (3/5) | ARTE
Le test ultime | Elections présidentielles USA (4/5) | ARTE
L’heure du choix | Elections présidentielles USA (5/5) | ARTE
<1480>
-
Vendredi 30 octobre 2020
«Ils parlent une langue que je ne comprends pas, pourtant c’est la même que moi.»Parole de la chanson « l’autre rive » chantée par les facteurs chevauxSommes-nous condamnés à parler un jour de pandémie et le lendemain du terrorisme ?
Et quand ça va vraiment mal, faut-il parler des deux…
Heureusement, qu’il nous reste la culture et l’Art.
La culture dont nous avons tant besoin et qui souffre aujourd’hui de la situation créée par la pandémie.
La culture qui si l’on croit les annonces gouvernementales, n’est pas essentielle, puisque les salles de spectacles sont fermées.
 Je ne connaissais pas Fabien Guidollet et Sammy Decoster qui ont fondé ensemble un duo qu’ils ont appelés « Facteurs chevaux. »
Je ne connaissais pas Fabien Guidollet et Sammy Decoster qui ont fondé ensemble un duo qu’ils ont appelés « Facteurs chevaux. »
J’écoutais une émission de France Culture, « la Grande Table », l’invité était Fabrice Lucchini.
Et puis la journaliste Olivia Gesbert a brusquement annoncé : « Nous allons écouter une chanson »
Ce fut un moment sublime.
Et elle dévoila qu’il s’agissait de la chanson <L’autre rive> que les facteurs chevaux interprétaient et qui faisait partie de leur dernier album « Chante-nuit» paru en juin 2020, juste après le premier confinement.
Alors j’ai voulu en savoir un peu plus.
Ce site : https://www.detoursdechant.com/concerts/facteurs-chevaux/ les présente de manière subtile.
« Pénétrer dans l’univers des Facteurs Chevaux risque d’ouvrir une brèche spatio-temporelle dans votre quotidien, sans certitude de retour à la normale. […]
Suivre les Facteurs Chevaux, c’est accepter d’oublier le dernier métro et le café du lundi matin pour se propulser dans la pureté du son de la voix et du bois. C’est se laisser charmer par le murmure de l’un, le baryton de l’autre, s’ouvrir aux mots qui refusent toute temporalité et naviguer à vue dans un espace pétri de mysticisme, de légendes et de réflexions empiriques. […]
Ebloui, sonné, interloqué ou enchanté… chacun réagira à sa manière selon son pouvoir d’émerveillement et sa dose de nihilisme. Mais vous l’aurez compris le voyage auquel nous convie ce disque – gravé dans le vinyle de notre époque – est hors des cartes routières et c’est pour cela que son souvenir ne peut que s’imprimer de manière indélébile dans les méandres de ceux qui iront jusqu’au bout du chemin.»
Il me semble que c’est assez juste.
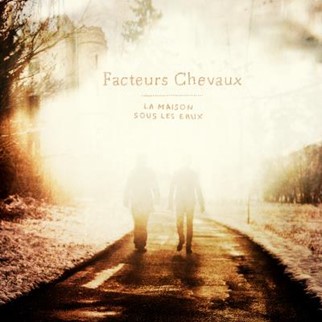 Leur premier album « La Maison sous les eaux » paru en 2016 avait été présenté par les Inrockuptibles de cette manière :
Leur premier album « La Maison sous les eaux » paru en 2016 avait été présenté par les Inrockuptibles de cette manière :
« Superbe premier album d’un duo français buissonnier, pratiquant un folk singulier.
D’abord il y a ce nom, Facteurs Chevaux, qui met la puce à l’oreille autant que l’eau à la bouche. Une telle référence oblique au facteur Cheval, fameux représentant de l’art brut admiré par les surréalistes, ne peut émaner que de gens aimant prendre la clé des champs et gambader allègrement sur les sentiers buissonniers. […]
Après avoir travaillé ensemble sur les disques de Verone, les deux gaillards se lancent avec Facteurs Chevaux dans une nouvelle aventure 100 % nature. Conçues dans un village du massif de la Chartreuse, avec deux guitares acoustiques, une autoharpe et deux voix, les huit chansons réunies sur leur premier album, La Maison sous les eaux, semblent jaillir, vives et claires, comme l’eau d’une source. Évoquant les comptines d’un folklore perdu ou inconnu, ces chansons mêlent des textes teintés d’une douce étrangeté à des musiques d’une fervente sobriété. A la fois spontané et raffiné, élégant et divagant, l’ensemble distille un parfum aussi subtil que pénétrant. »
<3C> est une société de production bordelaises de spectacles et tournées. Je pense qu’elle doit être, comme d’autres, en grande difficulté en ce moment. Elle présente le nouveau disque « Chante-nuit ».
« C’est dans un village du massif de la Chartreuse que Sammy Decoster et Fabien Guidollet façonnent leurs chansons épurées : une guitare et des harmonies vocales pour des textes-contes en français qui convient les esprits de la forêt ou les légendes des montagnes. A l’instar de l’illustre Facteur Cheval, Sammy et Fabien se font maçons d’édifices fragiles, triturent une glaise musicale faite d’argile harmonieuse pour en faire un palais idéal.
On avait laissé Fabien Guidollet et Sammy Decoster sur la branche de l’arbre où leur magnifique premier album La Maison sous les Eaux les avait assis en 2016 : duo acoustique aux harmonies vocales entêtantes parcourant les sous-bois d’une France rurale, largement ignorée par le milieu des musiques actuelles.
Le soleil s’est couché derrière le château et a laissé la place à une nuit peuplée de créatures fantastiques tandis que Facteurs Chevaux semblent s’être réconciliés avec l’humain, auquel ils concèdent une certaine empathie, quand il veut bien se donner la peine (comme eux) de regarder vers le haut.
Et de fait leur nouvel album, Chante-Nuit, est empreint tout au long de ses neuf titres d’une soif d’apesanteur, fuyant l’immobilisme, la boue et les rancœurs, pour mettre en valeur l’imagination, la danse et finalement susciter l’espoir. »
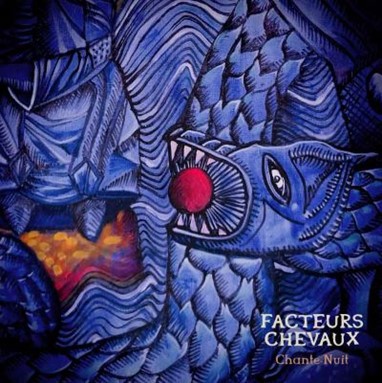 Les paroles de cette chanson « L’autre rive » sont les suivantes :
Les paroles de cette chanson « L’autre rive » sont les suivantes :
Oh ton cœur est si léger-beau qu’il ne prend pas racine dans un pot
oh ton coeur est si léger-beau qu’il ne prend pas racine dans un pot
c’est pourquoi tu trépignes au milieu des autres
ils parlent une langue que je ne comprends pas
pourtant c’est la même que moi
je suis le frère d’une autre rive
et je flotte à la dérive
je te rejoindrai ma fille à mille lieues de là
oh tu t’es envolée là-haut
moi je reste étrange et sot
étourdi détrempé d’eau
J’ai choisi, comme exergue, la phrase « ils parlent une langue que je ne comprends pas, pourtant c’est la même que moi. » parce qu’elle correspond à ce que je ressens.
Je ne comprends pas de quoi, ils parlent.
Evoquent-ils la mort ?
Je ne le sais pas.
Mais je sens que c’est très beau. <L’autre rive>
J’ai acheté l’album.
Il existe aussi <Cette vidéo>
Et si vous aimez cela, une autre chanson : <Facteurs Chevaux – Firmament>
<1479>
-
Jeudi 29 octobre 2020
«Un Lièvre en son gîte songeait (Car que faire en un gîte, à moins que l’on ne songe ?) »Jean de La FontaineNous sommes donc à nouveau confinés.
Et que peut-on, le lendemain, raconter ?
Nous sommes dans notre gîte à songer….
Comme le lièvre dont La Fontaine parlait
Un Lièvre en son gîte songeait
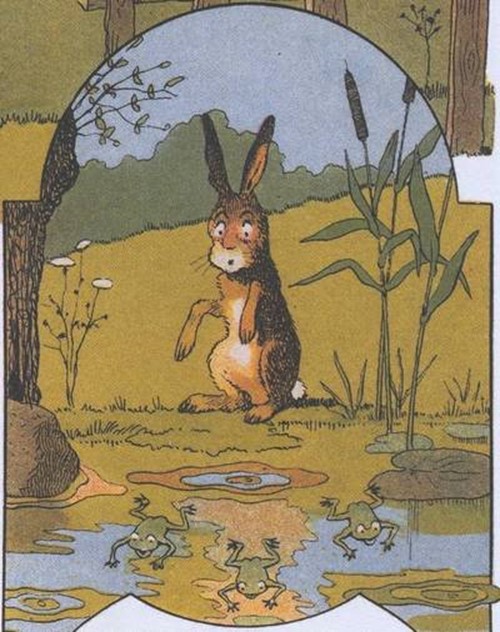
(Car que faire en un gîte, à moins que l’on ne songe ?) ;
Dans un profond ennui ce Lièvre se plongeait :
Cet animal est triste, et la crainte le ronge.
« Les gens de naturel peureux
Sont, disait-il, bien malheureux.
Ils ne sauraient manger morceau qui leur profite ;
Jamais un plaisir pur ; toujours assauts divers.
Voilà comme je vis : cette crainte maudite
M’empêche de dormir, sinon les yeux ouverts.
Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle.
Et la peur se corrige-t-elle ?
Je crois même qu’en bonne foi
Les hommes ont peur comme moi. »
Ainsi raisonnait notre Lièvre,
Et cependant faisait le guet.
Il était douteux, inquiet :
Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre.
Le mélancolique animal,
En rêvant à cette matière,
Entend un léger bruit : ce lui fut un signal
Pour s’enfuir devers sa tanière.
Il s’en alla passer sur le bord d’un étang.
Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes ;
Grenouilles de rentrer en leurs grottes profondes.
« Oh! dit-il, j’en fais faire autant
Qu’on m’en fait faire ! Ma présence
Effraie aussi les gens ! je mets l’alarme au camp !
Et d’où me vient cette vaillance ?
Comment ? Des animaux qui tremblent devant moi !
Je suis donc un foudre de guerre !
Il n’est, je le vois bien, si poltron sur la terre
Qui ne puisse trouver un plus poltron que soi. »
Le Lièvre et les Grenouilles
Jean de La Fontaine
Dans une autre fable, La Fontaine parlait de confinement.
Certain Ours montagnard, ours à demi léché,
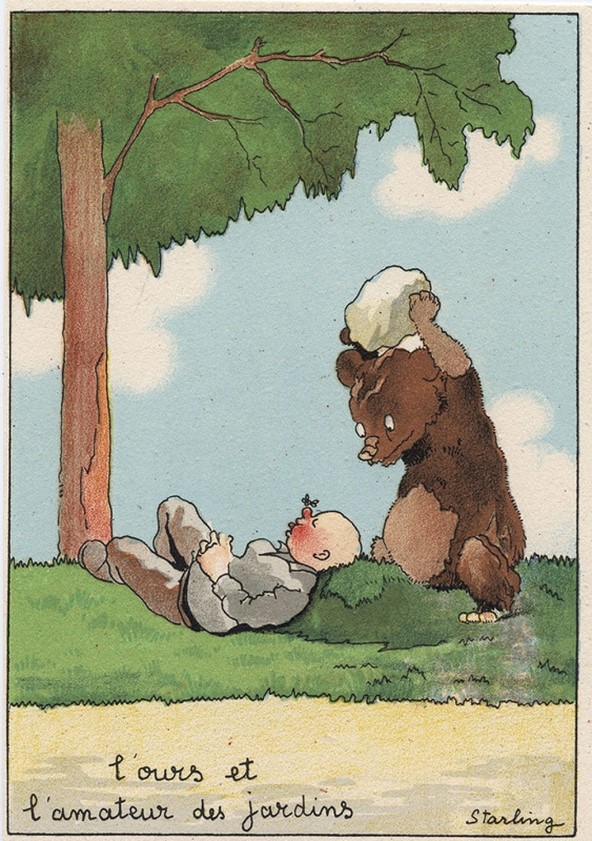
Confiné par le Sort dans un bois solitaire,
Nouveau Bellérophon, vivait seul et caché.
Il fût devenu fou : la raison d’ordinaire
N’habite pas longtemps chez les gens séquestrés.
Il est bon de parler, et meilleur de se taire ;
Mais tous deux sont mauvais alors qu’ils sont outrés.
Nul animal n’avait affaire
Dans les lieux que l’Ours habitait ;
Si bien que tout Ours qu’il était,
Il vint à s’ennuyer de cette triste vie.
Pendant qu’il se livrait à la mélancolie,
Non loin de là certain Vieillard
S’ennuyait aussi de sa part.
Il aimait les jardins, était prêtre de Flore,
Il l’était de Pomone encore.
Ces deux emplois sont beaux ; mais je voudrais parmi
Quelque doux et discret ami.
Les jardins parlent peu, si ce n’est dans mon livre :
De façon que, lassé de vivre
Avec des gens muets, notre homme, un beau matin,
Va chercher compagnie, et se met en campagne.
L’Ours, porté d’un même dessein,
Venait de quitter sa montagne.
Tous deux, par un cas surprenant,
Se rencontrent en un tournant.
L’Homme eut peur : mais comment esquiver ; et que faire ?
Se tirer en Gascon d’une semblable affaire
Est le mieux : il sut donc dissimuler sa peur.
L’Ours, très mauvais complimenteur,
Lui dit : « Viens-t’en me voir. » L’autre reprit : « Seigneur,
Vous voyez mon logis ; si vous me vouliez faire
Tant d’honneur que d’y prendre un champêtre repas,
J’ai des fruits, j’ai du lait : ce n’est peut-être pas
De nos seigneurs les Ours le manger ordinaire ;
Mais j’offre ce que j’ai. » L’Ours l’accepte et d’aller.
Les voilà bons amis avant que d’arriver ;
Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble :
Et bien qu’on soit, à ce qu’il semble,
Beaucoup mieux seul qu’avec des sots,
Comme l’Ours en un jour ne disait pas deux mots,
L’Homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage.
L’Ours allait à la chasse, apportait du gibier ;
Faisait son principal métier
D’être bon émoucheur ; écartait du visage
De son ami dormant ce parasite ailé,
Que nous avons mouche appelé.
Un jour que le Vieillard dormait d’un profond somme,
Sur le bout de son nez une allant se placer
Mit l’Ours au désespoir ; il eut beau la chasser.
« Je t’attraperai bien, dit-il, et voici comme. »
Aussitôt fait que dit : le fidèle émoucheur
Vous empoigne un pavé, le lance avec raideur,
Casse la tête à l’Homme en écrasant la mouche ;
Et non moins bon archer que mauvais raisonneur,
Raide mort étendu sur la place il le couche.
Rien n’est si dangereux qu’un ignorant ami ;
Mieux vaudrait un sage ennemi.
L’ours et l’amateur des jardins
Jean de La Fontaine (1621-1695)
Pendant le confinement de la première vague Fabrice Luchini avait enregistré et diffusé sur Instagram des fables de la Fontaines.
Un internaute a compilé ces enregistrements dans une vidéo que vous trouverez <ICI>
La première fable de cette série est l’ours et l’amateur des jardins.
Il cite le début du lièvre et des grenouilles vers la 16ème minute.
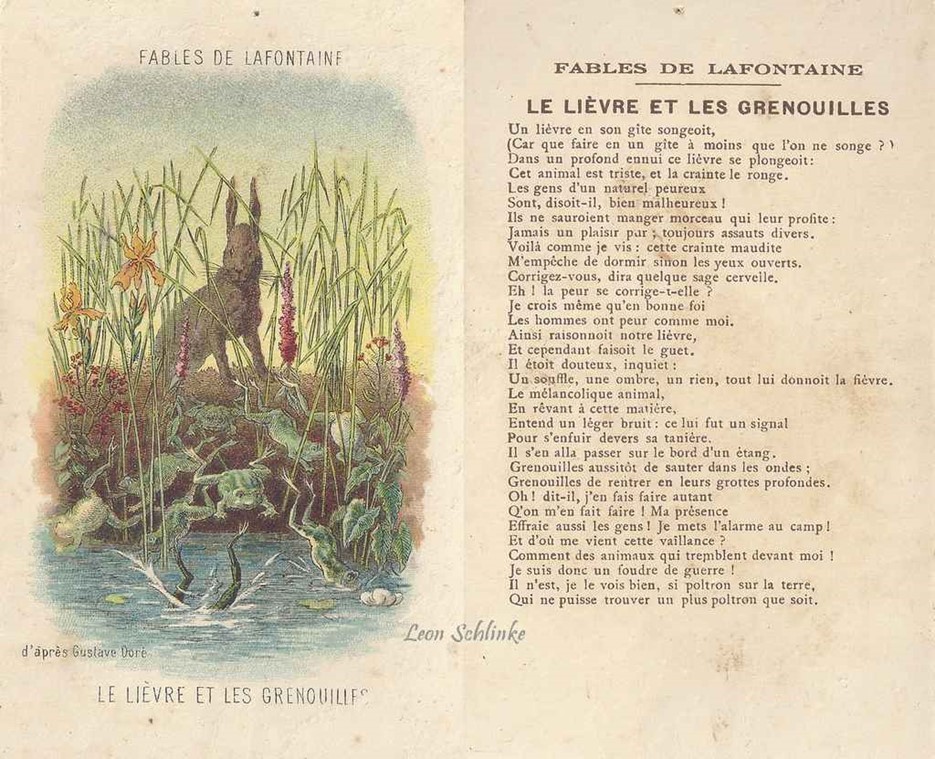
<1478>
-
Mercredi 28 octobre 2020
«Nous sommes bien seuls pour défendre notre conception de la liberté d’expression.»Le Monde ne comprend pas la FranceJe ne m’arrêterai pas aux éructations d’Erdogan qui poursuit d’autres projets que la simple défense des musulmans « maltraités en France ».
L’Elysée a vivement réagi aux insultes du sultan de Turquie et a rappelé son ambassadeur d’Ankara, un geste diplomatique très fort, le précédent date de 1901.
La Présidence Française a aussi dressé le constat de :
« L’absence de toute marque officielle de condamnation ou de solidarité des autorités turques après l’attentat terroriste de Conflans-Sainte-Honorine »
Mais c’est une vague de fond dans les pays musulmans contre notre liberté de critiquer et de se moquer de toutes les religions.
Il n’existe pas une hiérarchie sunnite, ni quelque chose d’équivalent au Pape dans l’islam sunnite. Cependant l’Université d’Al-Azhar du Caire qui est une institution islamique sunnite d’enseignement, a commencé sa mission en 988, elle est l’un des plus anciens lieux d’enseignement islamiques au monde et constitue une référence.
<Wikipedia> précise que :
« Selon l’article 2 de cette loi, al-Azhar « est un organisme savant islamique qui cherche à préserver, à étudier, à divulguer et à diffuser le patrimoine islamique, à diffuser le message islamique qui a été confié, à tous les peuples et à le promouvoir, à montrer l’islam et son influence sur le progrès de l’humanité, le développement de la civilisation, le maintien de la paix, la tranquillité et la paix d’esprit de tous les peuples, ici et maintenant».
Cette Université est présidée par cheikh Ahmed al-Tayeb qui a condamné mardi 20 octobre la décapitation d’un professeur en France, « un acte criminel odieux» mais il a tout de suite ajouté qu’insulter les religions au nom de la liberté d’expression constitue «un appel à la haine».
<Le Figaro> précise que
« Il s’exprimait à distance dans un discours lu à Rome, sur la célèbre place du Capitole, devant un prestigieux parterre de leaders religieux du christianisme, du judaïsme et du bouddhisme – dont le pape François, le patriarche oecuménique Bartholomée ou encore le grand rabbin de France Haïm Korsia- qui se sont retrouvés mardi pour signer un appel commun à la paix.
«En tant que musulman et grand imam d’Al-Azhar, je déclare que l’islam, ses enseignements et son prophète n’ont rien à voir avec cet acte criminel odieux», déclare en arabe le grand imam sunnite dans ce discours. «Dans le même temps, j’insiste sur le fait qu’insulter des religions et attaquer leurs symboles sacrés au nom de la liberté d’expression est un double standard intellectuel et un appel à la haine», a-t-il ajouté.
«Ce terroriste ne représente pas la religion du prophète Mahomet», a encore commenté le grand imam d’Al-Azhar, dans son discours traduit de l’arabe par l’AFP. L’institution islamique sunnite avait qualifié début septembre d’«acte criminel» la réédition en une du journal français Charlie Hebdo des caricatures du prophète Mahomet à l’occasion du procès des attentats djihadistes de janvier 2015 en France.
Et en octobre elle avait jugé « raciste » le discours du président français Emmanuel Macron contre le « séparatisme islamiste », dénonçant des « accusations » visant l’islam.»
C’est très clair, il ne fallait pas tuer, mais car il y a toujours un mais ce n’est pas bien ce que fait, ce que dit la France sur le rire, la caricature et l’humour sur les religions. Car il s’agit bien de la France, Samuel Paty dans son enseignement était le digne représentant des valeurs de la France. Cela crée bien sur une ambiance, un climat dans lequel des illuminés pensent qu’ils peuvent passer à des actes violents.
Par ailleurs, cheikh Ahmed al-Tayeb a exprimé une demande bien précise : l’adoption d’une législation mondiale sur la « diffamation des religions et de leurs symboles sacrés »
Je ne me lasserai pas de rappeler que si dans la déclaration universelle des droits de l’homme, il n’a pas été mentionné qu’on avait le droit de changer de religion c’est en raison de l’opposition de pays musulmans.
Dans ces domaines nous ne sommes vraiment pas dans le même camp.
Quand sur Twitter, immédiatement après l’assassinat de Samuel Paty, j’ai réagi pour défendre nos valeurs et notre liberté, tout de suite quelqu’un a réagi en me répondant
« Qu’est ce que tu dirais, si on pissait sur ton prophète ? »
Dès lors, on constate que notre position n’est pas admise dans beaucoup de pays musulmans.
Et c’est ainsi que « Le Monde » a publié ce mardi un article : « Colère grandissante du monde musulman contre Macron ». Même les opposants de Macron doivent comprendre qu’ici il n’est pas question de l’homme politique qu’ils combattent mais du Président de la République que les manifestants voient comme l’image de la France.
L’Arabie saoudite ce pays de l’intolérance et des mœurs archaïques ne se tait pas :
« Considérée comme une alliée de la France, l’Arabie saoudite a condamné à son tour les représentations jugées offensantes du prophète Mahomet, rapporte l’agence Reuters. »
Au Bangladesh,
« Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté mardi à Dacca, appelant au boycott des produits français et brûlant une effigie d’Emmanuel Macron […]. Selon la police, plus de 40 000 personnes ont participé à cette marche organisée par l’Islami Andolan Bangladesh (IAB), l’un des principaux partis islamistes bangladais […] « Macron fait partie des quelques dirigeants qui adorent Satan », a déclaré à la foule rassemblée à la mosquée Baitul Mukarram un haut responsable de l’IAB, Ataur Rahman. Il a appelé le gouvernement bangladais à « mettre dehors » l’ambassadeur français. Un autre dirigeant islamiste, Hasan Jamal, a pour sa part, déclaré que les protestataires allaient « mettre à terre chaque brique » de l’ambassade si l’ambassadeur n’était pas renvoyé. »
Et aux Emirats :
« Le Conseil des sages musulmans, sis à Abou Dhabi, a, de son côté, annoncé son intention de poursuivre Charlie Hebdo. Ce conseil, regroupant des dignitaires musulmans de divers pays, « a décidé de mettre en place un comité de juristes internationaux pour poursuivre en justice Charlie Hebdo », fait savoir un tweet publié mardi sur le compte de l’institution sunnite Al-Azhar, située au Caire. Le conseil, présidé par le grand imam d’Al-Azhar, affirme qu’il envisage également de « poursuivre en justice quiconque offense l’islam et ses symboles sacrés ».
« La liberté d’expression (…) doit respecter les droits d’autrui et ne devrait pas permettre d’utiliser les religions dans les marchés de la politique ou dans la propagande électorale », affirme le conseil. »
Et en Algérie :
« Décapitation de Samuel Paty : le Haut Conseil Islamique algérien condamne la campagne « enragée » contre la « religion de paix » et fustige les « dépravés qui prétendent s’exprimer au nom de la liberté d’expression » »
Devant cette déferlante sommes nous soutenus par les pays occidentaux ?
Certes ils condamnent tous l’acte terroriste, mais ils ne soutiennent pas la liberté d’expression à la Française.
Les pires sont certainement les américains.
Immédiatement après l’assassinat de Samuel Paty a circulé sur la toile cette photo d’un texte sensé avoir été publié par le New York Times
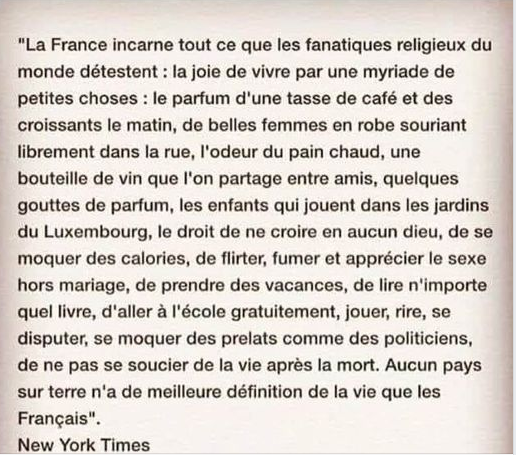 Mais le site <Des décodeurs> du Monde nous apprend que ce texte est de 2015 et :
Mais le site <Des décodeurs> du Monde nous apprend que ce texte est de 2015 et :
« Ce joli texte de soutien à la France, dont on a pu lire qu’il était extrait d’un éditorial, est en fait un commentaire publié dans la nuit de vendredi à samedi sur le site du New York Times »
Ainsi le New York Times officiel a titré après l’attentat terroriste :
« La police française tire et tue un homme après une attaque mortelle au couteau dans la rue »
Ce journal réputé de gauche et progressiste a donc traduit ce qui s’est passé à Conflans saint Honorine comme une vulgaire bavure policière.
La victime principale semble être le terroriste tchétchène.
Heureusement que des américains ont protesté. Ainsi une journaliste américaine Claire Lehmann a twitté :
« Un professeur de collège est décapité pour avoir blasphémé en France – la plus laïque des nations – et le New York Times titre comme cela »
Alors le New York Times a fait un effort et a modifié son titre :
« La police française tue un homme qui venait de décapiter un professeur dans la rue »
Est-ce vraiment mieux ?
Le point essentiel reste que la police a tué un homme.
Ce titre révèle bien sur la condamnation sur le fond. Le New York Times est désormais totalement paralysé par le risque de pouvoir choquer, blesser une communauté particulière qu’il a renoncé de publier des dessins de Presse,
Il n’est pas isolé, cette vision est celle de la plupart des médias que nous pensons progressistes aux Etats-Unis.
Bien sûr, il existe au sein même du monde musulman des hommes et des femmes qui se lèvent et soutiennent la France : Kamel Daoud, Boualem Sansal.
Mais globalement l’air du monde ne sent pas bon.
Le plus probable c’est que par lâcheté, par lassitude, pour l’économie nous allons nous coucher. Il n’y aura plus de caricature, plus que des critiques très modérés de ces machines religieuses qu’on n’aurait pas le droit de blesser.
Je le regrette profondément, les pays dans lesquels la religion est religion d’État que ce soit dans le passé ou aujourd’hui, ne sont pas des pays où il fait bon vivre, rire et réfléchir.
Vous pouvez lire avec beaucoup d’intérêt ce bel entretien de Caroline Fourest :
« Nous sommes l’un des rares pays à regarder le fanatisme dans les yeux »
<1477>
-
Mardi 27 octobre 2020
«Le problème de l’échiquier de Sissa.»Légende indienne qui permet « un peu » d’appréhender une évolution exponentielleIl faut être bienveillant.
Les prévisions sont compliquées surtout si elles concernent l’avenir.
Dimanche 4 octobre 2020 Jean-François Toussaint, professeur de physiologie de l’Université Paris-Descartes et directeur de l’IRMES, Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport à l’INSEP, affirmait sur CNews : « Il n’y aura pas de deuxième vague, nous sommes dans une instrumentalisation. »
Lundi 5 octobre 2020, le docteur Laurent Toubiana, chercheur épidémiologiste à l’Inserm, déclarait sur Sud Radio : «Il n’y aura pas de deuxième vague car nous avons atteint l’immunité collective »
Le Professeur Raoult a eu des propos divergents sur ce sujet. <RTL> a cherché à suivre la chronologie de ses analyses. Sa dernière version est qu’il n’a jamais dit qu’il n’y aurait pas de seconde vague.
Il semble, quand même, selon les soignants, qui sont en première ligne, qu’il y a bien une seconde vague.
Ainsi, dans un article paru dans le Parisien du 25 octobre, Martin Blachier, médecin de santé publique et épidémiologiste exprime son désarroi : «Quand j’ai vu les chiffres, je n’y ai pas cru» et constate une «accélération non contrôlée».
Nos hôpitaux sont à nouveau sous tension.
Je n’ai aucune compétence pour parler de ce virus, de la manière de le contrôler, de ce qu’il faut faire ou de ce qui aurait dû être fait. Mais j’entends les cris de détresse de celles et de ceux qui doivent accueillir les malades et les soigner.
Cependant, il y a un phénomène qui m’est un peu plus familier, parce que dans ma jeunesse j’avais quelque facilité en mathématiques.
Et ce phénomène est ce que les mathématiques appellent « une fonction exponentielle ». Dans le langage courant on parle d’une évolution exponentielle.
Mais connaitre conceptuellement et je dirais par les chiffres et les graphes le profil d’une courbe exponentielle, ne permet pas forcément d’appréhender la réalité du phénomène.
Un article, qui date déjà de juin, du journal Suisse « Le Temps » tente d’expliquer : « Pourquoi notre cerveau ne comprend rien à la propagation du coronavirus »
Cet article se réfère à une étude menée par des chercheurs allemands aux Etats-Unis qui met en évidence la difficulté de la population à appréhender la croissance exponentielle de l’épidémie. Un biais qui a un impact sur l’adhésion aux mesures de distanciation sociale :
« Des chercheurs allemands se sont livrés à une analyse regroupant trois études menées aux Etats-Unis pour comprendre pourquoi une importante partie de la population a du mal à accepter et à comprendre l’utilité de ces mesures. […]
Ces études ont été menées sur trois groupes différents de plus de 500 personnes pendant la deuxième partie du mois de mars, alors que la croissance de l’épidémie s’emballe aux Etats-Unis. Dans un premier temps, les chercheurs ont demandé aux participants d’estimer le nombre de nouveaux cas sur les cinq jours passés. Sur les trois premiers jours de la semaine, ces derniers ont tendance à surestimer le nombre de cas, mais la tendance s’inverse sur les deux derniers jours. Sur l’ensemble de la période, les personnes interrogées ont en moyenne sous-estimé la croissance de l’épidémie de 45,7% par rapport à son évolution réelle.
Cette double tendance s’explique par la difficulté à appréhender la propagation exponentielle du virus. Les estimations de la majorité des participants suivent en fait un modèle linéaire d’évolution de l’épidémie. Les chercheurs ont également cherché à mettre en évidence l’influence des convictions politiques sur les estimations des participants. Globalement, ceux se considérant comme conservateurs ont eu plus de mal à estimer la vitesse de diffusion du virus que ceux se présentant comme libéraux. »
Je ne cite pas tout l’article que vous pouvez consulter. Dans le domaine économique, des études avaient aussi mis en évidence cette difficulté d’appréhender le phénomène de croissance exponentielle.
Et bien sûr, quand on ne comprend pas un phénomène on a du mal à adhérer à des consignes visant à contrôler ce phénomène, surtout si ces consignes sont contraignantes.
Il existe cependant une légende qui peut nous aider à devenir un peu plus sage.
Vous l’avez certainement déjà entendu, mais ce qui est pertinent c’est de l’appliquer au contexte du COVID.
Il s’agit d’une légende, mais elle nous apprend quelque chose de vrai.
Il était une fois en Inde, un roi du nom de Belkib qui s’ennuyait beaucoup.
Il n’y avait pas les réseaux sociaux numériques à cette époque, ni Netflix et toutes ces séries qui permettent d’occuper l’esprit quand on a du mal à remplir sa vie intérieure.
Pour lutter contre son ennui il a demandé qu’on invente un jeu pour le distraire.
Aujourd’hui en France on lancerait un appel d’offre.
Un sage du nom de Sissa se mit alors à inventer le jeu d’échecs.
Le roi Belkib fut ravi et voulut comme tout bon souverain récompenser celui qui avait si bien su le distraire.
Il était tellement content qu’il demanda même à Sissa de choisir sa récompense qui pourrait être fastueuse.
Et c’est alors que…
Sissa demanda au roi de prendre le plateau du jeu et, sur la première case, poser un grain de riz, ensuite deux sur la deuxième, puis quatre sur la troisième, et ainsi de suite, en doublant à chaque fois le nombre de grains de riz que l’on met.
Et de faire ainsi jusqu’à la 64ème case.
Le roi exprima son étonnement, il ne comprenait pas alors qu’il promettait une récompense fastueuse que le sage Sissa demande un cadeau aussi « modeste ».
Alors pour comprendre qu’il n’y a rien ici de modeste, mais que nous sommes devant un phénomène exponentiel je vous renvoie vers le problème de mathématiques qu’a publié l’Académie de Paris et qui propose aussi la solution : « La légende de l’échiquier »
L’humain moderne que nous sommes, s’il veut se rendre compte, va utiliser son tableur préféré pour calculer cette évolution dans les 64 cases puis faire la somme.Et cela vous apprendra qu’à partir de la case 50, le tableur commence à réaliser des approximations parce qu’il atteint ses limites ou plutôt qu’il cherche à optimiser ses ressources. Les concepteurs du tableur ont, en effet, fait le choix qu’à ce niveau de nombre il n’était pas judicieux de mobiliser des moyens pour donner le chiffre exact.
En conclusion, sur la 64ème case, il faut déposer 263 grains de riz, ce qui se dit en français, 2 puissance 63. En effet, sur la première case Sissa met un grain ce qui se définit par 2 puissance 0, et sur la deuxième case on aura donc 2 puissance 1 qui est égale à 2. Et ainsi de suite ce qui conduit au résultat sur la 64ème case de 2 puissance 63.
Et quand on additionne tous les grains sur les 64 cases on obtient 18 446 744 073 709 600 000. Ce qui est donc une approximation du tableur
La solution mis en ligne sur le site de l’Académie de Paris, nous donne un éclairage supplémentaire sur ce chiffre qui ne signifie pas grand-chose pour nous :
« De nos jours la production annuelle mondiale de riz est environ 600 x 106 tonnes, en français 600 millions de tonnes. (en 2000)
Un grain de riz pèse environ 0,06 g.
Le tableur donne 18 446 744 073 709 600 000 comme valeur approchée du nombre de grains de riz qui auraient dû être déposés sur l’échiquier !
La masse serait alors de 1 106 804 644 422 570 000 grammes, soit approximativement 1 106 804 644 423 tonnes.
Ce qui correspondrait à 1 845 années de production mondiale de riz ! »
Là je crois que nous comprenons mieux, ou plutôt nous sommes sidérés.
La demande de Sissa conduit à demander 1845 années de production mondiale de riz de l’année 2000 !
Comment mieux expliquer qu’on perd le contrôle.
De manière technique, cet exemple se base sur la puissance de 2, c’est une fonction exponentielle. Il en existe, bien sûr, beaucoup d’autres.
C’est Gilles Finkelstein qui, lors de son face à face avec Natacha Polony du 24 octobre 2020 sur France inter, a rappelé cette légende et l’a rapprochée de l’évolution actuelle du COVID.
Le site de l’Académie de Paris a aussi mis en ligne un dessin de l’échiquier qui fait mieux que le tableur et donne les valeurs exactes sur chaque case.
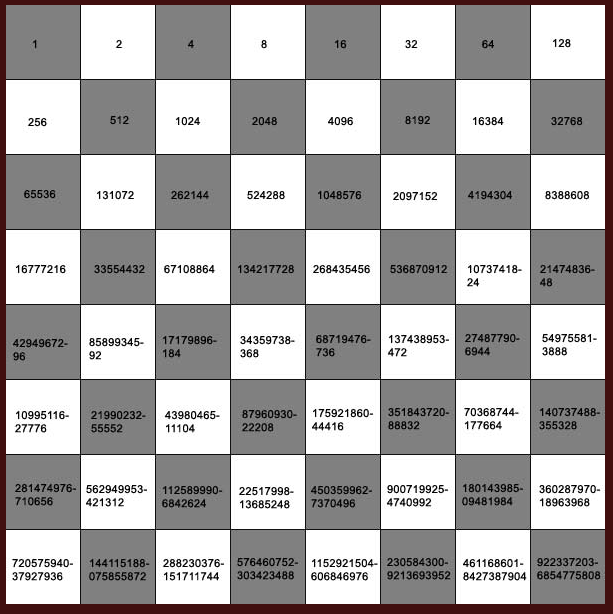
<1476>
-
Lundi 26 octobre 2020
«Nous sommes terriens !»Petite réflexion suite à un dessinAu départ, il y a ce dessin partagé par mon ami Lucien sur Facebook

Lucien avait lui-même partagé le dessin qui avait été initialement publié par une personne se faisant appeler « Citoyen du monde » et qui se définit ainsi :
« Personne qui pense que les habitants de la Terre ne forment qu’un peuple commun et que les droits et les devoirs sont universels. Il privilégie l’intérêt du monde par rapport aux intérêts nationaux … »
Je suis, en effet, terrien et vous aussi.
Nous sommes terriens et nous habitons la terre, avec beaucoup d’êtres vivants, animaux, végétaux, bactéries et autres.
Et nous avons beaucoup de problèmes à résoudre pour que la terre continue à être accueillante pour tous ceux qui y habitent : réchauffement climatique, diminution de la biodiversité, contraintes sur les ressources, impact d’homo sapiens sur l’écosystème, conflits entre les Etats…
Alors je sais bien que le plan A de quasi tous les gouvernants de Macron à Trump, en passant par Xi Jinping ou Boris Johnson est que le génie de l’homme va trouver des solutions innovantes et techniques qui permettront de résoudre tous nos problèmes.
Il existe selon certains, un plan B dans lequel une aide extérieure à laquelle ils donnent le nom de Dieu va régler tous ces problèmes. En ce qui concerne les chrétiens que je connais le mieux, cette phase de solution dans laquelle Dieu vient résoudre les difficultés, passent par un jugement dernier dans lequel un grand nombre va passer un sale quart d’heure.
J’ai quelques doutes sur ces deux plans.
Il reste le troisième dans lequel, il y a une prise de conscience collective qui nous fait comprendre que nous sommes tous terriens et que nous avons avec notre descendance un destin commun, sur l’unique planète qui est à notre portée.
Je pense qu’il est rationnel de penser à ce plan C.
<1475>
-
Vendredi 23 octobre 2020
«Pause (Les tisserands : réparer ensemble le tissu déchiré du monde)»Un jour sans mot du jour nouveauLe mot du jour qui s’approche des 1500 articles, n’est pas qu’un billet quotidien.
Il est aussi une somme de sujets abordés, plusieurs portent l’étiquette « islam ».
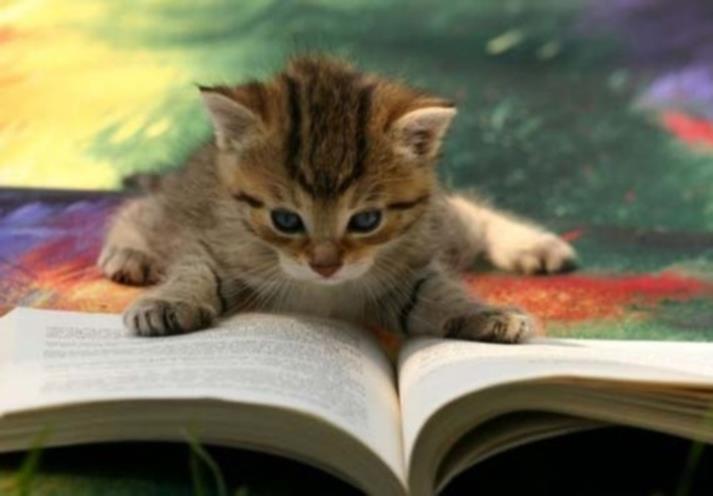 Aujourd’hui je vous propose de revenir sur celui du 17 juin 2016
Aujourd’hui je vous propose de revenir sur celui du 17 juin 2016
Il donnait la parole à Abdennour Bidar qui avait répondu à une interview lors de la sortie de son livre :
«Les tisserands : réparer ensemble le tissu déchiré du monde»
Et il disait notamment :
«Abdennour Bidar – Qui dit religion dit système de croyances, c’est-à-dire quelque chose qui a historiquement imposé aux individus un ensemble de dogmes, de rites et une morale. C’est la première caractéristique pérenne et universelle des religions. La seconde est le caractère souvent clos de ces systèmes. Les religions ont une très forte puissance d’inclusion entre les membres de la communauté et une puissance d’exclusion des autres.
Ce sont ces deux aspects qui me semblent aujourd’hui absolument incompatibles avec les conditions de nos sociétés, de nos cultures et de nos mentalités. La civilisation contemporaine est fondée sur un très fort principe de liberté individuelle. Ainsi, l’individu est très réticent vis-à-vis de tout ce qu’il perçoit comme une vexation de sa liberté. Et ça ne s’applique pas seulement au domaine religieux. Dans nos sociétés, il y a une réelle crise de l’autorité. On a de plus en plus de mal à obéir à quelque chose d’imposé.
C’était le <mot du jour du 17 juin 2016>
<Mot sans numéro>
-
Jeudi 22 octobre 2020
«Pause (l’islam des lumières)»Un jour sans mot du jour nouveauDepuis le début de la semaine il est question d’une petite part des musulmans.
Minorité agissante et nuisible
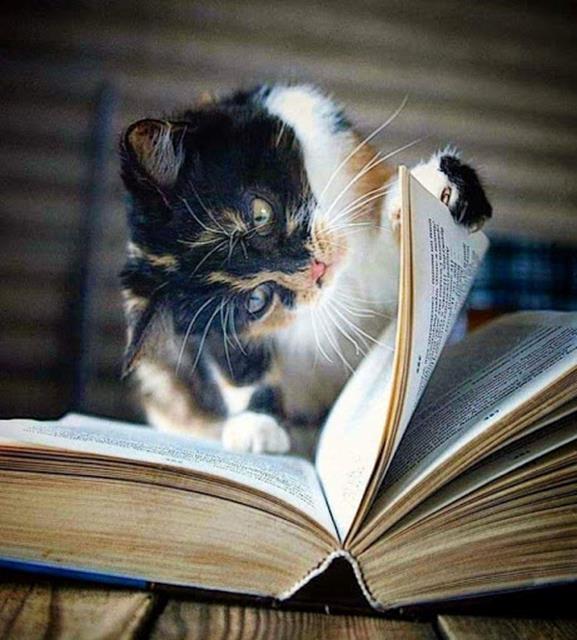 Heureusement qu’il en existe beaucoup d’autres.
Heureusement qu’il en existe beaucoup d’autres.
Malek Chebel était un homme remarquable.
Il est mort le 12 novembre 2016.
Le mot du jour du 17 novembre 2016 lui rendait hommage :
Malek Chebel
<Mot sans numéro>
-
Mercredi 21 octobre 2020
«Qui est islamophobe ? »Question légitime quand on constate l’abus et les conséquences délétères de l’usage de ce motSamuel Paty était accusé d’être islamophobe par certains parents d’élèves musulmans du collège dans lequel il enseignait.
Et il a été assassiné par un fou qui était de religion musulmane et qui croyait cette accusation exacte.
Il existe d’ailleurs, une officine trouble dont j’ai déjà parlé et qui a pour nom Collectif Contre l’Islamophobie en France et dont le site se trouve derrière ce lien : https://www.islamophobie.net/
J’avais déjà exprimé mon malaise par rapport à ce mot piège lors du mot du jour du 6 février 2020 : « islamophobie ».
Une phobie (du grec ancien φόβος / phóbos, frayeur, crainte ou répulsion) est une peur démesurée et dépendant d’un ressenti plutôt que de causes rationnelles, d’un objet ou d’une situation précise.
L’islamophobie est donc la crainte, la frayeur devant l’islam.
Alors, je vais vous soumettre une liste :
2012
Les 11 mars 2012, 13 mars 2012, 19 mars 2012, tueries à Toulouse et Montauban faisant 7 morts dont 3 enfants et 6 blessés.
- 11 mars 2012 : Mohammed Merah assassine un militaire à Toulouse
- 15 mars 2012 : Mohammed Merah assassine deux militaires et en blesse un autre à Montauban
- 19 mars 2012 : Mohammed Merah assassine quatre personnes devant une école juive de Toulouse
- 19 septembre 2012 : Jérémie Louis Sidney et Jérémie Bailly, membre de la cellule Cannes-Torcy, blessent 1 personne en lançant une grenade dans un épicerie juive de Sarcelles
2013
- Le 25 mai 2013, un extrémiste islamiste armé d’un couteau attaque et blesse un militaire français dans l’attentat de 2013 à La Défense.
2014
- Le 20 décembre 2014, attaque contre un commissariat de Joué-lès-Tours de 2014. Un homme criant « Allahu akbar » attaque un poste de police avec un couteau. Il blesse trois policiers avant d’être abattu5,6,
2015
- Du 7 au 9 janvier 2015, attentats en France. Une série d’attaques terroristes islamistes qui se déroule entre les 7 et 9 janvier 2015 en France, visant le comité de rédaction du journal Charlie Hebdo, des policiers et des Français de confession juive fréquentant une supérette cacher. Dix-sept personnes sont assassinées et vingt sont blessées ; les trois terroristes sont abattus par les forces de l’ordre le 9 janvier.
- Le 3 février 2015, trois militaires en faction devant un centre communautaire juif à Nice sont agressés au couteau par Moussa Coulibaly, demeurant à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Il exprime en garde à vue sa haine de la France, de la police, des militaires et des Juifs.
- Le 10 avril 2015, un soldat français est attaqué et blessé dans les toilettes de l’aéroport d’Orly.
- Le 19 avril 2015, affaire Sid Ahmed Ghlam. Une femme de 32 ans (Aurélie Châtelain) est assassinée par un étudiant algérien de 24 ans qui prévoyait un attentat dans une église de Villejuif, le projet de ce dernier ayant été déjoué peu de temps après.
- Le 26 juin 2015, attentat de Saint-Quentin-Fallavier en Isère, 1 mort décapité (Hervé Cornara, 55 ans) et 2 blessés. Brandissant un drapeau islamiste, un homme conduit son véhicule contre des bonbonnes de gaz stockées dans la cour de la filiale française du groupe américain Air Products.
- Le 21 aout 2015, attentat du train Thalys sur la ligne reliant Amsterdam à Paris, mené par un ressortissant marocain et déjoué par plusieurs passagers, on compte 3 blessés.
- Le 13 novembre 2015, une série de sept attaques, à Paris et en Seine-Saint-Denis, perpétrée par au moins dix terroristes avec au moins une vingtaine de complices, provoque la mort de 130 personnes et fait 413 blessés, dont 99 dans un état très grave. Les tueries sont revendiquées par l’État islamique.
2016
- Le 7 janvier 2016, un islamiste marocain portant une fausse ceinture explosif attaque des policiers à l’aide d’un couperet à viande, il est abattu.
- Le 11 janvier 2016, un adolescent turc âgé de 15 ans agresse à la machette un enseignant juif. L’auteur dit avoir agi « au nom d’Allah » et de l’organisation État islamique. Un blessé.
- Le 13 juin 2016, double meurtre à Magnanville. Un commandant de police et sa compagne, fonctionnaire du ministère de l’intérieur (Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider), sont assassinés devant leur domicile à Magnanville par Larossi Abballa. L’attentat est revendiqué par l’organisation État islamique.
- Le 14 juillet 2016 à Nice, le jour de la fête nationale, un Tunisien, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, fonce dans la foule au volant d’un camion sur la promenade des Anglais, tuant 86 personnes et en blessant 458, avant d’être abattu par les forces de l’ordre. L’État islamique revendique cet acte.
- Le 26 juillet 2016, lors d’une messe, deux islamistes munis d’armes blanches prennent en otage plusieurs personnes dans l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Un prêtre est égorgé, et un paroissien est blessé. Les deux terroristes sont abattus par les forces de l’ordre, l’un d’eux était fiché S. Selon le Président de la République, « les deux terroristes se réclament de Daesh ». L’attentat est revendiqué via Amaq, l’agence de presse de l’État islamique.
2017
- Le 3 février 2017, attaque contre des militaires au Carrousel du Louvre à Paris fait deux blessés.
- Le 18 mars 2017, un homme s’empare de l’arme d’un militaire à Orly avant d’être abattu. Même s’il a affirmé au moment de son geste vouloir « mourir par Allah » et a été signalé pour « radicalisation » lors d’un séjour en prison en 2011-2012, ses motivations restent floues (il ne souhaitait plus retourner en prison) et le lien avec le terrorisme islamiste non démontré.
- Le 20 avril 2017, un homme ouvre le feu à l’arme automatique sur des policiers le long de l’avenue des Champs-Élysées, vers 21 heures, L’un d’entre eux est tué pendant l’attaque, deux autres ainsi qu’une passante sont blessés. L’assaillant est abattu et l’État islamique revendique l’attaque dans la soirée.
- Le 6 juin 2017, un homme attaque avec un marteau un policier et le blesse légèrement devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les policiers répliquent et le blessent. L’assaillant, Farid Ikken, un Algérien de quarante ans, ancien journaliste disposant d’un visa étudiant, se déclare « soldat du califat ».
- Le 19 juin 2017, un homme armé percute un fourgon de la Gendarmerie sur les Champs-Élysées. Aucun mort n’est à déplorer, excepté l’assaillant, un fiché S. Le 13 juillet, l’État islamique revendique l’attaque.
- Le 9 août 2017, attaque à la voiture bélier qui blesse 6 militaires à Levallois-Perret en région parisienne.
- Le 15 septembre 2017, un homme armé d’un couteau attaque un militaire en patrouille à la station de métro Châtelet à Paris. L’auteur tient des propos faisant référence à Allah : « Allah akbar, vous êtes des mécréants ».
- Le 1er octobre 2017, un Tunisien en situation irrégulière connu pour différents crimes égorge deux jeunes femmes dans la gare de Saint-Charles à Marseille avant d’être abattu par les des militaires de l’opération Sentinelle. L’attaque est revendiquée par l’État islamique.
2018
- Le 23 mars 2018, un homme tue 4 personnes dont Arnaud Beltrame, lors d’attaques et une prise d’otage dans un supermarché dans l’Aude, à Carcassonne et Trèbes. L’homme, qui est par la suite abattu, est un Franco-Marocain se réclamant de l’État islamique, qui revendique l’attentat le jour même.
- Le 12 mai 2018 à Paris, vers 21 h un individu attaque à l’arme blanche des passants en criant « Allah Akbar », il tue une personne, en blesse quatre autres dont deux gravement, il se dirige ensuite vers une patrouille de police qui décide de l’abattre. L’attaque est revendiquée par l’État islamique.
- Le 11 décembre 2018 dans la soirée, à proximité du marché de Noël de Strasbourg, un homme déambule dans les rues du centre-ville, tue cinq passants et en blesse une dizaine d’autres. L’assaillant, un Franco-Algérien de 29 ans, est abattu le 13 décembre à Strasbourg par la police. L’attaque est revendiquée par l’État islamique.
2019
- Le 5 mars 2019, Attentat de la prison de Condé-sur-Sarthe, 3 personnes, dont un terroriste, sont blessées et 1 terroriste est mort lorsque 2 surveillants pénitentiaires sont attaqués au couteau en céramique. L’auteur a prêté allégeance à l’État islamique.
- Le 24 mai 2019, attentat de la rue Victor-Hugo de Lyon, 14 blessés. L’auteur reconnaît avoir prêté allégeance à l’État islamique.
- Le 3 octobre 2019, attentat de la préfecture de police de Paris, 4 policiers ont été tués dans une agression au couteau de cuisine à la préfecture de police de paris par un individu qui y travaillait. Il était converti à l’islam depuis 2008, le Parquet national antiterroriste s’est saisi de l’affaire.
2020
- Le 3 janvier 2020, dans le parc des Hautes-Bruyères à Villejuif, un jeune homme de 22 ans, attaque à l’arme blanche des passants, en répétant « Allah Akbar », tuant un homme et blessant gravement 2 femmes. L’individu sera par la suite neutralisé par une patrouille de policiers. Le jeune homme récemment converti à l’islam a perpétré cette attaque d’une « extrême violence » avec une « extrême détermination », selon les déclarations du Parquet national antiterroriste qui s’est saisit de l’affaire.
- Le 5 janvier 2020, un individu connu de la DGSI et fiché S, armé d’un couteau et criant « Allah Akbar », est interpellé à Metz après avoir tenté d’agresser des policiers.
- Le 4 avril 2020, à Romans-sur-Isère , un réfugié soudanais, Abdallah Ahmed-Osman, crie « Allah Akbar », tue au couteau deux passants et en blesse cinq autres, leur demandant s’ils sont de confession musulmane.
- Le lundi 27 avril 2020, en fin d’après-midi à Colombes (Hauts-de-Seine), le conducteur d’une voiture a percuté volontairement deux motards de la police à vive allure, les blessant gravement. L’auteur a fait allégeance à l’état islamique.
- Le vendredi 25 septembre 2020 , deux personnes sont grièvement blessées à l’arme blanche près des anciens locaux du journal Charlie Hebdo. Le Parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour « tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Selon l’AFP citant des sources concordantes, l’assaillant de nationalité pakistanaise assurait « assumer son acte qu’il situe dans le contexte de la republication des caricatures (de Charlie Hebdo, ndlr) qu’il n’a pas supportée ».
- Le 16 octobre 2020, un enseignant est décapité devant un collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Son agresseur présumé est abattu par la police dans la ville voisine d’Eragny (Val-d’Oise)
Evidemment c’est un peu long, mais ce n’est pas de mon fait.
Si vous voulez des liens et des précisions sur cette énumération, vous la trouverez sur cette page <Wikipedia>
Mais au bout de cette énumération, de ce qui s’est passé en France depuis 2012, n’est-il pas légitime d’avoir peur, d’avoir une phobie ?
D’ailleurs, je concède lorsque parfois je vois entrer, dans le métro, un homme barbu vêtu d’une longue tunique que je crois être un « qamis » une peur instinctive me saisit. Peur que je raisonne, en me disant qu’il n’y a aucune raison que cet homme ait de mauvaises intentions, comme 99,x % des musulmans habitant en France.
Mais pendant quelques secondes je deviens ainsi « islamophobe », mais non « anti-musulman ».
Bien sûr, il y a stigmatisation des musulmans en France, il existe une haine anti musulman que professent certains.
Il en est même qui leur envoie l’injonction de retourner chez eux, en Musulmanie je suppose, alors que la plupart à qui est adressée cette vilenie, sont français.
L’islam constitue une réalité française, des citoyens sont musulmans et ont autant de valeur et d’importance que des citoyens chrétiens, juifs, athées et tous les autres.
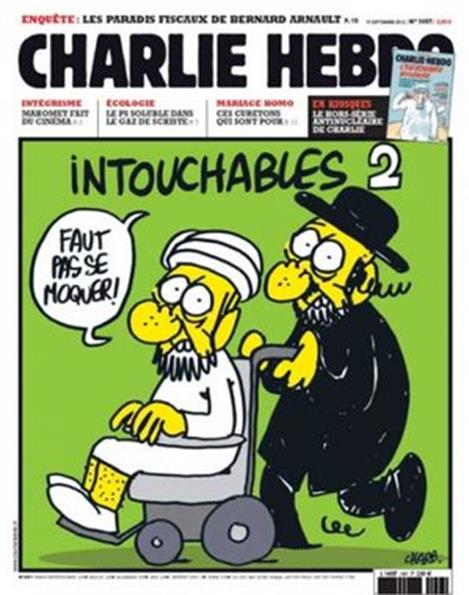 Mais l’usage du mot islamophobie est une imposture, une volonté délibérée de refus de critiquer et de se moquer des religions comme de toute autre doctrine.
Mais l’usage du mot islamophobie est une imposture, une volonté délibérée de refus de critiquer et de se moquer des religions comme de toute autre doctrine.
Derrière ce mot se cache une intolérance, une violence, un dessein secret.
J’ai beaucoup aimé la chronique de Sophia Aram de ce lundi, dans laquelle après avoir longuement remercié les enseignants qu’elle a eu au cours de sa scolarité elle dit cela :
« Je pense à notre responsabilité et à notre devoir de lutter contre les véritables promoteurs de ces attentats.
Notre rôle à l’égard de tous ceux qui entretiennent, encouragent et organisent la posture victimaire en expliquant qu’ils sont choqués, blessés, meurtris, par… Par un DESSIN.
Je pense à ce père d’élève faussement « dévasté » et claaamant sa peiiiine sur les réseaux sociaux tout en créant les conditions d’une mise à mort en publiant le nom et le lieu de travail de sa cible…
Je pense à cet agitateur qui se prétend Imam et qui l’accompagne dans cette entreprise macabre. Je pense à son petit air triste et tout chamboulé, horrifié par le dessin du cucul étoilé du prophète mais pas du tout gêné par son appel, dont il sait déjà qu’il fera office de condamnation à mort.
Mais comment ces deux faussaires arriveraient-ils à faire croire à leur blessure et à condamner à mort un homme, s’il n’y avait pas une cohorte de lâches prêts à comprendre, à justifier et à légitimer quotidiennement l’hypothèse qu’un croyant puisse être sincèrement blessé, meurtri et humilié par UN DESSIN.
Comment y arriveraient-ils sans tous ceux qui leur préparent le terrain en assimilant la caricature d’un prophète ou d’un symbole religieux à du racisme ?
Comment y arriveraient-ils sans les promoteurs du concept d’islamophobie ?
Sans ces associations communautaires et religieuses spécialisées dans la plainte victimaire ?
Enfin, comment y arriveraient-ils sans tous ces décérébrés, qu’ils soient militants, universitaires ou animateurs télé, venant dégouliner leur compassion morbide sur les musulmans pour leur expliquer « qu’il est normal, compréhensible d’être bouleversé, meurtri, blessé par un putain de DESSIN.
Je pense à vous, à vos faux semblants, à vos appels au meurtre à peine voilés, à votre médiocrité et votre condescendance.
Sachez que du plus profond de mon être je ne crois pas un seul instant à votre douleur.
Alors ne me parlez plus de votre blessure, elle est indécente face à la douleur bien réelle de tous ceux, dessinateurs, professeurs ou autres qui ont un jour fait le choix d’essayer de vous rendre moins cons. »
Elle a appelé sobrement sa chronique <Samuel Paty>
Et si vous souhaitez écouter une émission plus conceptualisée et historicisée, vous pouvez écouter le grand historien Michel Winnock qui était l’invité des matins de France Culture de ce mardi : <Où s’apprend la laïcité ? Avec Michel Winock>
Michel Winnock exprime les mêmes réticences devant l’utilisation suspecte du terme d’islamophobie, ce mot utilisé par des intolérants qui n’aiment pas la France, ni la culture et les mœurs de notre vieux pays.
<1474>
- 11 mars 2012 : Mohammed Merah assassine un militaire à Toulouse
-
Mardi 20 octobre 2020
«Cela fait des siècles que les fanatiques haïssent « l’humour »Guillaume Erner dans sa chronique du 19/10/2020La terreur islamiste a de nouveau frappé la France. Une fois de plus le prétexte fut le rire, un dessin, une caricature.
En janvier 2015, après les attentats des 7, 8 et 9 janvier à Charlie Hebdo, Montrouge et à l’Hyper Cacher, j’avais écrit le mot du jour du <12 janvier 2015> qui était une réflexion sur le rire, sur sa force et l’arme qu’il constitue contre les intolérants, les totalitaires de toute obédience et parmi lesquels les fanatiques religieux constituent une des pires espèces.
Pour ce faire, je m’étais appuyé sur «le nom de la Rose» d’Umberto Ecco et cette diatribe du moine fanatique qui empoisonnait ses frères religieux qui s’intéressaient à un livre qui évoquait le rire :
« Le rire libère de la peur du diable, […]
Le rire distrait, quelques instants de la peur.
Mais la loi s’impose à travers la peur, dont le vrai nom est crainte de Dieu. […]
Et que serions nous, nous créatures pécheresses, sans la peur, peut être le plus sage et le plus affectueux des dons divins ? »
Ce lundi matin Guillaume Erner en se basant lui aussi sur «le nom de la Rose» a également parlé du rire dans sa chronique : « L’Humeur du matin par Guillaume Erner » :
<Qu’est ce qui a été visé en Samuel Paty ? >
Et la réponse de Guillaume Erner est :
« A peu près tout ce que nous aimons, le savoir, le partage, la tolérance, mais aussi, le rire, le rire qui récapitule probablement ce qui précède, le savoir, le partage et la tolérance. »
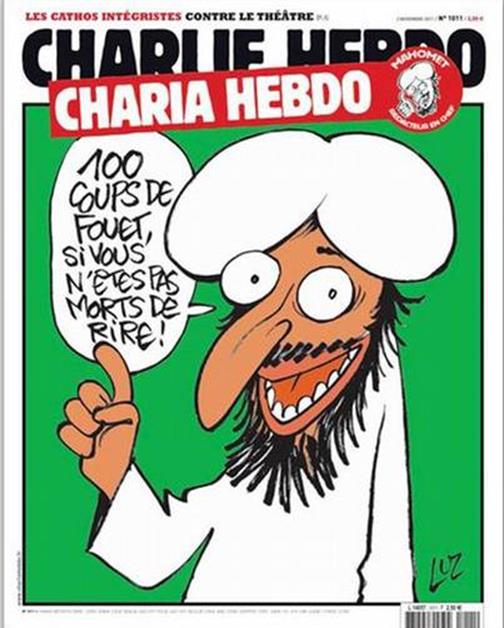 Et il ajoute :
Et il ajoute :
« […] Le terroriste qui a frappé au nom de l’islam ne s’est pas seulement attaqué à un enseignant professant le dialogue et l’ouverture, la laïcité et la coexistence, il s’en est pris à quelqu’un qui enseignait le rire.
Ce qu’il y a de plus singulier dans ces assassinats, tellement nombreux hélas, depuis le premier attentat contre Charlie Hebdo, c’est que ces terroristes visent le rire. Ces fanatiques ne s’en sont pas pris à des prêcheurs d’intolérance, à des promoteurs de la haine, non ils s’en sont pris à des dessinateurs de crobar, ou à ceux qui montraient ces petits crobars. Pourquoi cette obsession ? Pourquoi cette réaction inouïe face à des dessins humoristiques ? […]
En réalité, cela fait des siècles que les fanatiques haïssent « l’humour ». Cette haine est d’ailleurs au cœur de l’un des plus grands romans historiques du XXe siècle, « Le nom de la rose », d’Umberto Eco. Souvenez-vous, dans le « nom de la rose », le personnage central Guillaume De Baskerville est un jeune franciscain amoureux du rire, il affronte le vieux moine aveugle, contempteur du rire, Jorge de Burgos. D’ailleurs il est largement question, dans le nom de la rose, non pas des caricatures de Mahomet, mais d’un de leurs équivalents pour l’église du Moyen Âge, le texte parodique et truculent des « Cena Cypriani », rédigé au IX e siècle, ou il est notamment question d’un banquet ou Jésus mange un âne à belles dents…
Or l’église condamne le rire ; il n’y a pas de passage présentant Jésus riant, et la règle monastique de Saint Benoit interdit « le rire prolongé ou aux éclats ».
Pourquoi cette haine du rire ?
Parce que le rire est la libre interprétation – il doit permettre une lecture au premier, deuxième ou troisième degré ? On peut rire ou ne pas rire, le rire est de la liberté, et souvent on n’y peut rien : il n’y a rien de pire que de se forcer à rire.
D’où ce que Guillaume de Baskerville répond au moine Jorge de Burgos dans la scène finale : « le diable est la foi sans sourire (…). Je te hais Jorge, et si je pouvais je te mènerai en bas sur le plateau, nu avec des plumes de volatile enfilées dans le trou du cul, et la face peinte comme un jongleur et un bouffon, pour que tout le monastère rie de toi, et n’ait plus peur ».
Guillaume avait raison, rire des fanatiques est la meilleure manière de les montrer pour ce qu’ils sont, des bouffons. »
Cette chronique renvoie aussi vers un article qui évoque le sujet du rire et de la religion, dans le Nom de la Rose : <Problématique du rire dans Le Nom de la Rose d’Umberto Eco (1980)>

<1473>
-
Lundi 19 octobre 2020
«Miséricordieux»Mot souvent utilisé par des croyants en évoquant le dieu auquel ils croientSelon le dictionnaire du <CNRS>, la miséricorde se définit ainsi :
« 1remoitié du xiies. misericorde «bonté par laquelle Dieu pardonne aux hommes. […] Emprunté au latin misericordia «compassion, pitié», dér. de misericors «qui a le cœur (cors) sensible à la pitié».»
Nous sommes donc dans la combinaison des trois mots latins suivants :
- miser (« malheureux »)
- misereor (« avoir pitié »)
- cor, cordis (« cœur »)
Le Littré donne encore d’autres explications : <Miséricorde>
Mais le mot utilisé par les religieux est « miséricordieux ».
Le dictionnaire <CNRS> définit ce mot de la manière suivante :
« Plein de miséricorde, qui pardonne généreusement ».
L’assassin de Samuel Paty a tweeté sur son compte après son sinistre forfait, comme le relate <Le Monde> :
« Un message de revendication a été publié sur un compte Twitter, vendredi, quelques minutes après le drame. Un compte sous le pseudonyme @Tchetchene_270 sur lequel apparaissait une photo de la tête décapitée du professeur avec le message : « Au nom d’Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, (…) à Macron, le dirigeant des infidèles, j’ai exécuté un de tes chiens de l’enfer qui a osé rabaisser Muhammad, calme ses semblables avant qu’on ne vous inflige un dur châtiment. » »
Alors, on explique que la miséricorde décrite ainsi est l’acceptation chrétienne de ce mot, dans laquelle le pardon est au cœur du sentiment.
Mais il semble que l’islam ne donne pas la même définition.
<Wikipedia> explique ainsi que :
« Rahma » est un concept coranique souvent associé à la miséricorde divine et se traduisant par « la sensibilité »ou « la bonté, la bienveillance » Présent 114 fois dans le Coran, ce terme concerne Allah, sauf trois fois où le terme est utilisé pour des humains :« les fils envers leurs père et mère (XVII, 24), les époux entre eux (XXX, 21), les Chrétiens entre eux (LVII, 27). »
La traduction la plus courante de ce concept est « miséricorde ». Pour D. Gimaret, elle « est inadéquate, pour la raison que dans le français actuel, et notamment dans le vocabulaire religieux, «miséricorde» inclut fondamentalement l’idée de pardon ». Alors que le principe de pardon divin est généralement absent du concept de Rahma. »
Nous avons plus de précisions sur ce <site>
« « Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux ». Le Coran s’ouvre par ces mots, ainsi que 113 des 114 sourates qui le composent. Une sourate entière, la 55, porte le nom de ar-Rahmân, « le Tout Miséricordieux ». En outre, la Fâtiha (la première sourate) est récitée par les musulmans à chacune de leurs cinq prières quotidiennes. Enfin, la liste des 99 « beaux noms de Dieu » de la tradition islamique, commence par : Dieu (Allâh), le Bienfaiteur (ar-Rahîm), le Miséricordieux (ar-Rahmân). La notion de miséricorde est donc très présente dans l’islam.
Que signifie-t-elle au juste ?
[…] On l’a vu, à proprement parler, la miséricorde en islam désigne davantage la compassion ou la bienveillance (d’Allah ou des croyants) que le pardon des fautes. Interpréter ces versets coraniques avec la compréhension chrétienne du terme « miséricorde » serait faire un profond contresens. L’Encyclopédie de l’islam ne craint pas d’affirmer que l’idée de pardon « est totalement absente des emplois coraniques de rahma », même si le Coran associe parfois ces notions : Ton Seigneur est celui qui pardonne : Il est le maître de la miséricorde (XVIII, 58).
D’ailleurs, l’islam est aussi très loin de l’idée chrétienne d’un pardon illimité s’étendant à toutes les fautes et à tous les hommes ! Il suffit de comparer la parabole du débiteur impitoyable auquel le maître remet 10 000 talents, ou la réponse de Jésus à Pierre « Je ne te dis pas [de pardonner] jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois » (cf. Mt 18,21-22) avec ce verset coranique : […] Il pardonne à qui Il veut. (IV, 116). Non seulement, Dieu ne pardonne qu’aux musulmans, auxquels il réserve son paradis, mais ce pardon s’étend arbitrairement sur « qui il veut » […] A cinq reprises, le Coran affirmera : « Dieu pardonne à qui Il veut ; Il châtie qui Il veut » (II, 284 ; III, 129 ; V,18 ; V,40 ; XLVIII, 14) »
Mais ceci est de l’ordre religieux.
En France, ce n’est pas la loi religieuse qui s’impose, mais la Loi de la République.
Et nous la défendons fort mal.
Ce professeur, Samuel Paty a fait son devoir, il a voulu expliquer à ses élèves ce qu’était la liberté d’expression, comme le voulait le programme de l’éducation nationale.
Mais pour que cet enseignement ne s’abime pas dans le concept, il a voulu expliquer en quoi les caricatures de Mahomet constituent une expression de cette liberté.
Il a même pris la précaution de suggérer à des élèves qui pourraient être « choqués » par ces dessins de se cacher les yeux ou de quitter momentanément la classe.
Il a accompli sa mission, l’apprentissage des Lois de la République.
Et que lisons-nous dans cet <article de Libération ?>
« Libération a pu consulter une note du renseignement territorial des Yvelines (RT78) rédigée le 12 octobre. Elle établit une chronologie précise des événements depuis le 5 octobre, et le cours tenu par Samuel Paty, durant lequel le professeur d’histoire a montré une caricature de Mahomet à des élèves de 4e. La note affirme que l’épisode a déclenché «une vive polémique chez certains parents de confession musulmane, considérant qu’il s’agit d’une véritable offense». Le RT des Yvelines envisage alors des «menaces de sit-in et de manifestations», et transmet ses observations à sa centrale (SCRT), à l’antenne yvelinoise de la Direction générale de la sécurité intérieure (DDSI), aux préfectures des Yvelines et de Paris.
Le document confirme que Samuel Paty a préalablement demandé aux élèves «qui pourraient être offensés par cette image, de fermer les yeux ou de sortir de la classe quelques secondes en présence d’une auxiliaire de vie scolaire». C’est la présence, à ce moment-là, d’une accompagnante d’un élève en situation de handicap (AESH) qui permet de confirmer les détails de la scène. Le lendemain, une mère de famille « contactait la principale en pleurs », affirme la note du RT78, «lui rapportant que sa fille avait été mise à l’écart dans le couloir sous prétexte qu’elle était musulmane», et qu’elle «vivait cette situation comme une discrimination». La cheffe d’établissement demande alors à Samuel Paty de rencontrer la mère en fin de semaine, et de revenir avec la classe concernée sur son enseignement «controversé», en l’invitant également à «s’excuser s’il avait été maladroit». L’intéressé s’exécute, précise le document du renseignement.
Pour autant, la tension ne retombe pas. Selon le RT78, la cheffe d’établissement reçoit le 7 octobre «des messages anonymes de protestation, via la boîte mail de l’établissement». L’un d’entre eux mettait en exergue le climat de défiance envers les musulmans: «Face au climat actuel de la France, où un climat d’islamophobie s’est installé, pourquoi cherchez-vous à diviser en plus dès le plus jeune âge?»
La principale rencontre ensuite le père de famille et le prédicateur du collectif Cheikh-Yassine, Abdelhakim Sefrioui, actuellement en garde à vue après la diffusion de vidéos virales sur les réseaux sociaux. Sefrioui y qualifie notamment Samuel Paty de «voyou ». Lors de l’entrevue avec la cheffe d’établissement, ils font part de leur colère et refusent de rencontrer Samuel Paty. Cette dernière demande alors, selon la note du RT78, «l’intervention de l’équipe Laïcité et Valeurs de la République [personnels d’accompagnement et de prévention de l’Académie, ndlr]». Par ailleurs, la venue d’un inspecteur est programmée le 9 octobre à 13h45, afin «d’accompagner la principale lors d’un entretien avec le professeur pour notamment lui rappeler les règles de laïcité et de neutralité». En outre, poursuit le document, «cela permettait de préparer la rencontre programmée entre le professeur, la principale puis les parents d’élèves».
En dépit de la diffusion des vidéos qui ont animé les réseaux sociaux, la note du RT78 conclut: « La communication entre la direction et les familles a visiblement permis d’apaiser les tensions, lesquelles sont principalement du fait de la famille C. [le père actuellement en garde à vue, ndlr]. Précisons que pour l’heure, les responsables de la communauté musulmane locale ne sont pas manifestés. […] Au sein du collège, aucune tension majeure n’est palpable, tant du côté de la communauté éducative que de la fédération des parents d’élèves qui, tout en reconnaissant une certaine maladresse du professeur (bien apprécié par sa hiérarchie), ne le désavoue pas pour autant »
Je lis donc qu’on a demandé à ce remarquable professeur de s’excuser auprès de parents en plein délire et même qu’un inspecteur avait l’intention de lui rappeler les règles laïcité et de neutralité !
C’est inadmissible !
On ne peut pas mettre sur un même plan le rôle de ce professeur et la sensibilité exacerbée d’une famille.
L’Éducation Nationale, L’État Français n’ont pas dit le Droit, pas fait parler la République.
Alors, depuis il y a eu le meurtre et maintenant le langage est différent.
 Comme la Mosquée de Pantin qui a diffusé la vidéo d’un père de famille revendicatif.
Comme la Mosquée de Pantin qui a diffusé la vidéo d’un père de famille revendicatif.
Après avoir supprimé cette diffusion, après l’acte de terrorisme, la Mosquée de Pantin a appelé à manifester pour la paix !! ??
Les responsables de la Mosquée reconnaissent avoir diffusé l’appel <la mosquée de Pantin reconnaît avoir diffusé la vidéo du père de famille >
La défense du président de la Mosquée interrogé est surprenante :
«Je n’ai pas été choqué par les caricatures. Qu’elles soient publiées ou non, on s’en fiche maintenant.» […] Ce qui aurait motivé M Henniche, c’est la discrimination imposée, selon lui, aux élèves musulmans dans le cadre du cours donné le 5 octobre par Samuel Paty. «Je ne comprends pas que l’on demande à des enfants de la République de sortir d’une classe», déclare Henniche. »
Mais comme l’écrit Libération :
« Cette lecture des événements ne correspond pas tout à fait à ce qui s’est passé au collège du Bois-d’Aulne. De fait, Brahim C., le père de famille, semble avoir entretenu une certaine ambiguïté dans sa vidéo postée le 7 octobre. Quoi qu’il en soit, M’hammed Henniche endosse la responsabilité d’avoir diffusé la vidéo. Mais il réfute avoir démultiplié son audience. «Elle était déjà virale dans les milieux musulmans», assure-t-il. »
On apprend ainsi que le président de la mosquée est une figure connue en région parisienne. A la tête de l’Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis, M Henniche est influent auprès de responsables locaux de lieux de culte et de personnalités politiques du département. L’affaire est plus qu’embarrassante pour la future grande mosquée de Pantin. Sa construction aurait dû démarrer cet été mais a été retardée à cause de la pandémie de Covid-19. […] En attendant, les prières ont toujours lieu dans les anciens locaux très fréquentés, il y a quelques années, par des groupes de jeunes salafistes. «Cela a beaucoup changé», assure Henniche. Pourtant, l’imam salafiste Ibrahim Abou Talha y est toujours en poste. D’origine malienne, il s’est formé au sulfureux centre de Dammaj au Yémen qui avait vu passer l’un des frères Kouachi.
Mais sa défense ultime est que :
«Personne, dit-il, vraiment personne, ne pouvait imaginer, le 9 octobre quand je l’ai postée, que cela se terminerait par cet assassinat».
Et il en va de même avec Abdallah Zekri (Observatoire de lutte contre l’islamophobie) qui prétend qu’« Il faut faire bloc autour de la République ».
 Ce triste sire est le même qui a affirmé que la jeune Mila « l’avait bien cherché ». J’avais parlé de cette autre affaire de lâcheté républicaine lors du mot du jour du <6 février 2020>.
Ce triste sire est le même qui a affirmé que la jeune Mila « l’avait bien cherché ». J’avais parlé de cette autre affaire de lâcheté républicaine lors du mot du jour du <6 février 2020>.
Le Point est revenu il y a 4 jours sur cette lâcheté <Affaire Mila : une défaite française> qui explique dans quelles conditions elle doit vivre aujourd’hui.
Rien ne peut justifier cette violence, ces menaces et ces comportements.
Nous n’avons peut-être pas un problème avec l’Islam en France, mais nous avons clairement un grave problème avec certains musulmans en France !
Je finirai par cette réponse d’une jeune fille sur Twitter :
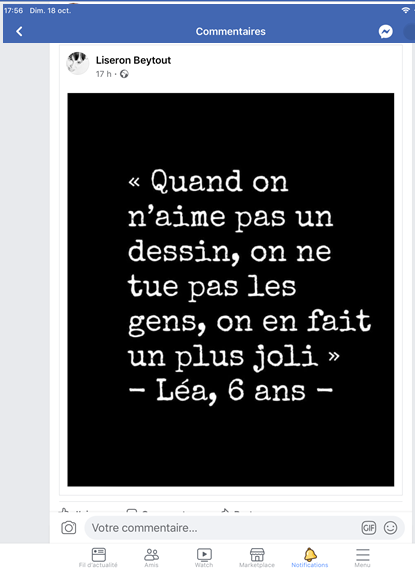
<1472>
- miser (« malheureux »)
-
Vendredi 16 octobre 2020
«Pause (Tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin)»Un jour sans mot du jour nouveauLe mot du jour qui s’approche des 1500 articles, n’est pas qu’un billet quotidien.
Il est aussi pour moi une source que je peux utiliser dans la vie quotidienne, dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle.
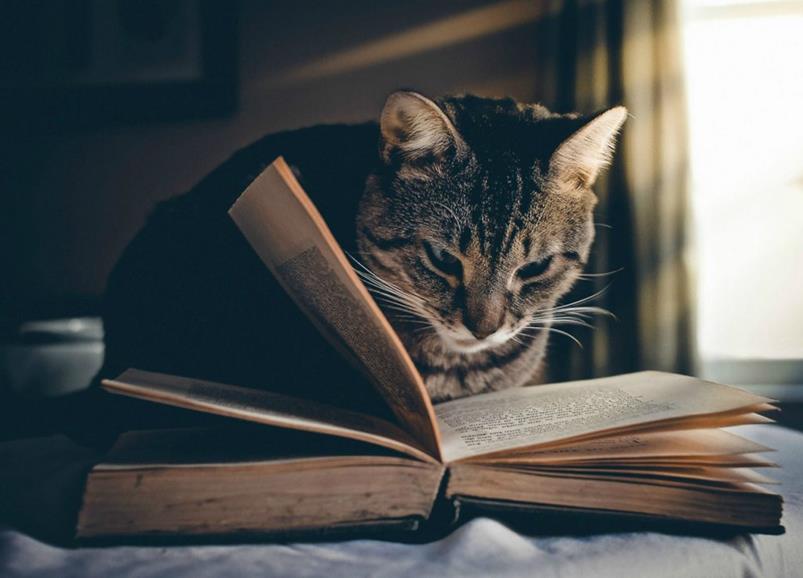 Ainsi, dans ma vie professionnelle j’ai souvent utilisé pour convaincre les collègues d’accepter de sortir de comportements un peu trop individualistes pour manifester un esprit de meilleure coopération, ce proverbe africain :
Ainsi, dans ma vie professionnelle j’ai souvent utilisé pour convaincre les collègues d’accepter de sortir de comportements un peu trop individualistes pour manifester un esprit de meilleure coopération, ce proverbe africain :
« Tout seul on va plus vite.
Ensemble on va plus loin »
Ce proverbe avait été cité par la membre d’une compagnie de danse : la compagnie XY.
Elle était invitée dans le cadre de la biennale de la danse de 2014.
Cette biennale se passe tous les deux ans, à Lyon, en 2014, 2016, 2018.
Mais pas en 2020. Elle a été annulée en raison du COVID 19.
A l’époque, le spectacle de cette compagnie était trop récent pour pouvoir disposer d’une vidéo.
Mais aujourd’hui, il existe une présentation et des extraits de ce spectacle : <Il n’est pas encore minuit>
C’était le mot du jour du <16 septembre 2014>
<Mot sans numéro>
-
jeudi 15 octobre 2020
«Pause (Pour que les hommes se reconnaissent et se garantissent mutuellement des droits)»Un jour sans mot du jour nouveauLe mot du jour qui s’approche des 1500 articles, n’est pas qu’un billet quotidien.
Il est ainsi possible de faire comme ce chat, feuilleter virtuellement le livre des mots du jour.
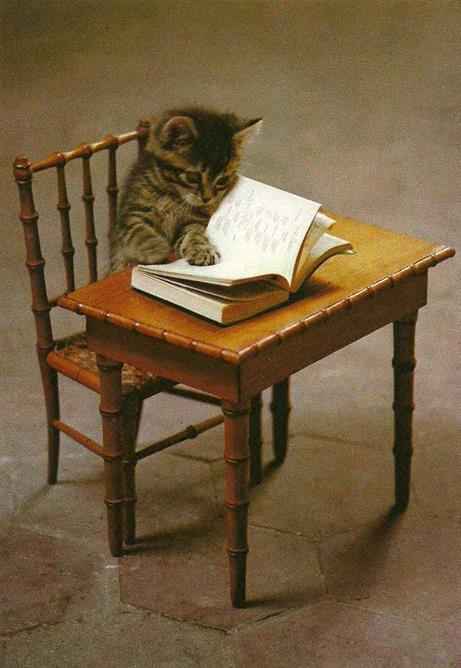 Ainsi le 12 septembre 2014, je citais le grand sociologue français Émile Durkheim (1858-1917).
Ainsi le 12 septembre 2014, je citais le grand sociologue français Émile Durkheim (1858-1917).
La Démocratie c’est accepter d’être dans la minorité et d’obéir à des lois avec lesquels on n’est pas fondamentalement en accord, mais les accepter parce que elles ont été voulues par la majorité.
La démocratie sociale, ou l’Etat providence c’est encore plus difficile.
On accepte de payer des impôts et des cotisations sociales non pas forcément pour en tirer un bénéfice de même niveau directement. Mais pour aider d’autres dans les difficultés de la vie et de vieillesse. D’autres qui ne sont pas les parents ou les enfants, ni même la famille, mais la communauté nationale.
Et pour que ce miracle de la civilisation humaine et non de la nature puisse exister il faut que se réalise ce qu’Emile Durkheim a écrit :
« Pour que les hommes se reconnaissent et se garantissent mutuellement des droits, ils faut qu’ils s’aiment et que pour une raison quelconque ils tiennent les uns aux autres et à une même société dont ils fassent partie. »
C’était le mot du jour du <12 septembre 2014>
<Mot sans numéro>
-
Mercredi 14 octobre 2020
«Pause (tout ce qui se trouve au-dessus d’elles est incapable et indigne de les gouverner)»Un jour sans mot du jour nouveauLe mot du jour qui s’approche des 1500 articles, n’est pas qu’un billet quotidien.
Il est tout à fait possible de relire des articles anciens.
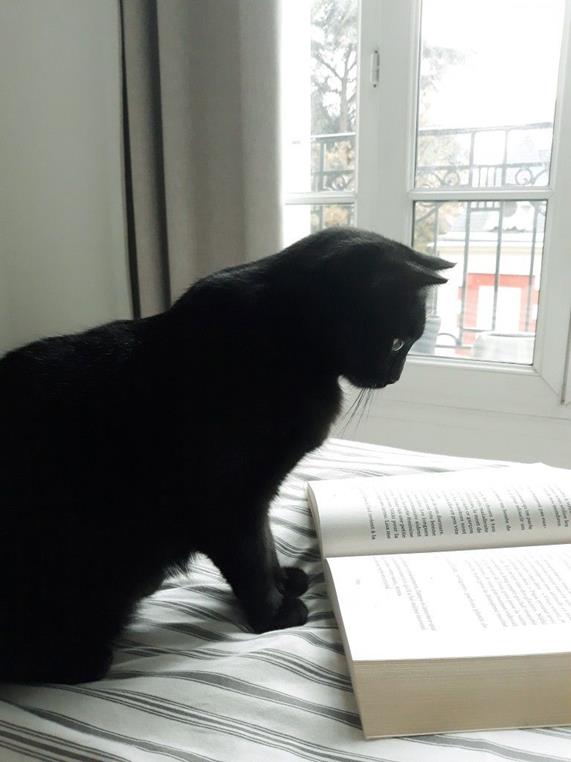 Bien avant les gilets jaunes, le 28 mars 2014, je citais un grand intellectuel français qui lui était encore beaucoup plus ancien.
Bien avant les gilets jaunes, le 28 mars 2014, je citais un grand intellectuel français qui lui était encore beaucoup plus ancien.
Il s’agit de l’auteur de la « Démocratie en Amérique » et d’un ouvrage que j’ai étudié lors de mes études de Droit : « L’Ancien Régime et la révolution ».
Il est mort en 1859, soit quasi 100 ans avant ma naissance, à un an près.
Alexis de Tocqueville disait .moins d’un mois avant la Révolution de 1848 :
« il se dit dans leur sein [ des gouvernés] que tout ce qui se trouve au-dessus d’elles est incapable et indigne de les gouverner »
C’était lors du <Discours à la Chambre des députés du 27 janvier 1848>
<Mot sans numéro>
-
Mardi 13 octobre 2020
«Pause (Un anniversaire) »Un jour sans mot du jour nouveauLe mot du jour qui s’approche des 1500 articles, n’est pas qu’un billet quotidien.
Il est aussi une collection d’articles qui touchent énormément de domaines.
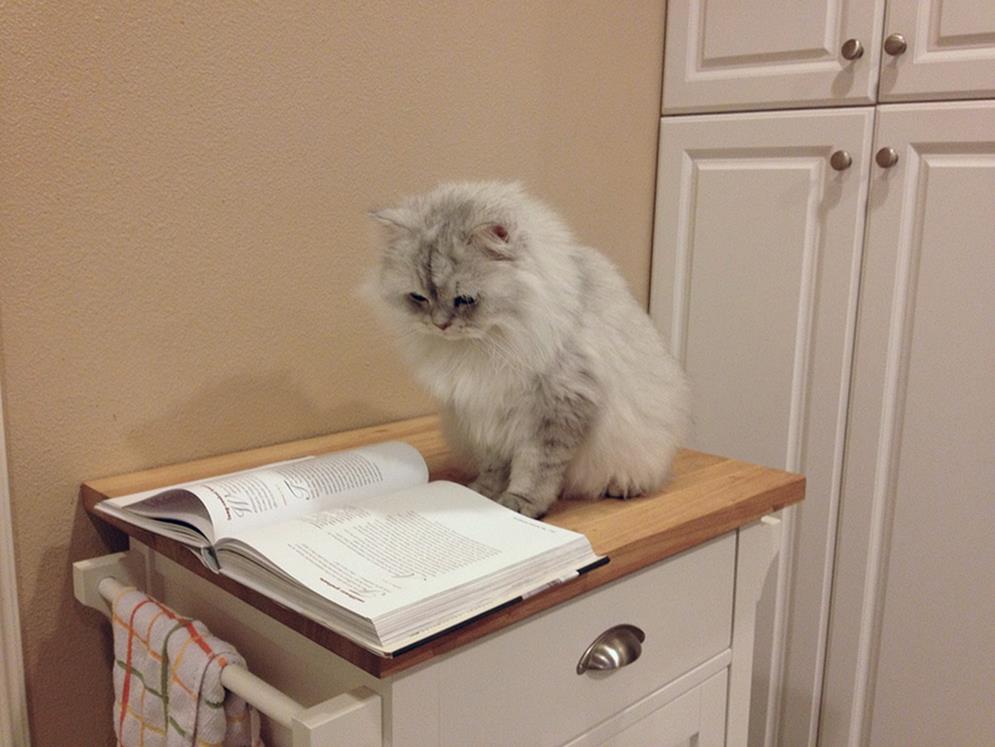 C’est pour cette raison qu’il m’est difficile de présenter le «mot du jour» en quelques phrases.
C’est pour cette raison qu’il m’est difficile de présenter le «mot du jour» en quelques phrases.
Ce n’est pas un billet d’humeur, parfois cela peut l’être, mais pas que.
En pratique je parle de tout.
Ainsi il y a 3 ans le 13 octobre 2017, je parlais d’anniversaire, à travers l’Histoire de ce mot et de l’évènement que chacun a l’habitude de célébrer.
Il y eut une époque à laquelle on ne connaissait même pas sa date d’anniversaire.
L’usage était de fêter le saint de son prénom.
Le 13 octobre, nous fêtons ainsi les Géraud.
Pour ma part, je n’ai jamais rencontré une personne portant ce prénom.
L’original, celui qui a été canonisé était Saint Géraud d’Aurillac (né en 855 à Aurillac et mort le 13 octobre 909 en Quercy). Il était le fils de Géraud, seigneur d’Aurillac, et d’Adeltrude, qui fut également canonisée.
Il fut fondateur de l’abbaye d’Aurillac, modèle de celle de Cluny, sa vie a été relatée par Odon de Cluny qui en a fait le modèle chevaleresque du seigneur chrétien qui met sa force et ses richesses au service de la Justice et des humbles.
Peut être un prénom pour des parents en quête d’un prénom peu usité…
Mais le mot du jour du 13 octobre 2017 parlait d’« Un anniversaire »
<Mot sans numéro>
-
Lundi 12 octobre 2020
«Pause (Si la progression permanente, depuis deux décennies, de l’inégalité sociale)»Un jour sans mot du jour nouveauLe mot du jour qui s’approche des 1500 articles, n’est pas qu’un billet quotidien.
Il est aussi une somme de sujets abordés, parfois plusieurs fois, sous différents angles.
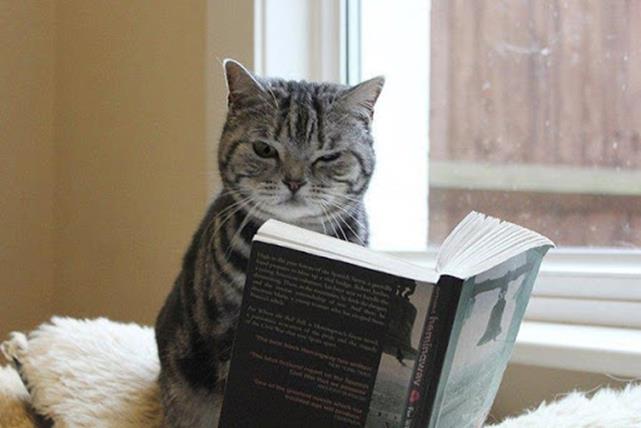 On peut ainsi y revenir.
On peut ainsi y revenir.
C’est ainsi que je le conçois.
Aujourd’hui je vous propose de revenir 6 ans auparavant en 2014.
J’avais mentionné une tribune dans le Monde du philosophe allemand : Jürgen Habermas :
« «Le modèle de société européen […] repose sur le rapport interne de l’Etat social et de la démocratie.
Si la progression permanente, depuis deux décennies, de l’inégalité sociale (une tendance empiriquement prouvée pour les pays industriels),
ne se laisse pas inverser, ce rapport se déchirera.»
Son propos reste d’une brulante actualité.
Jurgen Habermas a aujourd’hui 91 ans.
Je vous renvoie donc vers le mot du jour du <25 février 2014>
Si vous êtes abonnes au Monde vous pouvez aller directement vers l’article :
< Repolitisons le débat européen, par Jürgen Habermas >.
<Mot sans numéro>
-
Vendredi 9 octobre 2020
« L’intelligence c’est aussi important que le soleil. »Juliette GrécoJe ne me suis intéressé à « Boomerang », l’émission d’Augustin Trapenard sur France Inter qu’à partir de cette exceptionnelle série « Lettres d’intérieur » dans laquelle, pendant le confinement, il a lu chaque jour la lettre d’un écrivain, d’un artiste, d’un journaliste qui parlait de ce moment étonnant et unique. Il lisait de sa voix chaude, avec émotion et pudeur.
J’en ai fait quatre mots du jours « Je te demande pardon. » d’Ariadne Ascaride, « Puisque seul l’amour sait nous raconter à ceux qui savent écouter. » de Yasmina Khadra, «C’est la bonté qui est la normalité du monde car la bonté est courageuse, la bonté est généreuse et jamais elle ne consent à être comme une embusquée, qui, à l’arrière vit grâce au sang des autres.» de Wajdi Mouawad et «Mais nous, dis, nous resterons tendres ? On ne va pas se faire avaler !» de Sophie Fontanel.
Mais il en ait tant d’autres à écouter sur la page des « Lettres d’intérieur ».
Dans Boomerang, il invite une ou un artiste et lui pose des questions.
Il est de la lignée de Jacques Chancel, celui qui laisse toute sa place à l’artiste, qui présente un écrin dans lequel l’artiste se sent accueilli et peut exprimer sa liberté et sa créativité.
Il n’est pas de la lignée de Thierry Ardisson ou Laurent Ruquier qui tout en étant de grands professionnels ont d’abord pour objet de se promouvoir eux même.
Et donc, dans cet écrin il avait accueilli Juliette Gréco, en 2015, à la veille de la sortie de l’album de sa tournée d’adieu.
Cette émission a été rediffusée le 24 septembre 2020 : <Muse, Juliette Gréco>. C’est encore une pépite qui fait du bien à écouter. Échange de profondeur et aussi plein d’humour
J’en prendrai quelques extraits :
Augustin Trapenard lui fait parler de sa pudeur. Elle aime être habillée en noir. Comme cela sur scène on ne voit pas son corps, on ne voit que ses mains et son visage.
Elle explique que sa pudeur vient peut-être de sa nature ou de son éducation religieuse bourgeoise. Elle dit qu’elle préfère peut-être le mystère à l’étalage. « Je trouve cela plus sensuelle », dit-elle. Et elle ajoute cette phrase merveilleuse :
« Je suis ravi de voir des filles qui ont des jupes au ras du bonheur »
Augustin Trapenard aussi a adoré cette expression « des jupes au ras du bonheur. »
Et quand le journaliste lui demande qu’elle sont ses goût musicaux, ce qu’elle écoute dans son salon, dans sa voiture.
« C’est plutôt ce qu’on appelle la musique classique, j’ai besoin du silence de la musique classique et j’ai besoin qu’il n’y ait pas de mots. J’ai besoin qu’on me réconforte. Si je suis de mauvaise humeur c’est Mozart. Si je suis de bonne humeur c’est Schoenberg ou des choses compliquées. »
Juliette Gréco a beaucoup chanté les poètes. Et quand Augustin Trapenard lui demande quels sont les poètes d’aujourd’hui, elle a cette réponse :
« Le nouveau langage est celui des rappeurs, des slameurs. Je pense que c’est un nouveau langage qu’il faut absolument respecter et qu’il faut bien écouter. Ils sont la parole de la jeunesse. Et c’est une chose qu’il ne faut pas louper parce que c’est grave. Il faut écouter ce qu’ils ont à dire. »
Et puis il y a son histoire d’amour avec le compositeur et trompettiste de jazz américain. : Miles Davis
Au printemps 1949, alors de passage à Paris pour se produire au festival de jazz international, Miles Davis rencontre Juliette Gréco. Cette dernière donne un concert au cabaret Le Bœuf sur le toit où elle chante des textes de Boris Vian, Jean-Paul Sartre et Jacques Prévert. Miles Davis est alors âgé de 23 ans. Leur coup de foudre est réciproque.
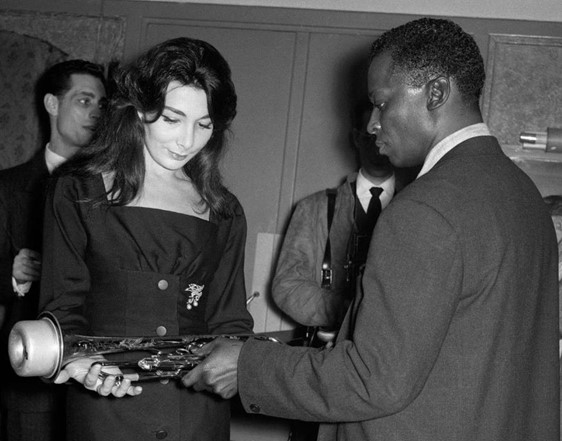 Et elle a cet échange avec Augustin Trapenard :
Et elle a cet échange avec Augustin Trapenard :
« Il parait que c’était une révolution. Je ne m’en suis pas rendu compte du tout. […] Quand j’ai vu Miles, je n’ai pas vu qu’il était noir. J’ai vu un mec avec une trompette sur la scène, de profil qui était absolument magnifique. Qui jouait de manière magnifique. Qui était un être unique. Et il est sorti de scène, je l’ai regardé et il m’a regardé et c’est parti.
Ça a fait scandale ?
Oui surement. Bien sûr.
Et vous en vous êtes pas du tout trouvé heurtée par ce scandale-là ?
Je me suis sentie heurtée par ce scandale, en allant en Amérique. En France, ils étaient plus sournois. Ça ne faisait pas chic d’être raciste, à cette époque-là. En Amérique cela faisait partie de la vie, de l’éducation.
Qu’est-ce qui vous révolte aujourd’hui Juliette Gréco ?
Eh bien cela par exemple, le racisme. L’absence de tolérance. »
Ils avaient évoqué le mariage. Mais aux États-Unis (à l’époque, les unions entre Noirs et Blancs sont illégales dans de nombreux États américains) c’était terriblement compliqué. Ils renonceront et Miles Davis rentrera à New York.
Lors de son entretien elle a aussi évoqué ses rencontres avec des gens intelligents : Camus, Sartre, Simone de Beauvoir et tant d’autres avec qui elle échangeait. Elle a dit :
« L’intelligence c’est aussi important que le soleil, c’est aussi important que les choses essentielles qui nous aident à vivre, qui nous font vivre. »
Lors de l’émission Augustin Trapenard fit écouter plusieurs chansons de Juliette Gréco. Particulièrement celle qui fut écrite pour sa dernière tournée de 2015 <Merci>.
Pour finir l’émission, il fit écouter <Le temps des Cerises>
J’avoue une tendresse particulière pour cette interprétation en 1972 de <la Javanaise de Gainsbourg>
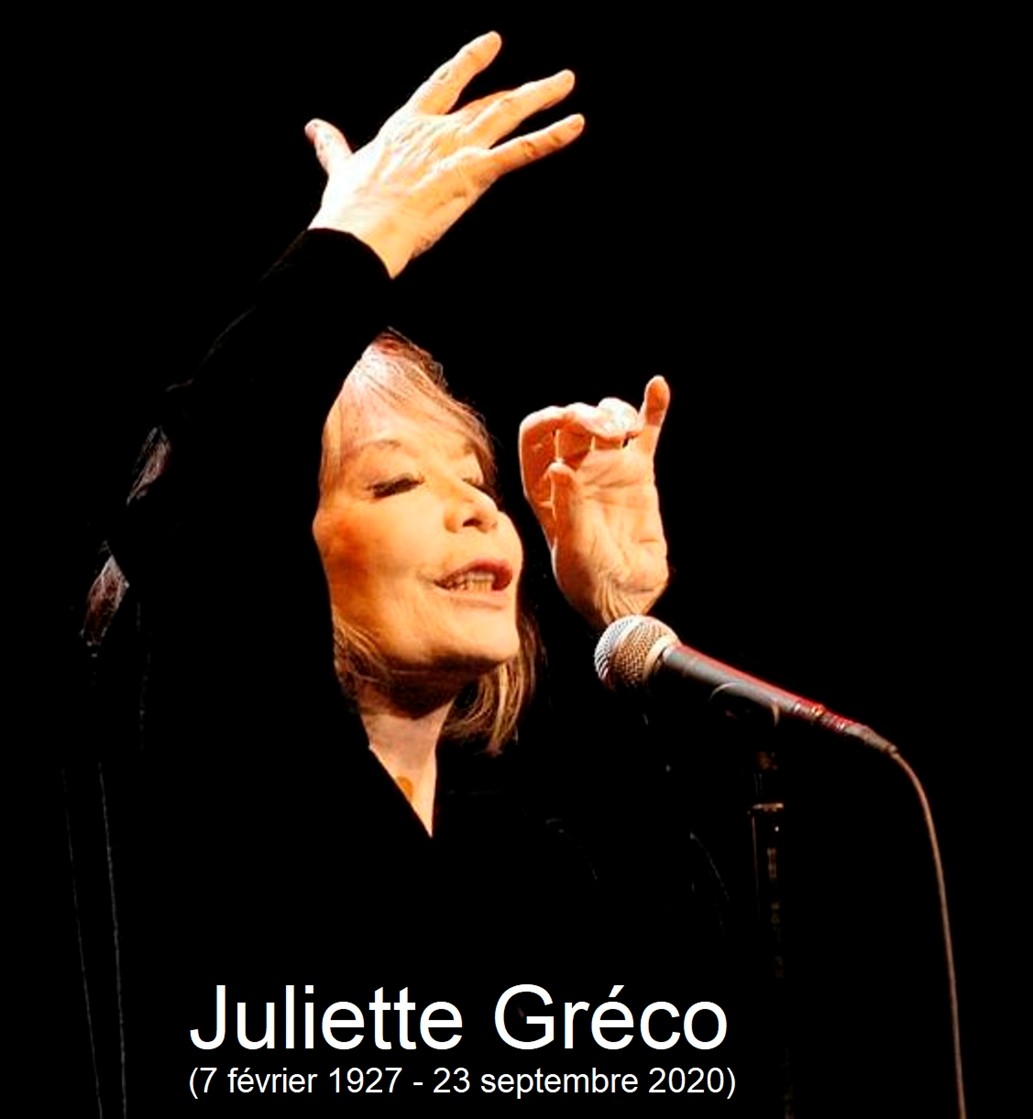 Cette page de France Inter lui rend aussi hommage : <La chanteuse Juliette Gréco est morte>. Mais rien ne saurait remplacer la poésie de l’échange entre Juliette Gréco et Augustin Trapenard : <Muse, Juliette Gréco>
Cette page de France Inter lui rend aussi hommage : <La chanteuse Juliette Gréco est morte>. Mais rien ne saurait remplacer la poésie de l’échange entre Juliette Gréco et Augustin Trapenard : <Muse, Juliette Gréco>
<1471>
-
Jeudi 8 octobre 2020
« La France prend des bonnes mesures, mais elle est toujours un peu en retard. C’est ça le problème. »Axel Kahn, le 6 octobre sur France CultureOn les appelle « les rassuristes ». Il s’agit de scientifiques et de médecins qui prétendent que les précautions contre le COVID sont excessives et que la pandémie est en déclin.
Ainsi, l’épidémiologiste de l’Inserm Laurent Toubiana, affirme qu’une partie énorme de la population a été exposée à ce virus. Il pense donc que nous disposons d’une immunité collective.
Ce à quoi répond sur un site de presse canadien, Florian Krammer, professeur de microbiologie à l’école de médecine Icahn de l’hôpital Mount Sinaï à New York :
« L’immunité collective par infection naturelle n’est pas une stratégie, c’est le signe qu’un gouvernement n’a pas réussi à contrôler une épidémie et qu’il en paie le prix en vies perdues ».
D’autres comme Jean-François Toussaint, directeur de l’Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport (Irmes), affirme que la pandémie régresse :
« Les autorités sanitaires parlent « d’explosion », alors que «la pente actuelle [du nombre de cas positifs] est quinze fois plus faible que celle que nous avons connue en mars».
<Libération> a publié un article le 4 octobre dans lequel il fait le point sur les propos des rassuristes et tout en reconnaissant la réalité de certains constats ne partage pas la stratégie et les conséquences qu’en tirent ces scientifiques optimistes.
Le Professeur Didier Raoult, et le professeur Christian Perronne considèrent que le virus a muté et qu’il est devenu moins dangereux.
Dans les matins de France Culture de Guillaume Erner, chaque vendredi à 7h12, Nicolas Martin, producteur de l’émission « La méthode scientifique », tient une chronique qui s’appelle Radiographie du coronavirus.
Dans celle du 25 septembre, il essaie de répondre à la question « le SARS-CoV2 a-t-il muté ? ». Avec une équipe qui l’entoure, il lit les publications scientifiques avant d’en faire la synthèse pour sa chronique. Et sa conclusion et sans appel : le virus a muté de façon très marginale et :
« Donc, il n’est pas vrai de dire qu’aujourd’hui, la version qui circule et qui nous contamine est une version moins virulente que celle qu’on avait au mois de mars. C’est a priori strictement la même. »
Nicolas Martin
Pour cette chronique il a été très attaqué sur les réseaux sociaux et aussi par des courriers à la médiatrice de France Culture.
Il défend sa position devant ses accusateurs sur cette page : « Le rendez-vous de la médiatrice de France Culture du 1er octobre 2020»
Enfin le confinement est remis en cause.
Laurent Toubiana avait affirmé sur RT France, le 24 août
« On s’aperçoit que cette épidémie se propage exactement de la même manière partout, et notamment, une chose très remarquable, indépendamment des mesures prises. »
Et Jean-François Toussaint, sur Sud Radio, évoque, lui, une étude britannique prouvant l’inefficacité du confinement :
« L’université d’Oxford a démontré que dans le monde entier, il n’y avait aucun lien entre l’importance du confinement et la réalité de la mortalité pour chacun des pays qui ont défini des cas.»
Sur le premier point l’exemple de la Suède montre le contraire.
Car il faut comparer les choses comparables et donc la Suède qui n’a pratiqué aucun confinement et pas d’obligation de porter le masque, avec ses voisins immédiats, le Danemark, la Norvège et la Finlande qui ont pratiqué la politique inverse.
Sur ce <Site> vous pouvez voir la mortalité du COVID pour 100 000 habitants :
- Suède 59,15 / 100 000
- Danemark 11,83 / 100 000
- Finlande 6,30 / 100 000
- Norvège 5,17 / 100 000
Le mot du jour <du 17 juin 2020> soulignait que ces 3 derniers pays étaient gouvernés par des femmes.
Pour compléter le tableau, la France est à 48,37 / 100 000.
Le responsable scientifique de cette stratégie, l’épidémiologiste suédois Anders Tegnell, de l’Agence de santé publique, a reconnu que la mortalité était « vraiment » trop élevée.
Concernant spécifiquement le confinement, le généticien et président de la Ligue contre le cancer Axel Kahn affirme que le confinement cela marche.
Et la Chine s’en sort bien. Car même si les chiffres officiels sont faux, ce n’est pas une hécatombe et l’activité et les voyages à l’intérieur de la Chine montrent que ce pays est en train de sortir de la pandémie.
Pour Axel Kahn l’explication est évidente :
« Il y a deux raisons à cela. La première raison est que, évidemment, l’épidémie l’a frappée avant tout le monde. Et la deuxième raison, c’est qu’elle a utilisé plus massivement l’arme, qui est l’arme absolue contre le virus : le confinement, le confinement complet total prolongé. On l’a vu d’ailleurs en France, il n’y a pas plus efficace. […] C’était un confinement bien pire que ce que l’on a connu en France. La Chine, évidemment, a pâti économiquement durant le confinement. Maintenant, elle a repris sa marche en avant et elle peut faire des fêtes sans masque. Et donc, elle peut dire « nous, par rapport à l’Amérique qui n’arrive pas à se tirer de ce désastre dû à une gestion épouvantable, cataclysmique ; nous, notre modèle est meilleur ». Ce à quoi on a assisté à l’occasion de cette pandémie, c’est une accélération de la bascule du monde vers l’Orient. »
C’est ce qu’il a déclaré dans l’émission du Matin de France Culture du <06/10/2020>
Dans une tribune sur le site de France Culture du 30 septembre dans laquelle il s’exprime assez longuement sur la stratégie suivie en France et sur son analyse de l’évolution de la pandémie depuis mars, il prétend que sans les gestes barrières, les masques et les autres restrictions l’épidémie repartirait comme en mars.
Il dénonce « la brochette d’abrutis qui disent que rien ne se passe »
Dans l’émission du 6 octobre après avoir fait le constat que le confinement en France a bien freiné considérablement la diffusion de la pandémie, il ajoute :
« En France, la grosse erreur a été le déconfinement. Le déconfinement a fait perdre une partie de ce que le confinement avait permis. »
Il faut préciser qu’il ne remet pas en cause la décision de déconfiner, mais la stratégie et les conseils qui ont été ou n’ont pas été donnés pour accompagner un déconfinement plus responsable.
Et son analyse c’est que :
« La France prend des bonnes mesures, mais elle est toujours un peu en retard. C’est ça le problème. Il est certain que le problème économique est majeur. Le problème de choix de la joie d’y vivre également. Mais parce qu’on veut en tenir compte un peu trop, on est obligé de serrer la vis. »
Nous sommes dans une situation très compliquée.
Il faut, je crois, rester très humble dans ses prises de position et ses affirmations.
L’article de Libération me semble très intéressant et assez nuancé.
<1470>
- Suède 59,15 / 100 000
-
Mercredi 7 octobre 2020
« [Pour me sentir mieux] je prends de la distance. »Mafalda dessinée par QuinoJ’avais déjà fait appel à Mafalda lors du mot du jour du <20 novembre 2019> : « Vivre sans lire c’est dangereux, cela t’oblige à croire ce que l’on te dit »
 Et je pense que dans le monde de l’immédiateté, des avis sur tous les sujets, cette parole que Quino a mis dans la bulle de Mafalda est bienvenue.
Et je pense que dans le monde de l’immédiateté, des avis sur tous les sujets, cette parole que Quino a mis dans la bulle de Mafalda est bienvenue.
Mafalda a été créée en 1964 par le dessinateur et scénariste argentin Joaquin Salvador Lavado, dit Quino,
Quino est décédé mercredi 30 septembre à l’âge de 88 ans, à Mendoza, la ville qui l’avait vu naître en 1932.
<Atlantico> écrit :
« Quino avait créé cette petite héroïne anticonformiste en 1964. Il livrait, à travers les yeux de cette fillette issue de la classe moyenne argentine, sa propre réflexion contestataire sur le monde. Mafalda critiquait notamment la gestion de la planète par les adultes. Ce personnage était très concerné par les problèmes économiques et sociaux, les inégalités ou bien encore l’injustice. »
Quino a créé de nombreuses autres œuvres et des recueils de dessins d’humour mais il est définitivement connu pour le personnage de Mafalda.
<Le Figaro.fr> nous apprend qu’on le surnommait le « Sempé argentin » et ajoute :
« Il n’a jamais cessé de se battre contre l’arbitraire et les abus d’un monde en pleine mondialisation. Entré à l’école des Beaux Arts de Mendoza à 13 ans, ce fils d’Andalous avait arrêté ses études assez vite pour se consacrer à sa passion, l’illustration d’humour. En plus d’un demi-siècle de dessins de presse et de bande dessinée, cet humoriste à la douce poésie graphique, aura toujours porté avec lucidité, sa plume dans les plaies du globe. »
Mafalda est la petite fille d’un agent d’assurances argentins marié à une femme au foyer. Les parents sont souvent dépassés par la maturité de cette jeune héroïne rebelle. Inlassablement elle questionne sur la condition féminine, la dictature, la surpopulation, la guerre atomique ou encore Fidel Castro. Et le plus souvent elle exprime son indignation contre le monde injuste.
Quino avait expliqué comment Mafalda était née, au départ d’une idée pour faire de la publicité. Il déclarait au Figaro en 2004 :
«Mafalda est un peu la petite sœur argentine du petit Nicolas… en plus politisé[…]. Toutefois, elle est née d’une bien curieuse manière. C’était en 1962. Une marque d’électroménager m’avait commandé une campagne de publicité où je devais combiner Peanuts et la série Blondie. Il s’agissait des aspirateurs Manfield, marque argentine équivalente à Philips. J’avais créé une douzaine de «strips» où Mafalda évoluait, au quotidien, au sein d’une famille modèle. Finalement, la campagne n’eut jamais lieu. C’est mon ami Julian Delgado, rédacteur en chef de la revue hebdomadaire Primera plana, qui me demanda, en 1964 : « Tu aurais quelque chose pour nous ? » C’est ainsi que Mafalda, dont j’avais trouvé le nom dans le roman de David Vinas, Dar la cara, vit le jour… »
<Le Monde> précise que c’est son épouse qui a eu l’intuition que le personnage de publicité pourrait devenir un personnage de BD :
« Ma femme a été l’élément clé dans la reconnaissance de Mafalda », avait-il assuré en 2014 lors de la remise du prix Prince des Asturies. »
Quino était un créateur de comic strip, ou simplement strip. C’est-à-dire une bande dessinée de quelques cases disposées en une bande le plus souvent horizontale.

Les aventures de Mafalda ont été l’un des « comics strips » les plus publiés au monde.
Lors des 50 ans de la création de Mafalda, Le Monde publia un entretien avec son créateur le <30 janvier 2014>
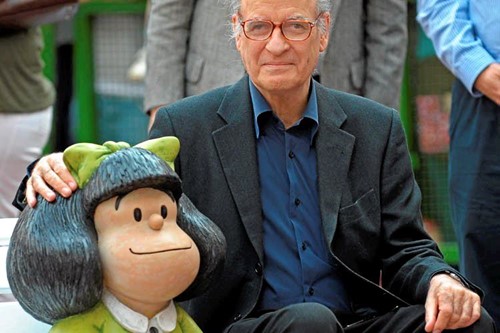 Quino, papa désabusé de Mafalda, une gamine de 50 ans
Quino, papa désabusé de Mafalda, une gamine de 50 ans
Lorsque le journaliste lui demande d’expliquer la notoriété planétaire de son personnage il répond :
« Je ne le sais pas moi-même, mais peut-être est-ce dû au fait qu’une grande partie des questions qu’elle se pose sont encore sans réponse. Parfois, je me surprends moi-même de voir comment certains strips que j’ai dessinés il y a plus de quarante ans s’appliquent à des questions d’aujourd’hui. L’année dernière est sorti un livre en Italie, qui reprenait des vignettes de Mafalda parues dans la revue Siete Das. Elles étaient classées par thèmes : politique, économie… Ce qui est incroyable, c’est que de nombreux strips semblaient faire directement référence à la dernière campagne de Berlusconi ! »
Finalement Mafalda n’aura occupé qu’une petite période de l’activité de Quino de 1964 jusqu’en 1973. Il ne regrettait pas d’avoir arrêtée si tôt le personnage auquel il continue à être associée :
« Absolument pas. Cela a été très difficile, mais je ne voulais pas que Mafalda devienne une de ces BD que les gens lisent par habitude. De plus, faire un strip n’est pas la même chose que faire une BD traditionnelle. Il s’agit d’un travail très routinier : il faut dessiner toujours les mêmes personnages, dans les mêmes proportions. C’est comme si un menuisier devait toujours tailler la même table. Moi, je voulais aussi faire des portes, des chaises et des banquettes. »
Et il finit l’entretien par ce propos pessimiste :
« Si je suis heureux de voir que Mafalda a encore des lecteurs aujourd’hui, cela m’attriste de constater que les thèmes dont elle parle restent d’actualité. Ils ont un autre nom aujourd’hui, mais ils restent les mêmes. Le monde qui existait en 1973 quand j’ai cessé de faire cette BD et que Mafalda critiquait tellement est le même, voire pire aujourd’hui. »
Il était proche de Wolinski et de Cabu. Il avait exprimé lors de l’attentat de Charlie Hebdo et de ceux qui ont suivi que son héroïne Mafalda aurait ressenti une « terrible peine ». Une autre fois il avait affirmé : « Mafalda c’est moi ! »

<1469>
-
Mardi 6 octobre 2020
« Et je dis aux femmes trois choses : votre indépendance économique est la clé de votre libération. Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations, qui attentent à votre dignité. Ne vous résignez jamais !»Gisèle HalimiLe Président de la République a célébré, au Panthéon, les 150 ans de la proclamation de la république, le 4 septembre 1870. Depuis, nous sommes en République.
 En Histoire, les choses sont toujours vraies à peu près, disait le grand Historien Fernand Braudel.
En Histoire, les choses sont toujours vraies à peu près, disait le grand Historien Fernand Braudel.
Entre le 10 juillet 1940 et le 20 août 1944, durant l’occupation de la France par l’Allemagne nazie, un autre régime politique a assuré le gouvernement de la France. Son siège était à Vichy et le chef de l’État était le Maréchal Pétain. En effet, après le vote des pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain, le 10 juillet 1940, par l’Assemblée nationale (réunion de la Chambre des députés et du Sénat), la mention « République française » disparaît des actes officiels ; le régime est dès lors désigné sous le nom d’«État français ».
Sous la présidence du Général de Gaulle, le Gouvernement provisoire de la République française proclama, par son ordonnance du 9 août 1944, toujours en vigueur, relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, la permanence en droit de la République française et nia toute légitimité au gouvernement de Vichy et de ses actes.
C’est ainsi que grâce au récit national, nous sommes en République depuis le 4 septembre 1870, sans interruption. C’est à cela que sert un récit national, raconter les faits de manière à ce que l’histoire soit conforme à ce que l’on souhaite.
Pour fêter ces 150 ans, le Président de la République a prononcé un discours que vous trouverez derrière <ce lien>.
Il est possible que j’y revienne plus longuement, mais aujourd’hui je vais m’arrêter à une phrase du discours qui m’a touché :
« Comment ne pas évoquer Gisèle HALIMI, disparue cet été. De sa chère Tunisie, à notre Assemblée nationale, des prétoires, des hémicycles, de plaidoyers en manifestes, celle qui était née Zeiza TAÏEB, plaida pour l’émancipation des peuples et fit faire des bonds de géant à la cause des femmes. »
Gisèle Halimi nous a quitté pendant cet été, le 28 juillet 2020 à 93 ans.
Cette avocate, cette grande Dame, cette combattante a été tout au long de sa vie du bon côté, c’est au moins ce que je crois.
C’était le combat du féminisme et c’était le combat de la liberté.
 Elle a raconté que ce combat venait de loin.
Elle a raconté que ce combat venait de loin.
Elle est née en 1927 près de Tunis dans une famille modeste d’une mère séfarade et d’un père d’origine berbère. Ses parents voulaient un fils. Sa mère marqua toujours sa préférence pour ses fils.
Et sa première révolte fut au sein de sa famille contre l’obligation faite aux filles de servir les hommes à table, y compris ses frères, et contre l’obligation de se consacrer à des tâches ménagères dont ses frères sont dispensés. C’est pourquoi à l’âge de treize ans, elle entame une grève de la faim afin de ne plus avoir à faire le lit de son frère. Au bout de trois jours, ses parents cèdent et elle écrit dans son journal intime de l’époque :
« Aujourd’hui j’ai gagné mon premier petit bout de liberté »
Dans ses derniers mois, elle a eu la force d’écrire avec la journaliste Annick Cojean, ses mémoires qui ont parues le 19 août : « Une farouche liberté »
Annick Cojean qui avait publié dans le Monde, le 22 septembre 2019, une longue interview de Gisèle Halimi : « J’avais en moi une rage, une force sauvage, je voulais me sauver »
Elle a embrassé la carrière d’avocate :
« Avocate pour se défendre et pour défendre. Avocate parce que l’injustice lui est « physiquement intolérable ». Avocate parce que, femme, elle est depuis le début dans le camp des faibles et des opprimés. Avocate « irrespectueuse », comme elle aime à se définir, parce que l’ordre établi est à bousculer et que la loi doit parfois être changée. Enfin parce que « ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience », comme l’écrit René Char, qu’elle cite volontiers. »
Dalloz qui est la référence pour toutes celles et ceux qui ont étudié le Droit en France lui a rendu un long hommage dans son journal <Dalloz actualité> par la plume de Dominique de la Garanderie, avocate, ancien bâtonnier de Paris.
Et cet hommage commence ainsi :
« La défense, jusqu’au bout, quoi qu’il en coûte. La défense, d’abord pour des hommes et des femmes, la défense qui est leur droit. La défense, pour gagner, mais aussi la défense qui fait douter des aptitudes à défendre. La défense pour la justice, la défense contre la loi.
Sa vocation peut être née d’un profond sentiment d’injustice qui l’a conduite à faire la grève de la faim à 10 ans pour protester et lutter contre un asservissement à l’égard de ses frères.
Sa vocation peut être née de l’assimilation des principes républicains de liberté, égalité et fraternité.
Sa vocation peut être née du refus de l’organisation de la société de la première moitié du XXe siècle et d’une mère ancrée dans les principes les plus traditionnels.
Gisèle Halimi était avocate.
La nécessité de l’indépendance, l’évidence de la recherche de justice, la volonté d’agir, la rage de convaincre ont été des moteurs au service d’une intelligence hors du commun et d’une détermination à toute épreuve. Elle devait être avocate. »
 Et quelle avocate !
Et quelle avocate !
Mais dans l’interview d’Annick Cojean, elle revient sur les racines de sa colère, de sa soif de justice dans ce qu’elle a vécu et compris dans sa jeunesse :
« Ma grand-mère, ma mère et moi avons vécu comme ça ; alors toi aussi ! », me disait ma mère, Fritna, faisant du mariage et de la sujétion à un homme mon horizon ultime. Cela impliquait de me mettre au service des hommes de la famille, de servir mes frères à table et de faire leur lit, le ménage et la vaisselle. Je trouvais cela stupéfiant. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Avant même la révolte, je ressentais une immense perplexité. Pourquoi cette différence ? Elle n’avait selon moi aucun fondement ni aucun sens. […] Tout était déjà là. Et ce récit, entendu dès mon plus jeune âge, m’a tout de suite fait comprendre la malédiction d’être née femme. C’est l’histoire de mon père Edouard, si consterné en apprenant que sa femme avait mis au monde une petite fille, qu’il a nié ma naissance pendant près de trois semaines ! Aux amis qui venaient aux nouvelles, il affirmait : « Non, Fritna n’a pas encore accouché. Bientôt, bientôt… » Il a fini par s’habituer à l’idée de la catastrophe – après tout, l’honneur était sauf, il avait déjà un fils aîné –, et nous nous sommes beaucoup aimés. Mais tout, dans mon enfance, était fait pour me rappeler que je n’étais qu’une femme, un être éminemment inférieur. […] « C’est pas juste !, disais-je constamment. C’est pas juste ! » Mon père s’énervait : « Tu n’as que ce mot-là à la bouche ! » C’est vrai. Je l’ai eu toute ma vie. Et il est indéniable que mon féminisme et mon besoin de corriger les injustices sont ancrés dans cette révolte initiale. »
Dans la jeunesse de Gisèle, le combat féministe premier était contre les mères. D’ailleurs elle aimait profondément son père, avec sa mère c’était beaucoup plus compliqué :
« Elle me pensait anormale. Quelque chose ne tournait pas rond chez sa fille pour qu’elle refuse ainsi sa condition de fille. Elle-même avait été mariée à 16 ans, selon la norme en Tunisie, avait ensuite enfanté tous les deux ans, et entendait bien que je poursuive la tradition. Le jour où j’ai eu mes règles, elle m’a d’ailleurs prévenue : « Maintenant, c’est fini !
– Qu’est-ce qui est fini ?
– Tu ne joues plus du tout avec les garçons. »
J’étais sidérée. Moi qui jouais au foot avec eux, courais pieds nus dans les rues, nageais à perte de souffle avec une bande de copains, j’aurais dû tout arrêter ? « Mais pourquoi ?
– C’est comme ça ! »
Là encore, quelle injustice ! De quoi étais-je coupable ? Quand j’avais 16 ans, elle a tenté de me marier à un riche marchand d’huile de 35 ans. « Il a trois voitures ! », répétait-elle, tel l’Harpagon de L’Avare répétant « sans dot ! ». »
Son premier combat fut pourtant celui de la décolonisation et de la résistance. Elle deviendra l’amie d’Habib Bourguiba dont elle dit :
« Voilà un visionnaire qui avait compris que l’inclusion des femmes était gage de progrès. »
Puis sa mission d’avocat auprès des militants de la cause algérienne l’a conduit aussi à demander la grâce de ses clients auprès du Président de la République, d’abord René Coty, puis le Général de Gaulle. Et c’est lors d’une telle démarche qu’a eu lieu cet échange célèbre :
 « Le 12 mai 1959, à la suite du grand procès d’El Halia en Algérie [en août 1955, des insurgés algériens tuèrent une trentaine d’Européens dans le village d’El Halia]. Et croyez-moi, c’était autre chose ! Quand il m’est apparu, il m’a semblé gigantesque. Il m’a tendu la main en me toisant. Et, de sa voix rocailleuse, il a lancé : « Bonjour madame » Il a marqué un temps. « Madame… ou mademoiselle ? » Je n’ai pas aimé. Mais alors pas du tout ! Ma vie personnelle ne le regardait pas. J’ai répondu en le regardant bien droit : « Appelez-moi maître, monsieur le Président ! » Il a senti que j’étais froissée et il a accentué sa courtoisie : « Veuillez entrer, je vous prie, maître. Asseyez-vous je vous prie, maître. Je vous écoute, maître. »
« Le 12 mai 1959, à la suite du grand procès d’El Halia en Algérie [en août 1955, des insurgés algériens tuèrent une trentaine d’Européens dans le village d’El Halia]. Et croyez-moi, c’était autre chose ! Quand il m’est apparu, il m’a semblé gigantesque. Il m’a tendu la main en me toisant. Et, de sa voix rocailleuse, il a lancé : « Bonjour madame » Il a marqué un temps. « Madame… ou mademoiselle ? » Je n’ai pas aimé. Mais alors pas du tout ! Ma vie personnelle ne le regardait pas. J’ai répondu en le regardant bien droit : « Appelez-moi maître, monsieur le Président ! » Il a senti que j’étais froissée et il a accentué sa courtoisie : « Veuillez entrer, je vous prie, maître. Asseyez-vous je vous prie, maître. Je vous écoute, maître. »
Elle raconte que De Gaulle connaissait parfaitement le dossier. Il accorda la grâce.
Son combat pour l’indépendance de l’Algérie fut encore une magnifique manifestation de courage :
« Oui, et j’étais assurément considérée comme une « traîtresse à la France » par les militaires et tenants de l’Algérie française. Il y avait des crachats, des huées, des insultes et des coups à l’arrivée au tribunal. Des coups de fil nocturnes – « tu ferais mieux de t’occuper de tes gosses, salope ! », des menaces de plastiquage de mon appartement et des petits cercueils envoyés par la poste. Je n’y ai longtemps vu que gesticulations et tentatives d’intimidation, jusqu’à l’assassinat, à Alger, de deux confrères très proches, puis la réception, en 1961, d’un papier à en-tête de l’OAS [Organisation de l’armée secrète, pour le maintien de la France en Algérie] qui annonçait ma condamnation à mort en donnant ordre à chaque militant de m’abattre « immédiatement » et « en tous lieux ». Je n’ai jamais eu peur. Sauf une nuit, au centre de torture du Casino de la Corniche, à Alger, où l’on m’avait jetée et où j’ai pensé avec culpabilité à mes fils de 3 et 6 ans, m’attendant à être exécutée. »
Et puis il y eut les combats féministes pour défendre «Djamila Boupacha » jeune militante du FLN qui avait avorté après avoir été violée et torturée par les militaires français.
Et puis le célèbre procès de Bobigny dans lequel .Marie-Claire Chevalier, 17 ans, était aussi poursuivie pour avoir avorté après un viol.
Richard Berry avait fait un spectacle qu’il a appelé « Plaidoiries » et dans lequel il mettait en scène 5 plaidoiries d’avocat dont celui de Maître Halimi dans ce procès de Bobigny.
Richard Berry dit : « Grâce à sa plaidoirie, Gisèle Halimi a changé la vie des femmes » et ajoute :
« Cette plaidoirie a une dimension particulière, d’abord parce qu’elle a eu une effet absolument extraordinaire sur la loi et sur la société », […] Je suis porté par ce texte, peut-être parce que j’ai trois filles et que je me sens donc concerné par cette forme d’oppression que les femmes ont subi, et que sans Gisèle Halimi elles continueraient peut-être de subir », prophétise Richard Berry. « Sans Gisèle Halimi, Simone Veil n’aurait peut-être pas fait passer sa loi, et ne serait peut-être pas enterrée au Panthéon. »
Et en 1971, elle est la seule avocate qui signe le manifeste des 343 femmes proclamant avoir avorté a lancé un sacré pavé dans la mare. Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Catherine Deneuve, Delphine Seyrig…
Elle explique :
« Et moi ! J’avais tenu à le signer malgré ma profession d’avocate et le blâme probable qui en résulterait. Car j’avais moi aussi, à 19 ans, connu la plus profonde détresse après un avortement réalisé par un jeune médecin sadique, un monstre, qui avait fait un curetage à vif en disant : « Comme ça, tu ne recommenceras pas. » J’ai beaucoup pleuré cette nuit-là, avec le sentiment qu’on m’avait torturée pour sanctionner ma liberté de femme et me rappeler que je dépendais des hommes. Mais je ne regrettais pas. La biologie m’avait tendu un piège. Je l’avais déjoué. Je voulais vivre en harmonie avec mon corps, pas sous son diktat. »
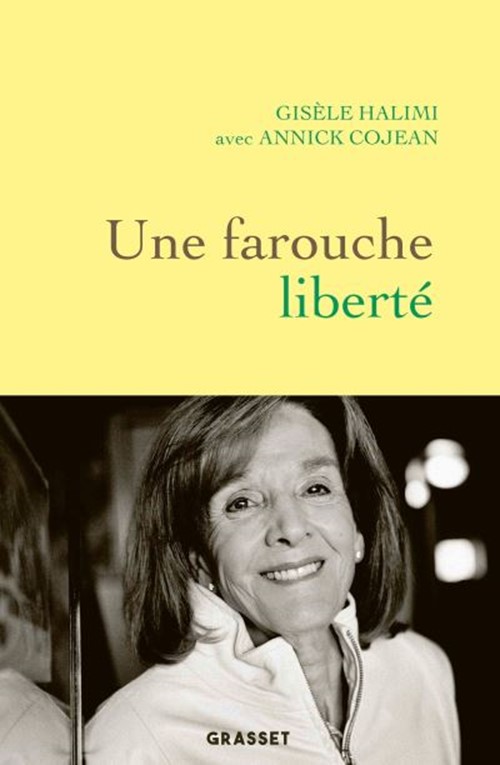 Elle revient aussi sur sa relation avec Simone Veil :
Elle revient aussi sur sa relation avec Simone Veil :
« On s’aimait beaucoup. J’ai longuement travaillé avec elle et j’ai vu grandir son féminisme. Elle m’invitait à déjeuner chez elle et n’hésitait pas à chasser son mari pour qu’on puisse papoter tranquillement : « Antoine, tu nous gênes ! » Ou bien elle m’emmenait en virée dans sa voiture avec chauffeur à la recherche d’un bistrot, moche et bien planqué, où elle pourrait fumer sans être reconnue… car elle était alors ministre de la santé. On buvait un verre de vin et on s’amusait en passant en revue le gouvernement ou en évoquant nos maris et nos fils. »
Et elle finit cet entretien par cet appel :
« Je suis encore surprise que les injustices faites aux femmes ne suscitent pas une révolte générale. […]
[Il faut] La sororité ! Depuis toujours ! La solidarité ! Quand les femmes comprendront-elles que leur union leur donnerait une force fabuleuse ? Désunies, elles sont vulnérables. Mais, ensemble, elles représentent une force de création extraordinaire. Une force capable de chambouler le monde, sa culture, son organisation, en le rendant plus harmonieux. Les femmes sont folles de ne pas se faire confiance, et les hommes sont fous de se priver de leur apport. J’attends toujours la grande révolution des mentalités. Et je dis aux femmes trois choses : votre indépendance économique est la clé de votre libération. Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations, qui attentent à votre dignité. Ne vous résignez jamais ! »
Elle gagnera aussi le combat pour criminaliser le viol, il faut la regarder défendre calmement et avec autorité ses arguments : < en 1977, le combat de Gisèle Halimi pour criminaliser le viol>
Ce fut une très grande Dame, un bel être humain.
Je pense, comme d’autres, que sa place est au Panthéon.
Car quand on fait le récit national, il est important de savoir ce que l’on met en avant, quels sont celles et ceux qui ont mené les combats qui honorent toute l’humanité.
Gisèle Halimi a mené ces combats-là et c’est pourquoi notre Récit national serait plus humaniste s’il lui faisait toute la place qu’elle mérite.
<1468>
-
Lundi 5 octobre 2020
« Schadenfreude»Mot allemand qui signifie la joie du dommage qu’autrui subitLa réputation de la langue allemande a beaucoup souffert des errements des allemands lors de la première moitié du XXème siècle. Pour beaucoup c’était devenu la langue des nazis et de la Gestapo. Les films montraient des gens en uniforme, agressifs voire carrément odieux et qui vociféraient des ordres ou des injures dans la langue de Goethe.
Il ne faut cependant pas oublier que la langue allemande est aussi la langue de Goethe, de Rilke dont j’ai parlé récemment et aussi des grands philosophes allemands.
Et c’est probablement pour aider les philosophes dans leurs réflexions que l’allemand offre des mots qui n’existent pas dans les autres langues.
<Le mot du jour du 15 avril 2019> avait pour objet un tel mot : « Die Heimat »
Aujourd’hui l’actualité me donne l’occasion de parler d’un autre mot intraduisible par un mot français : « Schadenfreude ». Cette fois ce mot utilise cette facilité de la langue allemande de construire un mot en accolant deux autres mots.
« Schaden » signifie le dommage ou le dégat. Et « Freude », tout le monde le sait grâce à Schiller et à Beethoven signifie « joie ».
Il y a bien une expression française qui permet de traduire ce mot : « Se réjouir du malheur d’autrui ».
Guillaume Erner dans la petite chronique qu’il tient au début « des matins de France Culture » avait consacré celle du < 02/07/2018> à «Schadenfreude, la joie mauvaise à l’idée du malheur d’autrui »
Il avait abordé ce sujet de cette manière :
« Ça n’est pas très avouable, mais puisque l’on est entre nous on peut se le dire : être heureux ne suffit pas, ce qui importe c’est que les autres soient malheureux. Ce principe c’est la notion que Freud a nommé la Schadenfreude – la joie mauvaise à l’idée du malheur d’autrui.
Ce principe est en réalité beaucoup plus puissant que les multiples méthodes proposées aujourd’hui pour nous apprendre à être heureux. Beaucoup de sages et de moins sages, de psy quelque chose, bref des bonheurologues nous proposent d’éprouver le plaisir de la joie d’être heureux.
Et à chaque coup, ça ne rate pas, ça rate.
Si ces méthodes destinées à être heureux seul, ou en couple, pire en famille, et pourquoi pas en troupeau, si ces méthodes avaient la moindre efficacité, vous vous doutez bien que la consommation de psychotropes, drogue et alcool aurait chuté – si les méthodes de « Self Help » comme on dit aux Etats unis pour qualifier ce rayon gigantesque dans les libraires, si ces méthodes ne fonctionnent pas, c’est peut être parce que l’on est trop angélique.
En réalité, ce qu’il faut pour nous sentir bien, ça n’est pas seulement être heureux, c’est aussi et surtout savoir que les autres sont malheureux. Cette certitude est bien antérieure à Freud – Aristote en avait déjà fait la remarque dans l’Ethique à Nicomaque.
Chez Aristote on trouve un mot nouveau Epichairekakia, un mot qui peut se traduire littéralement par joie née du mal, terme qui désigne la vilaine émotion que ressent celui qui, loin de s’affliger du malheur des autres, s’en réjouit. Beaucoup de temps a passé depuis Aristote, mais ce sentiment demeure – c’est lui qui explique que l’on puisse rire bêtement quand quelqu’un tombe, sentiment tellement présent qu’il a donné naissance a des heures de programme télévisés, les calamiteux sottisiers.
Plus encore, si l’on en croit Spinoza, une bonne part de la compassion serait de la Schadenfreude. Nous plaignons quelqu’un pour sa souffrance, on prend de ses nouvelles, mais en réalité, une joie mauvaise bouillonne en nous, la compassion serait ainsi bien souvent un sentiment ambivalent. »
Il donne ainsi parfaitement raison à la psychologue « Lea Boecker » qui explique dans le journal allemand <der Spiegel> :
« Schadenfreude ist ein allgemeinpsychologisches Phänomen. Menschen auf der gesamten Welt empfinden sie. Sogar in Ländern, in denen es nicht einmal ein Wort für Schadenfreude gibt. »
Ce que je traduirai de la manière suivante : « Schadenfreude constitue un phénomène universel que les humains du monde entier éprouvent même dans les pays où le mot « Schadenfreude » n’existe pas ».
Le Spiegel vient de publier cet article récent en utilisant le mot Schadenfreude pour la raison que Donald Trump vient d’attraper la COVID 19 et que certains éprouveraient une joie mauvaise à cette nouvelle.
Le journal pose la question à la psychologue pour savoir si cela est permis ?
A priori les gouvernants du monde n’expriment pas un tel sentiment. Tous ont manifesté de la bienveillance et souhaité un prompt rétablissement au président des États-Unis.
Nous ne pouvons que faire de même et ne pas éprouver de « Schadenfreude » devant cette épreuve que traverse Donald Trump.
Toutefois, il ne me semble pas incongru de penser, comme l’ont fait d’autres avant moi, que c’est bien la première fois, depuis quatre ans qu’il est président des États-Unis, qu’il y a quelque chose de positif chez Trump.
<1467>
-
Vendredi 2 octobre 2020
« L’année 1828 fut l’année la plus féconde de toute l’histoire de la musique parce que c’est la dernière de la vie de Schubert, pendant laquelle il a écrit tant de chefs d’œuvre.»Benjamin BrittenC’est au cœur de la période de confinement, comme je l’explique sur la page qui présente la série de mots du jour, consacrés aux œuvres de l’année de 1828 de Schubert, que j’ai eu cet élan pour essayer d’interroger cette affirmation du grand compositeur anglais Benjamin Britten.
Depuis que je me suis éveillé à la musique, il y a environ 50 ans, j’ai aimé la musique de Franz Schubert, comme une musique de l’intime, de l’émotion et de l’évidence. Oui, j’aime passionnément Schubert.
Oui, j’aime passionnément Schubert.Pour réaliser cette série, je suis allé plus loin que pour toutes les autres séries et mots du jour que j’ai écrits jusqu’à présent.
J’ai d’abord fait la liste de toutes les œuvres qu’il avait écrites en 1828. J’ai acheté les quelques œuvres que je n’avais pas.
Ces œuvres, dont je connaissais quand même la plus grande part, presque toutes, je les ai écoutées et réécoutées pendant tous ces mois, depuis avril jusqu’à septembre. Je crois que certaines d’entre elles, je les ai écoutées plus de vingt fois.
Cela a donné 11 mots du jour.
Les dix premiers sont consacrés chacun a un chef d’œuvre et le onzième à toutes les autres œuvres, il s’agit encore de 20 œuvres mais dont deux ont été perdues.
…
J’aime faire des pas de côté.
Hier, en parlant de Trump et de la démocratie américaine j’ai atterri sur la mort de Socrate
Aujourd’hui, je vais vous parler de Spotify et de son patron Daniel Ek qui est suédois.
Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Spotify est une plate-forme de streaming musical.
La différence entre un robinet et Spotify c’est que d’un robinet coule de l’eau, alors que de Spotify coule de la musique ou quelquefois simplement des sons dont le lien avec la musique est ténu.
En tout cas, c’est une entreprise qui veut utiliser de l’Art ou des choses qui y ressemblent pour faire de l’industrie.
Les vrais artistes sont très peu payés, contrairement au patron du robinet qui lui est immensément riche.
Daniel Ek a fait une déclaration pendant cet été 2020 qui a fait beaucoup réagir.
Dans une interview accordée à Music Ally, il a lancé aux artistes cet avertissement :
« Certains artistes qui réussissaient dans le passé pourraient bien ne plus réussir dans le futur. On ne peut pas enregistrer de la musique tous les trois ou quatre ans et penser que cela va suffire ».
C’est un raisonnement d’industriel, qui veut que son robinet soit de mieux en mieux approvisionné.
C’est aussi un raisonnement de capitaliste qui prévient ses salariés que s’ils veulent gagner plus ou même simplement gagner autant, il va falloir améliorer la productivité.
C’est enfin quelqu’un qui n’a aucun respect pour les artistes et pour le temps de la maturation nécessaire à l’acte de création.
Gide aurait dit : « je ne juge pas, je condamne ! »
…
Mais après avoir fait ce pas de côté et condamné ce triste sire, revenons à Schubert.
A l’aune de ce que nous venons d’évoquer, Schubert a créé, en dix mois, entre janvier et octobre 1828, l’équivalent de 12 albums.
Je ne sais pas ce que diront dans 200 ans nos successeurs des albums réalisés par Beyoncé, Michael Jacskon, Madonna et les autres.
Mais ce que je peux dire, c’est que deux cent ans après 1828, les dix albums qui correspondent aux dix chefs d’œuvres dont j’ai parlé précédemment continuent à faire naître l’émotion, à faire vibrer celles et ceux qui se donnent la peine à s’ouvrir à cette musique qu’un jeune homme de 31 ans a composé, pardon il est plus juste d’écrire : qu’un génie a offert à la postérité et à l’humanité.
Je vous donne le lien vers la page qui présente l’ensemble de la série : <Franz Schubert : l’année 1828>
Et aussi la liste de l’ensemble des mots de la série
Nr Œuvres
Lien
1 Fantaisie D. 940 pour piano à quatre mains. Samedi 25 avril 2020 2 Symphonie no 9 en ut « La Grande » D. 944 Samedi 2 mai 2020 3 Sonate pour piano N°19 D. 958 Vendredi 8 mai 2020 4 Sonate pour piano N°20 D. 959 Samedi 9 mai 2020 5 Sonate pour piano N°21 D. 960 Dimanche 10 mai 2020 6 Le chant du cygne D. 957 Lundi 24 août 2020 7 Messe N°6 en mi mineur D. 950 Mercredi 26 août 2020 8 Klavierstücke D 946 Jeudi 27 août 2020 9 La dernière œuvre de Schubert D 965 Vendredi 28 août 2020 10 Le quintette à cordes D 956 Mardi 1 septembre 2020 11 Les autres œuvres de 1828 Vendredi 4 septembre 2020 <1466>
-
Jeudi 1er octobre 2020
« Alors ce que nous devons à la Grèce, la Démocratie et la Philosophie seraient ensemble dans une même scène apaisée. Mais cela ne s’est pas du tout passé comme cela !»Patrick Boucheron qui raconte le Procès de Socrate dans l’émission « Quand l’Histoire fait date »Nous sommes donc tombés encore plus bas que lors du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Le débat entre Trump et Biden a été pire que ce que l’on pouvait imaginer
 Pour l’éditorialiste Dan Balz, du Washington Post :
Pour l’éditorialiste Dan Balz, du Washington Post :
« Aucune personne vivante n’avait jamais assisté à un débat comme celui-ci. Un festival de cris inconvenants, d’interruptions et d’insultes personnelles. C’était une insulte au public et un triste exemple de l’état de la démocratie américaine, cela cinq semaines avec les élections ».
Pour le site « Politico » le débat fut un « moment épique de honte nationale ».
« Annulez les deux prochains débats » supplie le magazine « Time »
Le chaos est presqu’uniquement imputable à l’occupant actuel de la Maison Blanche. Il est arrivé à rendre Joe Biden sympathique. Et quand ce dernier l’a traité de « clown », de « menteur », de « raciste » et surtout quand il a fini par lâcher : « Tu vas la fermer, mec ? » (« Will you shut up, man », en anglais), nous ne pouvions que l’approuver.
Il y a encore plus inquiétant lorsque Trump refuse de s’engager à reconnaître le résultat du scrutin, laissant entendre que s’il perd cela ne peut être qu’en raison de tricheries de ses adversaires.
Et il prépare les ferments de guerre civile en refusant de condamner les milices d’extrême droite qu’on appelle les suprémacistes et même encore plus grave quand il envoie, en plein débat, ce message explicite à l’organisation d’extrême droite : «Proud Boys, mettez-vous en retrait, tenez-vous prêts». <Le Figaro> explique qui sont ces hommes misogynes, racistes et amateurs d’armes à feu.
Est-ce ainsi que les démocraties finissent ?
Parallèlement j’ai regardé un nouvel épisode de cette remarquable série que Diffuse ARTE et dans laquelle l’historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, nous raconte les dates marquantes de l’Histoire. Mais il ne raconte pas seulement ce qui s’est passé à cette date, mais aussi avant et après, le contexte qui explique ce qui s’est passé et les conséquences jusqu’à nos jours de cet évènement : <Quand l’Histoire fait dates>.
Cette fois la date étudiée se situait il y a 2400 ans, plus exactement 2419 ans en -399, dans la cité d’Athènes. <-399, le procès de Socrate | Quand l’histoire fait dates | ARTE>
Il introduit son sujet ainsi
« De quoi sommes-nous redevables à l’Athènes du 5ème siècle. De ce passé ancien, ensoleillé.
On dirait deux choses : La philosophie d’une part, la Démocratie, d’autre part.
On aimerait tant que ce soit la Philosophie et la Démocratie, la Philosophie avec la Démocratie.
On aimerait tant voir Socrate converser avec des citoyens qui l’interpelleraient et lui répondrait.
Et de ce dialogue naîtrait un rapport raisonnable qu’on appellerait la Politique
Alors tout serait raccordé
Alors ce que nous devons à la Grèce, la Démocratie et la Philosophie seraient ensemble dans une même scène apaisée.
Mais cela ne s’est pas du tout passé comme cela ! »
Patrick Boucheron va développer son propos pendant une demi-heure : <-399, le procès de Socrate | Quand l’histoire fait dates | ARTE>
 Le procès de Socrate est l’un des procès les plus célèbres de l’Histoire.
Le procès de Socrate est l’un des procès les plus célèbres de l’Histoire.
Il était accusé de corrompre la jeunesse, de nier les dieux de la cité et d’introduire des divinités nouvelles. Pour cette raison il sera condamné à mort, il avait 70 ans. Contrairement aux demandes pressantes de ses amis, il refusera de s’enfuir et se soumettra à la décision du Tribunal de la démocratie athénienne, il boira la cigüe.
Nous connaissons cette histoire par le récit qu’ont en fait deux de ses disciples Platon et Xénophon, dans leur Apologie de Socrate respective.
Évidemment nous n’entendons ainsi qu’une partie au Procès. Platon développera des thèses très anti-démocratiques, la démocratie a tué son maître et l’homme qu’il admirait le plus.
De très nombreux ouvrages ont discuté de ce procès.
Boucheron aborde un sujet développé ces dernières années qui est l’opinion de Socrate sur la démocratie avant le procès. Parce ce que les chefs d’accusation sont la corruption de la jeunesse et une question sur les dieux de la cité. Dans l’apologie de Socrate il n’est pas question d’une atteinte à la démocratie athénienne. Mais il semble qu’il y a aussi un conflit sous-jacent à ce sujet.
Car la cité d’Athènes est une démocratie qui se trouve en difficulté au moment du Procès de Socrate.
Athènes est durant le Ve siècle la cité la plus puissante du monde grec. Mais la guerre du Péloponnèse contre Sparte et ses alliés, commencée en -431, se termine par une terrible défaite.
À la fin de la guerre, c’est le régime démocratique lui-même qui est mis en cause.
Il y eut une première tentative pour renverser la démocratie en 411 et en 404, une nouvelle tentative, dirigée par Théramène, institue le régime des Trente qui est un régime oligarchique.
La défaite fut attribuée à une prétendue perte des valeurs traditionnelles. Ce n’est pas très éloigné des blancs qui font le succès de Trump et qui pense que l’Amérique est en train de perdre la guerre de la mondialisation, parce qu’elle a abandonné ses valeurs originelles. C’est exactement les thèses défendues par les suprémacistes.
Pour revenir à Socrate et son opinion par rapport à la démocratie, on lit dans <Wikipedia>
« Les opinions politiques qu’on lui attribue et qu’ont embrassées certains de ses disciples n’aident pas sa défense. Critias, un ancien élève de Socrate, a été l’un des chefs de file des Trente tyrans, un groupe d’oligarques favorables à Sparte qui dirige Athènes durant un peu plus de sept mois, de mai 404 à janvier 403, après la fin de la guerre du Péloponnèse. Durant cette même guerre, Alcibiade, un des principaux disciples de Socrate durant sa jeunesse, a trahi Athènes en rejoignant le camp des spartiates. De plus, d’après les portraits laissés par des disciples de Socrate, ce dernier épouse ouvertement certaines vues anti-démocratiques, estimant que ce n’est pas l’opinion de la majorité qui donne une politique correcte, mais plutôt le savoir et la compétence professionnelle, qualités que peu d’hommes possèdent. Platon le décrit aussi comme très critique envers les citoyens les plus importants et les plus respectés de la démocratie athénienne ; il le montre affirmant que les responsables choisis par le système athénien de gouvernement ne peuvent être regardés de façon crédible comme des bienfaiteurs, car ce n’est pas un groupe nombreux qui bénéficie de leur politique, mais « un seul homme […] ou alors un tout petit nombre ». Enfin Socrate est connu pour louer les lois des régimes non démocratiques de Sparte et de la Crète. »
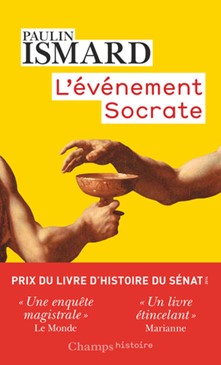 L’historien , Paulin Ismard a écrit un livre en 2013 « L’événement Socrate » : dans lequel il revient sur « l’affaire » Socrate et pose la question : <Socrate, ennemi de la démocratie ?>
L’historien , Paulin Ismard a écrit un livre en 2013 « L’événement Socrate » : dans lequel il revient sur « l’affaire » Socrate et pose la question : <Socrate, ennemi de la démocratie ?>
Dans l’entretien au Point il explique :
« Mais sa condamnation s’explique aussi en partie par le contexte politique athénien de la charnière des Ve et IVe siècles. A la fin de la guerre du Péloponnèse (431-404), les partisans du régime oligarchique profitent du soutien des troupes spartiates pour renverser le régime démocratique et instaurer durant quelques mois ce qui s’avère rapidement être une pure tyrannie, connue sous le nom de régime des Trente. Le procès de Socrate se déroule quatre ans après ces événements, à un moment où le camp démocrate, désormais tout-puissant, désire solder ses comptes avec ses anciens adversaires. A cette date, Socrate est clairement assimilé aux anciens partisans de l’oligarchie dans la mesure où plusieurs de ses disciples (dont Critias, l’idéologue des Trente) ont participé à son instauration. Socrate lui-même, contrairement à de nombreux Athéniens, était resté dans la ville durant les heures les plus sombres du régime des Trente, ce qui devait apparaître aux yeux de nombreux citoyens comme un témoignage de soutien.
[…] Incontestablement, la philosophie politique socratique, d’après ce qu’en rapporte l’ensemble de ses disciples, était hostile aux principes fondamentaux du régime démocratique, le cœur du différend portant sur la place octroyée au savoir dans l’exercice du pouvoir. Socrate pouvait apparaître comme un promoteur du gouvernement des experts, alors que le régime démocratique athénien refusait que la compétence technique puisse être un titre à gouverner. ».
Ce sont finalement des débats très actuels.
Si la démocratie conduit à ce que le peuple souverain élise un type comme Trump, ne faut-il remettre en cause la démocratie ?
Et comme le pense le philosophe Socrate donner le pouvoir à ceux qui savent ?
C’est un peu ce que l’Union européenne, essaye de mettre en place et qui est dénoncé par Emmanuel Todd ou Michel Onfray.
J’avais évoqué ce sujet lors de mots du jour. Par exemple mercredi 21 octobre 2015 : « Mon mandat ne provient pas du peuple européen. » qui est une phrase qu’a tenue Cécilia Malmström, la commissaire européenne, en 2015, chargée du commerce et donc des négociations du TTIP ou TAFTA, ou celui du mercredi 25 mars 2015 qui rapportait les propos d’un fonctionnaire européen : «Ne vous inquiétez pas, en Europe nous avons le système qui permet de ne pas tenir compte des élections.»
Sommes-nous condamnés à choisir entre un gouvernement des experts ou un gouvernement à la Trump ?
N’est ce pas des gouvernements d’experts qui ont conduit à élire des gens comme Trump ?
Boucheron prétend que nous ne sommes pas encore remis de cette divergence initiale entre la philosophie et la démocratie qui a eu lieu il y a 2400 ans.
<-399, le procès de Socrate | Quand l’histoire fait dates | ARTE>
<1465>
-
Mercredi 30 septembre 2020
«Ce n’est qu’alors qu’il peut arriver qu’en une heure très rare, du milieu d’eux, se lève le premier mot d’un vers.»Rainer Maria Rilke Pour écrire un seul vers (1910), Les Cahiers de MalteOn peut faire de merveilleuses rencontres, mais il faut être prêt à les accueillir.
Le grand acteur de théâtre Laurent Terzieff, mort en 2010, avait rencontré, par le livre et la scène, l’un des plus grands poètes allemands Rainer Maria Rilke ( 1875-1926). Poète de langue allemande serait plus juste, il est né à Prague, en Bohème dans l’Empire Austro-Hongrois.
Il fut un grand voyageur mais passa de longs moments de sa vie à Paris. Il était poète, il a aussi écrit un roman largement autobiographique : « Les Cahiers de Malte Laurids Brigge » qu’on désigne souvent sous le nom abrégé « Les Cahiers de Malte ».
Laurent Terzieff avait mise en scène, au Théâtre du Lucernaire un spectacle appelé « Une heure avec Rainer Maria Rilke »
Il y eut une deuxième rencontre, en présentiel, dit-on aujourd’hui. Laurent Terzieff a rencontré Bernard Pivot sur le plateau d’Apostrophes, le 3 février 1995. Et lors de cette émission, Bernard Pivot a invité Laurent Terzieff à dire un extrait de ce livre en prose, extrait dédié au difficile exercice d’écrire un vers.
Et Laurent Terzieff s’est exécuté.
Mais il ne dit pas le texte, il l’habite et le transcende, dans un moment de grâce.
Et il y eut une troisième rencontre.
Une rencontre virtuelle que j’ai pu accueillir en regardant la vidéo qui rappelle ce moment.
Libre à vous, à votre tour, d’être touché par un homme qui vit le texte écrit par un autre homme.
Les mots de ce texte sont les suivants.
Pour écrire un seul vers,
il faut avoir vu beaucoup de villes, d’hommes et de choses,
il faut connaître les animaux,
il faut sentir comment volent les oiseaux
et savoir quel mouvement font les petites fleurs en s’ouvrant le matin.
Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues,
à des rencontres inattendues,
à des départs que l’on voyait longtemps approcher,
à des jours d’enfance dont le mystère ne s’est pas encore éclairci,
à ses parents qu’il fallait qu’on froissât lorsqu’ils vous apportaient une joie et qu’on ne la comprenait pas ( c’était une joie faite pour un autre ),
à des maladies d’enfance qui commençaient si singulièrement, par tant de profondes et graves transformations,
à des jours passés dans des chambres calmes et contenues,
à des matins au bord de la mer,
à la mer elle-même, à des mers,
à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles
– et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela.
Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d’amour, dont aucune ne ressemblait à l’autre,
de cris de femmes hurlant en mal d’enfant, et de légères, de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient.
Il faut encore avoir été auprès de mourants,
être resté assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à-coups.
Et il ne suffit même pas d’avoir des souvenirs.
Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d’attendre qu’ils reviennent.
Car les souvenirs ne sont pas encore cela.
Ce n’est que lorsqu’ils deviennent en nous sang, regard, geste,
lorsqu’ils n’ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous,
ce n’est qu’alors qu’il peut arriver qu’en une heure très rare, du milieu d’eux, se lève le premier mot d’un vers.
– Pour écrire un seul vers (1910), Les Cahiers de Malte —
Il s’agit d’une traduction. Il est possible de trouver l’intégralité de ce texte dans sa version originale en allemand derrière <ce lien>.
Il m’a donc été possible de mettre vis-à-vis les versions françaises et allemandes.
Pour écrire un seul vers, Um eines Verses willen il faut avoir vu beaucoup de villes, d’hommes et de choses, muß man viele Städte sehen Menschen und Dinge il faut connaître les animaux, man muß die Tiere kennen il faut sentir comment volent les oiseaux man muß fühlen wie die Vögel fliegen et savoir quel mouvement font les petites fleurs en s’ouvrant le matin. und die Gebärde wissen mit welcher die kleinen Blumen sich auftun am Morgen. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, Man muß zurückdenken können an Wege in unbekannten Gegenden à des rencontres inattendues, an unerwartete Begegnungen à des départs que l’on voyait longtemps approcher, und an Abschiede die man lange kommen sah à des jours d’enfance dont le mystère ne s’est pas encore éclairci, an Kindheitstage die noch unaufgeklärt sind à ses parents qu’il fallait qu’on froissât lorsqu’ils vous apportaient une joie et qu’on ne la comprenait pas ( c’était une joie faite pour un autre ), an die Eltern die man kränken mußte wenn sie einem eine Freude brachten und man begriff sie nicht (es war eine Freude für einen anderen –) à des maladies d’enfance qui commençaient si singulièrement, par tant de profondes et graves transformations, an Kinderkrankheiten die so seltsam anheben mit so vielen tiefen und schweren Verwandlungen à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, an Tage in stillen verhaltenen Stuben à des matins au bord de la mer, und an Morgen am Meer à la mer elle-même, à des mers, an das Meer überhaupt an Meere à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles an Reisenächte die hoch dahinrauschten und mit allen Sternen flogen – et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. und es ist noch nicht genug wenn man an alles das denken darf. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d’amour, dont aucune ne ressemblait à l’autre, Man muß Erinnerungen haben an viele Liebesnächte von denen keine der andern glich de cris de femmes hurlant en mal d’enfant, et de légères, de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient. an Schreie von Kreißenden und an leichte weiße schlafende Wöchnerinnen die sich schließen. Il faut encore avoir été auprès de mourants, Aber auch bei Sterbenden muß man gewesen sein être resté assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à-coups. muß bei Toten gesessen haben in der Stube mit dem offenen Fenster und den stoßweisen Geräuschen. Et il ne suffit même pas d’avoir des souvenirs. Und es genügt auch noch nicht daß man Erinnerungen hat. Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d’attendre qu’ils reviennent. Man muß sie vergessen können wenn es viele sind und man muß die große Geduld haben zu warten daß sie wiederkommen. Car les souvenirs ne sont pas encore cela. Denn die Erinnerungen selbst sind es noch nicht Ce n’est que lorsqu’ils deviennent en nous sang, regard, geste, Erst wenn sie Blut werden in uns, Blick und Gebärde, lorsqu’ils n’ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous, namenlos und nicht mehr zu unterscheiden von uns selbst, ce n’est qu’alors qu’il peut arriver qu’en une heure très rare, du milieu d’eux, se lève le premier mot d’un vers. erst dann kann es geschehen, daß in einer sehr seltenen Stunde das erste Wort eines Verses aufsteht in ihrer Mitte und aus ihnen ausgeht Je redonne le lien vers la vidéo d’Apostrophes : <Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu…>
<1464>
-
Mardi 29 septembre 2020
«Un baiser d’amour pour mourir ? Je veux bien cela…Violette, une grand-mère de 92 ans qui veut que ses petit-enfants l’embrassent et la touchent malgré la COVID 19Beaucoup de questions se posent sur cette pandémie qui envahit notre espace, nos vies nos relations.
Michelle a posé beaucoup d’interrogations dans un commentaire au mot du jour d’hier.
Nous constatons qu’il y a des contradictions entre les scientifiques, mais cela nous savons que c’est normal. D’autres interrogations se portent sur certaines incohérences dans les décisions et la stratégie des pouvoirs publics.
Poser des questions est toujours une bonne démarche. Poser les bonnes questions constitue une quête.
J’ai aussi beaucoup de questions, mais j’ai si peu de réponses. Je ne sais pas, telle est la vérité
Mais il y a quand même une question pour laquelle j’ai l’intuition d’un début de réponse.
André Comte-Sponville, depuis plusieurs mois maintenant, alerte sur ce qu’il considère comme une erreur, celle de faire de la santé une valeur suprême :
« La santé n’est pas une valeur du tout, c’est un bien ! »
Et il continue
« Et si on la considère comme une valeur suprême nous avons tendance à tout déléguer à la médecine. Déléguer non seulement la gestion de nos maladies, ce qui est normal, mais aussi la gestion de nos vies et de notre société »
Il dit cela par exemple dans cette <vidéo> de deux minutes où il explique aussi la différence entre la générosité et la solidarité.
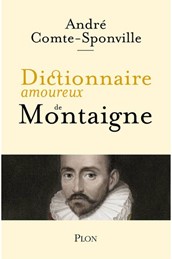 Et dans <celle-ci> il parle de Montaigne, il vient de publier un livre sur ce philosophe « Dictionnaire amoureux de Montaigne ».
Et dans <celle-ci> il parle de Montaigne, il vient de publier un livre sur ce philosophe « Dictionnaire amoureux de Montaigne ».
En citant Montaigne, il parle de la COVID19 et appelle à ne pas continuer à nous laisser dominer par la peur :
« Ce dont j’ai le plus peur, c’est de la peur »
Et il ajoute que c’est une formule qu’il s’est souvent répété ces jours-ci.
Alors, il précise bien qu’il porte le masque et respecte les gestes barrières, mais il y a une sorte d’excès qu’il dénonce.
Elie Semoun n’est pas philosophe, mais humoriste.
Il vient de perdre son père qui est mort en Ehpad, dans le 8ème arrondissement de Lyon, pas loin de mon domicile.
Et il n’est pas content : « Le confinement a tué mon père » :
« La lecture des nouvelles mesures me met en colère, écrit l’acteur sur son compte Instagram. Il est très douloureux pour moi de l’écrire, mais le confinement a tué mon père. »
[…] Mais je dois rendre publique que l’arrêt obligatoire de nos visites à son Ehpad durant deux mois a accéléré son déclin déjà fragilisé par Alzheimer.
C’est quasi criminel d’empêcher nos anciens d’être entouré de l’amour de leurs proches. Parce qu’un Je t’aime, un baiser, un geste, valent mieux que la solitude dans laquelle nous plonge la peur de ce virus. »
Dans le même article, le journaliste donne aussi la parole à Nicolas et Victoria les enfants de Guy Bedos. Victoria dit :
« J’en veux [au] coronavirus, [au] confinement qui nous a éloignés de toi avec Nicolas. Pendant deux mois, on n’a pas pu te voir par peur de te tuer en t’embrassant. Et on t’a tué en ne venant pas t’embrasser, finalement. Tu as cessé de manger, de marcher, de lutter. À quoi bon puisque mes enfants ne m’aiment plus ? »
Nous t’avons tué en ne venant pas t’embrasser !
Et je veux partager avec vous <cette vidéo> dans laquelle une psychothérapeute raconte sa rencontre par le canal numérique avec une vieille grand-mère de 92 ans qu’elle appelle Violette.
Cette psychothérapeute, Gislaine Duboc, qui annonce aussi d’autres compétences plus spirituelles, a donc reçu en consultation la vieille Dame parce que cette dernière voulait qu’elle joue le rôle de médiatrice ou même qu’elle tranche le différend qui existait entre elle et ses petits-enfants.
Les enfants et les petits enfants venaient voir régulièrement Violette, ils étaient masqués, ne s’approchaient pas d’elle et par voie de conséquence ne la touchait pas, ce que Violette trouvait insupportable. Les petits enfants lui rétorquaient qu’il leur était impossible de risquer de lui apporter la mort, et que si tel était le cas il porterait cette culpabilité pour le restant de leurs jours.
Dans ces conditions la grand-mère ne voulait plus les voir, ce que les petits enfants trouvaient très injustes, car ils aimaient venir voir leur grand-mère.
Violette a demandé à Gislaine Duboc de trouver les mots pour convaincre ses petits-enfants de se ranger à ses arguments. Gislaine Duboc qui dit comprendre la position des deux, se dit incapable de jouer ce rôle mais elle demande à Violette de dire avec ses mots ce qu’elle désire. Et Violette parle :
« Je n’ai pas peur [de la mort]. Je sens que c’est la fin. Vous savez je suis à la fin de l’hiver, je le sens. Mes jours, mes mois ne seront pas très longs. Je vais avoir 92 ans, pour moi je suis à la fin de ma vie. Et c’est bien comme cela.
Mais je ne veux pas être privée des baisers. Je ne veux pas être privée des bras de mes enfants et de mes petit-enfants.
Je suis quelqu’un qui les touche depuis toujours […] Je caresse toujours […] j’ai besoin de toucher.
Et là depuis des semaines, j’ai l’impression de rentrer dans un froid incroyable.
Alors si je dois mourir dans le froid ça, ça ne va pas. Que j’aille vers le froid d’accord, mais pas mourir de froid.[…]
Comprenez bien, la mort elle vient par où elle veut. Tout est messager pour la faire venir. Eh bien, moi si c’est l’amour de mes enfants qui m’amène la mort, un baiser d’amour pour mourir, je veux bien cela. »
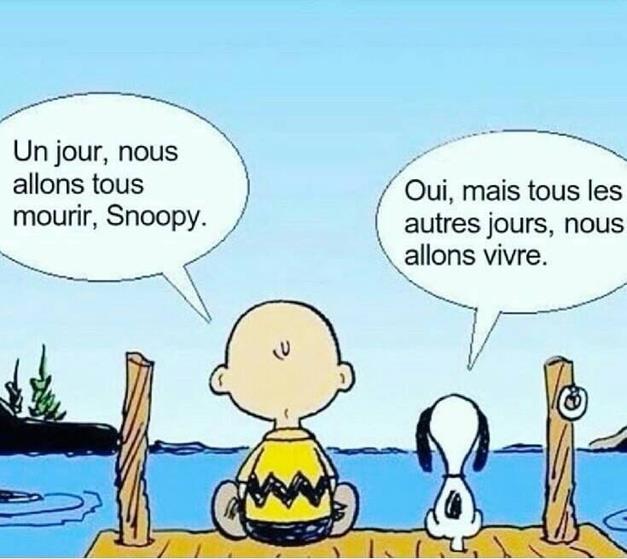 « Un baiser d’amour pour mourir ? je veux bien cela ! ». En quelques mots l’essentiel est dit.
« Un baiser d’amour pour mourir ? je veux bien cela ! ». En quelques mots l’essentiel est dit.
Il y a un temps où ce qui compte c’est la qualité, la chaleur du lien et de la vie et non pas la quantité froide d’une vie dont on aurait extrait la substance.
Il faut regarder la vidéo c’est beaucoup plus émouvant que ce que je peux raconter.
Merci Violette pour cette leçon de vie dont la mort fait partie.
<1463>
-
Lundi 28 septembre 2020
«Les gardiens de la raison – Enquête sur la désinformation scientifique»Livre de Stéphane Foucart, Stéphane Horel et de Sylvain LaurensEntre les croyances et la Science, je suis résolument du côté de la science. Et je le reste !
La croyance, surtout dans le cadre des religions monothéistes, pense détenir la vérité et la réponse à toutes les questions.
La Science c’est le doute, le règne de l’incertitude, la capacité cependant d’écarter ce qui est faux et de trouver des réponses partielles aux questions. Réponses partielles qui cependant ont permis des progrès techniques extraordinaires et notamment de rallonger la vie des humains, comme de lutter très souvent contre la douleur, ce qui n’était pas possible dans les siècles d’avant le XXème. Michel Serres a expliqué plusieurs fois qu’on ne pouvait rien comprendre à la doctrine du « dolorisme » qui était omniprésente dans la religion chrétienne, si on ne se rendait pas compte combien nos ancêtres souffraient au quotidien sans disposer des médicaments ou des moyens médicaux pour l’empêcher.
Evidemment, il est possible que nous soyons un peu désemparé quand le docteur en physique, Laurent Toubiana, chercheur à l’Inserm, où il dirige l’équipe SCEPID (Système Complexes et Epidémiologie) au sein du LIMICS (Laboratoire d’informatique Médicale et d’Ingénierie des Connaissances) affirme que <la pandémie est terminée>, alors que d’autres affirment que la propagation virologique du SRAS V2 est très inquiétante et qu’il est nécessaire de prendre des mesures contraignantes pour la freiner.
Dans son service Checknews, Libération fait appel à d’autres scientifiques pour contester les arguments de ce chercheur : < Sur quoi se fonde l’épidémiologiste Laurent Toubiana pour affirmer que «l’épidémie est terminée» ? >.
Dans le fond ce débat est normal, il est sain.
S’il vous choque c’est que probablement et sans le savoir vous êtes encore très influencés par la religion dont vous êtes issue et qui vous a fait croire, jusque dans vos recoins les plus intimes, que non seulement la vérité existait et qu’en outre il existait des humains qui étaient capable de vous la révéler.
Vous avez simplement remplacé « Dieu » par la « Science ».
Or cela n’a rien à voir.
Dans la Science le savoir est limité et l’incertitude grande.
Et je rappelle toujours cette phrase de Rachid Benzine qui explique cela :
« Le contraire du savoir ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes. »
Mais pour que la Science joue ce rôle éminent que je pourrai décrire par des mots simples comme : « ça oui ! ça c’est peut-être possible ! ça ce n’est probablement pas vrai ! ça c’est faux et surtout, surtout ça je ne le sais pas », il faut qu’elle soit éthique.
C’est-à-dire que le scientifique parle en toute liberté par rapport aux expérimentations et aux études qu’il a menées ou qu’il a pu lire parce qu’elles ont été décrites dans des revues scientifiques rigoureuses contrôlées par des comités de lecteurs qui le sont autant.
Or il y a un problème et ce problème c’est l’argent. L’argent qui corrompt.
Un livre vient de sortir. Je ne sais pas s’il donne toutes les clés, mais il est intéressant qu’il pose le problème et qu’il donne des exemples de ce qu’il prétend.
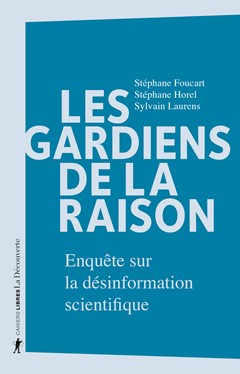 Ce livre est l’œuvre de Stéphane Foucart, journaliste d’investigation, chargé de la couverture des sciences au sein du journal Le Monde, en particulier des sciences de l’environnement et des sciences de la Terre, de Stéphane Horel également collaboratrice du Monde, ayant réalisé plusieurs enquêtes sur les conflits d’intérêts et les lobbys et Sylvain Laurens, sociologue, maître de conférences à l’EHESS.
Ce livre est l’œuvre de Stéphane Foucart, journaliste d’investigation, chargé de la couverture des sciences au sein du journal Le Monde, en particulier des sciences de l’environnement et des sciences de la Terre, de Stéphane Horel également collaboratrice du Monde, ayant réalisé plusieurs enquêtes sur les conflits d’intérêts et les lobbys et Sylvain Laurens, sociologue, maître de conférences à l’EHESS.
Le titre de ce livre édité par les éditions de la Découverte et paru le 24 septembre est « Les gardiens de la raison – Enquête sur la désinformation scientifique »
La première fois que j’ai entendu parlé de ce livre c’est dans l’émission <L’instant M du 24 septembre> de Sonia Devillers dans laquelle les deux journalistes du Monde étaient invités.
Cette émission qui s’est donnée pour titre : « Désinformation scientifique : quand la raison est instrumentalisée par des intérêts privés » explique que l’enquête des journalistes analyse les nouvelles stratégies de lobbying pour peser dans le débat scientifique et médiatique.
Et Sonia Devillers a présenté l’ouvrage ainsi :
« Les auteurs criblent tous les canaux, toutes les voies et les voix qu’empruntent les lobbys de l’industrie pour battre en brèche le principe de précaution et disqualifier les combats pour la santé ou l’environnement. Et ce, au nom de la science. Au nom de la « bonne » science, celle qui n’entraverait en rien le progrès. Traduire : qui n’entraverait en rien la loi du marché. Quels sont ces canaux ? Des maisons d’édition, des journaux, des radios, des chaines de télé et une myriade de blogs, comptes Twitter ou chaînes Youtube. Ainsi que des agences de relations publiques qui fabriquent des arguments scientifiques tout prêts pour journalistes paresseux ou simplement ignorants. Ce livre est dense, précis, fouillé, très polémique, édifiant et passionnant. »
Le journal <L’Humanité> ne tarit pas d’éloges :
« Dans cet ouvrage remarquable, les journalistes Stéphane Foucart et Stéphane Horel démasquent, avec le sociologue Sylvain Laurens, les discours et démarches au service des intérêts privés. Ou comment la science et la raison sont désormais instrumentalisées par un camp réactionnaire. Un travail d’un intérêt public.
Le discours rationaliste est aujourd’hui mis à mal par des acteurs scientifiques et médiatiques qui, prétendant s’appuyer sur les principes de la science, défendent principalement les intérêts des industriels. La remarquable enquête de Stéphane Foucart et Stéphane Horel, deux journalistes, et d’un sociologue, Sylvain Laurens, à propos de ces pseudo-rationalistes met en exergue les logiques argumentatives et les tactiques politiques à l’œuvre dans cette vaste entreprise de désinformation. »
Leur journal « Le Monde » publie bien sûr un article sur ce livre : <C’est la possibilité même de la diffusion de la vérité scientifique auprès du plus grand nombre qui se trouve désormais attaquée.>.
L’article rappelle d’abord ce que l’on sait désormais sur l’industrie du tabac :
« Les procès faits à l’industrie du tabac à la fin des années 1990 ont permis la mise en ligne de millions de documents confidentiels révélant les stratégies de leurs cabinets de relations publiques. Ironie de l’histoire, c’est l’important travail de sensibilisation de l’opinion publique et de diffusion de ces informations par des chercheurs, des ONG et des journalistes qui a précipité la mutation et l’accélération des formes de manipulation de la science par le secteur privé. L’industrie s’est adaptée à cette vague de scandales et de documentation de ses actes. Ce que nous explorons dans ce livre, en somme, ce sont les nouvelles frontières du lobbying et les degrés insoupçonnés de raffinement qu’atteignent désormais les stratégies des firmes pour défendre leurs intérêts en instrumentalisant le savoir. »
La stratégie est de s’appuyer sur des scientifiques ou des personnes qui se prétendent scientifiques pour accuser d’obscurantisme tous ceux qui entraveraient les intérêts des puissantes firmes et écarter toute critique de leurs actions et produits :
« L’enjeu consiste maintenant à prendre position dans l’espace de la médiation scientifique, dans ces lieux où l’on fait la promotion de la science et de son esprit auprès des citoyens, parfois avec l’aide des pouvoirs publics. Prendre position, mais aussi possession. Les arguments de l’industrie étaient parés des atours de la science, ils sont maintenant dissimulés derrière une défense de la science comme bien commun. Chacun a entendu ces affirmations dans le débat public : être contre les pesticides dans leurs usages actuels, interroger certains usages des biotechnologies, critiquer l’industrie du nucléaire, c’est être « contre la science », c’est verser dans l' »obscurantisme ». La stratégie des marchands de pétrole, de plastique, de pesticides et d’alcool consiste désormais à dire ce qu’est la « bonne » science. De ce fait, nous n’assistons plus seulement à un dévoiement de l’expertise scientifique, mais à un détournement plus profond des logiques mêmes de fonctionnement d’un espace public reposant sur un idéal de vérité. »
L’article est plus précis :
« Les firmes s’emploient à faire passer leur matériau de lobbying scientifique pour l’état de la science. Elles veulent voir leurs études validées, agrémentées d’un coup de tampon officiel. Voire financées sur fonds publics. Mais elles ont aussi besoin de disséminer leurs informations et de recruter des défenseurs, parfois à leur insu. […] Mais ceux qui relaient les messages des firmes et de leurs consultants n’ont pas toujours conscience de ce qu’ils font. Et c’est justement là l’une de ces nouvelles stratégies furtives concoctées par le marketing digital. Pour certaines agences spécialisées dans la manipulation des réseaux sociaux, le nouvel horizon du lobbying scientifique est le citoyen ordinaire, le micro-influencer, comme dit le jargon du métier. Transformé en « relais de terrain », il diffuse des argumentaires conçus et façonnés par d’autres. […]
La description de ces phénomènes risque de choquer des engagements sincères, de heurter ceux qui donnent de leur temps pour faire progresser l’idéal scientifique auprès de différents publics. Car les simples amateurs de science, aussi, sont enrôlés dans cette entreprise de propagande. Dans l’écosytème de la tromperie modern style, la cible privilégiée des influenceurs n’est plus seulement le ministre ou le haut fonctionnaire de la Commission européenne, mais le professeur de biologie de collège, animateur d’un « café‑science », ou l’agronome éclairé, passeur de savoir sur son blog. Ayant pris conscience que leur monde était désormais traversé par ces ruses retorses, certains se plaignent de la récupération de leurs idées à des fins mercantiles. Ainsi, des animateurs de chaînes YouTube ou de blogs scientifiques ont déjà eu la mauvaise surprise de voir leurs logos repris sur des plaquettes de think tanks financés par le secteur privé. »
« Libération » consacre aussi plusieurs articles à ce livre
<La science perd-elle la raison ?> évoque les
« «rationalistes», une petite communauté d’acteurs du monde de la science peu connue du grand public mais dont les luttes internes peuvent avoir des répercussions dans la vie des Français. Il suffit pour mesurer le niveau de tensions de voir le cyclone de réactions qu’a fait naître, avant même sa parution, le livre des journalistes du Monde Stéphane Foucart et Stéphane Horel et du sociologue Sylvain Laurens»
Un autre dans lequel intervient Sylvain Laurens qui affirme : «Le rationalisme est devenu un combat pour le droit de dire des choses fausses»
Un dernier « La fabrique du doute » qui révèle que l’une des cibles du livre est le sociologue Gérald Bronner qui intervient dans beaucoup de médias que j’écoute et qui se veut, en effet, le pourfendeur de l’obscurantisme.
Grâce à Wikipedia on peut aussi lire la défense des personnes attaquées :
« [Stéphane Foucart] met en cause des personnalités faisant la promotion de la rationalité, comme le sociologue Gérald Bronner, le physicien Jean Bricmont, le politologue Virginie Tournay, le psycholinguiste Franck Ramus, le biologiste Marcel Kuntz, le journaliste Laurent Dauré ou encore le Youtubeur Thomas C. Durand. Ces derniers, dans leurs réponses (cf. liens ci-après) pointent les inexactitudes dont selon eux est truffé ce livre, présenté comme une enquête d’investigation, ce qui les amène à s’interroger sur sa réelle compétence journalistique ainsi que sur sa déontologie. »
Voici les liens donnés par Wikipedia :
« Des journalistes du Monde et un sociologue attaquent Jean Bricmont dans un livre : il répond » sur Le Média pour Tous, 22 septembre 2020
« Un nouveau journalisme : de l’insinuation à l’inquisition. » sur VIRGINIE TOURNAY, 23 septembre 2020
« Les champions de l’intox » sur Ramus méninges, 19 septembre 2020
Marcel Kuntz, « Merci aux auteurs du livre Les Gardiens de la Raison » sur OGM : environnement, santé et politique
« La RAISON n’est pas un trophée – réponse à Foucart, Horel & Laurens », sur La Menace Théoriste, 12 septembre 2020
« Les naufrageurs de la raison (et de la gauche) : réponse à Foucart, Horel et Laurens » , sur Ruptures, 23 septembre 2020
Ce livre me semble poser des problématiques très salutaires. L’exemple du lobbying de l’industrie du tabac dont on connait aujourd’hui l’histoire montre la réalité de cette menace de l’utilisation de « pseudos connaissance scientifiques » pour défendre des intérêts uniquement industriels et financiers.
Bien entendu, il n’est pas davantage possible de prendre pour vérité certaine toutes les affirmations de ce livre et il faut aussi lire la parole de la défense.
La science n’est jamais le domaine des certitudes.
<1462>
-
Vendredi 25 septembre 2020
«Un tour de France sans dopage est ce possible ?»Question posée par France CultureNotre nouveau maire de Lyon, Grégory Doucet a donc osé critiquer le Tour de France qui passait par la Capitale des Gaules. Il l’a traité de « machiste et de polluant. »
Machiste parce qu’il n’existe pas de Tour de France féminin.
 Et aussi parce qu’on demandait à deux femmes de remettre aux vainqueurs du jour leurs différents maillots (jaune, vert, à pois, etc.). Elles leur offraient alors un bouquet et une bise. Cette tradition vient d’être abandonnée, c’est désormais un homme et une femme qui remettront les tuniques et trophées.
Et aussi parce qu’on demandait à deux femmes de remettre aux vainqueurs du jour leurs différents maillots (jaune, vert, à pois, etc.). Elles leur offraient alors un bouquet et une bise. Cette tradition vient d’être abandonnée, c’est désormais un homme et une femme qui remettront les tuniques et trophées.
Et polluant !
Avec Annie, nous avons vu par hasard la fameuse caravane du Tour arriver sur les quais du Rhône à Lyon.
C’est affligeant, d’une laideur sans pareille et une invitation à une société de bullshit consommation.
Pour mettre quelques chiffres sur cette pollution qui accompagne le vélo écologique, on peut lire cet article d’Ouest France qui s’essaie à un article équilibré :
« La caravane publicitaire [c’est] : 170 véhicules qui distribuent environ 18 millions de goodies, le plus souvent des gadgets en plastique, de basse qualité, de la plus faible valeur possible et fabriqués en Chine, la plupart du temps donnés sous blister, selon Consoglobe, dont 500 000 sachets de saucisson Cochonou et 1,5 million de sachets de bonbons Haribo.
Ajoutez à cela une flotte d’environ 2 000 véhicules pour transporter équipes et matériel, 10 à 12 millions de spectateurs qui se déplacent le long des routes, dont beaucoup en camping-car, et environ 3 tonnes de déchets par ville étape »
J’ai trouvé ce reportage sur <La caravane haribo> c’est très instructif.
Pendant ce temps, dans des endroits reculés des Pyrénées il pleut des particules de plastique.
Mais le maire de Lyon a été attaqué de toute part et l’argument le plus souvent utilisé était qu’on ne peut pas critiquer un évènement aussi populaire.
Est-ce que c’est un argument ? On ne peut pas critiquer, parce que c’est populaire !
Les exécutions capitales publiques étaient aussi populaires. Mais on a eu l’intelligence d’y mettre fin, bien que ce fusse populaire.
Il était aussi populaire de boire de l’alcool sans tenir compte du fait qu’on allait prendre le volant. D’ailleurs, c’était si populaire que pendant longtemps quand on provoquait un accident en étant alcoolisé, on bénéficiait de circonstances atténuantes, parce qu’on n’était pas en possession de toute sa lucidité. Des esprits clairvoyants ont mis fin à ces pratiques et les mentalités ont évolué.
Notre président qui nous a donc révélé son opposition féroce au modèle amish, est du côté populaire : il est à 100 % pour le Tour de France.
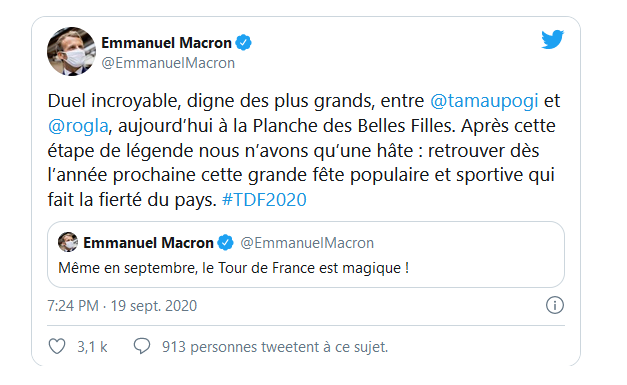 Et à la fin de l’étape, contre la montre, qui a décidé du vainqueur du tour de France, il a twitté :
Et à la fin de l’étape, contre la montre, qui a décidé du vainqueur du tour de France, il a twitté :
« Duel incroyable […] Après cette étape de légende nous n’avons qu’une hâte : retrouver dès l’année prochaine cette grande fête populaire et sportive qui fait la fierté du pays. »
Notre Président aime les vainqueurs.
Il a finalement gardé une âme d’enfant capable de s’enthousiasmer devant le spectacle qu’on lui montre.
L’ombre du doute ne l’effleure pas, est ce que le vainqueur est légitime ?
Car, si notre maire de Lyon a parlé de machisme et de pollution, il n’a pas évoqué la tricherie.
C’est très compliqué d’instiller le soupçon de la tricherie dans ce beau récit des combattants de la route qui se surpassent pour gagner un maillot jaune.
Finalement, il y a quand même eu un article dans le journal « l’Equipe » du lundi qui a suivi le triomphe du jeune slovène pour instiller le doute au milieu de toutes les pages qui magnifiaient cette grande fête populaire pour reprendre les termes du Président de la République.
C’est le journaliste et rédacteur en chef Alexandre Ross qui écrit dans l’édito dont le titre est « Jeune et insouciant »
« Remporter le tour de France, c’est gagner un lion en peluche et un paquet de suspicion »
Plus loin il se pose la question si nous somme victime d’une nouvelle supercherie pour répondre.
« Nous ne savons rien, encore une fois nous sommes perdus ».
Il est très prudent, mais au moins ose t’il poser la question.
<Ouest France> donne la parole à un ancien maillot jaune Stéphane Heulot, mais un maillot jaune qui n’a pas gagné la grande boucle :
« « Le dopage est tellement ancré chez certains managers, comme Mauro Gianetti, qu’ils ne peuvent pas concevoir le cyclisme autrement… » En 2008, le Rennais Stéphane Heulot, maillot jaune du Tour 1996, disait ceci de Mauro Gianetti, manager à l’époque de la sulfureuse Saunier-Duval, aujourd’hui homme fort de la formation UAE Team Emirates, celle du vainqueur du Tour Tadej Pogacar.
Stéphane Heulot connaissait bien Mauro Gianetti. Il avait été son équipier à la Française des Jeux, en 1998, quand le Suisse avait notamment fait son malaise après avoir absorbé du PFC (substance utilisée à titre expérimental dans les hôpitaux, proche de l’EPO). Il était resté trois jours dans le coma, en 1998). Quelques années plus tard, le Breton s’était retrouvé, par le biais de sa société HPC Événements, chargé des relations publiques pour le groupe Saunier-Duval sur le Tour, entre 2005 à 2007.
[…] Un temps éloigné du milieu, Mauro Gianetti a réussi à revenir dans le vélo il y a quelques années, devenant le patron de l’équipe UAE Team Emirates. […]
Mais quand même. Joint ce dimanche, Stéphane Heulot avoue se sentir « plus que mal à l’aise » par rapport au climat général de cette fin de Tour. Sans cibler Pogacar, le Breton se « pose des questions, forcément, comme tout le monde j’espère… » Il poursuit : « Honnêtement, je ne regarde plus le Tour depuis dimanche et la montée du Grand-Colombier (victoire de Tadej Pogacar). Je n’y arrive plus, en fait… Il y a des choses assez faciles à évaluer, quand même, en termes de performance. J’ai du mal à comprendre comment un coureur de 75 kg peut monter à une vitesse folle un col et maintenir sa montée ensuite. En terme de vitesse ascensionnelle, on a vu des trucs qui n’étaient pas possibles, non plus, pour certains… »
[…] Stéphane Heulot se sent mal lorsqu’il évoque ce Tour de France 2020. « C’est pire, même. Vous voyez l’émoticone avec l’envie de vomir, et bien je ressens ça, ça me dégoûte… »
[…] Le dopage sera là tant que des gens seront indéboulonnables. C’est comme si demain, Al Capone était ministre de la Justice… Comment se sortir de tout ça quand 80 % du staff de Jumbo-Visma vient de Rabobank et de l’époque Michael Rasmussen ? Non, ce n’est pas possible… Heureusement, des mecs ont changé, plein de mecs ont changé, mais il y a encore des tricheurs malheureusement, et il faut en avoir conscience. » »
Dans la revue de presse de <France inter> Askolovitch cite d’autres articles : …
« La Dépêche me rappelle que l’homme qui a découvert Pogacar, quand il était un gamin qui chassait les pelotons sur un vélo trop grand pour lui, s’appelle Hauptman, ancien champion slovène qui en l’an 2000 avait dû renoncer à prendre le départ du Tour de France en raison d’un taux d’hématocrite trop élevé, c’était le temps de l’EPO qui densifiait le sang des coureurs… Le Monde, implacable rappelle des affaires de dopages qui ont déjà traversé le cyclisme slovène, ces dernières années… »
Dans <Slate> la journaliste rappelle simplement que
« Certains des meilleurs grimpeurs de cette édition ont battu des records d’ascension qui avaient été établis par des coureurs dopés dans les années 2000. […]
Au sommet du col de Peyresourde dans les Pyrénées, le Slovène Tadej Pogacar a ainsi explosé le record de la montée (24 minutes 35 secondes contre 25 minutes 22 secondes) qui appartenait au très sulfureux Kazakh Alexandre Vinokourov, exclu du Tour de France 2007 après un contrôle positif à la transfusion sanguine.
Autre record inquiétant, dans la très raide montée de Marie-Blanque, toujours dans les Pyrénées, Roglic, Pogacar, Bernal et Landa, quatre des meilleurs grimpeurs de ce Tour de France de rentrée scolaire, ont grimpé 23 secondes plus vite qu’un petit groupe emmené en 2005 par Lance Armstrong, le septuple vainqueur de l’épreuve dont le nom a été effacé du palmarès pour dopage avéré. »
Il est donc possible de faire mieux sans se doper !
Lance Armstrong n’a jamais fait l’objet d’un contrôle positif pendant toutes ces années.
Comment croire qu’on ne se trouve pas aujourd’hui dans la même situation ?
<Le Parisien> cite un autre professionnel, aussi ancien maillot jaune : Romain Feillu :
« Retiré des pelotons depuis l’année dernière, Romain Feillu (36 ans) organise des stages destinés aux cyclistes chez lui en Corrèze. Durant sa carrière, l’ancien maillot jaune du Tour de France (2008) n’a jamais pratiqué la langue de bois. Alors que les performances de l’équipe Jumbo Visma du maillot jaune Roglic suscitent quelques interrogations, le sprinter aux 21 victoires pros n’a pas hésité à exprimer ses doutes publiquement avec une certaine ironie. « Quand je pense que certains s’offusquent qu’un mec de 80 kilos monte les cols plus vite que Pantani… Le maillot magique, Jumbo, les Éléphants volants! Ce n’est pas nouveau, il suffit d’y croire… », a ainsi écrit l’ancien sprinteur sur Twitter.
Des propos qu’il a précisés dans un entretien à Ouest-France : « Ceux qui connaissent le vélo savent bien que ce n’est pas normal. »
France Culture pose la question : <Un Tour de France sans dopage, est-ce possible ?>.
Dans cette émission, le journaliste David Opoczynski explique :
« Tadej Pogacar a réalisé quelque chose d’exceptionnel, de l’avis même des spécialistes. C’est ce qu’il est important de souligner : aujourd’hui, effectivement, malheureusement, le doute accompagne de façon permanente les performances des meilleurs du Tour de France (certaines performances – il ne faut surtout pas généraliser). Quand il y a des choses exceptionnelles, qu’elles sont soulevées, font l’objet de critiques, et viennent des gens du milieu, même du cyclisme là, on peut vraiment commencer à s’interroger et à analyser ces performances. »
« Pour vous donner un ordre d’idée, Tadej Pogacar a fait 1 minute 21 secondes à l’arrivée de mieux que celui qui fait deuxième. Et celui qui fait deuxième était à son meilleur niveau. Quand l’écart est plus grand, quand on est au-dessus de tous les autres, de tous les meilleurs, il peut y avoir un doute. »
L’article de Slate, déjà cité donne la parole à ancien entraîneur de l’équipe Festina, celle de Richard Virenque qui a été dopé « à l’insu de son plein gré », formule qui restera éternellement attaché à ce coureur.
Et Antoine Vayer est plus explicite :
« À la question « y a-t-il des tricheurs sur ce Tour de France? », je dis oui. À la question « sont-ils devant? », je dis oui aussi»
Le cyclisme reste un sport épatant, mais il n’est pas possible de ne pas jeter un regard lucide sur les dérives qui restent prégnants malgré des récits de conte de fée pour adultes consentants.
<1461>
-
Jeudi 24 septembre 2020
«La liberté, c’est d’abord dans nos cœurs»Abderraouf Derradji dit SoolkingLe rap ne fait pas partie de mon monde culturel. La plupart du temps quand j’entends un morceau qui se réclame de cette culture, je n’éprouve aucun plaisir à écouter et souvent cela me conduit à m’éloigner ou à changer la station de radio qui le diffuse.
Mais j’ai trouvé un morceau qui m’a parlé et m’a fait vibré.
Il s’agit de <La liberté> du rappeur algérien <Soolking>, de son vrai nom Abderraouf Derradji et qui est né en 1989 en Algérie.
C’est l’émission Mediapolis d’Olivier Duhamel du <19/09/2020> qui me l’a fait découvrir, en fin d’émission. Olivier Duhamel fait toujours une chanson en écho avec l’actualité.
 L’actualité était la condamnation du journaliste Khaled Drareni, par la justice algérienne, à deux ans de prison. Il était jugé pour « incitation à un attroupement non armé et atteinte à l’intégrité du territoire national ». Dans la réalité il couvrait tout simplement, comme journaliste, en particulier pour TV5 Monde, des manifestations contre le pouvoir.
L’actualité était la condamnation du journaliste Khaled Drareni, par la justice algérienne, à deux ans de prison. Il était jugé pour « incitation à un attroupement non armé et atteinte à l’intégrité du territoire national ». Dans la réalité il couvrait tout simplement, comme journaliste, en particulier pour TV5 Monde, des manifestations contre le pouvoir.
Le Monde dans un <Article du 15 septembre 2020> affirme que :
« La sentence, inédite par sa brutalité, a surpris et choqué journalistes, avocats et ONG, en Algérie et au-delà. »
Le Monde l’avait rencontré en février :
« Khaled Drareni se savait dans le collimateur des autorités : « Ils veulent étouffer toutes les voix divergentes et museler la presse indépendante. Il s’agit d’isoler le Hirak. Il est important de tenir et, pour les journalistes, de s’organiser », confiait-il alors. »
Le Hirak (en français « Mouvement »), désigne une série de manifestations qui ont lieu depuis le 16 février 2019 en Algérie pour protester dans un premier temps contre la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel.
Vous trouverez une description précise et documentée de ce mouvement sur une page Wikipedia <Le Hirak>
Ce mouvement que tous les observateurs ont loué pour sa maturité, son refus de la violence ainsi que la clarté des revendications : mise en place d’une vrai démocratie et mise à l’écart des apparatchiks qui monopolisent le pouvoir et les richesses économiques.
Ils ont eu des succès. D’abord le régime a renoncé à présenter Bouteflika une nouvelle fois à la présidentielle. Puis il a accepté d’écarter définitivement Bouteflika du pouvoir en organisant sa démission.
Mais par la suite le pouvoir n’a plus rien lâché en organisant une élection verrouillée qui a conduit à la désignation d’un président acceptable par la nomenklatura au pouvoir : Abdelmadjid Tebboune qui est président depuis le 19 décembre 2019.
Depuis plus rien n’a changé, les manifestations continuent même si le COVID joue un rôle négatif sur la mobilisation dans la rue, mais la répression est de plus en sévère.
Libération écrit dans un article du 18 septembre 2020 : « Khaled Drareni ou les illusions perdues du hirak algérien »
« La condamnation confirmée en appel du journaliste illustre l’intention du pouvoir algérien de dissoudre le Hirak pour survivre tel quel, sans la moindre avancée démocratique.
Il est des sujets sur lesquels chacun d’entre nous a le devoir de s’exprimer, qu’on ait un lien ou non avec le peuple algérien. En tant que citoyens, en tant qu’inlassables défenseurs de la démocratie, en tant qu’héritières et héritiers de ce long et glorieux combat pour la liberté, mené par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et tous ceux, qui se sont battus, souvent au prix de leur vie, pour un pays libre, démocratique, et indépendant.
Rien n’aura été, depuis la décennie noire, aussi réjouissant, que le hirak, lancé en 2019, victime du coronavirus en 2020. Ce mouvement pacifique et contestataire, spontané et populaire, aura réveillé la bête autocratique et militaire. Presque 60 ans après la révolution algérienne comme la nommait Frantz Fanon, voici l’Algérie, république dite « démocratique et populaire », qui retombe dans ses pires travers : arrestations arbitraires, emprisonnements pour « délit d’opinion », censure, et autres mesures dignes d’un régime autoritaire. […]
Khaled est surtout l’un de ceux qui a permis de donner au mouvement une visibilité médiatique malgré la censure du pouvoir, il a porté et diffusé la voix de tout ce peuple algérien, défilant chaque vendredi, pour libérer leur pays du carcan autocratique qui le bride depuis des décennies. Khaled est devenu un symbole, l’incarnation de tous ces manifestants, l’effigie du hirak et à ce titre, il est aujourd’hui condamné pour servir d’exemple, par un pouvoir qui rêve d’étouffer le mouvement populaire lancé depuis plus d’un an. […]
Chacun d’entre nous retient le sourire de Khaled, comme une promesse : il reviendra, continuer ce long combat. Nulle part, sur les chaînes d’information publiques contrôlées par le pouvoir, vous n’entendrez parler de Khaled. Partout, des rues algériennes aux réseaux sociaux, vous verrez, quelque part, trôner le sourire de Khaled, symbole de sa liberté d’expression. »
Ceci nous amène à la chanson de Soolking
Le Parisien dans un article de mars 2019 a écrit : « «Liberté» de Soolking devient l’hymne de la jeunesse algérienne » :
« La chanson du rappeur, véritable phénomène en Algérie, est reprise dans les rues et a dépassé les 17 millions de vues sur YouTube.
La jeunesse algérienne vient de trouver son hymne. Soolking, la méga star du pays a dévoilé, sans effet d’annonce, une chanson sobrement intitulée « Liberté », en duo avec Ouled El Bahdja. Ce titre politique poignant a été écrit en écho à la crise politique que traverse le pays. »
Le lien entre cette chanson et le mouvement date donc du début du Hirak et faire l’entendre en évoquant le journaliste Khaled Drareni est donc plein de sens.
 <Voici une interprétation de cette chanson>
<Voici une interprétation de cette chanson>
La liberté
« Paraît que le pouvoir s’achète
Liberté, c’est tout c’qui nous reste
Si le scénario se répète
On sera acteurs de la paix
Si faux, vos discours sont si faux
Ouais, si faux, qu’on a fini par s’y faire
Mais c’est fini, le verre est plein
En bas, ils crient, entends-tu leurs voix?
La voix d’ces familles pleines de chagrin
La voix qui prie pour un meilleur destin
Excuse-moi d’exister, excuse mes sentiments
Et si j’dis que j’suis heureux avec toi, je mens
Excuse-moi d’exister, excuse mes sentiments
Rends-moi ma liberté, je te l’demande gentiment
La liberté, la liberté, la liberté
C’est d’abord dans nos cœurs
La liberté, la liberté, la liberté
Nous, ça nous fait pas peur
La liberté, la liberté, la liberté
C’est d’abord dans nos cœurs
La liberté, la liberté, la liberté
Nous, ça nous fait pas peur
Ils ont cru qu’on était morts, ils ont dit « bon débarras »
Ils ont cru qu’on avait peur de ce passé tout noir
Il n’y a plus personne, que des photos, des mensonges
Que des pensées qui nous rongent, c’est bon, emmenez-moi là-bas
Oui, il n’y a plus personne, là-bas, il n’y a que le peuple
Che Guevara, Matoub, emmenez-moi là-bas
J’écris ça un soir pour un nouveau matin
Oui, j’écris pour y croire, l’avenir est incertain
Oui, j’écris car nous sommes, nous sommes main dans la main
Moi, j’écris car nous sommes la génération dorée
La liberté, la liberté, la liberté
C’est d’abord dans nos cœurs
La liberté, la liberté, la liberté
Nous, ça nous fait pas peur
La liberté, la liberté, la liberté
C’est d’abord dans nos cœurs
La liberté, la liberté, la liberté
Nous, ça nous fait pas peur
Libérez li rahi otage, libérez lmerḥouma, kayen khalel f lqada’
Libérez ceux qui sont otages, nous, c’est tout c’qu’on a
[…]
La liberté, la liberté, la liberté
C’est d’abord dans nos cœurs
La liberté, la liberté, la liberté
Nous, ça nous fait pas peur
La liberté, la liberté, la liberté
C’est d’abord dans nos cœurs
La liberté, la liberté, la liberté
Nous, ça nous fait pas peur »
Je constate donc que si un artiste a quelque chose à dire, et sait le dire bien, il arrive à me toucher même quand il s’agit de rap.
Le 21 septembre nous apprenions que le gouvernement algérien interdisait désormais la diffusion de la chaîne M6 après la diffusion d’un documentaire.
<1460>
-
Mercredi 23 septembre 2020
«De la Montagne de la stupidité au Plateau de la consolidation, en passant par la Vallée de l’humilité»Les trois étapes de l’effet Dunning-KrugerHier, j’ai parlé de ce mot imprononçable : « l‘ultracrépidarianisme »
Cette mauvaise évaluation de sa compétence personnelle ou surconfiance a été étudiée scientifiquement et a finalement fait l’objet, après une série d’expériences qu’ils ont dirigées, de la publication d’un article par les psychologues américains David Dunning et Justin Kruger en 1999.
<Wikipedia> qui comme toujours est précis, écrit :
« Leurs résultats ont été publiés en décembre 1999 dans la revue Journal of Personality and Social Psychology ».
Et c’est ainsi que depuis 1999 on parle de l’effet Dunning-Kruger.
J’aurai pu mettre cette expression effet Dunning-Kruger, en exergue du présent mot du jour, mais j’ai préféré citer les trois étapes de cet effet :
- Montagne de la stupidité
- Vallée de l’humilité
- Plateau de la consolidation
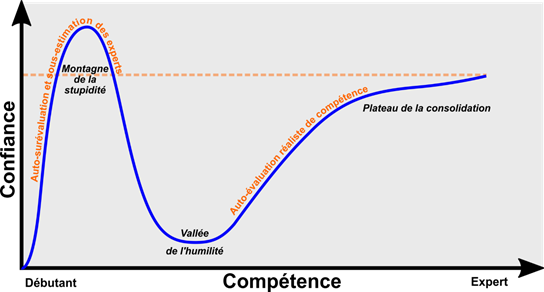
Il arrive aussi qu’on parle aussi de «surconfiance».
Ils ont démontré que les personnes non qualifiées ont plutôt tendance à surestimer leur niveau. Pendant cette période de la montagne de la stupidité, non seulement la personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence mais en outre ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent véritablement.
De manière corollaire, les personnes les plus qualifiées ont plutôt tendance à sous-estimer leur niveau de compétence.
<Etienne Klein> explique ce paradoxe par le fait qu’il faut être compétent pour mesurer l’incompétence. Ainsi l’incompétent n’a pas la qualité pour mesurer son incompétence, alors que le compétent comprend les limites de son savoir.
Ils ont donc réalisé ce tableau qui montre l’évolution dans le temps de la confiance en soi, au fur et à mesure de l’acquisition des compétences. Le tableau est très explicite, mais notons que lorsque l’acquisition de la compétence permet d’atteindre le plateau de la consolidation, la confiance ne se situe pas au niveau de la montagne de stupidité du début.
<Clément Viktorovitch > a expliqué cela très bien lors d’une émission de Canal+ –
L’article de Wikipedia ajoute une précision selon l’espace culturel des personnes observées
« Les études sur l’effet Dunning-Kruger ont surtout été réalisées sur des Occidentaux. Une étude sur des sujets est-asiatiques suggère que pour ces personnes un effet inverse (sous-estimation de sa propre valeur et motivation pour s’améliorer) pourrait être à l’œuvre ».
Cette observation doit probablement être affinée, mais si elle était confirmée elle montrerait, en moyenne, une attitude plus humble et donc plus propice à l’acquisition sérieuse de compétences de la part des sujets asiatiques.
<1459>
- Montagne de la stupidité
-
Mardi 22 septembre 2020
«Sutor, ne supra crepidam»Apelle de CosUn mot du jour court, mais plein de sens, au temps du COVID19 et d’autres incertitudes. Cette période que nous vivons et dans laquelle tant de gens deviennent compétents en moins de temps qu’il ne faut pour le dire et sur des sujets d’une diversité et d’une complexité que manifestement ils ne perçoivent pas.
J’ai entendu cette expression dans une émission de radio, mais l’explication m’a été donnée par Wikipedia auquel je viens de réitérer un don, car je crois qu’il s’agit vraiment d’une œuvre d’utilité publique dans un monde du numérique triomphant.
Apelle de Cos, était un célèbre peintre grec qui a vécu au IVe siècle av. J.-C.. Il était le contemporain d’Alexandre le Grand dont il a peint des portraits.
Aucune de ses peintures, n’a été conservée. Mais elles ont été décrites et louées par des grands écrivains anciens : Ovide, Cicéron et Pline l’ancien
Ainsi d’après Cicéron (De Officiis, III, II, 10), personne n’osa terminer la Vénus qu’Apelle peignit pour les habitants de l’île de Cos, et qu’il avait laissée inachevée en mourant :
« La beauté du visage en effet ôtait l’espoir d’y égaler le reste du corps. »
Et c’est Pline l’Ancien qui dans son ouvrage « l’Histoire naturelle » [XXXV, 851 (Loeb IX, 323–325)] raconte l’histoire de cette parole de sagesse.
Apelle, lorsqu’il exposait ses peintures à l’étal, avait coutume de se tenir derrière les tableaux et d’écouter les commentaires des passants. Il arriva un jour qu’un cordonnier critiquât la manière dont Appelle avait peint une sandale : dans la nuit qui suivit, l’artiste retoucha l’œuvre.
Le cordonnier, constatant le lendemain les changements apportés, et fier de ce que son jugement ait convaincu le peintre, se mit à critiquer d’autres points de la peinture qui lui déplaisait.
Et c’est alors que le peintre lui rétorqua :
« Sutor, ne supra crepidam »
Ce qui signifie :
« Cordonnier, pas plus haut que la sandale »
Dans d’autres versions on lit « Ne sutor ultra crepidam » (« que le cordonnier ne juge pas au-delà de la sandale »).
Ou encore « nē suprā crepidam sūtor iūdicāret » (« un cordonnier ne devrait pas donner son avis plus haut que la chaussure »).
C’est un conseil très sage qui invite de rester dans sa zone de compétence et qui s’adresse à chacun de nous.
Cette locution latine a donné naissance à un terme français « ultracrepidarianisme » qui est donc le comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets sur lesquels on n’a pas de compétence crédible ou démontrée.
Pour le reste, rien n’interdit de poser des questions pertinentes ou ingénues, mais il serait pertinent de s’abstenir de réponses, surtout péremptoires.
<1458>
-
Lundi 21 septembre 2020
«Sais-tu […] que la perdrix cacabe, que la cigogne craquette et que si le corbeau croasse, la corneille corbine ?»Fernand Dupuy, «L’albine»Je reprends donc l’écriture quotidienne d’un mot du jour. C’est une discipline exigeante, parfois difficile et particulièrement complexe dans notre monde troublé par une pandémie, par des défis encore plus considérables de la destruction en cours de la biodiversité, du dérèglement climatique, de l’amenuisement des ressources naturelles.
Pour ce faire je ne dispose que du langage, cette structure verbale qu’utilise depuis des millénaires les humains pour échanger des informations, des récits, des injonctions et même des sentiments qui eux peuvent aussi s’exprimer différemment.
Mais aujourd’hui je vais m’intéresser aux sons qui sortent des la bouche des autres animaux ou des animaux non humains. C’est encore avec le langage humain qui a nommé ces sons que je vais pouvoir évoquer ce début de langage de nos colocataires sur terre.
C’est mon amie Marianne qui m’a signalé un texte qu’elle a trouvé sur une page Facebook.
Mais j’ai aussi trouvé ce même texte sur ce blog de <Henri Girard : Auteur de romans et de nouvelles>.
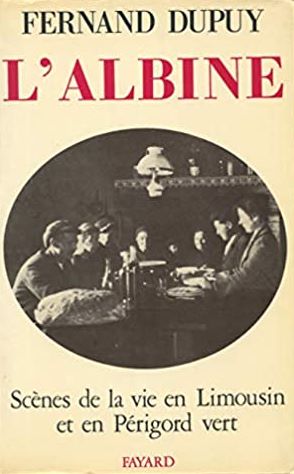 En réalité ce texte a été écrit par Fernand Dupuy dans un livre : « L’Albine, scènes de la vie en Limousin et en Périgord vert ».
En réalité ce texte a été écrit par Fernand Dupuy dans un livre : « L’Albine, scènes de la vie en Limousin et en Périgord vert ».Qui est Fernand Dupuy ?
Fernand Dupuy est né en1917 à Jumilhac-le-Grand en Dordogne à la limite du Limousin. Il sera instituteur puis résistant et s’engagera dans l’action politique. Il sera élu député et maire communiste de Choisy-le-Roi de 1959 à 1979.
Il fut aussi le secrétaire de Maurice Thorez (1948-1951) et membre du Comité central du PCF (1947-1964).
Il était aussi écrivain.
A son décès, en 1999, <L’Humanité> a écrit un hommage qui commence ainsi :
 « Celui qui ne connaît pas le plaisir de voir se lever le jour sur le clapotis de l’eau ; qui, tapi dans les herbes, n’a jamais vu une biche venir boire ; celui-là est un infirme »
« Celui qui ne connaît pas le plaisir de voir se lever le jour sur le clapotis de l’eau ; qui, tapi dans les herbes, n’a jamais vu une biche venir boire ; celui-là est un infirme »Et le journal ajoutait qu’il avait déclaré cela au Matin de Paris, en 1977.
Il a écrit des livres politiques comme « Jules Ferry, réveille-toi ! » (Fayard) et puis des livres sur la nature : « Histoires de bêtes » et « Pêcher la truite vagabonde ».
Et donc « L’Albine ». Ce livre est présenté par le site <Persée> :
« On appelle parfois Périgord Vert le pays qui prolonge au sud-ouest le plateau Limousin : même paysage de châtaigniers, de prairies plantées de pommiers et de cultures pauvres. Autour de l’Albine […] une femme de tête qui anime la vie et le travail d’une ferme de moyenne importance en Périgord Vert, dont la mentalité présente un mélange d’ouverture au progrès et d’attachement à de vieux usages et superstitions, Fernand Dupuy a tracé un vivant tableau de la vie rurale en ce pays ; il montre les profondes transformations survenues dans les trente dernières années. Dans ce pays où la scolarisation s’est poursuivie avec retard, les transformations ont été d’autant, plus lentes. »
Voici donc le langage des autres animaux, les animaux non humains :
« Sais-tu que le chien aboie quand le cheval hennit ?
Que beugle le bœuf et meugle la vache,
Que l’hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage.
Que les moineaux piaillent, le faisan et l’oie criaillent quand le dindon glousse.
Que la grenouille coasse mais que le corbeau croasse et la pie jacasse.
Et que le chat comme le tigre miaule, l’éléphant barrit, »L’hirondelle gazouille, mais les animaux humains le font aussi sur ce réseau social qui a pour nom anglais : « Twitter ». Je vous donne ci-dessous quelques exemples de la polémique sur la 5G et le modèle amish
 « Que l’âne braie, mais que le cerf rait. »
« Que l’âne braie, mais que le cerf rait. »Mais enfin, le cerf brame allez vous me dire ! Oui, mais il rait aussi, du verbe <réer>.

Mais que pourrait nous dire ce cerf victime de ce jeu qu’ont inventé les homos sapiens : la chasse à courre.
« Que le mouton bêle évidemment et bourdonne l’abeille, brame la biche quand le loup hurle. »
Nous sortons masqués en ce temps de COVID. Certains ne sont pas d’accord et utilisent pour expliquer leur désaccord la comparaison avec ce pauvre animal bêlant qui se laisse faire. « Nous ne sommes pas des moutons » devient le cri de ralliement.
« Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ?
Que si le canard nasille, les canards nasillardent,
Que le bouc ou la chèvre chevrote,
Que le hibou hulule mais que la chouette, elle, chuinte,
Que le paon braille et que l’aigle trompette. »Mais Donald Trump, qui semble être un animal humain chevrote t’il ? ou chuinte t’il ? quand il affirme ça finira bien par se refroidir ?
« Sais-tu encore ?
Que si la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule, que la perdrix cacabe, que la cigogne craquette et que si le corbeau croasse, la corneille corbine, et que le lapin glapit quand le lièvre vagit ».Les humains aussi peuvent roucouler. Mais les humains ont créé des séparations, des groupes et des communautés dont il ne faut pas sortir pour roucouler. Ainsi une famille bosniaque et de confession musulmane n’a pas toléré qu’une de ses femmes, veuille se marier avec un serbe chrétien
« Tu sais tout cela ? Bien.
Mais sais-tu ?
Que l’alouette grisolle,
Tu ne le savais pas ? Et, peut-être, ne sais-tu pas davantage
que le pivert picasse. C’est excusable !
Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère
Tu ne sais pas non plus (peut-être…) que la huppe pupule. (Et je ne sais pas non plus si on l’appelle en Limousin la pépue parce qu’elle pupule ou parce qu’elle fait son nid avec de la chose qui pue.)
Qu’importe ! Mais c’est joli : la huppe pupule ! »Le chameau blatère ! Je ne le savais pas. Les humains déblatèrent plutôt. Le dictionnaire du CNRS explique que ce verbe déblatérer signifie ; « parler avec violence et prolixité contre quelque chose ou contre quelqu’un. » . Ce verbe vient du latin deblaterare « dire en bavardant à tort et à travers ». Verbe latin qui vient de blaterare « causer de quelque chose ». Le chameau causerait-il de quelque chose ?
Et voici la fin toute poétique de ce texte :
« Et encore sais-tu ?
Que la souris, la petite souris grise : devine ? La petite souris grise chicote ! Hé oui !
Avoue qu’il serait vraiment dommage d’ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de ne pas savoir, que le geai cajole ! »C’était un texte de Fernand Dupuy (L’Albine, scènes de la vie en Limousin et en Périgord vert).
<1457>
-
Vendredi 4 septembre 2020
«Les autres œuvres de 1828»Franz SchubertMe voilà donc à la fin de ce que je ne peux pas désigner sous le terme de butinage mais bien davantage d’un approfondissement.
Je connais bien et j’aime particulièrement la musique de Schubert que j’ai beaucoup pratiqué au cours de mes presque 50 ans de mélomanie. Mais quand on écoute une œuvre il est rare que la première question que l’on se pose soit de se demander en quelle année, elle a été écrite.
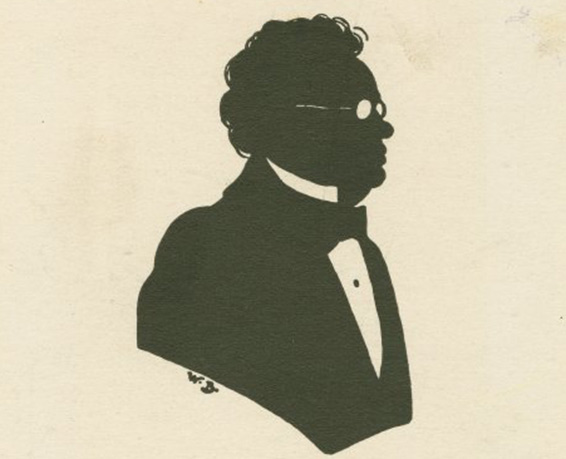
Mon cheminement est parti d’une phrase qui m’avait marquée. Phrase qu’avait prononcée Benjamin Britten et que j’avais entendu lors d’une émission d’une radio suisse.
Cette phrase, cette affirmation est la suivante :
« L’année 1828 est l’année la plus féconde de l’Histoire de la musique occidentale, parce que ce fut la dernière année de la vie de Schubert pendant laquelle il a écrit tant de chef d’œuvres.»
J’ai donc voulu me confronter à cette affirmation.
En réalité, il s’agit des 10 premiers mois de l’année 1828. Il est mort le 19 novembre, et les derniers jours, il était trop malade pour composer.
J’ai d’abord grâce au catalogue Deutsch que l’on trouve sur <Internet> et la monumentale biographie de Schubert par Brigitte Massin, pu faire la liste de toutes les œuvres de cette année-là.
Liste qui commence par le Lied « Lebensmut », « Courage de vivre » traduit wikipedia, je préfère « force de vie ». C’est un poème de Ludwig Rellstab, l’auteur des premiers poèmes du « chant du cygne D. 957». Schubert ne mettra en musique que le début du poème, ce qui en fait un lied très court d’une minute.

C’est encore troublant que la première œuvre de cette année qui sera la dernière de sa courte vie soit un hymne à la vie, le poème évoque le bruissement d’une source de vie : « Rauschet der Lebensquell ».
Et qui finit avec les œuvres D. 965 que j’ai évoqué lors du mot du jour du <vendredi 28 août 2020> dont l’extraordinaire « Le pâtre sur le rocher D 965. »
Je connaissais la plupart de ces œuvres, mais je ne les connaissais pas toutes.
J’ai dû en acheter certaines comme cette <Fugue D.952> qui a été écrite à l’origine pour orgue, seule œuvre pour orgue de Schubert. Mais elle est aussi jouée dans une version de piano à quatre mains. Je ne l’ai trouvé enregistré que sous cette forme
Grâce aux techniques modernes numériques, j’ai pu ainsi constituer un album spécifique de toutes ces œuvres dans l’ordre du catalogue Deutsch du D.937 au D.965A.
Deux œuvres ont été perdues
- Un chœur D. 941 mais Schubert a écrit deux autres versions sur le même texte D. 948 et D. 964 que l’Histoire a conservé et qui sont enregistrées.
- Une œuvre de piano D. 944A
Tout au long de l’écriture de cette série, j’ai écouté et réécouté toutes ces œuvres. Certaines de très nombreuses fois et dans plusieurs versions. Je crois pouvoir dire que je suis rempli par ces œuvres de 1828.
Schubert a écrit des chefs d’œuvre avant 1828 et toutes les œuvres de 1828 ne sont pas des chefs d’œuvre.
Cependant, les 10 œuvres que j’ai présentées dans des mots du jour spécifiques constituent des sommets au Panthéon des œuvres musicales occidentales.
- La fantaisie pour piano à quatre mains D. 940, avec laquelle cette série a débuté, est la plus belle œuvre pour piano à quatre mains du répertoire.
- Il n’y a pas d’équivalent du quintette en ut D. 956 pour deux violoncelles
- Il n’y a pas plus exceptionnel que les trois dernières sonates de piano D. 958, D. 959 et D. 960. Les dernières sonates de Beethoven sont à ce niveau, mais pas au-dessus
Nous sommes dans ces sommets pour les autres œuvres : le chant du cygne D. 957, la symphonie en ut D. 944, la Messe en mi D. 950, les 3 Klavierstücke D. 946 et l’unique « Pâtre sur le rocher D. 965 ».
Les autres œuvres de 1828 sont au nombre de 20 dont les deux qui ont été perdus, il en reste 18. En voici la liste sous forme de tableau.
D.
Titre
Effectif
Notes
1 937
Lebensmut (« Courage de vivre ») Voix, piano poème de Rellstab (fragment) 2 938
Winterabend (« Soir d’hiver ») Voix, piano poème de Leitner 3 939
Die Sterne (« Les étoiles ») Voix, piano poème de Leitner 4 941
Hymnus an den Heiligen Geist (« Hymne au Saint Esprit ») 2 ténors, 2 basses poème de Schmidl (perdu) 5 942
Mirjam’s Siegesgesang (« Chant de victoire de Myriam ») Soprano, chœur, piano poème de Grillparzer 6 943
Auf dem Strom (« Sur la rivière ») Voix, cor / violoncelle, piano poème de Rellstab 7 944 A
Danse allemande Piano perdue 8 945
Herbst (« Automne ») Voix, piano poème de Rellstab 9 947
Allegro Piano à 4 mains « Lebensstürme » 10 948
Hymnus an den Heiligen Geist (« Hymne au Saint Esprit ») 2 ténors, 2 basses, chœur poème de Schmidl (deuxième version, cf. D. 941) 11 949
Widerschein (« Reflet ») Voix, piano poème de Schlechta (deuxième version, cf. D. 639) 12 951
Rondo Piano à 4 mains 13 952
Fugue Orgue ou piano à 4 mains 14 953
Psaume XCII Baryton, chœur Chant pour le sabbat sur un texte en hébreu 15 954
Glaube, Hoffnung und Liebe (« Foi, espérance et charité ») Chœur, vents Poème de Friedrich Reil 16 955
Glaube, Hoffnung und Liebe (« Foi, espérance et charité ») Voix, piano Poème de Kuffner 17 961
Benedictus Solistes, chœur, orgue, orchestre Second Benedictus pour la Messe, D. 452 18 962
Tantum ergo Solistes, chœur, orgue, orchestre 19 963
Offertoire (« Intende voci ») Ténor, chœur, orchestre 20 964
Hymnus an den Heiligen Geist (« Hymne au Saint-Esprit ») 2 ténors, 2 basses, chœur d’hommes, vents Poème de Schmidl (troisième version, cf. D. 941 et D. 948) Beaucoup sont des chœurs. Schubert fut le grand maître du lied mais il fut aussi le plus grand compositeur de chœurs de l’Histoire.
Les 4 avant-dernières œuvres, c’est-à-dire avant le D. 965 sont des chœurs, des chœurs de musique sacrée.
J’ai déjà évoqué le chœur D. 961, qui est en fait une seconde version du Benedictus de sa Messe N°4, dans le mot du jour consacré à la Messe en mi D. 950.
L'<Offertoire (« Intende voci ») D. 963> est une œuvre très belle.
Et Schubert a même écrit lors de cette année une œuvre destinée à la synagogue de Vienne. Ce fut probablement une commande et fut écrite pour Salomon Sulzer, réformateur du chant religieux juif.
C’est un psaume qui est <Un cantique pour le jour du Sabbat D. 953> pour baryton et chœur. Brigitte Massin écrit :
« En dépit de quelque recherche dans l’ornementation du style, l’œuvre obéit à un parti pris de pureté et de simplicité »
Brigitte Massin, Schubert, page 1253
 Et puis je privilégierai trois œuvres
Et puis je privilégierai trois œuvres
- <Rondo D. 951>, pour piano à 4 mains, cette œuvre clos la série des trois œuvres de pianos à 4 mains de l’année 1828, la fabuleuse Fantaisie D. 940, puis un Allegro D. 947 et Brigitte Massin pose cette question :
« On peut se demander si […] ce rondo n’aurait pu finir le mouvement final d’une sonate qui commencerait avec l’allegro. […] Ce serait la réponse heureuse et épanouie à l’impulsion vitale libérée dans l’Allegro. Mais le Rondo admirablement construit et équilibré, n’en est pas moins une œuvre qui se suffit à elle-même. »
Page 1247
Je vous invite à écouter cette œuvre dans une interprétation qui associe <Martha Argerich et Daniel Barenboïm>
- Le lied « Auf dem Strom » (sur le fleuve) D. 943, est encore sur un poème de Rellstab, l’auteur des 7 premiers lieder du cycle du « Chant du cygne ». Et Schubert va ajouter au piano, un cor (quelquefois le cor est remplacé par un violoncelle) pour accompagner la voix créant ainsi un précédent à son chef d’œuvre presque final du pâtre sur le rocher avec la présence de la clarinette. C’est encore une œuvre d’une rare qualité, avec un équilibre entre la voix et les instruments admirablement dosé.
- Et le lied « Herbst » (Automne) D. 945 toujours de Rellstab, avec un accompagnement évocateur et d’une subtilité qui n’appartient qu’à Schubert.
Peut être que certains lecteurs attentifs s’étonneront-ils que deux des œuvres que j’ai évoqués lors du mot du jour sur les dernières œuvres ne soient pas présents ici.
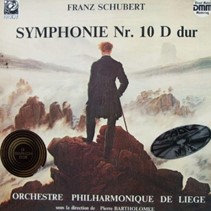 Je veux parler de la 10ème symphonie et de l’Opéra le « Comte de Gleichen ». Mais ces deux œuvres sur lesquels Schubert a travaillé dans ses derniers jours sont restés inachevés et à l’état d’esquisse.
Je veux parler de la 10ème symphonie et de l’Opéra le « Comte de Gleichen ». Mais ces deux œuvres sur lesquels Schubert a travaillé dans ses derniers jours sont restés inachevés et à l’état d’esquisse.
Les esquisses de la 10ème symphonie ont été retrouvés et publiés en 1978. Il a fallu lui trouver un numéro intermédiaire : 936A soit juste avant le commencement officiel de l’année 1828 : D. 937.
Quant au Comte de Gleichen , il fut classé dans la période dans laquelle Schubert a commencé à le composer en 1827, son numéro est D. 918.
Des musicologues ont tenté d’achever ces deux œuvres et ils ont même été enregistrés.
Il y a plusieurs enregistrements de la 10ème symphonie. J’ai acheté la version de l’Orchestre Philharmonique de Liège, sous la direction de Pierre Bartholomée. Chaque version est différente, puisque les musicologues n’ont pas fait les mêmes choix pour compléter l’œuvre. Ce que l’on entend n’est donc qu’une idée de ce qu’aurait pu devenir l’œuvre si Schubert avait pu la conduire à son terme.
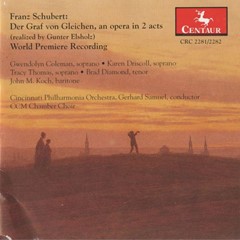 Pour « le Comte de Gleichen », il n’existe à ma connaissance qu’une seule version réalisée par un ensemble de Cincinnati que j’ai acquis également.
Pour « le Comte de Gleichen », il n’existe à ma connaissance qu’une seule version réalisée par un ensemble de Cincinnati que j’ai acquis également.
Si je dois donner mon avis, ces deux œuvres ne sont pas du niveau des œuvres de Schubert de 1828.
Les musicologues qui ont retravaillé ces œuvres sont certainement très érudits et talentueux mais ils n’ont pas le génie de Schubert.
 On trouve alors de ci de là quelques mélodies ou idées intéressantes, mais rien qui n’élève l’âme ou nous fait vibrer dans les profondeurs.
On trouve alors de ci de là quelques mélodies ou idées intéressantes, mais rien qui n’élève l’âme ou nous fait vibrer dans les profondeurs.
Ce sont des curiosités mais qui n’ont pas leur place dans cette collection inestimable des œuvres de 1828.
<1456>
- Un chœur D. 941 mais Schubert a écrit deux autres versions sur le même texte D. 948 et D. 964 que l’Histoire a conservé et qui sont enregistrées.
-
Mardi 1 septembre 2020
«Le quintette en ut pour deux violons, alto et deux violoncelles D. 956»Franz SchubertEt Schubert composa cette œuvre qu’on désigne souvent sous le nom du quintette pour deux violoncelles.
En matière d’art, surtout quand nous nous situons à des sommets, il n’est pas possible de hiérarchiser, de faire un classement.
Comparer Rembrandt et Van Gogh pour dire qui est le plus grand n’a pas de sens.
Et à l’intérieur des œuvres de Rembrandt dire que la « Ronde de nuit » ou « La fiancée juive» est sa plus grande œuvre n’a pas davantage de pertinence.
 Il n’est donc pas possible de désigner la plus grande œuvre de Schubert.
Il n’est donc pas possible de désigner la plus grande œuvre de Schubert.
Cependant si je m’adonne à ce jeu qui consiste à désigner le disque de musique unique que j’aurai le droit d’emporter sur une île déserte, je n’ai pas beaucoup de doute. Depuis mes 20 ans jusqu’à présent, ma réponse est toujours la même : « Le quintette en ut D 956 de Schubert, écrit au courant de l’été 1828 et terminé en septembre. »
Christine Mondon parle de l’opus magnum.
« Que dire du Quintette pour cordes (D956), l’opus magnum de la musique de chambre ? […] Ce quintette appelle au recueillement, à une écoute ressentie et éprouvée en profondeur. »
Christine Mondon : « Franz Schubert, Le musicien de l’ombre », pages 225
Marcel Schneider cite Schumann qui exalte la qualité des Trios pour violon, violoncelle et piano de Schubert, pour ajouter :
« Il me semble pourtant que Schubert a réussi à pousser l’aventure encore plus loin et à donner l’œuvre la plus accomplie de ce que qu’on peut appeler la fusion du lyrisme dans la musique de chambre avec son Quintette en ut pour deux violoncelles, qu’il écrivit en août septembre 1828. […] Comme il ne fut publié qu’en 1853, Schumann en a-t-il pris connaissance ? […] »
Schubert, Marcel Schneider, collection Solfèges, page 135
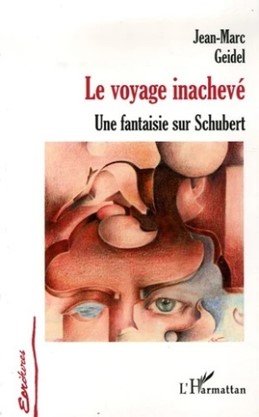 Jean-Marc Geidel est un médecin, mais aussi un passionné de musicologie et de Schubert. Il a écrit un roman : « Le Voyage inachevé – Une fantaisie sur Schubert. » publié par les éditions de l’Harmattan. Le quintette en ut occupe une position centrale dans ce livre. Interviewé par Resmusica « Il y a la musique, et il y a Schubert » que je vous invite à lire, il dit :
Jean-Marc Geidel est un médecin, mais aussi un passionné de musicologie et de Schubert. Il a écrit un roman : « Le Voyage inachevé – Une fantaisie sur Schubert. » publié par les éditions de l’Harmattan. Le quintette en ut occupe une position centrale dans ce livre. Interviewé par Resmusica « Il y a la musique, et il y a Schubert » que je vous invite à lire, il dit :
« Il y a trente ans, je considérais déjà le quintette à deux violoncelles comme étant la plus belle œuvre jamais écrite parmi celles que je connaissais. »
Et il ajoute des paroles qui résonnent en moi :
« […] L’émotion que j’écoute en écoutant Schubert est d’une autre sorte que celle que me procure en général la musique. Pourtant les immenses trésors du Quintette se réduisent à une simple partition. Il y a là quelque chose d’irréductible à la raison, d’aussi mystérieux que l’amour. L’amour ce n’est pas simplement de l’amitié en mieux ou en plus fort. Il y a un saut qualitatif, un changement de nature du sentiment. Les émotions que l’on ressent sont de l’ordre de l’énigme. Elles ont trait à notre être profond dans ce qu’il a de plus impénétrable. Comme on est dans le domaine de l’ineffable, les mots semblent toujours trop étroits ou un peu à côté. En exergue du livre de Brigitte Massin, consacré à Schubert en 1977, on pouvait lire ce jugement de Max Jacob, à propos d’Apollinaire : « Il ne comprend rien à la musique, il n’aime que Schubert ». On sent qu’il y a chez Schubert quelque chose qui est de l’ordre du défi à la musique, comme il y a chez les « amoureux de Schubert » une sorte de défi à l’académisme musical. »
La musique de Schubert constitue un mystère. Le plus souvent et particulièrement pour le quintette, c’est une musique qui immédiatement vous touche et vous parle. Pourtant du point de vue de la technique et même de la science musicale, les spécialistes ont du mal à expliquer, à justifier et simplement à comprendre.
On pourrait penser que cette phrase « Il ne comprend rien à la musique, il n’aime que Schubert » constitue un jugement péremptoire d’un esprit embrumé dans un moment d’égarement.
Mais on lit que Pierre Boulez a eu ce jugement :
« Si Schubert a écrit une seule note de musique, cela veut dire que je n’ai rien composé du tout. »
A mon humble avis, si on prend cette phrase au premier degré, je pense que c’est la deuxième proposition qui est la plus vraisemblable.
Lors d’une tribune des disques consacrée au quintette j’ai entendu un critique, dont j’ai opportunément oublié le nom, affirmer que cette œuvre était mièvre. Expression que le Larousse définit par les mots de fade et affecté.
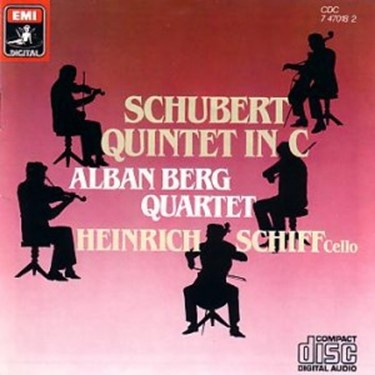 Dans le livret qui accompagne la très belle version du quintette par le quatuor Alban Berg et Heinrich Schiff, le musicologue Philippe Andriot explique :
Dans le livret qui accompagne la très belle version du quintette par le quatuor Alban Berg et Heinrich Schiff, le musicologue Philippe Andriot explique :
« Si les mots sont généralement bien pauvres pour donner une idée de la musique, dans le cas d’œuvres de la nature du Quintette en Ut majeur de Schubert, ils semblent non seulement hors de proportion mais presque insignifiants. […] il n’est pas de compositeur qui ait davantage prêté à la confusion des analyses. […] Quant à l’œuvre elle-même, un siècle et demi après, elle est encore l’objet d’analyses divergentes, contradictoires même, parfois de confusions, et n’a en tout cas pas acquis cette homologation inattaquable qui lui ouvrirait les oreilles et les cœurs comme elle les ouvre à la moindre page d’un Bach ou d’un Beethoven. C’est quelle porte en elle un élément rebelle à l’analyse, non seulement rebelle, mais qui interdit toute classification facile, se refuse à toute assimilation confortable, entraîne la création dans une fuite éperdue au moment où l’on croit pouvoir en définir les bornes. Cet élément qu’aucun compositeur n’a possédé en un tel état de pureté, c’est le rêve. Un rêve qui, bien sûr, débouche directement sur un ailleurs illimité. « J’ai parfois l’impression de ne pas appartenir à ce monde » aurait dit Schubert. Un rêve qui ne peut s’épanouir complétement sans aborder des domaines lointains, inexplorés, mystérieux. »
Si on essaye de replacer cette œuvre dans l’histoire de la musique occidentale et plus précisément la musique de chambre, il faut rappeler que depuis Haydn, le cœur de la musique de chambre pour cordes se trouve dans la forme du quatuor à cordes : deux violons, alto, violoncelle.
C’est dans cette forme que Beethoven a composé ses plus grands chefs d’œuvre. Haydn, Mozart, Chostakovitch, Debussy, Ravel et Dutilleux ont aussi écrit des quatuors à cordes inoubliables.
Schubert en a écrit de très beaux et deux chefs d’œuvres : Le quatuor N°14 « La jeune fille et la mort » D. 810 et son dernier quatuor à cordes N°15 D. 887, tous les deux terminés en 1826. Les deux liens renvoient vers des interprétations exceptionnelles le 14 par l’Alban Berg quartett et le premier mouvement du 15 par le Quatuor Belcea.
Autour de cette forme idéale, se sont construits d’autres formes et notamment des quintettes.
Les quintettes avec piano dans lesquelles le compositeur ajoute un piano au quatuor à cordes. Cette forme a aussi donné naissances a des œuvres admirables de Schumann, Brahms, Dvorak, Franck, Chostakovitch.
Et Schubert a écrit un quintette avec piano. Mais là comme pour le quintette en ut, il a été disruptif.
En effet, dans le quintette de la truite D. 667 composé en 1819, à 22 ans ! Schubert a exclu le second violon et a ajouté une contrebasse.
Pour renforcer les basses et apporter un autre équilibre à l’ensemble.
Pour le quintette en ut, il n’a pas non plus suivi les normes en usage. C’est Mozart qui a donné ses lettres de noblesse au quintette à cordes, il en a composé 6 dont deux merveilles (K 515 et 516), en ajoutant un second alto au quatuor à cordes. Brahms va reprendre cette formule pour composer ses deux beaux quintettes à cordes.
J’avais lu qu’avant Schubert, Luigi Boccherini (1743-1805) avait inventé le quintette avec deux violoncelles. Plein d’espoir j’ai acheté un coffret prétendant regrouper les principaux quintettes de Boccherini. J’ai été très déçu, c’est d’un ennui…
Dans le D. 956 de Schubert, dès les premières mesures on entre dans un monde d’émotion et de temps suspendu.
Voici ce début par <Le quatuor Ebène et Gautier Capuçon>
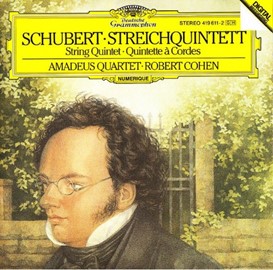 Volker Scherliess dans le livret accompagnant une des meilleures versions de cette œuvre, la dernière version du quatuor Amadeus avec Robert Cohen, écrit :
Volker Scherliess dans le livret accompagnant une des meilleures versions de cette œuvre, la dernière version du quatuor Amadeus avec Robert Cohen, écrit :
« Le début est déjà inexplicable, mystérieux : la tonalité fondamentale ut majeur est transformée dès le deuxième accord, passant à l’ut mineur pour revenir ensuite au majeur. De telles tensions qui tantôt se voilent, tantôt se dévoilent, sont fréquentes dans ce quintette. En donner une explication de technique, compositionnelle n’avance guère. »
La beauté ne s’explique pas, l’entrelacement des différentes voies ouvre à chaque moment d’autres perspectives qui sont autant de respiration de l’ineffable.
Et après ce mouvement où on pense qu’on a atteint les sommets ultimes, vient l’adagio. Marcel Schneider écrit à propos de l’Adagio ;
« Cette fois, le développement est d’une simplicité absolue : la grandeur de l’inspiration, la profondeur du sentiment sont telles que Schubert n’a pas eu besoin de recourir aux subtilités de la technique. Les instruments jouent souvent à l’unisson, les reprises sont nombreuses : seul un interlude plus violent vient rompre l’atmosphère de douceur, de sérénité divine, de tristesse impalpable qui baigne tout l’adagio. On admire que Schubert ait osé concevoir un mouvement qui dût si peu à la science et tant à l’effusion lyrique et qui ainsi fait, pût soutenir la comparaison avec les plus nobles œuvres de la musique »
Schubert, Marcel Schneider, collection Solfèges, page 136
Françoise Dolto a écrit un livre admirable sur la solitude : « Solitude ». A la fin de son ouvrage, un chapitre : « La mort : clameurs et chuchotements » commence ainsi :
« Solitude, pour nous vivants, pleins de sève, tu es, épreuve insolite d’être sans savoir, qui nous fait languir d’un visage en qui nous connaître, avec qui nous reconnaître et découvrir par-delà nos dissemblances et nos différences, par-delà nos séparations dans le temps et l’espace, la joie de la communication, l’ardeur d’un vivre qui, dans chacun de nos corps, à ses besoins, à ses limites réduit est à sa détresse confiné ».
C’est un ouvrage exigeant mais en introduction Françoise Dolto donne une clé :
« Alors, ceux qui comme Don Juan, n’apprécient ni le papier, invention des guêpes cartonnières, ni les longs discours, s’ils veulent toutefois apprendre un peu sur Solitude – Soledad, peuvent, à la place, écouter avec un plaisir infini l’Adagio du Quintette à cordes de Schubert … »
 Voici l’adagio par <le Quatuor Parisii et Emmanuelle Bertrand> enregistré le 23 juin 2020 par France Musique.
Voici l’adagio par <le Quatuor Parisii et Emmanuelle Bertrand> enregistré le 23 juin 2020 par France Musique.
Arrivé à ce niveau d’émotion, il faut redescendre. Le troisième mouvement, le scherzo emprunte un caractère orchestral, ce qui signifie qu’on peut penser parfois que les cinq musiciens constituent un orchestre au complet. Une impression de tempête se dégage parfois dans des harmonies somptueuses interrompu par le trio que Marcel Schneider décrit ainsi
[Le trio] fait entendre une étrange musique, « languissante et funèbre » eut dit Gérard de Nerval, où les instruments sont employés dans leur registre le plus grave, et qui s’oppose à la vivacité du scherzo […] de sorte que la reprise du scherzo prend un accent angoissé que n’avait pas l’exposition »
Schubert, Marcel Schneider, collection Solfèges, page 136
Puis, le quatrième mouvement est par contraste beaucoup plus léger. Marcel Schneider écrit :
« Le final, allegretto, qui revient au ton principal, ramène à la légèreté. Nouvelles surprises : nous nous attendions à une autre fin, mais soit que Schubert veuille affirmer une joie ingénue qu’il ne possède plus de puis 1823, soit qu’il espère se concilier les puissances qu’il ne faut pas nommer en agissant comme un musicien que ne tourmentent pas les soucis, soit enfin que par modestie il décide de terminer de façon ordinaire cette œuvre extraordinaire, il nous offre une conclusion d’allure populaire, sans prétention, qui évoque les réunions amicales des tavernes viennoises, comme si, après avoir plongé dans les ténèbres de son âme et nous en avoir révélé les mystères, Schubert voulait remonter à la surface et nous laisser le souvenir de son apparence habituelle, comme si les angoisses, les nostalgies et les visions célestes du Schubert des heures solitaires cédaient le pas à l’image qu’offrait l’homme extérieur.»
Schubert, Marcel Schneider, collection Solfèges, page 136
Je laisse la conclusion à ce même auteur :
« Le Quintette en ut appartient à la musique de chambre, mais il est aussi autre chose : une intuition de l’au-delà, un fragment de la musique ininterrompue du monde. »
Schubert, Marcel Schneider, collection Solfèges, page 167
Pour cette œuvre non plus, Schubert ne verra ni sa première exécution publique, ni son édition. La première aura lieu le 17 novembre 1850 au Musikverein de Vienne par le Quatuor Hellmesberg et le violoncelliste du théâtre impérial Josef Stransky. L’œuvre sera publiée sous le n° d’opus 163 en 1853 par la maison viennoise de C. A. Spina, successeur du célèbre éditeur Anton Diabelli, qui avait publié en 1838 les trois dernières sonates pour piano de Schubert D. 958 à D. 960.
Actuellement, l’édition du Quintette de 1853 constitue la source connue la plus ancienne, son autographe étant introuvable.
Il est possible de trouver sur Internet de très belles interprétations :
D’abord un enregistrement de 2018 du <Quatuor Emerson et du violoncelliste David Finckel>
Puis une version fougueuse de jeunes musiciens entrainés par la flamboyante <Janine Jansen>
Et une <troisième> qui montre une rencontre étonnante de cinq musiciens membres de cinq quatuors à cordes parmi les plus réputés :
- Norbert Brainin, Quatuor Amadeus, premier violon
- Earl Carlyss, Quatuor Juilliard, second violon
- Piero Farulli, Quartetto Italiano, alto
- Stefan Metz, Quatuor Orlando, premier violoncelle
- Valentin Berlinsky, Quatuor Borodin, second violoncelle
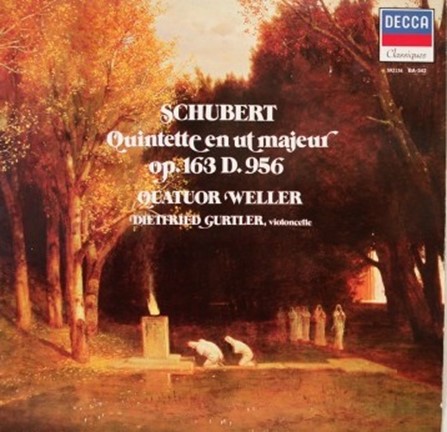 Et pour les enregistrements audiophiles, j’ai déjà évoqué plusieurs interprétations de ce quintette, mais j’ai gardé pour la fin ce choix éminent et subjectif du disque de l’ile déserte.
Et pour les enregistrements audiophiles, j’ai déjà évoqué plusieurs interprétations de ce quintette, mais j’ai gardé pour la fin ce choix éminent et subjectif du disque de l’ile déserte.
Il s’agit pour moi de l’interprétation viennoise du Quatuor Weller avec Dietfried Gürtler.
Ce n’est pas l’interprétation avec laquelle j’ai découverte l’œuvre. Cette découverte je la dois à mon frère Gérard qui avec l’ensemble auquel il participait, l’Octuor de Paris, a joué dans les lieux de concert les plus réputés du monde et ainsi a également joué au Festival Prades qui a été créé par Pablo Casals et avec lequel notre premier ministre actuel Jean Castex a un lien particulier.
Et c’est en revenant de ce festival que Gérard m’a fait découvrir l’enregistrement réalisé pendant un festival précédent par Pablo Casals, Isaac Stern, Alexander Schneider, Milton Katims et Paul Tortelier.
Mais immédiatement après j’ai « rencontré » l’interprétation intemporelle du Quatuor Weller.
Pour finir, je voudrais quand même balayer les propos stupides de Pierre Boulez par l’avis éclairé d’un autre compositeur contemporain et chef d’orchestre émérite : Hans Zender (1936-2019) :
« Les dernières œuvres de Schubert contiennent des germes qui ne s’épanouiront que des décennies après leur mise au jour, chez Anton Bruckner, Hugo Wolf, Gustav Mahler »
C’est bien sûr lui qui a raison. On peut être intelligent comme Boulez, mais être aveuglé par son dogmatisme. Boulez qui n’aimait pas non plus Chostakovitch et Britten qui eux adoraient Schubert.
<1455>
- Norbert Brainin, Quatuor Amadeus, premier violon
-
Vendredi 28 août 2020
«La dernière œuvre D. 965»Franz SchubertC’est encore mon père qui m’a guidé vers cette œuvre :
« Ecoute-bien Alain, c’est la dernière œuvre de Schubert »
« Le pâtre sur le rocher D 965» en allemand « Der Hirt auf dem Felsen ».
C’est un lied mais auquel Schubert a ajouté, de manière disruptive dirions-nous aujourd’hui, une clarinette.
Dès le premier mot du jour de cette série, en m’appuyant sur le fameux catalogue Deutsch qui a réalisé, autant que possible, le classement chronologique des œuvres de Schubert, j’affirmais que les œuvres de 1828 occupent les numéros de 937 à 965. Il est donc bien clair que l’œuvre portant le numéro D. 965 constitue la dernière œuvre de Schubert.
C’est une œuvre absolument magnifique.
Brigitte Massin la décrit ainsi :
« Mais le Pâtre sur le rocher n’est pas à proprement parler un lied. C’est un petit air de concert. Il a été commandé par Anna Milder-Hauptmann à Schubert, et elle ne le recevra que quelques mois après la mort du compositeur »
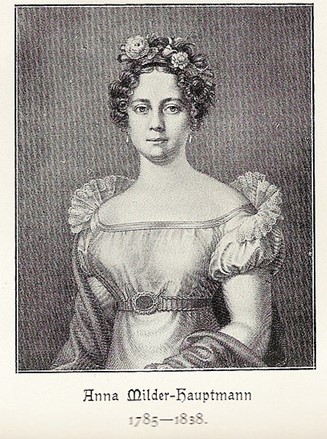 Anna Milder-Hauptmann (1785 – 1838) était une grande cantatrice d’opéra en ce début du XIXème siècle. C’est elle qui créa le rôle-titre de la Léonore de Beethoven, première version de Fidelio seul opéra de Beethoven. Et c’est aussi elle qui fut choisie par Mendelssohn pour chanter la partie soprano lors de la première interprétation depuis la mort de Bach de la Passion selon Saint Matthieu, le 11 Mars 1829 à Leipzig.
Anna Milder-Hauptmann (1785 – 1838) était une grande cantatrice d’opéra en ce début du XIXème siècle. C’est elle qui créa le rôle-titre de la Léonore de Beethoven, première version de Fidelio seul opéra de Beethoven. Et c’est aussi elle qui fut choisie par Mendelssohn pour chanter la partie soprano lors de la première interprétation depuis la mort de Bach de la Passion selon Saint Matthieu, le 11 Mars 1829 à Leipzig.C’était donc une des plus grandes chanteuses de son époque et elle n’ignorait rien du talent de Schubert dans le domaine du Lied. Elle était d’ailleurs une de ses amies.
Ce lied est constitué par l’amalgame de deux poètes la partie la plus importante du texte (le début et la fin) a été écrite par le poète Wilhem Müller qui est aussi l’auteur de la Belle meunière et du Voyage d’hiver, la partie centrale a été écrite par Karl August Varnhagen von Ense.. Pendant longtemps on a cru que c’était l’œuvre d’Helmina von Chézy qui est aussi la poétesse de Rosamunde, mis en musique par Schubert. C’est ce que Brigitte Massin écrivait encore dans sa biographie que je possède et imprimé en 1977.
Ce lied est d’une difficulté extrême pour la soprano. Il évoque un berger heureux dans la montagne contemplant la vallée. Mais, comme souvent, le lied, bascule ensuite dans un climat plus triste : il est question d’une bien aimée lointaine, de la solitude, de la nostalgie.
Mais la dernière strophe est pleine d’espoir :
Der Frühling will kommen,
Der Frühling, meine Freud’,
Nun mach’ ich mich fertig
Zum Wandern bereitBientôt ce sera le printemps.
Le printemps, ma joie.
Il me faut me préparer
Prêt à partir en voyageDans <Wikipedia> vous pouvez lire l’intégralité du poème.
Brigitte Massin écrit à propos de cette fin :
« Le printemps, invitation au voyage, nourrit une dernière fois l’éternel grand rêve de liberté »
Brigitte Massin, Schubert, page 1290Le plus parlant est certainement de l’écouter, par exemple dans cette <interprétation de Kathleen Battle> accompagnée par James Levine et surtout par le merveilleux clarinettiste de la Philharmonie de Berlin : Karl Leister
Si vous privilégiez la voix, il faut plutôt écouter <Margaret Price>
Mais la science des musicologues a progressé et il a été établi que Schubert avait écrit et fini un autre lied après le Pâtre sur le rocher. C’était un lied connu, puisque l’éditeur Tobias Haslinger, que j’ai déjà évoqué, avait inclus initialement ce lied comme le 14ème lied du chant du cygne. Il portait donc le numéro D. 957 / 14. Cela ajoutait un troisième poète à ce cycle créé artificiellement par l’éditeur : Johann Gabriel Seidl.
Ce lied a pour titre « Die Taubenpost » (« Le pigeon voyageur »).
Le catalogue Deutsch avait donc fait une erreur de chronologie, il a fallu ruser et on trouva la solution de lui donner le numéro D. 965 A.
Ce lied n’a rien à voir avec les terribles et modernes lieds composés sur les poèmes de Heine « Der doppelgänger » ou « Die Stadt ».
C’est un poème tendre, léger, « témoin de l’entrain de Schubert en octobre 1828 » écrit Brigitte Massin.
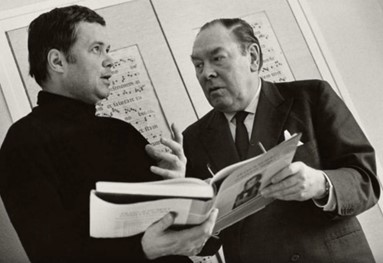 Il faut l’écouter par le jeune Dietrich Fischer-Dieskau accompagné déjà par Gérald Moore en 1957, je n’étais pas encore né.
Il faut l’écouter par le jeune Dietrich Fischer-Dieskau accompagné déjà par Gérald Moore en 1957, je n’étais pas encore né.Il est de plus en plus rare que les chanteurs intègrent ce lied dans le cycle du chant du cygne, tant il y a rupture entre les lieds sur les poèmes de Heine et celui-ci.
Schubert travaillait aussi, lors de ces dernières semaines, sur deux œuvres qu’il a laissé inachevées : sa 10ème symphonie dont la partition était près de son lit et un début d’opéra dont le titre aurait été « Le Comte de Gleichen »
Mais concernant les œuvres terminées, celles qu’on peut écouter et qui sont enregistrées il y a ces deux lieds : « Der Hirt auf dem Felsen D.965». et « Die Taubenpost D.965A»
Et pourtant ce n’est pas encore la dernière œuvre achevée.
Je ne sais pas si en racontant la motivation qui a conduit à l’écriture de cette œuvre qui a été numérotée D. 965 B, il faut en sourire ou en pleurer.
Franz Schubert était un des plus grands génies de la musique. Subitement dans les dernières semaines de sa vie, un doute le saisit, il pensait qu’il avait des lacunes théoriques. Il pris, alors, de son temps précieux pour aller prendre des cours de contrepoint auprès d’un professeur célèbre de Vienne qui fut aussi le professeur d’Anton Bruckner : Simon Sechter né 9 ans avant Schubert en 1788 mais décédé, bien plus âgé, le 10 septembre 1867 à Vienne.
Grâce à Wikipedia, j’ai appris qu’il fut un compositeur particulièrement prolifique (environ 8000 œuvres). Par hasard, j’ai trouvé sur internet une œuvre qu’il a écrite pour orgue en l’honneur de Schubert : « Fuge Dem Andenken des zu früh verblichenen Franz Schubert », ce qui signifie Fugue à la mémoire du trop tôt disparu Franz Schubert.
Schubert pris donc une leçon de contrepoint, il ne put aller à la suivante et après il est mort.
 La dernière œuvre achevée de Schubert est une Fugue, qu’il avait écrite à la demande de Simon Sechter et qu’il devait lui présenter à la leçon suivante :
La dernière œuvre achevée de Schubert est une Fugue, qu’il avait écrite à la demande de Simon Sechter et qu’il devait lui présenter à la leçon suivante :« L’histoire de l’œuvre de Mozart s’interrompt sur la Flûte enchantée et la dernière « Cantate maçonnique » ; celle de Beethoven sur « les cinq derniers » quatuors ; celle de Schubert non sur quelque dernière sonate ou quelque dernier lied, mais sur les premiers feuillets d’un devoir d’apprenti. On en demeure bouleversé, tellement c’est « ressemblant » par rapport au destin de l’homme, à cette fatalité de la modestie au sein de laquelle ce génie inventa sa liberté la plus profonde. Et on ne peut aussi s’empêcher de penser qu’un tel genre d’interruption est salutaire pour en finir avec la mystification de la mort comme point final, de la mort comme acte décisif qui donnerait à la vie son sens suprême.
On meurt presque toujours sur trois points de suspension… »
Brigitte Massin, Schubert, page 1294<1454>
-
Jeudi 27 août 2020
«Trois Klavierstücke D. 946»Franz SchubertLors de l’année 1828, le Catalogue Deutsch répertorie la composition de 46 œuvres, une majorité de lieder (22) et en deuxième position, en nombre, des œuvres pour piano (11).
J’ai commencé d’ailleurs par une œuvre pour piano à 4 mains : « la Fantaisie D. 940 », sommet absolu de la musique de piano à 4 mains
Puis après avoir présenté la symphonie en ut, seule œuvre orchestrale de 1828, j’ai présenté successivement les trois dernières sonates de piano qu’il a écrits les unes derrière les autres : D. 958, D. 959, D. 960. J’exprimai alors la conviction que s’il existait quelques rares autres sonates de piano, comme les trois dernières de Beethoven par exemple, qui peuvent prétendre se hisser à ce niveau de perfection et de musicalité, il n’en est pas qui les dépasse.
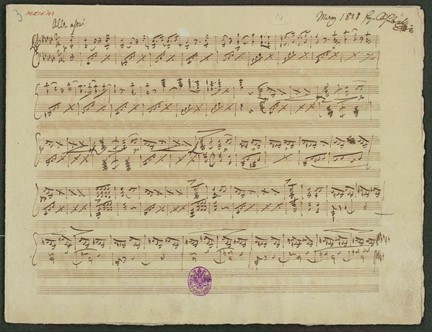 Et entre la fantaisie et ces trois sonates Schubert a écrit trois pièces qui sont entrées dans la postérité sous le nom de « trois Klavierstücke D. 946 ». En traduction littérale on doit dire trois « morceaux de musique »
Et entre la fantaisie et ces trois sonates Schubert a écrit trois pièces qui sont entrées dans la postérité sous le nom de « trois Klavierstücke D. 946 ». En traduction littérale on doit dire trois « morceaux de musique »
Ces trois pièces n’ont été publiées que 40 ans après leur composition. C’est, en effet, en 1868 que Johannes Brahms publia ces œuvres et leur donna le titre de Klavierstücke.
Aujourd’hui, les spécialistes pensent que Schubert avait pensé entamer une nouvelle série de quatre impromptus dont il ne composa que les trois premiers.
Schubert a écrit deux séries de quatre impromptus qui pendant longtemps ont été connus sous le nom d’Opus 99 et d’opus 142. Nous savons que cette classification en numéro d’opus qui suit l’ordre de publication des œuvres de Schubert est désormais obsolète car elle se heurte à la double limite que la plus grande part des œuvres de Schubert ne fut pas publiée de son vivant et que celles qui furent publiées ne suivaient pas du tout l’ordre de composition.
Désormais, ces deux séries d’Impromptus sont connus sous les numéros D 899 et D 935. Quand on sait que la première œuvre que le catalogue Deutsch situe en 1828 est le lied D. 937 « Lebensmut » (« Courage de vivre »), on saisit que ces œuvres ont été composées très peu de temps avant 1828. Les D. 935 furent composées comme leur numéro l’indique dans les derniers jours de décembre 1827.
Il s’agit d’un autre sommet de la musique de piano.
Marcel Schneider explique page 98 de son ouvrage que Schubert inventa cette forme de pièces libres pour piano auxquelles il donna le nom d’Impromptus ou de Moments musicaux (D. 780) et que Schumann, Liszt et Chopin l’utiliseront à leur tour.
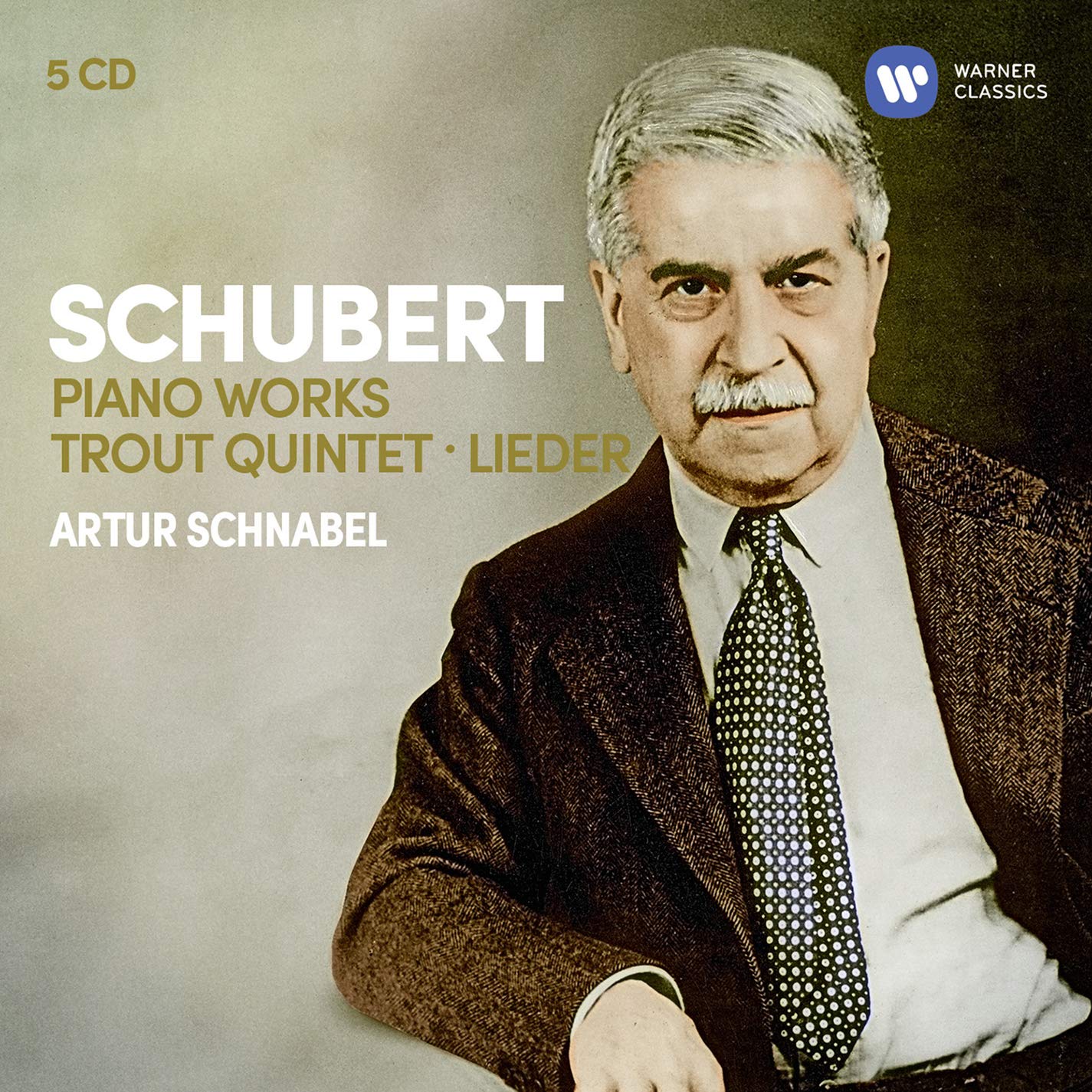
Pendant longtemps, les œuvres de piano de Schubert ne furent pas enseignés au conservatoire de Vienne, la ville de Schubert, jusqu’au début du XXème siècle. Ce fut Artur Schnabel qui commença à jouer ces œuvres. J’ai entendu récemment, à la radio, qu’Artur Schnabel pendant qu’il enregistrait aux studios d’Abbey Road à Londres, dans les années 1930 rencontra un autre grand pianiste, il me semble que c’était Rachmaninov, quelqu’un de ce niveau-là en tout cas, qui enregistrait aussi. Ce dernier demanda à Schnabel, ce qu’il enregistrait et quand la réponse fut « Des sonates de Schubert », l’autre grand pianiste rétorqua :
« Ah bon, Schubert a écrit des sonates de piano ? ».
Depuis, les choses ont bien changé.
Et quand on demanda à Daniel Barenboïm de jouer à la cérémonie funèbre de jacques Chirac, à l’église Saint Sulpice, il interpréta <l’impromptu D935 N°2>
Brigitte Massin précise que le manuscrit de Schubert porte en tête du premier morceau « mai 1828 ».
Ces trois œuvres sont au niveau des autres impromptus.
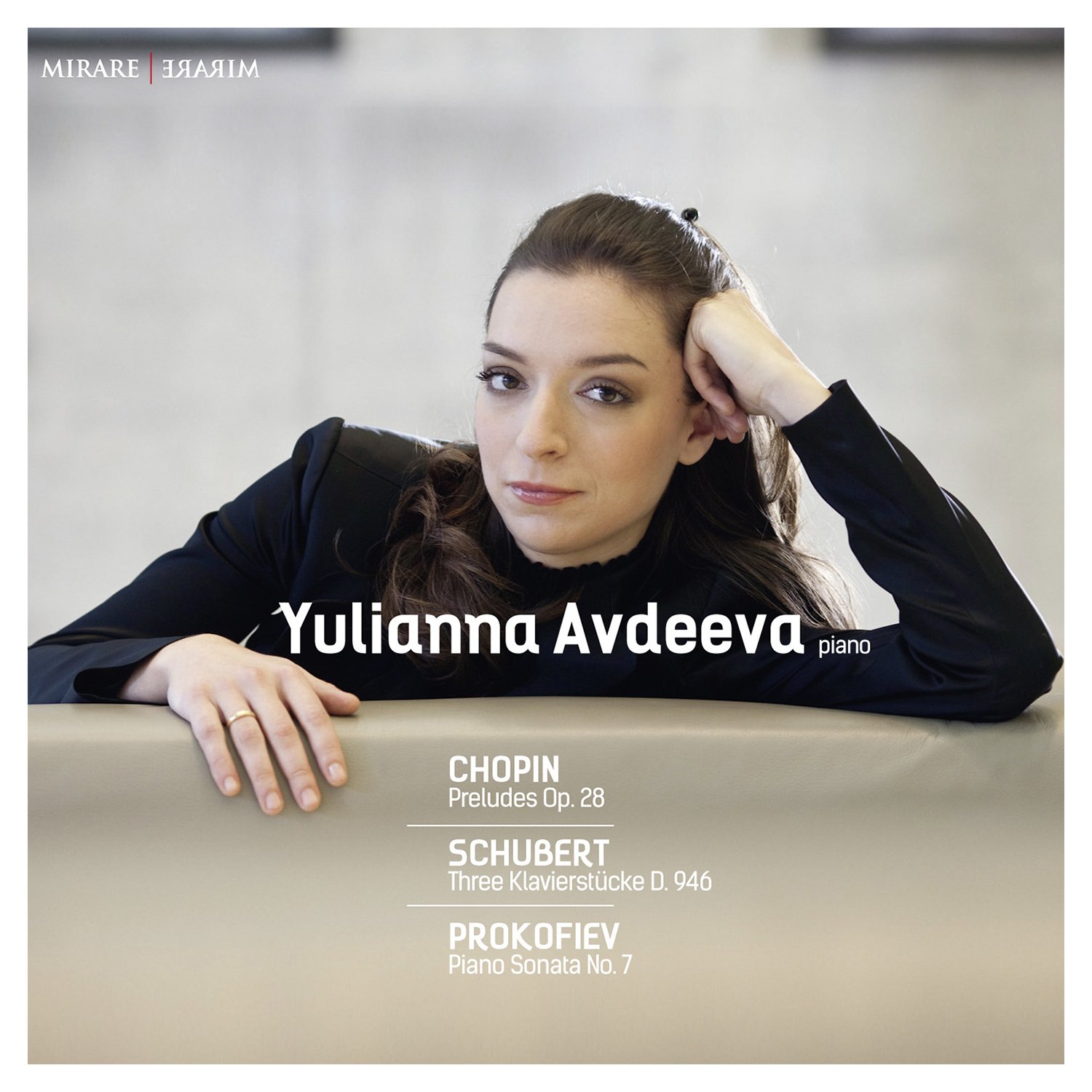
En introduction à son disque de 2014 dans lequel elle interprète le D. 946, Yulianna Avdeeva écrit :
« Les Drei Klavierstücke figurent à mon sens parmi les œuvres pianistiques les plus profondes et les plus personnelles. La partie principale du n°1 en mi bémol mineur, avec ses triolets palpitants à la main gauche et ses brèves exclamations à la droite, crée un climat dramatique et agité. […] Le Klavierstück n°2 en mi bémol majeur est un grand morceau lyrique pourvu de deux trios, en ut mineur et la bémol mineur. Cette dernière section, avec sa belle ligne vocale toute simple et l’accompagnement qui la sous-tend, est à mon avis l’une des déclarations les plus personnelles et les plus émouvantes de tout le répertoire classique. Quant au n°3 en ut majeur, il regorge de syncopes et possède un caractère très joyeux. . […] Dans la coda (elle aussi construite sur des syncopes), Schubert nous mène à l’apogée de la luminosité et de la joie. »
Schubert nous mène à l’apogée de la luminosité et de la joie, je pense qu’elle a raison.
Moi j’entrerai dans ces œuvres par le numéro 2, interprété ici par <Paul Lewis>
Il commence par une petite mélodie lyrique qui vous entraîne dans un doux rêve et puis je laisse la parole à Brigitte Massin :
« Quelques mesures de conclusion, comme pour un lied, bouclent sur elle-même cette exposition d’un univers rassurant, dépourvu d’agressivité.
L’absence de transition rend d’autant plus violent le contraste qu’impose le premier couplet : libération des fantasmes de terreur et d’obscurité, univers du fantastique et des ténèbres intérieures. En une page, un condensé de toutes les expériences de Schubert en ce domaine. »
Page 1245
La main gauche émet, au moment de cette transition, un grondement qui laisse présager les plus grandes épreuves. Schubert avec un piano crée un monde, un univers de complexité et de clair-obscur.
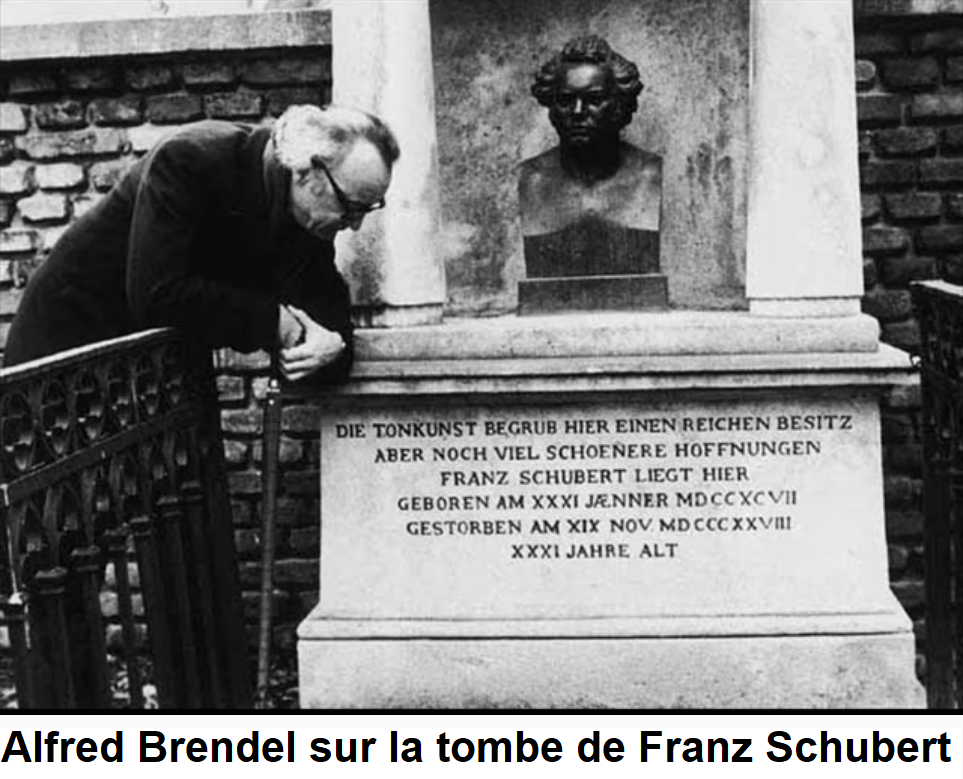
Pour entrer ensuite dans le premier acte de cette œuvre, qui en compte trois, je vous propose d’écouter l’immense interprète de Schubert et de Beethoven : <Alfred Brendel : Klavierstücke D. 946 No. 1>
Et puis le troisième, le plus court je le confierai à <Maria Joao Pires joue Klavierstücke D. 946 No. 3>
D’ailleurs s’il faut conseiller un CD, un seul, je prendrai celui de Maria Joao Pires toute en sensibilité et intériorité.
Ce disque a pour titre « Le voyage magnifique ».
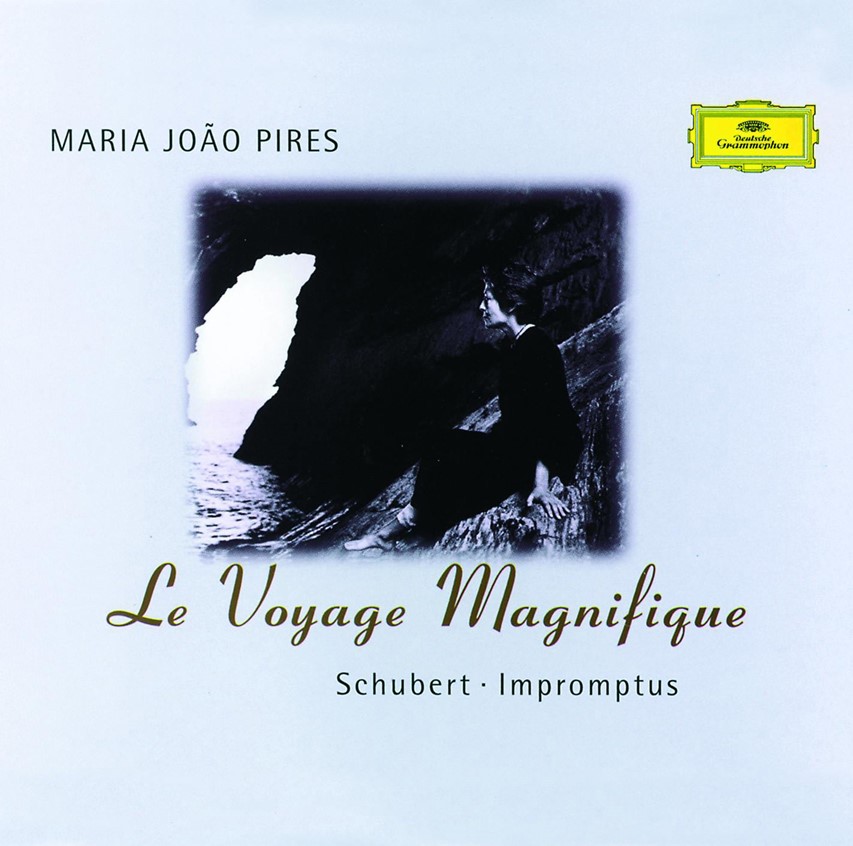 Liszt comparait ces œuvres de Schubert à un « trésor divin ».
Liszt comparait ces œuvres de Schubert à un « trésor divin ».
<1453>
-
Mercredi 26 août 2020
«Messe en mi bémol majeur D. 950»Franz SchubertSchubert a composé 6 messes latines et un petit bijou en allemand qui s’appelle « Messe allemande » et a été composé en 1826 et 1827 <En voici un court extrait>
Pour les 6 messes latines, il faut distinguer les quatre premières qui sont des œuvres de jeunesse composées entre 1814 et 1816, Schubert avait donc entre 17 et 19 ans et les deux dernières qui constituent des œuvres majeures..
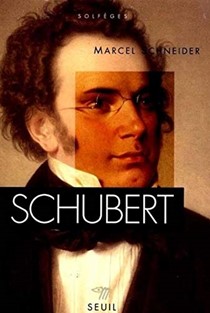 Un des biographes de Schubert, Marcel Schneider, écrit à propos de ces 4 premières messes :
Un des biographes de Schubert, Marcel Schneider, écrit à propos de ces 4 premières messes :
« Ses messes restent des compositions décoratives, faites pour sonner dans des églises baroques, aux couleurs claires, à la décoration surchargée. […] Ce sont des œuvres courtes, naïvement touchantes, où la candeur remplace la solennité, le charme la grandeur »
Schubert, Marcel Schneider, collection Solfèges, page 139
Le jugement est un peu sévère et il ne faut pas oublier que Schubert avait moins de 20 ans. On y trouve cependant des beautés. Pour sa 4ème messe, il a en outre composé un nouveau Benedictus qui fait partie de ses toutes dernières œuvres puisqu’elle porte le numéro D. 961.
Vous trouverez derrière <ce lien> les deux Benedictus enchainés le premier de 1816 et le second de 1828 et vous entendrez que la version de 1816 ne démérite pas.
Il faut reconnaître cependant que ces premières messes n’ont rien à voir avec les deux dernières que Schubert a appelées Missa Solemnis.
Ma vie musicale a été jalonnée de rencontre avec des œuvres, rencontre dont pour beaucoup je me souviens encore des circonstances. A la fin des années 1970, dans ma région natale de l’est lorrain, un homme portant le nom Oudart avait forgé le projet de réunir des musiciens amateurs, des choristes et d’inviter 4 chanteuses et chanteurs solistes pour jouer en concert la Messe N°5 en en la bémol majeur D.678. Il avait demandé à mon père d’assurer le rôle de premier violon solo. J’assistais bien sûr au concert qui eut lieu à Sarreguemines. Ce fut ma première rencontre avec cette œuvre composée entre 1819 et 1822, évènement rare pour Schubert de mettre 3 ans pour finir une œuvre.
Bien sûr, depuis ce concert, j’ai entendu des interprétations plus abouties et techniquement plus irréprochables mais le souvenir associé à ce moment de beauté et de grâce reste brulant. Dans ma tête il y a toujours la réminiscence de l’« Hosannah » qui finit le <Sanctus> de cette messe et qui constitue une ouverture vers le divin.
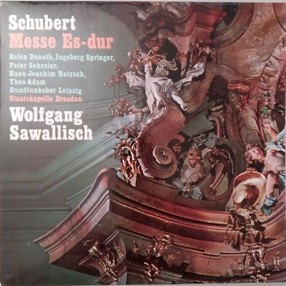 La Messe en la bémol majeur est très belle mais comme l’écrit un Marcel Schneider, cette fois convaincu :
La Messe en la bémol majeur est très belle mais comme l’écrit un Marcel Schneider, cette fois convaincu :
« Schubert se surpassera pourtant […] dans l’admirable Messe en mi bémol de l’été 1828 »
Page 140
Nous sommes bien en présence d’un autre chef d’œuvre ineffable que Schubert a écrit lors de cette extraordinaire année 1828.
Selon Brigitte Massin, la messe en mi bémol a été commencée probablement en juin 1828, elle ajoute :
« Il est probable qu’elle a été commandée à Schubert dans les mêmes conditions que le chœur « Glaube, Hoffnung und Liebe » quasi contemporain D. 954 car elle sera exécutée, presque un an après la mort de Schubert, le 4 octobre 1829, et sous la direction de son frère Ferdinand, dans cette même église du faubourg viennois de l’Alsergrund, pour laquelle avait été écrit et où avait été déjà exécuté, en septembre 1828, le chœur en question. »
Page 1248
Il s’agit encore d’une de ces œuvres exceptionnelles que Franz Schubert a laissé à l’humanité sans n’avoir jamais entendu, de son vivant, une interprétation de la musique qu’il avait écrite.
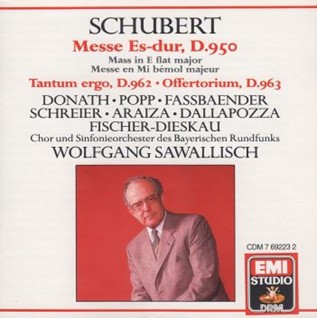 Mais les messes de Schubert ne peuvent pas ou du moins ne pouvait pas être jouée lors d’un office religieux catholique, parce que Schubert prenait des libertés avec le texte. Brigitte Massin répertorie toutes les omissions qu’il a pratiquées :
Mais les messes de Schubert ne peuvent pas ou du moins ne pouvait pas être jouée lors d’un office religieux catholique, parce que Schubert prenait des libertés avec le texte. Brigitte Massin répertorie toutes les omissions qu’il a pratiquées :
« Du point de vue de l’attention portée au texte liturgique, la même irrégularité se manifeste ici de la part de Schubert que dans les messes précédentes, et surtout dans la Messe en la bémol achevée en 1822 .
Dans le Gloria, les omissions portent sur « Domine Fili unigenite » et « Jesu Christe, Filius Patris » (cette dernière affirmation sera pourtant mise en musique ensuite dans le même Gloria: « Agnus Dei, Filius Patris »).
Omission encore de « Suscipe deprecationem nostrarn » et de « Qui sedes ad dexteram Patris », et finalement omission de la proclamation « Jesu Christe » après le «Tu solus altissimus ».
Dans le Credo : omission, au début, du « Patrem omnipotentern » pour la personne de Dieu le Père, du «Genitum non factum » pour celle du Fils, surtout de « Et Unam Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam», dogme absent de toutes les messes de Schubert, et cette fois encore, comme pour la Messe en la bémol, omission de « Et exspecto resurectionem mortuorum. »
On pourrait développer chacun de ces oublis, mais je ne m’arrêterai que sur l’un d’entre eux : un oubli systématique dans toutes les messes, dans le Credo, de cette phrase : « Et Unam Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam», c’est à dire « Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. »
C’est lors du Concile de Nicée en 325, premier concile qui réunit tous les évêques de l’Empire Romain que fut adopté la profession de foi chrétienne qui énumère les points fondamentaux de la croyance. On l’appelle le « symbole de Nicée ». Pour les amoureux d’Histoire, il fut complété lors du concile de Constantinople de 381.
Il faut se remettre dans le contexte. Nous ne sommes pas dans la France de Charlie Hebdo et du début du XXIème siècle, nous sommes au début du XIXème siècle, dans le très catholique Empire Austro-Hongrois, nous sommes à Vienne. Franz Schubert est né dans une famille très catholique, dans une société très catholique, un empereur et un gouvernement très catholique.
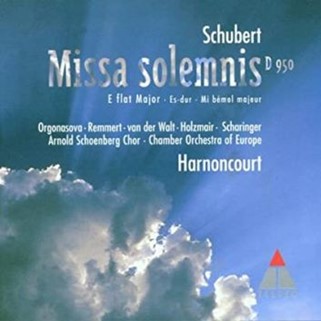 Et ce jeune homme, timide, discret qui n’ose pas se mettre en avant, à 17 ans, décide d’enlever du Credo en ne le mettant pas en musique : « Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. ». Et il va réitérer ce défi, lors de toutes les messes suivantes jusqu’à sa dernière, la messe en mi bémol composé en 1828.
Et ce jeune homme, timide, discret qui n’ose pas se mettre en avant, à 17 ans, décide d’enlever du Credo en ne le mettant pas en musique : « Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. ». Et il va réitérer ce défi, lors de toutes les messes suivantes jusqu’à sa dernière, la messe en mi bémol composé en 1828.
Pour saisir l’ampleur de ce geste, il faut savoir que le Panthéiste Beethoven dans sa Missa Solemnis comme dans sa Messe en ut, n’a pas eu cette audace Lui a mis en musique qu’il croyait en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Et Jean-Sébastien Bach, le luthérien, le protestant lui aussi dans sa Messe en Si fait chanter : « Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. ».
Beethoven, non ! Bach, non ! Mais Schubert oui, il a osé cette modernité de ne pas se cacher et dans la mesure où il ne chérissait pas l’Église catholique, de ne pas faire résonner la croyance en l’Église.
Contrairement à la Messe N°5, les solistes ne jouent pas un grand rôle dans cette œuvre qui donne la première place au chœur. Brigitte Massin écrit :
« La Messe en mi bémol est essentiellement chorale. Elle apparaît comme le prolongement de l’expérience musicale réalisée dans la Messe allemande de 1827. Aucune recherche d’un style brillant, le chœur (soprano, alto, ténor et basse) intervient par larges plans, chantant le plus souvent une note par syllabe, peu soucieux d’ornements et de fioritures. La respiration est plus ample que dans la Messe allemande, l’air circule davantage dans la partition, c’est ainsi qu’aux épisodes de l’affirmation du chœur succède souvent, dans une large plage de silence choral, une intervention orchestrale. Les solistes n’ont, pour leur part, qu’un rôle très restreint d’alternance avec le tutti du chœur. »
Il y a en fait un seul passage qui donne une place première aux solistes c’est le « Et incarnatus est » du Credo dans lequel Schubert confie au chant du violoncelle la préparation de l’épisode le plus humain du Credo : « il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.». »
Vous pouvez entendre ce moment dans l’interprétation de <Claudio Abbado – Et incarnatus est »
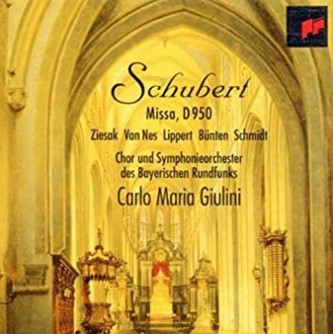 Brigitte Massin conclut :
Brigitte Massin conclut :
« Entre la glorieuse Messe en fa des débuts du musicien de dix-sept ans et cette Messe en mi bémol si profondément humaine, il y a tout le trajet de l’aventure intérieure vécue par Franz Schubert. »
Pour entendre la messe dans son intégralité il est possible d’écouter et de voir <Un concert avec l’orchestre et le chœur de la radio néerlandaise de Philippe Herreweghe>.
En revanche, pour l’instant il n’y a pas d’enregistrement CD de cette messe N° 6 par Herreweghe.
J’ai jalonné le texte de ce mot du jour des quatre interprétations que je possède et entre lesquelles je ne sais pas choisir.
Dans ce mot du jour, j’ai donc parlé de Charlie Hebdo, du symbole de Nicée et de la force de caractère d’un jeune homme qui a eu le courage d’affirmer ses idées et qui surtout possédait un génie unique pour déployer le chant, la ligne mélodique, l’harmonie chorale et nous faire vibrer.
<1452>
-
Lundi 24 août 2020
«Le chant du cygne D. 957»Franz SchubertJe poursuis, avec l’objectif de l’achever, cette série commencée lors des week-ends du confinement et consacrée à la musique que Schubert a composée lors de l’année 1828, dernière année de sa courte vie.
Le grand compositeur du XXème siècle, Benjamin Britten, a affirmé que l’année 1828 fut l’année la plus féconde de l’histoire de la musique occidentale en raison de tous les chefs d’œuvre que Schubert a composé lors de cette année.
Schubert avait déjà composé bien des chefs d’œuvre avant l’année 1828, mais il est vrai qu’il y eut une densité sidérante lors des 11 derniers mois de sa vie.
Schubert fut longtemps méconnu, sauf dans un domaine, il était le maître du Lied. Il en composa 650.
Selon <Wikipedia> les lieder étaient à l’origine des chants ecclésiastiques allemands populaires et furent une source du choral luthérien.
Il s’agit d’un chant confié à une voix, rarement plusieurs, accompagnée par un piano. Par la suite, notamment Mahler, composa des accompagnements avec orchestre.
Il est commun de dire que le lied est l’équivalent allemand de la mélodie française. Mais l’article de Wikipedia souligne opportunément le
« Fait que le lied soit d’origine populaire (Volkslied) avant de s’académiser. A contrario, la mélodie est un genre savant dès le départ »
Historiquement on continue à appeler «Lied» un chant composé en allemand, en Allemagne ou en Autriche, alors que les mélodies sont le genre français et au-delà. Quand le compositeur anglais Britten compose des chants pour une voix soliste et orchestre comme « Illuminations » on parle de mélodie, non de Lied.
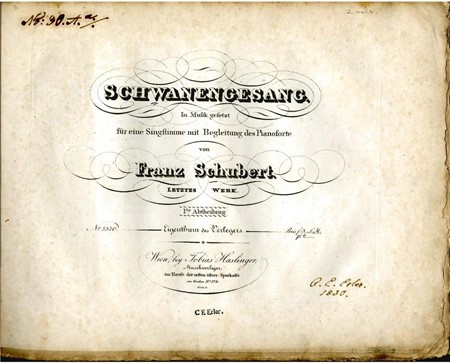 Schubert a aussi composé des lieder en 1828. 13 d’entre eux seront rassemblés en un recueil appelé « Der Schwanengesang », c’est-à-dire le Chant du cygne.
Schubert a aussi composé des lieder en 1828. 13 d’entre eux seront rassemblés en un recueil appelé « Der Schwanengesang », c’est-à-dire le Chant du cygne.
Mais pourquoi le « Chant du cygne » ?
Selon <Wikipedia> c’est une légende qui remonte à la haute antiquité grecque et évoquerait le dernier chant merveilleux et tragique du cygne d’Apollon (Dieu de la mythologie grecque du chant, de la musique, de la poésie, des purifications, de la guérison, de la lumière, et du soleil) au moment où il sent qu’il va mourir.
Ce <site canadien> et <Historia expliquent que Platon a mis dans la bouche de Socrate, lors des derniers instants de sa vie (dans le Phédon), l’évocation du chant du cygne. Le philosophe, âgé de soixante-dix ans, aurait alors déclaré, juste avant de boire le poison mortel, la fameuse cigüe :
« Les cygnes qui, lorsqu’ils sentent qu’il leur faut mourir, au lieu de chanter comme auparavant, chantent à ce moment davantage et avec plus de force, dans leur joie de s’en aller auprès du Dieu dont justement ils sont les serviteurs. »
C’est pourquoi, en référence à cette légende, on appelle le « chant du cygne » le dernier témoignage d’un homme ou d’une femme, l’ultime œuvre d’un artiste, la déclaration finale d’un poète avant de partir vers la mort.
C’est bien une légende, les études scientifiques n’ont jamais constaté un tel phénomène lors de la mort d’un cygne.
Le Chant du cygne D.957 (Schwanengesang, en allemand) est donc un recueil de treize des derniers lieder de Schubert. Ce ne sont pas tous les derniers lieder, nous y reviendrons.
On parle d’un cycle. Schubert avait déjà composé deux cycles célèbres :
- La belle meunière
- Le voyage d’hiver
Œuvres sublimes, sur des vers du poète Wilhelm Müller qui serait resté un absolu inconnu, si ses poèmes n’avaient pas été magnifiés par la musique de Franz Schubert.
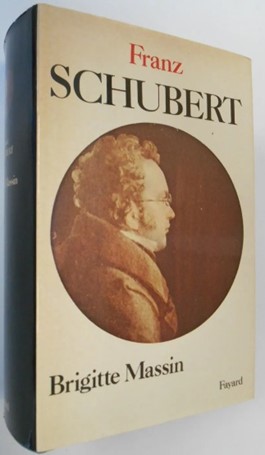 Pour le Chant du cygne c’est un peu plus compliqué. En réalité, on pense aujourd’hui que Schubert avait esquissé le début de deux cycles qui n’avaient rien à voir : les 7 premiers sur des poèmes de Ludwig Rellstab qui a un statut de notoriété proche de celui de Wilhem Müller et les 6 derniers sur des poèmes de Heinrich Heine qui serait connu sans Schubert.
Pour le Chant du cygne c’est un peu plus compliqué. En réalité, on pense aujourd’hui que Schubert avait esquissé le début de deux cycles qui n’avaient rien à voir : les 7 premiers sur des poèmes de Ludwig Rellstab qui a un statut de notoriété proche de celui de Wilhem Müller et les 6 derniers sur des poèmes de Heinrich Heine qui serait connu sans Schubert.
Ces deux séries de lied n’ont rien à voir, mais l’éditeur Tobias Haslinger a trouvé pertinent de les assembler et de les publier à titre posthume en 1829 sous ce nom « Le chant du cygne » sous lesquels ils sont parvenus à la postérité. Il avait probablement le projet de présenter ce cycle comme le testament artistique de Schubert. Selon Brigitte Massin dans sa grande Biographie de Schubert, ces lieder ont été composés entre mai et octobre 1828
Les 7 premiers, sur les poèmes de Ludwig Rellstab sont plutôt entraînant, célébrant la nature, une certaine légèreté. Certes on y trouve aussi de la nostalgie, de la mélancolie, un peu de vague à l’âme pour l’absence de la bien-aimée, de la tristesse mais sans le tragique que raconte le voyage d’hiver.
Dans cette série le 4ème « Ständchen » traduit en français par « Sérénade » est un des plus célèbres lieds de Schubert. Mon père adorait le chanter ou le fredonner.
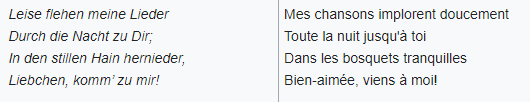 Il commence par une douce imploration de l’être aimée
Il commence par une douce imploration de l’être aimée
Et il finit sur une conclusion pleine d’optimisme :
« J’attends de te rencontrer
Viens, rends moi heureux! »
En voici une très belle interprétation par <Barbara Hendricks et Radu Lupu>.
Mais quand une œuvre devient si célèbre elle dépasse son statut initial, par exemple est transcrite pour des instruments : <Ici une version au violoncelle jouée par Camille Thomas », elle dépasse aussi la frontière du classique <Voici une interprétation par Nana Mouskouri>
Voici les titres des 7 poèmes de Ludwig Rellstab
1 – Liebesbotschaft (« Message d’amour »)
2 – Kriegers Ahnung (« Le pressentiment du guerrier »)
3 – Frühlingssehnsucht (« Désir du printemps »)
4 – Ständchen (« Sérénade »)
5 – Aufenthalt (« Séjour »)
6 – In der Ferne (« Dans le lointain »)
7 – Abschied (« Adieu »)
Le dernier lied « Adieu » que je qualifierai de charmant est décrit ainsi par Brigitte Massin (page 1261) :
« Avec ce lied, Schubert dit « adieu » aux poèmes de Rellstab. Ravissant adieu que cette chevauchée qui entraîne d’un seul élan irrésistible les 6 strophes du poème. […] Seule, la dernière strophe […] connaît un assombrissement passager, vite balayé par le grand souffle de la cavalcade. »
Vous pouvez entendre ce moment presque d’insouciance à l’heure de la mort <ici chanté par Fischer-Dieskau>
Mais il y a le second versant du « chant du cygne » les poèmes de Heine.
Schubert écrit :
« J’ai aussi mis en musique quelques lieder du Heine qui ont énormément plu ici. »
Schubert à Probst le 2 octobre 1828, cité par Brigitte Massin page 1261
 Christine Mondon dans son ouvrage « Franz Schubert, Le musicien de l’ombre » écrit :
Christine Mondon dans son ouvrage « Franz Schubert, Le musicien de l’ombre » écrit :
« Selon ses amis, il est, à la lecture du recueil «Le retour» (Die Heimkehr), publié en 1826, dans un état proche du somnambulisme. Il choisit six poèmes et modifie l’ordre constitué par Heine : Der Atlas (« Atlas »), Ihr Bild (« Son image »), Das Fischermädchen (« La fille du pêcheur »), Die Stadt (« La ville »), Am Meer (« Au bord de la mer ») et Der Doppelgänger (« Le double ») »
Page 212
Cette fois, nous sommes dans le sombre, le tragique.
Le premier lied est dramatique, plonge dans la mythologie grecque et évoque la souffrance du géant Atlas « Infortuné Atlas » qui porte la terre sur son dos. Dès l’attaque du piano on constate qu’on a changé d’univers.
Pour le deuxième « Son image » qui décrit le portrait du visage aimé, Brigitte Massin écrit
« Schubert atteint sans doute ici au dépouillement le plus extrême dans sa catégorie des lieder de l’immobile. C’est la sobriété suprême »
Et puis, il y a les deux lied « la ville » et surtout « le double » dans lesquels la musique devient hallucinée, d’une expression intense. Musique visionnaire, totalement moderne, le « double » se termine en « sprechgesang », il n’y a plus de chant, plus que la violence des paroles. Schubert annonce Schoenberg un siècle plus tard. Entre temps, aucun compositeur n’ira si loin que Schubert.
Christine Mondon écrit :
« Au premier lied répond le dernier lied : le double nous glaçant d’effroi dans une immobilité hors du temps, dans le dépouillement absolu décuplant l’intensité dramatique :
Il y a aussi un homme qui regarde en l’air
Et se tord les mains de violente douleur ;
Avec horreur, lorsque je vois son visage
La lune me montre mes propres traits.
Dans la tonalité funèbre de si mineur nous avons la confession d’un cœur désespéré »
Vous pouvez écouter ce lied chanté par « Hans Hotter », et sur ce site vous avez le texte du lied et sa traduction française.
Pour l’ensemble du cycle, internet permet d’entendre <<la très belle interprétation de Matthias Goerne accompagné par Christoph Eschenbach>
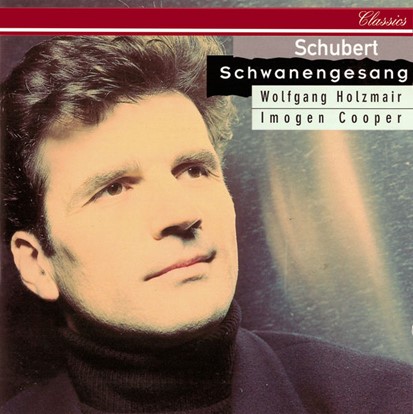 En CD j’ai une préférence pour l’interprétation de Wolfgang Holzmair avec Imogen Cooper. Bien sûr les versions de Dietrich Fischer Dieskau, notamment celle avec Alfred Brendel constituent aussi une expérience inoubliable.
En CD j’ai une préférence pour l’interprétation de Wolfgang Holzmair avec Imogen Cooper. Bien sûr les versions de Dietrich Fischer Dieskau, notamment celle avec Alfred Brendel constituent aussi une expérience inoubliable.
Dans ce mot du jour, j’ai donc parlé de Socrate, d’une légende dans laquelle on raconte que l’élégant cygne élèverait un chant divin en quittant la vie et aussi des manœuvres marketing d’un éditeur autrichien du début du XXème siècle.
Mais j’ai surtout évoqué un nouveau chef d’œuvre de Schubert, dans lequel il devient prophétique et annonce la musique du XXème siècle.
<1451>
- La belle meunière
-
Lundi 6 juillet 2020
« Le mot du jour est en congé.»Il reviendra le 21 septembreIl faut savoir faire silence, se reposer, se régénérer, lire, flâner, méditer, pour revenir pour de nouveaux partages, réflexions et questionnements.
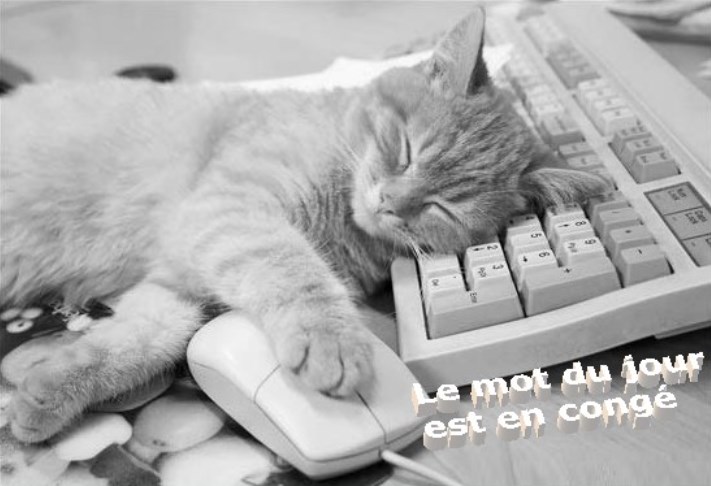
Je souhaite cependant terminer la série sur les œuvres que Schubert a écrites lors de l’ultime année de sa vie, l’année 1828.
Je me livrerai à cet exercice, au fil de l’eau et de l’inspiration en publiant ces mots quand ils seront prêts, sans attendre la reprise de septembre.
<mot sans numéro>
-
Vendredi 3 juillet 2020
« La part de ce qui unit [l’humanité…] demande de l’intelligence, encore de l’intelligence, comme de l’amour, encore de l’amour.»Edgar Morin, ultime phrase de son dernier livre «changeons de voie»Le 8 juillet 2021 sera la date du centième anniversaire de cet homme admirable qui a pour nom Edgar Morin, bien qu’il soit né Edgar Nahoum.
Il vient de publier, il y a quelques jours, en collaboration avec son épouse Sabah Abouessalam, un nouveau livre dans lequel il essaye de tirer les leçons du coronavirus, de comprendre les défis de l’après corona et de trouver un autre chemin, il parle de changer de voie.
Pour présenter son livre, il était l’invité de Nicolas Demorand et de Léa Salamé, sur France Inter le 25 juin 2020 : « Jamais je n’ai vu une crise aussi multidimensionnelle et aussi totale »
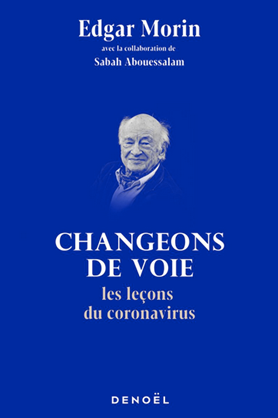 L’après-midi, je suis allé acheter le livre et j’ai commencé à le lire.
L’après-midi, je suis allé acheter le livre et j’ai commencé à le lire.
Le lire, comme on lit ce type de livre : l’introduction, puis la conclusion et ensuite on picore au milieu. Et quand cette approche donne faim, on lit de livre dans son intégralité. J’ai commencé cette dernière phase. Le silence qui s’annonce me permettra de le finir et aussi de commencer « Les souvenirs viennent à ma rencontre », ses Mémoires.
Edgar Morin n’aurait pas dû naître, c’est ce qu’il explique en introduction de son livre « Changeons de voie ».
Car il retrace rapidement les quasi cent ans qu’il a passé sur terre, et toutes les crises qu’il a rencontrées au cours de sa vie jusqu’à celle du coronavirus.
Les premiers mots de son livre concernent la grippe espagnole :
« Je suis une victime de l’épidémie de la grippe espagnole et du reste j’en suis mort, en fait né-mort, et ranimé par les giflements ininterrompus du gynécologue qui me tint trente minutes suspendu par les pieds. »
Sa mère Luna Beressi avait contracté une lésion au cœur suite à la grippe espagnole en 1917. Les médecins lui avait interdit d’avoir un enfant, car l’accouchement lui serait mortel. Elle n’en parla pas à son mari, ce n’était pas entendable à cette époque. Quand elle fut enceinte, elle consulta une « faiseuse d’anges » clandestine, puisque c’était interdit alors, qui lui donna des produits efficacement abortifs. Le résultat fut celui attendu, une fausse couche.
Enceinte à nouveau, elle tenta la même échappatoire, mais le fœtus s’accrocha. Edgar Morin écrit :
« Très perturbé, il naquit en sortant par le siège, étranglé par son cordon ombilical, le matin du 8 juillet 1921. Le gynécologue avait promis de sauver la mère. Il sauva mère et fils ».
Mais ce ne fut qu’un petit répit, Edgar Morin perdit sa mère à dix ans.
Puis, il y eut la crise de 1929 qui ruina son père, la montée de l’antisémitisme et la guerre. La guerre pendant laquelle Edgar Morin entra en résistance.
Avant de devenir l’immense intellectuel qu’il est, il y eut encore d’autres combats comme celui de prendre fait et cause pour le peuple algérien mais sans pactiser avec le FLN.
Faisant un grand bond en avant.
En 2008, il perd son épouse Edwige. Le Monde écrit :
« Ce grand intellectuel français, célébré dans de nombreux pays, n’en finit pas de pleurer Edwige, qu’il avait rencontrée pour la première fois au Chili en 1961 et épousée en 1978 après bien des péripéties. Elle est morte l’an dernier, après de longues souffrances, des crises terrifiantes, des nuits infernales, et il ne parvient pas à s’y résoudre. « Elle était mon rocher, ma citadelle », écrit-il dans un ouvrage où larmes et sanglots sont présents à toutes les pages. « Je pleure, je pleure, je la pleure et me pleure. » »
Il a 87 ans. Et l’improbable surgit encore, lors d’un festival de musique, au Maroc : un coup de foudre. Sabah Abouessalam est sociologue. En 1979, elle a 20 ans, découvre Edgar Morin dans les livres, s’éprend de ses idées. En 2009, elle voit la main du père de la pensée complexe s’abattre sur la sienne : « Je vous lâche quand vous me donnez votre numéro de téléphone. » Edgar et Sabah se sont mariés quelques mois plus tard.
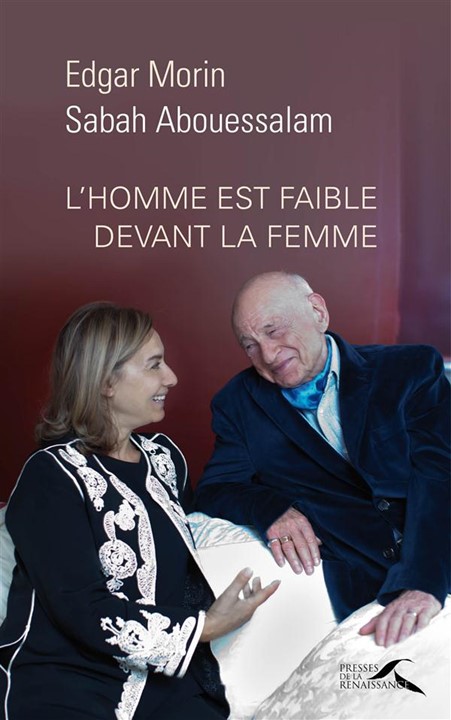 Ils ont écrit un livre sur leur histoire et sur l’amour : « L’homme est faible devant la femme »
Ils ont écrit un livre sur leur histoire et sur l’amour : « L’homme est faible devant la femme »
Et c’est aussi avec elle qu’il a écrit ce dernier livre : « Changeons la voie ».
Au bout de sa vie et après toutes ces crises qu’il a vécu et étudié, il dit pourtant à propos de celle qui nous a saisi en ce début de 2020 :
« Jamais je n’ai vu une crise aussi multidimensionnelle et aussi totale »
Comment un minuscule virus dans une très lointaine ville de Chine a-t-il déclenché le bouleversement du monde ? Edgar Morin s’interroge surtout sur la capacité des humains à réagir :
« L’électrochoc sera-t-il suffisant pour faire enfin prendre conscience à tous les humains d’une communauté de destin ? Pour ralentir notre course effrénée au développement technique et économique ? »
Nous sommes aujourd’hui confrontés à de nouvelles perspectives : de grandes incertitudes et un avenir imprévisible. Ce à quoi l’humanité actuelle – qui vit à flux tendu – ne s’est pas préparée : « Il est temps de Changer de Voie pour une protection de la planète et une humanisation de la société. »
Morin et son épouse tirent des leçons de la crise que nous venons de vivre et de l’inimaginable – et inédit – confinement de plus de la moitié de l’humanité pendant trois mois : leçon sur nos existences ; sur la condition humaine ; sur l’incertitude de nos vies ; sur notre rapport à la mort ; notre civilisation ; le réveil des solidarités ; l’inégalité sociale dans le confinement ; la diversité des situations et de la gestion de l’épidémie dans le monde ; la nature de la crise ; la science et la médecine ; l’intelligence ; les carences de pensée et d’action politique ; les délocalisations et la dépendance nationale ; la crise de l’Europe ; la crise de la planète.
Dans l’émission de France Inter il dit :
« Il faut lier le politique, l’écologique, l’économie et le social »
Et aussi qu’il n’est pas pour la décroissance globale, mais il faut que la production de produits et de services futiles et superflus décroissent alors que des choses essentielles comme une bonne alimentation saine croissent.
Je ne peux pas faire une synthèse de ce livre que je n’ai pas encore approfondi.
Mais je voudrais, dès aujourd’hui, partager la conclusion qui me parait si essentielle dans son esprit, dans ses valeurs.
Aujourd’hui quand je discute avec des amis ou des gens moins proches, je sens souvent une immense colère, parfois même de la haine.
Certes, nos dirigeants ont fait des erreurs mais c’est une grande illusion de croire qu’ils sont responsables de tout et qu’il suffirait d’en changer pour que tout aille mieux.
Les choses sont plus complexes, une grande part du changement se trouve en chacun de nous.
Pepe Mujica nous invitait à la sobriété, Jean-Marc Jancovici nous disait qu’il fallait accepter de vivre avec moins et même les moins riches des pays occidentaux.
Rien de bon ne saurait être fait avec la colère qui aveugle et la haine qui détruit.
Edgar Morin et Sabah Abouessalam commencent leur conclusion de cette manière :
« Être humaniste, ce n’est pas seulement penser que nous faisons partie de cette communauté de destin, que nous sommes tous humains tout en étant tous différents, ce n’est pas seulement vouloir échapper à la catastrophe et aspirer à un monde meilleur ; C’est aussi ressentir au profond de soi que chacun d’entre nous est un moment éphémère, une partie minuscule d’une aventure incroyable qui tout en poursuivant l’aventure de la vie, effectue l’aventure hominisante commencée il y a sept millions d’années, avec une multiplicité d’espèces qui se sont succédé jusqu’à l’arrivée de l’Homo sapiens.
Un moment éphémère dans une aventure qui nous dépasse.
Et voici l’achèvement de sa conclusion
« Chacun est individu, sujet, c’est-à-dire presque tout pour lui-même et presque rien pour l’univers, fragment intime et infirme de l’anthroposphère ; mais quelque chose comme un instinct insère ce qu’il y a de plus intérieur à ma subjectivité dans cette anthroposphère, c’est-à-dire me lie au destin de l’humanité.
Au sein de cette aventure inconnue chacun fait partie d’un grand être avec les 7 milliards d’autres humaines, comme une cellule fait partie d’un corps parmi des centaines de milliards de cellules, mille fois plus de cellules chez un humain que d’êtres humains sur terre.
Chacun fait partie de cette aventure inouïe, au sein de l’aventure elle-même stupéfiante de l’univers. Elle porte en elle son ignorance, son inconnu, son mystère, sa folie dans sa raison, sa raison dans sa folie, son inconscience dans sa conscience, et chacun porte en lui l’ignorance, l’inconnu, le mystère, la folie, la raison de l’aventure. Je participe à cet insondable, à cet inachèvement, à cet inconnu si fortement tissé de rêve, de douleur, de joie et d’incertitude, qui est en nous comme nous sommes en lui…
Je sais que, dans l’aventure du cosmos, l’humanité est de façon nouvelle sujet et objet de la relation inextricable entre d’une part de ce qui unit (Éros) et d’autre part ce qui oppose (Polémos) ainsi que ce qui détruit (Thanatos). Le parti d’Eros est lui-même incertain, car il peut s’aveugler, et il demande de l’intelligence, encore de l’intelligence, comme de l’amour, encore de l’amour. »
C’est sur ces mots que je souhaite terminer cette saison de mots de jour, pour entrer dans le silence, la lecture, le ressourcement.
Je souhaite cependant terminer la série sur les œuvres que Schubert a écrites lors de l’ultime année de sa vie, l’année 1828.
Je me livrerai à cet exercice, au fil de l’eau et de l’inspiration en publiant ces mots quand ils seront prêts.
Pour la reprise de l’exercice quotidien d’écriture, il faudra attendre la seconde moitié de septembre, à une date qui reste à fixer.
<1450>
-
Jeudi 2 juillet 2020
«Quand j’achète quelque chose, quand tu achètes toi, on ne le paye pas avec de l’argent. On le paye avec du temps de vie qu’il a fallu dépenser pour gagner cet argent.»José Mujica, Président de l’Uruguay de 2010 à 2015Le documentaire « Human » dont je parlais hier, présente presqu’exclusivement des femmes et hommes inconnues du monde médiatique.
Il y a quelques exceptions et je voudrai revenir sur une de ces exceptions. Il s’agit de José Mujica, surnommé Pepe Mujica. Il a été Président de l’Uruguay de 2010 à 2015.
Il a été remarqué par son refus des avantages octroyés par sa fonction de président de la République.
Vous vous souvenez que François Hollande avait voulu être un « Président normal ». Et beaucoup en découvrant José Mujica ont pensé que c’était lui « Le président normal ». C’est pour cette raison que je lui ai déjà consacré un mot du jour, celui du < 5 novembre 2013>
Il a été guérillero des Tupamaros dans les années 60-70 et pour cette raison il a été détenu par la dictature entre 1973 et 1985.
Pendant sa présidence, il n’a pas seulement été normal et soucieux de rester très simple. <Wikipedia> nous apprend que
« La part des dépenses sociales dans le total des dépenses publiques passe ainsi de 60,9 % à 75,5 % entre 2004 et 2013. Durant cette période, le taux de chômage passe de 13 % à 7 %, le taux de pauvreté national de 40 % à 11 % et le salaire minimum a été rehaussé de 250 %.
Il soutient par ailleurs le renforcement des syndicats. D’après la Confédération syndicale international, l’Uruguay est devenu le pays le plus avancé d’Amérique en matière de respect « des droits fondamentaux du travail, en particulier la liberté syndicale, le droit à la négociation collective et le droit de grève » […] En octobre 2012, le Parlement vote la légalisation de l’avortement. Contrairement à son prédécesseur, qui avait mis son veto à cette légalisation, Mujica fait approuver la loi. L’Uruguay devient ainsi le deuxième pays d’Amérique latine à autoriser l’avortement après Cuba. En avril 2013, les parlementaires approuvent définitivement une loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. »
Il reversait aussi la quasi-totalité de ses revenus à un programme de logement social.
Certains libéraux expriment un bilan plus critique sur sa présidence en insistant sur le fait qu’il a fait augmenter la dette du pays.
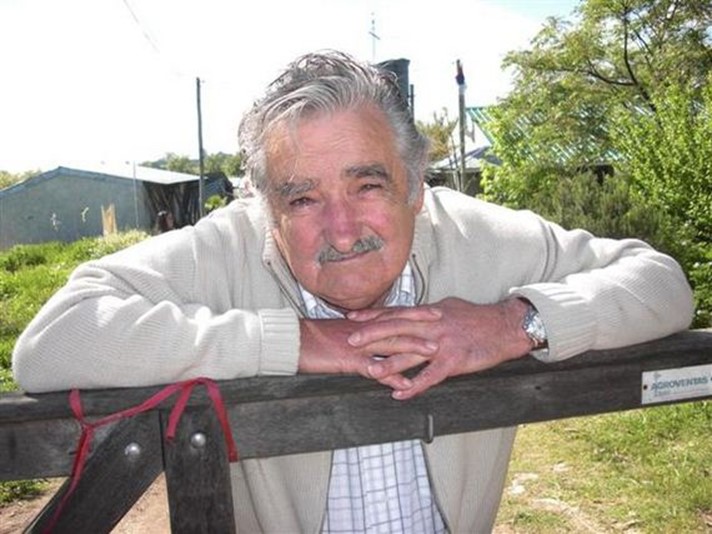 Dans le documentaire indiqué hier, il n’apparait que 2 minutes. Mais dans son cas, il existe en ligne un extrait de cet entretien plus long. Il dure environ 10 minutes : <L’interview de José Mujica – URUGUAY>
Dans le documentaire indiqué hier, il n’apparait que 2 minutes. Mais dans son cas, il existe en ligne un extrait de cet entretien plus long. Il dure environ 10 minutes : <L’interview de José Mujica – URUGUAY>
Il commence ainsi son entretien :
« J’ai été paysan pour gagner ma vie.
Puis je me suis engagé dans la lutte pour transformer et améliorer la vie de ma société.
Aujourd’hui je sui Président et demain comme tout le monde je ne serai qu’un tas d’asticots et je disparaîtrai. »
Mais ce que je voudrais surtout partager se situe à partir de 1’30. C’est aussi cet extrait qui a été repris dans le documentaire :
« J’ai beaucoup réfléchi à tout cela.
J’ai passé plus de 10 ans dans un cachot.
J’ai eu le temps de réfléchir.
J’ai passé plus de 7 ans sans ouvrir un livre.
Et voilà ce que j’ai découvert.
Soit on est heureux avec peu de choses, sans s’encombrer, car le bonheur on l’a en soi. Soit on n’arrive à rien.
Je ne fais pas l’apologie de la pauvreté mais de la sobriété.
Mais nous avons inventé la société de consommation en quête perpétuelle de croissance. Pas de croissance, c’est le drame.
On s’est inventé une montagne de besoins superflus. Il faut constamment jeter, acheter, jeter et c’est notre vie qu’on dilapide.
Quand j’achète quelque chose, quand tu achètes toi, on ne le paye pas avec de l’argent.
On le paye avec du temps de vie qu’il a fallu dépenser pour gagner cet argent.
A cette différence près que la vie, elle ne s’achète pas. La vie ne fait que s’écouler.
Et il est lamentable de gaspiller sa vie à perdre sa liberté. »
Pour consommer, et pour beaucoup acheter du futile ou du superflu, on paie formellement avec de l’argent, mais en réalité c’est du temps de vie que nous donnons. Le temps de vie nécessaire pour pouvoir acquérir l’argent de la consommation.
Le cinéaste serbe Emir Kusturica a tourné un documentaire sur cet homme étonnant. <Cet article> d’un journal canadien parle de cette rencontre.
<1449>
-
Mercredi 1er juillet 2020
«Human»Yann Arthus-BertrandHuman est un documentaire réalisé par Yann Arthus-Bertrand et sorti en 2015.
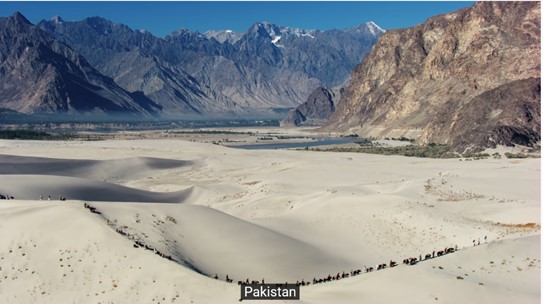 Je ne le connaissais pas. C’est une amie qui me l’a signalé et m’a appris que ce documentaire pouvait être vu en Haute définition sur internet.
Je ne le connaissais pas. C’est une amie qui me l’a signalé et m’a appris que ce documentaire pouvait être vu en Haute définition sur internet.
Vous avez le choix. Vous pouvez voir le film de 3 heures 11 : <Human le film>
Ou vous pouvez faire le choix de voir ce documentaire en trois parties. Trois parties qui globalement sont encore plus longues que le film
<Human volume 1> de 1 heure 23
<Human volume 2> de 1 heure 26
<Human volume 3> de 1 heure 33
Et puis vous avez une page complète qui permet de visionner tout cela mais aussi des reportages sur le tournage, la musique, des extraits etc. : <HUMAN>
Annie et moi avons regardé la version en 3 parties.
Nous avons été saisis par la beauté de notre terre qui est montrée sur ces images et aussi ému par les témoignages des humains de tout milieu, de tout pays, de toutes conditions, même si les pauvres, pour une fois, sont plus nombreux que les riches et que les flamboyants winner de la mondialisation.
Ce film regroupe en effet, un ensemble de témoignages de personnes réparties sur l’ensemble de la planète. Le réalisateur s’est appuyé sur des interviews de plus de 2 000 personnes dans 65 pays. Mais, lors du montage, seule un peu plus d’une centaine ont été conservées.
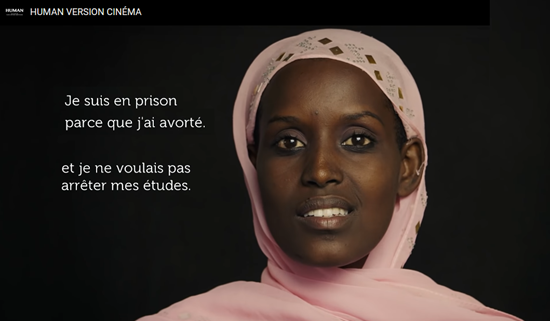 Les témoignages sont toujours filmés de la même manière : sur un fond noir, le visage en très gros plan.
Les témoignages sont toujours filmés de la même manière : sur un fond noir, le visage en très gros plan.
Cette manière de filmer permet de sentir l’émotion, la colère, la joie, le désespoir, quelquefois l’embarras.
Les interviews conservés sont courtes et souvent pleine d’intensités.
De quoi parle toutes ces femmes et tous ces hommes : de l’amour, des injustices, des inégalités, des discriminations, de la violence, du malheur et du bonheur.
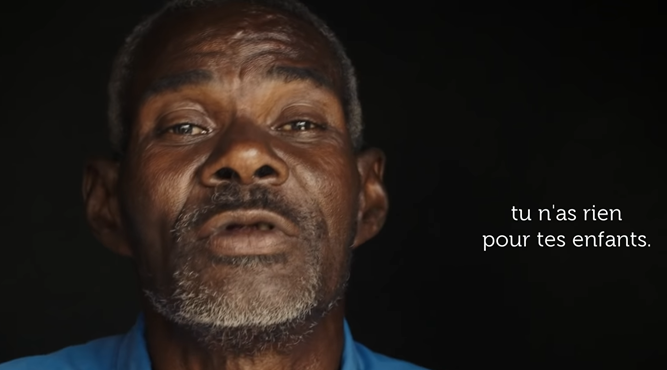
<Le Figaro> présente ces témoignages de la manière suivante :
« Chacun à sa manière, des personnages de toutes races, religions et continents, très différents les uns des autres, se racontent. Ils parlent librement d’amour, de guerre, de discriminations, de violences, de la liberté des femmes, de l’homophobie. Et aussi de pauvreté, sécheresse, exploitation de l’homme par l’homme, et des désastres écologiques et de leurs conséquences sur les populations. Interviews fortes, brèves : un père palestinien et un père israélien qui ont perdu chacun un enfant, un Rwandais témoin de massacres, une sud-américaine finalement heureuse d’avoir divorcé et des femmes musulmanes très heureuses de vivre en polygamie, une scandinave lesbienne qui ne pourrait vivre sans son autre, une mère de famille acculée au désespoir par la misère, une très vieille femme d’Asie ridée et édentée qui accuse avec véhémence le monde riche de prospérer sur leur misère. »
 Et ces témoignages sont entrecoupées de paysages d’une beauté exceptionnelle.
Et ces témoignages sont entrecoupées de paysages d’une beauté exceptionnelle.
Le film commence d’abord par des visages expressifs et qui ne parlent pas.
Puis on voit le désert du Pakistan, une longue caravane d’humains se déploient accompagnés par une musique qui immédiatement fait vibrer.
La musique a été écrite par Armand Amar, je ne le connaissais pas non plus. Elle est somptueuse et sublime les vues aériennes comme les témoignages.
Des tambours japonais, des voix de tous les pays, des instruments incroyablement différenciés, des musiques traditionnelles et même …un violon, la musique montre aussi la richesse de l’humanité sur la terre…
Après le désert du Pakistan, le premier témoignage vous saisit immédiatement.
C’est léonard, un noir américain qui parle de sa vie. De son enfance, de la violence de son beau-père qui l’a éduqué, ou dressé serait plus juste. Cette violence qu’il a ensuite exercée lui-même à l’égard d’autres. En croyant que l’amour et la violence étaient liés. Et puis, il a tué. Il a tué une femme et son enfant. La grand-mère et mère de ses victimes est venue le voir, lui a parlé. Elle lui a parlé de l’amour. Et cet homme rude a compris le message de cette femme, il raconte ce moment et les larmes coulent sur son visage.
Les témoignages ne sont jamais commentés, seule la parole du témoin trouve sa place.
 Et puis, des lacs magnifiques, des mers déchaînées, des montagnes, des steppes, des déserts, des plaines, des marchés filmés par hélicoptère, des images majestueuses, une qualité de photo sublime rendent ce documentaire unique.
Et puis, des lacs magnifiques, des mers déchaînées, des montagnes, des steppes, des déserts, des plaines, des marchés filmés par hélicoptère, des images majestueuses, une qualité de photo sublime rendent ce documentaire unique.
Voilà ce que je souhaitais dire et partager sur cette œuvre.
Alors, je sais qu’il y a des critiques et des intellectuels qui n’aiment pas du tout ou même rejettent.
Marianne Durano, agrégée de philosophie et Gaultier Bès, agrégé de lettres modernes utilisent les initiales de Yann Arthus-Bertrand pour inventer l’adjectif « Yabien ». Et ils <écrivent> :
« Human est en fait une succession de clichés, au double sens du terme. Tandis que la géographie est réduite à un album de cartes postales, la diversité des cultures est résumée en une mosaïque de stéréotypes. Filmés sur fond noir, des êtres sans nom ni identité apparaissent, innombrables, et tellement interchangeables que le visage de l’un se superpose à la voix de l’autre, le rire d’une jeune Africaine achevant celui d’un vieux Portugais, comme pour nous dire qu’au fond, tout ça c’est tout pareil. […] L’humanité yabienne est une juxtaposition sans coordination, un patchwork sans couture.
Désincarné: c’est le mot qui caractérise le mieux la dernière œuvre de Yann Arthus-Bertrand. Désincarné au sens propre du terme, puisque même les corps sont gommés, dans la succession de portraits censés dépeindre une humanité variée, mais réduite à des bustes sans contexte.»
Nous n’avons pas vu le même film.
Yves Cusset qui se présente comme philosophe écrit sur le site de l’Obs :
« son film est l’un des avatars les plus obscènes de la société du spectacle et du simulacre, capable de faire disparaître totalement l’humain derrière l’image qu’il veut de toute force en imposer à tous (en faisant céder de tout le poids de ses images impressionnantes la résistance du spectateur, qui n’en peut mais, le pauvre) via les canaux les plus puissants de diffusion et de publicité, le type veut encore se faire passer, comble du narcissisme, comme le héraut de la réconciliation de l’humanité universelle avec elle-même. C’est cet insupportable mensonge qui m’a mis hors de moi, tellement évident déjà dans le titre si bêtement prétentieux de cet opus. Si le kitsh totalitaire a encore un sens aujourd’hui, assurément YAB l’incarne au mieux, chaque image transpire du désir délirant et panoptique de tout montrer et de tout tenir dans son orbite, qui débouche sur le résultat rigoureusement inverse, celui de ne plus montrer que des images qui ne parlent que d’elles-mêmes et de rien d’autre, pures monstrations qui se complaisent dans leur esthétique absolument creuse. »
 A ce jugement sans nuance, une condamnation en quelque sorte, un internaute a répondu :
A ce jugement sans nuance, une condamnation en quelque sorte, un internaute a répondu :
« Je suis allé me recoucher et suis retourné à mon petit monde bourgeois, plein d’aigreur, si éloigné de la grandeur universelle de l’humain. Pourquoi user les touches de votre clavier, quand l’intégralité de votre article peut se résumer en une phrase. »
D’autres critiquent les milliardaires qui ont financé ce film, l’ont rendu possible et même sa diffusion gratuite.
Ainsi vous avez une vision complète sur cette œuvre.
Annie et moi faisons partie de ceux qui aiment ce documentaire.
Pour ma part, je l’aime de façon simple parce que cela m’émeut, parce que cela me parle, parce que cela me construit.
Je redonne le lien vers la page complète qui permet de tout visionner : <HUMAN>
<1448>
-
Mardi 30 juin 2020
«Toute la panoplie des instruments que la doxa libérale a longtemps décriée doit continuer à être mobilisée pour lutter contre la crise.»Daniel CohenDaniel Cohen rédige de petites chroniques dans l’Obs comme celle qu’il a publiée le 26 juin 2020 : <Guérir ces maladies du capitalisme révélées par le Covid-19>
Daniel Cohen écrit :
« La montée irrépressible du chômage et des faillites d’entreprises gronde comme un orage qui avance. »
Cet article du 9 juin < les dégâts du virus sur l’emploi> nous donne déjà un petit aperçu de l’orage.
Et Daniel Cohen de poser cette question :
« Comment un choc, somme toute limité à deux mois de vacance de l’activité, peut-il produire un tel cataclysme ? »
La réponse est dans l’immense fragilité du capitalisme.
Gaël Giraud l’avait déjà expliqué : « Avec cette pandémie, la fragilité de notre système nous explose à la figure », c’était le mot du jour du 7 avril 2020.
Guérir du Covid consiste donc à essayer de réparer ses faiblesses.
Et il pose ainsi le constat :
« Si la France était une personne unique, un « agent représentatif » comme les économistes aiment parfois à penser les nations, la crise serait simple à décrire : atteinte par une maladie imprévue, elle a peu travaillé et peu consommé, passant deux mois à se soigner. Le seul coût rémanent serait le déficit des paiements vis-à-vis du reste du monde, qui mesure le solde des dépenses qu’elle n’a pu couvrir par ses ventes à autrui. Les chiffres disponibles estiment, pour le mois d’avril, un déficit commercial en légère hausse de 1,8 milliard. La France a importé plus de masques et exporté moins d’avions… Le reste de l’ajustement peut s’interpréter comme un jeu à somme nulle entre Français. Si nous étions capables d’agir de manière solidaire, coordonnée, le coût de la crise serait totalement négligeable. »
Si nous étions capables d’agir de manière solidaire…par la coopération. Le système centré en premier sur la compétition montre ici toute sa limite.
Bien sûr, les grandes firmes du numérique continuent à pleinement profiter même de la pandémie.
Le mot du jour du 8 avril 2020 avait déjà donné la parole à Daniel Cohen : « La crise du coronavirus signale l’accélération d’un nouveau capitalisme, le capitalisme numérique »
Et il a réitéré cette thèse, début juin, dans WE demain : « On dirait que cette crise a été faite pour les GAFAM »
Enfin il faut être plus précis que cela, l’économiste distingue à l’intérieur des GAFAM
« Les gagnants, on les connaît : ce sont les GAFAM (Google, Apple, Facebook Amazon, Microsoft) et les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), en réalité moins ceux qui dépendent de la publicité – qui s’est effondrée –, comme Google, que ceux qui ont réinventé le commerce en ligne, comme Amazon. On a le sentiment que cette crise a été faite pour eux : la distanciation sociale condamne toutes les activités où le client et le prestataire sont en vis-à-vis, du commerce traditionnel à la santé ou à l’éducation.
L’objectif du numérique, c’est de réduire les contacts, avec toujours l’obsession de réduire les coûts, d’économiser sur les relations de face-à-face. C’était déjà le rêve du monde bancaire : plus besoin d’agence, de banquier, de cartes puisque tout est dématérialisé. Même chose pour Amazon : pourquoi aller dans une librairie, dans un commerce, faire la queue, alors qu’on peut tout vous apporter chez vous ?…
Idem pour Netflix : pourquoi aller au cinéma, alors qu’une salle représente un coût énorme, et reste sous-utilisée en dehors des soirées et des week-ends ?
L’économie numérique vise à réduire les coûts de tous ces lieux de contact qui font le sel de la civilisation urbaine. Voyez encore les transports en commun : ça peut paraître absurde quand ils sont bondés, mais prendre un bus et traverser une ville fait partie de ces moments de détente dont on prend pleinement conscience quand on ne les a plus et que l’on est enchaîné à des réunions en ligne.
C’est tout ça que l’économie numérique veut affronter. Les grands gagnants sont bien les GAFAM. D’ailleurs, Jeff Bezos est le seul milliardaire qui s’est enrichi pendant la crise. »
Il faudra donc ajouter NETFLIX aux gagnants et probablement au GAFAM
Pour le commun des mortels, les préoccupations immédiates sont plus prosaïques
« Mais les loyers doivent être payés, les traites honorées. Les inégalités traversant la société créent des phénomènes irréversibles, qui laissent des traces durables sur le corps social. Quand une firme fait faillite ou qu’un salarié est licencié, c’est comme un arbre qu’on abat. La défaillance des uns n’est pas compensée par la bonne santé (relative) des autres. »
Daniel Cohen montre une autre fragilité du système, celle d’être incapable de se poser mais d’être toujours dans l’anticipation de ce qui doit arriver de sorte le plus souvent de créer ce que l’on a craint :
« La seconde fragilité du capitalisme est son extrême sensibilité à l’égard du futur. Si les firmes pensent que la situation va s’aggraver, les embauches ralentissent et la situation s’aggrave vraiment : les crises peuvent être autoréalisatrices. C’est l’une des différences majeures avec les lois de la physique. En économie, l’anticipation d’un événement peut suffire à le déclencher. L’incertitude liée à la crise sanitaire est d’une autre nature mais tout aussi radicale : on ne sait quel modèle utiliser pour appréhender son évolution. […] Tant que ces questions n’auront pas de réponses, les entreprises resteront attentistes, et aucune ne prendra le risque de recruter. C’est pour cette raison que le flux normal d’entrée et sortie du marché du travail est désormais bloqué et le chômage en train d’exploser. »
Daniel Cohen esquisse des idées et des actions à mener. Elles ne sont pas dans la panoplie du parfait libéral.
« La montée des inégalités et la peur de l’incertitude sont les deux maladies que les politiques publiques doivent guérir. Eviter les licenciements, soutenir les secteurs les plus menacés, maintenir le revenu des personnes en difficulté : toute la panoplie des instruments que la doxa libérale a longtemps décriée doit continuer à être mobilisée pour lutter contre la crise. Une contribution exceptionnelle permettant de payer les loyers des victimes de la crise pourrait être aussi envisagée.
Il faut également réfléchir à des mécanismes innovants, adaptés à l’incertitude du moment. L’économiste Joseph Stiglitz proposait ainsi d’inventer des contrats contingents à l’évolution du virus. Par exemple : vous achetez un appartement à crédit mais le contrat prévoit une clause qui retarde les échéances en fonction de la pandémie. Le coût du report du paiement (pas l’échéance elle-même) serait pris en charge par l’Etat. Une indemnisation plus généreuse du chômage pourrait également être accordée, en alignant le retour à la normale à l’évolution de la situation du marché de l’emploi. Une crise aussi extraordinaire que celle que nous connaissons exige des idées nouvelles. »
Il faut, en effet, des idées nouvelles.
<1447>
-
Lundi 29 juin 2020
«Nous nous dirigeons vers un monde où nous aurons moins de moyens pour plus de problèmes.»Jean-Marc JancoviciJean-Marc Jancovici est un spécialiste de l’énergie et un acteur de la lutte pour une économie décarbonée, c’est-à-dire une économie qui ne crée plus de gaz à effet de serre et ne contribue plus au réchauffement climatique.
Il est ainsi le président du think thank :<THE SHIFT PROJECT> dont l’ambition est justement d’œuvrer en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone. Sur son site il est écrit :
[Nous sommes] une Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe.
Pour renvoyer vers une vidéo de plus de 2 heures, dans laquelle Jancovici répond aux questions des internautes à la fin de la période de confinement le 8 mai 2020, Yann Arthus-Bertrand le présente ainsi
« Jean-Marc Jancovici, […] me fascine toujours par son esprit de synthèse et son bon sens. Cette vidéo dans laquelle il répond aux questions des internautes le démontre une fois de plus : la langue de bois est absente de ses réponses. Ça fait du bien ! Sans être forcément toujours d’accord sur toutes ses propositions, elles méritent d’être écoutées et réfléchies. À écouter absolument car ça fait réfléchir. »
C’est très bien synthétisé, il fait réfléchir, les arguments qu’il apporte sont toujours précis, rationnels.
C’est un esprit très brillant, polytechnicien, Ingénieur Télécom né en 1962.
Si on s’intéresse à son parcours, on constate qu’il est entré très tôt dans la conscience écologique et dans la réflexion sur l’énergie.
Il ainsi collaboré avec l’Ademe Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie pour la mise au point du bilan carbone dont il est le principal développeur.
Il a aussi joué un rôle de premier plan dans la fondation Nicolas Hulot, notamment en étant coauteur du Pacte écologique signé par les différents candidats à la présidentielle de 2007. Par la suite il s’est éloigné de Nicolas Hulot en raison d’un désaccord sur la place de l’énergie nucléaire dans le cocktail énergétique à moyen terme.
 La première fois où je l’ai écouté c’était lors des matins de France Culture du 7 novembre 2019, lors que Guillaume Erner l’avait invité sur le sujet : « Transition énergétique : avons-nous encore le temps ? »
La première fois où je l’ai écouté c’était lors des matins de France Culture du 7 novembre 2019, lors que Guillaume Erner l’avait invité sur le sujet : « Transition énergétique : avons-nous encore le temps ? »
Dans cette émission, il a exposé sa thèse de la prééminence de l’énergie dans la société économique que les humains ont bâti :
« Tout ce que nous avons aujourd’hui dans le monde moderne, notre pouvoir d’achat et les retraites, c’est l’énergie qui l’a permis. »
Dans une interview du <Figaro> il précise sa pensée sur ce point ;
« La quantification économique a pris le pas sur d’autres métriques pour juger l’utilité de quelque chose. On pense spontanément que ce qui est utile vaut cher, que tout ce qui fait notre vie s’achète, or comme l’énergie ne coûte pas très cher dans notre poste de dépense (environ 10% pour un ménage pour logement et transports), le lien de dépendance n’est pas ressenti. Or ce qui fait notre mode de vie : les villes, le pouvoir d’achat, les études longues, le basculement dans le tertiaire, les week-ends, les 35h, les retraites, les six semaines de congés payés, la viande à tous les repas, c’est l’énergie, et très majoritairement les combustibles fossiles.
Les machines sont invisibles dans la convention économique : on continue à dire que les gens travaillent mais en réalité ce sont surtout les machines qui produisent. La puissance des machines dans le monde occidental, c’est 500 fois la puissance des muscles des Occidentaux. Pour que la France produise ce qu’elle produit aujourd’hui, sans machines, il faudrait multiplier sa population par 500 à 1000. Les machines sont totalement dépendantes de l’énergie, qui est un facteur beaucoup plus limitant que la force de travail pour l’économie. On ne se rend pas compte car on juge les choses à travers leur prix, convention humaine qui ne tient pas compte des réalités physiques. Dans le système économique moderne, on a considéré que tout ce qui venait de la nature était gratuit, n’avait pas de prix. En ce sens le pétrole est aussi gratuit que le vent car personne n’a rien payé pour qu’il se forme. La gratuité de ces sources énergétiques fait qu’elles ne sont pas dans notre radar. Nous sommes des urbains déconnectés des flux physiques qui nous permettent de vivre. Le thé que nous sommes en train de boire en ce moment a poussé à des milliers de kilomètres d’ici ! »
Dans l’émission de France Culture je l’ai trouvé assez irritant parce qu’il était méprisant à l’égard des questions de Guillaume Erner.
D’ailleurs cette émission avait conduit à un certain nombre d’articles en soutien à Guillaume Erner et aussi d’auditeurs qui ont écrit et que <La page de la Médiatrice de France Culture > a publié :
« Mon message est un message de soutien et d’encouragement au mérite à l’attention de Guillaume Erne, qui ce matin (jeudi 7 novembre), et à ma complète stupéfaction, a dû essuyer les assauts hautains et répétés de son invité dans la matinale, j’ai nommé M. Jean-Marc Jancovici, […]
Fidèle auditrice de France Culture depuis plus de 40 ans (oui !) […] C’est pourquoi je souhaite vous dire mon indignation après avoir entendu pendant plus d’une heure les propos arrogants […]
En écoutant cette agressivité et cette hargne remplie de certitudes !!! »
Toutefois au-delà de cette tension qui avait davantage à voir avec l’émotion qu’avec l’intelligence, j’ai fait des recherches sur Internet et j’ai constaté qu’en effet cet homme un peu rugueux était quand même quelqu’un d’intéressant qui argumentait et présentait ses réponses sans langue de bois pour reprendre l’expression de Yann Arthus-Bertrand.
Par la suite j’ai compris que Jean-Marc Jancovici est présenté comme un lobbyiste pro-nucléaire et qu’il avait demandé à Guillaume Erner que le sujet du nucléaire ne soit abordé que de manière marginale. Guillaume Erner ne respecta pas cette promesse.
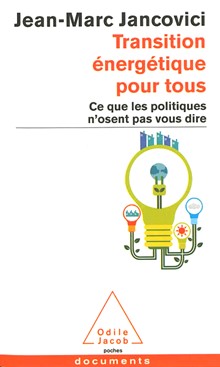 Jancovici défend en effet la conservation d’une énergie nucléaire conséquente mais uniquement pour atténuer l’impact sur nos modes de vie de la diminution de l’énergie carbonée.
Jancovici défend en effet la conservation d’une énergie nucléaire conséquente mais uniquement pour atténuer l’impact sur nos modes de vie de la diminution de l’énergie carbonée.
Laissant de côté l’affect et l’irritation je suis revenu vers ses arguments :
« Donc discuter de l’énergie, c’est discuter de tout ce qui nous entoure aujourd’hui. L’essentiel de ce qui permet ça dans le monde, ce n’est pas du tout le nucléaire, ce sont les combustibles fossiles, c’est à dire le pétrole, le charbon ou le gaz. Il se trouve qu’en France, deux tiers de nos émissions de CO2, c’est à dire ce qui provoque le changement climatique, viennent du pétrole, un quart vient du gaz, 5% vient du charbon, et 0% du nucléaire. Le nucléaire a des inconvénients. Mais ne parler que du nucléaire est quelque chose qui finit par devenir un peu contre-productif. […]
Le risque zéro n’existe pas. Par contre, ce qui est dommage aujourd’hui, c’est que dans le public il y a une compréhension du risque nucléaire qui est totalement erronée. Je vais vous donner un premier exemple de faillite médiatique : 80% des Français pensent que le nucléaire contribue au changement climatique. Il peut avoir tous les défauts de la Terre, mais pas celui-là. Les déchets nucléaires font plus peur à la population que, tenez-vous bien, les accidents de la route ou que les accidents domestiques. Les accidents domestiques, c’est 20 000 morts par an. Les déchets nucléaires, c’est zéro. Ça fait plus peur que l’obésité chez les jeunes, ça fait quasiment aussi peur que le tabagisme. »
Pour résumer ce qu’il dit :
- La priorité c’est de diminuer les énergies fossiles qui augmentent la température ;
- Selon lui cette diminution nécessite que nous devenions beaucoup plus sobres et consommions beaucoup moins d’énergie. Ce qui aura pour conséquence une diminution de notre train de vie
- Il pense pour différentes raisons que les énergies renouvelables solaires et éoliennes ne pourront pas remplacer le pétrole, le gaz et le charbon d’abord parce qu’ils donnent de l’énergie intermittente dépendant du soleil et du vent et d’autre part parce qu’ils nécessitent pour leur construction et leur renouvellement d’éléments très perturbants écologiquement et qu’enfin il nécessite une grande emprise foncière pour pouvoir fonctionner.
- Ainsi pour atténuer l’atterrissage comme dirait Bruno Latour, le moindre mal reste l’énergie nucléaire.
Il dit :
« Globalement, il faut baisser de 4% par an nos émissions de CO2. Alors là-dedans, ni les énergies renouvelables, ni le nucléaire ne permettront de compenser cette baisse pour conserver le confort moderne. Il faut bien comprendre que de lutter contre le changement climatique, c’est de se mettre au régime. […] Le non-dit politique majeur aujourd’hui, c’est que cela n’est pas compatible avec la croissance économique. Ce n’est même pas compatible avec le maintien de la production économique actuelle. Donc, cela veut dire perte de pouvoir d’achat, pour être très clair, pour tout le monde, pas juste pour les riches. »
Pour lui, tous ou quasi tous les occidentaux sont concernés et consomment trop d’énergie. Il a ajouté, dans un autre article, dans ce monde de diminution, les inégalités actuelles avec les hyper riches seront encore plus insupportables.
Il a été réinvité par Guillaumer Erner, dans une émission beaucoup plus calme avec des échanges beaucoup plus apaisées le 14 mai 2020 : <La pandémie va-t-elle accélérer la transition énergétique>
C’est lors de cette émission qu’il a eu cette phrase que j’ai mis en exergue :
« Nous nous dirigeons vers un monde où nous aurons moins de moyens pour plus de problèmes »
Dans cette émission il a apporté une nouvelle analyse que je n’ai pas entendu ailleurs :
« Il y a une transition énergétique cachée derrière cette crise dont on ne se rend pas compte qui concerne le pétrole. Avant la crise du covid, la production de pétrole dans le monde s’est arrêtée de croitre depuis maintenant un an et demi. Et le covid n’a fait qu’accélérer cette tendance-là. La crise économique a fait plonger les prix du pétrole vers le bas. Et l’offre de pétrole va baisser. […]
La transition énergétique qui va se faire sans qu’on s’en rende compte, c’est que l’après ne pourra pas revenir au niveau de l’avant parce qu’il n’y aura pas assez de pétrole. Donc, une partie du tourisme ne pourra pas revenir. Quoi qu’on fasse, une partie des déplacements ne pourra pas revenir quoi qu’on fasse tout comme une partie de l’économie. »
[…] On va opérer graduellement une transition de force car on n’a pas voulu faire celle qui était de gré. En ce moment la transition énergétique est une diminution de la consommation subie. En France comme dans beaucoup de
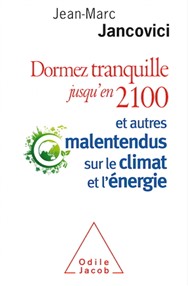 pays européens, on voit la transition énergétique comme une évolution technologique dans un univers en croissance. On a des lois en France de « croissance verte ». En fait, la transition énergétique va passer par une privation du pétrole, du charbon et du gaz. Donc toute cette production va se contracter et l’économie va elle-même se contracter. Et la grande question est d’organiser un monde dans lequel il n’y a pas de plus en plus mais de moins en moins. […] »
pays européens, on voit la transition énergétique comme une évolution technologique dans un univers en croissance. On a des lois en France de « croissance verte ». En fait, la transition énergétique va passer par une privation du pétrole, du charbon et du gaz. Donc toute cette production va se contracter et l’économie va elle-même se contracter. Et la grande question est d’organiser un monde dans lequel il n’y a pas de plus en plus mais de moins en moins. […] »
La voiture électrique ne trouve pas non plus grâce à ses yeux. Il pense plutôt qu’il faut remplacer les SUV par des petites voitures :
« La chose la plus évidente pour remplacer une voiture qui consomme 6L/100km, c’est de la remplacer par une voiture qui consomme 2L/100Km. Il y a aussi le passage sur le vélo, le vélo électrique en particulier, est quelque chose qui a un potentiel très important dès que vous avez 10 ou 15 km à faire, parce que c’est un vélo sans effort. Le problème du vélo électrique, c’est de construire des pistes cyclables pour avoir une voirie séparée pour les vélos. »
Dans l’article du Figaro, déjà cité, il donne des pistes qui lui semblent judicieuses pour les individus afin de diminuer leur empreinte carbone :
« Pour les individus : Nous avons sorti une étude avec Carbone 4 intitulée « Faire sa part» pour essayer de calculer comment diminuer de moitié son empreinte carbone par des gestes et des investissements sans que ça soit trop violent. Il y a quatre gros postes d’émissions carbone chez les particuliers. D’abord l’alimentation : un premier geste peut être de manger moins de viande. En France, il faudrait diviser le cheptel bovin par deux et multiplier les prix unitaires par trois pour que les éleveurs puissent se payer correctement. Ensuite, les déplacements. Le particulier doit privilégier les voitures les plus petites possibles, et les déplacements sans voiture (bus, vélo, marche, train, diminution des trajets en portée, ou covoiturage). L’état devrait mettre une prime à la casse extrêmement élevée dès lors qu’on achète une voiture neuve qui consomme moins de la moitié de l’ancienne. Il peut aussi remettre en place la vignette et réglementer à la baisse les émissions des voitures neuves. Troisième poste d’émission : la consommation : il faut acheter moins de « tout », que ce soit des vêtements ou de l’électronique (cette dernière représente un pas qui croit très vite!). Enfin, le chauffage : on peut baisser le thermostat, isoler, ou changer sa chaudière fioul ou gaz pour une pompe à chaleur ou au bois en milieu rural. »
C’est donc une pensée sans concession, mais qui me semble indispensable à connaître et à lire, pour réfléchir et se poser des questions pertinentes.
Rien n’interdit cependant d’apporter d’autres réponses que Jankovici. Il dispose d’un site que vous trouverez derrière ce lien : https://jancovici.com/ Ce mot du jour a été publié le jour de la fermeture définitive de la centrale nucléaire de Fessenheim.
<1446>
- La priorité c’est de diminuer les énergies fossiles qui augmentent la température ;
-
Vendredi 26 juin 2020
«Pause»Un jour sans mot du jourPas de mot du jour nouveau aujourd’hui.
 Le 26 juin 2019 je faisais une nouvelle fois appel à Michel Serres pour parler des nomades et des sédentaires :
Le 26 juin 2019 je faisais une nouvelle fois appel à Michel Serres pour parler des nomades et des sédentaires :
« Je ne crois pas que l’on puisse imaginer un monde sans agriculture. »
Un combat éternel disait-il.
L’agriculteur est un sédentaire.
Et il en référait même à Cain et Abel.
Ce sont les nomades qui sont les vainqueurs de la mondialisation.
Mais le COVID fait s’interroger sur le nomadisme effréné.
<Mot sans numéro>
-
Jeudi 25 juin 2020
«Le point Godwin»L’instant dans un débat ou dans une discussion où apparait la comparaison avec Hitler ou les nazisAu commencement, il n’était pas question de « point » mais de Loi Godwin et cette dernière s’appliquait aux discussions en ligne. Reprenons cela.
C’est un avocat américain qui s’appelle Mike Godwin qui a énoncé cette Loi empirique en 1990 :
« Plus une discussion en ligne dure, plus la probabilité d’y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s’approche de un. »
Ce qui signifie que la probabilité qu’elle se réalise est proche de 100%
Xavier de La Porte avait consacré une chronique en 2014 à ce sujet : <Pour en finir avec le point Godwin>. Il rappelle que Mike Godwin a réalisé ses observations sur Usenet qui constituait des prémices de l’Internet .
C’est pourquoi cette règle s’appliquera facilement à Internet dans une logique de continuité.
Xavier de La Porte fait remonter cette Loi à un philosophe allemand :
« En fait, Mike Godwin applique aux conversations en ligne un phénomène identifié dès le début des années 1950 par le philosophe Léo Strauss sous le nom de « reductio ad hitlerum » (« réduction à Hitler »), et qui consiste à disqualifier l’argumentation de l’adversaire en l’associant à Hitler, au Nazi ou à toute autre idéologie honnie de l’Histoire. »
<Wikipedia> est une nouvelle fois d’un grand secours et permet d’apporter à la fois des nuances et des précisions.
Dans son application première, la Loi de Godwin entend conceptualiser ce moment où l’argument disparaît pour être transformé en des analogies extrêmes essayant de discréditer la position de l’adversaire. Il constitue aussi l’arrêt de la discussion puisque les arguments cessent.
La nuance est que la comparaison avec les nazis n’est pas toujours une figure rhétorique mais peut être légitime quand des paroles ou des actions peuvent rappeler l’époque nazi. C’est le cas lorsque certains commencent à évoquer des discriminations ethniques ou religieuses.
Par exemple, Mike Godwin est intervenu lui-même dans la presse au cours des manifestations de Charlottesville d’août 2017 (rassemblant des supremacistes blancs, des néonazis et d’autres branches de l’alt-right américaine) pour dire que, bien sûr, les participants aux marches pouvaient être comparés à des nazis :
Mais ce n’est pas dans ce cas que la Loi Godwin est pertinente. Il faut plutôt que le sujet de la discussion soit très éloigné d’un quelconque débat idéologique, une comparaison de ce genre est alors considérée comme un signe d’échec de la discussion.
Wikipedia précise :
« Selon Mike Godwin, « le point Godwin » est une expression qui s’est développée dans les milieux francophones : « Pour être tout à fait clair, j’ai inventé la « loi de Godwin », pas « le point Godwin » – cette expression s’est développée chez les francophones. Ceux-ci parlent de « point Godwin » quand ils atteignent, dans la discussion, le stade de la comparaison avec les nazis : ils se décernent mêmes des « points Godwin » par dérision ! J’apprécie cette inventivité linguistique mais, à ma connaissance, cette expression est propre aux francophones.»
C’est pourquoi je trouve intéressant de parler de « point » à partir duquel il est temps de clore le débat, dont il ne sortira plus rien de pertinent.
 On dit que l’on a atteint le « point Godwin » de la discussion. Wikipedia analyse :
On dit que l’on a atteint le « point Godwin » de la discussion. Wikipedia analyse :
« Bien que le point Godwin ait originellement le sens de « point de non-retour », les francophones jouent sur deux sens du mot « point », qui peut désigner :
- soit le moment de la discussion auquel le dérapage survient ; dans ce sens du terme, on atteint le point Godwin ;
- soit le point en tant que récompense ou mauvais point attribué au participant qui aura permis de vérifier la loi de Godwin en venant mêler Adolf Hitler, le nazisme ou toute idéologie extrémiste à une discussion dont ce n’est pas le sujet ; dans ce sens du terme, on marque ou gagne un point Godwin.»
Recevoir un point Godwin devrait faire réaliser qu’on a été ridicule dans son argumentation.
Il existerait même des « remises de prix » publiques de points Godwin.
Depuis, le point Godwin s’est étendu à d’autres sphères qu’internet.
Par exemple le domaine politique : Le chef d’Etat Recep Tayyip Erdogan, en 2017 a comparé les Pays-Bas et l’Allemagne aux nazis parce que ces deux pays européens avaient refusé l’organisation de meeting turc sur leur territoire.
Pourquoi je parle aujourd’hui du point Godwin ?
Parce que je n’en ai jamais parlé et que cela étend encore les sujets évoqués par le mot du jour.
Mais aussi, parce qu’il a été atteint dans les élections municipales et métropolitaines à Lyon.
Vous savez qu’il est possible que les écologistes s’emparent de la mairie de Lyon et aussi de la métropole de Lyon. C’est pour cette raison que Gérard Collomb s’est associé à la Droite pour éviter ce résultat.
Dans un premier temps, assez naturellement Collomb et ses alliés ont traité les écologistes d’incompétents.
Puis, ils sont allés plus loin, comme le rapporte de journal <Les Echos> Ils les ont traités « d’extrémistes »
« Son camp et celui de la droite dénonçaient le « péril rouge-vert » et « l’extrémisme écologiste ». »
Puis des textes et des mails ont circulé, Annie en a reçu, dans les milieux économiques pour appeler à faire barrage aux écologistes.
Ils se sont nommés « des Acteurs de Lyon ». Ce collectif revendique l’anonymat, de peur d’exposer leurs entreprises qui dépendent parfois de la commande publique.
On peut lire par exemple :
« Les écologistes, c’est la décroissance et la misère. »
Une étape plus loin, Christophe Marguin, président des Toques Blanches lyonnaises qui est une associations de cuisiniers opérant à Lyon, a traité les électeurs des écologistes de « connards ».
Cet homme inélégant est lui-même chef cuisinier du restaurant « Le Président », il est aussi candidat sur la liste LR dans la circonscription Lyon Nord.
Et enfin…
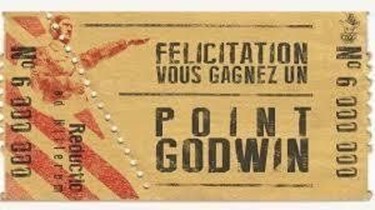 Le Point Godwin a été atteint par un bijoutier lyonnais : Jean-Louis Maier
Le Point Godwin a été atteint par un bijoutier lyonnais : Jean-Louis Maier
<Lyon Capitale> rapporte :
« Jean-Louis Maier a franchi un nouveau cap dans un podcast d’Arte Radio publié ce mercredi en comparant les Verts à Adolf Hitler. « Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement. Ce n’était pas une bonne idée », lâche-t-il. « Le danger est au même niveau entre l’arrivée de Bruno Bernard à la tête de la métropole et celle d’Adolf Hitler pour la population lyonnaise ? », le reprend le journaliste. « Oui. Quand vous avez perdu la démocratie vous ne la retrouvez pas facilement », répond, le ton presque inquiet, Jean-Louis Maier. »
Je pense que nous pouvons attribuer le Point Godwin à Monsieur Jean-Louis Maier.
Je me demande quand même si toutes ces agitations ne sont pas contreproductives et ne vont pas conduire des électeurs moins convaincus à voter vert pour rejeter tous ces excès.
Et je ne résiste pas à finir ce mot du jour par une affiche d’antan
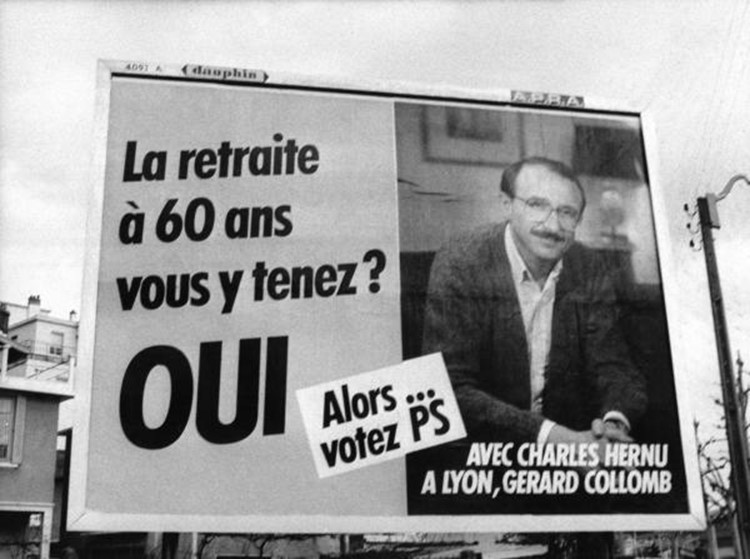 Gérard Collomb n’avait pas expliqué, à cette époque, qu’il était pour la retraite à 60 ans …
Gérard Collomb n’avait pas expliqué, à cette époque, qu’il était pour la retraite à 60 ans …
pour les autres …
Il a fêté le 20 juin ses 73 ans. Dans 6 ans à la fin du mandat qui commencera après les prochaines élections il en aura 79.
<1445>
- soit le moment de la discussion auquel le dérapage survient ; dans ce sens du terme, on atteint le point Godwin ;
-
Mercredi 24 juin 2020
«L’antiracisme est un combat juste. Il ne doit pas devenir un acte de vandalisme intellectuel ou de désordre dans ce monde si fragile.»Kamel DaoudLors des derniers mots du jour, j’ai évoqué à plusieurs fois le racisme de blancs à l’égard des noirs, des crimes contre les noirs et des questions de mémoire aussi.
La mémoire que l’on met en avant dans un récit et qui se reflète dans des statues que l’on érige dans les villes ou les noms qu’on donne à des boulevards ou des avenues et aussi ceux qu’on donne à des ruelles ou des impasses.
Lundi, j’évoquais la proposition de donner le nom de Franz Fanon à une ruelle d’un nouveau quartier de Bordeaux. Ce n’était pas grand-chose, ce n’était qu’une ruelle. Mais c’était encore trop pour ceux qui continuent à raconter le récit de l’Algérie française. Dans ce récit un opposant au colonisateur ne peut pas être honoré, même d’une ruelle.
En revanche, il n’y a pas de problème en France d’avoir des rues et des statues au nom du Maréchal Bugeaud qui fut un responsable de la colonisation de l’Algérie. C’est la réflexion que je me faisais, hier soir, en passant par la rue Bugeaud dans le cossu 6ème arrondissement de Lyon.
Une avenue parisienne porte son nom dans le 16e arrondissement de Paris qui est un peu l’équivalent du 6ème de Lyon. La place centrale de la ville de Périgueux porte une monumentale statue de ce maréchal de France. J’ai lu qu’une rue porte aussi son nom dans le 3ème arrondissement de Marseille.
Le Maréchal Bugeaud qui a dit
« Le but n’est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile ; il est d’empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, […] de jouir de leurs champs […]. Allez tous les ans leur brûler leurs récoltes […], ou bien exterminez-les jusqu’au dernier. »
Ou encore
« Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Sbéhas ! Fumez-les à outrance comme des renards. »
Cet article <des Inrocks> donne la parole à Benjamin Stora pour essayer de décrire le personnage et ses actes.
Article qui avait été écrit après qu’Eric Zemmour ait dévoilé son récit de la France, qu’hélas un trop grand nombre partage :
« Quand le général Bugeaud arrive en Algérie, il commence à massacrer les musulmans, et même certains juifs. Eh bien moi, je suis aujourd’hui du côté du général Bugeaud. C’est ça être Français ! »
Voilà qui est dit !
Mais s’il est possible de s’interroger, de se poser des questions sur ce sujet des récits, sur des hommes qu’on a mis en avant jusqu’à présent et aussi sur les femmes et les hommes qu’on pourrait aujourd’hui mettre en avant, il est tout aussi possible de ne pas partager tous les combats de celles et ceux qui aujourd’hui se prétendent de la lutte antiraciste.
On peut désapprouver une femme noire qui insulte un policier de peau noire et le traite de <vendu> parce que selon ses préjugés antiracistes, on ne peut être noir et policier de la République. Pour elle un policier est blanc et c’est la police des blancs. Avec ce type de réaction, nous n’allons pas avancer beaucoup dans notre société.
C’est ce que dénonce Caroline Fourest dans son livre « génération offensée » dans lequel elle dénonce l’antiracisme identitaire et des procès en appropriation culturelle qui peuvent menacer la liberté d’expression et de création artistique. Puisque pour ces antiracistes, un blanc ne peut pas avoir un discours ou créer un ouvrage artistique qui défend les noirs ou simplement dénonce l’injustice qui leur est faite. Il n’a pas le droit de le faire parce qu’il n’est pas noir et ne peut donc pas comprendre les souffrances et les sentiments des noirs.
J’aime beaucoup Caroline Fourest.
 J’aime aussi Kamel Daoud qui est un esprit libre et qui comme Caroline Fourest aspire à une pensée universaliste et non sectaire.
J’aime aussi Kamel Daoud qui est un esprit libre et qui comme Caroline Fourest aspire à une pensée universaliste et non sectaire.
Car, avant, le contraire du raciste était l’universaliste celui qui considérait que tous les humains étaient égaux et que chaque humain avait le droit de défendre un autre humain même s’il n’appartenait pas à sa tribu. Et chaque humain avait le droit de critiquer sa tribu et des humains de sa tribu.
Rien de tel chez beaucoup d’antiracistes d’aujourd’hui, pour qui la défense de sa tribu ne permet aucune nuance.
Kamel Daoud est universaliste et il est ainsi critiqué parce qu’on le soupçonne de trahir sa tribu. Le journal algérien « El Watan » rapporte, en janvier 2020, les propos de Rachid Boudjedra, l’auteur de « la Répudiation », sur Kamel Daoud :
« Kamel Daoud dont les œuvres récentes, sont idéologiquement plus référencées à la mentalité de l’ancien colonisateur qu’au patrimoine historique et culturel de son pays. Il lui adressa en ce sens une critique sans concession qui a eu du mal à passer dans les milieux intellectuels algériens, une diatribe frontale pour lui signifier que sa « soumission » psychologique à l’intelligentsia outre-Méditerranée est une véritable dérive. Le rapport à l’écriture est ainsi vu comme une grave altération à la liberté de penser et de s’exprimer à partir de l’instant où il devient dépendant et s’exécute en fonction d’un imaginaire trompeur et souvent perfide, qui va trop loin aussi dans la déformation de la vérité. »
Et le journal d’ajouter :
« Tout est sciemment articulé autour de ce « lien » avec l’ancien colonisateur qui doit être visible et pas seulement suggéré »
Kamel Daoud a publié une tribune dans le journal le Monde publié le 22/06/2020, tribune que je veux partager aujourd’hui : « L’Occident est imparfait et à parfaire, il n’est pas à détruire »
Il interroge d’abord sur cette obsession de vouloir détruire, piétiner l’occident :
« Faut-il détruire l’Occident ? Le mettre à feu et à sang pour mieux le reconstruire ou mieux le piétiner dans ses ruines ? […] On aura beau le nier et le relativiser, il y a déjà un instinct de mort dans les airs de la révolution totale imaginée par chacun. L’Occident étant coupable par définition selon certains, on se retrouve non dans la revendication du changement mais, peu à peu, dans celle de la destruction, la restauration d’une barbarie de revanche. »
Il ne faudrait en effet pas oublier que les arabes ont aussi été des colonisateurs et ont aussi été des très grands esclavagistes.
Quand aujourd’hui on ne critique que l’occident démocratique et qu’on est complaisant, voire admiratif pour la Chine qui est un pays totalitaire avec un régime oppressif qui ne connait aucun contre-pouvoir, ne fait-on pas fausse route ?
Kamel Daoud signale cette faiblesse de critiquer ceux qui acceptent la critique et de ne pas critiquer ceux qui font pire mais qui ne tolèrent pas la contradiction.
« Ces procès anti-Occident à la soviétique, si faciles et si confortables, à peine coûteux quand on ne vit pas dans la dictature qu’on a fuie, menés par les intellectuels du sud en exil confortable en Occident ou par des fourvoyés locaux sont une impasse, une parade ou une lâcheté. Ils n’ont ni courage, ni sincérité, ni utilité. […]
La règle de ce confort est qu’il est plus facile de déboulonner la statue d’un tyran, au nord, sous les smartphones, que de déboulonner un vrai tyran vivant au « sud ». Et il n’est pas même utile de répondre à ceux qui, lorsque vous tenez ces propos pourtant réalistes, vous accusent de servilité intellectuelle. »
Et il fait ce que lui reproche le journal « El Watan » il ne trouve pas tous les torts du côté de l’occident et tous les vertus du côté de ceux qui le critique :
« Le fait même de défendre l’Occident comme espace de liberté, certes incomplète et imparfaite, est jugé blasphématoire dans cette nouvelle lutte des classes et des races. Il est interdit de dire que l’Occident est aussi le lieu vers où l’on fuit quand on veut échapper à l’injustice de son pays d’origine, à la dictature, à la guerre, à la faim, ou simplement à l’ennui. Il est de bon ton de dire que l’Occident est coupable de tout pour mieux définir sa propre innocence absolue. […]
Erreurs et illusions coûteuses. L’Occident est à la fois coupable et innocent. Or, tuer un coupable ne brise pas la chaîne de la douleur. Elle fait échanger les robes des victimes et des bourreaux. On le sait tous, et c’est une banalité utile à remémorer.
Il est urgent de rappeler que sur les colères d’aujourd’hui se greffent trop de radicalités pour qu’on puisse éviter la violence si on continue dans le même aveuglement. Brûler l’Occident, ce rêve si facile qu’Internet et ces militants agitateurs des réseaux commercialisent en guise de « néopureté » et de légitimité, est une erreur qui aura de lourdes conséquences. »
On se retrouvera, dans quelques décennies, à vivre dans ces champs nus, à construire la barbarie qu’on a cru dénoncer. »
Voilà des paroles fortes et j’aime particulièrement sa conclusion :
« Monstrueux quand il a faim, selon l’expression d’un internaute, injuste et au passé vandale, beau, fascinant dans la nuit du monde, nimbé dans le rêve et le fantasme pour le migrant, vertueux par une démocratie inachevée, hypocrite à cause de sa prédation des ressources, son passé colonial tueur, inconscient et heureux, l’Occident est ce qu’il est : imparfait et à parfaire. Il n’est pas à détruire. Ceux qui en rêvent sont ceux qui n’ont pas su avoir de rêve meilleur que la barbarie de revanche, pas su dépasser des rancunes intimes. […] L’antiracisme est un combat juste. Il ne doit pas devenir un acte de vandalisme intellectuel ou de désordre dans ce monde si fragile. Son but est un avenir meilleur, pas un passé aveuglant […] »
Paroles de la nuance, de la complexité.
Non pas un monde binaire dans lequel d’un côté il y a tout le bien et de l’autre tout le mal.
<1444>
-
Mardi 24 juin 2020
«Requiem pour Wolf Musique, institution de la vie musicale européenne depuis près de deux siècles.»Titre du Figaro annonçant la fermeture de ce magasin de musique de StrasbourgC’était une institution strasbourgeoise de 195 ans, située 24 rue de la Mésange. C’est-à-dire la rue qui relie la Place de Broglie où se trouve l’Hôtel de ville et l’Opéra du Rhin et la Rue des Arcades qui permet d’atteindre, en deux pas, la Place Kléber. Nous sommes dans l’hyper centre de Strasbourg.
 Cette institution était un magasin de musique : « Wolf Musique » l’un des plus anciens magasins de musique de France.
Cette institution était un magasin de musique : « Wolf Musique » l’un des plus anciens magasins de musique de France.
Ce magasin a été fondé en 1825 par Seeligman Wolf, négociant juif dont la famille venait d’Allemagne.
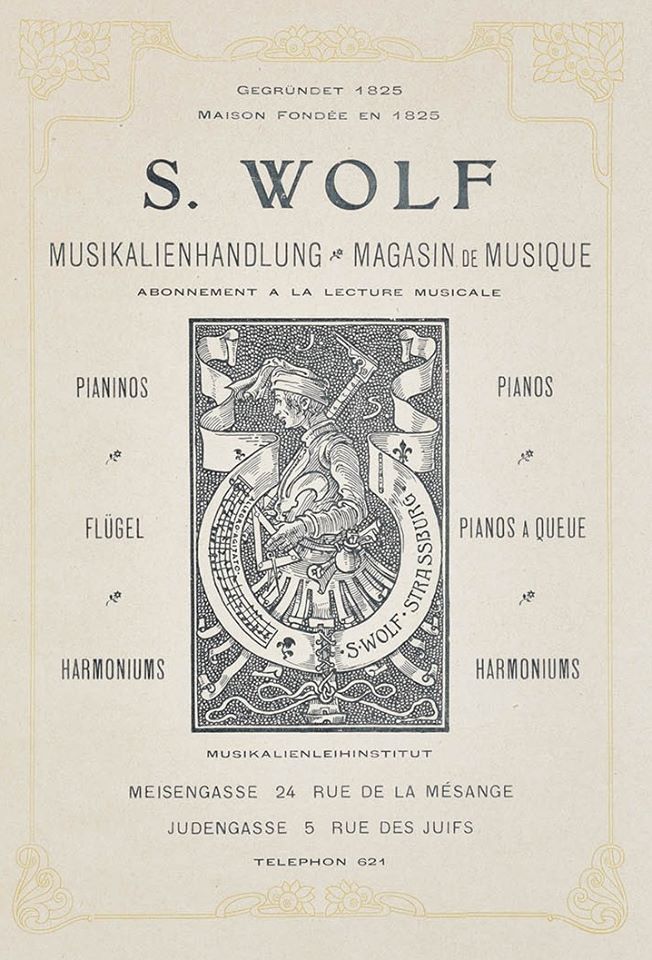 Mais en 1825, Strasbourg était française et la France était dans cette période que l’on appelait « La Restauration ». Charles X venait de succéder à son frère, Louis XVIII décédé en septembre 1824.
Mais en 1825, Strasbourg était française et la France était dans cette période que l’on appelait « La Restauration ». Charles X venait de succéder à son frère, Louis XVIII décédé en septembre 1824.
Strasbourg va devenir allemand entre 1870 et 1918.
C’est pendant cette période, qu’en 1905 c’est passé un évènement qui faisait, encore de nos jours, la fierté de ce magasin :
C’est <Le Figaro> qui le raconte le plus précisément :
« Mais sa légende, c’est à deux compositeurs qu’il la doit. Dix ans plus tard, à l’été 1905, Richard Strauss et Gustav Mahler se retrouveront dans sa boutique. Là, au milieu des instruments, Strauss s’accompagnant lui-même au piano, lui fera lecture, en chantant, de son opéra Salomé tout juste achevé. Alma Mahler, épouse du chef et compositeur, témoignera de la réaction enthousiaste de ce dernier en même temps que de l’excitation du moment : « Nous arrivâmes au passage de la Danse des sept voiles. « Ça, je ne l’ai pas encore écrit », dit Strauss, et il continua à jouer, après ce grand vide, jusqu’à la fin. Mahler suggéra : « N’est-il pas dangereux de laisser de côté la danse, et de l’écrire plus tard quand on n’est plus dans l’atmosphère du travail ? » Alors Strauss se mit à rire de son rire frivole : « ça, j’en fais mon affaire ! » » Quelques semaines plus tard, à tête reposée, Mahler lui-même exprimera par écrit à Strauss, encore grisé par l’émotion :
« C’est votre sommet. Oui, je prétends que rien de ce que vous avez écrit jusqu’à présent ne peut se comparer à cela…» »
 Wolf Musique était une véritable institution pour tout le monde musical français et une bonne partie du monde musicale d’outre-Rhin.
Wolf Musique était une véritable institution pour tout le monde musical français et une bonne partie du monde musicale d’outre-Rhin.
La boutique avait commencé, en 1825, par vendre des partitions, au début du XXème siècle des instruments s’y ajoutèrent.
Lazare Wolf, fils du fondateur, eu l’idée d’ajouter à son activité de vente, l’organisation de concerts.
Et c’est ainsi que les plus grands musiciens se sont retrouvés dans le magasin ou liés d’une manière ou d’une autre à l’institution. Richard Strauss et Gustav Mahler qui dirigèrent des concerts de leurs œuvres à Strasbourg dans des concerts organisés par Wolf Musique furent les plus grands. Mais on peut aussi citer Hans von Bülow, Furtwaengler, Klemperer et Charles Münch le régional de l’étape.
Après les années 1950, le magasin vendit aussi des disques et du matériel Hifi. Lors des 3 années que j’ai passées à Strasbourg entre 1976 et 1979, j’y allais régulièrement pour les disques. Je me souviens même d’y avoir acheté les 9 symphonies de Beethoven par Klemperer. La FNAC est arrivée à Strasbourg en 1978, Wolf a pu résister 10 ans pendant lesquels il a encore vendu des disques.

Le séisme provoqué par l’arrivée des grandes surfaces contraint Wolf Musique à se recentrer sur la vente d’instruments de musique et de partitions.
Wolf Musique créa aussi le célèbre Festival de Musique de Strasbourg.
La première édition eut lieu en 1932 avec le Philharmonique de Berlin sous la direction de Furtwängler. Wolf musique continua à participer à l’organisation de ce festival jusqu’en 2013. En 2014 le festival s’arrêta suite au dépôt de bilan de la Société des Amis de la Musique de Strasbourg… Dépôt de bilan annonciateur de celui de Wolf Musique, six années plus tard : fragilisé comme de nombreux professionnels du secteur par la montée en puissance d’internet, la vente en ligne puis par la baisse de clientèle liée aux attentats de 2015, qui ont amené les autorités à renforcer les mesures de sécurité autour du marché de Noël et à boucler une partie du centre-ville.
La pandémie lui aura donné le coup de grâce. Wolf Musique, n’a pas survécu à la crise économique liée au coronavirus, la boutique a baissé son rideau définitivement samedi 13 juin 2020.
Le magasin comptait encore 6 salariés. Dans les années 1960, Wolf Musique connaissait son âge d’or avec 49 employés répartis dans 9 boutiques
Cette fermeture n’est pas passée inaperçue, les sites et journaux ont donné un écho à cet évènement :
France Musique : <A Strasbourg, fermeture de Wolf, l’un des plus anciens magasins de musique de France>
Le Figaro <Requiem pour Wolf Musique, institution de la vie musicale européenne depuis près de deux siècles>
Le Parisien : <Strasbourg : Wolf, le plus vieux magasin de musique de province, tire le rideau>
Le Monde : <A Strasbourg, Wolf, institution du monde de la musique, fait entendre ses dernières notes>
 Cette faillite, rendue inéluctable par la perte de son chiffre d’affaires liée au Covid-19, n’est pas un cas isolé. Il vient s’ajouter à une liste hélas grandissante de vénérables lieux de culture et de musique, victimes un peu partout dans le monde des conséquences économiques du coronavirus.
Cette faillite, rendue inéluctable par la perte de son chiffre d’affaires liée au Covid-19, n’est pas un cas isolé. Il vient s’ajouter à une liste hélas grandissante de vénérables lieux de culture et de musique, victimes un peu partout dans le monde des conséquences économiques du coronavirus.
Le Figaro écrit :
« C’est ainsi que l’on a appris, il y a quarante-huit heures, la fermeture du plus ancien disquaire de Manhattan, à New York : Record Mart, fondé en 1958. Le mois dernier, c’était aussi le choc pour de nombreux mélomanes et musiciens néerlandais, qui découvraient que Hampe & Berkel, la plus ancienne boutique d’instruments et partitions d’Amsterdam, venait de mettre définitivement la clef sous la porte, après 178 ans de bons et loyaux services. »
Le monde de la musique et plus généralement de la culture est terriblement impacté par cette crise économique.
Souvent des institutions étaient déjà fragilisées en raison de l’évolution des modes de consommation, le COVID-19 a été dans ces cas l’épreuve de trop..
D’autres commerces aussi sont impactées.
Que deviendront nos villes quand un nombre de plus en plus important de commerces fermeront leurs portes et leurs vitrines ?
On me dit qu’Amazon va bien…
<1443>
-
Lundi 22 juin 2020
«Pause»Un jour sans mot du jourPas de mot du jour nouveau aujourd’hui.
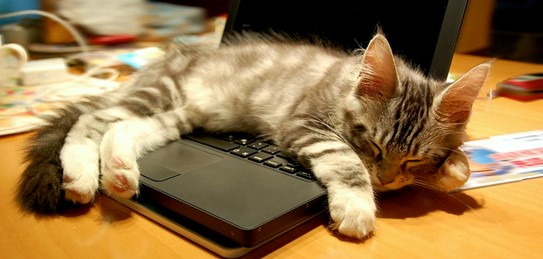 Les derniers mots du jour concernaient le racisme anti-noir et aussi le récit un peu étriqué que la France faisait à travers les statues qui parent nos villes comme aussi les noms des avenues, boulevards et rues.
Les derniers mots du jour concernaient le racisme anti-noir et aussi le récit un peu étriqué que la France faisait à travers les statues qui parent nos villes comme aussi les noms des avenues, boulevards et rues.
Le nombre d’hommes blancs ayant un rôle plus ou moins étroit avec les choses militaires est proportionnellement excessivement important.
S’il faut trouver des hommes de peau noire, on pourrait laisser une place à Franz Fanon.
Je lui avais consacré le mot du jour du 27 février 2019.
Et ce mot du jour donnait comme information que justement à Bordeaux
« Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a décidé de «surseoir» à la proposition de nommer une ruelle d’un des nouveaux quartiers de la ville du nom de Frantz Fanon (grande figure anticolonialiste). «Aujourd’hui, le choix du nom de Frantz Fanon suscite des incompréhensions, des polémiques, des oppositions que je peux comprendre. Dans un souci d’apaisement, j’ai donc décidé de surseoir à cette proposition», »
Gallieni, Bugeaud et d’autres assassins ne posent pas problème, en revanche Franz Fanon non.
Que lui reprochait t’on ?
« L’opposition municipale Rassemblement National ainsi que des internautes avaient critiqué le choix de nommer cette ruelle du nom de l’humaniste martiniquais, proche du Front de libération nationale (FLN) algérien qui a mené la guerre d’indépendance contre la France. »
La manière dont on nomme les rues constitue un récit et un choix que l’on fait dans la hiérarchie des mémoires qu’on veut privilégier.
<Mot sans numéro>
-
Vendredi 19 juin 2020
«Le Tata sénégalais de Chasselay»Cimetière militaire de la Seconde Guerre mondialeC’était il y a 80 ans.
Des hommes venant majoritairement du Sénégal, mais aussi du Mali, de Guinée, de Côte d’Ivoire, du Gabon se sont battus pour la France en 1940. Ils appartenaient à toutes les ethnies de la région, peuls, bambaras ou malinké. On les appelait les « tirailleurs sénégalais » mais on leur avait aussi donné le nom d’« armée noire ». Wikipedia nous apprend que jusqu’en, 1905, ce corps intégrait des esclaves rachetés à leurs maîtres locaux.
En 1940, ils faisaient encore partie de l’empire colonial français.
L’armée française les avait convaincus de venir se battre au côté de leur colonisateur pour défendre la France qui était attaqué par l’Allemagne nazi.
Et en juin 1940, le 25e régiment de tirailleurs sénégalais fait partie des troupes déployées au nord de Lyon, sur une ligne de défense censée retarder l’entrée des Allemands dans Lyon.
Ces affrontements des 19 et 20 juin sont parmi les derniers combats de la campagne de France.
 Ce sont des combats de l’inutile car la bataille de France est déjà perdue, le 17 juin, le maréchal Pétain a annoncé un cessez-le-feu et demandé l’armistice, signé le 22 juin à Rethondes, le 18 juin qui reste la date la plus célèbre de juin 40, le général de Gaulle appelle, depuis Londres les Français à poursuivre le combat.
Ce sont des combats de l’inutile car la bataille de France est déjà perdue, le 17 juin, le maréchal Pétain a annoncé un cessez-le-feu et demandé l’armistice, signé le 22 juin à Rethondes, le 18 juin qui reste la date la plus célèbre de juin 40, le général de Gaulle appelle, depuis Londres les Français à poursuivre le combat.
A Chasselay, ni les tirailleurs ni leurs officiers n’ont évidemment entendu le message lancé sur les ondes de la BBC. Malgré tout, ils vont contribuer, dès le lendemain, à entretenir cette « flamme de la résistance française » que l’exilé appelle de ses vœux.
Moins de 5 000 hommes dont 2 200 tirailleurs sénégalais vont s’opposer aux 20 000 soldats du régiment d’infanterie Grossdeutschland et de la division SS Totenkopf. Les Allemands se pensent déjà en terrain conquis ; ils ont traversé la Bourgogne sans rencontrer d’opposition et savent que Lyon a été déclarée « ville ouverte » le 18 au matin.
Tandis qu’ailleurs les soldats français préfèrent rompre et s’enfuir, à Chasselay et dans les communes environnantes, comme Lentilly, Fleurieu ou L’Arbresle, les tirailleurs sénégalais et quelques artilleurs aux moyens dérisoires font face à la Wehrmacht. Ils ouvrent le feu, le 19 vers 10 heures, sur les émissaires allemands venus leur intimer de se rendre. S’ensuivent plusieurs heures de combats meurtriers, notamment autour du couvent de Montluzin. Le lendemain, à la tête d’une poignée de braves regroupés dans le parc du château du Plantin, le capitaine Gouzy décide même d’un « baroud d’honneur ».
Les troupes françaises devront au bout du combat se rendre.
Et, le 20 juin 1940, en fin d’après-midi, quarante-huit tirailleurs sénégalais faits prisonniers sont conduits à l’écart des maisons de Chasselay, dans un champ, au lieu-dit Vide-Sac.
Désarmés, les bras en l’air, ils vont bientôt être fauchés par les mitrailleuses de deux chars, achevés au fusil et avec des tirs d’obus, certains écrasés par les chenilles des blindés lancés à la poursuite des fuyards.
Le Monde est revenu, le 16 juin, sur cette horrible histoire : <Ces tirailleurs africains massacrés par les nazis>
Le journal y revient parce qu’on a retrouvé des photos inédites de ce massacre.
 Le Monde raconte :
Le Monde raconte :
« Huit photos terrifiantes, prises par un homme de la Wehrmacht, illustrent la rage raciste à l’œuvre lors des fameuses journées. Les photos en question, totalement inédites, dormaient dans un vieil album, mis sur un site d’enchères par un brocanteur outre-Rhin et acheté par un jeune collectionneur privé de Troyes, Baptiste Garin. Sur une double page était épinglé un massacre de tirailleurs. « J’ai été saisi d’une émotion étrange, d’un malaise et puis du sentiment d’un cauchemar en croisant le regard de ces pauvres types », raconte l’acquéreur. Il prend contact avec un historien, Julien Fargettas. Voilà un quart de siècle que cet ancien militaire de 46 ans travaille sur cet épisode. Il vient même d’y consacrer un livre : « Juin 1940. Combats et massacres en Lyonnais (Poutan, 250 pages, 21 euros) ». Julien Fargettas identifie la scène. […] Ces preuves photographiques d’un crime de guerre corroborent les descriptions des gradés français témoins de la scène. Avant le carnage, ces Blancs avaient été mis à l’écart et forcés à se coucher au sol sous la menace de mitraillettes. »
Selon Julien Fargettas, les photos permettent d’identifier l’unité et les soldats responsables de la tuerie :
« Il ne s’agissait pas de SS, comme on l’a longtemps cru, mais d’hommes de la Wehrmacht ».
Certains voulaient épargner l’armée officielle allemande qui était une armée respectable pas comme les SS. Ce n’est pas exact.
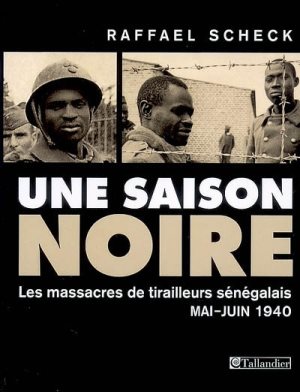
C’est un historien allemand Raffael Scheck qui a écrit un livre « UNE SAISON NOIRE. Les massacres de tirailleurs sénégalais (Mai-Juin 1940)» qui l’avait déjà révélé : la Wehrmacht aussi avait les mains sales.
Le Monde cite un témoignage, daté de 1975, du caporal Gaspard Scandariato :
« Tout à coup, un crépitement d’armes automatiques retentit, se renouvelant à trois ou quatre reprises, auquel se succédèrent des hurlements et des grands cris de douleur. Quelques tirailleurs qui n’avaient pas été touchés par les premières rafales s’étaient enfuis dans le champ bordant le chemin, mais alors les grenadiers panzers qui accompagnaient les blindés les ajustèrent sans hâte et au bout de quelques minutes les détonations cessèrent. L’ordre nous fut donné de nous remettre debout et, colonne par trois, nous passâmes horrifiés devant ceux qui quelques heures auparavant avaient combattu côte à côte avec nous et qui maintenant gisaient morts pour notre patrie. Quelques tirailleurs gémissaient encore et nous entendîmes des coups de feu épars alors que nous étions déjà éloignés des lieux du massacre. »
 Ces homo-sapiens de peau noire étaient des hommes et des soldats. Mais les militaires allemands leur déniaient ce double statut et les appelaient « Affen » (« singes »).
Ces homo-sapiens de peau noire étaient des hommes et des soldats. Mais les militaires allemands leur déniaient ce double statut et les appelaient « Affen » (« singes »).
Le Monde précise :
« Les nazis développeront par la suite une intense propagande contre ce qu’ils appelèrent « Die Schwarze Schande », « la honte noire ». « Envers ces soldats indigènes, toute bienveillance serait une erreur, ils sont à traiter avec la plus grande rigueur », pouvait-on lire dans un ordre venu de l’état-major du général Heinz Guderian, un des artisans de la victoire éclair contre la France. Après la capitulation, les exécutions de prisonniers noirs qui, selon l’historien Raffael Scheck, ont fait plusieurs milliers de victimes seront réduites à des péripéties de la guerre et jamais jugées. »
L’épisode de Chasselay fut le dernier d’une série d’exactions commises contre les tirailleurs africains pendant la campagne de France. Il faut ajouter qu’à Chasselay, les officiers blancs des tirailleurs sénégalais furent aussi fusillés, parce qu’ils commandaient des noirs.
Vous trouverez sur cette page Wikipedia : <Liste de massacres perpétrés par les forces allemandes en France durant la Seconde Guerre mondiale> une liste exhaustive des massacres allemands.
Sur cette liste il y a une erreur car le massacre de Chasselay est attribué au SS, alors que c’était la Wehrmacht qui était à l’œuvre.
 Au lieu précis du massacre, le lieudit Vide sac, un cimetière a été érigé : « Le Tata sénégalais de Chasselay »
Au lieu précis du massacre, le lieudit Vide sac, un cimetière a été érigé : « Le Tata sénégalais de Chasselay »
« Tata » signifie enceinte fortifiée en Afrique. L’édifice, entièrement ocre rouge, est constitué de pierres tombales entourées d’une enceinte rectangulaire de 2,8 mètres de hauteur. Son porche et ses quatre angles sont surmontés de pyramides bardées de pieux. Le portail en claire-voie, en chêne massif, est orné de huit masques africains.
On a fait venir de la terre de Dakar par avion, pour la mélanger à la terre française
Il sert aussi de sépulture à d’autres victimes de massacres de la région lyonnaise.
188 tirailleurs « sénégalais » ainsi que six tirailleurs nord-africains et deux légionnaires (un Albanais et un Russe) y sont inhumés.
C’était exactement, il y a 80 ans.
Ces hommes ont parcouru 5000 km du Sénégal jusque dans le Beaujolais pour défendre le territoire de la France.
Ils étaient noirs.
Et c’est pour cette unique raison qu’ils ont été abattus, assassinés par des soldats dont la peau était blanche.
Et dans notre langue on utilise le mot « noir » pour signifier le mauvais, le méchant « une âme noire », « des noirs desseins ».
Et on utilise le mot « blanc » pour désigner la pureté, l’innocence.
Mais il y a 80 ans, comme avant, comme après et comme encore aujourd’hui ce sont des blancs qui tuent des noirs, parce qu’ils sont noirs.
 Le Tata de Chasselay
Le Tata de Chasselay
Vous pouvez regarder ce documentaire de 50 minutes consacré à ce lieu : <Le Tata Sénégalais de Chasselay – Mémoire des tirailleurs sénégalais>
<1442>
-
Jeudi 18 juin 2020
«Le choix des statues dans une ville est un choix politique […] l’inscription des mémoires qui sont mis en avant !»Françoise VergésSortir de sa zone de confort…
Lundi, j’avais évoqué ce mouvement qui veut déboulonner la statue de Colbert, parce qu’il avait été l’instigateur du « code noir ».
Emmanuel Macron avait affirmé solennellement « La République ne déboulonnera pas de statue. » et avait ajouté :
« Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre Histoire, toutes nos mémoires, notre rapport à l’Afrique en particulier, pour bâtir un présent et un avenir possible, d’une rive l’autre de la Méditerranée avec une volonté de vérité et en aucun cas de revisiter ou de nier ce que nous sommes. »
J’étais plutôt d’accord avec lui.
Plusieurs ont exprimé cette idée d’accompagner les statues de Colbert d’une plaque expliquant ce que fut Colbert, son rôle positif dans la construction de l’Etat mais en rappelant aussi la tâche que fut sa participation à l’élaboration du code noir.
Et Françoise Vergés a répondu à Guillaume Erner qui avançait cette thèse :
« Mais si vous pensez cela, pourquoi vous n’acceptez pas qu’on érige des statues au Maréchal Pétain, c’est quand même le vainqueur de Verdun. ?»
Et elle ajoute qu’il suffirait aussi, dans ce cas, d’ajouter une petite plaque expliquant que sur ces vieux jours, il a fait d’autres choses qui ; elles ; étaient abominables. »
Et c’est là que l’on sort de sa zone de confort.
J’ai écrit une série de mot du jour sur l’antisémitisme, en montrant sa spécificité dans l’Histoire. La Shoah qui fut l’aboutissement d’un processus de haine extrême des juifs qui s’est développé tout au long de l’histoire chrétienne par des pogroms et des persécutions, jusqu’à cette volonté d’extermination, constitue une faute et une plaie insupportable de l’histoire d’homo sapiens.
Mais il n’est pas acceptable, surtout pour celles et ceux dont les ancêtres en furent les victimes, de ne pas donner toute sa place à l’horreur et à la faute tout aussi insupportable d’avoir toléré et développé l’esclavage des noirs. D’avoir considéré l’homme de peau noire comme un bien meuble, qui n’avait aucun droit et pouvait être mis à mort sans procès, fouetter autant que son maître le souhaitait et aussi mutiler s’il s’enfuyait ce qui est quand même la chose la plus naturelle quand on est réduit au statut d’esclave.
Il ne s’agit pas de dire que ces deux abominations sont identiques. Mais vouloir les comparer pour essayer, au bout d’une argumentation de l’horreur, de prétendre que l’une serait plus grave que l’autre me semble une autre abomination.
Or, il en est beaucoup de « nos héros » qui ont joué un rôle abominable, je persiste dans ce mot, à l’égard des humains de peau noire.
Et nous ne le savons pas ! ou si peu.
Le Général Gallieni par exemple, il y a une rue importante de Montreuil sous-bois qui porte son nom, à Lyon c’est un pont sur le Rhône, à Paris c’est une Avenue entre le quai d’Orsay et les Invalides, et puis il y a bien sûr de nombreuses statues.
Joseph Gallieni, c’est bien sur celui qui en réquisitionnant les taxis de la Marne a pu réaliser une manœuvre stratégique qui a permis de surprendre l’armée allemande et de stopper sa progression vers Paris en 1914 et éviter de perdre prématurément la guerre qui fut gagnée par la suite.
Dans les livres d’Histoire que je lisais toujours avec passion, il n’y avait que cet épisode qui était relaté.
A 65 ans, tout à la fin de sa carrière, Joseph Gallieni fut nommé gouverneur militaire de la place de Paris et c’est en tant que tel qu’il participa à cette manœuvre disruptive pour l’époque, comme on dirait maintenant.
En 1916, il mourut.
Mais avant 65 ans que faisait-il ?
Vous pouvez aller lire sa page Wikipedia qui raconte ses différentes missions en Afrique noire (1876-1882), puis son poste de Commandant supérieur du Soudan français (1886-1888), et la Mission en Indochine (1892-1896) pour finir Gouverneur général de Madagascar (1896-1905). On parle de massacres, de répressions dures et de politiques coloniales sans états d’âme. Mais cette page n’entre pas trop dans le détail.
Je vous renvoie donc plutôt vers un blog de Mediapart, qui pose cette question <Qui était Joseph Gallieni ?>
Vous pouvez lire. Il parle par exemple du massacre d’Ambiki et renvoie vers une page plus complète sur cet épisode : <Le Massacre d’Ambiky en 1897, par Paul Vigné d’Octon.> :
« Le roi Touère, les personnages de marque, tous les habitants tombèrent sous les coups des mitrailleurs dans cette matinée ; les tirailleurs n’avaient ordre de tuer que les hommes, mais on ne les retint pas: enivrés de l’odeur du sang, ils n’épargnèrent pas une femme, pas un enfant. […] Quand il fit grand jour, la ville n’était plus qu’un affreux charnier dans le dédale duquel s’égaraient les Français, fatigués d’avoir tant frappé.
Les clairons sonnèrent le ralliement, les sous-officiers firent l’appel : nul des nôtres ne manquait. On se reposa, on mangea, des chants joyeux ne célébrèrent pas la victoire. Une boue rouge couvrait le sol. À la fin de l’après-midi, sous l’action de la chaleur, un petit brouillard s’éleva: c’était le sang des 5000 victimes, l’ombre de la ville qui s’évaporait au soleil couchant. »
Et ce blog cite Aimé Césaire qui disait en 1950 :
« On s’étonne, on s’indigne. On dit : «Comme c’est curieux ! Mais, Bah ! C’est le nazisme, ça passera !» Et on attend, et on espère; et on se tait à soi-même la vérité, que c’est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries ; que c’est du nazisme, oui, mais qu’avant d’en être la victime, on en a été le complice ; que ce nazisme-là, on l’a supporté avant de le subir, on l’a absous, on a fermé l’œil là-dessus, on l’a légitimé, parce que, jusque-là, il ne s’était appliqué qu’à des peuples non européens ; que ce nazisme là, on l’a cultivé, on en est responsable, et qu’il est sourd, qu’il perce, qu’il goutte, avant de l’engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. »
Alors il ne faut pas accepter des statues de Pétain, mais des statues de Gallieni, pour lui il n’y pas de problème ?
Pétain eut un rôle plus important lors de la guerre 14-18 que Gallieni.
Et pour le reste ?
Les crimes de Gallieni ont été perpétrés contre des populations « non européennes » pour reprendre le mot d’Aimé Césaire.
 Françoise Vergés est née en 1952 à Paris, mais a passé la plus grande partie de son enfance à l’île de la Réunion où son père Paul Vergès poursuivait une carrière politique proche du Parti communiste.
Françoise Vergés est née en 1952 à Paris, mais a passé la plus grande partie de son enfance à l’île de la Réunion où son père Paul Vergès poursuivait une carrière politique proche du Parti communiste.
Le célèbre avocat Jacques Vergés était son oncle.
Paul et Jacques Vergés étaient les enfants de Pham Thi Khang, institutrice vietnamienne, et du docteur Raymond Vergès, consul de France au Siam, c’est-à-dire la Thailande.
La mère de Françoise Vergés était aussi une militante communiste et féministe : Laurence Deroin.
Françoise Vergés est une universitaire et militante féministe « décoloniale » française.
En effet, elle a publié en 2019 son livre « Un féminisme décolonial »
Elle explique dans l’émission <à Voix nue>
« Ce que j’appelle féminisme décolonial, c’est un féminisme qui, tout en reconnaissant qu’il y a une domination masculine, ne se focalise pas sur la question de l’égalité de genre. […] En faisant sienne la fiction selon laquelle le colonialisme a pris fin en 1962, le féminisme s’est leurré sur l’existence d’un vaste territoire ‘ultramarin’ issu de la période esclavagiste et post-esclavagiste comme la présence en France de femmes racisées. Complice alors des nouvelles formes du capitalisme et de l’impérialisme, il demeure silencieux sur les nouvelles formes de colonialité et de racisme d’État dans les Outre-mer et en France. […] La plupart des groupes qui constituent le mouvement féministe en France va rester aveugle et sourd à la question de sa propre généalogie, de sa propre histoire. Son récit se construit en rapport avec la domination masculine blanche (c’est la longue marche vers les droits) et l’histoire coloniale et raciale disparaît complètement de la construction de la société dans le récit féministe
Dans son livre précédent, « Le Ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme » elle rapporte que dans les années 70, on pratiquait des avortements et stérilisations, à leur insu, sur des centaines de femmes réunionnaises.
C’est cette femme que Guillaume Erner avait invité le 16 juin 2020 pour parler « des Mouvements antiracistes : un tournant dans l’histoire ? ».
Elle parle de sa voix calme et répond à l’attitude de Macron qui ne veut déboulonner aucune statue en rappelant que tout au long de l’Histoire on a évolué dans le statuaire, on en a enlevé certains, on en a ajouté d’autres.
Lors de la monarchie, c’était des statues de roi qu’on a remplacé sous l’Empire c’était différent et puis encore sous la République d’autres personnalités furent choisis, cela change constamment :
« Quand le Président dit qu’il sera intraitable sur le racisme et les questions d’égalité […] les demandes de retrait les statues est une question d’égalité. Il n’y a pas de justice dont la façon la France présente les monuments. (…) En réalité, il n’y a pas de récit figé. La République pourrait se demander les récits qu’elle voudrait mettre en avant (…). Quelles sont les statues que je vois quand je me promène à Paris ? Essentiellement des hommes blancs, dans des postures guerrières (..). Il n’y a pas d’égalité mémorielle. »
Et elle approfondit cette question des statues qui sont choisies pour remplir l’espace public, comme d’ailleurs les noms donnés aux Boulevards, places, rues, ruelles, impasse :
« Plus profondément, c’est la question d’une plus grande égalité, de l’anti-racisme. Quels sont les récits valorisés ? Qu’est-ce qui est enseigné à l’école ? Qu’est-ce que les enfants de France apprennent ? La question des statues est prise dans un contexte. […]
Les statues ce sont des choix politiques […] Ce sont constamment des choix. [Ne pas discuter de ce qu’il faut déboulonner et ce qu’il faut ajouter signifie] Rien ne changera et votre demande d’égalité ne sera pas entendu. C’est-à-dire ce que vous demandez, vous n’existez pas, vous n’appartenez pas à l’Histoire de France. Il n’y aura jamais de statue d’Aimé Césaire, il n’y aura jamais de statue de Léopold Sédar Senghor. […]
Il y a une sélection qui est faite, […] il y a une hiérarchie qui est donnée, à qui aura un boulevard, à qui aura une ruelle, une impasse. Il s’agit de l’inscription des mémoires qui sont mis en avant dans une ville. Ce que nous demandons c’est plus de justice, plus d’égalité »
[…] C’est une question d’égalité et de dignité pour l’histoire de plein de femmes et d’hommes qui sont dans la République française, qui sont des citoyens français. »
C’est une parole qui m’a fait évoluer dans ma perception de l’Histoire et des choix qui sont faits pour sélectionner, raconter et aussi de valoriser certains aspects, en cacher d’autres.
Je ne suis plus si sûr qu’il ne faille pas réfléchir à déboulonner certaines statues, ou du moins diminuer le nombre de certains personnages statufiés et ériger d’autres statues non encore présente dans la représentation publique.
Je vous invite vraiment à écouter cette émission pleine d’intelligence : « des Mouvements antiracistes : un tournant dans l’histoire ? ».
<1441>
-
Mercredi 17 juin 2020
«Les pays gouvernés par des femmes ont eu cinq fois moins de morts du coronavirus que les pays dirigés par des hommes.»Edito du New York TimesC’est la revue de Presse de Claude Askolovitch de lundi, le 15 juin, qui a rappelé cette information de première importance:
« Je lis dans un bel édito du New York Times que les pays gouvernés par des femmes ont eu cinq fois moins de morts du coronavirus que les pays dirigés par des hommes. »
Le New York Times confirme donc ou répond à la question que posait le site de TV5 Monde le 20 avril qui lui-même rapportait une question de FORBES : « Covid-19 : les pays dirigés par des femmes gèrent-ils mieux la crise ? »
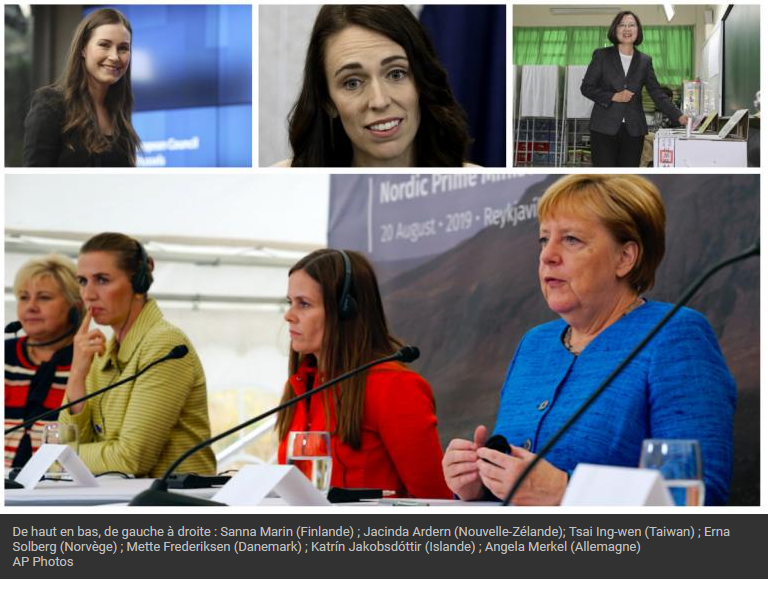 « De Taiwan à l’Islande, en passant par l’Allemagne ou la Nouvelle-Zélande, quelques pays sont parvenus à limiter le bilan de la pandémie de coronavirus. Qu’ont-ils en commun ?
« De Taiwan à l’Islande, en passant par l’Allemagne ou la Nouvelle-Zélande, quelques pays sont parvenus à limiter le bilan de la pandémie de coronavirus. Qu’ont-ils en commun ?
« Ils sont dirigés par des femmes », titre le magazine Forbes, daté du 13 avril 2020. Et elles ont fait face en déployant sans tergiverser franchise, détermination, empathie, réactivité et anticipation, qui sont aussi les clés d’une gestion efficace. Et sans jamais prononcer le mot « guerre »… »
Reprenons chacun de ces cas.
 D’abord l‘Islande.
D’abord l‘Islande.
« Anticiper pour ne pas se laisser prendre de court – tel semble avoir été le mot d’ordre du gouvernement de Katrín Jakobsdóttir. Lorsque le premier malade est confirmé sur son territoire, le 28 février 2020, l’Islande dépistait déjà depuis un mois, ayant commencé alors que la maladie causée par le coronavirus n’était même pas encore baptisée Covid-19, ni la pandémie déclarée. »
Dans ce pays selon Wikipedia, au 22 avril 2020, le nombre total de cas enregistrés était de 1 785, dont 1 462 se sont rétablis et 10 sont décédés. Le taux d’infection est d’un cas pour 245 habitants, l’un des plus élevés au monde. Mais avec un taux de létalité lié au Covid-19 qui est le deuxième plus bas au monde, en avril.
J’ai trouvé cette mise à jour au 16 juin :
« Avec 1 810 infections dont seulement quatre en juin, l’Islande a presque éradiqué le Covid-19 de son territoire grâce à une politique de dépistages massifs. »
Au 16 juin, le nombre de décédés était resté à 10 soit un taux de létalité pour un pays de 362 860 habitants de 27,5 pour 1 000 000 d’habitants. En France nous en sommes à 435 pour 1 000 000 d’habitants
Voilà donc le bilan de Katrín Jakobsdóttir !
 Ensuite Taiwan
Ensuite Taiwan
« Dès le mois de janvier, soit bien avant que l’alerte ne soit lancée à l’échelle mondiale et que l’OMS reconnaisse la transmission humaine du virus, et 21 jours avant la détection du premier cas de personnes contaminées à Taiwan, la présidente Tsai Ing-wen avait imposé 124 mesures fortes pour bloquer l’épidémie. Des prises de température sont mises en place à l’atterrissage de tous les vols en provenance de Wuhan dès le 31 décembre 2019, par exemple. Bilan à ce jour, 6 décès et moins de 400 personnes contaminées pour près de 24 millions de Taiwanais, et ce sans confinement de la population. »
J’ajoute que Taiwan est vraiment tout près de la source de l’épidémie : la Chine. Elle a donc de bien meilleurs résultats que la Chine totalitaire avec un régime démocratique !
Une information du 16 juin porte le bilan de Taiwan à 445 personnes contaminées et sept décès.
Voilà donc le bilan de Tsai Ing-wen
Pour l‘Allemagne je n’insiste pas, nous avons eu suffisamment de précisions qui nous renvoyaient à nos faiblesses françaises.
Le bilan de Angela Merkel est remarquable, concernant ce point précis du COVID-19.
Juste une petite précision Merkel n’a pas parlé de guerre à ses concitoyens mais dès le 11 mars elle a fait cette déclaration solennelle
« La situation est sérieuse, alors prenez-la au sérieux. »
C’est que les Allemands ont fait, suivant à la lettre les ordres de leur dirigeante.
 En Norvège :
En Norvège :
Au 16 juin le nombre de décédés pour le coronavirus est de 242 soit un taux de létalité de 45 pour 1 000 000 d’habitants..
Erna Solberg, n’a pas non plus parlé de guerre. Elle s’est en revanche adressé directement aux enfants à la télévision pour leur dire :
« Je sais que ça fait peur et c’est normal d’avoir peur quand tout est bousculé, comme en ce moment »
En Finlande
Au 16 juin le nombre de décès s’élevait à 326 soit un taux de létalité de 59 pour 1 000 000 d’habitants.
 TV5 donne ces informations :
TV5 donne ces informations :
« En décembre 2019, Sanna Marin devenait la plus jeune cheffe d’Etat du monde, à la tête d’une coalition exclusivement composée de femmes. Consciente que les médias traditionnels et les communiqués gouvernementaux ne sont pas les plus porteurs, surtout parmi les plus jeunes, elle a fait établir une liste d’influenceurs à suivre – bloggeurs, rappeurs, chroniqueurs, instagrameurs…. Sana Marin fait appel à ces « key workers » (acteurs essentiels) pour l’aider à partager l’information destinée à juguler la pandémie.
Les messages du gouvernement sont distribués au réseau de quelque 1500 influenceurs, qui restent libres de les relayer, ou non, à leur manière. La plupart ont eu à cœur de participer à cet effort national à leur échelle et se sont prêtés au jeu sans songer à demander de contrepartie, à l’instar d’Inari Fernández, une influenceuse professionnelle avec 34 000 followers sur Instagram. »
 Au Danemark
Au Danemark
Le taux de létalité est un peu plus élevé à 102 pour 1 000 000 d’habitants. Mais au Royaume-Uni du flamboyant Boris Johnson nous en sommes à 630 !
Le pays a fermé ses frontières dès le 13 mars, puis les autorités ont fait confiance aux Danois et cela a marché : « Les commerces ne sont pas engorgés et la distance sociale de deux mètres est respectée, y compris dans les parcs. Même à un feu, les piétons et les cyclistes reculent d’eux-même s’ils sont trop près les uns des autres, » expliquait un journaliste sur France Info le 13 avril.
C’est le bilan de Mette Frederiksen
 Il reste la Nouvelle-Zélande de Jacinda Ardem
Il reste la Nouvelle-Zélande de Jacinda Ardem
« Solidarité, proximité, empathie – les qualités que la Première ministre néozélandaise déploie dans la gestion de la crise sanitaire sont aussi celles qui avaient été remarquées il y a un an, dans l’onde de choc de la tragédie de Christchurch.
Jacinda Ardern et ses ministres ont décidé de réduire leurs rémunérations de 20 % en solidarité avec les victimes de la pandémie en Nouvelle-Zélande.
Dès les six premiers cas détectés, la Première ministre a ordonné la fermeture des frontières et le confinement. Elle a clairement annoncé à ses compatriotes le pourquoi et le comment de l’état d’alerte maximum dans lequel elle plaçait le pays. Il semble que l’intégrité de ses décisions et sa détermination ait épargné à son pays des milliers de morts : mi-avril la Nouvelle-Zélande ne déplorait que 4 décès dus au Covid-19 sur une population de 4,8 millions. »
Au 16 juin le bilan est monté à 22 décès, d’où un taux de létalité de 4 pour 1 millions.
Cependant, une information datant de quelques heures, au moment de cette rédaction, font état de nouveaux cas en Nouvelle Zélande après 25 jours de répit.
Comme le rappelle TV5, Jacinda Ardem est devenu célèbre dans le monde entier après la tragédie de Christchurch. Le 15 mars 2019, un suprémaciste blanc australien de 28 ans est entré dans deux mosquées de Christchurch a tué 51 personnes et blessé plusieurs dizaines d’autres.
Elle a su à la fois allier fermeté et une extraordinaire empathie pour ses compatriotes musulmans.
Elle a décidé d’aller à leur rencontre en portant le voile par signe de solidarité.

Quand Donald Trump lui a demandé ce qu’il pouvait faire pour la Nouvelle Zélande, elle a répondu :
« Avoir de la compassion pour les musulmans néo-zélandais »
Vous pouvez lire cet article de l’Obs : « L’appel de Christchurch » : 10 choses à savoir sur Jacinda Ardern, Première ministre de la Nouvelle-Zélande :
« Son attitude exemplaire après les attentats de Christchurch contre deux mosquées avait été saluée dans le monde entier. »
Ou cet article de France 24 : « Jacinda Ardern, première ministre, « le réconfort et l’acier » de la Nouvelle-Zélande »
Et encore cet article du Monde « Après les attentats de Christchurch, les Néo-Zélandais unis derrière Jacinda Ardern »
Plus globalement sur la capacité des femmes à bien gouverner, je partage cette conclusion de TV5Monde pleine de nuance et de pertinence :
« Est-ce qu’être une femme prédispose à la bonne gestion de crise ? Le syllogisme serait sexiste et, comme le souligne le quotidien britannique The Guardian, « une corrélation n’est pas un lien de cause à effet. Etre une femme ne donne pas automatiquement l’avantage dans la gestion d’une pandémie mondiale. Cela ne fait pas non plus de vous un meilleur chef d’Etat. » D’autres facteurs entrent en compte, souligne le Guardian, comme les politiques de santé mises en place par les gouvernements précédents ou la situation géographique d’un pays – moins il a de frontières terrestres, plus il est épargné. […] Il n’en reste pas moins que la gestion de crise exemplaire de certaines dirigeantes politiques devrait s’inscrire dans les annales. Et puis les femmes, dans un milieu politique majoritairement dominé par les hommes, ne doivent-elles pas être meilleures pour y arriver… ? »
Et puis quand même elles n’ont pas toujours le mot «guerre» et «combat» à la bouche, elles sont probablement plus pragmatiques et savent elles mieux ce que «prendre soin» veut dire
<<1440>
-
Mardi 16 juin 2020
«Dans toutes les villes où on a fait les enquêtes, la police en France a des comportements discriminatoires.»Sébastian RochéJ’ai déjà écrit deux mots du jour sur le sujet du comportement des policiers français dans le cadre de leurs missions.
Le premier était pour prendre leur défense de manière résolue, lors des manifestations des gilets jaunes : « C’était de l’ultraviolence. Ils avaient des envies de meurtre. Nous, notre but c’est juste de rentrer en vie chez nous, pour retrouver nos familles. »
Dans cet article, je prenais presque une posture émotionnelle : « Ces personnes sont des fonctionnaires comme moi. Ils ont fait le choix de se mettre au service de L’État et de la République. Mais quand ils sont appelés à assurer leur mission, sur un théâtre d’opération, ils ne sont pas certains de rentrer en bonne forme le soir, en retournant dans leur famille retrouver leurs enfants, leur compagne ou compagnon. »
Mais dans ce genre de questions il ne me semble pas pertinent de ne rester que dans l’émotion. Il faut aussi de l’analyse, des faits et de la rigueur dans le propos.
Plus d’un an plus tard, je me suis résolu à évoquer certains dysfonctionnements en utilisant explicitement le terme de « violences policières. »
Ce second article ne contredisait pas le premier, il exprimait simplement un autre aspect de la même réalité.
Pour ce faire j’ai d’abord entendu et lu des amis qui m’informaient de cette face sombre de la police en France.

Il y avait aussi le travail rigoureux et documenté du journaliste David Dufresne :
Il a effectué sur twitter, le recensement de violences policières : <Allo place Beauvau>.
Il a aussi écrit un roman traitant de ce sujet : « Dernière sommation ».
Il dispose aussi d’un site qui traite de l’ensemble de ses travaux : http://www.davduf.net/
Plus récemment, il s’est intéressé aux rapports de l’IGPN, cette structure interne à la Police qui a vocation à exercer un contrôle sur les activités de police. Mediapart l’a interrogé, il y a quelques jours sur les conclusions de son enquête : « Allo l’IGPN ». Selon lui, ce travail de contrôle n’est pas assez rigoureux et manifeste trop de laxisme sur les comportements déviants de la police.
Dans ce second article je citais aussi Sébastien Roché qui a écrit un livre : <De la police en démocratie>

« Sébastien Roché » est un chercheur spécialisé en criminologie, docteur en sciences politiques, directeur de recherche au CNRS et éditeur (Europe) de Policing and Society, un des journaux internationaux sur la science de la police les plus importants.
Ses travaux portent essentiellement sur les questions de délinquance et d’insécurité, puis sur les politiques judiciaires et policières comparées ainsi que sur la gouvernance de la police et les réformes du secteur de la sécurité.
C’est un chercheur respecté dans son domaine. Il avait été nommé en 2016 par Bernard Cazeneuve au Conseil de la stratégie et de la prospective du ministère de l’Intérieur. Et il a enseigné pendant 16 ans à l’École nationale supérieure de la Police (ENSP).
Mais le 27 août 2019, il est informé qu’il n’enseignera plus dans cette école.
Difficile de ne pas y voir un lien avec ses analyses critiques sur des violences policières pendant le mouvement des Gilets Jaunes.
Ce point m’alerte !
Il ne me semble pas pertinent de ne pas accepter la critique et de refuser de discuter des faiblesses et des problèmes. Le déni ne permet pas de progresser.
En ce moment, la question des violences policières est revenue sur le devant de la scène.
Sur France Culture Guillaume Erner a donc invité Sébastien Roché, vendredi le 12 juin, pour reparler de ce sujet : <La Police doit-elle se réformer ?>.
Dans cet entretien, il n’a pas été question de violences, mais de discrimination et de racisme. Sébastien Roché ne laisse pas de doutes sur le caractère extrêmement répandu de comportements discriminatoires :
« On a maintenant depuis plus de dix ans un grand nombre d’enquêtes sur la manière dont la police travaille, sur les contrôles d’identité et sur le traitement des personnes pendant les contrôles et les sanctions à l’issue des contrôles. Ces enquêtes je me rends compte qu’elles ne sont pas connues. Pourtant dès 2007, on a observé les comportements policiers dans les gares parisiennes avec une méthodologie très précise. Un peu plus tard « l’agence européenne pour les droits fondamentaux » a fait des enquêtes dans toute l’Europe, dans les grandes villes de France avec des échantillons qui permettent de bien comparer les gens, qu’ils soient blancs ou non, d’origine étrangère ou nationale. Et puis, il y a une énorme enquête, l’enquête « TeO » Trajectoire Et Origine, faite par l’INED (publié en 2016. Et puis il y a encore d’autres enquêtes, j’en ai dirigé une avec Dietrich Oberwittler pour comparer la manière avec laquelle la police travaille en France et en Allemagne et le contact avec les jeunes. Bref on a aujourd’hui un énorme corpus de données qu’on n’avait pas il y a dix ans. Et je me rends compte que le gouvernement fait comme s’ils n’existaient pas et le public ne les connait pas forcément.
Et toutes ces études montrent une chose simple : dans toutes les villes où on a fait les enquêtes, la police en France a des comportements discriminatoires. Que ce soit Grenoble, que ce soit Lyon, que ce soit les transports de la région parisienne, que ce soit Marseille, que ce soit Aix en Provence. […]
On a désormais la preuve d’une discrimination systémique. Cela ne fait plus de doute. »
Concernant l’accusation de racisme systémique dans la police, Sébastien Roché n’est pas aussi catégorique :
« Nous ne l’avons pas beaucoup observé ».
Toutefois récemment, le 4 juin, <Street Press> a révélé qu’un groupe facebook composé de milliers (8000) de policiers écrit des propos ouvertement racistes et vulgaires.
<Un deuxième groupe facebook> a été également révélé le 8 juin.
A la question de savoir, si la police Française se distingue par rapport aux autres polices européennes, Sébastien Roché répond :
« Toutes les polices sont différentes. La discrimination ethnique est un problème sérieux dans certains pays, particulièrement en France. Les écarts de traitement suivant votre couleur de peau, sont particulièrement nets. C’est pour cela qu’il y a cette émotion. Évidemment, ce n’est pas le seul pays en Europe à observer ce phénomène. Vous allez retrouver également en Espagne. Mais si vous prenez les pays qui sont les plus grandes puissances économiques européennes, c’est-à-dire celles qui ont le plus de moyens pour former les policiers et les encadrer, la France et l’Allemagne, vous voyez qu’en France, ces pratiques discriminatoires sont bien établies, alors qu’en Allemagne, elles sont très faibles, voire nulles pour la police des Länder. On voit simplement qu’on peut faire la police sans discrimination ou avec des niveaux de discrimination qui sont beaucoup plus réduits qu’en France. Donc on peut faire une meilleure police. Faire la police ne justifie pas la discrimination. »
Pour Sébastien Roché, avant toute chose il faut une vraie prise de conscience.
« La première étape, c’est vraiment la prise de conscience. C’est ce qu’il y a de plus inquiétant. On a le sentiment que le gouvernement n’a pas pris conscience du choc moral, malgré la vague de protestation au niveau mondial. Les syndicats de police majoritaire n’ont pas non plus pris conscience de ce choc. Il faut voir que la discrimination policière c’est une violation, tous les jours de la constitution et de la déclaration des droits de l’homme. […] C’est curieux que le gouvernement ne se mobilise pas pour défendre les droits constitutionnels des français.
On a pu penser que M. Castaner avait pris conscience d’un certain nombre de choses lors de ses premières annonces. Il a eu des propos qui laissaient entrevoir une ouverture du ministère de l’Intérieur, qui n’est pas courante. Mais il n’a pas annoncé de choses pratiques. Il n’a pas annoncé la création d’outils de connaissance de la discrimination. Comment lutter contre quelque chose que l’on ne connaît pas. Comment faire si on ne dispose pas d’outils de connaissance. Il n’a pas fait d’annonces au sujet des moyens. On sait très bien que si on veut faire une politique de lutte contre la discrimination efficace dans la police à tous les niveaux, il faut des moyens. Et il n’a pas non plus annoncé d’objectifs quantifiés clairs. De combien il veut réduire le phénomène, dans combien de temps. »
En mars, avant le confinement Sébastien Roché avait été interviewé par Mediapart : «Le modèle français, c’est la police qui fait peur».
La « Loi et l’ordre » disait récemment un dirigeant peu recommandable.On peut être d’accord sur cette devise, mais il est question d’abord de Loi. Il faut que la Loi soit respectée. La discrimination, l’usage disproportionné de la force ne sont pas conformes à la Loi.
Il ne s’agit pas de sous-estimer la difficulté de l’exercice du métier de la police et de la violence à laquelle elle-même doit faire face. Mais on ne peut pas rester dans le déni.
Il faut d’abord que la Police soit capable d’aider à maintenir la paix dans la société. Certains comportements ne vont pas dans ce sens.
<1439>
-
Lundi 15 juin 2020
«Le code noir»Promulgué en 1685 et préparé par Jean-Baptiste ColbertNotre jeune Président a donc, hier soir, dit solennellement : :
« Je vous le dis très clairement ce soir mes chers compatriotes, la République n’effacera aucune trace ni aucun nom de son Histoire. La République ne déboulonnera pas de statue. »
Il répond à un mouvement très général qui des Etats-Unis à la France, en passant par l’Angleterre, la Belgique a pour ambition de déboulonner des statues de personnages historiques qui au regard des valeurs contemporaines ne devraient plus être honorées selon certains.
J’avais déjà évoqué ce phénomène à propos de Christophe Collomb, le 1er octobre 2019 : « Une oppression, une servitude si dure, si horrible que jamais des bêtes n’y ont été soumises ». Il est reproché à celui qui nous a été présenté comme le découvreur du nouveau monde, sa cruauté extrême à l’égard des indigènes des iles qu’il a conquises.
Le mouvement de révolte suite au meurtre de Georges Floyd a accentué ce phénomène.
Nous lisons sur cette page de France Culture :
« Les manifestations contre le racisme ont trouvé un écho en dehors des États-Unis : en Europe et aux Antilles notamment, où la mémoire de l’esclavage et de la colonisation résonne encore avec les discriminations d’aujourd’hui. Parmi les images qui circulent, un moyen d’action frappe les esprits : le déboulonnage de statues qui incarnent ce passé… Aux États-Unis avec les monuments confédérés, en Angleterre avec cette statue d’un marchand négrier jetée à l’eau à Bristol, en Belgique avec le retrait du buste de Léopold II ou en France avec la figure de Colbert et même de Victor Schœlcher. Les contextes et les moyens d’action sont différents (les dégradations sur les statues de Schœlcher en Martinique ont eu lieu avant la mort de George Floyd et concernent une figure abolitionniste) mais des parallèles existent : cette histoire est toujours à vif et son récit fait l’objet de conflits. »
 Et je m’arrêterai aujourd’hui sur le personnage de Colbert.
Et je m’arrêterai aujourd’hui sur le personnage de Colbert.
Jean-Baptiste Colbert est né le 29 août 1619 à Reims et il est mort le 6 septembre 1683 à Paris. Il est un des principaux ministres de Louis XIV, certainement le plus connu. Il a été le Contrôleur général des finances de 1665 à 1683 et a joué un rôle fondamental dans l’économie française de cette époque.
Dans mes cours d’Histoire, j’ai appris qu’il était un grand homme politique de la monarchie et qu’il a été le concepteur et le réalisateur d’une politique économique interventionniste et mercantiliste.
L’étymologie du mot « mercantiliste » provient de l’italien « mercante », marchand. Dans le sens courant et banal ; le mercantilisme désigne l’attitude consistant à faire du commerce avec un esprit d’âpreté au gain.
Mais au sens économique et par rapport à la politique de Colbert le mercantilisme part du postulat que la puissance d’un Etat est fonction de ses réserves en métaux précieux (or et argent). Il prône le développement économique par l’enrichissement de l’Etat au moyen du commerce extérieur. Dans un système mercantiliste, l’Etat joue un rôle primordial en adoptant des politiques protectionnistes qui établissent notamment des barrières tarifaires et encouragent les exportations.
Parallèlement, il favorise le développement du commerce et de l’industrie en France par la création de fabriques et monopoles royaux, étatiques.
Cette politique économique qui donne un grand rôle à l’État est couramment utilisé désormais sous le nom de « colbertisme ».
 Les élites françaises ont tellement intégré cette prééminence de Colbert que le principal bâtiment du ministère de l’économie et des Finances, à Bercy, porte pour nom « Le bâtiment Colbert »
Les élites françaises ont tellement intégré cette prééminence de Colbert que le principal bâtiment du ministère de l’économie et des Finances, à Bercy, porte pour nom « Le bâtiment Colbert »
C’est le bâtiment des ministres et des services les plus prestigieux du Ministère comme l’Inspection Générale des Finances.
Dans mes souvenirs de cours d’Histoire, les livres et les professeurs racontaient aussi un épisode moins glorieux et plus cynique de la vie de Colbert : sa conspiration contre le surintendant Fouquet, celui qui a fait construire le château de Vaux le Vicomte et qui a fini sa vie en prison après une superbe fête organisée, en l’honneur du Roi, dans ce château.
Sur cette <page> du Ministère de l’Économie et des Finances en l’honneur de Colbert, classé parmi les grands noms du ministère, on parle aussi de cette épisode, en précisant que ce fut D’Artagnan qui arrêta Fouquet. On parle aussi du rôle économique et du colbertisme.
Mais on ne parle pas, comme on ne parlait pas dans mes cours et livres d’Histoire du « Code noir »
Depuis j’ai pu constater que des cours d’Histoire en ligne ont ajouté cette référence à la vie Colbert.
C’est le rôle joué dans la conception et la rédaction du Code Noir qui vaut à Colbert la menace de déboulonner ses statues et renommer les places, rues et bâtiments qui portent son nom.
Il se trouve ainsi dans le collimateur du Président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, l’ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault qui appelle notamment à débaptiser la salle Colbert de l’Assemblée nationale. Sa réflexion va plus loin et concerne des statues ou noms de rue, qui font référence à des personnalités impliquées dans la politique colonialiste de la France et qui pourraient avoir vocation à changer de nom.
Il existe trois édits différents connus sous l’appellation de Code noir. C’est le premier qui a été préparé par Colbert. Il a été cependant promulgué par Louis XIV en 1685, 2 ans après la mort de Colbert. Il fut ainsi terminé par le fils de Colbert, le marquis de Seignelay (1651-1690).
Ce code précise le statut civil et pénal des esclaves, ainsi que les relations entre les esclaves et leurs maîtres.
Sa lecture, ne peut que révolter notre regard contemporain. Certains voudront trouver dans ce texte quelques limites mis à la cruauté et à la toute-puissance des maîtres des esclaves. Force est de constater que ces limites sont très molles.
Je citerai trois articles ou extraits d’articles :
« Art. 44
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, […] »
Les esclaves dont on parle dans ce code sont évidemment de peau noire. Ils appartiennent à la même race d’homo sapiens que leurs maîtres blancs. Mais dans le code noir, cette humanité est niée puisqu’ils deviennent des biens meubles afin de pouvoir juridiquement justifier qu’ils soient propriétés d’autres humains et qu’ils puissent être vendus.
Ils sont des meubles, mais pourtant on les oblige a se soumettre à la même religion que leurs propriétaires. C’est même un des premiers articles du Code noir :
« Art. 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d’en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneurs et intendant desdites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. »
On prévoit bien sur des châtiments corporels et la mort dans un grand nombre de cas. Mais l’article 38 est horrible dans sa précision pour punir les fugitifs :
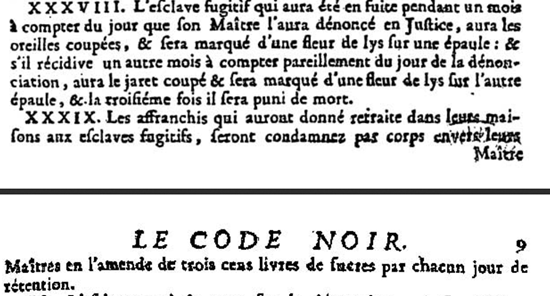
« Art. 38
L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort. »
Cela c’est le code noir.
Le mouvement de protestation qui a débuté aux États Unis après le meurtre de George Floyd et qui s’est répandu sur le monde entier, pose la question de l’Histoire et des hommes que l’on célèbre. La France est particulièrement touchée.
Le Nouvel Esprit Public de ce dimanche a consacré son émission à cette question : « Racisme : ils n’en souffraient pas tous, mais tous étaient frappés »
J’ai été saisi par l’intervention de Lionel Zinsou.
 Lionel Zinsou est un homme particulièrement brillant. Il est de peau noire.
Lionel Zinsou est un homme particulièrement brillant. Il est de peau noire.
Né d’un père originaire du Bénin, médecin de Léopold Sédar Senghor, et d’une mère française, il a fait ses études secondaires en France au lycée Buffon, en CPGE au lycée Louis-le-Grand, puis aux Écoles Normales Supérieures de Saint-Cloud et de la rue d’Ulm. Il passe l’agrégation de sciences économiques et sociales, puis étudie pendant deux ans l’histoire économique à la London School of Economics.
Il a aussi été premier ministre du Bénin de 2015 à 2016.
Il a répondu à des interventions précédentes :
« Permettez-moi de faire entrer un peu de l’émotion populaire dans notre émission. On ne peut pas considérer qu’une liste de discrimination positive, ou affirmative action sur les retraites avantagées et les subventions au voyage a la moindre efficacité sur les peuples.
La discrimination existe partout, qu’on travaille à la banque Rothschild ou à Noisy-le-Grand. Si l’on est Noir ou Maghrébin, elle est permanente. Dès la scolarité avec l’orientation professionnelle, pour l’accès à des stages, pour l’embauche, pour le logement … Tout cela est mesuré et parfaitement documenté. Alors certes, l’Etat et même les entreprises prennent des mesures et signent des chartes, mais les problèmes subsistent, et les nier reviendrait à dire qu’il n’y a par exemple pas de différence de traitement entre hommes et femmes.
Ensuite, on peut faire de la sémantique, mais l’émotion n’est pas à bannir totalement. Même si Adama Traoré a fait plusieurs fois de l’obstruction, ou de l’outrage à agent de la force publique, ce n’est pas passible de la peine de mort en France. Vous avez beaucoup plus de chances d’être condamné à mort dans la rue si vous vous appelez Adama Traoré que « Lionel Bourlanges ». La peine de mort s’applique en France de manière très différentielle, alors même qu’elle a été abolie.
Quand des jeunes gens renversent la statue de Colbert, on s’offusque, on évoque le bilan de Colbert : restauration des finances publiques, manufacture de Saint-Gobain … C’est vrai. Il y a aussi le Code Noir. Et je vous assure qu’il est dans la mémoire et dans la vie des gens d’aujourd’hui, et que toute l’Afrique, les Caraïbes et une partie de l’Amérique Latine en est encore révoltée.
Dans ce code, il est écrit que les Noirs ne sont pas des êtres humains, mais des meubles, ceci pour justifier juridiquement le fait de les vendre.
Oui, la France est la terre des droits de l’Homme et de l’abolition. Oui, il y a eu 1848. Mais après, il y a eu aussi le travail forcé, qui a fait des centaines de milliers de morts, jusqu’en 1946 et la loi Houphouët-Boigny. Ce n’était rien d’autre que l’esclavage perpétué, sans la déportation. 1946, ce n’est qu’à une génération, autrement dit, des abus inqualifiables sont encore tout proches de nous. Aucun catalogue de mesures favorables ne lavera jamais cela.
C’est pour tout cela qu’il y a de « l’émotion » (dans les deux sens du mot). Rien ne justifie les pillages, mais tout justifie la violence des sentiments. La seule façon de sortir de tout cela n’est pas de dire « la République fait beaucoup de choses ». Ce n’est pas le ressenti, et ce n’est de toute façon pas vrai. La discrimination est réelle, il faut cesser le déni. On ne s’en sortira qu’en disant l’Histoire, qu’en faisant mémoire.
Le président Hollande avait eu l’idée, que le président Macron a mise en œuvre, d’une fondation pour la mémoire de l’esclavage et des abolitions. Ce n’est qu’en étant factuel et objectif, et en disant les choses telles qu’elles se sont passées qu’on apaisera peu à peu ces situations. Il ne s’agit pas d’obtenir des réparations en numéraire, il s’agit de réparation historique. Cette fondation sert à cela, elle a des moyens éducatifs et scientifiques, et des programmes pour accomplir cette mission. Il ne s’agit pas de débaptiser toutes les rues Jules Ferry ou Colbert, il s’agit que nos enfants, Noirs, Blancs, juifs, musulmans ou que sais-je encore, soient dans la vérité de l’Histoire. Sans quoi nous n’aurons plus qu’une vérité de la violence. Ces choses n’étaient pas dans le récit national, c’est ce que François Hollande a reconnu en créant cette fondation. »
Il faut écouter toute l’émission, mais cette intervention me semble très forte.
Jean-Louis Bourlanges a réagi un peu plus tard et pose une autre immense question : qu’avons-nous à partager comme destin commun ?
« Il me semble qu’il y a deux problèmes différents.
Le premier est l’anachronisme, il concerne la dénonciation de Colbert […] Deux énormes asservissements entachent l’Histoire de l’humanité : l’inégalité homme/femme et l’esclavage. Vu d’aujourd’hui, l’esclavage est quasiment incompréhensible métaphysiquement, mais cela doit-il nous conduire à considérer que tous les gens de ces époques sont à mettre dans le même sac ? Devons-nous systématiquement considérer comme immoraux un certain nombre de personnages ? […]
Le second problème est de savoir ce qu’est une histoire mémorielle.
Pourquoi y a-t-il des statues par exemple ? Parce qu’elles faisaient consensus. Dès lors que le consensus n’existe plus, on se met à détruire les statues.
Pour des Français par exemple, Jules Ferry représentait avant tout l’école laïque et obligatoire. Pour des Malgaches ou des Indochinois, c’est une autre affaire. Lionel a raison d’exhorter à ce qu’on se ressaisisse de l’Histoire, avec objectivité et honnêteté intellectuelle. Mais c’est déjà fait ! L’historiographie moderne ne dit plus les énormités d’antan.
Il est vrai que les statues sont ce qui reste de cette période simpliste. Que faut-il enseigner en matière historique ? Car tous ces déboulonnages désacralisent ce récit national qui a façonné une grande partie de nos concitoyens.
Quelle société obtiendrons-nous avec une Histoire fragmentée, dont chaque groupe révère des éléments différents ? Ce n’est pas en en sachant davantage sur le passé que l’on résoudra ce problème, qui est central pour l’avenir du pays.
Nous avons aujourd’hui une impossibilité à vivre ensemble un destin commun, nous nous noyons dans ce qui nous oppose. C’est vraiment « une certaine idée de la France » (pour reprendre le général de Gaulle) qui se dissout dans la violence. »
Il faut être juste et s’efforcer à la rigueur. J’ai commencé ce mot du jour par une citation du discours d’Emmanuel Macron. Mais ce n’était que le début de ce qu’il a dit sur ce sujet. Il a aussi ajouté :
« Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre Histoire, toutes nos mémoires, notre rapport à l’Afrique en particulier, pour bâtir un présent et un avenir possible, d’une rive l’autre de la Méditerranée avec une volonté de vérité et en aucun cas de revisiter ou de nier ce que nous sommes. »
Ce qui me parait essentiel, c’est déjà de ne pas être dans le déni et d’être capable de regarder l’Histoire en face ainsi que la réalité d’aujourd’hui telle que la décrit Lionel Zinsou.
<1438>
-
Vendredi 12 juin 2020
«Comprendre le monde»Série d’entretiens publiés par la Revue XXIEn pleine période de confinement du COVID-19, alors que toute l’actualité et le bruit médiatique étaient concentrés sur la pandémie, j’ai souhaité faire un pas de côté et parler résolument d’autre chose.
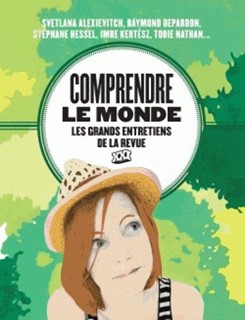 Pour ce faire j’ai repris un livre qui nous avait été offert il y a déjà longtemps, probablement en 2017. En effet, un jour une amie, lectrice du mot du jour, est venue à la maison avec ce livre.
Pour ce faire j’ai repris un livre qui nous avait été offert il y a déjà longtemps, probablement en 2017. En effet, un jour une amie, lectrice du mot du jour, est venue à la maison avec ce livre.
Elle nous a dit que ce livre pourrait nous intéresser Annie comme moi et que je pourrais même y trouver matière à mot du jour. Il a fallu le temps de la maturation pour suivre ce sage conseil.
J’en ai donc fait une série de 12 mots du jour.
J’ai regroupé l’ensemble de ces mots du jours en une page que vous trouverez derrière ce lien : <Comprendre le monde – Entretiens de la revue XXI>
Pour rappel, je vous redonne ci-dessous la liste de ces mots :
NR DATE
MOTS
AUTEUR
1413 Lundi 4 mai 2020 «La revue XXI» Mook fondé par Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry 1414 Mardi 5 mai 2020 «J’ai compris que je suis le monde. Tout ce que je vois, tout ce que je vis, tout ce que je mange, fait partie de mon univers, de mes créations, c’est réel et infini.» Xu Ge Fei 1415 Mercredi 6 mai 2020 «Face à un islam fondamentaliste, il s’agit de proposer un islam moderne, actif, réactif, une religion compatible avec le vivre ensemble et le temps présent, mais aussi avec les raffinements exquis qu’elle a inventés» Malek Chebel 1416 Jeudi 7 mai 2020 «Rendre lisible un texte du VIIe siècle à un lecteur du XXIe siècle en usant d’une langue simple.» Malek Chebel
1421 Mardi 12 mai 2020 «J’ai vu un chef d’État affirmer ses idées et agir en conséquence» Curtis Roosevelt
1422 Mercredi 13 mai 2020 «Rendre leur Histoire aux femmes» Michelle Perrot 1423 Jeudi 13 mai 2020 «Il est plus facile d’unifier des économies et des administrations que d’unifier des mémoires» Bronislaw Geremek
1425 Lundi 18 mai 2020 «Et je me suis lancée dans le combat contre le brevetage du vivant que je juge illégal, non scientifique, immoral et injuste.» Vandana Shiva 1430 Mercredi 27 mai 2020 «Je veux redonner la parole aux gens, moi qui ai tellement capté leur image.» Raymond Depardon 1431 Jeudi 28 mai 2020 «Pour ma part, j’en suis sûr : le sens de la solidarité nous vient du fond des âges, il est profondément ancré dans notre nature.» Frans de Waal 1432 Vendredi 29 mai 2020 «Quelle est votre richesse ? Qui êtes-vous que je ne suis pas ? est la seule question qui vaille» Tobie Nathan 1434 Vendredi 5 juin 2020 «La première attitude indispensable est d’être capable de se mettre à la place de l’autre. Si je peux me mettre à la place de l’autre, alors nous pouvons réfléchir ensemble.» Amin Maalouf <Comprendre le monde – Entretiens de la revue XXI>
<Mot sans numéro>
-
Jeudi 11 juin 2020
«L’idée même d’un système désigné sous le terme d’«économie» est un concept relativement récent. Il aurait été incompréhensible pour Luther, Shakespeare ou Voltaire»David GraeberNous avons donc appuyé sur le bouton « Stop » de l’économie pour nous confiner., L’épidémiologiste, Martin Blachier, a expliqué dans l’émission « C en l’air de France > que c’était l’arme atomique pour lutter contre le virus.
Cette émission qui reprenant les informations de l’OMS nous annonce que si en Europe la pandémie est en recul, sur le plan mondial elle s’aggrave. Les États-Unis restent très touchés, l’Amérique du sud, l’Inde, l’Iran constatent une aggravation. Dimanche dernier le 7 juin a constitué, dans le monde, le bilan le plus élevé concernant les nouveaux cas de contamination.
Désormais, en Europe et aussi aux Etats-Unis il est surtout question de relancer l’Économie.
Jean-François de Dijon a attiré mon attention sur une tribune publiée le 27 mai dans Libération : <David Graeber : vers une «bullshit economy»>
David Graeber a été cité deux fois dans le mot du jour, sans en être le sujet principal :
- La première fois, c’était le 4 novembre 2013. Cet article était consacré à la dette et plus précisément au concept allemand « Die Schuld » qui utilise le même mot pour désigner la dette et la faute ou la culpabilité.
- La seconde fois, c’était beaucoup plus récemment le 21 mars 2019, dans lequel il était question des « Juicers », c’est-à-dire ces personnes qui sont chargées de chercher et de recharger électriquement les trottinettes qui encombrent les trottoirs de nos villes.
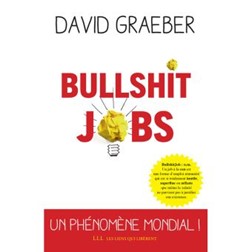 En fait, David Graber anthropologue américain a écrit un livre sur chacun de ces sujets.
En fait, David Graber anthropologue américain a écrit un livre sur chacun de ces sujets.
Le premier consacré à la dette : « Dette : 5000 ans d’Histoire » publié en 2013, le second consacré au « Bullshit job » publié en 2018 et dont la traduction française la plus immédiate pourrait être : « Les emplois à la con ».
Il reprend donc le terme de « bullshit » dans sa tribune pour l’appliquer à l’économie, l’économie qu’on veut relancer. Il explique d’abord que le terme économie est un concept récent qui date du XIXème siècle :
« Bien que cette notion soit aujourd’hui considérée comme un fait naturel, l’idée même d’un système désigné sous le terme d’«économie» est un concept relativement récent. Il aurait été incompréhensible pour Luther, Shakespeare ou Voltaire. Peu à peu, la société a accepté son existence, mais la réalité qu’il recouvre est restée mouvante. Ainsi, lorsque le terme d’«économie politique» est entré dans l’usage courant, au début du XIXe siècle, l’idée qu’il désignait était très proche de l’«écologie» (sa cousine étymologique) : les deux termes s’appliquaient à des systèmes dont on considérait qu’ils se régulaient d’eux-mêmes, et qui, tant qu’ils conservaient leur équilibre naturel, produisaient un surcroît de richesse – profits, croissance, nature abondante… – dont les humains pouvaient jouir sans limite. »
Il applique dès lors sa méthode d’analyse toujours décapante aux boulots générés par l’économie en s’appuyant sur quelques leçons tirées du confinement :
« Mais il semble que nous ayons atteint un stade où l’économie désigne non pas un mécanisme censé pourvoir aux besoins humains ou même à leurs désirs, mais majoritairement à ce petit surplus, la cerise sur le gâteau : ce qui naît de l’augmentation du PIB. Pourtant, le confinement nous l’a assez montré : ce n’est que de la poudre aux yeux. Pour le dire autrement, nous avons atteint le point où l’économie n’est qu’un vaste nom de code pour une bullshit economy, une «économie à la con» : elle produit de l’excès, mais non un excès glorifié pour sa propre superfluité, comme l’aristocratie aurait pu le faire jadis – un excès cultivé avec violence et présenté comme le royaume de la nécessité, de l’«utilité», de la «productivité», bref, d’un réalisme froid et forcené.
Or ce qu’on nous sommes en train de faire repartir en «relançant l’économie», c’est précisément ce secteur à la con où des managers supervisent d’autres managers, le monde des consultants en RH et du télémarketing, des chefs de marques, des doyens supérieurs et autres vice-présidents du développement créatif (secondés par leur cohorte d’assistants), le monde des administrateurs d’écoles et d’hôpitaux, ceux et celles qu’on paie grassement pour «designer» les visuels des magazines dédiés à la «culture» en papier glacé de ces entreprises dont les cols-bleus à effectif réduit et en perpétuelle surchauffe sont forcés de s’atteler à des monceaux de paperasserie superflue. Tous ces gens dont le boulot, en somme, consiste à vous convaincre que leur boulot ne relève pas de l’aberration pure et simple. Dans l’univers corporate, nombreux sont les employés qui n’ont pas attendu le début du confinement pour être intimement convaincus qu’ils n’apportaient rien à la société. Aujourd’hui, travaillant presque tous à domicile, ils sont bien obligés de regarder la réalité en face : la partie nécessaire de leur travail quotidien est pliée en un quart d’heure ; mieux, les tâches qui doivent impérativement être effectuées sur place – attendu qu’elles existent – le sont beaucoup plus efficacement en leur absence. Un coin du voile a été levé, et les appels à « faire repartir l’économie» dominent dans le chœur de nos politiques, terrifiés à l’idée que le voile pourrait se lever pour de bon si on tarde trop à venir le baisser. »
 Je pense qu’il doit être possible de nuancer son propos. Toutefois, certaines de ses diatribes trouvent quand même quelque écho dans notre vécu. Non ?
Je pense qu’il doit être possible de nuancer son propos. Toutefois, certaines de ses diatribes trouvent quand même quelque écho dans notre vécu. Non ?
Il continue résolument en impliquant la classe politique et le monde de la financiarisation :
« Cette question est d’une importance cruciale pour la classe politique en particulier, car c’est fondamentalement une question de pouvoir. Tous ces bataillons de larbins, de gratte-papier et de rafistoleurs professionnels, je crois qu’il faut les voir comme la version contemporaine du serviteur féodal. Leur existence est la conséquence logique de la financiarisation, ce système où les bénéfices de l’entreprise découlent non pas de la production ou même de la commercialisation de biens quelconques, mais d’une alliance toujours plus forte entre les bureaucraties entrepreneuriales et gouvernementales, créées pour produire de la dette privée et devenant de plus en plus nébuleuses à mesure qu’elles s’imbriquent. »
Et il donne un exemple, sans préciser dans quel pays cette histoire a eu lieu. Mais là aussi notre expérience nous conduit à croire crédible ce récit :
« Pour donner un exemple concret de ce système : récemment, une amie artiste s’est mise à fabriquer des masques en quantité industrielle pour les offrir à celles et ceux qui travaillent en première ligne. Et voilà qu’elle reçoit un communiqué en vertu duquel il lui est interdit de distribuer des masques, même gratuitement, sans avoir préalablement souscrit à une licence très onéreuse. Une demande à laquelle personne ne pourrait satisfaire sans emprunter ; ainsi, on ne demande pas seulement à l’individu de commercialiser son opération, mais aussi de fournir à l’appareil financier sa part de toutes les recettes futures. N’importe quel système fonctionnant sur le principe d’une simple extraction de fonds serait ainsi censé redistribuer au moins une part du gâteau pour gagner la loyauté d’une certaine partie de la population – ici, en l’occurrence, les classes managériales. D’où les boulots à la con. »
Il exprime cette idée qu’il partage avec d’autres comme Bruno Latour :
« Il est évident que nous nous porterions mieux si de nombreux emplois mis entre parenthèses étaient bientôt rétablis ; mais il y en a peut-être davantage encore que l’on aurait tout intérêt à ne pas voir revenir – à plus forte raison si nous voulons éviter la catastrophe climatique absolue. (Songeons un peu à la masse de CO2 recrachée dans l’atmosphère et au nombre d’espèces animales éradiquées pour toujours, à seule fin d’alimenter la vanité de ces bureaucrates qui, plutôt que de laisser leurs laquais travailler de chez eux, préfèrent les garder sous la main en haut de leurs tours scintillantes.) »
On peut cependant rétorquer que ces boulots donnent des emplois et des revenus. Et que trouver d’autres voies permettant à ces personnes de trouver des sources de revenus n’est peut-être ni évident, ni immédiat.
Il s’attaque alors à un autre « totem » de l’économie actuelle : « la productivité »
Si tout cela ne nous semble pas criant de vérité, si nous ne nous questionnons pas plus que ça sur le bien-fondé de la relance de l’économie, c’est parce qu’on nous a habitués à penser les économies à l’aune de cette vieille catégorie du XXe siècle, la fameuse «productivité». […] On sait aussi que les stocks de frigos, de blousons en cuir, de cartouches d’imprimantes et autres produits d’entretien ne se réapprovisionneront pas tout seuls. Mais si la crise actuelle nous a permis de tirer un constat, c’est bien que seule une infime partie de l’emploi, même le plus indispensable, est véritablement « productive » au sens classique – à savoir qu’elle produit un objet physique qui n’existait pas auparavant. Et la plupart des emplois « essentiels » sont en fait une déclinaison de la chaîne du soin : s’occuper de quelqu’un, soigner un malade, enseigner à des élèves, déplacer, réparer, nettoyer et protéger des objets, pourvoir aux besoins d’autres êtres ou leur garantir les conditions dans lesquelles ils peuvent s’épanouir. Ainsi, les gens commencent à se rendre compte que notre système de compensation est éminemment pervers, car plus on travaille pour soigner les autres ou les enrichir de quelque manière que ce soit, moins on est susceptible d’être payé.
Ce que l’on perçoit moins, c’est à quel point le culte de la productivité, dont la principale raison d’être est de justifier ce système, a atteint un point où il se grippe lui-même. Tout doit être productif : aux Etats-Unis, le bureau des statistiques de la Réserve fédérale [la Banque centrale américaine] va jusqu’à mesurer la « productivité » de l’immobilier ! Où l’on voit bien que le terme n’est qu’un euphémisme désignant en réalité les « bénéfices ». Mais les chiffres émanant de cet organisme montrent aussi que la productivité des secteurs de l’éducation et de la santé est en berne. Il suffit de faire quelques recherches pour constater que les secteurs du soin sont précisément ceux qui sont le plus submergés par des mers, des océans de paperasse ayant pour but ultime de traduire des résultats qualitatifs en données quantitatives, lesquelles pourront ensuite être intégrées à des tableaux Excel, afin de prouver que ce travail a une quelconque valeur productive – en faisant évidemment obstacle à l’enseignement, à l’accompagnement ou aux soins bien réels. »
Sa conclusion est un appel au vivant, à prendre soins les uns des autres et de repenser les indicateurs qui doivent guider notre activité.
On comprend alors que les exhortations à relancer l’économie ne sont que des incitations à risquer notre vie pour permettre aux comptables de retrouver le chemin de leur box. C’est pure folie. Si l’économie peut avoir un sens réel et tangible, ce doit être celui-ci : les moyens grâce auxquels les êtres humains pourront prendre soin les uns des autres, et rester vivants, dans tous les sens du terme. Qu’exigerait cette nouvelle définition de l’économie ? De quels indicateurs aurait-elle besoin ? Ou faudrait-il renoncer définitivement à tous les indicateurs ? Si la chose s’avère impossible, si ce concept est déjà trop saturé d’hypothèses fallacieuses, nous serions bien inspirés de nous souvenir qu’avant-hier, l’économie n’existait pas. Peut-être que cette idée a fait son temps.
On peut ne pas être d’accord avec toutes ses assertions, mais on ne peut nier que son analyse est revitalisante et pose questions
<1437>
- La première fois, c’était le 4 novembre 2013. Cet article était consacré à la dette et plus précisément au concept allemand « Die Schuld » qui utilise le même mot pour désigner la dette et la faute ou la culpabilité.
-
Mercredi 10 juin 2020
«Pause»Un jour sans mot du jourLe temps a manqué pour que puisse finaliser un mot du jour pour ce 10 juin 2020
 Pour votre réflexion, je vous invite à lire la tribune de François de Closets, publié le 29 mai 2020 sur le site du Monde : « La génération prédatrice du « toujours plus », née autour de 1950, devrait avoir honte »
Pour votre réflexion, je vous invite à lire la tribune de François de Closets, publié le 29 mai 2020 sur le site du Monde : « La génération prédatrice du « toujours plus », née autour de 1950, devrait avoir honte »
Le journaliste accuse les 150 signataires d’une tribune publiée sur le site du « Monde« le 26 mai et appelant à une « révolution de la longévité », de « revendiquer l’argent que nos enfants n’auront pas ».
« Publiée sur le site du Monde le 26 mai, une tribune appelait le pays à prendre soin de la génération des « nouveaux vieux » nés autour de 1950. Que l’on permette à un « ancien vieux » né dans les années 1930 d’y répondre. Et tout d’abord de poser aux signataires de ce texte plusieurs questions. N’éprouvent-ils pas de la gêne, pour ne pas dire de la honte, en regardant leurs enfants et petits-enfants ? Ne sont-ils pas conscients d’appartenir à une génération prédatrice qui laisse à ses descendants une nature dévastée et 2 000 milliards d’euros de dettes accumulées sans la moindre justification ? Croient-ils vraiment que nous n’y sommes pour rien ?
Leur texte fait référence au « défi de la longévité ». Fort bien. Celui-ci ne se traduit-il pas, en premier lieu, par le fait que l’on conserve plus longtemps la pleine possession de ses moyens, bref que nous sommes en état de travailler à un âge plus avancé que nos parents ? Et qu’avons-nous fait ? Notre génération du « toujours plus » a fixé la retraite pour tous, et pas seulement pour les ouvriers, à 60 ans, mettant ainsi cinq années de plus à la charge de nos enfants. Et pour que ces années soient confortables, nous nous sommes octroyé un niveau de vie supérieur à celui des actifs. C’est ainsi que la part de la richesse nationale affectée aux soins de la vieillesse atteint chez nous le chiffre record de 14 % du PIB. Et ce n’est pas assez, il faudrait y rajouter 10 milliards d’euros alors même que les budgets explosent de partout.
J’éprouve une immense gratitude vis-à-vis des moins de 60 ans qui ont accepté ce sacrifice, qu’ils vont payer très cher, pour nous sauver. Les auteurs de la tribune le rappellent eux-mêmes : le Covid-19 ne représente une menace mortelle que pour les plus de 64 ans. Les jeunes générations pouvaient parfaitement vivre avec et laisser mourir les anciens. C’est d’ailleurs ce que notre génération a fait, entre 1968 et 1970, avec la grippe de Hongkong, tout aussi géronticide. Nous n’avons pas, que je sache, arrêté le pays pour sauver nos parents. Donc nous sommes redevables aux moins de 60 ans et devons apporter tous nos efforts à la lutte contre l’épidémie.
Je dois avouer que l’argument sur le risque de discrimination, face au déconfinement, m’a beaucoup choqué. Cette crise est double, sanitaire et économique. L’une nécessite le confinement pour faire obstacle à la propagation du virus, l’autre exige que la France reprenne au plus vite le travail pour remettre en marche l’appareil de production. Il était donc naturel de demander aux actifs de sortir pour aller travailler et aux retraités de rester chez eux pour faire obstacle au virus. En vérité, c’est nous qui aurions dû le proposer. Au lieu de quoi le chœur des indignés a dénoncé une discrimination fondée sur l’âge. Indignation d’autant plus malvenue que nous nous étions écharpés tout au long de 2019 sur l’âge auquel devait s’établir la discrimination entre les actifs et les retraités. Vraiment, renoncer à promener le virus pour manifester notre gratitude aurait eu plus de cachet.
Que la fin de vie en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) n’ait rien de réjouissant, c’est un fait. Que chacun préfère finir sa vie chez soi, c’est bien naturel et les services sociaux agissent en ce sens. Que la dégradation de nos facultés rende ce séjour de plus en plus difficile, il ne faut pas l’oublier. Nous pouvons mieux faire et, pour les vieux comme pour les handicapés, il faut secouer l’égoïsme des bien-portants. Mais nous ne pourrons jamais avoir trois ou quatre personnes pour permettre le maintien à domicile de chaque personne impotente et dépendante. Dans un monde de familles éclatées, avec les progrès de la médecine qui vont multiplier les années de dépendance, nous serons de plus en plus nombreux à finir nos jours dans un établissement spécialisé et médicalisé. Telle est la réalité et nous n’avons pas à nous en scandaliser.
En revanche, arrivé au très grand âge, une question devient essentielle : le choix de sa mort. Des pays voisins et civilisés nous montrent en ce domaine des solutions que nous devrions suivre afin que chacun puisse décider de la voie qu’il souhaite emprunter à son heure dernière pour quitter le monde. Mais, de cette question essentielle, les promoteurs de la « révolution de la longévité » ne parlent pas.
Nous ferions bien de nous faire modestes, de nous mettre au service des générations qui nous suivent, ce qui va bien au-delà des seuls soins apportés à nos petits-enfants. Et, plutôt que revendiquer l’argent que nos enfants n’auront pas, demandons plus de liberté pour nous-mêmes, notre dernière liberté. »
<Mot sans numéro>
-
Mardi 9 juin 2020
«En envoyant simplement de la nourriture et des vêtements à ces personnes, nous soulageons sans doute notre conscience mais nous les privons de ce que tout un chacun aspire : avoir un travail, gagner de l’argent, décrocher diverses opportunités d’apprendre, aller à l’école et ainsi de suite. Nous n’entendons pas les véritables besoins de ces gens-là.»Leilah Janah, fondatrice de Samasource association visant à donner des emplois dans le numérique à des personnes pauvres et défavoriséesEn février de cette année, attiré par la Une du Point « Trump : l’Homme qu’il fallait prendre au sérieux », j’ai acheté l’hebdomadaire.
 La lecture de l’article consacré à « l’agent orange » comme l’appelle Spike Lee ne m’a pas beaucoup inspiré.
La lecture de l’article consacré à « l’agent orange » comme l’appelle Spike Lee ne m’a pas beaucoup inspiré.
Mais après les évènements qui se passent actuellement aux États-Unis je suis revenu vers ce numéro pour réexaminer la question.
Il n’y a pas grand-chose à en tirer, l’homme est vulgaire, peu cultivé, adepte des rapports de force, très égocentrique, ayant un rapport lointain avec la vérité.
Certains lui trouvent un certain sens politique, capable de comprendre une grande partie des électeurs, de les flatter et grâce à sa démagogie d’obtenir leur vote.
Mais pour ce faire, il est capable de dire n’importe quoi et surtout privilégie toujours le court terme en se moquant éperdument de ce qui peut arriver plus tard.
En pratique, il en appelle toujours aux instincts les plus bas, les plus égoïstes, les plus cupides qu’on peut trouver dans l’âme humaine.
Mais en parcourant ce numéro je suis tombé sur un tout petit article qui a attiré mon attention.
Le titre de cet article était : « Le dernier message de Leila Janah »
« Connaissez-vous Tolbi ? Il s’agit d’un objet connecté mis au point par un groupe d’élèves ingénieurs de l’École supérieure polytechnique de Dakar. Doté d’un capteur d’hygrométrie, il est capable de renseigner sur le besoin d’arrosage des plantes de manière extrêmement localisée, permettant de précieuses économies d’eau.
Il est accessible via un téléphone basique et s’adresse à des personnes qui ne savent pas forcément lire et écrire grâce à la transmission d’informations dans les langues locales, comme le wolof. […]
Utiliser l’intelligence artificielle pour aider les plus pauvres à s’en sortir : c’est ce qui a motivé tout au long de sa vie Leila Janah. Cette femme américaine d’origine indienne a créé Samasource, qui compte quelque 11 000 salariés et a noué des partenariats avec des entreprises comme Walmart, General Motors ou Microsoft. »
 Pour une fois Wikipedia ne donne, pour l’instant, aucune information sur cette jeune femme. Je veux dire le Wikipedia en français, la version anglaise, lui consacre bien <un article>
Pour une fois Wikipedia ne donne, pour l’instant, aucune information sur cette jeune femme. Je veux dire le Wikipedia en français, la version anglaise, lui consacre bien <un article>
Je suis abonné au Monde et à Libération. J’ai donc cherché un article sur cette femme dans ces deux quotidiens. Ni l’un, ni l’autre n’a jamais parlé de cette jeune femme, fille d’immigrés indiens, installée aux Etats-Unis.
Enfin, j’ai trouvé un article sur une page annexe du site de l’Obs datant de novembre 2016 : <Leila Janah le visage du caritatif nouvelle génération>
« Leila Janah, avec son association à but non lucratif Sama, assume pleinement son côté startuppeuse et une communication décomplexée. Au Kenya ou en Ouganda, elle vient en aide à des populations défavorisées en les formant aux métiers du Web. […]
En 2008, elle a fondé Samasource, une association à but non lucratif qui vise à former des personnes au Kenya aux métiers du Web et ainsi leur donner accès à des emplois qui ne nécessitent pas d’être localisés dans la Silicon Valley. […] « J’ai passé presque une décennie de ma vie à travailler d’abord comme professeur d’anglais, puis comme traductrice et chercheuse, et, par-dessus tout, comme une idéaliste. Je suis devenue très cynique par rapport au mouvement contre la pauvreté : tout le monde semblait voir les pauvres comme fondamentalement dans le besoin, comme des consommateurs passifs […], mais jamais comme des producteurs. […] »
En cherchant un peu plus, j’ai aussi trouvé un article d’avril 2017 du magazine « Usbek & Rica » qui poursuit l’objectif d’«explorer le futur » : <Leila Janah : l’économie numérique peut sortir des milliers de gens de la pauvreté> :
« On appelle ça l’« impact sourcing » : la démarche consiste à faire appel à une main d’œuvre issue de milieux défavorisés, dans l’idée de marier économie marchande et économie d’entraide. En 2005, diplômée d’Harvard et alors consultante en sous-traitance, Leila Janah visite un call-center de Bombay et réalise que seule la classe moyenne a la possibilité d’y travailler. Quid des milliers d’habitants des bidonvilles ?
Convaincue que la réponse à la pauvreté ne peut être que l’emploi, elle crée Samasource – « sama » signifie « égal » en sanscrit – une ONG via laquelle elle emploie des personnes vivant sous le seuil de pauvreté afin qu’ils fournissent des services numériques à de grandes entreprises comme Google, Microsoft ou LinkedIn.»
Dans cet entretien elle explique avoir été inspirée par Muhammad Yunus le créateur de la micro-finance et prix Nobel de la paix en 2006.
«Ma vision était de créer une entreprise qui embaucherait et paierait des personnes à très bas revenus afin de les sortir de la pauvreté directement grâce à l’économie numérique. L’idée était d’appliquer à la sous-traitance ce que Muhammad Yunus a fait pour le secteur bancaire. En constatant que le système financier excluait complètement les plus pauvres, qui n’avaient pas besoin de gros crédits mais n’avaient aucun moyen d’avoir accès à du capital, Yunus a créé la micro-finance, et cela me fascinait. Je me suis demandée si on pouvait faire la même chose pour le numérique : décomposer les projets numériques en petites tâches et apprendre aux gens à les réaliser. Grâce au micro-travail, nous avons employé plus de 8 000 personnes. Et comme chacune de ces personnes subvient aux besoins de quatre autres personnes, nous avons sorti 35 000 personnes de la pauvreté. »
Elle répond à la question de la sous-traitance qui aux yeux de certains constituent un dévoiement des circuits économiques, en expliquant que si les objectifs sont éthiques ces processus sont positifs :
« La sous-traitance est inévitable. Contrairement à ce que peuvent faire croire certains politiciens qui en ont fait un gros mot, comme Trump ou d’autres. En 2017, on sous-traite tout. Les matériaux des chaises sur lesquelles nous sommes assises proviennent du monde entier, l’ordinateur que vous utilisez n’a rien de français, tout est sous-traité. En revanche, il faut se demander : est-ce que les biens sont produits de façon équitable ? Est ce que les gens qui les fabriquent sont payés correctement ? Par correctement, j’entends : est-ce qu’ils gagnent un salaire décent ? Au Kenya, ce n’est pas très compliqué de payer quelqu’un à un salaire décent même si ça coûte évidemment plus cher que de les payer au plus bas salaire possible comme le font beaucoup d’entreprises. Mais je suis convaincue qu’en payant mieux ses salariés, on les fidélise et on construit une entreprise qui aura plus de valeur sur le long terme. […] Au Kenya par exemple, je crois pouvoir dire que nous sommes le meilleur employeur du pays. Nos employés nous le disent. Nous offrons trois repas par jour, les transports domicile-bureau, payons les heures supplémentaires, les congés maladie, les congés maternité… Nous rendons public sur notre site, tous les trois mois, le bilan de notre impact social. Nous savons qu’en moyenne nos employés augmentent leurs revenus de 400 % après avoir travaillé avec nous. »
Enfin j’ai encore trouvé un article de « Forbes » qui décrit la personnalité et la démarche de Leila Janah : <Leila Janah : Des racines et des ailes> :
« Fondatrice de Samasource et LXMI, l’entrepreneure Leila Janah a peaufiné, au gré de ses pérégrinations, une manière totalement novatrice d’aborder les thématiques de l’humanitaire et du caritatif engoncées dans un modèle sclérosé, en rendant aux populations les plus vulnérables les clés de leur destin via le digital. […]
 « En envoyant simplement de la nourriture et des vêtements à ces personnes, nous soulageons sans doute notre conscience mais nous les privons de ce que tout un chacun aspire : avoir un travail, gagner de l’argent, décrocher diverses opportunités d’apprendre, aller à l’école et ainsi de suite. Nous n’entendons pas les véritables besoins de ces gens-là ». Le constat est implacable de lucidité, et, forte de ce postulat, Leila Janah s’évertue à faire bouger les lignes dans le domaine des aides internationales en redonnant aux principaux concernés la maîtrise de leur existence. Objectif affiché : les extirper de cette position attentiste en étant essentiellement tributaire du bon vouloir des pouvoirs publics locaux. Et c’est peu dire que la sémillante entrepreneure, née à New York il y a 34 ans, maîtrise son sujet, elle qui, dès les prémices, s’est battue pour réussir. « J’ai été acceptée à Harvard mais ma famille ne disposait pas de suffisamment de ressources pour subvenir à mes besoins à l’université et j’ai dû, comme beaucoup, travailler en dehors de mes heures de cours pour pouvoir payer mes études. J’avais trois jobs différents à cette époque », souligne la jeune femme.
« En envoyant simplement de la nourriture et des vêtements à ces personnes, nous soulageons sans doute notre conscience mais nous les privons de ce que tout un chacun aspire : avoir un travail, gagner de l’argent, décrocher diverses opportunités d’apprendre, aller à l’école et ainsi de suite. Nous n’entendons pas les véritables besoins de ces gens-là ». Le constat est implacable de lucidité, et, forte de ce postulat, Leila Janah s’évertue à faire bouger les lignes dans le domaine des aides internationales en redonnant aux principaux concernés la maîtrise de leur existence. Objectif affiché : les extirper de cette position attentiste en étant essentiellement tributaire du bon vouloir des pouvoirs publics locaux. Et c’est peu dire que la sémillante entrepreneure, née à New York il y a 34 ans, maîtrise son sujet, elle qui, dès les prémices, s’est battue pour réussir. « J’ai été acceptée à Harvard mais ma famille ne disposait pas de suffisamment de ressources pour subvenir à mes besoins à l’université et j’ai dû, comme beaucoup, travailler en dehors de mes heures de cours pour pouvoir payer mes études. J’avais trois jobs différents à cette époque », souligne la jeune femme.
Au-delà de son cas personnel sans commune mesure par rapport à ce qu’elle va découvrir tout au long de ses moult périples, Leila Janah a déjà à cœur de s’intéresser aux autres et à la manière dont ils vivent. Elle est ainsi rapidement sensibilisée aux problématiques de l’humanitaire – et confrontée à leurs limites – lors d’un voyage d’un mois dans un village reculé du Ghana, avant justement de rejoindre Harvard. Une révélation. « Cela m’a vraiment aidé à être sûre de ce que je voulais faire plus tard ». Et déjà, les premières interrogations commencent à poindre. « Je me demandais pourquoi cette communauté était si pauvre alors que tout le monde travaillait dur dans les fermes et les champs. Certains d’entre eux allaient vendre de petits objets et de la nourriture au bord de la route. Ils avaient instauré un petit système de commerce à leur échelle, sauf que personne ne gagnait plus de 2$ par jour ». Mais la dignité de ses hommes et de ses femmes suscite l’admiration de Leila Janah. « C’était particulièrement désarçonnant de voir ces gens vivre dans de telles conditions, tout en étant heureux, souriants, et accueillants ». […]
Mais si la frustration est immense, Leila Janah n’est pas une femme à demeurer et à se complaire dans le constat d’urgence. Elle se met rapidement en quête de solutions et laboure de nombreuses terres de réflexion pour tenter de trouver – à son échelle – des alternatives aux solutions humanitaires dites classiques. « J’ai donc décidé d’étudier l’économie du développement pour pouvoir véritablement comprendre le problème. Pourquoi, par exemple, les gens sont si pauvres alors qu’ils sont résolument demandeurs d’un travail et ne ménagent pas leur peine ? Ou encore : quel impact a eu le colonialisme sur le seuil de pauvreté de ces pays ? À ce stade, je ne pouvais plus ignorer ces questions, il fallait que je trouve les réponses ». Or, aucune d’entre elles ne se trouvent dans la quiétude et le confort américains, et « la réalité du terrain » rattrape Leila Janah qui a, chevillée au corps – et au cœur -, cette volonté indéfectible de comprendre. « À partir de là, je passais tous mes étés à faire des stages en Afrique ou en Asie pour essayer d’aborder et d’apprécier, sous différents angles, la globalité du problème. Je travaillais avec des ONG d’autres organismes humanitaires, puis j’ai commencé à travailler pour La Banque Mondiale ». […]
« Quand les gens commencent à gagner de l’argent, ils réinvestissent le fruit de leur travail à une échelle locale, surtout les femmes. Elles investissent, en effet, près de 90% de leurs potentiels bénéfices dans leur famille et leur communauté, l’éducation de leurs enfants, la nourriture, et ainsi de suite. La meilleure stratégie de développement que les aides internationales peuvent fournir est de donner un travail à ces femmes afin qu’elles puissent gagner de l’argent, et les laisser le gérer comme elles l’entendent », diagnostique Leila Janah. Samasource est sur rampe de lancement et sortira finalement de terre en 2007. L’idée est simple : alors que les « produits physiques » peuvent rencontrer une multitude de problèmes, notamment d’acheminement, la « matière digitale » s’affranchit, de facto, de ce genre de considérations. « Tout ce dont vous avez besoin c’est d’électricité pour avoir une connexion internet, et même cela, nous pouvons l’obtenir grâce à l’énergie solaire. Ce qu’on ne peut pas faire avec des structures physiques, nous le faisons avec le digital ». […]
La réussite de Samasource n’est pas une fin en soi et déjà Leila Janah fourmille de projets. Sa seconde aventure entrepreneuriale baptisée LXMI, une gamme de produits et de crèmes de soins haute gamme, reprenant peu ou prou les codes de Samasource, mais dans le domaine du cosmétique et de la beauté, l’accapare également. « LXMI est présent dans tous les Sephora américains (300 magasins + Internet), et nous sommes la première marque de cosmétique engagée dans le développement durable. Le but est de créer un produit de luxe bio et issu du commerce équitable, avec une esthétique très travaillée ». L’entrepreneure s’attelle également à l’écriture d’un livre attendu dans toutes les librairies américaines le 12 septembre prochain et intitulé « Give Work » qui relatera justement ses pérégrinations et reviendra par le menu sur l’aventure Samasource et LXMI. Celle qui, sur les réseaux sociaux, se géolocalise à « San Francisco ou dans une valise » n’a pas fini d’arpenter le globe. Toujours au service des autres. »
Alors pour revenir à l’article du Point : « Le dernier message de Leila Janah »
Ce dernier message fut un tweet en novembre 2019 :
Il y a onze ans, quand je me suis lancée en voulant utiliser l’intelligence artificielle pour aider les Africains avec de grandes entreprises, tout le monde croyait que j’allais échouer ».
C’était son dernier message parce que cette femme brillante, pleine d’énergie, engagé dans le monde tel qu’il est mais pour aider à faire grandir les valeurs auxquelles elle était attachée, a quitté la communauté des vivants, à l’âge de 37 ans, le 24 janvier 2020.
Elle souffrait
 du sarcome épithélioïde, une forme rare de cancer qui lui avait été diagnostiquée en avril 2019
du sarcome épithélioïde, une forme rare de cancer qui lui avait été diagnostiquée en avril 2019
En septembre 2019 elle a publié sur Instagram une photo sur laquelle elle n’avait plus de cheveux, mais toujours ce regard plein de lumière. Elle remerciait les personnes qui lui ont écrit de doux messages.
Le site informatique « Dailygeekshow » lui a rendu hommage : « C’était une femme brillante qui a rendu le monde meilleur »
« Leila Janah était une brillante entrepreneuse de la Silicon Valley. Elle a fondé Samasource en 2008 qui « fournit des données de formation de haute qualité et la validation des principales technologies d’IA (intelligence artificielle) au monde. Leila a dirigé un mouvement mondial de sourcing d’impact et a été une championne de la durabilité environnementale et de l’élimination de la pauvreté dans le monde. Elle a été la fondatrice et PDG de trois organisations, toutes ayant pour mission commune de « donner du travail » : Samasource, un leader technologique mondial à but lucratif dans les données de formation pour l’IA ; LXMI, une entreprise de soins de la peau biologiques et équitables ; et Samaschool, un organisme à but non lucratif axé sur la requalification de la nouvelle économie. […]
Leila Janah et sa société sont parvenues à fournir un travail raisonnablement rémunéré à plus de 50 000 personnes. Elle avait d’ailleurs raconté l’histoire de Vanessa Lucky Kanyi, une Kenyane qui travaillait avant pour seulement 1 $ par jour, ce qui n’était réellement pas assez pour vivre. Samasource lui a offert la possibilité de travailler en tant qu’assistante virtuelle pour un client canadien et en tant que leader au sein de la société. Vanessa Lucky Kanyi a finalement décidé d’étudier aux États-Unis et a obtenu une bourse d’études au Santa Monica Community College où elle a pu étudier l’ingénierie. Cette Kenyane est donc parvenue à se reconstruire grâce à l’aide précieuse et au travail acharné de Leila Janah.
Motivée et ambitieuse, elle a toujours montré à quel point il est important de « cultiver son propre jardin« , autrement dit d’identifier ses propres valeurs et passions et d’y remédier à chaque fois que le monde autour de nous devient accablant. « Si vous ne respectez pas vos propres valeurs, eh bien, devinez quoi ? Tout ce qui précède ce moment est terminé, et tout ce qui se trouve après ce moment n’est pas encore écrit dans la grande histoire de votre vie, et vous êtes le seul auteur et arbitre de ce qui se passe dans votre jardin. Il n’y a aucune excuse ; il ne peut y avoir d’amertume envers un monde injuste, car dans votre jardin, il n’y a que de la beauté, de la lumière et du bien, fécondés par les décisions que vous choisissez de prendre» , a-t-elle notamment affirmé. »
Sur le site qui lui était consacré : https://www.leilajanah.com/ et qui a été fermé depuis, on trouvait cette photo en page d’accueil
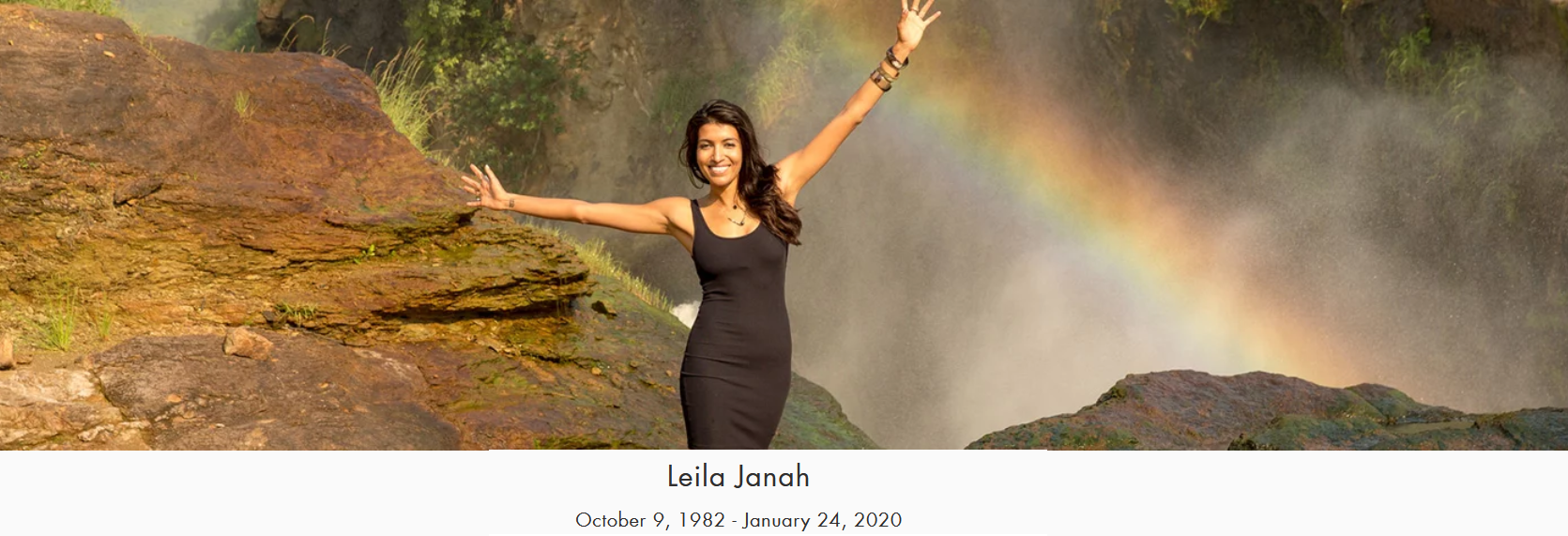
-
Lundi 8 juin 2020
« Les Etats-Unis ont été fondés sur le vol de la terre, le génocide des Indiens, et sur l’esclavage. Je le répète : c’est ainsi que les Etats-Unis ont été bâtis ! C’est la raison pour laquelle j’ai un vrai problème avec le terme « les pères fondateurs ».»Spike LeeAprès un nouveau meurtre d’un homme noir, George Floyd, par un policier américain à Minneapolis, une vague de protestation et de manifestations déferlent sur les grandes villes américaines.
Mais cet élan ne s’arrête pas aux Etats-Unis. De Bristol à Budapest en passant par Madrid et Rome, des dizaines de milliers d’Européens ont rejoint dimanche les manifestations contre le racisme. Et ce mouvement ne s’arrête pas non plus en Europe, il a gagné progressivement le reste de la planète.
<L’AFP> donne une description de ces différentes manifestations.
 Le journaliste de l’OBS, François Forestier, a interrogé sur ces évènements le cinéaste afro-américain Spike Lee : « Les Etats-Unis se sont bâtis sur l’assassinat des Noirs »
Le journaliste de l’OBS, François Forestier, a interrogé sur ces évènements le cinéaste afro-américain Spike Lee : « Les Etats-Unis se sont bâtis sur l’assassinat des Noirs »
Spike Lee devait présider le jury du Festival de Cannes, cette année 2020. Nous savons que le festival n’aura pas lieu.
Il comprend parfaitement la réaction des manifestants :
« Comment ne pas comprendre la réaction des gens ? Nous avons eu les émeutes des années 1960, l’assassinat de Martin Luther King, l’affaire Rodney King, et, à chaque nouvel événement, justice n’est pas faite. Les gens veulent se faire entendre… Encore et encore. Rien de nouveau là-dedans.
C’est la même chose depuis quatre cents ans. L’assassinat des Noirs, c’est là-dessus que le pays s’est bâti. Le positif, c’est qu’il y a des gens très divers dans les manifestations. Voir que nos frères et sœurs blancs sont dans la rue, c’est très encourageant. L’espoir est là, dans cette jeune génération qui ne veut pas perpétuer la situation… Quant à Trump, c’est un gangster qui tente de devenir un dictateur. »
Il souligne un point essentiel c’est que lors des manifestations actuelles, la communauté noire n’est pas la seule à se révolter contre cette injustice, mais que de nombreux « blancs » n’acceptent plus cette situation aux Etats-Unis
Il appelle Trump : l’agent orange. On comprend qu’il fait référence aux cheveux du président américain mais L’« agent orange » est surtout le surnom donné à l’un des herbicides arc-en-ciel, plus précisément un défoliant, le plus employé par l’armée des États-Unis lors de la guerre du Viêt Nam entre 1961 et octobre 1971
Il rappelle aussi que lors de la guerre du Viêt-Nam, alors que le pourcentage de Noirs aux Etats-Unis était de 13 %, sur le terrain de guerre les troupes en ligne allaient jusqu’à 30 %.
Spike Lee sort, le 12 juin, un film sur Netflix, « Da 5 Bloods », dans lequel cinq vétérans afro-américains reviennent au Vietnam pour chercher une caisse d’or.
Le journaliste l’interroge à son propos :
« Dans « Da 5 Bloods », vous faites référence à des héros inconnus de la guerre du Vietnam, comme Milton Olive, soldat noir qui s’est jeté sur une grenade pour sauver ses compagnons…
Ce que j’essaie de faire, c’est de mentionner des faits historiques, souvent oubliés. Milton Olive a été l’un des premiers soldats à mourir là-bas, au nom des Etats-Unis. En octobre 1965, alors qu’il patrouillait dans la jungle lors de la bataille de Phu Cuong, il s’est sacrifié en se couchant sur une grenade. Il avait 18 ans. On a lui attribué la Medal of Honor, à titre posthume.
[Les soldats afro-américains.] sont les grands oubliés. C’est comme ça depuis toujours. Les Etats-Unis ont été fondés sur le vol de la terre, le génocide des Indiens, et sur l’esclavage. Je le répète : c’est ainsi que les Etats-Unis ont été bâtis ! C’est la raison pour laquelle j’ai un vrai problème avec le terme « les pères fondateurs ». Ces putains de pères fondateurs étaient des esclavagistes ! George Washington, le premier président, possédait cent vingt-quatre esclaves à sa mort. Le pays a été construit sur cette inhumanité. »
Il souligne que la violence à l’égards des noirs et d’ailleurs aussi des indiens est consubstantiel eux Etats Unis.
Il faut d’ailleurs comprendre que si les blancs américains suite à la guerre de sécession ont accepté d’affranchir les esclaves noirs, ils ont en fait des citoyens de secondes zones et ont immédiatement considérés qu’ils constituaient une menace pour les biens et l’intégrité des personnes qui détenaient le pouvoir économique et étaient les anciens esclavagistes.
Et c’est la police qui a eu ce rôle de contenir par tous les moyens « le danger des anciens esclaves noirs ».
<Cet article du Monde> rappelle qu’en janvier 1865, quelques mois avant la fin de la guerre de Sécession et l’abolition de l’esclavage, le gouvernement d’Abraham Lincoln avait promis d’octroyer « 40 acres et une mule » aux quelque 4 millions d’esclaves noirs pour démarrer leur nouvelle vie d’hommes libres. Mais sa parole n’a pas été respectée et les lopins de terre, équivalents à 16 hectares, ont été rapidement rendus aux anciens propriétaires.
Cette manière de sortir de l’esclavage a eu des effets délétères.
On trouve ainsi sur le site de Mediapart un article d’une bloggeuse de New-York, cet article instructif <De l’esclavage à l’incarcération de masse> qui évoque un documentaire « The 13 th » de la réalisatrice Ava DuVernay qui expose les racines idéologiques suprémacistes de l’Amérique et les politiques qui ont abouti jusqu’à présent à la criminalisation et à l’incarcération exponentielle de la population noire aux Etats-Unis :
« Le titre The 13th, (le treizième) pourrait faire penser à un film d’horreur. Ce chiffre malheureux est celui du 13eme amendement de la Constitution des Etats-Unis, dont l’histoire retient qu’il a abolit l’esclavage en 1865, à une exception près: « sauf en tant que punition pour les personnes reconnues coupables de crime ». A partir de ces prémisses, Ava DuVernay retrace l’histoire terrifiante des injustices raciales et des violations des droits humains, toujours présentes au coeur de la politique et de société américaine.
[…] Remontant le fil de l’histoire, les protagonistes exposent la manière dont, dès la fin de la guerre de Sécession, la clause de criminalité du 13 eme amendement a été immédiatement utilisée pour reconstruire les Etats du Sud. L’esclavage était un système économique. Quatre millions de personnes qui étaient auparavant définies comme propriété sont désormais libres. Très vite, le stéréoptype du noir criminel remplace la figure de l’esclave dans la culture américaine. Après la guerre civile, les anciens esclaves sont arrêtés massivement et un nouveau système de location de détenus est mis en place, fournissant une main d’œuvre gratuite. Un système qui trouve son prolongement aujourd’hui à une échelle industrielle, dans la gestion de 150 prisons par des intérêts privés et dans l’exploitation du travail des détenus. La Corrections Corporation of America (CCA) et G4S, les deux entreprises leaders sur le marché des prisons privées, sous-traitent le travail des détenus aux 500 plus grandes entreprises comme Chevron, Bank of America, A&T, IBM, ou Boeing. Dans la plupart des Etats, près d’un million de prisonniers fabriquent des meubles de bureau, des composants électroniques, des uniformes, répondent aux appels dans des call-centers, travaillent dans des abattoirs et des champs de patates, ou fabriquent des jean’s , des chaussures ou des sous-vêtements pour de grandes marques, en étant payés entre 93 cents et $4,73 par jour. […]
Au fur et à mesure que la société devient moins tolérante à la discrimination raciale, le glissement sémantique qui s’opère entre noirs et criminels permet d’adopter des lois répressives qui ciblent les personnes de couleur et qui permettent de criminaliser les mouvements progressistes et les leaders de la communauté noire qui revendiquent plus de justice sociale. Dans une séquence édifiante, John Ehrlichman, secrétaire d’Etat aux affaires intérieures du président Richard Nixon déclare ainsi: « Nous ne pouvions pas rendre illégale l’opposition à la guerre du Vietnam ou aux noirs, mais en associant les hippies à la marijuana et les noirs à l’héroine, et en pénalisant lourdement les deux, nous pouvions disloquer ces communautés ».
La southern strategy inaugurée par Richard Nixon en 1968 et sa campagne présidentielle Law and Order, stigmatise les minorités ethniques comme criminels pour regagner l’électorat blanc démocrate dans les Etats du Sud. Cette stratégie sera poursuivie par Ronald Reagan dans les années 80 au nom de la « guerre contre la drogue », pénalisant bien plus lourdement le crack, qui ravage les quartiers pauvres noirs et hispaniques, que la cocaïne qui se répand dans les classes moyennes et supérieures blanches, puis par Bill Clinton dans la décennie suivante.
« L’institution de la ségrégation qui faisait des noirs des citoyens de seconde zone est remplacé aujourd’hui par le système d’incarcération de masse qui prive des millions d’américains noirs des droits supposés gagnés par le mouvement des droits civils. » analyse Michelle Alexander. »
Dans une <Tribune à Jeune Afrique> l’historien spécialiste des Etats-Unis Pap Ndiaye rappelle la longue histoire du racisme au sein de la police américaine :
« Au début des années 1920, la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), la principale organisation de défense des droits des Noirs, dénonçait la collusion entre certains services de police et de justice et des organisations suprématistes blanches comme le Ku Klux Klan (KKK), alors tout puissant dans le Sud profond. Des chefs du KKK portaient une étoile de shérif le jour et une cagoule blanche la nuit. Dans les grandes villes du Nord, ce sont les policiers, presque tous blancs jusqu’aux années 1960, qui étaient accusés de violences, comme à Chicago, en 1919, lorsqu’ils participaient aux ratonnades dans le quartier noir. […]
Pendant le mouvement pour les droits civiques, Martin Luther King n’hésitait pas à dénoncer les policiers violents et racistes. Dans son plus célèbre discours, « I have a dream », il avertissait : « Nous ne pouvons être satisfaits tant que le Noir est la victime des horreurs indicibles des brutalités policières ». Le combat contre la ségrégation et les violences trouva des échos profonds en Afrique. […]
Les départements de police de trop nombreuses villes américaines sont gangrenés en profondeur par un racisme structurel qui ruine la vie des Américains noirs depuis des décennies. Des efforts sérieux ont été consentis ici et là, mais on est encore très loin du compte. »
Cette page de France Culture retrace l’histoire aux <États-Unis des violences policières contre les noirs en quelques grandes dates>
Le mouvement de fond qui soulève actuellement l’Amérique doit se comprendre dans cette histoire de violence et d’asservissement. Et nous pouvons espérer qu’il débouche sur des évolutions importantes sur ce sujet de la violence faite aux noirs.
<1435>
-
Vendredi 5 juin 2020
«La première attitude indispensable est d’être capable de se mettre à la place de l’autre. Si je peux me mettre à la place de l’autre, alors nous pouvons réfléchir ensemble.»Amin MaaloufAmin Maalouf est né en 1949 à Beyrouth, dans une famille d’intellectuels de confession melkite, c’est-à-dire une petite communauté chrétienne du Liban.
Il a d’abord été journaliste comme son père, puis il est devenu écrivain.
Il a notamment reçu le Prix Goncourt en 1993 pour «Le Rocher de Tanios», et a été élu à l’Académie française en 2011.
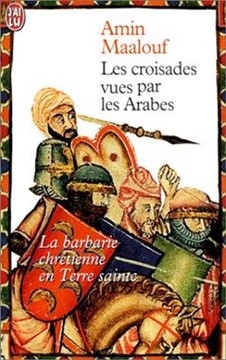 Pour ma part j’ai découvert cet auteur par l’essai « Les Croisades vues par les Arabes » qu’il a publié en 1983 qui a été à la fois une révélation et un choc pour moi.
Pour ma part j’ai découvert cet auteur par l’essai « Les Croisades vues par les Arabes » qu’il a publié en 1983 qui a été à la fois une révélation et un choc pour moi.
Entendre le point de vue des arabes sur ces grandes expéditions des occidentaux en Palestine, à Jérusalem et plus largement dans les pays de l’Islam entre 1096 et 1291 m’ouvrit d’autres horizons et me fit comprendre qu’il faut accueillir le point de vue de l’autre pour comprendre un évènement dans toute sa dimension.
Dans cet essai Amin Maalouf s’inspire des historiens et des chroniqueurs arabes de l’époque pour raconter comment fut ressenti, dans la civilisation islamique raffinée et sophistiquée de cette époque, l’arrivée des chrétiens pillant, massacrant et ne reculant devant aucune horreur par rapport à « l’autre » qui était « l’infidèle » celui qui ne partageait pas la même religion.
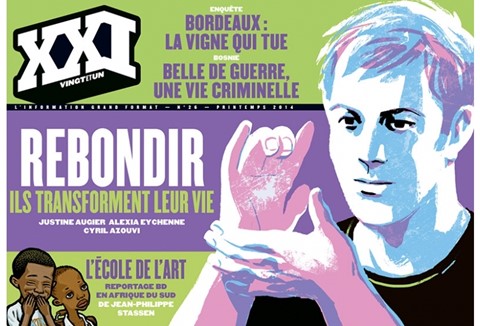
Amin Maalouf fait partie de ces intellectuels qui se révèlent dans le livre « Comprendre de Monde » élaboré à partir de la Revue XXI.
L’entretien qui a été mené par Maxime Amieux et Myriam Blal a été publié dans le N°26 de la revue XXI paru au printemps 2014. Il avait pour titre « Se mettre à la place de l’autre »
Il évoque d’abord son enfance au Liban, tant il est vrai que beaucoup se joue pendant l’enfance.
« Mon père était un homme très doux. Ma mère avait peur pour nous, elle nous protégeait plus que nous le voulions. […]. J’ai toujours vécu à la maison au milieu des journaux et des livres. Mon père recevait la plupart des quotidiens du pays. Le matin, nous recevions toute la presse quotidienne. Depuis mes 7 ans, nous nous installions ensemble avec un peu de café et nous parcourions l’actualité.
Mon père enseignait, comme certains de ses frères et sœurs. Enfant, je l’ai vu journaliste et enseignant. La sœur de mon père, dont nous étions proches, était professeur à l’université américaine de Beyrouth. Elle venait souvent nous raconter la vie de l’université. Le savoir et l’information étaient très présents. J’ai grandi dans une maison où mon père écrivait, je l’ai toujours vu écrire et, pour moi, travailler c’était écrire. La vie a fait que j’ai écrit plus que d’autres, mais je savais que j’allais avoir un métier d’écriture. J’en étais certain »
Ses parents organisent de nombreuses réceptions avec l’élite intellectuelle du Liban et de Beyrouth. Une divergence de point de vue allait naître entre Amin est ses parents.
« Oui, ces réceptions commencent à partir de 1963. Mon père, Rushdi, vient de fonder son journal. Il loue avec ma mère un très bel appartement de cinq cents mètres carrés à Beyrouth. Nous venons de quitter le quartier cosmopolite de Ras-Beyrouth pour nous installer dans un quartier à majorité chrétienne. Des ministres, des députés, des directeurs de journaux, des intellectuels […] viennent à la maison et je participe à ces activités mondaines avec mes sœurs. Mais à partir de 1964, mes idées commencent à différer de celles de mes parents. Je suis révolté contre le système communautaire au Liban, contre les inégalités, contre le colonialisme.
Mes parents reçoivent les notables du pays, et moi, je me mets à recevoir et organiser des réunions d’étudiants de gauche, dans l’esprit de ce que connaîtra la France en 1968. C’est ainsi que je rencontre des militants venus d’ailleurs : des Erythréens, des Sud-Africains. Olivier Tambo, alors président du Congrès national africain, le parti de Nelson Mandela, est venu une fois, j’avais 17 ans. Notre maison était grande, il était pratique de s’y réunir à plusieurs. Je faisais partie des dizaines d’étudiants libanais militants, mais je n’ai jamais eu de véritable rôle.
Mon père acceptait le fait que nous ne soyons pas d’accord, même s’il était mal à l’aise que je critique son entourage. Cela n’a pas affecté nos relations, mais nous étions en tension.»
Mais la guerre civile éclate au Liban, sous ses fenêtres, le 13 avril 1975. Ce qui va le conduire à quitter son pays natal pour venir en France :
« C’était un dimanche. Je rentrais de reportage. Je m’étais rendu au Bangladesh, en Thaïlande et au Vietnam où j’avais assisté au début de la bataille de Saïgon. J’avais quitté le Vietnam le 10 avril, pour me rendre à New Delhi où j’ai rencontré Mme Gandhi.[…] Le lendemain, un samedi, je suis monté ) à bord du Pan American 001, qui assurait la liaison New Delhi-Karachi-Téhéran-Beyrouth. On croit rêver aujourd’hui ! C’était un vol de nuit. Je suis arrivé à Beyrouth le matin du 13 avril 1975. Vers midi, j’étais chez moi avec ma femme et notre fils. C’est alors que nous avons entendu des tirs puis des cris. Nous avons sorti la tête pour regarder par la fenêtre de notre chambre et aperçu un autobus arrêté à un carrefour, à une centaine de mètres de chez nous. Il y avait un attroupement d’individus autour du car, qui discutaient avec des personnes armées. Soudain, nous entendons des tirs. Nous nous cachons derrière le mur. Au bout d’une dizaine de secondes, silence. Nous sortons discrètement nos têtes à travers la fenêtre. Il devait y avoir une vingtaine de cadavres au sol. J’ai appelé mon père pour le prévenir que nous ne pouvions aller déjeuner chez lui. Je me souviens lui avoir dit : « Je crois que la guerre a commencé. » Le soir même, notre quartier était sous les bombes. »
 C’est donc ainsi que la guerre a éclaté entre les communautés du Liban. Le Liban qui avait la réputation d’être la Suisse du proche orient.
C’est donc ainsi que la guerre a éclaté entre les communautés du Liban. Le Liban qui avait la réputation d’être la Suisse du proche orient.
La<guerre du Liban> qui s’est déroulée de 1975 à 1990 a fait entre 130 000 et 250 000 victimes pour un pays de 5 000 000 d’habitants. Comme toute guerre civile, elle fut le théâtre de massacres et d’horreurs.
Amin Maalouf et sa famille ont voulu rester au Liban, mais le déchainement de la violence a été trop intense. Ils ont finalement quitté le Liban en juin 1976.
Cette terrible expérience l’a conduit aux réflexions sur la place de l’autre et la nécessité de le comprendre pour s’entendre.
Cet homme issu de la communauté chrétienne du Liban et qui évoque souvent le monde chrétien comme le monde musulman manifeste une relation singulière à la spiritualité et aux croyances. Il répond à la question : Êtes vous croyant ?
« Si l’on entend par croyant être adepte d’une religion particulière, pas vraiment. Le dogme ne m’intéresse pas. Est-ce que je crois en revanche que le monde ne fonctionne que par des forces matérielles ? Non plus. Je ne suis pas un athée, je ne pense pas que monde soit arrivé par un jeu de molécules. Nous avons besoin d’une dimension spirituelle. Un des drames du XXème siècle est d’avoir laissé fleurir des idéologies totalitaires qui ont cherché à expulser la religion. Cela a abouti à des désastres. »
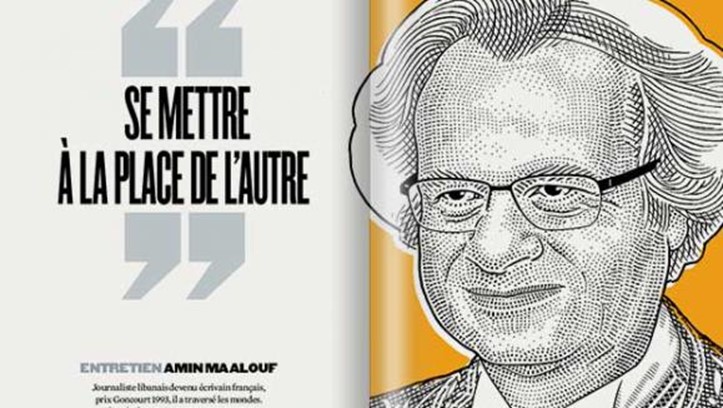 La partie la plus importante à mon sens de cet entretien consiste à cet appel de sagesse de se mettre à la place de l’autre. Amin Maalouf tire cette intelligence d’abord de sa position de minoritaire au Liban et aussi de sa double appartenance au Liban et à la France.
La partie la plus importante à mon sens de cet entretien consiste à cet appel de sagesse de se mettre à la place de l’autre. Amin Maalouf tire cette intelligence d’abord de sa position de minoritaire au Liban et aussi de sa double appartenance au Liban et à la France.
Ayant grandi au Liban, j’ai conscience depuis ma naissance de faire partie d’une minorité. En France, les recherches liées aux origines ethniques et à la religion sont interdites, ce qui est compréhensible et honorable. Mais au Liban, c’est impensable : là-bas, chacun connaît sa communauté d’appartenance. C’est inscrit sur les papiers d’identité, ça détermine l’école où chacun ira. Nous naissons avec la conscience d’appartenir à une communauté.
A partir de cette conscience communautaire, certains vont développer des attitudes hostiles envers les autres communautés, d’autres vont rêver d’établir des rapports harmonieux et vont consacrer leur vie à essayer de bâtir des passerelles. La question du vivre ensemble est une interrogation présente depuis ma naissance. Elle ne se pose pas de la même manière au Liban, en Bosnie, en France ou ailleurs, mais elle se pose partout.
Je viens d’une petite communauté. Et j’ai appris que lorsqu’on appartient à une petite minorité, on ne cherche pas à dominer, mais à mettre de l’huile dans les rouages. C’est dans une société réconciliée que nous vivons le mieux. Quand il y a des conflits, les petites communautés sont les premières victimes et les premières à fuir. Les plus faibles ont peur d’être écrasés ; les plus forts, peur d’être envahis.
Mais le monde change, il est devenu pluriel. Nous sommes chacun devenus les minoritaires des autres. De fait, personne ne peut plus considérer qu’il peut tout dicter. […]
Quand je suis avec des amis libanais, je parle du Liban comme si j’étais libanais.
Quand je suis avec des amis français, parle de politique intérieur en tant que Français. Mais, dans un cas comme dans l’autre, personne n’ignore, ne serait ce qu’à cause de mon accent, que je viens d’ailleurs et que mon regard est celui de quelqu’un d’extérieur. […]
Lorsque nous essayons d’établir des relations harmonieuses, la première attitude indispensable est d’être capable de se mettre à la place de l’autre. Si je peux me mettre à la place de l’autre, alors nous pouvons réfléchir ensemble. Si chacun reste à sa place, aucun de nous ne peut comprendre les besoins et les préoccupations de son interlocuteur. Il n’y a pas uniquement « moi » et « l’autre ». En « moi », il y a un peu de « l’autre », et en « l’autre », il y a un peu de « moi ». Se mettre à la place de « l’autre », c’est le commencement de la sagesse.
Et il finit par un exemple tout simple de la vie quotidienne et intime :
Dans l’intimité, nous pouvons ressentir les besoins de l’autre. Ma femme, Andrée, sait que l’écriture est essentielle pour moi, qu’elle est ma vie, que je pourrais passer ma vie entière à écrire. Mais elle sait également que lorsqu’elle m’exprime un besoin important, elle est prioritaire sur tout. »
C’est avec cet invitation à se mettre à la place de l’autre que je finis cette série de mots du jour que j’ai tirée du livre « Comprendre le monde » qui récapitulait certain des grands entretiens que la Revue XXI avait réalisé et publié avant fin 2016, date de la publication de cet ouvrage.
Amin Maalouf comme Tobie Nathan, dont j’ai parlé vendredi 29 mai, font partie de ces éclaireurs qui s’intéressent aux autres, d’abord par respect, puis pour comprendre et avancer ensemble, enfin pour s’enrichir spirituellement.
<1434>
-
Jeudi 4 juin 2020
«Ça veut dire aujourd’hui, si on parle des réfugiés, de la justice, des inégalités, si on doit sauver des vies, « quoi qu’il en coûte » ça vaut pour tout le monde, on est bien d’accord ?»Patrick BoucheronPatrick Boucheron est un de nos grands historiens. Je l’ai déjà cité dans deux mots du jour qui concernaient les réactions post attentats islamiques. Il s’agissait des mots du jour du <5 février 2016> et du <1er septembre 2016>.
Depuis j’ai acheté l’ouvrage imposant dont il a dirigé la rédaction « Histoire Mondiale de la France » et dont je ferais probablement une série de mots du jour.
Il est aussi professeur au Collège de France.
Il a été invité par Nicolas Demorand et Léa Salamé dans la matinale de France Inter de ce mercredi 3 juin : « La jeunesse a payé un prix extravagant à cette crise », pour revenir sur ce qui s’est passé, sur l’avenir et l’analyse de tout cela.
 J’ai trouvé cet entretien passionnant et je vous invite à l’écouter.
J’ai trouvé cet entretien passionnant et je vous invite à l’écouter.
J’en tire quelques extraits.
Pour évoquer le « Monde d’après » celui du déconfinement, Patrick Boucheron tire le bilan suivant :
« On est ramené aux conditions singulières de l’expérience. Nous avons vécu quelque chose ensemble et séparément, chacun confronté à sa propre solitude.
J’ai l’impression que c’est comme un séisme. La terre a tremblé pour tout le monde, c’est la même terre pour tout le monde, mais nous sommes plus ou moins près de l’épicentre. Et puis il y a des répliques qui ne sont pas les mêmes partout.
Et on n’a pas tous les mêmes fondations, sûres ou souples. Donc, il est temps de descendre à la cave pour voir les dégâts. C’est le cas pour les individus que nous sommes, solitaires et solidaires comme dirait Victor Hugo. Mais c’est vrai pour les sociétés. Et là, Il y a un gouffre qui s’ouvre devant nous, devant la responsabilité politique c’est l’autre temps, qui vient ».
Devant ces mots de « séisme », « dégâts », « gouffre » Léa Salamé l’interpelle pour lui demander s’il ne voit que le pire dans ce qui est arrivé et ce qui arrive.
Sa réponse décalée va concerner des intellectuels qui collent leur schéma de pensée sur les évènements et ne les regardent pas avec lucidité et sans filtre déformant.
Cette réponse me parait particulièrement pertinente pour le temps de l’analyse :
« Je me méfie spontanément des intellectuels à thèse qui viennent défendre leurs thèses. Comme si « le chien aboie, la caravane passe », le chien c’est l’évènement, la caravane, c’est leurs certitudes. Comme le dit Bruno Latour, très justement, « il ne faut pas gâcher une crise. Bien sûr, il y a une opportunité formidable. Mais de cela que l’on parle, on ne parle que de cela. L’histoire n’est pas là pour nous rassurer sur nos certitudes, mais pour nous dire « là, il y a une entaille », il s’est passé quelque chose, il y a un évènement. Et comme le disait l’historien du contemporain, Pierre Laborie : « Un évènement c’est ce qui advient de ce qui est advenu ». Il y a quelque chose qui est survenu et maintenant ce qui va avoir lieu, c’est à nous d’en décider collectivement, politiquement ».
Et il ajoute en revenant sur l’expérience des années sida :
« On n’a rien à attendre d’une maladie, sinon qu’elle ne nous tue pas et qu’elle passe le plus vite possible, ce sont les malades, les marqueurs sociaux, ça veut dire qu’on va en discuter en commun (…) La recherche publique : c’est en faire un enjeu commun. Comment l’arracher à la technostructure. C’est cela, au fond, l’enjeu d’aujourd’hui. »
Pour Patrick Boucheron, le COVID-19 a pris toute la place et mis à l’ombre tous les autres sujets mondiaux dont beaucoup sont aussi, sinon davantage préoccupants.
« Il faut parler d’autre chose, de ce qu’on a tu et qu’on a eu raison de taire.[…]
La terre entière, quels que soient les régimes politiques, quels que soient les structures démocratiques a pris une décision incroyable au regard de l’Histoire : défendre toutes les vies, même les plus vulnérables, même les plus âgées quoi qu’il en coûte, comme a dit le président Macron. « Quoi qu’il en coûte » est la formule même de l’inconditionnalité. Qui peut être discuté, mais ce n’est peut-être pas encore le moment.
Dans un calcul de santé publique, on dit « quoi qu’il en coûte ». Mais enfin, la misère entraîne une mortalité terrible.
Mais « quoi qu’il en coûte », veut dire que la vie est un bien inconditionnel. C’est ce que Didier Fassin appelle la « biolégitimité », mais il dit aussi qu’il y a une inégalité des vies. Ça veut dire aujourd’hui, si on parle des réfugiés, de la justice, des inégalités, si on doit sauver des vies, « quoi qu’il en coûte » ça vaut pour tout le monde, on est bien d’accord ?
C’est à ce moment-là qu’il faut vérifier qu’on est bien d’accord, ça vaut pour celles et ceux qui rament dans la vie, ça vaut pour celles et ceux qui sont sur des canots en Méditerranée, et ça vaut pour tout le monde.
Et là commence un moment politique, […] maintenant on discute et on discute aussi sur l’évènement. Car il nous a pris de court, mais il a nous a aussi pris en cours de quelque chose. D’autres sujets, on a vu hier soir les manifestations de Minneapolis après la mort violente de George Floyd qui montre le besoin de justice. »
Et puis il évoque le sacrifice générationnel :
« Cette crise a surtout touché les citoyens les plus âgés. […] la responsabilité est quand même là de dire quelque chose de ce temps. Et ce qu’on a à dire, c’est que tout de même. La jeunesse a payé un prix extravagant à cette crise. Elle a payé aujourd’hui et elle paiera encore demain. Je ne dis pas qu’il ne fallait pas le faire, mais au fond, il faut le dire il y a eu un sacrifice, un sacrifice générationnel. […] La jeunesse est sacrifiée. On a fait subir aux enfants, à l’école une épreuve terrible et les étudiants […]
« Dans les annonces gouvernementales, les universités venaient toujours en dernier, après les terrasses et le Puy du Fou de fou, on leur disait : ‘elles ne rouvriront pas’. Mais quel scandale !
« On ne parle que des examens, on s’assure qu’ils [les étudiants] n’ont pas triché, on utilise leurs webcam comme outil de télésurveillance. […]
La population étudiante n’est pas qu’une question sanitaire : ce sont des lieux de vie et de production du savoir, et on n’a jamais autant parlé de sciences que pendant cette crise. »
Patrick Boucheron a énoncé ce constat avec moults précautions, en ne disant jamais qu’il ne fallait pas faire ce qui a été fait mais il a dresse ce constat, l’essentiel de cette crise va devoir être assumé par les jeunes générations qui vont devoir financer d’une manière ou d’une autre le « quoi qu’il en coûte ».
Alors certains parlent de la « génération COVID », il existe même un site : https://generationcovid.fr/
Ce qui met Patrick Boucheron en colère.
« On ne peut pas se laisser désigner par une catastrophe, la jeunesse ne peut [accepter de se faire appeler la génération Covid], à eux de donner le nom du temps qu’ils ont vécu (…) l’événement, c’est moins l’épidémie, que la réponse politique : ce sont les jeunes qui doivent dire, aujourd’hui, de quelle génération ils veulent être. »
Et il fait une grande confiance à la jeunesse pour trouver des solutions… si on les laisse faire..
« On doit dire à la jeunesse qu’elle a peut-être la solution à des questions que leurs ainés ont été incapables de poser (…) J’ai 54 ans, et je suis dans une société où l’on considère que je suis jeune ! Ça ne va pas ! Je ne suis plus jeune ! »
Entretien donc très intéressant que je vous recommande d’écouter.
Et il a aussi ce propos avec lequel mon accord est total, tant il est vrai qu’un scientifique doute et que celui qui a des certitudes n’est pas un scientifique mais un croyant :
« Un scientifique qui affirme des certitudes, je ne comprends pas ce qu’il dit. Je ne comprends pas ce que veut dire chez un scientifique : « je suis sûr que … »
Son développement sur ce point est aussi d’une grande pertinence.
Je redonne le lien vers l’émission : « La jeunesse a payé un prix extravagant à cette crise »
<1434>
-
Mercredi 3 juin 2020
«Pause»Un jour sans mot du jourJe persiste et j’ai trouvé un nouveau chat qui regarde par la fenêtre pour essayer de voir si le monde tourne correctement.
 En 2015, le 3 juin était également un mercredi.
En 2015, le 3 juin était également un mercredi.
Le mot du jour fut consacré à Kamel Daoud qui a eu cette phrase : .
« En France, vous avez un art très rare qui est de fabriquer des religions sans dieu. Vous n’avez pas de roi mais un président qui ressemble à un roi, vous n’avez pas de religion d’Etat mais vous avez le Panthéon».
Kamel Daoud
<Mot sans numéro>
-
Mardi 2 juin 2020
«Pause»Un jour sans mot du jourJe ne suis pas parvenu à écrire un mot du jour pour ce mardi.
 L’année dernière le 2 juin était un dimanche.
L’année dernière le 2 juin était un dimanche.
Et le jour d’avant était le samedi 1er juin. C’est ce jour là que Michel Serres quitta la vie terrestre.
Le lundi 3 juin j’écrivais un mot du jour hommage à cet homme remarquable :
« Le moraliste espiègle s’en est allé … »
Michel Serres est décédé samedi 1er juin à 19 heures
Je n’imaginais pas lorsque je publiais le mot du jour, avant le long week-end de l’ascension, dans lequel je partageais l’émission de France Inter « Michel Serres – Questions Politiques du 26 mai 2019 », que lors du mot du jour suivant, il faudrait prendre congé de cet homme qui a été si inspirant et m’a donné tant de sources de réflexions.
Il est mort de vieillesse, je pense que c’est cela qu’il aurait dit
Dans notre société actuelle, on meurt de plus en plus vieux, mais selon ce que l’on dit on meurt du cancer, d’un infarctus ou de tout autre détail technique mais plus de vieillesse.
Dans ce qui sera donc sa dernière émission de radio, il était visible que si son esprit était toujours aussi pétillant et vivace, le corps était affaibli, malade.
Et <Sur cette page> il y a le rappel de 18 mots du jour inspirés par Michel Serres.
<Mot sans numéro>
-
Vendredi 29 mai 2020
«Quelle est votre richesse ? Qui êtes-vous que je ne suis pas ? est la seule question qui vaille»Tobie NathanPlusieurs fois à travers les émissions que j’écoute ou les articles que je lis, j’ai rencontré la route de Tobie Nathan. Chaque fois j’ai été happé par son humanisme, son intelligence, son ouverture d’esprit. Je n’ai jamais su pour l’instant transformer ces rencontres en un mot du jour. Mais il fait partie des grands entretiens de la revue XXI et ceci me donne l’opportunité enfin d’ouvrir une nouvelle porte vers la réflexion et l’action d’un homme remarquable de notre temps.
C’est un homme à l’écoute de l’altérité qui ne croit pas tout savoir. Qui est à la recherche de l’autre, du monde de l’autre, de ce qui explique l’autre, de ce qui peut le soigner.
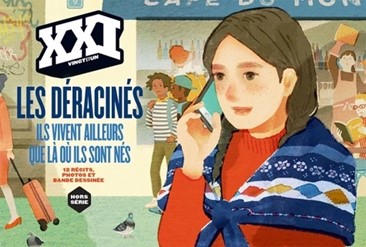 L’entretien de la revue XXI consacrée à Tobie Nathan était un hors-série « Les déracinés » paru en février 2016. Ce numéro explicitait son titre par cette définition : « Ils vivent ailleurs que là où ils sont nés ».
L’entretien de la revue XXI consacrée à Tobie Nathan était un hors-série « Les déracinés » paru en février 2016. Ce numéro explicitait son titre par cette définition : « Ils vivent ailleurs que là où ils sont nés ».
L’entretien, qui avait été mené par Marion Quillard a donc été repris dans l’ouvrage « comprendre le monde.
Tobie Nathan se présente ainsi :
« Je suis psychologue et je travaille dans le domaine de l’ethnopsychiatrie, mais je ne suis ni ethnologue ni psychiatre. »
Il va tenter pendant l’entretien de définir l’ethnopsychiatrie, cette psychiatrie imaginée pour les migrants, cette « obligation de prendre en compte le monde de l’autre pour le soigner ». Et à la fin, il a lâché :
« C’est la définition que je donnerais aujourd’hui. Demain j’en donnerai peut être une autre…. »
Marion Quillard raconte :
« Tobie Nathan ouvre des portes et ne les referme pas toujours. Roi de la pirouette, il reçoit au Centre Georges-Devereux, la structure qu’il a créée en 1993 à Saint Denis et qui se situe désormais en plein cœur de Paris. Au deuxième étage, des chaises en rang d’oignons, une petite cuisine dont s’échappe une odeur de café, quelques livres mis à disposition. Ici les consultations durent en moyenne deux heures « et elles sont gratuites » dit le drôle d’oiseau qui me fait face.
 Avec lui, des psychologues, des médecins, des éducateurs et des traducteurs prennent en charge la santé mentale des plus faibles. Les migrants, historiquement. Puis les anciens membres de sectes, les boulimiques, les transsexuels. […]
Avec lui, des psychologues, des médecins, des éducateurs et des traducteurs prennent en charge la santé mentale des plus faibles. Les migrants, historiquement. Puis les anciens membres de sectes, les boulimiques, les transsexuels. […]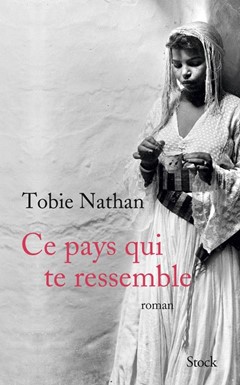 Écrivain de la nuit, il raconte dans son livre « Ce pays qui te ressemble » ; son monde disparu, celui des juifs d’Egypte, forcés à l’exil en 1956. La « déchirure » qui a fait de lui un oiseau migrateur. Attachant, mêlant la précision scientifique et gouaille de l’emberlificoteur, il fait toujours le pari de l’intelligence de l’autre. »
Écrivain de la nuit, il raconte dans son livre « Ce pays qui te ressemble » ; son monde disparu, celui des juifs d’Egypte, forcés à l’exil en 1956. La « déchirure » qui a fait de lui un oiseau migrateur. Attachant, mêlant la précision scientifique et gouaille de l’emberlificoteur, il fait toujours le pari de l’intelligence de l’autre. »
Tobie Nathan est né en 1948 au Caire, sa famille a été expulsée en 1956 parce que juive. Il est arrivé en France un an plus tard. Et quand Marion Quillard lui demande s’il ressemble aux migrants qu’il rencontre, il répond :
« Bien sûr ! Je partage avec eux une conscience aiguë de la contingence du monde. Contrairement à ce que pensent les Français, notre monde n’est pas éternel. Moi, je suis plusieurs. J’ai été un enfant égyptien, un enfant italien et un enfant français. J’aurais pu être un enfant canadien, puisque mes parents ont eu envie d’émigrer au Canada. Et je garde le souvenir de mes êtres précédents. Je n’ai jamais cru que le monde qui s’étalait sous mes yeux était « le monde ». Il y a eu d’autres mondes avant, il y en aura d’autres après, il y en déjà d’autres ailleurs. »
Et il raconte le début de son travail avec les migrants :
J’ai rencontré mon premier patient le 15 avril 1972 et il se trouve que c’était un migrant, un Tamoul de Pondichéry, en Inde. Il avait été métamorphosé par la migration. « Je » était devenu un autre. J’ai eu envie de comprendre et j’ai toujours travaillé sur cette « métamorphose ». Pourquoi notre identité change-t-elle quand nous passons d’un monde à l’autre ?
Comment la migration qui est un simple déménagement, un changement de décor, peut-elle à ce point affecter notre être intérieur ? Ces questions me sidèrent.
En France j’ai vu arriver les migrants par vagues successives : les Portugais, les Maghrébins, les Africains, les gens d’Asie du Sud-Est, et maintenant les Syriens.
A chaque fois, on refuse d’écouter ce qu’ils à nous dire. Avec notre universalisme simplet, nous pensons que ces gens nous ressemblent. Nous pensons à tort qu’ils viennent nous rappeler nos idéaux de justice, notre responsabilité dans la misère du monde. Pire encore, nous rappeler « d’où nous venons ». Mais les migrants ne sont pas là « pour nous ». Ils viennent pour des raisons qui leur sont propres et il nous faut les écouter, comprendre leurs mondes, leurs idées et leurs dieux.
Leur demander : « Quelle est votre richesse ? Qui êtes-vous que je ne suis pas ? » est la seule question qui vaille. »
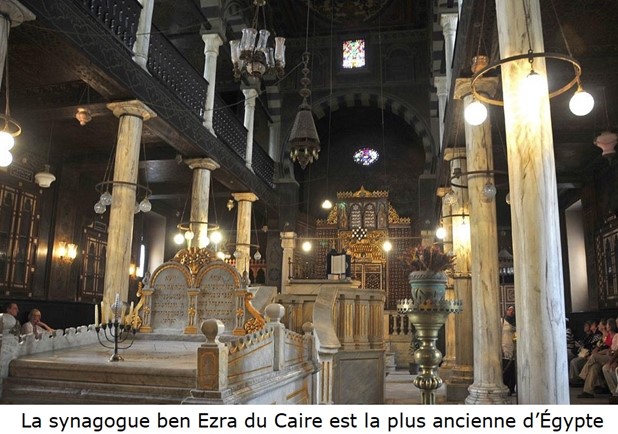 Nous sommes profondément ancrés dans nos racines, nos ancêtres, notre famille, le lieu de notre enfance, notre histoire. Tobie Nathan n’échappe pas à cette règle et lui, en plus, en est totalement conscient :
Nous sommes profondément ancrés dans nos racines, nos ancêtres, notre famille, le lieu de notre enfance, notre histoire. Tobie Nathan n’échappe pas à cette règle et lui, en plus, en est totalement conscient :
« Nous sommes en 1956, j’ai une passion pour la radio. […] Un soir, mes parents sortent et je demande à rester avec les bonnes pour écouter la radio. Toute la soirée, Nasser n’a qu’un mot à la bouche : « juif ». Il vient de nationaliser le canal de Suez […]. Mes parents sont encore insouciants ! Ils sortent ! Et moi, je pressens le cataclysme à venir. Je savais qu’à partir de ce moment-là nous serions expulsés. […]
Adulte, j’ai posé la question à mon père : Comment ça se fait que tu n’aies rien vu venir ? Tu étais commerçant, tu discutais avec tout le monde ! Il était incapable de me répondre. Il rigolait, il disait : parce que je suis con ! ». Une fois seulement, il m’a dit : « Je n’y ai jamais pensé. » Jamais il n’avait imaginé que le tissu qui maillait les Juifs et les Arabes en Egypte depuis des siècles allait se déchirer. Pour qu’il comprenne, il a fallu qu’un militaire surgisse à la boutique, sorte un flingue et le pose sur le bureau en disant : « Ouvre ce coffre, tout ce qui est ici appartient à l’Etat égyptien. » Nos biens ont été saisis, nous sommes partis les mains vides. […]
Je suis un juif d’Egypte. Du côté de ma mère, on trouve des rabbins de père en fils, les Israël, de 1500 à 1870.Le dernier était grand rabbin d’Egypte. Autant vous dire, le top du top. Un homme politique autant qu’un homme religieux. […]. Il s’appelait Yom-Tov Israël Shrezli et c’était le grand-père de mon grand-père maternel.
Et puis, il esquisse ces relations compliquées avec sa mère faites de respect, de crainte et de désir de s’échapper :
« Je suis marqué par ma mère oui, cette forte tête. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c’est, une mère juive égyptienne qui vous dit : « Hé, je te parle. Je t’ai porté pendant neuf mois dans mon ventre, t’étais une chiure de mouche. T’étais rien et maintenant t’élèves la voix devant moi ? » Vous tremblez. Vous avez 40, 50 ans, vous tremblez, je vous assure. Mais j’ai fait ce que je voulais. Je ne me suis laissé influencer par personne. J’ai fait des erreurs, mais de mon plein gré. J’ai pris des chemins de traverse…Ma mère pensait que je deviendrai ingénieur. Elle était prof. De maths, j’ai eu peur de l’avoir sur le dos, alors j’ai fait le contraire. J’ai étudié la philosophie. Je me suis passionné pour la psychanalyse. »
Et il parle de son don de soigner. Il rattache ce don à la famille maternelle de son père qui s’appelait Cohen :
« Ils étaient joailliers. Leur boutique au souk des orfèvres devait faire un mètre de large., mais ils vivaient dans un palais. Ils étaient riches donc, mais riches de quoi ? C’est un mystère.
Je sais juste qu’ils fabriquaient des bijoux spéciaux. Si vous passiez un examen, si vous vouliez vous marier, vous alliez les voir. Ils fabriquaient pour vous des bagues magiques, en diluant un texte sacré dans de l’eau et en y éteignant l’or ou l’argent. Les textes imprégnaient les bijoux, qui coutaient très chers. Ils fabriquaient aussi les objets du culte, les grenades en argent qui surmontent les Torah.»
 Et il part de ces origines pour se sentir légitime pour soigner. Il croit à son obligation de soigner ses semblables. Et il dépasse la seule souffrance psychologique pour parler de géopolitique. Et pour donner du corps à cette étonnante affirmation, il donne l’exemple de survivants de la shoah qui quarante ans après la guerre, font encore des cauchemars :
Et il part de ces origines pour se sentir légitime pour soigner. Il croit à son obligation de soigner ses semblables. Et il dépasse la seule souffrance psychologique pour parler de géopolitique. Et pour donner du corps à cette étonnante affirmation, il donne l’exemple de survivants de la shoah qui quarante ans après la guerre, font encore des cauchemars :
« La psychologie c’est de la géopolitique. Les causes et les traitements sont à l’extérieur des patients. Ils sont dans le monde, dans leur monde, pas dans leur petite tête !
Moi je n’ai pas de problèmes psychologiques, mais j’ai des problèmes de géopolitique. Ça oui. Je suis un hypersensible de la géopolitique. […] Lorsque j’écoute les informations par exemple. Il me semble insensé qu’un journaliste puisse prononcer la phrase suivante : « Il y a eu 2200 morts à La Mecque ». J’entends cette phrase sans la comprendre. En revanche, quand quelqu’un vient me voir en consultation et me raconte : « Mon grand-père est parti à La Mecque. Il faisait beau, il était fou de joie et, il y a eu cet accident terrible, les gens se sont marchés dessus… » Là je comprends »
Et puis il a cette appréhension très particulière, en tout cas assez éloignée des standards occidentaux concernant le concept d’individu, de sa liberté, de son indépendance :
« Je ne crois pas que les gens soient interchangeables. Je sais que c’est la relation des journalistes, celle de « l’individu quelconque ». Mais ce n’est pas la mienne. […] Où voyez-vous des individus ? Vous connaissez des individus ?
Les individus existent quand ils sont morts, quand on peut dire : « Il a été ». Mais « il est », ça n’a aucun sens. L’individu est une notion juridique. « Je » suis un état civil, un numéro de sécurité sociale, mais c’est tout. Il faut arrêter de se pavaner comme si nous n’étions rien d’autre que nous-mêmes. Nous sommes bien plus que nous-mêmes ! »
Et il parle de son expérience dans les banlieues de France qu’il a beaucoup étudié et surtout dans lesquelles il a rencontré les habitants, des habitants qu’il soignait.
Il donne ainsi les clés de sa méthode.
[Dans les banlieues] un nouveau monde, une nouvelle culture, de nouveaux êtres sont en train de naître. Dans ces banlieues que j’ai beaucoup fréquentées ces dernières années, personne n’est inscrit à la sécu, personne ne paie d’impôts, personne ne sort du quartier. […] Ils ont de nouveaux repères, de nouvelles divinités : la délinquance, le radicalisme religieux. Soit l’un, soit l’autre, souvent l’un puis l’autre. Et moi, j’ai besoin de comprendre pourquoi leur respect se porte sur ces mouvements.
J’insiste, ce n’est pas « l’islam qui vient », qui va nous envahir, nous submerger. Ça n’a rien à voir avec l’islam. C’est autre chose : des règles et des forces propres. Un monde que je ne connais pas bien encore, mais qu’il nous faut étudier. »
Nous sommes ici au point central de ce partage. Tout le début de l’article n’est qu’une longue introduction pour arriver à comprendre la démarche de Tobie Nathan, sa manière d’agir quand il se trouve en face de personnes en souffrance qui viennent d’ailleurs ou dont les racines ne sont pas dans le pays dans lequel ils résident.
[Il ne s’agit pas de] se mettre à la place, mais permettre à autrui de prendre sa place. Être possédé par autrui, se vider de son monde intérieur pour lui laisser une place. Et ensuite, quand l’autre s’en va, récupérer une partie de soi pour raconter cette métamorphose.
Le patient vient en famille. Il se raconte dans sa langue, des interprètes traduisent. Je dois savoir comment il aurait été soigné dans son pays ou dans celui de ses parents, car, même s’il n’y vit pas, les traitements potentiels de sa maladie sont inscrits dans sa culture d’origine. Pour cette raison, j’ai beaucoup voyagé, en Afrique de l’Ouest, à Tahiti, au Brésil, à la rencontre des guérisseurs et en quête de leur savoir. J’essaie d’entrer en communication avec le patient, à l’intérieur de moi. […] Soigner les gens, vous savez, c’est les rattacher quelque part, leur montrer un fragment de terre ferme. Sinon, ce sont des âmes errantes.
[C’est-à-dire] des âmes qui voient la terre ferme s’éloigner. Au sens physique du terme, des migrants, des gens qu’on arrache à leur terre natale, au sens métaphorique, des personnes qui perdent leurs repères qui ne savent plus à qui s’adresser et qui se tournent vers d’autres divinités, le radicalisme religieux par exemple.
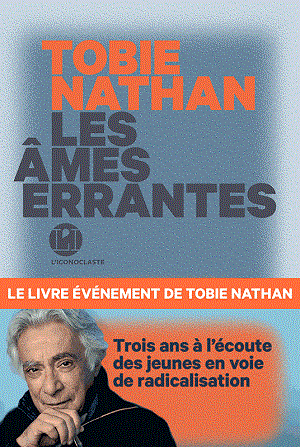 « Les âmes errantes » est devenu un livre que Tobie Nathan a publié en 2017 et qui est un essai sur la question des jeunes radicalisés, fondée sur une expérience clinique.
« Les âmes errantes » est devenu un livre que Tobie Nathan a publié en 2017 et qui est un essai sur la question des jeunes radicalisés, fondée sur une expérience clinique.
Claire Servajean l’a invité dans son émission sur France Inter pour présenter ce livre
<France Info> a également consacré une page à ce livre, qui n’a pas laissé indifférent et qui a même provoqué des réactions violentes.
Comprendre l’autre n’est pas toujours accepté.
Manuel Valls, à l’époque premier ministre, avait eu ce jugement définitif : « Expliquer c’est déjà vouloir un peu excuser »
Et il donne ce conseil de sagesse et d’humilité.
« On ne peut pas soigner les gens en les rabaissant. Il ne faut jamais faire le pari de la pauvreté des gens, toujours celui de leur richesse et de leur intelligence. Les soigner, c’est aller les chercher là où ils sont. »
Et comme conclusion de l’entretien, il explique comment il s’y prend avec les patients :
« Je laisse venir. Je lâche quelque chose au patient, et nous construisons ensemble une meilleure proposition. C’est du théâtre, de la création. Des moments magiques. Vous savez ce qu’on dit en Afrique ? toute la vérité est dans le sable. Il contient les os détruits, abimés, d’ancêtres très anciens. Si vous savez interroger le sable, vous gagnerez la sagesse… »
Tobie Nathan écrit des livres et tient un blog : https://tobienathan.wordpress.com/
<1433>
-
Jeudi 28 mai 2020
«Pour ma part, j’en suis sûr : le sens de la solidarité nous vient du fond des âges, il est profondément ancré dans notre nature.»Frans de WaalFranciscus Bernardus Maria de Waal, plus connu sous le nom de Frans de Waal est né en 1948 aux Pays-Bas. C’est un primatologue et un éthologue.
La primatologie est la discipline qui étudie les espèces de l’ordre des Primates donc essentiellement les singes, les humains et leurs ancêtres.
L’éthologie est l’étude scientifique du comportement des espèces animales, incluant l’humain, dans leur milieu naturel ou dans un environnement expérimental, par des méthodes scientifiques d’observation et de quantification des comportements animaux.
Deux mots du jour lui ont déjà été consacrés :
- Le 28 juin 2017 : « Est-ce que l’homme est plus intelligent que le poulpe ? On ne sait pas »
- Le 25 janvier 2019 : « La dernière étreinte » qui était le titre de son dernier livre, pour l’instant. Il portait pour sous-titre : « le monde fabuleux des émotions animales et ce qu’il révèle de nous »
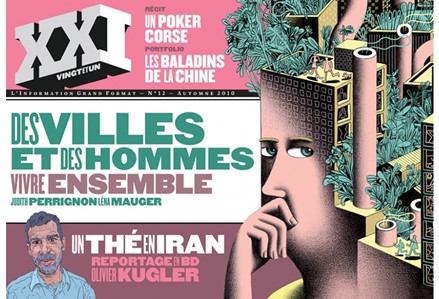 Frans de Waal a fait l’objet d’un entretien de la revue XXI, c’était dans le numéro 12 paru en octobre 2010.
Frans de Waal a fait l’objet d’un entretien de la revue XXI, c’était dans le numéro 12 paru en octobre 2010.
L’entretien, qui avait été mené par Pierre Vandeginste a été repris dans l’ouvrage « comprendre le monde
Dans son introduction le journaliste présente Frans de Waal de la manière suivante :
« L’homme descend du singe ? alors observons les singes pour mieux comprendre l’homme ! Tel est le point de départ du travail considérable abattu par Frans de Waal.
Il explique comment lui est venu le principal objet de ses études : l’observation de l’empathie chez les grands singes :
« Dans les années 1970, j’étais étudiant aux Pays-Bas et le grand sujet à la mode en éthologie était l’agression. C’était l’un des thèmes favoris de Konrad Lorenz, lauréat du prix Nobel 1973 qui avait publié en 1969 : « l’Agression, une histoire naturelle du mal ».
J’ai commencé à travailler sur ce sujet. Et, très vite, j’ai été surpris. J’ai constaté en observant des macaques, à Utrecht, que les conflits étaient rares et brefs. Et surtout, ils étaient séparés par de longues périodes pacifiques pendant lesquelles les ennemis de la veille vivaient en bonne entente. »
 Et il raconte des choses étonnantes qu’il a vu :
Et il raconte des choses étonnantes qu’il a vu :
« Un jour, mon attention a été attirée par une étrange scène : après une sévère bagarre, le groupe encerclait deux chimpanzés qui s’embrassaient, en les encourageant bruyamment. Or les deux singes s’étaient battus dix minutes plus tôt. Je venais de découvrir la réconciliation chez les primates.
J’ai longuement étudié le phénomène. Régulièrement, après une bagarre, je voyais les protagonistes entamer ce patient processus de réconciliation, qui les ramène l’un vers l’autre. Pendant un certain temps, ils gardent leurs distances, évitent de se croiser. Puis, insensiblement, ils se rapprochent, sans se regarder. Ils finissent par se trouver à proximité, mais dos à dos. Arrive enfin le moment où ils rétablissent le contact. Ils se rapprochent un peu plus, toujours sans croiser leur regard. Jusqu’à ce que l’un des deux pose une main – tout à fait par hasard – sur le dos de son adversaire pour se mettre négligemment à l’épouiller. »
Le plus étonnant de cette expérience, ce n’est finalement pas que Frans de Waal ait fait ces constats, mais c’est que la communauté scientifique ne les a pas tout de suite accepté et reconnu :
« A l’époque, tout comportement considéré comme négatif pouvait être associé aux animaux sans choquer. A l’inverse, les esprits n’étaient pas prêts à entendre que l’on observe chez l’animal, fut-il primate, un comportement présumé « humain ».
L’agression étant considérée comme quelque chose de « mal », il semblait logique que les bêtes en soient aussi capables. L’idée commune était que l’agressivité des hommes tenait à leur lointaine condition animale, ce n’était donc pas un problème d’utiliser le même mot pour parler de ce type de comportement chez l’homme et chez l’animal.
Pour ma part, je n’ai jamais considéré l’agression comme quelque chose de « mauvais ». C’est simplement une réalité biologique, un comportement que la sélection naturelle a retenu parce qu’il améliore la survie des individus »
Frans de Waal ne peut pas être considéré comme un homme naïf croyant à la bienveillance générale. Il a simplement observé que la bienveillance existait chez les primates, comme le désir de réconciliation.
Mais il a aussi constaté que les grands singes étaient des animaux politiques :
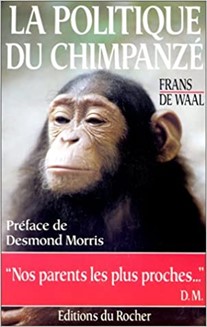 « Dans mon premier ouvrage pour le grand public « la Politique du chimpanzé », nos proches cousins ne sont pas présentés sous leur meilleur jour. C’est même souvent leur machiavélisme que je pointe.
« Dans mon premier ouvrage pour le grand public « la Politique du chimpanzé », nos proches cousins ne sont pas présentés sous leur meilleur jour. C’est même souvent leur machiavélisme que je pointe.
Par la suite il va s’installer aux Etats-Unis, à Atlanta au Yerkes, un centre de recherche sur les primates, où il disposera de moyens de recherche tout à fait remarquables. Lui et son équipe réalise des expériences sur des thèmes comme le partage de la nourriture, la réciprocité, la coopération et la résolution de conflits. Et son analyse est la suivante :
« Ces résultats scientifiques montrent qu’à des degrés divers, les grands singes, notamment le chimpanzé et le bonobo, mais aussi des petits singes comme le capucin ou le macaque, sont capables de certains comportements que nous avons l’habitude de qualifier de « moraux ».
Il devient de plus en plus raisonnable de soutenir l’hypothèse que la propension humaine à se préoccuper du bien d’autrui est apparue bien avant nous, et s’appuie sur des mécanismes présents depuis longtemps au cours de l’évolution. »
Il publie en 1996 un ouvrage au titre provocateur : « Le bon singe » dans lequel il entend étudier les origines du bien et du mal chez les humains et d’autres animaux :
« J’ai voulu poser clairement la question de la morale en termes évolutionnistes. »
Cet ouvrage suscite des réticences chez certains chercheurs qui l’accuse d’appliquer une grille de lecture humaine au comportement animal, de se laisser subjuguer par son amour des animaux. Il conteste cela et invente un nouveau concept « l’anthropodéni » :
« Nos expériences sont réalisés dans des conditions rigoureuses. […] Nous nous donnons beaucoup de mal pour nous en tenir à des faits observables, mesurables. […]
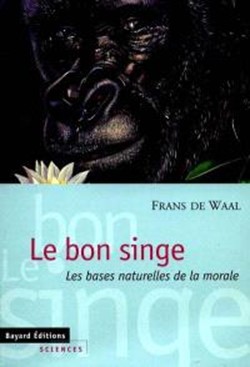 J’ai fini par construire le « anthropodéni », anthropodenial en anglais. L’anthropomorphisme consiste à prêter abusivement une caractéristique humaine à un animal. A contrario, quand tout montre que certains animaux partagent réellement quelque chose avec l’homme, mais que, pour des raisons extérieures, philosophiques, religieuses ou autres, on ne veut pas le voir, c’est une attitude que je propose de nommer « anthropodéni ».
J’ai fini par construire le « anthropodéni », anthropodenial en anglais. L’anthropomorphisme consiste à prêter abusivement une caractéristique humaine à un animal. A contrario, quand tout montre que certains animaux partagent réellement quelque chose avec l’homme, mais que, pour des raisons extérieures, philosophiques, religieuses ou autres, on ne veut pas le voir, c’est une attitude que je propose de nommer « anthropodéni ».
Dans la conclusion de l’article, l’éthologue donne sa conviction :
« Aujourd’hui encore, des économistes, des hommes politiques, notamment dans le camp républicain aux Etats-Unis, émaillent de justifications naturalistes leurs discours prônant le chacun pour soi. A les entendre, puisque l’homme est naturellement égoïste, il serait contre-nature de proposer des réformes allant dans le sens de la solidarité ou d’une réduction des inégalités. Nous ne serions, disent-ils, que motivés par la conquête du pouvoir, l’accumulation de biens matériels, sans aucune considération pour les autres.
Ces discours sont anciens. Darwin avait à peine publié que, déjà, on lui faisait dire – au mépris de ses textes – que l’homme se devait d’être un loup pour l’homme. Au nom du struggle for life*, de la lutte pour la survie, ce qu’il n’a jamais écrit.
Pour un biologiste, tout particulièrement pour un éthologue, c’est énervant, pour ne pas dire plus. A fortiori quand vous avez passé quarante ans à étayer la thèse inverse. Pour ma part, j’en suis sûr : le sens de la solidarité nous vient du fond des âges, il est profondément ancré dans notre nature. »
<1432>
- Le 28 juin 2017 : « Est-ce que l’homme est plus intelligent que le poulpe ? On ne sait pas »
-
Mercredi 27 mai 2020
«Je veux redonner la parole aux gens, moi qui ai tellement capté leur image.»Raymond DepardonRaymond Depardon est né dans le département du Rhône, en 1942, à Villefranche-sur-Saône. Il était fils de cultivateurs du Beaujolais
Il est considéré comme l’un des maîtres du film documentaire. Il est à la fois photographe, réalisateur, journaliste et scénariste.
Il a créé l’agence photographique Gamma en 1966 et est membre de Magnum Photos depuis 1979. L’agence Gamma a disparu en 2009 suite à une faillite.
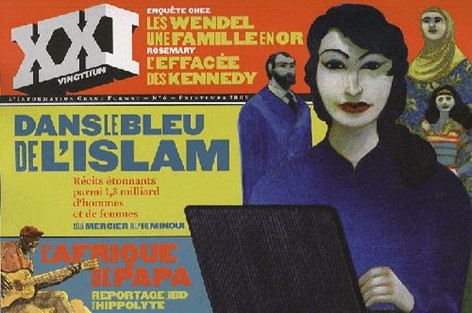 Raymond Depardon a fait l’objet d’un entretien de la revue XXI, c’était dans le numéro 6 paru en avril 2009.
Raymond Depardon a fait l’objet d’un entretien de la revue XXI, c’était dans le numéro 6 paru en avril 2009.
L’entretien, qui avait été mené par Michel Guerrin a été repris dans l’ouvrage « comprendre le monde»
Il explique que c’est son origine paysanne qui va malgré sa timidité lui permettre, dans ses premiers années, de devenir un photographe téméraire et opiniâtre :
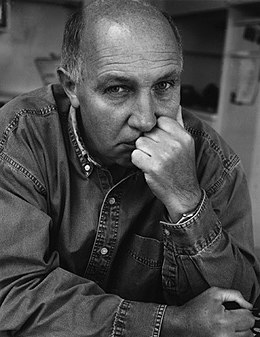
« Ce désir d’être photographe est venu à 14 ou 15 ans. […] Je pense à cette formule du paysan occitan Raymond Privat, qui apparaît dans mon film <La vie moderne > : « il ne faut pas seulement aimer son métier, il faut être passionné ».
L’orgueil est aussi un trait de mon caractère, quelque chose qui fait que je vais passer du statut de fils de paysan exploitant à petit photographe indépendant. Je pleure alors alors beaucoup, c’est lié à mon âge. Mais je pleure littéralement de rage quand je rate un cliché. Le désir de réussir une « plaque », c’est ma quête du Graal.
Un autre point central : comme un paysan, je déteste les activités structurées. J’ai enfin une grande curiosité. […] En fat, mon origine paysanne et mon extrême jeunesse vont se révéler être deux atouts.
Ma timidité s’estompe quand je tiens une raison de faire une photo. Dès le début, à 16 ans, je n’ai pas peur, je veux être sur la brèche, tout plutôt que la solitude du dimanche. Je me dis « Pourvu qu’il y ait un tremblement de terre, un fait divers, une personnalité à photographier »
Au début de sa carrière, il photographie beaucoup les personnalités, les vedettes. Il devient même une sorte de paparazzi.
Mais le voyage va l’éloigner de ce type de photographie du superficiel.
« A partir de 20 ans, je voyage beaucoup […] Ce qui me sauve, c’est de ne pas avoir peur du voyage. Je suis silencieux, empoté avec les filles, casanier, un peu sauvage, mais prendre un avion pour un pays lointain, même en guerre, ne me fait pas peur. Il est alors mille fois plus violent pour moi d’aller de Villefranche à Paris que de Paris à Saigon ou à Beyrouth en guerre. […]
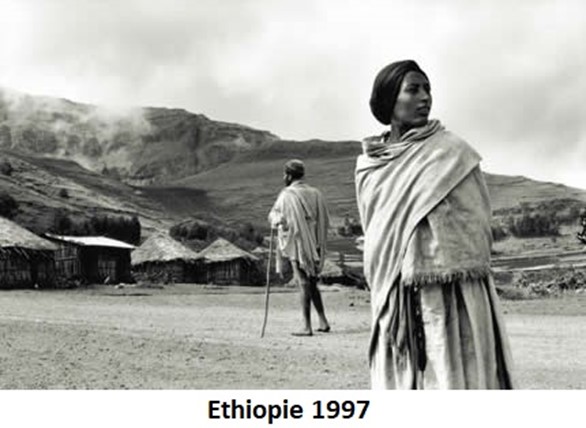 J’ai passé la fin de mon adolescence dans ces grandes villes du monde que sont Buenos Aires, Saïgon, Alger ou Beyrouth. Au marché des mouches à Djibouti, même si on ne s’occupe pas de toi, tu peux rester des mois, grimper dans les montagnes, il y a cette force de vivre. Dans ces villes, je retrouve étrangement l’atmosphère de Villefranche. Je cherche un marchand de journaux, je bois un Coca. Après la journée de combats, tu as fait des photos, la lumière est belle, tu as envie de rencontrer la femme de ta vie, mais tu es seul.
J’ai passé la fin de mon adolescence dans ces grandes villes du monde que sont Buenos Aires, Saïgon, Alger ou Beyrouth. Au marché des mouches à Djibouti, même si on ne s’occupe pas de toi, tu peux rester des mois, grimper dans les montagnes, il y a cette force de vivre. Dans ces villes, je retrouve étrangement l’atmosphère de Villefranche. Je cherche un marchand de journaux, je bois un Coca. Après la journée de combats, tu as fait des photos, la lumière est belle, tu as envie de rencontrer la femme de ta vie, mais tu es seul.
Quand je découvre l’Éthiopie, je me dis que ce pays, c’est la Bible. […] Je me suis marié à 45 ans avec Claudine, nous avons fait voyager très jeunes nos enfants ; nous avons vendu une maison pour cela. Si tu aimes voyager loin, si tu n’as pas peur, si ça devient naturel, même si le monde est dur, c’est une fantastique joie et une belle leçon de réel. C’est le réel qui m’a sauvé »
Toujours au long de sa vie et de son évolution, il veut affirmer son indépendance et aussi un destin d’artiste :
« Je ne veux dépendre de personne. Je veux rester propriétaire de mon travail, donc de mes négatifs. C’est parce que je ne le suis pas à l’agence Dalmas que je contribue, avec d’autres, à créer l’agence Gamma en 1967. Rejoindre Magnum, en 1979, c’est aussi la confirmation que je deviens un auteur. […] .Un photographe, c’est un propriétaire, une profession libérale. Pas un salarié, pas un métayer. C’est la même chose pour mon cinéma. Je suis propriétaire de tous mes films. Je ne les ai jamais faits pour un client ou pour une télévision […] Quand un photographe me dit : « Je suis photographe salarié à l’AFP », il fait le choix de recevoir un salaire quel que soit son travail. C’est un choix, pas le mien. Pour moi, un photographe n’est pas un ouvrier mais un artiste.
Quand on me propose de rejoindre l’agence Magnum, la première chose que je fais est de lire les statuts. Ils sont d’une intelligence incroyable. C’est comme une ferme autogérée : mettre des choses en commun, mais jamais sa personnalité artistique. »
Rappelons que « Magnum Photos » est une des plus grandes agence photo mondiales et a été créée en 1947 notamment par Robert Capa et Henri Cartier-Bresson. Vous trouverez <sur cette page> des photos que Raymond Depardon a réalisé dans le cadre de Magnum.
Toujours il privilégie l’art, la poésie :
« Je m’exprime en images pour percevoir au mieux. Pas comme un professionnel, mais comme un amateur. Mon problème en fait est ailleurs. Beaucoup de gens, dans la photo documentaire, ne voient que le contenu et pas la forme, la description et pas la poésie.
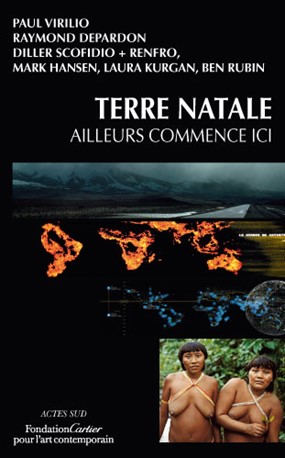 A la sortie de mon exposition « Terre natale », à la fondation Cartier, une femme dit à propos de ces portraits sonores de gens du monde entier dont la langue est menacée : « Vous avez montré toute les misère du monde ». Ce n’est pas du tout ce que je voulais traduire. C’est toute l’ambigüité de l’image. Mais ce n’est pas une raison de démissionner. Je continue résolument de travailler la forme. J’avance… Toujours avec l’image. »
A la sortie de mon exposition « Terre natale », à la fondation Cartier, une femme dit à propos de ces portraits sonores de gens du monde entier dont la langue est menacée : « Vous avez montré toute les misère du monde ». Ce n’est pas du tout ce que je voulais traduire. C’est toute l’ambigüité de l’image. Mais ce n’est pas une raison de démissionner. Je continue résolument de travailler la forme. J’avance… Toujours avec l’image. »
Vous trouverez derrière <Ce lien> une présentation de cette exposition par Raymond Depardon.
Et puis, il va passer de la photographie au cinéma, toujours dans la recherche de l’émotion et du partage de celle-ci. Ainsi en 1969, il part faire un reportage consacré à la minute de silence des Pragois visant à commémorer le premier anniversaire de la mort de Ian Palach qui s’était immolé par le feu pour s’opposer à l’intervention des chars russes en Tchécoslovaquie. Il va prendre une caméra et non un appareil photo et il s’en explique :
« L’image en mouvement est un rêve d’enfant, un rêve aussi de l’agence Gamma qui est toute jeune (créée en 1967). Nous voulons expérimenter, je peux oser des choses. Je veux étirer la minute de silence – le film dure douze minutes – et le cinéma est le meilleur moyen de le faire. C’est comme si je filmais ces gens pour la première ou la dernière fois. Ils sont magnifiques, car arrachés à leur quotidien. Entre mélancolie et perte.
Les bases de mon cinéma sont dans ce film. Montrer des choses qui disparaissent, un temps qui passe, mais sans nostalgie. Quand je fais un plan fixe de dix secondes, on me dit que c’est parce que je suis photographe. C’est faux, c’est même le contraire. C’est le rapport au temps qui s’oppose. En photo, je l’arrête ; au cinéma, je l’étire. »

Il va aussi faire des photos en Afghanistan où il rencontre le commandant Massoud qui devient son guide.
Et il raconte comment il s’est senti trahi par la Presse raison pour laquelle il s’est éloigné du photojournalisme pour se tourner davantage vers le documentaire :
« Une histoire en Afghanistan cristallise tout cela. A l’approche d’un village Massoud me dit de monter sur un cheval. Des enfants surgissent et me jettent des noix. C’est une tradition. Plusieurs mois après, je découvre l’image dans « Stern » avec cette légende « Les enfants fuient les bombes. » En fait, ils courent après les noix. Je suis triste, car je ne voix pas d’avenir pour cette photographie. Le cinéma m’aide alors à avancer. Je veux redonner la parole aux gens, moi qui ai tellement capté leur image. Mon cinéma part de là, filmer des mots, enregistrer ce que j’appelle le « discours frais ». »
Et j’aime beaucoup sa conclusion :
« Voilà comment, alors que je suis photographe, je décide de construire un cinéma fondé sur la parole. Sur le naturel des gens filmés, aussi. Pour cela, avec ma caméra, je deviens abat-jour ou portemanteau et prends un plaisir immense à être transparent. Gamin, à la ferme, j’avais vu une photo prise çà Lourdes d’un caméraman au milieu des pèlerins. Il leur disait : « Ne regardez pas la caméra, priez ! ». Je m’en souviens, car c’est un peu la métaphore de mon cinéma : « Ne regardez pas la caméra, parlez ! ».
Il existe des exemples sur Internet du travail de Raymond Depardon. Par exemple <10e chambre, instants d’audiences> qui est un film documentaire français réalisé en 2004. À travers 12 cas réels (conduite en état d’ivresse, petit trafic de drogue…), sélectionnés parmi plus de 200 filmés exceptionnellement entre mai et juillet 2003 à la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris, présidée par Michèle Bernard-Requin, ce film documentaire montre le quotidien de la justice. Les cas sont simplement filmés sans ajout de commentaire.
Je rappelle que Michèle Bernard-Requin est décédée le samedi 14 décembre 2019 et que quelques jours auparavant, elle avait écrit un texte bouleversant pour écrire un hymne au personnel hospitalier du pavillon Rossini de l’hôpital Sainte-Perrine, pavillon de soins palliatifs dans lequel elle finissait sa vie. Je l’avais repris dans un mot du jour <Une île>.

<1431>
-
Mardi 26 mai 2020
«June Almeida»Virologue ayant découvert le premier coronavirus et aussi la première à observer le virus de la rubéoleLe mot du jour du 13 avril 2018 avait pour exergue : « ni vues, ni connues » et parlait de ses nombreuses femmes qui ont eu une influence déterminante dans l’Histoire notamment des sciences mais n’ont pas été mentionnées ou ont été oubliées. Ce mot du jour faisait suite au mot du jour consacré à « Hedy Lamarr » qui était l’une d’entre elles.
La pandémie qui nous a submergé a conduit à retirer une autre femme de l’oubli. Car c’est une femme qui a identifié le premier coronavirus.
Je l’ai d’abord découvert grâce à la revue de presse du week-end de France Inter <La-revue de presse du week-end 10-mai-2020 >
Et c’est donc Frédéric Pommier qui a eu ces mots :
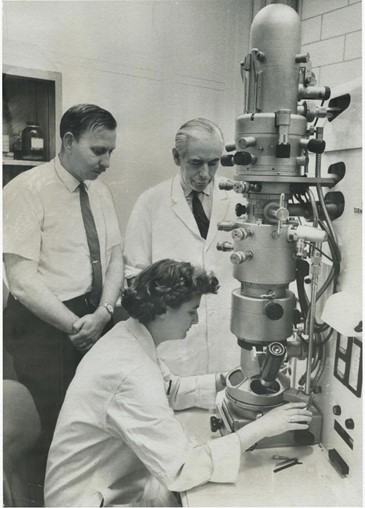 « Le visage d’une femme s’affiche ce matin à la fois dans Le Parisien et dans Le Journal du Dimanche. C’est celui d’une chercheuse écossaise morte en 2007. Son nom : June Almeida. Pourquoi nous parler d’elle ? Pourquoi nous conter son histoire ? Parce que, dans les années 1960, c’est elle qui a découvert les coronavirus.
« Le visage d’une femme s’affiche ce matin à la fois dans Le Parisien et dans Le Journal du Dimanche. C’est celui d’une chercheuse écossaise morte en 2007. Son nom : June Almeida. Pourquoi nous parler d’elle ? Pourquoi nous conter son histoire ? Parce que, dans les années 1960, c’est elle qui a découvert les coronavirus.
Elle nait en 1930, dans un modeste quartier de Glasgow. Son père chauffeur de bus et sa mère femme au foyer n’ont pas les moyens de lui payer l’université. Elle est contrainte d’arrêter l’école à 16 ans. Suite à quoi, comme elle est curieuse et désireuse de travailler dans les sciences, elle frappe à la porte du laboratoire royal de Glasgow. L’adolescente apprend comment examiner les tissus conjonctifs. Bactéries et microbes se succèdent sous ses yeux qui, à force, deviennent de plus en plus experts. Ensuite, elle rejoint Londres, puis avec son mari, peintre vénézuélien, elle s’envole pour le Canada.
Sa technique consiste à injecter des anticorps prélevés sur des personnes infectées, lesquels se regroupent autour du virus, signalant sa présence.
Elle est la première à observer le virus de la rubéole. Grâce à ce procédé novateur, June Almeida acquiert une petite notoriété.
De retour à Londres, un médecin la contacte, car il peine à identifier une bactérie proche de la grippe qu’il ne connaît pas. La chercheuse observe à son tour. Sa méthode lui permet de distinguer les nuances minuscules de couleurs, et surtout cette couronne avec une multitude de points en relief.
On est en 1964, et elle vient de faire une sacrée découverte : une nouvelle famille de virus, qu’on appelle désormais coronavirus
Elle est intéressante à plus d’un titre, cette histoire. D’abord, parce que, comme le dit Martin Catela, docteur de la Pitié-Salpêtrière, vient d’écrire un article scientifique à son sujet, «c’est une magnifique histoire d’ascenseur social», et un hommage aux «invisibles» sans qui les hôpitaux ne tourneraient pas. Et puis, c’est l’histoire d’une passion, remplacée par une autre à la fin de sa carrière. En effet, quand June Almeida a pris sa retraite en 1985, elle a décidé de commencer une nouvelle vie. Elle est alors devenue professeur de yoga »
Il a fallu attendre avril 2020 pour qu’on lui consacre une page wikipedia.
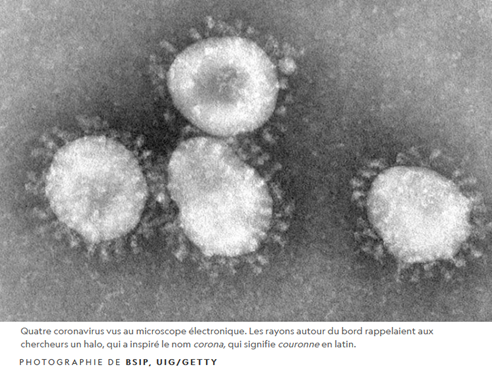 C’est un article de <National Geographic> qui donne davantage de précisions sur la découverte de 1964 :
C’est un article de <National Geographic> qui donne davantage de précisions sur la découverte de 1964 :
« Alors que June Almeida observait un échantillon au microscope électronique, elle a vu un point rond et gris couvert de minuscules rayons. Elle et ses collègues ont noté une sorte de halo autour du virus, formant comme une couronne.
Ce qu’elle venait d’observer allait porter la dénomination désormais bien connue de coronavirus ; Almeida joua un rôle central dans son identification. Cet exploit était d’autant plus remarquable que la scientifique âgée alors de 34 ans n’a jamais terminé ses études. […]
La technique de microscopie développée par June Almeida était simple, mais révolutionnaire pour le domaine de la virologie.
Lorsque vous travaillez avec des particules microscopiques, il est difficile de savoir exactement quoi rechercher. Le défi consiste à discerner si un petit point est un virus, une cellule ou tout à fait autre chose.
Pour résoudre ce problème, June Almeida a réalisé qu’elle pouvait utiliser des anticorps prélevés sur des personnes précédemment infectées pour localiser le virus. Les anticorps sont attirés par les antigènes, par conséquent quand la chercheuse introduisait de minuscules particules recouvertes d’anticorps, ceux-ci se rassemblaient autour du virus, signalant sa présence. Cette technique a permis aux cliniciens d’utiliser la microscopie électronique pour diagnostiquer des infections virales.
June Almeida a ensuite identifié une multitude de virus, dont la rubéole. Les scientifiques étudient la rubéole depuis des décennies, mais June Almeida a été la première à l’observer et la documenter.
Alors que ses compétences étaient de plus en plus reconnues, June Almeida est retournée à Londres où l’attendait un poste à la faculté de médecine de l’hôpital St. Thomas. Là, en 1964, elle a été contactée par le Dr David Tyrrell, qui supervisait une recherche au Common Cold Unit à Salisbury, Wiltshire. Son équipe avait collecté des échantillons d’un virus pseudo-grippal qu’ils avaient étiqueté « B814 » chez un écolier malade dans le comté de Surrey, mais avait eu beaucoup de difficultés à le cultiver en laboratoire. Les méthodes traditionnelles ayant échoué, les chercheurs ont commencé à soupçonner que le B814 pouvait être un nouveau type de virus.
À court d’options, David Tyrrell a envoyé des échantillons à June Almeida, espérant que sa technique d’observation microscopique pourrait permettre d’identifier le virus. « Nous n’avions pas beaucoup d’espoirs, mais nous pensions que cela valait la peine d’essayer », a écrit Tyrrell dans son livre Cold Wars: la lutte contre le rhume.
June Almeida avait beau n’avoir qu’un matériel limité, ses découvertes ont dépassé les espoirs les plus fous de David Tyrrell. Non seulement June Almeida a trouvé et produit des images claires du virus, mais elle s’est souvenue avoir par le passé observé deux virus similaires : l’un en observant une bronchite chez le poulet et l’autre en étudiant une inflammation hépatique chez la souris.»
Elle va écrire un article décrivant sa découverte pour une revue scientifique. Mais son article fut rejeté :
Elle avait écrit un article sur les deux cas, mais il avait été rejeté. Les examinateurs pensaient que les images n’étaient que des images de mauvaise qualité du virus de la grippe. Avec l’échantillon de Tyrrell, Almeida savait qu’elle avait identifié un nouveau groupe de virus.
Pendant une des réunions qu’Almeida, Tyrrell et le superviseur d’Almeida organisaient pour discuter de leurs conclusions, ils se demandèrent comment appeler le nouveau groupe de virus. Après avoir revu les images, ils se sont inspirées de la structure en halo du virus et ont
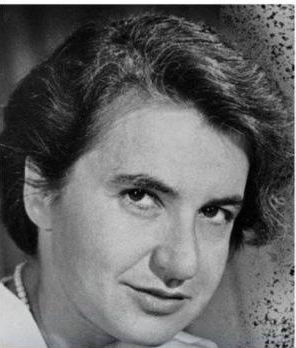 choisi le mot latin corona qui signifie couronne. Les coronavirus étaient nés. »
choisi le mot latin corona qui signifie couronne. Les coronavirus étaient nés. »
Cet article précise aussi :
« Avant sa mort en 2007 à l’âge de 77 ans, June Almeida est retournée à Saint-Thomas en tant que consultante et a participé à la production de certaines des premières images de haute qualité du VIH, le virus du sida. »
Le journal suisse « Le Temps » précise que c’est bien la technique de June Almeida qui a été utilisée en Chine pour observer le SARS-CoV-2. Ce même journal fait ce constat :
« Comme pour beaucoup de femmes en science, l’ampleur de sa contribution à la recherche scientifique, jusqu’ici oubliée, ressort au grand jour avec cette pandémie. »
L’article de National Geographic rapporte des propos de Hugh Pennington, professeur émérite en bactériologie à l’Université d’Aberdeen et qui a travaillé avec June Almeida à St. Thomas. Il la décrit comme son mentor. Il a déclaré au journal « The Herald » :
« Sans aucun doute, elle est l’une des scientifiques écossaises émérites de sa génération, mais malheureusement largement oubliée »
Le journal féministe « Terrafemina » exprime ce souhait :
« Peut-être serait-il même temps d’inscrire une bonne fois pour toutes son nom dans l’Histoire, en lui consacrant (par exemple) le nom d’un établissement, d’un laboratoire ou d’une rue ? »
Une série de podcasts portant pour titre « Une sacrée paire d’ovaires » consacrée à des femmes d’exception lui a consacré une émission <June Almeida, la scientifique qui découvrit le coronavirus>.
<1430>
-
Lundi 25 mai 2020
«Au nom de la terre»Film d’Edouard BergeonDepuis longtemps Annie voulait que nous regardions ce film qui lui avaient été chaudement recommandé par des agriculteurs. Nous n’avons pas pu le voir en salle, nous nous y sommes pris trop tard. Le film est sorti le 25 septembre 2019. Mais nous avons trouvé le DVD et ce week-end prolongé fut l’occasion de le voir.
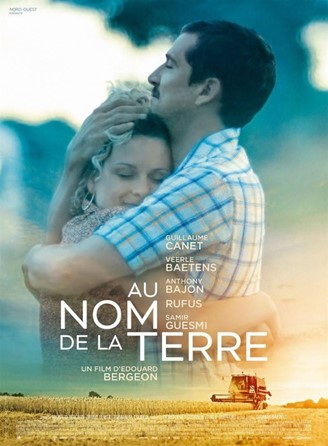 C’est un choc, un moment d’émotion et de multiple questionnements.
C’est un choc, un moment d’émotion et de multiple questionnements.
Ce film a été réalisé par Edouard Bergeon. Il était journaliste à France 2, spécialisé dans le documentaire, quand il s’est lancé dans l’aventure de la réalisation d’un film, de ce film.
Il est né en 1982 et a grandi dans une ferme, près de Poitiers.
Le film « Au nom de la terre » est une fiction largement inspirée de faits réels qu’il a vécus avec son père, sa mère et sa sœur.
Son père a repris la ferme familiale.
Le contexte est celui d’une économie aux mains des industriels, de la grande distribution et du règne du prix bas.
Pour s’en sortir, il faut investir. Pour investir il faut s’endetter.
Quand la dette devient trop compliquée à rembourser, des coopératives, des banquiers ou des industriels viennent vous aider et vous envoie un commercial qui explique au paysan que pour s’en sortir, il faut encore industrialiser davantage, donc investir, donc s’endetter mais avec de beaux rendements qui rendront possible le remboursement de la nouvelle dette et des anciennes dettes.
Cette industrialisation conduit à produire une alimentation de plus en plus médiocre.
Il suffit d’un grain de sable, d’un accident et toute cette construction dévoile sa fragilité.
Dans le film, un violent incendie ravage une grande partie des installations productives dans la ferme. Edouard Bergeon explique que dans la vraie vie, celle de son père, il y eut plusieurs incendies.
C’est trop lourd pour le paysan, il n’a plus la force de continuer le combat.
La fin du film, comme la réalité est une longue déchéance, un état de désordre psychologique qui nécessite des soins psychiatriques et qui mènent finalement au suicide.
C’est une chose de lire dans un article de septembre 2019 que
« Ce serait plus de deux suicides par jour, selon les chiffres de la Mutualité sociale agricole parus cet été. Elle évoque 605 suicides chez agriculteurs, exploitants et salariés. […] On parle bien de surmortalité. Le risque de se suicider est plus élevé de 12,6% chez les agriculteurs. Et ce chiffre explose chez les agriculteurs les plus pauvres. On atteint 57% chez les bénéficiaires de la CMU. Deux activités sont particulièrement touchées : les éleveurs bovins et les producteurs laitiers ».
C’est une autre chose que de le vivre dans l’émotion d’une œuvre de fiction dont on sait qu’elle montre la réalité de la vie, des contraintes et du piège dans lequel sont attirés grand nombre de paysans.
Avant ce film, Edouard Bergeon avait réalisé un documentaire <Les fils de la terre> dans lequel il racontait déjà l’histoire de son père avec en parallèle le récit contemporain d’un paysan et de son père confrontés aux mêmes difficultés de l’endettement et des prix bas dans le cadre d’une ferme de vaches laitières.
 Le film est porté par des acteurs remarquables et notamment Guillaume Canet qui joue le rôle du père. Et lorsque Guillaume Canet, lui-même fils de paysan, découvre par hasard le documentaire « Les fils de la terre » en allumant sa télévision, il est immédiatement conquis et veut en faire une œuvre de fiction. Il est alors en tournage de « Mon garçon », produit par Christophe Rossignon. L’acteur dit alors à ce dernier qu’il aimerait adapter un long métrage de ce documentaire et qu’il souhaite le réaliser. Christophe Rossignon explique que ce projet est déjà en développement et qu’il va le produire et qu’Edouard Bergeon va le réaliser. Il accepte immédiatement de jouer le rôle du Père dans cette distribution.
Le film est porté par des acteurs remarquables et notamment Guillaume Canet qui joue le rôle du père. Et lorsque Guillaume Canet, lui-même fils de paysan, découvre par hasard le documentaire « Les fils de la terre » en allumant sa télévision, il est immédiatement conquis et veut en faire une œuvre de fiction. Il est alors en tournage de « Mon garçon », produit par Christophe Rossignon. L’acteur dit alors à ce dernier qu’il aimerait adapter un long métrage de ce documentaire et qu’il souhaite le réaliser. Christophe Rossignon explique que ce projet est déjà en développement et qu’il va le produire et qu’Edouard Bergeon va le réaliser. Il accepte immédiatement de jouer le rôle du Père dans cette distribution.
Lors de la sortie du film Guillaume Canet et Edouard Bergeon avaient été invités sur France Inter dans l’émission de Nicolas Demorand et Léa Salamé
Dans cette interview Edouard Bergeon a dit :
« Aujourd’hui, beaucoup d’agriculteurs souffrent, se battent : un tiers de nos paysans français gagnent moins de 350 euros par mois. Ce sont eux qui remplissent notre assiette, il ne faut pas l’oublier. Moi je me bats pour tous ces agriculteurs qui se battent pour survivre, pour nourrir la France, et pour tous ceux qui sont partis trop jeunes. Mon père est parti il y a 20 ans, il avait 45 ans, je crois que c’est un peu trop jeune. C’est pour cela que j’ai voulu réaliser ce film, qui n’est pas un documentaire, qui est un film de cinéma, où j’ai voulu filmer de beaux moments et magnifier la nature.
[…] J’ai voulu faire un film sur la transmission de la terre sur trois générations : le grand-père, le père, le fils. Moi je suis le fils. Le grand-père, c’est la génération des 30 glorieuses. Il faut produire, on travaille, on modernise et on gagne de l’argent. On créée des outils, on les transmet au fils… et là on arrive en 1992, l’économie de marché, le marché intérieur, la bourse de Chicago qui fixe tout, et on est obligé de se diversifier pour faire bouillir la marmite. C’est une catastrophe pour cette génération-là qui travaille toujours plus, qui perd son bon sens paysan.
Et puis il y a cette génération, la mienne. Moi je suis parti. Mon père m’avait dit : « Travaille bien à l’école et tu choisiras ton métier… » et « tu mérites d’avoir une vie meilleure que la mienne : ne sois pas paysan… »
J’avais des parents qui avaient compris qu’il fallait que l’école représente notre ascension sociale. Car eux n’avaient pas choisi leur métier ».
[…] Les agriculteurs français sont vraiment isolés, parce qu’ils sont très incompris aujourd’hui. Mon père souffrait de l’image qu’avait le grand public des agriculteurs.
disait qu’il en avait marre de ce métier, et il s’est isolé. Lui qui avait un caractère fort, il a plongé encore plus fort dans un mal-être. C’est pour cela qu’aujourd’hui nous soutenons une association qui s’appelle <Solidarité paysans>, qui fait un travail incroyable de veille et d’accompagnement des agriculteurs en détresse. »
Et Guillaume Canet a ajouté :
« On les traite d’empoisonneurs, aujourd’hui, alors que ce sont eux qui sont les premiers empoisonnés aussi.
[…] j’étais tombé sur le documentaire « Les fils de la Terre » qu’avait réalisé Edouard et qui m’avait bouleversé. Et parce que son histoire est bouleversante, celle de son père, de sa famille, mais ça allait au-delà de cela. J’ai lu aussi ce scénario comme un citoyen, comme un père de famille, et il est vrai que les causes environnementales me touchent et m’importent, mais là, on va au-delà de l’agriculture. Ce qui m’intéressait dans ce scénario, c’est qu’il n’oppose pas les agricultures, la traditionnelle à la biologique. Simplement, il y a un état de fait qui renvoie à des questions importantes où l’on est concerné nous, en tant que consommateur. On a tous une assiette devant nous. Et cette assiette, c’est notre santé. Il faut se poser la question de savoir si ce qu’on a dans notre assiette nous fait du bien. Une chose est évidente, c’est que tout le monde n’a pas le pouvoir d’achat et la possibilité d’acheter bio. Mais il y a aussi une autre agriculture plus raisonnée, plus courte et moins dangereuse pour la santé. »
[…] Et moi c’est ce qui m’a touché : le fait de me dire qu’il faut alerter la population, que des gens n’ont pas la possibilité de choisir ce qu’ils mangent, mais que beaucoup d’autres l’ont, ce choix-là. Qu’on peut consommer autre chose. Et surtout, qu’on arrête d’importer des produits de l’étranger qui sont souvent de la merde, alors qu’on produit en France des produits d’exception que l’on exporte. »
En février 2020, le site <Allo Ciné> annonçait que le film avait fait plus de 2 000 000 d’entrées. Mais on apprend aussi que ce succès est un succès en province, les parisiens ont plutôt boudé le film.
Il est donc possible de le voir en DVD ou sur une plate-forme qui permet de le télécharger ou de le regarder en ligne, ce qu’on appelle le VOD : vidéo à la demande.
Il n’est pas nécessaire de passer par les fourches caudines et américaines de Netflix mais un site indépendant français comme <Universciné> permet de faire la même chose.
D’ailleurs, les <Inrocks> proposent 8 plateformes dont celle-ci, alternatives à Netflix.
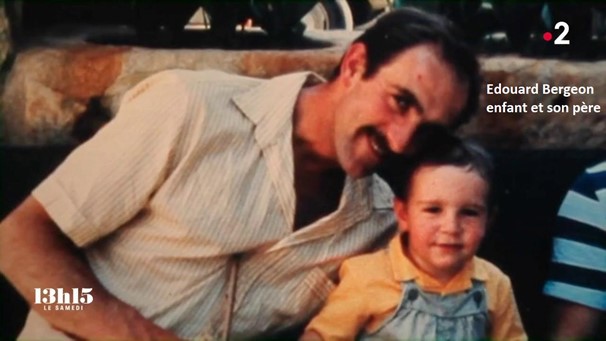 Vous pouvez aussi voir <La bande d’annonce> du film.
Vous pouvez aussi voir <La bande d’annonce> du film.
Il y a aussi cet article de Sud Ouest : « « Au nom de la terre », un film coup de poing qui a changé le regard sur l’agriculture » et qui permet de voir un court entretien d’Edouard Bergeon qui en quelque mots dit l’essentiel.
Et en plein confinement, le 29 avril Edouard Bergeon a pris une nouvelle initiative :
Il a créé une chaîne de télévision en ligne, <CultivonsNous.tv>.
Cette chaîne, créée en partenariat avec la plateforme numérique Alchimie se présente comme un « espèce de Netflix », explique Edouard Bergeon. C’est une « chaîne thématique de l’agriculture, du bien manger et de la transition écologique » qui ambitionne de « recoudre le lien entre la terre et les urbains. »
CultivonsNous.tv fonctionne sur la base de l’abonnement (4,99€ par mois), dont 1€ est reversé à des structures associatives. Pour le lancement du projet, l’association Solidarité Paysans, soutenue de longue date par Edouard Bergeon, est celle retenue.
La chaîne propose déjà une série de documentaires sur plusieurs thématiques : « Ceux qui nous nourrissent », « Ma vie de paysan 2.0 », « Dans quel monde vit-on ? », « Ce qu’on mange », « Ce qu’on boit »
Edouard Bergeon précise :
« Les documentaires racontent toute forme d’agriculture avec une envie d’être plus vertueux »
Je redonne le lien vers cette plate-forme : <https://www.cultivonsnous.tv/FR/home>
<1429>
-
Mercredi 20 mai 2020
«En fait ce que je veux, c’est assez simple, c’est que personne n’oppresse personne, qu’aucun homme n’oppresse un autre homme et qu’aucun état n’oppresse un autre état.»Anne BeaumanoirLe mot du jour est butinage et partage. J’avais prévu de continuer cette semaine de m’inspirer du livre « Comprendre le Monde » de la Revue XXI. Mais, samedi j’ai entendu Claude Alphandery à France Culture. Son expression, son optimiste, sa volonté, sa sagesse m’ont conduit à lui consacrer l’article d’hier. Mais j’ai lu qu’il n’était pas le seul président du « Conseil National de la Nouvelle Résistance », il partage cet honneur avec Anne Beaumanoir.
Si j’avais déjà entendu parler de Claude Alphandery, sans en connaître les détails que j’ai pu approcher hier, je n’avais jamais entendu parler d’Anne Beaumanoir.
Alors j’ai cherché. Et une nouvelle fois me vient cette citation d’Albert Camus :
« Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. » (Le premier homme)
Anne Beaumanoir mérite autant que Claude Alphandery cette appellation : « des êtres qui justifient le monde »
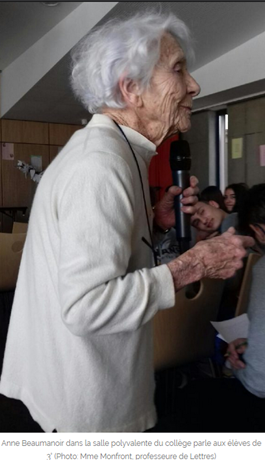 Je voudrais commencer par cette page du Collège Christiane Bernardin de Francheville qui l’avait invitée pour témoigner auprès des collégiens.
Je voudrais commencer par cette page du Collège Christiane Bernardin de Francheville qui l’avait invitée pour témoigner auprès des collégiens.
Sur cette page on peut lire :
« Mardi, au collège Christiane Bernardin, Anne Beaumanoir a raconté son histoire aux élèves de Troisième. Les collégiens étaient émus et très respectueux face à cette grande dame, car ils sont conscients de leur chance. A 96 ans, forte du feu qui l’anime toujours, elle exerce son Devoir de Mémoire auprès des élèves. Une nouvelle fois, elle est revenue jusqu’à Francheville pour raconter son incroyable vie, héroïque pour nous, simplement citoyenne et engagée pour elle. »
Dans les différents articles et vidéo que j’ai vu d’elle, c’est probablement outre son côté chaleureux et pétillant, l’humilité qui parait son trait de caractère dominant.
Elle a fait de brillantes études de médecine, elle a fait de la recherche en neurosciences, fait de la résistance à Paris, sauver avec ses parents de jeunes juifs des griffes des nazis, elle s’est engagée totalement dans la guerre d’indépendance de l’Algérie. Et pour tout cela elle dit, et on la sent sincère, ce n’était pas grand-chose.
Anne Beaumanoir est née le 30 octobre 1923 en Bretagne, près de Dinan, dans les Côtes-du-Nord. Elle est issue d’un milieu modeste. Ses parents sont restaurateurs.
Ce site <Le Maitron> consacré au mouvement ouvrier et social donne davantage de précisions.
« Le père d’Anne Beaumanoir avait été privé de sa part des biens de famille pour avoir déchu en se mariant avec une vachère, Marthe Brunet, fille de valets de ferme ; leur fille Anne est née avant leur mariage. […] Elève de l’école laïque, ce qui est déjà un signe de républicanisme qui vaut en pays catholique traditionnaliste, l’appellation de « rouges », Anne Beaumanoir grandit auprès de parents vivement antifascistes, partisans du Front populaire et vibrant au soutien des Brigades internationales dans la guerre d’Espagne. La mère suivait les réunions et activités communistes, [sans] être formellement membre du parti ; le père tout en soutenant les communistes résistants avait une réserve vis à vis du caractère sectaire et policier du parti (« l’esprit de parti ») ; quand en 1942, sa fille lui fit part de son adhésion au PCF, il eut cette réflexion sur les partisans communistes : « dans ce parti, la moitié d’entre eux est occupée à espionner l’autre ».
Anne Beaumanoir fut d’abord interne au collège de Dinan avant que ses parents au début de la guerre, viennent s’installer en ville tenant un café restaurant. Ayant commencé ses études de médecine à la faculté de Rennes, suspecte de sympathie pour la Résistance et le communisme, elle gagne Paris en 1942 et poursuit ses études médicales en suivant les stages à l’hôpital Cochin »
Elle poursuit donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, des études de médecine à Paris. Clandestinement, elle est militante communiste et membre des réseaux de résistance.Des amis de ses parents l’avertissent un jour qu’une rafle va avoir lieu la nuit suivante dans le 13e arrondissement de Paris, et lui demandent de prévenir une dame, Victoria, qui cache une famille juive. Anne Beaumanoir se rend chez Victoria, puis auprès de la famille juive, les Lisopravski ; mais elle ne parvient pas à les convaincre tous de la suivre d’urgence, seuls les deux enfants, Daniel et Simone, partiront avec elle.
Elle emmène, d’abord les enfants dans une cachette où logent de nombreux membres de la Résistance. Mais la Gestapo investit peu après le repaire, vraisemblablement sur dénonciation, et arrête tous les résistants sauf le chef qui parvient à s’enfuir par les toits, avec les deux enfants. Par la suite Anne Beaumanoir qui n’était pas à Paris à ce moment-là ; revient et emmène les deux enfants chez ses parents en Bretagne, dans leur maison de Dinan.
 Anne Beaumanoir en 1940
Anne Beaumanoir en 1940
À Dinan, son père Jean Beaumanoir est interrogé par la police qui soupçonne sa participation à la Résistance, mais le relâche faute de preuve. Sa mère Marthe Beaumanoir cache les enfants à deux endroits différents pendant deux semaines, puis avec son mari les accueille chez eux pendant presque un an. Après la Libération, les deux enfants sauvés gardent contact avec Anne Beaumanoir et ses parents.
Pour cet acte, Anne Beaumanoir et ses parents seront reconnus « Juste parmi les nations » le 27 août 1996 par l’institut Yad Vashem.
Elle raconte un peu de cette histoire dans ce court extrait d’une émission de <C à vous> de 2015.
Le Comité français pour Yad Vashem écrit au sujet d’Anne Beaumanoir :
« Lorsqu’on lui demanda, après la guerre, pourquoi elle avait sauvé deux Juifs, risquant ainsi sa vie et celle de ses parents, Anne Beaumanoir répondit simplement : « Je hais le racisme ; c’est physique ». »
« La Croix » lui a consacré un article en « Anne Beaumanoir, une vie d’actions » et elle raconte comment est venu cette vocation d’aller témoigner dans les établissements scolaires :
« Depuis neuf ans, Anne Beaumanoir transmet dans les écoles ces expériences et ce passé. Cela a commencé à Lyon. « Un couple d’amis m’a demandé d’en parler à leurs deux garçons. Ils ont suggéré ensuite que je le fasse pour leurs copains. » Une nièce, inspectrice d’académie, lui propose de continuer en Bretagne. Un jour, elle croise la ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. « Nous nous faisions coiffer avant de passer sur un plateau de télévision. Nous avons causé comme chez le coiffeur. »
La ministre l’engage dans la « réserve citoyenne » créée après les attentats de Charlie Hebdo, pour aller témoigner dans les classes. « Je tire une certaine fierté d’être Juste. Et de l’être avec mes parents. J’ai fait ce que j’ai pu, confie Anne Beaumanoir. C’est une reconnaissance qui engage. Mon travail dans les écoles est utile pour faire comprendre la vertu d’être tolérant. Si l’on vous nomme Juste, c’est pour vous dire : « Continuez » ! » »
Après la guerre, elle reprend ses études de médecine à Marseille, devient neurologue et se marie avec un médecin. Elle quitte le Parti communiste en 1955.
« Ce n’était pas l’idéologie qui me dérangeait. Simplement, je n’étais pas d’accord depuis un bout de temps avec les méthodes. »
Elle rencontre des prêtres ouvriers qui font un travail social auprès d’Algériens vivant à Marseille. Devenue chercheuse à Paris, elle aide le FLN qui combat pour l’indépendance de l’Algérie. Elle est arrêtée, jugée et condamnée à dix années de prison en 1959.
« J’ai trouvé cela normal. Quand on s’engage, on sait que c’est une possibilité. »
Libérée provisoirement pour accoucher, elle en profite pour s’évader en Tunisie. Elle devient la neuropsychiatre de l’armée algérienne, un poste où elle remplace l’illustre tiers-mondiste Frantz Fanon.
À la fin de la guerre d’Algérie, elle entre au cabinet du ministre de la santé du gouvernement de Ben Bella, le premier président du pays. « Le combat des Juifs, des résistants ou des Algériens est le même. C’est celui contre l’exploitation », résume-t-elle.
En 1965, elle est exfiltrée d’Algérie après le coup d’État militaire qui renverse Ben Bella, et va diriger un service de neurophysiologie à l’hôpital universitaire de Genève.
 Elle a écrit un livre, publié en 2009 <Le feu de la mémoire – La Résistance, le communisme et l’Algérie, 1940-1965>
Elle a écrit un livre, publié en 2009 <Le feu de la mémoire – La Résistance, le communisme et l’Algérie, 1940-1965>
Elle est bien sûr retraitée et vit tantôt à Saint-Cast-le-Guildo en Bretagne, son village natal, tantôt à Dieulefit dans la Drôme.
Là encore elle agit dans l’humanité et la solidarité.
Elle est à l’origine d’une lettre ouverte à la communauté de communes de Dieulefit pour l’accueil de réfugiés Syriens. Une quarantaine de personnes l’ont signée, et la commune « s’est occupée de trouver un logement à une famille syrienne. »
La Croix rapporte :
« Sur l’ensemble de cette épopée, Anne Beaumanoir a un constat clinique : « Non, ma vie n’est pas exemplaire. J’ai vécu dans une période extrêmement importante de notre vie nationale. Je fais partie de ces gens qui ont fait des choix que l’on trouve bien aujourd’hui. »
Denis Robert, journaliste d’investigation et documentariste, réalise en 2016 un documentaire sur la vie d’Anne Beaumanoir : « Une vie d’Annette ».
Je n’ai trouvé que <cette bande annonce> le documentaire dans son intégralité ne semble plus accessible.
C’est dans ce petit extrait qu’elle dit :
« En fait ce que je veux, c’est assez simple, c’est que personne n’oppresse personne, qu’aucun homme n’oppresse un autre homme et qu’aucun état n’oppresse un autre état. »
Et aussi en s’adressant à une jeune fille de 17 ans elle dit :
« C’est facile à 17 ans de s’engager, d’ailleurs il faut s’engager, c’est sûr, il faut faire des choix difficiles pour ton âge, c’est nécessaire parce-que ça te construit. »
Le même Denis Robert l’a interviewé pour « Le Media » : <Vivre c’est résister>. Dans cet entretien, elle parle de l’actualité, c’était le 1er juillet 2019, elle avait 96 ans. Elle montre son dynamisme, son humour, son alacrité.
J’ai encore trouvé ce témoignage de sa part :
« Pendant mon enfance bretonne, la rencontre avec ma grand-mère a été déterminante. Elle était illettrée. Enfant, elle gardait les vaches et on la payait d’une paire de sabots une année, d’une cape l’année suivante. Ensuite, veuve avec trois enfants, elle a vécu de la pêche à pied, c’est-à-dire qu’elle pêchait des coques, qu’elle mettait sur son dos et qu’elle vendait au porte à porte. Sa vie me montre combien nous avons fait des progrès depuis. »
 Que dire de plus qu’Albert Camus :
Que dire de plus qu’Albert Camus :
« Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. »
Je vais profiter de ce week-end de l’ascension pour profiter de faire une pause salvatrice. Prochain mot du jour, si tout va bien, lundi 25 mai 2020.
<1428>
-
Mardi 19 mai 2020
«Provoquer de nouvelles façons de produire, de consommer de se comporter, de vivre ensemble, de savoir vivre les uns avec les autres»Claude Alphandery en présentant le Conseil National de la Nouvelle Résistance qui vient d’être créé le 13 mai et dont il est co-présidentLe monde d’après le COVID-19 ?
Beaucoup l’imagine, en adéquation avec les souhaits, les utopies, les rêves qu’ils avaient avant.
Certains développent des tribunes, des initiatives ou même lance des mouvements. L’une de ses initiatives a retenu mon attention : la création du « Conseil National de la Nouvelle Résistance »
Non pas en raison du titre, mais parce que pour le présider les personnalités qui ont fondées ce mouvement ont eu l’idée de choisir deux figures de la résistance historique : Claude Alphandéry et Anne Beaumanoir.
Le premier est né en 1922 et la seconde en 1923.
Ce sont des grands seniors, mais qui à leur âge restent absolument épatants, au bout d’une vie …bien remplie. Camus a dit :
« Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. » (Le premier homme)
C’est Claude Alphandery qui a été invité aux matins de France Culture de ce samedi pour présenter ce Conseil national de La Nouvelle Résistance.
C’est donc de lui que je vais parler aujourd’hui.
Grâce à Wikipedia nous pouvons connaître son parcours à grands traits :
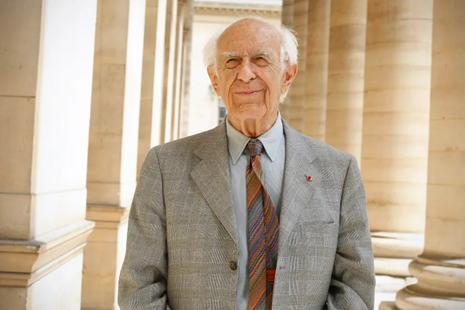 Claude Alphandéry est né le 27 novembre 1922 à Paris. Il s’engage dans des actions de résistance alors qu’il étudie au lycée du Parc à Lyon en automne 1941. Il assure notamment du transport de documents et des distributions de tracts.
Claude Alphandéry est né le 27 novembre 1922 à Paris. Il s’engage dans des actions de résistance alors qu’il étudie au lycée du Parc à Lyon en automne 1941. Il assure notamment du transport de documents et des distributions de tracts.
Après dénonciation de ses relations avec une réfugiée juive allemande, il entre dans la clandestinité pendant l’hiver 1942-1943. Il devient lieutenant-colonel dans les Forces françaises de l’intérieur (FFI), chef des Mouvements unis de la Résistance Drôme-Ardèche (MUR) puis président du comité départemental de Libération de la Drôme.
Après avoir été attaché d’ambassade à Moscou, Claude Alphandéry est élève de la 2e promotion de la nouvelle École nationale d’administration (ENA) en 1946. Il devient expert économique auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU) à New York. Cette expérience nourrira sa réflexion sur la société de consommation dont l’opulence cache de profondes inégalités dans la répartition des richesses tant du point de vue des individus que des États-nations.
Il devient membre du Parti communiste français en 1945 mais il quitte le PCF en 1956 à la suite du 20e Congrès du Parti communiste soviétique et de la parution du rapport Khrouchtchev.
En 1960, Claude Alphandéry participe à la fondation de la Banque de construction et des travaux publics dont il devient le président de 1964 à 1980.
Il continue de participer au débat public, en tant qu’animateur d’un cercle de réflexion, le Club Jean Moulin (1959-1965), ou dans les années 1970 au sein du club Échanges et projets, fondé par Jacques Delors et animé par Jean-Baptiste de Foucauld.
En 1976, il adhère au Parti socialiste, où il est proche de Michel Rocard.
Par la suite il va prendre un rôle de premier plan dans l’organisation de l’économie sociale et solidaire.
Au début des années 1980, Claude Alphandéry va conduire une mission sur le développement local et la lutte contre les exclusions. C’est ainsi qu’en 1988 il est amené à créer, présider et développer l’association France active, qui soutient et finance les initiatives économiques créatrices d’emplois et génératrices de solidarité et dont il est aujourd’hui le Président d’honneur.
En 1991, Claude Alphandéry devient président du Conseil national de l’insertion par l’activité économique.
En 2006, Claude Alphandéry et Edmond Maire, ancien secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), sont les initiateurs d’un « manifeste pour une économie solidaire ».
Considéré comme le porte-flambeau de l’économie sociale et solidaire, à 89 ans, Claude Alphandéry continue d’initier de nombreuses actions pour promouvoir cette économie qui place l’être humain avant le profit. Il est Président du Labo de l’Economie Sociale et Solidaire et a animé l’organisation des États généraux de l’économie sociale et solidaire, marqués par un grand rassemblement au Palais Brongniart les 17, 18 et 19 juin 2011.
Il a aussi participé, en mars 2012, à la constitution du Collectif Roosevelt que j’ai évoqué lors du mot du jour récent évoquant Franklin D. Roosevelt et son petit-fils Curtis..
Il me semblait important de savoir tout cela avant de dire qu’il participe avec une vingtaine de personnalités à la création du Conseil National de la Nouvelle Résistance (CNNR), le 13 mai 2020.
Sa conclusion dans l’émission fut la suivante :
« Nous avons vu comment, par la solidarité, la pandémie a pu être contenue. C’est un exemple de ce que nous pouvons faire, dans un monde qui risque d’être invivable. Avec ce nouveau Conseil, nous voulons susciter la renaissance de cet esprit de solidarité. Il existe, en France, des milliers d’associations, d’entreprises sociales et solidaires, qui doivent être un noyau de ce système nouveau que nous voulons mettre en place. […]
Il y a des adversaires, il y en a qui voudrait revenir au système actuel parce qu’il leur est hautement profitable.
Il faut savoir résister à ceux qui ne veulent pas du bien.
Mais il faut surtout savoir s’appuyer sur les choses existantes
Je pense que l’important pour la réussite c’est de s’appuyer complètement et développer sur tout ce qui existe déjà en France d’entraide, de coopération, de solidarité.
Il y a des milliers d’associations de l’économie sociale et solidaire qui se sont développées, ce sont elles qui doivent constituer le noyau de ce système nouveau que nous essayons de mettre en place.
On ne pourra pas avancer, s’il n’y a pas d’abord un sauvetage des faillites et du chaos. On a besoin d’un Etat qui fasse ce qu’il faut.
Mais pour investir dans ce nouveau système, il faut une bonne fiscalité, un bon code du travail, des crédits qui vont aux bonnes activités et pas aux mauvaises.
Il y a bien sûr ce qui vient de l’Etat ou de l’Europe, mais il y aussi ce qui se fait sur le terrain. C’est un changement de comportement qui au lieu de se fonder sur la seule concurrence, la seule compétition, se fonde sur la solidarité et la coopération.
Ce n’est pas irréaliste, cela existe un peu partout. Il faut simplement les aider, les soutenir.
Il faut simplement que tout ce qui existe, converge, coopère ensemble. Parce que pour l’instant c’est encore trop dispersé, disséminé, fragmenté. Et dans la mesure où c’est fragmenté, cela n’a pas l’impact suffisant.
Cela ne fait pas système, ça ne change pas la façon de produire de consommer, d’échanger, de faire des affaires.
Changer le système, il le faut au niveau de la France, au niveau de l’Europe, au niveau du monde et partout sur le terrain.
La nouvelle résistance, c’est cela : faciliter, encourager, soutenir, provoquer de nouvelles façons de produire, de consommer de se comporter, de vivre ensemble, de savoir vivre les uns avec les autres.
Et cela bien entendu nécessite l’Etat, mais à côté de l’Etat un Conseil National de la résistance qui vérifie la capacité de la société de se transformer profondément.
C’est cette fameuse métamorphose dont parle souvent Edgar Morin. »
Cela apparaît un peu utopique et le chemin est si compliqué dans un monde interdépendant où la France pèse si peu de chose.
Mais l’enthousiasme de cet homme de 98 ans est tellement communicatif.
Il n’est pas seul dans cette aventure outre Anne Beaumanoir, il y a aussi neuf femmes (Dominique Méda, Danièle Linhart, Sabrina Ali Benali, Anne Eydoux, Pauline Londeix, Véronique Decker, Fatima Ouassak, Anne-Claire Rafflegeau, Clotilde Bato) et neuf hommes (Dominique Bourg, Samuel Churin, Pablo Servigne, Olivier Favereau, Yannick Kergoat, Jean-Marie Harribey, Dominique Rousseau, Antoine Comte, Benoît Piédallu). Plusieurs de ces personnalités ont été citées dans des mots du jour.
 Ils ont un Logo et l’Obs leur a consacré un article : « Des personnalités créent un… « Conseil national de la Nouvelle Résistance » » il y a aussi une vidéo accessible dans cet article dans laquelle divers intervenants explique la démarche.
Ils ont un Logo et l’Obs leur a consacré un article : « Des personnalités créent un… « Conseil national de la Nouvelle Résistance » » il y a aussi une vidéo accessible dans cet article dans laquelle divers intervenants explique la démarche.
Ils vont produire un document dans lequel :
« Il s’agit d’énoncer les principes selon lesquels notre société devra être gouvernée et de sommer les responsables politiques de s’engager vis-à-vis d’eux. »
Le résultat de ces travaux sera publié le 27 mai, journée nationale de la Résistance.
<1427>
-
Lundi 18 mai 2020
«Et je me suis lancée dans le combat contre le brevetage du vivant que je juge illégal, non scientifique, immoral et injuste.»Vandana ShivaProbablement ne le saviez-vous pas, mais il est possible désormais de breveter le vivant en Europe. C’est ce que nous apprend cette page de France 5, mise à jour le 11-02-2020. Je la cite :
« On croyait le brevetage des plantes non modifiées génétiquement impossible en Europe. Pourtant, l’Office européen des brevets (OEB) vient d’octroyer plusieurs brevets pour des légumes au profit de firmes internationales. Comment cette décision a-t-elle été possible et avec quelles conséquences ?
C’est une décision de la Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets datée du 25 mars 2015 qui a permis de faire avancer « la cause » des multinationales sur le brevetage du vivant .
A la question « si l’on découvre un lien entre une séquence génétique existant naturellement dans une plante cultivée et un caractère particulier de cette plante, peut-on devenir propriétaire de toutes les plantes qui expriment ce caractère » , la Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets a répondu … »oui ».
La décision de l’Office européen des brevets (OEB) d’accorder un brevet pour une tomate et un autre pour un brocoli, fait donc réagir de nombreux acteurs de l’écologie, comme du secteur semencier et agro-alimentaire.
Cette décision d’accorder des brevets pour des plantes non modifiées génétiquement était crainte et attendue : près de mille demandes de brevets de la part des industriels du secteur ont été effectuées en quelques années. Toutes ces demandes le sont pour des plantes dites « classiques ».
Christine Noiville, présidente du Haut Conseil des biotechnologies, docteur en droit et directrice de recherche au CNRS confirme la propriété temporaire qu’obtient l’entreprise sur la plante : » Par cette décision, la Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets confirme que l’entreprise peut bien obtenir un monopole temporaire sur le brocoli dit « anti cancer » et, au-delà, sur le caractère « anti cancer » lui-même, tel qu’il pourrait être intégré dans n’importe quel autre type de plante. Donc les sélectionneurs, voire les agriculteurs, qui produiraient des plantes possédant ce caractère breveté seraient astreints à payer une redevance à l’entreprise détentrice du brevet. »
Jusqu’alors, en Europe, seul le Certificat d’obtention végétal (COV), lui-même déjà contesté par une partie des agriculteurs, pouvait être utilisé pour protéger la « propriété intellectuelle » de certaines semences issues des sélections naturelles.
L’inscription obligatoire au catalogue officiel [des semences] n’est pas toujours appréciée des agriculteurs, comme les redevances qu’ils doivent payer, mais dans l’absolu, l’échange de semences est toléré. Le COV semble un « moindre mal » comparé aux brevets, pour les agriculteurs. Pour la présidente du HCB, le basculement du COV vers les brevets est très important : « Le principe qui consiste à accepter que des plantes issues de procédés essentiellement biologiques, donc les produits de sélections essentiellement conventionnelles, soient protégées par des brevets, est une étape supplémentaire très importante dans l’évolution qu’ont connue les droits de propriété intellectuelle dans la sélection végétale ces 20 dernières années. »
Ce principe de brevetage du vivant — importé des Etats-Unis où il est actif depuis des décennies — est un cran au-dessus du COV, et amène un changement majeur pour le monde agricole, et par ricochet, pour la souveraineté alimentaire et l’autonomie semencière du continent européen. Par le biais de ce système, les plantes qui nourrissent la population peuvent devenir la propriété d’entreprises — le plus souvent spécialisées dans la génétique. Ces entreprises peuvent attaquer en justice — pour contrefaçon — les agriculteurs qui cultivent des plantes sous brevets sans autorisation et paiement d’une redevance. Comme dans le cas des plants d’OGM brevetés, majoritairement
 interdits à la culture en Europe. »
interdits à la culture en Europe. »
C’est dire combien est important le combat de cette formidable femme indienne Vandana Shiva qui se bat depuis de longues années contre le brevetage du vivant. Il me semble que je ne l’ai jamais cité dans les mots du jour. Ceci constitue un grave oubli que je répare aujourd’hui, parce qu’elle fait partie de ces personnes que la Revue XXI a interviewé et dont l’entretien a été inséré dans le livre « Comprendre le Monde » dans lequel je suis en train de butiner pour partager certains de ces entretiens.
L’article que je partage aujourd’hui a pour titre « L’illégal brevetage du vivant » et a été publié à l’automne 2015 dans la revue N° 32. La journaliste qui a réalisé l’entretien est Coralie Schaub.
<Wikipedia> la présente ainsi : Vandana Shiva est née le 5 novembre 1952 à Dehradun en Inde. Après avoir obtenu une licence de physique en 1972, puis un master en 1974, à l’université du Panjab, à Chandigarh en Inde, Vandana Shiva poursuit ses études au Canada. Elle y obtient un master de philosophie des sciences à l’université de Guelph en 1977, puis un doctorat dans la même discipline obtenu en 1978 à l’université de Western Ontario. Elle réoriente ensuite ses recherches dans le domaine des politiques environnementales à l’Indian Institute of Science.
Elle est l’une des chefs de file des écologistes de terrain et des altermondialistes au niveau mondial, notamment pour la promotion de l’agriculture paysanne traditionnelle et biologique, en opposition à la politique d’expansion des multinationales agro-alimentaires et au génie génétique. Elle lutte contre le brevetage du vivant et la bio-piraterie.
Tout en poursuivant sa lutte contre l’introduction des OGM dans son pays, Vandana Shiva s’engage dans une forme d’activisme mondial en faveur de la paix, la biodiversité et du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes.
Dans l’entretien, elle parle d’abord de son enfance :
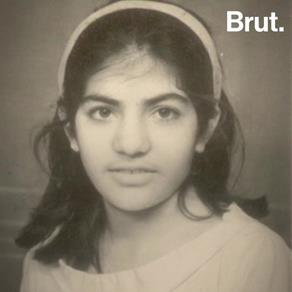 « Je suis née après la colonisation britannique dans les premières années de l’indépendance de l’Inde. Mes parents s’étaient engagés dans ce mouvement. Ma mère a persuadé mon père, major dans l’armée britannique, de quitter l’armée pour rejoindre le service indien des forêts. C’était un acte fort. Mes parents m’ont donné une éducation gandhienne, empreinte de spiritualité. Ils m’ont enseigné la non-violence, la simplicité et la compassion. […] J’ai eu la chance de grandir autour de gens exceptionnels. J’ai été marquée par les longues discussions qu’avait mon père avec deux disciples de Gandhi. Ces deux femmes, d’origine britannique, avaient été baptisées Mirabehn et Sarla Behn par le Mahlatma. Elles étaient très engagées dans la défense des forêts. Lakshmi Pandit, la sœur de Nehru alors Premier ministre, venait aussi à la maison. »
« Je suis née après la colonisation britannique dans les premières années de l’indépendance de l’Inde. Mes parents s’étaient engagés dans ce mouvement. Ma mère a persuadé mon père, major dans l’armée britannique, de quitter l’armée pour rejoindre le service indien des forêts. C’était un acte fort. Mes parents m’ont donné une éducation gandhienne, empreinte de spiritualité. Ils m’ont enseigné la non-violence, la simplicité et la compassion. […] J’ai eu la chance de grandir autour de gens exceptionnels. J’ai été marquée par les longues discussions qu’avait mon père avec deux disciples de Gandhi. Ces deux femmes, d’origine britannique, avaient été baptisées Mirabehn et Sarla Behn par le Mahlatma. Elles étaient très engagées dans la défense des forêts. Lakshmi Pandit, la sœur de Nehru alors Premier ministre, venait aussi à la maison. »
Elle précise que ses parents étaient rebelles au pouvoir, mais elle garde aussi le souvenir de sa vie dans la forêt et de ce que disait sa mère :
« Nous aimions jouer dans les ruisseaux, cueillir des fougères et des fleurs que nous faisions sécher pour décorer nos cartes de vœux. Grandir dans la forêt, c’était faire l’expérience de la beauté.
Ma mère, elle, plantait de nombreux arbres autour de la maison. Les gens ne comprenaient pas et s’étonnaient : « Mais ces arbres donneront des fruits dans vingt ans ! et vous ne serez plus là pour les manger ; » Elle leur expliquait : « on ne plante pas un arbre pour soi-même, mais pour l’avenir. D’autres mangeront les fruits »
C’est évidemment une philosophie de vie difficilement accessible aux possesseurs des grandes entreprises qui déposent des brevets sur le vivant : « D’autres mangeront les fruits ! ».
Ses parents étaient des esprits de progrès qui souhaitaient l’abolition des castes et l’égalité entre femmes et hommes. Un de ses grands-pères a donné sa vie pour que les filles puissent aller à l’école :
« En 1956, le père de ma mère est mort d’une grève de la faim pour défendre la création d’une école de filles, qui existe toujours. Il était persuadé que l’Inde ne pourrait se reconstruire sans l’éducation des filles. J’avais 4 ans, il a forgé la personnalité de ma mère et la mienne. »
La chaîne <Brut> présente la vie de Vandana Shiva en moins de quatre minutes
Elle commence des études de science dans la physique nucléaire. Mais elle va s’en détourner quand elle comprend que ce savoir est partiel et ne s’intéresse pas à l’humain :
« En physique nucléaire, on apprenait à calculer la libération d’énergie d’une réaction en chaîne, mais les effets des radiations n’étaient pas enseignés. J’ai compris que mon savoir était parcellaire et je me suis demandé pourquoi on ne nous apprenait pas tout. Pourquoi la science ne cherchait-elle pas à connaître ses impacts ? […] Alors, j’ai voulu me tourner vers l’essentiel, le plus fondamental. J’ai lu tous les journaux à la recherche des personnes qui posaient les questions et tentaient d’y répondre. Ils étaient tous au Canada. C’est là que j’ai poursuivi mes études, en physique quantique et en philosophie des sciences ».
Après ses études au Canada elle est retournée dans son pays natal. Elle fait des recherches et mène une étude sur l’exploitation minière de la vallée où elle a grandi pour le Ministère de l’Environnement :
« Nous avons démontré qu’il était plus rentable de ne pas extraire le calcaire qui stocke l’eau naturellement, car le détruire obligeait à construire tout un système de stockage. LE ministère a fermé les mines et notre travail a servi de base à la première jurisprudence de la Cour suprême indienne en faveur de l’environnement : « Quand le commerce détruit la vie, il doit cesser. »
Elle date son engagement militant dans l’écologie lorsqu’elle fait le constat des ravages de la déforestation :
« Avant de partir au Canada, j’ai voulu emporter avec moi un peu de la joie ressentie enfant dans la forêt et j’ai refait le chemin de mes anciennes randonnées, pas loin de Dehradun. C’était un choc : ma forêt de chênes avait disparu, les ruisseaux aussi. C’était comme si une partie de moi-même était morte. J’avais grandi en imaginant que les forêts étaient éternelles. Pour la première fois, je prenais conscience de la puissance des forces de destructions commerciales. [un vendeur de thé] lui dit : « Il y a de l’espoir, grâce aux activistes de Chipko ». C’est alors que je me suis promis de me consacrer à cette cause. […]
La forêt himalayenne a été ma seconde université, et les femmes de Chipko mes professeurs. Avant de les rencontrer, la forêt était jusque-là, pour moi, la beauté. Pour elles, c’était la survie : la source de leur approvisionnement en eau, en énergie… Je me suis mise à lire des livres de sylviculture. Tous ces ouvrages considéraient la diversité comme gênante : une plantation forestière uniforme était commercialement bien plus utile ! J’ai alors décidé de mêler le savoir pratique des femmes à mon savoir universitaire pour obtenir un tableau complet. Les villageoises avaient compris que la déforestation tarissait les sources et cela n’était pas abordé dans les livres !»
Du combat pour la sauvegarde de la forêt elle va aller vers l’engagement qui l’a mondialement fait connaître dans l’agriculture :
« En 1984, deux évènements terribles sont arrivés qui m’ont donné envie de comprendre pourquoi l’agriculture devenait un monde si violent.
Le premier était l’explosion de l’usine de pesticides de l’American Union Carbide, à Bhopal. Après l’explosion, les substances chimiques répandues ont causé la mort de milliers de personnes. Je me suis interrogée sur la raison de l’utilisation de produits aussi dangereux.
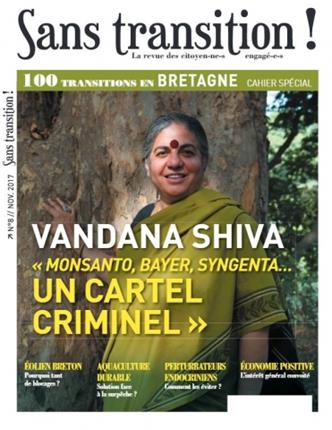 Le second évènement était la vague de violence dans l’Etat du Pendjab […] Pourquoi les fermiers de cette région, réputée la plus fertile d’Inde prenaient-ils les armes alors que la révolution verte était censée nous apporter prospérité et paix ? Quelque chose clochait. Quelque chose lié à la terre et aux ressources. […] Je me suis plongée dans l’histoire des engrais et des pesticides chimiques. Et je me suis rendu compte que ces produits, utilisés pour nous nourrir, avaient été conçus pour tuer par la machine de guerre nazie et l’industrie allemande, à l’époque IG Farben. »
Le second évènement était la vague de violence dans l’Etat du Pendjab […] Pourquoi les fermiers de cette région, réputée la plus fertile d’Inde prenaient-ils les armes alors que la révolution verte était censée nous apporter prospérité et paix ? Quelque chose clochait. Quelque chose lié à la terre et aux ressources. […] Je me suis plongée dans l’histoire des engrais et des pesticides chimiques. Et je me suis rendu compte que ces produits, utilisés pour nous nourrir, avaient été conçus pour tuer par la machine de guerre nazie et l’industrie allemande, à l’époque IG Farben. »
Et c’est en 1987 qu’elle découvre les noirs desseins de certains industriels. :
« Cette année-là, je suis invitée à un séminaire sur les biotechnologies organisé par une fondation suédoise à Genève. […] A un moment, les industriels évoquent leurs plans pour développer les OGM et prendre le contrôle des semences. Ils disent vouloir modifier génétiquement les plantes pour les breveter et accroitre leurs profits. Ils en parlent ouvertement et expliquent qu’ils comptent se regroupe pour mieux conquérir les marchés. Je suis secouée et j’entrevois ce qui risque de passer dans les fermes. Les paysans qui s’endettent pour acheter des engrais et des pesticides allaient aussi devoir s’endetter pour se procurer les semences.
Et c’est ce qui se passe ! Regardez : Ciba-Geugy, Sandoz et AstraZeneca ont fusionné pour devenir Syngenta ! Et Monsanto a racheté presque tous les semenciers de la planète. Ce que je n’imaginais pas à l’époque, c’est à quel point ces entreprises musèleraient les scientifiques s’intéressant à l’impact des OGM. A mes yeux, il n’y avait pas de temps à perdre et je me suis lancée dans le combat contre le brevetage du vivant que je juge illégal, non scientifique, immoral et injuste. Le plan exposé par les industriels me paraissait si totalitaire que seule une réponse gandhienne pouvait convenir pour lutter contre les multinationales et leur emprise sur la vie, les paysans, les citoyens »

Et c’est ainsi contre le brevetage du vivant et pour la conservation des semences anciennes et leur gratuité que Vandana Shiva va engager le combat.
L’entretien de la revue XXI et sa transcription dans le livre « Comprendre le Monde » ne se trouve pas sur Internet. Mais elle explique, de la même manière, sa stratégie et les outils de sa lutte dans <cet article d’Agora Vox> :
« Gandhi a été un modèle pour moi dès mon enfance, au travers de mes parents, qui m’habillaient avec le Khadi, un textile tissé à la main, mais surtout un symbole fort de son apport idéologique à l’Inde, son arme de lutte contre l’impérialisme britannique à une époque où tous les textiles provenaient d’Angleterre. Il clamait que nous ne serions jamais libres tant que nous ne produirions pas nos propres textiles. C’est la raison pour laquelle le tissage des vêtements a été une part importante de notre indépendance. […]
En 1987 à la Conférence de Genève, […] J’avais encore à l’esprit la façon dont Gandhi a symboliquement ressorti le rouet pour tisser et fabriquer des vêtements et je me suis demandé ce qui pourrait être le rouet de notre époque. J’ai pensé à la graine et j’ai commencé à en conserver depuis ce jour de 1987 en fondant Navdanya, mouvement de sauvegarde de la graine. La seconde facette de cette inspiration est le puissant concept de Satyagraha, que nous avons continuellement mis en pratique pour défendre notre droit aux semences libres..
Satyagraha signifie littéralement le « combat pour la vérité ». Et Bija Satyagraha signifierait le « combat pour la vérité de la graine ». Concrètement, la graine se reproduit, elle se multiplie, elle est partagée. Les paysans doivent avoir accès à ces semences. Nous avons commencé à pratiquer la « Bija Satyagraha » lorsque les grandes multinationales se sont mises à établir des monopoles sur les semences et ont utilisé notre gouvernement pour créer et mettre en place des lois qui existaient déjà en Europe et aux Etats-Unis, interdisant aux paysans d’utiliser leurs propres graines, rendant illégales des semences indigènes. »
Vous pouvez lire la suite dans l’article précité et dont je redonne le lien : < Vandana Shiva : graines de résistance>.
Je crois profondément que le combat de Vandana Shiva est juste.
Quand on réfléchit au monde d’après le COVID-19, cette question du brevetage du vivant et plutôt du non brevetage devrait se trouver parmi les tous premiers sujets à traiter.
Ce combat sera très âpre, tant les intérêts de puissantes forces financières sont à l’œuvre pour empêcher toute remise en cause de ces procédés qui leur assurent fortune et pouvoir.
<1426>
-
Vendredi 15 mai 2020
«Ces nouveaux malnutris [issus du COVID-19] viendront s’ajouter aux 820 millions de personnes souffrant déjà de faim, soit un Terrien sur neuf.»Le rapport sur la nutrition mondialeJe continuerai à décliner les entretiens du livre « Comprendre le Monde » la semaine prochaine.
Aujourd’hui je souhaite partager un article du Monde, publié le 12 mai : « Après la pandémie, une grave crise alimentaire menace au nord comme au sud »
Dans sa <Revue de Presse> Claude Askolovitch présente cet article ainsi :
« On parle de grains de riz…
Des grains de riz en tas pas bien haut pas bien larges, que vous voyez dans le Monde, dans une série de photos très belles et sombres, toutes composées de la même manière, d’un côté donc un tas de riz, quelques patates, des oignons et en face des êtres humains à la peau sombre et aux traits fins, qui portent des masques et pour les femmes des tissus colorés recouvrant les cheveux, un homme en chemise souffle la fumée de sa cigarette autour de sa compagne, des enfants s’accrochent à leurs mères: ce sont des habitants du bidonville de Korail à Dacca, capitale du Bengladesh, qui travaillaient avant la pandémie du Covid 19 et qui ne travaillent plus, et que l’on voit à côté de leurs réserves de nourritures pour les jours à venir…
Et par ces photos du grand documentariste Mohamed Rakibul Hasan vous comprenez ce ce qu’est le dénuement alimentaire, et ensuite vous pouvez lire sur le site du Monde l’article factuel que ces photos accompagnent, sur la crise alimentaire mondiale qui s’aggrave: nous étions avant le virus une planète où 820 millions de personnes souffraient de la faim, on rajoutera à la foule des mal-nourris 14 millions de personnes, ou 38, ou même 80, tout dépendra de l’ampleur de la récession…
Les récoltes de pomme de terre pourrissent dans des hangars en Guinée, des étudiants vivent des soupes populaires en France, on fait la queue à Genève pour un repas de charité et des enfants grandissent anémiés et leurs enfants le seront… C’est donc dans le Monde, quand sort aujourd’hui un rapport sur la malnutrition mondiale.
Vous lirez aussi sur les sites du Point et de la Vie des reportages sur cette faim qui enserre nos, villes, que contiennent des bénévoles qui sont un ultime recours… Dans la Vie parle Odile, qui a trois enfants: avant la maladie dit-elle, il y avait toujours moyen de s’en sortir, en glanant à la fin des marchés ou en faisant des petits boulots, maintenant ce n’est plus possible… Elle pourrait aussi bien vivre au Bengladesh mais elle est de Nanterre. »

L’article du Monde est écrit par la journaliste Mathilde Gérard. Elle écrit :
« Dans tous les pays frappés par la pandémie de Covid-19, des plus riches aux plus pauvres, la malnutrition a gagné de nouvelles populations. Les rues de Genève, l’une des villes les plus fortunées du monde, ont vu se former, chaque samedi, des files de plusieurs centaines de mètres pour recevoir des paniers alimentaires. Partout, la crise, dont on est loin encore de mesurer l’ampleur finale, pourrait faire basculer dans la faim des dizaines de millions de personnes. L’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) a calculé qu’elles seraient 14,4 millions à rejoindre les rangs de la sous-alimentation en cas de récession globale de 2 %, 38,2 millions si la contraction atteint 5 %, et jusqu’à 80,3 millions pour un repli de 10 % – le recul est pour l’heure estimé à 3 % en 2020. Ces nouveaux malnutris viendront s’ajouter aux 820 millions de personnes souffrant déjà de faim, soit un Terrien sur neuf. »
Cet article s’appuie sur <Le rapport sur la nutrition mondiale> publié mardi 12 mai. Publication, lancée en 2013 par plusieurs dizaines de parties prenantes (experts en nutrition, membres d’agences internationales, représentants du secteur privé et de la société civile, donateurs) et qui dresse un état des lieux des indicateurs de nutrition.
Le confinement imposé à une partie de la planète va probablement conduire à une aggravation de ces indicateurs en dépit de très bonnes récoltes agricoles cette année.
Cet article assez long montre la situation préoccupante notamment dans les pays pauvres mais pas seulement.
La conclusion rappelle que ce que nous vivons n’est pas qu’une crise sanitaire et bien rapidement ne sera plus essentiellement une crise sanitaire :
« A long terme, les effets de cette malnutrition s’annoncent dévastateurs. « Chaque pourcentage de recul du PIB entraîne une hausse de 0,7 million d’enfants en retard de croissance. Et ces enfants vont eux-mêmes donner naissance à une nouvelle génération d’enfants en retard de croissance », note Gerda Verburg, ancienne ministre de l’agriculture des Pays-Bas et coordinatrice du mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN, qui regroupe des dizaines d’Etats, représentants de la société civile, donateurs et secteur privé).
La faim ne sera pas la seule conséquence de la pandémie sur l’alimentation. La récession va durablement affecter les régimes des plus vulnérables, faisant craindre une hausse des pathologies liées à l’alimentation. « Les populations vont rediriger leurs achats de denrées vers des aliments plus abordables ou disponibles, mais moins diversifiés et nutritifs, souligne Valentin Brochard. On risque d’avoir une augmentation des taux de sous-nutrition et des carences en vitamines et micronutriments. »
Dans ce contexte, la crise alimentaire qui sévit appelle une réponse globale et coordonnée. Gerda Verburg met en garde contre un « contrecoup massif », car « l’attention est encore trop sur la question purement sanitaire et pas assez inclusive. Nos systèmes de production actuels créent non seulement de la sous-nutrition mais aussi de l’obésité. Nous ne pouvons pas les laisser détruire la santé humaine et le bien-être de notre planète ». Pour Nicolas Bricas, l’enjeu sera de ne pas occulter les objectifs de long terme : « On ne va pas échapper à une gestion de l’urgence. L’explosion de la demande d’aide alimentaire est une difficulté qui se voit. En revanche, on peut craindre qu’on passe sous silence les urgences environnementales. Il y a déjà une forte pression des acteurs économiques pour alléger leurs contraintes en la matière. »
Il y a aussi sur ce sujet une publication de l’ONU Covid-19 : « le nombre de gens confrontés à une crise alimentaire doublera en l’absence de mesures rapides »
Et je redonne le lien vers l’article du Monde : « Après la pandémie, une grave crise alimentaire menace au nord comme au sud »
<1425>
-
Jeudi 14 mai 2020
«Il est plus facile d’unifier des économies et des administrations que d’unifier des mémoires»Bronislaw Geremek parlant des mémoires différentes de l’Europe de l’Ouest et de l’EstNous considérons souvent comme une erreur l’intégration rapide des pays de l’est européen communiste dans l’Union européenne après la fin de la dictature communiste.
Et il est vrai quand nous voyons aujourd’hui Jarosław Kaczyński en Pologne ou Viktor Orban en Hongrie, nous pensons que tout cela n’est pas très raisonnable.
Mais lors des évènements qui ont libéré les pays de l’est européen du joug communiste, il n’y avait pas exactement le même type de personne qui dirigeait ou influençait ces pays. Il y avait la grande figure de Václav Havel en Tchécoslovaquie et en Pologne il y avait bien sûr Lech Walesa et surtout deux hommes qui le conseillaient : Tadeusz Mazowiecki et Bronislaw Geremek.
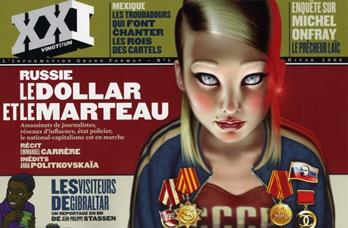 L’entretien dont je vais parler aujourd’hui concerne ce dernier homme politique : Bronislaw Geremek
L’entretien dont je vais parler aujourd’hui concerne ce dernier homme politique : Bronislaw Geremek
Il a été publié dans le premier numéro de la revue XXI qui est paru le 17 janvier 2008.
Le 13 juillet 2008, Bronislaw Geremek
conduit une voiture qui percute un véhicule de livraison. L’accident le tue sur le coup.
Le titre de cet article qui a été repris dans le livre « Comprendre le monde » qui constitue la source de cette série de mots du jour était : « L’Europe pour nous à l’Est, c’était un idéal »
La journaliste qui a mené l’entretien s’appelle Weronika Zarachowicz et elle a introduit son article par la phrase suivante :
« Il a consacré sa vie à chercher des raisons de vivre ensemble ».
Bronisław Geremek fait partie de cette catégorie d’intellectuels qu’on a appelé « les dissidents », ce qui qui signifie qu’ils n’étaient pas d’accord avec la politique de leur gouvernements. Mais comme il ne s’agissait pas de démocratie, bien qu’ils portaient par ruse le nom de « démocratie populaire », il ne pouvait exister d’opposition, donc d’opposants, c’est pourquoi ils étaient dissidents.
Il était né Benjamin Lewertow le 6 mars 1932 à Varsovie dans une famille juive. Il a pu fuir du ghetto de Varsovie en 1943 et ainsi sauver sa vie.
Il est devenu par ses études historien, il a d’ailleurs étudié en 1956 et 1957, à l’École pratique des hautes études. Il a été ainsi très fortement influencé par l’école française des Annales et la lecture des historiens français Lucien Febvre, Marc Bloch et Fernand Braudel. Dans son domaine universitaire il travaillera sur l’histoire des pauvres au moyen âge.
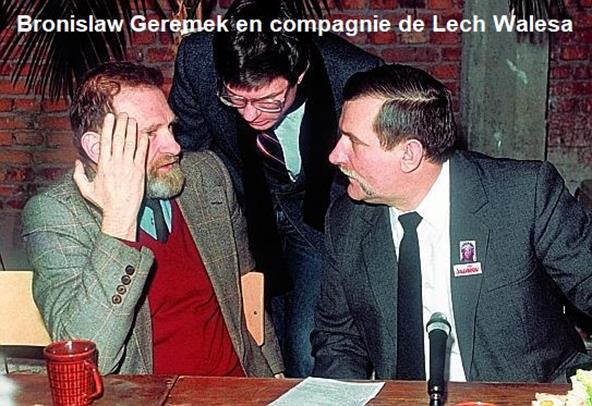 Au niveau politique, il assiste aux grandes grèves de Gdańsk en 1980 et rejoint le mouvement syndical Solidarność. Il fait partie des négociateurs « intellectuels » avec Tadeusz Mazowiecki que Wałęsa voulait à ses côtés pour négocier avec les autorités, ce qui aboutit à l’accord de Gdańsk le 31 août 1980. Il y incarne le collectivisme autogestionnaire antistalinien. Il devient conseiller personnel de Lech Wałęsa. À la suite du coup d’État du général Jaruzelski en 1981, il est interné durant deux ans et demi. Après sa libération, il est l’un des animateurs d’un comité pour la sortie pacifique du communisme et sera l’un des négociateurs du compromis du printemps 1989 et continuera à participer à la politique polonaise…
Au niveau politique, il assiste aux grandes grèves de Gdańsk en 1980 et rejoint le mouvement syndical Solidarność. Il fait partie des négociateurs « intellectuels » avec Tadeusz Mazowiecki que Wałęsa voulait à ses côtés pour négocier avec les autorités, ce qui aboutit à l’accord de Gdańsk le 31 août 1980. Il y incarne le collectivisme autogestionnaire antistalinien. Il devient conseiller personnel de Lech Wałęsa. À la suite du coup d’État du général Jaruzelski en 1981, il est interné durant deux ans et demi. Après sa libération, il est l’un des animateurs d’un comité pour la sortie pacifique du communisme et sera l’un des négociateurs du compromis du printemps 1989 et continuera à participer à la politique polonaise…
A quelques mois de sa mort, l’entretien avec Weronika Zarachowicz lui permet d’analyser les évolutions de l’Europe avec son expérience d’historien, de politique et d’homme d’action.
La Pologne est entrée dans l’Union européenne en 2004, mais en 2008 les dirigeants polonais expriment déjà du scepticisme à l’égard de l’Union, mais Bronislaw Geremek dissocie les dirigeants sceptiques et la population qui voue un véritable attachement à l’Europe. Mais les polonais n’attendaient pas que de l’Europe un marché commun, selon Geremek mais aussi une sécurité et une protection notamment contre la Russie toujours menaçante.
Pour l’historien, L’Europe n’était pas à l’origine un projet uniquement économique contrairement à ce que beaucoup prétendent aujourd’hui :
« Je ne cesse de rappeler qu’au début de l’histoire européenne, il y eut des rêves. L’Europe n’est pas une création de chefs comptables : elle est fille de l’imagination européenne, y compris celle de poètes et de philosophes. L’idée européenne est ancienne. Elle accompagne notre Histoire depuis le Moyen-âge. La communauté chrétienne médiévale était, déjà, une première unification de l’Europe. L’idée de coopération entre rois et princes s’est développée dans la foulée et a gagné l’Europe entière. Un légiste français du XIVème siècle a même été le premier à lancer cette idée d’unification européenne. »
Geremek ne précise pas qui est ce légiste français. Mais je pense qu’il s’agit de Pierre Dubois (1255-1321) qui était un légiste de Philippe Le Bel. Pierre Dubois a bien conceptualisé une union chrétienne des pays européens mais sous la direction du Roi de France. Il s’agissait de s’unir surtout en raison des croisades contre la puissance islamique. Et il avait imaginé par exemple, une cour internationale de justice pour régler les différends entre les nations et un interdit économique devrait être déclaré contre toute puissance chrétienne qui ferait la guerre à une autre puissance chrétienne.
Geremek continue :
 « Tout au long de l’histoire moderne, ce projet sera formulé et reformulé que ce soit par le Duc de Sully, l’intendant d’Henri IV […] Saint-Simon […] ou encore par Victor Hugo avec ses Etats-Unis d’Europe… »
« Tout au long de l’histoire moderne, ce projet sera formulé et reformulé que ce soit par le Duc de Sully, l’intendant d’Henri IV […] Saint-Simon […] ou encore par Victor Hugo avec ses Etats-Unis d’Europe… »
Et il explique que dans l’est de l’Europe des philosophes comme Jan Patocka et Edmund Husserl ont également imaginé une telle Union. Mais c’est sur la différence entre la vision de l’Ouest et de l’Est que la réflexion de Geremek est la plus intéressante :
« Il est plus facile d’unifier des économies et des administrations que d’unifier des mémoires…Nous avons hérité d’un fonds commun, mais aussi de blessures dramatiques.
Prenez le XIXème siècle ! Pour les Européens de l’Ouest, c’est le triomphe de l’Etat-nation, le siècle des merveilles technologiques et scientifiques. La perception est radicalement différente pour les Européens de l’Est. En particulier pour la Pologne, un pays qui fut l’une des plus grandes nations de l’Europe moderne avant d’être divisé et occupé, pendant 123 ans, par trois puissances. Un pays, donc, qui n’a pas eu pendant plus de cent ans d’existence indépendante…
Voilà notre XIXème siècle.
On retrouve la même antinomie quand on évoque la Première Guerre mondiale. Interrogez des anglais ou des Français, ils mentionneront Verdun, parleront d’une hécatombe de millions de morts, d’une guerre nouvelle avec l’utilisation des gaz et de l’aviation, du déclenchement d’une crise morale majeure…
Chez nous, à l’Est, le panorama est différent : la Première Guerre mondiale marque le début de l’indépendance de la Pologne, l’émergence de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de plusieurs Etats balkaniques.
Je vais poursuivre. Avec encore un exemple, mais il y en a tant. Tenez ! Dans vos livres d’Histoire, vous évoquez longuement le 1er septembre 1939, date de l’invasion de la Pologne par l’armée allemande. Pourquoi retenir cette date ? Parce que la France et la Grande Bretagne sont alors entraînées dans la guerre contre Hitler.
A l’Est, nous avons retenu une autre date. Celle du 17 septembre, qui marque le jour où l’armée rouge a envahi les territoires polonais et finlandais avant d’occuper les Républiques baltes.
Votre mémoire ignore certains de nos constats, comme celui-ci : la disparition de la Pologne est due à l’action de deux grandes puissances, et non d’une seule. Cette réalité-là vous est simplement inconnue. »
Le point de vue est différent, les expériences des mêmes évènements dissemblables et donc les réactions sont différentes aujourd’hui :
« L’incompréhension se lit régulièrement dans bon nombre de débats au Parlement européen. Quand les euro-parlementaires polonais, tchèques ou bulgares affirment que l’Europe doit offrir des garanties de sécurité, ils se voient souvent accusés d’entretenir une obsession de persécution. Mais ce n’est pas une obsession ! Ce n’est pas une rhétorique ! C’est une réalité que l’Histoire nous a enseignée de la façon la plus douloureuse qui soit ! Nous, nous connaissons nos voisins russes. Ce n’est pas le cas de l’occident. Il s’agit d’une différence de mémoire. »
Cet entretien parle encore de beaucoup d’autres sujets notamment de ses travaux d’historiens sur les pauvres du moyen âge dont il tire des enseignements sur le prolétariat d’aujourd’hui.
Il dit notamment :
« Plus j’approfondis ma réflexion sur le monde occidental, plus je m’interroge que le coût humain du changement et du progrès. La question de la main d’œuvre est à mon sens la question-clé de la formation du capitalisme. Sans la prolétarisation, sans l’existence de cette main-d’œuvre abondante et à bas prix, jamais celui-ci n’aurait pu se construire. […]Il faut observer le développement de nouveaux colosses capitalistes comme la Chine ou l’Inde. Il repose sur le travail d’une masse énorme de pauvres, à commencer par les millions d’ouvrières textiles. »
Mais le cœur de cet entretien me semble être cette mémoire séparée entre l’Europe de l’Ouest et L’Europe de l’Est que Bronislaw Geremek esquisse avec pertinence.
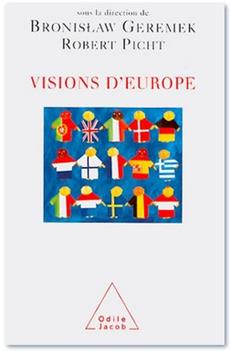 Bronislaw Geremek avait dirigé la collaboration d’historiens, de politiques, d’économistes pour un ouvrage : « Visions d’Europe » dans lequel, au-delà de l’Histoire, chacun cherchait surtout à parler de l’avenir pour essayer de trouver des pistes pour bâtir une Union qui corresponde aux besoins des européens de maintenant.
Bronislaw Geremek avait dirigé la collaboration d’historiens, de politiques, d’économistes pour un ouvrage : « Visions d’Europe » dans lequel, au-delà de l’Histoire, chacun cherchait surtout à parler de l’avenir pour essayer de trouver des pistes pour bâtir une Union qui corresponde aux besoins des européens de maintenant.
<1424>
-
Mercredi 13 mai 2020
«Rendre leur Histoire aux femmes»Michelle PerrotCet entretien date d’un des premiers numéros de la revue XXI, c’était le numéro 4 paru à l’automne 2008.
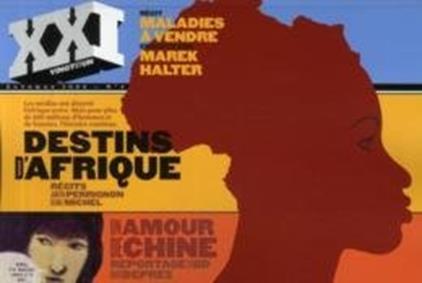 L’entretien, qui avait été mené par Catherine Meyer, concernait l’historienne Michelle Perrot et avait pour titre « Rendre leur Histoire aux femmes ».
L’entretien, qui avait été mené par Catherine Meyer, concernait l’historienne Michelle Perrot et avait pour titre « Rendre leur Histoire aux femmes ».
J’ai plusieurs fois cité Michelle Perrot et je lui ai consacré deux mots du jour.
Le premier concluait la série sur les violences faites aux femmes dans l’espace public : « La conquête de l’espace public par les femmes est très important. Le fait de pouvoir sortir seule, le soir, la nuit ce qui est encore considéré comme un danger pour les femmes, c’est quelque chose qui doit cesser, partout ! »
C’était le mot du <29 Janvier 2016>
La seconde fois était au cours de la série sur Mai 68 : <La femme de 1968 est à la fois contrainte et aspire à la liberté>
Michelle Perrot est née à Paris le 18 mai 1928. Elle a d’abord travaillé sur l’histoire du mouvement ouvrier, et sur le système carcéral français avant de devenir vraiment l’historienne de l’Histoire des femmes.
Pour introduire l’entretien, la journaliste, Catherine Meyer, retrace à grand trait cette Histoire :
« Depuis l’antiquité, les hommes écrivent leur Histoire afin que le temps n’efface pas leurs traces.
Les hommes… Les femmes, elle, n’ont pas d’Histoire. Mères silencieuses, ménagères de l’invisible, elles s’effacent devant les hommes sur le théâtre de la mémoire. Absentes des recensements, pendant des siècles elles n’existent tout simplement pas.
Jusqu’au tournant des années 1970, où les femmes s’emparent de leurs histoires pour construire une Histoire. Deux raisons à cel.
L’école de la « nouvelle histoire » voit le jour : sous l’impulsion de Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie ou Marc Ferro, elle s’intéresse aux individus, aux mentalités et s’insinue dans les replis du passé.
Quant à l’émancipation, elle progresse à grands pas : la réforme du régime matrimonial, en 1965, permet aux femmes d’ouvrir un compte en banque et de travailler sans l’autorisation de leur mari. Deux ans plus tard, la loi Neuwirth autorise la contraception. Puis apparaît le Mouvement de libération des femmes (MLF). En 1975, la loi Veil est votée. Se souvient-on que les avortements clandestins étaient alors la première cause de mortalité des femmes entre 18 et 50 ans ? »
Il est important de rappeler tous ces éléments pour savoir d’où nous venons. Et ces évolutions sont finalement récentes. Les femmes oubliées de l’Histoire pendant si longtemps, la moitié de l’humanité.
La grande œuvre de Michelle Perrot c’est la publication en 1990, avec Georges Duby de la monumentale « Histoire des femmes en occident »
 « Quand j’étais jeune je voulais faire partie du monde des hommes : j’avais passé toute mon enfance – du jardin d’enfants à la terminale – dans un pensionnat religieux. Le féminin était devenu pour moi synonyme d’enfermement, de soumission, de sacrifice. Je voulais sortir de ce sentiment diffus. Ma famille mes parents me proposaient un modèle complètement opposé. Mon père et ma mère étaient tous deux favorables au travail des femmes, à leur indépendance. C’étaient des parents modernes »
« Quand j’étais jeune je voulais faire partie du monde des hommes : j’avais passé toute mon enfance – du jardin d’enfants à la terminale – dans un pensionnat religieux. Le féminin était devenu pour moi synonyme d’enfermement, de soumission, de sacrifice. Je voulais sortir de ce sentiment diffus. Ma famille mes parents me proposaient un modèle complètement opposé. Mon père et ma mère étaient tous deux favorables au travail des femmes, à leur indépendance. C’étaient des parents modernes »
Son travail d’Historienne ne commence pas par les femmes mais par la classe ouvrière et ses luttes. Elle explique ce début par la culpabilité d’appartenir à une classe aisée :
De ma culture chrétienne, j’ai gardé un grand sentiment de culpabilité. L’impression obscure d’être privilégiée […] Comme le disait Mauriac à l’époque, « je suis née dans le camp des injustes ». Il ne faut oublier ce qu’était la France de l’après-guerre : pauvre, rongée par les problèmes sociaux. Le monde ouvrier était très actif, le chômage n’existait pas, c’était un monde rude. Dans mon éducation chrétienne, réussir sa vie, c’est s’occuper de l’Autre. […] Et la figure de l’Autre qui s’imposait, c’était l’ouvrier.
Elle ne va même pas être très intéressée, dans un premier temps mais elle y reviendra plus tard, au livre de Simone de Beauvoir « Le deuxième sexe ».
Ses préoccupations vont changer dans les années 1970, alors qu’elle est maître de conférence à Paris VII-Jussieu :
« C’était une université remuante et bourrée de féministes. Je participe à tout ce qui s’y passe. Et, tout d’un coup, je prends conscience que personne ne s’occupe de l’histoire des femmes : toutes les disciplines s’intéressent aux femmes, pas l’Histoire. On ne sait rien d’elles, elles sont invisible, mise à part les Jeanne d’Arc et autres héroïnes inscrites au Panthéon de la gloire. »
En 1973 elle propose à deux jeunes collègues, Pauline Schmitt et Fabienne Bock, de faire un cours sur les femmes intitulé « Les femmes ont-elles une Histoire ? ». Ce cours va avoir beaucoup de succès.
Le mouvement de l’Histoire est lancé. Michelle Perrot va diriger une centaine de mémoires.
Et quand un éditeur italien décide de lancer « L’histoire des femmes en occident » et le confie au grand historien de renommée mondiale Georges Duby, ce dernier propose à Michelle Perrot de codiriger cette
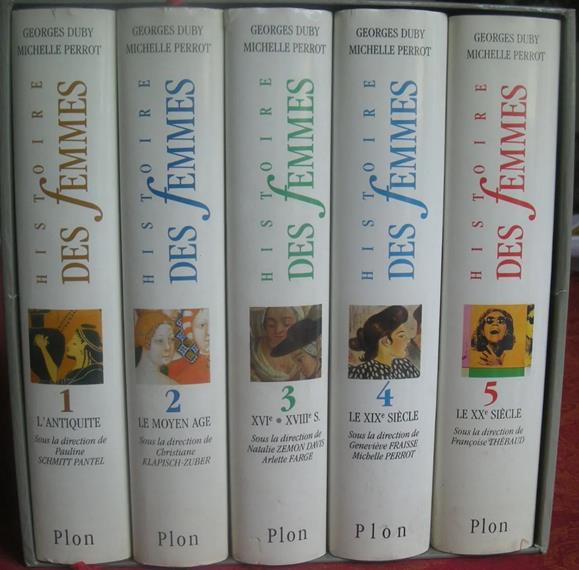 œuvre à laquelle vont participer 70 auteurs.
œuvre à laquelle vont participer 70 auteurs.
Elle raconte :
« Rien n’est linéaire [dans l’Histoire des femmes]. Les accélérations s’inscrivent dans les périodes troublées de l’Histoire. Chaque fois qu’il y a une brèche dans le pouvoir, les femmes surgissent. Au moment de la révolution française, par exemple, les acquis sont importants : reconnaissance des droits civils des femmes, droit de divorce, droit d’héritage. Puis c’est le retour en arrière du code civil napoléonien, une catastrophe pour les femmes : « La femme est donnée à l’homme pour qu’elle lui fasse des enfants. Elle est donc sa propriété comme l’arbre fruitier est celle du jardinier » dit Napoléon Bonaparte. Considérée comme incapable légalement – comme les criminels, les malades mentaux et les enfants – la femme n’a plus le droit de gérer ses biens, elle doit demander à son mari l’autorisation de travailler et ne peut percevoir de salaire. Le summum de la régression viendra avec la Restauration, qui supprime le droit au divorce. Au XIXème siècle, les femmes sont confinées au silence du privé, au travail domestique, à la couture et aux arts d’agrément. On les éduque plus qu’on ne les instruit. Celles qui s’intéressent à d’autres livres que les livres pieux sont suspectes. »
J’espère qu’après cette leçon de Michelle Perrot, plus aucune femme n’aura d’admiration pour Napoléon 1er. Mais il n’est pas le seul à avoir conservé le statut de mineure aux femmes tout au long du XIXème siècle.
Michelle Perrot insiste sur l’importance de connaître l’Histoire des femmes :
« L’Histoire des femmes n’est pas une simple curiosité. Elle est d’abord une arme critique. Si l’on connaît l’histoire de la notion d’égalité entre les sexes, on comprend mieux où en sont les rapports entre les hommes et les femmes, on est plus attentif aux droits d’aujourd’hui.
Connaître son histoire, c’est aussi mieux cerner son identité. Les femmes ont été façonnées par leur culture et leur passé. « On ne naît pas femme, on le devient » disait Simone de Beauvoir. […] Se réapproprier cette histoire, savoir pourquoi les filles n’accédaient pas à l’instruction, pourquoi elles étaient reléguées dans les foyers, permet de se comprendre et de comprendre les sociétés actuelles, extrêmement compliquées, où la hiérarchie des sexes persiste dans les représentations, les images, l’accès aux professions, les inégalités… »
Aujourd’hui la question des femmes n’est pas réglée, ce n’est jamais définitif dit la vielle dame qui a désormais 92 ans et a consacré toute la seconde moitié de sa vie à l’Histoire des femmes.
Elle prévient notamment :
« Il faut rester vigilant vis-à-vis des intégrismes : ils prennent appui sur des problèmes d’identité réels, mais peuvent représenter une menaces pour les femmes. Quelle que soit la religion. Voilà peu, [c’était en 2008] j’ai assisté à un colloque sur « les femmes, passerelles d’Europe ». Une représentante catholique de Slovaquie y défendait le modèle de la femme au foyer et s’insurgeait contre le droit à l’avortement. Même si l’Europe est une chance pour les femmes, des modèles traditionnalistes peuvent resurgir. »
Il reste d’ailleurs beaucoup de combats pour les femmes pour acquérir une place égale aux hommes dans la vie économique, dans la vie politique et aussi dans le partage équitable des tâches domestiques.
Concernant particulièrement le droit à l’avortement, <des tendances très rétrogrades> sont à l’œuvre en Europe.
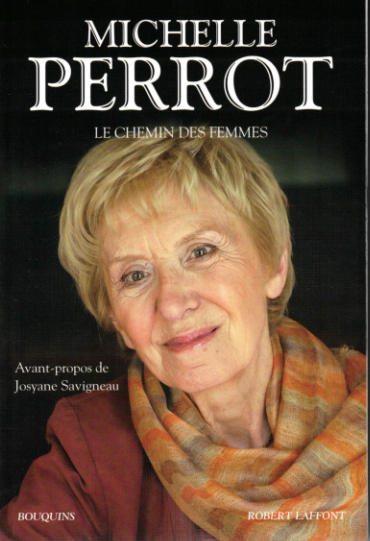 Je ne peux citer intégralement ce long article, ni d’ailleurs donner de lien vers Internet car je n’ai pas trouvé de publication de ce texte sur la toile.
Je ne peux citer intégralement ce long article, ni d’ailleurs donner de lien vers Internet car je n’ai pas trouvé de publication de ce texte sur la toile.
Mais je voudrais encore en extraire deux points :
D’abord ce rappel qu’il y a eu des résistantes dans le combat des femmes et singulièrement celles qu’on appelait les sorcières :
« Les femmes n’ont pas été passives, Simone de Beauvoir n’avait pas bien perçu cela. Pour elle, les femmes n’avaient pas d’histoire. Mais grâce aux recherches mises en route depuis plus de trente ans, cette histoire cachée émerge et nous découvrons qu’il y a une force historique des femmes, un désir des femmes. Et des résistantes : les béguines en Flandres et en Allemagne et, partout en Europe, les sorcières. Dans les campagnes, les sorcières jouaient un rôle important : grâce à leur connaissance des herbes, elles fabriquaient des onguents, des potions. C’étaient les médecins du quotidien.
Quand la médecine se développe, la science se méfie de ce savoir empirique, un peu nocturne, peut être diabolique. Le rôle de l’Eglise dans la persécution des sorcières est connu : elle les accuse d’avoir une sexualité débridée et perverse. Celui de la science savante et masculine l’est moins : elle voit d’un très mauvais œil la rivalité de cette médecine populaire et féminine. Et les accuse de provoquer la mort des nouveaux-nés, de fabriquer des onguents maléfiques. Environ cent mille d’entre elle sont brûlées. »
Ensuite son appréciation du féminisme est qu’il est en situation d’échec :
« Le féminisme n’a pas su se donner une bonne image. Aujourd’hui, il est perçu comme un peu ringard, outrancier. Cela tient, bien entendu, à ses ennemis qui ont fait passer les féministes pour des hystériques. Mais peut-être aussi à nous. Ce n’est pas toujours facile, nous n’avons pas toujours réussi à rendre notre combat attractif. Sans doute manquons-nous d’humour. »
Cette vision un peu pessimiste devrait pouvoir se tempérer maintenant, depuis l’émergence de figures venant d’autres continents, comme la lumineuse écrivaine nigériane, née en 1977, Chimamanda Ngozi Adichie qui proclame : « Nous devrions tous être féministes ».
Michelle Perrot a quant à elle mené une longue quête pour permettre de faire émerger l’Histoire des femmes et préparer le chemin à des Chimamanda.
Lors de l’entretien dont j’ai parlé aujourd’hui, Michelle Perrot avait 80 ans. Dans 5 jours, elle va fêter ses 92 ans et Philippe Meyer a enregistré un dialogue avec elle, le 29 avril 2020.
Ce long entretien a été publié en deux émissions :
<1423>
-
Mardi 12 mai 2020
«J’ai vu un chef d’État affirmer ses idées et agir en conséquence»Curtis Roosevelt à propos de l’action de son grand-père Franklin D. RooseveltJe reprends le livre « Comprendre le monde – Les grands entretiens de la Revue XXI »
La semaine dernière j’avais évoqué le destin et la vision du monde de cette étonnante chinoise née en Mandchourie et devenue éditrice de bande dessinées à Paris : Xu Ge Fei.
Puis j’avais évoqué la figure de l’Islam des lumières : Malek Chebel
Pour continuer je vais évoquer aujourd’hui l’inventeur du New Deal : Franklin Delano Roosevelt.. Bien sûr une revue créée en 2008 n’a pas pu s’entretenir avec un homme mort le 12 avril 1945.
 L’entretien mené par la journaliste Hélène Desplanques a été donc réalisé avec Curtis Roosevelt qui est son petit-fils. Curtis Roosevelt est né en 1930 à New York, un an après le krach financier d’octobre 1929 et en pleine Grande Dépression, Avec sa sœur et sa mère, il vécut douze ans à la Maison Blanche en compagnie d’un grand-père placé au premier rang des grandes crises du XXe siècle.
L’entretien mené par la journaliste Hélène Desplanques a été donc réalisé avec Curtis Roosevelt qui est son petit-fils. Curtis Roosevelt est né en 1930 à New York, un an après le krach financier d’octobre 1929 et en pleine Grande Dépression, Avec sa sœur et sa mère, il vécut douze ans à la Maison Blanche en compagnie d’un grand-père placé au premier rang des grandes crises du XXe siècle.
Sa mère, Anna Roosevelt était la fille de Franklin D. Roosevelt. Il a tenu divers postes de fonctionnaire international au Secrétariat des Nations unies à New York. Il prit sa retraite en 1983 et vécut ensuite dans le sud de la France, intervenant régulièrement dans les médias français en tant que commentateur politique.
Il participa, en mars 2012, à la constitution du Collectif Roosevelt qui plaidait pour une relance de l’économie française, par des réformes économiques et sociales et qui fut fondé par Stéphane Hessel, Susan George, Pierre Larrouturou, Edgar Morin et Cynthia Fleury. Michel Rocard y participa aussi.
Ce Collectif a été dissout le 17 novembre 2018. Il n’a, semble-t’il, pas survécu à l’élection d’Emmanuel Macron.
L’entretien date de 2013, depuis Curtis Roosevelt est décédé, le 26 septembre 2016 à Saint-Bonnet-du-Gard.
Il était bien sûr fort jeune quand suite à l’élection de son grand père et le divorce difficile entre sa mère et son père, il a rejoint, avec sa mère et sa sœur, Roosevelt à la Maison Blanche. Mais il a beaucoup étudié le parcours de son grand-père et peut donc en parler savamment.
Et il parle de la réaction de son grand-père après la grande crise de 1929 :
« Mon père a été ruiné et mon grand-père avait bien conscience des difficultés. Dès son discours d’investiture, il a été très clair. Il faut le relire. Il désigne sans fard les responsables de la crise de 1929 et dénonce les « pratiques des usuriers sans scrupules » qui, « devant le tribunal de l’opinion publique » sont « rejetées aussi bien par les cœurs que par les âmes des hommes ». Ses mots sont forts : les «usuriers sans scrupules », dit-il, « ne connaissent que les règles d’une génération d’égoïstes » : « ils n’ont aucune vision et, sans vision, le peuple meurt. »
Mais il ne s’arrête pas là, il donne le cap de sa politique : « Notre première tâche la plus importante, est de remettre les gens au travail.. Cela peut être accompli en traitant le problème comme nous traiterions l’urgence d’une guerre. » […]
Il disait ; « Ce que réclame cette nation, c’est de l’action tout de suite ! » C’est dans cette atmosphère que j’ai grandi. J’ai vu un chef d’État affirmer ses idées et agir en conséquence. »
Bien sûr, nous aurions tous envie d’avoir un tel chef d’État dans la période de crise qui se dresse avec de nouveaux « usuriers » et des «égoïstes » qui captent la richesse du monde. Nous ne sommes plus dans le même contexte, nous sommes dans un univers mondialisé et interdépendant. En plus nous ne sommes pas les États-Unis d’Amérique mais un petit pays à l’échelle de cet univers mondialisé. Mais je pense que même un président des Etats-Unis ne pourrait plus agir comme Roosevelt, parce que même les Etats-Unis dépendent des autres.
Mais on peut quand même apprendre et rappeler comment Roosevelt a agi. Curtis Roosevelt raconte la différence entre son grand-père et son prédécesseur Herbert Hoover.
« Herbert Hoover avait convoqué tous les directeurs des grandes banques. C’était la fin de son mandat, un des pires moments de la grande dépression, et Hoover voulait leur faire la leçon. Très bon économiste, il avait sorti ses graphiques devant les banquiers et leur avait démontré qu’ils avaient fabriqué une catastrophe. Il leur avait ensuite expliqué ce qu’ils devaient faire pour sortir le pays du marasme, « mais je ne vous impose rien, c’est à vous de prendre les mesures ». Tous les banquiers s’étaient alors levés et leur représentant avait pris la parole : « Merci, monsieur le Président, je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de bon sens. » Et ils étaient partis sans rien changer !
Quand il s’agit d’argent, le volontariat et la coopération ne marchent pas. Hoover avait compté sur le bonne volonté des banquiers, mais celle-ci n’existe pas dans les affaires »
Cet épisode raconté par Curtis Roosevelt me rappelle une anecdote que Bernard Maris a racontée plusieurs fois. Vincent Auriol ne fut pas que le dernier président de la 4ème république, il fut aussi le ministre de l’économie du gouvernement de Léon Blum. Et selon Maris, il aurait dit alors :
« Les banques je les ferme, les banquiers je les enferme ! »
Je ne sais pas si la solution est d’enfermer les banquiers, mais il ne faut certainement pas les laisser libre d’agir à leur guise sans régulation forte.
Curtis Roosevelt raconte aussi comment son grand père est arrivé à gagner la confiance des américains notamment par « les causeries au coin du feu » pendant lesquelles il s’efforçait de dire la réalité simplement et le plus justement possible.
 Et il donne la solution pour qu’un Président puisse disposer de la confiance de son peuple :
Et il donne la solution pour qu’un Président puisse disposer de la confiance de son peuple :
« La majorité des américains avaient le sentiment qu’il se préoccupait d’eux, qu’il était proche d’eux et qu’il travaillait dans leur intérêt »
Qu’il travaillait dans leur intérêt !
Et pour ce faire il s’est mis les riches à dos. Roosevelt parlait de haine à son encontre :
« Il n’exagère pas du tout. Les très riches n’aiment pas Roosevelt, et c’est encore vrai aujourd’hui aux Etats-Unis. Il reste celui qui a fortement soumis à l’impôt. Roosevelt voulait que les privilégiés paient leur part et, leur part étant forcément plus élevée que celle des gens ordinaires, l’impôt sur la plus haute tranche des revenus est monté jusqu’à 90%. Oui 90% ! Il a également institué l’impôt sur les successions.
Pendant ses mandats, les riches ont été imposés comme jamais. Roosevelt a aussi œuvré à une réglementation du monde des affaires, les banques et les institutions financières en particulier. Le dispositif qu’il a bâti a perduré jusqu’aux années 1980, jusqu’à ce que le président Ronald Reagan commence à supprimer les règles mises en place. Cette déréglementation a mené à la crise financière de 2008 »
Il me semble que Bill Clinton a joué également un grand rôle dans la déréglementation qui a contribué à la crise financière.
En tout cas Roosevelt, contrairement à beaucoup de gouvernants d’aujourd’hui a estimé qu’une politique qui devait aller dans l’intérêt du plus grand nombre devait contraindre les riches et qu’il ne pouvait donc pas être aimé d’eux.
Et pourtant, il n’était pas socialiste. C’était un libéral qui défendait les lois du marché mais en combattait les excès.
Le discours qui a le plus marqué son petit-fils, est celui du Madison Square Garden, dernier discours avant sa réélection en 1936. Dans ce discours il dit :
« Nous savons maintenant qu’il est tout aussi dangereux d’être gouverné par l’argent organisé que par le crime organisé. […] Jamais dans notre histoire, ces forces n’ont été aussi unies contre un candidat qu’elles ne le sont aujourd’hui. Elles sont unanimes dans leur haine contre moi, et leur haine me fait plaisir »
Curtis Roosevelt avait écrit un livre sur son enfance à la maison blanche : « Trop près du soleil »
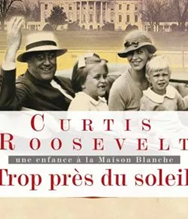
Dans cet interview du Figaro, Curtis Roosevelt explique ce titre :
« Ces années à la Maison-Blanche furent à la fois merveilleuses et désastreuses. Elles ont fichu en l’air mon identité pendant longtemps. «Trop près du soleil» signifie que je me suis brûlé les ailes, exposé comme je l’étais à ce pouvoir. Mais je n’étais pas le seul, tout le monde était «trop près». Ainsi, ma mère n’a longtemps existé que comme «la fille du président» ; quand les gens ne la reconnaissaient pas, elle avait l’impression de ne pas avoir d’identité! Moi-même, cette proximité m’a inhibé, empêché de mener une carrière digne de ce nom. Il a fallu attendre mes 60 ans, quand je me suis mis à écrire, pour que je me débarrasse enfin de cette espèce de complexe. »
<1422>
-
Lundi 11 mai 2020
«Ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir»Socrate rapporté par Platon dans l’Apologie de SocrateDECONFINEMENT !
Déconfinement est le maître mot de ce 11 mai 2020 en France.
La moitié de l’humanité a été confinée en ce premier quart du XXIème siècle pour freiner la propagation d’un virus.
Le confinement est une méthode archaïque, venu du fond des âges de l’humanité, pour lutter contre les épidémies.
Du fond des âges ?
Non plutôt depuis l’invention de l’agriculture et la création des villes dans lesquels homo sapiens a occupé plus densément l’espace. Cette problématique a été esquissée dans le mot du jour dont l’exergue est « Avons-nous eu tort d’inventer l’agriculture ? »
Que signifie concrètement ce confinement ?
C’est une extraordinaire, au sens premier de ce terme, limitation et même négation de nos libertés fondamentales. Je les cite, sans développer :
- Liberté de circuler
- Liberté de réunion
- Et même sous une certaine forme, la liberté de culte
- La justice elle-même est entravée dans son fonctionnement etc.
On entend même remettre en cause le secret médical en créant un fichier des malades du COVID-19. Lorsqu’on avait envisagé cela lors de l’épidémie du VIH, seule l’extrême-droite avait émis une telle proposition, tout le reste de l’échiquier politique s’était récusé. On voit bien aujourd’hui que nous sommes beaucoup plus perméables à ce type d’évolution.
Yuval Noah Harari nous avait prévenus : vous allez accepter des restrictions de plus en plus importantes à vos libertés pour préserver votre santé.
Jean-Pierre Bourlanges rappelle que Montesquieu a conceptualisé cette restriction temporaire des libertés :
« il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux »
Et Jean-Pierre Bourlanges continue en se centrant sur le cas de la France
« Ici tout repose sur le « pour un moment ». Quand s’arrêtera ce moment, et que restera-t-il une fois celui-ci passé ? Les restrictions à nos libertés sont tolérables si elles sont temporaires, le problème est que des habitudes se seront installées, des consentements seront donnés, des individus seront « attendris », bref la résistance sera moindre à l’emprise, bienveillante mais abusive, des pouvoirs publics.
Enfin, comme d’habitude en France, la façon de procéder de l’État est excessive. La façon dont le confinement a été mis en place le prouve, les exemples sont légion où l’on a confondu distanciation et surveillance de la distanciation. Certaines zones pourtant désertes étaient interdites. On a de même développé des phénomènes d’autorités qui allaient au contraire des exigences de responsabilisation. Quand vous dites à quelqu’un qu’il n’a pas le droit d’être dans la rue alors qu’il y est seul, vous incitez à un comportement irresponsable.
C’est une habitude ancrée profondément en France : on en fait toujours trop. »
Cela étant, si on en revient au déconfinement, l’atteinte à nos libertés fondamentales est toujours présente. La liberté de circuler a évolué d’1 km à 100 km, mais ce n’est pas une liberté : l’espace de restriction des libertés s’est élargi. La liberté de réunion est toujours remise en cause.
Alors est ce que ce confinement était nécessaire ?
Certains l’affirment : Les épidémiologistes de l’Ecole des hautes Etudes en Santé publique affirment que le confinement a permis de sauver 60 000 vies en France.
Sont-ils certains de leurs estimations ? Est-ce du savoir ? Ils basent leur raisonnement sur des modèles qu’ils appliquent sur un virus nouveau qu’ils ne connaissent pas.
D’autres affirment le contraire. Des chercheurs remettent en cause l’intérêt scientifique des mesures de confinement prises par le gouvernement. Il s’agit d’un article publié le 3 mai par Up’ Magazine : « Aurons-nous été confinés pour rien ? »
Mais ces chercheurs sont-ils davantage certains de leur thèse ? S’agit-il de savoir ? savent-ils ce qu’ils ne savent pas ?
J’avais rédigé mon plus long mot du jour jusqu’à présent pour analyser la controverse liée à l’utilisation du protocole du Professeur Raoult pour lequel ce dernier affirmait que c’était la meilleure solution à défaut d’une autre : «Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou.». Sans remettre en cause l’autorité, ni les grandes qualités du Professeur Raoult, je concluais que ce qu’il présentait comme scientifique n’était pas du savoir.
C’est finalement ce qui ressort le plus de cette période de pandémie et de confinement : l’étendue de ce que nous ne savons pas.
Or il existe tant d’hommes politiques et même de scientifiques qui ont du mal à dire cette chose simple : « Je ne sais pas ».
Certains y arrivent cependant mais ce ne sont pas les plus nombreux, ni les plus écoutés.
Tant l’homme moderne exprime le besoin de savoir, de sortir de l’incertitude.
Mais dans ce cadre du COVID-19, il y a énormément de choses que nous ne savons pas.
Nous savons que nous n’avons pas de vaccin et nous savons que nous ne disposons pas d’un médicament ou de plusieurs médicaments ayant fait la preuve d’un effet positif et indiscutable dans un nombre de cas significatifs
Certains diraient ce n’est pas du savoir, c’est du non savoir.
Pas du tout. Je dirais même que c’est l’essence du savoir, de savoir ce que nous ne savons pas.
Et pour ce faire je voudrais revenir à un texte exceptionnel, à l’origine de la philosophie occidentale. Ce texte est « L’apologie de Socrate » écrit par Platon. Mais Platon fait parler Socrate. Sommes-nous certain, savons-nous si ces paroles sont vraiment de Socrate ?
Bien sûr que non. Mais ce qui est écrit va chercher dans les profondeurs de l’intelligence humaine.
Socrate se trouve devant les juges de son procès, il entend démontrer son innocence. Or dans un moment de sa plaidoirie il parle de la sagesse et du savoir. Il est possible sans doute de le dire autrement, mais certainement pas mieux :
« Or, un jour [que Khairéphon] était allé à Delphes, il osa poser à l’oracle la question que voici – je vous en prie encore une fois, juges, n’allez pas vous récrier –, il demanda, dis-je, s’il y avait au monde un homme plus sage que moi. Or la pythie lui répondit qu’il n’y en avait aucun. […]
VI. – Considérez maintenant pourquoi je vous en parle. C’est que j’ai à vous expliquer l’origine de la calomnie dont je suis victime. Lorsque j’eus appris cette réponse de l’oracle, je me mis à réfléchir en moi-même : « Que veut dire le dieu et quel sens recèlent ses paroles ? Car moi, j’ai conscience de n’être sage ni peu ni prou.
Que veut-il donc dire, quand il affirme que je suis le plus sage ? Car il ne ment certainement pas ; cela ne lui est pas permis. »
Pendant longtemps je me demandai quelle était son idée ; enfin je me décidai, quoique à grand-peine, à m’en éclaircir de la façon suivante : je me rendis chez un de ceux qui passent pour être des sages, pensant que je ne pouvais, mieux que là, contrôler l’oracle et lui déclarer : « Cet homme-ci est plus sage que moi, et toi, tu m’as proclamé le plus sage. » J’examinai donc cet homme à fond ; je n’ai pas besoin de dire son nom, mais c’était un de nos hommes d’État, qui, à l’épreuve, me fit l’impression dont je vais vous parler. Il me parut en effet, en causant avec lui, que cet homme semblait sage à beaucoup d’autres et surtout à lui-même, mais qu’il ne l’était point.
J’essayai alors de lui montrer qu’il n’avait pas la sagesse qu’il croyait avoir. Par-là, je me fis des ennemis de lui et de plusieurs des assistants.
Tout en m’en allant, je me disais en moi-même : « Je suis plus sage que cet homme-là. Il se peut qu’aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon ; mais lui croit savoir quelque chose, alors qu’il ne sait rien, tandis que moi, si je ne sais pas, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc que je suis un peu plus sage que lui par le fait même que ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir. »
Notez cette phrase quand il parle de l’homme d’état : « Cet homme semblait sage à beaucoup d’autres et surtout à lui-même.», surtout à lui-même, peut être que certains de nos contemporains devraient méditer cette phrase.
Mais c’est la conclusion que j’ai choisi comme exergue de ce mot du jour et dont l’esprit est que la sagesse est lié au fait de savoir ce que je ne sais pas.
Nous savons scientifiquement indiscutablement plus qu’à l’époque de Socrate, mais l’étendue de notre non savoir est toujours considérable.
Rachid Benzine, dans une phrase que j’aime à répéter et à me répéter, a remarquablement modernisé le propos de Socrate : « Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes.»
Donc si nous savons que nous ne disposons ni d’un vaccin, ni d’un médicament efficace, il n’y avait que deux solutions pour les gouvernements :
- Prendre une stratégie d’immunisation de groupe qui permettait de rendre les populations résistantes au virus au bout de quelques mois et le virus inoffensif. Cette stratégie avait pour grand avantage de pouvoir continuer à faire fonctionner l’économie mais avait un grand désavantage d’augmenter le nombre de morts et surtout de saturer les unités de soins intensifs des hôpitaux.
- Prendre une stratégie de confinement qui permettait de freiner la propagation du virus, de maîtriser autant que possible la saturation des hôpitaux et de gagner du temps pour permettre à la recherche d’essayer d’avancer sur la confection d’un vaccin ou d’un médicament. Cette stratégie avait pour grand désavantage de ne pas régler le problème du virus car sans immunité de groupe, il va probablement continuer à se transmettre et puis il y a le désastre économique qui est devant nous et peut être les conséquences psychologiques du confinement.
Quelle était la meilleure stratégie ? Nous ne le savons pas. Le plus grand nombre d’États a choisi la seconde stratégie.
J’entends ceux qui disent, la seconde stratégie a privilégié la vie et la santé.
Je suis désolé, nous ne le savons pas. Nous pourrons approcher ce savoir après la crise économique qui s’ouvre devant nous.
Quelle sera l’ampleur de cette crise économique, nous ne le savons pas.
Cette crise va-t-elle permettre de faire mieux après ?
Nous ne le savons pas.
Certains sont très pessimistes comme Michel Houellebecq « Nous ne nous réveillerons pas, après le confinement, dans un nouveau monde ; ce sera le même, en un peu pire. », d’autres plus optimistes ou plus volontaristes comme Nicolas Hulot : « Le monde d’après sera radicalement différent de celui d’aujourd’hui, et il le sera de gré ou de force »
Mais cette incroyable expérience a quand même enrichi notre savoir :
Nous savons que nous avons construit un monde plein de fragilités, dans lequel un virus se transmet dans le monde entier en un temps record en raison des flux humains professionnels et touristiques.
Nous savons que nous sommes extraordinairement dépendants, dans le domaine de la santé, des chinois et des pays asiatiques aujourd’hui.
Nous avons compris que les soignants et les aides-soignants, les salariés des magasins d’alimentation, les éboueurs sont des métiers de l’essentiel, indispensables à notre survie et ces salariés sont situés en bas de l’échelle des salaires.
Nous avons compris que la stratégie des flux tendus, la volonté d’éviter au maximum des stocks immobilisés dans un hangar est inefficace quand on est en présence d’une pandémie comme celle que nous vivons.
Et nous avons chacun appris certainement tant d’autres choses utiles et qui doivent nous permettre de devenir plus sages.
Mais nous devons accepter de vivre dans un monde d’incertitudes et ne pas nous raccrocher à des femmes et surtout des hommes qui parlent haut et fort en prétendant savoir, alors qu’ils ne savent pas qu’ils ne savent pas ce qui est très dangereux.
Concernant les émissions récentes sur le confinement, j’ai trouvé très intéressantes celles de ce dimanche de :
- <L’esprit public officiel> : « Demain, quel retour au travail ? »
- Mais aussi l’émission, les papys font de la résistance : <Le nouvel esprit public> : « Liberté, que d’abus on commet en ton nom & Couple franco-allemand : chambre à part»
Demain je reprendrai à nouveau du recul par rapport à la pandémie et me replongerai dans le livre : « comprendre le monde ».
<1421>
- Liberté de circuler
-
Dimanche 10 mai 2020
«Sonate pour piano N°21 D. 960»Franz SchubertDernier mot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Je vais donc finir ce week end prolongé et cette série de mots du jour spéciaux du confinement par la dernière sonate pour piano en si bémol majeur de Schubert.
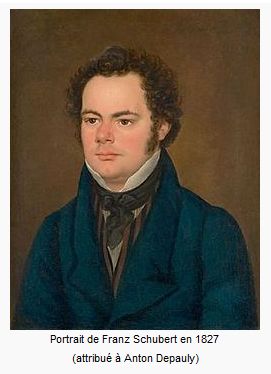 Mais je n’ai pas encore fini d’évoquer les chefs d’œuvre que Schubert a composé dans la dernière année de sa vie. Il faudra que je trouve d’autres créneaux que les samedis et dimanches de la période de confinement pour achever cette série consacrée à l’année la plus féconde de l’histoire de la musique selon Benjamin Britten
Mais je n’ai pas encore fini d’évoquer les chefs d’œuvre que Schubert a composé dans la dernière année de sa vie. Il faudra que je trouve d’autres créneaux que les samedis et dimanches de la période de confinement pour achever cette série consacrée à l’année la plus féconde de l’histoire de la musique selon Benjamin Britten
Le musicologue belge Jean-Marc Onkelinx juge que
« L’ultime Sonate pour piano de Franz Schubert figure parmi les monuments musicaux les plus bouleversants de l’Histoire de la Musique. »
Je crois qu’il a raison. Il n’y a rien de plus grand au piano. Il existe des œuvres comme la dernière sonate de Beethoven qui se trouve au même niveau, mais rien ne saurait dépasser cette œuvre grandiose, lyrique et au chant infini.
Le grand musicologue Marcel Schneider écrit :
« Car de même qu’il réussit enfin en cette même année 1828 à étendre le lied aux dimensions de la symphonie, avec sa grande Symphonie D 944, il parvient aussi à faire de sa dernière sonate une sorte de lied continu, illimité, si long, si varié, si touffu, à la fois si particulier et si général qu’il donne l’impression de l’infini »
Et pourtant Schubert est très malade en septembre 1828. C’est la raison pour laquelle il s’est retranché dans l’appartement de son frère Ferdinand.
On ne sait pas très bien de quoi il est mort, fièvre typhoïde a dit le médecin, sans aucune preuve tangible. Thèse reprise par les biographes classiques.
Les biographes relatent un autre épisode
Le vendredi 31 octobre 1828, Franz Schubert consomme du poisson dans une auberge de Vienne. Après quelques bouchées, il repousse l’assiette et dit qu’il y a du poison dans le plat. Il ne mangera plus rien de tangible jusqu’à l’instant de sa mort, 19 jours après. Certains tirent de cet épisode que Schubert serait mort empoisonné.
Jean-Louis Michaux, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, est un médecin, écrivain et mélomane. Il a écrit un livre sur ce sujet : « L’Énigme Schubert. Le mal qui ne voulait pas dire son nom». Il existe aussi un <podcast> sur Canal Académie dans lequel il développe certaines des thèses de son livre :
Schubert a contracté la syphilis entre 1822 et 1824. A l’époque, il n’existait pas de traitement sérieux et cette maladie évoluait vers la folie.
Les médecins ne savaient pas quoi faire et ils administraient sous diverses formes (orales, frictions) du mercure. Aujourd’hui nous savons que c’est un véritable poison. Jean-Louis Michaux écrit :
«Schubert s’est d’ailleurs retrouvé sans cheveux suite au traitement. Quand on sait les lésions que le mercure provoque au niveau du tube digestif, entraîne des modifications telles de l’organisme qu’il est très vraisemblable que le follicule pileux doit être altéré et faire tomber les cheveux. C’était donc des traitements très éprouvants qui maintenaient le malade dans une hospitalisation difficile, puis à domicile avec des régimes très contraignants de telle sorte qu’ils étaient absents de la vie sociale pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, ce qui a été le cas de Schubert. Il s’est alors rendu compte que c’était une maladie grave et que cela pouvait modifier sa vie. Il a eu des périodes de malaises. Aucun des médecins qui l’ont traité n’ont relaté l’évolution de sa maladie et donc il y a très peu de documents médicaux sur lui. Et contrairement à Beethoven, il n’y a pas eu d’autopsie après la mort de Franz Schubert. »
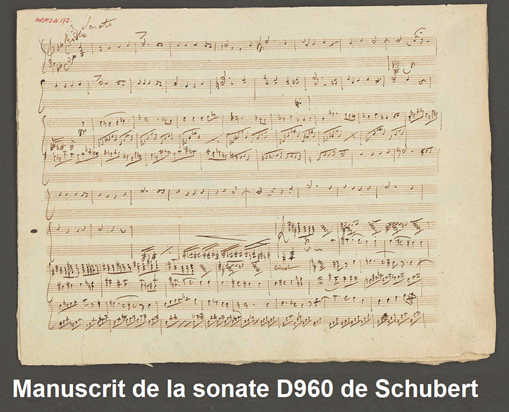 La thèse de Jean-Louis Michaux est que le mercure, outre les effets immédiats décrits ci-dessous, a continué une œuvre d’empoisonnement lente et fatale. Lors du repas décrit, ci-avant, le poison que Schubert a ressenti était latent dans son corps et révélait une lente progression morbide.
La thèse de Jean-Louis Michaux est que le mercure, outre les effets immédiats décrits ci-dessous, a continué une œuvre d’empoisonnement lente et fatale. Lors du repas décrit, ci-avant, le poison que Schubert a ressenti était latent dans son corps et révélait une lente progression morbide.
La musique de Schubert relate ces combats, ces moments de tristesse, mais elle est surtout lumière, pulsion de vie et élévation. Pourtant il a écrit dans une lettre que cite Michaux :
« Je m’éprouve comme le plus malheureux et le plus misérable des hommes de cette terre. Imagine un homme dont la santé ne pourra jamais être bonne et qui, par désespoir, fait les choses plutôt pires que meilleures. Imagine un homme dont les plus grandes espérances sont réduites à rien, auquel le bonheur de l’amour et de l’amitié n’offre plus rien que la plus grande douleur, dont l’enthousiasme pour le Beau menace de disparaître, et demande-toi si ce n’est pas là le plus misérable et le plus malheureux. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich find sie nimmer und nimmer mehr [Mon repos s’en est allé, mon cœur est lourd, je ne les retrouve plus et ne les retrouverai jamais], c’est ce que je peux bien chanter maintenant chaque jour, parce que chaque soir quand je m’endors, j’espère bien ne plus me réveiller, et chaque matin m’apporte seulement l’affliction de la veille. »
« Meine Ruhe ist hin » fait référence à un poème de Goethe que Schubert a mis en musique. Il est le premier des 72 poèmes de Goethe mis en musique par Schubert. Il s’agit de « Gretchen am Spinnrade » (Marguerite au rouet).
Mais revenons à la dernière sonate de piano de Schubert.
Michel Rusquet écrit sur le site Musicologie.org
« C’est la sonate ultime, et elle a acquis valeur de mythe car, en plus, c’est le « chant du cygne » de Schubert dans le domaine instrumental. On a beau s’en défendre, on y entend dès le début, le cœur serré, le détachement de l’homme vivant ses derniers instants. Derrière cette mélodie d’une profondeur d’intériorité poignante, qui semble surgir d’un rêve, on pense avec Paul Badura-Skoda à la première strophe du Lied « Am Meer » écrit la même année (« La mer resplendissait au loin sous les dernières lueurs du couchant »), et cette image de la fin du jour éveille un sentiment infini de beauté, de nostalgie, de souvenir, de regret, toutes émotions qui semblent justement se mêler dans l’immense premier mouvement molto moderato. Dans son cheminement prodigieusement riche en modulations magiques et en éclairages sans cesse renouvelés, ce mouvement va passer par des moments d’émotion intense, chargés d’angoisse et de désespoir, mais le climat général restera celui instauré par la mélodie initiale, un « univers de sage résignation et de sérénité seconde qui sera celui de toute l’œuvre […]
Avec la longue plainte du deuxième mouvement, d’une beauté bouleversante, nous sommes probablement en présence du joyau le plus absolu de l’œuvre pour piano de Schubert. Écrit dans la tonalité d’ut dièse mineur, cet andante sostenuto constitue le cœur de la sonate. Il marque l’apothéose du lyrisme instrumental de toute l’œuvre de Schubert dans une simplicité sublimée. Son expression s’intensifie jusqu’à l’entrée d’un thème central en la majeur, hymne de transfiguration bientôt entouré de figures scintillantes, avant une reprise encore plus douloureuse amenant une conclusion épurée, en ut dièse majeur, qui illumine l’ensemble d’une beauté toute particulière. »
Voici cette sonate interprétée par Alfred Brendel : <Sonata No 21 D 960 B flat major Alfred Brendel>
Je voudrais conseiller Wilhem Kempff qui était un poète et qui après Artur Schnabel a beaucoup œuvré pour défendre et faire connaître les sonates de Schubert.
Daniel Barenboim, interviewé par Anne Sinclair, raconte cette histoire incroyable : Serge Rachmaninov, immense pianiste, musicien érudit et instruit rencontre, dans la première moitié du XXème siècle, Artur Schnabel dans un studio EMI. Ils enregistrent tous les deux et s’enquièrent chacun de ce que l’autre enregistre. Et lorsque Schnabel répond : « Les sonates de Schubert »
Rachmaninov s’exclame « Ah bon Schubert a écrit des sonates ? »
C’était plus de 100 ans après la mort de Schubert ! Rachmaninov ne connaissait pas les sonates de Schubert, il en ignorait même l’existence.
Dans l’émission « les matins des musiciens » vers laquelle je renvoyais dans le mot du jour précédent, celui consacré à la D 959, Philippe Cassard racontait la même chose : Au conservatoire de Vienne, la ville de Schubert, on n’enseignait pas, on ne parlait pas des sonates de Schubert au début du 20ème siècle.
Et le musicologue André Tubeuf écrit le 11 février 2020 :
« Est-ce à croire ? Il y a cinquante ans, personne ou presque à Paris n’écoutait Schubert, ne le connaissait. »
Heureusement que les temps ont changé.
Je peux aussi conseiller ce disque de Maurizio Pollini consacré aux trois dernières sonates de Schubert. Et bien sûr les intégrales de Kempff, Brendel, Barenboïm et Radu Lupu..
<1420>
-
Samedi 9 mai 2020
«Sonate pour piano N°20 D. 959»Franz SchubertMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Je continue dans cette période confinement à explorer les compositions de Schubert dans cette extraordinaire année 1828, dernière année de sa vie.
 Je profite de ce week-end prolongé de 3 jours pour consacrer un mot du jour à chacune de ces trois dernières sonates de piano composées au mois de septembre 1828.
Je profite de ce week-end prolongé de 3 jours pour consacrer un mot du jour à chacune de ces trois dernières sonates de piano composées au mois de septembre 1828.
J’ai trouvé sur un blog cette description qui me paraît très juste :
« La sonate en la majeur D959 est la plus longue sonate de Schubert (la suivante n’est toutefois que de peu plus courte). Autant la précédente sonate était placée sous le signe de la nuit, autant celle-ci baigne dans le soleil. Attention toutefois : le Voyageur parcourt ici des paysages bienheureux dans l’éclatante lumière du printemps, mais les bosquets fleuris cachent parfois un charnier. »
Brigitte Massin dans son « Franz Schubert » publié par Fayard (p. 1281) évoque aussi la lumière :
« Avec son mode majeur et ses trois dièses, la sonate en la majeur peut apparaître comme le double inversé, la sœur lumineuse, de la précédente, en ut mineur et à trois bémols. »
Pour Harry Halbreich, « Guide de la musique de piano et de clavecin », Fayard (p. 67) c’est peut-être est-ce la plus belle de toutes, en partie par la perfection harmonieuse de ses proportions, et plus encore par sa noblesse d’expression, Schubert y donnant l’impression d’accéder :
« à cette sérénité seconde qui est également celle du Mozart de 1791, à cette zone de paix surhumaine que plus rien ne saurait ébranler désormais… »
Pour Philippe Cassard qui avait consacré, en 2013, deux émissions des matins de France Musique à cette sonate :
« En entendant ce dynamisme, on ne pourrait pas penser que la fin est si proche »
Pourtant Schubert est très malade ; il est allé se réfugier dans l’appartement de son frère Ferdinand. C’est dans cet appartement qu’il mourra le 19 novembre.
 Pour toutes celles et ceux qui veulent approfondir, il ne peut y avoir meilleur pédagogue que ce merveilleux musicien qu’est Philippe Cassard :
Pour toutes celles et ceux qui veulent approfondir, il ne peut y avoir meilleur pédagogue que ce merveilleux musicien qu’est Philippe Cassard :
<Schubert : Sonate D959 en la majeur (1) par P. Cassard>
<Schubert, Sonate D959 en la majeur (2) par P. Cassard>
C’est aussi un interprète exceptionnel de Schubert.
Sur Internet vous trouverez cette interprétation de Stephen Kovacevich qu’il a réalisé en <2017 à Pékin>
Wikipedia énumère les films qui ont utilisé, le second mouvement, l’Andantino :
« L’Andantino a servi de bande sonore au film de Robert Bresson, Au hasard Balthazar, au film de Samuel Benchetrit, J’ai toujours rêvé d’être un gangster, au film de Nuri Bilge Ceylan, Winter Sleep, ainsi qu’à la création de la version originale de Savannah Bay, de Marguerite Duras au Théâtre national de Chaillot, en 1995, dans une mise en scène de Jean-Claude Amyl, avec Gisèle Casadesus et Martine Pascal.
Il a aussi servi, du moins au niveau du thème mélodique, avec les mêmes harmonies et premiers développements, pour le film Valse avec Bachir, d’Ari Folman. L’andantino, pour partie, précède la charge d’Eylau dans le film de 1994 d’Yves Angelo, Le Colonel Chabert, Sagan (téléfilm et film de Diane Kurys). »
Un cinéphile et mélomane revient sur l’utilisation de l’andantino dans « Valse avec Bachir »
« Une des mélodies les plus belles, poignantes et mélancoliques que je connaisse. Brahms l’appelait « berceuse de la douleur », il avait raison. Ce seul thème sublime, c’est déjà une raison de placer au plus haut ce mouvement. Mais Schubert ne s’arrête pas là. Il le fait suivre d’une partie centrale stupéfiante, inattendue après cette première partie si émouvante et délicate, mais aussi étonnante pour l’époque (1828). L’andantino est de « forme-lied », c’est à dire que la 2° partie est « contrastante », alors que la 3° partie est un retour à la 1° partie (subtilement variée). Mais le contraste dans cette 2° partie est… fou. Des modulations particulièrement audacieuses et déstabilisantes, ajoutées à une violence, une liberté, une montée en tension et une frénésie qu’on ne pouvait imaginer succéder à une première partie aussi mélancolique et touchante. Bref, ce que fait ici le timide Schubert, quand on replace les choses dans leur contexte, c’est bien plus étonnant et violent que ce que feront les punks…
D’une certaine manière, c’est tout le romantisme qu’on retrouve dans ce mouvement. Si Beethoven est le « père », le précurseur, le guide pour les musiciens romantiques, il reste par certains aspects un classique comme Haydn et Mozart. Schubert, lui, est souvent considéré comme le premier vrai compositeur romantique. Dans cet andantino, on a les deux facettes du romantisme à leur plus haut :
1° et 3° parties : mélancolie, délicatesse, intériorité, solitude, rêve, tristesse, souffrance
2° partie : originalité, tension, folie, violence, étrangeté, provocation, fantastique, tourments, révolte
Cet andantino est d’autant plus surprenant dans cette sonate en la majeur que l’oeuvre est plutôt apaisée, lumineuse, sereine. Une œuvre écrite juste deux mois avant sa mort… après des compositions plus désespérées, sombres, témoignages de sa douleur, Schubert revient à un peu plus de « légèreté »… sauf dans ce 2° mouvement, poignant et déchirant, comme si la mort, la douleur et le tragique de sa condition surgissaient à nouveau au beau milieu d’une période de sage résignation.
La musique classique n’a pas forcément besoin de codes, de savoir, pour être comprise et aimée… surtout dans ce cas-là. Je ne vois pas comment – à moins d’être allergique à la mélancolie – on peut ne pas être sensible et touché par le thème génial de la 1° partie (et ne sautez pas la 3° partie, le thème y revient avec une magnifique variation). Si vous restez insensibles, c’est que vous n’êtes pas humain (je ne vois pas d’autre explication) »
Vous pouvez écouter ce seul andantino par Elisabeth Leonskaja : <D. 959 Second Movement (Andantino) – Elisabeth Leonskaja>
J’ai trouvé aussi ce texte très inspirant que Denis Pascal, interprète de cette sonate, a écrit pour accompagner son enregistrement
« Un mystère persiste : celui de la joie qui rayonne de cette musique, de la lumière que diffuse l’œuvre de Schubert toujours plus forte, ainsi que l’accomplissement personnel que l’on éprouve à la jouer, une joie que le compositeur d’œuvres aussi bouleversantes et mélancoliques que le Voyage d’Hiver ou de La Belle Meunière ne cesse de nous offrir.
Elle est bien l’objet de l’écriture et de l’interprétation schubertienne : la création transcendant le doute, la souffrance amoureuse et l’absurdité de la disparition ou de l’abandon.
La musique chantée, celle des lieder, montre clairement à l’interprète l’identification nécessaire à un personnage : la relation explicite de la musique à la poésie ou au drame, le choix d’un motif donnant une nouvelle perspective au texte suscitent encore de nouvelles interrogations, soit des voies possibles d’interprétation. L’œuvre sans parole, purement instrumentale, nous invite à un plus complexe et mystérieux voyage qui, lui, nous pousse à ouvrir notre imaginaire et à continuellement multiplier et superposer des référents à la fois personnels, intimes et liés à la vie de Schubert, ou tout simplement les référents des idiomes instrumentaux, notamment dans les impromptus op. 90.
S’il en est un qui reste, terrible et simple, aimable et cruel, tout au long de ces pièces et de la sonate D. 959, c’est le motif du triolet. Son mouvement lent ou rapide n’est plus celui de la Tarentelle ou celui d’une antique danse, ni même celui des tempêtes beethovéniennes, mais bien celui paisible du ruisseau, du temps, doux et implacable : flux infini emportant à la fois nos joies et nos
 tristesses et finalement balayant toutes nos questions et nos doutes. Tout passe. »
tristesses et finalement balayant toutes nos questions et nos doutes. Tout passe. »
Concertant les CD Audio.
J’ai découvert cette œuvre avec Michel Dalberto, j’y reste très attaché
Pendant les recherches que j’ai effectuées pour la rédaction des mots du jour consacrés à Franz Schubert, j’ai découvert un site étonnant : <Schubert online > qui permet la consultation en ligne des manuscrits des œuvres de Schubert.
On y trouve aussi des lettres de Schubert.
Le site est en allemand ou en anglais.
Pour les non spécialistes, historiens ou musicologues, il ne s’agit pas de consulter avec précision et approfondissement tous ces matériaux historiques, mais je crois que c’est très émouvant de voir ces pages de la main de Franz Schubert surtout quand sa musique touche notre âme au plus profond.
Ce site me permet donc, comme je l’ai fait hier d’agrémenter mon mot du jour par une page manuscrite de l’œuvre dont je parle.
-
Vendredi 8 mai 2020
«Sonate pour piano N°19 D. 958»Franz SchubertMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Nous sommes en septembre 1828. Il reste moins de 2 mois de vie à Schubert.
Et il va écrire en quelques jours trois immenses sonates pour piano qui reste parmi les plus grandes du répertoire des pianistes à l’égal des dernières sonates de piano de Beethoven.
« J’ai composé entre autres trois sonates pour pianoforte sel, que je voudrais dédier à Hummel […] J’ai joué ces sonates en différentes endroits avec beaucoup de succès »
Schubert à son éditeur Probst, le 2 octobre 1828 – Cité par Brigitte Massin page 1275
Notez : « entre autres » il écrivait en même temps d’autres œuvres
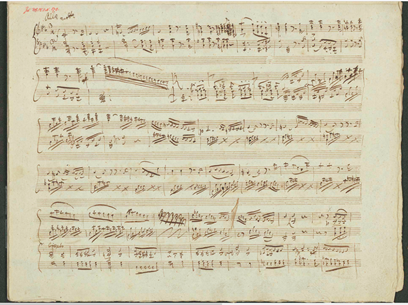 Hummel était compositeur, il était surtout un grand ami de Beethoven.
Hummel était compositeur, il était surtout un grand ami de Beethoven.
On ne dédiait les œuvres qu’à des personnes vivantes.
Il est probable donc que par ce geste Schubert voulait en réalité rendre hommage à Beethoven.
Quand ces sonates seront publiées, Hummel était déjà mort, la dédicace ne pourra donc lui être faite.
Les musicologues ne sont pas tous d’accord sur le nombre de sonates de piano de Schubert en raison du fait que certaines sont inachevées et sont comptés par les uns et non par les autres.
Récemment Daniel Barenboïm a réalisé une remarquable intégrale des sonates de piano, mais il n’a enregistré que les sonates complètes.
Cependant un consensus s’est dégagé et on retient le nombre de 21 sonates et 18 sonates avaient été composées avant ce mois de septembre 1828.
Concernant les trois dernières,
« Schubert a noté lui-même sur les manuscrits, les indications de « Sonate I, II et III » dans l’ordre où elles se présentent aujourd’hui.
Le manuscrit de la dernière sonate porte à la fin l’indication « Vienne, le 26 septembre 1828 » ; cette date doit donc être considérées comme celle de l’achèvement de la trilogie.
Dans l’esprit de Schubert, les trois œuvres forment un tout et c’est bien ensemble qu’elles seront publiées, dix ans après la mort de leur auteur en 1838, par les soins de Diabelli »
Brigitte Massin, ibid.
Aujourd’hui, je vais m’intéresser au premier de ces chefs d’œuvre.
Beaucoup en soulignent la dimension Beethovenienne de cette sonate, notamment par son entrée en matière avec des accords tonitruants. Mais très rapidement on en revient à la poésie qui n’appartient qu’à Schubert.
Voici ce qu’il dit lorsqu’il se confie à son mentor Antonio Salieri :
« Croyez-vous réellement que quelque chose puisse sortir de moi ? (…) Dans le calme, en secret, j’espère bien pouvoir encore faire quelque chose moi-même, mais que peut-on encore faire après Beethoven ? »
Je vous propose d’écouter cette œuvre dans l’interprétation de Sviatoslav Richter : <Studio recording, Salzburg, 12 & 13.VIII.1972>
Cet enregistrement n’est qu’audio, si vous préférez y adjoindre de la vidéo, je vous renvoie vers cette interprétation de <András Schiff>
Pour entrer dans cette œuvre, il faut peut-être commencer par l’adagio, deuxième mouvement de cette œuvre. Vous trouverez sur le site de France musique <L’adagio par Philippe Cassard>
Sur le site Musicologie.org Michel Rusquet écrit :
« Autre chef-d’œuvre incontesté, cette sonate ouvre la fameuse trilogie que Schubert, dans une formidable explosion d’énergie créatrice, composa en septembre 1828, deux mois avant de disparaître. De ces trois immenses sonates qui, à bien des égards, ont valeur de testament artistique, celle-ci, « ainsi que l’annonce sa tonalité, est la plus agitée, la plus sombrement passionnée et la plus violente, la plus beethovénienne aussi, encore qu’elle ne contienne pas une mesure qu’un autre que Schubert eût pu écrire. » D’entrée, on croit entendre Beethoven derrière les élans farouches et la puissance titanesque du thème initial du premier allegro, mais bientôt va apparaître un second thème doucement rêveur, typiquement schubertien, et surtout, avant de déboucher sur une conclusion presque désespérée, le mouvement va connaître un développement bien éloigné des schémas classiques, une sorte de musique informelle, aux antipodes de Beethoven, où Schubert associe ballade funèbre et marche héroïque, chromatismes mystérieux et motifs obsessionnels.
L’adagio, un des rares adagios véritables du musicien, adopte une forme de rondo avec, entrecoupés d’épisodes sombres et véhéments, des refrains dont l’ample mélodie, d’un détachement presque mystique, fait l’effet d’un chant de pèlerinage, non sans évoquer par instants les sombres paysages du Voyage d’hiver. L’étrange menuetto qui suit, un scherzo en réalité, n’apporte guère de détente qu’à travers son lumineux trio car, avec ses lourds accents, ses brusques cassures de rythmes et ses contrastes dynamiques abrupts, on y sent avant tout une forte passion dramatique. Et cette œuvre décidément sombre et passionnée s’achève sur une chevauchée infernale, une cavalcade effrénée, d’une allégresse sardonique et macabre, effrayante aussi bien par ses dimensions que par son déchaînement presque ininterrompu. Rares en effet sont les moments de répit dans cette course frénétique où l’instabilité tonale est permanente. On aura bien, peu avant la fin, une brève échappée vers on ne sait quel Paradis perdu, mais ce sera pour mieux replonger dans le tourbillon lugubre de ce finale dantesque. »
Pour choisir un enregistrement CD de cette œuvre, je propose parmi d’autres très belles interprétations celle de Radu Lupu.
Mais Alfred Brendel, Daniel Barenboim, Wilhem Kempff sont tout aussi remarquables.
<1418>
-
Jeudi 7 mai 2020
«Rendre lisible un texte du VIIe siècle à un lecteur du XXIe siècle en usant d’une langue simple.»Quête poursuivie par Malek Chebel dans sa traduction du CoranDans l’entretien évoqué hier, Malek Chebel revient assez longuement sur sa traduction du Coran et répond aussi aux questions que lui pose Léna Mauger sur son interprétation du livre sacré de l’Islam.
J’ai trouvé plus opérant de faire, de cette partie, un mot du jour spécifique.
Je l’ai déjà écrit, je dispose de sa traduction du Coran sur ma tablette. Mon objectif n’est pas de lire ou de m’approprier le Coran. Mais à plusieurs reprises j’ai éprouvé le besoin d’aller vérifier ce qu’il y avait vraiment d’écrit dans ce livre sur un sujet particulier ou plus encore vérifier quand on se référait précisément à une sourate du Coran.
Il me fallait donc disposer d’une traduction en laquelle je pouvais avoir confiance. Confiance que j’accorde à Malek Chebel.
J’ai d’ailleurs cité lors d’un mot du jour sa traduction du verset 32 de la Sourate V : « Celui qui sauve un seul homme est considéré comme ayant sauvé tous les hommes »
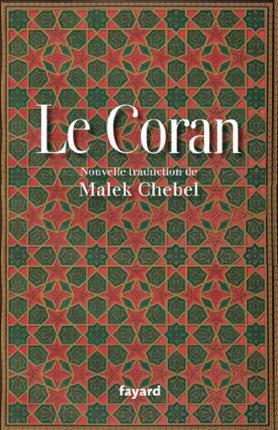 Malek Chebel explique d’abord pourquoi il a entrepris une traduction en français du Coran
Malek Chebel explique d’abord pourquoi il a entrepris une traduction en français du Coran
« Après le 11-Septembre, j’ai été sidéré par la méconnaissance de ce texte d’une beauté extraordinaire, truffé d’images élégantes et de métaphores. Les imams, « ceux qui dirigent la prière », bloquent l’accès au Coran. Ils sont pour la plupart de simples répétiteurs d’un texte qu’ils ne comprennent pas. Les actuelles traductions du Coran sont absconses ou vieillies. Celles qui passent pour être acceptables utilisent une langue obsolète : trop savante, trop maniérée ou trop décalée. J’ai donc voulu traduire ce texte, pas pour le « détraduire », mais pour le rendre dans une langue rigoureuse, sobre, belle, actuelle et sans concession. […]
Il m’a fallu démarrer ce travail avec une peau lisse. Il m’a pris dix ans, et j’en suis sorti plein de rides. Je m’étais fixé deux objectifs : rendre lisible un texte du VIIe siècle à un lecteur du XXIe siècle en usant d’une langue simple avec de nombreuses notes de bas de page, et le vendre à moins de 25 euros.»
Il nous apprend que même certains professeurs de l’école coranique avouent ne pas comprendre ou même tenter de comprendre leur texte sacré :
« Jeune, j’avais appris ce texte par cœur, en l’ânonnant comme tous les enfants de mon âge tenus par la peur des châtiments corporels en terre musulmane. Je suis tombé un jour sur mon professeur de l’école coranique, je l’ai interrogé sur un problème d’exégèse, il m’a pris par le coude : « Je peux t’avouer quelque chose ? Moi j’ai appris le Coran phonétiquement, sans rien y comprendre. »
Le Coran est un texte prescriptif :
« Il dicte précisément un ensemble de devoirs et d’interdits. Le Coran dit que le ramadan dure un mois, que les prières doivent être pratiquées cinq fois par jour, que l’aumône doit être prélevée et donnée aux pauvres, que les mécréants doivent être châtiés… La codification de l’inceste est très rigoureuse. »
Mais selon Malek Chebel on attribue des fausses prescriptions au Coran
« L’exigence de la circoncision ne figure pas dans le texte, c’est une tradition. L’excision est aussi absente. Et on ne trouve nulle recommandation sur la taille et la forme de la barbe, qui relève simplement d’une volonté d’imiter le Prophète. Mais il faut faire attention : d’une interprétation à l’autre, les écarts sont nombreux. […]
Le Coran ne dit rien sur la virginité. C’est la tradition bédouine patriarcale qui l’a imposée : elle faisait office de livret de famille, de filet de sécurité pour s’assurer de la paternité d’une grossesse et assurer les héritages. Les imams et les théologiens se sont appuyés au IXe siècle sur ce doute pour le cristalliser. Depuis personne n’a remis en cause leur parole, même si les mœurs ont évolué. […]
Les musulmanes étaient indépendantes à l’origine. On l’oublie souvent, mais Khadidja, la première épouse du Prophète et première musulmane, était plus âgée que lui, veuve et femme d’affaires. C’est elle qui l’a engagé comme caravanier. Sur les dix épouses du Prophète, six n’étaient pas vierges.
[Les femmes musulmanes n’ont pas d’obligation de se voiler] Seuls deux versets et demi du Coran évoquent le voile en utilisant le mot « djilbab », qui peut aussi bien se traduire par « fichu », l’accessoire traditionnel des vieilles dames en Orient. Les représentations les plus proches de l’époque coranique montrent des femmes tantôt découvertes, tantôt voilées, mais jamais intégralement.
Le voile intégral du type tchador ou burqa est apparu au XIXe siècle avec l’essor en Arabie Saoudite du wahhabisme, une vision puritaine et rigoriste de l’islam. L’obligation s’est rigidifiée avec le temps. En 1923, l’Égyptienne Huda Sharawi, leader du féminisme arabe, pouvait retirer son voile au Caire, suivie par des centaines de femmes, sans encourir de sanctions. »
Des prédicateurs affirment aujourd’hui qu’une femme non voilée n’est pas un être humain, mais une exhibitionniste, voire une hystérique. Soyons sérieux ! S’il faut voiler la femme pour en faire une musulmane, que faire des millions de femmes dévoilées pendant quatorze siècles ? Étaient-elles de mauvaises musulmanes ? Et les -Asiatiques non voilées, et les Africaines non -voilées, sont-elles encore musulmanes ?
Je défends un islam du cœur, pas un islam du fichu.
Il avait pris position contre le port du voile mais il s’est heurté aux conservateurs et aux archaïsmes instillés par les traditions des pays musulmans influents
« Oui, j’y suis allé la fleur au fusil. Je voulais montrer que l’islam était affaire de choix, que le voile est étranger à la religion.
Mais les conservateurs ont réussi leur travail de sape. Les idées des prédicateurs envoyés dans les banlieues françaises à partir des années 1970 ont infusé dans les mosquées, les salons, les mariages. Il n’y a plus de -mobilisation. Des mères nées dans les pays arabes et jamais voilées de leur vie imitent la quête identitaire de leurs filles. L’interdiction à l’école du port du foulard, selon un principe de laïcité, est défiée. Et ce, au moment même où des femmes des pays arabes revendiquent leur liberté. Au Qatar, plusieurs familles ont demandé à leurs filles de ne plus porter le voile à l’école. »
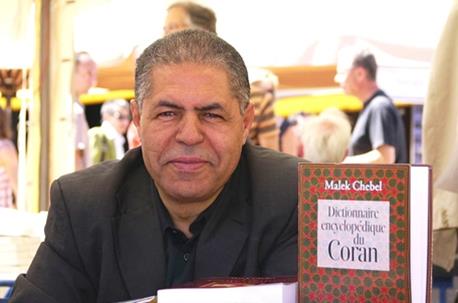 Il explique aussi la différence entre la charia et le Coran :
Il explique aussi la différence entre la charia et le Coran :
« Le Coran est un livre sacré ; comme tel, il donne des prescriptions relativement précises sur le dogme. La charia, en revanche, est une déclinaison, une transposition juridique du texte sacré. Elle rassemble un ensemble de normes définies par des hommes : la famille, la sexualité, l’héritage, l’éducation des enfants, l’obéissance aux préceptes dictés par les imams… De fait, elle est plus rigoriste. Œuvre des théologiens du VIIIe et du IXe siècle, elle traduit fatalement leur imaginaire et le degré d’acceptation de l’époque.
Les califes ont gouverné pendant des siècles avec la charia. Seuls les régimes musulmans les plus conservateurs l’appliquent aujourd’hui en totalité ou partie. On n’accepte plus aussi facilement que l’on coupe la main au voleur, que l’on lapide, que l’on excommunie pour une opinion…
Les fondamentalistes ne font aucune différence entre la charia et le Coran. Ces groupuscules populistes religieux envoient des gamins à la boucherie en présentant le djihad comme un impératif de la foi musulmane, alors que le Coran interdit strictement la guerre entre musulmans !
Le djihad ne peut être qu’une guerre d’autodéfense visant à protéger ses femmes, sa terre et ses enfants.
On peut aussi interpréter le djihad dont parle le Prophète comme une guerre spirituelle contre soi-même et ses mauvais penchants, un peu dans l’esprit du bouddhisme. »
Malek Chebel a introduit sa traduction du Coran par un texte daté du 23 février 2009, cité également dans le livre d’entretien de la revue XXI.
J’en cite le début et la conclusion pleine d’humilité et de retenue :
« Tous ceux qui maîtrisent la langue arabe savent qu’il est extrêmement difficile de comprendre le Coran et que sa traduction passe pour être une vraie gageure. D’ailleurs, on ne traduit pas le Coran comme une œuvre profane, on en interprète seulement les idées, on cherche à les comprendre et, si besoin est, à les restituer aux lecteurs d’une autre langue. […]
L’Islam cherche sa place dans le cadre d’une mondialisation des échanges humains et d’une circulation rapide des idées.
Faut-il le préserver de cette dynamique ?
Qui peut d’ailleurs croire qu’il en serait prémuni pour autant ?
Aussi, pour ne pas pratiquer une politique d’omission volontaire et d’autisme, j’ai cherché les voies possibles d’une cohérence de la compréhension du monde d’aujourd’hui avec les préceptes coraniques, sans dénaturer l’esprit de la Révélation ni méconnaître les réalités complexes qui influencent la présence au monde des musulmans.
Et c’est avec la plus grande bonne foi que j’ai agi, un peu dans l’esprit de ce que Goethe disait lorsqu’il écrivit ces mots – peut-être pensait-il au Coran :
«Ce livre sacré qui, chaque fois que nous le prenons, nous rebute de nouveau, puis nous attire, nous plonge dans l’étonnement et finit par exiger le respect. »
<1417>
-
Mercredi 6 mai 2020
«Face à un islam fondamentaliste, il s’agit de proposer un islam moderne, actif, réactif, une religion compatible avec le vivre ensemble et le temps présent, mais aussi avec les raffinements exquis qu’elle a inventés»Malek ChebelLe second entretien que j’ai choisi dans ce livre remarquable « Comprendre le Monde » que la revue XXI a réalisé à partir des articles qui avaient été publiés dans les numéros de la revue, est consacré à un intellectuel algérien qui donnait une vision lumineuse du monde de l’Islam : Malek Chebel.
 Il était d’ailleurs le défenseur de l’Islam des lumières. Il était, puisqu’il est mort le 12 novembre 2016 à Paris, d’un cancer.
Il était d’ailleurs le défenseur de l’Islam des lumières. Il était, puisqu’il est mort le 12 novembre 2016 à Paris, d’un cancer.
J’avais, à cette occasion, écrit un mot du jour lui rendant hommage : <17 novembre 2016>
C’était un anthropologue des religions qui a aussi étudié la psychanalyse.
Il a beaucoup exploré la sensualité, l’érotisme et le corps dans la culture islamique, mais aussi la vie intellectuelle et la société de l’Islam.
Sa voix douce et son érudition se trouvaient assez souvent sur les plateaux de télévision. Moi je l’ai surtout écouté sur les ondes de France Culture.
Dans une de ces émissions, invité de Laure Adler, il s’était décrit ainsi :
« Je suis un arabophone contrarié et un francophone accidentel »
<Cette page> énumère les différentes émissions de France Culture auxquelles il a participé.
Il a aussi traduit le CORAN et c’est sa version dont je dispose sur ma tablette. Mais j’en reparlerai demain.
L’entretien que je partage aujourd’hui a été publié dans le numéro 28 de la Revue XXI, paru en 2014 et a pour titre : « Penser l’islam en liberté »
La journaliste, Léna Mauger le décrit ainsi :
« Il tire lentement une chaise et s’assied dans son salon tiré au cordeau, où se distingue un mur-bibliothèque rempli de livres anciens en arabe, d’encyclopédies, de fresques historiques, de manuels de philosophie et de théologie. Depuis la publication de son premier ouvrage, Le Corps en Islam, en 1984, il n’a cessé d’explorer la dimension sensuelle, souvent ignorée, de la culture musulmane : sexualité, passion amoureuse, histoire de la chair, liberté des femmes. À 61 ans, l’universitaire se revendique passeur d’un islam moderne, éclairé, affranchi des évidences et des clichés. Depuis dix ans, il porte sa vision d’un « islam des lumières » de rencontres en conférences à travers le monde, rêvant d’un enseignement scientifique à l’université. »
Il parle d’abord d’un souvenir d’enfance qui l’a marqué à cause du désir contrarié, de l’injustice et de son rapport aux livres :
« Dans mon enfance. J’avais 6 ou 7 ans et, un jour, mon grand-père, polygame, a demandé à tous ses enfants et petits-enfants, garçons et filles, de lui transmettre une liste d’affaires scolaires pour la rentrée. J’avais perdu mon père peu avant et j’étais peut-être le plus marginal de la lignée. J’ai sollicité le minimum : quatre stylos Bic de couleurs différentes dans une pochette en plastique. Le jour de la distribution, le dernier des enfants de mon grand-père a réclamé ces stylos. Mon grand-père me les a ôtés des mains pour les lui donner. Depuis, la question du désir m’a longtemps torturé. Plus tard, j’ai compris que ma quête d’écriture était la quête de ces quatre stylos, symboles de ce père disparu. Les livres m’ont sauvé, guidé, épaulé. Sans eux, sans le désir d’écrire, je serais peut-être devenu un docker dans ma ville natale, Skikda, qui est un port. C’est là-bas que j’ai rencontré mon épouse, la fille du libraire ! »
Il est né dans une famille riche, patriarcale. Mais ayant perdu son père, il n’avait pas de défenseur face au grand père tout puissant qui selon ses propos se désintéressait des branches mortes de la famille. Il se retrouve dans un centre pour enfants abandonnés :
« À la mort de mon père, je suis entré dans un processus de déstructuration : j’étais d’une famille riche, mais je n’étais pas riche. Mon grand-père, grand propriétaire terrien, avait plus de vingt-huit descendants directs et indirects. Pour ne pas réduire son train de vie, ce patriarche a décidé de laisser de côté les branches mortes de la famille, à savoir mon frère et moi. La situation de ma mère était intenable : en ces années-là, une veuve perdait son statut social, elle devenait une quantité négligeable, superflue.
Un matin, ma mère nous a habillés comme pour une sortie de fête. Mon oncle, notre tuteur, est venu nous chercher en voiture. Il nous a déposés dans une Ddass qui recueillait les éclopés de la terre. -Orphelins, délinquants, jeunes drogués : tout ce monde parallèle devait apprendre à vivre en communauté au milieu d’une immense plage pelée de sept kilomètres. En un an, j’ai acquis des mécanismes de survie qui me sont utiles aujourd’hui, comme la ténacité, le travail, l’anticipation. Ce centre de regroupement était une école de vie. Je m’en échappais en contemplant la mer bleu pétrole : c’était elle, ma berceuse, ma conteuse, ma nounou. Elle a recueilli mes premières confidences.
Par chance, le directeur de l’établissement m’a pris sous son aile. Lui aussi était sans famille. Il était l’adulte sans enfant, et moi l’enfant sans référent paternel. Sur deux cent cinquante gosses, nous étions trois ou quatre seulement à étudier. J’ai obtenu ma sixième, qui était alors un examen et pas seulement un passage. Cela m’a permis d’être accepté en internat à l’école publique, du collège jusqu’au bac. »
C’est donc la rencontre avec un adulte, un référent ainsi que sa volonté et son désir d’apprendre qui vont permettre à Malek Chebel de s’extraire de cet établissement dans lequel très peu réussissent.
Il faut parfois beaucoup de combats, d’adversité pour devenir doux et lumineux.
Il va entreprendre d’abord des études de psychologies mais ce qu’il révèle de l’ambiance, de la liberté, des mœurs de l’Algérie de sa jeunesse montrent la régression qui existe actuellement :
« Plus tard, j’ai retrouvé dans mes documents de lycée un poème écrit en seconde dans lequel je rêvais de faire de la psychologie sans savoir ce que c’était !
En Algérie, notre classe a ouvert la discipline sous l’impulsion de jeunes professeurs français antimilitaristes, influencés par Camus, Foucault, Fanon…
Nous étions dans le bouillonnement post-1968 : la marijuana, Baudelaire, les voyages à Katmandou, Bob Marley, le reggae, le blues, le rêve sans limites, les voyages sans visa, les nuits à la belle étoile.
Tamanrasset, dans le Sud algérien, représentait le mythe américain à nos portes… Évidemment, tout le monde ne fumait pas du hasch ou était accro au sexe, mais cela faisait partie de notre bouillon de culture, un jus tonique.
La sexualité, jusqu’ici refoulée, était approchée de façon plus libre. Les femmes ne portaient pas de voile, la question ne se posait même pas. Elles prenaient le bus seules, allaient à la fac, se mettaient en maillot de bain deux pièces sur la plage, et n’étaient jamais embêtées pour cela. Au contraire, elles étaient adulées, enviées, courtisées.
Il va finir sa licence de psychologie en tant que major de promo ce qui lui permettra d’obtenir une bourse et venir étudier en France.
A cette époque, le début des années 1970, on parlait peu d’Islam en France :
« Je n’étais pas vu comme un musulman. Personne alors ne parlait d’islam, de barbe, de voile ou de halal. Seuls quelques milliers d’ouvriers de Renault ou Citroën, des hommes seuls, faisaient le ramadan et la prière dans leur coin – et d’ailleurs, certains finissaient par ne plus pratiquer… J’avais effectué un stage à l’hôpital en Algérie, le tabou de la virginité m’a paru être une porte d’entrée pour comprendre les nœuds des sociétés musulmanes. À la Sorbonne, j’ai demandé à faire ma thèse sur l’hymen au Maghreb, ce passeport pour le mariage. »
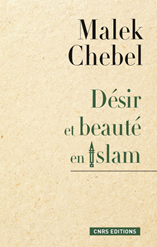 Il raconte sa tentative de revenir en Algérie enseignait à l’Université et l’envahissement du monde universitaire algérien par les frères musulmans et leurs idées rétrogrades :
Il raconte sa tentative de revenir en Algérie enseignait à l’Université et l’envahissement du monde universitaire algérien par les frères musulmans et leurs idées rétrogrades :
« En 1981, après ma première thèse, j’ai fait une tentative de retour et enseigné la psychologie à l’université de Constantine. L’Algérie cherchait alors à arabiser son système éducatif. Les autorités étaient en quête d’enseignants venus du monde arabe. De nombreux professeurs sont arrivés d’Égypte. Parmi eux, hélas, beaucoup étaient des Frères musulmans, des prédicateurs. Nous avons été la première génération à être confrontée à cet enseignement avec des thématiques religieuses fortes. L’islamisation de l’Algérie a démarré à la fac, par les étudiants et les femmes.
Mes cours sur la sexualité, les dérèglements affectifs et le corps déplaisaient. Un responsable de l’association religieuse a fini par m’annoncer que mon amphi allait être réduit de moitié pour installer une mosquée sur le campus. […] J’ai pris un aller simple pour Paris »
Il faut comprendre d’où vient Malek Chebel, de son évolution, de ses expériences pour comprendre l’émergence du concept d’« islam des Lumières »
« Le 11 septembre 2011, quand deux avions ont détruit les tours du World Trade Center, les concepts ont vacillé, la peur de l’islam s’est installée. La France, qui s’était endormie avec quatre millions de travailleurs immigrés sur son sol, s’est réveillée avec quatre millions de musulmans. J’écrivais un livre sur l’actualité de l’islam et j’ai voulu traiter de l’islam et la modernité. Le titre Islam des Lumières s’est naturellement imposé.
Face à un islam fondamentaliste, il s’agit de proposer un islam moderne, actif, réactif, une religion compatible avec le vivre ensemble et le temps présent, mais aussi avec les raffinements exquis qu’elle a -inventés. Dans cinquante ans, les musulmans seront deux milliards, croyez-vous que les interdits seuls arriveront à les canaliser ?
Non, il faut nourrir une culture du débat, l’ouverture d’esprit, la tolérance, le respect de l’autre. Si certains veulent vivre au Moyen Âge, c’est leur choix. Mais ils ne peuvent l’imposer en règle universelle. Les politiques et les théologiens du monde arabo-musulman ont verrouillé l’expression de paroles alternatives. Comme à l’époque des Lumières, les libres penseurs, les intellectuels, les philosophes doivent jouer un rôle d’éclaireurs. »
Dans cet article il parvient de résumer en quelques lignes l’Histoire de l’évolution contrariée de l’Islam :
« Il y a eu depuis le Moyen Âge de nombreuses réformes, mais homéopathiques. Et ceux qui les ont -portées l’ont souvent payé cher.
Dès le VIIIe siècle, soit un siècle après la Révélation, un esprit critique s’amorce en islam : on voit des ajustements et des correctifs au dogme théologique.
Du XIe au XVe siècle, l’islam produit une série de penseurs majeurs et autant de philosophies distinctes de la doxa. À cette époque, Averroès, né en Andalousie, juriste, médecin, philosophe et grand commentateur d’Aristote, milite pour asseoir la prééminence de la raison sur la croyance, ou au moins un équilibre entre les deux. Ibn Rochd, c’est son nom arabe, avance l’idée d’une foi cantonnée à la sphère privée. Mais il est exilé : son ouverture d’esprit et sa modernité déplaisent aux autorités musulmanes. Aujourd’hui encore, son œuvre est tenue pour subversive, certaines bibliothèques nationales refusent de la mettre à disposition des étudiants.
Il faut attendre le XIXe siècle pour voir naître un mouvement d’envergure, appelé « Nahda ». Ce mouvement, le « renouveau », est animé par une élite arabe souvent laïque. Il se développe sur les ferments du projet de Bonaparte, qui entendait transformer la -société égyptienne selon les idéaux de la Révolution française. Au Caire, puis à Damas, des philosophes, des activistes politiques et des journalistes ouvrent le débat sur la pertinence de la charia, sur la polygamie, sur l’adaptation de l’islam au monde…
Le juriste Mohamed Abduh crée avec un Afghan le mouvement du modernisme islamique et publie de nombreux articles sur le rôle de l’instruction et le retard de l’islam. De retour en Égypte après son exil, il est nommé mufti, soit « interprète de la loi musulmane ». Un autre intellectuel égyptien, Ali Abderraziq, publie en 1925 un livre majeur, « L’Islam et les fondements du pouvoir », qui s’attaque au refus de la distinction entre temporel et intemporel, un dogme qui permet aux théologiens de se mêler de politique. Ce livre, longtemps retiré de la vente, vaut à Ali Abderraziq d’être déchu de ses responsabilités à l’université.
En Algérie, au Maroc, en Tunisie, partout, une floraison extraordinaire de penseurs, d’hommes d’État, de théologiens et même de femmes font alors bouger les lignes, en posant des questions d’une audace folle.
Le tournant de la crise de l’islam se joue au XVe siècle avec la chute de Grenade. La perte de l’Espagne andalouse, le plus beau joyau, marque le début du rétrécissement du monde musulman. La perte d’influence est forte, l’islam se « provincialise » et les premières pensées critiques provoquent immédiatement des contre-réformes. Prenant le passé comme horizon, des théologiens réclament une application stricte de la charia, qui n’est autre qu’un discours humain sur le Coran.
Le début de la colonisation et la fin du califat, aboli par Atatürk en 1923, renforcent cette contraction d’un monde sur lui-même. Les fondamentalistes se mettent à jouer des frustrations pour s’ériger en censeurs. Ils se servent de l’islam comme d’un outil. Pour accéder au pouvoir, comme les Frères musulmans. Pour obtenir des droits à la sainteté, comme les salafistes. Ou pour régner sur un pays, comme les djihadistes.
La crise est profonde dans le monde musulman : absence de légitimité, absence d’éducation, peu de perspectives pour les jeunes.
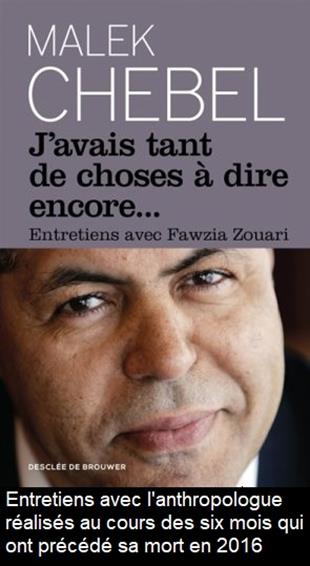 L’islam n’est qu’un habit, et il est balkanisé.
L’islam n’est qu’un habit, et il est balkanisé.
Aucune puissance, aucune autorité n’a de magistère. »
Selon Malek Chebel 80 % du corpus de l’islam s’adapte parfaitement à notre époque. Sa conception du monde, sa pratique, ses analyses et ses objectifs sont conciliables avec les règles économiques modernes, mais aussi avec l’éthique universelle : la démocratie, la République, les droits de l’homme et les conventions internationales :
« L’islam encourage la philosophie, les mathématiques, la biologie, la médecine, la curiosité scientifique et l’obligation de la lecture mais, de cela, personne ne parle ! ».
Le blocage provient à la fois d’archaïsme défendu par un groupe d’hommes qui n’ont pas intérêt au changement. Ce qui explique le statut médiéval de la femme, le refus quasi systématique de s’ouvrir à une théologie critique. Il dénonce aussi le rôle de grandes puissances régionales comme l’Arabie Saoudite ou l’Iran, arc-boutés sur leurs privilèges régaliens pour tirer profit d’avantages matériels immédiats.
Et il trouve dans les propos du prophète et le Coran, la justification de ses théories sur la sensualité au sein de l’Islam :
« Interrogé sur ce qu’il avait aimé de ce monde, le Prophète répondit : « Les femmes, les parfums et la prière. » La tradition raconte qu’il passa vingt-huit nuits consécutives avec son épouse copte Marya ! Sur les 6 218 versets du Coran, 650 parlent de la sexualité, de la femme, des règles, de la fécondité… Soit plus d’un dixième des versets !
Les musulmans vivent dans un quiproquo immense : ils subissent la contrainte de la religion, alors que l’islam leur recommande de vivre pleinement leur vie terrestre. La civilisation musulmane repose sur une idée fondamentale : le masculin et le féminin sont de création divine. L’exercice de la sexualité, l’amour et la tendresse sont donc, pour les hommes et les femmes unis par le mariage, une bénédiction de Dieu. Je n’ai fait qu’analyser les textes, mais écrivant cela, j’ai été traité de mécréant. Aucun de mes livres sur l’intime n’a encore été traduit dans le monde arabe ! »
Il ne répond pas à la question que lui pose la journaliste quant à sa croyance :
« Je suis en quête de sens, l’existence de l’homme m’intrigue. Mais il faut me juger selon ma méthodologie. Je suis d’abord un penseur ou un chercheur, la foi est du ressort de l’intime. »
A la fin de l’entretien il continue à prôner l’optimiste selon lui la société musulmane est en attente, l’histoire du monde musulman s’accélère, les blocages ne pourront durer.
J’aimais l’écouter et le lire.
Il permettait de voir la face lumineuse de l’Islam.
<1416>
-
Mardi 5 mai 2020
«J’ai compris que je suis le monde. Tout ce que je vois, tout ce que je vis, tout ce que je mange, fait partie de mon univers, de mes créations, c’est réel et infini.»Xu Ge FeiHier je vous ai présenté le livre d’entretiens que je vais décliner et partager ces prochains jours.
Et le premier entretien qui m’a marqué, il faut être juste c’est Annie qui l’a lu en premier et m’a immédiatement incité à le lire, concernait une jeune chinoise née en 1979 et qui est devenue éditrice de bande dessinées à Paris : Xu Ge Fei.
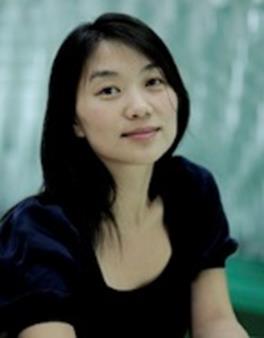 L’article a pour titre : « J’ai compris que je suis le monde ».
L’article a pour titre : « J’ai compris que je suis le monde ».
Cet entretien est paru dans le N°24 de la revue XXI : « Revue 21.fr N° 24»
Lorsqu’elle était enfant en Mandchourie, son grand père lui répétait qu’elle n’était rien que « de l’eau sur le sable, puisqu’elle était une fille ». Et depuis ce temps-là elle portait en elle le désir de faire lire des livres pour les jeunes filles.
Son histoire est étonnante, pleine de volonté, d’imprévue et de hasard qu’elle raconte dans son autobiographie : « Petite Fleur de Mandchourie».
Annie a acheté ce livre et l’a lu avec enthousiasme. Je n’ai pas été assez rapide pour le lire à mon tour, depuis Annie l’a prêté mais ne se souvient plus à qui.
Je lui ai demandé de le résumer et elle a dit « Un conte fée »
Xu Ge Fei a donc vécu une enfance pauvre avec un grand-père qui considérait les filles comme quantité négligeable, mais elle a été entourée de l’amour de ses parents. Mais j’y reviendrai.
Parce que je voudrai d’abord révéler le cœur de ce qu’elle dit, la révélation qui lui a donné le courage et la force d’affronter toutes les épreuves pour devenir une éditrice parisienne qui relie le monde chinois et le monde français :
« A 16 ans, je suis tombée sur cette phrase, dans un livre dont j’ai oublié le titre : « Dieu a deux mains. Sur l’une, il a écrit : « Tu n’es rien pour moi, pas plus qu’une poussière. Et sur l’autre : « Mais j’ai créé le monde pour toi. ». Je ne croyais pas en Dieu, mais cela a été une révélation pour l’adolescente que j’étais, qui cherchait désespérément le sens de la vie. J’ai compris que je suis le monde. Tout ce que je vois, tout ce que je vis, tout ce que je mange, fait partie de mon univers, de mes créations, c’est réel et infini. Tout est possible, je peux tout vivre. J’avais envie de vivre les livres. Je vis les livres ; de vivre à Paris, et je suis là. Tout est cohérent et vient de cette idée folle : je crois réellement que je suis le monde. »
C’est à la fois très beau et très profond.
Si on en revient au Dieu monothéiste des 3 religions du Livre, Régis Debray a cette description fulgurante et précise qui montre toute la prétention de cette conception de la divinité :
« C’est l’Infini qui dit « Moi, je » et qui de surcroit pense à moi. Il allie ces deux qualités a priori incompatibles qui sont la Transcendance et la proximité. D’une part, le Créateur est radicalement supérieur et distinct du monde créé, du monde sensible qui m’entoure mais il m’est possible de l’interpeller, dans un rapport intime de personne à personne. Autrement dit c’est un dehors absolu qui peut me parler du dedans. Il nous entend, nous voit et nous console.
Xu Ge Fei découvre une toute autre spiritualité. L’homme n’est qu’une poussière, disons un groupement de poussière. Mais il fait partie intégrante d’un monde dans lequel il peut vivre, s’épanouir en étant relié à tous les autres éléments et êtres vivants qui forment ce monde. Et dans ce sens chacun de nous est le monde.
 Xu Ge Fei est donc née pauvre, dans un camp forestier communiste à Antu en Mandchourie. Son père était bûcheron et sa mère responsable de la cantine du camp
Xu Ge Fei est donc née pauvre, dans un camp forestier communiste à Antu en Mandchourie. Son père était bûcheron et sa mère responsable de la cantine du camp
Son grand père était un brillant intellectuel dont tous les biens ont été confisqués lors de la révolution communiste. Il a fait quatre ans de prison et quatorze ans de travaux forcés pendant la révolution culturelle, des années 1960 à la fin des années 1970. On lui reprochait notamment de parler japonais, ce qui valait d’être considéré comme un traitre.
Bien qu’elle fût pauvre, elle raconte qu’elle a eu une enfance heureuse :
« C’était une enfance très heureuse. Je me souviens des visites de mon père qui travaillait à la ville pendant de longues périodes, de ce piano à treize notes qu’il m’a offert, de ce petit serpent à qui j’ai donné à boire du saké. Je n’ai que de bons souvenirs. Ma mère cousait mes vêtements. Elle me portait sur son dos quand j’étais bébé et qu’elle travaillait à la cantine du camp. Nous étions pauvres mais ce n’était pas une existence misérable, il y avait de l’amour de la tendresse. »
Son père l’aimait, mais la trouvait moche et le lui disait. Il a fallu surmonter quand même ce jugement paternel.
Mais le plus difficile fut certainement sa relation avec son grand-père lettré :
« Mon père lisait des bandes dessinées chinoises parce que c’était facile à lire et pas très cher.[…] J’ai grandi entourée de ces bandes dessinées, mais c’était comme des jouets, ce n’était pas du savoir. Et je n’avais pas le droit de toucher aux livres de mon grand-père. Je le voyais lire des textes anciens. Il répétait tout le temps qu’il n’y avait rien au monde de plus précieux que le savoir. Et puis un jour, il m’a dit « Toi, tu n’es rien, tu n’es que de l’eau sur le sable puisque tu es une fille. Tu vas te marier et changer de nom, tu n’existeras plus pour nous. A quoi cela servirait-il de t’apprendre des choses ?» […]
J’avais 4 ou 5 ans et envie d’apprendre le japonais. Il l’enseignait à mon frère, le seul héritier officiel. Il l’enfermait dans une salle tous les matins. Je me cachais derrière la porte et j’apprenais par cœur. Mon frère lui détestait le japonais. Un jour que mon grand-père le frappait avec une règle en bambou, je suis entrée et j’ai dit « Moi je veux apprendre le japonais ! » Il m’a renvoyée avec cette fameuse phrase : « Mais Toi, tu n’es rien, tu es de l’eau sur le sable ». Et il a rangé le livre très haut pour que ne puisse pas y accéder.
Confucius disait que la première vertu d’une femme est l’ignorance. Je n’aime pas sa façon de hiérarchiser la société : les généraux et les ministres doivent obéir à l’empereur, les capitaines aux ministres, le peuple à tous ces gens-là, les femmes à leur mari, les veuves à leur fils. C’est le fond de toute la pensée chinoise. Si j’avais eu accès aux livres, je n’aurais pas eu autant faim. C’est peut-être grâce à mon grand-père que je fais ce que je fais finalement »
Elle n’a pas été bonne à l’école. Et son père lui disait « Puisque tu n’es pas très jolie, personne ne va t’épouser donc il faut que tu sois forte à l’école, que tu cherches un boulot pour ne pas mourir de faim. »
Mais un jour elle peut acheter une copie piratée du « Monde de Sophie de Jostein Gaarder » et puis :
« Et là le choc. J’ai crié à ma mère : « QuI t’a donné le droit de me donner la vie sans donner le sens ! » Pendant 6 mois, j’ai démabulé dans la rue. J’étais perdue, j’arrêtais les gens, je questionnais les arbres : « Mais pourquoi vit-on ? ! » J’avais perdu dix kilos, j’étais comme folle. Personne ne me donnait de réponse qui me satisfasse. Je suis donc allée dans une bibliothèque pour chercher dans les livres. Et au bout de trois mois, j’ai trouvé cette fameuse phrase : « J’ai créé le monde pour toi. » »
Elle a alors appris le métier de comptable et l’anglais en autodidacte. Puis elle a quitté la Mandchourie et a parcouru la Chine à la recherche d’elle-même. Elle devient serveuse dans un restaurant à prostituées à Dalian, exerce tous les métiers possibles pour subvenir à ses besoins.
Finalement elle se fait entretenir par un jeune Californien à Shenzhen avant de filer à Shanghai, où son aplomb et sa passion pour l’anglais lui ouvrent les portes d’une entreprise de pétrochimie. Mais, toujours insatisfaite, elle met le cap sur Paris sur les conseils de Jim, un écrivain sino-canadien, pays clément avec les femmes, lui dit-il. Âgée de 24 ans elle prend alors des cours du soir pour apprendre le français. Mais elle doit trouver les 80.000 yuans (8.000 euros) exigés pour émigrer en France. Une somme colossale, réunie grâce au soutien de sa mère, qui a vendu son alliance en or et l’appartement familial.
A Paris, elle occupe aussi plusieurs emplois pour finalement grâce à sa connaissance des langues chinoises et françaises obtenir un poste de directrice générale de la filiale chinoise de Global Chem, une société française de marketing Internet, spécialisée dans la pétrochimie. Elle est très bien rémunérée, mais au bout d’un certain temps elle ne trouve plus de sens dans ce job et veut devenir éditrice de livres sans rien y connaître.
Elle ne sait comment faire. Mais elle va rencontrer son compagnon avec lequel, elle va créer les éditions Fei en 2009. Elle raconte sa rencontre avec son compagnon :
« C’est Patrick Marty [réalisateur-scénariste, ndlr]. Je l’ai rencontré à Paris, un jour où j’étais triste. J’avais quitté mon amoureux américain et mon travail dans la pétrochimie dans l’idée de devenir éditrice, mais je n’avais aucune connexion dans ce métier, plus d’argent, et mon visa allait expirer. Je confiais tout ça en pleurs, à voix haute, à « mon » arbre – le grand platane bicentenaire du parc Monceau –, quand Patrick s’est approché et m’a demandé : « Mademoiselle, qu’est-ce qui est si grave ? » Il était mal habillé, avec de grandes oreilles, mais il avait des yeux… Alors, je lui ai tout raconté. Mes premières années dans la forêt, en Mandchourie, en Chine du Nord-Est, où mon père était bûcheron. L’arrivée plus tard à Changchun, où ma mère travaillait dans une usine de cigarettes. Ma nuit passée dans la rue à Shenzhen. Mes nombreux jobs : vendeuse de rasoirs de poche, serveuse, réceptionniste, traductrice, commerciale. Et le sacrifice immense de mes parents, qui avaient vendu leurs alliances et leur appartement et emprunté à tous les voisins et amis pour payer mon visa pour la France. On a parlé jusqu’à ce que la nuit tombe. Entre nous, c’était magnétique. Quatre mois plus tard naissaient les éditions Fei, et les toutes premières BD franco-chinoises. »
Le Point raconte aussi sa rencontre avec Christian Gallimard, <Xu Ge Fei, le miracle à la chinoise> :
 « Une nouvelle rencontre, avec Christian Gallimard, le frère d’Antoine, a été, dit-elle, déterminante : « Il a lu mon business plan . Quelque temps après, alors que j’étais en Italie pour négocier les droits du « Juge Bao », il m’a appelée pour que je l’accompagne en Chine pendant quinze jours pour un voyage d’affaires. Là, il m’a expliqué toutes les subtilités du monde de l’édition, tout en me répétant que, pour réussir, il fallait également raconter ma vie et l’envoyer sous forme de synopsis à Bernard Fixot en septembre. En octobre, ce dernier m’a répondu favorablement. Et cela s’est passé exactement comme M. Gallimard l’avait prévu. » Avec la sortie conjointe du deuxième volume, somptueux, des aventures du juge Bao, et de ce récit de vie écrit en collaboration avec Patrick Marty, c’est une nouvelle page de la conquête chinoise qui s’écrit ici. Pacifique, culturelle et diablement séduisante. »
« Une nouvelle rencontre, avec Christian Gallimard, le frère d’Antoine, a été, dit-elle, déterminante : « Il a lu mon business plan . Quelque temps après, alors que j’étais en Italie pour négocier les droits du « Juge Bao », il m’a appelée pour que je l’accompagne en Chine pendant quinze jours pour un voyage d’affaires. Là, il m’a expliqué toutes les subtilités du monde de l’édition, tout en me répétant que, pour réussir, il fallait également raconter ma vie et l’envoyer sous forme de synopsis à Bernard Fixot en septembre. En octobre, ce dernier m’a répondu favorablement. Et cela s’est passé exactement comme M. Gallimard l’avait prévu. » Avec la sortie conjointe du deuxième volume, somptueux, des aventures du juge Bao, et de ce récit de vie écrit en collaboration avec Patrick Marty, c’est une nouvelle page de la conquête chinoise qui s’écrit ici. Pacifique, culturelle et diablement séduisante. »
« Le Juge Bao » fut la première bande dessinée que sa maison d’édition a publié.
La Tribune lui a aussi consacré un article : « Xu Ge Fei, sur la route du « Soi » »
Dans lequel elle répète que c’est Christian Gallimard qui lui a tout appris.
Et montre aussi cette belle philosophie :
« Je dois relever des défis au quotidien. Je fais des erreurs. Mais j’apprends chaque jour et c’est passionnant »
Mais les blessures de l’enfance restent vivace :
« J’avais peur de ne pas être jolie, parce que mon père me disait que j’étais moche, peur de ne pas plaire, de ne pas être aimée pour qui je suis. Alors je me suis coupé les cheveux. »
Dans <cette vidéo> elle se présente et parle de son autobiographie.
 Elle raconte avec émotion quand sa mère a dépensé une fortune, par rapport à ses revenus, pour lui offrir un dictionnaire français :
Elle raconte avec émotion quand sa mère a dépensé une fortune, par rapport à ses revenus, pour lui offrir un dictionnaire français :
« Parce que j’adore les langues.
J’adore surtout derrière les langues, les rencontres.
C’est magique d’apprendre une langue. C’est comme une porte qu’on ouvre, un autre monde nous attend derrière. »
Elle avoue son amour de la France et son désir de publier des livres pour les petites filles ; livre chinois pour faire découvrir la Chine aux petites françaises puis aussi faire découvrir la France aux petites chinoises.
Elle conclut l’entretien à la revue XXI par cette vision :
« Le jour où mon grand-père a placé ce livre sur la plus haute étagère de la maison, je me suis juré que je donnerais des livres à toutes les petites filles à qui il fut défendu d’apprendre. Mon but est de permettre l’accès au savoir, c’est cela qui changera le monde. Je le fais un peu avec l’édition. »
Elle explique aussi ce que signifie son nom Xu veut dire « petit à petit » ou « tout doucement », Ge c’est « révolution », « changer », « corriger ». Fei accolé aux deux autres mots, c’est tout ce qui est « injuste », « mauvais » ou faux ». C’est son grand père qui a choisi ce nom qui veut donc dire « Petit à petit révolutionner les choses injustes. »
J’aime beaucoup <cette vidéo> enregistrée par la Librairie Mollat au festival d’Angoulême où elle parle avec enthousiasme des BD qu’elle publie.
Les éditions Fei ont bien sûr leur site. Je vous renvoie vers la page des bandes dessinées : https://www.editionsfei.com/bande-dessinee
<1415>
-
Lundi 4 mai 2020
«La revue XXI»Mook fondé par Laurent Beccaria et Patrick de Saint-ExupérySortons résolument de l’actualité et du bruit médiatique.
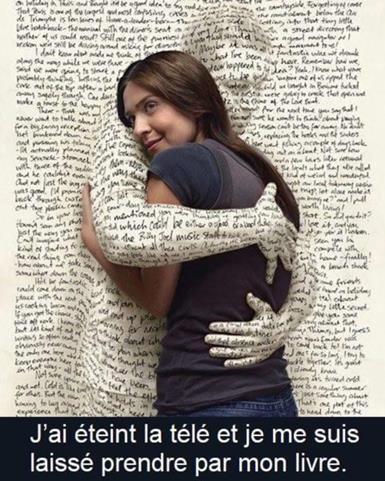 Un jour une amie, lectrice du mot du jour, est venue à la maison avec un livre.
Un jour une amie, lectrice du mot du jour, est venue à la maison avec un livre.
Elle nous a dit que ce livre pourrait nous intéresser Annie comme moi et que je pourrais même y trouver matière à mot du jour.
C’était il y a déjà longtemps, probablement en 2017.
Il a fallu le temps de la maturation pour suivre ce sage conseil.
Ce livre a pour titre « Comprendre le monde », il se trouve encore mais difficilement.
Ce titre fait sens avec l’exergue général que j’ai mis sur la page d’accueil de mon blog : « Comprendre le monde c’est déjà le transformer »
Cette phrase n’est pas de moi, mais de Guillaume Erner lors de sa première émission « Des matins de France Culture », le 31 août 2015, lorsqu’il a remplacé Marc Voinchet qui venait d’être nommé Directeur de France Musique. J’en avais d’abord fait un mot du jour, <le 9 septembre 2015>.
Le livre « Comprendre le monde » a pour sous-titre « Les grands entretiens de la revue XXI »
« XXI » est une revue trimestrielle française de journalisme de récit. Elle a été créée en janvier 2008.
C’est plutôt un livre qu’un journal, elle est vendue en librairie et sur abonnement.
Ce concept a été désigné sous le nom de « Mook », (contraction de « magazine » et de « book », livre en anglais).
Le nom de la revue, XXI, fait référence au XXIe siècle. Selon Wikipedia, elle est diffusée à 22 000 exemplaires en moyenne.
Le choix est celui de la qualité et du refus de la publicité. Chaque tome est vendu 16 euros.
Pour ses fondateurs Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry :
« L’idée était de rassembler le meilleur du journalisme avec le meilleur de l’édition »4 sur le modèle des grands reportages américains du New Yorker et de Vanity Fair ».
La propriété de la revue a évolué depuis 2008 elle est désormais associée à l’éditeur Le Seuil.
<TELERAMA> a salué le lancement de cette revue par un article élogieux :
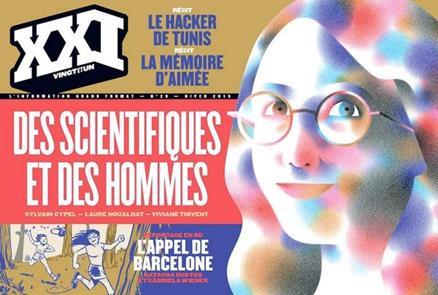 XXI N°29
XXI N°29
« Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Et même de très bonnes surprises venant de la presse magazine comme le succès d’une jeune revue atypique « XXI » (Vingt et un). Succès qu’aucun spécialiste du marketing et aucun éditeur de presse n’auraient prédit. Imaginez : un magazine papier, sans publicité, diffusé en librairie et exceptionnellement en kiosque, à la périodicité compliquée (trimestrielle) et qui offre des reportages et des enquêtes, du récit long, dépassant souvent les dix ou douze pages !
[…] Avec son goût pour le récit, cette revue qui fait facilement tomber ses lecteurs dans l’addiction est née de la rencontre de Patrick de Saint-Exupéry avec l’éditeur Laurent Beccaria. Directeur et fondateur des Arènes, ce dernier aime prendre des risques et publier à contre-courant, qu’il s’agisse de Denis Robert ou d’Eva Joly.
Les amateurs de généalogie iront rechercher les lointains ancêtres de XXI dans la famille du défunt L’Autre journal de Michel Butel, du New Yorker ou même de la presse populaire qui diffusait, en feuilletons, au début du XXe, les grands reportages d’Albert Londres. Peu importe. La leçon de XXI est qu’un journal de journalistes, né sur une intuition, sans penser produit marketing ni cœur de cible, semble avoir réussi son pari »
Jusqu’en 2020 le sous-titre était « L’information grand format ». Elle est désormais sous-titrée « Dans l’intimité du siècle », cela correspond à une nouvelle formule lancée le 10 janvier 2020.
Lors de ce lancement, le magazine « Les Inrocks » a consacré un article à cette nouvelle formule :
 XXI N°46
XXI N°46
« A son lancement il était un ovni, une exception. Bref, un objet surprenant et innovant. Mais douze ans plus tard, il fallait se rendre à l’évidence : XXI n’est plus la seule revue grand format. Plus d’un an après son rachat, ce trimestriel lance alors sa nouvelle formule ce vendredi 10 janvier. Exit « L’information grand format », et bienvenue « Dans l’intimité du siècle », nous dit le sous-titre. « XXI c’est avant tout une revue trimestrielle, sans publicité, qui raconte des histoires avec des reportages et des histoires incarnées humaines, à hauteur d’hommes », résument les rédactrices en chef Léna Mauger et Marion Quillard.
Fondé en 2008 [ce mook] recevait un bel accueil médiatique. Et pour cause, dans un milieu confronté à un manque de moyens, et où l’uniformisation de l’information devient la règle, l’objet fascine les journalistes.
Du slow média dans un secteur devant toujours faire plus vite, le pari était lancé avec cette revue indépendante privilégiant les reportages de terrain au long cours et une écriture soignée via des sujets éloignés d’une actualité sur laquelle tout le monde a les yeux rivés. Le tout vendu en librairies (16 euros), et donc libéré des contraintes des circuits de diffusion de la presse écrite.
XXI reste encore aujourd’hui un bel objet. Avec sa maquette, ses illustrations et ses photos élégantes, le mook attaque directement par le vif du sujet : son article de Une.[…]. Petite nouveauté : les formats courts du début sont supprimés au profit d’articles qui nourrissent les grands formats et permettent d’aller plus loin.»
Selon cet article la revue compte 8 000 abonnés et se vend à 22 000 exemplaires.
 <Le dernier numéro> porte le numéro 50 et a pour sujet « Achetez votre nationalité préférée ».
<Le dernier numéro> porte le numéro 50 et a pour sujet « Achetez votre nationalité préférée ».
L’édito de Léna Mauger qui me semble d’une grande pertinence est en accès libre. Je le partage ci-après :
« Je m’amuse toujours de l’étonnement des jeunes, quand je leur raconte qu’avant 1914 je voyageais en Inde et en Amérique sans posséder de passeport, sans même en avoir jamais vu un », raconte Stefan Zweig dans Le Monde d’hier, Souvenirs d’un Européen, chef-d’œuvre écrit à la veille de son suicide au Brésil, où l’écrivain autrichien, dépossédé de sa nationalité, s’était réfugié pour fuir le nazisme. Aujourd’hui, un Français peut se rendre sans visa dans 164 pays, un Syrien, dans 37, un Afghan, dans 30. Se déplacer, voyager est un marqueur de puissance, de richesse, de pouvoir. Et le passeport pourrait être l’allégorie d’un monde globalisé divisé entre ceux qui peuvent se payer le luxe d’aller partout, et ceux qui ne vont nulle part. Ce numéro de XXI explore des lignes de fracture à travers des histoires vraies sans frontières. En Australie, où l’eau est désormais cotée en Bourse, le marché a gagné et les agriculteurs trinquent. En Arabie Saoudite, le prince héritier se repose sur un yacht à un demi-milliard de dollars alors que les caisses de son royaume sont presque vides. En France, la mer engloutit des marins payés 3 euros de l’heure, et des invisibles, des oubliés, saisis dans l’objectif d’un photographe, se privent pour nourrir leurs enfants. À défaut de pouvoir leur offrir des visas pour un monde plus juste, XXI leur donne un visage. »
La revue XXI a bien sur un site sur lequel vous pouvez acheter un numéro ou vous abonner : https://www.revue21.fr/
<Ici vous trouverez tous les numéros déjà parus>
Pour ma part, à partir de demain je reviendrai sur un certain nombre d’articles qui date des 8 premières années de cette revue.
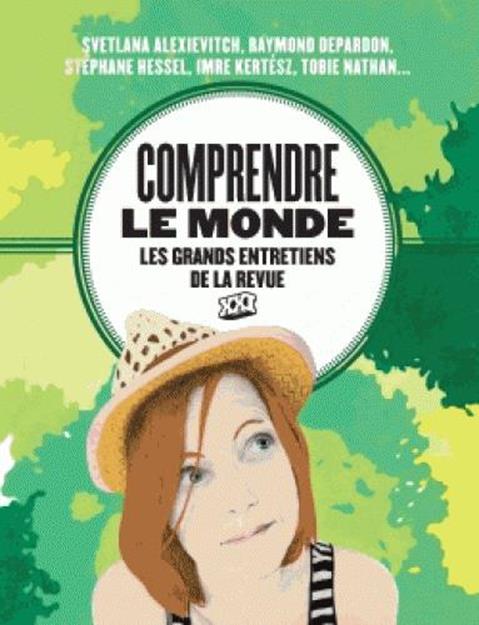 Ce livre est, en effet, paru fin 2016.
Ce livre est, en effet, paru fin 2016.
Ce livre reprend donc de grands entretiens d’écrivains, photographes, militants, historiens ou scientifiques…
Ils ont 30 comme 90 ans. Ils viennent d’Europe, d’Asie, d’Amérique ou d’Afrique.
Ils ont pour nom Xu Ge Feï, Raymond Depardon, Amin Maalouf, Michelle Perrot,Tobie Nathan, Vandana Shiva, Bronislaw Geremek…et d’autres encore.
A partir de demain, je vais vous inviter à partager leurs réflexions, leurs histoires, leurs analyses et souvent leurs histoires.
<1414>
-
Dimanche 3 mai 2020
«Pour aller plus haut»Alicia Gallienne, Cerise d’eau de vieMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Qu’écrire ce dimanche ?
Certainement pas reparler du sujet qui occupe tout l’espace médiatique.
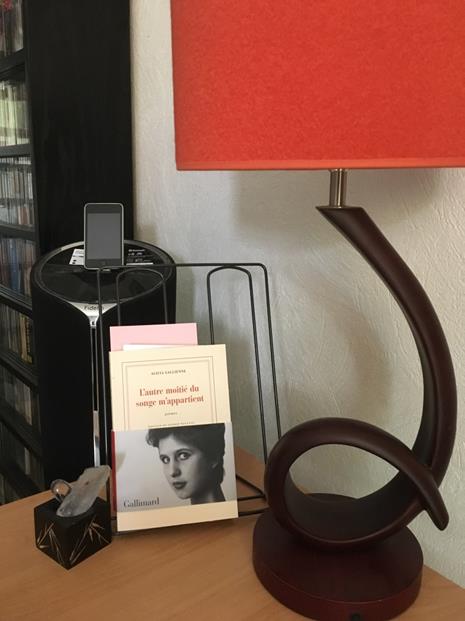 J’ai sur mon bureau d’écriture des mots du jour, un livre qui, comme la Joconde, me regarde.
J’ai sur mon bureau d’écriture des mots du jour, un livre qui, comme la Joconde, me regarde.
Ce livre, j’en ai déjà parlé trois fois : « L’autre moitié du songe m’appartient »
Je l’ouvre et je tombe page 311
C’est la fin d’un poème
Le poème a pour titre : « Cerise d’eau de vie »
Une vie suffit pour disparaître
Comme on est venu
Avec en poche quelques alibis de bonheur
Avec en tête la folle magie de lassitude
Qui engourdit la marche
Avec des mains pleines et douces
Au profil d’écume de jour
Avec cette échelle de rêves déterrés
Pour aller plus haut
Alicia Gallienne
Vous trouverez l’intégralité de ce poème derrière ce lien : Cerise d’eau de vie – Alicia Gallienne
<1413>
-
Samedi 2 mai 2020
«Symphonie no 9 en ut majeur « La Grande » D. 944»Franz SchubertMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
La symphonie n° 9 appelée la grande, une des plus belles symphonies romantiques du répertoire a été achevée en mars 1828. Il semblerait que cette œuvre ait été commencée en 1825, mais ce qui est certain c’est qu’elle a été achevée lors de cette fameuse année 1828 dont Benjamin Britten disait qu’elle était l’année la plus féconde de l’Histoire de la musique, parce que ce fut la dernière de la vie de Schubert et que jamais de mémoire d’homme, un compositeur n’a écrit autant de chef d’œuvre que Schubert, cette année-là.
Brigitte Massin écrit dans son livre monumental sur Schubert (p1222) :
« Dès la mort de Schubert, il semble, pour ses amis proches, qu’il y ait eu un rapport étroit, voire une identité absolue, entre la symphonie composée ou ébauchée – ou projetée – à Gastein en 1825 et la symphonie achevée en 1828 mais aucun document ne permet d’affirmer l’identité des deux œuvres. […] Beaucoup d’obscurités y demeurent. Le seul élément de certitude est qu’à la date de mars 1828, l’œuvre est conçue dans la totalité de son architecture, entièrement réalisée dans son écriture. »
Cette symphonie s’inscrit dans la suite de la symphonie inachevée (8) dont elle apparaît comme l’aboutissement.
Brigitte Massin écrit :
« Schubert résout la contradiction : […] traduire, lui habitué au dépouillement et au raffinement psychologique du lied, le mystère de l’intériorité par un langage symphonique.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit dès les premières mesures de la symphonie avec la longue phrase (8 mesures) des cors solistes. Porche insolite et génial qui introduit d’un seul coup au mystère de la prospection intérieure, requiert immédiatement la totalité de la concentration sur ce point focale et par le fait rend inutile et illusoire toute attention à un univers autre que celui qui soit se découvrir au terme de cet appel. »
Et il est vrai qu’après ce « porche insolite et génial » introductif, Schubert va nous mener au bout de l’émotion et de la beauté de ce chef d’œuvre.
 La période de confinement a incité des musiciens à mettre sur le support numérique des concerts anciens.
La période de confinement a incité des musiciens à mettre sur le support numérique des concerts anciens.
C’est ce qu’a fait l’Orchestre National de Lyon avec un beau concert du 28 avril 2018 à l’Auditorium de Lyon, dans lequel il interprétait justement la 9ème symphonie de Schubert D944.
Et puisqu’il existe une excellente version bien enregistrée sur Internet de notre Orchestre National de Lyon, pourquoi s’en priver ?
<La 9ème de Schubert par L’Orchestre national de Lyon dirigé par Karl-Heinz Steffens>
Pour les esprits curieux, il est possible d’aller un peu plus loin.
Nous savons déjà que cette symphonie comme beaucoup d’autres œuvres d’envergures n’ont jamais été interprétées de son vivant.
Les oreilles de Schubert n’ont jamais entendu ce que son génie a composé.
Un concert hommage à Schubert se tiendra à Vienne le 14 décembre 1828, un peu moins d’un mois après sa mort (19 novembre). Il ne s’agit que du deuxième concert public d’œuvres de Schubert, le premier et le seul de son vivant a eu lieu le 28 mars 1828.
Ses amis souhaitent faire jouer cette symphonie. Mais les musiciens de l’orchestre se récusèrent devant la longueur de l’œuvre et sa difficulté (surtout pour le quatrième mouvement) et l’œuvre ne fut pas jouée.
Wikipedia précise :
« Les musiciens de la Gesellschaft der Musikfreunde la jugèrent « difficile et pompeuse » (« schwierig und schwülstig » »
Par la suite la partition de cette œuvre va se retrouver entassée avec d’autres compositions de Schubert dans la maison d’un de ses frères : Ferdinand.
J’ai trouvé ce récit dans un programme en ligne de l’Orchestre Symphonique de Chicago :
« Lorsque Franz Schubert est décédé à l’âge de trente et un ans, l’inventaire légal de ses biens meubles indiquait trois manteaux habillés en tissu, trois redingotes, dix paires de pantalons, neuf gilets, un chapeau, cinq paires de chaussures, deux paires de bottes, quatre chemises, neuf foulards et mouchoirs de poche, treize paires de chaussettes, un drap, deux couvertures, un matelas, une housse de plumes et un contre-plat [couvre-lit]. « Mis à part quelques morceaux de musique ancienne », a conclu le rapport, « aucun effet n’a été retrouvé.
Il s’est avéré que certaines musiques anciennes faisaient référence à quelques livres de musique d’occasion et non à ses manuscrits. Ceux-ci étaient avec son ami Franz von Schober, qui les a ensuite confiés au frère de Schubert, Ferdinand. Personne, semble-t-il, n’a bien compris leur valeur. À la fin de 1829, Ferdinand a vendu d’innombrables lieder, œuvres pour piano et musique de chambre à Diabelli & Co. – qui a pris le temps de les publier – laissant de côté les symphonies, les opéras et les messes qui restaient sur des étagères à la maison. [Ferdinand eu quelques échanges épistolaires] avec le grand compositeur Robert Schumann, alors rédacteur en chef du prestigieux Neue Zeitschrift für Musik. Le journal contenait une liste des «plus grandes œuvres posthumes de Franz Schubert» disponibles à la vente.
 Cimetière central de Vienne avec la tombe de Schubert à droite et Beethoven à gauche.
Cimetière central de Vienne avec la tombe de Schubert à droite et Beethoven à gauche.
Le jour du Nouvel An 1837, Robert Schumann se retrouve à Vienne et pense à se rendre au cimetière de Währing pour visiter les tombes de Beethoven et Schubert, dont les pierres ne sont séparées que par deux autres. Sur le chemin du retour, il se souvint que Ferdinand vivait toujours à Vienne et décida de lui rendre visite. Voici le compte rendu de Schumann :
« Il [Ferdinand] me connaissait à cause de cette vénération pour son frère que j’ai si souvent exprimée publiquement. Il m’a d’abord dit et montré beaucoup de choses. . . . Enfin, il m’a permis de voir ces précieuses compositions de Schubert qu’il possède encore. La vue de ce trésor de richesses m’a subjugué de joie. Où commencer, où finir ! Entre autres choses, il a attiré mon attention sur les partitions de plusieurs symphonies, dont beaucoup n’ont encore jamais été entendues, mais ont été classées comme trop lourdes et compliquées.
Là, parmi les piles, gisait un lourd volume de 130 pages, daté de mars 1828 en haut de la première feuille. Le manuscrit, y compris la date et un certain nombre de corrections, est entièrement de la main de Schubert, qui semble souvent avoir volé aussi vite que sa plume. L’œuvre, une symphonie en ut, la dernière et la plus grande de Schubert, n’avait jamais été jouée. »
Robert Schumann était un grand compositeur mais aussi un remarquable musicologue et critique musical. Il avait un goût très sûr et L’Histoire a souvent donné raison à ses jugements musicaux sur ses contemporains.
Il sut reconnaître la qualité de cette œuvre et l’envoya rapidement au directeur des concerts du Gewandhaus de Leipzig, où son ami et autre grand compositeur Mendelssohn dirigea la première représentation le 21 mars 1839, plus de 10 ans après la mort de Schubert.
Ce fut cependant une version écourtée de la symphonie.
Schumann dans son journal, Neue Zeitschrift für Musik, écrivit :
« Je le dis d’emblée clairement : qui ne connaît pas cette symphonie connaît encore bien peu de choses de Schubert. […] En dehors de la maîtrise de la technique musicale de composition, il y a ici de la vie dans toutes les fibres, les plus fines nuances de coloris, de la signification en tout passage, la plus vive expression des détails et enfin, répandu sur le tout, un romantisme tel qu’on le connaît déjà en d’autres œuvres de Schubert. . Et les célestes longueurs de cette symphonie comme un gros roman en quatre volumes de Jean Paul…il faudrait copier toute la symphonie pour donner une idée du caractère littéraire qui la traverse. Du second mouvement seulement, qui nous parle d’une voix si touchante, je ne veux pas prendre congé sans un mot. Il contient un passage où un cor semble lancer un appel de loin et qui me paraît être venu à nous d’une autre sphère. Ici tout semble être à l’écoute, comme si un hôte céleste se glissait furtivement dans l’orchestre. – La symphonie a produit parmi nous un effet que n’a atteint aucune autre depuis celles de Beethoven… ».
C’est donc dans cet article consacré à la 9ème symphonie, que Robert Schumann inventa le concept de « célestes longueurs » une autre traduction parle des « divines longueurs » de Schubert.
Ce concept qui donna lieu à cet échange entre Igor Stravinsky et un journaliste :
« Ne craignez-vous pas que les divines longueurs de Schubert vous plongent dans le sommeil ? »
Stravinsky répondit :
« Que m’importe, si lorsque je me réveille je suis au paradis ! »
En 1840, l’Œuvre est enfin éditée par Breitkopf et Härtel à Leipzig.
Wikipedia nous apprend que l’œuvre ne reçut pas un bon accueil à Londres, où la répétition dirigée par François-Antoine Habeneck fut ponctuée de rires des violonistes lors du dernier mouvement qui est techniquement difficile. La pièce fut finalement donnée aux États-Unis avant Paris, où elle ne fut jouée qu’en 1851.
<La 9ème de Schubert par L’Orchestre national de Lyon dirigé par Karl-Heinz Steffens>
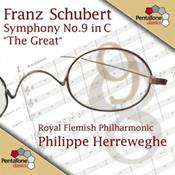 Si vous voulez disposer d’une version dématérialisée je vous informe que Qobuz offre jusqu’au 15/05/2020 le téléchargement gratuit de la version de Philippe Herreweghe.
Si vous voulez disposer d’une version dématérialisée je vous informe que Qobuz offre jusqu’au 15/05/2020 le téléchargement gratuit de la version de Philippe Herreweghe.
C’est une œuvre particulièrement enregistrée, il existe beaucoup de belles versions. Pour cette œuvre, ne choisissez pas Karajan, ce n’est pas son univers. La version historique est celle de Josef Krips avec l’Orchestre Symphonique de Londres.
Plus récemment, Gunter Wand, Claudio Abbado et Mariss Jansons ont été des interprètes éminents de cette œuvre
<1412>
-
Vendredi 1er mai 2020
«Mais nous, dis, nous resterons tendres ?
On va pas se faire avaler !»Sophie Fontanel, lettre à son frèreMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Nous sommes le 1er mai. Je n’écris jamais de mot du jour le 1er mai, ni les autres jours fériés, ni les week ends.
Mais depuis Samedi 28 mars et sur une suggestion de Jean-François, j’écris aussi ces jours, pendant cette période de confinement. J’arrêterai cette pratique probablement après le 11 mai, pour reposer l’esprit, la plume et l’inspiration.
 Augustin Trapenard continue sur France Inter, chaque matin à neuf heures moins 5, à lire une lettre que lui a envoyée un écrivain ou un artiste dans sa chronique : <Lettres d’intérieur>.
Augustin Trapenard continue sur France Inter, chaque matin à neuf heures moins 5, à lire une lettre que lui a envoyée un écrivain ou un artiste dans sa chronique : <Lettres d’intérieur>.
J’ai partagé le samedi 4 avril la lettre de l’écrivain algérien Yasmina Khadra à sa mère décédée et le dimanche 19 avril la lettre d’un autre écrivain Wajdi Mouawad à son fils : « Donne du courage autour de toi et n’accepte jamais ce qui te révulse… »
Cette fois c’est la lettre d’une écrivaine à son frère : « Tu t’en souviens très bien je pense, de la chambre de notre enfance… »
Cette lettre a été lue le vendredi 17 avril, il y a deux semaines.
L’écrivaine qui est aussi journaliste s’appelle Sophie Fontanel.
Sophie Fontanel est issue d’une famille d’origine arménienne., Actuellement elle est journaliste à l’Obs.
Elle est née en 1962 et publie des livres depuis 1995. En tant que journaliste elle est spécialiste de la mode.
Elle exprime des positions qui me plaisent. Ainsi, elle évoque cette incongruité qui veut que les hommes qui vieillissent restent séduisants et deviennent même sages alors qu’« On fait croire aux femmes qu’elles n’ont pas le droit de vieillir ».
Elle parle aussi de cette injonction aux femmes de teindre leurs cheveux. Elle la refuse et entend garder ses cheveux blancs : « Mes cheveux blancs m’ont fait entrer dans la lumière »
Vous trouverez sa lettre ci-après. Mais je crois qu’il faut surtout l’écouter.
Sophie Fontanel a twitté :
« La façon dont Augustin Trapenard lit…
il a lu cette Lettre à mon frère ce matin…
et c’était comme si je la découvrais. »
« Tu t’en souviens très bien je pense, de la chambre de notre enfance… »
Normandie, le 16 avril 2020
Lettre à mon frère,
Mon frère, tu es là près de moi.
Je te vois faire une réussite.
Eh, c’est un « solitaire », dis-moi !
Tu vois que je comprends très vite…
Je t’embête avec la télé,
Je ne veux plus la regarder,
Et je t’oblige à mettre un casque,
C’est ça, quand on n’a pas de masque.
Le studio est face à la mer,
Tu vis là depuis une année…
Et que penserait notre mère
À nous voir ici confinés ?
Ta seule possession sur terre
Ces tout petits mètres carrés.
Devant l’infini on se terre
Et l’on regarde les marées.
Quand tu es venu me chercher,
Déjà, on n’osait rien toucher…
Maintenant, on est immobiles.
On sort pas, on est inutiles.
On écoute les médecins,
Et tu m’as dit : « Ce sont des saints ».
Tu t’en souviens très bien je pense
De la chambre de notre enfance,
Le paquet de Choco BN
Et la bouteille de Fruité…
Je vois la vie se répéter.
Il y a des gens qui ont la haine
Parce que je suis venue ici
Au lieu de rester à Paris.
Mais je ne vois vraiment personne
À part l’horizon et ton rire
Quand notre humour enfin résonne
Et nous fait échapper au pire.
Les gens qui n’ont plus de famille
Ceux qui n’ont rien au-dessus d’eux,
Ils savent pourquoi on est deux,
Même espacés comme des quilles.
C’est drôle, ce mètre de distance
Il nous fait frôler tout le sens
Que l’on ne voyait plus aux choses,
Même si c’est une indécence
De voir les mots que certains osent.
Notre père racontait la guerre,
Ce qui se révélait en l’homme
Ce que l’on ne pouvait plus faire,
La vie réduite au minimum.
Notre mère en parlait aussi,
Paris était à la merci
D’une autre maladie virale,
La lâcheté d’un Maréchal.
Elle avait 16 ans en 39,
Et ils se partageaient un œuf.
On est loin de sa catastrophe,
Donc il faut rester philosophes.
Ses dents étaient toutes barrées
Elle avait manqué de calcium
Et elle souriait, contrariée,
En planquant tout au maximum.
Je te regarde mettre des cœurs
Sur des carreaux et sur des piques,
On discutera tout à l’heure,
Tu diras : « Qu’est-ce que tu fabriques ? »
Tu me soupçonneras d’écrire,
C’est ainsi depuis des années,
J’écouterai ta réthorique,
Et je t’admire, mon aîné.
Toi, tu découvres mon métier.
Je redécouvre ta bonté.
Tu sais comment ça va finir ?
L’être humain ne va rien comprendre
Et tout ce qu’il croit approcher
Tout ce grand vers quoi il croit tendre
Bah, ça fera des ricochets.
Il y aura des choses à vendre.
Et bien sûr, on va resaler.
Mais nous, dis, nous resterons tendres ?
On va pas se faire avaler !
Voilà, maintenant tu repères
Pourquoi j’ai voulu ce matin
Te faire écouter France Inter :
On parle de toi, mon frangin…
On parle de tous les frangins.
Sophie Fontanel
<1411>
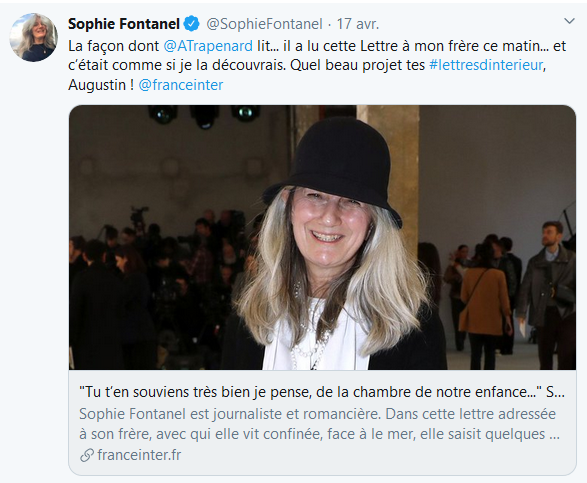
-
Jeudi 30 avril 2020
« Je pense qu’il faut qu’on ait des masques dans l’espace public. »Gérard CollombCe matin Gérald m’a envoyé une information, publiée sur Lyon-Mag :
 La maire en sursis de Lyon (*) Gérard Collomb veut imposer le port obligatoire du masque dans la ville qu’il dirige encore :
La maire en sursis de Lyon (*) Gérard Collomb veut imposer le port obligatoire du masque dans la ville qu’il dirige encore :
« C’est une mesure forte annoncée ce jeudi matin par Gérard Collomb.
Sur France Info, le maire de Lyon a expliqué qu’à partir du 11 mai, le port du masque devrait être obligatoire dans les rues de la capitale des Gaules.
« Je pense qu’il faut, si on veut éviter d’avoir un rebond sur l’épidémie à la fin du mois de mai, qu’on ait des masques dans l’espace public », a précisé Gérard Collomb, souhaitant s’inspirer des pays asiatiques et nordiques. »
Mais Gérald a immédiatement ajouté :
 « De toute façon, impossible à appliquer car la loi interdit de se cacher le visage. Il me semble bien que la loi est supérieure à une décision municipale. Il va donc falloir changer la loi. »
« De toute façon, impossible à appliquer car la loi interdit de se cacher le visage. Il me semble bien que la loi est supérieure à une décision municipale. Il va donc falloir changer la loi. »
J’ai alors répondu :
« Non je crois que la loi permet de déroger à la règle générale pour des raisons sanitaires. Je vais voir ça, cela occupera ma matinée »
Gérald n’était pas convaincu que cette quête soit utile :
 « Je pense que tu as d’autres possibilités d’occupation.
« Je pense que tu as d’autres possibilités d’occupation.
Préparer le prochain mot du jour par exemple. »
Alors pour réaliser ce que je souhaitais faire et écouter son conseil, j’en fais un mot du jour.
Il faut donc en revenir à la source et grâce à Légifrance, c’est un jeu d’enfant
« LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public »
Cette Loi dans son article premier édite l’interdiction :
« Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. »
Voilà une règle simple et sans ambigüité.
Mais nous sommes en France, pays des droits de l’homme, de la nuance et … des exceptions.
Et il suffit d’aller à l’article 2 IIème paragraphe pour constater que l’exception a bien été prévue :
II. ― L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.
 Il y a donc bien eu, dans un bureau obscur du ministre de la justice et qui s’appelait alors ministre de la justice et des libertés et qui était dirigé par Michèle Alliot Marie, un fonctionnaire vigilant qui a imaginé qu’il pourrait exister quelque chose qui ressemble au COVID-19 et a donc soulevé cette petite exception :
Il y a donc bien eu, dans un bureau obscur du ministre de la justice et qui s’appelait alors ministre de la justice et des libertés et qui était dirigé par Michèle Alliot Marie, un fonctionnaire vigilant qui a imaginé qu’il pourrait exister quelque chose qui ressemble au COVID-19 et a donc soulevé cette petite exception :
« L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est […] justifiée par des raisons de santé. »
Et ainsi grâce à la prévoyance de ce fonctionnaire, bureaucrate disent les ennemis de l’État, il est possible à la fois de respecter la Loi et de porter un masque pour protéger les autres du coronavirus SARS-CoV-2.
Car au-delà de toute polémique, il faut rappeler que le port du masque commun que l’on porte dans la rue n’a pas pour fonction de protéger celui qui le porte, mais de protéger les autres d’une éventuelle contamination que pourrait communiquer le porteur du masque.
(*) Gérard Collomb ne serait plus maire de Lyon sans COVID-19 parce qu’il y aurait une nouvelle équipe municipale au pouvoir. Or, Gérard Collomb ne s’étant pas présenté aux élections municipales mais à la métropole, ne pourrait plus être maire de Lyon.
 <1410>
<1410> -
Mercredi 29 avril 2020
«Je ne reprocherai jamais à un joueur de respecter l’éthique du jeu.»Robert Herbin après la défaite de Saint Etienne à Liverpool en 1977Dans ma famille, la grande passion était la musique qui était devenu le métier de mon père et qui a toujours été le métier de mon frère ainé Gérard.
Mais nous nourrissions tous une passion, disons secondaire, pour le football. Mon frère Roger a d’ailleurs abandonné le piano pour se consacrer davantage au football qu’il a pratiqué fort longtemps dans des clubs amateurs de très bon niveau. Mon père et moi avons ainsi visité de très nombreux stades de football de l’Est de la France pour le suivre.
Et Parallèlement nous avons suivi l’épopée des verts de l’AS Saint-Etienne sous la direction de Robert Herbin.
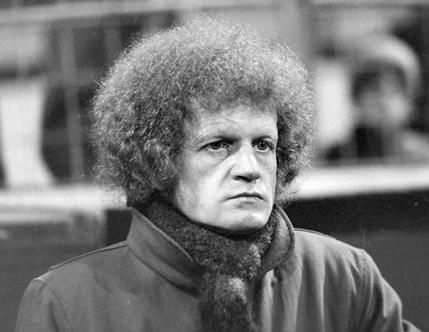 Depuis je me suis éloigné du football, j’ai expliqué ce malaise lors de plusieurs mots du jour consacrés au football et notamment la série réalisée avant la coupe du monde de 2018 en Russie et que j’avais mis sous la philosophie de cette phrase de Camus : «Ce que je sais de la morale, c’est au football que je le dois… »
Depuis je me suis éloigné du football, j’ai expliqué ce malaise lors de plusieurs mots du jour consacrés au football et notamment la série réalisée avant la coupe du monde de 2018 en Russie et que j’avais mis sous la philosophie de cette phrase de Camus : «Ce que je sais de la morale, c’est au football que je le dois… »
Il est vrai que depuis cette époque la financiarisation du monde s’est aussi abattue sur le monde du football, dans lequel le fric peut tout, envahit tout, salit tout.
Déjà à la fin de l’épopée des verts, Robert Herbin fut aussi touché par le scandale de la caisse noire mise en place par le président du club Roger Rocher noyé dans ses rêves de grandeur et de besoin d’argent pour faire face au début de l’inflation sur le marché du football.
C’était le début de la fin pour mon grand intérêt pour le football.
Mais avant, il y eut les 3 magnifiques épopées des verts en coupe d’Europe des champions.
Bien sûr, tout le monde parle des poteaux carrés du stade des Glasgow Rangers qui selon la légende avait empêché Saint Etienne de marquer un but à Sepp Maier, le mythique gardien du Bayern Munich.
Robert Herbin affirme ne jamais avoir revu ce match. Mais un autre joueur l’avait revu. Je ne me souviens plus du nom de ce joueur mais je me souviens de son analyse :
« Je croyais qu’on avait dominé le Bayern Munich, mais après avoir revu, le match j’ai compris que c’était eux qui le maîtrisait.»
Quelquefois les premières impressions sont trompeuses. Mais c’est avec cette légende et ces premières impressions d’une équipe de Saint Etienne quasi vainqueur qu’il avait été décidé de faire défiler l’équipe sur les Champs Elysées comme après chaque victoire sur les allemands …
Lors de la première épopée lors de la saison 1974-1975, Saint Etienne avait été stoppée en demi-finale déjà par le Bayern de Munich. Mais avant cela en Huitième de finale, Saint Etienne avait fait vibrer toute la France. Après un médiocre match aller en Yougoslavie perdu 4-1, Saint Etienne a réalisé un exploit au retour en battant Hajduk Split par 5-1. Cette remontée est restée dans ma mémoire, comme un moment d’émotion. Je pense que je ne suis pas le seul.
Puis la saison suivante, l’année de la finale, il y eut un autre retournement en quart de finale contre le Dynamo Kiev. Après un 2-0 à l’aller, Saint Etienne a vaincu le club du ballon d’or, Oleg Blokhine, 3-0.
Et puis vint la demi-finale avec une défense héroïque au PSV Eindhoven 0-0 après une victoire sur le plus petit score à l’aller à Geoffroy Guichard.
Mais c’est sur un autre match que je voudrai revenir, c’était la saison suivante, en quart de finale contre Liverpool.
Saint Etienne avait gagné le match aller 1-0 et le retour avait lieu dans le stade de l’Anfield Road dans lequel les supporters de Liverpool chante des hymnes qui subjuguent les adversaires de leur club et notamment le fameux « You’ll never walk alone ».
Ce fut un match magnifique. Saint Etienne était qualifié jusqu’à 6 minutes de la fin du match.
<Les cahiers du football> racontent alors ce qui s’est passé :
« La fatigue se fait sentir de part et d’autres et les entraîneurs commencent à procéder à quelques remplacements. Alain Merchadier a le visage en sang et se fait remplacer par un attaquant, Hervé Révelli. Robert Herbin est convaincu que le meilleur moyen de défendre face aux Reds est de les prendre à la gorge. De son coté, Bob Paisley remplace John Toshack par un jeune rouquin, quasiment inconnu chez nous, David Fairclough.
Le gamin de vingt ans est bien en jambes. À Liverpool, on le surnomme déjà Super-Sub pour avoir en quelques occasions inscrit un but important peu après son entrée en jeu. Lorsqu’il est lancé par Ray Kennedy, à la 84e minute de ce quart de finale contre Saint-Étienne, il se montre plus rapide que Christian Lopez. Il entre dans la surface de réparation, contrôle et frappe du pied droit. Le ballon passe sous Ivan Curkovic et va mourir au fond des filets.
« Supersub strikes again !« , s’égosille le commentateur de la BBC. Les images sont gravées dans l’inconscient collectif: Fairclough court ses longs bras levés devant le Kop qui, comme embrasé, est devenu entièrement rouge. 3-1, les Verts ne s’en relèveront plus. Certains esprits reprocheront à Christian Lopez de ne pas avoir su stopper la course du rouquin, de ne pas avoir commis la faute qui aurait empêché le but »
 Lopez n’a pas fait le croc en jambe avant la surface de réparation qui aurait annihilé la course de l’anglais contre un coup franc beaucoup moins dangereux.
Lopez n’a pas fait le croc en jambe avant la surface de réparation qui aurait annihilé la course de l’anglais contre un coup franc beaucoup moins dangereux.
Après le match, on a demandé à Robert Herbin s’il ne regrettait pas que Lopez n’ait pas taclé Fairclough. et par un acte d’anti-jeu permis à Saint-Etienne de se qualifier. La réponse de Herbin fut la suivante :
« Je ne reprocherai jamais à un joueur de respecter l’éthique du jeu »
Je n’ai pas retrouvé cette phrase sur internet, je la cite de mémoire et je suis certain de l’esprit de la réponse sans être sur des mots.
Cette saison-là Liverpool allait gagner sa première ligue des champions avant beaucoup d’autres et mettre fin au règne du Bayern de Munich vainqueur des trois dernières éditions.
Saint-Etienne si elle s’était qualifiée aurait peut être gagné la coupe, le Bayern était éliminé. Robert Herbin ne gagna jamais cette compétition.
On apprend beaucoup par le football, aussi qu’on peut mettre les valeurs et l’éthique avant la victoire. Tel était Robert Herbin.
On trouve sur le site de l’AS Saint-Etienne, le récit suivant :
« La suite est connue avec ce maudit 3e but de la part de Fairclough, à 6 minutes de la fin du match, remplaçant de luxe qui a l’habitude d’être décisif à chaque fois qu’il rentre. Christian Lopez a essayé de l’arrêter mais il n’a pas commis l’irréparable pour l’empêcher d’aller au bout de son action qui s’est terminé par un tir à ras de terre imparable. Il aurait pu pourtant et aujourd’hui, un défenseur ne se serait même pas posé la question mais à pas à l’époque. Il est trop tard pour revenir et Saint-Etienne est éliminée alors que tous les observateurs sont unanimes une fois de plus pour souligner que les Français ont réalisé certainement leur meilleur match européen. Cela n’a pas suffi et bien peu peuvent s’imaginer en fait qu’ils ont assisté à Anfield Road à la fin d’une épopée.
Obsédé par cette coupe dEurope, Roger Rocher va alors abandonner la politique de formation qui avait fait la force de l’ASSE pour recruter des stars avec le résultat que l’on connaît.
Pour sa part, Liverpool va continuer sa route qui le mènera jusqu’à la victoire finale. Quand on sait que les Anglais ont affronté le FC Zurich en demi-finale qu’ils ont surclassés ainsi que les Allemands du Borussia Moenchengladbach qu’ils ont facilement battu en finale (3-1), les regrets peuvent être éternels pour la troupe de Robert Herbin. »
Il y a une autre raison qui me plait chez Robert Herbin qui a quitté ce monde le 27 avril 2020, c’était un mélomane averti. Il rejoint ainsi ma première passion
Claude Askolovitch rapporte dans sa revue de presse de ce mardi:
« On parle d’une symphonie…Qui porte le beau nom de « Résurrection » et qu’un père musicien fit découvrir à son fils footballeur et blessé, c’était en 1966: Robert Herbin pendant la Coupe du monde était passé à la moulinette d’un anglais
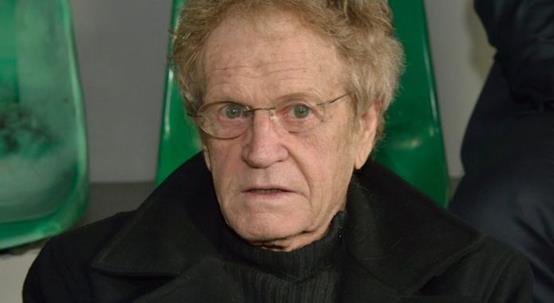 destructeur, Nobby Stiles, on ne savait pas s’il marcherait à nouveau, mais le papa de Robert jouait du trombone à l’opéra de Nice et savait ce qui guérit, la deuxième symphonie de Gustav Mahler, Résurrection. Robert qui marcha et joua à nouveau et puis fut entraineur et pendant le football et après le football continua à chérir Mahler et ce matin l’on me parle de Gustav Mahler dans l’Equipe, sur le site France Info dans le Parisien dans le Progrès où je vois des photos en noir et blanc d’un enfant footballeur puis d’un homme au même regard habité… C’est au Progrès qu’Herbin avait raconté en 2009 la naissance de sa passion musicale….
destructeur, Nobby Stiles, on ne savait pas s’il marcherait à nouveau, mais le papa de Robert jouait du trombone à l’opéra de Nice et savait ce qui guérit, la deuxième symphonie de Gustav Mahler, Résurrection. Robert qui marcha et joua à nouveau et puis fut entraineur et pendant le football et après le football continua à chérir Mahler et ce matin l’on me parle de Gustav Mahler dans l’Equipe, sur le site France Info dans le Parisien dans le Progrès où je vois des photos en noir et blanc d’un enfant footballeur puis d’un homme au même regard habité… C’est au Progrès qu’Herbin avait raconté en 2009 la naissance de sa passion musicale….
On me parle de Gustav Mahler parce que vous le savez Robert Herbin est mort et l’on égrène alors ce qui compta dans une vie qui changea la nôtre… »
Donc la symphonie N° 2 « Résurrection » de Mahler dont j’avais fait l’objet du mot du jour du <Dimanche 5 avril 2020>.
Claude Askolovitch qui nous donne aussi l’explication pourquoi on appelait Robert Herbin, le sphinx. Ce nom lui avait été donné par le journaliste Jaques Vendroux
« Vendroux, il le raconte à l’Equipe, était supporter et ami de Herbin, dont il avait trouvé le surnom qui fait la Une de l’Equipe ce matin, « la légende d’un sphinx », un jour où il s’était mis en colère contre Robert qui répondait par des oui monosyllabiques à ses question s: « T’es un sphinx, tu ne réagis pas, tu ne dis rien! » »
Robert Herbin vivait comme un ermite près de Saint Etienne. Il avait sombré dans l’addiction à l’alcool.
Pourquoi cette solitude, ce retrait ?
Jean-François Larios, ancien joueur de Saint Etienne alors que Robert Herbin était l’entraîneur donne son explication de ce retrait :
« Parce qu’à un moment donné, parler aux cons, ça les enrichit. Et il n’en avait plus envie. Il a préféré terminer ses jours dans son monde, entouré de ses chiens et bercé par sa musique. Sans déranger personne. »
Cette solitude au temps du confinement a conduit à une finitude triste :
« Éloigné volontairement de ses anciens coéquipiers et amis, il n’avait pour seule compagnie son chien. Il bénéficiait de l’aide d’une femme de ménage et d’un proche qui faisait ses courses, mais avec le confinement, il s’est retrouvé démuni. C’est sa sœur, inquiète de ne pas avoir de nouvelles depuis plusieurs jours, qui a lancé l’alerte. La gendarmerie a alors découvert Robert Herbin incapable du moindre mouvement, désorienté et en déshydratation. Le CHU de Saint-Etienne, malgré la crise du coronavirus, a pu lui trouver un lit. »
Sic transit gloria mundi
« Ainsi passe la gloire du monde ».
<1409>
-
Mardi 28 avril 2020
«Si on est conscient que la paresse est aussi la condition à un certain renouvellement des idées, nécessaire à la productivité qu’on recherche, on peut avancer dans le bon sens.»Gwenaëlle HamelinLa paresse n’a pas bonne presse.
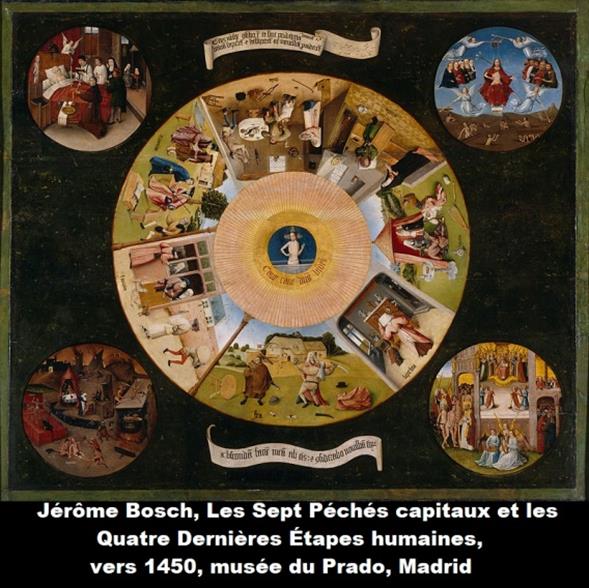 Elle fait partie de l’ensemble des 7 péchés capitaux que la religion catholique et Thomas d’Aquin ont répertorié comme les « vices » qui entrainent tous les autres.
Elle fait partie de l’ensemble des 7 péchés capitaux que la religion catholique et Thomas d’Aquin ont répertorié comme les « vices » qui entrainent tous les autres.
A l’école non plus la paresse n’est pas appréciée. « Paresseux » constitue souvent une critique très lourde à porter. « Dispose de potentialités, mais…la paresse l’emporte » et voilà un élève stigmatisé…
Dans la société comme dans le monde de l’emploi la réputation de paresse est quasi unanimement considérée comme un défaut. Et même un défaut impardonnable, parce que non excusable, dû uniquement à un manque de volonté.
Par rapport aux hikikomori décrits hier, plus que la réclusion chez leurs parents, ce qui est considéré comme le plus honteux est certainement le fait qu’ils se complaisent dans l’oisiveté et qu’ils sont donc paresseux.
Le confinement actuel, pour certains et pour certains seulement, peut conduire à une douce indolence, une paresse coupable voire des rêves fous d’un autre monde.
Le Centre patronal suisse s’en inquiète et veut lutter avec fermeté contre les effets nocifs du confinement :
« Il faut éviter que certaines personnes soient tentées de s’habituer à la situation actuelle, voire de se laisser séduire par ses apparences insidieuses: beaucoup moins de circulation sur les routes, un ciel déserté par le trafic aérien, moins de bruit et d’agitation, le retour à une vie simple et à un commerce local, la fin de la société de consommation… Cette perception romantique est trompeuse, car le ralentissement de la vie sociale et économique est en réalité très pénible pour d’innombrables habitants qui n’ont aucune envie de subir plus La mise à l’arrêt de nombreuses activités économiques, mais aussi sociales et politiques, a permis de limiter l’épidémie de coronavirus, mais elle a aussi un énorme coût financier et humain. Il faut maintenant – et le Conseil fédéral en est conscient – planifier un retour progressif à la normale »
Bernard Pivot, du haut de sa sagesse que lui donne son grand âge ne partage pas cette crainte : < Le confinement dans la paresse > et citent de nombreux auteurs qui en font l’éloge : Kundera, Baudelaire, Perec, Sagan, Kessel…
Il commence ainsi son article :
« Le plus célèbre des confinés de tous les temps, Robinson Crusoé, n’est pas tombé dans l’oisiveté. Pour survivre, il a été dans l’obligation de faire travailler son imagination et ses bras. Il n’en est pas de même pour les deux milliards de personnes tenues de rester chez elles pour lutter contre la propagation du coronavirus. Hormis celles et ceux qui ont la possibilité de recourir au télétravail et les mères et pères de famille nombreuse, les autres sont plus ou moins confinés dans l’inaction. Cela est insupportable pour certains. D’autres, au contraire, s’en accommodent, découvrant les plaisirs du temps à meubler, du temps à laisser filer, du temps à perdre. Ils pénètrent dans le monde enchanté, jusqu’alors inaccessible pour eux, de la paresse. »
J’avais déjà consacré un mot du jour à la paresse. C’était pour évoquer le livre du gendre de Karl Marx, Paul Lafargue, « Le droit à la paresse ». Livre qu’il avait écrit alors qu’il était incarcéré à la prison Sainte-Pélagie pour propagande révolutionnaire.
Un jour lors d’une des formations que j’ai suivie au cours de ma carrière, il m’avait été demandé de trouver un point de vue à défendre pour approfondir la capacité d’argumentation. J’avais alors défendu l’ide que c’était les paresseux qui avait fait avancer le monde.
J’avais à peu près tenu ce langage.
La société humaine est constamment écartelée par l’action de deux types de personnes : les paresseux et les besogneux.
Les besogneux travaillent, travaillent beaucoup sans se poser de questions. Ils font ce qu’il y a faire et veulent toujours faire plus.
Le paresseux voit faire les besogneux et il sent que la pression sociale l’oblige à réaliser à peu près le même boulot.
Alors le paresseux réfléchit et trouve la solution pour faire le même boulot que le besogneux mais en se fatigant moins.
C’est ainsi que c’est un paresseux qui a inventé la roue, parce qu’il ne supportait plus de porter de lourdes charges comme le besogneux.
C’est ce qu’on appelle le progrès.
Seulement, le besogneux est tapi dans l’ombre et c’est un copieur. Il s’est alors emparé de l’idée du paresseux pour porter des charges de plus en plus lourdes jusqu’à ce qu’un paresseux trouve l’idée du moteur etc.
J’avais tenu dix minutes à multiplier les exemples qui montrent ce balancement entre le progrès et le « toujours plus » dont nous souffrons aujourd’hui.
Alors j’ai été ravi d’apprendre que Bill Gates, le fondateur de Microsoft, disait :
« Je choisis une personne paresseuse pour un travail difficile, car une personne paresseuse va trouver un moyen facile de le faire ».
C’est ce que j’ai appris en écoutant l’émission de France Culture que j’ai évoqué hier et qui fait partie de la même série que « les hikikomori ».
 Car en réalité je n’ai découvert les hikikomori que dans un second temps, j’ai été attiré par l’émission qui avait pour titre : < Cherchons F/H paresseux pour un poste de directeur>
Car en réalité je n’ai découvert les hikikomori que dans un second temps, j’ai été attiré par l’émission qui avait pour titre : < Cherchons F/H paresseux pour un poste de directeur>
Nous sommes donc dans le monde de l’entreprise.
L’invitée était la psychologue du travail Gwenaëlle Hamelin, spécialiste du stress au travail et du burn out.
Le site de France Culture a mis sur la page de cette émission une photo de cette psychologue avec une peluche représentant un paresseux.
Je vous invite à écouter cette émission. J’en tire quelques extraits :
Elle insiste d’abord sur ce qui permet de déployer sa force de travail :
« L’énergie cela ne se décrète pas. L’énergie cela se puise dans le désir, dans l’envie. Et ça ce sont des valeurs qui ne s’apprennent pas, qui ne se décident pas, qui s’écoutent et c’est pour cela qu’il faut une certaine paresse et c’est cela que j’essaie de vivre au quotidien, qui me guide, qui me donne de l’énergie et que j’essaie d’essaimer quand j’interviens en entreprise ou quand je fais mes conférences. »
Alors évidemment dans l’entreprise ce n’est pas facile de dire qu’on a besoin de paresser un peu. C’est plutôt le contraire qui se passe et la psychologue pointe que souvent le salarié est complice de trop de travail.
« Aujourd’hui personne n’assume de dire qu’il accepte de se reposer, qu’il accepte de dire non. Même si on n’est pas surmené, souvent on véhicule l’image de quelqu’un qui l’est parce que c’est mieux pour sa carrière. C’est toujours bon de dire qu’on a travaillé tard, qu’on a travaillé le week end. Il y a une sorte de paradoxe à savoir si le travailler trop est subi ou choisi. Et même dans le burn out, il y a cette dualité : en effet il y avait un environnement qui poussait à travailler toujours plus et qui vous a fait exploser en vol. Et en même temps, on trouve en soi, un certain plaisir pour accepter ce challenge. »
Les personnes moins concentrées et moins productives seront plus à même d’observer et de repérer les signes. Adopter une certaine forme de paresse c’est diminuer son exposition au stress et au risque de burn-out.
« Aujourd’hui, on parle beaucoup de burn-out et on a oublié que cela existait déjà et qu’on appelait cela le surmenage. Il y a une différence, aujourd’hui on en parle et on comprend que c’est un phénomène menaçant, contre lequel il faut lutter et avoir des politiques de prévention. Alors qu’avant quand on parlait de surmenage c’était l’apanage du faible. Dans les offres d’emplois on pouvait même lire que dans les qualités recherchées il fallait une résistance importante au stress. Aujourd’hui personne ne s’autoriserait à marquer dans une offre d’emploi qu’il faudrait de la résistance au stress. Parce que cela véhiculerait une image de l’entreprise qui ferait partir les meilleurs candidats. […] Il y a donc une évolution des mentalités »
Toutefois Gwenaëlle Hamelin pense qu’il reste beaucoup à faire.
« Il y a une prise de conscience qui est en train de se dessiner. Les gens veulent du bien être avant toute chose. Et le bien-être, c’est s’autoriser une certaine paresse. Si on est conscient que cette paresse est aussi la condition à un certain renouvellement des idées, nécessaire à la productivité qu’on recherche, on peut avancer dans le bon sens. »
A ce stade l’émission renvoie vers une étude menée, en 2016, au Japon par le professeur Hasegawa . Il a fait une étude sur les parallèles entre des colonies de fourmis et les entreprises. Il a constaté que de 20% à 30% des fourmis ne font rien qui rentre dans la catégorie travail. Elles sont toutefois précieuses car elle dispose d’une réserve de force et prendront le relais de manière plus productive que les travailleuses en cas d’urgence.
Et c’est ainsi qu’on peut comprendre que les éléments considérés comme paresseux sont les seuls à être réactifs aux situations d’urgence. Les paresseux savent considérer et jouer habilement avec le temps, pour pouvoir être plus efficaces ensuite. Ils savent prioriser. En période de crise, ils ne se perdent pas dans les détails et se concentrent sur ce qui compte vraiment.
En outre le temps de paresse est aussi un temps de créativité.
Quand un salarie est toujours en activité, engluer à faire ce qu’il sait faire le plus vite possible sans s’arrêter, il ne reste aucun temps pour réfléchir, pour être créatif. Certes par entrainement, il est possible de faire de plus en plus vite ce que l’on sait faire. Mais on ne sort pas de là, on fait toujours la même chose, et ce n’est pas ainsi qu’on progresse et qu’on fait progresser l’entreprise.
Et la psychologue de rappeler le fameux « euréka » qu’Archimède a lancé en ayant compris la mécanique des fluides. Cette découverte scientifique majeure, il l’a découverte en paressant calmement dans son bain.
Bon je vous laisse écouter cette émission de moins d’une demi-heure : < Cherchons F/H paresseux pour un poste de directeur>
Il ne s’agit pas de ne rien faire, mais de se laisser du temps de réflexion, de paresse pour laisser murir sa créativité.
Comme le faisait si souvent l’inoubliable Gaston Lagaffe, créé en 1957 par André Franquin.
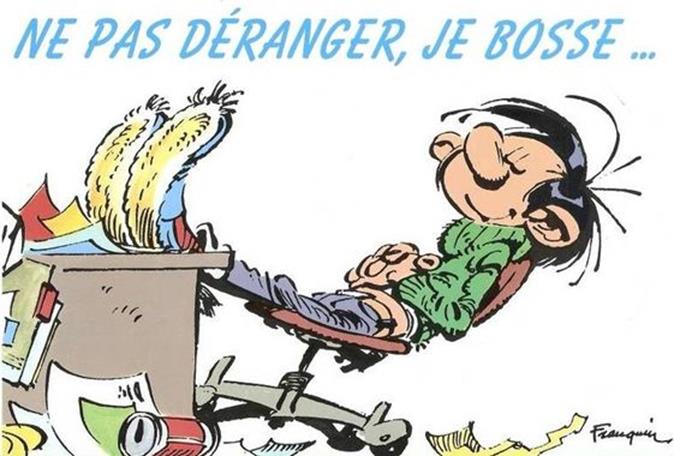
<1408>
-
Lundi 27 avril 2020
«Les Hikikomori»Phénomène japonais qui a tendance à s’étendreFrance Culture a consacré deux émissions à la paresse. Grâce à la première j’ai appris l’existence des hikikomori : « Les Hikikomori, se retirer pour ne rien faire »
C’est un phénomène qui serait apparu au début des années 1990 au Japon et qui tendrait à s’étendre aux États-Unis et à l’Europe.
Les hikikomori décident soudain de se couper du monde pour une durée indéterminée, et de se murer dans leur chambre, avec l’objectif de suivre le modèle d’une vie idéale, passée à ne rien faire : aucune ambition, aucune préoccupation vis-à-vis de l’avenir, un désintérêt total pour le monde réel.
Selon cette émission le phénomène toucherait aujourd’hui, au Japon, près d’un adolescent sur cent.
L’origine du terme « hikikomori » (hiki vient de hiku (reculer), komori dérive de komoru qui signifie « entrer à l’intérieur ») traduit un repli sur soi.
Dans une société japonaise dans laquelle la réputation sociale et le culte de la performance sont très valorisées, ce phénomène met en présence un enfant qui entend se retirer de la pression sociale et des parents paralysés par la honte d’avoir à leur domicile un enfant qui n’assume pas son rôle social. C’est pourquoi souvent les parents cachent la réalité.
Si j’ai bien compris dans le lieu de résidence les interactions sociales entre les parents et l’enfant sont également très réduites.
Le jeune homme, car il s’agit essentiellement d’un phénomène masculin, reste reclus dans sa chambre et souvent s’enferme.
Mais depuis quelques années cette pathologie est reconnue au Japon, des médecins et psychologues analysent ces cas et tentent d’aider les jeunes reclus à sortir de leur condition.
Pour qu’on parle d’hikikomori il faut que la réclusion dure plusieurs mois. Selon ce que j’ai compris, on fixe la limite inférieure à 6 mois, mais la réclusion peut durer plusieurs années.
Une fois qu’on connait le mot hikikomori, on constate qu’il existe beaucoup d’articles et d’émissions qui ont été consacrés à ce phénomène.
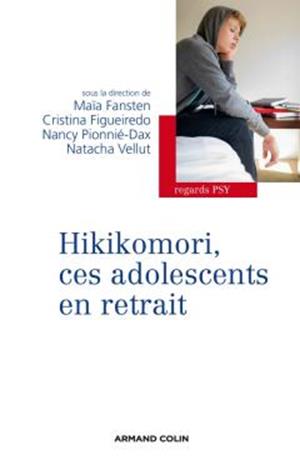 Il y a aussi un livre : « HIkikomori, ces adolescents en retrait » chez Armand Colin.
Il y a aussi un livre : « HIkikomori, ces adolescents en retrait » chez Armand Colin.
C’est un ouvrage collectif dans lequel sociologues, anthropologues, psychiatres, psychologues et psychanalystes essayent de décrire, comprendre et prendre en charge ce phénomène qui émerge
dans nos sociétés.En 2015, un film « De l’autre côté de la porte » de Laurence Thrush a également été consacré à ce phénomène.
En 2018, une autre émission de France Culture : < Les hikikomoris ou le retrait du monde > expliquait :
« En 2016, c’était près de 600 000 personnes qui avaient fait le choix de renoncer au monde. Un chiffre qui pourrait rapidement atteindre le million, tant le phénomène prend de l’ampleur ces dernières années.
L’AFP a ainsi rencontré un de ces « retirants » -selon les termes de la sociologue Maïa Fansten, spécialiste du sujet en France- un certain M. Ikeida, nom d’emprunt donné au journaliste, âgé de 55 ans et qui vit reclus dans sa chambre depuis près de trente ans.
Et c’est surtout une grande souffrance qui transparaît de cet entretien. Une souffrance et une décision de rejeter les impératifs de conformité auxquels l’astreignent la société, son entourage, sa famille. Il explique ainsi la pression et les brimades de sa mère pour qu’il réussisse à l’école.
Il raconte aussi son parcours sans faute, des bancs de l’une des meilleures universités de Tokyo, aux offres d’emploi qu’il reçoit de la part de grandes entreprises prestigieuses. Il parle enfin du déclic, de sa terreur de passer une vie en costume, à exercer un métier dénué de sens, dans un système compétitif qu’il abhorre.
Au-delà de cette expérience personnelle, nombreux sont les témoignages de « retirants » qui expliquent leur choix comme un réflexe de défense, une réaction de survie face à l’intense pression du système scolaire et du marché du travail japonais.
Certains parlent ainsi d’une volonté de faire cesser le temps. De créer un abri, un repli face aux vicissitudes du monde. Une pause avant l’entrée définitive dans la vie adulte. C’est l’aboutissement paradoxal d’une société qui, en multipliant les injonctions à la vitesse, à la croissance et au progrès, finit par reléguer certains de ses membres dans un état de paralysie sociale et de retranchement hors du temps.
Cette faille creusée comme une grotte primaire, cette rupture temporaire pour se panser dans un monde mauvais, pourraient avoir quelque chose de poétique, si elles ne traduisaient pas dans le même temps, une profonde souffrance humaine, un sentiment d’inadéquation avec la société dans laquelle ils ont été projetés.
Une situation encore aggravée par les mutations de la famille japonaise. C’est en tout cas ce qu’explique le neuropsychiatre Takahiro Kato pour qui on est passé de la famille traditionnelle, qui comptait beaucoup d’enfants et de générations réunies sous le même toit, à une cellule familiale réduite : père, mère et enfant, réduisant d’autant les mécanismes de solidarité familiale.
Ainsi de nombreux hikikomoris résident chez leurs parents, faute de moyens financiers, mais aussi comme une manière de se construire un cocon, protecteur et familier, dans un espace connu. Mais cela n’améliore pas nécessairement la situation. Comme l’explique Rika Ueda, qui travaille pour une association de parents, « les familles éprouvent une grande honte. Elles préfèrent cacher leur situation et à leur tour s’enferment ».
Un isolement facilité selon les spécialistes par les nouvelles technologies. Ces dispositifs permettent de s’enfuir, de s’évader virtuellement, grâce à internet et aux jeux vidéos. Ces appareils permettent de maintenir des liens, aussi ténus soient-ils, par le biais de relations numériques. Une sorte d’évasion vers un monde alternatif, fait de sociabilités sans paroles, de présences sans rencontre. »
Un article plus ancien de la revue « Cerveau & Psycho » : <Hikikomori : ces jeunes enfermés chez eux> essaye d’analyser plus en profondeur le phénomène :
Il donne d’abord un exemple d’un jeune japonais de 23 ans, Tatsuya, qui vit enfermé chez soi :
« Il n’est quasiment pas sorti de sa chambre depuis trois ans. Fils unique, il habite un deux-pièces qu’occupent ses parents dans la banlieue de Tokyo. Il passe sa journée à dormir. Il mange les repas préparés par sa mère qui les dépose sur le pas de la porte de sa chambre, toujours fermée. Il se réveille le soir pour passer la nuit à surfer sur Internet, à chatter sur des forums de discussion, lire des mangas et jouer à des jeux vidéo. Il refuse de s’inscrire dans une école de réinsertion professionnelle ou de chercher du travail, et même de partir en vacances. L’an dernier, ses parents se sont décidés à l’emmener consulter dans plusieurs hôpitaux de la région qui, tour à tour, ont évoqué une dépression ou une schizophrénie latente. La scolarité de Tatsuya à l’école élémentaire s’est déroulée normalement, mais il a commencé à manquer l’école quand il est entré au collège. Se mêlant peu à ses camarades, il se plaint d’être moqué et même humilié. Malgré ces brimades, ses résultats scolaires sont bons et il poursuit une formation universitaire d’ingénieur. Il y a trois ans, il a subitement tout arrêté et, depuis, vit cloîtré à domicile.
Tatsuya souffre d’hikikomori, c’est-à-dire en français de « retrait social ». […] Selon les critères diagnostiques réactualisés en 2010 par le ministère de la Santé japonais, le hikikomori est un phénomène qui se manifeste par un retrait des activités sociales et le fait de rester à la maison quasiment toute la journée durant plus de six mois. Il n’y a pas de limite d’âge inférieure. Bien que le hikikomori soit défini comme un état non psychotique, excluant donc la schizophrénie, les autorités sanitaires admettent qu’il est probable que certains cas correspondent en fait à des patients souffrant de schizophrénie, mais dont le diagnostic de psychose n’a pas encore été posé.
Qu’est-ce que le hikikomori ? En réalité, la situation peut se présenter sous plusieurs formes. S’il arrive que l’adolescent ou le jeune adulte puisse rester totalement reclus pendant des mois, voire des années, il peut aussi accepter de sortir, le temps de faire des courses dans le quartier, même s’il replonge dans son isolement en se barricadant dans sa chambre de retour dans l’appartement familial. Il peut aussi lui arriver de sortir la nuit ou au petit matin, lorsqu’il est le moins susceptible de rencontrer des gens, en particulier des camarades ou des voisins. Dans de rares cas, le sujet hikikomori dissimule son état en quittant son domicile chaque matin pour se promener ou prendre le train comme s’il se rendait à l’école, à l’université ou à son travail. »
La relation de cet état avec une addiction au numérique n’est pas avéré. Il semblerait plutôt que c’est la situation de réclusion qui entraîne une consommation du Web, pour occuper le temps :
« Dans 20 pour cent des cas, la pathologie commence entre 10 et 14 ans et, dans plus d’un tiers des cas, elle débute vers la fin de l’adolescence, entre 15 et 19 ans. Les premiers signes d’absentéisme scolaire ou d’isolement peuvent apparaître dès 12 à 14 ans. En 2003, on a constaté que certains élèves refusant d’aller à l’école devenaient par la suite des hikikomori. […]
Loin des idées reçues et des stéréotypes qui voudraient que cyberdépendance et hikikomori soient associés, il apparaît que si les reclus, au Japon comme en France, passent souvent beaucoup de temps sur le Web, ils ne témoignent pas d’une « addiction à Internet ». Selon Nicolas Tajan, doctorant en psychologie à l’Université Paris-Descartes et chercheur à l’Université de Kyoto, surfer sur Internet n’est qu’une de leurs activités dans la mesure où ils regardent aussi la télévision passivement pendant des heures, lisent ou écoutent de la musique. Certains ne se connectent d’ailleurs pas à Internet. Toutefois, note N. Tajan qui étudie depuis deux ans le hikikomori dans l’Archipel, une dépendance semble de plus en plus fréquente chez les hikikomori japonais, une tendance également observée en France. Surtout, il semble que l’apparition d’une utilisation intensive d’Internet soit plus le résultat de la claustration à domicile qu’une cause du retrait social. En fait, selon le psychiatre Takahiro Kato, de l’Université de Kyushu, Internet et les jeux vidéo contribuent à réduire le besoin de communication en tête-à-tête avec ses semblables et créent un sentiment de satisfaction sans qu’il soit nécessaire de passer par des échanges directs.
Internet et les jeux vidéo facilitent donc la vie du hikikomori, plutôt qu’ils n’en sont la cause. Dans de très rares cas, observés tant au Japon qu’en France, le hikikomori met à profit cette très longue période d’enfermement à domicile pour se former sur Internet et acquérir de façon autodidacte un nouveau savoir, parfois encyclopédique, sur un sujet technique ou artistique. »
Cet article souligne le lien de cette pathologie avec la culture japonaise :
« Plusieurs particularités socioculturelles et anthropologiques de la société nipponne pourraient intervenir dans « l’épidémie » d’hikikomori. Selon T. Kato, un facteur clé associé à ce phénomène tiendrait au concept d’Amae, défini par le fait de chercher à être gâté et choyé par son entourage. Cela peut parfois inciter le jeune à se comporter de façon égoïste vis-à-vis de ses parents avec le sentiment qu’ils lui pardonneront son comportement. Il existe dans la culture japonaise une tolérance, voire une complaisance, de l’entourage vis-à-vis du hikikomori, d’autant que les jeunes Japonais (comme en Corée du Sud ou à Taïwan) ont tendance à dépendre, plus encore qu’en Occident, de leurs parents sur le plan financier.
Par ailleurs, le Japon se trouve être une « société de la honte ». Le concept de Haji imprègne profondément la société : honte d’avoir échoué, de déshonorer son nom, de ne pas avoir tenu ses engagements, de mettre les autres dans l’embarras. De fait, les parents éprouvent une grande honte d’avoir un enfant hikikomori et tardent à consulter un médecin. Par ailleurs, fait remarquer Maki Umeda, chercheur en santé publique au Département de santé mentale de l’Université de Tokyo, certains parents préfèrent encore que leur enfant soit un hikikomori plutôt que d’apprendre qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou d’un trouble du développement, ce qui entraînerait une forte stigmatisation. […]
À tout cela s’ajoutent les brimades (Ijime) que subissent certains élèves à l’école (harcèlement, intimidation, persécution). Enfin, serait également en cause l’intense pression du système scolaire. Les lycées et les universités sont très hiérarchisés, en fonction de la difficulté du concours d’entrée obligatoire, ce qui susciterait chez une fraction des jeunes une peur de l’échec conduisant au retrait social définitif. »
Mais ce phénomène n’est pas que japonais.
Ainsi « le Monde » avait publié un article <Des cas d' »hikikomori » en France> et plus récemment, en février 2019, « L’Express » s’interrogeait : <Reclus et sans projet: qui sont les Hikikomori français ?>
Le phénomène est désormais mondial : <Hikikomoris : du Japon aux Etats-Unis, vers une jeunesse évaporée>
Un article de janvier 2020 de « Sciences et Avenir » évoque des études qui élargissent le phénomène hikikomori à d’autres populations que les jeunes hommes :
« Mais, selon des experts japonais et américains de l’équipe de l’Oregon Health and Science University (Portland, Oregon, États-Unis), ce phénomène qui a désormais dépassé les frontières de l’archipel, serait plus répandu qu’on ne le pense et mérite de fait une définition plus claire, dans le but d’un meilleur repérage et d’une prise en charge adaptée.
Dans une publication récente dans la revue World psychiatry, ces scientifiques pointent un persistant manque de connaissance de ce tableau clinique par les psychiatres et souhaitent donc sensibiliser leurs pairs à sa détection, comme le précise l’auteur principal, le Dr Alan Teo. Ils estiment en effet que les adolescents et les jeunes adultes ne sont pas les seuls concernés et que le syndrome peut aussi démarrer bien après l’âge de 30 ans et concerner des personnes âgées ou aussi des femmes au foyer. »
J’ai trouvé un site français entièrement consacré à l’accompagnement des familles qui sont dans la situation d’héberger un hikikomori : <https://hikikomori.blog/>
Je finirai par ce conseil donné dans l’article de la revue « Cerveau & Psycho »
« Pour la psychiatre, le message essentiel à faire passer lors des visites à domicile auprès de ces jeunes qui vivent cette tragique situation d’enfermement est qu’« ils font toujours partie du monde des humains ». »
<1407>
-
Dimanche 26 avril 2020
«Anywhere out of the world
N’importe où hors du monde»Charles Baudelaire – Petits Poèmes en prose (Le Spleen de Paris)Mot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Après mon bac en 1976, je me suis perdu pendant 3 ans en classe de mathématiques supérieures et spéciales au Lycée Kléber de Strasbourg.
 Je m’y suis perdu, parce que dans ces études on apprend très peu de choses utiles. L’étudiant est gavé, comme une oie, pour pouvoir ensuite participer avec cette connaissance largement inutile, à une compétition, sorte de «questions pour un champion». Compétition dans laquelle on choisit celles et ceux qui ont su garder dans leur mémoire les tonnes d’informations ingurgitées et disposent de la capacité de les régurgiter le plus rapidement.
Je m’y suis perdu, parce que dans ces études on apprend très peu de choses utiles. L’étudiant est gavé, comme une oie, pour pouvoir ensuite participer avec cette connaissance largement inutile, à une compétition, sorte de «questions pour un champion». Compétition dans laquelle on choisit celles et ceux qui ont su garder dans leur mémoire les tonnes d’informations ingurgitées et disposent de la capacité de les régurgiter le plus rapidement.
Je n’étais pas dans mon élément, dans ce monde de la compétition extrême. L’échec fut au bout de l’expérience.
J’ai quand même acquis de la connaissance dans cette expérience mais qui touche davantage l’humanité que la technique.
Et puis, il y avait les deux ouvrages littéraires que l’on étudiait chaque année.
J’avais déjà parlé de cette période 1976-1979, lors du mot du jour du <Mercredi 17 mai 2017> dans lequel j’évoquais le premier ouvrage qui m’avait marqué : « Les Pensées de Pascal ».
Mais nous avions aussi étudié un livre étonnant, profond et disruptif, si on reprend un mot à la mode : « Petits poèmes en prose » de Baudelaire.
Baudelaire était un génie, un génie proche de la folie.
Le portrait de Carjat est étonnant quand on se plonge dans le regard de Baudelaire tel que le peintre l’a restitué.
Baudelaire a été candidat à l’Académie française. Sa demande a été refusée. Sainte-Beuve qui était critique littéraire, avait évoqué lors de cet épisode, La folie Baudelaire !, :
« En somme, M. Baudelaire a trouvé moyen de se bâtir, à l’extrémité d’une langue de terre réputée inhabitable et par-delà les confins du romantisme connu, un kiosque bizarre, fort orné, fort tourmenté, mais coquet et mystérieux, où on lit de l’Edgar Poe, où l’on récite des sonnets exquis, où l’on s’enivre avec le haschisch pour en raisonner après, où l’on prend de l’opium et mille drogues abominables dans des tasses d’une porcelaine achevée. Ce singulier kiosque, fait en marqueterie, d’une originalité concertée et composite, qui, depuis quelques temps, attire les regards à la pointe du Kamtchatka romantique, j’appelle cela la folie Baudelaire. L’auteur est content d’avoir fait quelque chose d’impossible, là où on ne croyait pas que personne pût aller. »
En 2011 Roberto Calasso est revenu sur ce jugement pour évoquer le monde de Baudelaire : « Calasso : la folie Baudelaire »
Dans cet enfermement, Baudelaire avait toujours le désir de s’échapper.
Dans notre période de confinement, il me semble pertinent d’en appeler à lui, lui qui savait si bien écrire sur le voyage et sur l’évasion.
Poème Anywhere out of the world N’importe où hors du monde
Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là croit qu’il guérirait à côté de la fenêtre.
Il me semble que je serais toujours bien là où je ne suis pas, et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme.
Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d’habiter Lisbonne ? Il doit y faire chaud, et tu t’y ragaillardirais comme un lézard. Cette ville est au bord de l’eau ; on dit qu’elle est bâtie en marbre, et que le peuple y a une telle haine du végétal, qu’il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût ; un paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour les réfléchir !
Mon âme ne répond pas.
Puisque tu aimes tant le repos, avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante ? Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l’image dans les musées. Que penserais-tu de Rotterdam, toi qui aimes les forêts de mâts, et les navires amarrés au pied des maisons ?
Mon âme reste muette.
Batavia te sourirait peut-être davantage ? Nous y trouverions d’ailleurs l’esprit de l’Europe marié à la beauté tropicale.
Pas un mot. – Mon âme serait-elle morte ?
En es-tu donc venue à ce point d’engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal ? S’il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la Mort. – Je tiens notre affaire, pauvre âme ! Nous ferons nos malles pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l’extrême bout de la Baltique ; encore plus loin de la vie, si c’est possible ; installons-nous au pôle. Là le soleil ne frise qu’obliquement la terre, et les lentes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie, cette moitié du néant. Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres, cependant que, pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses, comme des reflets d’un feu d’artifice de l’Enfer !
Enfin, mon âme fait explosion, et sagement elle me crie : N’importe où ! n’importe où ! pourvu que ce soit hors de ce monde !
Baudelaire – Petits Poèmes en prose (Le Spleen de Paris) XLVIII
A ce poème noir, répond l’Invitation au voyage des Fleurs du mal
L’Invitation au Voyage
Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l’ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l’âme en secret
Sa douce langue natale.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde ;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
– Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or ;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Baudelaire, Les Fleurs du mal (1857)
Henri Duparc a mis merveilleusement en musique ce poème. Voici une interprétation de <L’invitation au voyage par Barbara Hendricks>. L’orchestre est celui de l’Opéra de Lyon dirigé par John Eliot Gardiner.
Dans les poèmes en prose, il existe un autre poème appelé « L’invitation au voyage »
L’Invitation au Voyage
Il est un pays superbe, un pays de Cocagne, dit-on, que je rêve de visiter avec une vieille amie. Pays singulier, noyé dans les brumes de notre Nord, et qu’on pourrait appeler l’Orient de l’Occident, la Chine de l’Europe, tant la chaude et capricieuse fantaisie s’y est donné carrière, tant elle l’a patiemment et opiniâtrement illustré de ses savantes et délicates végétations.
Un vrai pays de Cocagne, où tout est beau, riche, tranquille, honnête ; où le luxe a plaisir à se mirer dans l’ordre ; où la vie est grasse et douce à respirer ; d’où le désordre, la turbulence et l’imprévu sont exclus ; où le bonheur est marié au silence ; où la cuisine elle-même est poétique, grasse et excitante à la fois ; où tout vous ressemble, mon cher ange.
Tu connais cette maladie fiévreuse qui s’empare de nous dans les froides misères, cette nostalgie du pays qu’on ignore, cette angoisse de la curiosité ? Il est une contrée qui te ressemble, où tout est beau, riche, tranquille et honnête, où la fantaisie a bâti et décoré une Chine occidentale, où la vie est douce à respirer, où le bonheur est marié au silence. C’est là qu’il faut aller vivre, c’est là qu’il faut aller mourir !
Oui, c’est là qu’il faut aller respirer, rêver et allonger les heures par l’infini des sensations. Un musicien a écrit l’Invitation à la valse ; quel est celui qui composera l’Invitation au voyage, qu’on puisse offrir à la femme aimée, à la sœur d’élection ?
Oui, c’est dans cette atmosphère qu’il ferait bon vivre, — là-bas, où les heures plus lentes contiennent plus de pensées, où les horloges sonnent le bonheur avec une plus profonde et plus significative solennité.
Sur des panneaux luisants, ou sur des cuirs dorés et d’une richesse sombre, vivent discrètement des peintures béates, calmes et profondes, comme les âmes des artistes qui les créèrent. Les soleils couchants, qui colorent si richement la salle à manger ou le salon, sont tamisés par de belles étoffes ou par ces hautes fenêtres ouvragées que le plomb divise en nombreux compartiments. Les meubles sont vastes, curieux, bizarres, armés de serrures et de secrets comme des âmes raffinées. Les miroirs, les métaux, les étoffes, l’orfévrerie et la faïence y jouent pour les yeux une symphonie muette et mystérieuse ; et de toutes choses, de tous les coins, des fissures des tiroirs et des plis des étoffes s’échappe un parfum singulier, un revenez-y de Sumatra, qui est comme l’âme de l’appartement.
Un vrai pays de Cocagne, te dis-je, où tout est riche, propre et luisant, comme une belle conscience, comme une magnifique batterie de cuisine, comme une splendide orfévrerie, comme une bijouterie bariolée ! Les trésors du monde y affluent, comme dans la maison d’un homme laborieux et qui a bien mérité du monde entier. Pays singulier, supérieur aux autres, comme l’Art l’est à la Nature, où celle-ci est réformée par le rêve, où elle est corrigée, embellie, refondue.
Qu’ils cherchent, qu’ils cherchent encore, qu’ils reculent sans cesse les limites de leur bonheur, ces alchimistes de l’horticulture ! Qu’ils proposent des prix de soixante et de cent mille florins pour qui résoudra leurs ambitieux problèmes ! Moi, j’ai trouvé ma tulipe noire et mon dahlia bleu !
Fleur incomparable, tulipe retrouvée, allégorique dahlia, c’est là, n’est-ce pas, dans ce beau pays si calme et si rêveur, qu’il faudrait aller vivre et fleurir ? Ne serais-tu pas encadrée dans ton analogie, et ne pourrais-tu pas te mirer, pour parler comme les mystiques, dans ta propre correspondance ?
Des rêves ! toujours des rêves ! et plus l’âme est ambitieuse et délicate, plus les rêves l’éloignent du possible. Chaque homme porte en lui sa dose d’opium naturel, incessamment sécrétée et renouvelée, et, de la naissance à la mort, combien comptons-nous d’heures remplies par la jouissance positive, par l’action réussie et décidée ? Vivrons-nous jamais, passerons-nous jamais dans ce tableau qu’a peint mon esprit, ce tableau qui te ressemble ?
Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c’est toi. C’est encore toi, ces grands fleuves et ces canaux tranquilles. Ces énormes navires qu’ils charrient, tout chargés de richesses, et d’où montent les chants monotones de la manœuvre, ce sont mes pensées qui dorment ou qui roulent sur ton sein. Tu les conduis doucement vers la mer qui est l’Infini, tout en réfléchissant les profondeurs du ciel dans la limpidité de ta belle âme ; — et quand, fatigués par la houle et gorgés des produits de l’Orient, ils rentrent au port natal, ce sont encore mes pensées enrichies qui reviennent de l’infini vers toi.
Baudelaire – Petits Poèmes en prose (Le Spleen de Paris) XVIII
<1406>
-
Samedi 25 avril 2020
«Fantaisie D. 940 pour piano à quatre mains.»Franz SchubertMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Pendant cette période de confinement, j’écris aussi des mots du jour le week-end.
Ces mots sont souvent tournés vers la musique ou d’autres arts.
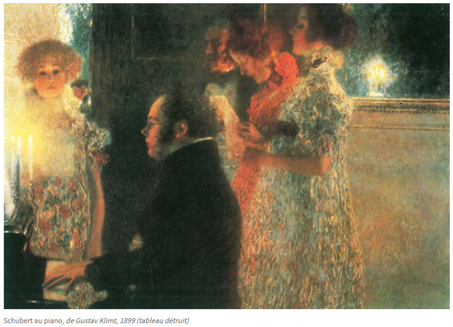 Et je m’aperçois que j’ai écrit 1404 mots et je n’en ai consacré aucun à Franz Schubert.
Et je m’aperçois que j’ai écrit 1404 mots et je n’en ai consacré aucun à Franz Schubert.
Il est vain d’essayer de classer les compositeurs, mais Schubert a toujours occupé une place particulière dans mon cœur.
C’est un amour de jeunesse et qui continue. C’est mon père qui m’a appris à le connaître et à révéler l’immensité de son génie.
Il faut songer que Schubert est mort à 31 ans le 19 novembre 1828 à Vienne, un an après Beethoven mort en 1827.
Ils vivaient dans la même ville et Schubert n’a jamais eu le courage d’aller à sa rencontre.
Mais Il fut un des porte-flambeau lors des funérailles du génie allemand inaccessible pour lui.
Exactement, un an plus tard, le 28 mars 1828 se déroula le premier concert public entièrement réservé à ses œuvres.
Oui Schubert n’eut de son vivant qu’un concert public de ses œuvres et ce fut ce 28 mars 1828.
Ce qui explique qu’il n’entendit jamais jouer certaines de ses œuvres qui nécessitait un orchestre ou un grand chœur.
L’essentiel de ses œuvres il les joua au milieu de son cercle d’amis.
Car, il avait en effet beaucoup d’amis et d’amis assez riches pour lui permettre de vivre au milieu d’eux sans avoir d’autres revenus de quelques leçons de piano qu’il donnait.
Ces réunions d’amis organisées autour de lui et de ses œuvres avaient été nommées par tous : « Les Schubertiades ».
Et aujourd’hui je vais partager avec vous « la Fantaisie D. 940 pour piano à quatre mains. »
<La revue de piano> la décrit de la manière suivante :
« Œuvre mythique du répertoire, la Fantaisie en fa mineur ouvre immanquablement, dès ses premières notes, les portes de ce monde simple et nostalgique qui caractérise les grandes œuvres de Schubert. Achevée en avril 1828 – les premières esquisses datent de janvier de la même année. ».
Cette fantaisie est un somment du répertoire de la musique pour piano à 4 mains.
<La lettre du musicien> consacrée au répertoire de la musique de piano à 4 mains écrit :
« Fantaisie en fa mineur, op.103, D.940, de 1828. Sans doute la plus belle œuvre écrite pour le piano à 4 mains, si ce n’est l’une des plus belles œuvres
 de musique qui soit. Rien que par son existence, elle justifie le genre. »
de musique qui soit. Rien que par son existence, elle justifie le genre. »
Je vous propose de l’entendre dans une version qui associe l’extraordinaire pianiste portugaise Maria Joao Pires avec une de ses élèves la jeune pianiste arménienne Lilit Grigoryan :
<Maria-João Pires et Lilit Grigoryan – Franz Schubert – Fantasie D.940>
Lilit Grigoryan est née à Erevan, en Arménie en 1985. Elle a été entre 2013 à 2016, artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en Belgique, sous la direction de Maria-João Pires.
 Christine Mondon écrit un long développement très sensible et juste consacré à cette fantaisie. J’en tire ces extraits
Christine Mondon écrit un long développement très sensible et juste consacré à cette fantaisie. J’en tire ces extraits
« Sa […] Fantaisie en fa mineur D.940, est son chef-d’œuvre. [parmi les fantaisies pour piano…] elle s’empare de l’être tout entier avec une telle puissance que l’on a le sentiment que le temps est suspendu au souffle de l’éternel voyageur des sons qu’est Schubert. […]
Toujours est-il que ce chant sublime – le plus beau « quatre-mains » de la musique – laisse entendre la fragilité de la vie, notamment lorsqu’il module vers le majeur ce qui le rend plus tragique encore, dans la quinte diminuée si-fa où Schubert traduit sa révolte face à la maladie et à la mort.
Dès les premières notes s’élève une mélodie d’une ineffable beauté. Molto moderato… une quête s’amorce, celle du voyageur vers l’inaccessible étoile. […]
Bouleversant est le cri étouffé de celui qui commence sa longue descente vers la mort. On ne sort pas indemne à l’écoute de la Fantaisie. En elle se cristallisent nos émotions car c’est de notre vie même dont il s’agit. »
Christine Mondon : « Franz Schubert, Le musicien de l’ombre », pages 221 à 223Cette œuvre a donc été écrite entre janvier et avril 1828.
Benjamin Britten a dit que l’année 1848 était l’année la plus féconde de l’Histoire de la musique, parce que ce fut la dernière de la vie de Schubert et que jamais de mémoire d’homme, un compositeur n’a écrit autant de chef d’œuvre que Schubert, cette année-là.
Cette fantaisie en est une.
Les œuvres de Schubert ont été classées par un musicologue Otto Erich Deutsch. Ainsi D 940, signifie que l’œuvre occupe la place 940 dans le classement de Deutsch. Ce classement est chronologique.
Les œuvres de 1828 occupent les numéros de 937 à 965.
Il y a cependant quelques numéros après 965, jusqu’à 998 et concernent des œuvres que Deutsch n’est pas parvenu à dater.
Schubert lui-même, accompagné par son ami Franz Lachner, jouera la fantaisie D940, pour la première fois, à Vienne le 9 mai 1828, au cours de l’une de ses fameuses Schubertiades.
Elle est dédiée à la comtesse Caroline Esterházy, une élève du compositeur. En février 1828, Eduard von Bauernfeld, dramaturge et autre ami de Schubert, note dans son journal :
« Schubert semble être réellement amoureux de la comtesse E. Il lui donne des leçons. ».
Le même von Bauernfeld (1802-1890) écrira bien plus tard :
« Lorsque la statue de Schubert fut inaugurée au Stadtpark, le 15 mai 1872, j’allai à la cérémonie avec Lachner. « Te rappelles-tu, me dit Lachner, comment je t’ai joué pour la première fois avec Schubert sa nouvelle fantaisie à quatre mains ? »
Cité par Brigitte Massin « Franz Schubert » chez Fayard page 439
Quarante-quatre ans plus tard, ces deux amis de Schubert se souvenaient de cet instant privilégié : la découverte d’un chef d’œuvre
Il y en eut bien d’autres, en cette année 1828, mais j’y reviendrai.
Pour celles et ceux qui voudrait approfondir, vous trouverez derrière ce lien <Fantaisie en fa mineur, Philippe Cassard et Cédric Pescia> une analyse faite par ces deux pianistes de l’œuvre. Et vous apprendrez que Schubert cite dans sa fantaisie un extrait de la 9ème symphonie de Beethoven.
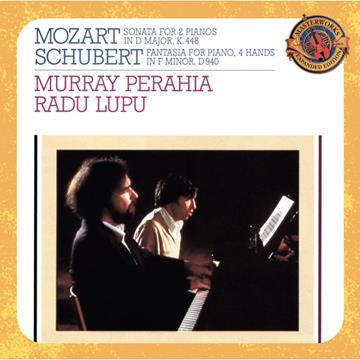 Si on souhaite un enregistrement audio de cette œuvre, il est possible de se tourner vers la superbe interprétation de <Murray Perahia et Radu Lupu>
Si on souhaite un enregistrement audio de cette œuvre, il est possible de se tourner vers la superbe interprétation de <Murray Perahia et Radu Lupu>
Il en est bien d’autres.
Maria Joao Pires l’a enregistré avec Huseyin Sermet
Un peintre von Schwindt qui faisait partie du cercle d’amis de Schubert a peint quelques années après la mort de Schubert, un tableau montrant l’ambiance des Schubertiades.
 <1405>
<1405> -
Vendredi 24 avril 2020
« 1er Ramadan 1441 »Identification de ce jour dans le calendrier hégirienNous sommes donc le 24 avril 2020 de l’ère chrétienne selon le calendrier solaire grégorien.
Mais si vous allez sur le site de la mosquée de Lyon vous trouverez cette annonce qui donne une autre identification à ce jour :
 « 1er ramadan 1441 »
« 1er ramadan 1441 »Ramadan est un mois d’un autre calendrier : le calendrier hégirien, qui est lui un calendrier lunaire.
C’est le neuvième mois de ce calendrier.
On parle de calendrier hégirien, parce qu’il débute lors de « l’hégire »
L’hégire désigne le départ du prophète de l’Islam Mohammed et de plusieurs de ses compagnons de La Mecque vers l’oasis de Yathrib, ancien nom de Médine, en 622 du calendrier solaire chrétien.
Les habitants de la Mecque ne sont pas très réceptifs à l’enseignement de Mohammed, en ces temps-là, et les compagnons du prophète sont victimes de violence et vont donc quitter La Mecque. Fuir diront certains.
<Wikipedia>, nous apprend
« Le terme hégire signifie en arabe « immigration » (du point de vue de Médine) ; le sens de « rupture de liens » (sous-entendu : familiaux) est parfois rencontré. Cet événement crée une rupture fondamentale avec la société telle qu’elle était connue des Arabes jusqu’alors. Mahomet vient en effet de rompre un modèle sociétal établi sur les liens du sang (organisation clanique), en faveur d’un modèle de communauté de destin fondée sur la croyance. Dans ce nouveau modèle, où tout le monde est censé être « frère », il n’est plus permis d’abandonner le démuni ou le faible comme c’était le cas auparavant. Les clans puissants de La Mecque vont tout faire pour éliminer cette nouvelle forme de société qui diminue leur influence car l’égalité entre les croyants est proclamée lors de la rédaction de la constitution de Médine, qu’ils soient libres ou esclaves, arabes ou non-arabes ».
Pour marquer l’importance de cet événement, le calendrier musulman commence donc au premier jour de l’année lunaire de l’Hégire, ce qui correspond au 16 juillet 622 du calendrier chrétien.
Pour les musulmans ce neuvième mois est le mois du jeûne.
Le jeûne du mois de Ramadan constitue l’un des cinq piliers de l’islam. Au cours de ce mois, les musulmans ayant l’âge requis selon les courants de l’islam ne doivent pas manger, boire, fumer, ni entretenir de rapport sexuel de l’aube au coucher du Soleil.
Selon <Wikipedia>
« Le nom ramadan a été donné au neuvième mois dans le monde arabe bien avant l’arrivée de l’islam. »
Comme le calendrier hégirien est un calendrier lunaire : chaque mois commence après la nouvelle lune, lorsque le premier fin croissant est visible. Il doit être aperçu avant qu’il ne disparaisse à l’horizon dans les lueurs crépusculaires. Si la nouvelle lune est postérieure au coucher du Soleil, l’observation se fait le lendemain. Comme le calendrier musulman peut compter dix, onze ou, les années bissextiles, douze jours de moins que le calendrier solaire et aucune intercalation, ramadan se décale d’autant chaque année et passe progressivement d’une saison à l’autre.
Tout cela étant parfaitement prévisible puisqu’il s’agit de mouvement cosmique et de la rotation de la lune autour de la terre, elle-même insérée dans le système solaire. Il y a donc un tableau prévisible qui donne le début du mois de ramadan de chaque année future. Ainsi cette année, il était prévu que le mois de ramadan commence le 24 avril.
Et c’est ainsi que le conçoit l’essayiste, islamologue et théologien Mohamed Bajrafil qui était l’invité des matins de France Culture de ce jeudi 23 avril 2020.
Mais ce n’est pas la position dominante des responsables de la communauté musulmane.
Ces derniers insistent sur l’observation locale du croissant de lune pour marquer le début du ramadan, parce que le premier croissant après la nouvelle lune n’est pas visible partout en même temps, les dates de début et de fin du mois dépendent de ce qui est visible dans chaque lieu.
Et c’est pourquoi un comité officiel s’est réuni et à l’issue d’une cérémonie à la Grande Mosquée de Paris, la date du début du Ramadan a été dévoilée ce jeudi 23 avril
Selon ce que relate le journal <France soir> :
« Le comité a pris acte de l’apparition de la nouvelle lune en ce 29ème jour du mois de Chaâbane 1441 de l’année Hégirienne, le mois sacré débutera donc demain vendredi 24 avril. »
C’est donc bien le 24 avril que commence le mois de ramadan, comme c’était prévu.
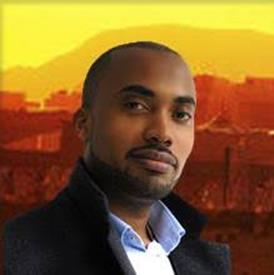 J’ai trouvé l’intervention de Mohamed Bajrafil sur le ramadan en temps de confinement très intéressant. Pour lui le confinement ne pose pas problème :
J’ai trouvé l’intervention de Mohamed Bajrafil sur le ramadan en temps de confinement très intéressant. Pour lui le confinement ne pose pas problème :« Le Ramadan est une pratique cachée, donc il cadre parfaitement avec le confinement. Là, il nous est donné la possibilité de combiner confinement spirituel et corporel. »
Mohamed Bajrafil est né en 1978 aux Comores, il est de tradition soufiste.
Il a rappelé que le ramadan constitue une discipline personnelle que vouloir obliger quelqu’un de respecter le ramadan n’est pas conforme à l’Islam d’abord parce que si l’action de faire le jeûne n’est pas une décision personnelle, elle n’a aucune valeur. Le faire parce qu’on est forcé, selon Mohamed Bajrafil, c’est comme si on ne le faisait pas. Celui qui force n’est pas davantage dans l’esprit du ramadan.
Et il dit notamment
« On doit vraiment lutter pour que personne ne suive personne mais que tout le monde agisse en son âme et conscience. Tout le monde doit pouvoir choisir de jeûner ou non et de prier ou non. »
Il dit aussi que, selon lui, l’aspect festif que certains exacerbent n’est pas davantage dans l’esprit. C’est une fête de la charité et du manque. Les repas de la nuit ont pour fonction de supporter le jeune de la journée sans que le manque ne doive disparaître. Il s’agit de se mettre à la place de celles et de ceux qui sont en manque général d’alimentation dans le but d’être plus sensible à leur sort.
« On a donné à ce rite un caractère festif qui n’a rien à voir avec le ramadan en lui-même. On en a fait un moment de festivité alors que ça doit rester un moment de spiritualité. »
A la fin du mois de Ramadan il s’agit d’ailleurs de donner des aliments aux pauvres. Et il ajoute :
« Le Ramadan est la pratique qui va le mieux avec la pauvreté. Elle est la pratique idoine car on nous demande de nous priver et nous donne un esprit de solidarité incroyable. »
Une présentation de cette épreuve spirituelle musulmane qui m’a touchée.
Je redonne le lien vers cette émission <Le ramadan est une pratique cachée qui cadre parfaitement avec le confinement>
<1404>
-
Jeudi 23 avril 2020
« Pause (L’attention, est une ressource dont nous ne disposons qu’en quantité finie.)»Un jour sans mot du jourContinuons avec tous ces chats confinés qui s’étonnent que leurs humains soient si souvent dans leurs pattes ces derniers temps.
 La période que nous vivons me fait penser à un mot du jour de 2016 :
La période que nous vivons me fait penser à un mot du jour de 2016 :
«L’attention, est une ressource dont nous ne disposons qu’en quantité finie.»
Matthew Crawford
Matthew Crawford est l’auteur de « l’ Eloge du carburateur », livre que Pablo m’a offert depuis que j’ai écrit ce mot du jour.
Livre qu’il me reste à lire.
Dans l’article je citais cette phrase de l’auteur
« L’épuisement provoqué par le papillonnage moderne, explique-t-il, n’est pas que le résultat de la technologie. Il témoigne d’une crise des valeurs, qui puise ses sources dans notre identité d’individu moderne. »
<Mot sans numéro>
-
Mercredi 22 avril 2020
« Pause »Un jour sans mot du jour Annie me rappelle que si nous n’étions pas confinés, nous serions en congé. Je n’ai toujours pas trouvé l’inspiration d’écrire un mot du jour.
Annie me rappelle que si nous n’étions pas confinés, nous serions en congé. Je n’ai toujours pas trouvé l’inspiration d’écrire un mot du jour.
J’accompagne cette fois la photo des chats confinés par un lien vers les matins de France Culture.
C’était l’émission du 20 avril.
Elle est présentée de la manière suivante sur le site de l’émission :
Alors que le monde est à l’arrêt, nous observons de notre fenêtre le printemps s’épanouir. Et si, paradoxalement le fait d’être coupé de la nature nous en rapprochait ? Comment repenser la cohabitation entre l’homme et les non-humains ?
Alors que le lien de l’homme avec son environnement serait directement en cause dans cette crise sanitaire, faut-il repenser notre rapport à la nature ? C’est ce que propose Philippe Descola, que nous recevons aujourd’hui. En 1976, il est étudiant et part à la découverte des Achuars, un peuple Jivaro situé au cœur de l’Amazonie, entre l’Équateur et le Pérou. S’en suit une longue réflexion sur l’anthropocentrisme, qui ouvre la voie d’une nouvelle relation entre les humains et leur milieu de vie.
L’épidémie est-elle une conséquence de l’action humaine sur la nature ? Est-elle une maladie de l’anthropocène ? Que nous apprend le lien que certains peuples entretiennent avec leur environnement ?
Philippe Descola est professeur émérite au Collège France, titulaire de la chaire d’anthropologie de la nature de 2000 à 2019. Il est auteur notamment de Les natures en question (Ed. Odile Jacob, 2017)
Quelle réponse des Achuars face aux épidémies ?
« Il n’y a pas de souvenirs de la catastrophe. On estime qu’environ 90% de la population amérindienne a disparu entre le XVIe et le XIXe siècle. Il y a une sorte d’imaginaire implicite du contact avec la maladie des « blancs ». De ce fait, lorsque les « blancs » arrivent dans les environnements amérindiens reculés, le premier réflexe des Amérindiens est la méfiance par la distanciation. »
La maladie n’est qu’un élément dans un cortège d’abominations apporté par la colonisation. Philippe Descola
« Chaque peuple réagit à ses épidémies en fonction de sa conception de contagion. La notion de contagion a mis un certain temps à se propager en Europe, au contraire des peuples amérindiens. C’est ce qui leur a permis d’adopter les bons gestes. »
Parler de la « nature » : une erreur ?
« La nature est un concept occidental qui désigne l’ensemble des non-humains. Et cette séparation entre humain et non-humain a eu pour résultat d’introduire une distance sociale entre eux. »
On peut penser que le virus est une métaphore de l’humanité. Nous avons vis-à-vis de la terre, le même rapport instrumental qu’un virus. D’une certaine façon, l’être humain est le pathogène de la planète. Philippe Descola
« Cette idée très humaine que la nature est infinie a eu comme conséquence que ce système si singulier basé sur la productivité et la rentabilité a engendré une catastrophe planétaire. »
L’idéal du « Monde d’après »
« Je forme le vœu que le monde d’après soit différent du monde d’avant. La pandémie nous donne un marqueur temporaire. Cette transformation, je la vois avec intérêt se dessiner et qu’elle aboutisse à ce que des liens avec les non humains soient à nouveau tissés. Il faut vivre avec une mentalité non destructrice de notre environnement. »
L’idée n’est pas de posséder la nature mais d’être possédé par un milieu. Philippe Descola
Vous pouvez (ré)écouter l’interview en intégralité en cliquant sur le player en haut à gauche de cette page.
Et pour approfondir, vous pouvez également retrouver Philippe Descola s’exprimer dans plusieurs vidéos de la chaîne YouTube du Collège de France consacrées aux sujets de l’émission
À ire en complément, la recension par La vie des idées de l’ouvrage « Les Natures en question »
<Mot sans numéro>
-
Mardi 21 avril 2020
« Pause »Un jour sans mot du jourMême en période confinement et en pleine pandémie, il est possible d’être démuni et de ne pas être en mesure d’écrire un mot du jour.
 J’accompagne cependant la photo du chat confiné avec un lien :
J’accompagne cependant la photo du chat confiné avec un lien :
C’est un article du Monde qui m’a été recommandé par Didier
« L’âpre combat d’une équipe médicale face à un virus indomptable »
<Mot sans numéro>
-
Lundi 20 avril 2020
«Je me fais plus de soucis pour l’avenir professionnel de mes enfants que pour ma santé de presque septuagénaire.»André-Comte SponvilleAndré-Comte Sponville est un de nos grands philosophe. Il a donné une interview dans un journal belge : « L’écho » : «J’aime mieux attraper le Covid-19 dans un pays libre qu’y échapper dans un État totalitaire »
Dans cet entretien, il tire comme enseignements positifs de cette crise :
« J’en vois trois principaux. D’abord l’importance de la solidarité: se protéger soi, c’est aussi protéger les autres, et réciproquement.
Ensuite le goût de la liberté: quel plaisir ce sera de sortir de cette « assignation à résidence » » qu’est le confinement!
Enfin l’amour de la vie, d’autant plus précieuse quand on comprend qu’elle est mortelle. Gide l’a dit en une phrase qui m’a toujours frappé: « Une pas assez constante pensée de la mort n’a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie.» Le Covid-19, qui fait que nous pensons à la mort plus souvent que d’habitude, pourrait nous pousser à vivre plus intensément, plus lucidement, et même – lorsqu’il sera vaincu – plus heureusement. »
Il aborde surtout cette crise sous un angle de vue intéressant : notre rapport à la mort.
Edouard Philippe a réexpliqué, ce dimanche, très pédagogiquement, l’unique raison pour laquelle la décision de confinement a été prise. Cette raison n’a pas été cachée par le gouvernement, mais il semblerait parfois qu’elle est perdue de vue, tant parfois on a l’impression que certains se croit en danger de mort immédiat s’ils ont le malheur de rencontrer le virus. Ce qui est totalement faux. On peut mourir de ce virus, mais ce n’est pas et de loin la conséquence la plus probable si on l’attrape.
L’unique raison du confinement est d’éviter la saturation des hôpitaux et particulièrement des services de soins intensifs. Cette saturation qui entrainerait pour conséquence l’impossibilité de soigner des patients atteint de symptômes graves et obligerait donc à les laisser mourir alors qu’avec des moyens de soins il serait possible d’en sauver une grande partie. C’est cela qu’on a voulu éviter, à cause du prix qu’on donne à la santé et à la vie. C’était aussi créer une tension et une pression insupportable pour les personnels soignants devant ce désastre sanitaire : ne pas être en mesure de sauver des vies en raison d’un manque de moyens, de lits, de personnel.
Car l’article de « l’Echo » rappelle que la grippe de 1968 – « grippe de Hong Kong » – a fait environ un million de morts, dans l’indifférence quasi générale. André Compte-Sponville ajoute la grippe dite « asiatique », en 1957-1958, en avait fait encore plus, et tout le monde l’a oubliée.
Il y a eu donc évolution, le philosophe a cette analyse :
« J’y vois trois raisons principales. D’abord la mondialisation, dans son aspect médiatique: nous sommes désormais informés en temps réel de tout ce qui se passe dans le monde, par exemple, chaque jour, du nombre de morts en Chine ou aux États-Unis, en Italie ou en Belgique… Ensuite, la nouveauté et le « biais cognitif » qu’elle entraîne: le Covid-19 est une maladie nouvelle, qui, pour cette raison, inquiète et surprend davantage. Enfin une mise à l’écart de la mort, qui la rend, lorsqu’elle se rappelle à nous, encore plus inacceptable.
[La mort] l’a toujours été, mais comme on y pense de moins en moins, on s’en effraie de plus en plus, lorsqu’elle s’approche. Tout se passe comme si les médias découvraient que nous sommes mortels! Vous parlez d’un scoop! On nous fait tous les soirs, sur toutes les télés du monde, le décompte des morts du Covid-19. 14.000 en France, à l’heure actuelle, plus de 4.000 en Belgique… C’est beaucoup. C’est trop. C’est triste. Mais enfin faut-il rappeler qu’il meurt 600.000 personnes par an en France? Que le cancer, par exemple, toujours en France, tue environ 150.000 personnes chaque année, dont plusieurs milliers d’enfants et d’adolescents? Pourquoi devrais-je porter le deuil des 14.000 mors du Covid 19, dont la moyenne d’âge est de 81 ans, davantage que celui des 600.000 autres? Encore ne vous parlais-je là que de la France. À l’échelle du monde, c’est bien pire. La malnutrition tue 9 millions d’êtres humains chaque année, dont 3 millions d’enfants. Cela n’empêche pas que le Covid-19 soit une crise sanitaire majeure, qui justifie le confinement. Mais ce n’est pas une raison pour ne parler plus que de ça, comme font nos télévisions depuis un mois, ni pour avoir en permanence « la peur au ventre », comme je l’ai tant entendu répéter ces derniers jours. Un journaliste m’a demandé – je vous jure que c’est vrai – si c’était la fin du monde! Vous vous rendez compte? Nous sommes confrontés à une maladie dont le taux de létalité est de 1 ou 2% (sans doute moins, si on tient compte des cas non diagnostiqués), et les gens vous parlent de fin du monde. »
Alors le philosophe accepte d’interroger cette affirmation d’Emmanuel Macron dans son dernier discours que « la santé était la priorité ».
La santé est-elle devenue la valeur absolue dans nos sociétés?
« Hélas, oui! Trois fois hélas! En tout cas c’est un danger, qui nous menace. C’est ce que j’appelle le pan-médicalisme: faire de la santé (et non plus de la justice, de l’amour ou de la liberté) la valeur suprême, ce qui revient à confier à la médecine, non seulement notre santé, ce qui est normal, mais la conduite de nos vies et de nos sociétés. Terrible erreur! La médecine est une grande chose, mais qui ne saurait tenir lieu de politique, de morale, ni de spiritualité. Voyez nos journaux télévisés: on ne voit plus que des médecins. Remercions-les pour le formidable travail qu’ils font, et pour les risques qu’ils prennent. Mais enfin, les experts sont là pour éclairer le peuple et ses élus, pas pour gouverner. Pour soigner les maux de notre société, je compte moins sur la médecine que sur la politique. Pour guider ma vie, moins sur mon médecin que sur moi-même.
La priorité des priorités, à mes yeux, ce sont les jeunes. Nous avons peut-être les meilleurs hôpitaux du monde. Qui oserait dire que nous avons les meilleures écoles? Le moins de chômage dans la jeunesse? »
Et il ajoute :
« Finitude et vulnérabilité font partie de notre condition. […] L’incertitude, depuis toujours, est notre destin. »
Dans cet article, André Comte Sponville, rappelle quelque saine vérité :
« Parler d’une vengeance de la nature, c’est une sottise superstitieuse. En revanche, qu’il y ait un déséquilibre entre l’homme et son environnement, ce n’est que trop vrai. Cela s’explique à la fois par la surpopulation – nos enfants ne meurent plus en bas-âge: on ne va pas s’en plaindre – et la révolution industrielle, grâce à laquelle la famine a disparu de nos pays et a formidablement reculé dans le monde: là encore, on ne va pas s’en plaindre. Mais la conjonction de ces deux faits nous pose des problèmes énormes. Le réchauffement climatique fera beaucoup plus de morts que le Covid-19!
Ce n’est pas la mondialisation qui crée les virus. La peste noire, au 14e siècle, a tué la moitié de la population européenne, et la mondialisation n’y était pour rien. En revanche, ce que cette crise nous apprend, c’est qu’il est dangereux de déléguer à d’autres pays, par exemple à la Chine, les industries les plus nécessaires à notre santé. Bonne leçon, dont il faudra tenir compte! »
Et il remet en perspective cette maladie avec les conséquences économiques qu’il rapporte à son propre cas :
« Je me fais plus de soucis pour l’avenir professionnel de mes enfants que pour ma santé de presque septuagénaire. La France prévoit des dépenses supplémentaires, à cause du Covid et du confinement, de 100 milliards d’euros. Je ne suis pas contre. Mais qui va payer? Qui va rembourser nos dettes? Nos enfants, comme d’habitude… Cela me donne envie de pleurer. »
Et puis il parle de nos ainés dans les EHPAD :
« Quant à nos aînés, leur problème ne commence pas avec le Covid-19. Vous êtes déjà allé dans un EHPAD? Le personnel y fait un travail admirable, mais quelle tristesse chez tant de résidents. Pardon de n’être pas sanitairement correct. En France, il y a 225.000 nouveaux cas de la maladie d’Alzheimer chaque année, donc peut-être dix fois plus que ce que le Covid-19, si le confinement fonctionne bien, risque de faire. Eh bien, pour ma part, je préfère être atteint par le coronavirus, et même en mourir, que par la maladie d’Alzheimer! »
En fin de compte, on a bien laissé mourir des patients du COVID-19 sans les prendre en charge dans les unités de soins des hôpitaux, c’était des personnes âgées qui étaient en EHPAD.
Mais le plus grave n’a t’il pas été qu’on a interdit, dans un premier temps, aux proches de les accompagner dans leurs derniers instants ainsi que dans la cérémonie funéraire ?
Et le philosophe nous invite à prendre du recul, plutôt que de nous laisser emporter par nos émotions – à commencer par la peur – et le politiquement correct.
<1403>
-
Dimanche 19 avril 2020
«C’est la bonté qui est la normalité du monde car la bonté est courageuse, la bonté est généreuse et jamais elle ne consent à être comme une embusquée, qui, à l’arrière vit grâce au sang des autres.»Wajdi MouawadMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Et je reviens inlassablement vers les <Lettres d’intérieur> d’Augustin Trapenard sur France Inter. Toutes sont à écouter. Bien sûr selon la sensibilité de chacune et chacun l’une ou l’autre aura un écho plus profond. La dernière que je citais était une lettre de l’écrivain algérien Yasmina Khadra à sa mère décédée il y a moins de deux ans.
Aujourd’hui je copie la lettre d’un autre écrivain à son fils Wajdi Mouawad qui est aussi metteur en scène : « Donne du courage autour de toi et n’accepte jamais ce qui te révulse… », lettre lu le lundi 13 avril 2020.
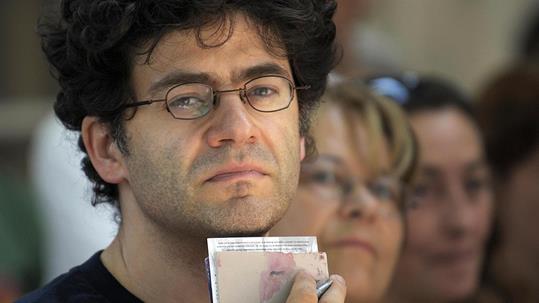 Wajdi Mouawad est né en 1968 au Liban.
Wajdi Mouawad est né en 1968 au Liban.
Il quitte son pays natal en 1978 à l’âge de dix ans à cause de la guerre civile au Liban. Sa famille immigre en France à Paris, puis au Québec dans la ville de Montréal en 1983. Il commence à faire du théâtre à Montréal et peu à peu travaille en France jusqu’à devenir le directeur du Théâtre de la Colline à partir de 2016.
<Wikipedia> nous apprend que parmi ses productions, en 2011, Wajdi Mouawad propose à 50 adolescents (sélectionnés par des théâtres) de l’accompagner pour une aventure longue de cinq ans. Ce projet est nommé « Avoir 20 ans en 2015 ». Cinq grandes villes y participent : les 50 jeunes forment cinq groupes de dix personnes provenant de Nantes, Namur, Mons, l’île de La Réunion et Montréal. En plus des jeunes, on compte aussi environ vingt accompagnateurs. Le projet est né d’une réplique d’Incendies, où une grand-mère dit à sa petite-fille :
« Si tu veux t’en sortir, tu dois apprendre à : lire, écrire, compter, parler et penser. »
Chaque verbe est associé à une année et à un voyage dans une ville où tous les jeunes sont invités et se retrouvent : Lire à Athènes, Écrire à Lyon, Compter à Auschwitz, Parler dans un pays d’Afrique, et Penser au cours d’un voyage en mer. Ils se retrouvent donc tous ensemble (Mouawad, les 50 jeunes et les accompagnateurs) une fois par an. L’aboutissement du projet n’est pas théâtral ; à la fin, les jeunes sortiront simplement d’une aventure littéraire et spirituelle exceptionnelle, enrichis d’un regard très riche sur le monde et de souvenirs inoubliables.
Wajdi Mouawad dispose aussi d’un site personnel : <http://www.wajdimouawad.fr/>
Voici la lettre à son fils :
Nogent-sur-Marne, le 12 avril 2020
Mon cher petit garçon,
T’écrire ces quatre mots me bouleverse. Ils rendent si réel l’homme que tu es, en cet aujourd’hui qui est le tien, quand, dans celui qui est le mien, tu n’es encore qu’un enfant.
Cette lettre je l’adresse donc à l’homme que tu n’es pas encore pour moi, mais que tu es devenu puisque te voilà en train de la lire. Tu l’auras trouvée sans doute par hasard sur cette clé où je consigne en secret les trésors de ton enfance. J’ignore l’âge que tu as, j’ignore ce qu’est devenu le monde, j’ignore même si ces clefs fonctionnent encore mais j’ai espoir que, la découvrant, tu trouveras un moyen de l’ouvrir.
Et par la magie de l’écriture, voici que cette lettre devient la fine paroi qui nous relie, et entre l’aujourd’hui où je t’écris – où tu commences à déchiffrer les phrases, où tu as peur dans le noir, où tu crois à la magie – et celui où tu me lis, chaque mot de ma lettre a gardé sa présence ; si à l’instant j’écris je t’aime, voilà qu’à ton tour, des années plus tard, tu lis je t’aime. Et que t’écrire d’autre que je t’aime, alors que nous vivons ce que nous vivons en ce confinement dont tu n’as peut-être plus qu’un vague souvenir ? Quoi dire de plus urgent que l’amour ?
En ces journées étranges où rode une mort invisible et où le monde va vers son ravin, un ravin qui semble être l’héritage laissés aux gens de ta génération, un père, plus que de raison, s’inquiète pour son fils. Je te regarde. Tu dessines un escargot. Tu lèves la tête et tu me souris. « Qu’est-ce qu’il y a papa ? » Rien mon garçon.
Je ne sauverai pas le monde. Mais j’ai beau ne pas le sauver, je peux du moins te désapprendre la peur. T’aider à ne pas hésiter le jour où il te faudra choisir entre avoir du courage ou avoir une machine à laver. T’apprendre surtout pourquoi il ne faudra jamais prononcer les mots de Cain et, toujours, rester le gardien de ton frère. Quitte à tout perdre. J’ignore d’où tu me lis, ni de quel temps, temps de paix ou temps de guerre, temps des humains ou temps des machines, j’espère simplement que ton présent est meilleur que le mien. Nous nous enterrons vivants en nous privant des gestes de l’ivresse : embrassades, accolades, partage et nul ne peut sécher les larmes d’un ami.
Mais si ton temps est pire que celui de ton enfance, si, en ce moment où tu me lis, tu es dans la crainte à ton tour, je voudrais par cette lettre te donner un peu de ce courage dont parfois j’ai manqué et, repensant à ce que nous nous sommes si souvent racontés, tu te souviennes que c’est la bonté qui est la normalité du monde car la bonté est courageuse, la bonté est généreuse et jamais elle ne consent à être comme une embusquée, qui, à l’arrière vit grâce au sang des autres. Nul ne peut expliquer la grandeur de ceux qui font la richesse du monde. Donne du courage autour de toi et n’accepte jamais ce qui te révulse.
Quant à moi : je t’aime. Ton père t’aime. Sache cela et n’en doute jamais.
Ton père ».
Wajdi Mouawad
J’aurais dû choisir comme exergue, la phrase choisie par Augustin Trapenard : « Donne du courage autour de toi et n’accepte jamais ce qui te révulse… » qui constitue un beau guide d’accompagnement de la vie, très inspirant et particulièrement pour ceux que les mirages de l’ambition économique pourraient entrainer vers des rivages obscurs.
Mais à l’heure où tant de femmes et d’hommes se dévouent, au prix parfois de leur propre santé, dans les hôpitaux pour sauver des vies et d’autres accompagnent nos ainés dans les EHPAD jusque dans leurs derniers instants, je trouve juste de rappeler la normalité de la bonté.
Je sais bien qu’il existe des corrompus, des cupides, des égoïstes mais pourtant je crois comme Christophe André que « Notre société ne tient que grâce aux gens gentils ».
Et pour l’instant présent, mais je crois que c’est une vérité éternelle, MEDIAPART nous rappelle que « Contre le coronavirus, les premières lignes sont des femmes ».
Ceci renvoie aussi à un mot du jour ancien, de 2016, mais qui garde tout son acuité et qui était consacré à Nancy Fraser : « Les contradictions sociales du capitalisme contemporain ». Elle écrivait :
«Historiquement, ce travail de « reproduction sociale », comme j’entends le nommer, a été assigné aux femmes.»
<1402>
-
Samedi 18 avril 2020
« A Mozart je dois une Église un arbre et une île»Alicia GallienneMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Le mot du jour du <7 février 2020> parlait d’un livre « L’autre moitié du songe m’appartient » sur la base d’un article du Monde.
<Le 18 février> j’évoquais l’émission de Guillaume Gallienne dans laquelle il lisait les poèmes de sa cousine : « Dire que je t’aime et je t’attends, c’est encore beaucoup trop de pas assez »
Depuis Annie m’a offert le livre d’Alicia Gallienne.
Aujourd’hui je voudrais partager un poème qu’elle a dédié à Mozart et plus précisément au Requiem de Mozart.
D’abord cet extrait
A Mozart je dois une Église un arbre et une île
Je lui dois la grandeur de la mer et de l’oubli
Les marches des mots pierres sculptées
Le mouvement de la mort au front du Requiem
L’art vient manger dans ma main
C’est une étrange fontaine qui coule inlassablement
Comme cette musique trop intelligente
Je referme ma main et le passé éclôt comme une fleur outragée
Pierre grimpante pierre projetée vers le haut
Qui s’enroule autour de moi pour une danse à l’envers
L’église se recroqueville au sein de la musique
Je me souviens mais à quoi servent attendre ?
Les voix se distillent la musique se retient
Et les yeux mystérieux appellent la mer
Toujours plus haut au-delà des mots qui s’enlisent
L’horizon plein d’embruns couronné d’épines
Dalles de pierre aux yeux meurtris du passé
Jets d’eau recueillis de ma profonde chapelle
Les vitraux pleins de ronces respirent la musique
Sur cette île en hauteur où l’Art a des reconnaissances
Me voilà trop humaine et le son qui s’en va
A Mozart je dois une église d’un arbre une île
Le mouvement de la mort au front du requiem
Diamant pur dans mes mains fontaine intarissable
A Mozart je dédie par avance le dernier instant de ma vie
Aux pieds de cette église où l’Art a des reconnaissances
Pour une ultime prière dictée à mes mots
Pour des flots de musique ravivant mes yeux éteints.
A Mozart je dédie par avance le dernier instant de ma vie !
Pour compléter, je vous propose <Cette extraordinaire interprétation du Requiem de Mozart par Bernstein>
Et voici le poème dans son intégralité, il s’appelle « Pierre grimpante »
Pierre grimpante
A la gloire de Mozart
Le soleil étanche mordille le lierre
Pierre grimpante couronne mon front
Je me souviens et c’est si facile d’attendre
Que les mystères renaissent prématurément
Les mots s’enroulent avec une obscure imprécision
La musique emporte tout sur son passage
Comme une marée basse aux algues intelligentes
Tu vois je respire des embruns de bas étage
Les marches se précisent celles d’une église
Pierre grimpante pierre projetée vers le haut
Un violon se ramifie c’est un bel arbre
Tu entends il y a des sons verdoyants sur mon front
Le soleil étanche s’attarde à la convalescence
Des vitraux de coupable industrie
Je me souviens d’avoir déjà gravi des étages
La musique s’enroule comme une femme folle
La femme folle serait ce moi ?
Les embruns venimeux lèchent les vitrines
Comme si la mer encerclait l’église
L’escalier grimpant mordille le cœur de l’île
Et l’art si impénétrable aux esquisses muettes
Accompagne le peintre reconnaître son œuvre
Les pleurs de couleurs délavent les vitraux
De la chapelle où l’on se perd de soi-même
Où sont l’Évangile l’orgue la falaise ?
Une seule ardeur rappelle un passé précipité
Seule la musique rivalise avec les symboles
Pierre grimpantes couronne mon front
A Mozart je dois une Église un arbre et une île
Je lui dois la grandeur de la mer et de l’oubli
Les marches des mots pierres sculptées
Le mouvement de la mort au front du Requiem
L’art vient manger dans ma main
C’est une étrange fontaine qui coule inlassablement
Comme cette musique trop intelligente
Je referme ma main et le passé éclôt comme une fleur outragée
Pierre grimpante pierre projetée vers le haut
Qui s’enroule autour de moi pour une danse à l’envers
L’église se recroqueville au sein de la musique
Je me souviens mais à quoi servent attendre ?
Les voix se distillent la musique se retient
Et les yeux mystérieux appellent la mer
Toujours plus haut au-delà des mots qui s’enlisent
L’horizon plein d’embruns couronné d’épines
Dalles de pierre aux yeux meurtris du passé
Jets d’eau recueillis de ma profonde chapelle
Les vitraux pleins de ronces respirent la musique
Sur cette île en hauteur où l’Art a des reconnaissances
Me voilà trop humaine et le son qui s’en va
A Mozart je dois une église d’un arbre une île
Le mouvement de la mort au front du requiem
Diamant pur dans mes mains fontaine intarissable
A Mozart je dédie par avance le dernier instant de ma vie
Aux pieds de cette église où l’Art a des reconnaissances
Pour une ultime prière dictée à mes mots
Pour des flots de musique ravivant mes yeux éteints.
Page 131 à 133
L’autre moitié du songe m’appartient
Alicia Gallienne
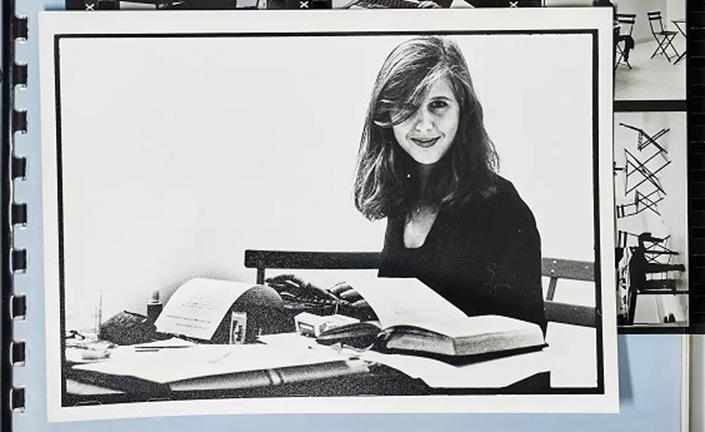
<1401>
-
Vendredi 17 avril 2020
« Mais l’histoire nous apprend quand même qu’après les grandes crises, il n’y a jamais de fermeture de la parenthèse. Il y aura un « jour d’après », certes, mais il ne ressemblera pas au jour d’avant »Stéphane Audoin-RouzeauMEDIAPART comme les autres journaux consacre l’essentiel de ses articles et aussi vidéos à la pandémie. Ce journal se distingue par une rhétorique très critique par rapport au pouvoir actuel et quelquefois des propos assez violents.
Mais il lui arrive aussi à donner la parole à des intellectuels dans le but de prendre un peu de recul par rapport à l’évènement.
Le 12 avril 2020, Mediapart a donné la parole à un historien, spécialiste de la grande guerre : Stéphane Audoin-Rouzeau. Mercredi 15 avril, France Culture a également donné la parole à cet historien : <Il y a un imaginaire de fin de guerre qui, avec la crise du Covid-19, n’arrivera jamais>, émission dans laquelle il dit des choses assez proches.
Le titre de l’article est : «Nous ne reverrons jamais le monde que nous avons quitté il y a un mois»
Il revient d’abord à la rhétorique de guerre d’Emmanuel Macron et dit d’emblée :
« Comme historien, je ne peux pas approuver cette rhétorique parce que pour qu’il y ait guerre, il faut qu’il y ait combat et morts violentes, à moins de diluer totalement la notion. »
Mais c’est pour aussitôt ajouter :
« Mais ce qui me frappe comme historien de la guerre, c’est qu’on est en effet dans un temps de guerre. D’habitude, on ne fait guère attention au temps, alors que c’est une variable extrêmement importante de nos expériences sociales. Le week-end d’avant le confinement, avec la perception croissante de la gravité de la situation, le temps s’est comme épaissi et on ne s’est plus focalisé que sur un seul sujet, qui a balayé tous les autres. De même, entre le 31 juillet et le 1er août 1914, le temps a changé. Ce qui était inconcevable la veille est devenu possible le lendemain. »
Et il cite deux phrases de Macron qui sont directement copiés de la phraséologie de la guerre 14-18 :
« La phrase la plus frappante d’Emmanuel Macron, lors de son second discours à Mulhouse, a été celle qui a été la moins relevée : « Ils ont des droits sur nous », pour parler des soignants. C’est le verbatim d’une phrase de Clemenceau pour parler des combattants français à la sortie de la guerre. […]
De même, pour le « nous tiendrons ». « Tenir », c’est un mot de la Grande Guerre, il fallait que les civils « tiennent », que le front « tienne », il fallait « tenir » un quart d’heure de plus que l’adversaire… Ce référent 14-18 est pour moi fascinant. »
Régis Debray l’avait aussi proclamé c’est le sacrifice qui rend sacré. Les soignants vont probablement sortir de ce moment avec une autre considération :
‘La reprise de la phrase de Georges Clemenceau par Emmanuel Macron était discutable, mais elle dit quelque chose de vrai : les soignants vont sortir de là un peu comme les poilus en 1918-1919, avec une aura d’autant plus forte que les pertes seront là pour attester leur sacrifice. Le sacrifice, par définition, c’est ce qui rend sacré. On peut donc tout à fait imaginer la sacralisation de certaines professions très exposées »
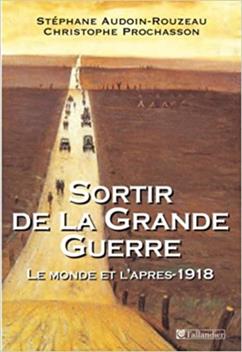 Pour essayer de décrire ce qui se passe en ce moment, le passage brutal d’un monde dans lequel on voyageait dans le monde entier, dans lequel on sortait dans la rue sans même y réfléchir, on allait au restaurant, au concert, dans les magasins, voir ses amis quand on voulait, on prenait sa voiture pour se rendre à un lieu quelconque de France et d’Europe à un monde du confinement, n’a pas d’égal dans notre histoire, sauf à le comparer à un temps de guerre.
Pour essayer de décrire ce qui se passe en ce moment, le passage brutal d’un monde dans lequel on voyageait dans le monde entier, dans lequel on sortait dans la rue sans même y réfléchir, on allait au restaurant, au concert, dans les magasins, voir ses amis quand on voulait, on prenait sa voiture pour se rendre à un lieu quelconque de France et d’Europe à un monde du confinement, n’a pas d’égal dans notre histoire, sauf à le comparer à un temps de guerre.
Nous sommes dans toute la complexité de la pensée : nous ne sommes pas en guerre, mais ce que nous vivons ressemble à un temps de guerre.
Et dans ce contexte, l’historien pense que comme pour un temps de guerre, il y a rupture entre « Après » et « Avant » :
« Je suis fasciné par l’imaginaire de la « sortie » tel qu’il se manifeste aujourd’hui dans le cas du déconfinement, sur le même mode de déploiement déjà pendant la Grande Guerre. Face à une crise immense, ses contemporains ne semblent pas imaginer autre chose qu’une fermeture de la parenthèse temporelle. Cette fois, on imagine un retour aux normes et au « temps d’avant ». Alors, je sais bien que la valeur prédictive des sciences sociales est équivalente à zéro, mais l’histoire nous apprend quand même qu’après les grandes crises, il n’y a jamais de fermeture de la parenthèse. Il y aura un « jour d’après », certes, mais il ne ressemblera pas au jour d’avant. Je peux et je souhaite me tromper, mais je pense que nous ne reverrons jamais le monde que nous avons quitté il y a un mois. »
Stéphane Audoin-Rouzeau a l’humilité de reconnaître qu’il ne sait pas et que sa profession d’historien ne lui donne d’aucune façon une science de la prédiction. Mais il a l’intuition d’un choc anthropologique.
Et il rappelle les deux chocs anthropologiques des guerres mondiales qui ont conduit à une crise morale.
Pour la première guerre :
« La Première a été un choc pour l’idée de progrès, qui était consubstantielle à la République. La fameuse phrase de Paul Valéry, « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles », dit quelque chose de très profond sur l’effondrement de la croyance en un monde meilleur : un effondrement sans lequel on ne peut pas comprendre le développement des totalitarismes au cours de l’entre-deux-guerres. »
Et la seconde :
« La Seconde Guerre mondiale a constitué un second choc anthropologique, non pas tellement par la prise de conscience de l’extermination des juifs d’Europe, bien plus tardive, mais avec l’explosion de la bombe atomique qui ouvrait la possibilité d’une autodestruction des sociétés humaines. »
Pour la crise actuelle, il voit un autre choc anthropologique :
« À mes yeux, nos sociétés subissent aujourd’hui un choc anthropologique de tout premier ordre. Elles ont tout fait pour bannir la mort de leurs horizons d’attente, elles se fondaient de manière croissante sur la puissance du numérique et les promesses de l’intelligence artificielle. Mais nous sommes rappelés à notre animalité fondamentale, au « socle biologique de notre humanité » comme l’appelait l’anthropologue Françoise Héritier. Nous restons des homo sapiens appartenant au monde animal, attaquables par des maladies contre lesquelles les moyens de lutte demeurent rustiques en regard de notre puissance technologique supposée : rester chez soi, sans médicament, sans vaccin… Est-ce très différent de ce qui se passait à Marseille pendant la peste de 1720 ?
Ce rappel incroyable de notre substrat biologique se double d’un autre rappel, celui de l’importance de la chaîne d’approvisionnement, déficiente pour les médicaments, les masques ou les tests, mais qui fonctionne pour l’alimentation, sans quoi ce serait très vite la dislocation sociale et la mort de masse. C’est une leçon d’humilité dont sortiront peut-être, à terme, de bonnes choses, mais auparavant, il va falloir faire face à nos dénis. »
Cette crise est en effet une crise de la modernité.
J’ai partagé plusieurs articles qui dénoncent la responsabilité humaine dans la dégradation de la biosphère, de la nature qui nous nourrit et d’autres qui font un lien direct entre ce qui nous arrive et l’action délétère de l’homme sur la nature.
Ces articles contiennent leur part de vérité et annoncent surtout les grands défis qui sont devant nous.
Mais considérant la pandémie actuelle qui certes s’est élargie au monde entier dans un temps record de quelques semaines, elle n’est pas l’apanage de nos temps modernes. Le monde des humains a connu bien des épidémies dans son histoire, des épidémies autrement mortelles que COVID-19. Epidémies qui n’ont pas attendu la démesure techniques et économiques d’homo sapiens pour faire des ravages. Ce n’est pas cela qui la rend si étrange au XXIème siècle. Ce qui la rend étrange c’est que nous ne disposions pas d’outils modernes pour la stopper ou au moins la ralentir.
Et pourtant son impact réel sur la population d’homo sapiens est négligeable.
<Ce site> évoque au 16 avril environ 137.500 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, donc en 4 mois, un tiers d’année.
Ce <site> pose comme norme dans le monde de 157.000 décès par jour, soit près de 57,3 millions chaque année. A l’aune de ce chiffre, et en rapportant le nombre de morts à une année (on multiplie 137 500 par 3), le coronavirus représente 0,7% des morts dans le monde.
Cette page de Wikipedia qui reprend le chiffre de 57 millions nous apprend qu’en moyenne 3,5 millions de personnes meurent d’infections des voies respiratoires. En moyenne 655 000 personnes meurent de paludisme.
Nous n’avons pas su réagir de manière moderne à cette épidémie qui à part sa vitesse de propagation n’est pas un phénomène particulièrement important et unique. C’est la réaction de confinement mondiale qui est unique.
Et ce qui est unique et aussi dénoncer par Boris Cyrulnik et cela est vrai une rupture historique dans le monde d’homo sapiens : l’accompagnement des mourants et des morts :
« Je reste sidéré, d’un point de vue anthropologique, par l’acceptation, sans beaucoup de protestations me semble-t-il, des modalités d’accompagnement des mourants du Covid-19 dans les Ehpad. L’obligation d’accompagnement des mourants, puis des morts, constitue en effet une caractéristique fondamentale de toutes les sociétés humaines. Or, il a été décidé que des personnes mourraient sans l’assistance de leurs proches, et que ce non-accompagnement se poursuivrait pour partie lors des enterrements, réduits au minimum. Pour moi, c’est une transgression anthropologique majeure qui s’est produite quasiment « toute seule ». Alors que si on nous avait proposé cela il y a deux mois, on se serait récriés en désignant de telles pratiques comme inhumaines et inacceptables. Je ne m’insurge pas davantage que les autres. Je dis simplement que devant le péril, en très peu de temps, les seuils de tolérance se sont modifiés à une vitesse très impressionnante, au rythme de ce qu’on a connu pendant les guerres. Cela semble indiquer que quelque chose de très profond se joue en ce moment dans le corps social. »
Pour une épidémie qui représente moins de 1% des décès dans le monde !
Dans une dizaine d’années comment regarderons-nous cette tragédie qui est en train de se jouer ?
Et nous aurons probablement d’autres pandémies, l’historien imagine qu’ils pourraient être encore plus tragique :
« Cette fois, on a le plus grand mal à penser « l’après », même si on s’y essaie, parce qu’on sait qu’on ne sera pas débarrassés de ce type de pandémie, même une fois la vague passée. On redoutera la suivante. Or, rappelons que le Covid-19 a jusqu’ici une létalité faible par rapport au Sras ou à Ebola. Mais imaginons qu’au lieu de frapper particulièrement les plus âgés, il ait atteint en priorité les enfants ?… Nos sociétés se trouveraient déjà en situation de dislocation sociale majeure.
Je suis, au fond, frappé par la prégnance de la dimension tragique de la vie sociale telle qu’elle nous rattrape aujourd’hui, comme jamais elle ne nous avait rattrapés jusqu’ici en Europe depuis 1945. Cette confrontation à la part d’ombre, on ne peut savoir comment les sociétés et leurs acteurs vont y répondre. Ils peuvent s’y adapter tant bien que mal, mieux qu’on ne le pense en tout cas, ou bien l’inverse. »
Et sa conclusion m’interpelle, car lorsque je parcoure les réseaux sociaux mais aussi certains journaux, certains philosophes et intellectuels, je vois un grand ressentiment se faire jour et de la haine s’exprimer.
Stéphane Audoin-Rouzeau conclut :
« De ce point de vue, les accusations actuelles me semblent n’être rien par rapport à ce qui va suivre. À la sortie, le combat politique a de bonnes chances d’être plus impitoyable que jamais, d’autant qu’on ne manquera pas de déclarations imprudentes et de décisions malvenues pour alimenter la machine. Rappelons au passage qu’en France, les unions sacrées s’achèvent en général en profitant aux droites, voire à l’extrême droite. Cette seconde hypothèse, je la redoute beaucoup pour notre pays. »
Camus disait :
« Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet mais ce n’est pas pour prendre de ses nouvelles. »
Il faut réfléchir à ce qui se passe, prévoir l’avenir, mais la haine et la recherche des boucs émissaires ne mèneront à rien de bon.
<1400>
-
Jeudi 16 avril 2020
« Mais non, ce virus n’est bon pour rien, ni personne »Camille Islert dans une Tribune à LibérationDepuis le début de la propagation du Covid-19, on voit fleurir des articles, des émissions, des messages, des dessins qui expliquent les bienfaits écologiques et humains du confinement. Il y a même des films, presque des récits religieux, dans lesquels un être quasi divin envoie COVID-19 pour punir les humains ou au moins les contraindre à changer, parce qu’ils n’ont pas compris la sagesse supérieure.
Voici par exemple une <vidéo> mise en ligne le 1er avril et déjà vu près de 1 300 000 fois, qui correspond à un tel récit religieux qui ne me parait ni utile, ni pertinent.
Si on veut avoir une vision plus large de la situation, il faut aussi donner la parole à celles et ceux qui ne sont pas d’accord avec ce point de vue positif.
Il y a d’abord Bernard Pivot qui du haut de ces 84 ans, ne voit pas d’un esprit bienveillant que le 11 mai il est possible que des jeunes soient déconfinés et que lui et les autres « vieux » seront toujours privés de liberté.
C’est ce qu’il a dit dans un entretien à distance dans l’émission <C à Vous du 14/04/2020> :
« Je me voyais à mon balcon le 11 mai le matin, voyant les enfants aller à l’école, des jeunes gens montés sur leur bicyclette et des hommes et des femmes aller dans le métro et moi dans l’incapacité de descendre mes escaliers ».
Et puis il fait cette description du virus :
« On écrit « Covid-19 » avec un « C » majuscule, parce qu'[on considère] que c’est un être vivant comme James Bond 007. Peut-être qu’un jour on aura un film James Bond contre COVID-19. Le bon contre le méchant.
Je crois qu’aujourd’hui on peut faire le portrait de ce COVID-19
C’est un anticapitaliste, il déteste les échanges mondiaux
C’est un écologiste, parce qu’il n’y a plus d’avion dans le ciel, la circulation des voitures a fortement décliné. L’air est frais, l’air est pétillant. Le Covid-19 a des supporters du côté des ours blancs.
C’est un misanthrope, il déteste que les hommes et les femmes parlent entre eux, boivent, déjeunent, chantent, rigolent ensemble. Il déteste cela, c’est un super misanthrope, même Molière n’aurait jamais imaginé un misanthrope pareil.
Et puis c’est un puritain, il déteste qu’on se touche, qu’on s’embrasse, qu’on se caresse etc…
Il hait le sexe, il ne s’introduit pas dans le corps par le sexe mais il le hait quand même, il déteste la sensualité.
Et puis enfin, c’est un tueur et quand même un peu spécialisé dans les personnes âgées. C’est cela qui est assez terrible.
Moi j’essaie de ne pas montrer mon âge, j’essaie de passer inaperçu. Par exemple je ne parle plus d’Apostrophes, parce que ça fait vieux et je me dis le Covid-19 va me bondir dessus parce qu’il va se dire c’est un vieux. »
Ensuite, c’est une tribune publiée par <Libération> et écrit par une doctorante en lettres modernes : Camille Islert qui dit tout le mal qu’on peut penser de ce coronavirus :
« Alors, oui, il fait beau et le ciel est clair, mais non, ce virus n’est bon pour rien, ni personne, et il serait temps d’arrêter de vouloir nous remonter le moral à grands coups de projections aussi sensationnelles qu’indécentes. »
Elle ne croit pas à ses vertus écologiques, c’est-à-dire la vertu de pouvoir convertir les humains à une autre manière de vivre sur cette planète :
« Non, le confinement n’est pas avantageux pour la planète, et il est encore moins un message que mère Nature nous envoie. Trois mois sans dégueulasser le monde ne sauveront rien du tout, et il y a de fortes chances, vu l’entêtement lunaire de nos dirigeants, que tout reprenne exactement comme avant à la fin des mesures. C’est déjà ce qu’ils nous disent, quand à l’heure où les trois quarts de la planète se rendent compte que leur travail n’est pas indispensable (oups), on force la moitié de ces trois quarts à continuer de produire. Que les choses ne changeront pas. C’est ce qu’ils nous disent quand ils nous distribuent les jours de confinement au compte-gouttes alors qu’on sait tous qu’on va y rester deux mois, comme des gentils papas qui ne veulent pas nous brusquer, quand ils nous racontent que les masques ça sert à rien ça-tombe-bien-y-en-a-pas puis que finalement c’est indispensable mais seulement si tu te le fabriques toi-même avec une vieille chaussette et un élastique. »
 Elle ne croit pas non plus que cela changera quelque chose pour les animaux :
Elle ne croit pas non plus que cela changera quelque chose pour les animaux :
« Et non, ce n’est pas parce que des canards, des cerfs, des meutes de loups argentés se trimballent en ville et qu’on verra bientôt des dauphins dans les fontaines que c’est une bonne nouvelle : ils ont juste faim, parce que plus personne n’est là pour leur balancer des miettes de sandwich au jambon. Faim, comme les milliers d’animaux de compagnie abandonnés qui se traînent dans les rues désertes et qui finiront euthanasiés dans les fourrières parce que les refuges sont pleins à craquer.
Non, le confinement n’est pas une bonne nouvelle pour les animaux. Ceux que nous avons rendus dépendants crèvent, et ceux qui n’ont pas besoin de nous crèvent, parce que les forêts, ça repousse pas en trois mois, et que même s’ils se promènent en ville, ça m’étonnerait qu’ils s’installent durablement dans un meublé. Sans compter que les jolis canards et les mignons hérissons d’aujourd’hui seront les premiers fauchés par les bagnoles dès la fin du confinement. »
Et pour les humains le confinement ne peut pas pas non plus les conduire à faire ce qu’ils ne sont jamais arrivés à faire :
« Non, le confinement n’est pas bénéfique pour les gens. Etre confiné, c’est nul. Etre à la rue, c’est bien plus nul encore. Le mieux, sans suspense, c’est de pouvoir passer de l’un à l’autre. C’est de pouvoir rentrer au chaud, dormir en sécurité, et à l’inverse, c’est de pouvoir sortir quand tu es seule et isolée du monde, juste pour voir des gens, c’est de pouvoir aller voir tes proches et tes amis quand tu en as, c’est de pouvoir baiser quand tu en as envie. Tout le monde sait ça, mais il semblerait que les pubs, les discours officiels, les contenus sponsorisés de toutes sortes aient trouvé bon de nous abreuver d’images de bonheur, avec des bouquins de Musil et de Cohen que-j’avais-encore-jamais-réussi-à-lire-en-entier, des miches de pain dorées faites maison, des armoires triées-rangées-pliées, des muscles dont on ne connaissait pas l’existence qui apparaissent en dessous du bras si on se tient à un programme bien réglé, des sites pour apprendre en quelques jours tous les rudiments du suédois. »
Les vrais héros de cette aventure sont les soignants, on leur donne de la reconnaissance saura t’on les récompenser tout simplement par une rémunération plus proportionnée à leur importance dans la société ?
« Non, «rester chez soi» ne sauve pas des vies. C’est le stade minimum de j’arrête de ne penser qu’à mon petit confort et à mon café en terrasse. Ça ne fait pas de nous, de toi, de moi, des héros. Ce qui sauve des vies, ou plutôt ceux qui sauvent des vies, aimeraient bien, sûrement, rester chez eux. Les médecins, les infirmières, bien sûr, mais aussi les livreurs, les caissières, les ouvrières, celles et ceux qui nous sauvent un peu la vie à toutes échelles. Ils ou elles ne sont pas des héros non plus d’ailleurs. Les héros, ça fait les choses pour le mérite et la gloire. C’est beau. Et c’est pratique surtout, de hisser les gens au rang de héros quand on a besoin d’eux, de stimuler leur besoin de reconnaissance pour ne surtout pas leur donner ce dont ils ont vraiment besoin, cette petite chose basse et sale et pas du tout héroïque qui s’appelle l’argent. »
Et de citer toutes celles et ceux qui sont même en danger par ce confinement :
« En fait, ça en met même en danger, des vies, de «rester chez soi». Celles des personnes qui sont seules, qui sont dépressives, qui sont malades et qui n’osent plus appeler les médecins, qui sont enceintes et culpabilisent d’avoir recours à une IVG en période de crise sanitaire, celles des gens qui vivent dans des logements minuscules, insalubres, sans accès à du confort de base. Celles des travailleur·ses du sexe qui n’ont plus de source de revenu. Celles des femmes et des enfants qui sont enfermés avec des hommes violents, avec des hommes qui vont parfois oublier tout principe de consentement parce qu’en étant enfermés H24 ensemble c’est inconcevable qu’on n’ait pas envie, et puis faut bien passer le temps, et puis les besoins naturels et tout et tout. Celles des LGBTQI+ coincés avec des familles homophobes. Plus largement, celles de toutes les personnes dont le foyer n’est pas cette chose molletonnée et rassurante avec crépitement de cheminée qu’on nous vend dans les pubs. Forcément, on a moins envie de les regarder que la cellule familiale parfaite, où tout le monde met la main à la pâte (à pain), où on vit l’enfermement comme une folle aventure. »
 Le virus, une catastrophe pour les femmes :
Le virus, une catastrophe pour les femmes :
« Il n’y a qu’à sortir pour s’en rendre compte : dans les magasins, dans les rues, partout, une majorité de femmes, avec ou sans masque, trimballent des sacs de victuailles. Des hommes aussi, mais moins, quand même, si, si. Parce que quand on a une chance dans la semaine d’acheter les trucs qu’il faut pour la famille, il vaut mieux pas se louper, et il vaut mieux que ce soit la personne en «charge», vous savez cette fameuse charge mentale, qui se «charge» directement des achats, pour éviter les erreurs. Et devinez qui c’est, dans la majorité des couples hétéros ? Vous avez deviné : probablement la même qui s’occupe des enfants d’une main tout en télétravaillant de l’autre. Jean-Michel, lui, il va sûrement penser à acheter des choses hors du commun, des petits plaisirs pour rendre la vie plus belle, mais pas sûr qu’il pense aux œufs et aux couches. Héros, Jean-Michel, avec ses chips d’exception qui rendent la vie plus belle, mais qui torchent définitivement mal les fesses de bébé. Héros, encore, comme quoi, tout se recoupe. »
Et sa conclusion
« En fait, il révèle et empire : les personnes agées, précaires, racisées sont en première ligne, encore. Non, le coronavirus n’apporte et n’apportera rien de bon, de la chambre à coucher à l’organisation mondiale, pas de bouleversement positif à l’horizon. Des milliers et des milliers de morts, des centaines de milliers de muscles atrophiés en réanimation, des millions de deuils. Non, la planète ne s’en portera pas mieux. C’est de la merde de bout en bout, on fait avec, c’est indispensable, salvateur, mais nous abreuver de raisons vaseuses de le nier n’est bon pour personne. Aidons-nous quand on le peut, donnons-nous du courage puisqu’on ne peut pas (a-t-on jamais pu ?) compter sur le haut de la chaîne pour ça, faisons-nous rire et relativiser quand on le peut. Mais par pitié, arrêtez de vouloir nous forcer à loucher sur les «bons côtés du virus». Il n’y en a pas, et c’est beaucoup plus normal et sain de se sentir dépassé, mou, déprimé, improductif, de faire ce qu’on peut, d’accepter qu’on ne peut pas. Cessez de vouloir nous faire «positiver» et «profiter» au prix de la décence : ça va, on va mal mais ça va. »
Bon….
C’est un point de vue.
Il permet de relativiser et il dit des choses très justes.
Il est un peu pessimiste pour l’avenir. Peut-être, en nous y prenant bien, saurons-nous la faire mentir, au moins en partie.
Prenez soin de vous et bon confinement.
<1399>
-
Mercredi 15 avril 2020
« Détruire la nature est au-dessus de nos moyens »Eloi Laurent« L’économie s’efface devant la question de la santé » était le constat que tirait Éloi Laurent de la réaction d’un grand nombre de pays devant la pandémie.
Mais cette pandémie arrive à un moment particulier d’abord concomitamment avec une autre crise bien plus grave : l’économiste parle de l’atteinte à la biodiversité et aux écosystèmes. Ensuite parce que depuis plusieurs années la pensée néo-libérale a fait reculer l’État social ou providence dans tous les pays d’Europe, continent sur lequel il avait été inventé.
Je continue aujourd’hui à évoquer cette émission de France Culture dans laquelle Guillaume Erner interrogeait Eloi Laurent sur son analyse de cette pandémie : « Doit-on profiter de cette crise pour repenser l’économie de demain ? »
Guillaume Erner a, en introduction, évoqué les propositions de l’ONG WWF pour préparer la reprise économique : sortir de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 en garantissant une sécurité sanitaire, écologique, sociale et économique. Et la question qu’il a alors posée à Eloi Laurent était de savoir si ce scénario relevait de l’utopie ?
Eloi Laurent a d’abord insisté sur le fait que par rapport à cette crise exceptionnelle le regard change au jour le jour.
Mais il a relevé trois points qu’il a appelés saillants.
Le premier point concerne le rapport de l’homme à la nature, à l’écosystème. De plus en plus d’avertissements nous montrent que nous sommes allés trop loin. Nous n’avons pas à revenir au temps des cavernes, mais nous ne pouvons pas vivre sans la nature, notre bien être dépend de la manière dont nous traitons l’écosystème de la terre :
« 1° Cette crise est une crise sanitaire dans ses conséquences, mais dans ses causes c’est une crise écologique. C’est une crise liée au traitement de la biodiversité et des écosystèmes. On va trop loin dans la conquête de la biodiversité et des écosystèmes. C’est le problème du marché des animaux vivants en Chine, c’est comme cela que ça a commencé. On a un système économique qui oublie la question de l’environnement. […]. C’est un traitement destructeur du bien être humain. C’est pourquoi, il faut relier cette crise du COVID-19 à l’autre crise majeure du début de l’année : des incendies géants en Australie. On a une décennie 2020 qui commence, avec un rappel très clair qui commence à être évident pour une majorité de la population : « C’est que détruire la nature est au-dessus de nos moyens ». Ce n’est pas seulement une folie en terme éthique, c’est une folie économique. Un système économique qui oublie la question des ressources naturelles et de l’environnement devient autodestructeur et suicidaire. C’est la première chose et la plus importante à comprendre. »
Le second point concerne le pays et le régime dans lequel cette pandémie a commencé : la Chine
2° La deuxième chose, c’est que tout cela a commencé dans un régime autoritaire qui a caché pendant 3 mois la réalité de la situation, qui a réprimé de façon féroce tous les lanceurs d’alerte. Il s’agit de la Chine. Et l’histoire qui dit que la dictature est une bonne affaire économique parce que le contrat social qui lie le régime et le peuple exige en contrepartie d’une croissance énorme (10% pendant 40 ans) une restriction forte des droits humains et des libertés individuelles. On voit que le coût économique de la dictature est astronomique puisqu’on a perdu 3 mois et que cela se compte en dizaine ou peut être centaine de milliers de vies humaines.
Il en conclut que l »idée qu’esquisse certain que la Chine pourrait être un modèle influent pour le reste du monde est une folie par rapport à nos valeurs mais aussi au niveau de l’efficacité. Puisque la volonté de nier toute information qui pourrait nuire au régime a conduit à un retard de réaction très préjudiciable.
Enfin le 3ème point concerne l’État providence :
« 3° Et la troisième analyse qu’on peut faire. C’est que c’est le plus mauvais moment, ce début du XXIème siècle pour abaisser nos protections collectives. Ce dont on a besoin, l’institution stratégique du XXIème siècle, c’est l’État providence. On a besoin de toutes nos protections sociales en raison de leur rôle de stabilisateur économique mais aussi pour leur rôle de réduction des inégalités. On entend qu’aux États-Unis les populations afro-américaines sont massivement touchées, c’est le cas aussi pour les populations défavorisées en France. Il y a des inégalités territoriales, toutes sortes d’inégalités révélées par cette crise et on a besoin d’une institution égalisatrice et puissante, c’est l’État providence. Et, il se trouve qu’on l’a affaibli depuis quinze ans, en France et ailleurs en Europe, là où il a vu le jour à la fin du XIXème siècle. Je rappellerai simplement qu’au moment où la crise frappait la France, on en était à l’application du 49-3 sur le système des retraites. Et que cela faisait un an que les personnels de santé criaient dans le désert qu’ils étaient à bout. »
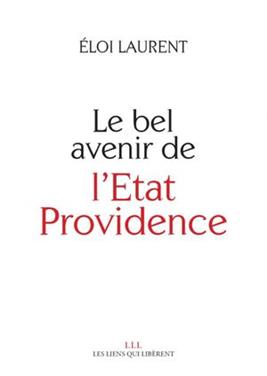 Eloi Laurent a publié, en 2014, un livre sur l’Etat Providence : « Le bel avenir de l’Etat Providence » chez « les Liens qui libèrent ». L’éditeur a d’ailleurs mis en ligne gratuitement ce livre, pendant la période de confinement, pour pouvez donc le lire intégralement à l’écran. Le lien que je donne vous envoie vers cette version en ligne.
Eloi Laurent a publié, en 2014, un livre sur l’Etat Providence : « Le bel avenir de l’Etat Providence » chez « les Liens qui libèrent ». L’éditeur a d’ailleurs mis en ligne gratuitement ce livre, pendant la période de confinement, pour pouvez donc le lire intégralement à l’écran. Le lien que je donne vous envoie vers cette version en ligne.
Vous trouverez un résumé de cet ouvrage sur <ce site> dont je reprends le début :
« L’État-providence n’est pas une faillite financière, ou un système trop coûteux qui favorise l’assistanat, et qui devrait donc être démantelé. Au contraire, l’État-providence permet le développement humain, « il est le développement humain ». Démontrant qu’il est nécessaire au marché, évoquant ses défaillances et ses fautes, Éloi Laurent ne se contente pas de le défendre, mais il en prépare la prochaine étape indispensable : l’État social-écologique pour prévoir l’arrivée des crises écologiques, étroitement liées aux crises sociales. L’État social-écologique permet de comprendre ainsi que le développement humain et la protection sociale incluent progressivement la question environnementale, en plus des enjeux sociaux.
Le début de l’essai se veut clair : « L’Europe est sur le point de commettre une faute historique : démanteler l’État-providence ». En effet, cette volonté répond à deux discours politiques, qui sont le néolibéralisme (éviter le parasitisme, limiter l’intervention de l’État, limiter la dette) et le discours xénophobe (défendre l’État-providence de l’étranger qui en profite). Au contraire, l’État-providence est l’institution qui a le plus contribué au développement économique et humain. Ainsi, citant Leandro Prados de la Escosura (Review of Income and Wealth, 2014), l’État-providence a fait bondir de 0,076 à 0,460 l’indice de développement humain entre 1870 et 2007, et 85 % de cette progression est due à la santé et l’éducation. »
On comprend donc que la pensée d’Éloi Laurent est tournée à la fois vers le social et l’écologie.
Il dénonce aussi une marchandisation de la biodiversité. Or il rappelle qu’il faut comprendre que l’économie se déploie dans la biosphère. L’économie dominante ne l’a pas comprise et même elle s’en éloigne.
Selon Eloi Laurent on s’en préoccupait davantage au XVIIIème siècle du temps d’Adam Schmidt qu’aujourd’hui :
« On a construit un système artificiel qui est largement théorique, qui sont des modèles qui tournent en dehors de toute réalité empirique. On voit cela très bien avec les modèles de l’économie du climat. On aboutit à des conclusions complétement aberrantes où vous avez le meilleur spécialiste de l’économie du climat récompensé par le prix Nobel d’économie qui vous explique que le monde économique optimum de la fin du XXIème siècle est un monde où il y a un réchauffement de 3,5 degrés. C’est-à-dire que c’est une thèse qui va à l’encontre de ce que dit la Physique, la Chimie et qui disent que c’est une folie. Si vous abordez un siècle aussi réel que le XXIè siècle avec un système aussi artificiel et éloigné des réalités c’est une catastrophe […]
La principale leçon c’est qu’on ne peut pas avoir des systèmes de pensée qui sont aussi éloignés de nos conditions de vie, qui disent autant le contraire de la réalité. L’Australie c’est un pays qui a 3 ou 4 points de croissance, la Chine 6 ou 7 points de croissance et on voit que cela ne prémunit de rien à partir du moment où les écosystèmes se retournent contre les humains. »
L’Académie royale des sciences de Suède a, en effet, donné en 2018 le prix de la Banque de Suède en l’honneur d’Alfred Nobel, improprement appelé « Prix Nobel d’Economie » à William Nordhaus qui estime qu’un réchauffement de 3,5 degrés représenterait un optimum économique.
<L’OBS> précise que :
« En 1998, [Nordhaus] trouvait que le protocole de Kyoto était trop ambitieux. Dans un document de 2016, il établit quatre scénarios, dont l’un est qualifié d' »optimal ». Que dit ce scénario ? Qu’en réduisant progressivement les émissions de CO2 de 40 gigatonnes par an en 2050 à 15 gigatonnes en 2100, on obtient « une politique climatique qui maximise le bien-être économique ». Or, dans le tableau suivant, on découvre que ce scénario optimal entraîne une augmentation de la température de… 3,5 degrés ! Le plus étonnant est que ce scénario est repris dans le communiqué de l’Académie royale des sciences de Suède, mais sans que les 3,5 degrés soient mentionnés. »
Pour Eloi Laurent, les fondations de l’économie étaient basées sous Aristote sur le bien-être et le bonheur. Les grands économistes comme Ricardo prenaient comme point de départ l’avarice de la nature. Simplement, on a oublié ça depuis le XIXe siècle et tout s’est accéléré depuis les années 1970. Il y a un problème de désarmement intellectuel et d’influence. »
Il affirme donc que les économistes modernes contrairement à leurs ainés ont oublié de prendre en compte la finitude du monde.
L’épidémie de COVID-19 va avoir des conséquences terribles sur l’économie mondiale. Le Ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire expliquait récemment que la France va vraisemblablement connaître la pire récession de sa croissance depuis 1945. Outre-Atlantique, les États-Unis enregistrent une hausse record du taux de chômage grimpant au mois de mars à 4,4 %, sa plus forte hausse sur un mois depuis janvier 1975.
Guillaume Erner a alors posé la question à Éloi Laurent :
« Etes-vous satisfait, nous sortons de la croissance ? »
 L’économiste à l’OFCE est en effet aussi l’auteur du livre « Sortir de la croissance : mode d’emploi » aux éditions Les Liens qui Libèrent.
L’économiste à l’OFCE est en effet aussi l’auteur du livre « Sortir de la croissance : mode d’emploi » aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Comme pour le livre sur l’Etat providence, ce livre peut être lu intégralement à l’écran en suivant le lien que je donne.
Concernant la réponse à la question de Guillaume Erner, Eloi Laurent répond par la négative, car il n’est pas décroissant, simplement il ne veut plus que tout le système économique soit organisé autour de ce seul indicateur de la croissance du PIB :
« Je ne suis pas heureux de ce qui se passe. Qu’on se retrouve bloqué cela ne crée pas le bonheur. La transition ce n’est pas une prison.
Sortir de la croissance, ce n’est pas prôner la décroissance c’est-à-dire utiliser le même indicateur à l’envers.
C’est la même erreur que de croire qu’augmenter la croissance résout tout, que de penser que faire baisser la croissance résout tout.
Je ne suis pas décroissant, je propose d’aller vers la transition du bien-être, c’est-à-dire de manière ordonnée et surtout démocratique de se donner de nouveaux indicateurs qui soient en phase avec les défis du XXIème siécle : les inégalités, la démocratie, l’écologie et d’aligner nos politiques publiques sur ces nouveaux indicateurs de bien-être.
Le point central c’est que chaque fois qu’on vote un budget à n’importe quel niveau, on le fasse sous l’égide d’indicateurs de bien-être humain et non plus de la croissance.
En tant que chercheur, je constate le décrochage de plus en plus fort entre la recherche de la croissance et le bien être humain.
Aux Etats-Unis, le pays le plus riche avec un le taux de croissance le plus fort de tous les pays développés et on va avoir la tragédie absolue du système de santé parce que c’est un pays qui ne cultivent pas sa richesse humaine. »
Le numérique ne trouve pas grâce non plus à ses yeux notamment en raison de son coût écologique qui est énorme pour lui.
Il est aussi contre les indicateurs uniques, il faut toujours une pluralité des indicateurs.
Je redonne le lien vers cette émission stimulante : « Doit-on profiter de cette crise pour repenser l’économie de demain ? »
France Culture propose aussi une page qui renvoie vers des émissions qui abordent les sujets de la Croissance et des biens communs : <Croissance et biens communs : 2 concepts clés en économie>
<1398>
-
Mardi 14 avril 2020
« L’économie s’efface devant la question de la santé. »Eloi LaurentÉloi Laurent est un économiste que j’écoute avec intérêt. Au mois de juin 2017 j’avais consacré une série de mots à son ouvrage : « Nos mythologies économiques ».
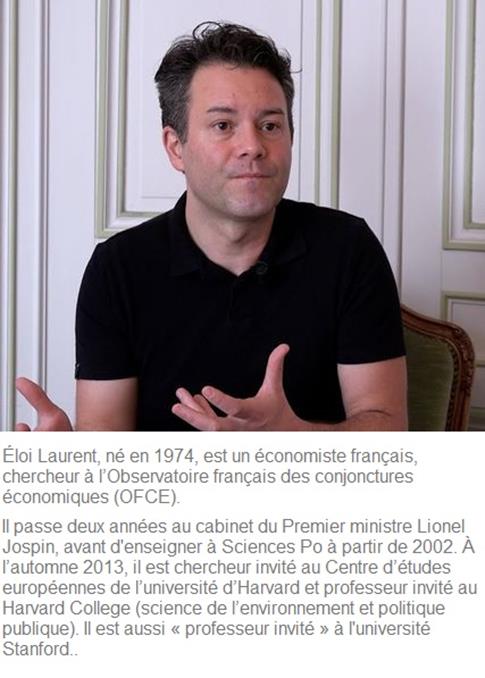 Il est intéressant d’entendre ce qu’il dit sur la crise actuelle.
Il est intéressant d’entendre ce qu’il dit sur la crise actuelle.
Il a été l’invité de Guillaume Erner sur France Culture le 8 avril : « Profiter de cette crise pour repenser l’économie de demain ».
Je reviendrai probablement plus longuement sur cette émission demain. Mais aujourd’hui, je voudrai m’arrêter sur une partie de sa conclusion qui me semble lourde de sens :
« L’économie s’efface devant la question de la santé.
C’est frappant de constater qu’en réalité la valeur sous-jacente universelle c’est la santé.
Dans le monde, il y a actuellement 3,5 milliards d’humains qui sont confinés. La valeur sous-jacente universelle c’est la santé ce n’est pas la croissance. Des pays du monde ont convergé de manière fulgurante vers cette valeur universelle, qui n’est pas l’économie.
Et cela doit nous interroger sur notre capacité à converger vers cette valeur universelle en temps normal et sur un mode non autoritaire. »
Il y a encore Jair Bolsonaro au Brésil qui tient un discours contraire : il faut sauver l’économie, tant pis pour les morts.
Mais Boris Johnson a du faire retraite : <Quand Boris Johnson se moquait du coronavirus>
Au début il s’en moquait disant qu’il suffisait de se laver les mains. Puis il a tenu un discours plus grave, en disant aux Britanniques qu’il y aurait des morts mais que sa stratégie était celle de l’immunité de groupe. Il suffisait que 50 à 60 % de la population ait été infectée pour que le virus ne puisse plus se propager. Bien sûr il y aurait des morts, mais la vie économique pouvait continuer et au bout du compte la victoire contre le virus serait plus rapide.
Mais il n’a pas pu tenir. Le 23 mars, l’exécutif britannique se résout à confiner sa population pour « sauver des vies et protéger le NHS [service de santé national]».
Et le 27 mars Boris Johnson est détecté positif au virus puis hospitalisé jusqu’à intégrer l’unité de soins intensifs. Aujourd’hui sorti d’affaire, il remercie le personnel soignant de lui avoir sauvé la vie.
Malgré toute sa volonté, il n’a pas pu privilégier l’économie, le peuple britannique n’acceptait pas qu’on laisse mourir des gens, sans les soigner parce que les hôpitaux étaient submergés.
On ne peut pas !
C’est quelque chose de très fort, cette vague de fond qui s’est emparé du monde entier.
Donald Trump n’a pas pu non plus faire prévaloir l’économie, l’emploi.
Il le voulait.
Mais la pression a été trop forte.
Aux Etats-Unis des hommes politiques ont posé le débat très clairement : Etait-il pertinent de rallonger de quelques années la vie de centaine de milliers vieux américains improductifs pour sacrifier des millions de productifs qui vont être laminés par la crise économique, le chômage et les faillites.
Ainsi, par exemple < Le vice-gouverneur du Texas estimait que les personnes âgées devraient se sacrifier pour l’économie> et il n’était pas le seul.
Pour lui le confinement de la population, et donc le ralentissement général de l’économie, était la plus grande menace pour les États-Unis.
«Êtes-vous prêt à prendre le risque [d’être malade] afin de conserver l’Amérique que tout le monde aime pour vos enfants et petits-enfants ?» a lancé celui qui est âgé de 69 ans et a six petits-enfants. «Si c’est le deal, je suis prêt à me lancer», a-t-il expliqué, assurant qu’il ne voulait pas «que tout le pays soit sacrifié».
Du point de vue de la rationalité économique, il avait peut être raison. La crise économique va entrainer des morts et probablement beaucoup plus de pauvreté.
Mais cela n’a pas pu se faire, ce débat n’a pas eu lieu.
Andrew Cuomo, le gouverneur de New York a exprimé la position dominante :
« Ma mère n’est pas sacrifiable. Pas plus que votre mère n’est sacrifiable, que nos frères et sœurs sont sacrifiables. Nous n’allons pas accepter le principe selon lequel la vie est jetable. Nous n’allons pas mettre un prix sur des vies humaines. S’il faut choisir entre la santé du public et l’économie, le seul choix est la santé du public. La priorité numéro un est de sauver des vies. Point final »
A ce stade c’est une victoire des valeurs. De la valeur de la vie.
Le site Atlantico a essayé cependant de mener le débat : <La santé ou l’économie ? Petites réflexions philosophiques sur un vrai dilemme>
L’un des philosophes interrogés Damien Le Guay dit :
« Le choix est tout sauf évident – même s’il s’impose d’une façon majoritaire en faveur d’un confinement. Un choix est fait, dont nous ne mesurons pas toutes les conséquences : étouffer l’économie, la mettre sous cloche, faire porter sur les générations futures la santé des contemporains, plutôt que de laisser la pandémie se dérouler comme toutes les pandémies en protégeant les individus. D’une certaine manière nous nous donnons le choix, nous croyons avoir le choix, pour être des économies riches et pour faire porter par la solidarité collective une grosse partie du coût de cet étouffement économique. Et, dans des économies plus libérales que les nôtres, comme les pays anglo-saxons, ce choix, quand il est fait en faveur du confinement, pèse plus lourdement sur les individus eux-mêmes. »
L’autre philosophe, Bertrand Vergely, analyse l’évolution de Donald Trump :
« Il y a deux façons de mesurer. La première se fait par le calcul et les mathématiques en appliquant des chiffres et des courbes à la réalité. La seconde se fait par l’émotion, la sensation, la sensibilité. Quand quelque chose plaît, je n’ai pas besoin de chiffres et de courbes pour savoir que cela plaît. Quand cela déplaît également. Lorsque Donald Trump a compris qu’il fallait s’occuper de la question sanitaire aux États-Unis et pas simplement d’économie, il n’a pas eu cette révélation à la suite d’un sondage. Il n’a pas utilisé les compétences d’instituts spécialisés. La réaction ne se faisant pas attendre, il a été plus rapide que les chiffres, les courbes et les sondages en changeant immédiatement son discours. Il a été découvert récemment que l’intelligence émotionnelle est infiniment plus rapide que l’intelligence mathématiques, abstraite et calculatrice. On peut sur le papier démontrer que l’humain coûte trop cher. Lorsque dans la réalité concrète on ne s’en occupe pas assez et mal, on a immédiatement la réponse. Donald Trump s’en est très vite aperçu. »
La conclusion de Damien Le Guay permet d’approfondir encore, en constatant que des décisions antérieures nous ont conduit à cette situation tragique, c’est-à-dire dans laquelle les deux solutions proposées sont mauvaises :
« Le problème (et nous le découvrons brutalement avec cette crise sanitaire) est que nous payons aujourd’hui une double défaillance : une défaillance stratégique de nos politiques publiques qui ont, en Europe, favorisé la mondialisation au détriment des intérêts stratégiques nationaux, sans définir des secteurs à protéger et sans mettre en place, au niveau des pays ou de l’Europe, des coordinations en cas de risques sanitaires ; une défaillance des entreprises pharmaceutiques et de santé publique qui ont cru qu’elles pouvaient se délester de secteurs entiers jugés « peu rentables », comme les systèmes de protections, la fabrication des médicaments génériques, les masques. La Chine, « usine du monde », détient ces marchés et ne peuvent répondre quand le monde entier passe d’énorme commande. La mondialisation se retourne contre les Nations en cas de crise. Elle se grippe avec une pandémie mondiale. Et les individus nationaux paient le prix de cette mondialisation défaillante.
Pour toutes ces raisons, nous n’avons plus la possibilité d’avoir le choix. Nos défaillances collectives nous font faire des choix malgré nous. L’État imprévoyant, l’Europe tatillonne pour les détails et aveugle sur les grands défis de santé publique et, pour finir, les entreprises médicales inconséquentes, soucieuses d’augmenter leurs profits, ont décidé à notre place. Ils nous ont privés du choix d’avoir le choix. Alea jacta est. »
J’avais cité Pierre-Henri Tavoillot, dans le mot du jour du 23 mars 2020 :
« Ce qui caractérise la tragédie, c’est qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions ; dans le meilleur des cas, il y en a des mauvaises et des pires. »
Et donc dans ce dilemme tragique, le choix de préserver la santé de nos ainés l’a emporté.
Ce n’était pas évident tant nous pensions que l’économie dominait tout et qu’on était prêt à tout sacrifier sur cet autel.
Ce n’est pas vrai, l’économie cette fois ne l’a pas emporté.
Cela doit nous donner de l’espoir, même si nous pouvons craindre que les mois et les années à venir seront très difficiles pour beaucoup d’entre nous et de nos proches.
<1397>
-
Lundi 13 avril 2020
« Par l’infinie ruse
De l’extrêmement petit
Nous avons compris
Vraiment l’indispensable »Quatrain que m’a inspiré cette histoire collective et mondiale qui nous arriveMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
François Cheng nous a expliqué la force de la concision d’un quatrain.
J’ai souvent écrit des mots du jour fort long, parfois ou souvent trop long.
J’essaye donc de synthétiser ce que cette expérience nous apprend dans un quatrain, 5 ; 7, 5, 7.
« Par l’infinie ruse
De l’extrêmement petit
Nous avons compris
Vraiment l’indispensable »
<1396>
-
Dimanche 12 avril 2020
« Maria Kehoane »Soprano suédoise qui magnifie la musique de BachMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Parce que nous sommes en période de confinement, j’écris donc un mot du jour le dimanche de Pâques.
Il est étonnant d’ailleurs que ce mot de «Pâques» soit au pluriel. Wikipedia nous donne une explication :
« Le pluriel de Pâques ne fait pas référence à une pluralité de dates. La langue française distingue en effet la Pâque originelle juive (ou Pessa’h) et la fête chrétienne de Pâques. La première commémore la sortie d’Égypte et la liberté retrouvée des enfants d’Israël. La fête chrétienne est multiple. Elle commémore à la fois la dernière Cène instituant l’eucharistie, la Passion du Christ et sa résurrection. C’est seulement après le XVe siècle que la distinction sémantique a été marquée par la graphie entre Pasque (ou Pâque) désignant la fête juive et Pasques (ou Pâques) désignant la fête chrétienne. ».
Pâque est donc la fête juive et Pâques la fête chrétienne et qui est pluriel parce qu’elle célèbre plusieurs évènements du récit chrétien.
Même si on ne partage pas le récit chrétien de Pâques et de la résurrection du corps physique du personnage central du christianisme supplicié deux jours avant, il faut quand même reconnaître que c’est une fête de joie, de la re-naissance.
Que partager ce jour-là ?
Il serait assez commode et naturel de partager une autre œuvre de Jean-Sébastien Bach ; la réponse de la Passion : l’Oratorio de Pâques BWV 249, créé à Leipzig le 1er avril 1725.
J’aurai choisi la version de la « Netherlands Bach Society » dirigée par Jos van Veldhoven avec l’alto déjà présent dans la version de la Passion selon Saint Matthieu de vendredi : Damien Guillon et avec la soprano Maria Keohane.
Et finalement j’ai pensé que le plus éclatant, le plus exceptionnel était de partager, la vidéo qui m’a fait découvrir cette soprano suédoise née en1971, spécialiste de la musique baroque et particulièrement de Jean-Sébastien Bach.
 Il s’agit d’un extrait d’une autre cantate de Bach composée à Leipzig également en 1725, mais en décembre, la cantate BWV 151 : <Süsser Trost, mein Jesus kommt> (douce consolation, mon Jésus vient).
Il s’agit d’un extrait d’une autre cantate de Bach composée à Leipzig également en 1725, mais en décembre, la cantate BWV 151 : <Süsser Trost, mein Jesus kommt> (douce consolation, mon Jésus vient).
Elle est accompagnée par le Concerto de Copenhague dirigé par Lars Ulrik Mortensen. Cela ne dure que 8:30, ce qui n’est pas long par rapport aux œuvres classiques que je partage habituellement.
Alors, si je peux me permettre, il faut entrer dans cette écoute, comme on entre en méditation.
Une écoute profonde et exclusive.
Et alors, on vit un moment de grâce absolue.
La première fois que j’ai entendu cet enregistrement, je l’ai réécouté plusieurs fois, tellement la beauté du grain de la voix, la sensibilité, l’extraordinaire agilité de cette chanteuse qu’aucun obstacle ne semble être en mesure d’entraver m’ont paru miraculeuses.
Sergiu Celibidache a parlé de ces moments magiques pendant lesquels tous les astres semblent alignés pour ne plus simplement tutoyer la perfection, mais l’atteindre.
Des micros et une caméra étaient là pour enregistrer ce moment magique.
Les musiciens qui accompagnent cette voix dans sa quête de l’inaccessible beauté sont fascinés.
On trouve bien d’autres enregistrements de cette artiste sur Internet, toujours remarquable mais sans atteindre les mêmes cimes.
Par exemple la cantate BWV 29 <Wir danken dir Gott> créé le 27 août 1731 à Leipzig. Le solo de Maria Keohane commence à 14:30.
Je donne aussi le lien vers <L’oratorio de Pâques> évoqué précédemment.
Si vous voulez les textes de cette cantate et leur traduction voici le lien vers <La page> du site entièrement consacrées aux cantates de Bach.
Cioran a dit : « S’il y a quelqu’un qui doit tout à Bach, c’est bien Dieu », Maria Kehoane élève la musique de Bach à des niveaux divins.
Mais les mots sont incapables de décrire cette émotion.
<1395>
-
Samedi 11 avril 2020
« Le quatrain de Jeanne d’Arc »Propos tenu par Jeanne d’Arc lors de son procèsMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
« Puis vint cette voix,
Environ l’heure de midi,
Au temps de l’été,
Dans le jardin de mon père. »
Jeanne d’Arc
L’Eglise catholique a beaucoup innové et beaucoup construit, dans les siècles de sa puissance.
Elle a aussi produit beaucoup d’écrits.
Même lorsqu’elle commettait des atrocités, il y avait un secrétaire qui écrivait scrupuleusement ce qui se passait lors de séances de tortures ou dans un procès inique comme celui de Jeanne d’Arc. Et ces documents ont été conservés.
Ainsi ce que l’on sait avec le plus de précision de la vie de Jeanne d’Arc, c’est son procès. On sait exactement ce qu’elle a dit.
Je le concède je ne m’y suis jamais intéressé de très près, il me suffisait de savoir que celui qui dirigeait tout cela était l’évêque Pierre Cauchon et que ce procès fut inéquitable.
Mais, Francois Cheng que j’ai déjà évoqué lors de cette période de pandémie et de confinement : « La mort n’est pas notre issue » avait été invité dans La grande librairie du 22 février 2018 sur France 5 pour présenter son ouvrage « Enfin le royaume » qui est un recueil de quatrains.
Et quand François Busnel lui pose cette question essentielle :
« Comment faites vous
Quel est le secret de la concision réussie
Comment une idée devient-elle
Quatre courts vers qui s’appelle un quatrain ? »
François Cheng lui répond par le quatrain de Jeanne d’Arc. Vous trouverez cela dans la vidéo à partir de 14:31.
Il raconte cet épisode ainsi :
« Au juge, textuellement, elle a dit :
«Puis vint cette voix,
Environ l’heure de midi.
Au temps de l’été
Dans le jardin de mon père.»
C’est un quatrain qui vient du fond du cœur et c’est le résultat de toute une vie.
Un quatrain à la fois simple et sublime.
On y entend une des plus belles voix de France.
Puis vint cette voix,
Environ l’heure de midi.
Au temps de l’été
Dans le jardin de mon père.
Il y a un accent éternel.
Tous les Français doivent retenir ce quatrain par cœur.
C’est un quatrain parfait. 5, 7, 5, 7.
C’est ma manière de répondre à votre question.
Jeanne d’Arc, avant d’aller sur le bûcher, a dit cela. »
Et il a ajouté
« D’ailleurs Cocteau a dit que Jeanne d’Arc était le plus grand écrivain français »
Dans cette émission magnifique, François Cheng a dit aussi
« Les vrais poètes sont des poètes de l’être »
« Le quatrain est le diamant.de la poésie universelle ! »
« Car vivre est savoir que tout instant de vie est rayon d’or sur une mer de ténèbres. »
Le lien vers cette émission est celui-ci : <La grande librairie du 22 février 2018>
France Musique a consacré une émission sur <Les Voix de Jeanne d’Arc>
<Sur ce site> vous trouverez d’autres citations de Jeanne d’Arc lors de son procès.
Il y a 100 ans, le 16 mai 1920, à Rome Jeanne d’Arc était canonisée et devenait sainte à l’intérieur de l’Église qui l’avait assassinée.
Rouen, lieu de son bucher, avait décidé de fêter le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc.
Encore des cérémonies annulées en raison du confinement.
Et si nous voulons, comme le souhaite François Cheng, retenir ce quatrain, répétons-le :
« Puis vint cette voix,
Environ l’heure de midi,
Au temps de l’été,
Dans le jardin de mon père. »
<1394>
-
Vendredi 10 avril 2020
« La passion selon saint Matthieu »Jean-Sébastien BachCe vendredi 10 avril 2020, le calendrier grégorien que nous utilisons indique : « Vendredi-Saint »
Dans le récit chrétien, le Vendredi saint est la commémoration religieuse de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ.

Ce jour est férié dans un grand nombre de pays ou de régions dont une partie de la population est chrétienne, en Europe (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Suisse…), en Amérique (Argentine, Canada, Chili, 12 des 50 États des États-Unis…), en Afrique (Éthiopie, Kenya, Nigéria…) et en Asie (Hong Kong, Inde, Indonésie, Macao…).
C’est également un jour férié pour les départements français du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle.
Il s’agit d’un jour de tristesse et de méditation pour la communauté chrétienne.
Ce jour particulier, probablement continuant à être profondément imprégné de culture chrétienne, j’ai pris l’habitude d’écouter, chaque année, la « Passion selon Saint Matthieu » de Jean-Sébastien Bach.
Le vendredi saint constitue dans la symbolique chrétienne, le temps de l’épreuve, de la souffrance, de la mort.
Nous ne sommes pas en guerre, mais ce temps de la pandémie est un temps de l’épreuve.
C’est pourquoi, il me parait assez naturel de faire lien entre ce que nous vivons et notre calendrier qui se fonde sur notre culture chrétienne et rythme notre temps de vie.
Je partage donc aujourd’hui, cette œuvre monumentale et exceptionnelle de la culture européenne et chrétienne de l’immense compositeur de culture protestante : Jean-Sébastien Bach.
Deux jours après, vendredi saint, il y a Pâques qui pour les chrétiens signifient résurrection.
Mais de la résurrection, j’en ai déjà parlé, dimanche dernier en évoquant la deuxième symphonie de Mahler. Dans cette œuvre, il n’est pas question de la résurrection du Christ, mais elle est cependant profondément imprégnée de culture religieuse chrétienne.
Comme dimanche dernier, je partage d’abord une interprétation de la Passion selon Saint Matthieu :
<Bach : Passion selon Saint Matthieu – Collegium vocale de Gand – Herreweghe>
Et comme dimanche dernier, j’écris :
« La lecture de ce mot du jour peut donc s’arrêter là et basculer vers le visionnage de ce concert. Voici l’essentiel. »
Et puis, la lecture peut aussi continuer, car il y a tant de choses à dire sur ce monument de la culture européenne, de la culture religieuse chrétienne, de la musique occidentale.
1 – Vendredi saint
La Pâque chrétienne est directement issu de la Pessah juive qui commémore la sortie des juifs d’Egypte. Mais l’étonnante Rabbine Delphine Horvilleur narre une autre histoire et parle d’une naissance et en puisant dans l’étymologie des mots hébraiques compare le passage de la mer rouge à la libération du liquide amniotique qui précède l’accouchement. <C’est ici>. Cette histoire juive rencontre l’histoire chrétienne puisque dans ce récit Jésus prépare la fête de Pessah, le jeudi, la veille du vendredi saint, lors de la célèbre <Cène> peint par tant de grands artistes dont Léonard de Vinci.
En 2020 , Pessah est célébré du jeudi 9 avril au jeudi 16 avril. Et la pâque chrétienne est célébré le premier dimanche qui suit la première pleine lune qui suit l’équinoxe de Printemps. Exprimé ainsi, on comprend bien que cette fête s’inscrit dans un calendrier plus ancien, lié à la nature et qui se situe au moment où la durée du jour reprend le dessus sur la durée de la nuit. Ces fêtes ont donc avec une autre symbolique occupé la place de fêtes païennes.
En revanche, il semble que le Vendredi Saint qui commémore la Passion, c’est-à-dire le supplice, la procession et la crucifixion du Christ, ce moment du récit évangélique qui clôt l’aventure « humaine » de Jésus constitue un jour propre au christianisme et qui ne se fonde pas sur une fête issue d’une autre tradition.
Dans la tradition chrétienne, pour rappeler la procession du Christ vers Golgotha, des processions, appelés chemin de croix sont organisés dans de nombreux lieux.
 Cette année constitue donc encore une particularité puisque toutes ces processions sont annulées en raison du COVID-19.
Cette année constitue donc encore une particularité puisque toutes ces processions sont annulées en raison du COVID-19.
2 – La crucifixion
La religion chrétienne est une doctrine très compliquée. Rien que le dogme de la Trinité qui révèle un Dieu unique sous trois « formes » différentes semble assez incompréhensible, peut être une prémisse de la mécanique quantique ? Mais que le représentant de Dieu sur terre, le fils de Dieu selon la doctrine, un des membres de la Trinité finisse sa vie terrestre par l’humiliation et la mort réservé aux esclaves dans l’empire romain est plus qu’incompréhensible par les adeptes de toutes les autres religions, impensable.
Pour René Girard, cette crucifixion constitue le sacrifice ultime faisant du Christ le bouc émissaire final et unique qui permet de surmonter la pulsion des sociétés à devoir désigner des boucs émissaires pour surmonter les tensions internes et apporter la paix en leur sein. Tout au long des mots du jour, notamment les derniers je constate que la recherche des boucs émissaires reste un exercice prisé de nos sociétés, qui sont il est vrai post chrétiennes. Harari avait résumé cette tendance par cette formule : « s’il y a un problème, c’est qu’il existe quelqu’un quelque part qui a merdé ».
La langue française réserve le terme de « crucifixion » à l’exécution de Jésus de Nazareth. Cette peine qui est toujours pratiqué en Arabie saoudite même si elle est pratiquée post mortem, avait été sordidement remis dans l’actualité lors de l’épopée sanglante de DAESH, dans ce cas on utilise le mot « crucifiement ».
Pour être exact, « Crucifixion» ne désigne pas seulement le supplice du Christ mais aussi des œuvres d’art qui décrive ce sujet. Et il en existe de nombreux. J’illustre ce mot du jour par la reproduction de certaines d’entre elles, peints par Rembrandt, Raphaël, Zurbaran, Dali.
3 – Le texte de la passion du Christ dans l’évangile selon saint Matthieu
Le récit de la passion selon Saint Matthieu.
Opportunément le journal catholique « La Croix » publie un extrait de La Bible dans la nouvelle traduction Bayard, et cet extrait est le récit de la passion selon saint Matthieu (26,14-27,66), à partir du moment où Judas vend son maître jusqu’au soir de cette journée qui deviendra dans le récit Vendredi Saint.
Et dans ce texte fondateur du christianisme, ce texte que Bach a mis en musique, on lit cela :
« Vint l’aube. L’assemblée des grands prêtres et des anciens du peuple délibéra sur Jésus et sur sa mise à mort. Ligoté, il fut conduit devant le procurateur Pilate, à qui on le livra. […]
Jésus se tenait debout devant le procurateur. Ce dernier l’interrogea : Es-tu vraiment le roi des juifs ?
Tu l’as dit, répondit Jésus, sans répliquer aux accusations des grands prêtres et des anciens.
Pilate insista : N’entends-tu pas tous ces témoignages contre toi ?
Jésus ne répondit rien. Ce silence impressionna fortement le procurateur.
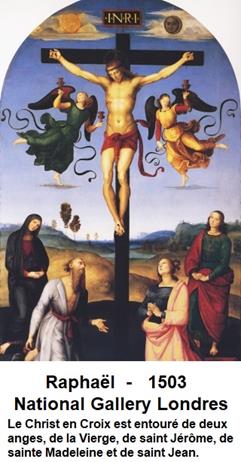 Les jours de fête, ce dernier avait l’habitude de relaxer un prisonnier choisi par la foule.
Les jours de fête, ce dernier avait l’habitude de relaxer un prisonnier choisi par la foule.
Barabbas était alors un prisonnier célèbre. À la foule rassemblée, Pilate demanda : Lequel des deux dois-je relâcher ?
Barabbas ? Ou Jésus, dit le Christ ?
Il savait que c’était par envie que Jésus avait été livré […].
Les chefs et les anciens persuadèrent les foules de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Le procurateur revint à la charge : Lequel des deux dois-je relâcher, selon vous ?
Des voix s’élevèrent : Barabbas !
Et Pilate : Qu’adviendra-t-il de Jésus, dit le Christ ?
Un cri monta de la foule : Qu’on le crucifie !
Et lui : Mais quel mal a-t-il fait ?
Les cris redoublèrent de fureur : Qu’on le crucifie ! L’agitation allait croissant. On ne peut rien faire, conclut Pilate.
Et prenant de l’eau, sous leurs yeux, il se lava les mains.
Je suis innocent du sang de ce juste, déclara-t-il. Cette affaire ne regarde que vous.
Et tout le peuple répondit : Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Barabbas fut remis en liberté. »
L’antisémitisme est aussi dans ce texte, dans ce récit mythique. Le récit des chrétiens qui fait dire au peuple juif « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Ce récit qui a été écrit plus de 30 ans après les faits a peu de probabilité de décrire avec précision ce qui s’est vraiment passé, si cela s’est passé. Si on prend l’hypothèse que ce texte relate une histoire à peu près exacte, on constate qu’il y’a manipulation de la foule par quelques dirigeants, la foule elle-même n’étant qu’une partie du peuple.
Mais le récit qui, pendant des siècles, a été lu, raconté dans les églises, dans les familles, chanté dans les passions parle d’un peuple juif déicide puisque dans la doctrine chrétienne Jésus est fils de Dieu.
Nous sommes au cœur de l’antisémitisme de source religieuse, nous savons qu’il en existe d’autres. J’avais développé ce sujet dans un mot du jour de début 2019 <La haine des juifs>
4 – L’œuvre de Jean-Sébastien Bach : « Die Matthaüs Passion » La Passion selon Saint Matthieu
Sans que cette date soit certaine, il semble que La Passion selon saint Matthieu (BWV 244) ait été exécutée probablement pour la première fois le Vendredi saint 1727, c’est-à-dire le 7 avril 1727 dans l’Eglise Saint Thomas de Leipzig, dans cette église où Bach fut le « Kantor » (maître de chapelle) de 1723 jusqu’à sa mort en 1750 et dans laquelle repose sa dépouille depuis 1950. Elle a été remaniée trois fois. La troisième version, définitive, a été créée en 1736.

Tous les deux ans, le vendredi saint, en alternance avec la Passion selon Saint Jean, la Passion selon Saint Matthieu est interprétée dans ce lieu particulier pour la culture musicale occidentale, l’église de Bach. D’ailleurs chaque année, à travers le monde, la Passion selon Saint Matthieu est donnée autour du jour du vendredi saint. Tous les ans, sauf cette année 2020 où le confinement créé par la pandémie du COVID-19 a conduit à annuler toutes ces manifestations, comme le fait remarquer <Libération>
Je ne développerai davantage la présentation de <cette œuvre> qui dure plus de 2 heures 30. Il y a lieu cependant de dire que Bach n’a jamais composé d’opéra, parce que dans un aucun de ses postes cela ne lui a été commandé. En outre, dans son dernier poste à l’église Saint Thomas, l’opéra n’était pas toléré dans l’austère et puritaine Leipzig. Mais les passions qu’il a écrites et particulièrement la « Saint Matthieu » sont en réalité des opéras religieux, même si elles sont données sous forme d’oratorio.
Pour dire la beauté de cette œuvre, je ferai appel, une fois n’est pas coutume à Alain Juppé : dans le livre « Alain Juppé sans masque » son biographe, Dominique Lormier raconte :
« Il faut le voir pour le croire, écrit Anna Cabana : ses yeux se mouillent quand il se met à fredonner les premières notes de son aria préférée de la Passion selon saint Matthieu. Bach lui tire des larmes, à Juppé. De vraies larmes, je peux en témoigner. »
La passion selon saint Matthieu occupe aussi une place très particulière dans l’Histoire de la musique. Pendant longtemps, on ne jouait que la musique des compositeurs vivants. On utilisait des partitions de musiciens morts pour les étudier, pour apprendre la musique, quelquefois s’en inspirer, mais on ne les jouait jamais en public.
Jamais jusqu’à Félix Mendelssohn Bartholdy qui à 20 ans va interpréter cette œuvre près de 80 ans après la mort de Bach :
« A Berlin, le mercredi 11 mars 1829, à 6 heures du soir, par un temps printanier, la salle de la Sing-Akademie résonne des premières notes d’une œuvre qui n’a plus été jouée depuis la mort de son auteur en 1750 : la Passion selon saint Matthieu de Johann Sebastian Bach. La salle, pouvant accueillir entre 800 et 900 spectateurs, est pleine à craquer au point qu’on a dû ouvrir les vestibules et une pièce derrière l’orchestre. Cela n’a pas suffi; il a fallu refuser plus de mille personnes. La famille royale, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III en tête, et de nombreux membres de la cour sont présents. Le tout-Berlin intellectuel et artistique est également là : Schleiermacher, Hegel, Droysen, Heine, Rahel Varnhagen… »
Pour Nikolaus Harnoncourt, cela constitue le début de cette nouvelle manière d’aborder la musique qu’on va appeler classique par la suite et qui est désormais une musique dont on célèbre et joue pour l’essentiel des compositeurs morts.
5 – Interprétation de l’œuvre.
L’interprétation vers laquelle renvoie ce mot du jour est exceptionnelle, d’abord en raison du chef belge : « Philippe Herreweghe »
L’élégance n’est pas la priorité de Philippe Herreweghe, quand il lève ses bras on a presque une impression de maladresse ou encore de la volonté de vouloir communiquer l’incommunicable. Le résultat est exceptionnel.
C’est mon ami Gilbert qui me l’a fait découvrir par un de ses premiers disques.
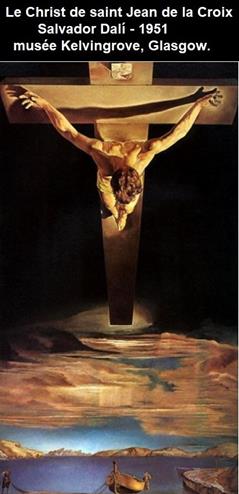
Et dans nos débuts communs à Paris, à la fin des années 1980, Annie et moi avons appris qu’il donnait des concerts à l’église des blancs manteaux avec son ensemble parisien la Chapelle Royale et son ensemble belge le Collegium vocale de Gand. Nous n’avons alors loupé aucun de ces concerts dans cette église.
Depuis, j’ai acheté tous les disques qu’il a réalisé et dans lesquels il interprète Bach.
J’en ai beaucoup d’autres, mais pas tous ses disques.
Mais tous les Bach et même quand il a enregistré trois fois la Messe en si, trois fois la passion selon saint Jean et pour l’instant deux fois la passion selon saint Matthieu mais on attend une troisième bientôt, j’ai acheté toutes les versions.
Et bien sûr quand il vient à Lyon, nous y allons aussi.
Dans la version proposée, il est bien sur accompagné de son remarquable ensemble du Collegium vocale de Gand mais aussi de chanteurs exceptionnels : l’évangéliste Christoph Prégardien, les deux sopranos, Dorothée Mields et Hana Blažíková,, la somptueuse basse Stephan Mac Leod. Une interprétation tout simplement exceptionnelle.
<Bach : Passion selon Saint Matthieu – Collegium vocale de Gand – Herreweghe>
<1393> -
Jeudi 9 avril 2020
« En santé, comme en éducation, les besoins sont infinis. »Philippe Mossé et Corinne GrenierMéfions-nous des explications simples.
J’écoute beaucoup d’intervenants qui racontent tous la même histoire.
L’hôpital a été délaissé par d’odieux gouvernants qui ont toujours cherché constamment à restreindre les moyens alloués à l’hôpital public.
Ce sont des criminels doublés d’imbéciles, la pandémie actuelle montre l’étendue de leur défaillance.
Dès que cette crise sera surmontée, il va falloir massivement redonner de l’argent à l’hôpital public pour que tout cela fonctionne à nouveau correctement.
J’ai l’impression que presque tout le monde est convaincu qu’énoncer ainsi nous avons à la fois le problème et la solution.
Enoncé encore plus synthétiquement le problème c’est qu’on a manqué de sous, la solution c’est de donner des sous.
C’est simple et compréhensible.
Pour mettre un peu de nuance dans cette vision de la réalité je vous renvoie vers un article de Libération écrit par Philippe Mossé, économiste, CNRS-Lest, Aix-en-Provence et Corinne Grenier, professeur Innovation en santé : <L’ajustement sans fin des ressources et des besoins>
Et pour une fois je cite cet article in extenso :
« . La difficulté extrême dans laquelle se trouve notre système de santé face à la pandémie est due à son extrême violence ; elle serait aussi la conséquence du «démantèlement de l’Etat providence» et du fait que, depuis des lustres, l’hôpital serait «la bête noire des pouvoirs publics». Ces critiques sans nuance, que vient contrebalancer le soutien exceptionnel que toute la population française apporte et devra pendant des mois encore apporter à ses soignants, ne sont pas nouvelles. Mais, paradoxalement, ce jugement sans appel rassure car il permet de cibler un ensemble de responsables : globalement les ministres de la Santé et leur administration aux commandes depuis la fin des années 1970.
Ainsi, malgré les changements de majorité politique et aveuglés par la pensée néolibérale, c’est à une entreprise de démolition systématique à laquelle tous et toutes se seraient livrés. Une fois ce constat posé et les boucs émissaires identifiés, il ne reste plus qu’à énoncer la solution : reconstruire un système de santé «cassé» et «démantelé» en faisant, enfin, de la santé une priorité, c’est-à-dire en y affectant, enfin, des moyens conséquents. Convenue et rassurante, attendue et souvent efficace, facile et accessible, cette solution est bienvenue. C’est que son caractère familier possède une vertu considérable : présente bien avant le problème, elle évite de l’identifier avec précision.
Certes, la France a connu sa tentation libérale. Par exemple, l’insistance mise à évoquer le concept trompeur de «l’hôpital-entreprise» aurait pu jouer un sale tour à l’hôpital public. En effet, c’est au nom de ce leurre que la tarification à l’activité (la fameuse T2A, ersatz de tarification à l’acte) a failli devenir le seul mode de financement de l’hôpital. Mais suite, notamment, à un rapport de l’actuel ministre, Olivier Véran, et via le plan «Ma santé 2022», porté par la ministre précédente, la T2A était sur le point d’être fortement limitée. De fait, ces retournements de modalités de financement, ces palinodies de «modes» de gouvernances, l’hôpital en a connu et en connaîtra encore. Car le malaise des professionnels de santé est un des traits structurels, à vrai dire, un levier de la négociation-confrontation entre l’Etat et l’ensemble des protagonistes du secteur.
Car, oui, l’hôpital et ses personnels manquent de moyens comme tout le système de santé et médico-social ; car oui, il faudra augmenter ces moyens et les citoyens, éclairés, qui seront sur ce point plus vigilants qu’avant la pandémie. Mais le niveau actuel des ressources n’est pas le résultat d’un rationnement, volontaire et orchestré, pour la bonne raison que cette politique n’a jamais existé, du moins en France. Ainsi, par exemple, depuis les années 1980, la part du PIB consacré à la santé n’a cessé d’augmenter et le reste à charge moyen des malades contenu à moins de 10%. De même, l’emploi sanitaire s’est régulièrement accru pour avoisiner les deux millions de professionnels dont la formation est devenue l’une des meilleures du monde. Quant aux nombreuses réformes institutionnelles, elles ont toutes ont eu pour objet de rationaliser l’offre sans la rationner : création des Agences régionales de santé, extension du champ de la Haute Autorité de santé, encouragement des gouvernances territoriales, incitation à la coopération entre professionnels et la recherche d’une meilleure localisation des ressources. Il va sans dire que les critères et les attendus de cette rationalisation (par exemple privilégier les malades chroniques et graves, favoriser la «médecine par les preuves» ou bien encore, encourager les soins individualisés au détriment de la santé publique) peuvent être discutés et ils le sont.
Mais alors que se passe-t-il puisque le malaise est bien présent et que les revendications sont à la fois nombreuses, quasi unanimes et, pour la plupart, justifiées autant que légitimes ? Esquissons une réponse, ou plutôt, mettons en débat une tentative d’explication. En santé, comme en éducation, les besoins sont infinis. S’il en était besoin en atteste le vieillissement de la population dû, pour partie, aux succès de la médecine, l’augmentation des maladies chroniques, la qualité croissante (technique et humaine) des prises en charge de plus en plus souvent au domicile, la demande d’égalité d’accès aux soins et à un accompagnement social, etc. Dans cette configuration, accroître l’offre revient à révéler des demandes correspondant à un besoin réel mais non encore satisfait.
Cette course entre besoins, demandes et offre est donc perdue d’avance. Pourtant, si elle est sans fin, elle n’est pas sans finalité. En effet, c’est elle qui pousse les chercheurs à trouver, les professionnels à innover, les politiques à réformer, les citoyens à réclamer. Mais cette course n’a pas de ligne d’arrivée. Comme l’horizon le but (satisfaire les besoins) recule alors qu’on croit s’en approcher.
C’est pourquoi, affronter les crises sanitaires, actuelles et à venir, consiste d’abord à admettre que ce décalage irréductible entre ressources et besoins est constitutif de l’action publique en santé. Mais admettre n’est pas renoncer. C’est la première étape d’un travail de dévoilement qui doit nous conduire à réfléchir démocratiquement, aux moyens d’utiliser au mieux les ressources disponibles quels que soient leurs niveaux. Loin des règlements de comptes dont on pressent ces jours-ci, les signes avant-coureurs, cette approche devra orienter le bilan qui sera fait de l’action des uns et de l’inaction des autres. Citoyens compris. Car la pandémie nous aura rappelé que remplir nos devoirs citoyens est le meilleur moyen de défendre notre droit à la santé. »
Cet article ne dit pas qu’il n’y a pas eu des erreurs notamment la tarification à l’activité, mais il nie que le problème soit simple à résoudre, simple comme on entend tant de voix l’exprimer.
J’ai fait quelques recherches. J’aurais aimé trouver des chiffres plus explicites et plus parlants, le temps m’a manqué. Mais si quelqu’un peut apporter ces éléments je suis preneur.
J’ai toutefois trouvé sur le site de l’INSEE <ICI> l’information suivante :
- En 2006, les soins hospitaliers de l’hôpital public s’élevaient à 54,4 milliards d’euros.
- En 2017, cette même rubrique était de 71,5 milliards d’euros
Il s’agit donc d’une évolution de 31,4%.
Pendant ce temps que s’est t’il passé au niveau du PIB ?
Souvent le PIB n’est pas pertinent, mais ici nous avons une question d’argent : on ne donne pas assez d’argent à l’hôpital ! C’est peut-être vrai, mais on semble dire qu’on utilise l’argent à autre chose.
Sur <ce site> vous découvrez l’évolution du PIB entre 2000 et 2018. Je suis parti en 2007 avec un PIB de valeur 100, en appliquant les hausses et la baisse d’une année après la crise de 2008, on arrive à un PIB en 2017 de 110,7.
Alors que les soins de l’hôpital public augmentait de de 31,4%, la richesse du pays a augmenté parallèlement de 10,7% soit 3 fois moins.
Philippe Meyer et ses coéquipiers ont invité l’ancienne Ministre de la Santé Roselyne Bachelot pour réfléchir sur ces sujets : <Thématique Hôpital Public et Pandémie>. Ils n’ont pas de solution toute faite, mais ils expliquent très justement que l’augmentation du budget ne suffit pas et surtout constitue un puits sans fond parce que les besoins tendent vers l’infini.
Notre population vieillit et exprime le besoin de plus en plus de soins. Les médicaments et les équipements sont de plus en plus onéreux.
Alors, il y a des questions intéressantes comme celle de l’arbitrage entre ce que nous acceptons de mutualiser donc de niveau de cotisation et ce que nous voulons individualiser donc le pouvoir d’achat. Je trouve que ce débat est trop souvent tronqué par le seul critère de la diminution des cotisations pour améliorer la compétitivité des entreprises ou augmenter le pouvoir sans que jamais ce problème de fond : qu’est-ce que nous acceptons de mutualiser soit au centre des débats !
Et ce sujet ne peut pas se résoudre uniquement par la pirouette : les riches paieront !
Accepter de mutualiser davantage cela peut vouloir dire accepter de prélever davantage les actifs et les retraités pour un meilleur service de l’hôpital. De toute façon si les dépenses augmentent plus vite que la richesse nationale, il n’y a pas de recette miracle, il faut diminuer certaines autres dépenses pour compenser.
Mais ce que veut surtout soulever ce mot du jour c’est qu’il faut trouver d’autres solutions que simplement une augmentation de budget disproportionnée par rapport à la croissance.
Sinon, que ferons-nous quand 100% du PIB sera consacré à la santé et que le besoin augmentera encore ?
<1392>
- En 2006, les soins hospitaliers de l’hôpital public s’élevaient à 54,4 milliards d’euros.
-
Mercredi 8 avril 2020
« La crise du coronavirus signale l’accélération d’un nouveau capitalisme, le capitalisme numérique »Daniel CohenParmi les économistes que j’aime lire et auquel j’aime me référer, Daniel Cohen occupe une place de premier plan, surtout depuis la mort tragique de Bernard Maris.
 J’ai donc lu avec beaucoup d’intérêt l'<Article> du Monde du 02 avril 2020 qui lui donne la parole sur l’analyse de la crise pandémique actuelle.
J’ai donc lu avec beaucoup d’intérêt l'<Article> du Monde du 02 avril 2020 qui lui donne la parole sur l’analyse de la crise pandémique actuelle.
Une de ses premières réflexions est le constat de la centralité de la Chine dans la mondialisation d’aujourd’hui. Enormément d’éléments de la chaîne de valeur qui se trouvent dans les objets que nous utilisons et consommons viennent de Chine, mais aussi les principes actifs des médicaments, les masques dont nous avons besoin viennent de Chine.
Et, ironie du sort le virus qui nous perturbe vient aussi de Chine.
« Ce « virus chinois », comme l’appelle le président américain Donald Trump, a permis de mesurer l’extraordinaire dépendance où se trouvent un très grand nombre de secteurs industriels à l’égard de la Chine.
La pandémie pourrait bien clore à cet égard un cycle économique qui a commencé avec les réformes de Deng Xiaoping en Chine au début des années 1980 et la chute du mur de Berlin, en 1989. L’onde de choc de cette mondialisation s’épuise. La guerre commerciale lancée par Donald Trump a d’ailleurs convaincu les Chinois eux-mêmes qu’ils devaient réduire leur dépendance à l’égard des Etats-Unis. »
Il rappelle aussi que cette crise n’est pas une crise financière mais une crise de l’économie réelle. Et en premier c’est une crise de l’offre, la machine de production s’est arrêtée, en raison du confinement, cette méthode ancienne pour lutter contre les épidémies. Si cet arrêt de la production conduit à de nombreuses faillites, il y aura un chômage de masse qui aura alors un impact majeur sur la demande.
Mais dans un premier temps il s’agit d’une crise de l’économie réelle et d’une crise de l’offre. Pour mesurer l’ampleur du problème il faudra connaître la durée de l’arrêt donc du confinement.
« La crise économique actuelle est en réalité profondément différente de celles de 2008 ou de 1929. Elle est d’emblée une crise de l’économie réelle. L’enjeu n’est pas, comme hier, de chercher à la soutenir par des mesures d’offre ou de demande. Ce qu’on attend de l’Etat est, paradoxalement, qu’il veille à ce que bon nombre d’entreprises ferment leurs portes. Du fait des mesures de confinement, il faut que le produit intérieur brut (PIB) baisse ! Le rôle majeur des politiques publiques, à ce stade, n’est pas de relancer l’économie, mais de s’assurer qu’elle reste dans un état d’hibernation satisfaisant, qui lui permette de repartir rapidement ensuite. Ce ne sont pas des mesures d’ordre macroéconomique qu’on lui demande, mais des mesures microéconomiques.
Il ne s’agit pas non plus de mesures de soutien à la demande – elles ne seront nécessaires que quand la pandémie sera terminée, car que peuvent acheter des consommateurs confinés à des entreprises à l’arrêt ? Des mesures d’offre sont nécessaires, mais dans les secteurs-clés dans la résolution de la crise sanitaire, qu’il s’agisse du fonctionnement des hôpitaux et de la médecine de ville, des entreprises produisant masques, tests, appareils respiratoires…
Pour le reste de l’économie, on attend surtout de l’Etat des mesures de soutien à chaque entreprise, à chaque individu en perte d’activité. Ce n’est pas du crédit qu’il faut distribuer, mais du soutien budgétaire direct qui soulage la trésorerie des entreprises, le revenu des ménages. A cet égard, le principe est simple, le déficit doit être tout simplement égal à la perte d’activité due à la pandémie. Si l’on suit les statistiques produites par l’Insee, chaque mois de confinement pourrait coûter 3 points de croissance sur l’année. C’est aussi idéalement le chiffre du déficit public pour accompagner la crise. Si la crise dure deux mois, ce serait le double… »
Harari avait expliqué que le risque était fort que nous acceptions une société de surveillance, pour améliorer notre santé. Le gouvernement envisage, comme l’on fait les pays d’Asie de suivre les citoyens pour mesurer les déplacements des citoyens afin de pouvoir d’une part analyser la diffusion du virus et d’autre part vérifier le respect du confinement. Pourrons-nous dire non, si la santé d’un grand nombre en dépend ?
Daniel Cohen nous indique une autre raison de passer dans une société de surveillance, celle de pouvoir affecter au mieux les aides financières dont l’économie aura besoin pour ne pas s’effondrer. La même question se posera, sera-t-il raisonnable de refuser cette évolution ?
« Un Etat moderne, un Etat du XXIe siècle, devrait avoir la capacité de faire du sur-mesure, de la microéconomie « chirurgicale », en ciblant les aides entreprise par entreprise, individu par individu. Nous avons maintenant les outils pour cela, comme le prélèvement à la source, les déclarations de TVA et de charges sociales des entreprises, qui permettent de flécher les aides vers ceux qui subissent la crise le plus violemment.
La contrepartie de cette possibilité est, bien sûr, le risque d’une surveillance généralisée, car nous allons nous apercevoir que l’Etat a acquis les mêmes capacités de communiquer – et de surveiller – tout le corps social, à l’égal des GAFA [Google, Apple, Facebook, Amazon]. »
C’est une question abyssale, je ne sais pas quelle est la bonne réponse.
Quand le journaliste, Antoine Reverchon, lui pose la question : « Cette crise signale-t-elle la fin du capitalisme néolibéral mondialisé ? », il répond :
« C’est certainement la fin, ou le début du recul du capitalisme mondialisé tel qu’on l’a connu depuis quarante ans, c’est-à-dire à la recherche incessante de bas coûts en produisant toujours plus loin.
Mais elle signale aussi l’accélération d’un nouveau capitalisme, le capitalisme numérique…
Pour en saisir la portée et les menaces nouvelles que recèle ce capitalisme numérique, il faut revenir en arrière, au temps où l’on pensait que la désindustrialisation allait conduire, dans les pays développés, à une société de services. L’idée, théorisée notamment par l’économiste français Jean Fourastié [1907-1990], était que les humains travailleraient non plus la terre ou la matière, mais l’humain lui-même : prendre soin, éduquer, former, distraire autrui, serait le cœur d’une économie enfin humanisée.
Ce rêve postindustriel était libérateur, épanouissant… Mais comme le souligne Fourastié, il n’était plus synonyme de croissance…
Si la valeur du bien est le temps que je passe à m’occuper d’autrui, cela veut dire aussi que l’économie ne peut plus croître, sauf à accroître indéfiniment le temps de travail.
Le capitalisme a trouvé une parade à ce « problème », celle de la numérisation à outrance.
Si l’être que je suis peut être transformé en un ensemble d’informations, de données qui peuvent être gérées à distance plutôt qu’en face-à-face, alors je peux être soigné, éduqué, diverti sans avoir besoin de sortir de chez moi…
Je vois des films sur Netflix plutôt que d’aller en salle, je suis soigné sans aller à l’hôpital…
La numérisation de tout ce qui peut l’être est le moyen pour le capitalisme du XXIe siècle d’obtenir de nouvelles baisses de coût…
Le confinement général dont nous faisons l’objet à présent utilise massivement ces techniques : le télétravail, l’enseignement à distance, la télémédecine…
Cette crise sanitaire apparaîtra peut-être, rétrospectivement, comme un moment d’accélération de cette virtualisation du monde. Comme le point d’inflexion du passage du capitalisme industriel au capitalisme numérique, et de son corollaire, l’effondrement des promesses humanistes de la société postindustrielle. »
Cette partie de l’article m’interpelle encore plus.
Les sociétés numériques comme NETFLIX et AMAZON vont sortir renforcés et plus riches de cette crise sanitaire.
Beaucoup vont voir dans le recours au télétravail massif une solution commode pour éviter que les salariés perdent du temps dans les transports et économiser aussi des surfaces de bureau dans des métropoles où le foncier et de plus en plus cher. Ce recours massif conduit à un risque de déshumanisation du travail.
Un article de l’OBS pose cette problématique : « Le télétravail est nécessaire, mais attention : il implique une déshumanisation »
L’OBS explique ainsi que
« On peut imaginer l’approfondissement d’au moins deux tendances actuelles du capitalisme.
La première est l’accroissement de l’auto-discipline : avec le télétravail, le contrôle n’est pas exercé directement par un chef qui surveille mais par soi-même, par intériorisation des normes, des objectifs, des résultats, par responsabilité individuelle. Des travaux ont montré que cette évolution n’était pas sans lien avec l’augmentation des malaises professionnels, voire des burn-out.
La seconde est l’accroissement de « la production bureaucratique de l’indifférence sociale », c’est-à-dire de la création de la distance dans le vécu quotidien : ne plus être en contact direct avec des patients, des clients, des étudiants, des usagers de service public… c’est aussi s’éloigner, voire développer un certain détachement par rapport à ceux auxquels on s’adresse. Sans compter que, comme toute technique, la numérisation n’empêche pas les inégalités mais en transforme les lieux de son expression : désormais les inégalités d’accès à Internet ou de maîtrise des outils techniques sont devenues fondamentales.
Tout ceci n’est pas de la science-fiction : cela ne fait que deux jours que nous sommes en confinement, et j’ai déjà reçu un email de ma banque qui vante les mérites des contacts à distance et des appli mobiles. Pour beaucoup d’entreprises, cette crise peut être une opportunité pour dématérialiser davantage, remplacer des vendeurs par des plateformes téléphoniques, etc. Il ne faut pas oublier que le télétravail est une forme de déshumanisation. J’ai une nièce qui a dû subir une opération dont les conséquences auraient pu être graves. Quand elle s’est présentée à la clinique le jour dit, la première personne qu’elle a rencontrée, c’était au troisième étage. Toutes les étapes précédentes, dont l’« accueil » (sic), étaient automatisées, donc gérées ou élaborées à distance par le télétravail. Est-ce le monde dont nous voulons ? »
Et aussi l’éducation nationale pourrait avoir une évolution fâcheuse. Utiliser mieux et de manière plus intelligente les outils numériques ne peut être qu’approuver. Mais n’existe-t’il pas la tentation d’imaginer les économies budgétaires qu’on pourrait obtenir en utilisant massivement les cours en lignes qui permettrait de se passer d’un certain nombre de salles de classe et aussi d’un certain nombre de professeurs, puisqu’il faut un professeur devant une classe de 25 à 40 élèves, alors qu’un cours en ligne pourrait s’adresser à un nombre plus considérable d’élèves. Cette évolution porte en germe une accentuation encore des inégalités.
Cette crise risque ainsi d’amplifier et d’accélérer des évolutions dont nous pourrions craindre qu’ils n’aillent pas dans le sens souhaité par Bruno Latour ou Gaël Giraud.
<1391>
-
Mardi 7 avril 2020
« Avec cette pandémie, la fragilité de notre système nous explose à la figure »Gaël GiraudGaël Giraud est un économiste remarquable et singulier.
 C’est d’abord un esprit extraordinairement brillant, selon les critères français :
C’est d’abord un esprit extraordinairement brillant, selon les critères français :
Après être passé par le lycée Henri IV (Paris), il intègre la rue d’Ulm : l’École Normale Supérieure. Ensuite comme école d’application il choisit l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE). Puis à la suite de deux années de service civil au Tchad (1995-1997), il soutient sa thèse de doctorat en mathématiques appliquées (à l’économie) au Laboratoire d’économétrie de l’École Polytechnique et à l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne.
Après cela il aurait pu entrer dans une des grandes entreprises françaises pour gagner beaucoup d’argent.
Lui devint prêtre catholique et jésuite.
C’est un humaniste qui regarde notre société avec recul, hauteur et intelligence du cœur.
Deux mots du jour lui ont été consacrés, tous les deux en 2014, tous les deux consacrés au monde bancaire.
D’abord pour fustiger les relations coupables entre l’Etat et le monde bancaire et l’incapacité du gouvernement français sous la présidence Hollande de réaliser ce que ce dernier avait promis, c’est à dire la séparation des activités spéculatives et de la banque de dépôt, au sein du système bancaire : «La collusion entre la haute finance publique et la haute finance privée aujourd’hui, paralyse notre société.»
Ensuite, il avait réagi à l’amende colossale que les Etats-Unis avaient infligé à BNP Paribas, s’étonnant que l’UE soit incapable de faire la même chose à l’égard des banques américaines qui ont joué un rôle délétère au sein de l’Union européenne : « les autorités européennes, grecques, italiennes… pourraient sanctionner Goldman Sachs pour avoir truqué les comptes publics grecs qui ont permis à Athènes d’entrer dans la Zone euro, et JP Morgan pour avoir vendu des prêts toxiques en Italie. »
Dans l’article de Marianne que j’avais cité dans le premier mot du jour, il définissait ainsi sa vie :
« D’abord, je partage la même soupe avec mes compagnons le soir, quoi que je pense du secteur bancaire par ailleurs. Cela permet de penser librement. Ensuite, la vie de partage communautaire est une expérience essentielle des biens communs, au sens de l’économiste Elinor Ostrom : aujourd’hui, nos sociétés redécouvrent les biens communs via Vélib’, Vélo’v, le covoiturage, l’économie de fonctionnalité, etc., et cet apprentissage me paraît décisif pour la transition énergétique. Il induit une transformation radicale de notre rapport à la propriété privée. Eh bien, la vie religieuse occidentale pratique tout cela depuis quinze siècles au moins ! »
Je l’ai d’abord vu et entendu dans l’émission de Frédéric Taddei : « Interdit d’interdire » consacrée aux conséquences économiques de la pandémie.
Je regarde, en effet, l’émission « Interdit d’interdire » sur la télévision d’influence de Poutine « Russia Today » en raison de la qualité des échanges que peut réaliser Frédéric Taddei avec ses invités. Pour le reste je me méfie des informations que je peux trouver sur cette chaîne, tout en ne les rejetant pas systématiquement. Ce n’est ni blanc, ni noir, c’est gris !
Cette émission donnait en première partie la parole à Paul Jorion qui a déjà fait l’objet de mot du jour et qui est certes intéressant mais beaucoup moins didactique et précis que Gaël Giraud.
L’intervention de Gaël Giraud commence à 25:45, et je vous invite à la regarder, elle se trouve derrière ce lien : <Conséquences économiques de l’épidémie>
Après cette émission j’ai trouvé un article du 20 mars de l’OBS qui interviewait Gaël Giraud : « Avec cette pandémie, la fragilité de notre système nous explose à la figure »
Dans cet article, il souligne d’abord la singularité de cette crise :
« Elle est unique. Contrairement au krach boursier de 1929 et à la crise des subprimes de 2008, elle touche d’abord et en son cœur l’économie réelle. L’appareil productif est mis à l’arrêt, les chaînes de valeurs mondiales ralentissent ou sont interrompues, le travail est « en grève » involontaire. Ce n’est pas seulement une crise keynésienne d’insuffisance de la demande, c’est aussi une crise d’offre.»
Et il montre ainsi la vulnérabilité et la fragilité de notre système :
«La pandémie marque l’entrée dans une époque nouvelle, traversée de risques liés au réchauffement climatique et amplifiés par un capitalisme financiarisé qui nous rend extrêmement vulnérables à la finitude du monde.
Tout le monde ne peut pas travailler depuis chez soi. Or nous avons collectivement construit un système dans lequel certains aliments, par exemple, font deux fois le tour de la planète avant d’arriver dans notre assiette. Pour maximiser le profit à court terme, nous avons bâti des chaînes d’approvisionnement à flux tendus selon le principe du « juste-à-temps ». Ces flux sont extrêmement fragiles car il suffit que, le long de la chaîne, une seule société soit à l’arrêt parce que ses salariés sont malades ou refusent de risquer leur vie au travail, pour que la chaîne s’interrompe. Certaines métropoles pourraient en faire la cruelle expérience dans les jours ou les semaines qui viennent avec l’approvisionnement alimentaire.
Un système dans lequel la volatilité des marchés financiers est extrême parce qu’en dépit des avertissements répétés depuis plus de dix ans, nous n’avons mis aucun frein sérieux aux bulles et aux paniques boursières. Dans lequel, pour suivre des dogmes néolibéraux sans fondement scientifique, nous avons sous-doté l’hôpital et privatisé des services publics. Tout cela, nous le savons depuis des années. Aujourd’hui, cette fragilité nous explose à la figure. »
Il montre aussi comment notre système économique et la position dominante d’homo sapiens explique la force et la propagation du virus :
« La destruction écologique à laquelle se livre notre économie extractiviste depuis plus d’un siècle partage avec cette pandémie une racine commune : nous sommes devenus l’espèce dominante de l’ensemble du vivant sur Terre. Nous sommes donc capables de briser les chaînes trophiques de tous les autres animaux (et c’est bien ce que nous faisons, des poissons jusqu’aux oiseaux) mais nous sommes aussi le meilleur véhicule pour les pathogènes. En termes d’évolution biologique, il est beaucoup plus « efficace » pour un virus de parasiter l’humain que le renne arctique, déjà en voie de disparition à cause du réchauffement. Et ce sera de plus en plus le cas à mesure que les dérèglements écologiques vont décimer les autres espèces vivantes. »
Et il revient sur les marchés qu’il a étudiés depuis de nombres années et qui ont conduit à la financiarisation du monde :
« Les marchés financiers, sur lesquels nous tentons de faire reposer notre prospérité depuis plusieurs décennies, n’ont aucunement vu venir la pandémie. Pourtant, celle-ci n’est nullement un cygne noir, elle était parfaitement prévisible : l’OMS avait prévenu que les marchés d’animaux sauvages en Chine présentaient des risques épidémiologiques majeurs. Allons-nous continuer d’entretenir la fiction que les marchés financiers sont la boussole suprême de nos sociétés ?
En outre, depuis trente ans, la globalisation marchande s’est construite sur l’abondance des énergies fossiles, et en particulier du pétrole. Ces énergies réchauffent massivement la planète. Elles ont aussi permis d’étendre les chaînes de production, de rendre négligeable le prix du transport, de délocaliser dans des pays à bas coût, la Chine en premier lieu. Le pétrole est l’ingrédient essentiel grâce auquel Covid-19 s’est transporté en trois mois de Chine en Europe là où le Sras de 2002 avait mis un an. Aujourd’hui, la mise à l’arrêt de l’économie réelle fait chuter le cours de l’or noir. Cette chute a non seulement des effets sur les compagnies pétrolières, mais aussi sur le secteur financier. Énormément d’actifs financiers sont appuyés sur les énergies fossiles.
La fin de la globalisation marchande va sans doute provoquer une réduction massive de l’usage du pétrole pour le transport de marchandises et donc un effondrement de la valeur de certains de ces actifs. Cela ajoute à la panique d’institutions financières assises sur des montagnes de dettes privées (et non publiques) qui ne peuvent être remboursées qu’au prix d’une poursuite de la croissance du PIB. Or, 2020 sera sans doute une année de récession pour la plupart des pays. Beaucoup d’investisseurs ont compris qu’ils risquaient de devenir rapidement insolvables.
[Il faut donc s’attendre] à un krach plus important que celui de 2008, sauf si les Etats réagissent fortement et très vite pour éviter les faillites en chaîne dans l’économie réelle. L’administration Trump a déjà annoncé un effort de près de 1 000 milliards de dollars pour les ménages et les entreprises. La BCE a annoncé un plan de 750 milliards de rachats de dettes. Ce sont les bons ordres de grandeur, mais tout dépendra de la façon dont est utilisé cet argent. Il faut le flécher massivement vers les PME et les ménages. Faire du « quantitative easing for people », ce que nous aurions dû faire déjà en 2009. Sinon, ces sommes, une fois de plus, serviront uniquement à sauver les banques.
Les pays qui oseront dépenser massivement pour leur économie réelle s’en sortiront mieux. Nous sommes « en guerre » ? Alors, il faut comprendre l’étendue des déficits publics auxquels nous devons consentir : le déficit public des Etats-Unis, rapporté au PIB fut de 12 % en 1942, 26 % en 1943, 21 % en 1944, 20 % en 1945. Pour ceux qui resteront attachés au dogme de l’austérité budgétaire (qui n’a pas de fondement économique), la récession qu’ils vont connaître risque de faire passer celle qui a suivi 2008 pour une promenade de santé. »
Il synthétise aussi les leçons de cette pandémie et trace des perspectives qui devraient guider nos gouvernants et nos nations. Il utilise notamment ce concept très fécond « des communs »
[Cette pandémie] nous contraint à comprendre qu’il n’y a pas de capitalisme viable sans un service public fort et à repenser de fond en comble notre manière de produire et de consommer.
Cette pandémie ne sera pas la dernière : le réchauffement climatique promet la multiplication des pandémies tropicales.
En 2016, la Banque Mondiale estimait, par exemple, que la seule résistance aux antimicrobiens pourrait provoquer une perte de 3 % du PIB mondial en 2050.
La déforestation, tout comme les marchés d’animaux sauvages à Wuhan, nous met au contact d’animaux dont les virus nous sont inconnus. Le dégel du pergélisol menace de diffuser des épidémies dangereuses : la grippe espagnole de 1918, l’anthrax… Les élevages intensifs, d’animaux stressés et homogènes, facilitent aussi la propagation des épidémies.
A brève échéance, il va falloir nationaliser des entreprises non viables et, peut-être certaines banques. Mais, très vite, nous devrons tirer les leçons de ce printemps : relocaliser la production, réguler la sphère financière, repenser les normes comptables pour valoriser la résilience de nos systèmes productifs, instaurer une taxe carbone et sanitaire aux frontières, lancer un plan de relance français et européen pour la réindustrialisation écologique, la rénovation thermique et la conversion massive vers les énergies renouvelables…
La pandémie nous invite à transformer radicalement notre mode de socialisation.
Aujourd’hui, le capitalisme connaît le coût de toute chose, mais la valeur de rien, pour reprendre la formule d’Oscar Wilde. Il nous faut comprendre que la véritable source de la valeur, ce sont nos relations humaines et avec notre environnement. A vouloir les privatiser, nous les détruisons et nous mettons à terre nos sociétés tout en supprimant des vies. Nous ne sommes pas des monades isolées, reliées entre elles uniquement par un système de prix abstrait, mais des êtres de chair en interdépendance avec d’autres et avec un territoire. Voilà ce que nous avons à réapprendre.
La santé de chacun concerne tous les autres. Même pour les privilégiés, la privatisation des systèmes de santé est irrationnelle : ils ne peuvent se séparer totalement des plus modestes, ne fût-ce que pour se faire livrer à manger. La
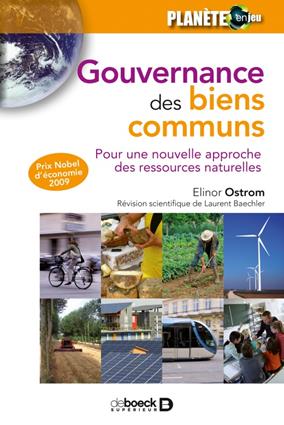 maladie les rattrapera donc toujours. La santé est un bien commun mondial et doit être gérée comme telle.
maladie les rattrapera donc toujours. La santé est un bien commun mondial et doit être gérée comme telle.
Les communs, remis à l’honneur notamment par l’économiste américaine Elinor Ostrom, ouvrent un espace tiers entre le marché et l’Etat, entre le privé et le public. Ils peuvent nous guider vers un monde plus résilient, à même d’encaisser des chocs comme cette pandémie.
La santé, par exemple, doit être traitée comme l’affaire de tous, avec des niveaux d’intervention stratifiés et articulés. Au niveau local, des communautés peuvent s’organiser pour réagir rapidement, en circonscrivant les clusters comme cela semble avoir été fait avec succès dans le Morbihan contre Covid-19 et, à l’inverse, comme cela n’a pas été fait en Lombardie. Au niveau étatique, il faut un service hospitalier public puissant. Au niveau international, il faut que les préconisations de l’OMS deviennent contraignantes. Rares sont les pays qui ont suivi les recommandations de l’OMS avant et pendant la crise. Nous écoutons plus volontiers les « conseils » du FMI… Le drame actuel montre que nous avons tort.
Ces derniers jours, nous avons vu des communs se constituer : des scientifiques qui, en dehors de tout cadre public ou privé, se sont spontanément coordonnés via l’initiative Opencovid19 pour mutualiser l’information sur les bonnes pratiques de dépistage du virus. La santé n’est qu’un exemple : l’environnement, l’éducation, la culture, la biodiversité sont des communs mondiaux. Il faut inventer des institutions qui permettent de les honorer, de reconnaître nos interdépendances et de rendre nos sociétés résilientes. Certaines existent déjà : Drugs for Neglected Disease Initiative (DNDi) est un magnifique exemple, créé par des médecins français il y a quinze ans, de réseau collaboratif tiers, où coopèrent le privé, le public et les ONG qui réussissent à faire ce que ni le secteur pharmaceutique privé, ni les États, ni la société civile n’arrivent à faire seuls. »
Et de manière plus immédiate, il nous montre ce que cette crise peut dévoiler :
« Elle nous délivre du narcissisme consumériste, du « je veux tout, tout de suite ». Elle nous ramène à l’essentiel, à ce qui compte « vraiment » : la qualité des relations humaines, la solidarité. Elle nous rappelle, aussi, à quel point la nature est importante à notre santé mentale et physique. Ceux qui vivent confinés dans un 15 m2 à Paris ou à Milan le savent déjà… Le rationnement qui s’installe sur certains produits nous rappelle la finitude des ressources. Bienvenue dans le monde fini ! Pendant des années, les milliards dépensés en marketing nous ont fait confondre la planète avec un supermarché géant où tout serait indéfiniment à notre disposition. Nous faisons brutalement l’expérience du manque »
Gaël Giraud est le contraire d’un naïf, il sait que des forces sont à l’œuvre pour aggraver le mal, utiliser cette crise pour surenchérir dans certaines voies délétères
« Je pense qu’un certain romantisme « collapsologique » va être vite tempéré par la vision de ce que signifie, dans la configuration actuelle, l’arrêt brutal de l’économie : le chômage, la ruine, les vies brisées, les morts, la souffrance au quotidien de ceux chez qui le virus laissera des traces à vie. Dans le sillage de l’encyclique « Laudato si » du Pape François, je préfère espérer que cette pandémie sera l’occasion de réorienter nos vies et nos institutions vers une sobriété heureuse et le respect de la finitude.
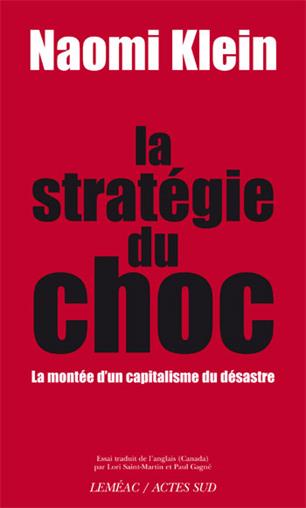 Le moment est décisif : on peut craindre ce que Naomi Klein a baptisé la « stratégie du choc
Le moment est décisif : on peut craindre ce que Naomi Klein a baptisé la « stratégie du choc
». Il ne faut pas que, sous prétexte de soutenir les entreprises, certains gouvernements affaiblissent encore davantage le droit du travail. Ou qu’ils en profitent pour resserrer encore la surveillance policière des populations. Ou que le commerce en ligne finisse de tuer les magasins de proximité. Encore moins que les achats d’armes par certains gouvernements servent à contraindre les salariés modestes à risquer leur vie pour ne pas interrompre les chaînes d’approvisionnement des plus privilégiés. »
Si vous lisez des informations qui viennent de Chine, des États-Unis et du Canada vous constaterez qu’on parle partout de relance de l’économie, mais de relance dans l’économie carbonée et de diminuer les contraintes écologiques que les prises de conscience ont permis de mettre en œuvre, faiblement mettre en œuvre.
Le plus probable est que tout recommence comme avant et peut être même en pire en prétextant l’urgence du chômage et de la baisse du niveau de vie.
Dans sa conclusion il essaie une interrogation géopolitique :
« Ce que l’on peut dire, c’est que le coronavirus exacerbe le bras de fer entre la Chine et les Etats-Unis. La propagande chinoise s’efforce d’instaurer l’idée que le pays a su stopper la pandémie et semble vouloir faire bénéficier le reste du monde de son expérience. Pékin a surtout à se faire pardonner d’être à l’origine du problème : les services publics chinois ont dissimulé l’épidémie pendant plus d’un mois avant de prendre la mesure de sa gravité. Reste que cette pandémie peut devenir pour la Chine ce que fut la Seconde Guerre mondiale pour les Américains : le moment d’un basculement géopolitique et d’une prise de leadership mondial. Surtout si l’économie des Etats-Unis devait connaître une très dure récession.
Dans les pays occidentaux, on entend d’ailleurs une petite rengaine valorisant l’autoritarisme chinois. « Et si nos démocraties étaient mal armées ? Trop lentes ? Engluées dans les libertés individuelles ? » Cette antienne se fredonnait déjà avant la pandémie et me semble très dangereuse. La Chine est un pays totalitaire. La pandémie a-t-elle atteint le Xinjiang ? Sur le million de Ouïgours qui y vivent en camp de « rééducation », combien ont été touchés ? Combien survivront à la prochaine pandémie ?
Certains se demandent si, pour conserver leurs privilèges, ce ne serait pas le moment de basculer du laisser-faire vers l’autoritarisme (néolibéral).
Ce serait suicidaire. Comme l’écrivait déjà La Fontaine à propos de la peste : « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. » Sacrifier l’âne innocent ne sert à rien et relève d’un paganisme médiéval. Il faut éviter la peste, c’est la seule attitude rationnelle pour tout le monde. »
Il y a comme toujours dans les réflexions qui ont du sens, plus de questions que de réponses.
L’avenir n’est pas écrit.
Nous ne pouvons certainement pas avec nos faibles moyens changer radicalement le monde. La tentation de la « tabula rasa » est d’ailleurs dangereuse, les expériences passées nous conduisent à beaucoup de prudence devant les doctrines qui nous promettent de tout reconstruire à partir d’une page blanche.
Je pense cependant que chacun de nous a un rôle, même minuscule, à jouer dans cette partition.
Pour ce faire il faut tenter de comprendre les forces qui sont à l’œuvre, se prémunir des solutions magiques et miraculeuses et accepter plus de sobriété comme nous y invitent les questions de Bruno Latour du mot du jour d’hier.
<1390>
-
Lundi 6 avril 2020
« La dernière des choses à faire serait de reprendre à l’identique tout ce que nous faisions avant. »Bruno LatourWikipedia nous informe que Bruno Latour est classé parmi les chercheurs les plus cités en sciences humaines et jouit d’une très forte notoriété dans le monde académique anglophone, où il est parfois décrit comme « le plus célèbre et le plus incompris des philosophes français.
Il est sociologue, anthropologue et philosophe des sciences. Il est né le 22 juin 1947 à Beaune.
Ces derniers travaux sont surtout tournés vers la crise écologique et la transition économique pour y faire face.
Le mot du jour du 8 février 2019 était consacré à son livre « Où atterrir ? » paru en 2017 dans lequel il exprimait ce constat selon lui évident : notre modèle de développement économique mondial ne dispose pas d’une planète lui permettant de continuer à se déployer. La terre, en effet, n’est pas cette planète, il faut donc atterrir, arrêter la course.
Pour ce faire, il demande à chacun de réfléchir à ses besoins essentiels, à ses interactions avec les autres afin de pouvoir construire le modèle de développement que la terre puisse accueillir.
Dans ce sens, il développe l’idée de cahiers de doléances comme ce qui s’était passé en France avant la révolution de 1789.
Un article du monde de janvier 2019 parle de ce projet : « Faisons revivre les cahiers de doléances » et une partie de son site est consacrée à ce thème <Atelier Nouveaux Cahiers de Doléance>
Devant la crise qui nous secoue et les réflexions qui doivent nous guider dans l’après, il a écrit un article sur le site AOC Média :
<Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise>
Il fut aussi l’invité de France Inter du vendredi 3 avril 2020 :<Si on ne profite pas de cette situation incroyable pour changer, c’est gâcher une crise>
C’est par l’émission de France Inter que j’ai appris que parmi les nombreuses études qu’avaient réalisé Bruno Latour, il s’était aussi intéressé aux microbes et aux épidémies.
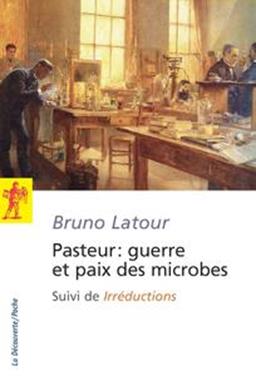 En 1984, il a écrit notamment : « Pasteur: Guerre et Paix des microbes »
En 1984, il a écrit notamment : « Pasteur: Guerre et Paix des microbes »
Et c’est ainsi qu’il répond à Nicolas Demorand qui évoque la surprise devant cette pandémie :
« Ce n’est pas une situation surprenante pour ceux qui ont travaillé sur l’histoire de la médecine, quand on laisse les microbes faire leur petit travail de mondialisation […] Chaque pays donne, à cause de son système de santé et sa préparation, une virulence à ce virus. La virulence varie considérablement. […] La nouveauté, c’est la capacité qu’a le virus de profiter de la globalisation. Imposer un régime de viralité à M. Trump et M. Macron en quelques semaines c’est assez stupéfiant. »
Et rejoignant la position de Sophie Mainguy-Besmain « Nous ne sommes pas en guerre et n’avons pas à l’être » il rejette la rhétorique guerrière :
« Parler de guerre n’a aucun sens »
Il dit des choses aussi simple que nous devons vivre avec le virus, quand un très grand nombre aura été contaminé, donc aura assimilé le virus et rendu inoffensif, la crise sera surmonté.
Ce n’est pas combattre le virus dont il s’agit, on ne le détruit pas, on s’y adapte.
Et surtout ce qui parait important à Bruno Latour c’est de bien se rendre compte que l’épreuve que nous vivons nous la surmonterons, avec plus ou moins de dégâts économiques, mais nous la surmonterons.
Or il est une autre crise qui pour lui est plus grave et dont il n’est pas certain que nous la surmonterons :
« En décembre, on allait vers une autre catastrophe qui est la mutation écologique. Malgré la situation tragique que nous vivons, elle est moins tragique pour les gens qui s’intéressent à la mutation écologique »
Et il pose un premier constat qu’il trouve encourageant :
« On a un arrêt général brusque […] On disait qu’il était impossible de tout arrêter, on l’a fait en deux mois. On se rend compte que brusquement, on peut tout arrêter et que les États peuvent s’imposer. »
Et il ajoute :
« Si on ne profite pas de cette situation incroyable pour voir ce qu’on garde ou pas, c’est gâcher une crise, c’est un crime. »
Et c’est ainsi qu’il débutait aussi son article sur AOC MEDIA :
« Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu pour de bon ou au contraire accéléré. L’inventaire annuel, c’est maintenant qu’il faut le faire. A la demande de bon sens : « Relançons le plus rapidement possible la production », il faut répondre par un cri : « Surtout pas ! ». La dernière des choses à faire serait de reprendre à l’identique tout ce que nous faisions avant.
Il y a peut-être quelque chose d’inconvenant à se projeter dans l’après-crise alors que le personnel de santé est, comme on dit, « sur le front », que des millions de gens perdent leur emploi et que beaucoup de familles endeuillées ne peuvent même pas enterrer leurs morts. Et pourtant, c’est bien maintenant qu’il faut se battre pour que la reprise économique, une fois la crise passée, ne ramène pas le même ancien régime climatique contre lequel nous essayions jusqu’ici, assez vainement, de lutter.
En effet, la crise sanitaire est enchâssée dans ce qui n’est pas une crise – toujours passagère – mais une mutation écologique durable et irréversible. Si nous avons de bonne chance de « sortir » de la première, nous n’en avons aucune de « sortir » de la seconde. Les deux situations ne sont pas à la même échelle, mais il est très éclairant de les articuler l’une sur l’autre. En tout cas, ce serait dommage de ne pas se servir de la crise sanitaire pour découvrir d’autres moyens d’entrer dans la mutation écologique autrement qu’à l’aveugle.
La première leçon du coronavirus est aussi la plus stupéfiante : la preuve est faite, en effet, qu’il est possible, en quelques semaines, de suspendre partout dans le monde et au même moment, un système économique dont on nous disait jusqu’ici qu’il était impossible à ralentir ou à rediriger. À tous les arguments des écologiques sur l’infléchissement de nos modes de vie, on opposait toujours l’argument de la force irréversible du « train du progrès » que rien ne pouvait faire sortir de ses rails, « à cause », disait-on, « de la globalisation ». Or, c’est justement son caractère globalisé qui rend si fragile ce fameux développement, susceptible au contraire de freiner puis de s’arrêter d’un coup.
En effet, il n’y a pas que les multinationales ou les accords commerciaux ou internet ou les tour operators pour globaliser la planète : chaque entité de cette même planète possède une façon bien à elle d’accrocher ensemble les autres éléments qui composent, à un moment donné, le collectif. Cela est vrai du CO2 qui réchauffe l’atmosphère globale par sa diffusion dans l’air ; des oiseaux migrateurs qui transportent de nouvelles formes de grippe ; mais cela est vrai aussi, nous le réapprenons douloureusement, du coronavirus dont la capacité à relier « tous les humains » passe par le truchement apparemment inoffensif de nos divers crachotis. A globalisateur, globalisateur et demi : question de resocialiser des milliards d’humains, les microbes se posent un peu là ! »
Il cite l’exemple d’un fleuriste hollandais face à la crise de pandémie :
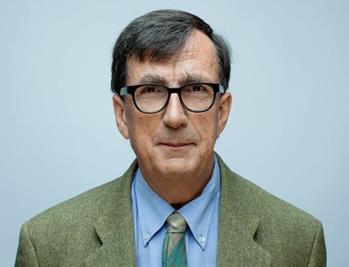 « Par exemple, l’autre jour, on présentait à la télévision un fleuriste hollandais, les larmes aux yeux, obligé de jeter des tonnes de tulipes prêtes à l’envoi qu’il ne pouvait plus expédier par avion dans le monde entier faute de client. On ne peut que le plaindre, bien sûr ; il est juste qu’il soit indemnisé. Mais ensuite la caméra reculait montrant que ses tulipes, il les fait pousser hors-sol sous lumière artificielle avant de les livrer aux avions cargo de Schiphol dans une pluie de kérosène ; de là, l’expression d’un doute : « Mais est-il bien utile de prolonger cette façon de produire et de vendre ce type de fleurs ? ».
« Par exemple, l’autre jour, on présentait à la télévision un fleuriste hollandais, les larmes aux yeux, obligé de jeter des tonnes de tulipes prêtes à l’envoi qu’il ne pouvait plus expédier par avion dans le monde entier faute de client. On ne peut que le plaindre, bien sûr ; il est juste qu’il soit indemnisé. Mais ensuite la caméra reculait montrant que ses tulipes, il les fait pousser hors-sol sous lumière artificielle avant de les livrer aux avions cargo de Schiphol dans une pluie de kérosène ; de là, l’expression d’un doute : « Mais est-il bien utile de prolonger cette façon de produire et de vendre ce type de fleurs ? ».
Il en appelle donc à profiter de cette crise pour réfléchir à l’après, à l’indispensable, à l’utile dans le cadre de la contrainte écologique.
Je ne peux citer tout l’article mais les 6 questions avec lesquels il le finit et qui s’adresse à chacun de nous :
Un outil pour aider au discernement
Comme il est toujours bon de lier un argument à des exercices pratiques, proposons aux lecteurs d’essayer de répondre à ce petit inventaire. Il sera d’autant plus utile qu’il portera sur une expérience personnelle directement vécue. Il ne s’agit pas seulement d’exprimer une opinion qui vous viendrait à l’esprit, mais de décrire une situation et peut-être de la prolonger par une petite enquête. C’est seulement par la suite, si vous vous donnez les moyens de combiner les réponses pour composer le paysage créé par la superposition des descriptions, que vous déboucherez sur une expression politique incarnée et concrète — mais pas avant.
Attention : ceci n’est pas un questionnaire, il ne s’agit pas d’un sondage. C’est une aide à l’auto-description*.
Il s’agit de faire la liste des activités dont vous vous sentez privés par la crise actuelle et qui vous donnent la sensation d’une atteinte à vos conditions essentielles de subsistance. Pour chaque activité, pouvez-vous indiquer si vous aimeriez que celles-ci reprennent à l’identique (comme avant), mieux, ou qu’elles ne reprennent pas du tout. Répondez aux questions suivantes :
Question 1 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles ne reprennent pas ?
Question 2 : Décrivez a) pourquoi cette activité vous apparaît nuisible/ superflue/ dangereuse/ incohérente ; b) en quoi sa disparition/ mise en veilleuse/ substitution rendrait d’autres activités que vous favorisez plus facile/ plus cohérente ? (Faire un paragraphe distinct pour chacune des réponses listées à la question 1.)
Question 3 : Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs qui ne pourront plus continuer dans les activités que vous supprimez se voient faciliter la transition vers d’autres activités ?
Question 4 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles se développent/ reprennent ou celles qui devraient être inventées en remplacement ?
Question 5 : Décrivez a) pourquoi cette activité vous apparaît positive ; b) comment elle rend plus faciles/ harmonieuses/ cohérentes d’autres activités que vous favorisez ; et c) permettent de lutter contre celles que vous jugez défavorables ? (Faire un paragraphe distinct pour chacune des réponses listées à la question 4.)
Question 6 : Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs à acquérir les capacités/ moyens/ revenus/ instruments permettant la reprise/ le développement/ la création de cette activité ?
(Trouvez ensuite un moyen pour comparer votre description avec celles d’autres participants. La compilation puis la superposition des réponses devraient dessiner peu à peu un paysage composé de lignes de conflits, d’alliances, de controverses et d’oppositions.)
Je redonne le lien vers l’article : <Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise>
Pendant ce temps, Trump profite de la crise pour enlever encore davantage les contraintes écologiques qu’avaient pu imposer Obama.
Il est à craindre qu’à la sortie de cette crise, les nombreux chômeurs et les entreprise affaiblies ou moribondes seront prêts à relancer la machine économique par tous les moyens et même les moins écologiques.
Mais je crois que fondamentalement Bruno Latour a raison de nous interpeller car cette crise est aussi une opportunité pour nous pour réfléchir et évoluer.
Achetez-vous encore des roses alors que vous savez que celles que vous trouvez chez votre fleuriste assèchent des lacs au Kenya et créent des désastres écologiques ?
Réfléchissez-vous à votre manière de faire du tourisme ?
Beaucoup de solutions finalement dépendent aussi de nous, c’est ce que nous apprend Bruno Latour.
<Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise>
<1389>
-
Dimanche 5 avril 2020
«La symphonie N°2 « Résurrection »Gustav MahlerMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Dimanche dernier, ARTE a retransmis, un concert qui a eu lieu en 2019 à Barcelone.
 Dans une salle somptueuse
Dans une salle somptueuse
Une interprétation magistrale
D’un très grand chef d’œuvre symphonique du répertoire.
Vous trouverez ci-après trois liens qui vous permettront de regarder et écouter ce moment magique :
<REPLAY ARTE> <Sur Youtube> <Sur Molotov>
La lecture de ce mot du jour peut donc s’arrêter là et basculer vers le visionnage de ce concert. Voici l’essentiel.
Mais on peut aller un peu plus loin…
D’abord s’intéresser à cette extraordinaire salle de concert <
Palau de la Música Catalana> « Le palais de la musique catalane » construit entre 1905 à 1908.
Wikipedia nous apprend que les bâtisseurs ont fait appel à des structures avancées telles que l’utilisation de nouveaux profils laminaires : il s’agit d’une structure métallique centrale stabilisée par des contreforts et des voûtes d’inspiration gothique. L’architecte innove par l’utilisation de murs-rideaux et fait appel à une grande variété de techniques artistiques : sculptures, mosaïques, vitraux et ferronneries.
L’architecte est catalan comme il se doit à Barcelone Lluís Domènech i Montaner. Cette salle a d’ailleurs mêlé son histoire avec celle de la Catalogne et ses combats contre le fascisme et pour l’indépendance.
Certains prétendent qu’il s’agit de la plus belle salle de concert du monde.
La salle de concert est le seul auditorium en Europe à n’être éclairé pendant la journée que par la lumière naturelle.
Le chef d’orchestre de ce concert Gustavo Dudamel dit :
« La beauté, l’aura de cette salle sont uniques au monde.
C’est un espace qui n’a rien de conventionnel.
A chaque venue, on y découvre quelque chose de nouveau. »
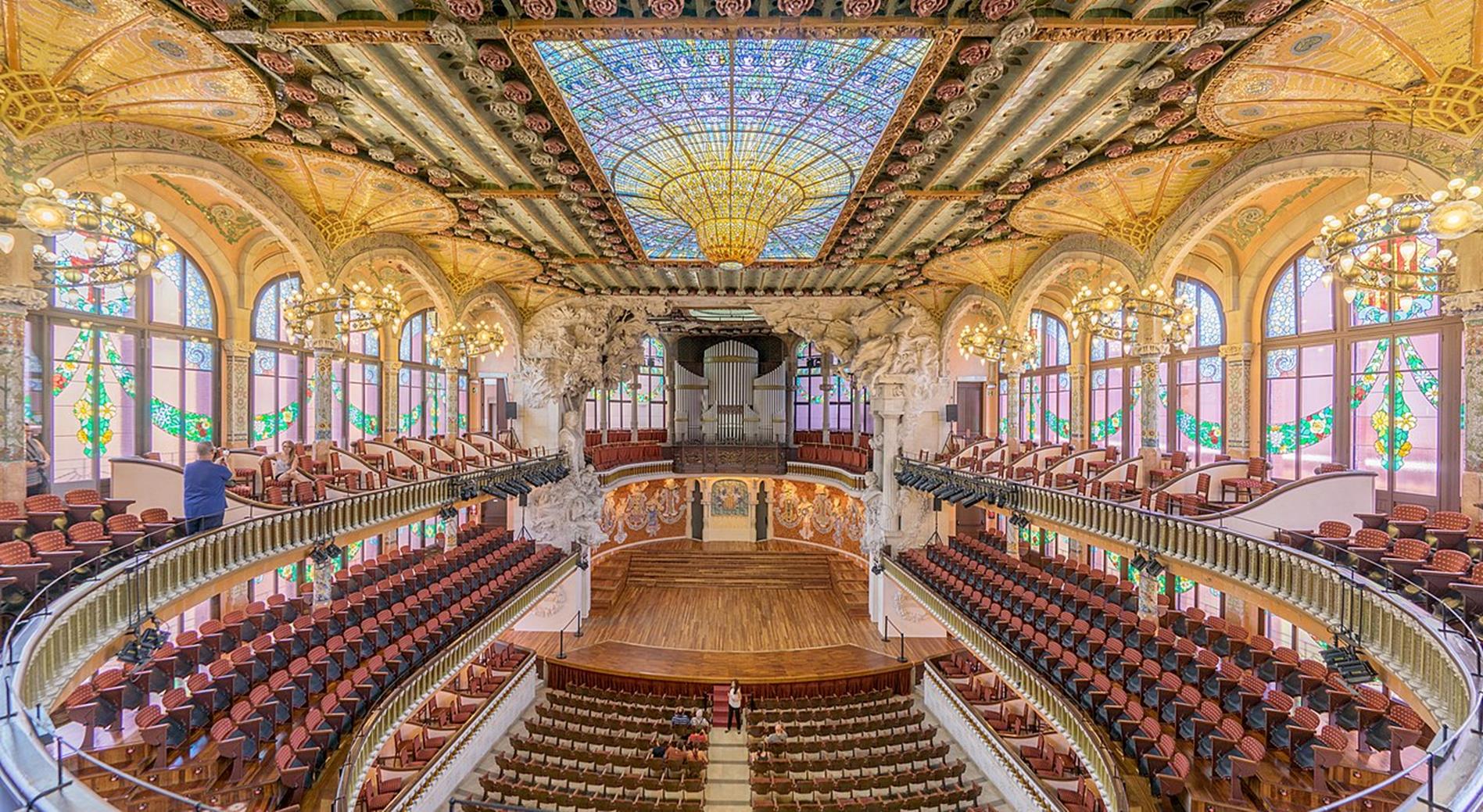 Ensuite, on peut s’intéresser à l’interprétation et aux interprètes.
Ensuite, on peut s’intéresser à l’interprétation et aux interprètes.
L’Orchestre est l’Orchestre Philharmonique de Munich.
Ce fut déjà l’Orchestre qui fut celui du concert de la 8ème symphonie de Mahler que j’ai essayé de raconter lors du <mot du jour du 20 février 2019>
Cet orchestre fondé en 1893 fut dirigé plusieurs fois par Gustav Mahler qui le dirige dès 1897, et qui y crée ses Quatrième et Huitième Symphonies. C’est le disciple de Gustav Mahler, Bruno Walter qui assurera la création du Chant de la terre de Mahler en 1911, toujours avec cet orchestre.
Orchestre qui connut son apogée, entre 1979 et 1996, lorsque son directeur musical fut Sergiu Celibidache, musicien exceptionnel à qui je n’ai pas encore consacré de mot du jour, mais cela ne pourra durer.
 Le chef d’orchestre est Gustavo Dudamel.
Le chef d’orchestre est Gustavo Dudamel.
Un des plus grands chef d’orchestre actuel, né en 1981, il a été nommé en 2009 donc à 28 ans directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles, soit un des plus grand orchestre du monde, c’est absolument unique. L’orchestre a d’ailleurs décidé de renouveler son contrat jusqu’à 2026.
Très jeune, il était arrivé à convaincre et à se faire conseiller par les grands chefs : Claudio Abbado, Daniel Barenboïm et Simon Rattle.
Mais ses débuts et son apprentissage, a eu lieu dans ce formidable programme d’éducation musicale El Sistema qui a été fondé par José Antonio Abreu au Venezuela et qui propose une méthode d’apprentissage alternative de la musique en permettant une intégration sociale de jeunes défavorisés.
L’élite de ces musiciens intègre l’Orchestre symphonique des jeunes du Venezuela Simón Bolívar. D’abord violoniste dans cet orchestre, il en devient rapidement le chef et fait des tournées mondiales avec cet orchestre d’une qualité remarquable.
Il faut voir et écouter cet orchestre, dirigé par Dudamel, jouait <Mambo de West Side Story Bersntein>
Et voici avec cette même formation, <Dudamel qui dirige aussi la 2ème symphonie de Mahler>
Avec Annie et Florence nous avons eu la chance de le voir avec son orchestre de Los Angelés. Chef charismatique, formidable musicien, il emporte l’adhésion.
Ce concert a aussi mis en valeur un chœur espagnol « Orfeó Català & Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana » (Simon Halsey Director)
Et aussi deux solistes remarquables :
La soprano israélienne Chen Reiss, soprano et surtout une mezzosoprano américaine que je ne connaissais pas : Tamara Mumford
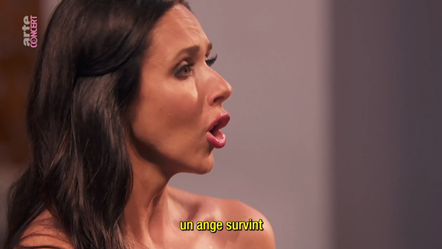 Quand elle se lève pour chanter, la première surprise est sa voix grave et profonde.
Quand elle se lève pour chanter, la première surprise est sa voix grave et profonde.
Et puis, il y a l’émotion qu’elle dégage dans son interprétation et qui émeut même Gustavo Dudamel.
Après les interprètes, il faut aussi s’intéresser à l’œuvre.
D’ailleurs l’œuvre est première par rapport aux interprètes.
La 2ème symphonie est la symphonie la plus populaire de Mahler probablement celle la plus souvent jouée dans les salles de concert. Elle fut créée le 13 décembre 1895 à Berlin.
Gustavo Dudamel la décrit de la manière suivante :
« C’est un hymne à la vie éternelle
Un hymne à la continuité.
Un hymne à la résurrection perpétuelle »
Cette symphonie est si populaire que lorsqu’on a vendu la partition originale aux enchères, elle est devenue la partition la plus chère de l’Histoire, le 29 novembre 2016, à Londres. Le manuscrit d’un morceau du compositeur autrichien a atteint le prix record de 5,32 millions d’euros.
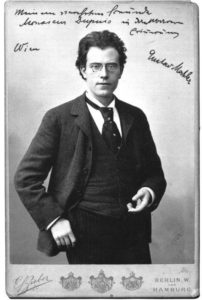
Photo dédicacée par Mahler au chef belge Sylvain Dupuis qui avait programmé la 2ème à Liège en 1899 et invita le compositeur à la diriger à son tour l’année suivante.
Pour en savoir plus, il peut être pertinent de se référer au site <Esprits Nomades> :
« La Deuxième symphonie semble d’une seule coulée, emportant l’auditeur vers l’élan final, vers l’au-delà. Pourtant elle aura mis plus de six ans à venir au monde. […]
Mahler aimera toujours cette œuvre et en ferra sa carte de visite auprès des orchestres […]
Mahler l’a dirigée treize fois et l’a choisie pour son concert d’adieu à Vienne afin de marquer la fin de son règne de 10 ans comme directeur de l’Opéra de Vienne. […]
Plus qu’une musique c’est une vision. Vision spirituelle et métaphysique et aussi description des combats tumultueux pour arriver à la lumière. Le thème est vieux comme le monde : le problème de la vie et de la mort résolu par la résurrection.
Bien des forces antagonistes se combattent, en cela elle est la plus beethovénienne des musiques de Mahler. »
La mezzo chante dans le quatrième mouvement :
« L’homme est accablé d’une si grande souffrance !
L’homme est accablé d’une si grande peine ! »
A cela le chœur et les deux solistes vont répondre dans le 5ème mouvement :
« Ressusciter, oui, tu vas ressusciter, […]
O crois, mon âme, crois
que rien n’est perdu pour toi !
Tu as maintenant ce que tu as désiré,
ce que tu as aimé, ce pour quoi tu as lutté !
O crois que tu n’es pas née en vain,
que ce n’est pas en vain que tu as vécu et souffert !
Ce qui a été engendré doit passer, ce qui est passé doit ressusciter ! Cesse de trembler ! Prépare-toi ! Prépare-toi à vivre ! […]
Ressusciter, oui, tu vas ressusciter, mon âme, seul instant !
Et ce que tu as vaincu
te mènera vers Dieu ! »
C’est merveilleusement beau.
La salle, les interprètes, l’œuvre et un dernier point pourrait être ma relation personnelle avec cette œuvre.
La relation notamment en concert. Je pense que c’est l’œuvre symphonique que j’ai le plus souvent entendu en concert.
Nous avons déjà eu deux concerts de la 2ème de Mahler à l’Auditorium de Lyon et cette saison, il est prévu le 23 mai que nous ayons à nouveau cette symphonie dirigée par Jukka-Pekka Saraste à Lyon. Le confinement sera-t-il terminé ?
Et puis je l’ai entendu plusieurs fois à Paris.
Mais deux concerts sont restés très forts dans ma mémoire.
- Le mardi 26 avril 1988, à la salle Pleyel, nous avons assisté Annie et moi à notre premier concert en commun, ce fut la 2ème symphonie de Mahler avec l’orchestre de Paris dirigé par Eliahu Inbal.
Depuis nous ne nous sommes plus quittés.
- Et puis le mercredi 30 mai 2012, à Angers, sur l’insistance de mon ami Didier, avec Didier et Hélène j’ai assisté au dernier concert dans lequel j’ai vu mon frère Gérard jouer.
Il était, alors, le super soliste de l’orchestre philharmonique des pays de la Loire et menait donc l’orchestre dans cette 2ème symphonie dans le cadre de la commémoration des 40 ans de l’Orchestre.
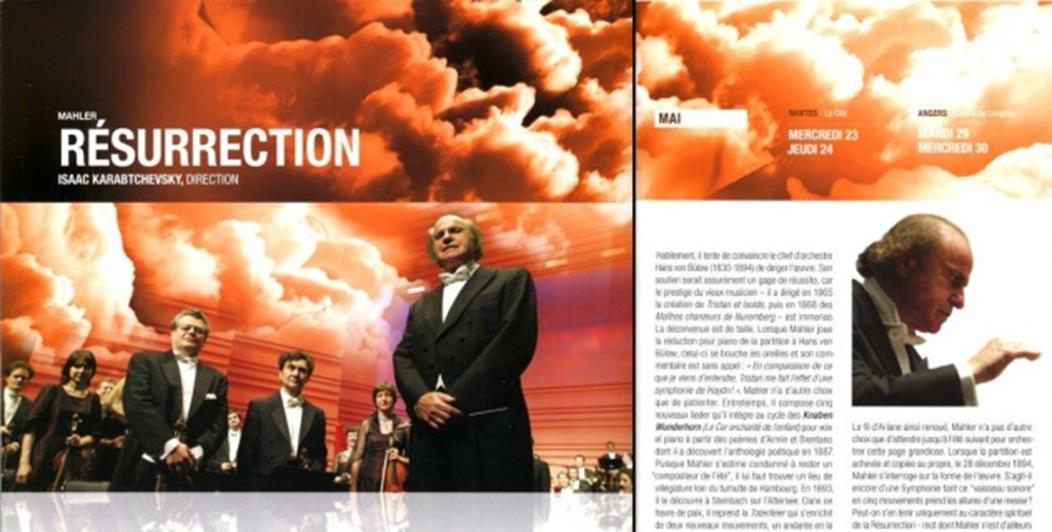 Dans le cadre de l’épreuve de COVID-19, il ne me semble pas trop tôt de parler de résurrection.
Dans le cadre de l’épreuve de COVID-19, il ne me semble pas trop tôt de parler de résurrection.
Il est important, quand on se trouve dans l’épreuve, de savoir qu’il y aura une fin et un nouveau départ.
<1388>
- Le mardi 26 avril 1988, à la salle Pleyel, nous avons assisté Annie et moi à notre premier concert en commun, ce fut la 2ème symphonie de Mahler avec l’orchestre de Paris dirigé par Eliahu Inbal.
-
Samedi 4 avril 2020
« Puisque seul l’amour sait nous raconter à ceux qui savent écouter. »Yasmina KhadraMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Augustin Trapenard continue sur France Inter, chaque matin à neuf heures moins 5, à lire une lettre que lui a envoyé un écrivain ou un artiste dans sa chronique : <Lettres d’intérieur>
Ce sont des perles, des respirations de l’âme, des moments où nous redevenons fiers d’appartenir à l’espèce humaine qui si souvent nous désespère.
Jeudi, il a lu une lettre de l’écrivain algérien Yasmina Khadra à sa mère décédée il y a moins de deux ans.
« Paris, le 2 avril 2020.
Ma chère petite maman,
Depuis quelques jours, je suis confiné chez moi à cause du coronavirus. L’enfermement est devenu une habitude, pour moi. Je sors rarement. Le temps parisien ne se prête guère à un enfant du Sahara qui ne reconnaît le matin qu’à sa lumière éclatante et qui a toujours rangé la grisaille du côté de la nuit.
Je suis en train de terminer un roman — le seul que j’aurais aimé que tu lises, toi qui n’as jamais su lire ni écrire. Un roman qui te ressemble sans te raconter et qui porte en lui le sort qui a été le tien.
Je sais combien tu aimais la Hamada où tu adorais traquer la gerboise dans son terrier et martyriser les jujubiers pour quelques misérables fruits. Eh bien, j’en parle dans mon livre comme si je cherchais à revisiter lieux qui avaient compté pour toi. Je parle des espaces infinis, des barkhanes taciturnes, des regs incandescents et du bruit des cavalcades. Je parle des héros qui furent les tiens, de Kenadsa et de ses poètes, des sentiers poussiéreux jalonnés de brigands et des razzias qui dépeuplaient nos tribus.
C’est toi qui m’as donné le courage de m’attaquer enfin à cette épopée qui me hante depuis des années. Je craignais de n’avoir pas assez de souffle pour aller au bout de mon texte, mais il a suffi que je pense à toi pour que mes peurs s’émiettent comme du biscuit.
Chaque fois que j’emprunte un chapitre comme on emprunte un passage secret, je perçois une présence penchée par-dessus mon épaule. Je me retourne, et c’est toi, ma maman adorée, ma petite déesse à moi. Je te demande comment tu vas, Là-haut ? Tu ne me réponds pas. Tu préfères regarder l’écran de mon ordi en souriant à cette écriture si bien agencée dont tu n’as pas les codes. Je sais combien tu aimes les histoires. Tu m’en racontais toutes les nuits, autrefois, lorsque le sommeil me boudait. Tu posais ma tête sur ta cuisse et tu me narrais les contes berbères et les contes bédouins en fourrageant tendrement dans mes cheveux. Et moi, je refusais de m’assoupir tant ta voix était belle. Je voulais qu’elle ne s’arrête jamais de bercer mon âme. Il me semblait, qu’à nous deux, nous étions le monde, que le jour et la nuit ne comptaient pas car nous étions aussi le temps.
C’est toi qui m’a appris à faire d’un mot une magie, d’une phrase une partition et d’un chapitre une saga. C’est pour toi, aussi, que j’écris. Pour que ta voix demeure en moi, pour que ton image tempère mes solitudes. Toi qui frisais le nirvana lorsque tu te dressais sur la dune en tendant la main au désert pour en cueillir les mirages ; toi qui ne pouvais dissocier un cheval qui galopait au loin d’une révélation divine, tu te sentirais dans ton élément dans ce roman en train de forcir et tu ferais de chacun de mes points d’exclamation un point d’honneur. Comment oublier l’extase qui s’emparait de toi au souk dès qu’un troubadour inspiré se mettait à affabuler en chavirant sur son piédestal de fortune ?
Pour toi, comme pour Flaubert — un roumi qui n’était ni gendarme ni soldat, rassure-toi — tout était vrai. Etaient vraies les légendes décousues, vraie la rumeur abracadabrante, vrai tout ce qui se disait parce que, pour toi, c’était cela le pouls de l’humanité. Quand il m’arrive de retourner à Oran, je vais souvent m’asseoir à notre endroit habituel et convoquer nos papotages qui se poursuivaient, naguère, jusqu’à ce que tu t’endormes comme une enfant.
C’était le bon vieux temps, même s’il ne remonte qu’à deux ans — deux ans interminables comme deux éternités. Nous prenions le frais sur la véranda, toi, allongé sur le banc matelassé et moi, tétant ma cigarette sur une marche du perron, et nous nous racontions des tas d’anecdotes en riant de notre candeur. Tu plissais les yeux pour mieux savourer chaque récit, le menton entre le pouce et l’index à la manière du Penseur.
Mon Dieu ! Que faire pour retrouver ces moments de grâce ? Quelle prière me les rendrait ? Mais n’est-ce pas dans l’ordre des choses que de devoir restituer à l’existence ce qu’elle nous a prêté ? On a beau croire que le temps nous appartient, paradoxalement, c’est à lui que revient la tâche ingrate de séparer à jamais ceux qui se chérissent. Ne reste que le souvenir pour se bercer d’illusions.
Ma petite maman d’amour, depuis que tu es partie, je te vois dans toute grand-mère ? Qu’elles soient blondes, brunes ou noires, il y a quelque chose de toi en chacune d’elles. Si ce ne sont pas tes yeux, c’est ta bouche ; si ce n’est pas ton visage, ce sont tes mains ; si ce n’est pas ta voix, c’est ta démarche ; si ce n’est rien de tout ça, c’est l’émotion que tu as toujours suscitée en moi.
Et pourtant, partout où je vais, même là où il n’y a personne, c’est toi que je vois me faire des signes au fond des horizons. Tantôt étoile filante dans le ciel soudain triste que tu lui fausses compagnie, tantôt île de mes rêves au milieu d’un océan de tendresse aussi limpide que ton cœur, tu demeures mon aurore boréale à moi. Si je devais un jour te rejoindre, maman, je voudrais qu’il y ait une part de nous deux dans tout ce qui nous survivrait. Puisque seul l’amour sait nous raconter à ceux qui savent écouter. »
Yasmina Khadra
Wikipedia nous apprend que : Yasmina Khadra est le nom de plume de l’écrivain algérien Mohammed Moulessehoul né le 10 janvier 1955 dans le Sahara.
Son père ancien officier de l’armée algérienne, l’envoie à l’âge de 9 ans à l’école des cadets de la Révolution afin de le former au grade d’officier. À 23 ans, il sort sous-lieutenant de l’Académie militaire, avant de servir comme officier dans l’armée algérienne pendant vingt-cinq ans. Durant la guerre civile algérienne, dans les années 1990, il est l’un des principaux responsables de la lutte contre l’AIS puis le GIA, en particulier en Oranie. Il atteint le grade de commandant.
Il fait valoir ses droits à la retraite et quitte l’armée algérienne en 2000 pour se consacrer à l’écriture.
À 18 ans, Mohammed Moulessehoul finit son premier recueil de nouvelles qui est publié onze ans après, en 1984. Il publie 3 recueils de nouvelles et 3 romans sous son propre nom de 1984 à 1989 et obtient plusieurs prix littéraires, parmi lesquels celui du Fonds international pour la promotion de la culture (de l’UNESCO) en 1993. Pour échapper au Comité de censure militaire, institué en 1988, il opte pour la clandestinité et publie son roman «Le Dingue au bistouri». Il écrit pendant onze ans sous différents pseudonymes et collabore à plusieurs journaux algériens et étrangers pour défendre les écrivains algériens. En 1997 paraît en France, chez l’éditeur parisien Baleine, « Morituri » qui le révèle au grand public, sous le pseudonyme Yasmina Khadra.
Il opte définitivement pour ce pseudonyme, qui sont les deux prénoms de son épouse, laquelle en porte un troisième, Amel en hommage à Amel Eldjazaïri, petite-fille de l’Emir Abdelkader. En réalité, sa femme s’appelle Yamina et c’est son éditeur qui a rajouté un « s », pensant corriger une erreur. Mohammed Moulessehoul explique ce choix :
« Mon épouse m’a soutenu et m’a permis de surmonter toutes les épreuves qui ont jalonné ma vie. En portant ses prénoms comme des lauriers, c’est ma façon de lui rester redevable. Sans elle, j’aurais abandonné. C’est elle qui m’a donné le courage de transgresser les interdits. Lorsque je lui ai parlé de la censure militaire, elle s’est portée volontaire pour signer à ma place mes contrats d’édition et m’a dit cette phrase qui restera biblique pour moi : « Tu m’as donné ton nom pour la vie. Je te donne le mien pour la postérité« . »
Dans un monde aussi conservateur que le monde arabo-musulman, porter un pseudonyme féminin, pour un homme, est une véritable révolution. Yasmina Khadra n’est pas seulement un nom de romancier, il est aussi un engagement indéfectible pour l’émancipation de la femme musulmane. Il dit à ce propos :
« Le malheur déploie sa patrie là où la femme est bafouée. »
En 2000, il part au Mexique avec sa femme et ses enfants pour s’installer par la suite en France en 2001. Cette même année il révèle sa véritable identité avec la parution de son roman autobiographique «L’Écrivain.»
<Une page qui renvoie vers les livres de Yasmina Khadra>

« Écoute ton cœur. Il est le seul à te parler de toi-même, le seul à détenir la vérité vraie.
Sa raison est plus forte que toutes les raisons du monde.
Fais-lui confiance, laisse-le guider tes pas.
Et surtout n’aie pas peur. »Yasmina Khadra, Les Hirondelles de Kaboul (2002)
<1387>
-
Vendredi 3 avril 2020
« Nous sommes devenus des cibles. »Virginie, infirmière libérale de MarseilleEssayer de comprendre le monde…
En voir la beauté, la solidarité.
Et je ne me lasserai pas de dire que c’est de l’entraide dont nous avons besoin. Que les gens vraiment intelligents le savent et le pratiquent.
Mais essayer de comprendre et regarder le monde c’est aussi voir le mal qui s’y trouve !
Mal, fruit de la bêtise, de l’égoïsme, de la peur parfois.
Notre période singulière de cette pandémie que personne n’attendait, sauf Bill Gates et la CIA, montre de merveilleux élans de solidarité et de soutien.
Laurent Garcia, cadre de santé en Ehpad a raconté ce jeudi matin sur France Inter, l’accompagnement des ainés dans un EHPAD de Bagnolet : <Tous les jours, c’est entre rires et larmes>. Témoignage poignant, lumineux et dramatique.
J’ai lu cet été deux livres dont je n’ai pas encore parlé lors d’un mot du jour.
Le premier est « Crépuscule » de Juan Branco dont je ne sais quoi dire et penser.
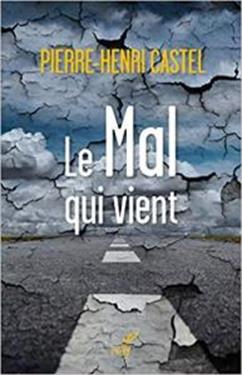 Et le second : « Le mal qui vient » de Pierre-Henri Castel dont je n’avais pas envie de parler
Et le second : « Le mal qui vient » de Pierre-Henri Castel dont je n’avais pas envie de parler
Dans ce livre, Pierre-Henri Castel pose comme hypothèse que la société humaine ne parvient à surmonter le défi climatique et il imagine le comportement des humains dans ce contexte d’une connaissance inéluctable du désastre.
Pendant longtemps les hommes se seraient tournés vers la Foi et la Religion, certains sont encore dans cette démarche.
Edgar Morin pense que cela pourra entraîner un sursaut du plus grand nombre qui à travers l’intelligence collective sauront affronter cette épreuve par la solidarité.
Pierre-Henri Castel examine cette situation en se centrant sur ceux qui par esprit de jouissance, voudront se livrer à ce qu’il appelle une « ivresse extatique de la destruction » : « plus la fin sera certaine, donc proche, plus la dernière jouissance qui nous restera sera la jouissance du Mal ».
Bien sûr cette pandémie n’a rien à voir avec l’hypothèse du livre de Pierre-Henri Castel, mais nous sommes dans une crise très particulière qui touche toute la société. Et dans ce contexte le type de mal qu’évoque ce philosophe, se révèle.
Nous avons dans nos rangs d’homo sapiens, des nuisibles.
Je trouve totalement inapproprié que l’on utilise ce terme de nuisible que pour des rongeurs, des insectes et d’autres parasites, alors qu’il s’applique parfaitement à certains humains.
Il y a des riches parmi ces nuisibles, mais ils ne sont pas tous riches. La pauvreté n’immunise pas contre ce fléau.
Cette semaine, à Bron, en banlieue lyonnaise :
« Devant le Leader Price, il fallait faire la queue avant d’entrer. Un homme âgé d’une trentaine d’années n’avait visiblement pas l’intention d’attendre et tenta de doubler tout le monde en malmenant un senior, tentant de le convaincre de lui céder sa place. Mais un client est intervenu et a provoqué la fuite du trentenaire. »
Moins de 10 minutes plus tard, deux voitures sont arrivées en trombe sur le parking du supermarché et huit individus en sont sortis. Il s’agissait du trentenaire qui était allé chercher du renfort, se riant au passage des consignes liées au confinement.
Armés de batte de baseball, ils s’en sont pris à la vitrine du Leader Price avant de repartir. Le client qui s’était interposé et qui était vraisemblablement recherché par le groupe a échappé au pire puisqu’il était à l’intérieur du magasin. »
Et, en ces temps où nous avons tant besoin des soignants, aide soignantes, infirmier(e)s, médecins, des nuisibles les agressent pour leur voler des masques ou d’autres ustensiles, leur demande de déménager parce qu’ils pourraient être contagieux ou pratiquent d’autres insultes à l’esprit ou à la morale.
<L’Obs a fait témoigner une infirmière>, Virginie, infirmière libérale de Marseille âgée de 37 ans, passée par le service réanimation de la Timone et qui raconte les difficultés auxquelles est confrontée sa profession depuis le début de la crise sanitaire :
« Bien sûr, il y a les applaudissements chaque soir à 20 heures. Les discours sur les « héros en blouse blanche ». Tout ça réchauffe le cœur.
Et puis, il y a aussi la réalité du terrain, souvent affligeante. La tension dans l’air qu’on ressent.
L’agressivité chez certains patients.
La peur de se faire agresser pour quelques masques, des gants ou le gel hydroalcoolique qui ne nous quittent plus. »
Elle raconte son quotidien, son sentiment de solitude devant le mal.
« Chaque jour, j’ai la boule au ventre. Je me dis que j’ai plus de risques de me faire voler mon matériel que d’attraper ce virus. Deux de mes collègues se sont fait voler leur caducée. Je ne comprends pas : les gens pensent que cela leur servira de laissez-passer. Mais chaque caducée porte un nom. Mon associée s’est fait fracturer son véhicule. On lui a dérobé trois masques et du matériel médical. Moi, la semaine dernière, je n’ai reçu qu’un carton de gants sur les deux que j’avais commandés. Le bordereau de livraison indique pourtant deux cartons. L’un d’eux a donc disparu. A-t-il été égaré, volé ? Moi, j’ai un besoin impératif de ces gants pour faire les toilettes.
Au départ, je pensais que c’était un phénomène propre à Marseille. Mais en me baladant sur les forums d’infirmiers, j’ai constaté que c’était partout la même chose. C’est terrible à dire mais nous sommes devenus des cibles pour certains. Du coup, j’ai retiré le caducée de mon pare-brise. Je l’ai pourtant toujours affiché avec fierté. Maintenant, on nous conseille de l’enlever.
Quand je me rends chez un patient, je laisse aussi ouverte la boîte à gants de ma voiture, je retire la plage arrière pour bien montrer que je ne transporte rien dans mon coffre. Lors de ma tournée, je ne porte plus ma surblouse pour ne pas attirer l’attention. Les forces de l’ordre, sortis des grands axes, on ne les voit pas. On a parfois l’impression d’être seule dans la ville. Il est facile de nous attaquer, de nous prendre nos voitures. On nous parle de solidarité avec le personnel soignant mais je crains que personne ne vienne nous défendre si cela se produit. »
Et elle explique que les infirmières libérales sont plus exposées et moins pris en considération que les médecins.
« Sur mon arrondissement, 85 % des médecins sont en télétravail. Nous sommes donc les seuls à nous déplacer chez les patients. Nous et les aides à domicile. Quand il y a une suspicion de Covid-19, ou qu’il s’agit d’administrer des soins à des malades souffrant du virus, c’est souvent nous qui sommes appelées. Pourtant, quand on se présente chez les pharmaciens pour récupérer des masques, on a l’impression de faire l’aumône. « Je n’ai que ça », m’a répondu un jour un pharmacien en me tendant une boîte de masques périmés. En vérité, certains préfèrent les réserver aux médecins, dont la plupart télétravaillent, plutôt que de les donner aux infirmières libérales. Peut-être parce que nous, contrairement à eux, nous ne prescrivons pas de médicaments. Ils pensent à leurs chiffres d’affaires quand tout sera rentré dans l’ordre. »
Ces infirmières se heurtent en premier au scandale de la pénurie des masques.
« La semaine dernière, nous nous sommes partagés quinze masques avec les deux autres infirmières de notre cabinet. Qu’est-ce qu’ils croient ? Que nous sommes immunisées ? Moi, quand je rentre chez moi tous les soirs, je me déshabille dans le jardin et je jette tous mes affaires dans un sac par peur de contaminer ma famille. »
Pierre Desproges avait inventé les « Chroniques de la haine ordinaire ». Je trouve cette expression appropriée pour les descriptions qui suivent :
« L’attitude des gens à notre égard a elle aussi beaucoup changé.
J’en viens même à douter qu’il s’agisse des mêmes patients que j’avais trois mois plus tôt. On ramasse toutes les peurs, on devient leur femme à tout faire. Un jour, un médecin m’a demandé de me rendre en urgence chez une personne. En vérité, celle-ci voulait seulement des informations sur le coronavirus.
Certains patients voulaient que j’aille leur acheter des bananes, le journal ou bien faire leurs courses.
Et quand je leur demande pourquoi ils n’appellent pas leurs enfants pour le faire, ils me répondent : « Mais vous plaisantez, je ne veux pas qu’ils prennent le risque de se faire contaminer ». »
Un jour, je suis intervenue pour un soin chez un patient. J’ai été reçu dans le couloir. Sa femme ne voulait pas que j’entre dans le reste de l’appartement. Elle avait même disposé des feuilles de papier journal partout sur le sol. Elle m’a interdit de toucher à quoi que ce soit, me suivait avec une lingette. Je comprends les peurs, mais là j’ai vraiment eu l’impression d’être une pestiférée.
Des collègues ont retrouvé des mots sur leur voiture : des voisins qui leur demandaient de déménager, leur disaient qu’ils portaient la poisse.
Moralement, c’est très dur. Je suis déçue par les gens.
Chaque soir, je rentre chez moi en pleurs. On dit que les crises révèlent certains caractères. Eh bien ce que je vois m’attriste au plus haut point. »
C’est aussi cela la crise que nous vivons en ce moment.
<1386>
-
Jeudi 2 avril 2020
« Si quelque chose tue plus de 10 millions de gens dans les prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement contagieux plutôt qu’une guerre »Bill Gates en 2015Quand Obama disait : « Les gens qui font de très belles choses ont des défauts. », peut être pensait-il à Bill Gates, le fondateur de Microsoft.
En mars 2015, lors d‘une conférence Ted, à Vancouver, Bill Gates a tenu ces propos :
« Aujourd’hui le plus grand risque de catastrophe mondiale, ne ressemble pas [à l’explosion d’une bombe atomique] mais plutôt [à un microbe]. Si quelque chose tue plus de 10 millions de gens dans les prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement contagieux plutôt qu’une guerre, pas des missiles, mais des microbes.
Une des raisons c’est que nous avons investi énormément dans la dissuasion nucléaire.
Mais nous n’avons n’a que très peu investi dans un système pour arrêter les épidémies.
Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie. »
S’il n’annonçait pas le COVID-19, c’était quand même assez proche de la réalité actuelle.
Il s’exprimait après l’épidémie d’Ebola qui avait ravagée l’Afrique de l’Ouest, en 2014, tuant des milliers de personnes auparavant.
Bill Gates analysait ainsi cette crise et prévoyait la suivante :
« Regardez Ebola : le problème n’était pas que le système n’a pas assez bien marché. C’était qu’il n’y avait pas de système tout court. La prochaine épidémie pourrait être bien plus dramatique. Il pourrait y avoir un virus avec lequel les gens infectés se sentiraient suffisamment bien pour prendre l’avion, aller au marché… […] D’autres variables rendraient les choses mille fois pires : par exemple, un virus capable de se propager dans l’air comme la grippe espagnole de 1918. […] Voilà ce qu’il se passerait: il se propagerait à travers le monde entier très très rapidement. Et 30 millions de gens mourraient de cette épidémie. […]C’est un problème sérieux. Nous devons nous en préoccuper»
Et dans cette description nous sommes, cette fois, proches de COVID-19.
Pour Ebola, il souligne qu’aucune équipe médicale n’était prête à intervenir pour endiguer la propagation du virus. Il précise aussi les raisons pour lesquelles Ebola ne s’est pas propagé à l’échelle mondiale : parce que le virus n’a pas touché de zones urbaines et que le virus qui infectait les gens les rendait très malade de sorte qu’il se déplaçait peu. Ebola est en effet un virus avec une bien plus grande force létale que celui qui nous préoccupe actuellement mais avec une moindre capacité de propagation. D’où cette prévision qu’un virus moins virulent mais plus infectieux pourrait créer des dégâts géographiquement beaucoup plus importants.
Une fois les dangers explicités, Bill Gates détaille les solutions possibles. Il précise que grâce aux téléphones portables il est possible de recevoir et diffuser l’information au public. Avec des cartes satellites on peut voir les gens et où ils vont. Et il proposait un certain nombre d’actions qu’il faudrait mettre en place pour éviter une catastrophe : la constitution d’équipes de santé prêtes à intervenir, tels des soldats au sein d’armées étatiques et intégrés dans des organismes internationaux. Il insistait aussi sur l’aide à apporter aux pays pauvres pour renforcer leurs systèmes médicaux, puisque son ambition était de lutter contre une épidémie mondiale et de mettre en place un système mondial.
<La libre Belgique> qui fait référence à cette intervention de Bill Gates, rapporte qu’un rapport de 2009 de la CIA était aussi prémonitoire :
« Un ancien rapport est ressorti ces derniers jours, où les analystes américains imaginaient déjà en 2009 « une nouvelle maladie respiratoire humaine virulente, extrêmement contagieuse ».
Les services de renseignements américains établissent, tous les quatre ans, un rapport contenant leurs prévisions pour les années à venir. En 2009 donc, ils ont imaginé comment serait le monde en 2025. Et dans leur rapport, publié à l’époque en français aux Éditions Robert Laffont, un passage retient aujourd’hui l’attention: le chapitre intitulé « Le déclenchement possible d’une pandémie mondiale ».
Les analystes de la CIA y abordent l’apparition éventuelle « d’une nouvelle maladie respiratoire humaine virulente, extrêmement contagieuse, pour laquelle il n’existe pas de traitement adéquat, pourrait déclencher une pandémie mondiale ». Si une telle maladie apparaît, d’ici 2025, des tensions et des conflits internes ou transfrontaliers ne manqueront pas d’éclater », peut-on lire dans le dossier, « En effet, les nations s’efforceront alors – avec des capacités insuffisantes – de contrôler les mouvements des populations cherchant à éviter l’infection ou de préserver leur accès aux ressources naturelles ».
Tant du point de vue de l’ampleur de l’épidémie que de sa nature, les experts avaient vu juste. Ils parlaient déjà de dizaines de milliers de morts, et de « dix à plusieurs centaines de millions » de cas de contamination. Ils prévoyaient également que la contamination serait due à « la mutation génétique naturelle, de la recombinaison de souches virales déjà en circulation ou encore de l’irruption d’un nouveau facteur pathogène dans la population humaine », comme l’est le coronavirus.
Le rapport de la CIA abordait, avec exactitude là aussi, le lieu de départ d’une telle pandémie. Selon les prévisions, la maladie aurait tendance à se déclarer « dans une zone à forte densité de population, de grande proximité entre humains et animaux, comme il en existe en Chine et dans le Sud-Est asiatique où les populations vivent au contact du bétail ». Ils ne se sont donc pas trompés. »
Malheureusement, force est de constater que ni le rapport de la CIA, ni l’alerte formulée par Bill Gates n’auront conduit à des actions concrètes sauf en Corée du Sud, à Taiwan et au Japon qui avait été touchés par de précédentes épidémies de coronavirus particulièrement l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002-2003. Par la suite il y eut aussi le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) à partir de 2012, épidémie ayant infecté peu de gens mais extrêmement mortelle.
<Europe 1> rapporte que Bill Gates s’est exprimé sur l’épidémie actuelle mi-mars :
« Nous devons rester calmes, même si nous vivons une situation exceptionnelle […] Le seul modèle efficace connu est celui d’une rigoureuse distanciation sociale. Si vous ne faîtes pas ça, alors le virus touchera une large partie de la population et les hôpitaux se retrouveront en état de saturation en raison de l’afflux de personnes malades […] La Chine voit le nombre de cas diminuer désormais parce que la mise en place des tests et du confinement a été très efficace. […] Si un pays réussi à mettre en place des tests et à faire respecter le confinement, alors entre 6 à 10 semaines, il devrait voir le nombre de cas baisser et commencer à pouvoir envisager un retour à la normal. ».
Même des gens qui ont des défauts peuvent être très utiles si on les écoutait parfois…<Conférence TED de Bill Gates (2015)>
<1385>
-
Mercredi 1er avril 2020
« Si la seule chose que vous faites, c’est critiquer, vous n’irez probablement pas bien loin. »Barack ObamaDans ce temps particulier que nos sociétés traversent dans le monde entier, la solidarité s’exprime, le dévouement des soignants et d’autres travailleurs dont on comprend aujourd’hui l’importance. Même si ce sont souvent des personnes que le monde de l’économie ne met pas en avant : les éboueurs, les caissières des supermarchés, les routiers qui véhiculent les denrées indispensables ou encore tous ceux et beaucoup plus celles qui nettoient les lieux de travail, les hôpitaux, les Ehpad.
Il y aussi beaucoup de critiques et même d’expression de haine.
Certains ont l’air de savoir exactement ce qu’il aurait fallu faire et qui sont les responsables de tous nos malheurs.
Et pourtant, ne faudrait-il pas davantage d’humilité ?
Beaucoup d’exemples pourraient être donné, mais je n’en donnerai qu’un celui de Christophe Prudhomme, représentant CGT des urgentistes qui tient désormais des propos très virulents contre le gouvernement, son manque d’anticipation, ses décisions en retard etc.
Ces propos qu’il tient à la fin du mois de mars sont incroyables quand on les rapproche des propos de ce même professionnel au début du même mois de mars. Sur le plateau de LCI il accusait alors le gouvernement de surréagir et considérait ce virus comme peu dangereux.
 Vous trouverez tous les éléments dans cet article avec notamment les deux interventions incompatibles de la même personne à 3 semaines d’intervalle.
Vous trouverez tous les éléments dans cet article avec notamment les deux interventions incompatibles de la même personne à 3 semaines d’intervalle.
Evidemment, nous manquons de masques !
Mais pourrions-nous nous souvenir que lors de l’épisode de la grippe H1N1, la ministre de la santé d’alors, Roselyne Bachelot avait anticipé et fait acheter des centaines de millions de masques ?
Cette épidémie-là ne s’était pas déployée, alors on l’a critiqué méchamment d’avoir dilapidé l’argent public.
J’aimerais qu’on rappelle les propos d’alors des spécialistes qui aujourd’hui trouvent anormal qu’on ne dispose pas d’un milliard de masques.
C’est <La revanche de Roselyne Bachelot>, elle qui dit aujourd’hui :
« Il suffirait de relire mon audition après la grippe A, je n’ai qu’une théorie : en matière de gestion d’épidémie, l’armement maximum doit être fait. Nous avions un stock près d’un milliard de masques chirurgicaux et de 700 millions de masques FFP2. J’ai été moquée pour cela, tournée en dérision, mais quand on veut armer un pays contre une épidémie, c’est ce qu’il faut ! »
Elle n’appartient pas à la majorité présidentielle, mais son expérience lui fait tenir des propos très mesurés :
« Je pensais qu’on me rendrait justice après ma mort. J’ai dû attendre dix ans. Gérer une crise sanitaire, c’est conduire une Ferrari sur une route verglacée. C’est très compliqué !
Olivier Véran est un bon ministre qui gère ça bien. Le chef de l’État prend les décisions appropriées. Le problème avec les masques ne vient pas d’eux. De toute façon, l’heure n’est pas aux polémiques, il faut respecter le confinement, rester chez soi. Faire preuve d’obéissance civile. Il n’y a que cela à faire. »
Je ne résiste pas au partage d’une petite vidéo d’une intervention de Barack Obama Le 29 octobre 2019 à Chicago dans le cadre du troisième sommet annuel de la fondation de Michelle et Barack Obama.
Il s’adresse aux jeunes et notamment aux jeunes sur les campus universitaires américains et particulièrement à ceux qui préconisent le « woke » expression américaine que je tenterai d’expliquer plus loin.
 Barack Obama a dit :
Barack Obama a dit :
« Cette idée de la pureté, de ne jamais faire de compromis, d’être toujours concerné par les questions sociales etc.
Vous devriez passer rapidement à autre chose.
Le monde est chaotique.
Il y a des ambiguïtés.
Les gens qui font de très belles choses ont des défauts.
Les personnes avec lesquelles vous vous disputez, aiment peut être leurs enfants et ont des points communs avec vous.
Je pense qu’il y a un danger chez les jeunes, particulièrement sur les campus universitaires.
Ma fille Malia et moi, nous en parlons.
J’ai parfois l’impression qu’aujourd’hui, chez certains jeunes, et ça s’est accéléré avec les réseaux sociaux, qu’il y a parfois ce sentiment que pour faire changer les choses, il faut être le plus critique possible envers les autres, et que cela suffit.
Par exemple, si je tweete ou si je mets un hashtag sur ce que vous avez mal fait ou sur le mauvais verbe que vous avez employé et après cela je peux me détendre et être plutôt fier de moi, genre : « T’as vu comme j’ai été concerné par les questions sociales ? Je t’ai bien affiché !
Puis j’allume ma télévision et je regarde mon émission, je regarde [ma série]. Ce n’est pas de l’activisme, ça !
Ça ne fait pas changer les choses.
Si la seule chose que vous faites, c’est critiquer, vous n’irez probablement pas bien loin. C’est trop facile. »
Barack Obama essaye donc de convaincre les jeunes qui se retrouvent sous l’expression», typiquement américaine « woke » qui signifie « éveillé ». Cette expression a été reprise par tout un nombre de représentants de minorités qui se jugent victimes de discriminations et développent une vigilance exacerbée contre la moindre trace de racisme ou de discrimination qu’ils pensent découvrir. Dans cette tendance un auteur blanc ne peut plus écrire sur le racisme à l’égard des noirs, parce qu’il n’est pas noir lui-même. Cet <article de la revue des deux mondes> explique cette dichotomie entre les adeptes de la pureté et ceux de l’universalisme.
Caroline Fourest a décrit cette dérive dans son livre <Génération offensée>
Mais je crois que ce discours de Barack Obama peut s’adresser à un plus grand nombre, notamment à tous ceux qui n’ont que la critique dans la bouche et sur leur clavier, qui pensent toujours que le problème vient d’ailleurs.
Que s’il y a un problème, c’est qu’une question technique n’a pas été bien analysée et que quelqu’un quelque part a « merdé ».
Les problèmes que nous avons à affronter ne sont pas toujours aussi simples.
Une grande part des difficultés ne se trouvent pas à l’extérieur de nous, mais dans nos impatiences, nos contradictions, nos désirs et notre adhésion à l’individualisme et au consumérisme.
Critiquer ne suffit pas, il faut aussi proposer.
Proposer des solutions qui peuvent être mises en œuvre, non de simples utopies dont on n’a pas le moindre commencement de début d’organisation viable à proposer à la dimension d’un État, sans parler de la dimension du monde.
Et quand on propose une solution, il faut en comprendre et décrire les conséquences pour notre quotidien, nos désirs et ceux des autres.
Il y a des ambigüités dit Obama.
<1384>
-
Mardi 31 mars 2020
« C’est au moment où on lâche, où on assume le rien, qu’on va aller puiser au cœur de soi, et qu’on va pouvoir le transformer. Ennuyons-nous ! »Odile ChabrillacTout le monde n’est pas égal devant ce confinement qui nous est imposé et qu’heureusement, le plus grand nombre accepte.
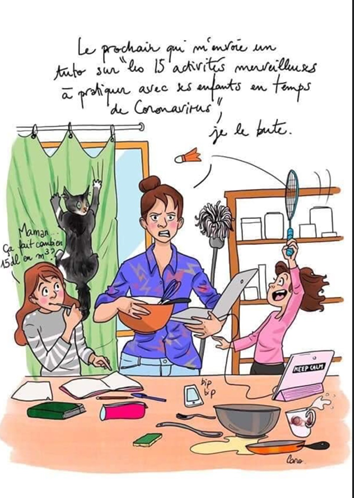 Il en est qui sont en confinement mais aussi en télétravail avec des responsables qui ne comprennent rien au temps présent et qui les harcèlent par des demandes de rendez vous vidéo répétitifs et trop longs. A cela s’ajoute peut être des enfants à occuper, à enseigner, à nourrir…
Il en est qui sont en confinement mais aussi en télétravail avec des responsables qui ne comprennent rien au temps présent et qui les harcèlent par des demandes de rendez vous vidéo répétitifs et trop longs. A cela s’ajoute peut être des enfants à occuper, à enseigner, à nourrir…
Il se peut aussi que des tensions apparaissent entre les occupants du lieu de confinement.
Et lorsque le chat commence à grimper aux rideaux le comble de la patience est dépassée.
Il en est aussi qui sont dans des lieux de confinement trop étroits pour le nombre de présents, c’est alors très difficile.
Mais pour d’autres qui sont davantage sans occupation précise, le risque est rapidement d’être totalement dépassé par l’ensemble des activités proposées par de nombreuses personnes
Marianne nous a fait parvenir une <petite vidéo> dans laquelle un homme confiné, cherche à trouver avec un ami, un moment pendant lequel ils pourront échanger plus longuement. Il s’aperçoit rapidement qu’il n’a plus aucun créneau disponible, tant son emploi du temps du confinement est rempli.
Surtout ne pas s’ennuyer !
Pas un moment de vide ! Un moment sans divertissement.
Le Point a publié un entretien, le 29 mars, avec Odile Chabrillac qui est psychologue et naturopathe : <Tuer l’ennui, quelle drôle d’idée ! >
L’article recommence par un rappel des Pensées de Pascal :
« Rien n’est plus insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, relevait Pascal, sans passion, sans affaire, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. »
Odile Chabrillac a publié un <Petit Éloge de l’ennui> (Éditions Jouvence, 2011).
Elle explique d’abord « l’ennui » :
« L’ennui est un sentiment extrêmement désagréable auquel on résiste, presque physiquement. Il y a quelque chose en nous qui a très peur de cet espace de vacuité parce qu’il nous fait penser à la dépression, à la mort. Alors, on met en place des stratégies d’évitement, de divertissement – au sens pascalien du terme –, on s’agite tous azimuts pour ne surtout pas en arriver là.
Or, précisément, c’est au moment où on lâche, où on assume le rien, qu’on va aller puiser au cœur de soi, et qu’on va pouvoir le transformer. Ennuyons-nous !
C’est dans cet espace vide laissé par l’ennui que se trouvent l’essence, la sève, le potentiel de joie, de créativité, d’invention. C’est la différence entre le vide vide et le vide plein. Mais évidemment, avant d’en arriver là, il est nécessaire de passer par cette phase très mélancolique, quasi dépressive, cette phase qui nous rappelle irrémédiablement les dimanches après-midi de notre enfance, lorsqu’on n’avait personne avec qui jouer et que l’on passait des heures à attendre que quelque chose se passe, que les adultes sortent de table ou prennent notre désœuvrement en compte. Ces après-midi d’enfance où le temps semblait s’étirer indéfiniment… »
Alors bien sûr, il ne s’agit pas d’un après-midi de l’enfance, mais d’une période de confinement longue dont nous ignorons pour l’instant la sortie :
« L’absence de perspective vient en effet majorer le désagrément intérieur. Non seulement on se retrouve dans une situation qu’on n’a pas l’habitude de gérer, mais surtout on ne sait pas pour combien de temps. C’est comme une maladie : il faut s’en remettre à plus grand que soi, ce qui, on le sait, n’est pas le fort des humains, qui ont tendance à vouloir tout contrôler. On se doute bien que la période engendrera de grandes transformations, autant du point de vue collectif que personnel. Mais que d’incertitudes à l’arrivée ! Cela rajoute beaucoup d’angoisse à l’ennui. C’est comme rouler avec le frein à main au plancher, c’est coûteux en énergie. Comme après tout traumatisme, notre cerveau est en train de se reconfigurer. Il se réinitialise en quelque sorte. Je pense que c’est pour cela que chacun se sent étonnamment épuisé en se couchant le soir. Certains de mes patients me décrivent une fatigue complètement disproportionnée par rapport à leur baisse d’activité. C’est bien que le cerveau est en train de turbiner. Il doute, angoisse, cherche des dérivatifs, de quoi remplir le vide, ne se satisfait pas, recommence, puis abandonne. Lessivé. »
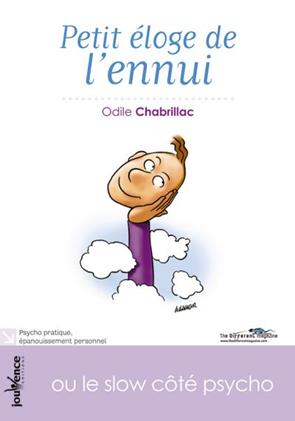 Mais nous sommes sollicités de toute part pour ne pas nous ennuyer, remplir le silence, remplir l’attente, de dizaines de choses à faire, partager, lire, regarder, agir.
Mais nous sommes sollicités de toute part pour ne pas nous ennuyer, remplir le silence, remplir l’attente, de dizaines de choses à faire, partager, lire, regarder, agir.
D’ailleurs lire, pendant cette période n’est pas si simple : « Pourquoi je n’arrive pas à lire de roman pendant le confinement. »
« Dès lors qu’on se rend compte que les distractions sont paradoxalement trop nombreuses, qu’on ne sait plus où donner de la tête, c’est qu’on est sur la bonne voie. On peut s’adonner plusieurs jours d’affilée à la compulsion visuelle, se noyer dans les écrans et se nourrir d’images, mais cela ne peut pas tenir sur la durée. Le jour où, lassé, on éteint la télévision ou on supprime la vidéo que l’on vient de recevoir sans y avoir jeté un œil, là, le vide devient intéressant. Angoissant, je suis tout à fait lucide là-dessus, voire fragilisant pour certaines personnes – il faut une structure psychique forte pour résister – mais c’est là que l’imagination va s’épanouir. »
Accepter le rien, grandir dans le retour sur soi.
Le mot du jour du <3 octobre 2019> donnait la parole au docteur Richard Béliveau « Malheureusement, pour beaucoup de gens, la seule fois dans leur vie où ils seront face à eux-mêmes, c’est au moment de mourir. »
« Affectivement, émotionnellement, cet enfermement peut en effet s’avérer très difficile à vivre. Je connais plein de gens qui n’auront jamais passé autant de temps avec leur femme, leur mari, leur famille, leurs enfants. C’est une bombe atomique en puissance ! Je pense qu’on est en train de vivre une véritable initiation collective. C’est mon interprétation, mais le monde occidental est aujourd’hui confronté de plein fouet à son plus grand tabou : la mort. Pour la regarder collectivement droit dans les yeux, il faut l’expérimenter chacun symboliquement, en acceptant le rien. Cela permet l’invention, on dirait, de nouveaux rituels collectifs. C’est assez fascinant à analyser. »
L’ennui qui devrait aussi permettre de se rendre compte que l’on peut vivre avec moins :
« C’est l’une de ses grandes vertus, en effet. On va réaliser que le vide, le silence, le fait de ne rien prévoir, n’est pas mortel. Mieux encore, que le renoncement, le dépouillement, a du bon. […] Ne vous inquiétez pas, les gens se mettent la pression au début, rangent tous leurs placards, font du tri, se mettent à lire Proust, mais ça ne peut pas tenir sur la durée. À partir de maintenant, nous allons entrer dans une phase de lâcher-prise et de renoncement. Certains en sortiront peut-être des œuvres de génie [qu’ils écriront comme les invite D’Ormesson] d’autres non. L’important, c’est la transformation collective que nous allons observer à l’arrivée. Mais en attendant, il faut traverser ! »
Un autre article du Point revient sur ce rejet de l’occupation à tout prix : <Michel Richard – Arrêtez avec vos conseils de lecture, de musique ou de visite !>.
Michel Richard écrit : « Nous croulons sous leurs propositions pour occuper notre vie recluse. Ils nous gavent et ne comprennent pas que le temps nous manque. »
Nous avons compris : Ennuyons nous !
<1383>
-
Lundi 30 mars 2020
« Il est urgent d’enquêter sur l’origine animale de l’épidémie de Covid-19 »Professeur Didier SicardDidier Sicard est un vieux professeur de médecine français. Il a 82 ans. Il a été chef de service de médecine interne à l’hôpital Cochin. Didier Sicard est aussi un spécialiste des maladies infectieuses, il a notamment travaillé longtemps sur le VIH. Il a également écrit de nombreux livres et a beaucoup réfléchit à l’éthique. Il a été le président du Comité consultatif national d’éthique de 1999 à 2008.
Il s’est aussi beaucoup impliqué dans la création de l’institut Pasteur au Laos.
France Culture et plus précisément la journaliste Tara Schlegel l’a longuement interrogé sur la pandémie actuelle. Avec le recul que lui donne son expérience et sa sagesse, il a fait des réponses qui m’ont interpelé et intéressé.
 Je vous conseille de lire ce long article (plus long que mon mot du jour de jeudi)
Je vous conseille de lire ce long article (plus long que mon mot du jour de jeudi)
Vous trouverez cet entretien derrière ce lien : < Il est urgent d’enquêter sur l’origine animale de l’épidémie de Covid-19>
J’en souligne certains points.
D’abord pour lui, si on veut avancer dans le domaine de la lutte contre les coronavirus, car nous serons touchés par d’autres virus de ce type, il faut réaliser des recherches fondamentales sur l’origine animale de ces virus. Or ce type de recherche n’est pas très valorisé et n’intéresse pas les laboratoires :
« Le point de départ de cette pandémie, c’est un marché ouvert de Wuhan dans lequel s’accumulent des animaux sauvages, serpents, chauves-souris, pangolins, conservés dans des caisses en osier. En Chine, ces animaux sont achetés pour la fête du Rat. Ils coûtent assez cher et ce sont des aliments de choix. Sur ce marché, ils sont touchés par les vendeurs, dépecés, alors qu’ils sont maculés d’urine et que les tiques et les moustiques font une sorte de nuage autour de ces pauvres animaux, par milliers. Ces conditions ont fait que quelques animaux infectés ont forcément infecté d’autres animaux en quelques jours. On peut faire l’hypothèse qu’un vendeur s’est blessé ou a touché des urines contaminantes avant de porter la main à son visage. Et c’est parti !
Ce qui me frappe toujours, c’est l’indifférence au point de départ. Comme si la société ne s’intéressait qu’au point d’arrivée : le vaccin, les traitements, la réanimation. Mais pour que cela ne recommence pas, il faudrait considérer que le point de départ est vital. Or c’est impressionnant de voir à quel point on le néglige. L’indifférence aux marchés d’animaux sauvages dans le monde est dramatique. On dit que ces marchés rapportent autant d’argent que le marché de la drogue. Au Mexique, il y a un tel trafic que les douaniers retrouvent même des pangolins dans des valises […] Les animaux sont effectivement à l’origine de la plupart des crises épidémiques depuis toujours : le VIH, les grippes aviaires type H5N1, Ebola. Ces maladies virales viennent toujours d’un réservoir de virus animal. Et on ne s’y intéresse pratiquement pas. »
Pour illustrer son propos, il donne l’exemple de la peste et des rats :
« La peste reste un exemple passionnant. Le réservoir de la peste, ce sont les rats.
Il y a des populations de rats qui sont très résistantes et qui transmettent le bacille de la peste, mais s’en fichent complètement. Et puis, il y a des populations de rats très sensibles. Il suffit qu’un jour, quelques individus de la population de rats sensible rencontrent la population de rats qui est résistante pour qu’ils se contaminent. Les rats sensibles meurent. A ce moment-là, les puces qui se nourrissent du sang des rats, désespérées de ne plus avoir de rats vivants, vont se mettre à piquer les hommes. Reconstituer ce tout début de la chaîne de transmission permet d’agir. Dans les endroits où la peste sévit encore, en Californie, à Madagascar, en Iran ou en Chine, lorsque l’on constate que quelques rats se mettent à mourir, c’est exactement le moment où il faut intervenir : c’est extrêmement dangereux car c’est le moment où les puces vont se mettre à vouloir piquer les humains. Dans les régions pesteuses, lorsque l’on voit des centaines de rats morts, c’est une véritable bombe.
Heureusement, la peste est une maladie du passé. Il doit y avoir encore 4 000 ou 5 000 cas de peste dans le monde. Ce n’est pas considérable et puis les antibiotiques sont efficaces. Mais c’est un exemple, pour montrer que l’origine animale est fondamentale et toujours difficile à appréhender. Elle est néanmoins essentielle pour la compréhension et permet de mettre en place des politiques de prévention. »
Et il revient alors au sujet du coronavirus et au besoin d’étudier les chauves-souris :
« C’est exactement comme le travail qui reste à faire sur les chauves-souris. Elles sont elles-mêmes porteuses d’une trentaine de coronavirus ! Il faut que l’on mène des travaux sur ces animaux. Evidemment, ce n’est pas très facile : aller dans des grottes, bien protégé, prendre des vipères, des pangolins, des fourmis, regarder les virus qu’ils hébergent, ce sont des travaux ingrats et souvent méprisés par les laboratoires. Les chercheurs disent : ‘Nous préférons travailler dans le laboratoire de biologie moléculaire avec nos cagoules de cosmonautes. Aller dans la jungle, ramener des moustiques, c’est dangereux. Pourtant, ce sont de très loin les pistes essentielles.
Par ailleurs, on sait que ces épidémies vont recommencer dans les années à venir de façon répétée si on n’interdit pas définitivement le trafic d’animaux sauvages. Cela devrait être criminalisé comme une vente de cocaïne à l’air libre. Il faudrait punir ce crime de prison. Je pense aussi à ces élevages de poulet ou de porc en batterie que l’on trouve en Chine. Ils donnent chaque année de nouvelles crises grippales à partir de virus d’origine aviaire. Rassembler comme cela des animaux, ce n’est pas sérieux.
C’est comme si l’art vétérinaire et l’art médical humain n’avaient aucun rapport. L’origine de l’épidémie devrait être l’objet d’une mobilisation internationale majeure. »
Il donne par la suite différentes pistes qui peuvent expliquer comment le coronavirus passe de la chauve-souris qui le plus souvent le supporte très bien à l’homme qui lui souvent le supporte très mal. Mais je vous laisse lire cela sur le site de France Culture.
Je m’attarderai sur l’expérience qu’il a vécu au Laos et du constat de racine écologique qu’il en tire
« Ce qui m’a frappé au Laos, où je vais souvent, c’est que la forêt primaire est en train de régresser parce que les Chinois y construisent des gares et des trains. Ces trains, qui traversent la jungle sans aucune précaution sanitaire, peuvent devenir le vecteur de maladies parasitaires ou virales et les transporter à travers la Chine, le Laos, la Thaïlande, la Malaisie et même Singapour. La route de la soie, que les chinois sont en train d’achever, deviendra peut-être aussi la route de propagation de graves maladies.
Sur place, les grottes sont de plus en plus accessibles. Les humains ont donc tendance à s’approcher des lieux d’habitation des chauves-souris, qui sont de surcroît des aliments très recherchés. Les hommes construisent aussi désormais des parcs d’arbres à fruit tout près de ces grottes parce qu’il n’y a plus d’arbres en raison de la déforestation. Les habitants ont l’impression qu’ils peuvent gagner des territoires, comme en Amazonie. Et ils construisent donc des zones agricoles toutes proches de zones de réservoir de virus extrêmement dangereuses. »
 Et puis il met l’accent sur le manque de clairvoyance et de compréhension des autorités françaises par rapport aux vrais dangers qui nous guettent :
Et puis il met l’accent sur le manque de clairvoyance et de compréhension des autorités françaises par rapport aux vrais dangers qui nous guettent :
« Quand le ministère des Affaires étrangères français retire le poste de virologue de cet Institut Pasteur qui est à quelques centaines de kilomètres de la frontière chinoise, on est atterré. Cela s’est passé en novembre 2019. Nous allons essayer de récupérer ce poste, mais c’est quand même effrayant de se dire qu’aux portes même de là où les maladies infectieuses virales viennent, on a de la peine à mettre tous les efforts. L’Institut Pasteur du Laos est soutenu très modérément par la France, il est soutenu par les Japonais, les Américains, les Luxembourgeois. La France y contribue, mais elle n’en fait pas un outil majeur de recherche.
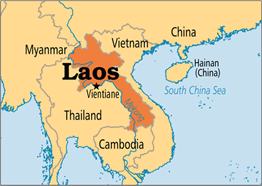 Sa mission est de former des chercheurs locaux. De faire des études épidémiologiques sur les virus existants le chikungunya, la dengue et maintenant le coronavirus. D’être un lieu d’études scientifiques biologiques de haut niveau dans un territoire lointain, tropical, mais avec un laboratoire de haute sécurité. D’être au plus près de là où se passent les épidémies et d’avoir des laboratoires à la hauteur. C’est très difficile pour les pays relativement pauvres d’avoir un équipement scientifique de haut niveau. Le réseau des Instituts Pasteurs – qui existent dans plusieurs pays – est une structure que le monde nous envie. Mais des instituts comme celui du Laos ont besoin d’être aidé beaucoup plus qu’il ne l’est actuellement. Ces laboratoires ont du mal à boucler leur budget et ils ont aussi de la peine à recruter des chercheurs. La plupart d’entre eux préfèrent être dans leur laboratoire à l’Institut Pasteur à Paris ou dans un laboratoire Sanofi ou chez Merieux, mais se transformer en explorateur dans la jungle, il n’y a pas beaucoup de gens qui font cela. Or c’est ce que faisait Louis Pasteur, il allait voir les paysans dans les vignes, il allait voir les bergers et leurs moutons. Il sortait de son laboratoire. Tout comme Alexandre Yersin qui était sur le terrain, au Vietnam, quand il a découvert le bacille de la peste. »
Sa mission est de former des chercheurs locaux. De faire des études épidémiologiques sur les virus existants le chikungunya, la dengue et maintenant le coronavirus. D’être un lieu d’études scientifiques biologiques de haut niveau dans un territoire lointain, tropical, mais avec un laboratoire de haute sécurité. D’être au plus près de là où se passent les épidémies et d’avoir des laboratoires à la hauteur. C’est très difficile pour les pays relativement pauvres d’avoir un équipement scientifique de haut niveau. Le réseau des Instituts Pasteurs – qui existent dans plusieurs pays – est une structure que le monde nous envie. Mais des instituts comme celui du Laos ont besoin d’être aidé beaucoup plus qu’il ne l’est actuellement. Ces laboratoires ont du mal à boucler leur budget et ils ont aussi de la peine à recruter des chercheurs. La plupart d’entre eux préfèrent être dans leur laboratoire à l’Institut Pasteur à Paris ou dans un laboratoire Sanofi ou chez Merieux, mais se transformer en explorateur dans la jungle, il n’y a pas beaucoup de gens qui font cela. Or c’est ce que faisait Louis Pasteur, il allait voir les paysans dans les vignes, il allait voir les bergers et leurs moutons. Il sortait de son laboratoire. Tout comme Alexandre Yersin qui était sur le terrain, au Vietnam, quand il a découvert le bacille de la peste. »
Il en appelle donc à retrouver les méthodes que Louis Pasteur avait mis en œuvre pour développer tous les médicaments et vaccins qui ont permis à l’humanité de faire des avancées majeures.
Il parle aussi du comportement des gens lors de cette pandémie surtout au début et sur l’obligation de penser à l’ensemble de la société et pas seulement en terme individuel.
« Il faut que chaque Français se dise : je fais tout pour que les autres ne puissent rien me reprocher. Nous avons besoin d’une attitude où l’on cherche le regard de l’autre avant son propre regard. Cela seul sera porteur d’efficacité. »
Il donne par exemple ces deux cas :
« L’épidémie est passée par des gens qui sont revenus de Chine ou d’Italie. Je connais l’exemple d’une femme italienne qui s’est rendue en Argentine. Elle a participé à un mariage et embrassé tout le monde. Cette femme a contaminé 56 personnes ! L’irresponsabilité en période d’épidémie fait d’immenses dégâts. Il faut au contraire respecter à la lettre les mesures barrières. Comme attendre, par exemple, devant le supermarché avant d’entrer si on voit qu’il y a du monde. »
Et puis il parle de l’hôpital :
« La souffrance du corps hospitalier, je la vois depuis dix ou quinze ans. Le nombre de mes collègues qui m’ont dit, tu as tellement de chance d’être à la retraite ! Nous souffrons, c’est épouvantable, l’hôpital est devenu une entreprise. Et je suis tout à fait d’accord avec leur discours : l’hôpital a été martyrisé. Avec des décisions purement économiques qui ont fait fi de l’intérêt des malades et des médecins.
Il faut mesurer le nombre de médecins qui sont partis en retraite anticipée en expliquant que leur métier n’avait plus d’intérêt et qu’ils avaient l’impression de passer leur temps à remplir des fiches et des cases. Il y a eu un vrai saccage de l’hôpital public depuis une décennie. Le dernier ministre de la Santé qui avait encore vraiment conscience de son rôle et qui respectait le personnel de santé, c’était Xavier Bertrand. Après, cela a été la catastrophe. »
Selon lui, cette casse du système hospitalier n’a pas trop de répercussion sur cette crise sanitaire [à l’exception cependant du manque de lit et de soignants selon moi] parce qu’on voit une inversion de l’autorité des administratifs et des médecins pour lutter contre cette pandémie?
« Toutes les mesures qui rendaient l’hôpital non fonctionnel ont temporairement disparu. Les administrateurs sont terrifiés dans leurs bureaux et ne font plus rien. Ce sont les médecins qui font tout. Ils ont retrouvé la totalité de leur pouvoir. Il y a pour eux un certain bonheur à retrouver le métier qu’ils ont toujours voulu faire. L’administration a plié bagage, ou plus exactement elle est aux ordres. Le rapport de force s’est renversé : il y a un an, les médecins étaient aux ordres de l’administration; à présent, c’est l’administration qui est aux ordres des médecins. C’est un phénomène très intéressant. Les médecins eux-mêmes ne sont plus entravés par la contrainte de remplir leurs lits avec des malades qui rapportent de l’argent, ce qui était le principe jusqu’alors. Maintenant, ils répondent à leur cœur de métier. A ce qui est la lutte contre la mort. Au fond, ils retrouvent l’ADN profond de leur métier.
C’est presque un paradoxe : il y a moins de détresse dans le corps médical actuellement en situation d’activité maximale, qu’il n’y avait de détresse il y a six mois quand ils étaient désespérés et déprimés car ils estimaient que leur métier avait perdu son sens. »
Et il donne un exemple dans l’hôpital public où l’instinct de rentabilité trahit la vocation de l’hôpital
« Je ne donnerai pas le nom de l’hôpital mais je connais une femme chirurgien spécialiste des grands brûlés. A l’hôpital, son service a fermé et elle n’avait plus de poste. Elle souhaitait néanmoins continuer à travailler avec des enfants victimes de brûlures. Or son service d’enfants brûlés a été transformé en un service de chirurgie plastique de la fesse et du sein. Parce que cela rapporte beaucoup d’argent. Mais elle me dit toujours que s’il y avait un incendie dans une école avec quarante ou cinquante enfants brûlés, on n’aurait plus la capacité de les accueillir parce qu’on considère que la brûlure n’est pas assez rentable et qu’il vaut mieux s’intéresser à la chirurgie des stars. Cette vision économique de la médecine, qui s’est introduite depuis dix ans, est une catastrophe absolue. [Il s’agit d’un hôpital public…] que dans le public, on détruise une activité qui n’est pas rentable – car les brûlures cela coûte effectivement très cher et rapporte très peu et il n’y a pas d’activité privé capable de les prendre en charge – qu’on écarte cela au profit d’activités rentables ce n’est pas normal. Au fond, le public était angoissé à l’idée qu’il lui fallait investir énormément dans des équipements haut de gamme pour être à la hauteur du privé. Or le public n’aura jamais autant d’argent que le privé et n’arrivera jamais à suivre. Et à force de dépenser de l’argent pour des secteurs ultra pointus, on finit par négliger l’accueil des personnes les plus vulnérables, […] 90% des médecins en ont été conscients et cela a été pour eux une souffrance terrible. Tout comme pour les infirmières et les autres personnels soignants, de faire un métier qui était relié à l’argent.
Il reste optimiste quant à l’avenir en espérant que les politiques sauront se souvenir de cette crise pour faire évoluer les ressources et l’organisation de l’hôpital.
Je redonne le lien vers cette émission : < Il est urgent d’enquêter sur l’origine animale de l’épidémie de Covid-19>
<1382>
-
Dimanche 29 mars 2020
« Je te demande pardon. »Ariadne AscarideMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Augustin Trapenard, sur France Inter, chaque matin à neuf heures moins 5, lit une lettre que lui a envoyé un écrivain ou un artiste.
Le sujet est libre, le destinataire choisi par l’auteur.
Cette chronique a pour nom <Lettres d’intérieur>
C’est un moment de partage.
Le 26 mars, il a lu une lettre d’Ariadne Ascaride, l’actrice née à Marseille et habitant à Montreuil sous-bois, ville chère à mon cœur.
« Montreuil, le 26 mars 2020
Bonjour « beau gosse »,
Je décide de t’appeler « Beau gosse ». Je ne te connais pas. Je t’ai aperçu l’autre jour alors que, masquée, gantée, lunettée, j’allais faire des courses au pas de charge, terrifiée, dans une grande surface proche de ma maison. Sur mon chemin, je dois passer devant un terrain de foot qui dépend de la cité dans laquelle tu habites et que je peux voir de ma maison particulière pleine de pièces avec un jardin.
Je suis abasourdie de vivre une réalité qui me semblait appartenir à la science-fiction.
À mon réveil chaque jour je prends ma température, j’aère ma maison pendant des heures au risque de tomber malade, paradoxe infernal et ridicule. La peau de mes mains ressemble à un vieux parchemin et commence à peler, je les lave avec force et savon de Marseille toutes les demie heures. Si je déglutis et que cela provoque une légère toux, mon sang se glace et je dois faire un effort sur moi-même pour ne pas appeler mon médecin. Je n’ai d’ailleurs pas fui en province pour rester proche de lui. Je deviens folle !
Sortir me demande une préparation mentale intense, digne d’une sportive de haut niveau, car pour moi une fois dehors tout n’est que danger ! »
Ariadne Ascaride avait été le sujet du mot du jour du 12 novembre 2019, en raison de son discours profond et humaniste qu’elle a tenu à la Mostra de Venise après avoir reçu le prix de la meilleure interprétation féminine pour « Gloria Mundi » de Robert Guédiguian : « J’ai une richesse incroyable, celle d’être la fille d’étrangers et en même temps d’être française. »
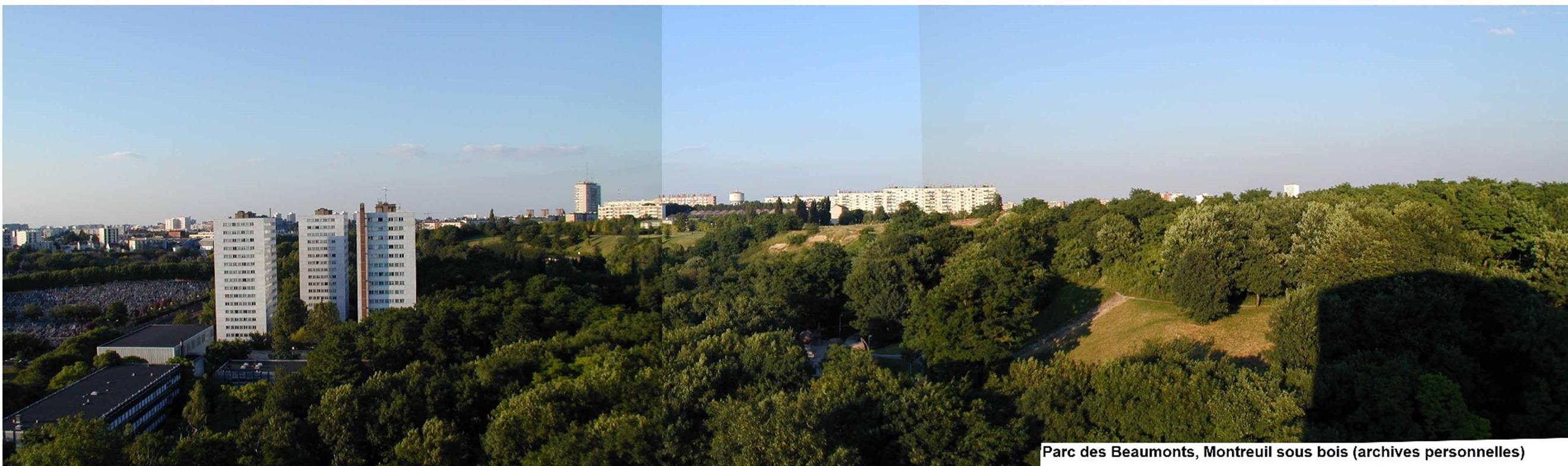 Dans cette lettre de Montreuil, elle avoue sa peur devant la maladie et son privilège de disposer de tous les éléments de confort pour vivre le moins difficilement son confinement.
Dans cette lettre de Montreuil, elle avoue sa peur devant la maladie et son privilège de disposer de tous les éléments de confort pour vivre le moins difficilement son confinement.
Et puis elle voit un jeune qui joue avec ses copains au football sur des pelouses de Montreuil.
Le bourgeois fort de ses certitudes n’aurait pas de mots assez durs pour condamner l’attitude « irresponsable » de ces jeunes « écervelés ».
Mais ce n’est pas l’angle de vue, de réflexion et d’analyse d’Ariadne Ascaride :
« Et c’est dans cet angoissant état d’esprit, que je t’ai vu, loin, sur ce terrain de foot, insouciant, jouant avec tes copains, vous touchant, vous tapant dans les mains comme des chevaliers invincibles protégés par le bouclier de la jeunesse.
Vous étiez éclatants de sourire, d’arrogance, de vie mais peut-être aussi porteurs de malheurs inconscients.
Si vous étiez dehors, c’est qu’il n’est pas aisé d’être je ne sais combien dans un appartement toujours trop étroit, c’est invivable et parfois violent.
Vos parents travaillent, eux, toujours, à faire le ménage dans des hôpitaux sans grande protection ou à livrer toutes sortes de denrées et de colis que nous récupérerons prudemment avec nos mains gantées après qu’ils ont été posés devant nos portes fermées. Prudence oblige.
[…] je suis née dans un monde similaire au tien je n’ai eu de cesse de l’avoir toujours très présent dans mon cœur et ma mémoire, et je n’ai eu de cesse de le célébrer et d’essayer de faire changer les choses. »
Au terme de cette analyse de la situation, elle demande pardon à ce jeune.
Pardon, parce que quoiqu’elle ait tenté au long de sa vie, elle n’est pas parvenue à ce que ce jeune puisse avoir un autre destin dans lequel, intégré à la société, dans des conditions de vie digne, il puisse comprendre et se soumettre aux injonctions de raison et de santé.
Elle souligne ainsi à quel point la crise constitue aussi un révélateur de l’inégalité sociale.
« Aujourd’hui je te demande pardon, à toi porteur sain certainement qui risque d’infecter l’un des tiens.
Je te demande pardon de ne pas avoir été assez convaincante, assez entreprenante, pour que la société dans laquelle tu vis soit plus équitable et te donne le droit de penser que tu en fais partie intégrante. Tout ce que je dis aujourd’hui, tu ne l’entendras pas, car tu n’écoutes pas cette radio.
Je voudrais juste que tu continues à exister, que ta mère, ton père, tes grands-parents continuent à exister, à rire et non pleurer.
Je ne sais pas comment te parler pour que tu m’entendes : je suis juste une pauvre folle masquée, gantée, lunettée, qui passe non loin de toi et que tu regardes avec un petit sourire ironique car tu n’es pas méchant, tu es simplement un adolescent qui n’a pas eu la chance de mes enfants. »
Ariane Ascaride
C’est une leçon d’humilité.
Une leçon d’humanité.
Une leçon de vie.
Un autre regard.
<1381>
-
Samedi 28 mars 2020
« Eux, ils soignent. »Narcisse, slameur suisseMot de jour spécial pendant la période de confinement suite à la pandémie du COVID-19
Mon ami Jean-François de Dijon m’avait dit : pendant cette période de confinement, il serait bien que tu écrives aussi un mot du jour le weekend. Il est vrai que la différence entre le weekend avec le reste de la semaine devient de moins en moins évidente.
Encore faut-il avoir matière pour écrire.
Alors ce matin, Gérald m’a envoyé une petite vidéo d’un artiste qui a fait un slam en l’honneur des soignants. Une véritable pépite.
Depuis elle circule beaucoup sur les réseaux sociaux, mais moi je l’ai découverte grâce à Gérald.
La puissance poétique de certains slameurs, elle, ce sont mes deux enfants qui me l’avaient fait découvrir.
L’artiste qui a fait cette poésie en slam est un suisse
Il a pour nom de scène : Narcisse, mais son nom de ville est Jean-Damien Humair. Il est né dans le Jura Suisse le 14 juin 1967.
Il a commencé le slam en 2006 à Lausanne nous apprend Wikipedia.
Vous trouverez son œuvre derrière ce lien : <Eux, ils soignent>
Et voici son texte
Tandis que nous chantons
Certains soirs aux balcons
Et que ceux qui comme moi
Ne savent pas chanter
Essaient aussi parfois
D’enchanter sans chanter
Pour que d’autres nous rejoignent
Eux ils soignent.
Et tandis qu’on dort tant
Qu’on n’en dort même plus
Qu’on lit pour passer l’temps
La Peste de Camus
Tandis que nos enfants
Coincés à la maison
Nous font prendre fermement
La bonne résolution
Qu’à la fin du printemps
On fera sans façon
A tous les enseignants
Un bisou sur le front
Parce que l’éducation
Par papa et maman
C’est une sacrée montagne
Eux ils soignent
Tandis que même passer
Dans des rues sans passants
Fait partie du passé
Tandis qu’on n’a pas su
Comment éviter ça
Ni comment s’en passer
Qu’on n’a ps vue les signes
Eux ils soignent
Et tandit qu’on se plaint
Des lacunes de Pékin
De la bourse en piqué
Des Coop sans PQ
Des journées sans copains
Sans sorties en campagne
Sans soirées au champagne
Eux ils soignent.
Tandis que la nature
Prend enfin du bon temps
Un printemps dans le printemps
Sans avions sans voitures
Tandis qu’on se confine
Et qu’on se déconfit
Quand la vieille voisine
S’égosille et confie
Qu’il y a des cons finis
Qui ignorent les consignes
Eux ils soignent
Ils soignent
Ils suent
Ils saignent
Ils souffrent
Subissent
Suffoquent
Supportent
Mais sans cesse ils soignent
Et grâce à eux au final
On gagne
<1380>
-
Vendredi 27 mars 2020
« La mort n’est point notre issue »François ChengCette période que nous vivons est un moment qui nous confronte à la mort.
Hier, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, [drôle de nom pour un fonctionnaire qui chaque soir égrène le nombre de malades, de personnes en réanimation et….] a déclaré que le nombre de morts du coronavirus lors des 24 dernières heures étaient de 365, soit une hausse de 58% par rapport au jour précédent.
Et nous savons que ce chiffre est sous-évalué, puisque les morts en EHPAD ou à domicile ne sont pas identifiés en tant que mort de cette pandémie.
La mort est là.
Mais le désir de vie est plus fort.
François Cheng, est né en 1929 en Chine.
Il est venu en France avec ses parents en 1948.
Mais, alors que sa famille émigre aux États-Unis dès 1949, lui à 20 ans décide de s’installer définitivement en France, motivé par sa passion pour la culture française.
Depuis il écrit, il écrit en français et il traduit les textes de poésie française en chinois.
En 1971, il a été naturalisé français.
Et en 2002 il est devenu membre de l’académie française, juste retour de son amour de notre langue et du rayonnement qu’il lui a apporté dans l’empire du milieu.
Nous l’avons vu plusieurs fois à la Grande Librairie, par exemple dans celle du <29 Janvier 2020>
Ceci a poussé Annie a acheté plusieurs de ses livres et parmi ceux-là « Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie »
Et hier soir quand je me suis posé la question, qu’est-ce que je vais bien pouvoir partager dans mon exercice quotidien d’écriture, j’ai pris ce livre.
Je l’ai feuilleté et je me suis arrêté page 139 :
La mort n’est point notre issue,
Car plus grand que nous
Est notre désir, lequel rejoint
Celui du Commencement,
Désir de Vie.
La mort n’est point notre issue,
Mais elle rend unique tout d’ici :
Ces rosées qui ouvrent les fleurs du jour,
Ce coup de soleil qui sublime le paysage,
Cette fulgurance d’un regard croisé,
Et la flamboyance d’un automne tardif,
Ce parfum qui nous assaille et qui passe, insaisi,
Ces murmures qui ressuscitent les mots natifs,
Ces heures irradiées de vivats, d’alléluias,
Ces heures envahies de silence, d’absence,
Cette soif qui jamais ne sera étanchée,
Et la faim qui n’a pour terme que l’infini…
Fidèle compagne, la mort nous contraint
À creuser sans cesse en nous
Pour y loger songe et mémoire,
À toujours creuser en nous
Le tunnel qui mène à l’air libre.
Elle n’est point notre issue.
Posant la limite,
Elle nous signifie l’extrême
Exigence de la Vie,
Celle qui donne, élève,
Déborde et dépasse.
François Cheng
Cinq méditations sur la mort, Albin Michel, 2013
Cinquième méditation
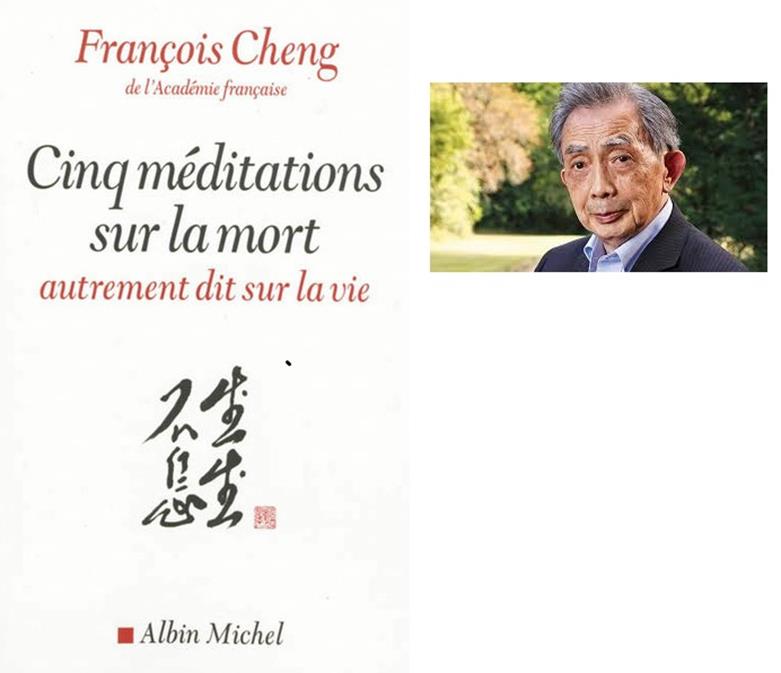
<1379>
-
Jeudi 26 mars 2020
«Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou.»Friedrich Nietzsche« Réfléchir au temps du coronavirus », pour s’inspirer d’un titre de Gabriel García Márquez, n’est pas chose simple.
Mais réfléchir n’est probablement jamais simple.
Ce qui est simple c’est de trouver un bouc émissaire et de lui faire porter tous les péchés, toute la faute qui explique que nous sommes dans cette situation.
Trouver un bouc émissaire ou un gourou ou une certitude à laquelle nous pourrons croire comme s’il s’agissait de la vérité.
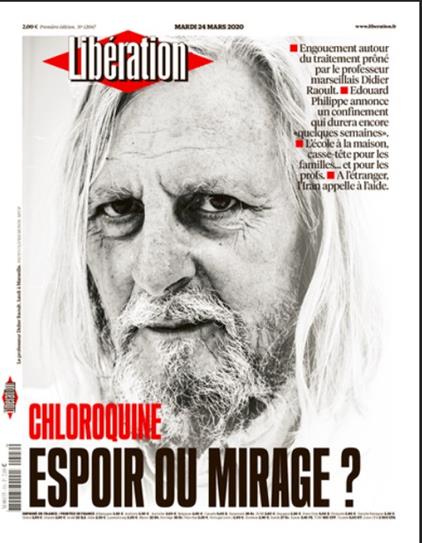 Dans cette querelle qui déchire la communauté nationale, la France plus que toute autre nation, sur le médicament que le Professeur Didier Raoult, président de L’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (« IHU Méditerranée Infection » préconise pour tous les malades du COVID-19, que peut dire un homme qui n’a pas la connaissance technique et qui voit et entend les spécialistes s’écharper ?
Dans cette querelle qui déchire la communauté nationale, la France plus que toute autre nation, sur le médicament que le Professeur Didier Raoult, président de L’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (« IHU Méditerranée Infection » préconise pour tous les malades du COVID-19, que peut dire un homme qui n’a pas la connaissance technique et qui voit et entend les spécialistes s’écharper ?
Une solution prudente est de se taire et de ne pas s’en mêler, en attendant que la situation s’éclaircisse.
Force est de constater que cette position de sagesse est très peu répandue.
Il me semble que le plus grand nombre des quidams, qui comme moi n’y connaissent rien, prennent la partie du professeur Didier Raoult et affirment qu’il faut donner « l’hydrocychloroquine » à ceux qui sont atteints de la maladie, certains affirment même qu’il faut le donner de matière préventive. Pour un grand nombre de ces partisans, les autres, ceux qui ne pensent pas comme eux : sont des incompétents, des crétins, des irresponsables et peut être même des assassins en puissance.
Il y a aussi des médecins qui soutiennent la solution du professeur marseillais.
Le professeur Raoult est un spécialiste de maladies infectieuses de renommée internationale. Selon les critères des organismes internationaux qui classent les spécialistes, il est le meilleur en France.
IC’est l’argument avancé par tous ceux qui le soutiennent. Il a raison parce que c’est lui !
L’argument est fort : il est spécialiste dans ce domaine, c’est incontestable et donc il a raison.
Dans mon appartement de confiné, moi qui ne suis pas spécialiste, qui n’y connait rien, il ne me viendrait pas à l’idée de contester ce que dit le professeur Didier Raoult.
Mais il y en a qui conteste.
Les partisans « du protocole Raoult », ceux qui sont les plus virulents disent : « Mais enfin ce n’est pas Madame Michu qui donne son avis, c’est le meilleur spécialiste ! »
Dans mon appartement de confiné, j’essaye de comprendre si ceux qui contestent sont des « Madame Michu ».
Si tel est le cas, leur avis n’a aucune valeur nous en revenons à la position indiscutable du professeur Raoult.
Mais l’homme simple que je suis et qui en toute humilité suit le bon bout de sa raison comprend que ceux qui contestent ne sont pas des « madame Michu » mais sont d’autres spécialistes, certes moins bien classées par les organismes de classement pour la raison simple qu’ils ont moins publié d’articles scientifiques dans les revues spécialisées. Est-ce que pour autant, ils ne sont pas crédibles ?
A ce stade, je vais faire un pas de côté et citer une émission de France Culture consacrée à la philosophie.
Parce que si on veut se lancer dans ce type de querelle, il faut s’appuyer sur des bases solides, des fondamentaux.
Parce qu’il y a la croyance et la science. La croyance a des certitudes, la science a des doutes.
Et pour trouver l’exergue de ce mot du jour, je pense que cette émission du 9 septembre 2019 <Les Chemins de la Philosophie> d’Adèle Van Reeth consacrée au philosophe Friedrich Nietzsche.
Pas plus que je ne suis spécialiste d’infectiologie, je ne suis pas spécialiste de ce philosophe allemand.
Mais quand ce dernier explique que ce n’est pas l’hésitation, l’incertitude, l’indécision, qui conduit à la folie, c’est de trop savoir, ou de trop croire qu’on sait, d’être sûr de savoir au point de ne plus douter du tout…cela m’interpelle.
L’émission cite son livre de « Gai savoir »
« Nietzsche parle des « dangereux peut-être » qui constituent le moteur de la recherche philosophique. Précisément parce que l’incertitude ou l’absence de réponse rend fou l’animal humain. Il faut combler cette ignorance, et ce que dit Nietzsche, c’est que la connaissance est une conséquence de la protection : le premier moteur de la connaissance c’est la crainte (de ne pas savoir, du lendemain…). On veut connaître parce qu’on a peur. Nietzsche travaille beaucoup sur la notion de crainte. Il dit qu’elle est le premier moteur de la connaissance, et que le deuxième est celui de la volonté de maîtrise. Connaître c’est s’approprier le monde de telle sorte que ce soit un rapport viable au milieu qu’est le monde. Cette viabilité passe par des falsifications qui font que notre point de vue sur le monde est toujours utilitariste, jusqu’à la logique, jusqu’aux sciences. Il y va de la survie psychique, l’homme est un animal inquiet de son destin, et la religion est l’exemple même d’une vérité destinée à apaiser la crainte. »
Et finalement, il dit cette phrase que je choisis pour exergue :
« Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou. »
La folie dans cette phrase signifie la perte de la raison, de ce qui est raisonnable, de ce que le raisonnement nous permet de comprendre à travers la réflexion et l’argumentation.
Alors Edgar Morin a twitté, le 23 mars, une question restant en suspens :
« Les précurseurs ont d’abord toujours tort. Les hautes autorités répugnent à la découverte contraire aux théories établies. Pasteur, Darwin, Watson-Crick (code génétique), Montagner (sida) ont connu le refus. Aujourd’hui docteur Raoult ? »
Et ce mercredi soir il a twitté :
« Ce qui est frappant autour de la chloroquine, c’est la religiosité du débat. Raoult, grand scientifique, est décrit comme une espèce de gourou faisant miroiter des «espoirs impossibles» et on décrit la «croyance» en ce médicament comme attente du «remède-miracle». »
Le premier tweet me pose problème, le second qui constate la religiosité du débat me parait plus convenir à ce qui se passe.
Avant de continuer je souhaiterai d’abord citer toutes les sources qui me conduisent à la réflexion qui suit.
<L’intervention du Alexandre Bleibtreu>, infectiologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris
Trois pages de France Inter
- <Didier Raoult chercheur disruptif>
- <Essais cliniques, enthousiasme de Trump, étude chinoise>
- <Le téléphone-sonne 24 mars 2020>
Deux articles de Libération
- <Covid-19 la chloroquine a-t-elle été utilisée pour soigner les malades en Chine>
- <Antiviral-antirivaux>
Un article de l’Obs :
Deux articles du Monde
- <Didier Raoult le trublion du covid 19>
- <Françoise Barré-Sinoussi : « Ne donnons pas de faux espoirs, c’est une question d’éthique »>
J’ai écouté plusieurs interventions du Professeur Raoult et aussi des interventions des médecins et virologues qui n’étaient pas d’accord, c’est-à-dire qui n’était pas d’accord de prétendre que l’essai clinique qu’a réalisé l’équipe du Professeur Raoult prouve que l’hydroxychloroquine guérisse le COVID-19.
De mon point de vue, de ce que j’entends d’un côté j’ai un professeur qui du haut de son magistère affirme des certitudes et de l’autre côté des médecins et spécialistes dans le même domaine qui expriment des doutes.
Ma culture scientifique, comme ma réflexion alertent ma vigilance à l’égard de celui qui est sûr de lui et donne plutôt du crédit à ceux qui doutent.
Allons un peu plus au fond.
Le professeur Didier Raoult a mené un essai clinique au sein de l’Institut hospitalo-universitaire de Marseille qu’il dirige, sur 26 patients. Sur ces 26 patients, six n’ont pas pu suivre l’essai jusqu’au bout et au final, les résultats portent donc sur 20 malades âgés de 12 ans et plus, en parallèle d’un groupe témoin constitué avec des patients de Nice, Avignon et Briançon. Six jours après avoir administré de l’hydroxychloroquine à des patients atteints de Covid-19, seulement 25 % d’entre eux étaient encore porteurs du virus, quand 90 % de ceux qui n’avaient pas reçu ce traitement étaient toujours positifs, selon lui. Si on ajoute un antibiotique, de l’azithromycine, alors la charge virale disparaît dans ce même laps de temps.
A l’issue de ce test, le Professeur Raoult a affirmé :
« A partir du moment où l’on a montré qu’un traitement était efficace. Quand vous avez un traitement qui marche contre zéro autre traitement disponible, c’est ce traitement qui devrait devenir la référence. […] « tout le monde » utilisera bientôt la chloroquine »
Sur une autre vidéo postée sur YouTube il prophétise la « fin de partie » du Covid-19 grâce à la chloroquine.
Didier Raoult explique qu’il n’est «pas un magicien», que c’est tout simplement de la science. Il dit, face aux attaques : «Je m’en fous ! Les médecins qui me critiquent ne sont ni dans mon champ ni dans ma catégorie de poids.»
Et cela pose justement question, car l’affirmation que l’essai clinique de Marseille puisse obtenir le label « science » n’est pas établie.
La méthodologie de l’essai a été critiquée, notamment par le biologiste moléculaire Olivier Belli. Sur son blog, il pointe du doigt le faible nombre de patients testés et l’exclusion de certains malades avant la fin de l’étude (« alors que leur cas leur cas suggère clairement un échec du traitement »). Il accuse ainsi le médecin marseillais d’avoir « propagé des graphiques sensationnalistes sur sa ‘découverte’, ne prenant en fait en compte que 4 patients du groupe contrôle et laissant arbitrairement les autres de côté ».
Le Monde affirme qu’un patient traité à l’hydroxychloroquine est mort mais n’a pas été inclus dans l’analyse, pas plus que trois autres dont l’état s’est aggravé et qui ont dû être placés en soins intensifs… et ce alors qu’aucun des patients non traités n’est mort ou n’a été conduit en réanimation.
L’épidémiologiste Philippe Ravaud lui a demandé, dimanche 22 mars, les données brutes de son essai sur l’hydroxychloroquine. Mardi soir, il n’avait toujours rien reçu.
Pourtant Didier Raoult écrivait, en 2015 dans Le Point :
« Pour redonner confiance dans les études scientifiques [il faut] mettre plus systématiquement les données brutes à disposition de tous ».
Une autre spécialiste la Pr Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine, à Paris a déclaré :
« En l’état actuel, les données sur l’hydroxychloroquine ne montrent pas son efficacité quand on applique les standards internationaux. Ça ne veut pas dire que le traitement ne marche pas : il faut qu’on montre qu’il marche »
Le Professeur Raoult affirme que les chinois qui ont utilisé ce médicament ont démontré un impact positif.
Libération a tenté de vérifier cette affirmation et a conclu que la chloroquine a bien été utilisée pour soigner les malades en Chine. Mais l’utilisation ne fut pas générale et les études chinoises déjà publiées sont loin d’être unanimes sur l’intérêt potentiel de la chloroquine. Les premiers essais achevés, de petite envergure, échouent à identifier le moindre effet bénéfique sur l’évolution des malades.
Parallèlement sur France Inter ce mardi, le Dr Philippe Klein, médecin Français basé à Wuhan a exprimé ses doutes sur l’efficacité de la chloroquine.
« Aujourd’hui nous avons près de 15.000 morts sur la planète. Je ne pense pas que les médecins italiens ou chinois soient suffisamment stupides pour avoir laissé de côté une molécule miraculeuse »
Le ministre de la santé, Olivier Véran, qui est médecin et qui sans être spécialiste des virus, maîtrise la démarche scientifique en matière médical a dit :
« Jamais aucun pays au monde n’a accordé une autorisation de traitement sur la base d’une étude comme celle [du professeur Raoult] »
Il a donc été décidé de lancer un essai clinique européen, baptisée Discovery, qui va être conduit avec la rigueur scientifique adéquate pour tester des soins incluant plusieurs molécules dont l’hydroxychloroquine. Elle concernera 3200 patients dont au moins 800 patients français atteints de formes sévères du Covid-19.
Il y a aussi l’OMS. Le 23 mars le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé qu’il devait tenir un discours dans lequel il a affirmé :
«Administrer des médicaments non testés, sans preuves suffisantes [d’efficacité], pourrait susciter de faux espoirs, et même faire plus de mal que de bien en entraînant des pénuries de médicaments essentiels pour traiter d’autres maladies».
Un autre argument avancé par le professeur Raoult, même s’il ne s’y attarde pas, me heurte profondément : il s’appuie sur le fait que Trump est enthousiaste sur ce protocole de soin….
En revanche, le spécialiste, à savoir le patron de la FDA, l’agence fédérale de pharmacovigilance, c’est-à-dire l’autorité américaine qui rend possible la mise sur le marché américain des médicaments a simplement expliqué que l’utilisation de la chloroquine pour soigner le coronavirus n’avait pas été approuvée, et qu’il fallait passer par un test clinique plus large. Il a mis en garde contre le risque de générer « de faux espoirs » au sein de la population
Et encore plus important un spécialiste, au moins du niveau de notoriété du Professeur Raoult : Anthony Fauci, qui dirige l’Institut national américain des maladies infectieuses, a qualifié d’« anecdotiques » les preuves d’une efficacité du Plaquenil (médicament qui contient l’hydroxychloroquine, faute d’« essai clinique contrôlé ».
Comme le professeur Raoult reconnaît quand même l’autorité de ce grand scientifique de 79 ans, il ne le traite pas « d’andouille » comme d’autres mais avance un autre argument :
« Il a dû devenir gâteux ».
Pourtant, notent certains : des chercheurs affiliés à son IHU ont publié, début mars, dans Antiviral Research, une synthèse de littérature indiquant que, jusqu’à présent, les effets encourageant in vitro de la chloroquine et de ses dérivés sur des virus, n’avaient jamais été confirmés in vivo. Et que, dans le cas du chikungunya, la molécule avait même eu des effets paradoxaux, aggravant la maladie. Des réserves dont Didier Raoult ne tient nul compte dans sa parole publique.
Car c’est une autre information que j’ai entendu expliquer par plusieurs « sceptiques » par rapport à ce médicament qui marcherait très bien en laboratoire sur des cellules infectées mais n’aurait pas montré son efficacité quand on l’utilisait sur l’homme pour d’autres infections virales.
Le Monde écrit :
« Au point que certains se demandent comment une telle étude a pu être acceptée pour publication par une revue à comité de lecture. De nombreux chercheurs relèvent un conflit d’intérêts patent : la revue ayant publié l’essai a pour éditeur en chef un collaborateur de Didier Raoult, Jean-Marc Rolain, également cosignataire de l’étude en question, de même que responsable de la « valorisation » de l’IHU Méditerranée Infection. Une situation peu conforme aux standards de la publication scientifique.
C’est là l’un des secrets du système mis en place par Didier Raoult : publier à tout prix. Selon la base de données Scopus, il totalisait, mardi 24 mars, 3062 articles de recherche publiés dans la littérature scientifique. Un chiffre phénoménal : une grande part des chercheurs publient au cours de leur carrière moins d’articles que le professeur marseillais en quelques mois (plus de trente depuis le début de l’année). Ce qui en fait le microbiologiste le plus cité au niveau international — le « champion du monde », aurait-il peut-être dit s’il avait répondu à nos sollicitations avant le bouclage de cet article.
Là encore, le professeur Raoult est son propre et plus redoutable ennemi. Car, dans la communauté savante, l’énormité de tels chiffres ne fait plus guère illusion : « Comment croire qu’un scientifique puisse participer réellement à des recherches débouchant sur quasi une publication par semaine ? », interroge à son propos le biologiste et journaliste Nicolas Chevassus-au-Louis, dans son dernier ouvrage (Malscience. De la fraude dans les labos, Seuil, 2016).»
 Je finirais par l’avis de la virologiste Françoise Barré-Sinoussi qui a eu, en 2008, le prix Nobel de médecine pour sa participation à la découverte du VIH à l’Institut Pasteur en 1983 :
Je finirais par l’avis de la virologiste Françoise Barré-Sinoussi qui a eu, en 2008, le prix Nobel de médecine pour sa participation à la découverte du VIH à l’Institut Pasteur en 1983 :
« Je suis inquiète, comme tout le monde, face à cette épidémie, qui me rappelle en bien des points beaucoup de choses douloureuses des débuts de l’épidémie de VIH-sida. C’est bien que les experts qui ont les mains dans le cambouis s’expriment, dont certains d’ailleurs ont vécu les premières années de l’épidémie de sida. Mais lorsque j’ai vu les dérives de ces derniers jours, je me suis dit que c’était aussi de ma responsabilité de m’exprimer. On entend parfois n’importe quoi, par exemple, parler de bactéries alors qu’il s’agit d’une infection virale.
Je réagis aussi à la vue, ces dernières heures, des files d’attente devant l’Institut hospitalo-universtaire de Marseille pour bénéficier d’un traitement, l’hydroxychloroquine, dont l’efficacité n’a pas été prouvée de façon rigoureuse. Certains peuvent être contaminés et risquent de diffuser le virus. C’est n’importe quoi. J’ai connu ce genre de situation dans les années 1980, ce qui peut semer la confusion auprès du grand public, déjà sidéré par l’ampleur de cette épidémie.
Que pensez-vous de l’hydroxychloroquine (Plaquenil) et des attentes suscitées par ce médicament ?
Pour l’instant, pas grand-chose, j’attends les résultats de l’essai Discovery, conçu dans le cadre du consortium « Reacting », qui vient de démarrer et qui portera sur 3 200 personnes, dont 800 en France. […] De premières analyses fiables devraient être connues dans une quinzaine de jours. Cet essai est fait dans les règles de l’art. Soyons patients.
Vous voulez dire que les résultats annoncés par l’équipe du professeur Didier Raoult ne sont pas fiables ?
Les premiers résultats publiés portent sur un tout petit nombre de personnes, une vingtaine, et l’étude comporte des faiblesses méthodologiques. Il est absolument indispensable que l’essai de ce médicament soit réalisé avec rigueur scientifique, pour avoir une réponse sur son efficacité, et ses éventuels effets secondaires. Il nous faut quelque chose de sérieux. D’autant plus que l’hydroxychloroquine, ce n’est pas du Doliprane, elle peut avoir des effets délétères et comporter des risques de toxicité cardiaque. Il n’est donc pas raisonnable de la proposer à un grand nombre de patients pour l’instant, tant qu’on ne dispose pas de résultats fiables.
Si cela marche, j’en serais très heureuse, et tester des molécules qui existent déjà sur le marché est une approche tout à fait raisonnable. Mais il faut des réponses solides à ces simples questions : est-ce efficace ? Existe-t-il des effets secondaires graves ? […]
Au début des années sida, il y avait des crises d’hystérie et d’angoisse parfois déraisonnées et déraisonnables du grand public, liées, entre autres, à des informations contradictoires, à de la désinformation, que je retrouve là en partie avec cette pandémie. »
Ce mot du jour est donc, pour l’instant, le plus long de tous ceux qui ont été écrits.
Le professeur Didier Raoult est un grand médecin qui a réalisé des avancées considérables dans sa spécialité, c’est un grand chercheur reconnu, il n’y a pas de question là-dessus.
 Mais son essai clinique ne présente pas une rigueur scientifique suffisante. Ses affirmations sur l’efficacité du produit n’appartiennent pas au monde de la science.
Mais son essai clinique ne présente pas une rigueur scientifique suffisante. Ses affirmations sur l’efficacité du produit n’appartiennent pas au monde de la science.
Et même si les essais en cours confirmaient, disons « ses intuitions, » cela n’enlèverait rien au fait que son action pour l’instant dans le cadre de cette pandémie n’appartient pas au domaine de la science.
Certains médecins, en l’absence d’autres médicaments, donnent ce médicament à titre de protocole compassionnel.
Dans mon appartement de confiné, je ne peux émettre aucun avis sur cette démarche. Pour ce que je comprends, c’est très probablement intelligent et pertinent.
Mais dans l’état actuel des connaissances de la science, par rapport à l’ensemble des éléments que j’ai pu entendre et lire, la modestie, la prudence et le doute sont de mise.
Nous ne sommes pas encore en présence de la potion magique de Panoramix dessiné par le génial Uderzo qui vient de décéder, à l’âge de 92 ans, mais pas du COVID-19.
<1378>
- <Didier Raoult chercheur disruptif>
-
Mercredi 25 mars 2020
« Le confinement, un temps pour balayer le superflu »Carlo OssolaJe ne connaissais par Carlo Ossola qui est né en 1946 à Turin et qui est un est un philologue, historien de la littérature et critique littéraire italien. J’apprends qu’il a été nommé en 2000, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Littératures modernes de l’Europe néo-latine » et qu’il l’est toujours.
« Philologue » vient du latin philologus (« lettré ») et du grec ancien philólogos (« qui aime parler, discourir ; savant érudit »), c’est un spécialiste des textes anciens et moins souvent, de textes modernes. Plus précisément la philologie, consiste en l’étude d’une langue et de sa littérature à partir de documents écrits
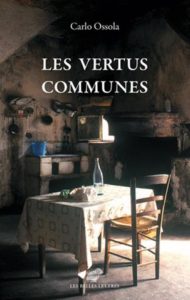
En octobre 2019, il a publié aux éditions des belles lettres un petit livre de 104 pages : « Les Vertus communes»
TELERAMA écrit à propos de ce livre :
« Ce livre redonne vie aux gestes oubliés qui adoucissent le quotidien : contre la violence et la brutalité des rapports humains, une écoute délicate, une manière de parler avec grâce, une bienveillance teintée d’indulgence… De quoi rendre ses lettres de noblesse à la gentillesse, qui a souvent tendance à passer pour un signe de stupidité. »
La table des matières donne la liste de ces vertus communes :
- L’affabilité
- La discrétion
- La bonhomie
- La franchise
- La loyauté
- La gratitude
- La prévenance
- L’urbanité
- La mesure
- La placidité
- La constance
- La générosité
Paré de ces vertus, il me semble plus simple de se faire aimer du plus grand nombre et d’affronter avec sérénité une longue période de confinement avec ses proches.
RFI avait interrogé l’auteur sur son livre lors d’une émission du <27 novembre 2019>
Pour ma part, c’est Claude Askolovitch qui lors de sa <revue de presse du 23 mars 2020> m’a fait découvrir cet homme de culture et de sagesse.
Concrètement Claude Askolovitch a renvoyé vers un article de <La Croix du 23 mars>.
Ce journal chrétien invite chaque jour, un grand témoin pour évoquer ce temps singulier du confinement.
Le titre de cet article :
« Le confinement, un temps pour balayer le superflu »
Carlo Ossola raconte :
« Je suis « confiné » dans mes collines turinoises depuis le 24 février. Ma fille médecin m’avait signalé que l’épidémie était sérieuse, difficile à endiguer et sous-estimée. J’ai donc pris la responsabilité d’annuler, dès le 25, mes cours au Collège de France et de les reporter pour ne pas soumettre mes auditeurs à des risques supplémentaires.
 Cet « isolement collectif » – la formule paradoxale me paraît pourtant exacte – que nous vivons crée un grand silence, bien plus radical que dans le film de Philip Gröning du même nom sur la Grande-Chartreuse. Dans ce film, il y avait une exaltation du silence. Aujourd’hui en Italie, tout est étouffé, comme dans un gouffre de silence où les bruits s’évanouissent. Cette situation crée aussi des comportements sociaux nouveaux : ce week-end, par exemple, d’une fenêtre à l’autre des rues désertes, les Italiens ont sorti leurs instruments de musique et ont animé de notes harmoniques un espace urbain normalement sillonné par la cacophonie exaltée de la vitesse. »
Cet « isolement collectif » – la formule paradoxale me paraît pourtant exacte – que nous vivons crée un grand silence, bien plus radical que dans le film de Philip Gröning du même nom sur la Grande-Chartreuse. Dans ce film, il y avait une exaltation du silence. Aujourd’hui en Italie, tout est étouffé, comme dans un gouffre de silence où les bruits s’évanouissent. Cette situation crée aussi des comportements sociaux nouveaux : ce week-end, par exemple, d’une fenêtre à l’autre des rues désertes, les Italiens ont sorti leurs instruments de musique et ont animé de notes harmoniques un espace urbain normalement sillonné par la cacophonie exaltée de la vitesse. »
Il remarque que cette crise liée à la pandémie remet certaines choses à l’endroit et notamment crée une autre hiérarchie des métiers indispensables à une société :
« Le travail « matériel » devient précieux, enfin !
Pour la première fois, au cours de ce siècle, un président du Conseil des ministres, en Italie, a remercié publiquement, dans la même phrase, les médecins et les ouvriers. Les structures profondes des sociétés, peut-être, renaissent : la santé, le travail, l’école. »
Le confinement correspond au fait de rester à un endroit, loin de ce désir d’ubiquité d’être partout à la fois, ou du moins de se déplacer rapidement d’un lieu vers l’autre, de ne jamais tenir en place. De ne pas suivre ce conseil de Pascal : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » :
« Je crois que nous vivons la fin du mythe de l’homme ubiquitaire. C’est salutaire. Il faut retrouver une « géographie propre » de l’humain, compatible avec les limites de nos corps. Je compte également sur la fin de la société liquide, vaporeuse, vouée à l’extension plutôt qu’à l’intériorisation. Ce parcours vers nous-mêmes évoque pour moi le Monde du silence, si bien décrit par le philosophe Max Picard (1888-1965). Max Picard parle du silence de la nature, des monuments, de ce qui est essentiel… Il le décrit comme une espèce de corde qui relie l’ensemble de l’univers. »
Les virus ne connaissent pas les frontières, les pauvres qui cherchent asile les subissent :
« L’Europe se relèvera-t-elle de cette crise, alors que les frontières nationales les unes après les autres se rétablissent ?
J’ose dire que cette parade de l’ainsi-dite « fermeture des frontières » est l’acte final de leur disparition au sens romantique célébré par le XIXe siècle et par la Première Guerre mondiale.
Aujourd’hui les frontières sont plus impalpables : le virus suit le trajet de nos avions.
Les frontières et les murs n’existent plus que pour les pauvres qui marchent à pieds nus cherchant un asile qu’ils ne trouvent que parcimonieusement chez nous.
Les frontières sont la représentation exacte de l’épaisseur de notre égoïsme : en Europe, comme en Israël, comme à la frontière entre États-Unis et Mexique. »
Et en partant de sa réflexion sur les vertus communes, il nous donne ces conseils, cette leçon :
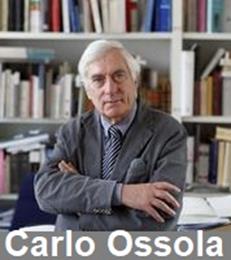 « Pour traverser cette période, les « vertus communes », ces vertus de la vie quotidienne qui ne sont pas de « petites vertus », peuvent nous aider […]. Elles peuvent être comprises comme des vertus d’adoucissement. Elles sont un « remède dans le mal » dirait Jean Starobinski. Comme le dit Ovide « Nominibus mollire licet mala » : il faut assouplir la « douleur de vivre » par des noms qui « nomment mieux », parce que dans nos vies tout geste, acte de parole, est aussi une action.
« Pour traverser cette période, les « vertus communes », ces vertus de la vie quotidienne qui ne sont pas de « petites vertus », peuvent nous aider […]. Elles peuvent être comprises comme des vertus d’adoucissement. Elles sont un « remède dans le mal » dirait Jean Starobinski. Comme le dit Ovide « Nominibus mollire licet mala » : il faut assouplir la « douleur de vivre » par des noms qui « nomment mieux », parce que dans nos vies tout geste, acte de parole, est aussi une action.
Deux me semblent nécessaires dans les détresses que nous commençons à connaître : la mesure et la constance. Savoir tenir un rapport de confiance et d’équilibre et en même temps admettre que les temps seront longs et difficiles et qu’il faut prendre des habitudes de longue durée.
La discrétion peut aussi nous être utile dans une période qui génère beaucoup d’angoisse, des rumeurs et qui provoque aussi de la promiscuité liée au confinement.
La discrétion est l’art de garder patiemment en soi tout ce que l’on écoute, la force de mettre de côté le bourdonnement mondain. Elle est proche du discernement. Il faut réduire, j’ose le dire, l’espace de nos pertinences, l’extension de notre pouvoir d’agir.
Le philosophe Vladimir Jankélévitch le résume admirablement : « Le plus d’amour possible (…). Le moins de mots possible pour le plus de sens possible » (Le Paradoxe de la morale).
Quant à l’urbanité et la prévenance, certains se demanderont si elles peuvent encore se pratiquer alors que toute vie civile pratiquement disparaît.
Au contraire, elles deviennent plus précieuses, puisque nous ne pouvons plus « éviter » l’autre, le voisin de palier, la communauté – souvent ignorée – de l’immeuble. La vie de famille pourra gagner en qualité, si nous adoptons et déclinons dans notre quotidien le mot « moindre » : moins d’espace, un ton de voix retenu, pour développer un espace intérieur, plein de souvenirs, de projets, de rêves, mais surtout d’écoute.
Enfin, la vertu de gratitude peut s’exercer. Je l’espère en tout cas. Nous commençons à voir comment tout le quotidien est précieux, le plus usuel dans le quotidien, le plus humble du quotidien : remercier les hommes, demander pardon à la nature que nous avons si maltraitée et qui fait pourtant surgir, chaque jour, le soleil et le printemps.
À côté de ces vertus actives, nous sommes aussi invités à redécouvrir des vertus passives : la patience, le renoncement, le détachement…
Non plus la prise, mais la déprise disait Roland Barthes. Pour les redécouvrir, le plus direct me semble d’adopter, chaque jour, un peu plus de Gelassenheit, de déprise par rapport aux objets.
Ce n’est pas un temps pour ramasser mais pour nettoyer, mieux encore balayer le superflu.
Et quand on commence, chaque petite promenade dans nos vies montre tellement d’incrustations de superflu… »
Claude Askolovitch a clos son propos sur cet article de « la Croix » en reprenant la citation de Wladimir Jankelevitch que fait Carlo Ossola :
« Le plus d’amour possible. Le moins de mots possible pour le plus de sens possible »
Je ne vois pas comment mieux conclure ce mot du jour.
<1377>
- L’affabilité
-
Mardi 24 mars 2020
« Fais pas la trogne enfin, à la fenêtre écoute les oiseaux ! »Lucien OrangeLucien est un humaniste et un poète.
Un poète de la Croix Rousse.
Nous nous sommes connus dans la section du PS de la Croix Rousse. Nous étions très souvent d’accord, quelquefois il était un peu plus à gauche que moi.
Mais même quand nous n’étions pas d’accord, cela n’avait aucun effet sur notre amitié d’esprit et de cœur.
C’est encore le cas, mais nous ne sommes plus au PS.
Lucien écrit des textes qui n’appartiennent qu’à lui, drôles, profonds, poétiques.
Aujourd’hui, avec son autorisation, je partage le dernier texte qu’il a envoyé.
Une petite merveille du temps présent.
T’en fais pas gone ;
Allons, gone, fais pas cette tête ! C’est pas la fin du monde c’qu’y arrive,
C’est tout de même pas comme si c’était la guerre ?
Ha si, il a dit que c’était la guerre ?
Ha bon, mais une guerre que tu fais chez toi, dans ton canapé, sans piloter un drone tueur à dix mille kilomètres de là.
Juste, si tu peux, du télétravail, pendant les heures de bureau. Bien sûr, certains ne peuvent pas travailler de chez eux, ou même travailler tout cours. Sans compter, hélas, ceux qui, à la rue, n’ont pas d’endroit pour se confiner. Là oui c’est un problème, et à ceux-là il faudra bien donner une sorte de revenu universel, vous savez comme un candidat proposait en 2017 ! L’idée à l’époque fut fort décriée, et aujourd’hui elle s’imposerait presque !
Allons fais pas la gueule, oui t’es chez toi, confiné qu’y disent, mais c’est qu’une question de mot ;
Dis-toi que t’es en pause, tiens, c’est ça en pause.
Va à la fenêtre, si tu as de la chance y’a peut-être un jardin pas loin de chez toi que tu peux apercevoir ?
Regardes, les arbres bourgeonnent, bientôt ils seront fleuris, dans ma rue on a des cerisiers à fleurs, ça commence à éclore, c’est beau tout ce blanc.
Et puis si t’as pas de jardin dans ton champ de vision regarde le ciel, il est toujours beau le ciel, le matin juste avant le soleil souvent il y a des fins nuages, des stratus, je crois, ça s’appelle, et au lever du jour ils sont roses, du rose sur bleu pâle. Et le soir aussi, juste quand le soleil est au raz des toits, si tu as la chance d’avoir un ou deux nuages, c’est un vrai festival des couleurs plein le ciel, profites en !!!
Fais pas la trogne enfin, à la fenêtre écoute les oiseaux, oui, oui, on peut entendre les oiseaux, depuis qu’il y a moins de voiture, que la pollution diminue, les oiseaux chantent, ils nichent dans les arbres […] C’est le printemps.
Allons rigoles, les gens avec qui tu vis, regarde-les.
Oui, tien, tes gamins ! Tu te rends compte que tu ne les vois pas grandir ? Le matin quand tu pars, ils dorment, et le soir quand tu rentres, ils dorment déjà.
Regardes les, découvres les, tu vois la grande tu t’étais même pas rendu compte qu’elle commençait à ressembler à sa mère, même façon d’être, même sourire, même caractère aussi. Ça c’est bien !
Aller arrête de t’angoisser, ce truc, là le virus, y va passer, en attendant si tu t’emmerdes parles avec eux, aide à la cuisine. Tu te souviens la cuisine t’aimais bien quand t’étais jeune, mets-toi aux fourneaux, ça va rudement te passer le temps, puis ça soulagera ta compagne. Tu vas comprendre les sens de l’expression « charge mentale »
Ha, t’es toute seule, tout seul ? Ben c’est le moment de te mettre à ta fenêtre, si ça se trouve tu vas voir un gars, ou une fille, accoudé à sa fenêtre. Vous allez vous regarder vous sourire peut-être, par la fenêtre sur un carton vous pouvez échanger vos 06 ………. Et voilà de quoi vous occuper pendant toute un confinement. et plus si affinités.
Allons, fais pas cette tronche, tu sais, ce bouquin, que tu as commencé il y a longtemps et que tu n’as pas eu le temps de finir, reprends le, tu vas voir comme le temps passe vite en lisant.
Ou encore ce truc qu’est cassé, tu voulais le réparer, tu l’as mis dans un placard, c’est le moment de bricoler, avec un peu de temps il va marcher à nouveau, toujours ça de moins à racheter, de la pollution en moins.
Bon voilà, ça va mieux, tu vas pas te mettre à râler au bout d’une semaine ?
Ca va durer au moins deux mois, minimum, alors si déjà tu te laisses aller, t’imagines dans deux mois ?
Moi ce que j’en dis, c’est pour toi, pour que tu saches que changer d’habitudes, c’est pas non plus la mer à boire.
Et puis surtout, à toi à qui il n’est jamais rien arrivé, tu vas te faire un sacré paquet de souvenirs, pour dans les années qui viennent.
Tu rigolais des anciens combattants, et bien toi aussi tu en seras un !
Dans les années trente lors des commémorations tu seras peut- être porte drapeau, avec, si ça se trouve ta décoration !
Ha oui je t’avais pas dit : il va y avoir une décoration pour ceux qui auront sauvé des vies en restant chez eux.
Ça va s’appeler l’ordre de l’édredon, avec naturellement des grades, le premier ce sera l’oreiller, puis la couette, de coton, de laine ou de plume. Et enfin l’édredon, trois niveaux, duvet de canard, duvet d’oie, et le plus prestigieux duvet d’Eider !
Ces décorations seront distribuées, pardon, attribuées, aux confinés les plus méritants, ceux qui ne seront jamais sortis de chez eux le plus longtemps possible ; ou qui auront fait des exploits particuliers comme le marathon du travail à domicile en téléconférence avec plus de cent correspondants sans s’endormir à l’écran.
Parce qu’on va organiser des concours, avec le télétravail il va falloir stimuler les employés pour que le rendement s’améliore.
La première semaine on a bien vu que ça glandait sec, Facebook a failli exploser, des gens de chez Orange se plaignaient que les réseaux qu’ils maintenaient à la force du poignet, étaient utilisés par des inconscients pour raconter des bêtises et encombrer les réseaux sociaux qui devaient être avant tout au service de nos forces vives !!!!
« Alors on s’y est tous mis (raconteras-tu dans tes souvenirs d’ancien combattant) et nous avons relancé la machine économique qui commençait à perdre pied.
Tous les confinés ont du faire le double de travail qu’au bureau, au prétexte qu’ils ne perdaient plus de temps à se raconter le WE à la machine à café. D’ailleurs bientôt il n’y eut plus de café.
Les retraités furent sollicités pour passer leurs commandes par internet afin de ne pas arrêter la production et relancer l’économie. Les livreurs furent transformés en pilotes de Drones livreurs pour que les humains ne trainassent pas dans les rues. Et l’on vit à cette occasion que les drones étaient plus efficaces que les livreurs humains, car ils ne perdaient pas de temps à discuter avec les clients ;
Pareils pour tous les métiers indispensables, on mit en services des robots éboueurs qui enlevaient les poubelles avec efficacités. Les policiers chargés de faire respecter le confinement, furent remplacés par des drones verbalisateurs. Et ainsi de suite. Il n’y eut que le personnel médical et les femmes de ménages qu’on ne put remplacer par des machines. »
Voilà, tu vois gone, c’est comme ça que ça va se passer, sûr y aura des morts, mais relativise.
Sais-tu combien il y a de morts « normales » par jour en moyenne d’habitude ? 1660, rien que ça, et là-dedans combien sont mort du tabagisme ? 164, et de l’alcool , 82 . t’as raison l’alcool ça fait moins mourir que le tabac, c’est rassurant non ?
Bien sûr ça ne diminue pas le risque du virus, mais quand même si en plus tu sais que c’est surtout les vieux qui disparaissent en premier ( 50% des morts ont plus de 83 ans) C’est moins angoissant , et si par hasard t’as plus de 83 dis-toi que tu fais du rab , comme moi !
Aller, arrêtes de mouronner, vis, regardes le ciel, les oiseaux, ta femme ou ton mec, souris, rigoles,
Tu verras ce sera vite fini.
Bises ;
Lucien
22 mars 2020
Si certains non lyonnais ne le savaient pas « gone » signifie un enfant dans le parler lyonnais et par extension c’est le nom qu’on donne à tous les habitants de Lyon (les Gones).
En 2004, je n’écrivais pas encore de mots du jour. J’avais d’autres activités que je partageais avec Lucien.
 <1376>
<1376> -
Lundi 23 mars 2020
« L’obéissance est la condition de la liberté »Pierre-Henri TavoillotLa France est donc confinée.
Des règles strictes ont été édictées et si on peut penser que le grand nombre les applique, tout le monde ne le fait pas.
Alors, des critiques apparaissent sur l’impréparation des gouvernants, sur les masques de protection qui ont disparu ou n’ont pas été renouvelés, sur les tests qui sont mal organisés ou pas assez nombreux, sur des décisions qui n’ont pas été prises assez rapidement.
Toutes ces questions sont à poser et seront à résoudre lorsque la crise aura été surpassée.
Mais ce n’est pas le temps d’aujourd’hui.
Et je voudrais, aujourd’hui, partager la réflexion du philosophe Pierre-Henri Tavoillot, l’auteur de l’essai : « Comment gouverner un peuple-roi ? »
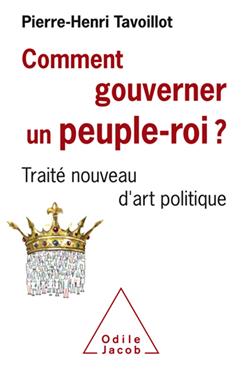 Invité du grand entretien du matin sur France Inter <Le 7 février 2020> il a parlé de
Invité du grand entretien du matin sur France Inter <Le 7 février 2020> il a parlé de
« L’extraordinaire difficulté de gouverner une démocratie aujourd’hui.
Aujourd’hui c’est la démocratie qui est complexe
Il faut écouter les gens, les individus, faire preuve de sollicitude, écouter les experts, prendre en compte les contraintes internationales et autres.
Il n’a jamais été plus difficile de gouverner dans l’histoire de l’Humanité qu’aujourd’hui [dans les démocraties libérales]. […]
L’art de gouverner est aussi un art d’être gouverné.
C’est un art d’obéir, à condition bien sûr que l’obéissance ne soit pas perçue comme la servitude.
L’étymologie d’obéissance c’est « ob » « audire » c’est-à-dire « prêter l’oreille ». J’écoute les autres.
Jean-Jacques Rousseau disait : « Un peuple libre obéit mais ne sert pas. Il a des chefs mais il n’a pas de maître ».
Très important comme formule.
L’obéissance est la condition de la liberté. Vous ne pouvez pas vivre avec les autres si vous n’obéissez pas à un certain nombre de règles.
La citoyenneté ne se définit pas comme la désobéissance mais comme l’obéissance pour être libre. »
Je crois ces paroles d’une profonde sagesse. Dans un monde d’individualisme sans règle, ou ce qui est la même chose de règles non respectées, la vie devient rapidement intenable.
Il faut savoir obéir aux règles si on veut faire société.
J’entends et je lis que ce serait Macron le responsable de tous les problèmes.
De manière très tranquille j’affirme qu’on peut remplacer Macron et les problèmes resteront.
Le 18 mars, Pierre-Henri Tavoillot, écrivait sur son <Blog>
« Le danger qui nous guette est de déplacer l’objet de notre haine sur nos gouvernants.
On l’entend déjà : « ils n’ont pas pris les décisions à temps » ; « ils nous ont menti » ; « ils sont nuls » ; « ils sont focalisés sur leurs intérêts politiciens ».
Cette haine, si elle se poursuit, sera délétère, car elle nuira à la confiance indispensable à la bonne conduite de la lutte sanitaire. Le défaitisme alors l’emportera.
Or nous entrons dans une période tragique telle que notre pays n’en a pas connu depuis 80 ans.
Ce qui caractérise la tragédie, c’est qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions ; dans le meilleur des cas, il y en a des mauvaises et des pires.
Je trouve dans les Mémoires du Chancelier allemand Schröder cette juste définition du tragique. C’était à l’occasion du très vif débat sur l’intervention militaire allemande au Kosovo (1999) : « Le mouvement de 68 nous a apporté beaucoup de nouveautés et beaucoup de bonnes choses. Mais il en a aussi enseveli certaines, notamment le sens du tragique. Nous en sommes venus à qualifier de « tragique » tout ce qui est triste. Non, une situation est tragique si l’on se rend coupable quoi qu’on fasse. Bien sûr qu’on devient coupable quand on largue des bombes. Mais la seule question qui vaille, c’est de savoir comment on peut se rendre plus coupable encore. »
Un gouvernement ou un président, par définition, est coupable, car il prend des décisions ; et décider, c’est trancher dans le vif du réel. Faut-il le lui reprocher ? Faut-il le haïr pour cela ? Non, car on finirait ainsi par se condamner à l’impuissance et in fine à se haïr soi-même.
Quand le temps sera venu, pour lui, de rendre des comptes, alors on pourra évaluer s’il a fait les choix les plus judicieux ou les plus malheureux.
En attendant, il faut accepter ses mauvaises décisions, forcément mauvaises … »
Il n’y a pas que le problème des gouvernants, il y aussi celui des gouvernés.
C’est cette réflexion féconde, absolument non démagogique ni populaire de Pierre-Henri Tavoillot qu’il me semblait utile de partager.
Si vous voulez en savoir davantage sur ce philosophe : il existe cet article de la <Revue Politique et parlementaire> qui analyse son ouvrage : « Comment gouverner un peuple roi ? »
Etienne Klein a partagé ce dimanche une nouvelle anagramme de Jacques Perry-Salkow :
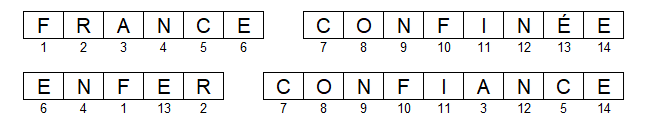 <1375>
<1375> -
Vendredi 20 mars 2020
« Le confinement peut nous aider à commencer une détoxification de notre mode de vie. »Edgar MorinL’«Obs» a voulu prendre un peu de hauteur, il est alors allé interroger le sociologue et philosophe, Edgar Morin, qui du haut de ses 98 ans (il est né le 28 juillet 1921) exprime sa vision sage. Nous disposons donc de cet <article> publié sur le site de l’Hebdomadaire.
 La première observation qu’il formule sur la crise actuelle est le fait que sauf pour les scientifiques et la recherche, la globalisation entraîne peu d’entraide internationale, c’est la fermeture des frontières et le chacun pour soi qui l’emporte.
La première observation qu’il formule sur la crise actuelle est le fait que sauf pour les scientifiques et la recherche, la globalisation entraîne peu d’entraide internationale, c’est la fermeture des frontières et le chacun pour soi qui l’emporte.
« Cette crise nous montre que la mondialisation est une interdépendance sans solidarité. Le mouvement de globalisation a certes produit l’unification techno-économique de la planète, mais il n’a pas fait progresser la compréhension entre les peuples. Depuis le début de la globalisation, dans les années 1990, guerres et crises financières ont sévi. Les périls planétaires – écologie, armes nucléaires, économie déréglée – ont créé une communauté de destin pour les humains, mais ceux-ci n’en ont pas pris conscience. Le virus éclaire aujourd’hui de manière immédiate et tragique cette communauté de destin. En prendrons-nous enfin conscience ?
Faute de solidarité internationale et d’organismes communs pour prendre des mesures à l’échelle de la pandémie, on assiste à la fermeture égoïste des nations sur elles-mêmes. […]
Les réseaux d’information nous ont permis d’être au courant de l’avancée de la pandémie pays par pays. Mais cela n’a pas déclenché de coopération au niveau supérieur. Seule s’est déclenchée une coopération internationale spontanée de chercheurs et de médecins. L’OMS comme l’ONU sont incapables d’apporter les moyens de résistance aux pays les plus dépourvus. »
Les réseaux sociaux ne permettent cependant pas aux États de cacher l’importance de l’épidémie ni les fragilités des gestions et cela même en Chine
« Même le régime chinois n’a pu étouffer l’information en punissant le héros qui avait donné l’alerte… »
Pour Edgar Morin, la difficulté de lutter contre le coronavirus est directement liée à la mise en œuvre de la doctrine néolibérale qui a conduit les gouvernement à diminuer les moyens de l’État providence.
« Le coronavirus nous dit avec force que l’humanité tout entière doit rechercher une nouvelle voie qui abandonnerait la doctrine néolibérale pour un New Deal politique social, écologique. La nouvelle voie sauvegarderait et renforcerait les services publics comme les hôpitaux, qui ont subi depuis des années en Europe des réductions insensées. La nouvelle voie corrigerait les effets de la mondialisation en créant des zones démondialisées qui sauvegarderaient des autonomies fondamentales… »
Quand il parle des réductions insensées, force est de constater que le nombre de lits d’hôpitaux a drastiquement diminué en France.
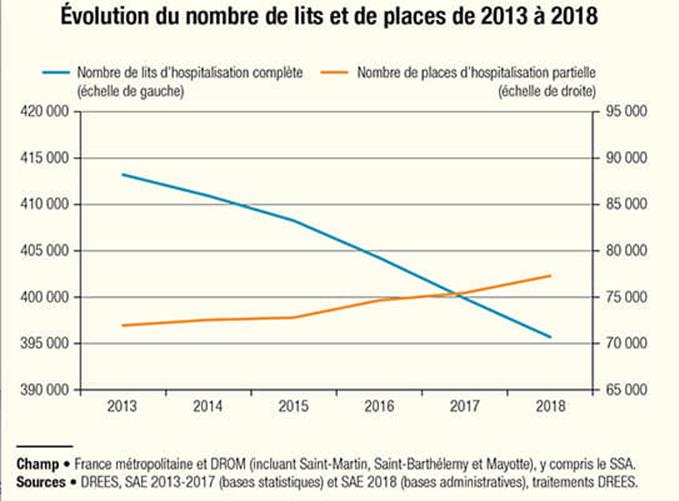 <Le quotidien du médecin> qui publie ce schéma, montre qu’en 2018 il existait moins de 400 000 lits d’hospitalisation complète en Français avec une diminution continue chaque année, légèrement compensée par une augmentation de l’offre d’hospitalisation partielle. Ce même article nous apprend que la diminution des lits d’hospitalisation complète s’était réduite de 69 000 lits par rapport à 2003. C’est un fait !
<Le quotidien du médecin> qui publie ce schéma, montre qu’en 2018 il existait moins de 400 000 lits d’hospitalisation complète en Français avec une diminution continue chaque année, légèrement compensée par une augmentation de l’offre d’hospitalisation partielle. Ce même article nous apprend que la diminution des lits d’hospitalisation complète s’était réduite de 69 000 lits par rapport à 2003. C’est un fait !
Bien sûr les techniques ont évolué, l’offre ambulatoire a progressé, toutefois la capacité d’accueil des hôpitaux a diminué dans une population vieillissante.
Mais si on veut examiner le besoin particulier que pose la pandémie à un pays comme la France, il faut s’intéresser aux soins intensifs. En effet, la crainte que nous avons c’est que les cas graves saturent les services de soins intensifs et déclenchent une surmortalité ou une « mortalité illégitime » c’est-à-dire des patients qui décèdent par faute de moyens en soins de qualité.
Or, le <Journal La Tribune> dans un article du 18 mars 2020 nous apprend que selon l’OCDE, la France ne disposait en 2018 que de 3,1 lits d’hôpitaux en soins intensifs pour 1.000 habitants. Elle se classe seulement au 19e rang loin des trois premiers pays ayant le plus de lits en soins intensifs à offrir à leurs habitants,: Japon (7,8 lits pour 1.000 habitants), Corée du Sud (7,1) et Allemagne (6).
Certains articles lient la capacité qu’a eu la Corée du Sud, très proche de la Chine, à éviter un nombre important de morts sans confinement au port de masques qui font cruellement défaut à la France. Mais l’explication ne se trouverait-elle pas plutôt dans la plus grande capacité de ce pays à disposer, en face d’une crise majeure, d’une offre de soins intensifs deux fois plus importante que la France.
Maigre consolation, la France se trouve devant les Etats-Unis (2,4).
Cette réalité donne quelque consistance à l’accusation d’Edgar Morin : une réduction insensée
Dans les évolutions indispensables, le philosophe insiste sur le besoin de se centrer sur les « autonomies fondamentales » qu’il définit ainsi :
« D’abord l’autonomie vivrière. A l’époque de l’occupation allemande, nous avions une agriculture française diversifiée qui a permis de nourrir sans famine la population en dépit des prédations allemandes. Aujourd’hui, il nous faut rediversifier. Et puis, il y a l’autonomie sanitaire. Aujourd’hui, beaucoup de médicaments sont fabriqués en Inde et en Chine et nous risquons des pénuries. Il faut relocaliser ce qui est vital pour une nation. »
Il espère qu’une prise de conscience suite à cette crise permettra de reconstruire des solidarités et poser un autre regard sur notre addiction au consumérisme :
« Nous sommes dans une société où les structures traditionnelles de solidarité se sont dégradées. Un des grands problèmes est de restaurer les solidarités, entre voisins, entre travailleurs, entre citoyens… Avec les contraintes que nous subissons, les solidarités vont être renforcées, entre parents et enfants qui ne sont plus à l’école, entre voisins… Nos possibilités de consommation vont être frappées et nous devons profiter de cette situation pour repenser le consumérisme, autrement dit l’addiction, la « consommation droguée », notre intoxication à des produits sans véritable utilité, et pour nous délivrer de la quantité au profit de la qualité. »
Le confinement pourra peut-être aussi faire évoluer notre rapport au temps, une sorte de temps retrouvé…
« Grâce au confinement, grâce à ce temps que nous retrouvons, qui n’est plus haché, chronométré, ce temps qui échappe au métro-boulot-dodo, nous pouvons nous retrouver nous-mêmes, voir quels sont nos besoins essentiels, c’est-à-dire l’amour, l’amitié, la tendresse, la solidarité, la poésie de la vie…
Le confinement peut nous aider à commencer une détoxification de notre mode de vie et à comprendre que bien vivre, c’est épanouir notre « Je », mais toujours au sein de nos divers « Nous ». »
Sa conclusion en appelle encore une fois à la solidarité et à la conscience commune du destin humain
« J’ai été très ému de voir ces femmes italiennes, à leur balcon, chanter cet hymne de fraternité, « Fratelli d’Italia » (« Frères d’Italie »). Nous devons retrouver une solidarité nationale, non pas fermée et égoïste, mais ouverte sur notre communauté de destin « terrienne »…
Avant l’apparition du virus, les êtres humains de tous les continents avaient les mêmes problèmes : la dégradation de la biosphère, la prolifération des armes nucléaires, l’économie sans régulation qui accroît les inégalités…
Cette communauté de destin, elle existe, mais comme les esprits sont angoissés, au lieu d’en prendre conscience, ils se réfugient dans un égoïsme national ou religieux. Bien entendu, il faut une solidarité nationale, essentielle, mais si on ne comprend pas qu’il faut une conscience commune du destin humain, si on ne progresse pas en solidarité, si on ne change pas de pensée politique, la crise de l’humanité s’en trouvera aggravée. »
Il nous rappelle finalement que si cette pandémie constitue une épreuve sérieuse qui nous est imposée, il existe d’autres épreuves qui s’annoncent et qui seront très graves si nous n’anticipons pas davantage leur atténuation et notre capacité à nous adapter aux défis qui nous attendent.
<1374>
-
Jeudi 19 mars 2020
« Nous ne sommes pas en guerre et n’avons pas à l’être »Sophie Mainguy-BesmainLes réseaux sociaux sont comme les couteaux ou la langue, ils peuvent être l’instrument du pire, de la haine, de la bêtise, du crime.
Ils peuvent être aussi, le lieu du partage de l’intelligence, de la réflexion, de la profondeur.
Comme pour le coronavirus, nous devons nous efforcer de transmettre tout ce qui aide la vie, la construction, l’intelligence, l’entraide et stopper la transmission de la bêtise et de toute la horde de ce qui détruit, divise et abaisse.
C’est au départ mon ami Yves qui m’a renvoyé vers une page facebook qui elle-même m’a renvoyé vers la page de Sophie Mainguy-Besmain qui est médecin à Toulon.
Elle a réagi à cet appel du Président Macron : « Nous sommes en guerre »
Et elle a répondu par la négative :
« NOUS NE SOMMES PAS EN GUERRE et n’avons pas à l’être…
Il est intéressant de constater combien nous ne savons envisager chaque événement qu’à travers un prisme de défense et de domination.
Les mesures décrétées hier soir par notre gouvernement sont, depuis ma sensibilité de médecin, tout à fait adaptées. En revanche, l’effet d’annonce qui l’a accompagné l’est beaucoup moins.
Nous ne sommes pas en guerre et n’avons pas à l’être.
Il n’y a pas besoin d’une idée systématique de lutte pour être performant.
L’ambition ferme d’un service à la vie suffit.
Il n’y a pas d’ennemi.
Il y a un autre organisme vivant en plein flux migratoire et nous devons nous arrêter afin que nos courants respectifs ne s’entrechoquent pas trop.
Nous sommes au passage piéton et le feu est rouge pour nous.
Bien sûr il y aura, à l’échelle de nos milliards d’humains, des traversées en dehors des clous et des accidents qui seront douloureux.
Ils le sont toujours.
Il faut s’y préparer.
Mais il n’y a pas de guerre.
Les formes de vie qui ne servent pas nos intérêts (et qui peut le dire ?) ne sont pas nos ennemis.
Il s’agit d’une énième occasion de réaliser que l’humain n’est pas la seule force de cette planète et qu’il doit – ô combien- parfois faire de la place aux autres.
Il n’y a aucun intérêt à le vivre sur un mode conflictuel ou concurrentiel.
Notre corps et notre immunité aiment la vérité et la PAIX.
Nous ne sommes pas en guerre et nous n’avons pas à l’être pour être efficaces.
Nous ne sommes pas mobilisés par les armes mais par l’Intelligence du vivant qui nous contraint à la pause.
Exceptionnellement nous sommes obligés de nous pousser de côté, de laisser la place.
Ce n’est pas une guerre, c’est une éducation, celle de l’humilité, de l’interrelation et de la solidarité.
Sophie Mainguy»
Cette épidémie constitue une leçon qui doit nous permettre de comprendre qu’il faut mettre des limites à notre individualisme forcené.
Non pas renoncer à la part de liberté qu’il représente, mais d’égoïsme qu’il génère.
L’entraide est plus que jamais la force dont le monde a besoin.
Et quand on parle de virus et de bactéries, on ne peut s’empêcher de penser au « microbiote intestinal humain » où des milliards d’êtres vivants et de virus collaborent, sans organisation pyramidale, pour nous aider à vivre et à digérer.
C’est vrai que dans cette connaissance du vivant, il semble hors de propos de parler de guerre, mais d’en appeler au vivant, à la coopération des ressources de vie et à l’éloignement des forces de destruction.
<1373>
-
Mercredi 18 mars 2020
« Factuel »Le fact-checking par l’AFPDans un premier élan, j’avais voulu écrire un mot d’humour du type : « L’humour au temps du coranovirus ».
Mais la multiplication de fake news ou d’opinions erronées, me pousse plutôt à renvoyer vers le remarquable site de l’AFP qui décrypte, analyse et démonte l’ensemble de ces « infox »
Ce site s’appelle « Factuel ». Son adresse est : « https://factuel.afp.com/ »
Vous apprendrez ainsi que contrairement à ce qui a été largement diffusé sur les réseaux sociaux, le joueur de football Christiano Ronaldo n’a pas décidé de transformer ses hôtels, au Portugal, en hôpitaux pour accueillir les personnes touchées par le nouveau coronavirus. Contactée par l’AFP, la chaine d’hôtels a démenti cette information.
Bien entendu, la propagation du nouveau coronavirus suscite de nombreuses publications qui préconisent des remèdes miracles dénués de tout fondement.
Pour certains, on se demande comment des gens peuvent y croire, la crédulité de certains est sans limite.
Vous trouverez donc sur cette <page> une liste de solutions publiées ainsi que les longs démentis argumentés des journalistes de l’AFP.
Par exemple :
- Non, boire de l’eau ne fait pas partie des mesures de prévention contre le coronavirus
- Non, la cocaïne ne soigne pas le coronavirus
- Non, les personnes noires ne sont pas plus résistantes au coronavirus
- Non, la viande de bœuf n’est pas le « meilleur vaccin » contre le coronavirus
- Les autorités sanitaires ne recommandent pas de se raser la barbe pour se protéger du coronavirus
- Non, le gel désinfectant pour les mains ne favorise pas le cancer
- Non, boire de l’eau toutes les 15 minutes ne protège pas du coronavirus
Etc..
Le site précise aussi le nombre de fois qu’une de ces informations a été diffusée. Il ne s’intéresse donc pas à des informations baroques confidentielles mais bien à des infox largement transmises.
Vous pouvez aussi contacter le site, par rapport à une information largement diffusée, en envoyant un message à cette adresse : factuel@afp.com
Il est aussi possible de le contacter par facebook ou twitter
Il s’agit donc ce site :
<1372>
- Non, boire de l’eau ne fait pas partie des mesures de prévention contre le coronavirus
-
Mardi 17 mars 2020
« L’anachronisme d’une semaine sur l’autre »Frédéric SaysAnachronisme vient du grec, ana : en arrière et khronos : le temps.
De manière très matérielle, on parle d’anachronisme dans une œuvre artistique, littéraire, dans un film lorsqu’on y trouve une erreur de chronologie qui consiste à y placer un concept ou un objet qui n’existait pas encore à l’époque illustrée par l’œuvre. Il est courant de trouver sur internet des sites comme <celui-ci> qui dévoile des anachronismes dans des films célèbres.
Mais ce sens est assez futil et superficiel.
L’anachronisme en Histoire présente un intérêt intellectuel d’une autre profondeur.
Pendant mes études d’Histoire, je me souviens de cet avertissement d’une professeure :
« Un historien doit toujours se prémunir devant l’anachronisme »
L’anachronisme en Histoire, c’est juger, apprécier une situation historique ancienne avec les valeurs, les connaissances, les mœurs d’aujourd’hui.
L’anachronisme doit bien sûr se comprendre par rapport à des évènements qui se sont passés il y a des siècles et qu’on ne comprend pas parce qu’on n’en apprécie pas le contexte de cette époque.
L’épidémie actuelle distord tellement notre rapport au temps que l’anachronisme se dévoile en l’espace de quelques semaines.
C’est ce que dévoile Frédéric Says dans sa chronique du 16 mars.
Il rappelle que des hommes politiques qui ont demandé, dimanche, le report du second tour des municipales comme une chose évidente et qui posaient la question de l’inconscience du président d’avoir organisé le premier tour dans ces conditions, avaient eux-mêmes, une semaine avant, affirmé que cette élection devait absolument se tenir, sinon nous n’étions plus dans un état de droit.
Une semaine avait suffi pour qu’ils oublient les conditions dans lesquelles leurs propos ont été tenus et la décision a été prise.
Il cite un autre exemple, celui de Carla Bruni Sarkozy.
« On se fait la bise, c’est dingue ! » avait-elle lancé au président-directeur général de LVMH avant de lâcher : « On est de l’ancienne génération, on a peur de rien nous. […] on craint pas le coronavirus » .
Elle a été filmée. Depuis elle a été attaquée sur ce point, elle s’est excusée.
Cet épisode avait eu lieu le 28 février, soit il y a 17 jours.
Frédéric Says pose alors de question de savoir où nous en étions, nous même, le 28 février au niveau de la bise, des contacts et de la conscience du danger de ce virus qui attaque le monde d’homo sapiens ?
Les propos qu’on attribue au Christ : « Que celui qui n’a jamais péché, jette la première pierre» semblent appropriés.
Moi-même, j’écrivais le 11 mars : « La plus grande menace qui nous guette, c’est une coronapanique » :
« Certes, c’est une épidémie, certes on n’a pas de vaccin, certes on n’a pas vraiment de médicament pour guérir cette maladie du Covid19 qui a débuté en décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine.
Maladie qui est provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2.
Mais quand même !
Je ne suis pas certain que nous sommes en face d’un grave danger de santé publique »
C’était, il y a 6 jours. Nous sommes dans un anachronisme accéléré.
Tout cela doit nous conduire à une grande humilité.
Frédéric Says dit :
« Le confinement doit aussi concerner les égos et les rodomontades »
<1371>
-
Lundi 16 mars 2020
« Le risque n’est pas individuel mais populationnel. »Philippe DevosNous avons vécu un week-end étonnant.
Samedi soir Edouard Philippe a annoncé la fermeture de tous les commerces « non indispensables ».
Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, interrogé sur France 2, a dit hier à 19h30 : «La situation se détériore pour nos compatriotes.».
Christian Jacob, le président de LR a été testé positif au coronavirus, la nouvelle a été connue ce dimanche. Or, ce responsable politique, parmi d’autres, a insisté pour que le premier tour des municipales ait lieu. Il qualifiait de <coup d’état> la possibilité de reporter le scrutin.
 Sur son fil twitter, il a publié plusieurs photos le 13 mars, soit 2 jours avant le scrutin, dans lesquelles il s’affichait fièrement à côté des candidats LR. Comme ici, assis à côté de Rachida Dati, dans un exercice de promiscuité sociale.
Sur son fil twitter, il a publié plusieurs photos le 13 mars, soit 2 jours avant le scrutin, dans lesquelles il s’affichait fièrement à côté des candidats LR. Comme ici, assis à côté de Rachida Dati, dans un exercice de promiscuité sociale.
Les élections municipales ont donc eu lieu. Le second tour n’aura probablement pas lieu.
Bien sûr, j’ai essayé de comprendre et de trouver des informations.
J’ai d’abord trouvé cette note américaine traduite en français et vers laquelle renvoie un article de Mediapart.
Il s’agit d’un article du 13 mars de Tomas Pueyo, un ancien de l’École centrale et de l’université de Stanford, établi en Californie. C’est un texte disposant de nombreux calculs et graphiques alarmants qui a beaucoup circulé parmi les scientifiques et dans la communauté du numérique.
Cette note qui semble très argumentée, conclut qu’il faut immédiatement appliquer « la distanciation sociale ».
Mais du point de vue pédagogique je n’ai rien trouvé de plus remarquable que cette émission de « Arrêt sur Images » qui m’a été indiquée par mon ami Anny.
Arrêt sur Images est un site payant, mais a décidé que compte tenu de la gravité de la situation, l’émission de vendredi soir consacrée au coronavirus, avec les médecins Francois Salachas, du collectif inter-hôpitaux, et Philippe Devos, intensiviste en Belgique pouvait être visionnée gratuitement.
Je vous engage à la regarder : « Coronavirus : On doit se préparer à l’ouragan ! »
Ces deux médecins sont très intéressants
Je voudrais surtout relever cette intervention de Philippe Devos. Elle répond à une question du producteur de l’émission, Daniel Schneidermann, qui après avoir montré diverses interventions de médecins, en janvier, qui minimisait la dangerosité de COVID-19 lui demandait pourquoi se sont-ils trompés ?
« En fait ce que ces gens n’ont pas compris, c’est que le risque n’est pas individuel, mais populationnel.
Si on regarde une personne 40 ans, le risque de décéder de ce virus est de 0,1%, c’est très faible.
La problématique de ce virus c’est qu’il va toucher énormément de gens et qu’il va être très agressif pour des personnes très âgées qu’il faudra prendre en réanimation et que ce phénomène va saturer nos structures de réanimation et qu’il va générer des morts indirects parce qu’on ne pourra plus soigner d’autres personnes.
Le risque, il est au niveau de la population, le virus va mettre les hôpitaux à terre, le risque individuel est faible, mais il est au niveau de la population. Et beaucoup de médecins se concentrent sur l’individu, parce qu’ils ne soignent que des individus.
Il faut avoir une réflexion au niveau épistémologique et en terme de risque de groupe pour comprendre ce qui se passe. »
Et, en effet je n’ai jamais compris de manière plus claire ce qui était en train de se passer.
Le VIH s’attaque à notre système immunitaire.
Le coronavirus s’attaque à notre système de soins en le saturant. Dès lors, le système de soins n’est plus en mesure de faire face au besoin de soins et les gens vont mourir de ce que François Salachas appelle « une mort illégitime », dans la mesure où si le patient avait pu être pris en charge de manière correcte il ne serait pas mort.
Et cela se passe de manière massive.
Vous trouverez sur cette page la démonstration que la France est en train de suivre, avec un décalage de 9 jours, la courbe d’infection et de décès de l’Italie.
Je ne reproduis pas cette courbe ici, mais je précise qu’elle est exponentielle. Ce dimanche, l’Italie a de nouveau battu son record de morts par jour, on annonçait 368 décès pour un total de plus de 1800. En France, nous en étions à un total de 127. Il y a 9 jours, le 6 mars, l’Italie en était à 197 morts.
Ce qui explique que des journalistes français et francophones établis en Italie lancent un cri d’alarme à la lumière de ce qu’ils ont observé ces derniers jours de la progression fulgurante de la maladie :
« Journalistes en Italie pour des médias français et francophones, nous couvrons depuis le début la crise épidémique du coronavirus dans la Péninsule. Nous avons pu constater la progression fulgurante de la maladie et avons recueilli les témoignages du personnel de santé italien. Beaucoup nous font part de la situation tragique dans les hôpitaux, les services de thérapie intensive saturés, le triage des patients, ceux – les plus faibles – que l’on sacrifie faute de respirateurs artificiels suffisants.
Par conséquent, nous considérons qu’il est de notre responsabilité d’adresser un message aux autorités publiques françaises et européennes pour qu’elles prennent enfin la mesure du danger. Tous, nous observons en effet un décalage spectaculaire entre la situation à laquelle nous assistons quotidiennement dans la péninsule et le manque de préparation de l’opinion publique française à un scénario, admis par l’énorme majorité des experts scientifiques, de propagation importante, si ce n’est massive, du coronavirus. Hors d’Italie aussi, il n’y a plus de temps à perdre.
Nous estimons qu’il est de notre devoir de sensibiliser la population française. Souvent, les retours qui nous arrivent de France montrent qu’une grande partie de nos compatriotes n’a pas changé ses habitudes. Ils pensent qu’ils ne sont pas menacés, surtout lorsqu’ils sont jeunes. Or, l’Italie commence à avoir des cas critiques relevant de la réanimation dans la tranche d’âge 40-45 ans. Le cas le plus éclatant est celui de Mattia, 38 ans, sportif et pourtant à peine sorti de 18 jours de thérapie intensive. Il est le premier cas de Codogno, fin février, au coeur de la zone rouge dans le sud de la Lombardie.
Par ailleurs, certains Français n’ont pas conscience qu’en cas de pathologie grave, autre que le coronavirus, ils ne seront pas pris en charge correctement faute de places, comme c’est le cas en Italie depuis plusieurs jours. Soulignons aussi que le système sanitaire impacté aujourd’hui est celui du Nord, soit le meilleur d’Italie, un des meilleurs en Europe.
La France doit tirer les leçons de l’expérience italienne. »
Très loin, du fantasme des transhumanistes qui ne parlent que de techniques sophistiquées, d’intelligence artificielle et de big data pour soigner, nous sommes revenus à des principes simples pour éviter la catastrophe : se laver les mains et pratiquer « la distanciation sociale »
L’auteur de « Demain » Cyril Dion se désole que les français aient autant de mal d’apprivoiser ce comportement de bon sens.
 Ce coronavirus nous apprend que l’individualisme doit être dépassé et que nous ne pouvons être heureux et vivre bien que si nous tenons compte de l’autre.
Ce coronavirus nous apprend que l’individualisme doit être dépassé et que nous ne pouvons être heureux et vivre bien que si nous tenons compte de l’autre.
<1370>
-
Vendredi 13 mars 2020
« Le Vivant, fils de l’Éveillé »Roman philosophique d’Ibn TufaylNous avançons donc avec certitude vers un désastre économique mondial ou si tous les prochains évènements sont favorables, au moins une très grave crise.
Concernons le COVID-19, les autorités agissent avec beaucoup d’ampleur et de vigueur.
J’aime que le président Macron, contrairement à Trump, mette en avant la science et les scientifiques pour approcher de plus près le savoir actuel de l’humanité sur cette épidémie.
Pour le reste, je ne m’engagerai pas davantage dans l’expression d’un avis sur la gravité de la situation sanitaire sur laquelle je n’ai pas compétence pour me prononcer.
Je considère comme très pédagogique la mésaventure qui est arrivée à un brillant basketteur français Rudy Gobert qui joue dans le championnat américain.
Lors d’une conférence de presse, il s’est moqué du COVID-19 et par provocation il a touché tous les micros de la salle. Mais il a appris un peu plus tard qu’il était infecté du coronavirus. Et même le championnat américain (NBA) a été suspendu en raison de sa contamination.
Gobert a écrit sur les réseaux sociaux après cette expérience :
« Je veux m’excuser publiquement auprès de tous ceux que j’ai pu mettre en danger, a également écrit Gobert. À l’époque, je ne savais pas que j’étais infecté. J’ai été négligent et je n’ai pas d’excuse. J’espère que mon histoire servira d’avertissement et incitera tout le monde à prendre cela au sérieux. Je ferai tout ce que je peux pour utiliser mon expérience comme moyen d’éduquer les autres et de prévenir la propagation de ce virus. »
La solution passe donc par le civisme qui nous conduit à adopter et à appliquer toutes les mesures barrières pour nous protéger, mais aussi pour protéger les autres, si nous étions infectés sans le savoir.
Certains pourraient peut-être connaître la tentation de se retrouver dans la situation de Robin Crusoé, tout seul sur une île, loin de tout humain susceptible de les contaminer.
Lors de mon mot du jour sur l’«islamophobie » j’ai déjà évoqué la remarquable émission, du dimanche matin sur France Culture, animé par Ghaleb Bencheikh : « Questions d’Islam ».
C’est Annie qui m’a fait découvrir cette émission qui parle d’idées, de philosophie, d’Histoire, de controverses, de débats et qui est de très loin l’émission religieuse, de toutes celles produites sur France Culture, la plus riche et la plus intéressante pour celles et ceux qui ont le goût d’apprendre et de s’ouvrir l’esprit.
 Et c’est grâce à cette émission que j’ai appris l’existence du philosophe andalou Ibn Tufayl (1105-1185)
Et c’est grâce à cette émission que j’ai appris l’existence du philosophe andalou Ibn Tufayl (1105-1185)
Rappelons que « Robinson Crusoé » est un roman écrit par l’auteur anglais Daniel Defoe et publié en 1719.
Cette émission m’a donc appris que près de 600 ans avant, cet auteur musulman a écrit l’histoire d’un homme sur une île déserte.
Il s’agit en fait d’un roman philosophique que l’on traduit en latin par « Philosophus autodidactus », et en français par « Le Vivant, fils de l’Éveillé ». L’original en arabe est « Hayy ibn Yaqdhan » ou « Ḥayy ibn Yaqẓān ».
C’est donc l’histoire d’un homme sur une île déserte. Il s’ouvre par la supposition d’un enfant né sans père ni mère. Il est adopté par une gazelle, qui l’allaite. Il grandit, observe, réfléchit. Doué d’une intelligence supérieure, non seulement il sait ingénieusement pourvoir à tous ses besoins, mais il arrive bientôt à découvrir de lui-même, par les seules forces de son raisonnement, les notions les plus élevées que la science humaine possède sur l’univers.
Lors de l’émission du 1er mars 2020, Ghaleb Bencheikh avait invité le philosophe Jean-Baptiste Brenet qui est professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où il enseigne la philosophie arabe. Jean-Baptiste Brenet vient de publier une adaptation de ce conte : « Robinson de Guadix, une adaptation de l’épître d’Ibn Tufayl, Vivant fils d’Éveillé » aux éditions Verdier (février 2020).
Kamel Daoud en a écrit la préface
Sur le site de France Culture, on lit :
« Écrit en arabe au XIIe siècle par le penseur andalou Ibn Tufayl, Vivant fils d’Éveillé est un chef-d’œuvre de la philosophie. L’épître dévoile sous la forme d’un conte les secrets de la « sagesse orientale ». Traduite en latin en 1671, elle connaîtra un immense succès dans l’Europe des lettres. Jean-Baptiste Brenet en propose ici une adaptation qui recompose le récit et donne la parole au personnage principal. Voici l’histoire d’un homme sur une île déserte, élevé sans père ni mère, qui découvre par sa raison seule la vérité de l’univers entier, puis qui rencontre un autre homme, religieux, mais sagace, venu d’une terre voisine. « Sorte de Robinson psychologique », écrivait Ernest Renan à propos du livre. Son premier auteur, Ibn Tufayl, est né à Guadix. »
Après cette émission j’ai trouvé un article de « L’Obs » du 29/02/2020 qui a eu la pertinente idée de faire dialoguer l’auteur avec le rédacteur de sa préface : Kamel Daoud.

L’article comme l’émission précisent que ce roman a été le texte arabe le plus lu dans le monde occidental après « le Coran » et « les Mille et Une Nuits », avant d’être totalement occulté, restant sous la forme de trace mémorielle pour le seul monde arabe et quelques doctes arabisants.
Kamel Daoud explique que
« Ce livre est un manifeste de liberté. Il se clôt sur un échec de « pédagogie », la radicalité de sa conclusion, mais c’est pour mieux l’exorciser. Sinon, conséquent avec son pessimisme, Ibn Tufayl n’aurait pas écrit l’histoire de Hayy. Il aurait choisi le silence et la vérité muette de l’insulaire, au lieu de revenir vers la cité avec un livre sous le bras proposé aux siècles à venir. On comprend mieux pourquoi il fut si célèbre à son époque, si connu et traduit durant le lent éveil du Moyen Age et pourquoi aujourd’hui il mérite de revenir et d’obséder. Car on ne peut plus parier sur l’invisible comme voie de salut, mais plutôt sur la liberté de le vouloir et d’aller au-delà des murs des royaumes, il reste que cette aventure est le mythe ultime de notre condition. S’y glisse une méfiance envers l’apparent, une distance prudente avec le Dogme et une empathie discrète envers ceux qui ne peuvent pas saisir l’envers cosmique de la Lettre, mais aussi la défense d’une liberté de croire et de découvrir qui restent incessibles. »
Dans cet article Jean-Baptiste Brenet précise : .-
« Sans qu’on l’ait prouvé, il est assez évident que Defoe a eu connaissance du texte d’Ibn Tufayl. Au XVIIIe siècle, d’ailleurs, plusieurs auteurs anonymes feront eux-mêmes la connexion entre le « Robinson » de Defoe et la fable du « Philosophe autodidacte. […]
Il croise à peu près tous les thèmes caractéristiques de la philosophie de l’Andalousie au XIIe siècle fondée sur Aristote, dont la modernité héritera. Cela va du développement de l’intellect, de l’ordre du savoir, de l’accès à la vérité et au « salut », jusqu’au rapport entre spéculation et « mystique », à l’accord entre philosophie et religion, ou bien à la nature politique de l’homme et au rôle social du philosophe.
Le prologue notamment est très instructif pour nous, puisqu’il dresse un bilan de la philosophie connue : on y voit passer Avicenne, Al-Farabi, Ibn Bajja, Aristote bien sûr ; mais aussi les soufis et le théologien Al-Ghazali, qu’Ibn Tufayl utilise de façon paradoxale dans un cadre philosophique. »
Et j’aime la réponse de Kamel Daoud à cette question : Ce texte, qu’a-t-il à dire au « musulman » du XXIe siècle ?
« On a ici un philosophe qui, dans un royaume, a osé réfléchir à haute voix – parce qu’écrire, c’est parler à haute voix mieux encore qu’avec sa propre voix – la question de la liberté, du salut, du bonheur, du sens, de la possibilité de sauver à la fois l’intuition et la Loi, la vision et la soumission. Ces questions se posent encore à nous aujourd’hui, et parfois de manière très violente :
Faut-il s’engager ou pas ?
Dois-je me rétracter sur mes propres convictions ou accepter l’usage du religieux au nom d’un ordre avec lequel je n’adhère plus ?
Doit-on être solidaire ou solitaire, à la fois ?
Qui est propriétaire de la religion ?
Qui a le droit d’en parler ?…
Que je sois d’accord ou pas avec lui, ce livre plaide pour la liberté de réfléchir des choses aussi fondamentales, il prêche l’individu, la singularité, le vivant et la vigilance, la possibilité de la raison. Il est nécessaire d’y revenir et de diffuser encore plus massivement des textes comme celui-ci pour prouver que penser librement la question religieuse ne date pas de maintenant mais a toujours existé, et que cela ne s’est pas toujours conclu avec des tragédies, des massacres ou des pendaisons. Et c’est d’autant plus urgent qu’il y a aujourd’hui des textes qui ont des royaumes, des principautés, des émirats derrière le dos, et qui nous font mal. Au fond, ce n’est pas nous qui revisitons ce texte, c’est lui qui vient nous revisiter, parce que c’est important. »
Je vous renvoie vers l’émission de Ghaleb Bencheikh «Questions d’islam : Le philosophe autodidacte »
<1369>
-
Jeudi 12 mars 2020
« Se laver les mains est une mesure très efficace et peu coûteuse pour éliminer germes, microbes et virus… »Découverte d’Ignace Philippe SemmelweisL’épidémie du Covid-19 a remis à l’honneur la discipline élémentaire et essentielle pour l’hygiène de se laver les mains.
Et ce rappel conduit au souvenir du médecin hongrois de Vienne : Ignace Philippe Semmelweis.
Plusieurs articles récents ont fait référence à cet homme essentiel qui fut rejeté par ses pairs et qui découvrit trop tôt ce que les gens de l’époque ne voulait entendre.
L’exergue du mot du jour est le titre d’un article du Monde publié le 13 février et écrit par Loïc Monjour, ancien professeur de médecine tropicale à la Pitié-Salpêtrière, Paris.
Dans cet article il écrit :
« Le nom d’Ignace Philippe Semmelweis, né à Budapest en 1818, est peu connu. Pourtant, depuis deux siècles, la plupart des femmes à travers le monde, de toutes conditions sociales, bénéficient de sa perspicacité et de ses travaux… Ce génie médical a aboli la tragédie des fièvres puerpérales (après l’accouchement) dans son service de la maternité de Vienne et découvert l’importance de l’asepsie avant le grand Pasteur.
Ses étudiants en médecine pratiquaient des autopsies avant de se rendre à la maternité pour effectuer des examens de femmes en travail ou procéder à des accouchements. La mortalité des parturientes était considérable, et Semmelweis, après une véritable enquête épidémiologique, imposa aux étudiants de se laver les mains avant toute intervention obstétricale, non pas avec du savon, mais avec une solution de chlorure de chaux, une initiative inconnue à l’époque.
Par cette seule mesure, le pourcentage de décès causés par la fièvre puerpérale s’effondra de 12 % à 3 %. Il allait révéler à ses confrères le danger que représentent ces infections que l’on appelle aujourd’hui « manuportées » et « nosocomiales » et l’intérêt de l’utilisation d’un antiseptique pour y parer. Mais, sans appui officiel, n’ayant pas su convaincre, peu à peu, il sombra dans la démence et mourut à 47 ans. »
Guillaume Erner dans sa chronique du 9 mars a également rendu hommage à ce précurseur :
« C’est ça l’intérêt du Covid : maintenant je peux vous demander sans passer pour un type un peu étrange si vous vous êtes lavé les mains… Lave toi les mains, ne dis pas bonjour à la dame, jette moi ce mouchoir, nous sommes tous devenus des parents, je veux dire des parents avec des gens qui ne sont manifestement pas nos enfants. Les délires les plus hygiénistes ont désormais complètement droit de cité. […]
Le Covid accompagne le retour en force d’Ignace Philippe Semmelweis, médecin obstétricien hongrois du XIX e siècle, lequel a beaucoup fait pour l’espèce humaine, en obligeant ses semblables à se laver les mains. C’est que l’on doit à Semmelweis : l’éradication de la fièvre puerpérale. Ce médecin avait découvert qu’il fallait se laver les mains après avoir procédé à une dissection de cadavre et avant de se livrer à un accouchement. Mais, hélas, le destin de Semmelweis fut d’être un Galilée du savon, je veux dire qu’il fut persécuté pour ce conseil étrange, il mourut à l’asile pour avoir suggéré à ses contemporains de se laver les mains…
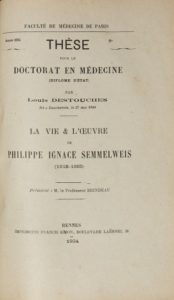
Et qui pris la plume quelques années plus tard pour défendre cet homme ?
Louis Ferdinand Céline, romancier mais aussi médecin, Céline consacra sa thèse de médecine, en 1924, à la vie et à l’œuvre de Semmelweis, ce qui évidemment n’arrange pas la mémoire de Semmelweis, je m’en voudrais de franchir le point Céline avant 7 h du matin.
L’épidémie de coronavirus marque une nouvelle victoire posthume de Semmelweis : l’idée que le salut de l’espèce passe désormais non seulement par le savoir, mais aussi et surtout par le savon. »
Le Figaro a publié le 9 mars 2020 : <Ignace Philippe Semmelweis, martyr du lavage des mains>
Et, Slate a publié un article le 10 mars 2020 : <Semmelweis, le médecin hongrois qui apprit au monde à se laver les mains> qui rappelle un peu plus précisément le destin de ce médecin :
« Vienne, été 1865. Dans l’asile psychiatrique du quartier de Döbling, au nord de la capitale autrichienne, un savant hongrois rongé par la démence vit sans le savoir ses deux dernières semaines. Interné par ses amis et ses parents, Ignace Semmelweis n’est plus que rage et rancœur contre un monde abhorrant son avant-gardisme. Le personnel de l’institution répond par les coups à la violence de l’homme dont la santé mentale s’est considérablement détériorée en quelques années. Le 13 août, Semmelweis succombe à ses blessures, laissant un héritage médical seulement reconnu post-mortem. »
Et il raconte son histoire :
« Deux décennies plus tôt, le praticien budapestois réalisa la découverte qui le rendit aussi fou que célèbre. En 1847, une femme sur cinq meurt en couches de la fièvre puerpérale dans le service de l’hôpital viennois où l’obstétricien officie. La même année, un ami professeur d’anatomie décède d’une infection similaire à celle des mères après s’être coupé le doigt avec un scalpel.
Semmelweis prescrit un lavage des mains via une solution d’hypochlorite de calcium entre le travail à la morgue et l’examen des patientes. La mortalité dévisse, Ignace a vu juste, mais le corps médical niera longtemps l’évidence.
[…] Semmelweis redoutait les cercles savants de Vienne et attendra le crépuscule de son existence avant d’assumer sa trouvaille. La majorité des scientifiques de l’époque, acquis à la médecine antique, pensaient que toute maladie résulte d’un déséquilibre des quatre éléments fondamentaux (air, feu, eau, terre) imprégnant le corps humain.
Qu’à cela ne tienne, le médecin hongrois étendit ses mesures d’hygiène aux instruments sollicités pour l’accouchement et éradiqua quasiment la fièvre puerpérale. Craignant l’influence croissante du Hongrois, le professeur Johann Klein le chassa de son service en 1849.
Semmelweis demande à obtenir un poste de professeur non rémunéré en obstétrique mais n’obtiendra gain de cause qu’au bout de dix-huit mois, sans accès aux cadavres et avec l’obligation d’utiliser des mannequins. Humilié, le praticien regagne sa Budapest natale et prend la direction de la maternité de l’hôpital Szent-Rókus de Budapest.
La recette Semmelweis fait de nouveau des miracles. Entre 1851 et 1855, seules huit patientes meurent de la fièvre puerpérale sur les 933 naissances enregistrées durant la période. Le praticien devient professeur et instaure le lavage des mains dans la clinique de l’université de Pest.
Semmelweis se marie, décline une offre à Zurich, rédige une série d’articles défendant sa méthode controversée et tacle le scepticisme de ses pairs dans un ouvrage de 1861 compilant ses découvertes. Fâché par plusieurs critiques défavorables de son livre, Semmelweis attaque ses détracteurs comme Späth, Scanzoni ou Siebold en les traitant de «meutriers irresponsables» et de «sombres ignorants» via une série de lettres ouvertes amères et courroucées. Médecins et biologistes allemands, emmenés par le pathologiste Rudolf Virchow, rejettent énergiquement sa doctrine. Le début de sa descente aux enfers. […]
Sa volonté de convaincre l’ensemble de ses confrères du bien-fondé de ses théories vire à l’obsession. Semmelweis n’a plus que la fièvre puerpérale en tête. Des portraits réalisés entre 1857 et 1864 montrent un état de vieillissement avancé, la quarantaine à peine passée. Les syndrômes de la dépression nerveuse l’envahissent. Au milieu de l’année 1865, son attitude préoccupe ses collègues et ses proches. Il sombre dans l’alcoolisme, s’éloigne de plus en plus souvent de sa famille et cherche le réconfort en fréquentant des péripatéticiennes. Son comportement sexuel intrigue son épouse Mária.
Le célèbre chirurgien János Balassa, pionnier de la réanimation cardiaque et médecin traitant de Semmelweis, monte une commission recommandant son placement en établissement spécialisé. Le 30 juillet, son ancien professeur Ferdinand Ritter von Hebra, partageant dès 1847 les découvertes de Semmelweis dans une revue médicale viennoise de renom, l’attire vers l’asile où il mourra en prétendant lui faire visiter l’un de ses nouveaux instituts locaux. Comprenant le piège, Semmelweis tenta de fuir avant d’être frappé par des gardes, mis en camisole et enfermé dans une cellule sombre. »
En 2013, l’Unesco adouba le «sauveur des mères» dont l’université de médecine de Budapest porte le nom en inscrivant ses constatations sur la fièvre puerpérale au patrimoine mondial de l’humanité. Aujourd’hui, plus personne ne conteste la nécessité de se désinfecter les mains afin d’éviter la propagation des maladies. Surtout en pleine épidémie de coronavirus.
Il y a encore du travail en France. Le premier article cité donne les informations suivantes :
« Dans une étude internationale portant sur 63 nations, la France se trouve en 50e position en ce qui concerne l’hygiène des mains. L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) concluait en 2012 que seulement 67 % des Français se lavent les mains avant de cuisiner, 60 % avant de manger et à peine 31 % après un voyage en transport en commun. Dans les toilettes publiques, 14,6 % des hommes et 7,1 % des femmes négligent ce geste de propreté élémentaire. »
 En janvier 2017, un mot du jour avait déjà été consacré à « Ignace Philippe Semmelweis »
En janvier 2017, un mot du jour avait déjà été consacré à « Ignace Philippe Semmelweis »
<1368>
-
Mercredi 11 mars 2020
« La plus grande menace qui nous guette, c’est une coronapanique »Philippe Juvin chef de service des urgences de l’hôpital Georges-Pompidou de ParisCertes, c’est une épidémie, certes on n’a pas de vaccin, certes on n’a pas vraiment de médicament pour guérir cette maladie du Covid19 qui a débuté en décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine.
Maladie qui est provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2.
Mais quand même !
Je ne suis pas certain que nous sommes en face d’un grave danger de santé publique, mais je suis certain que nous sommes entré dans une très grave crise économique en raison des réactions très fortes des autorités pour essayer d’éviter que le virus ne pénètre sur le territoire nationale (c’est raté !), ne se propage (c’est raté aussi !) et aujourd’hui ne se propage trop vite.
Dans son émission <Mediapolis> Olivier Duhamel a passé une interview sur LCI dans laquelle : Philippe Juvin chef de service des urgences de l’hôpital Georges-Pompidou de Paris s’exprimait :
« La plus grande menace qui nous guette, c’est une coronapanique. Quand les bus ne circulent pas, les infirmières et les médecins ne peuvent peut pas venir travailler. Quand le centre 15 est submergé d’appels de gens qui ont peur qu’est ce qui se passe en pratique ? Eh bien, si vous faites un infarctus et que vous appelez les secours, vous allez devoir attendre au moins une heure avant d’avoir un médecin. Ou si vous avez un problème de crise d’asthme grave, vous n’allez pas pouvoir joindre les secours. Et là, vous êtes en vrai danger. Notre système est en train de basculer assez dangereusement vers une forme de désorganisation parce que vraiment, parfois, on en fait trop. Evidemment, on parle d’une maladie grave, mais le plus grand danger du coronavirus, c’est la désorganisation du système de soins. C’est devenu un vrai risque. »
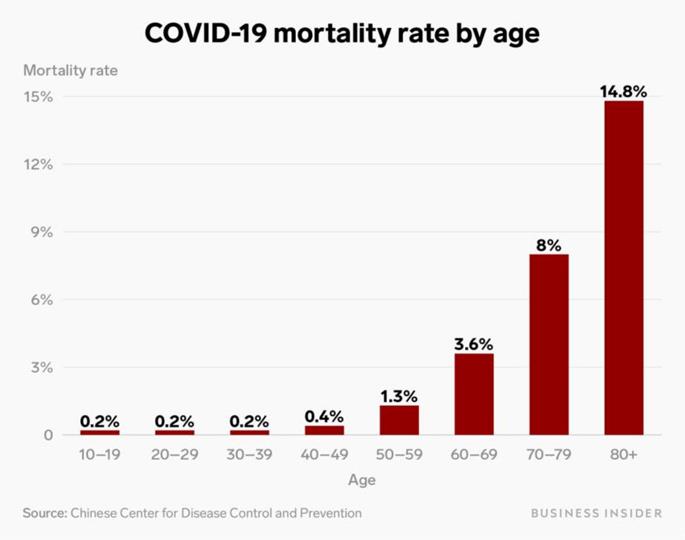 Le magazine de l’Obs renvoie vers un article de <businessinsider> qui donne les taux de mortalité du coronavirus selon les tranches d’âge.
Le magazine de l’Obs renvoie vers un article de <businessinsider> qui donne les taux de mortalité du coronavirus selon les tranches d’âge.
Ce site précise :
« Tout le monde n’est pas égal face au Covid-19. C’est ce que démontre une récente étude du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies : le virus affecte plus gravement les personnes âgées ayant des problèmes de santé préexistants. En outre, des recherches avancent qu’environ 80 % des cas de coronavirus seraient bénins.
Pour réaliser cette étude, les données concernant plus de 44 000 patients confirmés en Chine ont été recueillies jusqu’au 11 février. Il s’agit de l’une des plus larges représentations des effets du Covid-19 sur l’homme. Ces données suggèrent que les risques de mourir de la maladie augmentent avec l’âge. L’étude ne fait état d’aucun décès chez les enfants de moins de 10 ans, qui représentent moins d’1 % des patients. Les patients âgés de 10 à 19 ans auraient autant de risques de mourir que les trentenaires.
Voici le taux de mortalité pour chaque tranche d’âge, selon l’étude :
Le risque de mortalité serait nettement plus élevé chez les patients âgés de plus de 70 ans, probablement car nombre d’entre eux ont des problèmes de santé préexistants. Les patients atteints de coronavirus et de maladies cardiaques, par exemple, auraient un taux de mortalité d’environ 10 %, selon l’étude, tandis que ceux atteints de diabète auraient un taux de mortalité d’environ 7 %. Environ trois quarts des patients chinois n’avaient pas de problèmes de santé préexistants. Le taux de mortalité pour ce groupe serait légèrement inférieur à 1 % »
Lorsque des journaux ont annoncé un quatrième mort en France du coronavirus, âgé de 92 ans, j’ai réagi sur un réseau social pour dénoncer ce que j’ai appelé une fake news ou au minimum une information très exagérée.
Dans ma vision du monde, l’information exacte est :
« Un homme de 92 ans est mort de vieillesse dans le Morbihan.
On apprend que lors des dernières heures de vie, il a été détecté positif au virus Covid19. »
C’est tout de suite moins anxiogène, mais plus proche de la réalité.
Le même site qui donne ce tableau et ces analyses, compare la mortalité du COVID-19 (3,4%) aux autres coronavirus par exemple EBOLA 40,4% sur moins de pays (9) et d’autres dont la mortalité est encore plus importante mais sur des populations infectées beaucoup moins nombreuses.
Il en est qui estime qu’il est bon de paniquer. Et c’est notamment le cas de Nassim Nicholas Taleb
Nassim Nicholas Taleb s’est fait connaître dans le monde entier avec son livre « Le Cygne noir« paru en 2007. Juste avant le déclenchement de la crise des subprimes, il expliquait la fragilité des modèles utilisés dans la finance et leur aveuglement face aux événements extrêmes, imprévisibles, mais qui se produisent toujours plus souvent qu’on ne le croit. Son livre a été l’essai le plus vendu dans le monde avec 3 millions d’exemplaires. Il est en quelque sorte le spécialiste des catastrophes. J’avais consacré un mot du jour de 2014 à son autre ouvrage : « Antifragile » dans lequel il développait la thèse des objets ou des êtres antifragiles que l’adversité ou les chocs renforçaient. Cela peut d’ailleurs être le cas d’un virus qui peut dans un environnement qui lui est hostile muter et devenir plus virulent.
Taleb écrit dans <Le Point> les réactions de panique sont rationnelles, car elles empêchent le pire d’advenir. Il précise d’ailleurs que s’il faut paniquer, il vaut mieux le faire au début quand il est possible d’agir et non à la fin où il est possible que ce soit trop tard.
Guillaume Erner résume la pensée de Nassim Taleb de la manière suivante :
« Taleb, c’est le papa du Cygne noir, le cygne noir, je veux parler de l’oiseau. Je vous explique le principe : Taleb affirme que les sociétés modernes sont exposées à des évènements de probabilités faibles mais aux conséquences dévastatrices. L’exemple type, c’est le 11 septembre 2001 : un attentat de cette ampleur a peu de chances de se produire, mais s’il se produit c’est une catastrophe à tous les niveaux, humaine bien sûr, mais aussi géopolitique, économique, etc.
Et pourquoi baptiser un évènement à la probabilité faible mais aux conséquences infinies un cygne noir ? Eh bien tout simplement parce que pendant longtemps les ornithologistes ont cru que tous les cygnes étaient blancs, puis ils en ont croisé un noir, et cette découverte les a conduits à réviser leur vision de cette espèce animale.
Mais là en l’occurrence, le cygne noir, c’est un virus — le covid 19 — et pour Taleb, il est aujourd’hui absolument rationnel de paniquer. Le philosophe cite même en exemple Singapour, la cité état est susceptible de décider de fermer ses frontières en 14 minutes, et c’est admirable car, selon lui, seuls les paranoïaques, en pareil cas survivent.
D’où cette interrogation sur la rationalité de la panique. Si par rationalité, on entend bonne raison de paniquer, alors oui nous avons une bonne raison, donc ce virus nouveau, un virus mal connu, contre lequel on dispose de peu de traitements. Oui, mais dans le même temps, cette panique entraîne des conséquences dévastatrices, sur le plan économique notamment, au point de se demander, s’il n’y a pas sur réaction, et si la vraie catastrophe n’est pas causée par cette sur réaction. Autrement dit, quelle est la rationalité de l’irrationalité, est-il raisonnable de paniquer, ou la panique est-elle créée par notre comportement déraisonnable ?
Oui mais, dans le même temps, si nous ne paniquons pas et si la situation devient paniquante, on nous reprochera bientôt d’avoir été déraisonnable au point d’avoir voulu rester raisonnable… C’est cela qui est compliqué avec la déraison, c’est que l’homme a toujours de bonnes raisons d’être déraisonnable. »
Je préfère cet article de l’Obs : « pourquoi il ne faut pas s’affoler face à l’épidémie (sans la sous-estimer) » :
« Quand quelqu’un de 85 ans meurt du coronavirus, ce n’est pas le coronavirus qui le tue », mais plus souvent « les complications qui atteignent des organes qui n’étaient pas en bon état.
[…] pour le professeur français Jean-Christophe Lucet, le risque concerne avant tout les patients atteints des formes sévères de ces maladies. « Il faut être extrêmement clair » sur ce point, souligne-t-il à l’AFP.
« Le patient qui a un diabète, le patient qui a une hypertension artérielle, c’est des patients qui ne sont pas des patients à risques », rassure-t-il. « Les patients à risques, ce sont ceux qui ont des maladies cardiaques graves, des maladies respiratoires sévères, par exemple des bronchopneumathies chroniques obstructives (BPCO) avancées. »
Mais la dangerosité d’une maladie ne dépend pas seulement du taux de mortalité dans l’absolu, mais aussi de sa faculté à se répandre plus ou moins largement. « Même si seuls 3 % des cas décèdent, ça peut faire des chiffres importants si 30 % ou 60 % d’une population sont infectés », souligne le Dr Simon Cauchemez, de l’Institut Pasteur à Paris. »
Alors bien évidemment, tous les conseils d’hygiène devant l’épidémie : éviter de se serrer la main et de s’embrasser, se laver les mains fréquemment, tousser ou éternuer dans le creux de son coude ou dans un mouchoir jetable, porter un masque si on est malade…, sont judicieux et rationnel.
Mais pour le reste, par exemple l’annulation de tous les spectacles regroupant 1000 personnes ou plus qui mettent en péril la survie d’organisateurs de spectacles ainsi que des métiers et services qui sont liés à cette activité, est ce bien raisonnable ?
Il semble que la crainte des autorités soient liée au risque, dans l’hypothèse d’une propagation rapide de l’épidémie, que les hôpitaux français soient débordés et ne disposent pas des moyens pour faire face aux cas les plus graves, notamment ceux nécessitant une aide respiratoire. Ce qui aurait la double conséquence de créer une surmortalité et de faire monter davantage encore la panique dans la population. Ce mot du jour n’a pas pour vocation de nier la gravité de l’épidémie mais de s’interroger sur un vent de panique entretenu par les médias qui risquent d’être contre productif du point de vue de la santé, d’autres malades graves n’accédant plus aux soins et de l’économie qui risque de créer d’autres problèmes graves.
Le coronavirus présente cependant plusieurs potentialités :
Il a montré davantage que de longs récits notre immense dépendance par rapport à la Chine.
Quand la Chine ne produit plus, nos industries sont en panne de produits, de matériaux indispensables à leurs cycles de production.
Et si je savais ce que nos smartphones, nos voitures et nos produits hi tech devaient aux usines chinoises, j’ignorais notre dépendance à la Chine concernant les médicaments.
<80% des produits actifs des médicaments> sont fabriqués en Chine. Cette situation nous met dans une situation de fragilité extrême.
La crise du coronavirus va probablement entraîner une évolution de cette situation.
Et une autre conséquence positive du COVID-19, si elle atteint de manière conséquente les Etats-Unis ,pourrait être de contribuer à faire battre Donald Trump. D’abord parce que cela dégraderait la situation économique dont Trump veut faire un levier pour sa réélection, ensuite parce qu’il a, comme d’habitude, raconté une myriade de stupidités qui pourraient lui nuire si les faits démontrent ses erreurs.
<1367>
-
Mardi 10 mars 2020
« L’oursin vorace »Anagramme de Jacques Perry-SalkowJacques Perry-Salkow est un génie de l’anagramme. Il a écrit un livre avec Etienne Klein « Anagrammes renversantes ou Le sens caché du monde » dont j’avais parlé lors du mot du jour 12 février 2015
Je rappelle qu’une anagramme (le mot est féminin) – du grec ανά, « en arrière », et γράμμα, « lettre », anagramma : « renversement de lettres » – est une construction fondée sur une figure de style qui inverse ou permute les lettres d’un mot ou d’un groupe de mots pour en extraire un sens ou un mot nouveau.
Il a donc trouvé cette anagramme.
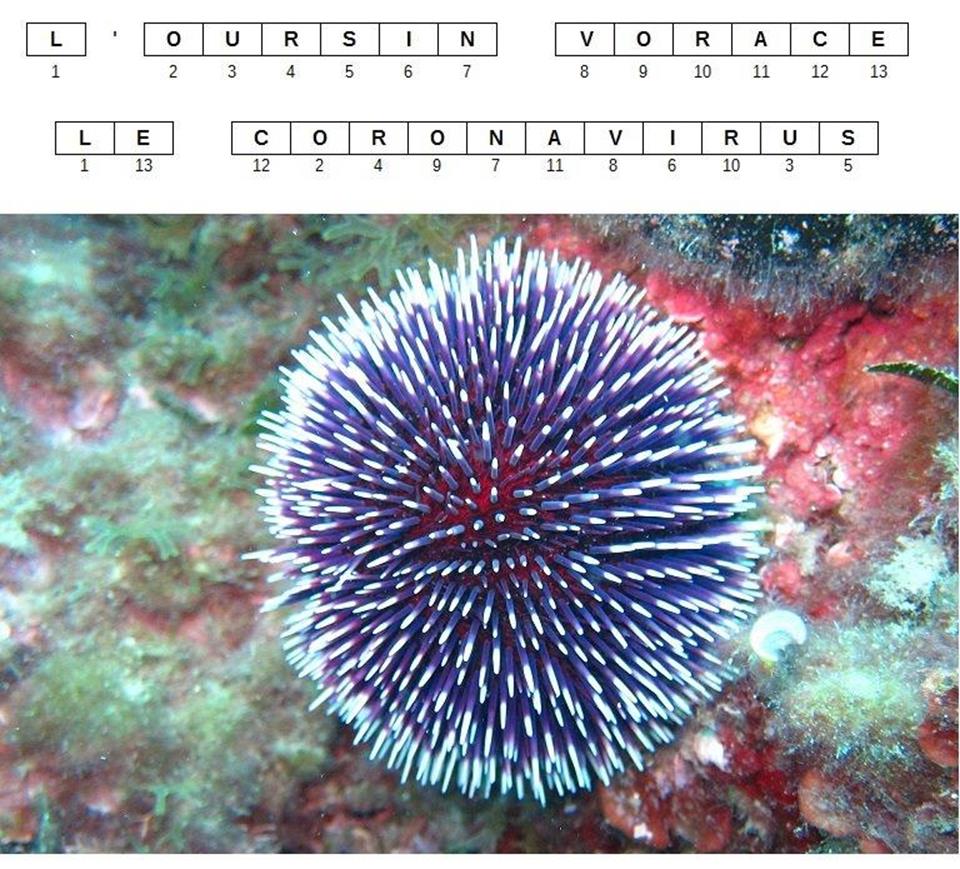
<1366>
-
Lundi 9 mars 2020
« Des millions de non nées »Dans certains pays du monde, la naissance des filles est contrariéeCe dimanche nous étions le 8 mars. Selon l’appellation officielle de l’ONU, on célébrait « la Journée internationale des femmes ». En France, il a été décidé de l’appeler « journée internationale des droits des femmes ».
Il y a cinq ans, j’avais consacré un mot du jour sur une violence particulière exercée sur les femmes : l’interdiction de naître, < Il nait de moins en moins de femmes dans le monde >
Un article récent de <TV5 Monde> montre qu’il n’y a pas d’amélioration sur ce front :
« Ainsi le monde commence-t-il à faire face à une « carence » de femmes en âge de procréer, qui pourrait conduire à terme à des déséquilibres démographiques lourds de conséquences. D’autant que la population globale vieillit, surtout dans les pays dits développés, tout en continuant à croître – d’ici à 2050, la Terre devrait compter 9 milliards d’habitants.
La masculinisation de la population varie selon les régions du monde. C’est d’abord en Asie que la proportion de garçons a commencé à augmenter parmi les nouveau-nés au début des années 1980 – au rythme des progrès de la science et des méthodes d’analyses prénatales. Et c’est en Inde et en Chine, qui représentent à eux deux 37 % de la population mondiale, que le déséquilibre est le plus inquiétant.
Les deux pays les plus peuplés au monde souffrent d’une évidente carence de femmes. Depuis plusieurs décennies, la Chine, le pays le plus peuplé du monde, présente un « rapport de masculinité » nettement plus élevé que la moyenne – dans certaines régions, il dépasse 120 garçons pour 100 filles. Et dans de nombreuses régions de l’Inde, ce rapport est aussi nettement supérieur à 105, également depuis des décennies. En dépit d’une amélioration dans les États les plus touchés au Nord-Ouest (Pendjab, Haryana, Rajasthan), plusieurs autres États comme l’Uttar Pradesh ou le Maharashtra, autrefois épargnés, semblent aujourd’hui atteints.
Dans ces deux pays, qui comptent en tout 2,76 milliards d’habitants, il y a environ 80 millions d’hommes de plus que le nombre jugé souhaitable, et plus de la moitié d’entre eux ont moins de 20 ans. « Rien de tel ne s’est jamais produit dans l’histoire de l’humanité », écrivait le Washington Post dans un article paru en avril 2018. »
Ce problème est aussi dans d’autres pays d’Asie, comme le Vietnam, le Népal ou le Pakistan, le nombre de garçons dépasse aussi celui des filles de plus de 10
Mais une partie de l’Europe est aussi concerné par ce phénomène :
« l’Europe orientale n’est pas en reste, même si elle pèse moins lourd dans la balance démographique. Depuis au moins 20 ans, il y naît bien plus de garçons que de filles, notamment dans le Caucase et les Balkans, où le sexe-ratio à la naissance se situe entre 110 et 117 pour 100 filles – soit davantage que la moyenne en Inde. L’Azerbaïdjan est le deuxième pays au monde après la Chine en termes de déséquilibre des sexes à la naissance. Durant la décennie 2000, on a même décompté en Arménie jusqu’à 185 garçons pour 100 filles parmi les troisièmes naissances, sans aucun doute un record mondial. En Albanie, au Kosovo, au Monténégro et en Macédoine occidentale, les niveaux avoisinent 110-111 naissances de garçons pour 100 filles, avec une redoutable régularité. »
Il est bien évident que ce niveau d’inégalité ne peut en aucune façon s’expliquer par des phénomènes naturels. Il y a intervention humaine pour arriver à un tel déséquilibre.
Pourquoi dans ces pays, les parents agissent pour diminuer les naissances de femme ?
« Les raisons de ces déséquilibres sont diverses. En Asie, plusieurs facteurs plaident en défaveur des femmes, à commencer par les coutumes, les croyances religieuses ou les considérations économiques. En Inde, mettre au monde une fille est vécu comme un risque pour la famille : destinée à se marier, elle devra remettre une dot puis se consacrera à sa belle-famille. Un garçon, au contraire, apportera aide et sécurité à ses parents. En Chine comme en Inde on préfèrera, selon sa catégorie socioprofessionnelle, investir dans un examen prénatal et choisir d’avorter plutôt que s’endetter toute une vie pour subvenir à l’éducation et au mariage d’une fille.
En Inde et au Pakistan, où il manque 5 millions de femmes, la pauvreté de nombreuses familles pousse ces dernières à préférer les garçons aux filles ; lors des mariages, la famille de l’épouse doit verser une dot à celle du marié, un coût que tous ne peuvent pas se permettre. Par ailleurs, on estime que les hommes sont plus productifs que les femmes, et en cela plus « rentables » pour les familles les plus démunies.
Il en va de même en Chine. En 1979, l’instauration de la politique de l’enfant unique, en vigueur jusqu’en 2015, ainsi que le développement progressif des techniques d’échographie ont fait beaucoup de tort au genre féminin, les parents préférant bien souvent donner naissance à un fils (les « enfants-empereurs »). Car s’il faut choisir, on garde le garçon qui, dans la tradition confucéenne, peut seul succéder aux parents et perpétuer le culte des ancêtres. »
Les techniques, la science sont mis en en œuvre pour poursuivre cette stratégie dans ces pays : privilégier la naissance de jeunes males d’homo sapiens :
« Des millions de non-nées
En 2016, le centre asiatique pour les droits de l’homme a évalué à environ 1,5 million le nombre de foetus féminins éliminés chaque année. En Chine, 35 années de politique de l’enfant unique ont causé la disparition de millions de filles par avortements sélectifs ou infanticide. Même chose pour l’Inde où ces pratiques ont considérablement réduit la population féminine, essentiellement dans le nord du pays. Difficile de naître fille en Asie.
Si, un temps, l’infanticide au féminin – la mise à mort des nouveaux-nés filles – était couramment pratiqué dans ces pays, la science a depuis progressé, rendant ce « gynécide » plus facile et contrôlable. Le développement de l’insémination artificielle permet de sélectionner avant la naissance le sexe de l’enfant. Les échographies déterminent de plus en plus tôt si le bébé à naître est un garçon ou une fille (pouvant conduire ou non à l’avortement sélectif). Or généralement, les familles, pour les raisons culturelles et/ou sociales évoquées plus haut font le choix d’avoir un ou plusieurs garçons.
La Chine et l’Inde accusent actuellement un déficit global de femmes d’environ 160 millions. Le nombre de « femmes manquantes » devrait même atteindre les 225 millions en 2025. A terme, si la proportion de filles par rapport aux garçons continue d’être aussi déséquilibrée, c’est tout un pan de la population qui ne pourra pas être renouvelé.
Des études montrent déjà que 94% des célibataires de 28 à 49 ans en Chine sont des hommes, qui pour la plupart, n’ont pas terminé leurs études secondaires. Certains craignent qu’une masculinisation trop importante de la société chinoise n’entraîne une hausse nette de la violence et du crime.
On assiste aussi à une augmentation des mariages par correspondance (mariages forcés avec des femmes venant de l’étranger), notamment en Chine. Beaucoup de Chinois se tournent vers l’étranger et notamment la Birmanie pour trouver une femme, parfois via un mariage arrangé
Pour des raisons socio-économiques, il faut aussi s’attendre à un ralentissement du taux de natalité dans les pays concernés d’ici 20 à 40 ans. D’où un vieillissement de la population et, à terme, un net ralentissement de ces économies pour l’instant très dynamiques. Parallèlement, la population devrait se féminiser, puisque l’espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes. »
Peu à peu il y a pourtant une prise de conscience des conséquences délétères de ces choix de naissance :
Certains pays ont anticipé ces impasses en prenant des mesures. La Corée du Sud, par exemple, qui au début des années 1990, présentait l’un des sexe-ratio les plus déséquilibrés du monde (près de 1200 hommes pour 1000 femmes) l’a fait baisser jusqu’à 106 garçons pour 100 filles actuellement. Ce « retour à la normale » s’explique tant par l’amélioration du statut des femmes que par les mesures prises par le gouvernement pour enrayer les avortements sélectifs et une importante campagne de communication autour du danger d’une disproportion hommes/femmes.
Des campagnes similaires ont été lancées en Inde : devant le nombre des familles recourant à l’avortement sélectif en fonction du sexe pour choisir les garçons, le gouvernement a adopté une loi interdisant le dépistage du fœtus et ce type d’intervention. En Chine, un assouplissement de la politique de l’enfant unique, notamment dans les campagnes, pourrait amener à rétablir un semblant d’équilibre des sexes dans le pays. Cependant il faudra attendre une vingtaine d’années avant que les premiers effets de ces politiques se fassent sentir.
En Europe du Sud et Caucase, de récents efforts de compréhension du phénomène sont plus le fait d’une mobilisation internationale que d’une prise de conscience de la population, et ils n’ont pas encore débouché sur des mesures concrètes. »
L’article propose une carte montrant le déséquilibre homme femme dans le monde
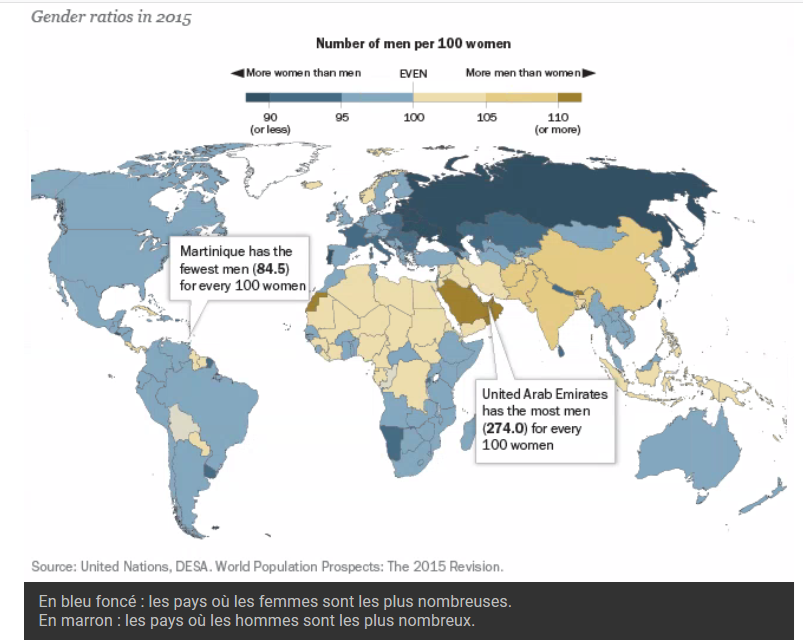 Il ne s’agit pas des naissances mais du nombre d’hommes et de femmes dans le pays.
Il ne s’agit pas des naissances mais du nombre d’hommes et de femmes dans le pays.
Dans les pays qui n’interviennent pas sur le choix du sexe à la naissance, les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes sont majoritaires.
En Russie, la situation est encore plus déséquilibrée, car il y a une surmortalité des hommes.
En Arabie Saoudite qui avec la Mauritanie est l’Etat qui compte le moins de femmes dans sa population, cette situation s’explique par le fait qu’une grande partie de la main d’œuvre est d’origine étrangère et les travailleurs migrants n’ont bien souvent pas la possibilité de faire venir leurs familles. D’où d’énormes déséquilibres statistiques, avec parfois plus de 2000 hommes pour 1000 femmes.
Et on constate que le phénomène dénoncé dans cet article se situe essentiellement en Afrique du Nord et au sud de l’Asie.
<1365>
-
Vendredi 6 mars 2020
« Du simple point de vue de l’équité et de la démocratie, pourquoi faudrait-il qu’il y ait indignation au-delà de l’Atlantique et résignation en deçà ? »Robert Guédiguian, Philippe Meyer et Bertrand TavernierEn raison des primaires démocrates, les médias parlent beaucoup des élections présidentielles américaines.
Election américaine totalement incompréhensible pour nous autres français.
En 2016, Trump a été élu alors que 65 853 514 bulletins s’étaient portés vers Hillary Clinton et que le président élu n’avait eu que 62 984 828 voix.
Si on calcule de la manière française on constate que Clinton a obtenu 51,1% et Trump 48,9%.
C’est un scandale ! Un déni de démocratie.
Mais on nous a expliqué que c’était en raison du caractère fédéral des Etats-Unis et que ce contexte rend nécessaire que chaque Etat des Etats-Unis puisse jouer un rôle suffisamment important dans cette élection et qu’il n’est donc pas possible de simplement compter les voix individuels qui donnerait un trop grand poids aux Etats peuplés et marginaliserait totalement les petits Etats.
Et c’est ainsi que les étatsuniens ont eu cette idée
- de faire élire le président par des grands électeurs
- que chaque Etat choisit un candidat (Dans le Maine et le Nebraska cette règle s’applique à des arrondissements de l’Etat ce qui a pour conséquence que ces deux Etats peuvent envoyer des grands électeurs de plusieurs candidats)
- et qu’alors tous les grands électeurs de l’Etat de ce candidat participeront au collège électoral qui élira le président.
Et le point fondamental étant que le nombre de grands électeurs de chaque État tient compte du nombre d’habitants mais de manière très pondérée.
La Californie qui a voté pour Clinton compte 55 grands électeurs, le Wyoming qui a voté Trump 3.
Mais la Californie compte 39 550 000 habitants ce qui fait qu’un grand électeur vaut 719 000 habitants et le Wyoming 577 000 habitants ce qui signifie qu’un grand électeur représente 192 000 habitants. Le rapport entre ces quotients est supérieur à 3,5.
Si on calcule par rapport aux nombres de votants : En Californie 8 753 788 électeurs ont voté Clinton chaque grand électeur pèse donc 159 160 électeurs alors que dans le Wyoming Trump a eu 174 419 voix et chaque grand électeur pèse alors 58 140 électeurs, le rapport entre les deux est de 2,7.
A la fin Trump a battu Clinton 304 grands électeurs à 227.
Dans le Wisconsin 22 748 voix séparaient Trump de Clinton soit 0,82% de l’ensemble voix que les deux ont obtenus. Cet Etat a donné 10 grands électeurs à Trump.
En Floride 112 911 voix séparaient Trump de Clinton sur les 9 122 861 que les deux avaient obtenus. Cet Etat a donné 29 grands électeurs à Trump.
L’inversion de ces deux Etats aurait donné 266 grands électeurs à Clinton et 265 à Trump.
C’est un mode d’élection donc totalement incompréhensible pour un français, une telle chose ne peut pas exister dans notre pays et nos traditions !
Descartes, Rousseau et Voltaire ne l’accepteraient pas.
Vous en êtes sûr ?
 Connaissez-vous la Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon, dite « Loi PLM » (ça sonne mieux que PML)
Connaissez-vous la Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon, dite « Loi PLM » (ça sonne mieux que PML)
Toujours en vigueur.
<Le Point> explique cette Loi.
D’abord il faut comprendre comment cela se passe dans les autres villes de France.
« Aux élections municipales, le mode de scrutin varie selon le nombre d’habitants. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il est majoritaire.
Dans celles comptant plus de 1 000 habitants, l’élection du maire est le résultat d’un scrutin proportionnel avec prime majoritaire. C’est-à-dire que la liste arrivée en tête emporte mécaniquement la moitié des sièges. L’autre moitié est répartie à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages. »
Prenons un second tour où 3 listes s’affrontent. La liste A reçoit 40,1% des voix la B 39,9% et la C 20%.
Supposons, pour être simple que le Conseil municipal comporte 100 membres.
La prime majoritaire donne 50 sièges à la liste A.
Les 50 restants sont distribués à la proportionnelle. Donc 20 pour A, 20 pour B et 10 pour C.
La liste A a donc 70% des sièges pour 40 % des voix. C’est arithmétiquement faux mais politiquement efficace.
Passons à PLM :
 « Un mécanisme électoral que l’on retrouve à Paris, Lyon et Marseille. À cette différence près que ces villes sont divisées en secteurs. Chaque secteur électoral correspond à un arrondissement de Paris ou de Lyon, mais à Marseille, on compte deux arrondissements par secteur. Cette division a été décidée en 1982 dans la loi PLM voulue par le ministre de l’Intérieur de l’époque, Gaston Defferre, ancien maire de Marseille.
« Un mécanisme électoral que l’on retrouve à Paris, Lyon et Marseille. À cette différence près que ces villes sont divisées en secteurs. Chaque secteur électoral correspond à un arrondissement de Paris ou de Lyon, mais à Marseille, on compte deux arrondissements par secteur. Cette division a été décidée en 1982 dans la loi PLM voulue par le ministre de l’Intérieur de l’époque, Gaston Defferre, ancien maire de Marseille.
Les élections ont lieu au sein de chaque arrondissement suivant les règles du scrutin majoritaire comme dans les communes de plus de 1 000 habitants. Les inscrits élisent leurs conseillers d’arrondissement et leurs conseillers municipaux, qui siégeront pendant six ans au conseil de la ville. Ces derniers procèdent à l’élection du premier magistrat de la ville et de ses adjoints.
Un système « à l’américaine » où le maire est élu par son conseil municipal pourvu qu’il ait remporté un nombre suffisant d’arrondissements. Si ce mode d’élection permet de dégager une majorité claire, il ne rend pas certaine la victoire de la liste ayant remporté le plus de suffrages. En effet, de très bons résultats en voix mais limités à un nombre restreint d’arrondissements ne garantissent pas d’avoir le nombre suffisant de conseillers pour être élu maire. »
C’est tout à fait, dans notre beau pays un système à l’américaine.
Le maire est élu par les « grands électeurs » des secteurs électoraux.
Et que pensez-vous qu’il arriva ?
Cette fois, <Wikipedia> nous informe :
« En 1983, Gaston Defferre est réélu maire de Marseille avec moins de voix que Jean-Claude Gaudin, mais en étant majoritaire en secteurs remportés.
En 2001, Gérard Collomb est devenu pour la première fois maire de Lyon, alors qu’il était minoritaire en voix (10 000 voix de moins que la droite), en même temps que Bertrand Delanoë devenait pour la première fois maire de Paris, en étant lui aussi minoritaire en voix (4000 voix de moins que la droite), tous les deux étant par contre majoritaires en nombre d’arrondissements gagnés et en nombre total d’élus (grands électeurs) dans l’ensemble des arrondissements.
En 2014, Anne Hidalgo est élue maire de Paris dans les mêmes conditions.
Les élections municipales de 1983, de mars 2001 et de mars 2014 ont donc montré (et confirmé) que la loi PLM avait les mêmes propriétés à Paris, Lyon et Marseille, que le mode de scrutin présidentiel aux U.S.A., qui permet à un candidat d’être élu Président des États-Unis en étant minoritaire en voix, mais majoritaire en nombre d’états gagnés et en nombre total d’élus (Grands électeurs) dans l’ensemble des états » »
Notez que cette Loi de 1982 a pleinement joué son rôle pour la première fois à Marseille. Et celui qui a profité de la Loi, le maire de Marseille et le Ministre qui a porté cette Loi, le Ministre de l’Intérieur était une seule et même personne : Gaston Defferre !
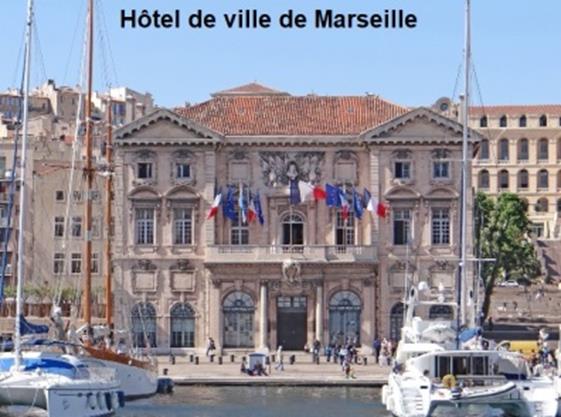 Dans un article du <JDD> Robert Guédiguian, cinéaste marseillais, Philippe Meyer, journaliste parisien, et Bertrand Tavernier, cinéaste lyonnais, demandent l’abrogation de la loi PLM, qui fixe un statut administratif particulier aux trois premières villes de France :
Dans un article du <JDD> Robert Guédiguian, cinéaste marseillais, Philippe Meyer, journaliste parisien, et Bertrand Tavernier, cinéaste lyonnais, demandent l’abrogation de la loi PLM, qui fixe un statut administratif particulier aux trois premières villes de France :
« Les noms circulent. Les rumeurs enflent. Les experts extravaguent. Les doutes s’insinuent. Les fèques niouzent. Les couteaux s’aiguisent. Les alliances se dessinent : dans quelques mois, les Français éliront leurs maires. Les Français, mais ni les Lyonnais, ni les Marseillais ni les Parisiens. La loi PLM (acronyme fabriqué à partir de la première lettre du nom de leurs villes) leur en enlève le droit. Elle les met dans une situation d’exception dont on ne saurait dire qu’elle fait honneur à la démocratie, puisque dans ces trois villes, le maire n’est pas élu par les citoyens au suffrage universel direct mais par un collège issu des conseils d’arrondissement.
Rappelons que cette exception qu’est la loi PLM fut établie en novembre 1982 afin de sauver le regretté Gaston Defferre en grand péril à Marseille et, de fait, elle le sauva, puisque, en 1983, bien que minoritaire en voix, il retrouva son fauteuil de maire. La droite, qui avait protesté contre cette manipulation, l’adapta à ses propres besoins et, minoritaire en voix, en ajoutant deux nouveaux secteurs, elle parvint à faire élire maire de la même ville Jean-Claude Gaudin.
Ce système, qui permit naguère l’élection de maires minoritaires, requiert à présent des majorités qualifiées pour conquérir les hôtels de ville. Selon une étude de Bernard Dolez, professeur de droit public et chercheur au CNRS, « vu le découpage actuel des trois plus grandes villes françaises, [il faut] 53 % des voix pour remporter le siège de premier magistrat à Paris, et 52 % à Lyon. Tandis qu’à Marseille, le seuil de renversement est de 53% ». Il y a donc, en France, 2.146.587 citoyens qui sont placés hors du droit électoral commun, pour ne pas dire dans un droit électoral d’exception.
On peut remarquer que cette situation est comparable terme à terme à celle qui nous indigna si fort lorsque, aux États-Unis, Al Gore, majoritaire en suffrages exprimés, fut battu par le regrettable George Bush junior, majoritaire en grands délégués, et qu’elle se répéta en 2016 en faveur du non moins regrettable Donald Trump. Certes, nous ne craignons pas que la loi PLM produise des catastrophes aussi planétaires, mais, du simple point de vue de l’équité et de la démocratie, pourquoi faudrait-il qu’il y ait indignation au-delà de l’Atlantique et résignation en deçà ?
Nous le refusons et nous demandons l’abrogation de la loi PLM. »
Et j’ajouterais, nous n’avons même pas l’excuse américaine d’être un pays fédéral qui peut justifier qu’on donne un poids accru aux petits États.
C’est tout simplement injustifiable.
<1364>
- de faire élire le président par des grands électeurs
-
Jeudi 5 mars 2020
« Nous vivons là-bas dans un incroyable mélange de différentes cultures – française, africaine, asiatique, arabe, tous les coins du monde »Kylian Mbappé de Bondy évoquant la banlieue dans laquelle il est néJe suppose que même celles et ceux qui ne s’intéressent pas au football connaissent ou ont entendu parler de Kylian Mbappé ce jeune footballeur talentueux qui joue actuellement au Paris SG.
Il vient de publier un article sur un site très particulier que je ne fréquente pas : <The Players’ Tribune>.
The Players’ Tribune est une plateforme destinée à l’expression de sportifs professionnels sans l’intermédiaire des médias traditionnels. C’est un ancien joueur de baseball Derek Jeter qui a fondé ce site.
Si je ne vais jamais sur The Players’ Tribune, je suis, en revanche, régulièrement Pascal Boniface qui est le fondateur et directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Et exprime des avis très pertinent sur la
 géopolitique mondiale, les tensions internationales et les stratégies des États. Il est aussi l’auteur du livre « Planète football Géopolitique d’un empire » que j’avais cité lors du dernier mot du jour de la série consacrée au football.
géopolitique mondiale, les tensions internationales et les stratégies des États. Il est aussi l’auteur du livre « Planète football Géopolitique d’un empire » que j’avais cité lors du dernier mot du jour de la série consacrée au football.
Et c’est pascal Boniface qui a attiré mon attention sur l’article du jeune footballeur millionnaire. : « Kylian Mbappé, footballeur citoyen » :
« Kylian Mbappé vient de publier un texte important qui n’a pas été suffisamment remarqué. On reproche aux footballeurs de ne pas s’intéresser aux problèmes de société. Le Français le plus talentueux dans ce sport le fait, et cela ne suscite que peu de commentaires.
On présente souvent les footballeurs comme repliés sur eux-mêmes et leurs privilèges, égoïstes, coupés de la société… Il y a certes de très mauvais exemples d’excès souvent dus à une explosion des revenus et de la notoriété à un très jeune âge. Un jeune footballeur qui connaît le succès a une exposition médiatique sans commune mesure avec des responsables politiques ou figures du milieu culturel qui ont trois fois son âge.
Ce n’est pas toujours facile à gérer, mais notons qu’on est beaucoup plus sévère sur les déviances des sportifs que sur celles d’autres milieux. De nombreux footballeurs s’engagent bénévolement dans de nombreuses causes, généralement en les finançant sur leur propre argent. Beaucoup le font de façon discrète, à l’abri des médias. Il y a toujours la peur d’être instrumentalisé, il faut distinguer dans les multiples propositions, mais beaucoup ont envie de redonner à la société une partie de ce qu’ils en ont reçu. Ils sont fiers et heureux d’être utiles en dehors du terrain. […]
C’est pour cela que l’initiative de Kylian Mbappé va plus loin et qu’il faut la saluer à sa juste mesure. Au moment où les unes des magazines, les débats sur les chaînes d’information permanente se multiplient avec pour point commun l’hostilité aux quartiers, aux banlieues vues comme « territoires ennemis » ou « perdus de la République », il frappe aussi fort que dans les filets adverses en revendiquant sa fierté d’être issu de ces territoires et en insistant sur tout le potentiel positif qu’ils contiennent, y compris sur le plan des valeurs, là où ils sont le plus critiqués. »
Allons donc sur ce site pour lire cette <lettre aux jeunes Kylian>
Il commence sa lettre par cette adresse :
« Aux enfants de Bondy,
Aux enfants d’Île-de-France,
Aux enfants des banlieues,
Je veux vous raconter une histoire. »
 Bien sûr il parle de football. Il évoque les jours passés lors d’un stage à Chelsea le grand club londonien ou au Real de Madrid rencontrer Zidane et ses autres expériences de vie dans le football, ayant été repéré par les spécialistes, parce qu’il avait quelques talents et qu’il s’entraînait beaucoup..
Bien sûr il parle de football. Il évoque les jours passés lors d’un stage à Chelsea le grand club londonien ou au Real de Madrid rencontrer Zidane et ses autres expériences de vie dans le football, ayant été repéré par les spécialistes, parce qu’il avait quelques talents et qu’il s’entraînait beaucoup..Mais le plus important qu’il écrit c’est sur la banlieue, sur les valeurs, sur la vie, sur le côté lumineux de la banlieue :
« Mais en fait, vous n’avez pas besoin d’aimer le football pour écouter cette histoire. Parce que cette histoire n’est vraiment qu’à propos de rêves. À Bondy, dans le 93, dans les banlieues, il n’y a peut-être pas beaucoup d’argent, c’est vrai. Mais nous sommes des rêveurs. Nous sommes nés comme ça, je pense. Peut-être parce que rêver ne coûte pas grand-chose. En fait, c’est gratuit.
Nous vivons là-bas dans un incroyable mélange de différentes cultures – française, africaine, asiatique, arabe, tous les coins du monde.
Les gens en dehors de France parlent toujours des banlieues de façon négative mais quand vous n’êtes pas de là-bas, vous ne pouvez pas comprendre ce que c’est. Les gens parlent de délinquants comme s’ils avaient été inventés là-bas. Mais il y a des délinquants partout dans le monde. Il y a des gens qui galèrent partout dans le monde. La réalité est que quand j’étais petit, j’avais l’habitude de voir certains des gars les plus durs de mon quartier porter les courses de ma grand-mère. Vous ne voyez jamais ce côté-là de notre culture aux infos. Vous entendez toujours parler du mauvais, jamais du bon. »
Il a ce développement sur le fait de serrer la main de tous quand on vient saluer une connaissance qui se trouve dans un groupe :
« Il y a d’ailleurs une règle à Bondy que tout le monde connaît. Tu l’apprends quand tu es jeune. Si tu marches dans la rue et que tu croises un groupe de 15 personnes et tu ne connais qu’une seule de ces personnes, tu as deux options: soit tu les salues d’un signe de la main et tu continues ton chemin, soit tu vas les voir et tu serres la main des 15 personnes.
Si tu vas les voir et que tu ne serres la main que d’une personne, les autres 14 personnes ne t’oublieront jamais. Ils sauront quel genre de personne tu es.
C’est marrant parce que j’ai toujours gardé cette part de Bondy en moi. L’an dernier, par exemple, lors de la cérémonie des FIFA’s Best Awards, j’étais avec mes parents avant le début de la soirée et j’ai vu que José Mourinho était de l’autre côté de la salle. J’avais rencontré José avant mais là il était avec quatre ou cinq amis que je ne connaissais pas. Je me suis revu à Bondy. Je pensais, « Est-ce que je salue Mourinho d’un signe de la main ? Ou je vais le voir ? »
Et bien, je suis allé le voir pour le saluer et lui serrer la main et ensuite, naturellement, j’ai fait la même chose pour chacun de ses amis.
« Bonjour ! » Poignée de mains.
« Bonjour ! » Poignée de mains.
« Bonjour ! » Poignée de mains.
« Bonjour ! » Poignée de mains.
C’était amusant parce qu’on pouvait voir leur surprise sur leurs visages, genre, « Oh, il nous dit aussi bonjour ? Bonjour ! »
Quand on les a quittés, mon père rigolait et il m’a dit, « Ça, ça vient de Bondy ». C’est comme un réflexe. C’est une philosophie de vie. À Bondy, on apprend des valeurs qui vont au-delà du football. Tu apprends à traiter tous les gens de la même façon, parce qu’on est tous dans le même bateau. On rêve tous du même rêve. »
 Il parle de ses rêves quand il était enfant et bien sûr du football.
Il parle de ses rêves quand il était enfant et bien sûr du football.
« Mes copains et moi, on n’espérait pas devenir footballeurs professionnels. On ne s’y attendait pas. On ne l’a pas planifié. On en rêvait. C’est différent. Certains enfants ont des posters de super héros sur les murs de leurs chambres. Les nôtres étaient couverts de footballeurs. […]
Parfois, les gens me demandent pourquoi tant de talents viennent des banlieues. Genre comme si il y avait quelque chose dans l’eau qu’on y boit, ou que nous nous entraînons d’une manière différente, comme Barcelone ou quelque chose comme ça. Mais non, si vous venez à l’AS Bondy, je suis désolé mais vous ne verrez qu’un club humble et familial. Des immeubles d’appartements et des terrains en synthétique. Mais je pense que le football est juste différent pour nous. C’est essentiel. C’est quotidien. C’est comme le pain et l’eau. »
Et il évoque la coupe du monde de Russie et fait ce constat qui ne peut que nous interpeller du point de vue de la sociologie du football, même celles et ceux qui ne s’y intéresse pas.
« Je trouve intéressant que parmi tous ceux d’entre nous qui ont soulevé la Coupe du Monde cet été là beaucoup ont grandi en banlieue. Les mélanges. Là-bas tu entends plein de langues différentes dans la rue. »
Il termine ainsi sa lettre :
« Aux enfants de Bondy,
Aux enfants d’Île-de-France,
Aux enfants des banlieues,
Nous sommes la France.
Vous êtes la France.
Nous sommes les rêveurs fous.
Et, heureusement pour nous, rêver ne coûte pas grand-chose.
En fait, c’est gratuit.
Kylian de Bondy »
Pascal Boniface conclut son article par ces mots:
« Le 15 juillet 2018, Kylian Mbappé a contribué au rayonnement de la France dans le monde et à l’affirmation de son soft power. Le 28 février 2020, il a apporté sa contribution à l’apaisement de la société française en s’efforçant de changer le regard que les jeunes des cités ont sur eux-mêmes et celui que porte la France sur eux.
Kylian Mbappé fait de la politique avec un P majuscule, la vie dans la cité. Au moment où la jeunesse de banlieue est stigmatisée et déshumanisée par des commentateurs qui ne la traverse que pour se rendre à Roissy et qui n’y sont jamais allés, il lui redonne estime de soi et perspective d’avenir. Il revendique avec fierté ses origines qu’il ne trahit pas, mais qu’il honore.
Au moment où certains s’efforcent de creuser un fossé entre différentes catégories de Français, il contribue à le combler. Son sourire est la meilleure réponse à apporter aux grimaces des oiseaux de mauvais augure. »
Je vous renvoie vers sa longue lettre : <Lettre aux jeunes Kylian>
<1363>
-
Mercredi 4 mars 2020
« Il n’y a pas de socialisme en Amérique, parce qu’on n’a pas de prolétaires mais des capitalistes momentanément dans l’embarras. »John SteinbeckCette phrase de John Steinbeck qu’il aurait prononcée dans les années 1930 a été citée par Christine Ockrent lors de son émission que j’ai déjà évoquée hier <Affaires étrangères>.
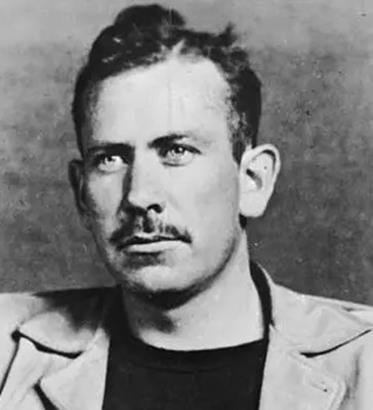 L’immense auteur des « Raisins de la Colère », « A l’est d’Eden », « Des souris et des hommes » voulait exprimer par cette phrase que les américains exploités n’avaient pas de conscience de classe. Ils ne considéraient pas qu’ils faisaient partie d’une même classe mais ils croyaient au récit du rêve américain qui prétendait que tout le monde avait la possibilité de devenir riche s’il travaillait beaucoup et savait saisir les opportunités qui lui étaient offerts.
L’immense auteur des « Raisins de la Colère », « A l’est d’Eden », « Des souris et des hommes » voulait exprimer par cette phrase que les américains exploités n’avaient pas de conscience de classe. Ils ne considéraient pas qu’ils faisaient partie d’une même classe mais ils croyaient au récit du rêve américain qui prétendait que tout le monde avait la possibilité de devenir riche s’il travaillait beaucoup et savait saisir les opportunités qui lui étaient offerts.
John Steinbeck avait des amitiés socialistes et regrettait cette mentalité américaine.
Il y a eu quelques cas qui ont pu faire croire que ce mythe constituait une réalité atteignable par un grand nombre de personnes.
Aujourd’hui ce récit est de moins en moins vrai, ce qui explique probablement le succès qu’obtient Bernie Sanders.
<1362>
-
Mardi 3 mars 2020
« Mais le socialisme existe déjà […] c’est du socialisme pour les riches »Bernie SandersCe mardi correspond au super Tuesday des primaires américaines, en l’occurrence les primaires démocrates.
Je ne vais pas rentrer dans la complexité de ces primaires et rester à des principes simples.
Chaque Etat vote d’une manière ou d’une autre pour désigner des délégués qui représentent chacun un candidat à la convention démocrate qui aura lieu du 13 au 16 juillet, à Milwaukee dans l’État du Wisconsin.
Pour être certain d’être désigné comme le candidat démocrate, il faudra obtenir 1991 délégués. Si personne n’obtient cette majorité absolue, le processus de désignation est plus complexe et pour rester concret ne sera pas favorable à Bernie Sanders.
Car avant le vote de ce jour, il y a clairement un affrontement entre Joe Biden l’ancien vice-président d’Obama et le « démocrate socialiste » Bernie Sanders.
Il y a bien un troisième candidat qui pourrait jouer les trouble-fêtes et essayer d’acheter les primaires : le milliardaire Michael Bloomberg, 9ème fortune du monde, ancien maire républicain de New York, entre 2002 et 2013. Il utilise sa fortune pour essayer par tous les moyens à faire voter pour lui, mais pour l’instant il a été médiocre lors des débats organisés entre les principaux candidats démocrates.
Les autres candidats qui restent en lice semblent distancés.
Remarquons d’abord la confusion absolue de l’organisation politique américaine d’aujourd’hui. En France, l’élection présidentielle de 2017 a mis une certaine pagaille dans les partis politiques français.
Mais que dire des américains dont on vantait la simplicité : deux partis le Parti démocrate et le Parti républicain. On était dans un de ces partis de père en fils et de mère en fille. Il y avait quelques indépendants et de tous petits partis qui ne jouaient aucun rôle au niveau fédéral.
Michael Bloomberg qui se présente à l’investiture démocrate avait été élu maire de New York comme candidat républicain et avait battu le candidat démocrate Mark Green.
Donald Trump lui-même avait toujours soutenu les candidats démocrates et notamment les Clinton avant de se présenter comme candidat républicain contre la démocrate Hillary Clinton.
Bernie Sanders n’a jamais été démocrate, il est indépendant et depuis longtemps se prétend socialiste.
Il n’y a guère que Joe Biden qui est un vieux démocrate assumé et qui reste donc en cohérence.
Quand j’utilise le terme vieux, il est de circonstance pour ces élections américaines. Les Etats Unis nous avait habitué à Clinton, Bush junior et Obama respectivement 46 ans, 55 ans et 48 ans lors de leur entrée en fonction.
Donald Trump a 73 ans, Joe Biden 77 ans, Michael Bloomberg 78 ans et Bernie Sanders 78 ans. C’est une gérontocratie qui est à l’œuvre désormais aux Etats-Unis.
Il y a pourtant, un vieux qui entraîne l’enthousiasme des jeunes : Bernie Sanders.
Il veut une couverture maladie publique à la française, il veut une université gratuite pour les étudiants et il veut taxer sévèrement les hyper riches.
L’avis majoritaire est que quelqu’un qui se prétend socialiste n’a aucune chance de gagner les élections présidentielles aux Etats-Unis.
Pour l’instant il fait la course en tête, mais de peu 60 délégués pour Sanders 54 pour Biden. Pour l’instant seuls 155 délégués ont été distribués.
Le Super Tuesday en désignera 1 357. Ce chiffre montre l’ampleur du défi qui est à l’œuvre aujourd’hui.
Bernie Sanders domine les sondages dans les deux États les plus riches en délégués : la Californie (415 délégués) et le Texas (228). Pour recevoir des délégués, il faut impérativement qu’un candidat fasse plus de 15 %.
Les candidats modérés Pete Buttigieg qui s’est retiré le 1 mars 2020 et Amy Klobuchar, le 2 mars 2020 vont apporter leur soutien à Joe Biden.
Une sorte de coalition se constitue contre Bernie Sanders, tout sauf Bernie.
Hillary Clinton qui l’avait battu il y a 4 ans, mais n’avait pas pu compter sur une grande part des électeurs de Bernie qui l’avait attaqué tout au long de la primaire en la traitant de candidate de Wall Street, est très agressive avec lui.
Il faut savoir que Bernie Sanders qui est depuis longtemps dans la politique américaine a commencé à être connu et populaire au niveau fédéral après le mouvement Occupy Wall Street
Ainsi Hillary Clinton a dit :
« dans le film intitulé Hillary. « Il a été au Congrès pendant des années, il n’avait qu’un seul sénateur pour le soutenir. Personne ne l’aime, personne ne veut travailler avec lui, il n’a rien fait », assène l’ex-secrétaire d’État américaine. « J’ai vraiment de la peine pour les gens qui s’y laissent prendre. »
Pourtant Bernie Sanders dit des choses très justes. Ainsi, lors du débat télévisé opposant les prétendants démocrates à l’investiture présidentielle, à Las Vegas, lorsqu’on l’interpelle à propos d’un sondage selon lequel deux tiers des électeurs seraient « mal à l’aise avec un candidat socialiste à la présidence », il répond :
« Mais le socialisme existe déjà […] Quand Donald Trump reçoit 800 millions de dollars en réductions d’impôts et en subventions pour construire des condominiums de luxe, c’est du socialisme pour les riches ! Et nous devons subventionner les travailleurs de Walmart qui sont sous Medicaid et coupons alimentaires parce que la famille la plus riche d’Amérique [propriétaire de Walmart] paie des salaires de misère. C’est ça le socialisme pour les riches, a conclu Sanders. Je crois au socialisme démocratique pour les travailleurs. »
Le Monde Diplomatique qui cite cette réponse : <Le socialisme existe, pour les riches> reprend un article de 2014 du journaliste anglais Owen Jones qui détectait cette réalité au Royaume-Uni. Un article plus récent publié par le même journal dévoile aussi cette mécanique à l’œuvre en France <Christian de Brie : Le fléau de l’assistanat>.
C’est probablement ce que voulait dire le subconscient de notre jeune Président quand il s’est exclamé : « Ça coute un pognon de dingue »
Bernie Sanders a certainement des défauts, mais pour une fois un candidat pointe le problème du gouffre des inégalités aux Etats-Unis, le peu de contribution des hyper riches au commun, le grande difficulté voire l’impossibilité des classes populaires de se faire soigner en cas de maladie grave ou simplement de faire des études dans de bonnes universités.
En outre, lui ne conteste pas les avertissements de la communauté scientifique.
Regardez comme il interroge l’administrateur de l’Agence de Protection de l’Environnement, Andrew Wheeler, nommé par Donald Trump.
 Et puis il déclenche de l’enthousiasme et notamment parmi les jeunes.
Et puis il déclenche de l’enthousiasme et notamment parmi les jeunes.
Au sein du Parti Démocrate, deux visions s’affrontent.
- La première est que l’élection de Trump constitue une anomalie, une erreur. Il faut un bon candidat non impopulaire comme Hillary Clinton, un peu empathique et modéré, rassurant tout le spectre des centristes démocrates et républicains et des indépendants et le mauvais rêve Trump s’évanouira. Biden est le représentant de cette vision.
- La seconde est que l’élection de Trump n’est pas une anomalie, mais au contraire révèle une terrible fracture au sein du peuple américain qui est en colère. En colère parce qu’il a le sentiment de se « faire rouler ». Trump ayant pour thèse que les responsables sont les étrangers. Les démocrates qui soutiennent cette vision, considèrent que c’est Sanders qui est le meilleur candidat pour s’appuyer sur cette colère et faire des réformes profondes. Car dans cette thèse le problème vient essentiellement de l’inégalité des richesses et de l’accaparement des fruits de la croissance par une infime minorité.
Dans l’émission <Affaires étrangères> consacrée aux présidentielles américaines, un des invités Jeremy Ghez, professeur à HEC, spécialiste de la politique américaine défend la thèse que la rupture au sein de la démocratie américaine a
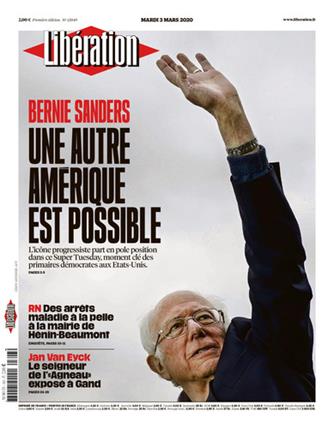 explosé lors de la crise de 2008. Que la première réponse des américains a été d’élire un candidat improbable, un métis, Barack Obama. Déçus, ils ont essayé Trump. Dans cette logique de rupture rien ne s’oppose à ce qu’ils votent pour Sanders.
explosé lors de la crise de 2008. Que la première réponse des américains a été d’élire un candidat improbable, un métis, Barack Obama. Déçus, ils ont essayé Trump. Dans cette logique de rupture rien ne s’oppose à ce qu’ils votent pour Sanders.
La Une de Libération de ce 3 mars 2020 affiche : « Bernie Sanders : Une autre Amérique est possible »
Il me semble que dans la situation où nous sommes et sans croire aux miracles, la meilleure chose qui pourrait arriver aux Etats-Unis c’est que la chance soit donnée à Bernie Sanders d’arriver au pouvoir suprême.
Il croit à la crise écologique.
Il pointe du doigt le problème des inégalités de patrimoine et de revenus.
Beaucoup, particulièrement au sein du Parti démocrate vont essayer de l’empêcher de devenir le candidat démocrate.
<Les supporteurs de Bernie Sanders ont peur que le parti « lui vole encore la nomination »>
S’il est désigné, il faudra qu’il affronte l’homme sans scrupule et bête de scène Donald Trump.
Robert Musil a écrit dans l’empire autrichien finissant « L’homme sans qualité ». Peut-être faudrait-il quelqu’un qui écrive le livre de l’Amérique de Trump : « L’homme sans vérité ».
Bernie Sanders pourra t’il battre Trump ?
Le journal canadien <L’actualité> affirme « Oui, Bernie Sanders peut gagner »
S’il gagne, pourra t’il appliquer son programme ?
C’est probablement des 3 points très compliqués (1° gagner l’investiture démocrate 2° gagner l’élection 3° Appliquer le programme) qu’il doit affronter, le plus compliqué des trois.
Pour le premier point, nous y verrons plus clair demain.
Il dispose de soutiens comme celui du maire de New York Bill Blasio ! Et aussi la charismatique « AOC » c’est-à-dire l’élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez qui avait fait l’objet du mot du jour du 1er avril 2019.
 Un politologue américain Allan Lichtman, qui a étudié toutes les présidentielles américaines depuis 1860, et ne s’est jamais trompé dans ses pronostics. Dans un article du site The Hill, Lichtman rappelle la longue liste des candidats démocrates «modérés et expérimentés», finalement battus : Michael Dukakis (1988), Al Gore (2000), John Kerry (2004) et Hillary Clinton (2016). A l’inverse, les démocrates élus furent tous, sinon de dangereux extrémistes, au moins des candidats ne provenant pas de l’establishment démocrate, comme Jimmy Carter, Bill Clinton et Barack Obama. Côté républicain, l’establishment démocrate se réjouissait en 1980 que soit opposé à Carter un extrémiste nommé Reagan. Le démocrate modéré n’en ferait qu’une bouchée. On sait ce qu’il en fut. L’extrémiste pulvérisa Carter.
Un politologue américain Allan Lichtman, qui a étudié toutes les présidentielles américaines depuis 1860, et ne s’est jamais trompé dans ses pronostics. Dans un article du site The Hill, Lichtman rappelle la longue liste des candidats démocrates «modérés et expérimentés», finalement battus : Michael Dukakis (1988), Al Gore (2000), John Kerry (2004) et Hillary Clinton (2016). A l’inverse, les démocrates élus furent tous, sinon de dangereux extrémistes, au moins des candidats ne provenant pas de l’establishment démocrate, comme Jimmy Carter, Bill Clinton et Barack Obama. Côté républicain, l’establishment démocrate se réjouissait en 1980 que soit opposé à Carter un extrémiste nommé Reagan. Le démocrate modéré n’en ferait qu’une bouchée. On sait ce qu’il en fut. L’extrémiste pulvérisa Carter.
S’agissant de la dernière élection, celle de 2016, les «pundits» démocrates (on dirait en France, les éditocrates) n’imaginaient pas une seconde que puisse être élu un candidat climatosceptique, préconisant l’interdiction d’entrée sur le territoire des musulmans, la construction d’un mur de séparation sur la frontière mexicaine, ou la guerre commerciale avec la Chine. On sait, là aussi, ce qu’il advint.
C’est ce qu’écrit Daniel Schneidermann dans un article <L’hypothèse Sanders>
J’aimerai croire à l’hypothèse Sanders.
<1361>
- La première est que l’élection de Trump constitue une anomalie, une erreur. Il faut un bon candidat non impopulaire comme Hillary Clinton, un peu empathique et modéré, rassurant tout le spectre des centristes démocrates et républicains et des indépendants et le mauvais rêve Trump s’évanouira. Biden est le représentant de cette vision.
-
Lundi 2 mars 2020
« On ne supporte pas d’attendre sur internet »Xavier de la PorteLe weekend end m’a permis de lire Intégralement le livre <4> d’Alexandre Laumonier dont j’ai parlé vendredi.
Ce livre est très détaillé et explique de manière précise cette course à la vitesse des traders haute fréquence.
Il explique aussi que la nature intervient dans ces communications. Ainsi lorsqu’il pleut les ondes radios sont ralenties. Ce qu’il traduit par cette belle phrase :
« Quand il pleut dans l’Ohio, la liquidité diminue dans le New Jersey ».
Dans le dernier mot du jour j’avais écrit :
« Mais avant de condamner, il faut comprendre pourquoi les hommes, dont nous faisons partie aspirent à cette vitesse. Mais cette réflexion attendra un autre mot du jour. »
Et c’est pourquoi je reviens au podcast de Xavier La Porte qui m’a fait découvrir cette histoire : <Le pylône qui valait 5 millions de dollars>
Xavier de la Porte interrogeait Alexandre Laumonier.
Et il a terminé son dialogue par cette réflexion et cet échange :
Xavier de la Porte :
« Est-ce que cela pourrait se ralentir. Sommes-nous condamnés à une accélération sans fin ? »
Alexandre Laumonier :
« Il faudrait trouver un cas où quelqu’un a décidé de ralentir. Je ne pense pas que cela soit arrivé. Il y a quand même une limite ultime : la vitesse de la lumière dans le vide. Le paradigme einsteinien reste d’actualité. Aux Etats-Unis ils sont à plus de 99% de la vitesse de la lumière pour la transmission des informations dans le trading de haute fréquence. C’est pour cela qu’is se battent pour des micros secondes. »
Xavier de la Porte :
« Ce qu’Alexandre Laumonier décrit c’est une tendance globale. Une sorte de pulsion humaine. Mais cela apporte une autre hypothèse.
Cette tendance à la vitesse, cette quête de la vitesse, elle n’est peut-être pas propre au trader à haute fréquence.
D’ailleurs, selon ce que j’ai pu voir, certains câbles, ont été cofinancés par des sociétés de trading mais aussi par d’autres qui n’ont rien à voir.
Et quand je pose la question à Alexandre Laumonier, il me parle spontanément d’Amazon. »
Alexandre Laumonier :
« Il y a tant d’ordres qui sont passés sur Amazon qu’il faut que les machines réagissent très vite. Et comme Amazon est dans le monde entier, il faut que ces informations transitent le plus vite possible. Je sais qu’Amazon est à une ou deux millisecondes près pour cela.
C’est parce qu’il y a tellement de gens sur le site qu’il faut que le système tourne à ces vitesses sinon vous allez cliquer et attendre 10 secondes une réponse. Dans le monde où on est, quand on clique on attend une ou deux secondes, s’il faut attendre 3 secondes on dit qu’il y a un bug, 4 secondes on dit que le site ne marche plus, au bout de 10 secondes on passe à autre chose. C’est pour cela qu’Amazon est à 2 millisecondes près. »
Xavier de la Porte :
« Le problème c’est que cette vitesse on la désire, tous.
On peut faire les atterrés, en trouvant fou que des sociétés de trading de haute fréquence dépensent des millions d’euros pour gagner des millisecondes mais ce ne sont pas les seuls. Et s’ils ne sont pas les seuls, c’est parce que collectivement nous ne supportons pas que ce qui pourrait aller vite, aille lentement.
Et c’est vrai que si on réfléchit à ce que c’est qu’un achat sur Amazon, on pourrait accepter quelques secondes entre l’ordre et sa réception.
En fait non, on ne le supporte pas. Et là ce ne sont plus les traders qui sont appâtés par le seul gain qui sont les commanditaires de la vitesse, là avec Amazon c’est nous qui sommes les commanditaires de cette vitesse, nous les consommateurs lambda.
Voilà, c’est un peu la leçon de morale du jour. »
Je pourrais m’en tirer en disant que je n’achète pas chez Amazon, ce qui est exact.
Mais hélas, je dois reconnaître ou plutôt me reconnaitre dans cette impatience derrière le clic et l’attente devant un site sur lequel je consulte ou achète.
Il est très simple de croire que la révolution n’est qu’à l’extérieur de nous, qu’il suffirait de faire dégager un certain nombre de « nuisibles » et « d’importuns » pour que tout aille mieux.
Ce n’est pas aussi simple une grande partie des problèmes se trouve à l’intérieur de nous, dans nos désirs sans limites, notre impatience…
<1360>
-
Vendredi 28 février 2020
« Le pylône qui valait 5 millions de dollars »Histoire racontée par Alexandre LaumonierAprès avoir parlé des riches autour de l’hebdomadaire « Le Un » et cette question : « Les riches sont-ils trop riches ?», je fais aujourd’hui un pas de côté.
Quoique je me demande s’il n’est pas encore question de riches ici…
Mon information était précise je savais que je trouverai le livre cherché à la bibliothèque de la Part-Dieu, dans la salle «Société» et sous la côte « ECO 350 ». Sur l’étagère, il y avait une vingtaine de livre, le plus fin était celui que je cherchais : « 4 » d’Alexandre Laumonier aux éditions Zones sensibles.
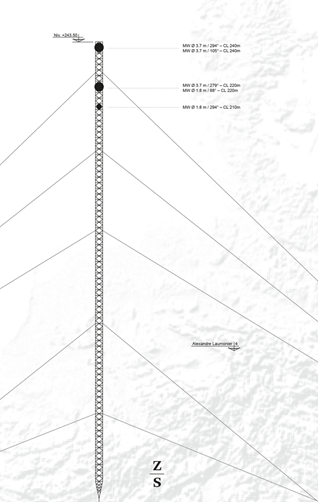 Disposant de ce livre, ce soir, je peux donc partager avec vous l’entame de cette enquête, ce thriller ou plus simplement une histoire d’aujourd’hui.
Disposant de ce livre, ce soir, je peux donc partager avec vous l’entame de cette enquête, ce thriller ou plus simplement une histoire d’aujourd’hui.
La scène se passe en Belgique en 2012 :
« À quelques mois de la retraite, le commissaire-priseur ne s’attendait sans doute pas à vivre les enchères les plus épiques de sa carrière.
En cette grise matinée du 19 décembre 2012, dans une pièce du tout nouveau bâtiment hébergeant le Bureau fédéral de la province de Flandre-Occidentale, à Bruges, le bien public 38025/838 sv, décrit comme un « Gewezen militair domein met communicatietoren (hoogte 243,5-m) en acht ankerpunten », d’une superficie de 1 hectare, 31 ares et 66 centiares, sis au 1, rue du Héron, à Houtem, dans la région des Moëres, était mis aux enchères par son propriétaire, le ministère de la Défense du Royaume de Belgique, au prix de 250 000 euros.
À 10 heures, et sans une seule microseconde de retard, onze personnes se regroupèrent autour d’une grande table rectangulaire. Le commissaire-priseur, son secrétaire et un représentant du ministère s’installèrent à l’une des extrémités de la table, tandis qu’en face d’eux trois groupes distincts prirent place, se regardant en chien de faïence : un Américain accompagné de deux avocats ; deux autres avocats travaillant pour un prestigieux cabinet belge mandaté par un acheteur potentiel ; et deux ingénieurs, qui restèrent silencieux tout au long de la matinée. Ils n’étaient pas venus pour acheter mais pour savoir qui allait l’emporter, information de première importance pour un certain nombre de personnes, notamment en France, au Canada, aux Pays-Bas et aux États-Unis.
Même si la présence d’un cabinet d’avocats haut de gamme était plutôt inhabituelle étant donné la vétusté de l’« ancien domaine militaire comprenant un pylône de communication de 243,5 mètres », dont le ministère souhaitait se débarrasser, la séance débuta sereinement. Le commissaire-priseur vérifia que les participants s’étaient bien acquittés des 1 000 euros de frais d’inscription, s’assura que tous avaient en leur possession les documents administratifs relatifs au domaine – y compris le relevé cadastral, sur lequel le domaine militaire apparaît en forme de croix –, puis il fixa le pas d’enchères à 5 000 euros et la vente démarra.
Ce qui ne devait être qu’une formalité se transforma en une longue matinée pendant laquelle le commissaire fut mis à rude épreuve. Au bout de vingt minutes seulement, la meilleure offre était déjà de 700 000 euros, ce qui réjouit le ministère de la Défense (il estimait secrètement faire une bonne affaire à partir de 400 000 euros) mais déstabilisa le commissaire-priseur. Il décida alors de monter le pas d’enchères à 10 000 euros pour accélérer la vente, puis la meilleure offre atteignit rapidement 1 million d’euros, puis 1,1 million d’euros, 1,2 million d’euros, 1,3 million d’euros, 1,4 million d’euros… À 2 millions, une heure plus tard, le commissaire-priseur, qui transpirait de plus en plus, réclama une pause et se réfugia dans les toilettes pour se ressaisir. L’histoire ne dit pas quelles pensées furent les siennes devant l’image de son visage sidéré que lui renvoya le miroir. « Du côté des vendeurs, personne n’arrivait à comprendre ce qui se passait », raconte un témoin, lui-même d’autant plus surpris par le montant des offres que, dans d’autres circonstances, il aurait pu lui-même enchérir.
Cette année-là, le Royaume de Belgique, en quête de liquidités, avait déjà revendu bon nombre d’installations démilitarisées pour un total de 12 millions d’euros. Parmi celles-ci : un vieux bunker cédé pour 350 euros à un paysan ravi de pouvoir le démolir car il se trouvait au milieu de son champ ; un ancien fort construit pour défendre la ville d’Anvers, racheté 287 000 euros par le riche pdg de Katoen Natie, une compagnie de logistique active dans les ports du monde entier ; un ancien hôpital militaire acheté 4 millions d’euros par la commune de Bruges pour être transformé en logements sociaux. À ces 12 millions s’ajouta, le 19 décembre 2012, le produit de la vente de l’« ancien domaine militaire comprenant un pylône de communication ». Au terme de plus de trois heures et demie de bataille acharnée, devant les représentants de l’État belge médusés, le bien 38025/838 SV fut finalement adjugé 5 millions d’euros, soit la meilleure affaire du ministère de la Défense pour l’année 2012.
Alors que les silencieux ingénieurs sortaient précipitamment de la salle du Bureau fédéral (le ticket de stationnement de leur voiture, malencontreusement garée devant un commissariat, était dépassé depuis longtemps), l’un des avocats au service de ceux qui remportèrent la mise fut approché par l’un de ses confrères qui, lui, représentait le camp vaincu. Le perdant tendit au gagnant sa carte de visite : « If we can arrange, here is my phone number. » Le 9 janvier 2013, le ministère rendit public l’acte de cession du domaine militaire sans toutefois divulguer le nom du nouveau propriétaire. « Information confidentielle », selon les services ministériels. »
Le livre raconte l’histoire de ce pylône construit par l’armée américaine dans le plat pays de Brel, l’Histoire de cette région appelé les Moëres et aussi de la raison pour laquelle une société qui ne voulait pas être connue, a mandaté une autre société et des avocats pour aller participer à cette mise en enchère et arracher la mise quelle qu’en soit le prix. Et puis beaucoup d’autres informations sur le métier de cette société basée à Chicago.
 Alexandre Laumonier est belge, il a créé en 2011 une maison d’édition établie à Bruxelles, spécialisée dans les sciences humaines : <Zones Sensibles>
Alexandre Laumonier est belge, il a créé en 2011 une maison d’édition établie à Bruxelles, spécialisée dans les sciences humaines : <Zones Sensibles>
Il se présente dans cet article : « L’art de publier des essais »
Le livre « 4 » a non seulement été édité mais aussi écrit par cet étonnant personnage. Il avait été précédé par « 6/5 ». Un peu comme un compte à rebours
Mais quelle est la réponse à cette question ? Qui peut vouloir payer 5 000 000 d’euros pour un ancien pylône de communication construit par l’armée américaine dans les années 1960 et donné à l’armée belge qui ne savait qu’en faire. En réalité la page 28 du livre nous apprend que le coût de remise en service du pylône aura coûté 1,5 millions d’euros, ce qui porte le budget de l’opération à 6,5 millions d’euros.
Ce pylône avait été construit par l’armée américaine pour transmettre des informations militaires par des micro-ondes notamment vers l’Angleterre.
En 2008, l’armée américaine s’est débarrassée de cette infrastructure, couteuse à entretenir, parce qu’elle allait remplacer ces stations radio par un système de communication moins cher et d’une plus grande capacité. Les informations n’allaient plus transiter dans les airs mais sous terre, grâce à une technologie plus récente que les ondes radio : la fibre optique, qui offre deux fois plus de débit.
L’armée belge pensait qu’un acheteur allait démonter ce pylône et le débiter pour en récupérer le métal et les équipements.
Mais l’acheteur voulait garder l’équipement et utiliser les ondes radios : les micros ondes
Parce que s’il y a moins de débit que sur la fibre optique, c’est-à-dire le volume de données qu’on peut transmettre, cette technologie permet de transmettre des informations plus rapidement
Le gain parait dérisoire.
<Cet article> qui présente le livre explique :
« Cette société gagna plus ou moins 10 microsecondes de temps de latence, soit 0,00001 seconde, soit cent fois moins de temps qu’il n’en faut à un être humain pour cligner de l’œil. La »valeur » d’une seule microseconde était donc, en 2013, de 650.000 euros. »
Voilà où en est la société humaine aujourd’hui.
Mais avant de condamner, il faut comprendre pourquoi les hommes, dont nous faisons partie aspirent à cette vitesse. Mais cette réflexion attendra un autre mot du jour.
Pour revenir au prix exorbitant de ce pylône chargé de transmettre des ondes radios, il faut une carte que Google nous offre gratuitement.

Le pylône de Houtem, dans la région des Moëres est sur le trajet, en ligne direct, à peu près à mi-chemin entre Francfort-sur-le Main, la place financière de l’immense puissance économique Allemande et siège de la BCE et Londres, la city, la plus grande place financière du monde.
Gagner des micro-secondes lors du transfert d’informations entre Londres et Francfort a motivé la société de trading à haute fréquence de Chicago du nom de Jump Trading à débourser 5 000 000 d’euros et quelques frais annexes d’avocats et des intermédiaires pour ne pas apparaître dans la transaction.
Ma source qui m’a conduit à aller à la Bibliothèque de la Part-Dieu pour aller chercher ce livre qui contient encore bien d’autres informations est Xavier de la Porte que je n’avais pas cité depuis longtemps.
Il produit un podcast natif sur France Inter, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une émission que vous pouvez écouter à la radio.
Ce podcast s’appelle <Le code a changé>.
Pour présenter le livre et Alexandre Laumonier, il a fait cet aveu :
« C’est le genre d’histoire qui me passionne parce qu’elle montre que la technologie, c’est une affaire très matérielle. Une affaire de câble, d’ondes, de hauteur, de vitesse. Le genre d’histoire qui me passionne parce qu’elle raconte la folie des hommes, une folie qui est souvent très ancienne et que les technologies d’aujourd’hui ne font souvent que rendre plus évidente. »
Le livre « 4 » porte pour exergue cette phrase de Ludwig Wittgenstein. philosophe et mathématicien britannique d’origine autrichienne :
« Nous attendons à tort une explication alors qu’une description constitue la solution de la difficulté, pour peu que nous lui donnions sa juste place, que nous arrêtions à elle, sans chercher à la dépasser. C’est cela qui est difficile, s’arrêter. »
<1359>
-
Jeudi 27 février 2020
« Le triomphe de l’injustice »Gabriel Zucman et Emmanuel SaezEn continuant la lecture du « Un » sur les riches, on tombe sur l’article central du journal qui consiste en un entretien avec Gabriel Zucman : « L’enjeu est de sortir d’une spirale d’Injustice fiscale ».
 Gabriel Zucman est un jeune économiste français mais qui vit actuellement aux Etats-Unis.
Gabriel Zucman est un jeune économiste français mais qui vit actuellement aux Etats-Unis.
Il est né en 1986 à Paris, il a enseigné à la London School of Economics, mais depuis 2015 il est professeur assistant à l’université de Californie à Berkeley.
Il s’est spécialisé dans le domaine des inégalités sociales et des paradis fiscaux.
Il a rédigé sa thèse « Trois essais sur la répartition mondiale des fortunes » sous la direction de Thomas Piketty
Le journal « Washington Examiner » confirme qu’il influence les deux candidats les plus à gauche de la primaire démocrate « Two French economists from Berkeley advise Warren and Sanders on wealth tax »
Les deux économistes français dont parle le journal de Washington sont les deux auteurs de l’ouvrage qui vient d’être traduit et publié en France le 13 février « Le triomphe de l’injustice » et qui a pour sous-titre « Richesse, évasion fiscale et démocratie ». Emmanuel Saez est de 14 ans plus âgé que Gabriel Zucman, il est professeur à la même université Berkeley. Il est aussi français mais a été naturalisé américain. Ses travaux portent aussi sur les inégalités économiques et les inégalités de revenu et il est également lié avec Thomas Piketty avec lequel il mène des études communes.
Picketty, Zucman et Saez, trois français, sont donc en train de convertir sinon les États-Unis au moins un des principaux candidats démocrates : Bernie Sanders au socialisme, à l’imposition des grosses fortunes et aussi à une redynamisation de la progressivité de l’impôt sur les revenus. Comme le dit le journal de Washington, ils ont aussi l’oreille d’Elisabeth Warren l’autre candidate de gauche des démocrates.
Mais c’est de plus en plus Bernie Sanders, celui qui se proclame socialiste et qui affirme aux USA que le régime de Castro à Cuba présentait des aspects positifs, qui fait la course en tête et qui est en train de s’envoler dans les sondages.
<Le Monde> avait consacré fin 2019 un article à ces trois français au pays de l’oncle Sam :
« Dans le sillage de Thomas Piketty, [Gabriel Zucman] le trentenaire, chercheur à Berkeley, cosigne avec son compatriote Emmanuel Saez un livre sur le triomphe des inégalités aux Etats-Unis. Et s’impose comme un des cerveaux influents de la gauche américaine.
Dans la bande à Piketty, il est le benjamin. Mais pas le moins doué. […]. Si Thomas Piketty, 48 ans, a été son directeur de thèse à Paris, c’est son complice, Emmanuel Saez, 46 ans, qui l’a fait venir aux Etats-Unis. A eux trois, ils sont en train de changer le paysage politique américain par leurs travaux sur les inégalités.
Avec son livre Le Capital au XXIe siècle (Seuil, 2013), devenu en 2014 un improbable best-seller au pays du marché-roi, Piketty a été le pionnier. « C’est lui qui a l’approche la plus ambitieuse, décrit Gabriel Zucman. Il veut créer une nouvelle idéologie de socialisme participatif. » Emmanuel Saez, coauteur de plusieurs travaux avec Piketty, est le surdoué : diplômé de Normale-Sup et du MIT, il est lauréat de la médaille John Bates Clark, la plus haute distinction américaine en économie. Un perfectionniste d’« une rigueur vraiment extrême », dit son jeune collègue. Au point que certains voient déjà sa voiture occuper un jour l’une des places réservées aux Prix Nobel sur le parking de la faculté.
Gabriel Zucman, lui, se range dans une catégorie plus modeste. « Plombier » de la justice sociale. Ajusteur des politiques publiques, pour « contribuer au progrès ». « S’il y a une volonté politique de créer un impôt sur la fortune, si on veut taxer les multinationales, comment on fait en pratique pour que ça fonctionne ? » Et pour « faire de la bonne plomberie », insiste-t-il, il faut « commencer par avoir de bons chiffres »
Il semble que c’est Gabriel Zucman qui a été chargé d’assurer la promotion, en France, du livre écrit avec Saez.
C’est ainsi qu’il a été l’invité de la Grande Table, émission dans laquelle je l’ai entendu pour la première fois : <Gabriel Zucman : réinventer l’impôt pour combattre l’injustice>
Dans leur livre les deux économistes épluchent les statistiques fiscales sur plus d’un siècle en prenant en compte l’ensemble des prélèvements supportés par les contribuables américains et non le seul impôt sur le revenu, comme c’était l’habitude.
Leur constat est clair : Les riches paient moins d’impôts que le reste de la population. Ils soulignent que, en 2018, à la suite de la réforme fiscale de Trump votée à la fin de l’année précédente et pour la première fois depuis un siècle, les milliardaires ont été moins taxés que les classes moyennes et populaires. Ainsi, une infime partie de la population américaine prend une part croissante de la richesse nationale : ce sont 0.1% des Américains qui possèdent la même portion de patrimoine que 99% du reste de la population. Et, alors que tous les groupes sociaux, classes populaires ou supérieures, payent entre 25 et 30 % de leurs revenus en impôts, les milliardaires ont un taux d’imposition effectif de seulement 23 %. Cela constitue une rupture dans l’histoire des États-Unis qui avec le New Deal de Roosevelt avaient créé un système fiscal véritablement redistributif.
Dans le « Un » Zucman est plus précis :
« C’est comme si vous aviez un impôt proportionnel géant qui devenait dégressif pour les plus riches ! Dans le détail, on a assisté à une détaxation du capital sous toutes ses formes et à une augmentation de l’imposition du travail. Jusque dans les années 1980, l’Amérique avait un impôt sur les sociétés de 50% des taux marginaux sur les dividendes de près de 90%, des taux de succession allant jusqu’à 80% – une taxation du capital beaucoup plus lourde que ce qui a jamais pu exister en France. Aujourd’hui, le produit de l’impôt sur les sociétés est passé de 8% du revenu national à 1% quand les cotisations sociales ont fait exactement le chemin inverse. »
Dans l’émission de France Culture, Gabriel Zucman a dit :
« Si la mondialisation est synonyme d’impôts toujours plus bas pour les grandes entreprises et d’impôts toujours plus élevés pour les petits commerçants, alors cette forme de mondialisation n’a pas d’avenir. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a d’autres formes de mondialisation »
Pour accompagner ce livre, les deux auteurs ont mis au point TaxJusticeNow.org, un site qui permet à chacun de simuler sa propre réforme fiscale et d’en évaluer les implications. Le tout destiné à un large public, afin d’apporter les connaissances nécessaires à un débat démocratique sur l’impôt. Car, montrent-ils, le sentiment croissant de trahison et d’injustice fiscale fait perdre foi en la démocratie, les impôts votés par les représentants du peuple ne cessant d’accroître les revenus d’une minorité favorisée. Il faut, nous disent-ils, inventer de nouvelles institutions fiscales et de nouvelles formes de coopération.
Dans l’émission, il précise qu’ils ne sont pas des conseillers officiels de Bernie Sanders et Elisabeth Warren mais que les deux s’inspirent de leurs travaux.
La grande révolution que préconise Bernie Sanders est de créer un impôt sur la fortune aux Etats-Unis.
Dans l’entretien du « Un », il précise :
« Un impôt sur la fortune qui ferait contribuer les milliardaires à hauteur de leurs revenus : puisque leur fortune croît en moyenne de 8% chaque année, alors Sanders propose un taux d’imposition sur la fortune de 8 % au-delà de 10 milliards de dollars. C’est audacieux mais c’est une manière de répondre à une demande de justice fiscale de plus en plus pressante. ».
Il prétend dans l’émission de France Culture :
« Si on appliquait le programme de Bernie Sanders à la France, cela ne toucherait que les plus riches mais rapporterait 25 milliards, soit 5 fois plus que l’ISF français ancienne mouture. »
Cela n’a en effet rien à voir avec l’ISF à la française qui imposait à partir du seuil de 1,3 millions de d’euros et dont le taux ne dépassait pas 1,5%.
Il faut bien comprendre ce que signifierait la proposition de Bernie Sanders, il veut au-delà d’un certain patrimoine capter la totalité des revenus générés par ce dernier : 8% de revenus, 8% d’impôts.
Cette mesure radicale devrait conduire à ce que les très hauts patrimoines n’augmentent plus ou au moins ralentissent beaucoup leur progression.
Mais pourrait-il être élu avec un tel programme aux Etats-Unis ?
Bill Gates qui avait déclaré son aversion pour Donald Trump, n’a pas exclu de voter pour lui si les Démocrates avaient des propositions fiscales trop extrémistes, c’est-à-dire les propositions de Bernie Sanders.
Et même s’il était élu, pourrait-il mettre en œuvre ce programme ?
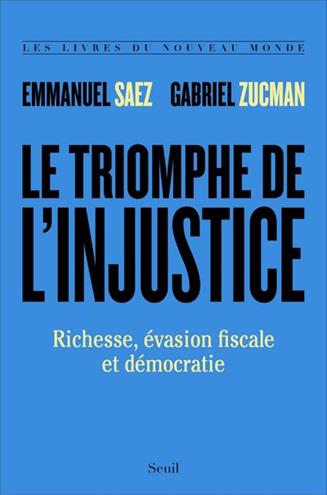 Dans le « Un » Zucman défend l’idée qu’il est possible d’augmenter massivement l’impôt sur le capital sans fuite des capitaux :
Dans le « Un » Zucman défend l’idée qu’il est possible d’augmenter massivement l’impôt sur le capital sans fuite des capitaux :
« Tous ces dirigeants (Thatcher, Reagan, Trump, Macron) ont adopté un discours selon lequel il n’y avait pas d’autres choix possible que celui de baisser les impôts sur le capital. Que la concurrence fiscale allait pousser les grandes fortunes à partir. Que l’imposition des multinationales allait encourager l’exil dans les paradis fiscaux. Et qu’il fallait donc baisser les taux marginaux supérieurs ou supprimer les impôts sur la fortune pour s’adapter à une mondialisation incontrôlable Mais c’est faux et c’est en cela que ce triomphe de l’injustice a des airs de déni de démocratie. C’est une analyse ignorante de ce qu’à pu être la taxation avant les années 1980 et qui porte un diagnostic erroné sur ce que peut être la mondialisation […]
Nous disposons aujourd’hui de traités de libre-échange, mais il n’existe aucune forme de coordination fiscale. Vous avez la possibilité d’avoir un taux d’imposition nul, mais pas celle d’instaurer des barrières douanières ! C’est un choix qui a été fait, mais qui peut être renversé, avec des traités commerciaux qui incluent un volet fiscal »
Il est certain que si les Etats-Unis entraient dans ce type de politique et de traité cela serait plus simple pour les autres. Car je m’interroge quand même sur la capacité d’un pays comme la France d’imposer de telles règles, alors que nous savons qu’à l’intérieur de l’Union Européenne il existe une concurrence fiscale qui n’est pas remis en cause.
Zucman pense aussi qu’il est possible de mettre fin au paradis fiscaux et d’imposer des taux d’imposition sur les très hauts revenus de 60% avec un taux marginal supérieur à 75 %.
La conclusion de son entretien se présente comme positif et volontariste :
« Je suis frappé par les similarités entre la situation actuelle et le Gilded Age, cette période de prospérité de la fin du XIX siècle marquée par une fiscalité régressive, une explosion des inégalités et la constitution de grands monopoles privés. Résultat : au début du XXème siècle il y a eu en quelques années un grand retournement qui a permis de mettre en place le système fiscal le plus progressif au monde. Aujourd’hui, l’émergence de figures politiques comme les démocrates Warren et Sanders aux Etats-Unis laisse penser qu’un autre modèle est possible. Quant à la France, où les prélèvements obligatoires sont déjà élevés, l’enjeu n’est pas de les augmenter encore, mais de sortir de la spirale d’injustice fiscales en échappant au nihilisme actuel : oui, on peut encore agir et renverser la table, à condition d’y mettre un peu de volonté politique. »
Il est certain pour qu’une vraie évolution puisse se réaliser il faut d’abord des théoriciens qui proposent des modèles différents de ceux qui sont à l’œuvre aujourd’hui et il faut ensuit des politiques qui prennent le risque de mettre en œuvre ces méthodes.
Peut-être que les théoriciens sont ces économistes français au pays de Trump et que Bernie Sanders est l’homme politique qui soit en mesure d’être le levier d’action.
La plupart des analystes pensent aujourd’hui qu’il n’a aucune chance de gagner.
Mais depuis l’élection de Trump, l’imprévisible est de rigueur.
Vous pouvez aussi lire cet article d’« Alternatives économiques » : <Gabriel Zucman : « La concentration des richesses pose un problème démocratique »>
<1358>
-
Mercredi 26 février 2020
« On commencerait par la perruque, et à la fin de l’histoire, on l’enlèverait comme si de rien n’était. »Léonor de RécondoJe continue à picorer dans le « Un » qui pose cette question qui pour certains est parfaitement stupide, qui pour d’autres entraîne une réponse affirmative évidente ; « Les riches sont-ils trop riches ? »
Hier nous étions dans le concept : comment déterminer le seuil à partir duquel on est riche ?
Nous avons surtout compris que le plus souvent le riche c’était l’autre.
Et pourtant les grands philosophes nous le disent et nous le savons intimement : l’argent ne fait pas le bonheur. Ou plus exactement, il fait une partie du bonheur jusqu’à un certain niveau, mais au-delà plus du tout.
Aujourd’hui, à l’aide de Léonor de Récondo, je vous invite à regarder la grande richesse à hauteur d’homme.
Pour être précis, il ne s’agit pas de la richesse, mais du comportement d’hyper riches quand ils se laissent aller à exprimer pleinement leur hubris.
 Le « Un » rapporte donc ce récit de Léonor de Récondo, qui fait débuter son récit à l’hôtel des menus plaisirs de Versailles :
Le « Un » rapporte donc ce récit de Léonor de Récondo, qui fait débuter son récit à l’hôtel des menus plaisirs de Versailles :
« On commencerait par la perruque, oui c’est ça. On commencerait par la perruque, et à la fin de l’histoire, on l’enlèverait comme si de rien n’était.
L’histoire officielle débute au château de Versailles, quand les invités arrivent. Ils sont escortés, ni calèches ni valets, pas encore, ils sont pour l’instant dans des berlines noires avec chauffeur, et sur leur trente-et-un. Quand la nuit tombe sur ce 9 mars 2014, ils sont à la fois excités et anxieux de ce qui les attend. Les ors, du vin et des mets, et des privilèges qui ne les protègent ni de la vulgarité ni des artifices. Quelques heures en ce château pour se chauffer au miroitement du Roi-Soleil, pour croire à ce conte de fées mis en scène et en bouche, une fois dans leur vie.
L’histoire officieuse, la mienne, commence quelques heures auparavant à l’hôtel des Menus-Plaisirs, là où a été votée l’abolition des privilèges, on a du mal à y croire. On est une cinquantaine de danseurs, comédiens, figurants et une quinzaine de musiciens dont moi. On me trouve une robe, dentelles et couleurs pastel, coupe Louis XIV, ajustée à la taille, pigeonnante au décolleté, un peu élimée, maintes fois portée. On me dit qu’elle provient du stock de la Comédie-Française. Versailles et le Français, on se prendrait presque au jeu. Manquent encore le maquillage poudré blanc, rose aux joues, une mouche de velours noir, une « galante », me précise-t-on, sur la pommette. Et puis, le filet sur le crâne avant la perruque haute, blanche, guirlande de boucles sur la nuque, épingles qui scalpent, sourire de rigueur. »
Il s’agit de la fête d’anniversaire que Carlos Ghosn a organisé au château de Versailles le 9 mars 2014.
Carlos Ghosn affirme que cette fête a eu lieu pour les 15 ans de l’Alliance Renault-Nissan.
De manière factuelle, Carlos Ghosn étant né 9 mars 1954, cette date constituait le jour de son 60e anniversaire. La date officielle de l’anniversaire de l’Alliance est quant à elle le 27 mars.
L’« Obs » cher à jean Daniel a écrit un article éclairant : « La vidéo de la folle soirée d’anniversaire de Carlos Ghosn à Versailles ».
 « Un travelling dans la galerie des Glaces où des convives en smoking ou robes de soirée et des figurants costumés comme au temps de Louis XIV regardent par les fenêtres un magnifique feu d’artifice tiré des jardins du château.
« Un travelling dans la galerie des Glaces où des convives en smoking ou robes de soirée et des figurants costumés comme au temps de Louis XIV regardent par les fenêtres un magnifique feu d’artifice tiré des jardins du château.
Voilà comment se termine une incroyable vidéo tournée à Versailles le 9 mars 2014, lors d’une grande soirée payée 634 000 euros par la filiale néerlandaise Renault-Nissan BV et organisée le soir des 60 ans de Carlos Ghosn. Un film de huit minutes et vingt secondes tout en lustre, dorures, et excès, […] De quoi conforter la conclusion des auditeurs du cabinet Mazars qui, après avoir scruté les comptes de la filiale Renault-Nissan BV, ont jugé que cette soirée était un événement privé et en aucun cas une fête pour les quinze ans de l’alliance comme avancé par Carlos Ghosn, même si c’était le thème officiel de l’événement et du discours d’accueil du PDG : ainsi que « l’Obs » l’avait révélé en février après avoir eu accès à la première liste d’envoi des invitations, de très nombreux amis ou connaissances personnelles du PDG étaient conviés, dont quantité de Libanais, et seules de très rares relations d’affaires de l’alliance. Carlos Ghosn assure, lui, que sa soirée d’anniversaire a eu lieu le lendemain dans un restaurant parisien… et payée de sa poche. »
Baudelaire a écrit dans son « invitation au voyage »
Là, tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et volupté.
Les hyper riches adorent le luxe et la volupté
Mais le dévoilement des faits, nous apprend aussi que les hyper riches aiment faire payer ce luxe par les autres. Ici la filiale néerlandaise de Renault-Nissan.
Dans sa conférence de presse de Beyrouth après son évasion du Japon, Carlos Ghosn <s’est défendu> avec vigueur.
Il a dénoncé une « diffamation » et a expliqué la raison de célébrer les 15 ans de l’Alliance Renault-Nissan dans un lieu aussi somptueux :
« Versailles, ce n’est pas Louis XIV, Versailles, c’est le site le plus visité en France, c’est le symbole du génie français, c’est un symbole de l’ouverture de la France sur le monde. Ce n’est pas parce que l’on veut imiter tel ou tel roi ou reine, Louis XIV ou Marie-Antoinette »
 Mais il l’assure, il a même adressé un discours portant sur l’Alliance lors de cette soirée. Manque de chance, ce discours a aujourd’hui mystérieusement « disparu ».
Mais il l’assure, il a même adressé un discours portant sur l’Alliance lors de cette soirée. Manque de chance, ce discours a aujourd’hui mystérieusement « disparu ».
Et pour expliquer l’absence des autres directeurs de Renault Nissan, il a aussi son argument ;
« Eh bien, c’est parce que cette fête n’était pas pour eux, cette fête était pour les partenaires et particulièrement les partenaires étrangers. Si on invite un Français à Versailles, il s’en fiche, mais si on invite un Chinois, un Japonais, un Américain, eux, ça les intéresse beaucoup. C’est pour ça qu’on a fait ça à Versailles. »
<L’Obs> a répondu à ces arguments.
« Selon nos informations, Carlos Ghosn a effectivement prononcé un discours à propos des quinze ans de l’alliance Renault-Nissan en ouverture de la soirée, avant celui de Catherine Pégard, patronne du château de Versailles.
[A propos des invités] Outre quelques personnes ayant des relations d’affaires avec Renault-Nissan, étaient présents aussi des convives dont la présence peut se justifier comme un ancien sénateur américain du Mississipi où Nissan a une usine. Mais selon nos informations, de nombreuses personnalités n’ayant aucun lien avec Renault-Nissan, en France et à l’étranger, étaient présentes à cette folle soirée. On peut ainsi citer un grand nombre de businessmen libanais, dont Raymond Debanne, Marwan Hamadé, Gilbert Chaghoury, Najil Nahas, Hussein Khalifa, Nadim Saikali, ou Maurice Sehnaoui.
Mais aussi : son beau-père et sa belle-mère Arfin et Greta Malas ; Etienne Debbané, copropriétaire avec Ghosn d’un vignoble au Liban ; Samir et Laura Lahoud, figures de la jet-set libanaise ; Amin Maalouf, écrivain libanais ; Nayla Moawad, femme politique libanaise ; Salim Daccache, l’ancien directeur du lycée jésuite à Beyrouth où Ghosn a étudié ; Mario Sarada, partenaire de Ghosn dans un complexe immobilier ; Alison Levasseur, architecte d’intérieur ; Ivonne Abdel Baki, femme politique équatorienne d’origine libanaise […] à l’issue de la soirée, une des filles de Carlos Ghosn a publié sur Instagram une photo accompagnée du mot-clef explicite #familyreunion. »

<Le Monde> nous apprend que Le constructeur automobile français Renault a annoncé lundi 24 février qu’il se constituait partie civile dans le cadre de l’enquête judiciaire en France pour abus de biens sociaux visant son ex-patron, qui a été transmise jeudi à un juge d’instruction et qui concerne cette soirée et une autre. Car en 2016, une autre soirée a été organisée dans Grand Trianon et dans le parc du château. Il s’agissait de fêter l’alliance, pardon le mariage de Carlos et de Carole, dernière épouse du franco-libano-brésilien.
Mais Léonor Récondo raconte avec beaucoup d’art cette soirée de l’intérieur :
« Une fois prêts, s’entassent dans ma Twingo un garde et deux danseuses en grand costume. On roule tête baissée à cause des perruques. Arrivés au château, on dîne avec les agents de sécurité dans les couloirs du rez de chaussée, et puis vers 19 heures, ça commence de bouger, il y a de l’agitation […] Lentement surgissent les berlines noires. Ils doivent rêver déjà, ils se préparent depuis longtemps aussi. […]
Le ballet des voitures traverse la cour d’honneur avant de s’arrêter devant la grille dorée, les invités parcourent ensuite la cour royale à pied. Le château brille de toute sa splendeur, le silence s’est posé, les touristes se sont évanouis.
Devant la porte est postée une haie de figurants habillés (déguisés ?) en gardes, lance au pied, provenant du même stock du Français. Les invités en ont plein les mirettes, les robes de soirée caresssent le pavé, les chaussures anglaises le battent. On se salue, se reconnaît, baisemain, la bise pour les intimes, quelle joie de se retrouver ! »
Et puis il y a la fête, les danses, la musique :
 « Le rêve prend corps de danseuse.
« Le rêve prend corps de danseuse.
Les musiciens sont répartis par petits groupes dans les différents salons que parcourent les invités jusqu’à la galerie des Batailles où est dressée l’immense table pour la centaine d’invités.
Je vais jouer du violon deux fois, d’abord dans un des salons avec flûtiste, claveciniste et chanteuse. Dans le brouhaha des pas personne ne nous écoute. On nous prend en photo, selfie enregistré, pour dire qu’on y était. […]
En livrée, le diner est servi.
Exclamation générale à la vue des pièces montées. C’est le moment où je joue avec les danseurs, le tableau que nous formons est plutôt charmant. »
Je ne connaissais pas Léonor de Récondo qui est violoniste baroque mais aussi romancière.
En 2019, elle a écrit « Manifesto » dont parle « Le Monde » dans un article « « Manifesto », le poignant hommage de Léonor de Récondo à son père »
On apprend que Léonor de Récondo est la fille d’un sculpteur espagnol Félix de Récondo, artiste épris de liberté. Sa mère Cécile était aussi artiste peintre.
Le Monde écrit :
« La romancière prête voix, dans Manifesto, son sixième livre, à son père, qui évoque sa famille : des républicains basques espagnols, exilés en France, à Hendaye, à l’époque du franquisme. Le père, la mère, Aïta, l’oncle curé, Amatxo, qui venait dire la messe à la ferme, l’enfance de Félix au collège de Dax : « Les Landes c’est la fin de mon enfance, dit Félix, la clandestinité, la pauvreté, l’exil, la chaleur de notre famille. » Mais c’est aussi, sur la plage d’Hendaye, la découverte éblouie des corps, qu’il ne cessera plus tard de dessiner et de sculpter. »
Pour celles et ceux qui aiment voir de leurs yeux, voici <le lien> vers la vidéo que Youtube et donc Google met gratuitement à notre disposition pour que nous puissions voir quelques éclats de cette belle fête.
Le cuisinier qui a préparé le diner était Alain Ducasse.
Si vous voulez vous offrir un repas préparé par Alain Ducasse, vous devez le payer.
Un hyper riche comme Carlos Ghosn fait payer une personne qu’on appelle morale.
Un professeur de fiscalité avait dit : « Je n’ai jamais serré la main d’une personne morale, mais j’ai constaté qu’à la fin c’était toujours elle qui payait »
C’est peut-être le secret des hyper riches : il ne paie pas (toujours ?) avec leur argent, leur désir de luxe.
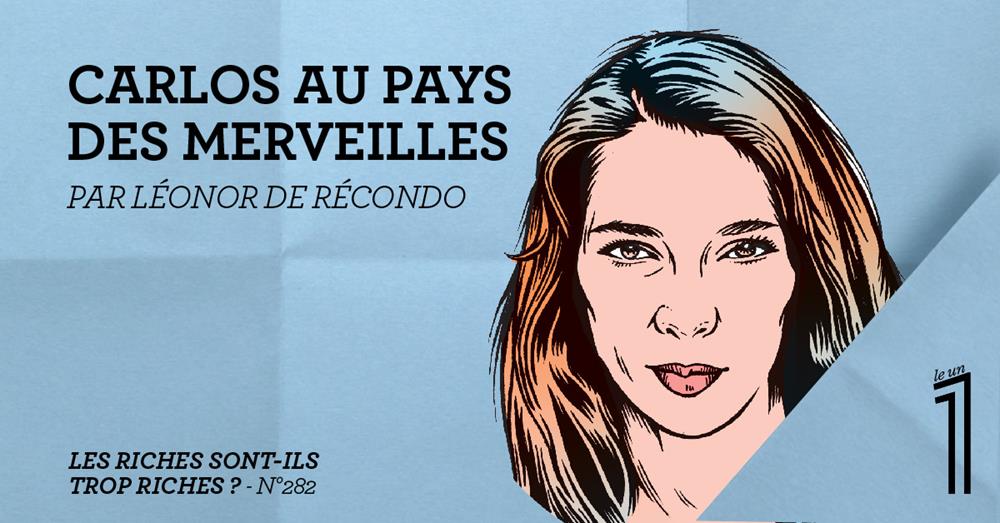 Le récit de Léonor Récondo se termine ainsi :
Le récit de Léonor Récondo se termine ainsi :
« A l’hôtel des Menus-Plaisirs, j’enlève ma perruque, je rends le costume. On me tend ma fiche de paie, 201 euros net. »
<1357>
-
Mardi 25 février 2020
« Comment définir un seuil de richesse ? »Pierre ConcialdiDébut février, le magazine « le Un » posait cette question « Les riches sont-ils trop riches ? ».
 Que signifie cette question ?
Que signifie cette question ?
Il y a évidemment la question morale que chacun peut poser :
Est-il moral de posséder autant de patrimoine et d’avoir des revenus aussi importants que certain multi milliardaires ?
Beaucoup, dont je fais partie, trouveront certains seuils de richesses indécents.
Surtout si on écoute Lao-Tseu qui aurait dit :
«Savoir se contenter de ce que l’on possède, c’est être riche ».
Le Un cite Nietzsche :
« Celui qui possède, lorsqu’il ne s’entend pas à utiliser les loisirs que lui donne la fortune, continuera toujours à vouloir acquérir du bien : cette aspiration sera son amusement, sa ruse de guerre dans la lutte avec l’ennui. C’est ainsi que la modeste aisance, qui suffirait à l’homme intellectuel se transforme en véritable richesse, résultat trompeur de dépendance et de pauvreté intellectuelles »
Nous somme dans le divertissement pascalien, pour tromper l’ennui et la mort, le riche s’adonne à la course vers de plus en plus de richesses.
Et pourtant, comme le rappelle <cet article du Figaro> :
« Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Princeton a montré qu’un revenu plus élevé augmentait le niveau de bonheur, mais seulement jusqu’à un salaire d’environ 75.000 dollars (soit un peu moins de 70.000 euros) par an. Et après? Après, cela bouge peu. Voire plus du tout. C’est pour cela qu’un actif ne peut avoir pour unique ambition de gagner beaucoup d’argent. C’est ce que montre également une étude de la LSE (London School of Economics), dirigée par l’économiste britannique Lord Richard Layard. «Les États doivent mettre de côté la création de richesse pour se concentrer sur la création de bien-être», explique-t-il, arguant notamment que le bien-être des citoyens est la valeur de demain. »
Cette quête semble donc assez vaine.
Mais la question intéressante que pose le Un est plutôt de savoir : « Est-ce que les choses iraient mieux dans le monde si les riches étaient moins riches. »
Toutefois, la première question qui se pose est plutôt de savoir qui est riche ?
Car il est apparaît qu’il est possible et juste de demander une contribution au bien commun plus importante aux riches.
Le journal <La Croix> avait aussi posé cette question qui est riche ?
Et ce journal explique que le riche est une espèce inconnue des statisticiens :
« L’Insee, qui scrute les Français sous toutes les coutures, reconnaît être un peu démuni. Aucune définition ne permet de fixer de façon incontestable le moment où un individu quitte la table de la classe moyenne supérieure pour s’installer au banquet des riches. « Les politiques publiques de lutte contre la pauvreté existent depuis longtemps. Elles ont besoin d’indicateurs statistiques. C’est très différent pour la richesse », explique Julie Labarthe, cheffe de la division revenus et patrimoine des ménages. »
La meilleure réponse se trouve peut-être dans ce dessin de Deligne que le journal publie.
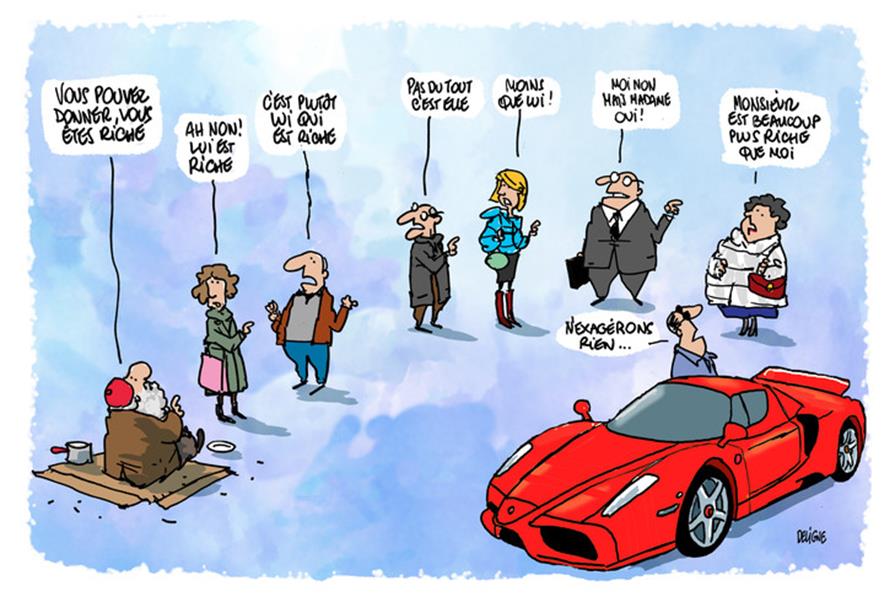 La conclusion est simple : « le riche c’est l’autre, celui qui est plus riche ou apparemment plus riche».
La conclusion est simple : « le riche c’est l’autre, celui qui est plus riche ou apparemment plus riche».
Pour essayer d’aborder cette question, le UN donne la parole à l’économiste Pierre Concialdi qui est membre de l’association des « économistes atterrés » :
« Plusieurs travaux récents permettent aujourd’hui de proposer une définition conceptuelle robuste d’un seuil de richesse ainsi que de premières estimations empiriques. Aux Etats-Unis, le mouvement Occupy Wall Street a popularisé l’idée d’une fracture au sein de la société entre la masse des citoyens (« les 99% ») et une petite élite oligarchique (le « 1% ») qui concentre à la fois le pouvoir économique et politique. Il est devenu depuis fréquent de définir « les riches » comme ceux qui font partie de ce 1%. Dans les sociétés capitalistes contemporaines caractérisées par une inégalité démesurée, cette façon d’identifier la population riche emporte assez facilement la conviction des citoyens ordinaires. En France, cela correspond pour une personne seule à un revenu annuel avant impôts de plus de 100 000 euros »
C’est à cette définition que fait appel Emmanuel Todd, dans son livre « Les luttes de classe dans la France du XXIème siècle» où il oppose deux classes « les 99% » et les « 1% ».
Cette définition cependant ne convainc pas l’économiste parce qu’elle méconnaît le fait que la proportion de riches peut varier dans le temps et aussi selon les pays.
Une seconde approche peut être proposée en retenant comme seuil de richesse, un multiple du revenu médian (2 fois ou 3 fois plus).
Rappelons que le revenu médian est celui que touche celui qui se trouve au milieu d’une population : 50% se trouve au-dessus et 50% se trouve en dessous.
C’est ainsi qu’on définit le seuil de pauvreté, fixés selon les pays à 60% ou 50% du revenu médian.
Le seuil de richesse serait la même chose dans l’autre sens. Pierre Concialdi y voit un avantage :
« Cette démarche présente l’avantage de s’appuyer sur un repère collectif (le revenu médian), ce qui signale que la richesse comme la pauvreté est une notion relative.’
Cette démarche présente le caractère subjectif de déterminer le coefficient multiplicateur.
Ainsi avec un revenu média, de 1 735 euros par mois en 2017 est-on riche à partir de 3 470 euros (2x) ou 5 205 euros (3x) ou encore 8 675 euros (5x)
Et il explique une autre manière d’aborder le sujet :
« Des travaux plus récents ont proposé de définir un seuil de richesse de façon plus argumentée en l’arrimant, en quelque sorte à un objectif d’éradication de la pauvreté.
Le seuil de de richesse correspond alors au niveau de revenu maximal auquel il faudrait abaisser les plus hauts revenus pour rééquilibrer la distribution de façon à permettre à tous d’atteindre un niveau de vie minimum décent.
L’idée qui fonde cette approche est que la société devrait avoir une aversion totale pour la pauvreté et donc se donner les moyens de l’éradiquer. Dit autrement, si nous voulons faire société, il est nécessaire que tous les citoyens puissent y participer au moins de façon minimale, ce qui nécessite de fixer une limite au plus hauts revenus. Une fois défini un seuil minimum d’inclusion sociale, on peut alors définir le seuil de richesse qui y est associé. »
La difficulté est d’aboutir à un consensus argumenté sur le panier de biens et de services nécessaires pour accéder à un niveau de vie décent.
La démarche proposée par des chercheurs britanniques est de parvenir à ce consensus par une démarche participative.
En France, une démarche analogue a été engagée par l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) qui a défini <les budgets de référence> représentant précisément un niveau de vie décent. Le revenu minimum est d’environ 1 500 euros par mois pour une personne seule.
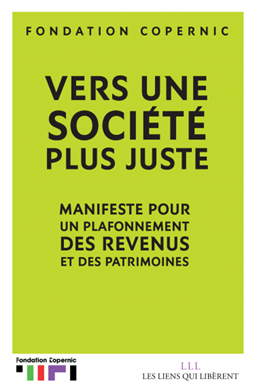 Et pour déterminer alors le seuil de richesse Concialdi cite un ouvrage de la Fondation Copernic « Vers une société plus juste » qui détermine une fourchette comprise entre 3,5 fois et 4 fois le seuil minimum d’inclusion. Soit toujours pour une personne seule, un revenu disponible (après impôts) égal à environ 6 000 euros par mois.
Et pour déterminer alors le seuil de richesse Concialdi cite un ouvrage de la Fondation Copernic « Vers une société plus juste » qui détermine une fourchette comprise entre 3,5 fois et 4 fois le seuil minimum d’inclusion. Soit toujours pour une personne seule, un revenu disponible (après impôts) égal à environ 6 000 euros par mois.
L’économiste prétend que :
« Cette approche présente l’avantage d’articuler la définition d’un socle minimum d’égalité socialement validé avec celle d’un revenu maximal. Elle permet ainsi de définir un repère collectif permettant d’orienter les politiques publiques en vue de contenir l’inégalité dans des limites socialement acceptables ; »
Il rappelle que la satisfaction des besoins peut aussi passer par le développement de services publics.
Concialdi répond donc précisément à la question posée par « le Un » : Oui les riches sont trop riches.
Et lutter contre la pauvreté, dispose comme premier levier d’empêcher les riches d’être trop riches.
Mais il en est qui conteste cette vision et pense qu’on ne lutte pas contre la pauvreté en luttant contre les riches.
La position défendue par Concialdi se heurte à une autre grande difficulté : Les contraintes qu’il propose sont de l’ordre du politique qui s’exerce dans le cadre des États.
Or la répartition des richesses dépend en grande part de l’économie pour laquelle les frontières étatiques ne représentent pas grand-chose.
<1356>
-
Lundi 24 février 2020
« Pourquoi le mal ? C’est la seule vraie question »Dernier édito de Jean Daniel dans l’obsLecteur régulier du nouvel observateur, aujourd’hui abonné, la lecture des articles de Jean Daniel m’a accompagné toute ma vie.
A 20 ans, je lisais déjà les contributions de ce journaliste, intellectuel et je n’hésite pas à l’écrire de ce « sage ». Il est décédé le 19 février à 99 ans
Robert Badinter a dit de lui : « Jean Daniel était un homme juste »
Jean Daniel était en effet de tous les bons combats de la décolonisation, des luttes sociales, de l’abolition de la peine de mort, du rejet des dictatures soviétiques et maoïstes, de la paix entre palestiniens et israéliens. Toujours du côté de la tempérance, de l’équilibre et de l’intelligence.
Il était aussi courageux et pendant la décolonisation à Bizerte, au cours d’un combat entre les insurgés et les forces françaises, alors qu’il sort d’une entrevue avec Habib Bourguiba, il tombe sous la mitraille d’un avion… français. Blessé gravement, il passe de longs mois hospitalisé.
Du point de vue politique il était du côté de Mendés France puis de Michel Rocard et non pas de celui de François Mitterrand. Ce qui le rend encore plus sage à mes yeux.
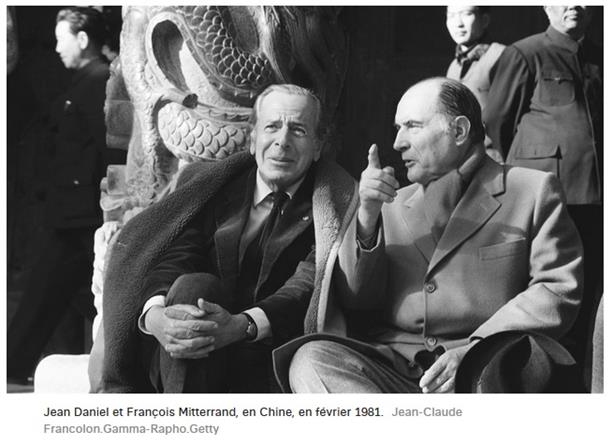 Robert Badinter raconte :
Robert Badinter raconte :
« Si François Mitterrand lisait avec attention les articles de Jean Daniel qu’il évoquait volontiers, celui-ci est toujours demeuré aux yeux de François Mitterrand entaché du péché de « rocardisme ». Je me souviens qu’il se plaisait à me brocarder à ce sujet : « Comme le dit votre ami Jean Daniel, qui aime tant Michel Rocard… »
Nous en plaisantions mais je pense que François Mitterrand a toujours considéré Jean Daniel comme un rocardien, ce qui suscitait chez lui plus de suspicion que de confiance. »
Il semble cependant, selon Hubert Védrine, qu’à la fin Jean Daniel a reconnu quand même quelque mérite à Mitterrand : «Plus Jean Daniel a connu Mitterrand, plus Mitterrand l’a fasciné»
Hubert Védrine qui parle aussi de son engagement pour la paix au proche orient, contre tous les extrémistes :
« Mais je voudrais maintenant préciser pourquoi je l’ai tant admiré : c’est pour son courage. Culture, intelligence, finesse, curiosité jamais rassasiée, oui. Mais plus encore courage. Face à la bêtise à front bas, et même parfois à la haine.
D’abord sur le Proche-Orient. Il n’a jamais cessé inlassablement, dans ses éditoriaux, de soutenir par ses explications, son argumentation et ses prises de position les chances d’une vraie paix entre Israéliens et Palestiniens contre le fanatisme, le sectarisme, le nationalisme, l’ignorance, l’idiotie. Il a constamment été soupçonné par les pro-arabes radicaux et attaqué plus encore par les extrémistes nationalistes et religieux israéliens. Mais, à l’époque, il y avait encore des travaillistes et un « camp de la paix » ! Il a fait front stoïquement avec force et sérénité. Tout est expliqué dans « la Prison juive ». Tous ceux qui ont œuvré dans le sens du dialogue et de la paix depuis plus d’un demi-siècle, d’un côté ou de l’autre, lui doivent quelque chose. »
Jean Daniel est né Bensaïd, le 21 juillet 1920 à Blida, en Algérie, dans une famille juive.
Il a fait plusieurs rencontres marquantes dans sa vie, mais il semble bien que celle avec Albert Camus soit la plus marquante. Albert Camus qui a disparu il y a 60 ans, dans un accident de voiture à Villeblin, dans l’Yonne le 4 janvier 1960.
Dans un article publié dans l’Obs lors d’un hors-série consacré à Albert Camus, Jean Daniel a écrit un article dont voici un extrait :
« Notre rencontre a illuminé ma vie. Quelle chance insolente, tout de même. A 27 ans, dans le Paris de l’après-guerre, je dirige une petite revue littéraire, « Caliban », quand un jour, à mon bureau, je reçois un coup de téléphone : « Ici Camus.» J’ai eu du mal à le croire, failli répondre « et moi je suis Napoléon », mais c’était bien lui. Il voulait me suggérer de publier dans « Caliban », qu’il appréciait, des extraits du roman « la Maison du peuple » de son ami Louis Guilloux. Nouveau coup de chance, je connaissais et j’aimais Guilloux. Une heure plus tard, je passais le voir dans son bureau, chez Gallimard.
Nos origines algériennes communes ont sans doute compté dans ce miracle : cet écrivain que j’admirais m’a fait le cadeau merveilleux de son amitié. Et de sa générosité : il m’a ouvert son carnet d’adresses, permettant à « Caliban » de survivre quelques années encore, a publié mon roman « l’Erreur » dans la collection qu’il dirigeait chez Gallimard, a fait par sa conversation ma culture littéraire et philosophique. Il ne donnait jamais de cours, ne prêchait pas, ne disait pas « il faut lire untel et untel », mais faisait simplement profiter de son savoir, de ses pensées. Et de sa joie de vivre : avec ceux qu’il considérait comme les siens, il aimait rire et, comme tout séducteur, danser — il prétendait danser mieux que les autres, mais il le faisait surtout plus joyeusement, plus librement. »
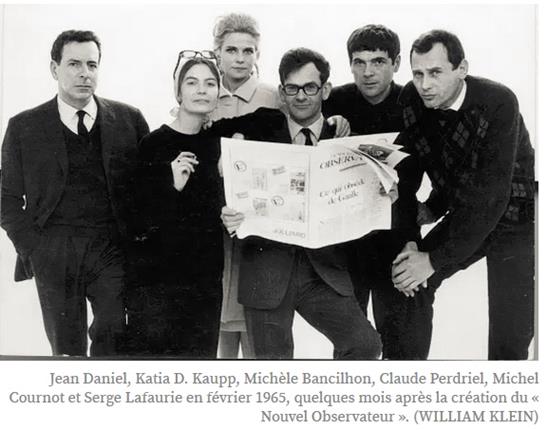 La revue « Caliban » va faire faillite, il travaillera alors quelques temps dans le journal «L’Express» de Jean-Jacques Schreiber avant de fonder avec Claude Perdriel « Le Nouvel Observateur » dont le premier numéro paraîtra le 19 novembre 1964. Les parrains de ce nouvel hebdomadaire seront Mendés-France et Jean-Paul Sartre.
La revue « Caliban » va faire faillite, il travaillera alors quelques temps dans le journal «L’Express» de Jean-Jacques Schreiber avant de fonder avec Claude Perdriel « Le Nouvel Observateur » dont le premier numéro paraîtra le 19 novembre 1964. Les parrains de ce nouvel hebdomadaire seront Mendés-France et Jean-Paul Sartre.
Et très longtemps, il a dirigé et écrit des éditos et puis il n’a plus eu la force de venir ni d’écrire.
Il a pourtant ressorti une dernière fois la plume pour écrire son <dernier édito> le 15 octobre 1919.
Trois évènements venaient de se passer :
- Un attentat en Allemagne, à Halle, contre une synagogue ;
- Le meurtre au sein de la préfecture de police de fonctionnaires sous les coups d’un islamiste radicalisé ;
- L’intervention de l’armée turque contre les kurdes, nos alliées dans le combat contre Daesh
Et il écrit :
« Cela devait arriver. C’est arrivé. C’est-à-dire que l’on est, une fois encore, en train d’aller jusqu’au bout du bout. Je n’en parlerai pas comme mes confrères. Si j’ai été absent si longtemps c’est parce que, cela se sait, j’étais malade. Bien sûr, il y avait autre chose, mais cela commence à se savoir aussi. Les amis que j’ai inquiétés me pardonneront ce silence, surtout si je n’emploie pas les mêmes arguments que les autres.
Selon certains, rien ne serait nouveau dans ce qui nous indigne et nous révolte, rien de rien. Ni la trahison, ni la barbarie, ni les fausses promesses. Les Kurdes du nord de la Syrie, fidèles à leur combat historique pour la reconnaissance de leur nation, ont eu le courage de combattre Daech, pied à pied, quartier par quartier, ruine par ruine. Les voilà livrés aux appétits du nationaliste Erdogan et à la soldatesque turque qui s’emparent de leur territoire, tandis que se rapprochent les colonnes de Bachar, elles aussi assoiffées de reconquête.
On en est jusqu’à s’indigner des trahisons et même des mensonges. Mon Dieu, les Kurdes sont en train de disparaître ! Quant aux Turcs, ce serait la première fois qu’ils désavouent et qu’ils mentent ! Que veux-je dire ? Que toute illusion sur l’entente des peuples est dangereuse ? Davantage, elle conduit à abandonner toute espèce de sens à un rapprochement quelconque entre les peuples. Alors, rien n’est possible ? Ce serait la fin des fins.
Il y a pourtant eu un commencement de sagesse, avant le déluge sans doute. Mais soyons patients. Le vrai déluge n’est pas encore arrivé. Je serai peut-être bientôt centenaire. Je n’ai rien fait pour et quand on m’en fait compliment, je suis dans la confusion. Mais si âgé que je sois, je voudrais dire que s’il m’était resté encore bien des mois pour lutter, car c’est bien une lutte, alors je les aurais passés à réfléchir et à écrire essentiellement sur la barbarie des hommes. Y a-t-il à ce trait constant de l’espèce la moindre justification ? Sans doute la vie ne pouvait-elle pas apparaître sur la terre sans la barbarie.
On dit que l’homme est un loup pour l’homme. Ce n’est pas insensé. La preuve, c’est qu’après la Première Guerre mondiale, il y a eu la Seconde. Je voudrais que les plus jeunes d’entre nous comprennent bien le sens de cette succession. Voilà des millions et des millions d’hommes qui inventent l’atroce guerre. Ils vont tous avoir une conscience et une mémoire sur la première guerre et ils ne vont pas hésiter à en refaire une seconde. Oui, une Seconde Guerre mondiale, et même, ils la rendront plus cruelle que la précédente.
Voilà le sujet qui me serait proposé. C’est la seule vraie question. Pourquoi le mal ?
Cette volonté sinistre, morbide sans la moindre justification.
Chacun pose la question à son dieu, jusqu’au moment où les dieux eux-mêmes se déchaînent.
Oui, pourquoi le mal ? Je ne vois pas une autre question digne d’être traitée aujourd’hui. »
Et en évoquant les tensions autour de l’Islam après la tuerie de la préfecture de police, il finit par cette conclusion :
« Pour le surmonter, nous avons toujours défendu ici la tradition d’un Islam éclairé, à l’origine même de notre humanisme sécularisé. Mais, c’est hélas le temps long de l’Histoire qui devrait nous renseigner sur la probable suite des événements. « Mon pays est un pays chrétien et je commence à compter l’histoire de France à partir de l’accession d’un roi chrétien qui porte le nom des Francs », disait le général de Gaulle en 1959. Ce constat du fondateur de notre Ve République n’ôte rien à la nécessité de tout faire pour aménager une concorde pacifique avec les musulmans qui vivent dans notre pays. Mais il dit aussi que vouloir extirper les racines millénaires d’un peuple est mission impossible. »
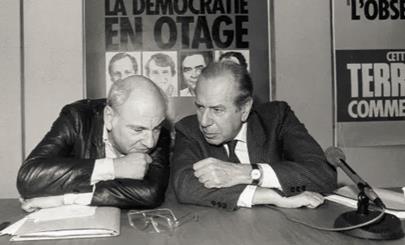 Edgar Morin, né en juillet 1921, un an après Jean Daniel était son ami.
Edgar Morin, né en juillet 1921, un an après Jean Daniel était son ami.
Il avait écrit pour les 99 ans de Jean Daniel une lettre <Salut l’ami>, dans laquelle il reconnaissait notamment sa grande clairvoyance par rapport au communisme ainsi que sa confiance en Camus dès le début :
« Alors que j’avais encore une foi mystique (que je croyais conviction rationnelle) en l’URSS, tu as résisté à la grande tentation des intellectuels de l’époque et l’amitié d’Albert Camus a contribué à ta sauvegarde. Camus ! Si proche et si semblable à toi, il illumina ta pensée et ta vie, alors que, pour moi, c’est un grand regret – moi qui appréciais son œuvre et l’avais connu chez Marguerite Duras – de l’avoir classé dans la catégorie dédaignée par Hegel des belles âmes et des grands cœurs, que je reconnais aujourd’hui comme les plus nobles de toutes. »
Je laisserai le mot de la fin à Anne Sinclair : « Le journalisme était grand sous Jean Daniel ».
<1355>
- Un attentat en Allemagne, à Halle, contre une synagogue ;
-
Vendredi 21 février 2020
« Bella Ciao »Un chant italien sur lequel on raconte des histoiresDans la série concernant les mots de l’actualité, le 11 février je parlais <des sardines>, ce mouvement anti populiste qui est né à Bologne pendant des élections locales pour stopper l’irrésistible ascension de Salvini et de la Ligue et qui s’est répandu à l’ensemble de la péninsule italienne.
Les « sardines » manifestaient, étaient nombreux, se pressaient les uns contre les autres et <chantaient Bella Ciao>
Una mattina mi son svegliato,
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
Je continue en français
Un matin, je me suis réveillé,
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
Un matin, je me suis réveillé,
Et j’ai trouvé l’envahisseur.
Hé ! partisan emmène-moi,
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
Hé ! partisan emmène-moi,
Car je me sens mourir.
J’ai pensé : voici un mot du jour facile, on raconte un peu l’histoire de cette chanson, on parle de sa renommée planétaire, on renvoie vers quelques versions de ce chant et ce sera une belle manière de terminer la semaine.
Opportunément ARTE a réalisé une petit documentaire de moins de quinze minutes : <Bella Ciao dans les rizières du Pièmont> qui racontent tout ce qu’il y à savoir sur ce sujet, chant des partisans lors de la dernière guerre mais dont l’origine remonterait aux ouvrières saisonnières qu’on appelait les « mondines » et qui travaillaient, dans de dures conditions, à la culture du riz dans les terres humides de la plaine du Pô, dans le nord de l’Italie.
<Wikipedia> reprend cette version :
 « C’est une chanson de travail et de protestation piémontaise. Elle exprime la protestation des mondines, les saisonnières qui désherbaient les rizières d’Italie du Nord et y repiquaient les plants de riz, contre les dures conditions de travail : les femmes devaient rester courbées toute la journée, dans l’eau jusqu’aux genoux, sous le regard et les brimades des surveillants. Les conditions de travail et de vie des mondines sont illustrées par le film <Riz amer> de Giuseppe De Santis, chef-d’œuvre du néoréalisme italien. »
« C’est une chanson de travail et de protestation piémontaise. Elle exprime la protestation des mondines, les saisonnières qui désherbaient les rizières d’Italie du Nord et y repiquaient les plants de riz, contre les dures conditions de travail : les femmes devaient rester courbées toute la journée, dans l’eau jusqu’aux genoux, sous le regard et les brimades des surveillants. Les conditions de travail et de vie des mondines sont illustrées par le film <Riz amer> de Giuseppe De Santis, chef-d’œuvre du néoréalisme italien. »
Dans cet article nous avons aussi les paroles complètes du chant des partisans, comme du chant des mondines dont je donne le début dans sa traduction française :
Le matin, à peine levée
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Le matin, à peine levée
À la rizière je dois allerEt entre les insectes et les moustiques
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Et entre les insectes et les moustiques
Un dur labeur je dois faireLe chef debout avec son bâton
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Le chef debout avec son bâton
Et nous courbées à travaillerQuelques recherches plus loin, j’ai appris que ce chant avait connu un regain de popularité récente en raison d’une série espagnole produite sur Netflix : « La casa de papel ». Je n’en ai jamais entendu parler avant, montrant ainsi ma déconnexion de Netflix et mon manque de culture actuelle et populaire. J’ai trouvé <cet article d’Ouest France> qui rapporte :
« Le dernier gros succès de la plateforme de streaming Netflix, la série espagnole La Casa de Papel, a remis au goût du jour le chant révolutionnaire italien Bella Ciao. […]
« O Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao… » Dans la série télévisée espagnole La Casa de Papel, qui cartonne sur Netflix, les protagonistes – qui participent à un impressionnant braquage organisé à la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre (à Madrid), pour imprimer 2,4 milliards d’euros – entonnent à plusieurs reprises ce chant au rythme entraînant, particulièrement addictif.
Au fil de la série, il devient en quelque sorte, la chanson de ralliement des malfaiteurs. Impossible de ne pas la siffloter quand on regarde les épisodes.
Depuis que la première saison a été diffusée sur Netflix (en décembre 2017), les recherches sur Google avec le mot-clé « Bella Ciao », explosent. Elles ont été multipliées par dix. Sur YouTube c’est pareil, elles grimpent en flèche depuis le début de l’année.La plateforme américaine a flairé le filon et a basé une grande partie de sa communication sur ce chant pour la deuxième saison de La Casa de Papel, diffusée depuis le 6 avril : affiches, vidéos, posts sur Twitter, sur Facebook, karaoké… À tel point que sur les réseaux sociaux, ça s’empoigne entre fans de la série qui font du morceau « LA chanson de La Casa de Papel » et les puristes, qui hurlent au détournement de ce chant partisan italien, né il y a plus d’un siècle. »
Et l’article revient sur l’origine des mondines :
« Car au tout début, Bella Ciao est un chant ouvrier, dont la datation précise est difficile. Les « mondines », ces ouvrières saisonnières piémontaises qui travaillaient dans les rizières italiennes de la plaine du Pô à la fin du XIXe siècle en seraient à l’origine. »
Alors il semble bien que c’est cette série qui en a fait un tube mondial :
D’abord en Amérique du Sud : <au Chili>, <au Venezuela>, <en Uruguay> on chante bella ciao ou en s’inspire de l’air.
L’obs nous parle de manifestations au <Liban>
« Depuis le début de la contestation la semaine dernière au Liban contre la classe politique, la précarité et les taxes, la foule compacte rassemblée place Al-Nour dans le centre de la capitale du Nord [Tripoli] se déhanche au son des basses du coucher du soleil jusqu’au bout de nuits euphoriques. […]
Sur la place Al-Nour, où trône une imposante sculpture formant le mot « Allah » (Dieu), un DJ officie depuis un balcon surplombant une marrée humaine illuminée par les lampes torches des milliers de téléphones portables. Limonade et friandises gratuites sont distribuées. Des slogans et des hymnes populaires sont repris en choeur comme la chanson révolutionnaire italienne « Bella Ciao », écrite en 1944, popularisée auprès des jeunes par la série Netflix espagnole La Casa de Papel et reprise aussi dans les manifestations en Algérie et à Barcelone. »
Donc le Liban, l’Algérie l’Espagne et aussi <des palestiniens qui font aussi appel à ce chant> dans leur lutte pour un Etat.
<Et cet article> parle du Kurdistan et de New Delhi en Inde où résonne ce chant dans des manifestations.
<En Irak> des artistes de Mossoul reprennent « Bella ciao » en arabe pour en faire un hymne de la contestation.
<Même à Hong Kong> on chante bella ciao.
Mais revenons à l’origine de ce chant.
« Mediapart » a publié quatre articles sur ce sujet : <1>, <2>, <3>, <4> et a donné comme titre à cette série : « Les métamorphoses de Bella Ciao »
Le premier article s’étonne qu’il n’y ait rien de collectif dans les paroles de Bella Ciao. Un homme s’engage seul, et fait ses adieux à sa bien-aimée en sachant aller à la mort : un récit atypique dans l’univers de la Résistance européenne.
Un historien, Bruno Leroux, s’est intéressé aux chants de maquisards français et en analysant un corpus de 85 de ces chants il constatait que 79 d’entre eux étaient « l’expression d’un nous » désignant « les maquisards » ou plus rarement « la Résistance et les Français ». Un nous, mais pas ce moi romantique que met en scène Bella Ciao.
La suite de l’article met en doute que cette chanson ait été souvent chantée par les partisans italiens :
« Très rares sont les témoignages d’anciens partisans qui disent se souvenir avoir chanté Bella Ciao pendant leur clandestinité. Tout au plus en trouve-t-on une poignée autour de Montefiorino, en Émilie-Romagne, mais recueillis si tard que l’on est enclin à y voir des souvenirs reconstitués »
Et l’auteur de l’article de poser cette question pleine de sens :
« Dès lors se pose une énigme. Comment une chanson qu’aucun partisan n’a chantée durant les années de la Résistance a-t-elle pu devenir un hymne international de l’antifascisme »
L’Italie, plus qu’un autre pays occidental, après la première guerre mondiale et la révolution soviétique était minée par des quasi guerres civiles entre les forces de gauche et les forces conservatrices qui vont muter vers le fascisme. Puis après la seconde guerre, avec le parti communiste le plus puissant de l’ouest, les forces de gauche vont forger l’histoire de ce chant méconnu de la résistance italienne.
« C’est dans ce contexte politique complexe que se comprend l’émergence de Bella Ciao comme chanson emblématique de l’antifascisme. On l’a vu dans le premier volet de cette série, l’hymne était entre 1943 et 1945 inconnu des nombreuses formations locales de partisans, appuyées sur une vallée, un plateau, un massif.
Comment se fait-il que Bella Ciao ait conféré à l’Italie antifasciste cette unité qui lui manquait tant ? Les travaux historiques manquent sur ce point. Tout juste note-t-on souvent que les chorales populaires dans les communes acquises à la gauche firent beaucoup pour populariser, dès la Libération, la chanson. Pour la gauche unie des socialistes, des communistes et d’autres formations aujourd’hui oubliées comme le Parti d’action, Bella Ciao offrait un consensus fédérateur : mourir aux côtés des partisans luttant pour la liberté, voilà qui donnait une image flatteuse et fédératrice de la gauche, tout en évitant les questions qui fâchent.
La première représentation publique de Bella Ciao prend forme lors de la création du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, organisé à Prague à l’été 1947. D’autres représentations suivront au festival de Budapest (1949) et Berlin-Est (1951). La délégation italienne y enthousiasme ses camarades internationalistes par ses claquements de mains accompagnant le refrain qui donne son nom à la chanson. En ce début de guerre froide, Bella Ciao est devenu un hymne fédérateur du camp progressiste.»
Et puis…
Dans les années 1960, un milanais Roberto Leydi, journaliste et musicien, a pour objectif de faire une anthologie de la chanson populaire italienne. Il parcoure l’Italie du Nord, magnétophone à l’épaule, pour y recueillir des chants populaires. Et en 1962, lors d’une de ces campagnes de collecte, Leydi fait la connaissance d’une certaine Giovana Daffini. Ancienne mondine (ces ouvrières des rizières de la plaine du Pô), elle est aussi une musicienne accomplie. Et voici qu’elle déclare à Leydi qu’elle chantait, dès les années 1930, l’air de Bella Ciao, mais sur de tout autres paroles.
L’auteur de l’article, Nicolas Chevassus-au-Louis, analyse :
« Pour la gauche italienne, l’irruption de Giovana Daffini est du pain bénit. Bella Ciao a été construit après guerre comme hymne antifasciste consensuel. Et voici que la chanson se rattache aux plus anciennes luttes sociales italiennes, celles des journaliers de l’agriculture, qui présentent de surcroît l’avantage de pouvoir mobiliser tant au nord qu’au sud. Leydi est enchanté de sa découverte. Quant à Giovanna Daffini, elle connaît, à 47 ans, la gloire. »
Mais cette histoire ne semble pas plus exacte que la précédente :
« L’ancienne « mondine » multiplie les versions, jusqu’à son décès en 1967. Tantôt elle aurait chanté son Bella Ciao des rizières avant guerre, tantôt après. Dans son livre Guerra, guerra ai palazzi e alle chiese (Odradek, 2003, non traduit), Cesare Bermani, un ancien des Nuovo Canzionere Italiano, donne le fin mot de l’histoire. Comme il le résume en empruntant une citation à l’historien britannique Eric Hobsbawm, l’histoire que l’on raconte dans les années 1960 de Bella Ciao n’est rien d’autre que « l’invention d’une tradition ». Irrité par la notoriété soudaine de Giovanna Daffini, Bermani rapporte qu’un ancien ouvrier agricole, Vasco Scansani, écrit à L’Unità, quotidien du PCI, pour affirmer qu’il a composé en 1951 les paroles de l’air des mondines… Ce que ne conteste pas la chanteuse, qui n’en est pas à une palinodie près. »
Au départ je croyais à une histoire toute simple et un mot du jour rapide….
Cette <Page> de France Culture est un peu plus synthétique que Mediapart
« La popularité de « Bella Ciao » n’est plus à prouver. Pourtant ses origines restent floues, mélangeant faits historiques et légendes urbaines.
[…] On l’aurait vu apparaître en 1943 pendant la guerre civile italienne et la plupart des résistants l’auraient entonnée. […] En réalité la chanson a été très peu connue et chantée par les résistants.
Elle aurait donc bien été écrite dans ces années-là mais elle n’aurait été que très peu connue. […] La chanson acquiert en réalité sa notoriété après 1945. La presse socialiste la reprend et une revue d’ethnographie la publie dans ses pages en 1953.[…]
Une des légendes de « Bella Ciao » situe les origines au début du XIXe siècle dans le Nord de l’Italie. Là-bas des femmes, appelées les « Mondines » travaillent dans les rizières autour du fleuve Pô principalement. On raconte qu’elles auraient été les premières à chanter « Bella Ciao » mais avec des paroles différentes pour dénoncer leurs conditions de travail.
[…] Pour des historiens ce pan de l’histoire est une invention. Le témoignage de Vasco Scansiani, désherbeur dans les rizières va dans cette direction. Il affirme avoir écrit les paroles de la chanson en 1951 après les premières apparitions du chant « partisan ».
On ne sait pas davantage, d’où vient la mélodie. Certains avancent l’idée d’une origine française qui daterait du XVIe siècle, d’autres pensent que la mélodie pourrait aussi venir d’un chant yiddish de 1910.
Et l’article conclut :
« La popularité de cette chanson s’est construite au fil des ans. Les fables autour des origines de ce chant renforcent sa symbolique et aident le pays à se projeter dans l’histoire de « Bella Ciao », dont tous les Italiens se revendiquent, aujourd’hui encore. »
En voici une version italienne et traditionnelle <Bella Ciao>. <Les Swingle Singers> chantent avec une grande perfection, mais on peut se demander si l’âme du chant se trouve dans cette version épurée. Et si on veut entendre une version plus dans l’émotion je pense qu’il faut plutôt faire appel à cette chanteuse italienne <Tosca>. Elle s’appelle Tiziana Tosca Donati, mais a choisi comme nom de scène le titre du célèbre opéra de Puccini.
J’ai trouvé un extrait de la série <La casa de papel – Bella Ciao> dans lequel deux des protagonistes fredonnent puis chantent ce chant que cette série a contribué à faire connaître planétairement.
Les textes se trouvent dans <Wikipedia>
<1354>
-
Jeudi 20 février 2020
« Dieu est Dieu, nom de Dieu »Maurice ClavelMaurice Clavel est un écrivain, philosophe et journaliste du temps de ma jeunesse. Il écrivait dans le Nouvel Obs et il a été un des fondateurs de Libération.
Il s’est rendu célèbre un soir, le 13 décembre 1971, en quittant le plateau d’une émission de la télévision qui à l’époque était totalement sous le contrôle du gouvernement, en lançant la formule :
« Messieurs les censeurs, bonsoir ! »
L’émission avait projeté un reportage qu’il avait réalisé et avait coupé un passage dans lequel il soulignait le peu d’appétence du Président de la République d’alors, Georges Pompidou, pour la résistance. Et il est vrai qu’il reste surprenant, malgré toutes les grandes qualités intellectuelles de Georges Pompidou, que De gaulle ait choisi comme principal premier ministre de ses deux mandats, un homme qui n’a manifesté ni en parole, ni en acte, pendant toute la seconde guerre mondiale, la moindre opposition au régime de Vichy.
Il y eut une époque en France où la liberté d’expression à la télévision était très restreinte ou du moins très encadrée. Et si les « vieux » comme moi se souviennent de cette épisode, c’est parce qu’à l’époque personne ne disait rien et que l’esclandre de Maurice Clavel a été unique dans un monde de soumission.
Maurice Clavel était un intellectuel haut en couleur et savait être virulent.
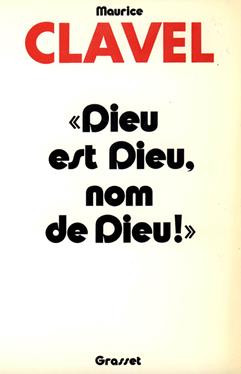 Mais si je le cite aujourd’hui, c’est en raison d’un de ses livres que j’avais lu lors de mes vingt ans, lorsque je traversais un moment de mysticisme et de Foi chrétienne : « Dieu est Dieu, nom de Dieu ». Je ne me souviens plus en détail de ce livre, mais je garde une impression d’ensemble très forte que je résumerais ainsi : si vous croyez en Dieu, il faut tirer toutes les conséquences de ce que j’appellerai aujourd’hui cette hypothèse.
Mais si je le cite aujourd’hui, c’est en raison d’un de ses livres que j’avais lu lors de mes vingt ans, lorsque je traversais un moment de mysticisme et de Foi chrétienne : « Dieu est Dieu, nom de Dieu ». Je ne me souviens plus en détail de ce livre, mais je garde une impression d’ensemble très forte que je résumerais ainsi : si vous croyez en Dieu, il faut tirer toutes les conséquences de ce que j’appellerai aujourd’hui cette hypothèse.Je me souviens qu’il répondait notamment aux incrédules qui mettaient en cause la naissance de Jésus sans acte charnel humain préalable : « Mais enfin si Dieu existe, il est évident qu’il sait faire cela. Dieu est Dieu nom de Dieu. »
Et il est vrai qu’aujourd’hui les humains savent le faire, donc il n’y aucune raison que de tout temps, si on fait l’hypothèse d’un Dieu omnipotent qui s’intéresse aux humains, ce qui me semble être une description honorable et juste de la croyance monothéiste, il est capable de faire un enfant de manière extra naturelle.
Mais ce n’est pas de la naissance dont je voudrais parler mais du blasphème et de l’histoire de Mila que j’ai narré lors du mot du jour consacré au mot « islamophobie ».
Je constate avec effarement et colère qu’un sondage Ifop réalisé pour « Charlie Hebdo » montre combien les Français semblent divisés après l’affaire Mila, à propos du droit au blasphème : 50 % y seraient « favorables », 50 % « défavorables ».
C’est une insulte à notre liberté et à notre République.
Lors du mot du jour sur l’islamophobie, j’ai eu un échange privé avec un ami lecteur qui n’a pas souhaité mettre ses observations sur le blog. Je respecte bien entendu cette volonté et je ne le citerai donc pas. Mais je voudrai citer un extrait de ma réponse :
« Quand tu te plonges dans l’histoire des religions, dans ce qu’on peut en savoir et ne pas savoir on est incapable de déterminer si Dieu existe ou non.
En revanche, cela nous en apprend beaucoup sur les dérives des hommes de religion, les organisations qui ont été mises en place et les crimes que toutes ces religions monothéistes ont perpétrés.
C’est cela que je dénonce et non pas la foi intime du croyant dans sa prière et son dialogue avec le Dieu qu’il porte dans son cœur.
Sur mon blog, il y a une autre information qui me révolte : dans la charte du CFCM (Conseil français du culte musulman) les dirigeants de cette association ont refusé de mettre dans la charte le droit de changer de religion.
Car c’est bien cela aussi qui m’est insupportable dans ce mot « religion » qui est une organisation, un système de valeurs c’est qu’elle oblige les autres, qu’on va imposer des contraintes aux autres, c’est cela l’intolérance.
Et c’est pour cela que le rejet laïc du blasphème est si important.
Le jour où on a pu dire merde à la religion, dans un pays chrétien, sans se faire bruler ou d’autres supplices exquis au nom du Dieu miséricordieux il a fait très beau et on a pu avancer.
Il faut être très précis il n’existe pas un droit au blasphème en France, mais plus radicalement le blasphème n’existe pas. Le blasphème c’est un concept religieux à l’intérieur d’une religion. Dans le droit laïc français il est permis de critiquer toutes les idéologies et donc les croyances religieuses. Devant ce Droit, personne ne peut être accusée de blasphème, ce concept n’existe pas.
Mais c’est maintenant que je veux faire intervenir Maurice Clavel et son injonction : « Dieu est Dieu nom de Dieu ».
Celles et ceux qui croient en Dieu, et elles et ils ont cette liberté et je m’en réjouis, comment ne peuvent-ils pas admettre que si quelqu’un blasphème selon leurs critères, Dieu a tous les moyens pour agir, avec une panoplie de mode d’action incommensurable par rapports aux humains, contre le « blasphémateur » ?
Il me semble que si ces croyants estiment qu’ils doivent agir par eux-mêmes c’est qu’ils ne croient pas vraiment ou manifeste une confiance mesurée en leur Dieu.
Ils montrent ainsi que leur Foi n’est ni profonde, ni apaisée.
Sophia Aram lors d’une de ses chroniques du lundi matin a dit la même chose sans faire appel à Maurice Clavel.
« Alors répétons-le, les religions reposent sur des croyances et des pratiques auxquelles il est possible d’adhérer ou pas, comme il est possible de leur opposer toute forme de critiques, de railleries, de chansonnettes, voire de menace de touchés rectaux.
C’est comme ça c’est la loi.
Et si ça ne va pas à certains ou certaines qu’ils se résignent derrière l’idée à laquelle tout le monde peut se rallier, que l’on soit croyants, athées, intégristes, rabbins, imams ou archevêques, c’est que, dans l’hypothèse où Dieu existe et dans l’hypothèse où il serait totalement réfractaire à toute forme de critiques et aux touchés rectaux… Dieu devrait être capable de le gérer tout seul et que jusqu’à preuve du contraire, soit il n’a pas Instagram, soit il s’en fout, soit… Il n’existe pas.
Alors pour tous les « followers » de Dieu que ça défrise je vous propose de vous occuper l’esprit ailleurs et en attendant que Dieu se manifeste, vous pouvez prier, dormir un peu, boire frais bref, autant d’activités qui me semble nettement plus compatibles avec la foi que l’injure, l’anathème et la menace.
Amen »
Vous trouverez, cette chronique derrière ce lien <Dieu et ses followers>
Résumons : le blasphème cela n’existe pas en France, il n’est donc pas possible d’être pour sa reconnaissance. Je suis par conséquent très inquiet sur la faculté de raisonnement des 50% de sondés qui y sont favorables.
<1353>
-
Mercredi 19 février 2020
« Le Mozart espagnol »Juan Crisóstomo Jacobo Antonio de Arriaga y Balzola, dit ArriagaLa précocité, le talent et la brièveté de la vie de cette enfant de la lumière qui a pour nom Alicia Gallienne, m’a fait irrésistiblement penser à un autre destin d’un jeune artiste qui a achevé sa course à 20 ans.
C’était un compositeur et c’est mon père qui avait une tendresse infinie pour lui, qui me l’a fait découvrir.
Il s’appelait « Arriaga », son prénom était un peu long. On l’abrégeait en Juan Crisostomo. Mais plus simplement on parle d’Arriaga.
Le dernier mot du jour de 2019 rappelait que le 27 janvier était la date anniversaire de Wolfgang Amadeus Mozart qui est né en l’an 1756 à Salzbourg.
Exactement, 50 ans après, le 27 janvier 1806, à Bilbao, naissait Arriaga.
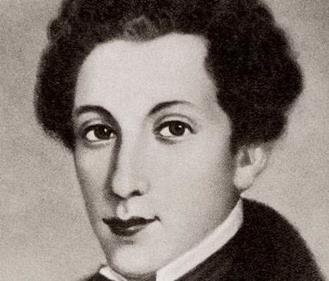 Mozart était mort depuis 15 ans, puisqu’il n’a atteint que l’âge de 35 ans.
Mozart était mort depuis 15 ans, puisqu’il n’a atteint que l’âge de 35 ans.
Tous les musiciens ne meurt pas jeune, puisque l’autre grand compositeur classique d’avant Beethoven, Joseph Haydn avait 74 ans en 1806 et vivra encore 3 ans.
Mais ce ne fut pas le destin d’Arriaga qui est mort de la tuberculose à Paris, avant ses 20 ans, le 17 janvier 1826.
Il quittera ainsi la vie un an avant Beethoven et deux ans avant un autre immense génie qui aura disposé de peu de temps pour composer et à qui on le comparera aussi : Franz Schubert, décédé le 19 novembre 1828, à 31 ans.
Alors la question qui se pose était-il un compositeur inspiré du niveau de Mozart ?
Je crois qu’il n’y a pas beaucoup de doute, la réponse est oui.
Il faut bien sûr comparer Arriaga à Mozart à 20 ans
Pour Schubert, il en va autrement. Lui a composé des chefs d’œuvres avant 20 ans son lied « le roi des aulnes » sur un texte de Goethe a été composé à 18 ans et « Marguerite au Rouet » toujours d’après un poème de Goethe a été composé à 17 ans.
Il y a un autre compositeur exceptionnel par sa précocité : Mendelssohn qui est né 3 ans après Arriaga.
Lui aussi a composé des œuvres qui sont restés dans le panthéon des chefs d’œuvre de la musique classique avant ses 20 ans.
L’ouverture du songe d’une nuit d’été a été composée à l’âge de 17 ans (en revanche la célèbre marche nuptiale a été composée 17 ans après) et son célèbre octuor à cordes à 16 ans.
Arriaga n’a pas composé de tels chefs d’œuvre, mais le comparer à Mozart d’avant ses 20 ans est réaliste.
<Ce site> sur la culture espagnole écrit :
« Arriaga est né à Bilbao en 1806. C’est son père, Juan Simón de Arriaga, organiste à Berriatúa, qui lui apprend les fondements de la musique[…]. À 11 ans, il compose et représente déjà ses œuvres dans les sociétés musicales de Bilbao. À 15 ans, son père décide de l’envoyer au conservatoire de Paris pour qu’il y poursuive sa formation. […] En 1824, il est nommé professeur adjoint de Fetís dans ce même conservatoire. »
Beaucoup de ses œuvres sont perdues.
Il a ainsi écrit « une fugue à huit voix sur « Et vitam venturi dont la partition » est perdue et que Luigi Cherubini, directeur du Conservatoire, considère en 1822 comme un chef-d’œuvre. »
Il reste de lui essentiellement trois quatuors (1823) et une Symphonie (1824).
Cette musique fait penser à Mozart et à Schubert.
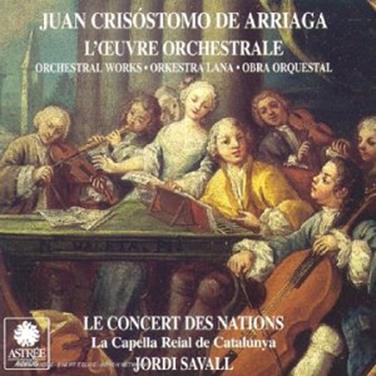 Il existe une très belle interprétation de sa symphonie par Jordi Savall qui est espagnol comme lui, mais catalan alors qu’Arriaga est basque.
Il existe une très belle interprétation de sa symphonie par Jordi Savall qui est espagnol comme lui, mais catalan alors qu’Arriaga est basque.
Sur la présentation de ce disque vous pourrez lire :
« S’il n’y en qu’une… mais il faut avouer avec tristesse que dans le cas de Juan Crisóstomo Arriaga, c’est déjà miracle qu’il y ait au moins une symphonie à son répertoire, puisque l’infortuné musicien disparut à l’âge de dix-neuf ans – dix jours avant son vingtième anniversaire –, en laissant derrière lui d’immenses promesses et un minuscule répertoire dont, comble de la méchanceté du sort, une partie est perdue. Mais l’écoute de sa symphonie en ré (ni mineur ni majeur, l’équilibre entre les deux étant très égal), on ne peut que se lamenter que la planète a, en effet, perdu là l’un des compositeurs qui serait bientôt devenu l’un des plus immenses créateurs du XIXe siècle. A la jonction entre le classicisme finissant et le romantisme naissant, Arriaga eut le temps de « digérer » son Beethoven, son Rossini, son Mozart tardif […]. Quoi qu’il en soit, l’enregistrement qu’en a réalisé Jordi Savall en 1994 est dorénavant orné du très-convoité macaron de la Discothèque idéale de Qobuz »
Vous trouverez <derrière ce lien> une interprétation de la symphonie par un autre orchestre espagnol.
Et je vous donne le lien vers <Le dernier quatuor à cordes> interprété par le quatuor Sine Nomine.
<Sur ce site> vous trouverez la liste de toutes les œuvres connues de ce jeune compositeur.
Le 13 août 1933 un monument commémoratif par Francisco Durrio est inauguré à Bilbao et une Commission permanente est constituée pour la publication de ses œuvres.
 La statue représente Euterpe pleurant la mort d’Arriaga devant le Musée de Bilbao
La statue représente Euterpe pleurant la mort d’Arriaga devant le Musée de Bilbao
Dans la mythologie grecque, Euterpe était la muse qui présidait à la musique.
Arriaga fut une étoile filante de la musique, un météore, un destin brisé.
<1352>
-
Mardi 18 février 2020
« Dire que je t’aime et je t’attends, c’est encore beaucoup trop de pas assez »Alicia GallienneLe mot du jour du vendredi 7 février 2020 parlait d’Alicia Gallienne, une jeune femme extraordinairement précoce dans l’écriture et qui est décédée à 20 ans d’une maladie du sang.
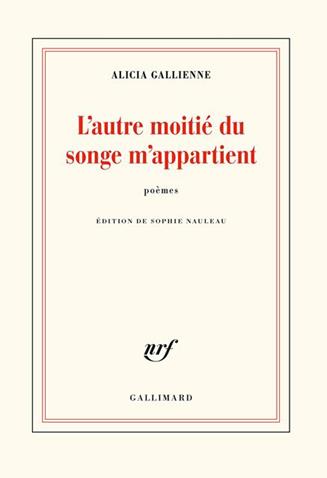 Annie a voulu me faire une surprise et m’offrir son livre de poésie qui vient d’être publié : « L’autre moitié du songe m’appartient ». Mais le livre est épuisé chez l’éditeur.
Annie a voulu me faire une surprise et m’offrir son livre de poésie qui vient d’être publié : « L’autre moitié du songe m’appartient ». Mais le livre est épuisé chez l’éditeur.
Je pense que l’émission, sur France Inter, de son cousin Guillaume Gallienne <ça peut pas faire de mal> du 8 février, sa toute dernière émission, qu’il a consacrée à ce livre et à ces poèmes ne sont pas étrangère à ce succès.
Guillaume Gallienne a introduit son émission par cette invitation :
« Ce soir, pour la dernière émission de « ça peut pas faire de mal », j’aimerais vous faire découvrir ces textes intimes, que je porte en moi depuis si longtemps, comme des fragments de ma propre adolescence… »
Nous avons écouté ce moment d’émotion et de grâce.
Je voudrais partager un de ces textes que j’ai essayé de recopier aussi bien que possible.
Guillaume Gallienne a présenté ce texte :
« On n’est pas sérieux quand on a 17 ans écrivait Arthur Rimbaud mais à l’âge de l’insouciance et des premiers baisers, Alicia ressent la profonde gravité de la vie.
Découvrons ce poème dédié à sa mère intitulé : « A propos d’un fauteuil et d’un arbre » et daté du 2 avril 1987.
On dirait que les rôles s’inversent et que la fille apporte à la mère des paroles de consolation comme une provision d’amour pour un avenir incertain. »
Voici ce texte :
« Pour toi maman
Doucement, je reprendrai ma place dans le grand fauteuil qui s’endort.
Le soir sera à la fenêtre, il dansera sur une chanson douce, comme chantait ma maman.
Il dansera jusqu’à l’étourdissement.
L’arbre du jardin s’éteindra dans l’ombre et soupirera des prières pleines de feu.
Mon âme s’abandonnera alors à ces psaumes silencieux qui embraseront ton nom.
Oui, je serai là où mon bonheur habite, entre ces quatre murs où aboutit le regard de l’obscurité,
Où il n’y aura que moi et mon fauteuil, puis l’espace pour t’appartenir.
Dire que je t’aime et je t’attends, c’est encore beaucoup trop de pas assez.
Les étoiles en veilleuse et le ciel qui se fond me parleront de toi où que tu sois.
Je t’attendrai, assise, avec mon cœur qui débordera.
Oui je sais que le moment viendra où tu me retrouveras.
L’arbre du jardin s’épaissira tout à coup.
Et éclatera mon attente figée ainsi que la fenêtre de vitres brisées.
Des milliards de miroirs s’envoleront dans l’air du soir.
Dans chacun, épris de mouvement, ta voix reviendra bercer mon enfance.
L’arbre mystique qui connaît tous les chemins, te rendra à moi pour la mémoire d’un voyage.
Bois ma nuit, éternellement.
Dire que je t’aime et je t’attends c’est encore beaucoup trop de pas assez »
Alicia Gallienne
<1351>
-
Lundi 17 février 2020
« Je n’oublie pas, ça fait partie de ma vie, mais je n’y pense plus »Fatima Zekkour , une jeune fille qui a choisi d’aider les autresUn mot du jour de 2017 était consacré à ce livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle « L’autre loi de la jungle : l’entraide »
Tant il est vrai que si les médias et notre propre attention sont le plus souvent mobilisés pour nous intéresser à des faits qui n’honorent pas ou peu la réputation d’altruiste d’homo sapiens, il existe pourtant tous les jours des êtres humains qui aident d’autres êtres humains et même d’autres espèces vivantes qui en ont besoin, comme par exemple ces australiens qui ont sauvé des koalas.
Quelquefois, des humains se haussent à la dimension de l’héroïsme pour appliquer cette autre loi de la jungle.
Ce fut le cas d’une jeune fille : Fatima Zekkour, en mai 2013
C’est encore, France Inter, la revue de Presse de Claude Askolovitch du <11 février 2020> qui m’a appris l’existence et l’acte de courage de Fatima Zekkour :
« On parle d’une jeune fille…
Que je découvre en dehors de toute actualité apparente dans le Journal du Centre, mais souvent quand elle apparait les gens se lèvent et l’applaudissent, c’est encore arrivé le week end passé au rassemblement nivernais de l’Ordre national du mérite: Fatima Zekkour est une héroine de la république, qui à 17 ans est entrée dans un immeuble en flamme pour sauver des vies et en est ressortie comme une torche vivante, elle a 24 ans et accepte son corps reconstitué, elle cherche du travail.
Le 4 mai 2013 elle se promenait au quartier de la grande pâture à Nevers, quand elle a vu un départ d’incendie dans le hall d’un immeuble où un canapé abandonné avait pris feu… Fatima et sa soeur enceinte sont allé taper à toutes les portes des quatre étages de l’immeuble, la fumée montait après elle, la soeur de Fatima est sortie mais elle est resté prisonnière des flammes; elle pensait que les pompiers n’allaient pas tarder mais les pompiers n’avaient pas cru sa maman qui les avait appelés -on leur fait si souvent des blagues… Ne voyant rien venir, fatima est allé seule traverser le rideau de feu. « Je suis tombée dans les pommes plusieurs fois en descendant. J’ ai traversé le hall, je me suis à nouveau évanouie sur le canapé en feu. Je ne me souviens pas comment j’ai pu ouvrir la porte et sortir ».
Elle est brulée à 70 %, au visage aux mains aux jambes, aux poumons, on la plonge dans un coma artificiel pendant 20 jours, quand elle se réveille elle a tout oublié et puis elle se souvient et elle cauchemarde enveloppée de bandages, on va l’opérer 50 fois, micro chirurgie et greffes de peau…
Fatima est un personnage du Journal du centre. J’ai retrouvé dans les archives une photo d’elle avant, mignonne brunette, je vois une photo d’elle aujourd’hui, femme au grand sourire dont je devine la peau torturée. Elle n’est plus jamais retournée au lycée, elle a tâtonné avant de trouver sa voie dans l’accompagnement médical auprès de malades d’Alzheimer, elle cherche un emploi stable et si elle n’enlève pas les gants qui couvrent ses mains meurtries, elle n’a plus peur d’allumer des bougies et voudrait se marier. Elle avait 17 ans le jour où le courage l’a pris. ».
Le journal du Centre avait dans un <article de juin 2013> parlé de cet acte héroïque et publié une photo de Fatima Zekkour dans la beauté de sa jeunesse.
Le même journal a publié récemment l‘article que commentait Claude Askolovitch et qui relatait le parcours de cette jeune fille jusqu’à aujourd’hui. Vous y trouverez une photo récente de cette jeune femme qui a appliqué la loi de l’entraide au péril de sa vie et de son intégrité physique, après les nombreuses opérations qu’elle a subies.
L’article conclut sur les objectifs actuels de Fatima :
« Mon souhait, désormais, c’est juste de mener une vie normale. Trouver du travail, d’abord, car je suis au chômage depuis un mois. J’ai arrêté les CDD car je cherche un emploi à plein-temps, mais dans le même milieu, auprès des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Je suis d’ailleurs prête à partir de Nevers. Pour le reste, j’ai des envies simples : fonder une famille, me marier… Une vie normale. »
Jeune femme admirable qui continue à trouver sa motivation dans le fait d’aider les autres et notamment les plus fragiles : celles et ceux qui ont perdu leurs repères et la capacité de mémoire.
La vie est plus belle quand on croise la route, même si ce n’est qu’à l’occasion d’un article ou d’une émission, d’une femme comme Fatima Zekkour.
<1350>
-
Vendredi 14 février 2020
« La vie »Eternellement actuel, ce mot est aussi le titre d’un livre de Didier FassinJe termine aujourd’hui cette série sur les mots et expression d’aujourd’hui.
Il s’agissait de mots nouveaux qui viennent d’être inventés : « TikTok », « Méga-feux », « Flygskam » ou des expressions : « OK boomer »
Et puis il y avait aussi des mots qui ont une signification différente que celle attendue « Les sardines » ou des mots dont on retrouve la signification réelle comme « le consentement ».
Enfin des mots plus anciens mais qui ont une brûlante actualité « Populisme », « Hôpital public »
J’aurais pu parler d’« agribashing » de « Brexit » de « retraite » de « censure » et sur ce dernier mot il faut lire l’édito de Riss sur le site de Charlie Hebdo : « Les nouveaux visages de la censure »
Et puis « Féminicide » qui a été désigné comme le <mot de l’année> par le dictionnaire du Petit Robert. Ce terme qui <interroge la magistrature> et <le Droit> mais qui correspond à cette triste réalité de la violence que les hommes exercent à l’égard des femmes.
Mais je veux terminer par ce mot : « La vie ».
Je ne crois pas qu’il puisse exister un mot plus éternellement actuel que « la vie ».
Si je n’étais pas en vie je ne pourrais pas écrire, et si vous ne l’étiez pas vous ne pourriez pas lire. La vie est ce que nous avons de plus précieux.
La vie qui est relation comme l’écrit si bien Alain Damasio :
« Une puissance de vie !
C’est le volume de liens, de relations qu’un être est capable de tisser et d’entrelacer sans se porter atteinte. »
L’académicien François Cheng qui parle si bien de la beauté (regardez cette <vidéo> à partir de 21’10 qui est un replay de la Grande Librairie) et qui a rédigé « Cinq méditations sur la mort autrement dit sur la vie » a écrit :
« Disons dès à présent sans détour que je fais partie de ceux qui se situent résolument dans l’ordre de la vie. […] pour nous, le principe de vie est contenu dès le départ dans l’avènement de l’univers. Et l’esprit, qui porte ce principe, n’est pas un simple dérivé de la matière. Il participe de l’Origine, et par là de tout le processus d’apparition de la vie, qui nous frappe par sa stupéfiante complexité. Sensibles aux conditions tragiques de notre destin, nous laissons néanmoins la vie nous envahir de toute son insondable épaisseur, flux de promesses inconnues et d’indicibles sources d’émotion. »
Cinq méditations sur la mort, pages 16 & 17
Si un jeune, dans un moment de sérénité pendant lequel il n’aurait pas la tentation de me lancer « Ok boomer » mais plutôt de me demander : à ton âge, avec ce que tu as appris si tu n’avais qu’une phrase à me dire, laquelle serait-elle ?
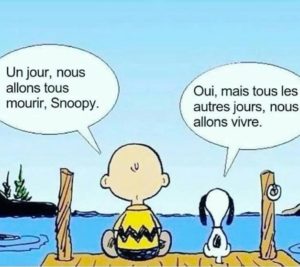 Je répondrai certainement
Je répondrai certainement
« N’oublie pas qu’il y a une vie avant la mort ! »
Qu’il y ait une vie après la mort, certains le croient, mais ce n’est pas sûr.
En revanche, avant la mort il y a une vie à vivre.
L’actualité du mot « vie » est aussi liée aux menaces qui pèsent sur la biodiversité. « La sixième extinction massive a déjà commencé ». La disparition des insectes est profondément préoccupante.
L’homme n’est pas seul sur terre. Sa vie, son équilibre dépendent aussi de la vie d’autres espèces.
Le médecin Marie François Xavier Bichat (1771-1802) a écrit dans son livre « Recherches physiologiques sur la vie et la mort » un aphorisme souvent repris :
« La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort »
Jean d’Ormesson a nuancé cette définition :
« Ma définition à moi serait plutôt l’inverse : la vie, c’est ce qui meurt. La vie et la mort sont unies si étroitement qu’elles n’ont de sens que l’une par l’autre. »
La vie est aussi tout ce qui se passe entre la naissance et la mort.
Et cette vie n’est pas la même pour tous, ni en ce qui concerne la durée, la santé, la souffrance, le plaisir et la joie.
Et ainsi l’actualité du mot « La vie » vient aussi de la leçon inaugurale, le 16 janvier, de Didier Fassin au Collège de France sur « l’inégalité des vies ».
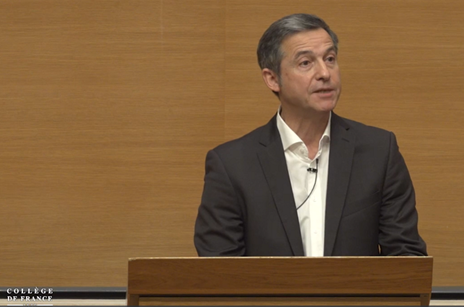 Vous trouverez sa leçon inaugurale derrière <ce lien>
Vous trouverez sa leçon inaugurale derrière <ce lien>
Didier Fassin, né en 1955, est un anthropologue, sociologue et médecin français. Il est professeur de sciences sociales à Princeton et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Il a été élu au Collège de France pour occuper une chaire annuelle en 2020 consacrée à la santé publique. Il a travaillé sur les malades du sida, les demandeurs d’asile, l’humanitaire, la police, la justice, la prison, et sur « l’inégalité des vies ».
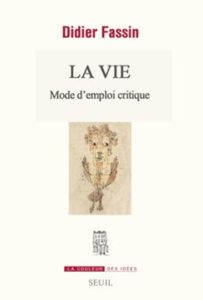 Il a écrit un livre paru en 2018 qui pour titre « La vie » et sous-titre « Mode d’emploi critique ».
Il a écrit un livre paru en 2018 qui pour titre « La vie » et sous-titre « Mode d’emploi critique ».
Je l’ai d’abord entendu sur France Inter, le 17 janvier 2020, invité par Ali Baddou puis sur France Culture, le 18 janvier 2020, pour évoquer sa leçon inaugurale pour parler de ses recherches et de sa réflexion.
L’Obs a republié un grand entretien qu’il avait mené avec Didier Fassin lors de la sortie de son livre sur la « Vie »
Ces différents points d’entrée dans la réflexion et les études de Didier Fassin m’ont énormément intéressé.
Il arrive à réaliser cette performance de décliner avec naturel les statistiques et les études générales sur l’espérance de vie, la qualité de vie et les inégalités mais aussi de se mettre à hauteur d’homme pour illustrer la froideur des chiffres par l’émotion et la vérité de l’histoire de la vie d’êtres humains dont il raconte la réalité.
Il ne m’est pas possible de faire une synthèse de son propos mais je citerai un extrait de sa leçon inaugurale qui commence par l’espérance de vie :
« (…) Ce que nous nommons d’une expression aussi élégante que trompeuse « espérance de vie » n’est qu’une mesure abstraite résultant de la sommation de la probabilité de décéder aux différents âges et imaginant une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l’année considérée. Mais où donc est passée la vie ? Certes, l’espérance de vie nous informe sur un fait majeur : les disparités considérables de longévité existant dans nos sociétés – treize ans en France, quinze ans aux Etats-Unis, quand on compare les plus riches et les plus pauvres.
Mais ce qu’on peut dire de l’inégalité des vies tient-il dans cette seule mesure ? Deux illustrations suggèrent que cette quantification est nécessaire mais non suffisante. Elément troublant, en France, mais l’observation vaut pour d’autres pays occidentaux, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, les femmes ont une mortalité plus faible que les hommes. Ainsi les ouvrières vivent-elles plus longtemps que les hommes cadres, même si l’écart s’est réduit au cours des dernières décennies.
Ce fait, principalement lié à des différences de comportements à risque au regard de la santé, a souvent été décrit comme signant un privilège pour le sexe féminin. Or, d’une part, si les ouvrières ont une espérance de vie à 35 ans de deux années supérieure aux hommes cadres, leur espérance de vie sans incapacité est de sept ans inférieure, conséquence probable de conditions de travail défavorables ; l’avantage apparent est donc un artifice. D’autre part, et surtout, l’espérance de vie ne renseigne pas sur la qualité de vie, que ce soit en termes d’autonomie, d’émancipation, d’exposition au sexisme, et finalement de réalisation de soi ; nul besoin de souligner combien, sur ces différents plans, les femmes ont été et sont encore pénalisées dans un pays où elles n’ont obtenu que récemment le droit de voter et d’ouvrir un compte bancaire, l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse, l’autorité parentale conjointe et l’égalité des époux dans la gestion des biens de la famille, la reconnaissance des violences conjugales et du harcèlement sexuel.
Comme n’a cessé d’y insister Françoise Héritier [1933-2017], ce qu’elle appelle la « valence différentielle des sexes » est, dans toutes les sociétés humaines connues, le produit de hiérarchies qui opèrent dans l’univers symbolique autant que dans le monde social, le premier servant souvent de justification au second pour distribuer inégalement le pouvoir. Qu’en France, ou ailleurs, les femmes vivent plus longtemps que les hommes ne nous dit rien, par conséquent, de ce qu’est leur vie ou, plus précisément, ce que la société en fait.
Une réflexion en quelque sorte symétrique peut être développée pour ce qui est des hommes noirs aux Etats-Unis qui, eux, vivent moins longtemps que les hommes blancs. La mort d’hommes et d’adolescents afro-américains tués par des policiers, et notamment d’Eric Garner étouffé lors de son interpellation pour vente de cigarettes à la sauvette [le 17 juillet août 2014, à New York], de Michael Brown abattu de plusieurs balles alors qu’il marchait dans la rue [le 11 août 2014, à Ferguson], de Freddie Gray victime de fractures cervicales occasionnées par son arrestation à la suite d’un contrôle d’identité [le 15 avril 2015, à Baltimore], de l’enfant Tamir Rice tué sur un terrain de jeux alors qu’il portait à la ceinture un pistolet factice [à Cleveland, le 22 novembre 2014], et de bien d’autres, a révélé la fréquence de ces incidents mortels. »
Et il revient à la réflexion sur la vie que j’ai essayé d’esquisser au début de ce mot du jour mais en la confrontant à la réalité des inégalités :
« Il y a ainsi, d’un côté, la vie qui s’écoule avec un commencement et une fin, et de l’autre, la vie qui fait la singularité humaine parce qu’elle peut être racontée : vie biologique et vie biographique, en somme. L’espérance de vie mesure l’étendue de la première. L’histoire de vie relate la richesse de la seconde. L’inégalité des vies ne peut être appréhendée que dans la reconnaissance des deux. Elle doit à la fois les distinguer et les connecter. Les distinguer, car le paradoxe des femmes françaises montre qu’une vie longue ne suffit pas à garantir une vie bonne. Les connecter, car l’expérience des hommes afro-américains rappelle qu’une vie dévalorisée finit par produire une vie abîmée. »
Et il cite Bourdieu et parle de notre société économique et sociale :
« Comme Pierre Bourdieu, dont les livres m’ont fait découvrir les sciences sociales, l’a montré à propos de sa propre histoire : c’est en prenant la distance épistémologique nécessaire qu’on transforme une expérience en connaissance et qu’on fait d’une dette sociale une œuvre scientifique. La question de l’inégalité est présente dans toute la sienne, même s’il lui donne d’autres noms, reproduction et domination, force de l’habitus et lutte des classements. De cette inégalité, qui prend de multiples formes, à l’école et dans le travail, en termes de capital économique et de capital social, la plus profonde est celle devant la vie même. »
J’ai donc voulu terminer cette série de mots par la « vie » avec un regard d’abord philosophique et poétique pour ensuite, grâce à Didier Fassin, esquisser la réalité sociologique des inégalités devant la vie. Car la vie n’est pas la même si un enfant nait en Somalie ou en Allemagne, s’il nait dans une famille pauvre ou dans une famille riche, s’il nait dans une famille noire ou dans une famille blanche, s’il nait femme ou homme dans beaucoup de pays du monde.
Et sur ce point on comprend bien que les solutions ne sauraient être individuelles mais sont politiques au sens le plus noble de ce terme.
Je sais que beaucoup ne croit plus en la politique. C’est pourtant la seule solution, celle de ne pas s’occuper de son seul ego, de sa petite famille, de son petit jardin mais de s’intéresser plus globalement à la communauté des vivants.
Didier Fassin restreint son propos à homo sapiens. J’aimerais élargir cette vision et inclure dans la communauté des vivants, non seulement l’espèce humaine mais aussi les autres espèces et les végétaux qui sont « en vie ».
Je finirai pas un dessin qui pose une question :

<La Leçon inaugurale de Didier Fassin : l’inégalité des vies>
<1349>
-
Jeudi 13 février 2020
« L’hôpital Public »Un trésor national en périlAvec « retraite », « hôpital » est le mot actuellement le plus cité dans les médias. Plus précisément l’«hôpital public» car il semblerait que les hôpitaux privés et les cliniques se portent plutôt bien.
Encore hier soir, mercredi le 12 février, France inter y a consacré son émission le téléphone sonne <Hôpital public : pourquoi la crise continue ? >. Fabienne Sintes a invité deux chefs de service pour parler de cette crise.
La Professeure Agnès Hartemann, Chef du service de diabétologie de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et Xavier Mariette, Chef du service rhumatologie de l’hôpital Kremlin-Bicêtre. Ils font partie des 600 médecins, chefs de service ou de structure, qui ont démissionné de leurs fonctions administratives depuis le mois de janvier, ulcérés par les failles de l’hôpital public, par le manque de moyens, la pression à la rentabilité, le travail « robotisé ».
C’est-à-dire qu’ils ont cessé de s’acquitter de leurs fonctions administratives. Ce qui signifie qu’ils poursuivent les soins, mais « ne sont plus en contact avec les administrations » hospitalières, ne codifie plus les actes qu’ils réalisent et refusent obstinément d’examiner les tableaux excel et les ratios de rentabilité que leur présentent leurs directeurs administratifs.
D’ailleurs pour la saint Valentin, ils feront une manifestation. Cette journée prendra la forme d’une journée baptisée « hôpital mort », seuls les soins d’urgence seront prodigués. Les personnels hospitaliers attendent une déclaration d’amour pour l’hôpital public.
A Paris, selon ce que j’ai lu, il est prévu un rassemblement à 12h pour un départ à 14h et le trajet se passera entre hôpitaux : Necker > Cochin > Pitié Salpêtrière.
L’hôpital !
Pour le dictionnaire Larousse ce mot vient du latin hospitalis domus : maison où l’on reçoit les hôtes.
Le dictionnaire du CNRS cite Chrétien de Troyes :
« ospital : établissement charitable [le plus souvent dépendant d’un monastère] où l’on accueille les pauvres, les voyageurs »
Wikipedia fait remonter l’histoire de l’hôpital au VIe siècle. Au Moyen Âge, c’est un établissement de l’Église qui accueille les pauvres et les exclus.
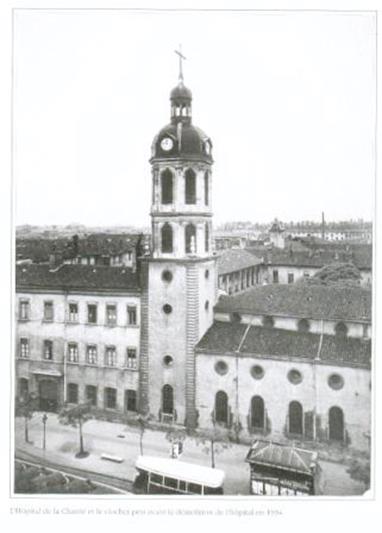 Ainsi, l’hôpital de la Charité de Lyon, construit au XVIIe siècle était destiné aux enfants orphelins et les indigents.
Ainsi, l’hôpital de la Charité de Lyon, construit au XVIIe siècle était destiné aux enfants orphelins et les indigents.
En 1529 et 1531, de grandes famines frappent la France à la suite d’une période de sécheresse provoquant un afflux de migrants sur la ville de Lyon. Afin d’offrir une aide à la population, l’Aumône générale est créée en 1534 au couvent des Cordeliers. Mais ses moyens restent insuffisants. En 1581, l’Aumône générale décide de construire l’hôpital de la Charité.
Il a été détruit en 1933, le maire de Lyon ayant trouvé plus opérant de faire construire à sa place un immense bâtiment, de style…(en fait sans style !), abritant la poste centrale de Lyon.
Il en va de même pour les Hôtels Dieu, parfois orthographié « Hostel Dieu », présents dans plusieurs villes et qui recevait les orphelins, les indigents et pèlerins et qui était administré par l’Église.
L’Hôtel Dieu de Lyon dont la construction débuta en 1184 par des religieux n’échappa pas à ce destin d’accueillir les pauvres et les pélerins. Il se situe à Lyon en face du pont de la guillotière qui pendant longtemps a été le seul pont qui traversait le Rhône pour entrer dans le Lyonnais. La rive gauche, du Rhône n’appartenant pas au Lyonnais mais au Dauphiné et le chemin des pèlerins qui venaient de l’est ou des migrants passaient par là.

L’hôtel Dieu de Lyon a été magnifiquement rénové, essentiellement par des fonds privés. Il a abandonné sa vocation d’accueil gratuit ou de soins pris en charge par l’État providence et est devenu un vulgaire centre commercial destiné à la consommation.
Dans notre vision de l’hôpital, il ne s’agit plus d’accueillir des indigents, mais des malades et de les soigner. De soigner tout le monde, avec les mêmes médecins, le même équipement ultra moderne et sophistiqué, les mêmes médicaments qu’elle qu’en soit le prix.
Mais la crise actuelle peut conduire à s’interroger : Est-ce que l’hôpital ne va redevenir un lieu d’accueil des pauvres. Les riches se faisant soigner à prix d’or dans les établissements privés dans lesquels la carte American express aura remplacé la carte vitale. Les plus beaux établissements pourront être rachetés par des fonds privés qui pourront y loger des commerces et services de luxe, comme l’Hôtel Dieu de Lyon.
Lorsque le Professeur Hartemann et ses confrères ont décidé d’entrer dans la grève administrative cité ci-avant, elle est venue devant la presse pour expliquer ce geste.
Vous trouverez la vidéo de cette intervention derrière ce <Lien>
« On nous demande de produire du séjour, alors que nous avions l’habitude de prodiguer des soins. Et on s’est mis à avoir, comme chef de service, à chaque fin de mois des tableaux Excel. Et là on se voyait dire, ah là c’est vert, Bravo ! vous avez fait plus de séjour. Et une autre fois c’était rouge, c’est mauvais vous avez fait moins dix séjours. Petit à petit on s’est rendu compte qu’on était infantilisé. […] et on a peur parce que quand notre activité baisse on nous coupe des moyens pour soigner.
[…]Je devenais une espèce de robot, à dire : ‘Quand est-ce qu’il sort ? Cela fait quinze jours qu’il est là, il occupe la chambre, je ne vais pas pouvoir faire du séjour’. Ce sont les jeunes, les infirmières, qui me regardent. Maintenant je sais que quand on me regarde comme ça, c’est que je ne suis plus éthique »
Et elle explique que dans son service réservé à des diabétiques sévères, quand elle les soigne bien et qu’ils restent dans la chambre ils ne sont plus rentables au sens de la gestion de l’Hôpital. Mais si on les ampute ils redeviennent rentables pour quelques jours.
En terme technocratique on parle de la « T2A », c’est à dire le fonctionnement de La tarification à l’activité (T2A) qui est la méthode de financement des établissements de santé qui a été mise en place à partir de 2004
Celui qui explique cela de manière très didactique est Stéphane Velut, neurochirugien et essayiste, qui publie « L’Hôpital, une nouvelle industrie » (Gallimard, coll. « Tracts », janvier 2020).
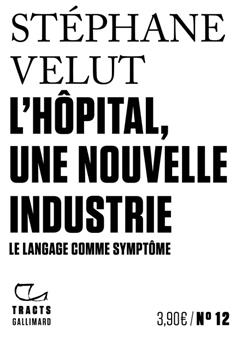 Ce livre est présenté ainsi :
Ce livre est présenté ainsi :
« Tout juste soixante ans se sont écoulés depuis la création des Centres hospitaliers universitaires. Ces structures sont le cœur d’un système à la réputation excellente. Mais ce cœur s’est emballé. Le corps soignant s’épuise et les patients s’inquiètent. Les crises se succèdent avec leurs ordonnances de vains remèdes. Le malade que nous sommes, ou que nous serons presque tous un jour, a tout lieu de s’inquiéter. Le mal est profond. Il s’entend dans le nouveau langage qui s’est imposé au sein des pratiques hospitalières. Tel est l’éloquent symptôme qui révèle le dessein de faire de l’hôpital une nouvelle industrie, au mépris de son humaine justification. Un dessein indicible, qui rêve de fondre le soin dans la technicité abstraite et gestionnaire de notre société. »
Stéphane Velut pose cette question :
« Tenter de soustraire au maximum le facteur humain, trop humain, du système hospitalier, c’est prendre le risque que ce système s’effondre. Il faudra quand même, un jour, se demander si c’est bien. »
Il était invité à l’émission « La grande Table » du <24/01/2020>. Il raconte
« Je me suis réveillé tard, pour me rendre compte de ce qui se passait. Et il a fallu que j’entende les discours que je lise et que j’écoute parler ceux qui gèrent l’hôpital pour me rendre compte que quelque chose a changé et qui m’a échappé.. [C’est à la suite de cela que j’ai écrit ce petit ouvrage]
Le contexte est spécial. On m’a convié à une réunion où était présent un consultant d’une société de conseil. […] Le sujet concernait un futur hôpital qui devait voir le jour en 2025 et il a eu cette phrase que je note et qui est la suivante : Dans une démarche d’excellence, il va falloir transformer l’hôpital de stock en hôpital de flux. Et c’est cela qui m’a réveillé
Je me suis dit que ce langage qui est très nouveau est certainement le symptôme de quelque chose que je n’avais pas depuis que j’exerce, depuis les années 1980.
De quels stocks on parle, de quels flux on parle. En effet, ce sont les gens, ce sont les malades. C’est-à-dire que [..] il y a tout d’un coup cette volonté de faire de la maladie une matière première, et de la guérison un produit fini, comme si nous étions dans une industrie, une chaîne de production, à la différence qu’il ne s’agit pas de voitures, il ne s’agit pas d’autre chose que de gens. […] En reprenant d’anciens courriels, des lettres, des gazettes j’ai essayé d’analyser quand le langage avait changé. Il a changé en 2015/2016. Il a changé radicalement, si vous voulez savoir d’où il vient, vous n’avez pas beaucoup d’effort à faire il suffit d’acheter la havard business review, qui vous a
 pprend comment manager une équipe, comment s’adapter à la transversalité de projet, afin de parvenir à une meilleure agilité. Des choses qui sont très étrangères à l’action de soigner. »
pprend comment manager une équipe, comment s’adapter à la transversalité de projet, afin de parvenir à une meilleure agilité. Des choses qui sont très étrangères à l’action de soigner. »
Le CHU a toujours été géré ce sont des grosses structures qu’il faut organiser et diriger. Mais il y eut une époque où la structure tenait comme seule fin la santé des gens et où le langage de l’administration était plus compréhensible.
Aujourd’hui on utilise un méta langage pour fabriquer du consentement, il utilise ce mot pour rappeler le livre de Noam Chomsky et Edward Herman « La Fabrication du consentement ».
Il a cette formule :
« On peut mentir avec sa langue, mais le langage ne ment pas ».
Il considère ainsi que le gestionnaire hospitalier qui gérait l’argent les recettes et les dépenses, l’hôtellerie, s’est hissé progressivement au rang d’administrant.
Il ne pouvait pas faire autrement parce qu’il devait faire des économies de manière radicale.
« Et pour ce faire, il a dû utiliser un langage qui n’a pas la sincérité du langage que nous avons parce que confronté à la maladie, à la mort, à la souffrance, à l’angoisse. »
C’est ainsi qu’il comprend que ces gestionnaires veulent transformer l’hôpital en une industrie où la vitesse et la rentabilité prennent le pas sur le souci de la personne humaine.
Et pour Stéphane Velut, le constat est clair : la seule façon de faire des économies, c’est de réduire le nombre de lits.
« C’est indicible, on parle de « redimensionnement capacitaire« … C’est ce manque de sincérité qui fait que ce malaise est grand. »
Une pédagogie qui explique ce qui se passe à l’intérieur, absolument remarquable, une émission à écouter.
Il parle aussi de la fuite des infirmières et des aides-soignantes qui en raison du manque d’effectifs sont de plus en plus en difficultés par rapport à leur travail. Elles quittent massivement l’hôpital public.
Les médecins aussi, d’autant que les cliniques privés les reçoivent à bras ouvert et les paient beaucoup plus chers
Stéphane Velut pense que si le processus actuel n’est pas enrayé, on en reviendra à ce que j’ai décrit ci-dessus : un hôpital public pour les indigents avec des soins de base et les cliniques privés pour les soins de très haute qualité que seuls les gens très aisés pourront se payer.
Et je finirai par deux extraits d’une émission du Guillaume Erner le 13/01/2020 : « Quel avenir pour l’hôpital si 1 000 médecins démissionnent ? » dans laquelle l’invitée était aussi La Professeure Agnès Hartemann.
Quand on la voit parler, on sent qu’elle est atteinte au plus profond d’elle, les larmes ne sont jamais loin.
Le premier extrait continue dans la description de la même logique à l’œuvre :
« Depuis dix ans, on subit l’ambiance de l’hôpital-entreprise. Nous on prodiguait des soins, on s’est mis à nous demander de produire du séjour, de produire de plus en plus de séjours pour rapporter de l’argent à l’hôpital. Et c’est un jeu de dupes, parce que la Sécurité sociale a un budget fermé, elle n’a pas pu suivre. Donc, on nous a supprimé au fur et à mesure de plus en plus de moyens et les conditions de travail des personnels en particulier sont devenues très difficiles. Et on a perdu beaucoup, beaucoup d’infirmières. […]
« Les infirmières ont été découragées, elles sont parties : actuellement à l’APHP il y a 800 postes vacants d’infirmières. Depuis deux ans, on est partis en vrille. C’est à dire que maintenant, on est obligés de fermer des lits par manque de personnel. […] Je vais donner ma démission, parce que je suis amenée à faire des choses non éthiques. Le vendredi, le samedi et le dimanche, il n’y a qu’une infirmière pour 13 lits dans cette unité [pour grands diabétiques]. Le vendredi, quand on se rend compte que les 12 patients qui sont là sont extrêmement lourds, et bien on appelle celui qui devait rentrer pour éviter d’être amputé. Et on lui dit « Écoutez monsieur, on ne pourra pas vous prendre. Il va falloir que vous alliez aux urgences près de chez vous et on vous prendra quand on pourra », pour prendre un malade moins lourd. C’est terrible. C’est une perte de chance terrible. Et si vous voulez prendre le patient le moins grave au lieu de prendre le patient le plus grave, c’est insupportable. »
Et puis vers la fin de l’émission, elle explique autre chose qui me plonge dans un abime de perplexité :
« Vous savez on ne demande pas des choses folles. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais le budget qui vient d’être voté pour l’hôpital public est à nouveau un budget à la baisse. En fait, il augmente de 2,3%, mais il y a des charges à l’hôpital public et des salaires, il y a des traitements de plus en plus chers, les patients vieillissent, ils sont de plus en plus graves, donc ils demandent de plus en plus de moyens. Et donc, chaque année, si on veut juste couvrir les charges, il faut augmenter le budget de 4% »
Evidemment que tous ces témoignages sont insupportables. Evidemment que la voix de l’empathie, de l’humanisme nous pousse à dire : il faut donner plus de moyens à l’hôpital.
Le professeur Hartemann parle d’un budget à la baisse.
Mais vous lisez ses chiffres et la réalité n’est pas celle-là, il y augmentation du budget de 2,3%. Or la croissance augmente en France en dessous de 1,5%, rarement à 2% et jamais à 4%. Ce n’est plus dans la capacité de l’économie française actuelle. Et d’ailleurs, toutes nos craintes légitimes quant au désastre écologique nous incitent à ne pas faire trop augmenter la croissance.
Dès lors les choses sont explicites : si on veut augmenter le budget de l’hôpital chaque année de 4%, il faut que d’autres dépenses baissent.
Or nos infirmières sont très mal payées (le 28ème rang de l’OCDE) selon Xavier Mariette, nos enseignants sont très mal payés. Et les chercheurs ? Et les policiers et l’état de la Justice ?
La France est pourtant un des tout premiers pays concernant la dépense publique et le volume des redistributions.
Xavier Mariette croit que les français sont prêts à payer davantage.
Je suis persuadé que de manière individuelle, celles et ceux qui disposent de moyens sont prêts à le faire pour eux.
Mais dans ce débat, il ne s’agit pas d’un problème individuel mais de mettre au pot commun, pour mutualiser les dépenses de santé.
Souvent quand on entend parler les gens, ils sont toujours d’accord d’augmenter les impôts et les cotisations …des autres.
Nos gouvernants ne sont pas très bons, mais le problème me semblent beaucoup plus compliqué que de simplement dire : il suffit d’augmenter le budget de l’hôpital.
<1348>
-
Mercredi 12 février 2020
« Pause »Un jour sans mot du jourJe ne suis pas parvenu à écrire un mot du jour pour ce mercredi.
 J’essaie de préparer ceux de demain et après-demain.
J’essaie de préparer ceux de demain et après-demain.
Mais il y a 5 ans, le 12 février 2015, je partageais les anagrammes d’Etienne Klein et de Jacques Perry-Salkow.
Ce n’était pas des mots nouveaux.
Cela ne conduisait pas au sens des mots, quoique…
C’était incontestablement le renversement des mots.
Je partage une anagramme nouvelle non citée il y a cinq ans :
Albert Einstein = rien n’est établi
Voici le lien : « L’arôme des mots à l’infini »
<mot sans numéro>
-
Mardi 11 février 2020
« Les sardines »Invention italienne anti-populisteLa sardine est un poisson gras excellent pour la santé notamment en raison de la présence d’oméga 3. Le docteur canadien Richard Beliveau, que j’ai déjà cité et sur lequel je reviendrai en fait l’éloge sur son site et prétend même qu’il s’agit une arme anti cancer <Adoptez les poissons gras> :
Mais ce n’est pas de ces sardines que je voudrais parler aujourd’hui, mais de sardines italiennes.
L’Italie constitue un laboratoire mondial pour la politique.
C’est l’Italie qui avant tout le monde, avant Trump, a mis à sa tête un milliardaire vulgaire, sexiste et sidérant : Silvio Berlusconi.
Au préalable, la justice avait lancé la grande opération < Mani pulite > (en français « Mains propres ») au début des années 1990 et visant la corruption de personnalités du monde politique et économique italien. Ces enquêtes mirent au jour un système de corruption et de financement illicite des partis politiques. Des ministres, des députés, des sénateurs, des entrepreneurs et même des ex-présidents du conseil furent impliqués. Elles donnèrent lieu à une grande indignation de l’opinion publique et révolutionnèrent la scène politique italienne, provoquant la disparition de partis historiques comme la Démocratie chrétienne (DC), le Parti socialiste italien (PSI), le Parti socialiste démocratique italien (PSDI) ou encore le Parti libéral italien (PLI). Et ouvrirent la voie à Berlusconi.
Après Berlusconi et quelques péripéties, un jeune homme, maire de Florence, gendre idéal, séducteur, libéral-social et ouvert à la mondialisation su s’emparer du cœur des italiens. Cela ne vous rappelle rien de plus récent en France ?
Parce qu’en Italie, c’était avant et l’homme dont il s’agit était Matteo Renzi.
Il accumula les réformes jusqu’à celle de trop et un référendum qu’il perdit avec plus de 59% de Non. Les élections législatives qui suivirent, amenèrent au pouvoir un duo populiste improbable :
- l’extrême gauche : « le mouvement 5 étoiles » de Luigi Di Maio
- et l’extrême droite « La ligue » de Matteo Salvini.
Le mouvement 5 étoiles avait nettement plus de députés que la Ligue. Mais dans le gouvernement, mis en place avec un premier ministre technocrate, Giuseppe Conte, les deux chefs politiques n’étaient que vice-ministre, l’impétueux Matteo Salvini allait rapidement s’imposer face à son partenaire d’extrême gauche. Les sondages montraient une chute de Di Maio et une montée inexorable de Salvini.
Cela se concrétisa lors de scrutins régionaux, mais surtout lors des élections européennes dans lesquelles La Ligue gagna largement avec 34,26% des voix, le mouvement 5 étoiles ne représentant plus que la moitié 17,06 %.
Salvini fort de ses succès et voulant accentuer sa politique d’extrême droite que le mouvement 5 étoiles tentait de maîtriser, souhaita convoquer de nouvelles élections et mis fin à la coalition. Les institutions italiennes résistèrent à cette manœuvre et Salvini fut éjecté du gouvernement au profit du Parti Démocrate.
Et c’est dans cette situation que fin 2019 se préparait les élections régionales d’Emilie-Romagne du 26 janvier 2020 qui ne pouvait qu’amener une victoire éclatante du populiste Matteo Salvini dans une région à gauche depuis 70 ans et encore gouverné alors par le Parti Démocrate.
Et, il s’est alors passé quelque chose d’étrange. Une sorte de mouvement des gilets jaunes à l’envers. Non pas un mouvement pour contester le gouvernement ; mais pour contester… l’opposition, en particulier Matteo Salvini.
Ce mouvement a pris le nom de Sardine (sardines) car, lors de sa première action publique, sur la Piazza Maggiore de Bologne le 14 novembre 2018, les organisateurs ont invité les participants « à se serrer comme des sardines ». La référence aux sardines vient, en effet, de l’expression « serrés comme des sardines dans une boite » (stretti come sardine),
 <Wikipedia> nous apprend que :
<Wikipedia> nous apprend que :
« Lors du lancement de la campagne électorale pour les élections régionales en Émilie-Romagne, le 14 novembre 2019, la Ligue du Nord pensait lancer la candidature de la candidate Lucia Borgonzoni. En même temps, un groupe de quatre amis crée sur Facebook une manifestation d’opposition nommée « 6000 sardine contro Salvini » (six mille sardines contre Salvini) avec pour objectif d’organiser « la première révolution piscicole de l’histoire » et de jeter dans l’ombre la campagne électorale adverse en rassemblant [sur la place publique] au moins six mille personnes, soit plus que les 5 750 places assises de [la salle] réservées par la manifestation adverse.
Le succès du rassemblement des sardines à Bologne (peut-être dix mille personnes) est ensuite répliqué le 19 novembre sur la Piazza Grande de Modène puis, à travers de mobilisations éclair (flash mob), dans d’autres villes italiennes, mais aussi à l’étranger, avec une manifestation à New York, portant une visibilité internationale. Le 14 décembre à Rome, les sardines rassemblent 35 000 personnes selon la préfecture de police, 100 000 personnes selon les organisateurs ; au cours de cet évènement, un des organisateurs, Mattia Santori, réclame en particulier l’abolition du « décret sécurité » passé par Matteo Salvini lors du précédent gouvernement Conte I et qui a introduit une série de mesures contre l’accueil des migrants ou qui en facilitent l’expulsion ».
Grazia, le magazine italien dans un article récent : < « Les Sardines Miraculeuses », le mouvement antipopuliste qui anime l’Italie > décrit ce mouvement ainsi :

« Les sardines ne sont pas qu’un bon petit plat, mais un mouvement antipopuliste qui se répand comme une tache d’huile en Italie. […]
Un van déboule sur une place romaine à coups de joyeux Klaxon. Décoré d’un filet de pêche, il s’arrête et diffuse Bella Ciao , le chant des résistants italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Collés sur un barnum, des poissons en papier délivrent ces slogans : « Non au racisme », « Non à la haine », « Non à l’homophobie », « Non à la violence physique et verbale ». Des militants invitent les passants à inscrire leurs pensées et propositions sur des poissons prédécoupés et à les déposer dans des filets. Voilà l’esprit des sardines
[Tout commence le 14 novembre 2019, à Bologne] Quatre trentenaires inconnus au bataillon – un coach sportif diplômé en sciences politiques, une kiné, un guide touristique et un ingénieur – lancent un appel sur Facebook à une contre-manifestation. Le mot d’ordre : « Pas de drapeau, pas de parti, pas d’insulte. Créez votre propre sardine et participez à la première révolution piscicole de l’histoire. […]
« Être une sardine, c’est faire bloc contre le populisme, explique Alice, une Turinoise de 26 ans. Seul, le petit poisson est incapable de se défendre, mais, en banc, il peut survivre à une attaque de requins. » Comme tant d’autres Italiens, Alice n’en pouvait plus du « climat de haine » régnant dans son pays – rien que ces derniers mois, une femme noire interdite de monter dans un bus, une librairie de gauche brûlée à Rome, une famille rom chassée de son logement social par des néofascistes… Après Bologne, plus de 400 groupes se créent spontanément sur Facebook et Telegram pour remplir les places à Palerme, Naples, Florence, Milan, Rome […] « La Péninsule n’avait pas vu ça depuis trente ans », s’étonne Emiliana De Blasio, sociologue. En interviewant plus de 1 000 Sardines, elle est surprise de trouver parmi elles des électeurs « de gauche, bien sûr, mais aussi du Mouvement 5 étoiles et du centre droit ». Valeria, 48 ans, a participé au rassemblement de Ferrare un livre à la main « Chacun en avait apporté un, certains Les Raisins de la colère de John Steinbeck, censuré par Mussolini. Un clin d’œil à la candidate de la Ligue en Emilie-Romagne qui venait de déclarer avec fierté n’avoir lu aucun livre depuis trois ans. »
 A priori, ils ne veulent pas créer un parti politique :
A priori, ils ne veulent pas créer un parti politique :
« Mattia Santori, l’un des fondateurs devenus aussi difficiles à interviewer qu’un ministre, le répète : « Nous ne voulons pas nous substituer aux politiques. » Jeune, sourire et charme XXL, il a été propulsé « sardine en chef » et invite à regarder plus loin que l’écran de son téléphone : « Nous courons un seul risque croire que les sardines sont la solution à tous les maux. Les sardines n’existent pas et n’ont jamais existé. Il existe seulement des personnes qui prennent position. »
<Marianne> a interrogé Bernard Spitz, président de l’association les Gracques, un groupe de réflexion qui souhaite une rénovation de la gauche française autour de valeurs sociales-libérales :
« Il s’est passé un événement exceptionnel samedi dernier : plus de 100.000 personnes rassemblées dans la rue pour protester ! […] Et elles ne protestaient pas pour réclamer, elles protestaient pour défendre l’intérêt général. L’ennemi désigné n’était pas seulement la Ligue et ses alliés d’extrême droite, elles se dressaient contre la mauvaise foi, les fake news, la démagogie, la pratique systématique de l’invective et de l’insulte dans le débat politique. Et elles ont choisi pour emblème les sardines. […]
Le choix de la sardine est un symbole d’humilité. De petits poissons qui circulent en nombre et se serrent les uns contre les autres. Leurs meetings se terminent par une chanson connue de tous : ciao bella ciao, une sorte de chant des partisans sur un rythme enlevé qui se termine par l’éloge de la liberté.
Les sardines offrent à la société civile l’occasion de s’engager pour des valeurs positives et pour l’intérêt général. C’est la raison pour laquelle nous les avons rencontrées à Rome cette semaine, que nous soutenons leur initiative et espérons les aider à l’élargir au-delà des frontières italiennes, pour diffuser leur message positif d’universalité. »
Et cela a fonctionné. Je donne la parole à <L’HUMANITE> du 27 janvier 2020.
« Cette région dirigée par la gauche depuis 70 ans restera dans le giron du Parti démocrate. Le président sortant Stefano Bonaccini l’emporte avec 51 % des voix. Matteo Salvini, le leader de l’extrême droite espérait l’emporter dans cette région centrale de l’Italie pour mettre en difficulté la coalition au pouvoir au niveau national.
Les sardines ont repoussé le requin. Le parti d’extrême droite de Matteo Salvini, la Ligue, a échoué, dimanche 26 janvier, lors des élections régionales en Émilie-Romagne. Sa candidate, Lucia Borgonzoni, n’a obtenu que 43,8 % des suffrages
[…] La prise de conscience permise par le mouvement des Sardines semble avoir fait son effet. La participation électorale a été plus forte qu’aux européennes dans les villes qui votent centre-gauche. »
« Les sardines » est un mot nouveau puisqu’il désigne un nouveau mouvement qui a pu gagner une bataille contre le populisme d’extrême droite.
Mais la guerre est encore loin d’être gagnée.
<1347>
- l’extrême gauche : « le mouvement 5 étoiles » de Luigi Di Maio
-
Lundi 10 février 2020
« Populisme »Un concept politique en expansion dans le monde« Le populisme » est vraiment un mot qui fait l’actualité.
Il est difficile de saisir précisément ce qu’il signifie, mais il est beaucoup utilisé. Et à ma connaissance toujours avec une connotation négative. Le « populiste » c’est l’autre.
Dans ma jeunesse, il y avait un autre mot très utilisé en politique : « démagogue ». Mon professeur de français de troisième nous a dit :
« Vous serez intelligent le jour où vous comprendrez le sens du mot démagogie »
La démagogie est assez facile à définir. C’est la méthode d’un homme politique qui pour se faire élire va multiplier les promesses et flatter les électeurs sans être capable une fois au pouvoir de mettre en œuvre ses promesses.
Mais le populisme est une notion plus floue.
En revanche il est plus commode de faire la liste d’un grand nombre de personnalités politiques qui sont traitées de populiste :
- Donald Trump le président des Etats-Unis
- Narendra Modi le premier ministre indien
- Jair Bolsonaro le président brésilien
- Boris Johnson le premier ministre britannique
- Matteo Salvini l’ancien ministre de l’intérieur italien
- Viktor Orban le premier ministre hongrois etc..
Et en France Marine Le Pen et Jean-Luc Melenchon sont le plus souvent traités de leaders populistes.
Dans leur défense, ces leaders retiennent que dans le mot populiste, il y a le mot peuple et que ils se réjouissent de représenter le peuple.
C’est une première approche du populisme que de constater qu’un de leur point commun est le fait d’opposer « le peuple » et « les élites » et de prétendre qu’ils sont du côté du peuple.
Pour Donald Trump, c’est un rôle de composition, mais qu’il joue visiblement très bien.
Plus largement, l’historien Pierre Rosanvallon s’est intéressé à ce terme de « populisme » en expansion partout dans le monde :
« De l’Inde à l’Amérique de Trump, à notre Europe et à l’Amérique latine, ce qu’on appelle populisme est en train de gagner. »
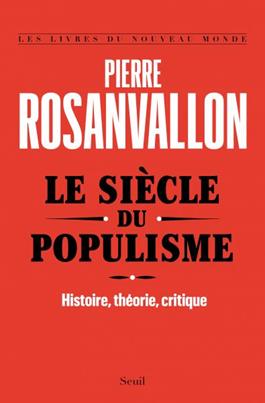 Et pour faire cette analyse, il a écrit un livre « Le siècle du populisme » édité par le Seuil et paru le 9 janvier 2020
Et pour faire cette analyse, il a écrit un livre « Le siècle du populisme » édité par le Seuil et paru le 9 janvier 2020
Il a été l’invité d’Ali Baddou le <10 janvier 2020>, émission dans laquelle il explique qu’il a voulu faire une Histoire de ce mot « populisme »
Il nous apprend que l’apparition explicite du mot populiste, en France, apparaît d’abord en 1929 dans le monde littéraire : « Le manifeste populiste » rédigé par Léon Lemonnier et qui entend inciter l’élite littéraire de s’intéresser à la vie du peuple, à la société profonde, d’en raconter les réalités et de beaucoup moins s’intéresser à la vie élégante de la bourgeoisie.
Le livre de Rosanvallon a pour ambition de combler un vide parce que le populisme n’a jamais été théorisé en tant que pensée politique.
Il analyse ainsi que :
« Le populisme, c’est à la fois un symptôme et une proposition […] Le populisme-symptôme est facile à analyser : c’est le dégagisme, la critique de la mal-représentation dans la société, c’est le dégoût devant des inégalités galopantes. [A l’inverse] le populisme-proposition apparaît beaucoup plus diffus, d’autant plus qu’il n’a jamais fait l’objet d’une analyse de fond, contrairement, par exemple, au communisme avec Marx, le socialisme avec Jaurès, le libéralisme avec Tocqueville. Toutes les grandes idéologies ont eu leur traducteur. »
Pierre Rosanvallon ne veut bien sûr pas faire œuvre d’idéologue comme les penseurs cités précédemment, il n’est pas populiste. Mais il dit :
« J’ai voulu montrer que derrière une certaine confusion, il y avait quand même un certain nombre de lignes directrices. J’ai voulu être un théoricien du populisme »
Et il fait remonter le populisme politique en France à Napoléon III :
« Le populisme est inséparable de l’histoire de la démocratie, c’est d’abord une proposition démocratique. Pendant la Révolution, il y a beaucoup de débats sur les rapports entre la représentation et la démocratie directe, immédiate. Et, le premier à apporter une réponse originale à cette problématique c’est Napoléon III. Parce qu’il dit que la démocratie repose d’abord sur le suffrage, d’abord sur le référendum. Au nom de la souveraineté du peuple, il a été le premier à critiquer les corps intermédiaires, la liberté de la presse et les partis, en disant aux journalistes que personne ne les avait élus, qu’ils n’étaient pas représentants de la société. Et aux partis politiques qu’ils n’étaient que des entrepreneurs politiques, pas des représentants. Il est le premier à avoir théorisé la suprématie de ce qu’on appelle aujourd’hui la démocratie illibérale. Et quand on relit Napoléon III, on voit que c’est exactement le discours d’Orban, et à certains égards le discours de Trump aussi ».
Il donne donc à Napoléon III la paternité de ce premier élément du populisme : celui de la démocratie directe, immédiate qui rejette les corps intermédiaires. Tout doit être soumis au pouvoir, parce que celui-ci a eu l’onction populaire.
Le second pilier du populisme serait le « dégagisme ». Pierre Rosanvallon situe son essor en Amérique latine en parallèle avec l’essor d’un leader comme incarnation du peuple. C’est évidemment connu de tous le « péronisme » argentin. Mais ; Il cite en premier leader sud-américian, un colombien : Jorge Eliécer Gaitán (1898 – assassiné le 9 avril 1948). Gaitan qui a été admiré par Peron, par Castro et Chavez disait :
« Je suis un homme peuple ».
Il ne savait pas qu’il reprenait ainsi la formule des partisans de Napoléon III.
« Puisqu’il est élu du peuple, il est un homme peuple »
Il y a donc selon Rosanvallon, une théorie de la démocratie dans le populisme.
Et dans une des principales propositions des populistes, en face des inégalités, c’est de se refermer sur soi-même, d’arrêter les flux d’immigrés, c’est ce que Pierre Rosanvallon appelle :
« Le national protectionnisme. »
Il parle ainsi d’une théorie sous-jacente du populisme qui :
- D’abord oppose le peuple et l’élite ;
- Ensuite conduit à l’émergence d’un leader qui émane de l’élection par le suffrage universel ;
- Ce leader une fois élu n’a pas à tenir compte de corps intermédiaires parce qu’il est l’homme peuple ;
- Enfin la principale proposition est de nature nationaliste, protectionniste et souvent xénophobe.
Ces 4 éléments définissent assez bien Donald Trump, Viktor Orban, et quelques autres.
Pierre Rosanvallon a déclaré au journal belge le «Soir»:
«Les populismes prétendent être une forme supérieure de démocratie»
Dans cet article de <Philosophie Magazine> qui analyse l’ouvrage de Rosanvallon, je retiens cette conclusion :
« Si le populisme n’apporte que des réponses simplistes, il a au moins le mérite d’obliger la démocratie à se critiquer et à se réinventer. Au lieu de s’en remettre au référendum, qui n’offre selon lui qu’une souveraineté impuissante, Rosanvallon en appelle plutôt à complexifier la démocratie, à l’élargir, à la généraliser, à la démultiplier et à la rendre interactive sous la vigilance de « l’œil » du peuple (destiné à compléter sa « voix »). Le populisme, enfant terrible de nos démocraties désenchantées, pourrait finalement en être le ferment. »
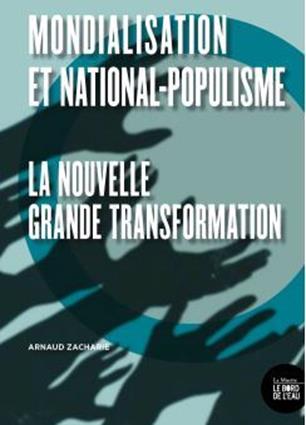 Lors de la préparation de ce mot du jour, j’ai appris qu’un autre livre vient de paraître le 10 janvier : « Mondialisation et national-populisme » d’Arnaud Zacharie
Lors de la préparation de ce mot du jour, j’ai appris qu’un autre livre vient de paraître le 10 janvier : « Mondialisation et national-populisme » d’Arnaud Zacharie
Arnaud Zacharie est belge et « Le Monde » a consacré un article à ce livre : <Les populismes observés à la lumière de l’histoire>
<Le Monde> qui consacre aussi un article au livre de Pierre Rosanvallon dans lequel on peut lire :
« La démocratie, écrit-il, « est par nature expérimentale ». Elle reste à ce titre le meilleur instrument pour permettre aux sociétés d’apprendre à vivre dans le changement perpétuel. Mais à condition de progresser encore, de se « démultiplier » en accroissant sa capacité de représentation de la réalité des vies et en donnant aux individus davantage de prise sur ses procédures, qu’il s’agit dès lors d’enrichir, à côté de l’exercice électoral, de « dispositifs permanents de consultation, d’information, de reddition des comptes ».
Il y a aussi cette émission de la Grande Table : <Populisme, l’affaire du siècle ?>
Et cet article de l’Obs : <Pierre Rosanvallon : « Il faut prendre le populisme au sérieux »>
<1346> - Donald Trump le président des Etats-Unis
-
Vendredi 7 février 2020
« L’autre moitié du songe m’appartient »Alicia GallienneAujourd’hui, je vais me laisser la liberté d’interrompre ma série sur les mots et expressions nouvelles et les mots anciens qui sont revenus dans l’actualité.
Parce qu’aujourd’hui je voudrais parler d’Alicia.
Le grand acteur Guillaume Gallienne, anime chaque samedi sur France Inter, depuis septembre 2009, une émission :<Ça peut pas faire de mal> dans laquelle il lit des extraits d’œuvres littéraires
Sa première émission le 5 septembre 2009 était consacrée à Marcel Proust « Les pages comiques de la Recherche »
Puis de samedi en samedi d’autres écrivains ont été à l’honneur : Balzac, Cervantès, Tchekhov, Kafka et bien d’autres.
Mais il a décidé d’arrêter cette émission ce samedi 8 février 2020, il s’en est expliqué au micro de Léa Salamé : <le 3 février 2020>.
Pour sa dernière émission, il lira des textes et des poésies d’une auteure qui est morte comme tous les écrivains qu’il a lus tout au long de ses dix ans.
Mais cette auteure : Alicia est quand même un peu particulière.
D’abord c’est sa cousine.
Ensuite, Alicia Gallienne est morte alors qu’elle avait 20 ans.
Enfin, vous lirez dans <cet article de février 2009> de Libération :
« Jusqu’à 19 ans, jamais Gallienne n’avait pensé être comédien. A cet âge, il est en hypokhâgne et rêve d’être missionnaire. Ou avocat. Ou journaliste. Bref, n’importe quoi. La mort brutale de son adorée cousine Alicia bouleverse son regard sur la vie tandis que sa sexualité en éveil chamboule ses plans religieux. «On était très proches, elle était fascinante, incroyable. Sa mort, un 24 décembre, m’a réveillé : si je peux crever demain, alors je veux faire du théâtre.»
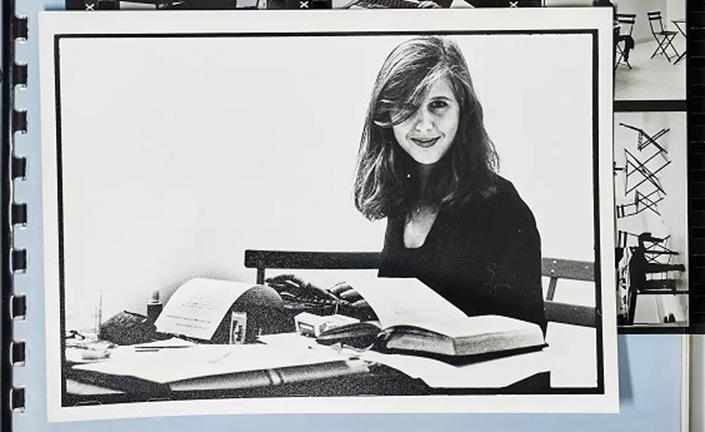 J’ai d’abord découvert son existence grâce à la revue de Presse de Claude Askolovitch du <31 janvier 2020> dans laquelle il parle de la beauté d’Alicia :
J’ai d’abord découvert son existence grâce à la revue de Presse de Claude Askolovitch du <31 janvier 2020> dans laquelle il parle de la beauté d’Alicia :
« Une jeune femme morte le 24 décembre 1990 d’une leucémie, qui treize ans plus tôt avait pris son petit frère, mais la cruauté n’est rien, car Alicia est devant nous Alicia dans la beauté de ses vingt ans, sa dernière année sur terre, les joues enfantines, les lèvres pleines photographiées par son dernier amour…
Elle écrivait depuis l’enfance et la nuit sortait dans des lieux à la mode, Régine le Palace et Castel, elle dinait en robe moulante chez Maxim’s et festoyait d’autant plus qu’elle savait la maladie… « Depuis toujours, écrit Pascale Nivelle dans un texte au diapason de la jeune fantôme, depuis toujours, elle tient à distance ses terreurs, les ponctions qui bleuissent ses clavicules, les piqures à toute heure, il lui arrive de se piquer en parlant, seringue plantée dans la cuisse sous une table de bistro, elle veut vivre plus que de raison, la nuit elle noircit ses cahiers de poèmes d’une écriture ronde, sans rature, j’écris pour être lue dit- elle à sa mère. »
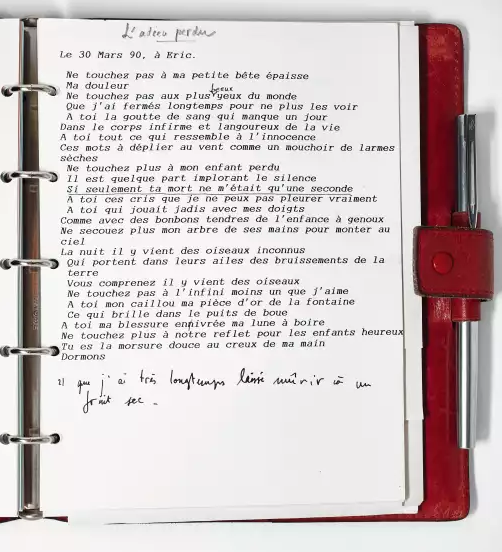 Elle écrivait ceci pour conjurer sa peur.
Elle écrivait ceci pour conjurer sa peur.
« Faiblesse je te hais de toi même; vivre c’est accepter de tomber sous le poids de ce qui ne nous appartient pas. »
Elle écrivait cela en pensant à son frère
« Ne touchez pas à ma petite bête épaisse ma douleur
Ne touchez pas aux plus beaux yeux du monde que j’ai fermés longtemps pour ne plus les voir
Ne touchez plus à mon enfant perdu, il est quelque part implorant le silence
A toi mon caillou ma pièce d’or
A toi ma blessure enivrée ma lune à boire
Tu es la morsure douce au creux de ma main.
Quand Alicia est morte, sa famille a gardé ses textes mais un jour sa maman a réalisé que les seuls mots de sa fille que l’on pouvait lire étaient sur sa tombe à Montparnasse. Alors, elle est allée voir son neveu, le comédien Guillaume Gallienne, que sa cousine vivante encourageait à vivre. Il est allé montrer ses poèmes chez Gallimard, une éditrice Sophie Naulleau s’est prise pour Alicia d’une de ses amitiés qui passent les frontières de la vie et le livre est là et Alicia vous attend ce matin, dans le magazine du Monde. »
Dans son entretien avec Léa Salamé, Guillaume Gallienne modifie un peu cette histoire. C’est lui qui est allé voir sa tante et l’a trouvée triste et affectée. A sa demande, elle lui expliqua qu’elle venait de se faire disputer par son frère qui lui reprochait de ne jamais avoir publié les magnifiques textes d’Alicia. Elle expliqua qu’elle avait essayé après 1990 mais que les maisons d’édition refusait en disant que cela ne les intéressait pas d’éditer un livre unique qui ne sera suivi d’aucun autre. Et c’est alors que la Mère d’Alicia a demandé à Guillaume Gallienne s’il ne pourrait pas intervenir auprès de son éditeur. Et c’est ce qu’il fit et il se trouva chez Gallimard des professionnels qui trouvèrent pertinent de publier cet ouvrage qui est paru hier le 6 février.
L’article du Monde auquel renvoie Claude Askolovitch a pour titre : < Alicia Gallienne, étoile filante de la poésie >
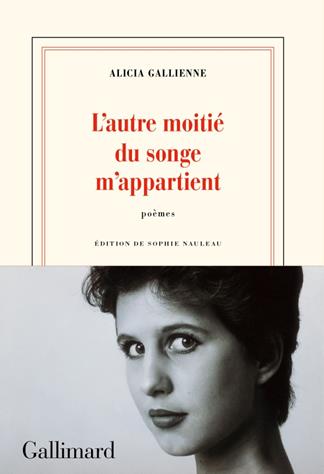 Ce très long article commence par une visite à la tombe d’Alicia :
Ce très long article commence par une visite à la tombe d’Alicia :
« C’est une tombe toute blanche au cimetière du Montparnasse, non loin du cénotaphe de Baudelaire. Une alcôve de verdure grimpante, avec une grande croix sculptée et un quatrain gravé dans la pierre. « (…) Mon âme saura s’évader et se rendre (…). »
Morte à 20 ans d’une maladie du sang, Alicia Maria Claudia Gallienne a écrit des centaines de poèmes entre 1986 et 1990. « Qu’importe ce que je laisserai derrière moi, pourvu que la matière se souvienne de moi, pourvu que les mots qui m’habitent soient écrits quelque part et qu’ils me survivent », écrivait-elle à Sotogrande, dans la propriété de sa famille maternelle en Espagne.
Les quatre lignes inscrites sur sa tombe, déjà érodées par le temps, sont longtemps restées la seule trace visible de son œuvre. Quelques années encore et les mots se fondront dans le grain de la pierre. Envolés, comme la dernière image d’Alicia dans son cercueil, le visage serti dans la mantille blanche des mariées sévillanes. […]
Un après-midi de janvier, trente ans après la mise en bière, une longue femme brune s’avance vers la tombe, se recueille un instant devant la jeune poète disparue et l’objet qu’elle vient de déposer doucement sur la pierre. Ce livre de la collection « Blanche » de Gallimard, L’autre moitié du songe m’appartient, par Alicia Gallienne, qui sort ce 6 février, tient du miracle.
Sans la longue femme brune, Sophie Nauleau, écrivaine et éditrice, et sans le comédien et réalisateur Guillaume Gallienne, cousin d’Alicia, ce pavé de près de 400 pages, ovni dans le petit monde de la poésie, n’aurait jamais été imprimé. Et il n’aurait pas connu un tirage de 4 000 exemplaires, un chiffre très élevé pour de la poésie, genre littéraire loin de tous les classements de vente. »
Sophie Naulleau a écrit la préface du livre de poèmes.
Guillaume Gallienne raconte :
« Dans la famille, « on lisait parfois en pleurant quelques-uns de ses poèmes et on disait « le coin d’Alicia » pour désigner le secrétaire qui renfermait ses trésors. »
L’article se termine ainsi :
« Dans sa bulle aseptisée, sur son « lit de cristal », Alicia a écrit ses pensées au feutre noir, avec des étoiles, des points d’exclamation et d’interrogation. « J’ai toujours su ce qui m’attendait en venant ici. » En décembre 1990, elle remercie son amant « (…) Pour tous les moments où nous avons fait le bonheur à deux ! » Les pages suivantes sont restées blanches. »
Aujourd’hui, je voulais parler d’Alicia Gallienne.
<1345>
-
Jeudi 6 février 2020
« Islamophobie »Mot piègeEn réponse à mon premier article de cette série, Lucien a répondu :
« Les mots peuvent être des armes, certains sont des larmes ! »
Certains mots sont aussi des « pièges, des ruses, des escroqueries »
C’est indiscutablement le cas du mot « islamophobie ».
Et comme je l’écrivais lors de ce premier article, il faut expliquer un mot par d’autres mots imparfaits, incomplets pour comprendre la globalité d’un sujet.
Essayons donc, de faire œuvre de pédagogie, de rigueur et de lucidité.
Dans la rigueur du français, ce mot signifie la phobie de l’islam.
La « phobie » c’est avant tout la crainte de quelque chose.
Wikipedia nous apprend que le mot vient du grec ancien « φόβος » / « phóbos, » qui signifie frayeur, crainte ou répulsion et signifie une peur démesurée et dépendant d’un ressenti plutôt que de causes rationnelles, d’un objet ou d’une situation précise.
Ce terme est particulièrement utilisée en médecine : pour « agoraphobie », peur de la foule et des lieux publics, « claustrophobie », peur des lieux clos, il existe même la « cancérophobie » je ne crois pas nécessaire d’expliquer.
L’arachnophobie, la peur des araignées est très répandue.
La phobie de l’islam signifie donc la peur de l’islam.
Mais les utilisateurs crispés et excités de ce mot entendent dire autre chose : la haine des musulmans, c’est-à-dire des êtres humains qui professent la foi de l’islam ou plus largement qui sont reconnus comme appartenant à la communauté musulmane par leur naissance, par leur famille. Ils veulent donc dire « anti-musulmans »
Cela n’a rien à voir.
- L’islam est une religion, une idéologie, un concept.
- Le musulman est un être humain, un citoyen qui dispose de la liberté de conscience.
La loi française protège le second de l’injure, de la menace, de la haine.
Elle ne fait rien de tel pour la première : la religion, l’idéologie.
Le terme d’islamophobie constitue donc un piège, un subterfuge qui veut se servir de la liberté de conscience des citoyens pour interdire la critique de l’islam.
Rien ne permet de mieux illustrer ce point que « l’affaire Mila » et surtout les réactions qui ont été causées par elle.
Je vais raconter l’histoire de Mila en reprenant les éléments qu’apporte <20 minutes> et d’autres que j’ai trouvé ailleurs, comme <cette vidéo> dans laquelle la jeune fille raconte sa version des faits.
Mila est une lycéenne, elle est originaire de l’Isère et elle a 16 ans
Cette jeune fille se revendique lesbienne. Elle a posté une vidéo, samedi 18 janvier sur instagram, dans laquelle elle parlait de chant. Ensuite, les choses sont moins claires, elle aurait échangé avec une autre fille de relations amoureuses. Il semble qu’il a été question à un moment d’une discussion avec une autre fille dans laquelle les deux ont marqué leur accord sur le fait que les arabes, « rebeux » dans le texte n’étaient pas «leur truc» pour ce type de relations. La discussion s’est envenimée, et des jeunes ont commencé à la traiter de « sale lesbienne » puis de « sale raciste » et aussi d’ « islamophobe » et elle affirme des insultes « plus hard ». Et puis la discussion a dérivé sur la religion et c’est là que Mila a dit (selon 20 minutes) :
« Le Coran est une religion de haine […] Votre religion, c’est de la merde, votre Dieu je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci au revoir ».
Il est vrai et je peux le reconnaitre que l’argument scatologique ainsi que la préconisation d’un coït anal digital divin n’apporte rien au débat et n’élève pas la pensée.
Cette jeune fille dans un moment d’énervement a utilisé l’injure, elle aurait pu s’abstenir.
Et elle a d’ailleurs eu des paroles d’explications et d’excuses dont se fait l’écho <La nouvelle Tribune> :
« Je ne regrette absolument pas mes propos, c’était vraiment ma pensée », a notamment déclaré l’ado lors de son passage sur le plateau de l’émission. Elle a tout de même voulu présenter ses excuses à celles et ceux qui se sont sentis blesser par ses déclarations.
Je m’excuse un petit peu pour les personnes que j’ai pu blesser, qui pratiquent leur religion en paix, et je n’ai jamais voulu viser des êtres humains, j’ai voulu blasphémer, j’ai voulu parler d’une religion, dire ce que j’en pensais », a-t-elle ajouté. »
Elle dit donc clairement qu’elle a voulu exprimer son opinion sur l’islam et elle souhaitait blasphémer.
Ce qui est totalement et absolument autorisé et accepté par la Loi et les textes fondamentaux français.
Dans toutes les versions de la phrase polémique, il n’est jamais question de personnes, de musulmans. Il est question d’une idéologie, d’une doctrine que Mila n’aime pas.
Cette histoire qui aurait pu rester dans un cercle très restreint, une sorte « d’embrouille » entre jeunes n’aurait pas dû s’étendre à une discussion nationale.
Mais c’est la suite qui est importante. La jeune fille a immédiatement été la cible d’une vaste campagne de cyberharcèlement, d’insultes et de menaces de mort avec toute la gradation de sévices qu’entendent pratiquer les fous de de Dieu à l’égard de celles et ceux qui leur déplaisent. Certains internautes ont dévoilé l’identité de la jeune fille, son adresse, et même celle de son lycée. La jeune fille a déclaré :
« Je recevais 200 messages de pure haine à la minute ».
Face à cette vague de haine, la jeune fille a dû être « déscolarisée » a indiqué à 20 Minutes le rectorat de Grenoble.
« Le proviseur de son établissement, situé dans le nord Isère, a procédé dès lundi matin à un signalement auprès du procureur de la République, et auprès de la plateforme Pharos [service de la police nationale chargé de la lutte contre la cybercriminalité]. La lycéenne, élève de seconde, ne s’est pas présentée en cours cette semaine »
Le ministre de l’intérieur a déclaré que la jeune fille et sa famille ont été mises sous protection policière.
Deux affaires ont été portées devant la justice, l’une, comme il se doit, contre les personnes ayant proféré des menaces de mort, l’autre plus étonnante contre Mila avec pour motif : «provocation à la haine à l’égard d’un groupe de personnes». Cette seconde affaire est sans fondement, Mila a attaqué l’islam non les musulmans.
Et la <Justice Française> a fait son devoir et a rejeté cette accusation ;
«Dans un communiqué diffusé jeudi 30 janvier, le parquet de Vienne a indiqué que les investigations «n’ont révélé aucun élément de nature à caractériser une infraction pénale (…) L’enquête a démontré que les propos diffusés, quelle que soit leur tonalité outrageante, avaient pour seul objet d’exprimer une opinion personnelle à l’égard d’une religion, sans volonté d’exhorter à la haine ou à la violence contre des individus à raison de leur origine ou de leur appartenance à cette communauté de croyance».
L’autre pour identifier les internautes ayant exprimé les menaces de mort continue.
Mais l’affaire ne s’arrête pas là.
Il y a d’abord Abdallah Zekri qui dirige l’Observatoire national contre l’islamophobie et qui est délégué général du CFCM qui a tenu des propos inacceptables.
Je rappelle que le Conseil français du culte musulman (CFCM) est une association française régie par la loi de 1901, placé sous l’égide du ministère de l’Intérieur, et qui a vocation à représenter les musulmans de France auprès des instances étatiques pour les questions relatives à la pratique religieuse. Il a été mis en place alors que Sarkozy était ministre de l’Intérieur.
Après avoir condamné les menaces de mort il a rejeté sur Mila la responsabilité de ce qui lui arrive. <Marianne le cite> :
« Cette fille, elle sait ce qu’elle a dit. Elle a pris ses responsabilités. Qu’elle critique les religions, je suis d’accord, mais d’insulter et tout ce qui s’ensuit… Maintenant, elle assume les conséquences de ce qu’elle a dit. » Lorsque les chroniqueurs de Sud Radio lui ont fait remarquer que Mila avait réagi, certes avec outrance, à des insultes, le délégué général du CFCM a affiché ses doutes : « Est-ce qu’on lui a dit ‘sale française’ ? Ou est-ce qu’elle le dit pour se faire plaindre ? Vous la croyez, cette fille-là ? Moi je ne la crois pas. » Quand l’avocate Yael Mellul indique à Zekri qu’il peut difficilement dire que Mila « n’a que ce qu’elle mérite », celui-ci rétorque : « Si, je le dis. Elle l’a cherché, elle assume. Les propos qu’elle a tenus, je ne peux pas les accepter. »
Il ignore probablement qu’il habite le pays de Voltaire, de Hugo, de Jaurès, de Camus.
Beaucoup plus grave : La ministre de la Justice Nicole Belloubet sur Europe 1 a fait la même dichotomie.
Elle a donc condamné les menaces de mort et puis dans un même élan, je dirais sur le même plan elle a jouté :
«L’insulte à la religion, c’est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c’est grave»
Les bras m’en tombent !
Il y a deux énormités dans ce qu’elle raconte
La première c’est de mettre sur le même plan des menaces de mort, de viols et tout ce qui s’en suit donc très clairement un appel à la haine vers une personne physique et quelques insultes à une religion. Elle est donc exactement sur la même longueur d’onde qu’ Abdallah Zekri les insultes peuvent expliquer les menaces de mort !
La seconde est encore plus grave. Nous avons donc une Ministre de la Justice qui ignore ce point fondamental du Droit en France : le blasphème n’existe pas.
D’ailleurs les juges connaissent le Droit et ont jugé l’affaire dans ce sens.
L’avocat Richard Malka lui a répondu de manière cinglante : «Non, Madame Belloubet, injurier l’islam n’est pas une atteinte à la liberté de conscience!»
Et on voit bien ce que je dénonçais au début, le mot islamophobie est un piège puisque lentement on en vient à accepter dans les esprits le concept de blasphème.
Je me souviens, un jour dans notre cuisine, peu de temps après la tuerie de Charlie Hebdo, un jeune lecteur du mot du jour m’a interpellé :
« Tu ne trouves pas qu’on en fait un peu trop sur cette affaire »
 Je me souviens de ma sidération et j’ai trouvé un dessin de presse qui mieux que les mots exprime la situation.
Je me souviens de ma sidération et j’ai trouvé un dessin de presse qui mieux que les mots exprime la situation.
Je partage le tweet de Raphaël Enthoven :
« #JeSuisMila car le blasphème n’est pas un délit, mais une œuvre de santé publique. »
Et Charlie Hebdo qui ose ce titre : <Affaire Mila : le droit au blasphème fait fuir les lâches>
L’islam a un grand problème, comme le christianisme et le judaïsme : c’est une religion monothéiste.
Et Régis Debray a magnifiquement synthétisé le problème :
« Non seulement, ces religions [monothéistes] entendent régler nos mœurs et notre vie intime mais ce sont elles qui ont liées la notion de croyance et la notion de vérité et ça c’est de la dynamite. »
La confusion entre la croyance et la vérité !
Et pendant des siècles chaque fois qu’ils disposaient du pouvoir temporel elles ont imposé leur terreur, tuant les blasphémateurs et les incroyants.
Les religions ont insulté et traité de manière ignoble toutes celles et ceux qui ne suivaient pas « leur vérité ».
Le blasphème, c’est-à-dire la critique du sacré a été un formidable progrès dans nos sociétés. C’est une libération
Et l’islam est hélas aujourd’hui la seule religion qui de manière officielle continue à tuer pour le blasphème dans certains pays.
C’est là qu’il faut interrompre tous ces mots imparfaits qui essayent de décrire le problème que pose l’utilisation du mot islamophobie.
Pour en dire d’autres qui nuancent et apportent des précisions.
Il y a une très grande majorité de musulmans en France qui vivent leur Foi de manière apaisée et qui sont parfaitement intégrés dans les valeurs de la République.
Et puis il y a des musulmans qui tentent de faire évoluer les mentalités. C’est Annie qui m’a fait découvrir cette remarquable émission du dimanche matin sur France Culture : <Questions d’islam> par Ghaleb Bencheikh le dimanche entre 7 heures et 8 heures. Des réflexions d’une hauteur de vue remarquable.
La dernière émission avait invité l’essayiste Malik Bezouh qui a écrit un livre dont la couverture est déjà tout un programme :
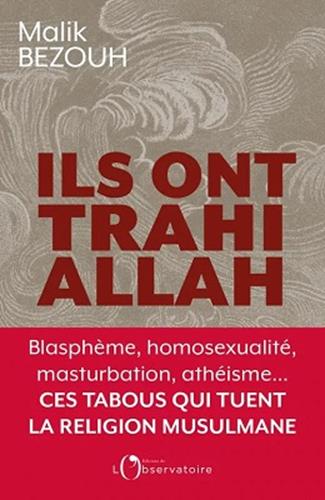 Il dit :
Il dit :
« Blasphème, homosexualité, masturbation, athéisme… la puissance du tabou qui enveloppe ces thèmes rend presque impossible tout débat en islam. Figé politiquement par un despotisme empêchant l’émergence d’une réflexion apaisée et rationnelle, englué dans un conservatisme religieux anachronique, et travaillé en profondeur par des courants réactionnaires, le monde islamique, hétérogène, complexe, est à la peine lorsqu’il s’agit de considérer sereinement ces sujets, pourtant fondamentaux. Marqueurs d’une modernité enfantée par un Occident jadis chrétien, hier colonisateur, aujourd’hui sécularisé, ces questions génèrent des crispations parfois paroxystiques comme en attestent les attentats commis sur notre sol depuis quelques années. Aujourd’hui, l’islam est à la croisée des chemins. »
Vous pouvez écouter cette émission derrière <ce lien>
Une autre réalité à dire, c’est qu’il existe une haine anti-musulmane et anti-arabe dans une partie de la population française.
Inacceptable bien sûr, mais l’islamophobie n’est pas le bon mot pour décrire cela.
Wikipedia cite Caroline Fourest et Fiammetta Venner qui affirment,
« en 2003, que le mot a pour la première fois été utilisé en 1979 par les mollahs iraniens, puis réactivé « au lendemain de l’affaire Rushdie, par des associations islamistes londoniennes comme Al Muhajiroun ou la Islamic Human Rights Commission », pour justifier en 1990 la fatwa contre l’écrivain Salman Rushdie, pour condamner à mort Taslima Nasreen et plusieurs autres intellectuels musulmans pour des écrits jugés blasphématoires. Elles ajoutent que le terme est toujours utilisé par le régime iranien pour condamner toute production artistique jugée blasphématoire, comme l’accusation d’islamophobie lancée en 2007 par Mehdi Halhor contre le dessin animé Persepolis, réalisé d’après la bande dessinée de Marjane Satrapi. »
Et c’est une idéologie nocive qui vient de certains pays musulmans archaïques et intolérants et qui tentent grâce à leurs formidables pouvoirs financiers d’infiltrer la société française musulmane pour l’éloigner du modèle républicain et la faire muter vers des mœurs régressifs et un formidable recul de la liberté de pensée et d’opinion.
Ils utilisent le mot «islamophobie » pour souder une communauté de plus en plus large, empêcher la critique et la dénonciation de leur entreprise sournoise.
Saviez-vous que lorsque le CFCM a été créé, le gouvernement français a renoncé à ce que la charte de l’Islam au cœur de cette création ne contienne le droit fondamental de changer de religion :
« En novembre 1999, Jean-Pierre Chevènement entame une consultation large rassemblant toutes les fédérations musulmanes, les grandes mosquées et certaines personnalités3 et leur soumet un texte qui ne pouvait « faire l’objet d’une négociation », mais qui a cependant été amendé. Le texte initial ajoutait que cette convention : « consacre notamment le droit de toute personne à changer de religion ou de conviction ». Assimilée à un acte d’apostasie, cette précision sur le droit à changer de religion ou de conviction était pour Jean-Pierre Chevènement cruciale. Elle soulevait la question de la liberté religieuse. Si un musulman est libre de changer de religion, sa décision supplante celle du groupe. Inversement, pour un individu soumis à la communauté des croyants, cette soumission prime sur celle qu’il doit à la nation.
Après de longues discussions, Chevènement obtint dans un premier temps un engagement sur ce point, mais celui-ci fut finalement retiré à la demande des autorités musulmanes. Le pacte fut signé le 28 janvier 2000. Si Alain Billon, conseiller de Chevènement, considère le texte comme « expression positive de laïcité », il souleva immédiatement des critiques qui portent précisément sur le droit de changer de religion : ainsi, pour Leïla Babes et Michel Renard, « les pouvoirs publics, en acceptant d’altérer un texte présenté comme « non négociable », introduisent un état d’exception qui pourrait se révéler préjudiciable pour l’intégration de l’islam dans le cadre du droit. »
C’est sidérant !
Cela ne change rien au Droit français et à la liberté d’opinion.
Mais cela prouve bien le problème que posent certains idéologues de l’Islam à notre République et à notre manière de penser la liberté.
« Islamophobie » est vraiment un mot important de l’actualité française.
Et certains hommes de gauche se perdent dans ce combat qui n’est pas un bon combat.
Et j’espère que personne ne doutera que je pense que le combat contre la haine des musulmans ou le racisme anti-arabe sont, quant à eux, de très bons combats.
<1344>
- L’islam est une religion, une idéologie, un concept.
-
Mercredi 5 février 2020
« Les voraces »Vincent JauvertQuand on évoque les voraces à Lyon, on pense immédiatement à la <Cour des Voraces> qui se situe sur les pentes de la colline de la Croix Rousse.
 Le site vers lequel je renvoie prétend que selon l’hypothèse la plus courante, le mot VORACES serait une déformation du mot « devoirants », lui-même dérivé de « Compagnons du Devoir », dénomination choisie en 1846 par une association compagnonnique qui avait établi en ce lieu son quartier général. Il s’agissait d’une des nombreuses organisations ouvrières plus ou moins secrètes, de longue date basées dans le quartier.
Le site vers lequel je renvoie prétend que selon l’hypothèse la plus courante, le mot VORACES serait une déformation du mot « devoirants », lui-même dérivé de « Compagnons du Devoir », dénomination choisie en 1846 par une association compagnonnique qui avait établi en ce lieu son quartier général. Il s’agissait d’une des nombreuses organisations ouvrières plus ou moins secrètes, de longue date basées dans le quartier.
La Cour des Voraces est en pratique une cour d’immeubles, construite vers 1840, célèbre pour son monumental escalier de façade de six étages. C’est une impressionnante traboule qui permet de passer du 9 de la place Colbert au 14 de la montée de Saint-Sébastien ou au 29 rue Imbert-Colomès, à des niveaux différents. Elle est liée à l’industrie de la soie qui avait ses quartiers à la Croix Rousse.
Mais l’actualité de ce mot est due à un livre d’un journaliste de l’Obs, Vincent Jauvert : « Les voraces. Les élites et l’argent sous Macron » paru le 16 janvier dernier.
J’ai découvert ce livre et les réflexions de Vincent Jauvert par l’émission <C à Vous du 16/01/2020>
Le Littré donne comme définition de vorace : « Qui dévore, qui mange avec avidité. » Le mot vient du latin voracem, de vorare, c’est-à-dire dévorer.
Avant le livre, nous avons eu l’extraordinaire feuilleton de toutes les activités du haut-commissaire à la Réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye qui avait omis de déclarer dix mandats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dont plusieurs présentaient un risque de conflit d’intérêt majeur avec sa mission sur les retraites. Tous ces mandats posaient aussi la question de savoir comment cet homme, certes dynamique et efficace, était en mesure de remplir toutes ces activités.
Il y eut aussi la polémique de Sylvie Goulard que la France voulait nommer commissaire européen et dont la nomination a été rejetée par le parlement européen à cause de ses liens, alors qu’elle était eurodéputée, avec l’Institut Berggruen, think tank américain, connu pour faire du lobbying en matière commerciale. Pour ce job elle percevait 12 000 euros par mois
L’association « Anticor » a été créée pour mener des actions en vue de promouvoir l’éthique en politique et de lutter contre la corruption et la fraude fiscale. Une de ses responsables, Elise Van Beneden, ajoute à propos de Mme Goulard :
« Elle avait aussi soutenu, alors qu’elle était sous-gouverneure de la Banque de France, deux amendements au Parlement européen, qui étaient en réalité des quasi copiés-collés de l’argumentaire de la Deutsche Kreditwirtschaft représentant les intérêts du secteur bancaire allemand. »
Mi-novembre Muriel Pénicaud, ministre du Travail, avait accepté d’entrer, au conseil d’administration du Forum de Davos. Elle y aurait côtoyé le président du désormais fameux gestionnaire d’actifs américain Black Rock. La Haute Autorité lui a demandé de démissionner…
Le livre de Vincent Jauvert me semble donc venir à point. Lui qui écrit :
« Fascinées par le train de vie toujours plus flamboyant des PDG du Cac 40, encouragées par l’exemple des gouvernants d’aujourd’hui qui ont fait fortune dans le privé, nos élites politico-administratives se sont engagées dans une course effrénée à l’argent »
L’Obs, le journal de l’auteur, a consacré dans son numéro du 16 janvier 2020, plusieurs articles à ce livre
- <La course effrénée à l’argent des élites de la république>
- <Salaires démesurés cumul de fonctions lobbying ces voraces qui nous gouvernent>
- <Jean-Marc Sauve : il y a des déontologues partout sauf au gouvernement>
- <Lobbies pantouflage rémunérations sous macron la république est loin d’avoir été moralisée>
- <Pour ANTICOR il y a une porosité dangereuse entre les élites politiques et économiques>
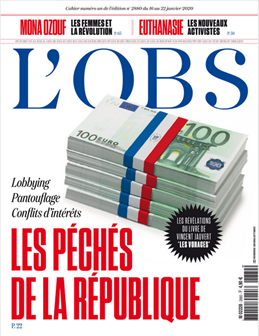 J’en tire quelques extraits.
J’en tire quelques extraits.
Vincent Jauvert synthétise les différentes dérives selon lui :
- Des maires de grandes villes qui, pour compenser la perte financière due à la fin du cumul des mandats, prennent des emplois à temps plein loin de leur commune ;
- Des grands commis de l’État qui se font embaucher à prix d’or par des entreprises qu’ils ont eu à surveiller dans leurs fonctions antérieures ;
- Des hauts fonctionnaires qui, tout en restant dans leur corps d’origine, y ajoutent des indemnités d’élus, jusqu’à toucher des salaires de PDG ;
- D’anciens ministres, et parmi les importants, qui rentabilisent leurs carnets d’adresses aussitôt quitté le gouvernement en devenant lobbyistes, avocats d’affaires ou consultants.
Prenons des exemples.
Deux présidentiables, un de droite, l’autre de gauche.
A ma droite, le maire de Troyes, dans le costume de gendre idéal :
«François Baroin [est maire] de Troyes et président de la métropole, une agglomération de 170 000 habitants. Afin de conserver une visibilité nationale, […] continue de diriger, à Paris, la puissante Association des Maires de France. Depuis octobre 2019, il est aussi membre du comité stratégique de LR, présidé par son ami Christian Jacob. De quoi l’occuper à temps plein.
Ses indemnités d’élu – 8 500 euros brut par mois, le maximum autorisé – représentent plusieurs smic. Mais là n’est pas l’essentiel de sa rémunération. Loin de là. Depuis plusieurs années, François Baroin est aussi avocat, toujours à Paris. Sa notoriété aidant, ses affaires se portent très bien. En 2015, il a touché 183 000 euros net de son activité juridique, 171 000 en 2016 et 125 000 l’année suivante. En 2018, il s’associe avec le célèbre avocat Francis Szpiner. L’ancien défenseur de Jacques Chirac et d’Alain Juppé lui offre un fixe de 7 500 euros net par mois plus une participation aux bénéfices. Mais ce n’est pas tout.
La même année, en mars, l’ancien ministre de la République est recruté par la banque d’affaires britannique Barclays. Officiellement, il sera « conseiller extérieur ». […] En clair, il sera le « VRP de luxe » de la banque […]. On ne connaît pas ses émoluments. Ils sont probablement élevés. […]
En décembre 2017, François Baroin entre au conseil d’administration de la compagnie belge Sea-Invest Corporation, l’un des principaux opérateurs de terminaux portuaires au monde. Il devient administrateur de trois de ses filiales, Sea-Tank International, Sea-Invest Africa et Sea-Invest France. Au total, pour le seul mois de décembre 2017, il percevra de ces trois sociétés 13 500 euros net de jetons de présence.
A Troyes, cet énième boulot du maire exaspère. On dit qu’il ne vient pas souvent dans l’Aube, qu’il laisse ses adjoints faire le boulot. Et même si le play-boy de la droite, à la fois qualifié de dilettante par les uns et de présidentiable par les autres, est charmant, là c’en est trop. Le quotidien de la ville, « l’Est Eclair », grogne. Sea-Invest a recruté le président de l’AMF, s’indigne-t-il, « pour cultiver ses relations avec les élus locaux […] des grands ports ». »
A ma gauche, l’ancien ministre de l’intérieur et premier ministre, dans le costume de l’homme éthique et incorruptible
« Bernard Cazeneuve […] a été recruté par l’un des plus grands cabinets d’avocats de la place, August & Debouzy, où il avait déjà travaillé au milieu des années 2000 comme associé pour son département contentieux. C’est une première historique, qui reflète parfaitement l’époque. Jamais, au cours de la Ve République, un Premier ministre n’avait rejoint aussi vite le privé. Dans son cas, immédiatement après avoir quitté ses fonctions.
Les négociations d’embauche entre le grand cabinet et le dernier Premier ministre de François Hollande ont même lieu avant que Bernard Cazeneuve ne quitte Matignon. La preuve : il a saisi la HATVP [Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique, NDLR] le 2 mai 2017, soit treize jours avant sa démission… Cette antériorité n’a cependant pas empêché l’autorité de déontologie de lui donner son quitus, à plusieurs réserves près, qui limitent grandement le champ d’action de l’intéressé – des réserves que celui-ci devra respecter jusqu’au 15 mai 2020, c’est-à-dire trois ans après son départ de Matignon. Pendant cette période, « M. Cazeneuve, écrit la HATVP, ne pourra réaliser des prestations, de quelque nature que ce soit, pour l’ensemble des administrations d’Etat sur lesquelles il avait autorité en tant que Premier ministre ». Autrement dit, quasiment toutes. De même, il « devra s’abstenir de toute démarche, pour le compte des clients du cabinet August & Debouzy, auprès des autres ministres avec lesquels il a siégé au gouvernement […] et auprès des administrations qui étaient placées sous son autorité ». Enfin, il « ne devra pas se prévaloir, dans le cadre de son activité, de sa qualité d’ancien ministre de l’Intérieur ou de Premier ministre ».[…]
Une question m’intriguait. Juste avant de quitter Matignon, Bernard Cazeneuve a cosigné un décret d’application de la loi Sapin 2 sur les lobbys, qui concerne notamment les avocats d’affaires. Or ce texte, très controversé, est beaucoup moins rigoureux que les députés socialistes ne l’espéraient. Même la HATVP, d’ordinaire très discrète, s’en est publiquement plainte dans son rapport annuel 2017. […]
Le décret en question stipule que les représentants d’intérêts doivent désormais s’inscrire dans un registre tenu par la HATVP et déclarer chacune de leurs actions auprès des ministères et des parlementaires. Mais il précise qu’ils ne sont tenus de ne le faire que l’année suivant l’action de lobbying, et surtout sans avoir à nommer les personnes visitées. Autrement dit, ce texte ne permet pas un contrôle effectif de l’activité si sensible et si lucrative. En outre, un cabinet ne doit s’enregistrer comme représentant d’intérêts que si l’activité de lobbying représente plus de la moitié de son temps de travail. Autrement dit, exit donc beaucoup de banquiers et d’avocats d’affaires qui font du lobbying mais seulement à temps partiel…
Ainsi émasculé, le décret a été signé par le Premier ministre Cazeneuve le 9 mai 2017, soit une semaine après qu’il a demandé l’autorisation de pantoufler chez August & Debouzy. Or l’un des deux créateurs du cabinet, Gilles August, apparaît dans les statuts de l’association des avocats lobbyistes comme l’un des fondateurs du groupement. Et sur sa page LinkedIn telle que je l’ai consultée le 18 novembre 2019, il est noté que « August & Debouzy offre aux entreprises des compétences de pointe tant en droit des affaires qu’en droit public et en matière de lobbying ». […]
[Interrogé], le porte-parole d’August & Debouzy assure que le cabinet « n’exerce aucune activité de lobbying ». Il ajoute : « Nous sommes sortis de l’association des Avocats lobbyistes bien avant l’arrivée de Bernard Cazeneuve. » Lorsque je lui indique le contenu de la page LinkedIn de son fondateur, Gilles August, le même porte-parole me répond : « Il est possible que nous ayons omis de supprimer la mention lobbying dans nos communications […]. Je vous remercie d’avoir attiré mon attention sur la bio LinkedIn de Gilles August, qui n’est pas à jour. » »
Elise Van Beneden d’Anticor répond à la question de savoir si Cazeneuve était en situation de conflit d’intérêts ?
« Cela me paraît évident. D’autant que ce décret limite énormément la portée de la réforme. La loi oblige les représentants d’intérêts à s’inscrire sur un registre tenu par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique (HATVP) et à déclarer les actions qu’ils ont menées et les catégories de responsables publics qu’ils ont rencontrées. Mais on ne connaît pas les noms des personnes présentes lors des rendez-vous. La loi dit aussi que seules les personnes qui consacrent plus de 50 % de leur temps au lobbying doivent s’inscrire sur le registre. Mais si vous travaillez dans un cabinet de 30 personnes, il est très facile de répartir la tâche pour que tout le monde reste au-dessous des 50 %.
Maintenant, dire que Bernard Cazeneuve a pu se trouver en situation de conflit d’intérêts ne veut pas dire qu’il y a eu pacte de corruption. Ce qui serait le cas si son embauche avait été la contrepartie de la signature du décret. Ce ne sont pas les mêmes reproches. La corruption est un acte très difficile à démontrer. La prise illégale d’intérêts, elle, est très formelle. Elle interdit de prendre une décision si vous, vos enfants, votre femme ou votre mari, ou même un ami, avez pu y trouver un intérêt personnel, dans un délai de trois avant et après la prise de décision. »
En matière de prévention des conflits d’intérêts, la France a été l’un des derniers pays occidentaux à se doter d’un arsenal législatif et pénal. Depuis l’éclatement de l’affaire Woerth-Bettencourt, en 2010, quatre lois ont été votées.
Et puis il y a le pantouflage ! <Wikipedia> nous explique qu’à l’origine, le mot « pantoufle » désignait, dans l’argot de l’École polytechnique, le renoncement à toute carrière de l’État à la fin des études. La « pantoufle » s’opposait théoriquement
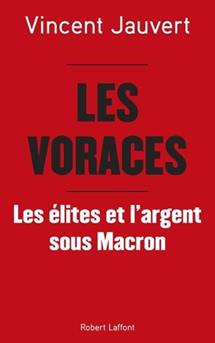 à la « botte ». Ceux qui « entraient dans la pantoufle », les « pantouflards », avaient le titre d’« ancien élève de l’École polytechnique » et renonçaient à celui de « diplômé de l’École polytechnique ». Plus tard, le terme a également désigné le montant à rembourser en cas de non-respect de l’engagement décennal (comparable au dédit-formation des entreprises privées).
à la « botte ». Ceux qui « entraient dans la pantoufle », les « pantouflards », avaient le titre d’« ancien élève de l’École polytechnique » et renonçaient à celui de « diplômé de l’École polytechnique ». Plus tard, le terme a également désigné le montant à rembourser en cas de non-respect de l’engagement décennal (comparable au dédit-formation des entreprises privées).
Le terme « pantouflage » s’applique aussi aux personnalités politiques qui, à la suite d’un échec électoral ou à la perte d’un portefeuille ministériel, occupent un poste grassement rémunéré dans une entreprise privée, avec des responsabilités limitées, s’arrêtant, en général à du lobbying, en attendant l’occasion de revenir sur la scène politique.
On parle aussi de rétro-pantouflage, dans le cas de hauts fonctionnaires ayant participé à des cabinets ministériels, pour ensuite « pantoufler » dans le privé avant de revenir servir l’État dont ils pourraient éventuellement espérer, en échange de ce retour, qui peut être pour eux un « sacrifice » financier, un poste important.
Le journaliste insiste sur le fait que cette porosité grandissante entre le public et le privé nécessiterait de resserrer l’encadrement des activités de lobbying, ce qui n’est pas le cas.
Les rémunérations des hauts fonctionnaires restent largement secrètes
« S’il faut une preuve de la puissance des hauts fonctionnaires, de leur capacité à faire obstacle à la volonté populaire, la voici : chaque fois que le Parlement a tenté de lever le secret sur leurs rémunérations, ils se sont débrouillés pour faire échouer le projet. […] Mission accomplie : le secret des rémunérations de la haute fonction publique reste bien gardé. […] »
Elise Van Beneden, d’Anticor a lu le livre de Vincent Jauvert et conclut :
« On constate une perte de sens du service public et une porosité dangereuse entre les élites politiques et économiques. Cette porosité est-elle plus importante qu’avant ? En tout cas, elle est plus visible. On entend certains dire que le service public n’est pas assez attractif. Mais des rémunérations jusqu’à 8 000 euros par mois devraient normalement mettre les gens à l’abri de la corruption. C’est peut-être la financiarisation de la société, et les gros revenus qui vont avec, qui créent ce sentiment d’un décalage de rémunérations entre le public et le privé. Mais si on veut gagner de l’argent, ce n’est pas vers la politique qu’il faut aller. On constate aussi que le lobbying s’est intensifié. Aujourd’hui, on voit des banques d’affaires et des cabinets de conseil démarcher directement des fonctionnaires dans les ministères pour leur proposer des opérations. »
<1343>
- <La course effrénée à l’argent des élites de la république>
-
Mardi 4 février 2020
« TikTok »Réseau social, nouvelle application préférée des adolescentsLorsque j’ai évoqué, hier, la vidéo qui serait à l’origine de la popularisation de l’expression « ok boomer », j’ai omis de dire que cette vidéo avait été publiée sur le réseau social « TikTok ».
La première fois que j’ai entendu parler de ce réseau social, c’était dans l’émission « Esprit Public » du <12/01/2020>. Je vivais donc jusqu’au début de cette année sans connaître cette application qui semble être très prisée par les adolescents.
Cette émission abordait le sujet des tensions entre les Etats-Unis et l’Iran suite à l’assassinat de Ghassem Soleimani par les Etats-Unis.
Emilie Aubry a introduit ce sujet ainsi :
« Si vous avez des ados connectés chez vous peut-être avez-vous comme moi vécu ce moment où l’enfant inquiet a surgi dans le salon pour vous demander : est-ce que c’est vrai ce qu’on dit sur les réseaux sociaux ? C’est le début de la 3ème guerre mondiale ? Aux sources de l’angoisse : depuis l’assassinat du général iranien Ghassem Soleimani par les Etats-Unis. Sur TikTok, la nouvelle appli préférée des ados, le #ww3 (World War 3) cumule plus de 1 milliard de vues. »
Le boomer que je suis était resté à
- « Facebook » avec ses 2,2 milliards d’utilisateurs actifs,
- « Twitter » la plateforme de microblogging, qui permet d’envoyer à des millions de personnes des tweets de 280 caractères maximum pouvant être illustrés de photos, de vidéos, de liens et inventeur des #hashtags. Twitter revendique 326 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, dont Donald Trump mais aussi Barack Obama, Emmanuel Macron et même Edgar Morin.
- « YouTube », propriété de Google, numéro 1 dans le partage et le visionnage de vidéos ainsi que « Dailymotion », le concurrent de YouTube et « Viméo » réseau plus confidentiel de partage de vidéos.
Je connaissais aussi l’existence des réseaux sociaux professionnels « Linkedin » le réseau social professionnel créé en 2002 en Californie et qui revendique plusieurs centaines de millions de membres et son petit frère français « Viadeo » créé en 2004 à Paris et qui revendique 7,5 millions de membres en France.
Enfin certains noms ne m’étaient pas inconnus : « Instagram », « Pinterest », « Snapchat » « Periscope » et «WhatsApp » que j’utilise depuis qu’Annie était allée à New York rendre visite à Alexis et Marie.
Mais TikTok je n’en ai jamais entendu parler avant ce dimanche 12 janvier dernier.
Dans l’émission, j’ai compris que TikTok était une application chinoise et qu’elle était encore plus problématique que les autres. Il me paraissait donc intéressant d’en savoir un peu plus.
 Le premier réflexe est de consulter <Wikipedia> :
Le premier réflexe est de consulter <Wikipedia> :
« TikTok, aussi appelé Douyin, est une application mobile de partage de vidéo et de réseautage social lancée en septembre 2016. Elle est développée par l’entreprise chinoise ByteDance. Son logo évoque une note musicale. »
Lancée par Zhang Yiming en septembre 2016, l’application s’est très vite développée. TikTok est le principal service de ce type en Asie, et l’application est considérée comme celle ayant la plus forte croissance tous pays confondus. Elle est l’application de partage de clips qui rassemble la plus grande communauté. En juin 2018, TikTok atteint les 500 millions d’utilisateurs actifs mensuellement. Au cours du premier trimestre de l’année 2018, elle est la première application mobile en nombre de téléchargements (45,8 millions selon des estimations). »
Zhang Yiming qui est un ingénieur chinois, avant TikTok, avait donc créé en 2012 <ByteDance> qui est spécialisée en intelligence artificielle et basée à Pékin. Son objectif est la conception d’une « Super Intelligence » qui dépasserait les travaux occidentaux en matière d’Intelligence Artificielle. En août 2018, Bytedance opère une levée de fonds de près de 3 milliards de dollars ce qui en fait la startup la plus valorisée au monde, à 75 milliards, devant Uber.
Si vous voulez en savoir plus vous pouvez lire cet article : <Bytedance le géant derrière tiktok>
Fin 2019, l’application compte désormais plus d’un milliard d’utilisateurs et connait un succès chez les adolescents aussi bien à l’Ouest qu’à l’Est
Cette page, graphique à l’appui affirme que « TikTok est la nouvelle appli préférée des ados »
<Cet article du Monde> que j’ai survolé semble expliquer assez précisément ce que l’on peut faire sur TikTok.
Pour ma part ce qui m’interpelle c’est qu’en février 2019, Tik Tok a été condamné aux États-Unis à une amende record de 5,7 millions de dollars par la Federal Trade Commission. La plateforme avait été reconnue coupable d’avoir illégalement collectée les données d’enfants de moins de 13 ans.
La même année, l’United States Navy de l’armée américaine ordonne à ses soldats de désinstaller l’application chinoise des smartphones militaires pour des raisons de cybersécurité.
<Ce site> nous apprend que le Royaume Uni a également engagé une enquête sur les agissements de TikTok et s’inquiète notamment de la faible protection des données qui pourrait faciliter les agissements de prédateurs sexuels. Dans Wikipedia il est question de reproche d’encourager le narcissisme et l’hypersexualisation de ses utilisateurs, souvent très jeunes.
Le journal l’Opinion a ainsi publié un article dont le titre est révélateur : « TikTok, l’appli dont les jeunes raffolent…et les pédophiles aussi »
Résumons, un entrepreneur chinois féru d’intelligence artificielle met à la disposition des adolescents chinois et du monde entier une application « sympa » de partage dans laquelle ces jeunes vont pouvoir s’identifier, s’exprimer, créer, révéler ce qu’ils aiment, dévoiler un peu leurs idées et aussi leurs angoisses comme par exemple la crainte d’une 3ème guerre mondiale. Cette application permet à des prédateurs sexuels de trouver un nouvel espace de chasse. Parallèlement ; l’intelligence artificielle chinoise peut collecter et analyser des milliards de données offertes gratuitement par les adolescents du monde entier et notamment occidentaux.
Il me semblait utile de citer « TikTok » dans les mots qui font l’actualité.
<1342>
- « Facebook » avec ses 2,2 milliards d’utilisateurs actifs,
-
Lundi 3 février 2020
« OK boomer »Interjection visant à faire taire un senior en train d’exprimer son opinionCette fois nous sommes en présence d’une expression très récente et qui grâce aux réseaux sociaux et à l’internet s’est répandue dans le monde comme une trainée de poudre.
Pour qu’elle puisse être lancée il faut imaginer au moins deux personnes. S’il y a du public en plus, c’est mieux.
Il faut une personne de mon âge, plus précisément né après 1945 et guère au-delà de 1960. Ces personnes qu’on appelle « baby boomer », parce que né en Occident pendant la période du baby boom.
En face, il faut une autre personne qui est née nettement après cette période.
La scène commence soit parce que « le vieux » exprime des idées qu’il pense tirer de son expérience, soit parce que le « jeune » exprime des idées et que le « vieux » réplique avec des arguments qu’il croit justifiés par son corpus intellectuel.
Et la réplique du jeune fuse :
« Ok boomer !».
Dans l’esprit du jeune, cette réplique doit avoir pour effet de clore la discussion à peine entamée.
Voici Chloé Swarbrick, députée néo-zélandaise de 25 ans interrompue par un de ses collègues, plus âgés, pendant qu’elle s’exprimait au Parlement néo-zélandais. Elle lance l’expression cinglante et continue son discours comme s’il ne s’était rien passé.
Sur une page de <Libération> qui s’interroge pour savoir si cette expression vient de l’extrême droite américaine et y répond par la négative, on apprend que The Guardian avait donné la parole à la jeune députée néo-zélandaise qui avait utilisé la formule avec beaucoup de succès médiatique :
«Ma remarque « OK boomer » au Parlement était spontanée, bien que symbolique de l’épuisement collectif de plusieurs générations qui allaient hériter de problèmes qui s’amplifient de plus en plus dans une période de temps de plus en plus courte. Il s’agissait d’une réponse – comme il va de soi – à un déluge de chahut dans une Assemblée parlementaire qui, à l’heure actuelle, détourne beaucoup trop de gens ordinaires de la politique.»
On parle d’un « mème ». Wikipedia explique qu’il s’agit d’« un élément de langage reconnaissable et transmis par répétition d’un individu à d’autres ». Le terme anglais mème a été proposé pour la première fois par Richard Dawkins dans Le Gène égoïste (1976) et provient d’une association entre gène et mimesis (du grec « imitation »). Dawkins construit également ce terme pour sa ressemblance avec le mot français « même » (bien que ce dernier ait une étymologie différente).
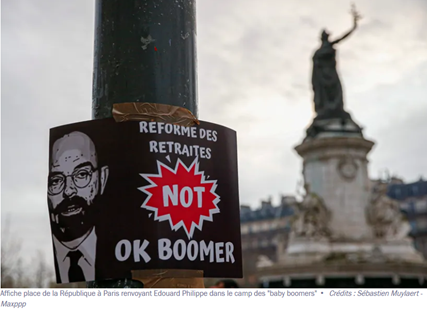 Le journaliste de Libération <Luc Le Vaillant > traduit l’expression de manière assez triviale : «ta gueule, vieux con !».
Le journaliste de Libération <Luc Le Vaillant > traduit l’expression de manière assez triviale : «ta gueule, vieux con !».
Dans ce <Billet politique du 20/12/2019> Stéphane Robert est un peu plus diplomate :
« Il s’agit d’un « mème » pour reprendre un anglicisme, autrement dit d’une idée, d’un concept, qui se diffuse de façon virale sur les réseaux sociaux, sur internet. Et qui est une manière polie qu’a trouvé la jeunesse de dire aux personnes d’un certain âge qui leur font la leçon (en l’occurrence à la génération vieillissante des « baby boomers ») qu’elles feraient mieux de se taire.
Autrement dit, c’est une insulte qui renvoie les vieux à ce qu’ils sont, des vieux, mais c’est une insulte qui reste polie. ok boomer ! : « vas-y, cause, tu peux causer, de toute façon, ce que tu dis, c’est des « trucs » de vieux, ça ne m’intéresse pas ».
[…] »Cause papy. De toute façon, tu es vieux, tu vas bientôt mourir (ou quelque chose dans ce goût-là)… »[…]
Elle témoigne d’une rupture générationnelle, écrivait il y a quelques mois le New York Times.
Plus encore peut-être, elle marque une fracture et un basculement entre le monde d’hier où l’on imaginait que l’humanité se dirigeait de façon continue et inéluctable vers le progrès et le bien-être, et le monde qui vient où les jeunes générations ont la certitude qu’elles vivront demain moins bien qu’hier. »
Brice Couturier dans sa chronique le Tour du mondes idées du 2 décembre 2019 : < « OK, Boomer » : les 55/75 ans, à leur tour victime d’une révolte générationnelle> donne l’origine de ce mème :
« Selon des sources qui paraissent mieux informées, comme Cosmo Landesman, dans The Spectator britannique, tout a commencé lorsqu’un homme d’âge mûr a fait circuler sur un réseau social, une vidéo dans laquelle il dénonçait la jeune génération. Cette classe d’âge, disait-il, refuse de grandir ; elle souffre du syndrome de Peter Pan. Aussitôt, un des jeunes en question a posté « OK, Boomer ! ». Et ce slogan est devenu viral. Il sert dorénavant [aux jeunes] à accuser celle qui est née entre 1945 et 1965 de lui léguer un héritage empoisonné. »
Et Brice Couturier continue à citer Cosmo Landesman
« L’antipathie éprouvée par [les jeunes] envers les baby-boomers, est basée sur toutes les raisons prévisibles : pour leur condescendance envers les jeunes, bien entendu, mais surtout pour avoir précipité le changement climatique, amassé des dettes publiques, augmenté le coût des études, poussé les cours de l’immobilier à la hausse… et élu Donald Trump. » Mais ce que les jeunes reprochent surtout aux 55 ans-75 ans, c’est de s’accrocher au pouvoir, alors que tourne l’horloge biologique. »
Il cite aussi des baby-boomers qui donnent du grain à moudre au développement de « ok boomer »
« C’est bien fait pour nous, écrit Andrew Ferguson, lui-même enfant du baby-boom, puisqu’il est de la cuvée 1956. Oui, car c’est nous qui avons lancé l’antagonisme inter-générationnel, en attaquant nos parents. Ils appartenaient, eux, à la génération qu’aux Etats-Unis, on qualifie à présent de « Génération du silence », parce qu’ils ne se plaignaient pas, malgré les épreuves. Ils auraient eu pourtant bien des raisons de se moquer des illusions des baby-boomers.
Et Ferguson d’en citer trois, assez cruelles en effet : le Viet-Cong est un mouvement réformiste agrarien, les capotes ne valent pas l’ennui de les mettre, Yoko Ono est une artiste…
Cosmo Landesman, de son côté, se moque des baby-boomers qui, après s’être bien amusés durant leur jeunesse, s’auto-flagellent à présent, pour tenter d’obtenir l’approbation des jeunes. Et il cite le livre de l’ancien Secrétaire d’Etat aux Universités du gouvernement Cameron, David Willetts. Celui-ci a en effet publié un livre intitulé « The Pinch », sous-titre : « comment les baby-boomers ont volé l’avenir de leurs enfants ». Selon ce dernier, sa génération est largement bénéficiaire de l’Etat-providence. Elle en retirerait approximativement 118 % de ce qu’elle y aurait investi ; la différence étant acquittée par ses descendants. Les baby-boomers ont également acquis et tentent de conserver une position hégémonique sur le plan culturel. »
Thibaut Déléaz prédit dans <Le Point> : que « OK boomer » sera le refrain de 2020 et fait cette analyse :
« Pour certains, cette expression symboliserait un mépris des jeunes générations envers leurs aînés. La réalité est un peu plus compliquée. […]
« Personne ne connaît les causes du changement du climat mondial. Nous savons que notre Terre a connu des périodes de réchauffement et de refroidissement, et cela peut dépendre de processus dans l’Univers. » Tels ces propos tenus par le président russe Vladimir Poutine mi-décembre, voilà le genre de phrase qui peut valoir à sa génération de se faire rétorquer par les plus jeunes « OK boomer ». Traduction : « OK, t’es encore bloqué dans ton époque, t’as rien compris. » […]
Mais que cache cette expression ? La députée LREM Audrey Dufeu Schubert s’inquiète dans Le Parisien d’une formule qui donne « dans la censure de la parole des personnes âgées ». « Cela participe à l’âgisme, qui est, en effet, une forme de racisme, du moins une discrimination. » […]
La réalité est plus complexe que ça. Aux États-Unis, où est née l’expression, les milléniaux, « sont plus pauvres que les générations avant eux, et pourraient ne jamais les rattraper », explique le Wall Street Journal. Avec « OK boomer », les jeunes générations ne s’adressent pas aux personnes âgées dans leur ensemble, mais à leurs aînés nés après-guerre, qui ont connu l’âge d’or de la reprise économique, le plein-emploi ou ont pu utiliser et gaspiller les ressources de la planète sans compter, quand eux connaissent plus de chômage, des emplois précaires, ont traversé la crise de 2008 et se retrouvent à devoir gérer la crise écologique. […]
Le climat est d’ailleurs, de loin, la première raison d’être du mouvement « OK boomer » selon les étudiants interrogés par Student Pop. Viennent ensuite les salaires et aides, le gouvernement et le logement. « Il n’y a pas tant un conflit de valeurs qu’une demande des jeunes d’avoir les mêmes chances dans la vie que leurs aînés, analyse sur France info le sociologue Camille Peugny. C’est surtout une génération qui peine à se faire entendre par la classe politique, alors qu’elle est l’avenir. »
Sur le site « Mr Mondialisation » vous pourrez lire un article conséquent publié en décembre 2019 : <« Ok Boomer » : un terme plus profond que vous imaginez…>
Bien que je sois un « baby boomer » je dois concéder que je comprends l’agacement des jeunes générations sur ces différents points.
Le monde rêvé des baby boomers est d’ailleurs en train de se heurter à l’évolution des mentalités. Ainsi, un article du 17 décembre 2019 signale qu’aux Etats-Unis, « les grandes maisons des baby-boomers ne trouvent plus preneurs. » :
« Si les baby-boomers sont friands de grandes maisons, avec plusieurs chambres et d’un style un peu ancien, c’est loin d’être le cas des millennials. Ce qui crée un vrai problème sur le marché immobilier.
(D’un côté, il y a la génération des baby-boomers, qui ont eu plusieurs enfants et rêvaient d’un pavillon au soleil. De l’autre, il y a la génération Y ou celle des millennials, qui ont moins d’enfants et privilégient davantage les centres-villes des grandes villes. Deux visions de la vie bien différentes et qui ont du mal à s’accorder. Ce qui a une conséquence directe sur le marché immobilier américain, relève Business Insider, citant notamment des informations du Wall Street Journal diffusées plus tôt cette année.
En effet, les millennials n’achètent pas les maisons des baby-boomers. Ces dernières sont grandes, possèdent plusieurs chambres, et beaucoup d’entre elles sont situées dans les États de la Sunbelt (comme l’Arizona, la Floride ou la Caroline du Nord ou du Sud. Les millennials veulent des maisons plus petites, plus modernes, d’un style épuré. Ils désirent des conceptions minimalistes, loin des styles méditerranéens ou toscans chers aux baby-boomers. Ils choisissent des maisons où ils n’auront pas de travaux d’entretien à entreprendre. Et ils privilégient les villes où ils peuvent tout faire à pied plutôt que les villas en périphérie où la voiture est indispensable pour faire les courses.
[…] Résultat, les maisons construites avant 2012 se vendent avec des décotes importantes. Parfois près de 50%. Il arrive même que des propriétaires finissent par vendre moins cher que ce qu’ils avaient déboursé pour construire leur maison. Il y a tout simplement trop de maisons trop grandes, avec 5 ou 6 chambres, notamment dans les régions ensoleillées. Et cela ne devrait pas s’arranger. Les ménages du baby-boom possèdent actuellement près de 32 millions de maisons et représentent près des deux cinquièmes des propriétaires aux Etats-Unis, selon un rapport publié en 2018 par Fannie mae, l’un des principaux organismes de refinancement hypothécaires du pays. Or, le vieillissement des baby-boomers devrait entraîner un surplus de biens à vendre sur le marché au cours de la prochaine décennie, au moment où certains d’entre eux vont revendre leur bien pour aller en maison de retraite ou payer leurs frais de santé. »
On voit donc que la fin de vie des baby boomers risque d’être compliquée aussi…aux Etats-Unis.
<1341>
-
Vendredi 31 janvier 2020
« Le consentement »Vanessa SpringoraLe consentement !
J’entends les protestations : « Alain ce mot n’est pas nouveau ! »
Ce n’est pas faux !
Le « consentement » est le substantif issu du verbe « consentir » qui lui-même vient du latin consentire « être d’accord avec ».
Le <dictionnaire> du CNRS fait remonter à la deuxième moitié du XIIème siècle l’introduction du mot « consentement » dans la langue française. Il est donc vrai qu’il ne date pas d’hier.
Il présente cependant une brûlante actualité. Actualité liée au livre écrit par Vanessa Springora : « Le consentement » et paru début janvier 2020.
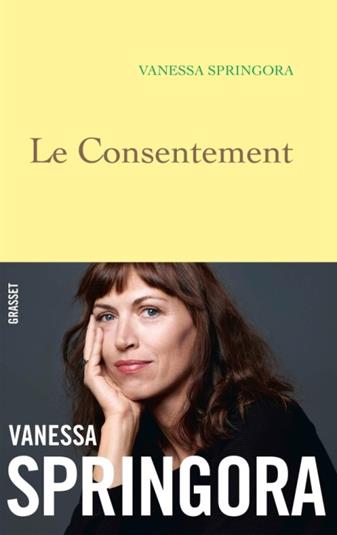 Mais selon moi, plus largement, c’est la pleine conscience de la signification de ce mot dans le domaine des relations sexuelles qui donne son actualité à ce mot et justifie que je l’utilise en exergue.
Mais selon moi, plus largement, c’est la pleine conscience de la signification de ce mot dans le domaine des relations sexuelles qui donne son actualité à ce mot et justifie que je l’utilise en exergue.
Le mouvement « #metoo » « moi aussi » a pris son envol, en octobre 2017, après la dénonciation par des actrices du comportement prédateur sexuel du puissant producteur de cinéma américain Harvey Weinstein. C’est l’actrice américaine Alyssa Milano qui a proposé de partager les témoignages de violences sexuelles et de la violence contre les femmes dans différents milieux, sous le hashtag « #MeToo ». Il semble que ce « mot de ralliement » autour des violences sexuelles à l’encontre des femmes existait depuis 2007.
La grande historienne de l’Histoire des Femmes, Michelle Perrot qui vient de publier un ouvrage de 1000 pages que j’ai offert à Annie : « Le chemin des femmes » dit :
« #MeToo, puisque c’est à cela que vous faites allusion, je pense que c’est un événement. Une révolution, je n’irai pas jusque-là, parce les révolutions ne se font pas comme ça : les rapports entre hommes et femmes sont issus de si vieilles structures que l’on ne les bouleverse pas si facilement. Mais c’est un événement. Dans « Me Too » les deux mots sont très importants. « Me », moi. Chacune des femmes concernées se dit : ça m’est arrivé à moi. « Too », aussi. Les autres aussi. Je ne suis pas seule, ce qui m’est arrivé n’est pas une histoire sur laquelle je ne dois rien dire parce que c’est honteux et que je suis seule. Non, c’est arrivé à beaucoup d’autres que moi.
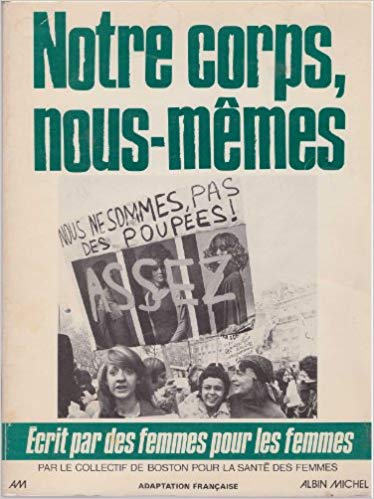
#MeToo, c’est une histoire du corps des femmes. Le corps des femmes est au cœur du mouvement de libération depuis les années 1970. Une des devises de ce mouvement était : « notre corps, nous-mêmes.» C’était le droit à l’avortement et à la contraception, qui avait été acquise par la loi de 1967. »
Vous lirez cela dans une interview sur le site de Mediapart : « Le silence sur les femmes m’est apparu incroyable : plongées dans l’obscurité »
Ce mouvement « #MeToo » s’est développé à l’échelle internationale et a libéré la parole des femmes.
Témoignage après témoignage, livre après livre nous découvrons l’ampleur de ce désastre, de cette prédation dans tous les milieux, dans tous les domaines dans lesquels des hommes par leur pouvoir, par l’argent, par le charisme, par leur emprise de type « gourou » de réalisateur, d’entraîneur, de chef d’orchestre, de star médiatique ont pris l’habitude d’abuser des femmes, parfois des hommes, souvent des enfants, en écartant l’impérieuse nécessité du consentement.
Le consentement est constitué par un accord donné de manière libre et dans lequel on s’engage entièrement à accepter ou à accomplir quelque chose.
En matière de santé on parle de « consentement libre et éclairé ».
Le consentement doit être libre, c’est-à-dire en l’absence de contrainte, et éclairé, c’est-à-dire précédé par une information.
L’importance du consentement est à la base de notre société libérale fondée sur le contrat.
Yuval Noah Harari dans son livre «Sapiens », pages 372 à 375, a raconté le parcours inverse, au début du XVIIème siècle, du déclin de la puissance tyrannique de l’Espagne et de la montée en puissance des Pays bas qui après s’être libérés de l’hégémonie de l’Espagne ont développé une société libérale basée sur la confiance, le contrat et le consentement. J’ai essayé de résumer ce récit historique par le mot du jour 2 juin 2016
Pour qu’un contrat soit valable il faut établir le consentement de chaque partie au contrat. Et l’autorité judiciaire indépendante est gardienne et juge des litiges sur les contrats et sur l’échange des consentements.
Le code civil français, qui consacre à ces questions, les articles 1128 à 1144, ne définit pas positivement le consentement lui-même.
Mais l’Article 1130 du Code Civil décrit le consentement en creux en donnant les cas dans lesquels le consentement est écarté. :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
La violence ou l’erreur, c’est-à-dire la méprise ou le malentendu sur l’acte ou la chose auquel on donne son consentement est simple à comprendre.
Le dol est un plus compliqué. Il correspond aussi à une erreur d’un des cocontractants, mais cette erreur a été provoquée par une manœuvre d’un autre cocontractant dans le but de tromper ou d’abuser son partenaire
L’Article 1128 précise qu’il y a deux autres conditions à la validité d’un contrat :
- La capacité de contracter ;
- Un contenu licite et certain.
La capacité est une question difficile en matière sexuelle, elle conduit au sujet de la majorité sexuelle.
Je m’étais indigné, en 2017, lors de deux mots du jour traitants d’affaires différentes : « Un enfant de 11 ans peut consentir à une relation sexuelle avec un homme de 28 ans » et « Un homme de 22 ans a une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Elle tombe enceinte puis l’enfant qui naît est placé dans une famille d’accueil. Cet homme vient d’être acquitté par la cour d’assises de Seine-et-Marne ». Ces deux affaires correspondaient à des positions de la Justice française. Dans le premier cas un avis du parquet, dans le second un jugement de cour d’Assises.
Vanessa Springora, avait un peu plus que 11 ans. Elle était élevée par une mère divorcée et lisait beaucoup. À treize ans, dans un dîner, elle rencontre Gabriel Matzneff., un écrivain, un « fabriquant » de livres très introduit dans la société littéraire de Paris. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de cinquante ans aux faux airs de bonze, par ses œillades énamourées et l’attention qu’il lui porte. Plus tard, elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin « impérieux » de la revoir. Quand elle a quatorze ans, elle s’offre à lui corps et âme.
L’histoire est très bien racontée par Claude Askolovitch lors de sa revue de presse de la veille de Noël :
« Le Consentement, aux éditions Grasset, […] amorce ce qu’on appellera tristement un scandale, quand il n’est que bouleversant. C’est le livre d’une femme « très belle, à la voix douce » de langue classique lumineuse et juste, qui a le mot vrai et qui sait penser, dit Le Magazine Littéraire, dans un superbe portrait parce qu’il est digne d’elle… Vanessa Springora, patronne des éditions Julliard, qui connaît les hommes de lettres.
Et notamment un écrivain, aujourd’hui vieillard en désuétude, mais qui il y a vingt ans, trente ans, était un dandy « propre, massé, le crâne épilé, aimable » que Bernard Pivot invita cinq fois à Apostrophes. Gabriel Matzneff qui collectionnait les amants, les amantes de onze ans, de douze ans, de quatorze ans… Et parmi ses amantes, il y eut Vanessa, qu’il connut en 1985, quand elle avait treize ans, une proie aux yeux bleus qui lisait Eugénie Grandet et qui plaçait les écrivains sur un piédestal, et dont il s’empara, corps et âme, l’ayant rassurée de lait, de mots doux, de mousses au kiwi, et elle fut la chose de l’ogre…
« À 14 ans, à la sortie du collège, on n’est pas supposée vivre à l’hôtel avec un homme de 50 ans, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche à l’heure du goûter », écrit dans son livre Vanessa Springora. Je retrouve cette phrase dans Le Monde et dans L’Express qui racontent une folie dans un autre siècle. Quand Matzneff, sans rien cacher, était un homme adulé de complaisance ; ce Gabriel qui se faisait passer pour un chef scout afin d’échapper à un père dont il avait happé l’enfant, « un chaton de 12 ans, l’un des gosses les plus voluptueux que j’ai connus ». En 1990, une romancière québécoise, Denise Bombardier, avait osé dire son dégoût à Matzneff sur le plateau d’Apostrophes. Elle s’était retrouvée ostracisée au cocktail après l’émission, raconte-t-elle au journal Le Monde et puis insultée, dénigrée par la fine fleur de la critique littéraire. En 1977 quand Matzneff lançait une pétition pour soutenir des gens qui s’étaient amusés avec des mineurs de douze et treize ans, le texte était publié dans Le Monde et signé Aragon, Sartre, Beauvoir, Roland Barthes, Francis Ponge, André Glucksmann, Bernard Kouchner, Félix Guattari, Jack Lang… Imaginez.
L’hôtel où Matzneff se repaissait de Vanessa était payé par Yves Saint-Laurent, lis-je dans L’Express. Un jour, Vanessa y reçut un appel téléphonique de François Mitterrand, président de la République, qui venait prendre des nouvelles de son « cher Gabriel » hospitalisé…
Et c’est donc, au-delà de Vanessa Springora elle-même, une aberration collective et s’impose pour des hommes admirables un mépris. « Votre rôle est d’accompagner Gabriel sur le chemin de la création et de vous plier à ses caprices », ordonna Emil Cioran à Vanessa Springora… Dans Le Monde où les amis de Matzneff se désolent que les temps ont changé, Frédéric Beigbeder redoute que Gabriel se suicide, il en est d’autres qui pourraient, se relisant, mourir de honte, s’ils vivent encore ici-bas. »
J’ai découvert Vanessa Springora lors de son passage dans les matins de France Culture du 3 janvier 2020.
Elle dit de Matzneff
« Il était bien ce qu’on apprend à redouter dès l’enfance : un ogre ».
Et lors de l’émission :
« C’était important pour moi de faire rentrer dans le champ littéraire la voix d’une jeune fille qui avait été victime. C’est une voix qu’on n’entend jamais en littérature. C’est un pendant de Lolita de Nabokov. J’ai longtemps tourné autour du sujet avant de parvenir à l’écrire de cette manière, à la première personne. J’avais pensé raconter l’histoire de Lolita inversée, du point de vue de la jeune fille.
[ l’attribution du prix Renaudot à Gabriel Matzneff en 2013 ] fait partie des provocations qui pour moi, à titre personnel, étaient insupportables. Il y en a eu beaucoup d’autres. […]
En 2015, il a écrit à la personne avec qui je travaillais un nombre invraisemblable de mails pour essayer de rentrer en contact avec moi. Il m’a toujours écrit partout où il a pu, essayé d’avoir mon adresse, il a toujours essayé de maintenir son emprise. Il continue d’ailleurs de le faire aujourd’hui avec la réponse qu’il a donnée hier à L’Express. [Je ne mérite pas l’affreux portrait que (…) tu publies de moi. (…) Non, ce n’est pas moi, ce n’est pas ce que nous avons ensemble vécu, et tu le sais »].
[…] La véritable raison [du livre] c’est d’être devenue moi-même mère et d’avoir autour de moi des adolescents et de comprendre enfin ce qui avait été très difficile pour moi, ce qu’était cet âge très particulier, de grande vulnérabilité, de transition entre l’enfance et l’âge adulte. C’est un moment où on est une proie idéale pour ce type de structure psychique auquel on a affaire avec cet homme. La particularité chez lui, c’est d’être écrivain, et donc de redoubler son entreprise de prédation par une exploitation littéraire.
[…] Pour qu’une histoire de ce type puisse se produire, il faut un certain nombre d’éléments. Il y avait chez moi un manque paternel assez criant, une grande solitude, une mère très prise par son travail et qui m’élevait seule, notamment dans ce milieu littéraire. Il fallait aussi être très attirée par la littérature, d’avoir magnifié toute mon enfance la figure de l’écrivain. Il avait cet ascendant d’adulte et quelqu’un qui avait l’aura de l’artiste. Pour moi qui était très attirée par cet univers, j’avais déjà très envie d’écrire à l’époque, c’était une figure forcément fascinante. […]
Il y a eu quelques alertes. Une personne a écrit une série de lettres anonymes qui ont été envoyées à la brigade des mineurs mais qui sont restées sans suite. Ma mère avait employé le mot ‘pédophile’ à son égard dès la première fois, quand je lui ai annoncé qu’on s’était écrit, qu’il m’avait donné rendez-vous. Je ne l’ai pas prise au sérieux parce que j’étais une adolescente un peu rebelle et que ce mot me paraissait ne pas correspondre à ce que j’étais en train de vivre. J’étais dans cette période de l’adolescence où on a tendance à se croire déjà adulte. Je ne me reconnaissais pas dans ce statut d’enfant et le terme pédophile était associé à l’enfance. Ce serait faux de dire qu’il n’y a pas eu d’alerte, en revanche, il n’y a eu aucune tentative pour mettre fin à cette histoire. Ma mère est vraiment dans le regret de ne pas avoir été plus loin. Elle était dans un état d’esprit qui ressemblait à celui de la fin des années 1970, qui était ‘il est interdit d’interdire’. »
Cela pose, en effet, la question de la capacité d’une jeune adolescente de consentir à une telle relation.
Mais, au-delà de cette question de capacité, par rapport à ce que j’expliquais sur le consentement il y a eu dol dans cette histoire qui a conduit la jeune fille dans l’erreur. Elle raconte sa prise de conscience :
« Tout d’un coup je me suis rendue compte (en le lisant) que eux et moi, ces très jeunes enfants, dont il parle dans son journal, qu’il va payer à Manille pour avoir des relations avec eux, je me suis sentie tout à fait solidaire d’une certaine manière. J’ai compris la manipulation dans laquelle j’étais tombée. J’étais face à quelqu’un qui était un prédateur et pas un amoureux des enfants, mais un chasseur. Cela a été extrêmement violent parce que c’est le moment où j’ai commencé à lui demander des comptes. Il m’avait interdit de lire ses livres, j’ai fini par braver l’interdit et à partir de ce moment-là notre relation est devenue extrêmement violente. J’ai eu du mal à m’en dépêtrer. »
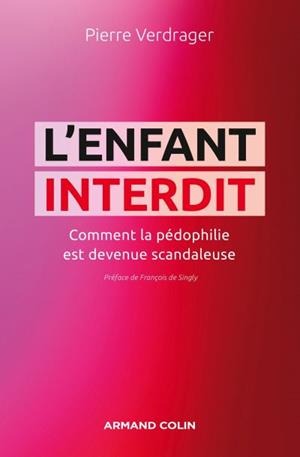 En seconde partie d’émission, Guillaume Erner a reçu le sociologue Pierre Verdrager, auteur notamment de « L’enfant interdit. Comment la pédophilie est devenue scandaleuse » aux éditions Armand Colin.
En seconde partie d’émission, Guillaume Erner a reçu le sociologue Pierre Verdrager, auteur notamment de « L’enfant interdit. Comment la pédophilie est devenue scandaleuse » aux éditions Armand Colin.
Celui-ci explique l’état d’esprit de cette époque après mai 1968. Il s’agissait de promouvoir la liberté sexuelle, il y avait le combat des homosexuels et on y associait sans trouver de problème moral à cela, les relations sexuelles avec des enfants.
Je vous renvoie vers cette page du site de France Culture <Quand des intellectuels français défendaient la pédophilie>. Vous y lirez des choses effarantes pour notre regard d’aujourd’hui. Il faut lire les noms de ceux qui (tous des hommes me semblent-ils !) qui défendaient la pédophilie comme le relate Claude Askolovitch.
Ainsi, le 4 avril 1978, l’émission « Dialogues » invite Michel Foucault, le romancier et membre fondateur du Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) Guy Hocquenghem et le juriste Jean Danet, tous trois signataires de la pétition qui demande la décriminalisation de la pédophilie. Durant une heure et quart, en public dans le studio 107, ces intellectuels vont défendre l’idée que des pédophiles sont incarcérés à tort parce que les enfants qu’ils ont abusés étaient consentants. Toujours le sujet du consentement
Il y eut une époque où de grands esprits considéraient que la défense de l’homosexualité et de la pédophilie constituaient un même combat !
Le livre de Vanessa Springora est un grand succès de librairie, mais les livres de Gabriel Matzneff ont aussi connu un rebond de ventes. Étrange société, dans laquelle on aime à aller voir dans la maison de l’ogre.
Vanessa Springora a aussi été invitée par Laure Adler dans <L’heure bleue> du 8 janvier 2020. Elle a tenu des propos qui m’ont beaucoup touché (à partir de 8:50):
« Ma mère me faisait la lecture des contes de fées. […] Je crois toujours au prince charmant puisque j’en ai rencontré un. Je crois que ça existe le prince charmant. Mais je crois que c’est une erreur quand on est petite fille d’y croire, il ne faut pas y croire, mais il faut le rencontrer sans l’attendre. [Moi] je l’ai cherché longtemps. J’ai eu beaucoup de chance de le trouver. »
J’ai été touché parce que malgré la souillure du début, l’exemple de Vanessa Springora prouve que le bonheur reste possible.
Ce jeudi matin, sur France Inter, j’ai entendu le témoignage de l’ancienne championne de patinage artistique Sarah Abitbol qui a été violée, dans le milieu sportif, par un de ses entraineurs. Elle aussi a trouvé une belle relation amoureuse et sexuelle, selon ce qu’elle a pu dire lors de son entretien. Son livre s’appelle «Un si long silence».
J’ai trouvé ce site canadien qui parle du <consentement sexuel>
<1340>
- La capacité de contracter ;
-
Jeudi 30 janvier 2020
« Flygskam »Honte de prendre l’avion« Flygskam » est un mot suédois qui fusionne « skam » (la honte) et « flyg » (voler). C’est donc la honte de voler ou de prendre l’avion à cause des conséquences environnementales de ce mode de transport.
C’est un mot qui est né en Suède mais a fait l’objet d’articles de journaux du monde entier en 2019. Il suffit de faire une recherche sur ce mot sur Internet pour en être convaincu. C’est typiquement un de ses « mots » qui a fait l’actualité.
Il est vrai que le magazine « GEO » affirme qu'<un trajet en avion est 1 500 fois plus polluant qu’un voyage équivalent en TGV> et explique :
« L’avion est aujourd’hui le moyen de transport le plus polluant, bien plus que les voitures individuelles et le train. […]
Par trajet, l’avion émet en moyenne 125 fois plus de dioxyde de carbone qu’une voiture individuelle, un chiffre qui monte à 1 500 pour les trains. En plus du CO2, l’avion répand également de l’ozone (O3), un gaz à effet de serre, et des cirrus (nuages de la haute atmosphère) qui ont un effet réchauffant. […]
Aucune solution technologique n’existe pour l’instant pour limiter la pollution des avions. Sa version électrique permettrait de parcourir que de petites distances. »
Actuellement le transport routier mondial génère plus de gaz à effet de serre que l’aviation, mais Wikipedia dans son article : <Impact climatique du transport aérien> précise que les tendances actuelles vont faire augmenter de manière très importante l’impact de l’aviation sur le réchauffement climatique :
« Les réacteurs d’avion contribuent de manière importante à l’effet de serre. Cela est dû principalement au CO2 produit par la combustion du kérosène, ainsi qu’aux traînées de condensation et aux nuages d’altitude qu’elles peuvent générer.
L’impact climatique du transport aérien, c’est à dire la contribution de l’aviation commerciale au réchauffement climatique, résulte principalement de la combustion de kérosène dans les réacteurs d’avion. Celle-ci est responsable de l’émission de dioxyde de carbone (CO2), un gaz à effet de serre qui s’accumule dans l’atmosphère et dont les émissions représentent de 3 à 4 % des émissions mondiales […]
Pour consolider les effets sur le climat de l’ensemble des émissions anthropiques, le GIEC utilise le forçage radiatif qui mesure les conséquences des activités passées et présentes sur la température globale. Il a estimé que le forçage radiatif dû à l’aviation représentait 4,9 % du forçage radiatif total de 1790 à 2005, environ trois fois plus que le seul impact du CO2. Avec la croissance rapide et continue du transport aérien (de 6 à 7 % par an depuis 2015) et l’incapacité du secteur à la compenser au même rythme par des améliorations techniques ou opérationnelles, son impact climatique ne cesse de croître. Selon des projections de la tendance actuelle, la part des émissions de CO2 de l’aviation pourrait monter à 22 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2050. »
 <Youmatter> qui est un média d’information en ligne rédigé en langue française et anglaise et dont l’objectif est d’analyser et de décrypter tous les grands phénomènes qui agitent nos sociétés, afin de fournir aux citoyens de meilleures clefs de compréhension et d’action dans un monde en transition, nuance un peu ce propos dans un article qui me semble techniquement très élaboré : <Contrairement aux idées reçues, l’avion ne pollue pas vraiment plus que la voiture.>
<Youmatter> qui est un média d’information en ligne rédigé en langue française et anglaise et dont l’objectif est d’analyser et de décrypter tous les grands phénomènes qui agitent nos sociétés, afin de fournir aux citoyens de meilleures clefs de compréhension et d’action dans un monde en transition, nuance un peu ce propos dans un article qui me semble techniquement très élaboré : <Contrairement aux idées reçues, l’avion ne pollue pas vraiment plus que la voiture.>
Mais cet article affirme cependant :
« Malgré tout, il ne faut pas considérer que prendre l’avion soit un acte anodin. L’avion reste un mode de transport polluant et problématique. Certes, globalement le transport aérien n’est pas extrêmement polluant (il représente moins de 4-5% des émissions de CO2 mondiales, alors que le transport routier représente 15% de ces émissions directes). Mais l’avion reste parmi les modes de transports les plus polluants avec la voiture. […] Le problème du transport aérien c’est sa généralisation et sa banalisation : voyager sur de longues distance par avion devrait rester exceptionnel. Sur le plan environnemental, la croissance du transport aérien n’est donc pas en soi souhaitable.
Le problème c’est que la croissance du secteur du transport aérien liée à la mondialisation, plutôt que de remplacer des modes de transport polluants pré-existant (comme la voiture), crée surtout de nouvelles opportunités de transport qui s’ajoutent aux pollutions actuelles. On découvre ainsi de nouvelles destinations, plus lointaines, ce qui nous incite à voyager plus et plus loin, et donc à polluer plus. Il faut garder à l’esprit qu’un vol Paris-New York en avion par exemple émet environ 1 tonne de CO2. Soit presque la totalité du « budget carbone » annuel auquel un français devrait se limiter s’il voulait vraiment lutter contre le changement climatique (1.22 tonnes par an et par habitant). Dans l’ensemble, réduire ses besoins en transport (en avion, mais aussi et surtout en voiture) est donc la meilleure manière de réduire son empreinte carbone. Conclusion : privilégiez le train ! »
Les suédois sont de très grands consommateurs de voyages aériens, et c’est donc chez eux que le Flygskam est né et a prospéré. En effet, <Wikipedia> nous apprend que ce sentiment [ de honte de prendre l’avion] est nommé pour la première fois en Suède en 2018 dans la foulée des grèves scolaires pour le climat initiées par Greta Thunberg.
Greta Thunberg, en janvier 2019 avait rejoint le Forum économique mondial (Davos en Suisse) en 32 heures de train, avant de dénoncer les 1 500 jets privés des dirigeants venus évoquer le réchauffement climatique.
Mais la jeune activiste n’est pas seule en Suède, deux autres Suédoises, Maja Rosen et Lotta Hammar, lancent une campagne de boycottage baptisée « We stay on the ground 2019 » (« Nous restons au sol en 2019 »), suivie par 15 000 de leurs compatriotes. En 2016, Magdalena Heuwieser lance un manifeste et un réseau international « Stay grounded » pour en « finir avec l’avion roi ».
Le <Figaro Economie> affirme que ce phénomène a touché la France :
« Afin de préserver l’environnement, certains Français renoncent totalement à prendre l’avion, quitte à abandonner leurs rêves de voyages à l’autre bout du monde. Ils privilégient des destinations plus proches, accessibles en train. À l’instar des Suédois, certains Français renoncent à prendre l’avion pour préserver l’environnement.»
C’est dans cet article qu’on peut lire que l’AEE (Agence européenne pour l’environnement) indique que les transports représentent plus d’un quart de la totalité des émissions de gaz à effet de serre en Europe: les transports routiers y contribuent à hauteur de 72%, l’aviation pour 13,3% et le transport maritime pour 13,6%. Le transport ferroviaire représente lui une part infime des émissions. Mais nous avons compris que le plus grave est que l’aviation présente un risque fort d’augmenter considérablement sa part de responsabilité.
<Courrier International> a également consacré un article au « flygskam » et on peut y lire notamment :
« Sur plus de 6 000 personnes sondées par UBS aux États-Unis, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, 21 % assurent avoir déjà décidé de réduire leurs voyages en avion au cours de l’année écoulée – soit une personne sur cinq. Si 16 % seulement des Britanniques interrogés ont déclaré avoir renoncé à certains déplacements aériens au cours des derniers mois, 24 % des voyageurs américains indiquent avoir déjà changé leurs habitudes. Dans ce même panel, une personne sur trois envisage de ne plus prendre l’avion dans les années à venir. »
Et il cite « The New York Times » qui indique que les deux tiers des vols au départ des États-Unis sont le fait de 12 % seulement des citoyens américains, qui effectuent plus de six voyages aller-retour en avion chaque année. Chacun de ces voyageurs émet en moyenne plus de trois tonnes de dioxyde de carbone par an, ce qui est considérable et largement supérieur, par ce seul canal, aux 1,22 tonnes qu’il faudrait atteindre. Le quotidien new yorkais affirme que certaines entreprises se demandent désormais si tous ces voyages sont vraiment nécessaires à l’ère du courrier électronique, de la messagerie collaborative et des téléconférences.
Dans « The Guardian », le journaliste John Vidal, lui-même grand voyageur par goût autant que par nécessité professionnelle, dresse une liste des nouvelles initiatives prises pour encourager divers publics à réduire les trajets aériens.
Aux États-Unis, le site Flying Less, qui s’adresse aux enseignants et aux chercheurs, a par exemple lancé une pétition pour appeler les universités à limiter le nombre des voyages professionnels en avion. Au Danemark, les journalistes du quotidien Politiken ont renoncé aux vols intérieurs et tentent de réduire au minimum indispensable le nombre de vols internationaux. La rubrique Voyage du journal met désormais en avant des destinations accessibles par d’autres moyens de transport – une démarche dont The Guardian entend lui-même s’inspirer. En Suède, une initiative intitulée Flygfritt (« Sans avion ») veut fédérer 100 000 personnes prêtes à s’engager à ne pas prendre l’avion en 2020.
Et c’est le quotidien économique <LES ECHOS> qui affirme que le « flygskam » plombe déjà le trafic aérien en Suède et que le train fait figure de grand gagnant :
« Les chiffres publiés pour l’ensemble des 38 aéroports du pays au premier trimestre 2019 par l’Agence suédoise des transports ont ensuite confirmé cette tendance : le nombre de passagers a diminué de près de 4,4 % sur un an, dont – 5,6 % sur les vols intérieurs. […] Faut-il y voir le point de départ d’un mouvement plus vaste sur le continent ? Pour le moment, les chiffres publiés par la plupart des aéroports des pays voisins témoignent toujours d’une hausse continue du trafic passagers, à l’image du reste du monde. Mais au vu de l’effervescence actuelle des mouvements pour le climat, à Londres comme à Paris , il n’est pas à exclure que la « honte de prendre l’avion » puisse s’étendre à d’autres pays aussi rapidement qu’en Suède. »
Et c’est le Figaro Economie qui pose la question : « Le trafic aérien mondial peut-il être menacé par le «flygskam»? »
« Ainsi, UBS inclut les considérations écologiques et estime que sur les quinze prochaines années, le nombre de vol dans l’Union européenne augmentera d’environ 1,5% par an en moyenne. Un chiffre deux fois plus faible que les prédictions d’Airbus, qui tablait récemment sur une hausse de 3%. Au premier semestre de l’année, le trafic aérien en Europe a d’ailleurs plus faiblement augmenté que l’année dernière, sur la même période, passant de 6,7% à 4,3%.
Aux États-Unis, la hausse de 2,1% prévue par Airbus a également été abaissée par UBS, à 1,3%. Sur le continent américain d’ailleurs, près d’un sondé sur quatre déclare d’ores et déjà avoir modifié ses habitudes.
Selon cette même étude, si une telle modification du paysage aérien, devait se produire, cela modifierait très nettement le marché. UBS estime que cela aboutirait pour Airbus à un manque à gagner colossal d’environ 2,8 milliards d’euros par an à terme. »
Pour cause, dans sa dernière étude de marché, Airbus estimait que pour répondre à l’importante demande mondiale, 39.210 avions neufs devront être construits en tout sur les 20 prochaines années. Si le sondage d’UBS porte les bons chiffres, alors Airbus, qui compte pour 57% du marché, aura à revoir ses prédictions de construction d’avions.
La question est de savoir comment chacun de nous réagit par rapport à ce sujet ?
Le mot du jour de mardi montrait l’urgence de la situation.
Alors je sais bien que les éternels optimistes prédisent que le génie humain va inventer les techniques qui permettront de continuer à tout faire comme avant, tout en préservant la planète.
Admettons que ce soit le plan A !
Mais avez-vous songé au plan B ?

En attendant, les précurseurs suédois ont progressé et ont inventé après « le flygskam », « le Köpskam », la honte de consommer, un néologisme qui émerge peu à peu dans la société nordique et qui vise surtout l’industrie de la mode, particulièrement montrée du doigt pour son impact sur l’environnement.
<1339>
-
Mercredi 29 janvier 2020
« Violences policières »Expression que le gouvernement n’accepte pasNotre Président de la République avait introduit cet « élément de langage » lors d’une réunion du grand débat national, le 7 mars 2019 :
« Ne parlez pas de répression ou de violences policières, ces mots sont inacceptables dans un État de droit. »
Il a dit par ailleurs qu’il « refusait « l’expression « violences policières » pour décrire les blessures « malheureusement » subies par des participants au mouvement des « gilets jaunes« . »
Bien entendu, tous les membres du gouvernement ont repris cette interdiction : ils refusent tous d’évoquer des violences policières !
Pour ma part, j’ai eu du mal. J’ai d’abord observé que depuis la période des attentats, les forces de l’ordre ont eu à subir une pression énorme qui s’est concrétisée par des millions d’heures supplémentaires et donc du repos en moins. Heures supplémentaires qui n’ont pas été payées pendant longtemps.
Et quand la colère et l’hystérie ont conduit certains gilets jaunes à engager des affrontements très violents avec la police, j’ai pris la défense de la police. Je trouvais les attaques injustes et le mot du jour du 10 décembre 2018 défendait l’action de la police et leur donnait la parole : « C’était de l’ultraviolence. Ils avaient des envies de meurtre. Nous, notre but c’est juste de rentrer en vie chez nous, pour retrouver nos familles. »
Mais peu à peu, il a fallu se rendre à l’évidence, il existait en France des violences policières. Ce n’était pas le fait de toutes les forces de l’ordre, mais parmi elles, certains usaient de manière disproportionnée de la force dont ils disposaient ou de manière inadéquate en utilisant mal les armes, voire usaient de violence gratuite. <Comment décrire autrement> le croche pied qu’a fait un policier à une manifestante et dont parle le journal « La Dépêche »
Et puis, il y a eu le décès de Cédric Chouviat, suite à un contrôle routier. Cet homme qui a été plaqué au sol par trois policiers est mort d’une «manifestation asphyxique avec une fracture du larynx». Il a certainement commis une infraction et n’a probablement pas immédiatement obtempéré lors de son interpellation, mais cela ne peut pas, ne doit pas conduire à la mort d’un citoyen non armé lors d’un contrôle routier.
<Le journaliste David Dufresne> a entrepris un recensement des actes qui pouvaient poser la question de violences policières.
Évidemment, il faudrait pouvoir discuter de cela sereinement. C’est pourquoi j’ai trouvé très intéressante cette émission des <Idées Claires> qui posait ouvertement la question : « La police française est-elle plus violente qu’avant ? »
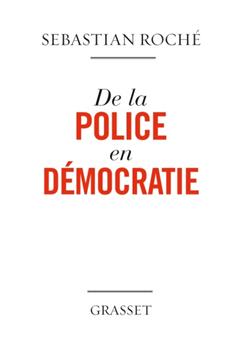 Et pour y répondre le journaliste Nicolas Martin a interrogé Sebastian Roché, sociologue, directeur de recherche au CNRS et auteur de « De la police en démocratie »
Et pour y répondre le journaliste Nicolas Martin a interrogé Sebastian Roché, sociologue, directeur de recherche au CNRS et auteur de « De la police en démocratie »
Et voici ce que Sebastian Roché a répondu :
« Il y a moins de violences policières qu’hier si on se reporte au début du XXe siècle, mais sur ces dernières années il y a une augmentation des armes de type grenade et de type LBD qui ont causé des blessures irréversibles dans des quantités précédemment inconnues, inconnues en France, mais également inconnues dans les autres démocraties européennes. »
Quand je me regarde, je me désole ; quand je me compare, je me console, a-t-on coutume de dire.
Il semble cependant que pour le cas que nous évoquons, la comparaison non seulement ne nous console pas, mais nous inquiète.
L’étonnant ministre de l’intérieur que notre jeune président a nommé pour remplacer le vieux maire de Lyon en contrat d’intérim à Paris, vient d’annoncer sur France 3, dimanche 26 janvier, avec un peu d’emphase, « Il faut prendre des décisions, et j’en prends une immédiatement. », l’interdiction de la grenade GLI-F4.
C’est cette grenade qui avait causé la mort de Rémi Fraisse, le militant écologiste, à Sivens (Tarn),
Cette arme qu’aucun autre pays européen n’utilisait, n’était plus fabriqué parce qu’elle était dangereuse. Mais le ministère de l’intérieur a décidé de l’utiliser jusqu’à l’extinction des stocks ! Si une arme est dangereuse et ne convient pas à sa mission, on ne l’utilise plus même quand il reste du stock.
J’espère qu’il restait encore des stocks, parce que sinon l’annonce du ministre était non seulement emphatique mais aussi trompeuse.
Sebastian Roché explique cependant que la professionnalisation, c’est à dire la création d’unités spéciales au XXème siècle, du type CRS, a fait diminuer de manière importante la violence, par rapport à la situation d’avant. La situation d’avant c’était l’armée qu’on envoyait et qui tirait sur la foule. Ce fut le cas de la fusillade de Fourmies qui s’est déroulé le 1er mai 1891 et a conduit à un discours très véhément de Clemenceau contre l’utilisation excessive de la Force. <L’Humanité> nous rappelle que quelques années plus tard, en 1908, lorsque Clemenceau fut au pouvoir, il n’hésita pas non plus d’envoyer l’armée tirer sur les manifestants
Quand on habite Lyon, on se doit de rappeler que l’armée a tiré le 14 avril 1834 sur les canuts lyonnais.
La police est donc moins violente qu’en 1900 mais qu’en est-il depuis 2000 ?
« Il est certain que c’est depuis les années 2 000 qu’il y a eu un durcissement, notamment avec un équipement comme les armes LBD qui sont passées de la police d’intervention, par exemple, contre le terrorisme, à la police dite anticriminalité avec un usage peu contrôlé de ces armes puisque ce sont les agents eux-mêmes qui décident de leur emploi. Ils ne le font plus en réponse à une instruction hiérarchique et la généralisation de ces outils va entraîner des dégâts, mais qui ne vont pas être immédiatement connus. Il va y avoir un certain nombre d’associations qui vont se mobiliser contre l’usage des LBD, qui vont se mobiliser par rapport au fait qu’il y a des décès au cours des opérations de police, surtout dans les banlieues, surtout des personnes des minorités. »
[Mais] Ce qui est nouveau avec le mouvement des « gilets jaunes », c’est que ce sont des personnes de la France périurbaine, voire rurale, en tous cas hors région parisienne, et que ce sont des personnes françaises d’origine française, blanches, qui vont être massivement touchées par les tirs. »
Alors, ce que dit ici, Sebastien Roché est encore plus navrant que le reste, navrant pour la France.
Il affirme que tant que la violence policière s’exerçait dans les banlieues, contre des personnes et des jeunes issues de l’immigration, les médias ne s’en inquiétaient pas trop.
Mais depuis que cela touche « des français innocents » pour reprendre la lamentable formule de Raymond Barre, ce n’est plus possible !
Le matériel utilisé pose problème :
« Le matériel qui est utilisé en maintien de l’ordre en France est singulier, puisqu’il y a à la fois différents types de grenades qui sont lancées, normalement à ras du sol mais on l’a vu bien souvent ce mode d’emploi n’est pas respecté, et les LBD. Et c’est la combinaison de ces deux types d’armes qui a occasionné les blessures irréversibles sur la trentaine de personnes qui a été mutilée. Les blessures causées par les grenades de désencerclement par exemple, peuvent être la perte d’un œil, ou si l’on touche la grenade au moment où elle explose, l’arrachage d’un pied ou d’une main. C’est une singularité française d’avoir ces deux types d’armes, les démocraties nordiques interdisent l’usage par la police pour le maintien de l’ordre soit des grenades, soit des LBD, soit des deux. […]
La police française, après le mouvement des « gilets jaunes », va se situer effectivement dans le haut de la fourchette des violences non-mortelles, puisque ce sont essentiellement des mutilations que l’on va compter. Par exemple, la police de Catalogne, après avoir fait perdre les yeux à cinq personnes, a décidé d’interrompre l’usage des LBD. En France, après plus d’une vingtaine de personnes qui ont perdu la vue en tous cas d’un œil, le gouvernement n’a pas pris de mesures comparables. Donc, la France n’est pas un très bon élève en Europe. »
Sebastien Roché refuse d’affirmer que c’est le gouvernement qui a incité certains policiers à devenir violents. Il relève cependant certaines formules malheureuses. Et un point qui me semble particulièrement important, le manque de rigueur dans le port du numéro d’identification du policier, appelé numéro RIO :
« Il est difficile de prouver que le gouvernement a voulu que la police soit plus violente. Ce qu’on peut dire c’est que le gouvernement a pu indirectement inciter à la commission de violence par certains policiers parce que tous n’ont pas eu le même comportement bien sûr, notamment parce que le ministre de l’Intérieur a désigné de manière répétée les manifestants comme étant « hostiles », « factieux » et donc indirectement il a légitimé l’usage de la force à leur encontre.
La deuxième chose c’est que le ministre de l’Intérieur n’a pas fait en sorte que les règlements soient appliqués et notamment la possibilité d’identifier chaque agent par le port d’un numéro, le numéro Rio (Référentiel des identités et de l’organisation). Dons si on n’oblige pas les agents à être identifiables de facto on ne fait pas peser sur eux le risque d’être comptables de leurs actes. »
Le discours du gouvernement a, un peu, évolué. Emmanuel Macron s’est exprimé le 14 janvier 2020, à Pau, en parlant de comportement « pas acceptable » de certains policiers et gendarmes. Et a ajouté attendre d’eux « la plus grand déontologie ».
Mais pour le grand juriste et avocat Henri Leclerc, président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme :
« Le problème est celui du commandement, de la hiérarchie ».
Il existe en effet un monde de vertu et de valeurs entre le Préfet Maurice Grimaud qui officiait en mai 1968, et dont le mot du jour du 20 août 2013 rappelait sa lettre aux policiers en pleine période d’émeutes : «Je veux leur parler d’un sujet que nous n’avons pas le droit de passer sous silence : c’est celui des excès dans l’emploi de la force.» et l’actuel préfet de police de Paris Didier Lallement qui a été nommé suite à la révocation de son prédécesseur qui n’avait pas été assez ferme et n’avait pas su empêcher la dégradation de l’Arc de triomphe le 1er décembre 2018.
Pour s’en convaincre, cet <article de Libération> permet d’éclairer la personnalité de celui qui est à la tête de la police de Paris.
Mais ce serait une simplification abusive de dire que tout le mal provient d’un seul homme qu’il suffirait de remplacer. Le mal semble plus profond. Il se trouve probablement aussi dans le manque de moyens humains et de formation des forces de l’ordre qui doivent affronter des défis majeurs, garantir l’ordre et la sécurité républicaine tout en conservant toujours la maîtrise de leurs nerfs et de leurs actions.
<1338>
-
Mardi 28 janvier 2020
« Méga-feux »Phénomène récent qui touche les forêtsPendant ce début du mois de janvier, il est un mot qui a été très utilisé. Je ne l’avais pas entendu avant : « méga-feux ».
Pendant le mois de janvier, ce mot a été utilisé pour ce qui se passait en Australie, depuis septembre 2019. En Australie, les observateurs ont donné un autre nom : « The monster ». Mais ce mot-là présente une ambigüité, car il a l’air d’annoncer que ce qui frappe l’Australie est un seul gigantesque incendie. Et ce n’est pas le cas. Il y en a plusieurs, Fabrice Argounès, que je cite plus loin, estimait qu’il existait entre 300 à 500, foyer d’incendies à qui on pouvait donner le nom de « méga-feux », c’est-à-dire un feu qui le plus souvent échappe à la capacité humaine de l’éteindre. Il faut attendre que le feu cesse de lui-même, ou qu’un autre événement naturel comme la pluie éteigne le feu.
L’émission « La Méthode scientifique » du <22 janvier 2020> nous donne quelques précisions sur ce concept : Le terme « megafire » est apparu d’abord en anglais, sous la plume de Jerry Williams, responsable du service américain des forêts. Il met en exergue le fait que les feux de forêt ont acquis un comportement que les spécialistes et les riverains qui en sont victimes n’avaient jamais observé dans le passé.
Les incendies qui ont ravagé le sud-est de l’Australie ont réduit en cendres plus de 10 millions d’hectares. On ne parle pas ici d’incendies « classiques », mais de mégafeux, une notion encore incomplètement définie par les scientifiques. La recherche s’engage depuis des années à comprendre comment ces incendies d’une ampleur sans précédent fonctionnent et interagissent avec le climat et les conditions météorologiques. Avec le changement climatique en cours provoquant des canicules et des sécheresses intensifiées, ces mégafeux vont devenir de plus en plus fréquents.
 En Australie, comme un symbole, plusieurs vidéos ont montré l’image pathétique de koalas aux milieux des flammes, ou des koalas quémandant de l’eau aux humains et aussi des humains qui sauvaient cet animal si mignon et si propice à déclencher des vagues d’émotion.
En Australie, comme un symbole, plusieurs vidéos ont montré l’image pathétique de koalas aux milieux des flammes, ou des koalas quémandant de l’eau aux humains et aussi des humains qui sauvaient cet animal si mignon et si propice à déclencher des vagues d’émotion.
Les koalas sont encore plus menacés que les autres animaux, car ils n’ont pas l’habitude de fuir devant le feu.
Un vétérinaire explique :
« La particularité du koala, c’est que c’est un animal qui vit dans son garde-manger. Il se nourrit d’eucalyptus et vit dans cet arbre-là. Donc le koala va avoir comme réflexe de survie de monter dans l’arbre pour se cacher, et va brûler en même temps que lui. »
En outre l’eucalyptus est gorgé d’huile, une fois une certaine température atteinte, il va exploser et le koala avec.
Ces méga-feux ne sont pas confinés à l’Australie. L’été dernier, des feux ont également ravagé la Sibérie, l’Arctique, le bassin du Congo, « deuxième poumon vert mondial » ou encore la forêt amazonienne où entre janvier et septembre 2019, le nombre d’incendies a augmenté de 41% par rapport à l’année précédente.
En Australie, qui est un pays habitué aux feux et qui dispose de pompiers très aguerris, le nombre de victimes a été en fin de compte relative faible en regard de la violence des incendies : moins d’une trentaine de morts. Le chiffre d’un milliard d’animaux morts est souvent cité, mais j’ai entendu plusieurs commentateurs le mettre en doute, car il semble que les autorités sont incapables de mesurer l’impact de ces catastrophes sur le monde animal. Il peut toutefois être conclu que l’impact est considérable.
Dans un article du New York Times, on apprend qu’en Nouvelle-Galles du Sud, un des états australiens les plus touchés par les incendies, une librairie a changé son enseigne. On peut y lire ceci : «les romans de fiction post-apocalyptiques se trouvent désormais au rayon actualités.».
Les matins de France Culture pour essayer d’analyser ces dérèglements climatiques avaient invité : Fabrice Argounès, géographe et politiste, enseignant chercheur à l’Université de Rouen, auteur du « Dictionnaire de l’Anthropocène », Charlotte Epstein, professeure associée à l’Université de Sydney, et Joëlle Zask, philosophe qui enseigne la philosophie à l’université Aix-Marseille et a publié « Quand la forêt brûle ».
Cette émission dont le début peut être vu en vidéo <ICI> est très intéressante, elle est écoutable en intégralité audio <Ici>.
Guillaume Erner introduisait l’émission de la manière suivante :
« Les catastrophes arrivent dans un pays traditionnellement peu versé sur la question écologique où la remise en question de la dépendance au charbon reste taboue. Dénonçant l’inaction de son pays, l‘écrivain australien Richard Flanagan publiait le 3 janvier une tribune dans le New York Times alertant du «suicide climatique » qu’était en train de commettre son pays.
Face à l’épreuve des méga-feux, une prise de conscience est-elle en train de s’opérer ? La catastrophe qui touche l’Australie nous donne-t-elle un avant-goût des dérèglements à venir dans le reste du monde ? »
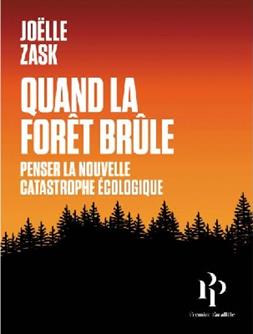 Joelle Zask a aussi participé à un article dans la revue <Reporterre>
Joelle Zask a aussi participé à un article dans la revue <Reporterre>
« Ces incendies vont au-delà même de tout ce que j’avais pu imaginer et décrire dans mon livre. C’est d’une gravité extrême. Le désastre est devant nous : plus les zones brûlées s’étendent et plus les feux deviennent intenses, moins la réversibilité de la situation semble envisageable. […] Le feu détruit non pas la planète, mais les conditions d’existence des êtres humains et de nombreux animaux sur Terre.
Un autre aspect me révolte : l’attitude négationniste du Premier ministre Scott Morrison. Le gouvernement, qui a longtemps été climato-sceptique, refuse d’arrêter la production de charbon. Ces feux ne sont pourtant pas un phénomène naturel. Le croire est criminel.
[L’activité humaine est en cause] Ces incendies sont nourris par le réchauffement climatique. L’augmentation des températures fait baisser le taux d’humidité, la végétation sèche et devient extrêmement inflammable. Les forêts sont aussi de plus en plus attaquées par des insectes ravageurs et des pathologies qui croissent avec la chaleur. En Californie, une région qui a connu aussi de nombreux incendies ces dernières années, un arbre sur dix est victime d’agents pathogènes, de virus ou de champignons. Les forêts sont malades, les écosystèmes fragilisés et donc plus vulnérables à des incendies. Avec la sécheresse et le réchauffement climatique, la saison des feux s’allonge. »
Joëlle Zask dit une chose que j’ai lu sur d’autres site de manière assez cohérente.
Le dérèglement climatique ne crée pas les feux mais les rend plus intense, plus hors de contrôle, il a donc un impact énorme sur le phénomène des méga-feux.
Nous sommes en face d’un phénomène qui s’aggrave :
« Cela fait plus de dix ans que le phénomène des feux s’est aggravé et que les incendies sont devenus hors norme. C’est notre perception qui a changé récemment. On a commencé à en parler, à les voir, à les conscientiser. On revient de loin. Quand j’ai commencé la rédaction de mon livre [Quand la forêt brûle], il y a trois ans, la vulgate disait que les incendies étaient bons pour la forêt, qu’ils la régénéraient.
Les positions ont évolué depuis que les feux sont rentrés dans les villes, quand les habitants de Singapour ont commencé à suffoquer à cause des incendies en Indonésie ou que les gens de Sao Paulo étouffaient du fait de l’Amazonie en feu. En Australie, c’est parce que le brasier menaçait Melbourne et Sydney que les médias et les politiques ont commencé à s’emparer de la question. On ne peut plus en faire abstraction, l’incendie vient défier notre société urbaine, frapper à ses portes. Ses fumées entraînent de nombreuses maladies respiratoires et condamnent des dizaines de milliers de personnes à une mort prématurée. Canberra, en Australie, est désormais la ville la plus polluée du monde, avec un taux de pollution de l’air plus de 20 fois supérieur au maximum autorisé. Les gens s’empoisonnent. Désormais, on le sait. Avant le territoire des indigènes ou des ruraux brûlait en silence, sans susciter l’indignation. Ça prouve que pour se mobiliser contre le réchauffement climatique, il faut le vivre dans sa chair, ses tripes. C’est ce que découvrent aujourd’hui des populations urbaines partout sur la planète. »
Selon Joëlle Zask, la France ne sera pas épargnée dans l’avenir :
« Certains scénarios de la Nasa envisagent un embrassement des terres émergées. Quand on regarde le planisphère des feux, on se rend compte que leurs foyers se rapprochent de plus en plus les uns des autres. On estime qu’en 2050, 50 % des municipalités françaises seront exposées aux méga feux. »
Bruno Fady, directeur de recherche à l’INRAE émet les mêmes craintes :
« Ce qui se passe en Australie se passera dans le bassin méditerranéen et en Europe, dans les décennies à venir, si nos sociétés continuent à ne pas fournir les efforts nécessaires pour suivre les résolutions de l’accord de Paris sur le climat de 2015. »
L’industrialisation est aussi une cause de ces incendies :
« J’ai été frappée par les feux de forêt, totalement inédits, en Suède, à la fin de l’été 2017. C’était sidérant parce que l’on ne s’attendait pas à ce que des forêts boréales et même arctiques brûlent. Ces incendies ont révélé le fait que la Suède possédait une forêt à 70 % industrielle. Des plantations de pins, des monocultures uniformes qui appauvrissent les sols et affament les rennes qui manquent de lichens. Les méga feux se sont rapidement propagés du fait de l’extrême densité de ces pins et de la vulnérabilité de ces forêts industrielles. On voit la même chose se développer en Espagne ou au Portugal avec les plantations d’eucalyptus particulièrement inflammables. »
Pour Joëlle Zask la solution se trouve dans une évolution de nos idéologies et de notre récit :
« Il faut évidemment lutter contre les causes du réchauffement climatique mais aussi remettre en cause les croyances qui irriguent la pensée occidentale : l’idéologie qui voudrait soumettre la nature, la dominer, mais également le préservationnisme – c’est-à-dire l’idée selon laquelle les équilibres naturels et la présence humaine sont incompatibles, que la nature fait bien les choses, qu’il faut s’en retirer, la protéger en la sanctuarisant et en la mettant sous cloche. Au contraire, je pense qu’il faut prôner une sorte de coopération et de partenariat, développer un modèle de soin de la forêt où cette dernière ne serait pas uniquement vue sous l’angle de l’extractivisme.
Concrètement, cela veut dire revenir à des pratiques menées par des peuples indigènes mais aussi par les paysans traditionnels. Monter la garde, débroussailler, habiter le territoire, faire des feux de surface pendant la saison des pluies. Devenir l’auxiliaire de la nature. Faire avec elle plutôt que contre. S’opposer à la nature, c’est la détruire mais c’est aussi détruire nos chances de vie sur la Terre. »
Certains pensent justement que le savoir des peuples aborigènes pourra aider à combattre ces dérèglements : <Le savoir des Aborigènes d’Australie pour survivre aux futurs méga-feux>.
Ce n’est pas indifférent que ces catastrophes arrivent dans un pays riche et climato-sceptique comme l’Australie.
Le site Conspiracy Watch rapporte en outre tous les mensonges que les autorités australiennes et le groupe de média australien Murdoch ont propagés pour essayer de nier le lien entre l’intensité des feux et le réchauffement climatique auquel l’Australie apporte une part énorme.
L’Australie paye ainsi un énorme tribut au désastre écologique, mais son économie est entièrement tournée vers les énergies fossiles. Dans un pacte faustien, il ne veut pas abandonner ce qui fait sa richesse mais qui va entraîner sa perte. Il est envisageable qu’à terme l’Australie ne soit plus habitable.
Sur <ce site> on apprend que :
« Au niveau de l’OCDE, l’Australie est le premier pays émetteur de CO2 par habitant, devant le Canada et les États-Unis. Il faut dire que l’île-continent est riche en minerais. Elle détient les principales réserves mondiales en or, en nickel ou encore en zinc dont l’extraction nécessite beaucoup d’énergie. Or, le mix énergétique national est à 93 % composé d’énergies fossiles, et à 75 % dépendant du charbon.
Mais pour les gouvernements successifs, difficile de renoncer à une telle manne financière. En pleine crise, le Premier ministre australien a ainsi continué à défendre cette industrie. Ce qui pousse l’écrivain australien Richard Flanagan à parler de « suicide climatique » dans une récente tribune parue dans le New York Times. « Les gouvernements conservateurs qui se sont succédé depuis 1996 se sont battus pour renverser les accords internationaux sur le changement climatique au nom de la défense de l’industrie fossile nationale », fustige-t-il.
Tony Abbott, premier ministre australien de 2013 à 2015, climatosceptique avéré, avait enterré la taxe carbone aussitôt élu. Scott Morrison, l’actuel Premier ministre, a martelé qu’il serait irresponsable de tourner le dos au charbon, alors que le pays était ravagé par les flammes. En 2017, alors ministre de l’Économie, il avait frappé les esprits en faisant circuler un morceau de charbon dans l’assemblée parlementaire, invitant à « ne pas en avoir peur ». Le pays a également renoncé à inscrire dans la loi les objectifs de réduction d’émissions pris en amont de l’Accord de Paris. »
Le Monde explique dans une vidéo de 5 minutes <Pourquoi l’Australie brûle>.
Il faudrait comme l’avait annoncé Hollande, sans le réaliser, que « le changement soit maintenant », car il semble de plus en plus clair que « la catastrophe soit déjà maintenant ! »
<1337>
-
Lundi 27 janvier 2020
« Il nous reste les mots »Georges Salines et Azdyne AmimourLorsque mon fils Alexis travaillait et résidait à Lyon, nous avions pris l’habitude de nous retrouver, une fois par semaine, à l’heure du déjeuner pour nous voir en tête à tête et dialoguer, c’est-à-dire nous féconder mutuellement l’intelligence. Un jour Alexis m’a dit : « Si on y réfléchit, les humains ont fait le choix de communiquer essentiellement par le langage et les mots. Ce n’était peut-être pas la meilleure solution. »
 Les scientifiques ne savent pas encore très bien comment communiquent entre eux les poulpes. Mais l’hypothèse qu’ils communiquent à partir de leur système nerveux qui est complètement distribué sur tout leur corps est possible. Franz de Waal posait cette question provocante : « Est-ce que l’homme est plus intelligent que le poulpe ? On ne sait pas ».
Les scientifiques ne savent pas encore très bien comment communiquent entre eux les poulpes. Mais l’hypothèse qu’ils communiquent à partir de leur système nerveux qui est complètement distribué sur tout leur corps est possible. Franz de Waal posait cette question provocante : « Est-ce que l’homme est plus intelligent que le poulpe ? On ne sait pas ».
Daniel Barenboïm a écrit qu’il en apprenait plus sur la personnalité et l’intimité d’un humain en jouant de la musique avec lui pendant dix minutes plutôt qu’en lui parlant pendant des heures.
Quand on s’enlace avec tendresse et ouverture, il y aussi communication qui dépasse les mots.
Mais pour exprimer la complexité, nous autres humains utilisons les mots.
C’est l’objet même du mot du jour.
Le 1er septembre 2014, après un autre silence d’un mois j’avais fait appel à Victor Hugo et au 8ème poème du livre Un des contemplations : « Les mots sont les passants mystérieux de l’âme ».
Mais quand on analyse ce qui se passe, de la difficulté à exprimer et encore plus à entendre le message que peut former les mots, on peut être découragé.
Parce qu’un mot ne suffit pas, il faut une phrase, puis une autre qui précise ou nuance la première. Puis d’autres qui vont encore apporter des précisions et des nuances. Celui qui écoute a souvent envie d’intervenir dès la première phrase ou la seconde, enfin très vite ne laissant pas celui qui parle, développer la complexité de sa réflexion.
Sur les plateaux de la télévision, on demande toujours de s’exprimer en quelques mots.
On privilégie le « bon mot », « la phrase choc » que les anglicistes appellent les punchlines.
Faisons l’hypothèse que vous possédiez, sur un sujet particulier, une réflexion complexe dans votre cerveau et que vous vouliez la transmettre à votre interlocuteur.
Ce qui serait idéal c’est que vous puissiez transmettre, en une fraction de seconde, l’intégralité de cette réflexion dans le cerveau de l’autre, par une sorte de télé transmission et que l’autre puisse la recevoir en une seule fois, dans sa globalité et la comprendre immédiatement.
Mais ce n’est pas possible, pas encore, disent peut être les transhumanistes.
Il nous reste, pour l’instant les mots. Alors il faut accepter de prendre le temps, pour que mot après mot la communication confiante et détaillée puisse s’épanouir et se partager.
C’est ce qu’ont fait Georges Salines, le père de Lola qui a perdu la vie, à 28 ans, au Bataclan le 13 novembre 2015 et Azdyne Amimour, le père de Samy qui a aussi perdu la vie, à 28 ans, le même jour, dans le même lieu mais qui était, lui, un des trois terroristes qui a donné la mort avant de la recevoir.
« Il nous reste les mots » est le titre du livre qu’ils ont commencé à écrire ensemble après avoir dialogué plus d’un an. Ils ont utilisé ces outils imparfaits, insuffisants, pauvres que sont les mots pour échanger leur chagrin, leur désarroi, leurs blessures mais aussi trouver la force pour continuer à croire à la vie, au bonheur, à l’humanisme.
Georges Saline est médecin, il a bien sûr été dévasté par l’assassinat de sa fille, mais n’a pas voulu rester figé dans sa douleur, sa colère. Il a rapidement participé à la création d’une association : « 13 onze 15 : fraternité et vérité » dont il est devenu Président. Il voulait comprendre et faire de la prévention, comme le rapporte cet article de <La Croix>.
Il est devenu ainsi une personnalité publique qui s’exprimait dans les médias. C’est ainsi que l’a connu Azdyne Amimour qui a pris l’initiative de lui écrire en février 2017, pour le rencontrer.
C’est ainsi qu’ils se voient pour la première fois dans un café de la place de la Bastille, à Paris.
Un journaliste commente et leur donne la parole :
« Les deux pères, évidemment, appréhendent cette impensable rencontre. « Au départ, j’étais inquiet, je ne savais pas comment il allait prendre la chose, se rappelle Azdyne Amimour. Dès les premiers mots, j’ai lu sur son visage ses traits de caractère et donc il m’avait mis à l’aise. » Lors de cette première rencontre, le père du terroriste montre une photo de son fils à l’âge de 12 ans. « On voit la photo d’un petit garçon propre sur lui, mignon, auquel on a envie de faire une bise, décrit Georges Salines. Ce que ça m’a apporté, c’est d’essayer d’être capable de ne pas réduire cette vie à son acte final. Personne ne peut être réduit à ce qu’il a fait de pire dans sa vie. Je sais que je suis sorti de cet entretien totalement bouleversé. »
La première question du père de Lola au père de Samy a été de demander pourquoi il voulait le rencontrer.
« L’homme d’origine algérienne lui répond : « Parce que je me sens aussi victime par rapport à mon fils. » Une réponse qui ne choque pas Georges Salines. « J’avais publié un livre qui s’appelle L’indicible de A à Z où j’avais dit que les familles de jihadistes sont aussi des victimes, se souvient le père de Lola. Je le savais pour avoir rencontré des mères qui avaient perdu leur enfant en Syrie et j’avais pu toucher du doigt leur détresse. À vrai dire, je pense que les terroristes, qui sont totalement coupables et à qui je ne pardonne rien, sont aussi des victimes de leur propre folie. Ils ont perdu leur vie en poursuivant une chimère »
Le père de l’enfant devenu terroriste exprime ses terribles questions :
« Je sais que j’ai failli quelque part mais je n’arrive pas à trouver. Le ‘pourquoi ?’, ça me hante, jusqu’à présent. »
<Libération> présente la famille du jeune tueur :
A Drancy (Seine-Saint-Denis) chez les Amimour, Samy, cadet de la fratrie, est un adolescent influençable et taiseux. Ses parents s’inquiètent souvent pour lui.
Dans la famille, l’islam n’est pas central, le père se définit comme «croyant mais pas pratiquant». Pour lui, Samy a «déraillé»; il a voulu partir en Afghanistan et au Yémen, pour finir par rejoindre le groupe État islamique en Syrie en septembre 2013.
La question du pardon est difficile :
« Quand le père de Samy demande «pardon pour son fils», le père de Lola balaie la question: M. Amimour «n’a pas de pardon à demander, il n’est coupable de rien, et moi je ne peux pas accorder de pardon parce qu’il n’y a plus personne pour me le demander».
«Vous étiez à mille lieues de l’intolérance, du sectarisme et de la violence, (…) tu n’es pas responsable des méfaits de ton fils (…) Le déterminisme à ses limites», répond le père de Lola. »
<Ouest France> présente les doutes de Georges Salines après la lettre d’Azdyne Amimour :
« D’abord « perplexe », le père de Lola, alors président de l’association de victimes « 13onze15 : Fraternité et vérité », accepte. « J’avais déjà parlé avec des mères de jeunes partis en Syrie, dit-il. Mais là, c’était un autre engagement : le fils d’Azdyne était potentiellement le meurtrier de ma fille. »
Mais ils concluent :
« Ce dialogue, estiment finalement les auteurs, représentait une extraordinaire opportunité de montrer qu’il nous était possible de parler. Si un tel échange avait lieu entre nous, alors nous pouvions abattre les murs de méfiance, d’incompréhension, et parfois de haine, qui divisent nos sociétés. »
Vous pouvez aussi visionner cette émission de France 24 dans laquelle, ils ont tous les deux participé.
Il a fallu du temps pour que ces mots échangés puissent permettre de se faire confiance, de se comprendre et d’avancer.
Puisqu’il nous reste les mots, je vais, dans les prochains jours, évoquer des mots et des expressions qui ont été inventés récemment ou ont été très utilisés dans l’actualité. Je tenterai de les éclairer par d’autres mots, pour continuer d’essayer maladroitement, péniblement et modestement de mieux comprendre le monde.
<1336>
-
Lundi 30 décembre 2019
«Pause»Mot du jour en hibernationComme annoncé vendredi, le mot du jour est en congé.
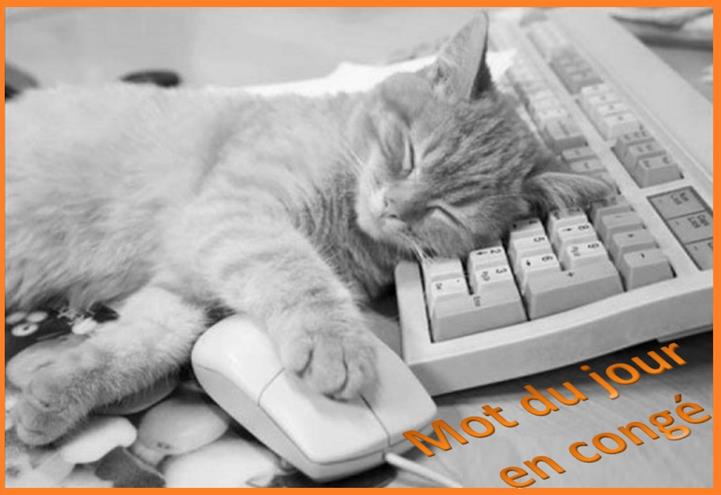 Il est possible que le prochain mot du jour soit publié le 27 janvier 2020. Mais entretemps j’ai retravaillé un certain nombre de mots du jour de la série de Michel Serres.
Il est possible que le prochain mot du jour soit publié le 27 janvier 2020. Mais entretemps j’ai retravaillé un certain nombre de mots du jour de la série de Michel Serres. Récemment, lors d’une rencontre au restaurant avec Rémy, ce dernier m’avait rapporté qu’en l’absence de nouveau mot du jour, il avait eu le souhait de relire les mots du jour consacrés à Michel Serres et dont j’avais fait une série.
Et il m’a révélé son désappointement de ne pas trouver le lien ad hoc sur la page des séries. Ceci ne peut pas se faire automatiquement mais demande du travail. Mais voilà qui est fait, vous la trouverez désormais sur la page série. Et aussi en suivant <ce lien>
<Mot du jour sans numéro>
-
Vendredi 27 décembre 2019
«Le monde n’a plus besoin de battants, de gens qui réussissent, il a besoin de rêveurs, de personnes capables de reconstruire et de prendre soin… et surtout, surtout, on a tous besoin aujourd’hui, plus que jamais, de gens heureux.»Pedro CorreaLe mot du jour a coutume de se mettre en pause à la fin de l’année. On parle de la trêve des confiseurs.
L’année dernière j’ai commencé « une tradition » d’une pause d’un mois. Plus qu’une trêve de confiseurs, il s’agit plutôt d’une hibernation.
Le mot du jour va donc se mettre en congé et reviendra, lundi 27 janvier 2020, jour anniversaire de la naissance de Wolfgang Amadeus Mozart né le 27 janvier 1756
Et, c’est une histoire belge que je voudrais partager pour ce dernier mot du jour de l’année.
Pedro Correa est un artiste photographe professionnel. Mais ses études l’avaient conduit d’abord à un diplôme d’ingénieur civil qu’il avait décroché dans l’école d’ingénieur de l’UCL, c’est-à-dire « l’Université Catholique de Louvain. »
Il explique son parcours <sur ce site bruxellois>
Et son université d’origine a eu l’idée de l’inviter à faire un discours à la cérémonie de remise de diplômes d’ingénieur de cette année, c’est-à-dire devant celles et ceux qui ont suivi les mêmes études que lui, quelques années après lui.
Et il a tenu un discours que ce <site catholique belge> appelle «Un surprenant discours ». Ce discours il l’a tenu devant les nouveaux ingénieurs, leurs parents, leurs professeurs et d’autres anciens élèves
L’université lui avait donné carte blanche et il avait donc toute liberté d’aborder tous les sujets qu’il souhaitait.
C’est pourquoi il a commencé à remercier pour cette initiative :
« Je voulais aussi féliciter l’AILouvain, ( Association des diplômés de l’Ecole Polytechnique de Louvain) d’avoir fait preuve de courage, non seulement en m’invitant dans ce panel (ce qui est déjà assez courageux) mais surtout en mettant au centre de ses interventions et de leur programme de conférences des termes comme « le sens », « le bonheur » « et la joie au travail », au-delà de ceux sur lesquels on insistait uniquement lors des discours que j’avais à votre âge en ingénieur, et qui étaient plutôt à l’époque « le sacrifice », « le sérieux », « la compétitivité » ou « l’excellence ». Merci donc vraiment à l’UCL pour cet élan de vent frais ».
Avec beaucoup d’humour préparatoire à ce qui va suivre, il prévient :
« Faire un Doctorat en Sciences Appliquées pour finir artiste photographe, je pense que cela doit figurer dans le top 3 des cauchemars des parents ici présents… »
Puis il évoque la figure qu’il nomme « son idole », Philippe Bihouix.
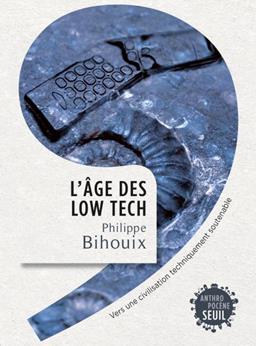 Philippe Bihouix est un ingénieur français qui écrit des livres qui vantent les « Low-Tech » par opposition au « High Tech ».
Philippe Bihouix est un ingénieur français qui écrit des livres qui vantent les « Low-Tech » par opposition au « High Tech ».
Bien sûr, comme toute personne raisonnable il est préoccupé par le défi climatique et écologique qui se dresse devant nous. Il a la conviction que les hautes technologies, comme le numérique ou la robotique, ne peuvent être la solution magique pour lutter contre la crise climatique en raison de leur impact sur notre environnement et nos ressources.
Il ne croit pas à la croissance verte et à la civilisation des énergies renouvelables, des réseaux intelligents, de l’économie circulaire, des nano-bio-technologies et des imprimantes 3D
Il a ainsi écrit un livre que cite Pedro Correa : « L’âge des Low Tech »
Il décrit la civilisation du high tech comme plus consommatrice de ressources rares, plus difficiles à recycler, trop complexe et menant à une impasse. C’est pourquoi il propose de prendre le contre-pied de la course en avant technologique en se tournant vers les low tech, les « basses technologies ». Il ne s’agit pas de revenir à la bougie, mais de conserver un niveau de confort et de civilisation agréables tout en évitant les chocs des pénuries à venir.
Mais revenons au discours de Pedro Correa devant les jeunes ingénieurs.
Vous trouverez une grande partie de ce discours sur le site du journal la Libre Belgique.
J’ai choisi comme exergue la dernière phrase, mais je souligne dans le texte les autres phrases avec lesquelles j’ai hésité.
Il ne faut pas recevoir tout ce discours comme parole d’évangile, mais le prendre comme un regard décalé qui pose des questions fondamentales et appelle à s’interroger sur le sens, l’essentiel et le chemin :
« Mais si je ne vais pas vous donner de conseils, c’est surtout parce que je me rends compte que nous, les plus vieux, n’avons rien à vous apprendre, et que bien au contraire, nous ferions mieux de plus vous écouter. Quand je vois les valeurs de consommation, d’accumulation, d’égocentrisme, de compétition et de croissance continue, sur lesquelles les deux générations précédentes ont bâti le système dans lequel on surnage pour l’instant, et quand je vois les élans de solidarité, d’empathie, de collaboration, et de quête de sens qui brillent au fond des yeux des jeunes aujourd’hui… je me dis que vous êtes celles et ceux qui peuvent inverser la tendance vers une société plus heureuse et plus juste… et que vous avez déjà tout en vous.
Je vais par contre commencer par une statistique que je vais poser là, exprès pour vous faire un peu peur. C’est une donnée que l’on entend très rarement, et qui représente à mes yeux le canari dans la mine qui devrait nous alerter que quelque chose va mal : depuis 5 ans, la Belgique dépense plus de budget national en malades de longue durée (essentiellement des dépressions et des burn-out), qu’en charges liées au chômage. Cela veut donc dire que contrairement à ce que l’on nous martèle chaque jour à propos du chômage, en sortant d’ici, vous avez plus de risques de tomber malade ou de devenir dépressifs à cause de votre emploi, que de ne pas en trouver. »
Ce constat assez déroutant et dérangeant est aussi développé sur le <site de la RTBF>. Il s’agit de la Belgique, le taux de chômage y était en juin 2019 de 5,7%, en France nous sommes juste en dessous de 9%. Je pense cependant que si le coût du chômage en France est nettement plus élevé, le constat par rapport à la santé psychologique au travail est probablement très proche de la Belgique.
Il ajoute :
« Passionné de développement personnel, je me suis penché sur les causes de cette donnée, et ce résultat n’est finalement pas si étonnant. Toutes les études scientifiques en neurosciences et en psychologie du bonheur sont unanimes : placer des termes anxiogènes comme le « sérieux », l' »excellence », la « compétitivité » ou le « sacrifice » au centre de notre vie, sans en placer d’autres, essentiels, comme « la joie », « le sens » ou « la collaboration », c’est prouvé, cela ne peut que mener à la tristesse, à la fatigue, et au final, à la maladie… au burn-out.[…]
Certains vous feront miroiter des contrats avec d’énormes voitures à la clé, et ils vous assureront que c’est la preuve ultime de la réussite. De mon côté, je ne peux que vous parler avec le gage de mon propre bonheur lorsque je me lève chaque matin pour faire mon travail, que je reste absorbé pendant des heures sans voir le temps passer à capturer des instants de beauté éphémère, et le bonheur de mes enfants avec qui je passe de longues après-midi.
Je ne peux donc que vous partager mon expérience, qui a tout d’abord été de me rendre compte que le bonheur, ça se travaille. Le bonheur ne nous tombe pas du ciel en regardant notre vie s’écouler sur des rails construits par d’autres, des rails qui vont on-ne-sait-où, plutôt que de mettre en pratique nos propres envies.[…]
Mon chemin a commencé par cette condition, indispensable je pense, d’écouter mes propres envies, d’écouter ma voix intérieure. Cette voix intérieure n’a rien de mystique, c’est juste la propre voix de chacun, cette voix authentique qui n’a de compte à rendre à personne, c’est une voix du cœur, celle qui vous prend aux tripes. Elle est très difficile à entendre parce que depuis tout jeune, nous avons entassé d’autres voix par-dessus : la voix des parents, des professeurs, des pubs. […]
Nous avons tous en nous la voix qui sait ce qui est mieux pour nous. Il faut juste du travail sur soi pour l’entendre et la reconnaître. »
Et il dit combien notre conditionnement peut nous empêcher d’écouter et d’entendre cette voix intérieure. Et pour donner un exemple, ll décrit le malaise d’un salarié dans le contexte suivant :
« C’est super dur d’écouter cette voix sans se dire que c’est du n’importe quoi, sans se dire oh là là mais qu’est ce qui me prend, j’invente des trucs. Mais il est très bien rémunéré ce super job qui optimise ce software d’évasion fiscale pour une multinationale qui empoisonne l’eau potable de milliers de personnes à l’autre bout du monde. Je ne comprends vraiment pas pourquoi mon estomac se noue et que j’ai des sueurs froides à chaque fois que j’arrive au bureau, c’est absurde. Et puis si on ne fait rien, l’estomac reste noué comme ça, jour après jour pendant des mois. Et puis, bizarrement on tombe malade. »
Il donne ensuite une clé de son parcours personnel qui passe par le décès brutal de son père à un âge auquel on s’attend désormais à vivre encore de longues années.
« Pour moi, cela a été plus rapide : j’ai pris un raccourci et j’ai pu éviter des années d’écoute attentive pour arriver à l’entendre. C’est un raccourci, certes, mais que je ne souhaite à personne : c’était de voir mourir mon père, soudainement. Il avait 56 ans, j’en avais 29. Il était fort comme un roc un jour, et parti le lendemain. Nous savons tous que nous sommes mortels, mais la nuance est énorme entre savoir que nous sommes mortels et savoir que nous allons mourir, et que ça peut arriver du jour au lendemain.
À ce moment-là, ma voix intérieure a pris un mégaphone et a percé toutes les autres voix, pour me demander chaque jour très clairement : «maintenant que tu sais que tu pourrais mourir demain, aurais-tu changé quelque chose à cette dernière journée que tu viens de passer ? »
Et c’est impossible de vivre comme avant lorsque l’on se pose cette question à la fin de chaque journée. Cette prise de conscience a été douloureuse au début. De là sont nés d’abord de petits changements, des compromis, puis des plus grands, et puis petit à petit, cette voix est devenue un guide sur le chemin vers le bonheur.
Pour être heureux, il m’a fallu aussi trouver du sens. Je pense qu’il faut que notre vie à tous (et donc notre métier, où nous passons 8h par jour) ait du sens à nos yeux. Car notre voix intérieure sait que nous sommes tous sur le même bateau, et le bonheur ne pourra donc être atteint que si nos actions ont un impact réel sur ce bateau.
Et pour finir, il nous faut aussi du courage, parce qu’en plus d’entendre et de reconnaître votre voix, il faudra aussi avoir le courage de l’écouter, car elle ne va pas toujours dire des choses évidentes à mettre en place, ni des choses qui vont plaire à votre entourage.
On m’a souvent dit : « Mais quel courage ! Ça ne doit pas être facile de vivre en tant qu’artiste ! ». Ce à quoi je répondais : « Parce que vous croyez que c’est facile, pour un artiste, de vivre en tant que banquier ? ».
Je vais terminer. Et vous l’avez compris, j’ai menti, je vous ai quand même donné un conseil tout au long de ce discours : celui de ne pas m’écouter. Vous êtes des adultes, vous avez votre diplôme, la vie est à vous. Alors n’écoutez plus ceux issus de ce monde périmé, de ce constat d’échec que nous vivons. Ne m’écoutez plus moi, n’écoutez plus les parents, n’écoutez plus les professeurs, n’écoutez plus les pubs ni les médias, et écoutez-vous, écoutez-vous en tout premier.
Le monde n’a plus besoin de battants, de gens qui réussissent, il a besoin de rêveurs, de personnes capables de reconstruire et de prendre soin… et surtout, surtout, on a tous besoin aujourd’hui, plus que jamais, de gens heureux. »
Paul Eluard écrivait déjà : « Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d’autre »
Il existe des vidéos de ce discours. Il faut l’écouter parce qu’il est drôle aussi et que cela fait passer le message autrement : <ICI>
C’est très beau, cela donne des désirs d’utopie dont nous avons besoin. Ce n’est pas un discours programme.
Il peut être nuancé et critiqué comme par cet autre ingénieur : « pourquoi je ne suis pas d’accord avec Pedro Correa »
Mais je pense que sur des questions de sens, d’éthique et de priorité de vie il dit des choses essentielles.
Le mot du jour du 7 janvier 2014 citait John Lennon :
« Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand.
J’ai répondu « heureux ».
Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question,
j’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie. »
<1335>
-
Jeudi 26 décembre 2019
«Schwowe Bredele»Gâteaux de noël alsaciens n°7 (Sablés souabes)Le 26 décembre était dans mon enfance et ma Moselle natale le deuxième jour de Noël. C’est un jour férié, là bas.
C’est le jour de « Saint Étienne » premier martyr de l’histoire du christianisme.
Et le jour de Saint Étienne, les habitants d’Alsace et de Moselle sont au repos. Le lendemain de Noël est chômé dans seulement trois départements de France : la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
Ce jour était chômé dans toute la France avant 1905, mais avec la Loi de séparation des Églises et de l’État, la troisième République a décidé de supprimer ce jour férié religieux.
En 1905, l’Alsace et la Moselle étaient allemands et continuaient à célébrer ce jour férié. Lorsqu’ils ont été rattachés à la France en 1918, les trois départements ont refusé d’abandonner les avantages que l’Allemagne de Guillaume II leur avait offerts. Cela fait partie du concordat d’Alsace-Moselle.
Ailleurs en Europe, le 26 décembre est aussi férié en Allemagne, en Autriche, en Irlande, en Italie, au Royaume-Uni, en Catalogne et dans certains cantons de la Suisse.
Cette introduction était nécessaire pour justifier qu’il était encore légitime d’évoquer une recette de gâteau de noël alsacien, puisque aujourd’hui c’est encore Noël en Alsace.
Mais ce sera la dernière recette et comme c’est la dernière il y aura en bonus une recette supplémentaire.
Ces «Schwowe Bredele» ou en allemand «Schwabe Bredele» sont avec les spritz vu mardi, les gâteaux alsaciens les plus traditionnels.
C’est encore une recette de Françoise.
Pour ces dernières recettes, je vais simplifier, j’écris d’abord les instructions et je mets les photos à la fin.
Les ingrédients sont les suivants :
- 500g de farine
- 250g de sucre fin
- 250g de beurre
- 150g d’écorce d’orange haché
- 250g d’amandes moulues
- ¼ de zeste de citron
- 5g de cannelle en poudre
- 2 à 3 jaunes d’œuf
Françoise fait une remarque préalable :
Important : Préparer la pâte la veille. Cette pâte peut se garder pendant plusieurs jours au frais.
Et puis voici la manière de faire :
Verser la farine dans un récipient et dresser une fontaine.
Dans un autre récipient, malaxer le beurre, ajouter le sucre, la cannelle, l’écorce d’orange, la poudre d’amande, le zeste de citron et les 2 jaunes d’œufs.
Bien mélanger le tout. Puis déposer cette préparation dans la fontaine de farine.
Pétrir pour obtenir une pâte ferme. Si la pâte est trop sèche, rajouter un 3ème jaune d’œuf.
Laisser reposer au frais.
Le lendemain étaler la pâte sur 3mm d’épaisseur.
Puis découper avec l’aide d’emporte-pièce de différentes formes, Françoise utilisait le terme de formes de Noël.
Un dernier conseil : Si la pâte est trop dure, il faut la travailler un peu avec les mains mouillées.
Enfourner et cuire à four moyen, c’est-à-dire 140° pendant 15 minutes.

Et une dernière recette pour laquelle je n’ai aucune appétence, mais que beaucoup aime, je m’incline donc.
« Spetzbuewe »
Gâteaux de noël alsaciens bonus au n°7 (Fourrés à la confiture)Les ingrédients sont les suivants :
- 250g de farine
- 100g de sucre semoule
- 80g de noisettes
- 150g de beurre
- 1 œuf entier
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 cuillère à café rase de levure chimique
- 1 cuillère à soupe de lait
- 1 petit pot de gelée de fruits rouges (Annie privilégie la groseille)
Pour la préparation : il convient de faire de la sorte :
Hachez les noisettes.
Mélangez la levure chimique à la farine et rajouter le sucre et le sucre vanillé.
Incorporez ensuite le beurre ramolli par petits morceaux et pétrissez jusqu’à absorption complète.
Ajoutez le lait et l’œuf entier, ainsi que les noisettes.
Travaillez bien la pâte, afin d’obtenir une pâte lisse.
Placez au frais pendant 30 minutes
Étalez la pâte en une abaisse de 3 à 4 millimètres d’épaisseur et avec l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre découpez la pâte (4cm de diamètre) et déposez les pièces sur des tôles recouverts de papier sulfurisé.
Dans la moitié des pièces ainsi obtenues, découpez un trou central. La recette officielle demande de découper 3 petits trous d’un centimètre de diamètre. Annie trouve cette complication inutile.
Enfournez à une température de 150°C pendant 12 à 13 mn.
Dans la recette officielle, il est prévu qu’après cuisson et refroidissement, on saupoudre les pièces trouées de sucre glace. Annie ne le fait pas : «trop de sucre ne vaut ! »
Étalez une couche de confiture sur les disques pleins, et déposez par-dessus les disques troués. Puis écrasez légèrement le montage.
Voilà ce que cela donne en photo :


L’instrument un peu mystérieux qui sert à faire le trou central (3) dans le gâteau est celui-ci : il est vendu sous le nom de de vide-pomme. Mais votre créativité et les ustensiles de cuisine dont vous disposez doivent vous permettre d’arriver au même objectif sans cet appareil. De vieux grimoires alsaciens évoquent l’idée d’un dé à coudre.
Et pour finir, un après-midi Sylvie est venue nous aider et aussi recueillir une partie de la transmission de cette tradition.Elle a, avec un bout de pâte qui restait du Schwowe Bredele, c’est-à-dire du sablé souabe, confectionné cette forme d’une taille conséquente.

C’est une invitation à la fantaisie, ce que permet la confection de ces gâteaux.
Et pour revenir à la tradition, nous avons accroché ce gâteau à notre sapin.
<1334>
- 500g de farine
-
Mardi 24 décembre 2019
«Spritz»Gâteaux de noël alsaciens n°6Cette fois nous sommes sur les fondamentaux, le « Spritz » est le gâteau de Noël alsacien par excellence.
Dans le livre de Thierry Kapler (page 23) ils appellent cela « Spretz bredele» traduit en français par « sablés aux amandes ».
Ce n’est pas notre terminologie, nous appelons ces gâteaux « Spritz » et puis c’est tout !
Annie les fait selon la recette donnée par Françoise et écrite ci-dessous, cette fois en français.
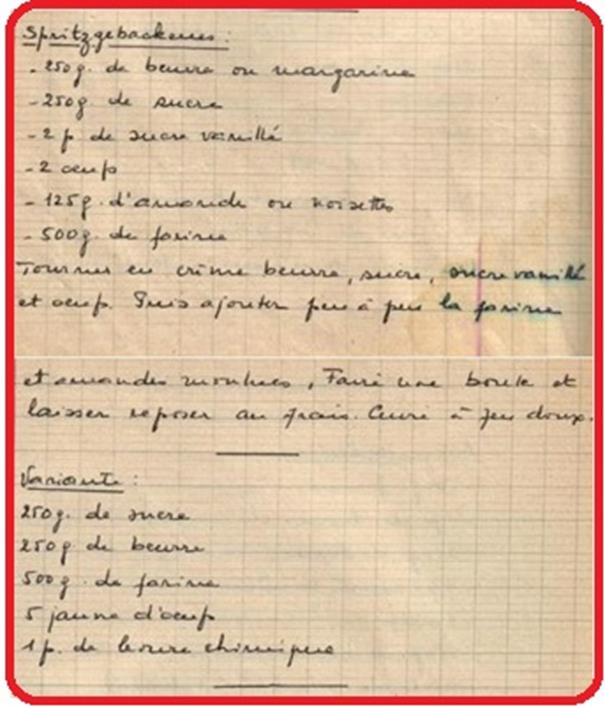
Par rapport à ce qui est écrit ci-dessus, il faut faire des choix.
Donc nous prenons les ingrédients suivants :
- 250 g beurre
- 250 g sucre semoule
- 2 paquets de sucre vanillé
- 2 Œufs entiers
- 125 g d’amandes moulues
- 500 g farine
Les « Spritz » ne nécessitent pas de peser les œufs.
Pour bien faire ces gâteaux il vaut mieux disposer d’une machine à hacher la viande de vieille tradition à laquelle on doit adapter un embout spécial gâteau.
 Une photo valant mieux qu’un long discours, voici cet appareil venu tout droit de la cuisine de nos grand-mères. Vous pouvez acheter cet appareil sur ce <site> spécialisé en bredele.
Une photo valant mieux qu’un long discours, voici cet appareil venu tout droit de la cuisine de nos grand-mères. Vous pouvez acheter cet appareil sur ce <site> spécialisé en bredele.
Il faut réaliser la pâte avec le robot ménager ou un batteur traditionnel.
On tourne d’abord en crème le beurre, le sucre et le sucre vanillé
Puis on ajoute les 2 œufs entiers.
Et enfin, peu à peu la farine et les amandes moulues.

Cette pâte est lisse et molle.
Il faut la mettre en boule, la couvrir et la laisser reposer au réfrigérateur afin de la rendre plus ferme.
Et il faut la sortir au fur à mesure et immédiatement la faire passer par l’appareil dans lequel elle va se ramollir rapidement.
 On tourne donc avec la manivelle pour faire sortir la pâte par l’embout qu’on a choisi et on guide le gâteau délicatement avec la main. Puis quand la taille qui nous convient est atteinte, on coupe avec la main en la soulevant et on repose le gâteau sur la tôle couverte de papier sulfurisé qu’on a eu soin de déposer au pied de l’appareil.
On tourne donc avec la manivelle pour faire sortir la pâte par l’embout qu’on a choisi et on guide le gâteau délicatement avec la main. Puis quand la taille qui nous convient est atteinte, on coupe avec la main en la soulevant et on repose le gâteau sur la tôle couverte de papier sulfurisé qu’on a eu soin de déposer au pied de l’appareil.
Si on ne dispose pas de l’appareil, il est possible de s’en passer.
Dans ce cas, on fait des boudins ou des rectangles et puis on les cisèle à l’aide d’une fourchette.
Puis on enfourne.
La cuisson se fait à 160°C
Annie écrit pour le temps : 15 minutes + ou – 2 minutes.
Le conseil impératif c’est que le gâteau reste blanc au dessus, il ne doit pas brunir, sinon ce n’est pas un gâteau alsacien.
Le résultat ressemble à cela.

Dans cette recette, il est tout à fait possible de remplacer les amandes par des noisettes, si ces dernières ont votre préférence.
Vous lirez sur le cahier de Françoise qu’il existe une variante qui exclut amandes ou noisettes et remplace les 2 œufs entiers par 5 jaune d’œufs.
Du point de vue de l’œuf alsacien normé vous constaterez que c’est le même poids :
- 2 œufs entiers : 2x50g =100g
- 5 jaunes d’œuf : 5x20g=100g
Nous n’avons jamais fait cette variante qui nous prive du goût des amandes ou des noisettes.
Joyeux Noël à tous. En alsacien : « gleckika Wïanachta ». Vous trouverez sur <ce site> la traduction de «joyeux noël» en 135 langues.
<1333>
- 250 g beurre
-
Lundi 23 décembre 2019
« Haselnuss Blattle »Gâteaux de noël alsaciens n°5 (aux noisettes)Ce gâteau, je ne le fais que depuis 3 ans. Il se trouve dans le livre de recettes dont j’ai parlé lundi dernier, page 73.
Le nom français donné est « Losanges aux noisettes »
Ma fille Natacha dit de ce gâteau : «c’est une tuerie !».
Pour arriver à cet « extrémisme » il faut beaucoup aimer les noisettes.
Puisqu’il n’y a que des noisettes dans ce gâteau avec du sucre et des œufs.
Il n’y a toujours pas de beurre mais il y a :
- 250 g de de sucre semoule
- 250 g de noisettes moulues
- 2 œufs entiers
- 125 g de sucre glace
Concernant l’équilibre des ingrédients, ce gâteau ne présente pas de fragilité, il n’est donc pas nécessaire dans ce cas de peser les œufs.
Il faut moudre les noisettes.
Puis séparer un des œufs en blanc et en jaune.
Puis on mélange les noisettes moulues, le sucre semoule, le second œuf qui est resté entier et le jaune d’œuf du premier. Et on bat ce mélange pour obtenir une pâte ferme.

Il faut donc étaler cette pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie
La recette officielle précise en une abaisse de 4 millimètres d’épaisseur.
C’est une des difficultés de cette recette. Comme cette pâte est collante, lorsque vous passez le rouleau à pâtisserie, une partie de la pâte va s’accrocher au rouleau et rendre l’opération de plus en plus compliquée.
La recette officielle conseille d’utiliser du sucre glace pour éviter que la pâte se colle au rouleau. Je trouve qu’il y a déjà assez de sucre comme cela.
On peut aussi utiliser de la farine.
Mais je crois que la solution la plus intelligente est de poser du papier sulfurisé sur la pâte et de passer le rouleau à pâtisserie par-dessus le papier.
 L’étape suivante consiste à battre le blanc d’œuf restant avec le sucre glace en neige très ferme.
L’étape suivante consiste à battre le blanc d’œuf restant avec le sucre glace en neige très ferme.
Puis, à l’aide d’une spatule, il faut couvrir la pâte étalée avec la préparation de blancs en neige.
Ensuite on découpe la pâte en bande, la recette dit de 3 cm de large. Je fais moins. Puis on découpe ces mêmes bandes en petits losanges.

 Il faut ensuite déposer délicatement chaque pièce sur une tôle recouverte de papier sulfurisé.
Il faut ensuite déposer délicatement chaque pièce sur une tôle recouverte de papier sulfurisé.
La cuisson est : 125° C, pendant 25 minutes.
Et voici le résultat :

<1332>
- 250 g de de sucre semoule
-
Vendredi 20 décembre 2019
« Pain d’épice de Nuremberg »Gâteaux de noël alsaciens n°4Cette recette est particulière pour Annie et moi car c’est notre amie Françoise qui nous l’a apprise.
Elle nous a aussi permis de scanner son cahier dans lequel elle avait minutieusement écrit tous ses secrets.
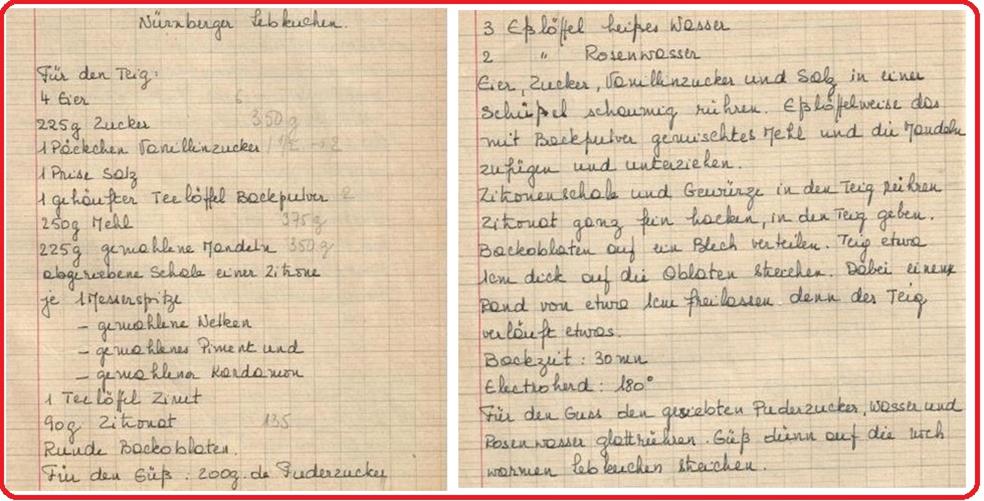
Ce sont aussi de nos souvenirs que notre vie d’aujourd’hui se nourrit.
Vous constaterez que la recette est écrite en allemand. Il s’agit donc du « Nürnberger Lebkuchen »
Si les trois gâteaux des jours précédents relevaient de ma spécialité, celui-ci a toujours été fait par Annie. C’est un gâteau facile à faire, qui parfume la cuisine et donne un résultat généreux. Très gratifiant, Annie conseille de commencer le festival des gâteaux de Noël par celui-ci.
En ce qui concerne le nombre d’ingrédients, nous montons en gamme, il y en a douze, mais pas de beurre
- 250 g de farine
- 225 g de sucre
- 1 paquet de sucre vanillé (7,5 g
- 1 cuillère à café de levure chimique (bien pleine)
- 4 œufs (pas nécessaire de les peser précise Annie
- 225 g amandes moulues (émondées ou non)
- 90 g de fruits confits coupés (orange, citron,…
- 1 zeste de citron
- 1 cuillère à café de canelle
- 1 cuillère à café de piment dou
- 1 pincée de cardamone et de clou de girofle moulu
- du sucre glace pour la décoration

On commence par mélanger les œufs, le sucre et le sucre vanillé.
Puis on ajoute la farine et la levure.Et après, on met peu à peu le reste, c’est-à-dire :- Les amandes moulues
- les fruits confits et coupés (orange, citron,…)
- le zeste de citron
- la cuillère à café de canelle
- la cuillère à café de piment doux
- les pincées de cardamone et de clou de girofle

Cette pâte est collante. Il faut l’étaler sur une tôle, comme toujours, couverte de papier sulfurisé.

Cette opération peut être réalisée à l’aide d’une spatule ou d’un couteau.
Quand la pâte est étalée, on l’enfourne immédiatement.
Les consignes d’Annie :
Température : 160°C pendant 15 minutes à 20 minutes.
Il faut regarder et sortir le gâteau quand il est prêt. On peut le vérifier en plongeant un couteau dans la pâte.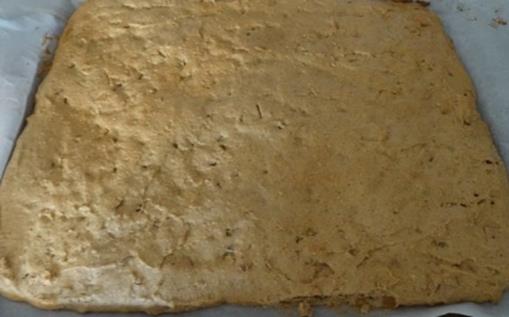
A la sortie du four il ressemble à cela.
Puis on fait une préparation de glaçage comme pour les rhum bredele mais sans rhum.
On va utiliser plus prosaïquement de l’eau chaude avec laquelle on mouille le sucre glace pour faire la crème.
On badigeonne le gâteau refroidi.
On laisse sécher.
Puis on coupe en petits carrés
Et voici le résultat

<1331>
-
Jeudi 19 décembre 2019
« Rhum bredele »Gâteaux de noël alsaciens n°3Ce gâteau n’est pas un gâteau de mon enfance.
Il présente l’immense avantage qu’après avoir fait les macarons aux amandes, vous disposez de jaunes d’œufs inutilisés. Ces gâteaux vont permettre de les utiliser. Et j’ai trouvé cette recette dans le livre que nous a offert Françoise et dont j’ai parlé lundi.
Cette fois il y a du beurre et du sucre et… du rhum. Je suppose que c’est l’association de ces 3 ingrédients qui font tout le succès de ces gâteaux.
Cette fois il y a beaucoup d’ingrédients : huit.
La recette, page 79 du livre, annonce :
- 175g de farine
- 125g de sucre fin
- 100g de beurre
- 3 jaunes d’œufs
- ½ cuillère à café rase de levure chimique
- 50g de raisins de secs (sultanines)
- 150g de sucre glace
- 4 cuillères à soupe de rhum
Quelques remarques préliminaires :
A mon sens cette recette, bien qu’il y ait beaucoup d’ingrédients, me semble plus simple à réaliser que les deux premiers gâteaux. Je veux dire qu’il est plus rare de rater sa réalisation.
- Le point le plus délicat me semble être la préparation du glaçage pour napper les gâteaux. A ce stade, la mesure de 150 g de sucre glace et de 4 cuillères à soupe de rhum ne me semble pas la bonne la manière d’aborder le sujet, il faut être plus pragmatique. Nous y reviendrons.
- Vous constatez que dans cette recette, il est question de 3 jaunes d’œufs alors que vous disposez de 6 jaunes d’œuf après avoir fait les macarons. Rien ne vous empêche de doubler les mesures de cette recette. L’apport de beurre, de sucre et de rhum me semble cependant inciter à une certaine modération, même si vous êtes en très bonne santé.
- L’indication de la recette officielle : « ½ cuillère à café rase de levure chimique » me semble obscure. Une cuillère rase je vois ce que c’est, une demi cuillère aussi, mais une demi cuillère rase me semble un concept flou. Je prends une demi-cuillère.
- Vous pouvez peser les jaunes d’œufs qui doivent donc dans ces proportions peser 60g. Toutefois pour cette recette, l’équilibre des ingrédients n’est pas fragile comme pour les anis et les macarons.
- Il m’est arrivé et j’ai trouvé le résultat probant de remplacer une partie des 50g de raisins par des cranberrys secs, disons 10g.
- Enfin depuis l’année dernière j’ai remplacé dans la recette 10g de sucre et 40g de farine par 50 g de noisettes en poudre. Cela ajoute un goût plus subtil.
J’ai fait une dernière innovation, mais j’en parlerai plus tard.
La première étape consiste à battre le beurre en mousse avec le sucre fin jusqu’à blanchir la masse.
Il faut évidemment que le beurre soit à température ambiante et soit sorti du réfrigérateur au moins depuis deux heures.
S’il le faut et avec beaucoup de prudence et à température très douce, il est possible de faire fondre une petite partie du beurre dans une casserole.
Puis il faut ajouter un à un les jaunes d’œufs.
Puis la farine ; la levure chimique et les raisins secs.
 Cela donne une pâte assez solide et compacte.
Cela donne une pâte assez solide et compacte.
La dernière innovation consiste à mettre une cuillère à café de rhum sur les raisins secs, avant de les insérer dans la pâte.
 Trop de beurre nuit au beurre et surtout à la santé, donc encore une fois vous ne beurrez pas la tôle mais vous la recouvrez de papier sulfurisé.
Trop de beurre nuit au beurre et surtout à la santé, donc encore une fois vous ne beurrez pas la tôle mais vous la recouvrez de papier sulfurisé.
Contrairement aux anis et au conseil du livre je ne trouve pas opérant d’utiliser deux cuillères à café pour déposer la pâte sur la tôle.
Je trouve beaucoup plus simple de faire ce travail à main nue et en confectionnant des petites boules avec les doigts.
Au four cette pâte va s’étaler pour donner des palets.
Après cela on peut enfourner.
 Dans notre four c’est 125°C pour 15 minutes.
Dans notre four c’est 125°C pour 15 minutes.
Je rappelle que pour les gâteaux on n’utilise pas la chaleur tournante du four.
Il faut les laisser refroidir au moins une heure avant de les glacer.
 Pour le glaçage, je préconise de ne pas suivre la recette de manière rigide. Moi je mets un fond de sucre glace dans un ramequin que je mouille peu à peu de rhum, tout en le remuant avec le pinceau qui va me permettre d’étaler le glaçage sur le gâteau.
Pour le glaçage, je préconise de ne pas suivre la recette de manière rigide. Moi je mets un fond de sucre glace dans un ramequin que je mouille peu à peu de rhum, tout en le remuant avec le pinceau qui va me permettre d’étaler le glaçage sur le gâteau.
Et je m’arrête de mouiller, à partir du moment où j’obtiens une préparation propice à être utilisée.
Et je recommence la mixture, lorsque j’ai totalement étalé la première préparation.
Si vous voulez aller trop vite vous allez successivement rajouter du rhum ou du sucre glace pour obtenir la bonne texture. Et au bout du bout, vous aurez une préparation bien trop importante pour vos besoins. En outre, vous aurez gâché du rhum et du sucre glace.
 Après le glaçage vous obtenez des gâteaux qu’il faut encore laisser reposer avant de pouvoir les manger une fois que le glaçage aura fait son effet.
Après le glaçage vous obtenez des gâteaux qu’il faut encore laisser reposer avant de pouvoir les manger une fois que le glaçage aura fait son effet.
A consommer donc avec modération…
<1330>
- 175g de farine
-
Mercredi 18 décembre 2019
« Les macarons aux amandes »Gâteaux de noël alsaciens n°2Comme pour les « Anis Bredele » les macarons aux amandes ou si on veut rester dans l’ambiance alsacienne « die Mandel Makrone » sont liés à mon enfance car ceux que faisait ma mère étaient succulents et mon objectif de pouvoir approcher cette perfection s’est révélé encore plus difficile.
Hier, il y avait 4 ingrédients. Pour les macarons, il n’y a plus que 3 ingrédients et toujours pas de beurre…
- 6 blancs d’œufs
- 250g de sucre fin
- 350g d’amandes
Nous avons maintenant l’expérience d’une première recette de gâteaux alsaciens, la deuxième pourra être un peu plus rapide et insister sur les points particuliers.
 Si on veut résumer ce gâteau, c’est assez simple :
Si on veut résumer ce gâteau, c’est assez simple :
C’est une meringue à laquelle on ajoute de la poudre d’amandes.
La première chose est donc de séparer les blancs des jaunes.
Nous trouvons l’utilisation d’un petit ustensile particulièrement commode pour procéder à cette opération.
Nous disposons donc à la fin de 6 blancs d’œuf.
Si vous avez bien suivi, vous saurez que nous allons les peser.
Il faut donc une précision supplémentaire :
Un œuf c’est 50 g, un blanc d’œuf c’est 30 g et un jaune d’œuf 20g.
6 blancs d’œuf devraient donc peser 180g. Cette année quand j’ai pesé les 6 blancs d’œuf j’ai obtenu 235g.
Nous ne sommes pas dans la configuration rapportée hier pour les anis (308 pour 300 soit un surplus de 3%). Cette fois, nous avons un surplus de 55g, ce qui représente 31% de plus par rapport à la mesure attendue, cohérente avec les mesures de sucre et d’amandes.
Il est très clair que si vous ne mettez pas en œuvre, dans un tel cas, les mesures correctives grâce à une habile règle de trois, développée hier, le résultat que vous allez obtenir sera d’une platitude désespérante. Probablement même que vous n’obtiendrez pas des gâteaux individuels mais une masse informe sur l’ensemble de votre plaque qui aura certes quelque gout, mais dont l’aspect vous interdira de le présenter à quiconque.
Donc on rectifie les mesures comme il se doit.
Ensuite, il s’agit de mélanger les blancs d’œufs et le sucre. Pour ce faire, la tradition veut que vous fassiez le mélange dans une casserole que vous allez chauffer à 55°C, mélange que vous remuerez, sans arrêt, manuellement à l’aide d’un fouet.
 Je suppose qu’il existe des appareils électriques qui à la fois remue le mélange, le chauffe exactement à 55°C et le conserve à cette température. Si vous disposez d’un tel appareil n’hésitez pas à l’utiliser. Ce n’est pas notre cas.
Je suppose qu’il existe des appareils électriques qui à la fois remue le mélange, le chauffe exactement à 55°C et le conserve à cette température. Si vous disposez d’un tel appareil n’hésitez pas à l’utiliser. Ce n’est pas notre cas.
Une fois la température atteinte et le mélange sucre, blanc d’œuf homogène, vous allez battre cette préparation en neige ferme. Je ne donne aucun temps, il suffit de regarder. Et de savoir ce qu’est une neige ferme. Une photo permet de visualiser le concept.
Après cela, il faut incorporer la poudre d’amandes qui est le moment le plus délicat de cette recette.
Au préalable il faut bien sûr disposer de poudre d’amandes.
Vous pouvez l’acheter directement sous format de poudre. Nous l’avons fait souvent. A Lyon, la famille d’origine arménienne Bahadourian vend d’excellents produits.
Mais on peut aussi émonder les amandes et les moudre soit même à l’aide d’un appareil adéquat.
Pour les émonder, la méthode la plus simple est de les mettre dans de l’eau chaude. La peau s’enlève facilement. Mais vous avez alors des amandes légèrement cuites et surtout humides.
Ma maman les mettait au four avant de les moudre.
Il est aussi possible de mettre les amandes dans de l’eau froide une nuit et le lendemain de les émonder. L’avantage c’est qu’ainsi leur goût n’est pas altéré par l’eau chaude, l’émondage est un peu moins commode.
De toutes les manières, il faut arriver à de la poudre d’amandes. En principe, dans la recette toutes les amandes sont émondées. Mais ce qu’il y a de bien avec ces traditions, c’est qu’elles permettent des innovations, je ne dis pas des progrès. Cette année, nous avons laissé un peu moins du quart des amandes avec leur peau et nous avons mélangé les deux poudres obtenues. Il semble que le résultat soit tout à fait convaincant. Moi je ne sais pas, je n’ai pas goûté.

Je disais donc que l’étape délicate de cette recette c’est l’incorporation de la poudre d’amandes dans les œufs battus en neige ferme.
Il faut, autant que faire se peut, ne pas « casser » la préparation obtenue.
Je fais cette opération manuellement en adoptant un mouvement de roulis et …
Comme toujours en prenant mon temps.
Aucune précipitation ne saurait obtenir un bon résultat.
 C’est encore une photo qui permet d’approcher ce que devrait être le résultat final.
C’est encore une photo qui permet d’approcher ce que devrait être le résultat final.

Puis il faut déposer sur la tôle (non beurrée !!!) mais protégée par du papier sulfurisé des dômes de cette pâte.
On se sert d’un appareil avec douille, une poche ou comme ici une seringue.
Et doucement, délicatement on dépose comme une offrande une petite forme qui deviendra macaron.
Une fois ce travail réalisé, il faut encore attendre. Laissez reposer environ 2 heures.
Puis vous enfournez comme précisé hier.
La température est faible 125°C.
Le temps de cuisson est dans notre four de 25 minutes.
Selon votre goût, vous pouvez jouer sur quelques minutes.
Et voici le résultat

<1329>
- 6 blancs d’œufs
-
Mardi 17 décembre 2019
« Anis Bredele »Gâteaux de noël alsaciens n°1Les gâteaux à l’anis constituent des souvenirs d’enfance. Ma mère en faisait de très bons et mon objectif a toujours été de pouvoir approcher cette perfection.
Au départ c’est simple il y a 4 ingrédients :
- 600 g de farine blanche
- 500g de sucre fin
- 6 œufs donc en traduction 300 g d’œufs (6 x 50g)
- 4 cuillères à soupe bombées de grain d’anis.
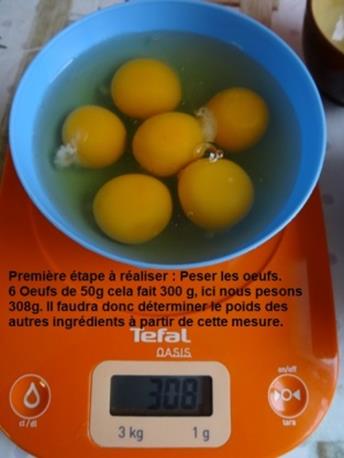
Sur ce point la recette officielle dit 4 cuillères à café.
Mais cette mesure n’est que pour celles et ceux qui détestent l’anis.
On peut se poser la question légitime dans ce cas s’il est judicieux de vouloir faire des gâteaux à l’anis.
Mais dans ma conception, même 4 cuillères à soupe correspondent à des personnes qui n’aiment pas trop l’anis.*
Moi j’en mets au moins 6 et 7 les années euphoriques…
Cela étant, la première étape est de peser les œufs.
On prend 6 œufs et on s’attend qu’ils pèsent 300 g.
Cette année ils pesaient 308 g. C’est un peu supérieur à 300g.
A ce niveau, vous pourriez ne pas changer les mesures de farine et de sucre.
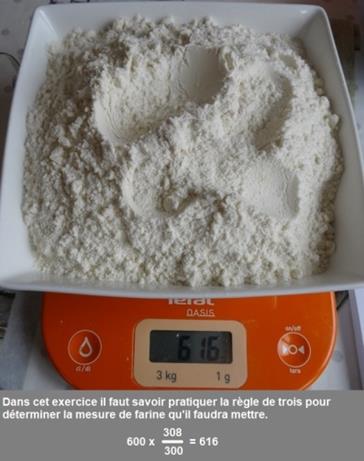
Mais dans ma rigueur germanique et alsacienne, je tiens compte du dépassement et je paramètre donc la recette selon une belle règle de trois.
Mon professeur de mathématiques supérieures au Lycée Kléber de Strasbourg disait : « si vous savez faire une règle de trois, vous savez faire des mathématiques »
L’application de la règle de trois dans ce cas pour la farine, donne 616 g.
On agit de même pour le sucre et on obtient 513 g.
Puis on mélange les œufs et le sucre et on les bat.
La recette dit au moins 20 minutes.
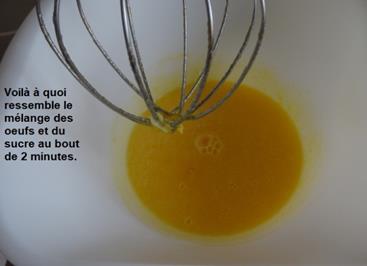
Pour ma part, cela dure plutôt 30 minutes.
Ma façon de faire est de commencer à petite vitesse.
Puis d’augmenter la vitesse.
Puis je reviens à une vitesse plus modérée pour empêcher l’appareil de trop chauffer.

La pâte doit être épaisse et bien claire.
On mélange alors la farine avec le nombre de cuillères d’anis qui vous va bien, selon votre affinité avec cette épice. A ce stade, il faut changer le fouet du robot ménager. Il est, en effet, nécessaire de disposer d’un fouet capable de mélanger une pâte lourde à base de farine.
On peut alors ajouter, peu à peu, l’anis et la farine,

Cette opération est aussi assez longue.
Il faut obtenir une pâte homogène et qui s’étire en ruban.
Avec mon appareil, cette année, cela a duré 20 minutes.
Cette pâte n’est pas facile à étaler.
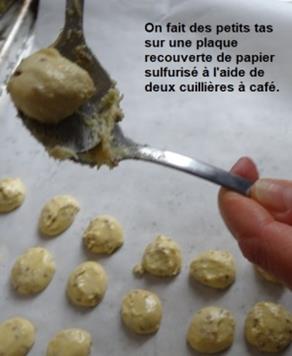
Il faut faire des petits tas sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Après plusieurs tentatives diverses et variées, il nous semble à Annie et moi que le plus opérant est d’utiliser deux cuillères à café pour arriver à ce résultat.
Hier j’ai écrit, qu’il faut savoir prendre son temps.

C’est particulièrement vrai pour les gâteaux à l’anis
Il faut donc laisser reposer 24 heures dans un endroit tiède dit la recette..
Nous on laisse reposer à température ambiante. Il ne faut malgré tout qu’il ne fasse pas trop chaud dans votre appartement.
La solution rapide de faire reposer 12 heures est possible.
C’est moins bon, mais possible.
Si vous voulez faire reposer moins de 12 heures, je vous conseille de faire un autre gâteau.
Une fois que l’heure est arrivée, il faut les mettre dans le four.
Notre four dispose de 5 niveaux, je mets la plaque au 2ème niveau en commençant par le bas, autrement dit c’est en dessous du milieu.
Dans un four plus petit vous les mettez au milieu.
La température c’est 160°, le temps c’est 11 ou 12 minutes.
Souvent la première plaque c’est 12 minutes puis la suivante 11 minutes.
Cela doit dépendre du four.
L’objectif c’est que la pâte reste blanche, aucune tâche colorée n’est tolérée.
Il faut évidemment qu’il y ait un pied qui fait que cela ressemble un peu à un champignon
Le pied qui a reposé sur la plaque doit lui être un peu coloré.
Et voici le résultat :

<1328>
- 600 g de farine blanche
-
Lundi 16 décembre 2019
« Les gâteaux de Noël alsaciens »Patrimoine culinaire alsacienDepuis une tradition ancestrale qui remonte au moins au début des années 2000, Annie et moi fabriquons dans notre cuisine des gâteaux de Noël alsaciens appelés dans le langage de là-bas les « Bredele ».
Faire ces gâteaux, c’est d’abord un plaisir des yeux et une satisfaction olfactive délicate et harmonieuse.
C’est aussi un plaisir du goût et de la saveur.
Et puis c’est un plaisir du partage et du don.
Certaines et certains qui ont bénéficié de ce don les années passées, quand arrive la période de Noël, réclament d’ailleurs le renouvellement de l’offrande.
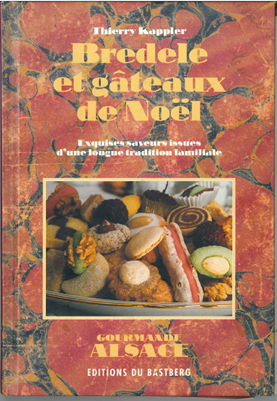 Mais faire des gâteaux de Noël prend du temps et nécessite une attention assez exclusive.
Mais faire des gâteaux de Noël prend du temps et nécessite une attention assez exclusive.
Je ne peux pas faire des bredele et en même temps écrire des mots du jour sur la Chine.
Alors j’avais deux solutions :
- Suspendre l’écriture des mots du jour
- Ou écrire des mots du jour sur le sujet qui m’occupait en ce moment avec Annie.
Je vais donc décliner, avec l’aide d’Annie, dans les jours qui viennent les recettes de certains gâteaux de Noël.
Il y a quelques questions techniques.
Comme celle par exemple du poids d’un œuf alsacien.
J’avais déjà consacré un mot du jour, celui du <25 décembre 2017> à ce détail technique.
En effet, quand on vous dit pour une recette il faut prendre 600g de farine, 500g de sucre et 6 œufs, la dernière mesure est imprécise.
Vous n’arriverez pas au même résultat si ces 6 œufs pèsent comme le prévoit les alsaciens 300 g ou s’ils pèsent 350 g ou plus rarement 250 g.
Mais la technique ne suffit pas, il faut aussi savoir prendre son temps et y mettre… un supplément d’âme et de générosité.
Nous avons été initiés par notre inoubliable amie Françoise.
Avant Noël, elle venait à Lyon et pendant plusieurs jours faisait des gâteaux pour ses enfants, pour nous, un tout petit peu pour elle.
C’était le moment le plus heureux et le plus magique de la période de Noël.
C’est elle qui nous a transmis, ce secret du poids de l’œuf alsacien, révélation qui lui avait été donnée par une vielle alsacienne.
Elle nous a aussi offert ce livre : « Bredele et gâteaux de Noël » de Thierry Kappler.
Mais comme je l’ai écrit la technique est indispensable mais ne suffit pas.
Elle nous a aussi montré le supplément d’âme, la joie de faire pour que cette joie puisse se retrouver dans les gâteaux offerts et savourés.
J’ai trouvé sur <ce site> quelques explications alsaciennes :
« En dialecte, leur nom varie selon que l’on est Haut‐rhinois (Bredala) ou Bas‐Rhinois (Bredele) et, à Strasbourg, on les appelle bredle »…
J’exprime un doute sur ce dernier point, à Strasbourg j’ai toujours entendu parler comme pour le reste du Bas-Rhin de Bredele.
L’article poursuit :
« Bredele vient du mot allemand « Brot »qui signifie « pain ». Ce sont donc littéralement des « petits pains ». Leur petite taille est leur point commun à tous, puisqu’elle ne dépasse pas 3‐4 cm, que ce soit en hauteur, en largeur ou en diamètre.
Il existe des bredele spécifiques, ceux que l’on confectionne à l’approche de Noël (Winàchta) : on les appelle les Winàchtsbredele, ou petits gâteaux de Noël. Selon un dicton alsacien : « Quand au crépuscule rougeoie l’horizon, on dit que c’est le Christkindel (l’enfant Jésus) qui allume le four pour faire cuire les bredele… ». Traditionnellement, la confection des bredele commence dès la fin novembre et se poursuit tout au long de l’Avent.
Cela s’explique par le fait que, jusque dans les années 1950, les bredele servaient aussi à décorer le sapin de Noël. Pendant longtemps, les décorations du sapin faisaient office de cadeaux : les bredele et les petits pains d’épices étaient souvent les seuls présents que recevaient les enfants puisque les ingrédients entrant dans leur composition étaient rares et chers (farine blanche, fruits confits, épices, sucre de canne, beurre).
Les théories sur l’origine des bredele sont nombreuses. De mémoire d’Alsacien, « Ça existe depuis toujours ! ». Certains indices laissent à penser que la fabrication des bredele viendrait des traditions des peuples païens qui ont vécu en Alsace. En effet, les Celtes et les Romains offraient aux dieux des petits gâteaux à base de farine et de miel.
D’autres indices sur la fabrication des bredele sont révélés par les moules qui servaient à les façonner. Les plus anciens retrouvés aux abords du Rhin datent du 14e siècle. Et la première recette de bredele à être mentionnée dans des écrits du 16e siècle est celle du « Anisbrod « , littéralement « pain à l’anis « , l’ancêtre des actuels Springerle et Anisbredele.
Au 16e siècle, les moules à bredele étaient fabriqués en terre cuite, un matériau permettant plus facilement des décors fantaisie et résistant à la cuisson. Puis, à partir du 18e sont apparus les moules métalliques et les emporte‐pièces et, avec eux, d’innombrables formes différentes.
A partir du 19e siècle certains ingrédients de base deviennent plus accessibles, comme le sucre de canne, la farine, le beurre, les fruits à coques et les épices. La créativité et l’inventivité des boulangers alsaciens n’a alors plus de limites, et de multiples recettes de petits gâteaux très variés voient le jour. »
Je vais tenter, humblement, de transmettre un peu de cette tradition dans les prochains mots du jour.
Cette année sera pour moi particulière, puisque convaincu que «les cellules de trop de vie» qui se sont développées dans mon organisme sont particulièrement friandes de sucre, je ne mange plus de sucre raffiné depuis le 18 janvier.
Il reste le plaisir des yeux et la satisfaction olfactive délicate et harmonieuse et surtout la joie du partage et du don.
<1327>
- Suspendre l’écriture des mots du jour
-
Vendredi 13 décembre 2019
«La persécution de la communauté juive de Kaifeng»Une minuscule communauté qui met en danger la nation chinoise ?Après le mot du jour d’hier dans lequel je décrivais l’ambition de XI Jinping et des autorités du Parti Communiste Chinois de faire le récit d’une grande nation chinoise homogène dans laquelle les particularités de toute sorte doivent s’estomper, il serait cohérent de parler de l’action du gouvernement chinois au Tibet et au Xinjiang.
Mais il m’a paru plus pertinent encore d’évoquer non une ethnie minoritaire, mais une communauté religieuse qui existe à l’état de trace dans l’immense Chine.
Elle est de taille minuscule, j’ai trouvé peu d’informations à son sujet mais je crois comprendre qu’elle ne compte guère plus que de 1000 membres sur toute la Chine. Une poussière au regard de l’immensité du nombre de chinois et particulièrement de l’ethnie Han.
Pourtant elle est persécutée.
Il s’agit de la communauté juive.
J’ai été informé de ce sujet par un reportage de France 24 sur <La communauté juive de Kaifeng>
La Chine compte une minuscule communauté juive centrée autour de la ville de Kaifeng, dans l’Est. Une centaine de familles était jusqu’il y a peu une curiosité touristique mais elle est désormais sous pression des autorités, sommée d’effacer toute trace visible de son héritage historique. Des décisions qui font écho à la volonté de Xi Jinping, qui a récemment appelé à se prémunir « des infiltrations des puissances étrangères dans la société chinoise, par le biais de moyens religieux ».
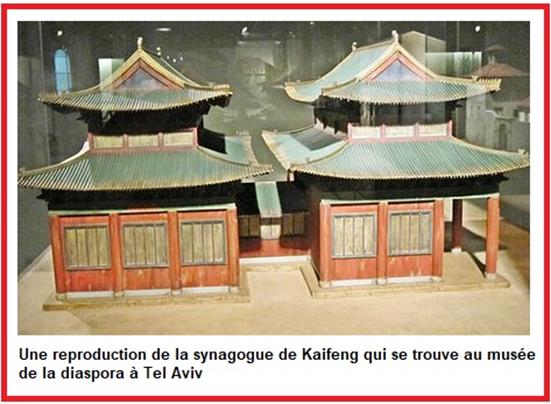 C’est une communauté qui ne compte qu’une centaine de familles. Mais elles troublent probablement l’homogénéité ou doit-on parler de la pureté de la nation chinoise ?
C’est une communauté qui ne compte qu’une centaine de familles. Mais elles troublent probablement l’homogénéité ou doit-on parler de la pureté de la nation chinoise ?
Le gouvernement a exigé que les ruines de la synagogue soient détruites.
Les rassemblements pour les prières ont été interdits.
Les autorités chinoises ont fait table rase du passé.
Il a fallu enlever les étoiles de David et même la pancarte indiquant l’existence de l’ancienne synagogue.
Les juifs se seraient installés à Kaifeng il y a dix siècles
Leurs ancêtres seraient des marchands venus de Perse par la Route de la Soie au VIIIème siècle.
Ce <site> donne quelques précisions supplémentaires sur la communauté juive de Kaifeng et l’hostilité de l’administration de Xi Jinping :
« La Nouvelle ère de surveillance et de sécularisation chinoise touche à présent une petite communauté juive de la région rurale de Kaifeng, dans la province du Henan au centre de la Chine. Ses membres disent avoir peur de se rassembler dans les espaces publics ou de protester contre la surveillance du PCC dont ils font l’objet. Leur histoire est aussi fascinante qu’elle est menacée par des politiques qui empêchent la communauté d’avoir tout contact avec les étrangers et qui ont causé l’arrêt des travaux de reconstruction de leur synagogue détruite. […]
Pour beaucoup, apprendre que la Chine abrite depuis plus de mille ans une communauté juive relativement isolée est un choc. Mais les Juifs de Kaifeng étaient autrefois un groupe prospère, avec de bonnes relations, qui vivait au centre de la route de la soie de l’Asie orientale.
Au IXe siècle, un groupe de marchands juifs persans est arrivé en Chine par la route de la soie. Ils ont été chaleureusement accueillis par des émissaires de la dynastie Song du nord dans la ville de Kaifeng. Les marchands ont fini par décider de s’installer à Kaifeng et ont commencé à s’intégrer socialement dans la société chinoise des Hans. En dépit de la lenteur du processus qui a duré plusieurs siècles, des mariages entre leur communauté et des familles hans locales ont pu avoir lieu. Ces familles persano-hans combinaient les traditions du judaïsme avec des éléments sociaux et religieux de la culture chinoise han et, ce faisant, se sont unies pour former un groupe singulier et distinct en Chine : les Juifs de Kaifeng. Ils étaient plus de mille.
En 1163, les Juifs de Kaifeng ont alors décidé d’ériger le Temple respectant les Écritures de la voie, une synagogue autour de laquelle ils organiseraient leur vie religieuse et communautaire.
[…] en 1849, une autre énorme inondation du Fleuve Jaune a de nouveau détruit la synagogue. Les Juifs de Kaifeng, alors pauvres, n’ont pas pu la reconstruire et ses ruines ont été laissées à l’abandon pendant des siècles. Les vestiges étaient devenus un vénérable symbole du passé prospère de la communauté et de son futur cloisonné.
[…] Cependant, lorsque Deng Xiaoping a institué la réforme de la « porte ouverte » en Chine à la fin du XXe siècle, des chercheurs, des universitaires et des touristes occidentaux ont commencé à affluer pour rendre visite aux Juifs de Kaifeng dont ils avaient entendu parler mais qu’ils n’avaient jamais pu rencontrer auparavant. […] Le premier point à l’ordre du jour était la reconstruction de la synagogue.
[…] Parmi les activités proposées figuraient des cours d’hébreu, des cours de cuisine et l’apprentissage de traditions et de textes juifs anciens. Certaines ont attiré des dizaines de personnes et les fêtes juives se sont avérées particulièrement populaires. Autour du quartier historique où vivaient les Juifs de Kaifeng, des panneaux en hébreu ont commencé à apparaître et des expositions sur la vie de leurs ancêtres organisées dans des musées ont attiré des touristes arrivant des quatre coins de la Chine. […] Lorsque les bureaux centraux du PCC ont eu vent de ce plan [de reconstruire la synagogue], l’ordre a été donné d’arrêter les projets »
Le prétexte était que ces actions étaient encouragées par des associations juives internationales.
De toute manière une vague de répression touche aussi les activités communautaires des chrétiens et des musulmans.
C’est l’étroitesse de cette communauté et la volonté chinoise d’effacer l’histoire millénaire des Juifs de Kaifeng jusqu’à étouffer toute tentative d’en récupérer les vestiges qui montre l’étendue du fanatisme des idéologues actuellement au pouvoir en Chine.
Ceci me fait penser au mot du jour du 27 février 2019 qui évoquait cette grande figure du tiers-mondisme Frantz Fanon qui disait : «Quand vous entendez dire du mal du juif, tendez l’oreille, on parle de vous !».
<1326>
-
Jeudi 12 décembre 2019
« Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation. Rien ne peut empêcher la nation et le peuple chinois d’aller de l’avant »Xi Jinping lors du discours qui célébrait le 70e anniversaire de la République Populaire de ChineAprès des mots du jour du début de cette semaine qui parlait d’émotion, de souvenir et d’humanisme, je vais revenir à ce sujet qui m’intéresse, m’interpelle et m’inquiète quelque peu dans la géopolitique du monde, la Chine de Xi Jinping.
La Chine est un empire qui veut être une nation.
La différence entre un empire et une nation avait déjà été abordée lors du <mot du jour du 30 octobre 2019> consacré à la dichotomie entre les Kurdes et la Turquie.
J’expliquais ainsi que les empires comme l’empire ottoman, l’empire austro-hongrois, l’empire russe et aussi l’empire chinois sont composés de plusieurs peuples, avec toujours un peuple dominant : les turcs pour le premier, les allemands pour le deuxième, les russes pour le troisième, les hans pour le quatrième. Dans un empire il est admis et nécessaire que l’empereur ou celui qui dirige l’empire soit en mesure, tout en préservant la domination de son clan, de faire en sorte que ces peuples puissent vivre ensemble.
La différence, la diversité sont non seulement acceptées mais aussi organisées.
Dans un État nation, c’est beaucoup plus compliqué d’exprimer ses différences. Le récit est celui de l’unicité de la nation.
Indiscutablement la Chine est formée de plusieurs nations, les tibétains, les ouïghours sont des peuples spécifiques.
<La constitution de la République Populaire> le reconnaît d’ailleurs, même si elle parle d’ethnie et non de peuple.
Cette constitution commence par un long préambule.
La première phrase du préambule est :
« La Chine est l’un des pays dont l’histoire est l’une des plus anciennes du monde. Les ethnies de Chine ont toutes ensemble créé une brillante culture et possèdent une glorieuse tradition révolutionnaire. »
Et plus loin dans le préambule nous lisons :
« La République populaire de Chine est un pays multi-ethnique unifié fondé en commun par toutes les ethnies du pays. Les relations socialistes déjà établies sont des rapports d’égalité, de solidarité et d’entraide, elles continueront à se renforcer. Dans le combat pour la sauvegarde de l’union des ethnies, il faut s’opposer au chauvinisme de grande ethnie, et en particulier au chauvinisme grand Han, il faut aussi s’opposer au nationalisme local. L’État doit consacrer tous ses efforts à la prospérité commune de toutes les ethnies. »
Et puis, il y a le fameux article 4 de la constitution :
« Article 4 : Toutes les ethnies de République populaire de Chine sont égales. L’État protège les droits et intérêts légitimes de toutes les ethnies, maintient et développe des relations inter-ethniques fondées sur l’égalité, la solidarité et l’entraide. Toute discrimination ou oppression d’une ethnie, quelle qu’elle soit, est interdite ; tout acte visant à briser l’unité nationale et à établir un séparatisme ethnique, est interdit.
Tenant compte des particularités de chaque ethnie minoritaire, l’Etat aide les régions d’ethnies minoritaires à accélérer leur développement économique et culturel.
Les régions où se rassemblent les minorités ethniques appliquent l’autonomie régionale ; elles établissent des organes administratifs autonomes et exercent leur droit à l’autonomie. Aucune des régions d’autonomie ethnique ne peut être séparée de la République populaire de Chine.
Chaque ethnie a le droit d’utiliser et développer sa propre langue et sa propre écriture, a le droit de conserver ou réformer ses us et coutumes. »
Cet article débute très bien en affirmant l’égalité de toutes les ethnies et surtout cette règle que même les « droits de l’hommiste occidentaux » honnis de Xi Jinping ne sauraient qu’approuver : l’interdiction de toute discrimination et oppression d’une ethnie. Cette règle devrait être de nature à rassurer les tibétains et les ouïghours … Les rassurer en théorie…
On attribue à Pierre Desproges ce beau souhait utopique : «Un jour j’irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien.». <Marc Levy> affirme cependant qu’il n’y a nulle trace montrant que Desproges soit l’auteur de cette phrase.
Il y a toutefois une limite qui est dressée dans ce même article 4 : il est aussi interdit tout séparatisme ethnique. Dès lors, dans ce régime qui vante son efficacité et son pouvoir centralisé fort, il suffit pour sortir de la théorie d’accuser une ethnie de séparatisme pour pouvoir exercer une force unificatrice et violente sur ses membres. Nous verrons cela dans des mots du jour ultérieurs.
Sur une page du site de l’ambassade de Chine en France, visant à faire connaître ce grand et vieux pays, on peut lire :
« La population chinoise comprend 56 ethnies identifiées. La population des diverses ethnies connaît de grands écarts ; les Han sont beaucoup plus nombreux, et les 55 autres groupes sont appelés « ethnies minoritaires ».
Selon une enquête effectuée au moyen de sondages auprès de 1 % de la population du pays en 2005, la population totale des 55 ethnies minoritaires était de 123,33 millions, représentant 9,44 % de la population nationale. »
Ceci trace immédiatement une répartition extraordinairement inégalitaire de l’empire du milieu.
Le gouvernement chinois reconnaît donc 56 ethnies mais l’une représente 90,5% de la population et les 55 autres ensembles 9,5%.
Vous pourrez trouver sur cette page la liste des 56 ethnies, leur implantation géographique et leur importance numérique.
Les « Han » : presque 1,2 milliard, les «Tibétains » 5,416 millions, les « Ouïgours » 8,3984 millions et certaines ethnies sont vraiment peu nombreuses « Les Tatars » 4 900 personnes.
Remarquez la précision, au millier près, du nombre de personnes constituant une ethnie sauf pour les han où la précision s’arrête à la centaine de millions….
Dès lors, quand une ethnie est soupçonnée de séparatisme sur un territoire, il suffit de puiser dans les réserves inépuisables de l’ethnie majoritaire pour aller changer totalement l’équilibre ethnique du lieu. C’est ainsi que <Le Tibet> est de plus en plus une région habitée par l’ethnie Han.

Comme toujours, la situation est plus complexe que celle décrite ci-avant, l’ethnie Han ne constitue pas un bloc totalement homogène. Wikipedia nous apprend que l’anthropologue Dru C. Gladney indique qu’il existe au sein même de la population han une diversité notamment dans les populations du Sud comme les Cantonais, les Hakkas ou les Mins du Sud du Fujian. Ainsi la majorité han est composée de locuteurs de huit groupes de langues différentes (mandarin, cantonais, wu, xiang, hakka, gan, min du Nord et min du Sud). Le chinois mandarin est la langue officielle depuis le début du XXe siècle, standardisé sur le parler de la région de la capitale, Pékin. Il coexiste donc, même à l’intérieur de l’ethnie Han, diverses langues parlées.
En pratique, le nom de cette ethnie fut d’abord « Huaxia » mais elle changea de dénomination à l’époque de la dynastie Han (206 av. J.-C. à 220 apr. J.-C.), et pris le nom de la dynastie.
Indiscutablement, ils constituent le peuple chinois « historique ». Devant une telle situation inégalitaire il est difficile de ne pas assimiler la « culture chinoise » à la « culture Han ».
Mais cela est l’introduction.
- En 2019, il y a une révolte extraordinairement puissante à Hong Kong, c’est un défi pour Pékin.
- En 2019, il y avait aussi les 30 ans de la répression de Tien an Men. Cela c’est un déni pour Pékin. J’en avais fait un mot du jour : « Le massacre de la place de la porte de la Paix céleste» publié le jour anniversaire le 4 juin.
- Pékin a célébré, en revanche, les 70 ans de la création de la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949.
Et la célébration a magnifié la grandeur de la Chine et sa puissance militaire.
Un nombre impressionnant de vidéos montre cette parade : <Démonstration de force en Chine pour les 70 ans du régime>, <La Chine communiste fête ses 70 ans>, <La République populaire de Chine fête ses 70 ans>
Toutes ces vidéos durent moins de 3 minutes.
Mais pour notre information pleine et entière sur l’empire du milieu il existe « CGTN » China Global Television Network, financé par le gouvernement chinois. Et nous disposons donc, grâce à ce canal, une vidéo de 4h59 minutes qui montre la cérémonie, avec des commentaires français, dans sa durée et sa splendeur : < En direct : Célébrations du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine>
<Le Monde> nous explique :
« A Pékin, tout était sous contrôle. […]Il s’agit, selon les dirigeants, du plus grand défilé militaire organisé à Pékin depuis 1949. L’occasion pour la Chine d’exhiber quelques-uns de ses fleurons, notamment des drones high-tech et – pour la
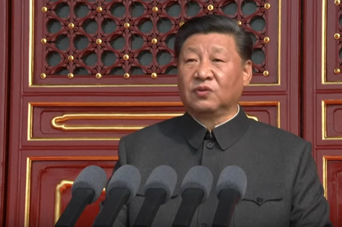 première fois – des Dongfeng-41, des missiles balistiques intercontinentaux possiblement dotés d’ogives nucléaires et qui peuvent atteindre les Etats-Unis en trente minutes.
première fois – des Dongfeng-41, des missiles balistiques intercontinentaux possiblement dotés d’ogives nucléaires et qui peuvent atteindre les Etats-Unis en trente minutes.
[…] Ces nouvelles capacités militaires, qui sont, comme le martèle la propagande, « au service de la paix », illustrent les ambitions mondiales de la Chine de Xi Jinping. Lorsqu’il s’adresse aux 90 millions de membres du Parti communiste, celui-ci ne cesse de mettre en garde contre les « menaces » qui l’assaillent. En revanche, l’image qu’il entend donner au pays et au reste du monde est au contraire celle d’un parti qui a accompli un «miracle».
[…] Le mot figure en toutes lettres dans le Livre blanc publié le 29 septembre par le gouvernement chinois sur le rôle international du pays. « En soixante-dix ans, sous la direction du Parti communiste chinois, la République populaire de Chine a connu de profonds changements et réalisé un miracle de développement économique sans précédent dans l’histoire de l’humanité », est-il écrit, dès l’introduction. « La Chine a réussi à accomplir quelque chose que les pays développés ont mis plusieurs centaines d’années à réaliser », ajoute le document. Le PIB du pays est passé de « 67,9 milliards de yuans [8,7 milliards d’euros] en 1952 à 90 000 milliards de yuans [11 570 milliards d’euros] en 2018 », est-il précisé. Pourtant, le Livre blanc affirme que la Chine reste un « pays émergent ». Pas question en effet d’accepter de perdre les avantages qu’octroie ce statut au sein de l’Organisation mondiale du commerce, à laquelle la Chine a adhéré en 2001. »
Et le plus important, à 10 heures, au balcon de la Porte-de-la-Paix-Céleste, au sud de la Cité interdite, qui donne sur la place Tiananmen, là même où Mao Zedong avait proclamé le 1er octobre 1949 la création de la République populaire de Chine, Xi Jinping, secrétaire du Parti communiste depuis 2012 et président de la République depuis 2013, a prononcé un discours très bref de sept minutes.
Et c’est dans ce discours qu’il a eu cette phrase :
«Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation. Rien ne peut empêcher la nation et le peuple chinois d’aller de l’avant»
Là il est question de « la nation chinoise », unique, unifié dans laquelle les différences doivent être minimes.
Une nation prête pour la conquête économique, prête à se défendre contre n’importe quel ennemi, une nation où chacun doit souscrire aux messages de Xi Jinping et dans laquelle les particularismes doivent se dissoudre dans l’Unité et ….
 le culte de la personnalité…
le culte de la personnalité…
<1325>
- En 2019, il y a une révolte extraordinairement puissante à Hong Kong, c’est un défi pour Pékin.
-
Mercredi 11 décembre 2019
« Une île »Michèle Bernard-RequinAujourd’hui, je ne ferais aucun commentaire, je n’ajouterai rien.
Ma seule action sera de relayer un article publié le 09/12/2019 sur « Le Point » : <La déclaration d’amour de Michèle Bernard-Requin>
Michèle Bernard-Requin, magistrate exemplaire, a rassemblé ses dernières forces pour écrire un hymne au personnel hospitalier du pavillon Rossini de l’hôpital Sainte-Perrine.
Voici un texte poignant, bouleversant, qui tirera les larmes même aux plus insensibles d’entre nous. Des lignes que Michèle Bernard-Requin nous envoie depuis l’hôpital Sainte-Perrine à Paris, où elle se trouve, selon ses mots, « en fin de vie ». Michèle Bernard-Requin est une des grandes figures du monde judiciaire. Elle fut tour à tour avocate puis procureure à Rouen, Nanterre et Paris. En 1999, elle est nommée vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris, elle présida la 10e chambre correctionnelle de Paris puis la cour d’assises, et enfin elle fut avocate générale à Fort-de-France de 2007 à 2009, date à laquelle elle prit sa retraite.
Auteur de plusieurs livres, elle intervient de temps à autre dans les médias et tient depuis 2017 une chronique régulière sur le site du Point dans laquelle elle explique avec clarté, talent et conviction comment fonctionne la justice et pourquoi, parfois, cette institution dysfonctionne. Aujourd’hui, c’est un tout autre cri d’alarme qu’elle pousse dans un « petit et ultime texte pour aider les « unités de soins palliatifs » », a-t-elle tenu à préciser dans ce mail envoyé par sa fille dimanche 8 décembre au matin. Un texte que nous publions tel quel en respectant sa ponctuation, ses sauts de ligne, son titre évidemment. JB.
« UNE ÎLE
Vous voyez d’abord, des sourires et quelques feuilles dorées qui tombent, volent à côté, dans le parc Sainte-Perrine qui jouxte le bâtiment.
La justice, ici, n’a pas eu son mot à dire pour moi.
La loi Leonetti est plus claire en effet que l’on se l’imagine et ma volonté s’exprime aujourd’hui sans ambiguïté.
Je ne souhaite pas le moindre acharnement thérapeutique.
Il ne s’agit pas d’euthanasie bien sûr mais d’acharnement, si le cœur, si les reins, si l’hydratation, si tout cela se bloque, je ne veux pas d’acharnement.
Ici, c’est la paix.
Ça s’appelle une « unité de soins palliatifs », paix, passage… Encore une fois, tous mes visiteurs me parlent immédiatement des sourires croisés ici.
« Là tout n’est qu’ordre et beauté, luxe calme et volupté ».
C’est une île, un îlet, quelques arbres.
C’est : « Mon enfant, ma sœur, Songe à la douceur d’aller, là-bas, vivre ensemble ».
C’est « J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans » (« Spleen ») Baudelaire
Voilà, je touche, en effet, aujourd’hui aux rivages, voilà le sable, voilà la mer.
Autour de nous, à Paris et ailleurs, c’est la tempête : la protestation, les colères, les grèves, les immobilisations, les feux de palettes.
Maintenant, je comprends, enfin, le rapport des soignants avec les patients, je comprends qu’ils n’en puissent plus aller, je comprends, que, du grand professeur de médecine, qui vient d’avoir l’humanité de me téléphoner de Beaujon, jusqu’à l’aide-soignant et l’élève infirmier qui débute, tous, tous, ce sont d’abord des sourires, des mots, pour une sollicitude immense.
À tel point que, avec un salaire insuffisant et des horaires épouvantables, certains disent : « je préfère m’arrêter, que de travailler mal » ou « je préfère changer de profession ».
Il faut comprendre que le rapport à l’humain est tout ce qui nous reste, que notre pays, c’était sa richesse, hospitalière, c’était extraordinaire, un regard croisé, à l’heure où tout se déshumanise, à l’heure où la justice et ses juges ne parlent plus aux avocats qu’à travers des procédures dématérialisées, à l’heure où le médecin n’examine parfois son patient qu’à travers des analyses de laboratoire, il reste des soignants, encore une fois et à tous les échelons, exceptionnels.
Le soignant qui échange le regard.
Eh oui, ici, c’est un îlot et je tiens à ce que, non pas, les soins n’aboutissent à une phrase négative comme : « Il faut que ça cesse, abolition des privilèges, il faut que tout le monde tombe dans l’escarcelle commune. » Il ne faut pas bloquer des horaires, il faut conserver ces sourires, ce bras pour étirer le cou du malade et pour éviter la douleur de la métastase qui frotte contre l’épaule.
Conservons cela, je ne sais pas comment le dire, il faut que ce qui est le privilège de quelques-uns, les soins palliatifs, devienne en réalité l’ordinaire de tous.
C’est cela, vers quoi nous devons tendre et non pas le contraire.
Donc, foin des économies, il faut impérativement maintenir ce qui reste de notre système de santé qui est exceptionnel et qui s’enlise dramatiquement.
J’apprends que la structure de Sainte-Perrine, soins palliatifs, a été dans l’obligation il y a quelques semaines de fermer quelques lits faute de personnel adéquat, en nombre suffisant et que d’autres sont dans le même cas et encore une fois que les arrêts de travail du personnel soignant augmentent pour les mêmes raisons, en raison de surcharges.
Maintenez, je vous en conjure, ce qui va bien, au lieu d’essayer de réduire à ce qui est devenu le lot commun et beaucoup moins satisfaisant.
Le pavillon de soins palliatifs de Sainte-Perrine, ici, il s’appelle le pavillon Rossini, cela va en faire sourire certains, ils ne devraient pas : une jeune femme est venue jouer Schubert dans ma chambre, il y a quelques jours, elle est restée quelques minutes, c’était un émerveillement. Vous vous rendez compte, quelques minutes, un violoncelle, un patient, et la fin de la vie, le passage, passé, palier, est plus doux, c’est extraordinaire.
J’ai oublié l’essentiel, c’est l’amour, l’amour des proches, l’amour des autres, l’amour de ceux que l’on croyait beaucoup plus loin de vous, l’amour des soignants, l’amour des visiteurs et des sourires.
Faites que cette humanité persiste ! C’est notre humanité, la plus précieuse. Absolument.
La France et ses tumultes, nous en avons assez.
Nous savons tous parfaitement qu’il faut penser aux plus démunis.
Les violences meurtrières de quelques excités contre les policiers ou sur les chantiers ou encore une façade de banque ne devront plus dénaturer l’essentiel du mouvement : l’amour. »

<1324>
-
Mardi 10 décembre 2019
« Un mercredi, il y a cent ans… »Une histoire qui commenceC’était un mercredi, il y a cent ans, le 10 décembre 1919.
Dans une ville minière, d’environ 6000 habitants, au nord-est de la Lorraine, dans une maison familiale, un enfant venait de naître au monde.
C’était un garçon.
Son père était revenu dans cette maison, depuis un an à peine, soldat d’une armée vaincue.
Mais ce 10 décembre, il était citoyen d’une Nation triomphante et père d’un septième et dernier enfant, le seul à être né français.
Un an auparavant, quand il était enfin de retour, ce fut quelques jours trop tard pour accompagner son 5ème enfant, une fille du nom de Pauline, à sa dernière demeure à l’âge de 10 ans. Elle avait succombé à la grippe espagnole le 20 novembre 1918, 9 jours après l’armistice.
Félix, le père de l’enfant qui venait de naître, fut celui dans sa lignée qui fit sortir sa famille du néolithique. Aussi loin qu’on remontait le temps qu’il était possible de connaître, la famille était constituée de paysans qui vivaient dans des fermes. Lui a quitté la ferme pour se rendre vers une petite ville qui s’était construite sur un territoire industriel émergeant autour de l’activité des mines de charbon.
Il avait conservé quelques lopins de terre pour la nourriture domestique mais avait changé de métier et était devenu menuisier.
La mère s’appelait Katherine avec un « K » car elle était née dans une commune près de Mannheim qui se trouve actuellement dans le Bade-Wurtemberg mais qui historiquement faisait partie du Palatinat.
Elle n’était donc pas comme Félix, née sur ce territoire tant disputé entre les germains de l’est et les germains de l’ouest qui sont les Francs. Elle est née sur le territoire des germains de l’est.
D’ailleurs leur mariage fut célébré à Mannheim.
Le père était travailleur, rude, peu enclin au dialogue et pas très drôle.
Katherine était douce, pleine d’humour et aimait chanter.
Dans cette famille pauvre à la sortie de la terrible grande guerre, la vie n’était pas simple.
Mais quand il y avait quelques loisirs, la famille se réunissait faisait de la musique et chantait ensemble.
Dans cette ambiance et probablement sous l’influence de sa mère, le jeune garçon s’éveillait à la musique, à la poésie et à l’art.
Mais quand il exprima son souhait d’embrasser le métier de musicien et plus précisément de violoniste, la réponse du père fut catégorique et sans appel :
« Musicien est un métier de fainéant, tu seras menuisier comme ton père et tu feras de la musique comme tout le monde en amateur »
Le jeune Rodolphe bien qu’obéissant savait ce qu’il voulait et ne se soumit que provisoirement.
Il attendait patiemment l’âge de la majorité qui était de 21 ans, pour échapper à l’autorité parentale et réaliser son rêve devenir musicien professionnel.
Mais en ces temps troublés, il a eu 20 ans en 1939 et une nouvelle guerre allait embraser l’Europe, la France et l’Allemagne.
Il partit donc à la guerre, mais avant de finir ses classes la France était vaincue par l’étrange défaite de 1940 selon le livre du grand historien Marc Bloch.
Quand les autorités allemandes invitèrent les alsaciens les lorrains de revenir dans leur région natal en leur promettant qu’il ne serait pas incorporé dans la Wehrmacht il écouta le conseil d’un sage adjudant qui lui dit : « Les allemands vont perdre la guerre, et quand ils auront besoin de troupes pour leurs derniers combats, ils obligeront tous ceux qu’ils trouveront à incorporer leur armée ».
Il l’écouta et passa les années de guerre dans la petite ville de Renaison dans la Loire, près de Roanne à 100 km de Lyon.
Il ne revint dans sa région natale qu’à la fin de la guerre en 1945, il avait déjà 26 ans. C’était le temps de trouver épouse.
 Il rencontra une jeune femme qui n’était pas française, mais polonaise, issue de l’immigration de travail que réclamaient les houillères de Lorraine. Elle devint française par le mariage.
Il rencontra une jeune femme qui n’était pas française, mais polonaise, issue de l’immigration de travail que réclamaient les houillères de Lorraine. Elle devint française par le mariage.
Toute cette petite histoire, que je préfère appeler l’histoire à hauteur d’homme, rencontre la grande histoire et relativise beaucoup des idées et des concepts qu’on entend développer par des idéologues qui rêvent un passé qui n’a jamais existé.
La France est mélange, mélange entre peuples germains, francs, alamans, teutons, burgondes quelques latins bien sûr et aussi comme dans cet exemple des slaves et bien d’autres
Nous sommes loin de nos ancêtres les gaulois…
Il devint père une première fois en 1947 puis en 1949.
Pour nourrir sa famille, il accepta les métiers qu’il pouvait exercer. Malgré les difficultés, malgré un départ bien tardif il poursuivit son rêve de faire de la musique et d’approfondir la musique et la pratique du violon.
Il alla prendre des cours dans la ville allemande proche de Sarrebruck.
Il accéda enfin à son objectif de faire du violon son métier, lorsqu’il eut l’opportunité de participer à la création de l’école de musique de Forbach en 1951. Il avait 31 ans. Les conditions financières étaient exécrables pendant de nombreuses années, il lui fallut exercer d’autres missions pour parvenir à des revenus toujours modestes mais permettant de vivre. Mais il ne se plaignait jamais car il pratiquait le métier qu’il aimait.
Il devint un professeur remarquable qui apprit le violon à des générations d’élèves de 1951 à 1991. Les enfants et même à la fin les petits enfants de ses premiers élèves devinrent aussi ses élèves.
Il disait :
« Avant de leur apprendre le violon, j’essaye surtout de leur faire aimer la musique »
Et le miracle, c’est qu’il y parvint le plus souvent.
Vous savez compter, il a pris sa retraite en 1991, il avait 72 ans.
C’est aussi une leçon par rapport à nos débats sur les retraites. On peut travailler jusqu’à 70 ans, mais cela dépend du métier, cela dépend du sens qu’on peut lui donner. Notre problème de retraite n’est-il pas avant tout un problème de travail, de travail de seniors, de condition et de qualité de travail ? Et du sens de tout cela ?
En 1958, ce garçon né en 1919, à Stiring-Wendel, devint mon père.
Il était aussi compréhensif, bienveillant et tendre que son père était dur et rigide.
Avant de quitter la communauté des vivants en 2009, il chanta encore des chansons à ses infirmières jusqu’à ses derniers instants de lucidité.
Nous ne sommes pas des individus venus un jour au monde et qui nous construisons nous même. Nous nous inscrivons dans une lignée familiale et sommes le fruit des transmissions que nous avons su accueillir.
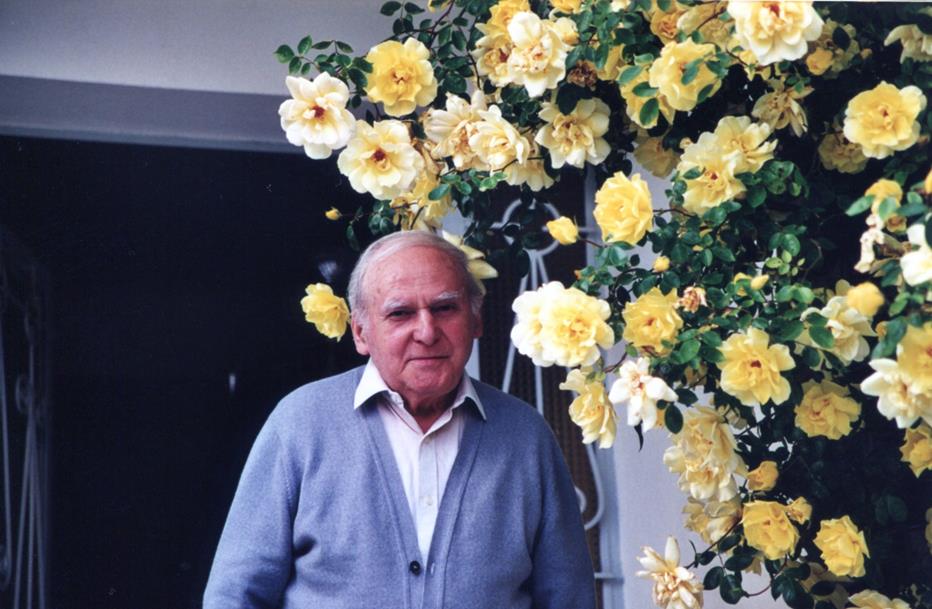 Mon père m’a appris à aimer la musique.
Mon père m’a appris à aimer la musique.
Il m’a aussi appris la bienveillance.
Il m’a aidé à avoir confiance en moi.
Il m’a conduit à aimer la vie.
<1323>
-
Lundi 9 décembre 2019
«Réaliste, indestructible et révolutionnaire dans un monde uniformément fade et mécanisé»Philippe Sollers en évoquant Martha ArgerichCette saison, c’est la fête des pianistes exceptionnels à l’Auditorium de Lyon.
Il ne manque que Grigory Sokolov.
Daniel Barenboïm est déjà venu en octobre.
Evgeni Kissin viendra en janvier et Murray Perahia en avril.
 Et ce dimanche, 8 décembre, Martha Argerich était là.
Et ce dimanche, 8 décembre, Martha Argerich était là.
Et c’est quelque chose qu’elle soit là, tant il est vrai qu’il lui arrive de renoncer à venir quand elle ne se sent pas prête.
C’est au moins sa réputation.
<Wikipedia> affirme :
« Elle n’a jamais été poursuivie en rupture de contrat simplement parce que, jalouse de son indépendance, elle n’en a jamais signé. »
Si cette affirmation est exacte, il faut être Martha Argerich pour être programmée dans un concert, sans que l’organisateur ne dispose d’un contrat solide avec l’artiste et accepte cette incertitude.
Mais quand elle est présente, la prestation tient de l’exception.
Elle arrive même à convaincre que le concerto de piano n°1 que Beethoven a composé à 25 ans, encore bien éloigné de sa maturité, constitue un chef d’œuvre.
En me replongeant dans sa biographie, j’ai appris que ce même 1er concerto de Beethoven qu’elle a interprété à Lyon était aussi au programme de son premier concert à Buenos Aires où elle est née en 1941.
Lors de ce premier concert elle avait 8 ans !
Elle a commencé le piano vers 4 ans et à le travailler vraiment à 5 ans.
Elle ne voulait pas devenir pianiste, elle voulait devenir médecin. Ses parents ont certainement insisté beaucoup.
 L’Express dans un article de 2000 : « Le jour où Martha Argerich osa jouer » raconte :
L’Express dans un article de 2000 : « Le jour où Martha Argerich osa jouer » raconte :
« Il était une fois à Buenos Aires une petite fille de 2 ans et 8 mois qui se planta devant un piano et reproduisit instantanément l’air que fredonnait sa puéricultrice, parce qu’un petit camarade venait de lui dire: «T’es pas cap’ de jouer du piano.» Mais, cinquante-six ans plus tard, Martha Argerich n’en finit pas de regretter d’avoir relevé ce défi. «J’aime jouer du piano mais je déteste être pianiste», ne cesse-t-elle de répéter. Elle est sans doute la pianiste la plus inspirée et la plus torturée de notre époque. Si elle figure simplement en bonne place dans le hit-parade des concerts annulés, elle est la seule à refuser de se produire seule sur une scène, depuis dix-neuf ans. Plus exactement était, car, le 25 mars dernier, elle se résignait enfin à offrir un récital au public enthousiaste de Carnegie Hall. »
Cet article apporte une autre information, Martha Argerich ne veut plus jouer seul sur scène, elle a toujours besoin de partager la musique avec des amis.
Ce dimanche, elle a d’abord joué de la musique pour deux pianos avec un autre pianiste né à Buenos Aires : Eduardo Hubert.
Le concerto de Beethoven, elle l’a jouée avec un orchestre de chambre hongrois remarquable : L’orchestre de chambre Franz-Liszt de Budapest dirigé par Gabor Takacs-Nagy.
Ce concert new-yorkais dont parle l’Express et qui était donc une exception depuis 19 ans et qui l’est redevenue depuis, était tout à fait particulier.
En 1990, Martha Argerich a été atteint par le cancer : un mélanome. Elle avait été traitée avec succès. Malheureusement, elle a rechuté en 1995 avec des métastases pulmonaires et un envahissement des ganglions lymphatiques. Un nouveau traitement institué au John Wayne Cancer Institute lui a permis d’obtenir une nouvelle rémission. Et le concert de Carnegie Hall était organisé au profit du John Wayne Cancer Institute de Santa Monica (Californie), dirigé par le Dr Morton, qui a su traiter la grave affection cancéreuse dont elle souffre.
Martha Argerich est donc une survivante qui défie les statistiques morbides des récidives cancéreuses et de leurs complications métastasiques.
Quand elle joue sur scène, on voit son plaisir, son espièglerie à faire de la musique avec d’autres avec une technique sans faille et une émotion à fleur de peau.
J’ai aussi emprunté à l’article de l’express l’exergue de ce mot du jour. C’est un portrait littéraire de Martha Argerich écrit par Philippe Sollers «Réaliste, indestructible et révolutionnaire dans un monde uniformément fade et mécanisé», Et comme l’écrit le journaliste son jeu, toujours fidèle au texte de la partition, est d’une liberté et d’une spontanéité absolues, comme si la musique naissait sous ses doigts pour la première fois.
 Martha Argerich fuit les journalistes et les interviews.
Martha Argerich fuit les journalistes et les interviews.
Et c’est donc quasi inespéré de la voir simple, attachante dans un documentaire tourné en 1972 par la <Télévision Suisse> à l’époque où elle était mariée avec le chef Charles Dutoit.
Un autre documentaire plus court sur <Euronews> la montre en Italie, en 2012, alors qu’elle prépare un concert avec Antonio Pappano.
Sur la page de présentation de ce documentaire, on lit :
« La pianiste virtuose a fait chavirer Rome dernièrement en interprétant le Concerto de Schumann aux côtés de musiciens qu’elle estime exceptionnels : […] Farouchement attachée à son indépendance, rejetant les règles imposées par la carrière et la célébrité, Martha Argerich n’interprète pas la musique, elle l’incarne. « Il est impossible de séparer la personne de la musicienne : elle est la musique, » affirme le chef Antonio Pappano […] Pour Martha, la musique n’a de sens que si elle est partagée. Insoumise et courageuse, la virtuose a lutté toute sa vie contre la solitude. « Friedrich Gulda m’avait dit : « il faut que tu apprennes tout avant 16 ans parce qu’après on devient un peu stupide, » raconte la musicienne, « je trouvais que je menais la vie d’une personne de quarante ans quand j’en avais 17 et je voulais vivre la vie des jeunes étudiants de mon âge qui étaient libres, qui s’amusaient un peu, qui n’avaient pas le trac et qui n’avaient pas ces problèmes. Je trouvais que ma vie était triste, » poursuit-elle, « je faisais des voyages, seule, j’étais très timide, je suis très timide parce que je crois que cela, on ne le perd pas ! » lance-t-elle avant de souligner : « à présent, il y a des amis partout, alors on prend soin de moi. » »
Et puis il faut voir Martha Argerich jouer :
Très jeune <La polonaise héroïque> de Chopin.
Et en 2010, à Varsovie avec un orchestre polonais <le concerto n°1 de Chopin>. Il est rare qu’un musicien classique affiche plus de 2 800 000 vues sur youtube.
A Leipzig, <le concerto de piano de Schumann> dans une interprétation lumineuse.
Et des plus petites pièces : <Une petite œuvre de Bach> dans laquelle, elle excelle.
Et un de ses bis fétiches <la sonate K141 de Scarlatti> dans laquelle s’exprime sa virtuosité.
Et pour finir France musique qui pose la question <Peut-on percer le mystère Martha Argerich ?>
<1322>
-
Vendredi 6 décembre 2019
« Pause »Un jour sans mot du jourCette année la fête des lumières de Lyon commence le 5 décembre et se terminera le 8 décembre jour de la vraie fête des lumières.
 J’avais le projet d’y aller le premier jour pour faire des photos, car comme tout habitant de Lyon je sais que c’est le moment où il est possible d’aller voir les différentes œuvres de lumière sans qu’il n’y ait une foule trop importante.
J’avais le projet d’y aller le premier jour pour faire des photos, car comme tout habitant de Lyon je sais que c’est le moment où il est possible d’aller voir les différentes œuvres de lumière sans qu’il n’y ait une foule trop importante.
Visiblement, beaucoup de lyonnais ont eu cette idée et les lyonnais sont nombreux.
Je me suis donc retrouvé avec Annie dans une foule dense et compacte.
La foule, le froid et la fragilité de santé qui me poursuit désormais m’a empêché de persévérer dans mon projet, il m’a fallu rentrer.
Je n’ai donc pas de photos à vous proposer.
Mais la fête des lumières dispose d’un « site »
<Mot sans numéro>
-
Jeudi 5 décembre 2019
« C’est en France que la durée de vie après la vie professionnelle est la plus longue. »Etude de l’OCDEAujourd’hui c’est la grève !
La grève pour nos retraites.
C’est un sujet très compliqué qui me laisse songeur.
La retraite par répartition que nous avons en France constitue une magnifique œuvre de solidarité et d’entraide, mais elle est très contraignante et nécessite le contraire d’une réaction individualiste. Elle nécessite une réaction sociale et solidaire.
Si tout le monde se précipite sur la place publique et dit : « Et moi et moi, et moi, j’ai des droits », sans jamais se poser la question des droits des autres, ni encore davantage qui paiera, nous ne nous en sortirons pas.
La première question à se poser, est de savoir si nous voulons continuer à rester dans un système essentiellement par répartition.
J’avais déjà abordé ce sujet de manière assez personnelle dans le mot du jour du 2 mai 2018 : « Grandeur et servitude du système de retraite par répartition »
Si la réponse à cette question est oui, il faut bien sûr s’interroger sur un niveau acceptable de pension pour les retraités, mais il faut tout autant s’interroger sur la capacité des actifs à payer la pension de ces retraités.
A partir des éléments factuels recueillis sur le site du Conseil d’Orientation des Retraites j’avais pu établir cette projection :
« Ceci signifie qu’en 1960 : 4 actifs cotisaient, en moyenne, chacun 25 euros pour qu’un retraité puisse toucher 100 euros. Selon cette projection en 2050, un actif devra cotiser 83,33 € pour arriver au même résultat que le retraité puisse toucher 100 euros. »
Aborder ce vaste sujet uniquement par l’angle des droits, sans aborder la question du coût pour les actifs me parait hautement déraisonnable.
Cela étant dit, la communication chaotique du gouvernement est anxiogène. Nicholas Baverez l’a dit sur France Inter :
« Sur les retraites, on a multiplié les incertitudes sans apporter de solutions »
En outre, les technocrates qui nous gouvernent ont trouvé pertinent d’inventer une novlangue qui par son côté obscur ajoute à l’anxiété.
Alternatives économiques a proposé un article : « Tout comprendre à la novlangue des retraites »
L’article est introduit ainsi :
« Comme si la réforme des retraites n’était pas déjà suffisamment compliquée, le vocabulaire qui l’accompagne ajoute à la confusion générale. Si les Français ont bien compris que l’orientation choisie par l’exécutif était de les faire travailler plus longtemps, beaucoup n’ont toujours pas saisi les subtiles modalités de cet allongement de la durée de vie au travail.
De nouveaux concepts émergent dans le débat, à l’instar de l’âge minimum de taux plein, certains sont sortis de la naphtaline comme la clause du grand-père. D’autres encore recouvrent des nuances techniques qu’il est utile de définir. Car tous ces termes sont lourds de conséquences pour les futurs pensionnés. »
Les journalistes apportent ainsi des précisions sur dix expressions :
1/ Age pivot ou âge d’équilibre
2/ Age minimum du taux plein
3/ Age d’annulation de la décote ou du taux plein automatique
4/ Age de départ moyen ou âge de départ effectif
5/ Age conjoncturel de départ en retraite
6/ Clause du grand-père
7/ Réforme paramétrique ou systémique
8/ Taux de remplacement
9/ Valeur d’acquisition et valeur de service du point
10/ Désindexation des pensions
Si vous vous dépêchez vous devriez pouvoir lire l’article, car Alternatives économiques a décidé d’ouvrir son site gratuitement pour 24h.
« Tout comprendre à la novlangue des retraites »
Thomas Picketty attaque sévèrement le gouvernement en parlant « d’arnaque » et il dénonce le fait que gouvernement tente d’opposer les bas salaires entre eux.
Il émet cette idée qu’il faudrait faire davantage cotiser les hauts salaires.
Et en effet, le gouvernement a prévu de ne taxer les revenus au-delà de 10 000 euros uniquement à 2,8 %.
Mais Léa Salamé a répliqué que la part au-dessus de 10 000 euros ne permettrait plus de percevoir de pensions qui sont ainsi plafonnés. Cet argument a été repris le jour suivant par Dominique Seux :
« La complexité du sujet permet à chacun de projeter ses propres fantasmes. Avant-hier, au micro de Léa Salamé, Thomas Piketty a cru pouvoir lever un lièvre en expliquant qu’avec un taux de cotisation de 2,8% au-delà de 10 000 euros bruts par mois, les plus riches étaient les grands gagnants cachés. Léa Salamé a rappelé qu’il n’y aura aucun droit à retraite en face, et elle a bien fait. La vraie conséquence est que des cadres ne bénéficieront plus de la solidarité nationale à un seuil nettement inférieur à ce qu’il est aujourd’hui.
Le plus amusant est que Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une réforme qui obligera les classes moyennes (sic, à plus de 10 000 euros par mois) à souscrire à un fonds de pension, tandis que François Ruffin dénonçait lui aussi un cadeau aux riches. Il faudrait savoir, la politique a ses raisons qui font parfois déraisonner. »
Et Alternatives Economiques explique davantage le mécanisme dans un article : « Qui paiera la retraite des super-cadres ? »
« La réforme prévoit de diminuer le plafond de la retraite : il n’y aura plus de cotisation au-dessus de trois plafonds de la Sécurité sociale (10 000 euros brut par mois environ) et la part du salaire supérieure à ce niveau n’est pas inclue dans le calcul des droits à la retraite. Il restera une cotisation de solidarité de 2,8 % est versée sur la totalité du salaire. Malgré la forte communication du gouvernement sur ce sujet, cette cotisation de solidarité n’est pas vraiment une innovation, mais simplement un léger relèvement (de 0,4 point) du taux par rapport à celui pratiqué dans système actuel.
Ainsi, les cadres à très haut salaire obtiennent leur « bon de sortie » du système collectif de Sécurité sociale. Plus précisément, ils y sont toujours affiliés, mais uniquement pour le « bas » de leur salaire. Pour le haut de leur salaire, charge à ces personnes, et à leur employeur, de s’assurer elles-mêmes une retraite en se tournant vers différents fonds de pensions privés (fonds qui d’ailleurs sont en partie subventionnés par différentes formes d’avantages fiscaux ou sociaux).»
Alternatives Économiques soulève cependant le problème de la transition qui semble être le vrai lièvre sur ce sujet :
« La partie supérieure des hauts salaires ne cotise plus, ou presque, mais elle ne donne pas de droits à retraite. Il n’y a donc pas de problème ? Au niveau individuel, peut-être, mais au niveau collectif, ce n’est pas tout à fait exact. En effet, les cadres supérieurs qui sont déjà à la retraite, ou même encore en activité, ont acquis des droits à la retraite y compris au-dessus de trois plafonds de la Sécurité sociale. Autrement dit, jusqu’à leur mort ces cadres percevront leur retraite, calculée sur des salaires pouvant aller jusqu’à huit plafonds de la Sécu. Ces salaires ont par le passé été soumis à cotisation et leurs droits à retraite ne seront pas remis en cause – ce qui est relativement logique dans le cadre d’une assurance sociale.
Le problème c’est qu’à partir du basculement dans la réforme (par exemple en 2025), il n’y aurait plus de cotisations versées entre trois et huit plafonds de la Sécu par les cadres dirigeants actuellement en activité. Cela veut dire que pendant plusieurs décennies, le système de retraite devra en même temps verser des pensions calculées sur des très hauts salaires, tout en ayant renoncé à percevoir des cotisations sur les très hauts salaires. Cela créerait un déséquilibre entre recette et prestations dans le système, qui sera au final financé par la diminution globale des pensions. »
Mais au milieu de toutes ces difficultés, il y a quand même une heureuse nouvelle pour la France : Nous sommes premiers !
Les Français sont le peuple qui a la durée de vie après la vie professionnelle la plus longue de tous les pays développés, nous confirme l’OCDE.
C’est écrit dans le panorama annuel publié hier sur les retraites par l’OCDE, l’Organisme d’études économiques des pays développés.
L’information et le classement se trouve en ligne :
Pour les hommes voici le classement sur les données 2018
1 France 22,7
2 Luxembourg 22,3
3 Greece 21,8
4 Spain 21,7
5 Belgium 21,1
6 Italy 20,7
7 Australia 19,8
8 Austria 19,3
9 Finland 19,1
10 Germany 19,1
Les Etats-Unis sont 24ème avec 16,4.
Pour les femmes, c’est encore les françaises qui sont en tête
1 France 26,9
2 Spain 26,6
3 Greece 26,4
4 Italy 25,7
5 Slovenia 25,6
6 Belgium 25,5
7 Luxembourg 25,0
8 Austria 25,0
9 Poland 24,3
10 Finland 23,5
Les Etats-Unis sont cette fois 32ème avec 19,8 années et l’Allemagne 19ème avec 22,5.
Dominique Seux a tenté d’analyser ces chiffres
« Que montre ce tableau ?
Que la France est, reste, et d’assez loin, le pays où le temps passé à la retraite une fois que l’on quitte le marché du travail et jusqu’à hélas l’inévitable décès, ce temps est LE plus long de tous les pays industrialisés.
Notre pays se singularise ailleurs aussi : un taux de pauvreté des retraités plus faible, et un niveau de la pension par rapport au dernier salaire plus élevé.
Qu’inspire ce temps à la retraite record ?
Il s’explique par une sortie de l’emploi plus précoce qu’ailleurs (avec un âge de la retraite plus bas qu’ailleurs et très dispersé – régimes spéciaux), et par un chômage des seniors plus haut. Alors, disons-le clairement : il n’y aucune raison de principe de toujours s’aligner par le bas, et être différent par le haut n’est bien sûr pas un problème a priori.
A partir de là, la question posée est double : pourquoi ne nous rendons-nous pas compte de cet avantage français, qui est réel et pas une fake news inventée par les ultra-libéraux ? Pourquoi ? Je ne sais pas.
Et comment est financée cette durée hors-norme ? Si c’est un choix de société, il faut avoir conscience que ce sont les actifs qui en supportent le coût. »
Les allemands disaient « Heureux comme Dieu en France »
Avec ces tableaux, ils risquent de dire « Heureux comme un retraité en France ».
Cela ne règle, bien sûr, en rien le problème du financement.
<1321>
-
Mercredi 4 décembre 2019
« Le document 9 »Document secret du pouvoir central chinois présidé par Xi JinpingL’excellent documentaire, « Le monde selon Xi-Jinping » montre d’abord que le Président chinois est un prince rouge. C’est-à-dire un enfant du premier cercle de Mao lors de la proclamation en 1949 de la République populaire de Chine.
C’est une sorte de noblesse qui perpétue son pouvoir dans la Chine communiste et capitaliste non libéral.
Il raconte aussi la descente en enfer de son père et de lui-même lors de la purge réalisée pendant la révolution culturelle. Et dans laquelle ils comptèrent parmi les victimes. Il dit lui-même que les gardes rouges ont plusieurs fois menacé de le fusiller. Il fut victime de violences physiques, morales et aussi d’un travail dur à la campagne au milieu de rudes paysans. Sa sœur ainée s’est suicidée pendant cette période
Mais il garda toute sa confiance dans le Parti Communiste, il y adhéra après bien des péripéties. Puis, il fut suffisamment consensuel pour grimper tous les échelons.
Lors des dernières marches il sut écarter ceux qui pouvaient être des concurrents. Il affiche un motif noble : la lutte contre la corruption. Il semble que la corruption est importante en Chine communiste.
Dès lors, beaucoup peuvent être inquiétés pour cette raison.
Ainsi, il a pu écarter un autre prince rouge « Bo Xilai » qui apparaissait comme un rival très sérieux. Condamné à la prison à perpétuité et spolié de tous ces biens il ne constitue plus un obstacle pour Xi Jinping.
Mais la famille de XI Jinping est à la tête d’une fortune colossale de plus de 290 millions d’euros, selon une enquête de Bloomberg qui a valu au site de l’agence d’être suspendu quelques jours en Chine pendant l’été.
Cette fortune n’est elle que le fruit du travail ?
Xi Jinping est devenu le secrétaire général du Parti communiste en novembre 2012 et Président de la République le 14 mars 2013.
Normalement depuis Deng Xiao Ping, ce poste était occupé pendant dix ans puis tranquillement l’élite du Parti se mettait d’accord sur un successeur. Xi Jinping a rapidement su mettre en place les conditions de la prolongation indéfinie de son mandat. Il souhaite probablement « le refaire à la Mao » rester au pouvoir jusqu’à sa mort ?
Aujourd’hui, je souhaite m’arrêter sur un autre point développé dans le documentaire, le « document 9 ».
 Xi Jinping, n’était pas depuis longtemps au pouvoir quand a été divulgué, en 2013, un document secret du Comité Central, « le document 9 ».
Xi Jinping, n’était pas depuis longtemps au pouvoir quand a été divulgué, en 2013, un document secret du Comité Central, « le document 9 ».
Le pouvoir chinois a accusé la journaliste Gao Yu née à Chongqing en 1944 et qui faisait partie de cercles d’intellectuels dissidents, d’être la responsable de cette fuite.
Elle avait été arrêtée en 1989 après les manifestations de la place Tian’anmen et libérée 14 mois plus tard pour raison de santé. De nouveau arrêtée en octobre 1993 et condamnée à 6 ans de prison, elle est arrêtée une troisième fois le 24 avril 2014, en raison du document 9.
Gao Yu est réapparu le 8 mai 2014 sur les écrans de la télévision chinoise, filmée assise sur une chaise en fer dans une salle capitonnée, une salle d’interrogatoire, d’un centre de détention, exprimant, d’un ton las et hésitant, une autocritique, pour son «crime», qui porterait «atteinte aux intérêts nationaux». Ses amis s’interrogent sur les moyens et les pressions exercées sur cette femme de conviction solide pour lui arracher une telle autocritique
En avril 2015, Gao Yu est condamnée, à une peine de sept ans de prison.
Ce document 9 dont un des principaux auteurs serait le président chinois lui-même, Xi Jinping, a vocation à servir de référence à la politique chinoise dans les dix ans à venir. Ce document identifie dix périls à combattre dans la société chinoise :
Le tout premier est la «démocratie constitutionnelle occidentale».
Les autres incluent la promotion des «valeurs universelles» des droits de l’homme, les idées d’indépendance des médias et de participation citoyenne inspirées par l’Occident, le «néolibéralisme» qui défend avec ardeur l’économie de marché et les critiques «nihilistes» du passé traumatisant du parti ».
Bref, il rejette toutes les valeurs auxquels nous autres occidentaux, malgré nos différences, sommes attachées.
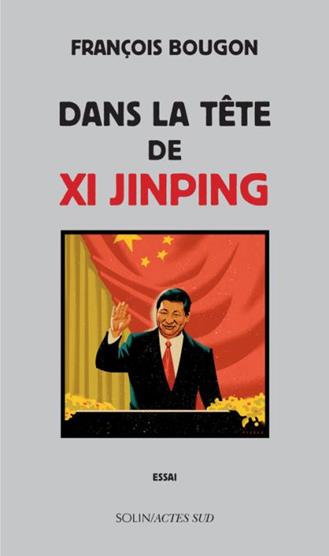 François Bougon est journaliste au « Monde », il avait été correspondant de l’AFP en Chine pendant 5 ans. Il a écrit un livre : « Dans la tête de Xi Jinping » publié en 2017 et édité par Actes Sud.
François Bougon est journaliste au « Monde », il avait été correspondant de l’AFP en Chine pendant 5 ans. Il a écrit un livre : « Dans la tête de Xi Jinping » publié en 2017 et édité par Actes Sud.
François Bougon insiste d’abord sur une illusion que nous autres occidentaux pourrions avoir d’espérer qu’apparaisse au sein du PCC, un Gorbatchev chinois qui parle de réforme, de transparence, de refus de la violence et qui fasse évoluer la Chine vers un régime plus proche de nos valeurs.
C’est un espoir vain, selon ce journaliste. Gorbatchev est l’anti-modèle pour les responsables chinois.
Et particulièrement Xi Jinping est marqué par la chute de l’URSS en 1991, suite à la « mollesse » de Gorbatchev. Il est résolu à éviter cette faute et considère que le salut du Parti est dans la lutte pied à pied contre la démocratie, et la réactivation d’un marxisme aux couleurs de la Chine.
Bougon s’intéresse au document « n°9 » de 2013 et considère particulièrement important de constater que Xi Jinping y pourfend les « valeurs universelles », la « démocratie constitutionnelle», les ONG, les « forces hostiles » de l’étranger, et le « nihilisme historique » – le fait de tourner en dérision les héros révolutionnaires et leurs actes.
Bougon le constate mais il est sceptique sur les chances de survie d’un régime ayant tourné le dos à toute concession et toute réforme politique. L’auteur suggère que le pouvoir, entré dans la dernière phase de son existence, joue ses dernières cartes et ne pourrait survivre plus d’une à deux décennies. Sous l’angle économique, Xi veut rendre ses concitoyens réactifs et créatifs, pour obtenir des entreprises et des universités mondialement compétitives. Mais sous l’angle politique, Xi veut en même temps maintenir cette société muselée.
Un tel grand écart devrait devenir rapidement intenable : « aucun Parti ne peut régner ad vitam aeternam », conclut F. Bougon.
Vous pouvez voir François Bougon présenter longuement son ouvrage et ses idées dans une <vidéo> d’une conférence qu’il a fait à la fondation Jean Jaurés.
Il explique notamment que par rapport aux discours des droits de l’homme des occidentaux, aux leçons des valeurs universelles, Xi Jinping ne se situe pas dans une posture défensive, mais dans un discours revendicatif, un discours conquérant et même de sanctions économiques pour ceux qui ne voudraient pas comprendre. La Chine a sa propre civilisation, a des solutions pour le monde qui ne s’inscrivent absolument pas dans le corpus idéologique des occidentaux. Notamment dans cette vision, la Loi n’a pas pour vocation de garantir des droits individuels mais d’imposer des solutions pour que la Société fonctionne efficacement.
L’obsession de Xi Jinping est que la Chine «communiste» devienne la première puissance mondiale économique et militaire pour le centenaire de sa création, en 2049, et qu’elle surpasse enfin les Etats-Unis. Pour atteindre ce but, il choisit de faire prendre au pays un virage de plus en plus totalitaire.
<Le Figaro> parle aussi de ce document 9 et conclut très justement :
« En réalité, il ouvre une guerre idéologique frontale à un Occident qui, aveuglé par les chimères de l’eldorado chinois, réduit au commerce sa relation à la Chine. »
<Le Monde> explique
« Le Document n°9 apparaît aujourd’hui comme ayant tracé la feuille de route exacte de la répression qui n’a cessé de s’intensifier, dès l’automne 2013 et la fin du procès de Bo Xilai, contre la société civile chinoise, les intellectuels, les blogueurs, les avocats ou les militants d’ONG. […]
Cette « note de l’Office général du Comité central du parti », diffusée jusqu’aux plus bas échelons de l’organisation, a pris le nom de « Document n°9 », car il est alors le neuvième document de ce type diffusé depuis le début de l’année, selon le site China File, qui en offre une traduction intégrale en anglais, tirée de la version en chinois publiée par le magazine papier du site Mingjing News aux Etats-Unis en septembre 2013. […] le « Document n°9 » se lit comme le pense-bête d’un régime obnubilé par l’Occident, un »kit anti-subversion » qu’il faut suivre à la lettre. Il prévient que « les forces occidentales antichinoises et les « dissidents » de l’intérieur sont toujours en train d’essayer activement d’infiltrer la sphère idéologique chinoise et de mettre au défi notre principale idéologie ». Le combat est « complexe et intense », prévient le préambule. Pour ce faire, sept tendances ont été identifiées comme autant de moyens inventés par l’Occident pour saper l’autorité du parti et le renverser. Le document expose les principaux arguments en leur faveur, et les condamne d’autorité.
On y trouve la « démocratie constitutionnelle occidentale » : Certains « attaquent les dirigeants en disant qu’ils se placent au-dessus de la Constitution ». « D’autres prétendent que la Chine a une Constitution, mais qu’elle n’est pas gouvernée de manière constitutionnelle ». « Leur objectif est d’utiliser l’idée de la démocratie constitutionnelle occidentale pour saboter le rôle dirigeant du parti, abolir la démocratie populaire et nier la Constitution de notre pays ». Les « valeurs universelles » : « Ces gens croient que la liberté, la démocratie, les droits de l’homme sont universels et éternels. C’est évident dans la manière dont ils tordent la promotion par le parti de la démocratie, la liberté (etc.) ». « Le but est d’utiliser le système de valeurs de l’Occident » pour « supplanter les valeurs fondamentales du Socialisme ».
Suivent la « société civile », accusée d’être « une tentative de démantèlement de la fondation sociale du parti dirigeant » ; le « néolibéralisme économique » ; le « journalisme à l’Occidental » (qui « met en question le principe que les médias et l’édition doivent être soumis à la discipline du Parti »). Le « nihilisme historique » : certains « dénient la valeur scientifique et pédagogique de la pensée Mao Zedong », d’autres « tentent de détacher ou même d’opposer entre elles la période de l’ouverture et des réformes [à partir de 1978] et celle qui a précédé [le maoïsme]. […]
Le « Document n°9 » s’attache ensuite à démasquer tous ceux qui œuvrent et s’agitent contre le parti : « Certains ont diffusé des lettres ouvertes et des pétitions en appelant à la réforme politique, à l’amélioration des droits de l’homme, (…) à revenir sur le verdict du 4 juin [1989] ». D’autres ont « monté en épingle la transparence du patrimoine chez les dirigeants », l’idée de la « supervision du gouvernement par les médias », ou ont prétendu « combattre la corruption sur l’Internet ». D’autres encore « réalisent des documentaires sur des sujets sensibles », « manipulent et montent en épingle les immolations de Tibétains » ou les « problèmes ethniques ou religieux ». Attention « aux ambassades étrangères, aux médias et aux ONG » qui « opèrent en Chine sous diverses couvertures, répandent les valeurs occidentales et cultivent à dessein les forces antigouvernementales ».
J’ai aussi trouvé cet article de <Slate>
Cet homme ne nous considère pas comme des partenaires, mais comme des ennemis.
Pendant ce temps les entrepreneurs occidentaux voient dans la Chine un marché immense et dévoilant tant de potentiel…
<1320>
-
Mardi 3 décembre 2019
« Je jure de préserver les secrets du Parti Communiste »Serment des dirigeants chinoisC’est un lecteur du mot du jour habitant le Viet-Nam qui, il y a déjà assez longtemps, c’était le 20 décembre 2018, m’a écrit
« J’ai vu un super documentaire d’ARTE il y a peu, sur YouTube : « Le monde selon Xi Jinping ». Je pense que ça te plaira ».
J’ai plusieurs fois voulu partager ce documentaire ou le rappeler à celles et ceux qui l’ont déjà vu et écrire une série de mots du jour sur la Chine, la Chine de Xi Jinping.
Mais j’ai toujours reporté le moment d’aborder ce sujet.
Il faut bien se lancer…
Cette série aura toutefois une publication discontinue, car certains éléments vont me conduire à l’interrompre pour écrire des articles spécifiques.
La Chine est un empire qui aspire à devenir une nation.
C’est un empire, l’empire du milieu.
Pendant longtemps, cet empire dominait économiquement le monde.
Et puis il y a eu la révolution industrielle en Angleterre et en Europe.
Au XIXème siècle, les chinois qui avaient, et je dirais à juste titre, une haute opinion de leur culture et de leur civilisation ont été brusquement confrontés à une puissance militaire bien supérieure qui les a vaincu et, plus grave encore, à une civilisation britannique tellement fière d’elle-même et méprisante par rapport aux autres et particulièrement aux extra-européennes, que ce fut un choc, un choc d’humiliation.
Il y eut alors une réaction contre le système impérial qui va conduire à la révolution en 1911. La république de Chine est proclamée en février 1912 et met à sa tête « Sun Yat-Sen» qui était une personnalité en exil et qui va créer le parti nationaliste « Kuomintang ».
Il aura le plus grand mal à unifier le pays et devra combattre contre des Seigneurs de la guerre, des chefs de clan. Il crée une académie militaire et met à sa tête un militaire « Tchang Kaï-chek » qui prendra la tête du Kuomintang à sa mort en 1925.
Mais parallèlement, en s’inspirant de l’empire voisin de Russie, un Parti communiste chinois se crée et organise un premier congrès en 1921.
Par la suite, tantôt allié contre les Seigneurs de la guerre, puis contre le Japon, tantôt ennemi, le Parti Communiste et le Kuomintang vont s’affronter jusqu’à la victoire finale des communistes qui ont mis à leur tête Mao Tse Toung. Les nationalistes du Kuomintang et Tchang Kaï-chek, vont se retirer sur l’île de Formose que les chinois appellent Taïwan.
Mao proclame la république populaire de Chine le 1er octobre 1949.
Mao et les communistes vont avoir comme premier objectif de rendre sa fierté à la Chine.
Il y eut quelques succès, mais surtout beaucoup de répressions, beaucoup de morts et un désastre économique.
Le désastre économique conduit à limiter les pouvoirs de Mao et à donner une grande importance à un de ses proches collaborateurs Deng Xiaoping qui met en œuvre, avec d’autres, une libéralisation économique. Parmi ceux qui ont accompagné Mao très tôt et qui désormais sont au côté de Deng Xiaoping il y a Xi Zhongxun le père de Xi Jinping.
Nous savons que pour reprendre l’intégralité du pouvoir, Mao lance avec les jeunesses communistes la révolution culturelle qui va chasser du pouvoir, violenter, humilier, obliger à des « travaux de rééducation » en usine ou à la campagne tous ceux qui ont participé à cette première libéralisation économique. Pour être exact, « bénéficierons » de ce traitement, ceux qui n’ont pas été tués. Par ailleurs, le cercle de celles et de ceux qui seront opprimés est beaucoup plus large que ceux qui ont participé à la libéralisation de l’économie.
Xi Jinping en tant que fils de Xi Zhongxun va aussi subir la disgrâce. Wikipedia nous apprend que :
« En 1969, lors de la révolution culturelle, il est envoyé […] dans le village de Liangjiahe, dans la province de Shaanxi. Il y vit près de sept ans, de 15 à 22 ans, dans une habitation troglodytique. À cette époque, les enfants des hauts fonctionnaires intègrent en général l’armée, mais son père Xi Zhongxun étant exclu du PCC a perdu tout appui. Toutefois, la région est l’ancienne base révolutionnaire de son père, et Xi Jinping y est bien accueilli. Après quelques mois, il s’enfuit et regagne Pékin, où il est découvert et envoyé dans un camp de travail pour avoir déserté la campagne. »
Avec une telle histoire, on pourrait penser qu’il exprime un certain ressentiment à l’égard du Parti Communiste.
Mais et c’est ce que nous apprend le documentaire « le monde de Xi Jinping », en réalité il va subir l’effet qu’on appelle « le syndrome de Stockholm », terme créé par le psychiatre Nils Bejerot en 1973. Le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique observé chez des otages ayant vécu durant une période prolongée avec leurs geôliers et qui ont développé une sorte d’empathie, de contagion émotionnelle vis-à-vis de ceux-ci, selon des mécanismes complexes d’identification et de survie.
Et il fera tout ce qu’il pourra pour être intégré et gravir les échelons du Parti Communiste. Et pourtant ce ne fut pas simple : Il essuya neuf refus avant de pouvoir adhérer à la Ligue de la jeunesse communiste chinoise en 1971. Puis, il réussit en 1974 à adhérer au Parti communiste chinois.
Après le retour au pouvoir de Deng Xiaoping qui fut suivi rapidement de la réhabilitation de son père Xi Zhongxun, les choses devinrent plus simples pour lui.
Toujours est-il que sans bruit, avec beaucoup de diplomatie il parvint à grimper jusqu’à la plus haute marche du pouvoir en Chine.
Il est vrai que ce documentaire <Le monde selon Xi-Jinping> est passionnant et inquiétant aussi. Plusieurs points sont à souligner.
Aujourd’hui je me concentrerai sur le début du documentaire, cela commence à 3 min13.
Xi Jinping est arrivé au pouvoir suprême.
Accompagné d’un très petit nombre de dirigeants, il pénètre dans un endroit étrange qui est ce que j’appellerai « le sanctuaire du Parti Communiste Chinois », le lieu historique du premier congrès.
Ils sont sept.
Ces 7 dirigeants constituent le : « Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois ». On les appelle parfois «les empereurs».
C’est en fait eux qui dirigent la Chine.
Et comme pour une cérémonie religieuse devant la stèle qui représente les premiers dirigeants du Parti, tous ces hommes lèvent le point et vont prêter serment. Le numéro 1, Xi Jinping parle en premier, puis les six autres répètent :
« Je jure de préserver les secrets du Parti Communiste
Je jure de lutter pour le communisme
Je jure de ne jamais trahir le parti »

C’est quand même un étrange serment.
Je peux comprendre qu’ils jurent de ne jamais trahir le parti.
Je pense que ne pas trahir le parti devrait conduire à ce qu’on ne dévoile pas ce qui n’a pas vocation à être dévoilé. Et donc, ne pas trahir le parti doit impliquer, doit englober le fait de ne pas trahir les secrets.
Et non seulement, il s’agit d’un verset spécifique de ce serment, il s’agit même du premier.
Ils ne doivent pas être très honorables ces secrets pour que ces 7 dirigeants trouvent si essentiel de le déclamer en premier.
<1319>
-
Lundi 2 décembre 2019
«Mariss Jansons avait atteint un classicisme supérieur, qui lui appartenait.»Rémy LouisLe 31 octobre 2019, Annie, Florence et moi étions à Paris, à la Philharmonie, pour vivre un concert avec l’orchestre de la radiodiffusion bavaroise sous la direction de Mariss Jansons. C’était il y a un mois.
Et hier dimanche, nous apprenions que Mariss Jansons, venait de décéder à l’âge de 76 ans à Saint Pétersbourg.
J’avais évoqué ce concert ,en introduction au mot du jour consacré au livre de Sylvain Tesson, « La panthère des neiges » :
« Ce fut un soir de grâce.
Je vous avais déjà présenté l’extraordinaire 10ème symphonie de Dimitri Chostakovich, écrite après la mort de Staline.
J’en avais parlé après une très belle interprétation à l’auditorium de Lyon avec l’Orchestre National de Lyon, dirigé par un jeune chef de 23 ans, plein de talent. Ce fut le mot du jour du <jeudi 16 mai 2019>
Mais cette fois, le jeudi 31 octobre 2019, cette œuvre fut interprétée par l’orchestre de la radio de Bavière avec un des meilleurs chefs d’orchestre actuels : Mariss Jansons, dans la Philharmonie de Paris.
Un orchestre qui agit comme un seul corps vivant, qui rugit, murmure, éclate, explose, chante, court à l’abime puis se régénère. On ne se trouve plus dans la même dimension, ce n’est plus une belle interprétation, c’est une offrande, un moment sublime.
Le chef de 76 ans fait peu de gestes, mais à la moindre de ses sollicitations l’orchestre répond immédiatement. Nul ne saurait, quand il assiste à un tel échange, douter de ce qu’un chef apporte à son orchestre. Il est vrai que Jansons est le directeur musical de l’orchestre de la radio de Bavière depuis 16 ans. »
 Le critique musical, Michel Le Naour écrivit, précisément à propos de concert, sur le site <Concert Classic.com> :
Le critique musical, Michel Le Naour écrivit, précisément à propos de concert, sur le site <Concert Classic.com> :
« Mariss Jansons et l’Orchestre Symphonique de la Radio bavaroise à la Philharmonie – Un accomplissement
Démarche hésitante et visage amaigri, Mariss Jansons donne l’impression d’être à bout de forces. Dès qu’il s’empare de la baguette à la tête de son orchestre bavarois, dont il est directeur musical depuis 2003, cette impression se dissipe tant l’investissement du chef letton et son osmose avec les instrumentistes transfigurent la musique qui paraît couler de source.
Dès l’Ouverture d’Euryanthe de Weber, la profondeur sonore qui se dégage fait entendre l’inouï avec des cordes lumineuses et denses, une petite harmonie d’une perfection rare et des cors d’une absolue justesse. L’équilibre d’ensemble ainsi obtenu résout la quadrature du cercle entre puissance et clarté. La même impression prévaut avec le Concerto pour piano n° 2 de Beethoven […] Accompagnement de rêve qui laisse le soliste aller droit son chemin, doigts ailés mais toujours contrôlés. […]
La Dixième Symphonie de Chostakovitch n’a pas non plus de secret pour Jansons, et il semble encore ici la réinventer. Un miracle de progression dans la conduite du Moderato initial d’un poids dramatique quasi insoutenable, culminant dans des accords déchirants avant de mourir dans la stridence du duo des flûtes piccolo (magnifiques de cohésion) et l’homogénéité du tapis de cordes. L’Allegro – un portrait de Staline ? – est tenu de bout en bout par une direction implacable où chaque pupitre paraît mettre sa vie en danger, à l’image de l’exceptionnel timbalier Raymond Curfs. L’intensité de l’Allegretto, mortifère […], précède un final aux infinies nuances jusqu’à la jubilation tellurique de la bacchanale. Une interprétation inoubliable saluée par un public debout, sous le coup de l’émotion, et qui peine à quitter la salle. »
En matière d’art, je ne crois pas au classement. Je n’écrirai donc pas que c’était le plus grand chef d’orchestre vivant. Mais c’était de toute évidence l’un des plus grands.
Herbert von Karajan qui était sûr de son talent immense et de son mérite disait qu’il n’y avait, à son époque, qu’un autre chef d’orchestre vivant de son niveau : Evgeny Mravinsky, directeur musical austère et rigoureux de l’orchestre Philharmonique de Léningrad. C’était le nom de Saint-Pétersbourg à l’époque soviétique et donc de ce chef égal de Karajan selon ce dernier.
Il n’en reste pas moins que Mariss Jansons a été le disciple de ces deux immenses musiciens et qu’il a probablement beaucoup appris de l’un et de l’autre.
Il a dû apprendre par
 un autre professeur l’art de sourire et de rayonner pendant qu’il dirigeait.
un autre professeur l’art de sourire et de rayonner pendant qu’il dirigeait.
Des esprits pertinents diront, en choisissant une photo, on peut lui faire dire n’importe quoi. Ce n’est pas faux. Mais j’ai vu des vidéos des trois, celui qui souriait le plus était de loin Jansons, Mravinsky ne souriait jamais, Karajan rarement.
Sur cette page « classicisme supérieur » vous verrez plusieurs vidéos de cet immense chef.
Avant de devenir le directeur musical de l’Orchestre de la Radiodiffusion Bavaroise et pendant plusieurs années parallèlement le directeur de l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, il fut à partir de 1979 le directeur de l’orchestre Philharmonique d’Oslo pendant 23 ans.
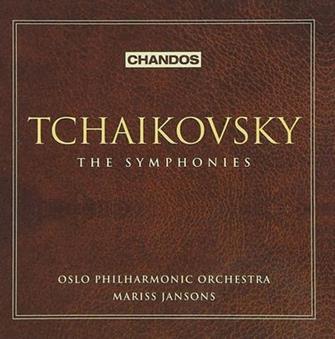 C’est à ce moment-là que j’entendis parler de lui, car il réussit avec cet orchestre, peu connu, des enregistrements exceptionnels.
C’est à ce moment-là que j’entendis parler de lui, car il réussit avec cet orchestre, peu connu, des enregistrements exceptionnels.
J’avais lu plusieurs critiques qui considéraient son enregistrement des symphonies de Tchaïkovski avec l’Orchestre Philharmonique d’Oslo comme le plus abouti, malgré la très grande concurrence d’orchestre et de chef de grand renom dans ce répertoire. J’ai acheté cette interprétation et je confirme qu’elle est splendide.
Par un hasard de l’histoire, le jeune chef de 23 ans, Klaus Mäkelä, que j’ai évoqué lors du mot du jour du 16 mai 2019 et rappelé au début de celui-ci vient d’être nommé directeur musical de l’Orchestre Philharmonique d’Oslo.
Je pense qu’on se trompe rarement quand on achète un disque dirigé par Mariss Jansons.
Il a également réalisé une intégrale des symphonies de Chostakovitch remarquable.
Tous ses derniers enregistrements avec l’orchestre bavarois ou le Concertgebouw d’Amsterdam sont très aboutis.
Vous trouverez aussi sur <cette page d’hommages> des vidéos et des enregistrements audio qui montrent l’étendue de son talent.
Le terme utilisé par Michel Le Naour « d’accomplissement » me semble très juste.
Il faut bien trouver un exergue pour ce mot du jour. Je le tire de la présentation du concert du 31 octobre 2019 par le musicologue Rémy Louis :
« Jansons a aujourd’hui atteint un classicisme supérieur, qui lui appartient. On peut trouver plusieurs raisons à cela: d’abord une présence physique, une autorité naturelle, une technique de direction claire et persuasive, épurée comme toujours par l’âge et l’expérience. Ce qui n’exclut ni le panache ni l’inspiration du moment. Il faut également souligner son sens superlatif de la forme, éclairé par la justesse fascinante de ses transitions. En outre, l’instinct musical de cet artiste de grand savoir embrasse un répertoire d’un éventail stylistique considérable, au concert comme au disque. ».
Il faut désormais parler au passé : « Jansons avait atteint un classicisme supérieur, qui lui appartenait ».
<1318>
-
Vendredi 29 novembre 2019
« Et ce que je célébrais, ce jour de novembre 1989, c’était la réunification des deux parties de ma vie dont le Mur odieux symbolisait la déchirure. »Mstislav Rostropovitch en parlant de son concert devant le mur de BerlinJ’avais fini un peu rapidement, le mot du jour sur la chute du mur de Berlin par une photo de Mstislav Rostropovitch jouant au violoncelle devant un pan du mur en cours de destruction.
C’est un peu rapide, parce qu’il y a une petite histoire de ce concert improvisé hors du temps.
Et puis, il y a aussi la Grande Histoire….
 Et enfin, il y a un artiste exceptionnel et qui est aussi devenu un homme exceptionnel et que tout ceux qui l’aimaient, appelaient, Slava.
Et enfin, il y a un artiste exceptionnel et qui est aussi devenu un homme exceptionnel et que tout ceux qui l’aimaient, appelaient, Slava.
Aujourd’hui je parlerai de l’homme
Et je n’oublierai pas qu’à côté de cet homme, il y avait une femme, tout aussi exceptionnelle dans l’art comme dans l’humanité, et à laquelle il faudra que je consacre aussi un mot du jour : Galina Vichnevskaia.
Commençons par la petite histoire, celle de ce concert improvisé.
Rostropovitch, le 9 novembre 1989, était à Paris, il n’avait pas le droit de retourner dans son pays natal : la Russie.
Et il apprend la nouvelle. <Cette archive de l’INA> le montre racontant cette découverte :
« Ce soir-là, des amis m’ont appelé et m’ont dit : regarde un peu ce qui se passe.
J’ai allumé mon poste de télévision, mais je ne comprenais rien.
Il y avait des gens sur une plate-forme qui ouvraient des bouteilles de champagne.
Quand j’ai commencé à réaliser, les larmes me sont montées aux yeux. »
La suite est racontée par son ami, le PDG de Danone, Antoine Riboud :
« J’appelle et je tombe sur Slava qui me dit : Antoinetchik, mur Berlin effondré, nous obligés aller Berlin pour voir liberté.
Alors on arrive à Berlin, on prend deux taxis, un pour nous, l’autre pour le violoncelle. Et on est allé au mur de Berlin qui était juste à côté.
Et là Slava s’est assis, la foule s’est réunie. Silence fantastique… Et Slava a joué une sarabande de Bach.
Dans la vie, quand il y a d’immenses émotions, il y a toujours un extraordinaire moment d’humour.
Alors Slava jouait, on était à côté de Charlie door.
Et tous les allemands de l’Est passaient et voyaient un monsieur assis sur une chaise blanche qui jouait du violoncelle, il avait les cheveux blancs. Alors ils faisaient le détour, ils écoutaient, et puis avec un geste merveilleux, ils déposaient un peu d’argent, l’argent de l’Allemagne de l’est au pied de Slava.»
Antoine Riboud oublie dans son récit que Slava est venu avec son violoncelle mais sans un accessoire essentiel. Rostropovitch raconte, lui-même dans un article du Monde du 5 novembre 2009 : comment il a pu obtenir un siège pour jouer car il avait oublié cet accessoire indispensable pour tout violoncelliste
« Je m’en suis rendu compte, planté devant le Mur. Pas un endroit pour m’asseoir ! J’étais catastrophé. Jamais je n’avais réalisé que ce simple accessoire m’était aussi indispensable que l’instrument précieux. Toujours, on m’avait évité ce tracas ! Mon violoncelle sous le bras, j’ai sonné à une loge de concierge pour emprunter une chaise. Un homme m’a dévisagé : ‘Etes-vous Rostropovitch ?’ Puis il a disparu trois minutes avant de rapporter une chaise et une vingtaine de personnes ! »
Cela c’est la petite histoire, mais dans le même article il dit le sens profond de son geste :
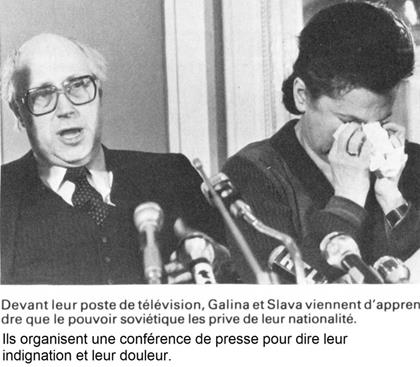 « Toute ma vie est là-dedans.
« Toute ma vie est là-dedans.
Ma cohérence, mon unité.
Mais qui pourrait comprendre ? C’est mon histoire à moi.
Et ce que je célébrais, ce jour de novembre 1989, c’était la réunification des deux parties de ma vie dont le Mur odieux symbolisait la déchirure.
D’un côté de la Muraille se trouvaient mon passé, mon pays, mes racines ; de l’autre côté mon exil, mon travail, mon avenir.
Deux pans de vie cloisonnés, hermétiques, que j’avais cru ne jamais pouvoir réunir et qui me donnaient le sentiment d’être amputé, incomplet. » Qui, en effet, pouvait imaginer que le Mur cachait des lézardes ? Que, de l’intérieur, le système était miné ? »
Nous pensions tous que le communisme allait durer mille ans !
Et que jamais, jamais nous ne pourrions revenir au pays.
L’exil est toujours une blessure. Mais celui d’URSS et des pays du bloc était le plus cruel et le plus désespéré : tout départ signifiait un adieu. »
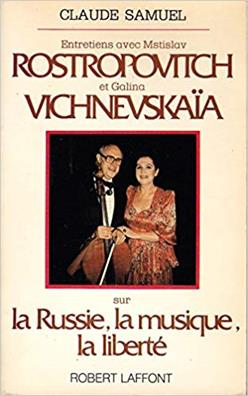 Pourtant, après les années d’apprentissage, Slava et Galina étaient adulés par toute l’élite soviétique. Dans le livre de Claude Samuel : « Entretiens avec Rostropovitch et Vichnevskaïa » publié chez Robert Lafont, que j’avais lu, il y a assez longtemps et que j’ai relu partiellement pour écrire ce mot du jour on voit une photo sur laquelle il est en compagnie de Nikita Khrouchtchev, alors secrétaire général du parti communiste et successeur de Staline.
Pourtant, après les années d’apprentissage, Slava et Galina étaient adulés par toute l’élite soviétique. Dans le livre de Claude Samuel : « Entretiens avec Rostropovitch et Vichnevskaïa » publié chez Robert Lafont, que j’avais lu, il y a assez longtemps et que j’ai relu partiellement pour écrire ce mot du jour on voit une photo sur laquelle il est en compagnie de Nikita Khrouchtchev, alors secrétaire général du parti communiste et successeur de Staline.
Les premiers doutes viennent à partir du moment où le pouvoir soviétique commence à censurer et à harceler Chostakovitch et Prokofiev pour lesquels il a une profonde admiration et avec lesquels il a noué un lien artistique et amical fort.
Il y a un second épisode qui est rarement raconté et qui m’avait marqué lorsque je l’ai entendu pour la première fois.
Un des plus beaux concertos de violoncelle est celui de Dvorak. Anton Dvorak est le plus grand compositeur tchèque. Sa musique chante l’âme slave et tchèque.
En 1968, il y eut aussi le printemps de Prague, pendant lequel les jeunes tchèques voulurent croire en un communisme au visage humain avec à leur tête Alexander Dubček. Mais les soviétiques n’acceptaient pas une évolution qui leur échappe. Pendant la nuit du 20 au 21 août 1968, des blindés de plusieurs pays communistes pénètrent dans Prague pour réprimer le vent de liberté. Ils ont rencontré une vaine mais héroïque résistance de la part des étudiants notamment dans les rues de la capitale.
Par le hasard des programmations de concert, le 21 août au soir un concert était prévu à Londres par Rostropovitch et l’orchestre symphonique d’Etat de l’URSS dirigé par Evgeny Svetlanov. Au programme, il y avait justement le concerto de Dvorak. Mais les musiciens russes furent accueillis par une salle hostile, des gens se levèrent pour les invectiver les russes et les traiter d’envahisseurs.
Cependant, Rostropovitch parvint par son interprétation à faire passer une immense émotion. Ceux qui y ont assisté racontent que les larmes coulaient sur le visage de Slava pendant qu’il jouait.
Vous pouvez entendre cette interprétation sur cette <page>
Et puis à la fin de son interprétation, il joua comme bis la Sarabande
de la Suite n°2 (BWV 1008) de Bach et la dédiera « à ceux qui sont tristes ».
Ensuite, il y a l’épisode beaucoup plus connu dans lequel Slava et Galina vont accueillir Soljenitsyne chez eux, en 1969. Le futur auteur de l’archipel du goulag n’a nulle part où aller, les autorités soviétiques entendent le priver de tout.
Et au départ, il ne s’agit pas pour Rostropovitch d’un acte de dissidence, simplement un acte d’humanité.
Il répond à Claude Samuel (page 103) :
« Lorsque Soljenitsyne a commencé à vivre chez nous, il n’était pas question pour nous de faire de la politique. C’était simplement un acte d’humanité. Quand on a voulu nous obliger à le chasser, c’est là que le conflit a éclaté. On me disait : « vous savez, il est antisoviétique ! » Et je répondais : « Avant d’affirmer qu’il est ou non anti soviétique, dites-moi s’il est ou non un être humain. Il faut qu’il vive quelque part et nous ne pouvons pas le renvoyer. Si vous lui donnez un appartement ou même une chambre, c’est lui qui partira.»
Dans un article publié par Libération le 19 novembre 2005 : Il raconte plus précisément les pressions, les peurs.
« Les officiels du Parti m’ont fait savoir que je devais mettre Soljenitsyne à la porte. Je leur ai dit qu’il faisait moins 30 degrés et qu’il n’en était pas question. Soljenitsyne avait été chassé de la Maison des écrivains et il n’avait d’autre choix que d’habiter chez nous. Une fois il m’a dit : «On ne fera plus le trajet ensemble jusqu’à Moscou en voiture, on ne va pas les laisser se débarrasser de deux personnes avec un seul camion.» Ma hantise était qu’ils suppriment Soljenitsyne chez moi, et que mes enfants et petits-enfants me suspectent d’avoir été indirectement complice du KGB. Du coup, j’ai écrit une lettre que j’ai envoyée à quatre journaux dans laquelle je disais tout ce que je pensais du régime. Je savais qu’elle ne serait jamais publiée et qu’on pouvait m’arrêter, mais je savais également qu’elle serait copiée des centaines de fois. La preuve, tout le monde était au courant à Paris, dès le lendemain. Je jouais alors en Allemagne. Un agent du KGB est venu me trouver après le concert dans ma chambre d’hôtel. Il m’a dit : «Vous avez entendu cette provocation ? On a publié une lettre sous votre signature dans laquelle on vous fait dire que c’est un scandale que des compositeurs comme Chostakovitch et Prokofiev ont été critiqués dans leur pays, et qu’il faille aller à Paris pour voir les films de Tarkovski.» J’avais également écrit dans cette lettre : «Dans vingt ans, nous aurons honte de ce passé.» »
Il dit aussi qu’après cela, les autorités ont annulé tous ses concerts en Union soviétique. Galina raconte qu’on la laissait chanter, mais on enlevait son nom des affiches. On l’empêche aussi d’aller faire des tournées en occident. Dans un régime comme celui de l’Union soviétique, toute activité dépendait du pouvoir qui pouvait dès lors enlever toute ressource économique à ceux qu’elle voulait punir.
Slava et Galina ne molliront pas.
En 1974, Soljenitsyne est d’abord arrêté puis expulsé et déchu de sa nationalité soviétique. La situation des époux Rostropovitch ne s’améliorera pas.
Rostropovitch parviendra à négocier un départ temporaire d’URSS. Les autorités soviétiques lui auraient promis de le laisser revenir en U.R.S.S. à l’expiration de ce délai. Mais ils ne respecteront pas cette promesse.
Mstislav Rostropovitch quittera l’Union soviétique, pour Londres, le 26 mai 1974 avec Galina Vichnevskaïa, et ses deux filles.
Le mercredi 15 mars 1978, « Les Izvestia » annoncent que lui et son épouse sont déchus de leur nationalité soviétique, interdiction sera faite à Aeroflot de lui vendre un billet d’avion.
Slava et Galina recevront cette décision comme une déchirure et furent très affectés :
<Un article du Monde de 1978> décrit la scène :
« Mstislav Rostropovitch et Galina Vichnevskaïa ont donné, vendredi après-midi 17 mars, une conférence de presse à Paris. Tendue, le visage fermé, parfois au bord des larmes, la grande cantatrice a attaqué la première, disant qu’ » il n’y a pas de mot pour exprimer l’indignation devant cet acte inhumain. Nous avons appris notre déchéance de la nationalité soviétique par la télévision. L’ambassade d’U.R.S.S. savait que nous étions à Paris ; elle n’a pas daigné nous annoncer officiellement cette exécution par contumace de notre famille. Je ne reconnais pas au gouvernement soviétique le droit de me priver de la terre qui m’a été donnée par Dieu « .
[…] En achevant leur conférence de presse, Rostropovitch et sa femme ont déclaré : » Nous sommes sûrs que nous reviendrons un jour dans notre patrie. »
Par la suite, Rostropovitch prendra aussi fait et cause pour Andrei Sakharov un autre dissident célèbre.
Il déclarera, dans un article du Monde en 1984, pendant une grève de la faim du dissident : Andreï Sakharov est en train de mourir pour que nous restions libres. :
« Nous souffrons avec lui. Nous le voyons comme s’il était ici, et nous ressentons toutes ses souffrances. Le destin est en train de mettre à l’épreuve la force morale des hommes libres en Occident. Pouvons-nous par notre force morale sauver la vie d’un homme qui meurt pour nous pour que nous conservions notre liberté ? […]
Quand j’étais encore à Moscou, nous étions très proches. Ses yeux sont ceux d’un saint homme. Je ne connais personne au monde qui ait un regard comme lui. Je l’ai connu à une époque où il commençait à perdre tous ses privilèges (d’académicien). Il a choisi ce chemin de croix en sachant parfaitement ce qui l’attendait. Il a d’abord été changé en un homme normal qui faisait la queue pour les pommes de terre. Comme moi. Nous étions voisins à la datcha. Maintenant, sa situation est plus mauvaise que la normale. Et toutes ses souffrances sont pour nous. C’est pourquoi je considère que nous sommes tous responsables de sa vie.
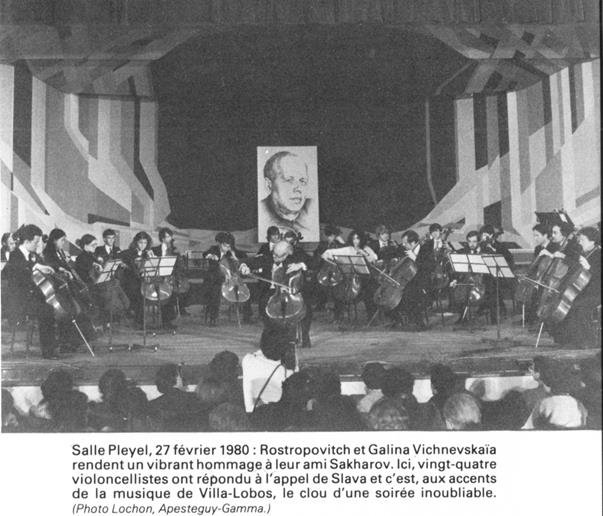
Ce n’est pas un simple artiste qui est allé, un jour de novembre 1989, jouer du Bach à l’endroit où il fallait être à ce moment-là.
C’est un homme qui avait de l’épaisseur et qui comprenait ce que pouvait signifier pour des millions d’homme, l’écroulement du mur de la honte.
Le 16 janvier 1990, Mikhaïl Gorbatchev signera le décret de réhabilitation de Rostropovitch.
 Son rejet du communisme soviétique et de l’administration kafkaienne et incompétente qui dirigeait ces pays de l’est était devenu total et absolu.
Son rejet du communisme soviétique et de l’administration kafkaienne et incompétente qui dirigeait ces pays de l’est était devenu total et absolu.
Il explique <Dans cet article du Nouvel Obs> :
« Presque tous les artistes, tous les musiciens, les écrivains, la crème de la Russie, avaient émigré, et Staline a fait disparaître ceux qui étaient restés. On se dispute sur le nombre de millions de morts qu’il a faits. Trente, cinquante ? Et qui le système stalinien visait-il ? Ceux qui travaillaient. Ceux qui ne faisaient rien, les incapables, ont été épargnés.
Ceux qui dirigeaient la vie artistique ne comprenaient rien à l’art. Et ce qu’ils ne comprenaient pas était forcément mauvais. Voyez Chostakovitch, Prokofiev : ils n’avaient pas le droit de composer parce qu’ils n’étaient pas compris de ceux qui avaient le pouvoir. Je vais vous raconter une histoire que je n’ai jamais racontée. J’avais un imprésario en Amérique, Sol Hurok, que j’aimais comme un père, et qui était un grand bonhomme ; il travaillait aussi avec Chaliapine, Stravinsky, Heifetz, Stern… Je devais faire une tournée de deux mois aux Etats-Unis. Je lui dis que je ne peux pas dire oui, parce que le ministère russe doit me donner son autorisation. En attendant, me répond Hurok, pouvez-vous me donner votre programme ? Bien sûr : Suite de Bach, sonate de Brahms, de Prokofiev, de Chostakovitch, et quelques petites choses. J’avais joué tout ça mille fois. Le ministère donne son accord pour la tournée (je ne conservais que deux cents dollars de chaque cachet, et le ministère empochait le reste), mais apprend que j’ai donné mon programme : « Nous savons que vous l’avez donné à votre imprésario ! Sans notre autorisation ! De quel droit ? Vous ne partirez jamais plus ! Nous avons ordonné à Hurok d’annuler le programme ! Vous devez fixer un autre programme, et il passera par nous ! » Ils ne savaient pas de quoi était composé mon programme, mais Hurok leur avait dit qu’il l’avait déjà. J’ai dit : d’accord, veuillez noter mon nouveau programme. Et je dicte : « Suite de Bach n° 9 [il n’y en a que six], Sonate pour violoncelle n°3 de Mozart [il n’y en a pas une seule], entracte, puis de la musique russe : quelques sonates pour violoncelle de Scriabine [il n’en existe pas]. » Ils ont noté, envoyé le programme à Hurok, qui était fou furieux, mais qui a compris ce que cela signifiait. Il a imprimé le vrai. Evidemment, le ministère a fini par savoir que j’avais joué ce qui était prévu. Et à mon retour ils ont fait un scandale dont on se souvient encore, ils ont voulu me mettre en prison… Tels étaient les responsables russes. Tout de même, sous l’Ancien régime, les affaires professionnelles étaient tenues par des gens qui savaient leur métier ! Le système communiste et les millions de tués ont rendu le peuple russe défectueux. »
Celui qui a incarné aux yeux du monde entier la lutte pour la liberté de création à l’époque du glacis soviétique s’est éteint vendredi 27 avril 2007 à Moscou, à l’âge de 80 ans
<1317>
-
Jeudi 28 novembre 2019
« Pause »Un jour sans mot du jourIl est prévu que parfois je m’autorise à faire une pause quand je ne suis pas en capacité, dans un temps raisonnable, de finaliser l’article que j’avais prévu.

Il y a deux ans, <Le 28 novembre > tombait un mardi.
Il était consacré à un sujet passionnant, le cerveau.
« Notre cerveau invente le monde qu’il ne voit pas selon ce qu’il suppose qu’il doit être »
<Mot sans numéro>
-
mercredi 27 novembre 2019
« Le Petit Prince, un livre pour enfant ? »Question que je me pose et que je poseGérard Philippe est mort le 25 novembre 1959, à 36 ans, d’un cancer du foie qui l’a emporté en 3 mois. C’était donc il y a 60 ans et 2 jours.
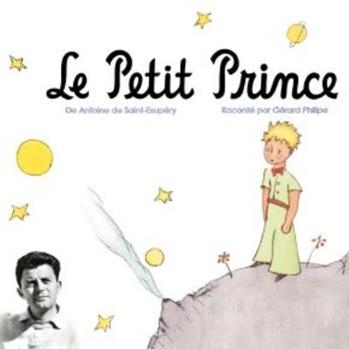 Un article du Figaro : «La mort il y a soixante ans de Gérard Philipe a provoqué un tsunami» renvoie vers un livre de Jérôme Garcin qui vient de paraître : « Le dernier hiver du Cid »
Un article du Figaro : «La mort il y a soixante ans de Gérard Philipe a provoqué un tsunami» renvoie vers un livre de Jérôme Garcin qui vient de paraître : « Le dernier hiver du Cid »
Gérard Philippe a beaucoup contribué à la popularité du « Petit Prince » de Saint Exupéry lorsque parut, en 1954, son enregistrement du conte, toujours disponible.
Cet enregistrement de 1954 célébrait les dix ans de la mort de Saint-Exupéry.
Sa voix envoutante qui distillait l’émotion a su porter ce conte à la dimension d’un mythe.
Antoine de Saint-Exupéry qui est né à Lyon en 1900, n’est pas non plus mort vieux. Il a disparu, pendant la guerre, en vol le 31 juillet 1944 au large de Marseille. Il est mort pour la France.
Le « Petit Prince » a été publié à New York en 1943, donc un an avant son décès.
Le livre du « Petit Prince » selon Wikipedia a été vendu à plus de cent quarante-cinq millions d’exemplaires dans le monde et douze millions d’exemplaires en France. Il est traduit en 270 langues et dialectes, ce qui en fait l’ouvrage de littérature le plus vendu au monde et le plus traduit après la Bible.
Comme beaucoup, j’ai succombé à ce mythe. J’ai cédé à la faiblesse d’acheter un de ces mobiles qu’on trouve dans tous les magasins d’enfants représentant le petit prince dans son univers. Mobile que nous avons accroché dans la chambre des enfants, à Montreuil.
Récemment, j’ai retrouvé ce mobile. Ma première réaction a été de vouloir l’offrir à d’autres enfants. Mais les années avaient passé et ma réflexion a évolué et je n’ai pas persévéré dans ce souhait.
Peut-on remettre en cause le mythe du Petit Prince ?
Je pense que nous devons questionner tous les mythes, mythes religieux, mythes nationalistes et mythes littéraires.
Très récemment, un article de France Culture sur Facebook m’a conduit à une réaction d’humeur et à de beaux échanges avec d’autres personnes qui ont tenté de me convaincre que je ne voyais pas toute la complexité du Petit Prince.
« Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ».
Une de ces phrases du Petit Prince qu’on aime à distiller dans des conversations, quand ils touchent un peu plus à l’intime. Mais avant de venir à cette discussion sur Facebook, parce que Oui on peut avoir des conversations intelligentes sur Facebook avec des inconnus avec qui on partage des valeurs et des sujets de conversation qui ont du sens.
Mais avant de venir à ces échanges, quelques éléments un peu factuels.
A peu près dans tous les pays du monde si vous cliquez sur ce lien : <Le Petit Prince> vous tombez sur un site canadien qui donne accès gratuitement au texte intégral du « Petit Prince » écrit il y a 76 ans.
Mais si vous êtes en France, cela ne fonctionne pas.
Au Canada, l’œuvre est entrée dans le domaine public mais pas en France.
Dans la plupart des pays du monde, c’est la Convention de Berne qui s’applique avec une protection de 50 ou 70 ans révolus après la mort de l’auteur. Aux États-Unis c’est plus compliqué et plus long, vous pouvez approfondir avec <cet article> si vous le souhaitez.
Mais « Le Petit Prince », comme le reste de l’œuvre de Saint-Exupéry, reste en France protégé par le droit d’auteur jusqu’en 2032. Cette exception tient à l’extension de la durée des droits concernant les auteurs morts pour la France avec en plus une prorogation de guerre, comme toutes les œuvres publiées avant 1948. Dans les autres pays du monde, où la durée de soixante-dix ans après la mort de l’auteur est en vigueur, l’œuvre de Saint-Exupéry est bien dans le domaine public depuis le 1er janvier 2015, 70 ans après la fin de la guerre. Au Canada et au Japon, où la durée des droits n’est valable que cinquante ans après la mort de l’auteur, le Petit Prince est déjà dans le domaine public depuis 1995.
C’est bien naturel quand les enfants de l’auteur ont la douleur de perdre leur père pendant la guerre, de leur donner quelques signes de réconfort et de reconnaissance supplémentaire sous la forme d’espèces sonnantes et trébuchantes.
Antoine de Saint Exupéry n’avait pas d’enfants.
Mais il a des héritiers et il existe même un légataire universel de la veuve. Et tous ces gens se disputent le magot. La <Justice a dû intervenir> notamment concernant les produits dérivés, comme ce mobile que je ne veux plus donner à un enfant.
Dans le clan des héritiers, il y a la famille Giraud d’Agay qui descend de la sœur cadette de Saint-Exupéry, et José Martinez-Fructuoso, ancien secrétaire de l’épouse de Saint Exupéry, Consuelo, qu’elle a désigné comme légataire universel.
Bien entendu, comme c’est déjà le cas pour les personnages de Tintin et de Zorro, les héritiers de Saint-Exupéry ont déposé le personnage du roman comme marque de commerce jusqu’en juin 2028.
Donc chaque fois que vous achetez une bricole qui a un rapport avec « Le Petit Prince », celui qui dit :
« Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les hommes n’ont plus d’amis. (Chap. XXI) »
le tiroir-caisse de ces rapaces tinte délicatement avec le son métallique des pièces de monnaie qui y tombe. Bien sûr, cela est encore beaucoup moins poétique dans la réalité, ces sommes alimentent automatiquement et informatiquement la ligne dématérialisée et sans âme d’un compte en banque.
Ils font certainement une lecture orientée de cette autre phrase :
« Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. (Chap. X) »
Il y a bien sûr une boutique en ligne pour vous permettre de faire de magnifiques cadeaux de Noël. Une boutique en ligne qui vend 80.000 produits chaque année. Plus de 800 références y sont disponibles, livraison dans le monde entier
Elle a une adresse toute simple : https://www.lepetitprince.com/
Il y a un tel décalage, entre le discours tenu par le Petit Prince et toute la camelote autour qui est vendue au profit d’un mercantilisme le plus obscène. Je trouve cela d’autant plus choquant pour ce livre précisément. Je ne suis pas seul à critiquer les héritiers mercantiles. Vous trouverez un article dans L’express qui détaille les obsessions des ayants droits à utiliser tout prétexte, tout vague anniversaire pour organiser des commémorations promptes à dégager des revenus : <Le Petit Prince : le grand ras-le-bol !>
Mais passons au fond sur l’Histoire. La publication de France Culture que j’ai évoquée est celle-ci : Pourquoi il faut relire « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry
Avec cette entame : « Le Petit Prince » : qu’est-ce que c’est ? Une histoire pour enfants ? Un conte fantastique ? Un conte philosophique ? Peut-être tout cela à la fois… Dans tous les cas, le plus grand livre de la littérature du XXe siècle pour le philosophe Martin Heidegger ! Une œuvre assurément attentive au présent. »
C’est bien d’en appeler au grand philosophe allemand « Martin Heidegger » au goût si sûr puisqu’il jugeait aussi avec grande bienveillance et admiration le national socialisme. Il adhéra au Parti nazi en 1933 alors qu’il avait déjà 44 ans et une réputation de philosophe affirmé. Il resta nazi jusqu’en 1944.
Je critique le Petit Prince mais je ne comprends pas bien le lien qui peut exister entre la doctrine nazi et le contenu du Petit Prince. Mais Heidegger n’est pas le seul à classer le Petit Prince en haut de l’affiche.
En 1999, la Fnac et Le Monde ont tenté de trouver un comité capable d’établir un classement français des livres considérés comme les cent meilleurs du XXe siècle.
« Le Petit Prince » termine quatrième, devancé par « L’Étranger » d’Albert Camus, « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust et « Le Procès » de Franz Kafka.
Ce type de palmarès me semble assez vain pour les œuvres de l’esprit.
Mais que « Le Petit Prince » devance « Les raisons de la colère » de Steinbeck ne me convainc pas et ce n’est qu’un exemple parmi d’autre.
Il faut bien comprendre que je ne nie pas les qualités de ce livre mais je trouve qu’on en fait trop et surtout je prétends que ce n’est certainement pas un livre pour enfant, ou alors il faut mentir aux enfants ou travestir la réalité.
Donc j’ai réagi à la publication de France Culture par cette envolée :
« Je ne partage pas l’enthousiasme du plus grand nombre.
Un livre pour enfant ?
C’est l’histoire d’un petit prince poète et malheureux.
Et la porte de sortie qu’il trouve est le suicide.
Ce n’est pas un livre d’enfant, c’est un livre de dépressif qui finit mal ! »
A ce niveau il y a toujours quelqu’un pour marquer son étonnement : « Ah bon le Petit Prince se suicide ? »
Dans le fil de la discussion, la question qui est venue avec 4 points d’interrogations « A quel moment il se suicide ???? »
Eh bien, à l’avant dernier chapitre, le 26, il le fait à la Cléopâtre.
Il y a des circonvolutions, des échanges avec le narrateur qui dilue un peu le récit. Mais il suffit de lire :
« Le petit prince dit encore, après un silence : – Tu as du bon venin ? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps ?
[…]
Alors j’abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur, et je fis un bond ! Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en trente secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais, au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable, comme un jet d’eau qui meurt, et, sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal.
Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige.
– Quelle est cette histoire-là ! Tu parles maintenant avec les serpents !
[…]
– Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi…
– Comment sais-tu !
Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j’avais réussi mon travail !
Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta:
– Moi aussi, aujourd’hui, je rentre chez moi…
[…]
– Cette nuit… tu sais… ne viens pas.
– Je ne te quitterai pas.
– J’aurai l’air d’avoir mal… j’aurai un peu l’air de mourir. C’est comme ça. Ne viens pas voir ça, ce n’est pas la peine…
[…]
– Tu comprends. C’est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C’est trop lourd.
[…]
Et il se tut aussi, parce qu’il pleurait…
– C’est là. Laisse-moi faire un pas tout seul.
Et il s’assit parce qu’il avait peur.
[…]
– Voilà… C’est tout…
Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. Moi je ne pouvais pas bouger.
Il n’y eut rien qu’un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable. »
Peut-être certains seront-ils scandalisés par ce traitement aux ciseaux du chapitre. Mais quand on enlève, l’enluminage, le rêve, les histoires qu’on raconte pour supporter la réalité de la mort : c’est un suicide.
Des internautes ont tenté de me convaincre
« C’est l’enfance qui cède sa place ! En ce qui concerne la mort du Petit Prince, c’est une métamorphose initiatique. »
Ou
« Ce n’est pas un suicide, mais une transformation. Tel Dante, le petit Prince quitte son corps de chair pour s’élever dans les étoiles. »
Évidemment, si on fuit le réel et on se réfugie dans le mythe, on arrive à écrire que se donner la mort est une transformation. Je rappelle Camus : « mal nommer les objets, c’est ajouter du malheur au monde. »
Je me souviens que les adeptes du temple solaire parlaient aussi en allégorie et en langage transcendantal. Ils pensaient se retrouver sur Sirius.…
Je m’insurge sur le fait de dire que c’est un conte pour enfant.
Quel serait le message de ce conte pour enfant ?
Quand on ne se sent pas bien nulle part, il faut mourir ?
Il y a dans ce livre de la dépression, de la collapsologie avant l’heure et l’odeur de la mort
Rien de ce que je dis n’est absolu. Je ne prétends pas dire la vérité qui n’existe pas d’ailleurs dans cette matière. Je pousse seulement les gens à se questionner, à interroger et non pas à suivre la foule et dire comme cette histoire est belle, poétique et instructive !
Vous apprendrez dans cet article que <Le Petit Prince est le fruit d’un chagrin d’amour>
Un des internautes qui croit aux grandes vertus de ce petit livre a fini notre conversation de réseaux sociaux sur ce petit texte et je lui laisse, bien volontiers, le dernier mot
« Tout est contenu dans tout: le mal dans le bien, le bien dans le mal, comme le laid dans le beau ou le beau dans le laid. Ainsi, une parole lumineuse peut dissimuler un dessein sombre, de même qu’un langage rustre peut dissimuler une âme pure et belle. L’allégorie n’est qu’une forme ou une apparence pour dissimuler un autre sens que ce qui est immédiatement lu.
Nous ne sommes pas jury littéraire, critique ni censeur. Chacun reçoit une œuvre et l’apprécie au regard de son histoire personnelle, de sa culture, son éducation, ses valeurs ou ses croyances. Ce que vous ressentez ne se juge pas.
Au moins, je constate un point en faveur de l’œuvre: elle ne vous indiffère pas. Elle nous amène d’ailleurs à échanger et partager nos avis ici. Même à travers un ressenti contradictoire, le Petit Prince réunit.
C’est toute la puissance d’une œuvre littéraire au-delà de sa résonance immédiate : que laisse-t-elle dans la culture, quelle empreinte imprime-t-elle dans l’histoire ? Une œuvre qui dépasse les générations, qui séduit petits et grands, qui s’étudie de l’école à l’université reste un marqueur de notre temps, de notre société, de notre pensée.
Ne pas y avoir été sensible ne vous éloigne aucunement d’une quelconque vérité. J’imagine que votre sensibilité s’exprime ailleurs et c’est toute la richesse de la diversité humaine. Peut-être avons-nous une lecture commune qui nous rassemble entièrement ? A l’inverse, peut-être êtes-vous marqué par une œuvre à côté de laquelle je suis passé sans la moindre émotion ?
Quant au marketing littéraire, comment ne pas vous rejoindre ? Tout ce qui peut rapporter de l’argent est source de commerce. Du magnifique à l’abject, de l’utile au futile.
Le marketing nous retient dans la matérialité, ce que le Petit Prince justement nous invite à dépasser. Souvenez-vous : « on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »
<1316>
-
Mardi 26 novembre 2019
« Qui est le Colonel Picquart ?»Question posée dans l’émission Répliques à deux spécialistes qui ont écrit deux ouvrages assez différents.Je ne suis pas allé voir « J’accuse » de Roman Polanski.
Je suis allé voir « les enfants d’Isadora »
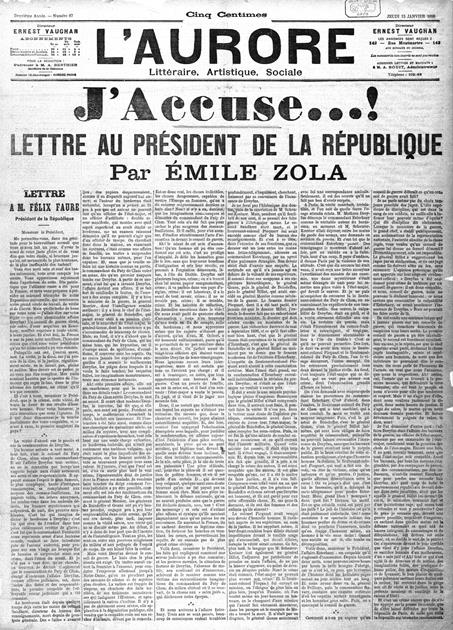 Je rappelle que le titre « J’accuse » est pour l’Histoire le titre de l’article qu’Emile Zola a publié dans le journal l’Aurore dans lequel Georges Clemenceau était éditorialiste..
Je rappelle que le titre « J’accuse » est pour l’Histoire le titre de l’article qu’Emile Zola a publié dans le journal l’Aurore dans lequel Georges Clemenceau était éditorialiste..
Mais, la première question que beaucoup se posent aujourd’hui, est de se demander s’il est pertinent d’aller voir un Film de Roman Polanski.
Roman Polanski est en effet accusé par la photographe Valentine Monnier de l’avoir violée après l’avoir frappée, en 1975, dans un chalet à Gstaad, en Suisse, alors qu’elle était invitée avec d’autres amis chez le cinéaste.
Dans <cet article> du Monde, Valentine Monnier explique pourquoi elle n’a pas porté plainte au moment des faits, plainte désormais prescrite.
Elle a cependant rompu le silence pour porter l’affaire devant le tribunal médiatique.
Elle l’a fait parce qu’elle n’a pas supporté la réponse suivante que Polanski a faite à l’écrivain Pascal Bruckner qui l’interrogeait :
«Travailler, faire un film comme celui-là, m’aide beaucoup, je retrouve parfois des moments que j’ai moi-même vécus, je vois la même détermination à nier les faits et me condamner pour des choses que je n’ai pas faites »
Elle n’a donc pas supporté que Roman Polanski puisse se réclamer de l’innocence de Dreyfus pour mettre en cause ses accusatrices et la Justice qui l’ont poursuivi.
Roman Polanski a par la suite rectifié son propos dans « Le Point » le 7 novembre en déclarant :
« Il y a dans le destin de Dreyfus certains aspects que je connais. Mais si on pense que je me compare à lui, je n’ai même pas envie d’en discuter, c’est complètement idiot ! »
Concernant les diverses accusations portées contre lui, une chose est certaine il a bien violé une adolescente de 13 ans, en 1977 aux États-Unis après l’avoir droguée. Il a reconnu ces faits et pour ne pas subir les foudres de la justice américaine, il ne se rend plus aux États-Unis. Samantha Geimer souhaite ne plus entendre parler de cette affaire et demande qu’on ne poursuive pas le cinéaste pour ces faits.
Outre Samantha Geimer et Valentine Monnier, trois autres femmes accusent Roman Polanski de viol, mais la Justice n’a été saisie pour aucune de ces affaires.
Concernant Valentine Monnier, il semble que des voisins du chalet de Gstaad qui l’avaient recueillie traumatisée, apportent de la crédibilité à son accusation.
Je pose cependant la question que si nous prenons pour acquis le crime de Polanski, faut-il pour autant boycotter l’œuvre du criminel.
Un premier aspect me semble important, le film est une œuvre collective. Ne pas aller voir le film, parce que l’un des auteurs est coupable d’un crime, c’est exercer une sanction collective. Une sanction collective n’est jamais la Justice.
Mais il y a un second aspect qui est la différenciation entre l’auteur et l’œuvre. Autrement dit, l’œuvre n’a rien à voir avec l’accusation portée contre l’auteur. Prenons l’exemple souvent cité de Céline. « Voyage au bout de la nuit » est un chef d’œuvre qui n’a rien à voir avec la haine antisémite de Céline. Faut-il se priver de cette lecture ?
En revanche, les pamphlets antisémites de Céline sont l’expression du crime dont on l’accuse. Ce qui parait raisonnable c’est de lire « Voyage au bout de la nuit » mais non Bagatelles pour un massacre.
Le film de Polanski n’a pas pour sujet la violence faite aux femmes. Il n’est pas un pamphlet appelant au viol des femmes. C’est un film sur un sujet historique qui traite de l’antisémitisme et de l’obstination de l’Armée française de refuser de reconnaitre une injustice pour ne pas avoir à se déjuger. Dès lors, à mon analyse, je peux aller voir ce film.
Cependant ce film met en avant le rôle héroïque du Colonel Picquart et selon ce que je comprends parle peu des autres acteurs de ce drame, par exemple de Zola.
Ceci me conduit à un deuxième cas de conscience : celui d’Alain Finkielkraut qui perdant ses nerfs dans l’émission de Pujadas a dit des sottises. Cette émission <La Grande Confrontation> sur LCI qui a duré plus de trois heures est absolument inepte. J’en ai regardé une grande partie pour remettre les propos déplacés de Finkielkraut dans le contexte de l’émission. C’est une émission dans laquelle un nombre exagéré d’intervenants s’invectivent sans s’écouter en cherchant à avoir le dernier mot ou de faire le buzz. C’est intellectuellement navrant et sans intérêt. Je ne comprends pas pourquoi Finkielkraut se compromet dans de telles émissions, surtout que connaissant ses fragilités il y a toujours de forts risques qu’il s’énerve et dise des choses maladroites ou stupides.
Mais rien de tel dans son émission « Répliques » dans laquelle le respect et la hauteur de vue sont la règle.
Et dans sa dernière émission du 23/11/2019 il a invité deux intellectuels qui ont débattu sereinement, en s’écoutant parler, en répondant posément aux arguments de leur contradicteur, en reconnaissant tous les points sur lesquels ils étaient d’accord. Bref un débat qui grandit l’esprit et rend plus instruit.
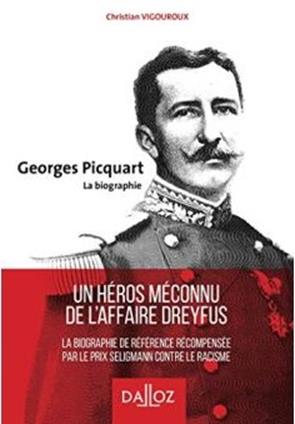 Résolument Christian Vigouroux qui a écrit une biographie de Georges Picquart : « Un héros méconnu de l’affaire Dreyfus » est dans le camp de ceux qui encensent le colonel et montrent son rôle de premier plan.
Résolument Christian Vigouroux qui a écrit une biographie de Georges Picquart : « Un héros méconnu de l’affaire Dreyfus » est dans le camp de ceux qui encensent le colonel et montrent son rôle de premier plan.
Il est, en effet, le chef du service secret militaire français pendant l’affaire Dreyfus. Et c’est lui qui trouve la preuve matérielle de l’innocence d’Alfred Dreyfus et de la culpabilité d’Estherazy.
Deux points sont soulignés par Vigouroux, le premier c’est qu’il garde cette preuve et ne la détruit pas. Ses supérieurs, les généraux qui ne voulaient pas qu’on puisse dire que l’Armée s’était trompée en condamnant Dreyfus, auraient aimé qu’il la détruise.
Vigouroux a un autre argument de poids, c’est que son intransigeance l’a conduit à être d’abord écarté de la carrière fulgurante qui lui était promise, puis être emprisonné et enfin banni de l’armée.
Il n’a pas donc pas choisi sa carrière au profit de son honneur.
Indiscutablement, la preuve qu’il a gardé permettra d’innocenter Dreyfus.
Picquart sera récompensé en fin de compte puisqu’il deviendra Ministre de la Guerre pendant deux ans et demi de 1906 à 1909 dans un gouvernement dirigé par Clemenceau. Il meurt le 19 janvier 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, des suites d’une chute de cheval en Picardie
Mais Christian Vigouroux n’est pas totalement crédible quand il dit qu’il a refusé de se terrer dans le silence.
Car c’est bien le reproche qu’on pourra lui faire, il est resté longtemps silencieux.
Ce n’est pas un lanceur d’alerte.
C’est quelqu’un qui avec courage certes a voulu convaincre l’armée de l’intérieur.
Car son premier combat n’était pas en faveur de Dreyfus, mais pour l’honneur de l’Armée.
Car lui, contrairement aux généraux, une fois qu’il avait acquis la conviction que Dreyfus était innocent, était persuadé que la vérité éclaterait un jour.
Et que dans ses valeurs à lui, il valait mieux que ce fusse l’Armée qui déclare la vérité que des gens de l’extérieur humilient l’Armée en montrant qu’elle s’est trompée et a persisté dans l’erreur.
Ce combat, il l’a perdu. Il s’est passé exactement le contraire de ce qu’il espérait.
Et c’est l’historien Philippe Oriol qui est l’auteur de l’ouvrage de référence « L’Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours » (Les Belles Lettres, 2014) et a publié chez Grasset la correspondance inédite du capitaine Dreyfus et de Marie-Louise Arconati-Visconti, Lettres à la marquise (2017) qui nuance les propos laudateurs de Vigouroux :
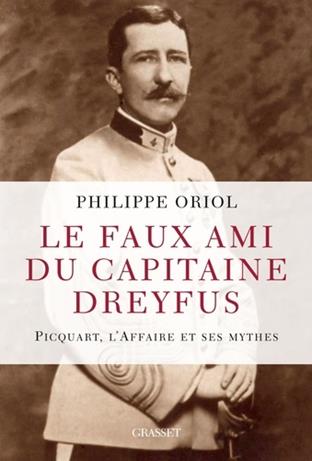 « Dans la mémoire, collective, l’affaire Dreyfus est l’histoire d’une victime : Dreyfus, et d’un héros : Picquart. Picquart, le brave lieutenant-colonel, qui, découvrant l’erreur qui a fait condamner un innocent, met tout en œuvre pour faire réparer l’injustice, jusqu’à la prison et au sacrifice de sa carrière. En 1906, après la victoire du droit, il est réintégré, nommé général, et bientôt ministre de la Guerre dans le cabinet présidé par Georges Clemenceau.
« Dans la mémoire, collective, l’affaire Dreyfus est l’histoire d’une victime : Dreyfus, et d’un héros : Picquart. Picquart, le brave lieutenant-colonel, qui, découvrant l’erreur qui a fait condamner un innocent, met tout en œuvre pour faire réparer l’injustice, jusqu’à la prison et au sacrifice de sa carrière. En 1906, après la victoire du droit, il est réintégré, nommé général, et bientôt ministre de la Guerre dans le cabinet présidé par Georges Clemenceau.
Ce récit ne correspond pas à la vérité historique que ce livre, sur la base d’une nombreuse documentation inédite, rétablit. Le vrai Picquart, c’est un homme qui, s’il a tenté de faire réparer l’erreur judiciaire, l’a plus fait pour préserver l’armée que pour sauver un homme ; qui, dès le début des représailles, a fait marche arrière ; qui, pour assurer sa propre sauvegarde, a entravé l’action des partisans de l’innocent et ne s’est finalement lancé qu’à son corps défendant, sachant que son propre sort était scellé. Enfin, le « vrai » Picquart s’est acharné sur Dreyfus après sa grâce, faisant courir les plus injurieuses rumeurs, l’attaquant dans la presse avec des propos proches de ceux du camp adverse et, une fois ministre, a refusé de réparer la dernière injustice dont il était victime. Comment cet antisémite obsessionnel est devenu un héros permet de comprendre la manière dont l’histoire de France peut se raconter des histoires, afin de se blanchir… »
Il a écrit un livre à ce sujet : « Le faux ami du capitaine Dreyfus – Picquart, l’Affaire et ses mythes » dans lequel il accuse Picquart d’être un opportuniste et un antisémite.
J’ai écouté l’émission de Finkielkraut dans laquelle ces éminents intellectuels débattaient.
Je ne suis pas allé voir le film de Polanski.
Notre temps est limité, il faut savoir choisir ses priorités.
Sur cette page de France Culture sur Facebook, vous verrez aussi Philippe Oriol développer ses arguments.
Si vous faites le choix d’aller voir le film, sachez qu’il ne s’agit pas de la vérité historique et qu’il faut regarder cela plutôt comme un roman historique qui contient une part de vérité, mais qu’une part.
Lorsque <la fiche du film> déclare :
« L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. »
Vous devez savoir que la première phrase est exacte et que la seconde ne l’est pas dans l’absolu.
Vous pourrez aussi lire avec intérêt <cette critique> du roman de Robert Harris qui a servi de trame au film de Polanski.
<1315>
-
Lundi 25 novembre 2019
« Les enfants d’Isadora »Film de Damien Manivel autour d’une danse composée en 1923 par Isadora DuncanAvec Annie, nous allons peu au cinéma. Mais nous avons eu le désir d’aller voir « Les enfants d’Isadora ».
Ce film ne répond pas, mais alors pas du tout aux standards des films américains, films qu’on nomme blockbuster. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet des superproductions américaines, vous pouvez lire cet article de « Slate.fr » : « La recette du blockbuster » qui vous renverra vers un livre d’un scénariste américain : Blake Snyder : « Les règles élémentaires pour l’écriture d’un scénario. ».
Pour suivre ce modèle, auquel beaucoup de spectateurs se sont habitués, il faut de l’action, des bons et des méchants, des scènes qui s’enchainent rapidement etc.
« Les enfants d’Isadora » est un film lent, très lent. C’est à ce prix qu’on obtient la poésie et la grâce.
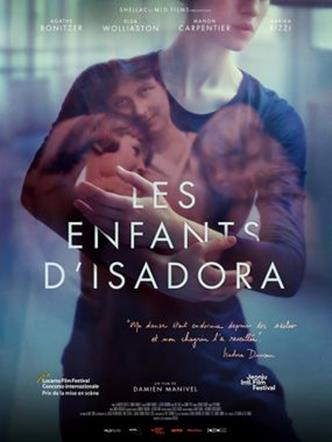 Le film raconte des femmes qui sont fascinées par une danse composée en 1923 par la grande chorégraphe américaine Isadora Duncan : « Mother »
Le film raconte des femmes qui sont fascinées par une danse composée en 1923 par la grande chorégraphe américaine Isadora Duncan : « Mother »
<Isadora Duncan> est née en 1877 à San Francisco, et morte tragiquement le 14 septembre 1927 à Nice.
C’est une danseuse américaine qui révolutionna la pratique de la danse et apporta les premières bases de la danse moderne européenne, à l’origine de la danse contemporaine.
Elle donna une place particulière à l’harmonie du corps, à la beauté. Elle osa des danses presque nue, simplement couverte par quelques voiles avec un retour au culte des corps et au modèle des figures antiques grecques.
Elle fonda plusieurs écoles de danse aux États-Unis et en Europe et même en Russie après la révolution soviétique où elle adhéra, un temps, à l’idéal révolutionnaire.
Elle fut, à Paris, la voisine d’Auguste Rodin, « son ami et son maître » selon son récit « Ma vie » publiée en 1927.
Et, lorsque le théâtre des Champs-Élysées est construit en 1913, son portrait est gravé par Antoine Bourdelle dans les bas-reliefs situés au-dessus de l’entrée, et peint par Maurice Denis sur la fresque murale de l’auditorium représentant les neuf Muses.
Elle fut totalement non conventionnelle dans son art, comme dans sa vie.
Elle eut des enfants sans être marié, fut aussi bisexuelle et de mœurs très libres.
Elle meurt tragiquement le 14 septembre 1927 à Nice : le long foulard de soie qu’elle porte se prend dans les rayons de la roue de la voiture dans laquelle elle était montée. Elle est brutalement éjectée du véhicule et meurt sur le coup dans sa chute sur la chaussée. Elle a été incinérée et ses cendres reposent à Paris au columbarium du cimetière du Père-Lachaise
Avant cela, en 1913 elle vécut une tragédie.
Ses deux enfants, tous deux hors mariage : Deirdre, née le 24 septembre 1906, et Patrick, né le 1er mai 1910, se noyèrent dans la Seine le 19 avril 1913. Les enfants se trouvaient dans la voiture avec leur nourrice de retour d’une journée d’excursion pendant qu’Isadora était restée à la maison. La voiture fit un écart pour éviter une collision. Le moteur cale, le chauffeur sort de la voiture pour faire redémarrer le moteur à la manivelle mais il a oublié de mettre le frein à main ; dès qu’il fait démarrer la voiture, celle-ci traverse le boulevard Bourdon, dévale la pente et les deux enfants et leur nourrice meurent noyés dans la Seine à Neuilly-sur-Seine.
Quelques mois plus tard, le 1er août 1914, Isadora Duncan accouche d’un enfant qui ne vivra que quelques heures. Elle écrira dans « Ma vie » :
« Je crois qu’à ce moment-là, j’atteignis le sommet de la douleur humaine, car avec cette mort il me semblait que mes autres enfants mouraient encore une fois ; c’était comme la répétition de la première agonie, avec quelque chose qui s’y ajoutait encore. »
Et puis, 10 ans plus tard, en 1923 à Kiev, sur une musique de Scriabine, elle créa une danse pour dire Adieu à ses enfants morts. Danse qu’elle appela « Mother ».
Un très bel article de « Libération » explique :
« En 1923, dix ans après avoir tragiquement perdu ses deux enfants, la pionnière de la danse moderne Isadora Duncan créait Mother, un solo funèbre et mythique dont il n’existe ni film d’époque ni photographie. Juste une partition – grâce au système de notation Laban, que peu d’experts savent déchiffrer -, à laquelle s’ajoutent les récits que se sont transmis corporellement et de manière quasi légendaire les disciples de la chorégraphe, et ces quelques lignes : «Ma danse était endormie depuis des siècles et mon chagrin l’a réveillée.»
Et tout le film est la recherche de femmes danseuses, pour retrouver les gestes et les pas de cette danse à partir de la partition pour créer l’indicible et l’émotion.
Le réalisateur Damien Manivel, né en 1981 avait commencé sa vie artistique par la danse contemporaine, il fait partager à ses actrices son désir de retrouver le geste bouleversant de l’immense artiste du début du XXème siècle pour surmonter sa souffrance.
<Slate> qui a également encensé ce film écrit :
« Ce qui est à venir est, malgré l’apparente absolue modestie du film, d’une ampleur immense. Il s’agit du travail, et il s’agit de la mort; il s’agit du deuil et de la manière dont des œuvres peuvent affronter l’abîme insondable de la douleur.
Il s’agit des puissances souterraines et sidérantes de la vie, et de sourcières qui en détectent les possibles résurgences. Qui parfois en permettent les triomphants jaillissements, même dans la pénombre d’une marge. […]
Les Enfants d’Isadora, c’est la promesse, dans le monde, avec les autres, en soi-même, de la possibilité d’une élégance du geste, d’une harmonie de formes, d’un accord entre des rythmes intérieurs et extérieurs. Ce film a su nous approcher de cela; il inspire une infinie gratitude. »
L’intelligence de Damien Manivel est de construire cette quête en 3 actes.
D’abord une jeune danseuse parisienne qui travaille, étudie, réfléchit, essaie la partition avec les doutes qu’on perçoit, il n’y a quasi aucune parole échangée lors de ce premier acte.
L’actrice qui incarne ce premier rôle est Agathe Bonitzer. Quand elle parvient au geste d’émotion, le réalisateur passe au second acte.

Ce second acte se joue dans un théâtre dans lequel une chorégraphe (Marika Rizzi) répète avec une adolescente trisomique (Manon Carpentier), cette même danse. Au début les gestes sont très éloignées de ceux auxquels était arrivée la danseuse précédente. Mais peu à peu, Manon trouve aussi le chemin pour s’approprier « mother ».
Le troisième acte est étrange, on voit une femme noire massive qui assiste au spectacle « Mother », sans que jamais le spectacle ne soit montré, et qui pleure.
Après un long et pénible voyage pour retourner dans son appartement, dans lequel on comprendra qu’elle a également perdu un enfant, elle esquissera aussi des gestes de cette chorégraphie.
Slate m’apprend que l’actrice qui joue ce rôle est Elsa Wolliaston, jamaïcaine et américaine qui vit en France et qui est une grande figure de la danse contemporaine africaine.
Slate écrit à son propos:
« Cette femme a tout d’un monument: une puissance qui sait la fragilité, une légèreté et une détermination qui d’emblée en imposent. Cette femme est
un monument. »

Un acte de grâce et d’humanité.
On trouve une photo sur Wikipedia qui montre Isadora Duncan avec ses deux enfants Deirdre et Patrick en 1912.
Un site consacré à la Danse publie aussi un article sur ce film et rapporte une autre phrase d’Isadora Duncan qui prend tout son sens au bout de la quête poursuivie par ce film :
« La vraie danse est la force de la douceur : elle est commandée par le rythme même de l’émotion profonde »
La musique sur laquelle ce solo a été dansée est l’<Etude opus 2 N° 1 d’Alexandre Scriabine>
<1314>
-
Vendredi 22 novembre 2019
« Les raisins de la misère »Ixchel DelaporteHier, jeudi 21 novembre nous étions le troisième jeudi de novembre. C’est-à-dire la date à laquelle le beaujolais nouveau est mis en vente dans le monde entier.
Habitant Lyon, une sorte de règle déontologique m’interdit d’en dire du mal.
J’attends l’inspiration qui me permettra d’en dire du bien pour écrire un mot du jour consacré à ce phénomène et à cette passion japonaise.
Habitant Lyon, il ne m’est pas interdit de parler du vignoble de Bordeaux, de manière critique.
Au départ, il y a une jeune journaliste à l’Humanité, Ixchel Delaporte, qui découvre, en 2014,une note de l’INSEE, la note 194, qui détecte un « couloir de la pauvreté » dans le bordelais
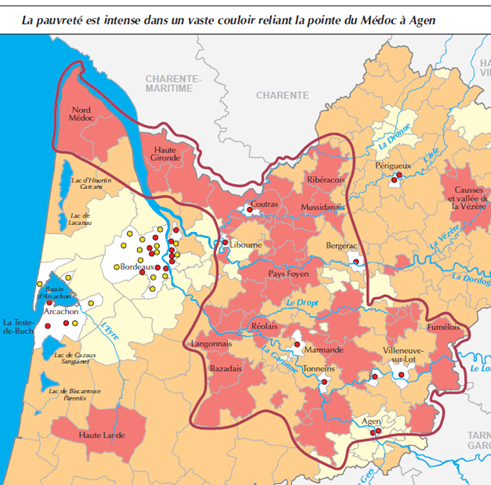 Ixchel Delaporte raconte cette découverte et ce qu’elle en fit dans un entretien à <Rue 89 Bordeaux> :
Ixchel Delaporte raconte cette découverte et ce qu’elle en fit dans un entretien à <Rue 89 Bordeaux> :
« C’était en 2014, je travaillais sur la pauvreté. Je suis tombée sur la note 194 de l’INSEE, publiée en 2011. Elle était assez impressionnante car elle détectait le fameux « couloir de la pauvreté » […]. C’était assez surprenant de voir ce liseré qui entourait une zone assez précise : elle part du Nord Médoc, passe par la Haute-Gironde, Blaye, contourne l’agglomération de Bordeaux et redescend ensuite du coté de Libourne, embrasse l’Entre-deux-Mers, Saint-Emilion, Sauternes, jusqu’à se refermer du côté de Marmande et Villeneuve-sur-Lot. Une cartographie de la pauvreté extrêmement bien délimitée, je n’avais jamais vu ça nulle part. Je suis partie à la rencontre des gens pour comprendre d’où venait cette pauvreté. […].
La première fois que je suis partie, c’était purement dans l’optique d’un reportage sur le couloir de la pauvreté.
Le sujet est resté dans mon esprit. Cela m’avait surprise sur place de voir la beauté des territoires, certains lieux très charmants et touristiques, des vignes très belles, des châteaux viticoles… Après coup, en rentrant, j’ai commencé à regarder la carte des appellations d’origine contrôlée, les zones considérées comme importantes au niveau viticole.
Petit à petit j’ai commencé à faire le lien entre ces deux cartes, celle de la pauvreté et celle des vins et des grands crus. Et j’ai compris qu’il y avait un lien clair et net.
[…] On me demande souvent si j’ai voulu participer au « Bordeaux bashing ». Le problème c’est que je ne connaissais pas le bordelais. Je ne suis pas amatrice de vin, je ne connaissais pas cette région, pour moi c’était une campagne comme une autre. Mais à chaque fois que je croisais des gens, ils avaient un lien avec la vigne. Ils ramenaient toujours leurs récits à elle, au fait que c’était un travail difficile, subi. Beaucoup de jeunes me disaient : « Je sais qu’il y a la vigne, mais je ne veux pas y aller parce que mon père est malade, ma mère a le dos cassé, ma tante a un cancer… ». À chaque fois quelque chose de très négatif. »
Au bout de son enquête, elle écrit un livre publié en octobre 2018 : « Les raisins de la misère » aux éditions Rouergue.
Les vignobles nécessitent des travailleurs saisonniers et intermittents travailleurs précaires. Bordeaux n’est pas seul dans ce cas, souvent les saisonniers sont mal traités. Mais à Bordeaux, c’est plus flagrant parce que la misère côtoie l’arrogance de la richesse.
L’éditeur présente le livre ainsi :
« De la pointe Nord du Médoc jusqu’à Agen, se concentre un fort taux de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté, travailleurs saisonniers, mères célibataires, familles tziganes, retraités aux pensions minimales… Sur cet arc long de deux cent quarante kilomètres et large de quarante, cohabitent deux mondes, celui des châteaux aux noms prestigieux, Pauillac, Saint-Emilion, Sauternes, et une France invisible, celle des petits boulots, des habitats dégradés, des maladies professionnelles, du chômage, qu’on croit réservée aux régions du Nord ou des banlieues urbaines. ».
L’auteur ajoute dans l’article précité :
« De ce point de vue-là, il n’y a pas grand-chose qui puisse ressembler au bordelais ailleurs en France. »
La misère, omniprésente dans le « couloir de la pauvreté » est multiple :
« On a affaire à beaucoup de familles monoparentales, de mamans seules qui se retrouvent en grande difficulté. Leur grand problème c’est l’impossibilité de travailler, car il faut faire garder les enfants. Elles commencent à travailler dans la vendange ou les petites façons (les travaux viticoles de base). Évidemment ce sont des horaires très contraignants et saisonniers. Donc elles se retrouvent (et ce n’est pas propre à ce territoire) à mettre l’ensemble de leur salaire dans la garde des enfants. Au bout d’un moment, ce système ne fonctionne pas, donc elles arrêtent de travailler et se retrouvent au RSA, quelques centaines d’euros par mois, ce qui ne permet pas de vivre. […]
[Les étrangers] incarnent un autre type de pauvreté. Je les ai retrouvés dans toutes les villes. Il y a ceux qui viennent avec leur famille, surtout des Marocains qui étaient venus en Espagne et sont remonté suite à la crise. Ces familles-là sont en situation de très grande précarité, parfois sans papiers, en très grande angoisse, la peur de se faire renvoyer au Maroc où ils n’ont souvent plus d’attache. Ils sont dans la pire situation : ils ne touchent aucune aide, paient des loyers très chers dans des taudis insalubres loués par des marchands de sommeil. La femme garde les enfants et le mari se tue à la tache toute la journée à travailler pour des prestataires de services. Ce sont les derniers maillons de la chaîne.
On rencontre aussi beaucoup de jeunes espagnols, italiens et portugais. Venus travailler en camion, ils ont un mode vie alternatif, et tiennent à leur liberté et leur indépendance. Mais ils sont soumis aux mêmes problèmes quand ils sont embauchés : énormément de travail, des accidents du travail, etc. En revanche, eux ont la chance d’être européens : ils sont comptabilisés par la MSA et sont couverts en cas d’accident.
Le problème, c’est qu’on les chasse de partout dès qu’ils s’installent. Ils se retrouvent à devoir se cacher sur un parking de grande surface, sur les bords de fleuve, à camper aux abords de déchetteries. C’est-à-dire les coins les plus sales, sans point d’eau. Les situations de pauvreté viennent s’additionner et grossir ce couloir de la pauvreté. »
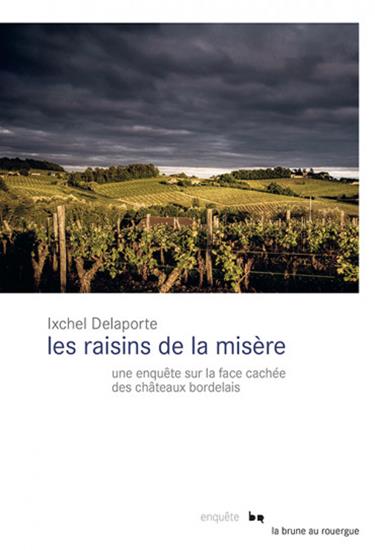 Et à la question du journaliste : « Vous décrivez une opposition extrême entre la richesse et la pauvreté, le luxe et la misère. Mais ces deux mondes cohabitent. Comment est-ce possible ? Qu’est-ce qui fait que le décor pour touristes ne s’effondre pas ? » elle répond :
Et à la question du journaliste : « Vous décrivez une opposition extrême entre la richesse et la pauvreté, le luxe et la misère. Mais ces deux mondes cohabitent. Comment est-ce possible ? Qu’est-ce qui fait que le décor pour touristes ne s’effondre pas ? » elle répond :
« Cette pauvreté n’était pas très visible. On me dit : « Votre livre est le seul qui parle de la saisonnalité dans la vigne ». Je me suis aperçue en travaillant dessus que c’est un sujet très délicat. Les gens n’osent pas critiquer tellement c’est un débouché économique majeur. Y compris chez les élus : ils n’osent pas mettre en évidence cette pauvreté car la vigne est un tel pourvoyeur d’emploi qu’on préfère faire profil bas et se dire « c’est déjà ça ».
Parfois il y a des petites retombées en terme de mécénat, alors il vaut mieux en rester là que de critiquer un système qui serait inégalitaire, injuste et peut-être même féodal comme me l’ont dit beaucoup de gens. Comme me l’a dit quelqu’un de la MSA, le rapport de force est totalement inégalitaire, voire n’existe pas en réalité.
On sait qui tire les ficelles économiques, qui aura le dernier mot, qui est soutenu au plus haut niveau de l’État. Beaucoup de présidents étaient proches des Rothschild [famille possédant une banque et plusieurs châteaux dans le bordelais] : Pompidou a travaillé chez Rothschild, Macron également. On ne touche pas aux intérêts du vin en France, donc on ne touche pas à la pauvreté des gens qui vivent dans ce territoire. On préfère, comme le font très bien Jean-Michel Cazes, ou Mimi Thorisson dans son village superbe de St-Yzans-de-Médoc, raconter une belle histoire et faire vivre un mythe, pour le business. Et Bernard Arnault peut inviter des gens à signer de très gros contrats au château d’Yquem. Ce ne sont pas eux qui vont venir nous expliquer qu’il y a de la pauvreté, où ils se tirent une balle dans le pied.
D’ailleurs, je ne suis pas sure que ces gens-là eux-mêmes soient conscients de la pauvreté. Ils sont dans un monde à part, un monde parallèle. Beaucoup font la navette entre les châteaux, Bordeaux et Paris, et je pense qu’ils ne se posent même pas la question. »
Ces inégalités viennent de loin :
« Le couloir de la pauvreté est un territoire où, dès le XVIIe siècle, les élites et les propriétaires ont capté les terres et se sont agrandis. À mesure qu’ils s’enrichissaient, autour d’eux les autres s’appauvrissaient : ceux qui pouvaient vivre de leur potager, les petits paysans qui ne cultivaient pas que de la vigne. Aujourd’hui il n’y a plus que de la monoculture : ce territoire-là n’a été fabriqué que pour le business de la vigne. […]
C’est d’autant plus choquant quand on voit l’argent qui est généré : la France est le 3e exportateur de vin au monde, l’économie du vin représente un chiffre d’affaire de 9 milliards d’euros en 2017 dans le pays. Quand on prend les dix plus importantes fortunes de France dans le classement de Challenge, il y en a sept qui ont un ou plusieurs châteaux dans le bordelais. Pierre Castel est l’exemple type de quelqu’un qui a bâti sa fortune d’abord sur le mauvais vin, puis sur le vin de marque.
Je cite l’historienne Stéphanie Lachaud qui explique parfaitement bien la fabrication du territoire et l’histoire de ces inégalités. Les personnes qui travaillaient pour les châteaux, les journaliers, faisaient comme les tziganes aujourd’hui : ils allaient louer leur force de travail à la journée d’un château à l’autre. C’était des forçats de la vigne, entre le XVIe et les XVIIIe siècles.
Le marché du vin et l’exportation ont explosé au moment de la traite négrière : le vin est devenu une monnaie d’échange très importante puisqu’il pouvait se conserver très longtemps dans les bateaux. C’était très pratique d’échanger des esclaves contre du vin.
Hélas aujourd’hui dans certains châteaux, ça n’a pas beaucoup changé. Y compris dans les mentalités, dans la manière dont on considère les petites gens qui travaillent dans la vigne. Alors que sans ces petites mains, il n’y a pas de vin. »
Le premier article qui m’avait alerté sur ce livre était publié par un site très intéressant pour disposer d’informations alternatives « BASTA ». Je vous invite à lire cet article très détaillé qui vous apprendra aussi que des marchands de sommeil prospèrent dans cette misère et donnent à ces pauvres salariés des taudis sordides. Il y a aussi une réflexion sur les avantages fiscaux dont bénéficient le vin, ce joyau de la France.
Ixchel Delaporte dit ainsi :
« Il est faux de dire, comme l’a prétendu Emmanuel Macron que les jeunes ne se soûlent pas au vin. Ils se soûlent aussi avec le vin, et notamment avec des prémix (Les « prémix », ces alcools très sucrés dont les jeunes raffolent, bénéficient eux aussi de ristournes quand ils sont élaborés à partir de vin.) Comme l’ont rappelé des médecins addictologues dans une tribune en mars dernier, le vin représente près de 60 % de la consommation d’alcool. Il est la seconde cause de cancers après le tabac. L’alcool, et notamment le vin, est à l’origine de violences familiales, conjugales et de violences sur la voie publique, de binge drinking (« beuverie expresse », ndlr), d’une part importante des affections mentales, des suicides et de la mortalité accidentelle et routière
Et elle raconte aussi cette anecdote, un fait qui révèle beaucoup :
« Un ancien tractoriste de Cheval blanc, un grand cru de Saint-Émilion appartenant à LVMH, rapporte s’être senti « tout petit » quand le gérant est venu lui demander de garer sa voiture dans les vignes pour que personne ne la voie. Il me raconte que sur le parking, c’étaient plutôt des Porsche, Ferrari et Maserati. Il faut dire que le domaine détient le record de la bouteille de vin la plus chère jamais vendue au monde : une Impériale de six litres, remportée pour plus de 200 000 euros… »
Il y a aussi <cet article d’Agora Vox> qui donne encore d’autres précisions et renvoient vers une vidéo des sociologues Pinçon-Charlot qui ont consacré leur vie à étudier les riches, leur mœurs et leurs relations entre eux et avec les « autres »
Le mot du jour du 14 mai 2013 qui faisait suite à l’effondrement d’un atelier textile au Bangladesh et qui avait fait 1127 morts, relayait cette question de Michel Wieviorka & Anthony Mahé : « Sommes-nous capables de regarder en face (la vie de) ceux qui nous permettent de consommer comme nous le faisons ? »
Nous pouvons poser, ici, la même question mais cette fois c’est en France que cela se passe.
<1313>
-
Jeudi 21 novembre 2019
« Une forme de sidération devant la catastrophe annoncée : On assiste à l’effondrement de l’hôpital public »Rémi Salomon, chef de service à l’hôpital NeckerLe mot du jour de mardi reprenait la provocation de Jean-Louis Bourlanges : « La France est pauvre au regard des désirs de ses habitants.».
J’introduisais le sujet par l’hôpital qui est en péril.
A priori, le gouvernement a trouvé quelque argent, puisqu’il a annoncé, hier, que <l’Etat allait reprendre, en trois ans, 10 milliards d’euros de la dette des hôpitaux>
Ces 10 milliards représentent un tiers de la dette des hôpitaux Le gouvernement donne, en outre, un coup de pouce au budget annuel des hôpitaux publics et de nouvelles primes aux soignants.
Le monde explique « Ce que contient le plan d’urgence pour l’hôpital public »
Nicolas Demorand et Léa Salamé avaient invité Tiphaine Morvan, infirmière à l’hôpital Saint-Louis, et Rémi Salomon, chef de service à l’hôpital Necker à <la matinale de France Inter du 13 novembre>.
Rémi Salomon qui étaient un des signataires de la Tribune collective de Soixante-dix directeurs médicaux des départements médico-universitaires, publiée par « Le Monde » du 13 novembre 2019 : « L’hôpital public s’écroule et nous ne sommes plus en mesure d’assurer nos missions »
La tribune revendique comme première solution :
« Nos revendications sont les suivantes : réviser à la hausse l’objectif national des dépenses d’assurance-maladie – le Parlement vote actuellement son montant (première lecture le 29 octobre) » ;
Rémi Salomon réitère cette exigence dans l’émission de France Inter. Il précise que le budget prévisionnel (c’était avant les annonces d’hier) était en augmentation de 2%. Et il affirme que la dépense de l’hôpital allait augmenter de 4%.
Parallèlement l’inflation prévisionnelle sur l’année se situe en 1,2% et 1,4%. J’arrête avec les chiffres.
Mais ce que cela dit c’est que le budget des hôpitaux ne baisse pas, ni ne stagne. L’augmentation dépasse l’inflation.
Mais il n’augmente pas assez et Rémi Salomon revendique le double de l’augmentation.
Je vais citer par la suite, certaines des conséquences de cette situation, mais avant de faire parler l’émotion, les valeurs et les utopies, il faut revenir aux questions factuelles.
Le coût de la santé augmente dans le panier de nos dépenses.
Ce ne sont pas les « autres » – qu’ils soient riches, GAFA ou d’autres encore – qui paieront cette augmentation mais « nous ».
La question est de savoir si nous voulons une dépense mutualisée dans laquelle nous laissons augmenter les cotisations et les impôts pour bénéficier de l’hôpital public ou si nous préférons individualiser la dépense en la privatisant.
En dessous d’un certain seuil de revenus, la réponse est contrainte : sans hôpital public des soins de qualité ne sont tout simplement pas possible.
Au-dessus d’un certain seuil de revenus, la réponse est moins simple, des soins privatisés permettront peut-être plus de confort et peut être même de meilleure qualité. Choisir dans ce cas la solution collective est une philosophie de vie. Et pour que cela puisse se réaliser comme le disait Emile Durkheim que j’ai cité lors du mot du jour du Vendredi 12 septembre 2014 :
« Pour que les hommes se reconnaissent et se garantissent mutuellement des droits, ils faut qu’ils s’aiment et que pour une raison quelconque ils tiennent les uns aux autres et à une même société dont ils fassent partie. »
Et si nous devons consacrer davantage de nos ressources à notre santé, il faut aussi se demander dans quels domaines nous pourrions consommer moins. Sauf si on revient vers des taux de croissance comme on n’en connaît plus, mais qui ne sont pas forcément souhaitables par rapport à l’enjeu écologique.

Mais sur la situation de l’hôpital les choses apparaissent, en effet, grave. Dans la Tribune des 77 directeurs médicaux, on lit :
« Nous vous alertons car ce système s’écroule et nous ne sommes plus en mesure d’assurer nos missions dans de bonnes conditions de qualité et de sécurité des soins.
Des centaines de lits d’hospitalisation de médecine et de chirurgie, des dizaines de salles d’opération à l’hôpital public fermés, et chaque semaine des unités de soin ferment. Les conséquences : des conditions d’accès aux soins dégradées, la qualité et la sécurité des soins sérieusement menacées.
L’accès au diagnostic et aux soins médicaux et chirurgicaux à l’hôpital public est extrêmement difficile, et les équipes soignantes démotivées. Les délais de programmation des interventions s’allongent, les soins urgents ne sont plus réalisés dans des délais raisonnables. Les usagers sont de plus en plus obligés de se tourner vers les établissements privés. Trop peu de recrutements de soignants sont en vue pour espérer un retour à la normale du « système sanitaire ».
Des centaines de postes de soignants (pourtant budgétisés) ne sont pas pourvus ; et, plus grave encore, des soignants quittent l’hôpital public. Cela concerne les infirmiers dans les services médicaux et chirurgicaux de l’hôpital (IDE), les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire, les aides-soignants, les professionnels de rééducation dont les masseurs-kinésithérapeutes, les manipulateurs en radiologie, en médecine nucléaire et en oncologie radiothérapie, les techniciens de laboratoire et les préparateurs en pharmacie. Cela concerne aussi les médecins dont les médecins anesthésistes-réanimateurs, les biologistes et d’autres catégories professionnelles.
Le résultat est une surcharge de travail quotidien croissante et un épuisement des soignants restants ainsi que des cadres de santé, chargés de gérer au quotidien des équipes de soignants sous tension. Pour maintenir les lits ouverts et poursuivre l’accueil des patients, il est nécessaire de faire appel aux soignants restants en leur demandant de réaliser des heures de travail supplémentaires ou à des personnels soignants intérimaires extérieurs appelés au fil de l’eau pour combler les manques mais sans expertise dans les spécificités des différents services. […]
L’objectif national des dépenses d’assurance-maladie (Ondam), montant prévisionnel établi annuellement pour les dépenses de l’assurance-maladie et celui en particulier consacré à l’hôpital public, est revu insuffisamment à la hausse, ce qui aggravera la situation de l’hôpital public et fait craindre le pire pour demain dans un contexte de vieillissement de la population et d’augmentation de la fréquence des maladies chroniques.
L’absence d’attractivité de l’hôpital public particulièrement est également le fait d’une non-revalorisation salariale des personnels paramédicaux (en premier lieux des infirmiers) depuis plusieurs années. C’est particulièrement vrai à l’AP-HP et plus largement en Ile-de-France, où les salaires actuels ne tiennent pas compte des coûts des loyers, de la vie, propres à la région.
Les chirurgiens ne peuvent plus opérer faute d’accès au bloc opératoire, et sont de plus en plus nombreux à rejoindre des structures privées. Une disparité des salaires de base et du tarif des gardes (pour assurer la continuité de service toute l’année), de praticiens hospitaliers (PH) entre le public et le privé : jusqu’à trois fois plus dans les établissements privés. La fuite des médecins des hôpitaux universitaires met en péril la formation de toute la profession et, au-delà, le niveau de la santé en France. »
Et dans l’émission de France Inter, Rémi Salomon perçoit le monde médical dans
« Une forme de sidération devant la catastrophe annoncée : On assiste à l’effondrement de l’hôpital public ».
Avant de parler de revenus Tiphaine Morvan parle d’un manque de moyens, surtout moyens humains pour faire face à la charge et à une éthique des soins qu’elle porte en elle.
Et donc cette tribune, comme l’émission nous apprennent qu’il y a une fuite des soignants de l’hôpital public vers le privé.
Rémi Salomon affirme :
« Si les soignants quittent l’hôpital, ce n’est pas de gaîté de cœur, c’est le dernier rempart de la République [Les] soignants n’ont même plus le temps de rassurer, on leur demande d’être rentables : Il y a de la souffrance éthique ».
Un autre <article du monde> qui donnent la parole à des personnels soignants relate :
« Certains se disent « en colère », d’autres « désabusés ». Tous évoquent l’épuisement dû à une « déshumanisation progressive des soins » ces dernières années. « Chaque jour, j’ai des infirmières qui craquent et qui pleurent à cause de ce rythme « à la chaîne » que je leur impose malgré moi. Chaque jour, je ne sais pas comment la journée va se finir », témoigne une cadre de santé d’un centre de lutte contre le cancer. « Ça fait deux ou trois ans que c’est vraiment raide, à se dire « je vais aller faire caissière » », assure une infirmière. »
C’est encore une question de priorité qui se pose ici.
Il faut certainement remettre de l’humain dans tout cela, en nombre et en qualité.
Pour ce faire il faut sûrement un meilleur partage de la charge selon les moyens des citoyens, mais probablement aussi une autre répartition de nos dépenses individuelles.
Et je finirai ce mot, comme celui de mardi : si nous entrons dans ce débat avec l’esprit d’un consommateur et non d’un citoyen, il n’y a aucune chance que les solutions collectives l’emportent.
<1312>
-
Mercredi 20 novembre 2019
« Vivre sans lire c’est dangereux, cela t’oblige à croire ce que l’on te dit »Dans le monde de Mafalda par Quino publié par GlénatIl faut savoir parfois être court.
Court mais percutant.
Voilà un dessin trouvé sur facebook et qui me semble répondre à cette définition.

Je ne trouve rien à ajouter à la réflexion de Mafalda, cette petite fille qui découvre la vie à travers le talent de Quino qui l’a créé en 1963.
<1311>
-
Mardi 19 novembre 2019
« La France est un pays pauvre, en tous cas au regard des désirs de ses habitants. »Jean-Louis Bourlanges dans le Nouvel Esprit Public du 20/10/2019L’hôpital public est en péril. C’est ce que disent de plus en plus de professionnels. Et nous qui sommes utilisateurs, nous constatons en effet qu’il y a un problème non seulement dans l’hôpital Public mais aussi dans la médecine de ville.
La santé en France manque d’argent.
L’éducation nationale, on peut se tourner vers l’état des locaux des Universités, on peut aussi constater que les professeurs français sont nettement moins rémunérés que dans les autres pays analogues à la France. L’Éducation nationale manque d’argent en France.
L’état des prisons en France devrait être pour chacun une honte nationale. Les prisons françaises manquent d’argent. Plus globalement la justice manque de moyens.
On peut aussi parler de la police.
La manière dont nous accueillons les immigrés est indigne.
L’État n’a quasiment plus les moyens d’acheter ou de louer des locaux pour ses services au centre des métropoles, c’est trop cher.
Il n’a, en parallèle, pas les moyens non plus de conserver des services publics dans les territoires.
Il semble très difficile d’augmenter les retraites. Et la défense nationale ? Nous avons été humiliés par Erdogan, comme en Syrie lorsque Obama a lâché la France, nous étions démunis. Dans le monde qui est et qui vient une parole sans une armée conséquente pour la crédibiliser n’aura aucune portée. La défense française manque d’argent.
Toutes ces dépenses nécessitent l’appel à l’impôt et aux cotisations sociales.
Mais parallèlement, les français souhaitent voir augmenter leur pouvoir d’achat. Pour répondre à ce souhait le gouvernement a décidé de diminuer les impôts. Donc à diminuer encore davantage ses ressources. Souvent une baisse des cotisations est préconisée pour résoudre des problèmes d’emploi ou autres. Ce type de solution a pour objet d’augmenter les ressources individuelles au détriment des ressources collectives et partagées. Celles qui permettent de financer ce que nous n’arrivons plus à financer et que j’ai énuméré ci-avant.
Bien sûr, pour certains la solution est simple. Il suffit d’augmenter substantiellement l’impôt et les cotisations pour les plus riches et lutter contre la fraude fiscale.
Sur le premier point, la France ne peut pas le faire massivement tout seul dans un monde globalisé.
Concernant le second point, c’est certes une piste. Cela permettrait, en effet, d’améliorer un peu la situation. Mais croyez-vous sérieusement que même une lutte aboutie contre la fraude fiscale permettrait de répondre à tous les enjeux que j’ai évoqué ci-dessus ?
Pour ma part je ne le crois pas.
Et j’ai trouvé le constat que Jean-Louis Bourlanges avait énoncé lors de l’émission du Nouvel Esprit Public du 20/10/2019 et qui avait pour sujet : « Radicalisation des rapports sociaux » assez désespérant et pourtant véridique : « La France est un pays pauvre, en tous cas au regard des désirs de ses habitants. »
Pour remettre ces propos dans leur contexte Jean-Louis Bourlanges a dit :
« Il est très difficile de ne pas schématiser ou caricaturer dans un débat d’une telle ampleur. Sur la question des inégalités, elles sont indéniables et très profondes, mais je ne pense pas qu’elles soient la cause déterminante des violences. D’abord parce qu’il n’est pas vrai qu’elles se sont aggravées ces dernières années, comme en attestent le taux de dépense publique et le nombre de fonctionnaires. En revanche, elles sont de plus en plus mal ressenties, et c’est tout à fait compréhensible, Mathias Fekl a très bien décrit les galères de certains. Pourquoi passe-t-on d’une situation d’inégalité acceptée à une situation d’inégalité refusée ? C’est cela qu’il s’agit de comprendre.
La France est un pays pauvre, en tous cas au regard des désirs de ses habitants. Le Produit Intérieur français ne permet pas de donner davantage. Le président a distribué quelques milliards, sans qu’on sache où il va les trouver. C’est un jeu dans lequel les marges de manœuvre sont très limitées. Tant que nous ne développerons pas de la croissance, on aura du mal. Sans compter que la croissance elle-même pose les problèmes écologiques que l’on sait. »
La solution serait en effet dans une croissance du niveau de l’après-guerre. Mais nous savons qu’une telle croissance n’a plus vocation à revenir. Et qu’en outre, les contraintes de l’écologie ne la rendent même pas souhaitable.
Ce qui ne signifie pas qu’il ne faut rien faire.
Mais jusqu’à présent nous sommes toujours parti de ce constat que la France était riche et donc que tout était possible.
Mais ce n’est pas vrai.
Il faut donc choisir les priorités et avoir conscience des enjeux collectifs avant d’aborder les revendications individualistes. Y sommes nous prêts ? Il est vrai que la conscience des inégalités, qui sont pourtant moindre en France, n’aident pas à l’acceptation, par le plus grand nombre, de discussions sur les situations acquises. Mais si nous entrons dans ce débat avec l’esprit d’un consommateur et non d’un citoyen, il n’y a aucune chance que les solutions collectives l’emportent.
<1310>
-
Lundi 18 novembre 2019
« 6 décembre 1989, Ecole polytechnique de Montréal : Premier féminicide de masse revendiqué »Hélène Jouan, dans un article du monde rappelle ce massacre et le déni qui s’en suivitLe mardi 12 novembre 2019, à Montfermeil, Aminata a été tuée de nombreux coup de poignards par la main de son mari.
Il s’agit du 133e féminicide de l’année 2019 en France. Il a été perpétré en présence des deux fillettes du couple qui en criant se sont réfugiées chez des voisins et ont alerté sur le drame en cours.
Aminata s’est défendue et a blessé son meurtrier qui est mort plus tard, à l’hôpital.
Aminata et son meurtrier étaient originaires du Mali.
Mais ce dernier élément est un détail sans importance.
La violence faite aux femmes, particulièrement dans le cercle intime, existe dans tous les pays du monde, chez des mâles de l’espèce homo sapiens de toute origine.
Avant qu’on ne mette le mot « féminicide » sur de tels actes, on parlait de « drame de la jalousie », de « crime passionnel ».
« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » écrivait Camus.
D’autant que nommer ces crimes de cette manière conduisait toujours à accorder des circonstances atténuantes au meurtrier.
Un « féminicide », c’est un homme qui tue une femme parce qu’il croit qu’elle lui appartient ou qu’elle est responsable de ses problèmes.
Le féminicide a été longtemps l’objet d’un déni.
Et c’est en écoutant la revue de presse de Frédéric Pommier de ce dimanche que j’ai appris l’histoire d’un autre déni de féminicide qui s’est passé il y a 30 ans.
C’était au sein de l’École polytechnique de Montréal, école dans laquelle mon fils a passé une partie de ses études d’ingénieur.
Je savais certes qu’il y avait eu un massacre d’étudiants, comme il en existe en Amérique du nord mais plus souvent aux États-Unis qu’au Canada.
C’était le récit d’un de ces massacres; mais je ne savais pas qu’il s’agissait d’un déni de féminicide.
Frédéric Pommier citait un article d’Hélène Jouan publié par <Le Monde du 15 novembre 2019>
Voici d’abord les faits racontés par Hélène Jouan :
« Les filles à gauche, les garçons à droite. » L’homme tire une première fois au plafond. […] Derniers cours de l’année avant les examens, puis ce sera les vacances de Noël. Bientôt, les étudiants chercheront leur premier job d’ingénieur pour construire routes, barrages et centrales du pays. […]
Au deuxième étage du bâtiment, dans la salle C-230.4, un homme vient d’entrer. Les deux mains agrippées à un fusil. Personne ne saisit qui est ce jeune homme au look de chasseur, casquette militaire sur la tête […] Le professeur lui demande de sortir. L’homme s’énerve : « Les filles, au fond de la classe ! Les gars, sortez ! » Nouveaux tirs de sommation. Un à un, les garçons et leurs deux professeurs quittent la pièce, […]
Il reste neuf filles dans un coin de la salle. Neuf filles sur cinquante étudiants.
« Savez-vous pourquoi vous êtes-là ? », leur demande l’homme. « Non », ose l’une d’elles. « Vous êtes toutes des féministes et je hais les féministes », réplique-t-il. « On n’est pas des féministes », rétorque [L’une d’entre elles]
Qu’importe, l’homme ne la laisse pas finir. Il tire. Rafales de bas en haut, puis de gauche à droite. Neuf corps qui virevoltent et tombent. Des femmes au peloton d’exécution. Six d’entre elles meurent sur le coup, quelques-unes leurs mains entrelacées. […]
L’homme quitte la salle de cours. Il emprunte l’Escalator, parcourt les étages. La jeune Geneviève Bergeron, 21 ans, le voit recharger son fusil automatique, elle s’enfuit vers la cafétéria, se cache derrière de hautes caisses au fond de la salle. L’homme repère la jeune femme blonde, s’approche, tire à bout portant. Corridors, salles de cours. Debout sur les tables, il cible les jeunes filles qui tentent de s’abriter sous les chaises, abat à travers une porte vitrée une femme barricadée dans son bureau. […]
Il entend une étudiante blessée appeler à l’aide, revient sur ses pas, sort un couteau et la poignarde de trois coups en plein cœur.
[…] Le tueur […] s’assied […] place le fusil entre ses jambes, canon calé sous le menton, et appuie sur la détente. Marc Lépine, 25 ans, est mort, il a tué quatorze femmes, a blessé quatorze autres étudiants, dont dix étudiantes. […]
la lettre trouvée sur sa dépouille par les policiers entrés dans l’école ne souffre d’aucune équivoque : « Veillez noter que si je me suicide aujourd’hui (…) c’est bien pour des raisons politiques. Car j’ai décidé d’envoyer ad patres les féministes qui m’ont toujours gâché la vie (…) J’ai décidé de mettre les bâtons dans les roues à ces viragos. Même si l’épithète « tireur fou » va m’être attribué dans les médias, je me considère comme un érudit rationnel (…) Les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes (…) tout en s’accaparant de ceux des hommes. » »
Voilà les faits. Il s’agit d’un féminicide de masse revendiqué.
Mais ce ne sont pas ces mots qui vont être utilisés. On va même cacher le fait qu’il ne s’agit que de femmes.
Ce type de déni porte un nom : l’« Invisibilisation ». Ce fut l’objet du mot du jour du 20 juin 2016 dans lequel ce substantif était défini de la manière suivante : « pour exprimer le fait de rendre invisible une réalité ».
Lors de ce mot du jour de 2016, il s’agissait de nommer la tuerie d’Orlando où un criminel se réclamant de DAESH a massacré des homosexuels !
Les journalistes français avaient aussi parlé d’un massacre dans une boite de nuit, sans préciser qu’il s’agissait d’une boite gay. C’était un meurtre homophobe.
Mais revenons à l’évènement de 1989 à Montréal et à l’histoire du déni.
« Mais à 17 h 28 ou 29, ce 6 décembre, commence à s’écrire un curieux scénario qui va subrepticement conduire à taire, à nier puis à dénaturer, pendant des années, le crime commis. […]
La police refuse de publier la lettre de revendication de Marc Lépine, […] mais elle diffuse dès le lendemain une « annexe » jointe à cette lettre, une liste de dix-neuf noms de femmes. Des journalistes, une vedette de la télé, une syndicaliste, des femmes politiques, des policières… Avec cette annotation : « Ont toutes failli disparaître aujourd’hui. Le manque de temps (car je m’y suis mis trop tard) a permis que ces féministes radicales survives».
Francine Pelletier, chroniqueuse dans un grand quotidien national, apprend en regardant la télé qu’elle est « l’une de ces femmes à abattre ». Elle a cette analyse :
« Pour moi, il y a eu deux tragédies ce jour-là. La première, c’est l’assassinat de ces quatorze jeunes filles, tuées parce qu’elles occupaient leur place de femmes. La deuxième tragédie, c’est ce qu’on a vécu après, le déni. »
Au lendemain du drame, l’éditorial du journal de Québec Le Soleil s’intitule « Une tuerie inexpliquée ». « « Je hais les féministes », a lancé le tueur fou avant de tuer et de blesser les femmes. Cela ne prouve rien », affirme le journaliste.
Le jour des funérailles nationales, organisées à Montréal dans la basilique Notre-Dame, le directeur du Cegep (un établissement scolaire postbac) de la vieille ville dans lequel Marc Lépine a suivi une partie de sa scolarité, appelle ses élèves à réfléchir
« au geste de désespoir qui vient d’être commis. Puissions-nous sensibiliser à l’importance de combattre l’isolement des personnes dans notre société ».
Hélène Jouan assène :
« Quatorze femmes viennent d’être assassinées, mais c’est le tueur la victime… »
Francine Pelletier écrit avec beaucoup de justesse :
« Je me souviens de notre état de vulnérabilité. Certaines d’entre nous venaient de payer le prix d’être une femme, mais personne ne voulait le reconnaître. Si un homme blanc n’avait tué que des Noirs, n’aurions-nous pas tous hurlé à l’attaque raciste ? Là, on nous intimait le silence, il était inconcevable d’aggraver la déchirure qui venait de se produire entre les hommes et les femmes. J’ai compris ce jour-là combien nous avions été naïves. »
La dénégation collective prendra fin officiellement dans quelques jours :
« Dans quelques jours, la ville de Montréal va desceller, place du 6-Décembre-1989, la plaque apposée en 1999 en mémoire des victimes, pour la remplacer par une nouvelle. L’ancienne se contentait d’évoquer « la tragédie survenue à l’École polytechnique », il sera désormais gravé que « quatorze femmes ont été assassinées lors d’un attentat antiféministe ». Trente ans pour dire, enfin. Il y a eu, au fil des années, des petits cailloux blancs semés sur le chemin de l’acceptation du drame pour ce qu’il est. Un an après « Poly », la publication de la lettre du tueur commence à dessiller les yeux des plus sceptiques : Lépine a signé sa haine misogyne, il suffit de lire ses mots.
[…] En 2009, le film Polytechnique, de Denis Villeneuve, qui n’élude rien des motivations du tueur, va concourir à ce que « les murs de brique construits entre nous s’effritent », raconte Catherine Bergeron. « Le temps du deuil pour une société est le même que pour une personne », ajoute-t-elle joliment, comme pour excuser son pays d’avoir mis si longtemps à nommer l’horreur. »
Frédéric Pommier concluait :
« Pour dire les mots, les écrire, il aura donc fallu attendre trois décennies. »
<1309>
-
Vendredi 15 novembre 2019
« Il m’est d’ailleurs arrivé de penser que gagner ne servait à rien »PoulidorComme tout le monde, j’aimais Poulidor et j’aurais voulu qu’il gagne le tour de France.
Mais dire qu’il est l’éternel second est évidemment une fake news.
Son palmarès est remarquable puisqu’il peut se prévaloir de 189 victoires, dont Milan-San Remo (1961), la Flèche wallonne (1963), Paris-Nice (1972, 1973), le Critérium du Dauphiné (1966, 1969), le Tour d’Espagne (1964) etc.
Evidemment, la réputation d’éternel second est liée à la course la plus prestigieuse du cyclisme : le tour de France.
Et dans cette course il y eut comme une malédiction, un « chat noir ».
Il participa à 14 tours de France, le premier en 1962 à 26 ans et le dernier à 40 ans en 1976. Dans le premier et le dernier tour de France auquel il a participé, il a terminé troisième.
Il est d’ailleurs le recordman de podium sur le Tour de France puisqu’il termina 8 fois sur le podium dont 3 fois deuxième mais jamais premier.
Et même plus que cela, il ne porta jamais le maillot jaune, bien qu’il remporta 7 étapes.
 Le moment le plus emblématique fut la course épaule contre épaule dans la montée du Puy de Dôme en 1964.
Le moment le plus emblématique fut la course épaule contre épaule dans la montée du Puy de Dôme en 1964.
<Libération> rapporte cet affrontement avec ces mots :
« Ce jour-là, sur des pentes à 10%, le cyclisme est presque devenu un sport de contact, de combat. Épaule contre épaule, sans échanger le moindre regard, les deux hommes vont au bout de leurs limites. A la pédale et au mental, Poulidor finit par lâcher son adversaire, qu’il laisse à 42 secondes au sommet. Insuffisant pour le dépouiller de sa tunique jaune. Au final, Poulidor termine deuxième du Tour, à 55 secondes d’Anquetil. »
Ce qu’on dit rarement c’est que Poulidor ne gagna pas cette étape.
Il faut aller lire l’article de <La Montagne> pour savoir qu’il ne finit que troisième devancé par Jimenez et Bahomontés.
L’article de la Montagne est très complet et rapporte que ce Tour 1964 ne fut pas perdu lors de cette ascension mais dans les étapes précédentes :
« Sur les premières semaines, il aurait pu (dû?) s’emparer du maillot jaune. En effet, que de temps perdu dans les étapes précédentes ! D’abord, il y a cette arrivée rocambolesque à Monaco (9e étape) où le Creusois déboule en tête sur le vélodrome de la Principauté mais descend de son vélo un tour de piste trop tôt, ce qui permet à… Anquetil de lui passer devant et de remporter l’étape, empochant ainsi la bonification d’une minute promise au vainqueur…
Puis il y a ce contre-la-montre entre Peyrehorade et Bayonne (17e étape), épreuve sur laquelle Anquetil excelle d’ordinaire, où Poulidor alors en tête est victime d’une crevaison. Arrive ensuite un incroyable concours de circonstances : le mécano se précipite avec un vélo de rechange mais trébuche et tombe dans un fossé, se blessant à la cheville. Le coureur est ainsi obligé de descendre pour aller chercher sa nouvelle monture, mais suite à la chute de celle-ci, le guidon est faussé, obligeant Poulidor à s’arrêter à nouveau quelques mètres plus tard pour tout remettre en ordre. »
Mais ce que je trouve remarquable c’est ce que Poulidor raconte dans un article publié par le journal suisse « Le Temps » :
«Plus j’étais malchanceux, plus le public m’appréciait, plus je gagnais du fric. Il m’est d’ailleurs arrivé de penser que gagner ne servait à rien.»
Il répétait souvent, à la fin de sa vie:
«Si j’avais gagné le Tour, on ne parlerait plus de moi aujourd’hui.»
Il raconte dans un autre article que sa popularité était telle que pour avoir sa participation, les organisateurs de critérium lui versaient des primes plus importantes qu’à Anquetil qui gagnait davantage de courses. Ce dernier en était d’ailleurs fort marri.
Poulidor apparaissait comme le perdant, mais un perdant magnifique qui était allé au bout de lui-même.
Des esprits chagrins, croyant de la supériorité du vainqueur, ont d’ailleurs, en s’appuyant sur la popularité de Poulidor, reproché aux Français de préférer les perdants. Ils entendaient pointer ainsi du doigt, selon eux, une tare de la France dans la compétition mondiale.
Le Huffington Post a consacré un article à ce sujet : « Pourquoi on adore les perdants comme Raymond Poulidor »
Pour ma part, lors d’un des mots du jour sur le football, avant la coupe du monde 2018, je m’étais offusqué de l’injonction de notre jeune président qui fait probablement partie de ces esprits chagrins.
Ce fut le dernier de la série, publiée le 26 juin 2018 et je racontais la chose suivante :
« Et puis pour finir vraiment, je voudrais revenir à la visite d’Emmanuel Macron à l’équipe de France de football à Clairefontaine. Pendant cette visite il a eu ce jugement :
«Une compétition est réussie quand elle est gagnée»
Montrant bien que pour lui ce sont les gagnants que l’on doit admirer et honorer.
C’est une philosophie de vie, c’est une morale.
Une morale que je ne partage pas.
Et le football encore m’aide à l’expliquer.
L’équipe de France de 1982 a perdu à Séville contre l’Allemagne. Je crois que tous ceux qui aiment le foot gardent beaucoup d’affection pour cette équipe de perdants.
Et l’équipe de 1986 qui avait battu le champion du monde sortant italien en 1/8ème finale. En ¼ de finale elle a rencontré l’équipe de Brésil de Socratés que j’ai déjà évoqué lors du mot du jour de vendredi. Certains historiens du football disent que ce fut le plus beau match de l’Histoire du football, tous disent que ce fut l’un des plus beaux. Et ce fut l’Argentine qui gagna la coupe du monde, l’Argentine de Maradona qui se qualifia grâce à la tricherie de ce dernier marquant un but avec la main contre l’Angleterre.
L’équipe de France de Platini et l’équipe du Brésil de Socratés furent des équipes de perdants, mais des perdants magnifiques.
Heureusement, M Macron que le monde de nos souvenirs et de nos célébrations n’est pas qu’un monde de gagnants. Il serait beaucoup moins beau, avec moins d’émotion, d’intelligence, de saveur, plus uniforme, plus triste. »
Et je crois que le témoignage de Poulidor nous apporte cette sagesse qu’il n’y a pas que la victoire qui est belle.
C’est un monde assez affreux que celui dans lequel on n’honore que le vainqueur.
Dans un monde où le premier rafle tout.
C’est un monde assez proche de celui dans lequel nous vivons.
Mais les français aiment Poulidor, c’est peut-être cela leur particularité et leur grandeur.
« Il m’est arrivé de penser que gagner ne servait à rien »
<1308>
-
Jeudi 14 novembre 2019
« Ce que [Jessye Norman] projetait, silencieuse et face à nous, était si intense que l’assistance a fondu en larmes »Bob WilsonJessye Norman est décédée le 30 septembre, je lui ai consacré le mot du jour 2 octobre 2019.
 Le magazine de musique « Diapason » de Novembre a publié un beau dossier à l’«adieu à Jessye Norman »
Le magazine de musique « Diapason » de Novembre a publié un beau dossier à l’«adieu à Jessye Norman »
Ce dossier retrace son parcours et parle aussi de sa foi religieuse.
Mais ce que je voudrais partager aujourd’hui c’est le témoignage que le grand metteur en scène Bob Wilson a donné au Los Angeles Times et que Diapason a reproduit.
Robert Wilson est metteur en scène et plasticien. Il a suivi des études de peinture et d’architecture.
Il a souvent mis en scène des spectacles de Jessye Norman.
Par exemple, en 1982 «GREAT DAY IN THE MORNING» et en 2001, il avait mis en scène, au Théâtre du Châtelet, un spectacle consacré au « Voyage d’hiver » de Schubert.
Et voilà ce que narre Bob Wilson :
« Au moment des attentats du 11 septembre, nous donnions Le Voyage d’Hiver au Châtelet. Le lendemain du drame, Jessye m’appelle pour me dire qu’elle avait pleuré toute la nuit et n’aurait pas la force de chanter. Je lui ai répondu « Mais Jessye, c’est justement pour cela que tu dois chanter. Nous avons besoin d’entendre ta voix ».
Elle l’a fait.
Et bien sûr, à un moment, l’émotion l’a submergée , elle s’est arrêtée, demeurant immobile.
Elle ne chantait plus, ne bougeait plus, restait juste debout. Je ne connais personne d’autre qui aurait pu faire ça.
Ce qu’elle projetait, silencieuse et face à nous, était si intense que l’assistance a fondu en larmes.
Cela dura dix minutes. Dix minutes ! Son silence était plus puissant encore que son chant.»
Et il raconte une autre anecdote.
« Dès notre rencontre, au début des années 1970, j’ai été fasciné par elle. Elle a toujours compris son propre génie d’actrice […]. Il se nourrrisait de son exigence morale profonde, de sa révolte devant toute forme d’inégalité. Je me souviens avoir passé une nuit entière avec elle dans un commissariat, car elle avait vu des policiers arrêter dans la rue un homme noir qu’elle ne connaissait pas, mais voulait être certaine qu’il ne serait victime d’aucune discrimination ou mauvais traitement !
Elle l’a attendu jusqu’au matin. »
Jessye Norman, telle qu’en elle-même immense, sensible et généreuse.
Mais on ne peut finir un mot du jour sur Jessye Norman, sans un moment de chant.
Je n’ai pas trouvé d’extrait du spectacle du Voyage d’Hiver. Elle n’a d’ailleurs pas enregistré ce cycle de Schubert.
Mais écoutez donc ce bijou de moins de 2 minutes : « Zueignung » de Richard Strauss.
En voici les paroles et la traduction
Zueignung
Dédicace
Ja, du weißt es, teure Seele,
Daß ich fern von dir mich quäle,
Liebe macht die Herzen krank,
Habe Dank.Oui tu le sais précieuse amie,
Que loin de toi, je me tourmente.
L’amour fait souffrir les cœurs
Sois remerciée.Hielt ich nicht, der Freiheit Zecher,
Hoch den Amethysten-Becher,
Und du segnetest den Trank,
Habe DankUn jour assoiffé de liberté,
J’ai levé le gobelet d’améthyste
et tu as béni mon breuvage
Sois remerciée.Und beschworst darin die Bösen,
Bis ich, was ich nie gewesen,
Heilig an das Herz dir sank,
Habe Dank.Tu as conjuré le mal,
Et j’ai osé ce que je n’avais jamais osé,
Saintement je me suis reposé sur ton cœur,
Sois remerciée<1307>
-
Mercredi 13 novembre 2019
« Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas »Chanson interprétée par Marie LaforêtCe 11 novembre, je regardais par la fenêtre de mon salon et je découvrais les couleurs d’automne qui paraient les arbres de rouge, d’orange, de marron et de vert.
J’étais saisi par la beauté de ce moment. Mon premier réflexe fut de prendre une photo, mais j’arrêtais mon élan.
A quoi bon vouloir tout photographier ?
C’est vouloir privilégier la vie dans le futur où on pourra regarder la photo prise, photo qui ne sera jamais aussi belle que ce que je voyais avec mes yeux, dans le présent de ce que je vivais.
Alors j’ai plutôt appelé Annie et sa sœur Simone qui nous offrait sa visite, pour partager cette beauté ensemble, partager ce cadeau.
« La vie c’est cadeau. »
C’est ce que dit Marie Laforêt dans cet entretien à France 5 de 2005.
Elle en avait fait une chanson d’ailleurs.<Cadeau>
Elle est morte le 2 novembre 2019.
Les goûts, les affections ne se commandent pas.
Bien qu’il y eut une véritable ferveur populaire au moment de la mort de Johny Halliday par les gens de ma génération et même de la précédente, je n’éprouvais rien pour lui.
Mais j’aimais les chansons de Marie Laforêt. Elle avait une voix unique, elle était actrice autant que chanteuse et savait communiquer tous les registres de l’émotion.
C’était une personnalité complexe, avec sa part d’ombre.
Elle est née Maïtena Doumenach. C’est Louis Malle qui trouvera son nom de scène : <Marie Laforêt>.
Elle raconte qu’elle a été violée à 3 ans par un voisin. Viol sur lequel des mots n’ont pu être prononcés que bien tard.
On trouve aussi dans un magazine que je n’ai pas l’habitude de lire, une anecdote sur le tournage de « Plein Soleil » de René Clément, film qui l’a rendu célèbre comme il a rendu célèbre un jeune acteur de 25 ans : Alain Delon.
Ce dernier, bellâtre en sa splendeur, lui a simplement lancé : « Tu veux que je te saute ? ». #Meeto n’était pas encore à l’agenda. Elle lui en gardera une rancœur tenace.
Comme tant d’autres elle a connu dans sa vie la violence faite aux femmes.
L’émission <C à vous> lui a rendu un bel hommage, en insistant sur son recul et sa modestie par rapport à son talent, contrairement à Alain Delon.
 Elle a dit :
Elle a dit :
« Ma carrière est de bric et de broc, mais ma vie est remplie du début à la fin »
Cette émission rappelle aussi qu’elle a incarné au Théâtre le rôle de Maria Callas dans ses Master Class.
J’aimais et j’aime toujours particulièrement, parmi ses chansons, « La tendresse », parce qu’elle est belle et parce qu’elle dit une chose simple, mais simplement vraie.
« La Tendresse » est une chanson française écrite par Noël Roux, mise en musique par Hubert Giraud.
Elle a d’abord été interprétée par Bourvil en 1963, et l’année suivante en 1964 elle a été reprise par Marie Laforêt qui l’a rendue célèbre.
Voici les paroles de cette chanson simple
On peut vivre sans richesse
Presque sans le sou
Des seigneurs et des princesses
Y’en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas
Non, non, non, non
On ne le pourrait pas
On peut vivre sans la gloire
Qui ne prouve rien
Etre inconnu dans l’histoire
Et s’en trouver bien
Mais vivre sans tendresse
Il n’en est pas question
Non, non, non, non
Il n’en est pas question
Quelle douce faiblesse
Quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant
Vraiment, vraiment, vraiment
Le travail est nécessaire
Mais s’il faut rester
Des semaines sans rien faire
Eh bien… on s’y fait
Mais vivre sans tendresse
Le temps vous paraît long
Long, long, long, long
Le temps vous parait long
Dans le feu de la jeunesse
Naissent les plaisirs
Et l’amour fait des prouesses
Pour nous éblouir
Oui mais sans la tendresse
L’amour ne serait rien
Non, non, non, non
L’amour ne serait rien
Quand la vie impitoyable
Vous tombe dessus
On n’est plus qu’un pauvre diable
Broyé et déçu
Alors sans la tendresse
D’un cœur qui nous soutient
Non, non, non, non
On n’irait pas plus loin
Un enfant vous embrasse
Parce qu’on le rend heureux
Tous nos chagrins s’effacent
On a les larmes aux yeux
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu…
Dans votre immense sagesse
Immense ferveur
Faites donc pleuvoir sans cesse
Au fond de nos cœurs
Des torrents de tendresse
Pour que règne l’amour
Règne l’amour
Jusqu’à la fin des jours
<1306>
-
Mardi 12 novembre 2019
« J’ai une richesse incroyable, celle d’être la fille d’étrangers et en même temps d’être française. »Ariane Ascaride, à la Mostra de Venise après avoir reçu le prix de la meilleure interprétation féminine pour « Gloria Mundi » de Robert GuédiguianAriane Ascaride est une actrice pleine de sensibilité et de talents. Fille d’immigrés italiens, elle est née en 1954 à Marseille.
Elle a surtout tourné ses films avec son mari, également né à Marseille, le réalisateur d’origine arménienne : Robert Guédigian
D’ailleurs les films de Guédigian sont presque toujours joués par le même noyau d’acteurs, Ariane Ascaride, Gérard Meylan et Jean-Pierre Darroussin.
Ces trois acteurs jouaient dans le premier film de Guédigian que nous avons vu avec Annie : « Marius et Jeannette » qui avait reçu le César du Meilleur film en 1998.
Film admirable, à hauteur d’homme qui se situe dans le quartier de l’Estaque à Marseille. Il raconte la rencontre de deux représentants des « gens d’en bas » si on reprend les concepts utilisés aujourd’hui.
Nous en avons vu d’autres toujours avec grand plaisir, car ils expriment la profondeur des sentiments et la vie des gens, des vrais gens.
Depuis, nous allons peu au cinéma mais nous avons encore vu en 2006, « Le voyage en Arménie » dans lequel Robert Guédigian évoque la terre de ses ancêtres.
Beaucoup de films de Guédigian et d’Ariane Ascaride se passent à Marseille, mais ils habitent depuis longtemps à Montreuil-sous-bois, la ville de Georges Méliès, qu’Annie, Alexis, Natacha et moi avons aussi habité avec bonheur de 1991 à 2002.
Un nouveau film va donc sortir le 27 novembre 2019 : « Gloria Mundi »
 Ce film a été présenté à la Mostra de Venise et Ariane Ascaride a eu le prix d’interprétation féminine.
Ce film a été présenté à la Mostra de Venise et Ariane Ascaride a eu le prix d’interprétation féminine.
Quand on reçoit un prix, on fait un discours.
Le discours d’Ariane Ascaride fut bref et poignant :
« Je suis la petite-fille d’immigrants italiens qui un jour ont pris le bateau pour tenter leur chance pour fuir la misère.
Ils sont finalement arrivés à Marseille, et c’est là que je suis née.
Ce prix me donne la possibilité de retrouver mes racines et c’est très important.
J’ai une richesse incroyable, celle d’être la fille d’étrangers et en même temps d’être française.
Sachez-le c’est très important d’avoir une, deux, trois cultures pour vivre dans ce monde.
Je dédie ce prix à tous ceux qui reposent pour l’éternité au fond de la Méditerranée. »
Vous trouverez derrière <ce lien> le discours en italien sans sous-titrage et pour avoir le discours sous-titré il faut aller sur la <page facebook de Robert Guédiguian>.
<France Info> dédie un article à lire sur ce prix et Ariane Ascaride.
<1305>
-
Vendredi 8 novembre 2019
« La réunification de l’Allemagne ? Ce fut une annexion – [Non] cela a été tranché par le vote des allemands de l’est»Jean-Luc Mélenchon & Daniel Cohn-BenditDemain, nous commémorerons le 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin : le 9 novembre 1989.
Certains affirment que les années en 9, sont très importantes pour l’Histoire. Je tenterais peut être une série à ce sujet : certaines années se terminant par 9.
Le 9 novembre 1989, j’avais 31 ans et je ne croyais pas ce que je voyais. Je ne m’imaginais pas que le système communiste s’effondrerait aussi rapidement.
Je ne reviendrais pas sur le contexte de cet évènement tout en rappelant qu’à cette date les allemands de l’est pouvaient déjà rejoindre assez massivement l’Ouest en passant par la Hongrie.
Je ne m’étendrais pas davantage sur l’étonnante manière qui a conduit à ce que le 9 novembre 1989, les portes du mur de Berlin s’ouvrent en rendant célèbre pour l’Histoire Günter Schabowski qui était à ce moment-là le porte-parole du gouvernement de la RDA.
Il y a cette petite <vidéo> qui rappelle cela. Et dans l’émission <C a vous> consacrée à cet évènement vous pourrez visualiser la feuille sur laquelle se trouvait les notes de Günter Schabowski et qu’il tenait devant ses yeux pendant sa conférence de presse.
Ce papier griffonné et peu lisible est présenté au musée de Berlin.
Il s’agit d’un document historique.
La chute du mur et l’ouverture des frontières ont rendu la réunification allemande possible.
Sur ce point, il y aurait matière à de très longs développements, sur les réticences de François Mitterrand et de la France, de la volonté sans faille d’Helmut Kohl et du fatalisme de Mikaël Gorbatchev, ainsi que de toutes les longues tractations qui ont rendu la renaissance d’une seule Allemagne possible.
Mais ce n’est pas de cela que je vais parler aujourd’hui.
Au départ, il y a la « Une » du Monde Diplomatique de ce mois de novembre :
 « Allemagne de l’Est, histoire d’une annexion »
« Allemagne de l’Est, histoire d’une annexion »
Puis il y eut la réaction de Jean-Luc Mélenchon sous forme de tweet qui en renvoyant vers cette « Une » a ajouté :
« Enfin le mot juste pour nommer ce qui s’est passé il y a trente ans. Une violence qui n’en finit plus de se payer. »
C’était jeudi de la semaine dernière.
Dimanche, Jean-Luc Mélenchon était l’invité sur France Inter à <Questions Politiques>.
A la fin de l’émission (51:24 de la video), Ali Baddou est revenu sur l’évènement et sur ce tweet.
Et Jean-Luc Mélenchon a confirmé et précisé son « gazouillis » :
« D’abord c’est une annexion, je vous renvoie à mon livre, « le Hareng de Bismarck », où je fais la démonstration, où je montre comment l’Allemagne de l’Est a été annexée. Ce n’était même pas constitutionnel. Ce n’était pas ce que demandaient les Allemands de l’Est. Ils voulaient, eux-mêmes, faire une Constituante, ils voulaient voter, se prononcer sur l’intégration Est-Ouest et sur la préservation d’un certain nombre de leurs acquis. Dans ce pays, un autre pays voisin a annexé toutes les usines du pays, changé toutes les institutions et modifié le régime de la propriété. Ça s’appelle une annexion. […] C’est une violence sociale inouïe qui a été commise contre les Allemands de l’Est, comme dans tout le reste de l’est de l’Europe et ce n’est pas une bonne chose. »
Le Lundi matin, toujours sur France Inter, l’invité était Daniel Cohn Bendit : <Cette fois la question est posée en début d’entretien>
Daniel Cohn Bendit considère que les propos de Jean-Luc Mélenchon sont d’«une bêtise incroyable »
Et il raconte :
«Ce que fut il y a trente ans la réunification, c’est un mouvement extraordinaire en Allemagne de l’Est pour abattre une dictature. […] Moi, j’ai pleuré, j’ai pleuré… Quand les murs tombent, que cela soit les murs de la dictature au Portugal, que cela soit les murs de la dictature en Espagne, que cela soit les murs au Chili, c’est quelque chose d’extraordinaire. […]
Et ce mouvement non violent extraordinaire de millions de citoyens d’Allemagne de l’Est qui ont fait tomber le mur, ce n’était pas une annexion. »
Il a cependant reconnu que tout n’a pas été parfait et qu’à l’époque d’autres voies auraient peut-être été possible. Mais il ajoute :
« Le débat a été tranché par le vote des gens en Allemagne de l’Est. Ils ont voté à majorité CDU [le parti conservateur, du chancelier Kohl], bah j’y peux rien, c’est la démocratie. »
J’innove aujourd’hui, pour la première fois l’exergue que j’utilise est la concaténation d’avis divergents.
Qui a raison, qui a tort ?
A cet instant je pense à une histoire que me racontait mon père.
Un vieux sage reçoit la visite d’un homme qui lui raconte des faits et tire une conclusion de ces faits. Le vieux sage approuve la conclusion et dit : « tu as raison ».
Un jour plus tard, un autre homme lui rend visite et raconte les mêmes faits, à sa manière et finit par une conclusion diamétralement opposée à celle du précédent visiteur. Le vieux sage approuve aussi cette conclusion et dit : « tu as raison ».
L’épouse du sage qui avait assisté aux deux conversations dit un peu plus tard : « Tu as dit au premier qu’il avait raison, et tu viens de dire au second qui dit l’inverse qu’il a raison aussi ? ».
Je me souviens du sourire malicieux de mon père en rapportant le propos du sage à son épouse : « Tu as raison !».
Il ajouta cependant : « Chacun a raison par rapport au point de vue dans lequel il se place ! »
La réunification de l’Allemagne fut bien une annexion. Les États de la RDA entrèrent dans la République Fédérale Allemande en reprenant la constitution, les règles, l’organisation économique et sociale de la République Fédérale.
D’autres voies auraient été possibles, étaient proposées.
Mais c’est celle qu’avançait le chancelier de l’Allemagne de l’Ouest et son parti la CDU qui fut approuvée par le vote démocratique des allemands de l’Est.
Une annexion n’est pas forcément un acte de guerre. Le dictionnaire du CNRS dit explicitement :
« Tout acte, constaté ou non dans un traité, en vertu duquel la totalité ou une partie du territoire d’un État passe, avec sa population et les biens qui s’y trouvent sous la souveraineté d’un autre État. »
Dans ce sens la réunification fut bien une annexion.
Et comme le montre <cet article> du Monde avec ses cartes, la fracture entre l’Allemagne de l’Est et de l’Allemagne de l’ouest perdure que ce soit selon le critère de la religion, de la présence des jeunes sur le territoire, du taux de chômage, du revenu des ménages et aussi de la taille des exploitations agricoles.
Je finirai par cette photo de Mstislav Rostropovitch jouant Bach, le 11 novembre 1989, devant le mur défait .
 <1304>
<1304> -
Jeudi 7 novembre 2019
« Certaines personnes […] trouvent plaisir dans l’attente. Pour cela il faut posséder un esprit philosophique porté à l’espérance »Sylvain Tesson parlant de Vincent MunierPour que le beau livre de Sylvain Tesson existât, il fallut d’abord un artiste qui le précéda et l’emmena avec lui : Vincent Munier.
Vincent Munier a un site sur lequel, il montre les photos qu’il réalise et dont il fait par la suite des livres : http://vincentmunier.com/indexflash.html
 Vincent Munier et Sylvain Tesson
Vincent Munier et Sylvain Tesson
Sylvain Tesson écrit :
« Munier, lui rendait ses devoirs à la splendeur et à elle seule. Il célébrait la grâce du loup, l’élégance de la grue, la perfection de l’ours. Ses photos appartenaient à l’art, pas à la mathématique. » page 40&41
Sur ce site vous trouverez des photos magnifiques comme ce loup :
 Pour accompagner ces photos réalisées dans l’attente et le silence, j’ai souhaité mettre en exergue une phrase de Sylvain Tesson dans son livre que je remets dans son contexte (page 23):
Pour accompagner ces photos réalisées dans l’attente et le silence, j’ai souhaité mettre en exergue une phrase de Sylvain Tesson dans son livre que je remets dans son contexte (page 23):
« L’affût est un pari : on part vers les bêtes, on risque l’échec. Certaines personnes ne s’en formalisent pas et trouvent plaisir dans l’attente. Pour cela il faut posséder un esprit philosophique porté à l’espérance. »
Parce qu’il faut savoir faire silence, attendre.
Sylvain Tesson avant son aventure avec Vincent Munier n’était pas de ce genre.
Il suivait plutôt cette règle qu’il écrit ironiquement page 17 :
« L’ennui court moins vite qu’un homme pressé »
Mais à la fin de son livre et de l’expérience partagée avec le photographe amoureux de la nature, il révélait (page 161)
« J’avais appris que la patience était une vertu suprême, la plus élégante et la plus oubliée. Elle aidait à aimer le monde »
Mais Vincent Munier dans sa quête de l’inaccessible et du monde sauvage exprime une crainte :
« Depuis 30 ans, je balade mes objectifs pour tenter de montrer le beau (…) à la recherche d’endroits où la nature n’a pas été maîtrisée, gérée. En France, parfois je suffoque. [Au Tibet], si haut, on se sent respirer. Mais je vis le paradoxe de montrer des endroits non anthropisés, où il peut y avoir un tourisme qui pourrait porter préjudice à ces animaux. Je suis en mutation à ce niveau-là, je réduis mes voyages pour essayer d’être cohérent. »
Il avoue par ailleurs qu’on peut aussi regarder la nature dans les Vosges.
Car en effet, le monde sauvage n’a pas besoin de l’homme. L’homme qui par sa démographie et son désir inexorable de croissance augmente sans cesse son emprise sur la terre, faisant reculer le territoire des autres espèces qui disparaissent par une <extinction de masse dont le rythme s’accélère>.
Lorsque le dernier hectare de vie sauvage aura été éradiqué pour installer des humains ou leurs œuvres, je ne donne pas cher de la durée de survie qui restera à homo sapiens. Et cela arrivera bien avant le dernier hectare, si nous ne savons nous arrêter à temps et fixer des limites à nos désirs insatiables.
Sylvain Tesson entreprend une réflexion sur les hommes qui sont sortis des grottes :
« La grotte dans laquelle je venais de rentrer avec Léo avait été occupée. […] Les grottes avaient constitué la géographie matricielle de l’humanité dans ses lamentables débuts. Chacune avait abrité des hôtes jusqu’à ce que l’élan néolithique sonne la sortie de d’abri. L’homme s’était alors dispersé, avait fertilisé les limons, domestiqué les troupeaux, inventé un Dieu unique et commencé la coupe réglée de la Terre pour parvenir, dix mille ans plus tard, à l’accomplissement de la civilisation : l’embouteillage et l’obésité. On pourrait modifier la pensée B139 de Pascal : – « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repose dans une chambre » – et trouver que le malheur du monde débuta quand le premier homme sortit de la première grotte » (pages 135 & 136)
Je ne partage pas ces propos désabusés. Je suis heureux que l’homme soit sorti de la grotte, parce que sinon il n’y aurait pas eu Jean-Sébastien Bach, William Shakespeare, Léonard de Vinci, Pasteur et tant d’autres que l’humanité s’honore de compter parmi les siens.
Mais la raison devrait nous inciter à méditer cette parole qu’on attribue à Géronimo, le chef amérindien :
« Quand le dernier arbre aura été abattu, la dernière rivière empoisonnée et le dernier poisson péché, alors l’homme s’apercevra que l’argent ne se mange pas. »
<1302>
-
Mercredi 6 novembre 2019
« Sur les traces de la panthère des neiges »Frédéric et Olivier LarreyDans mes recherches sur la panthère des neiges, j’ai trouvé un documentaire diffusé par Arte <Sur les traces de la panthère des neiges>.
Il est l’œuvre de deux frères Frédéric et Olivier Larrey qui sont photographes naturalistes et sont comme Vincent Munier et Sylvain Tesson aller au Tibet pour observer la panthère des neiges qu’on appelle aussi « l’once » et aussi «Léopard des neiges », ou « Irbis »
Vous n’avez pas beaucoup de temps pour regarder ce documentaire sur le site de replay d’Arte, puisque vous devez le regarder aujourd’hui.
Sinon, Arte annonce une nouvelle diffusion le vendredi 22 novembre à 10:15
C’est un documentaire d’une beauté stupéfiante, aussi en raison des paysages qui abritent cet étonnant animal.
La quête des frères Larrey est d’essayer de photographier et filmer une mère avec son petit.
Quête qui s’achèvera selon le vœu de ceux qui la poursuivent.

Lors de la troisième apparition décrite par Sylvain Tesson, page 139 de son livre, on lit :
« La panthère nous avait repérés. Se tournant sur le flanc, elle leva la tête et nous croisâmes son regard, braise froide. Les yeux disaient : « Nous ne pouvons-nous aimer, vous n’êtes rien pour moi, votre race est récente, la mienne immémoriale, la vôtre se répand, déséquilibrant le poème » »
<1302>
-
Mardi 5 novembre 2019
« La panthère des neiges »Sylvain TessonCe fut un soir de grâce.
Je vous avais déjà présenté l’extraordinaire 10ème symphonie de Dimitri Chostakovich, écrite après la mort de Staline.
J’en avais parlé après une très belle interprétation à l’auditorium de Lyon avec l’Orchestre National de Lyon, dirigé par un jeune chef de 23 ans, plein de talent. Ce fut le mot du jour du <jeudi 16 mai 2019>
Mais cette fois, le jeudi 31 octobre 2019, cette œuvre fut interprétée par l’orchestre de la radio de Bavière avec un des meilleurs chefs d’orchestre actuels : Mariss Jansons, dans la Philharmonie de Paris.
Un orchestre qui agit comme un seul corps vivant, qui rugit, murmure, éclate, explose, chante, court à l’abime puis se régénère.
On ne se trouve plus dans la même dimension, ce n’est plus une belle interprétation, c’est une offrande, un moment sublime.
Le chef de 76 ans fait peu de gestes, mais à la moindre de ses sollicitations l’orchestre répond immédiatement.
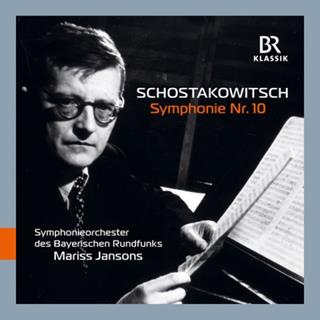 Nul ne saurait, quand il assiste à un tel échange, douter de ce qu’un chef apporte à son orchestre. Il est vrai que Jansons est le directeur musical de l’orchestre de la radio de Bavière depuis 16 ans.
Nul ne saurait, quand il assiste à un tel échange, douter de ce qu’un chef apporte à son orchestre. Il est vrai que Jansons est le directeur musical de l’orchestre de la radio de Bavière depuis 16 ans.
Mais on est souvent malhabile de parler de musique et d’interprétation.
Il vaut mieux écouter.
Or il est possible d’acheter un enregistrement de cette œuvre avec ce chef et cet orchestre.
Il est plus facile de parler d’un livre, parce qu’on peut le citer, plus facilement le décrire.
Or, avant ce concert que Florence a vécu aussi, elle m’a offert un livre de beauté, de quête, de vie et de patience : « La Panthère des neiges » de Sylvain Tesson.
Ce livre vient d’ailleurs d’être couronné du Prix Renaudot.
Oui c’est un livre de grâce, grâce de l’affut, de l’attente.
Sylvain Tesson s’était lié d’amitié avec un photographe, un artiste de la photographie animalière : Vincent Munier.
Le livre commence d’abord dans une forêt française dans laquelle Vincent Munier a entraîné Sylvain Tesson pour observer des blaireaux.
Et à la fin de cette journée Vincent Munier invita Sylvain Tesson par ces mots :
« — Il y a une bête au Tibet que je poursuis depuis six ans, dit Munier. Elle vit sur les plateaux. Il faut de longues approches pour l’apercevoir. J’y retourne cet hiver, je t’emmène.
— Qui est-ce ?
— La panthère des neiges, dit-il.
— Je pensais qu’elle avait disparu, dis-je.
— C’est ce qu’elle fait croire. »
 Si vous voulez une présentation de cet animal qui vit dans des contrées sauvages, les dernières que l’homme a encore laissées à la vie sauvage :
Si vous voulez une présentation de cet animal qui vit dans des contrées sauvages, les dernières que l’homme a encore laissées à la vie sauvage :
https://www.wwf.fr/especes-prioritaires/panthere-des-neiges
Il y a aussi cette <vidéo> de National Geographic :
Et c’est ainsi que Sylvain Tesson, habitué à bouger et à s’agiter, a appris à rester des heures à l’affût, dans le froid des plateaux du Tibet.
« L’affût était une prière. En regardant l’animal, on faisait comme les mystiques : on saluait le souvenir primal. L’art aussi servait à cela : recoller les débris de l’absolu. » (page 57)
Il y a de tout dans ce livre, la beauté, la philosophie, le silence, l’essentiel quand le superflu a disparu.
Il écrit :
« Les panthères des neiges étaient braconnées partout. Raison de plus pour faire le voyage. On se porterait au chevet d’un être blessé. […]
La bête mariait la puissance et la grâce. Les reflets électrisaient son pelage, ses pattes s’élargissaient en soucoupes, la queue surdimensionnée servait de balancier. Elle s’était adaptée pour peupler des endroits invivables et grimper les falaises.
C’était l’esprit de la montagne descendu en visite sur la Terre, une vieille occupante que la rage humaine avait fait refluer dans les périphéries » (Page 24)
Et avant la rencontre, le verbe de Sylvain Tesson, poussé par la connaissance de la nature de Vincent Munier, admire le blaireau, s’émerveille devant le loup, s’émeut devant le yack.
Il s’énerve que tant de beaux esprits veulent enfermer le monde dans les nombres et philosophe en citant Eugène Labiche :
« La statistique, madame, est une science moderne et positive. Elle met en lumière les faits les plus obscurs. Ainsi dernièrement, grâce à des recherches laborieuses, nous sommes arrivés à connaître le nombre exact des veuves qui ont passé le Pont-Neuf pendant le cours de l’année 1860 »
Puis rapporte les propos de Munier :
« Un yack est un seigneur, je me fiche qu’il ait dégluti douze fois ce matin ! » (page 41)
Il partage aussi sa découverte que l’homme dans la nature est observé par les bêtes :
« J’ai été regardé et je n’en savais rien. » (page 48)
Quand il se trouve, la nuit, dans la cabane qui constitue leur abri sur le plateau himalayen, il médite sur les proies et les prédateurs :
« Je pensais aux bêtes. Elles se préparaient aux heures de sang et de gel. Dehors, la nuit du chasseur commençait. […] Chacun cherchait sa proie. Les loups, les lynx, les martres allaient lancer les attaques, et la fête barbare durerait jusqu’à l’aube. Le soleil mettrait terme à l’orgie. Les carnassiers chanceux se reposeraient alors, ventre plein, jouissant dans la lumière du résultat de la nuit. Les herbivores reprendraient leurs errances pour arracher quelques touffes à convertir en énergie de fuite. Ils étaient sommés par la nécessité de se tenir tête baissée vers le sol, rasant la pitance, cou ployé sous le fardeau du déterminisme, cortex écrasé contre l’os frontal, incapables d’échapper au programme qui les vouait au sacrifice. » (page 52)
Finalement il va rencontrer la bête étrange, rare et mystérieuse. Il y aura plusieurs apparitions :
La première est décrite par ce moment de grâce :
« Munier la repéra, à cent cinquante mètres de nous, plein sud. […] mais je mis un long moment à la détecter, c’est-à-dire à comprendre ce que je regardais. Cette bête était pourtant quelque chose de simple, de vivant, de massif mais c’était une forme inconnue à moi-même. Or la conscience met du temps à accepter ce qu’elle ne connaît pas. L’œil reçoit l’image de pleine face mais l’esprit refuse d’en convenir.
Elle reposait, couchée au pied d’un ressaut de rochers déjà sombres, dissimulée dans les buissons. Le ruisseau de la gorge serpentait cent mètres plus bas. On serait passé à un pas sans la voir. Ce fut une apparition religieuse. Aujourd’hui, le souvenir de cette vision revêt en moi un caractère sacré » (page 106)
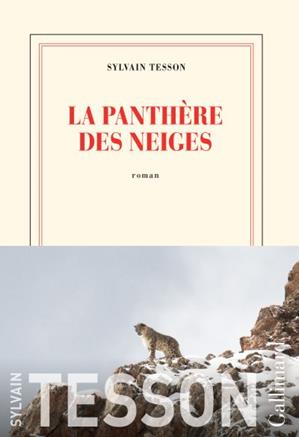 Dans <une présentation> que Gallimard fait de ce livre en s’entretenant avec Sylvain Tesson ce dernier déclare :
Dans <une présentation> que Gallimard fait de ce livre en s’entretenant avec Sylvain Tesson ce dernier déclare :
« On la connaît peu et mal. Il n’en resterait que cinq mille spécimens dans des zones inaccessibles, du Pamir à l’Himalaya oriental et de l’Altaï au Népal. C’est un animal adapté à la très haute altitude : on a repéré ses traces à 6 000 mètres. Mais l’une des principales raisons pour laquelle elle est peu connue est qu’elle est très difficile à voir : elle possède des capacités de camouflage telles qu’on peut passer à dix mètres d’elle sans la voir. Comme elle est lourde, massive, et s’attaque à des proies très agiles, elle compense sa relative lenteur par ce camouflage qui lui procure l’effet de surprise et de fulgurance indispensable pour chasser. […]
Probablement. Parmi les deux raisons qui m’ont poussé à suivre Vincent Munier, il y a cette recherche de la part animale de soi, dont on s’est beaucoup éloigné. Cet éloignement constitue d’ailleurs notre propre vie, il s’appelle la culture, le langage.
Renouer avec cette part animale, tenter de comprendre à nouveau la nature dans laquelle on se place, était donc la première raison. La deuxième, c’est que Munier me proposait de me comporter dans la nature comme je ne l’avais jamais fait, en pratiquant l’art de l’affût : l’attente, la dissimulation, l’immobilité, le silence. Un art de l’intégration, de la dissolution, quasiment, dans le substrat. Moi qui suis dans l’agitation permanente, je n’avais jamais éprouvé ce genre d’usage du monde. […]
Ce qui m’a beaucoup intéressé, c’est la capacité d’abnégation absolue face aux souffrances qu’on endure à l’affût. Ce qui ramène à l’idée que l’objectif mental que l’on s’assigne — le nôtre était de voir apparaître l’animal —permet d’oublier tout le reste. […] Je suis là pour l’apparition, et je pense que j’ai éprouvé très rapidement, en attendant la panthère, un sentiment qui relevait du sacré. Ce n’est ni de la pensée magique, ni du chamanisme de bistro, c’est simplement que j’étais très peu habitué à vivre dans les tensions de l’attente et de la patience. J’ai découvert les vertus de la patience, j’ai réalisé qu’entre l’espérance que quelque chose arrive et le moment où cela arrive, il y a un intervalle qui se remplit de pensées insoupçonnées, qui ne viennent jamais lorsqu’on n’attend pas.
L’affût est antimoderne dans la mesure où il nous ramène à tout ce à quoi nos vies modernes, hyperactives, désordonnées, chaotiques, vouées à l’immédiateté, nous arrachent. Il nous oblige à considérer l’hypothèse qu’on peut consacrer beaucoup de temps à attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. À l’affût, nous sortons de l’immédiat pour revenir à la possibilité de l’échec même. »
Sylvain Tesson et Vincent Munier étaient les invités de France Inter du <10 octobre 2019>.
Tout seul l’écrivain fut aussi l’hôte de la Grande Table du 25 octobre <Sylvain Tesson : Le face-à-face avec l’animal, c’est la véritable expérience de l’Altérité>
Un livre qui change notre perception du monde, de l’animal et de la nature.
<1301>
-
Jeudi 31 octobre 2019
« Le crépuscule [de l’utopie] du Rojava »Eric Biegala journaliste à la rédaction internationale de Radio FranceBien sûr, il y aurait encore tant de choses à écrire sur le peuple Kurde et la lutte qu’il mène pour obtenir sinon un Etat ou au moins une autonomie plus grande.
Parler par exemple du <Kurdistan irakien> qui est une entité politique autonome du nord de l’Irak, reconnue par la constitution irakienne, adoptée le 15 octobre 2005 par un référendum populaire. Cette région autonome qui est l’endroit du monde où les kurdes disposent de la plus grande latitude pour se gouverner. Il ne s’agit pas encore d’un État mais on s’en approche. Les Kurdes d’Irak ont su profiter des erreurs de Saddam Hussein et des guerres que les États-Unis ont mené contre ce dictateur pour obtenir cette situation enviable par rapport aux autres kurdes des trois autres pays.
Selon Wikipédia la répartition des kurdes entre les quatre États serait la suivante :
- Turquie de 12 à 15 000 000
- Iran de 6 à 9 200 000
- Irak de 5 à 7 000 000
- Syrie environ 2 800 000
On constate donc que la Syrie est celui des quatre qui possède la communauté kurde nettement la moins importante. L’Allemagne compterait 1 000 000 de kurdes sur son sol et la France 150 000.
Il serait aussi possible de parler de l’éphémère État du Kurdistan iranien proclamé en janvier 1946 : <La République de Mahabad>. En réalité c’était plutôt une région autonome qui s’appuyait sur le soutien de l’armée soviétique qui occupait le nord de la Perse. Mais dès que les troupes soviétiques se sont retirées, l’armée iranienne a repris le contrôle de la région et les chefs de la République ont été pendus. Sauf l’un d’entre eux qui s’est enfui en URSS : Moustapha Barzani.
C’est son fils Massoud Barzani qui est né en août 1946 durant les derniers mois d’existence de la République, qui est l’actuel président du Gouvernement Régional du Kurdistan (KRG) en Irak
La République de Mahabad n’aura duré qu’une petite année mais elle demeure dans l’imaginaire kurde la première entité politique indépendante, le premier Kurdistan.
Mais je souhaite arrêter cette série sur les kurdes en revenant sur l’organisation et les règles que le PYD : le Partiya Yekita Demokrat et les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) que j’avais évoqué lors du mot du jour précédent avaient commencé à mettre en œuvre dans le nord-est de la Syrie après que les troupes de Damas se soient retirés. Cette région de la Syrie appelée le « Rojava » ou « Rojavayê Kurdistanê »
Pour ce faire j’ai regardé cette très intéressante émission : <ARTE : Le Rojava l’utopie des Kurdes>
L’article d’Eric Biegala sur le site de France Culture, déjà cité hier, donne aussi des informations très intéressantes : <Kurdes de Syrie le crépuscule du Rojava.>
Il situe son analyse après la violente intervention turque.
De même que cet article plus court de la Croix En Syrie les Kurdes voient sombrer leur projet Rojava>
 Quand on voit l’émission d’Arte, ce qui frappe d’abord c’est la présence féminine très importante à la fois dans les unités combattantes et aussi dans les organes dirigeants mis en place. Cette présence est vraiment remarquable dans une partie du monde qui réserve encore aux femmes un rôle limité aux tâches domestiques et un état de soumission à l’ordre mâle. Ces femmes, en outre, portent rarement le voile alors qu’en Turquie depuis la prise de pouvoir d’Erdogan, le voile fait un retour en force, en pleine régression par rapport à l’État d’Atatürk.
Quand on voit l’émission d’Arte, ce qui frappe d’abord c’est la présence féminine très importante à la fois dans les unités combattantes et aussi dans les organes dirigeants mis en place. Cette présence est vraiment remarquable dans une partie du monde qui réserve encore aux femmes un rôle limité aux tâches domestiques et un état de soumission à l’ordre mâle. Ces femmes, en outre, portent rarement le voile alors qu’en Turquie depuis la prise de pouvoir d’Erdogan, le voile fait un retour en force, en pleine régression par rapport à l’État d’Atatürk.
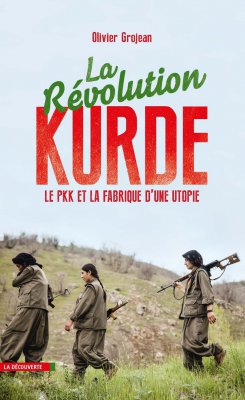
Ils ont mis aussi en pratique une sorte d’utopie sociale dont une partie a été inspirée par les réflexions d’Abdullah Öcalan, le chef emprisonné du PKK : Il s’agit d’une organisation sociale et sociétale en « communes », communautés réduites d’individus s’administrant eux-mêmes et promouvant «le développement de coopératives autogérées au sein des municipalités», le tout pour « mettre en place un modèle économique diamétralement opposé au productivisme et au capitalisme mondialisé », résume le politologue Olivier Grojean dans son dernier ouvrage consacré au PKK.
Et l’article d’Eric Biegala précise que
« La dimension anticapitaliste, issue du marxisme, demeure fondamentale mais elle est associée à un rejet des structures d’un État comme de celles d’une Nation. Il ne s’agit donc pas de constituer en Syrie un Kurdistan autogéré sur le modèle de l’Etat-Nation. D’ailleurs, les références ethniques kurdes disparaissent peu à peu du Rojava. Celui-ci est rebaptisé Fédération Démocratique de la Syrie du Nord, laquelle se dote d’une Constitution en décembre 2016. Fin 2017, les représentants de plus de 3 000 « communes » y sont élus. »
Les analystes ont donné pour nom à cette organisation le « communalisme démocratique »
Les deux autres principes fondamentaux sur lesquels repose cette organisation sont l’écologie et ce qui m’a frappé lors de l’émission d’Arte « l’égalité stricte des sexes ».
Chaque président de commune, chaque cadre administratif ou politique y est doublé d’un co-président ou d’un alter-ego du sexe opposé. A côté des YPG, un contingent de femmes combattantes (YPJ) participe à toutes les batailles contre l’organisation Etat Islamique.
Rien que cet aspect me rend sympathique les Kurdes du Rojava.

Bien sûr tout n’était pas parfait dans cette organisation.
Eric Biegala rapporte :
« Ce n’est pas une démocratie parfaite, concède encore Nadim Houry ; l’opposition politique, quand elle existe, est mal tolérée ; la justice est rudimentaire… Il n’en reste pas moins que l’administration fonctionne effectivement et que le Rojava a réussi à maintenir sur son territoire une vraie forme de sécurité ; ce sont les cantons de Syrie où le taux de criminalité est le plus bas du pays. »
En résumé, le niveau de liberté et de sécurité dans le Rojava est sans commune mesure avec ce que l’on peut trouver ailleurs en Syrie, qu’il s’agisse des territoires tenus par le régime ou la rébellion, sans parler bien sûr des djihadistes. Le « Communalisme » de cette Fédération Démocratique de la Syrie du Nord soutient sans doute aussi la comparaison avec le niveau de liberté garanti par quelques-uns des États de la région : l’Iran, l’Irak et même peut-être avec une démocratie formelle comme la Turquie, surtout depuis que le régime de cette dernière dérive vers l’autoritarisme d’un seul homme. Ce n’est d’ailleurs pas tout à fait un hasard si cette dérive est concomitante de l’avènement du Rojava en Syrie. »
Le journal « La Croix » rapporte les propos de Président de l’association Espoir Afrin, Hassan Hamdoche :
« Nous avions trouvé une espérance, un lieu dans lequel le peuple kurde pouvait se gérer, construire un début de démocratie laïque et égalitaire qui tranchait avec l’obscurantisme de la région […] Tout n’était pas parfait, mais nous étions sur la bonne voie. »
Toutefois certains analystes considèrent qu’il y avait une partie d’affichage dans cette présentation : « Ses représentants à l’étranger connaissent tous les mots-clés – démocratie locale, égalité, écologie, etc – pour obtenir des financements de l’Union européenne ».
Certaines parties de la société syrienne du nord et certains villages de la région restent très réticents par rapport au rôle que les femmes jouent dans ce communalisme.
Pourtant ; ce qui avait été mis en place dans cette région constituait une immense modernité par rapport à l’archaïsme qui règne dans la plupart des pays musulmans du moyen-orient.
Il faut en parler au passé puisque les hordes barbares turques sont en train de mettre à bas cette organisation.
Mais l’Histoire n’est pas encore écrite, rien ne dit que les plans d’Erdogan se réaliseront selon ses souhaits.
En tout cas il faut regarder l’émission d’Arte <ARTE : Le Rojava l’utopie des Kurdes>.
On trouve d’autres vidéos sur le rôle des femmes dans le Rojava. Par exemple cet autre reportage d’Arte : <Syrie : Rojava, la révolution par les femmes>.
<1300>
- Turquie de 12 à 15 000 000
-
Mercredi 30 octobre 2019
« Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples. »Charles de Gaulle, Mémoire de guerreBien sûr, on peut parler des Kurdes, des turcs et des russes avec uniquement émotion et une vision binaire des luttes. Dire qui représente le bien et qui est le mal absolu.
Evidemment les milices qui ont sauvagement assassiné Havrin Khalaf ne peuvent pas apparaître autrement que le mal absolu.
Mais pour le reste, c’est beaucoup plus compliqué…
Comme souvent…
Bien sûr, on peut aspirer à ce souhait que le Général de Gaulle a écrit dans ses Mémoires de guerre : « Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples. ».
Pourquoi pas, encore ne faut-il pas que cela devienne des idées simplistes !
Les empires comme l’empire ottoman, l’empire austro-hongrois, l’empire russe et aussi l’empire chinois sont composés de plusieurs peuples, avec toujours un peuple dominant : les turcs pour le premier, les allemand pour le deuxième, les russes pour le troisième, les hans pour le quatrième.
Dans un empire il est admis et nécessaire que l’empereur ou celui qui dirige l’empire soit en mesure, tout en préservant la domination de son clan, de faire en sorte que ces peuples puissent vivre ensemble.
Mais les européens et particulièrement la France ont fait émerger l’idée de l’État-nation. Une nation qui se réunit et qui fonde une structure juridique internationale qui est l’État.
Un État-nation a beaucoup de mal à accepter une division en son sein. Parce qu’étant donné son essence : « c’est une nation qui fonde un état » dès qu’un peuple veut revendiquer sa singularité en son sein, il va très naturellement aspirer à devenir lui-même un Etat nation. Ce qui est évidemment insupportable pour l’Etat nation qui l’entoure, puisque si ce processus va à son terme il sera amputé à la fois d’un grand nombre de citoyens et d’une partie de son territoire.
L’empire austro-hongrois a connu ce processus à un degré tel que son cœur, l’Autriche, est devenu un tout petit pays, sans aucune commune mesure avec l’Empire qui l’a précédé.
Les parties de l’empire qui ont tenté de créer des nouvelles nations : yougoslaves, tchécoslovaques ont connu aussi, dès que les régimes autoritaires ont été balayés, de nouvelles scissions pour créer de nouveaux Etats-nations.
Lors de guerres terribles pour la Yougoslavie, parce qu’il y avait un peuple dominant : les serbes et un autre qui l’était en second : les croates. Mais les peuples qui ont le plus soufferts étaient les peuples dominés des bosniaques et des kosovars.
La séparation s’est faite de manière beaucoup plus apaisée entre les tchèques et les slovaques, parce que chacun allait de son côté et que personne ne pensait être amputée d’une partie de son État.
L’ordre mondial, une fois que les frontières ont été dessinées, n’aime pas beaucoup qu’on les remette en cause, car cela crée des tensions, des violences et de l’instabilité.
Peu d’États se sont levés pour défendre la tentative de sécession du Biafra au Nigeria, que l’ethnie Igbos a tenté de réaliser. Et quand cela fonctionne comme au Soudan, où le Sud Soudan a pu devenir indépendant du Nord Soudan. Une fois que les sud soudanais se sont retrouvés entre eux et qu’ils n’avaient plus d’ennemi commun, ils se sont battus entre eux dans une guerre civile d’une telle violence et barbarie, de nature à décourager tout géopoliticien de soutenir la création d’un état-nation par scission d’un État préexistant.
C’est pourquoi, une fois que les kurdes n’ont pas pu ou su saisir leur chance en 1920, c’est devenu extrêmement compliqué. Et rien ne dit que si par un hasard de l’Histoire, il puisse exister un jour un État des Kurdes, celui-ci ne serait pas la proie de querelles internes, comme le Sud-Soudan. Tant il est vrai qu’une fois l’ennemi commun disparu, le lien qui unit ceux qui l’ont combattu peut se révéler fragile et mettre en évidence des antagonismes d’une violence inouïe.
Contrairement à l’Autriche, la Turquie a su conserver par les armes une grande partie de son territoire, cœur de l’empire ottoman.
Et l’état nation ne supporte pas qu’une fraction d’entre elle puisse vouloir entrer en résistance.
Mustafa Kemal a d’abord chassé les chrétiens de son pays, après le génocide il a découragé par tous les moyens les arméniens de revenir sur leurs terres, de même que pour les autres minorités chrétiennes qui existaient dans l’Empire.
Pour les kurdes musulmans, ils devaient rester mais en devenant turc.
Et il y a nombre de kurdes qui ont accepté, mais il en est d’autres qui ont créé le PKK qui a pris les armes pour lutter contre l’Etat Turc.
Et pour le reste je vais vous renvoyer vers un article sur le site de <France Culture> qui explique d’abord que si la Syrie a pratiqué de la même manière que la Turquie à l’égard de ses Kurdes, en réprimant toute velléité d’autonomie voire seulement de liberté d’usage de la langue :
« [La Syrie a] en revanche soutenu, financé, armé et entraîné les rebelles kurdes de Turquie, ceux du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) depuis 1981 et jusqu’en 1998. C’est en effet à partir du territoire syrien que les militants armés du PKK lancent leurs premières attaques en Turquie en 1984. Jusqu’à l’automne 1998, le leader du PKK lui-même, Abdullah Öcalan, a sa résidence permanente à Damas. Quant à ses cadres, on les rencontre régulièrement dans les quelques grands hôtels de la capitale syrienne où ils ont pris pension, très vraisemblablement aux frais du régime. »
La Syrie et la Turquie ne sont pas des alliés, pour formuler leur situation respective par une litote.
Et c’est alors que d’une part l’invasion américaine de l’Irak a déstabilisé la région et conduit à la création Daesh et d’autre part le printemps arabe a touché le régime autoritaire et sanguinaire de Bachar Al Assad.
Dans cette situation très compliquée pour lui, son régime ne tenait alors, avant l’intervention de la Russie, qu’à un fil fragile, Bachar al-Assad a pris une initiative pour concentrer ses forces autour de Damas :
« à la mi-2012, les troupes de Bachar al-Assad décident d’évacuer la quasi-totalité des provinces nord et nord-est de Syrie, laissant toute la zone aux Kurdes, le régime fait le pari que ces derniers préserveront la région des avancées de la rébellion. C’est un pari risqué : si les Kurdes de Syrie ne revendiquent pas une indépendance stricto sensu, ils entendent tout de même administrer leur territoire de façon autonome et suivant les principes d’une idéologie bien précise : celle du PKK, ancien « compagnon de route » du régime syrien.
[…]Or le parti kurde le plus important dans le nord-syrien en 2012, celui à qui le régime laisse les clefs de la région, est le PYD : le Partiya Yekita Demokrat, ou Parti de l’Union Démocratique. Parti kurde syrien mais surtout « parti-frère » du PKK, construit dans le pays par des cadres du PKK sur le même modèle, avec la même idéologie. Comme le PKK, le PYD est aussi flanqué d’une branche armée, sa milice : les Unités de Protection du Peuple ou Yekîneyên Parastina Gel (YPG). Depuis les premières manifestations de défiance envers le régime syrien, vite transformées en rébellion armée, ces miliciens de l’YPG se sont davantage retrouvés du côté de la répression des manifestations que de leur organisation, n’hésitant pas à détruire complètement quelque centre communautaire, ou le QG d’une formation politique d’opposition au régime.
Quand celui-ci évacue quasi complètement le nord et le nord-est du pays, le PYD et les YPG investissent les centres du pouvoir administratif ou économique et contrôlent le terrain sur trois régions, correspondant approximativement aux zones où la population est majoritairement kurde ».
Vous avez donc bien lu que l’YPG s’est davantage retrouvé du côté de la répression des manifestations que de leur organisation. Cela correspond certainement à de la real politique. Le PYD souhaitait préserver un minimum de relations convenables avec Al-Assad . L’avenir lui a donné raison puisque, même si cela est délicat, il a pu demander l’aide du maître de Damas, pour faire contrepoids à l’invasion turque actuelle.
Par la suite quand Daesh a attaqué les terres kurdes l’YPG s’est défendu, très bien défendu et a aidé les armées occidentales qui en réciproque ont fait de même.
Et ils ont ainsi créé le « Rojava » ou « Rojavayê Kurdistanê » en langue kurde, c’est-à-dire Kurdistan occidental.
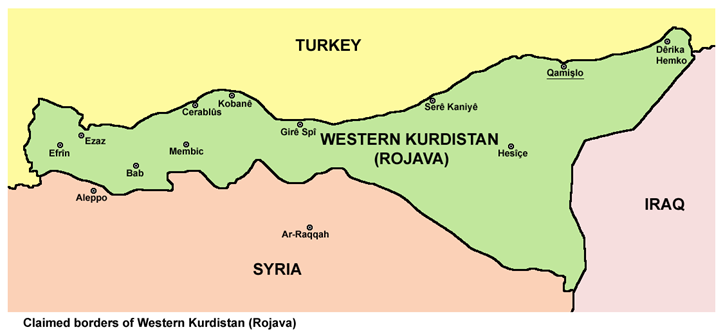
Et :
« Lorsque le PYD et ses YPG se retrouvent maître des trois cantons du Rojava, à l’été 2012 et surtout à partir de mars 2013, les transferts de combattants et surtout de cadres du PKK en provenance de Turquie ou du nord Irakien (où le groupe armé dispose de bases arrières) vont se poursuivre, voire se multiplier. En Turquie, en effet, l’heure est à la détente, voire à la paix. Le chef du PKK Abdullah Öcalan, embastillé dans l’île-prison d’Imrali au sud d’Istanbul depuis 1999, et le pouvoir de Recep Tayyip Erdoğan ont entamé des discussions baptisées « processus de résolution ». A l’été 2013, le leader du PYD, Saleh Muslim est même officiellement invité à Istanbul par le ministre des Affaires étrangères turc pour y participer. Ces pourparlers prévoient un arrêt de la lutte armée en Turquie et un retrait des combattants du PKK hors du territoire turc. Ceux-ci se replient en effet, en nombre, sur le nord-irakien et surtout dans le Rojava syrien… Résultat de quoi, une bonne partie des combattants des YPG en Syrie, notamment ceux qui affronteront les djihadistes de l’organisation Etat Islamique à partir de l’été 2014, semblent être arrivés de Turquie. C’est en tout cas ce qu’indique la recension de leurs « morts au combat ». Les YPG en effet indiquent systématiquement le lieu de naissance de leurs combattants dans les avis de décès et selon un décompte de l’Atlantic Council, entre janvier 2013 et janvier 2016, 49 % des « morts au combat » des YPG en Syrie étaient nés en Turquie, contre 44% nés en Syrie. Autrement dit, près de la moitié des combattants YPG disparus lors d’affrontements étaient probablement des citoyens turcs. »
Je n’ai aucune espèce de début de sympathie pour Erdogan
Mais lorsqu’il affirme que les kurdes de Syrie sont alliées au PKK kurde et que des kurdes de Turquie se réfugient en Syrie pour combattre son État, il est probable qu’il ait raison.
Pour donner le change, les forces kurdes vont créer une nouvelle organisation les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) :
« Durant l’année 2015 et les suivantes, sur le théâtre syrien, le partenariat militaire kurdo-américain va toutefois se poursuivre et s’accélérer. En quelques mois, les forces des YPG, appuyés par l’aviation occidentale, attaquent et réduisent les positions de l’organisation Etat Islamique qui lui sont le plus accessibles ; d’abord à Tal Abyad, entre les cantons de Kobanî et d’Al Hasakah. Avec la conquête de Tal Abyad, les YPG contrôlent dorénavant une bonne partie de la frontière turco-syrienne et poussent également vers l’Ouest, récupérant d’autres zones non majoritairement kurdes. Ankara s’en inquiète de plus en plus ouvertement. D’autant qu’au printemps 2015, cette même Turquie, pour des motifs de politique intérieure, a relancé sa guerre contre le PKK.
Pour présenter un visage moins évidemment kurde le long de cette frontière turque, les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) sont officiellement fondées en octobre 2015. Elles regroupent des brigades syriennes arabes, des forces tribales et des Chrétiens autour des YPG qui en demeure pourtant le contingent le plus important et le fer de lance. En 2015-2016, ces FDS sont les seules forces qui affrontent les djihadistes de l’organisation Etat Islamique en Syrie. Elles grignotent son territoire, reprenant Aïn Issa, au sud de Kobanî, fin 2015, puis Mambij, à l’Ouest de l’Euphrate, à l’été 2016. En plus des avions de la coalition internationale qui les appuient, les combattants des FDS sont maintenant épaulés sur le terrain par un contingent de plus en plus important de soldats occidentaux des forces spéciales : jusqu’à 2 000 Américains, environ 200 Français et peut-être autant de Britanniques sont présents à leurs côtés. Raqqa, la « capitale » de l’organisation Etat Islamique en Syrie est conquise en octobre 2017. Dans la foulée, les FDS poursuivent leurs avancées dans la province sud-est de Deir Ez-Zor. Fin 2017, elles contrôlent pratiquement toute la zone à l’est de l’Euphrate ; près d’un tiers du territoire syrien est dorénavant passé sous leur coupe, dont l’essentiel des régions productrices d’hydrocarbures. »
Dans sa logique d’État nation, Erdogan, en dehors de toute moralité défend ses intérêts. Les menaces qu’il dénonce ne sont pas inexistantes.
Ce qui ne m’empêche pas d’avoir plutôt de la sympathie pour le peuple kurde.
Mais les choses ne sont pas simples, c’est ainsi que je commençais ce mot du jour.
<1299>
-
Mardi 29 octobre 2019
« L’éradicateur »Désignation du rôle d’Erdogan en Syrie par le magazine « Le Point »J’ai acheté le « Le Point » de cette semaine qui a pour titre « l’éradicateur » et qui accuse Erdogan de nettoyage ethnique.
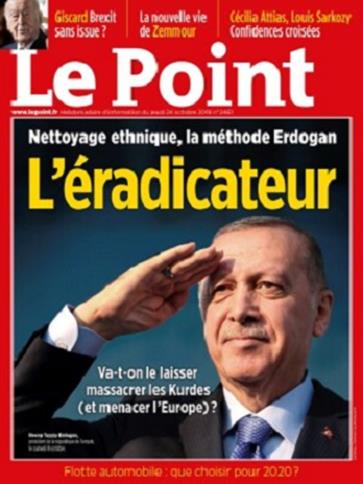 Et le président turc attaque le magazine en justice.
Et le président turc attaque le magazine en justice.
Suite à cette « une », l’avocat de M. Erdogan, Hüseyin Aydin, a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général d’Ankara pour « insulte au chef de l’État ». Cette plainte vise le directeur du magazine Etienne Gernelle ainsi que le rédacteur en chef de la rubrique « International », Romain Gubert.
Etienne Gernelle a répondu par un édito publié sur le site du magazine :
« Recep Tayyip Erdogan a décidément un problème avec la liberté. Son avocat a déposé aujourd’hui une plainte contre Le Point, auprès du bureau du procureur général d’Ankara, pour « insulte au chef de l’État », […]
En cause ? Notre dernier dossier de couverture, intitulé « L’éradicateur », dans lequel nous détaillons son opération de nettoyage ethnique à l’encontre des Kurdes de Syrie. Notre reportage raconte les exactions, les évictions de populations, la crainte de l’anéantissement. Notre enquête explique également comment le pouvoir turc a pactisé avec d’anciens de Daech et Al-Qaïda, qui se chargent pour lui des sales besognes.
Il est logique que cela ne plaise pas à Erdogan. Bien évidemment, nous ne retirons pas un mot de ce que nous avons écrit.
Au contraire : le fait qu’il nous attaque pour « insulte au chef de l’État », sorte de crime de lèse-majesté, tend plutôt à confirmer notre précédente couverture à son propos, dont le titre était « Le dictateur ». À l’époque (c’était en mai 2018), il avait publiquement attaqué notre journal. Dans le même temps, en France, des affiches du Point étaient arrachées par ses partisans, et des kiosquiers étaient menacés. Notre journal aussi avait reçu des menaces de mort directes.
Erdogan a fait emprisonner de nombreux journalistes en Turquie et pense peut-être que ses pulsions de censure peuvent s’exercer aussi dans des pays où la presse est libre. L’hubris du maître d’Ankara connaît visiblement peu de limites. Il sera déçu : nous ne lâcherons rien.
Notre numéro Erdogan, l’éradicateur est disponible en kiosque et dans notre boutique. »
Je pense que dans ce genre de situation, il faut aider les journaux qui font leur travail.
Car il s’agit bien d’une volonté de nettoyage ethnique du Nord de la Syrie, nettoyage des habitants kurdes.
Et Erdogan utilise des milices supplétives pour faire le sale boulot.
Un exemple a été donné par l’assassinat sordide et barbare d’Havrin Khalaf.
Si vous voulez lire des détails vous les trouverez sur le site de TV5 : « Havrin Khalaf : une voix kurde pour les femmes et la paix assassinée »
Je conseille aux âmes sensibles de s’abstenir d’aller lire les détails.
 Havrin Khalaf avait 35 ans. Elle était kurde, ingénieure, à la tête du parti Avenir de la Syrie et engagée auprès des femmes dans le nord de la Syrie. Elle a été exécutée par des mercenaires islamistes en plein chaos provoqué par l’offensive turque.
Havrin Khalaf avait 35 ans. Elle était kurde, ingénieure, à la tête du parti Avenir de la Syrie et engagée auprès des femmes dans le nord de la Syrie. Elle a été exécutée par des mercenaires islamistes en plein chaos provoqué par l’offensive turque.
TV5 la présente ainsi :
« Havrin Khalaf était connue de toutes celles et ceux qui travaillent dans le nord de la Syrie : diplomates, journalistes, politiques… Tout le monde connaissait le visage et la détermination de cette militante pour la conciliation, la négociation, la paix. Coprésidente du parti Avenir de la Syrie et membre de la direction du Conseil démocratique syrien, le bras politique de l’alliance de forces kurdes et arabes alliées de Washington dans la lutte antijihadiste, elle multipliait les initiatives en faveur du pluralisme. Elle prônait le rapprochement pacifique entre Arabes, Kurdes et Turkmènes, musulmans, chrétiens et yézidis, qu’elle voulait réunir dans un même combat, à la fois contre le régime de Bachar El-Assad et l’Etat Islamique.
Havrin Khalaf s’investissait auprès des femmes musulmanes dans le Rojava (Kurdistan occidental), auprès desquelles elle défendait le modèle d’égalité hommes- femmes et de coprésidence auquel elle adhérait – l’autre coprésident d’Avenir de la Syrie était un homme, arabe. Le mois dernier encore, elle assistait à un forum des femmes tribales à Tabqa, où elle disait sa fierté au vu des « progrès accomplis par les femmes dans le nord-est de la Syrie sous le gouvernement kurde ».
Ceux qu’elle dérangeait l’ont facilement identifiée et localisée ce samedi 12 octobre, entre les localités de Qamishli et Minjeb, dans le nord de la Syrie. Elle circulait en voiture avec son chauffeur – lui aussi exécuté – quand elle a été prise dans une embuscade sur la route M4, l’axe international qui relie le nord-est, dominé par les Kurdes, au nord-ouest de la Syrie, contrôlée par la rébellion.
Elle n’a pas été que tuée, elle a été torturée, mutilée, massacrée.
Et le site TV5 d’ajouter :
« L’assassinat d’Havrin Khalaf s’inscrit dans le chaos qui s’est emparé de la Djézireh, la partie nord-est de la Syrie, depuis le lancement de l’offensive turque. Une opération qui a provoqué un déchaînement de violences sans précédent dans la région et qui, selon l’ONU, a poussé 130 000 personnes à fuir la région. Dans la même journée de samedi, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme, huit autres civils ont assassinés par les supplétifs syriens qui participent à l’opération militaire turque ; certaines exécutions ont été filmées.
Ceux que l’on appelle « supplétifs » sont d’anciens combattants islamistes contre le régime syrien qui ont changé de camp, financés par les Turcs pour se battre contre les Kurdes. Pendant que l’armée turque installe sa zone dite de sécurité, ils sont chargés d’éliminer. Selon le quotidien allemand FAZ, entre autres, l’assassinat d’Havrin Khalaf serait le fait du groupe Ahrar al-Cham, composé de rebelles salafistes et apparu au cours de la guerre civile syrienne.»
Les Etats-Unis ont condamné. Un responsable du département d’Etat américain a déclaré :
« Nous trouvons ces informations extrêmement préoccupantes, à l’instar de la déstabilisation générale du nord-est de la Syrie depuis le déclenchement des hostilités… Nous condamnons le plus fermement possible tout mauvais traitement et exécution extrajudiciaire de civils ou de prisonniers, et sommes en train d’étudier de plus près les circonstances de ces événements, »
Bien sûr, ils ne feront rien.
Quant à la France et à l’Europe, ils sont tout simplement impuissants, ils sont sortis de l’Histoire.
Quand le chef d’état-major particulier d’Emmanuel Macron ; l’amiral Rogel a voulu recevoir une responsable politique kurde Ilham Ahmed, les diplomates ont tenté de l’en dissuader en expliquant que cela vaudrait à la France de sérieuses fâcheries avec beaucoup de monde, à commencer par les turcs. Mais l’amiral l’a reçue quand même. Emmanuel Macron est aussi venu par la suite pour saluer les kurdes et discuter avec eux. Mais c’est bien peu.
Il s’agit bien d’un éradicateur qui est au pouvoir en Turquie.
Il fait toujours partie de l’OTAN, comme nous.
D’ailleurs il n’est pas prévu de pouvoir exclure un État de l’OTAN.
<1298>
-
Lundi 28 octobre 2019
« Les kurdes contre les arméniens »Retour sur l’Histoire des kurdes et des arméniensSi je résume ce que j’ai écrit sur les Kurdes dans les mots du jour précédents, le premier élément est que le peuple Kurde, selon un dénombrement qui est assez largement admis, représente 40 millions d’individus et dans ces conditions il s’agit du peuple le plus nombreux qui n’a pas d’État.
En 1920, après le traité de Sèvres, il était prévu qu’il existe un Kurdistan, en Anatolie, sur un territoire qui a été depuis récupéré par la Turquie.
L’Histoire qu’on nous a apprise et qui souvent est encore sous-jacente pour toutes les analyses concernant la situation des kurdes est : Il n’y a pas d’Etat Kurde, parce que Mustafa Kemal a gagné la guerre et que les occidentaux ont lâché les kurdes en acceptant le traité de Lausanne.
L’article, cité vendredi, de l’historien Jordi Tejel « 1920, l’occasion manquée », ne nie pas que ces deux raisons sont importantes, mais il insiste sur une troisième : la désunion des Kurdes.
Désunion qui allait jusqu’à ne pas vouloir d’un Etat Kurde.
Jordi Tejel qui avait été invité, suite à son article, par l’émission de France Culture <La Fabrique de l’Histoire> a précisé qu’une partie des Kurdes considérait les turcs, musulmans comme eux, comme des frères d’arme et trouvaient normal de former un État avec eux.
Mais il y a une autre raison qui était encore plus importante et qui a poussé des tribus kurdes à se battre au côté des turcs et de Mustafa Kemal. Cette raison est si on l’exprime de manière modérée : l’hostilité à l’égard des arméniens, et si on le dit de manière plus abrupte : la haine des arméniens.
J’ai cité un extrait de l’article vendredi qui rapportait que
« Prenant tout le monde de court, le général Chérif Pacha, représentant du KTC, signe en 1919 un accord avec l’Arménien Boghos Noubar Pacha, prévoyant la création d’une Arménie et d’un Kurdistan indépendants. Alors que les délégations arménienne et kurde avaient présenté au préalable des revendications sur la totalité des provinces orientales de la Turquie actuelle, elles acceptent finalement l’une et l’autre un compromis sous la pression des Européens. En particulier, Chérif Pacha espère qu’en consentant des « pertes » territoriales au bénéfice des Arméniens les chancelleries occidentales arménophiles – telle la France – accepteront le principe de la création d’un État kurde. »
Cette initiative n’est pas du tout du goût d’un grand nombre de kurdes, notamment parmi les élites. Du point de vue de ces opposants Chérif Pacha « brade » des territoires « kurdes » au profit des arméniens et surtout il accepte le principe de la création de l’Arménie sur des territoires « musulmans ».
Les Kurdes étaient, comme beaucoup d’autres peuples du moyen orient, organisés en tribus et étaient reconnus comme des guerriers. C’est-à-dire qui savaient se battre.
Il faut se souvenir que le grand <Saladin> celui qui a repris Jérusalem en 1187 aux Francs était kurde.
La relation des tribus Kurdes avec l’Empire Ottoman a parfois été conflictuelle, mais le plus souvent et particulièrement depuis la fin du XIXème siècle, ils constituaient des troupes auxiliaires du Calife. Des supplétifs auxquels on confie les basses besognes.
Et les élites Kurdes ont des craintes après le traité de Sèvres :
« Le traité de Sèvres est perçu comme une menace à d’autres titres. Tout d’abord, dès 1919, divers cadres et fonctionnaires ottomans sont déférés devant des cours martiales, accusés de complicité dans l’exécution du génocide arménien. Et certains chefs kurdes craignent eux aussi d’être jugés pour leur participation active aux massacres. En outre, la formation d’un État arménien supposerait sans aucun doute la rétrocession obligatoire des terres confisquées aux Arméniens en 1895 et en 1915. Beaucoup préfèrent donc combattre le traité de Sèvres et renoncer à un État kurde plutôt que d’admettre la naissance de la Grande Arménie prévue par le traité. »
En effet, des soldats kurdes ont largement participé au génocide arménien et ont même participé à des massacres avant 1915. Ils ont profité de ces massacres pour « voler », le terme officiel est « confisquer » des terres aux arméniens.
Parce que les Kurdes ont été en première ligne pour défendre l’empire ottoman contre la « prétendue » traitrise des « chrétiens arméniens » au profit des chrétiens de l’empire russe. Les historiens ont établi que cette traitrise na pas existé, du moins pas de manière importante au sein du peuple arménien
Jordi Tejel écrit :
« Après la révolution jeune-turque de 1908 qui voit arriver au pouvoir le comité Union et Progrès, quelques notables kurdes fondent le KTTC (« Comité kurde d’entraide et de progrès ») et se dotent d’un organe de presse. Les objectifs de l’association sont modérés : appuyer le mouvement constitutionnel, garantir le progrès et l’instruction des Kurdes d’Istanbul, consolider les bonnes relations avec les autres peuples ottomans et, enfin, faire tous les efforts possibles pour sauver l’Empire ottoman.
D’une manière générale, durant cette période « unioniste » (1908-1918), les intellectuels, notables, chefs tribaux et religieux kurdes d’avant-guerre restent attachés à l’idéal d’une unité ottomane garantie par l’institution du califat*. Cette fidélité portée au cadre ottoman par les autres nationalités de l’empire peut nous étonner aujourd’hui, mais s’explique aisément. Elle tient d’abord à un motif religieux : les Kurdes, musulmans sunnites pour la plupart, appartiennent à la « communauté dominante » (millet-i hakime), au même titre que le sultan-calife, ainsi que la majorité des Turcs et des Arabes et à la différence des chrétiens et des Juifs.
Ces derniers, jusqu’au milieu du XIXe siècle, étaient reconnus comme « gens du Livre » – ayant eu donc la révélation divine. Mais ces groupes « protégés » (dhimmi) étaient aussi assujettis. Tout change avec les réformes administratives et politiques libérales connues sous le nom des Tanzimat (« réorganisation », 1839-1876). Dans la perspective de moderniser l’empire afin d’en assurer la survie, ces réformes introduisent des transformations qui remettent en question les rapports de domination séculiers entre les communautés. D’une part, elles visent, sur le modèle occidental, à affirmer l’égalité des individus devant la loi, sans distinction de langue ni de religion. D’autre part, elles reconnaissent des droits collectifs aux millet non musulmans, s’exprimant en majorité dans une langue particulière – l’arménien, le grec, l’araméen… -, renforçant ainsi leur sentiment d’être des « groupes » à part.
Ces réformes ne sont guère appréciées par les élites musulmanes sunnites dont les Kurdes font partie. Les choses s’aggravent encore avec l’ingérence croissante des puissances européennes à la périphérie de l’empire qui envenime les relations « de proximité » entre les Arméniens et les Kurdes dans l’Anatolie orientale. La « question d’Orient », qui se trouve en partie à l’origine des Tanzimat du XIXe siècle, est, en bordure de l’empire, une « question arméno-kurde », une question agraire : la fin des principautés kurdes a permis à des notables urbains et des chefs tribaux de s’approprier indûment un grand nombre de terres, aux dépens des paysans et petits propriétaires arméniens.
Face aux revendications arméniennes et aux pressions étrangères exprimées lors du congrès de Berlin de 1878, des Kurdes saisissent les occasions qui se présentent pour « résoudre » la question à leur avantage. Durant l’automne 1895, les hamidiye kurdes participent à d’amples massacres anti-arméniens dans les régions arméno-kurdes.
En 1915, à nouveau, alors qu’Istanbul est entré en guerre au côté de l’Allemagne, des leaders kurdes s’allient aux autorités ottomanes, sous la bannière du « panislamisme », pour mener à bien la déportation et le génocide des Arméniens. »
Le dossier de l’Histoire évoqué dans le mot du jour précédent a consacré un article sur la responsabilité des kurdes dans le génocide arménien. Cependant il souligne aussi qu’il y eut des kurdes qui ont des attitudes de solidarité. Il y a toujours des humains qui sauvent leur groupe de l’inhumanité :
« Alors que la plupart des historiens insistaient sur le facteur religieux pour expliquer la participation de tribus et notables kurdes au génocide arménien, les litiges arméno-kurdes touchant à la propriété foncière ont été prépondérants, comme l’a montré Hans-Lukas Kieser. Les massacres de 1895 sont, en ce sens, un premier chapitre précurseur. Cependant, en 1915, le contexte est différent. L’Empire ottoman, entré en guerre au côté de l’Allemagne, est défait par l’armée russe à Sarikamis, ce qui entraîne dans les provinces orientales famine, épidémies, et la mort de milliers de soldats kurdes. La propagande du régime unioniste impute ce désastre à la traîtrise arménienne.
Hans-Lukas Kieser a mis en évidence la participation de Kurdes aux exactions, dans les villes – Diyarbakir, Van, Kharpout – comme dans les campagnes. Seule exception significative : au Dersim, des tribus alévies protègent les Arméniens dans cette première phase du génocide. Il est encore malaisé cependant d’évaluer jusqu’à quel point les Kurdes, dans leur ensemble, ont pris part aux massacres organisés par le pouvoir ottoman. Les récits arméniens ne laissent néanmoins pas de doute sur la complicité de bon nombre d’entre eux dans les massacres directs, les exactions commises sur les caravanes de déportés arméniens ou encore l’islamisation forcée de milliers de fillettes arméniennes.
Dans le même temps, les témoignages de rescapés arméniens et le travail sur l’histoire locale mettent en lumière maints exemples de solidarité kurde avec des Arméniens. Enfin, intellectuels et politiciens kurdes ont réalisé des avancées importantes dans la reconnaissance des responsabilités kurdes dans ce chapitre inouï de l’histoire du XXe siècle. »
Des kurdes ont donc largement contribué au génocide arménien, mais il en est qui ont su sauver l’honneur de leur peuple.
Il semble qu’aujourd’hui <des kurdes reconnaissent leur responsabilité> dans cette terrible fracture de l’humanité.
<1297>
-
Vendredi 25 octobre 2019
« 1920, l’occasion manquée par les Kurdes »Jordi Tejel, dans la revue « l’Histoire »Les kurdes sont un peuple sans État. On estime à 40 millions la population mondiale qui peut se revendiquer de ce peuple.
Les azéris qui comme les kurdes ont une langue d’origine iranienne, une culture spécifique, appartiennent au monde musulman et représentent une population mondiale d’environ 40 millions de personnes, ont un État : « l’Azerbaïdjan. » Il est à noter que moins de 9 millions d’Azéris habitent cet État alors que l’Iran compte 15 millions d’azéris.
On estime le nombre de juifs dans le monde à 15 millions, eux aussi ont un État : « Israël ».
On estime le nombre de palestiniens à 12 millions, eux n’ont pas d’État, mais en revendique également un.
Les arméniens ont aussi dans la douleur et pas sur une grande partie de leur territoire historique, obtenu un État : « L’Arménie ». On estime la population arménienne mondiale à environ 10 millions. Les kurdes et les arméniens occupaient d’ailleurs des régions communes dans l’Empire Ottoman et leurs relations furent compliquées.
Cette introduction est certes quantophrénique. Elle me semble cependant montrer, à l’évidence que le fait que les Kurdes ne disposent pas d’un État est anormal.
Dans la série consacrée à la guerre 14-18, le mot du jour du 20 novembre 2018 : « Du traité de Sèvres en 1920 au Traité de Lausanne en 1923» avait déjà abordé ce sujet.
Les arméniens, les kurdes étaient des peuples de l’Empire ottoman. Et l’Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine, le futur territoire d’Israël étaient des régions de ce même empire.
L’empire ottoman, lors de la guerre 14-18, était dans le mauvais camp, celui des vaincus.
La défaite de l’empire ottoman est acquise par l’armistice de Moudros qui sera signée le 30 octobre 1918.
Mais l’armistice n’est pas la paix. La paix aurait dû être la conséquence du traité de Sèvres, conclu le 10 août 1920 et qui sera signé par le sultan Mehmed VI.
Mais ce traité qui établissait un État arménien en Anatolie et un État kurde, n’a jamais été ratifié ni appliqué.
Le sultan Mehmed VI règne à Constantinople, mais à Ankara, un général Mustafa Kemal a pris la tête d’un gouvernement émanant d’une Grande assemblée nationale de Turquie créée le 23 avril 1920. Et Mustafa Kemal ne reconnait pas la validité de ce traité qui menace l’intégrité territoriale notamment de l’Anatolie qui est, dans sa conception, le cœur de la Turquie
Mustafal Kemal avec ses partisans va faire chuter le sultan et reprendre le combat notamment contre les grecs. Les Turcs se soulèvent en masse, s’enrôlent dans l’armée kémaliste et déclenchent la Guerre d’indépendance turque en mai 1919. Au bout de quatre années de conflit, les kémalistes sont victorieux et obtiennent la négociation d’un nouveau traité.
Ce traité sera le traité de Lausanne (24 juillet 1923).
Une carte publiée par la revue « L’Histoire » montre le projet du Traité de Sèvres et la réalité du Traité de Lausanne.
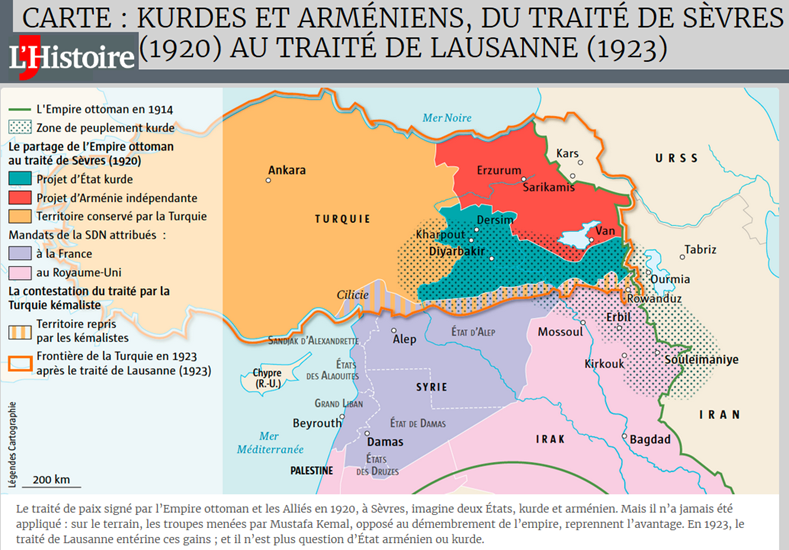 C’est par les armes et la guerre que Mustafa Kemal a privé les Kurdes de l’État qui aurait dû être le leur.
C’est par les armes et la guerre que Mustafa Kemal a privé les Kurdes de l’État qui aurait dû être le leur.
Mais la réalité est plus complexe, il n’y avait pas tous les kurdes d’un côté et les turcs de l’autre.
La revue l’Histoire avait consacré un dossier à ce sujet dans son numéro de novembre 2016 : <Les Kurdes : Mille ans d’un peuple sans État>
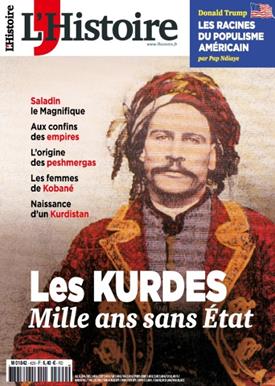 Et l’historien Jordi Tejel a écrit un article concernant précisément ce moment entre Traité de Sèvres et Traité de Lausanne : « 1920, l’occasion manquée »
Et l’historien Jordi Tejel a écrit un article concernant précisément ce moment entre Traité de Sèvres et Traité de Lausanne : « 1920, l’occasion manquée »
Les kurdes trouvent commode d’accuser les européens de les avoir privés d’un Etat, c’est partiellement vrai mais les kurdes ont joué eux-mêmes une partition trouble.
« Si les élites nationalistes kurdes tendent encore aujourd’hui à faire porter l’entière responsabilité de cette occasion manquée sur les puissances européennes et leurs promesses non tenues, la réalité est bien plus complexe. La prise en considération de facteurs à la fois externes (intérêts divergents des Occidentaux, victoires militaires de Mustafa Kemal) et internes (divisions au sein des comités kurdes), ainsi que des trajectoires historiques antérieures (génocide arménien, scissions tribales et religieuses propres à la société kurde) permet de reconstituer ce moment historique unique. »
Dans cette région les Britanniques et les Français se sont partagés les provinces arabes lors du fameux accord Sykes-Picot, mais les provinces à majorité ou avec une forte présence kurde sont également concernées par ces accords. Cependant la création d’un État kurde sous influence britannique n’est pas écartée par les diplomates anglais. La France, malgré des réticences initiales finit par approuver la création d’un État kurde.
Mais il y a une grande différence entre la Syrie, l’Irak et les territoires kurdes :
« En 1918, tandis que les provinces arabes de l’empire sont occupées par les Alliés, la majeure partie du Kurdistan turc est encore sous la tutelle ottomane. Le mouvement kurde naissant se retrouve dépourvu de soutiens extérieurs, contrairement à la dynastie hachémite arabe par exemple qui peut, elle, s’appuyer sur les Britanniques ».
Et c’est ainsi qu’on apprend que les élites kurdes sont divisées en raison de la concomitance entre la création d’un État kurde et d’un Etat arménien. Il en existe qui compte sur la cause arménienne soutenu par les européens de l’Ouest pour obtenir parallèlement à la création d’un Etat arménien, un Etat Kurde. Mais d’autres préféreront qu’il n’y ait pas d’Etat Kurde plutôt que d’accepter un Etat Arménien à ses côtés. Ainsi, alors que la force qui les empêche de devenir un Etat est l’armée turque de Mustapha Kemal, ils s’allieront à lui pour contrer les arméniens :
« Lorsque les Alliés occupent Istanbul, le 12 novembre 1918, le Comité pour le relèvement du Kurdistan (KTC) entre en contact avec les Français et les Britanniques afin de défendre les aspirations de la « nation kurde ». Ses intentions ne sont toutefois pas forcément claires. La question de l’indépendance du Kurdistan suscite des débats houleux au sein de l’association. Les partisans de l’indépendance totale, réunis autour d’Emin Ali Bedir Khan, affrontent ceux qui, sous la houlette de Seyyid Abdulkadir, préconisent l’autonomie dans le cadre du nouvel État turc-ottoman. Ces derniers justifient leur position par les liens religieux des Kurdes avec les Turcs, garantis par l’institution du califat. Ils s’opposent violemment à la création d’un État arménien prévu par les négociations de paix à Paris.
Prenant tout le monde de court, le général Chérif Pacha, représentant du KTC, signe en 1919 un accord avec l’Arménien Boghos Noubar Pacha, prévoyant la création d’une Arménie et d’un Kurdistan indépendants. Alors que les délégations arménienne et kurde avaient présenté au préalable des revendications sur la totalité des provinces orientales de la Turquie actuelle, elles acceptent finalement l’une et l’autre un compromis sous la pression des Européens. En particulier, Chérif Pacha espère qu’en consentant des « pertes » territoriales au bénéfice des Arméniens les chancelleries occidentales arménophiles – telle la France – accepteront le principe de la création d’un État kurde.
Cet accord est confirmé par le traité de Sèvres du 10 août 1920, […]
Mais le traité de Sèvres ne sera pas appliqué. Entre-temps, bon nombre de tribus kurdes sunnites se sont ralliées aux forces rebelles turques menées par Mustafa Kemal au nom de la fraternité musulmane : elles refusent le traité de Sèvres, l’amputation du territoire et la création d’une entité arménienne. Les Kurdes participent massivement aux campagnes contre les troupes françaises et les milices arméniennes en Cilicie. »
Diviser c’est régner et le futur Atatürk va en profiter largement, surtout que les alliés franco-britanniques vont aussi diverger en raison de leurs intérêts coloniaux.
« Des divergences entre les Alliés d’une part et entre les Kurdes d’autre part, ainsi que les victoires des armées nationalistes d’Ankara sur le terrain ouvrent la porte à une renégociation du traité de Sèvres. A l’ouest, l’armée grecque est défaite par les Turcs. A l’est, les soulèvements des Kurdes alévis sont réprimés par les forces loyales à Mustafa Kemal en mars 1921, tandis que les troupes françaises en Cilicie subissent d’importants revers face aux soldats turcs et milices kurdes. Le retrait du territoire turc des troupes italiennes, grecques et françaises, entre 1920 et 1921, met la Grande-Bretagne dans une situation critique. Dès 1922, les Britanniques sont prêts à renégocier les termes de la paix avec le nouveau gouvernement de Mustafa Kemal. La délégation turque conclut en juillet 1923 avec les Alliés le traité de Lausanne, plus favorable à la nouvelle Turquie et rendant caduc celui de Sèvres. Dans le nouvel accord, aucune mention n’est faite d’un État kurde ou arménien. »
Il semble donc bien que l’ensemble de la population kurde de Turquie n’a pas lors de cette période cruciale entre 1920 et 1922 mis toutes les cartes de leur côté pour obtenir un État. La détestation des arméniens a joué un grand rôle. Et certains ne semblaient pas si désireux de se séparer des turcs.
<1296>
-
Jeudi 24 octobre 2019
« Trump est en train de mettre en pièces tout le réseau d’alliances, politiques et militaires, patiemment mis en place par ses prédécesseurs. »Shlomo Ben-Ami, ancien ministre israélien des Affaires étrangèresLes américains ont lâché les Kurdes de Syrie et ont permis à la Turquie d’Erdogan de se déchaîner contre eux.
Le Canard Enchaîné qui trouve les mots justes, a titré : « Les Kurdes victimes d’un meurtrier en Syrie ».
Quand il a fallu se battre contre les fous de Dieu de Daesh, les Américains et leurs alliés occidentaux ont bien voulu bombarder, envoyer des troupes spéciales et des formateurs. Mais se battre sur le terrain, envoyer de l’infanterie étaient beaucoup trop dangereux. C’est alors les hommes et aussi les femmes combattantes kurdes qui se sont battues et ont vaincu sur le terrain Daesh, malgré le jeu trouble de la Turquie d’Erdogan, qui a toujours considéré que les Kurdes étaient plus dangereux pour la Turquie que l’État islamique.
Les États-Unis ont donc trahi les Kurdes.
Les États sont des monstres froids.
Leurs trahisons sont multiples. Les américains ont abandonné de la même manière, à la vindicte des Nord-Vietnamiens triomphants, les Sudvietnamiens qui avaient combattus à leurs côtés.
Notre pays a agi de même avec les Harkis qui avaient choisi la France et qui étaient donc des traîtres pour le FLN, ils n’ont pas été défendus ou protégés par le pays qu’ils croyaient être le leur.
Plus récemment les Français ont abandonné leurs traducteurs afghans <Les interprètes afghans, un scandale français>. Il semble que depuis la France ait un peu assoupli sa politique de visa pour ceux qui l’ont aidée dans leur guerre contre les talibans.
Il ne fallait pas beaucoup d’américains, 2000 ont été rapatriés, pour retenir les Turcs d’attaquer, ces derniers ne pouvant se permettre de risquer de blesser ou tuer un soldat américain.
Mais l’homme cynique et connaissant si peu des leçons d’Histoire que les états-uniens ont mis à leur tête, a décidé de rapatrier les troupes américaines.
L’allié français, Emmanuel Macron a été informé par un tweet comme tout le monde.
Par la suite, l’hôte de la maison blanche a tenu des propos décousus, ignobles, stupides.
« Nous sommes en train de quitter la Syrie, mais nous n’avons absolument pas abandonné les Kurdes qui sont des gens formidables et de merveilleux combattants » <ICI>
Puis il menace : « Si la Turquie fait quoi que ce soit qui dépasse les bornes je détruirais son économie » et ajoute pathétique et grotesque : « Si cela dépasse les bornes selon ma grande et inégalable sagesse ».
Puis, dans un autre tweet, il affirme que les Kurdes ont reçu énormément d’argent.
Puis il a affirmé « [les kurdes] ne nous ont pas aidés pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ne nous ont pas aidés en Normandie ! ». A priori pendant la seconde guerre mondiale, c’étaient des États qui combattaient et les Kurdes n’avaient pas d’État mais devait se soumettre à l’autorité des quatre États dont ils étaient une minorité.
Puis il a dit : « Nous devons entretenir de bonnes relations avec les membres de l’OTAN et la Turquie est un membre de l’OTAN ».
Et il a écrit à Erdogan dans un langage de cour de récréation : « Ne jouez pas au dur ! Ne faites pas l’idiot ! »
Pour finalement se ranger totalement derrière Erdogan : « Le PKK est une menace terroriste pire que Daech ». Rappelons que le PKK est l’organisation kurde en Turquie qui se bat pour obtenir sinon une indépendance au moins une autonomie qui lui a toujours été refusé, peuple sans état, trahi par les traités le lendemain de la première guerre mondiale. La principale organisation des kurdes « YPG « de Syrie est accusée par Erdogan d’être l’allié du PKK
Et quand ses envoyés en Turquie obtiennent une suspension de l’attaque turque de 5 jours en contrepartie de l’acceptation par les kurdes de se soumettre aux objectifs de guerre d’Erdogan et de se retirer de trente kilomètres sur une terre qu’ils habitent et qu’ils peuvent considérer être la leur, sans même avoir eu la possibilité d’exprimer leur avis, Trump déclare :
« C’est un grand jour pour la civilisation, pour les Etats-Unis, la Turquie et les Kurdes. Nous avons obtenu tout ce dont nous aurions pu rêver ».
Cet homme inculte sait-il ce qu’est une civilisation ?
Comprend-il ce qu’il dit ? Ou se croit-il toujours dans une émission de télé-réalité dans laquelle les mots n’ont pas grande portée ?
Brice Couturier qui lit les auteurs autres que français rapporte des avis qui pensent qu’il fait une grande bêtise : <La trahison déraisonnable d’un allié stratégique>
Il cite ainsi Shlomo Ben-Ami, ancien ministre israélien des Affaires étrangères et intellectuel de notoriété internationale :
« La décision précipitée du président Donald Trump de retirer les troupes américaines de Syrie, dégageant la voie à une offensive turque contre les Kurdes, constitue la trahison déraisonnable d’un allié stratégique. Une telle malhonnêteté, on aurait pu l’attendre d’un régime fasciste ou dictatorial et pourtant, ce sont les Etats-Unis – leader mondial doté, paraît-il d’idéaux élevés – qui ont ainsi émergé comme empire de perfidie. […]
Trump est en train de mettre en pièces, tout le réseau d’alliances, politiques et militaires, patiemment mis en place par ses prédécesseurs. Il déclare la guerre commerciale à ses alliés européens. Il dit se laver les mains du retour en Europe des djihadistes de Daesh, jusqu’à présent gardés par les forces kurdes de l’YPG. »
Et en effet, énième saillie du milliardaire golfeur et président il a déclaré en conférence de presse.
« Bon, ils vont s’échapper vers l’Europe, c’est là qu’ils veulent aller. Ils veulent rentrer chez eux ».
Et Brice Couturier de conclure :
« Les alliés des Etats-Unis sont amenés à des révisions déchirantes. L’Inde se tourne vers la Chine et la Russie. La Corée du Sud, constatant que Washington a perdu tout intérêt pour empêcher le « petit rocket man » de se doter d’un arsenal nucléaire, envisage des concessions préjudiciables à son dangereux voisin. Taïwan, qui se sent abandonnée, va être contrainte de se rapprocher de la Chine continentale. L’Arabie saoudite, consciente du peu de valeur de l’alliance américaine, entame des négociations urgentes avec l’Iran – qui lui fait si peur… »
Richard Haass, diplomate, ancien membre important de l’administration de George W Bush et aujourd’hui président d’un des principaux think tank américains, « le Council on Foreign Relations », juge l’abandon des Kurdes catastrophique. Parce qu’il renforce les doutes que pouvaient nourrir les alliés des Américains à travers le monde sur la fiabilité de ce partenaire. Il analyse :
« Ce que faisaient les Etats-Unis dans le Nord de la Syrie était intelligent et efficace .Ils se contentaient de fournir aux forces kurdes un soutien logistique, de l’entraînement et de l’information. Mais la seule présence d’un millier d’Américains sur place suffisait à dissuader les Turcs, les Syriens, les Russes ou les Iraniens de s’attaquer au territoire ainsi gagné par les Kurdes et leurs alliés arabes sur le soi-disant « Etat islamique ».
Le problème, souligne Haass, c’est que, comme souvent, Trump apparaît en phase avec une grande partie de l’opinion américaine. Beaucoup d’électeurs ont été séduits par son précédent slogan de campagne « America First ». Ils estiment que les besoins de leur pays dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement ont été, dans le passé, sacrifiés aux besoins de financement de guerres lointaines qui n’ont apporté que des ennuis. Une vague isolationniste traverse à présent les Etats-Unis. Et c’est sur elle que Trump entend surfer pour obtenir une réélection qui se présente mal.
Mais l’histoire nous apprend, poursuit Haass, que les périodes de repli sur soi finissent souvent par des chocs violents, qui obligent les Etats-Unis à se lancer dans de nouvelles odyssées risquées. Croire qu’il suffit de se retrancher dans la « citadelle Amérique » pour éviter les périls est une illusion. Les attentats du World Trade Center et du Pentagone devraient servir de leçon…
Et pour les européens la leçon est amère. Brice Couturier dit lucidement : :
« Les Européens, qui avaient misé sur le renversement du régime sanguinaire de Bachar Al-Assad comme d’ailleurs, la Turquie d’Erdogan, peuvent renoncer au rêve d’une Syrie démocratique. Ce sont les Russes, les Iraniens et les Turcs qui vont régler entre eux l’avenir de la Syrie. L’Europe est aux abonnés absents… comme souvent. Elle n’a encore rien compris au XXI° siècle. »
Et il est vrai que Poutine et Erdogan se sont rencontrés, mardi, à Sotchi et semblent s’être bien entendu sur le dos des Kurdes et des occidentaux mais pour le plus grand intérêt de la Russie, de la Turquie et du régime de Bachar Al Assad.
<Syrie: Erdogan et Poutine imposent leur paix dans le nord du pays>
<1295>
-
Mercredi 23 octobre 2019
« Noémie »Un prénom qu’une femme intelligente a donné à sa filleUn peu d’humour ne nuit pas. Mais est-ce de l’humour ?
Nous sommes encore dans les mots, il faut nommer les êtres humains et même les « prénommer ». Il semble que par le passé on appelait les personnes par leur nom de famille, sauf dans le cadre le plus intime où on utilisait le prénom. Aujourd’hui l’usage s’est répandu d’appeler ses collègues et les personnes que l’on connaît par leur prénom.
Ce n’est pas la première fois que je parle de « prénom ».
D’abord le mot du jour du <Vendredi 26 octobre 2018> : « Le prénom n’a rien d’anodin. Il touche à l’intime, et raconte infiniment plus que ce qu’on pourrait croire. »
Ensuite le mot du <Mardi 30 avril 2019> : «On est passé de 2000 prénoms en 1945 à 13.000 aujourd’hui ». C’était une observation de Jérôme Fourquet , l’auteur de « L’archipel français »
Le mot du jour d’aujourd’hui est une continuation de ces deux mots du jour, plutôt du second d’ailleurs.
C’est une journaliste Emmanuèle Peyret qui a publié un article, le 20 octobre 2019, sur le site de Libération : « Le petit Robaire des prénoms inventés »
Je suppose que ce titre veut faire penser au dictionnaire le petit Robert, mais utilise un patronyme « Robaire » très rare puisqu’il n’existe que 21 personnes nées en France depuis 1890, dans 6 départements, qui ont porté ou portent ce nom. Il se trouve au 248008ème rang des noms les plus portés en France
Alors que le patronyme « Robert » est celui de 102 950 personnes nées en France depuis 1890, dans 101 départements et qu’il est au 5ème rang du même classement.
Comme l’avait fait observer Jérôme Fourquet le nombre de prénoms a explosé en France. Emmanuèle Peyret écrit :
«Il y a environ 750 000 naissances par an en France actuellement. Le prénom le plus donné, Gabriel, l’a été à 5 400 bébés, soit moins de 1 %. Aujourd’hui, un bébé sur dix reçoit un prénom qui été donné six fois ou moins dans l’année. Ces prénoms très rares ne servaient qu’à 2 % des naissances en 1975», explique Baptiste Coulmont, sociologue, spécialiste des prénoms, et maître de conférences à l’université Paris-VIII . Quelques stars ont ouvert le bal avec des Tallulah Belle (fille de Demi Moore et Bruce Willis), Bear Blaze (fils de Kate Winslet), Bronx Mowgli (fils de la chanteuse et actrice Ashlee Simpson-Wentz. »
Nous apprenons dans cet article que « Ysé » est un prénom inventé par Paul Claudel pour un personnage du « Partage de Midi ».
Ces prénoms rares sont en général formés par une variation d’une lettre ou en ajoutant des consonnes et des voyelles à un prénom déjà existant ou on combine deux prénoms.
Longtemps contrôlé par les officiers d’état civil, l’attribution d’un prénom est aujourd’hui libre et la Loi autorise de choisir un nom original «dans la mesure où il ne porte pas préjudice à des tiers ou à l’enfant». En outre, l’officier d’état civil est tenu d’inscrire le prénom choisi et d’alerter éventuellement le procureur de la République, s’il juge qu’il porte préjudice à l’enfant ou à des tiers.
Et la journaliste cite des prénoms qui ont été interdit :
- Clitorine
- Vagina
- Un prénom imprononçable : Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116
- Babord et Tribord ou Fish and Chips pour des jumeaux.
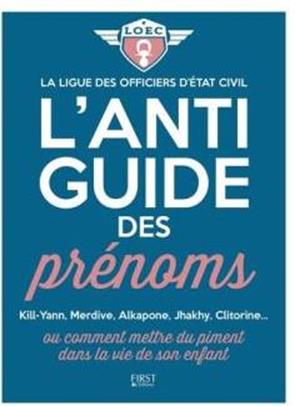 Vous connaissez tous le « Guide des prénoms », mais l’article nous informe que deux officiers d’état civil sous couvert d’anonymat ont écrit « L’Antiguide des prénoms ». Il porte pour sous-titre : « comment mettre du piment dans la vie de son enfant », je pense que c’est très ironique et j’ai l’intuition que les auteurs désapprouvent de tels prénoms
Vous connaissez tous le « Guide des prénoms », mais l’article nous informe que deux officiers d’état civil sous couvert d’anonymat ont écrit « L’Antiguide des prénoms ». Il porte pour sous-titre : « comment mettre du piment dans la vie de son enfant », je pense que c’est très ironique et j’ai l’intuition que les auteurs désapprouvent de tels prénoms
Voici une liste de prénoms qui ont ainsi été donnés pour être original et mettre du piment…. : « Tuba », « Bruce-Lee », « Merci Mireille », « Alkapone », « Batman », « Barack Obama », « Rolce-Roméo », « Lola-Poupoune », « Dior Gnagna », « Boghosse », « Youyou », « Jesunette », « Jean-Clode », « Djustyne », « Zac-Harry », « Kill-Yann »
L’oubliable Nabila a ajouté une lettre pour nommer son enfant « Milann », certains en enlèvent une par exemple « Delphie », on peut aussi orthographier un prénom de manière originale ( ?) :
Il semble aussi qu’ajouter ou remplacer des lettres par des k et des y soient très « tendance ». «Kamille, Klaude, Styvy». On peut ajouter un h « Khamylle, Khlaude, Sthyvhy».
Et la journaliste de s’amuser : «
Avec un préfixe ou un suffixe, «transformez votre prénom en création improbable, Zsthyvy-du-loft» pour finir par un poétique «Zshtyv’hy dhu lauft». Sont-ils moqueurs, hein ?
[…] Le prénom composé invraisemblable se donne beaucoup aussi, Ahthena Cherokee, Elvees Pressley, Christ Brythoon, non, on n’invente rien, c’est recensé dans l’opus. »
Vous savez sans doute que Cécile Duflot a donné à une de ses filles le prénom « Térébentine », je parle bien de Cécile
Car Esther Duflo, le prix Nobel d’économie a donné à sa fille le prénom «Noémie ». Le <Parisien> rapporte que cela signifie « délicieuse » en hébreu.
Esther Duflo explique :
« [C’est] un prénom facile à prononcer dans les trois langues, français, anglais et bengali, pour qu’elle comprenne son appartenance à ces trois mondes ».
J’ai la faiblesse de préférer Noémie à Lola Poupoune et à quelques autres cités dans cet article.
<1294>
- Clitorine
-
Mardi 22 octobre 2019
« Notre vision de la pauvreté est dominée par des caricatures et des clichés »Esther DufloEsther Duflo a eu le Prix Nobel d’économie cette année avec son mari Abhijit Banerjee et un troisième économiste Michael Kremer, .pour leurs travaux sur la lutte contre la pauvreté.
<Le Monde> nous rappelle que ce qu’on appelle le Prix Nobel d’Economie est en réalité le prix de la Banque de Suède à la mémoire d’Alfred Nobel, car ce dernier n’avait pas prévu que le comité Nobel désigne un lauréat en économie.
Ces trois économistes ont essayé de mettre un peu de démarche scientifique dans l’économie qui en est fort dépourvu même si des économistes prétendent le contraire.
Ils ont œuvré dans le domaine de la pauvreté et ont concrètement mis en œuvre des programmes visant cet objectif, notamment en Inde, en mesurant l’impact de ces programmes. Une population X bénéficiait du programme et une population Y comparable n’en bénéficiait pas, puis on comparait les résultats de la population Y et X et on jugeait de la pertinence du programme.
Evidemment nous nous intéressons surtout à Esther Duflo parce qu’elle est française. Elle est seulement la seconde femme à recevoir ce prix de la banque de Suède.
 <Ici vous pourrez visionner la leçon inaugurale> « Expérience, science et lutte contre la pauvreté » au Collège de France d’Esther Duflo pour mieux comprendre sa démarche.
<Ici vous pourrez visionner la leçon inaugurale> « Expérience, science et lutte contre la pauvreté » au Collège de France d’Esther Duflo pour mieux comprendre sa démarche.
<Ici> vous trouverez un résumé de 11 pages sur le cours qu’elle a donné au Collège de France sur ce sujet.
<Challenges> précise que :
« La sensibilité de cette économiste, née à Paris en 1972, a pris corps dans une famille protestante, avec une mère pédiatre, investie dans l’humanitaire et qu’elle cite régulièrement en modèle, et un père mathématicien, enseignant-chercheur.
Diplômée de l’Ecole Normale Supérieure, de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), elle est aussi titulaire d’un doctorat du Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux Etats-Unis, où elle est aujourd’hui encore professeure. »
Le New Yorker la décrivait ainsi : « C’est une intellectuelle française de centre-gauche qui croit en la redistribution et en la notion optimiste que demain pourrait être meilleur qu’aujourd’hui. Elle est largement à l’origine d’une tendance académique nouvelle »
Elle a écrit un livre avec son mari « Repenser la pauvreté » qui a aussi été primé en 2012.
A l’occasion de la sortie de ce livre elle avait répondu à un entretien à l’AFP où elle disait :
« Notre vision de la pauvreté est dominée par des caricatures et des clichés: le pauvre paresseux, le pauvre entrepreneur, le pauvre affamé. Si on veut comprendre les problèmes liés à la pauvreté, il faut dépasser ces caricatures et comprendre pourquoi le fait même d’être pauvre change certaines choses dans les comportements, et d’autres non ! »
Et c’est donc intéressant de savoir ce que cette intellectuelle qui a consacré sa vie à la compréhension du phénomène de la pauvreté et des programmes de lutte contre ce fléau pense des mots, utilisés par notre jeune président à propos de la pauvreté en France.
Je cite donc <France Info> :
« « Il y a un risque de rendre les pauvres coupables de leur propre sort » C’est l’inquiétude formulée par la prix Nobel d’économie Esther Duflo, invitée de franceinfo mardi 15 octobre. Elle est revenue sur la notion des « premiers de cordée » défendue par Emmanuel Macron à l’automne 2017 et sur ses propos tenus en 2018 lors d’une réunion de travail à l’Élysée : « On met un pognon de dingue dans les minima sociaux ».
« Dans cette imagerie ‘pognon de dingue’ ou dans l’idée qui allait avec de responsabiliser les pauvres », Esther Duflo estime qu’il y a un sous-entendu : « Ils ne sont pas assez responsables par eux-mêmes » Selon elle, ce risque est présent « depuis toujours dans les politiques sociales. On rend la personne en difficulté coupable de ses malheurs. Tout en l’aidant on lui enlève sa dignité ».
La prix Nobel d’économie juge cette approche « dangereuse ». « Une fois qu’on vous enlève votre dignité, vous n’êtes pas dans les meilleures conditions possibles pour retomber sur vos pieds. Cela terrorise ceux qui ne sont pas pauvres aujourd’hui et qui se disent que peut-être un jour ils le seront ».
Esther Duflo explique que, pour les personnes en situation « un peu fragile », ce type de discours peut « les rendre inquiets de tout ce qui change, de tout ce qui peut être différent. Cela peut mener à une espèce de sclérose politique qui vient de la peur du risque. Parce que si vous tombez par terre, la société va vous en vouloir et va vous dire que c’est de votre faute. C’est très dangereux. »
Nous sommes toujours dans la réflexion de Victor Klemperer, de l’usage des mots, du sens profond qu’ils ont et de ce que leur usage dit de la conception de la société et du lien social de celui qui les utilisent.
<1293>
-
Lundi 21 octobre 2019
« Un temps de misère communicationnelle »Frédéric JolyVendredi dernier j’évoquais l’ouvrage de Victor Klemperer « LTI. La langue du IIIe Reich » et le livre récent de Frédéric Joly « la Langue confisquée » consacrée à une relecture de celui de Klemperer.
Or un article paru dans l’Obs du 5 septembre 2019 et écrit par la journaliste Marie Lemonnier : « Des outrances nazies aux mots creux du management : quand la langue devient un poison » me semble un complément et un approfondissement intéressant, en cela qu’il s’intéresse davantage encore à la situation d’aujourd’hui.
Aujourd’hui tout est communication. Quand une mesure du gouvernement est rejetée par la population ou une partie de la population, c’est qu’il y a eu « mauvaise communication».
Et des cohortes de politique munis « d’éléments de langage » vont répéter les mêmes mots creux et diffuser un message rassurant qui a souvent un rapport assez lointain avec les motivations et les effets de la mesure.
Le monde de l’entreprise et du management se trouvent dans cette même dérive : utiliser des « mots » qui présentent la réalité sous un angle très orienté.
 C’est ce que Frédéric Joly définit comme un temps de misère communicationnelle.
C’est ce que Frédéric Joly définit comme un temps de misère communicationnelle.
Marie Lemoine introduit son article par cet éloge du livre de Frédéric Joly
« L’ensauvagement des mots précède et prépare l’ensauvagement des actes », déclarait récemment Mona Ozouf (1), soulignant l’importance capitale de lire « LTI. La langue du IIIe Reich » de Victor Klemperer pour le comprendre. Frédéric Joly, auteur du brillant essai « la Langue confisquée. Lire Klemperer aujourd’hui », vient ainsi d’exaucer le vœu de l’historienne en se replongeant dans les écrits du philologue juif, qui laissa l’un des documents les plus hallucinants sur l’hitlérisme.
Elle explique que c’est précisément pour mieux penser notre temps, « un temps de misère communicationnelle », que Frédéric Joly convoque Klemperer. Bien sûr, rappelle-t-il, on ne saurait comparer les heures sombres du totalitarisme aux nôtres. « Mais si aucune « lourde barre de métal rouillé » ne pèse plus sur nous, nous connaissons d’autres empêtrements qui, sans doute parce qu’ils ne sont pas synonymes de coercition, ne semblent pas nous préoccuper outre mesure. » C’est un tort qu’il souhaite voir réparer en suscitant notre vigilance sur les distorsions infligées aujourd’hui à la langue et sur nos « adhésions non contraintes à des logiques d’appauvrissement langagier ».
Frédéric Joly constate d’abord une « brutalisation » de la langue, un « ensauvagement » des mots, dont l’injure et la mauvaise foi contre l’adversaire, sur les réseaux sociaux comme sur les plateaux télé, sont parmi les symptômes les plus affligeants.
Et la journaliste Marie Lemoine poursuit :
« Comment ne pas penser en ce moment même aux éructations répétées du Twitter fou de la Maison-Blanche ou d’un Bolsonaro enragé ? Dans son récent message de pardon adressé à la France, suite à la très gênante passe d’armes entre les chefs d’Etat français et brésilien au sujet de l’Amazonie en feu, l’écrivain Paulo Coehlo relevait « l’hystérisme » langagier de Jair Bolsonaro, dans lequel il percevait, à juste titre, une manifestation du « moment de ténèbres » que traverse son pays.
Joly ne peut, en outre, que remarquer la puissante imprégnation dans nos structures mentales, et donc dans nos vocabulaires, du monde économique et du « management », mais aussi de la programmation et de la mécanisation. On doit ainsi « profiter » de ses amis, de son temps, de toute occasion ; il faut sans cesse chercher à « s’optimiser », à « augmenter » ses capacités et son bonheur ; on va « reprogrammer » son cerveau, « gérer » sa vie et ses émotions… […].
J’ai toujours détesté utiliser le verbe « profiter » pour une autre raison que celle à laquelle il est essentiellement destiné : le profit capitalistique. On ne profite pas de ses amis, on les rencontre, on remplit l’échange d’informations, de sens et d’affect. Les mots de l’économie et du marché nous polluent.
Et Marie Lemoine de conclure :
Mais à la phraséologie néolibérale, reprise comme un seul homme par tous les gourous de la psychologie positive, Joly ajoute la grave réduction du langage à sa seule fonction communicationnelle. Or, avant d’être un outil de communication – ce qu’il est, bien sûr –, le langage « signifie ». Tirer le langage « vers le signal », délivrer un message à tous les coups univoque, voilà qui est tuer toute possibilité d’interprétation, ou d’implicite. C’est, au fond, une attaque contre la culture, la civilisation, toute l’humanité. « La dégradation de la Raison : voilà la racine du mal », concluait Klemperer en juillet 1945.
Or appauvrir une langue, contribuer à son appauvrissement, quels que soient les mobiles d’une telle opération (volonté de domestication politique, de facilitation ou de simplification de l’argumentation, de « fluidification » des échanges), c’est l’obscurcir et se condamner à mal communiquer », déplore l’essayiste. Pire, c’est perdre l’idée de la vérité, puisque la vérité « est une fonction permanente du langage ». Aussi, pour Frédéric Joly, n’y a-t-il pas lieu de s’étonner de ce climat de défiance généralisée quant au langage argumenté et aux vérités qui semblaient jusque-là établies. A l’ère de la post-vérité, les professionnels du brouillage entre le vrai et le faux sont légion.
« Nos sociétés du « bullshit » ne bannissent pas la vérité : elles la considèrent seulement comme inutile. En cela, elles ne diffèrent pas spectaculairement de la société décrite par Klemperer. »
Puisse cet avertissement ne pas demeurer un vain mot. Parce qu’aucun mot ne l’est. »
Nous ne sommes pas assez vigilants dans notre quotidien de ce que signifient les mots utilisés pour décrire une situation.
<Le mot du jour du 26 avril 2016> : développait cette remarque de Paul Jorion : « Le salaire est une charge, un coût, quelque chose de négatif qu’il faut réduire. Les dividendes des actionnaires et les bonus des patrons sont des parts de profit donc positifs. Le mépris du salarié, c’est dans nos règles comptables qu’il est inscrit.»
Ainsi parler de la charge salariale c’est induire un type de raisonnement et de priorité, alors qu’on pourrait parler de l’investissement salariale pour décrire ce que représente pour l’entreprise le fait de faire confiance à un salarié et de le payer.
<1292>
-
Vendredi 18 octobre 2019
« Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir.»Victor KlempererJ’avais l’intention de mettre en exergue du mot du jour d’hier consacré à Eric Zemmour et aux mots de haine qu’il a prononcés, la phrase de Victor Klemperer que j’ai mis aujourd’hui.
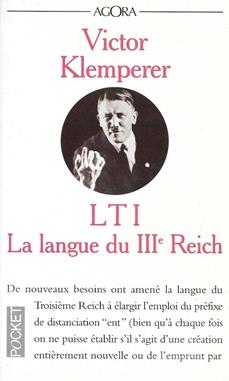 Mais l’article devenait tellement long que j’ai préféré agir autrement et revenir aujourd’hui sur Victor Klemperer un philologue allemand (1881-1960).
Mais l’article devenait tellement long que j’ai préféré agir autrement et revenir aujourd’hui sur Victor Klemperer un philologue allemand (1881-1960).
Sa grande œuvre paru en 1947 est le livre « LTI – Lingua Tertii Imperii: » dont le sous titre est « Notizbuch eines Philologen » ce qui traduit donne : « Langue du Troisième Reich : carnet d’un philologue ».
La philologie vient du grec ancien phĭlŏlŏgĭa (« amour des mots, des lettres, de la littérature ») et consiste en l’étude d’une langue et de sa littérature à partir de documents écrits.
C’était le métier de Viktor Klemperer, métier qu’il a exercé sur la langue utilisée par les nazis.
Car, avant les grandes catastrophes il y a d’abord des mots, des mots qui forment un récit. Un récit qu’un grand nombre s’approprie, pour finalement analyser et voir le monde à travers ce récit, avec des mots choisis soigneusement et qui sont les vecteurs des idéologies et des croyances qui doivent embraser l’esprit des peuples.
Le livre qu’il nomme lui-même « LTI » a été écrit peu à peu, car Klemperer a construit son analyse au fur à mesure des années, entre 1933 et décembre 1945, dans le journal qu’il tient. C’est un essai sur la manipulation du langage par la propagande nazie depuis son apparition sur la scène politique jusqu’à sa chute.
Et c’est ainsi qu’il écrivait dans LTI :
«Le nazisme s’insinue dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s’imposaient à des millions d’exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir»,
Grâce à <Wikipedia> nous apprenons que
Victor Klemperer est né en 1881 dans une ville qui s’appelle aujourd’hui Gorzów Wielkopolski et qui était en Pologne mais était au moment de sa naissance dans l’Empire allemand. Il est mort le 11 février 1960 à Dresde, en Allemagne de l’Est.
Pour les connaisseurs en matière de musique, il est le cousin du grand chef d’orchestre Otto Klemperer (1885-1973).
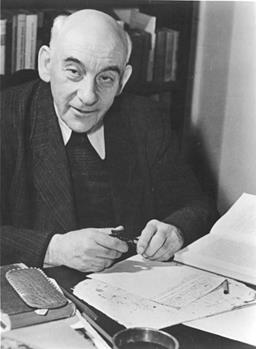 Il est né dans la communauté juive, il était même enfant d’un rabbin. Mais en 1906 il épouse Eva Schlemmer, pianiste et musicologue qui est protestante. Et en 1912, il se convertit au protestantisme
Il est né dans la communauté juive, il était même enfant d’un rabbin. Mais en 1906 il épouse Eva Schlemmer, pianiste et musicologue qui est protestante. Et en 1912, il se convertit au protestantisme
Mais après l’arrivée des nazis au pouvoir, Klemperer se voit interdire le droit d’enseigner en raison de ses ascendances juives alors qu’il est converti au protestantisme.
Son journal personnel, qu’il avait commencé avant 1933, devient alors un moyen intellectuel de survie. Il y note jour après jour ce qu’il désigne comme « les piqures de moustique » des humiliations et interdictions imposées par le régime et toutes les manipulations des nazis sur la langue allemande.
Après la guerre, il s’installa à Dresde et adhéra même avec son épouse au Parti communiste est-allemand. Il vécut jusqu’à sa mort en RDA.
Un article de <Libération> consacré à un nouvel ouvrage sur « LTI » dont je reparlerai plus loin révèle cependant que :
« Après la guerre, et malgré sa clairvoyance, Klemperer, épuisé, décide de demeurer à Dresde, sous contrôle soviétique. En 1952, il prend la direction du département de romanistique à l’Institut Humboldt de Berlin. Membre du KPD et sénateur, il ne critiquera jamais publiquement le régime. Mais il n’est pas dupe : dès juin 1945, en écoutant Staline, Klemperer a la certitude qu’est née une langue du IVe Reich qu’il nomme «LQI», «Lingua quarti imperii». Elle diffère à peine de la «LTI» : même mépris des faits, même recours aux superlatifs et aux métaphores militaires. Les deux langues caressent un mot-clé identique, l’adjectif «total» «à faire frémir, cette identité de LTI et de LQI, de la chanson soviétique et de la nazie», remarque Klemperer. »
Il semble que l’essayiste Frédéric Joly qui a aussi écrit un livre sur « Robert Musil » et a réalisé de nombreuses traductions d’auteurs de la première moitié du vingtième siècle (Georg Simmel et Walter Benjamin, notamment) comme d’auteurs contemporain, soit le premier qui ait consacré un ouvrage en français à « LTI » et Victor Klemperer.
Il a écrit : « La langue confisquée, lire Victor Klemperer aujourd’hui »
Libération a consacré une chronique à ce nouvel ouvrage : <Victor Klemperer décrypteur de la langue totalitaire> :
Victor Klemperer, décrypteur de la langue totalitaire
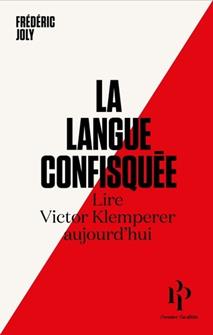 « Victor Klemperer, […] est l’auteur d’une analyse de la langue totalitaire qui fait désormais figure d’ouvrage de référence classique pour toute réflexion menée sur ce thème et pour les spécialistes du IIIe Reich. Il fut le premier à comprendre que la rhétorique nazie, en corrompant la langue allemande, réussirait à faire passer pour vrai ce qui était faux. Pourtant que sait-on de Victor Klemperer, l’auteur de LTI, la langue du IIIe Reich, devenu l’étude de référence du langage totalitaire ? A peu près rien. Les deux volumes de son journal n’ont été traduits en français que depuis une vingtaine d’années (le Seuil, 2000) et son autobiographie (Curriculum vitae, plus d’un millier de pages) ne l’est toujours pas.
« Victor Klemperer, […] est l’auteur d’une analyse de la langue totalitaire qui fait désormais figure d’ouvrage de référence classique pour toute réflexion menée sur ce thème et pour les spécialistes du IIIe Reich. Il fut le premier à comprendre que la rhétorique nazie, en corrompant la langue allemande, réussirait à faire passer pour vrai ce qui était faux. Pourtant que sait-on de Victor Klemperer, l’auteur de LTI, la langue du IIIe Reich, devenu l’étude de référence du langage totalitaire ? A peu près rien. Les deux volumes de son journal n’ont été traduits en français que depuis une vingtaine d’années (le Seuil, 2000) et son autobiographie (Curriculum vitae, plus d’un millier de pages) ne l’est toujours pas.
C’est pourquoi l’essai de Frédéric Joly, […] vient combler un vide.
[…] Victor Klemperer a l’intuition du fait qu’une langue énonce une vérité sur son temps : «Ce que quelqu’un veut délibérément dissimuler, aux autres et à soi-même, et aussi ce qu’il porte en lui inconsciemment, la langue le met au jour. Tel est sans doute aussi le sens de la sentence : le style, c’est l’homme ; les déclarations d’un homme auront beau être mensongères, le style de son langage met son être à nu», écrit-il. L’arrogance de cette langue traduit la morgue d’un régime, certain de réussir à se débarrasser d’un peuple qu’elle juge parasite. LTI montre que la propagande par les mots n’imprègne pas seulement les idées, mais également les actes. »
Le journal suisse <Le Temps> décrit ainsi la démarche de Klemperer et l’ouvrage que Frédéric Joly lui a consacré :
« Alors que son pays basculait dans les ténèbres, Victor Klemperer devint un exilé de l’intérieur, décrivant avec minutie la contamination de la langue par l’idéologie nazie. Frédéric Joly consacre à cet amoureux des Lumières un essai passionnant
Au cœur de l’Allemagne nazie, à Dresde, il y avait un homme, professeur de langues romanes, qui sentait jour après jour se resserrer autour de lui les roues dentées du quotidien. Sa foi dans les Lumières françaises, auxquelles il consacrait le meilleur de son érudition, il ne pouvait plus la cultiver que dans son couvre-feu intérieur. […]
Son matériau, pas besoin d’aller le chercher dans les bibliothèques, il s’étalait devant lui: conversations entre voisins, journaux, discours d’Hitler, romans, cinéma. Au fil des jours s’accumulèrent ainsi des centaines de feuillets soigneusement dissimulés qui, espérait-il, pourraient un jour lui servir. Il n’en était pas sûr, tant son corps était entamé, son psychisme en lambeaux, son trésor de papiers menacé.
[…] Car la langue, la langue ordinaire de tous les jours est bien plus qu’un simple instrument de communication: elle est un révélateur sans pareil de l’esprit d’une époque, de ses préjugés, de ses distorsions. Klemperer: «Il arrive que l’on veuille dissimuler la vérité derrière un flot de paroles. Mais la langue ne ment pas. Il arrive que l’on veuille dire la vérité. Mais la langue est plus vraie que celui qui la parle». «In lingua veritas» était sa devise.
Il montrera ainsi par exemple comment les métaphores mécanistes (on soumettait les enseignants à une «révision», comme un moteur) ou naturalistes (le fameux Lebensraum, qui légitime l’espace vital potentiellement menacé par l’étranger) ont envahi le parler ordinaire. Ces formules, qui semblent inoffensives à force de les entendre, se sont immiscées dans les esprits. Au final, elles légitiment un langage de la fonctionnalité et de l’efficacité, donnant lieu à ce que Klemperer a appelé la LTI, «Lingua Tertii Imperii», la langue du IIIe Reich. »
Et j’aime beaucoup la prospective que donne cet article :
« Mais la thèse qui le guidait – «In lingua veritas» – comme elle guide l’essai de Joly est tellement forte qu’on ne peut pas ne pas penser à notre époque. A l’heure où l’on profite des vacances pour «recharger ses batteries», où tout n’est que «connexion», «news» (fake ou pas), «expérience utilisateur», «objet intelligent», ou encore «maximisation», «optimisation» et «sécurisation», «performance», «rendement», «in- et output»; à l’heure où le français est ventriloqué par l’anglais, comment ne pas s’interroger sur le mystérieux mais évident rapport du langage au temps, y compris, bien sûr, le nôtre? Klemperer nous y invite, notre temps nous y oblige. »
Il y a aussi cette émission de France Culture consacrée au livre de Frédéric Joly et à un autre ouvrage écrit par Gérard Noiriel : « Le Venin dans la plume : Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part sombre de la République »
<1291>
-
Jeudi 17 octobre 2019
« Quand ils ont peur, c’est pour eux-mêmes. Mais leur haine est pour les autres. »Albert Camus, État de siègeEt quelques politiciens, proches de Marion Maréchal qui ne veut plus qu’on accole à son nom celui de la famille «Le Pen», dont elle est issue, ont donc organisé une : « convention de la droite » le 28 septembre 2019.
Soyons précis ce rassemblement qui a réuni un millier de personne dans le 15ème arrondissement de Paris, dans une salle dédiée à l’organisation d’«opérations à caractère festif » et répondant au nom de « La Palmeraie » a été organisée par le magazine « L’Incorrect » et des associations « Racines d’avenir » et « Cercle Audace ». Déjà leurs titres constituent un programme.
Cet évènement n’a pas attiré de femmes ou d’hommes politiques de premier plan, mais il y avait un invité particulier qui est monté sur la tribune, a agrippé le pupitre et a lu un discours d’une demi-heure, courbé sur ses feuilles.
On parle beaucoup de ce discours en raison de son contenu et aussi parce que la chaîne de télévision LCI a retransmis l’intégralité de ce discours.
Peut-être que cette chaîne avait la conviction qu’elle était en train de retransmettre un moment d’Histoire… j’espère que non !
Plus probablement espérait-elle faire de l’audience, de sorte de pouvoir bénéficier de la manne publicitaire.
Et c’est ainsi qu’Eric Zemmour a révélé à la salle mi-conquise, mi-sceptique, car elle trouvait peut-être qu’il exagérait un peu, l’existence d’« Une guerre d’extermination de l’homme blanc hétérosexuel »
A d’autres moments du discours il ajoutait l’appartenance religieuse : catholique, comme par exemple :
« L’homme blanc hétérosexuel catholique n’est pas attaqué parce qu’il est trop fort, mais parce qu’il est trop faible, non parce qu’il est assez tolérant, mais parce qu’il l’est trop. »
Cette fois nous ne sommes plus dans le concept, mais devant une question pratique : les droits de l’homme et la liberté d’opinion doivent-ils autoriser Eric Zemmour à s’exprimer ?
Poser la question de cette manière et après les mots du jour précédents la réponse ne saurait être que Oui.
Certains propos constituent des délits et peuvent faire l’objet de sanction pénale. D’ailleurs Eric Zemmour a été définitivement condamné, après une longue procédure jusqu’à la Cour de Cassation qui a confirmé, le 19 septembre 2019, la condamnation pour provocation à la haine religieuse après des propos anti-musulmans tenus dans le cadre de l’émission « C à vous » diffusée le 6 septembre 2016 sur France 5.
Il ne faut donc pas de censure préalable, mais laisser dire puis condamner, s’il y a lieu.
Mais il faut écouter et essayer de comprendre ce qu’il dit.
Son intervention intégrale, se trouve derrière <ce lien>.
Il faut bien sûr analyser et décrypter.
D’abord « extermination ». Si comme moi, vous êtes un homme blanc hétérosexuel et qu’on vous dit qu’on veut donc vous exterminer, il est très possible qu’après un haussement d’épaule, cette phrase vous revienne et commence à instiller le doute : et s’il avait raison ?
Si vous êtes sur cette pente, vous allez rapidement essayer de déterminer qui sont ceux qui voudraient vous exterminer. Et un peu plus loin vous allez regarder ces exterminateurs potentiels avec suspicion, peut-être crainte, bientôt avec ressentiment et dans ce cas la voie de la haine est proche.
Quand vous dite à quelqu’un qu’il va être exterminé, vous devez vous attendre qu’il réagisse et qu’il ne se laisse pas faire. Une pulsion assez basique consisterait à exterminer les exterminateurs…
Nous sommes clairement dans une logique de guerre civile.
L’homme courbé sur son pupitre désigne très clairement les exterminateurs, ils sont dans deux camps d’un côté « les progressistes », de l’autre « les musulmans ». Et l’homme blanc hétérosexuel catholique est
« […] ainsi pris entre l’enclume et le marteau de deux universalismes »
Même si « les musulmans » en tant que communauté homogène n’existent pas. Ce qui existe ce sont « des musulmans » dans leurs diversités. Mais on comprend à peu près l’amalgame qu’il fait pour désigner ce premier groupe qui constitue peut-être, dans son esprit, le marteau
Mais les « progressistes » ceux qui seraient alors l’enclume sur laquelle reposerait notre tête pour que le marteau puisse l’écraser dans l’entreprise d’extermination, qui sont-ils ?
Voici ce que dit Éric Zemmour.
« Progressisme : la religion du progrès, un millénarisme qui fait de l’individu un dieu et de ses volontés jusqu’aux caprices un droit sacré et divin. Le progressisme est un matérialisme divinisé qui croit que les hommes sont des êtres indifférenciés, interchangeables, sans sexes ni racines, des êtres entièrement construits comme des Legos et qui peuvent être donc déconstruits par des démiurges. […]
Le progressisme est un messianisme sécularisé, comme le furent le jacobinisme, le communisme, le fascisme, le nazisme, le néolibéralisme ou le droit-de-l’hommisme. Le progressisme est une révolution. D’ailleurs, souvenez-vous, le livre de campagne de notre cher président s’appelait Révolution. Une révolution ne supporte aucun obstacle, aucun retard, aucun état d’âme. Robespierre nous a appris qu’il fallait tuer les méchants. Lénine et Staline ont rajouté qu’il fallait aussi tuer les gentils. La société progressiste au nom de la liberté est une société liberticide. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Le cri de Saint-Just est toujours à son programme. Depuis les Lumières, depuis la Révolution française, depuis la révolution de 17, jusqu’à même la IIIe République avec ses radicaux franç-macs, jusqu’à aujourd’hui, c’est toujours le même progressisme : la liberté c’est pour eux, pas pour les autres. […] »
Il ajoute que ce millénarisme dispose d’outils de diffusion, de « propagande » dit-il et pour que ce soit clair pour le « mal-comprenant » il cite Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler afin que le lien avec le nazisme tombe dans l’évidence :
« appareil de propagande qui réunit la télévision, la radio, le cinéma, la publicité, sans oublier les chiens de garde d’Internet. Son efficacité fait passer Goebbels pour un modeste artisan et Joseph Staline pour un débutant timoré. Le progressisme, c’est l’omniprésence de la parole soi-disant libre, servie par une technologie d’une puissance de diffusion jamais vue dans l’histoire mais en même temps, comme ils aiment dire, un appareil répressif de plus en plus sophistiqué pour la canaliser et la censurer. »
Dans ce progressisme il classe aussi le :
« libre échange mondialisé […] la sainte cause des minorités » sexuelles et ethniques de l’extrême gauche. »
L’ennemi du progressisme ainsi défini est donc :
«Le seul ennemi à abattre, c’était l’homme blanc hétérosexuel catholique […] Le seul à qui l’on fait porter le poids du péché mortel de la colonisation, de l’esclavage, de la pédophilie, du capitalisme, du saccage de la planète, le seul à qui on interdit les comportements les plus naturels de la virilité depuis la nuit des temps au nom de la nécessaire lutte contre les préjugés de genre, le seul à qui on arrache son rôle de père, le seul qu’on transforme au mieux en seconde mère ou au pire en gamète, le seul qu’on accuse de violences conjugales, le seul qu’on balance comme un porc. »
Noter qu’entre autre combat, il défend aussi « les comportements les plus naturels de la virilité depuis la nuit des temps ».
Bien sûr, il parle des musulmans, de l’immigration, du grand remplacement inventé par Renaud Camus, et de l’inversion de la colonisation
« Le dynamisme démographique de notre continent a permis aux Blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les Indiens et les Aborigènes, asservi les Africains. Aujourd’hui, nous vivons une inversion démographique, qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs Indiens et leurs esclaves : c’est vous ! […au ] triptyque d’antan – immigration, intégration, assimilation – s’est substitué invasion, colonisation, occupation ».
[…] nous sommes ainsi pris entre l’enclume et le marteau de deux universalismes qui écrasent nos nations, nos peuples, nos territoires, nos traditions, nos modes de vie, nos cultures : d’un côté, l’universalisme marchand qui, au nom des droits de l’homme, asservi nos cerveaux pour les transformer en zombies déracinés ; de l’autre, l’universalisme islamique qui tire profit très habilement de notre religion des droits de l’homme pour protéger son opération d’occupation et de colonisation de portions du territoire français qu’il transforme peu à peu, grâce au poids du nombre et de la loi religieuse, en enclave étrangère. (…) Ces deux universalismes, ces deux mondialismes, sont deux totalitarismes. »
Pour répondre à cette menace, il remet au centre du débat et du combat : « l’identité »
« Je ne dis pas que la question de l’identité est la seule qui nous soit posée, je ne dis pas que l’économie n’existe pas (…), je prétends seulement que la question identitaire du peuple français les précède toutes, qu’elle préexiste à toutes, même à celle de la souveraineté. C’est une question de vie ou de mort […] Nous devons savoir que la question du peuple français est existentielle quand les autres relèvent des moyens d’existence. Les jeunes Français seront-ils majoritaires sur la terre de leurs ancêtres ? Je répète cette question car jamais elle n’avait été posée avec une telle acuité. Dans le passé, la France (…) a été occupée, rançonnée, asservie, mais jamais son peuple n’a été menacé de remplacement sur son propre sol. […] Ne croyez pas ceux qui vous mentent depuis 50 ans […] les optimistes qui vous disent que vous avez tort d’avoir peur, vous avez raison d’avoir peur, c’est votre vie en tant que peuple qui est en jeu ».
Ce sont les mots de la discorde, il instille l’idée que nous avons été envahis, que nous sommes déjà occupés qu’il faut donc entrer en résistance, que nous allons être colonisés et finalement exterminés, c’est à dire disparaître.
Que nous devons avoir peur, que notre vie, en tant que peuple, est menacé.
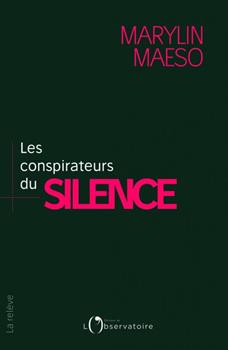 <Marianne> a donné la parole à une philosophe Marylin Maeso, spécialiste d’Albert Camus et auteure d’un essai, « Les conspirateurs du silence » (L’Observatoire).
<Marianne> a donné la parole à une philosophe Marylin Maeso, spécialiste d’Albert Camus et auteure d’un essai, « Les conspirateurs du silence » (L’Observatoire).
Elle cite Albert Camus qui dans sa pièce de théâtre de 1948 « L’état de siège » écrit :
« Quand ils ont peur, c’est pour eux-mêmes. Mais leur haine est pour les autres. »
Marylin Maeso ajoute :
« Arrêtons-nous sur ce fantasme d’une « guerre d’extermination de l’homme blanc hétérosexuel catholique ». Le brandir au moment même où la Tchétchénie emprisonne et assassine ses citoyens homosexuels, pendant que la Chine crée des camps où les Ouïghours sont torturés, forcés à renier leur religion, dépouillés de leurs organes et tués avec l’aval de trente-sept pays n’est pas un geste anodin. Les mots ont un sens, et leur détournement, un objectif bien précis. Cette stratégie s’appuie sur un double mécanisme de subversion du langage et d’instrumentalisation de l’histoire ayant pour but de recouvrir le réel d’un dangereux voile idéologique. En se réappropriant une terminologie martiale extrêmement connotée (« occupation », « asservissement », « extermination », « propagande [digne de] Goebbels », etc.) pour la plaquer sur une réalité sans commune mesure, Zemmour fait poindre la menace d’une guerre civile doublée d’une guerre de civilisation, d’autant plus meurtrière qu’elle avance masquée.
C’est la fameuse thèse du « Grand Remplacement » formulée par Renaud Camus, que le polémiste n’a pas manqué de citer lors de sa conférence, et qui soutient que l’immigration est une extermination douce, qui ne passe pas par l’industrialisation de la mort de masse mais par la conquête silencieuse et fourbe de la natalité. Quant à l’utilisation fallacieuse de l’histoire, qu’il s’agisse du colonialisme ou du nazisme, elle a pour fonction de mobiliser des schémas de pensée traumatiques durablement gravés dans notre mémoire collective, de manière à optimiser le potentiel de ce que le philosophe Peter Sloterdijk appelle les « affects thymotiques » (colère, vengeance, rejet de l’autre, etc.) et que Zemmour entend ici exploiter. »
Eric Zemmour utilise des mots « colonisation », « invasion », « occupation », « extermination » qui expriment la violence, mais qui surtout font référence à des moments historiques très connotés où il y avait d’un côté le bien et de l’autre le mal, des moments très sombres, d’oppression et de guerre.
L’« autre » vous veut du mal, c’est un ennemi qu’il faut combattre, chasser et s’il le faut, tuer.
Cette rhétorique de guerre civile est dangereuse et en outre ne présente aucune solution viable et à long terme.
Mais si Zemmour a un si grand succès d’audience de télévision ou de radio, si ses livres se vendent si bien, c’est aussi parce que ses propos trouvent un écho chez un grand nombre de nos concitoyens et qu’en face une grande partie du discours politique « des gens raisonnable » est dans le déni et l’évitement.
Ainsi, quand lors de l’Esprit Public du 6 octobre 2019, Philippe Manière a essayé de suggérer que si Eric Zemmour prônait des solutions ineptes et moralement inacceptables, il évoquait un certain nombre de problèmes qui dans des quartiers de France sont réels et exaspèrent un grand nombre de français, il s’est immédiatement fait rabrouer pour dire que tout ceci était faux et que les tableaux excel disaient le contraire. On ne dira jamais assez qu’on ne comprend rien aux communautés humaines si on se contente d’analyser des tableaux excel.
Dire que l’émergence d’un islam militant sur les terres de notre pays parmi les migrants de fraiche date comme dans des populations depuis beaucoup plus longtemps français ne pose pas un problème à notre République, à notre manière de faire société et de vivre en société constitue un déni contreproductif.
Quand on dit que l’islam peut parfaitement s’intégrer dans la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905 et que cette Loi est adaptée à toutes les religions, c’est qu’on dispose d’une vision biaisée de la réalité.
La Loi de 1905 ne concernait en rien l’islam, elle a, dans un contexte de conflit et de violence, assuré la séparation entre la sphère politique et le véritable État dans l’État qu’était la religion dominante catholique. Religion qui était riche de lieux de culte, de patrimoine, de généreux donateurs français et d’un corpus idéologique parfaitement adapté à la société française qu’elle avait d’ailleurs contribué à façonner.
Rien de tel pour l’islam et pour les français musulmans pratiquants qui veulent vivre pleinement leur Foi en France. Bien sûr, pour celles et ceux, qui ont, je dirais, une relation apaisée avec leur religion et plus encore celles et ceux qui ont une relation distanciée voire plus de relation du tout, il n’y a pas de difficulté particulière de vie en société en France.
En outre, l’Islam jusqu’à maintenant, n’a pas montré sa grande capacité de séparer la politique et la religion. Quand Atatürk parle de laïcité en Turquie, il dit très clairement que tous les turcs sont musulmans et que le gouvernement est composé de musulmans, simplement il ne veut pas que « les religieux » contestent le pouvoir politique, son pouvoir dans le domaine des affaires et des intérêts de l’État.
Gérard Collomb, lors de son discours de départ du ministère de l’intérieur avait dit :
«On vit côte à côte, je crains que demain on ne vive face à face, nous sommes en face de problèmes immenses»
Et que rapporte Gérard Davet et Fabrice Lhomme dans leur livre « Un président ça ne devrait pas dire ça… » des propos de François Hollande ?:
« Qu’il y ait un problème avec l’islam, c’est vrai. Nul n’en doute.»
Et L’ancien président dit aussi
«Comment peut-on éviter la partition? Car c’est quand même ça qui est en train de se produire: la partition.»
Les solutions ne sont pas simples, la stigmatisation des musulmans que font Zemmour et ses semblables est inacceptable, injuste, inutile et dangereuse pour la cohésion de la société française. Mais il faut aussi regarder les problèmes qui existent et qui constituent le terreau du succès de cet homme peu recommandable.
<1290>
-
Mercredi 16 octobre 2019
« Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s’est dédoublé »Clara YséDans mon butinage je suis tombé sur un article du Point qui m’a renvoyé vers <Ce Clip>
Clip étonnant, chanson envoutante, voix androgyne, texte émouvant et beau, j’ai été comme happé.
J’ai fait bien sûr des recherches
Et j’ai compris qu’Ysé était un nom d’artiste.
Cette jeune fille qui chante « J’ai crié que quelqu’un me vienne en aide », s’appelle dans la vie civile Clara Dufourmantelle.
Elle est la fille d’Anne Dufourmantelle.
Cette psychanalyste et philosophe qui a écrit
« La puissance de la douceur » et qui a fait l’objet du mot du jour du <26 septembre 2019>. Le mot qui a suivi celui consacré à <Cécile>
Anne Dufourmantelle qui est morte d’un arrêt cardiaque, conséquence d’un acte spontané de don de soi, pour sauver des enfants qui étaient en train de se noyer.
On comprend mieux le clip et les paroles de cette chanson écrite en hommage à sa mère et pour surmonter l’immense peine.
Elle décrit sa sidération par ces mots :
« Le monde s’est dédoublé, Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles.»
Un ami lui vient en aide :
« J’ai accueilli un ami qui m’a pris dans ses bras
Et m’a murmuré tout bas
Regarde derrière les nuages
Il y a toujours le ciel bleu azur
Qui lui vient toujours en ami
Te rappeler tout bas
Que la joie est toujours à deux pas »
Je rappelais dans le mot du jour dédié à Cécile les paroles de Tchekov « Enterrer les morts, réparer les vivants ».
Dans cette chanson cela devient
« Vers un nouveau rivage
Ton cœur est emporté
L’ancien territoire t’éclaire de ses phares »
C’est bouleversant.
 Cette chanson se trouve sur un album dans lequel elle chante en français mais aussi en espagnol et en anglais.
Cette chanson se trouve sur un album dans lequel elle chante en français mais aussi en espagnol et en anglais.
J’ai acheté cet album de 6 titres et j’ai appris un nouveau sigle « EP » qui correspond à « extended play », c’est un format de disque qui est plus grand qu’un single qui comporte 2 titres et plus petit qu’un album qui contient au moins 8 titres.
Clara Dufourmantelle a <dit> :
« Cet EP, c’est ce qui m’a permis de vivre »
Oui parce qu’après un évènement brutal comme celui de la mort de sa mère, dans les conditions dans lesquelles cette rupture a eu lieu, il faut continuer à vivre.
La poésie, l’art peut être un moyen.
<Libération> a écrit :
« […] on tombe, interdit, sur la puissance de feu et la folie certaine de la formidable Clara Ysé.
[…] Jonglant entre le français, l’anglais et l’espagnol, Clara Ysé explore un territoire inconnu, en nous bombardant littéralement avec ses bouleversantes chansons habitées par une poésie du réel. Et puis il y a surtout la puissance originale de son chant qui lui permet donc de venir tutoyer ces fameuses figures tutélaires qui elles aussi imaginaient leur propre route sans jamais chercher à se rapprocher d’une quelconque hype éphémère.
Une voix est née. »
Je crois que c’est fort bien écrit et résumé.
Voici les paroles de la chanson : « Le monde s’est dédoublé » de Clara Ysé
Ce matin il est arrivé une chose bien étrange
Le monde s’est dédoublé
Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles
Le monde s’est dédoublé
J’ai pris peur j’ai crié que quelqu’un me vienne en aide
Le monde s’est dédoublé
J’ai accueilli un ami qui m’a pris dans ses bras
Et m’a murmuré tout basRegarde derrière les nuages
Il y a toujours le ciel bleu azur
Qui lui vient toujours en ami
Te rappeler tout bas
Que la joie est toujours à deux pasIl m’a dit prends patience
Mon ami prend patience
Vers un nouveau rivage
Ton cœur est emporté
L’ancien territoire t’éclaire de ses phares
T’éclaire de ses pharesCe matin il est arrivé une chose bien étrange
Le monde s’est dédoublé
J’ai senti le temps se fendre un instant sur les visages même
Le monde s’est dédoublé
Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude
Ont perdu leur densitéRegarde derrière les nuages
Il y a toujours le ciel bleu azurQui lui vient toujours en ami
Te rappeler tout bas
Que la joie est toujours à deux pas
Il m’a dit prends patience
Mon ami prend patience
Vers un nouveau rivage
Ton cœur est emporté
L’ancien territoire t’éclaire de ses pharesRegarde en dessous de la nuit
Y’a toujours le jour qui pose ses lumières
Sur un coin de la terre
Te rappelant tout bas
Que la joie est toujours à deux pas
Je te dis prends patience
Mon ami prends patience
Vers un nouveau rivage
Ton cœur est emportéL’ancien territoire t’éclaire de ses phares
Regarde derrière les nuages
Il y a toujours le ciel bleu azur
Qui lui vient toujours en ami
Te rappeler tout bas
Que la joie est toujours à deux pas
Il m’a dit prends patience
Mon ami prends patience
Vers un nouveau rivage
Ton cœur est emporté
L’ancien territoire t’éclaire de ses phares
T’éclaire de ses pharesEt <ICI> elle la chante en concert.
Et puis voici une autre chanson de l’EP : <Mama>
<1289>
-
Mardi 15 octobre 2019
« ALICEM »Application mobile conçue par le Ministère de l’intérieurCes derniers temps, grâce à François Sureau, je me suis inquiété sur l’état de nos libertés publiques en France.
Frédéric Says dans sa chronique du 8 octobre 2019 : <Données privées, libertés publiques> a donné un exemple d’initiative qui montre le caractère raisonnable de l’inquiétude, préalablement évoquée.
Lui-même citait ses sources : <Le site de Bloomberg, l’agence d’actualités financières>.
Le nom de l’application possède une consonance rassurante : « Alice aime ».
Derrière cet acronyme se cache une application de reconnaissance faciale.
Le site de Bloomberg annonce que de cette manière la France va devenir le premier pays européen à utiliser officiellement la reconnaissance faciale. Car cette application pour mobile conçue par le ministère de l’Intérieur, permet de s’identifier en se prenant en photo ou en vidéo, pour accéder aux services publics en ligne.
Frédéric Says précise :
« Le nom de cette application ? Alicem, acronyme pour « Authentification en ligne certifiée sur mobile ». Étonnamment, ces programmes jugés intrusifs portent toujours des noms doucereux, printaniers, féminins. « Alicem », cela rappelle délicieusement le prénom Alice et finit par la syllabe « aime ».
Il y a eu un précédent. C’était en 2008. Souvenez-vous d’« Edvige ». Une base de données qui fichait les individus potentiellement dangereux, mais aussi les préférences religieuses et sexuelles de responsables politiques, syndicaux, économiques. Michèle Alliot-Marie était alors ministre de l’Intérieur. Devant le tollé, elle avait dû reculer [extrait sonore].
Alicem, Edvige : comment nourrir le moindre soupçon envers de si jolis noms ? Certes, ce serait étonnant que ces programmes s’appellent « Terminator 3.0 » ou « GeorgeOrwell2019″…
Il ne s’agit pas ici de dire, bien sûr, que le gouvernement masque des intentions totalitaires. Le ministère de l’Intérieur rappelle d’ailleurs que cette application s’appuie le consentement de l’utilisateur. Il n’est pas question de reconnaissance faciale non consentie comme en Chine.
Aujourd’hui oui, mais demain ?
L’avancée technologique rend possibles le traitement de masse des données privées, et donc le rétrécissement massif des libertés publiques. »
Cette application devrait voir le jour en novembre.
La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) joue une sorte de rôle de lanceur d’alerte et prétend que cette application serait en contradiction avec le droit européen, notamment parce qu’elle ne propose aucune alternative à la reconnaissance faciale pour se connecter à certains services.
Ce site spécialisé en informatique précise les réticences de la CNIL <ALICEM : la biométrie de l’identité numérique sur mobile fait tiquer la CNIL>
Si vous voulez en savoir davantage, « Sciences et Avenir » essaye de faire <le point sur Alicem, le système de reconnaissance faciale du ministère de l’Intérieur>
L’association <La Quadrature du Net> a déposé un recours contre Alicem devant le Conseil d’État.
Tout ceci est bien sûr mis en œuvre pour assurer une meilleure sécurité sur Internet, éviter le passage par un mot de passe qui selon tous les avis autorisés constitue une passoire en matière de sécurité.
Certains prétendent que cette évolution, « ce progrès » disent-ils, est inéluctable.
Il n’en reste pas moins que tout ce qui est techniquement possible n’est pas forcément souhaitable. Il faut au moins se poser la question…
<1288>
-
Lundi 14 octobre 2019
« Il y a un concours Lépine délirant de la répression »François SureauQuatre fonctionnaires de police ont été assassinés, le jeudi 3 octobre 2019, dans les locaux de la Préfecture de Police par un autre fonctionnaire de la préfecture exerçant des missions informatiques. L’assassin était doté d’une habilitation secret-défense, qui lui permettait d’avoir accès à des informations protégées.
Il y a probablement eu des dysfonctionnements dans l’organisation de la préfecture qui ont conduit à ces conséquences dramatiques.
Qu’on s’interroge sur la nature des dysfonctionnements et de la manière à essayer d’y remédier semble raisonnable.
Mais cela conduit à nouveau à des propositions de nouvelles lois, de nouvelles règles, pour essayer de détecter la « radicalisation » au plus tôt et des propositions toujours plus liberticides voient le jour.
François Sureau a été aussi invité par Olivier Duhamel sur Europe 1 dans l’émission <Médiapolis du 12 octobre 2019> et a me semble t’il avancé des explications qui sont intéressantes à partager.
Les propos que j’ai essayé de transcrire commencent à la minute 18. C’est d’abord Olivier Duhamel qui donne son analyse après les assassinats de la préfecture :
«On a l’impression d’avoir entendu, cette semaine, des choses terrifiantes sur les propositions concernant la lutte contre le terrorisme islamiste.
On a l’impression que plus personne, quand il se produit un attentat, plus personne ne se pose la question : jusqu’où peut-on aller dans les mesures à prendre, sans toucher aux libertés fondamentales ?
C’est une question qui n’existe même plus !»
Et voici ce qu’a répondu François Sureau :
« Il y a un concours Lépine délirant de la répression.
Il y a en plus un oubli fondamental de ce que nous sommes. Notre système a été pensé pour qu’il permettre une répression extrêmement dure, y compris pour les actes terroristes, sans pour autant s’écarter des principes.
On peut trouver, sans difficulté, des juges anti terroristes pour signer des mandats. On a tout à fait les moyens pour arrêter les gens.
Ce n’est pas comme si nous vivions dans un Droit pénal de bisounours. Notre Droit pénal est extrêmement sévère et répressif, il n’y a rien à y ajouter.
La question est pourquoi on y ajoute quelque chose ?
La première raison est comme le dit Olivier Duhamel que la question de savoir si on ne touche pas de manière disproportionnée aux libertés fondamentales a disparu de l’esprit de tout le monde.
A la fin, il y a les 9 sages du Conseil Constitutionnel qui de temps en temps retoque une mesure. Mais avant ça, il n’y a absolument plus rien. Et ceci me parait extrêmement dangereux
La deuxième raison je crois c’est aussi un déséquilibre institutionnel. J’ai lu le premier tome des mémoires de Cazeneuve, c’est très intéressant. Lors des attentats terroristes, la totalité de cette question : l’arbitrage « sécurité – liberté » passe dans la cervelle du ministre de l’Intérieur et de lui seul. Comme s’il n’y avait pas de Ministre de la Justice, comme s’il n’y avait pas de Parlement, pas de commission des Lois, comme s’il n’y avait personne. C’est extrêmement gênant et c’est du probablement à l’évolution institutionnelle de la Vème République.
Il y a une troisième raison, nous sommes devenus une Société qui est incapable de supporter la présence du Mal en elle-même. Le Mal doit être extérieur, il doit être étranger. Il doit être éradiqué sans que l’on ne regarde d’aucune manière aux principes qui peuvent gouverner aux procédures de son éradication.
Le Mal est quelque chose que nous ne pouvons plus penser. Nous n’avons plus d’idée du salut individuel, nous n’avons plus d’idée du progrès politique.
Le Mal doit être éloigné de nous !
Et tout ce qu’on voit en matière de concours Lépine, tout comme la rétention de sureté, tout comme la déchéance de nationalité manifestent cette idée que nous allons expulser le mal parce que nous sommes des purs.
Ceci m’inquiète énormément. »
J’insiste sur ce sujet des libertés, parce que nous sommes vraiment dans une dérive de plus en plus inquiétante.
Surtout que l’imagination liberticide de certains technocrates semble débordante.
Et je considère qu’un homme comme François Sureau reste un port d’attache de nos valeurs qui dit les choses simplement :
Les moyens répressifs et de contrôle existent.
Il existe des difficultés d’organisation et de mise en œuvre.
Mais il est nul besoin d’alourdir sans cesse les contraintes et les libertés de tout le monde pour lutter contre ce type de criminalité.
Surtout sans se poser les questions des libertés fondamentales.
Et je trouve ce rappel que le mal existe, qu’il faut l’affronter avec nos valeurs, constitue un rappel salutaire.
<1287>
-
Vendredi 11 octobre 2019
« Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté. »Paul Eluard, dernière strophe du poème « Liberté »Lors de <l’entretien> que je vous invite vraiment à écouter, François Sureau a cité le poème d’Eluard : « Liberté »
Je trouve pertinent après avoir distillé l’argumentation rationnelle hier, à reprendre aujourd’hui le même sujet mais sous le format de la poésie.
« Liberté » est un poème que Paul Éluard a écrit en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, comme une ode à la liberté face à l’occupation allemande. Il s’agit d’une longue énumération de tous les lieux, réels ou imaginaires, sur lesquels le poète écrit le mot « liberté ».
Le titre initial du poème était « Une seule pensée » : Paul Eluard a confié :
« Je pensais révéler pour conclure le nom de la femme que j’aimais, à qui ce poème était destiné. Mais je me suis vite aperçu que le seul mot que j’avais en tête était le mot Liberté. Ainsi, la femme que j’aimais incarnait un désir plus grand qu’elle. Je la confondais avec mon aspiration la plus sublime, et ce mot Liberté n’était lui-même dans tout mon poème que pour éterniser une très simple volonté, très quotidienne, très appliquée, celle de se libérer de l’Occupant »
Le poème est publié le 3 avril 1942, sans visa de censure dans un recueil clandestin « Poésie et vérité ». Il est parachuté à des milliers d’exemplaires par des avions britanniques de la Royal Air Force au-dessus du sol français
Liberté
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom
Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom
Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom
Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom
Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom
Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom
Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom
Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom
Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom
Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom
Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom
Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommerLiberté
Paul Eluard
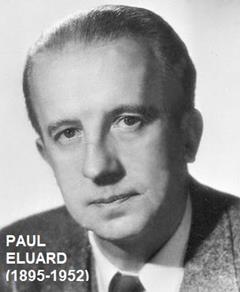 Paul Eluard écrivait aussi : « Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d’autre »
Paul Eluard écrivait aussi : « Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d’autre »
On trouve sur internet plusieurs artistes qui déclament le poème <Liberté>:
D’abord <Paul Eluard> lui-même qui présente son poème, les conditions de sa création puis le récite.
Et aussi dans <cette vidéo> Paul Eluard récite le poème qui s’affiche strophe après strophe.
<Jean-Louis Barrault> le récite, comme <Gérard Philippe>.
Plus récemment <Guillaume Gallienne> a aussi interprété ce poème.
Et je finirai par <Le poème mis en musique par Yvonne Schmidt> et chanté par Francesca Solleville.
<1286>
-
Jeudi 10 octobre 2019
« Je pense que sans la liberté il n’y a rien dans le monde »François-René de ChateaubriandHier nous nous posions la question, les droits de l’homme rendent-ils idiots ?
Tant il est vrai que de plus en plus de beaux esprits et de gouvernants fustigent les « droitsdel’hommiste » qui empêcheraient l’efficacité et ne comprendraient pas la vraie aspiration des gens du peuple.
Notre société s’est construite autour des droits de l’individu et de la liberté.
Liberté qui n’existe pas dans les pays théocratiques ou même dans des sociétés très religieuses, dans des ֤États dirigés par des dictatures et même des États autoritaires ou nationalistes.
Or nos libertés sont en train d’être restreintes de manière de plus en plus sérieuse et avec une totale disproportion avec la réalité des dangers que les lois liberticides entendent prévenir.
C’est ce que dit l’avocat François Sureau, pourtant ami de Macron qu’il n’hésite pas à critiquer dans le domaine des libertés et de la répression.
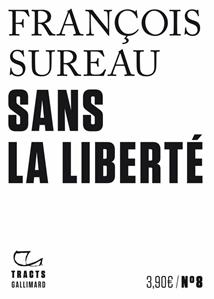 Il a rédigé un petit ouvrage de 64 pages : « Sans la liberté »
Il a rédigé un petit ouvrage de 64 pages : « Sans la liberté »
François Sureau a déjà fait l’objet de trois mots du jour :
- Une première fois le 18 septembre 2013 : «Le Droit ne fait pas Justice.» où il expliquait qu’une de ses plus terribles expériences de justice fut lorsqu’il dut participer à une décision du Conseil d’État qui refusa l’asile politique à un militant basque Javier Ibarrategui qui se disait menacé de mort en Espagne. Ibarrategui retourna donc dans son pays où des groupes d’extrême droite, des anciens franquistes, l’assassinèrent comme il l’avait annoncé.
- Une seconde fois lorsqu’il plaida devant le Conseil Constitutionnel avec une éloquence et une hauteur de vue exceptionnelles contre cette idée absurde de vouloir interdire et de sanctionner la liberté d’aller sur des sites djihadistes : « La liberté de penser, la liberté d’opinion, […] n’existent pas seulement pour satisfaire le désir de la connaissance individuelle, le bien-être intellectuel de chaque citoyen. […] Elles [existent] aussi parce que ces libertés sont consubstantielles à l’existence d’une société démocratique ». C’était le mot du jour du
13 février 2017. Pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus qu’une telle interdiction est à la fois stupide et liberticide, il faut relire cette plaidoirie.
- La dernière fois le 22 juin 2017, lorsqu’il s’attaqua à la volonté de son ami Macron de mettre dans la Loi du commun des mesures de l’état d’urgence qui est par essence exceptionnel. « Un gouvernement généralement mal inspiré, face à une angoisse générale totale, a cherché la chose la plus spectaculaire qu’il pouvait mettre en place et il a décidé de mettre en place l’état d’urgence »
Je l’ai entendu le 24 septembre 2019 sur France Inter interrogé par Nicolas Demorand et Léa Salamé. Il dit que « la liberté a déjà disparu à cause de la demande sociale de sécurité » mais que son texte plein de vitalité espère lutter contre cette pente douce et dangereuse. Il espère que ce qui nous caractérise, nous, les français et les européens, l’amour de la liberté reprendra le dessus « sur la trouille généralisée ».
Et dans cet entretien qu’il faut écouter il énumère :
« Nous vivons dans un pays où
- Le gouvernement peut choisir ses manifestants ;
- Où on continue d’enfermer les gens après l’expiration de leurs peines ;
- Où des juges ont qualité pour censurer l’expression d’une opinion ;
- Il n’est pas nécessaire de passer à l’acte pour être condamnable, mais simplement d’en avoir l’idée ;
- Partout des policiers en tenue de goldorak ;
Rien de tout cela n’était concevable pour quelqu’un de ma génération »
Dans un article de <La Croix> son ouvrage est présenté ainsi :
« Les faits sont connus pour qui veut bien les voir : restriction des libertés liée à l’état d’urgence, présence dans nos rues de forces de l’ordre dotées d’armes de guerre, loi anti-casseurs conduisant à considérer le citoyen libre comme un délinquant en puissance, loi anti-fake news sanctionnant les contenus a priori, loi contre les « contenus haineux » encourageant les opérateurs privés d’Internet à la censure…
Autant de dispositions législatives témoignant d’un climat général, celui « d’un pays où les libertés ne sont plus un droit mais une concession du pouvoir, une faculté susceptible d’être réduite, restreinte, contrôlée autant dans sa nature que dans son étendue ». »
Dans son livre il cite Chateaubriand que j’ai choisi comme exergue de ce mot du jour : « Je pense que sans la liberté il n’y a rien dans le monde. »
Et <Le monde> le cite :
« Que les gouvernements, celui d’aujourd’hui comme les autres, n’aiment pas la liberté, n’est pas nouveau. Les gouvernements tendent d’abord à l’efficacité. Que des populations inquiètes, après un demi-siècle passé sans grandes épreuves et d’abord sans guerre, du terrorisme ou d’une insécurité diffuse ne soient pas portées à faire le détail n’est pas davantage surprenant. Mais il ne s’agit pas de détails. L’état de droit, dans ses principes et dans ses organes, a été conçu pour que ni les désirs du gouvernement ni les craintes des peuples n’emportent sur leur passage les fondements de l’ordre politique, et d’abord la liberté.
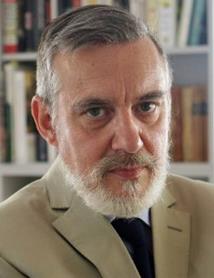 C’est cette conception même que, de propagande sécuritaire en renoncements parlementaires, nous voyons depuis vingt ans s’effacer de nos mémoires sans que personne ou presque ne semble s’en affliger. Je tiens pour vain l’exercice de l’indignation. L’indignation suppose je ne sais quel optimisme que je ne partage plus, l’idée qu’une protestation bien argumentée pourrait faire dévier le cours des choses. Nous n’en sommes plus là. Nous nous sommes déjà habitués à vivre sans la liberté. (…)
C’est cette conception même que, de propagande sécuritaire en renoncements parlementaires, nous voyons depuis vingt ans s’effacer de nos mémoires sans que personne ou presque ne semble s’en affliger. Je tiens pour vain l’exercice de l’indignation. L’indignation suppose je ne sais quel optimisme que je ne partage plus, l’idée qu’une protestation bien argumentée pourrait faire dévier le cours des choses. Nous n’en sommes plus là. Nous nous sommes déjà habitués à vivre sans la liberté. (…)
Les hasards de la vie m’ont amené à voir comment se prenaient les décisions qui affectent nos libertés, qu’elles soient gouvernementales, législatives ou juridictionnelles. Je n’ai pas été rassuré à ce spectacle, qui m’est apparu comme celui de la démission des acteurs principaux de la démocratie représentative face aux réquisitions intéressées des agents de la répression. A eux non plus il n’est pas possible d’en vouloir, mais bien plutôt à ceux qui ont la charge de les contrôler et de les commander et qui s’en abstiennent, soit par incapacité, soit par inculture – je parle ici d’inculture constitutionnelle –, soit par démagogie. On peut tenir pour peu de chose la déclaration de tel ministre de l’intérieur selon laquelle les forces de l’ordre le trouveront toujours derrière elles, pour les suivre en effet et les absoudre autant qu’il est possible, et non pas devant elles, pour les commander. On peut aussi y voir l’aveu d’une démission que tous les grands mots du monde ne pourront plus effacer de notre mémoire collective, si du moins nous ne cessons pas d’oublier que nous sommes des citoyens avant d’être des électeurs.
Citoyens, tant que nous le restons, nous devons accepter de prendre sur nous une large part des fautes de ceux que nous nous sommes donnés pour nous diriger. Il n’y a pas de ministre de l’intérieur. Il dépend à la fin de nous que ceux qui gouvernent et répriment puissent ou non aller jusqu’au bout de cette inclination à l’autoritarisme qui est le lot de tout pouvoir […]
Notre système des droits n’a pas été pensé seulement pour les temps calmes.
A l’époque où il est apparu sous sa forme moderne, l’insécurité était assez générale. On ne traversait pas la forêt de Bondy sans escorte. C’est en des temps bien plus calmes que nous nous sommes éloignés des principes. Il n’est pas nouveau que les gouvernants s’impatientent de la liberté. Il est plus étonnant que le citoyen y consente, parce qu’il est inquiet bien sûr, mais plus profondément parce qu’il se pense moins désormais comme citoyen que comme individu, réclamant des droits pour lui et des supplices pour les autres, prêt à ce que la liberté de tous s’efface pour peu qu’on paraisse lui garantir la sienne, sous la forme d’une pleine capacité de jouissance des objets variés qu’il aime.
Bernanos écrit que la liberté des autres lui est aussi nécessaire que la sienne. Cette idée n’est plus si communément partagée. Les gouvernements n’ont pas changé. C’est le citoyen qui a disparu.
Nous pouvons voir à présent où ce chemin nous mène. Il s’en est fallu de peu que, sous prétexte de terrorisme, ne soit introduit dans le droit français un pur délit cognitif, celui de la consultation de sites Internet, motif pris de leur caractère dangereux ; c’est-à-dire que nous consentions à cette censure qui, à la fin, ne peut se fonder que sur l’idée que le citoyen n’est pas un être majeur et capable de discernement ; il s’en est fallu de peu que, répudiant une conception qui animait notre droit criminel depuis le Moyen Age, nous ne considérions qu’il était possible de condamner quelqu’un sur la vague intention du passage à l’acte, sans même pouvoir relever un commencement d’exécution ; il s’en est fallu de peu que les agents du gouvernement ne pussent assigner à résidence de simples suspects, comme sous la Terreur ou dans les pires moments de la Restauration. Gouvernements et Parlement de droite et de gauche ayant cédé sous la vague, par lâcheté, inculture ou démagogie, il n’a dépendu que du Conseil constitutionnel que ces errements soient arrêtés. Encore n’est-ce, on peut le redouter, que temporaire. Tout le monde voit bien, si l’on en juge par tant de déclarations fracassantes, que le moindre attentat nous met à la merci des mêmes emportements.
Ce qui est troublant, c’est qu’on ne peut pas les réputer fondés sur la recherche d’une efficacité maximale dans la répression. Le droit pénal français, modifié pratiquement chaque année depuis dix ans, est l’un des plus durs qui soient, et personne ne peut tenir les procureurs et les juges du siège pour des agneaux bêlant les litanies de l’humanitarisme. Ainsi le sacrifice des principes ne sera-t-il jamais payé d’une autre monnaie que celle de l’abaissement en pure perte. Tout se passe comme si, depuis vingt ans, des gouvernements incapables de doter, de commander, d’organiser leur police ne trouvaient d’autre issue que celle consistant à restreindre drastiquement les libertés pour conserver les faveurs du public et s’assurer de son vote, dans une surprenante course à l’échalote qui nous éloigne chaque année un peu plus des mœurs d’une véritable démocratie. (…)
Ce qui est inattendu, c’est que les atteintes portées au droit depuis vingt ans ont été le fait de gouvernements et de Parlements en réalité plutôt centristes. De tels pouvoirs ne sont d’ordinaire pas portés aux excès dans la gestion des libertés publiques, puisqu’ils ne peuvent se réclamer d’aucun horizon, d’aucune perspective qui les justifieraient. Si bien que le viol des libertés par un gouvernement généralement centriste manifeste simplement son manque de fermeté d’âme dans l’occupation du terrain qui est le sien propre, ce qui, et de loin, ne permet pas de l’absoudre. […]
Nous avions fait des droits de l’homme le principe de notre gouvernement, mais nous n’avons pas cessé de nous trouver de bonnes raisons de les méconnaître, si bien que nous n’avons plus ni vraiment de liberté ni vraiment de gouvernement. Nous sommes devenus incapables, par voie de conséquence, de respecter ces instruments qui ne sont que des instruments mais qui conditionnent l’exercice de la liberté effective, et d’abord la séparation des pouvoirs, continûment violée dans sa lettre et dans son esprit depuis près de dix ans, au mépris des droits du citoyen. »
Des paroles fortes, un esprit vigilant !
Il se passe quelque chose de pas sain au sein de notre vieille France. Les autres États qui nous ressemblent n’en sont d’ailleurs pas épargnés.
Tout cela fait penser à <la fable de la grenouille> qui relate une observation supposée concernant le comportement d’une grenouille placée dans un récipient contenant de l’eau chauffée progressivement. Cette fable peut s’énoncer ainsi :
Si l’on plonge subitement une grenouille dans de l’eau chaude, elle s’échappe d’un bond ; alors que si on la plonge dans l’eau froide et qu’on porte très progressivement l’eau à ébullition, la grenouille s’engourdit ou s’habitue à la température pour finir ébouillantée.
<1285>
- Une première fois le 18 septembre 2013 : «Le Droit ne fait pas Justice.» où il expliquait qu’une de ses plus terribles expériences de justice fut lorsqu’il dut participer à une décision du Conseil d’État qui refusa l’asile politique à un militant basque Javier Ibarrategui qui se disait menacé de mort en Espagne. Ibarrategui retourna donc dans son pays où des groupes d’extrême droite, des anciens franquistes, l’assassinèrent comme il l’avait annoncé.
-
Mercredi 9 octobre 2019
« Les droits de l’homme rendent-ils idiot ? »Justine Lacroix et Jean-Yves PranchèreJustine Lacroix est belge. Elle est professeure à l’université libre de Bruxelles spécialisée dans les sciences politiques.
Elle a écrit avec Jean-Yves Pranchère qui enseigne dans la même université, dans le même domaine de recherche, un livre paru le 26 septembre 2019 : « Les droits de l’homme rendent-ils idiot ? »
C’est un titre provocateur !
Les gens de mon âge, surtout s’ils ont fait des études de droit et se sont intéressés à la politique française et internationale, considéraient comme évident que les droits de l’homme constituaient une valeur universelle qui ne pouvaient que progresser dans tous les pays du monde. Même les dictateurs, de droite, expliquaient que si pour l’instant pour des raisons conjoncturelles, les droits de l’homme n’étaient pas respectés dans leur pays, la situation allait bientôt évoluer et qu’à terme le respect des droits de l’homme constituait une cible à atteindre.
Je dis de droites, parce que les dictatures communistes se méfiaient des droits de l’homme et des libertés qu’ils appelaient « formelles » des États libéraux pour ne s’intéresser qu’aux prétendus droits des classes laborieuses. Au bout d’arguments fallacieux, ces « démocraties populaires » qui n’étaient ni démocratiques ni populaires, cachaient, derrière une rhétorique obscure, des régimes de surveillance et de terreurs ne profitant qu’à une petite nomenklatura.
Alors quand le système communiste s’est effondré à l’est, nous pensions que la victoire des droits de l’homme était inéluctable.
Nous avons dû déchanter.
D’abord la Chine, refuse cette valeur individualiste des droits et des libertés de l’homme pour se réfugier dans des valeurs confucéennes de hiérarchie, d’autorité et de suprématie du collectif sur l’individu.
Les régimes « illibéraux » ou « démocratures » qui se multiplient dans le monde et en Europe, laissent encore fonctionner des élections, mais considèrent que les droits individuels et les libertés qui sont le cœur des droits de l’homme sont un obstacle à l’identité du pays et au rayonnement national.
Et même, à l’intérieur des démocraties libérales les plus anciennes, il y a des tendances suspectes par rapport à cette question.
Aux Etats-Unis, Donald Trump n’évoque jamais les droits de l’homme.
Et en France ? nous y reviendrons ultérieurement.
Guillaume Erner a invité Justine Lacroix à son émission matinale du 8 octobre 2019 : <Immigration, climat, terrorisme les droits de l’homme-sont-ils-dépassés ?>
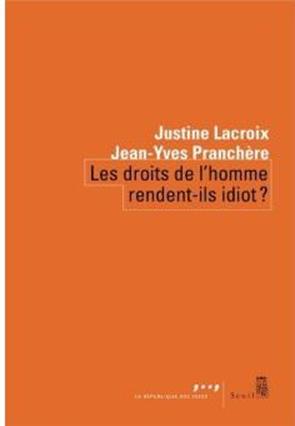 L’émission est introduite ainsi :
L’émission est introduite ainsi :
« Le débat sur l’immigration à l’Assemblée Nationale s’est ouvert ce lundi. Centrale dans l’acte 2 du quinquennat, la question fait débat depuis les années soixante-dix. Aux pourfendeurs de l’accueil s’opposent ceux qui dénoncent le « droitsdelhommisme ». Quand les premiers invoquent des droits universels, les seconds, eux, critiquent ce qui serait une forme de bien-pensance et de générosité naïve. Par ailleurs, en matière d’écologie, les actions de désobéissance civile se multiplient, comme ce samedi avec l’occupation du centre commercial Italie 2, interrogeant sur leur légitimité en démocratie. Les conséquences du changement climatique, la crise des réfugiés ou encore le terrorisme sont autant d’enjeux où notre rapport aux droits de l’homme est mis à l’épreuve. Peut-on encore faire face aux défis du temps présent sans renoncer aux droits de l’homme ? »
Guillaume Erner s’appuyant sur la revue de presse internationale qui évoquait le retrait américain en Syrie laissant la voie libre à une intervention militaire sanglante des turcs contre les Kurdes qui jusqu’à présent étaient les alliés des américains et avaient combattu en première ligne contre nos ennemis communs les fanatiques islamistes de Daech et des autres groupes djihadistes, a posé la question de savoir si ce n’était pas la preuve que les droits de l’homme étaient de plus en plus bafoués ?
Justine Lacroix, après avoir dit que les actions des États étaient rarement basées sur les droits de l’homme, a ajouté :
« Ce qui est vraiment nouveau c’est que les droits de l’homme sont largement discrédités. Il y a eu un retournement depuis une décennie. Dans les années 1990, il y avait une adhésion au moins de surface : on ne pouvait pas les critiquer ouvertement. Aujourd’hui, on voit des dirigeants qui théorisent leur remise en cause. […]
Dans ces nouveaux discours, les partisans des droits de l’homme apparaissent de plus en plus comme des naïfs. »
Elle fait remonter le malaise à la deuxième guerre d’Irak qui a décrédibilisé les droits de l’homme. Et il est vrai que les américains en s’exonérant de toute légalité internationale et de tout accord de l’ONU se sont lancés dans cette guerre sans pouvoir justifier de raisons légitimes. Aujourd’hui, nous savons en outre que les preuves avancées par le gouvernement de Georges Bush junior pour prétendre que l’Irak disposait d’armes de destruction massive étaient fausses et fabriquées
Justine Lacroix conclut sur ce point :
« L’instrumentalisation des droits de l’homme par l’administration américaine a conduit à associer les droits de l’homme à une logique de domination impériale. »
En France, les projets de loi, comme les déclarations de membres du gouvernement mettent très souvent l’accent sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme ou l’immigration clandestine, sans insister sur les droits de l’homme et même en considérant qu’ils constituent un obstacle à la bonne « gouvernance » et aux politiques légitimes pour satisfaire ce qu’ils estiment être les aspirations des français.
Et c’est Nicolas Sarkozy qui a utilisé cette formule des « droit-de-l’hommisme » pour essayer de discréditer cette valeur. Sans doute aurait-il répondu « Oui » à la question posée par le livre : « Les droits de l’homme rendent-ils idiot ? »
Selon Justine Lacroix et concernant l’origine de cette expression :
« Il semble que ce soit Jean-Marie Le Pen le premier qui ait forgé cette expression, puis elle s’est imposée petit à petit chez des responsables politiques situés dans des champs plus respectables de l’échiquier politique. Nicolas Sarkozy l’a utilisé dans le contexte précis de la question migratoire. »
Justine Lacroix n’a pas une vision simpliste des droits de l’homme, notamment par rapport à l’immigration :
« Aujourd’hui, le débat oppose de façon tronquée et manichéenne des « droits-de-l’hommistes » caricaturés comme plaidant pour un droit universel de circulation à l’échelle du globe et qui voudraient l’ouverture totale des frontières et les autres, qui auraient le sens de la préservation de l’intégrité culturelle, des équilibres sociaux, qui feraient preuve de plus de réalisme. […] Les droits de l’homme ne déterminent pas totalement nos rapports à des sujets comme l’immigration. Est-ce que les droits de l’homme signifient que chaque individu s’installe où il le souhaite ? Peut-être, dans une conception très individualiste des droits de l’homme. Mais est-ce que les droits de l’homme ne renvoient pas d’abord à une liberté collective ? Liberté d’autodétermination, liberté de délibérer ensemble de notre avenir commun. […]
À partir des droits de l’homme, on a tout le champ du possible qui s’ouvre, et je refuse cette façon d’associer celui qui croit aux droits de l’homme aux bourgeois, où le bourgeois serait celui qui croit à l’ouverture des frontières. »
Justine Lacroix qui veut évidemment réhabiliter la notion de droit de l’homme et des libertés individuelles considèrent qu’on met trop souvent en avant la notion de droit, alors qu’il s’agit simplement d’un désir.
Ainsi « le droit à un enfant » que certains revendiquent, c’est un désir d’enfant, existe-t-il un droit ? L’enfant a droit à des parents et en toutes hypothèses a droit à une éducation. L’enfant a aussi le droit d’être protégé devant les violences et menaces de toute sorte. Mais existe-t-il un droit à un adulte de revendiquer un enfant ? La réponse que j’approfondirai dans un autre mot du jour est très certainement « Non ».
Justine Lacroix estime aussi qu’il n’est pas judicieux de parler de droit des animaux. Il est, selon elle, légitime d’interdire les pratiques qui font souffrir les êtres sensibles que sont les animaux, sans que pour autant il faille conférer « un droit » à l’animal.
Il n’existe pas davantage un droit de polluer, correspondant à une liberté individuelle, surtout si cette pollution a pour conséquence un dommage à l’humanité entière.
Elle en appelle à Hannah Arendt qui considérait que les droits de l’homme n’avaient de raison d’être que parce qu’il existait une société, c’est-à-dire une multitude d’hommes. Or l’homme ne peut et ne doit pas, par sa liberté, porter atteinte à la société dans son ensemble. Les droits de la personne dans son esprit ne sont pas en contradiction avec la solidarité.
C’est une réflexion qui me parait très féconde et je vous redonne le lien vers l’émission : <sous format vidéo>
<1284>
-
Mardi 8 octobre 2019
« Pour rester en bonne santé, soyez optimiste et ayez des amis »Conclusions de plusieurs études scientifiquesLes personnes optimistes auraient moins de risques de mourir prématurément. C’est ce que suggère <le site SLATE>
Et pour argumenter cette assertion, Slate se réfère à une étude, publiée sur le site du JAMA Network le 27 septembre 2019, et conduite par une équipe de scientifiques new-yorkais spécialisés en cardiologie et en sciences comportementales. Leurs travaux de recherche rassemblent les données de quinze analyses déjà publiées portant sur 230.000 hommes et femmes à travers le monde sur une période de quatorze années.
Les chercheurs et chercheuses ont pu montrer l’existence d’un lien entre l’optimisme, défini comme «la tendance à penser que de bonnes choses vont se produire dans le futur», et un risque moins élevé de 35% de souffrir d’une crise cardiaque, et de 14% de décéder d’une mort prématurée, toutes causes confondues (cancer, démence, diabète, etc).
Une des explications donnée est qu’une personne optimiste pourrait avoir tendance à adopter un mode de vie plus sain, à faire plus d’exercice, à arrêter de fumer…
Et l’article cite une autre étude du début de l’année 2019, de l’université de Boston, qui avait déjà montré que l’optimisme pouvait être un facteur d’allongement de l’espérance de vie.
Le magazine <Psychologie> quant à lui s’est intéressé à une étude qui démontrerait qu’avoir des amis serait aussi bon pour la santé particulièrement pour lutter contre la maladie d’alzheimer :
« L’étude anglaise Whitehall II a porté depuis 1985 sur plus de 10 000 fonctionnaires : elle vient de montrer le lien entre notre cerveau et nos relations sociales. Les chercheurs expliquent dans la revue Plos Medecine qu’une plus grande fréquence des rapports sociaux à l’âge de 60 ans s’accompagne d’une réduction du risque de développer une démence comme celle de la maladie d’ Alzheimer. On sait désormais également le rythme idéal de nos soirées et autres sorties: un sexagénaire qui verrait un ou deux amis par jour réduit ses risques de 12 % par rapport à quelqu’un qui ne verrait ses amis qu’une fois par mois ! L’interaction avec d’autres est en effet capitale : elle permet de solliciter les circuits cérébraux, de développer la mémoire, de faire naître des émotions. Plus étonnant encore : les amis protègent mieux contre Alzheimer que la famille. En effet, avec ses proches, on reste dans sa zone de confort, on fait moins d’efforts qu’avec les amis qu’il faut convaincre, séduire, conserver. »
Et <Frédéric Pommier> qui dans sa revue de presse renvoie vers ces deux articles, conclut :
« […] tant qu’à faire, choisissez des amis optimistes. »
C’est probablement plus facile à dire ou à écrire qu’à faire.
Mais cela donne au moins des pistes et des voies vers lesquelles ils faut tenter de s’approcher si on considère que rester en bonne santé constitue un objectif sérieux et souhaitable.
Ce que j’ai la faiblesse de croire.
<1283>
-
Vendredi 4 octobre 2019
« Pause »Prochain mot du jour le 8 octobre 2019
Pour patienter, je vous laisse méditer sur cette planche de dessin
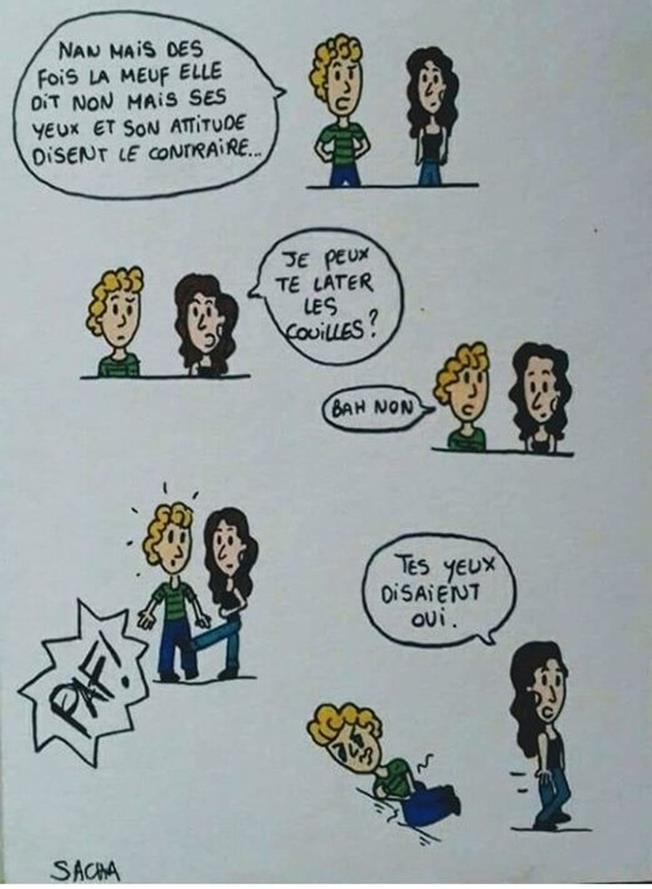
-
Jeudi 3 octobre 2019
« Malheureusement, pour beaucoup de gens, la seule fois dans leur vie où ils seront face à eux-mêmes, c’est au moment de mourir. »Richard BéliveauRichard Béliveau est un docteur en biochimie et un chercheur en cancérologie. Il est canadien.
Je l’ai découvert grâce à David Servan-Schreiber qui lui faisait une grande confiance concernant l’alimentation.
Car Richard Béliveau prétend que l’alimentation constitue une véritable arme pour tenir le cancer à distance et quand il est là, l’alimentation peut aider aussi, même si cela est compliqué.
Mais quand j’attaquerai la seconde partie de ma série sur l’alimentation, je reviendrai vers les propositions du docteur canadien.
Il s’intéresse aussi à un autre sujet. Sujet avec lequel les derniers mots du jour ont, plusieurs fois, été confrontés : la mort.
Et il a écrit un livre, qui comme ceux pour l’alimentation est co-rédigé par le docteur Denis Gingras et dont le titre est « La Mort : Mieux la comprendre et moins la craindre pour mieux célébrer la vie ». Ce livre a été publié en 2010
J’ai trouvé un site canadien qui l’a interviewé à propos de ce livre. Cet entretien m’a beaucoup touché car dans des mots simples, il dit des choses essentielles sur la mort et donc sur la vie.
La mort pour beaucoup constitue un tabou. Une réalité qu’on cherche à fuir par tous les moyens. La suractivité en étant le moyen le plus usité.
Très humblement, je ne crois pas qu’il faut fuir ainsi, car la mort a beaucoup de choses à nous dire sur la vie et le docteur Béliveau essaie de nous aider dans ce sens.
L’ouvrage lui-même, selon ce que j’en comprends car je ne l’ai pas lu, explique les processus biologiques liés à la mort, les différentes causes de mort, et expose des conceptions historiques, culturelles et spirituelles de la mort. Il explore la biologie et les limites de la vie, les rituels de la mort et les craintes qui lui sont associées et décrit les phénomènes entourant la perte de la vie. Le livre est illustré par des copies d’œuvre de l’art, peintures et sculptures offrant diverses représentations de la mort.
L’entretien du docteur Béliveau que j’ai lu se trouve derrière <ce lien>
Il explique pourquoi il a souhaité aborder ce sujet :
« Lorsqu’on s’oriente vers la recherche, c’est pour trouver des solutions à des problèmes non résolus, et le cancer est le tueur numéro un dans les pays industrialisés, dont le Canada. C’est une maladie terrible qui détruit des vies, qui détruit des espoirs et c’est le type de maladie qui illustre parfaitement le paradoxe de la vie. Quand on travaille sur le cancer, on est toujours à la très mince frontière entre la vie et la mort, parce qu’on doit développer des médicaments qui tuent une forme de vie – la vie des cellules cancéreuses – tout en épargnant les cellules saines voisines. Un chercheur en oncologie navigue perpétuellement sur cette mince frontière qui sépare la vie de la mort. Or, dans mon travail, je suis nécessairement en contact avec des gens très malades qui meurent. Et ce contact avec la mort est quelque chose qui exerce beaucoup d’influence. La détresse, la sérénité, ou encore les questionnements existentiels des gens deviennent vôtres, parce qu’ils sont les vôtres. »
Prendre conscience que la vie est quelque chose d’extraordinaire comme l’écrit <Damasio>.
« Ce qui m’attriste, c’est de penser qu’il y a des gens qui meurent sans avoir vécu à leur pleine mesure, sans avoir pris conscience que la vie était quelque chose d’absolument extraordinaire. »
Et il donne cette évidence que la pensée de la mort, m’aide à mieux vivre.
« la mort ne me fait pas peur, je dirais même qu’elle me fascine. Comme être humain, je sais que je vais mourir. Et la pensée de la mort m’aide à mieux vivre. Ça m’aide à donner une perspective, à relativiser les problèmes qui m’agressent au quotidien. »
La mort est devenue un tabou dans notre société qui essaye de l’éviter sauf pendant quelques rares moments, souvent avant une cérémonie funèbre..
Richard Béliveau pratique les arts martiaux et il est passionné par la culture japonaise qui, selon lui, ne connaît pas ce tabou de la mort.
« Je déteste les tabous, quels qu’ils soient. Un chercheur n’aime pas les tabous. Un chercheur est un défonceur de portes. C’est un explorateur de l’inconnu; il fait changer les idées, il provoque des réflexions. »
Il considère que sa réflexion sur la mort et la continuation de son combat pour la vie et contre le cancer :
« Pour moi, c’est la continuité de ce que j’ai fait toute ma vie. Je travaille contre la mort depuis le début. Il m’est juste apparu comme une conséquence inéluctable d’en parler. Une fois qu’on a décidé de se prendre en main, qu’on ne fume pas, qu’on fait de l’exercice, qu’on mange bien, qu’on reste mince et qu’on se tient loin de la bouffe industrielle, quand on a fait tout ce qu’on pouvait faire dans son quotidien pour prendre soin de sa vie, quelle peur nous reste-t-il ? La peur de mourir… Les gens qui sont confrontés à la mort se posent des questions. Comment meurt-on du cancer ? d’une maladie cardio-vasculaire ? [etc…] Je crois que s’il y a une façon de transcender notre peur de la mort, c’est en la comprenant, et en la comprenant au point d’en rire. Parce que tout le monde passe par le même chas d’aiguille en fin de compte. Donc la logique pour moi était de vaincre cette peur-là, d’en parler, d’en parler, d’en parler et d’en parler. Plusieurs perceptions de la mort viennent du cinéma, et toutes ces perceptions sont fausses. On a banalisé la mort, on en a fait un jeu d’arcade, alors que c’est un événement très intime, très personnel, très angoissant.
Selon le Dalaï-lama, « Les gens vivent comme s’ils n’allaient jamais mourir et ils meurent comme s’ils n’avaient jamais vécu. » Ça résume très bien mon dernier livre.
Et il conteste qu’aborder la mort de front soit une marque de pessimisme ou de négation de la vie. Bien au contraire :
« Les gens les plus vivants que j’ai connus dans ma vie étaient confrontés à la mort sur une base régulière. Ils prenaient conscience de l’aspect précieux de la vie. On ne peut pas savourer la vie si on ne pense pas à la mort. C’est toujours la comparaison entre deux choses qui permet de les mettre en perspective. Des gens m’ont dit avoir commencé à vivre quand ils ont reçu un diagnostic de cancer. C’est aberrant de penser à ça, mais c’est la réalité. Si tous les êtres humains se levaient le matin en se disant que le soir ils pourraient être morts, on ne vivrait pas de la même façon. On conduirait moins vite sur les autoroutes, on serait plus patient avec les autres, on serait plus tolérant avec soi-même. Plutôt que de cacher la mort, la nier, la fuir ou la dénigrer comme on le fait, je pense qu’il y a une réflexion à faire là-dessus. C’est l’ignorance qui tue. L’ignorance de ce qui nous arrive est le facteur principal de stress, alors pour moi, comprendre la mort est capital. »
Et avant de mourir, il faut vivre et avoir une démarche responsable de santé, comme celle d’être acteur de sa guérison quand on est malade en s’inscrivant dans le temps long et la persévérance :
« On veut tout, tout de suite. On achète des objets dont on n’a pas besoin avec de l’argent que nous n’avons pas. Alors imaginez, nous, on arrive en prévention en disant « faites quelque chose maintenant qui va vous payer plus tard. » On est à contre-courant. Mais en même temps, beaucoup répondent à notre message. C’est faux de penser que les gens sont stupides et qu’ils ne changent pas; 70 % sont ouverts, curieux et prêts à changer. Sur la rue, des hommes bedonnants me disent avoir acheté leur première bouteille d’huile d’olive ou avoir goûté à de la grenade pour la première fois de leur vie. […] Nous sommes, en grande partie, responsables de notre santé !
Il n’y a pas de bouton de remise à zéro dans la vie ! On ne peut pas appuyer dessus et effacer les 30 dernières années.
Arrêtez de penser que vous pouvez fumer, ne pas faire de sport, être trop gras et mal manger pendant 50 ans sans problème. C’est un train de vie qui vous amène chez le médecin. Et là, vite guérissez-moi docteur ! Je ne veux pas que ça fasse mal, je ne veux pas d’effets secondaires, et je veux que ça prenne trois semaines. La responsabilité individuelle pour moi c’est important, il faut se prendre en main. »
Et je finis de le citer par ce constat si dur et si vrai que j’ai choisi comme exergue :
« On est surprotégé de façon hallucinante et pour moi, la façon la plus flagrante de le réaliser, c’est lorsqu’on est confronté à la mort. Parce que la mort, c’est la solitude, et la solitude est une expérience de confrontation à soi-même. Malheureusement, pour beaucoup de gens, la seule fois dans leur vie où ils seront face à eux-mêmes, c’est au moment de mourir. »
Ce n’est pas morbide de penser à la mort, à sa mort. C’est une leçon de vie qui fait qu’on aborde la vie autrement et dans la vie, sa santé aussi.
Le mot du jour se met en pause ce vendredi et lundi.
Mon frère et son épouse nous font l’honneur de nous rendre visite.
Et je veux me rendre pleinement disponible pour être là dans l’échange et dans la vie.
Je ne pourrai donc pas rédiger de mot du jour qui reviendra normalement mardi 8 octobre.
<1282>
-
Mercredi 2 octobre 2019
« Stand Up Straight and Sing
Tiens-toi droite et chante ! »Jessye Norman, titre de son autobiographieBien sûr, il y eut le 14 juillet 1989 et Jessye Norman habillée d’une robe tricolore qui prêtait sa voix, Place de la Concorde, pour chanter la marseillaise, une marseillaise pleine de passion, pleine de force.
 Depuis l’annonce de la mort de la chanteuse à la voix somptueuse, ce moment a souvent été rappelé et montré.
Depuis l’annonce de la mort de la chanteuse à la voix somptueuse, ce moment a souvent été rappelé et montré.
Mais mon souvenir est antérieur.
Il date d’une époque où la télévision donnait la possibilité à Jacques Chancel d’utiliser la première partie de la soirée pour faire une longue émission consacrée à une seule artiste souvent de musique classique comme Jessye Norman. Il s’agissait du <Grand Echiquier>. Je crois que l’émission eut lieu en 1984
Et Jessye Norman avait demandé à Jacques Chancel de diffuser un extrait du discours « I have a dream » de Martin Luther King, la fin de ce discours.
Alors, Jessye Norman s’est levé et dès que la voix de Martin Luther King s’est tue, elle a chanté « Amazing grace », a capella.
Moment d’émotion et de grâce.
<Une video existe> qui retranscrit cet instant unique
Tous les fibres de son être étaient en phase avec le pasteur noir qui avait lutté contre le racisme et la ségrégation.
Elle est née dans l’état de Géorgie un des principaux états confédérés lors de la guerre de sécession. La ségrégation raciale y était toujours présente au moment de la naissance de la future cantatrice, en 1945 dans la ville d’Augusta.
Ses parents militaient au sein de l’organisation NAACP pour les droits des Afro-Américains,
Dans son livre « Tiens toi droite et chante » publiée en 2014 sous le titre original « Stand Up Straight and Sing », une phrase que lui répétait sa mère, elle écrit :
« J’ai découvert la discrimination raciale et le système américain de l’apartheid bien avant d’entrer à l’école […] Mes parents, profondément engagés dans le mouvement en faveur des droits civiques (…), n’hésitaient pas à nous dire la vérité sur la ségrégation. »
Le racisme apparaît dans sa vie à l’âge de cinq ans, lorsqu’elle souhaite s’asseoir dans un bus et qu’elle découvre les places réservées aux « Colored people ». Au cours de sa carrière, le racisme a imprimé sa marque indélébile :
Et c’est en chantant dans l’église que Jessye Norman s’initie aux « « spirituals » au sein de la communauté noire. Elle décrochera une bourse d’étude à l’université Howard, établissement fondé à Washington pour accueillir les étudiants noirs en pleine ségrégation.
 Elle raconte que plus récemment :
Elle raconte que plus récemment :
« Il n’y pas si longtemps, j’attendais dans un hall d’hôtel en Floride que la pluie cesse de tomber. Un employé a appelé la sécurité pour s’assurer que j’étais bien cliente. C’est ce que j’appelle du racisme ordinaire… »
Le musicologue Alain Pâris a rapporté qu’elle lui a dit qu’ elle a appris très jeune le piano «par amour du chant» et le chant «par amour de la vie».
Et en 2014 elle disait à la radio américaine NPR :
« Je ne me souviens pas d’un moment dans ma vie, où je n’ai pas été en train d’essayer de chanter ».
Quand elle ouvrait la bouche , son visage rayonnait et une voix somptueuse pleine d’émotion vous saisissait et vous faisait vibrer jusqu’au plus profond de votre âme.
Il faut voir et surtout entendre cette vidéo dans laquelle elle chante la mort de Didon du « Didon et Enée » de Henry Purcell : < When I am laid in earth>
Peut on trouver plus beau ?
André Tubeuf écrit : « La voix, nourrie par un souffle à sa taille, était inépuisable de nuances, d’émotion, de profondeur. »
Car elle avait un corps imposant, je dirais généreux comme ses interprétations.
Je ne l’ai vu qu’une fois en concert en 78 au Palais des Congrès et de la musique à Strasbourg. J’avais le sentiment qu’elle était très à l’aise dans son corps. Elle utilisait tout pour interpréter, sa voix chatoyante, ses bras, son expression de visage et l’ensemble de son corps.
 Emmanuelle Giuliani écrit dans le journal <La Croix>
Emmanuelle Giuliani écrit dans le journal <La Croix>
« Hors normes en effet, sa stature de déesse, imposante, majestueuse, qu’elle parait d’atours d’une somptueuse élégance ; son beau visage comme sculpté dans l’ébène, illuminé par un sourire flamboyant ; l’aisance avec laquelle, d’un mouvement de la main ou d’une inflexion de la nuque, elle donnait vie à une reine antique selon Rameau, à une Bohémienne fatale magnifiée par Bizet, à une amoureuse mythique chantée par Richard Strauss. Mais exceptionnelle, avant tout, cette voix voluptueuse, profonde, pulpeuse, capable d’emplir tout un théâtre d’un seul murmure avant d’en faire trembler les murs tant elle recelait de puissance sonore. »
Cet article nous apprend aussi que la fameuse marseillaise du bicentenaire a été chantée bénévolement :
« Je chante gratuitement ; c’est ma contribution à la France […] La Marseillaise, je la sais par cœur depuis que je suis toute petite. Et la Révolution, dont il faut remercier les Français, appartient au monde entier. »
Dans la vidéo de la mort de Didon, on la voit, à la fin, parler allemand.
Elle dit
«Ich leb’ allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied. …
Schöner gibst nicht »
« Je vis seul dans mon ciel,
Dans mon amour, dans mon chant »
Et elle ajoute : «Il ne peut exister plus beau »
Les deux premiers vers qu’elle cite sont les derniers du lied de Gustav Mahler « Ich bin der Welt abhanden gekommen » Je suis perdu pour le monde qui fait partie du cycle des Rückert Lieder.
Elle chante ce lied dans <cette video>
L’article de la Croix précise cependant que si chez elle tout semblait extraordinaire, elle se plaisait à répéter que sa vie de diva exigeait de respecter une routine quotidienne où le travail tenait la première place, le yoga, la natation et la méditation un rôle essentiel.
Dans Paris-match elle déclare :
« Un concert de deux heures, c’est trois mois de préparation. Sur scène, je veux prendre du plaisir et en donner au public. La condition sine qua non, c’est le travail. Si on trouve ça trop astreignant, il faut faire autre chose. Moi, j’ai toujours adoré travailler. »
Toni Morrison, prix Nobel de littérature (1993), qui a quitté la communauté des vivants, en août dernier, disait :
« La beauté et le pouvoir, la singularité de la voix de Jessye Norman : je ne me souviens pas d’autre chose de semblable […] Je dois dire que parfois, lorsque j’entends votre voix, cela me brise le cœur. Mais à chaque fois, lorsque j’entends votre voix, cela soigne mon âme ».
Le Monde écrivait en 2006 pour son incarnation de Judith dans le Barbe bleue de Bartok :
« L’entrée de Jessye Norman est déjà un spectacle en soi. La cantatrice porte une luxuriance d’étoffe lourde et craquante d’un vert émeraude intense – la robe de Judith, la dernière femme de Barbe-Bleue. Magnifique de présence irradiante et de beauté lumineuse. Ce qui suit ressemble musicalement à de la magie pure. »
Elle était généreuse et engagé socialement : elle a fondé dans sa ville natale la Jessye Norman School of the Arts pour soutenir de jeunes artistes socialement défavorisés
« J’espère inspirer aux gens, aux artistes, musiciens ou autres, le désir d’aller au-delà d’eux-mêmes, au-delà de leurs professions. Nous devons nous assurer d’agir au sein de nos communautés pour soutenir ceux qui en ont besoin. Il s’agit d’un devoir : c’est le prix à payer pour être un être humain. »
Et puis il faut peut être revenir à l’origine au spirituals.
Comme ici où elle chante <Give me Jesus>
Et là elle s’associe à Kathleen Battle pour chanter <Certainly, Lord>
Et si vous avez le temps le concert avec Kathleen Battle est en ligne en entier : <Spirituals in Concert, Jessye Norman & Kathleen Battle, Carnegie Hall>
C’est une reine du chant et une femme admirable qui nous a quitté !

<1281>
-
Mardi 1 octobre 2019
« Une oppression, une servitude si dure, si horrible que jamais des bêtes n’y ont été soumises »Bartolomé de las Casas , Brevisima Relacion de la destruccion de las IndiasDepuis longtemps on nous raconte le beau récit de Christophe Colomb, ce marin génois qui s’est mis au service des monarques catholiques espagnols Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon. Et en cherchant une route vers l’ouest pour atteindre les Indes, a découvert l’Amérique en 1492.
Il était courageux, opiniâtre et après beaucoup d’effort il a pu accomplir son exploit.
C’était aussi un remarquable cartographe comme le rappelle <Cet article> qui rappelle les péripéties et les différents voyages qui l’ont rendu célèbre.
Cette histoire qu’on nous raconte, n’est en réalité, pas une belle histoire.
Déjà le mot « découverte » pose question. L’Amérique et les iles caraïbes qui ont fait l’objet de l’accostage des navires du génois étaient habités par des humains. Il ne s’agissait donc pas de les « découvrir » mais de les « conquérir ».
Colomb n’est même pas le premier européen à avoir accosté sur le grand continent qui se trouve de l’autre côté de l’Atlantique, il a été précédé par les vikings.
Par ailleurs, Christophe Colomb n’a jamais eu une idée précise de la taille et de la profondeur de ce continent. D’ailleurs, le continent n’a pas été appelé Colombie mais Amérique en souvenir d’Amerigo Vespucci (1454 Florence, 1512 Séville) qui est aussi un explorateur controversé mais qui selon le récit européen serait le premier Européen à comprendre que les terres découvertes par Christophe Colomb font partie d’un nouveau continent.
La petite histoire dit que c’est en Lorraine, dans les Vosges, dans la ville de Saint-Dié que le cartographe Martin Waldseemüller et l’érudit Mathias Ringmann, désignent en son honneur ce nouveau monde du nom d’« America » dans le planisphère qu’ils éditent en 1507.
Donc si le continent ne s’appelle pas Colombie ou Colombus, Christophe Collomb est cependant très présent en Amérique et aux États Unis.
La grande université de New York s’appelle l’université <Columbia>. Des statues de Colomb se trouve quasi dans toutes les grandes villes des États-Unis, à New York, à Los Angeles et dans beaucoup d’autres.
Et puis, les Etats-Unis fêtent le <Columbus Day> (ou « Jour de Christophe Colomb » en français), le deuxième lundi d’octobre. L’Amérique latine et l’Espagne fêtent aussi ce jour.
Mais cela devient de plus en plus compliqué
Hier je vous racontais que Jacques Chirac, maire de Paris avait refusé de fêter les 500 ans de la fameuse « découverte » mais avait organisé, en 1992 au Petit Palais, une exposition sur la civilisation Tainos qui fait partie d’une ethnie plus large qui sont les arawaks, bref les « fameux indiens » que Colomb a rencontré puis massacré.
Cet épisode avait fait l’objet d’une conversation « virile »entre le maire de Paris et le roi d’Espagne. « C’est le fameux coup de fil que lui passe le roi d’Espagne [Juan Carlos] qui lui demande : « Qu’est-ce que tu vas faire pour commémorer la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb ? » Jacques Chirac [maire de Paris] lui répond, racontait-il souvent après : « Je ne vais rien faire pour cet assassin, mais je vais faire quelque chose en l’honneur du peuple qu’il a fait disparaître ». »
Et Le Monde.fr complète :
« Il usera des mêmes mots lors du dîner officiel d’inauguration de l’exposition sur l’art des Indiens Taïnos, ethnie amérindienne décimée par les conquistadors. « Offusqué par mes propos, l’ambassadeur d’Espagne quitta aussitôt la table, avec son épouse, en signe de protestation », racontera-t-il dans ses Mémoires. »
Chirac fut un précurseur. Cet <Article> de 2017 raconte un mouvement d’ampleur aux États-Unis qui tend à faire déboulonner les statues du navigateur sanguinaire :
« La majorité des villes majeures aux Etats-Unis possède une statue du célèbre explorateur. […] des critiques virulentes sont portées sur le personnage historique, accusé notamment d’avoir perpétré des massacres de natifs américains et initié le commerce triangulaire. Ce mois-ci, les statues de Houston, Baltimore ou encore New York ont été vandalisées. Au Columbus Triangle Park de New York, le message « Tear it down. Don’t honor genocide » y a été tagué, littéralement « Détruisez-la. Ne célébrez pas le génocide »
Dans la même philosophie le « Columbus day » est remis en cause. Il est de plus en plus souvent remplacé par « une Journée des peuples indigènes ».
Les inrocks ont publié un article « La fête de Christophe Colomb fracture l’Amérique » :
« Un néophyte qui jetterait un œil aux festivités n’y verrait que la célébration bon enfant de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb (en 1492). Parmi les nombreuses réjouissances prévues: exaltation du patriotisme, parades géantes, exposition de reliques du XVe siècle.
Mais ce succédané de 4 Juillet, la fête nationale, ne fait plus recette. Célébrer l’arrivée des colons espagnols, et avec elle son cortège génocidaire, fait mauvais genre. A tel point que certains États refusent purement et simplement de célébrer cette journée. […]
Austin, Las Vegas et une cinquantaine d’autres villes ont fait le choix de rebaptiser le jour férié en « Journée des peuples indigènes » (Indigenous People Day). La fête se veut ainsi plus respectueuse. »
« RFI » précise :
« Certains Amérindiens étaient venus plaider leur cause en tenue traditionnelle devant le Conseil municipal de Los Angeles. Par 14 voix contre une, il a finalement été décidé de créer une Journée des peuples indigènes en remplacement de Colombus Day, jour férié national célébrant Christophe Colomb depuis 1937.
Après Phoenix, Seattle, Denver, Portland, et d’autres, c’est une nouvelle victoire pour les peuples originels des Etats-Unis et tous ceux qui considèrent que l’explorateur italien est l’un des responsables du massacre de millions de personnes. « Ce n’est encore qu’un tout petit pas pour réparer les dommages qui ont été causés », a expliqué un élu de Los Angeles. « Il faut surtout changer l’enseignement qui est fait sur cette question à l’école », a rappelé le conseiller municipal d’une ville du Maine, qui a pris la même décision à l’extrême opposé du pays. »
Mais qu’en est-il de ce héros de nos livres d’Histoire ?
Le site Agoravox prétend nous donner <la vérité sur Christophe Colomb> :
« D’après des récits retrouvés, issus de son propre carnet de route, puis d’autres, écrits de la main de son propre fils, Fernando Colomb ou d’un prêtre et Historien accompagnateur : Bartolomé De Las Casas, le navigateur était un sanguinaire sans morale.
Les Arawak (indiens) l’ont accueilli de façon pacifique. Il les a d’ailleurs qualifiés dans son journal de bord, d’hommes gentils « qui ne portaient pas d’armes, ils ne savent pas ce qu’est une épée et lorsqu’ils l’ont touchée, ils l’ont prise par la lame et se sont coupés. Ce sont des gens gentils, les meilleurs du monde, qui ne connaissent rien du mal, ils ne tuent pas, ne volent pas.. Ils aiment leurs voisins comme eux-mêmes, ils parlent de façon douce et rient sans cesse ». Si ses écrits s’étaient arrêtés là, Colomb mériterait sans nulle doute, cette place dans l’Histoire. Mais il poursuit pourtant en indiquant « qu’ils feraient de bons serviteurs, ils sont très simples. Avec 50 hommes, nous pourrions tous les subjuguer et faire d’eux, ce que nous voulons ». Et le mal prenant le pas sur le bien, Christophe Colomb n’a pas hésité une seconde a mettre à profit ses mauvaises pensées afin d’obtenir des richesses et surtout, de convertir les natifs au Christianisme.
Couper des mains aux Indiens ne lui ramenant pas assez d’or, couper des oreilles ou des nez à ceux qui refusaient de suivre ses ordres et lois, couper des jambes aux enfants Indiens, cherchant à s’échapper et ce, afin de tester les lames des épées, telles étaient les sanctions pratiquées par Christophe Colomb. Bien décidé à s’approprier les Amériques ainsi que les Antilles, il ne laissa aucune chance aux autochtones déjà en place. Après avoir tué près de 10 000 Haïtiens en leur coupant des membres et en les laissant se vider de leur sang, il s’est attaqué à l’actuelle République Dominicaine, laissant derrière lui, une mare de sang.
Les consignes qu’il avait reçues étaient pourtant claires : « s’efforcer de gagner la confiance des habitants en s’abstenant du moindre mal » mais à l’autre bout du monde, avec un grand sentiment d’impunité, les actes étaient tout autres.
Ce n’était pas la guerre, mais bien pire encore Samuel Eliot Morison, historien, utilise même le terme de « génocide » pour décrire les atrocités des colons..
Des enfants finissaient rôtis à la broche avant d’être découpés en morceaux, des jeux-défis étaient lancés entre Européens afin de savoir qui des deux dualistes pourraient couper d’un seul coup, la tête de sujets Indiens. La bestialité des soldats occidentaux les poussaient à décapiter sans raison aucune, les enfants qu’ils croisaient et pire encore, lorsque les chiens de meute de l’équipage étaient à cours de viande, ce sont des bébés Arawak qui étaient tués ou parfois donnés vifs en guise de repas. Des actes de barbarie de la sorte, les Indiens les ont endurés jour et nuit, et ce, pendant des années. Leur docilité a même donné l’idée à Christophe Colomb, de les ramener en Europe afin qu’ils soient exploités comme esclaves. Pendant les traversées, les femmes et les jeunes filles étaient violées puis battues à mort. […]
Les viols étaient récurrents et ce, dès que les fillettes atteignaient 9 ans. Le Professeur d’Histoire et sociologue de l’Université du Vermont : James Loewen, a souligné que « Dès 1493, le navigateur récompensait ses lieutenants avec des
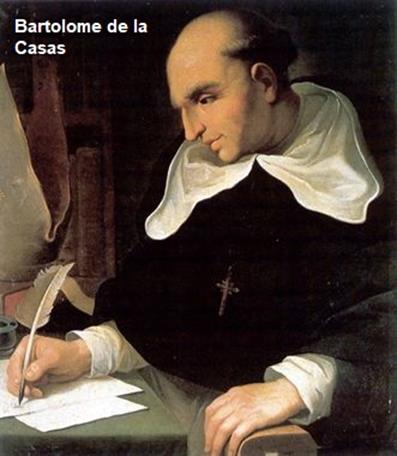 femmes Indiennes ». Bien bêtes sont ceux qui pensaient que des hommes pouvaient rester des mois et des mois en contenant leurs appétits sexuels !
femmes Indiennes ». Bien bêtes sont ceux qui pensaient que des hommes pouvaient rester des mois et des mois en contenant leurs appétits sexuels !
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, en 1493, les Arawak comptaient huit millions d’habitants étendus dans les Caraïbes (surtout en Haïti et République Dominicaine). A son départ, en 1504, il ne restait que 100 000 individus. »
Et ce texte est en effet confirmé par l’exemplaire prêtre dominicain <Bartolomé de las Casas> qui dénonça ces crimes et fut le défenseur des peuples indigènes.
Dans ce <récit historique> il dénonce :
« Des chrétiens rencontrèrent une Indienne, qui portait dans ses bras un enfant qu’elle était en train d’allaiter ; et comme le chien qui les accompagnait avait faim, ils arrachèrent l’enfant des bras de la mère, et tout vivant le jetèrent au chien, qui se mit à le dépecer sous les yeux mêmes de la mère (…). »
Vous trouverez aussi sur cette page, l’extrait suivant :
« C’est parmi ces douces brebis, ainsi dotées par le Créateur des qualités que j’ai dites, que s’installèrent les Espagnols. Dès qu’ils les connurent, ceux-ci se comportèrent comme des loups, et des tigres et des lions, qu’on aurait dit affamés depuis des jours. Et ils n’ont rien fait depuis quarante ans et plus qu’ils sont là, sinon les tuer, les faire souffrir, les affliger, les tourmenter par des méthodes cruelles extraordinaires, nouvelles et variées, qu’on n’avait jamais vues ni entendu parler. […]
Il y a eu deux façons principales pour ces gens qu’on appelle chrétiens, d’extirper et rayer ainsi de la terre ces malheureuses nations: la première ce furent les guerres cruelles, sanglantes, tyranniques; la seconde fut, après la mort de tous ceux qui pouvaient aspirer à la liberté et combattre pour elle – car tous les chefs et les hommes Indiens sont courageux – une oppression, une servitude si dure, si horrible que jamais des bêtes n’y ont été soumises. La raison pour laquelle les chrétiens ont détruit une si grande quantité d’êtres humains, a été seulement le désir insatiable de l’or, l’envie de s’emplir de richesses dans le délai le plus rapide possible, afin de s’élever à des niveaux sociaux qui n’étaient pas dignes de leur personne. »
Extrait tiré de : Bartolomé De Las Casas (1542), Brevisima Relacion de la destruccion de las Indias (= Très brève relation de la destruction des Indes).
Jacques Chirac avait raison en parlant de « cet assassin ».
Les monstres qui se comportaient ainsi, se prétendaient chrétiens. Christophe Colomb était très croyant. Et dire que cette ethnie arrogante, les européens chrétiens, prétendaient apporter la civilisation au monde. Nous, en tout cas moi je pensais qu’ils avaient été cruels parce qu’ils voulaient s’enrichir, gagner des terres et étendre leur pouvoir. La réalité est pire, ils étaient pervers et cruels par goût morbide.
<1280>
-
Lundi 30 septembre 2019
« Nous n’allons pas célébrer le 500ème anniversaire de la découverte de l’Amérique, mais rendre hommage aux peuples pré colombiens, en particulier aux peuples des caraïbes les tainos arawaks »Jacques ChiracCe lundi nous sommes donc en deuil national. Notre ancien Président de la République, Jacques Chirac, est décédé.
Selon un sondage récent « Jacques Chirac serait le meilleur président de la Vème République » avec Charles de Gaulle quand même.
Et il est, toujours selon les sondages, extraordinairement populaire et a laissé une image « sympathique » : 87% le considèrent comme « proche des gens » et « incarnant bien la France ». Sa personnalité est considérée comme « charismatique » par 83% des sondés, et « dynamique » pour 75%.
C’est très étonnant…
<Il faut écouter Mediapolis d’Olivier Duhamel> pour savoir que les émissions spéciales qu’ont diffusées les chaines de télévision ont fait de mauvais score. Ainsi quand France 2 a décidé de se mettre en émission spéciale et TF1 a décidé de ne pas le faire, il y a eu un transfert énorme de téléspectateurs de France 2 vers TF1. Et si les journaux du lendemain ont fait de meilleures ventes qu’un jour normal, il n’y a aucune comparaison possible avec la mort de Johny Halliday.
Parce que quand même si on reprend des chiffres sérieux des élections présidentielles depuis 1974 et qu’on compare le résultat au premier tour de chaque président élu, là où se révèle les vrais sympathisants et les plus ou moins convaincus, on constate que
- Chirac a obtenu en 1995, 20,84% (il est vrai que c’était un miracle puisque tout le monde pensait que Balladur serait élu) mais en 2002, alors qu’il était président sortant sans adversaire sérieux dans son camp il a obtenu 19,88 %
- Giscard en 1974 a eu 32,60 %
- Mitterrand en 1981, 25,85 % et 34,10 % en 1988
- Sarkozy en 2007, 31,18%
- Hollande en 2012, 28,63%
- Macron en 2017, 24,01 %
C’est le président le plus mal élu de tous les présidents.
 Jean-Louis Boulanges dans <le nouvel esprit public> de ce dimanche a probablement révélé une part de vérité :
Jean-Louis Boulanges dans <le nouvel esprit public> de ce dimanche a probablement révélé une part de vérité :
« Que Chirac soit apprécié de tous n’est pas étonnant, puisqu’il n’a cessé de dire tout et son contraire sa vie politique durant. Ainsi, tout le monde a un morceau de Jacques Chirac dont il peut se réclamer. »
<Sur France Inter> Gilles Finkelstein a dit la même chose :
« Il a été là si longtemps et il a été si changeant que, comme l’a dit Johny, on a tous quelque chose de Jacques Chirac. Ça a fini d’être vrai, il y a au moins un moment, un discours, un acte où nous avons pu nous reconnaître en lui. »
Pour ma part, je ne crois pas qu’il fut un bon président de la république et je n’avais pas particulièrement d’affection pour lui.
Comme l’ont dit Jean-Louis Bourlanges et Gilles Finkelstein c’était un démagogue, une sorte d’archétype de démagogue !
Il en était pleinement conscient. Plusieurs journaux dont Libé rapportent qu’il avait lancé à son équipe de campagne présidentielle de 1995.
«Je vous surprendrai par ma démagogie»
Un jour qu’on l’interrogeait sur ses convictions de droite ou de gauche, il avait eu cette réponse :
«Vous voulez le fond de ma pensée ? Vous voulez vraiment ? Eh bien franchement, je n’en sais rien.»
C’est le même article de Libé qui rapporte cette réponse.
Il a vécu sa vie politique sur des trahisons multiples :
- En 1974, membre de l’UDR, il trahit Chaban-Delmas candidat de l’UDR pour rallier Giscard d’Estaing. Ce dernier lui offrira pour le prix de trahison le poste de premier ministre.
- Deux ans plus tard il démissionne et s’oppose à Giscard d’Estaing, pourquoi pas. Mais aujourd’hui, il est documenté qu’en 1981 les responsables du RPR donnaient comme consigne oral à leurs militants et sympathisants qu’il fallait voter Mitterrand contre Giscard au second tour.
- En 1995, il fut lui-même trahi par Balladur, Sarkozy et Pasqua.
Il s’en suivit une campagne, où comme il l’a donc prédit lui-même, d’une démagogie inimaginable. Il prit pour slogan « la fracture sociale ». Gilles Finkelstein analyse très justement que pour être élu dans une élection présidentielle il faut parvenir à imposer le thème principal puis faire croire qu’on est la solution. C’est ce qu’il est parvenu à faire contre Balladur, mais il n’avait pas le début de l’esquisse d’une solution. D’ailleurs, une fois au pouvoir, très rapidement ce thème n’était plus du tout prioritaire.
En 2002, il fit de même avec Jospin et parvint à imposer le thème de l’insécurité.
Ce fut un animal politique qui sut méthodiquement détruire toute concurrence dans son camp et tout homme ou femme qui s’opposait à lui. A la fin, il fut quand même écarté par Sarkozy qui le traita de « roi fainéant ». Sa haine à l’égard de Nicolas Sarkozy n’eut pas de répit. Probablement que dans sa popularité, il y a une part de cette aversion anti sarkozienne qui plut beaucoup à tous ceux que Sarkozy indisposait.
Alors, il était sympathique avec tous ceux qui n’étaient pas des concurrents politiques. Il était capable d’aller vers les gens avec empathie et visiblement aimait cela.
Tout n’a pas été négatif.
- Il a su s’opposer à cette guerre imbécile que Bush fils a déclenché en Irak,
- Il a mis fin au récit gaulliste mensonger sur une France sans tâche pendant la guerre, lors de son remarquable discours du Vel d’Hiv,
- Il a mis fin à la conscription, de cette obligation pour les jeunes garçons de passer une année voire plus dans l’armée.
- Il a été un des hommes de droite qui a voté l’abolition de la peine de mort.
- Il a lancé des plans qui ont eu un impact positif : le plan cancer, le plan sécurité routière et aussi la charte de l’environnement.
Vous trouverez des précisions dans cet article de Sciences et Avenir
On sait moins qu’il participa à la création de l’ANPE.
La création de l’Agence nationale pour l’emploi date du 13 juillet 1967. A l’époque, le pays ne compte guère à l’époque que 430 000 chômeurs, soit 2,1 % de la population active. L’ordonnance créant l’ANPE est signée, entre autres, par le secrétaire d’Etat aux Affaires sociales chargé des problèmes de l’emploi : Jacques Chirac.
Mais si on creuse un peu plus, on pourra trouver quand même un point où Jacques Chirac fut grand et visionnaire.
Car la bienveillance s’efforce toujours de trouver, au milieu des défauts, les qualités.
Françoise Giroud avait révélé une part de son jardin secret :
« D’habitude, les hommes lisent Playboy ou Lui cachés derrière un ouvrage de poésie. Chirac, lui, lit un livre de poésie caché derrière un Playboy »,.
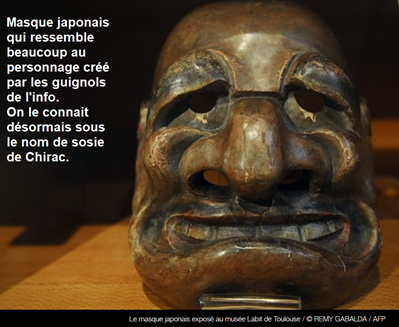 Il eut la passion des autres cultures, c’est-à-dire des cultures non européennes.
Il eut la passion des autres cultures, c’est-à-dire des cultures non européennes.
Il fut le chantre des « arts premiers » terme qu’il parvint à imposer à « art primitif » qui sous-tend une hiérarchie qu’il récusait.
Le musée du quai Branly, qui a pris le nom de « Jacques Chirac » fut la concrétisation de ce beau combat.
L’année même où il refuse la guerre en Irak, il annonce la création d’un département des arts de l’Islam au Louvre.
Mais il était aussi passionné des arts et de l’Histoire de la Chine, de l’Inde et du Japon. Jamais, il n’étala cette immense culture de l’ailleurs publiquement.
Jean-Jacques Aillagon qui le connaissait bien explique :
« Chirac avait une vision de la France ouverte, généreuse, faite de collages et de synthèses. Il était contre le choc des civilisations. C’est un enfant de la première moitié du XXe siècle, de la négritude, du musée imaginaire d’André Malraux et de l’appel de Stockholm. »
On sait maintenant que lycéen il séchait des cours pour des visites répétées au Musée Guimet, à Paris, musée des arts asiatiques.
On pourrait croire que ce sont des récits qui revisitent l’histoire de Jacques Chirac pour y mettre un grain d’élévation.
Rien ne serait plus faux, aujourd’hui les témoignages se multiplient pour démontrer que cette culture n’était pas feinte, mais profonde et précise.
Ainsi, un voyage officiel à Shanghaï manque de tourner à l’incident diplomatique lors de la visite du Musée de la ville. « Ils ont voulu nous tester en sortant une silhouette en bronze d’un cochon et en prétendant qu’il s’agissait d’un objet du VIIe siècle avant J.-C. Chirac dit : « Ils sont fous, c’est du Xe siècle avant J.-C. », raconte Christian Deydier. Petite passe d’armes, les esprits s’échauffent de part et d’autre, avant que lesdits spécialistes chinois n’admettent leur erreur…
Et lors d’un voyage les 21 et 22 octobre 2000, en Chine il se rendit à Yangzhou, ville natale du président chinois de l’époque, Jiang Zemin, pour admirer les beaux paysages ainsi que la culture de cette ville ancienne.
Accompagné de Jiang Zemin, Jacques Chirac visita le musée de Yangzhou et les tombeaux de la dynastie des Han. À la fin de sa visite, M. Chirac a demandé à aller voir le Grand Canal creusé dès la dynastie des Sui. Ce canal relie Hangzhou, au Sud de la Chine, à Beijing, via les provinces du Jiangsu, du Shandong, du Hebei et la ville de Tianjin. Ce désir particulier initia une conversation sur l’ascension et la chute des Sui. À propos du nombre d’empereurs de la dynastie des Sui, un Chinois a affirmé sans réfléchir : « Deux, les empereurs Wendi et Yangdi des Sui ». « Mais non, l’a immédiatement corrigé Jacques Chirac. Ils étaient trois. Le dernier est l’empereur Gongdi, qui régna de l’an 607 à 608 ; Li Yuan était le prince régent. »
Le matin du 22 octobre, alors que le président Jiang prenait le petit-déjeuner avec le président Chirac, il dit à ce dernier :
« J’ai vérifié hier soir et vous aviez raison, la dynastie des Sui a bien eu trois empereurs. Le troisième fut l’empereur Gongdi ».
<France Culture a invité Jean-Jacques Aillagon> ancien ministre de la Culture, sous la présidence de la République, qui a narré l’histoire suivante :
En 1991, Jean-Jacques Aillagon était directeur des affaires culturelles de la Mairie de Paris. Et se souvenant qu’en 1492, l’Europe découvrit l’Amérique, il envoya plusieurs fiches à Jacques Chirac pour lui proposer de créer un évènement culturel à Paris pour célébrer ce 500ème anniversaire. Le maire de Paris ne lui répondit pas, mais lui demanda de passer le voir :
« Ecoutez Aillagon, on ne va quand même pas célébrer le 500ème anniversaire de la découverte de l’Amérique.
Nous autres européens, nous nous sommes comportés de façon ignoble.
Nous avons détruits des civilisations. Nous avons anéantis des peuples.
Nous avons importé nos maladies.
Nous avons fait croire que notre religion était meilleure que celle des peuples soumis.
Nous n’allons pas célébrer le 500ème anniversaire de la découverte de l’Amérique, mais rendre hommage aux peuples pré colombiens, en particulier aux peuples des caraïbes les tainos arawaks.
Vous savez bien sur tout sur la civilisation des tainos arawaks. ?
Ma culture sur la civilisation des tainos et des arawaks était à l’époque très sommaire et je réponds « bien sûr » Monsieur le Maire
Si vous n’en savez pas assez, allez voir Jacques Kerchache et vous pourriez peut-être, lui confier le commissariat de cette exposition qui pourrait se dérouler au Petit Palais.»
Et cette <exposition> eu lieu au Petit Palais en 1992. Si vous suivez le lien que je vous donne vous entendrez même Jacques Chirac montrer son érudition et présenter des pièces de l’exposition.
Ce qu’il y a de grand dans ce « jardin secret » de Jacques Chirac, c’est son ouverture au monde et sa compréhension que l’Europe n’est ni seule, ni au centre du monde mais qu’il y avait d’autres civilisations tout aussi respectables, qu’il a étudié et qu’il s’est efforcé de connaître et d’approfondir.
Cela explique aussi peut-être, au-delà des contingences politiques, pourquoi il s’est opposé de suivre la « petite civilisation américaine » (en terme de profondeur historique) dans sa guerre à l’Irak, lieu de la Mésopotamie et de la civilisation islamique de Bagdad.
Jacques Chirac un antidote au choc des civilisations !
<1279>
- Chirac a obtenu en 1995, 20,84% (il est vrai que c’était un miracle puisque tout le monde pensait que Balladur serait élu) mais en 2002, alors qu’il était président sortant sans adversaire sérieux dans son camp il a obtenu 19,88 %
-
Vendredi 27 septembre 2019
« Ainsi, là où règne la quantité, il ne sera plus question de qualité. Là où le nombre est roi, le verbe se réduira au code. Là où plus rien n’a de valeurs, tout a un prix »Anne DufourmantelleDans la suite du mot du jour d’hier et des recherches attenantes je suis tombé sur la dernière chronique d’Anne Dufourmantelle dans Libération.
L’intelligence et la sensibilité qu’elle manifeste dans cette courte chronique m’ont subjugué.
Elle est décédée le 21 juillet 2017, cette chronique date du 22 juin 2017.
Vous la trouverez derrière ce le lien <Les-points sur les QI>
Au départ, il y a les réflexions de Laurent Alexandre, co-créateur de doctissimo en 2000. Mais aujourd’hui il est surtout connu pour ses essais et conférences sur l’intelligence artificielle et le transhumanisme.
J’avais consacré en 2017 un <mot du jour> à son analyse sur l’intelligence artificielle qui va constituer un bouleversement considérable et auquel il faut, selon lui, s’adapter rapidement ce que nous ne faisons pas pour l’instant.
Il avertit des dangers pour mieux nous inciter à adhérer à l’évolution en cours pour ne pas être dépassé, « largué » en langage courant.
Anne Dufourmantelle l’avait entendu affirmer à la radio : «La démocratie ne pourra pas survivre à des écarts de QI. La Sécurité sociale devra rembourser les opérations pour augmenter le cerveau.»
A cette affirmation elle réplique immédiatement :
« En une seule des prophéties dont il a l’habitude, trois contrevérités sont assénées sur le ton de la certitude.
Premièrement, le QI serait la référence absolue en matière d’intelligence.
Deuxièmement, la médecine doit transformer le corps de façon à faire correspondre les individus aux nouvelles normes que ces progrès instituent.
Troisièmement, pour éviter les inégalités que ne manquerait pas de susciter la mise en circulation de ces nouvelles normes, la Sécurité sociale doit se préparer à venir en aide aux nouveaux infirmes que ces dernières, en fait, «produisent». »
Je n’ai pas retrouvé l’émission de radio évoquée par Anne Dufourmantelle, mais j’ai retrouvé cette interview publiée, sur le site du Figaro, le 13/06/2017 soit 9 jours avant l’article que je souhaite partager : «Bienvenue à Gattaca deviendra la norme». Dans cette interview, il explique
« On ne sauvera pas la démocratie si nous ne réduisons pas les écarts de QI. Des gens augmentés disposant de 180 de QI ne demanderont pas plus mon avis qu’il ne me viendrait à l’idée de donner le droit de vote aux chimpanzés.
Il va falloir parler QI ce qui n’est pas simple tant le sujet est politiquement chaud. Ne vous y trompez pas: le tabou du QI traduit le désir inconscient et indicible des élites intellectuelles de garder le monopole de l’intelligence à une époque où elle est de plus en plus le moteur de la réussite et du pouvoir: cela est politiquement et moralement inacceptable »
Et contrairement au journaliste qui lui rétorque : « L’homme ne se réduit pas à son cerveau. Il est aussi sensibilité et vie intérieure. » il considère :
« Vous avez à mon sens tort, l’homme se réduit à son cerveau. Nous sommes notre cerveau. La vie intérieure est une production de notre cerveau. L’Église refuse encore l’idée que l’âme soit produite par nos neurones, mais elle l’acceptera bientôt comme elle a reconnu en 2003 que Darwin avait raison, 150 ans après que le pape déclare que Darwin était le doigt du démon. C’est d’ailleurs indispensable si les chrétiens veulent participer aux débats neurotechnologiques qui sont clé dans notre avenir. Jusqu’où augmente-t-on notre cerveau avec les implants intracérébraux d’Elon Musk? Jusqu’où fusionne-t-on neurone et transistor? Quel droit donne-t-on aux machines? L’émergence de nouvelles créatures biologiques ou électroniques intelligentes a des conséquences religieuses: certains théologiens, tel le révérend Christopher Benek, souhaitent que les machines douées d’intelligence puissent recevoir le baptême si elles en expriment le souhait. Les NBIC posent des questions inédites qui engagent l’avenir de l’humanité. »
On comprend donc mieux la référence du titre de l’article à <Bienvenue à Gattaca>, film de science-fiction sorti en 1997. Qui présente une société dans laquelle on pratique l’eugénisme à grande échelle.
Mais ce que je trouve le plus pertinent ce sont ces mots d’Anne Dufourmantelle :
 « Depuis quelques années, la doctrine transhumaniste trouve un écho complaisant dans les médias sans que jamais y soit explicitée sa teneur scientiste, ultralibérale et in fine eugéniste. Séduisante parce que relevant de la fantasmagorie de science-fiction, intimidante parce que placée sous le sceau du progrès des neurosciences et du génie génétique, cette idéologie fonctionne comme toutes les doctrines à ambition messianique : au nom d’un avenir que l’on qualifie d’inéluctable, elle prône la mise en place d’un monde visant à le prévenir mais qui, en réalité, le produit.
« Depuis quelques années, la doctrine transhumaniste trouve un écho complaisant dans les médias sans que jamais y soit explicitée sa teneur scientiste, ultralibérale et in fine eugéniste. Séduisante parce que relevant de la fantasmagorie de science-fiction, intimidante parce que placée sous le sceau du progrès des neurosciences et du génie génétique, cette idéologie fonctionne comme toutes les doctrines à ambition messianique : au nom d’un avenir que l’on qualifie d’inéluctable, elle prône la mise en place d’un monde visant à le prévenir mais qui, en réalité, le produit.
Aucun fanatisme religieux n’est allé aussi loin que le transhumanisme puisqu’il prône l’avènement d’un homme nouveau n’ayant pas seulement assimilé ses dogmes mais allant jusqu’à les incarner en transformant son corps de manière à ce qu’il corresponde au nouvel ordre qu’il met en place.
L’immortalité, le corps augmenté… autant de leitmotivs millénaristes remis au goût du jour du struggle for life [lutte pour la vie] capitaliste.
Avant de chercher à «augmenter» son corps, ne faudrait-il pas se demander si chacun vit pleinement la magie de ce qu’il est ?
Avant d’aspirer à l’immortalité, ne devrait-on pas permettre à chacun de vivre une vie pleine et choisie ?
Les technolâtres invoquent la raison d’être de la médecine qui serait de tout temps intervenue sur l’homme pour remédier à ses maux.
Argument fallacieux. Il s’agit justement, avec le transhumanisme, de toute autre chose que de médecine. Il s’agit d’une maintenance technologique qui considère le corps comme une machine en panne ou poussive à perfectionner.
Guérir, soigner, corriger, n’est pas conditionner, programmer, transformer.
Comme l’écrit Mathieu Terence, auteur d’un bref livre qui révèle la vérité de ce discours totalitaire (« Le transhumanisme est un intégrisme », le Cerf, 2017), le transhumaniste est en effet le self made man absolu. Il va jusqu’à se construire une vie artificielle capable de fournir les performances que notre monde artificiel attend de lui.
Ainsi, là où règne la quantité, il ne sera plus question de qualité. Là où le nombre est roi, le verbe se réduira au code. Là où plus rien n’a de valeurs, tout a un prix.
L’intelligence est réduite à une performance logique, au comportement correspondant le mieux à une consigne. Oubliées l’imagination, la sensibilité, la mémoire et leurs infinies combinaisons. C’est dans cette perspective cynique qu’il faut entendre l’éloge du QI du docteur Alexandre spécialiste de la question s’il en est puisque urologue de formation. Celui qui confond QI et intelligence confond la palette du peintre avec le tableau.
Cette confusion entre les qualités d’un être et ses performances est bien le fait de notre époque où l’approche économique (rentable, comptable) prime sur toute autre, y compris sur ce que le vivant a de plus précieux. Ne parle-t-on pas aujourd’hui d’élèves de maternelle à «haut potentiel» ainsi que toutes les DRH du monde le font de certains membres d’une entreprise. L’évaluation est devenue tyrannique, un outil de management incontournable, un mot d’usage public qui sert insidieusement la dévaluation, le contrôle des individus et à la délation. Il s’agit de savoir plaire, et non de savoir. Il y avait la servitude volontaire, il y aura de plus en plus la volonté de servitude. »
Avec des mots simples, Anne Dufourmantelle rappelle l’essentiel et dénonce la folie de ceux qui veulent créer « homo deus ».
Une femme, une intellectuelle profonde et visionnaire.
<1278>
-
Jeudi 26 septembre 2019
« Puissance de la douceur »Anne DufourmantelleJ’avais prévu de consacrer le mot d’aujourd’hui au livre de Pierre-Henri Castel « Le mal qui vient » que j’ai lu pendant ces vacances.
J’ai essayé, mais je n’y arrive pas. Alors j’en parlerai plus tard, ou pas.
Alors je vais partager une petite vidéo (5 mn) que j’ai trouvée par hasard pendant ces vacances : <Anne Dufourmantelle – Puissance de la douceur>
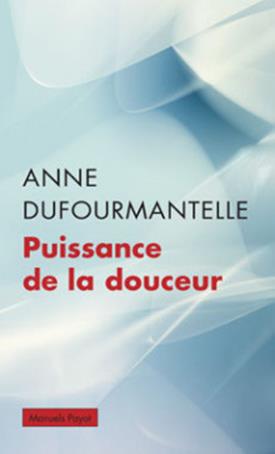 « La puissance de la douceur » est un livre qu’Anne Dufourmantelle a écrit et publié en juin 2013
« La puissance de la douceur » est un livre qu’Anne Dufourmantelle a écrit et publié en juin 2013
Après avoir partagé la vidéo avec Annie, elle a immédiatement souhaité l’acheter et a commencé à le lire depuis peu.
J’avais entendu parler de cette psychanalyste et philosophe, en raison des circonstances de son décès, mais je ne l’avais pas encore approché.
Tous les médias avaient, en effet, parlé de sa mort tragique, le 21 juillet 2017, sur la plage de Pampelonne, près de Ramatuelle (Var), en portant secours à deux enfants dont le fils d’un de ses amis âgé de 13 ans, qui était en train de se noyer. Ces enfants étaient allés se baigner alors qu’il y avait un très fort vent et des vagues, avec drapeau orange puis rouge. Au cours de ce sauvetage, elle a succombé à un arrêt cardiaque car elle souffrait d’une faiblesse cardiaque. Son action n’avait pas été vaine parce que des sauveteurs sont intervenus et ont sauvé les deux enfants.
Anne Dufourmantelle avait 53 ans.
Elle était aussi chroniqueuse à Libération. Libération lui avait rendu hommage dans son <numéro du 23 juillet 2017> :
« Douceur, c’est le premier mot qui vient à l’esprit quand on pense à Anne Dufourmantelle, philosophe et psychanalyste, décédée tragiquement ce 21 juillet après-midi […] «Quand il y a réellement un danger auquel il faut faire face […], il y a une incitation à l’action très forte, au dévouement, au surpassement de soi», nous confiait en 2015 celle qui faisait l’Éloge du risque. […]
Notre peine est immense car Anne Dufourmantelle était chroniqueuse à Libération, mais c’était surtout une amie. On se souvient de la douceur de sa voix, inquiète, quand elle nous appelait chaque mois pour savoir si sa chronique était à la hauteur de nos attentes. Et elle l’était. Depuis deux ans dans nos colonnes, comme dans l’ensemble de son travail, Anne Dufourmantelle, spinoziste, questionnait le rapport entre la fatalité et la liberté, ce qui fait qu’une vie s’ouvre à la liberté malgré les conditionnements, les fidélités, les obéissances. […] Ses mots, son intelligence, sa douceur nous manqueront, parce qu’ils nous aidaient à prendre le risque de s’ouvrir à l’autre et au monde. »
<Le Monde> rapportait
« A la question « Peut-on vivre sans prendre de risque ? », elle avait répondu : « La vie tout entière est risque. Vivre sans prendre de risque n’est pas vraiment vivre. C’est être à demi-vivant, sous anesthésie spirituelle. (…) Le risque commence dans les plus petits détails et gestes de la vie. Sortir de ses gonds, de ses habitudes, c’est déjà un risque. C’est se laisser altérer, c’est rencontrer l’altérité dans chaque événement. » »
Elle avait consacré un ouvrage au risque « Éloge du risque »
Et l’Obs ajoutait :
« Dans «La Femme et le sacrifice», elle montrait en quoi «la féminité a partie liée depuis très longtemps avec le sacrifice» à travers le récit des vies d’héroïnes mythologiques comme Antigone ou Iphigénie, mais aussi à travers des existences de femmes anonymes, les femmes «d’à côté».
Interrogée au sujet cette notion de sacrifice sur France Culture, elle expliquait notamment que «le mouvement du sacrifice est aussi un aller vers la vie». En 2011, elle publiait «Éloge du risque», livre dans lequel on pouvait lire ces mots: «Risquer sa vie est l’une des plus belles expressions de la langue française.» «
La revue Psychologies lui avait également consacré un bel hommage : <Anne Dufourmantelle, une lumière s’éteint>
 Mais revenons à « la puissance de la douceur ».
Mais revenons à « la puissance de la douceur ».
Dans le monde de la compétition et de la performance la douceur est souvent assimilée à de la faiblesse ou de la mièvrerie. On préconise même l’agressivité dans l’action. La douceur suppose la reconnaissance de la vulnérabilité de ce qui est approché, touché, caressé. Pour Anne Dufourmantelle la douceur est une puissance !
La « Puissance de la douceur » débute ainsi :
« La douceur est une énigme. Incluse dans un double mouvement d’accueil et de don, elle apparaît à la lisière des passages que naissance et mort signent. Parce qu’elle a ses degrés d’intensité, parce qu’elle a une force symbolique et un pouvoir de transformation sur les êtres et les choses, elle est une puissance.
Une personne, une pierre, une pensée, un geste, une couleur… peuvent faire preuve de douceur. Comment en approcher la singularité ? Son approche est risquée pour qui désire la cerner. A bien des égards elle a la noblesse farouche d’une bête sauvage. Il semble qu’il en aille ainsi de quelques autres espèces rares. L’innocence, le courage, l’émerveillement, la vulnérabilité, en marge des concepts arraisonnés par la grande histoire de la pensée sont eux aussi regardés d’un œil inquiet par la philosophie »
L’auteure a mis en exergue de son livre cette phrase de l’empereur stoïcien Marc Aurèle
« La douceur est invincible ».
La Revue <Muze> explique : .
« Car si l’on y réfléchit bien, et si l’on se reporte un instant à ses souvenirs d’enfance, on retrouvera cette force insaisissable, ce pouvoir de persuasion et d’enchantement, ce mouvement d’accueil et de don à la fois, cette langue intime qui s’adresse tout autant à l’esprit et au corps. La douceur tisse autour de l’enfant un halo de sens informulé mais pénétrant, dans une constante réciprocité qu’illustre au mieux l’image du petit endormi, qui nous renvoie nous-mêmes à cet abandon initial dont nous provenons. De cet échange muet, nous conservons à jamais la trace, celle de toutes les métamorphoses, dans les moments de fragile incertitude où nous développons nos potentialités.
« Si la douceur était un geste, elle serait caresse » imagine l’auteure »
La douceur anime une collection de sentiments où gravitent mansuétude et amour, indulgence et pardon, harmonie ou pitié, soin et souci de l’autre – ce que les anglo-saxons ont nommé le « care » comme l’a rapporté Nancy Fraser que j’ai citée ce mardi.
Le soin a toujours été associé à la douceur, qui même si elle ne suffit pas à guérir, si elle ne s’autorise d’aucun pouvoir ni savoir, ajoute au soin une relation de compassion qui revient à souffrir avec l’autre, à reconnaître par là-même sa propre vulnérabilité, mais à éprouver la souffrance d’autrui en se gardant d’y céder, de manière à porter secours.
Sans avoir fini l’ouvrage, Annie est enchantée de ce qu’elle lit.
<1277>
-
Mercredi 25 septembre 2019
« Cécile »Je ne savais pas quel autre mot du jour écrire aujourd’huiJ’aime beaucoup le prénom de Cécile, c’est la sainte patronne des musiciens.
Selon le récit chrétien, il s’agissait d’une martyre du IIème siècle de notre ère et en allant au martyre, elle entendit la musique de Dieu et se mit à interpréter des chants mélodieux. C’est pourquoi Sainte Cécile qui est fêtée le 22 novembre est la patronne des musiciens.
<Si vous voulez en savoir plus> sur la patronne des musiciens.
Les compositeurs de l’époque baroque et aussi classique ont composé plusieurs odes à Sainte Cécile.
Dans ce concert <diffusé par Arte> il y a trois œuvres dédiées à Sainte Cécile de Purcell, de Haendel et de Haydn.
Plus récemment le domaine des chansons a aussi célébré Cécile.
<Cécile, ma fille> de Nougaro, <Cecilia> de Simon and Garfunkel, reprise en version française par Joe Dassin, <Cécile> de Julien Clerc.
Dans les années 1970, les parents aimaient donner ce prénom à leurs filles.
Cécile était le prénom d’une de nos chères collègues.
 Une jeune femme pétillante qui semblait irradier la joie de vivre. Pleine d’empathie pour les autres, c’était un bonheur de travailler avec elle.
Une jeune femme pétillante qui semblait irradier la joie de vivre. Pleine d’empathie pour les autres, c’était un bonheur de travailler avec elle.
Le mot du jour est né dans une structure professionnelle par une suggestion de Betty.
Le premier fut écrit et envoyé le 9 octobre 2012 par courriel à 6 destinataires :
Betty, Fabien, Pierre, Jérôme, Anne-Laure et Cécile.
Après avoir longtemps travaillé dans la même structure, je fus appelé à d’autres fonctions, sur ma demande, le 2 janvier 2014. Ce même jour, la première à m’écrire un message fut Cécile :
«Bonjour Alain,
Quelle tristesse à mon arrivée au bureau de voir que tu n’étais plus là ! Le bureau semble vide…Et Thierry m’a dit que tu avais pris tes nouvelles fonctions……SNIF……Tu vas nous manquer (enfin à moi c’est sûr) !
Mais heureusement que tu n’es pas loin et je sais très bien que tu es heureux de ce changement donc me voilà rassurée !
Pour toi l’année 2014 est donc l’année du changement ! Je te souhaite une belle et heureuse année remplie d’amour, de joie, de bonheur et une excellente santé bien sûr.Je suis certaine que tu vas t’épanouir dans ce nouveau poste.
Les agents de ton service ne savent pas encore la chance qu’ils ont d’avoir un chef comme toi, mais je pense qu’ils vont vite s’en apercevoir !
Bises
Cécile»Cécile est entièrement dans ce message ; enthousiaste, bienveillante, généreuse et attentionnée.
Cécile est partie de la communauté des vivants, elle n’avait pas cinquante ans.
La cérémonie des adieux a eu lieu hier.
Notre univers de relations qui nous construit, qui nous inspire, qui nourrit notre quotidien comprend toutes celles et tous ceux que nous avons rencontrés et avec qui nous avons pu construire des échanges qui nous ont fait du bien.
Cette communauté de relations comprend des vivants et aussi ceux qui sont partis. Tant il est vrai que « Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants. ».
Mais quand le départ est aussi brutal, incompréhensible surtout pour les plus proches il est nécessaire de revenir à cette recommandation d’Anton Tchekov « Enterrer les morts et réparer les vivants. »
Réparer les vivants, parce que les vivants doivent continuer leur route.
Alain Damasio écrivait :
« Le vivant n’est pas une propriété, un bien qu’on pourrait acquérir ou protéger.
C’est un milieu, c’est un chant qui nous traverse dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés.
Si bien que s’il existe une éthique en tant qu’être humain.
C’est d’être digne de ce don sublime d’être vivant.
Et d’en incarner, d’en déployer autant que faire se peut les puissances.
Qu’est-ce qu’une puissance ?
Une puissance de vie !
C’est le volume de liens, de relations qu’un être est capable de tisser et d’entrelacer sans se porter atteinte.
Ou encore c’est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables
Vivre revient alors à accroitre notre capacité à être affecté.
Donc notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému.
Contracter une sensation, contempler, habiter un instant ou un lieu.
Ce sont des liens élus. »
Une puissance de vie ! C’est le volume de liens, de relations qu’un être est capable de tisser et d’entrelacer sans se porter atteinte.
Et pour clôturer cet article selon le conseil de Jean-Philippe, finissons par la cathédrale Sainte Cécile d’Albi que les hommes ont érigée pour s’inscrire dans la durée.

<1276>
-
Mardi 24 septembre 2019
« Tout ce temps, les femmes avaient tenu, endurantes et malmenées.Nicolas Matthieu, « leurs enfants après eux » page 419Le roman que j’ai évoqué hier parle beaucoup des hommes meurtris par la fermeture des usines, de leur destin, de leur humiliation et aussi de leur attachement viscéral à la terre qui les a vu naître et grandir.
Le roman se termine par cette belle phrase appliquée au personnage principal du livre, Anthony :
« Cette empreinte que la vallée avait laissée dans sa chair. L’effroyable douceur d’appartenir. »
L’effroyable douceur d’appartenir !
Effroyable parce que le fait de rester prisonnier de cette vallée, de ne pas vouloir la quitter constitue un des termes de leur problème, car pour trouver un emploi, s’en sortir mieux financièrement, il faudrait partir, aller ailleurs.
Mais aussi douceur du lieu qu’ils habitent, qu’ils connaissent et qui les rassurent.
Mais ce que je veux surtout partager aujourd’hui c’est une belle analyse qui se trouve à la fin du livre page 419 (le livre en compte 426) dans lequel Nicolas Matthieu parle des femmes, c’est-à-dire des conjointes et des mères de ces hommes qui se lamentent, qui boivent, sont déprimés quelquefois violents.
Cela correspond aussi à mon expérience de mon pays natal.
Bien sûr, il y a toujours des exceptions et des hommes qui assurent et font face avec courage, détermination et lucidité aux épreuves de la vie.
Mais bien plus souvent ce sont les conjointes et mères qui constituent seules ou quasi seules, ce port d’attache qui dans les épreuves assurent l’essentiel, alors que souvent elles sont encore plus malmenées par la vie.
Je trouve ce moment du livre très fort et touchant :
« Le père était mort.
Quant à sa mère, elle refaisait sa vie. Elle voyait des types.
Elle avait les cheveux auburn maintenant, coiffés en pétard.
Elle serait à la retraite dans quinze ans, si le gouvernement ne pondait pas une connerie d’ici là.
C’était loin encore. Elle comptait les jours. Le week-end, elle voyait sa sœur. Elle rendait visite à des copines. C’était fou le nombre de femmes seules qui voulaient profiter de la vie. Elles faisaient des balades, s’inscrivaient à des voyages organisés.
C’est ainsi qu’on voyait des bus parcourir l’Alsace et la Forêt Noire, gorgés de célibataires, de veuves, de bonnes femmes abandonnées. Elles se marraient désormais entre elles, gueuletonnaient au forfait dans des auberges avec poutres apparentes, menu tout compris, fromage et café gourmand. Elles visitaient des châteaux et des villages typiques, organisaient des soirées Karaoké et des cagnottes pour aller aux Baléares.
Dans leur vie, les enfants, les bonhommes n’auraient été qu’un épisode. Premières de leur sorte, elles s’offraient une escapade hors des servitudes millénaires. Et ces amazones en pantacourt, modestes, rieuses, avec leurs coquetteries restreintes, leurs cheveux teints, leur cul qu’elles trouvaient trop gros et leur désir de profiter, parce que la vie, au fond était trop courte, ces filles de prolo, ces gamines grandies en écoutant les yéyés et qui avaieint massivement accédé à l’emploi salarié, s’en payaient une bonne tranche après une vie de mouron et de bouts de chandelle. Toutes ou presque avaient connu des grossesses multiples, des époux licenciés, dépressifs, des violents, des machos, des chômeurs, des humiliés compulsifs.
A table, au bistrot, au lit, avec leurs têtes d’enterrement, leurs grosses mains, leurs cœurs broyés, ces hommes avaient emmerdé le monde des années durant. Inconsolables depuis que leurs fameuses usines avaient fermé, que les hauts fourneaux s’étaient tus. Même les gentils, les pères attentionnés, les bon gars, les silencieux, les soumis. Tous ces mecs, ou à peu près, étaient partis par le fond. Les fils aussi, en règle générale, avaient mal tourné, à faire n’importe quoi, et causé bien du souci, avant de trouver une raison de se ranger, une fille bien souvent. Tout ce temps, les femmes avaient tenu, endurantes et malmenées.
Et les choses, finalement, avaient repris un cours admissible, après le grand creux de la crise. Encore que la crise, ce n’était plus un moment. C’était une position dans l’ordre des choses. Un destin. Le leur. »
Cette analyse me rappelle un mot du jour de 2016 que j’avais consacré à l’intellectuelle américaine Nancy Fraser qui dans le cadre d’une réflexion historique et plus conceptuelle évoquait ce rôle des femmes qui en le disant simplement agissent pour que la famille continue à tenir ensemble et chacun à tenir debout.
Je vous invite à relire ce mot du jour : « Les contradictions sociales du capitalisme contemporain »
<1275>
-
Lundi 23 septembre 2019
« J’ai eu l’impression d’assister en direct à la chute de la classe ouvrière »Nicolas MatthieuLes vacances constituent un moment privilégié pour lire des livres, c’est ce que j’ai fait.
Je ne lis quasi jamais le prix Goncourt de l’année, tant il est vrai que cette récompense me parait, avant tout, une opération marketing dans laquelle les manœuvres des maisons d’édition dans les salons parisiens constituent le principal moteur.
Je n’ai fait que deux exceptions.
La première fut, lors de ma longue hospitalisation en 2011, « L’Art français de la guerre » d’Alexis Jenni. Il y avait des circonstances particulières. Parmi celles-ci il y avait le fait que j’ai rencontré Alexis Jenni à plusieurs reprises parce qu’il était le professeur de biologie de mon fils Alexis au Lycée Saint Marc de Lyon. Une autre raison « plus intellectuelle » était que le sujet abordé m’intéressait particulièrement, à savoir les traumatismes français des guerres coloniales perdues en Indochine et en Algérie ainsi que les conséquences dans la société française, de ces évènements.
La seconde a eu lieu lors de ces vacances, j’ai lu le prix Goncourt 2018. « Leurs enfants après eux » de Nicolas Matthieu.
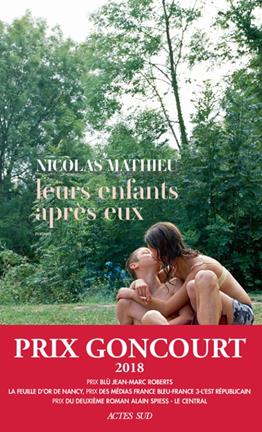 Ce roman est encore un récit des conséquences sur la société française d’un traumatisme : la désindustrialisation de régions françaises dans lesquelles la société s’était construite dans ses valeurs, dans son organisation, dans sa socialisation, autour de ces industries.
Ce roman est encore un récit des conséquences sur la société française d’un traumatisme : la désindustrialisation de régions françaises dans lesquelles la société s’était construite dans ses valeurs, dans son organisation, dans sa socialisation, autour de ces industries.
Nicolas Matthieu est né en 1978 en Lorraine, dans le département des Vosges, à Épinal.
Il a commencé à faire des études d’histoire et de cinéma puis a exercé une multitude de métiers : scénariste, stagiaire dans l’audiovisuel, rédacteur dans une société de reporting, professeur à domicile, contractuel à la Mairie de Paris….
Et puis, il a commencé à écrire.
En 2014, il a publié son premier roman, « Aux animaux la guerre » qui avait déjà reçu un certain nombre de prix littéraire, moins prestigieux que le Prix Goncourt.
Ce premier roman se passait déjà dans sa région natale et concernait les conséquences sur les salariés et leurs familles de la fermeture d’une usine, dans un lieu sinistré économiquement.
Ce roman a été adapté dans une série télévisée française en six épisodes de 52 minutes, diffusée du 15 au 29 novembre 2018 sur France 3. Nicolas Mathieu avait participé à l’adaptation de son roman pour cette série ayant un titre homonyme : « Aux animaux la guerre ».
Mon premier contact avec cet auteur et le livre qui fait l’objet du mot du jour, a été lors de son entretien sur France Inter le 8 novembre 2018 : « J’ai eu l’impression d’assister en direct à la chute de la classe ouvrière »
Il parlait d’un monde que je connaissais et qui m’était familier : celui de familles qui ont vécu (mal vécu) la fin du monde industriel dans lequel ils connaissaient les règles, leur place, leur environnement et maîtrisaient les liens sociaux.
Dans cet entretien, il dit :
« Je suis né dans ces régions-là. Mon père était ouvrier. J’ai assisté aux plans sociaux. J’ai eu l’impression d’assister en direct à la chute de la classe ouvrière. »
Mais son livre s’intéresse surtout aux enfants des ouvriers qui ont connu cette rupture.
Le lendemain, il a été l’invité d’Olivia Gesbert dans « la Grande Table du 9 novembre ». Il a eu cette autre réflexion :
« Ce qui est décrit dans le roman, c’est une petite vallée où un monde est en train de s’achever. […] [Mais] ce n’est jamais la fin du monde à la fin d’un monde, c’est toujours l’émergence de quelque chose de nouveau. »
Après ces deux émissions, j’ai décidé d’acheter et de lire ce Prix Goncourt là.
Son roman se passe dans une vallée perdue quelque part dans une ville de l’Est avec des hauts-fourneaux qui ne brûlent plus, de rouille, de chômage et dans laquelle se trouve un lac.
Il donne un nom imaginaire à cette ville : « Heillange » dans la « vallée de la Hennenote » en Moselle. Mais tout le monde reconnait dans cette ville imaginaire la ville réelle de Hayange et la vallée de la Fensch.
 Dans ma Lorraine et Moselle natale, il y avait deux bassins d’emplois miniers : celui du charbon autour des villes de Forbach et de Freyming-Merlebach et celui du fer dont parle Nicolas Matthieu et dont Hayange est un exemple. Ces deux bassins industriels ont été touchés de la même manière par la fermeture brutale des usines qui structuraient la vie sociale, économique et simplement la vie des gens qui y demeuraient.
Dans ma Lorraine et Moselle natale, il y avait deux bassins d’emplois miniers : celui du charbon autour des villes de Forbach et de Freyming-Merlebach et celui du fer dont parle Nicolas Matthieu et dont Hayange est un exemple. Ces deux bassins industriels ont été touchés de la même manière par la fermeture brutale des usines qui structuraient la vie sociale, économique et simplement la vie des gens qui y demeuraient.
Le titre est tiré d’une citation que l’auteur a mise en exergue du roman :
« Il en est dont il n’y a plus de souvenir,
Ils ont péri comme s’ils n’avaient jamais existé ;
Ils sont devenus comme s’ils n’étaient jamais nés,
Et, de même, leurs enfants après eux. »
Et il donne la source de la citation : Siracide ; 44,9.
Il s’agit, en fait, d’un livre apocryphe de l’Ancien Testament, « le livre de Jésus, fils de Sirach » qu’on nomme aussi « Siracide », « l’Ecclésiastique » ou encore « La Sagesse de Ben Sira, »
Comme le décrit cet exergue, ces gens ont vécu ce traumatisme comme une négation de leur existence, touchés dans leur chair et leur esprit avec ce sentiment qu’ils ne servaient à rien.
Comme je l’ai écrit et le titre le suggère, le roman parle surtout des enfants de ces gens.
Le livre s’articule en quatre moments chronologiques : 1992, 1994, 1996, 1998
Il est question d’adolescents : Anthony, « son cousin » qui ne sera jamais désigné autrement et Hacine qui habite un autre quartier de la ville et qui est d’origine maghrébine. On apprendra plus tard que les pères d’Anthony et Hacine travaillaient ensemble à l’usine.
Les garçons sont attirés par les filles et par l’appel de la libido. Deux filles joueront aussi un grand rôle dans le roman : Steph et sa copine Clem qui elles aussi sont dans le désir et la découverte des relations sexuelles mais issues d’un milieu social plus élevé. Il y a d’autres personnages qui tissent des liens d’attirance, de domination, de méfiance et d’affrontement. Il est aussi beaucoup question d’ennui.
Au cœur de l’histoire, il y a l’affrontement d’Anthony et d’Hacine et de leurs familles autour d’une histoire de moto volé puis détruite.
Mais c’est bien la situation sociale provoquée par la fermeture des hauts fourneaux qui trace le ressort du désœuvrement, de l’amertume et des frustrations des personnages qui cohabitent, s’affrontent et se détruisent.
C’est un roman fort et qui permet de percevoir ce que produit ce moment de rupture quand le travail à l’usine s’est arrêté.
C’est un roman à lire, pour comprendre au-delà des chiffres et des statistiques la réalité de la vie et des ressentis des gens touchés par ces évènements.
<Le Masque et la Plume> l’avait aussi chaudement recommandé.
Toutefois, dans cette émission Patricia Martin a cette réserve :
« On se retrouve face à des adolescents d’un autre siècle car c’était avant le portable…
Ce livre, à la fois montre l’explosion de l’adolescence et il est en même temps une restitution très précise d’un monde.
Le seul bémol c’est que selon moi un roman doit avoir un effet hypnotique, ce doit être un lieu de plaisir, une niche… là j’ai eu du mal à dépasser les 70 premières pages. Il y a vraiment des longueurs…
Je dirais aussi que les dialogues entre les adolescents ne m’ont pas du tout emballé, ça ne fonctionne pas du tout selon moi. »
Je la cite parce que j’ai aussi eu le sentiment que la langue et l’écriture n’était pas le point fort de cet ouvrage.
Je n’ai pas été subjugué comme par exemple lors de la lecture du livre d’Arundhati Roy « Le Dieu des Petits Riens »
 Nicolas Matthieu écrit et dit cependant des choses très intéressantes comme lors de cette émission de <Répliques> dans laquelle il était invité avec Maria Pourchet auteure de « Toutes les femmes sauf une » qui raconte le combat des femmes, de génération en génération, dans un monde qui les respecte peu et où elles sont assignées à la maternité.
Nicolas Matthieu écrit et dit cependant des choses très intéressantes comme lors de cette émission de <Répliques> dans laquelle il était invité avec Maria Pourchet auteure de « Toutes les femmes sauf une » qui raconte le combat des femmes, de génération en génération, dans un monde qui les respecte peu et où elles sont assignées à la maternité.
<1274>
-
Vendredi 20 septembre 2019
« Puisqu’on peut mourir du jour au lendemain, quel risque je prends à tenter de faire ce qui me plaît ? »Alex BeaupainC’est encore Frédéric Pommier qui m’a guidé vers cette phrase, cette histoire, cet article publié le 15 septembre 2019 par « le Monde ».
Alex Beaupain est né à Besançon en 1974, il est auteur-compositeur-interprète et aussi compositeur de musiques de films français.
Ce chanteur sort un sixième album, et « Le Monde » l’interroge dans sa série <Je ne serais pas arrivé là si…> dans laquelle le journal interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence.
Et Alex Beaupain raconte :
« La réponse est sordide, mais évidente : si mon amoureuse, Aude, n’était pas morte quand j’avais 26 ans. C’est l’événement fondateur.
Nous étions ensemble depuis dix ans. C’était un premier amour, très fort, très fusionnel.
Et puis un soir, nous étions avec des amis en boîte de nuit, à Paris, et elle a eu un arrêt cardiaque. Mort subite. On n’en connaît toujours pas la raison. C’était en novembre 2000.
Ce décès brutal a déclenché deux choses.
En partant de cet événement, j’ai commencé à écrire de bonnes chansons, plus intéressantes, plus profondes.
Et puis, devant l’absurdité de cette disparition, je me suis dit : puisqu’on peut mourir du jour au lendemain, quel risque je prends à tenter de faire ce qui me plaît ? »
Et il ajoute :
« Face à un deuil, certains se replient, d’autres se libèrent. Moi, cela m’a profondément libéré. Avant, j’étais un garçon assez velléitaire. J’avais fini par décider, trois ans plus tôt, d’essayer d’être chanteur. Mais la mort d’Aude m’a rendu plus volontaire. D’autant qu’elle croyait beaucoup en moi, beaucoup trop par rapport au petit talent que j’avais à l’époque. Elle avait par exemple décidé que c’est elle qui travaillerait, pour que je me consacre aux chansons. Elle m’avait offert le piano numérique sur lequel je joue encore.
[…] Je ne sais pas si j’ai fait son deuil, mais j’ai réussi à faire quelque chose de ce deuil. Quelque chose de l’ordre de l’énergie, de la vie. Quelle chance de pouvoir ainsi élever des tombeaux aux gens qu’on a aimés, et de continuer à les faire vivre – même si je suis athée !
La mort d’Aude a été assez exceptionnelle de ce point de vue : elle a suscité des livres de sa sœur, Isabelle Monnin, le film de Christophe Honoré, mes chansons… J’en ai peut-être abusé. »
 La carrière d’Alex Beaupain a été lancée en 2007 par le film de Christophe Honoré : « Les chansons d’amour », pour lequel il a écrit la musique récompensé par le César 2018 de la meilleure musique de film.
La carrière d’Alex Beaupain a été lancée en 2007 par le film de Christophe Honoré : « Les chansons d’amour », pour lequel il a écrit la musique récompensé par le César 2018 de la meilleure musique de film.
Il reconnait tout ce que ce film lui a apporté :
« Encore un « Je ne serais pas arrivé là si » ! Ce film a sauvé ma carrière. Après avoir pensé que je m’étais totalement planté, le fait que mes chansons intégrées à ce film soient écoutées, appréciées, m’a rassuré. Avec juste un doute : est-ce qu’elles plaisent quand elles sont interprétées par de bons acteurs, et sont insupportables quand je les chante, moi ? »
Les « Inrocks » avaient écrit à propos de ce film :
« Un drame musical enchanteur, un film gai et grave sur l’amour et l’absence. Sublime. »
<Liberation> a aussi consacré un article à ce film, à l’épisode fondateur et à la personnalité du chanteur :
« Alex Beaupain. Ce dandy pop, 34 ans, a longtemps chanté sa compagne disparue subitement. Drame qui a fait la trame du film «les Chansons d’amour» de Christophe Honoré. […]
Alex Beaupain écrit et chante des chansons d’amour, de perte, et de confusions des sexes et des sentiments. Novembre est son mois et la pluie, sa saison. Il chante sa vie, puisque la vie ne lui a pas donné le choix. Mais avec cette distance élégante, qui rend le très grave suffisamment léger pour en faire des refrains. Dandy mais pas poseur, il laboure le petit sillon de la pop romantique des chanteurs sans voix qui reliait déjà Françoise Hardy à Etienne Daho. Et aujourd’hui, il est probablement un des auteurs les plus talentueux de la chanson française.
Tout a vraiment commencé quand tout s’est effondré. D’une façon aussi violente qu’absurde. Ce soir de novembre 2000, lui et son amoureuse sortent en boîte de nuit avec des amis. Elle s’écroule. D’un coup, sans prévenir, comme si la vie lui avait été retirée d’un claquement de doigts. Il n’en dira pas plus. «Mes chansons sont déjà suffisamment impudiques comme ça. Je n’ai pas envie que les détails de ce moment-là se retrouvent imprimés dans un journal.» Il nous fera même promettre de ne pas écrire son nom. Ce sera donc A.
Elle et lui vivent depuis six ans un amour de jeunesse, à la vie à la mort, qui n’a pas eu le temps de négocier les premières concessions. Ils se sont embrassés pour la première fois à Besançon. Après le bac, ils partent à Paris pour intégrer Sciences-Po et vivre ensemble. En couple modèle. «Il ne faisait aucun doute pour moi que c’était la femme de ma vie», dit-il. «C’était un pôle d’attraction d’une force incroyable. D’ailleurs on était rarement ami de l’un ou de l’autre, mais presque toujours des deux à la fois», se souvient Didier Varot, ami du couple et à l’époque directeur artistique d’une maison de disques. Leur appartement est ouvert aux quatre vents, et à ces soirées de tarot qui ont du mal à s’épuiser avant cinq heures du matin. Il est étudiant velléitaire et secrètement auteur-chanteur-compositeur. A. est son seul public. Elle le pousse, l’encourage. Il fait comme s’il ne l’entendait pas. Christophe Honoré, à l’époque apprenti cinéaste, est l’un des premiers à être mis dans la confidence de cette ambition rentrée. Il exige une invitation formelle pour un concert à domicile. «Un moment horriblement stressant», se souvient Alex Beaupain. Honoré aime immédiatement les chansons et le convainc de se mettre au travail. Il envoie plusieurs titres à une cinquantaine de producteurs. En retour : deux courriers qui ne donneront rien. Si ce n’est l’envie de faire son premier concert dans un bar minuscule, le Paris-aller-retour. Son petit frère est à la guitare, lui au piano. A. au premier rang.
Trois semaines après la mort de A., Alex écrit une chanson, Brooklyn Bridge.«D’un seul coup je trouve une profondeur que je n’avais jamais réussi à approcher.» Cette mort devient, malgré lui, un puits d’énergie positive, d’urgence créatrice. Son drame, son inspiration. «C’est ma culpabilité : écrire des belles chansons grâce à sa disparition.» Alors il la chante, elle, leur vie, leur amour, cette absence inconsolable et ses larmes qui ne «servent à rien». Chaque petit détail de leur vie à deux vient s’incruster dans ses couplets.
Ses copains lui payent de quoi aller enregistrer à Besançon une maquette. En 2005, son premier disque, Garçon d’honneur, sort. Un bide commercial. Mais un an plus tard, Christophe Honoré lui propose d’écrire une comédie musicale à partir de ses chansons et de son histoire. Ce sera les Chansons d’amour. Le film est écrit en quelques semaines. Les chansons enregistrées en six jours. Alex Beaupain se tient à distance du tournage, sauf pour une scène. C’est lui qui interprète le chanteur lors du concert où l’héroïne, jouée par Ludivine Sagnier, décède. Sur scène, il chante Brooklyn Bridge. La boucle est bouclée. Le film est sélectionné à Cannes et la bande originale reçoit un césar. Depuis Alex Beaupain vit (chichement) de sa musique. »
Il n’est pas, nécessaire de philosopher longuement, mais de se répéter simplement cette phrase de vie, d’évidence et d’énergie :
«Puisqu’on peut mourir du jour au lendemain, quel risque je prends à tenter de faire ce qui me plaît ? »
Alex Beaupain a bien sûr un site qui lui entièrement dédié : http://alexbeaupain.artiste.universalmusic.fr/
<1273>
-
Jeudi 19 septembre 2019
« Apprenez le tricot aux enfants, plutôt que les laisser devant un écran»Philosophie d’une école californienne dans laquelle certains cadres de la silicon valley envoient leurs enfantsMichel Desmurget est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l’Inserm. Il vient de publier « La Fabrique du crétin digital » avec pour sous titre : « Les dangers des écrans pour nos enfants »
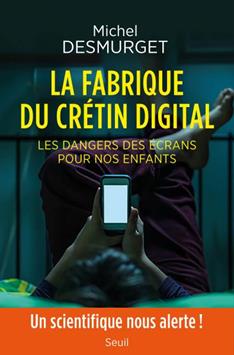 Il semble que les nouvelles générations passent beaucoup trop de temps devant des écrans : smartphones, tablettes, télévision. Selon les informations données par Michel Desmurges, dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque 3 heures d’écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45. En cumuls annuels, ces usages représentent autour de 1 000 heures pour un élève de maternelle (soit davantage que le volume horaire d’une année scolaire), 1 700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du secondaire (2,5 années scolaires).
Il semble que les nouvelles générations passent beaucoup trop de temps devant des écrans : smartphones, tablettes, télévision. Selon les informations données par Michel Desmurges, dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque 3 heures d’écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45. En cumuls annuels, ces usages représentent autour de 1 000 heures pour un élève de maternelle (soit davantage que le volume horaire d’une année scolaire), 1 700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du secondaire (2,5 années scolaires).
Selon Michel Desmurget le temps passé devant les écrans par les enfants dès leur plus jeune âge a des conséquences négatives sur la santé (obésité, développement cardio-vasculaire, espérance de vie réduite…), sur le comportement (agressivité, dépression, conduites à risques…) et sur les capacités intellectuelles (langage, concentration, mémorisation…).
Il affirme :
« Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais sans doute, dans l’histoire de l’humanité, une telle expérience de décérébration n’avait été conduite à aussi grande échelle ».
C’est en s’appuyant sur cette analyse que Telerama vient de publier un article : « Éloignez les enfants des écrans ! ».
Cet article est aussi cité par <la revue de presse de Frédéric Pommier du 15 septembre 2019> :
« Et l’hebdo s’intéresse à une école californienne, qui bannit les ordinateurs jusqu’à la classe de quatrième. Une école qui voit affluer de très nombreux enfants de cadres de la Silicon Valley. L’ingénieur qui dirige l’établissement explique que les machines, désormais super intuitives, empêchent les enfants de mobiliser tous leurs sens. Elles n’éduquent pas le cerveau à fonctionner au maximum de ses capacités. Et il prend un exemple : dans son école, au CP, tous les élèves apprennent à tricoter… Les compétences requises sont bien plus nombreuses que s’ils restaient devant un écran. Lorsque vous tricotez, vous suivez un algorithme. Ensuite, vous comprenez plus facilement son fonctionnement…
Pour faire de bons matheux, une solution, donc : le tricot ! «
Mais Louise Tourret, journaliste de France Culture, relativisait, sur le site de Slate, ces propos dans un article de mai 2018 : « Écrans et éducation, c’est compliqué » :
« Alimenter l’inquiétude, la culpabilité et l’angoisse éducative a toujours été un ressort efficace pour toucher le large public des parents. Pointer les dangers de l’époque pour les enfants est un vieux filon éditorial: vous pouvez très bien remplacer «écrans» par «sucre», «télévision» ou «rock’n’roll», suivant le moment et le lieu.
Il ne s’agit pas de tout relativiser: nourrir son enfant de sucreries et/ou passer sa vie devant la télévision n’est sûrement pas une bonne idée. Mais les critiques et les avertissements sont si excessifs que l’on peut questionner leur bien-fondé, leur efficacité et leur bonne foi. »
Elle remet aussi en cause l’exemple toujours cité des cadres de la Silicon Valley :
« Dans presque chaque débat sur les enfants et les écrans, on entend l’argument selon lequel les cadres de la Silicon Valley eux-mêmes interdisent les écrans à leurs enfants –Steve Jobs le premier– et les envoient dans des écoles où appareils électroniques et objets numériques sont bannis.
En France, la journaliste Guillemette Faure, qui a longtemps vécu aux États-Unis, en a fait le sujet d’un article publié en 2012 dans le supplément M du Monde, «Ces branchés qui débranchent».
Je lui ai demandé ce qu’elle pensait du succès de l’argument, et du fait qu’elle soit si souvent citée: «Je suis tellement contente que l’on me pose cette question ! Cet article parlait d’une école, et d’une seule, de la Silicon Valley [la Waldorf School of the Peninsula]. Je soulignais qu’il s’agissait d’une exception.[…]
Même si elle est souvent montée en épingle, l’idée d’une enfance «zéro écran» n’est pas représentative des méthodes éducatives de tous les cadres de la tech de Palo Alto. «Les familles ont des attitudes très variées. En Californie, certains parents envoient leurs enfants à des cours de code proposés pendant l’été», poursuit Guillemette Faure. Comme quoi tous les professionnels du numérique ne diabolisent pas les écrans auprès de leur progéniture. »
Pourtant vous trouvez bien dans cet article de Courrier International qui reprend un article du New York Times de 2014, dans lequel il est question du cofondateur mythique d’Apple :
« « Vos enfants doivent adorer l’iPad « avais-je lancé à Steve Jobs, en essayant de changer de sujet. La première tablette d’Apple venait d’être lancée sur le marché. « Ils ne s’en sont pas servis, m’a-t-il répondu. Nous limitons l’utilisation de la technologie par les enfants à la maison. » J’ai réagi avec un silence stupéfait. »
Le journaliste Nick Bilton continuait :
« Depuis lors, j’ai rencontré un certain nombre de PDG de la Silicon Valley qui m’ont tenu le même discours. Ils limitent strictement le temps d’écran de leurs enfants, interdisant souvent les gadgets électroniques les veilles d’école et fixant des limites très strictes les week-ends. »
Bill Gates, le fondateur Microsoft est sur cette même longueur d’onde :
« Il faut toujours chercher dans quels cas les écrans peuvent être utilisés d’une bonne manière – les devoirs, ou rester en contact avec ses amis – et dans quels cas cela devient excessif, détaille Bill Gates dans une interview au Mirror*. Nous n’avons pas de téléphone à table lorsque nous prenons nos repas, nous n’avons pas donné de portable à nos enfants avant leurs 14 ans, même quand ils se plaignaient que des camarades en aient déjà.»
Alors Xavier de la Porte a beau être agacé par cette injonction : « faites comme les cadres de la silicon valley, restreignez drastiquement le temps d’écran des enfants !», qu’il prétend d’ailleurs largement surfaite, il n’en reste pas moins que le temps passé devant les écrans par les jeunes enfants est problématique.
Dans l’article de Slate précité, Véronique Decker, directrice d’école élémentaire à Bobigny observe :
«Les enfants ont l’air sages, mais ils sont hypnotisés. Les parents regardent leur smartphone, les enfants jouent avec leur tablette; chacun regarde sa propre télé, et les gens vivent côte à côte au lieu de vivre ensemble. Le plus inquiétant, c’est que le temps d’interaction avec les humains se réduit».
Et elle ajoute
« Les élèves accèdent trop jeunes à des ressources, sans aucun contrôle ni accompagnement de leurs parents. »
Voilà donc la solution : faire faire du tricot à l’enfant et lui expliquer qu’il réalise un algorithme .dans son cerveau !
<1272>
-
Mercredi 18 septembre 2019
« Horreurs boréales en Bretagne »Charlène FlorèsCharlène Florès est bretonne et photographe.
Elle a fait son métier, elle a fait des photos.
Elle les a faites près de Rennes, à La Chapelle-des-Fougeretz.
C’est la revue de presse du jeudi 12 septembre 2019 de Claude Askolovitch qui a attiré mon attention sur l’article de l’Obs qui lui a été consacré.
Et j’ai constaté que LIBE en avait fait de même, avec plus de photos et moins de textes.
Charlène Florès précise :
« Mes photos n’ont fait l’objet d’aucune retouche couleur et aucune n’a de filtre. »
A la Chapelle-des-Fougeretz, il y a des serres. Dans ces serres, on produit des tomates toute l’année. Et pour ce faire, les maraîchers qui s’attellent à cette tâche ont recours aux éclairages LED pour faire pousser, plus vite et à moindre coût, leurs tomates cultivées sous serre.
Charlène Florès explique :
« Pour produire des tomates toute l’année, on les chauffe, on leur diffuse du CO2 et on offre un complément d’éclairage »

Le journaliste de l’Obs, Arnaud Gonzague décrit :
« Aux portes de Rennes, d’étranges dégradés fuchsia et or illuminent le ciel. Ils proviennent des éclairages artificiels émanant de grandes serres à tomates voisines. Une pollution lumineuse qui déboussole les campagnes alentour, comme le révèlent les photos de Charlène Florès. »
Vous avez donc compris qu’en plus de la pollution lumineuse des leds toute la nuit, on ajoute du CO2 !
Et l’article de Libération donne la parole à Vincent Truffault, chercheur au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
« Les plantes n’absorbent pas tout et on a donc d’importants rejets dans l’atmosphère.»
 Mais revenons à la pollution lumineuse.
Mais revenons à la pollution lumineuse.
Une maraîchère dit :
« Certaines nuits d’hiver, on voit le halo rose des serres jusque chez moi, à 30 kilomètres. »
Les villages alentours sont baignés d’une lumière fuchsia toute la nuit
Les vaches, qui sont dans des étables non fermées, sont exposées à la pollution lumineuse toute la nuit.
Tout ceci n’est évidemment pas sans conséquence. Charlène Florès rapporte :
« Un astrophysicien m’a expliqué que ces serres ont, à elles seules, une radiance [« brillance », NDLR] soixante fois plus intense que celle de la ville de Rennes, toute proche, qui compte pourtant 250 000 habitants ! »
C’est évidemment délétère pour l’horloge biologique de la flore et de la faune.
Et pour les humains ce n’est pas mieux :
« Et des travaux scientifiques démontrent que chez l’humain, la pollution lumineuse est suspectée de contribuer à l’augmentation des cancers hormono-dépendants [seins et prostate, NDLR. Mais aussi de la dépression et du diabète. »
Le journaliste de l’Obs s’offusque :
« Des tomates en hiver : le concept a déjà de quoi énerver les citoyens qui n’ont pas perdu tout bon sens. […] Difficile de ne pas faire de ces aurores boréales « façon LED » une parfaite métaphore de notre société de consommation : chatoyante, scintillante, séduisante… mais criminelle pour la planète.»
Dans l’article de Libération, avec d’autres mots, la même réalité est énoncée
« La recherche scientifique indique que cette pollution lumineuse a de sérieuses conséquences sur l’écosystème local exposé à ce rayonnement qui fait imploser le rythme des saisons, du jour et de la nuit : animaux désorientés, oiseaux chantant toute la nuit, baisse de la pollinisation nocturne, dormance des végétaux inhibée et exposition accrue aux pollutions et stress hydriques… »
Mes chers amis, il faut vraiment arrêter de consommer des tomates en hiver.
Car pour qu’on ne les produise plus, il suffit simplement de ne plus les acheter !

<1271>
-
Mardi 17 septembre 2019
«Les humains émettent du CO2, le CO2 est un gaz à effet de serre, l’effet de serre réchauffe la planète »David LouapreJ’entends dire certains qu’il y en a assez de parler du réchauffement climatique et de l’effet de serre.
Et il est vrai que d’autres défis se dressent devant nous, les besoins en eau potable, le recul dramatique de la biodiversité, l’augmentation démographique humaine qui n’a pas encore atteint son apogée, la pollution et les déchets etc.
Mais les autres défis ne signifient en aucun cas que le problème du réchauffement climatique ne constitue pas un défi majeur pour l’humanité.
Alors, il reste que des journalistes comme Pascal Praud continue à remettre en cause le phénomène. Il en est même qui utilise le concept de « pseudo réchauffement climatique ».
Et puis il y a un « pseudo scientifique » du nom de François Gervais qui fait des conférences dans lesquelles il déclare :« L’urgence climatique est un leurre »
François-Marie Bréon, chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, réfute les arguments de François Gervais dans cet article de <France soir>.
A ce stade-là, il faut rappeler ce qu’est la science, la connaissance scientifique.
Comme l’écrit si justement Rachid Benzine, le contraire de la connaissance, n’est pas l’ignorance mais les certitudes.
Les certitudes c’est pour le domaine de la croyance, pas pour le domaine scientifique.
En science, il existe des modèles qui font l’objet d’un large consensus scientifique, parce qu’ils sont vraisemblables, argumentées et qu’aucune expérience ou observation n’a pour l’instant pu les réfuter.
Je vous renvoie vers ce mot du jour de 2015 : « Une théorie qui n’est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. ». Cette phrase de Karl Popper constitue la base de la démarche scientifique qui se fonde sur le caractère réfutable d’une théorie.
Ce qui peut donc être dit, c’est que dans l’état actuel de nos connaissances la terre subit un réchauffement climatique dû à l’accumulation dans l’atmosphère de gaz à effet de serre produit par l’activité humaine. C’est l’hypothèse la plus vraisemblable. Et il n’y a pas d’observations suffisamment explicitées et argumentées qui ont été en mesure de réfuter cette théorie.
J’ai déjà évoqué la chaine Youtube <Science étonnante>, c’était le mot du 29 septembre 2017. L’animateur de cette chaîne est David Louapre
Je trouve ce jeune scientifique très pédagogue et il essaye avec simplicité de répondre à cette question : « Faut-il croire au réchauffement climatique ? »
Je trouve son approche remarquable et c’est pourquoi je la partage.
Il donne notamment ce schéma qui montre l’évolution de la concentration de CO2 dans l’atmosphère :
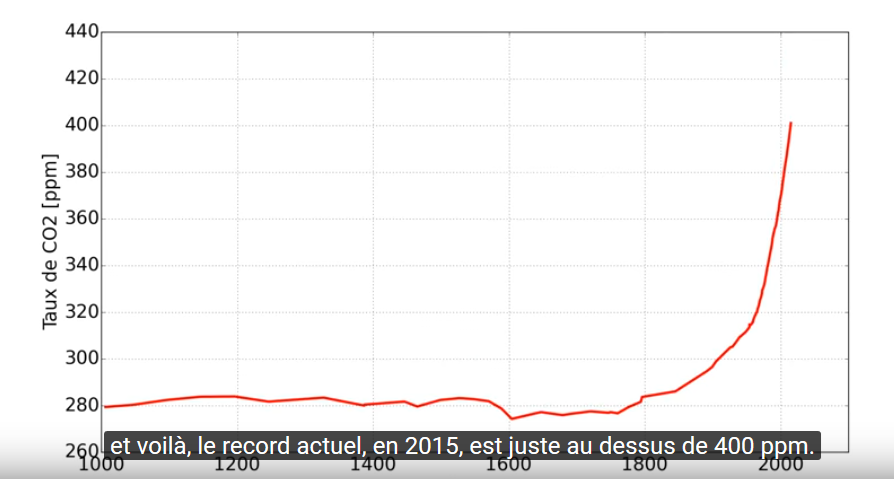
On peut remonter à l’an 1000 parce qu’on sait mesurer la concentration dans les bulles d’air qu’on trouve dans les glaces des pôles.
On utilise la mesure ppm qui signifie 1 / 1000 000. Actuellement la concentration est de 400 ppm, c’est-à-dire de 0,04 %.
On constate une augmentation sévère depuis l’apparition de la révolution industrielle
Je ne vais pas transcrire sa démonstration, mais j’ai appris quelque chose d’inquiétant. C’est que la vapeur d’eau est également un gaz à effet de serre. Mais la concentration de vapeur d’eau dans l’atmosphère n’évolue pas, en principe, parce qu’elle est régulée par l’eau des océans. Mais la concentration de vapeur d’eau dépend directement de la chaleur de l’atmosphère. Et si l’atmosphère se réchauffe, la concentration de vapeur d’eau augmentera ce qui aura pour effet d’augmenter encore la température dans un processus réflexif.
Il rappelle aussi cette évidence que la planète Mercure est beaucoup plus proche du soleil que Vénus. Mais la température moyenne de Vénus est de 462°C alors que celle de Mercure n’est (sic) que de 167°C. Et ceci s’explique probablement par le fait de la concentration de CO2 dans l’atmosphère de Vénus qui a créé un effet de serre terrible.
David Louapre a écrit des informations complémentaires sur son <blog>
<1270>
-
Lundi 16 septembre 2019
« Homo sapiens 2019 »Réflexions sur les voies qu’emprunte notre espèce humaine actuellementLe mot du jour s’est mis en pause le 12 juillet 2019 en honorant les héros humanistes contemporains qui sauvent des vies humaines en méditerranée. Particulièrement trois d’entre eux, 2 femmes et un homme, tous les trois allemands :
- Carola Rackete
- Pia Klemp
- Klaus Vogel
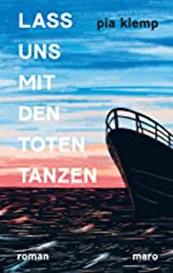 Depuis lors Pia Klemp a publié un livre sur ces sauvetages. Un livre sous forme de roman, rédigé en allemand et non encore traduit en français : « Lass uns mit den Toten tanzen ». Titre qu’on peut traduire par « Laissez-nous danser avec les morts ». ARTE l’a évoqué. Elle a aussi refusé le 20 août 2019 une décoration que voulait lui donner la maire de Paris Anne Hidalgo parce qu’elle n’est pas d’accord avec la politique migratoire de la capitale françaises.
Depuis lors Pia Klemp a publié un livre sur ces sauvetages. Un livre sous forme de roman, rédigé en allemand et non encore traduit en français : « Lass uns mit den Toten tanzen ». Titre qu’on peut traduire par « Laissez-nous danser avec les morts ». ARTE l’a évoqué. Elle a aussi refusé le 20 août 2019 une décoration que voulait lui donner la maire de Paris Anne Hidalgo parce qu’elle n’est pas d’accord avec la politique migratoire de la capitale françaises.
Quand à Carola Rackete elle a publié une tribune dans le Guardian le 4 septembre 2019 où elle fait le lien entre les migrations et la crise climatique :
« Dans des situations dans lesquelles les gens luttent déjà pour survivre, la crise climatique intensifie la pression, que ce soit par la montée du niveau de la mer, les pénuries d’eau, les dégâts des tempêtes ou les mauvaises récoltes. »
Que s’est-il donc passé depuis le 12 juillet 2019 de fondamental ?
Bien que notre Président de la République s’y soit manifesté particulièrement à son avantage, personne ne peut raisonnablement affirmer que « Le G7 de Biarritz » entre dans la catégorie des choses fondamentales.
Peut-être que la révolte de Hong Kong qui continue bien que nos grands média en parlent moins. Révolte contre la mise au pas de plus en plus autoritaire du pouvoir central de Pékin.
Si ce combat de David contre Goliath parait plus important que le G7, il n’est toujours pas fondamental au regard de notre espèce.
D’autres évènements politiques se sont déroulés :
- Matteo Salvini a provoqué, début août, une crise gouvernementale en Italie en réclamant des législatives anticipées et réclamant les « pleins pouvoirs » comme jadis Mussolini. Pour l’instant, une coalition hétéroclite a pu freiner momentanément ses ambitions.
- Boris Johnson a été élu à la tête du Parti conservateur le 23 juillet 2019 et est devenu par voie de conséquence Premier Ministre britannique. Il a apporté avec lui encore plus de confusion sur le Brexit et a abimé par ses outrances encore un peu plus l’image de la démocratie, comme le fait l’homme d’affaires et animateur de télévision pathétique que les américains ont mis à leur tête. Le second dit d’ailleurs beaucoup de bien, pour l’instant, du premier.
- En France, Emmanuel Macron continue à tenter de réformer la France, notamment par une ambitieuse réforme des retraites.
Mais tous ces évènements qui nous impactent tous à court terme ne sont pas fondamentaux au regard du temps long et de notre espèce : homo sapiens.
Un article du Monde nous apprend que le patron de Tesla Elon Musk et Neuralink ont présenté leur prototype d’implants cérébraux pour aider à communiquer avec des machines le mardi 16 juillet 2019. C’est la promesse de l’homme augmenté.
Je cite :
« Un implant discret et indolore, permettant au cerveau de communiquer directement avec des machines ou des interfaces numériques : c’est le projet, en partie concrétisé, qu’a présenté mardi 16 juillet Neuralink, la société financée à hauteur de 100 millions de dollars par Elon Musk (Tesla, SpaceX).
L’entreprise a détaillé pour la première fois, lors d’une conférence de presse diffusée en direct sur Youtube, le fonctionnement de son prototype d’interface se branchant directement sur le cerveau. Il devrait prendre, à terme, la forme d’un petit boîtier connecté sans fil directement au cerveau.
L’une des possibilités offertes par ces technologies et discutées pendant la conférence Neuralink qui s’est déroulée à San Francisco : la possibilité, pour des personnes paralysées, auxquelles on aurait réussi à implanter ce dispositif en creusant des trous dans leur crâne, de pouvoir contrôler par la pensée leur smartphone ou leur ordinateur. A terme, Neuralink espère que des millions de personnes pourront disposer d’un cerveau augmenté, selon un article de Bloomberg, qui reprend l’une des déclarations d’Elon Musk lors de la conférence : « au bout du compte, nous parviendrons à une symbiose entre le cerveau et l’intelligence artificielle. »
Mais les prototypes présentés le 16 juillet, qui semblent sortis de classiques de la science-fiction (et ont été comparés par certains internautes à un épisode de la série Black Mirror), sont encore loin d’être aboutis. Ils n’ont ainsi pas encore passé le stade des tests humains, mais seulement celui de premiers tests effectués sur des rats. Elon Musk a également laissé entendre, lors de sa conférence, que des tests avaient été effectués sur des singes avec succès.
[…]
Neuralink espère pouvoir débuter des tests sur des humains d’ici à la fin de 2020. Mais Neuralink a reconnu n’avoir pas encore démarré les démarches auprès de la Food and Drugs Administration (FDA), compétente aux Etats-Unis pour la régulation des dispositifs médicaux. Le processus pour obtenir un agrément pour ce type de dispositifs est « long et compliqué », a reconnu la société. »
C’est toujours la promesse d’améliorer la santé et les handicaps des humains touchés par le malheur qui sert à justifier ces recherches et inventions, mais quel monde nous prépare cette promesse de l’homme augmenté, l’homme relié à la machine ?
Il en va de même pour la perspective de créer des « chimères », c’est-à-dire des animaux qui portent des cellules humaines.
Cette fois c’est le Figaro qui nous apprend que :
« Le 24 juillet, le gouvernement japonais a approuvé un projet de recherche visant à créer des chimères homme-animal puis à les implanter dans l’utérus d’animaux de laboratoire. Une première au Japon. Ces travaux, dirigés par le Pr Hiromitsu Nakauchi, chercheur à l’université de Tokyo et à l’université de Stanford (États-Unis), ont pour objectif de fabriquer des organes humains dans des animaux en vue de réaliser des greffes. »
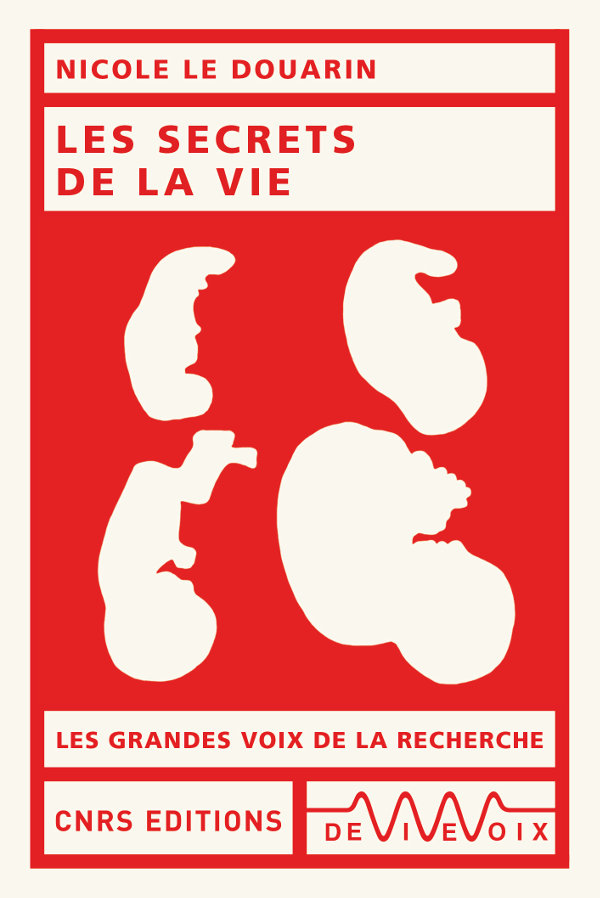 On apprend d’ailleurs que ces expériences qui sont pour l’instant au stade des recherches fondamentales existent déjà dans d’autres pays, comme la France d’ailleurs. Une de nos grandes chercheuses en biologie qui travaille au CNRS, Nicole Le Douarin vient de publier un livre : «les secrets de la vie». Elle a été invitée à l’émission de <la Grande Table du 12/09/2019>. Pour elle, ces recherches restent fécondes et éthiquement soutenables. Elle s’inquiète au contraire de la :
On apprend d’ailleurs que ces expériences qui sont pour l’instant au stade des recherches fondamentales existent déjà dans d’autres pays, comme la France d’ailleurs. Une de nos grandes chercheuses en biologie qui travaille au CNRS, Nicole Le Douarin vient de publier un livre : «les secrets de la vie». Elle a été invitée à l’émission de <la Grande Table du 12/09/2019>. Pour elle, ces recherches restent fécondes et éthiquement soutenables. Elle s’inquiète au contraire de la :«panique générale qui s’exerce, […] une espèce de doute vis-à-vis des scientifiques, vis-a-vis de l’avancée des sciences.»
Mais on comprend bien qu’on attaque là quelque chose de fondamental qui touche l’éthique et que homo sapiens continue à penser que l’animal est un simple objet dont la fonction principale est d’être utilisée par lui pour son plaisir, ses besoins et ses fantasmes.
Elon Musk veut fonder une colonie humaine sur Mars. Il croit la théorie de l’effondrement de la civilisation humaine possible, sinon certaine. C’est pourquoi il envisage et travaille dans ce sens avec son entreprise Space X pour créer une colonie d’humains sur mars. Une petite élite d’humain pourra ainsi être sauvée. Il a tweeté le 16 août 2019 son idée de faire exploser des bombes atomiques sur mars. Cette idée il l’avait déjà développée en 2015, mais on croyait qu’il y avait renoncé. Il pense être capable de créer un effet de serre susceptible de faire réchauffer la température de mars qui en moyenne est de -63°C.
L’effet de serre est bien réel sur terre. Cet été, la France a battu son record absolu de chaleur. C’est 46 degrés Celsius qui ont été atteints le 28 juin à Vérargues (Hérault), lors de la première vague de canicule . La seconde vague a vu Paris battre son record de chaleur, en atteignant 42,6°C.
Il n’est pas encore scientifiquement prouvé que l’augmentation des fréquences et de la force des ouragans soit directement liée au réchauffement climatique, certains l’affirment cependant.
Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres qui s’est rendu aux Bahamas, durement touchés par l’ouragan Dorian semble adhérer à cette thèse.
Les destructions ont été d’une telle ampleur que pour deux des îles : Grand Bahama et surtout Abaco, les survivants ont dû quitter leur île.
Le secrétaire général de l’ONU a ainsi visité des îles quasiment désertes. Il a déclaré à des journalistes de France Inter :
« J’ai vu de nombreuses inondations, tremblements de terre, des ouragans et leurs conséquences un peu partout dans le monde, et je dois dire que le niveau de destruction ici, c’est du jamais vu. »
Et il a ajouté :
« Si nous ne la respectons pas, la Nature nous frappe violemment ».
La BBC a publié sur son site des images de l’île d’Abaco.

Voici certains projets, idées et conséquences des actes d’homo sapiens en 2019.
<1269>
- Carola Rackete
-
Lundi 15 juillet 2019
« Le mot du jour est en congé »Il reviendra au mois de septembre après le 15 septembre à une date restant à fixerIl faut savoir faire silence, se reposer, se régénérer pour revenir pour de nouveaux partages, réflexions et questionnements.
 En attendant, je vous renvoie vers un mot du jour ancien consacré à un livre économique que je viens de retravailler, celui du 19 juin 2015 :
En attendant, je vous renvoie vers un mot du jour ancien consacré à un livre économique que je viens de retravailler, celui du 19 juin 2015 :
«Croissance zéro ?»»
Patrick Artus & Marie-Paule Virard -
Vendredi 12 juillet 2019
« Celui qui sauve un seul homme est considéré comme ayant sauvé tous les hommes »Coran, Sourate V verset 32, dans la traduction de Malek ChebelC’est le Président Barack Obama, lors de son fameux <Discours du Caire> tenu le 4 juin 2009 à l’Université du Caire qui a rappelé ce verset du Coran :
« Le Saint Coran nous enseigne que quiconque tue un innocent tue l’humanité tout entière,
Quiconque sauve la vie d’un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l’humanité tout entière !»
Et j’ai lu dans diverses sources que dans le Talmud il en va de même : « Celui qui sauve une vie sauve l’humanité entière ». (Traité Sanhedrin, chapitre 5, Mishna 5).
Je n’ai pas trouvé l’équivalent dans la littérature chrétienne, mais cela m’a peut-être échappé.
Carola Rackete
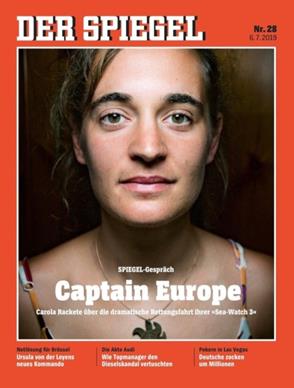 Le magazine allemand « Der Spiegel » a mis son portrait à la Une de son journal le 6 juillet et lui a donné pour surnom : « Captain Europe »
Le magazine allemand « Der Spiegel » a mis son portrait à la Une de son journal le 6 juillet et lui a donné pour surnom : « Captain Europe »
Elle était la capitaine du navire « Sea Watch 3 » qui a forcé le barrage et l’ordre de Matteo Salvini, pour accoster à Lampedusa, le 29 juin 2019, et faire débarquer les migrants en détresse sur la terre ferme, dans un port, comme le prévoit les règles internationales de la navigation.
Libération dans un article du <30 juin 2019> raconte :
« L’Allemande qui a accosté de force samedi à Lampedusa avec une quarantaine de migrants a été arrêtée par les autorités italiennes. »
Elle a été libérée depuis par une décision de la Justice italienne.
« Quelques jours avant d’accoster à Lampedusa, elle avait dit au Spiegel : «Si nous ne sommes pas acquittés par un tribunal, nous le serons dans les livres d’histoire.» […] Les autorités italiennes lui reprochent notamment d’avoir tenté une manœuvre dangereuse contre la vedette des douanes qui voulait l’empêcher d’accoster. Elle risque jusqu’à dix ans de prison pour «résistance ou violence envers un navire de guerre».
«Ce n’était pas un acte de violence, seulement de désobéissance, a expliqué Carola Rackete dimanche au Corriere della Sera. Mon objectif était seulement d’amener à terre des personnes épuisées et désespérées. J’avais peur.» «Après dix-sept jours en mer et soixante heures en face du port, tout le monde était épuisé, explique à Libération Chris Grodotzki de Sea Watch. L’équipage se relayait vingt-quatre heures sur vingt-quatre afin de surveiller les passagers pour les empêcher de se suicider.» »
Ce qui est marquant ici, c’est l’affrontement de deux groupes irréconciliables :
Carola Rackete a débarqué sur l’île italienne sous un mélange d’applaudissements et d’éructations haineuses : «Les menottes !» «Honte !» «J’espère que tu vas te faire violer par ces nègres». Dans un tweet, le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini, s’est réjoui de l’arrestation. «Prison pour ceux qui ont risqué de tuer des militaires italiens, mise sous séquestre du navire pirate, maxi-amende aux ONG, éloignement de tous les immigrés à bord, désolé pour les « complices » de gauche. Justice est faite, on ne fera pas marche arrière !»
Si l’extrême droite italienne la qualifie de «criminelle», Carola Rackete suscite l’admiration en Allemagne. Celle que le Tagespiegel surnomme «l’Antigone de Kiel» est née tout près de ce port en bordure de la mer Baltique il y a trente et un ans.
«J’ai la peau blanche, j’ai grandi dans un pays riche, j’ai le bon passeport, j’ai pu faire trois universités différentes et j’ai fini mes études à 23 ans. Je vois comme une obligation morale d’aider les gens qui n’ont pas bénéficié des mêmes conditions que moi», avait-elle expliqué à la Repubblica. Avant de rejoindre Sea Watch il y a quatre ans, elle a participé à des expéditions pour l’Institut Alfred-Wegener pour la recherche polaire et marine, et pour Greenpeace. […]
Les politiques allemands ont donc fini par réagir. Samedi, le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas (SPD), déclarait : «Sauver des vies est un devoir humanitaire. Le sauvetage en mer ne devrait pas être criminalisé. La justice italienne doit désormais clarifier rapidement ces accusations.» «Une phrase typique de diplomate allemand timoré, commente Chris Grodotzki de Sea Watch. Nous avons demandé un millier de fois à Heiko Maas de prendre position sur le sauvetage en mer, sans succès jusqu’ici.» Dimanche, le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, affirmait dans une interview télévisée : «Celui qui sauve des vies ne peut pas être un criminel.»
Les 42 migrants du Sea Watch 3 ont donc fini par débarquer à Lampedusa. Ils devraient être répartis entre cinq pays : la France, l’Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et la Finlande. Ceux-là ne seront pas morts en Méditerranée, où 17 900 personnes ont péri entre 2014 et 2018 selon un récent rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et où demeurent toujours engloutis les restes de 12 000 personnes. »
« Celui qui sauve une vie sauve l’humanité entière »
Pia Klemp
 Pia Klemp est aussi une jeune allemande qui était la capitaine d’un navire qui a sauvé des migrants.
Pia Klemp est aussi une jeune allemande qui était la capitaine d’un navire qui a sauvé des migrants.
Elle est toujours en prison, elle risque 20 ans de prison après avoir sauvé des migrants de la noyade.
C’est Frédéric Pommier qui en a parlé lors <d’une chronique> diffusé sur France Inter le 14 juin 2019
Elle est accusée du délit suivant : « aide et complicité à l’immigration illégale ». Une pétition a été lancée pour la soutenir
Frédéric Pommier explique ;
« C’est une femme dont la peau blonde est parsemée de tatouages d’inspiration japonaise : des montagnes sur une épaule, un goéland sur l’autre, des fleurs, des poissons… Un long maquereau nage sur l’un de ses tibias… Son corps est un tableau, comme un carnet de voyage… Mais ce n’est pas pour ces gravures colorées que les médias nous ont parlé d’elle ces derniers jours. Pas non plus pour sa formation de biologiste, mais pour ses fonctions de capitaine, car Pia Klemp – c’est son nom – est capitaine de bateau.
C’est au sein de l’organisation Sea Shepherd qu’elle a tout d’abord travaillé.Une ONG de défense des océans, dont la maxime est une citation de Victor Hugo.
« Il vient une heure où protester ne suffit plus ; après la philosophie, il faut l’action. »
Phrase tirée des Misérables. Un appel à la lutte et, dans le cas présent, la lutte pour la préservation des écosystèmes marins. Premier engagement de cette trentenaire née à Bonn en 1983.
C’est pour ça que j’ai appris à diriger un navire, pour ça que j’ai appris à diriger un équipage. La petite sortie du dimanche à la voile, ce n’est pas pour moi.
Sympathisante de la gauche radicale allemande, Pia Klemp a mené des expéditions dans les eaux de l’archipel nippon où, avec d’autres, elle est allée batailler contre les pêcheurs de baleines. Des centaines de cétacés harponnés chaque année… Massacre qui, là-bas, va d’ailleurs redevenir légal en juillet… Puis, après les rorquals, la jeune activiste a décidé de porter assistance aux hommes, espèce qui, elle aussi, parfois, mérite d’être protégée.
On est en 2016, et Pia Klemp se met au service d’autres ONG. Cette fois en Méditerranée, devenue, depuis le début de la guerre en Syrie, le plus grand cimetière d’Europe.
Aux commandes de deux bateaux humanitaires, elle participe au sauvetage de plus d’un millier de naufragés, en perdition sur des canots pneumatiques
Elle a sauvé des vies, des femmes, des ados, des enfants mais, suite à cela, elle est sous la menace d’un procès en Italie. […]
Calcul simple : 1 000 vies sauvées, amende de 15 millions d’euros . […]
Pour sa défense, elle invoque le droit maritime international, qui impose de porter secours à toute personne en détresse. C’est aussi ce qu’évoquent ceux qui la soutiennent. Une pétition en ligne a été lancée pour exiger l’abandon des charges qui pèsent sur elle… Elle a déjà recueilli plus de 100.000 signatures, et une photo accompagne le texte, celle d’un petit corps gisant sur une plage de Turquie ; le cliché tristement célèbre du petit Alan Kurdi, mort noyé à l’âge de trois ans, alors qu’il fuyait avec sa famille la guerre en Syrie.
C’était en 2015, et il était devenu le symbole de ces désespérés qui, au péril de leur vie, tentent de rejoindre une Europe qui ne sait les accueillir. Pia Klemp, elle, est devenue un autre symbole.
Elle est le nouveau visage de ceux que l’on accuse de délit de solidarité
Sur les réseaux sociaux, certains écrivent qu’elle aurait dû reconduire les naufragés de l’autre côté de la mer et que oui, elle mérite la taule !
Non. Elle mérite notre respect.
Cette femme aux tatouages d’inspiration japonaise fait honneur à l’humanité. »
« Celui qui sauve une vie sauve l’humanité entière »
Klaus Vogel
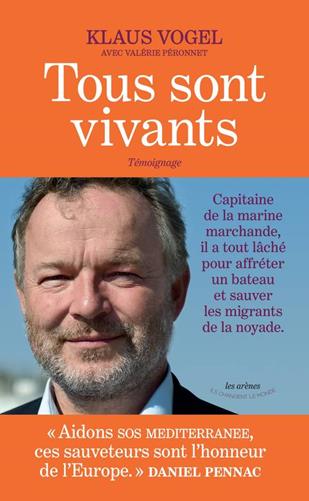 Klaus Vogel est aussi allemand, un peu moins jeune que ses deux compatriotes. En octobre 2014, l’Italie met fin à l’opération humanitaire Mare Nostrum, chargée de porter secours aux migrants en Méditerranée. Klaus Vogel est alors capitaine dans la marine marchande. Il démissionne et crée avec Sophie Beau, en mai 2015, l’association <SOS Méditerranée> qui a pour ‘objectif d’affréter un bateau pour ne pas laisser des hommes et des femmes mourir aux portes de l’Europe. Ce bateau est l’Aquarius. Il écrira un livre qui raconte cette aventure : «Tous sont vivants»
Klaus Vogel est aussi allemand, un peu moins jeune que ses deux compatriotes. En octobre 2014, l’Italie met fin à l’opération humanitaire Mare Nostrum, chargée de porter secours aux migrants en Méditerranée. Klaus Vogel est alors capitaine dans la marine marchande. Il démissionne et crée avec Sophie Beau, en mai 2015, l’association <SOS Méditerranée> qui a pour ‘objectif d’affréter un bateau pour ne pas laisser des hommes et des femmes mourir aux portes de l’Europe. Ce bateau est l’Aquarius. Il écrira un livre qui raconte cette aventure : «Tous sont vivants»
C’est encore Frédéric Pommier qui en parle si justement et si simplement. <La revue de presse est de 2017>
« Il s’appelle Klaus Vogel, il a 60 ans, il est Allemand et pendant des années, il a fait le même cauchemar : un homme à la mer à qui il tend la main.
Son regard est empli d’effroi, mais impossible de l’agripper, sa main ne cesse de glisser et il n’est que le premier d’une longue farandole de naufragés désespérés qui tentent de flotter. Puis les plus éloignés disparaissent progressivement. « Je n’ai pas pu attraper le premier, et finalement ils sont tous morts », raconte Klaus Vogel dans les colonnes de SOCIETY.
C’est il y a 25 ans que, pour la première fois, il a fait ce cauchemar-là. A l’époque, il est lieutenant sur un cargo et la veille, son capitaine a refusé de prendre la route qu’il avait tracée – la route pourtant la plus rapide, la route pourtant la plus logique.
Mais non, il n’avait pas voulu, au motif qu’elle passait près des côtes du Vietnam et qu’ils risquaient donc de croiser des boat people en détresse. Klaus a donc obéi, tracé un autre itinéraire. Puis le soir même, il faisait le cauchemar de l’homme à la mer à qui il tend la main.
C’est le cauchemar de la mauvaise conscience
« J’étais prêt à participer à des sauvetages, et l’équipage aussi je crois, et c’est simplement par souci économique qu’on a fait un détour : au moins, on était sûr de ne pas croiser un boat people en difficulté qui nous aurait retardé. Mais, poursuit-il, cette idée de perdre du temps, et donc de l’argent parce que l’on sauve des hommes, du point de vue moral, c’est incompréhensible.
On ne perd pas du temps dès lors qu’on gagne des vies ! »
Lui en a gagné, des vies. Il a sauvé des milliers de vies.
Et c’est pour cette raison que le quinzomadaire dresse son portrait sur trois pages. Décidant de faire le boulot dont l’Europe et les politiques se sont, en somme, lavé les mains, l’ancien responsable de la marine marchande a fondé, il y a deux ans, SOS MEDITERRANEE. Une ONG dont le patrouilleur baptisé L’Aquarius, vient en aide à ceux qui ont eu la malchance de naître du mauvais côté de la mer.
L’Aquarius a déjà récupéré près de 20.000 naufragés au large des côtes libyennes, et depuis ces missions de sauvetage, Klaus Vogel ne fait plus le cauchemar qui l’a hanté durant plus de 30 ans. Plus de cauchemar, mais ce sont les témoignages des rescapés qui l’empêchent désormais de dormir. Il a donc décidé de passer le relais. Il a transmis à d’autres les rennes de l’ONG et de son projet Aquarius. « Pour moi, aller plus loin serait aller trop loin », dit-il.
Et l’on songe alors à cette parole du Coran qui, du reste, est également un proverbe juif : « Celui qui sauve une vie sauve l’humanité entière. »
Libération lui avait également consacré un article le 5 juin 2017 : « Klaus Vogel, cœur en stock » :
« Pas à pas, tenace et organisé, Vogel jette son dévolu sur un patrouilleur de 77 mètres. Depuis un an et demi, Aquarius a accompli 100 opérations de sauvetage et a récupéré 18 000 naufragés. Voici quelques jours, 1 000 personnes se sont hissées à bord, bien au-delà des capacités autorisées. Mais comment faire autrement, quand la flotte marchande se tient prudemment à distance de ces parages où se noie la misère du monde, et que les navires de guerre sont tenus de contenir le flux plutôt que venir au secours de ceux qu’emporte le vent noir de l’histoire immédiate ?
Initiateur de l’ONG SOS Méditerranée, le marin a dirigé les premières campagnes comme maître à bord. Depuis, il est le porte-voix et le glaneur de fonds de l’association.[…]
Pour pouvoir mener à bien une mission dont il ne tire aucun revenu, Vogel a créé une petite boîte de conseil. Il intervient auprès d’une association qui fait du coaching pour demandeurs d’emploi et leur explique comment il a réussi à mettre à flot sa structure maritime. De l’intérêt serpentin qu’il y a à se mordre la queue… Karin, sa femme de toujours, est infirmière. Leurs 4 enfants sont adultes. Récemment, ils ont vendu la grande maison de Göttingen et se sont installés à Berlin. Ils se promettaient des évolutions seniors de préretraités prêts à tout et intéressés par beaucoup. Et puis, SOS Méditerranée a tout bouleversé. Il ne sait trop de quoi demain sera fait. Si la caisse de bord sonne le creux, il pourra toujours retrouver un commandement au long cours. Il aime le large, moins l’éloignement qu’il impose. Et puis, il y a les vagues d’actualité qui se fracassent, et l’urgence en exigence. »
Après avoir perdu son pavillon et avoir été harcelé, immobilisé par les autorités maritimes, la justice italienne a demandé le placement sous séquestre du navire, SOS Méditerranée et ses partenaires ont annoncé en décembre 2018, renoncer à continuer d’utiliser <L’Aquarius>,.

Les Inrocks lui ont également consacré un article : « Un héros de notre temps : Klaus Vogel, capitaine au long cours au secours des migrants »
La question de la migration n’est pas chose simple. Elle ne peut pas être résumé à des tableaux de chiffres qui pour les uns disent qu’il y a peu de migration et que nous n’avons aucune peine à l’intégrer et qui pour les autres prétendent qu’un grand remplacement est en marche.
Mais on ne peut pas laisser mourir des enfants, des femmes et des hommes qui sont en train de se noyer dans la mer.
C’est aux États de réaliser cette mission.
Ils ont renoncé et c’est des femmes et des hommes qui se sont levés pour aller en mer réaliser ce devoir premier de l’humanité : empêcher les humains de mourir.
« Celui qui sauve une vie sauve l’humanité entière »
Le mot du jour se met au repos et au silence pour la trêve estivale. Il reviendra, si tout va bien, dans la seconde moitié du mois de septembre.
<1268>
-
Jeudi 11 juillet 2019
« Seul le meilleur est acceptable »Herbert von Karajan (5 avril 1908 – 16 juillet 1989)Karajan est né dans une famille autrichienne et il avait aussi un ancêtre paternel originaire de Grèce comme Sappho de Mytilène.
 Il est né à Salzbourg, la ville où est né Mozart
Il est né à Salzbourg, la ville où est né Mozart
Le 16 juillet 2019, cela fera 30 ans qu’il a quitté la communauté des vivants.
Il y a 30 ans j’étais plus jeune et je crois que j’étais très injuste dans mon appréciation sur ses qualités et son importance dans la musique.
Je me souviens de discussions passionnées avec mon ami Bertrand G. qui considérait que c’était le plus grand.
Moi je ne voyais que la part d’ombre
Le fait qu’il avait par deux fois adhéré au parti nazi, pour sa tranquillité et pouvoir continuer à exercer son métier. Il n’était cependant pas dans les grâces d’Hitler qui le traitait de « freluquet autrichien ».
Je n’aimais pas, à l’époque, son côté autocrate, je disais « dictatorial ».
Je n’aimais pas ses interprétations et préféraient toujours d’autres interprétations.
Chaque fois qu’il y avait une histoire drôle à ses dépens je m’en délectais.
Comme celle qui mettait en scène 3 grands chefs de l’époque qui se disputait pour savoir qui est le plus grand.
« C’était d’abord Bernstein qui disait : c’est moi le plus grand parce que je suis aussi compositeur et que j’ai composé West Side Story,
Solti s’approchait alors en disant : Dieu m’a dit…
Immédiatement interrompu par Karajan répliquant : comment ça je ne t’ai rien dit. »
 Mon frère m’a rapporté que lorsque l’Octuor de Paris dont il était membre, était allé à Berlin pour un concert à la Philharmonie, lui et ses collègues avaient demandé au chauffeur de taxi de les emmener à la Philharmonie. Le chauffeur de taxi avait conclu :
Mon frère m’a rapporté que lorsque l’Octuor de Paris dont il était membre, était allé à Berlin pour un concert à la Philharmonie, lui et ses collègues avaient demandé au chauffeur de taxi de les emmener à la Philharmonie. Le chauffeur de taxi avait conclu :
« Ah oui au Karajan Circus »
Ou cette autre histoire :
C’est Karajan qui prend un taxi à Berlin. Le chauffeur lui demande : « Où dois-je vous emmener Maestro ? ». Et la réponse de Karajan : « N’importe où, partout on a besoin de moi ! ».
Et cette manie de diriger les yeux fermés dans les années 1970 !
Simon Rattle dit aujourd’hui :
« Les dernières années lorsque Karajan se mit à diriger les yeux ouverts. […]. Ce contact visuel établi sur le tard avec ses musiciens, après des années où il sembla commander à des escadrons fanatisés, est comme une rédemption. »
Et il est vrai qu’à la fin de sa vie, Karajan est tombé gravement malade et il ne pouvait plus garder les yeux fermés pour une question d’équilibre.
Et je me souviens que Yehudi Menuhin disait : « Il est tombé malade et a gagné énormément en humanité.»
Mais ce n’était que l’écume des choses !
J’ai beaucoup appris depuis et notamment à travers les propos de Christophe André sur « l’admiration »
« L’admiration, c’est la volonté de porter son regard sur ce qui rend le monde meilleur. […]
Admirer quelqu’un alors qu’on connait bien ses travers !
L’admiration est un contraire de la mesquinerie qui va chercher les défauts derrière les qualités.
Plusieurs travaux de psychologie positive ont mesuré en laboratoire les conséquences de différentes formes d’admiration […] ont confirmé qu’admirer nous rend meilleur, plus proche des autres, plus altruiste, plus motivé à progresser »
Et maintenant 30 ans après, je vois surtout son extraordinaire capacité d’aller vers la plus grande qualité d’interprétation, l’approfondissement.
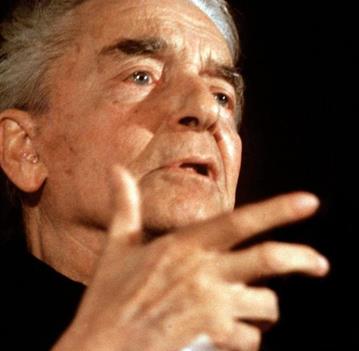 Dans des propos rapportés par le Figaro Magazine du 22 juillet 1989, il disait :
Dans des propos rapportés par le Figaro Magazine du 22 juillet 1989, il disait :
« Seul le meilleur est acceptable !
La maladie affolante de notre société c’est de ne pas demander le meilleur possible »
Contrairement à d’autres grands chefs, et à ceux d’aujourd’hui qui folâtrent d’un orchestre vers l’autre et qui ont la responsabilité de deux voire trois orchestre, lui a été le chef d’un seul orchestre : l’Orchestre Philharmonique de Berlin. Parfois il allait diriger l’Orchestre Philharmonique de Vienne mais revenait toujours à son orchestre, dans un travail en profondeur pour obtenir une pate orchestrale et une qualité unique et phénoménale.
Et que dire lorsqu’on sait qu’alors il était tout à la fin de sa longue carrière et qu’il entendit Evgeny Kissin 16 ans alors, jouer du piano il fut ému aux larmes.
Son épouse Eliette Mouret raconta comment malgré ses tentatives répétées de lui faire rencontrer Pablo Picasso, elle n’arriva jamais à l’organiser, Karajan parvint toujours à se défiler.
Après la mort du peintre, son épouse lui demanda si ça ne l’aurait pas intéressé de le connaître. Il répondit :
« Si bien sûr, beaucoup, mais je ne pouvais pas m’imaginer que ce serait intéressant pour lui de me rencontrer »
Il était aussi visionnaire et a pleinement participé à l’essor des nouvelles technologies audio.
<Il joua un rôle éminent dans l’émergence du CD>
Evidemment, 30 ans après c’est devenu un support du passé.
Jamais Karajan ne fit de concessions à l’exigence musicale.
Ce fut un des plus grands musiciens interprètes du XXème siècle.
Je me délecte aujourd’hui à écouter les enregistrements qu’il a laissés à l’Histoire.
Et si je dois en choisir qu’un petit nombre je prendrai :
Le Pélléas et Mélisande de Debussy
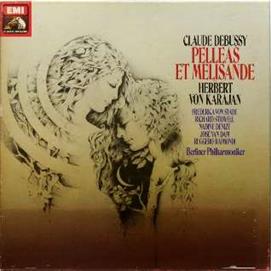
Le Parsifal de Wagner
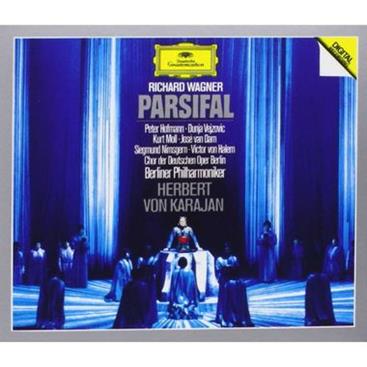
Et son anthologie des œuvres de Berg, Webern et Schoenberg
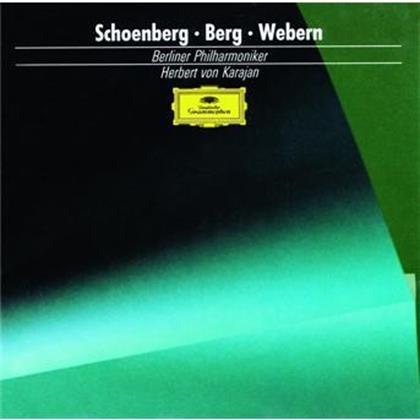
Et une madeleine de Proust : Les préludes de Liszt
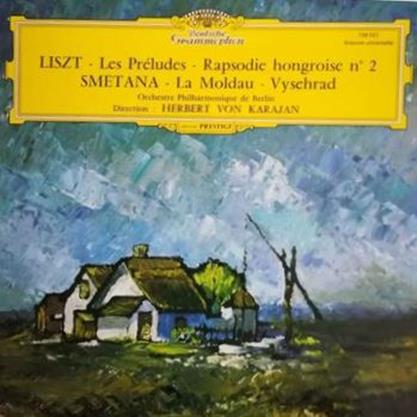
<1267>
-
Mercredi 10 juillet 2019
« Anthe Amerghissan
(J’ai vu cueillant des fleurs) »Poème de Sappho de Mytilène mis en musique et chanté par Angélique IonatosIl était tôt le matin, ce lundi. J’ai allumé la radio, évidemment France Culture. C’était la fin de l’émission « Les nuits de France Culture »
L’invité était Emmanuel Guibert.
Emmanuel Guibert est un dessinateur et scénariste de bande dessinée. Il parlait de son œuvre.
Et puis pour terminer l’émission, la journaliste lui avait demandé de choisir une œuvre de musique.
Et il a choisi une chanson parce que « c’est tout simplement magnifique ».
Et c’est ainsi que j’ai découvert « Angélique Ionatos » « et « Sappho de Mytilene ».
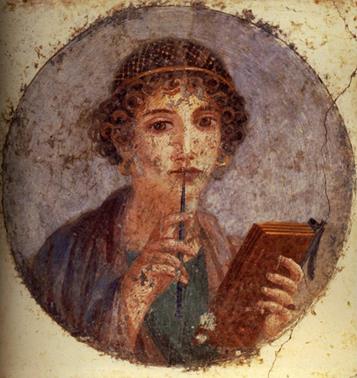 Nous connaissons cette fresque, maintes fois représentée dans les livres d’Histoire et de l’Art.
Nous connaissons cette fresque, maintes fois représentée dans les livres d’Histoire et de l’Art.
Elle a été découverte dans une villa à Pompéi et représente un buste de femme avec un stylet et une tablette dans chaque main.
La tradition et la légende prétendent qu’il s’agit de Sappho de Mytilene.
Il n’y a quasi aucune chance qu’il y ait une quelconque ressemblance avec la grande poétesse grecque.
Cette fresque a été réalisée au I siècle après J.C.
Sappho a vécu aux VIIe siècle et VIe siècle av. J.-C., à Mytilène sur l’île de Lesbos.
Elle fut très célèbre durant l’Antiquité, mais son œuvre poétique ne subsiste plus qu’à l’état de fragment.
De nombreux poètes et auteurs anciens parlent d’elle, ne laissant aucun doute quant à son existence réelle et son talent.
Solon le célèbre législateur et homme d’État de la démocratie athénienne était son contemporain. Il aurait dit, après avoir entendu la lecture d’un de ses poèmes :
« Mon désir est de l’apprendre et de mourir ensuite »
Selon Wikipedia quand dans le monde antique on disait « le poète » il s’agissait d’Homère, de même si l’on parlait de « la poétesse » c’était Sappho.
On lui doit la création d’une forme métrique particulière, la « strophe sapphique ».
C’était une femme libre qui est aussi connue pour avoir exprimé dans ses écrits son attirance pour les jeunes filles d’où le terme « saphisme » pour désigner l’homosexualité féminine tandis que le terme « lesbienne »est dérivé de Lesbos, l’île où elle a vécu.
Mais si vous voulez en savoir plus <Wikipedia> consacre un très long article à Sappho de Mytilene et fait un point très complet de ce que l’on sait d’elle et aussi les différentes hypothèses qui ont été développées sur sa vie et son œuvre.
 <Angélique Ionatos » est compositrice, guitariste, chanteuse grecque, mais elle vit en France.
<Angélique Ionatos » est compositrice, guitariste, chanteuse grecque, mais elle vit en France.
Elle a composé sur des vers d’il y a 2500 ans, des vers écrits par Sappho de Mytilène.
Et comme le dit Emmanuel Guibert « C’est tout simplement magnifique ».
« Anthe Amerghissan » une autre chanteuse intervient Nena Venetsanou.
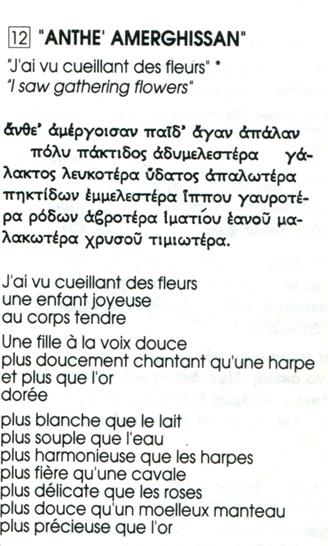
Le soir j’ai acheté sur « Qobuz » l’album qui contenait cette chanson, mais sans livret.
Hier, j’ai emprunté le disque à la bibliothèque pour en avoir le livret et comprendre les paroles chantées.
Je suis donc en mesure de partager ce chant et ce texte parce que c’est tout simplement magnifique.
Angélique Ionatos chante aussi des poèmes du poète grecque « Odysseus Elytis » né en Crète en 1911 et dont la famille est originaire de Mytilène (Lesbos). Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1979 et il est mort en 1996.
Il écrit dans le livret de ce disque qui porte pour titre simplement « Sappho de Mytilène » ce texte :
« La nature crée ses propres parentés, quelquefois plus puissantes que celles forgées par le sang.
2500 ans en arrière, à Mytilène, je crois voir Sappho comme une cousine lointaine avec qui je jouais dans les mêmes jardins, autour des mêmes grenadiers, au-dessus des mêmes puits.
A pêine plus âgée que moi brune avec des fleurs dans les cheveux et un cahier secret plein de poèmes qu’elle ne m’a jamais permis de toucher.
Il est vrai que nous avons vécu sur la même île. […]
Mais avant tout, nous avons travaillé – chacun à sa mesure – sur les mêmes notions pour ne pas dire avec les mêmes mots : le ciel et la mer, le soleil et la lune, les végétaux, les filles, l’amour.
Qu’on ne me tienne pas rigueur, alors si je parle d’elle comme d’une contemporaine. Dans la poésie, comme dans les rêves, personne ne vieillit. »
Odysseus Elytis
<ICI> vous trouverez un autre poème du disque chanté par Angélique Ionatos, cette fois en vidéo.
« De tous les astres le plus beau »
Baudelaire a évoqué Sappho dans un des poèmes des « Fleurs du mal » : « Lesbos »
«De la mâle Sapho, l’amante et le poète,
Plus belle que Vénus par ses mornes pâleurs !
– L’oeil d’azur est vaincu par l’oeil noir que tachète
Le cercle ténébreux tracé par les douleurs
De la mâle Sapho, l’amante et le poète !»Verlaine aussi a écrit un poème sur la poétesse : <Sappho>
 Et je finirai par des vers de Sappho c’est la première chanson du disque : <Aérion épéon>
Et je finirai par des vers de Sappho c’est la première chanson du disque : <Aérion épéon>
« J’écris mes vers avec de l’air
Et on les aime.
J’ai servi la beauté
Etait-il en effet pour moi
Quelque chose de plus grand ?
Même dans l’avenir
Je le dis
On gardera de moi le souvenir »
J’ai servi la beauté…
Les anciens égyptiens disaient qu’un humain meurt deux fois.
La première fois quand le corps meurt.
La seconde fois quand plus personne ne prononce son nom.
Sappho de Mytilène n’a pas connu cette seconde mort.
<1266>
-
Mardi 9 juillet 2019
« 30% de calories en moins, c’est 20% de vie en plus ».Frédéric SaldmannEvidemment si vous espériez que cette série de mots du jour réponde à la question de savoir si la meilleure huile est l’huile d’olive ou l’huile de colza vous ne pouvez être que déçu.
Mais, dans le premier article qui a introduit cette série, « L’homme est ce qu’il mange » j’avais prévenu :
« Pour celles et ceux qui espèrent trouver des réponses dans ces mots du jour, je ne peux que reconnaître que cet espoir n’a aucune chance de prospérer.
Mais notre expérience nous l’a appris, pour progresser ce qui est fondamental ce n’est pas de trouver les réponses, mais c’est d’abord de poser les bonnes questions. »
Alors pour avoir de bons conseils pour manger, la troisième émission du sens des choses : <Comment faudrait-il manger aujourd’hui pour tirer le meilleur de son corps et de son esprit ?> aurait pu servir à cette fin
Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini avaient, dans ce but, invité le médecin nutritionniste Frédéric Saldmann.
En fait, Frédéric Saldmann est un médecin qui a d’abord appris à la faculté de médecine la cardiologie.
Il raconte qu’il souffrait d’obésité et que cela lui a valu des problèmes de santé. Quand il a consulté un confrère ce dernier lui a prescrit tout un paquet de médicaments.
Frédéric Saldmann a décidé de ne pas prendre ces médicaments et de changer radicalement son alimentation. Il a perdu 25 kilos, n’était plus malade, a décidé d’écrire des livres et de devenir nutritionniste.
Tout au long de l’émission, il a lancé des affirmations avec un ton extrêmement convaincant.
Il a parlé notamment de deux patients qui sont venus le voir, tous les deux avaient le cancer.
Et chacun des deux affirmaient manger très sainement et avec beaucoup de soins.
Avec un questionnement approfondi il a pu découvrir que le premier patient buvait des boissons brulantes ce qui est propice au cancer de l’œsophage qu’il avait. Le second faisait beaucoup de barbecue et aimait manger la viande très grillé, brulé. Le cancer du côlon en était la conséquence.
Le conseil est donc de ne pas boire trop chaud et de ne pas manger de la viande carbonisée.
Ceci s’entend, je l’ai lu ailleurs et c’est très probablement exact.
Mais pour la viande carbonisée il affirme : 3 cm de croute brulée c’est comme fumer 200 cigarettes !
C’est probablement plus convainquant avec des chiffres !
Il m’étonnerait beaucoup qu’une étude ait été menée pour parvenir à cette comparaison…
Et puis il a aussi avancé cette « vérité » :
« 30% de calories en moins, c’est 20% de vie en plus ».
D’où sort-il ces chiffres ? Mystère.
C’est le type de message qui immédiatement mobilise mes capteurs d’alertes. Le doute surgit !
Si ce cardiologue devenu nutritionniste avance des arguments de ce type sans preuve peut-on croire le reste de ces affirmations ?
Il dit qu’il ne faut pas seulement se focaliser sur les calories mais aussi sur l’indice glycémique des aliments.
L’index glycémique permet de comparer des portions d’aliments qui renferment le même poids de glucide en fonction de leur capacité à élever le taux de sucre dans le sang (glycémie). Il indique à quelle vitesse le glucose d’un aliment se retrouve dans le sang.
Frédéric Saldmann donne alors comme exemple la pastèque qui a peu de calories mais un index glycémique élevé. Quand vous mangez des pastèques, cela va faire sécréter énormément d’insuline par le pancréas, le sucre va se transformer en graisse et va créer de l’inflammation. Et il compare à un avocat qui a un index glycémique proche de zéro, il n’a aucun effet inflammatoire. Et quand on prend un burger frites, ce qu’il ne faut pas faire selon F.S., l’avocat fait baisser de 30% l’effet inflammatoire de ce mauvais repas. Toujours des chiffres pour crédibiliser l’argument.
Il donne aussi comme conseil au milieu du repas de s’arrêter de manger pendant 3 minutes et au bout de l’attente de vérifier si on a toujours faim. Et bien sûr de s’arrêter si on constate le contraire. C’est certainement un bon conseil.
Comme celui de manger beaucoup de légumes et de fibres.
Il parle des « aliments retards » comme les sardines, les maquereaux, les poivrons grillés qui restent très longuement dans l’estomac et permettent ainsi d’éviter d’avoir faim rapidement.
Par contre quand il conseille de commencer le repas avec une banane nappée de chocolat à plus de 80% pour couper la faim on peut s’interroger.
De mettre de la cannelle sur les pommes ?
Et puis c’est un adepte du jeûne intermittent que lui appelle séquentiel. Il dit :
« On arrive à un moment très paradoxal. Pendant très longtemps les humains se sont battus, ont lutté pour se nourrir, avec leur force. Et aujourd’hui, cette abondance nous nuit.
Je m’interroge beaucoup à un sujet qui est le jeûne séquentiel.
C’est-à-dire entre 12 à 16 heures, vous décidez d’arrêter de vous alimenter. Vous buvez beaucoup d’eau de la tisane, du thé. Vous arrêtez de diner à 21 heures et vous déjeunez à 13 heures.
A ce moment-là, vous vous apercevrez que le teint est plus clair, que vous êtes plus tonique, qu’il y a moins d’asthme et moins de rhumatisme.
Qu’est ce qui se passe ?
A chaque seconde, on produit 20 000 000 de cellules, pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Le problème c’est que plus on avance en âge, plus le nombre d’erreur de copies augmentent, donnant lieu à des cancers. Quand on jeûne, on renforce son ADN, on diminue le nombre d’erreurs de copie. »
<Il répète cette injonction dans cet entretien>
Mais parallèlement, dans ce même entretien il prétend qu’il faut le faire de manière occasionnelle, une fois par semaine peut être. Et aussi qu’il faut le faire avec l’accord du médecin traitant.
Mais, en même temps, il prétend que 3 repas c’est trop dans une journée et il préconise deux repas. C’est-à-dire que si vous faites au plus équilibré, il y aura au moins douze heures entre deux repas Et si vous équilibrez moins la journée, vous arriverez à plus de 12 heures pour l’un des entractes entre les deux repas. Or, le jeûne séquentiel est justement une interruption entre les deux repas entre 12 et 16 heures.
Il parait donc contradictoire de prétendre d’une part qu’il faut que le jeûne séquentiel soit épisodique et d’autre part en faire une norme.
Ceci m’a conduit à essayer de cerner le sérieux et l’activité de ce docteur Saldmann
J’ai d’abord trouvé cet article très critique de Libération pour la sortie de son ouvrage « «Le meilleur médicament, c’est vous !» : <Avaler des évidences plutôt que des cachets> et cet autre article <Astuces du Dr Saldmann pour mourir en forme> sur un autre livre, best-seller du cardiologue reconverti : « Prenez votre santé en main ! »
Nous pouvons penser que « Libération » est injuste avec ce « nutritionniste » mondialement connu.
A priori <Wikipedia> soutient Libération :
« Frédéric Saldmann, […] est un médecin cardiologue, nutritionniste et chef d’entreprise français. Il a présidé les sociétés commerciales SPRIM et EQUITABLE jusqu’en 2014.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la santé et l’hygiène alimentaire, et intervient régulièrement dans les médias.
Certaines affirmations contenues dans ses ouvrages sont critiquées, concernant l’interprétation peu rigoureuse qu’il fait de recherches et statistiques. […]
Il a présidé les sociétés de conseil en affaires et gestion SPRIM — laquelle conseille des multinationales de l’agroalimentaire comme Danone, Nestlé, Coca-Cola, Herta ou encore Blédina — et EQUITABLE jusqu’en 2014.
Sa troisième épouse, Marie Saldmann, préside les deux sociétés depuis cette date. […]
Il dirige avec Gérard Friedlander, une société commerciale, l’Institut européen d’expertise en physiologie (IEEP) qui fait « l’interface entre groupes industriels et monde académique ». L’IEEP est largement financé par les dépenses de recherche de Coca-Cola, ayant reçu près de 720 000 euros au cours de la période 2010-2014 pour un « projet de recherche sur les édulcorants intenses », alors que « la multinationale aménage de multiples clauses pour exercer une influence sur les travaux scientifiques qu’elle sponsorise. ». […]
Lors de plusieurs prises de positions, Frédéric Saldmann émet des recommandations alimentaires basées sur des études observationnelles. Bien que ce type d’étude permette de mesurer des corrélations (par exemple entre comportement et état de santé), cela ne suffit pas à établir un lien de causalité et permet tout au plus d’aider à proposer des actions de prévention et non d’établir un traitement.
Il affirme que le chocolat noir 100 % permet de réguler son poids, notamment grâce à son effet coupe-faim dans le livre « Le Meilleur Médicament c’est vous », ainsi que lors de la promotion du livre dans les médias. Il cite pour cela une étude réalisée par Beatrice Golomb de l’Université de Californie à San Diego ayant relevé une corrélation entre poids et la consommation régulière de chocolat. Cependant, l’étude est critiquée pour sa méthodologie car celle-ci ne permet pas d’établir un lien de cause à effet. Elle est également citée comme principal exemple de mauvaise interprétation des recherches scientifiques dans le documentaire Pour maigrir, mangez du chocolat ! Vérité scientifique ou manipulation ? (Arte, 2015). Cette corrélation du chocolat est connue dans le milieu scientifique comme un exemple caricatural de junk science (« science poubelle », publications racoleuses et peu fiables destinées essentiellement à la viralité médiatique). »
La journaliste Sophie des Déserts lui a consacré également un article documenté et peu favorable : « Docteur Frédéric Saldmann, médecin et gourou du Tout-Paris »
C’est un article est très long. Je n’en tire que 3 extraits : d’abord sur la clientèle.
« Le docteur Saldmann reçoit sur rendez-vous, deux ou trois matinées par semaine, à l’hôpital européen Georges Pompidou, joyau de la médecine publique. Deuxième étage, service des « explorations fonctionnelles ». Il n’est pas souvent là mais il est réputé pour son goût des lumières (des caméras de télé le filment souvent, aux yeux de tous, sur la passerelle du grand hall) et pour la renommée de sa patientèle. Quand on évoque celle-ci, il oppose un strict secret professionnel et refuse de donner le moindre nom. Isabelle Adjani ou Roman Polanski ? « Des amis », se contente-t-il de préciser. Mais dans le couloir, on peut croiser Bernard Tapie, Jack Lang, Claude Lelouch ou Charlotte Rampling. »
Bien sûr, selon votre degré de célébrité vous n’êtes pas reçu dans les mêmes délais.
« Cardiologue, nutritionniste, expert autoproclamé en médecine prédictive (une discipline non reconnue par la faculté de médecine), fondu de médecine chinoise et de méditation, Saldmann est le nouvel oracle du bien-être et de l’éternelle jeunesse. Cet homme-là prétend que tout est affaire de volonté et d’attention à son corps. Que la retraite est la pire des défaites. Que l’on peut à tout âge faire l’amour et gravir des montagnes. Vivre cent cinquante ans et bientôt peut-être plus encore. Les baby-boomers adorent, a fortiori quand ils sont célèbres, fortunés, puissants mais tellement démunis pour affronter les affres du temps. Saldmann est leur Dieu, non pas parce qu’il consulte au tarif sécu (la plupart de ses patients n’ont pas de problèmes de fins de mois), mais parce qu’il leur offre, sous le label de l’assistance publique, une médecine haute couture, un service personnalisé, rapide et efficace. Un patient recommandé peut être reçu dans les quarante-huit heures. Pour le quidam, c’est évidemment beaucoup plus long. « J’ai un rendez-vous le 15 novembre à 14 heures », m’a proposé sa secrétaire d’une voix désabusée. Nous étions en décembre, s’agissait-il d’une erreur?? « Non, c’est bien cela, comptez un peu moins d’un an. Le planning est plein. » »
Il sait parler de tout, a un avis sur tout et surtout gère bien ses affaires.
L’ouvrage est à son image, un curieux mélange de pragmatisme et d’érudition, d’argumentations solides et de fantaisies. On y trouve des citations de Montaigne, Woody Allen, Pierre Dac (« L’éternuement est l’orgasme du pauvre »), des leçons de choses, d’hygiène, des recettes de grands-mères, quelques envolées futuristes, de la psychologie positive et beaucoup de bonnes nouvelles. La génétique ne pèse que 15 %, la libido masculine s’entretient ad vitam æternam et la ménopause, avec une bonne hygiène de vie, peut reculer de sept ans?! Il est question de sexe, de stress, d’épices, de méditation et même de constipation. « Avec un petit tabouret devant soi sur le trône, jambes allongées, l’angle ano-rectal est moins fermé, le transit facilité. On gagne une heure par semaine et un ventre plat?! […]
Pédagogue, toujours disponible, il est devenu ce qu’on appelle un « bon client ». Il peut causer de tout, des bienfaits de l’écharpe, de la carotte et du poivre, des allergies, de l’éjaculation précoce, de la chirurgie esthétique et du réchauffement climatique. Et pendant ce temps, loin des projecteurs, le cardiologue mène tranquillement son autre vie, de businessman. »
On apprend aussi qu’il est un grand ami de BHL et bien d’autres informations très surprenantes sur cet homme énigmatique qui a l’air de tout comprendre et de tout savoir sur l’alimentation.
Pour ma part je suis très sceptique sur l’accumulation des livres, des conseils, et détails chiffrés que présente ce médecin, devenu homme d’affaires.
C’est très compliqué de rencontrer des personnes sérieuses sur ce sujet.
La série sur l’alimentation n’est pas terminée par cet article, il y a encore beaucoup à dire sur le sucre, l’obésité, la capacité de la terre de nourrir 10 milliards d’individus, de la grandeur et des « arrangements » du bio et de tant d’autres sujets.
Mais provisoirement je suspends cette série.
A partir de vendredi, le mot du jour se mettra dans une longue pause estivale.
D’ici là, j’ai prévu 3 mots du jour sur d’autres sujets, à partir de demain.
<1265>
-
Lundi 8 juillet 2019
«Manger avec la main, c’est naturel, manger avec une fourchette, c’est culturel »Patrick RambourgMichel Serres et Jacques Attali affirment que l’arrivée de la fourchette et du couteau de table est relativement récente et est contemporain de l’éclosion de l’individualisme et de l’autonomisation de l’individu par rapport au groupe.
Avant, on mangeait avec les mains dans le plat commun.
D’ailleurs cette tradition existe encore dans un certain nombre de pays comme le Maroc et l’Inde. C’est aussi le cas dans beaucoup d’autres pays…
Et également dans l’espace…
Ainsi <Le Parisien> rapporte ces propos de Thomas Pesquet lors de son séjour à bord de la Station spatiale internationale :
« J’ai de la chance, car beaucoup des miens [mes conserves] ont été préparés par Alain Ducasse et Thierry Marx, deux très grands chefs français étoilés qui ont tenu compte de mes goûts, d’une part, mais aussi des obligations liées aux conditions dans l’espace. Ainsi, filet de saumon au citron de Menton confit, émincé de volaille, et langue de bœuf à la sauce piquante, trois de mes plats préférés, ont été traités puis pasteurisés pour qu’aucune bactérie étrangère ne prolifère à vitesse grand V dans la station. Je place ces mets dans notre four électrique pendant quelques minutes. Je récupère le sachet, je le coupe avec des ciseaux et je n’ai plus qu’à manger avec les doigts. Pas besoin d’assiette puisque tout flotte! »
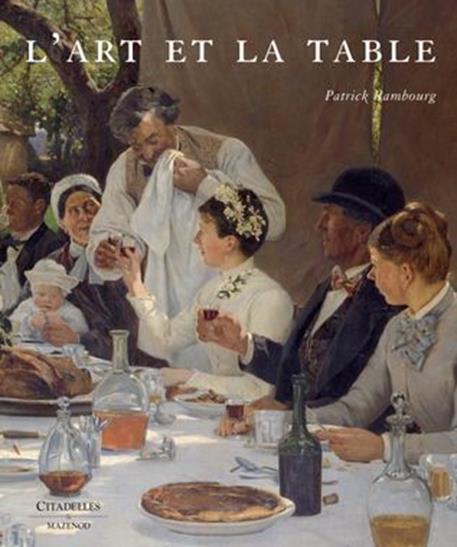 Patrick Rambourg, est un historien spécialiste de la cuisine et de la gastronomie. Il est vrai que ses parents tenaient un restaurant. Il a aussi reçu une première formation de cuisinier professionnel avant de suivre son cursus universitaire en histoire à l’Université Paris 7 Denis Diderot.
Patrick Rambourg, est un historien spécialiste de la cuisine et de la gastronomie. Il est vrai que ses parents tenaient un restaurant. Il a aussi reçu une première formation de cuisinier professionnel avant de suivre son cursus universitaire en histoire à l’Université Paris 7 Denis Diderot.
Il est devenu un spécialiste sur l’histoire de la cuisine et de la gastronomie, de l’alimentation et des manières de table, sur les représentations de la cuisine et de la table. (source Wikipedia).
Il est ainsi l’auteur de nombreux livres sur ce sujet :
- « À table… le menu ! » Editions Honoré Champion, 2013, 128 pages
- « Histoire de la cuisine » et de la gastronomie françaises Editions Perrin (coll. tempus n°359), 2010, 381 pages
- « La cuisine à remonter le temps » Editions du Garde-Temps, 2007, 129 pages.
- « De la cuisine à la gastronomie. Histoire de la table française » Editions Louis Audibert, 2005, 286 pages.
En 2016, il a écrit : « L’Art et la table » Paris, Editions Citadelles & Mazenod, 2016, 392 pages.
Et le Monde, dans un entretien publié <le 25/01/2019> l’interroge sur ce choix de manger avec les mains ou avec une fourchette ou des baguettes.
J’en retiens que la moitié de l’humanité mange avec la main.
Trois milliards et demi de personnes dans le monde mangent avec les doigts.
Patrick Rambourg explique que cela a aussi été le cas longtemps en Europe et en France.
« Manger avec les mains est le plus commun dans le monde, mais c’était une habitude même en Europe pendant des siècles, y compris pour les élites au Moyen Age, aux XIVe et XVe siècles. Les seuls couverts qui apparaissaient alors sur la table, c’était un couteau, voire une cuillère, que le convive apportait lui-même. La fourchette existait déjà en Italie dès le XIe siècle : il s’agissait des petites fourches à deux branches utilisées par les femmes. Mais la main était l’ustensile le plus répandu pour les pauvres comme pour les élites. »
Patrick Rambourg, explique que la France a progressivement adopté la fourchette.
« Contrairement à une idée répandue, cela ne s’est pas fait du jour au lendemain, à la Renaissance, avec Catherine de Médicis. A la cour du roi Henri III, on essaie déjà d’imposer la fourchette, mais elle est considérée comme maniérée et féminine. Nous avons des textes qui montrent qu’à la cour les gens se moquent de ceux dont l’aliment tombe de la fourchette. Il faut apprendre à l’utiliser.
La main, c’est naturel, la fourchette, c’est culturel.
A la mort d’Henri III, dans un premier temps, elle est utilisée pour se servir dans le plat commun, alors qu’on se servait avant avec les mains. Puis on mange sa part avec les doigts. Elle apparaît ainsi dans l’iconographie du XVIe siècle, où elle ne servait pas à porter l’aliment à la bouche. Aux XVII et XVIIIe siècles, elle est présente sur la table des riches, mais son usage n’est toujours pas systématique.
Louis XIV mange avec ses doigts tandis que la reine tient une fourchette. Puis la haute société s’y convertit progressivement. Au XIXe siècle, la fourchette n’est plus considérée comme élitiste, notamment grâce à la création en 1760 des restaurants publics, qui peu à peu s’adressent à tous les groupes sociaux, grâce aux auberges et aux cabarets. Mais dans les campagnes, on pouvait encore manger avec ses doigts au XIXe siècle. »
Dans de nombreuses parties du monde, manger avec ses mains constitue la normalité.
Dans l’article du monde, une carte représente les pays dans lesquels on utilise ses mains pour manger. La couleur diffère selon que l’on utilise simplement ses doigts, ou des ustensiles en plus, comme souvent une cuillère. Ainsi au Népal, en Ethiopie, au Soudan on n’utilise que les doigts. Au Pérou et en Équateur, on utilise les doigts et des couverts.
Même en France, par exception, pour certains mets, les doigts sont de rigueur par exemple : les cuisses de grenouille.
Selon l’historien, la fourchette s’est imposée en raison d’un traité d’Erasme
« La fourchette s’est imposée parce que les mœurs de table ont évolué, notamment à la suite de la diffusion de <La Civilité puérile>, un traité d’Erasme expliquant à l’aristocratie comment se comporter à table. Le traité d’Erasme prend comme comparaison les animaux. Il influence beaucoup les manières de manger. Cela passe par les élites : il y a l’idée que celui qui se tient bien à table, c’est celui est en haut de la société. Petit à petit, il faut que la main ne touche plus la denrée. Il y a, par ailleurs, une question d’hygiène qui s’impose. La fourchette et les couverts ont contribué à une meilleure civilité à table. Mais pour nos ancêtres, il a fallu du temps. »
En revanche, les européens ne sont pas parvenu à imposer la fourchette en Chine :
« N’oublions pas non plus que les Européens ont été très présents en Chine, pays qu’ils se sont partagé politiquement. Or, ils n’ont jamais réussi à imposer la fourchette sur la table : c’est la force d’une culture, d’une civilisation. Si le monde occidental a pu imposer beaucoup de choses dans le monde, on voit bien qu’au niveau de la table c’est plus complexe. Les baguettes restent très représentatives de la culture asiatique. Et puis, quand on apprend enfant à manier un ustensile, cela devient une habitude de vie, tout simplement. »
<Cet autre article sur le sujet du journal Libération> prétend que le sage chinois Confucius aurait dit :
«L’homme honorable et droit se tient loin de l’abattoir et de la cuisine. Et il ne tolère aucun couteau à sa table.»
Ce même article précise que l’existence des baguettes est attestée en Chine depuis la dynastie Shang (- 1570 à – 1045 av. J.-C.), la première à avoir laissé des écrits.
Il cite aussi Roland Barthes qui loue l’usage de la baguette qui ne
«violente jamais l’aliment […] fait glisser la neige alimentaire du bol aux lèvres […] introduit dans l’usage de la nourriture, non un ordre, mais une fantaisie et comme une paresse».
Et pour revenir au premier questionnement de l’usage de la main ou d’ustensiles cet article confirme les propos de Michel Serres et Jacques Attali concernant le lien entre l’individualisme et l’utilisation de la fourchette :
« Marc de Ferrière le Vayer, historien des arts de la table, nourrit l’analyse : «Cette course à l’individualisme est caractéristique de la Renaissance. On prend de plus en plus de distance avec les aliments et entre convives.» La main quitte les plats et déserte la bouche. La fourchette prend du galon: elle aura quatre dents au milieu du XVIIIe. Un siècle plus tard, «elle s’est raffinée et généralisée à l’ensemble de la population», »
Et nous apprenons que c’est à Venise que la fourchette a fait son apparition après l’an mil :
« Une princesse byzantine, venue épouser un doge, se refusait de toucher les aliments et préférait utiliser une fourchette à deux dents. […] Un érudit du XVIIIe siècle, Ludovico Antonio Muratori, rapporte dans ses Annales d’Italie qu’en 1071, la fourchette s’était invitée au repas de noce du doge Domenico Silvio. A partir du XIIIe siècle, l’introduction des pâtes dans l’alimentation accompagne la diffusion de la fourchette qui gagne les tables des aristocrates et des bourgeois au cours du XVIe siècle. »
Je retiens donc que manger avec les doigts est naturel.
<1264>
- « À table… le menu ! » Editions Honoré Champion, 2013, 128 pages
-
Vendredi 5 juillet 2019
« Je savais les rendre heureux ! »Une des dernières paroles de Babette dans le festin de Babette, livre de Karen Blixen porté au cinéma par le danois Gabriel AxelLe repas autour de la table crée et approfondit le lien social.
On peut imaginer qu’après avoir inventé le feu, les humains après avoir fait cuire les aliments se regroupaient autour du feu pour partager la nourriture et converser autour de la chaleur du foyer.
Michel Serres dit :
« Le repas, c’est l’invention de la table, on est en commun et cela crée le lien social fondamental »
Manger en commun.
Mais aussi prendre son temps pour manger et se laisser du temps.
Cependant, il n’en va pas de même pour tous les pays du monde, certains n’adoptent pas du tout cette philosophie de vie.
Avant cette série, j’avais déjà écrit certains mots du jour sur l’alimentation particulièrement celui du <31 mars 2017>.
Et c’était Bruno Parmentier qui expliquait ces différentes conceptions qui s’affrontaient aussi dans l’Union européenne :
« On est 28 en Europe c’est très compliqué. Et il faut savoir que le rapport à la nourriture est très différent selon les pays.
Dans l’entreprise que je dirigeais, il y avait un règlement intérieur qui disait : pas moins de 45 minutes pour déjeuner. Dans une entreprise en Angleterre, ce n’est pas plus de 10 minutes pour déjeuner. Et moyennant quoi, le rapport à la nourriture est très différent. Dans un cas on mange un sandwich au pain de mie avec du jambon carré et du fromage carré et on s’en fout du goût puisqu’on mange ça devant l’ordinateur et de l’autre côté on a envie de bien manger.
Du côté où on a envie de bien manger et où on veut une agriculture de qualité c’est les pays latins : La Grèce, l’Espagne, l’Italie, la France, le Portugal. Mais on est très minoritaire. On l’a vu pendant la crise du porc, la majorité des européens, ils veulent des tranches de jambon carré pas cher. Pour faire des tranches de jambon carré pas cher, on fait de l’industrie [sans se soucier de la qualité].
En Angleterre on utilise 9% de son salaire pour manger. En France c’est 14%, aux Etats-Unis c’est 7%. Mais en France c’était encore 40%, il y a 30 ou 40 ans.
Les citoyens doivent aussi dire qu’est-ce qu’ils veulent.
Est-ce que la gastronomie anglaise et américaine nous fait tellement envie qu’on a encore envie de diviser par 2 notre coût pour l’alimentation ? et avoir des coûts de santé absolument fou parce qu’on mange n’importe quoi ?
Ou est-ce qu’on se dit : bien manger en France aujourd’hui, c’est consacrer un peu plus de temps et un peu plus d’argent à cette activité essentielle.
Cet argent nous permettra d’être en meilleur santé et d’avoir plus de plaisir et de convivialité.
Mais quand on négocie en Europe c’est très difficile d’avoir une unanimité, puisque la majorité des pays veulent du jambon carré.
Et le jambon carré, c’est de l’élevage de 2000 à 3000 porcs, complètement industriel, avec en Allemagne des bulgares payés au prix de la Bulgarie, des roumains payés au prix de la Roumanie et puis quand on est dans l’industrie c’est toujours les allemands qui gagnent pas les français. »
C’est en effet une manière anglo-saxonne et aussi germanique de considérer le repas comme une sorte de perte de temps qui perturbe et empiète sur les autres activités de la vie.
Cela vient aussi dans nos pays où une partie de la population importe les standards d’outre atlantique.
Dans une société dans laquelle on est de plus en plus autonome, mais aussi de plus en plus seul.
Cette manière de faire n’est pas bonne pour le lien social, elle n’est pas non plus bonne pour la santé.
Pascal Picq lance cet appel :
« Aujourd’hui c’est dramatique, on le voit bien. Pardon de passer des chimpanzés à la période actuelle.
Mais le fait d’avoir déstructuré les repas, avec les fast food, on mange chacun dans son coin, on mange rapidement.
C’est de l’obésité, on n’a pas d’échanges avec les autres.
Et surtout, il n’y a plus d’interdit : quelle que soit la viande qui est dans cette nourriture, il n’y a plus de représentation que derrière cette viande il y avait un animal qui a peut-être souffert et qui avait une vie.
Nous vivons aujourd’hui une déstructuration de ce qui fait l’humanité depuis 1 millions d’années.
Ceci a des conséquences extrêmement importante en termes de sociabilité, de santé, de culture.
Nous payons extrêmement cher cela.
Et nous pouvons déterminer cela très précisément.
Les pays où il y a le moins d’obésité, où les hommes et les femmes sont les plus minces c’est la France et l’Italie et une partie de la suisse, parce que ce sont des pays dans lesquels on mange à peu près à heure régulière, avec les amis et la famille.
Nous prenons du temps à table et nous avons des conversations »
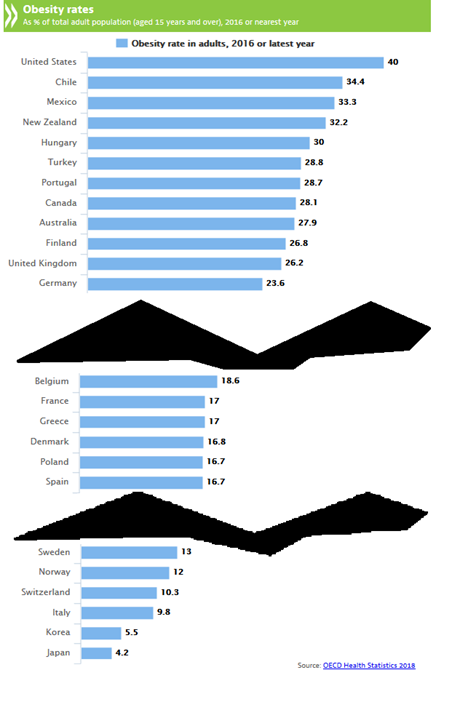 Pascal Picq semble avoir partiellement raison.
Pascal Picq semble avoir partiellement raison.
Selon <cette étude de l’OCDE> sur l’obésité, l’Italie est en effet très bien placé
J’ai extrait ce schéma en gardant les pays « obèses » les pays « sveltes » et aussi les moyens car c’est dans cette partie que se trouve la France.
Si vous voulez l’intégralité du schéma, il suffit d’aller sur le site.
Ce schéma qui date de 2018 porte sur une étude faite courant 2016 et qui donne la proportion de personnes « obèses » (pas simplement en surpoids) dans la population d’adultes en partant de 15 ans.
La France ne tient pas son rang, elle comporte légèrement plus d’obèses que l’Espagne.
L’Italie et la Suisse sont bien classées dans les pays sveltes, comme le pense pascal Picq.
Mais le Japon et la Corée font encore mieux.
Les vainqueurs de cette sordide compétition sont les américains. Selon d’autres études le Mexique aurait dépassé les États-Unis, mais c’étaient des études plus anciennes et l’OCDE est en principe une organisation très sérieuse.
Et Michel Serres raconte que lorsqu’il est arrivé aux États-Unis, il avait été très surpris par l’attitude des américains qui l’invitaient à diner.
En comprenant la situation de Michel Serres éminent philosophe qui vient enseigner dans des prestigieuses universités américaines comme Stanford, on peut penser qu’il ne s’agissait pas d’américains moyens qui l’invitaient mais plutôt des universitaires mondialisées qui connaissaient la manière française de vivre et de manger.
Voici ce que Michel Serres raconte :
« Quand je suis arrivé en Amérique, on m’invitait à diner et on me disait, évidemment il n’y aura pas les enfants ! On ne peut pas leur imposer cette obligation abominable de rester à table avec nous ».
Et il ajoute aussi cette manière d’organiser l’alimentation :
« Et j’ai vu des familles en Amérique où l’ainé venait d’un long voyage et où la mère le recevait avec beaucoup de joie.
Au bout d’une heure, elle lui disait : si tu veux manger prends les choses qu’il y a dans le frigo, il est plein !
Chez nous les pays européens [plutôt latin] elle aurait fait une fête autour d’un très bon repas.
Il y a une sorte de perte de socialisation.
Il me semble quand un français ou un italien se met à manger, il est content et ça se voit.[…] Ce n’est pas le cas des américains. »
Et il conclut cette différence entre la culture catholique des italiens et des français et la culture protestante des américains. :
« Je crois que c’est un peu puritain, le débordement du goût est un peu interdit. »
Et cette remarque m’a fait irrésistiblement penser à un merveilleux film de 1987 : « Le festin de Babette » qui se situe justement dans une communauté puritaine au Danemark.
Je n’ai pas lu la nouvelle de Karen Blixen mais vu le film dans lequel Babette était incarné par Stéphane Audran.
Cela se passe dans un petit village au Danemark, au XIXe siècle, un pasteur luthérien autoritaire et possessif a deux jolies filles, Martine et Filippa. Chacune d’elles aura une histoire d’amour naissante mais sans lendemain. Trente-cinq ans plus tard, les deux sœurs sont toujours célibataires et ont pris la suite de leur père à la tête de la petite communauté. Elles accueillent Babette comme servante qui a fui la France à cause de la révolte de la Commune. Babette sert humblement les deux sœurs en s’adaptant à la cuisine locale.
La communauté est rigoriste, sans chaleur et minée par les conflits et rivalité.
Un jour elle apprend avoir gagné à la loterie 10 000 francs et elle va tout dépenser pour offrir un repas aux deux sœurs et à des membres de la communauté comme elle savait les faire à Paris dans un grand restaurant gastronomique.
Malgré leur réticence initiale, les convives apprécient vite le repas et sont peu à peu envahis de bien-être, le mélange des alcools aidant. Au moment du café, les tensions sont apaisées et chacun se réconcilie.
Dans la scène finale que vous trouverez derrière <ce lien> les deux sœurs, métamorphosées remercient Babette du fond du cœur. Et quand elles comprennent que Babette a dépensé tout l’argent pour leur faire cet unique repas, elles lui disent : « mais tu vas rester pauvre toute ta vie », Babette a cette réponse :
« Un artiste n’est jamais pauvre »
Et un peu plus loin, se rappelant de son métier à Paris : elle a cette phrase :
« Je savais les rendre heureux »
J’ai trouvé que cette phrase et ce film étaient une merveilleuse manière de répondre à celles et ceux qui considèrent le fait de manger comme une contrainte, dont il fallait se débarrasser, au plus vite, sans même se donner le temps comme le conseille le talmudiste de « regarder ce que l’on mange ».
<1263>
-
Jeudi 4 juillet 2019
« Le repas est une caractéristique de l’humanité depuis très longtemps »Pascal PicqLe Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Père du Messie des chrétiens, Jésus de Nazareth, Allah le Dieu de l’Islam, le Dieu monothéiste qui est unique selon ces trois religions et toutes les chapelles qui sont à l’intérieur de ces 3 religions, ce Dieu là, il ne mange pas.
Jacques Attali écrit dans son livre « Histoires de l’Alimentation » page 56 :
« A la différence des divinités des religions précédentes, le Dieu des juifs, qui a créé les hommes, ne mange pas : manger est, dans le judaïsme, le propre des créatures de Dieu ; c’est même ce qui Le distingue des hommes. »
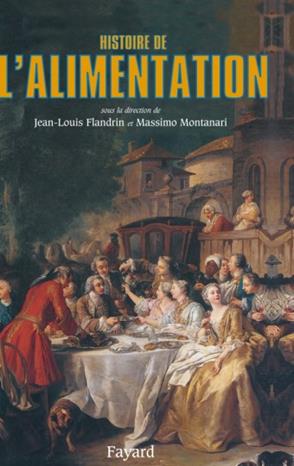 Chez les dieux grecs dans l’Olympe, on festoyait en mangeant et en buvant.
Chez les dieux grecs dans l’Olympe, on festoyait en mangeant et en buvant.
Dans cette somme qu’est « l’Histoire de l’Alimentation » de Jean-Louis Flandrin et Massimo Montanari :
« Dans l’Olympe, le banquet est le passe-temps favori des dieux. « Toute la journée et jusqu’au coucher du soleil, ils demeurent au festin et leur cœur n’a pas à se plaindre du repas où tous on leur part » raconte Homère. Ils mangent et boivent des nourritures d’immortalité, ambroisie et nectar. » (page 154)
C’est toujours intéressant de s’intéresser aux dieux, ou plutôt à la manière dont les hommes décrivent les dieux. Cela dit beaucoup des humains
Le chapitre 2 de ce même livre a pour titre : « La fonction sociale du banquet dans les premières civilisation » et on y lit :
« Si la société divine a vraiment reproduit, dans la conception que s’en faisaient les Mésopotamiens, certaines caractéristiques de la société humaine, c’est sans doute dans les descriptions des banquets auxquels participent les divinités que le parallèle est le mieux établi : l’esprit comme la forme de ces réunions illustrent, en effet, directement la fonction de ce type de réjouissances à Sumer, en Babylonie ou en Assyrie. […]
L’assemblée des grands dieux, au cours de laquelle sont prises des décisions importantes, se tient souvent lors d’un banquet. Le banquet apparaît comme une des principales marques de la solidarité qui unit ce groupe, en même temps qu’il illustre les agréments de la vie divine telle que la conçoivent les humains. Le banquet est normalement organisé et les invitations faites par le dieu le plus âgé ou le plus haut placé. […]
De même, dans le « cycle de Baal » de la littérature ougaratique, en Syrie occidentale, le dieu Baal inaugure le palais qu’on vient de lui construire par un grand banquet. […].
[après avoir cité un certain nombre d’exemples les auteurs concluent ] Ces exemples […] nous livrent les caractéristiques du banquet en Mésopotamie : rassemblement festif d’une communauté, moment important d’une cérémonie, règles de conduite. […]
Le plaisir du repas pris en commun
Tout accord un peu solennel qui unit des individus et surtout des groupes familiaux se concrétise par leur participation à un repas pris en commun » (page 47 et 48) »
La littérature et les éléments dont s’inspire l’historien qui écrit ces lignes date du IIIème ou IIème millénaire avant notre ère.
Il est question déjà de banquet de repas pris en commun.
Pascal Picq a expliqué que, chez les chasseurs cueilleurs, lorsqu’une importante proie venait d’être chassée, la viande qui en résultait faisait l’objet d’un partage, d’une négociation autour d’un repas commun.
Pascal Picq explique que nous sommes des mangeurs sociaux depuis très longtemps. Les chasseurs cueilleurs, semble-t-il, aimait grignoter :
« Quand il y a des baies succulentes pas en grande quantité on les consomme. Ce qui n’est pas en grande quantité on peut picorer au passage.
Quand il y a des collectes importantes qui peuvent être rapportées dans des paniers ou autre, là par contre ils font l’objet d’échange.
Le repas est une caractéristique de l’humanité depuis très longtemps.
En quoi ce que nous mangeons ensemble, en quoi c’est un enjeu social et de solidarité. On l’a peut-être oublié. »
Pascal Picq comme l’histoire des dieux, non monothéistes, nous montre que les humains ont adopté une attitude sociale du repas en commun : moment où on partage, où on discute, où on prend des décisions.
Un grand nombre d’animaux mange tout le temps, au fil de la journée. L’homme prend des repas : il déjeune. Déjeuner signifie sortir du jeûne, ce qui conduit justement à manger à des moments précis de la journée et de ne rien manger entre temps. Je sais bien, qu’aujourd’hui il en est qui grignote. Tout le monde le sait, ce n’est pas bon de grignoter, de ne pas respecter le jeûne entre deux repas.
Il y a divers mots qui sont utilisés pour désigner les repas.
<Ce blog érudit> nous informe que :
« En 1694, le Dictionnaire de l’Académie française (DAF, 1ère éd.) les définit de la façon suivante :
Desjeuner Repas qu’on fait le matin avant le disner.
Disner Repas que l’on fait ordinairement à midy.
Souper Repas du soir. »
En 1935, l’Académie française (DAF, 8e éd.) ne définit plus ces termes exactement de la même façon :
Déjeuner Repas du matin OU celui du milieu du jour.
Dîner Repas qu’on fait le soir. […] Il se disait autrefois du Repas du milieu du jour. Il a gardé cette acception dans quelques provinces.
Souper Repas du soir. On dit plutôt aujourd’hui, en ce sens, Dîner. Il se dit particulièrement d’un Repas que l’on prend à quelque heure de la nuit.
Aujourd’hui nous disons plutôt petit déjeuner, déjeuner et diner. Si ce sujet vous intéresse le blog indiqué ci-avant est très disert sur l’évolution et les particularismes régionaux..
<selon ce site> nos cousins québécois continuent à enchaîner déjeuner, diner, souper.
Du point de vue étymologique Wikipedia nous apprend que « Dîner » et « déjeuner » ont la même origine puisqu’ils sont tous deux dérivés du latin populaire disjunare signifiant « rompre le jeûne », et constituent donc un doublet lexical.
Est-ce que seuls les humains prennent un repas en commun ?
On voit que les vaches broutent ensemble, les moutons aussi. Mais Michel Serres raconte une histoire qui lui a été rapporté par un forestier des landes qui est allé exercer son beau métier au Gabon :
« C’était dans une forêt tropicale. A la fin de la journée, il avait l’habitude de coucher là. Et tout d’un coup un gorille est arrivé et l’a regardé longuement. Et le forestier qui était tout seul a regardé aussi. Et puis le lendemain le gorille est revenu. Et il est revenu comme ça 8 soirs. Et le neuvième soir il est arrivé avec sa guenon, tous les deux. Et la guenon avec un geste de la main, lui a fait un geste presque d’invitation. Et avec un courage que j’admire beaucoup, il les a suivis dans la forêt. Et tout d’un coup il s’est trouvé près d’un tronc d’arbre sur lequel était posé des bananes et d’autres fruits. Le gorille et sa guenon avait invité l’humain a un repas commun. »
C’est très étonnant. Cette sociabilité précède peut-être même l’espèce humaine.
Le repas à heure fixe est urbain. Michel Serres précise qu’à la campagne l’heure des repas dépend des saisons, du rythme et des impératifs des travaux agricoles.
Pour les marins, que Michel Serres a aussi été, les repas dépendent de l’organisation des services de quart. J’ai appris aussi que dans la marine nationale, un pavillon était levé pour indiquer que le capitaine du bateau était en train de manger. Dans une certaine tradition, l’officier le plus jeune chantait le menu au capitaine.
Bien que le Dieu monothéiste ne mange pas, ses fidèles mangent et prient pendant le repas. La messe chrétienne a été organisée par le récit de la dernière cène du Christ où il a partagé le pain et le vin, ce qui est toujours célébré lors des messes ou services divins d’aujourd’hui.
Le shabbat juif est ponctué de repas succulent, la famille se réunit, moment du partage du pain, de bénédictions et de paroles et d’échanges.
Les musulmans ont aussi une grande tradition de repas partagé. Nous connaissons un peu mieux les repas du soir après le jeune du ramadan.
Pour nous autres français, italiens et latins tout se passe autour de repas partagé. Quand on rencontre un ami qu’on n’a pas vu depuis longtemps, immédiatement on l’invite à déjeuner et on parle autour d’un bon repas.
Même dans les exercices de séduction, souvent tout commence par un repas. Quand la famille éparpillé se retrouve, quand un fils longtemps absent revient voir les parents, les retrouvailles se passent autour d’un repas pris ensemble.
Et Michel serres de nous faire remarquer que lorsqu’on est au restaurant, on voit souvent la joie qui illumine le visage des convives quand le plat arrive à table.
Joie, partage, échange, sociabilité tout cela se joue autour de nos repas.
Mais tout le monde ne partage plus aujourd’hui cet enthousiasme pour le repas pris en commun, mais nous essayerons de voir cela demain.
<1262>
-
Mercredi 3 juillet 2019
« Les animaux non humains ont la bouche en avant pour manger, le propre de l’homme est le retrait de la bouche »Michel SerresNous étions donc restés hier sur cette belle réflexion du talmudiste :
« Manger, c’est penser. On parle et on mange par le même organe qui est un trou qui est la bouche.
C’est curieux symboliquement que ce qu’on fait rentrer est la nourriture et ce qui en ressort c’est la parole.»
La bouche qui permet de se nourrir, la bouche qui nous offre la parole pour l’échange.
L’émission suivante avait pour invité Michel Serres : <De quoi manger est-il le nom ?>
Et j’ai déjà rapporté qu’à la question posée par le titre de l’émission, le philosophe a répondu :
« Je crois que manger est une activité triple
Elle est Biologique d’abord et vital qui est la survivance
Deuxièmement, c’est une activité sociale, politique et éthique parfois puisque cela pose des questions de circulation des vivres, de spéculation etc…
Et puis c’est aussi un acte religieux, sacré »
Hier nous avions insisté sur le côté sacré et aujourd’hui nous allons nous intéresser à la biologie.
Et Michel Serres de rappeler que:
«Manger concerne les animaux, pour les végétaux c’est différent. Les animaux sont hétérotrophes et les végétaux sont autotrophes.»
Cette première phrase déjà réclame des explications.
Un organisme « autotrophe » est un organisme capable de générer sa propre matière organique à partir d’éléments minéraux. Il utilise pour cela l’énergie lumineuse soit par photosynthèse, soit par chimiosynthèse chez quelques espèces.
L’autotrophie se limite aux végétaux chlorophylliens, aux cyanobactéries et à quelques bactéries. Le plus souvent, l’énergie lumineuse sert à la synthèse de glucides à partir de dioxyde de carbone et d’eau. Les cellules végétales disposent d’organites particuliers, les chloroplastes. Ceux-ci contiennent la chlorophylle et sont ainsi nécessaires aux processus d’autotrophie. »
Le terme « hétérotrophe» qualifie un organisme incapable de synthétiser lui-même ses composants et qui recourt donc à des sources de matières organiques exogènes. Ce mode de nutrition est caractéristique de tous les êtres vivants qui ne sont ni des végétaux chlorophylliens, ni des cyanobactéries, ni certaines espèces bactériennes capables de photosynthèse ou de chimiosynthèse, ceux-ci étant autotrophes. Autrement dit, les animaux, les champignons, quelques plantes, les protozoaires et l’essentiel des procaryotes sont hétérotrophes.
Vous qui me lisez et moi qui écrit nous sommes hétérotrophes, et que dans l’ordre de la biologie nous avons besoin de matières organiques exogènes, c’est-à-dire qui se trouvent à l’extérieur de nous.
Cette connaissance scientifique rend encore plus problématique la prétention de celles et ceux qui entendent se nourrir de « prana »
En effet, lors de la journée de pause du 20 juin 2019 j’avais évoqué ces personnes qui prétendent qu’on peut vivre sans manger.
Ces gens prétendent devenir « pranique » et d’être en capacité de vivre sans manger et sans boire ou avec très peu de solide et de liquide.
Une de ces vidéos se trouve derrière ce lien : <Se nourrir de prana>. Dans ce film vous verrez un homme qui s’appelle Gabriel Lesquoy qui affirme que depuis 2012, il ne se nourrirait plus qu’avec de la lumière. Il concède manger de temps à autre un morceau de chocolat.
<Il y a aussi cet extrait d’un documentaire du nom de Lumière>
Et puis une interview d’un homme du nom de « Henri Monfort » qui dit ne plus se nourrir d’aliment solide depuis 2002 et qui parle d’une période de transition de 21 jours nécessaires pour entrer dans un « état pranique ».
Le pranisme a aussi pour nom L’inédie ou le respirianisme.
Pour l’instant, aucune expérience scientifique sérieuse et encadrée n’a pu valider la véracité de ces pratiques. Et dans la connaissance scientifique actuelle, l’hypothèse la plus vraisemblable reste que nous sommes hétérotrophes. Car rappelons que la science, contrairement à la religion, ne connait pas le concept de vérité mais celui de réfutation. Une hypothèse scientifique reste vraie jusqu’au moment où une expérience ou plusieurs la réfutent. Je ne peux donc croire au pranisme sauf à ce que des expériences rigoureuses établissent que les humains peuvent devenir autotrophes.
Manger est donc le propre de l’animal. Et qu’est-ce qu’un animal ?
Michel Serres continue
« Animal, cela veut dire animé. Les animaux courent, ils se déplacent.
Ils se déplacent pourquoi ?
1° Pour attraper leurs proies
2° Pour éviter d’être mangé
3° Pour être à distance de leurs propres excréments, c’est-à-dire le résultat de manger.
4° Pour trouver un partenaire sexuel. […]
 J’ai toujours été fasciné par les poissons.
J’ai toujours été fasciné par les poissons.
Le poisson a une forme effilée, hydrodynamique, composée d’une arête centrale et une queue qui le dirige comme un gouvernail.
Mais tout est orienté vers la bouche.
Vous voyez le poisson qui ouvre la bouche et quels que soient les évènements c’est la bouche qui est en avant.
Donc, c’est un appareil de locomotion fait pour manger !
La bouche est en avant !
Et une fois que j’ai été fasciné par le poisson, je me suis dit, mais voyons les boas c’est la même chose.
[…] et les autres animaux.
Les quadrupèdes quand ils sont à quatre pattes, ont aussi la bouche en avant.
Les oiseaux, aussi ils ont les pattes et les ailes pour la locomotion et le bec est en avant, quand ils volent.
Les animaux courent ou volent pour manger.
Un animal ne peut être animé que s’il a de la nourriture énergétique pour qu’il puisse conserver sa chaleur.
Et nous les humains ?
Les animaux ont un pôle nord pour manger, Mais pour nous humains, la bouche n’est pas seulement faite pour manger, elle est faite pour parler, pour chanter, pour aimer. Chez nous la bouche est multifonction. […]
Je ne suis pas naturaliste, mais j’ai l’intuition que quand nous étions à quatre pattes, la bouche aussi était en avant pour manger.
Et comme nous nous voulons faire autre chose avec la bouche que simplement de manger, nous nous sommes mis debout.
Et la bouche n’est plus en avant. […]
Il y a une preuve de cela extraordinaire !
C’est que l’angle facial par rapport aux primates a évolué, homo habilis et notre autre ancêtres sont prognathes : la bouche est encore en avant.
Et nous au fur à mesure que nous nous mettons debout le prognathisme s’efface et l’angle facial ne fait que croitre.
Et ainsi le propre de l’homme est le retrait de la bouche.
Et ainsi les animaux comme les pigeons, les moutons et les vaches broutent tout le temps sauf pendant la rumination.
Et nous les humains nous avons le privilège de ne pas manger tout le temps. »
C’est ainsi que l’homme a créé les repas, c’est la dimension sociale.
Mais revenons aux détails techniques qu’énoncent Michel Serres.
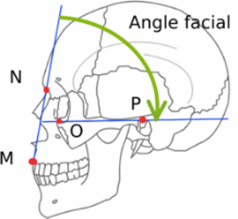 Le « prognathisme » (du grec pro, « avant » et gnathos, « mâchoire ») est une configuration faciale selon laquelle une des deux mâchoires est plus saillante que l’autre vue de profil par rapport à la verticale du front et du nez.
Le « prognathisme » (du grec pro, « avant » et gnathos, « mâchoire ») est une configuration faciale selon laquelle une des deux mâchoires est plus saillante que l’autre vue de profil par rapport à la verticale du front et du nez.
L’angle facial est la mesure qui permet d’évaluer le prognathisme.
L’angle facial est une mesure qui permet d’évaluer le prognathisme d’un crâne, c’est-à-dire la projection plus ou moins avancée des mâchoires et de la face.
C’est l’angle aigu formé par les deux droites (OP) et (MN), avec :
- O point le plus bas de l’orbite oculaire;
- P point le plus haut du trou auditif;
- M point le plus proéminent de l’os maxillaire supérieur entre les alvéoles des deux incisives supérieures centrales;
- N rencontre de la suture des os nasaux et de l’os frontal.
Toutes ces précisions sont tirées de Wikipedia.
Or l’évolution de l’espèce humaine a justement pour caractéristique une augmentation de l’angle facial et un prognathisme de moins en moins marqué.
Si on aborde ce sujet d’une manière chiffrée on a ces évolutions
- Homo habilis : 65 à 68°
- Homo erectus : 75 à 81°
- Homo neanderthalensis : 71 à 89°
- Homo sapiens : 82 à 88°
Sur le site de l’Université de Picardie et sur cette page <La lignée humaine> on trouve ce schéma évolutif.
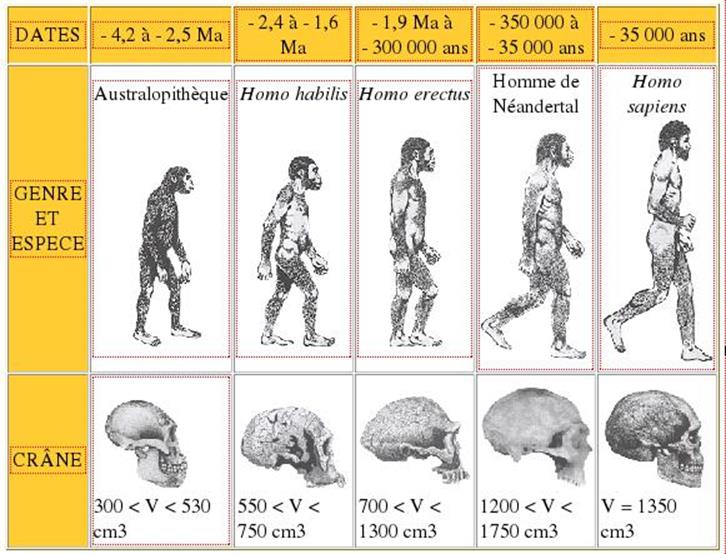
Et Michel Serres de faire l’hypothèse que c’est peut-être le destin de la bouche qui nous a mis debout. Mais c’est aussi peut être parce que l’homme s’est mis debout que la bouche est devenue cet organe multifonction et que nos capacités cognitives se sont développées.
<1261>
- O point le plus bas de l’orbite oculaire;
-
mardi 2 juillet 2019
« Il est incroyable que le monde ait du goût »Pierre-Henry SalfatiDans la première émission du « sens des choses » consacrée à l’alimentation : Le sens religieux de la nourriture : cannibalisme et interdits religieux. Il y avait deux invités :
- Le premier, très connu Pascal Picq, paléoanthropologue au Collège de France, que j’ai déjà évoqué lors du mot du jour du <18 juin 2019>
- Le second moins, Pierre-Henry Salfati scénariste et réalisateur français de cinéma et de télévision. Mais ce n’est pas en tant que réalisateur qu’il a été invité mais en tant que talmudiste.
<Talmudiste> a plusieurs signification, dans le cas de Pierre-Henry Salfati cela signifie qu’il est un spécialiste de l’étude du Talmud.
Le « Talmud » est un ensemble de textes du judaïsme. Si vous ne savez rien de ce pilier de la Loi juive, vous pouvez lire ce court article de <La Croix>.
En résumé, le début de la bible chrétienne commence par les « cinq livres de Moïse » ou Pentateuque, ce n’est qu’une partie de l’ancien testament.
Ces cinq livres sont communs avec la religion hébraïque, d’ailleurs ils ont été écrits dans le cadre de la religion hébraïque, les chrétiens n’ont fait que reprendre ces textes.
Les juifs appellent ces 5 livres : « La Torah »
Cependant, les talmudistes prétendront que les chrétiens n’ont pas bien traduit les textes de « la Torah » et leur ont parfois donné un sens qu’ils n’avaient pas.
« Le Talmud » appartient uniquement à la tradition du judaïsme. Il représente des commentaires de la Torah fait par les rabbins et les docteurs de la Loi et traite toutes les affaires du quotidien, de la législation, de la culture de l’histoire du peuple juif. La Croix écrit :
« On peut y voir une véritable encyclopédie du judaïsme. Maintes fois censuré, interdit et brûlé en place publique (à Paris en 1244, à Rome en 1553, en Pologne en 1757…), il n’a cessé de jouer un rôle d’unité dans la vie intellectuelle et spirituelle juive. Son étude constitue toujours l’objet principal, voire exclusif, de l’enseignement dans les « yeshivot » (écoles talmudiques) à travers le monde. »
Dans l’émission suivante, l’invité était Michel Serres à qui Jacques Attali a demandé de quoi manger est-il le nom ?
Et Michel Serres a répondu
« Je crois que manger est une activité triple
- Elle est Biologique d’abord et vital qui est la survivance
- Deuxièmement, c’est une activité sociale, politique et éthique parfois puisque cela pose des questions de circulation des vivres, de spéculation etc…
- Et puis c’est aussi un acte religieux, sacré »
Manger a quelque chose d’intime avec le sacré.
Le récit sacré qui a structuré une grande partie de notre imaginaire et aussi de notre civilisation s’occupe très vite de la nourriture et du manger.
Et Michel Serres de souligner qu’au début du premier texte de la bible : la genèse il est question de nombreuses fois de manger.
J’ai vérifié : le verbe manger se trouve en effet 17 fois dans le chapitre 3 de la Genèse, celui où les humains vont manger le fruit de l’arbre de connaissance et être chassés du paradis. Il est présent 4 fois au chapitre 2, qui est le chapitre où l’interdiction est posée.
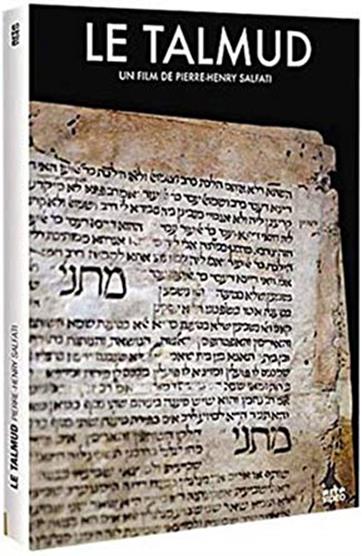 Pierre-Henry Salfati commence son intervention par cette réflexion :
Pierre-Henry Salfati commence son intervention par cette réflexion :
« Le premier monothéisme n’évoque pas l’homme en tant qu’être mangeant, mais en tant qu’être ne mangeant pas.
Quand on sort du ventre de sa mère, le premier réflexe est de casser son jeûne. On va tout de suite manger. Manger sa mère en l’occurrence.
Il s’avère que dans ce texte inouï [Genèse], la première chose qui lierait ce que d’autres appellent Dieu, ce que la Torah appelle autrement, à sa créature, c’est de ne pas manger une chose : tu ne mangeras pas cela.
En quelque sorte le premier contact, c’est le jeûne ou la restriction »
Rappelons, en effet, le texte de la Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17 tel que l’écrit la bible chrétienne
« L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;
Mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal »
Annie nuance beaucoup le propos de Salfati qui prétend que le premier réflexe de l’enfant qui naît est de casser le jeûne.
En effet, l’enfant dans le corps maternel ne jeûne pas, bien au contraire il est nourri sans avoir même besoin de réclamer à partir du cordon ombilical qui le relie au placenta.
D’ailleurs le placenta et les cellules de l’embryon sont issus des mêmes cellules originaires qui ensuite se différencient pour devenir d’une part le nouvel être vivant et l’autre la matrice nourricière.
Alors quand l’enfant sort à l’air libre, son souci n’est pas de casser le jeûne mais de continuer à se nourrir. Et cela constitue, en effet, une rupture celle de devoir faire un effort pour s’alimenter, alors qu’avant il avait tout ce dont il avait besoin sans effort et même si cela devait se faire au détriment de la mère.
Cela étant le texte fondateur du judaïsme édicte en effet comme première règle, une règle alimentaire qui détourne l’homme d’un aliment végétal précis.
Le fruit de l’arbre de la connaissance, tout un programme…
Pierre-Henry Salfati estime que
« On est ailleurs que dans le religieux ici. Si on étudie ce texte uniquement sous l’aspect philologique. Le végétal interdit est curieusement lié au savoir. […] [Dans une tradition du Talmud] l’interdiction devait durer 3 heures. L’interdit sera transgressé malgré la courte période de l’interdiction. Alors on est dans le symbolique, mais pas que. L’homme ne fait que transgresser son propre symbole.
Ce qui va finalement fonder cette religion-là, c’est le rapport à la conscience : qu’il est incroyable que le monde ait du goût
Que cet univers soit comestible. Comestible non seulement parce qu’il va nous sustenter mais en plus que ce que l’on mange a du goût.
On ne se pose pas la question de savoir si les hommes d’autrefois, aimaient le goût de ce qu’ils mangeaient.
Et le gout déjà fait le choix. L’homme va manger ce qui va le nourrir mais aussi ce qu’il aime, ce qui a bon goût.
Manger en hébreu se dit « èèkhol » (je ne suis pas certain de l’écriture rappelons que j’entends ce talmudiste à l’oral) cela se décompose en « taureau » ou « l’unique » puis « l’un et tout » (‘kohl’). Ce qui signifie qu’en hébreu manger, c’est manger le monde, c’est manger un bout du monde. Manger une pomme, c’est manger l’humanité. Curieusement la science le démontrerait. On est ailleurs que dans le religieux.
Le mot « goût » en hébreu veut dire « la raison » et veut aussi dire « l’accent » (dans le sens accent marseillais)
Le fait que le monde soit comestible avec un certain goût est un mystère.»
C’est pour nous une évidence qu’il existe des aliments et que ces derniers aient un goût.
L’innocent ou le talmudiste s’en étonne et s’en réjouit, le monde est comestible et a du goût.
Notons que de joyeux drilles, mais sont-ils vraiment joyeux, je n’en suis pas sûr, estime que manger prend beaucoup trop de temps et qu’il serait plus simple de disposer de quelques poudres ou de pilules sans goût spécifique permettant d’apporter les éléments nutritifs au corps.
Il faut avouer qu’on est alors très loin du sacré et du goût. On est dans l’utilitarisme et on s’éloigne probablement autant de l’humanisme que du divin…
Mais « l’interdit alimentaire » qui est la première chose qui vient à l’esprit quand on associe le premier monothéisme et l’alimentation.
Rappelons que le judaïsme comme l’islam manifestent des interdits alimentaires. Le christianisme, en revanche, n’a pas d’interdit alimentaire.
Dans les religions non monothéistes, en vertu du principe de non-violence envers toute forme de vie, tous les jaïns ainsi qu’une grande partie des bouddhistes, des hindouistes et des sikhs sont végétariens. Ce n’est toutefois une prescription absolue que dans le jaïnisme où la non-violence est l’idéal fondateur et fondamental.
Les prescriptions alimentaires juives sont définies par les règles de la <cacherout>.
Mais le premier interdit qu’il y a eu dans la religion juive est le sacrifice humain qu’on peut situer à 3000 ou 4000 ans avant notre ère.
La Bible considère le cannibalisme comme une malédiction
(Lévitique 26 verset 29, 2 Rois 6 verset 28)
Par la suite, la religion hébraïque a aussi interdit les sacrifices animaux contrairement aux religions concurrentes de l’époque romaine comme le culte de Mithra où on sacrifiait un taureau dans une cérémonie qui avait pour nom le « taurobole »
Il en était de même avec la déesse Cybèle qui fut une autre concurrente du christianisme. Le musée gallo-romain de Lyon présente des autels tauroboliques pour Cybèle.
Mais Pierre-Henry Salfati aborde le sujet de l’interdit de la manière suivante :
« Qu’est-ce qu’on interdit quand on interdit ?
Est-ce qu’on interdit le goût des choses ou est-ce qu’on interdit quelque chose qui serait toxique ? »
Plus loin il explique qu’il n’y a pas de liste d’aliments toxiques dans les textes juifs. Et il ajoute qu’aujourd’hui il y a des tas de rabbins orthodoxes qui meurent du cholestérol. La nourriture casher les rend aussi malades que les autres.
Mais en fait, ce que ce récit apporte c’est de s’intéresser à la nourriture, à regarder ce que l’on mange :
« La première loi talmudique sur la nourriture qui est le lien le plus intime avec le divin, pour ceux qui croient et le lien, le plus intime avec l’humanité pour ceux qui ne croient pas […] commence par : Regarde ce que tu manges.
C’est la première loi, d’examiner ce qu’on mange.
Je vois tous les jours des gens qui sont en train d’examiner plus que jamais ce qu’ils mangent.
Or ce que l’on mange nous tue, c’est clair.
Mais avant de mourir on a le temps de réfléchir.
On est assassiné par ce monde-là, mais il est consommable.
Certains se sont demandés pourquoi l’homme pouvait comprendre un peu le cosmos, peu se sont demandés pourquoi le cosmos est consommable. »
Le talmudiste s’intéresse ensuite aux mots. Et il explique notamment que le christianisme a traduit des mots hébreux par des concepts qui n’appartiennent pas au judaïsme :
« Il y a une énorme méprise sur le judaïsme lié à une grande histoire culturelle. Je veux en venir aux mots par exemple.
En hébreux, il n’y a pas de mot qui signifie « interdit », en fait si on traduit le mot qui est devenu interdit en français, ce mot signifie « attaché ». Cette chose qui vous attache ou à laquelle vous vous attachez. »
Aujourd’hui on parlerait peut être d’addiction. N’en est-il pas ainsi, par exemple, pour le sucre qui crée de l’addiction ?
« Ce qui est devenu « permis » voulait dire à l’origine « libéré ». Ce qui t’attache d’un côté, ce qui te libère de l’autre côté. »
On interdirait donc des choses qui nous aliéneraient et on nous autorise des choses qui nous libèrent.
Salfati résume :
« On nous incite à nous libérer. Quand on te dit ceci te libère, ceci t’attache, c’est autre chose que de la morale. Le Dieu que le christianisme a rendu rétrospectivement les juifs responsables, les juifs n’y sont pour rien. Il n’y a pas de mot « Dieu » dans toute la Torah. Il y a dix noms qui ont été traduits par Dieu, mais originellement ces noms n’ont rien à voir avec cette affaire. […] De soi-même l’homme choisit ce qu’il mange, ce qu’il peut attraper. Au départ les hommes sont des chasseurs, ils veulent attraper ce qui est le plus facile, ce qui est le plus proche. Manger un lion c’est difficile […] L’animal sauvage est difficilement consommable.»
Et l’animal sauvage fait partie des interdits alimentaires de la cacherout.
Et le lien le plus évident avec le sacré n’est-il pas finalement que l’organe qui permet de parler est aussi celui qui permet d’absorber les aliments qui nourrissent notre corps :
« Manger, c’est penser. On parle et on mange par le même organe qui est un trou qui est la bouche.
C’est curieux symboliquement que ce qu’on fait rentrer est la nourriture et ce qui en ressort c’est la parole.»
<1260>
- Le premier, très connu Pascal Picq, paléoanthropologue au Collège de France, que j’ai déjà évoqué lors du mot du jour du <18 juin 2019>
-
Lundi 1 juillet 2019
« Pause »En raison de la caniculeLe clavier était trop chaud.

En attendant la suite, la série sur l’alimentation compte pour l’instant 8 articles :
-
1-« Der Mensch ist, was er ißt
L’homme est ce qu’il mange »
Ludwig Andreas Feuerbach
-
2-«L’homme est omnivore comme ses cousins singes, mais il est seul à cuire les aliments et c’est une différence fondamentale »
Connaissance apportée par la paléoanthropologie
-
3-«On ne mange pas son prochain comme cela, qu’on soit néandertalien ou sapiens.»
Pascal Picq, le « sens des choses » 1ère émission (16 :30)
-
4-« Le régime alimentaire des humains d’aujourd’hui est beaucoup plus restreint que celui des premiers chasseurs-cueilleurs »
Naama Goren-Inbar archéologue et paléoanthropologue israélienne
-
5-« Il a bien fallu que quelqu’un, un jour, fasse le geste de mettre un grain en terre ! »
Patricia Anderson & George Willcox, chercheurs au CNRS « L’Histoire » N°193 du novembre 1995
-
6-« Je ne crois pas que l’on puisse imaginer un monde sans agriculture »
Michel Serres
-
7-« Avons-nous eu tort d’inventer l’agriculture ? »
Question posée par Jared Diamond, James Scott et quelques autres
-
8-« Au Japon la poterie, la complexité sociale et la sédentarité ont précédé l’agriculture »
Jean-Paul Demoule
<Article sans numéro>
-
-
Vendredi 28 juin 2019
«Au Japon la poterie, la complexité sociale et la sédentarité ont précédé l’agriculture»Jean-Paul DemouleDonc dix mille ans avant notre ère l’agriculture nait au Moyen-Orient. Puis dans d’autres régions du monde, très vite en Chine et en Nouvelle Guinée (-9000), puis en Amérique du Sud et en Amérique Centrale vers -5000.
Hier nous nous demandions si c’était une bonne idée d’inventer l’agriculture et si on pouvait s’en passer.
En tout cas, il y a une région du monde qui s’en est passée longtemps : le Japon.
Ainsi cet article de la revue « l’Histoire » : <Déroutante préhistoire du Japon…> nous apprend que c’est seulement vers 300 avant notre ère que l’agriculture a fait son apparition au Japon. Dix mille ans après les premiers villages ! :
« La préhistoire japonaise est peu connue en France : les publications, très nombreuses, sont rarement écrites dans des langues occidentales et presque jamais en français. Pourtant l’archéologie y connaît un essor sans précédent, grâce à des moyens accordés pour l’essentiel au sauvetage des quelque 10000 sites découverts chaque année lors d’opérations d’aménagement.
Les résultats sont spectaculaires : des sites préhistoriques entiers reconstitués avec leurs dizaines de bâtiments de bois et leurs musées dotés des derniers perfectionnements audiovisuels reçoivent chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Ils posent aussi des problèmes passionnants.
Pour se limiter aux dix derniers millénaires avant notre ère, le Japon offre en effet une image qui s’oppose presque point par point à l’évolution du Bassin méditerranéen et de l’Europe pendant la même période. »
L’article a été écrit par l’historien Jean-Paul Demoule professeur de protohistoire européenne à l’université de Paris I. Il est l’auteur d’un livre sur l’époque qui m’occupe depuis le début de la semaine : « Les dix millénaires oubliés qui ont fait l’Histoire » et qui a pour sous-titre « Quand on inventa l’agriculture, la guerre et les chefs ». Ce livre j’aurai bien aimé l’emprunter à la bibliothèque pour approfondir ma réflexion mais il était déjà prêté.
Jean-Paul Demoule rappelle comment les évènements se sont enchainés dans le Croissant fertile, en Chine et ailleurs :
Il y a eu dans nos régions, on le sait, une « révolution néolithique » : la sédentarisation, dans le Levant méditerranéen et, vers 10000 avant notre ère, de petits groupes de chasseurs-cueilleurs qui ont fini par domestiquer les céréales ainsi que les moutons, les chèvres, les bœufs et les porcs.
Deux à trois millénaires plus tard, la poterie est inventée. Cette stabilité des ressources alimentaires provoque un accroissement démographique continu. D’où une migration en auréole autour de cette région d’origine, aboutissant à la colonisation de l’ensemble de l’Europe à partir de 6500 avant notre ère. Et une complexité sociale croissante, favorisant, au moment où apparaît la métallurgie, l’émergence des premiers États, en Égypte et en Mésopotamie, vers 3000 avant notre ère.
Or, à cette succession si bien établie qu’elle nous paraît la seule voie qu’ait pu suivre l’humanité tout entière on la retrouve en Chine, au Mexique ou au Pérou, le Japon oppose un tout autre schéma. »
La séquence connue dans les pays de l’invention de l’agriculture peu de temps après 10 000 avant notre ère peut se synthétiser ainsi :
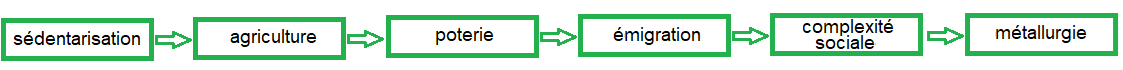
Alors qu’au Japon, selon Jean-Paul Demoule nous assistons à cet enchaînement :
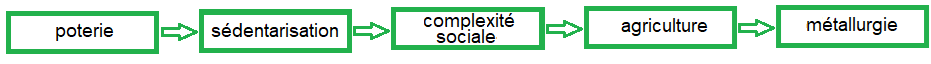
Au Japon ce sont donc des chasseurs-cueilleurs qui commencent à fabriquer de la poterie. L’article de la revue « L’Histoire » parle de poterie grossière, à fond conique, parfois décorée sommairement d’impressions de doigts.
Il semble que ce soit avec celle de la Chine du Nord, à peu près contemporaine, la plus ancienne du monde. Cette tradition technique qui va peu à peu se développer aura pour nom : « La période jomon » qui s’étend de 11000 à 300 avant notre ère.
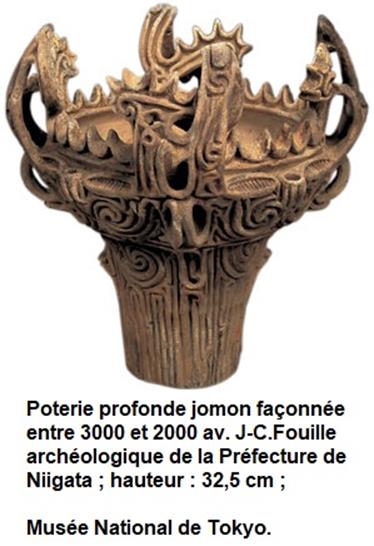 Les japonais n’ont pas été précurseurs en matière d’agriculture mais en matière de poterie ils l’ont été.
Les japonais n’ont pas été précurseurs en matière d’agriculture mais en matière de poterie ils l’ont été.
Sur ce site japonais en langue française : « La céramique japonaise à travers les âges » nous pouvons lire :
« La poterie commença dans l’Archipel nippon il y a treize mille ans, ce qui, à la lumière des plus récentes découvertes, semble être la précocité sur n’importe quel site du monde. Les plus communes étaient les grands pots profonds à bouillir l’eau. Les ustensiles étaient alors montés au colombin et simplement décorés en roulant ou en appliquant sur la surface encore humide des cordes tressées. C’est cette décoration « cordée » qui valut à la poterie de cet âge fort reculé l’appellation de jomon doki (jo = corde ; mon = motif, doki = poterie). Il y a quelque cinquante siècles donc, cette période Jomon produisait déjà des dessins d’un dynamisme fabuleux, dont cette décoration de vagues furieuses soulevant les bords de certains pots, et autres motifs fantasques ou extravagants décorant l’extérieur. »
Non seulement la poterie a précédé l’agriculture, mais même la complexité sociale. Alors que dans le récit que nous avons l’habitude d’entendre, seule l’agriculture permettait d’obtenir la complexité de l’organisation sociale :
« A partir de 10000 avant notre ère s’achève la dernière glaciation et commence l’actuelle période climatique. Cette amélioration de l’environnement permet aux premiers « Jomons » de se sédentariser en exploitant les ressources naturelles : chasse du sanglier, du cerf et du singe ; exploitation intensive des ressources lacustres et marines poissons, coquillages ; collecte des plantes sauvages, essentiellement des variétés de noix, de glands et de châtaignes, stockés dans des silos. Cette gestion du milieu naturel autorise une sédentarisation qui prend des formes spectaculaires. Les villages peuvent regrouper, à partir de 9000 avant notre ère, plusieurs dizaines de maisons, construites en bois et en terre, de forme circulaire puis quadrangulaire. Haches polies pour travailler le bois et meules pour fabriquer des farines sont alors en tous points identiques à celles qui, au Proche-Orient et en Europe, caractérisent les sociétés néolithiques.
Pourtant, ce terme de « néolithique », qui sert en Europe à désigner un mode de production fondé sur l’agriculture et l’élevage, ne convient pas au Japon. On n’y a trouvé aucune trace de domestication animale, hormis celle du chien, destiné à la chasse et non à l’alimentation. La culture du riz et du blé semble bien malgré quelques rares témoignages, ténus et discutés absente. En revanche, il n’est pas exclu que des arbres comme le châtaignier aient fait l’objet d’une exploitation contrôlée, une sorte d’arboriculture qui reste encore à préciser ; ce pourrait également être le cas de quelques autres plantes locales.
Enfin, à partir de 5000 avant notre ère, et plus encore de 3000 le « Jomon moyen », on constate une manifeste complexité sociale. La taille des villages croît encore, les bâtiments et les pratiques funéraires se différencient, des rituels apparaissent, avec des constructions spécialisées, des objets non utilitaires : poteries à décors en relief exubérants, masques d’argile, figurines fémi nines, grands phallus en pierre…
Mais toujours aucune trace d’agriculture ni d’élevage. »
Finalement l’agriculture va quand même arriver au Japon probablement en provenance de la Corée.
« C’est seulement avec la période suivante, celle de la civilisation dite de Yayoï du nom d’un site archéologique situé dans l’agglomération de Tokyo, entre 300 avant et 300 après notre ère, que la céréaliculture et la riziculture font brusquement leur apparition, en même temps que la métallurgie du bronze et du fer.
C’est la conséquence de fortes influences continentales, principalement coréennes. Cette brève civilisation de Yayoï débouche sur la formation du premier État japonais, avec ses tumulus monumentaux les kofuns , mais également l’adoption du bouddhisme et de l’écriture, phénomènes venus eux aussi tout droit du continent.
Cette évolution spécifique appelle au moins deux réflexions. La première est qu’on observe dès la préhistoire du Japon cette alternance de périodes d’ouverture et de fermeture qui sont caractéristiques de toute son histoire. La culture de Jomon commence ainsi en symbiose avec le continent, et se termine sous son influence. La seconde est qu’entre les deux se sont déroulés dix millénaires d’une expérience totalement originale.
Mais pas totalement isolée : çà et là, autour de la Baltique, au Portugal, en Ukraine ou sur la côte nord-ouest américaine, des groupes de chasseurs-cueilleurs, vivant en général de ressources aquatiques, ont pu également développer des sociétés sédentaires, parfois même hiérarchisées. »
Et l’article de conclure :
« Si les agriculteurs l’ont finalement emporté partout grâce à leur supériorité démographique, ils n’étaient peut-être pas le seul avenir de l’humanité. »
Réflexion qui relance donc les débats d’hier sur cette idée, quand même saugrenue, de remettre en cause le caractère inéluctable du passage par l’agriculture.
<1259>
-
Jeudi 27 juin 2019
« Avons-nous eu tort d’inventer l’agriculture ? »Question posée par Jared Diamond, James Scott et quelques autresLa question peut paraître étonnante. Surtout après le mot du jour d’hier : « Je ne crois pas que l’on puisse imaginer un monde sans agriculture »
Pendant longtemps aucun d’entre nous n’aurait même pas pensé poser une telle question
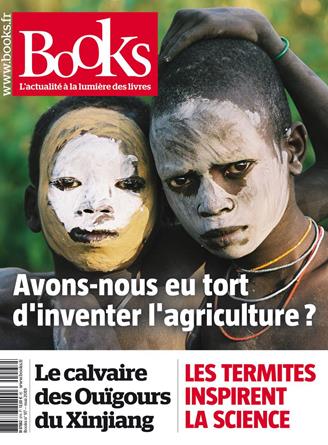 On peut même se demander si cette question a un intérêt.
On peut même se demander si cette question a un intérêt.Homo sapiens a inventé l’agriculture et c’est tout !
Et maintenant nous en sommes où nous en sommes parce qu’homo sapiens a inventé l’agriculture et que nous ne pouvons revenir en arrière sur ce point.
Les tentatives d’<uchronie> sont souvent assez vaines et très incertaines.
Toutefois les personnes qui posent cette question nous apprennent beaucoup de choses.
Souvent on nous fait passer pour du progrès des évolutions beaucoup plus complexes, je veux dire dont une partie plus ou moins importante est régression.
Je pense que nous pouvons appliquer ce schéma à un certain nombre d’évolutions contemporaines.
Mais revenons à notre sujet : l’invention de l’agriculture a permis de nourrir une population bien plus importante, a permis de créer des villes de plus en plus grandes et des civilisations de plus en plus sophistiquées.
Wikipedia nous apprend que l’affirmation que l’agriculture apporta aux hommes une maîtrise accrue de leur approvisionnement en nourriture, est contredite depuis qu’on a découvert que la qualité de l’alimentation des populations néolithiques était généralement inférieure à celle des chasseurs-cueilleurs et que l’espérance de vie pourrait avoir été plus brève, en partie à cause des maladies.
Il semble que cette évolution fit baisser la taille moyenne d’homo sapiens de 1,78 m pour les hommes et 1,68 m pour les femmes, à respectivement 1,60 m et 1,55 m, et il a fallu attendre le XXe siècle pour que la taille moyenne humaine revienne à ses niveaux pré-Néolithiques..
Le néolithique apporta un accroissement de la population en raison d’une augmentation considérable des naissances qui parvint à compenser largement une augmentation du taux de mortalité. Wikipedia explique :
« En réalité, en réduisant la nécessité de porter les enfants (pendant les déplacements), la sédentarisation des populations néolithiques augmenta le taux de natalité en réduisant l’espacement des naissances. En effet, porter plus d’un enfant à la fois est impossible pour des chasseurs-cueilleurs, ce qui entraîne un espacement entre deux naissances de quatre ans ou plus. Cet accroissement du taux de natalité était nécessaire pour compenser l’augmentation des taux de mortalité. Le paléodémographe Jean-Pierre Bocquet-Appel estime que sur cette période, le taux de fécondité est passé de 4-5 enfants à 7 enfants par femme en moyenne, entraînant une transition démographique importante avec un taux d’accroissement naturel de 1 %, faisant passer la population mondiale de 7 millions d’individus à 200 millions ».
Et puis l’organisation sociale allait évoluer considérablement : l’apparition du stockage des aliments et la constitution de réserves ont eu pour effet indirect la mise en place d’une classe de guerriers pour protéger les champs et les réserves des intrusions de groupes étrangers. Les surplus alimentaires rendaient possibles le développement d’une élite sociale qui n’était guère impliquée dans l’agriculture, mais dominait les communautés par d’autres moyens et par un commandement monopolisé. Bref, l’inégalité était en marche.
Du chasseur cueilleur debout pour cueillir et chasser on est passé à l’homme courbé sur son lopin de terre.
Par ailleurs les maladies se répandaient bien davantage que du temps des chasseurs-cueilleurs.
Wikipedia explique que
« Des pratiques sanitaires inadéquates et la domestication des animaux peuvent expliquer l’augmentation des morts et des maladies pendant la révolution néolithique, puisque les maladies se transmettaient des animaux aux humains. Quelques exemples de maladies transmises des animaux aux humains sont la grippe, la variole et la rougeole. »
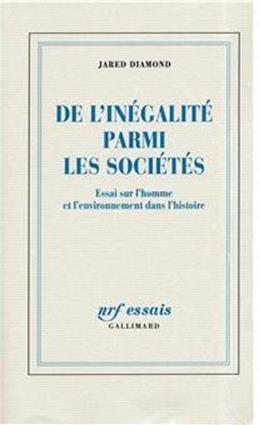 Le premier qui s’est sérieusement attaqué à cette question semble être l’américain Jared Diamond, géographe, biologiste évolutionniste notamment par son ouvrage publié en 1997 : « De l’inégalité parmi les sociétés » (prix Pulitzer 1998).
Le premier qui s’est sérieusement attaqué à cette question semble être l’américain Jared Diamond, géographe, biologiste évolutionniste notamment par son ouvrage publié en 1997 : « De l’inégalité parmi les sociétés » (prix Pulitzer 1998).Le titre original est : « Guns, Germs, and Steel » (Armes, germes et acier).
Diamond situe l’origine de sa démarche dans un échange avec Yali, un politicien de Nouvelle-Guinée. S’interrogeant sur les inégalités entre les sociétés européennes et la Nouvelle-Guinée qui fut colonisée par ces dernières pendant deux cent ans, Yali demanda à Diamond de se prononcer sur l’origine des inégalités dans la répartition des biens et technologies que les Européens ont apportés avec eux et dont les peuples de Nouvelle-Guinée sont par contraste si cruellement dépourvus.
Dans son livre, Diamond va d’abord récuser l’idée d’une supériorité génétique ou morale des Européens pour mieux mettre en lumière l’importance des facteurs écologiques. Les inégalités entre les sociétés ne reflètent pas tant des différences raciales ou culturelles qu’elles ne s’expliquent par les opportunités de complexification offertes par la géographie aux sociétés eurasiennes qui s’enracinent dans le « Croissant Fertile » du Proche et Moyen-Orient. La civilisation européenne a pu conquérir le monde parce qu’elle a bénéficié d’un environnement privilégié et d’effets de rétroaction positifs induits par l’utilisation des ressources naturelles – animales et végétales – pour le développement de la société.
Et c’est dans ce livre que Jared Diamond va interroger le progrès qu’est sensé avoir été apporté par l’invention de l’agriculture.
Selon lui l’humanité était plus heureuse, plus égalitaire et en meilleure santé avant l’invention de l’agriculture et l’apparition des premiers États.
Une analyse de cet ouvrage et du suivant qu’a écrit Diamond ainsi que des critiques formulées contre sa thèse se trouve sur ce site mis en ligne par le collège de France <La vie des idées>.
En 2005, le livre a été adapté en un film documentaire en 3 parties de 55 minutes, produit par National Geographic Society, et diffusé sur Arte en avril 2008, sous le titre « Un monde de conquêtes ».
Vous pourrez visionner ce documentaire en plusieurs épisodes sur <Un monde de conquêtes>.
J’ai trouvé aussi un article de Jared Daimond, qui a précédé sont livre, traduit en français sur ce site : <La pire erreur de l’histoire de l’humanité : l’agriculture ?>
Le magazine Books qui essaye de faire la part des choses introduit le sujet de cette manière et surtout évoque un nouvel ouvrage traduit en français en 2019 : « HOMO domesticus » :
« L’humanité était plus heureuse, plus égalitaire et en meilleure santé avant l’invention de l’agriculture et l’apparition des premiers États. Cette thèse, déjà formulée par Jared Diamond dans les années 1980, est reprise et approfondie par le politologue et anthropologue américain James Scott dans un livre traduit en français, Homo domesticus.
Le néolithique a représenté selon lui une véritable catastrophe, y compris sur le plan sanitaire. Il y voit l’origine des travers les plus détestables des sociétés humaines, dont nous sommes toujours les victimes. L’archéologue britannique Steven Mithen, spécialiste de la période qui a immédiatement précédé le néolithique, fait l’éloge du livre et abonde dans le sens de l’auteur.
Mais tout le monde n’est pas d’accord. Après les critiques formulées par un écologue britannique, nous donnons la parole à un spécialiste américain de l’histoire de l’agriculture, Mark Tauger. La Mésopotamie n’était pas l’enfer ! Si l’on
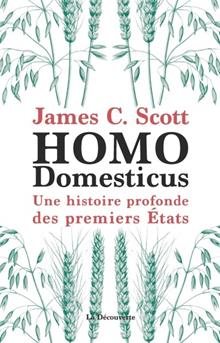 observe aussi que les sociétés de chasseurs-cueilleurs n’étaient pas toutes paisibles et égalitaires, on aboutit à un tableau d’une grande complexité, dans lequel les arguments font pencher la balance tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. »
observe aussi que les sociétés de chasseurs-cueilleurs n’étaient pas toutes paisibles et égalitaires, on aboutit à un tableau d’une grande complexité, dans lequel les arguments font pencher la balance tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. »Pour James Scott également, l’invention de l’agriculture a entraîné des effets pervers en série. En se fixant dans des villages et en vivant en symbiose avec les animaux domestiques, les humains se sont privés de sources alimentaires diversifiées et ont contracté toutes sortes de maladies. La création des cités-États qui s’en est suivie a renforcé les inégalités.
Même dans les conditions les plus extrêmes, les chasseurs-cueilleurs n’avaient pas à lutter constamment pour leur survie et disposaient de temps libre. I
Et le magazine Books de détailler :
« Le feu a changé les humains autant qu’il a changé le monde. La consommation d’aliments cuits a transformé nos organismes ; notre tube digestif s’est sensiblement raccourci, avec pour conséquence un surcroît d’énergie disponible pour le développement de notre cerveau. Le feu a aussi domestiqué Homo sapiens en lui apportant chaleur, protection et énergie. Si la maîtrise du feu marque le début du progrès humain vers la « civilisation », l’étape suivante – selon le récit traditionnel – a été l’invention de l’agriculture, il y a environ 10 000 ans. C’est l’agriculture, dit-on, qui nous a permis d’échapper à la pénible existence nomade des chasseurs-cueilleurs de l’âge de la pierre et de nous établir, de bâtir des villes et de créer les cités-États qui ont constitué le berceau des premières civilisations. Les gens y ont afflué car ils trouvaient, à l’abri de leurs épaisses murailles, sécurité, distractions et activités économiques. L’étape suivante a été l’effondrement des cités-États et les invasions barbares qui ont plongé les mondes civilisés – l’ancienne Mésopotamie, la Chine, la Méso-Amérique – dans les siècles obscurs. Les civilisations prospèrent puis s’effondrent. C’est du moins ce que nous dit le récit classique.
[…] Et si le récit classique était complètement erroné ? Et si les ruines antiques témoignaient davantage d’une aberration au regard du cours normal des affaires humaines que d’un passé glorieux dont nous devrions aspirer à perpétuer les prouesses ? Et si l’avènement de l’agriculture ne nous avait pas libérés mais au contraire asservis ? Scott propose un contre-récit nettement plus passionnant, ne serait-ce que parce qu’il se garde de toute autosatisfaction à l’égard de ce que l’humain a accompli. L’exposé qu’il fait du passé lointain n’entend pas mettre un point final au débat, mais il est sans aucun doute plus exact que celui auquel nous sommes habitués et fait apparaître les faiblesses de la pensée politique contemporaine, qui repose sur l’idée de progrès continu de l’humanité et sur l’idéal de la cité-État et de l’État-nation. Pourquoi l’humanité s’est-elle donc mise à l’agriculture ? Lors d’un colloque à Chicago en 1966, l’anthropologue Marshall Sahlins s’appuya entre autres sur les travaux de Richard Lee sur les !Kungs du Kalahari pour affirmer que les chasseurs-cueilleurs représentaient la « première société d’abondance » . Même dans les environnements les plus extrêmes, expliquait-il, les chasseurs-cueilleurs n’avaient pas à lutter constamment pour leur survie et disposaient de temps libre. Marshall Sahlins et ses inspirateurs sont peut-être allés un peu loin, omettant par exemple de prendre en compte le temps consacré à la préparation des aliments (il fallait en casser, des noix de mugongo !). Mais leur thèse était suffisamment étayée pour porter un coup sévère à l’idée que l’agriculture avait été un salut pour les chasseurs-cueilleurs : de quelque façon que l’on considère la question, l’agriculture représente une charge de travail plus lourde et demande un effort physique plus important que les activités de chasse et de cueillette ; et plus on en apprend, fait valoir James Scott, plus les chasseurs-cueilleurs apparaissent sous un jour favorable, si l’on en juge par leur régime alimentaire, leur santé et leur temps libre. »
Cette thèse est donc contredit par Mark Tauger : « Ce n’était peut-être pas l’enfer »
Yuval Noah Harari prend dans son livre « Sapiens » nettement parti pour James Scott et a cette expression : « Le choix de la sédentarité est la plus grande arnaque que l’humanité ait connue »
Il le répète dans cet article de Philosophie Magazine : <Auriez vous préféré être chasseur-cueilleur>.
En conclusion :
Nous avons l’agriculture et notre quête actuelle c’est d’en garder une de qualité et que l’industrie ne pervertisse pas trop.
Mais ces réflexions montrent l’écart entre le récit du progrès éternel et la réalité de ce que l’on peut connaître aujourd’hui. Car même si Diamond ou Scott sont critiqués certaines de leurs découvertes et affirmations ne sont pas remises ne causes, notamment l’asservissement de l’agriculteur et les maladies qui ont été générés par cette évolution.
Par ailleurs concernant la qualité nutritionnelle, la perte de taille de l’homme du Néolithique n’est pas non plus contesté.
L’agriculture enfin a contribué à une perte immense de la biodiversité des plantes en se focalisant sur celles qui, avant tout, étaient plus rentables.
<1258>
-
Mercredi 26 juin 2019
« Je ne crois pas que l’on puisse imaginer un monde sans agriculture. »Michel SerresHier nous avons vu les laboureurs l’emporter sur les chasseurs-cueilleurs dans la révolution du néolithique. Les sédentaires ont remplacé les nomades.
Bien sûr ce n’était pas aussi simple que cela, l’Histoire et la vie sont complexités.
Mais restons sur cette simplification.
Aujourd’hui on parle aussi des nomades et des sédentaires.
Les nomades sont les élites mondialisées qui partout sont chez eux. Enfin, ils sont davantage chez eux dans les métropoles que dans les territoires périphériques
Raphael Glucksmann reconnaissait dans <cette interview> se sentir culturellement plus chez lui à New York et à Berlin qu’en Picardie. Il faut être juste, il le regrettait et trouvait cela anormal.
Les sédentaires sont plutôt les perdants de la mondialisation.
Beaucoup d’agriculteurs qui sont les sédentaires par excellence, sont les perdants de l’économie moderne.
Dans son livre «The Road to Somewhere» le britannique David Goodhart estime que la division gauche/droite a perdu beaucoup de sa pertinence. Il propose un nouveau clivage entre ceux qu’il appelle « les Gens de Partout » (anywhere) et « le Peuple de Quelque Part » (Somewhere). Les premiers, les Gens de Partout ont bénéficié à plein de la démocratisation de l’enseignement supérieur. Ils sont bien dotés en capital culturel et disposent d’identités portables. Ils sont à l’aise partout, très mobiles et de plain-pied avec toutes les nouveautés.
Les membres du Peuple de Quelque Part sont plus enracinés. Ils habitent souvent à une faible distance de leurs parents, sur lesquels ils comptent pour garder leurs enfants. Ils sont assignés à une identité prescrite et à un lieu précis. Ils ont le sentiment que le changement qu’on leur vante ne cesse de les marginaliser, qu’il menace la stabilité de leur environnement social. Ils sont exaspérés qu’on leur ait présenté la mondialisation et l’immigration de masse comme des phénomènes naturels, alors qu’ils estiment que ce furent des choix politiques, effectués par des politiques et des responsables économiques appartenant aux Gens de Partout.
Brice Couturier a développé ces réflexions dans sa chronique du <15 mai 2017> et je l’avais évoqué lors du mot du jour consacré à « Die Heimat »
 Le Mensuel « Philosophie Magazine », publié le 28/04/2016, a consacré un dossier sur le même sujet : « Nomades contre sédentaires, la nouvelle lutte des classes
Le Mensuel « Philosophie Magazine », publié le 28/04/2016, a consacré un dossier sur le même sujet : « Nomades contre sédentaires, la nouvelle lutte des classes
Et un des articles de ce dossier a donné la parole au philosophe malicieux : Michel Serres.
Et je ne peux m’empêcher de partager cet article dans lequel Michel Serres, dans une de ses itinérances spéculatives dont il avait le secret convoque le mythe de Caïn et Abel pour parler des nomades et des sédentaires, des chasseurs-cueilleurs et des agriculteurs. Et bien sûr, il prend le parti de celui qui n’a pas le beau rôle : Caïn, l’agriculteur.
Michel Serres narre d’abord l’histoire :
« Au départ, l’histoire est simple : Abel, le berger, offre à Jéhovah des agneaux, son frère Caïn, le cultivateur, des fruits et des légumes issus de son travail de la terre. Jéhovah accepte les offrandes du premier mais pas celles du second, qui jalouse cette préférence.
Cependant, oublions Dieu et parlons d’histoire : Caïn est né au Néolithique avec l’agriculture ; Abel, tout éleveur qu’il est, est demeuré chasseur-cueilleur, errant au gré des nécessités de sa subsistance. Abel est l’homme ancien, né au Paléolithique supérieur. Abel et Caïn rejouent en effet le conflit anthropologique entre le chasseur-cueilleur et l’agriculteur, le nomade et le sédentaire. »
Conflit qui se termine par le meurtre :
« Le meurtre montre combien l’équilibre est difficile à trouver. Abel cherche l’herbe tendre pour ses bêtes, les fruits mûrs et le gibier pour se nourrir. Ses troupeaux traversent l’emblavure préparée à la sueur de son front par Caïn, forcé de vivre sédentaire pour semer ou récolter. Le premier qui, « ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi » fut, non pas le fondateur de la société civile, comme l’écrit Rousseau, mais celui de l’agriculture. Poussé à ce geste par les nécessités de la culture, il déclencha la guerre. Caïn, c’était donc lui, ferme son lopin et le défend, bec et ongles, de toute incursion. Mais Abel, comme Rémus, défiant plus tard Romulus, saute la limite et trouve la mort au fond d’un sillon. La querelle est inéluctable… et sans fin. »
Le journaliste pose la question : « Pourquoi sans fin ? » et Michel Serres évoque ce conflit des nomades et des sédentaires à travers l’Histoire.
« Parce qu’Abel le nomade est le préféré de Dieu, traduisez le préféré de l’histoire. Depuis la Bible, le peuple élu est un peuple de pasteurs, et le Moyen-Orient, région où s’inventent l’agriculture et la tradition pastorale, est le théâtre de cet affrontement.
Mais dans l’histoire, malgré le meurtre originel d’Abel, ce sont toujours les nomades qui gagnent.
Les lointains descendants des chasseurs-cueilleurs sont les conquérants à cheval, nomades et pasteurs guerriers comme Attila qui défia l’Empire romain au V siècle, ou Gengis Khan, venu de Mongolie au XII siècle pour envahir la Chine, l’Asie centrale, et construire le plus grand empire de tous les temps en ravageant en Eurasie l’équivalent de 25 % de la population mondiale, essentiellement paysanne en ces régions. Gengis Khan, Attila, c’est la vengeance d’Abel.
Vient ensuite la féodalité où le noble asservit le cultivateur.
La noblesse ne cultive pas ; elle chasse. Abel est le seigneur qui chasse sur les terres exploitées par des Caïn serfs.
L’image de nos livres d’histoire est bien connue : les nobles passent au grand galop, comme un orage, sur le travail des manants et saccagent leurs fruits.
Ce n’est pas un hasard si la tradition cardinale de l’aristocratie fut la chasse à courre.
La noblesse venge Abel le nomade, qui réduit alors Caïn le sédentaire à l’esclavage et, souvent, le tue. Inversement, on raconte qu’une partie de la Révolution française a été faite par des paysans qui voulaient chasser, droit réservé aux nobles… […] »
Et Michel Serres parle d’aujourd’hui, des bourgeois qui font l’éloge de l’errance et des traders qui spéculent sur les aliments.
« […] l’aristocratie errante d’aujourd’hui est en réalité la bourgeoisie possédante qui tient le commerce et l’industrie – il n’y a que les bourgeois pour faire l’éloge de l’errance !
Ces Abel ont pressuré à mort l’agriculture des Caïn et sont en train ainsi de détruire le monde. […]
La punition de Caïn se perpétue. La tradition relate qu’après avoir tué son frère Abel, Caïn erra sur la Terre, poursuivi par l’ire divine et surveillé par son oeil ubiquiste.
Le casanier fut condamné à devenir un émigré, à devenir nomade à son tour. Par les études, en effet, par le travail, pour les uns par les vacances, pour les autres forcés par la famine ou la guerre, nous sommes tous, riches ou misérables, devenus des nomades ; rares sont ceux qui ont l’heur de ne pas errer sur la Terre. Nous sommes des Caïn maudits devenus petits-fils d’Abel qui assassinons tous les jours les sédentaires qui demeurent […] les autoroutes, la croissance des faubourgs, les rails du TGV et les aéroports, engorgés d’errants, saccagent les champs fertiles et, parfois, des vignobles sacrés. Les plus grands nomades contemporains, ce sont les traders, affranchis de tout territoire, qui spéculent sur les produits alimentaires, ce qui est pour moi le crime absolu des Abel contre les Caïn modernes.
Cette spéculation est probablement responsable de la plupart des famines dans le monde, alors que les révolutions vertes ont peu ou prou résolu les questions alimentaires au niveau de la production.
Caïn, paysan sédentaire et producteur d’aliments, est le personnage le plus persécuté de la planète. »
Et puis il finit par le besoin de courir et pourtant d’habiter et de la nécessité des agriculteurs pour nous nourrir.
« […] Qu’est-ce qu’un animal ? Par définition, un vivant qui court.
Il court pour quoi ? Pour attraper son gibier, pour échapper à ses prédateurs et pour mettre la plus grande distance entre lui et ses excréments.
L’animal court, mais il faut aussi qu’il mange, qu’il dorme, qu’il s’accouple, que la femelle allaite, qu’il protège ses enfants qui ne savent pas encore marcher ou voler, donc il doit aussi s’arrêter. Les oiseaux créent alors des nids, les renards des terriers et nous, les humains, des huttes, des tentes, des maisons… La tension archaïque qui précède la lutte entre bergers et agriculteurs se trouve au sein même de la faune, déchirée entre l’obligation de courir et celle d’habiter, de se déplacer le plus possible et de rester le plus possible. En tant que vivants, nous devons donc être à la fois nomades et sédentaires.
Y aura-t-il un jour la paix ?
On commence à voir des retournements de situation. Je ne crois pas que l’on puisse imaginer un monde sans agriculture, et toute l’écologie actuelle est un sauvetage de Caïn. Nous autres, errants féroces, oublions dangereusement que nous dépendons de Caïn le casanier pour boire et manger, c’est-à-dire survivre. Va-t-il se venger ? Je me souviens des disettes durant la dernière guerre. Les habitants des villes allaient crier famine dans les fermes voisines, priant le paysan de leur donner quelque grain pour subsister. Mon père et moi nous y rendions à bicyclette, pour échanger des heures de travail contre du lait, des œufs, un quart de cochon. J’ai vécu naguère le retournement à venir de cette tension fratricide entre Caïn et Abel. »
C’est beau, intelligent et déroutant comme du Michel Serres
<1257>
-
Mardi 25 juin 2019
« Il a bien fallu que quelqu’un, un jour, fasse le geste de mettre un grain en terre ! »Patricia Anderson & George Willcox, chercheurs au CNRS « L’Histoire » N°193 de novembre 1995Et il y eut la « Révolution du Néolithique », «le nouvel âge de la pierre». Ce lien conduit à un diaporama publié par l’académie de Grenoble pour une classe de CE2.
Le climat se réchauffe. L’homme découvre l’agriculture, puis l’élevage et se sédentarise.
Ceci se produit il y a 10 000 ans au Moyen-Orient, au sein du croissant fertile, entre 3 Fleuves : L’Euphrate, Le Tigre et le Nil. C’est-à-dire en Mésopotamie (pays entre les deux fleuves) et en Égypte.
 Wikipedia nous donne une carte de cette région, permettant de visualiser le « croissant fertile ».
Wikipedia nous donne une carte de cette région, permettant de visualiser le « croissant fertile ».
Donc l’homme invente l’agriculture et une population de plus en plus immense sur terre devient paysanne.
C’est la plus grande partie de l’Humanité pendant des millénaires.
Michel Serres définissait le XXème siècle comme celui de la sortie du « Néolithique » le pourcentage de paysans dans le monde passe sous la barre des 50%.
En France, <Ce site> nous apprend qu’en 1856, la proportion de la population active qui était agriculteur était de 51,4%, en 1906 ce taux était tombé à 43,2% représentant à peu près 9 000 000 de paysans.
<Ce rapport parlementaire de 2005> nous explique que la population active agricole, composée des travailleurs salariés et non-salariés ayant une activité principale agricole, compte 929 000 personnes en 2004, soit moins de 4 % de la population active totale, contre 13 % en 1970.
Dans le monde cependant, en 2012 l’agriculture employait encore plus de 1,3 milliards de personnes, soit près de 40 % de la population active mondiale. Dans une cinquantaine de pays, l’agriculture employait la moitié de la population, voire jusqu’à 75 % pour les plus pauvres.
Mais cette histoire de la naissance de l’agriculture est complexe et finalement, il y a assez peu de certitudes et beaucoup de questions non résolues.
Pourquoi ? Comment ?
Qu’est ce qui fut premier : l’élevage ou l’agriculture ? La sédentarisation ou l’agriculture ?
Toutes ces questions sont largement débattues, mais les réponses données sont diverses.
Par exemple Jacques Attali, dans la première émission (nous en sommes toujours à la première émission sur huit) de la série « De quoi manger est-il le nom ? » affirme que c’est l’élevage qui fut premier et que ce sont les éleveurs qui ont inventé l’agriculture.
Souvent on considère que le terme agriculture comprend à la fois la culture des sols et la culture des animaux dont le synonyme est l’élevage. C’est en effet l’acceptation générale.
Mais dans la rigueur des principes et des mots : « ager » signifie « champ » en latin, l’agriculture est donc en premier la culture des champs. Il peut donc être légitime de distinguer l’agriculture et l’élevage.
Mais de quoi est-on certain ?
Il y eut bien un terme au cycle des glaciations du début du Quaternaire à ce moment. La dernière a pour nom « la glaciation de Würm » (- 125 000 à – 11 430).
Dès lors, le climat va se réchauffer et permettre à une flore et une faune nouvelles (forêt tempérée peuplée d’aurochs, cerfs, chevreuils et sangliers) de remplacer les étendues herbeuses de climat froid et sec comme la steppe ou la toundra qui nourrissaient les rennes, rhinocéros laineux, bisons.
Les premières traces de culture de plantes et de domestication d’animaux à des fins alimentaires sont originaires du Moyen-Orient. Les premières traces de ville se trouvent sur le lieu actuel de Jéricho, ville actuel de Cisjordanie. A l’époque Néolithique elle était un port au bord d’une mer qui n’était pas encore morte.
C’est encore dans la revue l’Histoire : « De l’Euphrate à la Chine : les premiers agriculteurs » que j’ai trouvé les explications les plus complètes et les plus nuancées sur ce sujet.
Notamment que si l’Europe n’a rien inventé à ce stade et n’a pu entrer dans l’agriculture que parce que des « sachants » du Croissant fertile ont migré vers notre continent pour apporter la connaissance, l’agriculture a été inventée dans le monde à d’autres endroits sans apport de la science du moyen orient :
« Car c’est sur plusieurs continents à la fois, au cours de très lentes mutations qui ont duré parfois des millénaires, que l’homme a vu se modifier son rapport à la nature. Cette nouvelle approche du phénomène est aujourd’hui au cœur des travaux des préhistoriens.
Ces sites des rives de l’Euphrate, des Andes ou de la Chine n’ont rien de spectaculaire : on y voit des fosses, des trous de poteaux… Il y traîne des pierres taillées et des déchets de taille, souvent des pilons et des mortiers, des os d’animaux. Des fragments de végétaux carbonisés sont parfois restés au fond des fosses. Loin de ce qu’on appelle les « splendeurs des grandes civilisations », ce sont de simples villages paysans. Mais dont les plus anciens témoignent du plus grand changement que les sociétés humaines n’aient jamais connu avant la révolution industrielle : la naissance de l’agriculture.
En effet, voici une humanité qui, durant deux à trois millions d’années – depuis qu’elle existe -, a toujours vécu en ramassant, cueillant, chassant ou péchant. Et un beau jour, la voilà qui change son mode de vie : sa nourriture, au lieu de la prélever, elle se met à la produire. C’est au cours des mêmes millénaires, entre 10 000 et 7 000 ans av. J.-C, qu’apparaissent en plusieurs régions du monde l’agriculture, l’élevage et les premiers villages sédentaires. Les hommes cultivent des champs et élèvent des troupeaux. Leur attitude à l’égard de la nature et du territoire se modifie radicalement. Dans les temps qui suivent, la population se multiplie par cent et l’histoire commence à se faire turbulente. Villes, temples, rois et guerres se devinent à l’horizon de la Mésopotamie, de l’Égypte, de la Chine. En se mettant à changer le monde, l’humanité a aussi changé de monde.»
On trouve sur Wikipédia cette carte qui montre l’apparition de l’agriculture dans différentes régions du monde. Dans un temps court au regard de l’échelle préhistorique.
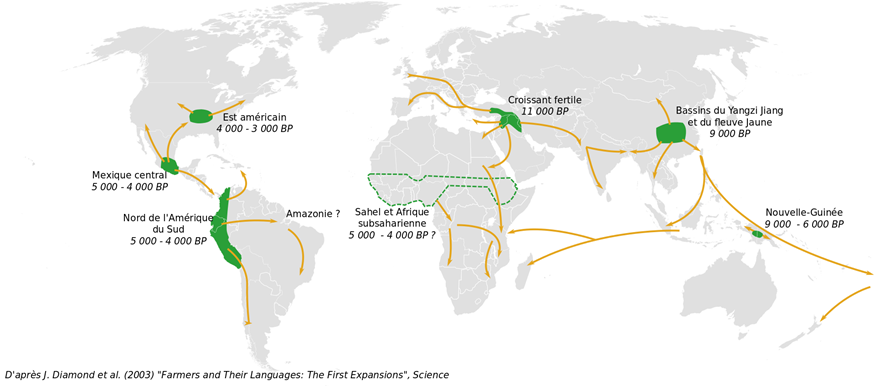
Beaucoup de théories se succèdent en se contredisant. La concomitance de l’invention de l’agriculture, de la sortie du modèle chasseur-cueilleur et de la sédentarisation n’apparait plus comme une évidence.
Il semble selon cet article que depuis cinquante ans, une multitude de découvertes et de travaux a remis en cause l’idée d’une évolution linéaire, valable pour l’humanité entière. En effet, dans les diverses régions du monde où l’agriculture est apparue, on voit que cultures, élevage, sédentarisation et invention de la poterie s’enchaînent dans un ordre différent :
« Les villages ? Loin d’avoir été un résultat de l’agriculture, ils paraissent bien l’avoir précédée dans certaines régions. [sur] le site de Mallaha […] les habitants de ce village, sédentaires, vivaient en chasseurs-pêcheurs-collecteurs dans la meilleure tradition paléolithique. Ils disposaient d’un environnement assez riche en ressources diverses pour n’avoir pas à se déplacer, et péchaient beaucoup. Ces villages sans agriculture sont un des caractères essentiels de la civilisation appelée « natoufienne » qui s’est étendue au Proche-Orient, du Neguev à l’Euphrate entre 12 500 et 10 000 ans av. J.-C, avant les premières civilisations agricoles.
Les villages non agricoles ont été nombreux en Amérique aussi. Il y en avait dans la vallée de Mexico vers 7000 av. J.-C, dans un environnement de forêts et de lacs. Il a existé de vrais villages préhistoriques de pêcheurs le long des côtes du Pacifique depuis les États-Unis jusqu’au Chili.
A l’inverse, dans certaines régions, la sédentarisation n’a eu lieu que plusieurs milliers d’années après l’apparition des premières cultures. Au sud du Mexique, dans la vallée de Tehuacan, on a découvert au début des années 1960 que les premières cultures avaient précédé de quatre mille ans les premières communautés sédentaires. De même, dans les régions andines, les premières domestications, aussi bien d’animaux que de plantes, ont été le fait de groupes nomades ou semi nomades – et qui le sont restés longtemps. »
Les hommes du néolithique n’ont donc pas fait une « grande découverte » qui en aurait entraîné d’autres, mais plusieurs, en ordre dispersé.
Et l’article de conclure :
« Les recherches montrent donc que cette fameuse invention n’en a pas été une. Bien des sociétés paraissent s’être glissées dans le monde de la production sans en avoir eu conscience. »
Un encart de cet article m’a donné l’occasion de trouver l’exergue de ce mot du jour :
« La tracéologue Patricia Anderson et le paléobotaniste George Willcox se sont lancés depuis 1985 dans l’étrange expérience de cultiver du blé et de l’orge sauvages à la commanderie de Jalès, en Ardèche (base de l’Unité propre de recherche 7537 du CNRS). Tous les étés, ils récoltent (à la faucille de silex), tous les automnes (ou au printemps) ils sèment ; et prennent des notes. Ils ont ainsi pu voir que les grains récoltés verts avaient déjà leur pouvoir germinateur et qu’on pouvait les semer. Ils envisagent donc une période de culture de céréales sauvages antérieure à la transformation de ces plantes et qui a dû être longue : la sélection des épis qui conservaient leurs grains à maturité a pu se faire par la suite sans que les hommes le veuillent, au fil des siècles.
Mais une énigme demeure : l’action de semer suppose une décision et représente une rupture, la rupture… Même si les ramasseurs ou ramasseuses laissaient tomber quelques épis en chemin et si les premières ébauches de champs ont, elles aussi, été involontaires, il a bien fallu que quelqu’un, un jour, fasse le geste de mettre un grain en terre ! »
Mais <la révolution néolithique> implique d’autres transformations que simplement semer des graines. Au cours des millénaires suivants, elle transforme les petits groupes chasseurs-cueilleurs mobiles en sociétés sédentarisées qui modifient radicalement leur environnement au moyen de techniques agricoles de plus en plus sophistiquées.
Cette révolution va bien sûr avoir des conséquences essentielles sur l’alimentation, mais aussi sur l’organisation sociale et politiques des humains, sur la culture et le sacré !
Elle favorise le développement de grandes densités de population, d’une division du travail complexe, des économies de production puis de commerce, de structures administratives et politiques centralisées.
On inventera l’écriture pour compter la production puis pour écrire des livres sacrés.
Plus tard, l’effet fortement multiplicateur de l’irrigation sur le rendement a favorisé le développement d’une population nombreuse dans les vallées des grands fleuves, tandis qu’une forte densité de population était nécessaire à l’entretien et à l’extension des digues et canaux. Les premières grandes civilisations sont apparues le long de ces fleuves : le Nil, le Tigre, l’Euphrate, l’Indus et le fleuve Jaune.
On créera des empires, des hiérarchies, des guerriers des prêtres et des paysans asservis aux premiers.
Les premières plantes qui furent plantées étaient des céréales : le blé amidonnier (ancêtre du blé), le petit épeautre, l’orge, la lentille, le pois chiche, un peu plus tard les carottes et des salsifis
Le Moyen-Orient fut aussi la source de nombreux animaux domesticables tels que les chèvres et les cochons. Cette région fut également la première à domestiquer les dromadaires.
Au cours des millénaires, l’agriculture sélectionnera et hybridera les plantes les plus productives et transformera totalement notre alimentation.
<1256>
-
Lundi 24 juin 2019
« Le régime alimentaire des humains d’aujourd’hui est beaucoup plus restreint que celui des premiers chasseurs-cueilleurs »Naama Goren-Inbar archéologue et paléoanthropologue israélienneL’espèce humaine est omnivore dès la préhistoire. Il lui arrive d’être cannibale.
La Préhistoire se divise en deux grandes parties, le Paléolithique (l’âge de la pierre taillée) et le Néolithique (l’âge de la pierre polie), qui se divisent elles-mêmes en différentes sous-périodes. La phase de transition entre ces deux grandes périodes est appelée le Mésolithique.
Lithique vient du grec ancien, lithikós (« de pierre, pierreux ») ou de lithos (« pierre »).
Le Paléolithique commence, dès lors, avec l’apparition des premiers outils lithiques, il y a 3,3 millions d’années en Afrique. Il s’achève il y a 11 700 ans avec la fin de la dernière période glaciaire, qui ouvre la voie au Mésolithique, d’abord au Proche-Orient, puis en Europe et dans le reste du monde. Le Paléolithique couvre donc environ 98 % de la durée de la Préhistoire, qui s’achève, selon nos conventions, avec l’apparition de l’écriture vers 3 300 ans av. J.-C. L’écriture ouvrant l’ère de l’Histoire.
Pendant la période Paléolithique et la période Mésolithique, les humains sont tous des chasseurs-cueilleurs ! C’est ainsi qu’ils accèdent à leur nourriture.
Les hommes de ces périodes sont la plupart du temps des nomades, se déplaçant au gré des saisons en fonction des ressources alimentaires disponibles, qu’elles soient végétales ou animales.
La densité de la population est très faible, Wikipedia donne une densité inférieure à 0,01 habitant/km², contre 50 habitants/km² sur la planète aujourd’hui, un rapport de 1 à plus de 5000.
C’est bien sûr le néolithique qui a sédentarisé une majorité de la population humaine. Mais il existait déjà des structures pérennes avant cette période. Göbekli Tepe est un site préhistorique du Mésolithique, situé au sud-est de l’Anatolie, en Turquie
C’est encore grâce à l’article de Wikipedia : <Chasseur-cueilleur> qu’on peut disposer d’une vision assez complète et aussi complexe de ce moment de l’histoire humaine pendant lequel les hommes prélèvent leur alimentation directement dans la nature par la chasse, la pêche et la cueillette.
Pourtant nous apprenons que :
« De très nombreuses découvertes, surtout depuis les années 2000, en particulier en alliant les disciplines archéologiques et anthropologiques, ont montré que les cultures de chasseurs-cueilleurs ont donné à l’humanité certaines inventions fondamentales qui étaient autrefois attribuées aux sociétés du Néolithique. Parmi ces innovations : la pierre polie et la céramique, la domestication du chien et la sélection de certaines espèces végétales, certaines formes d’agriculture comme la sylviculture. […]
Il apparait aujourd’hui qu’en général les chasseurs-cueilleurs anciens se sont adaptés à leur environnement naturel très riche en faune et en flore, dans lequel ils ne prélevaient que ce dont ils avaient besoin. Ils ne furent donc pas contraints de modifier grandement cet environnement, au contraire des cultures basée sur l’agriculture et l’élevage dans laquelle les hommes cherchent à produire les ressources plutôt qu’à les prélever. »
Le chasseur-cueilleur est naturellement nomade lorsque les ressources naturelles viennent à manquer, mais il peut aussi se contenter de se déplacer un peu pour revenir au même endroit quelque temps plus tard.
Le chien, est le premier et longtemps l’unique animal domestique des chasseurs-cueilleurs paléolithiques. Il semble qu’un large consensus existe pour affirmer qu’il aide les hommes dans la chasse mais n’est pas mangé par l’homme.
Pour construire des abris les chasseurs-cueilleurs n’utilisent que des matériaux disponibles dans la nature. Nous savons qu’ils utilisaient des abris sous-roche pour se protéger des prédateurs et aussi des intempéries.
Mais Wikipedia nous apprend :
« On a découvert en Sibérie des structures habitables construites par des chasseurs-cueilleurs avec des ossements de mammouths, leur taille pouvant être de grandes dimensions. »
Mais dans le domaine précis de l’alimentation que peut-on dire ?
<Selon des chercheurs israéliens> nos ancêtres chasseurs-cueilleurs étaient omnivores mais consommaient plus de végétaux que de viandes :
« Lors de fouilles archéologiques réalisées sur le site de Gesher Benot Ya’aqov, situé au nord de la vallée du Jourdain, plusieurs traces d’herbes et fruits comestibles ont ainsi été retrouvées, explique le Jerusalem Post. Des restes botaniques datant d’il y a 750 000 ans constituent bien la preuve, d’après les chercheurs, qu’au sein des sociétés paléolithiques, les repas étaient beaucoup plus équilibrés qu’on ne le croit.
Le régime alimentaire des humains d’aujourd’hui est beaucoup plus restreint que celui des premiers chasseurs-cueilleurs », affirme Naama Goren-Inbar, qui a mené l’étude. Et pour cause : les recherches sont parvenues à identifier 55 espèces différentes de végétaux, parmi lesquelles figurent des fruits, noix, graines, feuilles, tiges, racines et tubercules. Sur toutes les espèces identifiées, dix ont disparu aujourd’hui.
[…] Nos ancêtres consommaient bien de la viande […] mais en faible quantité au regard de la diversité des plantes comestibles dont ils disposaient.
[…] L’importance de la viande dans le régime alimentaire préhistorique avait jusqu’alors été surestimée par les archéologues, pour la simple et bonne raison que les squelettes d’animaux sont mieux préservés que n’importe quel reste de plante. À l’intérieur du site de Gesher Benot Ya’aqov, les restes botaniques ont ainsi pu être conservés pendant des centaines de milliers d’années grâce à un environnement particulièrement humide.
« Il est peu vraisemblable que les hommes de l’époque aient pu survivre en suivant un menu végétarien strict, mais seule une petite portion de protéines et de graisses animales étaient nécessaires pour compléter leur régime majoritairement composé de plantes », affirme Amanda Henry au New Scientist.
Et puis sur un autre plan, celui de la division sexuelle du travail ; il semble que cette organisation simple qu’on nous présentait : l’homme chasse, la femme cueille soit beaucoup trop simpliste.
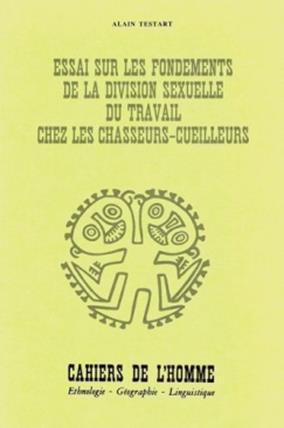 C’est Alain Testart, anthropologue et ethnologue français qui par ses recherches infirme cette division binaire.
C’est Alain Testart, anthropologue et ethnologue français qui par ses recherches infirme cette division binaire.
Alain Testart : Essai sur les fondements de la division sexuelle du travail chez les chasseurs-cueilleurs, coll. « Cahiers de l’Homme », Paris, École des hautes études en Sciences sociales, 1986.
Un article de la revue « L’Histoire » : < Hommes ou femmes : qui sont les chasseurs de la préhistoire ?> relate les conclusions des études d’Alain Testart :
« On ne peut donc prétendre que les femmes ne chassent pas parce qu’elles en sont incapables. Il est vrai, cependant, que là où les femmes chassent, elles le font différemment des hommes : ceux-ci forcent le gros gibier à l’aide de lances, de harpons, de flèches et de couteaux ; celles-là traquent le petit gibier avec des bâtons à fouir, des massues, des pierres, et en utilisant le feu ou les chiens.
Selon l’auteur, les grossesses et les soins donnés aux enfants n’entravent que passagèrement la mobilité des femmes. Si, dans la majorité des sociétés de chasseurs-cueilleurs, l’enfant est sevré très tard – vers trois ou quatre ans – et accompagne sa mère jusqu’à la naissance suivante, c’est en raison d’un choix culturel, non de contraintes naturelles. Car rien n’empêcherait de sevrer les enfants plus tôt ou d’organiser des tours de garde.
[…] Quand l’importance économique de la chasse et celle de la cueillette s’équilibrent, les deux sexes ont des activités très distinctes. Quand la chasse est plus importante, les femmes participent à certaines formes de chasse car c’est alors une activité vitale. C’est aussi le cas lorsque le gibier est rare, […]
Curieusement, la division sexuelle du travail s’applique aussi à toutes les activités économiques, à commencer par la cueillette. Les hommes y participent et certaines tâches, telles que grimper dans les arbres et les abattre avec un instrument tranchant, leur reviennent toujours. Cette même division régit aussi l’usage des techniques de fabrication : les hommes fabriquent leurs armes et souvent aussi les ustensiles féminins : bâtons à fouir et récipients.[…]
L’essai d’Alain Testart dissuade définitivement le lecteur d’envisager la division sexuelle du travail comme un phénomène uniforme et immuable qu’une simple raison d’ordre physiologique suffirait à expliquer. »
En conclusion :
- Les chasseurs cueilleurs mangeaient de manière plus variées que nous ;
- Les rôles hommes femmes n’étaient pas aussi caricaturaux qu’on nous l’avait enseigné.
<1255>
- Les chasseurs cueilleurs mangeaient de manière plus variées que nous ;
-
Jeudi 20 juin 2019
« Pause (Le prana) »Un jour sans mot du jourJ’interromps donc la série sur l’alimentation, pendant ce week-end prolongé.
 Après mon premier mot du jour de la série, Florence m’a envoyé un lien vers une vidéo, en me disant que c’était pour ajouter encore du trouble à mes doutes.
Après mon premier mot du jour de la série, Florence m’a envoyé un lien vers une vidéo, en me disant que c’était pour ajouter encore du trouble à mes doutes.
J’ai affirmé que pour un être vivant, l’essentiel est de s’alimenter, car s’il n’avale pas de nourriture et ne boit pas, il meurt.
Il semblerait qu’il existe des gens qui prétendent qu’on peut vivre sans manger.
Ce serait un courant issu du hindouisme et du yoga.
Le mot utilisé est le « prana »
Prāṇa est un terme sanskrit. La signification de ce nom intègre simultanément les notions de souffle et de principe vital du souffle et de sa manifestation organique dans la respiration.
Ces gens prétendent devenir « pranique ».
C’est-à-dire qu’ils sont en capacité de vivre sans manger et sans boire ou avec très peu de solide et de liquide.
Une de ces vidéos se trouve derrière ce lien : <Se nourrir de prana>
Dans ce film vous verrez un homme qui s’appelle Gabriel Lesquoy qui affirme que depuis 2012, il ne se nourrirait plus qu’avec de la lumière. Il concède manger de temps à autre un morceau de chocolat.
<Il y a aussi cet extrait d’un documentaire du nom de Lumière>
Et puis une interview d’un homme du nom de « Henri Monfort » qui dit ne plus se nourrir d’aliment solide depuis 2002 et qui parle d’une période de transition de 21 jours nécessaires pour entrer dans une sorte d’état pranique.
Je n’ai pas approfondi ce sujet, mais j’ai constaté qu’il y avait de nombreuses vidéos et sites qui tournaient autour de ce discours de la possibilité de vivre sans manger et aussi sans boire.
Le pranisme a aussi pour nom L’inédie ou le respirianisme.
Cette <page Wikipedia> essaye de faire le point sur ces prétentions et donne une liste de cas qui seraient rattachés à cette possibilité de vivre sans apport de nutrition solide.
On y lit que :
« Les connaissances actuelles de la physiologie humaine, en particulier du métabolisme basal ne permettent pas de la considérer comme plausible. »
Il est avéré que des personnes qui se sont soumises à ces pratiques sont mortes. Les « gourous » de ces méthodes ont alors affirmé que ces personnes décédées n’avaient pas suivi les préconisations qui avaient été énoncées.
Pour l’instant, aucune expérience scientifique sérieuse et encadrée n’a pu valider la véracité de ces pratiques.
-
Mercredi 19 juin 2019
«On ne mange pas son prochain comme cela, qu’on soit néandertalien ou sapiens.»Pascal Picq « Le sens des choses » première émission (16:30)Donc les hommes mangent de la viande depuis des centaines de milliers d’année. De manière différenciée selon la région de la planète qu’ils occupent, le climat et la présence plus ou moins importante de végétaux capable de les nourrir.
Les esprits taquins diront, mais il y a des civilisations qui sont végétariennes !
Certes, mais selon les recherches récentes le végétarisme est apparu entre -600 et -500 avant notre ère, dans la vallée de l’Indus, au sein de la culture hindoue et du développement du jaïnisme qui est une religion (source : Histoires de l’Alimentation de Jacques Attali page 46). Car il a fallu le récit, le sacré et le développement des mythes pour renoncer à manger de la viande. Mais nous y reviendrons certainement. Constatons cependant que c’est très récent dans l’échelle de l’histoire humaine.
Mais s’ils mangent de la viande, l’idée qu’ils peuvent manger leurs congénères qui constituent « de la viande de proximité » peut être crédible.
Il pourrait même être questionné si le cannibalisme était très largement développé chez les premiers hommes.
Mais, il faut au préalable rappeler quelques définitions
« Le cannibalisme » est un terme générique qui n’est pas réservé aux humains. En fait, le cannibalisme est une pratique qui consiste à consommer un individu de sa propre espèce et s’applique à tous les animaux. Un « être humain cannibale » est plus précisément « un anthropophage ».
L’anthropophagie (du grec anthrôpos, « être humain », et phagía qui se rapporte à l’action de « consommer ») est donc la pratique du cannibalisme qui concerne exclusivement l’espèce humaine.
Il n’y a aucun doute que l’anthropophagie existait chez les premiers hommes, l’importance du phénomène n’est pas connue avec certitude.
Dans l’émission que j’ai citée hier Pascal Picq dit :
« Pour les ancêtres des Néandertaliens qu’on appelle par commodité les pré-Néandertaliens, notamment sur des sites d’Espagne où il y a beaucoup de découvertes, vers 600 000 à 400 000 ans il y avait une stratégie de cannibalisme qui était quand même assez importante. On n’aime pas trop en parler, il y a des tabous autour du cannibalisme alors on se dit que c’était du cannibalisme rituel ou occasionnel ou de disette. Il semble quand même qu’il y avait une stratégie assez poussée comme on en connaîtra chez les amérindiens à d’autres époques, ce qui avait beaucoup scandalisé les espagnols lors de la conquête des Amériques.
Le nombre d’os qui ont été grattés, passes au silex et aux feux est absolument considérable. »
 Il semble que le site le plus ancien actuellement connu est Atapuerca, en Espagne près de Burgos, vieux de 800 000 ans. On a trouvé en 1994, 11 ossements humains (enfants, femmes, hommes) avec des marques de décapitation, des stries de boucherie et des fractures anthropiques (notamment sur des os à moelle) opérées par des outils en pierre, le tout mêlé à des restes d’animaux (bisons, cerfs, moutons sauvages).
Il semble que le site le plus ancien actuellement connu est Atapuerca, en Espagne près de Burgos, vieux de 800 000 ans. On a trouvé en 1994, 11 ossements humains (enfants, femmes, hommes) avec des marques de décapitation, des stries de boucherie et des fractures anthropiques (notamment sur des os à moelle) opérées par des outils en pierre, le tout mêlé à des restes d’animaux (bisons, cerfs, moutons sauvages).Ce <site> donne la parole à la préhistorienne Marylène Patou-Mathis :
« L’origine de ces pratiques semble (…) très ancienne. En effet, les ossements humains les plus anciens que nous connaissions en Europe, trouvés dans le site de la Gran Dolina d’Atapuerca, au nord de l’Espagne, et datés de 800 000 ans, étaient mêlés à des restes d’animaux et portent des marques de décapitation, des stries de » boucherie » et des fractures résultant d’une action humaine (notamment sur des os à moelle). Femmes, hommes et enfants auraient été consommés »
<Il y a aussi cet article du Figaro>
Pascal Picq donne raison à Jacques Attali lorsque ce dernier dit sa conviction, plus par intuition que par science, que le cannibalisme est structurant, dans la condition humaine, parce que manger l’autre, c’est manger le mal pour en recevoir la force
Et Pascal Picq d’ajouter :
« C’est peut être le cas que nous avons, en Ardèche, au Baume Moula ou on a trouvé des restes d’ossements humains néandertaliens qui portent des marques de traitement de boucheries. [Grâce à d’autres prélèvements sur les os] on est certain qu’il y a eu consommation de viande humaine »
Située face au Rhône, la grotte de Baume Moula-Guercy se trouve sur la commune de Soyons, un peu au sud de Valence. <Cet article> nous apprend qu’il y a près de 120 000 ans, un clan néandertalien établi dans la grotte de la Baume Moula-Guercy, en Ardèche aurait pratiqué l’anthropophagie en raison … du réchauffement climatique.
Il existe aussi le site de la Caune de l’Arago en France sur la commune de Tautavel, dans les Pyrénées-Orientales, et qui a donné naissance à « l’homme de Tautavel ». Cet article de la Dépêche de Toulouse évoque du « Cannibalisme rituel ».
Le cannibalisme avait donc de multiples causes, la disette, certains évoque aussi la volonté de terroriser un ennemi ou encore la consommation de facilité : il était plus facile de tuer un homme que grand nombre d’animaux.
Mais il semblerait que l’aspect rituel était très important dans ces pratiques.
Et Pascal Picq prétend que :
« Il y a encore beaucoup de rituels, même aujourd’hui, dans lesquels les cendres des morts ou même les parties des morts sont intégrés dans des plats de façon que l’on réintègre leur âme leur force ou certains aspects de leur spiritualité. »
J’ai voulu en savoir un peu plus et j’ai trouvé des chasseurs cueilleurs qui au XXème siècle vivaient dans les forêts tropicales de l’est du Paraguay : les Guayaki.
Guayaki signifie « rats féroces » mais ce sont leurs voisins et rivaux qui les appelaient ainsi, eux-mêmes s’appelaient « Aché » « vraies personnes » dans leur langue.
Il semble donc qu’avant 1960, il restait un groupe de Guayaki qui consommait tous leurs morts. Wikipedia nous apprend
« Les morts étaient mangés, quelle que soit la cause du décès. Si le décès avait lieu trop tard dans la journée ou bien la nuit, le cadavre était couvert de fougères, car il était interdit de manger la plupart des viandes à la nuit tombante. Ce n’est donc que le lendemain que le corps était découpé, avant d’être rôti sur un gril […]. Tous les membres du groupe participaient au repas sauf le père, la mère et le conjoint principal de la victime. Les fils et les filles du défunt pouvaient ou non être amenés à manger leur géniteur. Si le mort avait été victime d’un autre membre du groupe, celui-ci était exclu du repas ainsi que son père et sa mère. La pratique renvoie à celle de la chasse et au fait que le chasseur ne peut consommer le gibier qu’il a lui-même tué. Le repas suivait les règles qui gouvernent la consommation de gibier : ne pas rire, ne pas manger couché ou lorsque la nuit est tombée. Mais une fois la viande humaine consommée, les os du cadavre étaient brisés, sucés, puis jetés dans le feu ; le crâne était pilé et ses morceaux brûlés, la fumée emportant alors l’âme vers le ciel. La crémation des os répondait en fait à une double exigence : permettre la montée d’Owé — l’âme céleste, bénéfique — vers le ciel, et écarter Ianwé — l’âme tellurique, associée à tous les esprits mauvais et redoutée par les Aché.»
Vous pourrez en savoir davantage sur Wikipedia et plus encore dans cet article d’une ethnologue spécialiste des Guayaki : Hélène Castres « Rites funéraires Guayaki »
Finalement, l’anthropophagie reste quand même un tabou, quelque chose que les hommes ne faisaient pas naturellement, il fallait un motif, un rite.
Et Pascal Picq dit cette phrase que j’utilise comme exergue pour résumer ce mot du jour :
« On ne mange pas son prochain comme cela, qu’on soit néandertalien ou sapiens »
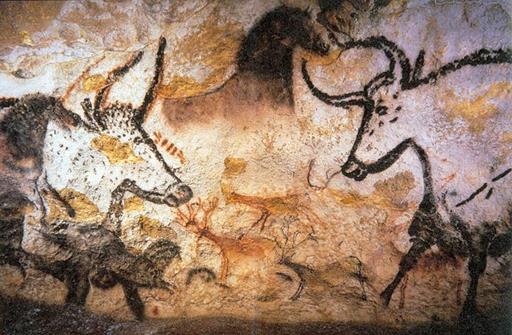 A partir de l’Art préhistorique, il révèle aussi un fait qui me parait étrange et surprenant :
A partir de l’Art préhistorique, il révèle aussi un fait qui me parait étrange et surprenant :« A Lascaux sont représentés des aurochs, des cerfs, des chevaux, des bouquetins quelques prédateurs et on a pensé pendant longtemps que c’était des fresques, des représentations qui pouvaient avec quelques cultes rendre la chasse plus propice. Que Nenni ! En fait on s’aperçoit qu’ils mangeaient du renne. On peut imaginer qu’il existe une différence, comme l’exprime l’art préhistorique à Lascaux et ailleurs entre les espèces qu’on représente qui sont des espèces symboliques qui relient à leur cosmogonie, à leur conception de la création du monde et de ce que doit être le monde, dans les mondes imaginaires et le monde de l’au-delà et ils ne mangeaient pas les mêmes animaux que ceux représentés. »
Pascal Picq nous dit donc que les animaux que les hommes préhistoriques mangeaient n’étaient pas ceux qu’ils représentaient dans les grottes.
Pour revenir au cannibalisme humain
Wikipedia nous rapporte, que dans les terribles monstruosités auxquels le XXe siècle a donné naissance, il y eut une résurgence d’anthropophagie de masse pour des raisons de disette : pendant la famine soviétique de 1921-1922 et durant le siège de Leningrad. Et aussi en Chine :
« Selon l’universitaire chinois Yang Jisheng, Mao Zedong engage de 1958 au début 1960, le Grand Bond en avant qui « provoque un gigantesque désastre économique ». Pour approvisionner les villes, mais aussi pour briser la résistance paysanne comme en URSS sous le régime de Staline, « les paysans sont affamés ». Yang Jisheng indique que le nombre de personnes ayant perdu la vie de façon « anormale » pour l’ensemble de la Chine est de 36 millions et que des cas de cannibalisme sont alors constatés dans l’ensemble du territoire chinois. »
Je redonne le lien vers l’émission du « Sens des choses : de quoi manger est-il le nom » : Le sens religieux de la nourriture : cannibalisme et interdits religieux.
<1254>
Nous allons prendre avec Annie un week-end prolongé. Le prochain mot du jour sera publié le 24 juin 2019
-
Mardi 18 juin 2019
«L’homme est omnivore comme ses cousins singes, mais il est seul à cuire les aliments et c’est une différence fondamentale »Connaissance apportée par la paléoanthropologieLe premier invité de la première émission du « sens des choses » évoquée hier était le paléoanthropologue Pascal Picq, auteur notamment de « Le nouvel âge de l’Humanité » mais il avait fait l’objet <du mot du jour du 3 octobre 2017> pour un autre livre : « Qui va prendre le pouvoir ?: Les Grands singes, les hommes politiques ou les robots ? »
Cette première émission avait pour titre : Le sens religieux de la nourriture : cannibalisme et interdits religieux.
Pascal Picq remonte aux premiers représentants des hommes sur terre pour expliciter leur alimentation:
« Si on compare avec l’espèce qui est la plus proche de nous qui sont les chimpanzés, les hommes ont le même régime alimentaire. C’est-à-dire, un régime omnivore essentiellement composé de fruits, de feuille tendre, d’insectes et aussi de viande. Il y a quelques espèces de singe qui mange de la viande. Ce sont les babouins, les macaques, les singes capucins, surtout les chimpanzés et bien sûr les hommes. »
Il insiste que la viande n’est pas pour les singes et les hommes un aliment comme les autres. :
« Les premiers hommes au sens strict sont les homo-erectus. Ils apparaissent en Afrique il y a 2 millions d’années. Eux aussi consomment de la viande, mais pour eux comme pour les chimpanzés d’ailleurs, la viande n’est pas un aliment banal. Les chimpanzés mangent des aliments végétaux, et voient passer une antilope qu’ils attrapent et là cela devient un acte social extrêmement important. Car la viande est la seule nourriture qui arrive de façon discrète ».
Pour celles et ceux qui sont adeptes des mathématiques, « façon discrète » fait penser à « fonction discrète » ou « variable discrète » et permet d’en comprendre le sens.
Pour les autres, Pascal Picq veut dire que la chasse fructueuse de l’antilope conduit à une rupture du rythme d’alimentation des chimpanzés parce que ce fait amène une grande masse d’aliments en une seule fois et que la communauté des chimpanzés, comme les premiers hommes va s’organiser pour partager et profiter de cet apport nutritionnel important.
C’est la même chose pour les hommes mais ce qui va changer fondamentalement, c’est l’arrivée de la cuisson. On estime désormais selon Pascal Picq, que la cuisson est apparue il y a 2 millions d’année.
Et selon, Pascal Picq, la cuisson n’est pas essentielle pour la viande. Car la viande crue se digère très bien. La cuisson de la viande permet d’enlever des toxines, de l’attendrir, il y a des réactions chimiques et cela donne un autre goût.
« Mais la cuisson est surtout très important pour la prédigestion des aliments végétaux, les tubercules, les racines, les bulbes ou autres, ce sont des nourritures de bonne qualité nutritives mais qui nécessite une cuisson qui va favoriser la digestion.
A partir de ce moment, les premiers hommes vont inventer la co-évolution. [Ce que Pascal Picq décrit comme innover et s’adapter avec les autres] Dès cette époque, il y a deux millions d’années les inventions culturelles et techniques vont considérablement modifier leur morphologie, leur biologie et même leur capacité cognitive. »
L’affirmation de Pascal Picq sur l’apparition de la cuisson il y a deux millions d’années est un peu contestée. Peut-être que les hommes connaissaient le feu et pouvaient se servir de lui quand ils pouvaient le récupérer de manière naturelle.
Mais la domestication du feu est généralement datée d’environ 500 000 ans et ce n’est donc que depuis 500 000 ans que la cuisson des aliments a pu se généraliser dans le monde des hommes.
D’ailleurs, Jacques Attali reprend cette thèse dans son livre « Histoires de l’alimentation » qu’il a écrit suite à ces émissions du sens des choses ;
« Il semble que ce soit en Chine, vers -550.000 qu’apparaît la domestication du feu. A Zhoukoudian, juste à côté de Pékin, ont été découverts des restes de foyer d’un feu allumé par celui qu’on nomme « l’homme de Pékin » un homo erectus datant de 450 000 ans.
La domestication du feu constitue un immense bouleversement : les aliments deviennent plus facilement assimilables, ce qui permet d’augmenter encore la quantité d’énergie disponible pour le cerveau et de rendre comestibles des végétaux jusque-là toxiques.
Cela permet également de résider dans des zones au climat plus froid, de se nourrir d’une cuisine plus élaborée et d’éliminer germes et bactéries » (Page 23)
Dans l’article « la domestication du feu » de Wikipedia, on nous explique
« La cuisson de la viande mais surtout des légumes-racines tubéreuses agit comme une forme de « pré-digestion », permettant de consacrer moins d’énergie à la digestion de la viande, des tubercules, ou de protéines telles que le collagène. Le tube digestif a diminué, ce qui a permis d’octroyer plus d’énergie au cerveau humain15. Ainsi, par comparaison, si l’homme moderne mangeait seulement des aliments crus et des produits alimentaires non transformés, il aurait besoin de manger 9,3 heures par jour afin d’alimenter son cerveau. Un régime essentiellement crudivore entraine à long terme de graves carences nutritionnelles (baisse de l’indice de masse corporelle, aménorrhée chez les femmes).
Comme des neuroscientifiques l’ont montré, le nombre de neurones est directement corrélé à la quantité d’énergie (ou de calories) nécessaire pour alimenter le cerveau. La cuisson des aliments a donc permis de faire sauter un verrou physiologique et métabolique, fournissant plus d’énergie au cerveau qui aujourd’hui ne représente que 2 % de la masse corporelle des hommes modernes mais consomme 20 % de l’énergie basale nécessaire au corps humain. »
Notre cerveau est donc un grand consommateur d’énergie.
Les centaines de milliers d’années vont se passer, les hommes vont bouger, plusieurs espèces d’homo vont cohabiter et se répandre sur la terre :
« Il y a une règle générale pour l’alimentation, quand vous allez des tropiques vers les hautes latitudes, [c’est-à-dire vers le pôle] la part de l’alimentation carnée augmente. […]
Dans les grandes tendances, quand vous êtes près de l’équateur c’est 2/3 de ressources végétales et 1/3 de ressources animales. Quand vous monter vers les hautes latitudes la part des ressources animales augmente pour finalement devenir presque exclusive. ».
Et Pascal Picq émet une hypothèse concernant l’éviction de l’homme de Neandertal par homo sapiens par la nourriture.
En effet, l’homme de Neandertal n’était pas, a priori, moins bien adapté que homo sapiens pour se développer : Il disposait d’un cerveau plus gros que celui de sapiens, comme lui il réalisait des rites funéraires pour ces congénères morts, il avait une science de la chasse des grands mammifères dont sapiens était dépourvu.
Pour Pascal Picq, l’homme de Neandertal qui vivait dans des parties plus froides de la terre, se nourrissait quasi exclusivement de viande. Nos ancêtres homo sapiens qui venait d’Afrique avaient une nourriture beaucoup plus diversifiée avec une prépondérance de végétaux. Ce mode d’alimentation rendait homo sapiens beaucoup moins fragile que l’homme de Neandertal qui finalement a disparu.
Il n’existe aujourd’hui aucun consensus concernant la raison de la fin de l’homme de Neandertal. Ce site qui décrit bien la problématique et les diverses hypothèses de la fin de l’homme de Neandertal, considère que l’explication de sa disparition par le seul facteur du mode d’alimentation est peu vraisemblable.
En conclusion :
- L’homme comme d’autres singes est omnivore ;
- Mais l’homme cuit ses aliments et cela a eu des conséquences essentielles dans l’évolution de l’espèce humaine ;
- Il consomme de la viande quand il en a l’occasion, mais la proportion de viande dans son alimentation dépend de l’absence de végétaux comestibles ;
- La consommation de viande a joué un rôle considérable dans la socialisation des repas et le partage autour des repas.
<1253>
- L’homme comme d’autres singes est omnivore ;
-
Lundi 17 juin 2019
« « Der Mensch ist, was er ißt
L’homme est ce qu’il mange » »Ludwig Andreas FeuerbachQu’est ce qui est essentiel pour un être vivant comme l’homme ?
C’est d’abord d’éviter d’être tué par un danger naturel, un accident, un prédateur.
Puis c’est de s’alimenter, car s’il n’avale pas de nourriture et ne boit pas, il meurt aussi.
Si on dépasse l’individu et on se situe au niveau de l’espèce, il faut en outre pour que l’espèce puisse perdurer, qu’il se reproduise.
Après cela, il y a des activités très importantes, l’habitat, le soin, la culture, le jeu, l’échange et toutes ces choses qui font que la vie est belle.
Mais en premier il faut éviter de mourir et « s’alimenter »
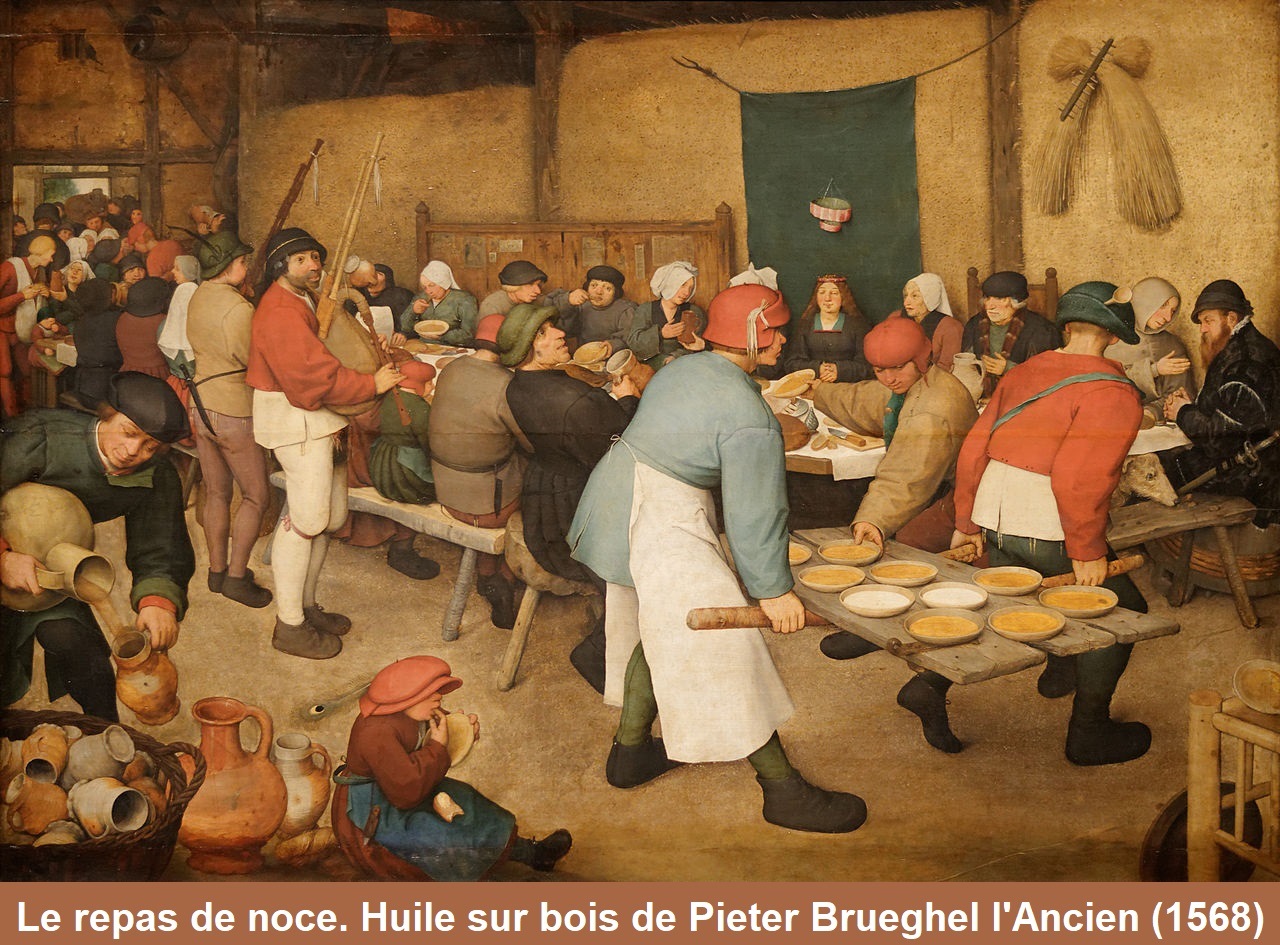
Lors de l’été 2017, France Culture a diffusé 8 émissions dans la série appelée « Le sens des choses » sur le thème de l’alimentation. Stéphanie Bonvicini et Jacques Attali, animaient ces émissions et invitaient, pour chacune d’entre elles, des personnes érudites pour évoquer une question particulière de cette thématique qu’ils ont synthétisée par cette question « De quoi manger est-il le nom ? ».
Depuis un livre est paru qui retrace ce parcours de réflexion : « Histoires de l’alimentation ». Notez qu« Histoire » porte un « s ».
J’avais écouté ces 8 émissions pendant mes vacances de 2017 et je les ai trouvées absolument passionnantes. Dès leur écoute, j’avais souhaité en faire une série de mots du jour. Mais chaque fois que j’ai voulu entreprendre cette tâche, je me suis découragé devant son ampleur, tant il est vrai que ces questions nécessitent approfondissement, compréhension, vérification.
Je ne me suis jamais senti prêt à attaquer cette série depuis 2017.
Je ne suis toujours pas prêt.
Mais depuis janvier 2019 et la découverte que le mal qui me rongeait avait franchi une nouvelle étape, le sujet de l’alimentation est devenu de plus en plus important pour moi.
Il ne manque pas d’ouvrages, de sites internet, d’émissions de radio et de télévision ou de chaine Youtube, d’articles de magazine qui donnent des centaines de conseils pour la meilleure alimentation pour combattre le cancer ou d’autres maladies ou simplement pour mieux vivre.
Le gros souci c’est que très fréquemment toutes ces sources se contredisent.
L’autre souci qui n’est pas moins important, c’est que si on creuse un peu, on constate que les affirmations péremptoires d’autorités auto-proclamées, comme celles que je dénonçais lors du mot du jour auquel j’ai renvoyé vendredi dernier, ne repose sur rien ou sur si peu de chose.
C’est assez décourageant.
Je vais pourtant commencer, en partant des émissions de 2017, à tenter une nouvelle itinérance, cette fois sur le sujet de l’alimentation d’homo-sapiens.
Je ne sais pas où cela va me mener. Je ne sais pas combien de temps cela durera.
Pour celles et ceux qui espèrent trouver des réponses dans ces mots du jour, je ne peux que reconnaître que cet espoir n’a aucune chance de prospérer.
Mais notre expérience nous l’a appris, pour progresser ce qui est fondamental ce n’est pas de trouver les réponses, mais c’est d’abord de poser les bonnes questions.
Je l’ai écrit vendredi, j’aurais aimé introduire cette série par la phrase d’Hippocrate : «Que votre aliment, soit votre médicament». Mais à la réflexion cette phrase focalise trop sur la santé. Or si le lien de causalité entre l’alimentation et la santé est évidemment très important, l’alimentation d’homo sapiens n’est pas seulement une question de santé de l’homme, mais aussi une question de la place de l’homme sur la terre, de biodiversité, de capacité pour la terre à fournir le désir de nourritures des humains, d’organisation sociale, de règles de vie en société et encore de beaucoup d’autres équilibres.
C’est pourquoi j’ai trouvé que cette phrase : « L’homme est ce qu’il mange » finalement plus pertinente pour commencer.
Cette phrase est souvent utilisée sur les sites évoqués en introduction de cet article. Et on trouve aussi un livre : « Vous êtes ce que vous mangez de Gillian McKeith ». Gilian McKeith a assuré une émission de télévision britannique sur la chaîne « Channel 4 » : « You Are What You Eat » et le livre semble reprendre, en partie, le contenu de cette émission.
Quand on lit la présentation de l’éditeur français, mes doutes sur le sérieux et la rigueur de ces gourous sont dans une position d’ «alerte rouge » :
« Le docteur Gillian McKeith, consacrée meilleure nutritionniste du Royaume-Uni et véritable star, a déjà transformé l’existence de milliers de déplorables mangeurs, grâce à son ouvrage et à son émission célèbre du même nom, You Are What You Eat, sur Channel 4.
Dans la clinique qu’elle dirige à Londres, elle reçoit notamment des sportifs de haut niveau, des membres de la famille royale britannique et des vedettes d’Hollywood. La presse anglaise se fait notamment l’écho de Madonna, Demi Moore, le chanteur Bryan MacFadden, l’actrice Charlize Theron ou encore Jennifer Aniston…
[…] Le docteur Gillian McKeith est une nutritionniste de renommée mondiale. Consacrée « Meilleure nutritionniste du Royaume-Uni » et « Gourou de la diététique » (Sunday Times), elle s’est récemment vu décerner une récompense prestigieuse, le prix « Uplifting The World ». »
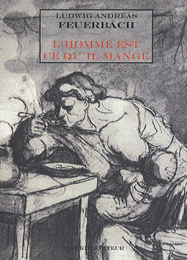 En toute hypothèse, cette expression n’est pas d’elle mais semble être de Feuerbach.
En toute hypothèse, cette expression n’est pas d’elle mais semble être de Feuerbach.
« L’homme est ce qu’il mange » est un ouvrage du philosophe allemand Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) connu comme un des inspirateurs de Karl Marx.
C’était un philosophe matérialiste, critique de la religion et du christianisme.
Selon ce que je comprends, Feuerbach ne s’intéressait pas à la santé dans cette phrase mais plutôt à la culture et à la personnalité de l’homme par rapport aux traditions et aux règles culinaires auxquelles il se rattache.
Il écrit :
« La nourriture de l’homme est la base de la culture et de l’état d’esprit de l’homme (…) L’homme est ce qu’il mange ».
Et il est vrai que l’alimentation est aussi une question de culture, de savoir-vivre, d’échanges, de communication.
Je vais donc entreprendre ce cheminement avec humilité, doute et soif de trouver les bonnes questions à poser.
<1252>
-
Vendredi 14 juin 2019
« Repos »Un jour sans mot du jourJ’avais l’intention après avoir publié la page de la série du football, puis celle de la grande guerre, de publier la série que j’avais consacrée à Michel Serres.
Le temps et l’énergie me manquent pour mener à bien ce dessein. Ce n’est que partie remise
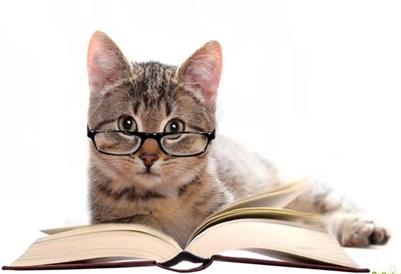
Il est de tradition désormais quand je suis dans cette situation, après avoir consulté le livre des mots du jour comme ce chat, de rappeler un mot du jour ancien.
Et aujourd’hui c’est assez simple.
J’aurais voulu utiliser lundi prochain pour exergue cette phrase d’Hippocrate :
«Que votre aliment, soit votre médicament»
Mais il faudra que j’en trouve un autre, parce que cette phrase je l’ai déjà utilisée pour le <mot du jour du 16 juin 2015>.
C’était pour avoir un regard critique sur les discours de deux éminents professeurs de médecine qui du haut de leur magistère assénaient des sentences sur l’alimentation, sur ce qu’il fallait manger et surtout ce qu’il ne fallait pas manger pour être en bonne santé.
Ils prétendaient qu’il s’agissait de vérités scientifiques, alors que ce n’était au mieux que des croyances.
Ils oubliaient d’être humbles et modestes.
Sur le fond ils avaient cependant raison, l’alimentation constitue un enjeu majeur pour homo sapiens et il est essentiel de bien manger.
<Mot du jour sans numéro>
-
Jeudi 13 juin 2019
« Retour sur la grande guerre »Publication de la page consacrée à la sérieA partir du 9 novembre, j’entrepris ce qui est pour l’instant la plus longue série de mots du jour sur un thème : 16 articles.
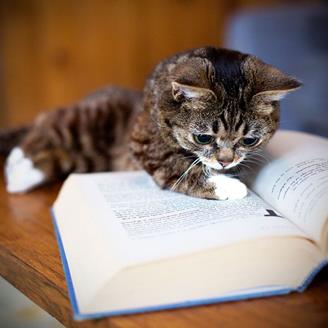 Le centième anniversaire de l’armistice fut pour moi l’occasion de réinterroger ce que je savais sur ce sujet d’Histoire et comme toujours apprendre beaucoup.
Le centième anniversaire de l’armistice fut pour moi l’occasion de réinterroger ce que je savais sur ce sujet d’Histoire et comme toujours apprendre beaucoup.Pendant nos cours d’Histoire, on nous a beaucoup parlé des batailles, de la guerre des tranchées, des taxis de la marne, du courage des soldats et aussi des monuments aux morts qui s’érigèrent sur toutes les places des villages de France.
Mais je ne me souviens pas qu’on nous ait parlé de :
- l’existence du camp de concentration de Crest et d’autres camps pendant la première guerre mondiale ;
- l’existence de la commission King Crane sur le moyen Orient
- L’invention par le norvégien Fridtjof Nansen du « passeport » pour les apatrides qui porte son nom : « passeport Nansen »
-
Du souhait du japonais Saionji Kinmochi:d’inscrire l’ égalité des races dans la charte du SDN et le refus des européens de le faire
Et je découvris l’extraordinaire, bouleversant poème de René Beziau, brancardier à Verdun, oncle de notre amie Marianne :
Quel est ce pauvre inconnu?
O toi qui fus meurtri sur la glèbe entrouverte
Où la fureur humaine a consommé ta perte,
Mort, quel est ton passé ? Quel était ton pays ?
Es-tu le montagnard qui paissait ses brebis ?
Le coron de la mine abritait il ta tête ?
Es-tu le doux pêcheur qui bravait la tempête,
Ou l’humble laboureur suivant dans le sillon
Le pas lent de bœufs lourds qu’éveille l’aiguillon?
Es-tu le grand savant pâli sur son grimoire
Et rêvant d’imposer au monde sa mémoire,
Ou l’artiste charmant, l’aimable Cyrano
Que chacun à l’envie fêtait d’un long bravo?
Es-tu l’heureux époux, l’incomparable père,
L’artisan, l’ouvrier combattant la misère?
Ou bien l’amant timide au regard langoureux.
Le Don Juan vainqueur ou l’obscur amoureux ?
Qu’importe!…
Maintenant, appuyé sur ma pelle,
Je songe à te remettre au néant qui t’appelle.
Et j’admire comment une étrange splendeur
Vint mêler sur ton front le sublime à l’horreur…
Ce n’est qu’un extrait.
La page consacrée à ce thème se trouve derrière ce lien : < La grande guerre s’est terminée il y a cent ans>
<Mot sans numéro>
- l’existence du camp de concentration de Crest et d’autres camps pendant la première guerre mondiale ;
-
Mercredi 12 juin 2019
« Retour sur la série consacrée au football »Publication de la page consacrée à la sérieHier, je consacrais le mot du jour au football joué par des femmes.
 Je montrais notamment que ce fut un combat pour que ce domaine, autant touché par le machisme que le reste de la société, fut conquis par la moitié de l’humanité auquel l’autre moitié a toujours voulu interdire toute activité autres que les tâches domestiques et la charge des enfants.
Je montrais notamment que ce fut un combat pour que ce domaine, autant touché par le machisme que le reste de la société, fut conquis par la moitié de l’humanité auquel l’autre moitié a toujours voulu interdire toute activité autres que les tâches domestiques et la charge des enfants.
En ce moment, se déroule en France, la coupe du monde féminine de football.
L’année dernière, eut lieu en Russie, la coupe du monde masculine de football.
Ce fut pour moi l’occasion de consacrer une série de 11 mots du jour au football.
A la morale du football, à l’économie du football, aux dérives…
Mais encore à l’Histoire des jeux de ballon.
Et aussi à la philosophie et à la société, puisque j’ai mis cette série sous l’égide d’Albert Camus qui aurait dit que tout ce qu’il savait de la morale, c’était au football qu’il le devait.
J’ai plusieurs fois écrit que la démarche du mot du jour était avant tout pour moi un travail d’approfondissement et d’explication qui constituait un enrichissement pour moi, mais aussi je ne saurais le nier un vrai travail.
C’est encore beaucoup plus exact quand j’écris des séries.
Car, bien que je me sois intéressé au football depuis mon plus jeune âge, la plus grande part de ce que j’ai écrit dans ces 11 mots du jour je l’ai appris pendant que j’écrivais cette série.
Ainsi, avant de tenter de commencer une nouvelle série la semaine prochaine, je voudrais revenir sur certaines que j’ai déjà écrites et les publier sur une page qui se trouve dans l’onglet des « séries ».
Cette page qui les replace dans l’ordre chronologique, donne un extrait rapide de chacun des mots et renvoie vers l’article qu’on peut souhaiter approfondir.
La page consacrée au football se trouve derrière ce lien : <Le football par l’Histoire, l’Économie et la Morale>
<Mot sans numéro>
-
Mardi 11 juin 2019
« [Que les jeunes filles] osent courir après un ballon dans une prairie qui n’est pas entourée de murs épais, voilà qui est intolérable ! »Henri Desgrange en 1925Sauf à ce que vous soyez totalement isolé ou que vous n’écoutiez aucun média, il n’est pas possible que vous ne sachiez pas que la France organise la coupe du monde féminine de football.
Il ne faut pas parler de « football féminin », puisque les règles qui s’appliquent sont rigoureusement les mêmes que celles des hommes et que dès lors il n’existe pas une autre forme de football qui serait le football féminin.
Ce qui existe, ce sont des compétitions réservées aux femmes, il s’agit donc d’une compétition féminine de football.
Notez que les compétitions masculines sont également exclusives et réservées à un seule genre.
Mais le fait qu’il existe aujourd’hui des compétitions féminines et que presque plus personne ne conteste la légitimité des femmes de jouer au football ou d’ailleurs à tout autre sport collectif, ne fut pas un long fleuve tranquille.
Même celles et ceux qui ne le lisent pas, connaissent l’existence du quotidien sportif « L’Equipe » fondé, après la guerre, en 1947 par Jacques Goddet. Ce journal a repris les structures d’un journal qui l’a précédé : « L’Auto ».
Et c’est « Henri Antoine Desgrange » qui était cycliste qui fonda en 1900 ce journal qui s’appela d’abord « Auto-Vélo » jusqu’en 1902, puis simplement « Auto ». L’Auto fut le principal quotidien sportif français du 16 octobre 1900 au 17 août 1944. C’est ce journal sous l’impulsion de son directeur qui mit notamment en place le Tour de France. Il fut interdit de parution en 1944 car il était considéré comme ayant été favorable à l’Occupant allemand. L’honneur d’Henri Desgrange, ne fut pas en cause puisqu’il mourut en 1940, avant le désastre pétainiste.
Mais c’est en tant que journaliste sportif et directeur de l’ « Auto » qu’en 1925, il eut ce jugement péremptoire :
« Que les jeunes filles fassent du sport entre elles, dans un terrain rigoureusement clos, inaccessible au public : oui d’accord. Mais qu’elles se donnent en spectacle, à certains jours de fêtes, où sera convié le public, qu’elles osent même courir après un ballon dans une prairie qui n’est pas entourée de murs épais, voilà qui est intolérable ! »
<Wikipedia> rapporte ces propos qui ont été cités dans le livre de Laurence Prudhomme-Poncet, « Histoire du football féminin au XXe siècle », Paris, L’Harmattan, 2003
Ci-dessus, j’ai écrit que « presque plus personne » ne conteste aux femmes le droit de jouer au football.
L’inénarrable Alain Finkielkraut, que Sonia Mabrouk, lors de l’émission « Les Voix de l’info » sur CNews,. a eu la mauvaise idée d’interroger sur le sujet de la coupe du monde féminine a eu droit à cette réponse :
«J’ai pas envie, j’ai pas envie […] . Alors là, je n’aime pas le football féminin. Arrêtez avec l’égalité ! L’égalité bien sûr, mais avec un peu de différence. Cela ne me passionne pas. Ce n’est pas comme ça que j’ai envie de voir des femmes. »
 C’est pendant la Grande Guerre, à un moment où les femmes ont pris de plus en plus de responsabilités, en l’absence des hommes qui étaient au Front, que les femmes commencèrent à jouer des matches de football.
C’est pendant la Grande Guerre, à un moment où les femmes ont pris de plus en plus de responsabilités, en l’absence des hommes qui étaient au Front, que les femmes commencèrent à jouer des matches de football.
Le 30 septembre 1917, le premier match de football féminin est disputé en France.
Le journal L’Auto, relate dans son édition du 2 octobre 1917 que « pour la première fois des jeunes filles ont joué au football ».
J’ai trouvé d’autres informations sur ce site consacré au football amateur : « Les femmes ont (aussi) découvert le football durant la Grande Guerre » :
« Le 18 janvier 1918, la Fédération des sociétés féminines sportives de France (FSFSF) est fondée. Elle organise le championnat de France de football féminin à partir de 1919. Le premier match de cette compétition s’est déroulé le 23 mars 1919 au stade Brancion à Paris entre Fémina Sport et En Avant, un autre club parisien.[…] le football féminin va rapidement décliner… « Il y a une volonté délibérée de ne pas développer le football féminin, poursuit Michel Merckel. Les médecins de l’époque assurent que le sport peut détruire leur appareil reproducteur. » […] En 1941, le régime de Vichy interdit tout simplement le football féminin qu’il juge nocif. Pour le renouveau, il faudra attendre 1968 et l’idée de Pierre Geoffroy, journaliste à L’Union, de mettre sur pied un match de foot féminin dans le cadre de… la kermesse de son journal, à Reims. La FFF va ainsi reconnaître le football féminin dès l’année suivante.
Un peu plus de cent ans après le premier match, le foot féminin est aujourd’hui en pleine croissance. Mais le chemin fut long pour que ces dames puissent se faire une place dans le monde du ballon rond. »
Wikipedia montre que ce combat fut général à tous les pays occidentaux. L’organisation mondiale la FIFA eut beaucoup de mal a accepté le principe d’une coupe du monde féminine. Il fallut attendre les années 1990, pour que ce devint possible.
Et contrairement à ce que certains pensent encore : « le football n’est pas moins bien quand ce sont des femmes qui jouent », je dirais bien au contraire.
J’ai regardé le match d’ouverture : de beaux buts, de belles phases de jeu, jamais aucune contestation de l’arbitre, jamais de « cinéma » après une faute. Bref, plus de temps de jeu effectif, plus de fluidité.
Et, l’engouement du public fonctionne, n’en déplaise à Alain Finkielkraut. Le <Figaro> précise :
« . Au niveau des audiences TV, les Bleues ont établi vendredi soir un «record historique» pour la discipline: près de 10 millions de téléspectateurs étaient devant TF1, diffuseur de la rencontre en clair et en «prime-time», selon des données de Médiamétrie diffusées samedi. Soit une part d’audience considérable de 44,3%! Au chiffre de 9,8 millions sur TF1 il faut ajouter les 826.000 téléspectateurs sur la chaîne cryptée Canal+. Soit près de 11 millions au total.
À titre de comparaison, le premier match de l’équipe de France masculine lors du Mondial 2018, disputé un samedi à la mi-journée, avait rassemblé 12,59 millions de téléspectateurs. »
Cela étant, il se pose une problématique à la fois légitime et inquiétante. Les joueuses expriment légitimement un souhait d’être mieux rémunérées en comparaison avec les rémunérations exorbitantes des joueurs. Mais inquiétante, car il semble qu’une évolution est en marche qui ne vise pas à réguler le marché masculin, mais de faire rattraper les dérives masculines par des dérives féminines. <Panem et circenses>. Alternatives économiques a commis un article dans ce sens : <Le football féminin, un marché prometteur>.
Je finirai par un peu d’humour que nous donne le dessinateur de presse Denis Pessin et qu’il a publié sur <Slate> :

<1251>
-
Vendredi 7 juin 2019
« La salle de bain, les perturbateurs endocriniens et Yuka »Expérience sur des produits que nous utilisonsIl y a quelques années, j’avais des problèmes de gencives. J’étais très naturellement allé voir un professionnel, c’est-à-dire un dentiste.
 Ce dentiste m’a conseillé de prendre une pâte gingivale bien connue, me semble t’il : « Arthrodont. »
Ce dentiste m’a conseillé de prendre une pâte gingivale bien connue, me semble t’il : « Arthrodont. »
J’utilise ce produit depuis plusieurs années.
Mais ce n’est que tout récemment que j’ai enfin cherché à savoir si ce produit était bon.
Cela fait pourtant longtemps, 2013, que le magazine <Que Choisir> nous avait informés :
« Des perturbateurs dans la salle de bains […]
Alors qu’on ne s’est jamais autant préoccupé du contenu de nos assiettes, nous sommes beaucoup moins attentifs aux effets indésirables des cosmétiques sur notre santé. Pourtant, les laboratoires y incorporent de nombreux composants chimiques : conservateurs, antioxydants, émollients, filtres solaires, etc., aux effets encore mal maîtrisés. Or, les quantités de ces produits que nous nous appliquons sur la peau au cours de notre vie sont loin d’être négligeables. Si l’on additionne le nombre de cosmétiques qu’une femme peut utiliser dans une journée, du lait de toilette au mascara en passant par la crème hydratante, le rouge à lèvres, le gel douche, le shampooing, la laque ou le fond de teint, on arrive souvent à plus de dix produits… qui contiennent plusieurs centaines de substances chimiques ! Et les hommes ne sont pas en reste. Il y a beau temps que leur consommation ne se résume plus aux produits de rasage et d’hygiène.
Depuis des années, de nombreux chercheurs, organismes et associations tirent la sonnette d’alarme sur les perturbateurs endocriniens (parabènes, filtres solaires, etc.). Ces substances chimiques ou naturelles sont capables de produire des effets nocifs sur l’organisme, même à très faibles doses. »
Pendant longtemps nous pensions que si un produit était dangereux, les autorités sanitaires ne permettraient pas qu’il soit commercialisé.
Quelques scandales plus tard et conscient du poids des lobbys, nous savons aujourd’hui que les autorités réagissent souvent bien trop tard.
Revenons à mon dentifrice et regardons la composition :
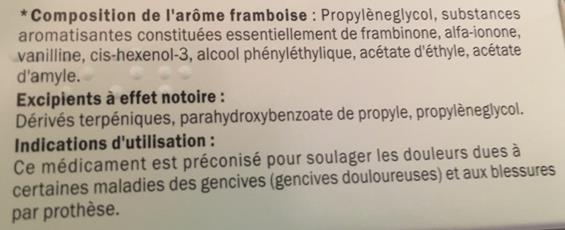 Nous voyons qu’il y a un paragraphe : « Excipient à effet notoire »
Nous voyons qu’il y a un paragraphe : « Excipient à effet notoire »
C’est sympa d’attirer notre attention.
Imprudent que j’étais, je n’avais jamais regardé cette composition de près.
On voit donc qu’il y a du « parahydroxybenzoate de propyle ». Quand on fait quelque recherche sur internet, on s’aperçoit qu’il a des synonymes :
le « 4-Hydroxybenzoate de propyle » « E 216 » et surtout le « le propylparabène »
Cette dernière appellation attire davantage le regard parce qu’il est question de « parabène » qui est connu comme un perturbateur endocrinien.
D’ailleurs, l’article de Que choisir cité ci-avant le cite..
On peut lire la version officielle dans <Wikipedia> :
« Beaucoup de consommateurs s’inquiètent et réagissent à la présence de ce produit dans plus de 400 médicaments, alors que l’on ne connait pas encore précisément l’impact de l’absorption de ce produit dans le corps.
Risques connus : Allergène mineur.
Risques soumis à études :
impact négatif sur le système endocrinien ;
risque cancérigène lié à la perturbation endocrinienne ;
impact négatif sur la fertilité masculine ;
reprotoxique.
À part l’effet allergène, les autres risques ne sont pas confirmés chez l’homme et n’en sont qu’à l’état de test, les risques importants ne sont pas inexistants mais les chances qu’ils soient réels sont suffisamment faibles pour ne pas interdire le produit dans l’alimentaire, le pharmaceutique et la cosmétique. »
« Les risques importants ne sont pas inexistants mais les chances qu’ils soient réels sont suffisamment faibles pour ne pas interdire le produit dans l’alimentaire, le pharmaceutique et la cosmétique ». Cela est écrit en termes mesurés. L’hypothèse que cette phrase ait été écrite par un lobbyiste, n’est pas à exclure.
Mais de mon point de vue, pourquoi prendre un risque pour un dentifrice surtout s’il en existe qui ne présente pas ce danger ?
 En pratique je n’ai pas fait cette démarche analytique compliquée, mais j’ai utilisé une application que j’avais téléchargé sur mon smartphone : « Yuka ».
En pratique je n’ai pas fait cette démarche analytique compliquée, mais j’ai utilisé une application que j’avais téléchargé sur mon smartphone : « Yuka ».
Je l’avais dans un premier temps surtout téléchargé pour l’alimentation.
En un temps record cette application après avoir scanné le code barre donne des informations sur la composition du produit : graisse saturée, sel, sucre, additifs etc.
Je me demande si cette application n’est pas encore plus utile pour le produits de salle de bains.
Il existe d’autres applications
L’application par un système de pondération, note de 0 à 100.
Mon dentifrice a reçu la note de 14.
Et le qualificatif de « Mauvais », ce qui est le cas quand la note est inférieure à 25.
En première ligne apparait immédiatement le fameux « propylparabène ».
Mais l’application donne plus d’information si on clique sur le produit en cause.
Je donne une copie d’écran du début de l’analyse.
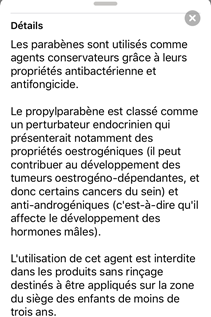
A la fin de l’article, il y a plusieurs liens vers des sites qui développent ces analyses.
Pour ma part j’ai jeté ce dentifrice et j’en utilise d’autres.
Et je scanne tous les produits de ma salle de bains.
Chacun est libre de faire comme cela lui paraît bien. Yuka dispose aussi d’un <site>
<1250>
-
Jeudi 06 juin 2019
« L’histoire du Zolgensma »Un médicament de 2,1 millions de dollarsJ’ai entendu cette histoire incroyable dans la revue de Presse de Claude Askolovich, <ce mercredi>.
Il a cité l’Express et le Canard enchaîné que j’ai achetés immédiatement.
Vous avez entendu qu’un laboratoire Suisse est parvenu à faire accepter aux Etats-Unis la commercialisation d’un médicament dont le prix unitaire est 2,1 millions de dollars.
Le laboratoire Suisse est « Novartis. »
La question est de savoir comment Novartis a investi dans les brevets et la recherche pour parvenir à ce résultat.
Et cette histoire pourrait commencer par :
« Il était une fois, en France, le téléthon ».
Voici comment Claude Askololovich raconte cette histoire :
« On parle d’une culbute financière…qu’a révélée l’Express et dont parle aussi le Canard enchaîné, une culbute scandaleuse et légale dont nous sommes français les victimes, et qui, sacrilège, concerne la santé.
On a appris en mai que la firme suisse Novartis allait commercialiser le médicament LE PLUS CHER DU MONDE; le Zolgensma qui à deux millions cent mille dollars la prise combat l’amyotropie spinale, maladie génétique qui tue des nourrissons, paralysant leurs muscles et leur respiration.
Et bien, ce médicament a été inventé chez nous en France, par le Généthon, le laboratoire du Téléthon, cause pour laquelle nous mettons chaque année la main à la poche. Les chercheurs du Généthon avaient déposé des brevets; mais quand on dépose des brevets, vos données deviennent publiques, dans le monde réel qui est plus dur qu’un brave labo née d’une association de malades.
Le Généthon avait investi 15 millions d’euros pour des expériences sur les souris, une start-up americaine Avexis a levé 500 millions de dollars pour réaliser des essais cliniques et le passage à l’espèce humaine.
Et le Généthon dépassé, pour quinze millions de dollars, en gros le prix de ses recherches, a cédé ses brevets à son jeune vainqueur…
Lequel vainqueur s’est fait racheter par Novartis pour 8.7 milliards de dollars.
Et Novartis espère vendre pour 2 milliards par an de Zolgensma; le généthon touchera des royalties sur ces ventes, qui seront réinvesties dans la recherche, car nous sommes français des gentils, peut-être inadaptés.
L’Express et le Canard le martèlent, la France n’a pas su créer de filière pour les thérapies génétiques, qui irait de la recherche jusqu’à l’industrialisation, pas seulement pour être nous aussi milliardaires, mais pour maîtriser le prix des médicaments… »
Donc résumons :
1° Un sympathique laboratoire français investit 15 millions d’euros.
2° Mais pour la suite il faut un financement bien plus important. Une start up américaine arrive à mobiliser 500 millions de dollars et rachète les brevets du petit laboratoire français.
3° La start up américaine est très efficace mais ne sait pas industrialiser sa découverte. Pas de souci un laboratoire suisse rachète tout pour 8,7 milliards de dollars.
- Les suisses ont un magnifique business plan, ils pensent vendre pour 2 milliards par an de ce Zolgensma.
- Les propriétaires de la start up américaine sont devenus très riches et pourront s’ils ont en le besoin acheter le médicament.
- Le laboratoire français peut tenter de faire d’autres recherches pour trouver des brevets qui permettront d’assurer un nouveau business plan pour une autre firme fortunée.
L’Express rapporte la défense de Novartis devant le tollé provoqué par le prix de ce médicament : :
« Ce prix est inférieur de moitié au coût sur 10 ans du seul autre traitement existant contre cette pathologie, qui doit être administré durant toute la vie des malades »
Et précise
« L’information est passée inaperçue jusqu’ici, mais ce produit est en effet né dans un laboratoire de recherche français. Et pas n’importe lequel : le Généthon, à Evry (Essonne). Celui-là même qui est largement financé par les dons du Téléthon et par des fonds publics, à travers le salaire d’une partie des chercheurs, issus du CNRS ou de l’Inserm, qui y travaillent. »
Le Canard Enchainé donne la parole aux professionnels français :
« « On s’effondre dans son fauteuil en découvrant des montants pareils ! s’indigne Alain-Michel Ceretti le président de France Assos Santé qui fédère les associations de patients. Au bout de la spirale, le prix du médicament est totalement déconnecté de son coût de recherche développement. […]
Pour la France, c’est une réussite sur toute la ligne : non seulement la découverte lui échappe, mais en plus la Sécu devra payer le remède au prix fort (une centaine de bébés pourraient en bénéficier chaque année. Le 22 mai 2018, au cours d’un déjeuner organisé par le club de l’Europe (une boite de lobbying), le patron de Novartis France avait déjà évoqué devant une brochette de députés, sénateurs et associations de patients, le coût du futur Zolgensma : « Il a parlé de 800 000 euros » pour la France mais ce sera peut-être plus, vu le prix délirant obtenu aux Etats-Unis » raconte un des participants. »
Et le Canard enchaîné donne le mot de la conclusion à Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l’AFM-Téléthon :
« On tire la sonnette depuis des années pour éviter ce scénario. Je ne compte plus les ministres et les présidents (y compris Macron) que l’on a interpellés pour les convaincre de créer une filière française des thérapies géniquesqui irait de la recherche jusqu’à l’industrialisation et qui permettrait de maîtriser le coût du médicament. Sinon on est dépossédés de nos brevets. »
Que dire de tout cela ?
D’abord que le prix de ce médicament doit une petite part au travail de recherche et développement des laboratoires qui ont œuvré à sa réalisation et une très grand part à la spéculation puisqu’il y a eu accord sur un prix exorbitant que la firme suisse a accepté de payer parce qu’elle en espérait un profit ultérieur énorme.
Et la firme suisse a trouvé un allié de poids : les assurances américaines privées qui n’ont pas négocié pour minimiser le prix mais ont eu pour objectif de créer la rareté pour pouvoir augmenter leur profit par une hausse de leurs tarifs justifiée par un médicament exceptionnel.
Je ne dis pas que le marché n’est pas efficace et que les entreprises privées ne sont pas utiles pour la création de valeur.
Mais cet exemple montre aussi la perversité et l’oubli des valeurs humaines quand la logique du marché est poussée à son paroxysme et la cupidité des hommes ne se heurte à aucune limite.
Je me souviens d’un professeur qui comparait la santé organisée par le « Public » et celle par le « Privé »
Le « Public » cherche à soigner la population au meilleur coût.
Le « Privé » cherche à soigner la population en maximisant les profits.
Par ailleurs, il ne me semble pas juste de dire qu’il n’y a pas d’argent en France. Les français épargnent énormément. Simplement nous n’arrivons pas collectivement à mobiliser ces capitaux pour aider et continuer les travaux de nos laboratoires jusqu’à la commercialisation.
Ce mot du jour montre le monde économique comme il fonctionne.
<1249>
- Les suisses ont un magnifique business plan, ils pensent vendre pour 2 milliards par an de ce Zolgensma.
-
Mercredi 5 juin 2019
« Le titulaire d’une marque est un fils, en droite ligne, de ces putains alexandrines »Michel SerresNous avons tous, notamment avec nos enfants, été confrontés à la tyrannie des marques. Il faut des chaussures de telle marque, des vêtements de telle autre sinon l’enfant est ostracisé, exclu du groupe.
Les marques permettent des marges considérables, surtout depuis que les sociétés qui les possèdent ont trouvé le filon d’aller faire fabriquer le support de leur logo dans des pays de main d’œuvre peu chère et d’un droit du travail particulièrement accommodant pour les employeurs cupides.
Mais d’où vient cette appellation de « marque ».
C’est encore Michel Serres qui apporte son explication particulière. Il a dit lors de l’émission que j’ai déjà évoquée deux fois ces derniers jours : « Michel Serres – Questions Politiques du 26 mai 2019 » :
« Autant il est facile de trouver l’origine du mot marque et sa fonction linguistique dans le droit de propriété, autant la date de son apparition historique sur le marché restait, à ma connaissance inconnue.
Sauf que, feuilletant un vieux grimoire de l’époque hellénistique, je découvris que les putains d’Alexandrie sculptaient en négatif leur nom et leur adresse sous les semelles de leurs sandales et les imprimaient ainsi en marchant sur le sable de la plage. Marchant, elles marquaient. […] Leurs clients les suivaient à la trace.
La publicité, rien de plus rationnel, fut inventée par les filles publiques. Comment nommer le titulaire d’une marque ? Un fils, en droite ligne, de ces putains alexandrines. »
Un peu de recherche a permis de constater qu’il avait déjà rapporté cette origine dans livre « Le mal propre »
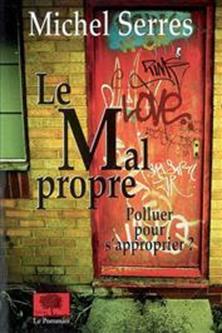 Le mal propre commence ainsi :
Le mal propre commence ainsi :
« Le tigre pisse aux limites de sa niche. Le lion et le chien aussi bien. Comme ces mammifères carnassiers, beaucoup d’animaux, nos cousins, marquent leur territoire de leur urine, dure, puante ; et de leurs abois ou de leurs chansons douces, comme pinsons et rossignols.
Marquer : ce verbe a pour origine la marque du pas, laissée sur la terre par le pied. Les putains d’Alexandrie, jadis, avaient coutume, dit-on, de ciseler, en négatif, leurs initiales sous la semelle de leurs sandales, pour que, les lisant, imprimées sur le sable de la plage, le client éventuel reconnaisse la personne désirée en même temps que la direction de sa couche. Les présidents des grandes marques reproduites par les publicitaires sur les affiches des villes jouiront sans doute, ensemble, d’apprendre qu’ils descendent en droite ligne, comme de bons fils, de ces putains-là.
Ou de ces bestioles-là, qui marquent de leurs déjections les frontières de leur aire. De même, certains végétaux diffusent alentour de petits jets invisibles d’acide… Rien ne pousse à l’ombre glacée des sapins. »
Il y a donc selon lui deux origines aux « marques ».
- L’instinct des mammifères « de pisser » aux limites de leur territoire pour en « marquer » les limites et leur appropriation de ce territoire.
- La pratique des prostituées d’Alexandrie d’imprimer leur trace dans le sable afin que leurs clients puissent les retrouver.
Je ne sais pas s’il faut considérer ces explications comme la vérité historique.
Mais je dois avouer qu’elles me plaisent beaucoup, tant il est vrai que « les marques » sont devenus une sorte de drogue qui crée l’addiction à une société de surconsommation dont nous savions déjà qu’elle était la ruine de l’âme et dont nous comprenons aujourd’hui qu’elle est aussi une immense menace pour la survie de notre espèce sur la terre.
<1248>
- L’instinct des mammifères « de pisser » aux limites de leur territoire pour en « marquer » les limites et leur appropriation de ce territoire.
-
Mardi 4 juin 2019
« Le massacre de la place de la porte de la Paix céleste»Episode fondamental de l’Histoire de la République Populaire de ChineLe 4 juin 1989, le mur de Berlin n’était pas encore tombé, mais les pays communistes dans l’Europe de l’est étaient en pleine ébullition et Gorbatchev essayait vainement de réformer l’Union soviétique.
Je ne m’en souvenais pas, mais le jour précédent, le 3 juin 1989, l’austère et fanatique Ayatollah Khomeini venait de mourir.
Et le 4 juin fut le jour du massacre de la place Tian’anmen à Pékin
Or « Tian’anmen » signifie « la porte de la Paix céleste ». C’est une porte monumentale de l’avenue qui constitue l’entrée Sud de la Cité impériale. Elle borde au Nord la place qui porte son nom.
Le 4 juin 1989, il y a 30 ans, fut donc le jour du massacre de la place de la porte de la Paix céleste
Associer « la paix céleste » et « un massacre » constitue un oxymore dont la Chine communiste semble coutumière.
J’avais souligné lors du <mot du jour du 24 mai 2013> l’extraordinaire article 1 de la constitution de la Chine populaire :
« La République populaire de Chine est un État socialiste de dictature démocratique populaire dirigé par la classe ouvrière et fondé sur l’alliance entre ouvriers et paysans.
Le système socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine. Il est interdit à toute organisation ou tout individu de porter atteinte au système socialiste. »
D’ailleurs la seconde partie de cet article « Il est interdit à toute organisation ou tout individu de porter atteinte au système socialiste » semble lourd de sens et annonciateur de ce qui s’est passé en juin 1989.
En 1989, la Chine était au début de son extraordinaire développement économique qui l’a amené à son niveau d’aujourd’hui, à savoir en rival des États-Unis d’Amérique. Tout le monde attribue cette évolution remarquable à Deng Xiaoping qui est arrivé à écarter le successeur désigné de Mao : Hua Guofeng. De manière officielle Deng Xiaoping sera le principal dirigeant chinois à partir de décembre 1978
Autour de Deng Xiaoping trois dirigeants vont jouer un rôle éminent dans toute cette affaire :
- Hu Yaobang qui a été le secrétaire général du parti communiste chinois de 1980 à 1987. Mais il sera limogé en 1987 de ses fonctions à la tête du Parti à la suite déjà de manifestations étudiantes dont il aurait soutenu les revendications démocratiques. Il avait l’image du réformateur.
- Zhao Ziyang était Premier ministre de 1980 à 1987 puis il remplace Hu Yaobang comme Secrétaire général du Parti communiste chinois de 1987 à 1989.
- Li Peng qui a pris la place de Zhao Ziyang comme Premier ministre en 1987 et le restera jusqu’en 1998.
Ces 3 hommes sont des disciples et des proches collaborateurs de Deng Xiaoping, mais n’auront pas toujours sa confiance
En avril 1989, Deng Xiaoping ne se présente plus au premier plan mais tire encore les ficelles. Au premier plan, il y a Zhao Ziyang le chef du Parti et Li Peng le premier ministre.
Et c’est dans ce contexte que Hu Yaobang meurt le 15 avril 1989. Des manifestations spontanées ont lieu dans tout le pays pour saluer son rôle de réformateur et .demandent la réhabilitation politique de Hu Yaobang. Le 18, quelques milliers d’étudiants et de civils se rendent sur la place où ils organisent un sit-in devant le Grand Palais du Peuple (l’assemblée nationale). C’est la première grande manifestation.
C’est ainsi que commencent les évènements de Tian’anmen.
Ce sont des intellectuels, des ouvriers et des étudiants qui vont manifester, faire des grèves de la faim et finalement même ériger une statue de la liberté « chinoise ». Ils dénoncent la corruption et demandent des réformes politiques et démocratiques.
Ces évènements vont durer du 16 avril jusqu’au 4 juin. Ils vont durer aussi longtemps parce qu’il y a désaccord au sein du groupe des dirigeants Zhao Ziyang étant à la tête du groupe qui souhaite négocier et accéder à certaines réformes, Li Peng à la tête d’un groupe qui veut tuer dans l’œuf toute évolution du régime et de remise en cause du rôle du Parti Communiste Chinois.
Finalement c’est le groupe de Li Peng avec le soutien de Deng Xiaoping qui va gagner, la ligne dure l’emporte, et après l’établissement de la Loi martiale en 19 mai, Zhao Ziyang est immédiatement limogé et placé en résidence surveillée où il restera jusqu’à sa mort.
Mais les manifestants restant mobilisés, malgré la Loi martiale, le gouvernement chinois va envoyer l’armée et réprimer le soulèvement dans le sang le 4 juin 1989 de triste mémoire.
Les officiels chinois prétendront qu’il y a eu 200 morts, d’autres sources dont l’Union Soviétique comme les États-Unis estiment ce massacre à plus de 10 000 morts.
Tous ces évènements sont précisément décrits dans <Wikipedia>
Il y a aussi ce documentaire <d’Arte> :
Et puis dans une perspective contemporaine, il y a cette émission du Grain à moudre sur France Culture : « Que reste-t-il de Tiananmen ? ».
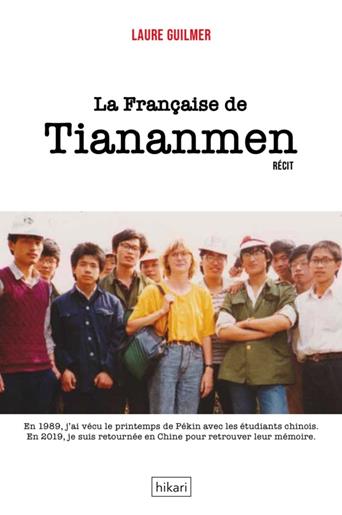 Parmi les invités, il y avait la journaliste Laure Guilmer qui avait couvert ces évènements et qui est retourné en Chine en 2019 pour retrouver les étudiants désormais cinquantenaires qu’elle avait connus alors. Elle raconte combien il est difficile de les faire reparler de ce moment de leur vie, certains sont totalement dans le déni.
Parmi les invités, il y avait la journaliste Laure Guilmer qui avait couvert ces évènements et qui est retourné en Chine en 2019 pour retrouver les étudiants désormais cinquantenaires qu’elle avait connus alors. Elle raconte combien il est difficile de les faire reparler de ce moment de leur vie, certains sont totalement dans le déni.
Le gouvernement a d’ailleurs poursuivi une vraie politique d’occultation, d’omerta et continue à le faire.
Comme l’écrit le journal : « La Croix » <Pékin minimise toujours la gestion des « turbulences » de Tian An Men> :
« Cet incident était une turbulence politique et le gouvernement central a pris les mesures pour mettre un terme à ces turbulences, ce qui a été la décision correcte », a expliqué dimanche 2 juin à Singapour le général chinois Wei Fenghe à une question d’une journaliste portant sur la répression militaire le 4 juin 1989 à Pékin. […]
Pékin n’a jamais reconnu le nombre de victimes, parlant de « 200 ou 300 dont beaucoup de soldats ». Le nombre de victimes se chiffre beaucoup plus autour de « plusieurs milliers », pas seulement sur la Place Tian An Men et à Pékin mais dans des dizaines de villes chinoises où les étudiants s’étaient également soulevés. […]
La mémoire de ces tragiques événements est toujours portée par de nombreux militants à travers le monde et même à Hong Kong, seul endroit du territoire chinois où il est encore possible d’évoquer « Tian An Men » et où les défenseurs de la démocratie se battent encore, convaincus de voir la vérité triompher en citant le grand auteur chinois Lu Xun (1881-1936) : « Les mensonges écrits à l’encre ne peuvent camoufler les faits écrits dans le sang. »
Cet échange entre le général chinois et le journaliste ne sera pas évoqué dans les médias chinois en Chine.
Depuis 1989, il n’est pas possible de parler de ces évènements en Chine. Les moteurs de recherche chinois ne permettent pas d’accéder aux sites qui parlent du 4 juin ou des massacres de Tien an Men.
Le <Figaro> rapporte :
« Dans un éditorial, le quotidien de langue anglaise Global Times, très proche du parti au pouvoir, estime que «l’incident» du 4 juin 1989 «est devenu un événement historique oublié» et que cet oubli même a permis à la Chine de poursuivre son spectaculaire développement économique.
«Depuis l’incident, la Chine est parvenue à devenir la deuxième économie mondiale, avec une amélioration rapide du niveau de vie», salue le journal, alors que l’ensemble des autres médias gardaient le silence sur l’anniversaire du massacre. «En vaccinant la société chinoise, l’incident de Tiananmen augmentera grandement l’immunité de la Chine contre tout trouble politique à l’avenir», estime le quotidien, dont l’éditorial ne figurait pas dans la version du journal en langue chinoise et n’était pas non plus disponible en ligne. »
Quelles conclusions tirer de ces évènements et de leurs suites ?
- En Chine, le régime fort et sans remord mis en place par Deng Xiaoping a enterré, l’illusion de beaucoup d’occidentaux qui prétendait que le développement du capitalisme se réalisait en parallèle avec un développement des libertés démocratiques. L’évolution chinoise a démontré exactement le contraire. Le développement a continué de plus belle et jamais la population chinoise n’a été aussi surveillée et privée de liberté.
- Les dirigeants chinois ont explicitement proposé ce « contrat » à leurs citoyens : Vous pouvez vous enrichir autant que vous voulez, mais personne n’a le droit de toucher à l’organisation politique et au rôle du Parti communiste.
- Seules des difficultés économiques importantes pourront remettre en question « ce contrat ».
- Enfin, la Chine constitue un exemple parfait de la soumission qu’on obtient quand on parvient à transformer les citoyens, en simples consommateurs. Même si je doute que tous soient atteints par ce trouble du discernement qui est celui de se réfugier dans la seule et exclusive consommation.
En tout cas, la Chine n’est en aucune façon, dans le contexte d’aujourd’hui, un État et une organisation politique désirables.
<1246>
- Hu Yaobang qui a été le secrétaire général du parti communiste chinois de 1980 à 1987. Mais il sera limogé en 1987 de ses fonctions à la tête du Parti à la suite déjà de manifestations étudiantes dont il aurait soutenu les revendications démocratiques. Il avait l’image du réformateur.
-
Lundi 3 juin 2019
« Le moraliste espiègle s’en est allé … »Michel Serres est décédé samedi 1er juin à 19 heuresJe n’imaginais pas lorsque je publiais le mot du jour, avant le long week-end de l’ascension, dans lequel je partageais l’émission de France Inter « Michel Serres – Questions Politiques du 26 mai 2019 », que lors du mot du jour suivant, il faudrait prendre congé de cet homme qui a été si inspirant et m’a donné tant de sources de réflexions.
Il est mort de vieillesse, je pense que c’est cela qu’il aurait dit
Dans notre société actuelle, on meurt de plus en plus vieux, mais selon ce que l’on dit on meurt du cancer, d’un infarctus ou de tout autre détail technique mais plus de vieillesse.
Dans ce qui sera donc sa dernière émission de radio, il était visible que si son esprit était toujours aussi pétillant et vivace, le corps était affaibli, malade.
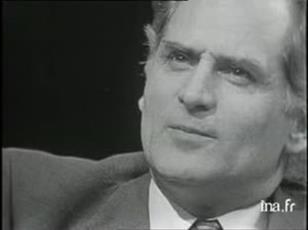 <Le Parisien du 23 mars 2019> rapporte une visite de Michel Serres dans une maternelle dans laquelle il échangeait avec de tous jeunes enfants.
<Le Parisien du 23 mars 2019> rapporte une visite de Michel Serres dans une maternelle dans laquelle il échangeait avec de tous jeunes enfants.
Un garçon lui posa la question :
« C’est quoi ton projet en ce moment ? »
« Peut-être que je vais disparaître dans quelque temps. Alors j’essaye d’écrire mon dernier livre », répondit le philosophe.
Une pluie d’hommages lui a été rendue ce week-end.
Sur twitter…
Rappelons cependant cette anecdote qu’il a racontée dans l’émission « Questions Politiques »
« Dernièrement j’ai fait des conférences, et j’ai parlé de bobards sur gazouillis et personne ne comprenait. Alors j’ai dit « pardon je parlais de fake news » sur Twitter ». Quand c’est en anglais, tout le monde comprend. Les classes dominantes, les grandes entreprises et les publicitaires ne parlent qu’anglais et c’est terrible. »
Donc sur Twitter, j’ai aimé Michel Field qui faisant référence à un de ces derniers livres qui voulait démontrer que « ce n’était pas mieux avant », a écrit :
« On est contraint de le contredire. Oui, Michel, c’était mieux avant. Quand tu étais là. »
Un autre a écrit :
« Nous vous avons tant aimé, Monsieur. Vous nous avez illuminés en nous faisant croire que nous étions intelligents. ».
Mais tout le monde n’était pas convaincu par le philosophe
Ainsi j’ai lu comme commentaire à l’émission « Questions Politiques du 26 mai 2019 » : « comme d’habitude Michel Serres parle, pour ne rien dire ».
Même dans <Cet article d’hommage> du Monde qui écrit de belles choses et reste globalement très positif, on lit cependant :
« Michel Serres est, pour les éditeurs, une valeur sûre, entretenue par les articles amicaux d’une pléiade d’anciens élèves. Du coup, le philosophe ne sait plus s’arrêter. C’est dommage car, pour rester un genre « noble », l’essai suppose une exigence de rigueur qui, ici, tend à se relâcher au fil des ans. Le Parasite, ces deux textes curieusement « girardiens » que sont Genèse et Rome (tous trois chez Grasset),
puis des ouvrages comme Les Cinq Sens, L’Hermaphrodite, Statues, Le Contrat naturel ou Le Tiers-Instruit (Grasset, Flammarion, François Bourin) ne peuvent pas ne pas décevoir – surtout ceux qui se souviennent des débuts du philosophe. »
Et puis <Dans un autre article d’hommage>, Le Figaro rapporte que deux intellectuels américains Sokal et Bricmont, dans les années 1990, critiquèrent « férocement » Michel Serres dans un livre « Impostures intellectuelles »(Odile Jacob) dans lequel, ils contestent sa tendance à utiliser des concepts scientifiques hors de leur contexte.
Pour ma part, j’ai toujours été ébloui par ses fulgurances, son autre regard, sa capacité de porter un œil totalement neuf sur des sujets quelquefois inattendus.
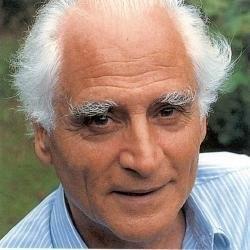 Ainsi, je me souviens d’un jour où je l’ai entendu parler du vélo à la radio.
Ainsi, je me souviens d’un jour où je l’ai entendu parler du vélo à la radio.
Il avait expliqué qu’on lui avait demandé d’écrire un article sur le vélo et la modernité du vélo.
D’abord sceptique, il a brusquement eu une idée ou disons une association d’idées.
Vous pourrez trouver cet article publié dans « Le Hors-série de Science et Vie, de mai-juin 2008 » <ICI>
Et voilà ce que donne ce plaidoyer de la bicyclette par le philosophe facétieux
« Le Cambrien – il y a 500 millions d’années – a vu émerger, chez les vivants monocellulaires mous, des parties dures, sortes de plaques de calcaire pluricellulaires. Des populations sont apparues, munies de toits dont la dureté mit à l’abri leurs parties douces : mollusques aux coques chantournées, armées d’insectes couverts de chitine, sauriens et reptiles émaillés d’écailles…
Des centaines de millions d’années après émergèrent des espèces douces dont l’anatomie inversa exactement la dureté précédente. Chair, poils, plumes, duvets,… toutes les parties souples sortirent lentement de ces coques cristallines ou de ces carapaces calcaires et devinrent parfois, à l’intérieur, os, cartilages et squelettes. Ainsi notre corps sut, à la longue, se faire doux dehors et dur dedans.
Mais avec nos mains, nous ne pouvons encore fabriquer que du dur dehors et du doux dedans, à l’image de ces véhicules d’acier qui nous entourent. Tout se passe comme si nous ne parvenions à modeler que des fossiles archaïques…
Regardons passer wagons et locomotives, camions et automobiles, fonctionner grues et bétonnières, s’élever usines et fabriques… tous mous à l’intérieur et d’acier à l’extérieur. Nous voyons défiler – s’entrechoquer quelquefois mortellement – des millions de fossiles, revêtus de cuirasses comme des crustacés, mollusques, arthropodes, insectes et sauriens…
Nos automobiles ressemblent à la fois à des animaux conservés ou fossiles et à des armures de guerriers préhistoriques. Quand saurons-nous produire des techniques douces à l’image de nos corps ?
Le doux émergera tout naturellement de nous lorsque nos techniques s’ouvriront au monde au lieu de le combattre…
Une exception à cela. Nous avons su, une seule fois, fabriquer de nos mains une machine si souveraine qu’on la nomma, dès sa naissance, « la Petite Reine ».
Une machine qui, pour la première fois dans l’évolution comparée de la vie et des techniques, ne nous protège pas de sa cuirasse, mais mime au contraire l’intimité des os en laissant notre chair déborder vers le monde…
Bras sur le guidon, mains serrant les freins ou les poignées, cul sur selle, mes jambes se posent hors cadre. Mon corps entoure, surplombe, habille, environne ma bicyclette, ainsi devenue squelette interne de mon corps roulant.
Passant de l’ère primaire au quaternaire, réellement moderne, le vélo devance de millions d’années les autres véhicules, inimaginablement archaïques. »
Je trouve cette manière de décrire l’évolution absolument déroutante et pourtant pleine de sens.
Quand on se promène en ville, on voit bien que la voiture n’est pas le bon moyen de circuler. Elle pollue, elle fait du bruit. Et puis du point de vue de la bonne utilisation des ressources qui devrait être la préoccupation première de toute personne qui réfléchit un peu, je dis bien un peu : comment expliquer qu’il faut mettre en mouvement un engin de 1,5 tonnes pour transporter un humain de 75 kg. (Le SUV le plus vendu en France en 2017, le Peugeot 3008 pèse 1.480 kg) ?
L’écrire simplement montre l’aberration de la situation et de la solution mise en œuvre pour résoudre le problème de la mobilité humaine.
Donc oui ! Je trouve la manière avec laquelle Michel Serres compare la voiture et la bicyclette, particulièrement inspirante.
 Le journal <Sud-Ouest> cite un auditeur qui écrit ce que j’ai souvent ressenti à l’écoute de Michel Serres :
Le journal <Sud-Ouest> cite un auditeur qui écrit ce que j’ai souvent ressenti à l’écoute de Michel Serres :
« On se sent plus intelligent en vous écoutant »
Ce à quoi Michel Serres a répondu :
« C’est le but de ma vie. Ce n’est pas de rendre plus intelligents les gens, c’est de découvrir qu’ils sont intelligents, aider à découvrir l’activité délicieuse et joyeuse de l’exercice de l’intelligence. »
Lui qui écrivait :
« La seule autorité est celle qui grandit l’autre, qui l’«augmente ». Dans notre démocratie désormais horizontale si vous n’êtes pas investi de cette autorité, fondée sur la compétence, inutile de devenir député professeur Président voire parent »
Et aussi
«Ce qui m’intéresse, c’est l’accouchement du monde qui vient»
Alors bien sût celles et ceux qui attendent une grande explication unique et simpliste du monde en sont pour leur frais.
Dans le mot du jour du <Jeudi 16 mars 2017> il affirme que contrairement à l’allégorie de la caverne de Platon « Il n’y a pas qu’une vérité. Il y a des milliards de vérité»
Toutes ces réflexions qui autorisent le doute, le doute fécond.
Et puis il y a bien sûr les milliers de papas ronchons qui disent que c’était mieux avant et auxquels, il répond :
«Les lamentations prophétiques selon lesquelles nous allons perdre notre âme dans les laboratoires de biochimie ou devant les ordinateurs s’accordent sur cette haute note: que nous fûmes heureux dans notre petite cabane! Quel bonheur: nous ne pouvions guérir les maladies infectieuses et les années de grand vent, la famine tuait nos enfants ; nous ne parlions point aux étrangers de l’autre côté du ruisseau et n’apprenions pas de sciences difficiles (…) jamais la conscience de nos moyens ne s’accompagna d’un tel concert de regret de la part de ceux qui ne travaillèrent jamais sur ces moyens».
C’était mieux avant (Pommier, 2017).
Il n’assénait pas la vérité mais nous permettait de réfléchir.
Il ne prétendait pas posséder la vérité. Il a dit à plusieurs reprises dans l’émission « Questions Politiques »
« Je suis trop jeune et trop ignorant … »,
Et il commençait souvent ses cours avec cette invite :
« Mesdemoiselles, Messieurs, écoutez bien, car ce que vous allez entendre va changer votre vie… »
Il fut aussi l’invité de l’émission la Grande Librairie <du 28 février 2019> bouleversant.
Il fut aussi interviewé en 2019 par Léa Salamé pour évoquer sa vision de « l’art d’être Français ».
Et sur Arte, l’émission « 28 Minutes samedi » du <18/05/2019>
<1245>
-
Mercredi 29 mai 2019
« Les philosophes ne proposent pas un modèle alternatif au modèle capitaliste. »Michel SerresLe dimanche sur France Inter, Ali Baddou anime une excellente émission qui s’appelle « Questions Politiques ».
Enfin, pour qu’elle soit vraiment excellente il faut un invité qui ait des choses pertinentes à dire.
C’est de plus en plus rare, dans le monde politique. Or, le monde politique est justement le domaine de cette émission.
Mais dimanche 26 mai 2019, était un jour de chance : en raison des élections européennes, il était interdit au service public de relayer des avis partisans.
Ali Baddou n’a donc pas invité un politique mais Michel Serres. Michel Serres est né le 1er septembre 1930 à Agen. Il aura donc bientôt 89 ans et il est donc plus jeune qu’Edgar Morin qui était au cœur du mot du jour de vendredi dernier.
 Vous pouvez voir la vidéo de cet entretien derrière ce lien : « Michel Serres – Questions Politiques du 26 mai 2019 »
Vous pouvez voir la vidéo de cet entretien derrière ce lien : « Michel Serres – Questions Politiques du 26 mai 2019 »
Michel Serres est probablement l’auteur le plus souvent cité dans les mots du jour, celui d’aujourd’hui est le quatorzième pour lequel l’exergue a été écrit ou dit par lui.
C’est pour moi toujours un plaisir, un ravissement de l’écouter.
Et même s’il répète des idées, des histoires il arrive toujours un moment où il me surprend et me redonne matière à penser.
Il y a plus de deux ans, fin 2016, le navigateur Thomas Coville avait battu le record du tour du monde à la voile en multicoque avec un temps de 49 j et quelques minutes….. Il est arrivé le soir de Noël avec plus de 8 jours d’avance sur son poursuivant. Michel Serres avait marqué son admiration pour ce navigateur, il faut savoir qu’à 19 ans il est rentré dans la navale et il revendique toujours son état de marin.
Il était donc invité le 2 janvier 2017 sur France Inter et avait parlé de cette admiration devant l’exploit de Thomas Coville.
Mais il ne savait pas que Thomas Coville, réciproquement avait un immense respect pour le philosophe qu’il est. Il avait emmené des émissions de Michel Serres qu’il écoutait pendant son tour du monde.
La journaliste, pendant l’émission, les a mis en relation et ils ont pu échanger par téléphone.
Voici ce que cela a donné :
Thomas Coville :
« Vous êtes une des personnes qui depuis […] mon adolescence, m’ont inspiré d’aller jusqu’au bout de mes rêves. »
Michel Serres :
« Ne changez pas les rôles, c’est moi qui vous doit l’admiration ! »
Thomas Coville
« Non, non, non, non. Vous avez rempli votre rôle de philosophe.
Quand une nation donne plus la parole aux sportifs qu’aux philosophes c’est qu’elle est en danger.
Moi je vous ai écouté comme philosophe, comme celui qui se permet, parce qu’il a étudié, parce qu’il est sage, de donner un sens, donner une voix – et après à ceux qui l’écoutent d’essayer de la transcrire en faits.
J’ai finalement trouvé dans le petit garçon que j’étais une voix qui était un rêve complètement fou, faire le tour du monde en solitaire en multicoque, mais c’est parti d’un monsieur qui vous dit « écoutez cette petite voix, allez jusqu’au bout de vos rêves et ce rêve-là en alimentera un autre qui en fera faire un autre, etc.
Vous êtes l’un de ceux qui m’a inspiré et m’a fait aller jusqu’au bout »
C’est <ICI>.
Je trouve cet hommage à Michel Serres à la fois touchant et particulièrement juste.
Mais ce n’est pas de cette émission de 2017 dont je voulais parler, mais de celle « du 26 mai 2019 »
Vous n’avez qu’à l’écouter.
Je vais quand même picorer quelques fulgurances, de ci de là.
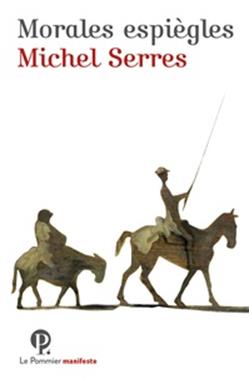 Michel Serres a publié en février 2019 un nouveau petit livre (96 pages, 80 g, 7 euros) : « morales espiègles » dans lequel il parle de rire, de chahut, de dialogue entre Petite Poucette et Grand papa ronchon.
Michel Serres a publié en février 2019 un nouveau petit livre (96 pages, 80 g, 7 euros) : « morales espiègles » dans lequel il parle de rire, de chahut, de dialogue entre Petite Poucette et Grand papa ronchon.
Dans l’émission, il oppose « le rire doux » celui qui moque sans volonté de faire du mal, la farce, le canular et le « rire dur » celui qui peut tuer :
« J’ai publié morales espiègles pour une bonne raison. C’est que quand on met les pieds dans la morale, on parait des donneurs de leçon. C’est emmerdant comme la pluie et c’est inefficace. S’il y a une voie pour l’enseignement de la morale, c’est le rire. C’est une vieille tradition. Molière corrigeait les mœurs en riant. Même la commedia dell’arte, c’est vieux comme le monde. Par exemple, on vous dit : « ne soyez pas menteur ». Ça va quoi…Mais si vous regardez une comédie qui s’appelle « le menteur » vous riez de la première réplique à la dernière…Il ment, on pose une question, il est obligé de mentir plus et encore plus, de sorte qu’à la fin tout est cul par-dessus tête.
Si vous écoutez cela, vous allez dire : « mais mon Dieu si je mens je vais m’embarquer dans une galère terrible ». Et là, c’est efficace. […]
Dans les réseaux sociaux il peut y avoir une telle calomnie qui prend de l’importance que celui qui en est victime peut prendre des décisions extrêmes qui est de se suicider. Le rire dur c’est la calomnie, c’est ultra critique. On rit ad hominem, sur la personne même.
J’ai parlé du « menteur », c’est un fantoche, c’est un personne de théâtre, c’est un acteur. Ce n’est pas lui qui est en cause mais le personnage qu’il représente »
Il dit aussi que nous avons toujours un peu d’agressivité en nous, et il ajoute :
« La seule règle morale que je connaisse, transformer notre agressivité en action, en travail, en créativité. »
Quand on l’emmène sur le terrain politique il explique que :
« Les institutions sont désadaptées par rapport à l’état actuel du monde […]
Nous sommes en train de vivre une période exceptionnelle de l’Histoire.
On a vécu 70 ans de paix, l’espérance de vie a cru jusqu’à 80 ans, la population paysanne est passée de 75 à 2 %… Par conséquent, toutes les institutions que nous avons créées l’ont été à une époque où le monde n’était pas ce qu’il est devenu. À peu près toutes sont obsolètes. »
Pour lui, le problème vient du fait qu’on n’a pas « réinventé » ces institutions :
« Quand on a fait la Révolution de 89, on avait Rousseau derrière. Aujourd’hui, on n’a personne, et c’est la faute à qui ? Aux philosophes. C’est leur rôle de prévoir ou d’inventer une nouvelle forme de gouvernement ou d’institutions, et ils ne l’ont pas fait. »
Le système actuel lui semble désastreux. :
« L’économie telle que le capitalisme l’a mise en place est catastrophique, au moins du point de vue écologique […] L’économie est en train de détruire la planète. [Mais] les philosophes ne proposent pas un modèle alternatif au modèle capitaliste »
En revanche il est contre le catastrophisme, même éclairé parce qu’il paralyse. Il veut bien dire « Alerte » et même « Alerte rouge ». Mais il reste optimiste et croit à l’action.
Il raconte aussi le début d’internet et de la silicon valley qu’il a vu naître alors qu’il était à Stanford. Il raconte les espoirs qui naissaient alors pour un monde libertaire, un monde plus égalitaire. Mais c’est l’argent qui a tout gâché. Quand on est riche comme les Gafa, on a plus de goût à l’égalité.
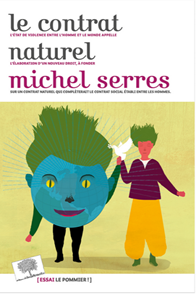 Pour lui la solution qui peut être esquissé c’est celle du droit, le droit est global et international.
Pour lui la solution qui peut être esquissé c’est celle du droit, le droit est global et international.
Il avait écrit un livre « Le contrat Naturel » il y a 30 ans dans lequel il préconisait de faire de la nature un sujet de droit.
Il explique aussi qu’il avait eu une discussion avec le secrétaire général de l’ONU qui lui expliquait qu’il voudrait bien parler de l’eau, des ressources, de la biodiversité mais que les représentants des nations lui disent qu’ils représentent leurs États et leurs habitants pas la nature. D’où cette idée de faire de la nature un sujet de droit.
Or, Michel Serres nous apprend qu’aux États-Unis, le « Lac Erié » est devenu sujet de droit. Ainsi Michel Serres était un précurseur. Car cette évolution signifie que des « représentants » ont pour ce lac « le droit d’ester pour attaquer des utilisateurs abusifs ».
Il conclut :
« Le ‘contrat naturel’ est en train d’arriver dans les mœurs et les habitudes juridiques ».
Mais je ne vais pas retracer tous les échanges, ce serait trop long.
Devant les journalistes qui l’assaillent de question et lui demandent des solutions à tous les problèmes, il répond humblement :
« Ne me posez pas des questions auxquelles je n’ai pas de réponse »
Regardez et écoutez : « Michel Serres – Questions Politiques du 26 mai 2019 »
<1244>
-
Mardi 28 mai 2019
«La peur de l’immigration est une crise de la fraternité humaine»François GemenneRécemment, nous avons eu une discussion sur l’immigration avec Annie. Peu de temps après, elle m’a tendu une revue et m’a dit : « tu devrais lire cet article ».
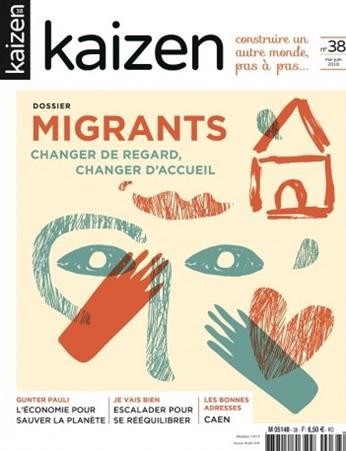 La revue Kaizen est un bimestriel fondé en 2012, entre autre, par Cyril Dion, l’auteur du film « Demain ».
La revue Kaizen est un bimestriel fondé en 2012, entre autre, par Cyril Dion, l’auteur du film « Demain ».
Selon <Wikipedia> :
Le mot kaizen est la fusion des deux mots japonais kai et zen qui signifient respectivement « changement » et « meilleur » [ou « bon »]. La traduction française courante est « amélioration continue ». En fait, par extension, on veut signifier « analyser pour rendre meilleur ».
Dans cette <présentation> du magazine, les auteurs expliquent :
« L’humanité vit des heures décisives : dérèglements climatiques, épuisement des terres arables, disparition en masse des espèces et pollutions généralisées, crises économiques, sociales, financières. Et plus grave encore : abandon de l’être humain. Face à ce constat nous aurions toutes les raisons du monde de désespérer et pourtant, silencieusement, un nouveau monde est en marche : intelligent, sobre, mettant au premier rang de ses priorités l’épanouissement de la Vie sur notre planète. C’est à ce monde que nous choisissons de donner la parole, à ces personnes qui portent les (r)évolutions que nous attendons, courageusement… A ces initiatives pionnières qui, par leur simplicité et leur bon sens, nous offrent de nouveaux horizons, de véritables raisons de croire en l’avenir. Plus que tout, nous croyons qu’il ne peut y avoir de réelle métamorphose de nos sociétés sans un profond changement de ceux qui la constituent : NOUS. »
Avec Annie, nous achetons régulièrement des numéros de ce magazine qui souhaite « construire un autre monde pas à pas »
<Le numéro 38> de mai-juin 2018 contenait un dossier sur les migrants. Et dans ce dossier, l’article dont il est question ci-avant, donnait la parole à François Gemenne, membre du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui enseigne les politiques d’environnement et les migrations internationales à Sciences Po et à l’Université libre de Bruxelles.
Hier, le mot du jour évoquait l’attitude de femmes, dans le cadre d’une communauté éducative, qui confrontées au dénuement et à l’isolement d’une famille de migrants sénégalais ont agi, comme des humains dignes de leur humanité réagissent quand ils voient d’autres humains en souffrance.
Il n’était plus question de migrants, mais d’humains. Il n’était plus question de discours politiques mais de regards qui se croisaient et qui se comprenaient, il n’était plus question de quotas mais de détresse et d’aide.
En 1979, il y eut la crise des boat people d’Indochine. A l’époque la France a recueilli sur son territoire plus de 120 000 réfugiés vietnamiens et cambodgiens qui fuyaient les régimes communistes. Deux grands intellectuels Raymond Aron et Jean-Paul Sartre s’étaient levés pour défendre le principe de l’accueil. Ce moment avait fait l’objet du mot du jour du <28 avril 2015> qui avait rappelé cette phrase de Sartre :
« Parce que ce qui compte ici, c’est que ce sont des hommes, des hommes en danger de mort. »
François Gemenne dénonce des analyses émotives ou instrumentalisées sur la crise migratoire et replace le contexte actuel dans l’histoire des sociétés humaines et de leurs migrations.
Quand on lui parle d’une « crise des migrants », il répond :
« Plus qu’une crise, il y a la perception d’une crise. Si on regarde les chiffres bruts, il n’y a pas d’augmentation substantielle des migrations : le nombre de migrants internationaux reste stable, autour de 3 % de la population mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant 1940, les chiffres étaient beaucoup plus importants, environ 6 à 10 %. La France a connu une lente augmentation : environ 220 000 titres de séjour sont accordés chaque année, chiffre globalement stable depuis quinze ans. Il n’y a donc ni explosion, ni invasion.
Par contre, il y a bien une crise de l’accueil, dans la mesure où les migrants arrivent aujourd’hui dans des conditions de plus en plus difficiles, avec des procédures de plus en plus inhumaines. C’est une crise politique, qui n’a rien à voir avec les flux migratoires. »
Il y a à l’évidence, une crise de l’accueil.
Les pouvoirs publics laissent faire. Je veux dire ; laissent les migrants s’installer dans des conditions d’hygiène indigne, souvent dans les quartiers populaires. Cette manière de faire conduit les habitants de ces quartiers à constater les nuisances de ces installations, constats qui conduisent à l’exaspération.
Est-ce cela qui est souhaité ?
L’accueil des immigrés n’a jamais été simple, particulièrement en France. L’immigration italienne, par exemple, a fait l’objet d’un rejet qui est allé jusque dans les plus grandes violences : <Le massacre des Italiens d’Aigues-Mortes des 16 et 17 août 1893> constitue un fait parmi d’autres.
Mais que dire, lorsqu’on laisse des dizaines ou des centaines de personnes s’entassaient dans des tentes sur des lieux non préparés à cet accueil, au milieu d’habitants qui pour certains puisent dans leur humanité pour aider au mieux mais qui pour la plupart sont effrayés, angoissés ou simplement désemparés.
En tout cas, si on souhaitait créer des tensions et un profond rejet à l’égard des migrants, on n’agirait pas autrement.
Lorsque le journaliste oppose à François Gemenne le fait que les procédures d’asile ont doublé en dix ans, selon les derniers chiffres officiels de l’Ofpra, avec plus de 100 000 demandes en 2017 dont à peine 30 % sont acceptées. Voici sa réponse :
« Il n’y a pas d’évolution linéaire des demandes d’asile : certaines années, il y en a beaucoup, d’autres très peu. Il y a eu un creux historique en 2007, ce qui explique que l’augmentation ait l’air spectaculaire sur dix ans, mais les chiffres étaient quasi identiques (65 000 demandes) entre 2004 et 2014, par exemple. Le nombre de demandes d’asile tient surtout à des conditions exogènes au pays d’accueil : les crises qui frappent certains pays, l’organisation des filières de passeurs qui privilégient telles régions, etc. L’asile reste un instrument humanitaire, cela ne doit pas être un outil de contrôle et de régulation : la France peut décider du nombre de titres de séjour qu’elle donne, pas du nombre de demandes d’asile auxquelles elle accède.
C’est bien là qu’il y a problème : comme on ne pense plus du tout une politique d’immigration, ceux qui veulent venir en France n’ont plus guère que l’asile comme moyen d’y parvenir. Cela crée un engorgement des procédures d’asile, et de l’accueil. Ce qui crée de l’injustice, car beaucoup de gens qui devraient pouvoir recevoir l’asile n’y parviennent plus. C’est comme cela qu’on dévoie l’outil qu’est l’asile. »
Il constate que désormais on n’aborde ce sujet des migrants que sous l’aspect émotionnel :
« Mais on n’aborde plus la situation migratoire que sous cet angle émotionnel, sur un registre de peur ou d’empathie, ce qui crée ce sentiment qu’il y a un problème à régler. On ne voit jamais les migrants dans des situations normales, en train de conduire leurs enfants à l’école ou de faire à manger en famille, car ce n’est pas un élément d’actualité. On continue de les voir comme un groupe social particulier plutôt que comme partie intégrante de la société. »
Il dénonce aussi l’opposition entre les réfugiés et les migrants économiques :
« Je suis né en Belgique et venu travailler en France : je suis donc un migrant, à Paris. Mais quand on parle des migrants dans les médias, on ne parle jamais de moi – ni de tous les chercheurs, cadres dans les multinationales ou époux de conjoint français. Pourquoi ? Probablement car je suis blanc et catholique. Le mot « migrant » est devenu un terme racialisé, qui désigne par-là les noirs, les Arabes et les musulmans. C’est comme cela qu’on en fait un thème qui va cristalliser un certain nombre d’angoisses, alors que c’était jadis un terme connoté très positivement : les migrants étaient des aventuriers, ceux qui avaient le courage de partir et de chercher une vie meilleure. D’ailleurs, en Afrique ou en Asie, cela reste un terme plutôt élogieux pour désigner ceux qui ont réussi à dépasser les difficultés en allant voir plus loin.
Mais en Europe, le terme a été complètement dévoyé depuis au moins trente ans pour être assimilé à une anomalie. Avec la crise des réfugiés syriens, face à la nécessité humanitaire de les accueillir, les gouvernements ont monté en épingle une vieille dichotomie entre d’un côté le « bon » migrant, qui serait le réfugié politique, persécuté dans son pays et dont la présence en Europe est de ce fait légitime, et de l’autre, le « mauvais » migrant, celui qui décide volontairement de migrer pour des raisons économiques et qu’il faut donc renvoyer chez lui. Comme si, pour renforcer l’acceptabilité sociale des réfugiés aux yeux de l’opinion publique, il fallait forcément le faire aux dépens des migrants. Alors qu’en réalité, les réfugiés sont simplement une catégorie particulière de migrants, nécessitant une protection particulière. »
Il explique pourquoi selon lui cette distinction « réfugiés », « migrants économiques » n’est plus pertinente :
« Parce qu’elle est héritée d’une histoire qui n’offre plus les bonnes lunettes pour comprendre le monde actuel. L’essentiel de notre régime politique et juridique sur les migrations vient de la Seconde Guerre mondiale : la Convention de Genève est créée en 1951 pour protéger les Juifs déplacés en Europe. Il y avait une condition de temps et d’espace. Par la suite, en 1967, un protocole additionnel ouvre le concept de réfugiés à des populations touchées par d’autres guerres ou violences, ailleurs, à la suite des crises de la décolonisation notamment. Mais on reste sur ce vieil instrument. Dans le même temps, les années 1950 et 1960 connaissent d’importantes migrations économiques : les pays du Nord – la France, la Belgique, l’Allemagne – achètent des travailleurs en Espagne, en Italie, au Maroc ou en Algérie pour aller dans les mines. Il y avait donc des parcours très linéaires et relativement simples : les réfugiés déplacés par les guerres, et […] les travailleurs invités qu’on faisait venir volontairement. Aujourd’hui, cela ne se passe plus du tout comme ça. Les flux sont complètement éclatés dans le temps, avec différents motifs de migrations qui s’imbriquent les uns dans les autres. Non seulement les gens ne bougent plus directement d’un pays vers un autre, puisqu’ils passent par toute une série de pays, mais en plus ils ne migrent plus pour un seul motif. Les raisons politiques, économiques et environnementales se mêlent les unes aux autres : l’environnement est devenu un enjeu géopolitique majeur, et les tensions économiques débouchent sur des crises politiques.
Le problème, c’est qu’on ne s’intéresse pas du tout aux parcours des migrants avant qu’ils n’embarquent sur un bateau en direction de l’Europe : on ne se rend pas compte qu’il y a des mois, parfois des années, d’errance à travers plusieurs pays. Souvent, le pays qui termine le parcours n’est pas celui qui était pensé comme destination finale, à l’origine. La plupart des migrants de la Corne de l’Afrique n’ont pas pour projet de terminer en Europe : ils quittent leur campagne pour trouver un boulot dans la ville la plus proche, mais n’en trouvant pas, ils franchissent la frontière pour aller dans le pays voisin, dans lequel ils tombent sous la coupe d’un gang de passeurs, qui leur ont fait miroiter un job en Libye, où ils finissent persécutés, réduits en esclavage, violentés ou torturés… […]. Cette distinction sur le motif des migrations n’a plus de sens aujourd’hui, c’est juste une façon, en Europe, de rationaliser un discours politique face à ce qui est perçu comme une crise insurmontable. Or non seulement cette catégorisation n’a guère de sens de manière empirique, mais elle pose toute une série de problèmes éthiques.
Prenons le cas de la population africaine : la moitié dépend de l’agriculture qui est sa principale source de revenus. Ça veut dire que toute variation de température ou de pluviométrie peut avoir une incidence considérable sur les récoltes et donc sur ses conditions de vie. Pour elle, l’environnement et l’économie, c’est la même chose ! En Europe, nos bulletins de salaire à la fin du mois ne dépendent quasiment plus du climat, mais on ne se rend pas compte que dans le reste du monde, les revenus restent directement affectés par les conditions environnementales. Et qu’à ce titre, un migrant économique est aussi souvent un migrant environnemental. […]
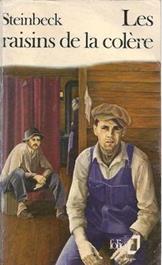 C’est l’histoire de la famille Joad que Steinbeck raconte dans Les Raisins de la colère. Dans les années 1930, la grande sécheresse appelée le « Dust bowl » en Oklahoma, en Arkansas et au Texas a poussé entre 200 000 et 300 000 personnes, essentiellement des paysans, à tout quitter pour aller vers la Californie. À l’époque, il n’y a rien en Californie, à part quelques chercheurs d’or. L’exode est un calvaire, les conditions sont extrêmement difficiles et les migrants sont très mal accueillis. Pourtant, si c’est devenu aujourd’hui l’État le plus prospère et le plus peuplé des États-Unis – et la 5e économie mondiale, devant la France ! – c’est à ce peuplement migratoire que la Californie doit cette richesse. »
C’est l’histoire de la famille Joad que Steinbeck raconte dans Les Raisins de la colère. Dans les années 1930, la grande sécheresse appelée le « Dust bowl » en Oklahoma, en Arkansas et au Texas a poussé entre 200 000 et 300 000 personnes, essentiellement des paysans, à tout quitter pour aller vers la Californie. À l’époque, il n’y a rien en Californie, à part quelques chercheurs d’or. L’exode est un calvaire, les conditions sont extrêmement difficiles et les migrants sont très mal accueillis. Pourtant, si c’est devenu aujourd’hui l’État le plus prospère et le plus peuplé des États-Unis – et la 5e économie mondiale, devant la France ! – c’est à ce peuplement migratoire que la Californie doit cette richesse. »
Il considère qu’il serait illusoire de vouloir fixer les populations humaines :
« C’est à rebours de l’Histoire. Les flux migratoires sont comme le jour et la nuit : on peut éclairer les rues tant qu’on veut avec des projecteurs, on n’empêchera pas la nuit de succéder au jour. Idem, on peut mettre tous les barbelés et les garde-frontières du monde, l’immigration continuera d’exister. Cette idée qu’on ne contrôle pas les flux est très difficile à faire passer. […]
Les frontières sont devenues des totems symboliques. On reste encore pénétrés par cette idée que le degré d’ouverture détermine les flux migratoires mondiaux : si on ouvre, tout le monde va venir, si on ferme, plus personne ne viendra. C’est une méconnaissance totale de la réalité du projet migratoire : jamais un migrant ne va se décider à partir parce qu’une frontière est ouverte en Europe. Et à l’inverse, il ne renoncera pas parce qu’une frontière est fermée. »
Il prétend que « l’appel d’air » est un mythe :
«L’appel d’air est un concept d’extrême droite qui est entré dans le vocabulaire courant : toutes les recherches sont unanimes depuis des années pour affirmer que cela n’existe pas. Les conditions d’accueil et d’aides sociales ne déterminent absolument pas le pays de destination pour un migrant : personne ne vient à Calais parce qu’on y installe des douches… C’est une décision extrêmement difficile de migrer, ça implique de quitter sa famille, c’est aussi un investissement qui coûte très cher et c’est donc une possibilité qui s’offre à une toute petite minorité de la population mondiale.
Tout le monde ne veut pas venir ici, c’est une vision très eurocentrée. Quand on regarde un panorama mondial des flux migratoires, on n’a pas du tout cette impression de crise : il y a un certain équilibre entre les régions du monde, et la plupart des migrations africaines vont vers l’Afrique, et non vers l’Europe comme on se l’imagine souvent. Le plus grand flux d’émigration, il est du sud vers le sud – soit environ 35 % des migrations mondiales. D’ailleurs, un flux migratoire en forte augmentation ces dernières années, c’est celui du nord vers le sud – et non l’inverse. De plus en plus d’Européens pensent qu’ils vont avoir une meilleure vie s’ils migrent dans des pays africains ou asiatiques. Malgré tout, ce sentiment de crise et d’invasion est très vivace, en Europe. »
Sa conclusion est que la peur de l’immigration est nourrie par nos craintes devant notre identité collective et constitue une crise de la fraternité humaine :
« L’immigration interroge des peurs autour de notre propre identité collective, ce qui définit le « nous » et ce qui définit l’autre, le « eux » – Sarkozy a très bien senti cela quand il crée un ministère de l’immigration et de l’identité nationale, en 2007. C’est pour cela qu’il y a une telle obsession autour des frontières actuellement, parce que c’est le moyen de marquer concrètement, sur le territoire, le « nous » et le « eux ». Il y a une logique de repli où chacun voudrait être une petite Grande-Bretagne, à gérer ses propres affaires sur son territoire, sans prendre en compte l’impact que cela a partout dans le monde. C’est pour ça que l’enjeu environnemental rejoint directement celui des migrations. Cette crise de l’identité collective est une crise du cosmopolitisme, dans laquelle on n’arrive plus à se penser comme des humains habitant la même planète. C’est une crise de la fraternité humaine. »
Voilà ce que dit et écrit François Gemenne.
Cependant comme je l’écrivais ci-avant, l’immigration et l’accueil des immigrants n’ont jamais été simples. En plus, aujourd’hui, s’il n’y a pas de crise de l’immigration, il y a au moins une crise de notre État social.
Nos gouvernants ne cessent de marteler que notre État social coûte trop cher. Alors même si dans les faits, il peut être affirmé que l’immigration ne coûte quasi rien à notre État social, comment ne pas comprendre que cette crainte d’un coût excessif puisse exister.
Il y a aussi une crise de notre société, crise du chômage et crise de l’intégration, crise de la fragmentation de notre société. Toutes difficultés qui augmentent la crainte d’accueillir.
La thèse d’ouvrir totalement les frontières comme le préconise François Gemenne me pose question. La vieille formule de Michel Rocard : « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit prendre sa part », ne serait-elle pas plus appropriée ?
C’est pourquoi la manière dont on traite aujourd’hui les migrants qui sont sur notre territoire est indigne et ne règle en rien le problème. Sur ce point comme sur d’autres, je rejoins François Gemenne.
<1243>
-
Lundi 27 mai 2019
« Une histoire simple »Une histoire racontée sur twitterUne histoire simple est un film de Claude Sautet avec Romy Schneider.
Ce titre s’est imposé à moi comme exergue pour partager une histoire lue sur twitter et écrit par Vincent qui raconte ce qu’il comprend de ce que fait sa mère qui est Principale de collège.
Ce sont des faits, rien que de faits.
Je la partage sous la forme des tweets.
vincent @WaveDock
24 mai 13:08
J’invite ma mère au restaurant ce soir pour la fête des mères. On parle de nos vies, nos boulots. Je la sens un peu préoccupée. J’insiste. Et là, elle me raconte ce qui lui « pèse » depuis plusieurs semaines.
En Janvier, elle a commencé à s’intéresser à une fille sénégalaise de 12 ans fraîchement débarquée dans le collège de la ville avec sa famille. Rapprochement familial, des évènements de la vie les amènent dans ce bled pommé au nord de Lyon.
Les 4 enfants sont scolarisés, mais les parents sont sans emploi, sans domicile, vivent à l’hôtel du patelin où le tenancier leur loue une chambre de 4 (pour 6) à un tarif défiant toute concurrence, mais sans aucun service. Pas de lessive, pas de changement des draps. Rien.
Ma mère rencontre les parents après des signes suspects sur la fille de 12 ans. Mauvaise hygiène, comportement bizarre … Et elle découvre la situation. Pas de salaire, la manche, payer l’hôtel à tout prix pour ne pas finir à la rue.
Ni une ni deux, ma mère saisit toutes les institutions, organismes, associations du coin. Rien. Alors elle commence elle-même à donner de sa personne. Elle commence par faire un CV au père de la famille. À chercher des appartements dans le coin.
Elle utilise son réseau pour démarcher des propriétaires du coin pour un logement. Se propose en caution solidaire pour l’appartement. Envoie des CV. Fait des lettres de motivation « en laissant deux ou trois fautes histoire de … ».
Bref, à ce moment là, ma mère est déjà une héroïne pour moi. Je vous passe les troubles scolaires des enfants, les messages racistes que cette gamine reçoit de camarades de collège « parce qu’elle pue », des histoires de Snapchat screenshotés.
Et puis on finit la conversation là-dessus. La situation se décante. Le père a trouvé un travail en 3×8, ma mère a trouvé un ami qui lui a vendu une vieille 205 à 300€. Ils ont une touche sérieuse pour un appart’. La fille de 12 ans va mieux.
On arrive chez ma mère dans son logement de fonction. Parce que ma mère est principale de collège, fonctionnaire de l’Éducation Nationale. Et cette gamine de 12 ans est une élève.
Dans le couloir de l’entrée je vois 2 gros sacs poubelle. Je lui demande « tu fais un ménage de printemps ? », et là elle me regarde et me dit « non, avec ma CPE on ramène leur linge les weekends pour le laver, ils sont 6 alors tu comprends … »
J’ai rien pu faire d’autre que lui faire un gros câlin. Ma mère gère depuis des années la misère sociale en étant au contact des gamins de familles au bord du gouffre. Mais jamais autant qu’aujourd’hui. Et jamais son rôle n’a été aussi important.
Bref, ma mère est la meilleure du monde et si j’entends encore quelqu’un parler en mal des fonctionnaires, je le déssoude.
J’ai oublié tout un tas d’éléments, mais la CPE en question fait les lessives en cachette, parce que son mari en a marre qu’elle soit la justicière en chef, se flingue la santé à faire du bénévolat partout et tout le temps.
La secrétaire italienne de ma mère a un jardin et un mari retraité qui jardine beaucoup, alors elle ramène tous les deux jours des pleins bacs de soupe pour eux, et quand elle a le temps elle leur prépare des lasagnes.
Les « dames de la cantine » planquent des barquettes de plats non entamées pour leur donner. Ce qui peut au passage leur valoir leur poste : « Quand c’est des frites les gosses mangent tout alors elles leur gardent du pain ».
Aaaaaah j’arrête j’ai les yeux qui piquent. Mais quelles femmes. <3
Vous avez été nombreux à le demander. En DM, par message Instagram, en mentions. Avec concertation avec ma mère, nous leur mettons en place une cagnotte Leetchi : https://www.leetchi.com/c/le-combat-de-grandes-femmes …
Dans le mot du jour du mercredi 27 mars 2019, je citais Christophe André : « Notre société ne tient que grâce aux gens gentils.».
<1243>
-
Vendredi 24 mai 2019
« Il faut sauver notre baraque européenne ! »Edgar Morin.Edgar Morin a 97 ans. C’était un résistant.
 Il est sociologue, philosophe, théoricien de la pensée complexe.
Il est sociologue, philosophe, théoricien de la pensée complexe.
C’est un sage.
Le Point est allé l’interviewer à Montpellier et a publié <cet entretien> le 22/05/2019
A la question : L’Europe est-elle en danger, il répond
« Je suis tellement pessimiste sur ce sujet, les craintes sont si fortes.
J’espère que ce scrutin ne va pas aggraver le risque, sinon d’une dislocation, du moins d’une fossilisation européenne.
L’Europe est sclérosée. L’Europe est trop bureaucratisée.
L’Europe est sous l’empire des puissances financières. Elle est soumise à des forces centrifuges, les pays de l’Est regardant ailleurs que ceux de l’Ouest.
Elle est menacée par des régimes néo-autoritaires qui se sont déjà installés à ses frontières avec la Turquie et la Russie et à l’intérieur d’elle-même avec la Hongrie.
D’autres pays, dont la France, sont sous cette menace.
Notre Union européenne subit la pression de forces de dissolution. Bien entendu, il subsiste des structures économiques qui font en sorte que beaucoup de pays dépendant de l’économie européenne ne puissent faire sécession. Mais, de toute façon, l’Europe est en danger, et la plus immédiate des menaces qui pèsent sur elle est que son Parlement se retrouve sous le contrôle d’une majorité anti-européenne.
Il n’est plus question désormais de revitalisation, de régénération de l’esprit européen.
Aujourd’hui, il s’agit de sauver la baraque ! Que chacun vote selon sa conscience !
Il fait remonter la crise européenne essentiellement à la guerre de Yougoslavie en 1991. Après la chute des dictatures communistes des pays de l’est, une nouvelle guerre a déchiré les Balkans et donc l’Europe. Et une fois de plus, les européens ont été incapables d’y mettre fin sans que les Etats-Unis n’interviennent comme en 1918, comme en 1945 :
« Mais, pour moi, le ver était dans le fruit, si je puis dire, bien avant : depuis la guerre en Yougoslavie en 1991.
La Yougoslavie était un microcosme de l’Europe. C’était un pays multiculturel en voie d’accomplissement. Sa population slave comptait des Serbes orthodoxes, des Croates catholiques, des Bosniaques en partie musulmans et une minorité juive.
Mais la crise du communisme a laissé se propager les nationalismes croates et serbes, lesquels ont provoqué une guerre fratricide épouvantable.
L’Allemagne a soutenu en sous-main les Croates, Mitterrand, très maladroitement, les Serbes, les Bosniaques ont été abandonnés.
Qui a arrêté la guerre ? Les Américains.
De la même manière que, plus tard, ils interviendront pour régler la question du Kosovo. Dès cette époque-là, l’Europe a fait preuve d’impuissance politique diplomatique et militaire. La cohésion des nations a eu pour stimulant le danger d’un ennemi extérieur. L’Europe a trouvé son ennemi à l’intérieur d’elle-même. Il n’y a pas eu d’organisme européen, seulement un squelette auquel il manque la chair.
La tragédie est que l’Europe aura de plus en plus un destin commun dans un monde dominé par d’énormes puissances, mais qu’elle est de moins en moins capable de l’assumer. »
Nous sommes vraiment au centre d’une tragédie.
Les Etats comme la France, mais aussi l’Allemagne n’ont plus l’envergure pour maîtriser leurs destins. D’une part le monde de demain appartient aux empires, c’est-à-dire aux entités humaines qui se déploient sur de grands espaces, avec une population importante et un pouvoir fédérateur ou même pour la Chine un pouvoir central fort. En face de ces puissances, seule une Europe parlant d’une voix homogène et décidée peut s’imposer et rester maître de son destin.
Et de manière encore plus essentielle, le défi climatique, le défi du vivant et de la biodiversité, le défi de l’énergie et des ressources ne peuvent être raisonnablement maîtrisés qu’à l’échelle de l’Union européenne.
Mais nous sommes si loin du but, tellement occupé par nos querelles intestines qu’il apparaît que nous passions à côté de l’essentiel.
Edgar Morin est, je crois comme nous tous, désabusé par le vide de la campagne européenne.
« Je ne suis pas certain que l’on puisse parler de campagne. J’observe tous ces jeux avec une certaine inquiétude. Et ce qui aggrave mon inquiétude est que l’impasse européenne actuelle n’est qu’un aspect d’une crise plus globale, planétaire. Il est dommage que nous n’ayons pas réussi à créer un modèle qui, tout en sauvegardant les nations, parvienne à les confédérer, voire à les fédérer.
[La multiplication des listes] est un aspect d’une décomposition de la pensée politique plus générale. Nous avons perdu l’idée d’une nouvelle voie politique qui aurait permis à l’Europe de surmonter sa crise et de mettre en place un modèle créatif. La pluralité de toutes ces listes montre que, faute d’une pensée commune qui relie, les candidats se dispersent sur des questions de clans et de personnes. »
Comme souvent au cours de ces dernières années, Edgar Morin fait appel à la célèbre phrase de Hölderlin qu’il aime répéter :
« Mais, comme le dit le poète et philosophe allemand Friedrich Hölderlin, « là où croît le péril croît aussi ce qui sauve ». Peut-être qu’au bord de l’abîme il y aura un sursaut, je n’en sais rien, j’ai peur que non. Mais c’est là le seul espoir qu’il nous reste à nous, Européens désabusés. »
En Europe, entre les nations comme au niveau de notre quotidien, je suis persuadé que la solution ne pourra pas venir principalement de l’esprit de compétition, mais de notre capacité à coopérer, à réaliser des choses ensembles non pour des destins individualistes mais pour des objectifs qui nous dépassent, sont plus grands et plus importants que nos egos.
Et bien sûr, malgré la vacuité de la campagne, il faut aller voter ce dimanche.
<1242>
-
Jeudi 23 mai 2019
« Les européennes»Élections auxquelles nous sommes appelés dimanche prochainHier soir, je n’avais pas de mot du jour pour ce jeudi et j’ai commis l’erreur de vouloir regarder le débat des européennes sur la 2.
 Je crois que ce chat, au moment de la photo, était en train de regarder quelque chose d’analogue.
Je crois que ce chat, au moment de la photo, était en train de regarder quelque chose d’analogue.
En tout cas, ce débat ne m’a donné aucune inspiration d’un mot du jour.
Alors je me retourne vers un article des Echos : « tout savoir sur le scrutin en 7 points »
On apprend que 400 millions d’électeurs sont appelés aux urnes, et c’est ainsi la deuxième plus grande élection au monde après l’Inde en nombre d’électeurs.
On parle bien sûr des démocraties, la Chine ne joue pas dans cette cour.
Ce scrutin est le neuvième de l’Histoire de l’Union européenne.
Dans tous les pays, les eurodéputés sont élus à la proportionnelle sur un scrutin de liste.
Dans beaucoup de pays c’est la règle pour les principales élections. Mais pas en France où nous connaissons surtout le scrutin majoritaire à 2 tours. Ni en Grande Bretagne où le scrutin majoritaire à 1 tour constitue la règle.
Ce qui signifie donc que nous français sommes assez mal préparés à ce type de scrutin.
Nous avons un système que j’ai déjà décrit au moment des dernières élections présidentielles, qui par la combinaison de trois éléments : le scrutin majoritaire à 2 tours, l’omnipotence du président de la république et l’ordre des élections, c’est-à-dire d’abord l’élection présidentielle puis l’élection législative réalise ce tour de passe-passe qu’un parti qui représente 24% des voix peut obtenir un pouvoir majoritaire qui n’a besoin de tenir nul compte des 76 % du reste du pays.
Ce n’est absolument pas envisageable dans le cadre d’un scrutin proportionnel qui oblige à des alliances et à des compromis avec d’autres partis.
C’est pourquoi la notion de « vote utile » (pour éviter un second tour dont on ne veut pas) ou la compétition pour savoir quelle est la liste qui arrive en tête, alors que les deux premières listes selon les derniers sondages devraient obtenir à une unité près le même nombre de députés, n’a pas beaucoup de sens.
Il pourrait cependant être question de vote utile si l’on considère que le vote devient inutile s’il n’y a pas de doute qu’aucun parlementaire ne sera élu sur la liste sur laquelle il s’est porté. Ainsi en France, il faut 5% des votes exprimés pour avoir des parlementaires.
Le journal des Echos publie une carte qui montre que si la France n’est pas la seule à donner ce seuil d’autres pays ont des seuils plus faibles. Et l’Allemagne, le Danemark, les Pays-bas, l’Espagne et le Portugal ne disposent d’aucun seuil.
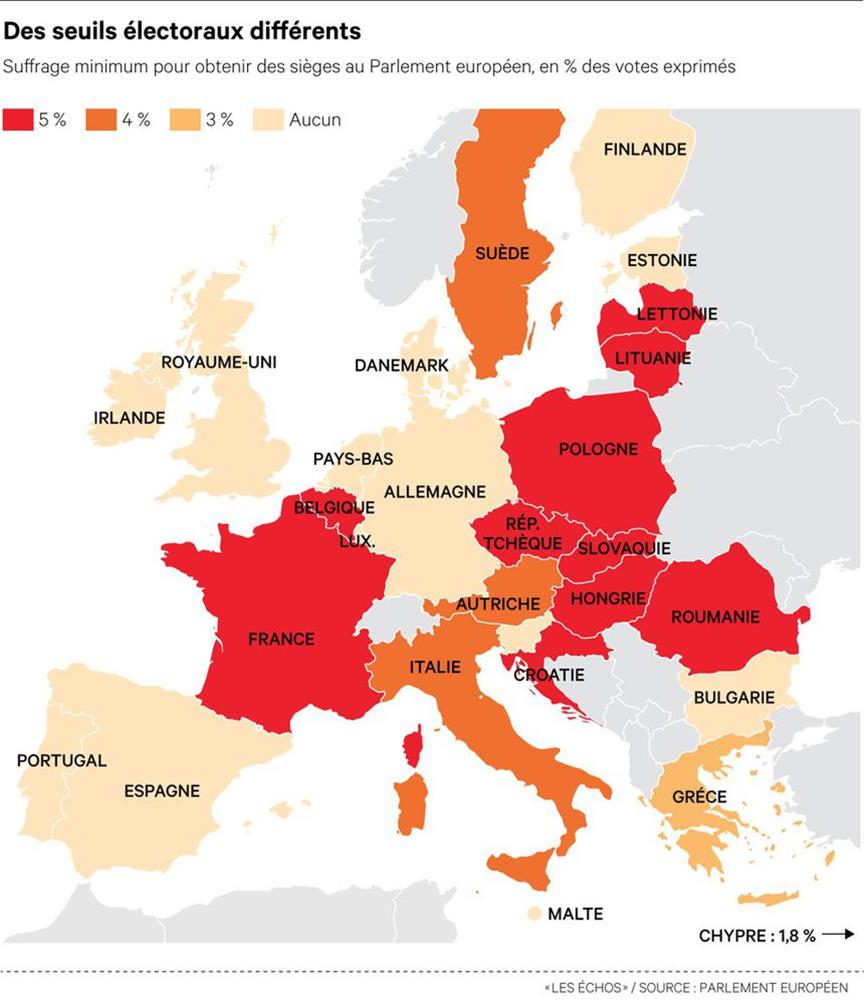
En France, nous voterons le dimanche 26 mai, comme 20 autres pays.
Mais certains peuples voteront avant, les Pays bas et le Royaume Uni commenceront aujourd’hui le jeudi 23 mai. Le 24 mai viendront le tour de la République Tchèque et de l’Irlande. Le 25 mai ce sera la Slovaquie et quelques autres.
On apprend aussi que seule l’Estonie permet de voter en ligne.
Parmi les autres informations que m’a apportées cet article j’ai appris que si la France et quatorze autres pays permettent à des candidats ayant 18 ans à se présenter, il faut avoir 25 ans en Grèce et en Italie.
Le Parlement compte aujourd’hui 751 sièges, qui ont été répartis selon un principe de proportionnalité dégressive, selon la population des pays. Mais les plus petits pays ont été favorisés afin de ne pas être représentés par moins de 6 élus.
« Le Brexit, lorsqu’il aura lieu (s’il a bien lieu), va modifier cette répartition. Exit les 73 sièges alloués au Royaume-Uni : 27 d’entre eux seront redistribués à 14 pays pour refléter des changements démographiques. Les 46 autres sièges seront gardés en réserve en cas d’intégration de nouveaux pays dans l’UE.
Et en attendant le Brexit, ces 27 sièges redistribués seront donc alloués à des députés… en suspens . Ces derniers seront bien élus mais ils ne pourront occuper leur siège que lors du départ de leur prédécesseur britannique. »
Le plus important reste cependant que pour agir au Parlement européen il faut appartenir à un groupe politique. . Pour former un groupe, il faut compter au moins 25 membres, qui ont été élus dans au minimum sept pays. C’est ce qui a longtemps posé problème au Front National qui a su coaliser 25 membres pour un groupe mais pas dans 7 pays.
Depuis longtemps c’est la coalition du Parti populaire européen (PPE), de droite, et du Parti Socialiste européen (PSE) de gauche qui a dirigé le parlement.
Le PPE est le lieu d’accueil du CDU-CSU allemand et des RPR, UMP, les républicains français, mais non des conservateurs anglais. Le PSE dont le nom de groupe est « Alliance progressistes et démocrates » accueille le PS français, le SPD allemand et les autres partis socialistes européens.
Un autre schéma publié par les Echos présente le Parlement actuel.
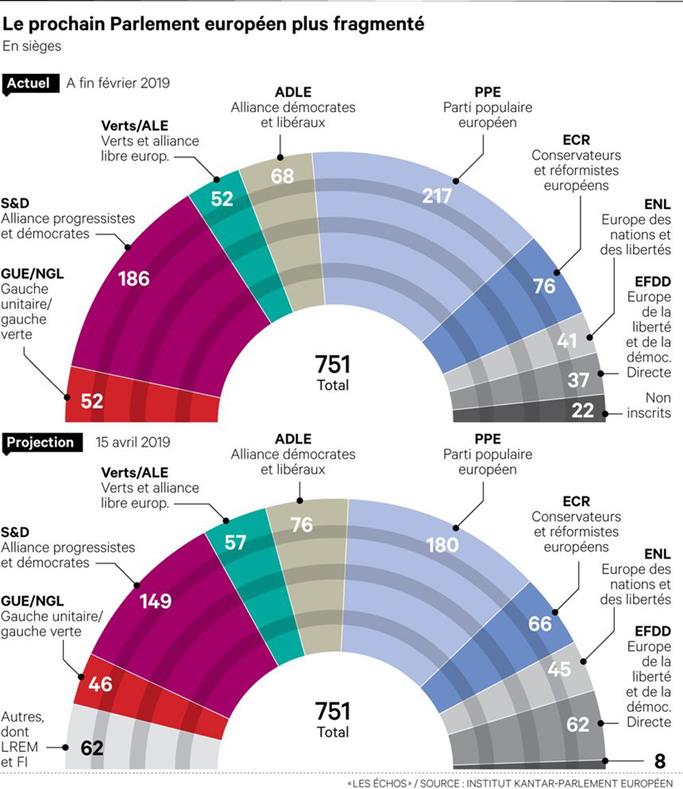
A priori les élus macronistes auraient l’intention de siéger avec l’Alliance démocrates et libéraux.
On constate tout de suite la modestie du positionnement.
Cela n’a rien à voir avec la 5ème République.
On constate ainsi mieux pourquoi le fait de savoir qui de LREM ou de RN recueille 1 % de plus que l’autre est dérisoire. Ce n’est pas ainsi que la France pourra influer sur le Parlement européen.
Le Point a publié un article : <Pourquoi la France a déjà perdu les européennes>
<1241>
-
Mercredi 22 mai 2019
« Si bien que s’il existe une éthique en tant qu’être humain.C’est d’être digne de ce don sublime d’être vivant. »Alain DamasioLe 13 mai 2019, Michelle a écrit à Annie et à moi un courriel, dans lequel, sans autre précision elle a écrit :
«J’ai envie de partager ce texte d’Alain Damasio.
Bel aujourd’hui »
Voici ce texte :
« Celle qui bruisse
Le vivant n’est pas une propriété, un bien qu’on pourrait acquérir ou protéger.
C’est un milieu, c’est un chant qui nous traverse dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés.
Si bien que s’il existe une éthique en tant qu’être humain.
C’est d’être digne de ce don sublime d’être vivant.
Et d’en incarner, d’en déployer autant que faire se peut les puissances.
Qu’est-ce qu’une puissance ?
Une puissance de vie !
C’est le volume de liens, de relations qu’un être est capable de tisser et d’entrelacer sans se porter atteinte.
Ou encore c’est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables
Vivre revient alors à accroitre notre capacité à être affecté.
Donc notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému.
Contracter une sensation, contempler, habiter un instant ou un lieu.
Ce sont des liens élus.
A l’inverse, faire face à des stimulus et y répondre sans cesse pollue notre disponibilité.
L’économie de l’attention ne nous affecte pas, elle nous infecte.
Elle encrasse ces filtres subtils sans lesquels il n’est pas de discrimination saine entre les liens qui libèrent et ceux qui aliènent.
Nos puissances de vivre relèvent d’un art du lien qui est déjà en soi une politique.
Celle de l’écoute et de l’accueil, de l’hospitalité au neuf qui surgit
Si bien qu’il devient crucial d’aller à la rencontre.
A la rencontre aussi bien d’un enfant, d’un groupe, d’une femme que de choses plus étranges…
Comme rencontrer une musique qui trouble, un livre intranquille, un chat qui ne s’apprivoise pas, une falaise.
Côtoyer un arbousier en novembre.
Epouser la logique d’une machine.
Rencontrer une lumière, la mer, un jeu vidéo, une heure de la journée, la neige.
Faire terreau pour que les liens vivent.
Des liens amicaux ou amoureux.
Collectifs et communautaires bien sûr.
Mais au-delà, et avec plus d’attention encore, les liens avec le dehors, le pas de chez nous.
L’autre soi !
Avec l’étranger d’où qu’il vienne.
Et plus loin encore, hors de l’humain qui nous rassure, les liens avec la forêt, le maquis, la terre,
avec le végétal comme avec l’animal, les autres espèces et les autres formes de vie.
Se composer avec, les accepter, nouer avec elles, s’emberlificoter.
C’est un alliage et c’est une alliance.
Peut-être n’est-il qu’une seule révolte au fond : contre les parties mortes en nous.
Cette mort active dans nos perceptions saturées de pensées qu’on mécanise.
Nos sensations éteintes.
Être du vif.
Relever du vif.
Devenir moins celui qui brûle que celle qui bruisse
Amener au point de fusion et de puissance
Pour en offrir l’incandescence à ceux qu’on aime. »
<Alain Damasio> est né le 1er août 1969 à Lyon. C’est un écrivain de science-fiction.
Je ne le connaissais pas, avant de faire des recherches sur lui, après le message de Michelle.
Il est connu pour son ouvrage <La Horde du Contrevent>, qui remporte le grand prix de l’Imaginaire en 2006.
Il vient de publier un nouveau roman « Les furtifs», c’est la raison pour laquelle Augustin Trapenard l’a invité dans son émission <Boomerang du 13 mai 2019>.
Augustin Trapenard présente ce dernier opus ainsi :
« Un roman plus ambitieux que jamais, « Les furtifs ». À travers le portrait futuriste et glaçant d’une société régie par la finance, l’hyper connexion, et l’auto aliénation c’est d’aujourd’hui qu’il nous parle. […] il dresse le portrait d’une société dans laquelle la finance et la technologie ont pris le pas sur l’humain et le vivant. »
 Il parle bien sûr de son livre qui décrit un monde dans lequel la finance achète tout et où les humains sont enfermés dans les traces qu’ils laissent sur la toile. Il a inventé un concept : «Le techno-cocon» et il ajoute que le techno-cocon est une prison. La technique numérique nous entoure comme un cocon qui nous capture.
Il parle bien sûr de son livre qui décrit un monde dans lequel la finance achète tout et où les humains sont enfermés dans les traces qu’ils laissent sur la toile. Il a inventé un concept : «Le techno-cocon» et il ajoute que le techno-cocon est une prison. La technique numérique nous entoure comme un cocon qui nous capture. Il imagine aussi que nos grandes villes qui sont endettées font faillite et sont rachetées par des multinationales. Ainsi Nestlé a fait de Lyon NestLyon, Paris est devenu Paris-LVMH, et Orange, la ville où débute l’histoire, s’appelle toujours Orange… parce que l’opérateur téléphonique l’a rachetée.
Dans ces « villes libérées », l’impôt, « optionnel », permet d’acquérir des niveaux de citoyenneté : standard, premium ou privilège. Certaines avenues, certains parcs sont réservés aux citoyens privilège. La consommation et la publicité sont partout ; les individus, connectés, « bagués » comme des pigeons et traçables en permanence. Ceux qui sortent des rails voient leur note personnelle dégradée, ou un drone les taser. Les milices privées pourchassent l’enseignement gratuit des « proferrants », au motif qu’il viole le droit commercial.
Vous pouvez aussi lire <cet article> sur le livre les Furtifs et écouter cette autre émission de France Culture : <La Méthode scientifique du 18/04/2019>.
Et à la fin de l’émission, Augustin Trapenard offre une carte blanche de 3 minutes à Alain Damasio qui remplit ce temps par ce texte qu’il lit, texte inédit qu’a envoyé Michelle pour que nous puissions le partager
J’ai choisi comme exergue de ce mot du jour l’extrait suivant :
« Si bien que s’il existe une éthique en tant qu’être humain.
C’est d’être digne de ce don sublime d’être vivant. »
Mais j’ai beaucoup hésité.
Que pensez-vous de ?
« Vivre revient alors à accroitre notre capacité à être affecté.
Donc notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému. »
Ou encore :
« L’économie de l’attention ne nous affecte pas, elle nous infecte.
Elle encrasse ces filtres subtils sans lesquels il n’est pas de discrimination saine entre les liens qui libèrent et ceux qui aliènent. »
Et cette fin remarquable :
« Devenir moins celui qui brûle que celle qui bruisse
Amener au point de fusion et de puissance
Pour en offrir l’incandescence à ceux qu’on aime. »
Merci à Alain Damasio pour ce texte incandescent.
Merci à Michelle pour ce partage.
<1240>
-
Mardi 21 mai 2019
« Ordos, la ville fantôme »Un exemple de la folie des hommesHier, j’esquissais l’effroyable prédation qu’homo sapiens exerce sur la terre, sans tenir compte du vivant non humain dont il a pourtant besoin pour sa survie.
Dans sa démesure, il arrache à la nature ou aux terres arables des millions d’hectares, utilise des millions tonnes de ressources pour bâtir et construire des villes, des complexes industriels, des aéroports et autres œuvres de son imagination.
Cet aveuglement devant les limites de ce que peut offrir la terre devient folie quand en plus de la démesure, il construit pour rien, sans ce que cela ne présente même une utilité ou un sens.
L’Europe, notamment l’Espagne n’a pas été exempte de cette folie.
Mais aujourd’hui, je voudrais partager un exemple chinois qui en compte de nombreux, semble t’il. Il s’agit d’Ordos en Mongolie-Intérieure.
 Comme nous l’apprend <ce site> :
Comme nous l’apprend <ce site> :
Ordos est une ville de la Mongolie Intérieure. Située dans le district de Dongshen au nord de Baotou. Le Régime chinois a voulu construire un quartier nouveau, une ville nouvelle d’Ordos avec l’ambition d’accueillir un million d’habitants nouveaux.
Le site nous donne des précisions :
« La ville d’Ordos est unique et vous laissera une étrange impression de ville désertée. Rien que pour son authenticité, elle mérite qu’on s’y arrête avant de partir sur les traces de Gengis Khan et son Mausolée.
Ordos est à l’origine (siècle avant J.C) une ancienne cité utilisée comme point de contrôle pour l’accès aux pâturages des peuples nomades turco-mongols. La ville fut ensuite recolonisée par les chinois en 127.
Son nom lui vient du clan Ordos qui était à l’époque chargée de protéger le Mausolée de Gengis Khan, fondateur de l’empire mongol.
La ville nouvelle d’Ordos
Avec l’aide du gouvernement et de gros investisseurs chinois, une toute nouvelle ville du même nom fut construite à quelques kilomètres de l’ancienne cité. Cette nouvelle ville érigée dans les années 2000 est aujourd’hui considéré comme l’une des plus grandes villes fantômes du monde en raison de sa très faible population.
En 2009, un grand nombre de quartiers et de bâtiments étaient encore en construction ou laissé à l’abandon faute d’investissements. L’estimation de la population fut alors revue à la baisse et 300 000 personnes sont attendues pour 2020 au lieu d’un million. »

Un autre site nous explique l’origine de cette folie :
« A l’origine, un million de personnes devaient vivre [dans la ville nouvelle d’Ordos] . C’était du moins l’objectif visé par le gouvernement chinois lorsqu’il a fait sortir de terre la nouvelle ville d’Ordos, dans le nord de la Chine, au tournant du millénaire. Des lotissements, des musées futuristes, des tours de bureaux et des routes à quatre voies ont été créés.
Mais le projet a avorté: reste le quartier de Kangbashi, qui peut accueillir 300’000 habitants. Pourtant, comme le rapporte le magazine d’information «Focus», seules 5000 personnes ont élu domicile dans le quartier.
Le fait que Kangbashi ait tout ce qu’il faut sauf des habitants est dû à une politique de développement urbain ratée et à l’orgueil démesuré des dirigeants. Au tournant du millénaire, d’énormes gisements de charbon et de gaz ont été découverts dans la région d’Ordos, et la ville désertique de Mongolie intérieure devait devenir une ville en plein essor.
Mais les bâtiments ont été construits à la hâte et à moindre coût, et les prix étaient bien trop élevés pour des ouvriers. Les appartements ont surtout été achetés par des investisseurs comme placement et non comme bien locatif.
Il est difficile de vérifier les chiffres avancés par «Focus» quant au nombre de personnes vivant réellement dans le quartier de Kangbashi. D’autres sources parlent de 20’000 à 100’000 personnes qui vivraient ici. »
Un article de GEO en 2011 consacrait un long développement à cette « ville en devenir » selon les propos des dirigeants chinois agacés quand on parle de « ville fantôme »
L’introduction de cet article commence ainsi :
« Ordos, place Gengis-Khans. Des statues monumentales de cavaliers mongols montent la garde devant les buildings austères de l’administration locale. Face à cette horde figée, la ville nouvelle étend sur trente kilomètres carrés ses larges avenues, ses immeubles futuristes et ses monuments à l’architecture fantasque – théâtre en forme de chapeau mongol, bibliothèque évoquant trois livres inclinés, musée rappelant un bloc de charbon. Un Dubai chinois, sorti des plaines de Mongolie-Intérieure en 2004, aussi vaste et vide que la steppe qui l’entoure.
Vide? pas tout à fait: dans un coin de la place, Sha, 18 ans, a installé son stand de boissons. La jeune femme est venue du nord-est du pays pour vendre des rafraîchissements aux premiers habitants de la ville-champignon. Ce n’est pas la foule, mais il en faudrait plus pour doucher son enthousiasme: «Chaque semaine, il y a un peu plus d’habitants, et un peu plus de clients» »
Cette démesure, cette quête de l’inutile et de la folie humaine ne sont pas limitées à Ordos comme nous l’apprend cet article de décembre 2015 de <la Tribune> :
« Ordos, en Mongolie-Intérieure, est devenue le symbole des villes fantômes chinoises. Construite entre 2005 et 2010, avec une capacité d’accueil d’un million de personnes, ses stades, avenues et gratte-ciel restent désespérément vides.
La Chine est ainsi parsemée de villes sans vie. Quelques-unes se rempliront, exode rural oblige ; une partie d’entre elles mettront des décennies à se peupler et d’autres resteront à jamais un musée, vitrine de la surcapacité et de la mauvaise allocation des ressources.
Un article publié par l’agence de presse officielle Xinhua, en octobre, a mis en lumière l’ampleur du phénomène. Chaque capitale provinciale construit actuellement de quatre à cinq nouveaux quartiers. Cela amènera la Chine à loger 3,4 milliards d’habitants, soit presque trois fois plus que la population chinoise actuelle. Une étude de MIT estime qu’il y a 50 villes vides en Chine.
Comment une telle frénésie est-elle possible ? D’une part construire permet aux gouvernements locaux de générer du PIB. Tous se disent qu’avec le temps, les espaces vides se rempliront forcément. Avoir construit un « nouveau quartier » est indispensable sur la carte de visite du gouverneur d’une ville, en compétition avec son voisin pour attirer les ruraux. Le problème, c’est qu’en attendant, ces espaces vides coûtent de l’argent aux banques, qui se voient obligées de reconduire des prêts stériles plutôt que d’investir dans des PME innovantes. »
<Vous trouverez aussi un reportage avec des photos sur ce site de Canal+>
Pour voir de manière plus palpable ce que ce cela signifie, il faut regarder <Cette vidéo qui montre la réalité de cette ville>.
Vous y verrez notamment ce remarquable et grand stade, inauguré en 2011 et quasi toujours entièrement vide.

<1239>
-
Lundi 20 mai 2019
« Les animaux vont disparaître, il n’en restera plus bientôt »Michel Simon, en 1965Le lundi 6 mai 2019, a eu lieu à Paris le <sommet mondial pour la biodiversité> :
« Le rapport qui sera adopté ce lundi 6 mai après-midi par 130 États à Paris sur la biodiversité sera sans appel : « Une grande partie de la nature est déjà perdue, et ce qui reste continue à décliner ». Selon les chercheurs, ce sera la sixième extinction de masse de l’Histoire… et la première due à l’Homme. Une extinction de masse, c’est quand l’essentiel de espèces qui vivent sur terre disparaissent en peu de temps. »
L’INA a publié une archive qui date de 1965, il y a 54 ans !
C’est un extrait d’une interview du grand acteur Michel Simon que tout le monde pense français mais qui est suisse.
Vous la trouverez <ici>
Et voici ce que dit Michel Simon :
« C’est tragique […]
Je n’envisage pas l’avenir. Ce n’est pas pensable.
Cette prolifération de l’être humain qui est pire que celle du rat. […]
Les bêtes sont merveilleuses parce qu’elles sont en contact direct avec la nature.
Ce qui aurait pu peut être sauver l’humanité c’est peut-être la femme, parce qu’elle est encore en contact avec la nature.
Elle échappe aux lois, aux imbécilités émises par les anormaux.
Elle est encore en contact avec la nature mais elle n’a pas voix au chapitre. […]
Les animaux vont disparaître il n’en restera plus bientôt.
En Afrique c’est l’hécatombe permanente.
Ici quand je suis venu, j’avais une trentaine de nids d’hirondelles.
L’année dernière j’ai eu deux nids d’hirondelles et pour la première fois j’ai ramassé une hirondelle qui était tombée de son nid, qui était si pauvrement alimentée. Grâce aux progrès de la science, la science chimique qui assassine la terre, qui assassine l’insecte, qui assassine l’oiseau, qui tue toute vie, qui assassine l’homme, on s’en apercevra peut être trop tard.
Grâce à cela, il n’y a plus d’oiseaux.
Dans ce parc, quand je suis arrivé en 1933, c’était merveilleux.
Le printemps, c’était une orgie de chants d’oiseaux.
C’était quelque chose de merveilleux.
Aujourd’hui il n’y en a plus.
[…] Je ramasse chaque printemps des oiseaux morts […] qui ont mangé des insectes empoisonnés et qui meurent ! »
C’était visionnaire, lucide et très dur.
En 1965, probablement que ce n’était pas entendable et que les gens ne croyaient pas ce qu’il entendait.
Aujourd’hui, nous savons qu’il avait raison.
Homo sapiens, peut-il penser qu’il a la moindre chance de survivre sur une planète dont il serait devenu le quasi seul animal vivant ?
Les insecticides, le réchauffement climatique et ce qu’il faut bien appeler la prédation de la terre par homo sapiens réduit de plus en plus la biodiversité nécessaire à la vie sur terre.
Je ne sais pas si les humains sont trop nombreux sur terre, en tout cas ils ne peuvent pas prendre davantage de place sur notre planète et il faut qu’ils se préoccupent de la place laissée aux autres espèces vivantes.
Exactement le contraire que ce que fait le président brésilien Jair Bolsonaro en <Amazonie>, ou le président turc Erdogan <en créant le plus grand aéroport du monde> ou encore la Chine avec son projet <de la nouvelle route de la soie>. Ce ne sont que quelques exemples dans un monde qui continue à croire qu’homo sapiens peut aller au bout de sa quête économique sans limite.
<1238>
-
Vendredi 17 mai 2019
« Attale, La Tante Bouchère »Marie-Françoise SeylerLes vacances sont, au moins pour moi, un moment privilégié pour lire.
Et parmi ces lectures, il y eut d’abord « Attale, La Tante Bouchère ».
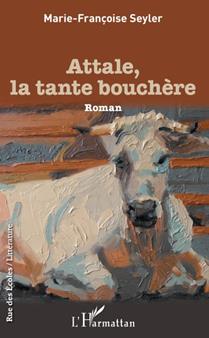 J’ai déjà parlé de notre amie Françoise lors du <mot du jour du 22 octobre 2018>.
J’ai déjà parlé de notre amie Françoise lors du <mot du jour du 22 octobre 2018>.
Car nous l’appelions Françoise, alors que son prénom de l’état civil était Marie-Françoise. Nous savons qu’à cette époque les parents aimaient particulièrement donner le prénom Marie, parfois en y ajoutant un autre prénom pour permettre de distinguer entre toutes les Marie.
Nous avons, Annie et moi, eu la grâce de la compter parmi nos amis.
Nous avons aussi eu la grâce de lui dire « Adieu » avant qu’elle ne quitte la communauté des vivants. Car nous savions alors, elle comme nous, que nous ne nous reverrions pas vivants.
Mais elle avait écrit un dernier roman, avant de poser la plume, d’arrêter de gambader, se coucher et ne plus se relever.
Ce livre est un petit bijou.
Il raconte la vie d’une jeune orpheline qui devient femme dans le monde rural autour et pendant la seconde guerre mondiale. Dans cette région que je connais bien puisque c’est là où je suis né.
Mais je n’ai pas cette connaissance intime de la ruralité, des choses de la terre et des plantes qu’avait Françoise.
Dans une langue simple mais précise, elle décrit les combats de cette jeune fille, protestante au milieu d’un village catholique, femme dans un monde d’hommes, dans un monde en ébullition et très dur. S’il existe de précieux moments d’empathie, ils sont rares.
Très rapidement, elle perd sa mère et son père ne supporte pas d’être seul. Peu à peu, Attale se rend compte qu’elle ne peut plus faire confiance et elle devient encore plus solitaire. Mais elle garde tout au long de sa vie, malgré les vents contraires, une force intérieure et une liberté qui irradie le roman.
J’ai lu avec gratitude ce dernier cadeau de Françoise.
Martine après l’avoir lu, m’a fait ce retour :
« Je viens de finir la lecture de ce beau roman qui relate le parcours de cette femme célibataire, Attale , courageuse qui affronte sa vie difficile mais à laquelle elle tient tellement !
C’est une femme qui sert encore d’exemple aujourd’hui, persévérante et bouleversante avec ce vécu gravé dans sa chair mais qui ne l’empêchera jamais d’avancer. »
Monique qui l’a lu également a eu ces mots :
« Il m’a rappelé entre autre, bien des souvenirs que nous a racontés Pauline ma belle maman, lors de l’évacuation en Charente ….
Puis le retour en Lorraine qui fut très décevant… habitat saccagé … vols … Il fallait tout refaire …
Enfin il n’y a pas que ça dans le roman … les souffrances psychologiques d’Attale avec ce père …abuseur … mais aussi taiseux …
Puis la perte de Zac son ami… Un très beau livre qui touche le fond du cœur. »
C’est un roman du terroir, un roman de vie et de combat écrit par une écrivaine qui nous parle de choses qu’elle connaît, qu’elle a vécu et compris.

Je dirai simplement : Merci Françoise.
<1237>
-
Jeudi 16 mai 2019
« La 10ème symphonie »Dimitri ChostakovichJ’ai déjà évoqué Dimitri Chostakovitch et une de ses grandes œuvres : l’opéra «Lady Macbeth du district de Mzensk».
C’était le mot du jour du lundi 1 février 2016.
Je racontais ses démêlés avec le pouvoir stalinien et Staline lui-même.

Pendant la guerre, la composition de la 7ème Symphonie « Léningrad » puis de la « Huitième », deux œuvres épiques et célébrant l’héroïsme et le courage du peuple soviétique l’avait fait rentrer en grâce auprès du dictateur et de ses affidés.
Il finit ce cycle des symphonies de guerre, par sa neuvième créée le 5 novembre 1945 à Leningrad. Staline voulait une musique flamboyante célébrant la victoire de l’armée rouge et une œuvre dédiée à sa gloire personnelle. Mais Chostakovitch fit tout autre chose, une œuvre légère, traduisant un soulagement de la fin de la guerre et de la souffrance. Une musique manifestement non militariste.
Chostakovitch fut de nouveau écarté de tout poste officiel, on ne joua plus ses œuvres et il craignait toujours d’être envoyé au goulag.
Artistiquement, il fut condamné pour «formalisme» par Jdanov, président de l’Union des Compositeurs
Et il fallut attendre la mort de Staline, pour qu’enfin il puisse faire exécuter ce chef d’œuvre qu’est la dixième symphonie.
La dixième symphonie se compose de quatre mouvements.
Le plus connu est le deuxième mouvement. Une course à l’abime qui ne s’arrête pas d’une violence sans pareil. Il dure entre 4 et 5 minutes.
Voici par exemple une interprétation de ce mouvement par l’orchestre du Concert Gebouw d’Amsterdam sou la direction d’Andris Nelson : <C’est Ici>
Mais cette version par un remarquable chef et un orchestre superlatif est bien trop sage à mon goût.
Beaucoup plus mal enregistré, voici une version plus convaincante dans l’esprit par <Gustavo Dudamel dirigeant le Simón Bolivar Youth Orchestra of Venezuela>
Peut-être que certains seront sensibles à cette <version présentée comme du heavy métal>. Ce n’est absolument pas mon cas.
A tout prendre, je préfère cette version dansée par <Beyonce>. Au moins elle n’abime pas la musique du chef d’œuvre de Chostakovitch. Bien que selon moi, cette danse n’apporte rien à la musique qui se suffit à elle-même.
Si vous voulez entendre cette musique dans sa démesure et sa violence, il faut écouter <cet enregistrement de Karajan> au sommet de son art avec son orchestre berlinois.
Ce mouvement est un cri de colère et de rage contre Staline.
Dans ses Mémoires, Chostakovitch a écrit :
« Il est difficile de dessiner l’image d’un homme politique mais ici j’ai rendu son dû à Staline ; avec moi il a trouvé chaussure à son pied. On ne peut guère me reprocher d’éviter un phénomène repoussant de notre réalité ».
Il a dit aussi que c’était un « portrait au vitriol de Staline ». Pour approfondir vous pourrez lire <cet article>
Mais cette symphonie ne se résume pas à son deuxième mouvement, elle s’ouvre par un long premier mouvement qui s’apparente à une marche funèbre, peut-être en l’honneur des victimes du dictateur. Elle s’achève de manière tonitruante comme un chant de victoire après nous avoir bousculés dans tous les méandres de l’émotion.
Samedi 27 avril, nous sommes allés, avec Annie, à l’auditorium de Lyon pour écouter une interprétation de ce monument.
 Je ne savais rien du chef qui allait diriger.
Je ne savais rien du chef qui allait diriger.
Quand j’ai commencé à lire le programme je compris que le chef d’orchestre était particulièrement jeune : 23 ans.
J’étais un peu inquiet : n’était-ce pas un peu jeune pour s’attaquer à une telle œuvre ?
Je demandais par texto à mon ami Bertrand : «Connais-tu Klaus Mäkelä ?»
La réponse fut négative.
J’étais un peu rassuré, il venait d’être nommé directeur de l’Orchestre Philharmonique d’Oslo. Les norvégiens sont des gens sérieux et l’Orchestre Philharmonique d’Oslo a toujours accueilli des directeurs qui allaient devenir les meilleurs par la suite.
Et…
Ce fut une révélation. Ce jeune chef finlandais est remarquable et je pus renvoyer un message à Bertrand :
« Tu en entendras parler c’est un chef exceptionnel. Surtout à son âge »
Une interprétation ébouriffante, maîtrisée et profondément vécue.
Depuis je me suis intéressé à ce jeune chef qui est aussi un violoncelliste de très haut niveau.
Il dispose bien sûr d’un site : <Klaus Mäkelä>
On y lit cette critique de Classique News du 14/12/2018, après un concert avec l’orchestre du Capitole de Toulouse :
« Klaus Mäkelä, jeune maestro superlatif – Le génie n’attend pas le nombre des années
Parmi les chefs invités par l’Orchestre du Capitole, il y en a de toutes sortes. Ce n’est pas fréquent qu’un chef aussi jeune, 23 ans , fasse une impression aussi consensuelle et évidente sur d’autres qualités que la jeunesse. Le très jeune chef finlandais Klaus Mäkelä est déjà un très grand chef.
Les génies de la baguette sont rares et les plus audacieux ont su se l’attacher. Qu’apporte ce chef de si génial ? Une autorité bienveillante et naturelle, des gestes très clairs et dont la souplesse révèle une belle musicalité. Cet artiste est également un violoncelliste de grand talent ! La précision de la mise en place, la clarté des plans sont sidérantes. Il encourage l’orchestre et ne le bride pas. Il faut dire que l’Orchestre du Capitole atteint un niveau d’excellence qui permet à un chef musicien d’atteindre de suite des sommets.
Après l’entracte, le chef dirige avec un réel plaisir communicatif la pièce de Stravinski qu’il préfère, Petrouchka. Il faut reconnaître que son interprétation est marquée par une confiance absolue et une solidité remarquable. Rien ne vient ternir une énergie invincible. L’orchestre du Capitole répond comme un seul à cette direction précise et le résultat est particulièrement lumineux et même éclatant. Chaque instrumentiste est parfait. »
Ce texte est très proche de ce que j’ai vécu le 27 avril.
Quelquefois grâce à la toile, d’heureux hasards peuvent être rencontrés.
Vous trouverez derrière ce lien : <Klaus Mäkelä qui dirige la 10ème de Chostakovitch avec the Gothenburg Symphony>
Pour les impatients, le deuxième mouvement commence à 25 :40.
Et quand il joue au violoncelle, c’est très bon aussi : <un extrait du concerto de Dvorak>
Le talent n’attend pas les années.
Un bien belle rencontre.
<1236>
-
Vendredi 3 mai 2019
« Le mot du jour est en congé (Celui qui attend est comme un arbre)»Annie et moi prenons quelques jours réparateurs en AuvergneLe mot du jour est en congé jusqu’au 15 mai.
Fabien a publié un <commentaire> fort intéressant sur le couple franco-allemand en liaison avec le mot du jour consacré aux états d’âme de Quatremer.
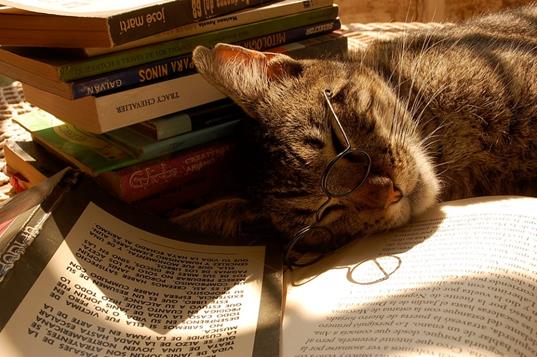 Lors de la reprise du mot du jour, en 2019, j’avais pris ce mot de Christian Bobin :
Lors de la reprise du mot du jour, en 2019, j’avais pris ce mot de Christian Bobin :
« Celui qui attend est comme un arbre avec ses deux oiseaux, solitude et silence. »
Au moment de sa publication, trompé par des sites internet, je prétendais que cette phrase se trouvait dans son livre « La plus que vive ».
Mais j’ai vérifié et je me suis procuré ce livre et c’était faux.
J’ai continué mes recherches et trouvé qu’elle était insérée dans un autre livre que j’ai acheté « L’autre visage ».
J’ai bien sûr corrigé.
Mais pour la période d’attente je voudrais en citer un extrait plus important (page 49 à 53)
Chez nous pas de montre ni d’horloge.
Le temps qui passe a la beauté pour unique preuve
la beauté ou la douleur,
tant il est vrai que nous n’avons jamais su démêler l’une de l’autre,
tant il est vrai que beauté et douleur sont dans nos âmes
comme les deux aiguilles de vos montres quand elles se superposent.
Le temps chez nous est comme de l’eau.
L’éternité chez nous est comme de l’eau.
Le temps, le cœur et l’éternel mélangent leurs eaux
partout dans le monde comme beauté, dans le monde comme douleur.
[…]
Attendre, c’est ce que nous savons faire de mieux,
L’art suprême auquel tous ici s’exercent, enfants comme vieillards,
hommes comme femmes, pierres comme plantes.
Caravane de l’attente avec ses deux chameaux,
solitude et silence.
Fier navire de l’attente avec ses deux grandes voiles,
solitude et silence.
Celui qui attend est comme un arbre
avec ses deux oiseaux, Solitude et Silence.
Il ne commande pas à son attente.
Il bouge au gré du vent,
docile à ce qui s’approche,
souriant à ce qui s’éloigne.
Celui qui attend,
nous l’appelons le « tout comblé »
car dans l’attente,
le commencement est comme la fin,
la fleur est comme le fruit,
le temps comme l’éternel.Christian Bobin
Au 16 mai…
-
Jeudi 2 mai 2019
« Le 1er mai, la fête du travail, Pétain et le muguet »Essai de faire le point historique sur les références et les coutumes du 1er maiSur la plupart des calendriers, vous voyez écrit à la date du 1er mai : « Fête du travail »
D’ailleurs notre Président de la République a accueilli, hier à l’Elysée, pour a priori fêter le travail, 400 professionnels des métiers de bouche et des fleurs. Le journal « La Croix » nous informe :
« Dans un quartier de l’Elysée bouclé par crainte des « black blocs », Emmanuel Macron a invité mercredi 400 professionnels des métiers de bouche et des fleurs pour la traditionnelle remise du muguet, autour d’un somptueux buffet.
« Je suis heureux de vous recevoir ici, avec Brigitte, parce que c’est une tradition de remettre le muguet et il est bon, dans les temps où les choses changent, que les traditions qui ont un sens, un symbole, soient tenues. En tout cas, j’y tiens », a déclaré le président de la République, devant l’assemblée réunie dans la salle des fêtes. »
Et puis il a dit autre chose et que pour que l’écho de ses propos dépasse la salle des fêtes de l’Elysée, il a tweeté la même phrase dite devant les 400 professionnels des métiers de bouche et des fleurs :
« Le #1erMai est la fête de toutes celles et ceux qui aiment le travail, le chérissent, parce qu’ils produisent, parce qu’ils forment, parce qu’ils savent que par le travail nous construisons l’avenir. Merci de porter ces valeurs et d’œuvrer chaque jour pour notre Nation.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 1, 2019 »
Ce tweet n’a pas convaincu Libération qui a répondu par un article courroucé : « 1er mai : Macron confond «fête du travail» et «fête des travailleurs» »
Et puis mon fils m’avait raconté que la fête du travail était célébrée au Canada en septembre.
Et enfin, on offre du muguet le 1er mai, ou plutôt certains le vendent et d’autres l’achètent. Je me souviens que lorsque nous habitions à Montreuil, une voisine venait sonner à notre porte, le 1er mai, pour nous vendre un brin de muguet au profit du Parti communiste français. D’où vient cette tradition ? C’est aussi la question que se pose RTL sur son site : « 1er mai : pourquoi s’offre-t-on du muguet pour la Fête du Travail ? »
Bref, il m’a semblé important de faire le point sur ces différentes coutumes, célébrations et de revenir à l’Histoire.
Et l’histoire commence le 1er mai 1886 aux Etats-Unis où des ouvriers réclament la journée de travail de huit heures. A l’appel du syndicat qui avait pour nom : « l’American Federation of Labor », 350 000 travailleurs débrayent aux États-Unis pour cette revendication de la journée de travail de huit heures. Cette journée va conduire à un évènement que l’Histoire retiendra sous le nom de « Le massacre de Haymarket Square » à Chicago.
Wikipedia nous donne ces informations :
« Tout commence lors du rassemblement du 1er mai 1886 à l’usine McCormick de Chicago. Il s’intégrait dans la revendication pour la journée de huit heures de travail quotidien, pour laquelle une grève générale mobilisant 340 000 travailleurs avait été lancée. August Spies, militant anarchiste, est le dernier à prendre la parole devant la foule des manifestants. Au moment où la foule se disperse, 200 policiers font irruption et chargent les ouvriers. Il y a un mort et une dizaine de blessés. Spies rédige alors dans le journal Arbeiter Zeitung un appel à un rassemblement de protestation contre la violence policière, qui se tient le 4 mai. Ce rassemblement se voulait avant tout pacifiste. Un appel dans le journal The Alarm appelait les travailleurs à venir armés, mais dans un seul but d’autodéfense, pour empêcher des carnages comme il s’en était produit lors de bien d’autres grèves.
Le jour venu, Spies, ainsi que deux autres anarchistes, Albert Parsons et Samuel Fielden, prennent la parole. Le maire de Chicago, Carter Harrison, assiste aussi au rassemblement. Lorsque la manifestation s’achève, Harrison, convaincu que rien ne va se passer, appelle le chef de la police, l’inspecteur John Bonfield, pour qu’il renvoie chez eux les policiers postés à proximité. Il est 10 heures du soir, les manifestants se dispersent, il n’en reste plus que quelques centaines dans Haymarket Square, quand 180 policiers de Chicago chargent la foule encore présente. Quelqu’un jette une bombe sur la masse de policiers, en tuant un sur le coup. Dans le chaos qui en résulte, sept agents sont tués, et les préjudices subis par la foule élevés, la police ayant « tiré pour tuer ». L’événement devait stigmatiser à jamais le mouvement anarchiste comme violent et faire de Chicago un point chaud des luttes sociales de la planète. On soupçonne l’agence de détectives privés Pinkerton de s’être introduite dans le rassemblement pour le perturber, comme elle avait l’habitude de le faire contre les mouvements ouvriers, engagée par les barons de l’industrie.
Après l’attentat, sept hommes sont arrêtés, accusés des meurtres de Haymarket. August Spies, George Engel, Adolph Fischer, Louis Lingg, Michael Schwab, Oscar Neebe et Samuel Fielden. Un huitième nom s’ajoute à la liste quand Albert Parsons se livre à la police.
[…]
Le 19 août, tous sont condamnés à mort, à l’exception d’Oscar Neebe qui écope de 15 ans de prison. Un vaste mouvement de protestation international se déclenche. Les peines de mort de Michael Schwab, Oscar Neebe et Samuel Fielden sont commuées en prison à perpétuité (ils seront tous les trois graciés le 26 juin 1893). Louis Lingg se suicide en prison. Quant à August Spies, George Engel, Adolph Fischer et Albert Parsons, ils sont pendus le 11 novembre 1887. Les capitaines d’industrie purent assister à la pendaison par invitation. Ils seront réhabilités par la justice en 1893.
Le gouverneur de l’Illinois John Peter Altgeld déclara que le climat de répression brutale instauré depuis plus d’un an par l’officier John Bonfield était à l’origine de la tragédie :
Alors que certains hommes se résignent à recevoir des coups de matraque et voir leurs frères se faire abattre, il en est d’autres qui se révolteront et nourriront une haine qui les poussera à se venger, et les événements qui ont précédé la tragédie de Haymarket indiquent que la bombe a été lancée par quelqu’un qui, de son propre chef, cherchait simplement à se venger personnellement d’avoir été matraqué, et que le capitaine Bonfield est le véritable responsable de la mort des agents de police. »
L’évènement connut une intense réaction internationale et fit l’objet de manifestation dans la plupart des capitales européennes.
George Bernard Shaw déclara à cette occasion : « Si le monde doit absolument pendre huit de ses habitants, il serait bon qu’il s’agisse des huit juges de la Cour suprême de l’Illinois »
Et en 1889, la deuxième Internationale ouvrière ou Internationale socialiste décide d’adopter le 1er mai comme la journée internationale de revendication des travailleurs.
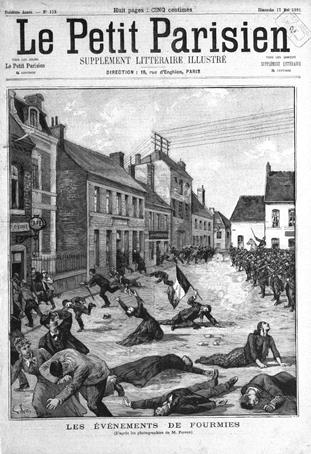 2 ans plus tard, lors de cette journée de revendication, en France, le 1er mai 1891, à Fourmies (Nord), la troupe tire sur les grévistes. Le bilan est de neuf morts et de 35 blessés. Bien que les forces de l’ordre aient été mises en cause, neuf manifestants furent condamnés pour entrave à la liberté de travail, outrage et violence à agent et rébellion, à des peines de prison de deux à quatre mois fermes. On appellera cet évènement : « la fusillade de Fourmies »
2 ans plus tard, lors de cette journée de revendication, en France, le 1er mai 1891, à Fourmies (Nord), la troupe tire sur les grévistes. Le bilan est de neuf morts et de 35 blessés. Bien que les forces de l’ordre aient été mises en cause, neuf manifestants furent condamnés pour entrave à la liberté de travail, outrage et violence à agent et rébellion, à des peines de prison de deux à quatre mois fermes. On appellera cet évènement : « la fusillade de Fourmies »
Nous sommes assez loin de la célébration de ceux qui « chérissent le travail » mais plutôt dans la revendication de celles et ceux qui sont exploités et qui réclament des droits pour les travailleurs. Il paraît donc légitime de parler de « la journée internationale des travailleurs. »
Mais alors pourquoi parle t’on de la fête du travail ?
La fête du travail a une autre origine et qui est plutôt nationale. En pratique on a donné, en Europe, ce nom à plusieurs fêtes qui furent instituées à partir du XVIIIe siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs. Vous pourrez en savoir davantage derrière ce <Lien>.
Et pour confondre les deux, il a fallu le régime de Vichy et Pétain qui vont fixer la fête du travail qui sera chômée au 1er mai. Rappelons que la devise de ce régime était : « Travail, Famille, Patrie ». Le travail remplace la « Liberté » et la Famille l’« Egalité » de la République.
C’est une Loi d’avril 1941 qui créa la « Fête du travail et de la concorde sociale » le 1er mai.
Et ceci permet de résoudre l’énigme de mon fils, au Canada comme aux Etats-Unis, on ne confond pas ces deux jours et si la journée internationale des travailleurs est bien célébrée le 1er mai, c’est la fête du travail qui a lieu en septembre. Et… seule la seconde est chômée, selon ce que j’ai compris.
Et le muguet du 1er mai ? C’est encore Pétain !
On trouve sur Internet cette affiche d’époque.
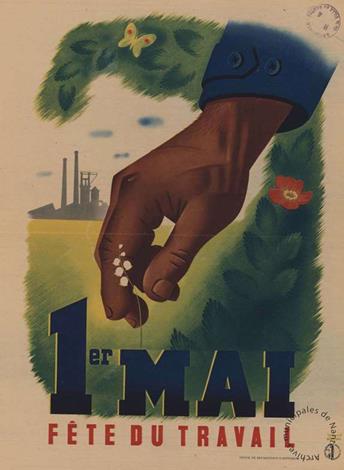 Sur la page du site de RTL « 1er mai : pourquoi s’offre-t-on du muguet pour la Fête du Travail ? » on apprend que : un Noble dont on conserve la mémoire en raison de son geste d’avoir offert un brin de muguet au roi de France Charles IX, est à l’origine de cette tradition d’offrir du muguet. Il a pour nom Chevalier Louis de Girard de Maisonforte.
Sur la page du site de RTL « 1er mai : pourquoi s’offre-t-on du muguet pour la Fête du Travail ? » on apprend que : un Noble dont on conserve la mémoire en raison de son geste d’avoir offert un brin de muguet au roi de France Charles IX, est à l’origine de cette tradition d’offrir du muguet. Il a pour nom Chevalier Louis de Girard de Maisonforte.
En 1561, Charles IX qui régnera de 1560 à 1574, séduit par cette pratique, officialisera la tradition d’offrir un brin de muguet chaque printemps aux dames de sa cour.
Au printemps pas précisément le 1er mai.
RTL donne la parole à Mathilde Larrere, présentée comme historienne des révolutions et de la citoyenneté :
« L’imposer comme fleur du 1er mai, c’est bien Pétain. »
Le 1er mai des ouvriers, après, la répression sanglante de Fourmies avait fait de l’églantine écarlate, la fleur emblématique du mouvement, en mémoire au sang versé. Elle raconte :
« C’est à ce moment que le 1er mai devient « la Fête du travail et de la concorde sociale » et le maréchal Pétain impose alors le muguet pour remplacer l’églantine « trop prolétarienne, trop rouge, trop révolutionnaire » »
La page citée rappelle que :
« Le muguet n’est pas forcément le meilleur cadeau à offrir au niveau de la santé. En effet, en plus d’être issu d’une tradition vichyste, le muguet peut être toxique.
Le poison se trouve dans la tige et les feuilles, pas dans les fleurs. Le pire, ce sont les petites boules rouges : les fruits du muguet qui viennent après les fleurs. La substance dangereuse s’appelle la convallarine.
Elle ralentit le rythme cardiaque »
En réalité il y a trois toxines dans le muguet :
- la convallatoxine
- la convallarine
- la convallamarine).
Pétain était aussi toxique que le muguet.
Et notre président n’avait pas tort, contrairement à ce que dit « Libération », simplement il ne se référait pas à la journée internationale des travailleurs, mais à la « vraie » Fête du travail, qui est autre chose.
Les références auxquelles on se rapporte disent beaucoup de nos priorités…
<1235>
- la convallatoxine
-
Mardi 30 avril 2019
«On est passé de 2000 prénoms en 1945 à 13.000 aujourd’hui »Jérôme FourquetLe mot du jour d’hier était consacré au livre de Jérôme Fourquet sur l’« archipelisation française », c’est-à-dire la division de la France en divers ilots de population. Une grande partie de son ouvrage a été consacrée à l’évolution des prénoms qui sont donnés. Il s’agit aussi d’un marqueur de l’évolution des segmentations.
Le point fondamental de l’étude de Jérôme Fourquet montre l’individualisation des choix. Le marqueur le plus simple et le plus évident est constitué par l’évolution du nombre de prénoms différents donnés aux enfants qui viennent de naitre au cour d’une année.
On est passé ainsi de 2 000 prénoms dans les années 60 à 13 000 aujourd’hui, une augmentation de 650 %.
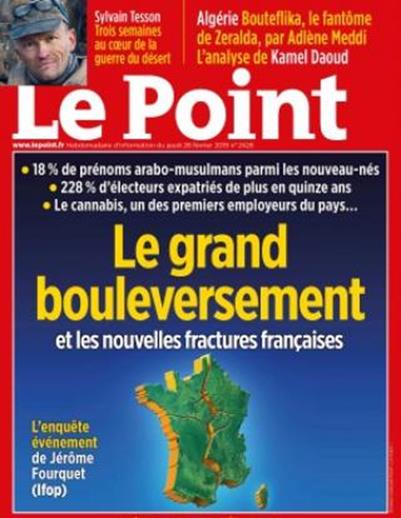 Toutefois ce que beaucoup de médias ont retenu, en premier, de l’étude de Jérôme Fourquet, c’est qu’il y a désormais 18% de prénoms arabo-musulmans parmi les nouveau-nés.
Toutefois ce que beaucoup de médias ont retenu, en premier, de l’étude de Jérôme Fourquet, c’est qu’il y a désormais 18% de prénoms arabo-musulmans parmi les nouveau-nés.
La Une du Point, par exemple, considère que c’est le premier bouleversement.
Ce qui n’est objectivement pas le cas.
Le bouleversement, c’est que les familles d’origine chrétienne ne donnent plus à leur fille, prioritairement le prénom de Marie. Il y a des exceptions que je connais, mais aujourd’hui moins de 1% des filles reçoivent le nom de la mère de Jésus, 0,3% en 2015. En 1900, 20% des filles s’appelaient Marie. Le même phénomène peut être observé chez les garçons pour Jean.
C’est un signe fort de la déchristianisation qui est un développement important de l’ouvrage de Fourquet comme cela a été relaté dans le mot d’hier.
Mais plus largement, l’auteur constate que grosso modo la France a fonctionné de 1900 à 1960 avec un stock de 2 000 prénoms puis il y a eu explosion de l’inventivité, de la créativité des parents qui ont amené ce chiffre à 13 000.
Alors si on veut parler des prénoms « arabo-musulmans », il explique que si dans les années 1960, on est à moins de 1% de prénoms d’origine arabo-musulmane, on est à plus de 18 % sur les dernières années. Et lorsque que Jérôme Fourquet compare la vague migratoire actuelle avec d’autres vagues de l’Histoire de France comme celles des familles polonaises, il note une différence de pratiques :
« Les familles polonaises, pendant une génération, ont donné des prénoms polonais à leurs enfants, puis ce phénomène s’est éteint et ces familles se sont fondues dans le catalogue « commun » des prénoms. ».
Par ailleurs, il constate que ces prénoms sont particulièrement donnés par des personnes qui se rattachent à l’immigration.
Il y a eu une mode, en France, dans les années 90 de donner des prénoms anglais à des enfants de familles françaises depuis plusieurs générations, il semble qu’il n’existe pas une telle mode pour les prénoms arabo-musulmans.
Jérôme Fourquet écrit :
« On peut faire l’hypothèse, au regard des prénoms qui sont donnés, on a un processus moins rapide et beaucoup plus difficile que pour beaucoup d’autres vagues migratoires. Et en même temps on constate que toute une partie de cette immigration a pris l’ascenseur social et est aujourd’hui totalement intégrée. »
Lors d’une des émissions que j’ai écoutée, il a souligné que ces prénoms sont donnés alors même que les familles savent que ces prénoms conduisent à ce que leurs enfants soient soumis à des discriminations dans la société française.
Et il compare cette attitude avec celle des enfants issus de l’immigration asiatique qui donne très fréquemment un prénom « occidental » public à leurs enfants, alors que dans le lieu privé de la famille ils utilisent un prénom conforme aux traditions de leurs ancêtres. Tel ne semble pas être la pratique des familles musulmanes issues de l’immigration.
Mais je me souviens de ce qu’a raconté le grand violoniste « Yehudi Menuhin », sa mère l’avait prénommé « Yehudi » pour qu’il n’y ait pas d’ambigüité sur ses origines juives, alors même qu’elle connaissait les ravages de l’antisémitisme.
Mais chez Guillaume Erner, Jérôme Fourquet avait dit :
« Ces prénoms (issus des immigrations turques, subsahariennes ou maghrébines) ne présagent en rien du degré d’intégration ou de patriotisme des personnes qui les portent ou les donnent. Rappelons que le policier qui est mort devant Charlie Hebdo s’appelle Ahmed Merabet, tout comme les trois premières victimes de Mohamed Merah étaient des parachutistes français issus de l’immigration. »
Il a dit aussi :
« Le choix d’un prénom doit permettre d’affirmer sa ressemblance avec ceux auxquels on s’identifie ou dont on souhaite se rapprocher et en même temps de marquer ses distances avec ceux dont on souhaite se distinguer. C’est un choix éminemment personnel, [avec des facteurs qui sont aussi] du registre de la transmission (ancêtres, prénoms régionaux…). »
Il n’en reste pas moins que le phénomène principal est celui de l’individualisme, de la volonté des parents de chercher à donner un prénom original, certains le voudraient unique. Parfois, ils arrivent à donner un prénom rare donné 2 ou 3 fois dans une année.
<Cet article de la Dépêche> évoque aussi l’évolution des prénoms et notamment le phénomène des « prénoms rares » que la sociologie attribue aux prénoms donnés moins de 20 fois dans une année.
Il y aussi cet article de Wikipedia qui donne le prénom le plus donné depuis 1946 par région française. Il s’arrête en 2015.
On apprend ainsi que pour toute la France et les prénoms masculins :
- Les années 1946 à 1958 fut le règne exclusif de Jean
- Puis de 1959 à 1966 ce fut Philippe détrôné cependant en 1965 par Thierry
- De 2011 à 2014 ce fut Lucas et en 2015 Gabriel
Mais on constate que la prééminence d’un prénom reste le plus souvent plusieurs années de suite Christophe (1967 à 1973), Sébastien (1975 à 1979), Nicolas (1980 à 1982), Julien (1983 à 1988), Kevin (1989 à 1994) avec retour de Nicolas en 1995, puis Thomas, Lucas, Enzo et à nouveau Lucas.
Et pour les prénoms féminins :
- Parallèlement à Jean, ce fut Marie de 1946 à 1958
- Brigitte en 1959
- Catherine en 1960
- Sylvie de 1961 à 1964
- Nathalie de 1965 à 1971
- Sandrine de 1972 à 1973
- Stéphanie de 1974 à 1977
- Céline de 1978 à 1981
- Aurélie de 1982 à 1986
- Julie en 1987
Puis Élodie (1988 à 1990), Marine (1991), Laura (1992 à 1994), Manon (1995 à 1996), Léa (1997 à 2004), Emma (2005 à 2013), Louise (2014 à 2015).
J’avais déjà consacré un mot du jour au prénom : « Le prénom n’a rien d’anodin. Il touche à l’intime, et raconte infiniment plus que ce qu’on pourrait croire. ». C’était le 26 octobre 2018.
<1234>
- Les années 1946 à 1958 fut le règne exclusif de Jean
-
Lundi 29 avril 2019
« Naissance d’une nation multiple et divisée »Jérôme FourquetSi vous écoutez les émissions politiques actuellement, à un moment de la discussion il sera question de « L’archipel français » de Jérôme Fourquet. Il semblerait que c’est le livre qu’il faut lire.
J’ai choisi pour exergue de ce mot, le sous-titre du livre : « Naissance d’une nation multiple et divisée. »
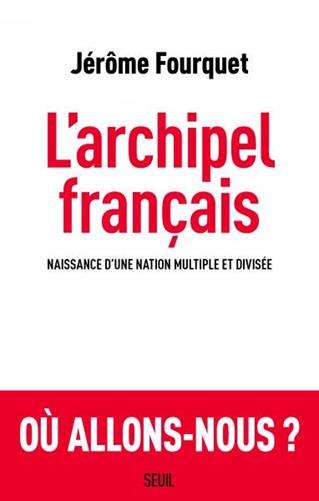 Dans sa longue et sévère diatribe contre le livre des jeunes conseillers d’Emmanuel Macron « Le progrès ne tombe pas du ciel », Jean-Louis Bourlanges l’a aussi cité :
Dans sa longue et sévère diatribe contre le livre des jeunes conseillers d’Emmanuel Macron « Le progrès ne tombe pas du ciel », Jean-Louis Bourlanges l’a aussi cité :
« Ensuite, c’est un livre erroné sur les priorités. On pense tout de suite au livre de Jérôme Fourquet, pour qui le problème français est celui d’une fragmentation du corps social »
Pour aborder ce livre avec des idées simples et solides, il faut en revenir aux textes fondamentaux, à savoir l’article 1er de la Constitution française en son début :
« La France est une République indivisible »
C’est cela notre récit, la France est Une et Indivisible. Et on devient français par assimilation, on intègre en tant qu’individu la nation française dans son unité.
Jérôme Fourquet, prétend que ce récit est de plus en plus éloigné de la réalité.
Jérôme Fourquet est directeur du département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’institut de sondages IFOP depuis 2011 et il vient donc de rédiger et publier ce livre qui a obtenu le « prix 2019 du Livre Politique »
Pour ma part, j’ai entendu l’auteur parler de son livre lors de 3 émissions :
- D’abord le jeudi 7 mars 2019, lorsqu’il était l’invité de Nicolas Demorand et Alexandra Bensaid : « L’enjeu des années à venir sera de trouver la cohésion d’une France fragmentée »
- Puis dans l’émission du 6 avril 2019 d’Ali Baddou : « Le Grand Face-à-face »
- Et après ces deux émissions de France Inter, il fut l’invité des « Matins de France Culture » de Guillaume Erner du 23 avril.
Il a également été reçu par l’émission C Politique du 7 avril 2019.
Le terme « archipel », correspond à un schéma qui s’impose peu à peu d’une « séparation », d’îles fragmentées avec plusieurs lignes de clivage.
Jérôme Fourquet dit ainsi :
« On peut parler d’une vaste île populaire qui peut s’illustrer dans un certain nombre de territoires par un vote massif pour le front national et qui a rejailli plus récemment avec le mouvement des « Gilets jaunes ».
Il y aussi toute une analyse sur une sécession des élites avec un regroupement dans le grand centre urbain, la métropole parisienne par exemple mais aussi un certain nombre de villes de province.
On peut également évoquer un certain nombre de tropismes régionalismes et on pense là à la Corse, où un vote nationaliste est aujourd’hui majoritaire sur l’île de beauté. On a d’autres formes de fragmentations, avec ce phénomène que l’on connaît maintenant depuis une quarantaine d’années qui est celui d’une immigration relativement soutenue et qui a abouti au fait que nous sommes dans une société qui de facto est hétérogène sur le plan socio-culturel. […] On est en rupture par rapport à l’histoire de longue durée de la société française»
Dans cette rupture, on assiste au stade terminal de la déchristianisation en France. Car le catholicisme a été un socle fort pour structurer la société française, d’abord seul puis en duo lors des combats de la République avec d’un côté une « société laïque et républicaine » et de l’autre « le monde catholique ». Il rappelle qu’au début des années 60, on avait 35% des Français qui déclaraient aller à la messe tous les dimanches, voire davantage. Aujourd’hui, ils sont à peine 5 ou 6 %. On peut penser aussi que d’ici 25 ans, il n’y aura plus de prêtres en France.
Il souligne aussi l’écroulement d’un autre pilier de la société française du XXème siècle : le Parti communiste. :
« Un autre socle fort s’est aujourd’hui atténué : celui du corps électoral communiste, notamment le « communisme municipal ». De 20 à 25 % de vote communiste jusque dans les années 70, aujourd’hui ce vote ne structure plus la société française. »
Dans un autre entretien que vous trouverez sur ce <site>, il présente son analyse ainsi :
« Ce livre prend naissance dans mon travail quotidien à l’IFOP ainsi que ma réflexion et mon observation de la société française depuis une vingtaine d’années. J’ai senti le besoin de mettre tout cela sur papier. Je voulais mettre tous les éléments du puzzle, que j’avais mis de côté au fil des ans, en cohérence pour dresser un panorama le plus objectif possible de la société française d’aujourd’hui.
Le constat apparu est celui d’une fragmentation sans précédent de la société française sur des logiques économiques et territoriales. En reprenant et en affinant les tests de Christophe Guilluy, on s’aperçoit d’une fragmentation multiple.
Une fragmentation éducative et culturelle, avec une stratification de plus en plus accrue de la société française sur le niveau scolaire.
Une fragmentation idéologique et affinitaire sur certains modes de vie. […]
Et pour finir, une fragmentation ethnoculturelle avec le phénomène majeur de l’immigration de ces dernières décennies.
Ce phénomène a modifié, avec d’autres facteurs, la physionomie de la société française. Au terme de cette vague d’investigations, l’image qui nous est venue à l’esprit est celle de l’archipel. D’où le fait de parler d’archipellisation dans cet ouvrage. C’est une forme de fragmentation assez massive.
Il ne s’agit pas de mythifier un âge d’or, qui n’a jamais existé, d’une France totalement homogène et sans aucune fracture ni conflit. Mais de faire le constat d’un degré de fragmentation que la France n’a sans doute jamais connu par le passé. »
Le journal « Les Echos » l’a également interrogé : « La fragmentation de la société française est sans précédent » et l’a notamment interrogé sur ce que révèlent les « gilets jaunes » :
« Une fragmentation multiple de la société française. D’abord sociale, avec des catégories modestes assez représentées dans le mouvement alors que les personnes plus aisées le regardaient avec distance, voire condescendance.
Une fracture territoriale ensuite, qui se double d’un clivage sur les modes de vie. Le déclencheur de cette crise a été la hausse des taxes sur les carburants, et la France qui s’est mobilisée est celle des ronds-points, de l’étalement urbain, la France de la voiture. En face, on retrouve les gens pour qui la voiture n’est plus centrale. La fracture est aussi celle de la France diplômée, qui a regardé de très loin ce mouvement animé par des gens moins éduqués.
Enfin, dernière fracture, on a vu que la tentative de la gauche de la gauche d’opérer une jonction entre les « gilets jaunes » et le mouvement syndical et la France des banlieues a échoué.
La France qui s’est mobilisée est celle du travail, qui a peur du décrochage. Alors que les habitants des banlieues, pour une partie significative, vivent avec des aides sociales. Enfin, les gens des banlieues ne se sont pas reconnus dans les visages et les slogans des « gilets jaunes ». »
Et il utilise le terme de « moyennisation » pour expliquer que la classe moyenne qui avait progressé dans la première moitié du 20ème siècle se trouve confronter à une crise :
« On peut aussi y voir les premiers symptômes de la fin de la « moyennisation » de la société française. Pendant les Trente Glorieuses et après, moins puissamment, toute une partie des catégories populaires et des petites classes moyennes, ouvriers et employés, se sont arrimées pleinement à la société française, notamment par le prisme de la consommation. Ils pouvaient se doter d’un équipement pour leur foyer cochant toutes les cases du standard minimum exigé, c’est-à-dire une voiture, de l’électroménager, l’accès aux loisirs et aux vacances et à horizon d’une vie, envisager l’accession à la propriété.
La moyennisation s’est aussi caractérisée par le règne de l’hypermarché, où tout le monde allait faire ses courses. Tout le monde ne met pas la même chose dans son Caddie, mais tous se fournissent dans un même lieu.
[…] La désindustrialisation massive du pays a abouti à une dégradation de la qualité des emplois, et parallèlement le niveau du standard de vie érigé en « basique » par la société de consommation s’est considérablement élevé. […]
Par exemple, avec l’équipement de tous les membres du foyer en smartphones. Les modèles présentés dans certaines émissions de télévision pour l’équipement de la maison coûtent très cher et deviennent hors de portée pour toute une partie de la population. Le fait de ne pas pouvoir accéder à cela, alors même que les deux conjoints travaillent dans le couple, est vécu comme le début d’un déclassement voire d’une déchéance.
Les « gilets jaunes » disent souvent qu’ils n’ont plus rien le 15 du mois, ou qu’ils ne peuvent plus se faire un petit « extra ». Ils se demandent ce qui s’est passé. Ils se retournent alors contre les taxes, ce qui confirme que la question des prélèvements obligatoires est centrale même s’il faut aussi y voir les prémices de la fin de cette moyennisation. Elle va s’amplifier dans le temps.
On peut faire le lien avec la paupérisation de la classe moyenne blanche américaine, qui a abouti à l’élection de Trump. Les Américains ont de l’avance, mais nous sommes confrontés au même mécanisme. »
La solution se trouve bien sûr dans un nouveau récit, un projet commun. Jérôme Fourquet cite le défi climatique comme possible ciment d’une telle ambition :
« Est-ce que la mobilisation autour de l’urgence climatique et de la transformation en profondeur de la société peut jouer ce rôle-là à l’avenir ? Il est un peu tôt pour le dire. On voit bien que les responsables politiques, au premier rang desquels Emmanuel Macron, sont très conscients de cette fragmentation et cherchent à s’appuyer sur tous les événements tragiques ou heureux pour essayer de recréer du commun. […]
Quand on regarde historiquement, le catholicisme et le communisme avaient en commun d’offrir une transcendance, un horizon positif qui vaut la peine de lutter, de se sacrifier pour lui.
Dans une société de consommation et d’individualisme, on touche du doigt le déficit de transcendance qui permettait l’agrégation d’un certain nombre de groupes dans une perspective commune.
L’écologie peut-elle jouer ce rôle, ce ciment pour laisser une planète à nos petits-enfants ? »
Encore faudrait-il que chacun soit convaincu de l’urgence climatique…
<1233>
- D’abord le jeudi 7 mars 2019, lorsqu’il était l’invité de Nicolas Demorand et Alexandra Bensaid : « L’enjeu des années à venir sera de trouver la cohésion d’une France fragmentée »
-
Vendredi 26 avril 2019
« L’écriture donne du sens à l’incohérence »Boris CyrulnikVendredi j’avais évoqué un livre de Boris Cyrulnik publié en 2004 : « Parler d’amour au bord du gouffre » pour en tirer une histoire qu’il a racontée et arriver à ce désir : « Avoir une cathédrale dans la tête ».
Ce neuropsychiatre qui a vécu des traumatismes terribles dans son enfance et qui en a tiré l’expérience de la résilience vient d’écrire un nouveau livre au titre étrange et merveilleusement beau : « La nuit, j’écrirai des soleils » où il parle du besoin d’écrire pour surmonter les traumatismes, les crises, les difficultés. C’est un livre qui lie la résilience et la littérature.
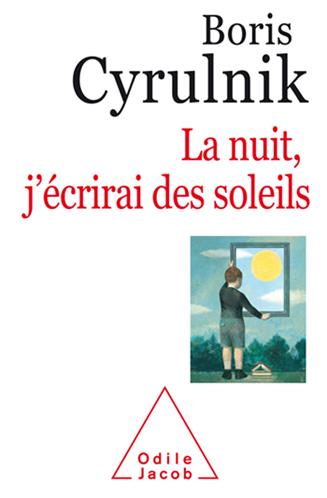 Je l’ai d’abord entendu parler ce livre parce qu’il avait été l’invité d’Ali Badou <le 12 avril 2019>.
Je l’ai d’abord entendu parler ce livre parce qu’il avait été l’invité d’Ali Badou <le 12 avril 2019>.
Il avait notamment révélé lors de cette émission
« Nous avons constaté que parmi les créatifs, il y avait un nombre anormalement élevé d’orphelins. Nous nous sommes demandés quel rapport il pouvait y avoir entre l’orphelinage et la créativité dans toutes ses formes. Parce que probablement, l’identité n’est plus contrainte. Comme disait Jean-Paul Sartre, ‘n’ayant pas eu de père, j’avais toutes les libertés’, donc c’est une nouvelle manière de poser le problème psychologique après un trauma »
Et j’ai lu son entretien au magazine du journal le Progrès : « Fémina » dont j’ai aimé particulièrement le titre que j’ai repris comme exergue de ce mot du jour : « L’écriture donne du sens à l’incohérence »
J’ai aimé ce titre, je crois que je comprends intimement sa réalité. Pour Boris Cyrulnik partager sa souffrance ne suffit pas à diminuer l’impact de la blessure, il faut aussi en devenir acteur. Ce que permet l’écriture.
Boris Cyrulnik dit par exemple :
« Donald Winnicott nous a appris qu’un enfant qui ne sait pas parler peut trouver dans le dessin la force de dire ce qu’il ne peut exprimer. La recherche a montré depuis que beaucoup d’enfants en difficulté déployaient à l’âge scolaire une véritable fièvre de l’écriture. En m’intéressant à l’origine du besoin d’écrire, j’ai découvert que sur les trente-cinq écrivains les plus célèbres du xixe siècle, dix-sept sont des orphelins ou des enfants abandonnés. Prenons aussi l’exemple des soldats engagés dans un conflit armé. Ceux qui peuvent écrire ce qu’ils ont vécu présentent peu de syndromes post-traumatiques de retour chez eux au regard de ceux qui n’ont pu en parler ou s’exprimer. »
Grâce aux techniques modernes de la neuro-imagerie, il est possible aujourd’hui de voir la réaction et l’évolution d’un cerveau. Et cela permet notamment d’examiner le cerveau de ceux qui ont subi des chocs affectifs ou des traumatismes :
« La neuro-imagerie révèle de graves lésions cérébrales chez les bébés en carence affective et sensorielle. Elle montre aussi que, dès qu’ils sont en contact avec une famille d’accueil aimante, les circuits neuronaux sont à nouveau « réchauffés », mais que ce n’est pas suffisant. Ces enfants-là gardent la trace de la privation passée et acquièrent une grande vulnérabilité neuro-émotionnelle qui les expose à la dépression, au passage à l’acte (suicide, délinquance) ou bien à une forme intense de rêverie qui les coupe du réel. Ceux qui retrouvent goût à l’existence sont ceux qui parviennent à faire « quelque chose » de leur malheur passé. Cela s’explique très bien sur le plan cérébral. Les neurones préfrontaux – qui ont pour fonction d’anticiper un scénario et de freiner les réactions de l’amygdale rhinencéphalique, socle neurologique des émotions insupportables – sont alors stimulés. Ils peuvent à nouveau jouer leur rôle de régulation émotionnelle. »
Et c’est là qu’intervient l’écriture :
« Elle permet d’échapper à l’horreur du réel qui fait disjoncter le cerveau, de ne pas rester prisonnier du contexte et de ne pas tomber dans la jouissance immédiate que procure, par exemple, la drogue. En sublimant la souffrance, en la transformant en œuvre d’art, l’écriture donne du sens à l’incohérence, au chaos, comble le gouffre de la perte (dans le cas de la mort d’un enfant, par exemple, comme chez Victor Hugo) et crée un sentiment d’existence. De simple témoin impuissant, l’auteur devient créateur de ce qu’il raconte. »
Il explique savamment ce que mon intuition m’a fait découvrir : la force de l’écrit par rapport à la parole :
« Quand un mot parlé est une interaction avec un interlocuteur réel qui réagit à notre discours et l’influence (soupirs, mimiques, relances…), le mot écrit nous fait plonger dans l’imagination et l’introspection puisque nous nous adressons à un ami invisible.
La poésie et la musique des mots, leur résonance affective, cassent aussi le langage logique et mettent en place une langue irrationnelle, qui dit la vérité du monde le plus intime.
Les mots écrits possèdent enfin un pouvoir de mise à distance et de « métabolisation » plus important. Ce n’est pas l’acte de parler qui apaise, c’est le travail de recherche des mots, des images, l’agencement des idées, qui entraîne à la régulation des émotions. Cela explique pourquoi ceux qui souffrent peuvent écrire des poèmes, des chansons, des essais, des romans où ils expriment leurs souffrances alors qu’ils sont incapables d’en parler en face à face. »
Il explique le sens de ce titre énigmatique : « La nuit, j’écrirai des soleils ? »
C’est dans le noir que l’on espère la lumière, c’est dans la nuit que l’on écrit des soleils… Jean Genet commettait des vols pour aller en prison et se contraindre à écrire. Rimbaud s’isolait dans les latrines. Eux qui avaient tant besoin d’affection s’en privaient volontairement pour stimuler leur créativité ! L’écriture opère comme une sorte de phénomène compensatoire, comme les enfants aveugles qui développent leur ouïe. Quand il y a déficit de perceptions, l’imagination flambe et empêche l’agonie psychique. Fort heureusement, de nombreux auteurs (Pierre de Ronsard, Jacques Prévert…) parviennent à écrire lorsqu’ils sont heureux. Il ne s’agit alors plus de combler un manque mais de jouer avec les mots, les idées, les représentations. Quel plaisir pour le lecteur !
Il rappelle aussi son enfance meurtrie et la relation particulière qu’il a développé avec l’écriture :
« [L’écriture] m’a sauvé en me permettant de sortir du silence et de me réapproprier mon histoire. Ayant échappé de justesse à une rafle à 6 ans, pendant la guerre, on m’a dit que j’allais mourir si je parlais.
A la Libération, on ne m’a pas cru, on m’a fait taire, on m’a expliqué que mes parents avaient dû commettre de grands crimes pour être déportés et subir de telles souffrances et, même, on a ri de mon trauma.
Puisque je ne pouvais m’exprimer, je me suis réfugié dans la rêverie et la lecture. Pendant quarante ans, ma vie a été muette, jusqu’au moment où je me suis décidé à écrire… En achevant cet essai, je ne vois plus mon enfance de la même manière. Je me suis plongé dans les archives, je suis retourné sur les lieux qui m’ont marqué, j’ai échangé avec d’autres personnes… J’ai aujourd’hui l’impression de l’enfance d’un autre, intéressante et détachée. Le travail de l’écriture a modifié ma mémoire. Je ne suis plus traumatisé en la racontant. Et je ressens toujours un profond bonheur quand mon récit résonne pour le lecteur : « Cela me fait penser à moi. »
Et il finit son entretien par cet appel à trouver son moyen d’expression, car tout le monde n’est pas capable d’écrire. Il en cite de nombreux : la musique, la peinture, la danse, le théâtre, la vidéo, le slam, la bande dessinée, l’engagement associatif, une cause humanitaire….
Une « création » qui donne sens.
Je vous conseille, si vous ne l’avez pas encore vu, de regarder ce bel et profond entretien qu’il accorde à François Busnel dans « La Grande Librairie » du 11 avril 2019. Il parle de son enfance fracassée, des grands auteurs qui on tous vécu un traumatisme, des étapes de la résilience. Il parvient à faire se rejoindre la science et la poésie.
<1232>
-
Jeudi 25 avril 2019
« Les progressistes contre les populistes »Clivage politique défendu par Ismaël Emelien et David Amiel, conseillers de Macron et auteurs d’un livre récentCe soir notre jeune président va parler pour nous dire ce qu’il a compris du grand débat et nous annoncer les mesures qu’il a décidées pour le bien des français et de la France. Il s’inscrira comme toujours dans le camp des progressistes pour expliquer le cap qu’il a fixé. Emmanuel Macron est jeune, il est né peu avant Noël 1977 et a donc été élu à moins de 40 ans.
Il est vrai qu’à cet âge Alexandre le Grand avait tout accompli de son œuvre et était déjà mort depuis 8 ans. Et dire qu’on prétend que tout va de plus en plus vite…
La jeunesse n’est pas une tare, même pour diriger. Elle peut même être un atout puisqu’elle permet d’avoir pris moins de mauvaises habitudes que les vieux.
Mais on pourrait penser que lorsqu’on se trouve dans cette position difficile à 40 ans, on s’entoure de conseillers d’expérience, de stratèges ayant du vécu. Quitte à les bousculer, à ne pas toujours les suivre dans leurs conseils prudents.
Mais ce n’est pas ce qu’a fait notre jeune président : il s’est entouré de conseillers encore plus jeunes que lui.
Ismaël Emelien est né en 1987 et a donc dix ans de moins qu’Emmanuel Macron. Il est banalement diplômé de Siences-Po Paris où Strauss Kahn était son professeur. Il est naturellement entré en politique dans les cercles Strauss-Kahnien comme Benjamin Griveaux, Stanislas Guérini ou encore Sibeth Ndiaye tous aujourd’hui dans le premier cercle de Macron. Il a travaillé dans le secteur privé et dans un think-tank : la fondation de Jaurès, toujours dans la communication et la politique. Il est devenu conseiller d’Emmanuel Macron au moment de son entrée au gouvernement comme ministre de l’Économie, en 2014. Comptant parmi les fondateurs d’En Marche, puis directeur de la stratégie de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron, il a ensuite été nommé conseiller spécial du Président de la République.
Conseiller spécial du Président de la République !
Pour donner une idée de ce poste on rappellera que fut le rôle joué par le jeune Jacques Attali auprès du vieux François Mitterrand ou d’Henri Guaino auprès de Nicolas Sarkozy.
Wikipedia écrit ;
« il est décrit par le quotidien Le Monde comme faisant partie, avec le président de la République et le secrétaire général de l’Elysée Alexis Kohler, des trois hommes qui « dirigent la France. » Le Figaro indique qu’« il travaille pêle-mêle sur la stratégie du président, la communication numérique, la gestion de crise, livrant des « éléments de langage » aux communicants du gouvernement par le biais d’une boucle Telegram. Il relit les interviews ministérielles, y rajoute des mots-clés (le « wording », dans le jargon des communicants) ». Il invente le slogan « Make Our Planet Great Again », en réaction à la décision du président américain Donald Trump de quitter l’accord de Paris sur le climat, en référence à son propre slogan de campagne « Make America Great Again »6, ou encore l’expression « premier de cordée ». Il est également à l’origine de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo où Emmanuel Macron parle des aides sociales qui coûtent, selon lui, « un pognon de dingue».
Si vous voulez en savoir plus vous pouvez lire ce petit article de « l’Obs » <10 choses à savoir sur Ismaël Emelien>
Il vient de quitter l’Élysée, les mauvaises langues disent que c’est à cause de l’affaire Benalla.
 Mais ce n’est pas la raison officielle. La raison officielle c’est pouvoir assurer la promotion du livre qu’il a écrit avec David Amiel qui était aussi conseiller du Président et qui a aussi quitté l’Élysée pour la même raison.
Mais ce n’est pas la raison officielle. La raison officielle c’est pouvoir assurer la promotion du livre qu’il a écrit avec David Amiel qui était aussi conseiller du Président et qui a aussi quitté l’Élysée pour la même raison.
David Amiel est encore plus jeune que le jeune Ismaël, puisqu’il a 6 ans de moins.
Il est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm). En 2015, après un séjour de recherches à l’université de Princeton aux Etats-Unis, il rejoint Emmanuel Macron, alors ministre, comme économiste. Pendant la campagne présidentielle, il coordonne l’élaboration et la rédaction du programme. Il est nommé en mai 2017 conseiller du Président de la République.
Ces deux très jeunes conseillers viennent donc de publier un livre : « Le Progrès ne tombe pas du ciel ».
Ils se placent clairement dans le camp du progrès.
Je ne nie pas la complexité de leur pensée et je dois d’ailleurs concéder que je ne l’ai pas approfondi.
Mais j’ai écouté plusieurs émissions dans lesquelles ils développaient cette pensée, leur vision du monde.
Je les ai entendus une première fois, invités sur France Inter par Nicolas Demorand et Alexandra Bensaid le <26 mars 2019>.
Loin de moi de prétendre qu’ils ne développent pas des analyses intéressantes. Mais reprenons le postulat de départ
Ils sont progressistes et le camp d’en face ce sont les populistes.
Pour eux le clivage gauche / droite ne reviendra pas et les partis politiques qui représentaient ce clivage ne se relèveront pas de leur léthargie actuelle.
C’est tout à fait possible et je pense même probable.
Mais ce qu’il faut comprendre c’est que dans un clivage droite/gauche, les gens qui se font face sont des personnes qui en principe se respectent tout en sachant qu’ils ne pensent pas les mêmes choses et qu’ils ont toutefois en commun beaucoup de valeurs. Ainsi Juppé et Rocard avaient un profond respect l’un pour l’autre tout en se combattant politiquement et dans un autre style et d’autres convictions il en allait de même entre Seguin et Chevènement.
Mais dans le clivage qu’impose ces très jeunes conseillers, nous ne sommes plus dans cette joute maîtrisée et respectueuse.
Le clivage qu’ils proposent, l’Histoire le connaît.
Pour les chrétiens, les croyants contre les mécréants, dans l’islam on opposait les vrais musulmans contre les kouffars et pour le premier peuple du livre : les juifs contre les goys.
Dans la religion laïque du communisme les communistes et les dissidents.
Bref les bons contre les mauvais, une analyse manichéenne.
Ils constatent que dans leur échelle des valeurs, les progressistes perdent beaucoup de batailles dans le monde : Trump, Bolsonaro, brexit, Italie, Hongrie etc., mais en France les progressistes l’ont emporté. Ils ont une vision de l’échiquier politique français :
« Il existe des progressistes ailleurs que dans la majorité présidentielle, mais la majorité présidentielle est la seule force politique exclusivement composée de progressistes »
A ce stade, Alexandra Bensaid a posé la seule question qui vaille : qu’est-ce que le progressisme ?
David Amiel a répondu :
« Le progressisme c’est un objectif, une condition et une méthode.
L’objectif c’est de permettre à chacun de maximiser ses possibles. Donner à chacun la possibilité de choisir sa vie.
La condition est de le faire ensemble. Parce que si chacun cherche à le faire dans son coin, cela ne marchera pas. Ce n’est pas au chômeur de résoudre tout seul le problème du chômage.
La méthode c’est de commencer par le bas. Il faut permettre aux individus d’être acteur du changement.
C’est pourquoi nous avons appelé notre livre : « le progrès ne tombe pas du ciel » »
C’est une vision. Elle est individualiste. Certes on promet de le faire ensemble, donc d’aider chacun à s’en sortir au mieux. A chacun de devenir acteur.
Mais quelle est la contrepartie de cette vision ?
C’est que si vous échouez à « maximiser vos possibles » c’est de votre faute, puisque vous n’avez pas su saisir votre chance, tirer tout le potentiel de l’aide qu’on vous a donnée. Vous n’avez pas su devenir acteur de votre changement.
Dans la vision de gauche, il y avait des classes sociales, un collectif. « Faire ensemble » ce n’est pas tout à fait la même chose. Une armée d’auto entrepreneurs peut faire ensemble mais ce n’est pas un collectif.
Ils le disent d’ailleurs explicitement :
« Les progressistes ne s’adressent plus à des classes sociales, mais à des personnes »
Si vous cherchez sur internet vous verrez de nombreuses interventions des deux auteurs qui défendent leur livre, la politique d’Emmanuel Macron et le cap qui est le bon.
Même la crise des gilets jaunes est analysée comme une confirmation des intuitions du macronisme.
« D’abord ils nous disent exactement ce qu’on avait dit pendant la campagne : leur souci principal est que le travail paie. Ils ne revendiquent pas une redistribution massive, le fait d’augmenter tous les minimas sociaux.
Ensuite ils ne se reconnaissent ni dans la gauche, ni dans la droite, et donc ils nous renvoient quelque part à la figure ce que nous, on a dit il y a deux ans »
Pour répondre plus longuement à ce livre, je vous laisse écouter « Le nouvel esprit public » de Philippe Meyer, émission du 31 mars 2019 que vous trouverez derrière ce lien : https://www.lenouvelespritpublic.fr/podcasts/115
J’ai été particulièrement conquis par l’analyse du « vieux » et brillantissime Jean-Louis Bourlanges qui rappelons est centriste, député du MODEM et donc membre de la majorité présidentielle.
Et cette « nouvelle ancienne » émission a innové et présente désormais un verbatim des échanges verbaux, ce qui me facilite le partage
« Bien que député de la majorité, Jean-Louis Bourlanges (JLB) ne connaît pas les deux auteurs du livre. Il les a seulement écoutés parler sur France Inter et a lu leur livre. Cette écoute et cette lecture lui ont permis de comprendre le malaise qu’il éprouve depuis deux ans en tant que parlementaire de la majorité. Il y a maldonne entre ces ex-conseillers et lui (« lui » en tant que député de base de l’ancien monde, pas en tant que personne). Il a cependant un petit espoir : il semble qu’il y ait aussi un malentendu entre les auteurs et Macron lui-même.
Ce livre a paru à JLB prétentieux, étriqué, erroné sur ses priorités, assez profondément malveillant, et carrément mensonger.
Prétentieux d’abord. On est en face d’un texte ne contenant pas une idée, ni une analyse intéressante. Simplement l’affirmation qu’ils ont tout compris. Ce qui conduit à des bizarreries : pour donner de l’originalité à leur maximisation des possibles, ils disent que ça n’a rien à voir avec l’égalité des chances (ce qu’ils peuvent se permettre de faire en donnant à l’égalité des chances une interprétation totalement restrictive). Il y a certes une différence, mais elle n’est pas à l’avantage de la maximisation des possibles. Maximiser les possibles, c’est se situer dans une perspective « jeune cadre dynamique concurrentiel » de la liberté. Ce qui mène à des déviations : le modèle philosophique de la vie réussie devient celui de l’enrichissement financier. La liberté d’une personne ne consiste pas forcément en la maximisation de ses possibles, on peut aussi faire le choix d’une vie plus calme …
C’est aussi un livre étriqué. Il y a une méconnaissance totale de tous les enjeux collectifs. L’Europe et le monde sont en effet absents. Même la France n’y est pas, c’est là que se situe la différence avec Macron, qui lui au moins fait le chemin mémoriel. Ici, aucun enjeu. La société selon les deux auteurs de ce livre est une RPJ : une Résidence pour Personnes Jeunes. La société est ici un réservoir d’outils, plus ou moins informatisés, qu’on fournit aux gens. Or ce n’est pas cela, une société. C’est un ensemble de solidarités, c’est un destin collectif. Si un bulletin de vote peut avoir un poids, c’est parce qu’il est inscrit dans un parti, un mouvement, quelque chose qui dépasse la seule capacité individuelle. La dimension intermédiaire de l’engagement collectif est fondamentale.
Ensuite, c’est un livre erroné sur les priorités. On pense tout de suite aux livres de Jérôme Fourquet, pour qui le problème français est celui d’une fragmentation du corps social, et le but du président de la République, c’est d’abord d’établir des liens entre ces fragments. C’est cela l’enjeu fondamental, et il est totalement ignoré.
Il y a en outre une grande malveillance. Macron a été élu sur le thème de la bienveillance, du rassemblement, de l’écoute. Ici, on n’a que l’exaltation d’une idéologie « bobo », qui consiste à faire honte aux gens qui ne se comportent pas comme ils le devraient (en matière d’écologie par exemple).
Enfin, c’est mensonger, sur deux points essentiels. La solidarité d’abord, puisque ce livre est un hymne à l’individualisme, qui est la plus grande menace pour la société française. L’autre mensonge est celui du mouvement de bas en haut. Ce qui mène là aussi à des acrobaties stylistiques, car expliquer que le jupitérisme vient d’en bas est une gageure. Par exemple « il faut que le haut fonctionnaire soit au service des agents de terrain ». D’accord, mais qu’est-ce que ça veut dire ?
C’est du baratin. Typiquement ce qu’on appelait en mai 68 « de l’idéologie ».
Le progrès ne tombe pas du ciel, mais il ne tombe pas de ce livre non plus. »
Vous constatez que Jean-Louis Bourlanges est très sévère mais tente de préserver le président de sa majorité.
Mais Philippe Meyer répond à cette prétention en faisant appel à Michel Rocard.
« Pour Philippe Meyer, il est difficile d’épargner Macron en séparant clairement sa pensée des choses lues dans ce livre, car ce livre émane de son entourage très proche. On avait par exemple longtemps reproché à Michel Rocard de s’être fourvoyé dans une campagne pour les européennes (où son score avait été si faible qu’il avait dû abandonner toute espèce d’autre ambition par la suite). Il s’était présenté sur le (mauvais) conseil de son directeur de cabinet Jean-Paul Huchon. Si bien que des années plus tard, quand on lui disait « vous aviez été mal conseillé dans cette affaire », il répondait « oui. J’ai été mal conseillé par des gens que j’ai choisi ». Il n’a jamais accepté que la responsabilité incombe au mauvais conseil. »
J’avais un jour pris comme mot de jour cette phrase de Shakespeare extrait du Roi Lear: « Tis the time’s plague when madmen lead the blind.» ce qui signifie « Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles. ».
Aujourd’hui un dramaturge voyant notre monde pourrait peut-être dire : Quelle époque terrible que celle où de jeunes rois inexpérimentés font appel à des stratèges plus jeunes et plus inexpérimentés qu’eux.
<1231>
-
Mercredi 24 avril 2019
« La cathédrale de Strasbourg est la plus belle des cathédrales »Pierre NoraCertains ont été surpris par l’élan d’émotion et aussi de dons qui se sont dirigés vers Notre-Dame de Paris après son incendie. Plus qu’une Église, plus qu’un lieu de culte catholique il s’agit d’un symbole national, à la fois religieux, républicain et populaire.
Beaucoup d’émissions ont été consacrées à ce sujet.
Ainsi Hervé Gardette avait invité pour son émission du 20 avril, l’historien Nicolas Offenstadt pour parler de cette dimension symbolique : « Aux vieilles pierres la patrie reconnaissante » .
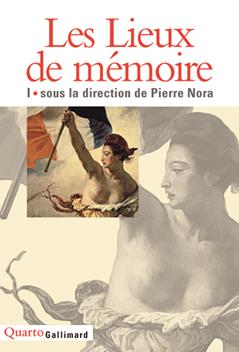 Et Ali Baddou a invité le même jour le grand historien Pierre Nora, inventeur du concept des « Lieux de Mémoire ».
Et Ali Baddou a invité le même jour le grand historien Pierre Nora, inventeur du concept des « Lieux de Mémoire ».
L’essentiel de ses travaux a été consacré au « sentiment national » et à sa composante mémorielle.
<Cette émission> était donc particulièrement intéressante et les échanges de grande qualité et je vous invite à l’écouter.
Pour ma part, je vais aujourd’hui écrire à l’économie et ne pas tenter de faire une synthèse ou un résumé des propos échangés.
Mais taquin, je vais me concentrer sur un très court extrait dans lequel Pierre Nora a exprimé un avis qui m’a enchanté.
Tout en long de l’émission, il a souligné l’importance de Notre Dame de Paris dans le sentiment national et la symbolique qu’elle représente.
Mais après il a dit :
« Il y a des cathédrales qui sont plus belles que Notre Dame de Paris. Chartres est plus belle que Notre Dame de Paris. Et Strasbourg n’en parlons pas. Elle est la plus belle des cathédrales, avec cette dentelle de pierres, c’est extraordinaire absolument. »
Je suis évidemment d’accord avec cet avis subjectif, la plus belle c’est la cathédrale de Strasbourg.
Et c’est un lorrain qui le dit !
Il est donc très probable que c’est exact.
J’ai trouvé <cette vidéo> qui montre la cathédrale de Strasbourg filmé par un drone.
Et <Une vidéo des Racines et des ailes> et encore <Une autre>
C’est un chef d’œuvre de majesté et d’équilibre.

<1230>
-
Mardi 23 avril 2019
« Les mystères du cerveau, les mystères de la vie »Conclusion de Frédéric Pommier après avoir cité un article du magazine SocietyIl est encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, nous autres humains. Il faut l’accepter et le reconnaître.
Le magazine « Society », qui est un bimensuel mais qui se dit « quinzomadaire », a consacré un article sur ce sujet. Et c’est à nouveau la revue de presse du week-end de l’irremplaçable Frédéric Pommier du dimanche de pâques, <Le 21 avril 2019> qui m’a informé de ces étranges aventures.
Le premier destin dont il est question est Franco Magnani. Frédéric Pommier a dit :
« Il y a quand même des gens qui ont des vies exceptionnelles… Ou des cerveaux exceptionnels. Et là, je ne parle pas de ceux qui sont dotés d’une intelligence formidable, je ne parle pas de ceux qui ont toujours été des génies, mais de ceux qui, alors qu’ils menaient une existence tout à fait normale, ont eu un accident, et suite à cet accident, se sont découvert des capacités nouvelles. C’est l’histoire de l’Italien Franco Magnani. On est en 1960, il tombe gravement malade, forte fièvre, il délire et, une fois guéri, le voilà qui se met à peindre le village de son enfance avec une précision quasi photographique… »
En pratique cet homme vivait en Californie et avait quitté son village natal depuis une vingtaine d’années et n’avait aucune pratique ou goût pour la peinture.
J’ai trouvé un autre article qui évoque Franco Magnani et aussi d’autres destins similaires d’un talent explosant subitement pour la peinture après un évènement de la vie. Il donne plus de précisions sur cet italien :
« il est né en 1934 –, […] Franco Magnani n’a rien publié sur lui-même et tout porte à croire que son nom serait resté à jamais ignoré sans la reconnaissance fortuite de l’Exploratorium de San Francisco, un grand centre culturel qui tente d’allier arts et sciences. En effet, au milieu des années 1980, un des animateurs du centre, Michael Pearce, vient à connaître l’existence d’un cuisinier italien qui tient avec son épouse Ruth, peintre elle-même, une petite galerie dans la banlieue de San Francisco, à North Beach. Il y expose quelques-uns de ses tableaux, essentiellement des vues, des vedute, d’un village accroché sur un promontoire escarpé. Michael Pearce rend visite au peintre, il l’écoute. Le cas qu’il représente l’intrigue, son insertion dans une grande exposition sur la mémoire est décidée.
Conformément à son orientation, l’Exploratorium soumet l’œuvre à un dispositif expérimental. Franco Magnani affirme qu’il peint exactement son pays, quitté depuis plus de vingt ans, il suffit de vérifier la chose. La photographe attachée à l’institution, Susan Schwartzenberg, se rend dans le village pour retrouver quelques-unes des vues de Magnani, elle ramène une série de clichés qui confirment l’exactitude sidérante de ses représentations; exposés à côté des tableaux, ils identifient en Magnani une exceptionnelle «hypermnésie visuelle» et le consacrent comme «memory artist». Oliver Sacks, le neurologue qui a renouvelé la narration littéraire du «cas» psychologique, voit ces tableaux, rencontre leur auteur et en fait un des héros de son livre, « An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales (1995) », où il ancre le diagnostic d’hypermnésie dans une physiologie du cerveau tout en racontant la biographie de l’artiste »
J’ai donc appris un nouveau mot « hypermnésie » du grec huper, « avec excès », et mnesis, « mémoire » qui une pathologie caractérisée par une mémoire autobiographique extrêmement détaillée du passé.Les personnes atteintes d’hypermnésie peuvent se remémorer des périodes lointaines de leur vie, remontant à la petite enfance.
Franco Magnani dispose d’un <site> en anglais où il raconte son aventure et où on voit certaines de ses œuvres.
Mais Frédéric Pommier évoque un autre cas cité par Society :
« 2002 : c’est l’histoire de l’Américain Jason Padgett. On l’agresse à la sortie d’un karaoké, sévère commotion cérébrale, mais l’incident l’a transformé en cador des mathématiques… »
Vous trouverez aussi plusieurs sites qui évoquent le cas de ce mathématicien né brutalement à la conscience mathématique. Par exemple cette page : « Une réalité mathématique dessinée en fractales par un homme atteint par le syndrome du savant. »
Cette pathologie a également un nom : « synesthésie ». Je ne développe pas et je n’ai pas approfondi.
Frédéric Pommier donne encore un autre exemple :
« Et puis, en 2012, c’est l’histoire d’un jeune Australien, Ben McMahon. Victime d’un accident de la route, il tombe dans le coma et, au bout d’une semaine, ses parents croient rêver quand leur fils se réveille : il parle en mandarin, un mandarin fluide à l’accent remarquable. Les scientifiques évoquent ici « le syndrome de la langue étrangère ». Il y a d’autres exemples. On ne les explique pas. Les mystères du cerveau, les mystères de la vie. »
Là aussi si vous tapez le nom de Ben Mac Mahon dans un moteur de recherche vous accéderez à de multiples articles en anglais sur cette aventure. Le « Dauphiné » a consacré un article en français à ce syndrome.
L’article de Society parle encore d’autres cas :
En 1860 Eadweard Muybridge s’était cogné à un rocher et est tombé dans le coma pendant 9 jours. Après cet accident il devient un inventeur génial.
En 1951 Kim Peek se souvenait de 98% des 12 000 livres qu’il avait lus. Son histoire a servi d’inspiration pour le film « Rain Man » dans lequel Dustin Hoffmann jouait le rôle de cet autiste à la mémoire phénoménale.
« Hypermnésie », « synesthésie », «syndrome de la langue étrangère », Frédéric Pommier a raison de parler « des mystères du cerveau, des mystères de la vie ».
La science ne sait pas expliquer.
Pendant longtemps des récits mystiques essayaient de donner des pseudos explications à de tels phénomènes.
Aujourd’hui encore des charlatans ont des théories qu’ils exposent avec une grande assurance et avec lesquelles ils espèrent parfois gagner beaucoup d’argent et y arrivent parfois. D’autres cherchent plus simplement exercer un pouvoir sur des adeptes.
L’humilité nous conduit simplement à dire que nous ne savons pas, ou si nous sommes optimiste que nous ne comprenons pas encore.
Car le contraire de la connaissance n’est pas l’ignorance mais les certitudes.
<1229>
-
Vendredi 19 avril 2019
« Avoir une cathédrale dans la tête. »Boris CyrulnikLa destruction par le feu de Notre Dame de Paris a entraîné beaucoup de réactions et beaucoup de discussions. Surtout depuis que des riches mécènes ont décidé très rapidement de verser de grosses sommes d’argent.
Certains ne comprennent pas qu’on puisse trouver autant d’argent, en si peu de temps pour relever des murs, alors qu’on n’en trouve pas pour loger les sans-abris et pour éradiquer la misère.
D’autres plus mesurés, comme les représentants de la fondation de l’Abbé Pierre, de l’armée du salut ou d’ATD Quart monde, expriment leur satisfaction de constater que des financements vont permettre de réparer l’édifice religieux mais voudraient que la générosité s’étende aussi à la misère humaine. Le Monde a publié un article : <Le malaise des associations caritatives face à la générosité pour Notre-Dame> qui présente ces interrogations.
Le journal a relayé un tweet de l’essayiste Ollivier Pourriol, posté mercredi 17 avril :
« Victor Hugo remercie tous les généreux donateurs prêts à sauver Notre-Dame de Paris et leur propose de faire la même chose avec les Misérables. »
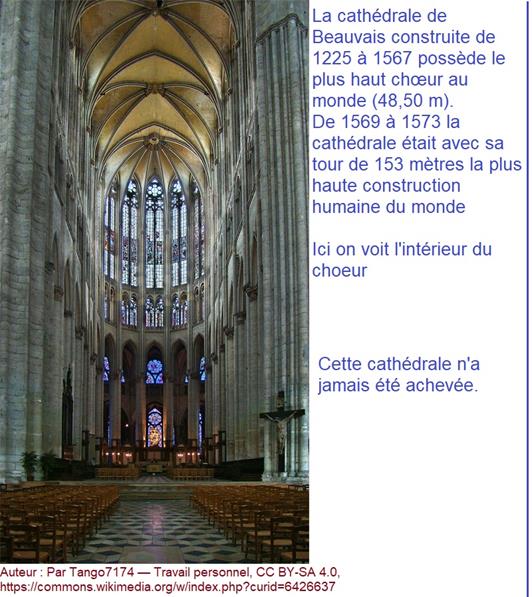 J’y reviendrai, peut-être, dans un mot du jour ultérieur.
J’y reviendrai, peut-être, dans un mot du jour ultérieur.
Mais aujourd’hui et avant le week-end pascal qui commémore le cœur du récit de la civilisation chrétienne dont je suis issu et beaucoup d’entre vous certainement aussi, et en écho à ce magnifique monument qui a été construit au moyen âge et qu’un grand nombre souhaite reconstruire, je veux partager une autre histoire, une histoire de valeur, de sens et d’intelligence.
Boris Cyrulnik avait publié en 2004 : « Parler d’amour au bord du gouffre ».
Dans le chapitre II intitulé : « La résilience, comme un anti-destin » il donne comme titre à un de ses développements : « Avoir une cathédrale dans la tête »
Et il raconte cette histoire :
« J’ai souvent attribué à Charles Peguy la fable suivante. En se rendant à Chartres, Peguy voit sur le bord de la route un homme qui casse des cailloux à grand coup de maillet. Son visage exprime le malheur et ses gestes la rage.
Peguy s’arrête et demande: « Monsieur que faites-vous ?». «Vous voyez bien ! lui répond l’homme, je n’ai trouvé que ce métier douloureux et stupide.».
Peguy aperçoit un autre homme qui lui aussi casse des cailloux, mais son visage est calme et ses gestes harmonieux. «Que faites-vous monsieur?» lui demande Peguy. «Eh bien, je gagne ma vie grâce à ce travail fatigant mais qui a l’avantage d’être en plein air».
Plus loin, un troisième casseur de cailloux irradie de bonheur. Il sourit en abattant la masse et regarde avec plaisir les éclats de pierre. «Que faites-vous? » lui demande Peguy. L’homme lui répond: «Moi, répond cet homme, je bâtis une cathédrale !»
« Je bâtis une cathédrale ! »
Cyrulnik reconnait lui-même, dans son livre, que cette histoire n’est pas de Charles Peguy. Certains site comme <celui-ci> ou <celui-là> attribue cette fable à Raymond Lulle philosophe, poète et théologien de Majorque (1232-1315).
Mais ce qui est essentiel, c’est cet homme qui transcende son travail pénible par la compréhension du but de son action : « bâtir une cathédrale »
Boris Cyrulnik explique:
«Le caillou dépourvu de sens soumet le malheureux au réel, à l’immédiat qui ne donne rien d’autre à comprendre que le poids du maillet et la souffrance du coup. Alors que celui qui a une cathédrale dans la tête transfigure le caillou, il éprouve un sentiment d’élévation et de beauté que provoque l’image de la cathédrale dont il est déjà fier». »
Il y a deux faces à cette force qui transforme un geste pénible et parcellaire en un grand dessein :
La première est une responsabilité individuelle : chercher le sens de ce que l’on fait et accepter de participer à une œuvre qui nous dépasse. C’est ce dont parle principalement Boris Cyrulnik.
La seconde est collective et à mon sens plus importante. Quel est le récit qui bâtit notre civilisation, dans lequel nous pouvons nous inscrire, donner de nous-même pour quelque chose de plus grand que nous ?
Il m’étonnerait beaucoup que ce dessein mobilisateur pourrait être de vouloir toujours consommer davantage, ou que chaque jeune ait le désir de devenir milliardaire ou encore que la science puisse allonger indéfiniment la durée de vie de certains homo sapiens pour qu’ils puissent consommer plus longtemps.
La question qui se pose est bien celle-ci ; quelle cathédrale avons-nous envie collectivement de bâtir ?
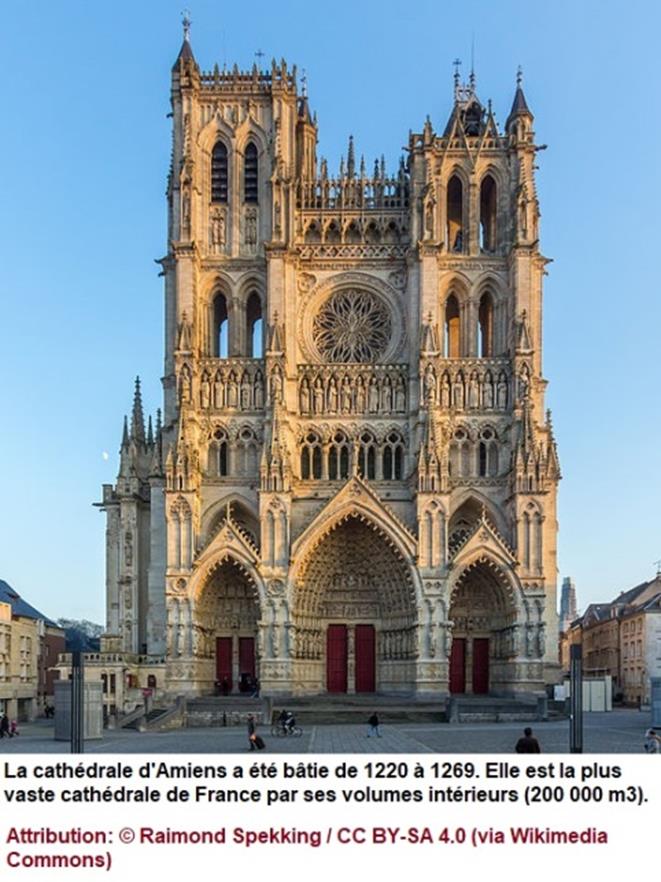
PS : J’avais déjà cité cette histoire dans un mot du jour mais sans en faire le point central du mot. C’était le mot du jour du 29 novembre 2016 et qui concernait la création par Ambroise Croizat de la sécurité sociale.
<1228>
-
Jeudi 18 avril 2019
« Le couple franco-allemand au bord du divorce »Jean QuatremerEmmanuel Macron a beaucoup de contrariétés ces derniers temps.
Une révolte provenant de la profondeur de la France, en dehors des métropoles insérées dans la mondialisation, conteste sa politique et sa vision économique du monde.
Au moment où il entend donner son discours à la France pour répondre à cette révolte, Notre Dame s’embrase et l’oblige à changer de discours.
Sur le plan international, rien ne va non plus comme il l’espérait. Malgré tous ses efforts de calinothérapie avec Donald Trump, ce dernier n’a en rien infléchi sa politique ni ses décisions vers des choix souhaités par notre président.
Mais sa plus grande déception, vient de l’Allemagne. Il espérait le soutien de l’Allemagne après avoir lancé une politique de réforme du marché du travail dans le sens voulu par l’Allemagne, après avoir courtisé Angela Merkel ; toutes ses propositions ont été systématiquement ignorés par nos voisin d’outre Rhin.
Celui que beaucoup d’hommes de gauche aiment traiter d’europhile béat ce qu’il conteste : « Jean Quatremer : « Il faut arrêter d’être euro-béat ! », le correspondant de Libération à Bruxelles, Jean Quatremer pense que le divorce entre les responsables des deux pays est proche.
Jean Quatremer a en effet publié, le 14 avril, un article dans libération avec ce titre : « Le couple franco-allemand au bord du divorce »
Il explique notamment
« La fiction du «couple» franco-allemand a volé en éclats lors du sommet spécial Brexit, mercredi et jeudi. S’il y a souvent eu de profonds désaccords entre les deux rives du Rhin, c’est la première fois qu’Angela Merkel l’a affiché publiquement et sans précautions diplomatiques excessives. La chancelière a jugé «incompréhensible» le «raisonnement» d’Emmanuel Macron défavorable à une extension trop longue du délai avant un Brexit définitif, alors qu’elle était prête à donner un an de plus à Theresa May pour lui donner le temps d’essayer de faire adopter l’accord de divorce conclu avec l’Union. »
Jean Quatremer est résolument du côté de notre président et ironise sur les positions allemandes:
« Le «raisonnement» du chef de l’Etat français est pourtant simple : l’Union, confrontée à d’autres défis, ne peut se permettre d’être prise en otage par une classe politique britannique incapable de mettre en œuvre la décision d’un référendum qu’il a lui-même provoqué… Finalement, un compromis a été trouvé – prolongation jusqu’au 31 octobre –, mais le gouvernement allemand n’a pas caché sa colère face à la résistance d’un partenaire d’habitude plus docile. Norbert Röttgen, le président (CDU) de la commission des affaires étrangères, n’a pas hésité à accuser Macron, dans un tweet vengeur, de «donner la priorité à ses intérêts de politique intérieure sur l’unité européenne». Car il est bien connu que Berlin n’a jamais aucune arrière-pensée de politique intérieure, comme l’a si bien démontré la crise grecque gérée de façon brutale pour ne pas effrayer les électeurs allemands… »
Jean Quatremer accuse les médias français de donner une vision biaisée de la France qui serait isolée alors qu’elle dispose de soutien. En outre le désaccord n’est pas seulement sur la stratégie à l’égard de la Grande Bretagne mais aussi sur les discussions concernant les relations commerciales avec les Etats-Unis. La France pense que l’Allemagne pour amadouer Trump sur les importations de voiture américaine, entend brader l’agriculture européenne et particulièrement française pour ouvrir la porte à une importation plus massive de produits américains.
« Curieusement, les médias français ont souligné l’isolement de Paris – qui était pourtant soutenu par la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne, Malte, mais aussi, en second rang, par l’Autriche et le Danemark –, l’accusant presque de ne pas avoir joué collectif en refusant de s’aligner sur Berlin. «Il est incroyable que l’on nous présente comme des empêcheurs de tourner en rond alors qu’on a été les empêcheurs de sombrer en rond face à la mollesse collective», se récrie-t-on à l’Elysée. Une position que Macron s’apprête à assumer ce lundi en votant contre l’ouverture de négociations commerciales avec les Etats-Unis, là aussi initiée sous la pression de l’Allemagne, qui craint que Donald Trump ne taxe ses importations automobiles. […]
Emmanuel Macron semble avoir fait son deuil de la relation franco-allemande après y avoir longtemps cru. Il a pris conscience que les démocrates-chrétiens de la CDU-CSU, mais aussi les sociaux-démocrates, défendent avant tout les intérêts allemands travestis en intérêts européens, comme on l’analyse désormais en France. Depuis un an et demi, le chef de l’Etat n’a cessé de recevoir des rebuffades sur quasiment tous ses projets (création d’un budget de la zone euro, d’un Parlement de la zone euro, d’une taxe sur les géants du numérique, d’une Europe de la défense, etc.). »
Cela devient un drame shakespearien. Sans l’Europe, la France ne représente plus grand chose sur le marché économique mondial. L’Union européenne n’est forte que si les allemands et les français parviennent à s’entendre et à s’accorder. Mais l’Allemagne et la France ont des intérêts de plus en plus divergents.
<1227>
-
Mercredi 17 avril 2019
« Papa fait du foot, maman passe le balai »Tania De MontaigneC’est la revue de presse de Frédéric Pommier, sur France Inter, samedi 13 avril qui m’a appris l’existence d’une chronique de Libération que je souhaite partager avec vous aujourd’hui.
Cette chronique est tenue en alternance par 5 personnes, écrivains, essayistes et même journalistes. La chronique du 12 avril 2019 a été rédigée par Tania de Montaigne.
Vous la trouverez derrière ce lien : « Papa fait du foot, maman passe le balai »
Pour celles et ceux qui parlent un peu la langue du football, aucune introduction n’est nécessaire.
Pour les autres, il suffit de savoir que dans le monde du football il y a 3 groupes. Le premier qui compte de nombreux adeptes, considère que le meilleur joueur de football d’aujourd’hui est Lionel Messi qui est argentin. Le second qui est aussi nombreux que le premier, considère que le meilleur joueur de football d’aujourd’hui est Christiano Ronaldo qui est portugais. Le troisième groupe est très minoritaire, il considère que c’est un troisième joueur qui est le meilleur, mais il n’arrive pas à se mettre d’accord pour savoir qui c’est, hormis le fait que ce ne serait ni Ronaldo, ni Messi.
Messi parle peu et ne se fait pas trop voir dans les médias, en dehors de ses activités sportives. Ronaldo parle souvent et se montre régulièrement dans les médias en dehors de ses activités sportives, il réalise aussi beaucoup de publicités.
Ici, il est question de Christiano Ronaldo
Revenons à la chronique de Tania de Montaigne :
« Il y a quelques jours, je suis tombée sur une petite vidéo trop mignonne. On y voit Cristiano Ronaldo, star maxi mondiale du football, jouant avec son fils d’un an et demi en grenouillère (le fils, pas le père), trop mignon. C’est beau, c’est de la transmission, le ballon qui va du père au fils, du fils au père. «Allez Mateo !» dit Ronaldo en poussant le ballon vers le petit garçon. Puis, on entend «Oooooohhhhh !» lorsque ledit Mateo renvoie la balle de son petit pied encore malhabile. C’est tellement cute, [mignon en langage branché] on pourrait pleurer. Un peu comme quand Bambi, encore chancelant, parvient à se dresser sur ses pattes arrière et fait ses premiers pas sous l’œil de sa mère qui, malheureusement (attention spoiler), ne tardera pas à mourir dans d’atroces souffrances. Ce que, bien sûr, nous ne souhaitons pas à Ronaldo qui, aux dernières nouvelles, se porte plutôt bien, si on met à part un claquage de la cuisse droite.
Ce qui est vraiment intéressant dans cette vidéo n’est pas au premier plan. Tout se passe ailleurs. Dans le fond, on aperçoit une petite fille, également en grenouillère, qui, elle, n’intéresse aucun des adultes présents dans la pièce. Ni celui ou celle qui filme ni celui qui joue. Elle est dans le champ sans y être. On la voit à l’arrière-plan, reproduire, quasiment à l’identique, les gestes du petit garçon. Elle agit en miroir, faisant, comme si elle appartenait aussi à cette scène. Elle tire dans un ballon imaginaire, celui qu’elle aimerait recevoir mais qui n’arrive pas. Elle joue dans le vide, parce que tout le monde s’en fout et que visiblement, le projet «transmission par le ballon» n’est pas prévu pour elle.
Au bout d’un moment, de guerre lasse, elle arrête de jouer au air-foot et s’en va chercher un balai et un petit kit de nettoyage sur roulettes. Il y a d’autres jouets dans cette salle de jeu, qui doit faire environ 8 250 mètres carrés, mais c’est vers le balai qu’elle se dirige. Un peu comme si la fête était finie.
Une mini-Cendrillon en grenouillère qui retourne à sa vie de toujours.
En voyant ces images, deux choses me frappent.
- Petit 1, étant moi-même très peu millionnaire ou fille de millionnaires, j’avais dans l’idée (idée préconçue, il faut bien l’avouer) que le petit kit de nettoyage et son balai coordonné ne rentraient pas dans la liste des cadeaux envisageables pour les gens de ce monde. Or, apparemment, même enfant de millionnaire, une fille reste une fille. Ce qui est d’autant plus étonnant qu’a priori, sauf grosse banqueroute, il y a de fortes chances pour qu’à l’avenir, cette enfant ait suffisamment d’argent pour pouvoir ne pas faire le ménage, si le cœur lui en dit.
- Petit 2, je me demande combien de temps il faudra attendre pour que le kit nettoyage, le mini-aspirateur, la microcuisine avec ses mignonnes casseroles et son croquignolet lave-vaisselle, cessent d’être dans les meilleures ventes des jouets pour filles. Car, à y regarder de plus près, si on se dit qu’un jeu ou un jouet, quel qu’il soit, a pour but de favoriser l’imaginaire et la créativité des enfants, quelle est exactement la zone du cerveau que l’on compte développer chez une petite fille qui passerait l’aspirateur ?
Pour répondre à cette question, je propose un test simple, scientifique, qui vaut pour tous les sexes. Attention, cette expérience est violente. Munissez-vous d’un balai, passez-le sur une surface de votre choix puis, notez sur une échelle allant de 0 à 10 l’intérêt que vous avez éprouvé en effectuant cette activité.
Sans vouloir influencer l’expérience en cours, je vous livre les résultats qui ont été observés. A ce jour, l’essentiel des réponses se situe entre 0 et 0.
Autrement dit, tous les gens qui ont passé le balai n’y ont vu aucun intérêt créatif. Ce qui nous conduit à penser que le principal intérêt d’un balai c’est de… retirer la poussière.
On peut donc en déduire que s’y préparer depuis l’enfance n’est pas vraiment nécessaire. Je sais, ça va loin !
N’hésitez pas à faire faire cette expérience à vos amis partout dans le monde, ce qui nous permettra d’avoir une base de données solide. Plus nous aurons de résultats, plus ce test aura une portée scientifique planétaire. Et qui sait, peut-être un jour n’y aura-t-il plus de mini-balais dans les magasins de jouets, car plus personne ne jugera nécessaire d’en acheter. ».
Cette chronique m’inspire les réactions suivantes :
- Ceux qui prétendent que la théorie du genre est une fable visant à nier la différence homme-femme, sont soit des doux rêveurs, soit des idéologues du machisme ou d’une religion quelconque, ce qui est très proche.
- Le progrès est certainement en marche, mais il est lent.
- Je crois que je vais m’intéresser aux chroniques de Tania de Montaigne. Frédéric Pommier dit d’elles : « Percutante et ciselée, comme le sont toutes ses chroniques »
<1226>
- Petit 1, étant moi-même très peu millionnaire ou fille de millionnaires, j’avais dans l’idée (idée préconçue, il faut bien l’avouer) que le petit kit de nettoyage et son balai coordonné ne rentraient pas dans la liste des cadeaux envisageables pour les gens de ce monde. Or, apparemment, même enfant de millionnaire, une fille reste une fille. Ce qui est d’autant plus étonnant qu’a priori, sauf grosse banqueroute, il y a de fortes chances pour qu’à l’avenir, cette enfant ait suffisamment d’argent pour pouvoir ne pas faire le ménage, si le cœur lui en dit.
-
Mardi 16 avril 2019
« Le jour qui fuit revêt la cathédrale sainte,
Ébauchée à grands traits à l’horizon de feu ;
Et les jumelles tours, ces cantiques de pierre,
Semblent les deux grands bras que la ville en prière,
Avant de s’endormir,
élève vers son Dieu. »Théophile GautierThéophile Gautier (1811-1872) a écrit un poème « Notre Dame » dans un recueil « La comédie de la mort » publié en 1838.
En voici des extraits :
 « Las de ce calme plat où d’avance fanées,
« Las de ce calme plat où d’avance fanées,
Comme une eau qui s’endort, croupissent nos années ;
Las d’étouffer ma vie en un salon étroit,
Avec de jeunes fats et des femmes frivoles,
Échangeant sans profit de banales paroles ;
Las de toucher toujours mon horizon du doigt.
Pour me refaire au grand et me rélargir l’âme,
Ton livre dans ma poche, aux tours de Notre-Dame,
Je suis allé souvent, Victor,
A huit heures, l’été, quand le soleil se couche,
Et que son disque fauve, au bord des toits qu’il touche,
Flotte comme un gros ballon d’or.
Tout chatoie et reluit ; le peintre et le poète
Trouvent là des couleurs pour charger leur palette,
Et des tableaux ardents à vous brûler les yeux ;
Ce ne sont que saphirs, cornalines, opales,
Tons à faire trouver Rubens et Titien pâles,
Ithuriel répand son écrin dans les cieux.
[…]

Comme, pour son bonsoir, d’une plus riche teinte,
Le jour qui fuit revêt la cathédrale sainte,
Ébauchée à grands traits à l’horizon de feu,
Et les jumelles tours, ces cantiques de pierre,
Semblent les deux grands bras que la ville en prière,
Avant de s’endormir, élève vers son Dieu.
[…]
Que c’est grand ! Que c’est beau ! Les frêles cheminées,
De leurs turbans fumeux en tout temps couronnées,
Sur le ciel de safran tracent leurs profils noirs,
Et la lumière oblique, aux arêtes hardies,
Jetant de tous côtés de riches incendies
Dans la moire du fleuve enchâsse cent miroirs.
[…]
 Et cependant, si beau que soit, ô Notre-Dame,
Et cependant, si beau que soit, ô Notre-Dame,
Paris ainsi vêtu de sa robe de flamme,
Il ne l’est seulement que du haut de tes tours.
Quand on est descendu tout se métamorphose,
Tout s’affaisse et s’éteint, plus rien de grandiose,
Plus rien, excepté toi, qu’on admire toujours. »
Théophile Gautier.
Le poème intégral se trouve derrière ce lien : https://www.poesie-francaise.fr/theophile-gautier/poeme-notre-dame.php
<1225>
-
Lundi 15 avril 2019
« Die Heimat »Mot allemand difficilement traduisible en françaisPendant ce moment d’absence, j’ai passé quelques jours auprès de mes frères, dans ma Lorraine natale.
Cette partie de la France a été très disputée, lors des siècles passés, entre les nations allemandes et françaises.
La partie Nord-Est, dont je suis issu, est cependant une région dans laquelle la langue allemande s’est enracinée dans les toponymes, les patronymes et probablement dans les esprits.
En retournant sur ces lieux, un mot allemand intraduisible en français s’est imposé à moi : « Heimat ». C’est ce qu’est cette région pour moi.
La racine de ce mot est « Heim » qui lui est parfaitement traduisible et signifie « maison » ou « foyer ». Il a la même étymologie que le mot anglais « home ».
Mais pour « Heimat », la traduction n’existe pas, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de le traduire par un seul mot.
Vouloir le traduire par « patrie » serait une grande erreur. La patrie est le pays des « pères » dont l’équivalent allemand est le mot « Vaterland ». On porte les armes pour la patrie, on meurt pour la patrie. Il n’y a rien de guerrier dans le mot « Heimat ».
<Wikipedia> exprime cela ainsi :
« Heimat est un mot allemand qu’il est impossible de traduire par un seul mot français, bien qu’il corresponde à un sentiment universellement répandu. Il désigne à la fois le pays où l’on naît, le village où l’on a grandi, mais aussi la maison où on a passé son enfance ou celle où on est chez soi.
Ainsi quand on est loin de chez soi, on a le mal du pays, le « Heimweh »
[…] Le mot « Heimat » est donc à la fois de l’ordre du sentiment, de la foi religieuse, du souvenir d’enfance, d’un horizon familier ou d’une atmosphère bien précise. […] Depuis, la « Patrie », en allemand « Vaterland » est devenu un concept politique : elle a des frontières, un drapeau, une capitale et un gouvernement, tandis que la « Heimat » n’a pas de drapeau. C’est, selon Waltraud Legros, « le pays que chacun porte à l’intérieur de soi ». »
Pour moi la question ne fait pas de doute j’ai une patrie « La France » et une « Heimat » qui est ce lieu de mon enfance à Stiring-Wendel, dans l’agglomération de Forbach, à moins de 10 km de Sarrebrück. Je n’y finirai certainement pas ma vie, mais il y a un lien qui m’attache à ce lieu et le mot « Heimat » exprime parfaitement ce lien.
Ce n’est certainement pas un lieu de vacances où on a envie de retourner régulièrement parce qu’on s’y plait. C’est un lieu de racines, où on se sent chez soi.
La question qui peut se poser est de savoir si tout le monde possède dans ses sentiments, dans son vécu : un tel lieu ?
Il n’est pas certain que les nomades mondialisés connaissent ce sentiment. Eux qui prétendent, souvent, se sentir chez eux partout dans le monde.
Ils s’éloignent de cette pensée que le stoïcien Sénèque a écrite :
«Il n’est pas de vent favorable pour qui ne connaît pas son port d’attache.»
Les migrants qui cherchent refuge ou un monde plus doux économiquement en Europe, ont certainement une « Heimat » mais qu’ils fuient parce que ce lieu leur est devenu difficile soit parce qu’ils y sont menacés dans leur intégrité physique, soit parce qu’il est difficile d’y vivre économiquement.
C’est une question que chacun peut se poser, peut-être d’ailleurs plutôt à 60 ans qu’à 18 : ai-je dans mon vécu, dans mon univers affectif une « Heimat » ?
Et puis il y a une question plus vaste, plus politique est-il bon pour la société des hommes que ceux qui la composent se sentent proche d’une « Heimat ? »
Brice Couturier dans une de ses chroniques a fait mention d’un ouvrage de David Goodhart, « The Road to Somewhere », proche un temps du New Labour de Tony Blair :
« Goodhart estime que la division gauche/droite a perdu beaucoup de sa pertinence. Il propose un nouveau clivage entre ceux qu’il appelle « les Gens de Partout » et « le Peuple de Quelque Part ». Les premiers, les Gens de Partout ont bénéficié à plein de la démocratisation de l’enseignement supérieur. Ils sont bien dotés en capital culturel et disposent d’identités portables. Ils sont à l’aise partout, très mobiles et de plain-pied avec toutes les nouveautés.
Les membres du Peuple de Quelque Part sont plus enracinés. »
Il en tire une réflexion et des conséquences qui ne concernent pas totalement mon vécu mais qui méritent cependant d’être rapportées :
« Les membres du « Peuple de Quelque Part ». habitent souvent à une faible distance de leurs parents, sur lesquels ils comptent pour garder leurs enfants. Ils sont assignés à une identité prescrite et à un lieu précis. Ils ont le sentiment que le changement qu’on leur vante ne cesse de les marginaliser, qu’il menace la stabilité de leur environnement social. Ils sont exaspérés qu’on leur ait présenté la mondialisation et l’immigration de masse comme des phénomènes naturels, alors qu’ils estiment que ce furent des choix politiques, effectués par des politiques et des responsables économiques appartenant aux Gens de Partout. C’est pourquoi le Peuple de Quelque Part éprouve une très grande frustration : le sentiment d’avoir été exclu de la parole publique, marginalisé, alors qu’il est majoritaire ; d’avoir été accusé de xénophobie et d’arriération, alors qu’il réclame simplement que le rythme du changement soit ralenti ; et que l’Etat en reprenne le contrôle. »
Certaines élites sont très vigoureusement contre ces sentiments et regardent avec hostilité notamment ceux qui en Allemagne ont remis sur le devant de la scène la « Heimat ». Depuis la nouvelle coalition de 2018, le ministre conservateur qui occupe le poste de Ministre de l’Intérieur a accolé à ce titre le mot « Heimat » : « Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. »
Un article publié par « Libération » et rédigé par sa correspondante à Berlin : Johanna Luyssen présente cette évolution comme problématique :
« […] lors de son premier discours au Bundestag, le […] ministre de l’Intérieur et du «Heimat» allemand, Horst Seehofer, est revenu sur le sens de ce terme […].
«Le Heimat, ça ne veut pas dire le folklore, la tradition ou la nostalgie. […] Cela veut dire l’ancrage, c’est un environnement culturellement enraciné dans un monde globalisé. Cela veut dire la cohésion et la sécurité, ce dont chacun a besoin dans ce pays.»
Vendredi matin, […] le conservateur bavarois Horst Seehofer, détaillait devant le Bundestag sa conception toute personnelle du mot Heimat. Une telle digression sémantique peut surprendre dans le cadre d’un discours sur les orientations de son ministère – le premier depuis sa prise de fonctions, mi-mars. C’est que ce terme lourdement connoté s’inscrit dans un débat agité en Allemagne, surtout depuis que le ministère de l’Intérieur fédéral a choisi de l’accoler à son en-tête.
Heimat : ce mot est passablement intraduisible en français. Disons qu’il évoque les notions de «patrie», de «terroirs», de «chez nous». Il désigne un sentiment d’appartenance régional plutôt que national, et fait appel à l’intime plutôt qu’au collectif. Cela pourrait presque s’apparenter à l’expression «au bled», ou au «petit pays» cher à l’écrivain Gaël Faye. Le terme a par ailleurs été, et c’est bien pour cela qu’il crée encore la controverse, utilisé par les nazis. Il fut également utilisé dans un slogan de l’AfD, le parti d’extrême droite allemand, lors de sa fondation en 2013.
Accoler «Heimat» à l’en-tête d’un ministère fédéral a fait réagir en Allemagne, beaucoup voyant dans la démarche la volonté de récupérer les faveurs d’un électorat d’extrême droite. »
Et puis il y aussi cet <article> qui en évoquant un film de Benedikt Nabben, Heimat Paris trouve ce concept de « Heimat » totalement incongru à l’heure du smarphone :
« Heimat » est-il vraiment un terme actuel ? Nous sommes en pleine mondialisation, nous écoutons du hip-hop américain, nous mangeons japonais, nous regardons des films argentins et connaissons la migration. Par ailleurs, il est aujourd’hui beaucoup plus facile de garder contact avec sa famille et ses amis grâce à Internet. Ainsi, nous gardons toujours notre « Heimat » dans la poche. Quoiqu’il arrive, ce terme restera toujours sujet à controverse à l’avenir, et il y a fort à parier qu’il ne trouvera jamais de définition figée non plus. »
Tout en me méfiant des arrières pensées du ministre allemand, je ne partage pas ce dernier avis. S’il suffit d’un smartphone qui permet d’accéder facilement et à tout moment à ses proches pour remplacer ses racines, c’est qu’on a rien compris à ce que c’est d’avoir des racines, ce que conceptualise admirablement le mot « Heimat »
<1223>
-
Mardi 2 avril 2019
« Pause »Un jour sans mot du jour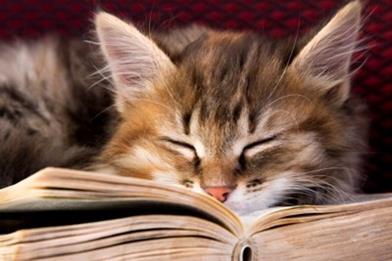
Normalement, je prévois d’écrire le prochain pour le lundi 15 avril 2019.
-
Lundi 1 avril 2019
« C’est de nos vies dont il est question »Alexandria Ocasio-CortezJe voudrais aussi partager une intervention pleine de force, de charisme et de vérité d’une étonnante élue à la chambre des représentants des Etats-Unis.
On l’appelle « AOC » , mais son nom est Alexandria Ocasio-Cortez, née le même jour que moi et …Chantal : le 13 octobre, mais beaucoup plus récemment (que moi) 1989 , à New York. Elle a grandi dans le Bronx, un des quartiers pauvres de New York.
Elle est élue le 6 novembre 2018 représentante du 14e district de New York à la Chambre des représentants des États-Unis, devenant la plus jeune représentante jamais élue au Congrès américain. Elle incarne la nouvelle vague démocrate, qui se revendique du socialisme démocratique dans la lignée de Bernie Sanders.
Elle est entrée en politique très vite : Étudiante à l’université de Boston, elle travaille auprès du sénateur démocrate Ted Kennedy sur les questions d’immigration car elle est la seule membre de son équipe à parler espagnol.
Lors de la campagne présidentielle de 2008, elle fait du démarchage téléphonique pour le candidat démocrate Barack Obama.
Elle fait de brillantes études, mais pour survivre aux Etats-Unis quand on n’est pas de famille riche, il faut accepter des petits boulots.
Et c’est ainsi qu’avant d’être élue, elle était serveuse dans un restaurant de tacos dans le sud de Manhattan.
 Mais vous pourrez trouver d’avantages de précision sur Wikipedia : <Alexandria Ocasio-Cortez>
Mais vous pourrez trouver d’avantages de précision sur Wikipedia : <Alexandria Ocasio-Cortez>
La vidéo dont il est question est une réponse cinglante à un élu républicain, le parti de Trump.
La question concernait l’écologie et l’environnement.
L’élu républicain accusait les démocrates de dérive « élitiste ».
Ce qui a fait sortir de ses gonds Alexandria Ocasio-Cortez :
« Le 26 mars. La démocrate était venue défendre le Green New Deal, un plan environnemental dont l’objectif est d’atteindre 100 % d’énergies propres et renouvelables d’ici 2035. Une initiative que le parlementaire républicain Sean Duffy a rapidement taxé d’« élitiste ».
Le qualificatif a suscité l’indignation de la femme politique qui a répliqué : « Ce n’est pas un sujet élitiste, c’est une question de qualité de vie ».
Elle a ensuite tenu avec vigueur un plaidoyer en faveur de l’écologie et pointé l’inaction de certains politiciens devant l’ampleur de la crise.
« C’est de nos vies dont il est question. Ça concerne la vie des Américains. Et cela ne devrait pas être une question partisane », soulève la démocrate. Au sein de l’hémicycle, elle évoque les enfants du Bronx qui souffrent d’asthme, la crise sanitaire qui touche la ville de Flint au Michigan ou encore les inondations qui submergent des terres du Midwest américain. La jeune femme fraîchement élue oppose à ces menaces la cupidité des hommes politiques qui se soucient davantage de « renflouer les banques » ou d’«aider les compagnies pétrolières» que d’affronter la «crise nationale » qui frappe le pays. »
Il est des saines colères. Celle-là, en est une.
J’ai vu d’autres interventions d’Alexandra Ocasio-Cortez tout aussi pertinente et pleine de force.
Alexandria Ocasio-Cortez donne espoir à ce que l’Amérique profonde s’éloigne des dérives néo-libérales et de la bêtise Trumpienne.
La vidéo peut être visualisée <ICI>
<1223>
-
Vendredi 29 mars 2019
« Reste simplement là. »David Servan SchreiberParallèlement au livre de Simonton, je lis aussi le premier livre de David Servan-Schreiber : « Anticancer ».
C’est un livre qui avait aussi renouvelé l’approche de cette maladie, beaucoup de conseils notamment alimentaires sont donnés, ainsi que des explications sur la manière dont elle se déclare et se développe.
Mais ce qui me fascine, avant tout, dans cet ouvrage, c’est l’humanisme qui s’en dégage.
David Servan Schreiber se décrit, avant, comme un jeune chercheur en neuroscience, ambitieux essayant de trouver des réponses grâce à la technologie la plus moderne, se désintéressant beaucoup des patients, peu enclin à des réflexions humanistes, tellement obnubilés par la réussite de ses recherches qu’il était prêt à sacrifier sa vie personnelle et sentimentale.
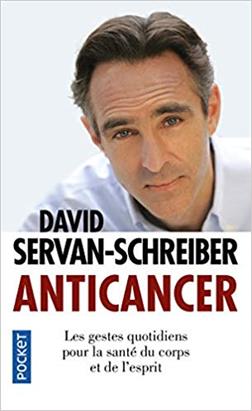 Et puis il y a après, après la découverte de son cancer.
Et puis il y a après, après la découverte de son cancer.
Et dans son chapitre 5 « Annoncer la nouvelle », il raconte une histoire et exprime aussi toute l’élévation spirituelle que lui a apporté et fait comprendre ce qui lui arrivait.
Et je voudrais partager le début de ce chapitre.
Souvent quand sait qu’une personne qu’on aime ou simplement qu’on apprécie est touchée par une maladie incurable ou très grave, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi dire, on voudrait aider mais le comment ne nous apparait pas. Quelquefois on est tellement mal qu’on peut aller jusqu’à fuir la présence de cette personne.
En toute simplicité, David Servan Schreiber répond à cette angoisse et peur : « reste simplement là » :
« La maladie peut être une traversée terriblement solitaire. Quand un danger plane sur une troupe de singes, déclenchant leur anxiété, leur réflexe est de se coller les uns aux autres et de s’épouiller mutuellement avec fébrilité. Cela ne réduit pas le danger, mais cela réduit la solitude.
Nos valeurs occidentales, avec leur culte des résultats concrets, nous font souvent perdre de vue le besoin profond, animal, d’une simple présence face au danger et à l’incertitude. La présence, douce, constante, sûre, est souvent le plus beau cadeau que puissent-nous faire nos proches, mais peu d’entre eux en savent la valeur.
J’avais un très bon ami, médecin à Pittsburgh comme moi, avec qui nous aimions débattre sans fin et refaire le monde. Je suis allé un matin dans son bureau pour lui annoncer la nouvelle de mon cancer. Il a pâli pendant que je lui parlais, mais il n’a pas montré d’émotion. Obéissant à son réflexe de médecin, il voulait m’aider avec quelque chose de concret, une décision, un plan d’action. Mais j’avais déjà les cancérologues, il n’avait rien à apporter de plus sur ce plan. Cherchant à tout prix à me donner une aide concrète, il a maladroitement abrégé la rencontre après m’avoir prodigué plusieurs conseils pratiques, mais sans avoir su me faire sentir qu’il était touché par ce qui m’arrivait.
Quand nous avons reparlé plus tard de cette conversation, il m’a expliqué un peu embarrassé : « Je ne savais pas quoi dire d’autre. »
Peut-être ne s’agissait-il pas de « dire ».
Parfois ce sont les circonstances qui nous forcent à redécouvrir le pouvoir de la présence. Le docteur David Spiegel raconte l’histoire d’une de ses patientes, chef d’entreprise, mariée à un chef d’entreprise. Tous deux étaient des bourreaux de travail et avaient l’habitude de contrôler par le menu tout ce qu’ils faisaient. Ils discutaient beaucoup des traitements qu’elle recevait, mais très peu de ce qu’ils vivaient au fond d’eux-mêmes. Un jour, elle était tellement épuisée après une séance de chimiothérapie qu’elle s’était effondrée sur la moquette du salon et n’avait pas pu se relever. Elle avait fondu en larmes pour la première fois. Son mari se souvient : « Tout ce que je lui disais pour essayer de la rassurer ne faisait qu’aggraver la situation. Je ne savais plus quoi faire, alors j’ai fini par me mettre à côté d’elle par terre et à pleurer aussi. Je me sentais terriblement nul parce que je ne pouvais rien faire pour qu’elle se sente mieux. Mais c’est précisément quand j’ai cessé de vouloir résoudre le problème que j’ai pu l’aider à se sentir mieux. »
« Dans notre culture du contrôle et de l’action, la présence toute simple a beaucoup perdu de sa valeur. Face au danger, à la souffrance, nous entendons une voix intérieure nous houspiller : « Ne reste pas là comme ça. Fais quelque chose ! » Mais dans certaines situations, nous aimerions pouvoir dire à ceux que nous aimons : « Arrête de vouloir à tout prix « faire quelque chose ». Reste simplement là ! »
Certains savent trouver les mots que nous avons le plus besoin d’entendre. J’ai demandé à une patiente qui avait beaucoup souffert pendant le long et difficile traitement de son cancer du sein ce qui l’avait le plus aidée à tenir moralement. Mish y a réfléchi plusieurs jours avant de me répondre par email :
« Au début de ma maladie, mon mari m’a donné une carte que j’ai épinglée devant moi au bureau. Je la relisais souvent. Sur la carte, il avait écrit : « Ouvre cette carte et tiens-la contre toi…
Maintenant, serre fort. »
A l’intérieur, il avait tracé ces mots : « Tu es mon tout – ma joie du matin, ma rêverie sexy, chaleureuse et rieuse du milieu de la matinée, mon invitée fantôme à déjeuner, mon anticipation croissante du milieu de l’après-midi, ma douce joie quand je te retrouve le soir, mon sous-chef de cuisine, ma partenaire de jeu, mon amante, mon tout »
Puis la carte continuait : « tout va bien se passer. »
Il avait écrit en dessous : « et je serai là, à tes côtés, toujours.»
Je t’aime.
PJ.
Il a été là à chaque pas. Sa carte a tellement compté pour moi.
Elle m’a soutenue tout au long de ce que j’ai vécu.
Puisque vous vouliez savoir…
Mish »
Voilà…simplement … l’essentiel….
<1222>
-
Jeudi 28 mars 2019
« L’effet placebo explique peut-être une partie du bénéfice reçu d’un vrai médicament. »Carl SimontonMartine est une ancienne infirmière en unité de cancérologie. Elle m’a conseillé un livre à lire, car c’était un livre qui l’a beaucoup inspiré ainsi que tout son service, par son approche de la maladie et plus encore des thérapies et de la démarche pour donner une chance à la guérison. J’ai donc suivi ce conseil et je suis en train de lire « Guérir envers et contre tout ».
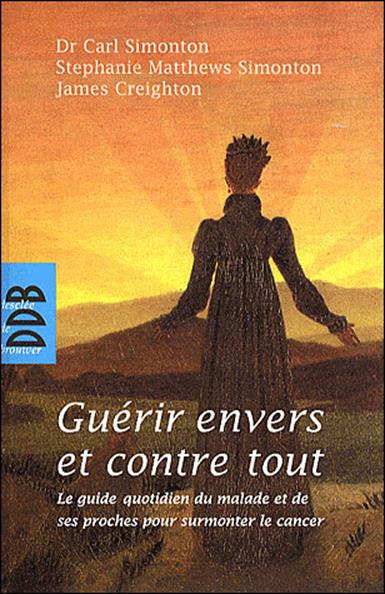 Carl Simonton (1942 – 2009) était un médecin américain, cancérologue et radiothérapeute. Il a écrit ce livre avec son épouse Stéphanie Matthews Simonton, psychologue et James Creighton, psychothérapeute. Il a été publié aux Etats-Unis en 1992.
Carl Simonton (1942 – 2009) était un médecin américain, cancérologue et radiothérapeute. Il a écrit ce livre avec son épouse Stéphanie Matthews Simonton, psychologue et James Creighton, psychothérapeute. Il a été publié aux Etats-Unis en 1992.
Dans ce livre il insiste beaucoup sur l’aspect psychologique du malade qui a des conséquences fondamentales sur la qualité de vie ainsi que la durée de survie et même la guérison. Il avait constaté qu’avec le même diagnostic, certains patients mouraient et d’autres non. Et même, avec un pronostic plus pessimiste que d’autres, certains connaissaient des rémissions beaucoup plus longues.
Il a observé que certains patients pouvaient retarder l’échéance fatale. Ceux-là marchandaient avec la mort, par exemple : « Je ne peux pas mourir maintenant, je ne peux pas m’en aller avant que ma fille se marie ». Ils se sentent indispensables et pensent qu’ils doivent être là jusqu’à ce que….
Et disons pour faire simple que le docteur Simonton a développé des méthodes qui se basent sur cette réflexion :
« Puisque les malades qui ont guéri sont des battants qui se persuadent et se voient guérir, je me dois donc d’apprendre à mes patients à devenir des lutteurs. »
Il donne comme conseil essentiel à tout malade d’être acteur de sa thérapie et de sa guérison et non simple spectateur du travail des médecins.
Mais ce que j’entends partager aujourd’hui, c’est une histoire vraie que Simonton raconte dans son livre et que vous trouverez d’ailleurs rapporter par plusieurs sites qui essaient d’approcher le phénomène de l’effet placebo :
« Un exemple particulièrement spectaculaire et dramatique, de l’effet placebo a été rapporté par le Docteur Bruno Klopfer, un chercheur travaillant à tester le médicament appelé Krebozien. En 1950, le Krebozien reçu une publicité nationale américaine formidable comme « cure » du cancer, et était en train d’être testé par l’association médicale américaine et le service national américain de contrôle des aliments et produits par. Un patient du Docteur Bruno Klopfer avait un lumphosarcome, un cancer généralisé, très avancé, qui touche les ganglions lymphatiques. Le patient avait des masses tumorales énormes partout dans son corps, et il était dans un état physique si désespéré, qu’il avait souvent besoin de prendre de l’oxygène à l’aide d’un masque ; il fallait lui enlever du liquide de sa poitrine tous les deux jours.
Lorsque le patient découvrit que le docteur Klopfer travaillait dans l’équipe de recherche sur le Krebozien, il supplia qu’on lui fasse le traitement au Krebozien.
Klopfer accepta et le rétablissement du patient fut étonnant. En peu de temps, les tumeurs avaient diminué de façon spectaculaire et le patient pu reprendre une vie normale, piloter son avion privé.
Puis lorsque les rapports de l’association médicale américaine et du service national américain de contrôle des aliments et produits pharmaceutiques sur les résultats négatifs du Krebozien commencèrent à être publiés, l’état du patient empire. Croyant les circonstances assez graves pour justifier des mesures exceptionnelles, Klopfer raconta à son patient qu’il avait obtenu un autre Krebozien, super raffiné, doublement puissant et qui produirait les meilleurs résultats.
En fait les injections que fit Klopfer n’étaient que de l’eau distillée.
Néanmoins, le rétablissement du patient fut encore plus remarquable. Encore une fois, les masses malignes fondirent, le liquide dans la poitrine disparut, et il redevint autonome ; même il reprit le pilotage de son avion. Le patient resta libre de tout symptôme durant deux mois. La foi celle du patient, indépendante de la valeur du médicament, avait produit son rétablissement.
Puis d’autres articles sérieux sur les tests, des rapports médicaux (A.M.A.) et gouvernementaux (F.D.A.) parurent dans la presse : « Des tests de portée nationale montrent que le Krebozien est un médicament sans valeur dans le traitement du cancer ». En l’espace de quelques jours, le patient mourut. »
L’effet placebo explique peut-être une partie du bénéfice reçu d’un vrai médicament. L’effet est créé aussi bien par la manière dont le docteur prescrit ou administre le médicament que par le processus par lequel les médicaments sont cautionnés par la profession médicale. Tout le monde sait que dans nos pays les nouveaux médicaments doivent subir au préalable des tests poussés par des laboratoires pharmaceutiques et qu’ils doivent être approuvés par le gouvernement. […] Le rite qui établit la croyance sociale dans le traitement médical est complet, on vient à croire que le médicament ordonné par un médecin doit être efficace.
Voici l’histoire : c’est parce que le malade croit que le médicament va le guérir, que le cancer recule et lorsque définitivement, il n’y croit plus, il meurt.
Dire que la psychologie est essentielle est certes intéressant, mais n’explique pas au fond ce qui se passe.
D’autres livres expliquent parfaitement que tout le monde développe des cellules cancéreuses au cours de sa vie, mais tous ne développent pas cette maladie.
La raison en est connue désormais, c’est parce que le système immunitaire, détecte les cellules anormales et déviantes et les neutralise.
Chez tous ceux qui n’ont pas le cancer, ce mécanisme fonctionne.
Pour ceux qui ont le cancer, il y a eu une faille dans la défense immunitaire.
Dans ce cadre, on peut admettre que le cerveau et donc ce que croit le cerveau a une influence essentielle sur le fonctionnement du système immunitaire.
Le médicament, dans cette hypothèse, ne guérit pas directement, mais aide notre système de défense à se mobiliser davantage et à faire le job.
Au-delà des recherches qui visent à renforcer directement le système immunitaire pour lui permettre de redevenir efficace, il me semble donc essentiel de comprendre que nous disposons, en nous, des outils et des armes pour vaincre la maladie. Il est donc bien important de se sentir acteur de sa guérison. Si on peut espérer que des médicaments peuvent nous aider dans cette tâche, ils ne peuvent pas grand-chose si notre corps ne mène pas la lutte.
Cela ouvre d’ailleurs des perspectives de compréhension dans d’autres domaines de réflexion.
Il est établi que des personnes qui sont allées en pèlerinage à Lourdes, ont été guéries.
Mais quand on sait ce que cette histoire racontée par Simonton nous apprend, nous ne pouvons pas être surpris que des personnes qui manifestent sincèrement une croyance forte à la toute-puissance de Dieu, peuvent dans le rituel du pèlerinage parvenir à mobiliser les ressources de leur corps et de leur défense immunitaire pour guérir.
Cela conduit à une conclusion simple : Dieu est un placebo !
Pour celles et ceux qui seraient choqués par ce constat brutal, il est possible d’exprimer cela de manière plus nuancée :
Les guérisons miraculeuses sont la résultante d’un effet placebo.
<1221>
-
Mercredi 27 mars 2019
« Notre société ne tient que grâce aux gens gentils »Christophe AndréC’est une émission que je ne fréquente pas, je veux parler des « Grandes gueules » de RMC.
Mais une lecture m’a amené vers un cours extrait de l’émission du 29 janvier 2019, dans laquelle avait été invité Matthieu Ricard et Christophe André.
Et c’est un petit extrait que je voudrais partager aujourd’hui. Il se trouve <ICI>
Les participants de l’émission essaient de prendre en défaut le chantre de la bienveillance, Matthieu Ricard mais ce dernier réplique :
« J’aime bien parler de la banalité du bien. Car il est clair la plupart des gens sur Terre se comportent de manière bienveillante les uns envers les autres, et c’est pour ça qu’on est choqués quand ce n’est pas le cas. La banalité du bien, on n’y fait plus attention. Ce qui est un bon signe ! »
Et Christophe André continue :
« Si vous voulez qu’on parle de vous il vaut mieux donner trois claques à quelqu’un que lui faire un compliment.
Je crois que ça veut dire que ça nous angoisse, que nous sommes fascinés par ce qui nous fait peur. Je pense que notre cerveau primitif cherche à voir d’où vient le mal et comment s’en protéger.
Mais en réalité notre société ne tient que grâce aux gens gentils. Ce sont les bienveilleurs, ceux qui font des actes et délivrent des paroles gentilles, sans se faire remarquer, sans rien demander. »
Je crois qu’il a profondément raison, c’est grâce aux gens gentils que notre société peut tenir.
<1220>
-
Mardi 26 mars 2019
« En 1990, le PIB chinois représentait le 1/3 du PIB français. En 2005, ils sont au même niveau. Aujourd’hui il est 4 fois plus important. »Pascal BonifacePascal Boniface est le directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques.
En quelques mots tout est dit.
1990, c’était il y a 30 ans…
Il y a là une dynamique en œuvre que l’on ne sent pas s’arrêter.
Vous savez tous que le Président chinois rend visite à notre Président.
Ajoutons une petite photo d’actualité pour être complet

Imaginez-vous un monde où la première puissance mondiale est un régime dictatorial ?
C’est ce qui se prépare.
<1219>
-
Lundi 25 mars 2019
« J’aime appuyer ma main sur le tronc d’un arbre devant lequel je passe, non pour m’assurer de l’existence de l’arbre – dont je ne doute pas – mais de la mienne. »Christian BobinNous avons tous un arbre qui a marqué notre vie. Je me souviens du poirier qui se trouvait dans le jardin de mes parents. Et je me souviens aussi avec douleur lorsque je l’ai vu abattu par les nouveaux propriétaires qui avaient racheté la maison. Annie se souvient des 4 magnifiques arbres centenaires qui se trouvent au milieu de la Place de la république de Strasbourg. Wikipedia nous apprend que le nom de ces arbres est ginkgo biloba; et que ces arbres auraient été offerts à Guillaume Ier par l’empereur du Japon Mutsuhito vers 1880.
Car,
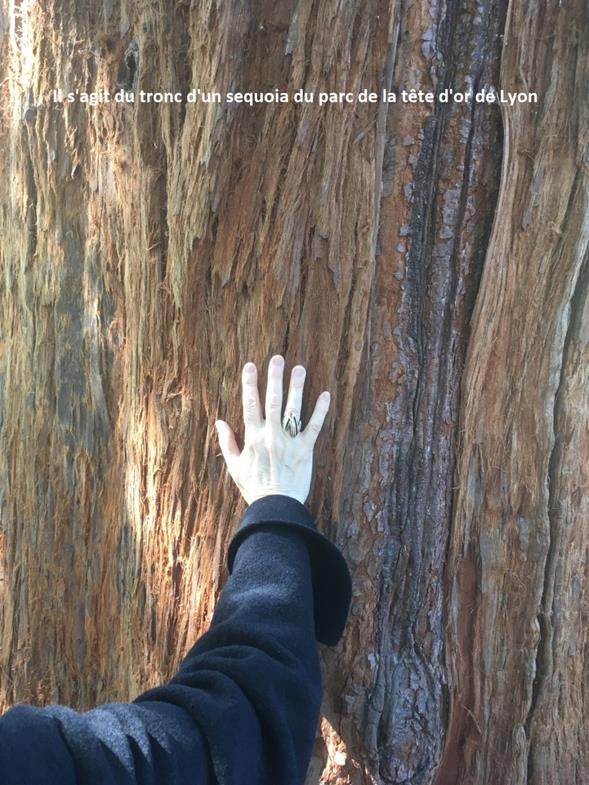 bien sûr en 1880, Strasbourg était allemande.
bien sûr en 1880, Strasbourg était allemande.
Pour en revenir à l’exergue et à la phrase de Christian Bobin, une visite, hier, au Parc de la Tête d’or a permis de réaliser son vœu.
Une émission de France Culture, déjà ancienne, a évoqué cette pensée du poète : <J’ai un arbre dans ma vie>
Et une autre plus récente dont l’un des invités était Peter Wohlleben : <Raconte-moi les arbres !>
Wohlleben qui est l’auteur de « La vie secrète des arbres » dont j’avais parlé lors du mot du jour du <22 décembre 2017>
Peter Wohlleben qui racontent la vie des arbres, des communautés d’arbres qui partagent, coopèrent, communiquent entre eux..
Car l’arbre est un végétal mais c’est avant tout un être vivant.
Et ce sont êtres vivants ayant le plus d’expérience, il existe des arbres qui sont âgés de milliers d’années.
Ce <site> Regard sur le monde énumère, selon les connaissances actuelles, les plus vieux arbres du monde.
3000 ans est un âge relativement fréquent.
Et quand on mesure des colonies d’arbres issues d’une racine mère unique on arrive à des époques encore plus anciennes. Ainsi dans l’Utah, on a détecté une colonie clonale de peupliers qu’on a appelé « Pando ». Cette colonie de 40 hectares est considérée comme l’organisme vivant le plus lourd et le plus vieux de la planète avec un poids estimé à 6 millions de kilogrammes et un âge de 80 000 ans. Toutes les pousses sont issues d’un immense système racinaire unique.
<Cette page de Futura-sciences>. fait aussi le point sur les végétaux les plus anciens de notre planète.
Nous ne pouvons qu’être très humbles devant tant d’expérience.
Et pour finir encore deux photos d’hier :
 <1218>
<1218>
-
Vendredi 22 mars 2019
« Vagabonds du monde, nous avons perdu un sage. Hackers pour le droit, nous sommes un de moins. Parents, nous avons perdu un enfant. Pleurons » »Tim Berners-Lee, l’inventeur du Web le lendemain du suicide d’Aaron Schwartz, le 11 janvier 2013Les deux premiers mots du jour de la semaine concernait le Web et notamment son inventeur d’il y a 30 ans : Tim Berners-Lee. Pour finir cette semaine je veux évoquer un autre mythe du Web.
Aaron Schwartz est connu par tous celles et ceux qui ont une culture numérique et se sont intéressés au début du Web.
C’était un génie il est né le 8 novembre 1986 et il s’est donné la mort à 26 ans parce que le monde était contre son idéalisme de partage des connaissances et de coopération.
Il était à la fois technicien de l’informatique, inventeur et penseur politique. Il écrivait beaucoup. Un livre paru en 2017 en France : « Celui qui pourrait changer le monde » rassemble ses principaux textes qui reflètent son engagement intellectuel sur des enjeux sociétaux dont le droit d’auteur, la liberté d’accès des connaissances et des savoirs dont les publications scientifiques ou la transparence en politique.
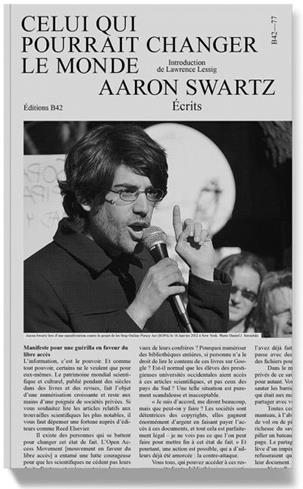 La préface de ce livre de Lawrence Lessig, professeur de Harvard, autre grand penseur d’Internet que j’ai déjà évoqué plusieurs fois.
La préface de ce livre de Lawrence Lessig, professeur de Harvard, autre grand penseur d’Internet que j’ai déjà évoqué plusieurs fois.
D’abord en parlant de son célèbre article de 2000 «The code is Law», «le code est Loi». Et aussi par le mot du jour du <23 juin 2017> où il exprimait qu’«Aujourd’hui dans toutes les grandes démocraties, nous avons le sentiment que le système a failli»
Lawrence Lessig était particulièrement admiratif de ce jeune homme.
Wikipédia nous apprend que malgré son jeune âge et bien qu’il n’ait pas les diplômes requis, Lawrence Lessig le nomme chercheur dans le centre de recherche le « Safra Center for Ethics » axé sur la corruption institutionnelle de l’université Harvard. Au début de leur relation, le juriste était comme un professeur pour Aaron, « mais à la fin, c’était lui mon mentor et moi son élève… ».
Lawrence Lessig le présente de la manière suivante :
« Aaron a appris plus de choses que la plupart d’entre nous n’en apprendront jamais et il a élaboré plus de choses que la plupart d’entre nous n’en élaboreront jamais. […] Peu d’entre nous auront jamais une influence, ne serait-ce que vaguement comparable, à celle qu’a eue ce garçon ».
Wikipedia nous rapporte ses actions selon son âge :
- À 12 ans, il crée The Info Network, une encyclopédie éditée par les internautes, qui repose sur un principe de collaboration ouvert aux internautes comme Wikipédia10.
- À 13 ans, il reçoit l’ArsDigita Prize, qui récompense les jeunes gens ayant créé des sites non commerciaux « utiles, éducatifs et collaboratifs ». Le titre lui donne droit à un voyage au MIT, où il rencontre des personnalités importantes du web. Cette même année, sa rencontre avec le juriste et théoricien du droit de l’internet, Lawrence Lessig lors d’une conférence TED fut le point de départ d’une longue collaboration.
- À 14 ans, il participe à l’élaboration de la spécification 1.0 du format RSS, une technologie permettant de recevoir en direct les mises à jour de sites web.
- À 15 ans, il contribue au développement informatique de la licence Creative Commons, alternative aux licences du droit d’auteur standard. Dans cette perspective de l’accès libre du droit d’auteur, Aaron Swartz était particulièrement admiratif de Tim Berners-Lee, l’un des principaux créateurs du World Wide Web, du fait de son initiative de laisser sa création libre et gratuite pour qu’elle puisse bénéficier à un large public.
Je vous laisse lire tous les détails sur Wikipedia et d’autres liens que je donnerais à la fin de ce mot du jour. Je résume simplement.
 Ce que le monde de l’économie lui reprochait c’est qu’il trouvait la propriété intellectuelle moins importante que le partage forcément gratuit des connaissances. Car lui n’était absolument pas intéressé par l’argent.
Ce que le monde de l’économie lui reprochait c’est qu’il trouvait la propriété intellectuelle moins importante que le partage forcément gratuit des connaissances. Car lui n’était absolument pas intéressé par l’argent.
Alors, il a fait des choses que la Loi américaine ne permettait pas
Durant son jeune âge, il expérimente ce principe de liberté d’accès des contenus encyclopédiques en utilisant les collections numériques de la bibliothèque du Congrès américain. Utilisant une partie de ses économies pour acquérir les droits des collections numériques, il organise la publication sur le Web des archives des millions de documents sur l’histoire et la culture américaine pour les rendre disponibles en ligne, gratuitement.
Le 19 juillet 2011, il est accusé d’avoir téléchargé 4,8 millions d’articles scientifiques disponibles sur le site de JSTOR qui est une bibliothèque numérique de publications universitaires payantes. Ce n’est pas l’organisation JSTOR qui a pas pris l’initiative de la démarche judiciaire, mais le procureur des États-Unis Carmen Ortiz qui a engagé des poursuites contre Aaron Swartz dans le but de le faire arrêter. La Justice américaine ne pouvait tolérer cet acte qui constituait une révolution dans le fonctionnement de l’économie de la connaissance.
Après la révélation de ses agissements, Aaron Swartz retourne les disques durs contenant les articles, en promettant de ne pas les diffuser. JSTOR décide alors de ne pas entamer de poursuites judiciaires. Néanmoins le bureau du procureur maintient cependant ses poursuites. Le MIT, traditionnel soutien de l’internet libre, choisit de ne pas soutenir Swartz.
Le 11 janvier 2013, Aaron Swartz s’est pendu dans son appartement de Brooklyn. Son procès fédéral en lien avec ces accusations de fraude électronique devait débuter le mois suivant. En cas de condamnation, il encourait une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 35 ans et une amende s’élevant jusqu’à 1 million de dollars.
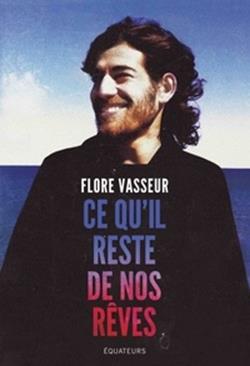 Lors du mot du jour du mardi j’ai donné le lien vers une émission de France Culture : <Qui a trahi le Web ?>. Parmi les intervenants, Hervé Gardette avait invité Flore Vasseur auteure du livre : <Ce qu’il reste de nos rêves>.
Lors du mot du jour du mardi j’ai donné le lien vers une émission de France Culture : <Qui a trahi le Web ?>. Parmi les intervenants, Hervé Gardette avait invité Flore Vasseur auteure du livre : <Ce qu’il reste de nos rêves>.
La <Grande Librairie> a également invité Flore Vasseur pour parler de ce livre, ainsi que <La Librairie Mollat>.
Ce livre est consacré à Aaron Schwartz.
<Le site Le lanceur> parle de ce livre avec ces termes : « Aaron Swartz, lanceur d’alerte sublimé par les mots de Flore Vasseur ». Il donne aussi la parole à Flore Vasseur :
« Aaron était le meilleur d’entre nous.
Il était adoubé par ses pairs, chéri par sa famille et avait assemblé les moyens de sa liberté – la création de REDDIT, 6e site au monde, l’a rendu millionnaire.
Et même lui n’a pas tenu.
À travers ce récit, je pense à celles et ceux qui doutent et s’interrogent sur l’effondrement que nous sommes en train de vivre et les inégalités, la corruption morale qui le sous-tend. Car c’est mon cas depuis le 11 Septembre. Ce doute, cette colère s’incarnent en plein d’endroits, les Gilets Jaunes mais aussi les artistes, les lanceurs d’alerte, les activistes qui se lèvent et agissent. Et cela ne date pas d’hier. Le « système » a passé son temps à nous diviser en faisant passer tous ces gens-là, nous au fond qui doutons, qui ne voulons pas nous conformer, obéir ou accepter, pour des ringards, des anarchistes, des complotistes. Si nous sommes dangereux, c’est uniquement à l’égard d’un système qui veut que rien ne change.
Comme Aaron Swartz l’a été, dangereux, en son temps. Ce qu’il n’a pu comprendre, c’est que nous ne sommes pas seuls, que cela passe par nous mais que nous ne sommes pas tout. Il y a une force incroyable à tirer de l’humilité qui consiste à croire que chacun est un maillon dans la chaîne des changements à opérer.
Snowden dit la même chose : il faut poser sa brique et accepter que cela ne soit que ça. »
Et voici les liens promis :
D’abord une page de « France Culture » : < Aaron Swartz : « Celui qui pourrait changer le monde »> avec des liens vers d’autres pages et émissions
Puis un article de « SLATE » : <Aaron Swartz, les mystères d’un idéaliste>, un très long article publié juste après sa mort en mars 2013
« LE MONDE » me donne l’opportunité de proposer deux articles : <Aaron Swartz, itinéraire d’un enfant du Net> qui présente un documentaire qui lui ait consacré
Cet article cite aussi son père Robert Schwarz :
« Jobs et Wozniak ont lancé Apple en créant des boîtiers pour téléphoner gratuitement en piratant les réseaux. Bill Gates a lancé Microsoft en utilisant les ordinateurs de la fac, ce qui était strictement interdit. La seule différence entre Jobs, Gates et Aaaon, c’est que lui voulait rendre le monde meilleur, pas gagner de l’argent. »
<L’esprit d’Aaron Swartz plane toujours sur le Web> article qui a été publié en 2017.
Et enfin, un article de « Usbek et Rica » le magazine trimestriel qui « explore le futur » et qui constitue une lecture très stimulante : <Aaron Swartz, martyr éternel de l’Internet libre> aussi consacré au livre de Flore Vasseur.
Et je voudrais finir par une photo publiée justement par usbeketrica, elle date de 2001. Aaron Schwarz a 15 ans et il parle au grand Lawrence Lessig qui a 40 ans.
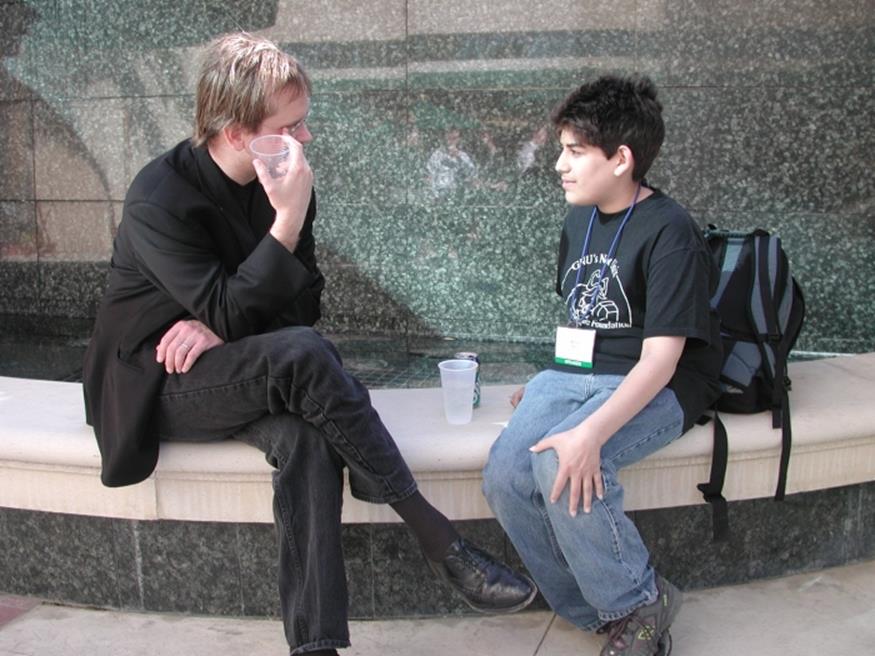
Qu’est ce qui mieux que cette photo qui montre ce moment d’échange entre un professeur reconnu de 40 ans avec un jeune de 15 ans permet de comprendre l’extraordinaire intelligence de ce brillant jeune homme que le monde des rapaces et de l’argent a conduit au suicide.
<1217>
- À 12 ans, il crée The Info Network, une encyclopédie éditée par les internautes, qui repose sur un principe de collaboration ouvert aux internautes comme Wikipédia10.
-
Jeudi 21 mars 2019
« Juicers »Rechargeur de trottinetteLa trottinette électrique est devenue tendance en ville. C’est un mode doux, qui permet aux citadins de se déplacer tranquillement, et harmonieusement avec les voitures et les piétons, sans compter les vélos.
 Et puis c’est un bel objet qui ressemble à la lettre « L » et qui met en valeur des décors souvent très fades comme ici la pyramide et le Palais du Louvre.
Et puis c’est un bel objet qui ressemble à la lettre « L » et qui met en valeur des décors souvent très fades comme ici la pyramide et le Palais du Louvre.
Nous vivons vraiment une époque moderne et formidable !
Selon wikipedia, le terme de trottinette proviendrait du terme de « trottin » qui au XIXe siècle désignait une petite employée de magasins chargée de faire les emplettes au pas de course pour des clients pressés. Elle trottinait donc pour faire sa commission.
Entre mode doux et gens pressés, on constate immédiatement qu’il peut apparaître quelques tensions.
Il y a de petits inconvénients. Certains utilisateurs qui trouvent commode de s’en servir, estiment que dès que leur trajet est terminé, ils peuvent descendre de ce moyen de locomotion pour s’en séparer. Nous voyons que cela peut avoir un lien avec le fait d’être pressés.
Au milieu du trottoir semble être une place appropriée pour des utilisateurs. Que cette décision unilatérale et égocentrée puisse énerver le passant qui utilise également le trottoir, ne semble pas préoccuper les premiers. Cette manière de faire peut énerver le passant moyen, il peut surtout constituer un obstacle risquant de faire tomber des personnes âgées ou des aveugles.
Et récemment le 12 mars je rentrais tranquillement à pied de mon travail et je cogitais sur ces « L » à roulettes quand je me suis retrouvé devant cet engin en haut du Cours Gambetta. Et je n’ai pas résisté à sortir mon smartphone pour agrémenter ce mot du jour d’une photo prise personnellement.
 J’ai lu avec dépit sur l’affiche publicitaire lumineuse derrière cet engin « Lyon toujours plus créative », mais peut-être qu’elle ne faisait pas référence à l’invasion des trottinettes…
J’ai lu avec dépit sur l’affiche publicitaire lumineuse derrière cet engin « Lyon toujours plus créative », mais peut-être qu’elle ne faisait pas référence à l’invasion des trottinettes…
La vitesse pose aussi problème. Il est vrai que la trottinette se trouve dans une situation inconfortable.
Ce <site spécialisé> précise que la trottinette électrique n’est pas tolérée sur la route. Le vélo est l’exception autorisée et réglementée. Il est assimilé à un véhicule, avec obligation d’aller sur la route (dérogation pour les enfants de moins de 8 ans, tolérés sur le trottoir). Et tout ce qui va sur le trottoir ne doit pas avancer à plus de 6 km/h, donc guère plus vite qu’un piéton marchant d’un bon pas.
La modernité provoque aussi des accidents.
Un autre <site> donne la parole à Alain Sautet, chef du service d’orthopédie de l’hôpital Saint-Antoine (Paris) qui s’inquiète face à l’augmentation des blessures liées à l’utilisation d’une trottinette électrique. Dans son service, 17 patients ont été admis lors des deux derniers mois, soit deux par semaine, explique-t-il à nos confrères de France TV. « Ce sont des lésions qu’on n’avait pas l’habitude de voir », s’inquiète-t-il. Fractures du poignet ou du fémur sont des fractures répandues chez les personnes d’un âge avancé. Or, Alain Sautet constate ces lésions sur des patients jeunes. Il conseille donc, comme ses confrères, de limiter sa vitesse, et de porter un casque. Selon une étude américaine, 40% des accidents de trottinette touchent la tête.
Mais tout n’est pas rose dans le monde la trottinette, lors de sa revue de presse du vendredi 1 mars 2019 Claude Askolovitch cite le magazine des Echos qui raconte qu’à San Francisco, des habitants brulaient des trottinettes électriques en libre-service qui encombraient leurs trottoirs, ou les jetaient contre les bus privés des grandes compagnies d’internet qui font la navette entre les campus de la baie de San Francisco et le centre-ville où logent les employés des GAFAM… Car les génies de la silicon valley habitent à San Francisco, quand ils ont les moyens…
Et Claude Askolovitch de continuer :
« Car dans le monde entier les trottinettes électriques prennent les villes et sont l’absolue fortune d’un trentenaire milliardaire au visage poupin, qui pose en coupe-vent pas très classe aux couleurs vertes de sa firme, Toby Sun, chinois venu grandir en Amérique et patron de Lime, la start-up des trottinettes qui à Paris aussi scandent le bitume. Elles seraient la réponse au besoin de mobilité et à la pollution… Et voilà que la ville cloaque est cool d’un engin connecté et elle s’adapte avec plaies et bosses, 45 blessés l’an dernier, dans les pages Paris du Parisien, des policiers enseignent aux enfants le maniement de ce jouet du nouveau monde… »
Et ce n’est pas un problème français : Depuis fin 2017 et les débuts de l’utilisation des trottinettes électriques, au moins 1500 personnes ont été blessées dans des accidents aux États-Unis.
Et s’il n’y avait que cela…
Parce que les trottinettes électriques, fonctionne à l’électricité comme nos smartphones et qu’il faut donc les charger.
Et c’est là qu’interviennent les « juicers », en français de base cela pourrait faire penser à des « jouisseurs », mais ce n’est pas du tout cela.
<J’ai trouvé un article du Huffingtonpost> qui explique :
« « Notre métier, c’est comme ‘Pokemon Go’, sauf qu’on est payés! » Renaud, la trentaine, voit son métier de « juicer » comme un jeu vidéo. C’est grâce à des personnes comme lui que les Parisiens peuvent tous les matins trouver leurs trottinettes électriques chargées et soigneusement mises en place près de chez eux. En quoi consiste ce nouveau travail des « juicers » qui, discrets et méthodiques, rechargent les trottinettes électriques pendant que la ville dort?
Les utilisateurs ne se posent même pas la question explique au HuffPost, Renaud, lucide sur le fait que son travail de « juicer » se fait à l’ombre du regard de la société. Comme tous les autres, il a un contrat d’autoentrepreneur, payé à la recharge « entre 5 et 20 euros la batterie rechargée » par les start-ups de location de trottinettes électriques. Il n’est pas salarié et préfère y voir le bon côté des choses: « On a une grande liberté, on travaille quand on veut. On a pas de compte à rendre ».
C’est à la nuit tombée que commence sa tournée des rues parisiennes, à la quête des trottinettes électriques vides. Et il n’est pas le seul à les chasser. Son point de départ commence en Seine-et -Marne, où il habite.
Après avoir fait quarante-cinq minutes de camionnette -pour pouvoir stocker les trottinettes- jusqu’à Paris, Renaud active l’une des applications de location de trottinettes électriques (Lime, Bird, ou plus récemment Bold et Wind). Celle-ci géolocalise les batteries vides ou presque. « Il faut commencer au plus tard à 21 heures, les dernières personnes qui rentrent du travail déposent les trottinettes. Là, il faut être hyperactif. » nous raconte-t-il.
Tout est une question de calcul: Renaud n’a qu’une petite heure pour en amasser un maximum, et « à 22 heures au plus tard, je suis reparti » car il doit vite faire le chemin du retour jusqu’à chez lui pour recharger ses prises du soir. C’est à ce moment-là qu’il trouve un peu de repos: « Je mets entre 4 et 5 heures à recharger une batterie vide ». Quelques heures de repos à peine avant de repartir pour la capitale au petit matin: « Il faut les déposer aux endroits stratégiques que nous indique l’application. »
« Il y a des jours avec et des jours sans, quand il pleut par exemple ». Pendant l’été, le tourisme et les beaux jours pouvaient lui permettre de récolter jusqu’à 30 trottinettes par jour, lui rapportant parfois 200 euros la journée. « Ce sont ceux qui se démènent le plus qui font les meilleurs chiffres », dit-il, conscient que cette quête ressemble en de nombreux points à une chasse.
« L’idée c’est d’aller le plus vite possible: le premier qui scanne est le premier servi » nous dit Renaud, qui malgré cette règle, qui peut paraître assez simpliste, n’a jamais senti de tensions particulières entre les « juicers ». Mais tous ne sont pas du même avis. »
Pour aller plus loin j’ai trouvé un article sur <Numérama> :
« David est ce qu’on appelle, dans le jargon de l’ubérisation, un « Juicer » : un chargeur de trottinettes électriques. Il n’est pas employé par Lime, pas plus qu’il ne l’est par Bird. Pourtant, ce sont bien les trottinettes de ces deux sociétés qu’il s’occupe de recharger presque quotidiennement, une fois sa (première) journée de travail achevée. David est autoentrepreneur : il a passé un contrat avec les deux entreprises qui le rémunèrent à chaque fois qu’il charge une nouvelle trottinette à Paris.
[…]
Sous couvert d’anonymat, David détaille volontiers les étapes qu’il a dû suivre pour offrir ses services à la société : « Il l faut passer un tutoriel pour apprendre comment récupérer les trottinettes. Pour continuer, il faut obligatoirement le valider à 100 %. » Il ajoute que Lime envoie ensuite un mail ou un sms aux futurs juicers qui ont validé le test, afin qu’ils viennent récupérer leurs premiers chargeurs auprès d’un représentant de Lime. »
On apprend que selon la bonne volonté de ces entreprises nouvelles, on peut disposer de 4 à 40 chargeurs de trottinette. Chaque chargeur a la taille d’un ordinateur portable.
« Chacun des appareils permet, selon Lime, de charger complètement une trottinette en quatre heures : leur batterie doit être pleine à 95 % pour que Lime ou Bird considère la mission accomplie. « Dans les faits, il faut plutôt cinq heures de charge », corrige David.
Une trottinette chargée rapporte à David la somme de 8 euros chez Lime. Chez Bird, société pour laquelle il est aussi devenu chargeur, ce paiement est récemment passé à 7 euros. « Avec l’arrivée d’Uber sur ce marché, le prix a tendance à baisser. D’autant que les contrats que j’ai passés avec ces entreprises disent que la rémunération par trottinette peut varier entre 5 et 25 euros. C’est intéressant tant que ça ne passe pas sous la barre des 6 euros. Après, ce n’est plus suffisant pour compenser les coûts d’un véhicule et d’un local qui sont nécessaires à cette activité. » Dans son enquête publiée le 4 octobre, BFM TV raconte également les difficultés de chasser ces trottinettes, qui sont nombreuses à être dissimulées par des particuliers, pour un butin effectivement maigre : après 2 heures et 15 minutes, ils ont récolté 6 euros (soit 2 euros de l’heure en ôtant leurs coûts d’électricité et la cotisation payée à l’URSSAF). »
Il y a des utilisateurs de trottinette qui les laisse au milieu du trottoir et d’autres qui les cachent ou les mettent dans des lieux « baroques » et le travail de juicer est presque clandestin :
Le juicer ne craint pas seulement de se mettre en danger lorsqu’il tente de récupérer un appareil de Lime ou Bird dans des lieux improbables. Il aimerait aussi pouvoir être clairement identifié comme chargeur pour éviter que son comportement semble suspect dans la rue : une personne qui ramasse des trottinettes et les entasse dans son coffre attire l’attention. « Lime refuse de nous donner des gilets, ou un signe distinctif que l’on pourrait porter pour être identifiés. Qu’est-ce que je fais le jour où la police vient me voir ? Je garde mon contrat sur moi, au cas où. »
Les optimistes libéraux, en s’appuyant sur le concept de la « Destruction créatrice » de l’économiste Joseph Schumpeter (1883-1950) veulent être rassurant et disent certes beaucoup de métiers vont disparaître, mais on va en créer d’autres, beaucoup d’autres.
Oui mais ce sont des « emplois à la con » en anglais « Bullshit jobs ».
David Graeber a écrit un livre sur les « Bullshit jobs » mais dans sa définition il ne met pas ce type de travail, car pour lui pour avoir droit à cette appellation, il faut que le job n’ait pas d’utilité. Or il faut reconnaître que le chargeur de batterie de trottinette est utile pour les utilisateurs de trottinette.
Mais est-il judicieux de mettre des trottinettes en libre-service pour la fortune de plateformes ubérisés ?
Pour ma part, la réponse est claire et négative.
<1216>
-
mercredi 20 mars 2019
« Retour sur les arêtes de poissons »Sujet déjà évoqué mais une page créée par le Progrès permet d’y revenirC’était il y a un an, j’ai écrit une série d’articles sur la ville de Lyon. Le deuxième de ces mots du jour était consacré à un sujet étonnant « Les Arêtes de Poisson ».
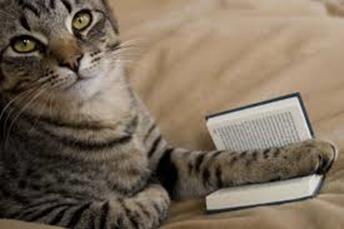 Il s’agit de galeries creusées sous la colline de la croix rousse à Lyon, qui selon la datation scientifique remonte à l’époque romaine.
Il s’agit de galeries creusées sous la colline de la croix rousse à Lyon, qui selon la datation scientifique remonte à l’époque romaine.
En utilisant des outils modernes de présentation, le journal « Le Progrès » a créé une page pour présenter ce mystère lyonnais : <Lyon : l’énigme sous la colline>
Il n’y a aucun élément nouveau, mais une autre manière de présenter ce mystère qui mérite d’être vue, c’est pourquoi je le partage.
<Article sans numéro>
-
Mardi 19 mars 2019
« [Le web] a été détourné par des escrocs et des trolls, qui l’ont utilisé pour manipuler le reste des internautes à travers le monde »Tim Berners-LeeJe reviens sur le développement du Web, la toile mondiale inventée par Tim Berners-Lee.
Et pour ce faire je vais m’appuyer sur la seconde partie de l’article du Monde cité hier :<Les 30 ans du web de l’utopie à un capitalisme de surveillance>
Et aussi une émission de France Culture Le Grain à moudre du 11 mars :
<Qui a trahi le Web ?>. Parmi les intervenants, Hervé Gardette avait invité Flore Vasseur auteure du livre : <Ce qu’il reste de nos rêves>
Revenons au début Tim Berners-Lee a donc conçu cette immense machinerie de connexion et de mise à disposition d’information et de savoir sur un ordinateur Next.
Ici, il faut peut-être revenir à l’histoire de l’informatique et à ce personnage mythique et controversé, créateur d’Apple avec Steve Wozniak et Ronald Wayne : Steve Jobs. Ce dernier avait recruté un directeur général John Sculley, avec pour mission de développer l’entreprise. John Sculley s’est rapidement opposé à Steve Jobs qui a été éjecté de l’entreprise en septembre 1985. Immédiatement Steve, Jobs a créé une nouvelle entreprise NeXT et organisé l’invention d’un ordinateur encore plus performant que ceux créés par Apple. Et c’est sur cet ordinateur révolutionnaire pour l’époque que Tim Berners-Lee put créer les bases du Web. NeXt ne fut pas une entreprise très rentable et ayant un fort développement, ses produits étaient réservés à une élite. Mais La stratégie de John Sculley pour Apple aboutit à un échec et conduisit cette entreprise au bord de la faillite. Steve Jobs reprit les rênes de la marque à la pomme, début 1997. Apple racheta NeXT et devint l’entreprise performante que l’on connaît grâce aux intuitions géniales et à la stratégie menée par Jobs. Les puristes diront qu’il fallut aussi un coup de pouce du vieil ennemi de Steve Jobs, Bill Gates, le patron de Microsoft. Mais ce n’est pas notre propos d’aujourd’hui.
Dans l’émission de France Culture, on apprend que Tim Berners-Lee a déclaré au New York Times :
« Il est devenu évident que le web n’est pas à la hauteur des espérances qu’il suscitait à ses débuts. Conçu comme un outil ouvert, collaboratif et émancipateur, il a été détourné par des escrocs et des trolls, qui l’ont utilisé pour manipuler le reste des internautes à travers le monde ».
Comme je l’avais rapporté hier, Tim Berners-Lee a tenu à ce que le nouvel outil qu’il avait découvert soit versé dans le domaine public. Il souhaitait que le Web devienne « un espace universel » où n’importe qui, en n’importe quel lieu, peut aller chercher librement des ressources, cela « gratuitement » et « sans permission ».
Il pressent qu’un des plus vieux rêves de l’humanité – rassembler toute la connaissance connue dans un espace que tous puissent explorer, une utopie qui remonte à la bibliothèque d’Alexandrie (fondée par Ptolémée en 288 av. J.-C.) et passe par l’imprimerie de Johannes Gutenberg (1400-1468) – devient possible, à la croisée du Web et d’Internet, et pense qu’il doit être offert au monde.
Une immense Toile qui se tisse
Par la suite, Tim Berners-Lee a quitté le CERN pour fonder, en 1994, avec l’appui du Laboratory for Computer Science du Massachusetts Institute of Technology (MIT), le World Wide Web Consortium (W3C). Organisme à but non lucratif, le W3C se consacre les années suivantes au développement de standards ouverts et gratuits qu’il va élaborer et partager avec les entreprises informatiques afin d’« assurer la croissance à long terme » du Web mondial naissant.
En l’an 2001, date de la création de Wikipedia, l’usage des sites est facilité par de nombreuses améliorations créées par le W3C (interfaces simples, RSS, mots-clés, tags, etc.) qui permettent plus d’interactivité et la production rapide de contenus. C’est l’époque où se créent les blogs, les Web services et les premiers réseaux sociaux – ce qu’on appellera le Web 2.0.
L’article du Monde précise :
« Il met en avant plusieurs idées révolutionnaires. Décentralisation : il n’y a pas de poste de contrôle central du Web. Universalité : pour que quiconque puisse publier sur le Web, tous les ordinateurs doivent parler les mêmes langues. Transparence : le code, comme les normes, ne sont pas écrits par un groupe d’experts, mais développés et enrichis au vu de tous, jusqu’à atteindre un consensus. Son leitmotiv : « Un seul Web partout et pour tous. » Ses principes : accessibilité, développement gratuit, acceptation d’un code d’éthique et de déontologie – « respect, professionnalisme, équité et sensibilité à l’égard de nos nombreuses forces et différences, y compris dans les situations de haute pression et d’urgence ».
Dans les années 1990, les penseurs du Web avaient peur de l’intervention des États. Pour la Chine, cette question reste plus que jamais d’actualité.
En 1996, John Perry Barlow va ainsi faire une déclaration qui va faire date la « Déclaration d’indépendance du cyberespace ».
« Gouvernements du monde industriel, géants fatigués de chair et d’acier, je viens du cyberespace, nouvelle demeure de l’esprit. (…) Vous n’avez aucun droit de souveraineté sur nos lieux de rencontre. (…) Nous créons un monde où chacun, où qu’il se trouve, peut exprimer ses idées, si singulières qu’elles puissent être, sans craindre d’être réduit au silence ou à une norme. (…) »
Mais en 1996, il y a aussi les futurs poids lourds de l’industrie numérique qui entrent en scène Amazon, Microsoft, Internet Explorer de Microsoft devient le navigateur dominant du Web, bientôt concurrencé par Google et son moteur de recherche.
Et finalement ce sont les grandes entreprises mondialisées et numériques qui vont prendre ce pouvoir que John Perry Barlow voulait refuser aux Etats.
Tim Berners-Lee, s’est dit « dévasté » par l’affaire Cambridge Analytica, quand Facebook a transmis les données personnelles de 80 millions d’« amis » à une société d’analyse alors mandatée par le futur président américain Donald Trump . Dans une lettre ouverte saluant le 28e anniversaire du Web, en 2017, il avertissait :
« Nos données personnelles sont désormais « conservées dans des silos propriétaires, loin de nous » et « nous n’avons plus de contrôle direct sur elles ». »
Et le Monde de raconter :
« Tim Berners-Lee déchante, sa créature lui a échappé. Il ne s’y résout pas. Il a lancé en novembre 2018, avec la Web Foundation, la campagne #fortheweb en vue de proposer « un nouveau contrat pour un Web libre et ouvert », et travaille au projet Solid, qui « vise à changer radicalement le mode de fonctionnement actuel des applications Web ». Berners-Lee n’est pas le seul à s’inquiéter. Un autre pionnier du monde numérique, le chercheur en intelligence artificielle (IA) Jaron Lanier, est plus radical encore.
En mai 2018, il publie Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now (« dix arguments pour fermer immédiatement vos comptes sur les réseaux sociaux », Bodley Head, non traduit). Il dresse ce réquisitoire grinçant contre Facebook :
« Pourquoi les gens doivent-ils être bombardés de messages de guerre psychologique bizarres avant les élections ou après une fusillade dans une école ? Pourquoi tout un chacun doit-il être soumis à des techniques de modification du comportement provoquant chez lui une dépendance simplement parce qu’il veut regarder des photos de ses amis et de sa famille ? » […]
Le lanceur d’alerte français Guillaume Chaslot, un informaticien qui a travaillé trois ans chez Google et dix mois sur l’algorithme de YouTube, dit, lui aussi, des choses graves.
« La démocratie a été oubliée en chemin par le Web », confie-t-il au Monde. Il a observé de l’intérieur comment l’extraordinaire média social qu’est YouTube, avec ses 1,8 milliard d’utilisateurs connectés en 2018, a dérapé dès qu’il s’est politisé. Avec l’aide de l’outil exploratoire qu’il a cofondé, Algo Transparency, Chaslot s’est aperçu que plus de 80 % des vidéos politiques recommandées par YouTube pendant la campagne électorale américaine étaient favorables à Trump.
Il devient concevable de manipuler une élection avec des campagnes ciblées et passionnelles sur le Web[…]
Au-delà des atteintes à la démocratie du fait de la viralité tapageuse des fausses nouvelles, le Web, dominé par les géants informatiques et le capitalisme de plates-formes, suit une autre pente fatale : il fonctionne sur un nouveau modèle économique qui s’appuie sur l’extraction et l’exploitation massive de nos données personnelles à des fins commerciales.
Cette économie du big data et des algorithmes, basée sur l’accompagnement permanent, la manipulation et la prédiction des comportements individuels, l’ex-professeure d’administration de la Harvard Business School Shoshana Zuboff l’appelle le « capitalisme de surveillance » (The Age of Surveillance Capitalism, 704 pages, Public Affairs, 2019, non traduit), et en fait une analyse implacable et pionnière.
Ce nouveau capitalisme, « issu, dit-elle, de l’accouplement clandestin entre l’énorme pouvoir du numérique, avec l’indifférence radicale et le narcissisme intrinsèque du capitalisme financier, et de la vision néolibérale », se fonde sur une idée forte : vendre, heure après heure, en temps réel, « l’accès à toute notre vie », tous nos comportements, en captant et décryptant nos épanchements sur les réseaux sociaux, en analysant et accompagnant toutes nos activités numériques par le biais de Google Maps, Google Agenda, Google Actualités, sans oublier les capteurs des objets connectés – c’est-à-dire au prix d’« une surveillance généralisée de notre quotidienneté ».
Ce véritable casse mondial sur nos vies privées s’est fait, constate l’économiste, sans rencontrer beaucoup de résistance, appuyé sur des « parodies de contrats » en ligne, fondés sur des chantages au service.
Cette appropriation, cette marchandisation et cette connaissance fine de l’autre lui fait dire que nous ne sommes pas dans le contrôle total des comportements « à la Big Brother », mais à la « Big Other » : « Big Other est un régime institutionnel, omniprésent, qui enregistre, modifie, commercialise l’expérience quotidienne, du grille-pain au corps biologique, de la communication à la pensée, de manière à établir de nouveaux chemins vers les bénéfices et les profits » (Journal of Information Technology, vol. 30, 2015).
C’est la nouvelle loi du capitalisme numérique, qui a fait du Web rêvé par Tim Berners-Lee un immense magasin en ligne, une gigantesque Matrix commerciale où nous évoluons, connectés, géolocalisés, recommandés, déchiffrés par les algorithmes, tous nos désirs les plus intimes traqués, flattés, devancés et assouvis. »
<1215>
-
Lundi 18 mars 2019
« Vague mais prometteur »Mike Sendall à Tim Berners-Lee, quand ce dernier lui apporta un document décrivant le Web en mars 1989Le Web est né il y a 30 ans.
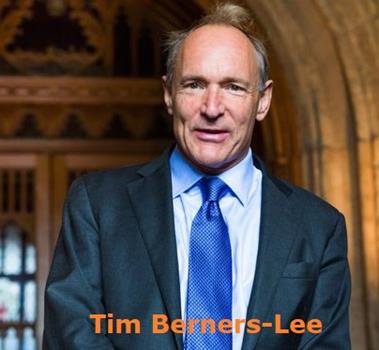 Tout le monde accepte de reconnaitre l’informaticien britannique Tim Berners-Lee qui travaillait à l’époque au CERN, comme son inventeur.
Tout le monde accepte de reconnaitre l’informaticien britannique Tim Berners-Lee qui travaillait à l’époque au CERN, comme son inventeur.
Le CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) est une organisation européenne située près de Genève et qui a été créé par 11 gouvernements européens. Il s’agit donc d’une organisation administrative et hiérarchique. C’est pourquoi Tim Berners-Lee avait un supérieur hiérarchique du nom de Mike Sendall. Et c’est pourquoi ce remarquable inventeur déposa, sur le bureau de son chef, un document donnant les bases du World Wide Web (WWW), appelé désormais le Web, pour obtenir son avis et validation. Sendall qualifia alors le travail de Tim Berners-Lee de :
« Vague, mais prometteur ».
A ce moment, je ne peux m’empêcher de rapporter ce « joke » (plaisanterie en français) que j’ai entendu de la bouche de Michel Serres : Une jeune fille incrédule demanda à sa mère : « – Maman tu m’as bien dit que vous n’aviez pas d’ordinateur à la maison quand tu avais mon âge. – Oui ma chérie ! – Mais alors comment faisiez-vous pour aller sur le Web ? »
Si vous n’êtes pas à l’aise avec tous ces concepts, un rappel s’impose.
Internet n’est pas le Web, il est le réseau qui permet le Web, mais il est aussi le support du courrier électronique, de la messagerie instantanée, du pair-à-pair. Donc confondre le World Wide Web et Internet constitue une erreur. Internet est le réseau informatique mondial accessible au public. C’est un réseau de réseaux, à commutation de paquets, sans centre névralgique, composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, eux-mêmes regroupés en réseaux autonomes.
Internet existait déjà quand Tim Berners-Lee a inventé le Web.
Le terme d’origine américaine « Internet » est dérivé du concept d’internetting (en français : « interconnecter des réseaux ») dont la première utilisation documentée remonte à octobre 1972 par Robert E. Kahn, à Washington.
Les origines exactes du terme « Internet » restent à déterminer. Toutefois, c’est le 1er janvier 1983 que le nom « Internet », déjà en usage pour désigner l’ensemble d’ARPANET et de plusieurs réseaux informatiques, est devenu officiel.
Wikipedia vous expliquera cela très bien et vous contera l’histoire d’Arpanet qui est l’ancêtre d’internet et qui a été mis au point par des chercheurs américains pour leurs propres besoins et les besoins de l’armée.
Sur le réseau mondial il a donc été possible de créer le World Wide Web (WWW), littéralement la « toile (d’araignée) à l’échelle mondiale ». Le Web permet de consulter, avec un navigateur, des pages accessibles sur des sites. L’image de la toile d’araignée vient des hyperliens qui lient les pages web entre elles. Il crée donc les hyperliens, le langage html, le concept de serveur http, l’adresse IP. Bref, tout ce qui vous permet de venir sur ce blog et de lire les articles que je rédige à partir de mon ordinateur personnel, dans mon appartement après avoir moi-même navigué sur le Web pour trouver toutes les informations qui me sont nécessaires pour alimenter et éclaircir mon propos.
<Le Monde> décrit cet échange et ce qui s’en suivit de la manière suivante :
« Le 12 mars 1989, l’informaticien britannique Tim Berners-Lee dépose sur le bureau de son chef de service, Mike Sendall, un topo de quelques pages intitulé « Gestion de l’information : une proposition ». Il y décrit sommairement les moyens de consulter directement l’énorme base de données du CERN, le laboratoire de physique nucléaire européen, stockée sur plusieurs ordinateurs, en allant chercher à son gré, grâce à des liens hypertextes, toute l’information disponible.
Les bases techniques d’une circulation souple dans les données numérisées sont jetées : le Web est inventé. « Vague, mais prometteur », lui répond Sendall.
Dans l’année, Berners-Lee conçoit le protocole « http », pour localiser et lier les documents informatisés, le « html », pour créer de nouvelles pages, l’« URL », l’adresse unique qui permet d’identifier une ressource. Puis il crée le premier serveur Web sur le réseau interne du CERN, affiché sur un outil « navigateur » qu’il nomme « worldwideweb ». Rapidement, les chercheurs du CERN s’en emparent.
Depuis, l’humanité est entrée dans l’âge de l’information et de la connexion instantanée, tissant la vertigineuse « Toile » mondiale – tout en donnant un immense pouvoir sur nos existences aux géants du numérique. […]
En avril 1993, Tim Berners-Lee obtient du prestigieux laboratoire européen qu’il enregistre le nouvel outil dans le domaine public, publie son code source et l’ouvre au « réseau des réseaux » mondial en gestation, l’Internet. Il est persuadé que le « véritable potentiel » du Web ne peut être libéré que s’il devient « un espace universel » où n’importe qui, en n’importe quel lieu, peut aller chercher librement des ressources, cela « gratuitement » et « sans permission ».
Il pressent qu’un des plus vieux rêves de l’humanité – rassembler toute la connaissance connue dans un espace que tous puissent explorer, une utopie qui remonte à la bibliothèque d’Alexandrie (fondée par Ptolémée en 288 av. J.-C.) et passe par l’imprimerie de Johannes Gutenberg (1400-1468) – devient possible, à la croisée du Web et d’Internet, et pense qu’il doit être offert au monde. »
Mais le CERN étant une vraie administration, Tim Berners-Lee n’avait pas qu’un chef mais aussi une superviseuse : Peggie Rimmer. Et <Libération> l’a interrogée à l’occasion du trentième anniversaire du Web.
« Peggie Rimmer a passé une grande partie de sa carrière au Cern, «La Mecque de la physique des particules». Cette fille de mineur, pionnière parmi les femmes dans une discipline qui n’en compte aujourd’hui encore que 10%, a supervisé le jeune Tim Berners-Lee dans les années qui ont précédé son invention révolutionnaire, le «Word wide web». Avec humour, elle revient sur la genèse du Web, qui fête cette semaine ses 30 ans.
Ma petite équipe s’appelait le Read Out Architecture (RA), on le voit mentionné sur le schéma en forme d’arbre généalogique que Tim a dessiné dans son document devenu célèbre : «Projet de Management de l’Information», qui deviendrait la base du Web. Au Cern, nous étions passés d’expériences réunissant 10 personnes à des groupes de quelques centaines de personnes, et bien sûr, ces personnes utilisaient 10 à 15 ordinateurs, tous différents. Notre tâche consistait à écrire un logiciel pour lire et stocker des données extraites des détecteurs. Cela impliquait notamment de définir des standards, des règles communes. Ce terrain était vraiment fertile pour accueillir l’idée de Tim, qui n’était pas tant liée au champ de la physique qu’au monde de l’informatique. C’est lui qui a choisi de nous rejoindre, donc j’imagine qu’il a senti que ce serait un bon endroit pour lui… Il avait des idées incroyables et il était très sympathique.
Au département, nous avions des réunions hebdomadaires. Pendant les interventions de Tim, au bout de quelques minutes, nous n’avions plus la moindre idée de ce qu’il racontait. Au début, on a cru que c’était à cause de son débit de parole, et nous écrivions sur des petits bouts de papier : «Va plus lentement, Tim.» C’est simple, la seule fois où je l’ai vu parler distinctement, c’est quand je l’ai vu jouer, un Noël, dans une pièce de théâtre. Mais la vitesse n’était pas le seul facteur. Aujourd’hui, quand il parle du Web, on peut deviner de quoi il s’agit, parce qu’on sait déjà à quoi ça ressemble, mais à l’époque… on se disait juste : mais de quoi il parle ?
[…] Ma plus grande contribution, pour ne pas dire l’unique, ça a été de dire à Tim que ses idées ne passeraient pas le seuil du laboratoire s’il ne prenait pas la peine de construire en dessous des règles, des définitions, des standards sur lesquels tout le monde pourrait se mettre d’accord pour utiliser son système. Il fallait, lui ai-je dit, que ces règles soient claires comme le cristal pour que, par exemple, quelqu’un à Vladivostok qui ne parle pas anglais puisse les implémenter facilement. Il n’était pas vraiment ravi. Mais quelque temps après, il a écrit les spécifications du HTML, du HTTP et de l’URL, qui se sont révélés suffisamment bonnes pour qu’aujourd’hui encore, ils soient fonctionnels. »
C’est ce qu’on appelle un génie ! Et c’est la jeune fille du « joke » qui l’explique le mieux : quand un génie invente, il change le monde et l’appréhension que l’on a du monde. On a du mal à s’imaginer le monde d’avant cette invention.
Mais Tim Berners-Lee était un idéaliste, il n’aime ce que le web est devenu.
<1214>
-
Vendredi 15 mars 2019
«Exprimer sa gratitude, c’est accepter l’idée que l’on est vulnérable.»Delphine ViganQuand on y réfléchit, on dit bien souvent « merci » dans une journée.
Merci de me tenir la porte, merci de m’apporter quelque chose, merci de me rendre de la monnaie.
On le dit par savoir vivre et ce qui n’est pas rien. La vie sociale en a besoin.
Quelquefois c’est presque mécanique, comme un réflexe, sans y penser.
Mais la « gratitude », c’est autre chose.
On utilise bien plus le mot « ingratitude », ce qui signifie que la gratitude que nous voudrions attendre, que nous souhaiterions, n’est pas la réponse que nous recevons ou percevons.
On utilise plus souvent le mot « reconnaissant », je vous suis reconnaissant. D’ailleurs, pour définir « gratitude » les dictionnaires utilisent fréquemment le mot reconnaissance.
Ainsi le Larousse définit « gratitude » par « Reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. ».
Il me semble que « gratitude » est plus intense que « reconnaissance », va plus loin dans l’intime : « rendre grâce », elle paraît d’essence spirituelle.
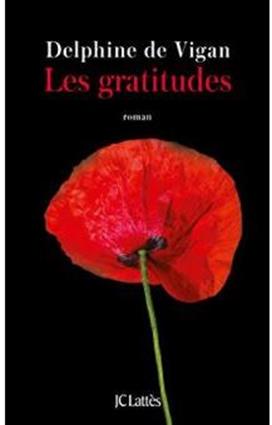 Michka est une vieille dame, qui vit désormais dans un Ehpad. Elle était dans sa jeunesse journaliste et correctrice. Mais maintenant elle perd le sens des paroles et des mots, le terme savant est «aphasie». Pourtant elle se souvient de son enfance où des personnes bienveillantes l’ont sauvé des gens qui voulaient lui faire du mal, parce qu’elle était juive. Elle n’a pas encore exprimé sa gratitude à leur égard et elle voudrait le faire.
Michka est une vieille dame, qui vit désormais dans un Ehpad. Elle était dans sa jeunesse journaliste et correctrice. Mais maintenant elle perd le sens des paroles et des mots, le terme savant est «aphasie». Pourtant elle se souvient de son enfance où des personnes bienveillantes l’ont sauvé des gens qui voulaient lui faire du mal, parce qu’elle était juive. Elle n’a pas encore exprimé sa gratitude à leur égard et elle voudrait le faire.
Marie vient régulièrement rendre visite à Michka pour lui exprimer sa gratitude. Quand elle était enfant, la maman de Marie ne s’occupait pas beaucoup d’elle, alors la petite fille venait frapper à la porte de sa voisine en quête d’affection et d’échanges. Et quand jeune femme, Marie est tombée malade, c’est aussi Michka qui venait la voir.
Et puis, il y a encore un troisième personnage, Jérôme, l’orthophoniste de l’Ehpad qui s’occupe de Michka et s’est attachée à elle. Lui voudrait exprimer sa gratitude à tous ses patients qui lui ont beaucoup apporté.
Jérôme dit :
« Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits. Je travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. Les confidences.
Et la peur de mourir. Cela fait partie de mon métier.
Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore aujourd’hui, après plus de dix ans de pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c’est la pérennité des douleurs d’enfance. Une empreinte ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne s’efface pas. »
C’est la trame du dernier roman de Delphine de Vigan : « Les gratitudes » dans lequel Michka dit simplement :
« C’est ça qui change tout, tu sais, Marie. C’est d’avoir peur pour quelqu’un d’autre, quelqu’un d’autre que soi. »
Delphine de Vigan était l’invitée de <La matinale de France Inter du 11 mars 2019>
Vous pouvez aussi retrouver des vidéos de cette émission sur <cette page>
Elle a dit des choses qui m’ont beaucoup touché.
« La gratitude, selon sa définition étymologique, c’est rendre grâce. Pour moi il y a effectivement cette notion de dette, mais aussi cette notion de partage. Dire à quelqu’un ‘voilà ce que tu m’as permis de faire’, c’est une façon de partager ce moment, cette joie, ce bonheur. »
 « Un concept parfois très éloigné de nos sociétés, alors que paradoxalement, « merci est un des mots qu’on emploie le plus souvent » dans une journée, pour tout et n’importe quoi. « D’une manière générale on a plus de mal à nommer les choses, on est dans une méfiance, une suspicion sur les sentiments qui nous habitent. Exprimer sa gratitude, c’est accepter l’idée qu’on a besoin de l’autre. Dans une société comme la nôtre, c’est compliqué de dire à l’autre ‘sans toi je ne serai rien’. »
« Un concept parfois très éloigné de nos sociétés, alors que paradoxalement, « merci est un des mots qu’on emploie le plus souvent » dans une journée, pour tout et n’importe quoi. « D’une manière générale on a plus de mal à nommer les choses, on est dans une méfiance, une suspicion sur les sentiments qui nous habitent. Exprimer sa gratitude, c’est accepter l’idée qu’on a besoin de l’autre. Dans une société comme la nôtre, c’est compliqué de dire à l’autre ‘sans toi je ne serai rien’. »
« Exprimer sa gratitude, c’est accepter l’idée que l’on est vulnérable »
Elle parle aussi de la vieillesse
« Ce qui m’intéresse, c’est d’approcher la vieillesse par le langage. Mon personnage a travaillé avec les mots, pour elle cette perte est encore plus douloureuse. À la maison de retraite, tout est petit [un petit goûter, une petite sortie, une petite toilette…], c’est un univers très codifié, très contraint. Ce qui m’intéressait, c’est la manière dont la perte d’autonomie rétrécit l’univers. Vieillir, c’est apprendre à perdre.»
Elle fait dire à Michka :
« Pourquoi dites-vous ‘les personnes âgées’ ? Vous devriez dire ‘les vieux’. C’est bien ‘les vieux’. Ça a le mérite d’être fier. Vous dites bien ‘les jeunes’, non ? Vous ne dites pas les ‘personnes jeunes’ ? »
Et en évoquant son propre destin, elle analyse le rapport aujourd’hui d’une société qui va de plus en plus vite avec les vieux :
« D’autant que là encore, notre société a du mal à savoir que faire face à la vieillesse. C’est sans doute ma propre peur de la vieillesse qui nourrit ce livre : il suffit de regarder ces derniers mois comment on prend en charge la grande vieillesse aujourd’hui dans nos sociétés. On vit très vieux et en même temps on vit dans un monde où ne pas être rentable pose un très gros problème. Si j’étais très vieille ce qui me hanterait le plus c’est d’être un poids pour la société. »
Après cette émission, une auditrice a écrit à la médiatrice de France Inter :
« Je viens d’écouter l’émission avec Delphine De Vigan. Merci pour ces échanges, merci de permettre l’expression de l’humanité à la radio, aux auditeurs de s’exprimer. Quels témoignages touchants dans cette actualité si dure. Merci à Delphine De Vigan d’écrire ce qu’elle sait si bien dire. Un moment de douceur en ce début de semaine. »
<Clara Dupont-Monod parle aussi avec bonheur de ce livre>
Si nous y réfléchissons bien, nous avons aussi certainement encore de nombreuses gratitudes à exprimer autour de nous.
<1213>
-
Jeudi 14 mars 2019
« On cherche un commissaire de police pour Cherbourg »Une vacance de pouvoir rapportée par les médiasDans mon butinage quotidien, il m’arrive de tomber sur des informations insolites ou au moins étonnantes.
Parmi les nouvelles racontées par la revue de presse de France Inter du samedi 2 mars, j’ai été interpellé par celle-ci :
« Cherbourg n’a pas de commissaire depuis huit mois
Cherbourg, 80 000 habitants, 4e ville de Normandie.
Mais personne pour prendre la tête du commissariat, relève Le Parisien-Aujourd’hui en France.
Une prime exceptionnelle, jusqu’à 1 000 euros par mois, a été ajoutée sur la fiche de recrutement pour appâter les candidats potentiels.
Mais visiblement, ça ne suffit pas. »
Pourquoi? »
La réponse est surprenante :
« Parce que le taux de délinquance de Cherbourg est trop bas ! Ça n’est pas attractif pour un commissaire, selon le maire socialiste Benoit Arrivé, qui a interpellé le ministre de l’Intérieur sur la question. »
En effet, l’article du Parisien va bien dans ce sens : « Invraisemblable » :
« Situation ubuesque dans cette ville de la Manche : le commissariat ne trouve pas de patron. Les autorités se renvoient la balle.
Après le désert médical… le désert policier !
Voilà près de huit mois que Cherbourg, quatrième ville de Normandie (avec 80 000 habitants), plus grosse circonscription de police du département de la Manche… n’a pas de commissaire ! »
Et le journal de donner la parole à un habitant de Cherbourg :
« C’est invraisemblable que dans une ville comme la nôtre, avec un port, des constructions de sous-marins, des chantiers navals importants, il n’y ait pas de patron au commissariat. Franchement, dans ces périodes agitées, c’est incompréhensible. Ça ne doit pas être si compliqué de dire à un jeune commissaire : On n’a personne à Cherbourg, tu y vas… »
Sonia Krimi est députée de la circonscription, élue de la République en marche (LREM), elle en appelle, au ministre de l’Intérieur de son gouvernement et affirme :
« Il semble que les jeunes commissaires soient plus enclins à aller vers les circonscriptions où la police est largement sollicitée. Mais quoi… Faut-il que notre taux de délinquance remonte pour que nous soyons entendus ? Un commissariat comme celui de Cherbourg est au cœur d’enjeux qui ont impérativement besoin d’un patron. Et si personne ne se propose spontanément, c’est à l’État de régler cette situation. C’est au ministre et je le lui ai dit. »
Ouest France avait interviewé le précédent occupant du poste, celui qui a quitté Cherbourg en juillet 2018 pour … Lyon : le commissaire Huignard. Et ce dernier avait, en effet décrit une ville plutôt sympathique dans mon échelle des valeurs :
« C’est une ville apaisée. Il n’y a pas d’attaques ciblées envers les forces de l’ordre, pas de logique de méfiance. La police peut aller dans tous les quartiers. Les gens disent bonjour, la discussion est facile. C’est vraiment une population accueillante, à l’écoute. […]
Nous avons progressé sur la sécurité routière. Il y a eu moins d’accidents mortels l’année dernière par rapport à l’année précédente. Il faut tout de même rester vigilant, la tendance peut vite s’inverser. Mais c’est un bilan satisfaisant dans l’ensemble. Cherbourg est une ville plutôt calme. La délinquance y est assez faible, il y a quelques affaires de stupéfiants, quelques homicides et des violences liées à l’alcool. Cela nous permet de traiter les affaires de façon complète. »
France 3 Normandie donne une autre explication géographique :
« Placée au Nord de la péninsule du Cotentin en bordure de la Manche, la ville de Cherbourg souffre de son éloignement géographique. Mais le problème de recrutement des commissaires existe à l’échelle nationale : près de 200 circonscriptions seraient concernées. »
En revanche, le même article rapporte l’incompréhension et le désaccord d’un responsable syndical de la Police qui considère la prime peu justifiée, car ce type de prime est prévu quand le poste est considéré comme difficile.
Pour lui «le signal lancé est très mauvais ».
Tout est bien qui finit bien : la Presse de la Manche a publié la bonne nouvelle : « Enfin un nouveau commissaire à Cherbourg ! ». Ce nouveau commissaire prendra ses fonctions le 8 avril 2019.
Cette histoire montre toute une série de problématique d’aujourd’hui :
- Les cadres privilégient souvent l’environnement dans lequel on leur propose des postes. Les métropoles sont privilégiées. Il faut un environnement attractif si on veut attirer les nomades d’aujourd’hui !
- Dans l’esprit de beaucoup, c’est plus simple d’essayer de se faire valoir en améliorant une situation dégradée vers un peu de mieux que d’essayer de conserver une situation bonne, même si dans le second cas il est possible de mieux travailler et d’aller plus loin dans la qualité.
- Enfin, un cas comme Cherbourg n’est-il pas en partie une conséquence de la quantophrénie ambiante, de la gouvernance par les chiffres ? Dans une situation avec une grande délinquance je suppose que les divers indicateurs statistiques peuvent atteindre des niveaux qui semblent très significatifs pour les autistes qui se réfugient dans le rassurant et stupide confort de la vision binaire et chiffrée du monde.
<1212>
- Les cadres privilégient souvent l’environnement dans lequel on leur propose des postes. Les métropoles sont privilégiées. Il faut un environnement attractif si on veut attirer les nomades d’aujourd’hui !
-
Mercredi 13 mars 2019
« La baisse des effectifs dans les services publics est une des raisons importantes de la coupure entre les Français et les services publics. Le phénomène de non réponse, ça s’explique car les services n’en ont plus les moyens »Jacques Toubon, sur France Inter le 12/03/2019Jacques Toubon est le défenseur des droits.
Le Défenseur des droits est une institution indépendante de l’État. Créée en 2011 et inscrite dans la Constitution, elle s’est vu confier deux missions :
- Défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ;
- Permettre l’égalité de tous et toutes dans l’accès aux droits.
Cette institution dispose d‘<un site> qui donne toutes les explications sur les motifs qui permettent de la solliciter et les moyens pour le faire.
Le Défenseur des droits a été précédé par 4 institutions. Dans sa volonté de rationnaliser, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement a regroupé ces quatre institutions :
- Le Médiateur de la République, créé en 1973 par le gouvernement Messmer, le premier titulaire fut Antoine Pinay.
- Le Défenseur des enfants, créé en 2000 par le gouvernement de Jospin
- La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) créé en 2004 par le gouvernement Raffarin
- La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) créé en 2000 par le gouvernement de Jospin
En 2011, mis à part le médiateur de la république, les autres institutions étaient d’extraction récente. Le premier titulaire en fut Dominique Baudis qui décéda lors de son mandat en 2014.
Et François Hollande, à la surprise générale et notamment de ses nombreux amis nomma Jacques Toubon, ancien maire RPR du 13ème arrondissement de Paris, ministre de la culture et de la Justice de gouvernements de droite, proche de Jacques Chirac qu’il a accompagné pendant toute sa carrière politique, le défendant contre vents et marées. Il avait une réputation d’homme de droite, plutôt partisan de politiques de sécurité et d’ordre, avec une conscience sociale limitée. Les amis de François Hollande étaient donc doublement surpris : d’une part ce n’était pas l’un d’eux qui était nommé, d’autre part le nommé qui n’était pas l’ami de François Hollande n’avait pas vraiment le profil du rôle.
Mais depuis qu’il est défenseur des droits, il surprend (en bien) et il agace le gouvernement.
Non seulement il agit lorsqu’il est sollicité par des français, environ 96 000 fois en 2018, mais en outre il produit avec ses services chaque année un rapport dans lequel il fait le bilan des affaires qui lui ont été soumis et il fait une synthèse des causes et dysfonctionnements qui conduisent les citoyens à se plaindre.
Vous trouverez le rapport 2018 publié le 11 mars 2019 derrière <ce lien>
Et comme souvent quand une institution produit un rapport, les radios invitent le responsable à s’exprimer. C’est ce qu’a fait France Inter ce 12 mars 2019 et vous pouvez donc écouter <Jacques Toubon lors de l’émission 7-9>
France Inter qui fait une synthèse <sur cette page> nous indique que le Défenseur des droits est de plus en plus sollicité et de plus en plus indigné. Et on apprend que 80 % des règlements amiables sont favorables au demandeur.
Le rapport indique par exemple :
« Sur nombre de sujets essentiels pour la cohésion nationale et l’appartenance à la République, sécurité et libertés, politique migratoire et droits humains, universalité et performance, égalité et modernisation, le débat public n’arrive pas à s’instituer »
L’essentiel des demandes concerne l’accès aux services publics et aux droits ainsi que des incidents liés au maintien de l’ordre. Ainsi le rapport fait le constat :
« Parallèlement au recul des services publics, s’est implantée une politique de renforcement de la sécurité et de la répression face à la menace terroriste, aux troubles sociaux et à la crainte d’une crise migratoire alimentée par le repli sur soi. [Une situation qui s’est] accentuée depuis l’instauration de l’état d’urgence en 2015, [un état d’urgence qui] telle une pilule empoisonnée, est venu contaminer progressivement le droit commun, fragilisant l’État de droit et libertés sur lesquels il repose »
Mais le plus intéressant est ce que Jacques Toubon a expliqué lors de l’émission de France Inter :
Il est revenu sur la problématique du maintien de l’ordre :
« Il y a des années que nous disons qu’il y a des problèmes quant au respect des droits fondamentaux dans la manière dont se fait le maintien de l’ordre. Ça fait plus d’un an que j’ai remis un rapport qui disait ce que l’on constate aujourd’hui. […] Interdiction du flash ball super pro, alerte sur les LBD 40×46, sur les grenades offensives, nous avons mis en lumière leur dangerosité ».
Ce qui n’a pas plu au ministre de l’intérieur qui a immédiatement critiqué ces prises de position et même rappelé le passé de Jacques Toubon, en tant que ministre de la Justice pendant lequel son discours aurait été très différent selon Christophe Castaner.
Et puis…
Je le cite simplement :
« C’est un rapport qui signale un vrai problème de relation entre ceux qui vivent dans notre pays et la sphère publique. Les gens ont le sentiment que la présence humaine disparaît.
[…] Le service public, la République française, ne peut pas admettre de fabriquer des laissés pour compte.
[…] La numérisation peut constituer un progrès. Il y a des associations qui ont mis en place des coffres forts numériques qui rend service aux SDF, « ça c’est un progrès ».
[…] il reste 3 ans et demi pour arriver à la numérisation des formalités administratives. On ne pourra le faire qu’en maintenant des alternatives papier, et en accompagnant les gens.
[…] La baisse des effectifs dans les services publics est une des raisons importantes de la coupure entre les Français et les services publics. Le phénomène de non réponse, ça s’explique car les services n’en ont plus les moyens. Nous avons en face de nous une situation où la macro économie et les impératifs de finances publiques ont pris le pas sur toute autre considération.»
Les services n’ont plus les moyens de réaliser un service de qualité et la présence humaine est importante quand on parle de service public.
Peut-être que Christophe Castaner dira la même chose dans 20 ans s’il est nommé défenseur des droits ?
<1211>
- Défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ;
-
Mardi 12 mars 2019
« Citoyens d’Europe »Emmanuel MacronEmmanuel Macron a écrit une lettre à tous les membres de l’Union européenne qu’il a commencée par cette invite : « Citoyens d’Europe », ce qui peut surprendre car il n’existe pas de citoyens d’Europe parce qu’il n’existe pas de nation européenne. On est citoyen d’un État national.
J’ai écouté plusieurs émissions sur ce sujet
D’abord « Du grain à moudre » du 8 mars 2019 : <L’Europe a-t-elle besoin d’Emmanuel Macron ?>
Puis le nouvel esprit public de France Culture de ce dimanche du 10 mars, animé par Emilie Aubry mais qui a gardé pour nom « L’Esprit Public » : <Macron, Superman de l’Europe ?>
Et enfin, l’ancien esprit public animé par Philippe Meyer qui se trouve désormais sur internet et qui s’appelle « Le nouvel esprit public » : <Macron, l’Europe au pied de la lettre ?>
Philippe Meyer a introduit le sujet de la manière suivante :
« Lundi 4 mars, Emmanuel Macron a fait paraitre dans les médias des 28 États membres de l’UE une tribune intitulée « Pour une Renaissance européenne ». Il y met en avant des propositions ordonnées en trois thèmes : « la liberté, la protection et le progrès ». Le chef de l’État veut « remettre à plat » l’espace Schengen avec la création d’une authentique police des frontières communes et un office européen de l’asile. En matière économique, il souhaite une redéfinition de la politique de concurrence avec en corollaire l’affirmation d’une « préférence européenne ».
Emmanuel Macron propose par ailleurs la création d’une banque européenne du climat pour financer la transition écologique ainsi qu’une Agence européenne de protection des démocraties contre les ingérences étrangères notamment en ce qui concerne les élections. En France, ces propositions ont suscité une fracture à droite de l’échiquier politique.
[…] En Europe, le volontarisme du président français est applaudi mais des réserves s’expriment quant à l’hypothèse de réformer l’espace Schengen. Les Premiers ministres belge, slovaque ou finlandais, qui ont salué le texte de M. Macron, se sont gardés de s’exprimer sur ce point. En Allemagne, des responsables de la CDU, du SPD et des Verts ont appelé le gouvernement à répondre aux propositions d’Emmanuel Macron. Le gouvernement hongrois a, quant à lui, fait part de son scepticisme tandis qu’en Italie c’est par le silence qu’ont régi les actuels dirigeants du pays. Une stratégie qu’ils avaient déjà employé la veille de la publication de la tribune, lorsqu’Emmanuel Macron avait accordé une interview à la chaine de télévision italienne « Rai Uno ».
Plus intéressant est la réponse à ce texte de la nouvelle patronne de la CDU allemande, Annegre Kramp-Karrenbauer rebaptisée AKK. Vous en trouverez la traduction <ICI>.
C’est globalement plutôt une fin de non-recevoir.
Aujourd’hui je n’écrirai pas grand-chose et je vous renvoie vers les émissions indiquées ci-dessus, mais je vais laisser parler les cartes, et notamment la carte politique mondiale dont nous avions l’habitude dans les salles de classe que nous avons fréquenté jadis.
Cette carte « classique » pose d’ailleurs des problèmes de taille relative à cause de la projection MERCATOR que je n’expliquerais pas aujourd’hui, mais vous pourrez lire quelques critiques sur cette carte que nous utilisons habituellement.
Juste pour vous donner un exemple de distorsion : le Groenland a en réalité une superficie de 2,166 millions de km2, elle est ainsi plus petite que la République démocratique du Congo 2,335 millions de km2 qui a la caractéristique de se trouver au centre du planisphère. Il apparaît clairement que sur cette carte « classique » les proportions ne sont absolument pas respectées pour ces deux états.
 Mais que voit-on à la seule lecture de cette carte ?
Mais que voit-on à la seule lecture de cette carte ?
Une Europe morcelée façon puzzle, en face de géants comme les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie, le Brésil, le Canada.
Et si on s’intéresse à la démographie la situation est pire, l’ensemble des pays européens pèse de moins en moins dans le monde. L’Europe pesait en 1900, 20%, elle pèse aujourd’hui moins de 10% de la population mondiale.
Et la vraie carte du monde est celle qui montre la Chine, l’Empire du milieu, au centre. Le monde s’organise autour de l’Océan Pacifique, L’Europe se trouve morcelée et à la marge.
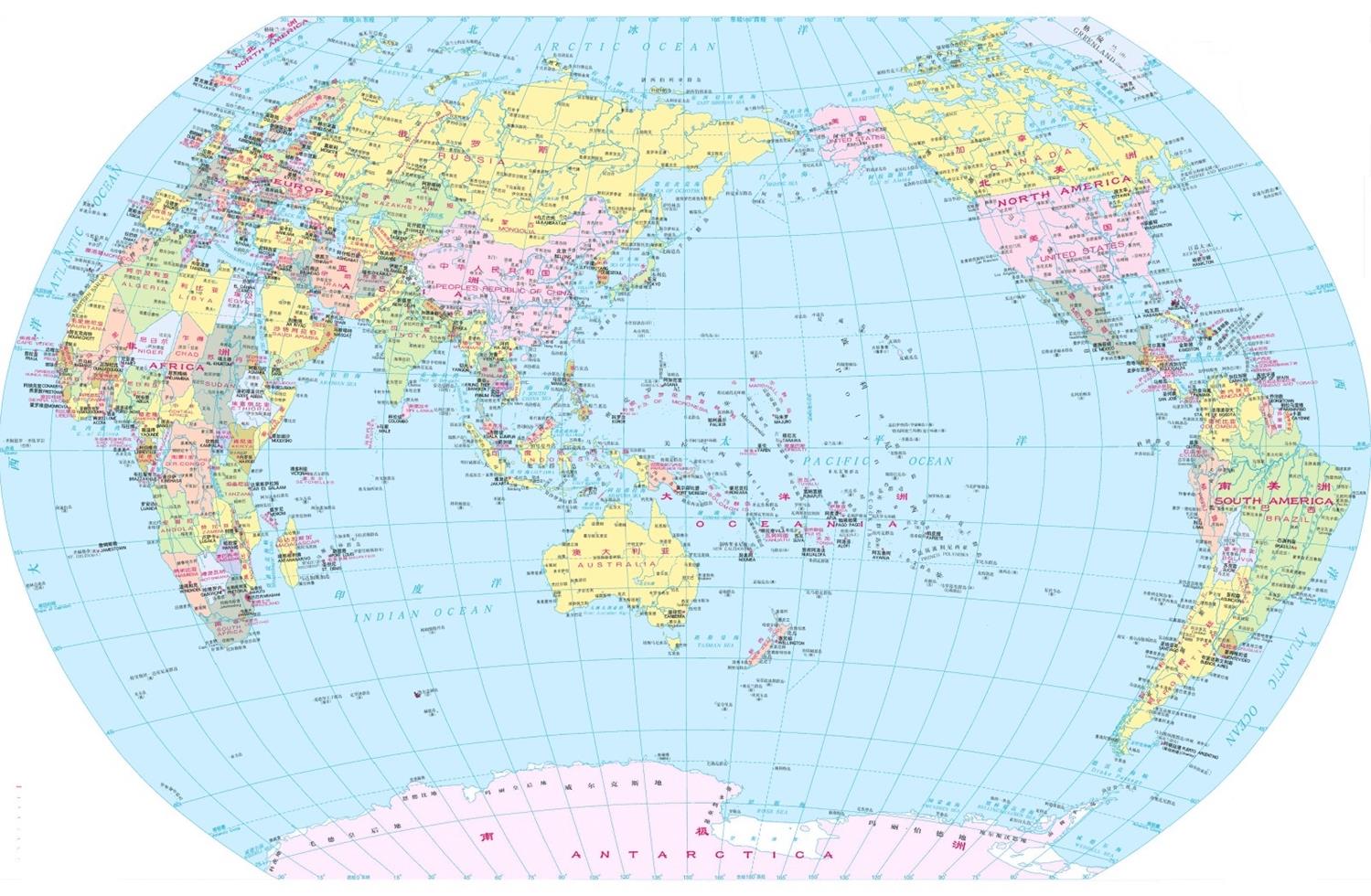
Notre Président, s’y prend peut être mal, mais il a raison de s’adresser aux « citoyens de l’Europe », soit nous arrivons à nous unir et alors nous pourrons peser dans le monde, engager, par rapport au défi climatique, des politiques significatives et ne pas subir la puissance économique des autres géants de la planète, soit nous n’y arrivons pas et nous serons une petite chose qui ne comptera guère et qui sera renvoyé aux marges de l’Histoire en train de se faire.
<1210>
-
Lundi 11 mars 2019
«Le monde est comme un masque qui danse : pour bien le voir, il ne faut pas rester au même endroit.»Proverbe igbo cité en conclusion de la lettre de Dominique Eddé à Alain Finkielkraut.Sauf à refuser tout contact avec les médias, personne ne saurait ignorer qu’Alain Finkielkraut a fait l’objet, à Paris d’une agression verbale, lors d’un samedi de manifestation des gilets jaunes par un salafiste qui après l’avoir traité de « sale merde de sioniste » a eu cette imprécation : « Nous sommes le peuple, la France elle est à nous, retourne à Tel Aviv ».
Il faut une certaine audace, pour qu’un Salafiste puisse s’écrier, dans le pays de Voltaire, le pays de la séparation de l’Église et de l’État, que la France est à des personnes qui professent ses idées.
C’est aussi d’une grande stupidité, parce qu’étant donné l’idéologie d’où cet individu parle, il ne pourra qu’attiser la haine et la division dans notre pays et alimenter la rhétorique d’extrême droite contre les musulmans et la théorie du grand remplacement.
Quasi tous les intellectuels, tous les journalistes, même ceux qui sont très opposés à certaines idées d’Alain Finkielkraut ont pris fait et cause pour lui et ont dénoncé l’acte haineux et stupide du salafiste.
J’ai avoué ma faiblesse pour l’émission de Finkielkraut sur France Culture : « Répliques » qui est selon moi un exemple d’émission tolérante où des idées peuvent s’exprimer et se discuter dans le respect.
Les opinons d’Alain Finkielkraut sont quelquefois plus contestables.
J’ai lu un point de vue que j’ai trouvé intéressant et qui a d’autant plus attiré mon attention en raison d’une censure du journal « Le Monde ».
L’article a été écrit par Dominique Eddé qui est libanaise. Elle est romancière, essayiste, critique littéraire, traductrice et éditrice. Elle écrit aussi des articles politiques publiés dans Le Monde et Le Nouvel Observateur.
Son dernier ouvrage traite d’Edward Said, universitaire palestino-américain décédé en 2003 que j’ai déjà évoqué parce qu’il a créé avec Daniel Barenboim, l’orchestre comprenant des musiciens arabes et israéliens, le <West-Eastern Divan Orchestra>
Cet ouvrage a pour titre : « Edward Saïd, Le roman de sa pensée ».
Après l’agression elle a souhaité écrire une lettre à Alain Finkielkraut.
Elle raconte :
« Rédigée le 23 février dernier, cette lettre à Alain Finkielkraut a été acceptée par le journal Le Monde qui demandait qu’elle lui soit « réservée », puis elle a été recalée, sans préavis, 9 jours plus tard alors qu’elle était en route pour l’impression.
L’article qui, en revanche, sera publié sans contrepoids ce même jour, le 5 mars, était signé par le sociologue Pierre-André Taguieff. Survol historique de la question du sionisme, de l’antisionisme et de « la diabolisation de l’État juif », il accomplit le tour de force de vider le passé et le présent de toute référence à la Palestine et aux Palestiniens. N’existe à ses yeux qu’un État juif innocent mis en péril par le Hamas. Quelques mois plus tôt, un article du sociologue Dany Trom (publié dans la revue en ligne AOC) dressait, lui aussi, un long bilan des 70 ans d’Israël, sans qu’y soient cités une seule fois, pas même par erreur, les Palestiniens.
Cette nouvelle vague de négationnisme par omission ressemble étrangement à celle qui en 1948 installait le sionisme sur le principe d’une terre inhabitée. Derrière ce manque d’altérité ou cette manière de disposer, à sens unique, du passé et de la mémoire, se joue une partie très dangereuse. Elle est à l’origine de ma décision d’écrire cette lettre. Si j’ai choisi, après le curieux revirement du Monde, de solliciter L’Orient-Le Jour plutôt qu’un autre média français, c’est que le moment est sans doute venu pour moi de prendre la parole sur ces questions à partir du lieu qui est le mien et qui me permet de rappeler au passage que s’y trouvent par centaines de milliers les réfugiés palestiniens, victimes de 1948 et de 1967.
Alors que j’écris ces lignes, j’apprends qu’a eu lieu, cette semaine, un défilé antisémite en Belgique, dans le cadre d’un carnaval à Alost. On peine à croire que la haine et la bêtise puissent franchir de telles bornes. On peine aussi à trouver les mots qui tiennent tous les bouts. Je ne cesserai, pour ma part, d’essayer de me battre avec le peu de moyens dont je dispose contre la haine des Juifs et le négationnisme, contre le fanatisme islamiste et les dictatures, contre la politique coloniale israélienne. De tels efforts s’avèrent de plus en plus dérisoires tant la brutalité ou la surdité ont partout des longueurs d’avance. »
L’Orient-Le Jour est un quotidien francophone libanais. C’est un des principaux journaux libanais du Moyen-Orient. Et vous trouverez l’article derrière ce lien : < Cher Alain Finkielkraut>
Elle commence à condamner sans ambigüité l’agression :
« Cher Alain Finkielkraut,
Permettez-moi de commencer par vous dire « salamtak », le mot qui s’emploie en arabe pour souhaiter le meilleur à qui échappe à un accident ou, dans votre cas, une agression. La violence et la haine qui vous ont été infligées ne m’ont pas seulement indignée, elles m’ont fait mal. Parviendrais-je, dans cette situation, à trouver les mots qui vous diront simultanément ma solidarité et le fond de ma pensée ? Je vais essayer. Car, en m’adressant à vous, je m’adresse aussi, à travers vous, à ceux qui ont envie de paix. »
Le plus simple est de lire l’article dans lequel, elle critique Alain Finkielkraut sur son refus de l’altérité et je dirai son manque d’empathie à l’égard du plus grand nombre des musulmans qui ne sont pas salafistes.
Elle écrit ainsi :
« Ainsi, l’islam salafiste, notre ennemi commun et, pour des raisons d’expérience, le mien avant d’être le vôtre, vous a-t-il fait plus d’une fois confondre deux milliards de musulmans et une culture millénaire avec un livre, un verset, un slogan. Pour vous, le temps s’est arrêté au moment où le nazisme a décapité l’humanité. Il n’y avait plus d’avenir et de chemin possible que dans l’antériorité. Dans le retour à une civilisation telle qu’un Européen pouvait la rêver avant la catastrophe. Cela, j’ai d’autant moins de mal à le comprendre que j’ai la même nostalgie que vous des chantiers intellectuels du début du siècle dernier. Mais vous vous êtes autorisé cette fusion de la nostalgie et de la pensée qui, au prix de la lucidité, met la seconde au service de la première. Plus inquiétant, vous avez renoncé dans ce « monde d’hier » à ce qu’il avait de plus réjouissant : son cosmopolitisme, son mélange. Les couleurs, les langues, les visages, les mémoires qui, venues d’ailleurs, polluent le monde que vous regrettez, sont assignées par vous à disparaître ou à se faire oublier. Vous dites que deux menaces pèsent sur la France : la judéophobie et la francophobie. Pourquoi refusez-vous obstinément d’inscrire l’islamophobie dans la liste de vos inquiétudes ? Ce n’est pas faire de la place à l’islamisme que d’en faire aux musulmans. C’est même le contraire. À ne vouloir, à ne pouvoir partager votre malaise avec celui d’un nombre considérable de musulmans français, vous faites ce que le sionisme a fait à ses débuts, lorsqu’il a prétendu que la terre d’Israël était « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Vous niez une partie de la réalité pour en faire exister une autre. Sans prendre la peine de vous représenter, au passage, la frustration, la rage muette de ceux qui, dans vos propos, passent à la trappe. »
Elle revient sur cette idée sotte de vouloir légiférer sur le mot « antisioniste » :
« Peut-être aurez-vous l’oreille du pouvoir en leur faisant savoir qu’ils ne cloueront pas le bec des opposants au régime israélien en clouant le bec des enragés. On a trop l’habitude en France de prendre les mots et les esprits en otage, de privilégier l’affect au mépris de la raison chaque fois qu’est évoquée la question d’Israël et de la Palestine. On nous demande à présent de reconnaître, sans broncher, que l’antisémitisme et l’antisionisme sont des synonymes.
Que l’on commence par nous dire ce que l’on entend par sionisme et donc par antisionisme. Si antisioniste signifie être contre l’existence d’Israël, je ne suis pas antisioniste. Si cela signifie, en revanche, être contre un État d’Israël, strictement juif, tel que le veulent Netanyahu et bien d’autres, alors oui, je le suis. Tout comme je suis contre toute purification ethnique.
Mandela était-il antisémite au prétexte qu’il défendait des droits égaux pour les Palestiniens et les Israéliens ?
L’antisémitisme et le négationnisme sont des plaies contre lesquelles je n’ai cessé de me battre comme bien d’autres intellectuels arabes. Que l’on ne nous demande pas à présent d’entériner un autre négationnisme – celui qui liquide notre mémoire – du seul fait que nous sommes défaits. Oui, le monde arabe est mort. Oui, tous les pays de la région, où je vis, sont morcelés, en miettes. Oui, la résistance palestinienne a échoué. Oui, la plupart desdites révolutions arabes ont été confisquées. Mais le souvenir n’appartient pas que je sache au seul camp du pouvoir, du vainqueur. Il n’est pas encore interdit de penser quand on est à genoux. »
L’article est beaucoup plus riche que ce que j’en cite. Elle finit par un proverbe igbo :
« Le monde est comme un masque qui danse : pour bien le voir, il ne faut pas rester au même endroit. »
L’igbo aussi appelé ibo est une langue parlée au Nigéria, dans la région qui avait abritée la révolte du Biafra.
Ce proverbe igbo ressemble un peu à l’expression que j’ai parfois utilisé de tourner autour du pot, afin de voir le pot sous tous ses aspects.
J’ai avoué mon incapacité actuellement de rédiger un mot du jour équilibré sur Israël, mais je crois qu’il faut lire cette intellectuelle arabe modérée et qui dit une autre partie de la réalité de ce qui se joue dans cet orient complexe.
Je ne comprends pas la censure du Monde.
Je redonne le lien vers son article : « Cher Alain Finkielkraut »
<1209>
-
Vendredi 8 mars 2019
«Hector Berlioz nous paraît former, avec Hugo et Eugène Delacroix, la trinité de l’art romantique. »Théophile GautierLe 8 mars 1869, Hector Berlioz mourrait au 4 rue de Calais, dans le 9e arrondissement de Paris. C’était il y a 150 ans.
 Il est né dans la petite ville de l’Isère de la Côte Saint André, sous le règne de Napoléon 1er , le 11 décembre 1803.
Il est né dans la petite ville de l’Isère de la Côte Saint André, sous le règne de Napoléon 1er , le 11 décembre 1803.
A la mort de Beethoven en 1827, il avait déjà 24 ans.
Parmi les grands compositeurs romantiques, il ne fut précédé que par Franz Schubert (1797-1828). Les autres compositeurs de cette période lui sont postérieurs : Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), Chopin (1810-1849), Schumann (1810-1856) et Liszt (1811-1886). Brahms (1833-1897) refermera cette période romantique.
La <symphonie fantastique> créée le 5 décembre 1830, six ans après la neuvième symphonie de Beethoven, fut un coup de tonnerre, une œuvre révolutionnaire, ouvrant de nouvelles perspectives à la musique symphonique et annonçant Bruckner et surtout Mahler.
C’était un compositeur extravagant, précurseur, génial, formidable orchestrateur.
Le nombre de ses œuvres reste cependant limité. Si on se lance dans une approche quantophrénique de ce domaine et qu’on prend comme unité de compte le CD, on pourra constater que si Warner vient de publier un coffret de l’œuvre intégrale de Berlioz en 27 CD, il est loin de Mozart (170 CD), Bach (155 CD), Beethoven (100 CD), Schubert (69 CD) et même Brahms (60 CD).
Peu avant de 18 ans, j’avais acheté, en livre de poche, les « Mémoires de Berlioz » et entrepris d’en commencer la lecture. Je n’ai pas fini, mais je me souviens encore d’un épisode qu’il a raconté. Cet épisode m’a amusé et me semble assez révélateur de sa personnalité.
Pour situer le contexte, il faut préciser que Luigi Cherubini venait d’être nommé directeur du Conservatoire de Paris. Cherubini était né à Florence en 1760 soit 10 ans avant Beethoven, mais il vécut beaucoup plus longtemps, jusqu’à 81 ans. Il a composé un très bel opéra « Médée » magnifiée dans une version chantée par Maria Callas et dirigée par Bernstein. Il écrivit aussi plusieurs messes et requiem de toute beauté. Ce fut un grand compositeur, ce ne fut pas un génie. Berlioz l’était.
Et voici ce que Berlioz raconte dans ses Mémoires au chapitre 9 :
« A peine parvenu à la direction du Conservatoire, en remplacement de Perne qui venait de mourir, Cherubini voulut signaler son avènement par des rigueurs inconnues dans l’organisation intérieure de l’école, où le puritanisme n’était pas précisément à l’ordre du jour. Il ordonna, pour rendre la rencontre des élèves des deux sexes impossible hors de la surveillance des professeurs, que les hommes entrassent par la porte du Faubourg-Poissonnière, et les femmes par celle de la rue Bergère ; ces différentes entrées étant placées aux deux extrémités opposées du bâtiment.
En me rendant un matin à la bibliothèque, ignorant le décret moral qui venait d’être promulgué, j’entrai, suivant ma coutume, par la porte de la rue Bergère, la porte féminine, et j’allais arriver à la bibliothèque quand un domestique, m’arrêtant au milieu de la cour, voulut me faire sortir pour revenir ensuite au même point en rentrant par la porte masculine. Je trouvai si ridicule cette prétention que j’envoyai paître l’argus en livrée, et je poursuivis mon chemin.
Le drôle voulait faire sa cour au nouveau maître en se montrant aussi rigide que lui. Il ne se tint donc pas pour battu, et courut rapporter le fait au directeur. J’étais depuis un quart d’heure absorbé par la lecture d’Alceste, ne songeant plus à cet incident, quand Cherubini, suivi de mon dénonciateur, entra dans la salle de lecture, la figure plus cadavéreuse, les cheveux plus hérissés, les yeux plus méchants et d’un pas plus saccadé que de coutume.
Ils firent le tour de la table où étaient accoudés plusieurs lecteurs ; après les avoir tous examinés successivement, le domestique, s’arrêtant devant moi, s’écria : « Le voilà ! »
Cherubini était dans une telle colère qu’il demeura un instant sans pouvoir articuler une parole :
« Ah ! ah ! ah ! ah ! c’est vous, dit-il enfin, avec son accent italien que sa fureur rendait plus comique, c’est vous qui entrez par la porte, qué, qué, qué zé ne veux pas qu’on passe ! —
— Monsieur, je ne connaissais pas votre défense, une autre fois je m’y conformerai.
— Une autre fois ! une autre fois ! Qué-qué-qué vénez-vous faire ici ?
— Vous le voyez, monsieur, j’y viens étudier les partitions de Gluck.
— Et qu’est-ce qué, qu’est-ce qué-qué-qué vous regardent les partitions dé Gluck ? et qui vous a permis dé venir à-à-à la bibliothèque ?
— Monsieur ! (je commençais à perdre mon sang-froid), les partitions de Gluck sont ce que je connais de plus beau en musique dramatique et je n’ai besoin de la permission de personne pour venir les étudier ici. Depuis dix heures jusqu’à trois la bibliothèque du Conservatoire est ouverte au public, j’ai le droit d’en profiter.
— Lé-lé-lé-lé droit ?
— Oui, monsieur.
— Zé vous défends d’y revenir, moi !
— J’y reviendrai, néanmoins.
— Co-comme-comment-comment vous appelez-vous ? » crie-t-il, tremblant de fureur.
Et moi pâlissant à mon tour : « Monsieur ! mon nom vous sera peut-être connu quelque jour, mais pour aujourd’hui… vous ne le saurez pas !
— Arrête, a-a-arrête-le, Hottin (le domestique s’appelait ainsi), qué-qué-qué zé lé fasse zeter en prison ! »
Ils se mettent alors tous les deux, le maître et le valet, à la grande stupéfaction des assistants, à me poursuivre autour de la table, renversant tabourets et pupitres, sans pouvoir m’atteindre, et je finis par m’enfuir à la course en jetant, avec un éclat de rire, ces mots à mon persécuteur :
« Vous n’aurez ni moi ni mon nom, et je reviendrai bientôt ici étudier encore les partitions de Gluck ! »
Voilà comment se passa ma première entrevue avec Cherubini. Je ne sais s’il s’en souvenait quand je lui fus ensuite présenté d’une façon plus officielle. Il est assez plaisant en tout cas, que douze ans après, et malgré lui, je sois devenu conservateur et enfin bibliothécaire de cette même bibliothèque d’où il avait voulu me chasser. Quant à Hottin, c’est aujourd’hui mon garçon d’orchestre le plus dévoué, le plus furibond partisan de ma musique ; il prétendait même, pendant les dernières années de la vie de Cherubini, qu’il n’y avait que moi pour remplacer l’illustre maître à la direction du Conservatoire. Ce en quoi M. Auber ne fut pas de son avis.
J’aurai d’autres anecdotes semblables à raconter sur Cherubini, où l’on verra que s’il m’a fait avaler bien des couleuvres, je lui ai lancé en retour quelques serpents à sonnettes dont les morsures lui ont cuit. »
Berlioz, comme en lui-même. Il savait ce qu’il voulait, ne se sous estimait pas, rebelle à l’autorité qui ne lui paraissait pas légitime ou professant des normes qui lui semblaient stupide.
Dans le langage d’aujourd’hui on dirait : « Il aimait casser les codes ». Je vous invite à écouter <La revue de Presse de Bernard Pommier> du 24 février qui n’a rien à voir avec Berlioz mais qui explique la vogue actuelle de tous ceux qui veulent « casser les codes ».
Avec une telle mentalité, il a eu du mal à s’imposer en France. Cet homme qui fut le seul grand compositeur à avoir comme instrument d’origine, la guitare, aurait dû devenir médecin comme son père Louis Berlioz qui a la réputation d’avoir introduit l’acupuncture en France. Son père ne trouvait pas le métier de musicien très sérieux. Et la première ambition de Berlioz fut de convaincre ses parents du contraire.
Il eut du mal parce qu’il ne parvint jamais à vivre de ce métier de musicien. S’il eut un revenu convenable, c’est grâce à un travail de journaliste et de critique musical.
Et en général, il eut du mal à s’imposer en France. Il écrivit :
« Il faut avoir un drapeau tricolore sur les yeux pour ne pas voir que la musique est morte en France maintenant, et que c’est le dernier des arts dont nous gouvernants voudrons s’occuper. On me dit que je boude la France, non je ne boude pas, le terme est trop léger : je la fuis comme on fuit les pays barbares quand on cherche la civilisation, et ce n’est pas depuis la révolution seulement. Il y a longtemps que j’avais étouffé en moi l’amour de la France. […] Sans l’Allemagne, la Bohême, la Hongrie et surtout la Russie, je serais mort de faim en France mille fois. […] Il y a un seul théâtre lyrique à Paris, l’Opéra et il est dirigé par un crétin et il m’est fermé. »
1848, Correspondance générale, III
Et cette réserve, il la conservera longtemps en France. Ainsi pour Debussy, il était le « musicien préféré de ceux qui ne connaissaient pas très bien la musique », mais Debussy a dit beaucoup de bêtises dans sa vie.
Beaucoup plus récemment, lors de l’essor du microsillon, celui qui entreprit d’enregistrer une intégrale des œuvres de Berlioz, ne fut pas un français, mais un anglais Colin Davis
avec pour l’essentiel l’Orchestre Symphonique de Londres. Ce cycle Berlioz de Colin Davis continue à faire référence dans sa globalité.
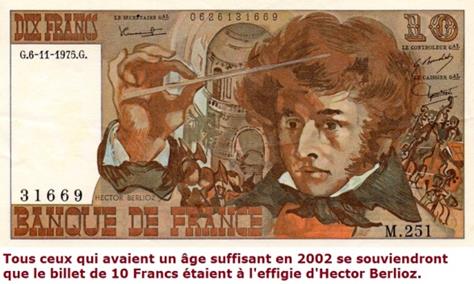 Il y a quand même des français qui ont su reconnaître ce musicien à sa juste dimension.
Il y a quand même des français qui ont su reconnaître ce musicien à sa juste dimension.
Ainsi, pour l’inauguration du monument élevé à Monte-Carlo, le samedi 7 mars 1903, en l’honneur du centenaire de la naissance d’H. Berlioz, Jules Massenet commença ainsi son discours :
« C’est le propre du génie d’être de tous les pays. A ce titre Berlioz est partout chez lui. Il est le citoyen de l’entière humanité. Et pourtant il passa sa vie sans joie et sans enchantement. On peut dire que sa gloire présente est faite de douleurs passées. Incompris, il ne connut guère que des amertumes. On ne vit pas la flamme de cette énergique figure d’artiste ; on ne fut pas ébloui par l’auréole qui le couronnait déjà ».
Il est vrai que Massenet est né à Saint Etienne qui se trouve dans la même région que l’isérois Berlioz
George Sand a écrit :
« Je parle sérieusement. Berlioz est un grand compositeur, un homme de génie, un véritable artiste. Il est très pauvre, très brave et très fier »
G. Sand, « Lettre à Everard », Lettres d’un voyageur, VI, 26….
Théophile Gautier qui est le poète des « Nuits d’été », chef d’œuvre de Berlioz rapproche Berlioz de Victor Hugo :
« Comme le poète a doublé la richesse des rimes pour que le vers regagnât en couleur ce qu’il perdait en cadence, le novateur musicien a nourri et serré son orchestration; il a fait chanter les instruments beaucoup plus qu’on ne l’avait fait avant lui »
T. Gautier, La Presse, 17 septembre 1838. On sait que les Nuits…
Et c’est dans l’ouvrage d’Emmanuel Reibel, « Comment la musique est devenue romantique : De Rousseau à Berlioz » paru chez Fayard, que j’ai lu la phrase de Théophile Gautier, datant de 1846, mis en exergue de ce mot du jour :
« Hector Berlioz nous paraît former, avec Hugo et Eugène Delacroix, la trinité de l’art romantique ».
 Berlioz repose au cimetière de Montmartre.
Berlioz repose au cimetière de Montmartre.
L’Association Nationale Hector Berlioz qui a son adresse dans la commune de naissance du musicien, La Côte Saint André, possède <un site> qui présente l’œuvre de Berlioz
Vous trouverez aussi <ICI> un site consacré entièrement à Hector Berlioz. Sur ce site sont publiés, l’intégral des Mémoires de Berlioz.
Le Ministère de la culture consacre aussi plusieurs pages au <150ème anniversaire de sa mort>
Il faut bien sûr finir avec quelques liens musicaux :
<Les nuits d’été par l’admirable et rayonnante Véronique Gens>
Une autre perle <La captive> toujours par Véronique Gens, il n’y a pas mieux.
Le duo d’amour des troyens : < Didon et Enée : Nuit d’ivresse>
Mais là il y a beaucoup mieux, sans la vidéo <Jon Vickers et Joséphine Veasey>
Pour la symphonie fantastique, je propose ce concert étonnant à Paris où Gustave Dudamel dirigeait à la fois l’orchestre Philharmonique de Radio France et ce qui était à l’époque son orchestre Simon Bolivar du Venezuela : <Symphonie fantastique par Gustavo Dudamel>
Et pour finir, parce qu’Annie et moi avions assisté en 2012 à ce concert mémorable à l’Auditorium de Lyon <Le Requiem avec l’Orchestre National de Lyon sous la direction de Leonard Slatkin>
<1208>
-
Jeudi 7 mars 2019
« Nomadland »Jessica BruderNomadland est un livre de Jessica Bruder que présente un article de MEDIAPART : «Nomadland» ou l’Amérique des seniors en quête d’emploi »
Lors du mot du jour du 15 mars 2018, j’avais retranscrit les paroles de Sylviane Agacinski qui est aussi l’épouse de Lionel Jospin: « Cela va de toute façon craquer. Je pense qu’on va aller un jour vers une catastrophe sociale ! »
Et parmi les exemples qu’elle donnait, elle évoquait les « Work campers » aux Etats-Unis qui sont des travailleurs endettés qui vendent leurs maisons et achètent un camping-car. Ces gens vont sillonner l’Amérique avec leur camping-car pour ce que certains vont appeler la mobilité, la fluidité et ils vont d’une ville à l’autre chercher du travail.
Ce sont ces travailleurs dont parle Nomadland.
Les Etats-Unis restent le pays le plus riche du monde, Trump se gargarise même de la croissance que l’économie américaine arrive à dégager, 2,9% en 2018. Mais le système crée de plus en plus de pauvres et de précaires.
L’auteure, Jessica Bruder a été l’invitée d’Olivier Gesbert dans <la Grande Table du 14 février 2019>.
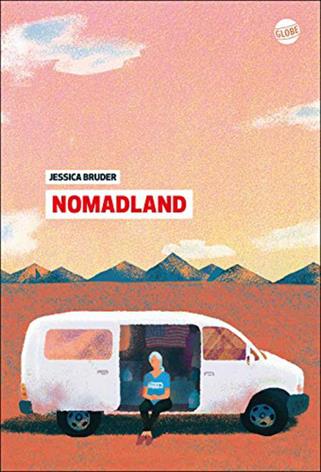 Jessica Bruder est journaliste, professeure de journalisme à la Columbia University, collaboratrice du New York Times.
Jessica Bruder est journaliste, professeure de journalisme à la Columbia University, collaboratrice du New York Times.
Nomadland est une enquête dans la tribu nomade des perdants de la crise des subprimes, riche en rencontres et en expériences itinérantes.
Olivier Gesbert a présenté Nomadland ainsi :
« A la manière d’un manuel de survie transcrivant aussi les histoires personnelles de ces marginaux, immersion dans le monde des quasi-nouvelles classes moyennes, des nomades qui se qualifient eux-mêmes de « sans adresse fixe », et qui, plus nombreux qu’on ne le croit, forment des réseaux de solidarité, trouvent dans la tribu une nouvelle famille, survivent aux difficultés du quotidien et parcourent l’Amérique. […]
Ils ont tout perdu suite à la crise de 2008 : leur maison, leur travail, leur place dans la société. Avec leurs dernières économies, ils ont acquis un Van, une voiture, un camping-car, une maison mobile, et ont pris la route. Véritables migrants dans leur propre pays, en quête de petits boulots intérimaires, des parcs d’attractions aux entrepôts d’Amazon, en passant par la récolte de betterave et l’entretien des campings.»
Jessica Bruder a exprimé la situation par ces mots :
« On peut parler de pauvreté et de minimalisme, de pauvreté et d’anti-consumérisme. […]. Les gens que j’ai rencontrés sur la route voient vraiment ça comme un situation permanente. »
Mais revenons à l’article de Mediapart :
« Ils ont cru qu’ils passeraient leurs vieux jours à siroter un jus de fruit en contemplant leur gazon bien taillé, ils se retrouvent à dormir dans leur van sur un parking de supermarché en attendant l’heure de l’embauche. Nomadland, de Jessica Bruder, est une enquête sur un pan encore méconnu de l’Amérique pauvre, les retraités itinérants à la recherche de jobs saisonniers.
lls préfèrent qu’on les appelle « sans adresse fixe » plutôt que « sans domicile fixe », beaucoup se présentent comme des « retraités » – même s’ils travaillent –, d’autres se définissent comme des « voyageurs », des « clochards de la route », des « gitans », on les appelle aussi les « réfugiés américains », les « tâcherons agricoles des temps modernes ». Ils sont des « travailleurs-campeurs » (« workampers »), des « travailleurs sur roues » (« workers on wheels »).
Nomadland se penche sur une Amérique blanche et déclassée, celle d’hommes et de femmes qui ont pu connaître des vies confortables mais se retrouvent, à l’âge de la retraite, à accumuler les heures dans des emplois physiquement harassants. Ils n’ont plus de maison, ils vivent dans leur van, qu’ils affublent d’un surnom en forme de mauvais calembour, ils forment un nouveau visage de l’Amérique contemporaine, et il faut le lire pour le croire : au début du XXIe siècle, aux États-Unis, une armée croissante de vieux précaires tente de survivre en vendant sa force de travail d’un bout à l’autre du pays. Presque un cinquième des plus de 65 ans, soit 9 millions de personnes, travaillaient en 2016 : même pendant la Grande Dépression, ils n’étaient pas si nombreux.
Un pays riche qui produit des pauvres !
Il faut être mobile, flexible, adaptable et voilà ce que cela donne :
« Ces travailleurs âgés composent une des pièces de la « gig economy », cette économie qu’ont imposée les nouvelles plateformes improprement nommées « collaboratives » : une économie qui nécessite une main-d’œuvre flexible, la moins chère possible, payée à la tâche, ou avec des salaires horaires minimaux. Or ces hommes et ces femmes nés pendant les Trente Glorieuses fournissent une main-d’œuvre qualifiée et consentante, disposée à vaquer au gré d’emplois saisonniers : gardien de parc naturel, ouvrier agricole, vendeur de sapins de Noël, manutentionnaire chez Amazon. »
Jessica Bruder s’est intéressé à une de ces nomades en particulier : Linda
« Ainsi en va-t-il de Linda, qui a connu une vie professionnelle bien remplie : elle a été inspectrice en bâtiment, camionneuse, cigarette girl dans un casino, gérante d’un magasin de moquette, entre autres. Mais à soixante ans, elle se retrouve sans travail ni indemnité chômage, « enchaînant une série de boulots mal payés », vivant dans un mobil-home sans électricité ni eau courante. Bien sûr, à l’âge de la retraite, elle touchera sa pension de la Sécurité sociale, mais il ne s’agira jamais que de 500 dollars, « soit même pas de quoi payer son loyer ».
Linda songe sérieusement au suicide ; elle va préférer une autre voie après avoir découvert un site créé par un ancien magasinier de supermarché, Bob Wells : CheapRVLiving.com (ou « Vivre pour pas cher en camping-car ») : « Imaginez une doctrine anticonsumériste prêchée avec le même zèle que la doctrine de la prospérité : tel était le credo de Bob. Il exhortait à vivre heureux dans la décroissance. Tous ses messages reposaient sur le même postulat : le meilleur moyen de trouver la liberté était de devenir ce que la société appelle communément un SDF. »
À 63 ans, Linda achète une vieille caravane, la retape, et se lance dans sa nouvelle vie nomade. L’auteure de Nomadland, Jessica Bruder, a entrepris de la suivre, elle et tant d’autres qui ont pris la route. Adepte d’un journalisme d’immersion, Jessica Bruder a durant ses deux années d’enquête tâté elle-même des petits boulots destinés à cette population itinérante et vécu épisodiquement dans un van, parcourant plus de quatre-vingt-dix mille kilomètres. »
On en revient aux « raisins de la colère » de Steinbeck ou encore aux photographies de Dorothea Lange, toutes les références de la Grande Dépression.
Mais la journaliste de Mediapart rappelle que nous ne sommes pas dans une période de grande dépression :.
« Après tout, ces « travailleurs-campeurs » sont souvent surnommés les « Okies de la Grande Récession », « allusion aux « Okies de la Grande Dépression », terme péjoratif décrivant les populations rurales de l’Oklahoma chassées sur les routes durant les années 1930 ». L’analogie tombe sous le sens.
Pourtant, il y a quelque chose qui cloche, et même qui déraille furieusement : l’Amérique d’aujourd’hui n’est pas en crise, elle est en pleine croissance économique.
Alors ?
Alors, si les USA constituent la première puissance économique mondiale, ils « affichent le plus fort taux d’inégalités sociales de toutes les nations développées » . Les vieux nomades que rencontre Bruder sont juste la version exotique – parce qu’encore largement méconnue – d’une pauvreté de plus en plus répandue. Certains ont pris de plein fouet la crise de 2008 : surendettés, ils ont dû revendre leur maison à bas prix ou vu leurs économies s’évaporer. Mais cette nouvelle catégorie de vieux travailleurs pauvres n’est pas née d’un accident ; beaucoup subissent les conséquences structurelles de choix politiques, économiques et sociaux : l’augmentation du coût du logement (« les salaires et le coût du logement ont suivi des courbes radicalement opposées ») ; l’abandon d’un système de retraite reposant sur des pensions réglées par les employeurs au profit d’un système par capitalisation, financé par les cotisations des employés. »
Elle s’intéresse particulièrement à Amazon :
L’exploration des conditions de travail dans les entrepôts d’Amazon constitue l’un des aspects majeurs de Nomadland. Ce n’est pas le premier livre sur le sujet, qui rapporte comment les employés parcourent en moyenne 20 km et s’agenouillent mille fois par jour, qu’ils tiennent grâce aux antidouleurs (en distribution libre sur le site) et perdent plusieurs kilos à chaque embauche. Mais Bruder s’intéresse ici au programme d’Amazon spécifiquement dévolu aux travailleurs nomades : CamperForce propose des « contrats à durée très limitée sur des sites logistiques ». Lorsque Bruder se fait elle-même embaucher, elle constate : « La plupart des recrues ont plus de soixante ans. Je suis la seule de moins de cinquante ans, et l’une des trois personnes qui n’a pas les cheveux gris. »
On peut se demander pourquoi Amazon recourt à une population qui n’est pas au meilleur de sa forme physique pour accomplir un travail à forte pénibilité. Les seniors sont plus fiables, ils ont une « meilleure éthique professionnelle que la moyenne », clament de concert les employeurs, et les employés, qui en font une source de fierté. Il y a des explications moins honorables : Amazon bénéficie de crédits d’impôt fédéraux pour l’emploi de travailleurs fragilisés : « Ces crédits d’impôt sont l’unique raison pour laquelle Amazon accepte de s’encombrer d’une main-d’œuvre lente et inefficace, notait ainsi une travailleuse itinérante sur son blog. »
Il paraît qu’il existe des gens qui se plaignent de ce type d’évolution et continue à acheter sur Amazon. Je crois qu’il s’agit de cas accomplis de dissonance cognitive.
Et cette Amérique que rencontre la journaliste est une Amérique blanche. La raison de ce constat nous entraîne encore plus loin dans le désastre moral des Etats-Unis :
« L’Amérique sur roues que rencontre Bruder au cours de son périple est avant tout une Amérique blanche. Elle finit (trop tardivement) par s’en étonner elle-même, pour apporter une explication éclairante – et effrayante : quand on mène une vie nomade, dormant dans son propre véhicule, qu’on peut régulièrement faire l’objet de contrôles policiers, il vaut mieux être blanc. Quand on est noir, c’est-à-dire susceptible de se faire plus facilement tirer dessus par la police ou, à tout le moins, de susciter des contrôles particulièrement méfiants, vivre dans un van est une mise en danger, pas une promesse de liberté et d’indépendance. »
L’article de Mediapart qui renvoie vers beaucoup d’autres articles est très intéressant.
Je pense que ce livre mérite d’être lu.
<Jessica Bruder dispose d’un site personnel>
<1207>
-
Mercredi 6 Mars 2019
« C’est quoi cette idée de mettre des herbicides dans nos culottes ? »Sophia AramPour mot du jour d’aujourd’hui, le coup de gueule salutaire de Sophia Aram lors de sa <chronique du lundi 26 février 2019>
Alors que les femmes utilisent en moyenne 11000 tampons dans leur vie, les fabricants industriels refusent de communiquer sur leur composition.
Et oui c’était la belle époque, à la question, « bonjour mesdames et messieurs les industriels, au fait c’est quoi la composition des tampons que je m’enfile tous les mois depuis des années ?« .
La réponse des industriels était toujours la même :
« on peut pas te le dire, c’est un secret… »
-M’enfin mesdames et messieurs les industriels, ça m’intéresse quand même un peu de savoir ce que vous mettez à l’intérieur de nos tampons, rapport au fait que nous on se les met à l’intérieur du dedans de nous ?
-Non, non, non on ne vous le dit pas c’est une surprise. »
Et quelques années plus tard, nous y voilà enfin !
60 millions de consommateurs dévoile les résultats d’une série d’essais sur les protections féminines, des traces de résidus toxiques, polluants industriels ou pesticides, y ont été détectés
Ah ben la voilà la bonne surprise !!!
En fait on s’enfile du glyphosate dans la teucha !!!
C’est rien que pour nous les filles, c’est cadeau !
Elle n’est pas belle la vie ?!!!
Alors, avant que tous les parangons de la modernité agricole viennent m’expliquer qu’il est tout à fait normal qu’une serviette hygiénique, un kilo de poids chiche ou un baril de Roundup contiennent exactement la même substance à savoir du glyphosate, j’aimerais quand même poser une question…
C’est quoi cette idée de mettre des herbicides dans nos culottes ?
C’est pour tuer les mauvaises herbes ? Ou pour nous éviter de nous retrouver avec une pelouse à la place du pubis ?!!!
Je veux bien que vous confondiez notre « jardin secret » avec un champ de maïs mais y a un moment où il faudra quand même redescendre un peu de la moissonneuse batteuse et discuter risques sanitaires ou tout simplement espérance de vie.
Parce que aussi surprenant que cela puisse paraître, le réceptacle qui entoure le tampon, et que vous avez tendance à considérer comme un hangar à herbicide… ça s’appelle une femme.
Alors, une femme qu’est-ce que c’est ?
C’est un organisme vivant et qui, comme tous les organismes vivants, aspire à le rester le plus longtemps possible, et de préférence en bonne santé… C’est dingue, non ?
Et non, ce n’est pas parce qu’une femme a en moyenne 13 menstruations par an, 480 cycles sur l’ensemble de sa vie et qu’elle utilisera 10560 protections hygiéniques dans sa vie, qu’il faut en profiter pour y écouler vos surplus d’herbicide.
Et ce, pour des milliers de raisons tout à fait compréhensibles par toute personne ne confondant pas une femme avec un hangar agricole.
Alors si on pouvait éviter de nous empoisonner le minou et considérer ensemble que l’on est en droit de savoir exactement qui on invite dans notre culotte et quels seront les effets à courts, moyens et long terme sur notre santé parce qu’à ce jour je ne suis pas certaine que beaucoup de femmes aient consciemment invité Monsanto ou d’autres industriels à venir nous rendre une visite aussi intime. »
Rien à ajouter, sauf à dire que Monsanto est une fiction, comme toutes les autres sociétés ou personnes morales. Derrière Chaque société, il y a des individus, des personnes physiques qui prennent des décisions ou laissent faire. Ce sont eux les responsables.
<1206>
-
Mardi 5 mars 2019
« Mardi gras »C’est aujourd’huiNous sommes donc le jour de mardi gras, demain ce sera mercredi des cendres et commencera la période de carême.
Carême fut l’objet du mot du jour du <29 mars 2018>, il paraît juste de consacrer, une année après, un mot à mardi-gras.
Quand on fait des recherches sur mardi gras, la question qui semble la plus importante est de savoir ce qu’on mange le Mardi Gras ?
La réponse semble : des beignets et des crêpes pour utiliser les aliments « gras » (comme le beurre) qu’on ne pourra plus consommer pendant la période de Carême.
<Voici une recette de beignets de Franche-Comté> mise en ligne hier le 4 mars
A Lyon ce sont les bugnes et <Ce journal prétend disposer de la meilleure recette>
Le site l’Internaute précise que les régions ont chacun leur particularité :
« Chaque région de France a ses beignets. Ainsi à Lyon, on perpétue la tradition des bugnes depuis le XVIe siècle, en Aquitaine, on mange des Merveilles, dans les Vosges on mange des beugnots, et en Provence ce sont des oreillettes… »
Ce site nous permet d’ailleurs d’être plus savant :
« Mardi gras est le dernier jour du Carnaval. Le mot italien provient du latin « carnis levare » (« ôter la viande »). Il fait référence aux derniers repas « gras » pris avant le Carême (on parlait au XVIIIe siècle de « Dimanche gras » ou de « Lundi gras » avant Mardi gras). Autrefois, cette saison correspondait, dans une société encore majoritairement agricole, à l’une des périodes les plus critiques. En effet, en février et en mars, les paysans puisaient dans leurs dernières réserves de nourriture stockées avant ou pendant l’hiver : la facilité à stocker œufs et beurre a favorisé – au même titre que pour la Chandeleur – la tradition consistant à préparer crêpes et gaufres pendant cette période.
Des rituels païens existaient dans la période proche de mardi gras : ils annonçaient ou célébraient la renaissance de la nature (durée du jour en progression, début du dégel, puis premiers bourgeons…). C’est cette réalité qui était traduite dans le calendrier romain, où le jour de l’an était fixé au 1er mars… D’ailleurs, il a fallu attendre le XVIe siècle pour le que jour de l’an soit fixé au 1er janvier ! Avec l’avènement de la chrétienté et la mise en place de la tradition du jeûne du Carême (au IVe siècle), la fête se transforme en période d’exubérance précédant les rigueurs de l’avant-Pâques.
Au Moyen Age, le Carême correspondait à une période des plus contraignantes pour la population, privée de danse, de fête, de nourriture copieuse, de sexe et de plaisir, relevait l’historien des religions Odon Vallet sur France 2 en 2014. Avant que cette période ne commence, la fête du Mardi gras et son carnaval permettaient notamment d’élire un « pape des fous » et d’inverser l’ordre du monde rationnel en même temps que l’ordre social (les riches pouvaient se déguiser en pauvres, les hommes en femmes…).
La dualité de la période est illustrée par le tableau « Le combat de Carnaval et de Carême »de Bruegel (1559). Sur une place marchande se mesurent deux chars. Le premier est paré : un homme ventripotent enjambe un tonneau, entouré de personnages absurdes et de musiciens. Sur l’autre char, une vieille femme, tractée par des moines et des nonnes. Sur une planche en bois, on remarque des poissons, symboles du Carême (période où l’on s’abstient de viande, hors produits de la mer). Côté auberge (Carnaval), on joue au dé et on se gave de gaufres ; côté église (Carême), les personnages voilés se prosternent… »

Et à Périgueux, le journal Sud-Ouest nous apprend que la fête sera celle de « Pétassou » le roi carnaval,
Aujourd’hui il me semble qu’il y a plus de gens qui fêtent mardi gras que de personnes qui suivent la rigueur de carême.
C’est une erreur du point de vue de la santé, jeûner est bien meilleur que faire bombance.
Mardi gras tombe cette année le 5 mars 2019, et les années suivantes ce sera :
-
- Le 25 février 2020
- Le16 février 2021
- Le 1 mars 2022
- Le 25 février 2020
Ce qui signifie qu’en 2021, Pâques tombera très tôt dans l’année…
<1205>
-
-
Lundi 4 mars 2019
« La causalité diabolique »Léon PoliakovJ’avais pensé clore cette série sur l’antisémitisme en parlant de l’État d’Israël, de sa création, de ses relations avec ses voisins, avec les palestiniens, l’Occident, les Etats-Unis, l’Allemagne, la Grande Bretagne, la France et de sa politique actuelle. Mais je ne suis pas encore prêt à écrire sur ce sujet.
Je vais donc finir cette série par un livre, un livre de Léon Poliakov.
J’avais lu son remarquable « Bréviaire de la Haine » qui portait pour sous-titre « Le 3ème Reich et les juifs ».
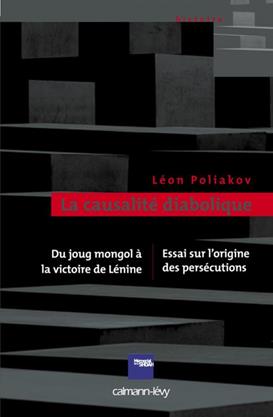 C’est Jean-Louis Bourlanges qui, dans le « Nouvel Esprit Public» de Philippe Meyer qu’il est possible d’écouter en podcast, a parlé de cet autre ouvrage de Poliakov : « La causalité diabolique »
C’est Jean-Louis Bourlanges qui, dans le « Nouvel Esprit Public» de Philippe Meyer qu’il est possible d’écouter en podcast, a parlé de cet autre ouvrage de Poliakov : « La causalité diabolique »
Léon Poliakov est né en 1910 dans une famille de la bourgeoisie juive russe, à Saint Pétersbourg. Son père, propriétaire d’une maison d’édition, a nommé son fils en hommage à Léon Tolstoï, mort quelques jours avant sa naissance. En 1920, la famille émigre en France pour fuir la révolution bolchévique ; le père y fonde une nouvelle maison d’édition qui prospère.
Pendant la seconde guerre mondiale, Léon Poliakov s’engagera dans l’armée française avant de s’engager dans la résistance.
En 1943, il participe à la fondation du « Centre de documentation juive contemporaine » qui se voue à recueillir les preuves documentaires de la Shoah. Il réussit à prendre possession des archives du Commissariat général aux questions juives, des archives de l’ambassade d’Allemagne à Paris, de l’état-major, et surtout du service anti-juif de la Gestapo, ce qui lui vaut, après la victoire alliée, d’assister en tant qu’expert Edgar Faure, le chef de la délégation française au Procès de Nuremberg.
Il est naturalisé français en 1947 et publie en 1951 « le Bréviaire de la haine », dans la collection de Raymond Aron, livre qui sera la première grande étude consacrée à la politique d’extermination des Juifs menée par les nazis.
Il devient par la suite un spécialiste de l’Histoire de l’antisémitisme à laquelle il consacrera la plus grande partie de ses études.
Il meurt en 1997.
Ces précisions biographiques sont issues de Wikipedia.
Le livre « La causalité diabolique » est paru en deux tomes aux éditions Calmann-Lévy, le premier en 1980, le second en 1985. Il est aujourd’hui réédité en seul volume.
Le premier plonge dans les racines du phénomène du bouc émissaire, il a pour sous-titre « Essai sur l’origine des persécutions ». Poliakov étudie bien sûr le destin des juifs dans leur rôle de bouc émissaire dans l’histoire de l’Europe, en tant que fauteurs d’épidémies, de guerres, de révolutions et autres désastres. Mais il étudie aussi d’autres groupes persécutés : Les jésuites et la papauté pendant la Révolution anglaise, la cour et les aristocrates, les francs-maçons et les philosophes lors de la Révolution française.
Le second est consacré à la patrie de ses origines : La Russie du joug mongol à la victoire de Lénine. Il remonte aux origines de l’histoire russe, marquée par une rupture entre le peuple et le pouvoir civil et religieux, et analyse la manière dont cette coupure a pu favoriser au cours des siècles l’idée que le « complot » expliquait tous les conflits. Cette idée connaît son apogée avec d’une part le « complot impérialiste » dénoncé par Lénine et, d’autre part, la « conspiration juive », responsable aux yeux des Blancs de la victoire bolchevique.
L’émission du Nouvel Esprit public évoquée précédemment était celle du 24 février. Elle traitait de deux sujets dont l’un était : <Face à la haine antisémite>
Et selon Jean-Louis Bourlanges, la mondialisation réactive la thèse de Poliakov sur la causalité diabolique : comme on ne comprend rien à ce qui nous arrive, qu’on ne voit pas de responsables, on prend un bouc émissaire. Et les Juifs, à cause du fantasme sur l’argent, du caractère transnational lié à la diaspora, font un bouc émissaire idéal. C’est là que se trouve un lien entre l’antisémitisme traditionnel, qu’on croyait éteint, et quelque chose de plus diffus dont l’extrémisme est l’antisémitisme de l’ultra-islamisme.
Léon Poliakov au début de son ouvrage explique :
« La croyance dans l’action des démons se trouve à la racine de notre concept de causalité. »
Tout récemment le Pape pour expliquer la pédophilie dans l’Eglise Catholique a d’ailleurs évoqué le rôle de Satan, preuve que l’action des démons est encore une réalité pour certains.
Vous pouvez lire la préface de Pierre-André Taguieff à la dernière édition <derrière ce lien> :
« Historien certes, mais aussi anthropologue, et psychologue, et politologue, cet esprit toujours en éveil cherchait dans tout l’espace des sciences sociales et chez les philosophes de quoi éclairer ses recherches et nourrir ses réflexions sur cette « animosité haineuse » à l’égard des Juifs.
[…] Léon Poliakov fut un savant modeste et un penseur exigeant. Un maître aussi, un initiateur, un incitateur, un éveilleur. Avec un intarissable humour, et une ironie légère, qu’il pratiquait d’abord envers lui-même. Cet érudit aux intuitions fortes se montrait soucieux de rester lisible alors même qu’il s’engageait dans des analyses subtiles. […]
Avec la publication, en 1980, du premier tome de La Causalité diabolique, Poliakov s’engage dans un champ de recherches dont l’objet principal est l’étude historique des mythes politiques modernes (parmi lesquels celui du « complot mondial » retient particulièrement son attention), tout en s’interrogeant en anthropologue et en psychologue, voire en philosophe, sur les fondements et les fonctions des croyances aux complots sataniques, croyances dont l’efficacité symbolique est attestée notamment par les dictatures totalitaires du XXe siècle. […]
Pour l’essentiel, ce que Poliakov appelle l’antisémitisme ou, d’une façon moins inappropriée, la judéophobie, renvoyant par là à « toutes les formes d’hostilité envers le groupe minoritaire des Juifs, à travers l’histoire », se réduit à une haine, la haine antijuive. Mais cette haine aux multiples figures ne se réduit pas elle-même aux affects irrationnels d’une passion, d’une quelconque passion négative, d’une « passion malsaine » à laquelle on opposerait paresseusement « la raison », elle se nourrit de représentations, elle est structurée par des mécanismes spécifiques, elle a des conditions historiques et culturelles d’existence (de virtualisation comme d’actualisation), elle paraît être nourrie par des abstractions et régie par des « raisons ».
Raymond Aron a excellemment soulevé la question : « Le phénomène décisif ce sont les haines abstraites, les haines de quelque chose que l’on ne connaît pas et sur quoi on projette toutes les réserves de haine que les hommes semblent porter au fond d’eux-mêmes.»
Les Juifs sont haïs non pas pour ce qu’ils font, ni même pour ce qu’ils sont réellement dans leur diversité, mais pour ce que les judéophobes croient qu’ils sont. Les Juifs sont essentialisés, réinventés comme les représentants d’une entité mythique, à travers un discours judéophobe qui se caractérise par sa longue durée et sa haute intensité. La logique de la haine antijuive est celle de la diabolisation du Juif qui, précise Poliakov, « n’apparaît qu’avec le christianisme », et qu’on « voit poindre dans l’Évangile selon Jean ». Mais les représentations diabolisantes ne sont pas restées confinées dans l’espace théologico-religieux, elles sont entrées en syncrétisme avec les évidences premières du racisme, invention de l’Europe moderne.
C’est pourquoi le discours antijuif porté par une haine idéologisée a semblé même dériver, dans le monde moderne où règne un rationalisme suspicieux, de « la Raison » traitée comme une idole. Les admirateurs inconditionnels de la « philosophie des Lumières », s’ils prennent la peine de lire le troisième tome (« De Voltaire à Wagner ») de l’Histoire de l’antisémitisme, paru en 1968, ne peuvent que nuancer leurs jugements sur des penseurs comme Voltaire ou le baron d’Holbach, qui ont reformulé l’antijudaïsme dans le code culturel « progressiste » de la lutte contre les préjugés et les superstitions […]
Poliakov insistait pédagogiquement sur la distinction analytique entre bestialisation et diabolisation. Si, dans l’Évangile de Jean et l’Apocalypse, les Juifs sont « explicitement « satanisés » », le racisme « ne se développe qu’au début des temps modernes dans la foulée des grandes découvertes et il correspond surtout à une bestialisation ». Les catégorisations négatives de l’altérité oscillent entre l’infériorisation de l’autre qui, animalisé ou bestialisé, devient objet de mépris ou de répulsion (sauvages, barbares, « non évolués », étrangers, « monstres », femmes, etc.), et la démonisation terrifiante de l’autre par son assimilation au diable ou à un démon, objet de crainte et de haine, avec lequel se construit la figure de l’ennemi absolu, contre lequel tout est permis, y compris l’extermination. […]
Poliakov soutient la thèse que, dans la modernité, le destin de la haine antijuive est lié, d’une part, au développement de la science, avec son inévitable rejeton, le « scientisme », puissant mode de légitimation de toute « mise à l’écart » des populations jugées « indésirables », et, d’autre part, à certaines « idées généreuses » qui ont mal tourné, liées au « progressisme » politique, comme en témoigne un certain « antiracisme » contemporain, par lequel se légitime l’antisionisme radical ou absolu, celui qui prône la destruction d’Israël comme « État raciste » tout en procès, de ranimer de sourdes animosités, si même le rappel des torts causés aux Juifs ne contribue pas à entretenir un climat qui un jour pourrait faire surgir, ce qu’à Dieu ne plaise, des menaces nouvelles ?»
<1204>
-
Vendredi 1er mars 2019
« Le sionisme apparaît parce qu’il y a l’antisémitisme »Alain DieckhoffTout le monde l’a compris, et le plus grand nombre est d’accord l’«antisémitisme» est inacceptable, indéfendable, condamnable.
Mais l’«antisionisme» serait acceptable pour certains, alors que d’autres voudraient l’assimiler à de l’antisémitisme.
Il semblerait que dans l’esprit de certains l’«antisionisme» constitue simplement un synonyme de « critique du gouvernement de l’État d’Israël » pour d’autres, plus radicaux « une critique de l’État d’Israël » et dans son stade ultime « la remise en cause de l’existence de l’État d’Israël ».
Mais sait-on bien de quoi on parle ? Parce que pour adhérer à l’antisionisme, il faut comprendre et savoir ce qu’est le « sionisme ».
Albert Camus a écrit : «Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde.»
Dans sionisme, la racine est « Sion »
Et « Sion » est le nom d’une colline de Jérusalem. C’est aussi le symbole de Jérusalem; le symbole du pays des Hébreux, ou du peuple lui-même. Dans le livre d’Isaïe le peuple Hébreux est nommé : « la fille de Sion ».
Mais quand on parle de « sionisme » on parle d’un concept qui a émergé dans la communauté juive ashkénaze, c’est-à-dire les juifs d’Europe.
Il y eut un premier mouvement qui est né en Russie « Les amants de Sion ». Il est fondé en Russie en 1881 par un médecin d’Odessa, Léon Pinsker et Moïse Lilienblum, à la suite de pogroms antisémites en Russie qui découragent la volonté d’assimilation des juifs et engendrent la naissance d’un mouvement populaire, organisé autour de l’idée du « retour vers Sion ». Le Conseil Odessa, créé par les amants de Sion est dissout en 1919 par les Bolchéviques.
Léon Pinsker (1821-1891) développait l’idée de créer un État indépendant pour protéger les juifs, mais pas forcément en Palestine, il envisageait une autre option en Amérique du Nord.
Des projets et idées similaires avaient précédemment déjà été évoqués à titre individuel, par d’autres personnalités juives mais les Amants de Sion sont par contre le premier mouvement populaire de grande envergure à développer l’idée de créer un territoire spécifique pour les juifs, territoire qui ne serait pas forcément un État mais pourrait être une province autonome avec de large prérogative à l’intérieur d’un État.
Au sens stricto le mot « sionisme » semble être apparu pour la première fois en Allemagne. En Allemagne le terme est « Zionismus » et il est utilisé le 16 mai 1890, sous la plume d’un publiciste juif de langue allemande, Nathan Birnbaum (1864-1937). En 1893, Nathan Birnbaum signe un article intitulé « Les principes du sionisme ». Max Bodenheimer publie un texte qui s’ouvre sur ces mots : « Sionistes de tous les pays, unissez-vous ! ».
Mais pour l’Histoire, le « sionisme » c’est Theodor Herzl.
Pour être plus savant je vous donne un lien vers une vidéo dans laquelle : <12 mars 2018, la journaliste Valérie Perez reçoit Denis Charbit> pour parler de Theodor Herzl. Denis Charbit est universitaire à l’Open University de Tel-Aviv et a écrit un livre « Retour à Altneuland: la traversée des utopies sionistes »
Et une émission plus récente de France Culture, le 21 février 2019 : « Antisionisme de quoi parle t’on ». Guillaume Erner avait invité Alain Dieckhoff, directeur de recherche au CNRS.
La première émission parle essentiellement d’Histoire, du sionisme et de Theodor Herzl, la seconde parle d’actualité et d’antisionisme.
Et dans cette seconde émission, Alain Diechkoff dit une chose évidente :
« Le sionisme apparaît parce qu’il y a l’antisémitisme »
C’est cela, la triste réalité historique.
C’est à cause de ces terribles pogroms en Russie et dans les pays slaves qu’a émergé l’idée de la nécessité d’un État protecteur des juifs.
Dans les États de l’Europe de l’ouest, la grande masse des élites juives étaient pour l’assimilation au sein des nations chrétiennes. D’ailleurs dans l’essor de la pensée des lumières beaucoup pensaient qu’à terme les sociétés sortiraient des religions.
Theodor Herzl étaient dans cette logique. Il n’a d’ailleurs pas fait circoncire son fils et Denis Charbit nous apprend qu’il avait eu l’idée de demander au Pape de venir dans une grande cérémonie, convertir, en une fois, des milliers de juifs qui acceptaient de quitter leur religion pour rentrer dans la religion dominante.
Theodor Herzl est né dans l’empire austro hongrois en 1860, dans le quartier juif de Budapest, capitale du Royaume de Hongrie. Wikipedia explique que cette ville abrite une population juive nombreuse, qui représente 20 % de ses habitants, aussi certains nommaient-ils la ville « Judapest ».
Theodor Herzl vit dans une famille bourgeoise germanophone. Son père, issu de l’immigration de la partie orientale de l’empire austro-hongrois, est déjà un partisan de l’assimilation des Juifs au sein de leurs terres d’accueil.
Après des études de Droit, Herzl essaye de devenir dramaturge et commence par écrire des pièces de théâtre, mais pour assurer un salaire régulier il devient journaliste à Vienne.
Il devient par la suite correspondant du journal Die Neue Freie Presse à Paris.
Et Wikipedia nous rapporte qu’en faisant le compte-rendu pour son journal d’une pièce d’Alexandre Dumas fils, « La Femme de Claude », où un certain Daniel encourageait les Juifs à revenir à la terre de leurs ancêtres, il écrit :
« Le bon Juif Daniel veut retrouver sa patrie perdue et réunir à nouveau ses frères dispersés. Mais sincèrement un tel Juif doit savoir qu’il ne rendrait guère service aux siens en leur rendant leur patrie historique. Et si un jour les Juifs y retournaient, ils s’apercevraient dès le lendemain qu’ils n’ont pas grand’chose à mettre en commun. Ils sont enracinés depuis de longs siècles en des patries nouvelles, dénationalisés, différenciés, et le peu de ressemblance qui les distingue encore ne tient qu’à l’oppression que partout ils ont dû subir. »
Pas la moindre de trace de sionisme.
Mais il va aussi couvrir l’affaire Dreyfus.
Lors de cette affaire, dans les articles qu’il écrit il considère comme acquis que le capitaine Dreyfus est coupable de trahison. Un de ses articles commencent par cette phrase : « Mais pourquoi a-t-il trahi ? »
Ce n’est donc pas l’histoire d’une injustice qu’il raconte.
Mais ce qui va le marquer, c’est la réaction d’une foule française qui va crier de manière haineuse « Morts aux juifs ». Non pas mort au capitaine Dreyfus, qui nous le savons aujourd’hui était innocent ce que ne savait pas Herzl à ce moment.
Mais, mort à tous les juifs !
La France était censée être immunisée contre l’antisémitisme. C’était le pays qui, le premier au monde, avait donné une totale égalité civique aux Juifs, en 1791. C’était aussi le pays qui avait donné la nationalité française aux Juifs indigènes d’Algérie en 1871 (décret Crémieux). Elle représentait la modernité occidentale en marche vers plus d’égalité. Que ce pays précisément soit secoué d’une telle haine des juifs, l’ébranle au plus profond de lui-même.
Les juifs seront-ils toujours rejetés ? Toujours haïs ?
Parallèlement, dans son pays l’empereur François-Joseph dans un objectif de démocratisation mesurée décide de permettre des élections locales libres. C’est-à-dire il permet aux habitants de son empire d’élire des bourgmestres de ville. Et la population de Vienne, va librement élire un maire professant essentiellement une idéologie antisémite. C’est un autre coup dur : quand on donne la parole au peuple, il réagit comme antisémite. François Joseph écartera cet élu.
Mais Hertzl va désormais consacrer les 9 années qui lui restent à vivre, il mourra à 44 ans en 1904, à œuvrer à la création d’un État pour les juifs, car il ne croit plus en l’assimilation.
Il pense que si tous les juifs se retrouvent dans un État et quittent les États chrétiens européens, l’antisémitisme disparaîtra. Nous savons depuis que c’est faux, il arrive même que des États sans juifs soient antisémites.
Il semble cependant que si c’est le récit le plus usité, alimenté par Herzl lui-même qui dit que c’est l’affaire Dreyfus qui l’a converti au sionisme, la réalité est peut-être un peu différente. L’affaire Dreyfus a été certainement un « coup de tonnerre » pour Théodore Herzl. Cependant, Claude Klein, dans son ouvrage intitulé Essai sur le sionisme, estime que « la réalité est évidemment bien loin de cette fiction ». Selon ce dernier, la question juive et l’antisémitisme n’ont jamais cessé de hanter Théodore Herzl. Mais c’est bien l’antisémitisme qui a fait le sionisme.
Profondément marqué par la culture européenne il veut créer un État de culture européenne, un État avec tous les bons éléments des États européens mais sans les tares de l’Europe, sans ses déficiences.
Il ne croît pas que dans cet État on puisse parler hébreu, autrement que lors des cérémonies religieuses. Il dit :
« On ne peut même pas acheter un billet de train en hébreux ».
En 1896, il écrit un livre dans lequel il esquisse ce que pourrait être l’Etat juif : « Der Judenstaat. »
Et, en 1897, Herzl réunit à Bâle, avec l’aide de Max Nordau, le premier congrès sioniste. Les assises de l’Organisation sioniste mondiale sont établies et il la présidera jusqu’à sa mort, en 1904.
Il dira : « Ce jour-là j’ai créé l’État des juifs »
Dans son journal au lendemain du congrès de Bâle.
« Aujourd’hui quand je parle d’un État juif on rit de moi, dans 50 ans on me trouvera tout à fait sérieux »
50 ans après, le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations unies vote la création d’un État juif.
Et quand Ben Gourion proclame la naissance de l’État d’Israël, il le fait sous un immense portrait de Theodor Hertzl.

Hertzl a écrit deux livres, le premier « L’État des juifs » déjà cité et un second qui était un roman de fiction qu’il a appelé : « Altneuland » qu’on peut traduire en français par : Le Pays ancien-nouveau
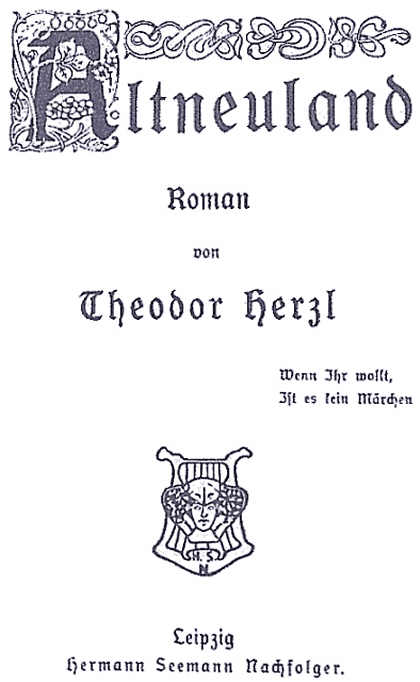 En exergue de ce roman il a écrit :
En exergue de ce roman il a écrit :
« Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve »
Nahum Sokolow (1859-1936) qui fut un de ses successeurs à la tête de l’Organisation Sioniste Mondiale, traduisit ce livre en hébreu sous le titre de « Tel Aviv » (Le Mont du Printemps).
Et quand les juifs de Palestine construisirent la première grande ville d’implantation, ils lui donnèrent le nom de « Tel Aviv »
C’est l’antisémitisme européen qui a conduit à l’émergence du sionisme.
Mais Theodor Hertzl qui voulait : « Pour un peuple sans terre, une terre sans peuple » a conduit à créer un État juif sur une terre qui avait déjà un peuple.
Pourtant d’autres solutions avaient été évoquées :
Celle qui avait été le plus loin est le « Plan Ouganda » :
1903 fut l’année des terribles pogroms de Kichinev. Ceux-ci seront suivis par une série d’autres pogroms jusqu’en 1906. L’émotion dans le monde occidental était grande, tant les pogroms ont été sanglants. Cette émotion est une des raisons pour lesquelles le gouvernement britannique, en particulier Joseph Chamberlain, secrétaire aux colonies propose en 1903 à Theodor Herzl de donner à l’Organisation Sioniste Mondial une partie de l’Ouganda de l’époque (dans l’actuel Kenya), pour y créer un « Foyer national juif ».
Hostile à l’abandon de la Palestine, le sixième congrès sioniste de 1903 se divisa fortement. Une commission est cependant envoyée sur place.
Mais, en 1905, le septième congrès sioniste se tint à Bâle. Il y fut décidé de repousser définitivement la proposition de l’Ouganda, ainsi que toute alternative à la Palestine.
<1203>
-
Jeudi 28 février 2019
« Je suis français »Léon Blum, dans le Populaire du 19 novembre 1938, réponse à toutes les attaques antisémites qui l’accusait d’être contre la France.Léon Blum né le 9 avril 1872 à Paris et mort le 30 mars 1950 à Jouy-en-Josas, est un homme d’État qui a profondément marqué la Gauche, le socialisme et la France.
Il restera dans l’Histoire comme le chef du gouvernement du front populaire en 1936.
Il commença par écrire des critiques de livres et des pièces de théâtre. Il faisait partie du milieu intellectuel de Paris.
Mais l’affaire Dreyfus le pousse à se lancer en politique et il rencontre Jean Jaurès en 1897 avec qui il va participer à la fondation du journal « L’Humanité » en 1904.
Après la guerre, en 1919 Léon Blum accède au cercle dirigeant de la SFIO.
 Il s’illustra lors du fameux congrès de la SFIO de Tours de 1920, ce moment unique où il n’y eut qu’en France, parmi les grands Etats développés qu’il se trouva une majorité de socialistes pour adhérer à la Troisième Internationale , celles des communistes, des bolcheviques, de Lénine. C’est ce qui explique que le journal de Jaurès « L’Humanité » devint communiste, il suivit la majorité.
Il s’illustra lors du fameux congrès de la SFIO de Tours de 1920, ce moment unique où il n’y eut qu’en France, parmi les grands Etats développés qu’il se trouva une majorité de socialistes pour adhérer à la Troisième Internationale , celles des communistes, des bolcheviques, de Lénine. C’est ce qui explique que le journal de Jaurès « L’Humanité » devint communiste, il suivit la majorité.
Blum refusa alors de se plier à la majorité.
Selon des propos relatés par Jean Lacouture dans la biographie consacrée à Léon Blum, celui-ci aurait dit :
« Le bolchevisme s’est détaché du socialisme comme certaines hérésies se sont détachées de religions pour former des religions nouvelles […] C’est parce que le bolchevisme a confondu la prise du pouvoir avec la Révolution, le moyen avec la fin, qu’il oriente toute sa tactique vers cette conquête du pouvoir, sans tenir compte ni du moment, ni des circonstances, ni des conséquences, qu’aujourd’hui encore toute la volonté du gouvernement des Soviets est tendue vers la conservation du pouvoir politique absolu, bien qu’il se sache hors d’état d’en tirer la transformation sociale. »
A la fin du Congrès de Tours, il prononça son discours célèbre dont la conclusion fut :
« Nous sommes convaincus, jusqu’au fond de nous-mêmes, que, pendant que vous irez courir l’aventure, il faut que quelqu’un reste garder la vieille maison. […] Dans cette heure qui, pour nous tous, est une heure d’anxiété tragique, n’ajoutons pas encore cela à notre douleur et à nos craintes. Sachons nous abstenir des mots qui blessent, qui déchirent, des actes qui lèsent, de tout ce qui serait déchirement fratricide. Je vous dis cela parce que c’est sans doute la dernière fois que je m’adresse à beaucoup d’entre vous et parce qu’il faut pourtant que cela soit dit. Les uns et les autres, même séparés, restons des socialistes ; malgré tout, restons des frères qu’aura séparés une querelle cruelle, mais une querelle de famille, et qu’un foyer commun pourra encore réunir. »
Jusqu’à aujourd’hui les deux parties de la famille ne surent se réconcilier. Ils sont en train de disparaître tous les deux, de manière séparée.
Blum fut un grand homme politique, clair, éloquent, humaniste, supérieurement intelligent, visionnaire sur certains points.
Il était juif, le premier chef de gouvernement juif que la France s’est donnée.
Il faut être juste sur ce point, comme sur les autres conquêtes des droits de l’homme, la Grande Bretagne nous a toujours devancé. Le 27 février 1868, soit près de 70 ans avant, un juif devint Premier Ministre à Londres, Benjamin Disraeli.
Blum fut la proie de l’antisémitisme le plus abject : « l’Obs » a consacré un article à cette haine qui lui fut constamment jetée : « A mort le juif ! »
L’Obs raconte d’abord l’agression du 13 février 1936 :
« Ce 13 février 1936, Léon Blum, alors député SFIO (qui deviendra le Parti socialiste en 1969) sort de la chambre des députés en voiture. Il est bloqué au niveau du croisement de la rue de l’Université et du boulevard Saint-Germain. Un groupe d’étudiants et de militants royalistes sont venus assister aux obsèques de l’historien Jacques Bainville, proche collaborateur de Charles Maurras, ennemi juré de Blum et patron du journal d’ultradroite » ils bloquent la voiture, tandis que les insultes fusent. « On va le pendre ! » ; « Blum assassin ! » »
La foule – plusieurs centaines de personnes selon la police – commence à s’énerver. Une dizaine d’individus s’acharnent sur le véhicule. Ils tapent avec leurs poings, avec des cannes. Un homme saisit une rampe d’éclairage, tape sur la vitre qui vole en éclat. Blum est blessé. Avec le couple d’amis qui l’accompagnent, il se réfugie en hâte dans un immeuble tandis que la foule continue à gronder : « Achevez-le ! » »
Il rapporte des écrits du journal de Maurras « l’Action française » :
« Ce juif allemand naturalisé ou fils de naturalisé, qui disait aux Français, en pleine chambre, qu’il les haïssait, n’est pas à traiter comme une personne naturelle. C’est un monstre de la République démocratique. Détritus humain, à traiter comme tel. […] C’est un homme à fusiller, mais dans le dos. »
Et quand un journal conservateur « Le Journal » cherche à jouer de la modération, il s’empresse d’ajouter
« Assez de ces incidents. Mais assez aussi de ces provocations. […] Si nous regrettons que le député de Narbonne ait été malmené, nous espérons qu’il comprendra mieux désormais le danger d’un appel à la force brutale pour mater ceux qui pensent autrement que lui. »
Toujours cette accusation que le juif l’a bien cherché.
Quand en Mai 1936 : le Front populaire gagne le second tour des législatives, Charles Maurras écrira :
« Chacun prendra conscience du bon moyen de défendre sa vie du sacrificateur juif : le couteau de cuisine. […]
Le jour de l’invasion, il restera toujours en France quelques bons couteaux de cuisine et Monsieur Blum en sera le ressortissant numéro 1. . […]
Juif d’abord ! C’est en tant que juif qu’il faut voir, concevoir, entendre, combattre et abattre le Blum. […] Si, par chance, un Etat régulier a pu être substitué au démocratique couteau de cuisine, il conviendra que M. Blum soit guillotiné dans le rite des parricides : un voile noir tendu sur ses traits de chameau. »
Des insultes et toujours ces accusations de ne pas être français.
Léon Blum se résout à répondre, dans son journal, « Le Populaire », le 19 novembre 1938 avec une tribune : « Je suis français »
« Sous la signature d’un homme que je ne veux pas nommer, la feuille infâme reprend avec une assurance effrontée une histoire qui courait déjà depuis longtemps dans la basse presse d’échos et dans les feuilles de chantage. Elle assure que le nom que je porte n’est pas le mien, que je ne suis pas né en France, mais en Bulgarie.
« Cette légende n’a pas encore pris dans le public la même consistance que celle de mes maisons suisses, de mes châteaux français, de mon hôtel parisien, de ma vaisselle plate et de mes laquais en culotte courte. Avec un peu de ténacité et de patience, la feuille infâme en viendra sans doute à bout ! »
« Je suis né à Paris le 9 avril 1872, français, de parents français. Ma maison natale, 151 rue Saint-Denis, existe encore et chacun peut voir en passant la façade étroite et pauvre. […]
« Aussi loin qu’il soit possible de remonter dans l’histoire d’une famille plus que modeste, mon ascendance est purement française. Depuis que les juifs français possèdent un état civil, mes ancêtres paternels ont porté le nom que je porte aujourd’hui. »
Tous ces faits sont aisés à démontrer […] La feuille infâme a entrepris sa campagne sans se soucier un instant d’éclaircir si son accusation était vraie […] Tout cela sera colporté par la médisance ou la haine comme l’histoire de mes châteaux et de mes laquais. Des gens honnêtes et de bonne foi se diront à nouveau ‘Tout de même, il y a forcément quelque chose de vrai. Pas de fumée sans feu’. Et le mensonge aura pris un beau jour. […] Il en sera ainsi jusqu’au jour où la loi permettra enfin de prendre à la gorge la feuille infâme et son pitre obèse […] de les châtier quand ils ont menti ou quand ils ont assassiné. »
Voilà ce qu’était l’antisémitisme d’avant-guerre.
Antisémitisme qui n’était plus possible depuis la shoah. C’est ce que l’on croyait.
La perte de mémoire étant passée par là, les réseaux sociaux ayant libéré la parole, de tels propos sont à nouveau présents dans la société française.
Et c’est tragique…
<1200>
-
Mercredi 27 février 2019
«Quand vous entendez dire du mal du juif, tendez l’oreille, on parle de vous !»Frantz FanonC’est dans l’article du journal <Le Monde> cité hier que Delphine Horvilleur a écrit :
« Cette haine qui veut « faire la peau » même aux morts raconte qu’elle ne s’arrêtera pas aux juifs qu’elle vise toujours d’abord.
Elle agit, comme toujours, en précurseur d’une haine généralisée, qui frappe le juif sous la forme d’une répétition générale.
« Quand vous entendez dire du mal du juif, disait Frantz Fanon, tendez l’oreille, on parle de vous ! » »
Par hasard, j’ai lu un autre article dans <Libération> parlant de Frantz Fanon :
« Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a décidé de «surseoir» à la proposition de nommer une ruelle d’un des nouveaux quartiers de la ville du nom de Frantz Fanon (grande figure anticolonialiste). «Aujourd’hui, le choix du nom de Frantz Fanon suscite des incompréhensions, des polémiques, des oppositions que je peux comprendre. Dans un souci d’apaisement, j’ai donc décidé de surseoir à cette proposition», »
Frantz Fanon est mort à 36 ans d’une leucémie. Mais dans son existence brève il fut psychiatre, écrivain et une figure emblématique du tiers-mondisme .
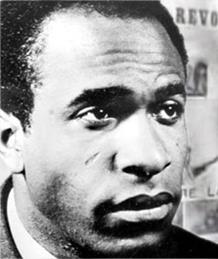 Je tire de ce site : <Ile en ile> des éléments de biographie :
Je tire de ce site : <Ile en ile> des éléments de biographie :
Il est né en 1925 à Fort-de-France en Martinique. Il reçoit son éducation secondaire au lycée Schoelcher où Aimé Césaire l’influencera. Fanon deviendra un penseur-phare du Tiers-mondialisme et de l’anti-colonialisme.
En 1943, Fanon rejoint les forces françaises libres à la Dominique. Luttant côte à côte avec les « tirailleurs sénégalais », il est décidé à libérer la mère-patrie du nazisme. À ses amis qui lui disent que cette guerre n’est pas la leur, Fanon répond :
« Chaque fois que la dignité et la liberté de l’homme sont en question, nous sommes concernés, Blancs, Noirs ou Jaunes, et chaque fois qu’elles seront menacées en quelque lieu que ce soit, je m’engagerai sans retour ».
Son idéalisme prend alors une tournure marquante car la seconde guerre mondiale révèle au descendant d’esclaves que la France qui leur avait inculqué un sens du patriotisme tricolore, avait également instillé dans l’esprit martiniquais et guadeloupéen un complexe de supériorité par rapport aux Africains. La condescendance pour d’autres frères soldats d’Afrique, la différenciation sentie chaque jour entre troupes françaises et celles des colonies, la hiérarchie dans l’armée et les administrations mettent Fanon mal à l’aise. Ces années de guerre l’engageront sur la double piste d’une libération mentale et physique.
Fanon entame des études de médecine à Lyon, loin de Paris, parce que, plaisantait-il, « il y a trop de nègres à Paris » .
La médecine – aussi bien que des cours de philosophie et de psychiatrie – lui permet de voir plus clair dans le processus complexe de la colonisation et dans la désubjectivation du colonisé. La médecine est une porte qui conduit Fanon vers la psychologie en milieu colonial, c’est-à-dire une branche de la psychologie qui prend en compte l’univers de la violence et l’aliénation du colonisé. […] En Algérie, Fanon fera adapter de nouvelles structures, la sociothérapie (la guérison par des pratiques sociales) et l’ergothérapie (la guérison par la pratique de métiers) et introduira des données spécifiquement « postcoloniales ». Préoccupé par le racisme qu’il affronte dans la vie quotidienne, il publie « Peau noire, masques blancs » en 1952, sa thèse de doctorat en psychiatrie.
[…]
Responsable de l’hôpital psychiatrique à Blida de 1953 jusqu’à 1956, Fanon soigne de jour les blessés parmi les soldats français, de nuit plutôt les victimes de l’oppression coloniale. Il s’engage dans le politique car, comme il l’écrira dans sa lettre de démission, il y a un lien entre la psychose et l’aliénation colonialiste :
« La folie est l’un des moyens de l’homme de perdre sa liberté. […] Si la psychiatrie est une technique médicale qui se propose de permettre à l’homme de ne plus être étranger à son environnement, je me dois d’affirmer que l’Arabe, aliéné permanent dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue ».
Deux ans après le déclenchement de la guerre de libération, Fanon démissionne de son poste à Blida.
Il sera expulsé d’Algérie en 1957 par les autorités françaises et s’installera à Tunis, où il rejoint le Gouvernement provisoire de la République algérienne. Il devient membre de rédaction d’El Moudjahid, organe important du FLN (le Front de libération nationale) et en 1959, fait partie de la délégation algérienne au Congrès pan-africain d’Accra. En mars 1960, Fanon est nommé ambassadeur de l’Algérie au Ghana et assume un rôle diplomatique. Il publie « L’An V de la révolution algérienne » en 1959 et « Les Damnés de la terre » en 1961.
<Wikipedia> lui consacre un long article.
Il est notamment question d’une rencontre mémorable avec Jean-Paul Sartre :
« Dès ses premiers écrits, Fanon ne cesse de se référer au philosophe Jean-Paul Sartre (notamment à Réflexions sur la question juive, Orphée noir, et L’Être et le Néant). À la publication de la Critique de la raison dialectique (1960), il se fait envoyer une copie de l’ouvrage et il parvient à le lire malgré son état de faiblesse provoqué par sa leucémie. Il fait même une conférence sur la Critique de la raison dialectique aux combattants algériens de l’Armée de libération nationale.
C’est en 1960 qu’il demande à Claude Lanzmann et Marcel Péju, venus à Tunis pour parler au dirigeant du GPRA, de rencontrer le philosophe. Il veut également que Sartre préface son dernier ouvrage, Les Damnés de la Terre. Ainsi écrit-il à l’éditeur François Maspéro : « Demandez à Sartre de me préfacer. Dites-lui que chaque fois que je me mets à ma table, je pense à lui »15.
La rencontre a lieu à Rome, pendant l’été 1961. Sartre interrompt son strict régime de travail pour passer trois jours entiers à parler avec Fanon. Comme le raconte Claude Lanzmann, « pendant trois jours, Sartre n’a pas travaillé. Nous avons écouté Fanon pendant trois jours. […] Ce furent trois journées éreintantes, physiquement et émotionnellement. Je n’ai jamais vu Sartre aussi séduit et bouleversé par un homme ». L’admiration est réciproque, comme le rapporte Simone de Beauvoir : « Fanon avait énormément de choses à dire à Sartre et de questions à lui poser. « Je paierais vingt mille francs par jour pour parler avec Sartre du matin au soir pendant quinze jours », dit-il en riant à Lanzmann » ».
Atteint d’une leucémie, il se fait soigner à Moscou, puis, en octobre 1961, à Bethesda près de Washington, où il meurt le 6 décembre 1961 à l’âge de 36 ans, quelques mois avant l’indépendance algérienne, sous le nom d’Ibrahim Omar Fanon. Dans une lettre laissée à ses amis, il demandera à être inhumé en Algérie. Son corps est transféré à Tunis, et sera transporté par une délégation du GPRA à la frontière. Son corps sera inhumé par Chadli Bendjedid, futur président algérien, dans le cimetière de Sifana près de Sidi Trad, du côté algérien. Avec lui, sont inhumés trois de ses ouvrages : Peau noire et masques blancs, La cinquième année de la révolution algérienne et Les Damnés de la terre. Sa dépouille sera transférée en 1965, et inhumée au cimetière des « Chouhadas » (cimetière des martyrs de la guerre) près de la frontière algéro-tunisienne, dans la commune d’Aïn Kerma (wilaya d’El-Tarf).
On apprend qu’il a eu deux enfants, un garçon et une fille Mireille, qui épousera Bernard Mendès France, fils de Pierre Mendès France.
Wikipedia parle de : « L’amnésie française et la reconnaissance tardive »
« Selon sa biographe, Alice Cherki, Fanon devient en France, « le pays pour lequel la guerre d’Algérie n’a pas eu lieu », « un philosophe maudit ». Il est occulté pour sa condamnation radicale du colonialisme français : « En redonnant à la colonie son rôle dans la construction de la nation, de l’identité nationale et de la république française, Fanon fait apparaître comment la notion de « race » n’est pas extérieure au corps républicain et comment elle le hante ». En dévoilant le clivage racial au fondement du système colonial, Fanon gêne le républicanisme d’une France qui se dit indifférente aux différences mais qui, dans son propre empire colonial, a dénié des droits à des populations au motif de leur « race » dite inférieure.
La reconnaissance de Frantz Fanon en France fut tardive. Fort de France possède désormais une avenue à son nom bien que la proposition qu’en avait faite son maire, Aimé Césaire, en 1965 eût été rejetée pendant des années. Il faut attendre 1982 pour que s’organise, sous l’impulsion de Marcel Manville, un mémorial international (colloque) en son honneur en Martinique. Peu à peu, plusieurs hommages lui sont rendus dans son île natale. Le lycée de La Trinité est baptisé en son honneur, la ville de Rivière-Pilote lui consacre une avenue et une bibliothèque. En France métropolitaine toutefois, s’il existe de nombreuses rues portant ce nom, David Macey signale n’avoir trouvé aucune avenue Frantz Fanon. En Algérie, dès 1963, une avenue Frantz Fanon est inaugurée à Alger. La reconnaissance dépasse désormais ces deux pays et la mémoire de Frantz Fanon est honorée dans de nombreux pays (Italie, Nigeria, États-Unis) où des centres de recherche ont été baptisés à sa mémoire. »
Une personnalité pleine de profondeur, d’intelligence et d’humanité. Et c’est un homme qui a compris que dans une société lorsqu’on commençait à se prendre aux juifs, les autres minorités devaient se méfier car cette société était en train de se déliter et d’entrer dans des heures sombres. C’est une autre façon de parler du canari des mineurs évoqué par Delphine Horvilleur.
Un chroniqueur du Monde Afrique, Abdourahman Waberi, lui a consacré un article, en février 2017, « Frantz Fanon, toujours vivant »
<1199>
-
Mardi 26 février 2019
« Réflexions sur la question antisémite »Delphine HorvilleurMais d’où vient cette haine des juifs ?
Juste à la sortie de la dernière guerre, en 1946, après le génocide, Jean-Paul Sartre publia un essai « Réflexions sur la question juive ».
Ce livre se trouve en bonne place dans ma bibliothèque, au même titre que « Réflexions sur les questions juives » d’Annie Kriegel ou encore « Sémites et antisémites » de Bernard Lewis.
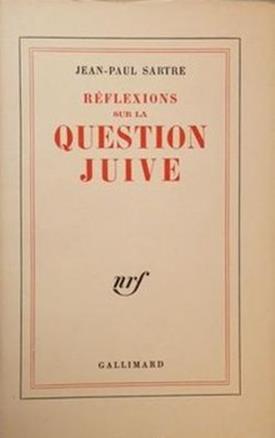 « Réflexions sur la question juive » de Sartre commence ainsi :
« Réflexions sur la question juive » de Sartre commence ainsi :
«Si un homme attribue tout ou partie des malheurs du pays et de ses propres malheurs à la présence d’éléments juifs dans la communauté, s’il propose de remédier à cet état de choses en privant les juifs de certains de leurs droits ou en les écartant de certaines fonctions économiques et sociales ou en les expulsant du territoire ou en les exterminant tous, on dit qu’il a des opinions antisémites. Ce mot d’opinion fait rêver…
C’est celui qu’emploie la maîtresse de maison pour mettre fin à une discussion qui risque de s’envenimer. Il suggère que tous les avis sont équivalents, il rassure et donne aux pensées une physionomie inoffensive en les assimilant à des goûts.
Tous les goûts sont dans la nature, toutes les opinions sont permises ; des goûts, des couleurs, des opinions il ne faut pas discuter.
Au nom des institutions démocratiques, au nom de la liberté d’opinion, l’antisémite réclame le droit de prêcher partout la croisade anti-juive. »
Pour Jean-Paul Sartre, c’est l’antisémite qui fait le juif, c’est le regard d’autrui qui fait du Juif, un Juif. Selon Sartre, pour mettre un terme à l’antisémitisme ce n’était pas le Juif qu’il fallait changer mais l’antisémite. Sartre estimait qu’il y a un antisémitisme latent même chez les esprits qui se veulent ouverts.
Cette thèse a été souvent décriée comme le rapporte cet article de Mediapart <Réflexions sur les Réflexions sur la Question Juive de Sartre> parce que
« Réflexions sur la Question Juive » est un essai publié en 1946 par Jean-Paul Sartre qui a souvent été décrié dans des milieux juifs parce que ceux-ci et manquait de profondeur. »
Pourtant la lecture de Raymond Aron m’avait conforté dans cette thèse de son ancien condisciple de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm.
En 1928, Aron est reçu premier à l’agrégation de philosophie. Et il se rend à partir de 1930 en Allemagne où il étudie un an à l’université de Cologne, puis de 1931 à 1933 à Berlin, où il est pensionnaire de l’Institut français et fréquente l’université de Berlin. Il observe alors la montée du totalitarisme nazi.
Dans son livre : « Le spectateur engagé » il raconte (page 34) :
« Quand je suis arrivé en Allemagne, j’étais juif et je le savais mais, si j’ose dire, je le savais très peu. Ma conscience de ma judéité, comme on dit maintenant, était extraordinairement faible. Je n’avais jamais été, dans une synagogue ou presque. […] en dehors du nationalisme qui était partagé par d’autres partis, [le nazisme] était singularisé par l’excès de l’antisémitisme, de telle sorte qu’à partir de cette année-là, 1930, je me suis toujours présenté d’abord comme juif. »
Il a aussi raconté un autre épisode vécu en Allemagne à cette époque. Il faut savoir qu’il était blond aux yeux bleus et ne correspondait pas à l’image que ce faisait beaucoup des pseudo-caractéristiques physiques des juifs. Il était logé par une femme allemande qui était très influencé par les discours nazis. Et un jour qu’elle avait encore dit tout le mal qu’elle pensait des juifs, Raymond Aron lui demanda si elle était vraiment sûre que les juifs étaient si terribles qu’elle les décrivait. Et elle lui répondit : qu’il était un brave garçon et qu’il ne les connaissait pas et ne pouvait donc pas s’imaginer de quoi « ils » étaient capable. Si l’époque n’avait pas été aussi tragique, cette histoire pourrait être drôle.
C’est en référence au livre de Sartre que la rabbin libérale Delphine Horvilleur a nommé son dernier livre sur la haine des juifs : <Réflexions sur la question antisémite>
Je trouve Delphine Horvilleur, l’une des trois femmes rabbins de France, absolument remarquable pour son ouverture d’esprit à l’égard des autres pensées et religions, pour son ouverture aussi sur les questions de sexualité sans tabou, de la féminité. Elle interroge les religions et la sienne sur ces sujets.
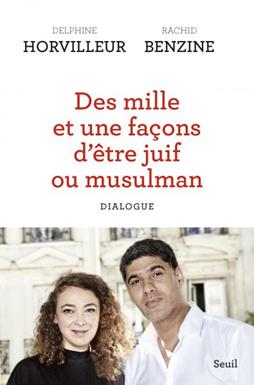
Elle a notamment écrit avec l’islamologue Rachid Benzine un livre de dialogue : « Il y a mille et une façons d’être juif ou musulman »
Rachid Benzine est l’auteur du livre « Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? », dont j’avais tiré une phrase plusieurs fois répétée et inspirante :
« Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes.»
Il avait également écrit en 1998 avec le père Christian Delorme, dans le cadre d’un dialogue islamo-catholique aux Minguettes, dans la banlieue de Lyon, un livre : Nous avons tant de choses à nous dire,
Delphine Horvilleur et Rachid Benzine présentent ainsi leur livre commun :
« Nous avons tous deux compris que la Bible et le Coran n’étaient pas étrangers l’un à l’autre. Et tous deux nous revendiquons la liberté de la recherche et de la parole religieuses : une liberté responsable, qui prend en charge les questions et affronte les conflits.
Or, de nos jours, partout des fondamentalismes et des mouvements identitaires se prévalent de traditions anciennes qu’ils croient pouvoir faire remonter aux origines de leur foi.
Nous en sommes convaincus : être « héritier » ne consiste pas à mettre ce qui a été reçu dans un coffre fermé à clé, mais à le faire fructifier. Cela ne consiste pas à reproduire à l’identique ce qui a été reçu, mais à le renouveler.
Nous espérons que notre parole libre et résolument fraternelle fera surgir beaucoup d’autres paroles libres et fraternelles ! »
Pour parler de <Réflexions sur la question antisémite>, Delphine Horvilleur avait été invitée par Alexandra Bensaid sur France Inter <vendredi 4 janvier 2019>
Dans cette émission, elle a dit fort justement que
« L’antisémitisme n’est pas le problème des juifs mais d’une nation. […] le marqueur d’une nation en faillite, comme le rôle du canari dans la mine »
On sait, en effet, qu’avant les techniques modernes capables de détecter la présence de gaz, les mineurs avaient recours au canari sensible aux émanations de gaz. Lorsque le canari s’agitait ou mourait, le mineur savait qu’il fallait remonter rapidement vers la surface !
« PHILOSOPHIE MAGAZINE » explique que pour Delphine Horvilleur
Il n’y a pas de question juive, il n’y a qu’une question antisémite. Elle reprend quelque peu la réflexion de Jean-Paul Sartre que c’est le regard de l’autre qui fabrique le Juif. Mais son point de vue essentiel n’est pas d’approfondir la manière dont l’antisémite « fait » le Juif, mais plutôt de s’intéresser à savoir comment le Juif voit l’antisémite, comment la conscience juive vit avec ce qui veut sa perte. Il s’agit donc plutôt de « réflexions juives sur la question antisémite » conclut le magazine.
Delphine Horvilleur distingue, selon moi avec beaucoup de pertinence le racisme et l’antisémitisme.
« Le racisme est un mépris, l’antisémitisme est une jalousie, le premier s’exprime de haut, le second d’en bas ou de côté, l’un est un rejet du barbare, l’autre une « rivalité familiale ». La différence de couleur de peau ou de culture est vue comme « quelque chose en moins », que l’autre n’a pas pour être « comme nous » ; au Juif, on reproche au contraire d’avoir « quelque chose en plus », sans doute usurpé, qu’il accaparerait en en lésant le monde commun. Même pauvre, discriminé, victime du pire, il est encore « trop » : « littéralement, il m’excède »
Par la haine des Juifs, l’antisémite leur reproche tout et son contraire et échappe à toute logique.
Delphine Horvilleur écrit qu’« il est peut-être vain et immoral de lui chercher des modalités explicatives, ou d’analyser le raisonnement de ses agents. Inutile, à moins d’interroger ce que le haineux exècre exactement à travers le Juif, et de quoi sa détestation est le nom ».
Quand on se rappelle des perversions politiques du XXème siècle, on se souvient qu’on reprochait aux juifs d’avoir amené le communisme et les communistes accusaient les juifs de soutenir les banques et les puissances de l’argent. Les régimes soviétiques ont aussi persécutés les juifs.
Et je cite encore Philosophie magazine :
« La haine du Juif s’accroche à la permanence de plusieurs thèmes. Retenons-en un, qui tient à cœur à la première rabbin femme de France : la misogynie. Que ce soit par la métaphore de l’ulcère (le trou) ou celle de la coupure (la circoncision), par lesquelles il est décrit, le Juif représente le féminin qui angoisse la virilité des hommes. »
Et elle fait le tour des héros juifs face aux fantasmes de puissance :
- Jacob, le doux, l’imberbe, est préféré à Esaü, le fort, le poilu, pour conduire le peuple d’Israël ;
- les héros juifs sont boiteux (Jacob),
- aveugles (Isaac),
- bègues (Moïse),
- stériles (Abraham).
Elle a raison, cette galerie des héros juifs est une collection d’anti-héros auxquel il manque toujours quelque chose. Ils ne sont jamais des symboles de virilité.
« LE MONDE DES RELIGIONS » approfondit l’explication psychanalytique ainsi qu’une montée de haine venue de minorités contre une autre minorité : <Le juif renvoie l’antisémite à sa peur de la castration>
Et l’autre piste que suit la rabbin est celle de la menace que fantasme l’antisémite que « les juifs » empêchent un groupe, une nation d’être un tout homogène.
Dès lors, ce que hait l’antisémite est ce « pas-tout » qui empêche le groupe, ou la nation, ou l’Empire, de faire bloc, de se penser comme total, Un, pur. L’antisémitisme est la logique mortifère selon laquelle «pour que le monde soit en paix, il faudrait se débarrasser de ce qui divise, et que le juif incarne». C’est la crainte que le Tout (religion universelle, nation) auquel les antisémites veulent appartenir soit menacé dans son intégrité. C’est une angoisse identitaire dont rien n’indique qu’elle ait cessé d’être actuelle.
Le journal « LIBERATION » a également consacré une interview à Delphine Horvilleur sur son livre : «L’antisémitisme n’est jamais une haine isolée, mais le premier symptôme d’un effondrement à venir»
J’en tire les extraits suivants :
Quand avez-vous commencé à vous intéresser à l’antisémitisme ?
« L’antisémitisme hantait mon histoire familiale mais j’ai longtemps pensé que ma génération en serait protégée. En mai 1990, il y a une bascule au moment de la profanation du cimetière de Carpentras. Je repense souvent à la manifestation nationale que Carpentras a suscitée. Près de trente ans plus tard, lorsque des stèles juives sont profanées, comme ce fut le cas il y a moins d’un mois près de Strasbourg, personne ou presque ne le mentionne. Quelque chose d’absolument anormal est aujourd’hui tombée dans la banalité. Mon besoin d’écrire sur l’antisémitisme est lié à son regain, mais pas uniquement. Penser le judaïsme pousse nécessairement à s’interroger sur les origines de la haine antijuive à travers l’histoire, même si je ne crois pas – et c’est pour cela qu’il m’importait de détourner le titre de l’essai de Jean-Paul Sartre – que ce soit l’antisémite qui fasse le juif. »
Quel est le ressort de ce regain ?
« L’antisémitisme n’est jamais une haine isolée, mais le premier symptôme d’un effondrement à venir. Il est bien souvent la première exposition d’une faille plus large, mais il est rarement interprété comme annonciateur au moment où il frappe. Les attentats de novembre 2015 suivent de quelques mois la prise d’otages à l’Hyper Cacher de Vincennes et de quelques années la tuerie à l’école juive de Toulouse. Mais, évidemment, en 2012, personne ne peut le formuler ainsi. Depuis cette date, une question me hante : pourquoi, lorsque furent assassinés des enfants dans une école, la France n’était-elle pas dans la rue ? Etait-elle anesthésiée, aveuglée ou indifférente ? Cet attentat donne alors lieu à des
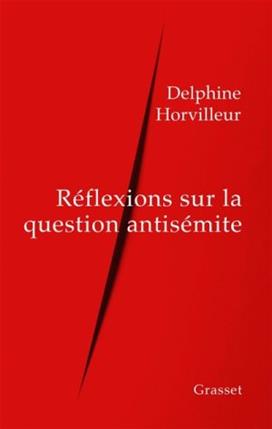 discours incroyablement déplacés : on évoquait l’importation supposée du conflit moyen-oriental ou des «tensions intercommunautaires» pour masquer l’horreur. L’absence de réaction collective reste une énigme insurmontable. »
discours incroyablement déplacés : on évoquait l’importation supposée du conflit moyen-oriental ou des «tensions intercommunautaires» pour masquer l’horreur. L’absence de réaction collective reste une énigme insurmontable. »
En quoi l’antisémitisme est-il différent du racisme ?
« On entretient une confusion en associant racisme et antisémitisme et à moins d’entrer dans une compétition victimaire, il ne s’agit pas de dire que l’un est plus grave que l’autre. Le racisme est souvent affaire de complexe de supériorité : je posséderais quelque chose qu’un autre n’a pas ou moins que moi. L’antisémitisme, au contraire, se construit sur une forme d’infériorité ressentie. On reproche aux juifs d’être plus ou d’avoir plus. Le juif est toujours accusé d’avoir un peu trop de pouvoir, ou bien d’être trop proche du pouvoir – on l’a entendu ici et là dans des slogans antisémites scandés en marge des manifestations des gilets jaunes. On soupçonne les juifs d’avoir un peu trop le contrôle, l’argent, la force et la baraka. Il y a toujours l’idée que le juif est là où je devrais être, qu’il a ce que je devrais avoir, qu’il est ce que je pourrais devenir. Peu importe que cela soit un fantasme. Peu importe qu’on puisse démontrer qu’il y a des juifs pauvres, qui n’ont ni influence ni pouvoir. Rien ne pourra ébranler cette conviction délirante, qui permet à certains de colmater les fêlures de leur existence. Dans tous les discours antisémites à travers les siècles, le juif représente la porosité ou la coupure qui empêche de se sentir en complétude. Quand un groupe ou une nation se perçoit en faillite, l’antisémitisme est l’énoncé le plus classique de sa tentative de reconstruction. C’est une consolidation identitaire qui se fait sur le dos d’un autre. »
Mais n’existe-t-il pas un communautarisme juif tout aussi clos sur lui-même ?
« Le communautarisme touche aujourd’hui tout le monde, et les juifs n’y échappent pas. La menace qui pèse sur un groupe dont les lieux de culte et les écoles doivent être protégés n’est pas de nature à inviter à ce que les portes s’ouvrent. Toutefois, il importe de ne pas renverser les responsabilités : ce repli n’est pas la cause de l’antisémitisme. De façon troublante, ce sont lors des moments dans l’Histoire où les juifs ont été les plus assimilés que l’antisémitisme a été le plus virulent. Ce fut le cas en Allemagne au début du siècle dernier. »
Il s’agit d’un article assez long écrit par la journaliste de Libération, Anne Diatkine et qui aborde de manière approfondie les questions sur l’identité juive tout en affirmant qu’elle est difficile à cerner.
Pour écrire ce mot du jour, je me suis encore inspiré des articles suivants :
De Médiapart : «L’antisémite à travers les siècles est toujours un intégriste»
L’Obs : « Qu’est-ce que l’antisémitisme »
<1198>
- Jacob, le doux, l’imberbe, est préféré à Esaü, le fort, le poilu, pour conduire le peuple d’Israël ;
-
Lundi 25 février 2019
« La haine des juifs »Réflexions sur une abomination qui remonte à la nuit des temps et subsiste dans nos sociétés modernesIls ont osé ! :
- Peindre des croix gammées sur le visage peint de Simone Veil !
- Couper les arbres en mémoire d’Ilan Halimi !
- Marquer le graffiti « Juden » sur un magasin de l’enseigne Bagelstein sur l’île Saint-Louis !
 Le ministère de l’Intérieur a mesuré 74 % d’augmentation des actes antisémites en 2018, en France.
Le ministère de l’Intérieur a mesuré 74 % d’augmentation des actes antisémites en 2018, en France.
Je trouve plus percutant et plus juste de parler de la « haine des juifs ».
Mais plutôt que de m’étendre sur les chiffres et l’argumentation par les nombres, je m’arrêterai d’abord sur un certain nombre d’actes sordides et révélateurs de la haine et de l’incommensurable bêtise de certains.
Ainsi ces croix gammées, couvrant le visage de Simone Veil.
Des croix gammées ! Le symbole des nazis eux qui ont industrialisé la haine des juifs et sont allés le plus loin dans l’abject et la déshumanisation des comportements.
Les nazis qui ont assassiné le père, la mère et le frère de Simone Veil et l’ont martyrisé dans les camps de la honte de la race humaine.
Il n’y a pas de justification, pas d’explication possible devant de tels actes de méchanceté absolue.
Simone Veil qui après ce qu’elle avait vécu, avait comme réponse mené le combat de la réconciliation avec l’Allemagne et la construction européenne.
Elle qui écrivait dans son livre « Une Vie » :
« Venus de tous les continents, croyants et non-croyants, nous appartenons tous à la même planète, à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants, et la défendre non seulement contre les forces de la nature qui la menacent, mais encore davantage contre la folie des hommes. »
Et que dire de la profanation du site et des arbres qui avaient été plantées en mémoire d’Ilan Halimi.
Ilan Halimi avait été attiré en 2006 dans un guet-apens par le gang des barbares dirigé par Youssouf Fofana. Il a été séquestré et torturé pendant 24 jours parce qu’il était juif et parce que les « juifs sont riches » et que ces criminels espéraient pouvoir toucher une rançon. Mais ce crime a été encore plus odieux par des tortures infligées uniquement par la haine des juifs que ces malades portaient dans leur esprit malade.
Les parents d’Ilan Halimi n’étaient pas riches. Et même s’ils avaient été riches, rien ne peut justifier cette barbarie, ces actes d’inhumanité.
 Même la mort n’a pas arrêté la bêtise et haine de s’acharner.
Même la mort n’a pas arrêté la bêtise et haine de s’acharner.
Une stèle avait été érigée dans un parc de Bagneux en 2011. Une première fois profanée en 2015 et réhabilitée. Elle a été une seconde fois souillée en 2017 couverte d’une croix gammée, le slogan « libérez Fofana » et le nom « Hitler » étant inscrits sur la stèle.
Et en février 2019, deux arbres qui avaient été plantés, en 2007 et 2016, en son honneur ont été retrouvés coupés.
Ces arbres se trouvaient sur le site, le long de la voie ferrée, à quelques mètres de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois, où son corps nu, torturé, brûlé, avait été découvert par une conductrice un matin de février 2006.
Comment appeler cette persistance dans la vilenie et la bassesse ?
Seule la haine peut permettre d’apporter un début de compréhension à l’incompréhensible.
Il n’y a rien de rationnel dans cela.
Certains esprits ose mettre ces actes en regard avec la politique condamnable de l’Etat d’Israël à l’égard des palestiniens.
Ces deux actes décrits ci-avant n’ont rien à voir avec cette justification.
Rien !
Pas plus d’ailleurs que le mot « Juden » écrit sur la devanture d’un magasin de l’enseigne Bagelstein.
 Les croix gammées, le mot « Juden », la référence à Hitler, toutes ces références font appel à l’imaginaire nazi
Les croix gammées, le mot « Juden », la référence à Hitler, toutes ces références font appel à l’imaginaire nazi
Comme cette photo des années noires en Allemagne, où apparaît le mot « juden » pour dire plus précisément « Allemand, défendez-vous, n’achetez pas chez les juifs »
Ces références ne peuvent que signifier dans ces esprits malsains qu’il faut continuer l’œuvre des nazis à savoir la destruction des juifs.
La « haine des juifs », l’antisémitisme comme on l’appelle communément est un racisme, mais il est plus que cela. Le « Juif » est le bouc émissaire premier qu’on a désigné dans nos sociétés.
Quand un malheur arrivait dans un village, il fallait trouver un coupable et systématiquement la population chrétienne se retournait vers l’« autre » et le désignait comme le responsable.
Des centaines d’écrits et de témoignages racontent de tels faits.
L’accusation de meurtres rituels qui aurait été commis par les juifs était particulièrement répandue, comme ce récit : <Accusation de meurtre rituel contre les juifs d’Uzès>.
Ou en encore cette <Accusation de meurtre rituel à Metz en 1670>
Il y a aussi ce livre de Pierre Hebey <Les disparus de Damas – Deux histoires de meurtre rituel > qui relate un évènement qui s’est passé en Syrie en 1840 et dans lequel un représentant du gouvernement français a joué un rôle considérable :
« Le 21 février 1840, le père Thomas, religieux d’origine sarde résidant depuis de nombreuses années à Damas, ainsi que son serviteur disparaissent. Aussitôt les Chrétiens de la ville accusent les Juifs d’avoir » immolé » le religieux afin de recueillir son sang. Ce drame se produit moins de quatre mois après l’arrivée du premier consul de France en Syrie, le comte Ulysse de Ratti-Menton. Or un traité franco-turc de 1740 reconnaît aux diplomates français un droit de protection sur les catholiques de l’Empire ottoman. Le nouvel arrivé en profite pour mener l’enquête concernant ces disparitions. Sa conviction, dès les premières heures, est établie : les coupables sont les membres d’une famille juive de notables. Avec la police du Pacha, il va s’attacher à le démontrer. Le consul, que les méthodes d’interrogatoire orientales ne rebutent pas, bouclera son instruction en quelques semaines. Ses conclusions devront forcément déboucher sur des exécutions. Les communautés juives de France et d’Angleterre -alors que leurs pays sont au bord du conflit- décideront d’envoyer deux hommes pour sauver de prétendus coupables dont l’innocence paraît évidente. Henri Heine, en poste à Paris pour La Gazette d’Augsbourg, consacrera plusieurs articles à l’Affaire de Damas. Dès le 7 mai 1840, révolté par ce qu’il a pu apprendre, il écrit : » … tandis que nous rions et oublions… le bourreau exerce la torture et, martyrisé sur le chevalet de la question, le Juif de Damas avoue… ».
Et pour la suite de cette affaire vous pouvez lire ce <petit article>
Vous pourrez lire cet article de Wikipedia : <Accusation de meurtre rituel contre les Juifs>
La foule haineuse les accusera aussi d’empoisonner l’eau des puits et de tous les complots qui puissent s’imaginer.
Je n’entends pas multiplier les exemples qui sont nombreux à en avoir la nausée.
L’historienne Annette Wierworka <invitée de Léa Salamé sur France Inter le 19 février> distingue 3 types d’antisémitisme en France :
- L’antisémitisme populaire qui se révèle chaque fois qu’il y a des moments de fièvre, comme l’épisode actuel des gilets jaunes. Cet antisémitisme est celui qui s’inscrit dans l’image du juif, maître de la Finance internationale, influençant tous les pouvoirs et adepte du complot dans lequel les juifs seraient les tireurs de ficelle…
- L’antisémitisme d’extrême droite, identitaire, qui reproche au juif d’être « cosmopolite » un intrus dans la nation, d’être non assimilable, toujours soupçonné de toutes les traîtrises. C’est évidemment cet antisémitisme qui était à l’œuvre lors de l’affaire Dreyfus et pendant la dernière guerre.
- L’antisémitisme gaucho-islamiste, antisémitisme de l’extrême gauche qui prend ses racines et ses prétextes dans le conflit israélo-palestinien en prétendant que n’importe quel juif dans le monde est forcément en accord avec la politique du gouvernement d’Israël et plus que cela responsable de la politique d’Israël.
Annette Wierworka ne cite pas une autre face de l’antisémitisme chrétien, celui du peuple déicide, puisque selon les Évangiles, ce sont des juifs qui ont réclamé aux romains de mettre à mort le Christ. Si l’on accepte de prendre au sérieux le récit des évangiles, cette accusation ne tient pas d’abord parce que ce n’est pas le peuple juif qui a demandé la mort de Jésus mais une partie de l’aristocratie de Judée et détenteur du pouvoir religieux qui ne représentait qu’une petite minorité au sein du peuple juif. Et ensuite et surtout pour une raison de fond que des non chrétiens et des non croyants ne peuvent pas comprendre, mais une raison qui doit illuminer des croyants de la Foi chrétienne : Le récit de la rédemption incarnée par le Christ qui est mort, plus exactement qui a été sacrifié pour « laver les péchés du monde » impliquait qu’il devait être crucifié pour pouvoir réaliser le cœur de la foi chrétienne. Dans « cette logique » il s’agissait d’un « plan divin » dans lequel le petit nombre de juifs qui ont participé à la mise en œuvre de ce sacrifice n’étaient que des acteurs inconscients d’un grand dessein qui les dépassait. J’ai bien précisé que les non croyants auraient de grandes difficultés de comprendre mon argumentaire…
Toujours est-il qu’il a fallu attendre le concile de Vatican 2 (1962-1965) pour que l’Église catholique rompe solennellement avec la notion de «peuple déicide» et avec l’antijudaïsme séculaire de l’Église. Ce n’est pas si vieux 1962, je vivais déjà. Et c’est encore plus récemment, en 2011, que le pape Benoit XVI dans un de ses écrits reprend le premier argument que j’ai soulevé ci-avant, c’est-à-dire de la responsabilité d’un petit nombre d’aristocrates <Slate> consacre un article à ce sujet :
« Le pape Benoît XVI publie, mercredi 9 mars, le deuxième tome de son livre Jésus de Nazareth dans lequel il traite en particulier de la Passion et de la mort de Jésus-Christ. Non seulement il reprend le récit évangélique de cet événement central de la foi chrétienne, mais il en propose une relecture qui exonère explicitement les juifs de toute responsabilité dans la mort de Jésus. L’expression «les juifs», associée dans les Évangiles et les écrits des Pères de l’Église à la Passion du Christ, «n’indique en aucune manière le peuple d’Israël comme tel et elle a encore moins un caractère raciste», écrit le pape. Elle désigne certains «aristocrates du peuple», mais certainement pas l’ensemble des juifs. »
Concernant l’antisémitisme d’extrême droite on pensait que la seconde guerre mondiale l’avait définitivement anéanti. On cite souvent la phrase, sorti de son contexte, de Georges Bernanos : « Hitler a déshonoré à jamais le mot antisémitisme ». J’avais déjà, dans un mot du jour précédent, cité la tribune de Philippe Lançon, l’auteur du « Lambeau » qui a resitué la phrase de Bernanos dans l’ensemble du propos qu’il avait écrit alors et qui évite de le classer dans la case antisémites. <Libération – le 2 septembre 2008>
Il reste cependant qu’on pensait que plus personne n’oserait exprimer cette haine anti-juive.
Sauf peut-être le général De Gaulle qui après la guerre des six jours, en 1967, a eu cette déclaration surprenante qui plonge ses racines dans le vieil antisémitisme de droite :
« …Certains même redoutaient que les juifs, jusqu’alors dispersés, qui étaient restés ce qu’ils avaient été de tout temps, un peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur, n’en viennent, une fois qu’ils seraient rassemblés dans le site de leur ancienne grandeur, à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu’ils formaient depuis dix-neuf siècles : l’an prochain à Jérusalem… »
Raymond Aron a alors pris la plume et a eu le glaive vengeur et estimé que le général de Gaulle avait solennellement réhabilité l’antisémitisme.
« Aucun homme d’Etat occidental n’avait parlé des juifs dans ce style, ne les avait caractérisés comme « peuple » par deux adjectifs, nous les connaissons tous, ils appartiennent à Drumont, à Maurras »
Pages 50 & 51 de l’ouvrage « Essais sur la condition juive contemporaine » qui réunit les textes de Raymond Aron sur ce sujet et qui occupe aussi une place de choix dans ma bibliothèque.
Pourtant quand le cimetière juif de Carpentras fut profané en 1990, il y eut des <manifestations importantes> pour condamner cet acte parce que tout le monde pensait que cet acte venait des mouvances de l’extrême droite. Ce qui se révéla d’ailleurs faux.
Mais quand en 2012, le criminel djihadiste dont je ne cite pas le nom à dessein après avoir assassiné deux militaires s’est introduit dans une école juive et je laisse <Le Monde> continuer :
« Vers 8 heures, un homme armé sur un scooter de grosse puissance gare son engin devant l’école juive Ozar-Hatorah dans un quartier résidentiel tout proche du centre de Toulouse. Il ouvre le feu avec un pistolet-mitrailleur, qui s’enraye, puis une arme de calibre 11,43, la même qui a servi pour tuer les parachutistes. Il tue Jonathan Sandler, 30 ans, professeur de religion juive, et ses deux fils Arieh, 5 ans, et Gabriel, 3 ans, qui attendaient ensemble le ramassage scolaire. Il poursuit dans la cour une fillette de huit ans, Myriam Monsonego, la rattrape et l’abat d’une balle dans la tête. Il blesse un adolescent de 17 ans, puis s’enfuit en deux-roues. »
Il n’y eut aucune manifestation, hormis des membres de la communauté juive.
Rien !
Le silence, l’indifférence.
Cette fois l’antisémitisme est celui désigné par Wierworka sous le nom « gaucho-islamiste ».
Des enfants !
Responsable !
Aujourd’hui un ignoble personnage comme Alain Soral réalise la conjonction entre les deux antisémitismes d’extrême droite et du gaucho-islamisme. Écoutez à ce propos l’émission <Le Grain à moudre du vendredi 15 février : < Antisémitisme, antiparlementarisme : comme un air de fascisme ?>
Non, « la haine des juifs » n’est pas comparable au racisme, au colonialisme à l’esclavagisme qui sont tous des fractures de l’humanisme qu’il faut combattre et dénoncer, bien sûr.
Mais la haine des juifs apportent en plus cette idée abjecte, ignoble qu’ils sont un peu coupables de ce qui leur arrive. Même les enfants sont coupables.
Moi je crois que le plus comparable avec cette attitude est celle à l’égard des femmes, des femmes violées à qui des hommes vont dire de manière aussi ignoble qu’elles l’ont bien cherché…
Cette disposition pathologique et nauséabonde a même saisi ce centriste pataud, aimant s’endormir à l’Assemblée après un bon repas, celui que Giscard avait désigné comme le plus grand économiste de France et qu’il avait aussi nommé premier Ministre.
Raymond Barre avait eu, en 1980, après l’attentat de la rue Copernic contre une synagogue, ce propos qui avait une première fois fait la synthèse entre l’antisémitisme d’extrême droite et de l’extrême gauche :
Raymond BARRE se déclare « plein d’indignation » à l’égard de cet attentat « odieux » :
« qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic »
Non, il ne s’agit pas de propos maladroits.
Cela vient de loin, d’idées et d’une corruption de l’esprit et des valeurs profondément ancrée. C’est cela l’antisémitisme :
- 1° Les juifs doivent être distingués des français
- 2° Les juifs ne peuvent pas être innocents
Pourquoi cette haine ?
<1197>
- Peindre des croix gammées sur le visage peint de Simone Veil !
-
Vendredi 22 février 2019
« Sodoma »Frédéric MartelRevenons à la source, au récit initiatique de notre civilisation judéo-chrétienne et aussi musulmane. A savoir « La Genèse » premier livre de la Bible chrétienne et de la Torah juive. Il est aussi désigné comme le premier livre du Pentateuque (« cinq livres de Moïse »)
La ville de Sodome est connue par le récit qu’en fait le chapitre 19 de la Genèse.
Dans la traduction de Louis Segond :
« Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir ; et Lot était assis à la porte de Sodome.
Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d’eux, et se prosterna la face contre terre.
Puis il dit : Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit ; lavez-vous les pieds ; vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue.
Mais Lot les pressa tellement qu’ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent.
Ils n’étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu’aux vieillards ; toute la population était accourue.
Ils appelèrent Lot, et lui dirent : Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions.
Lot sortit vers eux à l’entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui.
Et il dit : Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal !
Voici, j’ai deux filles qui n’ont point connu d’homme ; je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu’il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu’ils sont venus à l’ombre de mon toit.
Ils dirent : Retire-toi ! Ils dirent encore : Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge ! Eh bien, nous te ferons pis qu’à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s’avancèrent pour briser la porte.
Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte.
Et ils frappèrent d’aveuglement les gens qui étaient à l’entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, de sorte qu’ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. »
Vous noterez que dans ce récit fondateur de notre civilisation, il est totalement intolérable d’avoir des pulsions homosexuelles, mais que Lot, cet homme protégé de Dieu peut allègrement proposer à cette horde en furie de violer ses deux filles vierges dans une orgie sexuelle. Les deux anges et Dieu n’y trouvent rien à redire. Pour ma vision de rationaliste, je dirai plus prosaïquement que l’auteur du récit n’y voit aucun mal. Les religions monothéistes n’ont jamais eu beaucoup de considération pour les femmes…
Par la suite les deux anges vont donc sauver Lot et sa famille et annoncent que Dieu va détruire cette ville et qu’il ne faut pas se retourner dans la fuite.
Et l’histoire se termine ainsi :
« Alors l’Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l’Éternel.
Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre.
La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. »
Dans cet article de <Wikipedia>, des théologiens aux idées complexes essayent d’expliquer que cette histoire est plus compliquée qu’il n’y paraît, mais conviennent quand même que
« Dans la tradition chrétienne, ces passages bibliques sont évoqués comme fondements de la condamnation de la sodomie et de l’homosexualité. L’interprétation chrétienne est utilisée par les traités d’éthique chrétienne qui se fondent sur cette lecture particulière du passage Genèse 19, et inspire la plupart des traités de droit criminel condamnant l’homosexualité jusqu’au XVIIIe siècle avec une rigueur inouïe »
La discussion des théologiens tournent autour de l’expression « pour que nous les connaissions » qui pour tout lecteur averti de la Bible signifie avoir des relations sexuelles. Pour les théologiens qui écrivent dans Wikipedia c’est bien la signification pour des relations hétérosexuelles, mais ne le serait pas pour les relations homosexuelles.
Mais le Récit biblique est une chose et l’interprétation que les ecclésiastiques en ont fait est tout aussi importante.
Et cette interprétation est claire, « Sodome » est l’histoire qui montre que Dieu condamne l’homosexualité. Et la ville mythique donnera les noms communs honnis par les religions monothéistes de « sodomie », de « sodomites » et de toutes ses déclinaisons.
Cet autre article de Wikipedia rapporte l’Histoire de l’homosexualité et de la religion chrétienne, dont je tire les extraits suivants :
Ce qui est étonnant dès le début c’est que le premier édit a été décrété par un homosexuel. Rappelons que les relations charnelles entre homme ne posaient pas problème dans la Grèce antique.
« En effet, le 4 décembre 342, les empereurs romains Constantin II et Constant Ier décrétèrent, dans leur édit sur les adultères, la punition de tout homme, déclaré « infâme », qui se marierait en femme». Cette condamnation paraît contraster avec le fait que Constant Ier était lui-même notoirement homosexuel. Cet édit fut suivi par la loi du 14 mai 390 des empereurs Théodose Ier, Valentinien II et Arcadius, qui condamna les homosexuels passifs à la peine de mort par le feu, devant la plèbe réunie. »
Dans ces débuts le christianisme devint rapidement extrêmement cruel avec ce type de sexualité : .
« Plus tard, au VIe siècle de notre ère, jusque-là considérée comme un crime contre la dignité, l’homosexualité devint un crime contre l’ordre naturel créé par Dieu. En effet, en 538, l’empereur chrétien Justinien publia la première de ses Novellæ contre les personnes persévérant dans l’accomplissement d’actes homosexuels (ceux qui « commettent des [actes] contraires à la nature »), qu’il condamnait, en même temps que les blasphémateurs, à être arrêtés et soumis « aux derniers supplices ». Vers 542, en l’an 15 de son règne, Justinien ordonna de couper les parties génitales de deux évêques, Isaïe, évêque de Rhodes, et Alexandre, évêque de Diospolis, présents à Constantinople et, selon Michel le Syrien, « livrés à l’impureté sodomite ». Ils furent ensuite promenés par toute la ville, leurs membres amputés portés sur des lances. Justinien en profita pour établir « au nom de Dieu, la loi que quiconque serait surpris couché avec un mâle, aurait les parties viriles coupées ». »
Et si on s’intéresse plus précisément à L’Église catholique contemporaine, même s’il y a une évolution à l’égard des personnes, l’homosexualité et l’acte homosexuel sont toujours condamnés comme non naturelle et contraire aux lois divines.
Ainsi en novembre 2005 :
« sur le canal radiophonique de Radio Vatican, à l’occasion de la sortie du document de la Congrégation pour l’éducation catholique refusant l’ordination des prêtres jugés homosexuels, le cardinal Zenon Grocholewski déclara : « Beaucoup de gens défendent l’idée selon laquelle l’homosexualité serait une condition normale de la personne humaine. Au contraire, elle contredit absolument l’anthropologie humaine et la loi naturelle ».
Il y a bien sûr des évolutions, notamment grâce au Pape François, mais l’homosexualité continue à être condamnée par l’Église Catholique.
Et parmi ceux qui le condamnent, beaucoup sont homosexuels. Cette hypocrisie est dénoncée par le journaliste Frédéric Martel dans le livre qu’il vient de publier chez Robert Laffont et qui est sorti en Librairie ce jeudi 21 février: « Sodoma, Enquête au cœur du Vatican »
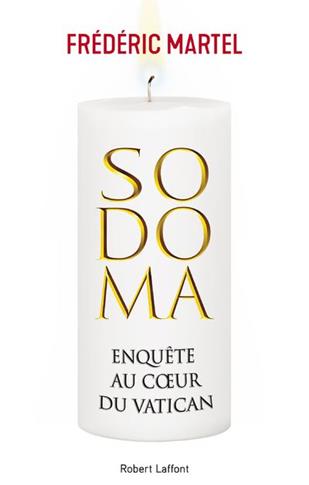 J’ai entendu parler ce journaliste de son livre pour la première fois sur France Culture le 15 février dans l’émission de Guillaume Erner : « les lourds secrets du Vatican»
J’ai entendu parler ce journaliste de son livre pour la première fois sur France Culture le 15 février dans l’émission de Guillaume Erner : « les lourds secrets du Vatican»
Et j’ai appris que le Vatican abriterait une des plus grandes communautés homosexuelles au monde.
Dans cette interview à CNews il affirme que
«Plus un prélat est homophobe, plus il a de chances d’être homosexuel».
Il décrit L’Église catholique comme une société «homosexualisée».
L’écrivain a enquêté pendant quatre ans au sein du Vatican, mais aussi dans trente pays et a interrogé près de 1.500 personnes, dont 41 cardinaux, 52 évêques et monsignori et 45 nonces apostoliques, précise « Le Point » :
Sur 630 pages, le sociologue décrit ce qu’il nomme « le secret le mieux gardé du Vatican » : l’omniprésence des homosexuels au sommet de l’Église. »
Car Frédéric Martel n’évoque pas un « lobby gay » mais presque une « normalité » :
« L’homosexualité s’étend à mesure que l’on s’approche du saint des saints ; il y a de plus en plus d’homosexuels lorsqu’on monte dans la hiérarchie catholique. Dans le collège cardinalice et au Vatican, le processus préférentiel est abouti : l’homosexualité devient la règle, l’hétérosexualité l’exception. »
Et il répète dans ce journal, l’hypocrisie à l’œuvre :
« Les prélats qui tiennent les discours les plus homophobes et traditionnels sur le plan des mœurs s’avèrent eux-mêmes en privé homosexuels ou homophiles, étant ces fameux « rigides hypocrites » dénoncés par François. »
L’article du Point explique que le livre revisite les pontificats de Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI sous ce prisme gay. Il est particulièrement terrible pour le pape polonais, qui a multiplié les anathèmes contre l’homosexualité et le préservatif en pleine épidémie du sida, mais dont l’entourage proche aurait été majoritairement constitué de gays, dont deux éminents cardinaux à l’homophobie d’apparat qui ont été mêlés à une affaire de réseau de prostitution masculine.
Par ailleurs, Frédéric Martel affirme que cette culture du secret et cette omni présence de l’homosexualité est une clé essentielle pour comprendre pourquoi certains cardinaux et évêques ont couvert des actes pédophiles : Ils avaient peur que dans le scandale, des révélations éclatent et dénoncent leur homosexualité et leur hypocrisie.
<Dans cet article du Monde>, le Pape actuel qui semble épargné par le livre est cité :
« « Derrière la rigidité, il y a toujours quelque chose de caché ; dans de nombreux cas, une double vie », a ainsi affirmé le pape argentin. Parmi ses ennemis, précise M. Martel, les « homosexuels planqués, pétris de contradictions et d’homophobie intériorisée » seraient légion. »
Dans un article 21 février 2019 sur le site <Slate> Henri Tincq explique que
« L’ouvrage de Frédéric Martel souligne les incohérences entre le discours de l’Église catholique sur l’homosexualité et la pratique de certains de ses dirigeants, notamment au Vatican »
Et il fait l’analyse suivante :
« Martel démontre ici la perversité d’un autre système de pouvoir, d’une machinerie d’Église complexe, génératrice d’une morale aussi ancienne qu’écrasante. Son livre est une quête haletante et absurde à travers les rouages d’une institution ubuesque, corrompue jusqu’à la moelle, schizophrène à un niveau inimaginable, à la fois homosexuelle et homophobe, dont l’auteur nomme les tireurs de ficelles et désigne les principaux criminels. »
Une des raisons de cette sur-représentation des homosexuels à l’intérieur de L’Église catholique serait dû au fait que des jeunes hommes catholiques sentant en eux des pulsions homosexuelles, moralement indéfendables et donc refoulées chercheraient une expression et une «sublimation» dans un milieu de pouvoir presque exclusivement masculin.
Pour cacher une homosexualité prohibée par les lois de l’Église, mais si répandue en son sein, la hiérarchie catholique se livrerait à une surenchère permanente dans l’homophobie. Il existerait un lien étroit entre l’homosexualité pratiquée dans ses rangs à une grande échelle et les combats acharnés que mènerait l’Église des dernières années contre cette «déviance», contre l’avancée des droits des homosexuels (alors même qu’elle se bat pour les droits humains en général), contre les unions de même sexe ou contre les moyens de prévention du virus du sida, notamment le préservatif.
<L’express consacre aussi un article conséquent à cet ouvrage>
Mais je finirai par cet avertissement que donne Marco Politi, vaticaniste italien, auteur de «François parmi les loups» sur le site de « L’Obs » :
« Mais après «Sodoma», l’Eglise doit se préparer à une autre vague de scandales: un #Metoo des femmes et des religieuses victimes d’abus sexuels par le clergé. En janvier, un prêtre du Vatican, chef de bureau à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a été officiellement démis pour avoir tenté », dans les années passées, d’obtenir les faveurs d’une religieuse pendant la confession. Les femmes ont désormais moins peur du pouvoir clérical et il est fort à parier que bientôt, depuis l’Europe et les Etats-Unis jusqu’en Inde, on assistera à une escalade de révélations.»: »
Et Marco Politi ne parle pas des crimes de pédophilies, pourtant très présent dans l’actualité.
L’Eglise catholique a vraiment un gros problème avec la sexualité.
<1196>
-
Jeudi 21 février 2019
« Un mot épicène »Mot qui n’est pas marqué du point de vue du genre grammaticalAvant c’était simple, un enfant avait une mère et un père.
Quelquefois la mère était inconnue, beaucoup plus fréquemment dans nos sociétés soumis à la loi du mâle le père était inconnu, et quelquefois les deux étaient inconnus, il s’agissait alors d’enfant abandonné.
Aujourd’hui la question du genre a évolué et crée des tensions dans nos sociétés.
Un technocrate ou un député mal inspiré a pensé pertinent de modifier des imprimés administratifs de l’éducation nationale en remplaçant «mère » et « père » par parent 1 et parent 2 !
Florence nous a envoyé un dessin drôle sur ce sujet :
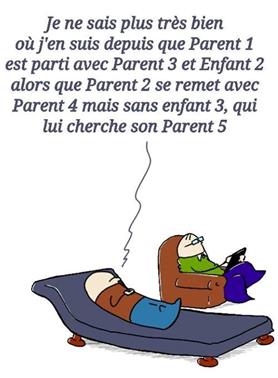 Il semble qu’une solution de compromis ait pu être trouvée.
Il semble qu’une solution de compromis ait pu être trouvée.
Le mot du jour d’aujourd’hui n’approfondira pas cette question contemporaine sauf à souligner deux points :
- Quand un technocrate cherche à résoudre un problème de société et d’humanité, il est rarement inspiré. Sa spécialité reste l’analyse par les nombres et l’organisation de la productivité.
- Il y a un problème de fond, lorsqu’on remet en cause une terminologie séculaire qui correspond encore à la réalité du plus grand nombre, pour prendre en compte les évolutions que l’on peut trouver, par ailleurs, tout à fait justifiées mais qui ne correspondent qu’à une toute petite minorité, même si elle est très visible.
Mais le problème de genre que j’entends développer aujourd’hui concerne non les couples et les familles mais un mot.
Ce mot est « hymne »
Hier la première phrase était : « Une hymne à la sacralité de l’Univers »
C’était l’auteur, ou selon certaines nouvelles pratiques l’Autrice, Louise Boisselier qui avait utilisé le féminin.
Comme certains d’entre vous, cela m’avait surpris.
« Un hymne » me paraissait la bonne formule.
Mais nous sommes dans le cas particulier d’un genre flou ou d’un bi-genre
« Un hymne » ou « une hymne » sont tous les deux justes, l’un et l’autre se dit.
Hymne est en même temps féminin et masculin.
C’est donc un mot très moderne.
Le dictionnaire libre : « wiktionary » explique que hymne provient :
« Du latin hymnus, lui-même du grec ancien ὕμνος, peut-être une variante du mot qui nous donne hymen, hyménée. Le mot est passé du masculin au féminin en ancien français, « plus ordinairement féminin » au dix-septième siècle, puis étymologiquement rapporté au genre masculin. (Vers 1140) »
Et précise :
« hymne \imn\ masculin ou féminin (l’usage hésite) »
Et c’est ainsi que j’ai appris que l’adjectif « épicène » correspondait au phénomène de ne pas être marqué du point de vue du genre grammatical et qu’un mot épicène peut être employé au masculin et au féminin sans variation de forme. Alors ce site : <Parler français> explique que le premier sens d’épicène définit un nom qui, bien que n’ayant qu’un genre, désigne indifféremment l’un ou l’autre sexe : la souris, par exemple, est un nom épicène féminin, en ce sens qu’il désigne aussi bien la femelle que le mâle. De même, témoin est un nom épicène masculin.
Le deuxième sens d’« épicène » se dit ensuite d’un nom, d’un pronom ou d’un adjectif qui ne varient pas selon le genre : ils ont la même forme au masculin et au féminin, et pourraient être qualifiés de neutres, d’androgynes. Par exemple : acrobate, adulte, artiste, camarade, concierge, élève,
Un prénom qui peut s’employer pour les garçons comme pour les filles est un « prénom épicène ». Camille, Claude ou Dominique sont des prénoms épicènes usuels dans le monde francophone.
Avec toutes ces précisions, il n’est pas certain que «hymne» soit un «mot épicène». C’est peut être simplement un mot au «genre indéfini» voire appartenant à un «genre douteux».
Pour être plus savant, il est aussi possible de consulter Wikipedia : <Mot épicène>
<1195>
- Quand un technocrate cherche à résoudre un problème de société et d’humanité, il est rarement inspiré. Sa spécialité reste l’analyse par les nombres et l’organisation de la productivité.
-
Mercredi 20 février 2019
« La symphonie N°8 « des Mille » de Mahler [entonne] une hymne à la sacralité de l’univers. »Louise Boisselier« Sa symphonie des Mille englobe vers et mélodies pour entonner, avec toute la force de ses effets démesurés, une hymne à la sacralité de l’univers. »… C’est ainsi que Louise Boisselier conclut la présentation de la 8ème symphonie de Mahler dans le livret qui accompagnait le concert auquel nous avons assisté ce dimanche à la Philharmonie de Paris avec Annie et Florence.
Expérience unique, fabuleuse et totale.
Mais comment en parler ?
La musique, la symphonie « des Mille » de Gustav Mahler, cela peut s’écouter, se vivre, se vibrer mais cela ne peut pas s’écrire, il n’y a pas de mots pour le raconter !
Alors ?
Je vais pourtant le tenter, par approches successives, en superposant les angles de vue et d’appréciation.
Vous pouvez avoir une première approche et un reflet de ce que nous avons vécu en écoutant et regardant sur le site de la Philharmonie de Paris, l’enregistrement du concert qui restera en ligne pendant 6 mois.
Vous trouverez cette vidéo derrière ce lien : <Concert du 17 février 2019>

1° La première approche est certainement à trouver dans l’Histoire de la Musique Occidentale.
Je me souviens de cet historien arabe qui a dit un jour, lors d’une émission : « la civilisation occidentale ne peut se prévaloir d’aucune supériorité sur les autres civilisations, ni sur les valeurs, ni sur la politique, ni sur la littératur, ni sur l’architecture, ni sur les arts graphiques, il n’y a qu’un domaine où elle n’a pas d’équivalent : Aucune civilisation n’a généré de Bach, de Mozart, de Beethoven.»
Car c’est une longue histoire qui remonte au moyen âge, passe par la renaissance, par Machaut, De Lassus, Monteverdi, Bach, Haydn. Et à chaque époque, les musiciens ont approfondi ce que leurs prédécesseurs ont appris et ont continué à créer.
Parmi les différentes formes musicales l’une est apparue assez tardivement : la symphonie. Ce n’est, en effet, que dans le deuxième tiers du XVIIIe siècle, en pleine période de classicisme que le genre s’est stabilisé.
C’est Joseph Haydn, appelé le « père de la symphonie » qui a fixé sa structure. Mozart y a ajouté son génie.
Puis il y eut Beethoven qui impressionna tous les successeurs et finit son œuvre symphonique par la 9ème qui se finissait par un chœur : le célèbre « ode à la joie ».
Après, il y en eut beaucoup d’autres : Berlioz, Schumann, Brahms, Bruckner, Dvorak etc.
Et puis, il y eut Mahler
Et Mahler dans sa 8ème symphonie, va aller jusqu’aux limites du possible avec un orchestre gigantesque, un orgue, un piano, 2 chœurs adultes, un chœur d’enfant et 8 solistes vocaux.
En se fondant dans la tradition, en y ajoutant son propre génie mélodique et son immense science de l’orchestre il va créer une œuvre d’une ampleur gigantesque, aboutissement de l’histoire de la symphonie occidentale.
Les musicologues puristes vous diront qu’Arnold Schoenberg a encore élargi l’orchestre, par rapport à cette œuvre, pour ses « Gurre Lieder ». Mais avec le déploiement vocal et choral, rien ne surpasse en puissance, la 8ème symphonie de Mahler.
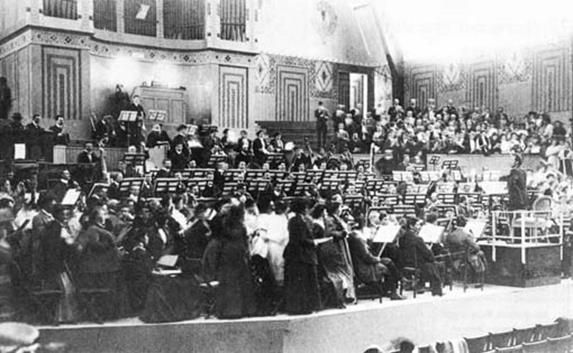 2° La seconde approche doit probablement partir de l’Histoire de Gustav Mahler lui-même.
2° La seconde approche doit probablement partir de l’Histoire de Gustav Mahler lui-même.
Après la 8ème symphonie, il écrira encore 3 œuvres : la 9ème, le Chant de la terre, et des fragments de la 10ème symphonie. Ces 3 œuvres seront créées au concert après le décès de Gustav Mahler
La 8ème sera la dernière qui sera jouée, en concert, du vivant du compositeur et Gustav Mahler dirigeait sa création à Munich, avec l’Orchestre Philharmonique de Munich, le même qui a interprété la symphonie au concert de ce dimanche à Paris.
L’effectif que dirigea Mahler à cette occasion mobilisait 1030 interprètes. L’imprésario chargé de la promotion de ce concert, Emil Gutman, y trouva l’inspiration pour appeler cette symphonie par le surnom de « Symphonie des Mille » qu’il inscrivit sur les affiches publicitaires.
Gustav Mahler marqua sa désapprobation pour ce titre qu’il trouva trop publicitaire. Il a trouvé cette campagne « extravagante » digne de « Barnum et Bailey » célèbre et immense cirque assurant un show jamais connu jusque-là, à la fin du XIXème siècle.
Ce nom restera cependant pour la postérité, même si aujourd’hui le nombre d’interprètes ne dépasse plus 500, à Paris ils étaient un peu plus de 350.
Il faut aussi reconnaître que la campagne publicitaire fonctionna très bien. <Ce site> rapporte :
« 19 heures 30, Munich, le 12 septembre 1910. Tout en verre et en acier, l’immense et nouvelle salle de concert de l’Exposition Internationale est déjà pleine à craquer. Trois mille quatre cents auditeurs y sont entassés devant huit cent cinquante choristes habillés de noir et de blanc (cinq cents adultes et trois cent cinquante enfants) qui ont pris place sur l’immense estrade aménagée pour l’occasion, serrés autour de l’orchestre, l’un des plus vastes jamais réunis depuis la création du célèbre Requiem de Berlioz, en l’occurrence cent quarante-six musiciens, auxquels s’ajoutent les huit solistes vocaux, plus huit trompettes et trois trombones à l’autre bout de la salle.
C’est la première impatiemment attendue de la Huitième Symphonie de Mahler. Dans la salle on reconnaît un grand nombre de visages célèbres. Outre la famille régnante de Bavière au grand complet, il y a aussi quelques princes de l’art contemporain, les compositeurs Richard Strauss, Max Reger, Camille Saint-Saens, Alfredo Casella, les écrivains Gerhard Hauptmann, Stefan Zweig, Emil Ludwig, Hermann Bahr et Arthur Schnitzler, les chefs d’orchestre Bruno Walter, Oskar Fried et Franz Schalk, le metteur en scène le plus illustre du moment Max Reinhardt, etc. etc. »
J’ai lu que Georges Clemenceau était également présent.
Ce fut un triomphe !
Le seul vrai triomphe de Gustav Mahler en tant que compositeur. Compositeur qui aujourd’hui est le plus joué par les plus grands orchestres symphoniques du Monde, il était reconnu comme le plus grand chef d’orchestre vivant mais était vilipendé comme compositeur : on l’accusait de réaliser un amalgame des œuvres des grands compositeurs qu’il dirigeait plutôt que de créer une œuvre spécifique.
On a écrit que Claude Debussy a ostensiblement quitté la salle au plein milieu de l’exécution de la première symphonie de Mahler. Aujourd’hui des spécialistes de Debussy prétendent que ce n’est pas possible car son savoir vivre l’en aurait empêché. C’est pourtant ce que l’on a écrit.
Le temps a fait son œuvre, aujourd’hui plus personne ne discute son génie.
Le grand spécialiste de Gustav Mahler, Henry-Louis de La Grange écrit :
« La création munichoise de la Huitième Symphonie devait être suivie d’un des plus grands triomphes de l’histoire de la musique. Le génie incomparable avec lequel Mahler a équilibré les masses sonores, la richesse évidente de l’invention mélodique, à partir d’un nombre très limité de cellules, la splendeur des deux codas, ne pouvaient manquer de fasciner son public. Ce jour-là, Mahler qui venait tout juste d’atteindre cinquante ans et dont la carrière entière n’avait été qu’une suite presque ininterrompue d’échecs et de demi-succès, fut littéralement sidéré de voir la salle entière hurler, trépigner et applaudir avec transport dans un délire collectif de quelque vingt minutes. Les enfants du chœur, en particulier, à qui il n’avait cessé de prodiguer conseils et attentions pendant les répétitions, n’en finissaient plus d’applaudir, ni d’agiter leur mouchoir ou leur partition. Pour lui, ils représentaient cet avenir qu’il sentait bien lui échapper. A la fin du deuxième concert, lorsqu’ils se précipitèrent tous ensemble à l’avant de la galerie qui leur était réservée pour lui donner des fleurs et lui serrer la main, lorsqu’ils hurlèrent à tue-tête: « Vive Mahler! Notre Mahler! », lorsque le compositeur eût reçu d’eux la seule couronne de lauriers, il ne put retenir ses larmes. Plus tard, une phalange d’admirateurs déchaînés l’attendra à l’extérieur de la salle pour continuer de l’acclamer. Il aura peine à se frayer un passage jusqu’à son automobile, d’où il devra encore remercier du geste cette foule exaltée qui ne peut se résigner à le voir disparaître.
Ce soir-là, tous les témoins ont noté la pâleur extrême de Mahler (si magnifiquement décrit par Thomas Mann sous le nom d’Aschenbach dans Mort à Venise). Rien, sauf peut-être ce teint cireux, ne peut alors laisser pressentir la fin prochaine. Pourtant, un témoin anonyme, et qui ne lui a jamais adressé la parole, saura bien lire l’avenir sur ce visage étrange. C’était un « jeune artiste » qui, pendant les acclamations, confie au critique viennois Richard Specht : « Cet homme mourra bientôt. Regardez ces yeux ! Ce n’est pas le regard d’un triomphateur qui marche vers de nouvelles victoires. C’est celui d’un homme qui sent déjà le poids de la mort sur son épaule. »
Et en effet, Gustav Mahler décéda le 18 mai 1911, soit 8 mois après la création de la « symphonie des Mille ».
3° La troisième approche est celle de considérer l’œuvre en elle-même.
Mahler écrivit dans une lettre du 18 août 1906 à Willem Mengelberg
le directeur musical de l’orchestre du Concert-Gebouw d’Amsterdam :
«C’est ce que j’ai fait de plus grand jusqu’ici. Et de si singulier, par la forme et le contenu, qu’il est impossible d’en parler par lettre. Imaginez que l’univers se mette à résonner! Ce ne sont plus des voix humaines, mais des planètes et des soleils qui gravitent »
De façon formelle, cette œuvre est divisée en deux parties :
Une première qui est une hymne religieuse du moyen âge : « Veni Creator Spiritus » qui en appelle à la Pentecôte et à la venue de l’Esprit créateur.
Et une seconde qui occupe les 2/3 de la durée de l’œuvre qui est la mise en musique du Second Faust de Goethe. Une œuvre littéraire emblématique du génie allemand. Moi je prétends que Goethe devait être sous l’effet de certaines drogues pour écrire de tels textes. Par exemple :
« Et pleine d’amour dans son vacarme
La masse d’eau se précipite dans l’abîme,
Destinée aussi à arroser la vallée ;
L’éclair, qui frappe de son feu
Pour purifier l’atmosphère
Qui porte en son sein poison et vapeur ;
Ce sont des messagers de l’amour, ils proclament
Que ce qui crée sans cesse nous entoure.
Que mon être intérieur s’y enflamme aussi,
Où mon esprit, confus et froid,
Agonise, prisonnier de mes sens affaiblis,
Attaché dans des chaînes douloureuses.
ô Dieu ! apaise mes pensées,
éclaire mon cœur qui est dans le besoin ! »
Annie, plus habituée aux textes ésotériques y trouve davantage de sens.
En résumé, Faust a fait beaucoup de bêtises sous l’influence de Méphistophélès. Puisque Faust a vendu son âme au diable pour vivre une seconde jeunesse. A la fin il devrait aller en enfer selon les standards religieux, mais Marguerite qui l’aimait le sauve par des prières.
Et Faust se trouvera donc après sa mort dans la félicité et ce que Mahler a mis en musique est la fin de ce second Faust.
Musique sublime qui magnifie ce texte étonnant.
Vous trouverez derrière ce lien : <L’humanité perpétuée> une analyse savante de cette scène finale de Faust.
J’ai trouvé une présentation assez humoristique et décalée d’un musicien qui poursuivait le projet déraisonnable et exaltant de monter cette œuvre avec des chœurs amateurs de Bourg en Bresse : <Première Partie> et <Seconde Partie>
Vous trouverez une analyse plus classique derrière ce <lien> :
4°La quatrième approche est celle d’essayer de décrire comment on peut recevoir une telle œuvre dans une magnifique salle de concert et avec de remarquables interprètes.
Bien sûr je ne suis capable que d’essayer en toute humilité de tenter de décrire mon propre ressenti.
Un jour j’ai appris qu’il existait des concerts, mais peut-on appeler cela des concerts ?, dans lesquels on se rend avec des boules Quies. Pour moi cela reste un mystère : Peut-on aller voir des peintures dans un musée avec un bandeau noir sur les yeux ?
Mais quand un orchestre de 120 musiciens avec un orgue et plus de 200 choristes jouent et chantent à pleine puissance, le volume en décibels est très important. Mais il n’y a aucune saturation que de la plénitude, du souffle. La salle se remplit de son, les fibres les plus intimes du corps vibrent et l’émotion submerge.
Le grand chef d’orchestre roumain Sergiu Celibidache, disait quand on vient me voir à la fin d’un concert en me disant c’était magnifique ! C’était sublime ! Cela ne m’inspire pas beaucoup. Mais quand on me dit : cela m’a fait du bien, alors je pense que le concert était bon.
Récemment j’ai échangé avec mon ami Gérald qui est aux portes de la retraite et qui me disait son désir de remplir le reste de sa vie encore de quelques beaux voyages. Pour ma part c’est un absolu d’avoir pu vivre en concert cette œuvre unique qui est jouée rarement, en raison des moyens qu’il faut mettre en œuvre pour l’interpréter. Pour moi, c’est aussi un voyage, un voyage au pays de l’émotion.
Les derniers vers de Goethe mis en musique par Mahler sont :
« L’indescriptible
Est ici réalisé ;
L’éternel féminin
nous entraîne vers les cieux. »
Vous pouvez donc écouter et voir une vidéo de ce concert sur le site de la Philharmonie : <Concert du 17 février 2019>. Bien sûr ce n’est qu’un reflet de ce qui se vit en concert, dans la salle.
Pour faire une comparaison, pour les amoureux du voyage, c’est comme une belle photo des pyramides de Gizeh ou du Taj Mahal.

Pour les enregistrements audio de cette symphonie, je propose deux versions
La version de Georg Solti avec l’orchestre de Chicago et la version de Giuseppe Sinopoli avec le Philharmonia de Londres

<1194>
-
Mardi 19 février 2019
« Repos »Un jour sans mot du jourComme je l’avais annoncé lors du mot du jour du 28 janvier 2019 il peut arriver que je n’aie pas eu le temps de finaliser un mot du jour. C’est le cas aujourd’hui.
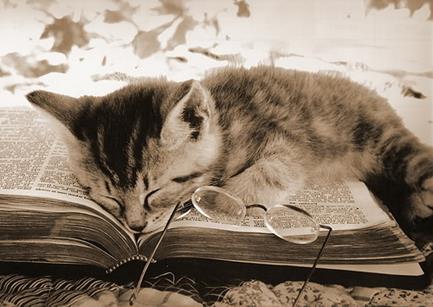 Mais si voulez quand même de la lecture, je vous propose le mot du jour écrit pour le 19 février….mais de l’année 2014
Mais si voulez quand même de la lecture, je vous propose le mot du jour écrit pour le 19 février….mais de l’année 2014
[Notre chant national] reçut des circonstances où il jaillit
un caractère particulier qui le rend à la fois plus solennel et plus sinistre : la gloire et le crime,
la victoire et la mort semblent entrelacés dans ses refrains.
Il fut le chant du patriotisme, mais il fut aussi l’imprécation de la fureur.
Il conduisit nos soldats à la frontière, mais il accompagna nos victimes à l’échafaud.
Le même fer défend le cœur du pays dans la main du soldat, et égorge les victimes dans la main du bourreau.
Lamartine
Cité par Philippe Meyer dans sa chronique du 06/02/2014 et publié sur le site de l’Assemblée Nationale avec d’autres commentaires de la marseillaise <ICI>
La marseillaise est un sujet de controverse pour les français, les uns ne veulent pas qu’on y touche, les autres veulent qu’on la remplace car trop guerrière.
Lamartine dans sa langue merveilleuse, en raconte toute la complexité. Voici ce texte dans son intégralité :
La naissance de La Marseillaise évoquée à la veille de la révolution de 1848.
Tout se préparait dans les départements pour envoyer à Paris les vingt mille hommes décrétés par l’Assemblée. Les Marseillais, appelés par Barbaroux sur les instances de Mme Roland, s’approchaient de la capitale. C’était le feu des âmes du Midi venant raviver à Paris le foyer révolutionnaire, trop languissant au gré des Girondins. Ce corps de douze ou quinze cents hommes était composé de Génois, de Liguriens, de Corses, de Piémontais expatriés, et recrutés pour un coup de main décisif sur toutes les rives de la Méditerranée; la plupart matelots ou soldats aguerris au feu, quelques-uns scélérats aguerris au crime. Ils étaient commandés par des jeunes gens de Marseille amis de Barbaroux et d’Isnard. Fanatisés par le soleil et par l’éloquence des clubs provençaux, ils s’avançaient aux applaudissements des populations du centre de la France, reçus, fêtés, enivrés d’enthousiasme et de vin dans des banquets patriotiques qui se succédaient sur leur passage. Le prétexte de leur marche était de fraterniser, à la prochaine fédération du 14 juillet, avec les autres fédérés du royaume. Le motif secret était d’intimider la garde nationale de Paris, de retremper l’énergie des faubourgs, et d’être l’avant-garde de ce camp de vingt mille hommes que les Girondins avaient fait voter à l’Assemblée pour dominer à la fois les Feuillants, les Jacobins, le roi et l’Assemblée elle-même, avec une armée des départements toute composée de leurs créatures.
La mer du peuple bouillonnait à leur approche. Les gardes nationales, les fédérés, les sociétés populaires, les enfants, les femmes, toute cette partie des populations qui vit des émotions de la rue et qui court à tous les spectacles publics, volaient à la rencontre des Marseillais. Leurs figures hâlées, leurs physionomies martiales, leurs yeux de feu, leurs uniformes couverts de la poussière des routes, leur coiffure phrygienne, leurs armes bizarres, les canons qu’ils traînaient à leur suite, les branches de verdure dont ils ombrageaient leurs bonnets rouges, leurs langages étrangers mêlés de jurements et accentués de gestes féroces, tout cela frappait vivement l’imagination de la multitude. L’idée révolutionnaire semblait s’être faite homme et marcher, sous la figure de cette horde, à l’assaut des derniers débris de la royauté. Ils entraient dans les villes et dans les villages sous des arcs de triomphe. Ils chantaient en marchant des strophes terribles. Ces couplets, alternés par le bruit régulier de leurs pas sur les routes et par le son des tambours, ressemblaient aux chœurs de la patrie et de la guerre répondant, à intervalles égaux, au cliquetis des armes et aux instruments de mort dans une marche aux combats. Voici ce chant, gravé dans l’âme de la France.
Ces paroles étaient chantées sur des notes tour à tour graves et aiguës, qui semblaient gronder dans la poitrine avec les frémissements sourds de la colère nationale, puis avec la joie de la victoire. Elles avaient quelque chose de solennel comme la mort, de serein comme l’immortelle confiance du patriotisme. On eût dit un écho retrouvé des Thermopyles. C’était de l’héroïsme chanté.
On y entendait le pas cadencé de milliers d’hommes marchant ensemble à la défense des frontières sur le sol retentissant de la patrie, la voix plaintive des femmes, les vagissements des enfants, les hennissements des chevaux, le sifflement des flammes de l’incendie dévorant les palais et les chaumières; puis les coups sourds de la vengeance frappant et refrappant avec la hache et immolant les ennemis du peuple et les profanateurs du sol. Les notes de cet air ruisselaient comme un drapeau trempé de sang encore chaud sur un champ de bataille. Elles faisaient frémir; mais le frémissement qui courait avec ses vibrations sur le cœur était intrépide. Elles donnaient l’élan, elles doublaient les forces, elles voilaient la mort. C’était l’eau de feu de la Révolution, qui distillait dans les sens et dans l’âme du peuple l’ivresse du combat.
Tous les peuples entendent à de certains moments jaillir ainsi leur âme nationale dans des accents que personne n’a écrits et que tout le monde chante. Tous les sens veulent porter leur tribut au patriotisme et s’encourager mutuellement. Le pied marche, le geste anime, la voix enivre l’oreille, l’oreille remue le cœur. L’homme tout entier se monte comme un instrument d’enthousiasme. L’art devient saint, la danse héroïque, la musique martiale, la poésie populaire. L’hymne qui s’élance à ce moment de toutes les bouches ne périt plus. On ne le profane pas dans les occasions vulgaires. Semblable à ces drapeaux sacrés suspendus aux voûtes des temples et qu’on n’en sort qu’à certains jours, on garde le chant national comme une arme extrême pour les grandes nécessités de la patrie. Le nôtre reçut des circonstances où il jaillit un caractère particulier qui le rend à la fois plus solennel et plus sinistre : la gloire et le crime, la victoire et la mort semblent entrelacés dans ses refrains. Il fut le chant du patriotisme, mais il fut aussi l’imprécation de la fureur. Il conduisit nos soldats à la frontière, mais il accompagna nos victimes à l’échafaud. Le même fer défend le cœur du pays dans la main du soldat, et égorge les victimes dans la main du bourreau.
La Marseillaise conserve un retentissement de chant de gloire et de cri de mort; glorieuse comme l’un, funèbre comme l’autre, elle rassure la patrie et fait pâlir les citoyens.
Alphonse de Lamartine (Histoire des Girondins, Furne et Cie – Coquebert, 1847, p. 408-414.)
<Mot sans numéro>
-
Lundi 18 février 2019
« la culture de la peur au 21° siècle »Frank FurediBrice Couturier écrit et publie sur « France Culture » une chronique : « Le tour du monde des idées » dans laquelle il s’éloigne de la presse hexagonale ainsi que des livres français pour s’ouvrir à ce qui s’écrit et se dit ailleurs.
Il a consacré sa chronique du 12 février 2019 à la « culture de la peur », le « catastrophisme ambiant » qui nous paralyse <Contre la « culture de la peur », retrouver le courage d’oser>
Il a commencé sa chronique par cette célèbre formule du président Franklin Roosevelt : « La seule chose dont nous pouvons avoir peur, c’est de la peur elle-même ». Il a dit cela en 1932 en pleine crise économique et sociale, dans une situation désespérante et contre laquelle il allait lancer son New Deal qui a d’ailleurs consisté, rappelons-le, à augmenter beaucoup les impôts des plus riches.
Brice Couturier en appelle à un sociologue hongrois pour fustiger le manque de courage actuel :
« C’est de l’absence d’un tel courage, d’une semblable hardiesse, que nous crevons aujourd’hui, d’après le sociologue Frank Furedi. Furedi, né hongrois, est devenu l’une des figures de la vie intellectuelle britannique. Il vient de publier un livre intitulé «How fear Works : Culture of Fear in the 21th Century ». Comment fonctionne la peur, la culture de la peur au 21° siècle. Furedi relatait récemment un fait divers, à ses yeux très révélateur de cette « culture de la peur ».
Dans le Surrey, un groupe d’agents de police assiste à un grave accident : une camionnette, après avoir dérapé, tombe dans la Tamise. Premier réflexe des policiers : tomber leur veste d’uniforme pour aller au secours du malheureux conducteur. Leur chef, un inspecteur nommé Gary Cross, le leur interdit. « Vous n’avez pas reçu l’entraînement nécessaire pour ce genre d’intervention dans le cadre de vos fonctions », explique-t-il. Quelles étranges sociétés sont devenues les nôtres pour qu’il soit interdit à des agents de police de céder à l’impulsion spontanée qui pousse tout être humain à se jeter au secours d’un semblable en train de se noyer… s’il n’a pas reçu un entraînement spécial, certifié par un document officiel. « L’esprit de courage, écrit Frank Furedi, est miné par la notion de gestion de risque. » C’est la peur du risque qui nous paralyse. La leçon de Roosevelt s’est perdue. »
Je me souviens que dans nos services, on n’a pas le droit de remplacer une ampoule électrique si on ne dispose pas de la formation et du diplôme adéquat. Il existe d’autres balivernes de ce genre pour utiliser une échelle ou un escabeau.
Et il ajoute :
« Autre exemple donné par Furedi : lors de l’attentat islamiste du 22 mai 2017 à l’Arena de Manchester, qui a fait 23 morts et 116 blessés, les pompiers sont arrivés sur les lieux avec deux heures de retard. Afin de respecter leurs procédures de sécurité…. Mais si les forces dont la mission est précisément de protéger les citoyens sont elles-mêmes tétanisées par des protocoles saugrenus et des précautions handicapantes, comment s’attendre à ce que le public, lui, fasse preuve de civisme et de courage ? »
La « gestion du risque », le « principe de précaution » sont alors des amplificateurs de nos angoisses et de nos peurs :
« L’obsession de la sécurité – en langage de technocrates, la « gestion du risque » – est devenue l’une des pathologies de notre époque. Paralysés par des anxiétés de toute sorte, nous n’osons plus oser. Une sorte « d’apocalypticisme », néologisme forgé par Gavin Jacobson, affaiblit nos sociétés.
Curieuse évolution de l’esprit du temps, dira-t-on. En moins d’un quart de siècle, les Occidentaux, si versatiles, sont passés de l’arrogance – notre modèle de société est tellement abouti qu’il va s’imposer au reste de l’humanité – à un catastrophisme tout aussi irrationnel. Du coup, l’optimisme progressiste, hérité de nos Lumières, a cédé la place à une fascination de la catastrophe, que nourrit, en particulier, une forme d’écologisme apocalyptique. Ceux qui prétendent qu’il est déjà trop tard pour que la planète demeure habitable entretiennent un sentiment d’impuissance et de paralysie.
En outre, ajoute Furedi, cette « culture de la peur » cherche à culpabiliser les gens pour mieux les assujettir. Se drapant dans l’autorité de la science, et sur le mode vertueux du bien et du mal, les autorités multiplient les interdits. »
Et il cite un nouvel ouvrage de Steven Pinker qui avait déjà fait l’objet d’un mot du jour, pour son livre précédent : « La part d’ange en nous. Histoire de la violence et de son déclin ». C’était le 21 novembre 2017.
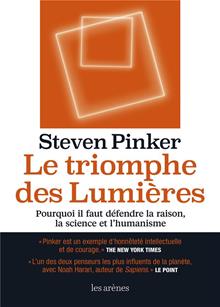 Steven Pinker qui donne des arguments pour montrer que cette peur et ce pessimisme apparait irrationnel.
Steven Pinker qui donne des arguments pour montrer que cette peur et ce pessimisme apparait irrationnel.
« C’est précisément contre ce pessimisme, facteur de paralysie qu’écrit Steven Pinker, le professeur de psychologie-star de Harvard.
Oui, j’avais déjà parlé ici de son livre « Enlightenment Now », bien avant qu’il ne soit traduit en français. C’est chose faite, grâce aux Editions des Arènes, sous le titre « Le triomphe des Lumières. Sous-titre : pourquoi il faut défendre la raison, la science et l’humanisme ». Enorme best-seller aux Etats-Unis et dans les pays anglo-saxons. Mérite de le devenir en France, pays ravagé – plus que d’autres, par le catastrophisme et la peur…
Pinker avait pris l’habitude de commencer ses conférences en distribuant à leurs participants des questionnaires comportant des questions, comportant trois réponses possibles. Exemple : A combien estimez-vous l’évolution du nombre de morts survenues, chaque année, du fait de désastres naturels au cours des cent dernières années ? Réponse A) Elles on plus que doublé, B) Leur nombre est demeuré globalement stable, C) Une baisse d’environ la moitié. Ou encore : A quel pourcentage estimez-vous le nombre d’enfants vaccinés contre les principales maladies dans le monde entier A) 20 %, B) 50 % ; C) 80 %. Et enfin : Au cours des vingt dernières années, diriez-vous que la proportion des personnes vivant en situation d’extrême pauvreté dans le monde A) a presque doublé, B) est restée à peu près stable, C) a été réduite de moitié.
Dans tous les cas, c’est la réponse C qui est la bonne. Les résultats récoltés par Pinker étaient, chaque fois, plus éloignés de la vérité que si les gens avaient répondu au hasard. »
Brice Couturier comme Steven Pinker sont des optimistes qui continuent à croire dans le progrès et l’évolution positive de l’humanité.
Il faut entendre aussi ces voix qui se fondent d’ailleurs sur des réalités qui montrent de grands progrès par rapport à hier.
Je m’étais fait l’écho de ce livre de Michel Serres : « C’était mieux avant » et dont le contenu contredisait absolument le titre, pour Michel Serres ce n’était pas mieux avant.
Mais le vieux sage a ajouté dans un entretien postérieur : « Cependant rien ne dit que demain ne sera pas pire »
Et dans une synthèse il dira : « Le monde de demain sera autre. Il sera et meilleur et pire. Il sera ce que nous en ferons »
<1193>
-
Vendredi 15 février 2019
« Le consommateur mange mieux !»Olivier Humeau, le PDG d’ Information Resources IncorporatedIl semblerait que les français deviennent plus sages et plus prudents concernant leur alimentation.
C’est une nouvelle réjouissante et positive.
Il est vrai qu’avec Annie, cela fait déjà plusieurs années que nous poursuivons une évolution vers une alimentation plus saine, dans laquelle les produits industriels sont bannis et les produits de qualité privilégiés avec une prédilection pour les aliments fournis par des producteurs locaux qui peuvent être bio mais aussi être adepte d’une agriculture raisonnée.
Cette évolution n’est pas solitaire, quand on parle autour de soi on constate qu’il y a une vraie prise de conscience et une évolution des pratiques de consommation.
Mais cette évolution n’est pas locale, comme le montre un article du journal « Les Echos » publié en fin d’année dernière : « La France devient une société de déconsommation ».
Le titre est un peu énigmatique, car il s’agit moins de consommer moins que de consommer mieux.
Cet article nous apprend que de manière globale :
« Les études montrent que les Français mettent de moins en moins de produits dans leur panier. Ils privilégient la qualité.
[…] La société d’études IRI d'(Information Resources Incorporated) note pour le premier semestre « une baisse des volumes d’un niveau jamais atteint en cinq ans ». Les ventes de petits pois, de lessives et autres shampoings ont trébuché de 1,2 %. C’est la plus forte chute depuis la crise financière de 2008. Les statistiques n’ont enregistré qu’un chiffre négatif, début 2016. Il n’était que de 0,3 %.
La consommation de masse change. Le consommateur mange mieux » résume Olivier Humeau, le PDG d’IRI. Tous les produits sont touchés, ou presque. « Les deux tiers des familles baissent ». Les bonbons chutent de 3,7 %, les biscuits de 2,9 %, la charcuterie de 3 % et l’hygiène de 1,5 %. Les acheteurs ne se restreignent pas parce que les prix montent.
[…]
Les consommateurs rejettent les produits qu’ils estiment mauvais pour leur santé. Le produit industriel, associé à tort à cette crainte [Cette remarque du journal me semble erronée], est boudé. Richard Girardot, le président de l’Association nationale des industries alimentaires, l’Ania, parle de « la destruction massive de l’alimentation ». A tort. Tout n’est pas boudé. Les clients composent leurs repas d’ingrédients de meilleure qualité et plus chers. Le marché des produits de grande consommation (PGC) a gagné 0,7 % en valeur. Les quantités diminuent. Le chiffre d’affaires progresse. Et cette croissance est nourrie à 75 % par les produits des PME…
« Quand le rayon charcuterie plonge de 3 %, les références allégées en sel croissent de 2,9 % ». Le patron d’IRI multiplie les exemples. Le « sans » emporte l’adhésion sans antibiotique, sans sucre ajouté (+21 % pour les compotes), sans sel d’aluminium (déodorants), etc. Le végétal progresse plus vite que les protéines animales. La tendance est née avec les scandales alimentaires et les recommandations sanitaires. Elle gonfle parce que les distributeurs adaptent leurs assortiments. C’est l’effet boule de neige.
Le marché du bio en fait la démonstration. Il a explosé de 17 % en 2017. Pourtant, les ventes des magasins spécialisés comme Biocoop ou La Vie Claire, plafonnent. Elles ont stagné à +1 %, au premier semestre 2018. Les grandes surfaces ont réussi le pari de la démocratisation du bio. Chez Carrefour, Auchan et Leclerc on met ses marques propres au service des nouvelles habitudes de consommation. Signe des temps, la promotion a moins d’effet sur les ventes.
[…]
Les grandes marques subissent une double peine. Elles subissent le raccourci qui prétend que le produit industriel est moins bon que le produit du petit fabricant. Elles ne récoltent pas les effets des baisses de prix qui leur sont imposées. Le consommateur s’oriente vers des articles plus chers. A la caisse, le montant de son addition ne diminue pas. »
Les français seraient-ils sur la bonne voie ?
Certains ne partagent pas l’empathie pour ce type d’évolution. L’émission de France Inter, «Le téléphone sonne» du 13 février : <Métro, boulot, quinoa : comment échapper à la tyrannie du bien-être ?>, évoque une tentative de culpabilisation :
«Le bien être devient un impératif moral. Si on coche toutes les cases du bien être, qu’on nous sert dans les pubs et ailleurs, alors on est forcément quelqu’un de bien ! Sinon on nous fait culpabiliser, le bien être oublie le bonheur, et à la place nous voilà cernés d’injonctions. Pour les plus fragiles d’entre nous, ça se termine en troubles de comportement, alimentaire souvent, ou vers la dépression parfois.»
Serait ce encore le conflit entre le progrès et le conservatisme ?
<1192>
-
Jeudi 14 février 2019
« La petite seconde d’éternité
Où tu m’as embrassée
Où je t’ai embrassée »Jacques PrévertPour la Saint Valentin, ces vers de Jacques Prévert (1900-1977) extrait du poème « Le Jardin »
Le jardin
Des milliers et des milliers d’années
Ne sauraient suffire
Pour dire
La petite seconde d’éternité
Où tu m’as embrassée
Où je t’ai embrassée
Un matin dans la lumière de l’hiver
Au parc Montsouris à Paris
A Paris
Sur la terre
La terre qui est un astre.
Ce poème est extrait du recueil « Paroles » qui a été publié pour la première fois en 1946.
C’est Jean-Louis Trintignant qui m’a fait découvrir ce poème, alors qu’il était l’invité de de Léa Salamé sur France Inter le <jeudi 13 décembre 2018>
J’avais déjà cité cette émission, lors du mot du jour du 14 décembre 2018, parce que Jean-Louis Trintignant s’était exprimé sur la crise des « gilets jaunes » :
« Entre les gens qui nous gouvernent et les gens qui souffrent, il y a un fossé. […] Macron je pense que c’est un homme honnête mais il n’a jamais eu faim. Il n’est pas assez proche du peuple »
Il avait aussi ajouté cette profession de foi :
« Je reste de gauche bien sûr. Les progrès sont des progrès de gauche. Les progrès de droite sont stupides. »
Mais il était invité à cette émission pour parler du spectacle qu’il donnait du 11 au 22 décembre 2018 à la Porte Saint Martin, spectacle de poésie sur de la musique argentine.
Pendant l’émission il a déclamé ces vers de Prévert.
« La petite seconde d’éternité où tu m’as embrassée… »:
Il a ajouté :
« Mais Prévert, c’était sans doute un type merveilleux. Je l’ai connu un petit peu. »
Il a cité aussi d’autres poètes comme par exemple Pierre Reverdy qui a écrit :
« On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux »
(tiré de «plupart de temps» )
Il a aussi été invité par Claire Chazal sur la 5, <émission> dans laquelle on voit de courts extraits du spectacle.
Mais, finissons par un autre poème de Prévert tiré du recueil « Paroles »
Paris at Night
Trois allumettes, une à une allumées dans la nuit
La première pour voir ton visage tout entier
La seconde pour voir tes yeux
La dernière pour voir ta bouche
Et l’obscurité toute entière pour me rappeler tout cela
En te serrant dans mes bras.
<1191>
-
Mercredi 13 février 2019
« Le programme télé avait avancé en âge avec moi. »Sonia DevillersQuand les journaux ont annoncé le décès de l’ami de Casimir :
« Patrick Bricard, le François de « L’Ile aux enfants » est mort »
J’étais très loin de penser que cette nouvelle allait me donner matière à un mot du jour.
 « L’ile aux enfants » était une émission de télévision pour les enfants diffusée entre 1974 et 1982.
« L’ile aux enfants » était une émission de télévision pour les enfants diffusée entre 1974 et 1982.
Mais la chronique de Sonia Devillers « L’édito M » du mardi 29 janvier 2019 « Casimir et les enfants de la télé » sur France Inter, m’a convaincu qu’il y avait là matière à faire un constat très pertinent sur la télévision :
« François de « L’île aux enfants » s’en est allé trop discrètement.
Pour ceux qui auraient eu le mouvais goût de naître dans les années 80 ou pire, après, Casimir était un monstre gentil, sorte de gros patator orange quoique arrivé à l’écran en noir et blanc. Vous me direz l’affirmation de la différence pour ce diplodocus en mousse ne fut pas affaire de couleur. Casimir n’avait que quatre doigts : « c’est mon droit, c’est mon droit », répétait-il crânement aux humains Julie, le facteur, Monsieur snob et François.
François, la queue de comète des années 70. Chemises à carreaux, éternel étudiant, marchand de ballons, rêveur et pédagogue. Il est à la fois celui qui explique et celui qui trouve de nouveaux jeux pour les enfants.
La découverte et la science sont jeu. L’imagination est un savoir. Pourvu, surtout, que l’apprentissage et le rire soient des activités inutiles et désintéressées, donc fondamentales. Le plus incongru c’est que tout cela c’était de la télévision (TF1 avant la privatisation) et de la télévision pour marmots à 18 heures.
En apprenant la mort de l’acteur qui incarnait François, j’ai compris soudain non pas que la société avait changé, mais que le programme télé avait avancé en âge avec moi.
Petite, je rentrais de l’école, je goûtais et à 18 heures « L’Ile aux enfants », sur la Une, « Récré A2 », en face.
Ado, je rentrais du collège, je goûtais et à 18 heures, « Beverly Hills », « Hélène et les garçons », etc…
Aujourd’hui, mère de famille, je rentre du boulot et à 18 heures, il y a des programmes pour les ménagères avec enfants. Sentiment étrange.
Je devrais regarder la télé en disant « c’est plus de mon âge ». Mais non, ça l’est toujours et dans vingt ans, à 18 heures, il n’y aura que des émissions pour les vieux comme moi. Le média vieillit avec moi. Pour me garder captive. Nous nous éteindrons ensemble. Sûrement.
Parce que les enfants d’après moi ont pris leur goûter devant un ordinateur et que mes enfants à moi goûtent devant leur smartphone. François, la dernière génération d’enfants de la télé te saluent. »
<Toutes les enquêtes le disent> les spectateurs de la télévision sont de plus en plus vieux :
« Toutes chaînes confondues, le téléspectateur moyen est âgé de 50,7 ans. Soit une dizaine d’années de plus que la moyenne des Français. […]
Lorsque Julien Lepers est évincé de Questions pour un champion, les médias vont chercher des réactions dans les maisons de retraite. Caricatural ? Hélas non. Le public de France 3 est vieux: 61,4 ans en moyenne. La moitié de son audience a même plus de 65 ans…
La télé attire les vieux
[…] les plus de 50 ans la regardent la télévision trois fois plus que les 15-24 ans.
Depuis 1992, l’âge moyen du téléspectateur a vieilli de 4,4 ans, soit à peu près au même rythme que toute la population.
Mais toutes les chaînes ne sont pas égales face à ce vieillissement. Certaines chaînes vieillissent plus vite que la moyenne. Ainsi, les dirigeants de M6 ont de quoi se faire des cheveux blancs: leur audience a vieilli de 4,4 ans depuis 2010. De même que ceux de TF1, dont le spectateur a pris 4 ans sur la période, et est désormais plus âgé que la moyenne des chaînes. »
Il faut se souvenir qu’il existait une époque dans laquelle, quasi tous les français regardaient la télévision et avaient ainsi un sujet de conversation commun le lendemain.
Au-delà des critiques légitimes de la qualité des émissions de l’époque, cela créait indiscutablement du lien, une sorte d’unité. L’ordinateur et les réseaux sociaux créent plutôt de la division façon puzzle.
<1190>
-
Mardi 12 février 2019
« Vous savez, la modestie s’impose.»Chloé BertolusDans son livre « Le Lambeau », évoqué hier, Philippe Lançon, a beaucoup évoqué et exprimé sa reconnaissance à l’égard de la chirurgienne qui lui a permis de retrouver un visage autorisant à aller dans la rue et de passer simplement inaperçu. Son journal « Libération » a pris l’initiative d’aller rencontrer cette femme et vient de publier une interview de Chloé Bertolus. C’est un article à lire. Le journaliste tente de décrire cette chirurgienne dans son humanité, dans sa vie de réparatrice, dans ses doutes. Je reste réservé quant à la question du désir d’enfant qui me semble appartenir à la vie intime et qui à mon sens n’avait pas sa place dans cet article. Il reste que cet entretien révèle un médecin humble et profondément humain.
Mais le premier sujet abordé qui m’a interpellé, a été l’émergence dans la vie de Chloé Bertolus de la notoriété et de la visibilité que lui a donné le livre de Lançon et ainsi la réputation qui peut devenir gênante dans sa relation avec ses patients d’aujourd’hui, comme elle l’explique délicatement :
«C’est un truc un peu bizarre que de se retrouver dans un récit […] Comment dire ? Le livre lui-même devient une espèce de manifeste. L’autre jour, et cela m’a un peu choquée, j’ai fait la visite au 2e étage. Sur la dizaine de patients, trois avaient le Lambeau à leurs côtés. […] C’est une forme de revendication. Philippe Lançon a fictionné notre relation. Et les autres, maintenant, revendiquent une relation similaire. Ou la réclament, je n’en sais rien. En tout cas, c’est un peu étrange.»
Et elle explique simplement son travail, une prouesse technique mais qui n’a qu’un rapport très lointain avec la chirurgie esthétique, c’est beaucoup plus important, c’est plus essentiel, c’est permettre de continuer à vivre normalement et c’est énorme !
«Cela n’a rien à voir avec la chirurgie esthétique […], on parle de gens qui ne peuvent pas sortir dans la rue parce qu’il leur manque la moitié du visage. [L’objectif est :] Je voudrais juste que mes patients passent inaperçus. »» Ou encore : «Je suis incapable de savoir ce que veulent mes patients. Ce que je sais, c’est ce que l’on est capable de leur proposer.» La voilà pédagogique : «On peut redonner une fonction. A des gens à qui on a enlevé la moitié de la langue, on va la reconstruire, et ils vont reparler. A d’autres, on va leur rebâtir une mâchoire, ils vont pouvoir manger. Mais aussi redonner un visage. Pour être reconnu comme un être humain, il faut avoir quelque chose qui ressemble à une bouche, à un nez, à des yeux. Il faut ressembler à quelqu’un. Ou à tout le monde.»
Puis elle touche l’essence des choses par l’humilité, par l’humanité dans ce qu’elle a de fragile, d’éphémère, de tragique et pourtant de beau. C’est la vie, notre vie :
«Vous savez, la modestie s’impose. Quand on a commencé dans notre service à opérer des patients cancéreux, un des chirurgiens nous disait : « Vous avez le sentiment d’avoir sauvé une vie. Souvenez-vous qu’en fait vous ne l’avez que prolongée. » Finalement, on ne sauve rien du tout.» Chloé Bertolus est ainsi, dans le faire. «A un curé avec qui je discutais, j’expliquais que certains soirs, avec certains patients qui ne vont pas bien du tout, on est là, sur le pas de la porte de leur chambre, et on se dit : « Pourquoi ? » C’est le grand pourquoi, le pourquoi de la vanité de l’existence. Pourquoi en passer par là, alors que l’on va tous mourir un jour ?»
Et l’article finit avec un retour sur la terre des comptables et la difficile équation des hôpitaux d’aujourd’hui :
« De son bureau, vient de sortir le DRH de l’hôpital. On leur a supprimé un des trois blocs opératoires : «L’hôpital, c’est rude. Mais j’ai toujours entendu que les hôpitaux étaient au bord de l’implosion. On a créé chez nous un sentiment étrange à force de nous répéter que l’on coûtait cher. […] Maintenant, comme cheffe de service, je dois mener d’autres combats.»
Les médecins sont bien sûr comme les autres communauté des humains, très divers. Certains font leur travail consciencieusement et restent très fonctionnels, les remplacer par des robots ne sera pas une grande perte.
D’autres sont pleins d’assurances, du moins veulent apparaître comme tels. Il existe aussi des professeurs qui se parent de leur titres pour asséner des affirmations, les écrire dans des livres en faisant croire qu’il s’agit de connaissances scientifiques, alors que ce ne sont souvent que des croyances. Bien sûr la médecine a fait de grand progrès, mais l’étendue de ce que l’on ne sait pas est toujours beaucoup plus important que ce que l’on sait. Ici aussi le contraire de la connaissance n’est pas l’ignorance, mais les certitudes.
Et puis il en est qui comme Chloé Bertolus, font un travail admirable tout en restant dans l’humilité, dans l’humanité et dans le service à l’égard de ceux qu’ils essayent de soigner, avec ce qu’ils savent. Pour ma part, je ne fais confiance qu’aux médecins humbles, c’est à dire qui n’expriment pas trop de certitudes.
<1189>
-
Lundi 11 février 2019
«Je n’avais pas du chagrin, j’étais le chagrin»Philippe Lançon, « Le Lambeau », page 211« Le Lambeau » est le livre dans lequel le journaliste Philippe Lançon, rescapé du massacre de Charlie Hebdo, raconte sa longue et douloureuse épreuve pour retrouver un visage regardable et une sérénité suffisante pour continuer à vivre, après tant de violences et tant d’amis perdus.
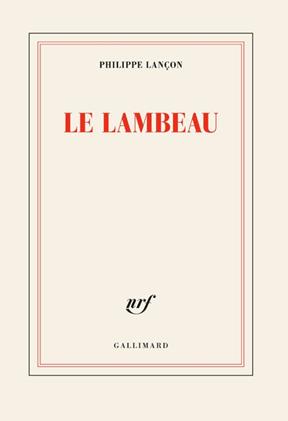 J’ai entendu Philippe Lançon parler de son livre dans deux émissions
J’ai entendu Philippe Lançon parler de son livre dans deux émissions
Sur France Inter l’interview de Léa Salamé : « Les victimes de Charlie Hebdo sont avec moi plus qu’ils ne l’ont jamais été de leur vivant »
Et sur France Culture dans l’invité des matins : «Après « Charlie », vivre et écrire». Dans cette émission il a dit :
« Écrire ce livre est un acte de mémoire sous forme de récit. Le livre fait partie d’une expérience, l’accompagne, lui donne sens et d’une certaine façon la conclut en essayant de la sublimer […] J’avais un problème de sensation à la mémoire. Je ne le sentais plus. C’est comme si j’avais oublié l’homme que j’étais auparavant. De la même façon que les nerfs, la mémoire revient d’une manière particulière dont j’ai essayé de faire le récit. »
Philippe Lançon était, en janvier 2015, journaliste littéraire à Libération et chroniqueur à Charlie Hebdo.
Dans l’équipe de « Charlie », il est avec Bernard Maris l’un des défenseurs de Michel Houellebecq, qui publiait ce même 7 janvier son livre « Soumission » dans lequel l’écrivain imagine un Premier ministre musulman à la France.
La veille, Philippe Lançon a accompagné une amie au théâtre pour assister à la pièce « La Nuit des rois », de William Shakespeare.
Ce matin du 7 janvier, Philippe Lançon est indécis. Passera-t-il d’abord par « Charlie » ou « Libération », dont il est salarié ? A Libération, il devait écrire une critique de la pièce de théâtre à laquelle il a assisté. Il décide que finalement ce sera « Charlie ». La conférence de rédaction est commencée. Les finances sont au plus bas. Depuis l’affaire des caricatures de Mahomet, le journal est « isolé ». Mais l’équipe ne cède rien à sa liberté de débattre. Et lorsque la mort surgit, il est justement question de l’abandon des banlieues, devenues ou non le nid d’un islamisme radical à la violence aveugle.
Il décrit les instants avant l’attaque :
« Il y avait une sorte de brioche devant Cabu. Wolinski dessinait sur son carnet tout en regardant d’un air amusé tel ou tel intervenant. Fabrice Nicolino n’avait pas encore entamé l’une de ses tirades nerveuses et mélancoliques contre la destruction écologique du monde. La voix de crécelle tonitruante d’Elsa Cayat a retenti, suivie d’un immense rire sauvage, un rire de sorcière libertaire. J’aimais beaucoup Elsa. Tignous dessinait peut-être. Il dessinait parfois pendant la conférence, toujours quand elle était finie. J’aimais le regarder travailler : un vieil enfant trapu et concentré, appliqué, lent, les épaules lourdes, un artisan. (…) Bernard Maris était sans doute resté à Charlie, ces dernières années, pour la même raison que moi : parce qu’il s’y sentait libre et insouciant. Ici, on disait ou l’on criait beaucoup de choses vagues, fausses, banales, idiotes, spontanées, on les disait comme on se dérouille le corps, mais, quand la sauce prenait, l’imagination suivait. Ce matin-là comme les autres, lecteur, l’humour, l’apostrophe et une forme théâtrale d’indignation étaient les juges et les éclaireurs, les bons et les mauvais génies, dans une tradition bien française qui valait ce qu’elle valait, mais dont la suite allait montrer que l’essentiel du monde lui était étranger.» »
La scène de l’attentat, longue d’une soixantaine de pages, est presque insoutenable à lire. Les balles des frères Kouachi lui ont arraché la mâchoire, l’ont défiguré, en ont fait une gueule cassée. « Blessure de guerre » a dit le pompier qui le transportait.
« J’étais maintenant à terre, sur le ventre, les yeux pas encore fermés, quand j’ai entendu le bruit des balles sortir tout à fait de la farce, de l’enfance, du dessin, et se rapprocher du caisson ou du rêve dans lequel je me trouvais. Il n’y avait pas de rafales. Celui qui avançait vers le fond de la pièce et vers moi tirait une balle et disait « Allah Akbar ! » Il tirait une autre balle et répétait encore « Allah Akbar ! »
Il était assis à côté de Bernard Maris, avec lequel il blaguait peu avant le massacre. Il se décrit comme dédoublé pour prendre conscience de la réalité :
« « Bernard est mort », m’a dit celui que j’étais, et j’ai répondu, oui il est mort, et nous nous sommes unis sur lui, sur le point de sortie de cette cervelle que j’aurais voulu remettre à l’intérieur du crâne et dont je n’arrivais plus à me détacher, car c’est par elle, à ce moment-là, que j’ai enfin senti, compris, que quelque chose d’irréversible avait eu lieu. […] Combien de temps ai-je regardé la cervelle de Bernard ? Assez longtemps pour qu’elle devienne une partie de moi-même. […] Je ne sentais pas le sang, dans lequel je baignais pourtant, je n’avais même pas encore vu le mien, mais j’entendais le silence, je n’entendais même que ça.»
Et il ajoute :
« Les morts se tenaient presque par la main. Le pied de l’un touchait le ventre de l’autre, dont les doigts effleuraient le visage du troisième, qui penchait vers la hanche du quatrième, qui semblait regarder le plafond, et tous, comme jamais et pour toujours, devinrent dans cette disposition mes camarades »
Et il raconte sa sidération :
« Etais-je, à cet instant, un survivant ? Un revenant ? Où étaient la mort, la vie ? Que restait-il de moi ? Je ne pensais pas ces questions de l’extérieur, comme des sujets de dissertation. Je les vivais. Elles étaient là, par terre, autour de moi et en moi, concrètes comme un éclat de bois ou un trou dans le parquet, vagues comme un mal non identifié, elles me saturaient et je ne savais qu’en faire. Je ne le sais toujours pas… »
Il vivra un incertain et long parcours médical avec une hospitalisation à la Pitié-Salpêtrière, puis à l’hôpital des Invalides, avec dix-sept interventions chirurgicales qui vont permettre à la cicatrisation de ses blessures, et surtout à la patiente reconstruction du tiers inférieur de son visage, détruit par un projectile,
« Ma mâchoire inférieure ayant disparu, on avait greffé à la place mon péroné droit, accompagné d’une veine et d’un bout de peau de jambe qui, sous le nom de palette, me tenait lieu de menton ».
Ce chemin de souffrance et de doute, il en viendra à bout accompagné par la lecture de livres qui puisent au plus profond de l’humanité : Shakespeare, Proust, Thomas Mann et Kafka, de l’écoute de la musique de la paix, de l’équilibre et du divin : Bach, et aussi de la puissance et du réalisme de la peinture de Vélasquez.
Il conclut :
« Il m’avait fallu atterrir en cet endroit, dans cet état […] pour sentir ce que j’avais lu cent fois chez des auteurs sans tout à fait le comprendre : écrire est la meilleure manière de sortir de soi-même, quand bien même ne parlerait-on de rien d’autre ».
<TELERAMA> : décrit ce livre avec ces mots :
« Le Lambeau n’est pas un document sur la violence, encore moins sur le terrorisme, islamiste ou autre (« Je n’ai aucune colère contre les frères K, je sais qu’ils sont les produits de ce monde, mais je ne peux simplement pas les expliquer. Tout homme qui tue est résumé par son acte et par les morts qui restent étendus autour de moi. Mon expérience, sur ce point, déborde ma pensée… »). Il s’agit, au contraire, d’un livre empreint d’une grande, d’une admirable douceur, s’employant à sonder, sans culpabilité, « la solitude d’être vivant ». Un livre calme, déterminé, à l’image de son auteur et en dépit de l’omniprésence de la douleur physique et morale, de l’angoisse, à « ne pas faire à l’horreur vécue l’hommage d’une colère ou d’une mélancolie que j’avais si volontiers exprimées en des jours moins difficiles, désormais révolus ».
<La page culturelle de France Info> commente et encense cette œuvre :
« En écrivant « Le lambeau » Philippe Lançon, […] ne fait pas seulement le choix de l’écriture ET de la vie. Il dépose à nos pieds une offrande. En partageant avec nous par la littérature son expérience, il nous autorise à faire corps avec les victimes de l’indicible événement, et ainsi, nous donne la possibilité d’en faire le deuil. […]
Le livre de Philippe Lançon est une offrande, déposée au pied de tous ceux qui ont été touchés par les attentats et l’indicible violence, par la perte de ces figures qui les ont accompagnés comme des tontons, des frères, des amis, depuis l’enfance : l’indémodable bouille et les dessins grinçants de Cabu, les dessins de Wolinski que l’on regardait en cachette quand on était enfant, les unes de Charb, la voix de Bernard Maris sur France Inter le vendredi matin[…]
C’est le récit d’une reconstruction, dans lequel l’auteur rend un hommage bouleversant à l’univers de l’hôpital, et plus largement à un monde dans lequel on ne tire pas sur les gens parce qu’ils ont fait des dessins, mais dans lequel au contraire on met tout en œuvre pour réparer les vivants, avec une place, toujours et quoi qu’il arrive, pour l’humour, pour les blagues, et pour la dérision. Le livre de Philippe Lançon est écrit dans une langue magnifique, tendue comme une peau de percussion au début du livre, puis se relâchant au fil du récit, à mesure que l’étau se desserre, que se banalisent les événements, que la vie revient, au rythme d’une marche paisible au bras de la femme qu’il aime, même si la violence, tapie, peut surgir à nouveau.
En partageant son expérience Philippe Lançon fait don au lecteur de la possibilité d’intérioriser un événement d’une violence tellement sidérante qu’il n’était pas possible de s’en emparer, de le faire sien ou de le digérer (d’autres diraient d’en faire le deuil). Avec ce livre, en faisant du « Je » un « Nous », il autorise chacun à faire entrer en soi les disparus. Comment réussit-il cette prouesse ? En produisant de la littérature, tout simplement. Merci Monsieur Lançon. »
J’ai aussi puisé la matière de ce mot du jour, hormis les articles et émissions déjà cités :
Dans le « Parisien » : <Dans l’enfer de l’attentat de Charlie>
Dans « Libération » : «J’allais partir quand les tueurs sont entrés…»
Dans « La Croix » : «Philippe Lançon, le Lazare de Charlie Hebdo »
Dans l’émission du « Masque et la Plume » de France Inter : <Philippe Lançon bouleverse les critiques du Masque et la Plume>
Dans l’émission du « Ca peut pas faire de mal » de France Inter : <Emission du 10 novembre 2018>
Il y a aussi cette interview dans « Elle » : <Je n’ai pas éprouvé de colère, jamais>
J’en tire ces extraits :
D’abord le commentaire du magazine :
« C’est un livre extraordinaire que « Le Lambeau », un récit splendide sur une expérience atroce, une épopée dans une chambre d’hôpital, la traversée d’un revenant, du monde des morts vers celui des vivants. […] Avec une fluidité remarquable, une intelligence éblouissante, Philippe Lançon raconte comment la nature de l’événement a changé la sienne, au cours de mois d’hospitalisation à la Salpêtrière puis aux Invalides. On dévore ce livre comme « Guerre et Paix », on en est sorti renversé, comme de cette rencontre avec cet homme revenu des enfers.
Puis des réponses de Philippe Lançon
« Je n’ai pas éprouvé de colère, jamais. Pendant quelques mois après l’accident, cela peut sembler paradoxal, mais j’ai été au meilleur de ce que je pouvais être, dans l’ordre de la patience, de l’endurance et de la bienveillance. Je pense que les caractères sont comme des palettes de peintre, certaines couleurs ne sont jamais utilisées. Des traits de mon caractère ont connu une excroissance soudaine. Je ne m’en vante pas, c’était un réflexe vital. Aujourd’hui, je sens avec une certaine mélancolie que ces trois vertus s’amenuisent à mesure que je vais vers une vie normale. Mais j’en ai toujours plus qu’avant ! […]
Ma vie, mon métier, c’est lire et écrire. Comment pouvais-je restituer le bien que m’ont donné Chloé – la chirurgienne qui m’a opéré -, les soignants, mes amis, ma famille, sinon en en faisant des personnages ? Si j’avais été charpentier, je leur aurais fait des tables et des chaises. Mon frère a été infiniment proche, cette histoire nous a rendus jumeaux alors que cinq ans nous séparent. Il était mon interface avec l’extérieur, nous étions arrivés, sans paroles, à un point de compréhension extraordinaire, presque à la vitesse de la lumière, en tout cas à la vitesse de l’amour fraternel. On va croire que je raconte « Le Manège enchanté », mais c’est vrai. […]
Écrire des chroniques pour « Libération » m’a aidé à sortir de ma condition de malade, chacune était un ballon d’oxygène, c’était un acte vital. Le livre, c’était différent. […]
Cette expérience m’a également enlevé le goût de juger. »
Et je finirai par ce qu’il disait dans l’interview de Léa Salamé citée en début d’article :
« Dans Le Lambeau, Philippe Lançon rend aussi hommage à « sa » chirurgienne, Chloé, la femme qui lui a permis de se reconstruire. « Ce processus m’a appris que le patient est quelqu’un qui doit y mettre du sien, absolument, ce n’est pas un enfant ou un oiseau qui attend la béquée ».
Son nouveau visage, trois ans après l’attaque, « n’est pas si différent de ce qu’il était avant ». « Si je me regarde dans une glace ou sur une photo, c’est plus moi. C’est une vision psychologique, moi je sais que mon visage a changé mais c’est surtout à l’intérieur que j’ai changé ». »
<1188>
-
Vendredi 8 février 2019
« Où atterrir ? »Bruno LatourLundi j’évoquais un ouvrage sur la démocratie, aujourd’hui c’est l’écologie qui est au cœur de la réflexion et du livre de Bruno Latour : « Où atterrir ? Comment s’orienter en politique » aux éditions La Découverte.
C’est encore un livre que j’aurais voulu lire avant d’en parler. Je n’y ai pas renoncé, mais ce n’est pas pour tout de suite. Or cet ouvrage date déjà d’octobre 2017.
J’en ai entendu parler lors de la Grande Table du 09/10/2017 : « La nature politique de Bruno Latour »
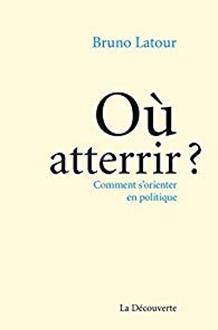 Bruno Latour est Agrégé de philosophie et s’est intéressé par la suite à l’anthropologie. Mais depuis quelques années son sujet central de réflexion principal est celui de l’écologie.
Bruno Latour est Agrégé de philosophie et s’est intéressé par la suite à l’anthropologie. Mais depuis quelques années son sujet central de réflexion principal est celui de l’écologie.
Si vous vous intéressez un peu à ce philosophe, vous lirez un peu partout : « Bruno Latour est l’auteur français le plus cité et le plus traduit dans le monde. »
Le point central de sa réflexion est ce constat que la modernité, la globalisation économique telle qu’elle est lancée ne dispose pas d’une Terre, c’est-à-dire d’une planète qui permette de s’épanouir.
Il a utilisé dans son ouvrage précédent le terme de « GAIA » qui dans la mythologie grecque est une déesse primordiale identifiée à la « Déesse mère » pour essayer d’illustrer sa démarche.
Cet ouvrage précédent « Face à Gaïa » avait pour sous-titre : « Huit conférences sur le nouveau régime climatique »
La Présentation de ce livre explique :
« Gaïa n’est pas le Globe, n’est pas la Terre-Mère, n’est pas une déesse païenne, mais elle n’est pas non plus la Nature, telle qu’on l’imagine depuis le XVIIe siècle, cette Nature qui sert de pendant à la subjectivité humaine. La Nature constituait l’arrière-plan de nos actions.
Or, à cause des effets imprévus de l’histoire humaine, ce que nous regroupions sous le nom de Nature quitte l’arrière-plan et monte sur scène. L’air, les océans, les glaciers, le climat, les sols, tout ce que nous avons rendu instable, interagit avec nous. Nous sommes entrés dans la géohistoire. C’est l’époque de l’Anthropocène. Avec le risque d’une guerre de tous contre tous.
L’ancienne Nature disparaît et laisse la place à un être dont il est difficile de prévoir les manifestations. Cet être, loin d’être stable et rassurant, semble constitué d’un ensemble de boucles de rétroactions en perpétuel bouleversement. Gaïa est le nom qui lui convient le mieux. »
« Où atterrir » est la suite de cette réflexion.
Et en effet, s’il n’existe pas de planète, de terre, de sol, de territoire pour y loger le Globe de la globalisation vers lequel tous les pays prétendent se diriger, pour vivre tous comme des américains, il s’agit d’atterrir. C’est-à-dire prendre en compte les contraintes et les ressources dont on dispose.
Pour présenter ce livre Philosophie Magazine écrit :
« L’élection de Donald Trump a fait sortir Bruno Latour de ses gonds. […] posons les pièces du Meccano – c’est le côté empirique, presque bricoleur, de Latour : la globalisation dérégulée, le creusement vertigineux des inégalités, le climatoscepticisme, le Brexit, l’accès de Trump à la présidence américaine, l’amplification des migrations en Europe, la crispation des identités locales et des frontières, la signature des accords de Paris après la COP21. Pour le pire ou le meilleur, certains éléments soufflent vers le global, d’autres ramènent au lopin.
Latour les articule ensemble autour d’un axe : le Nouveau Régime Climatique (notion qu’il élaborait dans Face à Gaïa, 2015) qui nous requiert.
Car nous le savons, nous commençons à l’éprouver, la planète ne survivra pas aux rêves exponentiels de modernisation, l’épreuve commune à tous sera, est déjà pour des millions de migrants, « de se retrouver privé de terre ». Cette évidence, insiste Latour en serrant ses boulons, la poignée « d’élites » qui dérégulent à tour de bras l’a comprise dès la fin des années 1980. C’est pourquoi elles nient énergiquement le réchauffement climatique pour, tant qu’il est encore temps et avant la panique générale, faire main basse sur les richesses et se mettre à l’abri hors du monde, « hors sol » (la thèse est « abrupte », Latour nous avait prévenus !).
La Grande-Bretagne, patrie du capitalisme, et les États-Unis, principaux responsables des inégalités mondiales et du dérèglement climatique, choisissent de faire sécession du monde commun en s’isolant en forteresses. Trump dénonce les accords de Paris sur le climat, promet le profit maximal réservé à la seule Amérique et ferme les frontières. […]
Le plus intéressant vient ensuite, […] Il s’agit en gros de réorienter la tension de l’axe du progrès entre le « Global » (la Terre vue de haut à la manière des idéaux des Modernes) et le « Local » (l’attachement au territoire), sur lequel se déterminait la partition gauche/droite, en le triangulant avec un troisième pôle attracteur : le « Terrestre », qui permettrait au local de s’ouvrir et au global de reformater ses horizons infinis. Attachement et détachement, sortir à la fois de l’illusion des frontières et de celle d’un « Grand Dehors », tel est le programme pour rendre le monde, le seul que nous ayons, habitable et partageable par tous.»
En exergue de livre, Bruno Latour a ironiquement fait figurer une phrase de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump : « Nous avons assez lu de livres. »
Il émet surtout une hypothèse qu’il avoue ne pas pouvoir démontrer et qui est cité plus précisément par <MEDIAPART> :
« Tout cela participe du même phénomène : les élites ont été si bien convaincues qu’il n’y aurait pas de vie future pour tout le monde qu’elles ont décidé de se débarrasser au plus vite de tous les fardeaux de la solidarité – c’est la dérégulation : qu’il fallait construire une sorte de forteresse dorée pour les quelques pour cent qui allaient pouvoir s’en tirer – c’est l’explosion des inégalités ; et que pour dissimuler l’égoïsme crasse d’une telle fuite hors du monde commun, il fallait absolument rejeter la menace à l’origine de cette fuite éperdue – c’est la dénégation de la mutation climatique. »
Pour Bruno Latour, nous serions face à une situation où, pour « reprendre la métaphore éculée du Titanic : les gens éclairés voient l’iceberg arriver droit sur la proue, savent que le naufrage est assuré, s’approprient les canots de sauvetage ; demandent à l’orchestre de jouer assez longtemps des berceuses pour qu’ils profitent de la nuit noire pour se carapater avant que la gîte excessive alerte les autres classes ! ».
Qu’une partie importante des classes dirigeantes soit arrivée à la conclusion que, si elles « voulaient survivre à leur aise, il ne fallait plus faire semblant, même en rêve, de partager la terre avec le reste du monde »
Et MEDIAPART pour renforcer cette accusation cite :
« l’article traduit dans le numéro 7 de la Revue du Crieur. Celui-ci montre que les ultrariches de la Silicon Valley ou des startups new-yorkaises, pourtant censés afficher leur confiance en l’avenir technologique de l’homme, commencent en réalité à stocker vivres et munitions, à acheter des terrains reculés, à se faire construire des bunkers de luxe et à se faire opérer des yeux pour survivre dans un monde où l’on ne pourra pas acheter ses lentilles de contact en bas de chez soi… »
Pour lui il semble donc que le déni climatique, la dérégulation économique et financière soient 3 faces de la même réalité.
<Le journal Les inrocks> lui pose la question qui vient naturellement concernant le complotisme de cette hypothèse :
« Vous estimez que les élites ont abandonné l’idée de monde commun. Elles auraient saisi la réalité des alertes sur le réchauffement et en seraient arrivées à la conclusion qu’il n’y aurait plus assez de place sur terre pour elles et pour le reste de ses habitants. Elles auraient alors mis en place une stratégie de dénégation du changement climatique pour déréguler et s’accaparer plus de richesses. Assumez-vous l’accent complotiste d’une telle théorie ?
Oui, cela peut sentir la théorie du complot, mais vous savez, le problème, c’est que les complots sont parfois exacts. Et en plus, celui là est au grand jour. Hier encore le ministre de l’environnement de Donald Trump a suspendu la seule mesure un peu ferme qu’avait pris Barack Obama pour diminuer les émissions étatsuniennes de CO2. Il ne s’agit pas ici d’un complot souterrain que j’aurais inventé mais d’une décision publique qui confirme exactement ce que je dis : la seule politique cohérente du gouvernement Trump – tout le reste est complètement chaotique – c’est l’organisation du déni climatique. C’est quand même très impressionnant. L’argument de l’abandon de la solidarité par les élites, là, j’avoue, je n’ai pas de preuves directes que cela a un lien avec la réalisation de la crise écologique. »
Bruno Latour affirme ainsi dans plusieurs interventions :
« Les super-riches ont renoncé à l’idée d’un monde commun »
Vous pourrez aussi lire cet entretien publié par « L’Obs » : Réchauffement climatique : le « J’accuse » de Bruno Latour
J’en tire les extraits suivants :
« C’est un réquisitoire cinglant. Le dernier essai de Bruno Latour s’appelle «Où atterrir?». Et dès les premières pages, le philosophe s’interroge sur l’étrange passivité de l’humanité devant le réchauffement climatique. […]
Plus grave encore au regard des normes actuelles du débat public: Latour prend la défense du peuple, y compris quand celui-ci se détourne de la mondialisation, se met à avoir peur, réclame un sol, une tradition, une identité… Latour, universitaire globe-trotter et citoyen du monde, virerait-il populiste? Non. Simplement, écrit-il, il faut avant de juger se rappeler que «ce peuple a été froidement trahi», qu’il a été «abandonné en rase campagne» par ceux qui avaient la charge de maintenir le monde commun. A l’oral, recevant «l’Obs», il est encore plus cash.
« Ma proposition est la suivante: au lieu d’accuser les gens d’être des réactionnaires ou des populistes, d’être des connards, on devrait leur dire que, oui, c’est vrai, on s’est mal orienté.» »
Il a une façon très drôle de prononcer «connard», imitant le mépris de classe qui suinte de tant de discours actuels sur les classes populaires. Dans son livre, il lui arrive d’avoir la dent très dure avec ces «super-riches» qui vivent «hors-sol», accumulant les miles à forcer de sillonner la planète…
[…]
Le Moderne s’est placé en surplomb de la nature et aujourd’hui, celle-ci se venge. Son essai, qui sort cette semaine, prend le temps d’expliquer ce retournement:
« Voilà que sous le sol de la propriété privée, de l’accaparement des terres, de l’exploitation des territoires, un autre sol, une autre terre, un autre territoire s’est mis à remuer, à trembler, à s’émouvoir», écrit-il avec son style imagé.» »
[…]
A l’étranger, son œuvre jouit depuis longtemps d’une influence immense. Un classement en a fait le dixième penseur le plus cité au monde. L’Allemand Peter Sloterdijk, la Belge Isabelle Stengers (qui a popularisé le thème de Gaïa), l’Américaine Donna Haraway (auteur du «Manifeste cyborg») ou l’ethnopsychiatre français Tobie Nathan se sont nourris de ses travaux. »
Il y a aussi l’entretien de Bruno Latour dans Libération : «Avec le réchauffement, le sol se dérobe sous nos pieds à tous» publié en mars 2018
Dans cet article l’attitude de Trump de sortir de l’accord de Paris est analysé comme une clarification des positions :
«Le détonateur du livre est la sortie des Etats-Unis de l’accord de Paris, le 1er juin 2017. Pour la première fois, un gouvernement assume le fait que l’humanité se sépare désormais en deux, que «nous, les nantis, n’appartenons pas à la même Terre que vous, et que vous mourrez avec elle». En quoi cette décision nous aide-t-elle à définir un cap politique ?
Les hommes politiques ont longtemps maintenu une hypocrisie de façade, personne n’avait osé rompre ainsi. On reconnaissait qu’il y avait des problèmes écologiques, mais on disait que le développement allait continuer et qu’il serait partagé, à terme, avec tout le monde. Or c’est la première fois que le pays le plus responsable de cette situation, avec l’Europe et la Chine, dit «non, nous ne partagerons pas, ce qui vous arrive ne nous arrive pas». Cela a permis, au moins, de mettre la question écologique au centre de la politique. »
Vous pourrez trouver encore de nombreux éclaircissements sur cette réflexion :
Quoi de mieux que d’aller à la source : une conférence de Bruno Latour de 1h43 à l’AGORA DES SAVOIRS : <Bruno Latour – Où atterrir ? : Comment s’orienter en politique>
<Et puis ce remarquable entretien dans la Revue Esprit>
Il y a aussi ces deux émissions de France Culture : <Objectif Terre !> et <Bruno Latour, le nouveau régime climatique> dans laquelle est également évoqué le livre « L’entraide. L’autre loi de la jungle – Pablo Servigne et Gauthier Chapelle » qui a déjà fait l’objet d’un mot du jour : le 18 décembre 2017
Il peut aussi être intéressant de lire ce billet de blog qui critique le livre de Bruno Latour : « Faut-il monter dans l’avion de Bruno Latour ? »
<1187>
-
Jeudi 7 février 2019
« Un homme qui lit en vaut deux »Edmond CharlotMardi, j’ai parlé du livre de Frédéric Gros « Désobéir ».
Hier, j’ai rappelé un mot du jour d’il y a 4 ans qui parlait des bibliothèques.
Et aujourd’hui, je vais évoquer un homme exceptionnel, qui était un insoumis et qui était un libraire, un bibliothécaire et un éditeur.
Edmond Charlot est cet homme qui disait non.
Il est connu comme le premier éditeur d’Albert Camus.
 Edmond Charlot est né en 1915 à Alger, alors que l’Algérie était colonie française.
Edmond Charlot est né en 1915 à Alger, alors que l’Algérie était colonie française.
Wikipedia nous apprend que sa famille était de longue date en Algérie puisque son arrière-grand-père paternel débarque en 1830 en Algérie et que ses ancêtres maternels, y sont arrivés en 1854.
Il croise Albert Camus au lycée d’Alger et leur professeur de philosophie commun, Jean Grenier encouragea Camus à écrire et conseilla à Edmond Charlot de se lancer dans l’édition
Et c’est ainsi que Charlot édita à Alger, en mai 1937, le premier livre d’Albert Camus : « L’envers et l’Endroit » qui est dédié à Jean Grenier.
Mais avant cette première, Edmond Charlot, sous ses initiales « E. C. », avait publié en mai 1936 (à 500 exemplaires) « Révolte dans les Asturies », pièce de théâtre collective écrite d’après un scénario de Camus et interdite par la municipalité d’Alger. Dès le début de sa vie d’adulte (21 ans) Edmond Charlot su dire Non et braver les interdits.
Mais sa première grande aventure fut d’ouvrir un lieu singulier et exceptionnel. Il demanda à Jean Giono l’autorisation d’utiliser le titre de son livre paru en 1936 : « Les Vraies Richesses ».
Je cite wikipedia :
«Edmond Charlot ouvre le 3 novembre 1936 à Alger, 2 bis rue Charras, à deux pas des facultés, une minuscule librairie « Les Vraies richesses », offrant Rondeur des jours de Giono, qu’il publie à 350 exemplaires sous la même enseigne, à ses premiers clients. Tout à la fois bibliothèque de prêt, maison d’édition et galerie d’art (des dessins et trois toiles de Bonnard y sont exposés dès l’ouverture pendant trois mois), elle devient l’un des principaux lieux de rencontre des intellectuels d’Alger, écrivains, journalistes et peintres »
Et à l’entrée de cette librairie, bibliothèque, maison d’édition, galerie d’Art, Edmond Charlot avait affiché cette phrase : « Un homme qui lit en vaut deux ».
C’est ce qu’a raconté Kaouther Adimi dans l’émission « La grande librairie » où elle était venu présenter son livre « Nos richesses » qui évoque le personnage d’Edmond Charlot et surtout sa librairie, bibliothèque « Les vraies richesses » qui existe encore, la rue a été rebaptisé Hamani.
J’ai découvert cette histoire, ce personnage et l’écrivaine algérienne Kaouther Adimi née en 1986, aussi à Alger, alors que je faisais des recherches sur désobéir de Frédéric Gros qui était invité de cette même émission..
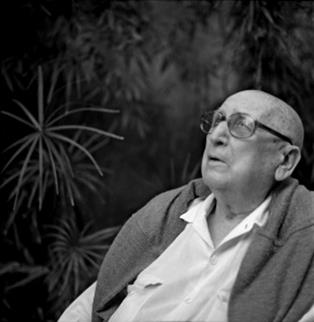 La BNF avait commémoré le centième anniversaire d’Edmond Charlot et décrit ainsi son aventure :
La BNF avait commémoré le centième anniversaire d’Edmond Charlot et décrit ainsi son aventure :
« En 1936, Edmond Charlot (1915-2004), soutenu par son professeur de philosophie Jean Grenier, ouvre en plein cœur d’Alger une librairie, « Les Vraies Richesses », qui publie notamment les premières œuvres d’Albert Camus et prend immédiatement place dans la vie littéraire et culturelle algéroise. Le débarquement allié du 8 novembre 1942 favorise l’essor des éditions Charlot, qui étendent leur champ de publication aux auteurs de la France combattante puis à la littérature méditerranéenne. À la Libération, la maison d’édition tente l’aventure parisienne, tout en maintenant son siège social à Alger. Elle s’ouvre alors aux plus grands noms de la littérature internationale et aux jeunes auteurs français. Après une percée spectaculaire, elle disparaît à la fin des années 1940, affaiblie par des difficultés économiques et par la forte concurrence qui divise l’édition française au lendemain de la guerre. Edmond Charlot poursuit alors ses activités de libraire-éditeur sous d’autres horizons, et joue un rôle de médiateur culturel aussi bien dans le monde de la radio que dans celui de la coopération.
Ce colloque vise à montrer le contexte historique dans lequel est née cette maison d’édition, à mettre l’accent sur son développement et sur les hommes, auteurs et administrateurs, qui l’ont permis, à souligner enfin l’originalité et les innovations des éditions Charlot dont les ouvrages sont aujourd’hui recherchés par les bibliophiles. Il veut également illustrer la diversité des engagements d’Edmond Charlot, au service de la littérature, de l’information et de la culture. »
Charlot a côtoyé et édité les plus grands écrivains et intellectuels de son temps, de Camus à Giono, en passant par André Gide, Vercors, Bernanos, Moravia, Saint Exupery, Frison Roche, Joseph Kessel…
Il participa aussi aux activités de la France Libre et publia à Alger « Le silence de la mer » de Vercors qui était un ouvrage interdit par le Régime de Vichy. Il fit d’ailleurs de la prison mais pu être rapidement libéré grâce à l’intervention d’une de ses connaissances auprès du Ministre de l’Intérieur.
Le reste peut être lu sur la page wikipedia qui lui est consacré
En septembre 1961, pendant la guerre d’Algérie Edmond Charlot subit, comme « libéral » opposé à tous les attentats, deux plasticages attribués à l’OAS qui détruisent la quasi-totalité de ses archives, de sa correspondance et des notes de lecture de Camus. Le directeur de Radio-France à Alger lui confie alors la réalisation de pages culturelles quotidiennes. En décembre 1962, quand la radio est remise à l’Algérie, il revient à Paris.
Il aura ainsi diverses activités culturelles à Paris mais décèdera en avril 2004, presque aveugle et dans une situation financière assez dégradée à Béziers.
Vous pourrez visionner <interview d’Edmond Charlot réalisée au printemps 2003> par RFI.
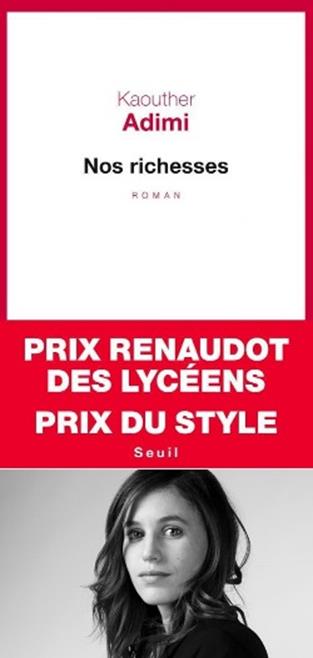 Cette destinée donne vraiment envie de lire le roman Kaouther Adimi : « Nos Richesses »
Cette destinée donne vraiment envie de lire le roman Kaouther Adimi : « Nos Richesses »
Beaucoup d’articles sont consacrés à ce livre et en regard au destin d’Edmond Charlot.
Ainsi « L’Humanité » : « Entrée dans les Vraies Richesses d’Edmond Charlot »
Kaouther Adimi explique notamment :
« C’était un homme hors du commun. J’ai pour lui une immense affection sans l’avoir jamais rencontré. Il ouvre sa librairie-maison d’édition à seulement 20 ans, avec ce slogan : « Des jeunes par des jeunes pour des jeunes. » C’est ambitieux. Il aime la littérature avec passion. C’est sa boussole. Durant la Seconde Guerre mondiale, il manque de papier. Il doit à cause de cela refuser l’Étranger de Camus. Charlot est le grand éditeur résistant de la France libre. Il est en lien avec de Gaulle. Pourtant, à la fin du conflit, il est quasiment oublié. À Paris, ses concurrents ne lui laissent aucune place. Il est mis à la porte de sa maison d’édition par ses amis, ceux qu’il avait accueillis à bras ouverts… Rentré à Alger complètement ruiné, il remonte une nouvelle librairie qu’il nomme Rivages. Il se fait plastiquer à deux reprises. Il ne renonce pas pour autant. À la retraite, il s’installe à Pézenas, où il ouvrira avec sa femme une ultime petite librairie.
J’ai emprunté des éléments d’information à partir d’interviews. J’ai effectué un travail considérable sur les archives existantes, sans me priver d’inventer. Je le fais notamment réagir sur les massacres de Sétif en 1945, alors qu’il était à Paris.
Il est très jeune quand il édite la pièce de Camus Révolte dans les Asturies, interdite par le maire d’Alger. Il publiera Vercors. Étiqueté comme résistant libéral, il aura maille à partir avec les communistes. Son grand projet : éditer tous les auteurs de la Méditerranée quels qu’ils soient. Je n’ai pas voulu faire l’impasse sur le contexte historique, en m’efforçant toutefois de ne rien figer. Dans le texte, j’utilise le « nous », qui me permet de raconter en même temps la petite et la grande histoire. Ce « nous » appartient à la mémoire collective, c’est le « nous » de ceux qui habitent le pays. J’ai imaginé la fermeture de la librairie comme simple prétexte narratif pour mieux raconter le lieu. J’avais en tête l’anecdote – je l’ai d’ailleurs utilisée – selon laquelle Edmond Charlot, pensant que sa librairie avait dû baisser le rideau, aurait dit en riant : « Peut-être qu’aujourd’hui on y vend des beignets. » J’ai voulu pointer du doigt le peu d’intérêt qu’on a le plus souvent pour ce type de lieux si essentiels. J’ai été récemment peinée par la disparition de certaines librairies à Alger, comme la librairie l’Espace Noun. La librairie des Beaux-arts, rue Didouche Mourad, a échappé in extremis au même sort.
[…] Par bonheur, le local des Vraies Richesses est toujours ouvert et l’on y trouve des livres d’Edmond Charlot. C’est une bibliothèque de prêt. »
Sur le site de France Info : « L’hommage de Kaouther Adimi à Edmond Charlot »
Il y aussi cette page : <Les richesses que dévoile Kaouther Adimi>
Et ces blogs :
<Les librairies d’Edmond Charlot>
< Edmond Charlot, reviens la littérature algérienne a besoin de toi >
Une belle rencontre.
Je ne sais pas si homme qui lit en vaut exactement deux, mais il est certain qu’il grandit intérieurement.
<1186>
-
Mercredi 6 février 2019
« Repos »Un jour sans mot du jourComme je l’avais annoncé lors du mot du jour du 28 janvier 2019 il peut arriver que je n’aie pas eu le temps de finaliser un mot du jour. C’est le cas aujourd’hui.
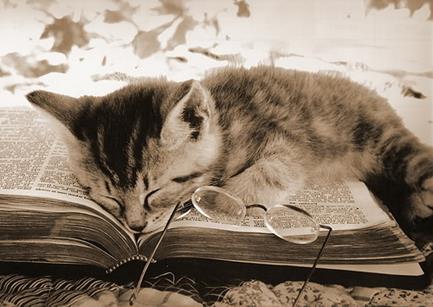 Mais si voulez quand même de la lecture, je vous propose le mot du jour écrit pour un 6 février….mais de l’année 2015
Mais si voulez quand même de la lecture, je vous propose le mot du jour écrit pour un 6 février….mais de l’année 2015
«L’exception française ce n’est pas la non ouverture des magasins le dimanche, L’exception française c’est la non ouverture des bibliothèques»
Patrick Weil
Historien et spécialiste des questions de citoyenneté et d’immigration, Patrick Weill était l’invité du 7-9 de France Inter de ce mercredi 4 février sur le thème de la laïcité.
Je vous donne, à la fin du message, le lien vers la page de cette émission très intéressante.
Il dit des choses simples : « la laïcité c’est le droit de pratiquer sa Foi et le droit de blasphémer, l’un ne va pas sans l’autre »
Il tient aussi des propos plus iconoclastes « Qu’on laisse en paix les femmes voilées »
Mais ce qui m’a surtout interpellé ce sont les propos qu’il a tenu sur les bibliothèques. Il faut savoir qu’il est président de Bibliothèques Sans Frontières, ONG française, à but non lucratif, également présente en Belgique, au Mexique, aux États-Unis et au Portugal qui vise à faciliter l’accès au savoir dans les pays en voie de développement par l’appui au développement des fonds des bibliothèques, des écoles et des universités, la formation de documentalistes, l’informatisation de centres documentaires et la structuration de réseaux de bibliothèques.
Il a dit notamment
« Vous savez combien de temps ouvre en moyenne une bibliothèque publique en France ? 15 heures par semaine
Il n’y a que 6% des bibliothèques françaises qui ouvrent 30 heures ou plus.
A Amsterdam ils ouvrent 70 heures.
C’est à dire que ce grand pays de la culture, de la laïcité a ses bibliothèques fermés.
Il y a un projet de Loi en discussion actuellement qui projette d’ouvrir les magasins, en France, le dimanche
L’exception française ce n’est pas la non ouverture des magasins le dimanche, en Allemagne ils sont fermés.
L’exception française c’est la non ouverture des bibliothèques
C’est là qu’on peut se cultiver […]
C’est là que les enfants qui n’ont pas l’internet, pas de livres chez eux peuvent aller travailler dans le calme
Vous savez Steve Jobs et Bill Gates n’ont pas préparé la création de leurs entreprises dans les magasins le dimanche, mais dans les bibliothèques.
Aux Etats Unis les bibliothèques sont ouverts jour et nuit.»
http://www.franceinter.fr/emission-le-79-patrick-weil-on-doit-pouvoir-croire-et-pouvoir-blasphemer
Il parle des bibliothèques dans la seconde vidéo de la page un peu après 5 mn.
Moi qui croyais de Steve Jobs et Bill Gates avaient commencé leur fabuleuse aventure dans des garages, mais à y bien réfléchir probablement que Patrick Weil a raison ils ont certainement commencé dans les bibliothèques.
<Mot sans numéro>
-
Mardi 5 février 2019
« Désobéir »Frédéric GrosUn matin je suis entré dans mon bureau professionnel et j’ai trouvé devant mon ordinateur un article du magazine « Elle » qui avait pour titre « Désobéir : comment l’insoumission peut nous rendre plus libre et heureux ».
Un esprit bienveillant avait semé une réflexion qui ne pouvait que féconder mon esprit.
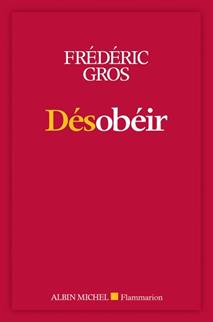 Désobéir, dire « Non » c’est poser un acte qui souvent va avoir des conséquences.
Désobéir, dire « Non » c’est poser un acte qui souvent va avoir des conséquences.
En 1940, De Gaulle a dit « Non ». La France d’alors, c’est-à-dire le gouvernement nommé par le Maréchal Pétain qui lui-même avait été désigné par l’Assemblée démocratiquement élue par les Français et qui était donc légitime pour donner le pouvoir au vieux Maréchal, a condamné le général de Gaulle à mort. Mais le général a continué à dire «Non » et à organiser la France libre. Il a même tenté d’organiser la résistance et en tout cas il a contesté la légitimité du régime de Vichy. Aujourd’hui l’Histoire, la France et le Monde disent qu’il a eu raison de dire « Non ».
J’avais déjà consacré un mot du jour à ce sujet, c’était celui <du 28 mars 2013>, un des 100 premiers.
Je citais le philosophe Alain : « Penser, c’est dire non ». Il ajoutait :
«Remarquez que le signe du oui est d’un homme qui s’endort ; au contraire le réveil secoue la tête et dit non. »
Et je citais aussi sa conclusion :
« Et ce qui fait que le tyran est maître de moi, c’est que je respecte au lieu d’examiner.
Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par cette somnolence.
C’est par croire que les hommes sont esclaves.
Réfléchir, c’est nier ce que l’on croit.
Qui croit ne sait même plus ce qu’il croit.
Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. »
L’article posé sur mon bureau faisait référence à un livre du philosophe Frédéric Gros : « Désobéir » qui venait d’être publié en septembre 2017.
La couverture du livre est rouge, le rouge de la colère, le rouge de la révolte.
Le mot « obéir » est écrit en blanc mais il est précédé par un préfixe « Dés » écrit en jaune, probablement une prémonition des « gilets jaunes »
Peu de temps après, toujours en référence à la sortie de ce livre j’ai pu entendre Frédéric Gros s’exprimer sur France Culture, dans l’émission « Matières à penser d’ Antoine Garapon » du 28/09/2017 : « C’est confortable d’obéir »
Antoine Garapon a présenté cet entretien par cette réflexion :
« [Frédéric gros s’interroge […] sur l’acte d’obéir, ou mieux, de surobéir, c’est-à-dire d’anticiper le désir du maître. Il trace la voie fragile – mais la seule qui puisse convenir à un homme démocratique – d’une obéissance à soi qui ne se confond pas avec le désir. »
Dans l’article de « Elle » que vous trouverez derrière ce <lien> il disait notamment :
« Le creusement abyssal des inégalités sociales et la dégradation précipitée de la nature, pour ne citer que deux exemples, ne provoquent pas de levée en masse. Seulement des mouvements de protestation très diffus. Qu’est-ce qui fait que l’on accepte l’inacceptable ? À quoi obéit-on ? C’est le point de départ de ma réflexion…
[…] Ce qui fait que l’on obéit, c’est d’abord la soumission. On a peur du coût de notre désobéissance, parce qu’elle peut avoir un effet en retour très fort, comme se faire bannir, humilier, rembarrer… Mais cela ne suffit pas. Il y a aussi une part secrète en nous, un peu maudite, qui est le désir, et même le plaisir d’obéir. Désobéir est plus complexe qu’il n’y paraît. »
Et il évoque justement cette tendance à «Sur-obéir »
« Mais souvent on va au-delà de la contrainte objective on « sur-obéit ». Pour se faire bien voir, pour faire plaisir au chef, pour la reconnaissance de ses pairs… Il y a quelque chose du syndrome de l’enfant sage en chacun d’entre nous. « Sur-obéir » pour avoir une reconnaissance, c’est un leurre immense que l’on traîne depuis l’enfance. Personne ne vous en saura gré du moment que vous faites bien votre boulot. L’illusion qui consiste à exprimer une demande d’amour par l’obéissance est une tromperie qui accentue notre propre aliénation. »
Il parle aussi du soulagement à obéir :
« Sans doute qu’obéir à tout, se réfugier dans une continuité docile, nous soulage du vertige existentiel. Peut-être cette obéissance fait-elle écran à la responsabilité si troublante d’avoir à répondre de sa vie, de savoir pourquoi on la vit. Dans « La Désobéissance », Alberto Moravia raconte que la première désobéissance, c’est d’arrêter de faire comme si tout était normal et évident. Mais cela peut ouvrir sur des questionnements douloureux. On répète comme une vérité que nous sommes nés pour la liberté, qu’elle serait l’objet de notre désir le plus profond, mais la veut-on vraiment ? Au fond, elle nous terrorise. L’obéissance a ceci de confortable qu’on laisse les autres décider et penser à notre place »
Et il oppose à l’obéissance du clan, de la tribu au partage de l’incertitude possible en amitié :
« Il y a une manière de faire société dans l’obéissance. C’est ce que j’appelle la condition tyrannique : se retrouver ensemble, réunis et soudés par l’obéissance au même chef, aux mêmes idées, aux mêmes injonctions. Mais la véritable amitié, c’est être prêt à partager avec quelqu’un ses incertitudes et ses inquiétudes par la parole, dans l’échange de nos petits bouts de vérité. Cet échange fait tomber le pouvoir dans ce qu’il a de plus tyrannique, c’est-à-dire l’adoration béate d’une seule vérité. »
Et il cite : La Boétie
« À force d’obéir, vous devenez les traîtres de vous-mêmes. […] Pour être libre, il suffit de le vouloir. ».
Pour parler de son livre, Frédéric Gros avait été aussi invité par « La Grande Librairie »
Vous pouvez lire aussi ce long article « des Inrocks » : « Les vertus de la désobéissance »
J’en picore encore quelques fulgurances :
« [Pour] La Boétie, le Discours sur la servitude volontaire « être libre, c’est d’abord s’émanciper du désir d’obéir, assécher en soi la passion de la docilité, cesser de travailler, soi-même depuis soi-même, à sa propre aliénation, faire taire en soi le petit discours intérieur qui légitime d’avance la puissance qui m’écrase »
Et aussi :
« la figure d’Antigone, icône culturelle de la révolte, nous invite à la désobéissance fière, publique, insolente. Ne cédant jamais à elle-même et à la loi de la communauté contre l’Etat, elle sombre dans la désobéissance tragique. « Antigone, dans sa désobéissance, n’affirme pas un ordre contre un autre ; elle inquiète la possibilité même de l’ordre ».
De l’ironie sceptique à la provocation cynique, incarné par Diogène, il existe d’autres façons de s’opposer au conformisme de masse, celui des traditions, des conventions et des rites. Diogène est celui qui se refuse à céder à la grande tromperie : « appeler naturel ce qui n’est jamais que du normal ; et normal ce qui au fond n’est que du socialement respectable ».
[…]
De Socrate à Montaigne, de la désobéissance civile de Thoreau (auteur largement redécouvert depuis dix ans) à la vigilance critique de Kant et des Lumières, des penseurs nous disent que, jusqu’à un certain point, désobéir est responsable. « Etre responsable, c’est d’abord cela : sentir peser un fardeau sur mes épaules », écrit Gros. Sans devoir se sentir responsable de tout, au risque de brûler au cœur d’une « incandescence éthique », l’auteur nous invite à puiser en soi la force de désobéir à l’autre, qui n’est que le miroir d’une obéissance à soi-même. »
Il a aussi été l’invité de « L’heure bleue » de Laure Adler
Mais on comprend bien que désobéir, c’est une invitation à réfléchir, à philosopher, à penser.
Ce n’est pas dire « Non » à tout, c’est avoir le « Non » sélectif. C’est aussi savoir dire «Oui», mais un oui qui n’est pas de soumission, mais de réflexion.
Car l’addition des « Non » ne fait pas société, pour faire société il faut savoir se rassembler autour d’un certain nombre de « Oui ».
C’est le défi de notre société d’aujourd’hui.
<1185>
-
Lundi 4 février 2019
« Le peuple contre la démocratie»Yascha MounkCette semaine je vais présenter un certain nombre de livres sur lesquels j’ai lu des articles et surtout écouté des entretiens avec les auteurs de ces livres et que j’ai trouvé très intéressants.
J’aurai voulu les approfondir et même en lire certains avant d’en parler. Mais comme je vous l’ai expliqué lors du mot du jour du <Lundi 28 janvier 2018>, je dois poursuivre d’autres priorités.
Le premier livre concerne un sujet essentiel de l’actualité international et française : « la démocratie ». En effet la démocratie libérale, respectueuse du Droit, des règles constitutionnelles du respect de l’opposition et du respect tout court est de plus en plus bousculée, contestée et mise à mal. Malgré la stabilité, la prospérité et la sécurité qu’elle a pu engendrer depuis 70 ans, la démocratie libérale est en effet en train de céder partout dans le monde face aux assauts d’un contre-modèle populiste, autoritaire et réactionnaire. Incarné par Donald Trump, ce changement d’ère politique prend ailleurs le visage d’Erdogan, la voix d’Orban, la gestuelle de Maduro, les outrances de Salvini et les provocations de Farage. Critiquées par les experts, exposées par la presse et dénoncées par leurs opposants, ces nouvelles figures de la modernité politique enchaînent néanmoins, semble-t-il contre toute logique, les succès électoraux.
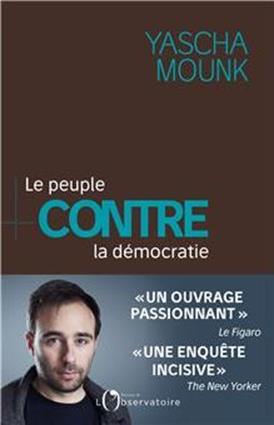 Ce livre a été publié le 29 août 2018
Ce livre a été publié le 29 août 2018
L’auteur en est Yascha Mounk, jeune politologue allemand, naturalisé américain. Il est à la fois universitaire, chercheur et chargé de cours à l’université Harvard à Boston, et journaliste indépendant écrivant pour le New York Times, The Wall Street Journal, Foreign Affairs, Slate et Die Zeit.
Si on creuse un peu davantage on comprend, selon Wikipedia, qu’il est né en 1982 à Munich et fils d’une émigrée polonaise ayant émigré avec ses parents en 1969 après avoir été autorisés à partir suite à la purge des Juifs de l’appareil communiste. En raison de ses origines, il se sentait toujours comme un étranger dans son pays de naissance, et bien que l’allemand soit sa langue maternelle, il ne s’est jamais senti accepté comme un « véritable Allemand » par ses pairs.
L’ouvrage qu’il a écrit « Le peuple contre la démocratie» a été très commenté sur les ondes de radio et dans les journaux.
Pour ma part je l’ai découvert lors des matins de France Culture du 4 septembre 2018 : « Pourquoi la démocratie ne fait plus rêver ? » dans laquelle il était invité.
Le débat a été présenté par Guillaume Erner de la manière suivante :
« Un monde en passe d’être englouti où il était possible de se contredire sans se haïr et de gagner sans écraser. Pourquoi la démocratie ne fait-elle plus rêver ? »
Lors de cette émission Yascha Mounk a dit notamment :
« On voit comment les populistes aiment à dire que si quelque chose ne va pas bien dans le monde, c’est toujours la faute des autres »…
« Si on regarde Viktor Orban en Hongrie, c’est peut-être le populiste le plus dangereux… Pour moi, le problème principal d’Orban, c’est qu’en Hongrie, il n’y a plus de média indépendant, l’opposition n’a pas une vraie chance de gagner les élections car le système électoral a été changé en faveur d’Orban. C’est ce qui met en danger la démocratie. Il change le système à un tel point que ce n’est plus possible de le chasser du pouvoir de manière démocratique. »
« A un certain moment, les peuples vont réaliser à quel point ils ont perdu de la liberté : en Hongrie, en Pologne, en Russie, en Turquie. »
Comment gérer la liberté religieuse dans une société laïque et multiethnique ? On peut clairement dire que la burqa est un problème dans une société libre mais il vaut mieux ne pas la criminaliser.
« ll y a 50 ans, les pays occidentaux avaient une idée mono ethnique d’eux-mêmes. Maintenant, avec 50-60 ans d’immigration dans leur histoire, cette idée commence à changer… C’est évidemment un progrès cette transition des sociétés mono ethniques en sociétés multiculturelles, mais je comprends que pour certains, cette transition est difficile, ils ont le sentiment d’avoir quelque chose à perdre. »
« Comment lutter contre ces populismes ? C’est très important de s’engager politiquement car une fois que ces systèmes politiques sont au pouvoir, c’est très difficile de les chasser. Même si on n’aime pas les partis établis, si on a certains problèmes avec les partis modérés, c’est très important de s’engager pour eux. Il y a aussi des causes plus structurelles sur la montée du populisme : il faut mener une politique économique pour le capitalisme le libre-échange mais qui s’assure que les avantages de ce système vont à des Français moyens. Il faut aussi se battre pour un patriotisme inclusif. »
Yascha Mounk était aussi l’invité du grand Face à Face de France Inter avec Ali Baddou, Natacha Polony : et Raphaël Glucksmann : <Emission du 10 novembre 2018>. Emission intéressante que j’ai également écoutée.
<Il a également répondu aux questions de Léa Salamé>
Pour les articles à lire, vous trouverez cette interview du <Magazine Littéraire> : « Nous vivons dans un système raisonnablement libéral mais insuffisamment démocratique »
Dans Telerama : « Les citoyens se détournent de la démocratie en nombre de plus en plus important »
Et sur le site de ce nouveau journal passionnant Usbek & Rica « Il n’y a jamais eu de système démocratique qui n’ait pas été capitaliste »
Dans Libération : « Yascha Mounk, lanceur d’alerte sur la démocratie en danger »
J’en tire l’extrait suivant :
« Rarement le livre d’un jeune chercheur étranger, inconnu ou presque en France, n’aura suscité un tel accueil. A commencer par celui du FigaroVox, la rubrique réac et souverainiste du Figaro, qui en a diffusé les premiers extraits en exclusivité sur son site, devançant un long entretien dans les colonnes du Point : «Un livre ambitieux dont on cherche l’équivalent hexagonal», encense l’hebdomadaire de la droite libérale. La Croix,
l’Express, France Culture, France Inter ou encore l’émission C Politiques sur France 5 se sont positionnés en queue de peloton de la tournée médiatique. Presque un paradoxe pour ce maître de conférences à l’Université de Harvard, «libéral de gauche» revendiqué, dont le livre propulsé «essai politique de la rentrée», le Peuple contre la démocratie (éd. de l’Observatoire, traduction de son best-seller The People vs. Democracy : Why Our Freedom Is In Danger And How to Save It), analyse les grandes tendances politiques à l’échelle planétaire.
[…] Affable et s’exprimant dans un français impeccable, il déroule le cœur de sa réflexion : une théorie sur la «déconsolidation démocratique», habilement construite entre la montée des populismes xénophobes et la confiscation du pouvoir par les technocrates. Le populisme est, analyse-t-il, la réaction à un système libéral de moins en moins démocratique. L’un entraînant l’autre, et inversement, jusqu’à l’usure de notre système politique. Un constat lucide qui cartonne outre-Atlantique. »
Le titre « Le peuple contre la démocratie » a pour première signification que si les autocrates ou des gens dangereux arrivent au pouvoir c’est parce qu’une partie du peuple votent pour eux et qu’une autre partie s’abstient et se désintéresse de la politique.
Je n’approfondis pas davantage, mais tous les liens que je donnent permettent d’en comprendre davantage sur la pensée de ce jeune et brillant politologue.
<Ici vous trouverez la page de Slate> sur laquelle sont répertoriés tous ses articles sur ce site.
<1184>
-
Vendredi 1er février 2019
« il n’y a pas d’ordre global du temps »Carlo RovelliJe vais donc terminer cette série de mots du jour sur le temps par une question abyssale : Le temps existe-t’il vraiment ?
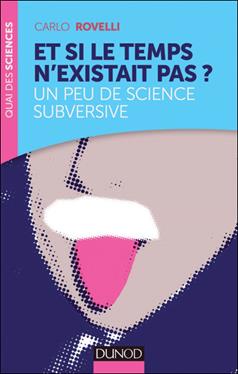 La réponse des scientifiques est clairement négative. Cela est pour nous autres humains, absolument contre-intuitif. Je vais essayer dans ce mot du jour d’expliquer ce que j’ai compris à l’aide du physicien italien Carlo Rovelli.
La réponse des scientifiques est clairement négative. Cela est pour nous autres humains, absolument contre-intuitif. Je vais essayer dans ce mot du jour d’expliquer ce que j’ai compris à l’aide du physicien italien Carlo Rovelli.
Né le 3 mai 1956 à Vérone, Carlo Rovelli est un physicien italien spécialiste de la physique quantique.
Carlo Rovelli a écrit plusieurs ouvrages sur le temps et notamment « Et si le temps n’existait pas ? »
C’est vers lui que le journal « Quartz » de New York s’est tourné pour avoir des éclaircissements sur ce sujet. Et l’article publié le 17 mai 2018 a été repris par <Le numéro de Courrier International> que Jean-François m’a offert avec l’injonction d’en faire des mots du jour.
Certains lecteurs m’expliquent qu’ils ne comprennent pas toujours ce que j’écris.
Je dois concéder qu’aujourd’hui je suis à la limite de ma propre compréhension.
Je publie d’ailleurs à dessein ce mot vendredi pour vous laisser le week end pour le lire à tête reposée.
Mais pour essayer de partir sur de bonnes bases, il faut poser deux fondements à notre réflexion.
Le premier concerne « Le temps » en lui-même. Quand Carlo Rovelli ou d’autres remettent en cause du « temps », de quoi parle t’il ?
Parce que parallèlement Courrier International a également traduit un article du journal « Motherboard » de New York : « Il lit l’heure dans les atomes » qui parle d’un scientifique américain d’origine chinoise Yun Ye qui par ses travaux a inventé l’horloge la plus précise du monde en utilisant le strontium 87. Cette horloge est d’une précision défiant aussi notre raison. Elle est définie dans l’article de la manière suivante :
« Si elle avait fonctionné depuis le big bang, il y a 13,8 milliards d’années elle n’aurait dérivé que d’une seule seconde »
Par comparaison une horloge au césium révolutionnaire inventé en 1955 par Louis Essen et Jack Parry se serait écartée d’une seconde en 300 ans.
Comment sortir de cette contradiction de mesurer de plus en plus finement un élément qui n’existe pas ?
Parce que nous verrons plus loin que le temps existe localement, par exemple sur la terre et encore à un endroit délimité de la terre. Et dans ce cadre on peut mesurer très précisément le temps qui s’écoule.
« Le temps » qui est remis en question est le temps universel permettant de dégager une chronologie universelle. Une autre manière d’aborder ce sujet serait de dire qu’on est capable de déterminer « un maintenant » c’est-à-dire un présent où on serait en mesure de dire : à ce moment précis il se passe telle chose sur terre, telle autre chose sur l’étoile SIRIUS et telle autre chose au niveau atomique dans un noyau d’hydrogène. Ce « maintenant» n’existe pas.
Dans son commentaire au mot du 24 janvier 2019, Etienne m’a lancé un défi : « « Oui mais la version linéaire est limitée et fausse à grande échelle. » J’attends la démonstration ». Et bien cette démonstration va être faite dans l’infiniment grand et l’infiniment petit.
Le second fondement concerne la science. Vous savez qu’il existe la mécanique quantique qui décrit l’infiniment petit et la relativité générale qui décrit l’univers et l’infiniment grand. Des scientifiques essayent de réconcilier ces deux sciences sans pour l’instant n’avoir trouvé de consensus général.
Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans un récit mythique mais dans la rigueur scientifique.
Mon professeur d’Histoire des Sciences, Girolamo Ramunni avait eu cette formule saisissante : « Si avant de monter dans un avion vous apprenez que le concepteur de cet engin met en doute la physique quantique, ne montez surtout pas, vous êtes en danger de mort ». En effet, énormément d’instruments qui assurent la sécurité de l’avion ne pourrait exister, si on n’avait pas mis en œuvre les découvertes de la mécanique quantique.
Et de la même manière au niveau de l’Univers et de l’infiniment grand, la théorie de la relativité d’Einstein n’a jamais pu être réfuté pour l’instant. Je vous renvoie vers <cette vidéo de Hubert Reeves> qui explique cela de manière remarquable.
Je l’avais déjà cité lors du mot du jour du <27 mars 2015> consacré à la définition que donnait Karl Popper de la science :
« Une théorie qui n’est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. »
Ce sont donc les scientifiques de la physique quantique et de la relativité générale, [c’est-à-dire ceux qui décrivent de la manière la plus rationnelle le monde dans lequel nous vivons] qui disent : Le temps, tel que nous l’avons défini, ci-avant, n’existe pas.
Citons d’abord l’article traduit par Courrier International et publié le 17 mai 2018 par le journal Quartz :
« Le temps est une réalité pour les êtres humains. Pourtant, du point de vue de la physique quantique, il n’existe pas. « Les équations fondamentales qui décrivent notre monde ne comportent pas de variable de temps », souligne Carlo Rovelli, spécialiste de physique théorique. […]
« Le temps est un sujet fascinant parce qu’il touche à nos émotions les plus profondes. Le temps est à la fois ce qui ouvre l’existence et ce qui engloutit tout. S’interroger sur la notion de temps, c’est questionner le sens même de notre vie. C’est pour ça que j’ai passé ma vie à étudier cette question », explique le chercheur.
Dans son dernier livre, L’Ordre du temps [éd. Flammarion, février 2018], le physicien nous parle non seulement du passage du temps et de la façon dont nous le ressentons en tant qu’êtres humains, mais aussi de son absence tant à l’échelle de l’infiniment vaste qu’à celle de l’infiniment petit. Et de nous démontrer que les notions de chronologie et de continuité ne sont que des produits de notre imagination que nous inventons pour donner du sens à notre existence.
Le temps, estime Carlo Rovelli, n’est qu’une question de perspective, et non une vérité universelle. C’est un point de vue que les humains ont en commun et qui est le produit de notre biologie, de notre évolution, de notre place sur terre et de la position de notre planète dans l’Univers.
« De notre point de vue – celui de créatures représentant une petite partie du monde –, le monde baigne dans le temps », écrit le physicien. Au niveau quantique pourtant, les durées sont trop courtes pour être fragmentées, et le temps n’existe pas.
En fait, poursuit Rovelli, il n’existe rien du tout. L’Univers entier se compose d’une infinité d’événements. Ce qui nous semble être un objet – une pierre, par exemple – est en réalité un événement se déroulant à une vitesse dont nous n’avons pas conscience. Car cette pierre est en réalité dans un état de transformation constant. Considérée sur une échelle de temps suffisamment longue, elle aussi n’est qu’une forme éphémère, appelée à se transformer.
« Dans la grammaire élémentaire du monde, il n’y a espace, ni temps : uniquement des processus qui transforment les quantités physiques [ce qui peut être mesuré] les unes dans les autres, dont nous pouvons calculer les probabilités et les relations » écrit Rovelli.
Si le temps nous semble s’écouler d’une façon ordonnée, c’est par ce que nous nous trouvons sur la terre, une planète caractérisée par une relation entropique unique avec le reste de l’univers. La façon dont notre planète se déplace créée pour nous une sensation d’ordre, qui n’est pas nécessairement perçu comme tel ailleurs dans l’univers.[…]
Si le monde nous semble ordonné, c’est parce que nous le considérons en partant du passé jusqu’au présent, relayant certaines causes à certains effets. Nous y superposons de l’ordre en fixant des événements dans un enchaînement particulier et linéaire. Nous voyons les événements à des résultats ce qui nous donne une idée du temps qui passe.
Reste que l’univers est infiniment plus complexe et chaotique que ce que nous pouvons imaginer, avance Rovelli. […]
Nos limites créent alors une impression d’ordre, erronée ou incomplète, et nous donne une image fragmentaire de la réalité. Pour le physicien, nous ne faisons en fait que « flouter » le monde pour nous concentrer dessus, nous nous aveuglons pour le contempler. Ce qui le pousse à affirmer que « le temps, c’est l’ignorance ».
Si cela paraît terriblement abstrait, c’est parce que ça l’est. Il existe toutefois un moyen assez simple d’illustrer le fait que le temps est une notion humaine mouvante, une expérience plutôt qu’un élément constitutif de l’univers.
Imaginez que vous observez une planète lointaine baptisée Proxima et depuis un télescope sur la terre. « Maintenant » n’est pas le même présent sur la terre et sur cette planète. La lumière que vous percevez depuis la terre lorsque vous contemplez Proxima, vous montre une réalité de ce qui s’y passait il y a quatre ans. « Il n’y a pas de moments particuliers sur Proxima qui correspondent à notre ici et maintenant » conclut le scientifique. […]
Rovelli : « Le temps est un concept complexe, comportant plusieurs niveaux et des propriétés distincts dérivées de différentes approximations. La structure temporelle du monde ne correspond pas à l’image naïve que nous en avons. » […]
Pour Rovelli, ce que nous ressentons comme le passage du temps est un processus mental qui se déroule dans les interstices entre mémoire et anticipation. « Le temps et la forme à travers laquelle nous, créatures dotées d’un cerveau contenant la somme de notre mémoire et de nos anticipations, interagissons avec le monde : c’est la source de notre identité. »
En résumé, le temps est une histoire que nous nous racontons toujours au présent, individuellement et collectivement. C’est un acte collectif d’introspection, de narration, d’enregistrement et d’anticipation, fondée sur nos relations à des événements antérieurs et la nécessaire survenu d’autres événements. […] Le temps est une expérience psychologique et émotionnelle. « Il est vaguement connecté à la réalité extérieure, concède Rovelli, mais c’est avant tout quelque chose qui se passe dans notre tête. »
TELERAMA avait également publié un entretien de Carlo Rovelli où il donne d’autres clés de sa réflexion : « Le présent est une notion locale, pas globale »
« A l’aide de la philosophie, de la recherche en mécanique quantique et de schémas scientifiques éclairants, Carlo Rovelli incite ses lecteurs à penser différemment leur rapport au temps pour mieux le comprendre. La connaissance du monde ouvre l’esprit et guide la vie au quotidien pour le physicien. Et puisque l’éternité est une illusion, le mot d’ordre est d’accepter le caractère éphémère des choses pour apprécier la beauté de la vie.[…]
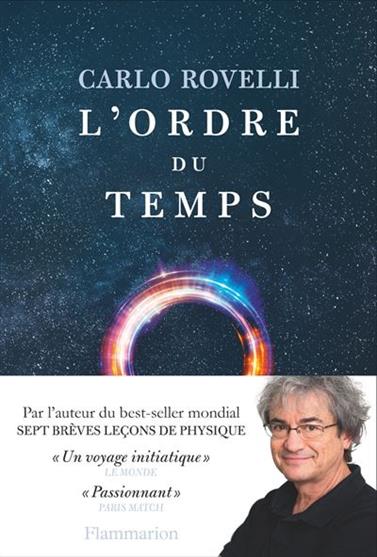 Nous avons tendance à penser que le temps est quelque chose de très simple et familier, une unité imperturbable qui s’écoule de façon uniforme, du passé vers le futur. Le cerveau joue un rôle dans notre perception de la temporalité, en dehors de toute équation. Par exemple, nous pensons que le passé est derrière nous et le futur devant : ce n’est pas une réalité physique mais émotionnelle. Nos angoisses, strictement liées au temps qui passe, à la peur de mourir, illustrent chaque jour l’importance de notre ressenti dans la compréhension du temps. L’idée commune de l’écoulement du temps est relativement récente. Dans sa Physique, Aristote affirmait, lui, que le temps est la mesure du changement. Si rien ne change, alors le temps ne s’écoule pas. Dépendant des événements, il permet avant tout de nous situer dans le compte des jours. Au XVIIe siècle, Newton s’oppose à cette vision aristotélicienne. Le physicien britannique conçoit le temps indépendamment de toute matière et de tout événement. Le temps, absolu, s’écoule quoi qu’il advienne. C’est Newton qui a forgé notre conscience actuelle du temps, et constitué les fondements de la physique moderne. Pourtant, au XXe siècle, les travaux d’Einstein bousculent ce schéma : le temps n’est en réalité ni indépendant, ni unitaire. […]
Nous avons tendance à penser que le temps est quelque chose de très simple et familier, une unité imperturbable qui s’écoule de façon uniforme, du passé vers le futur. Le cerveau joue un rôle dans notre perception de la temporalité, en dehors de toute équation. Par exemple, nous pensons que le passé est derrière nous et le futur devant : ce n’est pas une réalité physique mais émotionnelle. Nos angoisses, strictement liées au temps qui passe, à la peur de mourir, illustrent chaque jour l’importance de notre ressenti dans la compréhension du temps. L’idée commune de l’écoulement du temps est relativement récente. Dans sa Physique, Aristote affirmait, lui, que le temps est la mesure du changement. Si rien ne change, alors le temps ne s’écoule pas. Dépendant des événements, il permet avant tout de nous situer dans le compte des jours. Au XVIIe siècle, Newton s’oppose à cette vision aristotélicienne. Le physicien britannique conçoit le temps indépendamment de toute matière et de tout événement. Le temps, absolu, s’écoule quoi qu’il advienne. C’est Newton qui a forgé notre conscience actuelle du temps, et constitué les fondements de la physique moderne. Pourtant, au XXe siècle, les travaux d’Einstein bousculent ce schéma : le temps n’est en réalité ni indépendant, ni unitaire. […]
Einstein révolutionne la science. En introduisant la théorie de la relativité, il découvre que la durée d’une trajectoire est nécessairement relative à une autre chose. Le caractère unitaire du temps éclate, laissant place à une multitude de temporalités, de structures, de couches. La science n’étudie plus le monde dans le temps mais l’évolution des choses dans des temps locaux, et l’évolution de ces temps locaux les uns par rapport aux autres. Le temps n’a alors plus rien à voir avec la perception simple que nous en avons au quotidien. Il file à des vitesses différentes, passe plus vite en haut qu’en bas. Par exemple, si des jumeaux partent en vacances le même nombre de jours, l’un à la montagne, l’autre à la mer, ils ne vivront pas l’écoulement du temps de la même façon. Le montagnard rentrera de vacances plus vieux que son frère. C’est une réalité physique mesurée à l’aide d’horloges très précises. Le film de Christopher Nolan, Interstellar, décrit très bien la réalité du temps. Lorsque le héros rentre de son voyage dans l’espace, il découvre que sa fille est plus vieille que lui car le temps ne file pas à la même vitesse partout dans l’univers.
[…]
Effectivement, il n’y a pas d’ordre global du temps. L’univers se compose d’une multitude d’événements, mais une temporalité unique ne les organise pas[…]
Saint Augustin avait eu l’intuition d’un lien entre l’individu et le temps. Pour l’auteur des Confessions, la conscience de l’écoulement du temps n’existe qu’en nous-mêmes : « C’est en toi, mon esprit, que je mesure le temps. » La sensation de durée est imperceptible en dehors de notre être. Les neurosciences expliquent de plus en plus ce mécanisme. En enregistrant des informations, le cerveau, siège de la mémoire, tente de prédire les événements à venir. C’est la mémoire qui soude les processus éparpillés dans le temps dont nous sommes constitués. […]
Carlo Rovelli a, comme cela est relaté dans ces articles, écrit un autre ouvrage, paru en février 2018 et consacré au temps : « L’Ordre du temps » traduit de l’italien par Sophie Lem), éd. Flammarion, 288 p.,
Un article de The Conversation en livre un extrait « Pourquoi le temps ralentit. »
Et, si vous voulez creuser ce sujet davantage, vous pouvez écouter cette émission de mars 2018 : <La Méthode scientifique : Grand Entretien avec Carlo Rovelli>
Ou lire cet entretien publié par le Monde : « On ne voit jamais le temps, mais on voit les choses changer »Et je finirai par cette citation du philosophe grec Aristote également présente dans le numéro de Courrier International : :
«Nous vivons par les émotions et non par les heures du cadran solaire. Nous devrions compter le temps en battements de cœur»
<1183>
-
Jeudi 31 janvier 2019
«On n’a pas besoin de test pour savoir si on est du soir ou du matin»Jürgen ZulleyJe voudrais finir ma série de mots sur le temps débuté la semaine dernière.
Et j’en reviens encore à ce numéro de « Courrier International » du 20 décembre 2018 au 9 janvier 2019, envoyé par mon ami Jean-François de Dijon et portant le titre suivant sur sa page de couverture : « Le temps passe-t-il trop vite ? »
Cette fois je m’intéresse à un article publié le 16 novembre par le journal de Münich : « Süddeutsche Zeitung » et qui parle de notre biologie interne par rapport au temps.
Cet article donnait la parole à un spécialiste du sommeil : Jürgen Zulley qui affirme :
« On n’a pas besoin de test pour savoir si on est du soir ou du matin. »
Et l’article de citer l’exemple de deux grands écrivains de langue allemande : La journée de Thomas Mann était en général réglée comme du papier à musique. « Je travaille le matin », notait l’écrivain qui intégrait la sieste à son programme. En revanche, Franz Kafka, qui travaillait dans une compagnie d’assurances pour gagner sa vie, écrivait la nuit, parfois jusqu’aux petites heures du matin.
Il s’agit donc d’une confirmation scientifique que si certains sont du matin, d’autres sont du soir :
« Ce qui nous est facile, et à quels moments de la journée, dépend d’une série de rythmes d’une constance étonnante. Le plus rigide est le rythme de vingt-quatre heures. Il ne varie que de quelques minutes, même si on est à l’isolement total et sans lumière pendant plusieurs mois, comme l’ont montré des études réalisées dans des grottes en Italie et à Andechs [en Allemagne]. La journée est en outre ponctuée par des périodes de quatre heures et des périodes de quatre-vingt-dix minutes [soit une heure et demie].
« Les choses se faisaient déjà en fonction de ces rythmes avant même qu’ils soient connus de la science, explique Jürgen Zulley. Au bout de quatre-vingt-dix minutes de travail, les gens font une pause. C’est la durée de deux ‘heures’ de cours à l’école ou à l’université [en Allemagne] – et des matchs de football. » La plus grosse erreur que puisse faire un conférencier, c’est de prévoir un exposé de plus de quatre-vingt-dix minutes. »
Et c’est ainsi que nous apprenons que notre bioryhtme est influencé par le « cortisol »
Le site Doctossimo nous explique que :
« Le cortisol est sécrété par les glandes corticosurrénales à partir du cholestérol. Sa sécrétion dépend également d’une autre hormone, l’ACTH produite par l’hypophyse dans le cerveau (ACTH pour adrénocorticotrophine).
Cette hormone intervient dans la gestion du stress par l’organisme (adaptation de l’organisme au stress). En cas de stress, elle permet une libération de sucre à partir des réserves de l’organisme pour répondre à une demande accentuée en énergie pour les muscles, le cœur, le cerveau…
Cette hormone joue également un rôle dans le métabolisme des aliments : régulation des glucides, des lipides, des protides, des ions et de l’eau pour préserver l’équilibre physiologique de l’organisme. Elle joue également un rôle à la réaction anti-inflammatoire, la régulation de la pression artérielle, la croissance osseuse et participe à la régulation du sommeil et du système immunitaire. »
Et c’est un endocrinologue de l’Université de Munich qui précise :
« Notre biorythme hormonal est fortement influencé par le cortisol qui est sécrété surtout aux petites heures du matin […] Vers 3 heures du matin. Cela nous prépare à la matinée et à la journée »
L’être humain fonctionne par cycles : l’élan du matin est suivi d’un creux vers midi puis d’un autre pic l’après-midi qui retombe le soir.
Et ces cycles sont particulièrement importants pour les sportifs dont les performances peuvent varier de manière très sensible [d’un quart écrit l’article] lors de la journée. Cette différence peut alors être la cause de la victoire ou de la défaite :
« D’après une étude sur des athlètes de haut niveau publiée en 2015, le pic de performance dépendait de la durée écoulée depuis leur réveil. Ceux qui se levaient à 7 heures atteignaient leur maximum environ 5 heures plus tard, donc vers midi. Ceux qui dormaient jusqu’à 10 heures avaient besoin de dix heures d’éveil et n’atteignaient leur meilleure forme que vers 20 heures »
Notre consommation d’énergie connaît elle aussi des variations au fil de la journée, c’est ce que viennent de démontrer des chercheurs de Harvard. Cela expliquerait que les personnes qui font les trois-huit et celles qui passent leur vie dans les avions et changent tout le temps de fuseau horaire ont tendance à prendre du poids. Leur métabolisme est tellement irrité que leur bilan énergétique se retrouve sens dessus dessous.
Il peut donc y avoir conflit entre notre horloge interne et l’horloge externe.
Toutefois Jürgen Zulley affirme que :
« L’habitude fait aussi beaucoup, le corps apprend l’heure »
Bref l’expression : « connais-toi toi-même » cher à Socrate, doit aussi s’appliquer à notre horloge interne, à notre manière d’appréhender de manière optimale notre relation avec le temps ponctué d’activité et de repos.
<1182>
-
Mercredi 30 janvier 2019
« Ce sont des destins qui passent dont je vous parle en cet hiver de colère et de méfiances. [les voit-on ?]»Claude AskolovitchUn cordiste est un technicien qualifié qui se déplace à l’aide de cordes pour effectuer des travaux en hauteur et des travaux d’accès difficile sans utiliser d’échafaudage ni d’autre moyen d’élévation (type nacelle).
 On appelle aussi le technicien cordiste un travailleur acrobatique.
On appelle aussi le technicien cordiste un travailleur acrobatique.
J’ai trouvé une offre d’emploi qui vante ce métier sur <ce site> :
Intégrer une équipe où règne la bonne ambiance
Réaliser des tâches variées. Pas d’ennui
Développer un savoir-faire en termes de réalisation
Évoluer par formation interne
Réaliser des missions à fortes technicités.
Vous êtes Idéalement de formation technique, formé et expérimenté en Travail en hauteur ; apte et volontaire au port des appareils respiratoires et à l’intervention en milieux confiné et espace restreint
Quand vous travaillez dans un immeuble de grande hauteur, parfois vous apercevez des hommes de l’autre côté de la fenêtre, du côté du vide, qui nettoient les vitres de l’immeuble : ce sont des techniciens cordistes.
C’est la revue de Presse de <Claude Askolovitch du 11 janvier 2019> qui a attiré mon attention sur ce métier qui « permet donc de réaliser des tâches variées et d’éviter l’ennui » mais qui est aussi dangereux, surtout quand la pression économique conduit à oublier toute prudence.
Et Claude Askolovitch évoque un procès qui fait suite à un accident mortel de 2012 :
« Un procès qui vient bien tard, 7 ans après la mort de deux hommes ensevelis sous 3000 tonnes de sucre dans le silo qu’ils devaient nettoyer; c’était le 13 mars 2012 à Bazancourt dans la Marne, ils s’appelaient Arthur Bertelli et Vincent Dequin, ils étaient cordistes, c’est le nom de leur métier d’acrobates de l’industrie, employés comme intérimaires par la société Carrard services, pour faire disparaitre les agglomérats de sucre compact qui collaient aux parois du plus grand des silos du géant du sucre cristal union. A 11.30, dix minutes après le début de leur mission, le sucre s’est mis à glisser et couler comme un sablier, Arthur est parti le premier, Vincent ensuite qui a crié « Coupe ta corde, t’es pas dedans ! » à Frédéric Soulier qui était au-dessus de lui et qui a coupé la corde et qui s’est mis à hurler pour que l’aide arrive et elle ne venait pas…
Il s’en est sorti et ne s’en remettra jamais, Frédéric il le raconte dans le Parisien, il le dira au tribunal correctionnel de Reims où les représentants de Cristal union et Carrard Services vont répondre des faits « d’homicides et de blessures involontaires, commis par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement »…
Long intitulé pour comprendre comment deux hommes sont morts, deux de ces cordistes qui gagnent quelques dix euros de l’heure et que les accidents rattrapent. Le 21 juin 2017, Quentin Zaroui-Bruat, 21 ans, est mort à son tour , encore à Bezancourt, enseveli lui sous des tonnes de déchets de grains de céréales qui dégageait ce jour-là une poussière épaisse dans ce silo de la société Cristanol, une filiale de Cristal union, qui fabrique du carburant végétal… L’employeur de Quentin mettait la pression sur ses intérimaires, quand ils hésitaient à descendre en rappel, « Si vous n’y allez pas, vous n’êtes pas des hommes ! »
L’histoire de Quentin est racontée sur le Web, l’article a été mis en ligne début janvier par le site basta mag, un site engagé, et qui, comme la presse radicale autrefois, raconte ce qu’est la condition des ouvriers précaires et donc de ces cordistes, souvent itinérants, qui ont leur porte-parole, l’un d’entre eux qui est aussi écrivain. Un homme mur, Eric Louis, il avait connu Quentin dans un silo où ils transpiraient ensemble, et a écrit un livre, « on a perdu Quentin », pour qu’on n’oublie pas ce môme qui ne plaignait jamais, « posé, enjoué, gentil, attachant, volontaire, courageux » et qui venait travailler en Champagne depuis ses cotes d’Armor dans une 306 Peugeot à bout de souffle. Eric Louis se lit dans basta mag, il se lit dans un autre journal en ligne, la brique.net, où il a parlé de Quentin juste après sa mort.
Ce sont des destins qui passent, les voit-on, dont je vous parle en cet hiver de colère et de méfiances. »
Il renvoie vers deux articles qui parlent du second accident celui de Quentin Zaraoui-Bruat, cordiste de 21 ans:
« Quand le travail tue » sur le site « la brique » dans lequel Eric Louis qui était sur les lieux raconte comment les collègues ont compris peu à peu le drame avec l’arrivée des secours. Je tire de cet article qui est à lire ce court extrait :
« Plus tard, rentré à la maison, je consulte un article sur le site internet de L’Union, le quotidien local. […]. Sous la rubrique faits divers, je me tape le récit très succinct, au milieu duquel brille une publicité. Le nom de Quentin n’est même pas cité. Contrairement à celui du directeur de l’usine. Je suis écœuré.
J’y apprends que les pompiers du GRIMP (groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) n’ont pas voulu descendre dans le silo, estimant les conditions trop dangereuses. »
Et un article plus analytique sur le site « bastamag » « Si vous n’y allez pas, vous n’êtes pas des hommes ! »
Nous apprenons notamment que :
« Pour des questions de rendements, on a envoyé des cordistes à la mort dans un silo bien trop plein, au lieu d’attendre que la matière s’écoule toute seule. »
C’est encore une question d’impatience et de refus de laisser le temps faire son œuvre. Mais le temps c’est de l’argent, l’homo economicus n’a pas le temps.
Nous apprenons aussi qui était le commanditaire et la description du travail des cordistes dans ce lieu :
« Quentin Zaraoui-Bruat travaillait pour Cristanol, une filiale du deuxième groupe sucrier français Cristal Union – qui exploite les marques Daddy ou Erstein… –, installée à Bazancourt, dans la Marne.
À Bazancourt, la distillerie Cristanol se présente comme l’« un des leaders de la production de bioéthanol en Europe », un biocarburant obtenu à partir du blé et de la betterave. Dans ses silos, les résidus de céréales s’agglomèrent le long des parois et forment d’énormes blocs – qu’on appelle la « drêche ». Le travail de Quentin et ses collègues consistait à casser ces blocs, afin d’évacuer cette matière servant ensuite à l’alimentation des bovins. Toute la journée, ils tapaient à la pioche, à la houe, à la pelle, au marteau-piqueur, sous une chaleur étouffante, dans une atmosphère poussiéreuse, éclairés par une simple frontale. »
Il se passe aussi des épisodes comme ceux-ci dans notre beau pays.
<1181>
-
Mardi 29 janvier 2019
« L’envers du décor »Sonia Kronlund dans son émission “Les Pieds sur terre” du 28/01/2019 qui parle de la violence en cuisineLa France est fière de ses grands restaurants. La semaine dernière le nouveau Guide Michelin a été publié, des chefs ont perdu des étoiles et d’autres ont en gagné.
Parallèlement, on répète à satiété que c’est un gisement d’emplois et que les jeunes français ne se pressent pas pour occuper ce type d’emploi. Certains même prennent prétexte de ce fait pour dire que cela prouve bien que des gens se complaisent dans le chômage puisque lorsqu’il y a du travail, les postes ne sont pas pourvus.
Mais quelle est la réalité qui se cache en cuisine dans beaucoup de ces maisons ?
Hier, quand je me demandais quel mot du jour je pourrais bien partager aujourd’hui et j’écoutais France Culture en retournant à mon travail. C’était l’émission de Sonia Kronlund : « Les pieds sur terre », dont le titre était « L’envers du décor »
C’est une autre journaliste Pauline Maucort qui est allé à la rencontre de jeunes qui racontent la vie, les relations, l’ambiance dans les cuisines, ce sont 4 histoires.
Pauline Maucort a un cousin qui a le même âge qu’elle : Maxime.
Lorsqu’elle était au lycée, lui travaillait déjà.
Elle se souvient que pendant les fêtes, bien souvent toute la famille se déplaçait en Alsace, là où travaillait Maxime. C’était le seul moyen de passer avec lui les quelques heures qu’il avait entre les services. A l’époque Maxime était apprenti serveur et n’arrêtait jamais de travailler
Des horaires de fou, il avait juste un jour de congé par semaine, parfois deux par semaine mais c’était impossible de savoir lequel à l’avance, ce n’était jamais le même et jamais le weekend end, on y pensait même pas.
Une année, à Noël alors que Maxime n’avait aucun jour de congé, la famille avait décidé d’aller déjeuner dans le restaurant gastronomique où il travaillait. C’était une folie, mais tous se réjouissait de le voir dans le beau costume 3 pièces dont il était fier. Pourtant en arrivant, ce n’est pas lui qui les a placés.
Quand il a fini par apparaître, pour prendre la commandes des boissons, c’est à peine s’ils l’ont reconnu : il était tendu, livide, il ne souriait pas et ne semblait même pas les voir. Il s’exécutait professionnel avec un petit tremblement dans le menton qui n’échappait pas à sa cousine Pauline. Il n’était pas seulement concentré, il y avait quelque chose de pétrifié dans son attitude, son regard vide.
Plus tard Pauline comprendra que c’était la peur.
Pendant les dix ans pendant lesquels Maxime a travaillé dans la restauration, Maxime ne s’est jamais plaint.
Puis il a démissionné et il a changé de métier, C’est alors qu’il s’est mis à parler.
Vous en saurez plus en écoutant l’émission : « L’envers du décor ».
Mais il y a de nombreux articles consacrés à ce sujet :
- Dans le Figaro : «La violence est banale en cuisine»
- Dans Psychologies : « Violence en cuisine : le silence brisé »
- Dans le Huffington Post « Violences en cuisine: la sale affaire Robuchon »
- Sur un site spécialisé : Atabula :« Violences en cuisine : levons le voile »
Heureusement que cette réalité est désormais décrite et que des chefs réagissent comme l’écrit Ouest-France : « Violences en cuisine. Des chefs s’insurgent et protègent leurs commis »
Ma conclusion sera de nouveau une critique aux technocrates qui plutôt que de se plonger dans leurs tableaux excel et dans leurs statistiques et dire que les jeunes ne cherchent pas de travail, feraient mieux d’aller simplement voir à hauteur d’être humain, ils comprendraient mieux certaines réalités.
<1180>
- Dans le Figaro : «La violence est banale en cuisine»
-
Lundi 28 janvier 2019
«Si je n’apprends plus rien, je suis mort. »Clint EastwoodChers amis, chers lecteurs réguliers ou occasionnels du mot du jour,
J’ai longtemps hésité avant d’écrire ce mot du jour.
Je garde en mémoire cette réponse de Jacques Brel à un journaliste qui lui demandait de parler de sa vie personnelle :
« Mais cela ne présente aucun intérêt. Cela n’intéresse personne.
Ce n’est pas poli. Cela ne se fait pas !»
Le mot du jour est un lieu de partage de réflexions, d’émotions, d’humour et surtout de questionnements.
Mais l’écriture va devenir un peu plus compliquée dans les prochaines semaines, prochains mois. Et je voudrais en quelques phrases en dire le contexte.
Il ne va pas s’arrêter, car j’ai besoin de cette discipline d’écrire et tenter de partager tous les jours un sujet d’intérêt qui peut toucher ou faire réfléchir.
Vous savez que je me méfie du seul récit des faits : «L’homme médiocre parle des personnes, L’homme moyen parle des faits, L’homme de culture parle des idées ».
Ce mot du jour je l’avais cependant complété quelques jours plus tard, lors de l’article consacré à Barbara : « Barbara me rappelle que j’ai oublié le plus important :
L’homme de cœur et en l’occurrence la femme de cœur parle de la vie et de l’amour. »
Il faut cependant que je commence par quelques faits :
En novembre 2011, j’ai été opéré d’un cancer de la prostate, solution la plus raisonnable pour un cancer détecté précocement à un âge où il pouvait se développer rapidement. La promesse était une guérison.
Ce ne fut pas le cas, il y eut récidive en 2013.
Bien que ce cancer fût détecté précocement et que tout au long de ces années j’ai été suivi consciencieusement, l’attente dont j’ai parlé lundi dernier a conduit au diagnostic que cette maladie avait muté en un cancer des os avec des métastases au niveau des vertèbres. Le langage technique désignera cette situation sous le nom de : « cancer au stade 4 » qui constitue l’avant dernière étape, celle dans laquelle la médecine occidentale sait encore freiner et ralentir la progression de la maladie sans laisser la moindre perspective de guérison.
Il me faut donc faire face à une maladie plus grave. Je vais le faire avec détermination, calme et en étant pleinement acteur de ce combat honorable, comme l’avait appelé François Mitterrand.
Les faits s’arrêtent là.
Mais être acteur signifie aussi lire beaucoup d’articles ou de livres qui donnent des informations, consacrer du temps pour se soigner et accompagner le soin par des temps de silence et d’activités physiques.
Le temps n’étant pas extensible, il me faudra consacrer moins de temps à mon travail professionnel, mais aussi au temps consacré à rédiger le mot du jour.
En aucun cas, le mot du jour ne va se transformer en bulletin de ma santé, ni en lieu d’échanges sur ce sujet.
Si dans mes lectures ou découvertes consacrées à la santé, j’ai le sentiment que telle information, article ou livre mériteraient d’être partagé, je le ferais.
Mais je continuerai à m’intéresser à tous les autres domaines qui m’ont occupé jusqu’ici et même au-delà.
Car je veux continuer à interroger, apprendre, comprendre et expliquer.
Probablement, au moins dans un premier temps, je rédigerai moins les mots du jour en allant plus vite vers le lien qui a inspiré ma réflexion et le désir du partage.
Je renverrai aussi parfois à des articles déjà écrits qui me semblent mériter un rappel. J’écrirai aussi probablement plus souvent des mots du jour consacré à la musique que j’écoute pour me faire du bien et dont je pourrai partager les bienfaits.
Et s’il n’y a vraiment pas de temps, il y aura des jours de pause.
Je me suis résolu à expliquer le contexte dans lequel cette aventure du mot du jour va continuer, il me semblait que cet exercice de transparence était utile.
Et avant notre finitude que j’entends repousser jusqu’aux limites du possible, il faut vivre tous les jours jusqu’à ce moment et continuer à apprendre sur tous les plans, parce qu’apprendre c’est la vie.
Et les grandes épreuves permettent d’apprendre beaucoup.
Comme exergue, j’ai choisi une parole du grand artiste américain qui a accordé un entretien au journal « Le Monde » à l’occasion de la sortie de son dernier film : Rencontre avec Clint Eastwood. Cet article a été publié le 23 janvier 2019.
<1179>
-
Vendredi 25 janvier 2019
« La dernière étreinte »Jan van Hooff et MamaAvant ce week-end, je quitte légèrement la réflexion sur le temps et l’inspiration à partir du numéro de Courrier International déjà évoqué. Légèrement car il est bien ici question encore de temps, de temps qui passe, de temps qui reste…
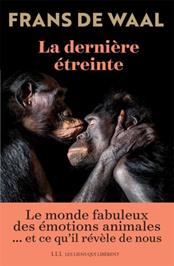 Au départ il y a un nouveau livre de Franz de Waal : « La dernière étreinte »
Au départ il y a un nouveau livre de Franz de Waal : « La dernière étreinte »
J’avais évoqué l’éthologue et primatologue Frans de Waal lors du mot du jour du 28 juin 2017 : « Est-ce que l’homme est plus intelligent que le poulpe ? On ne sait pas »
J’ai d’abord entendu Frans de Waal parler de son dernier ouvrage lors d’une émission de France Culture : « La vie intérieure des animaux » qui a été diffusée le jour de Noël le 25/12/2018.
Frans de Waal travaille sur les émotions des animaux et leur capacité d’empathie.
Dans ce nouvel ouvrage il évoque le rire, le deuil, la colère, la pitié car les animaux éprouvent une palette d’émotions extrêmement variées.
Comme je l’ai écrit lors du précédent article, les études et la connaissance de Frans de Waal remettent en cause nos certitudes.
Il fait ainsi état des recherches récentes sur les émotions animales : les mammifères et la plupart des oiseaux ressentent des émotions : tristesse, joie, colère, deuil, désir de pouvoir ou sens de l’équité…
Et ce qu’il nous dit c’est que plutôt que de penser qu’il se laisse aller à « l‘anthropomorphisme » qui est la tendance à assimiler l’attitude des animaux à celles des hommes, nous devrions plutôt nous interroger sur notre « anthropodéni », c’est-à-dire la croyance vaniteuse des hommes en l’incomparabilité de leur espèce.
Mais je voudrais insister sur « la dernière étreinte » qu’évoque Frans de Waal et à laquelle il n’a pas participé. L’humain impliqué dans cette histoire qui s’est déroulée en avril 2016 est un autre scientifique néerlandais : Jan van Hooff
Une petite vidéo de 2 mn montre ce moment d’émotion et de grâce : <La dernière étreinte>
 Aux Pays-Bas, le Burger’s Zoo d’Arnhem compte une colonie de chimpanzés étudiée de près par les scientifiques. Depuis les années 1970, une équipe de chercheurs observent la vie quotidienne et les comportements de cette communauté. Jusqu’en 2016, Mama, une femelle chimpanzé de 59 ans, était la matriarche de la communauté.
Aux Pays-Bas, le Burger’s Zoo d’Arnhem compte une colonie de chimpanzés étudiée de près par les scientifiques. Depuis les années 1970, une équipe de chercheurs observent la vie quotidienne et les comportements de cette communauté. Jusqu’en 2016, Mama, une femelle chimpanzé de 59 ans, était la matriarche de la communauté.
En avril 2016, à quasiment 60 ans, l’animal arrivait à la fin de sa vie. Mama était malade et refusait de manger.
L’équipe du zoo a alors eu l’idée de faire venir le professeur Jan van Hooff. Ce primatologue néerlandais est le co-fondateur de cette colonie de chimpanzés. Il connaissait Mama depuis 1972 et il avait tissé des liens profonds avec elle.
Alors qu’elle était sur le point de mourir, la vieille femelle chimpanzé reconnait le professeur qui avait commencé à s’occuper d’elle il y a près de 50 ans. Lorsque l’homme s’est approché d’elle et qu’il a commencé à lui parler et à la caresser, son visage s’est illuminé. L’animal affaibli a souri et a tendu sa main vers le professeur.
Lorsque Jan van Hooff se penche vers elle, Mama le touche, le caresse, se laisse nourrir et semble l’enlacer tandis que Jan van Hooff lui parle.
Une semaine après ces retrouvailles, Mama s’est éteinte à l’âge de 59 ans. Le professeur Jan van Hooff avait publié cette vidéo sur YouTube.
A sa mort, le scientifique lui a rendu hommage :
« Mama était un caractère unique, si puissant que tous les adultes mâles essayaient de rester dans ses bonnes grâces mais elle était aussi une source de réconfort et de soutien pour tous ceux qui étaient dans le besoin, tant qu’ils ne menaçaient pas sa position […] Elle me reconnaissait à chaque fois que je visitais le zoo et se montrait impatiente de « parler » avec moi et de m’épouiller. Elle nous manquera beaucoup ».
Mama jouait un rôle social important au sein de la colonie de chimpanzés d’Arnhem. Et c’est dans ce cadre que Frans de Waal l’a connu et en a tiré une partie de l’expérience relaté dans « La Politique du chimpanzé ».
J’ai tiré l’ensemble de ces informations de l’entretien à France Culture déjà cité et sur deux pages :
L’émotion, l’affection est évidente, la mémoire et les souvenirs aussi.
Mais est-ce que Mama comprenait que pour elle c’était le temps de la fin, qu’elle était en train de mourir ? C’est une question.
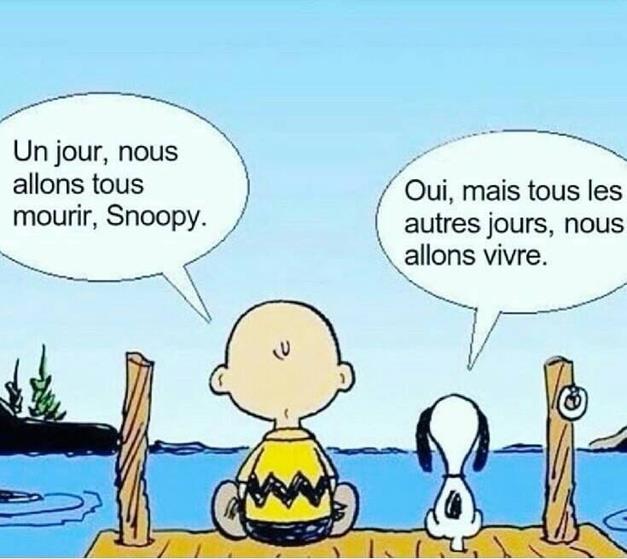
Parce que cette réponse de Snoopy à Charlie Brown est très belle, mais cela c’est de l’anthropomorphisme.
<1178>
-
Jeudi 24 janvier 2019
« La prééminence du temps linéaire correspond à une conception du monde eschatologique, où toute l’histoire humaine tend vers un jugement dernier. […] Il existe d’autres conceptions du temps »Julian BagginiPassé, présent puis futur, c’est une vision linéaire du temps. C’est celle que nous connaissons. C’est la vision occidentale.
Cette fois l’article traduit par courrier international est extrait du journal anglais : « The Guardian » et c’est le philosophe britannique Julian Baggini qui en est l’auteur.
Et il commence son article par une comparaison des philosophies du monde :
« Les premiers écrits philosophiques apparaissent à peu près en même temps à différents endroits du globe. Telle est l’une des grandes merveilles inexpliquées de l’histoire de l’humanité. Les origines des philosophies indienne, chinoise et grecque, ainsi que du bouddhisme, s’échelonnent sur une période d’environ trois cents ans, qui s’ouvre au VIIIe siècle avant J.-C.
Ces philosophies antiques ont déterminé les différentes formes de culte et les divers modes de vie, ainsi que la manière dont les hommes envisagent les grandes questions qui les concernent tous. La plupart d’entre nous ne formulent pas consciemment les principes philosophiques qu’ils ont intégrés, et souvent ils ne sont même pas conscients d’en avoir. Mais les idées concernant la nature du soi, l’éthique, les sources de la connaissance ou les buts de la vie sont profondément inscrites dans nos cultures et façonnent notre pensée sans que nous en soyons conscients.
Prenons par exemple le temps. Aujourd’hui, dans le monde entier, le temps est perçu comme étant linéaire, il s’échelonne en passé, présent et avenir. Nos journées sont organisées par la progression de l’horloge, à court et moyen terme nous nous appuyons sur des calendriers et des agendas, l’histoire court sur des fresques chronologiques embrassant les millénaires. Toutes les cultures ont leur propre conception du passé, du présent et de l’avenir, mais fondamentalement, pour une bonne part de l’histoire de l’humanité, on retrouve une constante, celle du temps cyclique. Le passé est aussi l’avenir, l’avenir est aussi le passé – le commencement est aussi la fin. »
Ainsi le monde des idées terriennes serait selon lui plutôt enclin à définir le temps par des cycles, un temps qui tourne en rond en quelque sorte.
Mais la révolution industrielle a donné la prééminence à l’Occident et c’est donc la conception occidentale qui l’a emporté, la vision linéaire.
Alors, d’où vient cette vision ?
Selon le philosophe britannique :
« La prééminence du temps linéaire correspond à une conception du monde eschatologique, où toute l’histoire humaine tend vers un jugement dernier. Sans doute est-ce la raison pour laquelle c’est devenu la manière la plus courante de concevoir le temps dans l’Occident chrétien. Quand Dieu a créé le monde, il a donné naissance à une histoire avec un début, un milieu et une fin. »
Mais il existe d’autres conceptions du temps.
De nombreuses écoles de pensée estiment que le commencement et la fin sont – et ont toujours été une seule et même chose dans une perspective de cercle qui revient vers son point de départ.
Le poème de Christian Bobin cité ce lundi disait d’ailleurs :
« car dans l’attente,
le commencement est comme la fin »
Et Julian Baggini de raisonner :
« Intuitivement, il s’agit de la manière la plus plausible de concevoir l’éternité. Quand on imagine le temps de façon linéaire, on finit par se demander, déconcerté : Que se passait-il avant le commencement du temps ? Comment une ligne peut-elle avancer sans fin ? Un cercle nous permet de visualiser un retour et un départ perpétuels, sans qu’il n’y ait jamais ni commencement ni fin. »
La vision linéaire permet de raconter des récits de création et de fin du monde, mais elle permet aussi de s’adapter au récit du progrès, récit d’abord occidental.
Avec le progrès on ne revient pas en arrière, il y a des innovations qui marquent une rupture : avant / après. Ce récit ou cette réalité a besoin d’une vision linéaire du temps :
- Avant/ après la révolution agricole
- Avant/ après l’invention de l’écriture
- Avant / après l’invention de l’imprimerie
Le temps cyclique était dès lors présent dans des sociétés dans lesquels il n’y avait guère d’innovations d’une génération à l’autre.
Dans l’Inde ancienne, le livre des hymnes Rigveda parle ainsi du ciel et de la terre :
« Lequel est apparu en premier, lequel a suivi ?
Comment sont-ils nés ? Ô sages, qui peut les discerner ? Ils contiennent eux-mêmes tout ce qui existe. Le jour et la nuit tournent comme sur une roue. »
La philosophie est-asiatique est profondément enracinée dans le cycle des saisons, lui-même intégré au cycle plus large de l’existence.
Mais il y a des conceptions du temps qui dépassent cette opposition linéaire/cyclique. Ainsi l’Islam qui selon cet article est fondé sur une vision cyclique, mais où chaque cycle fait avancer l’Humanité, chaque révélation s’appuie sur la précédente.
Et en Australie, l’anthropologue David Maybury-Lewis affirmait que le temps dans les cultures indigènes australiennes n’était ni cyclique ni linéaire : il ressemblerait plutôt à l’espace-temps de la physique moderne. Dans cette conception, le temps est intimement lié à l’espace, dans ce que le spécialiste appelle :
« Le temps rêvé du passé, du présent et de l’avenir, tous ici même »
C’est ainsi que dans cette tradition il semblerait que ce n’est pas la distinction entre temps linéaire et temps cyclique qui est fondamentale, mais si le temps est distinct de l’espace ou intimement lié à lui.
Nous sommes alors en pleine modernité dans un monde où le temps en tant que donnée intangible n’existe pas, c’est ce qu’affirment les physiciens modernes, mais nous y reviendrons.
Et Julian Baggini d’expliquer :
« Cette notion de lien est importante. Le temps et l’espace sont devenus des abstractions théoriques dans la physique moderne, mais dans la culture ce sont des réalités concrètes. Un point sur une carte ou un instant dans le temps n’ont pas d’existence propre, tous les phénomènes sont liés les uns aux autres. Donc pour comprendre le temps et l’espace dans les traditions philosophiques orales, il faut y voir moins des concepts abstraits que des réalités vivantes, au sein d’une conception du monde où tout est lié. »
Et il cite un autre chercheur australien Stephen Muecke :
« Pour ses amis indigènes […] la question fondamentale n’est pas « quand est-ce que ça s’est passé ? mais « en quoi est-ce lié à d’autres événements ? »
Et Julian Baggini de conclure
« Les différents conceptions du temps dans les traditions philosophiques s’avèrent être bien davantage que des curiosités métaphysiques. Elles déterminent à la fois la manière dont nous concevons notre place temporelle dans l’histoire et notre relation aux lieux physiques où nous vivons. Et elles montrent bien comment, en empruntant un autre système de pensée, nous pouvons voir notre monde d’un œil neuf. Parfois, il suffit d’un nouveau cadre pour modifier sa vision des choses. » :
Cet article est beaucoup plus riche d’idées que les quelques éléments que j’ai picorés pour partager cette ouverture et réflexion sur la notion de temps, dont la vision occidentale n’est qu’un aspect. Vision occidentale que la théorie de la relativité conteste d’ailleurs radicalement.
<1177>
- Avant/ après la révolution agricole
-
Mercredi 23 janvier 2019
« Nous sommes ainsi à la fois intempérants et intemporels, des analphabètes du temps »Marcia BjornerudJe continue mon butinage dans le numéro de « Courrier international » de la fin de l’année consacré au « Temps » qui passe trop vite.
Cette fois il s’agit d’un article directement écrit par les journalistes de Courrier international et non la traduction d’un article d’un journal étranger : « Nous, les illettrés du temps »
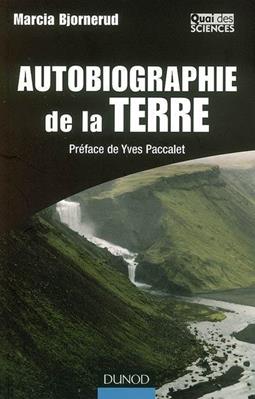 Cet article donne la parole à la chercheuse Marcia Bjornerud qui est originaire de Norvège, elle a étudié dans son pays, puis au Canada. Elle est aujourd’hui professeure de géologie à Lawrence University (Wisconsin).
Cet article donne la parole à la chercheuse Marcia Bjornerud qui est originaire de Norvège, elle a étudié dans son pays, puis au Canada. Elle est aujourd’hui professeure de géologie à Lawrence University (Wisconsin).
Elle a écrit un livre qui a été traduit en français et publié en 2006 : «Autobiographie de la terre» dans lequel elle se penche sur notre planète Terre.
Elle recommande la géologie comme remède à l’analphabétisme temporel.
Car savez-vous que notre planète est âgée de 4,54 milliards d’années ? Qu’une goutte d’eau peut rester neuf jours dans l’atmosphère terrestre ? Ou qu’une molécule de dioxyde de carbone peut y passer des siècles ?
Pour cette géologue ces notions sont essentielles et connaître les rythmes qui régissent la planète Terre est un enjeu majeur pour sa survie.
« La majorité des êtres humains, y compris ceux qui vivent dans des pays riches et techniquement avancés, n’ont aucun sens des proportions temporelles, de la durée des grands chapitres de l’histoire de la Terre, des taux de changement qui ont marqué les précédentes phases d’instabilité environnementale et des échelles de temps des capitaux naturels comme le système des eaux souterraines »
C’est ce qui l’a conduite à proposer le concept de « timefulness », que l’on peut comprendre comme « la conscience du temps ».
Et l’article de Courrier International s’appuie sur un ouvrage publié en 2018, non traduit en français, de la géologue : « Timefulness. How Thinking like a Geologist Can help Save the World » ce qui peut être traduit par : « La Conscience du temps. Comment penser comme un géologue peut contribuer à sauver le monde »
Marcia Bjornerud invite à prendre conscience du temps qu’il faut à une chaîne de montagnes pour s’élever , de celui qui est nécessaire à son érosion, et des échelles de temps différentes qui régissent les processus terrestres, en particulier à une époque où tout s’accélère.
Car elle écrit :
« N’aimant pas les histoires dépourvues de héros humain, beaucoup de gens ne trouvent tout simplement aucun intérêt à l’histoire naturelle. Nous sommes ainsi à la fois intempérants et intemporels, des analphabètes du temps »
Elle invite, à redorer le blason de cette science d’autant moins prestigieuse qu’il n’existe pas de prix Nobel pour la projeter périodiquement sous le feu des projecteurs.
« L’heure est venue pour toutes les sciences d’adopter le respect géologique pour le temps et sa capacité à transfigurer, détruire, renouveler, amplifier, éroder, disséminer, entrelacer, innover et exterminer. […] Le prisme de la géologie nous permet d’appréhender le temps en dépassant les limites de notre expérience humaine »
Cette réflexion constitue un excellent antidote à l’impatience et à la difficulté de savoir attendre.
Bien sûr, vous pourrez dire cette échelle des temps n’est pas forcément la plus pertinente pour l’échelle d’une vie humaine. Quoique savoir qu’une goutte d’eau peut rester neuf jours dans l’atmosphère terrestre reste à cette échelle et montre la patience de la nature.
Mais lorsque nous nous interrogeons sur les énergies fossiles, cette réflexion devient plus que pertinente, déterminante.
Ainsi le <site de la Radio Télévision Suisse> dans la réponse à une question explique la chose suivante :
« Les énergies fossiles (gaz naturel, le pétrole et houille de laquelle on extrait le charbon) mettent des millions d’années à se former. Le temps exact de leur formation dépend de différentes conditions (température, pression, profondeur, etc.). Selon les spécialistes, les gisements actuels datent de deux périodes principales (200 à 350 millions d’années ou 20 à 150 millions d’années). On estime que moins de 1% de la biomasse des êtres vivants qui ont peuplé la terre a été enfouie dans le sol ou a sédimenté au fond des mers et des océans pour former les ressources fossiles.
Ces ressources, sont donc présentes en quantité limitées et se renouvellent beaucoup plus lentement que nous les utilisons.
Pour se donner une meilleure idée du problème on peut faire un petit calcul : si l’on compare le temps de formation des énergies fossiles (env. 200 millions d’années) à une durée d’une semaine, les hommes commencent à utiliser les énergies fossiles le dimanche à moins d’une seconde de minuit. A minuit, les énergies fossiles sont épuisées. »
C’est dans cette proportion que l’homme dilapide le capital naturel qui lui a été donné.
Pendant ce temps, certains homo-sapiens envisagent d’aller s’installer sur Mars…
Peut être….
<1176>
-
Mardi 22 janvier 2019
« Les blancs ont la montre, nous avons le temps. »Proverbe africain cité par Courrier International du 20 décembre 2018 au 9 janvier 2019Avant la pause de noël, j’avais entrepris une réflexion sur le temps qui passe, à l’aune d’une phrase que ma grand-mère prononçait régulièrement à la sortie de Noël : « Bientôt Pâques ».
Après la pause, le mot du jour d’hier était centré sur l’attente qui est encore une réflexion sur le temps.
Pendant cette période, mon ami Jean-François de Dijon m’a envoyé par courrier un numéro de « Courrier International » qui portait comme titre sur sa page de couverture : « Le temps passe-t-il trop vite ? » avec le souhait que ces articles de la presse internationale fécondent ma réflexion et puissent, peut-être, alimenter le mot du jour.
Je crois que ce numéro est venu au bon moment et je vais donc partager avec vous ces connaissances ou ces spéculations sur ce « temps » qui obsède homo sapiens pour l’occuper, pour le retenir, pour l’allonger et au-delà, le plus important pour moi : le remplir.
Le premier article que je souhaite partager a été publié dans le journal espagnol « El Independiente » et pour titre : « Pourquoi nous sommes devenus impatients ». J’ai cependant préféré utilisé comme exergue, un proverbe africain également cité par le journal parce que cette phrase me parait plus poétique et que la montre est certainement une des raisons de cette impatience. Alors quand on parle de montre connectée et que l’on y voit que les innombrables services que ce tout petit objet peut rendre, il ne faudrait pas négliger aussi les conséquences de la « servitude volontaire » qu’elle impose et imposera à ses utilisateurs qui deviendront peut être des esclaves modernes de l’impatience et du flux des données et de l’information qui comme une avalanche nous submerge.
L’article commence par la description d’un fait, lorsque le journaliste appelle la chercheuse Amparo Lasén, cette dernière est en pleine dispute avec son fils qui lui reproche d’avoir oublié son portable à la maison ce qui ne lui a pas permis de la joindre pendant deux heures.
Cette tyrannie a été évoquée plusieurs fois par le mot du jour et particulièrement lorsque j’ai évoqué cette phrase écrite par Philip Roth :
« Qu’est-ce qui s’était passé depuis dix ans pour qu’il y ait soudain tant de choses à dire, à dire de si urgent que çà ne pouvait pas attendre ? »
Une pression diffuse et pourtant omniprésente nous impose non seulement dans le monde professionnel mais aussi dans le cercle familial et amical d’être accessible en permanence. Si nous n’y prenons garde nous sommes dans les deux rôles celui qui irrite la personne qui ne parvient pas à nous joindre mais aussi de celui à qui il paraît insupportable de devoir attendre une réponse de quelqu’un qui n’est pas joignable,
Oui ! Qu’est ce qui s’est passé ?
Amparo Lasén est professeure de sociologie de l’université Complutense de Madrid et sa spécialité est de répondre à la question : comment l’ère numérique nous transforme ?
Elle étudie notamment l’impact des téléphones portables sur notre vie quotidienne et conclut, comme Philip Roth, que notre capacité à attendre s’est dégradée de façon ahurissante ces dix dernières années, depuis que nous avons un téléphone portable dans la poche.
Mais notre dépendance envers le mobile n’est pas le seul symptôme de cette dégradation. En réalité, le temps comme valeur marchande est un concept relativement récent.
Francesc Núñez, directeur du mastère en humanités de l’université ouverte de Catalogne (UOC) explique :
« Avant l’industrialisation, le temps n’était pas perçu comme quelque chose de monnayable »
J’ai fait une recherche pour essayer de découvrir qui a inventé cette formule que chacun ânonne aujourd’hui comme s’il s’agissait d’une vérité scientifique : « Le temps c’est de l’argent ». Il semble qu’il s’agisse de Benjamin Franklin, donc un des fondateurs des Etats-Unis d’Amérique (1706 – 1790) ce qui situe bien cette phrase au début de la révolution industrielle.
Francesc Núñez ajoute :
« Internet fait voler en éclats notre manière de vivre le temps. Avec Google et les réseaux sociaux on a l’impression de s’affranchir de l’espace et du temps. N’importe quelle action peut être réalisée à tout moment, nous oublions que nous n’avons pas la maîtrise du temps. [avec Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook] nous avons énormément multiplié nos relations avec notre entourage en vue de faire des choses, mais tant d’immédiateté comporte le risque d’une insatisfaction constante. »
Et quand des spécialistes des sciences cognitives comme le Professeur Jordi Vallverdu de l’Université autonome de Barcelone décryptent ce qu’ils ont compris cela donne cela :
« Les likes agissent sur la neurochimie du cerveau. Sur les réseaux sociaux nous sommes comme ces rats de laboratoire qui courent après les récompenses. […] à chaque like nous avons une montée de dopamine et cela crée une dépendance. […] A mesure que le numérique s’est immiscé dans notre vie sociale, il a de plus en plus faussé notre perception de l’espace et du temps. »
Grâce à cet article, j’ai appris un nouveau concept : le « Fomo »
« L’abondance de divertissements disponibles à l’ère numérique donne lieu à ce que les spécialistes appellent le « Fomo » (fear of missing out) la peur de passer à côté de quelque chose d’important ».
Il semblerait comme le révèle cet article et je l’ai lu également dans d’autres articles que la capacité d’attention des jeunes générations diminue énormément par rapport à leurs ainés. L’article évoque une moyenne de 12 secondes.
Pour ma part, je reste très prudent par rapport à ce type d’information, je ne suis pas sûr qu’on mesure toute la complexité de la mutation qui est en train de se réaliser. Car il me semble que sur des jeux vidéo stratégiques des jeunes gamers sont capables d’une concentration très prolongée. En tout cas, il se passe quelque chose au niveau de l’attention, probablement que certains éprouvent de grandes difficultés de se concentrer sur des textes écrits qui demandent de longue période concentration. Mais parler simplement d’une capacité d’attention de 12 secondes, quel que soit le sujet de l’attention, me semble un peu court, comme aurait dit Cyrano.
En revanche, si on n’en revient au mot du jour d’hier le « savoir attendre » a clairement diminué, alors que comme le dit Amparo Lasén :
« C’était autrefois une qualité associé à la maturité ».
Et elle continue sur ce sujet en tirant les conséquences sur les relations sociales :
« Nous faisons culpabiliser les autres de nos propres urgences. »
Et Fransesc Nunez ajoute :
« Nous finissons par nous imaginer que le temps n’existe pas pour les autres, et nous exigeons d’eux qu’ils s’adaptent à nos besoins. Mais le fait que je sois pressé ne veut pas dire que je doive obliger l’autre à s’occuper de moi toutes affaires cessantes ».
L’article donne la conclusion à Jordi Vallverdu :
« Pour ne pas perdre le contrôle de notre temps, nous devrions arrêter de répondre à tout et réduire le nombre d’heures où nous sommes connectés. Au restaurant, on ne prend pas tous les plats de la carte. Il faudrait faire de même avec l’information : on n’a pas à tout avaler pour la simple raison que cela apparaît sur les réseaux. ».
Et j’ajouterai simplement que notre temps est limité, il est donc indispensable de choisir, de sélectionner ce qui le remplira pour notre équilibre personnel, ce qui nous nourrit vraiment et simplement nous fait du bien. Et je crois fermement que parmi ce que nous pouvons et devrions écarter il n’y a pas seulement la frénésie du flux d’informations numériques mais bien d’autres accapareurs de temps inutiles et malfaisants.
<1175>
-
Lundi 21 janvier 2019
« Celui qui attend est comme un arbre avec ses deux oiseaux, solitude et silence. »Christian BobinDans un premier temps, j’avais eu l’intention d’utiliser simplement : « L’attente » comme exergue de ce mot du jour.
Mais je suis tombé sur un poème de Christian Bobin qui m’a paru donné plus de profondeur et de force à ce que je souhaitais partager aujourd’hui, après une pause d’un mois.
C’est Christophe André qui m’avait fait découvrir cet écrivain né en 1951. Et c’est une citation de Christian Bobin que j’avais utilisée lors du mot du jour du « Jeudi 18 mai 2017» pour terminer la série de mots du jour consacré à l’émission « 3 minutes à méditer » qu’avait réalisée Christophe André :
« Pour qu’une chose se termine, il faut qu’une autre chose commence –
et les commencements, c’est impossible à voir»
L’attente est l’état de celui qui attend ou le temps pendant lequel on attend.
C’est un état qui pour beaucoup devient rapidement insupportable tant la société nous presse vers l’immédiateté : tout, n’importe quoi, tout de suite, donc sans l’attente.
Dès qu’une esquisse d’envie nous touche, surtout dans le domaine de la consommation, il suffit d’aller vers nos outils numériques et de commander sur les sites marchands en ligne.
J’ai appris récemment que pour l’instant Amazon réalise une marge infime dans son métier de commerce en ligne et cela notamment en raison de sa stratégie de vouloir livrer tous ses clients dans des délais extrêmement contraints.
Pourtant la vie est constituée de beaucoup d’attentes.
Quand on est enfant, on attend de devenir grand.
Avant l’enfant, il faut la naissance c’est encore une attente, qui est calibrée, il faut neuf mois à quelques jours près.
On attend une rencontre, un rendez-vous, sa première expérience sexuelle, son premier job et tant d’autres choses.
Ce site attribue à Jules Renard la citation suivante :
« Si l’on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce en serait la salle d’attente. »
Car le mot « attente » peut aussi avoir le sens de l’espérance ou de l’espoir. C’est le cas dans les expressions suivantes :
- Cet enfant a répondu à l’attente qu’on avait de lui.
- Il a rempli notre attente.
Pendant ses années d’études on attend, aussi notamment les résultats des examens. Dans ce cas l’attente est en effet espérance.
Et puis, il en est d’autres examens dont on attend les résultats.
Je me souviens avoir vu ce très beau film : « Cléo de 5 à 7 » d’Agnès Varda avec dans le rôle principal Corinne Marchand.
L’action se déroule à Paris, près de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Cléo, une jeune et belle chanteuse plutôt frivole, craint d’être atteinte d’un cancer. Il est 17 heures et elle doit récupérer les résultats de ses examens médicaux dans 2 heures. Pour tromper sa peur, elle cherche un soutien dans son entourage. Elle va se heurter à l’incrédulité voire à l’indifférence et mesurer la vacuité de son existence. Elle va finalement trouver le réconfort auprès d’un inconnu à l’issue de son errance angoissée dans Paris. Le film est constitué par ce temps de deux heures d’attentes
Télérama écrit :
« La jolie chanteuse (métier de Cléo) égocentrée et narcissique des premières scènes cède peu à peu la place à une autre femme, non plus objet mais sujet, qui regarde, qui écoute, qui se laisse enfin atteindre par les autres. C’est l’histoire inoubliable d’une transfiguration. »
Un film à voir et à revoir.
Je me trouvais dans la salle d’attente de la médecine nucléaire de Villeurbanne qui dispose d’un équipement très performant pour ausculter le corps humain.
Une femme très agitée est entrée. Elle avait mon âge.
Nous avons échangé des paroles, j’ai compris qu’elle était là non pour elle, mais parce qu’elle attendait sa fille de 25 ans.
Son attente n’était pas espérance, mais inquiétude
Nous avons échangé peu de paroles, mais l’échange se fait aussi par le regard, par l’attitude corporelle, par le silence.
Car le silence peut être habité, la solitude peut percevoir l’empathie.
Et l’empathie fait du bien à celui qui accepte de la recevoir.
Mais l’empathie fait aussi du bien à celui qui donne.
Et le don de l’empathie est probablement plus fort encore quand celui qui le donne se trouve lui-même dans la solitude et le silence.
L’exergue est extrait de ce poème qui se trouve dans «L’autre visage» publié aux Éditions Lettres Vives en 1991, aux pages 52 et 53 :
Celui qui attend
Celui qui attend est comme un arbre
avec ses deux oiseaux, Solitude et Silence.
Il ne commande pas à son attente.
Il bouge au gré du vent,
docile à ce qui s’approche,
souriant à ce qui s’éloigne.
Celui qui attend,
nous l’appelons le « tout comblé »
car dans l’attente,
le commencement est comme la fin,
la fleur est comme le fruit,
le temps comme l’éternel.
Christian Bobin
Un site que j’aime beaucoup, https://www.espritsnomades.net, parce qu’on y trouve de belles pages sur la musique classique et la littérature, a consacré une page à Christian Bobin : <Christian Bobin, notre part manquante>
<1174>
- Cet enfant a répondu à l’attente qu’on avait de lui.
-
Lundi 24 décembre 2018
« Pause »Mais vous pouvez trouver la liste des 1172 mots du jour déjà écrits dans <Liste des mots>L’attente se terminera pour vous, comme pour moi le 21 janvier 2019, date de la reprise du mot du jour.
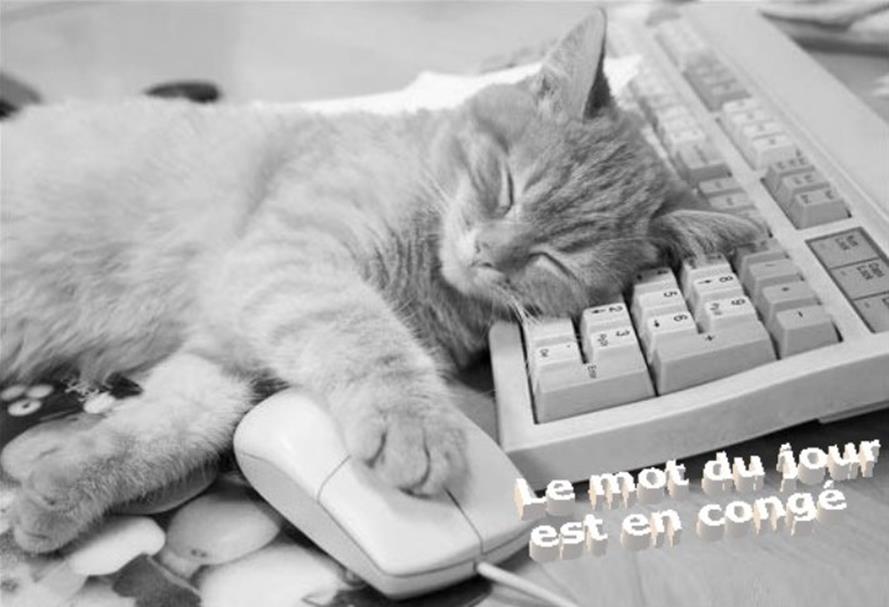
-
Vendredi 21 décembre 2018
« Bientôt Pâques »Ma grand-mère maternelle, dès que les fêtes de fin d’année étaient terminéesIl est temps d’arrêter de parler des affaires du monde et de la France, puisque le moment des fêtes de fin d’année débute.
C’est un moment de cadeaux, d’échanges, de repas.
Pour Annie et moi, il s’agit aussi du moment de faire les gâteaux de Noël alsaciens.
Et quand je pense gâteau, je pense à ma grand-mère maternelle dont le nom de Naissance était Franziska Kordonowski.
Elle était polonaise et se disait polonaise, bien que le jour de sa naissance le 15/06/1898, la Pologne n’existait pas, ou n’existait plus ou ne réexistait pas encore.
 Un matin, alors que je sortais du métro et que je me demandais quel mot du jour je pourrais bien trouver pour clore cette année 2018, avant la trêve de Noël, le regard doux et bienveillant de ma grand-mère m’est apparu.
Un matin, alors que je sortais du métro et que je me demandais quel mot du jour je pourrais bien trouver pour clore cette année 2018, avant la trêve de Noël, le regard doux et bienveillant de ma grand-mère m’est apparu.
Et je me suis souvenu qu’elle disait toujours, à peine les fêtes de fin d’année achevées : « et maintenant, bientôt Pâques »
Bien sûr, le lendemain du lundi de Pâques, elle disait de même : « Et maintenant, bientôt Noël ».
Pour cette femme chrétienne et croyante, l’année était rythmée par les fêtes religieuses et on allait de l’une à l’autre, dans un mouvement cyclique.
Jusqu’au moment où arrivé à un certain âge, on commence à se poser la question : est-ce que je vivrais encore la prochaine fête ?
Nous savons que ces fêtes religieuses ont épousé des fêtes païennes plus anciennes qui justement ponctuaient les saisons.
Le mot du jour du 23 décembre 2016 évoquait justement cette origine païenne de la fête de Noël :
L’empereur Aurélien (270-275), au milieu des divinités multiples qu’honorait le peuple romain, a assuré une place particulière à une divinité solaire : <Sol Invictus> (latin pour « Soleil invaincu »). Il proclame « le Soleil invaincu » patron principal de l’Empire romain et fait du 25 décembre, le jour du solstice d’hiver donc, une fête officielle appelée le « jour de naissance du Soleil » (du latin dies natalis solis invicti).
Parce qu’en effet, ce n’est pas un hasard que Noël se situe à quelques jours du solstice d’hiver. Solstice d’hiver qui a lieu précisément aujourd’hui, le 21 décembre 2018.
D’ailleurs depuis de nombreux siècles, cette fête se situe juste après le solstice d’hiver, lorsque le temps de la nuit commence à refluer devant le jour.
Et Pâques, dans sa formulation même évoque la saison. Je l’avais noté dans un mot du jour non consacré à Pâques, mais à la chanson de Craonne qu’il est bon de rappeler en cette fin d’année commémorative des 100 ans du 11 novembre 1918.
En effet, chaque année les chrétiens fêtent la «résurrection du Christ» le premier dimanche qui suit la première pleine Lune après l’équinoxe de Printemps.
Le printemps qui est bien sûr la saison de la renaissance de la nature.
Et donc, « Bientôt pâques » au moment de Noël pourrait aussi se dire « Bientôt le printemps » au moment de l’hiver.
L’expression « Bientôt pâques » d’une vieille dame de plus de 80 ans, peut aussi s’analyser comme la relativité du temps.
Einstein nous a appris que le temps absolu n’existe pas, il n’existe que des temps relatifs.
Ainsi quand on calcule la durée qui sépare l’hiver et le printemps on trouve environ 90 jours.
Dès lors pour un enfant de 6 ans qui a donc vécu 2 192 jours, cette durée de 90 jours représente 4,11% de son temps passé sur terre.
Pour un jeune homme de 20 ans cela représente 1,23%, et pour une dame de 85 ans qui a vécu 31 046 jours, cela représente 0,29% c’est-à-dire un temps relatif 14 fois plus réduit que celui de l’enfant de 6 ans.
Il apparait donc bien normal que pour cette dame de 85 ans, la période qui sépare l’une et l’autre fête apparaisse très courte dans son échelle de temps.
Pour finir ce mot avec un peu d’ivresse…

Chrystelle est une lectrice du mot du jour et quand elle a vu cette bouteille lors d’un repas convivial auquel elle a participé, elle a immédiatement pris une photo et a pensé à me l’envoyer.
Je ne vais pas la garder pour moi, je la partage donc avec tous ceux qui voudront bien lire ce mot du jour.
Le mot du jour ou the word of the day se met donc en congé pendant quelques temps.
Il reviendra en janvier, à une date qui reste à préciser.
<1173>
-
Jeudi 20 décembre 2018
« C’est trop cher ! »Réflexions personnelles sur une addictionJe sais comment conclure ce mot du jour, mais comment le commencer ?
Commençons par les impôts. Ils sont trop chers.
Ils grèvent le pouvoir d’achat, empêchent des investisseurs d’investir, les agents économiques dynamiques et nomades de toucher la juste rémunération de leurs mérites.
Les impôts paient le prix de la civilisation et du lien social de l’État providence, mais ils sont trop chers.
Les impôts servent aussi à payer des fonctionnaires, ils sont trop chers, ils sont trop nombreux.
Il y a trop d’enseignants, trop d’infirmières, trop de juges, trop de policiers… Il faut que cela coute moins cher.
Et les cotisations sociales, c’est comme les impôts ! Rare d’ailleurs sont ceux qui utilisent encore ce mot « cotisations sociales », on les appelle « des charges ». Un auditeur de France Inter, parlait de poids qu’on infligeait aux entreprises françaises dans la compétition mondiale, comme si on envoyait nos athlètes courir aux jeux olympiques avec une charge d’une dizaine de kilos sur les épaules. On ne peut pas gagner dans ces cas !
L’alimentation aussi, c’est trop cher. Je ne regarde pas la télévision et je n’écoute pas beaucoup les radios qui vivent grâce à la publicité. J’écoute, le samedi Europe 1 parce qu’il y a l’émission Mediapolis et pendant cette heure je reçois la dose extrême que je puisse supporter pour une semaine. Quasi tous les spots ont pour unique argument d’appel : c’est moins cher, décliné en promo, en offre spéciale etc. Ces publicités mettent en scène des couples qui hystérisent tel prix de 12 œufs ou d’un lot de pâtes, de cuisses de poulets ou encore d’un lot de 4 pneus. Enfin, n’importe quoi pourvu que le prix soit annoncé comme peu cher.
Jamais je n’entends une publicité qui vante la seule qualité du produit, c’est toujours le prix qui est déterminant.
Et les vêtements ? Les « fringues » comme on dit…
Jamais les conditions de fabrication ne sont évoquées…
Ah si ! Une fois lorsqu’une usine du Bengladesh à Dacca s’était effondrée, on l’avait appelé le drame du « Rana Plaza »
J’en avais fait un mot du jour : « Sommes-nous capables de regarder en face (la vie de) ceux qui nous permettent de consommer comme nous le faisons ? »
Les banques aussi sont trop chers… Il faut choisir des banques en ligne qui peuvent faire appel à des collaborateurs délocalisés qui eux aussi coûtent moins cher.
L’hôtel c’est trop cher. Il faut faire appel à des plateformes numériques qui poussent les hôtels à baisser leurs prix. Et voilà une branche d’activités qui ne peut pas vraiment être délocalisée : si vous allez dans un hôtel à Bordeaux, un salarié en Malaisie ne vous sera d’aucune utilité. Il peut être malaisien, mais il faut qu’il soit en France. Donc c’est une branche d’activité qui cherche des salariés pour faire le job et qui n’en trouve pas. C’est normal leurs salaires sont trop faibles. C’est bien sûr en raison de la rapacité des patrons. Oui, sans doute, mais c’est aussi parce il y a une forte pression sur les prix des chambres.
Et alors l’avion ? Mais enfin ! il faut absolument prendre les compagnies low cost. C’est moins cher. Vous savez que les salariés des compagnies low-cost doivent payer, sur leurs propres deniers, leur formation. Quand une compagnie low cost demande à un de ses pilotes qui habite en France de faire un vol Rome Los Angeles, c’est au pilote de payer son voyage à Rome et son hébergement avant le vol.
Le but n’est pas de multiplier à l’envie les exemples qui montrent toujours la même chose : la recherche du moins cher.
Que tous celles et ceux qui s’adonnent à cette quête quotidienne et obsessionnelle, ne soient point étonnés que le patron, le responsable, la société leur disent :
« Vous aussi vous coutez trop cher, vos salaires sont trop élevés. »
Car c’est bien cela la conclusion de toute cette addiction.
C’est cela que la mondialisation nous a offert : des produits et des services moins chers dans un monde ou peu à peu on nous fait comprendre que nous aussi, les classes moyennes des pays développés, sommes payés trop cher.
Il y là, quelque chose comme une « dissonance cognitive. »
C’est-à-dire que nous ne voulons pas voir que le malheur que certains vivent et que d’autres craignent, à raison, pour leur futur, provient de notre appétence, notre manière de consommer, l’organisation de la production dans le monde.
Un joueur de football comme Lionel Messi pourra réclamer des sommes exorbitantes, tant que des millions de gens beaucoup plus modestes accepteront de payer des droits télés, acheter des produits chers eux car estampillés « Lionel Messi » et accessoirement quelquefois payer pour aller le voir jouer dans un stade.
Quelques autres emplois de niches ou particulièrement qualifiés et recherchés ou encore des investisseurs disposant d’une puissance financière suffisante pourront continuer à espérer une augmentation forte de leurs revenus.
Pour un salarié ou un entrepreneur de la classe moyenne normale ce sera beaucoup plus compliqué d’avoir des exigences de revenus. L’automatisation et la robotisation vont encore accentuer ce phénomène.
Des économistes savants vous expliqueraient que le fameux « pouvoir d’achat » dont parlent les « gilets jaunes » dépend de ce qu’on gagne mais aussi du prix de ce qu’on souhaite acheter. Et aussi un peu des taxes et prélèvements qui permettent une vie sociale plus harmonieuse et solidaire.
Récemment, Villeroy de Galhau, le directeur de la Banque de France était l’invité des matins de France Culture et expliquait doctement que le protectionnisme, le frein au libre-échange, bref l’arrêt de la mondialisation se paierait immédiatement par une diminution du pouvoir d’achat qui pénaliserait en premier les populations les plus modestes.
Et, il a raison.
Il y a un monde entre :
- Le Fordisme où le patron disait : il faut que je paye à mes employés un salaire d’un niveau qui leur permette d’acheter les voitures (ou les produits) qu’ils fabriquent et que je vends ;
- Et la situation actuelle, où l’essentiel est de maîtriser les salaires et les charges en local. Le pouvoir d’achat des salariés étant assurés par tous les produits qu’ils peuvent acheter moins cher parce qu’ils sont fabriqués ailleurs, dans des pays où les salariés sont moins payés et où le coût de la protection sociale n’obère pas les prix.
Un jour, j’étais encore au PS et nous manifestions à Lyon, je crois que c’était contre le contrat premier embauche que voulait mettre en place Dominique de Villepin. C’était pour payer moins les salariés français qui entraient sur le marché du travail, puisque le problème est qu’ils coutent trop chers. Et je me souviens d’un jeune couple qui manifestait avec 4 chaises, chacun en portant deux. Je trouvais ces accessoires baroques et je les interrogeais : « Mais pourquoi avez-vous ces chaises ? ». Et le jeune homme de me répondre avec un grand sourire :
« Avant de venir à la manifestation, nous avons vu un magasin qui vendait ces chaises à 5 euros, alors comme ce n’était vraiment pas cher, nous les avons achetés »
Comment peut-on vendre des chaises à 5 euros ? Qu’est-ce qu’il faut qui se passe en amont pour que, arrivés dans le magasin, le prix soit de 5 euros ?
Et puis, on va manifester pour que le salaire, en France, reste à un niveau acceptable ?
C’est cela la dissonance cognitive.
Bossuet écrivait : « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes. »
Dans cette excellente émission « L’esprit Public » de ce dimanche, Daniel Cohen a cité Hannah Arendt (à 11:40) :
« Il faut accepter qu’on ait une société complexe. Or cette complexité n’est plus intelligible. Dans les sociétés traditionnelles que le monde industriel a portées, il y a des classes sociales, des ouvriers avec des syndicats, des ingénieurs avec leurs clubs d’ingénieurs. Tout ceci est assez visible et chacun sait qu’il a des ressources politiques, sociales, syndicales qui permettent d’exprimer une attente. Nous vivons dans un monde où tout cela est pulvérisé. [dans les années 30] Hannah Arendt disait dans son analyse de la montée du totalitarisme : on est passé d’une société de classe, où chacun comprend son intérêt et est capable de l’opposer à celui des autres, à une société de masse. Une société de masse ce sont des individus isolés qui n’ont plus la conscience collective de leurs souffrances individuelles. Ce mouvement a, autour des ronds-points, donné d’une certaine manière une dimension collective à la souffrance individuelle »
Une société de masse formée d’individus et pour être encore plus précis de consommateurs, n’a que faire des prélèvements publics, chacun préférera trouver sa propre assurance parfaitement adaptée à son profil et à ses revenus et pour le reste l’individu aimera trouver des biens et services au prix le moins cher.
Zygmunt Bauman appelle cette société d’individus et de consommateurs : « une société liquide » par opposition aux sociétés traditionnelles qui étaient des « sociétés solides »
Je ne dis pas qu’il existe une solution dans le système économique dans lequel nous vivons aujourd’hui.
Mais c’est une grande tromperie de le faire croire.
On pourra certainement avoir une société plus égalitaire mais elle sera indiscutablement plus pauvre en pouvoir d’achat.
Elle ne sera pas forcément moins désirable, mais cela induit de grands changements de comportement.
Et probablement que d’individus nous soyons à nouveau capable de faire société, peut-être plus totalement solide mais certainement un peu moins liquide.
Mais est-ce que le plus grand nombre le désire ?
Et est-il possible de faire cela dans un seul pays ?
J’ai peur que dans ce cas le reste du monde ressemble à Astérix et Obélix dans cet extrait « d’Astérix légionnaire » et que la France se trouve dans le rôle du centurion qui veut faire la pause..

Je ne dis pas que nous sommes entièrement responsables de ce qui arrive, mais nous y participons grandement quand nous oublions notre humanité, notre sociabilité, notre citoyenneté pour nous immerger dans notre seule condition de consommateur qui veut être servi tout de suite, à n’importe quelle heure, beaucoup et pour pas cher.
<1172>
- Le Fordisme où le patron disait : il faut que je paye à mes employés un salaire d’un niveau qui leur permette d’acheter les voitures (ou les produits) qu’ils fabriquent et que je vends ;
-
Mercredi 19 décembre 2018
« La classe moyenne allemande est fracturée. Sa partie centrale subit un vrai mouvement de mobilité descendante. »Oliver Nachtwey, un sociologue allemand cité par Brice CouturierLe mouvement social actuel ne concerne pas la partie la plus pauvre de notre population, mais plutôt la classe moyenne inférieure, qui peut être au chômage, mais qui le plus souvent possède un emploi mais ne parvient pas à vivre convenablement de son salaire.
Souvent nous nous comparons à nos amis allemands.
Il y a un point qui fait consensus : l’économie allemande est plus forte que celle de la France, dégage une plus grande productivité et crée des surplus commerciaux avec le reste du monde, alors que la France fait l’inverse.
Il y a un autre point qui fait consensus : le taux de chômage est nettement plus faible en Allemagne qu’en France.
Et puis, il y a un sujet qui crée de grandes dissensions entre les analystes.
- Les premiers, plutôt de gauche qui prétendent que certes il y a moins de chômage en Allemagne, mais il y a plus de pauvreté qu’en France.
- Les seconds, plutôt de droite, considèrent cette analyse fallacieuse et affirment qu’il n’y a pas plus de pauvreté en Allemagne.
Le média d’opinion participatif « Agora Vox » est plutôt dans le premier camp surtout dans <cet article> datant de 2015:
« Selon une étude publiée par la fédération d’aide sociale Paritätischer Wohlfahrtsverband, la pauvreté en Allemagne est actuellement à son niveau le plus élevé depuis la réunification, en 1990. A noter que le Paritätischer Wohlfahrtsverband (PW) est une fédération qui regroupe environ 10.000 associations actives dans le domaine de l’aide sociale et de la santé.
Le taux de pauvreté est passé de 15% en 2012 à 15,5% en 2013, un pourcentage qui correspond à 12,5 millions de personnes.[…]
Le directeur général ce cette fédération, Ulrich Schneider, a déclaré : « Depuis 2006, on observe clairement une dangereuse tendance d’augmentation à la pauvreté (…) La pauvreté en Allemagne n’a jamais été aussi élevée et la fragmentation régionale n’a jamais été aussi sévère qu’aujourd’hui », ajoutant que l’Allemagne « a clairement un problème croissant de distribution de la richesse ».[…]
Une autre donnée, toute aussi inquiétante, c’est la forte hausse du nombre de salariés qui se situent sous le seuil de pauvreté. Ce sont aujourd’hui 3 millions de salariés allemands qui se retrouvent dans cette situation, soit une augmentation de 25% en 7 ans (2,5 millions à l’époque). […]
On peut légitimement se poser des questions sur un modèle de société qui n’est pas capable de subvenir aux besoins de sa population, et bien plus grave encore, de ceux qui ont un emploi. »
Le journal « Libération » est plus ambigüe, tout en reconnaissant une augmentation de la pauvreté. Dans un article plus récent, publié le 26 mars 2018, le journal donne la parole à Bruno Amable, professeur à l’université de Genève : <Allemagne : moins de chômeurs, plus de pauvres> :
« Cette situation favorable de l’emploi s’accompagne aussi d’une hausse des inégalités. Celles-ci concernent en premier lieu le niveau des salaires. En moyenne, ils ont recommencé à augmenter en termes réels mais ces augmentations ne concernent pas l’ensemble de la distribution des revenus. Entre 1995 et 2015, alors que les 20 % de salariés les moins bien payés connaissaient une baisse de salaire réel de 7 %, les 30 % de salariés les mieux payés bénéficiaient d’une hausse allant de 8 % à 10 %.
Autre phénomène connu, la baisse du chômage s’est accompagnée d’une hausse de l’emploi atypique (temps partiel, CDD). Celui-ci ne représentait que 13 % de l’ensemble des emplois en 1991. En 2015, c’était plus d’un emploi sur cinq (21 %) qui était atypique. Cela ne signifie pas nécessairement que tous ceux ou celles qui occupent ces emplois vivent dans la précarité, mais d’autres indicateurs témoignent d’une dégradation de la situation des personnes employées. On définit de façon conventionnelle l’emploi mal payé comme celui qui correspond à un salaire inférieur à deux tiers du salaire médian. Les emplois mal payés représentaient à peu près 16 % de l’emploi au milieu des années 90 ; ce chiffre était monté à 22 % ou 23 % dans les années 2010. »
L’article de Libération développe aussi une analyse comparative entre la France et l’Allemagne mais en prenant en compte la structure familiale (célibataire, famille bi-active, ou famille mono-active). Dans cette analyse, les résultats sont différents selon les cas.
On en conclut cependant que s’il n’est pas totalement concluant que la pauvreté soit plus forte en Allemagne, il faut reconnaître selon ces éléments que le surplus de richesse et de force économique ne lui sert pas à diminuer vraiment la pauvreté par rapport à son voisin plus fragile économiquement.
Si « les Echos » (07/03/2017) contestent l’affirmation de Benoit Hamon de la plus grande pauvreté allemande, ils concluent cependant :
« Certes, en ce qui concerne les actifs, ces derniers sont plus nombreux à vivre sous le seuil de pauvreté en Allemagne. Près de 10 % de la population active qui occupe effectivement un emploi sont pauvres chez nos voisins germaniques alors qu’ils ne sont que 7,5 % en France. Cela s’explique largement par l’existence de mini-jobs, dotés de mini-salaires, dans de nombreux secteurs d’activité en Allemagne, et notamment les services à la personne. Et la pauvreté a tendance à augmenter plus vite en Allemagne qu’en France. »
Donc l’Allemagne est un géant économique mais dans la lutte contre la pauvreté, elle ne s’en sort pas mieux que la France.
Olivier Passet de Xerfi (institut d’études économique privé) (16/05/2018) rappelle l’objectif du père de la réforme allemande Peter Hartz :
« On se souvient de la formule de Peter Hartz, l’artisan de la réforme du marché du travail allemand: « Il vaut mieux un peu de travail que pas de travail du tout ». 15 ans après ses réformes, le taux d’emploi allemand a augmenté de 10 points, tandis que celui de la France a fait du sur-place. Avec l’impact que l’on connaît sur le taux de chômage, qui aujourd’hui est à son plus bas depuis la réunification.
Le revers de la médaille de cette politique, on le connaît aussi. C’est la montée de la pauvreté, et notamment de la pauvreté au travail, liée à la montée des mini-jobs. […] »
Et s’il signale l’avantage de la France concernant la lutte contre la pauvreté, il nuance ce jugement en raison d’une structure familiale par rapport au travail très différente en Allemagne, cet aspect est aussi développé dans l’article de Libération :
« Les écarts demeurent mais sont bien moins spectaculaires, lorsque l’on opère ces calculs sur la base du revenu disponible, après impôts et transferts sociaux donc et en incluant tous les types de revenus. C’est ce que l’on appelle le taux de risque de pauvreté au travail, indicateur largement commenté lui-aussi. La part des personnes en emploi touchant moins de 60% du revenu disponible médian ressort à 7,9% en France contre 9,5% en Allemagne. L’avantage reste à la France, mais l’Allemagne n’est plus en position polaire. […]
Plus récemment un troisième indicateur, produit par l’OCDE, a défrayé la chronique. Il concerne lui aussi la proportion de travailleurs pauvres. Il en ressort que le taux serait de 7,1% en France, tandis qu’il ne serait que de 3,7% en Allemagne. Il a bousculé le discours selon lequel l’Allemagne payerait son faible taux de chômage par une importante précarisation. Mais nuance, l’indicateur parle de pauvreté au niveau du ménage, après redistribution, une fois que l’on intègre l’ensemble des revenus perçus au niveau d’un foyer dans lequel au moins une personne travaille. Cela montre que si la proportion de personnes travaillant à bas salaire est incontestablement plus forte en Allemagne, le risque est mutualisé au niveau du foyer. 1/Il existe une répartition des rôles au niveau du foyer, entre celui qui produit le revenu principal, est celui (le plus souvent celle), qui fournit le revenu d’appoint, souvent à temps partiel). 2/ Il existe des transferts sociaux correcteurs, notamment pour les familles monoparentales, comme au Royaume-Uni notamment 3/ Le taux d’emploi, beaucoup plus élevé, permet de limiter le risque de pauvreté au niveau du foyer.
Point décisif remporté par Peter Hartz apparemment donc, puisque la diffusion des petits jobs réduirait bien le risque de pauvreté au niveau des ménages. Oui à cela près qu’il faut accepter une répartition très sexuée des rôles, de fortes dualités. Et qu’en définitive, cette politique a aussi des effets collatéraux sur les retraités. Beaucoup de petits jobs, c’est beaucoup de petites retraites en perspective et une montée de la pauvreté dans la population toute entière. C’est encore ce que racontent les statistiques sur l’incidence de la pauvreté au niveau de la population totale jusqu’à dernière nouvelle du moins. »
Si vous voulez un article qui réfute le fait qu’il y ait plus de pauvres en Allemagne il faut aller vers « l’Obs » : <Inégalités, pauvreté : non, l’Allemagne n’est pas un désastre social…>
Mais ce qui m’a parait intéressant et instructif, c’est une chronique de Brice Couturier qui est un macroniste revendiqué et qui dans chacune de ses interventions les années précédentes citait l’Allemagne de Merkel en exemple. Dans sa chronique du 14 décembre 2018, il a sensiblement évolué : <Merkel désigne son héritière mais laisse une Allemagne en mauvais état> :
« Un sociologue allemand, Oliver Nachtwey, dresse un sombre tableau de l’Allemagne d’aujourd’hui. « La stabilité et même la monotonie associée à la vie politique allemande sous Merkel apparaît devoir se terminer », dit-il. Et son départ imminent traduit une crise du système politique allemand qui menace l’Europe tout entière.
Mais la crise politique allemande, poursuit-il, traduit une crise sociale beaucoup plus profonde. Malgré l’atout que constitue une monnaie dévaluée de fait par rapport à ses excédents commerciaux, la puissance de son industrie manufacturière, la croissance allemande ne cesse de faiblir depuis une décennie.
Et le fameux modèle social allemand subit une érosion. Ulrich Beck l’avait nommé « l’effet ascenseur ». Des inégalités de revenus assez importantes étaient acceptées par la population parce que tout le monde avait le sentiment justifié d’être dans un ascenseur – même si certains montaient plus haut que d’autres.
C’est fini.
Les salaires du bas de l’échelle stagnent et ont même tendance à baisser. Le nombre de jobs procurant la stabilité et des salaires conséquents, qui étaient la norme il y a trente ans, se réduit progressivement. Les boulots précaires explosent. Ils concernent à présent près d’un tiers des travailleurs.
La classe moyenne allemande est fracturée. Sa partie centrale subit un vrai mouvement de mobilité descendante. Pour eux, l’ascenseur dégringole. »
En conclusion, et même si on reste prudent de savoir qui lutte le mieux contre la pauvreté de l’Allemagne et la France, on s’aperçoit qu’il y a bien un problème plus général dans nos pays occidentaux, qu’on soit un géant économique ou un compétiteur un peu faiblard :
- La problématique qu’il n’y a plus de travail pour tout le monde, la France ajuste cela par le chômage, l’Allemagne par un travail partiel accru par rapport à la France, surtout réservé aux femmes.
- L’autre problématique est que le travail des classes moyennes n’est plus suffisamment rémunéré.
Les Etats-Unis vivent exactement la même chose : les salaires des classes moyennes stagnent depuis de très nombreuses années.
La mondialisation a bien des attraits et notamment pour notre pouvoir d’achat puisqu’il est possible d’acheter des biens à des prix bas, mais la pression sur les salaires dans nos pays est terrible.
je ne crois pas un seul instant que Macron, ni d’ailleurs un autre homme politique sera capable de résoudre cette tension interne à la mondialisation actuelle.
<1171>
- Les premiers, plutôt de gauche qui prétendent que certes il y a moins de chômage en Allemagne, mais il y a plus de pauvreté qu’en France.
-
Mardi 18 décembre 2018
« Pris à part, chacun des éléments paraît logique, voire acceptable, mais placés bout à bout, ils finissent par former une infernale machine à broyer. »Florence AubenasFlorence Aubenas est allé s’immerger, pendant une semaine, au sein de groupes de gilets jaunes dans la région de Marmande dans le Lot et Garonne et en a tiré un reportage publié dans le journal Le Monde le 15 décembre 2018.
Son reportage est accompagné de photos en noir et blanc réalisés par Edouard Elias.
Florence Aubenas n’est pas une conceptuelle, elle n’est pas giletjaunologue, elle va simplement voir sur place, reste suffisamment longuement pour laisser s’exprimer celles et ceux qu’elle rencontre puis essaye de décrire le plus précisément possible ce qu’elle a vu et compris.
Elle avait publié un premier travail de reportage en France, en 2011, <Le quai de Ouistreham>, livre qu’elle a écrit après avoir, pendant six mois, essayé de « vivre la vie » des plus démunis, ceux et surtout celles qui tentent de s’en sortir en enchaînant des travaux précaires (femme de ménage par exemple) et du temps partiel. Elle a mené cette enquête à Caen. C’est un des emplois qu’elle a occupé : nettoyer un quai qui a donné le titre du livre.
Puis elle avait parcouru la France, les villages et les gens de France, ailleurs que dans les riches métropoles , là où il devient de plus en plus difficile ou compliqué de vivre et l’avait rapporté dans un livre « en France » publié en 2013 et auquel j’avais consacré une série de 5 mots du jour que vous retrouverez sur cette page : « « En France » – Chroniques dans les villes et villages de France »
Frédéric Pommier a parlé du reportage de Florence Aubenas sur les gilets jaunes lors de <La revue de Presse du week end> du dimanche 16 décembre 2018 :
« Les mouvements de contestation peuvent créer du lien social.
C’est ce qu’on découvre dans le formidable reportage que signe Florence Aubenas dans LE MONDE… « La révolte des ronds-points »… Un journal de bord qu’elle a tenu une semaine durant, s’installant sur les giratoires occupés près de Marmande par des dizaines de Gilets jaunes… Le photographe Edouard Elias était à ses côtés… Il faut lire et il faut dans le même temps regarder pour comprendre cette France qui, depuis plus d’un mois, se retrouve pour mener le combat contre les taxes et pour davantage de justice sociale… »
Et Florence Aubenas était l’invité de Léa Salamé lundi 17 décembre 2018 pour parler de son reportage : <L’invité de 7h50>
Léa Salamé a d’abord posé la question de ce qui l’avait le plus surpris :
« [On a vu sur ces ronds-points] des gens qu’on ne voyait jamais, ce n’était pas des gens qui avaient l’habitude de prendre la parole, ce n’était pas la grande gueule du coin. Pourquoi ces gens ne sortaient pas et sortent aujourd’hui et c’est cela qui serre le cœur. Ils ne sortaient plus de chez eux. […]
au début] Certains ne parlaient pas, ne se présentaient pas, écrivaient juste leur nom sur leurs gilets»
Et puis peu à peu, ils ont commencé à parler. A parler d’argent, de leurs difficultés financières. Sujet tabou qu’ils n’osaient jamais aborder, même avec leurs amis, mais là sur les ronds-points ils et surtout elles ont parlé et ont constaté qu’elles n’étaient pas seules que d’autres vivaient les mêmes choses.
Bien sûr, elle reconnait avoir entendu des propos racistes, et des propos extrêmes, mais elle ajouté tout de suite qu’elle en entend aussi dans les milieux de journalistes à Paris, même si les propos ont plus policés. Et elle a aussi entendu sur ces ronds-points des gens qui disaient « je ne suis pas d’accord » devant ces propos extrémistes.
Surtout le racisme était selon elle marginal et non au cœur des discussions.
Vous trouverez ce long reportage sur le site du Monde : <Sur les ronds-points les gilets jaunes à la croisée des chemins>
Il faut bien sûr être abonné pour pouvoir accéder à l’intégralité de l’article et des photos.
Florence Aubenas raconte par exemple l’expérience de Coralie qui est une gilet jaune rencontrée sur un rond-point :
Coralie arrive la première. A son mari, apiculteur, certains sont allés dire : « On a vu ta femme sur le rond-point avec des voyous et des cas soc’. » « Moi aussi, je suis un cas social », constate Coralie, 25 ans. Elle a mis un temps à digérer le mot, mais « objectivement », dit-elle, c’est bien celui qui pourrait la définir.
Elle vient de déposer à l’école ses deux fils d’un premier mariage. Garde le souvenir amer d’un élevage de chevaux catastrophique. Aimerait devenir assistante maternelle. Il fait très froid, il faudrait rallumer le feu éteint dans le bidon. « Qu’est-ce que je fais là ? », se demande Coralie.
Et puis, un grand gars arrive, qui voudrait peindre un slogan sur une pancarte. « Je peux écrire « Pendaison Macron » ? », il demande.
« Vas-y, fais-toi plaisir », dit Coralie. Personnellement, elle ne voit aucune urgence à pendre Macron. Et alors ? On affiche ce qu’on veut. Le gilet jaune lui-même sert à ça, transformer chacun en homme-sandwich de son propre message, tracé au feutre dans le dos : « Stop au racket des citoyens par les politiques » ; « Rital » ; « Macron, tu te fous de ton peuple » ; « Non au radar, aux 80 km/h, au contrôle technique, aux taxes, c’est trop » ; « 18 ans et sexy » ; « Le ras-le-bol, c’est maintenant » ; « Marre d’avoir froid » ; « Fatigué de survivre » ; « Staff du rond-point » ; « Frexit » ; « Le peuple en a assez, Macron au bucher. »
Depuis des mois, son mari disait à Coralie : « Sors de la maison, va voir des copines, fais les magasins. » Ça a été les « gilets jaunes », au rond-point de la Satar, la plus petite des trois cahutes autour de Marmande, plantée entre un bout de campagne, une bretelle d’autoroute et une grosse plate-forme de chargement, où des camions se relaient jour et nuit.
L’activité des « gilets » consiste ici à monter des barrages filtrants. Voilà les autres, ils arrivent, Christelle, qui a des enfants du même âge que ceux de Coralie, Laurent, un maréchal-ferrant, André, un retraité attifé comme un prince, 300 chemises et trois Mercedes, Sylvie, l’éleveuse de poulets. Et tout revient d’un coup, la chaleur de la cahute, la compagnie des humains, les « Bonjour » qui claquent fort. Est-ce que les « gilets jaunes » vont réussir à changer la vie ? Une infirmière songeuse : « En tout cas, ils ont changé ma vie. »
Le soir, en rentrant, Coralie n’a plus envie de parler que de ça. Son mari trouve qu’elle l’aime moins. Il le lui a dit.
Un soir, ils ont invité à dîner les fidèles du rond-point. Ils n’avaient jamais reçu personne à la maison, sauf la famille bien sûr. « Tu l’as, ton nouveau départ. Tu es forte », a glissé le mari.
Coralie distribue des tracts aux conducteurs. « Vous n’obtiendrez rien, mademoiselle, vous feriez mieux de rentrer chez vous », suggère un homme dans une berline.
« Je n’attends rien de spécial. Ici, on fait les choses pour soi : j’ai déjà gagné. »
Elle raconte aussi à Marmande la relation ambigüe entre le patron d’un Centre Leclerc d’abord soutenant les gilets jaunes puis estimant que la contestation avait assez duré essaye de casser le mouvement.
Ou encore cette réflexion :
« Dorothée, 42 ans, monteuse-câbleuse, 1 100 euros net, est l’une des deux porte-parole des « gilets » de Marmande. « Ça faisait des années que je bouillais devant ma télé, à me dire : « Personne ne pense comme moi, ou quoi ? » Quand j’ai entendu parler des « gilets jaunes », j’ai dit à mon mari : « C’est pour moi. » » »
Je retiens surtout ce besoin d’échanges, de dialogues qui n’existaient plus :
« Et puis, que s’est-il passé ? Comment tout le monde s’est soudain retrouvé à déballer devant de parfaits inconnus – « Des gens à qui on aurait marché dessus chez Leclerc à peine deux semaines plus tôt, sans les saluer » – les choses les plus profondes de sa vie ? Des choses si intimes qu’on les cachait soigneusement jusque-là, « sauf parfois entre amis, mais c’était gênant ». La cahute est devenue le lieu où « les masques tombent ». Plus de honte. « Ça fait dix ans que je vis sans sortir, à parler à ma chienne. Aujourd’hui, les digues lâchent », dit une infirmière. »
Et Florence Aubenas conclut :
« Chacun a son histoire, toujours très compliquée, mais toutes se ressemblent au fond, un enchevêtrement de problèmes administratifs, de santé, de conditions de travail. Pris à part, chacun des éléments paraît logique, voire acceptable, mais placés bout à bout, ils finissent par former une infernale machine à broyer. »
Elle raconte aussi la méfiance et peut être même la haine des politiques :
« La politique est prohibée : un militant communiste a bien essayé de tracter, puis un petit couple – lui en costume, elle en blouson de cuir –, se disant France insoumise. Tous ont été chassés. Le seul discours commun évoque les « privilégiés de la République », députés, énarques, ministres, sans distinction, à qui « on ne demande jamais de sacrifices ». En fait, c’est à eux qu’on en veut, bien davantage qu’aux multinationales ou aux patrons. »
Un reportage à lire.
<1170>
-
Lundi 17 décembre 2018
« Strasbourg »Une ville chère à mon cœur et à celui d’Annie, une ville aujourd’hui meurtrieStrasbourg est une de ces villes qui a une âme. Je l’ai rencontrée au sortir du bac pour commencer mes études supérieures dans cette grande ville de l’est de la France.
 Mes études dans les classes préparatoires aux grandes écoles au Lycée Kléber, se sont mal passées et ont fini par un échec.
Mes études dans les classes préparatoires aux grandes écoles au Lycée Kléber, se sont mal passées et ont fini par un échec.
Mais j’ai toujours continué à aimer cette ville.
Annie est venue aussi faire des études à Strasbourg, un an avant et elles se sont terminées, après mon départ, par un succès.
Chaque fois que nous y retournons, nous sommes heureux, émus et émerveillés par la beauté de cette ville.
Les Romains sont arrivés en Alsace en 58 av. J.-C. C’est sous la direction de Jules César que les romains sont intervenus en Gaule, à partir de cette date en 58 avant JC.
Cette intervention qui sera couronnée par la bataille décisive de la guerre des Gaules en 52 av. JC, le siège d’Alésia qui voit la défaite d’une coalition de peuples gaulois menée par Vercingétorix face à l’armée romaine de Jules César..
Finalement Wikipédia, nous apprend que le frère de Tibère, deuxième empereur romain après Auguste le fils adoptif de César, Nero Claudius Drusus fait construire sur le site de Strasbourg en 12 avant JC sur l’emplacement d’une forteresse gauloise, une ville qui s’appellera Argentoratum.
En l’appelant ainsi les romains n’ont fait que latiniser le nom celte de la forteresse gauloise Argentorate.

Rappelons que Strasbourg se trouve sur la rive gauche du Rhin, fleuve qui a souvent joué le rôle de frontière.
Lors de l’expansion de l’empire romain qui s’est étendu à la Germanie au IIe et IIIe siècles, Argentoratum va servir de base de repli pour les troupes romaines installées en Germanie. Mais en 260, les légions quittent définitivement la Germanie et Strasbourg redevient une ville frontière.
Et en 355, la ville est saccagée par des germains qui ont pour nom les « Alamans ».
Et il faut savoir que le nom français donné au pays voisin : « Allemagne » vient du latin « Alemannia » qui signifie le pays des Alamans.
Mais la réalité de nos voisins est complexe puisqu’en allemand ce pays est appelé Deutschland, en anglais Germany et en polonais Niemcy.
Une autre tribu germaine, « les Teutons » est aussi utilisée, en particulier en italien où « tedesco » signifie « allemand ».

Strasbourg va avoir un destin compliqué entre l’Allemagne et la France.
Mais avant cette dispute, ce sont les Huns d’Attila qui vont complétement détruire la ville en 451.
C’est un autre peuple germain « Les francs », qui je le rappelle sont autant nos ancêtres que les gaulois, qui au début du VIe siècle vont reconstruire la ville, sous le nom de Stratae burgus (le bourg de la route). Et Stratae burgus va devenir Strasbourg.
Le christianisme va bien sûr jouer un rôle considérable dans le développement de la ville. Comme pour Lyon, la ville sera essentiellement gouverné par la puissance épiscopale. Wikipedia nous apprend que sous l’impulsion de l’évêque Arbogast de Strasbourg, une première cathédrale et un couvent sont édifiés dès le VIème siècle.
Par la suite vous savez que Charlemagne va tenter de recréer un empire chrétien. Il sera couronné empereur par le Pape en l’an 800. Charlemagne qui est un empereur français comme nous l’apprennent les livres d’Histoire de France. Mais les livres d’Histoire
allemande le désignent comme un empereur germanique donc allemand. Pour départager les deux, il faut se rappeler que la capitale de Charlemagne est Aachen, ville allemande, même si les livres d’Histoire français continuent à la désigner sous le nom d’Aix la Chapelle.
Ceci est très important pour Strasbourg puisque après que le fils de Charlemagne Louis le Pieux lui ait succédé sur le trône de l’Empire, les trois petits fils vont se partager l’empire.
Et c’est alors qu’eut lieu le « Serment de Strasbourg » le jour de la Saint Valentin, le 14 février 842. L’aîné des 3 frères Lothaire avait l’ambition de jouer un rôle primordial dans la succession de son père. Mais les deux autres frères n’étaient pas d’accord et c’est par le serment de Strasbourg qu’une alliance militaire est signée entre Charles le Chauve et Louis le Germanique, contre leur frère aîné, Lothaire Ier.
Ce serment est fondamental à plusieurs titres.

Le premier c’est que la Lotharingie qui occupait une place centrale va être absorbée par les ces deux voisins à l’ouest va émerger la France et à l’est les pays allemands.
Le second c’est que Louis le Germanique prononce son serment en langue romane pour être compris des soldats de Charles le Chauve, et Charles le Chauve récite le sien en langue tudesque pour qu’il soit entendu des soldats de Louis.
Le texte en roman des Serments a une portée philologique et symbolique essentielle, puisqu’il constitue, pour ainsi dire, « l’acte de naissance de la langue française ».
Jusqu’alors ce type de texte était rédigé en latin.
Mais il est important de savoir qu’en 1493, Strasbourg est proclamée ville libre impériale par Charles IV. Ce qui en fait indiscutablement une ville allemande.
Strasbourg qui sera d’ailleurs un centre important de la réforme initiée par Martin Luther.
Mais comme je l’avais écrit lors des mots du jour sur Luther, avant la réforme il fallut inventer l’imprimerie, pour imprimer des livres et d’abord la bible en langue comprise par tous.
Cette invention est le fait Johannes Gutenberg qui est né à Mayence mais qui s’est installé à Strasbourg en 1434 et Strasbourg va devenir un des plus grands centre d’imprimerie d’Europe.
Cependant Wikipedia précise que :
« Gutenberg est retourné à Mayence entre 1444 et 1448 ce qui fait qu’on ignore exactement où a été finalisée cette invention majeure. Toujours est-il que Strasbourg devient très vite un des grands centres de l’imprimerie, puisque dès la fin du XVe siècle la ville compte une dizaine d’ateliers d’imprimerie, notamment la prestigieuse officine des Grüninger. De fait, Strasbourg va attirer nombre d’intellectuels et d’artistes. Sculpteurs, architectes, orfèvres, peintres, horlogers, la ville excelle dans de nombreux domaines. Strasbourg était une ville très influente d’où son statut très spécial et unique de « ville libre » elle produisait sa propre monnaie avec un commerce développé et grâce à sa situation géographique pouvait exporter et importer des produits. »
Une des principales places de Strasbourg a d’ailleurs été nommée du nom de l’inventeur de l’imprimerie.
Dans la suite Strasbourg va devenir un centre de la réforme puisque dès 1519, les thèses de Martin Luther seront affichées aux portes de la cathédrale et les dirigeants de la ville, notamment Jacques Sturm, sont favorables à ce changement. La ville adopte la Réforme en 1525 et devient protestante en 1532 avec l’adhésion à la confession d’Augsbourg.
 Mais il va s’en suivre une période de grands conflits religieux qui va notamment donner lieu à la terrible guerre de trente ans. Guerre qui va s’achever par les paix de Westphalie signés le 24 octobre 1648
Mais il va s’en suivre une période de grands conflits religieux qui va notamment donner lieu à la terrible guerre de trente ans. Guerre qui va s’achever par les paix de Westphalie signés le 24 octobre 1648
Ces traités vont conduire qu’une partie de l’Alsace sera rattachée à la France, mais Strasbourg demeure ville libre impériale.
La ville est sortie épargnée par la guerre mais est affaiblie, et l’empire germanique vaincu ne peut lui apporter d’aide.
Et c’est ainsi que le 28 septembre 1681, la ville est assiégée par une armée commandée par Louis XIV. La ville se rend deux jours plus tard et sera rattachée au royaume de France avec l’Alsace tout entière.
Strasbourg redevient ville frontière et abrite environ 6 000 soldats français, basés pour la plupart à la citadelle de Vauban dont les travaux ont débuté dès 1682 et dont on voit toujours les traces dans la ville actuelle.
En 1704, un prince de la famille Rohan devient évêque de la ville. La famille conservera le pouvoir épiscopal jusqu’en 1790 et fera construire le fameux palais des Rohan situé tout près de la cathédrale, sur les rives de l’Ill.
Durant toute cette période, même si le catholicisme va se développer, la ville reste majoritairement protestante.
Une autre institution fondamentale de Strasbourg sera son Université. Strasbourg aura été et reste un immense centre universitaire international.
Et un des plus célèbres étudiants de cette université sera Goethe.

Après la guerre 14-18 et le retour de Strasbourg en France, l’Université de Strasbourg fera l’objet de toutes les attentions du gouvernement français qui y enverra ses plus grands professeurs. Il faut savoir que c’est à Strasbourg en 1929 que fut créée la prestigieuse revue historique « les Annales » par ses deux fondateurs Marc Bloch et Lucien Febvre, tous deux professeurs à l’Université de Strasbourg. Revue qui donnera naissance au courant appelé l’école des Annales.
L’Histoire plus récente de Strasbourg est connue comme son rôle de ville du Parlement de l’Union européenne et du siège du Conseil de l’Europe.
Mais il faut rappeler que lors de la période révolutionnaire, la population strasbourgeoise se soulève. Le 21 juillet 1789, l’hôtel de ville est saccagé. Et c’est le 26 avril 1792 que Rouget de l’Isle compose à la demande du maire de Strasbourg, un chant pour l’armée du Rhin sans se douter qu’il deviendra un symbole de la Révolution française en devenant La Marseillaise.
La Marseillaise fut créée à Strasbourg.Après avoir accueilli le serment de Strasbourg qui est historiquement le premier document officiel en langue française, avoir été le lieu de la création de l’hymne national montre combien la ville de Strasbourg est importante pour la France, elle qui fut si longuement disputée par les deux entités issues de la dislocation de l’empire de Charlemagne.
Beaucoup des précisions historiques de ce mot du jour sont issues de Wikipedia.
Les photos qui agrémentent ce mot du jour ont toutes été réalisées par mes soins lors de notre visite à Strasbourg en avril 2018.

<1169>
-
Vendredi 14 décembre 2018
« Etant jeunes, ils ignorent ce qu’ils ignorent »Gaspard Gantzer à propos de l’entourage proche d’Emmanuel Macron et peut être de Macron lui-même
Dans le très bel entretien que Jean-Louis Trintignant a accordé à Léa Salamé, sur France Inter le 13 décembre 2018, il a un peu parlé des évènements actuels de la France :« Entre les gens qui nous gouvernent et les gens qui souffrent, il y a un fossé. . Macron je pense que c’est un homme honnête mais il n’a jamais eu faim. Il n’est pas assez proche du peuple »
Au-delà du fait d’avoir faim, il est probable que la distance, la différence de vécu est si grande entre celles et ceux qui gouvernent et une grande part de celles et ceux qui sont gouvernés qu’il est difficile pour les premiers de comprendre les seconds.
L’émission du Grain à Moudre du 11 décembre 2018 posait cette question : « Colère Jaune : Les circuits de l’information de l’État sont-ils grillés ? »
Hervé Gardette, le producteur de l’émission avait invité 3 personnes :
- Jacques Barthélémy, Ancien préfet ;
- Aurore Gorius, Journaliste d’investigation pour Les Jours ;
- Et Gaspard Gantzer, ancien conseiller de François Hollande et avant conseiller de Bertrand Delanoë.
L’ancien préfet Jacques Barthélémy racontait combien il était difficile d’être entendu et compris par la technocratie gouvernementale quand on tentait de leur expliquer ce qui pouvait remonter du terrain, chez les gens des provinces et de la France profonde. Et l’émission renvoie vers un article du Monde qui donne justement la parole à des préfets qui, bien sur, restent anonymes.
«Face à la crise du mouvement des « gilets jaunes », les préfets sonnent l’alerte politique »
«Qu’ils soient le bras armé de l’Etat dans un territoire ou chargés d’une mission d’intérêt général spécifique, les préfets manifestent rarement leurs états d’âme. Aujourd’hui, plusieurs d’entre eux, devant la crise engendrée par le mouvement des « gilets jaunes », font part, sous le sceau de l’anonymat, d’une certaine appréhension. Appréhension d’autant plus vive que les autorités centrales leur donnent parfois l’impression de ne pas avoir pris la mesure du problème et de les laisser sans consigne précise.
« Ce qui se passe est le fruit d’années de fragmentation de la société française, juge l’un d’eux. Pour l’heure, la réponse de l’exécutif est à côté de la plaque. » « Je suis très inquiet car le pouvoir est dans une bulle technocratique, renchérit un autre. Ils sont coupés de la France des braves gens qui n’arrivent pas à boucler leurs fins de mois. Ils n’ont aucun code et aucun capteur. Nous, les préfets, pourrions leur donner des éléments mais ils ne nous demandent rien. Quand ils viennent sur le terrain, c’est parés de leur arrogance parisienne. »[…]
Alors que la préfecture de Haute-Loire, au Puy-en-Velay, a été incendiée, samedi 1er décembre, plusieurs représentants de ce corps de hauts fonctionnaires parlent de situation « explosive et quasi insurrectionnelle », voire « pré-révolutionnaire ». […] Dans le mien, le mouvement agrège des travailleurs pauvres, des retraités avec de petites pensions qui s’estiment touchés dans leur dignité, des dirigeants d’entreprise de travaux publics confrontés à des hausses de prix des carburants et des patrons de sociétés de petite taille, qui affirment ne pas s’en sortir. »
Et Gaspard Gantzer raconte que lorsqu’il était conseiller de Bertrand Delanoë, ce dernier l’engueulait lorsqu’il le trouvait dans son bureau et lui disait, tu ne m’es pas utile dans ton bureau, il faut que tu ailles vers les citoyens dans les taxis, les bistrots et les lieux où tu peux rencontrer les gens et écouter ce qu’ils ont à dire.
La journaliste Aurore Gorius exlique :
« Il y a une administration, Bercy, dont est issue Emmanuel Macron et dont est issue son secrétaire général Alexis Kohler. C’est une administration qui porte des réformes et essaye de les promouvoir. Elle a une approche plus technocratique que d’autres. On retrouve ça dans la façon d’exercer le pouvoir d’Emmanuel Macron. »
Gaspard Gantzer explique que Macron pour gouverner ne s’est entouré que de jeunes esprits brillants, convaincus de leur savoir et il a ajouté cette phrase terrible :
« Et étant jeunes, ils ignorent ce qu’ils ignorent »
Dans ma vie quotidienne, il m’arrive aussi de rencontrer des jeunes pleins de certitudes. Surtout s’ils ont pu poursuivre des études brillantes pendant lesquelles on leur a dit qu’ils étaient les meilleurs. En outre, indiscutablement ils ont beaucoup travaillé intellectuellement et peut être même beaucoup lu des ouvrages souvent techniques.
Alors ils peuvent croire qu’ils savent. Ils savent des choses. Mais s’il est important de savoir ce que l’on sait il est encore plus important de savoir ce que l’on ignore. Au minimum de savoir qu’il y a des choses que l’on ignore. Cette manière de penser et de se comporter s’appelle l’humilité.
J’en avait fait un mot du jour je l’ai rappelé récemment, ce propos de David Axelrod, ancien conseiller de Barack Obama, à propos d’Emmanuel Macron :
« C’est quelqu’un qui a beaucoup de confiance en lui-même. Mais ce poste nécessite de l’humilité. »
J’avais aussi cité et rappelé, un jour de la Saint Valentin, la chanson de Gabin :
« Quand j’étais gosse, haut comme trois pommes,
J’parlais bien fort pour être un homme
J’disais, JE SAIS, JE SAIS, JE SAIS, JE SAIS
C’était l’début, c’était l’printemps
Mais quand j’ai eu mes 18 ans
J’ai dit, JE SAIS, ça y est, cette fois JE SAIS
Et aujourd’hui, les jours où je m’retourne
J’regarde la terre où j’ai quand même fait les 100 pas
Et je n’sais toujours pas comment elle tourne ! »Savoir ce que l’on sait, mais aussi savoir ce l’on ignore.
Douter souvent, mais ne pas douter que l’on ignore beaucoup.
<1168>
-
Jeudi 13 décembre 2018
« La beauté de la fêlure : Le Kintsugi»Art japonais pour réparer ce qui est casséLe récit japonais raconte qu’à la fin du XVe siècle, le shogun (chef de guerre) Ashikaga Yoshimasa aurait renvoyé en Chine, un bol de thé chinois auquel il tenait et qui était endommagé, pour le faire réparer. Mais la réparation chinoise lui avait fortement déplu. Et il aurait donc demandé à des artisans japonais de trouver un moyen de réparation plus esthétique, et qui prenne en compte le passé de l’objet, son histoire et donc les accidents éventuels qu’il a pu connaitre.
C’est cette démarche qui aurait été à l’origine de l’art traditionnel japonais de la réparation de la céramique cassée avec un adhésif résistant aspergé ensuite de poudre d’or.
Cet art s’appelle « le Kintsugi. ». Le terme « Kintsukuroi » désignant quant à lui l’art de réparer l’objet de façon à ce qu’il devienne plus solide et plus beau cassé.

Dans cet art, je dirai cette philosophie, La casse d’une céramique ne signifie plus sa fin mais un renouveau.
Il ne s’agit donc pas de cacher les réparations, mais de mettre en avant la zone brisée en recouvrant les fissures d’or. C’est donc par le métal symbole de valeur, symbole de richesse que les fêlures seront comblées, réparées, embellies.
Il existe des sites qui parlent de cet art pour l’étendre à la vie humaine et à la maladie : « La vie Kintsugi »
Nous sommes ici dans une philosophie de vie qui pense quand quelque chose qui a de la valeur se brise, il ne faut pas le jeter, le mettre de côté, mais le réparer pour qu’il devienne plus beau et plus fort.
Bien sûr cela peut certainement s’appliquer aux humains et aux sociétés humaines.
Le mot du jour du 17 Juin 2016 évoquait une idée proche, un livre d’Abdennour Bidar : «Les tisserands : réparer ensemble le tissu déchiré du monde».
<Le site Cosmopolitan> donne plus de détail sur cette technique :
« De kin, l’or, et tsugi, la jointure, le kintsugi évoque l’art japonais de réparer un objet cassé en soulignant ses fissures avec de l’or plutôt qu’en les camouflant. Les éclats de l’objet cassé sont récoltés, nettoyés et recollés à la laque naturelle. Une fois l’objet sec et poncé, on souligne ses fissures à l’aide de plusieurs couches de laque. Enfin, on saupoudre ses « cicatrices » de poudre d’or. »
Certaines pages ne parlent que du kintsugi, dans sa mission première de réparer la céramique : « Qu’est-ce que le kintsugi, la technique de réparation à la japonaise ? »
<J’ai trouvé aussi cette vidéo qui montre cet art en action>
Une jeune auteure veut en tirer des leçons de vie, c’est ainsi que Céline Santini a écrit : « Kintsugi, L’art de la résilience ».
Céline Santini a un propos plus ambitieux sur le site <esprit-kintsugi>, probablement qu’elle a aussi l’intention de vendre son livre et d’autres services.
Il faut certainement séparer le bon grain et l’ivraie.
Mais j’ai trouvé fécond et apaisant, dans ce monde troublé, insatisfait, violent, qui casse et sépare beaucoup, de mettre en avant un art qui a pour but de réparer, de rendre plus beau et plus fort.

<1167>
-
Mercredi 12 décembre 2018
«Giletjaunologue !»Julien Damon« Logue » vient Du grec ancien λόγος, logos (« étude »).
Dès lors, quand on ajoute « logue » à un mot on comprend qu’il s’agit de quelqu’un qui étudie ce que le mot désigne.
Toutefois, l’étude des mots, proprement dits, n’est pas faite par un « motologue ». Etudier les mots c’est la « sémantique ». En général c’est un « linguiste » qui étudie la sémantique.
En revanche :
- Le météorologue étudie la météo
- Le criminologue étudie le crime et les criminels
- Le vulcanologue étudie les volcans
- Le politologue étudie la politique.
Quelquefois c’est un peu plus compliqué. Ainsi on ne dit pas « vinologue » pour spécialiste du vin mais « œnologue » du grec ancien οἶνος, oînos (« vin »).
C’est qu’il faut faire savant.
Dans le même esprit, tout le monde comprend que le cancérologue est un spécialiste du cancer. Mais on préfère aujourd’hui le terme d’oncologue, De « onco »- (« tumeur », lui-même du grec ὄγκος, onkos, (« tas, masse »)
Toutes ces précisions ont été abondamment copiées dans Wikipedia.
Revenons au politologue, parmi eux, lorsque j’étais jeune il existait une catégorie à part qui s’appelaient les « kremlinologues ».
C’est à dire c’était des spécialistes du Kremlin qui était le palais qui abritait le gouvernement soviétique. C’était donc des spécialistes de la politique soviétique.
Alexandre Adler fut l’un d’eux :
« Je l’utilisai d’abord pour résoudre les énigmes policières de l’histoire soviétique qui m’avait obsédé, non sans quelques succès qui jalonnèrent ma première carrière kremlinologique à Libération. »
— (Alexandre Adler, Au fil des jours cruels, 1992-2002, 2003, p.1984)
Je l’ai un jour entendu expliquer ce qu’il faisait en tant que kremlinologue.
Il ne savait rien, les luttes de pouvoir et d’influence chez les responsables soviétiques étaient totalement secrètes et personne ne savait ce qui se passait.
Alors le plus infime détail était analysé : l’absence de tel responsable à telle cérémonie, la place respective des uns et des autres sur une tribune, lorsque tel responsable parlait à l’oreille d’un autre responsable lors d’une cérémonie àlaquelle le kremlinologue pouvait assister.
A partir de ces détails, le kremlinologue tissait des hypothèses, élaborait des théories, osait des prévisions.
Prévisions le plus souvent démenties par les faits
Tout ceci a occupé un grand nombre de gens et leurs analyses étaient abondamment relayées par les journaux occidentaux.
C’est probablement à cette pseudo science de kremlinologie que Julien Damon a pensé pour inventer le concept de cette nouvelle spécialité
le : « Giletjaunologue »
Julien Damon est professeur associé à Sciences Po et conseiller scientifique de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale. Il est présenté comme un sociologue des inégalités.
Il a écrit plusieurs ouvrages :
- L’exclusion (coll. Que sais-je, PUF, 2018)
- Les politiques familiales (coll. Que sais-je?, PUF, 2018)
- Quelle bonne idée ! 100 propositions plus ou moins saugrenues dans l’espoir fou de refaire le monde (PUF, 2018).
 Et il a été invité à l’émission la Grande Table du 3 décembre 2018 : « « Gilets jaunes » : quelles réponses à quelles questions ? »
Et il a été invité à l’émission la Grande Table du 3 décembre 2018 : « « Gilets jaunes » : quelles réponses à quelles questions ? »
Et c’est lors de cette émission, qu’il a, en l’appliquant d’abord à lui-même puis à Emmanuel Todd et à d’autres experts auto-désignés, créé cette spécialité de « Giletjaunologue ».
Donc des experts à qui on demande d’expliquer qui sont les gilets jaunes, quelles sont leurs exactes revendications et quels sont leurs objectifs.
Ils n’en savent rien mais ils parlent quand même comme les kremlinologues d’antan.
Car, on ne sait pas très bien qui ils sont, à part une collection d’individus mécontents.
On ne sait pas ce qu’ils pensent puisqu’ils expriment des revendications multiples, diverses, parfois irréalistes et surtout contradictoires.
On ne peut pas leur parler, sauf à des individus qui se représentent eux même. Les gilets jaunes ? Quel numéro de téléphone ? aurait dit Henry Kissinger, puisqu’ils refusent de se désigner des représentants.
Mais nous avons des spécialistes, des experts qui savent décrypter et nous expliquer ce que veulent les gilets jaunes et comment les contenter : ce sont des « Giletjaunologues ».
<1166>
- Le météorologue étudie la météo
-
Mardi 11 décembre 2018
« Ce n’est pas seulement une question de fiscalité et d’économie qui se pose, c’est de notre système démocratique dont il est question. De la défense de notre modèle social, de la préservation de l’ensemble de notre tissu industriel. »Bernard BenhamouJ’ai écouté notre jeune président…
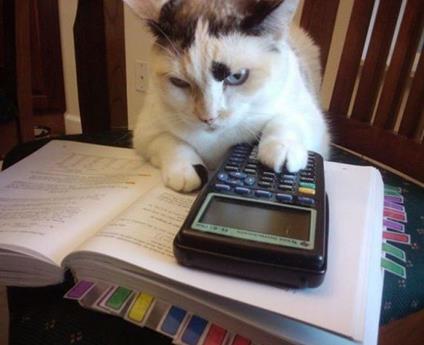 Et il me semble qu’après l’avoir entendu, il n’y a que ce chat qui a une attitude raisonnable.
Et il me semble qu’après l’avoir entendu, il n’y a que ce chat qui a une attitude raisonnable.
Il faudrait quand même savoir combien cela coute ?
Et où il va trouver l’argent ?
Nos amis allemands qui décrivent les français comme ces personnes qui veulent toujours voyager en première classe avec un billet de seconde classe ne se trompent pas.
Moins d’une heure après l’allocution présidentielle le grand journal <die Frankfurter Allgemeine Zeitung> titrait sur son site en page d’accueil :
Macrons Kehrtwende
La volte-face (ou le demi-tour) de Macron.
Er sei kein Weihnachtsmann, hatte der französische Präsident Emmanuel Macron zuvor gesagt.
Il n’était pas le père Noël, avait déclaré auparavant le président français Emmanuel Macron
Doch fast ein Monat mit teils gewalttätigen Protesten zeigt jetzt Wirkung: Zum 1. Januar gibt es in Frankreich Geldgeschenke.
Mais presque un mois de manifestations, en partie violentes, montre désormais son effet : le 1er janvier, il y aura des cadeaux monétaires en France.
Les allemands ne sont pas très gentils. Il est vrai que notre Président leur avait promis qu’avec lui la France serait gouvernée de manière rigoureuse et arrêterait de creuser la dette.
Je suis un peu dubitatif sur ce qui est annoncé.
A court terme, cela pourra, peut-être, calmer certains, les plus raisonnables des gilets jaunes.
Mais à long terme, qu’en est-il de la transition écologique ? Qu’en est-il des investissements ? Comment faire cela sans creuser davantage la dette.
Toutefois mon intention est de parler d’une autre décision essentielle qui a été prise dans l’Union Européenne et dans laquelle nos amis allemands ne jouent pas le rôle vertueux qu’ils aiment incarner. Ils ont plutôt jouer les peureux et les « courtermistes ».
Ils ont, en effet, lâché la France dans sa volonté de taxer les GAFA.
Parce si les États veulent récupérer de l’argent, il est certain qu’il faut d’abord aller le chercher dans les entreprises très riches, qui gagnent beaucoup d’argents en Europe et paient des impôts ridicules.
Mais l’Allemagne a peur. Peur que Trump taxe en retour les voitures allemandes. Et cela c’est au-dessus de la rigueur et de l’esprit de justice de nos amis issus de la révolution Luthérienne.
Pour illustrer cette situation j’ai trouvé trois articles qui m’ont paru instructifs :
- Sur le site des Inrocks : <Taxe sur les GAFA : « Ce n’est pas seulement une question de fiscalité, c’est notre modèle de société qui est en jeu »>
- Sur site de Capital : <Taxe GAFA : pourquoi c’est l’enfer à mettre en place>
- Et enfin sur le site du Monde : <Taxe GAFA : une nouvelle occasion manquée pour l’Union européenne>
Les Inrocks nous apprennent que selon une estimation de la Commission européenne, les GAFA ne seraient imposés qu’à hauteur de 8,5 % à 10,1 % de leurs profits dans l’Union européenne contre une fourchette de 20,9 % et 23,2 % pour les autres entreprises, dites « classiques ». A titre d’exemple, pour l’année 2017, Amazon aurait ainsi généré 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires en Europe pour un impôt quasi nul.
Et les Inrocks de continuer :
« Alors que les gilets jaunes battent le pavé et réclament plus de justice fiscale, le signe aurait été le bienvenu. Loupé. Le projet de taxe européenne sur les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), et plus largement sur les « services numériques » dont le chiffre d’affaire mondial dépasse 750 millions d’euros (et 50 millions en Europe), a été repoussé aux calendes grecques ce mardi 4 décembre. »
Et le Monde d’écrire :
« Mais cette mesure, qui apparaissait comme un signal important pour l’Union européenne (UE) en instaurant un peu plus de justice fiscale, est déjà largement vidée de sa substance et ne sera soumise à l’approbation des Vingt-Sept qu’en mars 2019. Quant à sa mise en œuvre, en cas d’accord, elle n’interviendra pas avant janvier 2021. Une fois de plus, les égoïsmes nationaux et les règles institutionnelles européennes sont en train de conduire à un immobilisme mortifère. »
C’est le site de Capital qui est le plus didactique :
« Pendant longtemps, le point d’achoppement s’est résumé à une confrontation entre Paris et Berlin. Le gouvernement allemand craint des mesures de rétorsion de la part des États-Unis, qui pourraient augmenter les taxes sur l’importation des voitures allemandes. Finalement, un accord a bien eu lieu le 4 décembre, grâce à une concession clé de la part de la France : la taxe de 3% sur le chiffre d’affaires concernera seulement la vente d’espaces publicitaires alors que l’activité globale était initialement concernée. Au terme d’une haute lutte, Berlin a également obtenu du dispositif qu’il ne s’applique pas avant 2021. […]
Cette concession majeure de la part de Paris réduit considérablement la portée de la taxe. Alors qu’une taxation globale aurait dû rapporter autour de cinq milliards d’euros par an à l’Union européenne, la limitation à l’imposition de la publicité ne remplirait les caisses que de 1,3 milliard, selon les estimations de Bercy. La taxe ne concernerait plus que quasi-exclusivement Google et Facebook, excluant de facto Amazon, Netflix, Microsoft, Uber, etc. qui ne vendent pas d’espaces publicitaires. »
Bien sûr, cette idée de taxation était nouvelle, puisqu’il s’agissait de taxer le chiffre d’affaires. Cette mesure disruptive ne va pas sans créer des problèmes juridiques qui pourraient conduire à une impasse.
« Traditionnellement, il est d’usage de taxer les seuls bénéfices des entreprises. Dans le cadre de la taxation des GAFA, les Européens ont quant à eux décidé de s’attaquer au chiffre d’affaires, afin d’éviter au maximum les techniques d’optimisation fiscale. Cette mesure d’efficacité revient néanmoins à traiter les entreprises du numérique différemment des autres, de manière discriminatoire, sans que cela soit justifié. De quoi fournir des arguments aux géants du Net en vue d’une contestation devant la Cour de justice de l’UE. »
Je passe sur la règle de l’unanimité et les Etats qui comme l’Irlande sont tous dévoués au GAFA pour en venir à un lobbying d’entreprises européennes se sentent solidaires des GAFA.
« On imagine que les géants du Net sont tous américains, mais l’Europe compte également quelques pépites. Les patrons de 16 grandes entreprises numériques européennes (Spotify, Zalando, Booking, Rovio, etc.) ont d’ailleurs écrit fin octobre aux 28 ministres des Finances de l’Union Européenne pour le leur rappeler. « Cette taxe a été conçue pour toucher des sociétés immenses et très profitables, mais il faut réaliser qu’elle aurait un impact bien plus important sur les sociétés européennes, et renforcerait la distorsion de concurrence », ont-ils rédigé dans une lettre que le Financial Times s’est procurée. Ils continuent : « Nous avons encore besoin de la totalité de nos ressources pour continuer à croître, et nos profits sont intégralement réinvestis. Cette taxe priverait nos entreprises d’une source indispensable de capital pour mener la compétition à l’échelle mondiale » Cet appel a visiblement été entendu car seule la publicité est désormais concernée par la taxe.»
Le site des Inrocks nous apprennent que les « Empires » sont à l’œuvre pour empêcher l’Union Européenne d’agir :
« Les Etats-Unis n’ont pas été en reste et ont également pesé de tout leur poids pour qu’une telle taxe n’aboutisse pas. De nombreuses sources diplomatiques attestent ainsi de « pressions directes de l’administration américaine ». « N’oublions pas que l’ambassadeur américain en Allemagne a clairement déclaré que son job était de faire monter l’ensemble des droites dures et eurosceptiques en Europe, complète Bernard Benhamou. On se retrouve dans une situation inédite où les trois grandes puissances mondiales, Etats-Unis, Chine et Russie, se retrouvent quant à l’idée de nuire à l’Europe. Ils ont un intérêt commun à la destruction de l’UE ou du moins, à son affaiblissement » ».
Et il donne la conclusion à Bernard Benhamou, secrétaire général de l’Institut de la souveraineté numérique (ISN) et ancien diplomate.
« Les GAFA sont aujourd’hui des sociétés qui interviennent tous secteurs confondus, ce ne sont plus seulement des sociétés technologiques. […]
Si on n’est pas capable de montrer les dents face à ces entreprises, ce n’est pas seulement une question de fiscalité et d’économie qui se pose, c’est de notre système démocratique dont il est question. De la défense de notre modèle social, de la préservation de l’ensemble de notre tissu industriel.
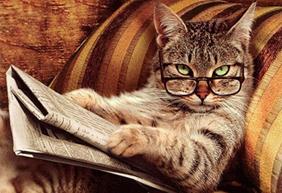 Vous savez ce que disent les diplomates américains au sujet de l’Union Européenne ? Ils disent qu’on a créé un animal sans dents. Un animal qui n’a pas les moyens d’être tranchant, qui ne sait pas mordre. Il faut impérativement créer un rapport de force avec ces entreprises. Et cela passe nécessairement par la constitution d’un axe franco-allemand fort. D’une vision commune ». Nul doute que pour y parvenir, la route reste longue. »
Vous savez ce que disent les diplomates américains au sujet de l’Union Européenne ? Ils disent qu’on a créé un animal sans dents. Un animal qui n’a pas les moyens d’être tranchant, qui ne sait pas mordre. Il faut impérativement créer un rapport de force avec ces entreprises. Et cela passe nécessairement par la constitution d’un axe franco-allemand fort. D’une vision commune ». Nul doute que pour y parvenir, la route reste longue. »
« Un animal sans dents ! »
Voilà ce que disent les américains de l’Union Européenne.
Et pour finir, le Monde reparle de notre jeune Président.
« Le volontarisme tricolore motivé par l’obsession de permettre à Emmanuel Macron de brandir un trophée avant les élections européennes de 2019 a conduit à braquer certains partenaires, qui ont fini par se lasser du ton professoral adopté par Paris. »
Il n’y a pas que les « gilets jaunes » qui sont agacés par une certaine attitude…
<1165>
- Sur le site des Inrocks : <Taxe sur les GAFA : « Ce n’est pas seulement une question de fiscalité, c’est notre modèle de société qui est en jeu »>
-
Lundi 10 décembre 2018
« C’était de l’ultraviolence. Ils avaient des envies de meurtre. Nous, notre but c’est juste de rentrer en vie chez nous, pour retrouver nos familles. »Une CRS présente à Paris lors de la journée de violences du 1er décembreDes images ont circulé en boucle montrant des excès des forces de l’ordre françaises contre des lycéens et puis contre les manifestants « gilets jaunes ».
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a critiqué la « violence disproportionnée » des autorités françaises face aux manifestations de « gilets jaunes », ajoutant qu’il suivait la situation « avec préoccupation » :
« Le désordre règne dans les rues de nombreux pays européens, à commencer par Paris. Les télévisions, les journaux regorgent d’images de voitures qui brûlent, de commerces pillés, de la riposte des plus violentes de la police contre les manifestants […] Ah ! Voyez un peu ce que font les policiers de ceux qui critiquaient nos policiers. […] l’Europe a échoué sur les plans de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés ».
Quand on lit les propos de cet autocrate qui réprime la liberté dans son pays avec une hargne et cruauté inacceptable, on hésite entre le rire et la colère.
Même des iraniens, comme le rapporte Libération, critiquent les forces de sécurité française :
« La scène se déroule mercredi dans la capitale iranienne devant l’ambassade de France. Les manifestants dénoncent la répression du mouvement des gilets jaunes. Rebelote vendredi : une poignée d’hommes, gilets jaunes sur le dos, brandissent des pancartes évoquant les «victimes» faites par Macron à Paris et au Yémen… Ces étudiants reprennent le mantra des conservateurs, prompts à épingler les atteintes aux droits humains dès lors qu’elles ont lieu dans les pays occidentaux. «Monsieur Rohani, c’est le bon moment pour téléphoner à votre homologue français et l’exhorter à… la modération», s’amuse sur Twitter une supportrice du régime, dans une allusion à l’appel de Macron au président iranien, en janvier, alors que des manifestations violentes éclataient un peu partout en Iran »
Il y a certes des excès, mais ce que l’on demande aux CRS, aux policiers et aux gendarmes est quasi inhumain.
Comme dans tout groupe humain, il existe des individus qui sortent du cadre. Par faiblesse, par peur ou par manque de maîtrise, ils peuvent déraper. D’ailleurs l’IGPN enquête dans ces cas.
Mais dans leur plus grand nombre, nous disposons de forces de maintien de l’ordre tout à fait remarquables et qui notamment à Paris sont parvenues à maîtriser la violence qui se déchaînait contre eux et contre les biens.
Ce sont des hommes et des femmes qui souvent sur certains points peuvent partager les indignations des gilets jaunes mais qui pour la sauvegarde de l’ordre républicain, dans la discipline et le courage font face aux débordements, la violence et même la haine et mette en danger leur propre intégrité physique.
Je partage ce que Dominique Reynié a déclaré lors de l’émission Esprit Public de ce dimanche
« C’est absolument admirable, ce qui s’est passé hier [le 8 décembre] dans le maintien de l’ordre. Nous avons vraiment des forces de l’ordre qui sont exceptionnelles. Sur le plan technique, chaque minute chaque interaction, chaque confrontation avec le risque d’un incident majeur, c’est manifestement ce qui est recherché par certains groupuscules qui souhaiteraient ardemment qu’il y ait un ou des morts pour enfin passer à la crise inévitable. Cela tient à la gestion du maintien de l’ordre, en ce moment avant même que les mesures soient annoncées par le chef de l’Etat qui convaincront ou non. Tout peut basculer dans une journée comme hier, nous sommes dans une grande fragilité. Un fonctionnaire fatigué ou isolé aurait pu faire basculer la France dans une situation dramatique que certains radicaux souhaitent. »
Et dans ce cas il faut en revenir à notre humanité, regarder ces choses à niveau d’homme ou de femme. Car il y a aussi des femmes dans les rangs des CRS qui sont déployés. Et le Monde consacre un article à une CRS auquel il a donné un
 pseudo : « Audrey » qui a été blessée lors des violences qui ont lieu à Paris la semaine dernière le 1er décembre : « On sait que la violence va monter d’un cran et on est épuisés physiquement »
pseudo : « Audrey » qui a été blessée lors des violences qui ont lieu à Paris la semaine dernière le 1er décembre : « On sait que la violence va monter d’un cran et on est épuisés physiquement »
La photo que je joins pour illustrer cet article n’est pas liée à l’article du Monde, elle a été publiée par le <Figaro> et raconte aussi des choses qui sont décrites ci-après :
« Elle fait partie de ces anonymes casqués, dont les images ont tourné en boucle sur les téléviseurs. Audrey, gardienne de la paix au sein d’une compagnie républicaine de sécurité (CRS) présente à l’Arc de triomphe samedi 1er décembre, a été blessée à la cuisse par un jet de pavé. Sa chute a été filmée et commentée à foison sur les chaînes d’information en continu les jours suivants.
« Des experts, tranquillement installés dans leur canapé, expliquaient que ça se voyait qu’on était désorganisés. Ça m’a rendue folle ! », raconte-t-elle. »
Il était environ 17 heures quand cette jeune policière, quatre ans et demi de service en tant que CRS au compteur, a chuté sous l’impact du bloc de pierre, qui est passé sous son bouclier. A cet instant, Audrey est sur le pont depuis quinze heures, sans interruption. « Je me suis levée à 0 h 30 pour prendre mon service à 2 heures », se souvient-elle. Sa compagnie, stationnée temporairement à Paris, est affectée à la sécurisation des abords de la place de l’Etoile. A partir de dix heures, elle doit se positionner dans une rue adjacente à l’Arc de triomphe, avec sa section.
Près d’une trentaine de femmes et d’hommes. Casques, jambières, boucliers, l’attirail habituel du maintien de l’ordre.
Pourtant, la journée ne se présente pas comme les autres. « Ma première pensée était : ça pue la révolution. Il y avait une atmosphère de pré-chaos, j’ai senti que c’était apocalyptique dès que j’ai posé le pied sur le pavé parisien ». […]
Des voix grésillent sur les ondes. Des manifestants sont en mouvement. Sa section reçoit l’ordre de les suivre. « On gravitait autour de la place, on rentrait dans les fourgons, puis on ressortait… » Vers 11 h 30, c’est l’heure de la pause sandwich. Les CRS se doutent que l’après-midi risque d’être autrement plus musclée. « On savait que ça allait être violent, avec toutes les conneries écrites sur les réseaux sociaux, les gens se montent le bourrichon. On avait lu que certains voulaient tuer du flic ! »
Soudain, des manifestants commencent à caillasser les véhicules. Les policiers forment un barrage de boucliers autour de leurs fourgons. Ils s’en sortent avec de la tôle froissée. Mais ce n’est que le début. « Ça a dégénéré, on aurait dit une guérilla », raconte Audrey. Sa section est appelée pour sécuriser les abords de l’avenue Kléber, où l’intérieur d’un hôtel particulier est en train de flamber. Les grilles ont été arrachées. « On est tombé dans un guet-apens, ils nous attendaient. J’ai déjà fait des manifestations qui dégénèrent, mais là, c’était de l’ultraviolence. Ils avaient des envies de meurtre. Nous, notre but c’est juste de rentrer en vie chez nous, pour retrouver nos familles. »
Elle raconte les insultes des manifestants et le mépris dans leurs yeux. « Quand on était en barrage, les gens passaient devant nous et crachaient à nos pieds. J’ai vu un mec nous expliquer qu’il était père de famille et pacifique. Deux minutes après, il nous jetait un pavé. Les gens deviennent fous. » L’effet de meute ? « L’effet mouton plutôt », corrige-t-elle.
Impossible de savoir l’heure exacte, la jeune CRS est « totalement déconnectée », dans une ambiance saturée de gaz lacrymogène. Mettre ou ne pas mettre le masque ? Un vrai dilemme. « Certains préfèrent faire sans, moi je ne supporte pas le gaz. Mais avec le masque, votre respiration est limitée, et la buée empêche de voir. » Deux de ses collègues, qui ont opéré sans, pour manier les lanceurs de balles de défense 40, ont eu la cornée brûlée.
La nuit commence à tomber quand l’endroit où sont stationnés les fourgons est menacé par les flammes. « Un groupe s’est rendu compte que notre fourgon n’était pas protégé par les CRS, ils ont commencé un énorme caillassage. A ce moment-là, je me suis dit : « Il va falloir que tu t’en sortes. » On a pris une pluie de projectiles, il n’y avait pas de moment d’accalmie. Ils étaient super bien organisés. » Un projectile se fraie un chemin entre le bouclier et la jambière. Elle s’effondre. « J’ai dit à mon binôme que j’étais touchée, il m’entendait mal. Quand il a compris que je n’étais pas bien, ils m’ont extraite de la fumée. J’étais perdue, je respirais le gaz. »
Audrey refuse cependant que le soigneur découpe son pantalon pour jeter un œil à la blessure. Cela aurait signifié pour elle la fin de la journée. Pas question d’abandonner ses collègues. Tout juste passe-t-elle une bombe de froid sous son pantalon. Le spray, actionné trop près, corrode la peau. Qu’importe, elle retourne aux côtés de son binôme, à qui elle cède la gestion du bouclier, incapable de l’appuyer contre sa cuisse.
Les manifestants commencent heureusement à se disperser. Sa compagnie est démobilisée vers 21 heures. Le lendemain, l’aspect de la plaie l’oblige à la signaler. « Ma blessure commençait à faire des cloques. » Écrasement du quadriceps et brûlure au deuxième degré, cinq jours d’arrêt.
Mais c’est moins pour elle que pour ses collègues qu’Audrey semble s’en faire. La compagnie, qui aurait dû être « gelée », selon le jargon policier, après un détachement de deux semaines, a été rappelée pour la journée du 8 décembre. « On sait que la violence va monter d’un cran, et on est épuisés physiquement. »
Le moral n’est pas non plus au beau fixe, notamment avec les accusations de violences policières. « Il faut arrêter de pointer les flics du doigt. Les gens voient une vidéo sur Facebook, sans le contexte, et ils croient qu’ils sont experts du maintien de l’ordre. » Et de cibler les casseurs. « Ils nous visent avec des pavés, des mortiers, des cocktails Molotov… J’en ai vu un prendre les débris de la grille pour en faire un javelot et nous le jeter à la tête. Ils veulent nous tuer. Et nous, on répond avec quoi ? Du gaz qui pique les yeux et des balles en caoutchouc. »
J’ai pratiquement cité tout l’article.
Ces personnes sont des fonctionnaires comme moi. Ils ont fait le choix de se mettre au service de L’État et de la République. Mais quand ils sont appelés à assurer leur mission, sur un théâtre d’opération, ils ne sont pas certains de rentrer en bonne forme le soir, en retournant dans leur famille retrouver leurs enfants, leur compagne ou compagnon.
Que se passerait-il, s’ils n’étaient pas là ?
Le désordre et le chaos !
Oui que se passerait-il si on laissait faire les violents qui ont infiltrés les gilets jaunes et qui ont aussi visiblement sut en entraîner certains ?
Ils prendraient le pouvoir ? Et instaureraient une belle démocratie participative ?
Toute personne qui a une toute petite culture historique sait comment finissent ces émeutes non maîtrisées : un régime autoritaire remplace la République dans ces cas.
C’est grâce à nos forces de maintien de l’ordre que l’Ordre républicain peut se maintenir.
Vouloir en faire des boucs émissaires est indécent.
Les fautes doivent être sanctionnées. Mais quelqu’un de raisonnable peut-il vraiment prétendre que si la quasi-totalité de ces hommes et femmes de devoir et d’abnégation ne maîtrisaient pas leurs actions, il n’y aurait pas un bilan très différent de celui qui est à déplorer.
Leur but est de remplir aussi bien que possible leur mission et comme le dit Audrey : « juste de rentrer en vie chez nous, pour retrouver nos familles ».
<1164>
-
Vendredi 7 décembre 2018
« Et puis il y a des trucs tout cons, comme les impôts.
Tu râles toujours un peu quand il faut les payer, mais finalement, quand tu arrives à l’hôpital, tu es pris en main de la manière dont tu es pris en main par des mecs qui ont fait quinze ans d’études. Avec des équipes de 30 personnes qui te sont dédiées et du matos où chaque couveuse vaut un demi-million d’euros. Tous les impôts que tu as payés de 0 à 40 ans, tu peux dire que tu les as mis là. »Gaël LeiblangJe suppose qu’il serait normal de continuer à parler des gilets jaunes.
De s’indigner contre cette prétention d’un des gilets jaunes, Eric Drouet à marcher sur l’Elysée samedi prochain et à entrer d’autorité dans le palais présidentiel.
Vouloir aller à l’Elysée pourquoi faire ?
Et alors ? Qu’est-ce qu’on fait après, à part créer le chaos ?
C’est stupide, provoquant et inutile.
Mais après avoir posé cette condamnation, il est possible de se souvenir qu’en pleine affaire Benalla, le jeune président devant les caméras de télévision et un public de partisan a osé cette formule :
« Qu’ils viennent me chercher »
Du point de vue juridique et du droit constitutionnel, cette phrase constituait une ineptie.
Du point de vue de la rhétorique, il me parait juste de reprendre les qualificatifs que j’ai utilisé pour le gilet jaune excité. Mais le fait que celui qui a prononcé ces mots soit Président de la République, ne constitue t’il pas une circonstance aggravante ?
Et je me souviens que lors du mot du jour du 10 novembre 2017 , je citai le principal conseiller du Président Obama qui après quelques mots aimables sur notre Président, qui n’était au pouvoir que depuis 6 mois, finissait son propos par ce jugement :
« La question qui se pose est : comment va-t-il faire arriver le changement ?
Comment est-ce que cela sera reçu.
C’est quelqu’un qui a beaucoup de confiance en lui-même.
Mais ce poste nécessite de l’humilité. »
Bien sûr, je pourrais aussi parler du climat, de la COP24 qui se passe à Katowice en Pologne et de ce nouveau bilan annuel de l’ONU : < Nous avons complètement dérapé> :
Globalement, les terriens étaient parvenus a stabilisé les émissions de CO2. C’était un premier pas. Nous savons que nous devons réduire ces émissions.
Mais nous avons globalement recommencé à faire progresser le taux de CO2 dans l’atmosphère :
« Selon un bilan annuel publié mercredi en marge de la 24e conférence climat de l’ONU, les émissions de CO2 liées à l’industrie et à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz devraient croître de 2,7% par rapport à 2017, après une hausse de 1,6% l’an dernier ayant suivi trois années quasiment stables. Il faut remonter à 2011 et la sortie de la crise financière de 2008 pour trouver pire taux, explique Glen Peters, climatologue au centre de recherche Cicero (Oslo) et co-auteur de l’étude, parue dans la revue Open Access Earth System Science Data.
Les politiques se font distancer par la croissance de l’économie et de l’énergie », souligne-t-il. « On est loin de la trajectoire qui nous permettrait de rester à 1,5°C ou même 2°C » de réchauffement, objectifs de l’accord de Paris.
« La rhétorique enfle mais l’ambition non, nous avons complètement dérapé » »
Mais dans mon butinage je suis tombé sur un article parlant d’un spectacle joué au Lucernaire à Paris ou plus précisément interviewant l’auteur et l’acteur de ce spectacle : Gaël Leiblang.
Et un paragraphe m’a tout de suite accroché et j’en ai fait l’exergue de ce mot du jour.
Parce qu’il y a une révolte fiscale. Celle que l’on voit, aujourd’hui de gens qui disent qu’ils ne peuvent plus payer les taxes qu’on leur réclame.
Mais il y a une autre révolte fiscale celle des très riches qui ne veulent plus payer leur part.
Et des multinationales qui savent mettre en œuvre des stratégies qui leur permettent de ne presque pas contribuer à l’effort commun.
L’affaire Carlos Ghosn m’a appris des tas de choses, d’abord sur le Japon qui n’est vraiment pas le pays merveilleux que certains touristes vantent. Mais aussi sur le fait que la Holding qui gère l’alliance Renault Nissan est une société de droit néerlandais. Un pays qui est un paradis fiscal. Et c’est Lionel Jospin et Laurent Fabius qui ont permis cette évasion fiscale.
On peut toujours revenir aux propos de Henry Morgenthau, secrétaire au Trésor américain sous la présidence de Roosevelt et qui disait en 1937 :
«Les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée, trop de citoyens veulent la civilisation au rabais»
J’en avais fait le mot du jour du 21 mars 2013
Mais j’ai aimé ce cri du cœur de cet homme qui au bout de l’épreuve a redonné le sens de la contribution à la civilisation.
Gaël Leiblang est un journaliste devenu comédien. Il est aussi père de famille. Sa compagne a donné naissance à leur fils Roman. Roman a vécu 13 jours.
Ces 13 jours, le couple les a passés à l’hôpital pour accompagner leur enfant.
Ils n’étaient pas seuls, ils étaient avec des médecins et des infirmières.
Suite à la décision collégiale des médecins d’arrêter les traitements et de laisser mourir le bébé, il a été décidé que les parents puissent donner un bain à leur enfant pour lui dire au revoir et créer le
 souvenir le plus charnel qui soit.
souvenir le plus charnel qui soit.
Il en a fait un spectacle : « Tu seras un homme papa »
«J’ai dit au metteur en scène : « Écoute, s’il n’y a pas le bain, il n’y a pas de pièce, parce que tout amène à ce moment de grâce absolu, de spiritualité, de mysticisme, de ce que tu veux. » On raconte quelque chose que personne ne peut voir, qui est complètement secret et qui est sacré.
Ce moment est toujours magique. […]
La première fois qu’on a fait une lecture à la maison, j’ai lu le texte pendant une heure. Et c’était tellement fort et violent que personne ne pouvait plus relever la tête. […]
On pourrait dire qu’il y a plutôt un silence assourdissant autour de ces bébés éphémères.
Parce que leur vie est tellement courte qu’il n’y a pas de souvenirs, et comme il n’y a pas de souvenirs, tu ne peux pas dire…
Moi, je vois bien, si je n’avais pas fait cette pièce, on ne parlerait pas de Roman. Pas parce que c’est tabou. On est une famille tout à fait sympa, on parle très librement et tout, mais parce qu’à un moment tu n’as rien à raconter. C’était treize jours. Tu peux dire « ah, tu te souviens quand il était dans la couveuse ? » une fois, deux fois, cent fois, mais au bout de trois, quatre ans, tu ne vas plus le dire. »
Et quand la journaliste lui pose la question : « Donc tu es devenu un homme avec Roman et avec cette pièce ? »
Il répond :
« Je suis foncièrement la même personne, avec les mêmes défauts. Je gueule pareil sur les trucs, mais il y a d’autres choses qui sont réglées.
La religion par exemple pour moi, c’est très clair maintenant. Il n’y a pas de Dieu, pas de lumière, pas de révélation.
Et puis il y a des trucs tout cons, comme les impôts. Tu râles toujours un peu quand il faut les payer, mais finalement, quand tu arrives à l’hôpital, que tu es pris en main de la manière dont tu es pris en main par des mecs qui ont fait quinze ans d’études. Avec des équipes de 30 personnes qui te sont dédiées et du matos où chaque couveuse vaut un demi-million d’euros. Tous les impôts que tu as payés de 0 à 40 ans, tu peux dire que tu les as mis là et que ce n’est pas grave. »
Cette interview est très longue et vous pouvez la lire derrière ce lien « Article Rue 89 Obs publié le 6 décembre 2018 »
<1163>
-
Jeudi 6 décembre 2018
« C’est une crise de la représentation démocratique dans toutes les démocraties occidentales »Jean Garrigues, professeur d’histoire contemporaineL’invité des matins de France Culture du 4 décembre 2018 pour essayer expliquer la situation actuelle de la France était Jean Garrigues, professeur d’histoire contemporaine. Et son propos le plus marquant fut celui-ci :
« C’est une crise de la représentation démocratique dans tous les pays occidentaux »
Dans <L’Esprit Public d’Emily Aubry de ce dimanche>, un des invités, François Xavier Bellamy a eu le même constat :
« Une crise très profonde de la représentation politique »
<L’émission Du grain à moudre du 4 décembre> avait invité Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien membre du Conseil Supérieur de la Magistrature de 2002 à 2006 et auteur du livre « Radicaliser la démocratie : proposition pour une refondation » paru aux Editions du Seuil en 2015
Et Dominique Rousseau a encore souligné cette crise-là : la crise de la représentation démocratique. Et pour illustrer son propos il a même fait appel au grand révolutionnaire Sieyès :
« La crise que l’on connaît c’est l’épuisement d’une forme représentative de la démocratie. Toutes les formes représentatives de la démocratie. Sieyès disait « Le peuple ne peut vouloir, ne peut agir et ne peut parler que par ses représentants ». On vivait là-dessus depuis 1789. Ce n’est plus le cas. Le Peuple dit, nous voulons parler par nous-même, en dehors de la parole des représentants. »
Quand on cite un glorieux ancien, je m’efforce toujours d’aller vérifier. Sieyès a tenu ces propos lors d’un Discours tenu le 7 septembre 1789 devant l’Assemblée Nationale constituante. La question abordée était celle du véto du Roi. La citation de Dominique Rousseau est extraite du paragraphe suivant :
« Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n’ont pas de volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »
Toujours se méfier des citations. Bien sûr cette phrase est prononcée au tout début de la révolution. Le pouvoir est encore partagé entre l’Assemblée et le Roi. Le Roi qui était entré sans sa royauté par la croyance d’un Roi de droit divin !
Toujours est-il que dans ce paragraphe Sieyès oppose clairement le principe représentatif et la démocratie. Il ajoute aussi cette phrase énigmatique : « La France ne saurait être une démocratie. » Pourquoi ? Peut-être parce qu’elle est trop vaste pour pratiquer la démocratie directe qui semble donc, si l’on comprend bien l’idée de Sieyès, la seule vraie forme de la démocratie.
Mais Sieyès est surtout connu pour une autre phrase beaucoup plus célèbre
« Qu’est-ce que le Tiers-État ? Tout.
Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien.
Que demande-t-il ? À y devenir quelque chose. »
Cette phrase se situe dans l’introduction de « Qu’est-ce que le Tiers-État ? », un pamphlet publié par l’abbé Sieyès en janvier 1789 en prélude à la convocation des États généraux. Sieyes y présente et critique la situation du moment, et indique les réformes souhaitables, notamment que le vote de chaque ordre se fasse proportionnellement à sa représentativité réelle dans la nation (évidemment favorable au Tiers-État, qui représente près de 98 % des Français). Il donne les prémices de l’avènement d’une assemblée nationale constituante.
Cela me semble assez proche de l’esprit exprimé par celles et ceux que nous appelons « les gilets jaunes » qui ne sont certainement pas 98% des français mais sont une part très importante de la population et une part qui est devenu assez invisible dans les institutions et les médias selon l’expression de Pierre Rosanvallon.
D’ailleurs Dominique Rousseau cite aussi Rosanvallon et cette explication de la révolte :
« Les « gilets jaunes » sont les forces vives de la nation, pour reprendre les mots de De Gaulle. C’est eux qui font vivre le pays. Et ils sont, comme disait Rosanvallon, invisible. Ou du moins ils l’étaient jusqu’à présent parce qu’on parlait en leurs noms. Les « gilets jaunes » sont tout dans le pays car c’est eux qui font le boulot. Ils ne sont rien dans les institutions. »
Pierre Rosanvallon qui avait écrit en 1998 un livre « Le peuple introuvable : histoire de la représentation démocratique en France» dans lequel il a souligné que si la démocratie a proclamé la souveraineté du peuple, mais que ce qui est advenu c’est une société d’individus. Et ainsi s’il peut être envisageable de représenter un peuple, il est compliqué de vouloir représenter une collection d’individus.
Une collection d’individus…
Lorsque Emmanuel Macron a été élu, nous étions dans cette crise de la représentation. Les partis politiques de gouvernement étaient rejetés. A ce rejet s’est ajouté un concours de circonstance qui a permis à ce jeune homme brillant et intégré dans la mondialisation d’être élu.
Il n’aura donc pas fallu longtemps pour que le mouvement que le jeune homme a créé et qui devait incarner la nouveauté, le nouveau monde, se trouve, à son tour, dans la tourmente et le rejet.
Mais la représentation est aussi normalement incarné par les corps intermédiaires que sont les syndicats et les médias qui eux aussi font l’objet de la plus grande méfiance du grand nombre.
En outre, cette crise des syndicats qui étaient déjà fragiles en raison du nombre très restreint d’adhérents a encore été accentuée par le jeune Président qui n’a pas souhaité les intégrer dans le processus de décision, persuadé qu’il connaissait le chemin à suivre par sa seule intelligence et son savoir.
Le mouvement actuel ne tient aussi aucun compte de ces corps intermédiaires.
La crise de la représentation est révélée par les faiblesses même du mouvement des gilets jaunes incapable de désigner des représentants ou après les avoir désignés, les récuse. Certains porte-paroles ont même expliqué qu’ils étaient menacés physiquement s’ils acceptaient de se rendre à des réunions de négociation avec les autorités politiques.
Une collection d’individus…
Mais, je crois surtout qu’il ne faut pas se polariser sur la France et la personnalité de Macron qui joue certes un rôle dans ces évènements mais qui n’est pas central.
Car comme le dit Jean Garrigues : « C’est une crise de la représentation démocratique dans toutes les démocraties occidentales ».
Toutes…
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés
Comment a été élu Donald Trump ?
Il s’est emparé du Parti Républicain à la hussarde contre la volonté de tous les dirigeants du Parti. D’ailleurs, lors des primaires il en vaincu plus de 10 qui étaient des représentants éminents, anciens et expérimentés du Parti. Puis il a vaincu la représentante du Parti Démocrate.
Plus récemment, un autre énergumène a profité de la crise de la représentation et du discrédit des Partis Politiques et notamment du Parti des travailleurs de Lula pour s’emparer du pouvoir. Il s’agit de Jair Bolsonaro.
Et l’Italie ? Les élites économiques et politiques avaient cru trouver leur champion en Matteo Renzi. Aujourd’hui c’est un leader d’extrême droite qui est au pouvoir, du moins qui monopolise la parole du pouvoir : Matteo Salvini.
C’est très inquiétant parce que l’Italie est un laboratoire qui fait office de précurseur et réalise les choses avant les autres.
Ils ont été les premiers à se débarrasser des grands Partis : la Démocratie chrétienne, le Parti communiste italien, le Parti socialiste. Puis c’est un milliardaire, spécialiste des médias bien avant Trump qui s’est emparé du pouvoir exécutif. Puis le « cercle de la raison » a vu émerger et soutenu Matteo Renzi, comme elle l’a fait pour Macron. Et c’est l’extrême droite qui est venu et on ne voit pas bien ce qui va venir après.
Dans le monde, les partis qui continuent à pouvoir prétendre à un soutien relativement solide des électeurs qui votent (je suis prudent et ne parle pas de peuple) sont des partis qui se sont donnés à un homme fort et autoritaire : Erdogan en Turquie, Orban en Hongrie, Poutine en Russie.
Des leaders qui font la part belle au nationalisme et à la xénophobie ou au moins insiste sur le danger extérieur pour renforcer leur pouvoir à l’intérieur.
La Grande Bretagne, le pays qui a inventé la démocratie moderne est aussi dans la tourmente.
L’Allemagne qui n’a pas inventé la démocratie, malgré ses grands philosophes, est aussi en difficulté du point de vue des partis de la représentation politique.
Alors il en est certain qui rêve à une démocratie directe plus active, notamment grâce aux outils numériques et modernes.
Peut-on vraiment croire à cette évolution ?
Certainement pas si on continue à rester des collections d’individus, des collections de consommateurs.
Seuls des citoyens, attachés à la chose publique peuvent faire fonctionner des institutions et une démocratie.
Mais la démocratie porte en elle l’aspiration à l’égalité des citoyens. Égalité politique qui peut accepter une certaine dose d’inégalité économique mais pas l’inégalité qui aujourd’hui se développe et fait diverger toujours davantage le destin des hommes, dans nos civilisations occidentales. Or le jeune Président avait pour ambition de faire entrer davantage la France dans la mondialisation et donc d’augmenter encore les inégalités entre français alors que jusqu’à présent notre système social malade et fragile continuait à nous préserver des dérives anglo-saxonnes.
Alors bien sûr quand on veut taxer le carburant de gens qui n’ont pas de marges de manœuvres financières… Pour qui le carburant est nécessaire pour aller travailler et bien plus que cela nécessaire pour avoir encore des espaces de liberté
Aurélie Filipetti dans l’émission l’Esprit Public citée en début d’article a eu cette belle phrase : « Tous leurs désirs nécessitent du carburant », pour retrouver un ami, emmener les enfants au sport, pour aller consommer etc..
Alors c’est compliqué, indécent serait plus juste, de leur demander de porter la charge de la transition écologique quand ces gens entendent que l’ex PDG de Nissan, Carlos Ghosn, faisait le tour du monde en avion plusieurs fois par semaine. On parle de l’avion personnel de cet homme. A-t-il payé cet avion ? Et même le kérosène, le carburant non taxé des avions, cet homme riche le payait-il de ses deniers propres ?
Bien sûr que non.
Vous savez bien que personne n’a jamais serré la main d’une personne morale, je veux dire d’une entreprise, mais à la fin c’est toujours elle qui paie la note. Pour des gens comme Carlos Ghosn.
Je suis persuadé que le principal problème de la crise de la représentation démocratique provient de la trahison et de la sécession de la plus grande partie des élites qui ne sentent plus de destin commun avec les gens simples. Ils veulent vivre dans un monde aseptisé de luxe où ils ne rencontrent les gens modestes que lorsqu’ils sont à leur service.
<1162>
-
Mercredi 5 décembre 2018
« On ne peut pas continuer comme cela, l’inégalité est trop forte. On risque l’insurrection »Alain MincAlain Minc, ne fait pas partie de mes auteurs préférés.
Je ne le cite que très rarement.
Mais en continuant mon libre butinage à travers les médias et les réseaux sociaux, je suis tombé sur cette interview d’Alain Minc par Libération et publié le 8 juillet 2018.
Il défend la politique et les choix de Macron mais y met une nuance qui me semble lucide et prémonitoire.
Dans ce cas je veux bien le citer :
« Le capitalisme est le système le plus efficace et le plus inégalitaire. Pendant cette période, les 1 % plus riches aux Etats-Unis ont fini par capter 25 % du revenu national. C’est un pourcentage hallucinant. En Europe, les «1 %» reçoivent 8 % du revenu, ce qui est plus raisonnable, mais toujours excessif. Je ne cesse de tirer la sonnette d’alarme auprès de tous les dirigeants. Une telle inégalité est insoutenable. Mais si l’on cherche à y remédier par les mécanismes classiques de la redistribution égalitaire, on a besoin de sommes énormes, qui seront prélevées sur la classe moyenne, ce qui n’est guère plus satisfaisant. Il faut instaurer le principe de l’équité : réserver la redistribution à ceux qui en ont le plus besoin en révisant les méthodes de l’Etat-providence. Quant aux salariés, ils doivent bénéficier d’un partage du capital, sous la forme d’une distribution d’actions qui leur garantit un patrimoine. […]
Il faut aller plus loin. En tout état de cause, on ne peut pas continuer comme cela, l’inégalité est trop forte. On risque l’insurrection. Elle a déjà commencé dans les urnes, avec la montée des partis populistes. »
Les choses sont bien compliquées. Quand Emmanuel Macron regarde le monde, il constate que, quasi partout, les inégalités sont beaucoup plus fortes qu’en France. Et il a même commencé son quinquennat par des réformes symboliques qui montrent de manière sous-jacente que le problème de la France, selon lui, est que les riches ne sont pas assez riches. Pour ma part je pense que le vrai problème du monde et aussi de la France c’est l’explosion des inégalités. Dans ce monde inégalitaire, il est très difficile de vouloir réaliser une révolution écologique. Probablement même qu’en démocratie c’est impossible, je veux dire dans une démocratie avec ce niveau d’inégalité.
<1161>
-
Mardi 4 décembre 2018
«Le coco fesse des Seychelles est menacé à cause du braconnage»Divers articles dont celui de Sciences et Avenir mis en lienMon neveu Grégory qui est un lecteur du mot du jour et qui est aussi un esprit subtil et clairvoyant, m’a dit un jour : « Finalement ce qui est bien pour toi, c’est que tu écris ton mot du jour sur le sujet que tu choisis sans demander de compte à personne, dans une souveraine liberté ».
Il n’a pas exactement utilisé ces mots, mais c’était bien l’esprit de son propos.
En effet, personne ne me contraint à traiter un sujet en particulier.
Si on écoute la radio, regarde la télévision, lit les journaux français et internationaux, il semblerait qu’il y a un sujet en France qui semble être au premier plan.
Il me semble qu’au départ de ce trouble, il était question d’un problème écologique.
Les questions écologiques sont aujourd’hui multiples sur notre planète.
Et j’ai donc, en toute liberté, décidé d’en traiter un qui concerne la biodiversité.
Le cocotier de mer (Lodoicea maldivica) est une espèce de palmier qui produit la plus grosse graine du règne végétal et qui ne pousse qu’aux Seychelles.
Jusqu’à peu je ne connaissais pas son existence. Je ne suis pas allé aux Seychelles. Oui je confesse que je tente de limiter mon impact carbone.
Mais à quoi ressemble cette graine ?
 Voilà, c’est cette graine ou ce fruit.
Voilà, c’est cette graine ou ce fruit.
Et des esprits orientés, probablement du genre male ont appelé ce fruit : « coco fesse ».
<Wikipedia> nous apprend, qu’aux Seychelles d’autres noms vernaculaires sont utilisés pour désigner ce fruit : coco jumeau, coco indécent et cul de négresse
La première fois qu’un occidental a aperçu ce fruit étonnant il l’avait trouvé en mer ou sur une plage. On ne savait pas sur quel arbre il poussait :
« La première mention botanique de ce palmier vient d’un médecin botaniste portugais, Garcia de Orta, qui en 1563, le nomme coco das Maldivasn. À cette époque, ces grosses noix de coco pouvaient être trouvées en mer dans l’Océan Indien et sur les plages des Maldives, de l’Inde et du Sri Lanka.
Rares, de forme pour le moins suggestive et d’origine inconnue, ces noix avaient tout pour susciter l’imagination débridée des hommes. On les nomma en conséquence cocos de mer ou cocos de Salomon pour évoquer leur origine merveilleuse.
« Ne connaissant pas l’arbre qui le produisait, ne le pouvant découvrir, on avait imaginé que c’était le fruit d’une plante qui croissait au fond de la mer, qui se détachait quand il était mûr, & que sa légèreté faisait surnager au-dessus des eaux » (Pierre Sonnerat, Voyage à la Nouvelle Guinée, 1776).
En Inde, on attribuait à sa coque des propriétés de contrepoison (thériaque), très appréciées des « grands seigneurs de l’Indostan » qui l’achetaient à prix d’or. Les souverains des Maldives firent un négoce fructueux de sa noix avec des pays lointains comme l’Indonésie, le Japon et la Chine où elle était renommée comme plante médicinale. »
C’est une grosse noix verte, ovoïde, pouvant faire jusqu’à 50 cm de long. Le fruit fait en général 20−25 kg mais peut atteindre 45 kg. Avec plus de 25 kg, c’est la graine la plus lourde du règne végétal
Et c’est donc un article de <Sciences et Avenir> qui nous enseigne sur la menace qui porte sur ce fruit qui est très convoité pour des raisons peu convaincantes.
L’article nous donne d’abord le procédé de braconnage et le résultat :
« Le procédé est toujours le même : les braconniers se fraient un chemin dans la forêt tropicale et montagneuse de l’île seychelloise de Praslin :
Les braconniers coupent le coco de mer et repartent sans laisser de trace. À part une cicatrice qui longtemps défigure son arbre amputé.
Depuis le début de l’année, une quarantaine de cocos de mer, gigantesques noix de coco surnommées « coco fesse » pour leur forme suggestive, ont disparu dans la vallée de Mai, classée au patrimoine de l’Unesco. La moitié a été dérobée sur le seul mois d’octobre 2014. »
Nous apprenons qu’il ne présente pas d’intérêt gastronomique :
« Moins sucré que la noix de coco classique, et difficile à fendre une fois arrivé à maturité, il [n’est] pas utilisé dans la gastronomie. »
Sciences et Avenir rappelle l’Histoire :
« Le coco de mer fait l’objet de convoitises depuis des siècles à des milliers de kilomètres de l’archipel de l’océan Indien: mystifié jusqu’en Europe ou en Asie, il passait dès le 16e siècle pour avoir des vertus curatives exceptionnelles.
À l’origine, on pêchait la noix à la dérive en pleine mer, ou on la trouvait échouée sur des plages de l’océan Indien.
Ne l’ayant jamais vue pousser sur terre, les marins pensaient qu’elle provenait d’arbres enracinés dans les fonds marins – d’où son nom, coco de mer.
Ce n’est qu’au 17e siècle que le lieu d’origine du fruit géant, en forme de bassin féminin, d’une vingtaine de kg, fut déterminé : l’île de Praslin. »
Et l’actualité :
« Un regain d’intérêt pour le coco de mer est survenu après l’indépendance des Seychelles, en 1976, et « le développement de l’industrie du tourisme », explique Victorin Laboudallon, membre du conseil de la Fondation des îles Seychelles (SIF), qui gère la Vallée de Mai. Un engouement lié à sa forme et à des pseudos vertus aphrodisiaques
Le fruit, récemment offert au jeune couple princier de Kate et William lors de leur voyage de noces, est prisé pour son côté décoratif, mais aussi, en Asie, en particulier en Chine, pour ses soi-disant effets aphrodisiaques, associés à sa forme suggestive.
En 2008, deux « cocos fesse » avaient atteint les prix de 6.000 et 11.000 euros lors d’enchères chez Christie’s à Paris.
L’engouement pour cette noix unique atteint une telle proportion qu’en 1978, les autorités décidèrent d’en contrôler le commerce: les Seychellois ne pouvaient plus la vendre qu’au gouvernement, qui la revendait accompagnée d’un certificat. »
Les habitants, (qui doivent avoir des gênes de français réfractaires) ont protesté auprès des autorités et bien sûr la taxe l’interdiction a été levée, mais l’exportation du fruit reste ultra-réglementée.
Mais tout ceci a aussi entraîné du braconnage et cette espèce végétale est désormais menacée :
« Au prix (450 dollars le kg) où se négocie sur les marchés asiatiques ce fruit introuvable hors de Praslin et d’une autre île seychelloise, Curieuse, la contrebande fait cependant rage.
Et, avec quelque 17.000 arbres recensés à Praslin et 10.000 autres à Curieuse, l’espèce est désormais jugée menacée: l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) l’a inscrite sur sa liste rouge en 2011.
Pour tenter d’enrayer le phénomène, et mieux surveiller les 19 hectares de forêt où se nichent les « cocos fesse », la SIF a augmenté ces dernières années le nombre de gardiens. Mais le terrain accidenté et l’absence d’enclos rendent leur tâche ardue.
Avant on pouvait voir près de 75 cocos sur un arbre, maintenant il y en a juste 25, déplore M. Laboudallon. Les arbres ne donnent pas autant de fruits qu’avant car quand on coupe un coco, cela l’affecte, et il ne produit plus autant. »
Aux Seychelles, le problème du braconnage est pris d’autant plus au sérieux que le coco de mer est un symbole national. Il figure même sur les armoiries du pays. Et, nous apprenons qu’une machine sophistiquée vérifie les valises et détecte les « cocos-fesses » dans les valises :
« Contre l’exportation illégale du fruit, Victoria a installé « une machine radiographique à l’aéroport qui vérifie toutes les valises qui quittent le pays », assure Ronley Fanchet, directeur de la Conservation au ministère de l’Environnement. »
 Pour être complet, il faut aussi montrer l’inflorescence mâle ou fleur mâle de cet étonnant arbre Lodoicea maldivica
Pour être complet, il faut aussi montrer l’inflorescence mâle ou fleur mâle de cet étonnant arbre Lodoicea maldivica
Que conclure de tout cela ?
D’abord que la nature renferme des curiosités pleines de malices.
Que dès qu’homo sapiens sent l’odeur de l’argent, il devient dangereux pour la nature.
Enfin qu’homo sapiens est très préoccupé par sa libido et que cette inclination qui souvent devient faiblesse, l’entraine à devenir très stupide. Car bien sûr ce fruit n’a aucun effet aphrodisiaque pas davantage que la corne de rhinocéros.
<1160>
-
Lundi 3 décembre 2018
« Grigory Sokolov »Un pianiste exceptionnelAnnie et moi sommes allés, comme chaque année, au concert que donne annuellement Grigory Sokolov à Lyon.
Cette année c’était le 8 novembre et je n’en ai pas fait un mot du jour le lendemain, parce que le 9 novembre je commençais mon itinérance intellectuelle et historique sur la guerre 14-18, sa fin et ses conséquences.
Cette itinérance étant terminé, je peux revenir à cet artiste.
 Souvent on lit « le meilleur » pour parler d’un sportif ou d’un artiste, dans un domaine. Quand j’étais plus jeune, il m’arrivait aussi de tomber dans cette faiblesse de la compétition à tous les niveaux.
Souvent on lit « le meilleur » pour parler d’un sportif ou d’un artiste, dans un domaine. Quand j’étais plus jeune, il m’arrivait aussi de tomber dans cette faiblesse de la compétition à tous les niveaux.
Aujourd’hui, il me semble que notamment dans le monde de l’art, il n’y a pas à faire de classement mais simplement à ressentir ou à comprendre ce qu’un artiste peut apporter.
Un artiste peut apporter le divertissement et ce n’est pas rien de divertir.
Dans d’autres domaines et dans la musique particulièrement et sur un piano singulièrement, l’artiste peut rechercher la performance.
C’est une incontestable performance qui d’ailleurs ravit le public et le divertit aussi un peu.
Grigory Sokolov ne fait ni l’un, ni l’autre.
Dans le monde des pianistes il existe une autre typologie :
- Les cogneurs ;
-
Et les autres ceux qui ont un toucher aérien, souple, magique, je ne sais comment les définir. Mais ce ne sont pas cogneurs.
Dans ce domaine, les cogneurs ne sont pas forcément des hommes, il existe des cogneuses.
Je peux vous donner l’exemple d’une pianiste très célèbre, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi, qui « cogne » un prélude de Rachmaninov : <Valentina Lisitsa – Prélude opus 23 N° 5 de Rachmaninov>.
Grigory Sokolov appartient au second type, ceux qui ne cognent pas. Cette même œuvre de Rachmaninov jouée par lui <donne cela>. Ce n’est pas une vidéo, il existe <une vidéo> dans laquelle on le voit « toucher » le piano, mais le son est assez mauvais.
Cette œuvre de Rachmaninov est surtout une œuvre très technique et brillante, il ne faut pas en attendre trop d’émotions, mais il y a quand même un monde entre l’exécution de Valentina Lisitsa et l’interprétation de Sokolov, un éléphant et un oiseau.
Lorsqu’il y a quelques années, après avoir lu certains articles sur lui, nous sommes allés la première fois l’écouter à l’Auditorium, la salle était à moitié pleine. Mais chaque année, probablement par le bouche à oreille, la salle se remplit davantage, cette année elle était pleine.
Grigory Sokolov est probablement un peu timide, peut-être même un peu autiste. Il rentre sur scène discrètement et rapidement. Il exige un éclairage minimum. Il passe toujours derrière le piano, pour que l’instrument le protège du public, il salue une fois, se met au piano et joue tout de suite. Et c’est le miracle. Cet homme fait parler son piano, la musique vous touche alors au plus profond de votre humanité, de votre âme si on se laisse aller au lyrisme.
Et même quand il joue un bis, une œuvre technique et brillante comme ce morceau de Couperin, il y met une légèreté et un sens de l’ineffable qui n’appartient qu’à lui : <Grigory Sokolov – Couperin – Le tic-toc-choc ou Les maillotins>
Je ne suis pas seul à penser et éprouver cela, le critique <Christian Merlin> écrit :
« Il y a un mystère Sokolov. On ne vous parle pas seulement de l’homme, de son côté autiste, qui apprend par coeur les horaires de train et les codes-barres, et ritualise son entrée en scène comme ses saluts. On vous parle bel et bien du pianiste. Une fois de plus, le récital que Grigory Sokolov a donné au Théâtre des Champs-Élysées[…] fut un moment hors de l’espace et du temps. Un moment passé à se demander: «Comment fait-il?»
Question que les pianistes présents dans la salle se posaient constamment, tentant par exemple de comprendre son jeu de pédale: sans avoir l’air d’y toucher, Sokolov alterne résonance et son étouffé sur une même note, comme s’il tirait les registres d’un orgue. Et tout cela avec des marteaux sur des cordes! Il y a sa souplesse de poignet aussi, cet art du trille où l’on a l’impression que même le nombre de battements est calculé. Cette façon de murmurer tout en jouant au fond du clavier, ou de tonner sans être brutal. En un mot, la maîtrise absolue, surhumaine, de quelqu’un qui travaillait encore sur scène une demi-heure avant le début du concert, empêchant le public arrivé en avance d’entrer, et serait capable de démonter et de remonter le piano pièce par pièce.
[…] il nous a tout simplement hypnotisé, nous faisant perdre le sens de l’orientation dans le temps, comme une image de l’éternité. Six bis, dont deux miraculeux intermezzi de Brahms, nous ont laissé écrasés par cette recherche d’absolu. »
Comme l’écrit Christian Merlin, à la fin de son concert, il joue de nombreux bis souvent plus de 5 et des bis qui sont souvent une œuvre à part entière. Ainsi à Lyon après avoir interprété les 4 impromptus opus 142 de Schubert, son premier bis fut un autre impromptu de l’autre série celle opus 90.
Et quand Sokolov joue Schubert cela donne un moment d’extase : <Grigory Sokolov – Schubert Impromptu Nr. 2 Es-Dur>
Un critique suisse parle du : « Triomphe du dépouillement pour un pianiste qui vit dans son monde, comme hanté par une mission hors normes. »
Grigory Sokolov, décide d’un programme unique pour une année, programme qu’il approfondit sans cesse et avec lequel il va faire tous ces concerts agrémentés de nombreux bis qui eux seront différents.
Ainsi le programme joué à Lyon le 8 novembre sera aussi joué entre autre
- Le 5 Décembre 2018 à la Philharmonie du Luxembourg
- Le 8 Décembre 2018 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris
- Le 6 mars 2019 au Palau de la Música Catalana à Barcelone
- Le 10 mars 2019 à l’Auditorium Rainier III à Monte Carlo
Il finira le 29 mai 2019 à Milan
Pour les toulousains, c’est trop tard car c’était le lundi 4 juin 2018
Et pour une dernière pièce la <Gigue de la 1ère Partita de Bach>
<1159>
- Les cogneurs ;
-
Vendredi 30 novembre 2018
«Le Musicien de la Guerre»René BeziauJe vais arrêter aujourd’hui mon itinérance intellectuelle et épistolaire autour de la guerre 14-18 et de ses conséquences.
Lorsque j’ai fait référence, lors du mot du jour du 14 novembre, à la dernière lettre d’un fusillé pour l’exemple à son épouse, Gérald m’a exprimé ses doutes.
Doute que j’avais aussi. Il était étonnant qu’un soldat du rang écrive aussi bien en 1914. Par ailleurs, il n’y avait aucune référence à son régiment, à son vrai nom.
Il est vrai que ce qu’il exprimait était si fort et si juste, qu’il est possible que ce fut une lettre écrite par une personne qui s’est mise dans la peau d’un tel destin et avec sa connaissance d’alors ait rédigé ce texte.
Je ne le sais pas.
Mais aujourd’hui je vais finir avec une lettre dont on ne peut douter de l’authenticité.
Notre amie à Annie et à moi, Marianne a découvert un poème écrit par son grand-père René et transmis par son oncle (le dernier de la fratrie paternelle) tout récemment.
Ce poème l’a beaucoup touchée et comme elle le dit c’est un témoignage d’une grande valeur. Elle m’a donné l’autorisation de le publier dans le mot du jour.
J’aurais pu encore évoquer bien des sujets et notamment j’aurais souhaité parler de l’émancipation inachevée des femmes, notamment en France. Car pendant que les hommes allaient au front pendant la guerre 14-18, il a fallu continuer à faire fonctionner la France de l’arrière, le travail des champs, le travail des usines et tout ce qui était nécessaire pour assurer la vie économique et sociale. Et pour ce faire, les femmes ont assuré ces travaux, des initiatives et une responsabilité qui ne leur était pas accordé d’habitude. Il paraissait logique qu’elles continuent avec ces mêmes responsabilités après la guerre, qu’enfin les hommes leur accordent leur vraie place dans la société économique et politique.
Ce ne fut pas le cas, il faudra attendre une ordonnance du 21 avril 1944, ratifiée par le général de Gaulle pour que ce droit de vote et l’éligibilité leur soit accordé.
L’Allemagne et l’Autriche furent les vaincus de la guerre, et… ils accordèrent le droit de vote aux femmes en novembre 1918, juste après la défaite.
La victoire rendrait-elle stupide ?
Et en France, il fallut attendre une Loi de 1965 pour qu’une femme puisse travailler sans l’accord de son mari ou ouvrir de compte en banque à son nom propre.
Quelle honte ! On voit là toute la distance entre l’image que la France a d’elle même et la réalité des faits.
Sur ce sujet, j’ai trouvé un dossier intéressant, issu d’un colloque de 2014 : <Les femmes pendant la guerre de 1914-1918 ou l’émancipation en marche ?>
Mais, nous finirons par le poème du grand-père de Marianne qu’Annie a saisi sur l’ordinateur pour qu’il puisse être inclus dans ce mot du jour. Mais vous trouverez aussi en pièce jointe la copie du manuscrit de René Beziau : <Lettre d’un musicien>. Car au delà des réflexions, de l’Histoire, de la politique, des relations entre les nations et les États, je crois qu’à la fin, il faut toujours revenir à la réalité de l’homme confronté à l’innommable qui fut la réalité de cette guerre.
Marianne précise : « Mon grand-père était musicien, alors pendant la guerre, quand on était musicien, on était…brancardier, comme son frère aîné Marcel, sauf que Marcel a eu moins de chance que René, il est mort 3 mois avant l’armistice. »
Le manuscrit précise que ce poème est de 1916, qu’il a été écrit à Verdun, côte 304.
On associe souvent les combats de la Cote 304 à ceux du Mort-Homme qui ont eu lieu en même temps et dans une grande proximité comme le montre <ce site>.
Si vous cherchez « côte 304 » sur Internet vous trouverez beaucoup de photos et des sites qui parlent de ces combats.
Par exemple <celui-ci> :
« Cote 304 Avocourt, du 5 Mai 1916 au 21 Mai 1916, le 125eme RI […] aura pour mission de reprendre ,les positions perdues et s’y maintenir. […], la cote 304 mouvement de terrain jumeau du Mort Homme sera perdue le 5 mai .Reconquise le 6 reperdue puis reprise le 7…Des aviateurs en observation au-dessus de ces positions avaient indiqués à l époque que le ciel était obscurci jusqu’à 800 mètres au-dessus du sol. »
Et pour comprendre le contexte de ce poème, je joins une photo :
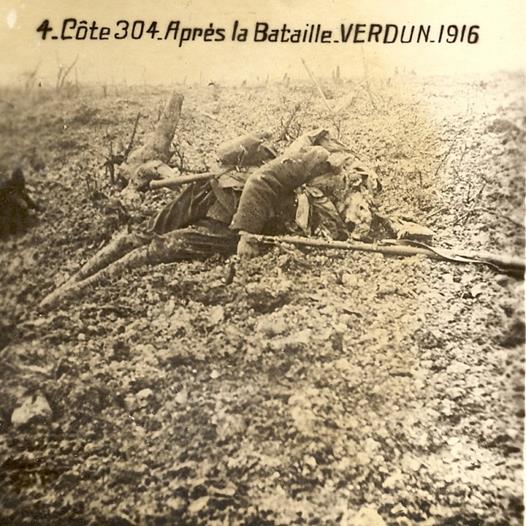
Le Musicien de la Guerre
L’assaut est terminé. Vite au travail. J’approche.
Voici mes instruments : une pelle ! Une pioche !
Un brancard ! Musicien, brancardier, fossoyeur !
Du funèbre charnier, c’est moi le nettoyeur
J’accours par les boyaux, me voici sur la plaine.
Je rampe dans la nuit, retenant mon haleine,
à l’appel d’un soupir vers les blessés râlant
J’emporte sur mon dos les pauvres corps sanglant,
Sans soucis des obus, je ramasse la vie.
Du moins ce qu’il en reste, et mon épaule plie
Sous le poids répété des convois douloureux.
Quelle grandeur superbe en ces blessés glorieux !
Je leur rends à la hâte un éclatant hommage.
Confiants, sans un cri plein d’espoir et de rage
Héroïques patients par le trépas guettés.
Ils raccrochent leurs âmes à leur corps mutilés…
Si je heurte un talus leurs souffrances s’avivent.
Pas un mot… dans leur désir de survivre ils vivent.
Mais vers l’arrière enfin. J’ai porté la douleur.
Plus rien ne vit ici …je deviens fossoyeur.
Je quitte le brancard pour la pelle et la pioche!
Allons va musicien !…
Un cadavre est tout proche.
Un mort! J’hésite. Quel débris ! Je suis ému
Ceci fût vivant !!…
Quel est ce pauvre inconnu?
O toi qui fus meurtri sur la glèbe entrouverte
Où la fureur humaine a consommé ta perte,
Mort, quel est ton passé ? Quel était ton pays ?
Es-tu le montagnard qui paissait ses brebis ?
Le coron de la mine abritait il ta tête ?
Es-tu le doux pêcheur qui bravait la tempête,
Ou l’humble laboureur suivant dans le sillon
Le pas lent de bœufs lourds qu’éveille l’aiguillon?
Es-tu le grand savant pâli sur son grimoire
Et rêvant d’imposer au monde sa mémoire,
Ou l’artiste charmant, l’aimable Cyrano
Que chacun à l’envie fêtait d’un long bravo?
Es-tu l’heureux époux, l’incomparable père,
L’artisan, l’ouvrier combattant la misère?
Ou bien l’amant timide au regard langoureux.
Le Don Juan vainqueur ou l’obscur amoureux ?
Qu’importe!…
Maintenant, appuyé sur ma pelle,
Je songe à te remettre au néant qui t’appelle.
Et j’admire comment une étrange splendeur
Vint mêler sur ton front le sublime à l’horreur…
Jadis, tu fis peut-être, et doux était ce rêve,
Le vœu de reposer sous le tertre ? qu’élève
Non loin du vieux clocher près des pins révérés,
L’ardente dévotion de parents éplorés
Après qu’une main chère eut fermé ta paupière
Ou songeais à dormir sous une lourde pierre,
Ou ceux qu’aima ton cœur viendraient agenouillés
En t’offrant leur douleur, pencher leurs yeux mouillés
L’inexorable sort au but impénétrable,
En décide autrement ; seul, triste, et misérable,
Sur cette boue immonde où la mort a sévie
Ton âme est anonyme et ton corps est pourri !…
Accomplissant ici ma besogne macabre
Je te pousse du pied, je tire sur ton sabre
Je traîne sur le sol ces amas répugnants
D’os brisés, de cervelles et de membres saignants!
Une fusée éclate : une lumière boche
Fait passer des lueurs sur le fer de ma pioche
L’ironique destin donne à ton meurtrier
La tâche d’éclairer ton funèbre ouvrier?
Et si l’orgue est absent à la cérémonie
Dans l’air troublé surgit la sauvage harmonie
Des monstres vomissant la mitraille et le feu
Qui crachent leur fureur jusqu’au ciel jusqu’à Dieu !
Tu meurs seul sans amis, pour toi nul deuil, nul cortège
La nuit seule. Étant mort tu n’as rien !… mais j’abrège.
Je vais mettre en leur trou les putrides restants.
Et c’est moins pour toi que pour la santé des vivants.
Je groupe tes lambeaux de chairs inanimées.
Ils serviront d’engrais à quelques graminées
Ainsi tu nourriras par de subtils détours
Ceux que tu crois avoir délaissés pour toujours
À moins que quelque obus en se trompant de route
Au lieu chez les vivants de porter la déroute
Vienne s’échouer là pour troubler ton repos
Et lancer dans les airs ce qu’il te rester d’os
Avant que d’un bras las je recouvre ta tête
Ô mort un dernier mot. Que ma pelle s’arrête
Découvert, à genoux, d’un adieu fraternel
Je tiens à saluer ton repos éternel
Adieu mort inconnu, toi qui bâtis l’histoire.
Adieu ! Le fossoyeur d’une si pure gloire
Salue en toi, la Mort et le brutal Destin
Héros ! Je te salue et j’honore ta fin !!!!
Maintenant, sur ton front je jette un peu de terre
D’une croix de bois je marque ton cimetière
J’ai fini, tu n’es plus !…
Un autre mort m’attend.
Je refoule une larme et je pars en chantant
René Beziau
Verdun côte 304
1916
<1158>
-
Jeudi 29 novembre 2018
«Il y avait partout des réfugiés. Comme si le monde entier devait se déplacer ou attendait de le faire»Homer Folks, le directeur du bureau des affaires civiles de la Croix Rouge (1)L’actualité récente parle beaucoup des réfugiés, mais il faut savoir que la Première Guerre mondiale avait engendré des déplacements de population d’une ampleur sans précédent, de plus de 12 000 000 de civils. La seconde guerre mondiale fera encore pire (près de 60 000 000).
La création d’Etats-Nation dans lesquels apparaissait des minorités, le nouveau tracé des frontières, les conflits qui perduraient ont jeté sur les routes des foules de réfugiés. Parmi les plus importants il y a eu des transferts de population entre la Grèce et la Turquie, l’arrivée de Russes blancs, d’Arméniens dans les pays d’Europe occidentale, le départ d’Allemands de territoires germains intégrés au nouvel État polonais.
L’historien « Bruno Cabanes » a écrit un article dans la revue « L’Histoire » consacré à la Grande guerre. Article qui a pour titre : «Réfugiés : La catastrophe humanitaire »
« « Il y avait des réfugiés dans toute l’Europe. Pendant cinq ans, c’est comme si presque tout le monde devait partir ou attendait de le faire. » Ces mots de Homer Folks, le directeur du département des affaires civiles de la Croix-Rouge américaine en France, résument bien la situation à la fin de la Première Guerre mondiale. Tout le conflit a été marqué par d’importants mouvements de populations : entre 1914 et 1918 déjà, près de 3 millions de personnes, en Belgique, en France, en Italie, dans les Empires allemand, russe et ottoman, avaient dû quitter leurs maisons et leurs terres.
Loin d’apaiser la situation, la sortie de guerre l’intensifie pour plusieurs raisons. D’abord, on assiste au retour chez eux de nombreux réfugiés : dès la fin 1918, c’est le cas des personnes ayant fui les départements du nord de la France, libérés de l’occupation allemande. Ensuite, de nouveaux affrontements armés éclatent à la fin de la Première Guerre mondiale ou immédiatement après, comme la guerre civile russe (1917-1923), la guerre soviéto-polonaise (1919-1921) ou la guerre gréco-turque (1919-1922), qui poussent sur les routes des centaines de milliers de personnes, chassées aussi par les catastrophes humanitaires comme la grande famine russe de 1921-1922. Ensuite, la fin de la guerre entraîne le démantèlement de quatre empires, allemand, austro-hongrois, russe et ottoman, créant de nouveaux États et une résurgence des tensions ethniques. Enfin, les traités de paix instaurent des clauses de protection des minorités et généralisent le principe d’option qui oblige tout individu à transférer sa résidence dans le pays dont il a adopté la nationalité. Le traité de Trianon (4 juin 1920), par exemple, place quelque 3 millions de Hongrois hors des frontières du nouvel État. »
Parmi tous ces réfugiés, il y a d’abord des réfugiés russes qui fuient la guerre civile et la brutalité des bolcheviques :
« Le premier groupe est composé de 800 000 « réfugiés russes » : certains ont quitté la Russie avant la révolution et ne peuvent y revenir (c’est le cas du compositeur Stravinsky installé en France et en Suisse), d’autres ont dû fuir le pays en 1917 (par exemple, Rachmaninov et sa famille). A la fin 1920, après la défaite des armées blanches, d’anciens militaires de l’armée Wrangel et leurs familles sont évacués de la Crimée vers la région de Constantinople que le diplomate britannique Philip Baker décrit comme « l’un des points noirs de l’histoire européenne de l’après-guerre » »
Il y a bien sûr le premier peuple victime d’un génocide :
« Le deuxième grand groupe de réfugiés de l’après-guerre est constitué par les quelque 700 000 survivants du génocide arménien de 1915, éparpillés en Syrie, au Liban, ou en Égypte après la guerre. Originaires d’un pays qui n’existe plus (l’Empire ottoman), ils sont victimes de la loi du 15 avril 1923 sur la confiscation des biens des « absents », par laquelle le gouvernement kémaliste refuse de reconnaître comme ses ressortissants les Arméniens ayant trouvé refuge hors des frontières de la nouvelle Turquie entre 1914 et 1923. »
Et puis les mouvements de population issus du conflit entre les grecs et les turcs.
Troisième groupe enfin, le plus important en termes numériques, les 1,5 million de personnes concernées par l’échange forcé de populations au terme de la Convention gréco-turque du 30 janvier 1923, intégrée au traité de Lausanne du 24 juillet 1923, qui remplace le traité de Sèvres du 10 août 1920 et met fin à la guerre gréco-turque. Environ 1,3 million de Grecs orthodoxes sont contraints de quitter la Thrace orientale, la Cappadoce ou le Pont pour partir s’installer en Grèce, tandis que 385 000 musulmans grecs font le chemin inverse vers la Turquie. En l’espace de quelques mois, la Grèce doit accueillir un afflux de réfugiés équivalent à 20 % de sa population, essentiellement à Athènes et à Thessalonique, ce qui ne manque pas de susciter de vives réactions de la part de la population locale. »
C’est une première dans le droit international qui conduit à ce que la reconnaissance du fait national s’accompagne d’une volonté de « purification » de la nation dont ceux qui n’en font pas strictement partie doivent partir.
Cette situation déplorable des réfugiés et relayés par les journaux va conduire à développer les mouvements humanitaires.
Mais parmi les réfugiés il y a une catégorie encore plus fragilisée et en détresse, c’est celle « des apatrides » :
« Comme on l’imagine, cette situation est particulièrement intenable pour les apatrides. Au lendemain de la Grande Guerre, l’apatridie, jusqu’ici tenue pour une anomalie juridique, est de plus en plus fréquente, puisqu’elle concerne environ 3 millions d’individus au début des années 1920, en particulier les Russes blancs que Lénine a dénaturalisés par un décret d’octobre 1921. Elle pose divers problèmes liés à la liberté de circulation, à l’attestation de leur identité, ou au droit civil (droit des successions, droit de la famille). Des juristes, nombreux à travailler sur ce sujet à l’époque, en soulignent les terribles conséquences pour les individus : déni de la protection qu’un État devrait apporter à ses ressortissants (c’est le sens de la fameuse formule de la philosophe allemande Hannah Arendt, le « droit d’avoir des droits »), exclusion de la communauté humaine, et perte de dignité.
 Il est créé aussi un « passeport » pour les apatrides et nous apprenons à connaître le Norvégien Fridtjof Nansen :
Il est créé aussi un « passeport » pour les apatrides et nous apprenons à connaître le Norvégien Fridtjof Nansen :
« Pour faire face à cette crise humanitaire sans précédent, la Société des nations fait appel au Norvégien Fridtjof Nansen, nommé en 1921 haut-commissaire de la SDN aux réfugiés russes. […]
Explorateur, océanographe, skieur habile, le Norvégien Fridtjof Nansen, né en 1861, devient diplomate sur le tard. Grand admirateur des idées de Wilson, il prend la tête, en 1920, du Haut-Commissariat de la SDN chargé du rapatriement des prisonniers de guerre puis, un an plus tard, du Haut-Commissariat aux réfugiés. Il donne son nom au « passeport Nansen », créé en juin 1922 lors de la Conférence intergouvernementale de Genève. Ce certificat, accordé aux Russes, puis aux Arméniens en 1923, enfin aux Assyriens et Assyro-Chaldéens en 1928, donne aux réfugiés une identité. Sans conférer à ses porteurs une totale liberté de mouvement ni la protection de leur pays de résidence, ce document constitue un premier pas vers la reconnaissance d’un droit international des réfugiés – défendue par Nansen jusqu’à sa mort, en 1930. »
En 1922, Nansen reçoit le prix Nobel de la paix pour son travail au nom des victimes déplacées de la Première Guerre mondiale et des conflits liés.
On constate, une fois de plus que les malheurs et les grandes souffrances pour des populations n’ont pas cessé avec le 11 novembre 1918. Ces déplacements de population feront des émules après 1945, avec des transferts massifs d’allemands chassés des pays dans lesquels ils vivaient avant la guerre, on peut aussi citer les terribles transferts de populations lors de la séparation entre l’Inde et le Pakistan.
<1157>
- Peter Gatrell et Philippe Nivet, La Première Guerre mondiale. sous la direction de Jay Winter Volume III Chapitre VIII Les réfugiés et les exilés pages 209 à 240, Fayard, 2014
- Peter Gatrell et Philippe Nivet, La Première Guerre mondiale. sous la direction de Jay Winter Volume III Chapitre VIII Les réfugiés et les exilés pages 209 à 240, Fayard, 2014
-
Mercredi 28 novembre 2018
« Et la proposition japonaise d’inscrire dans la charte de la SDN l’égalité des races et des nationalités fut repoussée ! »Une autre péripétie oubliée de l’après-guerre 14-18C’est dans l’une des émissions de France Inter déjà citées <1918, un monde en révolutions> que l’historien Nicolas Offenstadt, m’a appris l’existence de cette proposition rejetée par les vainqueurs de la guerre 14-18.
En 14-18, les japonais étaient contre les allemands et donc du côté des vainqueurs, mais ils étaient asiatiques au milieu de nations européennes et de « blancs ».
<Le numéro spécial de l’Histoire de juillet/août 2018> évoque cet épisode dans un petit encart qui a pour titre : « Saionji : le Japonais qui voulait l’égalité des races » :
 « Engagé dans le conflit dès 1914, le Japon, qui n’a joué qu’un rôle secondaire dans la Grande Guerre (il s’est contenté de s’emparer des possessions allemandes en Chine et dans le Pacifique), siège pourtant aux côtés des vainqueurs à Versailles avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’Italie. La délégation japonaise est menée par Saionji Kinmochi, un ami personnel de Clemenceau. Malade, Saionji est secondé par l’un de ses proches, le diplomate Makino Nobuaki.
« Engagé dans le conflit dès 1914, le Japon, qui n’a joué qu’un rôle secondaire dans la Grande Guerre (il s’est contenté de s’emparer des possessions allemandes en Chine et dans le Pacifique), siège pourtant aux côtés des vainqueurs à Versailles avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’Italie. La délégation japonaise est menée par Saionji Kinmochi, un ami personnel de Clemenceau. Malade, Saionji est secondé par l’un de ses proches, le diplomate Makino Nobuaki.
Issu d’une grande famille de l’aristocratie japonaise, toute-puissante au XIIIe siècle, Saionji Kinmochi est un libéral francophone qui a séjourné une dizaine d’années en France à partir de 1871. Il s’est alors lié avec les frères Goncourt, Gambetta et Clemenceau, à qui il transmet l’amour des choses japonaises. De retour au Japon, alors traversé par l’agitation démocratique, il fonde un journal d’opinion, La Liberté de l’Orient, dont il doit cesser la publication sur ordre impérial. Un jeune aristocrate ne doit pas s’encanailler avec des partisans de la liberté et des droits du peuple !
Contraint de se ranger, Saionji fait dès lors une carrière diplomatique et politique plus classique, accédant à plusieurs reprises au poste de Premier ministre à partir de 1906. Libéral dans l’âme, avec Makino, son second, il pousse à Versailles les Alliés à adopter une résolution de principe pour le pacte de la SDN en faveur de l’égalité des races et des nationalités. C’est, en ce temps-là, une mesure quasiment révolutionnaire. Souvent victimes de la condescendance raciste des Occidentaux, les Japonais tiennent à cette clause. Le texte vise aussi à contrer les mesures adoptées en Californie et en Australie contre l’immigration asiatique en général, et japonaise en particulier (en 1913, une loi californienne interdit ainsi aux Japonais d’acheter de la terre).
Le texte est critiqué, notamment par les Britanniques, mais adopté par 11 voix sur 17. Le président Wilson, qui avait voté pour, proclame néanmoins, sous la pression, que l’unanimité étant nécessaire pour l’adoption de ce principe, ce dernier est donc rejeté. Stupeur dans l’opinion japonaise qui vit très mal cette rebuffade occidentale. Du coup, pour éviter que le Japon ne torpille la future SDN, Wilson cède aux revendications japonaises sur le Shandong, s’aliénant l’appui du gouvernement chinois et sa propre opinion publique, inquiète devant la montée en puissance du Japon en Extrême-Orient. »
Un assez long article sur cette proposition japonaise et les débats qui ont suivi se trouve dans Wikipedia : « Principe de l’égalité des races ».
Et comme je veux faire court, pour une fois dans cette série de mots consacrés à 14-18, je vous laisse lire cet article si le sujet vous intéresse.
Il faudra attendre 1948, 30 ans plus tard et une barbarie européenne encore plus extrême pour que le principe de l’égalité de « tous les êtres humains » soit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
<1156>
-
Mardi 27 novembre 2018
« Les espoirs déçus des pays colonisés après 1918 »Comment les peuples colonisés furent galvanisés par le wilsonisme et puis déçusLorsque la première guerre mondiale éclate elle met aux prises des empires. Il y a les empires continentaux comme l’Autriche-Hongrie ou l’Empire Ottoman, mais il y a aussi les empires coloniaux Britanniques et Français. L’Empire allemand possédait aussi ses colonies. L’Allemagne s’était établi dans le Sud-Ouest africain (actuelle Namibie), mais aussi au Cameroun et au Togo et aussi en Afrique orientale allemande dans une partie de la Tanzanie actuelle et aussi du Rwanda. Toutes ces conquêtes ont eu lieu entre 1883 et 1885 en quelques mois, l’Allemagne se retrouva ainsi à la tête d’un empire colonial cinq fois plus grand que son territoire métropolitain, mais très peu peuplé.
Globalement, quand on regarde une carte des possessions européennes en 1914, on voit ceci :
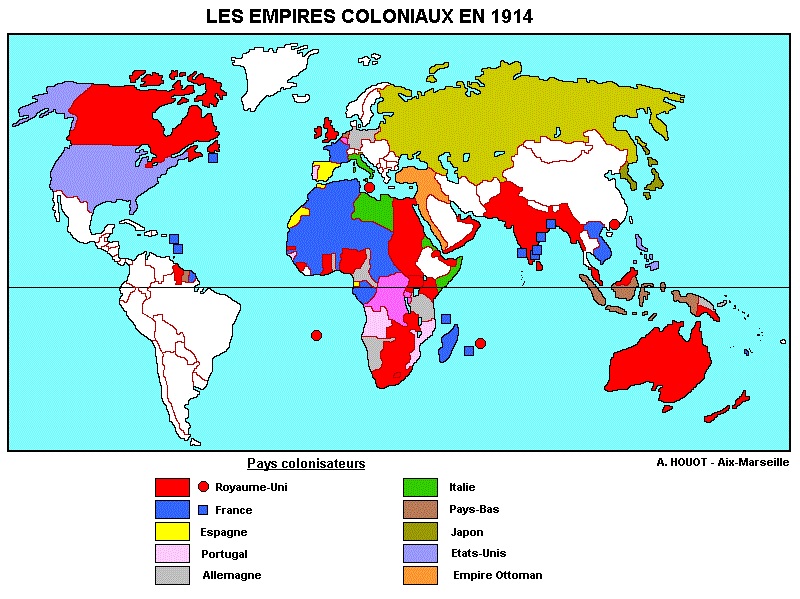
A la fin de la guerre, ces colonies aspiraient à devenir pour beaucoup indépendantes ou au moins autonomes.
Ces aspirations avaient deux fondements :
- Recueillir les fruits de leur participation à l’effort de guerre de la puissance coloniale ;
- Répondre au Wilsonisme et à l’espoir qu’il avait suscité.
En effet, les peuples colonisés ont participé à l’effort de guerre.
L’historien Jean-François Klein explique :
« . Les Français ont mobilisé à peu près 650 000 hommes dans leurs colonies (y compris les coloniaux – civils, militaires et missionnaires), ce qui est peu au regard des 7 800 000 métropolitains mobilisés. Les troupes coloniales représentent ainsi à peu près 8 % des combattants. […]
Du côté des Britanniques, aux 5 700 000 métropolitains (dont 500 000 Ecossais et 200 000 Irlandais) engagés et mobilisés s’ajoutent 1 315 000 hommes venus des quatre dominions (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud), 1 400 000 Indiens et 57 000 Africains, sans compter le reste, au total près de 3 millions d’hommes issus de l’empire. Seulement 12 % des troupes indiennes sont stationnées en Europe, en particulier vers Dunkerque et Ypres, le reste étant employé en Afrique et au Moyen-Orient. En revanche, les troupes blanches des dominions sont surtout déployées en Europe occidentale. »
Après tous ces combats et ces morts, les peuples colonisés attendent un juste retour des puissances impériales.
<Car comme le précise un article du Monde> :
« L’armée et la guerre forment des combattants et des cadres. Les colonisés de retour du front n’ont pas perçu l’expérience combattante comme une humiliation raciale. Pas plus qu’ils n’ont servi de chair à canon ! Le nombre de morts n’est pas plus élevé chez les « colored » que chez les Blancs. Au contraire, ils ont souvent eu au sein de l’armée et en Europe une liberté qu’ils n’avaient pas dans les colonies, en dépit de tentatives pour limiter les contacts avec les autochtones, surtout avec les femmes blanches.
Mais aucune barrière socio-raciale n’est jamais étanche. En dépit des vexations, nombre de ces anciens combattants ont connu la fraternité des armes, le respect de leurs chefs, durement gagné. Les problèmes se posent surtout lors du retour dans les colonies, lorsque l’ancien combattant reçoit de plein fouet la morgue coloniale. […]. Ces hommes ont donné leur vie en se battant aux côtés des Blancs. Là commence la remise en question du « lien colonial ». »
D’autres « colonisés » font un autre choix celui d’entrer dans l’administration coloniale des dominants :
« Certains, auréolés de leur gloire combattante, participent en tant que cadres subalternes à l’administration coloniale et forgent leurs propres stratégies d’ascension sociale. Sont-ils des traîtres ? Certains indépendantistes le pensent. Le cas des quelques centaines de Cambodgiens mobilisés est intéressant. Après la guerre, un monument aux morts a été érigé en hommage aux victimes. Lors de la prise de Phnom Penh le 17 avril 1975 par les Khmers rouges, seulement deux bâtiments très symboliques sont dynamités : la cathédrale et le monument aux morts de la guerre de 1914-1918, car ce dernier célébrait la fraternité entre Français et Cambodgiens. »
Mais le ressort fondamental de ce désir d’accéder à l’indépendance trouve ses racines dans l’appel de la liberté et trouve comme support le message du Président américain Woodrow Wilson qui à travers ses « quatorze points » développés lors de son discours du 8 janvier 1918, devant le Congrès américain évoque une « association générale des nations », clé de voûte d’un nouvel ordre international reposant sur une diplomatie ouverte et « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. »
Julie Clarini dans un article paru dans le Monde le 2 novembre 2018 : <Les militants anticolonialistes s’invitent à la conférence de paix à Paris> explique le climat intellectuel :
« Conçu pour remettre en ordre une Europe morcelée après l’éclatement des empires, le droit à l’autodétermination des peuples, contenu dans le programme de paix proposé par Woodrow Wilson en janvier 1918, soulève d’immenses espoirs en Asie et en Afrique. Chez beaucoup d’intellectuels issus des colonies et de chefs de mouvements anti-impérialistes, le discours du président américain électrise les aspirations à se débarrasser de la tutelle coloniale.
On rêve alors d’un ordre mondial post-impérial, avant que la restriction du principe wilsonien à la seule Europe n’y mette fin. Et même après cette première déconvenue, on continue de croire que les Etats-Unis vont aider à l’avènement d’une nouvelle ère de relations internationales qui sera marquée par le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Une prolifération de pétitions et de requêtes empruntant la rhétorique du président Wilson atteste de cet espoir.
[…] Les nombreux délégués qui se rencontrent à Paris partagent en effet cette même sensibilité à la dignité et à l’autonomie. Leurs arguments portent d’autant plus que l’Europe s’est décrédibilisée : après leurs dix millions de morts et un déchaînement de brutalité, les pays occidentaux peinent à convaincre encore de leur supériorité en termes de « civilisation ».
Signe de l’importance qu’ils accordent aux débats parisiens, les mouvements, les cercles, les réseaux anticolonialistes cherchent partout et à tout prix à envoyer des émissaires à Paris, même si très peu sont en effet admis à la table des négociations […]
Les miracles attendus à Paris n’ont pas eu lieu. Tout au contraire, les empires français et britannique s’agrandissent au terme de la conférence. Une profonde amertume saisit les militants anti-impérialistes. »
Des figures émergent dès 1919, l’article de la Revue « L’Histoire » : « Tumulte dans les colonies » raconte :
« En juin 1919, un jeune Indochinois qui travaille dans un restaurant à Paris essaie de présenter « Les demandes du peuple d’Annam » au président Woodrow Wilson alors que ce dernier participe à la conférence de la paix. Il n’y parvient pas. Mais l’homme que le monde connaîtra sous le nom de Ho Chi Minh est loin d’être le seul en 1919 qui demande que les principes wilsoniens soient appliqués aux colonies. Ces principes, surtout le droit national à l’autodétermination, avaient été conçus pour réordonner une Europe ravagée par quatre ans de guerre et dont les vieux empires multiethniques (russe, austro-hongrois et ottoman) avaient disparu. Pour bien des nationalistes coloniaux, ils sonnent comme un clairon anti-impérialiste. »
Seulement, le monde colonial n’est pas au centre des préoccupations des puissances rassemblées à Paris en 1919. « Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », est un principe qui mérite de s’appliquer aux « peuples européens ». Nous avons déjà vu que ce principe n’avait pas vocation à s’appliquer aux nations du moyen orient issues du démantèlement de l’Empire Ottoman et encore moins aux peuples de l’Inde et aux peuples africains.
Les pays vainqueurs sont plutôt préoccuper de s’attribuer les colonies de l’Allemagne sous l’égide de la Société des nations et selon le nouveau statut du « mandat ». Et bien sûr les provinces arabes de l’Empire ottoman – Syrie, Palestine et Mésopotamie, mais cela le mot du jour du 19 novembre «La commission King Crane» l’a déjà évoqué […]
Pourtant des mouvements voient le jour un peu partout. En Egypte :
« Le dirigeant nationaliste Saad Zaghloul cherche à plaider la cause d’une Égypte indépendante de la tutelle britannique (établie en 1882) au nom des principes wilsoniens. Son arrestation et sa déportation à Malte en mars 1919 déclenchent une vague de protestations qui, selon les autorités britanniques, recueillent « la sympathie des gens de toutes classes et de toutes croyances » et qui, dans l’historiographie arabe, deviendra « la révolution égyptienne. » Plus de 800 Égyptiens et 60 Britanniques y perdront la vie avant que l’armée britannique ne restaure l’ordre à l’automne de la même année. »
Et bien sûr l’Inde de Gandhi qui est rentré dans son pays de naissance en 1914 et qui va devenir un fervent Wilsoniste :
« En Inde, où les élites indigènes avaient au début de la guerre déclaré leur « loyauté » au Raj (l’Empire britannique des Indes) et où plus de 1 million de soldats s’étaient portés volontaires (dont la majorité se bat et travaille pour l’effort britannique au Moyen-Orient) […]. En décembre 1918, la formation la plus influente, le Congrès national indien, évoque le président américain ainsi que le Premier ministre libéral britannique Lloyd George pour réclamer un régime démocratique et autonome.
[…] en avril 1919, dans la ville d’Amritsar (au Pendjab), le général Dyer commande à ses troupes (indigènes) d’ouvrir le feu sur une manifestation contre la déportation de deux dirigeants nationalistes ; au moins 400 civils non armés sont tués.
Il est vrai qu’en Inde comme en Égypte les Britanniques adoptent, par la suite, une attitude plus conciliante : en 1922, l’Égypte devient « indépendante » tout en restant sous la tutelle britannique ; dans le Raj, certains droits politiques sont octroyés aux Indiens. Mais, dans un cas comme dans l’autre, cet adoucissement relatif ne peut faire oublier la répression : l’intransigeance des nationalistes anticoloniaux en sort renforcée. C’est à partir de ce moment que Mohandas Gandhi prend la direction du Congrès national en opposant une résistance non violente aux Britanniques ; Woodrow Wilson fait désormais partie de ses références. »
La Chine mène aussi un combat singulier :
« Le défi était tout autre pour une Chine qui en théorie était souveraine malgré les « concessions » territoriales accordées aux puissances étrangères au cours du XIXe siècle. En 1915, le Japon impose un traité à la Chine qui devait lui permettre de soumettre entièrement son grand voisin. D’où l’entrée en guerre de la Chine aux côtés des Alliés en 1917, car elle comptait sur une place à la conférence de la paix pour réaffirmer sa souveraineté surtout aux dépens du Japon – espoir conforté par les principes wilsoniens. Or la Chine ne se voit octroyer que le statut de « puissance mineure » à la conférence de la paix à Paris (avec seulement deux représentants contre cinq pour le Japon). […] C’est alors que le 4 mai éclate à Pékin un vaste mouvement nationaliste. […]. Le mouvement du 4 mai restera un épisode clé dans la résistance chinoise à l’ingérence étrangère. C’est à partir de ce moment que de nombreux Chinois s’approprient des idées occidentales, provoquant un débat culturel entre tradition et modernité dont sortira (entre autres choses) le communisme chinois. »
Les Etats-Unis possèdent aussi des colonies : les Philippines et « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » se retourne aussi contre eux quand Manuel L. Quezon (1878-1944), député élu de l’Assemblée des Philippines en 1907 et représentant démocrate des Philippines au Congrès des Etats-Unis depuis 1909, rappelle à M. Wilson que « les Philippins aussi veulent l’indépendance».
Et les pays colonisés vont aussi à la sortie de la guerre disposer d’un allié militaire et d’un appui spirituel prudent. Ainsi en 1919, le Komintern clame depuis Moscou que toutes les nations colonisées sont des nations prolétarisées qu’il faut libérer, tandis que le Saint-Siège amorce la marche vers les décolonisations en demandant aux cadres missionnaires de ne plus se mêler aux affaires coloniales: il faut que l’Eglise puisse rester après la dissolution des empires…
La sortie de la première guerre mondiale ne suffira pas pour donner la liberté aux peuples colonisés, il faudra attendre la seconde guerre mondiale où l’Europe s’abimera une nouvelle fois et perdra toute crédibilité pour donner des leçons de civilisation aux autres peuples : Le moment des indépendances était arrivé.
<1155>
- Recueillir les fruits de leur participation à l’effort de guerre de la puissance coloniale ;
-
Lundi 26 novembre 2018
« Le moment Wilson »Erez ManelaWoodrow Wilson, le président des Etats-Unis en 1918, a joué un rôle considérable dans l’après-guerre et même au-delà jusqu’à après la seconde guerre mondiale où ses successeurs Roosevelt puis Truman ont concrétisé son idée de créer une instance internationale chargée de gérer les conflits entre États et surtout éviter de nouvelles terribles déflagrations comme l’ont été les deux guerres mondiales.
Je dois avouer que pour synthétiser ce propos dans un exergue, j’ai beaucoup hésité.
J’aurais pu utiliser le titre d’un article d’André Fontaine, l’ancien directeur du journal « Le Monde », qu’il a publié dans celui-ci, il y a 20 ans : « Woodrow Wilson, l’idéaliste »
Cet article rappelle qu’il était fils d’un pasteur presbytérien qui avait été aumônier, pendant la guerre de Sécession, dans l’armée sudiste. Car, et nous y reviendrons, ce grand idéaliste était issue d’une famille de sudistes esclavagistes.
Il a été le premier, vingt-cinq ans avant Franklin Roosevelt, à jeter les bases d’un « ordre mondial » dont les Nations unies se veulent être aujourd’hui l’instrument.
Beaucoup pensent que son idéalisme l’a un peu aveuglé et éloigné du pragmatisme et de la rationalité nécessaire pour essayer de faire avancer de manière concrète « les affaires du monde »
Il avait été très marqué par son éducation religieuse, à tel point qu’aux yeux de Clemenceau il se prenait pour le Christ en personne.
<Freud lui a consacré un livre> dans lequel il a dressé un portrait impitoyable. Il prétend que pendant la plus grande partie de sa vie, le Président américain Wilson s’est senti en communication directe avec Dieu, « guidé par une puissance douée d’intelligence qui se trouvait en dehors de lui ». Selon lui, pendant huit ans, les Etats-Unis ont été dirigés par un malade mental, idéaliste pitoyable, menteur instable, dévot aliéné, pire : criminel fanatique
Cet article signale qu’Henry Kissinger condamnait aussi, dans un livre de la fin des années 1990, la vision passablement utopique ce président.
Un autre exergue aurait consisté à opposer « Woodrow Wilson et Lénine » ou encore « Le Wilsonisme et le Léninisme »
On trouve fréquemment mais aussi dans l’article d’André Fontaine cette affirmation de Trotski :
« Lénine et Wilson constituent les antipodes apocalyptiques de notre temps ».
Ce rapprochement parait assez judicieux, Wilson a fait entrer dans la guerre mondiale les États-Unis en 1917 ; alors que parallèlement cette même année Lénine a fait sortir la Russie de ce conflit.
Un autre signe du destin, ils sont tous les deux morts en 1924, à quelques jours d’intervalle le 21 janvier pour le russe et le 3 février pour l’américain.
Et surtout, ils ont été à l’origine de conceptions, de doctrines qui ont conduit leurs deux États respectifs l’Union Soviétique et les États-Unis à devenir hégémoniques, adversaires et s’affronter dans un long moment qu’on a appelé « la guerre froide ».
Jean-Claude Casanova, dans un article de 2004, « Il était une fois la guerre froide » rappelle un livre du même André Fontaine consacré à l’histoire de la guerre froide. Et il écrit :
« Le journaliste Walter Lippman a popularisé l’expression « guerre froide » en 1947. D’autres, comme Georges-Henri Soutou dans La Guerre de cinquante ans, partent de 1943 et de la conférence de Téhéran qui, selon Charles Bohlen, faisait de l’Union soviétique « la seule puissance militaire et politique significative sur le continent européen ».
« Si André Fontaine choisit, lui, pour point de départ, l’année 1917, c’est parce qu’elle voit s’opposer deux conceptions du monde. L’une exprimée par Woodrow Wilson, qui privilégie le libre-échange, le capitalisme, la démocratie et l’organisation internationale. L’autre par Lénine, qui prône la révolution, la terreur, le socialisme dans un seul pays. Wilson a triomphé en 1989 et le léninisme s’est effondré. »
Cyrus Leo Sulzberger, grand reporter au New York Times, avait écrit un livre en 1965 : « Les États-Unis et le Tiers Monde. Une révolution inachevée » dans lequel, il dénonçait le simplisme des conceptions sur lesquelles la politique international de son pays repose. Je ne résiste pas à partager ce constat, bien qu’il n’a rien à voir avec le sujet d’aujourd’hui, qu’il écrivait : « les chiens américains consomment chaque jour plus de protéines que la moitié de la population du globe. »
Mais il a surtout affirmé que le monde de la guerre froide et du tiers monde s’expliquait par la ;
« Triple révolution que symbolisent les noms de Woodrow Wilson pour la politique, Lénine pour l’idéologie et Marconi pour la technique. »
Et, il est sévère pour le premier nommé qui est selon lui « moitié intellectuel moitié charlatan », parce qu’il a fait
« Surgir avec le nationalisme une divinité » plus dangereuse que toutes celles que nous avons connues depuis Moloch ».
Et Lénine, lui-même s’est exprimé sur cette rivalité lors de la présentation de son rapport à l’Internationale Communiste le 19 juillet 1920 :
« Il arrive ainsi que l’Amérique elle-même, le pays le plus riche, auquel sont soumis tous les autres, ne peut ni acheter ni vendre.
Et ce même Keynes, qui a connu les tours et détours des négociations de Versailles, est contraint de reconnaître cette impossibilité, en dépit de sa décision bien arrêtée de défendre le capitalisme et malgré toute sa haine du bolchévisme. Soit dit en passant, je ne pense pas qu’aucun manifeste communiste ou, d’une façon générale, révolutionnaire, puisse jamais égaler, quant à sa vigueur, les pages où Keynes dépeint Wilson et le « wilsonisme » en action. Wilson fut l’idole des petits bourgeois et des pacifistes genre Keynes et certains héros de la II° Internationale (et même de l’Internationale « deux et demie ») qui ont exalté ses « 14 points » et écrit des livres « savants » sur les « racines » de la politique wilsonienne, espérant que Wilson sauverait la « paix sociale », réconcilierait les exploiteurs et les exploités, et réaliserait des réformes sociales.
Keynes a montré avec force comment Wilson a été joué comme un niais, et comment toutes ces illusions s’en sont allées en fumée au premier contact avec la politique pratique, mercantile et affairiste du capital incarné par MM. Clemenceau et Lloyd‑George. Les masses ouvrières voient maintenant de plus en plus clairement par leur expérience vécue, et les pédants savants pourraient le voir à la seule lecture de l’ouvrage de Keynes, que les « racines » de la politique de Wilson plongeaient dans l’obscurantisme clérical, la phraséologie petite‑bourgeoise et l’incompréhension totale de la lutte des classes. »
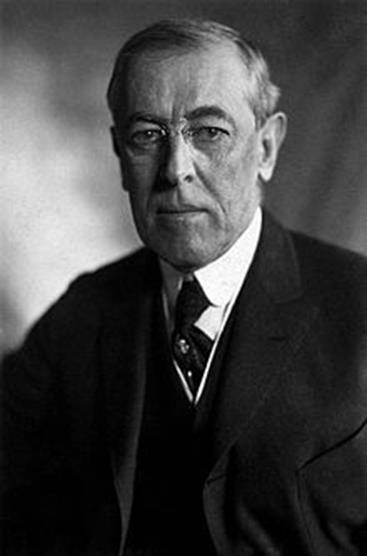 Mais j’ai préféré utilisé le titre du livre d’un historien américain Erez Manela, qui a parlé de « moment wilsonien » – thèse développée dans son ouvrage The Wilsonian Moment (Oxford University Press, 2007, non traduit).
Mais j’ai préféré utilisé le titre du livre d’un historien américain Erez Manela, qui a parlé de « moment wilsonien » – thèse développée dans son ouvrage The Wilsonian Moment (Oxford University Press, 2007, non traduit).
Car il y eut un vrai moment Wilsonien à la sortie de la guerre.
Woodrow Wilson fut élu une première fois Président des États-Unis en 1912, grâce à un concours de circonstance assez exceptionnel. Le président sortant républicain William Howard Taft et qui a obtenu l’investiture du Parti Républicain doit faire face à une dissidence de son propre parti, Théodore Roosevelt qui avait été Président des États-Unis juste avant Taft, n’accepte pas cette investiture et fonde son propre Parti progressiste. Woodrow Wilson est élu grâce à la division au sein du Parti républicain ; le total des votes de Taft et de Roosevelt est en effet supérieur à celui obtenu par Wilson.
Et en 1916, il est réélu sur un programme pacifiste et un slogan:
« Grâce à moi, l’Amérique est restée en dehors du conflit européen ».
Mais le 19 mars 1917, un nouveau torpillage d’un sous-marin allemand du paquebot Vigilentia (après celui en 1915 du Lusitania contre lequel les États-Unis avaient vigoureusement protesté), le pousse à changer de stratégie et de demander au Congrès d’accepter une déclaration de guerre des États-Unis contre l’Allemagne. Et le 6 avril 1917, le pays s’engage dans la Première Guerre mondiale.
Sur ces bases et probablement en raison de son « coté idéaliste » déjà souligné, le 8 janvier 1918, Wilson prononce son célèbre discours au Congrès dans lequel, il développe la liste des 14 points nécessaires à l’obtention de la paix. « The world must be made safe for democracy » (La paix dans le monde pour l’établissement de la démocratie). Il réclame notamment la création d’une « League of Nations » (SDN). Les autres points serviront de base au traité de Versailles de 1919. La première partie du traité de Versailles crée d’ailleurs la SDN.
C’est encore Georges Clemenceau qui en prenant connaissance de ce programme en quatorze points aurait dit :
« Le bon Dieu n’en avait que dix ! »
L’article de la revue « L’Histoire » : La SDN : Un immense désir de paix raconte l’accueil triomphal de Woodrow Wilson en Europe. Et c’est une première ! Lorsque le 4 décembre 1918, Wilson embarque pour la France afin d’assister à la Conférence de paix de Paris, c’est la première fois qu’un président américain en exercice se rend dans un pays étranger durant son mandat :
« L’accueil triomphal qu’il reçoit sur le continent, notamment cet « immense cri d’amour », pour reprendre la formule du Petit Parisien, que lui adresse la foule des Parisiens venue l’acclamer le 14 décembre, conforte sa volonté de « toucher les peuples d’Europe par-dessus la tête de leurs chefs » et de vaincre les réticences que ses projets inspirent aux dirigeants européens. […]
Le président américain cristallise alors autour de sa figure quasi messianique de libérateur et d’apôtre de la paix une aspiration générale à la paix durable, que l’opinion attend fébrilement comme la rançon de cette « guerre pour tuer la guerre ». Comme l’écrit le 14 décembre 1918 L’Homme Libre, le journal fondé par Clemenceau, « la guerre, pour [Wilson] comme pour les démocraties de l’Entente, n’est point un but. Pas même la victoire. Le but, c’est la Paix. Le but, c’est la sécurité de l’avenir du monde. […]. Paix juste. Paix humaine. Paix durable. Paix des peuples. Voilà ce que le monde attend des victorieux ». Nul doute que, dans l’esprit des contemporains, cette paix ne résulte d’abord d’un traitement sévère de l’Allemagne. Toutefois, pour une bonne partie de l’opinion, du centre à la gauche de l’échiquier politique, elle doit aussi passer par la création d’institutions multilatérales garantissant la stabilité du système international sur le long terme. »
L’idée de créer une organisation internationale des nations était antérieure à Wilson mais c’est bien lui qui força les vainqueurs a accepté ce point de vue :
« Toutefois, sous l’influence déterminante de Wilson, la question de la SDN a constitué le premier sujet débattu par la conférence de la paix à Versailles. Il prit d’ailleurs personnellement en charge la présidence de la Commission de la Société des nations, secondé par son fidèle conseiller, le colonel House, alors que les chefs des gouvernements britannique et français refusèrent de s’y impliquer directement, Clemenceau préférant y déléguer Léon Bourgeois et le professeur Larnaude, doyen de la faculté de droit de Paris.
Ainsi, la Commission se réunit quasi quotidiennement dans la suite du Colonel House à l’hôtel Crillon et elle avança très rapidement, les Britanniques et les Américains ayant combiné leurs points de vue dans un texte qui servit de base aux discussions. En une dizaine de jours seulement, on aboutit à un premier projet de pacte de la Société des nations, que Wilson présenta le 14 février 1919 au cours d’une séance plénière de la conférence de la paix. « Le rêve magnifique devient réalité », titra dès le lendemain Le Petit Parisien. »
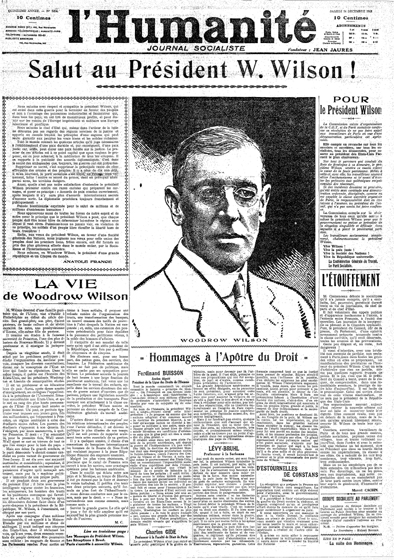
Mais la Société des nations, inventée par Wilson et à laquelle Clemenceau ne croyait guère, sera rapidement sans moyen d’action. Dès mars 1920, le Sénat américain a refusé la ratification du traité, et donc les Etats-Unis ne siègent pas à la Société des Nations .
Le Japon, membre permanent du Conseil, se retira en 1933 après que la SDN eut exprimé son opposition à la conquête de la Mandchourie par le Japon. L’Italie, également membre permanent du Conseil, s’est retirée en 1937. La Société avait accepté l’Allemagne en 1926, la considérant pays « ami de la paix », mais Adolf Hitler l’en fit sortir quand il arriva au pouvoir en 1933.
L’Union soviétique fut exclue de la Société le 14 décembre 1939, cinq ans après son adhésion le 18 septembre 1934.
Une Organisation sans les Etats-Unis, l’Union Soviétique, l’Allemagne, le Japon, l’Italie n’a plus les moyens d’organiser la paix dans le monde
« L’effondrement du wilsonisme est presque contemporain au projet lui-même » estime Bruno Cabanes, « c’est ce qu’avait montré le livre de Erez Manela, The Wilsonian moment (Oxford University, 2007) qui montre l’extraordinaire fascination que le président des États-Unis n’exerce pas seulement en Europe mais aussi un peu partout dans le monde, en Égypte, en Chine ». « Ce rêve s’écroule très vite avec la conférence de Paris et la non-ratification de la Société des Nations par les États-Unis, ajoute-t-il, l’échec du wilsonisme est l’échec d’une tentative de recomposition internationale, mais aussi l’échec d’une vision presque religieuse de la politique, au-delà de la mission qui incomberait aux États-Unis
Et aujourd’hui il n’existe plus guère de défenseur de Woodrow Wilson, surtout aux Etats-Unis.
Dans un article du Monde de 2015 « L’Amérique déboulonne ses symboles », on apprend même que le passé esclavagiste de Woodrow Wilson le rattrape aujourd’hui :
« Jusqu’à présent, les livres d’histoire associaient surtout le vingt-huitième président des Etats-Unis, Woodrow Wilson, à la création de la Société des nations, suggérée dans les quatorze points de son discours mémorable tenu en janvier 1918 devant le Congrès américain. C’est pourtant ce personnage, lauréat du prix Nobel de la paix en 1919, qu’un groupe d’étudiants de la prestigieuse université de Princeton (New Jersey) veut faire sortir de ses murs. Outrés par le racisme avéré de celui qui fut aussi président du campus au début du XXe siècle, ces étudiants demandent que son nom soit effacé des mémoires et que le département des affaires internationales, nommé en son honneur, soit débaptisé.
L’affaire ne relève pas d’un simple caprice, frappé d’idéalisme ou de « politiquement correct ». Un récent éditorial du New York Times est venu soutenir cette démarche. Le journal demandait doctement que l’administration de l’université reconnaisse « l’héritage toxique du président » en matière de ségrégation et de discriminations envers les Afro-Américains et fasse droit aux étudiants. »
Pourtant personne ne peut nier que si l’ONU existe aujourd’hui, Woodrow Wilson n’y est pas pour peu.
<1154>
-
Vendredi 23 novembre 2018
« Le tueur que l’on n’attendait pas »Claude Quétel, Revue l’Histoire, Juillet/Août 2018Ce fut une pandémie épouvantable.
Entre 25 et 40 millions de personnes sont mortes d’avril 1918 au printemps 1919, davantage de victimes que celles causées par la Grande Guerre. Ces chiffres sont très contestées aujourd’hui qui situe plutôt la fourchette, au niveau mondial, entre 50 et 100 millions de victimes.
On l’a appelé la grippe espagnole.
<Cette étude> qui est à la fois biologique et historique, explique que cette grippe n’a rien d’espagnole. Cette désignation vient de la neutralité de l’Espagne où les journaux sans censure relataient abondamment les soubresauts de la pandémie, au milieu du silence contraint des belligérants. Les journaux français parlaient donc de la grippe espagnole qui faisait des ravages en Espagne. Les faits historiques semblent localiser les premiers cas graves dans le Kansas. Car si aujourd’hui on pense que l’origine de la maladie se situerait en Chine, c’est aux Etats-Unis qu’a eu lieu la mutation du virus H1N1 qui l’a rendu si virulent et dangereux. <Ce site> donne des précisions sur ce point.
C’est encore un article de la Revue « L’Histoire » écrit par Claude Quétel directeur de recherche honoraire au CNRS qui donne une description d’ensemble de ce nouveau fléau qui a touché le monde après la première guerre mondiale.
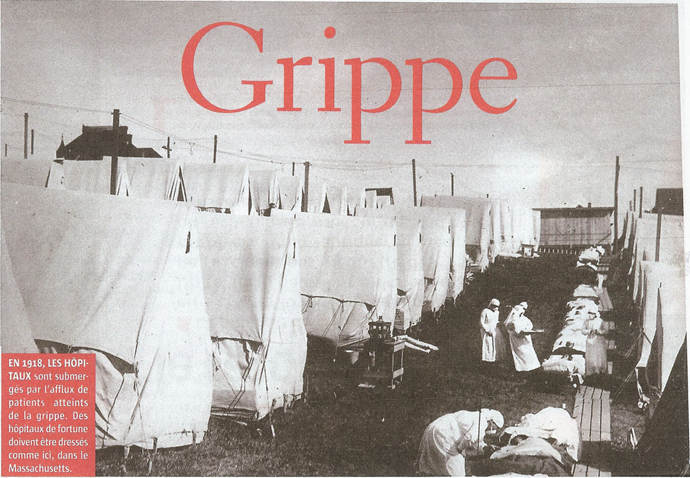 Il y a d’abord le contexte du démarrage et qui se situe bien dans le Kansas :
Il y a d’abord le contexte du démarrage et qui se situe bien dans le Kansas :
« Printemps 1918. La Grande Guerre dure depuis bientôt quatre ans. On n’en peut plus à force de tueries. A ceux qui depuis la fin de 1917 lui reprochent sa circonspection, Pétain répond qu’il attend « les Américains et les tanks ». Oui, mais les soldats américains du corps expéditionnaire, les doughboys (1) qui arrivent en fanfare dans les ports français de l’Atlantique au rythme de 200 000 par mois à partir d’avril 1918, ont la grippe.
A la veille de son entrée en guerre, l’armée des Etats-Unis ne comptait que 200 000 hommes. Elle en mobilise 4 millions. Des camps de transit ont été établis à la hâte dans d’exécrables conditions d’hygiène. Rien n’est prévu et il faut tout improviser. Le camp de Fuston, dans le Kansas, entasse 56 000 recrues. Les premiers cas de grippe y surviennent en mars 1918. On dénombre 1100 cas dont 237 avec complications pulmonaires. D’autres camps sont atteints ainsi que très vite la population alentour et les grands ports d’embarquement pour l’Europe. »
- Ils sont aussi appelés « Doughboys ». Cette appellation remonte à la guerre de Sécession. Elle vient de ce que les vareuses des soldats de cette époque portaient des boutons assimilables à des beignets (en anglais « doughnut »).
Et lorsque les doughboys débarquent en Europe, les évènements s’enchaînent :
« En juin-juillet 10% des soldats britanniques (200 000) sont grippés, Il en va de même chez les Allemands, au point que Ludendorff en fera plus tard l’une des causes de l’échec de ses offensives de printemps. Les épisodes sont cependant bénins et de courte durée, avec très peu de décès. […].
D’avril à juin, la grippe gagne la population civile de toute l’Europe. Faisant toujours figure d’une épidémie bénigne, elle se distingue néanmoins par l’extraordinaire rapidité de sa contagion et le fait qu’elle frappe dans une proportion importante (40 %) une nouvelle classe d’âge, entre 20 et 35 ans. L’épidémie semble disparaître au milieu de l’été au point d’être déclarée close par les autorités militaires américaines. En réalité, elle est toujours là, gagnant en sévérité ce qu’elle paraît avoir perdu en nombre de cas. Elle sévit notamment dans les équipages des navires. A la fin d’août, le croiseur HMS Africa qui relâche à Freetown (Sierra Leone) y débarque 51 morts de pneumonie hémorragique (7 % de son équipage). […]
On parle de « grippe maligne » car elle tue de plus en plus, à Brest et à Saint-Nazaire, dans les régiments au front, dans un village. Il se passe quelque chose mais qui a peur de la grippe ? Et puis, la Grande Guerre continue à tenir le devant de la scène, poursuivant sa moisson de vies. La grippe a retraversé l’Atlantique et cette fois elle tue. En septembre 1918, 45 000 soldats s’entassent à Camp Devens (Massachusetts). Au 1er du mois, quatre soldats y sont hospitalisés pour pneumonie. Ils sont 1 543 huit jours plus tard et bientôt 6 000, allongés sur des civières jusque dans les couloirs. A une incubation extrêmement courte et aux symptômes classiques de la grippe s’ajoutent très souvent la congestion pulmonaire, la pneumonie, la pleurésie. Le visage et les extrémités sont cyanosés (de couleur bleu noirâtre). La mort survient très rapidement dans un tableau effrayant de dyspnée (le malade respire de plus en plus mal) puis d’asphyxie. On pense avoir affaire à une nouvelle maladie et on parlera alors de « peste pulmonaire ».
La population civile est touchée à son tour, toujours en commençant par les ports puis en suivant les voies ferrées. L’incompréhension et l’inconséquence règnent, comme à Philadelphie où la municipalité n’entend pas annuler une grande parade prévue le 28 septembre en faveur de l’effort de guerre. L’argument classique qui est opposé aux « alarmistes » est qu’il ne faut pas provoquer de mouvement de panique dans la population. Le grand jour arrive. Des centaines de milliers de personnes s’agglutinent au long des boulevards pour voir passer le défilé. Deux jours plus tard, les hôpitaux s’emplissent. On dénombre déjà 117 morts le 1er octobre, mais 2 635 le 12 et 4 597 le 19. On a fermé les lieux publics (sauf les bars !) et interdit les rassemblements, mais trop tard. Tout le pays est frappé en seulement quinze jours. On est au bord du chaos, avec un taux de mortalité multiplié par dix.
Le tableau est tout aussi dramatique en Europe, à l’automne, pour les soldats américains comme pour les poilus et les tommies sans oublier les Allemands. La promiscuité des tranchées fait des ravages. Les grippés sont évacués vers l’arrière quand c’est possible mais c’est pour les voir alors grelottant de fièvre, trimballés pendant des jours d’une gare à l’autre, contribuant ainsi à propager la maladie meurtrière ; 402 000 cas de grippe vont être recensés par l’ensemble des services de santé dont 30 382 décès. […]
Dans les grandes villes, les enterrements font problème. Les morts encombrent les morgues et l’on manque de cercueils. A Lyon, les convois funéraires sont supprimés et les cérémonies religieuses se font directement dans les cimetières. A Caen, des prisonniers de guerre allemands sont réquisitionnés pour creuser les fosses. »
Il semblerait qu’après la grande guerre qui a tellement marqué les esprits, le terme de « grippe » restait dans l’esprit des gens une maladie banale, ce qui a eu pour effet de ne pas inquiéter la population et surtout l’a empêché de se rendre compte du fait qu’il s’agissait d’une redoutable tueuse, plus efficace dans sa basse besogne que la guerre elle-même. Ainsi :
« A aucun moment les transports en commun, principal vecteur de la contagion, ne sont interrompus. Il n’est pas question non plus de fermer les usines, ni d’ailleurs les cafés. »
Et même l’Académie de médecine est d’une cécité rare :
« il ne s’agit ni de choléra, ni de peste, ni de typhus ».
Seule l’Espagne voit ministre de l’Intérieur signaler :
« la gravité de l’épidémie régnante ».
On sait que c’est parce que les espagnols ont simplement communiqué et constaté la gravité de cette maladie qu’on l’a appelé « la grippe espagnole »
Et cette pandémie va faire le tour du monde :
« Par les voies maritimes, la grippe espagnole débarque en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Ensuite elle prend le train ou remonte les fleuves. A la fin de janvier 1919, elle a pratiquement contaminé toute la planète, en tuant à qui mieux mieux. C’est l’Asie qui connaît la plus grande hécatombe, avec notamment 4 à 9,5 millions de morts en Chine. En Inde, la grippe multiplie par deux un taux de mortalité pourtant très haut d’ordinaire en provoquant la disparition de 12,5 à 20 millions de personnes. Pour être abominablement élevés, de tels nombres auraient tendance aujourd’hui à être revus à la hausse. »
Cette pandémie conduira à créer « Le Comité d’hygiène de la Société des Nations » (SDN), ancêtre de l’OMS. Elle stimulera aussi la recherche :
« L’épouvantable pandémie de 1918 va cependant stimuler de nouvelles recherches sur l’agent pathogène de la grippe. Jusqu’alors, la doctrine médicale désignait le bacille de Pfeiffer, isolé lors de l’épidémie précédente en 1892, mais nombreuses sont les voix qui en font désormais un « microbe de sortie », à l’exemple des pneumocoques et autres streptocoques, agents des complications secondaires de la grippe. On soupçonne alors un « virus filtrant », un microbe assez petit pour passer à travers les filtres de kaolin et se soustraire ainsi à la vue du microscope. Encore faut-il l’attraper.
En 1933, des chercheurs britanniques mettent en évidence l’existence d’un virus filtrable. La voie est ouverte aux cultures et aux vaccins mais le chemin est encore long et c’est une tout autre histoire, très médicale, qui va aboutir à l’identification du virus H1N1. »
L’article de la revue « L’Histoire » m’a aussi appris une information qui du point de vue de la connaissance de la maladie est certainement très intéressante. Mais du point de vue des perspectives qui pourraient découler de la fuite accidentelle ou volontaire du virus ressuscité du laboratoire où il est enfermé, apparaît moins réjouissant :
« Des chercheurs avaient entrepris de se lancer à la poursuite d’un virus de la grippe espagnole sur le terrain. En 1950, un microbiologiste avait émis l’idée folle d’aller récupérer le virus disparu de la grippe de 1918 en exhumant une de ses victimes dans le permafrost du Grand Nord. Une première expédition échoue en 1951 en Alaska, puis une seconde dans le Spitzberg en 1997. Pas de virus dans les cadavres. C’est aussi en 1997 que Jeffery Taubenberger, dans un coin perdu de l’Alaska où la grippe espagnole avait tué presque tout le monde, exhume du permafrost un cadavre providentiel, une jeune femme inuit que son obésité a protégée de la décomposition. Dans les poumons de celle qu’on va appeler Lucy (par hommage à l’autre, l’australopithèque découverte en 1974), se trouvent des fragments du virus de 1918.
En fait, il faudra quatre autres cadavres (aux tissus pulmonaires conservés dans des blocs de paraffine) pour que Taubenberger puisse séquencer en totalité, gène par gène, le virus de la grippe espagnole. Quelques années plus tard, Terrence Tumpey, chercheur du National Center for Immunization and Respiratory Diseases, réalise la synthèse complète du virus disparu de 1918.
Testé dans un laboratoire de haute sécurité, celui-ci se révèle effectivement extrêmement virulent.
Depuis, le virus ressuscité est conservé dans un laboratoire militaire sous haute surveillance. »
Ma tante Pauline, la sœur que mon père, né en 1919, ne connut jamais est morte de la grippe espagnole le 20 novembre 1918, 9 jours après l’armistice, elle avait 10 ans.
Probablement que dans votre famille aussi certains furent touchés par cette tueuse.
Elle tua des personnes célèbres :
- Guillaume Apollinaire
- Edmond Rostand
- Max Weber
- Mark Sykes (des accords Sykes-Picot)
- Egon Schiele
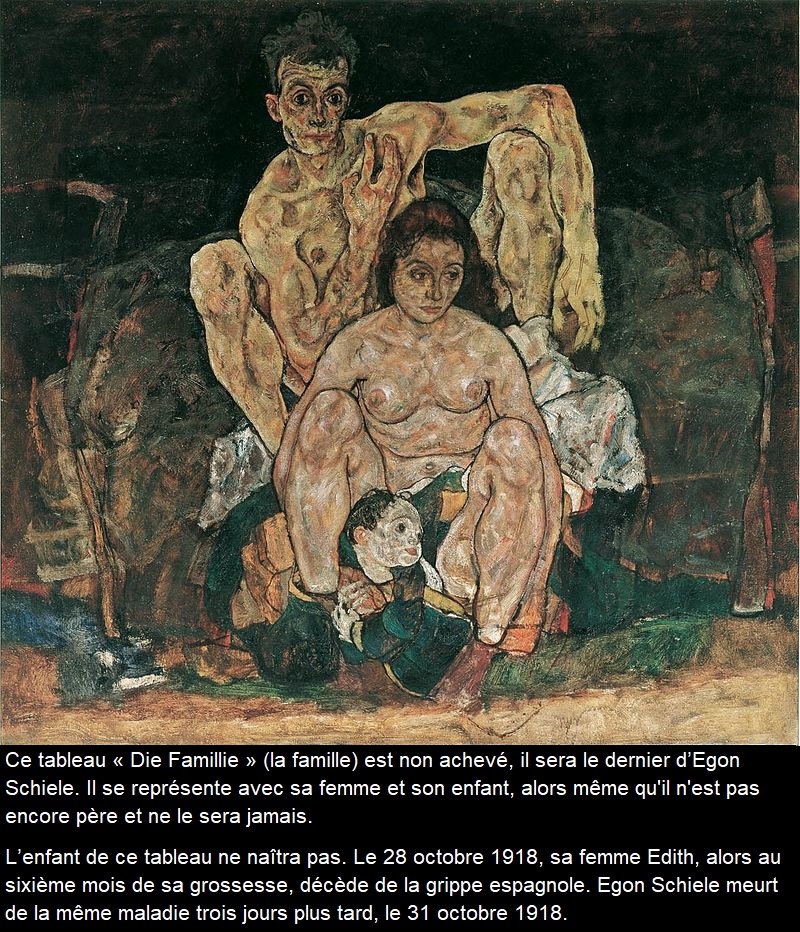
En conclusion je citerai l’étude déjà évoquée en début d’article :
« La pandémie de « grippe espagnole » est une catastrophe sans précédent, qui marquera durablement les esprits. Le premier bilan, dressé en 1927, estime à 21 millions le nombre de décès, pour une population mondiale de 1,8 milliard d’habitants à cette époque. Toutefois, en Inde seulement, on estime à 21 millions le nombre de morts, ce qui conforte les évaluations supérieures à 50 millions de victimes. Vu l’absence de données épidémiologiques dans des pays comme la Chine, il pourrait exister une forte sous-estimation du nombre de cas dans de nombreux pays du tiers-monde. En 1942, le virologue australien Macfarlane Burnet estime ce nombre entre 50 et 100 millions. Quelles que soient les estimations, il fait peu de doute que la mortalité a été considérable. La mortalité globale aurait été de 5 % de la population mondiale »
<1153>
- Ils sont aussi appelés « Doughboys ». Cette appellation remonte à la guerre de Sécession. Elle vient de ce que les vareuses des soldats de cette époque portaient des boutons assimilables à des beignets (en anglais « doughnut »).
-
Jeudi 22 novembre 2018
« Camps de concentration français dans la 1e guerre mondiale »Jean-Claude Farcy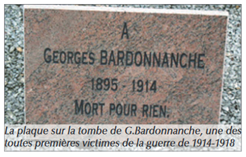 Quand nous cherchons un peu, nous avons tous, dans nos familles par le témoignage de nos ainés, des souvenirs qui nous lient avec la grande guerre.
Quand nous cherchons un peu, nous avons tous, dans nos familles par le témoignage de nos ainés, des souvenirs qui nous lient avec la grande guerre.
Mon ami Gérald qui a des liens familiaux anciens avec la commune de Crest dans la Drôme, m’a apporté un article du journal de la commune : « Le Crestois », dans lequel il m’a montré cette photo d’une tombe du cimetière de la commune.
Cet article que vous trouverez derrière ce lien : « Un explorateur de cimetière » est consacré à un professeur d’Histoire géographie qui étudie les lieux de repos des humains et qui est tombé sur cette plaque tombale. Si vous lisez l’article, vous comprendrez pourquoi la famille de ce soldat tombé de septembre 1914 a cru juste d’écrire « mort pour rien ».
Hier j’ai évoqué les expositions et le livre consacrés aux « Images interdites de la grande guerre ». Après avoir vu l’article du journal Crestois montré par Gérald, j’étais allé chercher ce livre à la Bibliothèque.
J’ai ouvert le livre au hasard.
Et je suis tombé sur cette photo
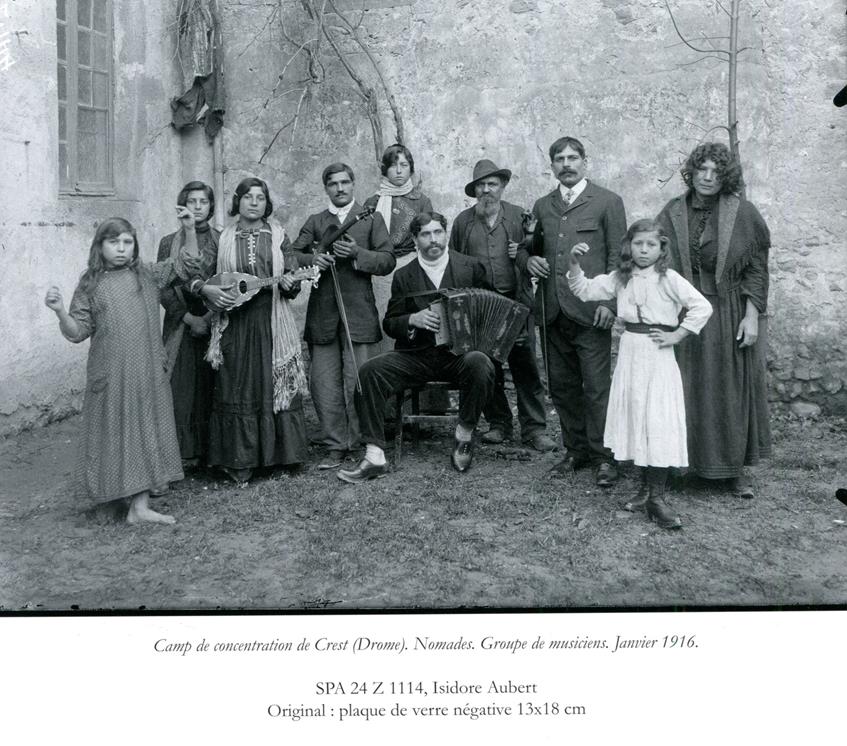
Vous lisez comme moi « Camp de concentration de Crest ». Il y eut donc des « camps de concentration » pendant la première guerre mondiale. Bien sûr, ils n’ont rien à voir avec les camps de concentration nazis, mais c’était le terme consacré et utilisé en 14-18. Aujourd’hui, les historiens préfèrent parler de « camp d’internement », Auschwitz, Treblinka et Dachau sont dans les mémoires depuis !
Une fois que l’on sait, on peut chercher et trouver.
Sur un site consacré aux Nomades de France, on trouve une page concernant le « Camp de concentration de Crest ». Nomades, car ce camp a surtout été lieu d’internement de tziganes venant l’Alsace-Lorraine.
Cette page nous apprend : qu’
« Entre 1914 et 1919 la France se couvre de 74 camps dans le Sud-Ouest, l’Est et le Massif Central principalement, parmi lesquels 13 dépôts pour Alsaciens-Lorrains, dont 5 dépôts surveillés (c’est-à-dire où l’on est privé de liberté, dont Crest). L’internement n’épargne pas les femmes et les enfants, pourtant, non mobilisables… »
J’ai aussi trouvé cette page : « Mémoire vive : les camps d’ incarcération de Crest » qui élargit le propos à la seconde guerre mondiale. Les autorités se sont toujours méfiés des nomades qui en voyageant peuvent voir des choses qu’il ne faut pas, entendre des informations qu’il ne faut pas divulguer et avoir tout simplement des aptitudes à l’espionnage…
S’agissant d’alsaciens, la Revue d’Alsace a consacré un article à un livre d’un historien, maître de conférences à l’université de Bordeaux I et spécialiste de l’histoire des Tsiganes, Emmanuel Filhol « Un camp de concentration français. Les Tsiganes alsaciens-lorrains à Crest, 1915-1919 ». Dans cet article nous pouvons lire :
« A partir d’août 1914, le gouvernement français, sous prétexte que les nomades, au même titre que les populations étrangères originaires des pays ennemis, étaient susceptibles de nuire en tant qu’espions à la Défense Nationale, se donna les moyens de les expulser de la zone des armées. Arrêtés dans les premiers mois de la guerre dans les parties de l’Alsace-Lorraine libérées, les Tziganes furent dirigés vers des centres de triage, puis internés dans des camps implantés dans le Midi (Brignoles, Saint-Maximin), avant d’être regroupés dans le « dépôt surveillé des Alsaciens-Lorrains romanichels de Crest » (Drôme). Le lieu d’internement est un ancien couvent de Capucins laissé à l’abandon, où les Tsiganes furent d’ailleurs précédés par des Alsaciens-Lorrains originaires des arrondissements d’Altkirch et de Thann qui y reçurent un bon accueil […] L’effectif total du camp varia entre 110 et 180, dont la moitié d’enfants. Les conditions de logement et d’hygiène y étaient déplorables. La vie des Tsiganes internés était une existence sous surveillance. Les règles cœrcitives, avec punitions infligées, sorties réglementées et visites refusées, pesèrent douloureusement sur ces populations habituées aux grands espaces et à la mobilité. […] La vie au dépôt de Crest était vécue comme un enfermement sans espoir. Elle perdura jusqu’en juin 1919. »
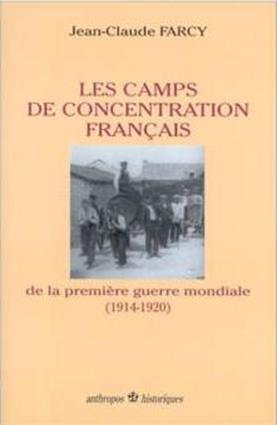 Mais, il semble que l’Historien qui a le plus complétement étudié la réalité des camps d’internement soit Jean-Claude Farcy. Le livre qui est le fruit de ses recherches a été publié en 1995. Il est toujours disponible, par exemple sur ce site.
Mais, il semble que l’Historien qui a le plus complétement étudié la réalité des camps d’internement soit Jean-Claude Farcy. Le livre qui est le fruit de ses recherches a été publié en 1995. Il est toujours disponible, par exemple sur ce site.
La revue Trames a publié <un long entretien> avec l’auteur en 1996.
Cette revue constate aussi que jusqu’à la publication de cet ouvrage, la réalité des camps d’internement de civils étrangers et de suspects pendant le premier conflit mondial étaient presque totalement ignorés. Le journaliste pose alors la question des raisons du silence des spécialistes de la Grande Guerre mais aussi du mutisme des historiens du pénal et de l’immigration.
Jean-Claude FARCY répond de la manière suivante :
« Il est difficile de donner une réponse simple à ce « mutisme » des historiens. On peut seulement avancer quelques hypothèses.
Les spécialistes de la Première Guerre mondiale sont devant un champ historique immense qu’ils ont d’abord exploré sur le plan militaire, avant d’en venir plus tard aux aspects économiques, sociaux et à l’étude des mentalités. L’analyse des « résistances » à la guerre, bien connue pour ce qui est des mouvements syndicalistes et socialistes, est à peine abordée, les dossiers de justice militaire ne donnant que depuis peu des études novatrices. Au sein des élites et dans la mémoire collective cette guerre a été pendant longtemps justifiée comme étant celle du droit, ce qui n’incitait pas précisément à traiter cette question des camps de concentration.
Les historiens du pénal en restent à ce qui est strictement « judiciaire » : les peines, alors que l’internement est une décision purement administrative. Les archives elles-mêmes ne sont pas toujours rangées directement dans les « fonds pénitentiaires ». […] On peut ajouter que, à l’époque, l’internement a été dans l’ensemble largement accepté par l’opinion (quand il visait des étrangers de nationalité ennemie et les repris de justice) et n’a jamais été à la source d’incidents, de révoltes ayant une ampleur nationale. L’absence d’études reflète aussi… le silence des victimes. »
Ces internements ne s’appuyaient pas sur des textes de loi et comme cela est écrit il ne s’agissait pas de décisions de justice mais bien de décisions administratives, exactement le contraire de l’état de droit.
« L’internement des civils – étrangers ou Français – pendant la guerre a toujours mis en difficulté les autorités quand il s’est agi d’en donner une justification légale. À plusieurs reprises le ministère de la Justice tient d’ailleurs à dégager toute sa responsabilité en la matière et l’on voit des procureurs refuser de poursuivre des évadés de camps arguant du fait qu’ils n’étaient pas détenus en vertu d’un mandat légal.
[…] Finalement le Conseil d’État « légalisera » la pratique : elle relève de l’exercice du pouvoir gouvernemental qui, étant chargé de veiller à la sécurité du territoire et d’assurer la défense nationale, peut prendre en temps de guerre toutes les mesures de police utiles à cet effet. […] Il n’y a donc pas de base légale à l’internement et comment imaginer – dans le contexte de la République démocratique, de la France terre des libertés… pour reprendre les expressions des internés protestataires qui se font fort d’avoir quelques notions d’histoire et de droit…- que des dispositions législatives aient pu être adoptées en la matière ? »
Il semble que les autorités françaises ne se méfiaient pas seulement des nomades mais aussi des civils Alsaciens Lorrains :
[Les Alsaciens Lorrains] qui n’avaient pas opté pour la France en 1871 et qui se trouvent sur le territoire français – soit qu’ils y séjournaient avant-guerre, soit qu’ils aient été « libérés » lors des premières offensives en Alsace et « évacués » de leurs domiciles sous le prétexte d’éviter d’éventuelles représailles en cas de reconquête allemande – sont dans les premiers mois de la guerre internés, dans l’attente de vérifier leurs « sentiments nationaux ». Il s’agit évidemment d’écarter toute possibilité d’espionnage et d’isoler parmi eux les « immigrants allemands » installés récemment en Alsace et supposés a priori dangereux. Cela concerne aussi bien les femmes que les hommes. La grande majorité, après avoir donné des garanties de domicile et de travail, est pourvue d’une « carte tricolore » qui assure une liberté complète. Une minorité reconnue allemande va dans les camps de mobilisables allemands. Une autre minorité, constituée d’Alsaciens ayant tenu des propos hostiles à la France ou ayant un casier judiciaire chargé, est considérée comme suspecte et placée dans des camps d’Alsaciens Lorrains, l’intention étant de pouvoir à terme les rallier à la cause de la France en les séparant des autres nationalités, ce qui d’ailleurs sera un échec, ces dépôts finissant par être, au début de 1917, assimilés aux dépôts d’Austro allemands.[…]
Il est probable – c’est l’hypothèse que nous avons formulée – que cet internement, au moins temporaire pour la majorité, de quelques 8000 Alsaciens a laissé des traces dans l’opinion de cette province et a pu donner des arguments au mouvement autonomiste qui se développe entre les deux guerres. Ce n’est pas pour rien que le gouvernement français met sur pied en 1927 une politique d’indemnisation, reconnaissant ainsi les torts de la France pendant la guerre. Mais il reste à vérifier concrètement – dans la littérature autonomiste notamment – cette hypothèse.
Bien sûr tout ressortissant issu d’un pays qui se trouve dans le camp de l’ennemi est forcément suspect mais avec des nuances :
« Internés au début comme les Autrichiens, les ressortissants des minorités de l’Empire austro-hongrois bénéficient assez vite d’un régime de faveur sous réserve que leurs sentiments « francophiles » soient au préalable vérifiés, ce qui explique le séjour des Polonais, Tchèques et autres Slaves au moins pendant plusieurs mois dans les camps. Des permis de séjour leur sont accordés quand ils offrent les garanties nécessaires pour avoir du travail. Ceux qui ne peuvent en obtenir ou restent soupçonnés d’être hostiles à la France restent dans les camps mais sont progressivement séparés des Allemands et Autrichiens et mis dans des dépôts dits de « faveur », réservés justement aux « francophiles ».
Ces camps hébergèrent aussi des civils français considérés comme suspects ou indésirables (prostituées par exemple) dans la zone des armées et :
« Tout ce qui entrave la défense nationale devient indésirable et suspect. […] l’envoi dans le camp sert de substitut à la relégation pour « purger » Paris d’une population marginale. Mais le lien est étroit avec la finalité militaire, si l’on veut bien prendre cette notion au sens large : tout ce qui est susceptible d’entraver la défense nationale peut être sanctionné de cette façon. […] les socialistes Russes sont internés nettement pour des motifs plus directement politiques. Il y a en germe, dans les camps de la première guerre, une forme de répression politique, mais dans l’ensemble, leur finalité est quand même d’ordre militaire. »
Les chiffres officiels sont les suivants :
« Le nombre de camps a varié, certains n’ont existé qu’en 1914. À défaut de données issues d’archives centrales, on ne peut utiliser que des listes datées de la fin 1915 ou du début 1917. En ne tenant pas compte des « dépôts libres » d’Alsaciens Lorrains, on peut estimer à entre 60 et 70 le nombre de dépôts d’internés ayant existé sur le territoire français, Algérie comprise. Le nombre total d’internés est encore plus délicat à mesurer. En termes de flux, puisqu’il y a des entrées tout au long de la guerre, mais aussi des libérations nombreuses, il est plausible d’avancer une fourchette de 60 000 à 70 000 personnes ayant à un moment ou à un autre de la guerre fait connaissance avec les camps français. En termes d’effectifs, le maximum est naturellement atteint à l’automne 1914. Au début de 1918, il n’y aurait plus que 12 000 civils Austro Allemands internés en France, chiffre sensiblement égal à celui des Français internés dans les camps d’Allemagne. »
Ces camps furent aussi l’objet de clivages soit pour des raisons de fortunes soit pour des raisons de nationalité
« ce qui frappe c’est le problème posé par les différences de classe parmi les internés. Alors qu’on attendrait de la part de ces victimes, une certaine solidarité, on a parfois l’impression d’une société en réduction, avec ses riches et ses pauvres. Les premiers s’ils n’accèdent pas au « camp de notables », s’arrangent toujours pour ne pas faire les corvées, payant au besoin les seconds pour cela. Les uns n’ont pas besoin de travailler, reçoivent des colis abondants, s’aménagent des lits « luxueux », ont toujours de quoi acheter à la cantine. Les autres doivent compter sur les secours mensuels en argent envoyés par leurs gouvernements et distribués sous l’égide de « comité de secours » bien souvent constitués de notables.
[…] Parmi les « Ottomans » s’opposent vivement les nationalistes « Jeunes Turcs » et les Arméniens, Grecs, Juifs et Syriens favorables à la France.
On a reproché à Jean-Claude Farcy d’avoir conservé le terme de l’époque « camps de concentration », alors que depuis 1945 il recouvre une réalité plus terrible.
Dans ce témoignage il apparaît cependant que s’il n’y avait pas de politique d’extermination, les conditions de vie étaient si dures qu’on y mourrait de faim :
« C’est dans un tel camp, à Angers, que fut internée la famille Wrzesinski, et c’est dans ce même camp que naquit, le 12 février 1917, leur troisième enfant, Joseph. Dans un entretien accordé en 1982 à l’hebdomadaire italien Gente, le père Joseph Wresinski se confiait de la sorte : « Je vais vous raconter quelque chose qui vous permettra de mieux comprendre pourquoi j’ai déclaré la guerre à la misère. Dans le camp où nous étions internés, la faim et la misère étaient telles que ma mère ne put allaiter sa fille la plus jeune et elle la vit mourir de faim entre ses bras. Ce n’est pas une histoire tirée de Victor Hugo, c’est notre vie. L’état de prostration dans lequel nous dûmes subir les années de guerre fut tel que mon père ne s’en remit jamais ».
Bien sûr de tels camps existaient aussi dans les autres pays, la France n’avait pas le monopole de cet exercice de défiance à l’égard des « autres » et des gens qui n’entraient pas dans la norme.
Dans le livre sur les images interdites on trouve encore cette photo :
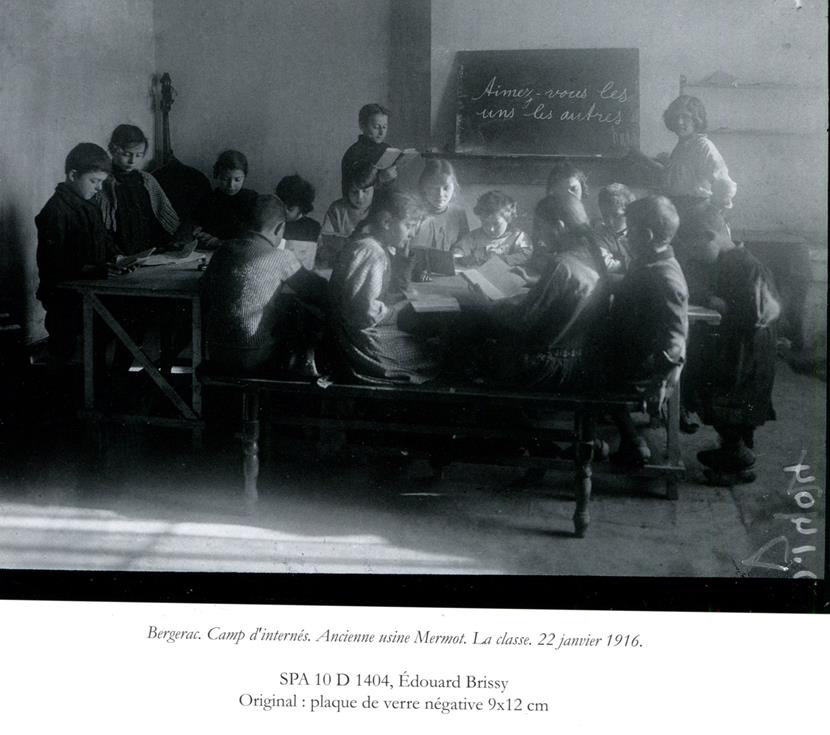
Ce sont les enfants de civils allemands et autrichiens internés à Bergerac.
Sur le tableau l’institutrice a écrit : « Aimez-vous les uns les autres »
C’était certainement une injonction inaccessible dans ces temps de barbarie et particulièrement pour ces enfants enfermés par la France parce qu’ils étaient allemands ou autrichiens.
<1152>
-
Mercredi 21 novembre 2018
« Images interdites de la grande guerre »Expositions et livre montrant et évoquant des photos de la guerre 14-18 qui avaient été censurées à l’époqueLa guerre 14-18 a été une grande productrice de propagande et déjà de fake news.
Le site Agora vox parle d’« une diffusion massive de leurres invraisemblables » :
« Plus [les armes] sont perfectionnées, moins elles causent de morts et de blessés ! (Le Temps, 4/8/1914). Celles de l’ennemi, en tout cas, ne sont pas dangereuses ; c’est de la camelotte ! (L’Intransigeant, 17/8/1914) : les obus (shrapnels) éclatent en pluie de fer inoffensive ! Les blessures par balles ne sont pas dangereuses ! »
Et il existait aussi la censure.
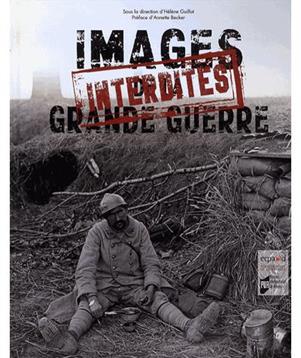 Aujourd’hui je voudrais vous parler de la censure de photos prise pendant la guerre.
Aujourd’hui je voudrais vous parler de la censure de photos prise pendant la guerre.
Pendant la guerre 14-18 le Haut commandement français avait compris l’intérêt et l’impact sur les populations que pouvaient avoir des photos de guerre et aussi les dangers et risques que cela représentait.
La photo avait déjà des dizaines d’années d’existence.
Même s’il fallut de nombreuses inventions avant d’aboutir à la photographie, on commence souvent l’histoire de cette technique avec Joseph Nicéphore Niépce, inventeur de Chalon-sur-Saône, qui parvint à fixer des images sur des plaques (1826 ou 1827). Louis Daguerre poursuit les expériences et parvient à raccourcir le temps de pose à quelques dizaines de minutes (quand même !). Et la date conventionnelle de l’invention de la photographie est fixé au 7 janvier 1839, jour de la présentation par Arago à l’Académie des sciences de l’« invention » de Daguerre, le daguerréotype.
Et ce n’est pas la guerre 14-18 qui fut le premier conflit à être photographié. Lors du mot du jour du <Lundi 17/03/2014> consacrée à « La guerre de Crimée » que Napoléon III avait mené contre la Russie (1853-1856).j’avais évoqué des photos qui avaient été réalisées et dont certaines ont été publiées sur le site de l’Obs : <Des photographies de la guerre de Crimée en 1855>.
Mais revenons aux photos censurées de la première guerre mondiale.
Plusieurs expositions ont présenté ces photos, appelées images interdites..
- En octobre 2014 à l’Université Paris 1 au Centre Panthéon Sorbonne
- Plus récemment une exposition au premier semestre 2017 a eu lieu au Château de Vincennes.
Un livre est paru sur ces deux expositions. Vous voyez ci-dessus la photo qui orne le livre et était aussi celle qui se trouvait sur l’affiche des deux expositions évoquées. Elle représente un soldat au repos et ayant l’air désabusé.
Pour ma part j’ai pu l’emprunter à la Bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon.
Ces photos qui n’ont pas été montrées pendant la guerre étaient pourtant l’œuvre d’une Unité de l’armée elle-même. Il n’était évidemment pas question d’embarquer des journalistes ou des photographes privés et de les laisser prendre les photos qui leur auraient paru pertinentes.
La section photographique de l’armée (SPA) est créée en 1915 pour fabriquer jusqu’en 1919 l’image officielle de la guerre en France.
Le livre prétend que la SPA est le premier organisme de production d’images officielles en Europe.
Ces expositions et ce livre présentent donc des vues qui n’ont jamais eu le droit de paraître. Censurées dès leur production, pour des raisons stratégiques, diplomatiques et aussi parce qu’elles auraient pu nuire à la crédibilité du discours du Haut commandement ou au moral de l’arrière, voire remettre en cause l’image négative de l’ennemi. Mais elles ont été inventoriées et conservées, comme toute administration et toute armée sait le faire.
Dans la préface au livre Annette Becker évoque l’écrivain Ernst Jünger qui en 1934 déclarait :
« La photo est une arme »
C’est donc une arme qui peut se retourner contre son auteur, sinon comment expliquer que l’Armée ait voulu censurer ses propres images.
Il existait une commission de censure spéciale qui était chargé de réaliser ce tri.
Il y a essentiellement deux types de raison :
- Un premier groupe revêt un caractère stratégique
- Le second rassemble des clichés pouvant avoir un effet négatif et contre-productif sur la propagande de la France aussi bien tournée vers l’intérieur que vers l’extérieur du territoire.
C’est l’Armée qui a fait les photos, les a répertoriées, classées et conservées. Ce ne pouvait donc être que l’armée qui organise ces expositions. C’est encore l’Armée qui affirme que sur un fonds de 90 000 clichés, il n’y a que 8% qui ont été censurés.
L’exposition commence donc par les photos censurées par stratégie et intérêts militaires. Ainsi des photos de postes d’observations ou de canons ne devaient pas être vues par l’ennemi. Cela ne présente à mes yeux pas grand intérêt.
Je suis beaucoup plus intéressé par le second groupe.
Il y a d’abord des photos de morts, de corps déchiquetés de mutilés qui ne sont pas compatibles avec les affirmations des journaux citées en début d’article.
Mais il y a d’autres photos qui me paraissent plus intéressantes à regarder avec nos yeux du XXIème siècle et 100 ans après ces terribles évènements.
J’en ai choisi trois.
1/ L’appel d’une classe d’âge en janvier 1916
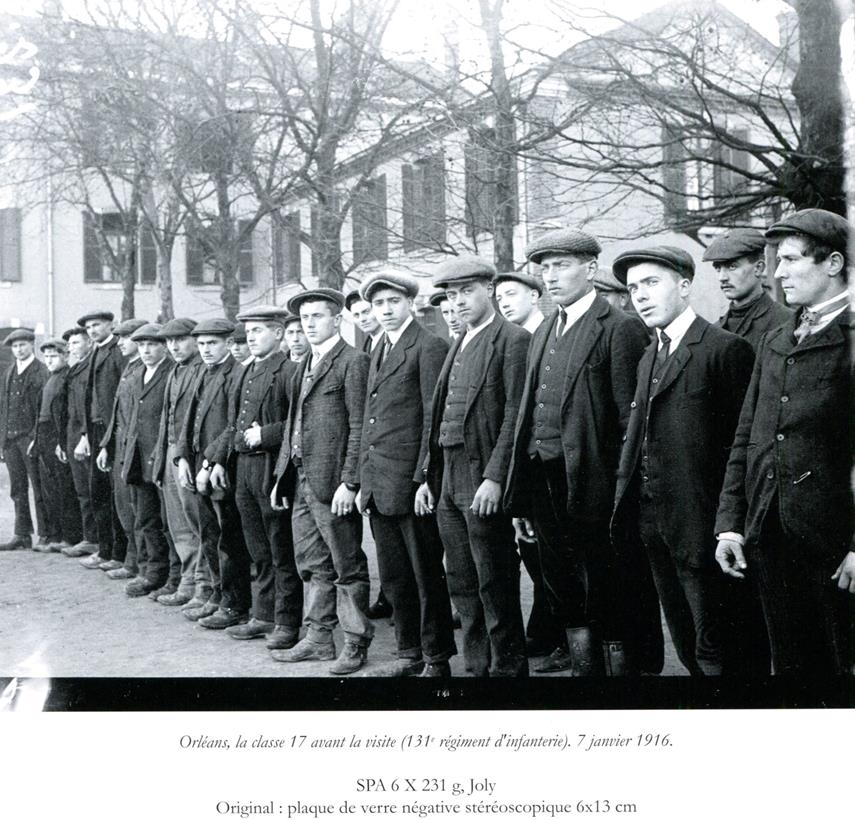
Le commentaire du livre est celui-ci :
« Les hommes sur cette photographie, au visage particulièrement juvéniles, ont l’air préoccupés, soucieux […] On ne voit pas de franche résolution, d’envie de se battre ou plus simplement de sourires comme dans les représentations montrant la mobilisation et le départ des premiers combattants et abondamment diffusées. »
Et donne l’explication de la censure :
« [Cette] photo exprime ce que l’opinion ne doit pas voir, l’image de la résignation »
Ces jeunes ne croient pas aux sornettes que racontent les journaux et que les balles allemandes ne tuent pas. Ils ont tout simplement peur et à raison. Combien de ces jeunes gens vont mourir au front ou être mutilés, dans les deux années qui suivent la prise du cliché ?
2/ Le prisonnier allemand
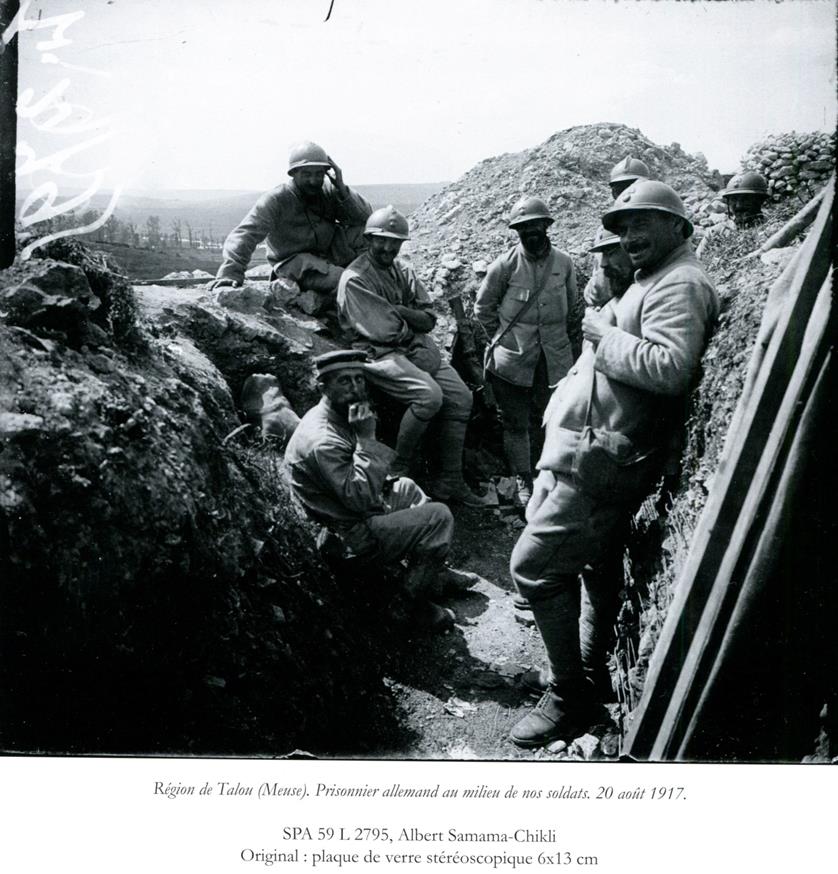
Les soldats français sont fiers, ils ont attrapé un soldat ennemi. Le soldat allemand est assis et mange un morceau de pain.
Cette fois je trouve le commentaire particulièrement approprié et incisif :
« Les Français posent bravache devant l’objectif tous debout, grands souriants. […] L’Allemand lui, l’autre a l’air minable, tout petit, recroquevillé, tout juste bon à grignoter un morceau de pain. C’est sûr qu’ils n’ont rien à manger chez eux ces barbares. Il a peur, il ne comprend rien que va-t-on faire de lui ? Pourtant, la convention de Genève sera respectée, demain il partira pour un camp de prisonniers […]. Très loin des siens. Pour lui la guerre est finie, c’est lui qui devrait sourire. »
Mais pourquoi censurer une telle photo ?
Parce qu’il faut que l’ennemi soit monstrueux, assoiffé de sang, cruel.
Cet homme simple, un peu perdu ne peut pas être haï.
Au contraire, un élan d’empathie peut apparaître.
On construit l’ennemi, on le raconte, on le criminalise pour pouvoir le haïr.
Et alors la dernière photo que j’ai choisie dans ce livre est encore bien pire pour la censure de l’armée.
3/ Tombe faite par les allemands à un « héros français »
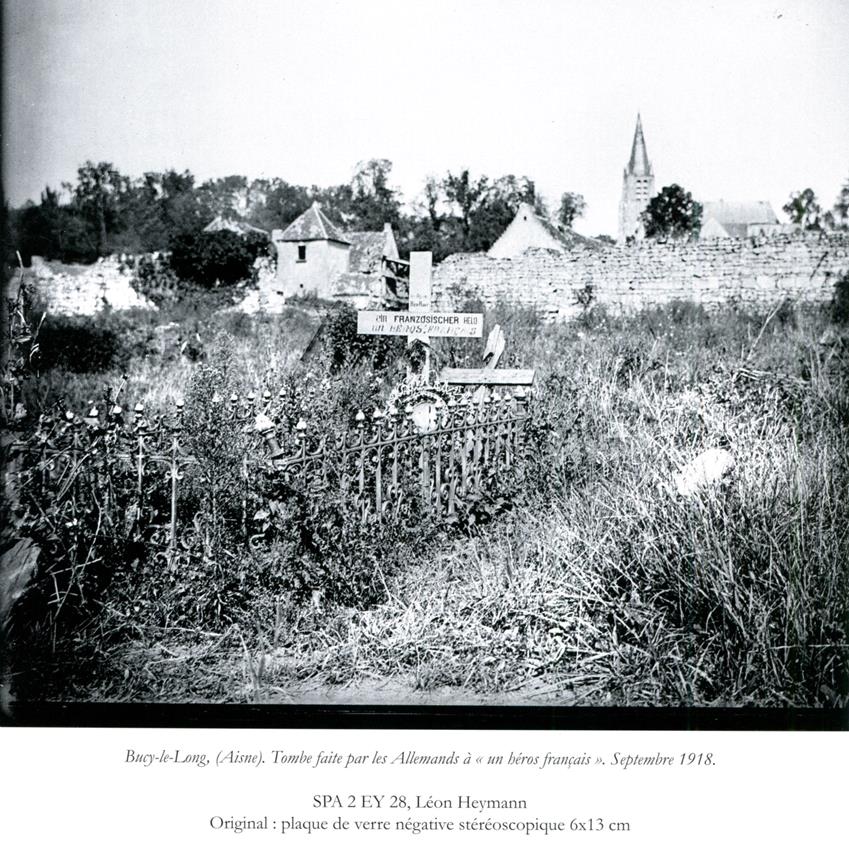
Dans un cimetière manifestement peu entretenu, avec en arrière-plan, un village relativement épargné par la guerre et les bombardements, cette tombe attire l’attention.
Il est écrit en allemand « Ein Französicher Held » « Un héros français »
Le commentaire en 2014 est :
« Cette inscription peut être émouvante, en ce qu’elle montre que même entre adversaires, on honore le courage de l’ennemi en lui offrant une sépulture… un geste rare. »
Il est bien évident qu’on ne peut montrer un tel geste chevaleresque de l’ennemi.
Aujourd’hui nous savons que parfois, les soldats des deux camps ont fraternisé.
J’ai évoqué ces moments dans le mot du jour du <21 décembre 2015>
Et j’avais utilisé comme exergue, cette phrase d’Albert Cohen :
«Frères humains et futurs cadavres, ayez pitié les uns des autres. »
<1151>
- En octobre 2014 à l’Université Paris 1 au Centre Panthéon Sorbonne
-
Mardi 20 novembre 2018
« Du traité de Sèvres en 1920 au Traité de Lausanne en 1923»De la défaite de l’empire ottoman à la victoire turque grâce à Mustafa KemalL’Empire ottoman était l’empire des Turcs.
Wikipedia nous apprend que
« La plus ancienne mention du terme « Türk » qui nous soit parvenue, provient des Göktürks du VIe siècle. Une lettre de l’Empereur de Chine […] l’identifie comme le « grand khan turc » en 585. Les stèles d’Orkhon, dans l’actuelle Mongolie, font usage du terme « Türük » (ancienne forme du pluriel de türk = fort, donc « Les Forts ») pour désigner les ancêtres des peuples turcs. Cette même étymologie a cours en Turquie moderne, où le mot « turc » signifie « fort » ou « puissant ». […]
La quasi-totalité du domaine scientifique pense que les peuples turcs sont originaires d’Asie centrale et de Sibérie (anciennement Turkestan). Une petite minorité, comprenant les idéologistes panturcs, envisagent une origine plus à l’ouest, suivie d’une migration vers l’Asie centrale durant la préhistoire. »
On parle « des » peuples turcs ou peuples « turciques ». Ainsi les Ouïghours de Chine, ou encore les Kirghizes, les Oghouzes qui vivent au Kazakhstan et les Turkmènes, c’est-à-dire des peuples qui habitaient en Union Soviétique sont des peuples turciques.
Les ottomans sont donc une tribu des peuple turcs qui va avoir un grand destin historique.
<Ils entrent en contact avec l’Islam> au 9ème siècle et deviennent à la fin du Xème siècle un élément essentiel de l’Islam parce qu’ils sont très présents dans les armées musulmanes.
Historiquement c’est Osman Ier qui va fonder l’empire ottoman à la fin du XIIIe siècle au nord-ouest de l’Anatolie, dans la commune de Söğüt (actuelle province de Bilecik). L’Anatolie est donc le cœur de l’Empire Ottoman qui va se déployer en Asie et en Europe.
Une carte de 1330, montre la région d’origine des Ottomans et laisse poindre qu’ils vont affronter l’empire des byzantins avec sa capitale Constantinople.

Il faudra un peu de temps mais en 1453, c’est fait ! Mehmet II a conquis Constantinople qui va devenir Istanbul et la nouvelle capitale de l’Empire Ottoman, l’empire byzantin n’existe plus.
Aux XVIe et XVIIe siècles, à son apogée, sous le règne de Soliman le Magnifique, l’Empire ottoman était un empire multinational et multilingue contrôlant une grande partie de l’Europe du Sud-Est, des parties de l’Europe centrale, de l’Asie occidentale, du Caucase, de l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique.
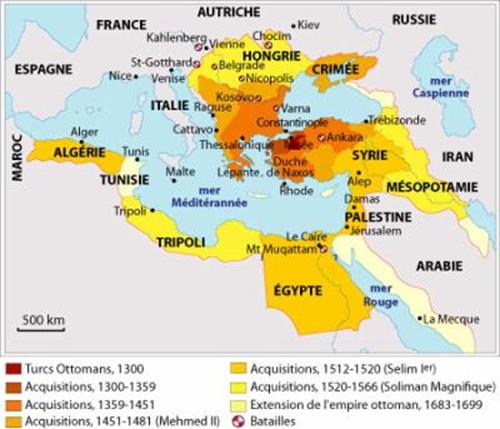 Son apogée se situe donc à la fin du XVIIème siècle.
Son apogée se situe donc à la fin du XVIIème siècle.
Mais les Ottomans subirent de graves défaites militaires à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle.
Et on attribue au tsar Nicolas Ier alors qu’il discutait avec l’ambassadeur britannique Sir G.H. Seymour en 1853 l’expression « l’homme malade » pour désigner l’empire Ottoman. Cet empire va se rapprocher de l’Allemagne notamment pour l’encadrement de l’armée et va très naturellement être de son côté au début de la grande guerre. C’était d’autant plus naturel que son grand ennemi, la Russie, était dans l’autre camp.
Malgré quelques victoires, la guerre sera un désastre pour l’Empire.
Ce sera aussi un désastre moral, puisque « Les Jeunes-turcs » qui ont pris le pouvoir vont perpétrer notamment le génocide arménien auquel j’ai consacré plusieurs mots du jour comme celui du <24 avril 2015> . Ce massacre de chrétiens soupçonnés d’être des traitres va aussi se réaliser pour des chrétiens assyriens et grecs.
La défaite de l’empire ottoman est acquise par l’armistice de Moudros qui sera signée le 30 octobre 1918.
Mais l’armistice n’est pas la paix. La paix aurait dû être la conséquence du traité de Sèvres, conclu le 10 août 1920 et qui sera signé par le sultan Mehmed VI. Mais il ne sera jamais ratifié ni appliqué.
Ce traité présentait notamment les conséquences suivantes :
- Renonciation définitive aux provinces arabes et maghrébines
- Mais aussi des reculs territoriaux au sein même de l’Anatolie.
- À l’ouest, la Thrace orientale, sauf Constantinople et ses environs, est donnée à la Grèce.
- À l’est, une grande Arménie est créé
- En outre un État kurde devient indépendant.
- Les détroits sont par ailleurs démilitarisés.
Mais si le sultan règne à Constantinople, un général Mustafa Kemal a pris la tête d’un gouvernement émanant d’une Grande assemblée nationale de Turquie créée à Ankara le 23 avril 1920. Et Mustafa Kemal ne reconnait pas la validité de ce traité qui menace l’intégrité territoriale notamment de l’Anatolie qui est, comme écrit ci-dessus, le cœur de l’empire des turcs. En effet le projet de créer un État Kurde et un grand État arménien impacte directement l’intégrité territoriale de l’Anatolie turque.
Mustafal Kemal avec ses partisans va faire chuter le sultan et reprendre le combat notamment contre les grecs. Les Turcs se soulèvent en masse, s’enrôlent dans l’armée kémaliste et déclenchent la Guerre d’indépendance turque en mai 1919. Au bout de quatre années de conflit, les kémalistes sont victorieux et obtiennent la négociation d’un nouveau traité.
Ce traité sera le traité de Lausanne (24 juillet 1923). Il y aura un autre traité moins connu celui de Kars, conclu en octobre 1921 avec la Russie soviétique.
Wikipedia nous apprend que
« [Le traité de Kars] lui permet de récupérer le territoire de Kars perdu en 1878 par les sultans et de bénéficier de l’armement soviétique dans sa lutte contre les Arméniens, les Grecs et la Triple-Entente. Les traités de Kars et de Lausanne sont en revanche désastreux pour l’Arménie, ainsi partagée à nouveau entre Turquie et Russie, et pour la Grèce. Cette dernière qui, après s’être émancipée de la protection obligatoire que les grandes puissances lui avaient imposée à la suite de la guerre d’indépendance grecque et après avoir été à deux doigts de réaliser sa Grande Idée, perd tous ses acquis et doit, en plus, accueillir un million et demi de réfugiés grecs d’Asie mineure (tandis que plus de 300 000 autres, notamment dans la région du Pont et en Cilicie, doivent se convertir à l’islam et passer à la langue turque pour survivre) : c’est ce que les Grecs appellent la « Grande Catastrophe ». »
Le traité de Lausanne est signé le 24 juillet entre la Turquie d’une part et la France, le royaume d’Italie, le Royaume-Uni, l’empire du Japon, le royaume de Grèce, le royaume de Roumanie, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes d’autre part.
Concernant le Moyen Orient, rien ne change. En revanche la Turquie reste maîtresse de l’Anatolie. Aucun territoire n’est cédé à l’Arménie et notamment pas le Mont Ararat, lieu sacré des arméniens reste en Turquie.
Les Kurdes n’auront aucun État. Ils formaient une nation homogène dans l’empire Ottoman. Sa dislocation va distribuer ce peuple entre plusieurs États : La Turquie, L’Irak, la Syrie et l’Iran.
Aujourd’hui encore on entend Erdogan pester contre les Kurdes, les attaquer, les bombarder sans relâche en Syrie, les traiter de terroristes, enfermer les responsables en Turquie.
Toutes ces difficultés d’aujourd’hui sont directement issues de la fin de la guerre 14-18 et de la gestion de la fin de l’empire Ottoman.
Parallèlement, il va y avoir des millions de réfugiés et de déplacés, car Mustafa Kemal bientôt appelé Atatürk va créer un état laïc, mais le plus possible homogène religieusement autour de l’Islam. Il n’y aura pas un autre génocide arménien, mais des mesures qui vont obliger les arméniens à quitter le territoire de la Turquie.
Les échanges de populations obligatoires seront organisés violemment entre la Grèce et la Turquie (1,6 million de Grecs ottomans contre 385 000 musulmans de Grèce ).
Atatürk va en outre souhaiter « rapatrier » des Turcs de Bulgarie, de Roumanie ou du Dodécanèse italien et se débarrasser des populations chrétiennes de Turquie.
Wikipedia précise :
« Près d’un demi-million de Grecs de Turquie sont morts (pour la plupart dans les camps ou en route) et 400 000 musulmans, en majorité Turcs, ont quitté, eux, la Grèce pour la Turquie. L’échange de population était strictement basé sur l’appartenance religieuse. Le traité prévoyait quelques exceptions : Istanbul et les îles de Gökçeada (Imbros) et de Bozcaada (Tenedos), où les minorités grecques (300 000 personnes) étaient autorisées à rester, et la Thrace occidentale, où la minorité musulmane (230 000 personnes) était aussi autorisée à rester. Mais, dans les décennies suivantes, les discriminations et persécutions déterminèrent aussi ces populations à quitter leurs territoires »
Mustafa Kemal fut pour la Turquie, un héros et un sauveur.
De notre point de vue, c’est un homme beaucoup moins recommandable.
Il ne reconnut jamais le génocide arménien, pourtant perpétré par un gouvernement qu’il a combattu. Il a ainsi débuté un déni qui continue aujourd’hui.
Il a, par une politique de terreur, vidée la Turquie du plus grand nombre possible de citoyens chrétiens, pour créer une Turquie musulmane la plus pure possible. Son Etat laïc est une mascarade, il signifie simplement que le gouvernement n’a pas à recevoir d’ordre des autorités religieuses. Il est très facile d’être laïc, dans la Turquie de Mustafa Kemal, à partir du moment où on est musulman.
Enfin sa politique intransigeante a interdit à la nation kurde d’accéder au statut d’État nation au même titre que les autres.
Elle n’a pas acquis sa souveraineté et fait partie des nations qui restent sacrifiées de la grande guerre. Vous pouvez aussi regarder cette <vidéo> sur une chaine Youtube «L’histoire par les cartes» et qui évoque en 8 minutes la fin de l’empire Ottoman.
<1150>
- Renonciation définitive aux provinces arabes et maghrébines
-
Lundi 19 novembre 2018
«La commission King Crane»Une commission d’enquête américaine au Moyen-Orient à la fin de la guerre 14-18 et après l’effondrement de l’empire OttomanAprès avoir évoqué le démantèlement de l’Empire Austro Hongrois, il est normal de parler de celui de l’Empire Ottoman.
C’est encore plus compliqué et je vais le faire en deux articles, celui de demain étant consacré au noyau de l’empire ottoman qui est devenu la Turquie.
A ce stade, je n’ai pas encore donné le lien vers un site que vous connaissez peut-être et qui a été créé par la mission du centenaire : <http://www.centenaire.org/fr>
Sur ce site il existe une page : <1918, un monde en révolutions> qui renvoie vers une série d’émissions qui a été réalisée par France Inter et le journaliste Ali Baddou et surtout le remarquable historien Nicolas Offenstadt, spécialiste, entre autre, de la Grande Guerre. A ce titre, il est membre du comité scientifique des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale.
Point à souligner, il a participé à la rédaction d’un rapport sur la réintégration des fusillés de ce conflit dans la mémoire collective, qui a notamment conduit à créer des espaces consacrés aux 639 fusillés à l’hôtel des Invalides.
Un livre sur ce sujet a été publié <Nicolas Offenstadt : Les Fusillés de la Grande Guerre> et peut être acheté ou consulté. Il a d’ailleurs écrit d’autres ouvrages sur la Grande Guerre.
La série d’émissions dont je parle comptait 8 épisodes et a été diffusé en juillet août 2018. Il s’agit d’émissions absolument passionnantes qui éclairent ce qui s’est passé après 1918 et ce qui subsiste aujourd’hui de tous ces évènements, drames et massacres car il y eut encore des massacres après 1918.
Les titres des 8 émissions sont les suivants :
- 1918 en Allemagne : Défaite, Révolutions et République
- 1918 en Chine : Nationalisme et communisme
- 1918. La Russie en révolutions : le pain et la paix
- 1918 en Autriche et en Hongrie : la fin d’un monde
- Des Slaves du Sud à la Yougoslavie : naissance d’un Etat
- 1918 en Italie : de la guerre au Fascisme
- 1918 en Syrie et en Palestine : après la chute de l’Empire Ottoman, le long héritage des mandats
- 1918. Entre Russie et Turquie : la première République d’Arménie
Ces émissions sont bien sûr toujours écoutables en podcast : Le lien se trouve sur la page <1918, un monde en révolutions> déjà cité.
Tous ces sujets sont particulièrement intéressants et remarquablement traités.
Pour le mot du jour d’aujourd’hui, je me suis largement inspiré de l’avant dernière émission <1918 en Syrie et en Palestine : après la chute de l’Empire Ottoman, le long héritage des mandats>.
Je vais donc parler du moyen orient.
Et pour rester pédagogique, voici une carte de cette région en 1914 que le Monde Diplomatique avait publié dans un article en 1992.
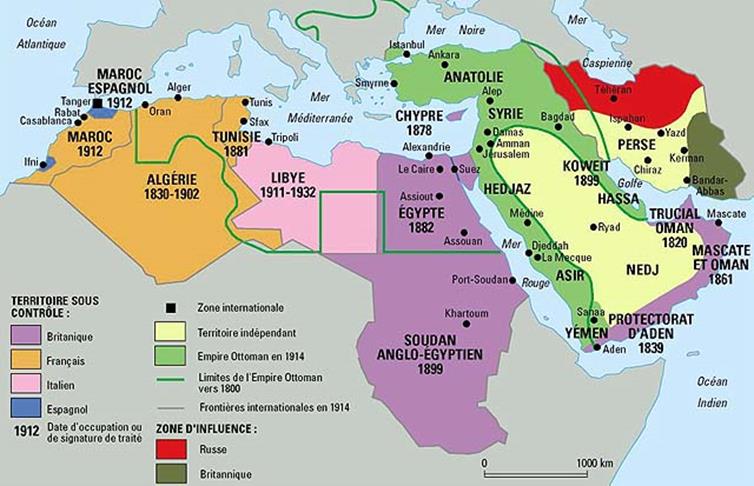
Cette carte montre que l’Empire Ottoman a beaucoup reculé depuis 1800, puisqu’on voit sur la carte qu’elles étaient les limites un siècle avant (en vert).
On voit d’ailleurs qu’il y avait tout une partie de l’Europe, la Grèce et les Balkans qui étaient à cette époque-là sous la domination ottomane. La Grèce a été en grande partie ottomane, dès avant la prise de Constantinople en 1453, de même que les balkans. La guerre d’indépendance grecque s’acheva au début des années 1830. Pour les pays balkaniques ce fut plus tardif, mais ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui.
Concernant le Moyen-Orient, il y a encore deux choses à noter :
- La très grande présence des britanniques à proximité de cette région : en Egypte, au Soudan et à ce qui aujourd’hui s’appelle le Yémen et Oman. Parallèlement la France est absente ou très loin, au Maghreb. Une petite exception depuis 1884, la France est à Djibouti dans la Corne de l’Afrique c’est-à-dire le côté africain du golfe d’Aden. Mais globalement, ce sont les britanniques qui sont là-bas et qui vont faire la guerre, notamment en se servant du nationalisme arabe pour affronter les troupes ottomanes. Et tous ceux qui ont vu le film « Lawrence d’Arabie » de David Lean qui est très proche de la réalité historique comprendront comment cela s’est passé.
- Le Centre de l’Arabie, le Nedj avec pour capitale Ryad et pour famille régnante la famille des Séoud, ne se trouve pas dans l’empire Ottoman.
Je vais essayer de résumer :
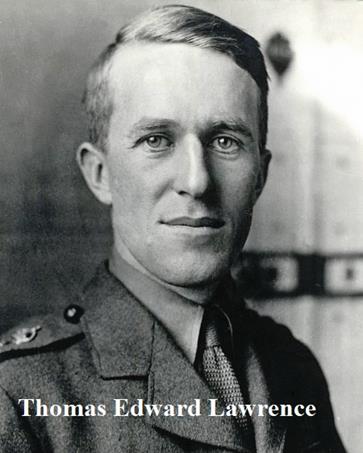 1° Les anglais et notamment grâce à l’officier des services de renseignements militaires britanniques arabophiles Thomas Edward Lawrence vont se servir des arabes pour vaincre les Ottomans. C’est lui qui parvient à gagner la confiance du chérif de La Mecque d’Hussein ibn Ali de la dynastie hachémite et va combattre directement avec les troupes arabes sous le commandement de Fayçal ibn Hussein fils du Chérif de la Mecque. Les arabes souhaitaient se débarrasser des ottomans mais pour qu’is collaborent si étroitement avec les anglais il fallait que ces derniers leur fassent quelques promesses alléchantes. Ils ont donc promis qu’une fois la guerre gagnée, un immense Etat arabe sous la direction de la famille régnante à la Mecque verrait le jour. Il n’est pas certain que le gouvernement britannique n’ait jamais vraiment considéré que ce fût une solution qu’il fallait mettre en place, mais Lawrence d’Arabie y croyait et sa hiérarchie l’a laissé croire. Comme il était le principal interlocuteur des chefs arabes de la Mecque, il a su être particulièrement persuasif à leur égard.
1° Les anglais et notamment grâce à l’officier des services de renseignements militaires britanniques arabophiles Thomas Edward Lawrence vont se servir des arabes pour vaincre les Ottomans. C’est lui qui parvient à gagner la confiance du chérif de La Mecque d’Hussein ibn Ali de la dynastie hachémite et va combattre directement avec les troupes arabes sous le commandement de Fayçal ibn Hussein fils du Chérif de la Mecque. Les arabes souhaitaient se débarrasser des ottomans mais pour qu’is collaborent si étroitement avec les anglais il fallait que ces derniers leur fassent quelques promesses alléchantes. Ils ont donc promis qu’une fois la guerre gagnée, un immense Etat arabe sous la direction de la famille régnante à la Mecque verrait le jour. Il n’est pas certain que le gouvernement britannique n’ait jamais vraiment considéré que ce fût une solution qu’il fallait mettre en place, mais Lawrence d’Arabie y croyait et sa hiérarchie l’a laissé croire. Comme il était le principal interlocuteur des chefs arabes de la Mecque, il a su être particulièrement persuasif à leur égard.
2° Les anglais vont conclure, en mai 1916, avec les français, les accords secrets Sykes-Picot. J’ai développé longuement cet évènement lors du mot du jour du <12 mai 2016>
Dans ces accords, il n’est pas question d’offrir aux Arabes un grand Etat indépendant mais de se partager le moyen orient en zone d’influence. Ce qui sera fait via la procédure des mandats internationaux par lesquels la France exercera un protectorat sur le Liban et la Syrie et les britanniques sur tout le reste et notamment la Palestine, ce dernier point n’était pas prévu au début. La position privilégiée des britanniques évoquées ci-dessus va permettre qu’ils tirent un bien meilleur bénéfice de ces accords que les français. Les arabes se sentiront floués et le colonel Lawrence aussi. Il se retirera de toutes les actions publiques, écrira son célèbre livre les « 7 Piliers de la sagesse » et se tuera dans des circonstances étranges lors d’un accident de moto à l’âge de 46 ans. La péninsule arabique échappa d’ailleurs à la famille hachémite pour revenir après une guerre éclair au souverain de Ryad : Ibn Séoud qui créera le seul Etat du monde dont le nom contient le nom de la famille régnante : l’Arabie Saoudite. J’ai également consacré un mot du jour à «La maison des Saoud» le < 21 Janvier 2015>
3° Et puis «last but not least » comme disent les sujets de la Perfide Albion, qui n’a jamais aussi bien porté son nom que dans ces épisodes de sortie de la grande guerre au moyen orient, le gouvernement britannique a produit « La déclaration Balfour ». Un mot du jour assez détaillé y a été consacré le 17 mars 2015.
Au cœur de cette déclaration on lit :
« Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif »
Par prudence, une petite phrase évoque que : «rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine ».
Si des esprits pervers avaient voulu créer le plus grand désordre dans cette région, il me semble qu’ils n’auraient pas pratiqué autrement que nos « amis » anglais. Les français bien qu’ils aient été largement bernés dans ces affaires moyen orientales par les anglais, n’ont rien fait pour empêcher cette confusion.
C’est à ce stade qu’intervient un épisode que relate Nicolas Offenstadt dans l’émission précitée « la commission King Crane »
Nicolas Offenstadt se penche sur le travail et le devenir de cette commission dans l’émission précitée.
Ce point est aussi développé sur un autre site d’historiens consacrés au Moyen Orient : « Les clés du Moyen-Orient ». C’est la fondatrice de cette publication Anne-Lucie Chaigne-Oudin, docteur en histoire de l’université Paris-IV Sorbonne qui a écrit cet article : « <Commission King-Crane >.:
Les américains et le Président Wilson ont :
« l’idée d’envoyer une commission dans les provinces arabes de l’ancien Empire ottoman […] afin d’enquêter sur place sur les volontés des populations. Le président Wilson souhaite que cette commission composée d’Américains, de Britanniques, de Français et d’Italiens enquête sur l’opinion des populations concernant leur avenir, dans tous les territoires liés par les accords Sykes-Picot.
Mais en dépit des souhaits de Wilson, la commission est finalement constituée uniquement par des Américains, issus des milieux missionnaires protestants. »
Les anglais et les français ne veulent évidemment pas participer à cette enquête qui pourrait être déstabilisante pour ceux qui avaient pris des décisions en chambre, entre diplomates et représentant des puissances coloniales.
« Présidée par le docteur Henri King, auteur d’ouvrages de théologie et de philosophie et par Charles Crane, industriel de Chicago, tous deux membres de la Conférence de la paix, la commission débute son enquête en mai 1919 et se rend dans la zone d’occupation britannique en Palestine (Jaffa, Jérusalem, Caza de Ramleh et de Lydda, région d’Hébron), dans la zone d’occupation arabe en Syrie (Damas, Déraa, Baalbeck, Homs, Hama), et dans la zone d’occupation française au Liban jusqu’à Alexandrette (Beyrouth, Djbail, Batroum, Bkerké, Saïda, Tyr, Ainab, Baadba, Zahlé, Tripoli, Alexandrette, Lattaquié) et en Cilicie, la Mésopotamie n’étant finalement pas incluse. Globalement, l’enquête met en évidence la volonté, dans les milieux musulmans de Syrie, du Liban et de Palestine, de l’unité arabe et de l’indépendance, et dans les milieux maronites et grecs-catholiques, de la présence française et de la création d’un Liban indépendant.
La commission sort son rapport à l’automne 1919.
Mais ses recommandations ne sont pas prises en compte, car dans le même temps, Wilson doit faire face à d’autres décisions et à un état de santé préoccupant. En outre, le sénat américain rejette le traité de Versailles et les responsables américains se retirent de la conférence de la paix.
Le rapport de la commission King-Crane n’est connu qu’en décembre 1922 et n’a aucune influence car les mandats ont déjà été attribués à la France sur la Syrie et le Liban et à la Grande-Bretagne sur la Palestine et l’Irak. »
En résumé et sous l’influence du Président Wilson, cette commission poursuit l’idée saugrenue d’interroger la population du Moyen-orient, cherche à connaître son avis sur les évolutions à venir et surtout vient enquêter sur place pour comprendre ce qui se passait et ce qui risquait de se passer.
Constatons qu’en face, les puissances coloniales Grande Bretagne et France n’ont interrogé personne, ont décidé selon leur bon vouloir, leurs intérêts. Elles ont décidé des frontières, des gouvernants et de la déstabilisation de la Palestine en encourageant une arrivée massive d’une population juive venant pour l’essentiel d’Europe.
Lors du démantèlement de l’empire austro hongrois, les alliés ont donné les clés du pouvoir des nouveaux États à des nationaux et surtout ont accepté que ces Etats soient souverains.
Rien de tel au Moyen-Orient.
Cette commission remet en cause le partage prévu par Sykes-Picot, préconise un grand Etat arabe et une limitation de l’émigration juive.
On ne sait pas, dit Nicolas Offenstadt, si les évènements se seraient déroulés très différemment et que la situation chaotique du Moyen-Orient d’aujourd’hui aurait pu être évitée si on avait poursuivi les réflexions de la commission King Crane.
Le fait que les Etats-Unis se soient retirés des instances internationales par le refus du Sénat américain de ratifier le Traité de Versailles rendait, en toute hypothèse, difficile de donner une suite à cette démarche. Les seuls maîtres du terrain restant les britanniques et les français.
En tout cas en 1920, la carte du Moyen Orient ressemble à cela :
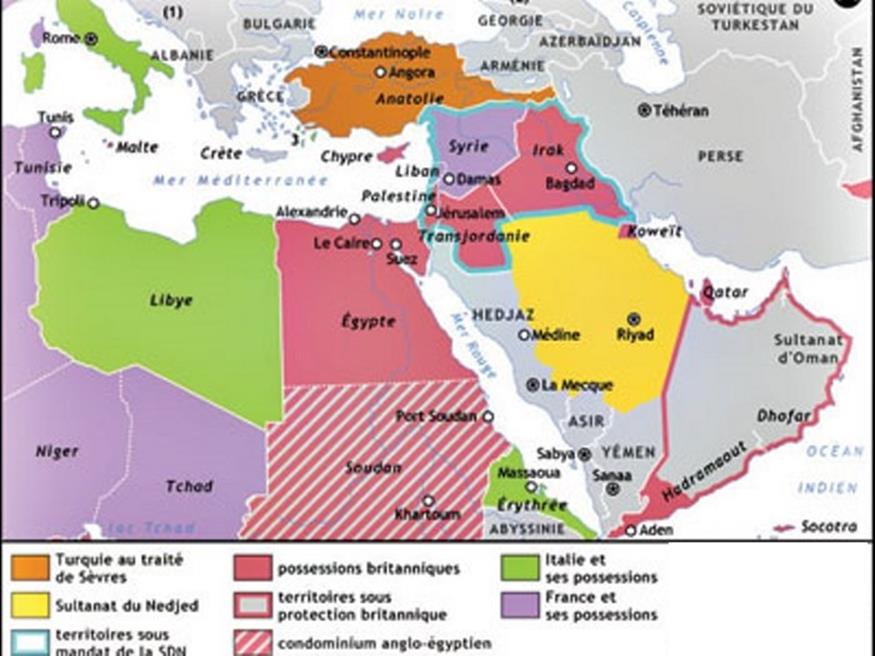
<1149>
- 1918 en Allemagne : Défaite, Révolutions et République
-
Vendredi 16 novembre 2018
« La dislocation de l’Autriche-Hongrie »Une des conséquences majeures de la défaite des empires centraux.La planète comptait 53 États indépendants et souverains en 1914. En 1932, elle en rassemblait 77.
Par comparaison l’ONU compte, aujourd’hui, 193 États membres.
 Mais revenons aux conséquences de la première guerre mondiale dont la partie la plus visible fut le démantèlement des Empires ottomans et Austro-Hongrois.
Mais revenons aux conséquences de la première guerre mondiale dont la partie la plus visible fut le démantèlement des Empires ottomans et Austro-Hongrois.
L’empire d’Autriche Hongrie représentait un immense territoire au milieu de l’Europe.
Sur la carte de 1914 que nous voyons ici, on constate qu’il avait un empire encore plus grand comme voisin, l’Empire de Russie. Le pouvoir tsariste va s’effondrer, Lénine va rapidement faire la paix avec les puissances centrales et abandonner ses alliés français et anglais.
Nous savons que les relations franco-anglaises ont toujours été conflictuelles. Le plus souvent ces deux Etats étaient ennemis. En tout cas, la Grande Bretagne a toujours été dans des coalitions contre la France, tant que la France constituait la puissance militaire continentale la plus forte.
Mais la guerre de 1870 et la création du 2ème empire, du deuxième Reich en langage tudesque a complétement changé la donne. La puissance continentale principale devenait l’empire allemand. Et ce que jamais la France n’est parvenu à faire, la puissance industrielle allemande a concurrencé puis dépassé celle du Royaume Uni. Insupportable pour cette dernière et elle fit donc alliance avec la France bien que cette dernière était une concurrente du point de vue de l’empire colonial. Mais moins forte que la perfide Albion, ce qui convenait à cette dernière. Mais ce passé explique que l’entente franco anglaise était pleine d’arrière-pensées.
Le véritable allié de la France était l’Empire Russe.
La guerre, la révolution bolchevique ont conduit à ce que la France qui était entrée dans la guerre avec l’alliance russe, en est sortie avec l’alliance américaine.
Le corps expéditionnaire d’Orient qui est illustré par le film « Capitaine Conan » sera d’ailleurs en partie engagé dans la guerre civile russe contre les bolcheviques et du côté des « blancs ».
Nous en sommes encore là. Il y chez certain politiques la nostalgie de la vieille alliance avec la Russie, mais pour l’instant et malgré l’histrion Trump, notre allié reste les Etats-Unis. Ceci remonte à 14-18.
L’empire russe à la sortie de la guerre va devenir l’Union Soviétique et ne perdra pratiquement aucun territoire. La seconde guerre mondiale renforcera sa puissance et lui permettra de soumettre des Etats vassaux dans une organisation entièrement dominée par elle : le Pacte de Varsovie.
Si la Russie se transforme en Union Soviétique militairement plus fort que la Russie, ce n’est pas le cas de l’Autriche-Hongrie.
J’avais consacré le mot du jour du 24/06/2014 à «La Cacanie» dont parlait Robert Musil dans son roman « L’homme sans qualités » pour désigner l’empire austro-hongrois avant la première guerre mondiale. Car cet empire avait pour nom précis L’empire d’Autriche et Royaume de Hongrie ce qui donnait en allemand : Kaiserliche und Königliche Österreichisch-Ungarischen, c’est-à-dire Kaiser Empereur et König Roi d’où KK et donc Cacanie
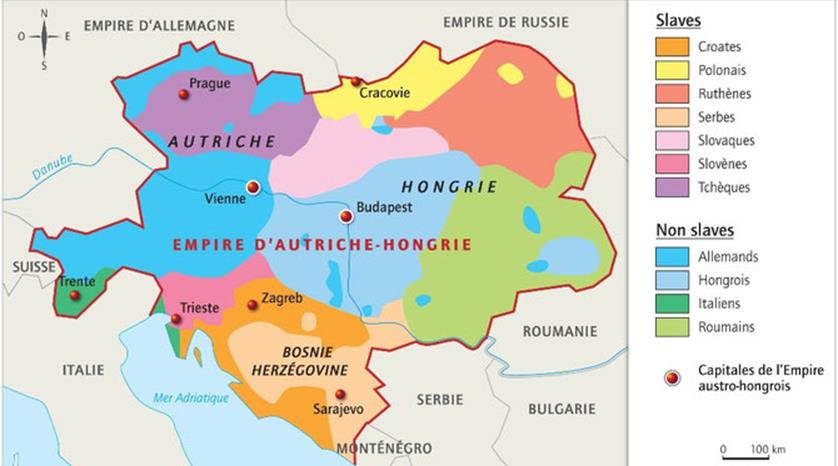 La Cacanie était un empire qui est le contraire d’un État nation.
La Cacanie était un empire qui est le contraire d’un État nation.
L’État nation peut comprendre des minorités mais pour l’essentiel est constitué d’un peuple national qui s’approprie l’État ou dit autrement obtient sa souveraineté par l’État.
L’Allemagne était un État nation en 1914.
Quand on regarde une carte de l’Autriche Hongrie, on constate que l’Empire est composé,d’une multitude de nations.
Et cette carte est particulièrement intéressante pour l’Européen d’aujourd’hui.
Il est question des « Croates » aujourd’hui il existe un État Croate, même que ce fut l’adversaire de la France en finale de la coupe du monde de football. Mais la Croatie ne date pas de 1918, il fallut une autre guerre pour que cet État se crée en 1991..
Alors, s’il n’existe pas de Ruthènie, mais aujourd’hui il existe la Slovaquie, la Slovénie, la Tchéquie et même quelques autres..
Nous avons parlé, hier, de la création de la Pologne qui a repris son territoire en amputant la Russie et l’Allemagne, mais aussi l’Autriche Hongrie qui occupait un territoire autour de Cracovie.
En principal cependant le démantèlement de l’Empire austro-hongrois consista dans la création de 4 États :
- L’Autriche, le cœur de l’empire et sa capitale, Vienne, désormais disproportionnée, se resserre dans un tout petit État qui est devenu une République. Les dirigeants souhaitaient fusionner avec l’Allemagne, les anglo-saxons trouvaient l’idée acceptable, mais pas la France qui a opposé un veto à cette perspective;
- La Hongrie, qui était le royaume à l’intérieur de la Cacanie et disposait de ses propres chambres législatives. Elle aussi rétrécit de manière considérable : perte des deux tiers de son territoire et de près des deux tiers de sa population (qui passait brusquement de 20 à 7,6 millions d’âmes). Les Hongrois garde la nostalgie de ce qu’ils appellent la « Grande Hongrie» qui fit aussi l’objet d’un mot du jour.
- La Tchécoslovaquie qui regroupait les nations tchèques et slovaques
-
La Yougoslavie qui regroupait les nations serbes, croates, bosniaques, slovènes.
La Tchécoslovaquie est sortie du traité de Saint-Germain-en-Laye outre le Tchèques et les Slovaques, ce nouvel État inclut aussi des minorités allemandes, ruthènes, hongroises, polonaises. La minorité allemande des sudètes constitua le prétexte pour Hitler d’occuper d’abord le territoire des sudètes après le sombre épisode des accords de Münich, puis tout le territoire tchécoslovaque. Hitler qui était autrichien, considérait l’annexion de ce jeune Etat comme un juste retour dans l’Empire Allemand qui avait fusionné avec l’Autriche.
Après la seconde guerre mondiale, la Tchécoslovaquie retrouva son indépendance, indépendance limitée par son appartenance au bloc soviétique. Mais quand le communisme s’effondra à l’est, les nations qui n’avaient pu devenir État-nation en 1918 prirent leur revanche et la Tchécoslovaquie donna naissance à la Slovaquie et la République Tchèque le 31 décembre 1992 à minuit. Cette séparation se passa dans le calme et la paix.
Tel ne fut pas le cas de la dislocation de la Yougoslavie.
Mais avant la dislocation il a fallu la créer. La Yougoslavie fut créée le 1er décembre 1918 sous le nom de Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Le nom Yougoslavie signifiant pays des Slaves du Sud.
En réalité la création de la Yougoslavie est la récompense accordée à la Serbie qui était du côté des alliés et notamment l’allié de la France. Rappelons que c’est la déclaration de guerre de l’Autriche-Hongrie contre la Serbie qui de manière factuelle entraîna toutes les autres déclarations de guerre dans les jours qui ont suivi et qui a ouvert la première guerre mondiale.
Cette déclaration de guerre qui avait pour prétexte le fait que la Serbie refusa, comme tout état souverain qui se respecte, de laisser entrer des policiers autrichiens sur son territoire pour poursuivre le groupe qui aida le bosniaque Gavrilo Princip à assassiner l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche le 28 juin 1914 à Sarajevo.
On constate donc que le territoire de la future Yougoslavie fut au cœur de ces évènements qui déclenchèrent la grande guerre.
Mais au sein de la Yougoslavie, la rivalité entre nations fut toujours vive pour finalement déboucher sur la terrible guerre de Yougoslavie.
Wikipedia précise qu’
« Immédiatement, des désaccords se manifestent à propos des termes de l’union proposée avec la Serbie. Au projet fédéraliste d’inspiration germanique, défendu surtout par les Slovènes et les Croates, s’oppose le projet jacobin et centralisateur d’inspiration française, défendu surtout par les Serbes. Svetozar Pribićević, un Serbe de Croatie, président de la coalition croato-serbe et vice-président de l’État, souhaite une union immédiate et sans condition. D’autres, en faveur d’une fédération yougoslave, étaient plus hésitants, craignant que la Serbie n’annexe simplement les territoires sud-slaves de l’ex-Autriche-Hongrie. »
Ce paragraphe nous apprend deux points importants, le premier est la désunion des nations de la Yougoslavie et le second est que les Croates furent toujours soutenus par les allemands et les Serbes par la France.
L’entourage du Président Macron a complément oublié ce point, ah les jeunes qui ne connaissent pas l’Histoire !, en ne donnant pas la juste place au Président de la Serbie lors de la cérémonie de l’Arc de Triomphe le 11 novembre 2018.
Le président serbe fut relégué sur une tribune annexe, alors que sur la tribune principale se trouvait le premier ministre israélien, alors qu’Israël n’existait pas en 1918 et Erdogan le président de la Turquie ennemie.
Mais cette désunion fut aussi sensible et contre-productive lors du déclenchement de la guerre civile en Yougoslavie dans les années 1990, car les allemands et les français plutôt que d’œuvrer pour la paix et la réconciliation avaient retrouvé leurs pulsions anciennes : la première aidant la Croatie et l’autre allant soutenir la Serbie. Après les horreurs de cette guerre civile, l’Allemagne et France retrouvèrent la raison et eurent une position plus positive. Mais comme toujours, depuis 14-18, c’est à nouveau l’intervention de l’Allié américain qui mit fin à cette guerre.
Pour finir ce mot du jour écrit un peu rapidement, mais qui laisse percevoir combien cette Histoire reste prégnante dans l’Europe d’aujourd’hui, voici la carte de l’Europe après 14-18 et les guerres qui ont suivi immédiatement. Cette carte qui changera encore beaucoup après l’effondrement du bloc soviétique.

<1148>
- L’Autriche, le cœur de l’empire et sa capitale, Vienne, désormais disproportionnée, se resserre dans un tout petit État qui est devenu une République. Les dirigeants souhaitaient fusionner avec l’Allemagne, les anglo-saxons trouvaient l’idée acceptable, mais pas la France qui a opposé un veto à cette perspective;
-
Jeudi 15 novembre 2018
« La Pologne fête les 100 ans de sa renaissance »Une des conséquences de la première guerre mondialeJe dois avouer que je ne connais rien de la Pologne qui est pourtant le pays de ma mère.
Il faut savoir que dans les conséquences de la guerre 14-18, il y a aussi la renaissance de l’État de Pologne.
Le sentiment national est très fort dans le cœur des polonais, mais en 1914 ils n’avaient pas d’État.
 Le dimanche 11 novembre pendant que le Président Macron présidait les cérémonies du centenaire de l’armistice, entouré de nombreux chef d’Etat et de gouvernement, à Varsovie une foule de 200 000 polonais fêtait les 100 ans de l’indépendance de la Pologne dans une grande marche patriotique et une forêt de drapeau. <J’ai trouvé cette vidéo d’Euronews> qui l’évoquait en soulignant qu’aucun représentant important des Etats de l’Union européenne n’était venu se joindre au peuple polonais pour fêter ce grand jour pour eux. Il est vrai que le gouvernement polonais a pris des décisions concernant le Droit et l’Histoire qui l’ont mis sinon au ban de l’Union du moins rendu peu fréquentable.
Le dimanche 11 novembre pendant que le Président Macron présidait les cérémonies du centenaire de l’armistice, entouré de nombreux chef d’Etat et de gouvernement, à Varsovie une foule de 200 000 polonais fêtait les 100 ans de l’indépendance de la Pologne dans une grande marche patriotique et une forêt de drapeau. <J’ai trouvé cette vidéo d’Euronews> qui l’évoquait en soulignant qu’aucun représentant important des Etats de l’Union européenne n’était venu se joindre au peuple polonais pour fêter ce grand jour pour eux. Il est vrai que le gouvernement polonais a pris des décisions concernant le Droit et l’Histoire qui l’ont mis sinon au ban de l’Union du moins rendu peu fréquentable.
L’image qui illustre le mot du jour a été publiée dans un article, sur ce sujet, du journal <La République des Pyrénées>
La Pologne et les polonais ont connu, au long des siècles, un grand problème : leurs voisins.
Le territoire des polonais est pris en étau, comme entre un marteau et une enclume :
- A l’Ouest, il y a l’Allemagne, avant 1870 la Prusse
- A l’Est, il y a la Russie,
Ces deux immenses puissances avaient pris l’habitude de se partager ce territoire. Et nous savons qu’elles le referons, une dernière fois en 1939, du temps de Staline et de Hitler par le pacte que signerons Von Ribbentrop et Molotov.
Quand l’Allemagne envahira la Pologne ce sera le déclenchement de la seconde guerre mondiale. Parallèlement l’Union Soviétique attaquera à l’est.
En 1914, un troisième empire, l’Autriche-Hongrie, participait à la partition qui datait de 1795.
Pourtant, les historiens font de la Pologne un des plus anciens pays d’Europe et date sa fondation de l’an 966, date à laquelle on fixe la christianisation de la Pologne. Wikipedia nous apprend que cette christianisation est l’œuvre de Mieszko Ier, duc des Polanes, et c’est son fils Boleslas Ier le Vaillant qui deviendra le premier roi de Pologne, sacré en 1025.
J’ai trouvé un site français spécialisé pour les pays de l’est de l’Europe, Il s’appelle : <Visegradpost>. Ce site écrit :
« Le 11 novembre est un jour de fête et de commémorations en Pologne.
Depuis plusieurs semaines déjà, les drapeaux blancs et rouges flottent fièrement pour célébrer la liberté si chère au peuple polonais, et dont ce dernier a longtemps été privé. En 1795, la jadis puissante Pologne a totalement disparu de la carte de l’Europe au profit de ses voisins. De 1795 à 1918, l’Empire russe, la Prusse et l’Autriche se partageaient l’entièreté du territoire polonais.
Durant cette longue période de 123 ans, le pays fait l’objet d’une importante campagne de dépolonisation.
En plus de l’occupation du territoire, les envahisseurs russes et allemands ont également mené une politique visant à annihiler la « polonité ». Le simple usage du polonais dans les territoires occupés était sévèrement puni dans ce contexte de germanisation (à l’Ouest) et de russification (à l’Est). Ceci explique en partie l’attachement des Polonais à leur identité (nationale, culturelle, religieuse,…). Ce n’est qu’au moment de la signature de l’Armistice du 11 novembre 1918 que la Pologne est réapparue sur la carte du monde.
Il faut garder à l’esprit que la Pologne demeure l’un des plus anciens pays d’Europe. La fondation de l’État polonais date de l’an 966. Au cours du XVIIe siècle, la Pologne représentait une des plus grandes puissances européennes avec un territoire s’étendant sur une superficie (largement) supérieure à celle de la France actuelle (Royaume de Pologne-Lituanie, 815 000 km2). »
Cet article qui parle d’une disparition totale de la Pologne en 1795, néglige un petit épisode du à Napoléon Ier qui créa Le duché de Varsovie en 1807, sur des territoires partiellement polonais pris au royaume de Prusse lors du traité de Tilsit. Le roi de Saxe Frédéric-Auguste Ier, allié de Napoléon, devient aussi duc de Varsovie. En 1809, le duché reçoit des territoires repris à l’Empire d’Autriche. Il prend fin dès 1813, étant occupé par l’armée russe à la suite du désastre de la retraite de Russie.
L’époque la plus glorieuse ou du moins la plus puissante de la Pologne se situe au XV et XVI siècle quand elle s’allie avec la Lituanie pour donner « La République des deux Nations ». C’est pendant cette période que la Pologne renforcée de la Lituanie a pu mener plusieurs invasions contre la Russie, alors affaiblie par une période de troubles internes. Ses troupes parvinrent même à occuper Moscou du 27 septembre 1610 au 4 novembre 1612.
L’amoureux d’Opéra que je suis, se rappelle que dans le chef d’œuvre de Moussorgski « Boris Godounov » les troupes polonaises envahissent le plateau à la fin de l’Opéra. Ce n’est pas tout à fait exact, les troubles internes dont il était question dans le paragraphe précédent concernent cette période qui suit la mort d’Ivan le Terrible et la vacance du pouvoir en raison de la mort de sa lignée. C’est bien Boris Godounov qui était un proche du Tsar qui va prendre le trône. Mais il mourra subitement, le 13 avril 1605 à Moscou donc avant l’occupation de Moscou par les polonais en 1610.
Cela n’arrivera plus et l’expansion de l’Empire Russe au XVIIIème siècle prendra le chemin inverse et grignotera peu à peu le territoire polonais.
Les russes ne sont pas les seuls à envahir la Pologne, il y a aussi les suédois, les prussiens et aussi les turques.
L’Histoire retiendra les « Les trois partages successifs de la Pologne » qui auront lieu en 1772, 1793 et 1795.
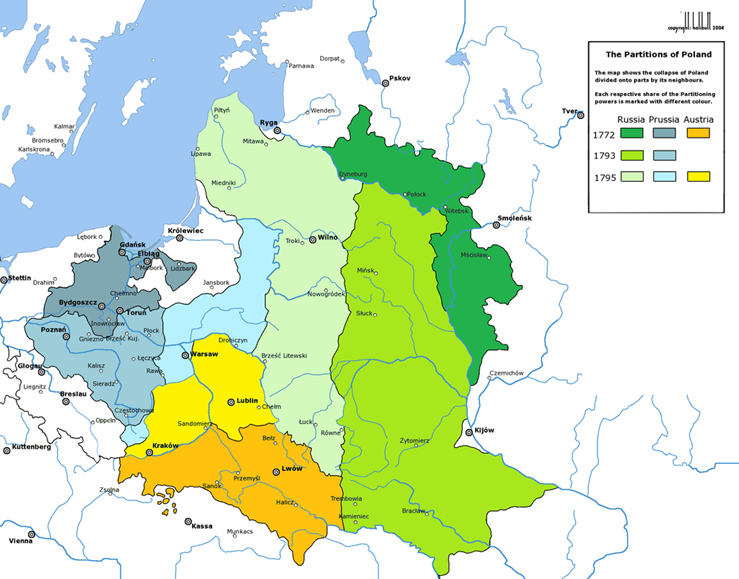
Wikipedia nous apprend :
« La première partition de la Pologne, en 1772, conduit à un sursaut civique. Ce sursaut mène en 1791 à la proclamation de la Constitution polonaise du 3 mai 1791, nettement moins « révolutionnaire » que celle de la France, mais, néanmoins perçue comme trop dangereuse pour ses voisins, d’où le deuxième partage, qui provoque une révolte menée par un héros de la guerre d’indépendance américaine, Tadeusz Kościuszko. Cette révolte sert de prétexte au troisième partage, quand le royaume de Pologne est rayé de la carte. »
Nous savons qu’il y a aura cependant pendant 6 ans l’existence du duché de Varsovie.
Mais pendant tout ce temps, le peuple polonais gardera sa fibre nationaliste. Les musiciens joueront un grand rôle : Chopin en raison de célébrité et dont la musique évoquera toujours sa Pologne natale qui n’existait plus en tant qu’Etat, il écrira notamment ses célèbres <Polonaises> et c’est un autre pianiste et compositeur Ignace Paderewski (1860-1941) qui jouera un rôle essentiel dans la renaissance de l’Etat polonais, ce sera d’ailleurs lui qui signera le Traité de Versailles au nom de la Pologne. Il aura surtout un rôle éminent auprès du Président américain Woodrow Wilson.
C’est ainsi que le président américain, dans son discours du 8 janvier 1918, prononcé devant le Congrès, inclut l’indépendance de la Pologne parmi ses Quatorze Points :
« Un État polonais indépendant devra être constitué, qui inclura les territoires habités de populations indiscutablement polonaises, [État] auquel devra être assuré un accès libre et sûr à la mer, et dont l’indépendance politique et économique et l’intégrité territoriale devraient être garanties par engagement international. »
La création de l’Etat polonais ne sera pas une partie facile, l’Allemagne est hors d’état de nuire, mais la Russie soviétique dans sa crise révolutionnaire s’attaque à la Pologne lors de la guerre russo-polonaise (février 1919 – mars 1921) car les frontières entre les deux États naissants, la Russie soviétique et la Deuxième République de Pologne n’avaient pas été clairement définies par le traité de Versailles. A la fin de la guerre le traité de 1921 se traduit pour la Pologne par des concessions territoriales au regard de la situation frontalière en avril 1920.

Et après le nouveau dépeçage de la Pologne entre l’Allemagne de Hitler et la Russie de Staline, les Polonais retrouveront un État en 1945, mais si peu indépendant car sous la coupe de l’Union Soviétique par l’intermédiaire du Parti Communiste qui s’appelait en Pologne le POUP : Parti ouvrier unifié polonais
On peut comprendre que les polonais continuent après cette longue histoire à se méfier des russes et peut être aussi des allemands.
La carte de la Pologne est aujourd’hui encore significativement différente de celle de 1921. Ainsi le Dantzig allemande est devenu Gdansk et la ville polonaise de Lwow est devenu ukrainienne sous le nom de L’viv. Varsovie s’est rapprochée de la frontière de l’Est et Poznan s’est éloignée de la frontière de l’Ouest. Bref, la Pologne a gagné sur l’Allemagne et a perdu sur l’Union Soviétique.
Les Européens exigeront comme condition de leur accord à la Réunification de l’Allemagne que cette dernière reconnaisse officiellement, en 1990, le tracé de la frontière polono-allemande appelé ligne Oder-Neisse

Si vous voulez en connaître davantage sur ce sujet pour pourrez lire sur le site du journal « La Croix » un entretien avec un historien américain : Timothy Snyder, qui parle de la complexité de cette nation jusqu’à aujourd’hui et aussi de ses parts d’ombre : <L’histoire de la Pologne, de la mort d’une civilisation à la naissance d’un État-nation>
<1147>
- A l’Ouest, il y a l’Allemagne, avant 1870 la Prusse
-
Mercredi 14 novembre 2018
« Ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur et de mon courage »Dernière lettre d’un soldat français en 1917 à son épouse et à sa filleDans la suite du mot du jour d’hier, dans lequel je m’interrogeais sur le vrai apport du haut commandement français dans la victoire finale, je voudrais partager aujourd’hui un témoignage.
Ce témoignage est une lettre d’adieu à l’amour de sa vie d’un soldat qui va être fusillé pour l’exemple. Il faut savoir se détacher des concepts et du refuge rassurant des idées pour redescendre à hauteur d’homme pour saisir la vérité du vécu.
Quelquefois les faits et le témoignage sont si forts qu’ils sont leçon de vie et d’Histoire.
«Le 30 mai 1917
Léonie chérie
J’ai confié cette dernière lettre à des mains amies en espérant qu’elle t’arrive un jour afin que tu saches la vérité et parce que je veux aujourd’hui témoigner de l’horreur de cette guerre.
Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique.
Aujourd’hui, les rives de l’Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n’est plus que champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne.
En plus des balles, des bombes, des barbelés, c’est la guerre des mines avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales, nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise, épaisse, collante dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s’écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements et des crânes, l’odeur est pestilentielle.
Tout manque : l’eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal ravitaillés, la galetouse est bien vide !
Un seul repas de nuit et qui arrive froid à cause de la longueur des boyaux à parcourir.
Nous n’avons même plus de sèches pour nous réconforter parfois encore un peu de jus et une rasade de casse-pattes pour nous réchauffer.
Nous partons au combat l’épingle à chapeau au fusil. Il est difficile de se mouvoir, coiffés d’un casque en tôle d’acier lourd et incommode mais qui protège des ricochets et encombrés de tout l’attirail contre les gaz asphyxiants. Nous avons participé à des offensives à outrance qui ont toutes échoué sur des montagnes de cadavres.
Ces incessants combats nous ont laissé exténués et désespérés. Les malheureux estropiés que le monde va regarder d’un air dédaigneux à leur retour, auront-ils seulement droit à la petite croix de guerre pour les dédommager d’un bras, d’une jambe en moins ?
Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie.
Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au Chemin des Dames.
Ce fut un échec, un désastre ! Partout des morts !
Lorsque j’avançais les sentiments n’existaient plus, la peur, l’amour, plus rien n’avait de sens. Il importait juste d’aller de l’avant, de courir, de tirer et partout les soldats tombaient en hurlant de douleur. Les pentes d’accès boisées, étaient rudes.
Perdu dans le brouillard, le fusil à l’épaule j’errais, la sueur dégoulinant dans mon dos. Le champ de bataille me donnait la nausée. Un vrai charnier s’étendait à mes pieds. J’ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés, une haine terrible s’emparant de moi.
Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion.
Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les mensonges de l’état-major. Tous les combattants désespèrent de l’existence, beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher. Des tracts circulent pour nous inciter à déposer les armes. La semaine dernière, le régiment entier n’a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée, nous avons refusé de continuer à attaquer mais pas de défendre.
Alors, nos officiers ont été chargés de nous juger. J’ai été condamné à passer en conseil de guerre exceptionnel, sans aucun recours possible.
La sentence est tombée : je vais être fusillé pour l’exemple, demain, avec six de mes camarades, pour refus d’obtempérer. En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectif d’aider les combattants à retrouver le goût de l’obéissance, je ne crois pas qu’ils y parviendront.
Comprendras-tu Léonie chérie que je ne suis pas coupable mais victime d’une justice expéditive ?
Je vais finir dans la fosse commune des morts honteux, oubliés de l’histoire.
Je ne mourrai pas au front mais les yeux bandés, à l’aube, agenouillé devant le peloton d’exécution. Je regrette tant ma Léonie la douleur et la honte que ma triste fin va t’infliger.
C’est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus et que ma fille grandira sans moi.
Concevoir cette enfant avant mon départ au combat était une si douce et si jolie folie mais aujourd’hui, vous laisser seules toutes les deux me brise le cœur. Je vous demande pardon mes anges de vous abandonner.
Promets-moi mon amour de taire à ma petite Jeanne les circonstances exactes de ma disparition. Dis-lui que son père est tombé en héros sur le champ de bataille, parle-lui de la bravoure et la vaillance des soldats et si un jour, la mémoire des poilus fusillés pour l’exemple est réhabilitée, mais je n’y crois guère, alors seulement, et si tu le juges nécessaire, montre-lui cette lettre.
Ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur et de mon courage car la France nous a trahi et la France va nous sacrifier.
Promets-moi aussi ma douce Léonie, lorsque le temps aura lissé ta douleur, de ne pas renoncer à être heureuse, de continuer à sourire à la vie, ma mort sera ainsi moins cruelle.
Je vous souhaite à toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai pas vous donner.
Je vous embrasse, le cœur au bord des larmes. Vos merveilleux visages, gravés dans ma mémoire, seront mon dernier réconfort avant la fin.
Eugène ton mari qui t’aime tant.»
Je ne peux exclure le fait que parmi les soldats fusillés, il y en eut qui ont fauté et qui n’ont pas su faire face à leur devoir.
Mais j’ai l’intuition qu’un grand nombre était comme cet Eugène qui acceptait de se battre, de défendre sa ligne et sa patrie mais pas de se lancer à l’attaque sans autre raison que se sacrifier sur l’autel de l’inutile. Quelquefois l’art sait montrer ce que les paroles sont incapables de décrire. Stanley Kubrick a réalisé ce film remarquable, si longtemps interdit en France : «Les Sentiers de la gloire». <Cet extrait du film montre un tel épisode d’attaque insensée >.
Mais pourquoi n’a-t-on pas, au minimum, jugé et condamné Nivelle ?
J’ai trouvé ce témoignage parmi d’autres sur le site du centenaire de 14-18 du pays du haut limousin.
Vous trouverez la page sur laquelle se trouve cette lettre derrière ce lien : https://centenaire1418hautlimousin.jimdo.com/lettres-des-poilus/lettres-de-poilus-et-des-familles/
<1146>
-
Mardi 13 novembre 2018
«Les puissances centrales perdent la guerre parce que le temps joue contre elle »Arndt Weinrich, chercheur à l’Institut historique allemand, spécialiste de la Première Guerre mondialePourquoi l’Allemagne et les Puissances Centrales ont-elles perdu la guerre 14-18 ?
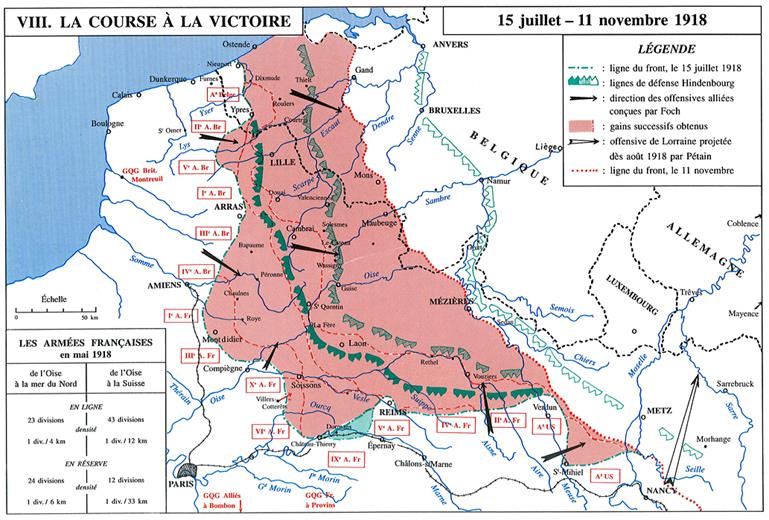 Les allemands répondent : « parce qu’on a poignardé l’armée allemande dans le dos ». D’abord le gouvernement civil qui n’a pas assez soutenu l’armée, puis les communistes qui ont commencé à faire la révolution dans tous le pays et ont affaibli la nation. Bientôt d’autres viendront et diront que c’est la faute des juifs.
Les allemands répondent : « parce qu’on a poignardé l’armée allemande dans le dos ». D’abord le gouvernement civil qui n’a pas assez soutenu l’armée, puis les communistes qui ont commencé à faire la révolution dans tous le pays et ont affaibli la nation. Bientôt d’autres viendront et diront que c’est la faute des juifs.
Les tenants de cette thèse présentent un argument factuel, l’Armée allemande était toujours sur le territoire français et belge, chez l’ennemi donc. Elle n’était donc pas vaincue.
Un dessin vaut mieux qu’un long discours, et si on regarde la carte du front au 11 novembre 1918, on voit que c’est exact. En 1918, Metz était en Allemagne mais le front ne l’avait pas encore atteint. Quand on regarde les autres villes sur le front Mons, Maubeuge, Mézières … pas de ville allemande.
Dès leur retour à Berlin, on leur dira : « Vous n’avez pas été vaincu ». Vous constaterez aussi qu’en face du Maréchal Foch, l’autorité allemande n’a pas envoyé un de ses généraux mais un civil : Matthias Erzberger.
Les français répondent autre chose. La France a gagné la guerre grâce à ses généraux. Le Maréchal Foch a gagné la guerre, voici ce qu’on lit encore dans les livres d’histoire et puis on associe d’autres généraux et maréchaux à cette célébration.
Mélenchon qui, une fois de plus aurait mieux fait de se taire, a twitté : « Le maréchal Joffre est le vainqueur militaire de la guerre de 14-18. »
Le maréchal Joffre qui était partisan de « l’offensive à outrance » qui a couté tellement de vies de soldats sans faire avancer pour autant les lignes ou de manière si dérisoire.
« Attaquons comme la lune »
Philippe Meyer dans son émission de ce dimanche attribua ce mot contre l’attaque à outrance et contre Joffre à Lyautey. Mais il se trompait, je sais depuis que ce mot était en réalité du général Lanrezac qui fut (limogé dès le 3 septembre 1914) par Joffre lui-même.
Les généraux français ont peut-être pu parfois décider d’une bonne stratégie ponctuelle, ils ont surtout, comme les généraux allemands d’ailleurs, été de grands pourvoyeurs d’assauts inutiles et meurtriers.
Je ne pense pas qu’ils méritent la gloire que l’on a voulu leur donner.
Et pour essayer de comprendre pourquoi l’Allemagne a perdu, je vous propose de lire l’analyse de cet historien d’origine allemande mais qui travaille en France : Arndt Weinrich. L’article dont je donne des extraits est encore une fois extrait de cette remarquable revue historique : « L’Histoire » et le titre de l’article est : « Pourquoi les puissances centrales ont perdu »
Il faut rappeler pour bien comprendre le texte qui suit que les « Alliés » ou l’«Entente » représentent la France, la Grande Bretagne, la Russie etc alors que l’Allemagne, l’Autriche Hongrie et l’Empire Ottoman sont appelés « Les puissances centrales ».
« A bien des égards, la question de savoir pourquoi les Puissances centrales ont perdu doit être inversée, pour s’interroger sur pourquoi elles ont réussi à tenir si longtemps ?.
Un rapide survol sur quelques chiffres clés permet de comprendre à quel point l’Allemagne, et cela est encore plus vrai pour son allié le plus proche, l’Autriche –Hongrie, était particulièrement mal inspirée de poursuivre une politique d’escalade en juillet 1914 : l’éclatement de la guerre met aux prises 118 millions d’Allemands et d’Autrichiens-Hongrois avec plus de 260 millions de Français, Russes, Britanniques et Serbes.
Un rapport de force démographique qui ne tient même pas compte des empires infiniment plus importants du côté de l’Entente (400 millions). Cela se traduit sur le plan militaire, par une nette supériorité numérique : ainsi, au début de la guerre, les puissances centrales mobilisent 6,3 millions de soldats contre quelques 9 millions du côté Allié. Sur toute la durée du conflit, et en tenant compte des différents pays venant renforcer les deux camps, 26 millions de mobilisés des puissances centrales se sont trouvés en face de presque 47 millions de mobilisés Alliés.
Sur le plan économique, ô combien important dans une guerre industrielle comme la Grande guerre, la situation est également très favorable à l’Entente : l’Allemagne avait beau être une puissance industrielle et technologique de tout premier plan, le PIB de l’Entente, était déjà en 1914, supérieur de 60 % à celui des puissances centrales. En 1917, avec l’entrée en guerre des États-Unis, première puissance économique mondiale, la situation devint rapidement intenable pour ces dernières.
Le rapport des forces économiques paraît encore plus déséquilibré si l’on tient compte du fait que l’économie allemande était très intégrée dans le commerce global et dépendait des importations de matières premières, importation compromise avec le blocus mis en place par la Royal Navy dès 1914, mais aussi parce que l’Allemagne, et l’on tend aujourd’hui à négliger cet aspect, faisait la guerre à ses principaux fournisseurs !
Avant 1914, l’état-major allemand avait évidemment conscience de cette infériorité structurelle, mais, au lieu d’en tirer la conclusion qu’il fallait éviter la guerre à tout prix, il en va à considérer que celle-ci pouvait être gagnée à condition qu’elle soit courte, c’est-à-dire si l’on arrivait à arracher, en frappant le plus dur et le plus rapidement possible, une victoire décisive.
Le plan Schlieffen, avec lequel l’Allemagne attaqua en août 1914 en lançant très vite l’offensive sur la France à travers le Luxembourg et la Belgique, est l’illustration la plus parlante de cet état d’esprit. […]
On comprend le désarroi du chef d’état-major allemand Helmuth von Moltke après la bataille de la Marne, en septembre 1914 qui permet aux Français d’arrêter l’avancée allemande. […]
Évidemment tout n’était pas perdu pour les puissances centrales ; après tout, la guerre n’est pas un exercice d’arithmétique où il suffirait de compter les effectifs, le potentiel démographique et économique pour déterminer le vainqueur. Reste que, à partir de ce moment-là, le temps de cessa de jouer en faveur des Alliés. […]
D’où la tentation de prendre des risques pour en finir à tout prix : c’est sur cette toile de fond qu’il faut comprendre la décision allemande de déclarer la guerre sous-marine à outrance en février 1917, décision qui s’est révélée non seulement inefficace pour arracher la victoire, mais qui a tout au contraire contribué à rendre la situation désespérée en entraînant les États-Unis et donc leur potentiel militaire et économique dans la guerre.
Fondamentalement donc, les puissances centrales perdent la guerre parce que le temps joue contre elle ; c’est un premier élément de réponse à la question de départ. […]
Et à partir de 1916, la situation alimentaire devient extrêmement préoccupante. Au début de 1917, à la sortie d’un hiver particulièrement rude l’apport calorique de la ration journalière, à l’arrière, tomba à 1000 calories, ce qui est largement insuffisant déclenchant des émeutes de la faim dans bon nombre de villes allemandes. En Autriche-Hongrie la situation était encore plus préoccupante.
Or, au lieu de chercher à tout prix une issue politique, les gouvernements misèrent, et la pression du Haut commandement allemand joua un rôle déterminant, sur une paix victorieuse, politique à risque, dont la poursuite tendit à aggraver la situation jusqu’à ce qu’elle devienne intenable. Dans une certaine mesure, la défaite est donc aussi dû, et cela est un deuxième élément de réponse, à un problème de gouvernance, le pouvoir civil s’éclipsant progressivement devant le militaire, qui arrive à imposer la décision. […]
Dans ce contexte, la plus importante des causes immédiates de la défaite a sans doute été la décision allemande de repasser à l’offensive sur le front occidental [début 1918] afin de tenter le tout pour le tout : obtenir une victoire décisive avant l’arrivée massive des troupes américaines. […]
Chacune des cinq offensives allemandes […] avait certes permis une avancée parfois assez spectaculaire, in fine, elles se sont toutes enlisées et ses échecs répétés ont porté le coup de grâce au moral des troupes, d’autant plus que les pertes ont été élevées : quelques 900 000 morts et blessés, qu’il était impossible de remplacer.
Erich Ludendorff, l’homme fort du Haut commandement allemand depuis 1916, avait joué sa dernière carte et il avait perdu. Avec le succès des offensives alliées à partir du 8 août, la « journée noire de l’armée allemande» (selon les propos mêmes de Ludendorff ) il devenait clair que celle-ci n’était plus en mesure de s’opposer pour longtemps aux coups de butoir de l’Entente et des Américains qui jouissaient d’une double supériorité technologique et numérique allant crescendo (plus de 2 millions de soldats américains étaient en France au moment de l’armistice).
Ludendorff est obligé de le reconnaître lui-même quand il demande le 28 septembre 1918, au gouvernement de négocier le plus rapidement possible, ce qui ne l’empêchera pas de devenir, dans l’immédiate après-guerre, l’un des promoteurs les plus farouches de la légende du coup de poignard. »
Et il ajoute
« Ce n’est qu’une fois convaincus (à très juste titre au vu du rapport de force militaire) de l’inévitabilité de la défaite que les soldats et les marins refusent d’obéir. […] Ce fut, en d’autres termes, la défaite qui engendra la révolution et non l’inverse n’en déplaise aux propagandistes de la légende du coup de poignard. »
J’ai lu cette même thèse chez d’autres historiens. Le romantisme et l’exaltation du récit c’est bon pour faire rêver. Mais la réalité est plus prosaïque, l’Allemagne a perdu parce que démographiquement, économiquement et du point de vue des ressources en énergie et en alimentation, les puissances centrales disposaient de moyens largement inférieurs à ceux de l’Entente. Et devant ce déséquilibre, si la guerre avait continué, l’armée française aurait continué jusqu’à Berlin. C’est ce que savait le Haut commandement militaire allemand qui pressait le gouvernement de demander la paix.
Elles n’ont pas gagné, en outre, parce qu’elles ne disposaient pas d’un général génial capable par des manœuvres audacieuses et déstabilisantes de surpasser au début de la guerre ce déséquilibre de moyens.
Et l’Entente et les français n’avaient pas non plus de général génial sinon ils auraient dû gagner bien avant.
En revanche, les soldats des deux côtés et les officiers qui se battaient avec eux, au-delà de toute raison, ont été d’un héroïsme que je qualifierai d’inhumain.
J’avais consacré le <mot du jour du 19 février 2016> à la bataille de Verdun qui avait commencé le 21 février 1916.
Et j’avais cité un livre que j’avais lu : « L’enfer de Verdun évoqué par les témoins».
Pour débuter la bataille, les allemands ont déclenché sur 60 km de front un bombardement qui a duré 9h.
Les généraux allemands ont alors lancé leurs fantassins sur le terrain pensant qu’ils ne rencontreront que des cadavres et qu’ils pourront progresser sans résistance jusqu’à Verdun et voilà ce qui va se passer :
« Leurs chefs n’escomptent aucune réaction, considérant que tout a été détruit devant eux. La marche, de 50 à 900 m, s’effectue l’arme à la bretelle. Certaines de ces colonnes franchissent sans s’en apercevoir l’emplacement fumant de ce qui a été notre première ligne, tant il a été pioché et retourné.
Les sections d’assaut progressent, en différents points, de 3 km sans se heurter à la moindre résistance.
D’autres sections voient avec stupeur d
 es fantômes titubants se dresser au bord des trous d’obus. Hébétés, épuisés, sourds, à demi-fous, les survivants obéissent à un réflexe de désespoir, de rage et de vengeance. Nos hommes balancent des grenades, s’ils en ont ; tirent, si leur fusil s’y prête malgré la terre qui le couvre ; ils ont mis baïonnette au canon. Les fantassins allemands s’aplatissent au sol, dégoupillent des grenades, placent en batterie des mortiers de tranchées, lancent des fusées, téléphonent à l’artillerie ; ils ont beau être à 10 contre un, ils sont stoppés !»
es fantômes titubants se dresser au bord des trous d’obus. Hébétés, épuisés, sourds, à demi-fous, les survivants obéissent à un réflexe de désespoir, de rage et de vengeance. Nos hommes balancent des grenades, s’ils en ont ; tirent, si leur fusil s’y prête malgré la terre qui le couvre ; ils ont mis baïonnette au canon. Les fantassins allemands s’aplatissent au sol, dégoupillent des grenades, placent en batterie des mortiers de tranchées, lancent des fusées, téléphonent à l’artillerie ; ils ont beau être à 10 contre un, ils sont stoppés !»
Et ces hommes hagards vont arrêter l’avancée allemande laissant le temps aux renforts de venir se positionner devant l’armée du Kronprinz.
Je ne vois pas pour quelle raison on honore les maréchaux et généraux davantage que les autres soldats. Comme eux, ils ont fait leur travail, quelquefois bien, souvent mal en ne tenant aucun compte des enjeux au regard des vies humaines dont ils exigeaient le sacrifice.
Dans la revue l’Histoire, j’ai vu cette reproduction d’un tableau de William Orpen qui était le peintre officiel de l’armée britannique. Celui-ci est un hommage au soldat inconnu britannique en France. Dans un premiers temps il était prévu de représenter, autour de ce cercueil, des dignitaires britanniques. Finalement Orpen décida de les supprimer de ce tableau.
Je pense qu’il a eu raison quand on sait ce que nous savons aujourd’hui.
<1145>
-
Lundi 12 novembre 2018
« La première guerre mondiale ne s’est pas terminée le 11 novembre 1918 »Retour sur la vérité historiqueBien sûr le 11 novembre 1918 à 11 heures, il s’est passé un évènement considérable, la puissance principale des empires centraux, l’Allemagne, a signé l’armistice. Le front occidental a fait taire les armes.
Mais ce n’est ni le début, ni la fin de la fin de la guerre.
Ainsi, il y avait eu 5 armistices avant celui du 11 novembre à Rethondes :
- 9 décembre 1917 entre la Roumanie et l’Allemagne (Focsani)
- 15 décembre 1917 entre la Russie bolchevique et l’Allemagne (Brest-Litovsk)
- 29 septembre 1918 entre la Bulgarie et les Alliés (Salonique)
- 30 octobre 1918 entre l’Empire ottoman et les Alliés (Moudros)
-
3 novembre 1918 entre l’Autriche-Hongrie et l’Italie (Villa Giusti près de Padoue)
En outre il y a déjà un Traité de paix celui de Brest-Litovsk (3 mars 1918) entre la Russie Bolchevique et les puissances centrales.
D’autres affrontements prennent bientôt ou ont déjà pris le relais. Entre 1917 et 1923 on ne recense pas moins de 27 conflits violents en Europe (1)
D’abord des guerres civiles :
- Finlande (janvier –mai 1918)
- Plus connue la guerre civile russe (1917-1923)
Il est d’ailleurs courant de considérer que sans la grande guerre, les souffrances des soldats russes et le fait que la guerre a permis aux révolutionnaires bolcheviques d’être armés, la révolution d’octobre n’aurait pas pu avoir lieu.
Le grand historien français François Furet dans son livre « Penser le XXème siècle » considère que la première guerre mondiale et son avatar, la révolution bolchevique, constituent :
« La matrice du XXème siècle »
Mais il y a d’autres guerres civiles :
- En Allemagne (1918-1919). C’est ainsi qu’on parlera des spartakistes qui forment alors le Parti communiste d’Allemagne. Mais la révolte spartakiste à Berlin en janvier 1919 sera écrasée. Les figures emblématiques du mouvement Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont tués.
- En Irlande (1922-1923) où la guerre civile succède à la guerre d’indépendance (janvier 1919–juillet 1921).
Dans l’article de la revue « L’Histoire » cité ci-après, il est affirmé que des corps francs allemands vont intervenir en Irlande avec « des armes et des tactiques héritées du conflit mondial. » Rappelons que les corps francs allemands vont constituer l’ossature des futurs SA qui seront la milice des nazis et leur outil de terreur pour la prise du pouvoir.
Et puis il y a les guerres entre États.
La guerre soviéto-polonaise de (février 1919 – mars 1921) qui est l’une des conséquences de la Première Guerre mondiale et qui est justifié par des conflits de frontière. Ce conflit fera 150 000 morts.
Et enfin la guerre gréco-turque (1919-1922), 45 000 morts, qui constituera la grande victoire de Mustafa Kemal et permettra d’arriver à cette conclusion que l’Empire ottoman fait partie des vaincus de la grande Guerre et la Turquie parmi les vainqueurs.
En réalité l’armistice n’est pas la fin de la guerre mais n’est qu’une interruption temporaire des combats. La fin des hostilités n’interviendra officiellement qu’au moment des traités de paix.
Et l’article de « L’Histoire » de préciser que :
« Face au chaos qui suit la Première Guerre mondiale, les historiens ont pris l’habitude, depuis les années 2000, de préférer la notion de « sortie de guerre » à celle d’«après-guerre » utilisée jusque-là par l’histoire diplomatique. »
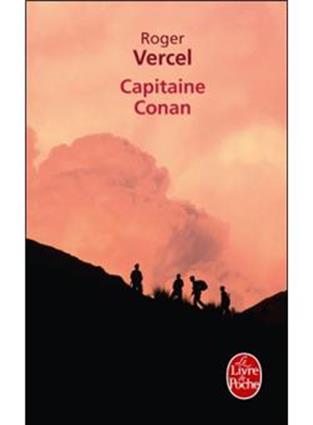 Et il rappelle :
Et il rappelle :
« Dans son roman Capitaine Conan (1934, adapté à l’écran par Bertrand Tavernier en 1996), Roger Vercel signale l’absurdité d’une coupure nette entre guerre et paix, lorsqu’il décrit un régiment français de l’armée d’Orient, miné par la dysenterie, sur les bords du Danube. C’est là, le 22 novembre en début d’après-midi, qu’on leur lit le communiqué de Foch qui s’achève par ces mots : « L’armistice est entré en vigueur, ce matin à 11 heures » Entre le 11 novembre 1918 et le 28 juin 1919, temps suspendu entre guerre et paix, les armées alliées procèdent à une lente démobilisation. »
(1) Je tire la plus grande partie de ces informations de l’article : « L’interminable sortie de la guerre » de la revue « L’Histoire » : « 1918 Comment la guerre nous a changés »
<1144>
- 9 décembre 1917 entre la Roumanie et l’Allemagne (Focsani)
-
Vendredi 9 novembre 2018
« Mourir pour la Patrie.»Ernst Kantorowicz, historien allemandCe dimanche nous serons le 11 novembre 2018.
Il y a cent ans le 11ème jour du 11ème mois de l’année à 11 heures, les armes de guerre se sont tues sur le front occidental.
Depuis fin septembre 1918, l’état-major allemand avec à leur tête Erich Ludendorff et Paul von Hindenburg a compris que la guerre était perdue pour les allemands, bien que la ligne de front continuait à rester sur le territoire français.
Le 1er octobre 1918, Erich Ludendorff envoie un télégramme au cabinet impérial :
« Envoyer immédiatement un traité de paix. La troupe tient pour le moment mais la percée peut se produire d’un instant à l’autre ».
Par la suite plusieurs échanges auront lieu entre l’état-major allemand et l’état-major alliés avec à sa tête le Général Foch. Parallèlement la situation sociale et politique se dégrade en Allemagne.
Le 9 novembre, le Kaiser allemand abdique et part en exil aux Pays-Bas. Il y a donc exactement 100 ans aujourd’hui.
Et, le 11 novembre, à 2 h 15 du matin, Matthias Erzberger, représentant du Gouvernement allemand emmène la délégation allemande dans le wagon français, dans la clairière de Rethondes, sur la commune de Compiègne dans l’Oise. Pendant près de 3 heures, les Allemands négocient en essayant d’obtenir des atténuations sur chacun des 34 articles que compose le texte. Entre 5 h 12 et 5 h 20 du matin, l’armistice est signé avec une application sur le front fixée à 11 heures du matin, et ce pour une durée de 36 jours qui sera renouvelée trois fois, la dernière fois pour une durée illimitée.
Wikipedia nous apprend :
« Le dernier jour de guerre a fait près de 11 000 tués, blessés ou disparus, […] Certains soldats ont perdu la vie lors d’actions militaires décidées par des généraux qui savaient que l’armistice avait déjà été signé. Par exemple, le général Wright de la 89e division américaine prit la décision d’attaquer le village de Stenay afin que ses troupes puissent prendre un bain, ce qui engendra la perte de 300 hommes.[…]
À 10 h 45 du matin, Augustin Trébuchon a été le dernier soldat français tué ; estafette de la 9e compagnie du 415e régiment de la 163e division d’infanterie, il est tué d’une balle dans la tête alors qu’il porte un message à son capitaine.
[…] l’Américain Henry Gunther est généralement considéré comme le dernier soldat tué lors de la Première Guerre mondiale, 60 secondes avant l’heure d’armistice, alors qu’il chargeait des troupes allemandes étonnées parce qu’elles savaient le cessez-le-feu imminent.
La date de décès des morts français du 11 novembre a été antidatée au 10 novembre par les autorités militaires. Pour les autorités militaires, il n’était pas possible ou trop honteux de mourir le jour de la victoire. »
Le Président Macron a entrepris entre le 4 novembre et le 9 novembre un pèlerinage sur les lieux des combats qu’il a appelé « Une itinérance mémorielle».
Le 11 novembre il sera à l’arc de triomphe avec de nombreux chefs d’Etat pour commémorer, mais commémorer quoi ?
Dans l’émission Esprit Public de ce dimanche 4 novembre Thierry Pech a eu cette itinérance intellectuelle et interrogative :
« C’est le centenaire de la première guerre mondiale. Au-delà des stratégies politiques, il faut se demander : qu’est-ce qu’on célèbre ?
A quoi veut-on réfléchir à l’occasion de ce centième anniversaire ?
C’est cela qui m’inquiète.
On peut continuer à faire ce que l’on a toujours fait.
Célébrer la bravoure de nos hommes tombés au combat.
Ce récit-là, il a cent ans
Quand Lionel Jospin à la fin des années 1990 a essayé de faire une place à ceux qui n’étaient pas dans le souvenir de la gloire et de la fureur, c’est-à-dire les mutins de 1917, on l’a accusé de néo révisionnisme.
Je ne sais pas à quoi on a envie de réfléchir.
D’ailleurs a-t-on envie de réfléchir ?
La guerre de 14, cela a été la découverte de la mort de masse.
Et il a fallu, après 10 millions de morts, 10 millions de morts !, il a fallu essayer d’habiller de symboles et de sens cette chose qui risquait aux yeux de tous de n’en avoir aucun.
[Et à partir de là] on a déployé des dépenses symboliques, des dépenses invraisemblables à donner du sens à ce qui s’était passé.
A ce qui ressemblait si l’on regardait de loin à un grand suicide des puissances européennes.
C’était cela la première guerre mondiale.
Et la France s’est échiné à interdire les bruits dissonants.
On a interdit pendant 20 ans les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick.
On a interdit pendant plus de 50 ans la chanson de Craonne, on a préféré la marseillaise. […]
J’aimerais qu’on réfléchisse vraiment à ce qu’a été cette guerre.
Le grand historien allemand, juif exilé, Ernst Kantorowicz a écrit un très bel article dédié à cette idée « mourir pour la patrie »
A la fin de cet article il a dit : « il faut donner du sens à la mort au combat sinon elle passera pour un meurtre de sang-froid et son souvenir prend la valeur et la signification d’un accident de circulation politique un jour de fête légale.»
Ce à quoi il faudrait réfléchir : comment en sommes nous arrivés là, à un grand suicide collectif des puissances européennes ? »
J’ai retrouvé la citation exacte que Thierry Pech citait de mémoire qu’Ernst Kantorowicz écrivait dans son article « mourir pour la patrie » en 1951 :
« Nous sommes sur le point de demander au soldat de mourir sans proposer un quelconque équivalent réconciliateur en échange de cette vie perdue. Si la mort du soldat au combat (…) est dépouillée de toute idée embrassant l’humanitas, fût-elle Dieu, roi ou patria, elle sera aussi dépourvue de toute idée anoblissante du sacrifice de soi. Elle devient un meurtre de sang-froid, ou, ce qui est pire, prend la valeur et la signification d’un accident de circulation politique un jour de fête légale.»
Lors de son itinérance, j’ai entendu Emmanuel Macron répéter :
« Ces soldats sont morts pour sauver la patrie ! »
La seconde guerre mondiale est l’enfant de la première, la conséquence inéluctable de la guerre et des traités de paix. Mais la seconde guerre mondiale a un sens : la défaite des nazis. L’élimination d’une idéologie monstrueuse et des crimes inimaginables qui ont été perpétrés au nom de cette abomination.
Mais la première ?
Si les soldats français sont morts pour sauver la patrie, pour quel objectif les soldats allemands sont-ils morts ?
Sans la guerre 14-18, étant donné ma famille et le lieu de leur habitation, je serais probablement allemand et non français. Serait-ce un drame ?
Les soldats allemands sont morts en 14-18 et n’ont pas sauvé leur patrie. Ils sont cependant « morts pour la patrie »
Des soldats allemands sont aussi morts en 39-45 et ont perdu la guerre. Heureusement ! j’ajouterai pour celle-ci.
Il y a eu des destructions énormes, des souffrances dus à la guerre.
Mais est-ce qu’aujourd’hui les allemands vont plus mal que les français ?
Alors est-il vraiment juste de dire que « Ces soldats sont morts pour sauver la patrie ! » ?
Bien sûr que non !.
Mais il faut raconter ce récit, ce mythe pour rendre acceptable cette tuerie, ce massacre d’humains qui se sont entretués sans se connaître au profit d’humains qui se connaissaient et ne se sont pas entretués, selon le mot de Paul Valéry.
Le chef d’œuvre de Bertrand Tavernier : « La vie et rien d’autre », dans lequel, en 1920, le commandant Dellaplane (Philippe Noiret) est chargé de recenser les soldats disparus sur les champs de bataille et d’en tenir la comptabilité se termine par une lettre que Delaplane écrit à Irène (Sabine Azéma) qui cherchait, pendant la durée du film, son mari disparu. La dernière phrase de cette lettre donne cette information :
« C’est la dernière fois que je vous importune avec mes chiffres terribles, mais par comparaison avec le temps mis par les troupes alliées à descendre les champs Élysées pour le défilé de la victoire, environ 3 heures, j’ai calculé que dans les mêmes conditions de vitesse de marche et de formation réglementaire, le défilé des morts de cette inexpugnable folie, n’aurait pas durée moins de 11 jours et de 11 nuits. »
Je vais tenter dans les jours qui suivent de m’interroger sur ce que cette guerre atroce a changé pour nous et pour le monde.
<1143>
-
Jeudi 8 novembre 2018
«L’opinion pense […] que l’esclavage est un phénomène anecdotique.Prendre conscience de son ampleur est difficile car il s’agit d’une réalité souterraine cachée.»Sylvie O’DY, présidente du comité contre l’esclavage modernedans le Un du 17 octobre 2018J’ai déjà évoqué à plusieurs reprises l’hebdomadaire « Le Un » qui chaque semaine ne traite que d’un sujet.
Le N° 221 du 17 octobre 2018 traitait du sujet de l’esclavage moderne et portait pour titre : « Esclavage : ça se passe près de chez vous »
Ce qu’il y a de bien avec ce journal c’est qu’on peut acheter facilement des numéros anciens par exemple sur ce site.
Nous apprenons donc que :
« Depuis l’abolition de 1848, l’esclavage est censé avoir disparu du territoire français. Il persiste pourtant dans les faits, et son ampleur est loin d’être anecdotique. Selon l’Organisation internationale du travail, il y a en France près de 129 000 personnes victimes d’une forme « moderne » de cette pratique. Des réseaux criminels, organisant la traite humaine, jouent d’ailleurs un rôle majeur dans ce phénomène dont les migrants, en particulier les femmes et les enfants, sont les premières victimes. Pour les associations, il est urgent que les autorités comme les citoyens prennent davantage conscience de cette situation. »
Le journal donne notamment la parole à Sylvie O’Dy membre fondateur du comité contre l’esclavage moderne (CCEM) qui détaille les principales formes de l’esclavage moderne en France au nombre de quatre :
- l’esclavage sexuel ;
- l’esclavage domestique ;
- le travail forcé ;
- la mendicité forcée.
Elle explique :
« À chaque fois, les victimes, le plus souvent d’origine étrangère, ont reçu la promesse d’un travail rémunéré et d’une régularisation de leur situation. Ce sont des personnes trompées. Des personnes qui arrivent pleines d’espoir et qui se retrouvent en enfer. Elles sont sous l’emprise de leurs exploiteurs, enfermées, maltraitées, privées de leurs papiers d’identité.
Quand la journaliste Dominique Torrès a fondé le Comité contre l’esclavage moderne en 1994, c’était pour dénoncer l’esclavage domestique. Puis nous nous sommes aussi intéressés aux victimes du travail forcé. Des associations s’occupaient déjà de la prostitution forcée.
Pendant très longtemps nous avons accueilli 95% de femmes. Aujourd’hui elles représentent 70% des victimes pour 30% d’hommes »
Les chiffres qui sont donnés sont les suivants :
- 40,3 millions de personnes seraient victimes d’esclavage moderne dont 129 000 en France.
-
Parmi elles, 24,9 millions seraient victimes de travail forcé.
Dont :
- 16 millions dans le secteur privé (travail domestiques, bâtiment ou agriculture)
- 4,8 millions seraient exploitées sexuellement
- Et 4 millions contraintes de réaliser des travaux forcés par des autorités publiques
- 16 millions dans le secteur privé (travail domestiques, bâtiment ou agriculture)
- 15,4 millions seraient prisonnières d’un mariage forcé
Et une victime sur 4 est un enfant.
L’agriculture est un domaine où l’esclavage moderne existe. Un article est consacré à ce sujet : « Des tomates au goût de sang »
Cet article est écrit par l’écrivain Laurent Gaudé, qui a eu le prix Goncourt en 2004 :
« Chaque été, dans les Pouilles, à la fin du mois d’août, c’est le même ballet : les camions se chargent de cagettes de tomates récoltées dans la plaine de Foggia et roulent vers Naples en une longue file ininterrompue de véhicules. Cet été, la tragédie est venue rappeler à l’Italie ce qu’elle savait déjà mais qu’elle s’était empressée d’oublier : les tomates ont parfois le goût du sang. Les 4 et 6 août 2018, coup sur coup, deux accidents terribles ont coûté la vie à seize travailleurs agricoles, tous étrangers. L’Italie a alors découvert qu’il existait des ombres en Europe, des travailleurs invisibles dont on ne connaît l’existence qu’en apprenant leur mort.
A la suite de ces accidents, les langues se sont déliées pour décrire ce qu’on ose à peine appeler des « conditions de travail » […]
D’un coup la tomate, symbole ensoleillé de l’Italie, devient aussi celui de l’exploitation. La sauce que l’on trouve en bouteille dans les supermarchés, la sauce qui s’étale sur les pizzas ou sert à faire le sugo della pasta est le fruit d’un travail d’esclaves. […]
Ces évènements tragiques nous saisissent parce que nous découvrons avec stupéfaction que les objets que nous utilisons au quotidien peuvent avoir été fabriqués dans des conditions de misère. Soit sur le sol européen. Soit à l’autre bout du monde.
Le paradoxe d’aujourd’hui est que notre monde exploite un autre monde, tout en ignorant parfaitement qu’il le fait. »
Il est aussi question d’une nigériane qui a été recrutée pour servir d’esclave sexuelle en France :
« Mains tendues face à elle, paumes vers le ciel, Rose* répète les mots du sorcier, une pointe de nervosité dans la voix : « Je jure d’obéir et de ne jamais contacter la police, quoi qu’il arrive. » Nous sommes en 2016, dans l’État d’Edo, au sud-ouest du Nigeria. À l’intérieur d’un temple de l’époque précoloniale, une adolescente se soumet, comme des milliers d’autres femmes avant elle, à la cérémonie du « juju », un rituel de magie noire.
Intimidée, Rose se plie aux ordres de l’homme au visage maquillé et vêtu d’une étoffe rouge et blanche. Elle ingère un foie de volaille cru, une poignée de noix de kola et une fiole d’alcool, avant de se laisser couper les ongles. Voués à être conservés par le sorcier, ces derniers ont tout d’une relique de mauvais augure. Si la jeune femme rompt sa promesse, le mauvais sort s’abattra.
À 16 ans, Rose est candidate pour l’Europe. Sa vie vient de basculer, quelques heures avant la cérémonie, lorsqu’« une amie de la famille » qu’elle « considère comme sa mère » l’a abordée alors qu’elle se promenait seule aux abords du village : « Rose, que dirais-tu d’aller étudier en France ? »
Avant-dernière d’une fratrie de sept enfants, l’adolescente a vu sa sœur aînée partir en Europe quelques années plus tôt pour rejoindre les bancs de l’école. Rêvant de marcher dans ses pas, elle accepte sur-le-champ. »
Puis l’article raconte son odyssée à travers la Libye où elle doit payer une rançon et voit des geôliers libyens tuer des récalcitrants en vendre d’autres pour du sexe.
En France elle tombe entre les mains d’une souteneuse qu’elle appelle « madam »et qui la force à se prostituer pour lui faire rembourser une dette que cette dernière prétend correspondre aux dépenses engagées pour lui payer le voyage depuis le Nigeria. Elle parviendra à s’échapper et même à retrouver sa sœur qui était tombé dans des mains similaires.
« En France, le nombre de victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle a considérablement augmenté au sein de la communauté nigériane ces deux dernières années. Selon le dernier rapport du GRETA – un groupe d’experts en lutte contre la traite des êtres humains, rattaché au Conseil de l’Europe –, cette recrudescence concerne tout particulièrement des mineures de moins de 15 ans, les plus jeunes étant âgées de seulement 11 ans. Un phénomène observé par le Bus des femmes, une structure parisienne destinée aux personnes prostituées, où « 300 à 400 victimes potentielles de traite sont identifiées chaque année », selon sa responsable, Vanessa Simoni. »
Julien Bisson le rédacteur en chef du magazine « Lire » a écrit un article : « Se forcer à les regarder » qu’il conclut ainsi :
« Ceux qui ne veulent pas le croire doivent lire ce numéro pour prendre la mesure du phénomène. Ou encore regarder le documentaire Cash Investigation diffusé il y a quelques jours et qui dévoile les sombres dessous du luxe à la française : des travailleurs sénégalais, contraints de travailler treize par jour dans des tanneries, au milieu des vapeurs chimiques, sous une température de 45 degrés, dans des conditions qu’on croyait d’un autre siècle. Alors la France peut bien annoncer la construction prochaine d’un mémorial, dans le jardin des Tuileries, pour rendre hommage aux victimes de l’esclavage, ce dernier n’est pas seulement une affaire de mémoire. C’est encore, hélas ! Une (mauvaise) histoire, qu’il faudra bien se forcer, un jour à regarder en face. »
<1142>
- l’esclavage sexuel ;
-
Mercredi 7 novembre 2018
« Attention les vieux ! »Un jeune enfant sur une trottinetteAvec Annie, nous marchions tranquillement, côte à côte sur le trottoir tout près de notre domicile.
L’espace disponible sur ce trottoir est diminué en raison d’arbres majestueux qui embellissent la rue.
Un enfant de 4 ou 5 ans, juché sur une trottinette, à laquelle par une action vigoureuse il tentait de donner une belle vitesse, arrivait à notre rencontre.
Je sentais une légère angoisse chez ce tout petit homme dont le visage esquissait un sourire crispé.
Il n’était pas sûr de pouvoir nous éviter et je pense qu’il éprouvait aussi une crainte de ne pas pouvoir freiner suffisamment.
Devant cette situation complexe et stressante, il a pensé que la meilleure solution était d’en appeler à notre bienveillance.
Il a alors lancé d’une voix forte et assurée :
« Attention les vieux !»
Notez-bien que dans l’échelle des impertinences, il aurait pu aller plus loin en criant : « Poussez-vous les vieux !». Mais il n’a pas du tout usé de cette injonction autoritaire, simplement pour nous préserver d’un choc qui aurait pu nous être préjudiciable, il a tenté de nous convaincre qu’il vaudrait mieux que nous nous écartions.
Nous n’étions pas tout à fait seul sur ce trottoir, mais nous étions les seuls qui marchions côte à côte.
Et pour nous distinguer des autres piétons, il a cherché à nous caractériser, à nous désigner par un mot qui nous permette de comprendre immédiatement qu’il s’agissait de nous. Et cela a fonctionné. Nous avons tout de suite compris que « les vieux » c’était nous.
Nous nous sommes donc écartés et Annie a quand même lancé à l’enfant que c’était un peu impertinent de nous traiter de vieux.
Sa mère qui suivait à pied n’a absolument pas compris ce qui se passait, montrant par-là que beaucoup de choses échappent aux parents.
Derrière nous, un jeune garçon d’une vingtaine d’années qui lui avait suivi parfaitement la scène a voulu nous rassurer :
« Mais non vous n’êtes pas vieux. Simplement de manière relative par rapport à lui, ce jeune garçon vous classe dans les vieux ».
Nous avons chaleureusement remercié ce garçon plein de sollicitude et de compréhension.
Je vous ai raconté un fait qui nous est arrivé. Les lecteurs attentifs du mot du jour savent que je trouve « moyen » de s’arrêter aux faits.
Il faut donc que je continue pour aller un peu plus loin dans la réflexion.
Je ne m’arrêterais pas à la question de savoir si à soixante ans on est vieux. Une chose est certaine on vieillit chaque jour et si on devient vieux c’est une bonne nouvelle, c’est une victoire de la vie. Car si on ne devient pas vieux, c’est qu’on est mort avant. « Vie » constitue d’ailleurs étonnamment les trois premières lettres de vieux.
On pourrait aussi, peut-être parler des trottinettes qui circulent sur les trottoirs et de la difficile cohabitation avec les piétons. <C’est pourquoi Paris veut interdire les trottinettes sur les trottoirs>
De manière plus globale, on pourrait évoquer ce que l’on a eu pour habitude d’appeler « les modes doux » de circulation, c’est-à-dire une alternative à la voiture.
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu’en observant l’attitude de certains, l’adjectif « doux » semble totalement inapproprié. Dans l’esprit de ces personnes, il ne s’agit pas de mode « doux » mais de mode « rapide », je veux dire plus rapide que les voitures embouteillées.
J’ai la faiblesse de penser que ce n’était pas cela que l’on imaginait quand on parlait de mode « doux ».
Mais ce fait me conduit surtout à penser à la question du rythme de la vie : il faut être efficace, rapide, gérer intelligemment son temps. Mais dans une société où il y a de plus en plus de vieux comment faire ? Comment concilier, se faire se rencontrer le temps du vieux et le temps du jeune startupper cher au cœur d’Emmanuel Macron ?
Prenons, le cas extrême des vieux en EHPAD et des soignants qui n’ont pas de temps, qui doivent réaliser leurs interventions à une vitesse peu compatible avec le temps des vieux et une durée frustrante au regard de l’attente de l’ainé.
On pourrait imaginer que le progrès et l’automatisation constituent une ressource pour laisser plus d’espace au « temps de l’humain ».
Mais tel n’est pas le cas, le progrès et l’automatisation aujourd’hui ne nous donnent pas davantage de temps, mais nous rendent davantage contraints à la vitesse comme si nous devions servir le progrès, les machines, les flux financiers et d’autres choses qui accélèrent notre temps.
Sylvain Menétrey et Stéphane Szerman ont bien écrit le livre « Slow attitude ! » et dont le sous-titre est « Oser ralentir pour mieux vivre ».
J’ai trouvé aussi cet article qui parle d’un film de Gilles Vernet « Tout s’accélère » qui est une réflexion sur le temps. A travers les yeux d’écoliers de CM2 et appuyé par l’avis de physiciens, de psychologues et d’écologistes, le documentaire décrypte le rythme frénétique de notre monde et appelle au ralentissement.
L’article nous apprend :
« Gilles Vernet est un ancien trader. L’accélération du monde, il la vivait au quotidien car à Wall Street, chaque seconde compte. Optimisation, efficacité, rapidité, rentabilité… cette spirale infernale s’est arrêtée le jour où Gilles Vernet a appris que sa mère était mourante. Deux ans, c’était le temps qu’il lui restait à vivre. Deux ans, c’est aussi « ce temps » qui a produit le déclic chez le réalisateur. « Le choc m’a fait passer à l’acte » confit-il.
Gilles Vernet abandonne le monde de la finance. Devenu instituteur, il interroge ses élèves sur la cadence démesurée de notre société. Pourquoi travailler si vite ? Le monde ralentira-t-il un jour ? »
Nous sommes vraiment dans la problématique des modes doux, du temps doux.
<1141>
-
Mardi 6 novembre 2018
« La Loi Gayssot est contreproductive, car elle fait des négationnistes des martyrs »Emmanuel PierratHier, je vous présentais le livre d’Emmanuel Pierrat « Nouvelles morales, nouvelles censures » et j’insistais sur les nouvelles censures qu’il dénonçait concernant l’art, le communautarisme et la morale.
Mais son propos concerne aussi la censure qui s’applique pour différentes raisons, morales, d’auto censures et aussi légales à l’expression d’avis divergents, gênants et même faux.
Je vous renvoie vers l’émission déjà citée hier sur France Inter et qui pose cette question fondamentale : « Faut-il des limites à la liberté d’expression ? »
La semaine dernière j’évoquais la mort de Robert Faurisson, celui que Robert Badinter accusait d’être un faussaire de l’Histoire.
La question est de savoir s’il vaut mieux accepter de le laisser s’exprimer et de le contester par des arguments ou le faire taire et le condamner par la justice s’il refuse de se taire sur ces sujets.
La France a choisi de le faire taire en promulguant différentes lois dont la plus célèbre est la Loi Gayssot du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.
Emmanuel Pierrat est résolument contre ce type de Loi et il dit que : « La Loi Gayssot est contreproductive, car elle fait des négationnistes des martyrs ».
Il en appelle à d’autres opposants à cette Loi comme l’historien Jean-Pierre Azema et surtout Pierre Vidal-Naquet qui fut l’un des premiers et des plus virulents adversaires de Faurisson, un ancien camarade khâgne qu’il a toujours détesté , son père Lucien et sa mère Marguerite sont morts à Auschwitz.
Pierre Vidal-Nacquet était résolument contre ce qu’il appelait les Lois mémorielles, disant que ce n’est pas le rôle du politique de dire ce qu’il faut dire et ne pas dire, mais de la controverse intellectuelle.
Il préconisait plutôt qu’il ait le droit d’écrire une préface à chaque ouvrage de Faurisson.
C’est un débat passionnant qui part de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
« Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »
Les limites reposent dans la définition de l’abus de la liberté.
Dans l’émission de France Inter cité, Emmanuel Pierrat comme Natacha Polony sont pour la liberté d’expression la plus grande possible, alors que Raphaël Glucksman préfère la restreindre quelque peu par précaution et ne pas permettre par exemple de nier l’existence des chambres à gaz sous peine de sanctions.
Emmanuel Pierrat explique qu’en faisant cela, on n’a pas confiance dans l’intelligence des citoyens et on provoque des réactions négatives, complotistes et qui font de « salauds » des martyrs.
Cette question se pose aussi quant à la publication d’une édition critique des pamphlets antisémites de Céline par Gallimard qui suite à des réactions indignées a renoncé en s’autocensurant. Il pourrait aussi être question des écrits de Charles Maurras.
Aux Etats-Unis, la liberté d’expression permet aux opinions racistes et antisémites de s’exprimer, mais critiquer la religion ou publier des caricatures de Mahomet est impossible. On a la censure différenciée !
Si je dois donner mon avis, je reste indéfectiblement confiant dans la démocratie. Et quand on défend la démocratie on croit que collectivement les citoyens sont assez intelligents pour voter. Et s’ils ont assez d’intelligence pour voter, ils sont assez intelligents pour se faire une opinion quand on leur présente des arguments. Dès lors, je pense comme Emmanuel Pierrat qu’il faut laisser la plus large place à la liberté d’expression. On ne peut pas et on ne doit pas interdire tout ce que l’on réprouve. Je reste persuadé que limiter l’expression libre constitue un chemin plus dangereux pour la liberté que la prétention de vouloir préserver le plus grand nombre d’opinions scandaleuses.
Je vous renvoie vers cet excellent débat : « Faut-il des limites à la liberté d’expression ? »
<1140>
-
Lundi 5 novembre 2018
« Nouvelles censures »Emmanuel PierratDans le monde, il n’y a finalement pas beaucoup de pays où la liberté d’expression est respectée.
Le pays le plus peuplée, la Chine, est un exemple parfait de cette triste réalité, il semblerait que même elle exporte son ignoble savoir-faire.
Dans tous les États du monde où la religion est prédominante et impose sa vue à la société, comme en Iran, en Arabie Saoudite ou au Pakistan, il ne saurait exister de liberté d’expression. Les dictatures comme la Corée du Nord ne connaissent pas non plus ce concept déstabilisant.
A un degré légèrement atténué, les démocraties illibérales ou démocratures comme la Turquie, la Russie et la Hongrie ne tolèrent qu’une liberté d’expression très tempérée.
Alors dans nos pays occidentaux, de démocraties libérales, sommes-nous épargnés ? Nous pourrions l’espérer.
Mais ce n’est plus le cas.
Dans nos pays, ce n’est que très rarement l’État et le gouvernement qui exercent cette censure, la censure est aujourd’hui beaucoup plus le fait d’action privée, d’individus, mais surtout d’associations, de ligues et même d’entreprises.
<Facebook a ainsi censuré et fermé le compte d’un internaute>.
Parce qu’il faisait l’apologie du terrorisme ou développait des idées racistes ou sexistes ?
Non c’est parce qu’il avait osé publier « L’origine du monde » la célèbre toile de Gustave Courbet réalisé en 1866 et qui montre le sexe nu d’une femme, dont on sait aujourd’hui qu’il s’agit très probablement de Constance Quéniaux.
 L’artiste Laina Hadengue, a voulu, quant à elle, présenter, sur Instragram, son œuvre « le fil des jours » dont vous voyez une copie.
L’artiste Laina Hadengue, a voulu, quant à elle, présenter, sur Instragram, son œuvre « le fil des jours » dont vous voyez une copie.
Elle fut immédiatement censurée d’Instagram pour ce bout de sein et son compte fut fermé.
Pour ne se pas retrouver « dans un monde d’images sans pensées », elle vient de lancer un blog « Toute Licence pour l’art » ouvert aux témoignages de tous les artistes, écrivains et autres créateurs victimes de ces nouvelles formes de censures.
Blog que vous trouverez derrière le lien qui se trouve sur le nom de l’artiste.
L’avocat Emmanuel Pierrat explique :
« Les géants des réseaux sociaux ambitionnent de dominer tous les marchés mondiaux ; et donc d’être regardables dans la très catholique Pologne ou la pieuse Arabie Saoudite. (…) On peut regretter que cet excès de moralisme des réseaux sociaux soit contre-productif et participe au contraire à entretenir dans la société un rapport malsain à la nudité. »
Emmanuel Pierrat est très préoccupé par le sujet de la censure sous toutes ses formes, notamment modernes.
Il vient d’écrire un livre très intéressant publié le 11 octobre que j’ai acheté : « Nouvelles morales, nouvelles censures ».
J’ai découvert Emmanuel Pierrat, grâce à deux émissions radio que j’ai écouté :
D’abord la Grande Table d’Olivia Gesbert du 23 octobre 2018 « Y a-t-il une censure « morale » ? »
Puis le « Grand Face à Face d’Ali Baddou » du 27 octobre 2018 : « Faut-il des limites à la liberté d’expression ? »
Pour être complet sort en novembre un autre livre sous sa direction : « Le grand livre de la censure » qui est présenté ainsi :
« La censure est, hélas, aussi éternelle qu’universelle : elle a condamné le philosophe grec Socrate à boire la mortelle ciguë pour avoir prôné la parole libre, et les œuvres de l’artiste contemporain Ai Weiwei sont traquées par des dizaines de milliers de fonctionnaires chinois sur les blogs et les réseaux sociaux. Dans ce Grand Livre de la censure, celle-ci est visitée au gré de ses différentes obsessions : les bonnes mœurs, la religion, la politique et le pouvoir, la préservation de la santé, le maintien de dogmes scientifiques, tout comme la lutte contre le « pacifisme », la drogue, la sorcellerie ou encore le « socialement incorrect ».[…] À travers près de deux cents affaires anciennes ou contemporaines, franco-françaises ou au retentissement mondial, en mêlant les grands scandales qui ont marqué leur époque et d’autres interdictions moins connues méritant d’être sorties de l’oubli, Emmanuel Pierrat fait comprendre que la censure est, depuis toujours, le miroir de l’humanité et de nos peurs. »
Ce sujet me parait particulièrement important, surtout qu’il est devenu dans nos contrées extrêmement insidieux.
Nous sommes des enfants ou des produits de la liberté d’opinion et d’expression, c’est notre oxygène, c’est du moins le mien.
Emmanuel Pierrat est avocat, il a notamment défendu Michel Houellebecq en 2002 pour ses propos sur l’Islam dans « Lire » en 2001. Il raconte comment une ligue musulmane a attaqué Houellebecq et n’a pas réclamé la censure de l’article mais des dommages intérêts de plusieurs centaines de milliers d’euros avec le motif de réparer le préjudice moral subi en raison des propos de l’écrivain.
Ce n’est donc plus l’État qui dans ce cas censure et interdit de publier un livre, le met « à l’index », mais une association privée qui par le biais de la justice et de l’argent entend faire taire les opinions qui lui déplaisent. Cette fois-là c’est Houellebecq et son avocat qui ont gagné le procès.
Ce point est fondamental ce n’est plus l’État qui agit, d’ailleurs Pierrat dit :
« L’État prend de moins en moins position, il est très perdu dans ses repères. »
Dans l’émission la Grande Table, Emmanuel Pierrat raconte que Pasqua avait tenté, lorsqu’il était ministre de l’intérieur, une telle expérience de censure de livres (il s’agissait notamment d’écrits de défense de la cause homo sexuelle) qui avait tourné au fiasco et depuis, affirme l’avocat, l’Etat n’agit plus sur ce terrain.
Ce sont donc des initiatives privées qui vont chez nous exercer ce vilain métier de censeur.
Quelquefois il s’agit banalement d’intérêts financiers. Emmanuel Pierrat a également défendu Olivier Malnuit, le rédacteur en chef de Technikart, qui avait lancé le site « jeboycottedanone » contre Danone. L’avocat de Danone avait simplement affirmé :
« que la liberté d’information ne devait pas faire oublier la liberté d’entreprendre, qui est tout aussi légitime. »
Dans ces deux cas la censure prend la forme de la menace d’une sanction financière devant dissuader le contrevenant de faire « mauvais » usage de sa liberté d’opinion et peut être même le ruiner.
Mais ce sujet est beaucoup plus vaste et Emmanuel Pierrat, dans son livre « Nouvelles morales, nouvelles censures » énumère de nombreux cas de censure « privée » d’aujourd’hui.
Il commence les 15 chapitres de son livre par : « cachez … » ces auteurs, ces mots, cette histoire qui n’est pas la miennes, ces livres pour enfants, ce passé etc…
Il cite notamment Carmen à l’opéra de Florence (page 39) qui pour l’amateur d’opéra que je suis est particulièrement stupide
En janvier dernier, au Teatro del Maggio à Florence, le Directeur suggère au metteur en scène Leo Muscato de réécrire la fin du célèbre opéra Carmen de Bizet. Vous savez que dans Carmen, qui est à l’origine une nouvelle de Prosper Mérimée, l’héroïne est poignardée à la fin de l’opéra Don José qui est fou de jalousie. Or pour les « pieds nickelés » du théâtre florentin, il ne peut être envisagé au XXième siècle d’applaudir le meurtre d’une femme. Cette remarque défie le sens, on applaudit la puissance dramatique de l’opéra par le meurtre d’une femme. Mais la mise en scène de Leo Muscato nous livre une Carmen qui tire sur son ancien amant pour se défendre et le tue.
Pour Emmanuel Pierrat et pour moi, amputer cet opéra de son dénouement tragique est une trahison et une censure du chef d’œuvre de Georges Bizet.
Dans le premier chapitre « Cachez ces auteurs et ces artistes que je saurais voir » Emmanuel Pierrat pose cette question (page 15) :
« Peut-on encore distinguer une œuvre et la vie de son auteur ? [car] une nouvelle morale semble prendre le pas sur la raison. Certains veulent désormais censurer des créations culturelles au motif que leurs auteurs, voire leur interprètes, auraient eu un comportement moralement blâmable »
Car ces auteurs n’ont, pour la plupart, pas été condamné par la justice et même dans ce cas une fois subi la sanction de la justice, toute personne condamnée à le droit de se réinsérer dans la société. Enfin, il faut distinguer l’œuvre et l’auteur.
Il cite les films de Polanski quel que soit leur propos, ne seraient plus programmables. C’est comme pour Woody Allen pour lequel les appels au boycott se multiplient.
De même deux expositions consacrées à Chuck Close et Thomas Roma, deux artistes américains de renom aux prises avec #MeToo ont été annulées par le National Gallery of Art de Washington.
Alors que dans tous ces cas les œuvres ne posent pas problème, mais on veut interdire l’auteur.
 Le deuxième chapitre s’intitule « Cachez la couleur de l’auteur » et Emmanuel Pierrat de citer de multiples exemples où il n’est plus accepté que l’on puisse défendre une cause, réaliser une œuvre artistique au profit d’une cause si l’on n’a pas les caractéristiques ethniques de celles et ceux qui ont subi les violences que l’on dénonce.
Le deuxième chapitre s’intitule « Cachez la couleur de l’auteur » et Emmanuel Pierrat de citer de multiples exemples où il n’est plus accepté que l’on puisse défendre une cause, réaliser une œuvre artistique au profit d’une cause si l’on n’a pas les caractéristiques ethniques de celles et ceux qui ont subi les violences que l’on dénonce.
Par exemple :
« Au printemps 2007, à l’occasion de la biennale du Whitney Museum de New York. La toile « Open Casket », signée Dana Schutz, s’inspirait d’un cliché très connu du visage déformé d’Emmet Till, un adolescent lynché en 1955. Le hic ? Dana Schutz est une artiste blanche, que plusieurs groupes d’activistes ont accusé de battre monnaie avec un « spectacle dont , en Caucasienne, elle n’a jamais eu à affronter la terrible expérience. La destruction du tableau était demandée et, faute de l’obtenir, les militants se sont relayés pour le masquer aux visiteurs. » (page 34)
Vous voyez une reproduction de cette toile et <Ici> un article qui parle de cet évènement.
« En 2017 ; c’est aussi le film Detroit de Kathryn Bigelow qui se voyait stigmatisé. Son tort ? avoir pour sujet les émeutes raciales de l’été 1967, mais surtout, avoir été réalisé par une cinéaste blanche. Le fait qu’elle soit une femme : sans importance ? oscarisée ? Presque un défaut. » (page 35)
Il n’y a pas que les noirs, dans une pièce de théâtre on a reproché à un metteur en scène d’avoir confié le rôle d’un bossu à l’acteur avec lequel il avait l’habitude de travailler et non à un bossu. (page 37)
Ne croyez pas que la France soit épargnée :
« En août 2016 déjà, un camp d’été « décolonial » était interdit aux personnes blanches car il était « réservé uniquement aux personnes subissant à titre personnel le racisme d’État en contexte français » (page 36)
Ce mot du jour est déjà particulièrement long et je vous renvoie vers les émissions données en lien et bien sûr à ce petit ouvrage de 158 pages. « Nouvelles morales, nouvelles censures »
Un dernier exemple cependant dans le chapitre « cachez ces livres pour enfants » (page 10) où il rappelle :
« Dans les années 1990, le Front national, lorsqu’il avait gagné quelques mairies du sud de la France s’était lancé dans une croisade contre certains livres proposés dans les bibliothèques municipales. Des années plus tard, en 2014, c’est au tour de Jean-François Copé de vouloir jeter « Tous à poil ! » dans un autodafé médiatique. »
Ces nouvelles censures sont bien plus insidieuses que les anciennes, par la peur des sanctions financières ou tout simplement la crainte des ennuis et des insultes ces manœuvres aboutissent de plus en plus à des réactions d’auto censure qui donnent finalement la victoire aux censeurs à l’esprit étroit qui s’agitent dans ce monde.
Je finirais par la conclusion du livre :
« La culture nous est vitale. Dans sa diversité, avec ses travers, ses hauts et ses bas, ses chefs-d’œuvre et ses classiques, ses avant-gardes et son passé.
C’est ce qui nous fait réfléchir, nous rend humains, nous fait vibrer. C’est une boussole qui nous guide vers la liberté et la créativité.
Ne perdons pas le cap. »
<1139>
-
Vendredi 2 novembre 2018
« Accapareurs de rêves »Richard V. ReevesC’est Mon ami Daniel qui a attiré mon attention sur cet article paru dans Slate et écrit par Monique Dagnaud Sociologue, directrice de recherche au CNRS : « Le diplôme, instrument de domination sociale des classes aisées américaines »
Nous savons qu’il est important de s’intéresser aux Etats-Unis puisque ce qui arrive là-bas le plus souvent se passe chez nous quelques années après.
C’est un article intéressant, en outre, parce qu’il évoque le concept de « Premier de cordée » cher à notre Président de la République.
Il s’agit d’une analyse des liens entre les plus riches et le système éducatif :
« Tout le monde a le sentiment que la réussite scolaire est socialement biaisée, en France comme dans beaucoup d’autres pays. Mais aux États-Unis, la grâce rendue à la compétition universitaire constitue le pendant de la vénération envers la société de marché et les jeux de concurrence.
La place que se taillent aujourd’hui les cadres sup’ et les professions intellectuelles au sommet de la société en témoigne: cette catégorie, en deux ou trois générations, a su capter en sa faveur les ressources croisées de l’éducation, de la culture, des revenus, des bons emplacements résidentiels (situés à proximité des écoles d’excellence), de la santé et de la –relative– stabilité familiale. »
Bref pour devenir riche aux Etats-Unis, il vaut mieux que les parents le soient aussi. Ce clivage qui se creuse est aussi une explication de l’élection de Trump.
L’article cite un ouvrage de 2017, d’un philosophe et politicien Richard V. Reeves, Dream Hoarders («Accapareurs de rêves») :
« Richard Reeves a quitté sa ville natale anglaise de Peterborough, tant il ne supportait plus le snobisme de classe régnant au Royaume-Uni. Lui-même issu d’un milieu populaire, il espérait en traversant l’Atlantique pouvoir baigner dans une «vraie société démocratique», où chaque individu est d’abord jugé pour lui-même –et en particulier dans les strates élevées de la société. Or c’est aux États-Unis qu’il découvre la société la plus cadenassée par les titres universitaires.
Le mythe américain de la méritocratie scolaire permet aux couches supérieures de justifier leur position par leur brillance intellectuelle et leurs efforts assidus bien plus que par la chance ou par un système parfaitement rodé. Au moins, la classe supérieure anglaise a la décence de se sentir coupable.
De cette stupéfaction est né un livre très documenté sur la façon dont les couches supérieures américaines, de plus en plus souvent formées dans les universités d’élite, ont édifié une digue de séparation avec la société, faisant éclater en mille morceaux le rêve américain du pays où chacun ou chacune a ses chances.
L’étude de Richard Reeves concerne le sommet de la pyramide des revenus, les 20% de personnes les plus aisées (le premier quintile). Les résultats sont imparables: c’est en facilitant l’accès de leur progéniture aux diplômes les plus élevés que les riches ont assuré leur maintien dans le haut de l’échelle sociale, un tournemain qui emboîte avec maestria revenus hérités et optimisation de l’effort éducatif.
Quelque 46% de leurs enfants quittent l’université avec le plus haut niveau d’éducation, et 76% atteignent un niveau éducatif très satisfaisant (l’indicateur retenu est le nombre d’années de scolarisation) –un score spectaculaire par rapport aux autres catégories: dans le quatrième quintile, juste en dessous, la proportion de hauts diplômes est plus de deux fois moindre.
Le collège –premier niveau des études supérieures aux États-Unis– auquel on accède s’avère le marchepied crucial de ces parcours d’excellence. Une claire corrélation se dessine entre le niveau de revenus des parents et les colleges de l’Ivy League, le summum étant détenu par Harvard, qui comprend 65% d’enfants appartenant aux familles du top 20%, et presque aucun des strates les plus pauvres.
Sur deux ou trois générations, le tremplin du collège s’est révélé une redoutable machine de sélection sociale, car l’accès à ces institutions se solde d’une pléiade d’avantages: sociabilité dans le milieu des personnes biens nées, accès à des réseaux tout au cours de la vie, meilleures chances pour des stages et des emplois et, last but not least, atout pour que votre progéniture puissent être recrutée par ce même collège. »
Bien sûr, le milieu social est fondamental à la maison pour stimuler l’évolution cognitive des enfants :
« Le parcours de l’enfant suit ensuite des balises que l’on connaît bien dans le système français: stimulation intellectuelle et abondance de jeux éducatifs dès le premier âge, suppression des écrans pendant la toute petite enfance, création d’un environnement protégé des risques et des violences, sélection d’écoles à pédagogie innovantes, dîners familiaux animés, suivi des devoirs et aides de profs à la maison, et multiplication des activités extra-scolaires. Chez ces parents, on parle en moyenne trois heures de plus aux enfants par semaine que dans les milieux modestes, ce qui étend le vocabulaire et favorise la dextérité argumentative: un word podometer, de fait, permet de mesurer l’exposition des jeunes à la diversité du vocabulaire.
Comme l’explique Richard Reeves, «nous ne sommes pas juste des parents, nous pratiquons le métier de parent». Un chercheur a d’ailleurs construit un indice de qualité du «parenting». Son étude longitudinale menée dans le cadre de la statistique nationale montre que près de 35% des ménages situés dans les 20% les plus aisés pratiquent une parentalité très active (et 4% une parentalité de faible intensité), contre moins de 5% pour les ménages situés dans les quatre derniers déciles des revenus (et 57% de parentalité de faible intensité). »
Et bien sûr, ces gens se marient entre eux :
« Ce tour d’horizon sur l’entre soi des 20% serait incomplet si l’on omettait une donnée essentielle, le renforcement de l’homogamie des mariages dans la classe aisée américaine. Depuis le boom de l’enseignement supérieur et son ouverture aux femmes, on se marie entre niveaux universitaires équivalents.
«Loin d’abandonner le mariage, les Américains diplômés l’ont réhabilité au profit d’une institution éducative adaptée à l’âge de l’économie de la connaissance.» David Brooks, auteur de Bobos in Paradise, démarre son livre par une succulente exploration des annonces matrimoniales du New York Times des années 2000.
«Si vous regardez le carnet mondain, vous pouvez sentir la force qui se dégage de tous ces taux de réussite aux examens d’entrée à l’université.» »
La conclusion est particulièrement intéressante :
« Une enquête sur la philosophie politique des créateurs et créatrices d’entreprises de la Silicon Valley, lieu où abondent les personnes très hautement diplômées et où la quête de talents constitue un leitmotiv des sociétés, démontre combien un sentiment de légitimité tranquille s’est installé dans ces milieux.
Les leaders du web se révèlent, comme on pouvait s’y attendre, radicalement pro business: peu favorables aux syndicats, elles et ils revendiquent l’extension des libertés d’entreprendre et pensent, entre autres, que le système scolaire pourrait être amélioré s’il était géré comme une entreprise.
Leur vision de la société est celle d’une méritocratie génératrice d’inégalités. Ces dirigeantes et dirigeants ne sont pas choqués par les écarts colossaux de revenus: pour elles et eux, les revenus doivent être alignés sur la contribution que chacun apporte à la société, ce qui induit naturellement des inégalités entre les individus. D’ailleurs, et sans plus de précaution, elles et ils «pensent que les citoyens n’ont pas tous le même potentiel, le même talent, pour contribuer à la société».
Ces premières et premiers de la cordée scolaire se lovent dans la bonne conscience de qui a remporté un marché à la loyale, à l’instar du self-made man qui se sent légitime par les risques qu’il a pris et les investissements qu’il a déployés pour développer ses affaires.
Dans le nouveau monde, on croit aux vertus du marché et de la compétition, et personne n’a envie de trop se prendre la tête pour savoir si la sélection scolaire résulte d’une concurrence réellement libre et non faussée. Les 20% se sentent pleinement de leur bon droit sur leur Olympe: le problème, c’est qu’ils sont de plus en plus souvent les seuls à le penser. »
Ce qui est très inquiétant, c’est cette bonne conscience et cette croyance que tous ceux qui ont envie et travaillent très fort peuvent monter en haut de l’échelle sociale.
J’avais, en m’inspirant d’émissions de Brice Couturier, développé une série consacrée à « la méritocratie » et le quatrième mot citait Nick Cohen, un journaliste éditorialiste anglais : «L’ancienne société de classe permettait du moins, quand on était en bas de l’échelle, à se sentir victimes d’une injustice. Aujourd’hui, le système méritocratique nous fait croire que nous sommes responsables de notre situation, quelle qu’elle soit.»
C’est cela aussi, la société des premiers de cordée, une société profondément injuste dans laquelle les classes sociales les plus aisées se reproduisent et laissent très peu d’accès aux autres.
Pour lutter contre cela, il faudrait de la redistribution, des services publics pour tous financés par l’impôt et…un impôt suffisant pour que les fortunes ne puissent pas grimper de manière aussi éhontée et les inégalités se creuser toujours davantage.
Bref exactement le contraire que ce qui se passe dans la plupart des pays du monde.
Et si on attend le bon vouloir des premiers de cordée, on attendra longtemps, peut-être les calendes grecques.
<1138>
-
Mercredi 31 octobre 2018
« Bolsonaro : la fulgurante ascension du capitaine de la haine »Titre d’un article de Libération consacré à l’élection brésilienne Chantal Rayes et François-Xavier GomezJair Bolsonaro, a été élu Président du Brésil.
Il a des idées étonnantes, ainsi il veut
« Donner l’accès au port d’arme aux gens biens ».
Mais qui sont selon lui les gens biens, les gens bons ?
En 2003, il avait fait scandale en prenant violemment à partie une parlementaire de gauche Maria do Rosario, et lui a lancé cette insulte innommable :
« Jamais je n’irai vous violer, vous ne méritez même pas ça !».
Il n’aime pas le droit du travail, d’ailleurs il a promis de quasi l’abolir :
« C’est une disgrâce d’être patron dans notre pays, avec toutes ces lois du travail. »
Sa misogynie va jusqu’à ses propres enfants
« J’ai quatre garçons. Pour le cinquième, j’ai eu un coup de mou et ça a été une fille ».
Dans une interview accordée au magazine Playboy en 2011, Jair Bolsonaro assure qu’il serait incapable d’aimer un fils homosexuel :
« Je préférerais qu’il meure dans un accident de voiture plutôt que de le voir avec un moustachu »
Quand en 2011, une animatrice brésilienne lui demande lors d’une interview télévisée quelle serait sa réaction si l’un de ses fils tombait amoureux d’une femme noire.
« Je ne discuterais pas de la promiscuité avec qui que ce soit. Il n’y a aucune chance que ça arrive. Mes enfants sont bien éduqués. Ils n’habitent pas dans les mêmes endroits que vous ».
En 2017, il part à la rencontre d’une communauté quilombola, composée de descendants d’esclaves en fuite. A la fin de cette visite, il résume:
« Ils ne font rien ! Ils ne servent même pas à la reproduction ! ».
Il ne fait pas mystère de ses préférences sur les méthodes de gouvernement. Ainsi il vote en faveur de la destitution de la présidente Dilma Rousseff et il dédie, très officiellement son vote à
« la mémoire du colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra ».
Ce militaire est accusé de plusieurs assassinats, et il aurait torturé Dilma Rousseff elle-même pendant la dictature, alors qu’elle était une jeune résistante.
Et il précise :« L’erreur de la dictature a été de torturer sans tuer ».
Car une dictature militaire avait gouverné le Brésil entre 1964 et 1985.
En août dernier, alors qu’il est en pleine campagne pour la présidentielle, il explique comment il va remettre de l’ordre dans son pays : en donnant l’impunité aux policiers :
« S’ils tuent 10, 20 ou 30 personnes, avec 10, 20 ou 30 balles dans la tête chacun, ils doivent être décorés, pas poursuivis ».
Voici un florilège que j’ai trouvé sur plusieurs sites. C’est cet homme, misogyne, homophobe, raciste et partisan de la dictature militaire que le suffrage universel a mis, sans fraude, à la tête du Brésil, 5ème pays mondial par la taille, 6ème par la population et 7ème par le PIB.
Avant le second tour de l’élection présidentielle, l’émission « Affaires Etrangères » a été consacrée au Brésil et à l’Amérique du Sud.
Dans cette émission, il était surtout question des relations entre Etats d’Amérique du Sud, avec le Chili et la Colombie à droite et le Venezuela de Maduro qui sert de repoussoir aux électeurs de Bolsonaro qui a déclaré :
« Les gens bien au Brésil veulent se débarrasser du socialisme, ils ne veulent pas d’un régime comme celui du Venezuela. Nous ne voulons pas que le Brésil soit demain ce que le Venezuela est aujourd’hui. »
Des tensions avec le Venezuela sont à craindre.
Christobal Rovira Kaltwasser, un professeur de sciences politiques à Santiago du Chili pense que:
« Ce phénomène Bolsonaro n’est pas représentatif du paysage politique d’Amérique latine, qui a effectivement viré à droite, mais reste modéré ».
Et un uruguayen, Andres Malamud, auquel l’émission donne la parole affirme :
« Je ne vois pas de schéma uniforme se dégager dans la région, explique-t-il : le Mexique vire à gauche la même année où le Brésil risque fort de virer à droite. En fait, s’il y a un schéma quelconque, c’est celui de l’hétérogénéité, avec certains pays (le Nicaragua et le Venezuela) où la démocratie s’est effondrée, et d’autres (la Colombie et l’Équateur) où elle s’est consolidée. » »
Au lendemain des élections, <les matins de France Culture> y ont été consacrés avec deux invités Olivier Dabène, professeur à sciences Po et président de l’OPALC (Observatoire Politique de l’Amérique latine et des Caraïbes) et une journaliste franco-brésilienne, Dani Legras.
Olivier Dabène explique qu’après le premier tour l’élection du candidat d’extrême droite n’était pas une surprise. Mais
« Si on remonte à quelques mois, c’est une immense surprise. Il y a un an tout le monde riait de cette candidature, personne ne l’a prenait au sérieux. Et finalement elle a enflé et rallié beaucoup de supporters à gauche et surtout à droite. Finalement à l’issue du premier tour cela devenait mission impossible de [l’empêcher de gagner]. […]
C’est un jour bien triste de voir revenir un nostalgique de la dictature au pouvoir, légalement, sans aucune fraude. Le suffrage universel a parlé.
Pendant 28 ans, il a été [un parlementaire] ignoré, méprisé. Il n’était pas corrompu parce qu’aucune entreprise ne s’intéressait à lui, parce qu’il était totalement insignifiant..
Pendant la campagne c’est moins évident, car lors de celle-ci des campagnes massives de « fausses nouvelles » émanant de son camp ont envahi les réseaux sociaux et au-delà. Ces campagnes très couteuses ont probablement fait l’objet de financement illégaux et de liens pervers avec certaines puissances économiques
<Ce site analyse la campagne brésilienne sous l’aspect des fake news> On apprend qu’un tweet a circulé accusant le Parti de Travailleurs (PT) d’avoir distribué un biberon avec une tétine en forme de pénis dans des écoles maternelles.
Rappelons d’où on vient : Lula, ouvrier métallurgiste de profession est élu président de la République en 2002, après avoir fondé le Parti des travailleurs (PT), mouvement d’inspiration socialiste, il sera président du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2011. Dilma Rousseff son bras droit lui succéda en 2011et fut réélu. Le Parti des travailleurs permit à des millions de brésiliens à sortir de la misère grâce à une solide politique de redistribution et à un boom économique qui fit du Brésil un des grands acteurs économiques du monde.
Mais cela, c’était avant.
La crise économique a rudement touché le Brésil dont l’endettement a grimpé, les brésiliens ont vu leur pouvoir d’achat stagner et les difficultés économiques au quotidien se développer.
Parallèlement, l’insécurité, les violences font du Brésil un des pays les plus violents de la planète, créant chez les citoyens un besoin de sécurité, d’autorité et de protection auquel visiblement Bolsonaro a fait croire qu’il saurait répondre. Olivier Dabène a indiqué qu’il y avait actuellement un homicide tous les 8 minutes et a précisé que cela représentait plus de morts par an (60 000) que tout le conflit israélo-palestinien. Et enfin, il y a la corruption endémique. Lula et le Parti des travailleurs n’ont pas su lutter contre elle et au contraire s’y sont enfoncés. Lula est d’ailleurs en prison pour de tels faits et Dilma Roussef a été destituée.
Beaucoup disent que le Parti des travailleurs étaient moins corrompus que les Partis de Droite. La moitié des députés brésiliens font l’objet de poursuites judiciaires pour corruption.
Il faut remarquer que dans les urnes si le Parti des Travailleurs a été battu il a au moins été au second tour, ce qui n’est pas le cas de la droite traditionnelle qui a disparu encore davantage que le PT.
Mais il y a eu un rejet du PT de la majorité des électeurs brésiliens qui se sont exprimés.
La journaliste Dani Legras a reconnu avec tristesse que même sa mère a voté Bolsonaro, bien que dans sa jeunesse et en tant qu’étudiante elle a eu à souffrir de la dictature militaire. Mais la mère de la journaliste minimise le danger d’une dictature militaire et affirme que ce dont le Brésil a besoin c’est d’un régime autoritaire sachant lutter contre la violence, l’autre raison étant de se débarrasser du Parti des travailleurs.
Olivier Dabène précise cependant :
« Il y a aussi 31 millions de Brésiliens qui n’ont pas voté. C’est un taux d’abstention record. Bolsonaro, ce n’est pas le raz-de-marée qu’on décrit. Il y a des Brésiliens qui ont choisi de ne pas trancher. Il y a énormément de votes blancs et nuls, et cela traduit un malaise. »
Toutefois s’ils n’ont pas voté c’est qu’ils acceptaient que cet homme peu recommandable arrive au pouvoir.
Homme qui a aussi été soutenu et porté par les mouvements évangélistes qui soutiennent son programme conservateur.
Ce politique qui avoue ne rien y comprendre à l’économie et prétend donner les clés à un économiste ultra libéral admirateur de l’école de de Chicago. Cette initiative et tendance lui ont permis d’obtenir l’appui des milieux économiques vers la fin de la campagne.
Evidemment l’écologie n’est pas sa préoccupation et la forêt amazonienne va encore davantage être exploitée et la déforestation va progresser.
J’ai choisi pour exergue pour ce mot du jour le titre d’un article de Libération consacré à cette élection « Bolsonaro : la fulgurante ascension du capitaine de la haine »
Ce qui me préoccupe c’est cette évolution étonnante des démocraties qui fait basculer les Etats-Unis d’Obama à Trump, le Brésil de Lula à Bolsonaro et à un degré moindre de Renzi (qui est une personne beaucoup moins lumineuse et intéressante que Lula ou Obama) à Salvani.
On pensait être dans une dynamique de progrès et on retombe plus bas qu’on n’était avant.
<1137>
-
Mardi 30 octobre 2018
« J’ai l’impression d’emporter avec moi un monde mort, aux synagogues détruites et aux tombes éventrées. »Robert BadinterHier, je vous disais que Robert Badinter avait été l’invité du 7-9 de France Inter du vendredi 26 octobre 2018, mais je ne vous en n’ai pas donné la raison.
Il avait été invité parce qu’il vient de publier un livre sur sa grand-mère maternelle, « Idiss » (edition. Fayard).
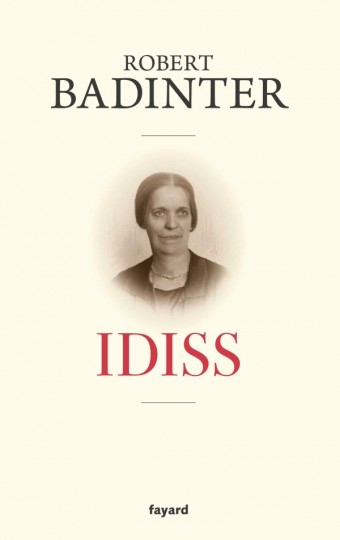 Il a dit lors de cette émission en parlant du destin de sa grand-mère :
Il a dit lors de cette émission en parlant du destin de sa grand-mère :
« C’est l’histoire d’une migration et de la fuite du régime tsariste. […] J’ai eu le sentiment qu’il fallait, avant qu’il ne soit trop tard, lui rendre témoignage. Les rapports entre les grands parents et les petits enfants ne sont pas de la même nature qu’avec les parents, c’est une source d’amour. […]
Fuyant le régime tsariste où les pogroms contre les juifs étaient fréquents, c’est en France que Idiss est arrivée : « On ne mesure pas ce qu’était cette très lointaine époque, dans l’empire allemand et celui du Tsar, le rayonnement de la République française. Celui qui a condamné de la façon la plus violente ces massacres, c’est Jaurès ». Il rappelle que « le Français était alors parlé dans toute l’Europe continentale. Et spécialement dans l’empire Russe. Le rayonnement de la langue, l’éclat des écrivains – Hugo était l’écrivain le plus vendu en Europe ».
La France et surtout la République, fille de la Révolution, avaient pour la première fois en Europe continentale donné aux juifs l’égalité des droits et la possibilité de devenir juge, officier, et la liberté complète comme les autres citoyens. D’où l’axiome de l’époque : « Heureux comme un juif en France ». C’est là où il fallait aller. »
Pour ce même livre, Robert Badinter a donné une interview à l’Express, publié le 23/10/2018 : « J’emporte avec moi un monde mort »
On apprend dans cet article que sa grand-mère maternelle, Idiss était originaire du Yiddishland, en Bessarabie, région située au sud de l’Empire tsariste, en lisière de la Roumanie. Elle était née en 1863, près de Kichinev qui est aujourd’hui la capitale de la Moldavie et qu’on appelle désormais Chisinau.
Kichinev est aussi entré dans l’Histoire en raison de deux pogroms qui ont eu lieu au tout début du XXème siècle. Ces deux émeutes antisémites appelés pogroms de Kichinev se sont déroulés en avril 1903 et en octobre 1905.
La Moldavie est un ancien Etat de l’Union soviétique coincée entre l’Ukraine et la Roumanie. C’est aujourd’hui le pays le plus pauvre d’Europe qui se vide de ses forces vives.
Le monde juif, le Yiddishland est évidemment un monde désormais perdu qui a été décimé par la Shoah.
Robert Badinter explique les raisons qui l’ont poussé à écrire ce livre :
« Il ne s’agit ni d’un projet de Mémoires, ni d’une biographie exhaustive sur la vie à la fois romanesque et tragique d’Idiss. C’est un geste. Un geste vers mon enfance d’abord, et un geste vers mes parents ensuite. J’ai compris à ce moment-là – ce qui n’est pas sans enseignement pour notre époque – que le fait de pouvoir se dire « j’ai eu des gens bien comme parents » est un grand réconfort dans la vie. »
C’est pour fuir la violence des pogroms de la Russie tsariste que beaucoup de juifs ont fui cette région.
Robert Badinter parle :
D’« un destin juif, européen et cruel. Son parcours relève des grandes migrations de cette période. [Ma grand-mère] fuit une Bessarabie russe dominée par le régime tsariste, avec tout ce que cela implique de violences antisémites, pour gagner Paris avant la Première Guerre mondiale. Après le dénuement des débuts, à force de travail et grâce à la prospérité des années 1920, Idiss et les siens connaîtront une aisance quasi bourgeoise, jusqu’à ce que survienne le désastre de la défaite de 1940 et de l’Occupation allemande. »
Et il raconte :
« Les fils d’Idiss, Avroum et Naftoul, partirent les premiers, vers 1907. Ils prirent la route après les pogroms meurtriers de Kichinev. Parmi les motivations de leur départ pour la France, il y a leur prise de conscience que l’antisémitisme rendait la poursuite de la vie en Bessarabie impossible. Le sionisme n’était encore qu’un rêve d’intellectuels. Pour eux, la seule solution était de s’en aller dans l’espoir de trouver les horizons de la liberté et de la dignité.
Partir, mais où ?
N’importe où vers les villes d’Europe centrale – Berlin, Vienne – et puis, au-delà, vers Paris, Londres et, bien-sûr, les Etats-Unis. Je me souviens d’une anecdote qui dit tout de l’esprit du temps. Un voisin juif vient faire ses adieux à un ami :
– « Je m’en vais.
– Mais où vas-tu ?
– Je vais à Chicago.
– C’est loin, ça…. »
Et l’autre répond : « Loin d’où ? »
Merveilleuse réplique… »
Et il parle d’une époque où la langue française et la France disposaient d’un prestige qu’elles n’ont plus aujourd’hui :
« Dans la Russie tsariste, la langue française tenait une place toute particulière. On la parlait, l’enseignait dans les lycées, les enfants grandissaient dans la culture française. On ne mesure pas l’amour et sa part de rêve qu’une grande partie de la population juive de Bessarabie portait à la France et surtout à la République. Chez les étudiants, en général les plus pauvres, la France de la Révolution française restait un exemple lumineux. Après tout, au XIXe siècle, elle était le seul pays d’Europe où un juif pouvait être titulaire de tous les droits civils et civiques. Il avait le choix de devenir, comme les autres, juge, officier ou professeur. C’était quelque chose d’inouï pour des sujets de l’empire tsariste. D’où l’expression : « Heureux comme un juif en France. » Ce propos fleurissait dans toute l’Europe. Son appel résonnait dans les profondeurs de la Russie tsariste. La réalité, hélas, n’était pas toujours aussi favorable. »
Et il évoque aussi l’école française de cette époque :
« L’école française, jusque dans les années 1930, était une prodigieuse machine assimilatrice. C’est pour cela que M. Martin – l’instituteur de ma mère, Charlotte – me paraît symbolique. Il prenait sur lui la charge des heures supplémentaires, car il y voyait le devoir d’intégrer les petits immigrés. Tous les enfants de « débarqués » allaient à l’école ; pas question de s’y soustraire. Tout cela eut un rôle majeur dans l’intégration de générations d’étrangers dans la République, et en particulier de juifs d’Europe centrale. »
En revanche, Lyon qu’on a appelé par la suite la capitale de la résistance ne lui a pas laissé un souvenir bienveillant :
« Oui, j’étais révolté par le spectacle de cette ville ruisselante de pétainisme. C’était bien pire qu’à Paris. Dans la capitale, la plupart des Parisiens attribuaient leurs souffrances aux Allemands. Les Lyonnais, eux, étaient plus enclins à incriminer les juifs, surtout étrangers. Il régnait une atmosphère avilissante, d’une médiocrité inouïe, marquée par l’adoration pour un vieillard comme le Maréchal qui incarnait un passé glorieux. J’étais consterné par les parades et le cérémonial ridicule qui entouraient le régime. Au lycée, les adolescents étaient rassemblés pour le salut aux couleurs et le chant en choeur de Maréchal, nous voilà ! C’était une époque d’une grande bassesse. Le cadet des fils d’Idiss, Naftoul, a été dénoncé par une voisine après la mort de ma grand-mère. A la Libération, la délatrice a été identifiée, et ma mère s’est rendue à une convocation pour la rencontrer. Elle lui demanda :
– « Mon frère était-il désagréable ?
– Non, il était très aimable.
– Alors pourquoi avoir dénoncé sa présence aux autorités ? »
Et la femme de faire cet aveu : « Mais pour les meubles ! » »
Et il conclut sur cette réflexion philosophique et historique :
« Ecrire sur Idiss, c’est exhumer un univers englouti. Une Atlantide culturelle. […]. Il m’arrive de réfléchir, au Mémorial, devant la liste interminable des victimes de la Shoah, et je suis pris de vertige devant les crimes commis, notamment à l’égard des enfants. Face à l’énigme de ce massacre des innocents, je songe que Dieu, ces jours-là, avait détourné son regard de la terre. J’ai l’impression d’emporter avec moi un monde mort, aux synagogues détruites et aux tombes éventrées. Et je me dois d’en témoigner, pour que l’oubli ne l’emporte pas tout à fait. Bien sûr, je reconstitue certains détails par l’imagination, mais j’espère avoir été fidèle à l’essentiel. A cette occasion, j’ai revécu par la pensée tout ce qu’a dû endurer Idiss, à la toute fin de sa vie, dans le Paris de 1942. Les dernières années de l’Occupation furent terribles. »
Un témoignage poignant et qui rappelle d’où nous venons et où surtout il ne faut pas retourner.
<1136>
-
Lundi 29 octobre 2018
« Pour moi, jusqu’à la fin de mes jours, tant que j’aurai un souffle Monsieur Faurisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils que des faussaires de l’Histoire.»Robert Badinter, 12 mars 2007. 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris.Robert Faurisson est mort le 21 octobre 2018. Il fut le premier négationniste emblématique, il est mort mais ses idées perdurent. Dieudonné par exemple lui a rendu hommage.
Et parallèlement, l’antisémitisme qui s’était terré depuis la seconde guerre mondiale resurgit en Occident avec de plus en plus de vigueur.
Georges Bernanos l’avait écrit : « Hitler a déshonoré à jamais le mot antisémitisme ». Donc on ne pouvait plus rien dire.
Pour être juste avec Bernanos, cette phrase est sortie de son contexte et même s’il appartint dans sa jeunesse à l’Action Française, il ne peut pas être classé simplement parmi les anti-sémites. <Lire à ce propos la tribune de Philippe Lançon dans Libération le 2 septembre 2008>
<Même dans l’Université>, que l’on pourrait espérer épargné par ce sentiment primaire et haineux l’antisémitisme progresse.
Et aux Etats-Unis les actes antisémites sont aussi en forte progression. Un <article du Monde> nous apprend que le nombre d’actes antisémites recensés par l’Anti-Defamation League a augmenté de 57 % entre 2016 et 2017.
Et la fusillade qui a lieu ce week end et qui a fait 11 morts dans une synagogue à Pittsburgh (Pennsylvanie), samedi 27 octobre, « est probablement l’attaque la plus meurtrière contre la communauté juive de l’histoire des Etats-Unis », a estimé Jonathan Greenblatt, le directeur de l’Anti-Defamation League (ADL), principale association de lutte contre l’antisémitisme du pays. Mais cette fusillade n’est pas une attaque isolée, puisqu’il y a eu une recrudescence des actes antisémites sur le sol américain.
En France, des familles juives ne se sentant plus en sécurité dans leur quartier déménagent vers d’autres lieux.
Cette triste réalité a plusieurs causes. Dans certains milieux de gauche on explique cela par l’assimilation que font certains entre la communauté juive et la politique de l’Etat d’Israël. Ce qui ne rend l’antisémitisme ni défendable, ni justifiable.
Mais dans un certain nombre de cas, on constate qu’est de retour ce « fantasme antisémite traditionnel » du juif qui est riche et qu’on peut faire payer. Ce fut las cas du meurtre d’Ilan Halimi mais aussi d’affaires plus récentes.
Il existe des juifs riches, mais il existe aussi des musulmans riches, des protestants riches, des catholiques riches, des bouddhistes riches, des hindouistes riches et même des athées riches.
Il existe aussi des juifs pauvres <Et selon lesinrocks ce n’est pas facile de faire diffuser> un documentaire sur ce sujet.
Robert Badinter qui était l’invité du 7-9 de France Inter du vendredi 26 octobre 2018. Dans cette émission il raconte que l’entraide n’existait pas vraiment, avant-guerre, dans la communauté juive entre les quelques riches et la masse des pauvres.
Mais pour que cet antisémitisme puisse resurgir, il a fallu des hommes comme Faurisson pour nier la shoah, nier les chambres à gaz, nier le génocide juif.
Car le génocide est un crime très spécial dans l’Histoire d’homo sapiens. On tue tout le monde qui appartient à une communauté spécifique, désignée comme telle.
Il y a eu d’autres génocides, celui des arméniens, celui des tziganes, celui des Tutsis au Rwanda.
Faurisson a inventé ce concept d’ « escroquerie politico-financière » pour tenter de jeter la suspicion sur la réalité du génocide , en essayant d’expliquer que c’était un complot pour obtenir des avantages politiques et financiers.
Lors d’une émission d’ARTE, le 11 novembre 2006, Robert Badinter l’a alors traité de « faussaire de l’Histoire ».
Robert Faurisson a alors assigné en diffamation Robert Badinter pour l’avoir qualifié ainsi.
Et au centre de ce mot du jour, je voudrais partager la saine colère de Robert Badinter lors de ce procès qui fut bien sûr a son avantage.
« Tout à l’heure vous avez encore répété : « cette escroquerie politico-financière »
Alors ça veut dire quoi ? Si on traduit dans sa vérité humaine comme moi je l’ai vécu.
Ça veut dire que tout ceux qui sont morts, mes parents et les autres, tous ceux-là sont devenus les instruments conscients utilisés par tous les juifs, pour quoi faire ?
Pour arracher des réparations auxquelles ils n’auraient pas eu droit ?
Je me souviens de ma mère qui recevait de misérables indemnités dont il ne restait rien. Alors elle était quoi ? La complice d’une escroquerie politico financière ? C’était ça qu’elle faisait à cet instant-là ?
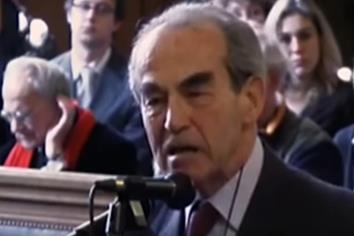 Et ses fils, nous étions quoi ? Des profiteurs, les bénéficiaires de cette escroquerie ?
Et ses fils, nous étions quoi ? Des profiteurs, les bénéficiaires de cette escroquerie ?
Les mots ont un sens, sauf pour ceux qui les utilisent comme vous.
Pour qu’il n’y ait aucune équivoque, pour que les choses soient claires
Pour moi, jusqu’à la fin de mes jours, tant que j’aurai un souffle Monsieur Faurisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils que des faussaires de l’Histoire.
Des faussaires de l’Histoire et de l’Histoire la plus tragique qui soit, dont j’espère que l’Histoire tirera la leçon et gardera le souvenir ».
<Ici la vidéo de cette intervention>
Je crois qu’il faut la regarder.
France Inter avait consacré, en 2017, une émission d’« Affaires sensibles » à cet épisode et plus généralement aux faussaires de l’Histoire.
Lors de l’émission de France Inter de vendredi précité, Robert Badinter est revenu sur ce moment :
« Je me souviens de cette passion qui m’a emportée, c’était insupportable. Il m’avait assigné parce que j’avais, de mémoire, un jour, dit que la dernière affaire que j’ai plaidée dans ma vie c’était contre Faurisson et les révisionnistes, ils avaient été condamnés comme faussaires de l’histoire. Ce n’était pas faussaires de l’histoire, c’était qu’ils avaient manqué au devoir de l’historien. D’où l’assignation ».
« Mais de l’entendre, de le voir, à ce moment-là, j’ai revu tout ce que j’avais connu, j’ai mesuré l’infamie des propos révisionnistes… ma grand-mère paternelle avait près de 80 ans quand on l’a jetée dans le wagon qui l’a emmenée à Auschwitz… ça c’est l’illustration du crime contre l’humanité ».
La grand-mère paternelle est morte dans le wagon à bestiaux, pendant le voyage.
<1135>
-
Vendredi 26 octobre 2018
« Le prénom n’a rien d’anodin. Il touche à l’intime, et raconte infiniment plus que ce qu’on pourrait croire. »Catherine Vincent, journaliste du MondeEt dans l’émission de Thierry Ardisson qui aime le buzz, le polémiste Eric Zemmour lança à la chroniqueuse Hapsatou Sy :
« Votre prénom est une insulte à la France. »
Et une longue polémique s’en suivit. Dans sa rhétorique, comme dans ses provocations Eric Zemmour est absolument insupportable. Dire à quelqu’un que son prénom, le nom par lequel, dès son plus jeune âge, sa mère et son père l’ont appelé est une insulte ne peut qu’être que blessant.
Auparavant, il y avait eu ces échanges :
Hapsatou Sy : « Je m’appelle Hapsatou »
Éric Zemmour : « Eh bien votre mère a eu tort »
Hapsatou Sy : « Vous vouliez qu’elle m’appelle Marie ? »
Éric Zemmour : « Absolument, c’est exactement ce que je veux. Votre mère a eu tort (…) Corinne, ça vous irait très bien. »
Eric Zemmour voudrait que Hapsatou Sy s’appelât Corinne Sy.
Venant de lui c’est absolument inécoutable.
Mais quand Marceline Loridan-Ivens dit exactement la même chose, est-ce écoutable ?
Dans cet extrait de l’émission <de la Grande Librairie>, elle raconte certes sur un autre ton et dans un tout autre esprit que son père a tenu à donner des noms français à ses filles pour qu’elles soient pleinement françaises : Marceline, Henriette, Jacqueline et elle valide ce choix. Son père ajoutait qu’elles pourraient aussi s’appeler Sarah, Myriam, mais dans l’intime, dans la famille non dans l’espace public. Et en plus dans cet extrait, elle dit, que selon elle, c’est une erreur de ne pas le faire.
C’est une vraie question que celle de donner un prénom de la tradition du pays où on habite ou de donner un prénom conforme à ses origines ethniques ou religieuses.
Je n’ai pas d’avis tranché sur ce sujet.
Mais ce qui est certain, c’est comme l’écrit la journaliste du Monde, Catherine Vincent dans son article au sujet du prénom : « Le prénom n’a rien d’anodin » :
« Moins anodin qu’on ne pourrait le croire, le prénom en dit long sur l’époque et le lieu où nous sommes nés et sur ceux qui nous l’ont donné. […] le prénom n’a rien d’anodin. Il touche à l’intime, et raconte infiniment plus que ce qu’on pourrait croire. Sur nous-mêmes, sur ceux qui nous l’ont donné, sur l’époque et le lieu où nous sommes nés, sur la classe à laquelle nous appartenons – en un mot, sur notre histoire privée et publique. »
Pendant longtemps, en Occident, le choix du prénom suivait des règles et des contraintes fortes
« Dans notre culture occidentale, le choix fut longtemps plus restreint. Le prénom avait pour rôle de porter un message familial et social. Et surtout, de désigner le descendant qui assurerait la survie économique de la lignée – ce qui impliquait la sauvegarde du patrimoine et la concentration des capitaux.
Dans une étude menée au début des années 1980, l’anthropologue Bernard Vernier a montré comment était autrefois régi le système de parenté de Karpathos, une île grecque du Dodécanèse. Dans chaque famille, le premier-né des garçons héritait de son père et portait le prénom de son grand-père paternel, tandis que la première-née des filles héritait de sa mère et portait le prénom de sa grand-mère maternelle – les prénoms attribués aux suivants provenant ensuite alternativement du stock paternel ou maternel.»
La révolution française a créé un service d’état civil indépendant de l’Église et a vraiment créé le « prénom ». Avant il s’appelait « le nom de baptême ». D’ailleurs les gens du peuple ne fêtaient pas l’anniversaire de leur naissance car il n’en connaissait pas la date. La date qui était portée dans les registres de l’église était la date du baptême. Et ce qui était fêté, c’était la fête du Saint dont on portait le nom :
« Qu’il concerne l’aîné ou les cadets, le choix du prénom, pendant longtemps, a donc été étroitement contraint par l’histoire familiale – mais aussi par l’Église. En France, il faut d’ailleurs attendre 1792, et la sécularisation de l’état civil, pour que le terme même de « prénom » commence à s’imposer : on parlait jusqu’alors de « nom de baptême ».
Historiquement, le nom de baptême avait été imposé par l’Église chrétienne dès les premiers siècles de notre ère, remplaçant ainsi l’usage romain des noms multiples. Dans un premier temps, les parents purent choisir librement le nom de baptême de leurs enfants. Puis, à partir du Xe siècle, il leur fallut exclusivement piocher dans le registre des saints, le martyrologe. »
« Avec l’école obligatoire, le service militaire et l’établissement de carnets d’identité, le XIXe siècle instaure progressivement l’usage d’un seul nom et d’un seul prénom – lequel nous définit désormais dans toutes les situations.
S’il n’est plus forcément tiré du martyrologe, il n’en reste pas moins, à cette époque, encadré de façon stricte par la loi du 11 germinal an XI (1er avril 1803), qui autorise seulement « les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus de l’histoire ancienne ». »
« Deux siècles plus tard, la situation a changé du tout au tout ! Les prénoms s’inventent, se composent, viennent d’ailleurs, prennent des consonances exotiques au libre choix des parents. Il faut attendre 1993 pour que cette évolution soit inscrite dans notre code civil, qui ne restreint désormais ce choix qu’a posteriori, sur intervention du procureur de la République, lorsque ces prénoms paraissent à l’officier de l’état civil « contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme ». Mais la libéralisation du droit a commencé bien avant, qui donne progressivement, depuis les années 1950, la maîtrise du choix aux parents plutôt qu’à l’Etat. »
Le prénom dit aussi quelque chose de la classe sociale :
« Certains – Astrid, Diane, Stanislas – restent majoritairement cantonnés aux beaux quartiers, d’autres sont plébiscités par les classes populaires : ce sont souvent des prénoms anglo-saxons rendus célèbres par les séries américaines, comme Dylan ou Kevin.
Baptiste Coulmont, qui calcule chaque année le taux de mentions « très bien » obtenues par les candidats au baccalauréat, observe ainsi qu’en 2016, plus d’un quart des candidates prénommées Esther ou Diane ont obtenu une mention « très bien », soit dix fois plus que les candidats prénommés Steven ou Sofiane. […]
Le prénom reflète partiellement la hiérarchie sociale, et donc la chance de réussite des uns et des autres. Et si nombre d’entre eux traversent toutes les couches sociales, ils ne le font pas au hasard, mais selon une dynamique bien précise.
Dans un article publié en 1986 sous le titre « Les enfants de Michel et Martine Dupont s’appellent Nicolas et Céline », Guy Desplanques, démographe à l’Insee, montrait ainsi, sur la base des prénoms à la mode, une stratification sociale des goûts. « La diffusion d’un prénom commence dans les couches sociales élevées et moyennes, notait-il. Puis les autres groupes sociaux emboîtent le pas : d’abord les professions intermédiaires et les artisans et commerçants, puis les employés et les ouvriers, enfin, avec un peu de retard, les agriculteurs. » »
Et la journaliste en arrive enfin à la manière dont les parents issus de l’immigration nomment leurs enfants :
«C’est dans ce contexte touffu qu’il faut analyser la manière dont les immigrés, les enfants d’immigrés et petits-enfants d’immigrés nomment leur descendance. […]
Dans un numéro de la revue Annales de démographie historique (« Nommer : enjeux symboliques, sociaux et politiques », 2016, n° 131), Cyril Grange, enseignant-chercheur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) et spécialiste de la parenté, rappelle les quatre scénarios principaux auxquels peuvent être confrontées les populations étrangères dans leur pays d’accueil :
- l’acculturation forcée (exemple : en 1984, la direction du Parti communiste bulgare obligea tous les Turcs à « bulgariser » leurs noms) ;
- la ségrégation forcée (dans l’Allemagne nazie, les juifs n’ayant pas un prénom permettant de les distinguer comme tels durent y adjoindre le prénom Israël pour les hommes, Sarah pour les femmes) ;
- l’acculturation volontaire (adoption sans contrainte de prénoms issus du groupe ethnique dominant) ;
- la ségrégation volontaire (désir d’une minorité d’exprimer son identité au travers de prénoms ethniques).
Dans nos sociétés libérales, le scénario de l’acculturation volontaire est, de loin, le plus fréquent : en une génération, deux tout au plus, les familles choisissent majoritairement des prénoms en vigueur dans leur pays d’accueil.
Et la journaliste conclut avec une histoire particulière qui concerne le « métèque » Moustaki et son admiration pour Brassens
« Dans un entretien donné à Libération à l’occasion de la sortie de son ouvrage La Méditerranée. Mer de nos langues (CNRS Editions, 2016), le linguiste Louis-Jean Calvet évoquait ainsi les pérégrinations de celui de son ami Moustaki. « Né à Alexandrie d’une famille juive grecque mais de langue italienne, baptisé Giuseppe par ses parents, inscrit à l’état civil égyptien sous le nom de Youssef, appelé à l’école française Joseph, puis Jo, un diminutif qui a fait croire, lorsqu’il est arrivé en France, qu’il s’appelait Georges, ce qu’il a laissé faire par admiration pour Brassens. » »
<1134>
-
Jeudi 25 octobre 2018
« Ce n’est pas de la faute des évêques si Jésus n’a choisi que des hommes comme apôtres »Un participant au dernier synode de l’Eglise catholique qui a permis à des religieuses de participer sur le thème « la place des femmes dans l’Eglise et l’éducation des jeunes filles », mais sans droit de vote et presqu’aucun espace pour parlerSur France Inter, Giulia Foïs réalise une chronique hebdomadaire, dans laquelle elle s’intéresse aux questions liées au genre.
Le mardi 23 octobre 2018 elle a fait une chronique sur différents sujets et je voudrai en partager un avec vous, concernant les femmes, l’église catholique et la lente évolution de cette dernière par rapport aux premières.
Et nous apprenons ainsi qu’a eu lieu, la semaine dernière un synode quasi révolutionnaire dans l’Eglise Catholique.
Pour savoir exactement ce que signifie synode, je me suis tourné vers des spécialistes, à savoir des journalistes du quotidien « La Croix », qui pose justement cette question : Qu’est-ce qu’un synode?
Nous apprenons donc que dans la tradition de l’Eglise, le synode est une assemblée d’évêques en principe et c’est un organe consultatif pour le Pape. Pour être complet sa signification est plus large car il peut s’agir d’une assemblée locale, un synode diocésain, qui regroupe des ecclésiastiques de plus basse hiérarchie que les évêques.
Par ailleurs, les autres religions chrétiennes protestantes et orthodoxes connaissent aussi des assemblées appelées synodes avec une signification un peu différente. Pour en savoir un peu plus, il faut aller sur Wikipedia.
Revenons aux explications du synode catholique par « La Croix »
« Le mot synode vient du grec. Il est formé de odos (chemin) et sun (ensemble). Il signifie « faire route ensemble » mais également « franchir un même seuil », « habiter ensemble« , donc se réunir. Le synode (ou le concile) désigne dans l’Église une assemblée réunie pour délibérer et prendre des décisions en matière de doctrine ou de discipline. […]
Il ne faut pas confondre le synode avec le concile qui a un caractère œcuménique et au cours duquel tous les évêques du monde sont appelés à participer. Lors d’un concile, les évêques abordent les questions qu’ils souhaitent et leur vote a autorité sur les décisions du pape. »
Pourquoi ce dernier synode fut il révolutionnaire ?
Parce que jusqu’à présent, « faire route ensemble », « habiter ensemble » signifiait dans la tradition catholique : être ensemble sans présence féminine.
Normal, me direz-vous puisqu’il s’agit d’évêques et que les catholiques veulent des évêques du genre masculin.
Ce n’est pas aussi simple, puisque depuis Paul VI, peuvent participer, toujours selon « La Croix » :
« Des religieux, des recteurs et des dirigeants de mouvements et d’associations nommés par le pape en qualité de pères synodaux et d’experts. »
Et donc ce qui fut révolutionnaire, c’est que des femmes ont été enfin invitées.
Mais, s’il y a révolution, il y a révolution lente.
Voici ce qu’en dit Giulia Foïs
« Réunis en synode, en fin de semaine dernière, à Rome, les évêques ont invité des religieuses à se joindre au débat…
Eh ben oui…
Comme quoi, on peut porter calotte et accorder aux femmes le droit de porter cerveau. Le droit de s’en servir, même, surtout quand ça les concerne directement.
Le thème du synode ?
La place des femmes dans l’église, l’éducation des jeunes filles, la « nécessaire lutte, je cite, contre la culture machiste » du dogme et de l’institution…
Du coup, les femmes étaient là, cette fois.
Elles étaient au moins… Oh ! Douze, les religieuses. Soit 10% des participants.
Ok, ce n’est pas beaucoup, mais elles ont pu parler.
A la pause-café, notamment, disait l’une d’entre elle à l’AFP.
Alors évidemment, comme seuls les hommes ont le droit de vote au synode, elles n’ont pas eu leur mot à dire sur le texte final…
Une pétition a bien circulé pour ouvrir le vote aux femmes…
Mais bon, comme le rappelait l’un des participants : ce n’est pas de la faute des évêques si Jésus n’a choisi que des hommes comme apôtres.
Ben oui.
Et la pomme, ce n’est pas la faute d’Adam non plus, ok ?
Mais baste, point de polémique au Vatican de grâce.
Réjouissons-nous qu’elles aient été invitées à participer.
Parce que du coup, elles ont tout bien écouté quand les hommes ont parlé. »
Vous allez me dire que c’est de nouveau la question de notre regard du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein.

A vrai dire, pour moi je verrai plutôt un verre quasi vide, ou un verre presque pas rempli.
L’Église n’a pas inventé la société patriarcale, mais y a très largement contribué et a permis de l’entretenir.
C’est une de ses tares, parmi d’autres.
<1133>
-
Mercredi 24 octobre 2018
« Dans des sociétés grisonnantes, le poids politique des personnes âgées augmentera constamment et dans des économies en mutation rapide, leur capacité à s’adapter périclitera »Edoardo CampanellaBrice Couturier a lors de sa chronique du 19 octobre 2018 évoqué un article d’un universitaire espagnol Edoardo Campanella qui explique une partie de la montée du populisme dans les pays occidentaux par l’attitude d’une majorité de seniors dont le poids démographique est de plus en plus prégnant dans le corps électoral de nos démocraties.
La réalité électorale est que les jeunes générations se désintéressent en grande partie du processus électoral qu’ils estiment sans grand intérêt.
Contrairement aux personnes âgées qui continuent à accomplir leur devoir d’électeur bien davantage que leurs enfants et petits-enfants.
A cette réalité comportementale, s’ajoute le fait que leur nombre devient intrinsèquement plus important du fait du vieillissement démographique des Européens.
Edoardo Campanelle explique dans son article « Le populisme des retraités va-t-il s’installer ? » sur le site de « project-syndicate » :
« Le populisme de droite qui a surgi ces dernières années dans de nombreuses démocraties occidentales pourrait durer bien plus qu’un feu de paille dans le paysage politique. Au-delà de la crise économique mondiale déclenchée en 2008 puis de la crise migratoire, qui créèrent toutes deux le terreau fertile des partis populistes, le vieillissement de la population occidentale va continuer d’infléchir les dynamiques politiques en faveur des populistes.
Il apparaît, en effet, que les électeurs âgés sont plutôt sympathisants des mouvements nationalistes.
Au Royaume-Uni, les personnes âgées ont voté massivement en faveur du départ de l’Union européenne, et ce sont elles qui, aux États-Unis, ont offert la présidence à Donald Trump. Ni le parti Droit et justice (PiS) en Pologne, ni le Fidesz en Hongrie ne seraient parvenus au pouvoir sans le soutien enthousiaste des plus vieux. Et en Italie, la Ligue doit son succès, en bonne part, à la façon dont elle a su exploiter le mécontentement du troisième âge dans le Nord. »
Il reconnait cependant qu’il existe des exceptions à cette règle, notamment en France et au Brésil :
« Seule Marine Le Pen, du Rassemblement national (ex Front national) en France – ainsi, peut-être, que Jair Bolsonaro au Brésil – peut compter, parmi les populistes de l’heure, sur le soutien des jeunes électeurs. »
En France au premier tour, Macron a réalisé un score de 23,7% mais les 60-69 ans ont voté à 26 % pour lui et ceux de 70 ans et plus à 27%. Il faut noter que ce dernier vote (celui des 70 ans et plus) s’était porté quasi majoritairement sur Fillon (45%). En France, les plus de 70 ans ont donc voté massivement (72% quand même) pour les deux candidats qui souhaitaient le plus réformer ou s’attaquer à l’Etat providence, vous choisirez le verbe qui vous va le mieux selon vos convictions politiques.
On pourrait aussi dire que c’était les deux candidats qui rassuraient le plus ou inquiétaient le moins, le monde économique.
Mais la France fait, pour l’instant encore, figure d’exception selon Edoardo Campanelle :
« Le plus probable est qu’un sentiment croissant d’insécurité pousse les plus âgés dans les bras des populistes. Si l’on met de côtés les particularismes de chaque pays, les partis nationalistes proposent tous de contenir les forces de la mondialisation, qui affectent plus que les autres les personnes âgées. »
Dans la plupart des autres pays, les personnes âgées ne sont pas vraiment en phase avec les aspirations des leaders économiques et plutôt que des réformes de l’état social, ils réclameraient selon l’universitaire espagnol plutôt davantage d’autorité et de fermeté pour lutter contre l’insécurité et l’immigration.
Campanelle pointe trois raisons
- L’attachement aux valeurs traditionnelles et à un monde connu qui leur parait trop bousculé par l’apport d’immigrés venant d’autres civilisations ;
- La peur des travailleurs vieux d’être exclus du marché du travail et ne plus trouver leur place dans le monde économique d’aujourd’hui ;
« De même, la mondialisation et le progrès technologique perturbent souvent les industries traditionnelles ou qui reposent sur un savoir-faire, où l’expérience est un facteur d’emploi. L’essor de l’économie numérique, où dominent les trentenaires, voire les moins de trente ans, relègue aussi vers les marges les travailleurs plus vieux. Mais à la différence d’autrefois, les systèmes de retraite, qui se décomposent, ne peuvent plus absorber ces chocs du marché du travail. En conséquence, les travailleurs les plus vieux qui perdent leur emploi sont condamnés au chômage de longue durée. »
Enfin, la crainte, qui n’est pas infondée, sur la pérennité et le niveau des pensions de retraite :
« En outre, les retraités ont aujourd’hui des raisons de craindre la menace pour leurs pensions que représentent leurs propres enfants. Les jeunes, insatisfaits de systèmes économiques qui jouent clairement en faveur des retraités, commencent à revendiquer une redistribution plus équitable entre générations de ressources devenues plus rares. Ainsi le Mouvement 5 étoiles italien, qui gouverne en coalition avec la Ligue, a-t-il récemment appelé à la création d’un « revenu citoyen », qui serait octroyé à toute personne au chômage, sans critère d’âge. Alors que les populistes de droite attirent à eux les électeurs âgés, les populistes de gauche ont gagné des partisans dans les générations plus jeunes. »
L’ensemble de ces « préoccupations » qui sont réelles constitue pour les partis politiques nationalistes une ressource dont ils usent pour convaincre l’électorat âgé de voter pour eux :
« De ce fait, les politiciens nationalistes recourent souvent à une rhétorique de la nostalgie, grâce à laquelle ils mobilisent leurs partisans âgés. Pour sa part, Trump a promis de ramener des emplois dans la « ceinture de la rouille », qui fut autrefois le centre de l’industrie manufacturière américaine. De même, on ne saurait trouver de symbole plus clair de la résistance au changement que le mur qu’il propose de construire à la frontière des États-Unis et du Mexique. Et la répression qu’il a engagée contre l’immigration illégale ainsi que l’interdiction d’entrer aux États-Unis imposée aux ressortissants de pays à majorité musulmane montrent son adhésion à une nation américaine « pure ».
En Europe continentale, les populistes de droite veulent eux aussi revenir en arrière, au temps d’avant l’euro et de l’espace Schengen de libre circulation dans la plupart des pays de l’Union. Et ils tentent de séduire directement les électeurs âgés en promettant d’abaisser l’âge de la retraite et d’augmenter les pensions (ce sont deux mesures phares de la Ligue italienne). »
On ne peut que souscrire à l’expression du défi qui se pose aux sociétés modernes :
Quoi qu’il en soit, la vague populiste est à tel point gonflée par la démographie qu’elle n’est probablement pas prête d’atteindre son point culminant. Dans des sociétés grisonnantes, le poids politique des personnes âgées augmentera constamment ; et dans des économies en mutation rapide, leur capacité à s’adapter périclitera. Les électeurs les plus vieux demanderont par conséquent de plus en plus de sécurité socio-économique, et des populistes irresponsables attendront en embuscade pour s’attirer leurs bonnes grâces.
Edoardo Campanelle se pose la question de ce qu’il convient de faire. Sa vision libérale plairait probablement à Emmanuel Macron puisqu’il donne l’injonction aux « personnes âgées » de se prendre en charge et d’être prêt de faire face aux perturbations actuelles, la politique devant simplement les aider à réaliser ces objectifs.
« Peut-on faire quelque chose ? Pour contenir la marée nationaliste, les partis traditionnels doivent instamment élaborer un nouveau pacte social qui puisse répondre au sentiment d’insécurité croissant des électeurs les plus vieux. Ils devront trouver un meilleur équilibre entre ouverture et protection, innovation et régulation ; et ils devront le faire sans tomber dans le piège régressif tendu par les populistes.
La réponse ne réside pas dans l’étouffement des forces de la mondialisation, mais dans la capacité à les rendre plus tolérables. Les citoyens de tous âges doivent être prêts à faire face aux perturbations actuelles et futures. En ce sens, il est préférable d’aider les personnes âgées à se prendre en charge plutôt que de se contenter de les protéger. Pour la plupart, les économies avancées ne pourront tout simplement pas se permettre d’allouer de nouvelles et énormes prestations à un groupe d’intérêts surdimensionné. Qui plus est, les mesures qui rendent les gens dépendants de quelque forme que ce soit de soutien extérieur posent, pour le moins, un problème moral.
Au lieu de cela, les gouvernements devraient s’attacher à renforcer les qualifications de la main-d’œuvre âgée, en créant plus d’opportunités pour qu’anciennes et jeunes générations puissent travailler ensemble, et en responsabilisant les perturbateurs du marché du travail sur les conséquences socio-économiques de leur activité. Les aides aux plus vulnérables ne devraient être accordées qu’en dernier ressort. »
La solution n’est certes pas simple.
Et je crains que cette prédiction : « ,Les économies avancées ne pourront tout simplement pas se permettre d’allouer de nouvelles et énormes prestations à un groupe d’intérêts surdimensionné. » se réalise.
Mais la capacité de s’adapter des personnes âgées dont parle Campanelle doit quand même être observée avec bienveillance.
La question qui se pose de plus en plus est de savoir quelle place la société laisse aux vieux.
Dans le monde du travail déjà cette question se pose, je ne crois pas raisonnable de croire qu’une personne de 30 ans et une personne de 60 ans soient interchangeables. Certes il faut s’adapter le mieux qu’on peut, mais je pense que si on suit simplement les conseils de cet universitaire espagnol et on laisse faire les règles de l’économie moderne on trouvera assez rapidement que l’employé de 60 ans n’est pas assez compétitif et que le mieux s’est de s’en débarrasser au plus vite. Le marché de l’emploi fonctionne d’ailleurs ainsi en grande partie.
Il faut réfléchir à la place des vieux dans une société qui vieillit. Et pas seulement dire qu’ils n’ont qu’à faire comme les jeunes.
Sinon je pense que les forces nationalistes et populistes verront s’ouvrir des boulevards à leurs ambitions politiques.
Et hélas, ils ne disposent d’aucune solution raisonnable et pérenne.
<1132>
- L’attachement aux valeurs traditionnelles et à un monde connu qui leur parait trop bousculé par l’apport d’immigrés venant d’autres civilisations ;
-
Mardi 23 octobre 2018
« Que nous apprend le cancer sur la vie ?»Réflexions personnelles sur cette maladieLe cancer fait mourir beaucoup de personnes autour de nous et porte en lui un imaginaire inquiétant.
C’est aussi une réalité, j’évoquais hier notre amie Françoise, il y a quelques années notre amie Cécile fut également emportée par ce mal et beaucoup plus tôt dans son histoire de vie.
Je poursuis, depuis quelques années, moi-même, une histoire intime avec cette maladie.
Parmi vous, il en est qui ont perdu des êtres aimés que la science actuelle des hommes n’a pas su prémunir d’une fin prématurée.
C’est bien sûr très encourageant quand on apprend que les recherches récentes offrent de nouvelles pistes de guérison qui viennent d’être honorées : Lundi 1er octobre, le prix Nobel de médecine 2018 a été décerné conjointement à l’Américain James P. Allison et au Japonais Tasuku Honjo pour leurs travaux sur l’immunothérapie.
Mais ce n’est pas de cette lutte scientifique contre la maladie que je souhaite parler aujourd’hui, ni d’explications scientifiques sur l’apparition et le développement du cancer. Dans le mot du jour du 29 septembre 2017, j’avais indiqué ce <Lien> vers une vidéo du site « science étonnante » dans laquelle, le créateur de ce site David Louapre était allé interroger des médecins de l’Institut Gustave Roussy.
Mon propos tente d’approcher une réflexion philosophique.
Je me souviens que très jeune et encore très peu préoccupé par cette maladie, avoir entendu parler un professeur de médecine qui d’après mes souvenirs était le professeur Jean Bernard.
Et ce qu’il a dit m’a beaucoup marqué, même si je n’en avais approfondi la signification.
Il avait exprimé cette réalité qu’il voyait dans les laboratoires :
« Qu’est-ce que le cancer en fin de compte ? Ce sont des cellules qui ne veulent pas mourir. Nous avons dans nos laboratoires des cellules cancéreuses, prélevées sur des humains qui sont morts depuis de nombreuses années. »
Le cancer ce sont des cellules qui ne veulent pas mourir !
Elles se reproduisent à un rythme accéléré et ne meurent pas en proportion.
Ce sont des parties, des éléments d’un corps global, d’un corps humain ou animal.
Ces éléments ne veulent pas mourir et de ce fait, ils font mourir le corps dont ils ne sont qu’un élément.
Alors je ne peux pas m’empêcher de penser à cette catégorie de transhumanistes qui ne veulent pas mourir, qui poursuivent le fantasme de Gilgamesh celui de devenir immortel ou a-mortel.
Un article de « Science et vie » pose cette question : « Pourquoi meurt-on ? ».
« Comment expliquer qu’on ait été mis au monde pour, un jour, mourir ? […] Au fil des générations, la sélection naturelle n’aurait-elle pas dû éliminer les gènes qui, in fine, nous sont fatals ? Là réside justement le secret. […]
Car si mourir paraît inacceptable au niveau de l’individu, c’est tout le contraire à l’échelle de l’espèce : si nous mourons, c’est parce que la finalité de la vie n’est pas sa préservation, mais sa perpétuation.
Une fois que l’individu a rempli sa mission de reproduction, la sélection naturelle ne le préserve plus. En sorte, c’est notre faculté à donner la vie qui, mécaniquement, signe notre arrêt de mort.
Pour comprendre cette surprenante conclusion, il faut avoir à l’esprit une loi intangible : au sein d’une même espèce, entre un individu doté d’une faible longévité mais se reproduisant abondamment, et un individu vivant longtemps tout en se reproduisant peu, le premier obtiendra les faveurs de la sélection naturelle, via une diffusion plus importante de ses gènes au cours des générations.
[…] En tout cas, dès que les organismes vivants ne sont plus capables de se reproduire, la sélection naturelle laisse s’accumuler les mutations délétères dans leurs génomes, lesquelles les mènent à une mort inéluctable.
[…] Si nous mourons, c’est pour mieux donner la vie. Tel est le véritable paradoxe de notre finitude. »
Les êtres vivants que nous sommes ont vocation à se reproduire et à survivre par leur descendance.
C’est à nouveau ce combat entre l’Ego et le Nous, le Nous de l’espèce.
Il existe même des espèces qui meurent en se reproduisant. On pense à la mante religieuse qui au terme de l’accouplement voit la femelle dévorer le mâle. Il en existe d’autres comme certains marsupiaux qui s’épuisent lors d’une frénésie d’accouplement :
« Certains d’entre eux se reproduisent avec différentes femelles pendant de longues heures et finissent par mourir d’épuisement. Selon des chercheurs australiens, ce comportement sexuel particulier leur permettrait de fertiliser le plus grand nombre de femelles possible et d’assurer ainsi leur descendance. »
Tout comportement excessif est déraisonnable.
Je crois que nous avons raison d’aspirer à une belle et longue vie qui ne soit pas brisée prématurément par une maladie brutale.
Les scientifiques et les médecins sont donc légitimes à chercher des moyens pour essayer de réaliser ces objectifs.
Mais lorsque le cofondateur de PayPal : Peter Thiel dit
« Je pense qu’il y a probablement trois grandes façons d’aborder la mort. L’accepter, la nier ou la combattre. Je crois que notre société est dominée par des gens qui sont dans le déni ou l’acceptation ; pour ma part je préfère la combattre. »
Je crois qu’il a tort. Il faut accepter la mort, sans cela nous nous comportons comme un cancer pour notre espèce.
Je finirai ce mot du jour un peu âpre par une reproduction du tableau de Gustav Klimt : « La Vie et la Mort » achevé en 1916.
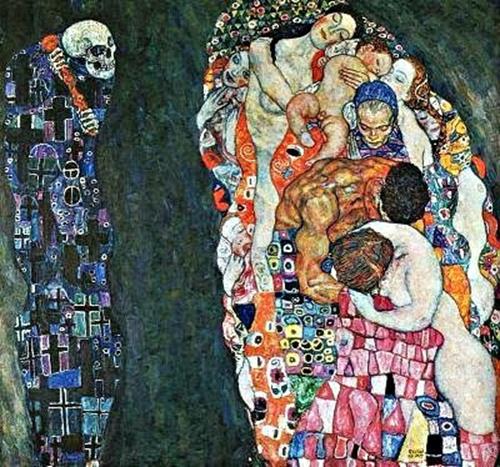
<1131>
-
Lundi 22 octobre 2018
« Une enfance heureuse »Marie-Françoise SeylerNous vivons une époque de mutation considérable mais ce n’est pas la première fois que notre société a été confrontée à ce type d’évolution : d’un monde connu vers un nouveau monde.
Ce fut le cas de nos ainés qui venaient du monde rural et se sont intégrés dans le monde urbain, c’est ce qu’on a appelé l’exode rural.
Wikipédia nous apprend que c’est entre 1850 et 1860 que la population rurale française avait atteint son maximum (en valeur absolue) avec 26,8 millions de ruraux. À partir de cette date, les effectifs de la population rurale ont commencé à décroître en France. La France a d’ailleurs connu un exode rural plus tardif que les autres pays d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord.
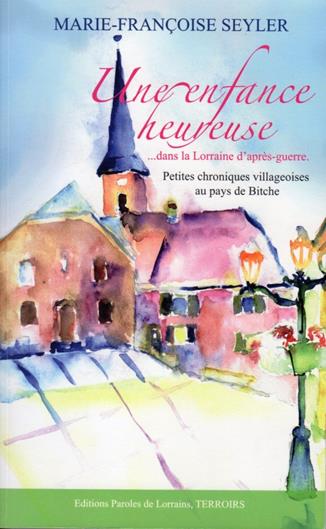 Pour Marie-Françoise Seyler que nous appelions Françoise, cet exode fut encore plus tardif puisqu’elle raconte dans ce livre « Une enfance heureuse » le début de sa vie au milieu du XXème siècle dans une famille agricole vivant dans un village au pays de Bitche : Petit-Réderging.
Pour Marie-Françoise Seyler que nous appelions Françoise, cet exode fut encore plus tardif puisqu’elle raconte dans ce livre « Une enfance heureuse » le début de sa vie au milieu du XXème siècle dans une famille agricole vivant dans un village au pays de Bitche : Petit-Réderging.
Elle raconte comment pour financer les études d’un enfant, son père vendait une bête et la réalité de la vie villageoise de cette époque.
Dans la préface de ce livre son frère Jean-Marie, relate comment il expliquait à ses enfants : « J’ai connu le Moyen Âge ».
J’ai rencontré Françoise en 1976, en arrivant à Strasbourg pour poursuivre des études.
Annie a rencontré Françoise un an plus tard.
Parfois Annie et moi nous croisions dans la maison de Françoise, sans jamais nous remarquer.
Après plus de 10 ans, en 1988, Françoise a conseillé à Annie de s’intéresser à moi et depuis nous vivons ensemble.
Lorsque chacun de nos enfants est né, c’est Françoise qui est venu pour nous aider, nous conseiller et être là tout simplement.
C’est encore elle qui nous a appris et a fait avec nous les merveilleux gâteaux de Noël alsacien.
Et au-delà du matériel, nous avons échangé tant de choses immatérielles lors de nos rencontres dans lesquelles sa bienveillance, son humanisme, son éthique étaient comme un phare qui permettait d’éclairer la route.
Michel Rocard a écrit : « Dans les cinq plus beaux moments d’une vie, il y a un (ou des) coup(s) de foudre amoureux, la naissance d’un enfant, une belle performance artistique ou professionnelle, un exploit sportif, un voyage magnifique, enfin n’importe quoi, mais jamais une satisfaction liée à l’argent. »
C’est ainsi qu’Annie et moi avons vécu l’amitié de Françoise : un des plus beaux moments de notre vie.
Pendant de nombreuses années elle a affronté son terrible cancer, les yeux ouverts plein de lucidité et de force. Elle continuait à voyager, à faire de longues randonnées et finalement aussi écrire.
Puisqu’elle a écrit un autre livre sur la vie d’antan à la campagne : « couleurs des saisons » et un roman toujours sur ce sujet du lien entre le monde rural d’hier et le monde d’aujourd’hui : « Le nouveau monde d’Anna », un autre livre a été écrit et devrait être édité prochainement.
Jusque dans son dernier combat avec la mort, elle fut pour nous un exemple et une leçon de vie. Sa cérémonie d’Adieu eut lieu le jour où j’entrais dans ma soixantième année.
Le vrai tombeau des morts est le cœur des vivants.
<1130>
-
Vendredi 12 octobre 2018
« Qu’adviendra-t-il de la société, de la politique et de la vie quotidienne quand des algorithmes non conscients mais hautement intelligents nous connaîtrons mieux que nous nous connaissons ? »Yuval Noah Harari « Homo deus » ultime phrase du livre.Nous avons tous à résoudre notre questionnement par rapport à notre avenir incertain.
Chacun fait comme il peut, pour ma part je ne blâmerai personne.
Certains ne pensent pas à toutes ces choses trop angoissantes et se contentent de vivre au jour le jour, en essayant de croquer à pleines dents dans toutes les opportunités qui se présentent : les relations avec leurs proches, les fêtes, les loisirs, les jeux de toute sorte, les voyages, les compétitions, les expériences artistiques et culturelles, le bien être personnel du corps et de l’esprit, peut-être la réussite professionnelle ou l’augmentation de leur capital pécuniaire. Bref, tout ce qui ressort du divertissement Pascalien.
Il y a bien sur quelques-uns qui se réfugient dans l’absorption de substances diverses qui permettent à l’esprit de s’échapper des réalités.
D’autres restent résolument optimistes et pensent que l’instinct de survie d’homo sapiens surmontera les difficultés et que toutes les découvertes techniques, l’intelligence artificielle permettront encore d’améliorer les soins aux maladies et le sort global des humains. Celles et ceux qui ont perdu un être cher de manière prématurée, une fille, un fils d’une maladie que la médecine ne savait pas encore guérir ne peuvent qu’espérer et soutenir une telle perspective.
Il y a aussi celles et ceux qui se réfugient dans la transcendance, la croyance dont, pour l’instant, le modèle le plus accompli est la foi religieuse. Ce type de réponse est très confortable puisque même si les humains se fracassent dans une catastrophe apocalyptique ayant pour dimension la terre entière, la perspective de se retrouver parmi les élus dans un autre monde au sein d’un univers dominé par la puissance et la sagesse divine, permet de se projeter dans un avenir rassurant et rimant avec l’éternité. L’humilité m’oblige à écrire que je ne peux définitivement affirmer que cette perspective constitue une chimère. Toutefois mon esprit rationnel, ce que je comprends de l’évolution d’homo sapiens, notre espèce, si remarquablement décrit par Yuval Noah Harari, mon expérience personnelle et ma fréquentation des religions, des croyants et de leurs discours, me pousse à penser qu’il s’agit d’une perspective peu vraisemblable.
Il y a bien sûr les transhumanistes extrémistes comme Kurzweil qui rêvent un homo sapiens augmenté, « a-mortel » agrémenté pour des gens comme Ellon Musk d’une fuite de quelques humains hors de notre vaisseau terrestre pour aller coloniser une autre planète, permettant de repartir sur de nouvelles bases après avoir définitivement abimé la terre. Pour ces esprits, il faut bien comprendre que la suite de l’aventure ne se fera pas avec 10 milliards d’homo sapiens. La quasi-totalité d’ « homo sapiens » sera probablement traitée par les « Homo deus » comme aujourd’hui les autres animaux sont traités par « homo sapiens »
Je privilégie quant à moi, le choix d’essayer de regarder la réalité en face, tout en gardant l’optimisme de la volonté et en essayant d’agir modestement et en essayant de comprendre ce qui se passe et quelles idéologies, quels mythes sont à l’œuvre quand des hommes de pouvoir économique ou politique, des intellectuels s’expriment ? mettent en œuvre des actions concrètes ou font des choix et prennent des décisions.
Yuval Noah Hariri soulève, à la fin de son livre ce défi intellectuel qui nous est posé :
« Nous sommes en face de tant de scénarios et de possibilités […]. Le monde change plus vite que jamais et nous sommes inondés de quantités inimaginables de données, d’idées, de promesses et de menaces [qu’il est essentiel de comprendre à quoi nous devrions prêter attention.]
Dans le passé, la censure opérait en bloquant le flux de l’information. Au XXIème siècle, elle opère en inondant la population d’informations non pertinentes. [nous] passons notre temps à débattre de problèmes annexes.
Dans les temps anciens, avoir le pouvoir voulait dire accéder aux données. Aujourd’hui, cela signifie savoir ce qu’il faut ignorer. » P.426
Et c’est alors qu’Harari exprime ces problématiques dans différentes unités de temps. C’est en cela que je trouve l’apport de Yuval Noah Harari particulièrement structurant et fécond.
« Si nous pensons en mois, nous ferions probablement mieux de nous concentrer sur des problèmes immédiats comme les troubles au Moyen-Orient, la crise des réfugiés en Europe et le ralentissement de l’économie chinoise. »
Et l’historien israélien évoque ensuite les questions qui se posent dans les décennies qui viennent :
« Le réchauffement climatique, l’inégalité croissante et les problèmes du marché de l’emploi passent au premier plan. »
Mais les questions à long terme, si on prend encore plus de recul mettent au premier plan trois processus liés les uns aux autres :
« 1 La science converge sur un dogme universel, suivant lequel les organismes sont des algorithmes et la vie de réduit au traitement des données.
2. L’intelligence se découple de la conscience.
3. Des algorithmes non conscients, mais fort intelligents, pourraient bientôt nous connaître mieux que nous-mêmes. »
Et en face de ces questions essentielles pour l’avenir d’«homo sapiens », Yuval Noah Harari finit son livre par trois questions cruciales dont il espère qu’elles resteront présentes à notre esprit longtemps après avoir refermé ce livre :
- «Les organismes ne sont-ils réellement que des algorithmes, et la vie se réduit-elle au traitement des données ?
- De l’intelligence ou de la conscience, laquelle est la plus précieuse ?
- Qu’adviendra-t-il de la société, de la politique et de la vie quotidienne quand des algorithmes non conscients mais hautement intelligents nous connaîtrons mieux que nous nous connaissons ? » P. 427
<1129>
La semaine prochaine, je ne vais pas écrire de mots du jour.
Le mot du jour reviendra le 22 octobre 2018.
- «Les organismes ne sont-ils réellement que des algorithmes, et la vie se réduit-elle au traitement des données ?
-
Jeudi 11 octobre 2018
« Le dataïsme : l’humanité n’aura été qu’une ondulation dans le flux de données cosmique »Yuval Noah Hariri : « Homo deus » page 425Dans le mot du jour du 2 octobre je précisais que mon objectif n’est pas de réaliser un résumé de « Homo deus » mais d’aborder des questions et des développements qui m’ont interpellé et pour lesquels Harari m’a appris quelque chose ou m’a permis de me poser des questions nouvelles.
Aujourd’hui, j’aborderai dans cet avant dernier article de la série, le sujet central de la préoccupation de Yuval Noah Harari qui se trouve dans l’exploration des capacités de l’intelligence artificielle, de ce qu’il appelle le découplage entre l’intelligence et la conscience et de la confiance de plus en plus grande que manifestent les hommes à l’égard des données, les data en anglais et qui amènerait à une nouvelle religion qui est le « dataïsme »
Yuval Noah Harari insiste beaucoup dans ses développements que dans notre manière de fonctionner et de réagir, nous les humains, mais aussi les autres animaux il y a une grande partie de procédures algorithmiques. Des algorithmes déclenchés par des événements extérieurs ou intérieurs.
Un algorithme n’est rien d’autre qu’un traitement de données, qui reçoit des données, les analyse puis donne un résultat qui est une action, une réflexion, un comportement. Et pour ce faire des processus biologiques, électriques et chimiques sont à l’œuvre dans notre corps.
Ces processus sont les mêmes chez homo sapiens et les autres animaux. L’animal voit, ressent, décide et agit comme le fait un humain. La différence est la taille du cerveau, le nombre de neurones, qui confère à un individu humain sa supériorité sur les autres animaux. Mais pour Harari, l’être humain se différencie aussi de l’animal par la conscience.
Harari a donné pour sa dernière partie un titre explicite : « Homo sapiens perd le contrôle » dont des sous parties sont :
- Le grand découplage
- L’océan de la conscience
- Et l’ultime chapitre : la religion des data
Et je commencerai par citer le début de « L’océan de la conscience »
« Il est peu probable que les nouvelles religions émergeront des grottes d’Afghanistan ou des madrasas du Moyen-Orient. Elles sortiront plutôt des laboratoires de recherche. De même que le socialisme s’est emparé du monde en lui promettant le salut par la vapeur et l’électricité, dans les prochaines décennies les nouvelles techno-religions conquerront peut le monde en promettant le salut par les algorithmes et les gênes. […]
On peut diviser ces nouvelles techno-religions en deux grandes catégories :
- Le techno-humanisme
- La religion des données [ou dataisme] »
Et Yuval Noah Harari, s’efforce d’abord de définir le techno-humanisme :
« Le techno-humanisme reconnaît qu’Homo sapiens, tel que nous le connaissons a vécu : il arrive au terme de son histoire et cessera d’être pertinent à l’avenir. Il conclut toutefois que nous devons créer Homo deus, un modèle d’homme bien supérieur. Homo deus, conservera des traits humains essentiels, mais jouira aussi de capacités physiques et mentales augmentées qui lui permettront de se défendre contre les algorithmes non conscients les plus sophistiqués. Comme l’intelligence est découplée de la conscience et que l’intelligence non consciente se développe à vitesse grand V, les hommes doivent activement optimiser leur esprit s’ils veulent rester dans la course. […]
Il y a 70 000 ans, la révolution cognitive a transformé l’esprit de Sapiens, faisant d’un insignifiant signe africain le maître du monde. L’esprit amélioré de Sapiens a soudain eu accès au vaste champ de l’intersubjectivité, ce qui lui a permis de créer des dieux et des sociétés, de bâtir des cités et des empires, d’inventer l’écriture et la monnaie et , finalement de scinder l’atome et d’aller sur la lune. Pour autant que nous le sachions, cette révolution stupéfiante a été le fruit de quelques menus changements dans l’ADN de Sapiens et d’un léger recâblage de son cerveau. Si tel est le cas, explique le techno humanisme, peut-être quelques changements supplémentaires de notre génome et un autre recâblage de notre cerveau suffiront-ils à lancer une seconde révolution. »
Par la suite Harari documente toutes les possibilités qui pourraient exister pour étendre nos capacités mentales, permettre de voir un spectre plus large de la lumière par exemple, augmenter nos capacités de raisonnement et notre rapidité de réaction et je vous renvoie par exemple vers le casque évoquée hier et qu’a expérimenté et décrit la journaliste au New Scientist Sally Adee.
Mais Harari reconnaît que le techno-humanisme conduit à un paradoxe :
« Le techno-humanisme est ici confronté à un dilemme insoluble. Il tient la volonté humaine pour la chose au monde la plus importante, et pousse donc l’humanité à élaborer des technologies qui puissent la contrôler et la remodeler. Après tout, il est tentant de contrôler ce qu’il y a de plus important dans l’univers. Or, si nous obtenions un tel contrôle, le techno-humanisme ne saurait qu’en faire car l’être humain sacré ne deviendrait plus qu’un produit manufacturé parmi d’autres. Tant que nous croirons que volonté et expérience humaines sont la source suprême de l’autorité et du sens, il nous sera impossible de composer avec ces technologies. »
C’est ainsi qu’Harari nous amène à son ultime chapitre :
« Aussi une techno-religion plus audacieuse cherche-t-elle à couper carrément le cordon ombilical humaniste. Elle voit se dessiner un monde qui ne tourne pas autour des désirs et expériences d’êtres de l’espèce humaine. Qu’est ce qui pourrait remplacer les désirs et expériences d’êtres de l’espèce humaine […] désirs et expériences qui sont à la source de tout sens et de toute autorité ?
Aujourd’hui, un candidat a pris place pour l’entretien d’embauche dans l’antichambre de l’histoire. Ce candidat n’est autre que l’information. La religion émergent la plus intéressante est le dataïsme, qui ne vénère ni les dieux ni l’homme, mais voue un culte aux data, aux données. »
Je ne peux affirmer que le concept « dataisme » ait été inventé par Harari mais, c’est lui qui l’a rendu populaire au point de parler d’une nouvelle religion celle des « données » des « data » puisqu’il faut donner un nom anglais pour que le concept paraisse sérieux.
Pour retracer l’histoire d’homo sapiens sur la longue période on pourrait écrire que pendant des milliers d’années, les humains ont pensé que l’autorité venait des dieux. Puis à l’ère moderne, la période « humaniste » l’autorité a été progressivement transmise aux êtres humains, aux savants, aux philosophes et aux humains élus par les citoyens. Aujourd’hui la révolution du numérique, des « big data » et des algorithmes qui savent analyser rapidement ces immenses masses de données conduisent à légitimer l’autorité des algorithmes et du Big Data.
Harari explique :
« Pour le dataïsme, l’univers consiste en flux de données, et sa contribution au traitement des données détermine la valeur de tout phénomène ou entité. […] p. 395
Prenons des exemples concrets :
Vous êtes gravement malade. Voici une machine qui recueille par des dizaines de connecteurs toutes les informations essentielles de votre organisme, elle peut rapidement se connecter à la base de vos données pour connaître vos antécédents et puis analyser dans des milliards de données d’autres humains pour trouver les cas analogues, similaires et choisir le traitement qui a eu le meilleur effet sur des personnes dont l’état de santé et le profil ressemblent au vôtre.
Voici un médecin, certes réputé, certes plein d’empathie mais qui possède beaucoup moins de connaissances que la machine, réfléchit beaucoup moins vite. Et en plus c’est un humain, il est fatigué, il pense à sa compagne, à son fils, à son prochain voyage, à une chanson qu’il a entendu en passant. En plus il est émotif, il a peur de se tromper.
Quel est la thérapie que vous choisirez ?
Notre vieil ami Luc Ferry, dira qu’il est stupide de présenter cette situation de cette manière. Cet optimiste nous dira qu’il ne faut pas opposer la machine et le médecin mais les associer, le médecin utilisera la force de l’intelligence artificielle pour parfaire son diagnostic et choisir la bonne thérapie.
Ah bon ?
Mais enfin, c’est l’intelligence artificielle qui diagnostiquera et décidera de la thérapie, le médecin ne sera que son porte-parole. je suis même persuadé qu’il n’osera pas contredire la machine.
Il pourra, peut-être mettre un peu d’empathie. Et même sur ce point Harari n’est pas convaincu, l’intelligence artificielle saura mieux que le médecin analyser dans quel état de stress et d’émotion vous êtes et trouver les mots les plus appropriés pour communiquer avec vous.
Harari cite l’exemple de la célèbre actrice Angelina Jolie. En 2013, l’actrice américaine a découvert grâce à un test génétique qu’elle portait une dangereuse mutation du gène BRCA1. Selon les bases de données statistiques, les femmes portant cette mutation ont 87% de probabilités de développer un cancer du sein. Sans attendre le cancer, Angelina Jolie a décidé de faire confiance aux algorithmes et de procéder à une double mastectomie.
Et le choix de l’âme sœur ? L’intelligence artificielle saura tout de vous et même mieux que vous et il saura tout des autres. Qui mieux qu’elle pourra réaliser la meilleure association pour la vie ? Ce ne serait pas rationnel de ne pas suivre son avis …
Et alors le choix du gouvernement démocratique ou la stratégie économique ? Peux t’on vraiment faire confiance à homo sapiens ? Pour les dataistes, c’est bien sûr l’intelligence artificielle qui sera la plus compétente pour faire les bons choix et décider des mesures à prendre.
Dans ce nouveau récit, c’est l’information analysée par des programmes sachant la maîtriser qui est source de sens et non plus les désirs et les expériences humaines.
Et Harari de conclure :
« Les dataïstes sont sceptiques envers le savoir et la sagesse des hommes, et préfèrent se fier au Big Data et aux algorithmes informatiques » p.396.
Pour les partisans de ce mouvement l’univers tout entier est un flot de données, les organismes comme des algorithmes biochimiques.
Car Harari explique que contrairement à ce qu’on pourrait penser, les sentiments ne sont pas l’opposé de la rationalité. Mais Ils représentent davantage la rationalité de l’instinct. Quand un babouin, une girafe ou un humain voit un lion, il éprouve de la peur car son algorithme biochimique lui indique qu’un individu à proximité représente une menace immédiate. Cet algorithme biochimique a évolué et s’est amélioré au fil de millions d’années d’évolution. Si les sentiments d’un ancêtre lui font commettre une erreur, les gènes autour de ce sentiment n’ont pas été transmis à la génération suivante. Il y a donc bien aussi dans ce cas production de données et d’informations.
L’humanité est à la confluence de deux vagues scientifiques. D’un côté, les biologistes déchiffrent les mystères du corps humain, et plus particulièrement ceux du cerveau et des sentiments humains. D’un autre côté, les informaticiens sont détiennent désormais un pouvoir de traitement de données sans précédent. L’association de ces deux sciences permet de créer des systèmes externes capables de surveiller et de comprendre nos sentiments mieux que nous-mêmes. Une fois que les systèmes Big Data nous connaîtront mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, l’autorité sera transmise des humains aux algorithmes.
Et harari pose alors cette question
« Si le dataïsme réussit à conquérir le monde, qu’adviendra-t-il de nous les hommes ?
Dans un premier temps, le dataïsme accélèrera probablement la quête humaine de la santé, du bonheur et du pouvoir. Le dataïsme se propage en promettant de satisfaire ces aspirations humanistes. Pour accéder à l’immortalité, à la félicité et aux pouvoirs divins de la création, il nous faut traiter d’immenses quantités de données qui dépassent de loin les capacités du cerveau humain. Les algorithmes le feront donc pour nous. Mais du jour où l’autorité passera des hommes aux algorithmes, il se peut que les projets humanistes perdent toute pertinence. » P.424
Et il devient poète :
« Nous nous efforçons de fabriquer l’Internet-de-tous-les-objets dans l’espoir qu’il nous rendra bien portants, heureux et puissants. Mais une fois que celui-ci sera opérationnel, les hommes risquent d’être réduits du rôle d’ingénieurs à celui de simples puces, puis de data, pour finalement se dissoudre dans le torrent des données comme une motte de terre dans une rivière […] Rétrospectivement, l’humanité n’aura été qu’une ondulation dans le flux de données cosmique. »
P. 424 & 425
Et il pointe ce danger :
« Le dataïsme menace de faire subir à l’Homo sapiens ce que ce dernier a fait subir à tous les autres animaux.» P. 424
<1128>
- Le grand découplage
-
mercredi 10 octobre 2018
« La révolution humaniste, le libre arbitre et notre « moi » qui décide »Développement de Yuval Noah Harari dans « Homo deus » pages 243 à321Nous savons comment Harari explique la conquête du monde par homo sapiens, ce qu’il appelle « l’étincelle humaine », deuxième sous partie de sa Première Partie : « Homo sapiens conquiert le monde ».
C’est notre capacité d’imaginer des choses qui n’existent pas dans la réalité et qui permet de fédérer des millions d’homo sapiens qui ne se connaissent pas personnellement. Harari cite par exemple : le dollar, Google ou l’Union européenne et explique que selon lui un chat ne peut que s’imaginer des choses réelles comme la souris qu’il va aller chasser.
Mais les grands mythes fédérateurs furent ceux des Religions.
Ainsi les femmes et les hommes de ces sociétés agissaient selon les règles qu’expliquaient les prêtres de ces Religions. Celles et ceux qui ne respectaient pas ces règles étaient d’une part exclus de leur famille ou de leur communauté et plus encore réprimés avec une grande violence. Nous connaissons cela.
A ces mythes déistes s’est substituée, selon Harari, dans le monde occidental, « la révolution humaniste »
La révolution humaniste est la 4ème sous partie de la deuxième partie « Homo sapiens donne sens au monde » qui en compte 4
- Les conteurs
- Le couple dépareillé
- L’alliance moderne
-
La révolution humaniste
Et Harari d’expliquer :
« L’humanisme, nouveau credo révolutionnaire a conquis le monde au cours des derniers siècles. La religion humaniste voue un culte à l’humanité et attend que cette dernière joue le rôle dévolu à Dieu dans le christianisme et l’islam, ou celui que les lois de nature ont tenu dans le bouddhisme et le taoïsme. Alors que traditionnellement, le grand plan cosmique donnait un sens à la vie des hommes, l’humanisme renverse les rôles et attend des expériences humaines qu’elles donnent sens au cosmos. Selon l’humanisme, les humains doivent puiser dans leurs expériences intérieures le sens non seulement de leur vie, mais aussi de tout l’univers. Tel est le premier commandement de l’humanisme : créer du sens pour un monde qui en est dépourvu.
La révolution religieuse centrale de la modernité n’a donc pas été la perte de la foi en Dieu, mais le gain de la foi en l’humanité. » P. 244
Toute la difficulté pour nous est de comprendre qu’il s’agit d’un nouveau mythe, car ce conte est contemporain, c’est celui de notre récit qui pour nous est forcément la réalité. Avant notre modernité, nous pouvons entendre qu’il s’agissait de mythes, de croyances, mais pour nous c’est différent…
Harari continue :
« Cela fait des siècles que l’humanisme nous a convaincus que nous sommes l’ultime source du sens, et que notre libre arbitre est donc l’autorité suprême en toute chose. Au lieu d’attendre qu’une entité extérieure nous dise ce qu’il en est, nous pouvons nous remettre à nos sentiments et désirs. Depuis la plus tendre enfance, nous sommes bombardés de slogans humanistes en guise de conseils : « Ecoute-toi, sois en accord avec toi-même, suis ton cœur, fais ce qui te fait du bien. » P. 246
Cette injonction vaut d’abord pour les relations amoureuses, conjugales et les relations amicales mais s’étend à tous les domaines de la vie.
Ceci conduit très largement à des aspirations individualistes et consuméristes.
« Nos sentiments ne donnent pas seulement du sens à notre vie privée, mais aussi aux processus politiques et sociaux. Quand nous voulons savoir qui doit diriger le pays, quelle politique étrangère et quelles mesures économiques adopter, nous en cherchons pas les réponses dans les Écritures. Pas davantage n’obéissons-nous aux commandements du pape ou aux conseils des lauréats du Nobel. Dans la plupart des pays, nous organisons plutôt des élections démocratiques et demandons aux gens ce qu’ils pensent de la question. Nous estimons que l’électeur sait mieux et que les libres choix des individus sont l’autorité politique ultime.
Mais comment l’électeur sait-il que choisir ? Théoriquement, tout au moins, il est censé écouter ses sentiments les plus profonds et s’y fier.
[…] Au Moyen Age, cela serait passé pour le comble de la folie. Les sentiments fugitifs des roturiers ignares n’étaient guère une base saine pour prendre des décisions politiques importantes.»
L’honnêteté nous conduit à reconnaître que le point de vue du moyen âge n’est pas dénué de raison.
Alors vous rétorquerez que comme Churchill : « Que la démocratie est la plus mauvaise solution, mais qu’il n’en existe pas de meilleure ».
Et vous ajouterez, en plus cela marche.
Mais l’esprit incrédule vous dira, oui mais cela marche de moins en moins.
Globalement vous voyez bien qu’en présentant les choses comme cela, nous constatons bien qu’il s’agit d’un mythe. Cela permet de fédérer un grand nombre de personnes derrière cette croyance, mais ce n’est pas la réalité de prétendre que la décision démocratique est la plus intelligente, préserve le mieux le long terme, est la plus rationnelle. C’est un mythe, un mythe qui fonctionne, mais c’est un mythe.
Le monde actuel est donc dominé par l’humanisme libéral avec l’individualisme, les droits de l’homme, la démocratie et le marché.
Et c’est là que les dernières découvertes scientifiques conduisent Harari à questionner la réalité du libre arbitre.
Et c’est encore un récit qui va être révélateur d’une réalité beaucoup plus complexe que celle à laquelle adhère le mythe humaniste :
« Sally Adee, journaliste au New Scientist, a été autorisée à visiter une installation d’entraînement pour snipers et à tester elle-même les effets d’un casque dont le nom technique est : « stimulateur transcrânien à courant direct ».
Elle est d’abord entrée dans un simulateur de champ de bataille sans porter le casque. Sally raconte comment la peur l’a terrassée quand elle a vu vingt hommes masqués, armés de fusils et sanglés pour un attentat suicide qui chargeaient. […] Visiblement je ne tire pas assez vite ; la panique et l’incompétence bloquent constamment mon arme » Heureusement pour elle, les assaillants n’étaient que des images vidéo projetées sur de grands écrans tout autour d’elle.
C’est alors qu’on l’a branchée au casque. Elle raconte n’avoir rien senti d’inhabituel, sauf un léger picotement et un étrange goût métallique dans la bouche. Elle s’est pourtant mise à abattre les terroristes virtuels l’un après l’autre, aussi froidement et méthodiquement que si elle était Rambo ou Clint Eastwood. […] quand l’équipe commence à me retirer les électrodes. Je lève les yeux et me demande si quelqu’un a avancé l’heure. Inexplicablement [le temps était le même que lors de la première expérience]. « J’en ai eu combien ? » demandai-je à l’assistante. Elle m’a regardée d’un air narquois ; « Tous »
L’expérience a changé la vie de Sally. Les jours suivants, elle a compris qu’elle avait vécu une « expérience quasi spirituelle» […] pour la première fois, dans ma tête, tout s’est finalement fermé […]. Que mon cerveau puisse être dépourvu du moindre doute était une révélation. Là, soudain, cet incroyable silence dans ma tête .[…] » p310 et 311
Harari précise que ces stimulateurs transcrâniens d’aujourd’hui sont encore dans l’enfance, mais si la technologie mûrit, ou si l’on trouve une autre méthode pour manipuler la configuration électrique du cerveau, quelle incidence cela aura-t-il sur les sociétés et les êtres humains ?
Et Harari cite beaucoup d’expériences sur les animaux dans lesquelles grâce à des stimulis extérieurs ces animaux font exactement ce que le manipulateur du stimulis veut qu’ils fassent.
Grâce à ces outils sophistiqués, il n’y a plus d’espace de libre arbitre, le manipulateur fait du cerveau de l’autre ce qu’il veut.
Mais cela montre aussi de manière certaine que des manipulations plus grossières, une publicité, une propagande, un récit répété sans cesse peut annihiler le libre arbitre du cerveau humain. Ce que nous savions, mais que la science démontre.
Et Harari conclut :
« Les expériences accomplies sur Homo sapiens indiquent que, comme les rats, les hommes sont manipulables et qu’il est possible de créer ou d’anéantir des sentiments complexes comme l’amour, la colère, la peur et la dépression en stimulant les points adéquats dans le cerveau humain. » p.309
Harari remet aussi en question la croyance de l’humanisme libéral qui nous définit en tant qu’individu, c’est-à-dire une seule entité indivisible. Il prétend que tel n’est pas le cas, qu’en réalité nous somme des « dividus », car il n’existe pas un seul moi qui prend les décisions. Il distingue le moi expérimentateur de notre conscience immédiate et le moi narrateur. Il développe ces expériences et analyses entre la page 312 et 321.
La plus révélatrice me semble être l’expérience menée par Daniel Kahneman, prix Nobel d’économie en 2002.
« Il invita un groupe de volontaires à participer à une expérience en trois parties.
Dans la partie courte de l’expérience, les volontaires introduisaient leur main une minute dans un récipient d’eau à 14°C, ce qui est désagréable et douloureux. […].
Dans la partie longue de l’expérience on commençait de la même manière mais au bout d’une minute on ajoutait subrepticement de l’eau chaude, portant la température à 15°C. On demandait de retirer la main 30 secondes plus tard. » P. 316
Puis on demanda aux volontaires de réitérer une des deux expériences et de choisir celle qui leur paraissait la moins pénible. 80% ont choisi l’expérience longue. Ils n’en connaissaient pas le détail et n’avaient que leur ressenti.
Mais si on examine cela de manière rationnel :
L’expérience longue comporte l’expérience courte à laquelle on ajoute 30 secondes d’eau à 15° – chose légèrement moins pénible, mais pas agréable non plus, en tout cas qui ne peut rendre l’expérience longue plus agréable. Il eut été rationnel de choisir l’expérience courte sans y ajouter encore 30 secondes d’expérience supplémentaire non agréable aussi.
Harari explique :
« Le moi qui expérimente ne se souvient de rien. Il ne raconte pas d’histoires ; quand sont en jeu de grandes décisions, il est rarement consulté. Exhumer des souvenirs, raconter des histoires, prendre des grandes décisions est le monopole d’une entité très différente à l’intérieur de nous : le moi narrateur. […] Il est perpétuellement occupé à raconter des histoires sur le passé et à faire des projets d’avenir.
[Le moi narrateur] ne raconte pas tout […] c’est la moyenne des sommets et la fin qui détermine la valeur de toute l’expérience [pour lui.] P. 317
C’est ainsi que l’expérience longue qui finit de manière moins désagréable est privilégiée.
Et Harari de conclure :
« La plupart d’entre nous nous identifions néanmoins à notre moi narrateur. Quand nous disons « je », nous voulons parler de l’histoire que nous avons dans la tête, non du flux continue de nos expériences. » P. 320
<1127>
- Les conteurs
-
Mardi 9 octobre 2018
« Les guerres et les conflits qui ont jalonné l’histoire pourraient bien n’être qu’un pâle prélude au vrai combat qui nous attend : le combat pour la jeunesse éternelle »Yuval Noah Harari, « Homo deus » page 41La mort de la mort est un des grands fantasmes de certains transhumanistes de la silicon Valley
Yuval Noah Harari nuance :
« L’immense majorité des chercheurs des médecins et des spécialistes se tiennent encore à distance de ces rêves affichés d’immortalité, affirmant qu’ils essaient simplement de surmonter tel ou tel problème particulier.»
Mais il est une minorité et qui selon Harari voit son nombre croître et qui :
« Parlent plus franchement, ces temps-ci et assurent que le projet phare de la science moderne est de vaincre la mort et d’offrir aux humains l’éternelle jeunesse.
Ainsi du gérontologue Aubrey de Grey et du polymathe et inventeur Ray Kurzweil. En 2012 Kurzweil a été nommé directeur de l’ingénierie chez Google et un an plus tard Google a lancé une filiale, Calico, dont la mission déclarée est de « résoudre le problème de la mort » ».
Vous pouvez aller sur le site internet de cette entreprise à la pointe de la modernité et dont l’objectif est donc de trouver les solutions techniques à la mort.
Et vous pouvez aussi voir cette conférence TED traduit en français dans laquelle Aubrey de Grey prétend « que le vieillissement n’est qu’une maladie — et de surcroît une maladie guérissable ».
Puis cette autre conférence TED dans laquelle Ray Kurzweil, explique comment selon lui « L‘homme sera transformé par la technologie ». Selon lui, d’ici les années 2020, nous aurons démonté le cerveau humain et des nano-robots opéreront notre conscience.
Larry Page et Sergey Brin, les patrons de Google avaient demandé à un autre convaincu de l’immortalité, Bill Maris, un neuroscientifique de formation, de prendre la tête du fonds d’investissement Google Ventures. Harari nous apprend que :
« Dans une interview de janvier 2015, Maris déclarait : « Si vous me demandez aujourd’hui s’il est possible de vivre jusqu’à 500 ans, la réponse est oui » […] Google Venture investit 36% de ses deux milliards de dollars en portefeuille dans des start-up spécialisées en sciences de la vie dont plusieurs projets ambitieux visent à prolonger la vie. Recourant à une analogie avec le football américain, Maris ajoute : dans le combat contre la mort, « nous n’essayons pas de gagner quelques mères. Nous cherchons à gagner la partie. Parce que mieux vaut vivre que mourir. »
L’édition anglaise d’Homo deus étant paru en 2016, Harari ne savait pas à l’époque que Bill Maris allait quitter Google Venture en août 2016, pour des raisons très louables : « s’occuper de son fils et être davantage avec son épouse » et aussi parce que Google Venture va très bien.
Et Harari cite aussi le cofondateur de PayPal : Peter Thiel :
« Je pense qu’il y a probablement trois grandes façons d’aborder la mort. L’accepter, la nier ou la combattre. Je crois que notre société est dominée par des gens qui sont dans le déni ou l’acceptation ; pour ma part je préfère la combattre. »
Harari explique :
« Le développement à vitesse grand V de domaines comme le génie génétique, la médecine régénérative et les nanotechnologies nourrit des prophéties toujours plus optimistes. Certains experts croient que les humains triompheront de la mort d’ici 2200, d’autres parlent même de 2100. Kurzweil et de Grey sont encore plus confiants. Ils soutiennent qu’en 2050 quiconque possède un corps sain et un solide compte en banque aura une chance sérieuse d’accéder à l’immortalité en trompant la mort de décennie en décennie. Tous les dix ans, selon Kurzweil et De Grey, nous ferons un séjour dans une clinique pour y subir une transformation qui nous guérira de nos maladies, mais régénérera aussi nos tissus en décomposition et améliorera nos mains, nos yaux et notre cerveau. Entre deux hospitalisations, les médecins auront inventé pléthore de nouveaux médicaments, d’extensions et de gadgets. »
Harari rappelle que ces projets s’ils aboutissent ne rendront pas ces humains immortels, mais plutôt a-mortels, car ils pourraient encore mourir dans une guerre ou un accident. Mais je crois qu’on peut rejoindre Yuval Noah Harari dans l’hypothèse, si ces choses arrivent cela ferait :
« Probablement d’eux les gens les plus angoissés de l’Histoire. »
Et Harari d’imaginer ce que cette nouvelle longétivité aurait pour conséquence sur la société et la famille :
« La structure familiale, les mariages et les relations parent-enfant s’en trouveraient transformés. Aujourd’hui, les gens s’imaginent encore mariés « jusqu’à ce que la mort les sépare » et une bonne partie de leur vie tourne autour de l’éducation des enfants.[…]. Une personne dont la durée de vie est de 150 ans […] se marie à 40 ans […] sera-t-il réaliste d’espérer que son couple dure cent dix ans ? […] A 120 ans une femme qui aura eu des enfants à quarante ans n’aura qu’un lointain souvenir des années passées à les élever qui seront comme un épisode plutôt mineur de sa longue vie. […]
Dans le même temps, les gens ne prendront pas leur retraite […] qu’éprouveriez-vous à avoir un patron de 120 ans, dont les idées ont été formulées du temps de la Reine Victoria ? »
Mais Harari n’y croit pas trop :
« Revenons à la réalité : il est loin d’être certain que les prophéties de Kurzweil et de Grey se réalisent d’ici 2050 ou 2100. A mon sens, espérer parvenir à l’éternelle jeunesse au XXIème siècle est prématuré et qui les prend au sérieux est voué à une cruelle déception. Il n’est pas facile de vivre en sachant que vous allez mourir, mais il est encore plus dur de croire à l’immortalité et de se tromper. »
Mais il pense quand même que ce combat restera un combat phare du XXIème siècle :
« Chaque tentative ratée de triompher de la mort nous rapprochera néanmoins un peu plus de ce but, nourrira de plus grands espoirs et encouragera les gens à consentir de plus grands efforts. Calico ne résoudra vraisemblablement pas le problème de la mort à temps pour rendre immortels les cofondateurs de Google […] mais elle réalisera très probablement des découvertes significatives en matière de biologie cellulaire, de médicaments génétiques et de santé humaine »
Et Harari imagine plus largement les conséquences de ce combat :
« L’establishment scientifique et l’économie capitaliste seront plus heureux d’épauler ce combat. La plupart des hommes de science et des banquiers se fichent pas mal de ce sur quoi ils travaillent, du moment que c’est l’occasion de nouvelles découvertes et de plus gros profit […]
Vous trouvez impitoyables les fanatiques religieux au regard brulant et à la barbe fleurie ? Attendez un peu de voir ce que feront les vieux nababs entrepreneurs […] s’ils pensent qu’un élixir de vie est à portée de main. Le jour où la science accomplira des progrès significatifs dans la guerre contre la mort, la vraie bataille se déplacera des laboratoires vers les parlements, les tribunaux et la rue. Dès que les efforts scientifiques seront couronnés de succès, ils déclencheront d’âpres conflits politiques. Les guerres et les conflits qui ont jalonné l’histoire pourraient bien n’être qu’un pâle prélude au vrai combat qui nous attend : le combat pour la jeunesse éternelle. »
Tous ces développements se situent entre les pages 35 et 41.
J’ajouterai une première limite à tous ces espoirs et développements, encore faut-il que la vie sur terre soit toujours possible à l’homme au-delà des années 2100, ce qui ne me semble pas totalement acquis.
Pour le reste le combat contre les maladies, pour la santé et pour éviter les morts prématurés ne peuvent que nous réjouir, notamment lorsque nous avons été confronté à la maladie ou à la mort prématurée d’un proche.
Mais Harari nous parle aussi d’une autre évolution qui est celle du big data et de l’intelligence artificielle dans ce domaine. Il est persuadé et probablement a-t-il raison que la plupart des humains accepteront d’ouvrir totalement les données privées de santé qu’ils livreront sans coup férir à ces outils à cause de la promesse d’une meilleure santé, promesse qui sera pour une part certaine respectée.
Ce sera un monde étrange dans lequel toutes les données de santé d’homo sapiens seront à la disposition de l’intelligence artificielle et probablement aussi des assurances et autres institutions financières qui feront tout ce qui est possible pour y avoir accès.
<1126>
-
Lundi 8 octobre 2018
« Rien de métaphysique dans tout cela. Uniquement des problèmes techniques »Yuval Noah Harari parlant de la mort dans « Homo deus » page 35Parmi les 5 auteurs que Yuval Noah Harari conseille de lire pour comprendre le monde (Dans le numéro du 20 septembre du Point) il cite Steven Pinker.
Le mot du jour du 21 novembre 2017 était consacré au livre de Steven Pinker : « La part d’ange en nous, Histoire de la violence et de son déclin » qui montrait que dans l’histoire de l’humanité il n’y a avait jamais eu aussi peu de violence et que globalement le sort des hommes n’avait jamais été aussi enviable qu’aujourd’hui.
Et c’est aussi ce que décrit l’historien israélien dans son livre quand il examine la situation de l’homme par rapport à la mort.
Depuis le début de l’humanité, plusieurs évènements étaient pourvoyeurs massifs de mortalité :
- La famine
- Les épidémies
- La guerre
La famine constituait un fléau récurrent. Autrefois, la production de nourriture était dépendante des intempéries et de la chance. Il arrivait régulièrement qu’à cause d’une mauvaise récolte les habitants meurent de faim. À titre d’exemple, 2,8 millions de Français (soit 15% de la population de l’époque) sont morts entre 1692 et 1694 à cause de la famine engendrée par la destruction des récoltes par le mauvais temps. Pendant ce temps-là, Louis XIV le Roi-Soleil batifolait à Versailles avec ses maîtresses. La famine toucha ensuite les autres pays, que ce soit l’Estonie, la Finlande ou encore l’Ecosse.
Les hommes d’alors accusaient le destin ou la volonté de Dieu.
Aujourd’hui, la famine n’est plus inéluctable, elle constitue essentiellement un problème politique. Si nous le voulions, tout le monde pourrait manger à sa faim. Même lorsqu’une zone est touchée par des inondations ou d’autres catastrophes menant à une pénurie alimentaire, des mécanismes internationaux entrent en œuvre pour faire face au manque alimentaire. Si des famines existent encore, c’est dans les zones de conflits où les ONG ou les organismes internationaux ne peuvent accéder en raison de l’insécurité. En effet, grâce à nos réseaux développés et au commerce mondial, on peut envoyer rapidement de la nourriture sur place.
Certes, il reste une insécurité alimentaire et aussi des problèmes de qualité de la nourriture mais plus des famines comme celles rappelées ci-dessus. Harari précise d’ailleurs que c’est plutôt d’une suralimentation ou d’obésité dont nous souffrons désormais. En 2010, la famine et la malnutrition ont tué 1 million de personnes alors que l’obésité en a tué trois fois plus. C’est généralement les personnes les plus pauvres qui sont concernées, se gavant de hamburgers et de pizzas. En 2014, plus de 2,1 milliards d’habitants étaient en surpoids alors que seulement 850 millions d’individus souffraient de malnutrition.
Pour les épidémies, l’évolution est encore plus radicale. La plus mémorables des épidémies est la peste noire qui se déclara au début des années 1330 en Asie de l’Est ou Asie centrale. La peste gagna toute l’Asie, l’Europe et l’Afrique du Nord en se propageant via une armée de rats et de puces. Entre 75 et 200 millions de personnes moururent à cause de cette épidémie. Tous étaient démunis face à celle-ci, on n’avait aucune idée qui aurait permis de l’enrayer. Seules des prières et des processions étaient réalisées en désespoir de cause, les hommes attribuant les maladies au courroux des dieux ou encore aux démons. Ils ne soupçonnaient pas qu’une minuscule puce ou une simple goutte d’eau puisse contenir toute une armada de prédateurs mortels. La peste noire ne fut même pas la pire des épidémies, les explorateurs et les colons décimaient jusqu’à 90% des autochtones en arrivant chez eux avec leurs maladies.
À côté de ces grandes épidémies, il y avait les autres maladies qui tuaient des millions de personnes chaque année, notamment les enfants qui étaient peu immunisés. Jusqu’au XXe siècle, un tiers des enfants mourraient avant d’avoir atteint l’âge adulte à cause d’un mélange de malnutrition et de maladie. Cependant, les progrès de la médecine ont permis de réduire la mortalité infantile à seulement 5% et même à 1% dans les pays développés. Tout cela grâce à l’élaboration de vaccins, d’antibiotiques, une meilleure hygiène et une infrastructure médicale améliorée.
Ainsi, la variole a été éradiquée. C’est la première épidémie que les hommes aient pu effacer de la surface de la terre.
Concernant la guerre, l’étude de Pinker est sans appel, même si parfois nous avons du mal à y croire. Depuis le début de l’humanité, la paix était précaire et la guerre pouvait se déclarer à tout moment. Désormais, la guerre s’est faite plus rare que jamais. De nos jours, seulement 1% de la population mondiale en meurt. Le diabète tue plus que la guerre :
« Le sucre est devenu plus dangereux que la poudre à canon » p.25
Aujourd’hui, on meurt plus de trop manger que de ne pas manger assez, plus de vieillesse que de maladies et plus de suicides que de la guerre.
Même le terrorisme, jugé à l’aune de la guerre d’autrefois ou d’autres problèmes constitue une menace mineure concernant la mortalité. Ils sèment plus de peur qu’ils ne causent de vrais dommages matériels.
« Pour l’Américain ou l’Européen moyen, Coca-Cola représente une menace plus mortelle qu’Al-Qaïda. » p.29
En dehors de ces catastrophes, il y avait toutes les maladies qui abrégeaient la vie des humains.
Car Harari fait remarquer que même dans les temps plus anciens il arrivait que certains hommes vivaient très vieux. Qu’ainsi la médecine moderne et l’hygiène n’ont pas tant allongé la durée de vie moyenne des humains que diminuer de manière drastique les causes de morts prématurés.
 Mais Harari rappelle surtout comment et dans quels univers mental les hommes mouraient :
Mais Harari rappelle surtout comment et dans quels univers mental les hommes mouraient :
« Les contes de fées du Moyen-âge représentaient la mort sou l’apparence d’une figure vêtue d’un manteau noir à capuche, une grande faux à la main. Un homme vit sa vie se, se tracassant pour ceci ou cela, courant ici ou là, quand soudain paraît devant lui la Grande faucheuse : elle lui donne une petite tape sur l’épaule de l’un de ses doigts osseux : « Viens ! » […] C’est ainsi que nous mourons. » P. 33
Le grand cinéaste suédois, Ingmar Bergman, dans son film « le septième sceau » reprend cette symbolique. Il y ajoute un élément d’indécision en faisant jouer aux échecs l’homme concerné et la mort. Mais bien sûr, dans ce récit, la mort gagne aussi aux échecs
Nous avons changé de récit et de compréhension :
« En réalité, cependant les hommes ne meurent pas parce qu’un personnage en manteau noir leur tapote l’épaule, que Dieu l’a décrété, ou que la mortalité est une partie essentielle d’un plus grand dessin cosmique. Les humains meurent toujours des suites d’un pépin technique. Le cœur cesse de pomper le sang, des dépôts de graisse bouchent l’artère principale […] Rien de métaphysique dans tout cela. Uniquement des problèmes techniques.
Et tout problème technique a une solution technique […] Certes, pour l’heure, nous n’avons pas de solutions à tous les problèmes techniques, mais c’est précisément pour cette raison que nous consacrons tant de temps et d’argent à la recherche sur le cancer, les germes, la génétique et les nanotechnologies. […]
Même quand des gens meurent dans un ouragan, un accident de la route ou une guerre, nous avons tendance à y voir un échec technique qui aurait pu et dû être évité. Si seulement le gouvernement avait mis en œuvre une meilleure politique ; si la municipalité […], si le chef des armées […], la mort aurait pu être évitée.
La mort est devenue une cause presque automatique de poursuites et d’enquêtes. Comment ont-ils pu mourir ? Quelqu’un, quelque part a failli ! » P 34-35
Et page 12, il exprime ce sentiment de manière encore plus péremptoire :
« Quand la famine, l’épidémie ou la guerre échappent à tout contrôle, nous avons plutôt le sentiment que quelqu’un a dû foirer »
La mort, un problème technique ?
Alors, évidemment des techniciens vont se mettre à l’ouvrage…
<1125>
- La famine
-
Vendredi 5 octobre 2018
« la révolution agricole a donné aux hommes le pouvoir d’assurer la survie et la reproduction des animaux domestiques, tout en ignorant leurs besoins subjectifs »Yuval Noah Harari, « Homo deus » page 97Reprenons notre cheminement à travers le livre de Harari : « Homo deus »
Nous en étions restés avec la révolution agricole, l’apparition du monothéisme et la séparation absolue de l’homme et des autres animaux.
A partir de ce moment, homo sapiens ne se pense plus comme un animal plus évolué, plus intelligent, disposant d’une place privilégiée dans la chaine alimentaire. L’homme ne se pense tout simplement plus comme un animal, mais d’une essence toute différente.
Dieu entre dans l’imaginaire d’homo sapiens. Les croyants diraient homo sapiens découvre Dieu.
Toujours est-il que l’homme se vit alors d’essence divine, les animaux n’ont rien de commun avec « les enfants de Dieu », pas d’intelligence et surtout pas d’émotion.
Et la révolution agricole va créer une catégorie très particulière d’animal : l’animal domestique.
Pour Harari
« La Bible, avec sa croyance en la singularité humaine, a été l’un des sous-produits de la révolution agricole qui a initié une nouvelle phase entre humain et animal. L’avènement de l’agriculture a produit de nouvelles vagues d’extinctions de masse, mais a surtout créé une nouvelle forme de vie sur terre : les animaux domestiqués » (P 92)
Harari fait un schéma de la biomasse sur terre des grands animaux distinguant les humains, les animaux sauvages et les animaux domestiques.
Il arrive alors à ce camembert.
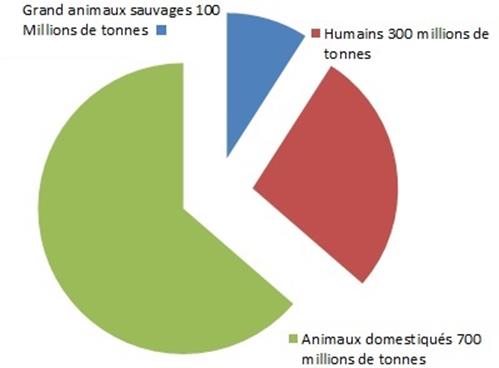 C’est un schéma assez impressionnant. Les humains et leurs animaux domestiques occupent plus de 90% de cette biomasse.
C’est un schéma assez impressionnant. Les humains et leurs animaux domestiques occupent plus de 90% de cette biomasse.
Mais parmi les animaux domestiques, s’il existe une sous-catégorie appelés animaux de compagnie, qui sont plutôt bien traités, il n’en va pas de même pour les millions d’animaux domestiques qu’homo sapiens utilise pour sa nourriture.
« Les espèces domestiqués ont malheureusement payé leur succès collectif sans précédent de souffrances individuelles sans précédent. Si le règne animal a expérimenté maints types de douleurs et de malheurs depuis des millions d’années, la révolution agricole a engendré de nouvelles formes de souffrance qui n’ont fait qu’empirer avec le temps (p 93) »
Peut-être que l’une ou l’autre, à ce stade, se pose la question mais pourquoi Harari s’intéresse t’il tellement à cette relation ancienne entre les hommes et les autres animaux ? Alors que « Homo deus » est censé donner des idées et des perspectives sur l’homme du futur qui veut devenir à l’égal de Dieu : maîtriser la vie, la mort, les instincts et disposer de toute l’information nécessaire (big data) et des algorithmes permettant d’analyser l’information rapidement afin de pouvoir prendre à chaque instant, la décision la plus rationnelle.
D’abord comme je l’ai transcrit dans le mot de lundi
« Ce livre retrace les origines de notre conditionnement actuel afin d’en desserrer l’emprise, de nous permettre d’agir autrement et d’envisager notre avenir de manière bien plus imaginative. »
Notre relation et notre vision du monde animal, ainsi que le mythe de notre séparation « étanche » avec les animaux est un de ces conditionnements.
Et j’ajouterai que dans notre comportement avec les animaux nous avons déjà tous les prémices de ce conditionnement d’ « homo deus »
Harari ne remet pas forcément en cause le fait que les humains mangent d’autres animaux, comme le lion mange la gazelle :
« Ce qui rend le sort des animaux domestiqués particulièrement dur, ce n’est pas uniquement la façon dont ils meurent, mais surtout la manière dont ils vivent.[…]
La racine du problème est que les animaux domestiqués ont hérité de leurs ancêtres sauvages de nombreux besoins physiques, émotionnels et sociaux jugés superflus dans les élevages humains. Les fermiers ignorent systématiquement ces besoins sans subir la moindre sanction économique.
Ils enferment les animaux dans des cages minuscules, mutilent cornes et queues, séparent les mères de leur progéniture, et élèvent sélectivement des monstruosités. Les animaux souffrent terriblement, mais vivent et se multiplient.[…] »

Quand Harari parle de fermier, il me semble juste d’ajouter qu’il parle d’agriculteurs qui ont perdu toute relation avec leurs bêtes, dans une volonté de plus en plus fort d’industrialisation des processus qui ne regarde plus que les animaux sous forme de matières premières capables de produire des protéines. Il existe encore des paysans qui ont un autre rapport avec leurs animaux.
Mais pour compléter son propos, Yuval Noah Harari s’intéresse particulièrement, pour l’exemple, aux cochons et à la femelle du cochon.
« Pour survivre et se reproduire, à l’état sauvage, les sangliers d’autrefois avaient besoin de parcourir d’immenses territoires, de se familiariser avec ce milieu tout en se méfiant des pièges ou des prédateurs. Ils avaient en outre besoin de communiquer et de coopérer avec leurs congénères formant ainsi des groupes complexes dominés par de vieilles matriarches expérimentées. […]
Les descendants des sangliers – les cochons domestiqués – ont hérité de leur intelligence, de leur curiosité et de leurs compétences sociales. […] Les truies reconnaissent les couinements de leurs porcelets qui, âgés de deux jours, différencient déjà les appels de leur mère de ceux des autres truies.
Le professeur Stanley Curtis de la Pennsylvania State University a entraîné deux cochons – Hamlet et Omelette – à actionner un levier avec leur groin et il s’est aperçu qu’ils ne tardaient pas à rivaliser avec les primates en matière d’apprentissage et de jeux vidéo.
Aujourd’hui, la plupart des truies élevées dans les fermes industrielles ne pratiquent pas les jeux vidéo. Leurs maitres humains les enferment dans de minuscules box de gestation, habituellement de deux mètres sur soixante centimètres. Les box en question ont un sol de béton et les barreaux métalliques, et ne permettent guère aux truies enceintes de se retourner ou de dormir sur le flanc, encore moins de marcher. Après trois mois et demi dans de telles conditions, les truies sont placées dans des box légèrement plus larges, où elles mettent au monde et allaitent leurs porcelets. Dans la nature, ils tèteraient leurs mères de dix à 20 semaines ; dans les fermes industrielles, ils sont sevrés de force au bout de 2 à 4 semaines et envoyés ailleurs pour être engraissés et abattus. La mère est aussitôt engrossée à nouveau et replacée dans son box de gestation pour un nouveau cycle » pages 95 & 96
La truie dispose de tout ce qui est indispensable pour survivre et se reproduire : nourriture, vaccin, protection contre les intempéries et insémination artificielle.
Harari ajoute :
« La truie n’a plus objectivement besoin d’explorer son environnement, de frayer avec ses congénères, de s’attacher à ses petits ou même de marcher. D’un point de vue subjectif, elle éprouve encore un besoin très intense de faire toutes ces choses et souffre terriblement si ces besoins ne sont pas assouvis. Les truies enfermées dans des box de gestation manifestent en alternance des sentiments de frustration intense et de désespoir extrême. […]
Tragiquement, la révolution agricole a donné aux hommes le pouvoir d’assurer la survie et la reproduction des animaux domestiques, tout en ignorant leurs besoins subjectifs » P 97
Et il pose cette question :
« Comment pouvons-nous être sûrs que des animaux comme les cochons possèdent effectif un monde subjectif de besoins, de sensations et d’émotions ? Ne sommes-nous pas coupable d’humaniser les animaux ? »
Et sa réponse est limpide, dans la mesure où l’on accepte de changer son conditionnement, de sortir de la déification d’homo sapiens et de se rappeler que nous sommes des mammifères. C’est-à-dire des animaux qui ont un lien particulier avec leurs petits qui est l’allaitement.
« En vérité, attribuer des émotions aux cochons, ce n’est pas les humaniser, mais les mammifériser »
Et de ces réflexions Harari amène à la science la plus moderne et explique l’émotion par des algorithmes biochimiques :
« Les émotions sont plutôt des algorithmes biochimiques vitaux pour la survie et la reproduction de tous les mammifères. »
Et il explique tout cela à partir de la page 97. Car en effet les animaux ont un sentiment fort à l’égard de leurs petits, c’est une souffrance quand on les prive de leurs présence de manière prématurée, les animaux ont des émotions.
Il est juste de dire que même pour les humains, il existait une époque où dans l’éducation des jeunes homo sapiens au début du XXème siècle, des prétendus spécialistes passaient totalement à côté des besoins émotionnels des enfants. Il cite ainsi John Watson.
Les animaux ont des émotions, ils ont aussi une capacité d’interaction avec les humains quand on les laisse exprimer ces facultés. Et pour ne pas être trop long et finir par un récit révélateur, je voudrais rapporter l’histoire du cheval « Hans le malin » qu’il raconte dans son livre :
Au début des années 1890, un cheval baptisé Hans le Malin devint une célébrité en Allemagne. En effet, il arrivait à comprendre et annoncer le résultat de multiplications en donnant le bon nombre de coups de sabots. Cependant, après qu’une commission scientifique l’eut observé, il s’avéra que ce cheval se contentait d’observer soigneusement le langage du corps de son public. Quand Hans le Malin approchait du chiffre exact, il était capable de lire la posture du corps et la physionomie afin d’arrêter ses coups de sabots au bon moment. Il n’avait pas donc cette capacité humaine du calcul mais il avait une autre capacité meilleure que celle des humains : il avait une bien meilleure observation du comportement des humains.
Vous trouverez sur internet des sites qui raconte plus en détail cette histoire : <Ici une page> et <Ici un podcast>
<1124>
-
Jeudi 4 octobre 2018
« La constitution de la 5ème république a 60 ans »Charles de GaulleJe n’ai pas de problème pour connaître l’âge de la constitution de la 5ème République, puisque je suis né 9 jours après sa promulgation et que tant que je connaîtrai mon âge…
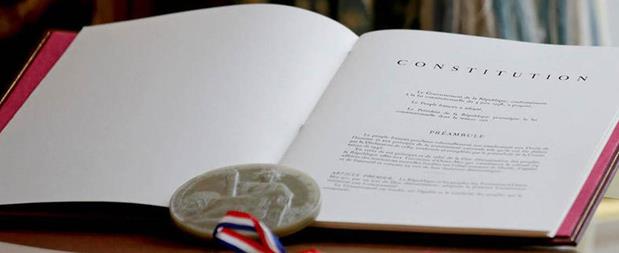 Notre texte fondamental a été adopté par référendum le 28 septembre 1958 et promulgué le 4 octobre 1958, on parle donc de la constitution du 4 octobre 1958.
Notre texte fondamental a été adopté par référendum le 28 septembre 1958 et promulgué le 4 octobre 1958, on parle donc de la constitution du 4 octobre 1958.
Dans le domaine de la longévité, elle semble sur de bonnes voies, si on la compare aux autres républiques et aux deux empires qui ont jalonné la vie politique française depuis la révolution française. Seule la 3ème république (1870-1940) a été plus longue, encore 10 ans…
Dans un mot du jour très personnel, j’en disais tout le mal que j’en pensais : <Mot du jour du 08 février 2017>
Parallèlement, je disais beaucoup de bien du régime parlementaire allemand : <Mot du jour du 25 septembre 2017>
Depuis, beaucoup de politologues sont revenus à la charge pour vanter les mérites de la 5ème république et montrer son efficacité par rapport aux régimes parlementaires allemands, anglais, espagnols et italiens qui sont aujourd’hui tous à peu près paralysés parce que tous ces pays n’arrivent plus à constituer une majorité cohérente formée d’un seul parti ou d’une coalition de partis d’accord sur un programme de gouvernement parce des partis extrémistes se développent à l’extrême droite surtout et aussi dans une moindre mesure à l’extrême gauche des partis de gouvernement. Et puis les Etats-Unis ont accouché de ce monstre : Donald Trump, menteur patenté, impulsif, démagogue.
La 5ème république nous prémunit contre ces dérives disent des gens aussi sérieux qu’Alain Duhamel et Edouard Balladur dans leur livre commun : « Grandeur, déclin et destin de la Ve République ; un dialogue»
De Gaulle voulait une constitution qui permette d’éviter que des manœuvres de partis politiques créent tout le temps de l’instabilité gouvernementale.
La Quatrième République a connu 24 présidents du Conseil en 12 ans. 9 gouvernements ont duré moins de 41 jours (plus d’un sur trois), et pour la dernière année, après mai 1957, il y a eu 5 gouvernements qui ont duré en moyenne moins de 59 jours. De plus, seuls deux gouvernements ont duré plus d’un an (Henri Queuille (1) pendant 12,8 mois et Guy Mollet pendant 15,6 mois).
Il est clair que la 5ème république est plus stable.
Faut-il, pour reprendre une expression macronienne un pouvoir exécutif fort et omnipotent pour museler un pouvoir législatif que les gaulois querelleurs ne sauraient maîtriser ?
Mais elle a été abimée en 2 étapes :
- La première fut l’œuvre de De Gaulle lui-même qui inventa l’élection présidentielle au suffrage universel, rendant les hommes politiques français littéralement fous et obnubilés par ce seul poste.
- La seconde fut l’apport désastreux de Lionel Jospin. Il le fit en 2 temps d’abord en alignant la durée du mandat présidentiel sur celui des députés, 5 ans puis en inversant l’ordre des élections d’abord la présidentielle puis les élections législatives.
Ce qui fait que les députés doivent tout au président élu.
On l’a bien vu lors des dernières élections, l’expression « même une chèvre avec le logo LREM aurait été élue » n’est qu’exagérée mais non fausse.
C’est pourquoi un mouvement, mais plutôt un homme pesant au mieux 30% des électeurs peut gouverner tout seul.
Il gouverne tout seul puisqu’il décide qui sera président de l’Assemblée Nationale et même qui doit être Procureur de Paris.
Alors, je ne dis pas forcément non à la 5ème République, mais je dis résolument non à la 5ème république Gaullo-jospinienne.
Aujourd’hui il n’existe plus de savant comme Newton ou Einstein qui invente ou comprenne le monde tout seul dans leur tête et devant leur bureau. Alors si pour les plus grandes avancées de la science et de la connaissance humaine il est nécessaire de travailler en équipe, comment imaginer qu’un homme détienne tous les clés pour gouverner un pays ?
Il faut certes un chef d’équipe mais pour cela il faut une équipe.
Le Président actuel en est fort dépourvu et il se trouve de plus en plus seul.
On ne peut qu’être inquiet sur la manière dont tout cela finira, et il n’est au pouvoir que depuis 16 mois.
C’est pourquoi il faudrait vraiment réformer cette 5ème république : Hollande souhaite la suppression du premier ministre
Je pense qu’il faut aussi davantage encadrer la dissolution de l’assemblée nationale ne donnant plus ce pouvoir au seul Président de la République.
Il faudrait à minima organiser les élections législatives en même temps que les élections présidentielles et ne plus en faire l’accessoire.
Le régime est peut être stable, mais sommes-nous bien gouvernés ?
Je ne le crois pas.
<1123>
- La première fut l’œuvre de De Gaulle lui-même qui inventa l’élection présidentielle au suffrage universel, rendant les hommes politiques français littéralement fous et obnubilés par ce seul poste.
-
Mercredi 3 octobre 2018
«Si les arméniens et les juifs n’aimaient pas vraiment la vie, ils auraient tous deux disparu depuis bien longtemps.»Charles AznavourCharles Aznavour vient de décéder ce 1er octobre 2018. Il a écrit plus de 1000 chansons, il a surtout écrit de bien beaux textes que j’ai déjà convoqués deux fois pour les mots du jour.
Une première fois pour exprimer ce que j’avais ressenti après avoir entendu, Polina Jerebtsova, auteur du « Journal de Polina, Une adolescente tchétchène » qui évoquait la guerre que la Russie a mené en Tchétchénie
La chanson avait pour titre « Les enfants de la guerre » qui débutait ainsi :
Les enfants de la guerre
Ne sont pas des enfants
Ils ont l’âge de pierre
Du fer et du sang
Sur les larmes de mères
Ils ont ouvert les yeux
Par des jours sans mystère
Et sur un monde en feu
Les enfants de la guerre
Ne sont pas des enfants
Ils ont connu la terre
À feu et à sang
Ils ont eu des chimères
Pour aiguiser leurs dents
Et pris des cimetières
Pour des jardins d’enfants
C’était le mot du jour du 24 septembre 2013
Et c’est bien sûr à Charles Aznavour, arménien, né en 1924, 9 ans après le début du génocide arménien que j’ai emprunté les mots pour évoquer cette faille de l’humanité le 8 avril 2015
J’expliquais que si les arméniens commémorent le génocide arménien le 24 avril, parce que le 24 avril 1915 correspond à l’arrestation de 300 intellectuels et notables arméniens à Constantinople et a été suivi par tout le mécanisme génocidaire, c’était le 8 avril 1915, à Zeitoun, ville de Cilicie au Nord l’Alep, que les exactions avaient commencé : <Massacres à Zeïtoun>
J’avais pris pour exergue un extrait de la chanson « ils sont tombés »
«Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps, au bout de leur courage
La mort les a frappés sans demander leur âge puisqu’ils étaient fautifs d’être enfants d’Arménie.»
Mais je crois qu’on peut citer ce texte plus longuement :
«Ils sont tombés, sans trop savoir pourquoi
Hommes, femmes, et enfants qui ne voulaient que vivre
Avec des gestes lourds comme des hommes ivres
Mutilés, massacrés, les yeux ouverts d’effroi.
Ils sont tombés en invoquant leur Dieu
Au seuil de leur église ou au pas de leur porte
En troupeau de désert, titubant, en cohorte
Terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu.
Nul n’éleva la voix dans un monde euphorique
Tandis que croupissait un peuple dans son sang
L’Europe découvrait le jazz et sa musique
Les plaintes des trompettes couvraient les cris d’enfants.
Ils sont tombés pudiquement, sans bruit,
Par milliers, par millions, sans que le monde bouge,
Devenant un instant, minuscules fleurs rouges
Recouverts par un vent de sable et puis d’oubli.
lls sont tombés, les yeux pleins de soleil,
Comme un oiseau qu’en vol une balle fracasse
Pour mourir n’importe où et sans laisser de traces,
Ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil.
Ils sont tombés en croyant, ingénus,
Que leurs enfants pourraient continuer leur enfance,
Qu’un jour ils fouleraient des terres d’espérance
Dans des pays ouverts d’hommes aux mains tendues.
Moi je suis de ce peuple qui dort sans sépulture
Qui choisit de mourir sans abdiquer sa foi,
Qui n’a jamais baissé la tête sous l’injure,
Qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas.
Ils sont tombés pour entrer dans la nuit
Éternelle des temps, au bout de leur courage
La mort les a frappés sans demander leur âge
Puisqu’ils étaient fautifs d’être enfants d’Arménie.»
Bien sûr Charles Aznavour a beaucoup agi pour la reconnaissance de ce génocide qui a touché le peuple de ses ancêtres et œuvré pour aider l’Arménie contemporaine.
Quand l’Arménie a été frappée par un séisme, il a organisé une collecte de fonds pour aider les sinistrés et écrit une autre chanson : « Pour toi Arménie ».
Mais ce que je trouve remarquable chez cet homme c’est qu’il ne s’est pas figé sur le seul malheur de son peuple.
Il s’est toujours senti proche de l’autre peuple ayant subi un grand génocide : le peuple juif.
Il a chanté « Yéroushalaim »
C’est sur ce site que j’ai appris que lors d’un voyage en Israël, il avait dit : « Si les arméniens et les juifs n’aimaient pas vraiment la vie , ils auraient tous deux disparu depuis bien longtemps »
Et les tziganes, autre peuple victime de la monstruosité des nazis étaient également chers à son cœurs : « Les deux guitares »
Le journal « Têtu » rappelle aussi qu’en 1972 :
La France pénalise toujours l’homosexualité, qu’elle considère encore comme une maladie mentale. Cette même année pourtant, Charles Aznavour séduit le pays avec « Comme ils disent». Une chanson qui dépeint la vie d’un homme gay avec une intelligence, une bienveillance et une finesse qui manque encore à beaucoup aujourd’hui.
Il fut aussi soutien du féminisme « Le Droit Des Femmes »
C’étaient les bons combats, la sensibilité, la bienveillance et la profondeur des textes mis au service de ces causes.
Et que dire de cette chanson qui ne peut que toucher les filles et les fils qui doivent dire un dernier adieu à leur maman : « La Mamma »
Claude Askolovitch a consacré une remarquable <revue de presse le 2 octobre> à Aznavour :
« Et d’un monde enfoui, quand un petit arménien de Paris portait une petite bague avec la faucille et le marteau, et serait pendant la guerre le témoin de l’héroïsme des résistants métèques et communistes. Il l’a raconté dans l’Humanité..
« Ma mère partait avec la voiture d’enfant où des armes étaient dissimulées. Les armes servaient, on les remettait dans la voiture, maman rentrait à la maison. » Et à la maison, Charles apprenait à jouer aux échecs avec un poète communiste et arménien qui s’ennuyait, caché, il s’appelait Missak Manouchian et serait le premier des fusillés de l’affiche rouge…
C’était Charles Aznavour, un auteur-compositeur-interprète, avant tout un poète et qui faisait aussi du cinéma.
<1122>
-
Mardi 2 octobre 2018
« Par rapport aux autres animaux, cela fait longtemps que les humains sont devenus des dieux. Nous n’aimons pas y penser trop sérieusement parce que nous n’avons pas été des dieux particulièrement justes ou miséricordieux. »Yuval Noah Harari « Homo deus » page 85Il n’est pas question pour moi de faire un résumé du livre, d’autres l’ont fait : https://www.beseven.fr/resume-detaille-homo-deus/amp/
Ma démarche consiste à aborder les questions et les développements qui m’ont interpellés et pour lesquels Harari m’a soit appris quelque chose ou m’a permis de me poser des questions nouvelles.
Je disais hier que pour entrer dans un ouvrage comme « Homo deus » il fallait commencer par la table des matières.
Il y a donc 3 parties :
- Partie I – Homos sapiens conquiert le monde
- Partie II – Homo sapiens donne sens au monde
- Partie III – Homo sapiens perd le contrôle
Ces trois parties étant précédées par une introduction : Le nouvel ordre du jour humain
Pour Luc Ferry que j’ai cité dans le mot d’hier ces trois parties constituent un simple plagiat d’Auguste Comte selon laquelle l’humanité serait passée par « trois états » : religieux, métaphysique et « positif » (scientifique) et que l’histoire occidentale se partagerait ainsi en trois âges : l’âge théologique où les principes qui définissent la morale et le sens de la vie venaient de Dieu ; l’âge métaphysico-humaniste, inauguré par Rousseau, qui entérinerait le retrait du divin en s’efforçant de situer toute autorité dans le cœur de l’homme, dans son libre arbitre et la sensibilité de son « moi profond ».
A ces remarques, je réponds que d’abord Harari n’est pas un chercheur mais un historien. Il n’invente ou ne trouve rien mais se sert des recherches, des inventions, des théories que d’autres ont élaboré pour en faire une synthèse et pour en tirer des problématiques et des questions.
Ensuite, c’est une vaste blague de dire qu’entre Auguste Comte et Yuval Noah Harari, il n’y a pas une accumulation de connaissances et de découvertes qui ont enrichi la réflexion de l’historien israélien pour présenter sa vision de l’évolution de notre espèce.
Car, c’est la grande force d’Harari de ne pas entrer dans cette aventure, cette histoire par la philosophie qui part d’un postulat donnant à l’homme une dimension, une destinée, une valeur dans le monde du vivant très supérieure à tous les autres êtres vivants.
Pour Harari, l’ « HOMME » est avant tout « homo sapiens », un mammifère, un cousin du singe qui était au départ faible, proie de prédateurs plus puissants que lui, et qui au fur à mesure de son évolution a colonisé la planète terre en créant des civilisations extraordinairement sophistiquées mais en même temps a détruit les ressources de la planète et éliminé en masse d’autres espèces de manière involontaire et surtout de manière inconsciente.
<Le mot du jour du 29 juin 2017> citait le livre «L’arbre de la science » qu’Eugène Huzar écrivait en 1857, au début de l’ère industrielle et qui lançait cette mise en garde :
«L’homme, en jouant ainsi avec cette machine si compliquée, la nature, me fait l’effet d’un aveugle qui ne connaîtrait pas la mécanique et qui aurait la prétention de démonter tous les rouages d’une horloge qui marcherait bien, pour la remonter à sa fantaisie et à son caprice. »
Mais l’expression d’une crainte d’un homme du XIXème siècle peut encore être considérée comme une peur irrationnelle du progrès, de l’inconnu et peut être même un conservatisme paralysant.
Mais quand Luc Ferry, cherche désespérément des références livresques pour filtrer la narration de « Sapiens » ou d « Homo deus » et donner son avis critique, je ne peux m’empêcher de penser à ces savants théologiens qui répondaient, jadis, à toute question par des références bibliques et des arguties rhétoriques.
Méthode à laquelle Galilée aurait répondu selon mon professeur d’Histoire, Girolamo Ramunni :
« Je cherche les réponses à mes questions dans le grand livre de la nature, non dans les livres sacrés »
Car oui la connaissance a augmenté depuis Auguste Comte, parfois le mot du jour a pu s’en faire l’écho :
Ainsi quand Franz de Waal pose cette question et ose cette réponse : « Est-ce que l’homme est plus intelligent que le poulpe ? On ne sait pas » <mot du jour du 28 juin 2017>
Ce grand scientifique qui a consacré une grande partie de sa vie à la recherche sur l’empathie des animaux, faisait le constat que chaque fois qu’on essaye de fixer une limite entre « homo sapiens » et les autres animaux terrestres, la limite est franchie dès que nos connaissances progressent par l’étude de l’univers animal.
Et dans le monde des vivants, au-delà des seuls animaux, nous apprenons comment vivent les végétaux sur terre. Peter Wohlleben nous donne à découvrir dans son merveilleux livre « La vie secrète des arbres », la communication, l’entraide de ces grands végétaux entre eux et avec d’autres organismes vivants de la forêt et dont l’âge pour certains se trouve dans des étalons de durée qui n’ont rien à voir avec ceux des humains : <mot du jour du 22 décembre 2017>
La première partie : « Homos sapiens conquiert le monde » se divise en deux chapitres :
- L’anthropocène
- L’étincelle humaine
Le chapitre « L’anthropocène » commence ainsi :
« Par rapport aux autres animaux, cela fait longtemps que les humains sont devenus des dieux. Nous n’aimons pas y penser trop sérieusement parce que nous n’avons pas été des dieux particulièrement justes ou miséricordieux.
[…] allez voir un film de Disney ou lisez des contes de fées : vous en retirerez facilement l’impression que la planète terre est surtout peuplée de lions, de loups et de tigres qui sont à égalité avec nous, les humains. […]
Combien de loups vivent aujourd’hui en Allemagne, le pays des frères Grimm, du Petit Chaperon rouge et du Grand Méchant Loup ? Moins de 100. […] En revanche, l’Allemagne compte 5 millions de chiens domestiques. Au total, près de 200 000 loups sauvages écument encore la terre contre 400 000 000 chiens domestiques, 40 000 lions contre 600 000 000 chats domestiques, 900 000 buffles africains contre 1,5 milliard de vaches ; 50 millions de pingouin et 20 milliards de poulets » (p.85).
Après ces énumérations et quantifications, Harari émet des hypothèses sur les fondements de nos mythes monothéistes qui sont apparus historiquement en même temps que la révolution agricole.
« Les données anthropologiques et archéologiques indiquent que les chasseurs-cueilleurs archaïques étaient probablement animistes : ils croyaient qu’il n’y avait par nature pas de fossé séparant les hommes des autres animaux. Le monde […] appartenait à tous ses habitants et tout le monde suivait un ensemble commun de règles. Ces règles impliquaient des négociations permanentes entre tous les êtres concernés. […]
La vision animiste du monde guide encore certaines communautés de chasseurs-cueilleurs qui ont survécu jusque dans les Temps modernes.
L’une d’elles est celle des Nayak, qui vivent dans les forêts tropicales de l’Inde du Sud. L’anthropologue Danny Naveh, qui les a étudiés plusieurs années, rapporte que lorsqu’un Nayak marchant dans la jungle rencontre un animal dangereux – un tigre, un serpent ou un éléphant – il peut s’adresser ainsi à lui : « Tu vis dans la forêt. Moi aussi. Tu es venu manger ici, et moi aussi je suis venu ramasser des racines et des tubercules. Je ne suis pas venu te blesser »
Un jour, un Nayak s’est fait tuer par un éléphant mâle, qu’ils appelaient « l’éléphant qui marche toujours tout seul ». Les Nayak ont refusé d’aider les hommes des services forestiers indiens à le capturer. Ils ont expliqué à Naveh que cet éléphant était très proche d’un autre mâle avec lequel il vagabondait toujours. Un jour, le service forestier a capturé le second éléphant, et « l’éléphant qui marche toujours tout seul » est devenu furieux et violent. « Que ressentiriez-vous si on vous enlevait votre épouse ? C’est exactement ce que ressentait cet éléphant.» […]
Beaucoup de peuples industrialisés sont totalement étrangers à cette perspective animiste. Aux yeux de la plupart d’entre nous, les animaux sont foncièrement différents et inférieurs. La raison en est que même nos traditions les plus anciennes sont nées des milliers d’années après la fin de l’ère des chasseurs cueilleurs. L’Ancien Testament, par exemple a été écrit au premier millénaire avant notre ère et ses récits les plus anciens reflètent les réalités du deuxième millénaire. Au Moyen-Orient cependant, l’ère des chasseurs-cueilleurs s’est terminée plus de 7 000 ans auparavant. Il n’est donc guère surprenant que la Bible rejette les croyances animistes et que son seul récit animiste apparaisse au début, comme un sombre avertissement. […Dans la Bible] la seule fois où un animal engage la conversation avec un homme, c’est lorsque le serpent incite Eve à goûter au fruit défendu de la Connaissance. (L’ânesse de Balaam dit aussi quelques mots, mais elle ne fait que lui transmettre un message de Dieu).
Au jardin d’Eden, Adam et Eve fourrageaient. L’expulsion du paradis frappe par sa ressemblance avec la révolution agricole. Au lieu de permettre à Adam de cueillir les fruits sauvages, un Dieu en courroux le condamne à « gagner son pain à la sueur de son front ». Que les animaux bibliques n’aient parlé aux humains qu’à l’époque préagricole de l’Eden n’est sans doute pas un hasard.
Quelles leçons la Bible tire-t’elle de cet épisode ?
Qu’il ne faut pas écouter les serpents, et qu’il vaut généralement mieux éviter de parler aux animaux et aux plantes. Cela ne conduit qu’au désastre.
L’histoire biblique contient pourtant des couches de sens plus profondes et plus anciennes. Dans la plupart des langues sémitiques, « Eve » signifie serpent ou femelle du serpent. Notre mère biblique ancestrale cache donc un mythe animiste archaïque suivant lequel les serpents ne sont pas nos ennemis mais nos ancêtres. Pour maintes cultures animistes, les humains descendent des animaux y compris des serpents et autres reptiles. La plupart des Aborigènes d’Australe croient que le serpent Arc-en-ciel a créé le monde. […] En fait les Occidentaux modernes croient eux aussi qu’ils sont issus de reptiles par l’évolution. Le cerveau de chacun d’entre nous est construit autour d’un noyau reptilien, et la structure de notre corps est au fond celle de reptiles modifiés.
Les auteurs du livre de la Genèse ont eu beau préserver un reliquat de croyances animistes archaïques à travers le nom d’Eve, ils ont pris grand soin d’en dissimuler toutes autres traces. Loin de descendre des serpents, dit la Genèse, les humains ont été créés par Dieu à partir de la matière inanimée. Le serpent n’est pas notre ancêtre, il nous incite à nous rebeller contre notre Père céleste. Alors que les animistes ne voyaient dans les humains qu’une autre espèce d’animal, la Bible plaide que les hommes sont une création unique, et toute velléité de reconnaître l’animal en nous nie nie la puissance et l’autorité de Dieu. » (Pages 86 à 92).
Et Harari achève sa démonstration en rappelant la négation de Darwin par les religions monothéistes et aussi la rupture avec Dieu des hommes convaincus par le récit darwinien :
« Quand les humains modernes ont découvert qu’ils descendaient effectivement des reptiles, ils se sont rebellés contre Dieu et ont cessé de l’écouter, ou même de croire en son existence. » (P 92).
Au bout de ce développement, la question que je me pose est de savoir si finalement l’invention par homo sapiens des religions monothéistes n’a pas eu comme première fonction de séparer homo sapiens des autres animaux afin de pouvoir justifier sa toute-puissance à l’égard des animaux et d’en faire de simples objets de possession dont l’homme pouvait faire ce que bon lui semblait.
Car si l’homme a été créé par Dieu et fait à son image, c’est donc que sapiens porte en lui une divinité qui lui permet d’agir comme un démiurge sur tout le reste du vivant sans tenir aucun compte de ces êtres qui sont sur bien des points semblables à lui. Homo deus était déjà en route.
Je me souviens de Boris Cyrulnik qui a raconté lors d’une émission que lors de ses études de médecine, on lui avait demandé de disséquer une grenouille vivante et que la grenouille criait. Cyrulnik en a fait part à son professeur qui surveillait l’expérience et qui lui a répondu : « mais non la grenouille ne sent rien. C’est comme votre vélo quand il crisse, il ne souffre pas »
Tant de certitudes, d’aveuglement et de cruauté nous laissent aujourd’hui sans voix.
Oui ! l’homme n’a pas été et n’est toujours pas pour les animaux un dieu juste et miséricordieux
<1121>
- Partie I – Homos sapiens conquiert le monde
-
Lundi 1 octobre 2018
« Tous les scénarios esquissés dans ce livre doivent être compris comme des possibilités et non comme des prophéties. »Yuval Noah Harari « Homo Deus » Page 425Le Point a fait sa Une de son numéro du 20 septembre 2018 avec ce titre :
« Yuval Noah Harari : Le penseur le plus important du monde. »
Titre assez stupide, mais dans l’air du temps. Il y a bien sûr la tentative d’avoir une couverture accrocheuse susceptible de faire vendre, Mais c’est aussi parce que, pour beaucoup, nous sommes dans le temps de la compétition dans lequel on cherche à toujours déterminer quel est le N°1.
Quel est le meilleur footballeur, le meilleur tennisman ?
Encore que dans ces domaines, il s’agisse d’activités humaines qui vivent en grande partie de la compétition.
Mais se poser la question, quel est le meilleur écrivain, le plus grand penseur, le plus grand scientifique est, selon moi, un exercice vain et dénué de pertinence.
Notez qu’il y en a qui ne sont pas d’accord.
Luc Ferry par exemple : <Harari ou l’avenir pour les nuls>, article publié dans le journal Le Figaro dans lequel, après avoir accusé Harari d’avoir plagié Auguste Comte, de ne pas savoir distinguer le communisme et le socialisme, il finit par cette condamnation sans appel :
« La vérité c’est qu’après avoir adapté Auguste Comte au goût du jour, c’est Orwell qu’Harari repeint aux couleurs de la Silicon Valley pour donner à son livre le ton apocalyptique sans lequel il n’est plus aujourd’hui de succès. Il veut vulgariser, pourquoi pas, mais au prix de simplismes si extrêmes que tout l’ensemble en devient franchement fallacieux. »
Mais si vous écoutez une interview de Yuval Noah Harari et que vous la comparez avec une interview de Luc Ferry, ou d’ailleurs de Michel Onfray ou de BHL vous êtes dans deux mondes différents, le monde de l’humilité d’un côté, le monde de l’arrogance de l’autre.
Ce n’est pas que Luc Ferry, Michel Onfray, c’est plus compliqué avec BHL ne disent pas des choses parfois très intéressantes, mais leur ton est toujours celui du sachant, de l’autorité intellectuelle et morale du haut de leur piédestal. Bref, ils sont incapables de la moindre modestie.
Rien de tel chez Yuval Noah Harari qui dans son expression, ses formulations propose, émet des hypothèses, bref nous donne à réfléchir.
Gaspard Koenig dans l’émission du Grain à moudre du 27/09/2018 a dit son admiration pour l’écrivain israélien avec ces mots :
« Harari est un historien qui regarde vers l’avenir »
Ce qui est une manière de le définir qui me convient.
Si le Point a fait sa couverture sur Harari, c’est parce qu’il vient de faire publier en France un troisième livre : «21 Leçons pour le XXIème siècle ».
Il va un peu vite pour que je parvienne à le suivre.
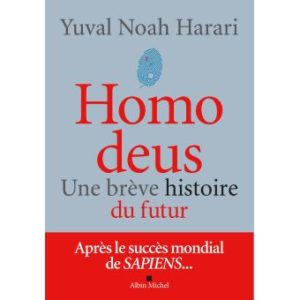 Pour ma part je n’en suis qu’à son deuxième « Homo Deus » que j’ai lu pendant les vacances d’été et que je vais essayer de présenter au cours d’une série de mots du jour.
Pour ma part je n’en suis qu’à son deuxième « Homo Deus » que j’ai lu pendant les vacances d’été et que je vais essayer de présenter au cours d’une série de mots du jour.
Vous savez que si pour un roman il peut apparaître pertinent de commencer par le début et d’arriver à la dernière page en ayant lu toutes celles intermédiaires, ce n’est pas du tout la bonne méthode pour un essai comme « Homo Deus » : On commence par la table des matières puis on lit la conclusion et le début dans l’ordre qu’on souhaite et on picore un peu au milieu.
Si cet examen est concluant et vous permet dès l’entame d’avoir une vision d’ensemble du propos, vous pouvez commencer à lire l’ouvrage de manière plus méthodique, en abordant les chapitres dans leur entier et si cela vous semble pertinent dans l’ordre dans lequel l’auteur les a publiés ou dans un autre ordre si votre compréhension du sujet vous dicte cette méthode.
Pour ce premier mot sur « Homo deus » je vous propose de commencer par la conclusion ou au moins le début de la conclusion qui valide cette vision d’humilité que je décrivais précédemment.
D’abord Yuval Noah Harari explique qu’il ne sait pas de quoi l’avenir sera fait.
« Nous ne saurions prédire l’avenir parce que la technologie n’est pas déterministe. La même technologie pourrait créer des sociétés de nature très différente Par exemple, la technologie de la révolution industrielle – Train, électricité, radio et téléphone – a pu servir à mettre en place des dictatures communistes, des régimes fascistes et des démocraties libérales. »
Et j’ajouterai, même des social- démocraties qui sont des démocraties libérales avec un supplément d’âme parce qu’ils ajoutent à la liberté et aux droits individuels, la solidarité.
Et il ajoute :
« L’essor de l’intelligence artificielle et des biotechnologies transformera certainement le monde, mais il n’impose pas un seul résultat déterministe. Tous les scénarios esquissés dans ce livre doivent être compris comme des possibilités et non comme des prophéties. »
Harari refuse à juste titre le rôle de prophète mais en accumulant les connaissances sur les progrès des technologies, les pistes de recherche dans les laboratoires et les lieux des plus remarquables ingénieurs et scientifiques, il tente de comprendre ce que l’alchimie de l’ensemble de ses technologies peut produire sur l’homme, la société, la terre et où elle peut nous mener.
Je vais partager un petit exemple qui n’est pas dans son livre mais est issue d’une chronique de Pierre Haski « Géopolitique 30/08/2018 »
1° Vous connaissez tous la technologie des drones. Ces petits engins volants qui permettent de faire de magnifique vidéo de lieux splendides ou d’une ville comme Lyon. Ils permettent aussi d’espionner des centrales nucléaires ou d’autres lieux qui pour divers raisons ont vocation à rester secret. Mais vous savez aussi qu’Amazon a le projet de faire transporter des colis par drone.
2° Vous avez entendu parler de la technologie de la reconnaissance faciale. Les chinois expérimentent cela à très grande échelle. Le taux de réussite s’améliore d’année en année, je veux dire le fait que le système de reconnaissance sait associer une image que capte une caméra et l’identité de la personne qui a été filmée.
3° Toutes les armées du monde et particulièrement celles des Etats-Unis, de la Chine et de la Russie travaillent à miniaturiser des armes létales. (arme létale est peut-être un pléonasme)
Que se passe-t-il si vous combinez ces trois technologies ?
Je donne la parole à Pierre Haski :
« Imaginez un minidrone qui tiendrait dans la paume de votre main, équipé d’un système de reconnaissance faciale et d’une charge explosive suffisante pour faire exploser un crâne. Vous le lâchez dans la nature avec un visage programmé comme cible, il le cherchera dans une foule et l’éliminera, sans intervention humaine.
Imaginez maintenant des centaines ou des milliers de tels minidrones lancés sur une ville, sur un rassemblement, ou sur une base militaire, coordonnant tout seuls leur approche et se partageant les cibles à éliminer.
Nous ne sommes pas dans la science-fiction, dans un remake de Terminator version 2018, mais dans la réalité de la guerre de demain. De tels engins, et bien d’autres encore tout aussi terrifiants, baptisés « Robots tueurs », sont à l’étude dans les labos de recherche d’une poignée de pays dotés des moyens scientifiques et financiers, et de la volonté politique de les développer.
Bienvenue au nouveau siècle de la guerre, celui de l’intelligence artificielle, une technologie dont Vladimir Poutine disait l’an dernier que le pays qui la maîtriserait contrôlerait le monde. »
C’est un sujet très sérieux puisque l’ONU a réuni fin août une conférence à Genève en vue d’interdire ou au moins de réglementer de tels robots tueurs.
Les esprits résolument optimistes diront : « Chic on va pouvoir éliminer de manière simple et avec quasi aucun dommage collatéral Bachar el-Assad, le boucher de Syrie.
Vous croyez ?
Ne pensez-vous pas que c’est plutôt Bachar el-Assad qui s’en servirait pour tuer, sans coup férir, les principaux responsables de son opposition ?
Ou le président chinois qui va éliminer les dissidents les plus virulents.
Ou encore Donald Trump qui utilisera ce moyen pour se débarrasser du lanceur d’alerte, Edward Snowden ?
Harari dans sa conclusion nous invite à comprendre et à combattre les évolutions que nous n’aimons pas :
« Certaines de ces possibilités ne vous plaisent pas ? Libre à vous de penser et de vous conduire de façon à ce qu’elles ne se matérialisent pas.
Il nous met en garde cependant de notre difficulté à penser à ce monde nouveau et les perspectives qu’il ouvre tant il est vrai que nous sommes limités par nos modes pensées anciens :
« Toutefois, il n’est pas facile de trouver de nouvelles façons de penser et de se conduire, parce que nos pensées et actes sont habituellement contraints par les idéologies et systèmes sociaux de notre époque. Ce livre retrace les origines de notre conditionnement actuel afin d’en desserrer l’emprise, de nous permettre d’agir autrement et d’envisager notre avenir de manière bien plus imaginative. Loin de de rétrécir nos horizons en prévoyant un seul et unique scénario définitif, il vise à les élargir et à nous faire prendre conscience que nous avons un spectre d’options bien plus large. »
C’est aussi la force de la réflexion de Harari de nous révéler nos conditionnements et ainsi d’élargir nos capacités de réflexion et de compréhension.
Et il finit par ce nouvel assaut d’humilité en phase avec toute sa démarche :
« Comme je l’ai maintes fois souligné, personne ne sait vraiment à quoi ressemblera le marché du travail, la famille ou l’écologie en 2050, ni quels religions, systèmes économiques et structures politiques domineront le monde »
Dire qu’ « Homo deus » est un ouvrage aussi fabuleux qu’« Sapiens » est probablement excessif.
C’est aussi plus compliqué de parler de l’avenir que de ce qui a été. Il approfondit d’ailleurs certaines des réflexions qu’il avait développées dans son premier livre et il en rappelle d’autres. Mais « Sapiens » présentait une telle quantité d’informations, de remise en question de mythes fondateurs que nous acceptons comme des vérités, de mise en perspective du comportement et de l’évolution de notre espèce, qu’il était probablement très difficile de rester à ce niveau.
Dans un entretien à l’OBS publié le 29 septembre 2018, Harari révèle ses craintes et sa démarche, bien loin des ambitions de magistère chères à Luc Ferry et consorts :
« Ma crainte, c’est que l’on commence à me voir comme une sorte de gourou. Il est bon d’apprécier le savoir et de respecter l’opinion des intellectuels, mais il est dangereux d’en faire des idoles. Celui qui est placé sur un piédestal court le risque de se croire tout-puissant, de développer un ego surdimensionné et de devenir fou.
Quant aux fans qui croient avoir trouvé un individu qui a réponse à tout, ils renoncent à leur liberté et arrêtent de réfléchir par eux-mêmes. Ils attendent que le gourou leur fournisse toutes les réponses, toutes les solutions, aussi mauvaises soient-elles. Je souhaite que mes lecteurs trouvent dans mes livres des questions plutôt que des réponses, qu’ils voient en moi un compagnon de voyage sur le chemin de la vérité plutôt qu’un devin omniscient. »
Je souhaite que mes lecteurs trouvent dans mes livres des questions plutôt que des réponses.
J’avais achevé la série sur « Sapiens » par cette injonction kantienne concernant la philosophie des lumières :
« Sapere aude ! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen !»
« Ose savoir ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement !»Mais pour reprendre le jugement excessif et stupide du Point, Yuval Noah Harari est un penseur essentiel qu’il faut lire pour apprendre beaucoup de connaissances et plus encore pour se poser les questions que sa démarche, ses hypothèses et son cheminement intellectuel suscitent en nous.
Et c’est donc à ce cheminement, à ce questionnement que je vais vous inviter dans les prochains jours.
<1120>
-
Vendredi 28 septembre 2018
« L’idéologie des droits de l’homme porte en elle une logique illimitée »Pierre Manent et Jean-Claude MichéaJe n’achète pas souvent le Figaro, mais quand j’ai appris que le journal du 19 septembre 2018 faisait dialoguer Pierre Manent, grand intellectuel libéral né en 1949 et Jean-Claude Michéa penseur de gauche né en 1950 pour parler de l’idéologie des droits de l’homme, je l’ai fait en toute simplicité.
L’idéologie des droits de l’homme est une pensée très positive dans notre système des valeurs.
C’est un champ illimité de progression des droits individuels contre les corporations, les religions, les Etats et toutes ces organisations qui ont toujours contraints les individus.
Ce fut depuis la philosophie des Lumières une évolution bénéfique. Certains pensent que nous sommes allés trop loin.
Pierre Manent a écrit : « La loi naturelle et les droits de l’homme » paru en mars 2018. <France Culture a consacré une page> et plusieurs émissions à ce livre et ce thème.
Jean-Claude Michéa a écrit : « Le loup dans la Bergerie » paru le 19 septembre 2018 <France Culture a consacré une page> et des émissions à ce livre.et ce thème.
J’en ai écouté une plus précisément <La Grande Table du 18 septembre> où Jean-Claude Michéa a développé son questionnement sur l’idéologie des droits de l’homme.
Il dit par exemple :
« Seule la liberté peut limiter la liberté. Sur le papier, c’est magnifique. (…) Mais arrive un moment où tout peut être considéré comme une nuisance. »
Et il a raconté une histoire vraie et je pense pertinent de commencer la réflexion par ce conflit de deux « droits de l’homme ».
J’ai trouvé un article sur le site France 3 Rhône Alpes Auvergne qui donnait plus de précision et confirmait les dires de Jean-Claude Michéa.
Voici l’histoire :
Un couple de citadins originaire de la Loire s’est installé dans le paisible village de Lacapelle-Viescamp, dans le Cantal. Il est incommodé par l’odeur des vaches et du fumier. Les citadins portent l’affaire devant le juge. Après un premier jugement dont l’article ne dit rien, la Cour d’appel de Riom donne raison aux citadins et condamne le paysan à éloigner les vaches et les ouvrages de stockage du fumier à 50 mètres du voisin. Autrement dit, cette ferme, construite en 1802 et située à 35 mètres des plaignants, doit déménager.
Les citadins invoquent le droit individuel de ne pas être incommodé sur leur lieu de vie privée.
Ils entrent en conflit avec un agriculteur issu d’une lignée d’agriculteurs qui exploitent cette ferme depuis 1802.
Nous avons déjà entendu parler de ces conflits de citadins qui se plaignent du bruit des cloches de l’église du village ou aussi des cloches des vaches.
<Il y avait aussi ce couple de parisiens qui voulait porter plainte contre le chant des cigales > ou encore ceux-là qui ont <interpellé le maire parce qu’il ne luttait pas contre les cigales par des insecticides>. Dans aucun de ces cas la justice n’a donné raison aux plaignants.
Que la décision de justice conduise à faire déménager une ferme constitue une étape supplémentaire.
Vous savez, même si cela en irrite certains, que les hommes moyens parlent des faits. Pour ma part, il me semble qu’il faut dépasser les faits et réfléchir à ce qu’ils signifient, quels sens leur donner, quelles conséquences pour notre vie en société, les uns avec les autres. Car il y a l’odeur de la ferme, le bruit des cigales mais surtout il y a toutes ces prétentions qui commencent par cette affirmation : «j’ai droit à… »
Jean-Claude Michéa explique :
« Le slogan du libéralisme et notamment de gauche, c’est mon corps, c’est mon choix et ça ne vous regarde pas. Mon temps, c’est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon argent, c’est mon choix, ça ne vous regarde pas. C’est vrai dans certaines limites parce que sinon on est dans un système totalitaire.
Mais à partir de quel moment, l’usage que je vais faire de mon temps, de mon corps, de mon argent, va détruire la vie commune ?
Prenons l’exemple du dimanche : le libéral dit : ‘je ne vous empêche pas de travailler le dimanche, si vous voulez vous reposer le dimanche, c’est votre problème, moi j’ai envie de travailler. En quoi ça vous regarde, je ne gêne personne. Je ne nuis à personne.
Mais au fur et à mesure que dimanche devient un jour comme les autres, tous les rythmes collectifs se désynchronisent.
La vie sportive, familiale et associative deviennent de plus en plus complexes à mettre en œuvre, et on s’aperçoit au bout de quelque temps que toutes ces décisions présentées comme privées finissent par modifier la vie commune, la re-sculpter. Si vous n’avez pas fait ces choix, vous allez être confrontés à des difficultés et des problèmes presque insurmontables. »
Dans l’article du <Figaro> Pierre Manent expose son opposition entre la Loi naturelle et les droits de l’homme :
« La philosophie des droits humains postule que nous disposons d’un pouvoir légitime et illimité sur tous les aspects de la condition et de la nature humaine. Je pense le contraire. Aussi vastes que soient les capacités humaines, elles restent liées à la condition et à la nature de l’homme. Celui-ci est l’être « intermédiaire » qui se cherche entre la bête et le dieu – entre les êtres qui sont en deçà de la loi et ceux qui sont au-delà de la loi. Il est donc voué à une vie politique, c’est-à-dire à une vie de liberté sous la loi. Ici intervient décisivement la notion ou plutôt le fait de la nature humaine. […] Nous tendons par nature à une vie commune réglée par la raison pratique. La loi naturelle, c’est l’ensemble des principes et critères qui guident cette raison commune. […] Notre liberté habite une nature qui nous donne à la fois l’impulsion, le but et la limite. Nous rejetons aujourd’hui avec impatience et dédain ces déterminations naturelles et prétendons à une liberté sans règle ni raison. »
Aucun de ces deux penseurs ne rejette les droits de l’homme, mais en revanche ils considèrent qu’en appeler exclusivement aux droits individuels constitue une impasse. Pierre Manent dit, une société dont la Loi serait exclusivement la somme des désirs individuels de ses membres est une société assez peu désirable. Car il me semble comme lui que ce qui importe c’est de faire société, de vivre ensemble.
Jean-Claude Michea préfère à la Loi naturelle, la « common decency » concept inventé par Orwell :
« La disposition morale, c’est-à-dire le sentiment, disait Orwell, qu’il y a des choses qui ne se font pas est effectivement présente dans toutes les sociétés humaines. Marcel Mauss l’avait déjà établi dans « l‘Essai sur le don », en montrant que le lien social primaire repose partout et toujours sur la triple obligation de « donner, recevoir et rendre ». […] Simon Leys considérait par exemple la tradition confucéenne comme une forme spécifiquement chinoise de la « common decency » »
Pour Michéa le grand responsable de cette évolution délétère est l’idéologie libérale et la marchandisation du monde :
« L’ennui c’est qu’il est devenu presque impossible, aujourd’hui de s’opposer aux dérives les plus folles de cette idéologie libérale (à partir du moment, en effet où tout comportement – faute de critères éthiques partagés- peut devenir objet de plainte, elle invite inévitablement à voir le mal partout et donc à remplacer tout débat par un appel aux tribunaux) sans remettre simultanément en question la dynamique du capitalisme lui-même. Un système économique dans lequel un bien n’est pas produit en raison de son utilité réelle ou de ses qualités propres mais, avant tout parce qu’il permet au capital déjà accumulé de s’accumuler encore plus ne peut, en effet, connaître écrivait Marx – ni frontière géographique ni aucune limite morale ou naturelle. […] Il est clair qu’une forme de société qui tend ainsi à noyer toutes les valeurs morales dans les « eaux glacées du calcul égoïste » est forcément incapable de fixer d’elle-même la moindre limite à ses propres débordements. Sous ce rapport, l’idée d’un libéralisme « conservateur » n’est donc qu’un oxymore. »
Pierre Manent est en accord avec le diagnostic, mais il continue à ne pas faire porter le poids de la faute sur le libéralisme dont il raconte l’histoire et tout ce qu’il a apporté en terme de liberté, de développement et de progrès pour les sociétés d’aujourd’hui. Il explique :
« L’imaginaire de la croissance illimitée où Jean-Claude Michéa voit à juste titre un des ressorts du charme maléfique qui emporte maintenant, avec l’Occident, l’humanité tout entière, n’est pas propre au libéralisme […] Après la Révolution française, une fois la révolution industrielle et la révolution démocratique entrées en phase, le libéralisme n’est plus qu’un facteur parmi d’autres et rarement le plus fort. L’Industrie, le Socialisme, l’Etat administratif, la Science, d’autres instances encore, furent tour à tour convoqués pour servir d’instrument à cette démesure de la raison organisatrice qui marqua tellement les deux derniers siècles. »
Et j’aime beaucoup la conclusion de Pierre Manent :
« Nous sommes en train de faire sur nous-mêmes une expérience morale ou métaphysique particulièrement cruelle. Au lieu de chercher les voies d’une éducation commune et de construire des institutions qui protègent, nourrissent et raffinent des expériences partagées, nous nous imposons une désintitutionnalisation toujours plus complète des contenus de notre vie. Qu’espérons nous donc de l’émancipation finale quand il ne restera plus sur la place publique que l’individu avec ses droits, pauvre homme séparé des hommes et des biens qui donnent son sens à la vie humaine ? »
<1119>
-
Jeudi 27 septembre 2018
« Je fus dupée par mon époque »Marceline LoridanJ’avais évoqué, lors du mot du jour de mardi, Marceline Loridan appelée parfois aussi Marceline Loridan-Ivens, en raison du nom de son époux Joris Ivens.
Camarade de déportation de Simone Veil, cinéaste, ce fut une femme tout à fait remarquable comme le disent toutes les personnes qui interviennent sur la page vers laquelle je renvoie et de nombreuses autres personnes.
C’est indiscutable et je m’incline devant le destin et la force de cette grande Dame.
C’est une grande question que celle de dire ou de taire les parts d’ombre des personnes qui méritent notre admiration et notre respect.
Récemment, tout en disant toute mon affection et ma gratitude à l’égard de Leonard Bernstein j’ai glissé aussi un article parlant d’un aspect de sa personnalité moins défendable.
Mon ami Bertrand m’en a fait reproche :
« Cela dit, je préfère écouter ses disques et regarder ses vidéos que de gloser sur la face cachée de sa nature complexe. »
Il me semble cependant qu’on ne doit pas cacher ces choses, car elles expliquent d’où on vient : « d’un monde où parce qu’on était reconnu comme un génie, on avait droit à l’impunité ».
Roman Polanski et certains de ses soutiens, semblent parfois le croire encore.
Cela nous permet de relativiser, de ne pas croire aux surhommes et de rester prudent et mesuré.
Alors pour cette grande dame, quelle fut sa part d’ombre ?
C’est que, comme beaucoup d’autres elle a succombé au mirage du maoïsme.
C’est d’autant plus surprenant qu’elle a, elle-même, subi l’horreur d’un totalitarisme et qu’elle a ensuite combattu et dénoncé le fascisme.
Mais elle n’a pas su reconnaître et comprendre qu’elle soutenait un des plus grands criminels de l’Histoire des totalitarismes. Si on s’en tient à la seule comptabilité morbide des morts, c’est le plus horrible.
C’est cela ici la question qui me parait fondamentale, comment n’a-t-elle pas compris immédiatement qu’il s’agissait d’un totalitarisme criminel, aveugle et ennemi absolu de la liberté ?
Heureusement, elle s’en est cependant rendu compte, même si c’est un peu tard.
Pierre Haski a publié le 15 juin 2014 sur le site de l’Obs (Rue 89) une interview de Marceline Loridan où elle reconnait son erreur.
Pierre Haski introduit le sujet ainsi :
« Il reste les images. Somptueuses. Une plongée exceptionnelle dans la vie de la Chine maoïste à une époque où elle était encore verrouillée et ne projetait au monde que les images de la folie collective de la Révolution culturelle.
Revoir, ou découvrir, en 2014 les treize heures de film de « Comment Yukong déplaça les montagnes », la saga chinoise de Joris Ivens et Marceline Loridan, éditée en coffret par Arte, c’est comme découvrir un trésor archéologique d’une époque révolue. » […]
Joris Ivens, cinéaste engagé néerlandais, déchu de sa nationalité par son pays pour avoir pris fait et cause pour l’« ennemi » sur tous les fronts du monde, et Marceline Loridan, Française d’origine juive polonaise, rescapée des camps nazis d’Auschwitz-Birkenau où elle avait été déportée adolescente, devenue sa compagne et complice, ont filmé la Chine de la Révolution culturelle au ras des hommes. Ils ont filmé les Chinois plus que la Chine, et c’est ce qui fait la valeur de leur document quatre décennies plus tard.
Lorsque l’engouement aveugle pour le maoïsme s’est dissipé en Occident, Ivens et Loridan ont dû faire face au reproche de « propagande » pour avoir filmé avec « empathie » (le mot est de Marceline Loridan) une expérience politique jugée sévèrement par l’histoire.
Ensuite vient l’entretien
Rue89 : Quel regard portez-vous sur ces films qui ressortent quatre décennies plus tard ?
Marceline Loridan :
« C’est très difficile à exprimer. Il reste profondément l’essentiel de ce qui est dit dans ces films. Avant on pouvait dire « c’est de la propagande… », on ne le dit plus aujourd’hui.
Tout d’un coup, ce qui reste, c’est la force des gens qui s’expriment et ce qu’ils disent, même si ce sont les choses les plus expérimentales. […] Mais comment présenter ces films à une génération qui grandit dans un monde tellement différent, sans avoir connu les utopies et les engagements de ces années-là ?
Je leur dis que nous avons été à la fois les complices et les victimes du « scientisme » du XIXe siècle. Ce que les générations précédentes nous ont laissé nous ont marqués profondément, et nous ont fait croire à un monde qui n’était pas possible, qui était faux. Il disait ce qui n’était pas : c’est ce que je pense aujourd’hui. […]
Notre connaissance vient de notre expérience individuelle, et c’est ce qui est le plus difficile à transmettre. Les nouvelles générations prennent l’histoire où elle en est, pour en faire tout autre chose. Du coup, sont gommés, quand on revoit ces films, nos cauchemars et nos rêves… Et il en reste quelque chose d’un réel qui est à la fois vrai et faux, mais qui a été.»
Elle parle d’utopie et on sent comme une nostalgie. Pourtant elle raconte des comportements des autorités chinoises qui auraient dû l’interpeller, et elle, victime du nazisme, l’arrêter immédiatement :
« Nous avons été durement attaqués par Jiang Qing [la femme de Mao, ndlr] après avoir montré nos films : nous avons quasiment dû nous enfuir de Pékin. Zhou Enlai [le Premier ministre, ndlr], qui était presque mourant, nous a fait passer un message pour nous dire de décamper au plus vite et de sortir nos films… Il n’a jamais pu les voir.
Nous étions tout à fait conscients. Ils nous demandaient 61 coupures, j’ai été traitée d’espionne parce que je faisais des photos de femmes voilées au Xinjiang, ou de femmes aux pieds bandés, ou que je montrais trop la pauvreté… Et Dieu sait si nous ne la montrions pas trop ! »
Heureusement qu’en 2014 elle pose le problème sous son véritable aspect :
« Mais cette empathie nous conduisait à croire les gens. Aujourd’hui, quand je revois certains films, je me dis « j’ai été une vraie conne, j’aurais dû poser aussi telle question, aller plus loin » […]
On s’est fait avoir pour deux raisons principales :
- la rupture idéologique entre l’Union soviétique et la Chine ;
- le fait qu’un chef d’Etat – Mao – appelle à la révolte de la jeunesse. Ce fut une réalité, mais une réalité sanglante.
On voulait cesser de caricaturer la Chine comme elle l’était dans la presse à l’époque. »
Et quand Haski pose la question qui ne peut que nous interpeller aujourd’hui :
« Vous avez connu le totalitarisme le plus total – le nazisme – et vous avez connu le maoïsme également considéré aujourd’hui comme un totalitarisme… »
Elle répond :
« Je crois que j’étais sous influence… des hommes. C’est une longue lutte que celle de la libération des femmes.
Après la guerre, j’avais beaucoup de mal à me construire. Et je me suis dit que puisque je ne pouvais rien faire pour moi, je pouvais peut-être le faire pour les autres. C’était une illusion.
Je ne savais plus qui j’étais. Je n’avais aucun bagage intellectuel. Quand j’ai été déportée, j’étais en classe de quatrième, interrompue parce qu’il fallait se cacher. Après, ça a été les camps, l’enfer, la violence qui pénètre en vous. Vous n’en sortez pas innocent.
Et quand vous revenez et que le monde ne vous entend pas, même dans votre propre famille, que la famille se détruit devant vous. Plus de père, la mère qui se remarie, deux frères qui se suicident… Comment faire ?
J’ai pensé que la seule solution était de m’occuper des autres, à travers la politique. J’ai passé six mois au Parti communiste français, mais j’étais incadrable. Je n’ai jamais pu rester dans une organisation, même de déportés !
Même aujourd’hui, je reste un électron libre, et donc pas aimée par ceux qui détiennent des pouvoirs, quel que soit le lieu.
Aujourd’hui, j’ai beaucoup plus de recul par rapport à cette gauche dont je vois les erreurs, les flottements, les compromissions, les corruptions, etc. […] Joris m’a embarquée… Mais je pense que j’ai été dupée par mon époque. »
Cet exemple montre que l’on peut avoir les meilleurs sentiments du monde, avoir vécu l’impensable et rester pourtant aveugle et sourd aux délires du présent. Je pense qu’aujourd’hui aussi des intellectuels et des bien-pensants sont dupés par leur époque sur bien des sujets et des causes dont ils ne voient pas le côté obscur..
<1118>
- la rupture idéologique entre l’Union soviétique et la Chine ;
-
Mercredi 26 septembre 2018
« Snow-Trampoline, aquaponey, chessboxing, footgolf»Sports destinés à des gens qui ont du mal à choisir une seule disciplineComme lundi, c’est la revue de presse de Frédéric Pommier qui me donne le sujet du mot du jour d’aujourd’hui.
C’était l’émission du 15 septembre 2018 qui s’est intéressé aux sports qui combinent deux disciplines :
« Lorsqu’on veut faire du sport, et que l’on hésite entre deux disciplines, il existe une solution : c’est de pratiquer les deux en même temps.
Vous souhaitez faire du ski de fond, et en même temps du tir à la carabine : inscrivez-vous dans un club de biathlon !
Vous souhaitez faire du hockey, et en même temps de la nage sous-marine : inscrivez-vous dans un club de hockey subaquatique !
Vous aimez le snowboard, et en même temps le trampoline : faites du « Snow-Trampoline » ; on rebondit les deux pieds chaussés d’une planche.
Dans le même genre, il y a bien sûr l’aquaponey – de l’équitation en piscine, ou encore le « chessboxing »… Là, il s’agit de mixer un sport et un jeu cérébral. La boxe et les échecs. Un round de boxe, un round d’échec, et il y a « échec et mat » dès que l’un des joueurs est KO.
Et puis un autre sport a fait récemment son apparition en France : le footgolf
Une pratique née au Pays-Bas. Ça se joue sur un terrain de golf, mais les trous sont plus larges, puisqu’on ne joue pas avec des balles, mais avec des ballons, les pieds se substituant aux clubs. Vous aimez le foot, et en même temps le golf : faites donc du footgolf !
C’est ce à quoi nous invite ce matin le journal de Saône et Loire, dont l’un des journalistes a tenté l’expérience. Il a trouvé ce double-sport très distrayant !
La solution pour ceux qui n’arrivent pas à choisir. »
Wikipedia nous apprend que le chessboxing a été imaginé en bande dessinée par Enki Bilal dans son album Froid Équateur en 1992.
<Ce site de la fédération de footgolf> précise que ce sport a été créé en Hollande en 2009 et qu’il est aujourd’hui en plein essor dans le monde. Déjà 35 nations ont créé leur fédération. Et sur 26 nations engagées, la France a terminé 9ème de la Coupe du monde 2016 organisée en Argentine.
On peut trouver des vidéos qui montrent ce que cela donne. Par exemple : <FOOTGOLF FRENCH OPEN 2018>..
Et je vous laisse découvrir les légendes de l’aquaponey sur le <site de la fédération d’aquaponey>
Le sport est bon pour la santé et en plus permet d’occuper son temps libre.
<1117>
-
Mardi 25 septembre 2018
« Nous n’étions que des enfants »Rachel JedinakLa semaine dernière la cinéaste Marceline Loridan-Ivens, camarade de déportation de Simone Veil pendant la Seconde guerre mondiale dans le camp d’Auschwitz-Birkenau, est morte à 90 ans.
Il y a un an c’était le tour de Simone Veil.
Il n’y a plus beaucoup de survivants de cette époque sombre et terrible de l’humanité.
Rachel Jedinak est l’une d’entre elle, elle est une des rescapées de la rafle de la Vel d’Hiv.
Elle vient d’écrire un livre publié le 19 septembre 2018 : « Nous n’étions que des enfants ». Elle était invitée sur France Inter le jeudi 20 septembre 2018.
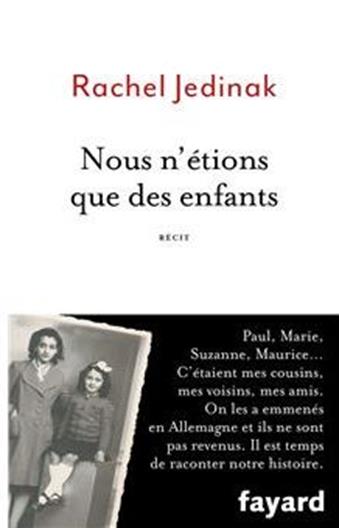 Elle raconte sa vie de petite fille juive, dans le Paris en guerre.
Elle raconte sa vie de petite fille juive, dans le Paris en guerre.
A la question pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour raconter votre histoire ?
Elle répond :
« En fait, après la guerre on ne nous a pas laissé parler.
On parlait de la France résistante !
Il m’est arrivé, je le dis dans le livre, d’essayer de parler de cela. On me répondait tais-toi on ne parle plus de cela, on parle de l’avenir.
J’ai entendu aussi, tu as eu de la chance d’être resté en vie. Alors tais-toi.
On ne parlait que de la France résistante.
Pendant cinquante ans, nous nous sommes tus.»
Lors des mots consacrés à Simone Veil j’avais déjà abordé ce sujet des mémoires. C’était le mot du 6 septembre 2017 dans lequel je citais Simone Veil :
« Si nous n’avons pas parlé c’est parce que l’on n’a pas voulu nous entendre, pas voulu nous écouter. »
Dans cet article je décrivais les différents types de mémoire à la sortie de la guerre et j’opposais notamment la mémoire triomphante des résistants à la mémoire blessée des déportés.
Rachel Jedinak considère que la véritable rupture de l’« omerta » se situe au moment de la reconnaissance par le Président Chirac de la responsabilité de la France dans la rafle du Vel d’Hiv.
« Lorsque Jacques Chirac, en 1995, a reconnu la responsabilité du régime de Pétain, de la France d’alors, les vannes se sont ouvertes et nous avons enfin pu nous exprimer, parler. Cela a mis du temps. »
En 1939, elle vivait une vie heureuse d’une enfant de Ménilmontant qui grandit, entouré d’amour par ses parents, dans une famille juive polonaise. Rachel Jedinak est née Rachel Psankiewicz. en 1934.
« Je vivais dans le quartier de Ménilmontant où vivait également des républicains espagnols, des italiens qui avaient fui le régime de Mussolini. Il y avait donc un melting pot d’enfants. Nous jouions ensemble, beaucoup dans la rue, parce qu’il y avait très peu de voitures à l’époque. »
En 1940, Pétain signe l’armistice avec Hitler, et la traque des juifs commence. Rachel Jedinak raconte des enfants qui ne veulent plus jouer avec elle, parce qu’elle est juive. Et l’étoile jaune qu’il faut porter, cela va valoir une scène avec sa mère qui est en train de coudre l’étoile jaune sur la robe de petite fille. Elle arrache la robe et l’étoile et dit : « je ne veux pas porter ça ! »
Et sa mère la gronde et lui dit : « C’est comme ça, je vais la porter, ta sœur va la porter et tu vas la porter ».
« Je garde l’image, parce que cela a été un moment difficile pour moi.
J’ai pu échanger, assez récemment avec des gens qui étaient plus âgés que moi.
Les adolescents bravaient cela.
Moi j’avais 8 ans et c’était très difficile de la porter.
Je garde de cela une honte non pas d’être juive, mais d’être juive avant toutes les autres choses que j’étais.»
Elle manifestait pourtant son hostilité, elle refusait de chanter l’hymne à Pétain que les écoliers devaient chanter en commençant la classe : « Maréchal nous voilà ». Et sa maîtresse lui permettait de ne pas le chanter.
« J’ai eu des maîtresses formidables qui nous ont materné, qui nous ont aidé. »
En juillet 1942, c’est la rafle du Vel d’Hiv. Elle est emmenée avec sa sœur et sa mère, parquées dans une cour dans un immeuble appelé « La Bellevilloise » qui est aujourd’hui un lieu festif où on joue du rock. Sa mère apprend qu’il y a une sortie de secours, alors elle ordonne à ses deux filles de s’enfuir. Mais Rachel refuse, elle s’accroche à la jupe de sa mère. La mère lui donne alors une gifle la première et la dernière qu’elle lui aura jamais donné. Cette gifle va lui sauver la vie. Sidérée elle obéit et s’enfuit avec sa sœur.
« Cette gifle m’a sauvé la vie, je ne l’ai réalisé que plus tard. »
Elle raconte les conditions dans lesquelles tout cela s’est passé, dans le petit matin, avec une chaleur insoutenable notamment parce que tous ces nombreux parents et enfants étaient serrés les uns contre autres, les petits réveillés dans la nuit criaient dans les bras de leurs mères. Personnes ne savaient ce qui allaient se passer, les enfants étaient angoissés, avaient peur. Quitter leur mère était un déchirement d’une violence inouïe.
Ni la mère, ni le père ne reviendront des camps.
Le récit de cette journée se trouve aussi sur cette « page ».
Rachel Jedinak est la présidente du « Comité « Ecole de la rue Tlemcen » », l’association pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés du XXe arrondissement de Paris.
<Ici vous verrez une video où elle raconte son histoire>
Ce n’était que des enfants.
<1116>
-
Lundi 24 septembre 2018
« Les fulgurés d’Azerailles »Des personnes unis à vie par quelques millisecondes d’électricité tombée du ciel.Je suppose que comme moi vous ignoriez jusqu’à l’existence d’Azerailles, petit village de Meurthe et Moselle de 800 habitants, proche de la cité du cristal : Baccarat.
Et si vous n’avez pas entendu parler d’Azerailles, vous n’avez pas non plus souvenir de ce qui s’est passé dans cette commune le 2 septembre 2017.
 C’est la revue de Presse de Bernard Pommier du 22 septembre 2018 qui en évoquant un article du Monde m’a fait connaître ce village et l’histoire qui intéresse la science.
C’est la revue de Presse de Bernard Pommier du 22 septembre 2018 qui en évoquant un article du Monde m’a fait connaître ce village et l’histoire qui intéresse la science.
Ce samedi-là, pourtant, rien n’annonçait le drame. C’était il y a un an, et le soleil brillait sur Azerailles. Ce samedi-là, se déroulait un festival champêtre : de la musique, des balades le long de la rivière, des ateliers pour découvrir les plantes sauvages…
Mais, vers 16 heures, la pluie se met à tomber dru. Tout le monde fonce sous la tente. Un énorme bruit retentit. Un enfant crie, un autre pleure et plusieurs personnes tombent à terre, inanimées. Un responsable pense qu’il s’agit d’un attentat. Au pied d’un aulne, la broussaille, subitement, prend feu.
Un pompier du village téléphone à son supérieur :
« Francis, c’est la guerre, on a plusieurs blessés ! »
Mais non, ce n’est pas la guerre, et pas non plus un attentat.
C’est la foudre qui vient de tomber sur Azerailles. Et l’on compte une vingtaine de « fulgurés »…
Car « Fulguré », c’est le terme qu’on emploie pour désigner une personne qui a survécu après avoir été frappé par la foudre. Les « foudroyés » meurent, les « fulgurés » survivent
A Azerailles, il n’y a pas eu de foudroyés, mais il y a eu une vingtaine de fulgurés.
C’est donc un article du Monde du 21/09/2018 qui parle de cet évènement et de sa suite : « Les miraculés d’Azerailles, unis par la foudre qui ne les a pas tués »
Car le Monde raconte que la vingtaine de personnes frappées simultanément par la foudre le 2 septembre 2017 en Meurthe-et-Moselle sont un groupe uni et un échantillon précieux pour la recherche.
Après que la foudre soit tombée une soixantaine de pompiers et une trentaine de gendarmes arrivent sur les lieux du drame et l’article nous décrit la suite :
« Une zone d’atterrissage pour hélicoptère est même improvisée en cas de besoin.
Au total, quatorze blessés, dont deux graves, sont évacués vers les hôpitaux de Lunéville, Saint-Dié et Nancy. Les concerts du soir sont annulés. Par un miracle que nul n’explique, la mort, qui faisait ce jour-là plusieurs millions de volts, n’a emporté personne.
Un an plus tard, les rescapés du 2 septembre forment un groupe unique, fascinant et mystérieux. Ils sont une vingtaine, en comptant ceux qui n’ont pas été hospitalisés. On les appelle des fulgurés. […]
Certains souffrent encore de séquelles importantes. D’autres se portent bien. Beaucoup expliquent devoir leur vie à leur nombre. C’est la thèse d’Herbert Ernst, correspondant local de L’Est républicain, fulguré en plein reportage.
« S’il n’y a pas eu de macchabée, pense-t-il, c’est parce que nous nous sommes partagé la décharge. Cette explication n’est peut-être pas vraie, mais je m’en fiche, c’est notre ciment. Quand on se retrouve, c’est difficile à expliquer, c’est comme faire un plein d’émotion. »
[…]
En un an, ils se sont réunis trois fois. Liés à jamais, les fulgurés d’Azerailles suscitent aussi un fort intérêt scientifique. Pour la première fois en France, un médecin peut observer sur un large groupe les effets de l’électricité naturelle, mal connus. Dans un contexte de changement climatique et de multiplication des orages, l’enjeu est particulièrement intéressant. »
Et le Monde raconte les séquelles et conséquences de ce coup de foudre sur plusieurs fulgurés.
L’histoire de Raphaëlle Manceau m’a le plus impressionné :
« De son côté, Raphaëlle Manceau n’était guère mieux lotie. Dans sa grande maison de rondins, au milieu des épicéas et des bouleaux, à Saint-Dié, dans les Vosges, elle explique avoir dû changer son rythme de femme suractive.
Professeure des écoles, elle est en arrêt longue maladie. Elle, ce ne sont pas ses jambes mais son cerveau qui a été touché. Lors du coup de foudre, elle a perdu connaissance. Les semaines suivantes, elle a souffert de forte fatigue et de maux « insupportables » à la tête et aux pieds, zones de passage de la décharge.
« La foudre est sortie par cinq points sur un pied, et sept sur l’autre, témoigne-t-elle devant un sirop de menthe maison. Ça faisait des taches noires, comme des verrues. » Chose étonnante, elle a bénéficié de capacités augmentées.
Raphaëlle Manceau est, avec Jocelyne Chapelle, qui est devenue son amie et confidente, l’une des victimes les plus touchées. Durant le mois qui a suivi l’impact, elle semble avoir présenté les symptômes d’une hyperactivité cérébrale.
« Je faisais des multiplications de trois chiffres par trois chiffres, en même temps je fredonnais des airs et pensais à l’organisation du quotidien », se souvient-elle. Mais ses « superpouvoirs » ont duré à peine plus d’un mois.
Elle a également changé de comportement. Déjà très sociable et enjouée, elle abordait des inconnus dans la rue pour un brin de causette, « attirée comme un aimant ». Puis, au bout d’un mois et d’un jour, elle a perdu la parole. Elle ne trouvait plus ses mots, s’exprimait de façon très lente.
Spécialiste des enfants en difficulté, elle a découvert qu’elle aussi était devenue dysgraphique, dysorthographique, dyspraxique (soucis de coordination)… Elle a alors multiplié les séances de kiné et d’orthophonie puis, au bout de trois mois, a commencé à mieux parler.
Aujourd’hui, c’est quasiment parfait. Mais, surprise, elle a attrapé l’accent alsacien. Elle a certes habité quelques années de l’autre côté des Vosges, mais certifie que jamais elle ne s’est exprimée ainsi. « Selon l’orthophoniste, ça me permet de faire traîner certaines syllabes et de réfléchir aux mots que je dois utiliser. »
Elle a beaucoup de mal à apprendre par cœur. En revanche, elle retrouve des souvenirs d’enfance oubliés. Enfin, elle souffre d’acouphènes et de fatigue intense. Parfois, en revenant de courses, elle doit se garer en urgence sur le bord de la route et dort… trois heures. « J’ai fini par accepter de ne plus être tout à fait moi », glisse-t-elle. »
D’autres racontent aussi des conséquences étonnantes et déstabilisantes.
Cet article nous apprend aussi qu’un coup de foudre c’est 30 000 degrés.
Plusieurs fulgurés souffrent toujours de stress post-traumatique.
Et l’article nous apprend que beaucoup d’entre eux cherchent un sens à l’histoire : pourquoi moi, pourquoi ce sursis, quel est le message ? Consciemment ou non, personne n’échappe à la mythologie de la foudre.
Les Médecins s’intéressent à ce groupe de fulgurés :
« Angoissés ou sereins, avec ou sans séquelles, toutes les victimes ont accepté de devenir des cobayes, au nom du progrès de la science. Interne en médecine aux urgences d’Aurillac, Rémi Foussat lancera un protocole de recherche d’ici à la fin de l’année. Juste après avoir passé sa thèse sur les troubles neurologiques chez les fulgurés.
En France, la foudre touche une petite centaine de personnes par an, recensées par le SAMU, et « de 200 à 500 personnes en tout, selon des estimations floues », dit-il. Parmi elles, de 10 % à 15 % décèdent. Avec le chef des urgences d’Aurillac, Laurent Caumon, il compte d’ailleurs créer un réseau régional de recensement des victimes de la foudre.
Mais les fulgurations collectives, qui permettent de comprendre les variantes entre individus, sont rarissimes. « Les troubles du groupe d’Azerailles sont assez représentatifs, constate l’interne. Ils sont de trois types : transitoires, prolongés et retardés. Ces derniers se déclenchent trois semaines à six mois après l’accident. Au bout d’un an, il y a donc peu de risque que de nouveaux troubles apparaissent. » Anne Chrisment devrait être rassurée.
« Nous avons une connaissance nulle de la façon dont passe le courant sur un organisme vivant. » Marie-Agnès Courty, géologue au CNRS
Il a été bien plus étonné par l’hyperactivité cérébrale de deux victimes, « symptôme très rarement décrit ». Quant à la thèse du partage de la décharge qui aurait sauvé tout le monde, il ne la retient pas : « Trop simpliste, juge-t-il. Le coup de foudre est si puissant que le diviser ne change pas grand-chose. » Mais il n’a pas d’explication.
Rémi Foussat va traquer chez ces survivants des marqueurs invisibles de la foudre. Il va tenter de déceler dans leur corps des nanocomposites, soit un assemblage de nanoparticules métalliques, végétales ou cristallines. Grâce à cette mise en évidence, il espère mieux comprendre les lésions d’un courant électrique sur les nerfs, afin d’expliquer, entre autres, les troubles retardés.
En France, la spécialiste du sujet s’appelle Marie-Agnès Courty. Géologue au CNRS à Perpignan, elle a découvert que les nanocomposites permettent de tracer les effets du passage d’un courant électrique sur un organisme vivant, un sol ou tous types de surfaces.
« Une fulguration entraîne la production considérable de nanocomposites sur le moment et dans les mois qui suivent, expose-t-elle. L’étude de Rémi Foussat représente un enjeu important car nous avons une connaissance nulle de la façon dont passe le courant sur un organisme vivant. »
La science pourra donc probablement progresser grâce aux fulgurés d’Azerailles. Mais il s’agit quand même, si on comprend bien ce qui s’est passé, de ce que l’on appelle dans notre compréhension d’une sorte de miracle.
<1115>
-
Vendredi 21 septembre 2018
« The God of Small Things (Le Dieu des Petits Riens) »Arundhati Roy« Ayemenem en mai est chaud et maussade. Les journées y sont longues et humides. Le fleuve s’étrécit, les corneilles se gorgent de mangues lustrées dans l’immobilité des arbres vert olive. Les bananes rouges mûrissent. Les jaques éclatent. Les grosses mouches bleues sont ivres et bourdonnent sans but dans l’air lourd et fruité. Pour finir par aller s’assommer contre les vitres transparentes et mourir, pansues et effarées, dans le
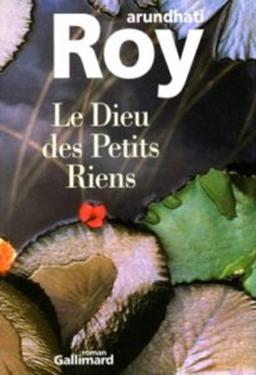 soleil.
soleil.
Les nuits sont claires mais baignées de paresse et d’attente chagrine.
Mais dès le début du mois de juin éclate la mousson du sud-ouest, et suivent alors trois mois de vents et de pluies, entrecoupés de brefs intervalles de soleil, d’une lumière vive, acérée, que les enfants tout excités saisissent au vol pour jouer. La campagne se couvre d’un vert impudique. Les démarcations s’estompent au fur et à mesure que s’enracinent et fleurissent les haies de manioc. Les murs de brique prennent des tons vert mousse. Les vignes vierges montent à l’assaut des poteaux électriques. Les pousses rampantes vrillent la latérite des talus et envahissent les chemins inondés. On circule en barque dans les bazars. Et des petits poissons font leur apparition dans l’eau qui remplit les nids-de-poule des Ponts et Chaussées.
Il pleuvait le jour où Rahel revint à Ayemenem. Des cordes argentées frappaient en séton la terre meuble, labourée comme sous le feu de la mitraille. La vieille maison sur la colline portait son toit à pignons pentu enfoncé jusqu’aux yeux. L’humidité qui montait du sol avait fait gonfler les murs spongieux et striés de mousse. Le jardin revenu à l’état sauvage bruissait des murmures et des courses d’innombrables petites bêtes. Dans les fourrés, une couleuvre se frottait contre une pierre luisante. De grosses grenouilles jaunes parcouraient la mare boueuse dans l’espoir de trouver l’âme sœur. Une mangouste trempée traversa comme une flèche l’allée jonchée de feuilles. »
C’est ainsi que commence « Le Dieu des Petits Riens » d’Arundhati Roy.
C’est un récit bouleversant dont l’action se situe au Kerala, en Inde du Sud. Il s’agit de l’histoire de jumeaux dizygotes, Estha et Rahel, de leur mère Ammu, au milieu d’une famille indienne chrétienne et du système des castes qui continue à être la règle dans le sous-continent.
Le récit est raconté, le plus souvent, à travers les yeux des deux enfants.
C’est un livre à lire, un livre à vivre, un chef d’œuvre que j’ai dévoré avec passion au courant du dernier été.
C’est un livre déjà assez ancien puisqu’il a été publié en 1997, mais je n’en ai eu connaissance que lorsque j’ai entendu parler pour la première fois d’Arundhati Roy, lors d’une émission de radio où elle était venue présenter son second roman, écrit 20 ans après le premier. C’était dans « Boomerang » d’Augustin Trapenard du 16 janvier 2018 et 2 jours plus tard elle était l’invitée d’Olivia Gesbert pour l’émission de « La Grande Table ». Après ces deux émissions et avoir entendu parler cette femme, de ses combats, de son Inde natal, j’ai décidé d’acheter le livre « Le Dieu des Petits Riens » et de le lire.
Arundhati Roy est née en Inde, son père est Rajib Roy, bengali hindou, gestionnaire d’une plantation de thé. Sa mère Mary Roy est une chrétienne syriaque, militante des droits des femmes originaire du Kerala. Ses parents divorcent quand elle a deux ans et elle retourne vivre avec sa mère et son frère au Kerala, là où se passe le « Dieu des Petits Riens » et où sa mère crée une école.
Ce roman, honoré par le Booker Prize le prix le plus prestigieux pour la littérature anglo-saxonne, lui apporte la gloire. Adulée par les altermondialistes, considérée comme un porte-parole du tiers-monde, elle prend la défense des plus faibles et dénonce la tradition des castes, prend position contre les grands travaux du gouvernement indien, lutte contre le fondamentalisme hindou…
Et entre ses deux romans, elle a écrit des essais, des articles et poursuivit ses combats politiques qui lui valent beaucoup d’inimitié et de haine.
Courrier international du 07/06/2017 qui consacrait aussi un article à son second roman « The Ministry of Utmost Happiness Le Ministère du bonheur extrême » écrit :
« Tous les journaux lui consacrent de longs articles. Il faut dire que l’auteure originaire de Shillong, capitale du Meghalaya, un petit État du nord-est de l’Inde collé au Bangladesh, « n’est pas tant une écrivaine qu’un fer de lance politique », rappelle India Today.
Celle qui s’est fait connaître dans le monde entier, il y a vingt ans, avec son premier roman Le Dieu des petits riens (Gallimard, 1998) – un ouvrage écoulé à six millions d’exemplaires, immédiatement remarqué par The New York Times et récompensé par le Booker Prize – est pourtant régulièrement « tournée en ridicule » dans son propre pays. En cause : ses prises de position pacifistes, écologistes et altermondialistes. Dans un pays de plus en plus en proie au sectarisme
 politique et religieux, « on la traite de sympathisante terroriste, de communiste et de sécessionniste », souligne India Today.
politique et religieux, « on la traite de sympathisante terroriste, de communiste et de sécessionniste », souligne India Today.
Signe de l’aversion qu’elle suscite, la parution de son deuxième roman (chez Penguin en Inde, Hamish Hamilton au Royaume-Uni et Knopf aux États-Unis) a valu à l’auteure un tweet menaçant (retiré depuis) d’un député du BJP [Parti du peuple indien], le parti nationaliste hindou au pouvoir : « Au lieu de lancer des pierres contre les Jeeps de l’armée », a écrit Paresh Rawal, dans une allusion aux violentes manifestations qui se déroulent depuis plusieurs semaines au Cachemire, lapidez Arundhati Roy ».
En 2010, Courrier International avait publié un article explicite : « Inde. Arundhati Roy, la voix qui dérange ».
D’autres mots du jour seront consacrés à cette femme d’exception, mais revenons à notre sujet d’aujourd’hui « Le Dieu des Petits Riens ».
On lit partout qu’il s’agit d’un roman semi-autobiographique, mais on ne sait pas bien quelle est la part d’autobiographie dans ce livre.
Le premier paragraphe qu’on lit quand on ouvre le livre commence ainsi :
« Ceci est une œuvre de fiction. Tous les personnages sont imaginaires ».
Jusqu’ici cela paraît clair mais la suite est énigmatique et sa formulation décalée semble remettre en cause les deux phrases précédentes.
« La situation des fleuves, des passages à niveau, des églises et des crématoriums n’est pas exacte. »
Ammu la mère dans le roman est chrétienne et vivait au Kerala comme la mère de l’auteure.
On sait qu’il lui a fallu 5 ans pour écrire ce livre.
Dans cet article de l’EXPRESS à la question de savoir pourquoi tant d’années ont séparé ses deux romans, elle fait cette réponse venue du fond de l’intime :
« J’ai mis du temps à me remettre du « Dieu des Petits Riens », pas seulement à cause de son succès matériel, mais parce que d’une certaine manière, je l’ai excavé des profondeurs de moi-même. »
L’Inde est un pays d’une richesse historique et culturelle inouïe. Elle a donné naissance à des sages qui ont inspiré le monde entier.
C’est aussi un pays d’une violence inouïe, avec des traditions d’une cruauté sans égale, comme cette coutume funéraire du sati.
Et c’est la folie de ce pays d’avoir créé le système de la séparation, de la justification des inégalités par l’organisation des castes.
C’est aussi ce qui est dénoncé dans ce roman de l’amour et du drame.
Au début, la structure du livre est à la fois déstabilisante et fascinante et on peut s’y perdre.
Mais cette structure crée aussi son unité car le livre commence par le retour de Rahel, vers le lieu du drame pour retrouver son frère dont elle a été séparée toute jeune. Et le roman entrelace le récit qui raconte ce retour et la rencontre avec son frère dont l’esprit est absent et le récit qui peu à peu laisse émerger le drame qui explique le récit contemporain. Quand l’histoire passée rencontre l’histoire du présent, le chef d’œuvre est achevé.
L’article de Courrier International déjà cité rapporte cette déclaration d’Arundhati Roy :
« Un roman, c’est presque comme une prière. Il est composé de plusieurs couches qui ne sont pas destinées à être consommées, mais à dessiner un univers. »
<1114>
-
Jeudi 20 septembre 2018
« Pour le moment, il semble qu’Huntington soit gagnant »Francis FukuyamaFrancis Fukuyama, universitaire américain, est devenu mondialement célèbre quand il a écrit et publié en 1992, le livre « La Fin de l’Histoire et le dernier homme ».
Cet ouvrage est contemporain d’un autre écrit en 1996 par un autre universitaire américain spécialiste de science politique : Samuel Huntington qui est l’auteur de « Le choc des civilisations ».
Ces deux livres, écrit tous deux lors de la dernière décennie du XXème siècle, défendent des thèses opposées.
Pour Fukuyama l’Histoire s’achèvera le jour où un consensus universel sur la démocratie libérale mettra un point final aux conflits idéologiques. Et en 1992, pour lui ce jour était très proche. Il a bien sûr pour modèle la démocratie américaine. Il a écrit cet essai alors que l’Union soviétique venait de se dissoudre et que les USA et le monde occidental libéral venait de gagner la guerre froide. Il avait publié, dès 1989, le camp des « démocraties populaires » de l’Europe de l’Est n’étaient déjà plus en grande forme et le mur de Berlin venait de tomber, un article sur ce même sujet : « The end of History ? ».
Wikipedia nous apprend que cet article fut publié par la revue The National Interest puis repris dans la revue française Commentaire no 47, automne 1989.
Huntington commença aussi à écrire d’abord un article « The Clash of Civilizations ? » en 1993 dans la revue Foreign Affairs.. Wikipedia nous apprend que cet article est inspiré de l’ouvrage de Fernand Braudel : « Grammaire des civilisations ». Et comme Fukuyama il va développer cet article pour en faire un livre, traduit en France en 1997 aux éditions Odile Jacob.
Je cite Wikipedia qui décrit cela fort bien :
« Dans un premier temps, les guerres avaient lieu entre les princes qui voulaient étendre leur pouvoir, puis elles ont eu lieu entre États-nations constitués, et ce jusqu’à la Première Guerre mondiale.
Puis la révolution russe de 1917 a imposé un bouleversement sans précédent, en ce qu’elle a promu une idéologie. Ainsi, dès ce moment, les causes de conflits ont cessé d’être uniquement géopolitiques, liées à la conquête et au pouvoir, pour devenir idéologiques. Cette vision des relations internationales trouve son point d’aboutissement dans la Guerre froide, celle-ci ayant institué l’affrontement de deux modèles de société.
Cependant, la fin de la Guerre froide marque un nouveau tournant dans les relations internationales.
Huntington nous dit qu’il faut désormais penser les conflits en termes non plus idéologiques mais culturels : « Dans ce monde nouveau, la source fondamentale et première de conflit ne sera ni idéologique ni économique. Les grandes divisions au sein de l’humanité et la source principale de conflit sont culturelles. Les États-nations resteront les acteurs les plus puissants sur la scène internationale, mais les conflits centraux de la politique globale opposeront des nations et des groupes relevant de civilisations différentes. Le choc des civilisations dominera la politique à l’échelle planétaire. Les lignes de fracture entre civilisations seront les lignes de front des batailles du futur1. »
En effet, les opinions publiques et les dirigeants seraient nettement plus enclins à soutenir ou à coopérer avec un pays, une organisation proche culturellement. Le monde se retrouverait alors bientôt confronté à un choc des civilisations, c’est-à-dire une concurrence plus ou moins pacifique, à des conflits plus ou moins larvés, tels ceux de la Guerre froide, entre blocs civilisationnels. Huntington définit les civilisations par rapport à leur religion de référence (le christianisme, l’islam, le bouddhisme…), et leur culture. Il définit sept civilisations et potentiellement une huitième : Occidentale (Europe de l’Ouest, Amérique du Nord, Australie…), latino-américaine, islamique, slavo-orthodoxe (autour de la Russie), hindoue, japonaise, confucéenne (sino-vietnamo-coréenne) et africaine. »
Les attentats du 11 septembre 2001 et l’émergence d’organisation terroristes islamiques visant à pousser à un affrontement entre le monde musulman et l’occident ont donné du crédit à sa thèse.
Il y a deux différences entre ces penseurs.
La première n’est pas essentielle, mais elle m’est personnelle j’ai acheté l’ouvrage d’Huntington et je l’ai parcouru. Je le lirai probablement un jour. Je n’ai pas acheté l’ouvrage de Fukuyama et je n’ai pas l’intention de le faire.
La seconde différence est que ces deux ouvrages n’ont pas été écrits à la même période de la vie de leur auteur.
Samuel Huntington avait près de 70 ans quand il a écrit « Le choc des civilisations ». Il était né en 1927 à New York, diplômé de l’université Yale à dix-huit ans, il débute sa carrière d’enseignant à vingt-trois ans à l’université Harvard dans laquelle il travaillera 58 ans. Il a aussi été membre du Conseil de sécurité nationale au sein de l’administration Carter. Et Samuel Huntington est décédé en 2008.
Francis Fukuyama, né en 1952 a écrit son ouvrage à 40 ans et il vit toujours.
En raison de cette situation inégalitaire, aujourd’hui seul ce dernier peut encore s’exprimer.
Brice Couturier, dans son émission <Le tour du monde des idées> du 14 septembre, nous apprend que Fukuyama reconnaît que Huntington avait raison. Mais profitant d’être le rescapé du débat, il émet des nuances et ne reconnaît qu’en partie la supériorité de son rival.
Brice Couturier explique :
« Souvenez-vous du début des années 1990 […]
A cette époque, s’affrontaient deux visions de l’histoire rivales. Celle de Samuel Huntington et celle de Francis Fukuyama.
Huntington […] prédisait que ce qui allait succéder à la lutte entre les Etats-Unis et l’URSS. La guerre froide, disait-il, avait gelé un certain nombre de conflits latents. A présent, ce qui allait faire retour, ce serait les conflits entre blocs culturels, entre grandes civilisations. Et il mettait en garde en particulier contre les turbulences qui agitaient le monde musulman : les frontières de l’islam sont sanglantes, disait-il. Partout où la civilisation islamique entre en contact avec une autre, il y a conflit.
En France, il fut vilipendé, mis à l’index. Nul besoin d’exposer ses thèses. Il suffisait de les condamner sans les connaître. Mais je me souviens qu’en Pologne, où j’arrivai cette année-là, il était considéré comme un oracle.
A la même époque, en 1992, dans «La fin de l’histoire et le dernier homme», Fukuyama nous annonçait un tout autre scénario. En gros, le modèle libéral, démocratique et capitaliste, avait vaincu son dernier adversaire. Ses réussites matérielles étaient tellement éclatantes que toute l’humanité tôt ou tard s’y convertirait. Bientôt, le monde entier ne serait plus qu’un seul unique et vaste marché, dont les conflits sanglants aurait disparu. Le tragique avait déserté l’histoire. Il fallait célébrer notre humanité réconciliée sous l’égide de l’Empire américain bienveillant. Cette année-là, Bill Clinton, élu président des Etats-Unis, semblait incarner le « fukuyamisme »…
Un quart de siècle plus tard, alors qu’Huntington est décédé depuis 10 ans, Fukuyama, publie une étude sur la pensée de son rival.
Dans la revue The American Interest, Fukuyama écrit : « Pour le moment, il semble qu’Huntington soit gagnant ». « Le monde d’aujourd’hui n’est pas en train de converger autour d’un gouvernement démocratique et libéral, comme cela semblait être le cas il y a une génération. » Il y a, une « récession démocratique ». « De grands pouvoirs autoritaires, comme la Russie et la Chine, sont devenus sûrs d’eux et agressifs. » Les démocraties libérales ont perdu de leur pouvoir de séduction à cause de la crise financière de 2008. Elles sont menacées en interne par la montée des populismes.
Car le clivage droite/gauche fait progressivement place à un autre, fondé sur les questions d’identité culturelle, ce qui, encore une fois, semble donner raison à Huntington.
Il n’avait pas tort aussi de prédire un retour en force du religieux dans l’espace politique. Le Moyen-Orient, l’Inde et même les Etats-Unis semblent lui donner raison. ».
C’est ensuite que viennent les nuances :
« Mais la religion n’est plus que l’une des composantes de l’identité culturelle, parmi beaucoup d’autres. Et ça, Huntington ne l’avait pas vu venir.
L’identité sexuelle est au moins aussi déterminante, comme le démontrent les mouvements des femmes dans des pays comme l’Iran. L’appartenance nationale redevient essentielle au Japon, en Chine et en Corée, en opposition, malgré leur commune appartenance à la « civilisation confucéenne ». Et le fait que la Russie et l’Ukraine relèvent de la même civilisation « orthodoxe » n’empêche pas la première de livrer à la seconde une guerre larvée.
Quant au monde musulman, même s’il correspond mieux que d’autres à la définition de la civilisation que proposait Huntington, en raison du concept d’Umma, communauté des croyants, il n’en est pas moins profondément divisé entre sunnites et chiites.
La vie politique s’est redéployée autour de la notion d’identité. Pas selon les clivages civilisationnels, annoncés par Huntington.
Non, le concept d’identité, tel qu’il a redéfini l’espace politique, ces dernières années, n’a pas grand-chose à voir avec « les civilisations » de Huntington. Il provient de l’idée que nous avons « un moi intérieur caché », qui nous rattache à d’autres, et dont la dignité est ignorée ou méprisée par la société environnante. Ces identités veulent être reconnues. Elles sont instrumentalisées par des leaders qui en font un usage politique.
Huntington croyait que les individus allaient faire allégeance aux grandes civilisations mondiales, aux dépends de leur appartenance nationale. Il s’est trompé. La politique des identités fracture les sociétés en groupes de plus en plus minoritaires. L’affirmation identitaire ne mène pas à la solidarité inter-civilisationnelle, mais à un fractionnement sans fin des nations. Et les Etats-Unis offrent l’un des exemples les plus frappants. »
Probablement que Huntington n’avait pas tout prévu. Les prévisions sont toujours périlleuses surtout quand elle concerne l’avenir.
Mais la Fin de l’Histoire était une vaste blague. Le monde des idées et des organisations politiques divergent. La démocratie libérale ne constitue plus un objet de désir pour beaucoup et notamment les jeunes comme le relate Yascha Mounk sur lequel je reviendrai un jour prochain.
Et concernant le choc des civilisations, s’il ne s’inscrit pas précisément dans le cadre des civilisations anciennes tel que le décrivait Huntington, il existe de vraies divergences d’aspiration et d’idéologie aujourd’hui dans le monde.
Tout ceci nous fait quand même songer que la civilisation humaine dans son ensemble est aujourd’hui en grande difficulté, parce qu’elle n’a pas suffisamment respecté les limites de sa terre nourricière qui lui a permis jusqu’à aujourd’hui de se déployer. Peut-être que le vrai choc sera celui de la civilisation humaine avec les réalités et les limites de la nature et de son lieu de vie.
<1113>
-
Mercredi 19 septembre 2018
« La République en marché ? »Frédéric SaysLundi, j’exprimais ma satisfaction concernant le Président de la République et son attitude à l’égard de la guerre d’Algérie et du destin de Maurice Audin.
Aujourd’hui, je vais vous parler des produits dérivés de l’Elysée.
Par exemple ce « T-shirt Champions du monde » est vendu 55 euros.
 Il nous rappelle que la France a gagné la coupe du monde Football et que notre jeune Président a illuminé de son euphorie et de ses qualités sportives cet évènement mondial.
Il nous rappelle que la France a gagné la coupe du monde Football et que notre jeune Président a illuminé de son euphorie et de ses qualités sportives cet évènement mondial.
Si vous souhaitez l’offrir pour Noël ou d’autres produits de ce type l’adresse est derrière ce lien : https://boutique.elysee.fr/
Le produit de la vente ne poursuit pas l’objectif de donner de l’argent de poche au couple présidentiel, mais doit servir à faire des travaux au Palais de l’Elysée sans passer par la case « impôts »
Frédéric Says a consacré sa chronique du 17 septembre à cette nouvelle disruption et a donné pour titre de son billet : « La République en marché ? »
Selon lui il s’agit d’une initiative moins anodine qu’il n’y paraît :
« 347 000 euros en trois jours : voici le chiffre d’affaires de la nouvelle boutique de l’Élysée.
Une boutique lancée ce week-end, à l’occasion des Journées du patrimoine. Sur place ou en ligne, elle rassemble des dizaines de produits dérivés liés à la présidence de la République. Cela va du stylo Bic bleu-blanc-rouge (3 euros) jusqu’au bracelet en or, estampillé liberté, égalité ou fraternité (250 €).
[…]
Plus sérieusement, la présidence de la République se justifie : les bénéfices de cette boutique seront affectés à la rénovation du palais de l’Elysée, dont certaines parties sont pour le moins décrépies.
Une stratégie de communication assez habile politiquement…
Oui, au moment où les ménages payent leur dernier tiers d’impôt sur le revenu, il ne sera pas dit que le contribuable finance les aménagements du « Château ». Par ailleurs, l’existence de cette boutique est cohérente avec les valeurs véhiculées inlassablement par Emmanuel Macron : la start-up nation, l’innovation, la disruption : ça n’avait jamais été fait, il faut donc le faire…
Évidemment, tout cela prête à hausser les épaules. Mais cette évolution n’est pas seulement anecdotique ou insolite. Elle éclaire aussi la philosophie générale du président sur la question de l’impôt. Peut-être connaissez-vous la formule d’Alphonse Allais : « il faut demander plus à l’impôt et moins au contribuable ».
Pour Emmanuel Macron c’est l’inverse. L’impôt ne peut pas tout, les budgets publics non plus. L’on a déjà vu cette logique à l’œuvre avec le loto créé pour venir en aide au patrimoine, sous la houlette de Stéphane Bern. Dans cette perspective, ce n’est pas à la puissance publique de soutenir le patrimoine en danger, c’est à la générosité du public. Même raisonnement pour la réfection de l’Élysée.
Bien sûr, l’État ne coupe pas tous ses financements. En l’occurrence, des fonds publics restent massivement engagés…
Mais derrière ces exemples très médiatisés, l’on entrevoit une idée générale, qui est ici introduite de manière subreptice. Celle de faire primer la charité sur la solidarité ; le mécénat individuel sur la contribution collective. Si l’on prend du recul, ces initiatives portent en germes l’idée d’un impôt à la carte : « je choisis les causes pour lesquelles je donne ».
D’ailleurs, il suffit d’étendre ce modèle pour en montrer les limites. Pourquoi ne pas imaginer, demain, une tombola pour financer la réfection d’une école ?
Une partie de poker pour la toiture du commissariat ?
Une loterie pour le matériel médical de l’hôpital ?
Ce serait à coup sûr disruptif. Voilà pourquoi cette boutique de l’Elysée a quelque chose de croquignolesque, pour ne pas dire de « poudre de perlimpinpin ». »
Je finirai en citant Philippe Meyer :
« Nous vivons une époque moderne où le futur ne manque pas d’avenir »
<1112>
-
Mardi 18 septembre 2018
« Une immersion dans l’art et la musique »Exposition consacrée à Gustav Klimt et d’autres viennois à l’atelier des lumièresCe week-end nous étions à Paris pour assister à la Philharmonie de Paris à une interprétation d’anthologie de la 3ème Symphonie de Mahler par le Boston Symphony Orchestra sous la direction de son chef Andris Nelsons.
Et dimanche matin, nous en avons profité pour aller à l’exposition Klimt, plus précisément l’exposition immersive et interactive sur l’œuvre de Gustav Klimt.
Je pourrai bien sûr analyser et décrire le fabuleux concert auquel nous avons assisté Annie, Florence et moi. Mais ce concert est terminé, il s’agit d’un moment passé et auquel vous n’aurez jamais accès, puisque la machine à remonter le temps n’a pas encore été inventé.
 En revanche, l’exposition à laquelle nous sommes allés est toujours ouverte. Et même, en raison de son succès, a été prolongé de fin novembre jusqu’au 6 janvier 2019.
En revanche, l’exposition à laquelle nous sommes allés est toujours ouverte. Et même, en raison de son succès, a été prolongé de fin novembre jusqu’au 6 janvier 2019.
Cette exposition, c’est d’abord un lieu : « L’atelier des lumières » qui se situe dans le 11ème arrondissement de Paris, 38 rue Saint Maur.
Il s’agit d’une ancienne fonderie de 3300 m² qui a été reconverti en espace culture numérique située dans le XIe arrondissement de Paris
Son nom était « La fonderie du Chemin-Vert » car située près de la rue du Chemin Vert. Elle avait été fondée en 1835 pour répondre aux besoins de la marine et du chemin de fer pour des pièces en fonte de grande qualité. L’usine occupait alors un terrain de 3 126 m2 et employait 60 personnes. L’usine produisait des moulages de toutes pièces en fonte de fer sur plans et sur modèles jusqu’à 10 000 kg.
L’affaire fait faillite et en 1935, la société est dissoute, 100 ans après sa création. Le terrain et les immeubles sont vendus aux actuels propriétaires et abritera une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de machines-outils.
Ce lieu a été investi par le même groupe de créateur et d’artistes, « Culturespace » qui avait déjà créé « Les carrières de lumières aux Baux de Provence. »
J’avais aussi eu la chance avec Annie, grâce à Marcel et Josiane, de visiter ce lieu naturel d’une beauté majestueuse situé aux Baux de Provence. Dans ce cas aussi, c’était au lendemain de la Première Guerre Mondiale, que le déclin de la pierre de construction s’était amorcé et que de nouveaux matériaux de construction faisant leur apparition, l’acier, le béton. les carrières de pierre allaient perdre leur destin industriel.
C’est dans les années 1960 que Jean Cocteau, envouté par la beauté des lieux décide d’y tourner « Le Testament d’Orphée ».
Et c’est, dans ce lieu des carrières de Baux de Provence, qu’en 2012 un groupe d’artistes : Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, sous le nom de Culturespaces vont créer un concept novateur AMIEX® (Art & Music Immersive Experience).
Des esprits retors et blasés diront qu’il s’agit d’un banal son et lumière se basant sur des œuvres picturales accompagnées de musique.
Oui c’est cela, mais c’est aussi très beau et permet d’entrer dans l’art avec des moyens modernes et numériques.
Tout cela est expliqué sur <Le site de l’Atelier des Lumières>.
Voici une vue de cet espace vierge de toute projection.

Et voici ce que cela donne avec les projections des tableaux de Klimt. Vous n’avez évidemment pas le son.
Mais vous pourrez en avoir un aperçu sur cette <Page consacrée à l’exposition Klimt>
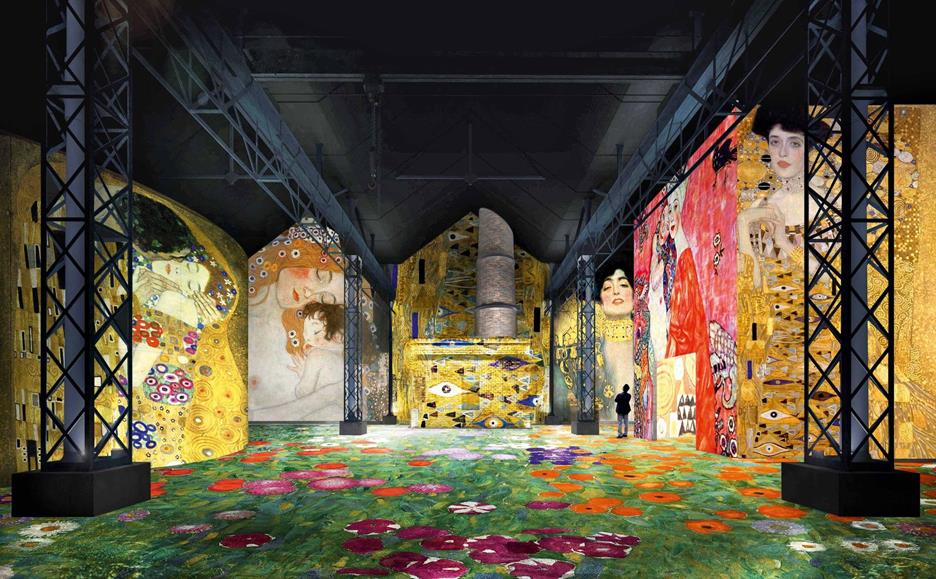
Culturespaces a voulu pour l’ouverture de l’Atelier des Lumières présenter un parcours immersif autour des représentants majeurs de la scène artistique viennoise avec au centre Gustav Klimt, mais aussi Egon Schiele et Friedensreich Hundertwasser. Leurs œuvres s’animent en musique sur l’immense espace de projection de l’ancienne fonderie.

Annie et moi avons aimé et nous ne sommes pas les seuls :
Culture Box présente : <L’Atelier des Lumières, nouveau lieu d’exposition à Paris, ouvre avec Klimt> :
« A l’aide de 140 vidéoprojecteurs et au son des valses et autres musiques de la Vienne de la fin XIXe siècle, les œuvres du peintre autrichien s’animent et habillent les 3.300 m² de surface de projection de ce nouveau lieu baptisé Atelier des Lumières, situé dans le XIe arrondissement. C’est « la plus grande installation numérique de ce type dans le monde », assure Bruno Monnier, le président de Culturespaces, la société privée en charge du lieu qui ouvre au public ce vendredi avec cette première exposition.
Pendant les 35 minutes de projection, le sol et les murs de cette ancienne fonderie se couvrent des œuvres, permettant aux visiteurs de voyager dans la Sécession viennoise, ce courant artistique autrichien dont Gustav Klimt est la figure de proue.
[…]. La bande-son venue tout droit de l’époque de Klimt contribue à l’immersion : Strauss, Chopin, Mahler… »
Le Parisien déclare : <A l’Atelier des Lumières : plein les yeux avec Klimt> :
« C’est à voir. Ça en jette, mais on ne trouve pas les mots. Certains parlent du « premier musée numérique ». Faux, un musée conserve des « vraies » œuvres en permanence. Ou à la limite, il en existe un au Japon, qui propose des reproductions de peintures dans leur cadre, sur un écran plasma. Rien de tel ici. Le contenu des projections Klimt dans ce nouvel espace, l’Atelier des Lumières, qui ouvre vendredi dans une ancienne fonderie du XIe arrondissement à Paris, tiendrait dans un disque dur. Culturespaces, la société très sérieuse qui le gère, parle plus raisonnablement de « premier centre d’art numérique » dans la capitale.
On entre dans le noir pour une projection de 40 minutes, et si l’on veut, deux autres expositions « immersives » plus courtes. D’abord Klimt *, le grand peintre de la Sécession Viennoise au début du XXe siècle, inventeur de formes nouvelles, de nus étranges couverts d’or, de femmes aussi attirantes et inquiétantes que dans un film de David Lynch.
Au sol, aux plafonds, aux murs, les couleurs explosent »
Et ce même journal précise :
« C’est de la culture plaisir. Et même à Paris, comme le souligne Bruno Monnier, patron de Culturespaces, « les musées ne touchent que 50 % de la population au grand maximum. Beaucoup de gens n’osent pas en pousser la porte. Peut-être que ceux qui ont peur d’y aller seront moins intimidés par un espace comme celui-ci ».
Soyons clairs : ce n’est pas une expo, aucun tableau n’est cadré comme au musée. Un ballet plutôt, plus de 3000 images mises en mouvement par 140 vidéoprojecteurs laser. La salle des miroirs, où la projection se poursuit sous vos pieds, sur l’eau d’un ancien bassin de la fonderie, à l’infini, offre un léger vertige.
[…] Car si l’on vient à l’Atelier des Lumières pour Klimt, on a été soufflé par le show donné dans la petite salle par le collectif Poetic_Ai, qui utilise l’intelligence artificielle dans un processus de création visuelle, à travers un algorithme qui compose une œuvre digitale et contemplative. Un noir et blanc sidérant, une musique plein les oreilles, une expérience vraiment spéciale. »
Et même le site de « Côté Maison » parle de cet évènement avec enthousiasme : <L’Atelier des Lumières, lieu d’exposition monumental> :
« Entre prouesse technologique et histoire de l’art revisitée, l’Atelier des Lumières démultiplie les émotions. Dans une ancienne fonderie du XIXe siècle, le premier centre d’art numérique à Paris est né. Chaque exposition est une aventure sensorielle unique. […]
Sous la réalisation de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, avec la collaboration musicale de Luca Longobardi, dès les premières notes la technologie s’efface. L’aventure sensorielle se teinte d’émotion esthétique. Un exercice du regard inédit accompagne l’histoire de l’art d’une nouvelle soif d’apprendre.. »
C’est bien mon ressenti, dans cet espace dans lequel on peut se déplacer et rester aussi longtemps qu’on souhaite, la technologie s’efface et la beauté s’impose.
Il y a des avis divergents
L’essayiste et romancière Cécile Guilbert a produit un article très critique dans le journal La Croix : <La guerre à mort de la culture contre l’art> :
« puisque seule l’approbation de tout a droit de cité dans cette inlassable zone d’activité frénétique qu’est aujourd’hui « la culture », cette industrie appliquée aux Beaux-Arts, ce bazar mondial que le génial polémiste viennois Karl Kraus définissait déjà en son temps comme « le mal rapporté au système des valeurs esthétiques ». […]
Regarder, c’est toujours penser. […]
D’où mon interrogation sur la prolifération contemporaine croissante d’« installations », de « dispositifs », d’« événements » culturels à propos desquels même le mot exposition ne convient plus tant ils semblent n’avoir pour finalité que de nous en mettre justement « plein la vue », c’est-à-dire – CQFD – nous dissuader de penser. Démesure et monumentalité des formats, des lieux d’expos, des coûts et des prix, n’est-ce pas là d’ailleurs le propre d’un certain art dit contemporain, entreprise d’intimidation et de terreur habile à compenser l’anéantissement des facultés sensibles par l’ironie de ses gros jouets pour milliardaires ?
[…] débauche techniciste et pillage des peintres du passé forment une doublette d’enfer pour vider l’art de tout contenu et de tout sens. […]
Car si le surgissement de toute œuvre d’art digne de ce nom s’avère un événement – celui de sa présence, de son aura –, sa mise en scène événementielle en configure à coup sûr le tombeau. Or c’est précisément ce à quoi n’a jamais pensé Culturespaces, entreprise issue d’Havas et filiale d’Engie (ex-Lyonnaise des eaux devenue GDF-Suez), à savoir l’entrepreneur privé d’ingénierie culturelle à l’origine de ce « barnum Klimt » et dont le « business model » est si prometteur qu’il opère déjà dans une dizaine de monuments et de musées français tandis qu’un système de franchises est prévu à l’étranger…
Système rentable, système parfait, croissance et dividendes garantis, mais aussi honte et désolation éprouvées au spectacle sans cesse amplifié de l’étouffement de l’art par la culture, au nom de la culture comme bras armé de l’économie politique dont se constate l’essor planétaire toujours plus meurtrier. »
Attaque brillante, qui a du contenu et dont certains arguments me touchent…. l’étouffement de l’art par la culture.
Le <Billet culturel de Mathilde Serrell> sur France Culture qui reprend ces arguments de Cécile Guilbert et en ajoute même un autre :
« Souligner qu’afin de toucher un public familial, les nus les plus provocateurs d’Egon Schiele ne figurent pas dans la sélection. »
nuance quand même le propos sous forme de question :
« Mais l’objectif annoncé est de s’adresser en plus des 50% de la population que peuvent toucher les musées, aux 25% de gens qui n’y vont jamais. Freinés par la barrière de l’établissement culturel. On aurait donc avec ce format de diffusion numérique une sorte d’expérience collective d’art qui ne serait pas une exposition mais un divertissement culturel. Et alors ? Pourquoi pas ? »
A vous de voir.
Mais même une invitation comme celle-ci : « J’ai vu un truc super, vous devriez aller le voir aussi » renferme en elle, de la complexité et des questionnements.
<1111>
-
Lundi 17 septembre 2018
« Il importe que cette histoire soit connue, qu’elle soit regardée avec courage et lucidité »Déclaration du Président de la République Française, Emmanuel Macron à propos de la mort de Maurice Audin et du système de torture mis en place par les autorités françaises lors de la Guerre d’Algérie« Tout se sait toujours » avait répondu Henry Alleg à son tortionnaire qui lui dit que jamais personne ne saura ce qui se passe dans les chambres de torture de l’armée française en Algérie.
Henri Alleg était un militant de la cause indépendantiste algérienne et était devenu célèbre en écrivant le livre « « la Question » qui est un livre autobiographique, publié en français en 1958 et en anglais. Il y narre et dénonce la torture des civils pendant la guerre d’Algérie. Et dans ce livre, il relate un dialogue avec ses bourreaux à qui il dit, épuisé par la torture : « On saura comment je suis mort. » Le tortionnaire lui réplique : « Non, personne n’en saura rien. ».
Et j’ai utilisé la réponse du supplicié : « Tout se sait toujours » pour le mot du jour du 1er mars 2018, consacré à Maurice Audin à la suite d’un article publié le 14 février 2018 par le journal « L’Humanité » qui présentait le témoignage d’un vieil homme qui pense qu’on l’a obligé, sans lui dire la vérité, d’enterrer le corps de Maurice Audin.
<Vous trouverez cet article derrière ce lien>
Maurice Audin a été arrêté le 11 juin 1957 par des militaires français, au cours de la bataille d’Alger et on n’a jamais retrouvé sa trace. Henri Alleg avait été arrêté le 12 juin 1957, soit le lendemain de l’arrestation de Maurice Audin,
 C’était un brillant mathématicien, il était marié à Josette avec qui il avait eu 3 enfants. Au moment de son arrestation il avait 25 ans.
C’était un brillant mathématicien, il était marié à Josette avec qui il avait eu 3 enfants. Au moment de son arrestation il avait 25 ans.
Pour Josette Audin, ce fut le combat de toute une vie de contester la pitoyable et monstrueuse version officielle : « Maurice Audin s’est évadé et on ne sait pas ce qu’il est devenu ». Elle était soutenu par une grande part de la communauté des mathématiciens dont Cédric Villani, ces dernières années, et aussi de communistes qui ne lâchaient pas leur camarade.
Après que le président Nicolas Sarkozy n’ait pas daigné répondre à une lettre de Josette Audin, le président François Hollande avait fait les premier pas au nom de la République, de la France :
- D’abord en 2012, il s’était rendu devant la stèle élevée à la mémoire de Maurice Audin à Alger et fait lancer des recherches au Ministère de la Défense sur les circonstances de sa mort
- Puis en juin 2014, dans un message adressé à l’occasion du prix de mathématiques Maurice Audin, il reconnaissait officiellement pour la première fois au nom de l’État français que Maurice Audin ne s’est pas évadé, qu’il est mort en détention, comme, explique-t-il, les témoignages et documents disponibles l’établissent.
Mais c’est à Emmanuel Macron qu’il est revenu de faire le pas décisif par une déclaration solennelle daté du 13 septembre 2018.
Ce même jour, il est venu apporter cette déclaration, en mains propres à Josette Audin qui a déclaré au journal l’Humanité : « Je ne pensais pas que ça arriverait »
Vous trouverez la déclaration intégrale du Président de la République Française derrière ce lien :
J’en tire les extraits suivants :
« Au soir du 11 juin 1957, Maurice Audin, assistant de mathématiques à la Faculté d’Alger, militant du Parti communiste algérien (PCA), est arrêté à son domicile par des militaires. Après le déclenchement de la guerre par le Front de libération nationale (FLN), le PCA, qui soutient la lutte indépendantiste, est dissous et ses dirigeants sont activement recherchés. Maurice Audin fait partie de ceux qui les aident dans la clandestinité.
Tout le monde sait alors à Alger que les hommes et les femmes arrêtés dans ces circonstances ne reviennent pas toujours. […]
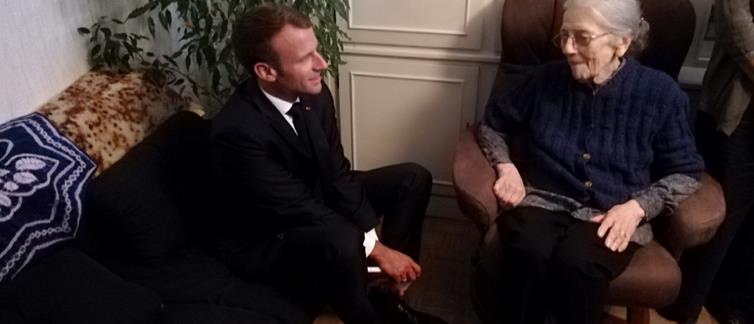 Maurice Audin n’a jamais réapparu et les circonstances exactes de sa disparition demeurent floues. Le récit de l’évasion qui figure dans les comptes rendus et procès-verbaux officiels souffre de trop de contradictions et d’invraisemblances pour être crédible. Il s’agit manifestement d’une mise en scène visant à camoufler sa mort. Les éléments recueillis au cours de l’instruction de la plainte de Josette Audin ou auprès de témoins indiquent en revanche avec certitude qu’il a été torturé.
Maurice Audin n’a jamais réapparu et les circonstances exactes de sa disparition demeurent floues. Le récit de l’évasion qui figure dans les comptes rendus et procès-verbaux officiels souffre de trop de contradictions et d’invraisemblances pour être crédible. Il s’agit manifestement d’une mise en scène visant à camoufler sa mort. Les éléments recueillis au cours de l’instruction de la plainte de Josette Audin ou auprès de témoins indiquent en revanche avec certitude qu’il a été torturé.
Plusieurs hypothèses ont été formulées sur la mort de Maurice Audin. L’historien Pierre Vidal-Naquet a défendu, sur la foi d’un témoignage, que l’officier de renseignements chargé d’interroger Maurice Audin l’avait lui-même tué. Paul Aussaresses, et d’autres, ont affirmé qu’un commando sous ses ordres avait exécuté le jeune mathématicien. Il est aussi possible qu’il soit décédé sous la torture.
Quoi qu’il en soit précisément, sa disparition a été rendue possible par un système dont les gouvernements successifs ont permis le développement : le système appelé « arrestation-détention » à l’époque même, qui autorise les forces de l’ordre à arrêter, détenir et interroger tout « suspect » dans l’objectif d’une lutte plus efficace contre l’adversaire.
Ce système s’est institué sur un fondement légal : les pouvoirs spéciaux. Cette loi, votée par le Parlement en 1956, a donné carte blanche au Gouvernement pour rétablir l’ordre en Algérie. Elle a permis l’adoption d’un décret autorisant la délégation des pouvoirs de police à l’armée, qui a été mis en œuvre par arrêté préfectoral, d’abord à Alger, puis dans toute l’Algérie, en 1957.
Ce système a été le terreau malheureux d’actes parfois terribles, dont la torture, que l’affaire Audin a mis en lumière. Certes, la torture n’a pas cessé d’être un crime au regard de la loi, mais elle s’est alors développée parce qu’elle restait impunie. Et elle restait impunie parce qu’elle était conçue comme une arme contre le FLN, qui avait lancé l’insurrection en 1954, mais aussi contre ceux qui étaient vus comme ses alliés, militants et partisans de l’indépendance ; une arme considérée comme légitime dans cette guerre-là, en dépit de son illégalité.
En échouant à prévenir et à punir le recours à la torture, les gouvernements successifs ont mis en péril la survie des hommes et des femmes dont se saisissaient les forces de l’ordre. En dernier ressort, pourtant, c’est à eux que revient la responsabilité d’assurer la sauvegarde des droits humains et, en premier lieu, l’intégrité physique de celles et de ceux qui sont détenus sous leur souveraineté.
Il importe que cette histoire soit connue, qu’elle soit regardée avec courage et lucidité. »
Cette déclaration ne donne pas, parce qu’il n’y a pas de certitude, les circonstances exactes de la mort de Maurice Audin.. <Cet article du Point> émet certaines hypothèses..
Mais cette déclaration reconnait surtout la responsabilité de la République dans la mise en place d’un système où la torture était possible et encouragée.
Et dire qu’en 1957, nous n’étions que 12 ans après la fin de la guerre 1939-1945 où tous les français dénonçaient le comportement de la Gestapo dans la France occupée.
Pour que de telle chose soit possible, il faut comme je l’ai écrit vendredi que des fictions, des mythes puissent faire croire que le combat qu’on mène, les actes « sales »qu’on commet poursuivent un but légitime.
A cette époque, la fiction était que « l’Algérie était la France. »
Alors, tout le monde n’est pas d’accord.
Si un Editorial du Monde du 14 septembre affirme : « La responsabilité de l’Etat dans la mort de Maurice Audin, une salutaire vérité !. »
<La décision de Macron dans l’affaire Maurice Audin divise> écrit « Le Parisien » dans son édition du 13 septembre 2018, qui cite Brice Hortefeux, ancien ministre de l’Intérieur, qui dit « qu’il faut arrêter de se repentir sur des actes qui ont été commis par des générations précédentes ».
<Nice Matin> explique dans son édition du 14 septembre que « La reconnaissance de la responsabilité de l’Etat dans la mort de Maurice Audin est mal passée chez les élus de droite » et cite Michèle Tabarot, Christian Estrosi et Eric Ciotti.
Et toutes ces personnes de considérer qu’il n’est pas possible que la France reconnaisse sa responsabilité alors que l’Algérie et donc la continuation du FLN ne reconnait pas les crimes qu’a commis le FLN contre les français et les harkis.
On peut bien sûr souhaiter que l’Algérie ouvre ses propres archives, comme l’ordonne Emmanuel Macron, dans sa déclaration, pour les archives françaises :
Une dérogation générale, dont les contours seront précisés par arrêtés ministériels après identification des sources disponibles, ouvrira à la libre consultation tous les fonds d’archives de l’Etat qui concernent ce sujet.
Enfin, ceux qui auraient des documents ou des témoignages à livrer sont appelés à se tourner vers les archives nationales pour participer à cet effort de vérité historique.
L’approfondissement de ce travail de vérité doit ouvrir la voie à une meilleure compréhension de notre passé, à une plus grande lucidité sur les blessures de notre histoire, et à une volonté nouvelle de réconciliation des mémoires et des peuples français et algérien. »
Mais dans la déclaration d’Emmanuel Macron il n’y a pas essentiellement une repentance, il y a d’abord un devoir de vérité.
Moi je crois que les Etats s’honorent de reconnaître la vérité des faits.
Sur ce point je suis totalement en accord avec Emmanuel Macron : « Il importe que cette histoire soit connue, qu’elle soit regardée avec courage et lucidité ». C’est cela le devoir de vérité.
Les faits c’est que Maurice Audin a été torturé et qu’il est mort en détention.
Les faits c’est que trahissant ses valeurs et les droits de l’homme, le gouvernement et le parlement français en 1956 ont mis en place des pouvoirs spéciaux rendant possible et probablement même inévitable la torture en Algérie.
Je ne me lasserai pas de rappeler qu’entre le 1er février 1956 et le 21 mai 1957, le gouvernement de la France était dirigé par Guy Mollet qui était à la tête de la SFIO, donc l’ancêtre du Parti Socialiste et que le Ministre de la Justice de ce gouvernement était François Mitterrand. Gaston Defferre était aussi ministre de ce même gouvernement.
L’éthique me pousse à concéder que Pierre Mendès-France l’était aussi, mais qu’il a démissionné en mai 1956 et a été remplacé par Jacques Chaban-Delmas.
C’est leur part d’ombre aussi.
<1110>
- D’abord en 2012, il s’était rendu devant la stèle élevée à la mémoire de Maurice Audin à Alger et fait lancer des recherches au Ministère de la Défense sur les circonstances de sa mort
-
Vendredi 14 septembre 2018
« Changer d’histoire pour changer l’Histoire »Cyril Dion – Chapitre 3 du livre : « Petit manuel de résistance contemporaine »Beaucoup d’émissions très intéressantes ont été diffusées ces dernières semaines sur le sujet du défi écologique qui se pose à l’espèce humaine.
Une première « Economie / écologie l’impossible conjugaison ? » du 1er septembre 2018 dans laquelle l’invité Gaël Giraud a rappelé cette évidence :
« Le dérèglement climatique est un problème créé par les riches dont les premières victimes sont les pauvres. »
Et puis une deuxième : « Comment rendre crédible la catastrophe écologique ? » du 8 septembre 2018, dans laquelle étaient invités la journaliste Jade Lindgaard qui insistait sur les initiatives locales (l’économie sociale et solidaire, les AMAP, l’agriculture biologique), Yves Cochet ancien ministre de l’Environnement de Jospin, et le philosophe Dominique Bourg qui faisait ce constat :
« Ça fait des siècles qu’on a dit aux gens qu’on dominait la nature, que le progrès était forcément linéaire et absolument cumulatif. Après on leur a raconté que l’économie pouvait permettre de tout comprendre et qu’il n’était pas question de nature parce que toute la technique était là pour la biffer et s’y substituer… Ça fait des siècles qu’on raconte ce genre d’âneries, vous n’attendez quand même pas, parce qu’il y a un soubresaut climatique, que les gens vont remettre ça en cause ! »
Et aussi une troisième ou au moins la première moitié de l’émission Esprit Public de dimanche dernier qui portait pour titre humoristique : « La vacance de Monsieur Hulot ». La seconde partie était consacrée à la Chine pour laquelle on apprenait que pour réaliser son ambition projet « Les routes de la Soie » elle envisageait de construire une cinquantaine d’aéroports et d’autres infrastructures qui ne vont pas dans le sens d’une atténuation de l’impact écologique humaine.
A partir de ces 3 émissions, j’envisageais d’écrire un mot du jour de synthèse qui aurait eu pour exergue : « Entre le déni et le catastrophisme » pour démontrer que l’un comme l’autre conduisent à l’inaction, le premier parce qu’il amène les gens à penser qu’il n’y a rien à faire et le second parce que dans ce cas les gens se persuadent qu’il n’y a plus rien à faire. Ce contre quoi je m’insurge, l’Histoire n’est pas écrite.
Mais j’ai préféré finir cette semaine par un extrait du dernier livre de Cyril Dion, le réalisateur du film documentaire : « Demain ». J’y avais consacré le mot du jour du lundi 11 janvier 2016.
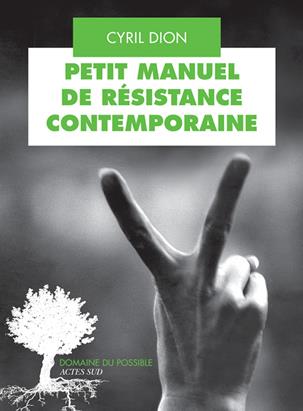 Ce livre s’intitule : « Petit manuel de résistance contemporaine »
Ce livre s’intitule : « Petit manuel de résistance contemporaine »
J’y reviendrai peut-être plus longuement dans une série ultérieure.
Aujourd’hui je m’arrêterai au chapitre 3 qui s’intitule « Changer d’histoire pour changer l’Histoire » et dans lequel, il cite plusieurs fois Yuval Noah Harari.
Il prend comme exemple les réseaux sociaux modernes et notamment Instagram. Et, il compare un article qu’on appelle « Post » dans ce monde-là dans lequel Kim Kardashian appelle à acheter son nouveau gloss à paillettes et un autre où Greenpeace appelle à agir pour le climat.
Si on lit la biographie de Kim Kardashian elle est décrite comme une femme d’affaires, productrice, styliste et animatrice de télévision américaine. On ajoute c’est une personnalité médiatique.
Mais son vrai métier est d’être une influenceuse.
Elle porte une robe, et se prend en photo, elle exhibe un sac à main et se prend en photo, elle se met du rouge à lèvres et se prend en photo.
Puis elle met cette photo sur Instagram et rapidement deux millions d’internautes cliquent pour dire qu’ils aiment cette photo, ce sont des « like ». Et plus que cela, le produit avec lequel elle s’est fait prendre en photo, voit immédiatement une augmentation de ses ventes…
En face des 2 millions de like pour un post de K.K., celui de Greenpeace arrive péniblement à 10 000.
Yuval Noah Harari explique que la formidable capacité de coopérer d’homo sapiens, sa supériorité sur les autres espèces provient de son génie de créer des mythes, des fictions, des histoires qui fédèrent des groupes extrêmement vastes et les poussent à agir ensemble.
Nous sommes aujourd’hui dans la fiction que rien n’est plus important que la vie humaine et sa recherche du bonheur et du bien-être. Et que dans cette quête la consommation est un outil extraordinaire pour se faire du bien, se sentir mieux et réaliser sa vie. Et c’est cette histoire fictionnel qui pousse les femmes et les hommes à acheter des vêtements, des produits de beauté, des voitures, des voyages, des chaines hifi, des consoles de jeu, des repas gastronomiques, des objets Hi Tech et tant d’autres choses, en écoutant leurs désirs.
Et parce qu’une foule innombrable adhère à cette histoire, à cette fiction, Kim Kardashian peut être une influenceuse et gagner énormément d’argent avec cette activité… futile si l’on y songe vraiment.
Mais les fictions humaines évoluent et alors c’est encore une caractéristique des hommes ils considèrent la fiction précédente incompréhensible, une folie…
En l’année 1000, un père chrétien européen était fier que son fils choisisse de se « croiser », c’est-à-dire devenir « croisé » pour aller combattre en Palestine contre les infidèles musulmans, « libérer Jérusalem » et probablement mourir jeune, au combat ou même de maladie dans ces contrées lointaines. Il y avait un objectif, une quête qui correspondait à un mythe, une histoire.
Aujourd’hui, quand un père voit son fils embrasser la foi musulmane pour aller faire le jihad en Syrie ou dans un autre pays proche de la Palestine, pour y aller mourir pour sa Foi, il pense que son fils est fou. Ce n’est plus la fiction d’aujourd’hui pour ce père, ce n’est pas l’histoire à laquelle il croit et qui le fait avancer.
Alors, il faut changer d’histoire, pour que plus personne ne croit que la consommation rend heureux, que l’individualisme et le culte du moi sont des valeurs qui méritent autant d’attention de notre part.
Quand nous aurons trouvé ce nouveau récit, l’hyperconsommation, acheter un nouveau smartphone tous les ans, nous passionner pour la dernière keynote d’Apple nous paraîtra une folie comme se faire tuer pour aller libérer le tombeau fantasmé et mythique du Christ.
Alors, oui il faut « Changer d’histoire pour changer l’Histoire » de l’Humanité sur terre.
<1109>
-
Jeudi 13 septembre 2018
« Un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres ?»Nicolas Hulot qui n’a pas posé cette affirmation sous forme de questionNicolas Hulot a démissionné du gouvernement le 28 août sur les ondes de France Inter.
Lors de cette émission, il a donné son point de vue et ses convictions.
Il a d’abord justifié sa démission parce que le gouvernement actuel de la France ne prend pas suffisamment en compte, selon son échelle d’exigence, l’urgence écologique et climatique.
Il s’est lancé dans un réquisitoire assez cinglant :
« Est-ce que nous avons commencé à réduire l’utilisation des pesticides ? La réponse est non.
Est-ce que nous avons commencé à enrayer l’érosion de la biodiversité ? La réponse est non.
Est-ce que nous avons commencé à nous mette en situation d’arrêter l’artificialisation des sols ? La réponse est non »
Il a dit son amitié pour le président de la république et le Premier Ministre mais a ajouté :
« Sur les sujets que je porte, on n’a pas la même grille de lecture. »
Il a aussi exprimé sa solitude :
« Ai-je une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité ? Ai-je une formation politique ? Est-ce que les grandes formations politiques et l’opposition sont capables de se hisser au-dessus de la mêlée pour s’entendre sur l’essentiel. »
Il a surtout donné des exemples concrets dont s’est félicité le gouvernement et qui selon lui sont à l’opposé de ce qu’il faudrait faire :
« Je me suis moi-même largement prononcé sur des traités comme le CETA et on va en avoir une floppée d’autres[…]
Où est passée la taxe sur les transactions financières ? […]
Le nucléaire, cette folie inutile, économiquement, techniquement dans lequel on s’entête.
Les grandes tendances demeurent. La remise en cause d’un modèle agricole dominant n’est pas là. On recherche une croissance à tout crin. Sans regarder ce qui appartient à la solution et ce qui appartient au problème. […]
Quand on se réjouit – ça va vous paraître anecdotique – de voir sortir de Saint-Nazaire un porte-conteneurs qui va porter 50 000 conteneurs. Superbe performance technologique. Est-ce bon pour la planète ? La réponse est non. […]
On se fixe des objectifs mais on n’en a pas les moyens parce qu’avec les contraintes budgétaires, on sait très bien à l’avance que les objectifs qu’on se fixe, on ne pourra pas les réaliser. Voilà ma vérité. »
Mais son avis le plus fort et le plus structurant est une dénonciation du système économique actuel :
« On s’évertue à entretenir voire à ranimer un modèle économique, marchand qui est la cause de tous ces désordres .
On n’a pas compris que c’est le modèle dominant [Le libéralisme ] qui est la cause. Est-ce qu’on le remet en cause ?»
Mais les libéraux ne sont pas d’accord.
Dominique Seux, Directeur délégué de la rédaction des Echos et chroniqueur économique sur France Inter a dit le lendemain, aussi pendant le 7-9 de France Inter :
« C’est clair : il faut refroidir l’économie, qui consomme et épuise trop d’énergies qui dégradent la nature et compromettent l’avenir de l’espèce humaine.
L’ami Thomas Legrand a été frappé par les porte-containers, on peut trouver plus absurde encore que l’on puisse traverser l’Europe en avion pour quelques dizaines d’euros parce que le kérosène est détaxé alors que le transport aérien émet du CO2.
Mais la question sous-jacente est de savoir si la transition énergétique, qui doit être plus rapide qu’on ne le pensait encore en 2015, peut se faire dans le cadre de l’économie de marché et -disons-le- du capitalisme.
La plupart des écologistes pensent que non, Nicolas Hulot aussi. On peut penser l’inverse. Avec de puissantes incitations et obligations, seul le capitalisme a les moyens d’investir, d’innover, de trouver les compromis entre la science et de nouveaux modes de vie. Ce sont des entreprises qui inventent et le solaire de demain et les véhicules électriques, dont on aura encore besoin pour se déplacer. »
Et c’est Daniel qui m’a signalé un article d’Eric Le Boucher avec lequel j’ai cru comprendre qu’il était d’accord : <Nicolas Hulot n’en serait pas là s’il avait développé une écologie applicable>.
C’est un article publié sur le site Slate.fr le 28 août 2018
Le journaliste pose la question d’une écologie non pas marquée par les quotas et les règlements imposés, mais alliée de la science, des technologies et de l’économie.
Il écrit :
« Mais le problème est général. Les militants verts estiment que l’écologie doit être imposée «politiquement» à l’économie comme un objectif supérieur, celui de la préservation de la planète. De même que des militants de gauche considèrent que le capitalisme est intrinsèquement mauvais, les Verts idéologues croient l’économie intrinsèquement nocive. Certains vont jusqu’à penser que la solution ne sera trouvée que dans la décroissance, tous pensent que les entreprises doivent être légalement forcées dans la bonne voie.
Dès lors, le succès d’un ministre est mesuré au nombre de quotas, de règlements, d’interdictions, de lois qu’il sait faire passer dans son gouvernement contre «les lobbies» des agriculteurs (productivistes) et des industriels (pollueurs) et contre Bercy qui en est le porte-parole.
[…]
Plutôt que de crier contre l’échec du gouvernement et de se lamenter, les Verts feraient mieux de réfléchir sur le leur. Comment inventer une écologie alliée de la science, des technologies et de l’économie? Comment dépasser les slogans du type «l’écologie va engendrer à un nouveau modèle de croissance qui va créer des millions d’emplois»? Comment trouver des solutions concrètes, applicables »
Ce sont deux visions très différentes de la solution à construire.
En première analyse je suis plutôt en phase avec la position de Hulot, c’est le capitalisme libéral, son addiction à la croissance et son moteur de cupidité qui sont en contradiction avec l’objectif de sauver la vie des humains sur terre.
Mais si on prend un peu de recul, on peut légitimement s’interroger :
Le monde des humains a longtemps été régi par une litanie de règles et de contraintes imposées par les religions et ceux qui parlaient en leur nom.
Peu à peu le monde libéral a affranchi les hommes en leur donnant la liberté de créer, d’entreprendre, d’inventer.
Contre les excès du monde libéral s’est élevé le communisme qui a voulu contraindre, encadrer, planifier, normer.
Le résultat fut catastrophique.
Les communistes ont encore davantage négligé la nature que les libéraux (comme par exemple la mer d’Aral).
Et surtout ils ont anesthésié la liberté, en allant de plus en plus loin dans la brutalité, l’enfermement. Il n’y avait plus d’opposants mais des dissidents qui étaient considérés comme fous qu’on devait soigner dans des hôpitaux psychiatriques.
Alors imaginons un monde de contraintes, de normes, de règles avec pour objectif cette noble cause de sauver l’espèce humaine.
On trouvera certainement un Staline écologique, entourés de soldats fidèles. Tous ceux qui ne suivront pas les règles édictées seront forcément fous, comment ne pas se soumettre à la cause suprême de la survie des humains ?
Alors, je ne rejetterai pas si vite la voie libérale, même si je ne partage pas l’enthousiasme dans les vertus du marché libre et non faussé que défendent Dominique Seux et Eric Le Boucher.
<1108>
-
Mercredi 12 septembre 2018
« Le citoyen ordinaire a deux cartes très importantes en main : sa carte d’électeur et sa carte bancaire. »Frank CourchampLors de la COP23, la 23e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui avait été organisée conjointement par les iles Fidji et l’Allemagne du 6 novembre au 17 novembre, 15 000 scientifiques de 184 pays ont signé un appel contre la dégradation de l’environnement qui a été publié dans la revue Bio Science de l’Université d’Oxford, le lundi 13 novembre.
Je m’en étais fait l’écho, lors du mot du jour du 20 novembre 2017 où je citais le climatologue allemand et fondateur de l’institut de Potsdam de Recherche sur le climat, Hans Joachim Schellnhuber : «La théorie des 3D : Désastres, Découvertes, Décence.»
Dans le journal du CNRS, Frank Courchamp, directeur de recherche au CNRS, revenait sur cet appel d’une ampleur inédite.
Frank Courchamp a d’ailleurs participé à la diffusion de cet appel:
« C’est effectivement du jamais-vu. La première mise en garde de ce genre, formulée en 1992 à l’issue du Sommet de la Terre à Rio, n’avait rassemblé que 1 700 signataires dont, il est vrai, une centaine de prix Nobel. Le présent manifeste a été rédigé par huit spécialistes internationaux du fonctionnement des écosystèmes […]. Il a été initié par le biologiste de la conservation américain William Ripple, qui a mis en évidence le déclin dramatique de presque tous les grands carnivores et tous les grands herbivores, des animaux qui jouent pourtant un rôle crucial dans l’équilibre des milieux naturels. William Ripple m’a contacté le 20 juillet et m’a demandé de relayer ce cri d’alarme, notamment en France, ce que j’ai fait. Au total, pas loin d’un millier de chercheurs français (soit un quinzième des signataires) ont souscrit à cet appel. »
Frank Courchamp signale que si des progrès ont été malgré tout accomplis depuis 1992, mais que sur des points essentiels le compte n’y est pas:
« L’interdiction des chlorofluorocarbures (CFC) et d’autres substances appauvrissant la couche d’ozone a eu des effets très positifs. De même, des points ont été marqués dans la lutte contre la famine et l’extrême pauvreté. Mais qu’il s’agisse des forêts, des océans, du climat, de la biodiversité…, les trajectoires que nous avons prises sont très préoccupantes et nous mènent dans le mur.
La plupart des indicateurs qui étaient dans le rouge il y a un quart de siècle ont viré à l’écarlate.
On continue de détruire les forêts à un rythme effréné. 120 millions d’hectares ont été rayés de la carte depuis 1992, essentiellement au profit de l’agriculture.
Les « zones mortes » (dépourvues d’oxygène), dans les océans, ont explosé de 75 %, tandis que l’eau potable disponible dans le monde par tête d’habitant a diminué de 26 %. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et les températures moyennes du globe se sont encore accrues.
Une proportion énorme des mammifères, des reptiles, des amphibiens, des oiseaux et des poissons a disparu.
Sans oublier qu’une étude, trop récente pour avoir été mentionnée dans l’appel, vient de montrer qu’en moins de trois décennies, les populations d’insectes volants (bourdons, libellules, papillons et autres diptères) ont chuté de près de 80 % en Europe et sans doute au-delà. »
Il y a d’une part la question de notre système économique basé sur une consommation toujours croissante et puis se pose la question démographique.
Evidemment cette question pose grand débat.
La Chine est revenue sur sa politique de l’enfant unique.
Et il est vrai que certains témoignages de famille chinoise révélaient la brutalité et l’inhumanité de cette règle rigide.
Mais le constat est implacable :
« Le nombre d’êtres humains a augmenté de 35 % en 25 ans, ce qui est incroyablement élevé. Nous sommes de plus en plus nombreux et nous consommons trop. Or, nous vivons sur une planète aux ressources finies qui ne peut pas répondre aux besoins alimentaires, entre autres, d’une population infinie. La Terre ne pourra jamais nourrir plus de 15 milliards de bouches, même à supposer que nous mettions fin à la surconsommation actuelle, que nous répartissions mieux les ressources et que d’hypothétiques progrès agricoles et des sauts technologiques se produisent.
À la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, Malthus, qui a été beaucoup critiqué pour cela, affirmait que si les populations humaines ne se régulent pas d’elles-mêmes, la Nature s’en charge à coups de guerres, d’épidémies et de famines. L’équation est on ne peut plus simple : dans n’importe quelle population de n’importe quelle espèce, quand il y a trop d’individus, ceux-ci se retrouvent confrontés à des problèmes qui les forcent à réduire leurs effectifs.
Ce n’est pas une question de religion ou d’idéologie, mais un problème de ressources disponibles. Il est important que certains pays en développement prennent conscience de l’importance de réduire leur croissance démographique. Ceci devrait passer, comme le préconise notre appel, par une plus grande généralisation du planning familial et des programmes d’accès à l’éducation des filles. »
Ce week-end un certain nombre de manifestations ont eu lieu en France et même dans le monde. En France, elles ont été provoquées par la démission de Nicolas Hulot.
Les signataires du manifeste appelaient justement de leurs vœux « un raz-de-marée d’initiatives organisées à la base ».
Et Frank Courchamp explique que :
« Le mouvement doit venir de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Une multitude d’initiatives individuelles et de micro-actions quotidiennes peut avoir un effet décisif, tout simplement parce que nous sommes des milliards.
Les politiques, dont l’agenda dépasse rarement l’horizon de la prochaine élection, mais qui sont sensibles aux pressions, suivront le mouvement, tout comme les acteurs économiques. J’ai l’habitude de dire que le citoyen ordinaire a deux cartes très importantes en main : sa carte d’électeur et sa carte bancaire.
Faire des choix de consommation judicieux comme acheter moins d’huile de palme, moins de viande, moins d’emballages…, conduira les industriels à produire moins d’huile de palme, moins de viande, moins d’emballages…, et améliorera l’état de la planète. »
Le scientifique n’a pas de doute sur la conclusion si la société des hommes ne parvient pas à faire évoluer son modèle de consommation, sa capacité à préserver et à réintroduire de la biodiversité enfin à diminuer l’utilisation moyenne des énergies fossiles par habitant.
« La bonne nouvelle, c’est que la biodiversité repartira. Les modèles prédisent qu’il faudra à peu près un million d’années pour qu’elle retrouve son niveau d’avant cette sixième extinction de masse imputable à l’Homme. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il n’y aura très probablement plus de sociétés humaines pour contempler le spectacle. Les toutes prochaines générations vont donc nécessairement rentrer dans l’Histoire puisque, soit elles parviendront à stopper la destruction de l’environnement, soit elles en subiront les conséquences de plein fouet et ne s’en relèveront pas. »
<1107>
-
Mardi 11 septembre 2018
« L’urbanisation a transformé radicalement la société française »Michel LussaultMichel Lussault, est Géographe et professeur d’études urbaines à l’École Normale Supérieure de Lyon (ENS). Il dirige l’École Urbaine de Lyon (EUL) qui a été créée en juin 2017 dans le cadre du Plan d’Investissement d’Avenir (PIA2) par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI).
Sur la page d’accueil du site de cette école on lit la description suivante :
« A travers son projet interdisciplinaire expérimental de recherche, de formation doctorale et de valorisation économique, sociale et culturelle des savoirs scientifiques, l’École Urbaine de Lyon innove en constituant un domaine nouveau de connaissance et d’expertise : l’urbain anthropocène.
Aux défis mondiaux de l’urbanisation et de l’entrée dans l’anthropocène correspondent en effet à la fois de nouveaux champs de recherche et de formation, de nouvelles professions et compétences, mais aussi une mutation profonde de la pensée, des représentations, des pratiques et des métiers de la ville. »
Il a été interrogé par la revue : Horizons publics
qui se présente comme ayant pour objet d’étudier la transformation de l’action publique. Elle est éditée par la maison d’édition Berger-Levrault.
Le titre de l’article est : « L’urbanisation a transformé radicalement la société française »
Dans cet article il est question de l’anthropocène, cette ère géologique qui succède à l’holocène et à partir de laquelle l’influence de l’homme marque le système Terre dans son ensemble. Le changement climatique est des manifestations les plus prégnantes de l’anthropocène.
Michel Lussault explique :
« L’urbanisation a transformé radicalement la société française en même temps que le monde. C’est un changement qui a la particularité d’être local et global. L’entrée dans l’anthropocène est également un changement global. D’ailleurs, en américain, on disait « global change » avant de parler d’anthropocène. Ces deux changements ont des conséquences simultanées sur toutes les sociétés et à toutes les échelles. Mon souci est de penser l’entrecroisement de ces deux changements globaux : comment s’alimentent-ils l’un l’autre ? Quels effets ont-ils sur les individus, sur les territoires, en fait sur le monde et toutes les échelles intermédiaires ? Il n’y a pas de plus grande urgence que de penser ces grands changements pour comprendre ce qu’ils produisent aux plans économique, politique, culturel, environnemental, social, paysager, architectural, urbanistique, etc.
D’ailleurs, plus que de changement, il faut parler de véritables mutations, qui non seulement imposent de reconsidérer les manières classiques de penser les réalités sociales et territoriales, mais aussi les façons d’agir, d’habiter les espaces et d’envisager notre futur.
Les instituts Convergence [dont fait partie l‘EUL] qui se comptent au nombre de 10 en France ont été créés [pour] rassembler sur un même site des scientifiques de haut niveau pour traiter de manière innovante des questions d’intérêts scientifique et sociétal majeurs.
Chacune des thématiques traitées par ces instituts est dite de sciences-frontières : elles imposent de sortir des cadres académiques institués, de poser les problèmes scientifiques autrement en recourant par exemple à une interdisciplinarité radicale.
Celui de l’école urbaine de Lyon consacré aux mondes urbains anthropocènes en est une parfaite illustration.
On doit y fonder des types de savoirs pertinents pour rendre intelligibles les évolutions urbaines et anthropocènes contemporaines. Nous pensons que les sciences classiques, constituées depuis deux siècles, n’offrent plus les ressorts suffisants pour saisir convenablement la complexité des systèmes urbains anthropocènes. »
Vous pourrez vous reporter à l’intégralité de l’article.
Mais j’ai trouvé cette approche intéressante et positive par rapport aux questions que nous nous posons : comment continuer à vivre sur cette planète en acceptant ses limites tout en trouvant des solutions pour permettre d’élargir le champ des possibles.
La science d’aujourd’hui doit se différencier de la science d’hier, en portant aussi la même considération aux réalités humaines et non humaines que nous observons, dans le sens de certaines anthropologies inspirées de la sociologie des sciences de Bruno Latour.
La réalité est composée d’une grande variété de modes d’existence qui oblige à sortir de notre posture anthropocentrique.
Comment écouter les voix de l’ensemble des opérateurs d’une situation données et évitant que celle du chercheur autorisé ne couvre les autres ?
« Notre projet de recherche échouera si nous ne parvenons pas à embarquer le plus grand nombre de protagonistes pour produire des savoirs différents, dans toute leur richesse et leur pluralité, des savoirs qui changeront radicalement l’intelligibilité des réalités sociales. Mais nous échouons également si nous ne répondons pas aux questions « qu’est-ce que agir, quels sont les modes de faire, quels sont les modes d’action à inventer dans l’urbain anthropocène ? » Ce sont des questions auxquelles nous nous pourrons répondre qu’avec les acteurs territoriaux, des professionnels jusqu’aux quidams si je puis dire. « Qu’est-ce que agir ? » ne relève plus dans l’anthropocène de la seule professionnalité mais fondamentalement du politique. Cela débouche sur une double interrogation : comment un individu à travers ses actions contribue-t-il à rendre intelligible la réalité du monde urbain anthropocène ? Comment un même individu à travers ses actions contribue à faire en sorte que les sociétés humaines soient capables d’affronter les défis de l’urbain anthropocène ? »
Je retiendrai aussi cette invitation de « sortir de notre posture anthropocentrique »
Grâce à Nicolas Copernic nous avons pu sortir de la théorie erronée du géocentrisme qui pensait que notre terre était au centre de l’Univers pour entrer dans l’héliocentrisme qui montrait que la terre tournait autour du soleil.
Il reste que pour beaucoup ce géocentrisme a subsisté sous la forme de l’anthropocentrisme, la terre n’est peut-être pas au centre du monde, mais l’homo sapiens peut-être ?
En tout cas, un doute subsiste pour certains… Les religions monothéistes y ont beaucoup contribué.
Cette vision est totalement déraisonnable.
Homo sapiens ne peut rien sans la nature, sans les produits et ressources de notre terre.
Parler d’environnement n’est pas qu’une erreur, c’est une faute. Je veux dire une faute morale.
Parler d’environnement c’est justement se placer dans la croyance de l’anthropocentrisme où homo sapiens est au centre et ce qui l’entoure est l’environnement.
C’est une théorie aussi erronée que le géocentrisme.
Nous sommes dans la nature et la nature est en nous.
Cela n’enlève rien au génie de notre espèce mais si nous ne parvenons à nous réconcilier avec la nature et la terre et à rendre notre société des hommes compatible avec les ressources et l’équilibre de la nature, nous disparaîtrons.
<1106>
.
-
Lundi 10 septembre 2018
« Cette climatisation qui surchauffe la planète »Michel RevolIl a fait chaud cet été.
Pour certains, cette chaleur est insupportable.
Dans notre société moderne, individualiste et privilégiant le court-terme, la tentation est grande d’acheter une climatisation.
Vous trouverez, de manière assez humoristique cette vidéo sur Internet : <Comment les climatiseurs ont changé le monde>
Vous apprendrez que chaque seconde, dix climatiseurs sont vendus dans le monde. En 2050, on en comptera près de six milliards. Inventé en 1902 par l’ingénieur américain Willis Carrier, le climatiseur a profondément modifié nos sociétés contemporaines. L’industrie culturelle, d’abord, en accompagnant l’âge d’or du cinéma hollywoodien. Les entreprises se sont ensuite équipées en masse, la climatisation étant réputée augmenter la productivité des salariés.
S’il a fallu attendre les années 1950 pour que les climatiseurs entrent dans les ménages américains, ils représentent aujourd’hui, aux Etats-Unis, une dépense énergétique équivalente à celle du continent africain tout entier.
Arrêtons-nous un instant sur ce constat :
« La dépense énergétique des ménages américains sur l’unique consommation dû aux climatiseurs est équivalente à celle du continent africain tout entier ! »
Et nous savons que c’est une autre dimension de la mondialisation : les africains veulent vivre comme les américains.
Nous savons aussi qu’au milieu du monde des chiffres pervers, il en est qui sont davantage sérieux et fiables. C’est le cas de ceux la démographie.
Les États-Unis comptaient 325 millions d’habitants en 2016. Mais selon <Wikipedia>, l’accroissement naturel du pays est de 0,81 %. Donc même avec l’immigration la démographie des Etats-Unis devraient rester stable à moyen terme.
Or l’Afrique comptait déjà 1,2 milliard en 2016, soit plus de 4 fois la population états-uniennes. Et selon les projections démographiques, dans les années 2050 la population de l’Afrique se situera entre 2 et 3 milliards puis 4,4 milliards en 2100.
La terre qui permettrait aux africains de se climatiser comme les américains n’existe pas !
Le problème dépasse bien la seule question de la climatisation pour s’étendre à l’ensemble du spectre de la consommation, des transports, de l’alimentation etc.
Mais pour ce mot du jour restons sur le sujet de la climatisation.
A l’heure d’aujourd’hui, le remède de la climatisation pour lutter contre la canicule est dévastateur.
Michel Revol a publié dans le Point un article qui a pour titre : « Cette clim qui surchauffe la planète »
Il écrit :
« C’est ce qu’on appelle un cercle vicieux : non seulement, à raison de 0,5 à 2 degrés, la climatisation réchauffe les villes en rejetant dans les rues de l’air chaud, mais elle participe aussi à élever la température de la planète en consommant beaucoup d’électricité, produite surtout par du gaz et du charbon, deux énergies fossiles – donc actrices de l’effet de serre. Et, puisque la planète se réchauffe du fait de la clim, il faut bien la faire fonctionner encore plus fort pour refroidir les magasins et les habitations. Impitoyable.
L’Agence internationale de l’énergie vient de s’alarmer du danger dans un rapport publié en mai dernier. Selon l’organisation, le nombre de climatiseurs devrait tripler dans le monde jusqu’en 2050. Il pourrait se vendre en moyenne un climatiseur toutes les quatre secondes d’ici à cette échéance, pour atteindre un total de 5,6 milliards de machines, contre 1,6 milliard aujourd’hui ! Cette flambée pourrait provoquer ce que l’AIE appelle un « cold crunch », un choc du froid : si rien n’est fait, la consommation d’énergie pour faire fonctionner les climatiseurs pourrait tripler d’ici à 2050. À ce niveau d’équipement, et si rien n’est fait, l’électricité nécessaire pour faire tourner ces équipements pourrait atteindre l’équivalent de la consommation actuelle de la Chine. Quant aux émissions de dioxyde de carbone dues à la climatisation, elles pourraient quasiment doubler d’ici à 2050 avec un milliard de tonnes supplémentaires – soit le volume de ce gaz rejeté chaque année par l’Afrique… »
Alors, bien sûr actuellement les équipements utilisés dans le monde sont peu performants et probablement que la technique pourra améliorer le rendement énergétique de ces appareils.
Mais globalement nous sommes confrontés à un problème technique de la conservation de l’énergie qui fait que si vous voulez refroidir un endroit vous allez en réchauffer un autre.
Il apparait clairement que la climatisation n’est pas la solution.
Une des solutions serait de créer des villes végétalisées..
Et aussi de rénover ou de construire des bâtiments qui deviennent ou soient thermiquement isolés.
Ces solutions ne sont pas individualistes et ne sont pas à court terme.
<1105>
-
Vendredi 7 septembre 2018
« Meine Zeit wird kommen » (Mon temps viendra) »Gustav MahlerBernstein fut un formidable interprète de Mahler. Mais sa relation avec Mahler fut bien plus profonde. Et il me paraît naturel de finir cette série sur Léonard Bernstein en associant ces deux noms : «Gustav Mahler» et «Léonard Bernstein».

Ils ont tellement de points communs…
Et le premier étant évidemment qu’ils étaient tous deux d’exceptionnels chefs d’orchestre reconnus parmi les plus grands par tous les critiques et musiciens et qu’en parallèle ils étaient compositeurs et voulaient avant tout s’imposer comme tel, et que dans ce domaine les critiques étaient beaucoup moins favorables.
Mahler, comme musicien juif fut banni totalement des concerts dans le monde nazi donc à Berlin et à Vienne, et cet ostracisme continua bien au-delà de la fin officielle du nazisme.
Dans le reste du monde, entre sa mort en 1911 et les années 1960, il n’était pratiquement pas joué. Seul son disciple Bruno Walter, et quelques grands chefs comme Otto Klemperer ou Jasha Horenstein parvinrent parfois à imposer aux responsables des salles de concert une de ses symphonies. Il y avait une exception aux Pays-Bas avec l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam et Willem Mengelberg.
Peu avant de mourir, Gustav Mahler avait eu cette phrase en parlant de son œuvre de compositeur : « Mon temps viendra ! »
Une statistique récente a montré que le compositeur le plus souvent joué de nos jours, par les plus grands orchestres symphoniques, est Gustav Mahler.
Gustav Mahler avait donc raison, son temps allait venir et il est venu.
Et je fais le pari que le compositeur Bernstein poursuivra une trajectoire parallèle et que son temps viendra aussi et qu’il est déjà en train de venir comme le prouve le succès de son œuvre « Mass » qui n’avait plus été joué pendant de nombreuses années et dont on redécouvre aujourd’hui l’incroyable richesse et beauté.
Bernstein ne fut pas le seul à défendre l’œuvre de Mahler dans les années 1960, mais il fut le premier qui enregistra toutes les symphonies de Mahler avec son Orchestre Philharmonique de New York de 1960 à 1967 pour CBS.
Un autre évènement donna une grande notoriété à Mahler ce fut « Mort à Venise » de Lucchino Visconti qui débute avec l’adagietto de la 5ème symphonie de Mahler.
Vous trouverez derrière <Ce lien> ce morceau interprété par Bernstein avec l’Orchestre Philharmonique de Vienne.
Mais si on creuse un peu on peut déceler bien d’autres points communs entre Bernstein et Mahler.
Tous les deux étaient juifs.
Les parents de Léonard Bernstein, des juifs ukrainiens débarquent à Ellis Island au même moment que Gustav Mahler, un peu avant 1910.
Car Gustav Mahler après avoir révolutionné la musique à Vienne et s’être fait quelques ennemis est venu à New York diriger au Metropolitan Opéra un peu avant de mourir. Bernstein a fait le chemin inverse révolutionnant d’abord la musique à New York avec le philharmonique de New York avant de venir briller à Vienne avec l’Orchestre Philharmonique de Vienne, l’orchestre que Mahler avait amené vers des sommets de qualité inconnus, au début du XXème siècle.
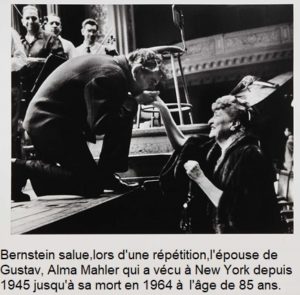 Quand Bernstein débarque en 1966 à Vienne, le Philharmonique n’avait plus joué Mahler depuis l’Anschluss en 1938. Les archives de l’Orchestre Philharmonique de Vienne sont désormais ouvertes, on sait qu’avant l’anschluss une proportion importante de musiciens de l’orchestre avaient adhéré au Parti Nazi autrichien, alors qu’il était officiellement interdit à ce moment. Une fois les nazis au pouvoir, les juifs sont chassés de l’orchestre et les nazis deviennent largement majoritaires. Après la guerre, il n’y eut quasi aucune épuration en Autriche ni à l’Orchestre. Dans ce dernier cas c’était pour préserver la fameuse tradition viennoise ce qui a eu pour conséquence aussi de préserver « la tradition antisémite ».
Quand Bernstein débarque en 1966 à Vienne, le Philharmonique n’avait plus joué Mahler depuis l’Anschluss en 1938. Les archives de l’Orchestre Philharmonique de Vienne sont désormais ouvertes, on sait qu’avant l’anschluss une proportion importante de musiciens de l’orchestre avaient adhéré au Parti Nazi autrichien, alors qu’il était officiellement interdit à ce moment. Une fois les nazis au pouvoir, les juifs sont chassés de l’orchestre et les nazis deviennent largement majoritaires. Après la guerre, il n’y eut quasi aucune épuration en Autriche ni à l’Orchestre. Dans ce dernier cas c’était pour préserver la fameuse tradition viennoise ce qui a eu pour conséquence aussi de préserver « la tradition antisémite ».
C’est dans cette atmosphère hostile que Bernstein est venu à Vienne surmonter les réticences et même les haines pour refaire de l’Orchestre Philharmonique de Vienne un orchestre mahlérien. Il a entendu, lors des premières répétitions des musiciens dirent à voix basse « musique de merde ».
Il va affronter les démons, les vrais, les nazis cachés dans les replis de l’histoire. Il va les débusquer avec son sourire, son énergie et sa formidable intelligence de l’autre, et il va les faire plier par amour de la musique.
Il va les convaincre que Mahler fait partie de leur tradition et que c’est une trahison de ne plus le jouer.
Il va en résulter des concerts, des disques, des vidéos qui sont autant de réussites et de diamants éternels.
Et Bernstein au bout de son combat victorieux a pu déclarer :
« La ville est si belle et si pleine de traditions. Tout le monde ici vit pour la musique, en particulier l’opéra, et je semble être le nouveau héros. Ce qu’ils appellent « la vague de Bernstein » qui a submergé Vienne et produit un étrange résultat ; tout à coup, il est à la mode d’être juif.. »
Tout ceci est développé dans cette remarquable émission de France Musique : <Léonard Bernstein : A nous deux Vienne !>
Mahler et Bernstein avait aussi en commun un goût pour l’humour noir, le théâtre, le folklore…
Dans l’œuvre des deux compositeurs on retrouve la même fascination pour l’innocence de l’enfance la même obsession du paradis qu’il soit terrestre ou céleste. Léonard Bernstein dans une des émissions consacrées à Mahler a dit :
« Quand Mahler est triste, il est dans une détresse totale, rien ne peut le réconforter, c’est comme un enfant qui pleure. Et quand il est heureux il est heureux comme un enfant sans retenue. C’est là une des clefs de l’énigme Mahler, il est comme un enfant ! »
Et il signifie ainsi que lui était probablement aussi comme cela.
Renaud Machart a écrit dans sa biographie de Bernstein :
« Bernstein s’est identifié de manière quasi obsessionnelle à Gustav Mahler. Les raisons de cette identification sont multiples […]
L’identification quasi gémellaire que Bernstein ressentait quand il dirigeait la musique de Mahler est frappante dans la plupart de ses déclarations orales ou écrites. Au risque de faire sourire certains, il n’hésitait pas à dire, en ces moments d’exaltation dont il était coutumier, qu’il se sentait comme la réincarnation du Viennois »
Page 106-107
En plus d’être un formidable interprète de Mahler, il revenait à ses talents de pédagogue pour parler de Mahler et le défendre avec des mots.
Dans son émission « Young People’s Concerts » l’une d’entre elle a pour titre : « Qui était Gustav Mahler ? » et vous pouvez la voir sur le site d’ARTE jusqu’au 25 novembre 2018.
Il a enregistré d’autres vidéos où il fait partager sa passion pour Gustav Mahler comme ce dvd : « the Little Drummer Boy: An Essay on Gustav Mahler by and With Leonard Bernstein »
Lui qui disait : « On ne vend pas la musique, on la partage »
France Musique a également consacré une émission passionnante sur cette relation entre un génie mort en 1911 et un autre né en 1918 : <Léonard Bernstein : Une vie avec Mahler>
Je ne résiste pas à vous donner aussi ce lien vers le final de la 2ème symphonie « Résurrection » qu’il dirige à Londres dans un moment d’extase.
Bernstein s’est fait inhumer avec une copie de poche de la partition de la 5e symphonie de Mahler et aussi un exemplaire du conte Alice au pays des merveilles !
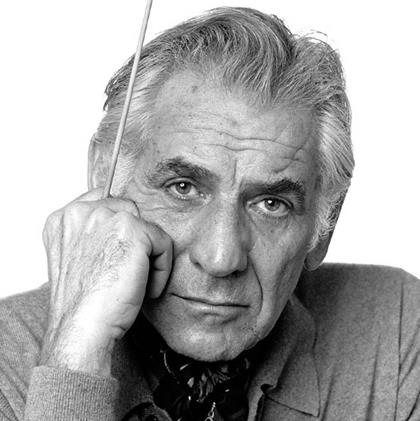
<1104>
-
Jeudi 6 septembre 2018
« Un petit démon »Léonard Bernstein parlant de sa sexualitéC’est dans le documentaire diffusé par ARTE et que j’ai évoqué lundi, que j’ai appris que Bernstein avait eu cette expression en parlant de lui.
Dans le documentaire, ce propos est d’ailleurs ambigüe car un auditeur non averti pourrait penser qu’il parle de son homosexualité, voire de sa bisexualité parce qu’il était question de cela au moment où cette phrase a été rapportée.
Il n’en n’est rien, Bernstein assumait son homosexualité.
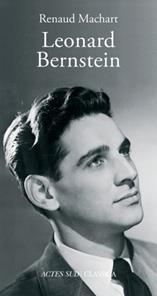 Je n’ai lu qu’une fois explicitement, dans un article français, la réalité qui se cachait derrière cette expression « un petit démon ». Peut-être que la biographie anglaise, non traduite en français, de Meryle Secrest : « Leonard Bernstein, a life » est plus explicite, mais dans la biographie française qui fait autorité, celle de Renaud Machart chez « Actes Sud » le sujet est abordé de manière très elliptique dans un petit paragraphe à la page 17 d’un ouvrage qui en comporte plus de 200 :
Je n’ai lu qu’une fois explicitement, dans un article français, la réalité qui se cachait derrière cette expression « un petit démon ». Peut-être que la biographie anglaise, non traduite en français, de Meryle Secrest : « Leonard Bernstein, a life » est plus explicite, mais dans la biographie française qui fait autorité, celle de Renaud Machart chez « Actes Sud » le sujet est abordé de manière très elliptique dans un petit paragraphe à la page 17 d’un ouvrage qui en comporte plus de 200 :
« Il y eut, toujours, le goût des hommes, qu’il n’a jamais caché alentour et à sa femme Felicia, d’une grande beauté et d’une fine élégance, avec laquelle il allait former en 1951, l’un des couples les plus sémillants d’Amérique. Le musicien était véritablement attaché à sa famille et à ses trois enfants, Jamie, Alexander et Nina. Il lui fallait sûrement, pour accepter vraiment cette manière de mise sous surveillance de sa propre liberté, des échappées vers l’autre part de lui-même. Décrit par beaucoup comme un prédateur sexuel, celui qui n’hésitait pas à parler aux musiciens de « battement pelvien », voulait aussi être père poule […]
Tous ceux qui l’ont connu parlent de l’énergie incroyable de l’homme, de sa présence physique. Bernstein donnait l’accolade mais plus souvent embrassait volontiers sur la bouche, femmes comme hommes. Sa réaction au moindre soupçon de résistance était d’embrasser encore plus fort, écrit le critique John Rockwell. »
Il faut être attentif, au détour d’une phrase il est possible de comprendre. Dans le mot du jour de lundi, je citais un journaliste dans le magazine Diapason de juillet/août 2018, qui parle de sa culpabilité après la mort de son épouse et ajoute :
« Rien ne l’apaise. Le monde est plein de jolis garçons qu’il consomme sans respirer… ».
Alors tout cela est noyé dans un discours exalté et enthousiaste :
« Diriger c’est comme faire l’amour : nous tous, moi au pupitre, les musiciens et les chanteurs à leur place, nous faisons l’amour chaque fois que nous jouons. Mes musiciens sont mes amants. J’en ai beaucoup c’est vrai… Mille amants en même temps ! »
Magazine Répertoire de septembre 1998, page 13
Evidemment que ce discours représente une réalité virtuelle, un monde de rêves et d’images.
Le problème est que dans ce domaine, Leonard Bernstein ne savait pas faire la part du virtuel et de la réalité. Il était donc un consommateur compulsif de jeunes et beaux hommes rencontrés dans les orchestres, sur les scènes de spectacle. Bien sûr il était si charismatique, si beau, si séducteur, si convaincant que personne ne lui résistait. Pouvons-nous en être si sûrs, qu’ils étaient tous consentants ?
La raison et l’expérience doivent nous contraindre à répondre non. Mais personne ne résistait à Leonard Bernstein.
Aujourd’hui, il est probable qu’un tel comportement ne serait plus possible et il aurait de gros ennuis.
Après l’affaire Weinstein, le monde de la musique classique a été éclaboussé, des chefs d’orchestre très connus ont été mis en cause.
L’opéra de New York, le Metropolitan Opera, a suspendu son chef d’orchestre historique, James Levine, car plusieurs hommes, dont certains étaient mineurs au moment des faits, l’ont accusé de harcèlement et de viol.
Norman Lebrecht est un écrivain, et critique d’art, il a écrit un article : < Did Leonard Bernstein have a James Levine problem ?>, « Leonard Bernstein avait-il un problème du même type que James Levine ? »
Après avoir accepté d’écrire que Bernstein a certainement poursuivi des jeunes hommes toute sa vie d’adulte, il arrive à la conclusion que toute ressemblance entre Levine et Bernstein est purement superficielle et la raison qu’il donne est que la différence entre Bernstein et Levine est que Bernstein était, pour la plus grande partie de sa vie, physiquement attrayant et intellectuellement convaincant.
Certes Leonard Bernstein était nettement plus séduisant et beau que James Levine. Mais on peut ne pas vouloir accepter les avances sexuelles même de quelqu’un de beau et on peut même ne pas désirer avoir des relations homosexuelles quand on est hétéro sexuel et je m’empresse d’écrire que le contraire est tout aussi vrai.
Le site de France Musique est revenu sur l’affaire Levine et a aussi évoqué des sujets de harcèlement dans le monde musique suédois et plutôt que de suivre les arguments de Norman Lebrecht je préfère le constat de Sofi Jeannin qui avance le problème du « culte du génie » pour lequel « on excuse encore des comportements et des excès »
Tout ceci n’enlève pas le talent, la magie de ses interprétations et le génie d’une grande part de ses œuvres, ainsi que la part d’humanisme qu’il portait et défendait.
Cela conduit à constater la complexité du personnage et ne pas occulter sa part d’ombre.
<1103>
-
Mercredi 5 septembre 2018
« Grâce à [la musique], nous pouvons encore nous sentir unis et, j’en suis sûr, si nous voulons vraiment être des hommes, il est indispensable que nous soyons unis »Léonard Bernstein.Léonard Bernstein était un humaniste, un progressiste, un homme de paix.
Dans le magazine « Répertoire des disques compacts » de septembre 1998 on lit ces propos de Lenny :
« La musique, l’art en général, est le seul langage humain qui permette à l’homme de se retrouver non seulement comme individu, mais aussi et surtout comme un être humain qui vit et qui doit vivre dans la fraternité de ses semblables. La musique est le langage le plus profond de l’homme. Grâce à elle, nous pouvons encore nous sentir unis et, j’en suis sûr, si nous voulons vraiment être des hommes, il est indispensable que nous soyons unis ».
Dans ce même journal on apprend que Léonard Bernstein songeait à écrire un grand opéra dramatique sur la shoah qui devait représenter l’histoire des cinquante dernières années, à partir de la deuxième Guerre Mondiale, et mettre en scène en plusieurs langues , divers lieux et villes désolés par la barbarie nazie, mais aussi insuffler l’espérance d’un monde meilleur :
« Nous devons édifier un monde nouveau et il ne suffit pas pour cela de détruire l’ancien : il faut réussir à améliorer ce monde ci et nous devons tous contribuer à cet effort. […] J’éprouve un grand soulagement quand je vois s’effondrer un régime totalitaire et le pouvoir de ces dictateurs qui privent un peuple de sa liberté en se camouflant derrière de nobles idéaux et de bonnes intentions.»
Il dénonce le maccarthysme, cette chasse à l’homme menée par les autorités américaines dans les années 1950 contre tous ceux qu’elles soupçonnaient d’être communistes, dans son opérette « Candide » selon le texte de Voltaire.
Bernstein désapprouve ouvertement la guerre engagée par les États-Unis au Vietnam, soutient l’intégration des minorités ainsi que le mouvement des droits civiques.
L’humanisme et l’engagement de Bernstein inquiètent les services de renseignement intérieur. Aujourd’hui, on sait que le dossier que le FBI possédait contre lui comptait plus de 650 pages.
Vous pouvez écouter la journaliste Nathalie Moller raconter cette histoire en 5 minutes.
Ou encore lire cette page sur le site de France Musique <Pourquoi Leonard Bernstein était-il surveillé par le FBI ?>
J’en tire les extraits suivants :
« En 1951, le nom de Bernstein apparaît pour la première fois dans le Security Index, la fameuse liste des personnes jugées dangereuses par les services de renseignement américains. Deux ans plus tard, le compositeur se voit refuser le renouvellement de son passeport et frôle même la détention…
Pour récupérer son passeport, Bernstein doit jurer sur l’honneur qu’il ne fait pas et n’a jamais fait partie d’une quelconque organisation communiste. Voilà notre compositeur pris au piège de la folie maccarthyste et victime de la ‘chasse aux sorcières’.
Autre engagement, autre fait qui dérange. Le 14 janvier 1970, Bernstein et sa femme Félicia organisent une soirée de soutien aux Black Panthers, un mouvement afro-américain qui, du fait de son caractère révolutionnaire, a été désigné comme principale menace pour la sécurité intérieure par John Edgar Hoover, le directeur du FBI. A ses yeux, Bernstein cumule les provocations… »
Et puis il y a l’épisode de « Mass » dont nous avons déjà parlé. Nous savons donc que Jacqueline Kennedy avait commandé à son ami ‘Lenny’ une œuvre pour l’inauguration du Kennedy Center of Performing Arts, un lieu de culture ainsi nommé en hommage à son défunt mari, le président John F. Kennedy.
Pour écrire cette œuvre, Bernstein demande l’aide d’un prêtre catholique, Philip Berrigan. Un choix qui lui coûtera bien cher… Car Philip Berrigan est un militant pacifiste particulièrement actif, farouchement opposé à la guerre du Viet Nam et qui, entre deux allers-retours en prison, subit lui aussi la surveillance accrue du FBI. Berrigan et Bernstein réunis ? Il n’en faut pas plus pour rendre le FBI parano.
Et si Bernstein avait glissé des messages anti-gouvernementaux dans son texte latin ? Et s’il avait demandé à ses interprètes d’injurier le président Nixon en plein spectacle ? Réunion de crise à la Maison Blanche : Richard Nixon ne doit pas assister au concert, et il serait bien qu’une critique négative de l’œuvre soit publiée dès le lendemain, dans le New York Times.
La mauvaise critique sera publiée, le président Nixon ne viendra pas à la cérémonie.
Dans l’émission de France Musique : <Léonard Bernstein, radical chic. Vraiment ?> Vous entendrez un enregistrement de Nixon et de ses conseillers qui discutent de cet évènement avant qu’il n’ait lieu. Vous remarquerez la vulgarité de Nixon qui n’a rien à envier à celle de Donald Trump.
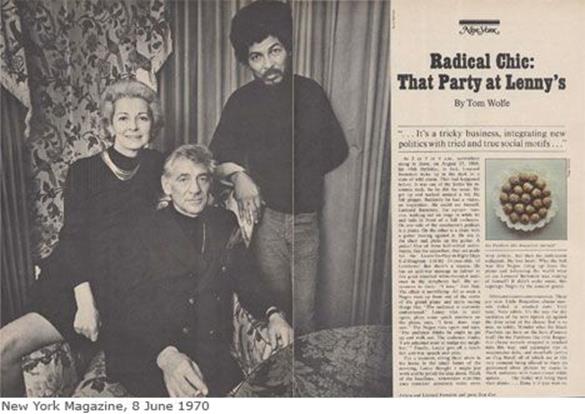 Radical chic renvoie vers un évènement et un article de journal qui affecteront beaucoup Bernstein et son épouse.
Radical chic renvoie vers un évènement et un article de journal qui affecteront beaucoup Bernstein et son épouse.
Nous avons évoqué la soirée de soutien aux Black Panthers organisé par les Bernstein dans leur appartement de New York
« Radical chic », par ces mots le journaliste Tom Wolfe qualifiait Bernstein dans un article publié dans les colonnes du New York Magazine en juin 1970. Article venimeux et accusateur qui allait faire beaucoup de mal à Lenny et à son entourage…
Juin 1970, en pleine révolution des Black Panthers, guerre du Vietnam et assassinats des Kennedy et Martin Luther King, le journaliste et écrivain Tom Wolfe publie un article sur Bernstein intitulé Radical Chic : That Party at Lenny ‘s. Le jeune journaliste se paye, le grand chef international, le compositeur national et le grand bourgeois parvenu qui se revendique homme de gauche Leonard Bernstein. Un texte archi brillant mais venimeux dont l’impact a été dramatique.
Lenny dupe de ses bons sentiments affirme Wolfe. Rappelons que Tom Wolfe, mort en 2018 n’est pas que célèbre en raison de cet article, mais aussi parce qu’il est l’auteur du «bûcher des vanités.».
La fille de Bernstein, Jamie, révèle :
« C’est un texte très bien écrit, c’est très malin, très ironique, c’est un très bon écrivain, mais il causé des dommages incalculables à ma famille. Il ne s’est pas rendu compte à quel point il avait pu faire du mal. »
Et je finirai ce mot consacré à l’humanisme et aux combats politiques de Bernstein par son hymne à la liberté qu’il imposa en changeant, dans l’ode à la joie de Schiller qui finit la neuvième symphonie de Beethoven, le mot « Freude » c’est-à-dire « joie » par le mot « Freiheit » qui signifie en allemand « Liberté ».
La chute du mur de Berlin le 9 Novembre 1989 moins d’un an avant sa mort lui donna beaucoup de joie et un immense espoir. :
« Je vis un moment historique, incomparable avec tous les autres de ma longue, longue existence »
Bernstein accepta spontanément l’invitation à diriger deux représentations de la 9e symphonie de Beethoven, pour célébrer la liberté. Deux concerts, chacun ayant lieu dans une partie de la ville divisée pendant 28 années : à la Philharmonie de Berlin Ouest le 23 Décembre, et Berlin Est le 25 Décembre 1989. Il apparût naturel que la liberté nouvelle de l’Allemagne de l’Est soit célébrée par cette symphonie.
« Je suis sûr que Beethoven nous aurait donné sa bénédiction. »
Ajouta-t-il.
A cette occasion, Léonard Bernstein, conduisit un orchestre et chœur composés de musiciens venant des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de France, et de l’Union soviétique.
L’orchestre de la radio bavaroise et son chœur fut ainsi rejoint par le London Symphony, le New York Philharmonic, l’Orchestre de Paris, le Staatskapelle Dresden, l’Orchestre du Théâtre Kirov à Stalingrad …
<Vous trouverez la vidéo d’un de ces concerts derrière ce lien>
Un disque existe aussi
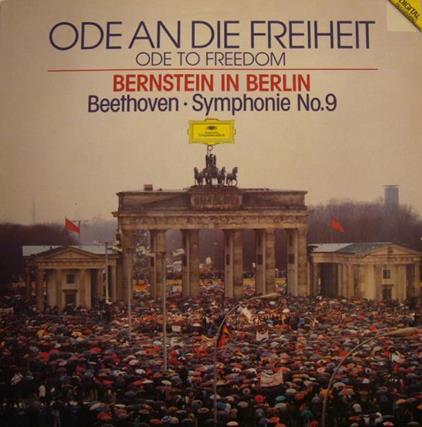
<1102>
-
Mardi 4 septembre 2018
«En apprenant aux autres, j’apprends d’eux»Leonard BernsteinBernstein était interprète et compositeur, mais c’était surtout un exceptionnel pédagogue.
ARTE a diffusé plusieurs épisodes tirés de l’émission emblématique : « Young People Concerts » :
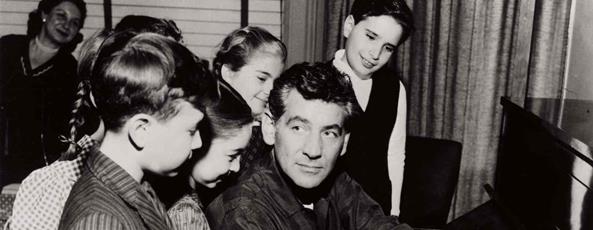 Deux semaines après sa nomination en tant que directeur musical de la Philharmonie de New-York, Bernstein enregistre son premier concert des Jeunes le 18 Janvier 1958.Cette tradition existait avant sa venue, mais c’est grâce à son talent que cette émission va connaître un immense succès et qu’aujourd’hui encore on les rediffuse pour en montrer la qualité et la richesse de l’enseignement produit.
Deux semaines après sa nomination en tant que directeur musical de la Philharmonie de New-York, Bernstein enregistre son premier concert des Jeunes le 18 Janvier 1958.Cette tradition existait avant sa venue, mais c’est grâce à son talent que cette émission va connaître un immense succès et qu’aujourd’hui encore on les rediffuse pour en montrer la qualité et la richesse de l’enseignement produit.
Entre la première émission qui eut lieu au Carnegie Hall de New York, jusque la dernière le 26 mars 1972 au Lincoln Center de New York 14 ans et 53 émissions ont passées.
Il s’agissait d’abord d’une leçon de musique réalisée dans une immense salle de concert remplie entièrement de jeunes et de leurs parents, avec l’Orchestre Philharmonique de New York. Séance diffusée en prime time sur une chaîne de grande écoute la CBS
Une de ces émissions que je vous recommande est consacrée au sujet suivant : <Les modes>
Il commence par expliquer ce qu’est le mode majeur et mineur puis il décline d’autres modes plus anciens :
- Le mode Dorien
- Le mode Phrygien
- Le mode Lydien
- Le mode Mixolydien
- Etc.
Et en illustrant ces différentes tonalités musicales par des morceaux classiques mais aussi des œuvres pop ou rock comme les Beatles ou Tandyn Almer, il rend ces théories compliquées très simples. Pour ce faire, il utilise termes simples, ludiques et accessibles à des publics profanes. Car Bernstein s’intéresse à tout : opéra, jazz, rock’n roll ou encore musiques latines. Il ne crée aucune hiérarchie entre les genres musicaux.
 Essayez, vous verrez qu’on apprend énormément à l’écouter, c’est un véritable voyage dans l’histoire de la musique.
Essayez, vous verrez qu’on apprend énormément à l’écouter, c’est un véritable voyage dans l’histoire de la musique.
Cette série de « leçons » a abordé des sujets comme qu’est-ce qu’une mélodie ? Que signifie la musique? Qu’est-ce que l’orchestration ?
Avant cette série d’émissions, il participa déjà en 1954 à une autre émission pédagogique appelée Omnibus. Jusqu’en 1961, Bernstein participa une dizaine de fois à Omnibus avec des sujets comme «Pourquoi un orchestre a besoin d’un chef?» ou «Pourquoi la musique moderne est-elle aussi étrange?». Libération avait en 1995 publié un article plein d’éloges sur ces émissions.
Arte a diffusé deux autres émissions des « Young People Concerts <Qui était Gustav Mahler ?> et <Un quiz musical>. Toutes ces émissions sont disponible jusque fin novembre 2018.
C’est dans le magazine « Classica » de novembre 2012 que j’ai trouvé l’exergue de ce mot du jour.
« Enseigner, c’est surtout avoir le don des mots pour le dire, le don de susciter le silence et l’empathie, donner envie d’en savoir plus. Ces qualités, que Bernstein possédait comme peu, seront immédiatement profitables à son métier de chef d’orchestre. D’ailleurs Bernstein considérait que diriger était une manière d’enseigner : « En apprenant aux autres, j’apprends d’eux », aimait-il à répéter. »
Léonard Bernstein prétendait que ses talents de pédagogue étaient un héritage de son père :
« J’ai soudain compris que mon instinct de pédagogue, j’en avais hérité de mon père et de tous mes professeurs qui m’ont appris comment on enseigne. Cet instinct presque rabbinique pour instruire, expliquer, formuler, trouvait un véritable paradis dans le monde électronique de la télévision. »
Dans l’entretien qu’il avait accordé à Judith Karp dans le magazine «Musiques» de septembre 1979, il était encore plus explicite :
«Je suis un enseignant. Un rabbin caché. Voilà pourquoi peut être je fais autant de gestes au pupitre. Je cherche désespérément à communiquer.»
France musique a consacré une émission à ce talent unique : <Leonard Bernstein et l’enseignement : l’histoire d’une vie>
<1101>
- Le mode Dorien
-
Lundi 3 septembre 2018
« Le déchirement d’un génie : Leonard Bernstein »Documentaire réalisé par Thomas von Steinaecker et présenté par ArteJ’ai écrit une introduction avant le sujet de ce mot du jour. Mais pour ne pas alourdir excessivement cet article, je l’ai finalement retirée et mise en commentaire.
 Le 25 août 1918, naissait à Lawrence, dans le Massachusetts (Etats-Unis), Léonard Bernstein dont on fête les 100 ans de la naissance. Or Léonard Bernstein est un personnage considérable du monde des arts et de la musique en particulier.
Le 25 août 1918, naissait à Lawrence, dans le Massachusetts (Etats-Unis), Léonard Bernstein dont on fête les 100 ans de la naissance. Or Léonard Bernstein est un personnage considérable du monde des arts et de la musique en particulier.
J’avais déjà consacré, un premier mot le 7 mai 2018 à Bernstein et à son œuvre éclectique, visionnaire et géniale : « Mass »(1)
Lors de ce mot du jour, j’annonçais :
« C’était un homme charismatique, plein de fougue et d’excès, j’y reviendrai dans un mot du jour ultérieur, plus proche de sa date anniversaire. »
Je vais donc respecter cette promesse et évoquer cet homme talentueux, séducteur, pédagogue, humaniste et possédant aussi sa part d’ombre. Cela m’occupera toute cette semaine.
La grande cantatrice allemande Christa Ludwig qui a beaucoup travaillé avec le musicien, comme avec Herbert von Karajan a dit en toute simplicité :
«Léonard Bernstein ne faisait pas de la musique, il était la musique!»
(Propos rapportés par le Figaro du 18 mars 2018)
Et elle ajoutait :
« On estimait Karajan, on aimait Bernstein »
Car en effet si Karajan et Bernstein ont souvent été comparés, seul Bernstein avait cette dimension que Karajan ne possédait pas : il était compositeur.
Et Bernstein a aussi tenté et souvent réalisé d’aimer toutes les musiques. Finalement la seule musique qu’il a vraiment rejetée fut la « musique classique contemporaine atonale », c’est-à-dire celle dont Pierre Boulez était le chantre comme Karl Heinz Stockhausen.
Celles et ceux que je connais et qui lisent ce blog me semblent en phase avec cette vision de Bernstein de préférer les Beatles, les Pink Floyd à Stockhausen, Nono et consorts.
Il disait lui-même :
« J’éprouve beaucoup plus de plaisir à suivre les aventures musicales de Simon et Garfunkel ou du groupe qui chante « Along Comes Mary » qu’à écouter la majorité des œuvres de la communauté des compositeurs d’avant-garde »
Beaucoup d’articles et d’émissions de télévision ont été consacrés à Léonard Bernstein ces dernières semaines.
France musique lui a consacré de nombreuses émissions et notamment une série <Un été avec Bernstein> réalisée par Emmanuelle Franc que j’ai écouté intégralement.
Cependant, pour ce premier article, je vais surtout faire référence à un documentaire diffusé par Arte et que vous pourrez visualiser jusqu’au 16/11/2018 derrière ce lien <Le déchirement d’un génie>.
C’est d’ailleurs le titre de ce documentaire que j’ai choisi comme exergue de ce premier article. Ce documentaire fait notamment intervenir les 3 enfants de Léonard Bernstein.
Avant d’en venir à l’explication de ce déchirement qui se situe selon moi à deux niveaux, quelques mots sur le début de la carrière du musicien.
Il n’est pas né dans une famille de musicien. Et Sam Bernstein, son père a même voulu empêcher son fils de devenir musicien, il souhaitait qu’il devienne rabbin. Léonard négocie : il pourrait devenir professeur de musique et entrer à Harvard. C’est d’ailleurs là qu’il fait ses premières grandes rencontres, avec Aaron Copland et Dimitri Mitropoulos. Le jeune homme fait ses humanités et passe ses nuits à animer les fêtes en jouant du boogie woogie !
Vous trouverez plus de précisions dans cette émission de France Musique : <Les débuts de Léonard Bernstein : Un étudiant brillant, forcément brillant !>.
L’Histoire raconte que tout commença à l’âge de 10 ans avec le piano de la tante Clara :
« Et puis un beau jour, l’année de mes 10 ans, ma tante Clara a dû quitter Boston où nous habitions. Elle ne savait pas quoi faire de quelques meubles encombrants parmi lesquels un énorme piano droit sculpté. On l’a donc entreposé chez nous avec des chaises rembourrées. Je l’ai vu, j’en suis tombé éperdument amoureux et je le suis toujours. »
10 ans c’est tard pour devenir un virtuose mais Léonard ou Lenny, comme tout le monde l’appelle, mis les bouchées doubles : il était talentueux et il travailla beaucoup et devint rapidement un incroyable musicien remarqué par des grands chefs d’orchestre installés aux Etats-Unis, tous d’origine européenne. Car ceci a une grande importance, Léonard Bernstein devint le premier grand chef d’orchestre né américain.
Il travailla beaucoup et su embrasser les opportunités notamment une qu’il raconte lui-même :
« J’étais sur le point de me noyer [au sens figuré, il n’avait pas de ressources] ce 25 août lorsque je reçu un appel téléphonique […] d’Artur Rozinski que je n’avais jamais rencontré. […] C’était un chef d’orchestre célèbre […] il me demanda de venir le voir. ».
Il se rend donc dans une ferme à Stockbridge où résidait Rozinski :
« Il m’entraîna vers une meule de foin où nous nous assîmes et me dit « comme vous le savez (je n’en savais rien) je viens d’être nommé directeur du Philharmonique de New York [et ajouta] j’ai besoin d’un chef assistant. Je ne suis pas sûr de mon choix. Alors j’ai demandé à Dieu qui je devais choisir et Dieu a dit : prenez Bernstein ! Aussi vous au-je appelé. Prenez-vous le job ? »
Authentique !
Donc Bernstein accepta et explique que son « Job » consistait à étudier les partitions et à se trouver prêt pour le cas où Rodzinski ou un chef invité serait dans l’incapacité de diriger pour les remplacer en répétitions ou au concert.
Bref une doublure. Bien sûr cela n’arrive quasi jamais :
« Je crois que pendant quinze ans, personne n’est jamais tombé malade à New York. »
Mais Bernstein étudiait toutes les partitions. Et un jour Bruno Walter, l’un des plus grands chefs de l’Histoire de la musique est tombé malade et Rodzinski n’avait pas la disponibilité de le remplacer ce fut donc à Bernstein de le faire.
Voici ce qu’on peut lire à ce propos :
« Or, le 14 Novembre 1943, le chef d’orchestre Bruno Walter qui doit assurer le concert tombe malade. C’est au tour de Lenny de jouer l’après-midi même. Il n’a pas le temps de répéter, il n’a jamais dirigé ce programme. Tétanisé, il passe au Drugstore en face du Carnegie Hall prendre un café. Il explique au pharmacien pourquoi il se sent si mal. Celui-ci lui donne une pilule pour avoir de l’énergie, une autre pour être calme… »
J’ai mis les deux pilules dans ma poche et je me souviens qu’avant de monter sur scène, je les ai prises et je les ai jetées aussi loin que j’ai pu à l’autre bout des coulisses du Carnegie Hall. Et j’y suis allé. Je ne me souviens de rien entre ce moment et la fin du concert. »
Pour en savoir plus sur ces débuts, écoutez l’émission de France musique : <Léonard Bernstein : De
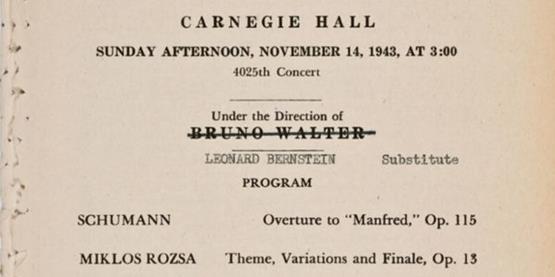 la vie de bohème au miracle >
la vie de bohème au miracle >
Vous trouverez aussi sur le site de France Musique une copie de l’affiche de ce concert avec le nom de Bruno Walter barré et celui de Léonard Bernstein rajouté.
Ce n’est que le haut de l’affiche, car le morceau essentiel de ce concert était une partition horriblement difficile : Le Don Quichotte de Richard Strauss.
Ce fut un triomphe !
Et pour en savoir plus sur la rivalité et aussi le respect mutuel entre ces deux artistes vous pourrez écouter l’émission sur France Musique : <Léonard Bernstein et Herbert von Karajan : le duel>
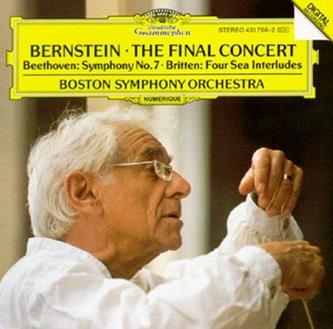 Mais revenons au « déchirement ».
Mais revenons au « déchirement ».
Le premier déchirement que Bernstein connut était celui d’être à la fois interprète et compositeur. Par raison et pour la postérité, il voulait surtout être compositeur.
Mais dans le documentaire d’Arte, sa fille Jamie dit « La direction était une véritable drogue pour lui !»
Bernstein explique lui-même que la composition est un exercice dur et solitaire, la récompense vient souvent très tard et parfois même pas du tout. Alors que l’interprétation est un exercice que l’on réalise en équipe et la récompense arrive beaucoup plus vite par les applaudissements du public.
Il a essayé plusieurs fois d’arrêter la direction pour se consacrer à la composition et chaque fois il a craqué. Quand finalement, notamment parce que son médecin lui a dit qu’il s’agissait d’une histoire de vie ou de mort il a décidé de faire son dernier concert à Boston le 19 août 1990, la vie ne lui a plus été accordée que pour quelques semaines, il est décédé le 14 octobre 1990.
Un disque a gardé le témoignage sonore de ce dernier moment d’extase.
La reconnaissance du public, des critiques et du monde musical était aussi particulièrement déséquilibrée : Des concerts de louange pour l’interprète, un scepticisme peu bienveillant, voire une hostilité manifeste à l’égard du compositeur, sauf pour les œuvres qu’il a écrite pour Broadway et notamment <West Side Story>, bien entendu.
Et nous arrivons eu second déchirement : sa bisexualité.
Il a des amours homosexuels depuis sa jeunesse mais il rencontre la belle actrice chilienne née à Costa Rica : Félicia Montaleagre en 1946, ils se marient en 1951 et auront 3 enfants.
 En 1951, quelques mois seulement après leur mariage, Félicia écrit à Lenny :
En 1951, quelques mois seulement après leur mariage, Félicia écrit à Lenny :
« Tu es homosexuel et cela ne changera sans doute jamais […] Je suis prête à t’accepter tel que tu es […] car je t’aime passionnément ».
C’est une relation assez unique et une hauteur d’âme de la part de Felicia remarquable à une époque où l’homosexualité était encore peu admise. Et Félicia écrit aussi :
« Notre mariage n’est pas fondé sur la passion mais sur une tendresse et un respect mutuel ».
Et Lenny écrit en 1957 :
« Les principales nouvelles c’est que je t’aime et que tu me manques, plus que je n’aurai jamais su »
Pendant 25 années l’épouse a toléré les relations extra-conjugales de son mari tant que celles-ci « restent discrètes ».
Et puis voici la fin de l’Histoire telle que la relate le magazine Diapason de juillet/août 2018 :
« Quand après un quart de siècle et trois enfants, ressurgit le dieu primordial sous les traits du jeune musicologue Tom Cothran, l’ogre jamais rassasié abandonne le domicile conjugal. Quelques mois plus tard, Felicia tombe malade. Cancer du poumon. Lenny lâche Tom et rentre à la maison, où Felicia s’éteint le 16 juin 1978. Il ne dort plus : tout est de sa faute. Dieu l’a puni. Whisky, médicaments, rien ne l’apaise. Le monde est plein de jolis garçons qu’il consomme sans respirer… ».
« de jolis garçons qu’il consomme sans respirer », je reviendrai sur cette addiction jeudi.
Il ne cessera cependant de parler et d’évoquer son épouse pendant les 14 ans qui lui restent à vivre.
Il lui dédiera des œuvres ou des interprétations comme ce Requiem de Mozart du 6 juillet 1988 qui a été enregistré par DG et dont vous trouverez la version vidéo sur cette page de la Philharmonie de Paris ainsi qu’un commentaire qui exprime l’émotion de cette interprétation
(1) Depuis que j’ai écrit le mot sur « Mass> J’ai trouvé sur Youtube, une version théâtrale jouée par des artistes de l’Université de Yale.
<1100>
-
Vendredi 29 juin 2018
« Éduque-la à la différence. Fais de la différence une chose ordinaire. Fais de la différence une chose normale. »Chimamanda Ngozi Adichie, conseil pour une jeune fille qui doit affronter un monde encore largement dominé par les hommesJ’ai entendu parler d’elle en janvier 2018 parce qu’elle avait été invitée par le Ministère des Affaires étrangères pour être la marraine de la troisième édition de la Nuit des idées, sur le thème « L’imagination au pouvoir » et que pour cette raison elle avait été invitée par plusieurs radios.
 Une vidéo montre son intervention lors de cet évènement.
Une vidéo montre son intervention lors de cet évènement.
Le Point avait titré à cette occasion : «Chimamanda Ngozi Adichie enflamme le Quai d’Orsay»
Je lui avais consacré le mot du jour du <Vendredi 26 janvier 2018> qui portait pour exergue : « Nous devrions tous être féministes ! »
Et elle avait enthousiasmé Annie qui a acheté plusieurs de ses livres.
Et surtout un livre.
Elle l’a acheté plusieurs fois, parce qu’entre-temps elle l’offrait à des personnes qui lui rendait visite.
Ce livre, paru en mars 2017, Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe est une lettre en réponse à son amie Ijeawele, qui lui demandait conseil afin d’offrir à sa nouvelle-née une éducation féministe. Chimamanda Ngozi Adichie lui fait des propositions pour éduquer sa fille pour qu’elle soit féministe, féminine, humaniste et pleine de confiance.
C’est un livre qui n’a qu’une soixantaine de pages, mais la qualité et la profondeur d’un message n’a que peu à voir avec la quantité de mots et de phrases utilisés.
Après avoir simplement rappelé que :
«C’est magnifique ce que tu as fait là, mettre un être humain au monde. »
Puis lui avoir adressé quelques mots d’affection, elle débute les recommandations :
« Je n’ai pas de règles gravées dans le marbre. Ce que j’ai de plus proche d’une recette, ce sont mes deux «outils féministes » et c’est ce que je te propose en guise de point de départ.
Le premier outil, c’est ton postulat de base, la conviction ferme et inébranlable sur laquelle tu te fondes. Quel est ce postulat ? Voici ce qui devrait être ton postulat féministe de base: je compte. Je compte autant. Pas «à condition que ». Pas «tant que». Je compte autant. Un point c’est tout.
Le second outil est une question : peut-on inverser une proposition X et obtenir le même résultat ?
Prenons un exemple : beaucoup de gens pensent que, pour une femme, réagir de façon féministe à l’infidélité de son mari implique de le quitter. Pourtant, selon moi, rester peut également être un choix féministe, en fonction du contexte. Admettons que Chudi couche avec une autre femme et que tu lui pardonnes, serait-ce la même chose si c’était toi qui couchais avec un autre homme ? Si la réponse Chère Ijeawele, est oui, alors ta décision de lui pardonner peut être un choix féministe, parce qu’il n’est pas déterminé par une inégalité de genre. Malheureusement, dans la plupart des mariages, la réalité est que la réponse sera bien souvent non, et ce pour une raison fondée sur le genre — cette idée absurde selon laquelle «les hommes sont ainsi» (ce qui signifie que l’on exige bien moins des hommes).
Et puis elle énumère toutes ses suggestions.
La première :
« Sois une personne pleine et entière. La maternité est un magnifique cadeau, mais ne te définis pas uniquement par le fait d’être mère. Sois une personne pleine et entière. Ce sera bon pour ton enfant. L’Américaine Marlene Sanders, pionnière du journalisme et première femme à couvrir la guerre au Vietnam (et qui avait elle-même un petit garçon), a un jour donné ce conseil à une consœur plus jeune : « Ne vous excusez jamais de travailler. Vous aimez ce que vous faites, et aimer ce que vous faites est un merveilleux cadeau à offrir à votre enfant. » Je trouve ce conseil extrêmement sage et émouvant. Tu n’es même pas obligée d’aimer ton travail ; tu peux te contenter d’apprécier ce que t’apporte ton travail : la confiance, le sentiment d’accomplissement que tu acquiers en étant active, en gagnant ta vie. »
« Accorde-toi le droit d’échouer. Une jeune mère ne sait pas forcément comment calmer un bébé qui pleure. Ne pars pas du principe que tu devrais tout savoir. Lis des livres, cherche sur Internet, demande à des parents plus expérimentés, ou essaie tout simplement en tâtonnant. Mais surtout, ne perds jamais de vue le fait de rester une personne pleine et entière. Accorde-toi du temps pour toi. Satisfaits tes propres besoins. »
Point important aussi, elle affirme l’idée de bannir l’idée du vocabulaire de l’aide :
« Quand nous disons que les pères aident, nous suggérons que s’occuper des enfants est un territoire appartenant aux mères, dans lequel les pères s’aventurent vaillamment. »
Quand un père s’occupe de son enfant, il s’occupe de son enfant et ce n’est que normal. En aucune manière il n’aide la mère.
Et je cite encore quelques conseils :
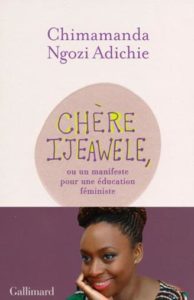
– « « Parce que tu es une fille » ne sera jamais une bonne raison pour quoi que ce soit. Jamais. »
– « Le bien-être des femmes ne doit jamais dépendre de la bienveillance des hommes. »
– « Apprends-lui à questionner les mots. Les mots sont les réceptacles de nos préjugés, de nos croyances et de nos présupposés. »
– « Apprends-lui à poser des questions comme celles-ci : quelles sont les choses que les femmes ne peuvent pas faire parce que ce sont des femmes ? Ces choses possèdent-elles un certain prestige dans notre société ? Si c’est le cas pourquoi seuls les hommes peuvent-ils faire ce qui a du prestige ? »
– « Apprends-lui à ne pas se soucier de plaire. Aucune fille ne devrait chercher à se rendre aimable mais toujours veiller à être pleinement elle-même, une personne sincère et consciente que les autres sont humains autant qu’elle. »
– « Apprends-lui à être sincère. Et bienveillante. Et courageuse. Encourage-la à exprimer ses opinions, à dire vraiment ce qu’elle pense, à parler vrai. »
– « Dis-lui qu’elle n’est pas seulement un objet qu’on aime ou qu’on n’aime pas, elle est également un sujet qui peut aimer ou ne pas aimer. »
– Chimamanda Ngozi Adichie insiste sur l’importance d’expliquer aux enfants, en particulier aux filles, les privilèges et les inégalités, et l’éthique de reconnaître sa dignité à toute personne en même temps que reconnaître les personnes mal intentionnée à leur égard.
– « Être féministe, c’est comme être enceinte. Tu l’es ou tu ne l’es pas. »
– « Éduque-la à la différence. Fais de la différence une chose ordinaire. Fais de la différence une chose normale. Apprends-lui à ne pas attacher d’importance à la différence (…). Parce que la réalité de notre monde, c’est la différence. Et en l’éduquant à la différence, tu lui donnes les moyens de survivre dans un monde de diversité. »
Mais Chimamanda Ngozi Adichie rappelle aussi que donner une éducation féministe aux filles n’implique pas de les contraindre à refuser la féminité. Cette femme est une féministe flamboyante qui assume son féminisme et sa capacité de séduction. Elle ne s’oppose pas aux hommes, elle les entraîne simplement à entrer avec elle dans le combat féminisme qui n’est pas autre chose que de mettre la femme à sa vraie place, la place égale à l’homme : «Je compte autant» . Et pourtant c’est loin d’être le cas dans nos pays et encore bien davantage dans la plupart des pays du monde. Et parmi ces pays, il semblerait que le pire soit l’Inde.
C’est pourquoi le combat de Chimamanda Ngozi Adichie est si important.
Comme est important un ressourcement par le silence. Silence que je commence à partir de lundi. Le prochain mot du jour, si tout va bien, est prévu pour le lundi 3 septembre.
<1099>
-
Jeudi 28 juin 2018
«L’ampleur des données génétiques aujourd’hui disponibles sur les sites rend quasiment impossible la protection des informations personnelles»Arthur Caplan, directeur du département de bioéthique à l’université de médecine de New YorkVous savez bien que les États-Unis sont toujours en avance sur nous. Il apparait donc pertinent de s’intéresser à ce qui se passe là bas pour savoir ce qui va se passer chez nous d’ici quelques années. Et comme le monde accélère, même plus rapidement que cela.
Quel a été un des cadeaux les plus tendances, aux États-Unis, en 2017 ?
Ce sont des tests ADN maison. On les appelle ainsi parce que ce n’est plus très cher et qu’on peut donc au lieu de s’offrir une photo ou une vidéo, plutôt s’offrir son profil ADN et même quelques informations supplémentaires.
Il existe des sociétés qui ont pour nom 23andMe, Ancestry, Family Tree DNA ou African Ancestry qui proposent, pour 80 euros, une recherche des origines ethniques. La société 23andMe va un peu plus loin et recherche des prédispositions à certaines maladies pour 170 euros.
Ce sont des kits ADN qu’on offre en cadeau ou qu’on achète puis ces sociétés font leur travail d’analyse et de recherche.
C’est un article du Monde qui m’a ouvert ces perspectives : <Aux Etats-Unis des profils ADN très peu confidentiels>
Tous les fidèles des séries américaines connaissent le concept des « cold cases », c’est-à-dire les « affaires non résolues ».
L’article du monde commence à raconter une histoire très morale, mais peut-être inquiétante aussi.
GEDmatch est une entreprise de taille modeste spécialisée dans les recherches généalogiques, située en Floride. Elle vend des Kits ADN et s’est créée une base de données.
Dans deux enquêtes anciennes, la Police disposait de traces ADN retrouvés sur les lieux de crime. Restés inexploitables pendant des décennies faute de correspondre à un profil répertorié dans les fichiers de la police, ces échantillons ont trouvé leur chemin dans les méandres de GEDmatch.
Alors vous pensez que les criminels stupides ont participé à un test ADN et que la police les a trouvés en donnant les échantillons qu’ils possédaient à GEDmatch.
Oui et non. La police a bien donné les échantillons à GEDMatch mais les criminels n’étaient pas stupides. Ils avaient simplement de la famille dont certains membres ont succombé à cette tendance de réaliser des tests ADN.
Et l’article du Monde explique :
« Les clients de cette entreprise, détentrice de leurs profils ADN, peuvent en effet rechercher dans l’immense banque de données du site les profils relevant de la même branche généalogique qu’eux afin de retrouver des membres de leur famille. Les policiers ont livré anonymement le génotype des deux criminels à GEDmatch, sans mandat et en profitant d’une zone grise du droit sur ces questions encore inexplorées. Puis, aidés de spécialistes, ils ont reconstitué un arbre généalogique, qui les a menés à des parents éloignés des suspects. Ils ont ensuite cherché, dans ces familles, les profils (âge, domicile à l’époque des crimes…) proches de ceux des suspects. »
Et c’est ainsi que Joseph James DeAngelo et William Earl Talbott, auteurs de crimes non résolus remontant aux années 1970 et 1980, ont été arrêtés à quelques jours d’intervalle.
Voilà une excellente nouvelle, deux histoires qui terminent bien, histoires parfaitement morales. Les américains vont certainement en faire un film…
Mais l’article du Monde continue :
« Beaucoup, aux Etats-Unis, ont été prompts à se réjouir de l’élucidation de ces cold cases grâce aux progrès technologiques et à l’incomparable base de données de GEDmatch. Néanmoins, ces événements sans précédent posent aussi de nouvelles questions éthiques et légales sur la protection de données aussi intimes qu’un profil ADN. D’autant qu’elles s’ajoutent aux inquiétudes déjà soulevées par la multiplication des tests ADN « maison », censés répondre aux interrogations de millions d’utilisateurs sur leurs origines ethniques, leurs parents biologiques ou leur santé.
Apparemment consciente des possibilités infinies ouvertes par ses services, la société GEDmatch prend la peine de prévenir ses clients que sa base de données peut être utilisée pour d’autres buts que la simple passion généalogique, et notamment pour la recherche d’auteurs d’un crime. Elle leur conseille donc de se désinscrire s’ils tiennent à la confidentialité de leurs données. La plupart, visiblement, n’en ont cure.
Ces affaires mettent pourtant en lumière un phénomène déjà observé avec Facebook et l’aspiration des données de millions de ses comptes par la société Cambridge Analytica : les informations qu’un individu fournit librement sur un site ou un réseau social dépassent largement sa propre personne. Sur Facebook, les données des « amis » des comptes concernés ont été récupérées, à l’insu de tous. Avec l’ADN, c’est le patrimoine génétique de toute une lignée qui est ainsi dévoilée. Sans que les proches ou lointains cousins en soient ni conscients ni avisés. »
Le monde cite Arthur Caplan, directeur du département de bioéthique à l’université de médecine de New York :
« L’ampleur des données génétiques aujourd’hui disponibles sur les sites rend quasiment impossible la protection des informations personnelles.»
Et l’article de continuer :
« La presse américaine regorge d’histoires de famille envenimées par les découvertes tirées des tubes à essai : un parent qui ne l’est pas vraiment, un ancêtre noir inattendu, la rencontre avec une fratrie inconnue… Surtout, chacun peut désormais recevoir par un simple courrier l’annonce qu’il court un risque élevé de contracter la maladie d’Alzheimer ou la fibrose kystique. Selon Susan Estabrooks Hahn, spécialiste de la maladie d’Alzheimer et membre de l’Association nationale des conseillers en génétique (ANCG), certains résultats peuvent être « source d’angoisse, écrit-elle sur le site de l’organisation, notamment lorsqu’il n’existe pas de remède pour la maladie identifiée ».
En outre certaines prédictions concernant la santé sont loin de pouvoir prétendre à l’exactitude
Il y a d’abord des appétits commerciaux et surtout un vide juridique considérable :
« Comme nombre d’experts, M. Caplan estime que les législateurs devraient se pencher sur le sujet afin que les données génétiques aujourd’hui facilement disponibles demeurent bien comprises et protégées. On en est loin, selon lui, « des protections existent mais elles ne sont pas assez complètes ». Des lois telles que le Genetic Information Nondiscrimination Act de 2008 interdisent aux employeurs de recruter, muter ou licencier les salariés en fonction d’informations génétiques. Et la couverture santé, l’Affordable Care Act, empêche les compagnies d’assurances de choisir leurs clients d’après leur ADN. Mais cette règle ne s’applique pas aux assurances-vie ou à celles liées aux handicaps, selon l’ANCG.
Le sénateur démocrate de New York Chuck Schumer a récemment appelé à un renforcement des contrôles sur les kits ADN. « Des clients peuvent, sans le savoir, mettre en danger leurs données génétiques si elles sont vendues à des tiers », a-t-il déploré. De leur côté, les sociétés assurent mettre en garde leurs clients. Le site de la société Ancestry prévient qu’elle peut utiliser, « avec votre consentement, vos informations pour des projets de recherche sur la généalogie ou le génome et pour des objectifs commerciaux internes ».
23andMe assure ne pas vendre les informations de ses clients et ne pas les utiliser à des fins de recherche « sans leur consentement personnel ». Mais, pour une société comme 23andMe, les revenus tirés de l’accès qu’elle offre à sa base de données sont primordiaux. L’entreprise a signé une vingtaine de partenariats avec des firmes pharmaceutiques et envisage de se lancer dans le développement de médicaments. »
Dans quel monde étonnant et inquiétant homo sapiens s’apprête-t-il à vivre dans le futur immédiat ?
De quels outils terrifiants vont pouvoir disposer les pouvoirs totalitaires ou simplement autoritaires qui se multiplient dans le monde. Parce que ces derniers temps, ce ne sont pas les démocraties libérales qui progressent.
Pour être concret il suffit de demander à un moteur de recherche (Qwant dans mon cas)
Et vous trouvez ce site pour <des tests de paternité> si vous avez des incertitudes ou au contraire si vous voulez avoir des certitudes.
Mais cela reste du niveau du théâtre de boulevard.
Si vous voulez en savoir davantage sur votre histoire, votre généalogie, j’ai trouvé ce site : <https://www.igenea.com/fr/home> a priori Suisse qui pourra vous guider, contre paiement bien sûr. Pour ma part, je n’irai pas vers cette voie.
<1098>
-
Mercredi 27 juin 2018
« Quand, dans cent ans, on sondera les fonds de ce petit bout de Méditerranée et qu’on y trouvera des centaines de corps humains, on se demandera quelle guerre s’est jouée là. »Roberto SavianoRoberto Saviano est un journaliste et un écrivain qui s’est rendu célèbre pour avoir décrit précisément les milieux mafieux dans ses écrits et articles, en particulier dans son œuvre Gomorra (2006), dans laquelle il décrit celui de la Camorra. En raison de l’immense succès dans son pays et à l’étranger de son livre, il vit maintenant sous protection policière permanente.
Roberto Saviano s’insurge dans un texte exclusif transmis au « Monde », contre la politique migratoire du ministre italien de l’intérieur, Matteo Salvini. Cet article a été publié le 21 juin 2018. Matteo Salvani l’a menacé de retirer sa protection policière, ce qu’il ne peut pas faire a priori, car la décision de cette protection appartient à une commission indépendante.
Roberto Saviano a répliqué à Salvani en l’accusant en tant qu’élu en Calabre, d’avoir fermé les yeux sur les activités de la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, d’avoir « oublié » les liens de la Ligue du Nord, son propre parti, avec cette mafia qui, selon lui, a recyclé de l’argent sale grâce au parti régionaliste. Et conclut, en rappelant les menaces de mort dont il est l’objet depuis des années :
« Tu crois que je vais avoir peur de toi ? Bouffon ! »
Je vous livre ci-après des extraits de cette tribune :
« On ne compte plus les journalistes et les faiseurs d’opinion qui, à l’aube du nouveau gouvernement, mais aussi au crépuscule du précédent, adoptent déjà des positions xénophobes à peine voilées. Matteo Salvini est en train de mettre en œuvre la « méthode Minniti », la doctrine de ce penseur politique [membre du Parti démocrate, ancien ministre de l’intérieur] qui entendait – je ne sais par quel miracle – éloigner le spectre d’un gouvernement jaune-vert (ainsi appelle-t-on en Italie, avec une pointe d’ironie, le ramassis formé par la Ligue et le M5S) en proposant une ligne politique proto-léguiste.
C’est Marco Minniti qui, l’année passée, fut le premier à déclarer : « Nous fermerons les ports aux ONG. » C’est lui qui obligea, au moyen d’une politique médiatique sans précédent, les ONG à signer un code de conduite parfaitement arbitraire, dont l’effet immédiat a été de diviser un front humanitaire qui doit rester uni pour pouvoir défendre ceux qui viennent en aide aux plus faibles. C’est encore Minniti qui expliqua aux Italiens à peu près ceci : même si les chiffres des cambriolages sont en baisse, nous, nous ne nous intéressons ni aux faits ni aux statistiques, mais à vos sentiments et, si vous vous sentez en insécurité, nous étudierons les moyens de vous laisser davantage de marge de manœuvre pour que vous puissiez vous défendre seuls. Tout cela a préparé le terrain à ce qui est en train de se produire aujourd’hui – pas de stupeur donc, rien qu’une infinie amertume.
[…]
Et la France dans tout cela ? Elle a criminalisé la solidarité, exactement comme l’a fait le gouvernement Gentiloni et exactement comme est en train de le faire le gouvernement Salvini-Di Maio. Prenez le cas de ce guide de montagne, Benoît Ducos, interpellé par la police française pour avoir porté secours à une migrante enceinte à la frontière franco-italienne. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, mais un exemple criant qui nous dit ce qui se fait couramment, et nous raconte comment les gouvernements ont décidé de contrer les extrémistes de droite en cherchant à les battre sur leur propre terrain.
[…]
A peine nommé, le ministre de l’intérieur déclare : « Pour les migrants, la fête est finie. » Quelle fête de naître en Afrique, de tout sacrifier et de s’endetter pour tenter de construire un avenir meilleur, dans l’espoir de pouvoir changer la donne et d’aider sa famille qui, en attendant, reste là-bas, parce qu’elle est trop nombreuse, parce qu’elle compte des femmes, des personnes âgées et des enfants qui ne supporteraient pas les souffrances d’un voyage long et éprouvant. Quelle fête de traverser le continent, de voyager entassé dans un véhicule conçu pour dix personnes qui en transporte cinquante. Quelle fête d’aller sans nourriture et presque sans eau, d’être dans la fleur de l’âge et pourtant si fatigué, épuisé, à bout et d’avoir, malgré tout, encore de l’espoir.
Quelle fête d’arriver en Libye, de faire l’impossible pour ne pas rester prisonnier dans un camp de réfugiés, de chercher à ne pas devenir une monnaie d’échange entre des ravisseurs assoiffés d’argent et la famille restée au pays qui, pour aider celui qui s’enfuit en Europe, contracte des dettes qu’elle remboursera avec des années de labeur – un emprunt pour la liberté, un crédit pour acheter l’espoir.
Quelle fête de payer sa place sur un Zodiac et d’être, peut-être, celui qui sera chargé de le diriger et qui se trouvera de fait considéré comme « passeur » au cas où les choses tourneraient mal. Quelle fête de passer des heures et des heures en mer. En mer calme, en mer agitée. En mer chaude et éblouissante le jour, froide et noire la nuit. Quelle fête d’être écrasé, entassé avec plus de cent personnes sur une embarcation qui prend l’eau de toutes parts, et de se trouver au centre, là où l’air manque, puis d’être assis au bord, les jambes ballantes, engourdies, glacées. Quelle fête d’être enfant et de vivre cet enfer, d’être mère, père, et de se sentir responsable d’avoir emmené ce que l’on a de plus précieux au monde dans une situation de danger extrême. Quelle fête quand le Zodiac ne tient plus le coup, qu’il prend l’eau et que la peur de couler vous tenaille.
Quelle fête quand Malte, l’Italie et le reste de l’Europe tentent de se débarrasser de la patate chaude et de l’envoyer le plus loin possible. Quelle fête quand les ONG – ces « taxis de la mer » (copyright Luigi Di Maio), ces « vice-trafiquants » (copyright Matteo Salvini) – sont empêchées de porter secours à des êtres humains, mais que l’on donne le feu vert à la garde côtière libyenne, à elle oui, elle qui est de mèche avec les trafiquants (source : ONU). Quelle fête lorsque l’on transmet à la télévision des vidéos des opérations de sauvetage de cette même garde libyenne et que l’on coupe les longues minutes pendant lesquelles les militaires frappent les migrants, tirent en direction des embarcations et menacent le personnel des ONG.
Impossible de me taire
Quelle fête quand personne ne vient à votre secours et quand votre embarcation est en train de sombrer, emportant avec elle les corps à présent sans force de ceux qui ont supporté la séparation d’avec leur famille, le voyage à travers le désert, la faim, les coups, les tortures dans les camps libyens, les viols et violences de tout type. Pensons-y, merde, quelle fête ! Quand, dans cent ans, on sondera les fonds de ce petit bout de Méditerranée et qu’on y trouvera des centaines de corps humains, on se demandera quelle guerre s’est jouée là.
Rome persiste et signe : Matteo Salvini, le ministre de l’intérieur a réitéré, samedi 16 juin, l’interdiction aux ONG d’accéder aux ports de la péninsule, au risque d’envenimer encore les tensions européennes autour de la crise migratoire.
Il s’est exprimé sur son compte Facebook : « Alors que le navire Aquarius navigue vers l’Espagne [arrivée prévue dimanche] deux autres navires d’ONG battant pavillon des Pays-Bas [Lifeline et Seefuchs] sont arrivés au large des côtes libyennes, en attente de leur cargaison d’êtres humains abandonnés par les passeurs. Que ces messieurs sachent que l’Italie ne veut plus être complice du business de l’immigration clandestine, et ils devront donc chercher d’autres ports (non italiens) vers lesquels se diriger. En ministre et en père, je le fais pour le bien de tous », a-t-il ajouté.
Matteo Salvini qui entend maintenant faire le recensement des roms en Italie pour les expulser et qui a eu cette phrase terrible de mépris et de racisme :
«Les Roms italiens, malheureusement, tu dois te les garder à la maison ».
Dans l’article du Monde Roberto Saviano continue
« L’objectif du « zéro débarquement » en Méditerranée n’est que de la propagande criminelle. Cela n’arrivera pas du jour au lendemain – cela n’arrivera de toute façon jamais. Matteo Salvini – c’est la ligne partagée par la Ligue et le M5S et c’est ce que nous souhaitons tous – dit vouloir empêcher d’autres tragédies en mer et soustraire les migrants à la voracité des trafiquants d’êtres humains de Libye et à celle des organisations criminelles d’Italie, mais la propagande est une chose, les faits en sont une autre. Le « zéro débarquement », tous les prédécesseurs de Salvini ont essayé d’y parvenir avant lui, avec les mêmes recettes et le même fiasco (construire des camps en Libye ne marche pas ; ce qui marche, c’est respecter les droits de tous les êtres humains). Salvini est juste plus ostensiblement mauvais et il a des alliés au gouvernement qui le soutiennent.
Au fil des ans, nous avons accordé des fonds à des pays instables, nous avons arrosé trafiquants et criminels avec l’argent des Italiens et des Européens sans rien résoudre, parce que tant qu’il y aura des personnes pour vouloir quitter l’Afrique et venir en Europe, en l’absence de moyens légaux de le faire, il y aura des personnes pour prendre leur argent et les y conduire.
Pour les Africains, les portes de l’Europe sont closes et l’unique voie est celle de la clandestinité – et il se trouve que ce sont les mafias libyennes qui les font passer (en moyenne 100 000 par an). Il existe une demande mais aucune offre légale pour la satisfaire. Qu’importent les méthodes brutales de Matteo Salvini et les discours mielleux de Luigi Di Maio, c’est la loi du marché la plus élémentaire : quand il y a une demande, il y a une offre, légale ou non.
Pouvons-nous accueillir tout le monde ? Non. Mais la part assumée par l’Italie n’est pas telle que l’on pourrait dire : « Là, c’est bon, ça suffit ! » Je me demande souvent quelle est la solution, comme s’il existait une solution qui pourrait résoudre le phénomène de la migration. Il n’existe pas une solution définitive, mais plusieurs pas à accomplir. »
Dans cette opposition frontale entre le courageux et humaniste Saviano et le raciste et démagogue Salvini, on ne peut être que résolument du côté du premier.
La situation est cependant loin d’être simple.
Les passeurs qui sont une autre mafia envoient des bateaux surchargés sur la méditerranée et gagnent un argent fou en promettant aux migrants qu’une fois arrivé au milieu de la méditerranée des bateaux occidentaux les prendront en charge pour éviter qu’ils fassent naufrage. Secourir, et il faut le faire, c’est aussi aider les mafias libyennes et autres à continuer leur business criminels.
En outre nous avons fermé nos frontières européennes aux migrants, dès lors des migrants économiques tentent d’entrer en Europe en essayant de se prétendre réfugiés. Or si nous devons accueillir, en raison des conventions internationales que nous avons signées, les réfugiés qui fuient les persécutions nous n’avons pas d’obligation d’accueillir les migrants économiques. Cette confusion augmente le chaos, car les vrais réfugiés sont regardés avec suspicion car les autorités croient qu’ils ont affaire à des migrants économiques, beaucoup plus nombreux aujourd’hui.
Mais certains considèrent que c’est une abomination de sélectionner les réfugiés et les migrants économiques, de «trier» disent-ils. Ils veuelent que tout le monde soit accueilli, parce que ce sont des humains qui cherchent simplement à avoir une vie meilleure.
Mais pendant ce temps, un après les autres les peuples européens votent pour les partis qui promettent de lutter brutalement contre cette immigration qu’ils qualifient d’invasion. L’Italie vient de tomber aussi dans cette spirale.
L’immigration ne s’est jamais passé facilement, le racisme contre l’étranger qui vient d’ailleurs a toujours existé. A cela s’ajoute cette fois que nos systèmes sociaux qui sont encore remarquables par rapport au reste du monde, régressent, avant tout à cause du vieillissement de notre population et de la crise économique.
Et mis bout à bout, les peuples européens ont peur de perdre leur identité et leurs droits sociaux.
En face de ces inquiétudes, les politiques de rigueur et de marchandisation du monde ne leur ouvrent que peu de perspectives d’espérer vivre un avenir de progrès social.
Mais que répondre à cette prophétie terrible de Saviano :
« Quand, dans cent ans, on sondera les fonds de ce petit bout de Méditerranée et qu’on y trouvera des centaines de corps humains, on se demandera quelle guerre s’est jouée là. »
<1097>
-
Mardi 26 juin 2018
« Peut-on encore aimer le football ? »Robert RedekerCet article est le 11ème de la série consacrée au football. Il me semble amusant de s’arrêter à 11 qui est le nombre de joueurs d’une équipe qui joue un match de football selon les règles prévues.
J’aurais pu aborder encore beaucoup d’autres sujets.
Parce exemple parler de la science du football comme cet article du Monde <Le foot est plus qu’un art c’est une science> qui est accessible aux abonnés et dans lequel on apprend que les deux plus grandes bases de données d’articles scientifiques, Scopus (propriété d’Elsevier) et Web of Science (propriété de Clarivate Analytics), recensent respectivement 20 120 et 18 870 publications avec le terme « soccer » (le nom du football aux Etats-Unis) dans leur titre ou résumé. Le plus vieil article remonte à 1932 dans Scopus, avec une étude sur l’évaluation du foot à l’école.
Et aussi cette vidéo de 3mn qui fait partie d’une série publiée également par <le Monde> et qui révèle que le football est le sport collectif le plus imprévisible. Un économiste David Sally qui a beaucoup étudié ce sujet a pu déterminer que dans le football le favori ne gagne en fin de compte qu’une fois sur deux. C’est presque comme une partie de pile ou face.
Sur les mêmes bases au base ball le favori l’emporte 3 fois sur 5 et au basket 2 fois sur 3. Selon David Sally la raison principale est que le football est un sport où les scores sont faibles. Entre 1901 et 2012, 17% des matches se sont achevés sur le score de 1-0. Et c’est probablement pour cela qu’il faut injecter autant de moyens financiers dans une équipe pour espérer faire diminuer de manière substantielle l’imprévisibilité du résultat.
J’aurais aussi pu évoquer tous ces livres qui ont paru sur le football, ces derniers mois en profitant de l’opportunité de la compétition actuelle qui mobilise tellement de supporters.
Si on va sur le site de la FNAC et qu’on recherche les livres parus en 2018, il en sort des dizaines, dont voici une partie :
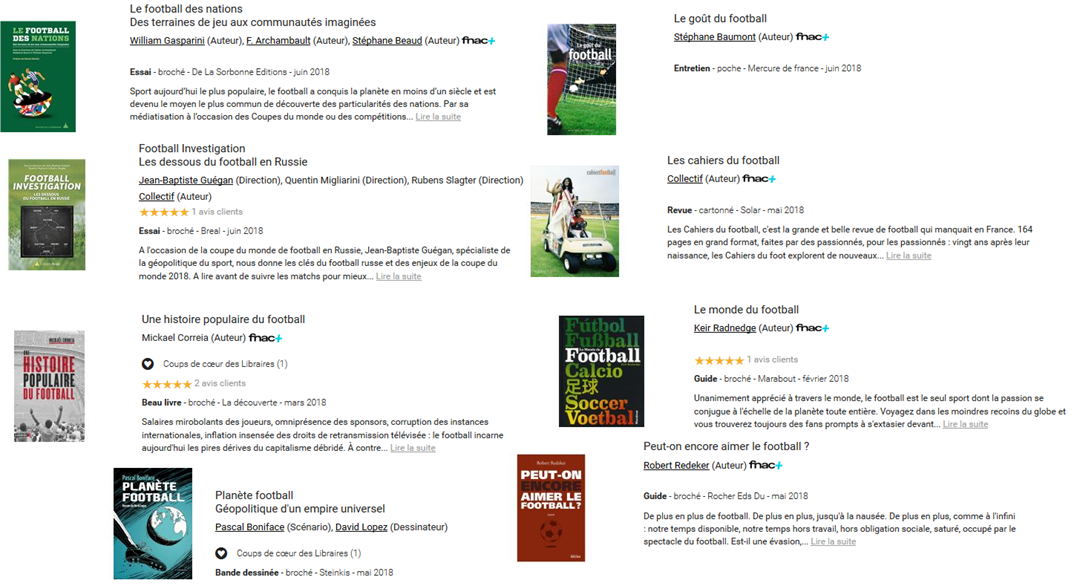
Et bien sûr, il y a des livres plus anciens dont j’ai déjà évoqué certains.
J’ai ainsi lu l’ouvrage du philosophe Jean-Claude Michéa : « le plus beau but était une passe ». Ce titre est une des répliques du film que le grand Ken Loach a consacré à Eric Cantona : « Looking for Eric » et c’est la réponse que le footballeur a répliqué à la question : quel était votre plus beau but ?
Dans ce livre, Jean Claude Michéa explique :
« Contrairement aux anciennes forme de domination politique ; qui laissaient généralement subsister en dehors d’elles des pans entiers de la vie individuelle et sociale, le système capitaliste ne peut maintenir son emprise sur les peuples qu’en pliant progressivement à ses lois l’ensemble des institutions, des activités et des manières de vivre qui lui échappaient encore.
Il aurait donc été étonnant qu’un phénomène culturel aussi massif et aussi internationalisé que le football puisse échapper indéfiniment à ce processus de vampirisation. Et, de fait, comme chacun peut le constater aujourd’hui, ce sport est devenu, en quelques décennies, l’un des rouages les plus importants de l’industrie mondiale du divertissement – à la fois source de profits fabuleux et instrument efficace du soft power (puisque c’est ainsi que les théoriciens libéraux de la « gouvernance démocratique mondiale » ont rebaptisé le « vieil opium du peuple ». »
Bref, le football n’est que la continuation de la marchandisation générale du monde.
Même Alain Finkielkraut, qui il est vrai a toujours affirmé son amour du foot, a consacré deux émissions à ce sujet.
Le 9 septembre 2017 « Peut-on encore aimer le football ? », puis le 16 juin 2018 « Football, amour et désamour » où il a invité Vincent Duluc, journaliste de l’équipe et Robert Redeker, écrivain et agrégé de philosophie qui vient de faire paraître un livre « Peut on encore aimer le football ?» qui reprend le titre de la première émission de Finkielkraut et que vous voyez dans les ouvrages reproduits ci-dessus. C’est ce titre que j’ai choisi comme exergue à ce dernier mot du jour de la série.
Dans son livre Robert Redeker écrit
« Que dit-on d’un régime politique qui cadenasse l’information jusqu’à ce qu’elle devienne unidimensionnelle, qui fait en sorte qu’à longueur de page, d’heures d’antenne radio et télédiffusées, le même sujet soit traité avec un constance qui finit par donner la nausée, que la géographie y tienne lieu d’esprit critique, que les intellectuels y soient tellement asservis qu’ils ne trouvent rien de mieux à faire que de s’épancher urbi et orbi en analyses de café des sports dont le premier supporter venu serait capable. Le jugement tombe sans appel : il s’agit d’un régime totalitaire.
Tous les 4 ans, pendant un mois, nos journaux, nos médias, nos intellectuels à travers leur monotonie ressemblent à ceux de l’ex-RDA de sinistre mémoire. Le foot, le foot, et encore le foot . Présence totale qui ne manque pas de rappeler la presse communiste : le parti, le parti, le parti. »
Et puis pour finir vraiment, je voudrais revenir à la visite d’Emmanuel Macron à l’équipe de France de football à Clairefontaine. Pendant cette visite il a eu ce jugement :
«Une compétition est réussie quand elle est gagnée»
Montrant bien que pour lui ce sont les gagnants que l’on doit admirer et honorer.
C’est une philosophie de vie, c’est une morale.
Une morale que je ne partage pas.
Et le football encore m’aide à l’expliquer.
L’équipe de France de 1982 a perdu à Séville contre l’Allemagne. Je crois que tous ceux qui aiment le foot gardent beaucoup d’affection pour cette équipe de perdants.
Et l’équipe de 1986 qui avait battu le champion du monde sortant italien en 1/8ème finale. En ¼ de finale elle a rencontré l’équipe de Brésil de Socratés que j’ai déjà évoqué lors du mot du jour de vendredi. Certains historiens du football disent que ce fut le plus beau match de l’Histoire du football, tous disent que ce fut l’un des plus beaux. Et ce fut l’Argentine qui gagna la coupe du monde, l’Argentine de Maradona qui se qualifia grâce à la tricherie de ce dernier marquant un but avec la main contre l’Angleterre.
L’équipe de France de Platini et l’équipe du Brésil de Socratés furent des équipes de perdants, mais des perdants magnifiques.
Heureusement, M Macron que le monde de nos souvenirs et de nos célébrations n’est pas qu’un monde de gagnants. Il serait beaucoup moins beau, avec moins d’émotion, d’intelligence, de saveur, plus uniforme, plus triste.
« Ce que je sais de la morale, c’est au football que je le dois… » disait Albert Camus.
C’est avec cette phrase que cette série a débuté…
<1096>
-
Lundi 25 juin 2018
« Quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux que le football ? »Pierre DesprogesNous avons jusqu’ici constaté qu’historiquement le football a comme ancêtre des jeux de ballons très brutaux comme la soule ou le calcio florentin.
Depuis la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle, ce jeu de balle au pied s’est un peu civilisé et s’est organisé autour de règles visant à diminuer la violence et augmenter la technique.
De sorte que la quête d’Eduardo Galeano qui se décrit comme «un mendiant de bon football» et implorant «Une belle action, pour l’amour de Dieu !» puisse acquérir quelque légitimité.
Nous avons aussi évoqué des tricheries qui ont émaillé l’histoire de ce sport et surtout les dérives du business football.
Pourtant globalement, le ton était plutôt bienveillant.
Mais il existe des personnes qui détestent ce sport, et je pense qu’il faut leur donner la parole aussi.
Il y a d’abord ceux comme le chanteur Renaud qui s’en prennent aux spectateurs et surtout aux hooligans. Il le fait dans sa chanson « Miss Maggie » qui avant d’être une chanson anti Margaret Thatcher est d’abord une chanson féministe et une des strophes est celle-ci
« Femme je t’aime parce que
lorsque le sport devient la guerre
y a pas de gonzesse ou si peu
dans les hordes de supporters
Ces fanatiques, fous-furieux
abreuvés de haine et de bière
déifiant les crétins en bleu,
insultant les salauds en vert
Y a pas de gonzesse hooligan,
imbécile et meurtrière
y’en a pas même en Grande-Bretagne
à part bien sûr madame Thatcher »
Et puis il y a Umberto Eco qui dans son recueil de nouvelles : « Comment voyager avec un saumon » a écrit dans le chapitre ayant pour titre « Comment ne pas parler de foot »
« Je n’ai rien contre le foot. Je ne vais pas au stade pour les mêmes raisons qui font que je n’irais jamais dormir la nuit dans les passages souterrains de la Gare Centrale de Milan (ou me balader à Central Park à New York après six heures du soir), mais il m’arrive de regarder un beau match à la télé, avec intérêt et plaisir car je reconnais et apprécie tous les mérites de ce noble jeu. Je ne hais pas le foot. Je hais les passionnés de foot.
Comprenez-moi bien. Je nourris envers les tifosi un sentiment identique à celui des partisans de la Ligue Lombarde envers les immigrés extra-communautaires : « Je ne suis pas raciste, à condition qu’ils restent chez eux. » Par chez eux, j’entends leur lieu de réunion en semaine (bar, famille, club) et les stades le dimanche où je me fiche de ce qu’il peut arriver, où ce n’est pas plus mal si les hooligans déboulent, car la lecture de ces faits divers me divertit, et puisque ce sont des jeux du cirque, autant que le sang coule.
Je n’aime pas le tifoso parce qu’il a une caractéristique étrange : il ne comprend pas pourquoi vous ne l’êtes pas, et s’obstine à vous parler comme si vous l’étiez. «
Mais Pierre Desproges dans ses chroniques de la haine ordinaire a exprimé un rejet plus global sur le football, dans sa chronique du 16 juin 1986 :
« Voici bientôt quatre longues semaines que les gens normaux, je j’entends les gens issus de la norme, avec deux bras et deux jambes pour signifier qu’ils existent, subissent à longueur d’antenne les dégradantes contorsions manchotes des hordes encaleçonnées sudoripares qui se disputent sur gazon l’honneur minuscule d’être champions la balle au pied. »
A ce stade il faut peut-être préciser qu’une glande sudoripare est une glande située sous la peau qui sécrète la sueur.
Rappelons qu’en 1986, il y avait aussi une coupe du monde et elle se déroulait au Mexique. Pierre Desproges continue :
« Voilà bien la différence entre le singe et le footballeur. Le premier a trop de mains ou pas assez de pieds pour s’abaisser à jouer au football.
Le football. Quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux que le football ?
Quelle harmonie, quelle élégance l’esthète de base pourrait-il bien découvrir dans les trottinements patauds de vingt-deux handicapés velus qui poussent des balles comme on pousse un étron, en ahanant des râles vulgaires de bœufs éteints.
Quel bâtard en rut de quel corniaud branlé oserait manifester publiquement sa libido en s’enlaçant frénétiquement comme ils le font par paquets de huit, à grands coups de pattes grasses et mouillées, en ululant des gutturalités simiesques à choquer un rocker d’usine?
Quelle brute glacée, quel monstre décérébré de quel ordre noir oserait rire sur des cadavres comme nous le vîmes en vérité, certain soir du Heysel où vos idoles, calamiteux goalistes extatiques, ont exulté de joie folle au milieu de quarante morts piétinés, tout ça parce que la baballe était dans les bois?
Je vous hais, footballeurs. Vous ne m’avez fait vibrer qu’une fois : le jour où j’ai appris que vous aviez attrapé la chiasse mexicaine en suçant des frites aztèques. J’eusse aimé que les amibes vous coupassent les pattes jusqu’à la fin du tournoi. Mais Dieu n’a pas voulu. Ça ne m’a pas surpris de sa part. Il est des vôtres. Il est comme vous. Il est partout, tout le temps, quoi qu’on fasse et où qu’on se planque, on ne peut y échapper.
Quand j’étais petit garçon, je me suis cru longtemps anormal parce que je vous repoussais déjà. Je refusais systématiquement de jouer au foot, à l’école ou dans la rue. On me disait : « Ah, la fille! » ou bien : « Tiens, il est malade », tellement l’idée d’anormalité est solidement solidaire de la non-footballité.
Je vous emmerde. Je n’ai jamais été malade. »
Chroniques de la haine ordinaire / Éditions du Seuil, Points, Warner / 16/06/1986
On peut, on a le droit de ne pas aimer le football. Et on doit même pouvoir le dire.
Et celles et ceux qui l’aiment doivent pouvoir l’entendre.
<1095>
-
Vendredi 22 juin 2018
« Comment ils nous ont volé le football »François Ruffin et Antoine DuminiFrançois Ruffin est désormais bien connu comme l’un des députés les plus flamboyants de la France insoumise et le réalisateur d’un film jouissif : « Merci Patron ».
Mais il était et reste le fondateur et rédacteur en chef du journal « Fakir ».
Antoine Dumini était quant à lui journaliste et rédacteur en chef au même journal « Fakir », il était aussi professeur des sciences économiques et sociales. Il était car il est mort d’une terrible maladie à l’âge de 26 ans en 2014.
À partir de 2013, le journal Fakir a lancé une collection de livres sur des sujets sociaux. Je me suis intéressé à celui qui a été écrit en 2013, dirigé par François Ruffin et Antoine Dumini : « Comment ils nous ont volé le football » et qui a pour sous-titre : « la mondialisation racontée par le ballon ».
Ce petit livre est passionnant et je vous en conseille vivement la lecture.
Le livre pose le problème de la manière suivante :
« Que s’est-il passé ?
On tape dans le ballon depuis la cour de récréation. […]
Que s’est-il passé ?
C’est le même jeu, un ballon, deux équipes, quatre poteaux, et voilà que ce sport du pauvre brasse des milliards, s’exporte comme un produit, devient la vitrine triomphante, clinquante, écœurante du capital.
Que s’est-il passé ?
Rien, en fait. Juste que l’argent envahit toute la société, lentement, depuis 30 ans, et que le football en est le miroir grossissant. C’est une histoire économique que ce sport nous raconte, à sa manière, les années 60 à aujourd’hui, de la libéralisation des ondes à la mondialisation des marques jusqu’aux fonds de pension, et on va la suivre décennie après décennie.
Le ballon, comme un monde en plus petit. » (Page 13 et 14)
Et puis très intelligemment il pose cette question pour nous, enfin pour tous ceux qui continuent à regarder et même à se passionner pour ce jeu :
« Que se passe-t-il en nous aussi ?
Ou plutôt : que ne s’est-il pas passé en nous ? Parce qu’on le sait bien, objectivement, il y a quelque chose de pourri au royaume du football, que le pognon a corrompu les âmes et les corps. »
Car oui, comment pouvons-nous continuer à faire comme si, si c’était comme avant un jeu qui ressemble à celui que nous jouions dans la cour de récréation.
Parce que oui, moi aussi je jouais avec mes camarades au football dans la cour de récréation de mon école primaire de la Verrerie-Sophie, dans ma ville natale de Stiring-Wendel.
Et c’est bien la question fondamentale, comment se fait-il que tant de gens continuent à supporter, à se passionner malgré tout…
Nous aussi.
Enfin, pour ma part je suis très mal à l’aise, je regarde pour l’instant très peu de match. Mais si la France se qualifie pour la seconde partie, c’est à dires les matches par élimination directe, probablement que je succomberais à nouveau à l’illusion du jeu de nos cours de récréation.
Le livre de Ruffin donne cette explication :
« Passion chevillée au cœur, et qui tient à quoi ?
A l’enfance, aux pères, au peuple, au miracle des maillots pliés… »
Le miracle des maillots pliés étant explicité dans le dernier chapitre qui est une ode au football amateur et à tous ces bénévoles qui font « tourner le foot ».
Mais avant d’en venir au foot business, les deux auteurs rapportent les tricheries qui existent depuis longtemps dans le football. Et par exemple la coupe du monde en Angleterre en 1966.
Un journaliste chilien Niden Icinow, ne parvient pas à faire publier un papier en juillet 1966, ainsi il le fait enregistrer sous un sceau officiel pour garder une preuve de ce qu’il décrit avant les évènements. Et voici ce que vous lirez dans ce livre et le chapitre « Le Nord contre les animaux » page 19 à 21..
« Le journaliste y décrit le plan conçu par le président de la FIFA, l’anglais Stanley Rous, pour favoriser l’Angleterre, pays organisateur de la 7ème coupe du monde qui s’ouvre la semaine suivante. L’article sera imprimé en septembre, alors que la prophétie s’est réalisée dans le moindre détail… C’est qu’avant la compétition déjà, les Sud-amériaicns s’apprêtent au cauchemar : « Contre notre équipe, écrit un journaliste de Rio, il y aura un complot international principalement européen. Pour arriver au titre, le Brésil [double tenant du titre 1958 1962 avec Pelé] devra non seulement vaincre les adversaires, mais aussi la violence, la provocation, les arbitres. Tout. Elle jouera en Angleterre où l’ambiance sera absolument hostile. Les anglais désirent le championnat pour eux, mais dans le pire des cas, ils désirent que le titre reste en Europe. […]
Lors du premier match, le bulgare Jetchev matraque impunément Pelé qui ne pourra pas participer au second match. Lors du troisième, c’est le portugais Morais qui agresse le prodige brésilien – sans recevoir la moindre sanction – réduit à dix joueurs valides le Brésil est éliminé de la compétition »
Et le scandale continue pour l’Uruguay l’autre grande nation sud-américaine du football :
« Il fallait alors écarter l’Uruguay. L’arbitre anglais Finney s’en charge. Lors du quart de finale Uruguay-Allemagne, il ignore une main flagrante d’un arrière allemand, ne sifflant pas le pénalty […] Deux uruguayens protestent, l’homme en noir les expulsent. A onze contre neuf, la tâche devient plus aisée : les allemands gagnent sans gloire.
Le même jour, dans le match Angleterre-Argentine l’arbitre allemand [un hasard ???] Kreitlin renvoie l’ascenseur aux britanniques : il expulse le capitaine argentin coupable de protestations. »
Tout cela aboutit au résultat espéré : les demi-finales ne comptaient plus que des nations européennes : L’URSS de Yachine et le Portugal d’Eusebio accompagnant l’Angleterre et l’Allemagne.
Bienvenue dans une compétition équilibrée et non faussée …
Mais le pire est à venir car si Stanley Rous était un tricheur ses deux successeurs d’abord le brésilien Joao Havelange puis le suisse Sepp Blatter seront des corrompus qui vont aider l’émergeance du foot business.
Il faut alors lire le chapitre : « Adidas-Fifa même combat » page 33 à 35
« Si ce n’est pas assez, n’hésite pas à me le dire… » Le même mot est glissé dans chaque enveloppe à bulle, discrète. Elles sont déposées dans les chambres des dirigeants de fédérations, à l’hôtel Steingenberger de Francfort, ce 10 juin 1974 en soirée. Et c’est Horst Dassler, le richissime patron d’Adidas qui se charge des cadeaux. Le lendemain se déroule l’élection à la présidence de la FIFA […]Entre le conservateur anglais Stanley Rous et son challenger Joao Havelange, Horst Dassler a choisi son poulain : l’homme nouveau capable de transformer le football en produit. »
Et Joao Havelange sera élu. Il restera Président de la FIFA de 1974 jusqu’à 1998, date à laquelle il sera remplacé par son dauphin Sepp Blatter.
Il était un homme d’affaires et d’argent et saura faire entrer le football de plein pied dans le capitalisme. Des contrats juteux avec Adidas et Coca-Cola garantissent les entrées d’argent, puis les droits de télévision vont permettre à la FIFA et au football de devenir une organisation intouchable et très riche.
Grâce à un article du Monde nous pouvons savoir qu’Havelange était devenu, en 1948, directeur juridique à la Viaçao Cometa, compagnie d’autobus qu’il dirigera durant cinq décennies et dont l’âge d’or coïncide avec la dictature militaire au Brésil (1964-1985). Il a par ailleurs fondé Orwec, entreprise spécialisée dans les revêtements métalliques, et a siégé aux conseils d’administration de l’agence publicitaire MPM et de la compagnie d’assurance Atlantica Boavista. Il eut aussi des liens troubles avec Castor de Andrade, parrain de la mafia à Rio.
Il mourra le 16 août 2016, à l’âge de 100 ans.
L’inimitable et intelligent joueur anglais, Gary Lineker, devenu commentateur sportif, eu, au moment de sa mort, ce commentaire sarcastique et juste :
« Le football lui a apporté beaucoup »
Sepp Blatter a pris la relève à la tête de l’organisation et a permis au foot d’être encore plus libéral et mondialisé que jamais. Il faut dire, qu’il fut bien aidé par l‘arrêt Bosman introduit en décembre 1995. Ce décret, relevant de la Cours de justice des communautés européennes (CJCE), qui porte le nom de son inspirateur (le médiocre joueur belge Jean-Marc Bosman), garantit la liberté de circulation des joueurs au sein de l’Union européenne.
Et Alternatives Economiques qui évoque aussi ce livre, fait ce résumé de la connivence de la télévision et du football :
« Mais c’est la télé et ses annonceurs qui vont faire grandir le foot fric. L’idée était simple et géniale : acheter des matches (des retransmissions) ! C’est alors que la FIFA « adapte le foot à la télé » et aux annonceurs (la pub) et que les droits TV flambent : 30 malheureux millions d’euros pour la Coupe du Monde de 1986, 2,1 milliards en 2010. C’est alors que des groupes de communication investissent dans des clubs : Berlusconi au Milan AC, Canal Plus au PSG, Murdoch dans plusieurs clubs britanniques. C’est alors aussi que les salaires des joueurs et les montants des transferts deviennent astronomiques (point suivant). Et peu après arrivent des clubs cotés en Bourse : Manchester United dès 1991, une vingtaine d’autres ensuite rien qu’au Royaume de sa gracieuse Majesté, et quelques autres ailleurs, certains achetés par les émirs du Golfe et les fonds de pension. Et comme dans toute mondialisation néolibérale, on va chercher des travailleurs dans les pays du Sud pour réduire les coûts de production d’un footballeur, dans des conditions inhumaines le plus souvent. Sans parler du nécessaire dopage, bien caché mais bien présent. »
J’avais déjà parlé <des footballeurs produits financiers> mais depuis j’ai vu <Cash investigation – Foot business : enquête sur une omerta> qui par des enquêtes montrent encore plus précisément ces dérives dans lesquels des fonds d’investissement achètent des parts de joueurs, ou investissent sur de tous jeunes garçons dont certains vont être cherchés en Afrique.
Il y a le foot business, la corruption mais ce livre insiste aussi sur les rapports « incestueux » entre les régimes dictatoriaux et le football. Ce qui fut déjà le cas de Joao Havelange.
Par exemple, le ballon rond a été l’instrument de blanchiment du fascisme franquiste, par le biais du club vedette du régime : le Real Madrid. En 1934, le régime fasciste de Mussolini mit aussi à profit l’organisation de la coupe du monde en Italie, coupe que remporta d’ailleurs l’Italie pour glorifier son régime, comme les jeux de Berlin de 1936 furent utilisés par les nazis.
Sans parler du scandale en 1978, quand la coupe du monde fut organisée par la dictature argentine de Videla. Et c’est encore au bout de tricherie et de match truqués notamment un match entre l’Argentine et le Pérou que le pays organisateur argentin put s’emparer du trophée.
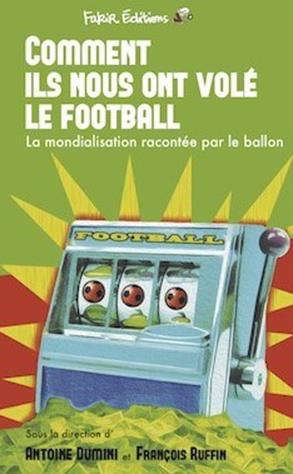 Quelquefois des footballeurs, ayant une conscience politique se révolte et le paie cher.
Quelquefois des footballeurs, ayant une conscience politique se révolte et le paie cher.
Vous lirez dans ce livre l’histoire de Carlos Caszely, joueur et opposant au régime de Pinochet en Chili :
« Qualifiée pour le Mondial de 1974 en Allemagne, la sélection chilienne est reçue par le général Pinochet en personne avant son envol pour l’Europe. Carlos Caslezy décide de frapper fort : « D’un coup les portes s’ouvraient et il y avait ce type avec une cape, des lunettes noires et une casquette. Avec une figure aigre. Sévère. Il commence à marcher… Et à saluer les joueurs qualifiés pour le Mondial en Allemagne. Et quand il arrive très près, très près, je mets mes mains derrière moi. Et quand il me tend la main, je ne lui serre pas. Et il y a eu un silence qui pour moi a duré mille heures. Ça a dû être une seconde ? Et il a continué. Moi, comme être humain, j’avais cette obligation parce que j’avais un peuple entier derrière moi en train de souffrir, et que personne ne faisait rien pour eux. Jusqu’à arriver à un moment où j’ai dit stop… Non à la dictature ! Au moins, laissez-moi protester. Au minimum, laissez-moi le dire. Au minimum, laissez-moi dire ce que je ressens. »
Son geste, l’attaquant le paiera très cher. À son retour d’Europe, sa mère lui confie, en larmes, qu’elle a été arrêtée et torturée. Le joueur ne peut y croire : « Je lui ai dit « arrête maman il ne faut pas plaisanter avec ce genre de choses ». Elle m’a montré sa poitrine avec ses brûlures et j’ai pleuré comme un enfant. Ils m’ont fait payer ça sur ce que j’avais de plus cher. Ma mère. »
En 1988, Pinochet organise un référendum pour sa réélection. Carlos Caszely enregistre un clip de campagne, avec sa mère qui témoigne, pour que le peuple vote « non », contre le général. « Ce clip fut une libération pour ma mère. Elle a pu dire les choses publiquement et j’ai senti que ce fut une forme de thérapie », confie-t-il. Cette prise de position, d’une icône nationale, a un grand impact sur les Chiliens. Selon les analystes, elle aurait convaincu près de 7% des indécis à voter « non ». Le 6 octobre, les résultats tombent : 44,01 % des voix aux partisans de Pinochet, contre 55,99 % à ses adversaires victorieux. Caszely l’emporte après les prolongations… »
François Ruffin et Antoine Dumini évoque aussi la figure lumineuse du joueur brésilien « Socrates »
Je ne peux pas développer tous les aspects de ce livre.
Mais pour Socrates vous pouvez lire cet article du magazine critique spécialisé en football <Sofoot> ou cet article de Telerama. <Sócrates, le footballeur qui faisait la révolution>.
Car le football est un monde où les figures exceptionnelles côtoient les tricheurs, les corrompus et les mafias.
Comme dans la vie de tous les jours, comme dans le monde d’aujourd’hui.
<1094>
-
Jeudi 21 juin 2018
« Le calcio florentin »Autre ancêtre du footballDans les 3 précédents mots du jour, nous nous situions dans les temps du moyen-âge et de l’antiquité. Peu de sources nous permettaient de décrire avec certitude les règles et les conditions de jeu.
Tel n’est pas le cas du dernier jeu que je présenterai dans ce panorama des jeux de ballon qui ont annoncé le football.
C’est mon butinage et mes lectures récentes qui m’ont fait comprendre que si on nomme le championnat de football italien, « Le calcio » c’est pour des raisons historiques.
Le nom complet est : « Calcio Storico Fiorentino ». Il a été inventé au moyen-âge et s’est épanoui à la Renaissance essentiellement dans la ville de Florence.
<Wikipedia> ramène aussi ce jeu à une filiation avec l’ « harpastum » dont il fut question lors du mot de mardi et qui était pratiqué par les légionnaires de l’Empire romain.
C’est donc un sport collectif florentin de la Renaissance qui avait disparu au cours du XVIIIe siècle, mais qui fut relancé à Florence dans les années 1930.
Cette fois les règles sont beaucoup plus claires puisqu’en 1580, le Comte Jean de Bardi di Vernio écrivit le « Discours sur le jeu de calcio florentin » qui restera sans doute comme la première publication des
 règles écrites sur le football. Giovanni Bardi, comte de Vernio, (né en 1534 et mort en 1612 à Florence) était un écrivain, compositeur de musique et critique d’art italien de la Renaissance. L’art, le sport, le jeu n’étaient pas incompatibles à Florence.
règles écrites sur le football. Giovanni Bardi, comte de Vernio, (né en 1534 et mort en 1612 à Florence) était un écrivain, compositeur de musique et critique d’art italien de la Renaissance. L’art, le sport, le jeu n’étaient pas incompatibles à Florence.
Donc nous savons que la compétition voit s’affronter deux équipes de 27 joueurs : des gardiens, des attaquants, des tireurs. L’objectif est d’aller marquer une « caccia »: mettre le ballon dans les filets d’en face. Il faut marquer plus de buts que l’adversaire.
Depuis 1930, une compétition opposant 4 quartiers de la ville de Florence est à nouveau organisée. Elle se déroule désormais chaque année à la mi-juin sur la piazza Santa Croce.
Le Nouvel Obs est allé enquêter et explique :
« Il y a une part de tactique. Pour libérer la voie aux tireurs, les attaquants s’affrontent dans des combats en un contre un. Ils peuvent se plaquer ou se taper dessus. C’est un mélange de rugby, de lutte et de boxe. »
Historiquement ce n’est pas comme « le mob football anglais » et la « soule française » un jeu du peuple, mais plutôt de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie :
Le livre « Le Dieu football » qui m’accompagne dans cette plongée aux origines écrit :
« Se déroulant sur la place du marché florentine, il était pratiqué par l’aristocratie avec un ballon gonflé. C’était une bataille rude entre deux masses constituées de 27 joueurs : il y avait beaucoup d’os fracturés et de sang. Les parties étaient des célébrations rituelles disputées durant les noces royales ou l’arrivée d’hôtes de marque. Elles avaient lieu sur la merveilleuse place de Santa Croce qui mesure approximativement 90 mètres de long et 45 mètres de large, soit à peu près les dimensions du football d’aujourd’hui. Les joueurs avaient le droit d’utiliser leurs mains et leurs pieds pour faire avancer la balle.
[…] Seuls les membres de la haute société pouvaient y participer, jusqu’à ce que la bourgeoisie aisée permît aux marchands et aux employés de banque d’y jouer. Des costumes riches et colorés, des combats âpres, de nombreux blessés à la fin de la partie, telles étaient les caractéristiques essentielles de ce dur amusement. »
Philippe Villemus ajoute ce jugement que certains des lecteurs d’origine italienne trouveront injuste, voire injustifiable :
« Le football italien d’aujourd’hui, intraitable en défense, en a hérité sa légendaire rugosité ! »
Il semble que ce sport fait partie de l’identité florentine. <Wikipedia> décrit le match le plus célèbre de ce jeu qui a été joué le 17 février 1530 :
« Les Florentins, profitant du pillage de Rome effectué par les forces armées impériales en 1527, chassèrent les Médicis de leur ville et proclamèrent la création de la République florentine. Cela ne plut pas au pape Clément VII, qui demanda une intervention à l’empereur, qui assiégea donc la ville à partir de l’été 1529.
Les Florentins, quoique affaiblis par le manque de nourriture provoqué par le siège de leur ville, ne renoncèrent pas aux festivités de Carnaval ; ils organisèrent un match sur la piazza Santa Croce qui, de par sa position, était bien visible par les troupes ennemies, campées sur les collines aux alentours. Pour se moquer davantage d’eux, des musiciens jouèrent sur le toit de l’église Santa Croce, de façon à donner aux soldats une idée plus claire du déroulement du
 jeu. Un boulet fut tiré par les soldats, mais il rata son but, tombant loin de l’église sans faire de dégâts, sous les huées de la foule.
jeu. Un boulet fut tiré par les soldats, mais il rata son but, tombant loin de l’église sans faire de dégâts, sous les huées de la foule.
On ne sait pas qui gagna cette partie, probablement parce qu’elle est restée dans la mémoire collective des florentins en tant qu’effort collectif contre l’ennemi et non un vrai match. Malgré le courage démontré par les Florentins, la ville fut contrainte de céder face au siège et de se rendre au pouvoir des Médicis. »
Mais comme les autres ancêtres du football et du rugby et à l’exception notable du « Kemari » japonais évoqué lundi, ce sport était d’une rare violence comme le décrit cet article : « Le Calcio storico : trop petit pour qu’on l’appelle la guerre et trop cruel pour être un jeu »
Vous pouvez aussi voir <cette vidéo> qui présente le calcio florentin.
On constate donc bien que le monde moderne est moins violent physiquement que le monde ancien comme plusieurs penseurs qui ont été cité dans les mots du jour l’ont relaté.
Après cela, et tout le monde le sait, ce furent les anglais qui inventèrent le football moderne
Le 26 octobre 1863, des représentants des divers clubs anglais se réunirent à la taverne des francs-maçons. Ils adoptèrent les règles de Cambridge et fondèrent la Football Association (FA). En décembre, les tenants du rugby se séparèrent.
Et la Fédération internationale de football association (désignée par l’acronyme FIFA) fut fondée le 21 mai 1904 à Paris.
Il est vrai que les anglais inventèrent la plupart des jeux collectifs modernes, alors que les français inventèrent les compétitions sportives.
 Ainsi si Pierre de Coubertin fut à l’origine des jeux olympiques modernes, c’est aussi un français Jules Rimet, président de la fédération internationale de 1920 à 1954 qui créa en 1924 la Coupe du monde, dont le premier tournoi eut lieu en Uruguay qui gagna la compétition.
Ainsi si Pierre de Coubertin fut à l’origine des jeux olympiques modernes, c’est aussi un français Jules Rimet, président de la fédération internationale de 1920 à 1954 qui créa en 1924 la Coupe du monde, dont le premier tournoi eut lieu en Uruguay qui gagna la compétition.
La coupe remis au vainqueur pris d’ailleurs le nom de Coupe Jules Rimet. Une règle traditionnelle à l’époque fixait que la nation qui gagnerait trois fois la compétition conserverait définitivement le trophée. C’est ce qui arriva en 1970 et le Brésil après cette victoire et celles de 1958 et 1962 est désormais propriétaire de ce trophée qui a été remplacé par l’actuel en 1974. La règle consécutive à trois victoires n’existe plus.
<Le ballon d’or> qui récompense chaque année le meilleur footballeur jouant en Europe est aussi une invention française : c’est le journal France Football qui le créa en 1956.
Ainsi va la rivalité entre les français et les anglais.
L’emblématique capitaine de l’équipe française de rugby des années 80, Jean-Pierre Rives aurait dit :
« Pour intéresser les anglais à la guerre, il faut leur expliquer que c’est du sport, pour intéresser les français au sport il faut leur dire que c’est la guerre ».
Demain nous reviendrons au football actuel et y porterons le regard critique de François Ruffin.
<1093>
-
Mercredi 20 juin 2018
«Le mob football anglais et la soule française»Ancêtres du footballAprès l’antiquité des grecs et des romains nous en arrivons au moyen-âge. (Page 51 à 58 du livre « Le Dieu football – Ses origines – ses rites – ses symboles »)
Et nous allons nous intéresser à l’Angleterre et à la France.
En introduisant ce sujet deux caractéristiques communes me frappent :
- D’abord ces jeux sont d’une grande violence ;
- Ensuite, les autorités religieuses et seigneuriales ont tenté de les interdire.
Commençons par l’Angleterre :
Le jeu de ballon commença à se répandre en Angleterre sous le nom générique de « mob football » (« football du peuple »).
Au XI e siècle, il s’appelait à l’origine « fute balle » , « foote balle » ou encore « foeth-ball » , ou simplement « football » . […]
 Il existait, bien sûr, plusieurs variantes de ces jeux de ballon.
Il existait, bien sûr, plusieurs variantes de ces jeux de ballon.
La première, appelée hurling at goal (« lancer au but »), était pratiquée sur des terrains de taille réduite par des équipes de 30 à 50 footballeurs.
L’objectif était de « dribbler » ( dribble veut dire « pousser » en anglais) la balle de cuir vers le but adverse.
La seconde variante, hurling in the country (« lancer dans la campagne »), était réellement une bataille sanglante dans les champs entre deux villages.Elle était pratiquée lors des fêtes, en particulier en juin pour célébrer le retour de l’été et surtout du soleil.
La partie s’arrêtait lorsqu’une des deux équipes avait transporté la balle dans le camp ennemi par tous les moyens nécessaires.
L’auteur prétend que la première description du football en Angleterre aurait été faite par Sir Fitz Stephen (1174-1183). Il existait à Londres un festival annuel appelé Shrove Tuesday (l’équivalent de mardi gras). Et lors de cette fête :
« Après déjeuner tous les jeunes de la cité sortaient dans les champs pour participer aux jeux de balle.
Les élèves de chaque école avaient leur propre balle ; les ouvriers des ateliers portaient aussi leur balle.
Les citoyens âgés, les pères et les riches arrivaient à cheval pour regarder leurs cadets s’affronter, et pour revivre leur propre jeunesse par procuration : on pouvait voir leur passion s’extérioriser tandis qu’ils regardaient le spectacle ; ils étaient captivés par les ébats des adolescents insouciants.»
Philippe Villemus continue sa description :
« L’Angleterre se prenait de passion pour les jeux chaotiques de Shrove qui réunissaient les villages et les villes des environs de Londres.
Les masses compactes de joueurs des deux équipes se disputaient avec acharnement le ballon en vessie de porc pour le porter aux marqueurs situés aux extrémités de la ville. […]
Des versions plus civilisées de ce jeu, quoique toujours très rudes, étaient jouées dans les écoles aristocratiques.
Il est fait référence, dans l’histoire du collège d’Eton, en 1519, à des élèves frappant des ballons pleins de foin.
Eton développa une version du football appelée field game (« jeu de terrain »), codifiée au milieu du XIX e siècle, intermédiaire entre le rugby et le football. Toujours pratiqué, le field game a évolué séparément des autres sports. »
Il semble qu’au début, ces différents jeux de balle n’étaient pas du goût des aristocrates mais étaient réservés au peuple.
Dans Le Roi Lear , Shakespeare fait dire à un des personnages, en parlant de Oswald : « You, base football player ». (« Toi, vil footballeur »). »
Mais ce qui semble évident c’est que ces jeux étaient brutaux et en outre étaient de nature à déclencher des émeutes. C’est probablement pour ces raisons que des interdictions vont se multiplier, Philippe Villemus en cite plusieurs :
En 1314, le maire de Londres :
« En raison des grands désordres causés dans la cité par des rageries de grosse pelote de pee dans les prés du peuple, et que cela peut faire naître beaucoup de maux que Dieu condamne, nous condamnons et interdisons au nom du roi, sous peine d’emprisonnement, qu’à l’avenir ce jeu soit pratiqué dans la cité.» L’interdiction s’étala du XIII e siècle jusqu’à 1617.
En 1365, le roi Édouard III:
« Aux Shérifs de Londres.
Ordre de faire proclamer que tout homme sain de corps de ladite cité lors des jours de fête, quand il en a le loisir, doit utiliser dans ses sports des arcs et des flèches ou des frondes et des arbalètes.
Il leur est interdit, sous peine d’emprisonnement, de se mêler à des lancers de pierre, troncs d’arbres, poids, à des jeux de balle à la main ou au pied, ou autre vains jeux sans utilité, comme le peuple du royaume, noble et simple, a utilisé jusqu’ici ledit art dans leurs sports quand avec l’aide de Dieu va au-devant de l’honneur du royaume et l’avantage du roi dans ses actions de guerre. »
En 1388, le roi Richard II :
« Domestiques et travailleurs doivent avoir des arcs et des flèches et s’en servir les dimanches et jours de fête et abandonner tous les jeux de balle que ce soit à la main comme à pied.»
Et enfin un livre est cité : « L’anatomie des abus » de Stubbs en 1583 :
« L’un de ces passe-temps diaboliques usités même le dimanche, jeu sanguinaire et meurtrier plutôt que sport amical.
Ne cherche-t-on pas à écraser le nez de son adversaire sur une pierre ? Ce ne sont que jambes rompues et yeux arrachés.
Nul ne s’en tire sans blessures et celui qui en a causé le plus est le roi du jeu. »
Et il est à noter, à cette autre époque où la religion était très présente :
« Pendant près de 300 ans, le football fut interdit le dimanche. »
Aujourd’hui rien ne saurait priver les anglais du football le dimanche. Autre temps, autres mœurs !
Mais aucune interdiction, aucune prohibition ne parvint à arrêter cette passion des britanniques pour le jeu de ballon. Et l’auteur ose cette explication qui semble pleine de bon sens :
« Sa popularité devait dépasser les interdictions, les édits et les sommations qui en prohibaient la pratique, puisqu’il fallait les renouveler sans cesse. »
Pour faire la transition, Philippe Villemus pose que Le football britannique du Moyen âge ressemblait à s’y méprendre à la « soule médiévale française ».
L’auteur parle de soule médiévale française pour immédiatement préciser que : « La soule se développa au Moyen Âge, aussi bien dans les îles britanniques qu’en France. En Irlande, la soule proviendrait d’un vieux rite solaire celtique.
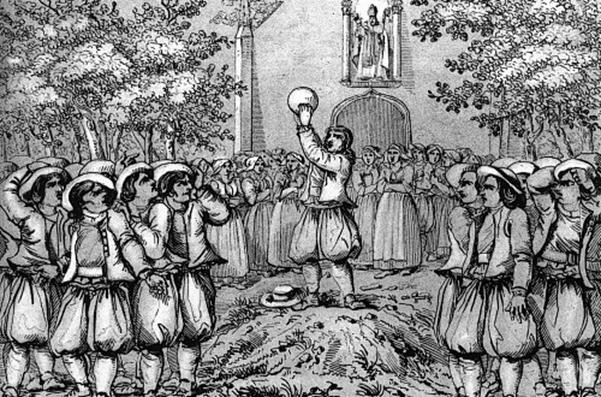 Ce rite celtique trouve des affinités avec d’autres rites primitifs dans lesquels un disque ou un objet globulaire symbolisent le soleil, source de vie. »
Ce rite celtique trouve des affinités avec d’autres rites primitifs dans lesquels un disque ou un objet globulaire symbolisent le soleil, source de vie. »
Pour rester dans la continuité des mots du jour précédents qui pour le premier opposait le Tsu chu chinois et le Kemari japonais, et celui d’hier qui opposait un jeu grec et un jeu romain, je trouve plaisant et commode d’opposer, aujourd’hui, un jeu anglais et un jeu français.
Mais il semble que la situation médiévale était plus compliquée et que les régions, les royaumes n’étaient pas étanches et que des coutumes passaient aisément de l’un à l’autre.
« La soule est un dérivé de l’ haspartum introduit par les légions romaines.
À l’époque gallo-romaine, on l’appelait ludos-soularum .
Le mot a deux origines possibles : soit sol (soleil), soit soles (sandales).
Pour certains, soule vient du latin solea qui veut dire pied.
Cela laisserait à penser que ce jeu, d’où aussi le mot « football », se pratiquait plutôt avec les pieds.
Le choulet , ou ballon, était une balle en cuir bourrée de son ou de foin, ou une vessie de bœuf gonflée d’air ; la balle était aussi en bois ou en osier.
La soule est mentionnée dans un édit de Philippe V le Long, en 1319.
La soule , ou choule ou cholle , est le prédécesseur à la fois du rugby, du football, du football américain et du football gaélique. »
Alfred Wahl a écrit un autre livre chez Gallimard consacré au football : « la balle au pied ».
Dans celui-ci on peut lire :
« Dans l’Europe médiévale, les jeux de balle avaient un caractère populaire et rude. Ils étaient pratiqués, conformément à la tradition, sans règles écrites. À l’intérieur de ce modèle, il existait d’innombrables variantes. […]
L’organisation de la soule était informelle. Les pratiques souples, non fondées sur des règles écrites et légitimées d’après la seule coutume, évoluaient lentement.
Le nombre de participants n’était pas fixé, ni la durée du jeu, ni même les limites précises de l’espace. »
Philippe Villemus continue :
« Le football et le rugby se disputent les origines de la soule, qui était plus un combat furieux qu’un jeu divertissant. Le coup d’envoi de la partie était donné devant l’église du village.
On présentait, au coup d’envoi, le ballon au soleil ou on le jetait en l’air vers l’astre solaire, comme pour l’invoquer ou rechercher sa bénédiction.
Ensuite, tous les coups étaient permis ou presque.
Les joueurs se jetaient les uns sur les autres, se mordaient, se cognaient dessus, se donnaient des coups de pieds, en hurlant et courant dans tous les sens.
Le but du jeu était de porter la balle dans un endroit précis. »
Et il cite encore Alfred Wahl :
« Les interdictions prononcées par les autorités attestent la brutalité d’un jeu dont les acteurs laissaient des éclopés sur le terrain et quelquefois des morts.»
Ce que confirme Philippe Villemus :
« Les rencontres étaient extrêmement violentes, et l’on conserve des lettres de rémission du XIV e siècle accordant le pardon à des maladroits qui avaient fendu la tête d’un adversaire au lieu de frapper le ballon ! Il faut dire que parfois on utilisait, pour s’emparer du ballon, de bâtons recourbés à l’image de notre moderne hockey ! Comme en Angleterre, Philippe le Bel, en 1292, Philippe V, en 1319, et Charles V en 1369, interdirent le jeu de soule par décret. »
Mais dans un monde de brutes, il y eut quand même une exception en Ecosse :
« À Inveresk, en Écosse, on a retrouvé les traces d’un jeu de balle pratiqué par les femmes, cette fois. C’est un des seuls témoignages connus du Moyen Âge qui permettait aux femmes de pratiquer ce jeu.
Une des deux équipes était constituée de femmes mariées, l’autre de célibataires. Il s’agit sans doute d’un rite lié à la fécondité et ayant pour but de conjurer la stérilité. Le football féminin est donc beaucoup plus ancien qu’on ne le croit. »
Les nobles jouaient rarement à la soule, mais nous apprenons que le roi Henri II y joua avec Ronsard : « Le Roi ne faisait partie où Ronsard ne fut toujours appelé de son côté.»
Et un poème de Ronsard contient ces vers :
« Faire d’un pied léger et broyer les sablons, Et bondir par les prés et l’enflure des ballons. Ore un ballon poussé vers une verte place.»
Les amours de Marie, XVI e siècle
Malgré les nombreuses interdictions :
« La fièvre du football se développa, aussi bien dans le peuple que chez les nobles et les clercs.
À Sens, on joua même au ballon dans une église.
À Auxerre, on sait que jusqu’au XVII e siècle, on jouait un jeu de ballon dans la cathédrale.
Les chanoines et les choristes s’y livraient un farouche combat pour la conquête du ballon. »
Rabelais, dans Gargantua , au chapitre XXIII, évoque aussi la soule :
« Se desportaient es près et joueaient à la balle, à la paume, à la pile trigone, galamment s’exerçant les corps comme ils avaient les âmes auparavant exercé.».
Tous ces jeux de ballon qu’on présente comme les ancêtres du football, dans des ouvrages consacrées au football, sont autant les ancêtres du rugby que du football et ressemble davantage à ce que j’appellerais de la bagarre.
<1092>
- D’abord ces jeux sont d’une grande violence ;
-
Mardi 19 juin 2018
« L’Episkyros grec et l’Haspartum romain»Ancêtres du football et aussi du rugbyNous en étions restés, hier, à des jeux chinois le tsu chu et japonais le kemari. Nous avons aussi évoqué des jeux de balle en Mésopotamie et en Egypte. Mais nous sommes une civilisation judéo gréco romaine.
Et pour commencer par les grecs, Philippe Villemus évoque dans son livre « Le Dieu football » « l’Episkyros » :
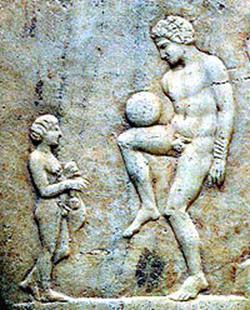 « Les traces les plus précises du football historique remontent à l’Antiquité grecque.
« Les traces les plus précises du football historique remontent à l’Antiquité grecque.
En visitant le siège de la FIFA, à Zurich, on peut admirer, dans la salle d’accueil, une sculpture offerte par la Grèce à l’occasion de sa qualification à la phase finale de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. Il s’agit d’une reproduction d’un bas-relief en marbre de 450 avant J.-C., dont l’original est au musée national d’archéologie d’Athènes. Il fut trouvé au Pirée, en 1836. La stèle représente un athlète nu jonglant avec une balle sur sa cuisse, et se privant volontairement de ses mains devant un enfant. Il lui enseigne sans doute cette technique de jonglage avec les membres inférieurs. […]
Les Grecs, en fait, jouaient à plusieurs jeux de balle : certains avec les mains, d’autres avec les pieds ou avec des instruments. Le rugby, le cricket, le handball et le football se réclament tous de ces sports hellénistiques. Au musée national d’Athènes, on peut observer un bas-relief montrant des athlètes grecs pratiquant une sorte de « hockey sur gazon » avec des crosses. Ce jeu avait sûrement été importé d’Égypte, où les jeux de crosses existaient déjà.
[…] Homère évoque déjà un jeu de balle pratiqué par les Phéaciens, peuple mentionné dans L’Odyssée . L’île de Phéacie, où Nausicaa accueillit Ulysse, est identifiée à Corcyre, aujourd’hui Corfou. Dans le chant VI, il décrit Nausicaa, la fille du roi Alkinoos, jouant à la balle avec ses compagnes. La balle tombe dans l’eau d’un ruisseau, près de la plage, où Ulysse a échoué. […] Le jeu episkyros, aussi appelé ephebike, fut pratiqué en Grèce dès 800 avant J.-C.
Une de ces règles essentielles était qu’on pouvait utiliser les mains, ce qui suggère une plus grande relation avec le rugby. Cependant, beaucoup de caractéristiques de l’episkyros étaient similaires au football, en particulier les dimensions du terrain et la composition des équipes à douze contre douze. Il était surtout joué à Sparte, et les joueurs se disputaient une vessie de bœuf gonflée, enveloppée dans un linge. L’écrivain Julius Pollux fait une description assez précise de ce loisir dans son Onomasticon 1 : « L’episkyros porte également les noms d’ephebike ou d’épicène . On trace à la craie entre les deux camps une ligne ; on pose la balle dessus. On trace ensuite deux autres lignes derrière chaque camp. Le premier camp lance la balle au-dessus de l’autre qui doit essayer de l’arrêter et de la relancer, sans franchir la ligne du milieu. Le jeu se termine quand un camp est bouté hors de la ligne de fond. » Était-ce une version antique du football, du rugby ou du handball ?
Tous les jeux grecs de balle, au pied ou à la main, se rapprochent de nos sports modernes. […] Le jeu le plus proche du football actuel était l’hasparton, aussi appelé pheninde (ce qui est paradoxal puisque hasparton est le mot grec qui désigne handball et non pas football). Un historien grec, Athénée, en fait un récit pittoresque dans Le banquet des Sophistes 3, au III e siècle après J.-C. : « Ayant pris la balle, il se plaisait à faire la passe à l’un tout en évitant l’autre ; il la faisait manquer à celui-ci, déséquilibrant celui-là et tout cela avec des bruits sonores : Je l’ai ! Balle longue ! Passe à côté ! Passe au-dessus ! En bas ! En haut ! Balle courte ! Passe derrière ! » Plus de 2 000 ans ont passé, mais le vocabulaire footballistique est resté le même. »
Les romains ont été des continuateurs des grecs sur les plans artistique, religieux et politique. Ils ont ainsi repris les jeux grecs de l’episkyros et l’hasparton. C’est une variante de ce dernier que les romains ont appelé l’Haspartum (on lit aussi parfois l’harpastum) qui est largement développé par Philippe Villemus. L’haspartum signifie en latin « le jeu à la petite balle ». Le terrain était un rectangle délimité, séparé par une ligne centrale. Les pieds étaient utilisés pour jouer à ce jeu, c’est probablement pour cette raison que l’auteur le décrit comme un ancêtre du football. .
La balle était plus petite (environ 18 centimètres de diamètre) et plus dure et on lit dans le livre :
« La solidité du ballon est attestée par un récit de Cicéron qui a raconté le cas d’un homme tué en recevant un ballon en pleine tête, alors qu’il se faisait raser chez un barbier ! »
Hier j’ai indiqué <ce documentaire> qui évoque (à partir de 4:20) l’haspartum en insistant qu’il s’agissait d’un jeu pratiqué par les légionnaires romains qui l’utilisait comme un entraînement militaire.
Philippe Villemus donne les détails suivants :
«Dans l’haspartum, pratiqué par les légionnaires, le but était d’amener la balle dans le camp adverse.
Pour fabriquer leurs ballons ou leurs balles, les Romains, comme les Égyptiens ou les Grecs, utilisaient plusieurs techniques selon le jeu de balle pratiqué. À la différence d’autres peuples, ils ne connaissaient pas le caoutchouc ou la gomme arabique. Certaines balles, dures (en bois), rebondissaient peu. On a retrouvé des balles faites de cheveux et de linges cousus ensemble dans les tombes égyptiennes datant de la période romaine. Pour fabriquer des « balles rebondissantes », les Romains utilisaient soit des vessies de porc ou de bœuf gonflées et recouvertes de la peau de l’animal, soit des intestins et des boyaux de chat hachés en forme de sphère et recouverts de cuir ou de peau, soit des éponges enveloppées dans des tissus ou enrobées de corde. En Turquie et en Égypte, on utilisait encore jusqu’à la fin du XXe siècle, dans certains villages, la technique des éponges comprimées par des cordes pour former une sphère, et ensuite protégées par un linge pour faire des balles.
Une mosaïque d’Ostie représente un ballon d’haspartum gonflé dans un gymnase. Une fresque d’une catacombe, à Rome, datant du Ier siècle après J.-C., montre des joueurs lançant la balle en l’air. […]
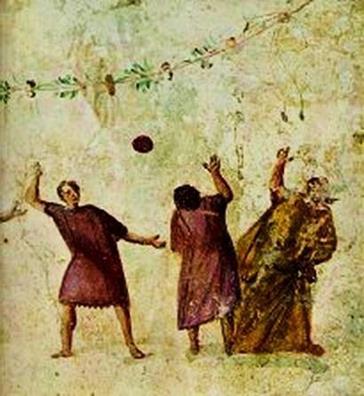 L’haspartum romain était extrêmement violent. Il ressemblait plus à une bataille rangée qu’à un jeu. Pratiqué par les militaires pour l’entraînement, on peut y voir l’origine de la tactique au football, avec une attaque, un milieu de terrain et une défense. »
L’haspartum romain était extrêmement violent. Il ressemblait plus à une bataille rangée qu’à un jeu. Pratiqué par les militaires pour l’entraînement, on peut y voir l’origine de la tactique au football, avec une attaque, un milieu de terrain et une défense. »
Dans le Satiricon de Pétrone l’haspartum est évoqué :
«Encolpe et Ascylte, les deux héros principaux, s’égarent, dans les premiers épisodes, aux thermes publics. On y voit Trimalchion (dont le nom aux racines sémitiques suggère l’idée de « puissant roi ») jouer à la balle dans un costume grotesque que n’aurait sans doute pas renié Federico Fellini. »
Galien, le médecin de Marc Aurèle, vante ainsi, au II e siècle après J.-C., l’haspartum :
« La supériorité du jeu de balle sur tous les autres sports n’a jamais été suffisamment mise en lumière par les auteurs qui m’ont précédé […]. Je dis que les meilleurs de tous les sports sont ceux qui non seulement font travailler le corps, mais sont de nature à amuser.»
Et l’auteur de continuer et nous faire comprendre que ce jeu ancêtre du football était finalement plus proche du rugby :
« Une règle importante de l’haspartum stipulait que seul le joueur en possession de la balle pouvait être empoigné, plaqué ou taclé . Cette restriction, majeure par rapport aux autres jeux de balle antiques, contribua au développement des passes et des combinaisons plus complexes. Les joueurs développèrent ainsi des rôles spécifiques et créèrent des stratégies et des tactiques plus élaborées. L’ haspartum resta populaire pendant près de 700 ans. Jules César, qui y joua sans doute lui aussi, utilisa ce sport pour entretenir la force physique de ses soldats. La propagation de l’haspartum à travers l’Europe se fit donc par les armées romaines. Les légionnaires exportèrent le jeu en Gaule, puis en Grande-Bretagne, où pourtant des jeux de balle moins sophistiqués (pas de terrain tracé, pas de règles spéciales) existaient déjà. On a trouvé des preuves de rencontres organisées entre des légionnaires romains et des habitants des îles britanniques ; en 276 après J.-C., une de ces rencontres « internationales » fut officiellement remportée par les Bretons, d’après des documents. À partir de cette date, l’Angleterre, de passion en interdiction, transformera peu à peu l’haspartum , qui va décliner sous sa forme originelle ; c’était quand même le sport de l’envahisseur ! »
<1091>
-
Lundi 18 juin 2018
« Le Tsu chu chinois et le Kemari japonais »Ancêtres du footballUn passionné d’Histoire comme moi, quand il veut approfondir le football va forcément s’intéresser à l’origine de ce jeu. Un groupe d’homo sapiens se partage en deux équipes et tape dans un ballon ou quelque chose qui peut faire office de balle.
<Ce documentaire très intéressant> commence par évoquer un jeu qui a été inventé il y a 3 400 ans au Mexique puis qui a été adopté par les Mayas. Il n’en reste pas moins que ce jeu ne se jouait pas au pied. Les « arènes » dans lesquelles se déroulaient cette pratique sont visibles dans toutes les villes vestiges des peuples mayas dans le sud du Mexique, notamment dans la péninsule du Yucatan. Munies d’une balle en caoutchouc pouvant peser jusqu’à plus de 3 Kg, deux équipes s’affrontent en se renvoyant la balle en la frappant à l’aide des hanches, des coudes des fesses ou des genoux, l’usage des mains et des pieds étant interdit. L’objectif est de renvoyer la balle sans qu’elle ne retouche le sol. A chaque faute, c’est-à-dire balle touchant le sol ou usage d’une partie interdite, l’équipe fautive perd un point et l’autre équipe en gagne un.
Ce jeu avait pour nom « le pok-a-tok ». Le terrain de jeu le plus ancien connu, découvert à Paso de la Amada, au Mexique, daterait de 1 600 avant J.-C. Le terrain mesurait environ 80 mètres de long entre deux murs ou deux rangées de gradins. Le terrain de Chichen Itza, le plus grand du monde maya, mesure 140 mètres sur 35 mètres.
<Cet article> en dit plus et évoque notamment le sujet du sacrifice humain à l’issue du jeu sans pouvoir déterminer si c’est le capitaine vainqueur ou perdant qui était tué.
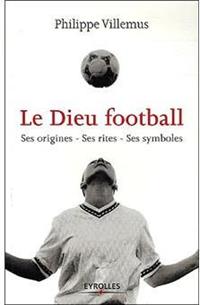 Mais pour en savoir plus j’ai emprunté « Le Dieu football – Ses origines – ses rites – ses symboles » de Philippe Villemus.
Mais pour en savoir plus j’ai emprunté « Le Dieu football – Ses origines – ses rites – ses symboles » de Philippe Villemus.
Dans ce livre, l’auteur pense que dès le début de l’histoire de l’humanité, les hommes ont dû jouer. Pour être plus précis, en remontant à l’aube des temps, le jeu débuta sans doute quand les premiers humains commencèrent à se transformer de chasseurs-cueilleurs en paysans-agriculteurs. Le temps des loisirs devint un élément de la vie quotidienne. Les jeux et les activités récréatives, individuels ou collectifs, apparurent dans une société où jusqu’alors les individus et les groupes étaient seulement préoccupés par la quête de nourriture, la protection contre les éléments et les ennemis, et l’affirmation de leur supériorité sur la nature
Et comme toujours, homo sapiens va inclure cette activité, a priori ludique dans notre ressenti moderne, dans des rites, des mythes et du religieux. Je cite le livre (page 30) :
« Dans les sociétés traditionnelles, toutes les activités sont marquées par les rites et le sacré. Nous verrons que les jeux de balle originels n’échappent pas à cette règle, en étant adroitement associés à des rituels religieux. »
Et, il est bien possible que les premiers ballons utilisés pour jouer à un football antique fussent des crânes humains :
« À Kingston-on-Thames, en Angleterre, on raconte une histoire tenace. Au XIe siècle, les Saxons vainquirent les Vikings qui venaient de débarquer et allaient envahir le bourg. Le chef viking eut la tête coupée par les vainqueurs. Les seigneurs saxons, selon la légende, poussèrent sa tête à coups de pieds dans les rues du village, comme un vulgaire ballon de foot. Bien avant cette triste histoire, dès que l’homme se tint sur ses deux jambes, on a dû jouer avec un crâne humain, d’abord avec les mains, ensuite avec les pieds. »
En tout cas, l’étrange fascination des hommes pour les jeux de balle remonte à la nuit des temps. Car les marques sont flagrantes et les historiens formels : dans toutes les civilisations, depuis que les hommes jouent, on a joué au « ballon », sous tous les cieux. Des traces de jeux de balle collectifs remontent à la plus haute Antiquité, en Asie, en Égypte, en Assyrie, en Grèce et à Rome. […] La maîtrise de la balle avec les pieds est sans doute apparue très tôt comme un art difficile qui exigeait une habileté très spéciale.
 Mais Philippe Villemus cite comme premier jeu de balle au pied un jeu chinois, dans l’Empire du Milieu appelé : « Le Tsu Chu » (parfois on trouve l’orthographe suivant « cuju »):
Mais Philippe Villemus cite comme premier jeu de balle au pied un jeu chinois, dans l’Empire du Milieu appelé : « Le Tsu Chu » (parfois on trouve l’orthographe suivant « cuju »):
« Le premier témoignage de l’histoire du jeu de balle au pied nous provient de l’empire chinois des Shang, près de 2 000 ans avant J.-C.[…] Les Shang connaissaient déjà l’écriture.[…] La légende attribue à l’empereur mythique Huang-Ti, vers 2 500 avant J.-C., l’invention d’un jeu de balle. Cette pratique faisait partie de l’entraînement militaire. La balle était ronde et en cuir de porc ou de chien. Elle devait être lancée au-delà de deux bâtons plantés.
Les autres traces avérées du football en Chine remontent à la période de 200 avant J.-C. Le livre des Han ( Han Shu ) retrace l’histoire de la première partie de la dynastie des Han (206 av. J.-C., 220 apr. J.-C.). Cet ouvrage a enregistré les faits et gestes des empereurs et parle d’un jeu de balle au pied. Pour les militaires chinois, cette activité au pied s’appelait tsu chu. Littéralement tsu chu signifie «frapper la balle avec le pied » ( tsu voulant dire « frapper du pied » et chu désignant la balle). Les scribes de la dynastie des Han nous apprennent que le ballon était fait de cuir rembourré de cheveux et de plumes. La balle devait être poussée avec les pieds et projetée dans un filet d’environ quarante centimètres, fixé à des bambous. Les joueurs pouvaient aussi utiliser la poitrine, le dos ou les épaules. Un poème attribué à Li Yu (136-50 av. J.-C.) décrit le jeu ainsi : « La balle est ronde, Le terrain carré pareil à l’image du ciel et de la terre. La balle vole au-dessus de nous comme le soleil Tandis que deux équipes se font face. » On notera l’analogie cosmique. Sous le règne de l’empereur Chengti, les soldats chinois jouaient au tsu chu en l’honneur de son anniversaire. Les vainqueurs devenaient rapidement des héros nationaux. On punissait les vaincus à coups de lanières. Le jeu devait donc être extrêmement violent et demandait une habileté diabolique pour faire passer la balle dans un filet de quarante centimètres de diamètre, situé parfois à plus de neuf mètres de hauteur entre deux bambous. […]
Toutes les parties du corps, sauf les mains, étaient autorisées pour marquer. »
Certains contestent absolument la descendance entre le Tsu chu chinois et le football, ainsi l’historien « Paul Dietschy » connu pour son ouvrage : « L’histoire du football ». Il développe cette thèse dans <cet article>
Et si la Chine connaissait le Tsu Chu, les japonais pratiquaient un autre jeu de balle au pied : « Le Kemari »
 « Il y a plus de 2 500 ans, les Japonais pratiquaient aussi un jeu de balle au pied : le kemari . Cette activité était bien distincte du tsu chu chinois, puisque c’était un divertissement plus « paisible », et non pas un entraînement militaire suivi de punition.
« Il y a plus de 2 500 ans, les Japonais pratiquaient aussi un jeu de balle au pied : le kemari . Cette activité était bien distincte du tsu chu chinois, puisque c’était un divertissement plus « paisible », et non pas un entraînement militaire suivi de punition.
Les joueurs pratiquaient le kemari avec beaucoup de courtoisie. La balle était en bambou recouverte de cuir. Pour y jouer, les princes et les courtisans, vêtus de costumes traditionnels, se réunissaient dans une cour ou un terrain bien délimité. L’objectif était de ne pas laisser tomber la sphère d’environ vingt centimètres de diamètre, à terre. Pour y parvenir on pouvait utiliser la tête, le genou ou le pied. Ce jeu, hautement symbolique, n’avait pas la violence du voisin chinois. Il était joué par huit personnes, au plus. Le terrain de jeu s’appelait le kikutsubo ; il était de taille rectangulaire avec un arbre planté à chaque coin (la version classique présentait quatre arbres différents : un érable, un pin, un cerisier et un saule pleureur). Les Japonais avaient même leur jargon kemari : quand il frappait la balle, le joueur criait ariyara ! (« Allons y ! ») Et quand il la passait à un autre joueur ari ! (« Ici ! »).
C’étaient les équivalents, en quelque sorte, des « la passe ! », « ici ! » ou « devant ! » des footballeurs d’aujourd’hui. La période d’or du kemari s’étala entre le Xème et le XVIème siècle. Le jeu se répandit dans les classes populaires et devint source d’inspiration pour les poètes et les auteurs. Une anecdote japonaise rapporte qu’un empereur et son équipe maintinrent la balle en l’air avec plus de mille coups de pied. Les poètes contemporains écrivirent que la balle « semblait suspendue en l’air, accrochée au ciel » Après cet exploit, la balle fut retirée et ennobli par l’empereur lui-même !
[…] Au musée de la FIFA, une estampe japonaise représente d’ailleurs des kemari japonais, en costume traditionnel, s’adonnant à cet ancêtre du football, dans une enceinte bien délimitée. Enfin, il y a des traces suggérant que les joueurs de kemari japonais et de tsu chu chinois s’affrontèrent en 50 avant J.-C. Ce fut, sans aucun doute, la première rencontre internationale de football, qui dut se dérouler dans une ambiance fascinante !
Le kemari est toujours pratiqué aujourd’hui par les Japonais qui veulent préserver les traditions anciennes.
Vous trouverez d’autres illustrations et d’explications sur <ce blog>
L’Égypte et la Mésopotamie qui constituent les racines de notre civilisation occidentale plus que les chinois et les japonais pratiquèrent aussi des jeux de balle, mais on n’en conserve pas le nom.
« Les Assyriens et les Égyptiens ont, eux aussi, pratiqué des jeux de balle. On a retrouvé, à Beni Hassan, en Haute Égypte, des peintures représentant des scènes de jeux de ballon. De nombreuses tombes de l’époque pharaonique contenaient des balles. Henri Garcia, dans La fabuleuse histoire du rugby, cite Frédéric Dillaye : « À Thèbes, dans des tombeaux égyptiens, on a trouvé des balles de son recouvertes de peau, et absolument faites comme les nôtres. » À Beni Hassan, la frise égyptienne représente plutôt des jongleries avec les mains et un jeu appelé la « balle cavalière », où des personnages juchés sur le dos de deux autres personnes se lancent alternativement des balles. Quand le cavalier, monté sur le dos de son équipier, ratait la balle, il devenait cheval ou âne à son tour. […]
Mais dans cette région d’Égypte, on a également trouvé une balle pleine, faite de feuilles de palmier, et une autre remplie de son et revêtue d’un cuir cousu avec de la ficelle, ce qui laisse à penser qu’elles étaient poussées avec les pieds. Les reliques remonteraient à 2 500 ans avant J.-C […]. Le manque d’information sur ces activités et leurs règles empêche d’en faire l’ancêtre direct du football. D’après certains historiens, les ballons remplis de graines, enrobés de linges coloriés, étaient envoyés avec les pieds dans les champs, durant les rituels de la fertilité en Ancienne Égypte. Pour un meilleur rebond, sans doute, les balles étaient aussi faites de boyaux de chats attachés en forme de sphère, et entourées de cuir ou de peau d’antilope.
En ce qui concerne les Assyriens, on sait qu’ils jouaient eux aussi à des jeux de boules.»
Ce sera tout pour aujourd’hui, mais l’Histoire est encore longue jusqu’à la coupe du monde de la FIFA.
<1090>
-
Vendredi 15 juin 2018
«Le football n’est pas une question de vie ou de mort, c’est quelque chose de bien plus important que cela.»Bill Shankly, (1913-1981) entraîneur de Liverpool de 1959 à 1974Liverpool est avec Manchester United le plus grand club de football anglais.
Bill Shankly (1913-1981) fut un de ses plus célèbres entraineurs.
Il était connu pour ses aphorismes sur le football :
«Quand vous êtes premier, vous êtes premier. Quand vous êtes deuxième, vous n’êtes rien.»
«Dans un club de foot, il y a une sainte trinité: les joueurs, les entraîneurs, les supporters. Les dirigeants ne sont là que pour signer des chèques.»
« La pression, c’est travailler à la mine. La pression, c’est être au chômage. La pression, c’est essayer d’éviter de se faire virer pour 50 shillings par semaine. Cela n’a rien à voir avec la Coupe d’Europe ou la finale de la Cup. Ça, c’est la récompense ! »
Mais il semble que pour les véritables passionnés de football en Angleterre la phrase la plus célèbre concernant le football est celle mise en exergue.
Il semble que la phrase exacte serait celle-ci :
«Certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je n’aime pas cette attitude. Je peux leur assurer que c’est beaucoup plus sérieux que cela.»
Un article de Slate du 31 août 2013 fait l’histoire de cette phrase et raconte :
« Finalement, la version la plus facilement trouvable de la phrase a été prononcée par Shankly en avril 1981, six mois avant sa mort, lors d’une interview pour la chaîne de télévision Granada TV : »
«Tout ce que j’ai, je le dois au football. Vous obtenez seulement de ce jeu ce que vous y investissez. Je m’y suis donc jeté corps et âme, à tel point que ma famille en a souffert.
– Avez-vous le moindre regret?
– Je le regrette beaucoup. Quelqu’un m’a un jour dit: « Pour vous, le football est une question de vie et de mort. ». J’ai répondu: « Ecoutez, c’est bien plus important que cela. » Et ma famille en a souffert, elle a été négligée.»
Il semblerait selon l’article que cette phrase a en réalité pour origine des entraineurs américains de football américain.
Mais le journaliste de Slate Jean-Marie Pottier analyse de manière plus approfondie le sens de cette phrase :
« Reste le principal débat: celui sur le sens de cette citation. Depuis la mort de son auteur, elle a souvent été réfutée: comment le football pourrait-il être encore plus important que la vie et la mort? Plus important que la vie d’un joueur, que le meurtre d’un arbitre, qu’une guerre, que le 11-Septembre?
L’aphorisme paraissait d’autant plus décalé [que] deux autres coachs mythiques de l’époque, Matt Busby et Jock Stein (qui lui ont été associés dans un beau documentaire) ont vu le foot les meurtrir dans leur chair: le premier a été grièvement blessé dans la catastrophe aérienne de Munich, en 1958, le second est mort d’une crise cardiaque sur le banc, lors d’un match qualificatif pour la Coupe du monde en 1985.
Quant au club de Liverpool, il fut, après la mort de Shankly, au cœur des deux grands drames du football des années 80: le Heysel en 1985 (39 morts à la suite d’une charge de supporters anglais sur une tribune) et Hillsborough en 1989 (96 morts dans un mouvement de foule). Dans son autobiographie, l’ailier des Reds John Barnes jugeait que cette dernière catastrophe faisait sonner la phrase de Shankly «encore plus faux»:
Les évènements du 15 avril 1989 à Hillsborough m’ont fait réaliser ce qui est vraiment important dans la vie. […] Le football a perdu sa signification obsessionnelle; il n’avait pas à être tout et l’aboutissement de tout. Comment pouvait-il l’être quand 96 personnes sont mortes, quand des parents ont perdu un enfant et des enfants un parent? La phrase de Bill Shankly selon laquelle « le football n’est pas une question de vie ou de mort, c’est bien plus important que cela » sonnait encore plus faux après Hillsborough. Le football est un jeu, une quête glorieuse, mais comment pourrait-il être plus important que la vie elle-même?»
Barnes n’est pas le seul à s’être servi de la phrase de Shankly comme d’un repoussoir: elle est régulièrement citée par les journalistes dès qu’un problème de violence envahit le football. Mais sans doute l’ont-ils comprise de travers: son auteur n’a pas asséné que «le football n’est pas qu’une question de vie ou de mort», mais «n’est pas une question».
Nuance de taille. Au Heysel comme à Hillsborough, le football était justement devenu une question de vie ou de mort, et rien d’autre, rendant le jeu dérisoire: des gens y sont passés de la vie à la mort lors d’un match de football. La phrase de Shankly, elle, écarte ce moment où l’on bascule entre vie et mort (voire entre victoire et défaite: il est d’ailleurs l’entraîneur le plus célèbre de Liverpool alors que c’est pourtant son successeur qui a de loin le palmarès le plus fourni) au profit de tout le reste.
De la façon, «bien plus importante», dont le football occupe une vie entière, au quotidien, dans les moments les plus intimes et infimes. Jour après jour, entraînement après entraînement, match après match, saison après saison.
Dans sa fameuse interview de 1981, Shankly, socialiste convaincu, échangeait ainsi sur sa vision du football avec l’ancien Premier ministre travailliste Harold Wilson:
«WILSON: C’est une religion aussi, n’est-ce pas?
SHANKLY: Je le pense, oui.
WILSON: Une façon de vivre.
SHANKLY: C’est une bonne expression, Sir Harold. Une façon de vivre. Tellement important que cela en devient incroyable.»
Le football n’est donc en effet pas une question de vie ou de mort. Lorsqu’il devient question de mort, il devient dérisoire.
Mais pour beaucoup c’est une question essentielle qui occupe tout l’espace de la vie disponible.
On peut certes juger cela excessif, déraisonnable mais cela correspond au quotidien d’un grand nombre de personnes et notamment des supporters des clubs anglais : Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea…
On dit toujours qu’un anglais quand il se présente ne parle pas comme un français du métier qu’il exerce mais du club de football dont il est le supporter.
Je ne juge pas, je constate.
Le football est quelque chose de très important pour un grand nombre de personnes.
En montant sur un piédestal et en me réfugiant derrière ma prétention d’obsession intellectuelle et artistique je dirais : « Le football occupe leurs journées, mais ne la remplit pas».
Mais en descendant de ce piédestal et en redevenant humble, comme il sied à quelqu’un qui a la tentation de comprendre le monde, je dois reconnaître que : « Le football remplit leurs journées ».
Et qui suis-je pour juger ?
Même si je peux éprouver un regret, en constatant comme Eduardo Galeano que derrière cette passion dévorante de gens que je ne permets pas de juger, des personnes cupides tirent les ficelles et profitent de l’importance que le football représente dans la vie de ces passionnés pour en tirer des profits indécents.

Vous voyez ci-dessus la porte du stade de Liverpool qui a pour nom « Shankly Gate »
Cette porte est surmontée du titre du chant que les supporters de Liverpool entonnent pour encourager leur équipe : « You’ll never walk alone ».
Derrière <ce lien> vous trouverez une des nombreuses vidéo qui vous montrent le peuple des supporters d’Anfield chanter leur hymne.
Ces supporters communient ensemble et son unis par une cause qui les dépasse.
Exactement comme une communauté religieuse rassemblée par une ferveur mystique.
La vidéo n’est certainement qu’un pâle reflet de ce qui se vit et se passe dans le stade.
En tout cas cela explique mieux que par des mots ce que j’ai écrit ci-avant.
<1089>
-
Jeudi 14 juin 2018
«Un vide stupéfiant : l’Histoire officielle ignore le football.»Eduardo Galeano dans « Football, ombre et lumière »Quand je décide d’écrire une série de mots comme celle en cours, je ne pars jamais de rien : je dispose d’informations, de connaissances, de lectures, de vidéos me permettant de savoir que je peux écrire des articles ayant quelque consistance.
Mais très souvent, au cours de mes recherches, je découvre des auteurs, des inspirateurs qui m’apportent des compréhensions nouvelles.
Il en est ainsi d’Eduardo Hughes Galeano que je ne connaissais pas. Il est né en 1940 à Montevideo et mort en 2015 dans la même ville. C’est un écrivain, journaliste et dramaturge uruguayen, célèbre pour avoir écrit « Les Veines ouvertes de l’Amérique latine. » qui est un acte d’accusation contre l’exploitation de l’Amérique latine par les puissances étrangères depuis le XVe siècle.
Il était un militant de gauche qui a été emprisonné par la dictature militaire de 1973 en Uruguay, par la suite il a dû s’exiler. Il a aussi fait partie des dix-neuf personnalités qui ont proposé et signé le manifeste de Porto Alegre.
Dès qu’on creuse un peu le sujet du football d’une manière analytique, de son rôle dans la société, de sa géopolitique on tombe immanquablement sur la citation de l’ouvrage qu’il a écrit « Football, ombre et lumière », paru en espagnol en 1995 avant d’être traduit trois ans plus tard en français.
Et lorsque France Inter dans son émission de ce dimanche 10 juin « Le grand face à face » invite Vincent Duluc de l’Equipe pour parler de la Coupe du Monde en Russie, c’est encore l’ouvrage de Galeano qui est cité comme exemple de compréhension de ce que représente le football et son évolution.
Galeano a écrit sur la 4ème page de couverture de son ouvrage :
« Pendant des années, je me suis senti défié par le sujet, la mémoire et la réalité du football, et j’ai eu l’intention d’écrire quelque chose qui fût digne de cette grande messe païenne, qui est capable de parler tant de langages différents et qui peut déchaîner tant de passions universelles »
J’ai emprunté le livre de Jean-Claude Michéa : « Les intellectuels le peuple et le ballon rond » qui est un hommage au livre de Galeano.
Michéa écrit :
« Au train où vont les choses, on peut donc se demander si la FIFA ne finira pas, un jour, par autoriser les clubs les plus riches (le fameux « G14 ») à recruter à la mi-temps d’un match clé, les meilleurs joueurs de l’équipe adverse, dans le but louable de sécuriser par un résultat encore plus prévisible, leurs investissements financiers et leur cotation en bourse. D’un autre côté, peut-être parce qu’«avec le danger croît aussi ce qui sauve », il est réconfortant de constater que, depuis l’époque où Galeano écrivait son livre, un certain nombre de travaux universitaires sont parus, qui témoignent enfin d’une compréhension intelligente de l’univers du football et de la culture populaire qui est associée. »
Car c’est bien ce que décrit Galeano un jeu populaire pour le peuple mais qui est devenu de plus en plus dévoyé en raison des puissances de l’argent.
Lui-même aimait jouer au football même s’il reconnait qu’il n’était bon joueur que dans ses rêves :
« Comme tous les Uruguayens, j’ai voulu être footballeur. Je jouais très bien, j’étais une vraie merveille, mais seulement la nuit, quand je dormais : pendant la journée, j’étais la pire jambe de bois qu’on ait vue sur les terrains de mon pays. »
Il faut rappeler que l’Uruguay fut le premier pays qui gagna la coupe du monde en 1930 et la gagna une seconde fois au Brésil en 1950 déclenchant le désespoir du peuple brésilien.
Le journaliste Antoine de Gaudemar avait, dans un article du 12 février 1998, offert cette description du livre dans libération :
« Eduardo Galeano est depuis toujours un fou de foot. Mais il a mis longtemps à le reconnaître, à assumer son identité de supporter: un supporter un peu particulier, sans port d’attache, sans tribune, seulement en quête d’un «miracle» sur gazon, où qu’il se produise et d’où qu’il vienne. Toute sa vie, au hasard de ses voyages, il est allé de par les stades, tel «un mendiant de bon football», implorant, «chapeau dans les mains»: «Une belle action, pour l’amour de Dieu !».
En 1995, âgé de 55 ans, après s’être senti toute sa vie «défié par le sujet», mais sans doute comblé par sa moisson, il décide de «faire avec les mains» ce qu’il n’a «jamais été capable de faire avec les pieds»: écrire sur le football «quelque chose qui fût digne de cette grande messe païenne», «demander aux mots ce que la balle, si désirée, (lui) avait refusé».
Traduit à la veille du prochain championnat du monde, le Football ombre et lumière est ainsi composé d’une centaine de courts textes, n’excédant pas deux pages. Chacun d’eux est consacré à l’un des multiples aspects du jeu: origines, règles, histoires de clubs, souvenirs de matches et de gestes parfaits, portraits de joueurs de génie, buts d’anthologie, mais aussi l’envers du décor, la corruption, le racisme, l’idolâtrie, les fins de carrière misérables, l’oubli.
Ecrits comme des nouvelles, […] ces textes révèlent toute l’étendue de la planète foot, mi-ombre mi-soleil, car l’histoire du football «est un voyage triste, du plaisir au devoir». Sous la domination de l’argent et de la technocratie, ce sport s’est transformé en industrie, le jeu en spectacle: heureusement, on voit encore sur les terrains «un chenapan effronté qui s’écarte du livret» et qui, pour le simple plaisir du corps, «se jette dans l’aventure interdite de la liberté». […]
A la fois anecdotique et érudit, l’ouvrage d’Eduardo Galeano forme un kaléidoscope. Il est comme une mémoire fragmentée et reconstituée, à la mesure du «vide stupéfiant» qui règne autour de ce sport, tant «l’histoire officielle ignore le football», ce nouvel opium des peuples. C’est vrai, accorde Eduardo Galeano, que le football ressemble à Dieu «par la dévotion qu’ont pour lui de nombreux croyants et par la méfiance de nombreux intellectuels à son égard» »
Antoine de Gaudemar évoque le voyage triste dont l’extrait plus complet est le suivant :
« L’histoire du football est un voyage triste, du plaisir au devoir. À mesure que le sport s’est transformé en industrie, il a banni la beauté qui naît de la joie de jouer pour jouer. En ce monde de fin de siècle, le football professionnel condamne ce qui est inutile, et est inutile ce qui n’est pas rentable. Il ne permet à personne cette folie qui pousse l’homme à redevenir enfant un instant, en jouant comme un enfant joue avec un ballon de baudruche et comme un chat avec une pelote de laine : danseur qui évolue avec une balle aussi légère que la baudruche qui s’envole et que la pelote qui roule, jouant sans savoir qu’il joue, sans raison, sans chronomètre et sans arbitre.
Le jeu est devenu spectacle, avec peu de protagonistes et beaucoup de spectateurs, football à voir, et le spectacle est devenu l’une des affaires les plus lucratives du monde, qu’on ne monte pas pour jouer mais pour empêcher qu’on ne joue. La technocratie du sport professionnel a peu à peu imposé un football de pure vitesse et de grande force, qui renonce à la joie, atrophie la fantaisie et proscrit l’audace. »
La conclusion du livre a pour titre : « La fin du match » :
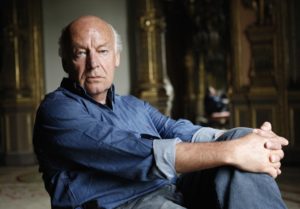 « Roule la balle, le monde roule. On soupçonne le soleil d’être un ballon de feu, qui travaille le jour et fait des rebonds la nuit dans le ciel, pendant que la lune travaille, bien que la science ait des doutes à ce sujet. En revanche, il est prouvé, et de façon tout à fait certaine, que le monde tourne autour de la balle qui tourne : la finale du Mondial 94 fut regardée par plus de deux milliards de personnes, le public le plus nombreux de tous ceux qui se sont réunis tout au long de l’histoire de la planète. La passion la mieux partagée : nombre des adorateurs du ballon rond jouent avec lui dans les stades ou les terrains vagues, et un bien plus grand nombre encore prennent place à l’orchestre, devant le téléviseur, pour assister, en se rongeant les ongles, au spectacle offert par vingt-deux messieurs en short qui poursuivent la balle et lui prouvent leur amour en lui donnant des coups de pied.
« Roule la balle, le monde roule. On soupçonne le soleil d’être un ballon de feu, qui travaille le jour et fait des rebonds la nuit dans le ciel, pendant que la lune travaille, bien que la science ait des doutes à ce sujet. En revanche, il est prouvé, et de façon tout à fait certaine, que le monde tourne autour de la balle qui tourne : la finale du Mondial 94 fut regardée par plus de deux milliards de personnes, le public le plus nombreux de tous ceux qui se sont réunis tout au long de l’histoire de la planète. La passion la mieux partagée : nombre des adorateurs du ballon rond jouent avec lui dans les stades ou les terrains vagues, et un bien plus grand nombre encore prennent place à l’orchestre, devant le téléviseur, pour assister, en se rongeant les ongles, au spectacle offert par vingt-deux messieurs en short qui poursuivent la balle et lui prouvent leur amour en lui donnant des coups de pied.
À la fin du Mondial 94, tous les garçons qui naquirent au Brésil s’appelèrent Romario, et la pelouse du stade de Los Angeles fut vendue par petits morceaux, comme une pizza, à vingt dollars la portion. Folie digne d’une meilleure cause ? Négoce vulgaire et inculte? Usine à trucs manipulée par ses propriétaires ? Je suis de ceux qui pensent que le football peut-être cela, mais qu’il est également bien plus que ça, comme fête pour les yeux qui le regardent et comme allégresse du corps qui le pratique. Un journaliste demanda à la théologienne allemande Dorothée Solle :
– Comment expliqueriez-vous à un enfant ce qu’est le bonheur ?
– Je ne le lui expliquerais pas, répondit-elle. Je lui lancerais un ballon pour qu’il joue avec.
Le football professionnel fait tout son possible pour castrer cette énergie de bonheur, mais elle survit en dépit de tout. Et c’est peut-être pour cela que le football sera toujours étonnant.
Comme dit mon ami Angel Ruocco, c’est ce qu’il a de meilleur : son opiniâtre capacité de créer la surprise. Les technocrates ont beau le programmer jusque dans ses moindres détails, les puissants ont beau le manipuler, le football veut toujours être l’art de l’imprévu. L’impossible saute là où on l’attend le moins, le nain donne une bonne leçon au géant et un Noir maigrelet et bancal rend fou l’athlète sculpté en Grèce.
Un vide stupéfiant : l’Histoire officielle ignore le football. Les textes de l’histoire contemporaine ne le mentionnent pas, même en passant, dans des pays où il a été et est toujours un signe primordial d’identité collective. Je joue, donc je suis : la façon de jouer est une façon d’être, qui révèle le profil particulier de chaque communauté et affirme son droit à la différence. Dis-moi comment tu joues et je te dirai qui tu es : il y a bien longtemps qu’on joue au football de différentes façons, qui sont les différentes expressions de la personnalité de chaque pays, et la sauvegarde de cette diversité me semble aujourd’hui plus nécessaire que jamais.
Nous vivons au temps de l’uniformisation obligatoire, dans le football et en toute chose. Jamais le monde n’a été aussi inégal dans les possibilités qu’il offre et aussi niveleur dans les coutumes qu’il impose : en ce monde fin de siècle, celui qui ne meurt pas de faim meurt d’ennui. »
<Alternatives Economiques> qui évoque aussi ce livre conclut de la manière suivante :
« Admirateur [des grands footballeurs], Eduardo Galeano souligne combien le football nourrit et se nourrit des enjeux sociaux et sociétaux les plus forts : inégalités, racisme, pauvreté, libéralisme exacerbé, revanche sociale, la victoire et la défaite, etc. La puissance symbolique d’un sport qui reste le « grand oublié de l’histoire officielle ». »
Voilà un exemple de complexité où le bonheur de jouer avec un ballon côtoie un voyage triste au milieu d’organisations corrompues et de financiers cupides. Car le football fait partie de nos sociétés et représente une part de notre Histoire.
Rappelons que les scènes de joie sur les Champs Élysées en 1998, après la victoire de la France en coupe du monde n’avaient qu’un évènement équivalent en terme de foule en liesse : La libération de Paris et la victoire de la seconde guerre mondiale. Si on ne perçoit pas cette dimension, on passe à côté d’un élément de compréhension de la société telle qu’elle est. Et cela même si on n’aimerait pas le football, ce qui n’est pas mon cas ou si on est désabusé par les dérives financières de ce sport, ce que je partage.
<1088>
-
Mercredi 13 juin 2018
« La France est l’équipe la plus chère de celles qui participent à la coupe du monde 2018 »Constat économique primaireCe que je sais de la morale, c’est au football que je le dois, disait Camus.
Pour apprendre la morale on peut passer par des expériences positives mais aussi négatives.
Tous ceux qui s’intéressent au football se souviennent du match de football de Séville, ½ finale de la coupe du monde, dans lequel le gardien allemand Harald Schumacher lors d’une sortie rageuse est venu heurter violemment le français Patrick Battiston alors qu’il n’était plus en possession du ballon. Le joueur français sera évacué du terrain, inanimé, sur une civière. Il aura perdu trois dents, une vertèbre sera endommagé et il devra porter une minerve plusieurs mois et même la porter pendant la cérémonie de son mariage. Les conséquences auraient pu être encore plus désastreuses s’agissant des cervicales. <Cette vidéo montre le choc et surtout la rencontre de Schumacher qui vint rendre visite à Battiston pour s’excuser>.
Il y a d’autres exemples moins brutaux mais aussi immoraux, comme par exemple la main de Thierry Henry qui permit à la France d’éliminer l’Irlande pour se qualifier pour la coupe du monde 2010. La France se qualifia mais les joueurs eurent un comportement délétère en Afrique du Sud et furent éliminés piteusement. La morale était finalement sauve, la victoire injuste ne profita pas aux tricheurs.
Mais le football ce n’est pas que cela et Thierry Henry eut été inspiré de suivre l’exemple de son entraîneur emblématique du club d’Arsenal : Arsène Wenger.
Lors d’un 8ème de finales de la coupe d’Angleterre opposant Arsenal à Sheffield United, le 13 février 1999, le but de la victoire d’Arsenal fut marqué par son avant-centre sur une touche rapidement jouée alors que les joueurs de Sheffield avaient sorti volontairement le ballon du terrain à la suite de la blessure d’un des leurs. C’est une règle non écrite, une règle de fair play quand une équipe sort le ballon du terrain en raison de la blessure d’un joueur, l’équipe adverse rend le ballon à cette équipe lors de la touche qui suit. Mais ce n’est pas ce que fit le joueur d’Arsenal et son club se qualifia.
Mais, à l’issue du match, Arsène Wenger, l’entraîneur d’Arsenal proposa que la rencontre soit rejouée dans son intégralité dix jours plus tard. Les dirigeants de Sheffield United acceptèrent et le match fut rejoué.
Il existe aussi de ces exemples-là dans le football.
Et ce n’est pas le seul, cet article de l’express cite d’autres cas :
- En mai 2005, alors qu’il évolue au Werder Brême, Miroslav Klose bénéficie d’un penalty contre Bielefeld. En disant lui-même qu’il n’y pas faute, il obtient de l’arbitre qu’il annule sa décision.
- Enfin, on a coutume de dire que les Italiens sont truqueurs, et pourtant Thierry Henry aurait été bien inspiré de suivre l’exemple de Daniele De Rossi. En 2006, sous les couleurs de l’AS Rome, Daniele De Rossi marque de la main. Les joueurs de Messine protestent. L’arbitre les ignore et valide le but. De Rossi s’avance alors vers lui et lui signale sa faute. Le but est annulé.
Pour moi, le football c’est aussi d’autres souvenirs. Alors que j’habitais Montreuil , avec deux autres pères Dominique et Yves nous emmenions nos garçons jouer, le dimanche, au football dans le parc des Beaumont, à côté de notre résidence. Le plus souvent d’autres jeunes garçons issus des cités et de ce qu’on appelle la diversité aujourd’hui venait nous rejoindre et demander de jouer avec nous. Ce furent des moments d’échanges et de joies simples qui me nourrissent encore. Lorsque pendant la semaine, déguisé en fonctionnaire cravaté et après avoir travaillé pendant la journée dans les immeubles de Bercy, je rentrais à Montreuil, je rencontrais parfois ces jeunes garçons qui me saluaient alors, les yeux plein de lumière. Car le football a aussi cette faculté de faire tomber les barrières et de rapprocher les humains.
Le football professionnel d’aujourd’hui constitue certainement un exemple explicite des dérives de l’économie d’aujourd’hui :
- la concentration des réussites,
- la richesse en argent qui donne un avantage comparatif excessif
Il n’est ainsi que le reflet de notre époque.
Il est vrai que lorsqu’on analyse la compétition la plus lucrative du football : la ligue des champions on constate les choses suivantes :
- Les 20 dernières ligues des champions ont été gagnées par seulement 8 clubs
- Mais la moitié soit 10 ont été gagnées par les deux clubs espagnols du Real de Madrid (6) et de Barcelone (4)
- 3 Clubs ont gagné chacun deux trophées (AC Milan, Manchester United, Bayern de Munich)
- Il reste 4 clubs qui n’ont gagné qu’une fois l’Inter Milan, Liverpool, Chelsea et le FC Porto.
Il y a donc bien, concentration des réussites et surtout tous ces clubs font partie des plus riches.
Selon ce classement publié en janvier 2018 après une étude du cabinet Deloitte, les 4 clubs les plus riches ont gagné 14 des 20 titres.
Tous les autres, à l’exception de Porto font partie des 15 plus riches.
L’AC Milan, le club de Berlusconi, n’en fait plus partie mais était dans le top 10 lorsqu’il gagnait.
Pourtant l’argent ne suffit pas, Manchester City et le Paris Saint Germain sont riches mais ne gagnent pas. Parce qu’il ne suffit pas de mettre les joueurs les plus chers ensemble, encore faut-il faire équipe.
Et cela aussi est une leçon du football, il faut faire une équipe qui joue ensemble.
Alors si nous nous intéressons à la coupe du monde qui commence demain, nous constatons aussi une formidable concentration, pire que celle de la ligue des champions.
Depuis 1930, 20 coupes du monde ont eu lieu, l’actuel en Russie est la 21ème.
Et si 8 clubs ont gagné les 20 dernières ligue des champions, il y aussi 8 nations qui ont emporté tous les trophées.
- 3 d’entre elles (Brésil, Allemagne et Italie) en ont gagné 13 soit 65 % des victoires.
- 2 pays d’Amérique du Sud ont gagné chacun deux victoires, l’Uruguay et l’Argentine, soit 20 %.
- Il ne reste que 3 victoires, soit 15%, pour l’Angleterre, la France et l’Espagne.
On constate qu’il s’agit d’une affaire entre l’Europe (11 victoires) et l’Amérique du Sud (9 victoires), les autres continents ne sont pas présents.
Si on s’intéresse aux finalistes, 12 des finalistes font aussi partie des 8 vainqueurs et pour les 8 places qui restent il n’y a que 4 nations (Pays Bas 3x, Hongrie et Tchécoslovaquie 2x, Suède 1 fois)
Il y a même des affiches qui sont identiques (Allemagne – Argentine 3x) (Brésil-Italie 2x)
Il existe un constat plus surprenant encore, entre 1950 et 2002, il y a eu 14 finales. A part, celle de 1978 qui opposa L’Argentine aux Pays Bas, dans toutes les autres finales il y avait soit le Brésil, soit l’Allemagne qui étaient présents mais sans jamais se rencontrer avant celle de 2002. Ils ne se rencontrèrent pas en Finale mais pas non plus dans aucun autre match du tournoi.
C’est assez extraordinaire quand on songe que ce sont les deux nations qui se sont plus souvent qualifiés et qui ont fait le plus de matchs de coupe du monde. Depuis 2002, ils se sont rencontrés une nouvelle fois en 2014, en demi-finale, lorsque l’Allemagne humilia les brésiliens au Brésil (7-1).
Alors pour conclure ce second mot du jour de la série football et trouver un exergue à cet article, je reviens vers l’économie et le football.
Et c’est justement le magazine économique les échos qui révèle ce constat qu’en faisant la somme de la valeur marchande de chaque joueur, car un joueur de football a une valeur marchande, c’est la France qui est l’équipe la plus chère de la coupe du monde.
Les économistes voudraient y voir un heureux présage pour ceux qui souhaitent la victoire de la Francei. Mais seule une équipe peut espérer gagner la victoire finale, non l’assemblage d’individualités.
Cette coupe du monde nous révélera si les joueurs français forment une équipe.
C’est une belle leçon morale au sens d’Albert Camus.
<1087>
- En mai 2005, alors qu’il évolue au Werder Brême, Miroslav Klose bénéficie d’un penalty contre Bielefeld. En disant lui-même qu’il n’y pas faute, il obtient de l’arbitre qu’il annule sa décision.
-
Mardi 12 juin 2018
«Ce que je sais de la morale, c’est au football que je le dois… »Citation attribuée à Albert CamusLa coupe du monde de football commence ce jeudi 14 juin 2018.
Je vais tenter de consacrer une série de mots du jour au football en étant conscient de la difficulté de la tâche.
Il est question de jeu (à rapprocher du <panem et circenses> des romains), il est question de passions, de violence, d’argent, de tricherie, de marchandisation d’êtres humains.
Il est question aussi d’équipes, d’entraînements, d’efforts, de discipline, de beauté du geste.
J’ai conscience que la quête d’intelligence, de critique, de mesure et d’équilibre risquent de mécontenter tout le monde.
- Les passionnés du « beau jeu » qui ne souhaitent pas que l’on parle du côté obscur de ce sport qui depuis longtemps a attiré les cupides du monde.
- Les indifférents et plus encore les « hostiles » à ce jeu qui est alors résumé par cette phrase cinglante : « un jeu financé par des gens modestes qui paient très chers pour aller regarder des millionnaires courir après un ballon » seront quant à eux exaspérés qu’on puisse consacrer du temps de cerveau et de réflexion à ce sport qui déclenchent tant de ferveur chez des millions de gens dans les stades et devant les écrans.
Je vais tenter pourtant de le faire, d’abord pour apprendre moi-même, ensuite pour essayer de mieux comprendre les aspects contradictoires : éclairer l’ombre par la lumière et percevoir l’ombre malgré la lumière.
Ce n’est pas la première fois que des mots du jour sont consacrés au football.
- En septembre 2015 : « Les footballeurs sont-ils des produits financiers ? »
- En décembre 2014 : «Je suis sorti de la dépression en achetant un club de foot»
Et aussi lors du précédent mondial au Brésil :
- Le 3 juin 2014 : « Un enfant pleure, devant lui, dans son assiette, un ballon de foot a remplacé les aliments »
- Le 12 juin 2014 : «On a rarement vu si étroitement rapproché [que pour cette coupe du monde au Brésil] l’arrogance de la richesse et du marketing et l’urgence de la pauvreté et du développement»
- Le 15 juillet 2014 : «la finale de la Coupe du monde symbolise les progrès de la parité en politique»
Ces différents articles étaient « à charge » et mettait le projecteur sur les dérives actuelles..
Je ne suis pas ignare en matière de football. Dans ma famille il y avait deux passions : la musique classique et le football. Mon frère Gérard était violoniste et mon frère Roger était footballeur amateur.
Pendant de nombreuses années, je l’ai accompagné sur les terrains de Moselle et de Lorraine, dans des villes et villages dont j’ignorerais le nom si le football ne me les avait pas fait croiser. Je me souviens encore avec ravissement du club de l’US Froidcul, ainsi que tous les clubs en ange : Hayange, Hagondange, Talange etc. Ainsi que le club de Blénod qui était un quartier de Pont à Mousson et dont les habitants s’appelaient les Bélédoniens.
A partir de 1966, avec la coupe du monde en Angleterre je me suis aussi intéressé au football international. Ainsi sans effort et sans note je peux donner, depuis le début c’est-à-dire 1930, les années, les pays organisateurs, les vainqueurs et même les finalistes. Je ne me souviens pas toujours du score.
Comme point d’entrée dans cette série, c’est mon ami Jean-François de Dijon qui m’a donné la clé ou plutôt m’a posé une question lors de l’été 2017 :
« Est-ce que tu pourrais voir si Albert Camus a vraiment écrit « Ce que je sais de la morale, c’est au football que je le dois… » ? ».
Et bien sûr en faire un mot du jour…
La citation est intéressante sur le fond, mais est-elle authentique ?
Beaucoup de sites internet répètent cette phrase et l’attribue à Albert Camus.
Dans mes recherches pour cette série, j’ai découvert un auteur essentiel qui est l’uruguayen Eduardo Galeano sur lequel je reviendrai, il cite cette phrase dans son livre qui fait référence : « Football, ombre et lumière ».
Mais le problème, c’est que nul ne donne la référence de la source permettant de vérifier.
<Le site sofoot> qui est la bible de celles et ceux qui intellectualisent le football rapporte aussi ce propos mais cite une version de 1959, plus complète, mais en ne citant toujours pas la source.
En revanche, ce site parle abondamment du lien qui unissait Albert Camus et le football :
Ah qu’elle a fait le bonheur des journalistes sportifs et autres ministres en manque d’alibis littéraires, la célèbre formule –« Ce que je sais de la morale, c’est au football que je le dois »! Et pourtant, elle dit bien peu de choses sur le rapport véritable qu’entretenait Camus avec le football.
[…]
Illustration parfaite le 23 octobre 1957, au Parc des Princes. Le Racing Club de Paris reçoit Monaco sous les caméras des « actualités françaises ». Sur une descente d’un ailier monégasque, qui largue une grosse frappe lourdingue à la trajectoire mollement bondissante, le gardien parisien se troue et la balle finit au fond des filets. Le reporter se tourne alors vers un « spectateur parmi les 35 000 spectateurs », debout en imper-cravate: Albert Camus, 44 ans, tout juste auréolé de son prix Nobel. Les malheurs du goal du Racing reçoivent chez l’écrivain « l’indulgence d’un confrère », qui le défend d’une phrase toute compassionnelle: « Il ne faut pas l’accabler. C’est quand on est au milieu des bois que l’on s’aperçoit que c’est difficile« . La nouvelle gloire nationale sait de quoi elle parle: « j’étais goal au Racing Universitaire Algérois », cloute l’écrivain, comme pour donner plus de poids encore à son propos.
<Sur ce site vous verrez une vidéo de l’INA> qui montre cet échange entre le journaliste et Albert Camus pendant la finale de la coupe de France (0:59).
 Le Racing Universitaire Algérois, voilà la grande affaire de Camus. « Je ne savais pas que vingt ans après, dans les rues de Paris ou de Buenos Aires (oui ça m’est arrivé) le mot RUA prononcé par un ami de rencontre me ferait battre le cœur le plus bêtement du monde », s’épanche-t-il un rien grandiloquent, contrairement à son habitude. S’il supporte le RC Paris, il n’y a d’ailleurs pas de hasard: « Je puis bien avouer que je vais voir les matchs du Racing Club de Paris, dont j’ai fait mon favori, uniquement parce qu’il porte le même maillot que le RUA, cerclé de bleu et de blanc. Il faut dire d’ailleurs que le Racing a un peu les mêmes manies que le RUA. Il joue ‘scientifique’, comme on dit, et scientifiquement, il perd les matchs qu’il devrait gagner », confie-t-il au journal du RUA, repris par France Football, à l’époque. Le mauvais sort de la ville lumière ne semble apparemment pas dater du PSG.
Le Racing Universitaire Algérois, voilà la grande affaire de Camus. « Je ne savais pas que vingt ans après, dans les rues de Paris ou de Buenos Aires (oui ça m’est arrivé) le mot RUA prononcé par un ami de rencontre me ferait battre le cœur le plus bêtement du monde », s’épanche-t-il un rien grandiloquent, contrairement à son habitude. S’il supporte le RC Paris, il n’y a d’ailleurs pas de hasard: « Je puis bien avouer que je vais voir les matchs du Racing Club de Paris, dont j’ai fait mon favori, uniquement parce qu’il porte le même maillot que le RUA, cerclé de bleu et de blanc. Il faut dire d’ailleurs que le Racing a un peu les mêmes manies que le RUA. Il joue ‘scientifique’, comme on dit, et scientifiquement, il perd les matchs qu’il devrait gagner », confie-t-il au journal du RUA, repris par France Football, à l’époque. Le mauvais sort de la ville lumière ne semble apparemment pas dater du PSG.
Albert Camus rejoint le RUA en 1929, après avoir débuté à l’AS Monpensier, bien qu’il loge alors au Belcourt où sa mère s’est installée en 1914 tandis que son père s’en allait défendre la patrie –voyage dont il ne reviendra pas. De ses années de gardien de but, Camus gardera d’abord une certaine frustration: ses rêves, pas complètement infondés, d’entamer une carrière sérieuse de goal sont fauchés nets par une tuberculose qui se manifeste dès ses 17 ans. Cette maladie sera sa malédiction, comme il le laisse entendre lorsque qu’il évoque ses tentatives ultérieures de renouer avec le jeu: « Lorsqu’en 1940, j’ai remis les crampons, je me suis aperçu que ce n’était pas hier. Avant la fin de la première mi-temps, je tirais aussi fort la langue que les chiens kabyles qu’on rencontre à deux heures de l’après-midi, au mois d’août, à Tizi-Ouzou. » Cela ne l’arrêtera pas complètement et il écrit encore en 1941 à Lucette Maeurer, qu’il est « avant-centre » dans une équipe de « grandes brutes ». Maigre consolation.
[…]
S’il ne deviendra jamais un grand gardien, Camus restera toute sa vie passionné de ce sport : quand avec l’argent du prix Nobel, il s’offre une propriété à Lourmarin dans le Lubéron, loin du tumulte dramatique algérois ou parisien, il occupe ses dimanches à traîner sur le bord du terrain en regardant les enfants du club local s’entraîner ou matcher contre le village voisin. Il ira même jusqu’à les sponsoriser et payer leur maillot. Le foot est, pour l’écrivain, un jardin secret au parfum d’enfance … celle passée dans le quartier de Belcourt, à Alger. Une madeleine de Proust pied-noir qu’il déclinera dans la bouche de Jean-Baptiste Clamence, le héros bovarien (moi c’est lui et vice et versa) de La Chute (récit qui signe en 1956 sa rupture avec les existentialistes et le milieu intellectuel parisien ): « Maintenant encore, les matchs du dimanche, dans un stade plein à craquer et le théâtre, que j’ai aimé avec une passion sans égale, sont les seuls endroits au monde où je me sente innocent
Voilà la passion simple et aussi l’indulgence de ce grand écrivain et intellectuel pour le football.
Mais pour savoir répondre à Jean-François, j’ai trouvé cet article, du 15 janvier 2010, du philosophe Jean Montenot sur le site de l’express
Jean Montenot évoque d’abord ce qu’il appelle cette sentence :
« Ce que je sais de plus sûr à propos de la moralité et des obligations des hommes, c’est au sport que je le dois »
Et ajoute, sentence parfois modifiée en :
« C’est au football que je le dois ! »
Et de préciser :
« Pourtant, ces propos, tirés d’un entretien donné en 1953 au bulletin du Racing universitaire d’Alger (pour lequel Camus avait joué comme gardien de but en junior), témoignent de l’importance qu’il accordait à ce sport, véritable école de la vie : « J’appris tout de suite qu’une balle ne vous arrivait jamais du côté où l’on croyait. Ça m’a servi dans l’existence et surtout dans la métropole où l’on n’est pas franc du collier. » C’est par leur passion commune pour le ballon rond que Rambert devient l’ami de Gonzalès dans La peste. »
Mais Jean Montenot cite surtout une autre référence indiscutable :
« Preuve enfin que cette passion n’est pas une toquade passagère, Camus y revient dans « Pourquoi je fais du théâtre ? », écrit en 1959. « Vraiment le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. » ( Bibliothèque de la Pléiade IV, p. 607.) »
Après tout cela, je crois que nous sommes en mesure de dire que l’exergue de ce mot du jour correspond bien à ce que Camus voulait exprimer.
Et je pense qu’il est possible d’abonder dans ce sens et de reconnaître que le football est aussi une école de la morale pour le bien de l’humain mais aussi pour le mal.
<1086>
- Les passionnés du « beau jeu » qui ne souhaitent pas que l’on parle du côté obscur de ce sport qui depuis longtemps a attiré les cupides du monde.
-
Lundi 11 juin 2018
« Donnez au monde le meilleur de vous-même malgré tout. »Hedy LamarrLe documentaire qui était évoqué lors de mon mot du jour du 6 avril 2018 consacré à Hedy Lamarr est sorti en France, le 6 juin.
 Il a pour titre, dans va version française « From extase to wifi »
Il a pour titre, dans va version française « From extase to wifi »
Nous sommes allés le voir avec Annie, le 8 juin au cinéma <Comoedia> de Lyon.
Il a été réalisé par Alexandra Dean et c’est une autre grande actrice « Suzan Sarandon » qui a produit ce film documentaire pour rendre justice à cette actrice d’une intelligence supérieure et géniale inventrice.
Le film se base sur la dernière interview qu’elle a donnée à un journaliste et on entend ainsi cette femme au crépuscule de sa vie faire preuve de détachement et d’intelligence sur sa vie.
Le documentaire est bouleversant et profondément révoltant face à l’injustice qu’a subie cette femme.
Outre l’interview et d’autres entretiens, des extraits de films, le documentaire repose beaucoup sur le témoignage de ses enfants.
Il y a tant d’injustices, notamment dans la manière dont étaient traitées les actrices.
Hedy Lamarr révèle que la fameuse scène simulée d’orgasme qu’elle a tournée dans le film « Extase » fut un montage éhonté. On ne lui pardonnera jamais cette « erreur » de jeunesse. Dans le documentaire, Hedy Lamarr explique qu’elle a été trompée lors du tournage. « J’étais seule dans la pièce. On me demandait de lever les bras, et j’ignorais pourquoi je devais faire cela ». Mais pour les magnats de la Metro Goldwyn Meyer, Hedy Lamarr sera toujours la fille légère, la dévergondée, la séductrice, la putain.
Par la suite, l’industrie cinématographique pour la faire tourner sans relâche l’a soumise à des injections de drogues, en lui faisant croire qu’il s’agissait de vitamines.
Ces drogues ont abimé sa santé et son caractère.
Ses enfants qui ont décrit une mère douce et affectueuse dans leur enfance, ont décrit par la suite une femme colérique et au caractère instable.
 Mais le cœur de ce documentaire se concentre sur son invention qui a pour nom le « saut de fréquence » et qui avait pour but de guider les torpilles contre les sous-marins allemands sans que la marine allemande ne puisse intercepter la communication.
Mais le cœur de ce documentaire se concentre sur son invention qui a pour nom le « saut de fréquence » et qui avait pour but de guider les torpilles contre les sous-marins allemands sans que la marine allemande ne puisse intercepter la communication.
Par de nombreux témoignages, le documentaire démontre l’intelligence et le génie de cette femme dont aujourd’hui plus personne ne conteste le rôle dans l’invention qui sera utilisée dans le domaine militaire mais servira plus généralement pour l’invention du wifi et du Bluetooth.
On lui reconnaitra tardivement la maternité de l’invention mais elle aura été flouée car jamais l’armée ne lui a payé l’utilisation de son invention dont elle avait pourtant déposé le brevet.
On estime aujourd’hui que son invention aurait dû lui rapporter des centaines de millions de dollars.
En outre son invention le « saut de fréquence » était en avance sur son temps et les militaires de la marine américaine n’ont pas voulu la prendre en sérieux : une belle femme ne pouvait pas inventer un système opérant pensaient-ils, la beauté excluait l’intelligence.
Et quand l’US Army lui balance ses schémas à la tête, tourne en ridicule son idée, et l’envoie récolter, à coup de baisers et de décolletés, des obligations de guerre auprès des Américains. Elle s’exécute avec brio et ramène à la cause plus de 45 millions de dollars.
Plus tard, en 1962, l’invention sera utilisée lorsque John Fitzgerald Kennedy décide d’envoyer des navires à Cuba – l’épisode du débarquement de la baie des Cochons. Une cérémonie en hommage à l’invention de Hedy Lamarr, en présence de militaires et d’officiels, a fini par être organisée en 1997.
Un documentaire à voir et qui finit de manière extraordinaire.
A la fin de sa vie, elle donne ces conseils :
« Les gens sont déraisonnables, illogiques et égocentriques, aimez les malgré tout.
Si vous faites le bien, on vous prêtera des motifs égoïstes et calculateurs, faites-le bien malgré tout.
Ceux qui voient grand peuvent être anéantis par les esprits les plus mesquins, voyez grand malgré tout.
Ce que vous mettez des années à construire peut être détruit en un instant. Construisez malgré tout.
Donnez au monde le meilleur de vous-même, et vous risquez d’y laisser des plumes.
Donnez au monde le meilleur de vous-même, malgré tout. »
Dans sa version originale le documentaire a pour titre « Bombshell : The Hedy Lamarr Story » et la réalisatrice Alexandra Dean explique sa démarche dans un <article passionnant publié par l’OMPI >, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

<1085>
-
Vendredi 8 juin 2018
« Le stone balancing est un art, un hobby, une façon de méditer, un art de vivre. C’est tout ça à la fois ! »Emmanuel Fourcarde, 29 ans, alias Manu TopicEmmanuel Fourcade avait pour métier, tapissier d’ameublement. Il a mis son métier entre parenthèse pour se consacrer exclusivement à sa passion le « stone balancing »
Il a pris pour nom d’artiste : Manu Topic
 J’ai appris son existence grâce à ce site
J’ai appris son existence grâce à ce site
<Un homme qui maintient l’équilibre entre les pierres>
Ce sont des œuvres éphémères en pierres.
Il me semble que le texte n’est pas utile, il suffit de regarder les photos.
Equilibre.
Harmonie
Fragilité
Patience
Maîtrise
Œuvre éphémère mais la photo les transforme en moment d’éternité.
Sur le site on lit : « Cette incroyable maîtrise des éléments qui consiste à empiler des pierres et à les maintenir dans un équilibre parfait est un art à part entière. En France, cet homme est l’un des rares à pratiquer cette discipline qui révèle, au grand jour, l’ensorcelante beauté de la nature à travers d’impressionnantes œuvres éphémères. »

Amoureux de la nature, Emmanuel Fourcarde, 29 ans, alias Manu Topic, découvre le stone balancing grâce à celui qui a popularisé cet art aux Etats-Unis, Michael Grab.
Il se consacre désormais à cet art étonnant et éphémère..
<Une vidéo montre Michael Grab à l’oeuvre>
Cette discipline consiste à créer des structures de pierres en jouant sur les points de pressions, la gravité et le contrepoids pour un résultat final à la fois spectaculaire et esthétique. Manu en donne sa définition :
Manu Topic donne sa
 définition :
définition :
« Le stone balancing est un art, un hobby, une façon de méditer, un art de vivre. C’est tout ça à la fois ! »
Il dit aussi :
« J’ai le besoin vital d’être au contact de la faune et de la flore. Je peux partager un bel instant avec la nature… sans laisser de traces. »
Bien sûr, ses œuvres disparaissent assez rapidement. Quelques heures suffisent pour que la Nature casse le fragile équilibre créé par l’artiste.
<Ici une vidéo montrant le travail d’un autre adepte de cet art>
Et un autre artiste qui joue avec les lois de l’équilibre
L’article nous apprend qu’il existe un Championnat du Monde de stone balancing.
 Lionel Terray avait écrit en 1961, un livre consacré à l’alpinisme auquel il a donné le titre : « Les Conquérants de l’inutile ». Il me semble que ce titre « les conquérants de l’inutile » pourrait être utilisé merveilleusement pour cet art du stone balancing.
Lionel Terray avait écrit en 1961, un livre consacré à l’alpinisme auquel il a donné le titre : « Les Conquérants de l’inutile ». Il me semble que ce titre « les conquérants de l’inutile » pourrait être utilisé merveilleusement pour cet art du stone balancing.
Mais ils créent la beauté et la beauté n’est jamais inutile.
En outre, l’aspect éphémère de ces œuvres ne symbolise t’il pas simplement la fragilité de notre existence sur terre..
<Ici vous verrez une vidéo qui montre la naissance d’une œuvre de Manu Topic>
Et si vous cherchez Manu Topic ou stone balancing ou même stone balance sur internet vous trouverez d’autres merveilles.

<1084>
-
Jeudi 7 juin 2018
« Martin Luther »La page récapitulant la série de mots du jour sur la Réforme et Martin Luther est publiéLe langage « chatien » ou langage du chat me permet grâce à des représentations de chats d’introduire des mots du jour particuliers.
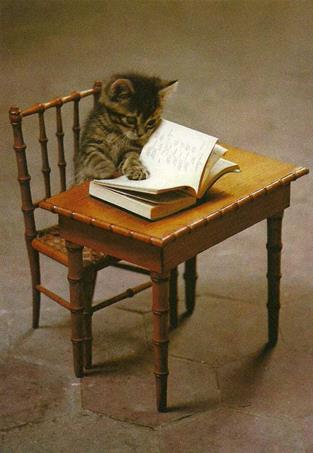
Autour du 31 octobre 2017, anniversaire des 500 ans de la Réforme, j’avais réalisé une série de 8 mots du jour sur ce mouvement religieux et particulièrement le personnage de Luther.
J’ai regroupé tous ces mots sur une page que vous trouverez derrière ce lien :
<Article sans numéro>
-
Mercredi 6 juin 2018
«Il faudrait enseigner à douter y compris du doute…»Edgar MorinJe suis abonné aux tweets d’Edgar Morin. Souvent en quelques mots il écrit des choses fondamentales.
Tel est le cas de cette phrase : « Il faudrait enseigner à douter » et il ajoute et même douter du doute.
Probablement que cette réflexion a été inspirée par cette incongruité de l’annonce par les services officiels de l’Ukraine du meurtre du journaliste russe Arkadi Babtchenko. Nous savons désormais qu’il s’agissait d’une <fausse information> (fake news en globish)
J’avais consacré un mot du jour au doute : «Nous devons combiner la graine fertile de la curiosité et l’esprit fécond du doute»
Plus récemment j’avais rappelé le propos du mathématicien Henri Poincaré : « Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir.»
Alors je trouve particulièrement important, dans un monde de fausses nouvelles et de théories du complot, de se reprendre à douter et même à douter du doute.
Par exemple :
- Douter des théories économiques.
- Douter du doute sur l’apport des vaccinations.
- Et même douter du libre-échange et douter du doute du libre-échange.
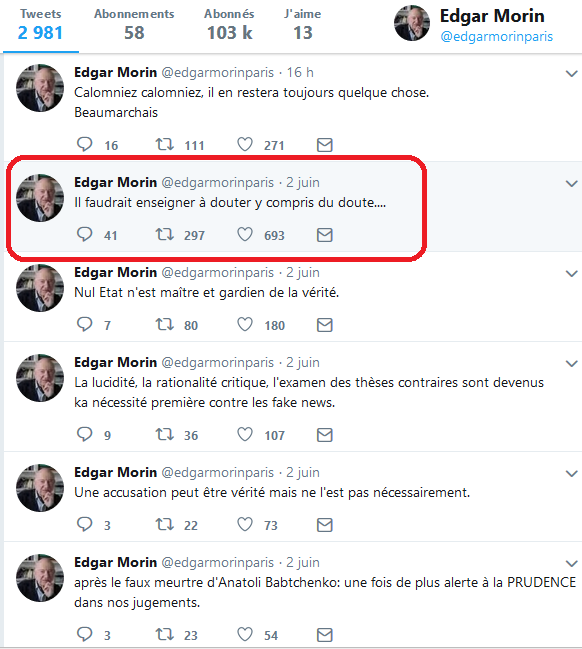
Nous sommes le 6 juin 2018. Ce blog a donc un an…
Le mot du jour introductif du blog, le mot du jour existait sous une autre forme depuis 2012, se trouve derrière ce lien <6 juin 2017>
<1083>
- Douter des théories économiques.
-
Mardi 5 juin 2018
« Le burn out parental »Moïra Mikolajczak et Isabelle RoskamLe mot du jour d’hier sur « l’ode à la fatigue » m’a conduit à revenir vers un article assez ancien que j’avais lu il y a plus d’un an mais dont je n’avais pas encore fait un mot du jour. C’était un article écrit par la journaliste Louise Tourret et publié sur Slate le 23.01.2017 : « L’autre burn-out : celui des parents à la maison »
La journaliste avait écrit son article suite à la découverte d’un livre de deux auteures belges, Moïra Mikolajczak et Isabelle Roskam, toutes les deux docteures en psychologie, « Le burn out parental. L’éviter et s’en sortir » publié chez Odile Jacob.
Louise Tourret pense ne pas être en brun-out mais elle reconnaît une lassitude régulière, une fatigue : « un domaine que j’explore avec beaucoup de constance » et des interrogations «suis-je à la hauteur?».
Le burn-out parental est un sujet qui depuis 2010, est devenu l’objet de nombreux livres comme « Mère épuisée » de Stéphanie Allénou (éditions Les Liens qui Libèrent) en 2011 ou « Le Burn out parental » de Liliane Holstein.
Et Louise Tourret parle de son expérience personnelle :
« La parentalité et sa conception évoluent avec le temps. En élevant mes propres enfants et en fréquentant mes parents, je me demande comment notre société est passée des questions relativement simples abordées par Laurence Pernoud avec J’élève mon enfant ou le docteur Spock avec Comment soigner son enfant à des livres censés rassurer les parents qui disent «je me réveille en pleurs tellement je n’y arrive pas».
J’ai interrogé la psychanalyste Sarah Chiche, pour un ouvrage sur les inégalités face à la parentalité (Mères, Libérez-vous, Plon, 2012), elle m’avait confié recevoir de plus en plus patientes que leur rôle de parent faisait craquer:
«Des femmes qui arrivent en thérapie car très soumises à la pression attachée au rôle de parent. À force d’injonctions, elles ne savent plus ce qui relève du devoir moral et de l’amour, ce sentiment d’amour et d’attachement que l’on construit avec son enfant. C’est comme si le devoir moral d’être une bonne mère recouvrait tout. L’injonction à être une bonne mère ou même une mère suffisamment bonne, envahit la vie psychique de certaines femmes et finit par les mettre en difficulté.»
Il semble que le burn-out parental atteint toutes les couches de la société et encore davantage les catégories diplômées:
Ainsi Moïra Mikolajczak a déclaré à la journaliste
«Au départ, nous pensions que le burn-out touchait davantage les milieux défavorisés dans lesquels, on le sait, les individus sont plus susceptibles d’être sujets aux troubles psychiatriques de manière générale (anxiété ou dépression). Mais, au regard des milliers de cas que nous avons étudiés (3000 participants à une enquête en ligne auxquels s’ajouter des entretiens), nous avons constaté que les parents qui avaient fait le plus d’années d’études plus ils étaient sujets au burn-out parental. Il est apparu qu’au niveau personnel, ce qui rendait les personnes vulnérables, c’est de vouloir être un parent parfait et d’être perfectionniste en général. Ce perfectionnisme est parfois à mettre en lien avec les histoires personnelles comme d’avoir eu soi-même des parents parfaits ou défaillants.»
Louis Tourret constate qu’en outre les conseils parentaux ne cessent de se contredire et c’est source de stress.
Elle cite aussi le sociologue Vincent de Gaulejac :
«Depuis les années 1980, de nouvelles formes de management, qui mettent les salariés sous tension; se sont généralisées. Pour résumer tous passe par des objectifs, le plus souvent chiffrés, à réaliser en un temps donné. Les conséquences, on les connaît tous, elle sont aujourd’hui désignée comme ça: maladies psychologiques ou sociales, épuisement professionnel ou… burn out. […]
Cela fait trente ans que je travaille sur l’épuisement professionnel et je constate aujourd’hui que les normes managériales ont pénétrées la famille. C’est en vérité un modèle social qui s’impose dans toutes les sphères de la société: il faudrait être performant dans tous les domaines. C’est la nouvelle norme. […]
Or, quelles sont les exigences attachées à la fonction de parent dans notre type de société en 2017? Ce n’est pas (plus) seulement de faire en sorte que son enfant soit en bonne santé grâce (à mon sens) à une alimentation correcte, une hygiène convenable et un suivi médical régulier ou que votre enfant soit scolarisé ou mette le nez dehors régulièrement. Non, il faudrait en plus absolument qu’il/elle obtienne de bons résultats scolaires, «c’est une source de stress, une pression qui a envahi l’école et donc la famille».
Et, […] les objectifs sont multiples:
Le mercredi devient le jour le plus horrible de la semaine: il faut assurer l’accompagnement aux activités extra scolaires (sport, musique, activités artistiques, les cours particuliers, le soutien scolaire). Mais pourquoi court-on autant sinon pour satisfaire une exigence sociale? Car on se sent coupable dès que l’enfant ne réussit pas – ou de ne pas tout faire pour qu’il réussisse et ce dans tous les domaines. Et donc les parents deviennent comme ces employés soumis au mangement par objectif et à l’évaluation standardisés… il perdent le sens de leur éducation !»
Je vous renvoie vers l’article : « L’autre burn-out : celui des parents à la maison »
Il y aussi cet article <Les 10 signes qui montrent que vous êtes en burn-out parental>
Ou encore cet article du site Psychologies.com <Mères épuisées, gare au burn-out>.
J’ai même trouvé un site entièrement consacré à ce sujet : https://www.burnoutparental.com/
<1082>
-
Lundi 4 juin 2018
« Ode à la fatigue »Eric FiatEt Zinedine Zidane, seul entraîneur de football ayant remporté trois fois de suite la ligue des champions de football est venu, devant les journalistes sportifs incrédules, annoncer qu’il arrêtait son travail d’entraîneur du Real de Madrid.
Des centaines de journalistes, de commentateurs ont analysé ce choix, les raisons de ce choix, savoir si c’était une bonne décision.
Pendant sa conférence de presse les journalistes ont posé des questions et il a répondu simplement :
« Je ne suis pas fatigué d’entraîner, je suis fatigué d’une manière plus… globale.»
Je suis fatigué, a t’il dit.
Peut-on encore dire qu’on est fatigué ?
Tous les « winners » de la terre, ne sont jamais fatigués. Par exemple Emmanuel Macron, non seulement dort peu mais en outre n’est jamais fatigué.
La fatigue est une faiblesse, peut-être une maladie. Il faut la soigner avec des médicaments, des drogues…
C’est encore la revue de presse de Claude Askolovitch du 1er juin 2018 qui mentionne un dossier d’un journal du Sud :
« [Ces drogues] qui nient la fatigue et qui détruisent la vie, et elles sont le dossier de La Provence ce matin. Ces nouvelles drogues de synthèse, NPS (nouveaux produits de synthèse), aussi glaçantes que Zidane est solaire, qui prennent la forme de bonbons et portent les noms de fêtes, Yucatan fire, Spice, Buddha blues, sont les petits cailloux d’un voyage au bout de la nuit. Elles tuent en France et ont tué en Provence l’été dernier, c’est arrivé là-bas… Et voilà pourquoi le journal s’en saisit.
C’est un dossier pédagogique, pour des adultes qui doivent apprendre ; des molécules chimiques sont inventés par les laboratoires dans les années 50 pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Elles sont désormais triturées et produites en chine, commercialisées sur internet, sans cesse renouvelées, elles sont des bombes chimiques. »
La revue « Psychologie » a donné la parole à un acupuncteur, Maurice Tran Dinh Can, qui dit : « Accepter sa fatigue n’est pas un aveu de faiblesse »
Dans cet article, cet acupuncteur explique :
« Nous vivons dans une société de production, de consommation et de performance. Ce qui signifie que nous sommes conditionnés depuis notre naissance pour être – ou du moins pour paraître – actifs et battants. Du coup, nous nous dépensons sans compter et sans nous écouter pour être reconnus et avoir notre place dans la société.
Le message est clair : il faut être productif, sous peine d’être socialement exclu. Nous n’avons ni le droit au repos, ni le droit à la fatigue. Notre société nous a déprogrammés – alors que la nature a mis des millions d’années à élaborer un programme d’équilibre interne que respectent toutes les autres espèces – et nous a reprogrammés en imposant des critères et des valeurs qui sont à l’opposé de notre bien-être.
Je suis persuadé que ce conflit entre ces deux impératifs – l’un naturel, l’autre culturel – est à la source de notre mal de vivre. Celui-ci s’exprime par des tensions internes très fortes qui se répercutent sur notre organisme »
Le philosophe, Eric Fiat, responsable du master d’éthique à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, va plus loin et explique :
« Vous êtes fatigué ? Tant mieux ! Car [la fatigue] a beau être un mal dont souffrent beaucoup de nos contemporains, la fatigue peut être bénéfique par son enseignement. Elle nous révèle de très belles choses sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Écouter sa fatigue c’est apprendre l’humilité, le courage et la rêverie. »
Il a écrit un livre qui vient de paraître « Ode à la fatigue » chez Payot en mai 2018.
Il a été interviewé par le journal suisse : « Le Temps »
« C’est un fait, de plus en plus de nos contemporains se plaignent d’être fatigués, d’où l’idée de cette réflexion. Mais je ne dirais pas que la fatigue soit un mal propre à notre époque. Premièrement parce que ce n’est pas toujours un mal. A côté des mauvaises fatigues, celles qui nous font ressentir l’existence davantage comme un fardeau que comme un cadeau, celles qui nous privent de ce qui nous paraît le plus propre à nous-mêmes, celles qui nous aliènent, celles qui nous accablent, celles qui créent en nous une sorte de lassitude d’être ce que l’on est, il demeure de bonnes fatigues. Celle du sportif vainqueur, des amoureux qui se sont aimés toute la nuit, de celui qui a l’impression du travail bien fait ou du devoir accompli… »
Il en appelle à Jonathan Crary qui a écrit « Le capitalisme à l’assaut du sommeil » et dont j’avais fait le mot du jour <du 26 septembre 2014> et explique qu’aussi notre fatigue est en grande partie à cause d’une certaine organisation du travail, de l’accélération de la vie, la sollicitation permanente qui nous vient de nos téléphones et ordinateurs…
« Tout cela fait que l’espace du calme, l’espace du retrait, l’espace du silence se réduisent un peu comme peau de chagrin. »
Et il cite un autre auteur, le sociologue Hartmut Rosa qui parle de « l’accélération du monde »
Et il en revient à La Fontaine :
« Pour ma part, j’aurais envie de dire de la fatigue des hommes d’aujourd’hui ce que disait La Fontaine de la peste des animaux d’hier: «Un mal qui répand la terreur […], la Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom) […] Faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés.» En effet, quand on pousse un peu nos contemporains dans leurs retranchements, même ceux qui apparemment réussissent, sont performants comme l’époque veut qu’ils soient, assez vite ils disent qu’ils sont crevés ou exténués. »
Il ne fait pas la distinction entre la fatigue physique et la fatigue morale :
« Je ne pense pas qu’il y ait de la fatigue physique d’un côté et une fatigue morale de l’autre. Opposer la lassitude du corps à celle de l’âme, ce serait rallier le camp de ces philosophes dualistes, lesquels affirmaient la séparabilité du corps et de l’âme, et je ne suis pas du tout dualiste. Il n’est pas de lassitude longue de l’âme qui ne finisse par engendrer une fatigue du corps, et il n’est pas une longue fatigue du corps qui ne finisse par engendrer une lassitude de l’âme. […]
On est dans une époque qui cultive les idéaux de performance, d’indépendance, d’autonomie, de maîtrise. Je ne dis pas que ces idéaux ne soient pas de beaux idéaux, mais la fatigue les menace. Parce que, quand on est très fatigué, on est moins autonome, on est moins indépendant, on est moins maître de soi. Or c’est justement parce que notre époque pense que l’homme doit légitimer sa place dans le monde en prouvant ses performances que notre époque craint la fatigue plus que d’autres. Pour beaucoup de nos contemporains, l’avouer est un aveu de faiblesse ou d’échec. Ce que je ne crois pas. »
[…] De toute façon, ça ne sert à rien de lutter contre, car elles auront toujours le dernier mot. La Fontaine, dans sa fable Le chêne et le roseau, nous apprend que lorsque le vent puissant arrive, le roseau plie mais ne rompt pas, alors que le chêne qui lutte contre le vent qui vient va finalement être déraciné. Eh bien, plutôt que de lutter contre la fatigue, comme le ferait le chêne, acceptons qu’elle nous fasse plier, comme ferait le roseau. Soyons plutôt roseau que chêne. Puisque nous ne pouvons pas lutter, écoutons ce qu’elle a à nous dire, les leçons qu’elle a à nous apporter. »
Et c’est alors qu’il parle des vertus de la fatigue :
« La première est l’humilité. La fatigue m’apprend que je ne suis pas un dieu, je ne suis pas un ange, je ne suis pas un héros, je ne suis pas une machine. L’humilité, ce n’est pas l’humiliation. L’humble, c’est celui qui s’estime à sa juste mesure, il ne se surestime pas, mais ne se sous-estime pas non plus. La deuxième leçon, c’est le courage, parce qu’on sait bien que le courage, ce n’est pas l’absence de peur: le courage, c’est le fait de surmonter la peur. De même, je dirais que le courage, ce n’est pas l’absence de fatigue. Un être courageux, c’est un être capable de la dépasser. Enfin, cette dernière nous apprend la rêverie. […]
La fatigue, ce n’est ni la pleine lumière de la conscience ni l’obscurité de l’inconscience, mais un état un peu flottant. Cet état introduit un rapport plus souple, plus fin, plus tendre à soi-même, aux autres et au monde. La rêverie est une attention précédée d’un abandon, c’est une vigilance précédée d’un laisser-aller, c’est une caresse du monde. Donc celui qui admet sa fatigue a finalement un rapport beaucoup plus tendre à lui-même, aux autres et au monde que s’il tentait de lutter tel un héros contre elle. »
La fatigue est une caresse du monde
Et puis dans ce monde, il semble interdit ou incongru de vieillir :
« On trouvait normal qu’en vieillissant on se mette un peu en retrait. Or aujourd’hui, il faudrait pour bien vieillir ne pas vieillir. Comme l’octogénaire qui ferait du jogging, qui serait surbooké et qui aurait une activité physique, sexuelle, intellectuelle comparable à celle des hommes de 20 ans. La fatigue, c’est une petite vieillesse. Quand on est épuisé, même quand on est très jeune, c’est comme si on était un peu vieux, c’est-à-dire qu’il y a quelque chose qui devient plus difficile dans le rapport à soi, aux autres et au monde. Le mot vient moins vite, la jambe ne bouge pas bien, le souvenir disparaît. Or notre société a tendance à considérer la fatigue comme un mal, de même que la vieillesse. […] »
 Et enfin il en appelle à l’art, à Rembrandt :
Et enfin il en appelle à l’art, à Rembrandt :
« Il y a au Louvre un tableau de Rembrandt qui aide, je crois, à faire cet éloge de la fatigue. Il s’agit de Saint Mathieu et l’ange. On y voit deux visages l’un à côté de l’autre, et étonnamment la lumière ne vient pas du visage de l’ange, mais du vieux saint fatigué et plein de rides. Et je crois que cette belle lumière ne serait pas venue de ce visage s’il avait lutté contre sa fatigue. On voit sur son visage qu’il a fait le dur métier d’exister, qu’il en est fatigué et qu’en même temps il a essayé de faire de son mieux. Et ce beau visage contient une magnifique lumière qui peut-être nous invite à nous réconcilier avec nos fatigues qui ne sont pas forcément mauvaises. Les assumer, c’est faire de même avec son humanité, sa finitude – notre contingence.
A vrai dire, il n’y a guère que les morts qui ne soient plus fatigués… »
Il avait été invité par la Grande table le 25 mai 2018: « La fatigue, un mal contemporain ».
France Culture lui a consacré une page de son site : « Les trois leçons de l’Ode à la fatigue d’Eric Fiat »
En décembre 2017, Adèle Van Reeth avait consacré quatre épisodes de son émission « Les Chemins de la philosophie » à la fatigue. Le 20 décembre, c’était la 3ème émission et elle avait pour titre « Ode à la fatigue ».
Je n’aurais pas écrit ce mot du jour si je n’éprouvais pas moi-même la fatigue, « la fatigue d’une manière plus globale » comme le dit, si justement, Zinedine Zidane.
Mais grâce à Éric Fiat j’ai appris que c’est une caresse du monde et qu’elle est leçon d’humilité.
<1081>
-
Vendredi 1 juin 2018
« Your Money or Your Life
Votre vie ou votre argent»Vicki Robin et Joe DominguezClaude Askolovitch a commencé sa revue de presse de France Inter du 18 mai 2018 par ces informations :
« Une rêverie de fin de semaine que la fatigue nous inspire avec ce titre dans Society, « Prends l’oseille et tire-toi ».
C’est le slogan de jeunes gens aux États-Unis, qui travaillent dans la « tech », et qui accumulent et économisent pour pouvoir arrêter le plus vite possible, comme Jeremy, ingénieur chez Microsoft, qui a tout compris de la vie en découvrant une île des philippines où il pouvait vivre, calculs faits, pour 8 000 dollars par an. Lui qui en gagnait 350 000, il a vendu sa grande maison et sa voiture, et travaillé d’arrache-pied. Dix ans plus tard, la quille, à 38 ans !
Mais il y a mieux. Emmy Pattee, qui est sortie du travail à 26 ans… Elle était dans la communication dans la Silicon Valley et se nourrissait de riz et de haricots dans sa chambre, dans la maison des parents de son copain… Mais elle est libre ?
Et c’est une tendance aux Amériques, plus encore un mouvement, avec son égérie, Vicki Robin, 72 ans, qui a cessé de travailler il y a un demi-siècle et vit de ses rentes. Elle a investi ses sous dans la marijuana.
Mais l’ennui guette nos jeunes retraités, et les statistiques sont implacables, prendre sa retraite avant 62 ans est mauvais pour l’espérance de vie. »
Pour en savoir un peu plus, je suis allé sur le site de <Society>, mais je n’ai pas trouvé l’article, ni même un extrait.
Heureusement, il existe le site Pressreader.
Et j’ai retrouvé l’article publié le 18 mai, par le magazine Society, il a pour titre « Riches à 30 ans »
Et on en apprend un peu plus sur ce fameux Jeremy Jacobson qui vit sur une île. Il déclare :
« Depuis la fin de l’université, je travaillais 60 heures par semaine minimum, recevais des mails jusque tard dans la nuit et mon téléphone sonnait constamment, même le week-end », revit-il. Le prix à payer pour empocher ses 135 000 dollars annuels, primes non incluses. Et une somme désormais plutôt avantageuse pour tirer parti de ces vacances tant attendues. Les premiers jours, Jeremy enchaîne les cocktails tropicaux, les excursions et les « crevettes géantes ». Les jours suivants, il se lance palmes aux pieds dans d’interminables discussions sur le « sens de la vie » avec son moniteur de plongée. Et enfin, il décide qu’il ne veut plus rentrer chez lui. Il fait le calcul. Il ne lui faudrait que 8 000 dollars par an pour s’assurer une existence paisible sur cette île d’à peine dix kilomètres carrés. Encore mieux: selon les formules mathématiques couchées sur papier, il pourrait mener cette existence en n’ayant plus à travailler. « Je découvrais une nouvelle manière de vivre », se souvient-il. Quelques mois plus tard, Jeremy vend sa grande maison en banlieue de Seattle, refourgue sa berline, s’installe dans un studio et ne se déplace plus qu’à vélo. Surtout, il travaille d’arrache-pied. En vue: une promotion rapide et encore plus d’argent sur son compte en banque. Cela arrive au milieu de l’année 2012. Jeremy fête ses 38 ans et envoie le message suivant à 4 000 destinataires, tous employés de Microsoft: « J’arrête tout. À bientôt. » « Tout le monde pensait que je partais en secret chez un concurrent. Mais non. J’étais enfin libre, pour toujours. »
Et il est alors question de Vicki Robin qui est américaine et née le 6 juillet 1945. Elle est auteure d’un best seller avec Joe Dominguez« Your Money or Your Life » donc «votre vie ou votre argent »
Et l’article de Society lui donne la parole :
« la plateforme participative Reddit, plus de 400 000 personnes débattent quotidiennement depuis plus d’un an sur la manière de prendre leur retraite avant 40 ans, et même, pour beaucoup, avant 30 ans. Elles viennent de partout dans le monde, même si c’est très américain. » Pour communiquer, ces personnes se sont donné un nom: le mouvement « FIRE », pour « Financial Independence Retire Early ». En clair, il s’agit de trouver le meilleur moyen de mettre assez d’argent de côté pour sortir du marché du travail, sans jamais avoir à y revenir. Tout ça le plus rapidement possible. »
Et ce magazine d’ajouter : « À 72 ans, Vicki Robin est considérée comme la « Ève de Adam et Ève » de cette « sous-culture », dont elle a établi les bases: se libérer de la société de consommation, ne plus être « victime d’un job qui vous aspire tout entier ni esclave du salaire ».
Et Vicki Robin d’ajouter :
« Personne ne veut se lever tous les matins pour aller s’asseoir dans un box au milieu d’un open space, se connecter sur un ordinateur et travailler à l’heure comme une personne louée pour une durée déterminée. Ce n’est pas une vie enrichissante, ça n’a même aucun sens de faire ça ! »
Cette dame n’agit donc plus ainsi depuis bientôt 50 ans. À la place, elle investit son argent dans la marijuana et quelques fermes locales depuis le ponton de sa maison perchée au-dessus du Puget Sound, dans l’état de Washington.
Et le magazine de donner d’autres exemples de jeunes qui cherchent à sortir le plus vite possible du marché du travail.
Je trouve le titre de l’article trompeur : « riche à trente ans ». Car finalement à l’aune de nos footballeurs vedettes ou même je pense des génies de la silicon valley, ces « aspirants retraités jeunes », donnés en exemple par l’article, ont des revenus très confortables mais pas mirobolants. Jérémy cité précédemment touche donc annuellement 135 000 dollars plus des primes, une autre personne citée « Emma Pattee » gagne 79 000 dollars annuels
Et Emma Pattee explique :
« L’époque n’a pas grand-chose à offrir à ma génération. Les robots feront bientôt le boulot à notre place, et comme l’a prouvé la crise de 2008, tout est trop fragile pour s’y adonner sérieusement. »
Et l’article de citer encore Russell Romney, 21 ans, fraîchement diplômé de l’université de l’idaho, actuellement ingénieur informatique, il considère que le niveau de bonheur ne fait que s’effondrer depuis des années, et peu importe le nombre de voitures possédées ou la rémunération. « C’est bien la preuve que le rêve américain, partagé par toutes les sociétés occidentales, est complètement absurde. Il n’aurait jamais dû être valide. » Alors pour Russell, c’est décidé : il mettra un terme à sa carrière professionnelle « à 35 ans maximum ».
Si je comprends bien et le livre de Vicki semble aller dans ce sens, il ne s’agit pas de devenir multi-milliardaire mais d’être très rigoureux sur ses dépenses, de chasser l’accessoire pour ne garder que le principal dans la consommation. Il vaut mieux commencer avec un petit pécule et puis ensuite on fait quelques investissements intelligents, des affaires comme la marijuana et le travail devient du passé.
Vicky Robin développe ces idées sur son site : <https://vickirobin.com/>
J’ai aussi trouvé un site canadien en langue française qui fait référence à Vicky Robin et qui a pris pour nom <modestmillionaires>.
L’exergue de ce site est « Atteindre l’indépendance financière avec la simplicité »
Une petite introduction sur la page d’accueil explique : « Nous sommes de jeunes parents dans la début trentaine vivant au Québec et ce blogue documente notre cheminement simple vers l’indépendance financière d’ici 2025. »
Alors tout n’est pas simple pour ces personnes et c’est encore Vicki Robin qui analyse :
« Ces gens-là gagnent quatre ou cinq décennies de temps libre. Très bien. Mais très peu ont réfléchi à comment les occuper […] Ils sont heureux d’avoir hacké la société. Mais ils n’ont pas pensé au reste. »
Ainsi selon le magazine Society : Une fois leur pari remporté, beaucoup tombent en dépression. Une récente étude de l’université Cornell, aux États-unis, a même fait un lien entre retraite avancée et mort précoce. L’arrêt du travail en dessous de 62 ans augmenterait les risques de décès prématuré de presque 20%.
Emma Pattee:
« L’entourage de nombreuses personnes est lié à leur travail. Leur statut social vient de là, leurs activités aussi, leurs amitiés également. Une fois débarrassés de tout cela, certains se retrouvent face à l’ennui. Et l’être humain n’est pas fait pour être tout seul. »
La jeune femme l’avoue, d’ailleurs: depuis quelques mois, elle a l’impression d’avoir quelque peu « trahi » ses amis retraités. Et se sent comme « le vilain petit canard » de la bande. Qu’a-t-elle donc fait? Elle souffle, à voix basse: « Je ne supportais plus cette solitude, moi non plus. Alors j’ai repris un job, à mi-temps. »
Certains diront peut être : l’esprit de mai 68 souffle encore…
<1080>
-
Jeudi 31 mai 2018
« Les soixante-huitards ne sont pas tous devenus des nantis »Serge AudierHier j’avais laissé Luc Ferry exprimer son analyse de la pensée 68 et des conséquences sociétales et économiques qui selon lui ont été portées par ce mouvement.
D’autres comme Guy Hocquenghem ont ciblé les parcours individuels. Dans sa «Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary » (1986) il retrace avec ironie la carrière, jusqu’en mai 1986, des gauchistes de Mai 68 qui selon lui ont trahi, par opportunisme, l’idéal de leur jeunesse. Il était un acteur de Mai 68, à l’époque il avait 21 ans et était élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm. Il est mort du sida en 1988.
Le journaliste Antoine Bourguilleau remet dans la perspective de 2018 cet essai assez violent contre les anciens camarades d’Hocquenghem que ce dernier désignait sous l’expression de «membres à vie du club ouaté des renégats».
<Si vous voulez en savoir davantage, vous pourrez lire l’article dans Slate>. Vous apprendrez qu’il désigne le journal Libération comme «La Pravda des néo-bourgeois» et Jack Lang comme l’«Amanda Lear de la culture».
Il me parait juste aussi de donner la parole à la défense. Ainsi Serge Audier qui est philosophe comme Luc Ferry, maître de conférences à Sorbonne-Université, a écrit une sorte de réponse à ce dernier « La Pensée anti-68 ».
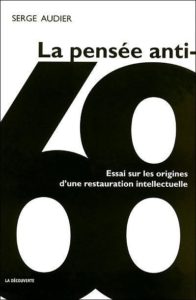 Cet ouvrage paru aux éditions de La Découverte en 2008, suivait l’élection de Nicolas Sarkozy qui avait voulu liquider le legs de 68.
Cet ouvrage paru aux éditions de La Découverte en 2008, suivait l’élection de Nicolas Sarkozy qui avait voulu liquider le legs de 68.
<L’Obs a accordé un entretien à cet auteur publié le 10 mai 2018>
Pour Serge Audier c’est une offensive idéologique qui prétend que l’esprit libertaire aurait favorisé la montée du néolibéralisme :
« Ce discours participe avant tout d’une offensive idéologique. Dans sa version radicale, il verse même dans l’erreur caractérisée quand il soutient, comme Luc Ferry récemment dans « le Figaro », que sous les pavés il n’y avait rien d’autre que « les exigences de l’économie libérale », les mœurs libertaires ayant selon lui été la condition expresse pour qu’émerge notre société de consommation.
Après tant d’autres, Ferry affirme à l’appui de cette thèse que la quasi-totalité des soixante-huitards se serait reconvertie dans la pub, le showbiz, l’entreprise ou au Medef. Bien des travaux historiques prouvent que c’est faux, mais l’idéologie a la vie dure.
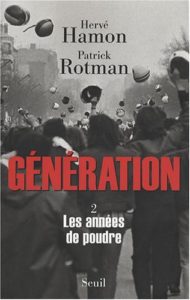 Il faut dire que le livre « Génération » de Patrick Rotman et Hervé Hamon, publié à l’occasion du 20e anniversaire des événements, a bien malgré lui fourni des armes aux tenants de ce dénigrement. Les auteurs, qui défendaient Mai-68, ont donné la parole à des soixante-huitards qui avaient entre-temps connu réussite et notoriété. Au risque de gommer ceux qui étaient – ou voulaient être – plus discrets : ceux qui occupaient des emplois moins médiatiques, ceux qui étaient partis élever des chèvres, sans parler des chômeurs et des suicidés.
Il faut dire que le livre « Génération » de Patrick Rotman et Hervé Hamon, publié à l’occasion du 20e anniversaire des événements, a bien malgré lui fourni des armes aux tenants de ce dénigrement. Les auteurs, qui défendaient Mai-68, ont donné la parole à des soixante-huitards qui avaient entre-temps connu réussite et notoriété. Au risque de gommer ceux qui étaient – ou voulaient être – plus discrets : ceux qui occupaient des emplois moins médiatiques, ceux qui étaient partis élever des chèvres, sans parler des chômeurs et des suicidés.
Le retentissement de « Génération » a contribué à imposer durablement cette vision déformée, occultant le fait que, comme tout événement historique, Mai-68 s’est diffusé dans toutes les sphères de la société. Il n’en fallait pas plus pour alimenter le réquisitoire de ceux qui, en cette fin des années 1980, avaient déjà commencé à dénoncer une alliance « libérale-libertaire ».
Plusieurs couches se sont superposées. La toute première occurrence de ce terme remonte à 1973, sous la plume d’un intellectuel du PC, le philosophe Michel Clouscard – les communistes français avaient, on le sait, mal digéré l’offensive des « anarchistes » soixante-huitards, très critiques vis-à-vis de l’URSS. Clouscard forge l’expression de « libéralisme libertaire » pour résumer sa conviction que la contestation gauchiste a été le cheval de Troie d’une mutation économique libérale : le Mai-68 libertaire a selon lui produit un « marché du désir » qui a sauvé le capitalisme tout en détruisant le barrage à la mondialisation libérale qu’était l’État-nation. L’idée était lancée que les mœurs libertaires et le libéralisme économique sont les deux faces de la même réalité. […] »
Il revient sur l’essai d’Hocquenghem. :
« Le pamphlet d’Hocquenghem, qui dépeint Serge July, André Glucksmann ou Bernard Kouchner en agents cyniques du capitalisme et de l’impérialisme, reflète son désarroi : comme d’autres, en ce milieu des années 1980, il est dépité face à l’expérience socialiste du pouvoir, après la conversion mitterrandienne à la « rigueur » en 1983. De nombreux déçus de la gauche reprendront sa critique des « libéraux-libertaires » soutiens de Mitterrand. Les plus carriéristes des soixante-huitards sont des coupables idéaux, accusés d’avoir fait de Mai-68 un tremplin pour liquider l’héritage de la gauche, laquelle aurait dépassé la droite dans la réhabilitation de « l’entreprise ».
Un troisième moment de ce discours intervient à partir des années 1990, sur fond de critique de l’Europe libérale et postnationale ou encore du « pédagogisme ». Des essayistes tels que Jean-Claude Michéa voient dans le « libéralisme culturel » de 68 le berceau de l’ultralibéralisme. Marcel Gauchet identifie dans son individualisme le foyer d’une société libérale et narcissique. La légende noire fleurit dans les milieux « nationaux-républicains » souverainistes, voire de gauche anticapitaliste, d’autant plus que Daniel Cohn-Bendit incarne alors une ligne fédéraliste européenne. Dans un registre néomaurrassien, Éric Zemmour déplore que la droite libérale ait fait des concessions aux soixante-huitards et prône un réarmement idéologique réactionnaire et identitaire. Une rhétorique qu’on retrouvera, soutenue par Henri Guaino et Patrick Buisson, dans les discours de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne présidentielle de 2007. »
Luc Boltanski et Eve Chiapello avaient écrit un livre : « le Nouvel Esprit du capitalisme« , publié en 1999, et dans lequel ils montrent que le néolibéralisme s’est appuyé sur l’individualisme et le désir d’une plus grande liberté individuelle qui étaient l’apanage des mouvements issus de mai 68. Serge Audier répond :
«Je ne rejette absolument pas ces analyses, mais elles ne suffisent pas à conclure – aux yeux mêmes de leurs auteurs ! – à une ligne directe courant de 68 au néolibéralisme. N’oublions pas que Mai-68 a effrayé les milieux politiques et économiques. Lors des accords de Grenelle, le patronat, fragilisé, lâche du lest. Mais, à la fin des années 1970, sur fond de crise, le rapport de forces se tend au plan mondial, et les logiques de déconstruction du syndicalisme, de flexibilité et de sous-traitance développées dès lors par les dirigeants économiques battent en brèche les idéaux de participation démocratique dans l’entreprise.
Les artisans de la révolution néolibérale n’étaient tout de même pas des progressistes ! Thatcher était une conservatrice attachée à la restauration de l’autorité et adepte d’un État pénal, tandis que Reagan fédérait une coalition ultralibérale et réactionnaire qui, au nom de la « majorité silencieuse », défendait l’ordre et le patriotisme, et attaquait les syndicats. Quant aux théoriciens du néolibéralisme, si Milton Friedman pouvait avoir des accents libertariens sur la question des stupéfiants, Friedrich Hayek était allergique aux contestataires. Ajoutons que le Chili de Pinochet, terrain d’expérimentation du néolibéralisme soutenu par l’un et l’autre, n’était pas vraiment « libéral-libertaire …
[Mais] en recyclant habilement certains éléments de la contre-culture, la pensée néolibérale les instrumentalise à des fins qui n’étaient pas celles des soixante-huitards. Confrontées à des résistances dans les entreprises, puis à la crise, les élites économiques voient la machine capitaliste s’essouffler et comprennent que les vieilles recettes « disciplinaires » sont insuffisantes. Après la crise de 1929, Roosevelt avait sauvé le capitalisme en lui administrant une forte dose d’interventionnisme ; après le marasme des années 1970, la « récupération » de certaines aspirations – pas toutes ! – à la créativité et à l’autonomie individuelle a contribué à une reconfiguration du système productif – mais parallèlement, je le répète, à un court-circuitage des luttes ouvrières par une guerre menée au syndicalisme, l’essor de la sous-traitance, des délocalisations, etc.»
Je pense qu’on peut le rejoindre sur ce point, les théoriciens et les metteurs en scène (Thatcher et Reagan) du néo-libéralisme ne sont pas des soixante-huitards. Et puis pour que le néolibéralisme, puisse s’imposer il a fallu bien d’autres évènements et avancées technologiques que les aspirations à la liberté des jeunes de Mai 68 : l’ouverture des frontières, les avancées technologiques des outils de communication, la chute du camp soviétique et maintenant la révolution numérique. Et la conclusion de Serge Audier est la suivante :
«[Si] un certain nombre d’individus qui ont eu 20 ans en 1968, et qui ont alors pu jeter quelques pavés, ont pris ensuite une part active à l’essor de l’économie néolibérale. Mais il ne faudrait pas oublier tous leurs anciens compagnons qui ont continué à militer pour leurs idées, sous d’autres formes – politiques, mais aussi associatives, en faveur de causes comme l’environnement, les immigrés, l’économie sociale et solidaire. En se focalisant sur la « trahison » supposée de certains leaders de Mai, on néglige cet héritage, certes silencieux, de 68.»
Par cet article s’arrête la série de mots du jour sur mai 68. Le 31 mai semble le jour idéal pour cela. J’aurais encore pu évoquer beaucoup d’auteurs, de livre, d’articles et d’émissions.
Souvent les émissions qui souhaitaient parler de mai 68 ont invité le sociologue Jean-Pierre Le Goff. Il avait 19 ans en mai 68. Il porte aujourd’hui un regard critique. Il est, selon les normes universitaires, un spécialiste de cette période. Il avait écrit un premier livre en 1998 « Mai 68. L’héritage impossible », puis en 2011 « La Gauche à l’épreuve 1968-2011 » dans lequel il évoque beaucoup les soixante-huitards qui ont été tout comme lui engagés dans des groupuscules d’extrême-gauche et qui ont évolué souvent vers le Parti Socialiste. Et il pose ce constat que ces hommes, car il s’agit presque exclusivement d’hommes, entraînés par leurs passions anciennes et leur utopies trotskystes ou maoïstes reproduisent dans les postes qu’ils occupent actuellement (journalistes, hommes politiques etc.) « Les mêmes postures d’imprécation et de justiciers, les mêmes réflexes dogmatiques et sectaires, toujours persuadés d’être dans le bon camp.»
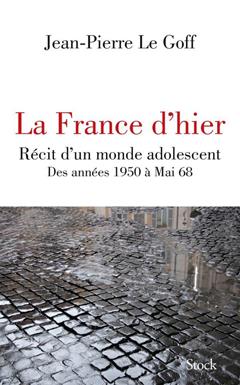 Et cette année il a publié aux éditions Stock « La France d’hier » et dont le sous-titre est « Récit d’un monde adolescent : des années 1950 à Mai 68 ».
Et cette année il a publié aux éditions Stock « La France d’hier » et dont le sous-titre est « Récit d’un monde adolescent : des années 1950 à Mai 68 ».
Je l’ai écouté présenter son livre dans deux émission : « La Grande Table du 1er mars 2018 » et « Répliques du 3 mars 2018».
Ce que j’ai compris c’est qu’il essaye de réhabiliter le monde d’avant 68, en disant qu’il n’était pas si dur qu’on le raconte aujourd’hui, qu’il y avait des structures solides et rassurantes.
Et pour Mai 68 il résume son ouvrage précédent par cette phrase :
« Mai 68, c’est bien sûr la revendication de l’autonomie de la société, mais c’est en même temps une fuite dans l’imaginaire : le refus de toute hiérarchie. C’est cela l’héritage impossible. La révolution introuvable. »
Et pour symboliser tout cela, il parle du « peuple adolescent ». Pour lui ce qu’il appelle le Yéyé auquel il ajoute le rock est la musique du peuple adolescent qui émerge en mai 68.
Invité par la chaine suisse RTS il en arrive à cette conclusion :
« On ne va pas rester adolescent toute sa vie »
Edgar Morin qui exprime davantage l’espérance de mai 68, le besoin de dépassement des contraintes et de la seule réussite économique avait aussi évoqué la classe adolescente (mot du jour du 23 mai 2018)
Daniel Cohn-Bendit lors d’une émission de Bernard Pivot avait lui aussi parlé de cette musique émergente et de la culture jeune qui l’accompagnait en considérant qu’un des événements les plus marquants de cette époque fut <le festival de Woodstock>. Car le 15 août 1969, 450 000 personnes se réunissent, sur la côte Est des Etats-Unis pour ce festival qui symbolise la contre-culture hippie.
Le site du journal belge <Le soir> décrit cette « effervescence » ainsi :
« En août 1969, Les hippies de Woodstock ont dansé nus, fait l’amour dans la boue, chanté au milieu de nuages de marijuana… »
Pierre Delannoy auteur du livre « L’aventure hippie » décrit un monde jeune et politisé :
« Il faut bien comprendre que les hippies ne sont pas les « babas cool », les doux rêveurs, qui ne pensent qu’à fumer de l’herbe et à courir tout nus, qu’on voit au cinéma. Au contraire, le mouvement hippie est très politisé. Ils ont tous l’âge d’aller se battre au Vietnam. C’est une jeunesse éprise de liberté qui s’engage contre la guerre. Ce serait réducteur de ne parler que de révolution des mœurs et de révolution sexuelle. Le mouvement hippie porte en lui une véritable révolution politique. C’est toute la société qu’ils veulent changer : de l’organisation du travail à celle de la famille et des rapports humains. Ils militent pour une société plus juste, plus égalitaire et vont même jusqu’à poser les bases de l’écologie.
[…] Le mouvement hippie marque une rupture. Les années 1960, c’est l’avènement de la jeunesse. Ce n’est plus l’appartenance à une classe sociale qui compte, mais la classe d’âge et la volonté de changer la société. Le mouvement hippie naît au milieu des Trente Glorieuses. Les hippies sont les enfants du baby-boom, de l’explosion de la classe moyenne et des débuts la société de consommation. Ils grandissent dans un monde qui change, mais au sein d’une société qui reste complètement coincée, conservatrice. Le mouvement hippie naît de cette rupture entre une société figée et une partie de la jeunesse qui aspire à vivre autrement. Pendant les années 1960, les hippies fondent des communautés, vivent une nouvelle expérience sociale et bousculent leurs propres barrières. »
L’autre auteur souvent invité ces derniers jours est l’historien Benjamin Stora, 18 ans en 1968. Il a écrit et vient de publier « 68, et après ». Je l’ai entendu dans un entretien qu’il a accordé à l’émission <La Grande Table du 29 mai 2018>.
Lui insiste sur la tentation de violence des groupes gauchistes de 68 :
« On a beaucoup présenté la dimension festive et libertarienne de mai 68. Mais cet événement a aussi une face sombre, celle d’un engagement militant dogmatique, radical, très enclin à la violence, et qui a même failli passer au terrorisme. »
Il rappelle que dans d’autres pays comme l’Italie ou l’Allemagne le mouvement a sombré dans le terrorisme des Brigades rouges et de la bande à Baader.
Et il a ce soulagement :
«Heureusement que nous, à l’extrême gauche, n’avons pas pris le pouvoir après mai 1968»
Et puis il évoque tous ces trotskystes qui sont devenus des piliers ou ce qu’on a appelé des éléphants du PS : Jospin, Cambadélis, Dray, Mélenchon et tant d’autres
 Mais pour mettre un point final à cet article et à cette série je vais vous donner un lien vers « <L’interview de Malek Boutih chez Laurent Ruquier le 19 mai 2018>.
Mais pour mettre un point final à cet article et à cette série je vais vous donner un lien vers « <L’interview de Malek Boutih chez Laurent Ruquier le 19 mai 2018>.
Si je n’ai qu’un lien à vous recommander c’est celui-ci. J’ai été séduit et aussi ému de ce que cet homme de conviction a su dire ce soir-là.
Le sujet de cet entretien n’était pas mai 68, mais était beaucoup plus large sur la pauvreté, les banlieues, la politique, la France.
Et vers 30:40mn il dit la chose suivante :
« Il y a tellement de gens supers […]
Je ne suis pas un self made man, je ne me suis pas fait moi-même
J’ai rencontré tant de gens…
Ce professeur qui m’a opéré et qui me permet de bien marcher.
Cette institutrice qui m’a acheté une trousse et un cartable, parce qu’on n’avait pas d’argent.
Et la génération de mai 68, des instituteurs sur lesquels on crache maintenant.
Nous on était dans des écoles où il n’y avait que de la schlague, de la violence, des coups de règle…
Et les gens de cette génération étaient positifs, gentils, souriants, ils nous faisaient de la culture alors qu’on n’avait droit à rien ! »
<1079>
-
Mercredi 30 mai 2018
« Mai-68 : Derrière les discours révolutionnaires se profilait une société hyperlibérale. »Luc FerryParmi les pourfendeurs de mai 68, Luc Ferry est un de ceux qui en a le plus conceptualisé les conséquences négatives. Il voit sous l’apparence d’une volonté collective une aspiration individualiste au plaisir.
Rappelons qu’en mai 68 quand les manifestants voulaient protester contre l’expulsion de Daniel Cohn Bendit leur slogan était :
« Nous sommes tous des juifs allemands »
Et lorsque les terribles attentats ont frappé Charlie puis Paris. Le slogan a été :
« Je suis Charlie ou Je suis Paris »
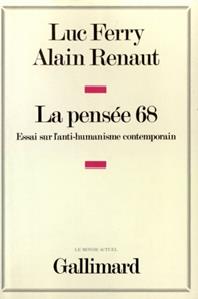 Pourtant, en mai 1968 Luc Ferry n’était pas un adepte de l’autorité et du conservatisme. Il raconte qu’il avait 17 ans et avait quitté le lycée depuis la troisième, ne supportait pas l’autorité, le côté caserne du bahut de son enfance. Il préparait son bac en candidat libre, grâce au télé-enseignement.
Pourtant, en mai 1968 Luc Ferry n’était pas un adepte de l’autorité et du conservatisme. Il raconte qu’il avait 17 ans et avait quitté le lycée depuis la troisième, ne supportait pas l’autorité, le côté caserne du bahut de son enfance. Il préparait son bac en candidat libre, grâce au télé-enseignement.
Mais en 1985, il a publié avec Alain Renaut « La pensée 68 » qui constitue une charge sévère contre Mai-68.
Selon ces deux auteurs « La pensée 68 » est un courant philosophique et intellectuel français qui a tenté d’avoir un rayonnement mondial. Et ils donnent des noms à ces intellectuels qui ont propagé cette pensée 68 : Michel Foucault, Louis Althusser, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze.
Il s’agit d’un livre érudit qui fait appel à l’histoire de la philosophie et qui pour un inculte de mon genre semble assez indigeste.
Toutefois, ils prétendent que cette pensée a poussé les occidentaux vers un individualisme forcené qui a conduit à une société hyper libérale.
« Les sixties philosophantes, ont amorcé et accompagné le procès de désagrégation du Moi qui conduit vers la conscience cool et désinvolte des années quatre-vingt… »
Le sous-titre de leur livre est « Essai sur l’anti-humanisme contemporain ».
La pensée 68 serait donc un anti-humanisme, privilégiant probablement le consommateur au profit de l’humaniste.
L’Obs est allé l’interroger Luc Ferry récemment pour savoir si son opinion a évolué sur le mouvement de mai, 33 ans après. Cet article a été publié le 15 avril 2018 et je vais en partager quelques extraits.
Il considère que l’évolution depuis 1985 a validé la thèse du livre :
« Nous disions en substance que Mai-68 n’avait pas été une révolution politique, mais sociétale, et que, derrière les discours révolutionnaires, c’était une société hyperlibérale qui se profilait.
Je reprenais au fond à Marcuse la notion de « désublimation répressive » : il fallait que les valeurs et les autorités traditionnelles fussent déconstruites, pour ainsi dire liquéfiées, pour que nous puissions entrer dans l’ère de la consommation de masse. Car rien ne freine autant la consommation que la sublimation et les valeurs traditionnelles. »
Les soixante-huitards entonnaient un discours marxiste-léniniste en béton armé, avec le fameux « élections pièges à con », mais sous l’apparence d’une visée collective et révolutionnaire c’est l’aspiration individualiste au plaisir et à la consommation qui faisait irruption comme jamais. Du reste, les slogans le disaient assez : « jouir sans entraves », « sous les pavés la plage », « il est interdit d’interdire », « vivre sans temps mort », etc.
La preuve ? Le système politique n’a pas changé d’un iota, nous sommes toujours dans la Constitution de 58. C’est le sociétal qui a changé, et en grande partie grâce à la droite libérale. C’est Giscard qui accorde le droit de vote à 18 ans, consacrant ainsi la victoire du jeunisme, c’est lui qui instaure l’égalité homme-femme dans le Code de la famille, c’est lui encore qui demande à Simone Veil une loi sur l’avortement, toutes réformes qui sont à l’évidence des héritages de 68…
Quant aux soixante-huitards, à quelques très rares exceptions près, ils vont se reconvertir dans la pub, le cinéma, l’entreprise, voire au Sénat, dans l’inspection générale et dans la social-démocratie bon teint, quand ce n’est pas au Medef, bref, dans les lieux d’argent et de pouvoir…
Il récuse le fait d’être un moraliste et de se placer dans une posture de condamnation de mai 68 et ne prétend qu’à l’analyse :
«J’essaie de comprendre ce qui s’est passé, voilà tout, et ce qui s’est passé était inscrit dans la logique du capitalisme si intelligemment analysée par Schumpeter : nous avons vécu un XXe siècle de déconstruction des autorités et des valeurs traditionnelles, une déconstruction qui était indispensable à l’essor de la consommation. Si nos enfants avaient les valeurs de nos arrière-grands-parents, ils ne seraient pas livrés comme ils le sont aujourd’hui à la consommation de masse. Désublimation, donc, mais répressive en ce sens qu’elle les ouvrait à ces fameux « temps de cerveau humain disponible » dont parlait l’ancien patron de TF1. »
Pour lui l’espérance de Mai-68 a été trahie mais le germe de la contradiction se trouvait déjà au sein des valeurs défendus dans ce mouvement :
« Ce ne sont pas des travers, c’est sa logique de fond, celle de l’innovation destructrice. Les soixante-huitards ont été les cocus de l’histoire. Ils voulaient changer le monde, créer une société anticapitaliste, sans classes, sans exploitation ni aliénation, et ils ont accouché du monde libéral dans lequel ils vivent maintenant comme des poissons dans l’eau. Même chose dans l’art contemporain : les artistes sont de gauche, mais les acheteurs de droite et au bout du compte le bohème et le bourgeois se sont réconciliés dans la figure de l’innovation destructrice… »
Il accepte quand même de trouver des apports positifs de Mai-68
« […], il est évident que la déconstruction des autorités traditionnelles a forcément des effets d’émancipation que je suis le premier à approuver : l’émancipation des femmes, des homosexuels, les lois Auroux par exemple. Je ne suis pas, contrairement à la plupart des anciens admirateurs de 68, comme mes camarades Finkielkraut ou Onfray par exemple, un antimoderne, au contraire. J’ai défendu le mariage gay jusque dans les colonnes du Figaro, et je me réjouis toujours des progrès de la liberté. »
L’ancien ministre de l’Education Nationale ne trouve cependant rien de bon pour l’école dans le mouvement de mai 68
« Non, c’est au contraire dans l’éducation que Mai-68 a été un vrai désastre, notamment à cause de la fameuse « rénovation pédagogique ». Il faut bien comprendre qu’il y a deux secteurs totalement traditionnels dans l’éducation : la maîtrise de la langue et celle de la civilité. Or c’est clairement dans ces deux domaines que notre école est le plus en difficulté.
Pourquoi ? Tout simplement parce que les règles de grammaire, comme celles de la politesse, sont purement patrimoniales, traditionnelles à 100%. Aucun d’entre nous n’a inventé ni le français ni les formules de politesse qui viennent clore une lettre. La créativité en matière de grammaire porte un nom : les fautes d’orthographe. Nous payons aujourd’hui dans ces deux domaines la déconstruction des traditions. »
La nostalgie de 68 constitue pour lui un signe de sénilité
« Tous les vieux, dans toutes les générations, regrettent leur jeunesse. […] Débarrassé des totalitarismes de l’Est comme des régimes fascistes d’Amérique latine, d’Espagne, de Grèce et du Portugal, le monde est infiniment meilleur aujourd’hui que dans les années 1960. N’était Daech, il serait presque idyllique en comparaison ; alors la nostalgie n’est guère à mes yeux qu’un signe de sénilité parmi d’autres. »
Et voilà Luc Ferry en 1969

C’est en tout cas une vision très différente d’Edgar Morin développé dans le mot du jour du 23 mai 2018
<1078>
-
Mardi 29 mai 2018
« Mai 68 : De Gaulle contre Georges Pompidou »Analyse du pouvoir politique en France en mai 68Le mouvement de mai va prendre un tour dramatique le 29 mai 1968. Le Général de Gaulle va quitter le territoire français, sans informer personne et notamment pas son premier Ministre Georges Pompidou qui ne saura donc pas, pendant plusieurs heures, où se trouve le Président de la République.
Le général De Gaulle a quitté l’Élysée mercredi 29 mai à 11 heures 15 après avoir soudainement ajourné le conseil des ministres. À Georges Pompidou, le président de la République a expliqué qu’il partait à Colombey-les-deux-églises. À 14 heures, Bernard Tricot, secrétaire général de la Présidence, a appris au Premier ministre que le Général ne se trouvait pas dans sa maison de famille en Haute-Marne. Tous ses proches collaborateurs ignoraient où il était parti. La disparition du chef de l’État a suscité de la surprise et de la panique au sein de son entourage.
Maintenant nous savons, il était à Baden Baden, dans le quartier général de l’armée Française en Allemagne. Armée qui était sous le commandement du Général Massu. A son arrivée le gouvernement allemand n’était pas non plus au courant.
C’était un acte extrêmement grave. Le Général de Gaulle en est conscient et évoque sa déchéance possible.
Georges Pompidou ne lui pardonnera jamais cet acte de « non confiance » ou de « fuite ».
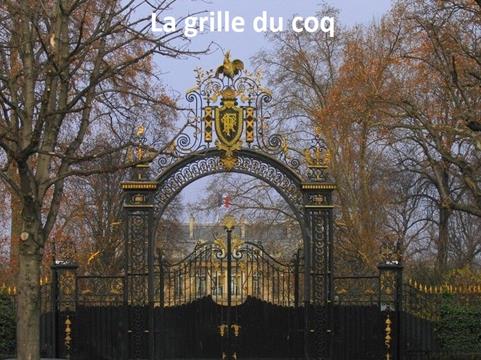 Le matin du 29 mai, De Gaulle avait fait venir à l’Élysée le général Alain de Boissieu qui était aussi son gendre et lui a fait cet aveu :
Le matin du 29 mai, De Gaulle avait fait venir à l’Élysée le général Alain de Boissieu qui était aussi son gendre et lui a fait cet aveu :
« Le peuple français n’a pas besoin de De Gaulle à sa tête … Je vais me retirer à Colombey… »
Et à 11h30, la DS présidentielle franchit, au fond du parc, la grille du Coq et ne sort donc pas par la porte principale au 55, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Elle file vers l’héliport d’Issy les Moulineaux et il est prévu que son fils : Philippe de Gaulle les rejoigne. Tante Yvonne, la discrète épouse murmure : « Cela ressemble à la fuite de Varennes… »
L’hélicoptère atterrit dans la résidence occupée par le Général Massu à 14h50.
Dans un livre publié en 2016 par La journaliste Christine Clerc: « Le tombeur du Général » dans lequel elle mélange fiction (un entretien imaginaire entre Cohn Bendit et De Gaulle) et la réalité historique, fait ce récit :
« A Matignon, Pompidou, jusque-là si calme est décomposé. Certes il connaît depuis longtemps les coups de blues du Général et sa tentation périodique du départ. Combien de fois Madame de Gaulle lui a-t-elle confié ses inquiétudes pour la santé de son mari. Mais en pleine crise politique et sociale, ce mercredi 29 mai, alors que la CGT et le PC prévoient pour le lendemain une manifestation géante dans le but d’affirmer leur prépondérance, son départ serait une véritable catastrophe. […] son retrait le placerait, lui, le Premier ministre, dans une situation constitutionnelle inextricable : verra-t-on le président du Sénat, Gaston Monnerville, qui n’a cessé de combattre le régime, assurer l’intérim ? […] De toutes parts, y compris au sein du gouvernement, des voix s’élèvent depuis plusieurs jours que l’on fasse appel à celui qui régla naguère le problème indochinois : Pierre Mendès France.»
Aujourd’hui nous disposons de divers témoignages, ainsi celui de l’entourage de Georges Pompidou :
« On est dans le salon avec Claude Pompidou et son fils Alain, ce 29 mai, à l’heure du café, lorsque le Premier ministre sort, « blême », de son bureau et lâche : « Le général de Gaulle a disparu, on a perdu sa trace. » »
Dans un article de l’Express du 8 mai 2008, l’amiral Flohic qui était en 1968 capitaine et aide de camp du Général et qui a accompagné la famille présidentielle a fait un récit « de cette escapade ». C’est lui qui révèle que le but réel du voyage a été caché jusqu’au dernier moment. Et c’est le capitaine Flohic qui raconte qu’une fois arrivée c’est lui qui téléphone au Général Massu. Récit amusant :
« – Nous sommes là !
– Qui nous ?
– Le Général et Mme De Gaulle.
– Laisse-moi 5 mn, je faisais la sieste à poil sur mon lit »
On saura plus tard qu’il avait reçu la veille le maréchal Kochevoï, commandant des troupes soviétiques en RDA. LA soirée avait été plutôt arrosée ! […]
Le président apostrophe Massu : « Tout est foutu ! » […]
A 15h20. Le chef de l’Etat m’interpelle : « Que va-t-il se passer maintenant en France, le Conseil constitutionnel va constater ma déchéance »
Et puis De Gaulle discute en tête à tête avec Massu et à 16 heures, le capitaine Flohic constate :
« Je trouve un homme transformé, ragaillardi. Il avait pris sa résolution. L’intervention de Massu s’est révélée déterminante. Il le confirmera quelque temps plus tard lors d’un déjeuner, s’adressant à Mme Massu : « C’est la Providence qui a placé votre mari sur mon chemin. »
La suite est connue. Il repart à 16h30 et cette fois va à Colombey. Dès qu’il arrive il téléphone enfin à Pompidou pour l’avertir de convoquer le Conseil des ministres le lendemain donc le jeudi.
Le lendemain matin, le 30 mai Pompidou présente sa démission à De Gaulle qui la refuse.
« Quand Pompidou arrive à l’Elysée, ce jeudi 30 mai à 14 h 30, sa grande lassitude le dispute à la déception. Il n’a toujours pas digéré les événements des vingt-quatre dernières heures. […]
Tenu à l’écart de cette initiative prise sous le sceau du secret le plus absolu, duquel même la garde rapprochée du chef de l’Etat a été exclue, il estime que le Général a commis une erreur. Partir ainsi, dans un pays étranger, pour chercher conseil auprès d’un autre général, Massu en l’occurrence, alors que la nation traverse une période d’instabilité profonde, constitue, selon lui, un risque majeur, explique-t-il à ses proches.
Ce différend entre le chef de l’exécutif et celui qu’il a désigné pour diriger sa majorité n’est pas le premier. Dix jours auparavant, les deux hommes s’étaient déjà montrés en désaccord sur la manière de répondre aux manifestations.
Le 19 mai, à son retour de Roumanie, où il a séjourné du 14 au 18, de Gaulle a convoqué Pompidou à l’Elysée, ainsi que Pierre Messmer, ministre des armées, Georges Gorse, ministre de l’information, Christian Fouchet, ministre de l’intérieur, et Maurice Grimaud, préfet de police de Paris. Dans un bloc-notes qu’il tient de manière quasi quotidienne, ce dernier livre un compte rendu de cette réunion. « Pompidou veut prendre la parole mais le général la lui coupe : « Ce qui se passe a assez duré. Cette fois, c’est la chienlit et l’anarchie. Ça n’est pas tolérable. Il faut que ça cesse. J’ai pris mes décisions. On évacue aujourd’hui l’Odéon et demain la Sorbonne. » » Dans la salle, quelques voix tentent de faire entendre la difficulté de l’entreprise. Bien que le Général refuse de les prendre en compte, l’ordre ne sera pas suivi d’effet. Ni le préfet ni Pompidou ne sont partisans de la manière forte.
[…] Le premier ministre cherche une sortie pacifique. Il pense que la surenchère des étudiants joue contre eux. Il sait que leur intransigeance inquiète les syndicats, surtout la CGT. Dans cette période d’agitation extrême, la centrale de Georges Séguy craint d’être débordée sur sa gauche. Elle aussi cherche une issue. Ces derniers jours, des contacts officieux, mais de plus en plus fréquents, sont établis entre les responsables de la CGT et les représentants de Matignon.
D’un côté comme de l’autre, on prépare la négociation de Grenelle à l’abri des regards. C’est dans ce contexte — entre le 18 et le 20 mai, la date exacte reste introuvable — qu’Henri Krasucki, numéro deux de la CGT, et Jacques Chirac se retrouvent en tête à tête à Paris, dans un lieu discret — le cabinet d’un avocat communiste.
Quand, en 1977, Chirac livre dans Paris Match sa version de ce tête-à-tête — il parle d’une chambre de bonne et d’une planque clandestine —, Krasucki s’en amuse. Avec sa gouaille inimitable, le dirigeant de la CGT décrit le jeune Chirac en « homme fébrile et angoissé » à l’idée de se rendre dans un endroit qui lui était inconnu. En vérité, et cet épisode rocambolesque l’illustre, durant toute la période de Mai 68, les ponts n’ont jamais été rompus entre le gouvernement et les syndicats. « Nous étions tous en relation avec nos interlocuteurs habituels », se souvient Edouard Balladur. […]
Blessé par l’épisode de la veille, Pompidou le rejoint en début d’après-midi. Sa lettre de démission en poche, le voici devant le Général. « Si vous partez, je pars aussi. Vous restez ! », rétorque celui-ci. De Gaulle n’a pas l’intention de sacrifier son premier ministre. A ses yeux, ce n’est pas le moment de fléchir. Le pays a besoin que s’exprime l’autorité de l’État. Le peuple veut en finir avec ce désordre. Le message vaut pour l’opinion, mais aussi pour ceux qui, dans l’entourage du chef de l’État — responsables militaires, hauts fonctionnaires et dirigeants de la droite —, douteraient de sa détermination. Il montre à Pompidou la déclaration qu’il s’apprête à faire à la radio. « Je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le premier ministre… » Il appelle à l’ordre et annonce la convocation d’un référendum sur la participation. […]
L’idée de ce référendum lui a été suggérée par Bernard Ducamin, l’un de ses conseillers, qui travaille au secrétariat général de l’Élysée sous l’autorité du fidèle Bernard Tricot.
Comme le révèle le livre 68, les archives du pouvoir (L’Iconoclaste, 304 p., 25 €), dès la mi-mai, Bernard Ducamin considère que l’exécutif a perdu suffisamment de temps. « Le tableau de la situation est sombre, écrit-il dans une note confidentielle qu’il remet à Bernard Tricot. […] Toutes les conditions objectives d’un drame sont réunies. » Et le haut fonctionnaire de recommander un remaniement ministériel, une reprise en main policière et l’organisation d’un référendum.
Mauvaise idée, selon Pompidou. Pour lui, ce référendum est un piège. Il n’en veut pas et le dit au Général. Le premier ministre plaide pour la dissolution de l’Assemblée nationale et l’organisation de nouvelles élections législatives dans la foulée. De Gaulle accepte. Aux yeux de Pompidou, cette décision a le mérite de satisfaire tout le monde : la gauche, qui réclame la démission du gouvernement ; les syndicats, qui ont rejeté ses propositions ; et les Français, qui souhaitent que tout ça se termine. »
Encore une fois, Pompidou fait fléchir De Gaulle et arrive à le convaincre de convoquer de nouvelles élections législatives et non de faire un référendum sur la participation dont Pompidou ne veut pas. Il est en effet beaucoup plus à droite que De Gaulle.
L’histoire retiendra que Pompidou par son calme ainsi que le préfet de police « Maurice Grimaud » ont évité des violences inutiles et surtout des morts et des blessés graves. De Gaulle aurait voulu une manière forte.
Cette Histoire est probablement vraie en partie.
Mais Pierre Mendés France dans l’émission Apostrophes du 23 janvier 1976, apporte de petites nuances. Le 27 mai 1968, s’était tenu le fameux meeting de la gauche non communiste au stade de Charléty. Et Mendés France était venu mais beaucoup s’étonnèrent qu’il n’y prenne pas la parole. Dans ce court extrait il explique à la fois la désunion de la Gauche, raison pour laquelle il ne trouvait aucun intérêt à parler devant la foule et il raconte autre chose : la raison de sa présence. Il avait appris, car ses réseaux au niveau du pouvoir étaient très présents, que dans l’entourage du premier ministre on voulait employer la méthode forte, brutale pour cette fois réprimer violemment les étudiants et les jeunes et lui avec son prestige avait la volonté d’éviter cela par sa présence. Il est vrai qu’il reconnait que l’échec à ce moment-là des négociations de Grenelle avait conduit les tenants de la manière forte à revenir à la modération.

Les syndicats avaient donné leur accord à Pompidou, mais le 27 mai Georges Séguy, secrétaire général de la CGT n’avait pas obtenu l’adhésion des ouvriers de Renault à Boulogne Billancourt qui trouvaient les avancées sociales insuffisantes.
Et cela est à rapprocher du témoignage d’Edouard Balladur sur France Inter que j’ai évoqué lors du mot du jour du 22 mai 2018….
On apprend que Pompidou n’était pas tant adepte de la méthode douce, mais qu’il était convaincu que la méthode forte contre les étudiants conduirait à la mobilisation de l’opinion publique contre le gouvernement.
Il a donc poursuivi une stratégie simple : attendre que le mouvement lasse l’opinion publique et faire diverger les intérêts des ouvriers et les revendications des étudiants. Si les accords de Grenelle avaient été concluants dès le 27 mai 1968, il n’aurait probablement eu aucun scrupule à essayer d’employer la manière forte à Charléty.
Tel ne fut pas le cas
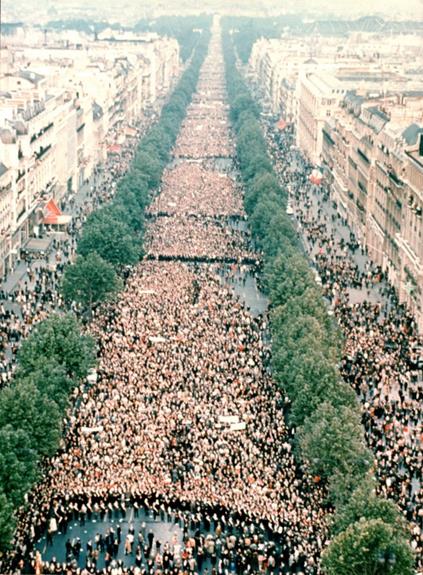 Le 30 mai le Général prend la parole à la radio :
Le 30 mai le Général prend la parole à la radio :
« J’ai envisagé depuis vingt-quatre heures toutes les éventualités. J’ai pris des résolutions. Je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd’hui l’Assemblée nationale. »
Immédiatement, des centaines de milliers de gaullistes remontent les Champs-Elysées vers la place de l’Étoile derrière Michel Debré et Malraux.
Le 1er juin, Georges Séguy écrit dans « l’Humanité » :
« La CGT n’entend gêner en rien le déroulement » des élections législatives fixées par de Gaulle à la fin du mois ».
Elle choisit ainsi avec le parti communiste résolument le parti de De Gaulle contre les anarchistes trotskystes et maoïstes que l’une et l’autre détestent. Il est vrai aussi que la France profonde est devenu lasse des perturbations et va prouver par son vote le retour à la normalité du pouvoir gaulliste et au-delà : il s’agira d’un triomphe.
La manifestation gaulliste du 30 mai et l’organisation des élections législatives les 23 et 30 juin sonneront la fin de Mai 68.
Mais Pompidou et De Gaulle ne sont plus sur la même ligne.
Pompidou démissionne, De Gaulle nomme Maurice Couve de Murville.
Georges Pompidou, lors d’un voyage à Rome en janvier 1969 déclarera :
« Ce n’est un mystère pour personne que je serai candidat à une élection à la présidence de la République quand il y en aura une, mais je ne suis pas du tout pressé ».
Il ira ainsi toujours plus loin dans la rupture.
En parallèle, une sordide affaire Markovic mettant en cause son épouse Claude augmentera encore son ressentiment car il ne trouvera pas le soutien qu’il aurait attendu de l’homme qu’il avait fidèlement servi pendant tant d’années.
De Gaulle tombera comme un fruit mur, comme une conséquence de mai 68 par le référendum du 27 avril 1969, moins d’un an après.
Et Georges Pompidou fut élu triomphalement Président de la République le 15 juin 1969 avec 58,21 % des suffrages exprimés. Il avait quitté son poste de premier ministre le 10 juillet 1968, moins d’un an avant !
Son opposant était un centriste, le président du Sénat Alain Poher. La Gauche ne fut même pas représentée au second tour.
Mai 68 fut le naufrage de la Gauche et le triomphe de Georges Pompidou contre la Gauche et finalement contre le Général de Gaulle.
Patrick Rotman avait produit un documentaire sur ce 29 mai <De Gaulle disparaît>
<1077>
-
Lundi 28 mai 2018
Ceux qui croient que ça se pense
Ça se hurle ça se souffre
C’est la mort et c’est le gouffre »Anne Sylvestre, « Non non tu n’as pas de nom »<66,4% des électeurs irlandais ont voté en faveur> de la légalisation de l’avortement dans ce pays où la tradition catholique a si longtemps résisté à cette évolution sociétale. Comme le rapporte <France Info> : « L’interdiction d’avorter est désormais une exception en Occident. Il reste encore la très catholique île de Malte. L’avortement y est totalement interdit. Les femmes qui y auraient recours et leurs médecins risquent trois mois de prison. À Chypre et en Pologne, l’avortement est autorisé, mais seulement en cas de viol, de malformation du foetus ou alors de risque pour la santé de la mère et de l’enfant »
Cette même émission précisait que dans le Monde, notamment sous le poids des religions, la situation n’est pas la même. Environ 60 % des femmes dans le monde n’ont toujours pas accès librement à ce droit.
Il semblerait que le premier État qui ait légalisé l’avortement fut l’Union soviétique en 1920 sous l’impulsion de Lénine. Mais en 1936 Staline l’interdit à nouveau et la légalisation est rétablie en 1955, 2 ans après la mort de Staline. Et c’est, quelques jours avant mai 68, le 27 avril 1968 que l’Angleterre autorise l’interruption volontaire de grossesse.
Pour la France, nous nous en souvenons, qu’il a fallu attendre 1975 et la Loi Veil pour rendre possible l’avortement médicalisé et non réprimé.
Mais lors du mot du jour du 5 septembre 2017 qui rendait hommage à Simone Veil, j’avais rappelé qu’elle avait au début de son intervention devant l’Assemblée Nationale eut ces propos :
« Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme. Je m’excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d’hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. C’est toujours un drame, cela restera toujours un drame ».
Deux avant 1975, Anne Sylvestre avait écrit, avec son talent et son humaniste, une chanson bouleversante évoquant ce drame, cette déchirure : « Non non tu n’as pas de nom »
Anne Sylvestre est connu par quasi tous les parents et les enfants grâce à ses fabulettes pour enfants. Je crois qu’à la maison nous avons tous les CD de ces chansons enfantines.
Mais ce n’était qu’une deuxième partie de sa vie artistique, la première et celle pour laquelle elle se produisait en public concernait la chanson à texte, chansons pour adultes, chansons engagées.
France Inter lui a consacré une émission parce que <Anne Sylvestre vient de fêter ses 60 ans de carrière de chanteuse à texte>
Elle est née le 20 juin 1934 à Lyon et a donc aujourd’hui 83 ans.
Un de ses petit-fils, Baptiste Chevreau 24 ans est tombé sous les balles des terroristes au Bataclan.
C’est donc en 1973 qu’elle a écrit, composé et chanté cette chanson dont elle disait que ce n’était pas une chanson sur l’avortement, mais une chanson sur l’enfant ou le non-enfant.
Quand on veut en citer un extrait on privilégie souvent :
« Oh ce n’est pas une fête
C’est plutôt une défaite
Mais c’est la mienne et j’estime
Qu’il y a bien deux victimes »
J’en ai choisi un autre comme exergue de ce mot du jour qui s’intercale entre ceux consacrés à Mai 68, celui consacré aux mères et qui célèbre à la fois cette victoire de la raison en Irlande et les 60 ans de carrière d’une artiste exceptionnelle.
Cette chanson se trouve sur l’album « Une sorcière comme les autres ».
Voici le texte intégral de cette chanson humaniste et qui parle au cœur et aux sentiments.
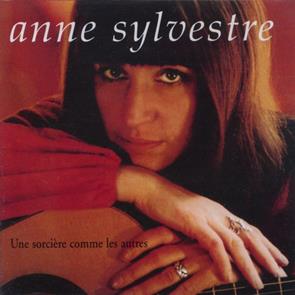 Non non tu n’as pas de nom
Non non tu n’as pas de nom
Non tu n’as pas d’existence
Tu n’es que ce qu’on en pense
Non non tu n’as pas de nom
Oh non tu n’es pas un être
Tu le deviendras peut-être
Si je te donnais asile
Si c’était moins difficile
S’il me suffisait d’attendre
De voir mon ventre se tendre
Si ce n’était pas un piège
Ou quel douteux sortilège
Non non tu n’as pas de nom…
Savent-ils que ça transforme
L’esprit autant que la forme
Qu’on te porte dans la tête
Que jamais ça ne s’arrête
Tu ne seras pas mon centre
Que savent-ils de mon ventre
Pensent-ils qu’on en dispose
Quand je suis tant d’autres choses
Non non tu n’as pas de nom…
Déjà tu me mobilises
Je sens que je m’amenuise
Et d’instinct je te résiste
Depuis si longtemps j’existe
Depuis si longtemps je t’aime
Mais je te veux sans problème
Aujourd’hui je te refuse
Qui sont-ils ceux qui m’accusent
Non non tu n’as pas de nom…
A supposer que tu vives
Tu n’es rien sans ta captive
Mais as-tu plus d’importance
Plus de poids qu’une semence
Oh ce n’est pas une fête
C’est plutôt une défaite
Mais c’est la mienne et j’estime
Qu’il y a bien deux victimes
Non non tu n’as pas de nom…
Ils en ont bien de la chance
Ceux qui croient que ça se pense
Ça se hurle ça se souffre
C’est la mort et c’est le gouffre
C’est la solitude blanche
C’est la chute l’avalanche
C’est le désert qui s’égrène
Larme à larme peine à peine
Non non tu n’as pas de nom…
Quiconque se mettra entre
Mon existence et mon ventre
N’aura que mépris ou haine
Me mettra au rang des chiennes
C’est une bataille lasse
Qui me laissera des traces
Mais de traces je suis faite
Et de coups et de défaites
Non non tu n’as pas de nom
Non tu n’as pas d’existence
Tu n’es que ce qu’on en pense
Non non tu n’as pas de nom
Paroles et musique: Anne Sylvestre, 1973
En 1998 à l’Olympia, Anne Sylvestre à 68 ans, a redonné une nouvelle interprétation à cette chanson que vous pourrez écouter et voir derrière ce <Lien>.
Sur ce même album « Une sorcière comme les autres », il y a aussi cette très belle chanson : « Un mur pour pleurer ».
<1076>
-
Vendredi 25 mai 2018
« Les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles. »Albert Cohen « Le livre de ma mère » chapitre 27Ce dimanche est consacré à la fêtes des mères. Pour ce jour je voudrais partager ce mot d’Albert Cohen.
L’immense écrivain, Albert Cohen a écrit un livre : « Le livre de ma mère », livre d’un fils qu’il a consacré à sa mère alors qu’elle ne faisait plus partie de la communauté des vivants.
C’est un livre bouleversant qui est certainement résumé par ces quelques mots que j’ai mis en exergue.
C’est un livre aussi très drôle où il raconte des anecdotes sur sa mère qui est une mère juive.
Mais toutes les mères sont un peu « des mères juives ».
Alors elle est bien sûr inquiète que son fils ne suive pas les règles communautaires :
« Dis mon enfant, à Genève, tu ne manges pas de l’Innommable ? [traduction : du porc].
Enfin, si tu en manges, ne me le dis pas, je ne veux pas savoir. » (page 25)
Ou encore :
« Écoute, mon fils, même si tu ne crois pas en notre Dieu, à cause de tous ces savants, maudits soient-ils, eux et leurs chiffres, va tout de même un peu à la synagogue, supplia t’elle gentiment, fais-le pour moi. (page 24)»
Elle était simple, pieuse et suivait scrupuleusement les règles religieuses qu’on lui avait enseigné. Elle était pourtant très lucide sur les fondements de sa religion :
« Mon fils, vois-tu, les hommes sont des animaux. Regarde-les, ils ont des pattes, des dents pointues. Mais un jour des anciens temps, notre maître Moïse est arrivé et il a décidé, dans sa tête, de changer ces bêtes en hommes, en enfants de Dieu, par les Saints Commandements, Tu comprends. Il leur a dit : tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, c’est mal […]. Moi, je crois que c’est lui qui a inventé les Dix commandements en se promenant sur le Mont Sinaï pour mieux réfléchir. Mais il leur a dit que c’était Dieu pour les impressionner, tu comprends. Tu sais comment ils sont, les juifs. Il leur faut toujours le plus cher. […] Alors, Moïse qui les connaissait bien, s’est dit : si je leur dis que les commandements viennent de l’Eternel, ils feront plus attention, ils respecteront davantage. » (Page 69)
La sagesse des simples…
Mais il n’est finalement que peu question de sujets proprement juifs dans ce livre. Il est bien davantage question de l’histoire universelle des fils avec leur mère.
Et Albert Cohen de raconter ce qu’il a vécu avec sa mère qui était toujours prête à l’impossible pour lui, à toutes les attentions et lui de raconter toutes ces fois où il a manqué de temps, d’attention, de douceur ou même les cas où il a été injuste à son égard. Et nous arrivons au chapitre 27 :
« Et pourtant je l’aimais.
Mais j’étais un fils.
Les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles.
Fils des mères encore vivantes, n’oubliez plus que vos mères sont mortelles.
Je n’aurai pas écrit en vain, si l’un de vous, après avoir lu mon chant de mort, est plus doux avec sa mère, à cause de moi et de ma mère.
Soyez doux chaque jour avec votre mère.
Aimez-la mieux que je n’ai su aimer ma mère.
Que chaque jour vous lui apportiez une joie, c’est ce que je vous dis du droit de mon regret, gravement du haut de mon deuil.
Ces paroles que je vous adresse, fils des mères encore vivantes, sont les seules condoléances qu’à moi-même je puisse m’offrir. […]
Aucun fils ne sait vraiment que sa mère mourra et tous les fils se fâchent et s’impatientent contre leurs mères, les fous si tôt punis.» (page 168-170)
On dit que les hommes de la guerre 14-18, endurcis et prêt à tous les sacrifices, au moment ultime et dans leur plus grande détresse n’avez qu’un mot qui venait spontanément : « Maman »
Fils des mères encore vivantes, n’oubliez pas que vos mères sont mortelles.
Car il y a une vie avant la mort, pendant laquelle vous pouvez agir avec attention, en bienveillance et en douceur.

<1075>
-
Jeudi 24 mai 2018
« Pause »Pas de mot du jour aujourd’huiLe mot du jour s’enrichit d’un langage « chatien » je veux dire basé sur des photos explicites de chat.
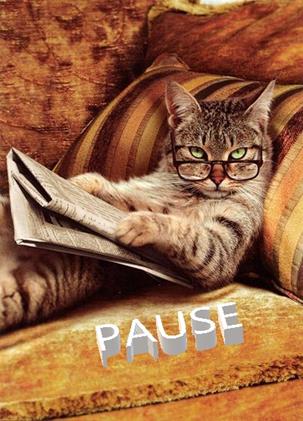 J’interromps la série sur mai 68, parce que je prépare un mot du jour pour demain qui sera consacré à la fête des mères de ce dimanche.
J’interromps la série sur mai 68, parce que je prépare un mot du jour pour demain qui sera consacré à la fête des mères de ce dimanche.
L’année dernière, déjà, j’avais écrit un mot du jour en l’honneur de la fête des mères :
« Maman, tu es simplement jeune, depuis plus longtemps !»
<Article sans numéro>
-
Mercredi 23 mai 2018
«Mai-68 : La brèche n’est pas refermée»Edgar Morin.Il y a les mentors de Mai 68, hier nous évoquions Jean-Paul Sartre. <Le Nouvel Obs> cite Herbert Marcuse (1898 -1979), sociologue marxiste, américain d’origine allemande qui dénonçait tant le bloc occidental que l’URSS. Je garde de lui cette phrase qui m’avait marqué quand j’étais jeune, « ce qui est pornographique ce n’est pas une femme qui montre son pubis mais le fait de mettre dans les vitrines des biens que des gens qui passent ne peuvent pas acheter. En 1964, il écrit « L’Homme unidimensionnel » (One Dimensional Man) qui paraît en France en 1968 et devient un peu l’incarnation théorique de la nouvelle révolte étudiante. En 1968, il voyage en Europe, et tient de multiples conférences et discussions avec les étudiants. (source Wikipedia).
Il y a aussi Louis Althusser. En 1968, Louis Althusser (1918-1990) est le gourou de la rue d’Ulm, et une figure majeure de la pensée marxiste mais flirtant avec la dépression avant de sombrer dans la folie.
L’article du nouvel obs cite aussi le philosophe et sociologue Henri Lefebvre (1901-1991) qui contrairement aux deux précédents m’était complétement inconnu. L’hebdomadaire ajoute : « Métro, boulot, dodo. – Le mot n’est pas de lui, mais ce slogan repris par les étudiants de 68 pourrait suffire à résumer le travail critique engagé Henri Lefebvre, inspirateur aujourd’hui un peu oublié de la révolte de Mai.
Mais selon cet article, ou plutôt ma compréhension de l’article, il semblerait que le plus grand inspirateur de Mai 68 soit Guy Debord, (1931-1994). Auteur en 1967 de «la Société du spectacle » que le nouvel obs décrit ainsi :
« Dans une nuée de formules ciselées, parfois poétiques, souvent obscures, il y critique tant la bureaucratie soviétique que le capitalisme occidental, englués selon lui dans la même illusion : le « spectacle ». Celui-ci ne saurait se résumer à l’extension tentaculaire de la publicité ou des médias de masse ; Debord le définit comme « le règne autocratique de l’économie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable, et l’ensemble des nouvelles techniques de gouvernement qui accompagnent ce règne ».
Il fonde « l’Internationale situationniste » :
« qui se donne pour but ultime de mettre fin à la séparation entre l’art et la vie. Pour s’en dégager, il propose dès 1957 de « construire des situations », c’est-à-dire « un ensemble d’impressions déterminant la qualité d’un moment ». Il s’agit d' »entraîner le spectateur à l’activité », aux prémices d’une révolution qui bousculera les vies rabougries, passives et aliénées auxquelles condamne la réalité « spectaculaire » – le modèle politique des « situs » se rapproche du conseillisme, de l’autogestion. »
 Et puis il y avait Edgar Morin « Témoin enthousiaste de Mai 1968 ». En 1968 Edgar Morin avait 46 ans et ressemblait à cette photo..
Et puis il y avait Edgar Morin « Témoin enthousiaste de Mai 1968 ». En 1968 Edgar Morin avait 46 ans et ressemblait à cette photo..
il analysait et décryptait à chaud dans des articles du Monde les évènements. A partir de ces articles il a écrit avec Claude Lefort et Cornelius Castoriadis « Mai 68, La Brèche » chez Fayard.
Ouvrage enrichi en 1988 par une nouvelle édition suivie de «Vingt ans après », éd. Complexe. 50 ans après l’Obs a réinterrogé Edgar Morin qui a désormais 96 ans. Le titre de l’article est « La brèche n’est pas refermée »
C’est cet article, publié le 23 mars 2018, que je partage aujourd’hui avec vous.
Lorsque les évènement de mai se sont déclenchés, il n’était pas totalement décontenancé car il avait détecté l’émergence d’une nouvelle classe d’âge adolescente :
« J’avais en tout cas diagnostiqué dès la fin des années 1950 qu’une nouvelle classe, la classe d’âge adolescente, s’était constituée après-guerre. Venue s’intercaler entre le cocon de l’enfance et le moment de l’insertion dans l’âge adulte, elle a acquis ses rites, son vocabulaire, son habillement, ses lieux de rassemblement, sa musique, et a développé des aspirations propres : alors que la civilisation des Trente Glorieuses prétendait apporter le bien-être par le confort matériel, les adolescents ressentaient la vacuité de cette promesse. Ils étaient à la recherche d’une forme d’authenticité personnelle, rêvaient de fraternité, de vie communautaire et en même temps d’autonomie individuelle.
Et ce décalage, ce malaise, qui ont pris corps sur grand écran avec les personnages incarnés par James Dean et Marlon Brando au milieu des années 1950, ont engendré des formes de rébellion. Il ne faut pas oublier que, le 22 juin 1963, lors du grand concert organisé place de la Nation par le magazine « Salut les copains », qui avait drainé une foule immense d’adolescents venus communier avec leurs idoles dont Johnny Hallyday, l’exaltation de la fête a suscité des débordements, grilles d’arbre arrachées, voitures renversées. »
Le phénomène « yéyé », ainsi que je l’ai baptisé dans un article que j’ai écrit pour « le Monde » après ce rassemblement alors inédit de 200.000 jeunes, révélait une soudaine violence. Derrière les vedettes plus ou moins canalisées dans le show-business que promouvait Daniel Filipacchi, le créateur de « Salut les copains », les banlieues ont vu proliférer les groupes de rock des « blousons noirs » en révolte. ».
Lorsque le journaliste s’insurge en disant cette évidence : « Mais ce ne sont pas les blousons noirs qui ont fait Mai-68… ». Edgar Morin réplique :
« Evidemment non. A partir de 1965, la classe adolescente s’est constitué une intelligentsia chez les étudiants, et d’abord à l’université de Berkeley, en Californie, où de jeunes contestataires ont théorisé et exprimé clairement leurs aspirations à une autre vie, en rupture avec celle, « unidimensionnelle » – pour citer leur mentor, Marcuse –, des adultes.
Or, début 68, par une sorte de contagion due à la mondialisation de l’information, des révoltes étudiantes ont éclaté dans des pays aux systèmes politiques et sociaux aussi différents que les Etats-Unis, le Mexique, l’Egypte ou la Pologne. Le point commun entre tous ces mouvements, c’était le rejet de l’autorité du monde adulte, qu’elle soit professorale, familiale, gouvernementale, institutionnelle, dictatoriale. Et j’ai compris que la France serait la prochaine sur la liste lorsque, en mars 1968, le philosophe et sociologue Henri Lefebvre, qui était alors professeur à Nanterre, m’a demandé d’assurer quelques cours à sa place.
En arrivant sur le campus, je n’avais aucune idée de l’agitation qui y régnait depuis quelques semaines ; quand j’ai voulu commencer mon cours, des étudiants présents dans l’amphi se sont mis à crier « Grève ! ». J’ai proposé de voter pour ou contre la tenue du cours, et le « pour » l’a emporté. Deux mécontents ont alors scandé : « Morin, flic ! » J’avais donc identifié des signes avant-coureurs. Pour autant, je n’avais nullement imaginé la tournure qu’allaient prendre les événements en France. »
Il parle aussi qu’au milieu de toutes les révoltes étudiantes dans le monde en 68, il y a une exception française car c’est la seule qui ait débordé l’université pour investir tous les champs de la société et provoquer une crise politique majeure.
« Mai-68 est un événement complexe, mélange de nécessité – le contexte universitaire international – et de hasard. Dans ce pays à l’économie florissante qu’est la France des années 1960, où l’ordre gaulliste semble avoir étouffé le débat politique, se produit un phénomène assez imprévisible de contagion en chaîne, de Nanterre au Quartier latin, puis du Quartier latin aux universités de province, des étudiants aux artistes et intellectuels, enfin de ces milieux privilégiés aux masses populaires.
Plusieurs facteurs ont joué. En France, les étudiants étaient moins isolés dans la société que ne l’étaient leurs homologues étrangers. L’influence des intellectuels était chez nous bien plus forte. Surtout, un événement décisif se produit début mai à la Sorbonne, lorsque cette révolte née dans un esprit principalement libertaire, l’esprit du Mouvement du 22 Mars de Nanterre animé par le génial petit stratège qu’était Dany Cohn-Bendit, est ralliée par des groupuscules trotskistes et maoïstes.
Les militants politisés disent alors aux étudiants : « Vos aspirations, votre quête de liberté, de fraternité, nous allons les réaliser par notre révolution. » Dès lors, les étudiants révoltés font des appels pressants à la classe supposée révolutionnaire qu’est la classe ouvrière. Et, malgré les réticences des dirigeants syndicalistes et communistes, le mouvement parvient à sortir de l’université pour s’agréger les revendications sociales et politiques de millions de Français, qui vont faire grève dans les usines puis dans les bureaux.
Dans cet effet boule de neige, l’imaginaire joue un rôle essentiel. En passant des manifestations, des slogans et des affiches aux barricades, on passe du jeu, de la kermesse, à l’affrontement violent. Alors se réveille une mémoire historique, celle des insurrections du passé, y compris le soulèvement relativement récent de Paris en août 1944. On réactive la tradition insurrectionnelle de la France, qui a toujours mêlé les âges et les conditions sociales. »
Et puis il répond directement à la « révolution introuvable » de Raymond Aron :
« Après la fin des événements, l’idée que Mai-68 aurait été une insurrection ratée a été propagée aussi bien par la droite, qui se vantait de l’avoir empêchée, que par l’extrême gauche, qui a voulu y voir une répétition générale de la révolution à venir. Or penser Mai-68 comme un épisode révolutionnaire classique, c’est passer à côté de sa vérité.
Avec mes amis Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, dans un livre que nous avons publié quelques semaines après les événements (1), nous avons au contraire avancé l’idée que Mai-68 avait été une brèche sous la ligne de flottaison de l’ordre social, par laquelle se sont engouffrées des valeurs, des aspirations, des idées nouvelles, appelées à transformer en profondeur notre civilisation. Avec Mai, rien ne change et tout change. L’ordre politique, social, économique est rétabli dès le mois de juin, mais un processus s’est enclenché qui va bouleverser l’esprit du temps et les sensibilités.
La première traînée de Mai-68, la plus visible, c’est la montée en puissance de ce qu’on a appelé le gauchisme, qui a tenu une place essentielle au sein de la jeunesse intellectuelle de la première moitié des années 1970. Ces militants trotskistes d’une part, maoïstes de l’autre, étaient alternativement excités et modérés par une partie de l’intelligentsia française, derrière Jean-Paul Sartre et Maurice Clavel.
A la différence de l’Allemagne et de l’Italie, il n’y a pas eu en France de minorité qui se soit lancée dans le terrorisme, mais des jeunes maoïstes sont par exemple allés en usine découvrir la condition ouvrière et propager la bonne parole. Reste qu’en 1977 le marxisme-léninisme connaît chez nous un collapsus brutal, lorsque l’épisode grotesque de la Bande des Quatre ternit le mythe maoïste, que le régime idéalisé de Hô Chi Minh au Vietnam révèle son visage dictatorial, que le message des dissidents soviétiques commence enfin à se faire entendre.
Dès lors, on a pu mieux mesurer l’importance de dynamiques sociales plus profondes, et durables, qui se sont enclenchées autour de 68 : l’émancipation des femmes, l’émergence d’une culture de la différence – celle des homosexuels ou, sur un tout autre plan, celle des néo-régionalistes –, le goût de l’expérience, individuelle ou communautaire, l’émergence aussi d’une conscience écologique, la mise en question du progrès scientifique.
Toutes ces dynamiques, filles de Mai, ont eu tendance à transformer l’euphorie de la civilisation du bien-être en problématisation. La presse féminine, qui vendait du bonheur, s’est mise à poser le problème du vieillissement, de l’abandon. Au cinéma, la fin des films n’a plus été systématiquement heureuse. L’air du temps a changé : on a vu une poussée conjointe du désir et de l’inquiétude, le doute critique a succédé à la croyance majoritaire dans le progrès technique et social des années 1950 et 1960, les malaises croissants ont cherché ou trouvé leurs remèdes dans l’antipsychiatrie, le yogisme, le bouddhisme zen…
Cette évolution des mentalités, conjuguée aux effets du choc pétrolier de 1973, a fini par détruire la tranquille assurance des officiels de la pensée et de la politique, qui croyaient qu’après 1945 la meilleure des sociétés possibles s’était enfin installée, et qu’elle ne pouvait que progresser dans ses bienfaits. »
Edgar Morin parle aussi de ce que Mai 68 lui a apporté personnellement :
« Est-ce que vous aussi, en tant que penseur et en tant qu’homme, avez été changé par Mai-68?
Ces événements m’ont marqué, indéniablement. Sur le moment, en observant les manifestations, j’ai été témoin d’un instant unique. D’un seul coup, dans les rues, les gens qui ne se connaissaient pas se sont mis à se parler. C’était une extase de l’histoire, comme j’en ai vécu deux autres, en juin 36 puis, surtout, à la Libération de Paris.
Même s’ils n’ont duré qu’un instant, même s’ils n’ont pas été suivis de tous les effets attendus, ces moments ont existé. Et le souvenir de l’extase, de la communion, reste bien vivant en moi. D’autant que j’ai eu la chance de regoûter à cette atmosphère l’année suivante en Californie, quand j’ai été invité à travailler plusieurs mois au Salk Institute for Biological Studies de San Diego. La Californie vivait alors les derniers mois d’une floraison magnifique, un Mai-68 qui a duré quatre ans, de 1967 à 1970. La fête ne s’arrêtait jamais. La vie et les idées se mêlaient. J’ai fréquenté des intellectuels dont j’ai appris beaucoup de choses, tout en passant avec eux des soirées à danser et à fumer de la marijuana.
J’ai écrit, alors : « A 48 ans, j’apprends à vivre », ce qui m’a évidemment valu des moqueries. Mais de fait, c’est à ce moment-là que je me suis autorisé à prendre la parole dans mes écrits, à exprimer des opinions et des interrogations personnelles – j’ai alors osé publier « le Vif du sujet », une longue méditation rédigée des années plus tôt, puis un Journal de Californie où je mêlais de même idées et expériences personnelles. Et cette ambiance, ces échanges incessants, ont aussi profondément influencé ma réflexion : c’est en Californie que je me suis définitivement convaincu de la nécessité de décloisonner les disciplines, de relier les savoirs pour penser la complexité. »
Et aujourd’hui à 96 ans Edgar Morin arrive à la conclusion que j’ai mis en exergue de ce mot du jour : « Cette brèche ne s’est pas refermée » :
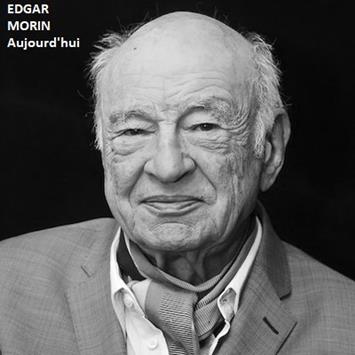 [La brèche est] toujours plus béante. Le problème civilisationnel mis en évidence par Mai-68 s’est aggravé, s’est durci : le rejet d’une civilisation qui prétend apporter aux hommes le bien-être, mais ne parvient pas à combler leurs aspirations profondes, est au cœur de nos difficultés contemporaines, collectives et individuelles. Consacré par la chute du communisme puis la mondialisation, le dogme néolibéral apparu dans les années 1970 a beau se présenter comme une réalité incontournable, sans alternative, c’est en fait la nouvelle idéologie, qui masque sous le calcul les vraies réalités humaines, qui impose à nos vies ses contraintes économiques et chronométriques.
[La brèche est] toujours plus béante. Le problème civilisationnel mis en évidence par Mai-68 s’est aggravé, s’est durci : le rejet d’une civilisation qui prétend apporter aux hommes le bien-être, mais ne parvient pas à combler leurs aspirations profondes, est au cœur de nos difficultés contemporaines, collectives et individuelles. Consacré par la chute du communisme puis la mondialisation, le dogme néolibéral apparu dans les années 1970 a beau se présenter comme une réalité incontournable, sans alternative, c’est en fait la nouvelle idéologie, qui masque sous le calcul les vraies réalités humaines, qui impose à nos vies ses contraintes économiques et chronométriques.
Nous avons besoin d’autre chose. Nous résistons chacun à notre façon : dans nos amitiés, nos amours parfois clandestines, nos jeux, nos « bonnes bouffes », nos danses, nous essayons d’arracher des bouts de poésie, cette poésie qui s’affichait sur les murs en Mai-68. N’oublions pas le sens de ces graffitis, « Sous les pavés, la plage », « Jouir sans entraves » : ils expriment l’aspiration à vivre poétiquement, c’est-à-dire dans la ferveur, l’intensité, la communion, loin de la vie sociale de plus en plus prosaïsée du monde adulte.
[…]
Au cours du dernier demi-siècle, les conquêtes des individualismes ont en effet contribué à dégrader les solidarités de nos sociétés. Au fur et à mesure que s’accroissait leur autonomie, les individus se sont retrouvés toujours plus compartimentés, isolés. C’est le grand défi actuel pour notre civilisation : tout en préservant l’autonomie individuelle, elle doit trouver un moyen d’insuffler un renouveau communautaire. Cela ne passera ni par une révolution marxiste-léniniste ni même sans doute par une explosion généralisée comme celle de 68.
Mais ce besoin révolutionnant renaîtra nécessairement suivant d’autres modalités. Il me semble d’ailleurs voir poindre, depuis quelques années, un phénomène qui répond en partie à ce besoin : l’essor des mouvements associatifs prônant des formes nouvelles de solidarité est une façon de retrouver les aspirations exprimées par Mai-68.
Je pense aux ZAD, à Nuit debout, aux associations anticorruption, à celles qui réclament la taxation des transactions financières, mais aussi aux écoquartiers, à l’agroécologie, à l’économie sociale et solidaire… Les milliers d’initiatives pour le mieux-vivre qui se multiplient en France et dans le monde, ce nouveau bouillonnement que ne voient ni les administrations ni les partis, c’est le regain de 68 sous de nouvelles formes et dans de nouvelles conditions. »
J’ai cité la quasi l’intégralité de cet article, car je n’ai rien trouvé de plus intelligent, pour l’instant, sur ce que signifiait Mai 1968 et sur ce qui reste aujourd’hui de cette aspiration à d’autres projets et d’autres valeurs.
Et en 1968, le 23 mai était un jeudi et plus précisément le Jeudi de l’Ascension. Philippe Sollers, devant les écrivains occupant la Société des gens de lettres, proclame: «Toute révolution ne peut être que marxiste-léniniste.»
La CGT approuve la décision d’interdiction de séjour prise à l’encontre de Cohn-Bendit. Les étudiants allemands prévoient de se réunir à Sarrebruck avec l’intéressé, et les Français à Strasbourg pour organiser le retour en force de Cohn-Bendit par le pont de l’Europe entre Kehl et Strasbourg.
A 21h30, des barricades se lèvent sur le boulevard Saint-Michel, grilles d’arbres, bancs arrachés, panneaux de signalisation, palissades, détritus, cette fois, il ne s’agit pas de tenir les barrages mais d’y mettre le feu pour retarder l’avancée des policiers. Des flammes montent de la chaussée jusqu’aux premiers étages, le dernier appel au calme d’Alain Geismar se perd en fumée. On abat des arbres, les forces de l’ordre mettront trois heures pour reprendre le boulevard.
<1074>
-
Mardi 22 mai 2018
« L’imagination au pouvoir »Jean-Paul SartreLe 20 mai 1968, Le Nouvel Observateur sort un numéro spécial consacré au débat ouvert par les événements qui secouent le pays.
Et il demande à Jean-Paul Sartre d’interviewer Daniel Cohn-Bendit. L’Obs a republié une partie de cette interview derrière <ce lien>. Vous pouvez avoir accès à l’intégralité de l’entretien si vous êtes abonnés.
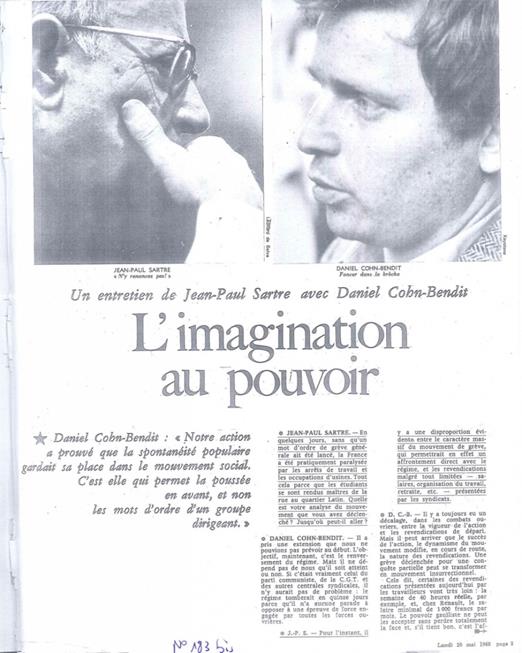 Il n’est pas évident de se rendre compte ce que représentait Jean-Paul Sartre à ce moment-là. Aujourd’hui on débat des confrontations entre Xavier Niel et Martin Bouygues.
Il n’est pas évident de se rendre compte ce que représentait Jean-Paul Sartre à ce moment-là. Aujourd’hui on débat des confrontations entre Xavier Niel et Martin Bouygues.
A cette époque il existait aussi des entrepreneurs français dont les fils sont toujours actifs, preuve que l’aristocratie du capital fonctionne bien, ils avaient pour nom Lagardère mais Jean-Luc non Arnaud, Bouygues mais Francis pas Martin ou encore Dassault mais Marcel pas Serge. Mais on les entendait peu, ils savaient être discret.
En revanche on parlait de la rivalité entre Jean-Paul Sartre et Raymond Aron.
Jean-Paul Sartre avait beaucoup de disciples, beaucoup plus que Raymond Aron et il était une sorte de « gourou incontournable ». A l’époque, certains préféraient avoir tort avec Sartre que raison avec Aron.
Il semble que c’était justement le patron du Nouvel Obs, Jean Daniel, à qui on doit cette phrase qu’on cite aujourd’hui comme le comble de la stupidité. C’est Claude Roy qui dans un article de 1968 a écrit : « Jean Daniel me disait : J’ai toujours préféré avoir tort avec Sartre plutôt que raison avec Aron »
Sartre était un monument.
Il semblerait selon diverses sources ou <ici> que le Général de Gaulle aurait répondu à certains de ses collaborateurs qui proposaient d’arrêter Sartre en raison de son action en 1968 : « On n’arrête pas Voltaire ». Je ne suis pas sur que cette phrase ait bien été prononcée, mais le fait qu’on la pense plausible montre la stature qu’avait ce philosophe à ce moment.
Et le nouvel observateur trouve donc pertinent de donner l’occasion à Cohn-Bendit de s’exprimer face à lui.
La question de Jean-Paul Sartre est simple : les gens comprennent que le mouvement des enragés du 22 mars veulent tout casser mais s’interrogent sur ce qu’ils voudraient construire après démolition.
Et Dany le Rouge de répondre :
« Evidemment! Tout le monde serait rassuré, Pompidou le premier, si nous fondions un parti en annonçant: «Tous ces gens-là sont maintenant à nous. Voilà nos objectifs et voici comment nous comptons les atteindre…». On saurait à qui l’on a affaire et on pourrait trouver la parade.
La pensée est élaborée on veut bien mettre le bordel mais au-delà il faut rester dans l’ambigüité. On en revient au mot du Cardinal de Retz que François Mitterrand aimait répéter : « Nul ne sort de l’ambigüité qu’à ses dépens ».
« La force de notre mouvement, c’est justement qu’il s’appuie sur une spontanéité «incontrôlable», qu’il donne l’élan sans chercher à canaliser, à utiliser à son profit l’action qu’il a déclenchée. Aujourd’hui, pour nous, il y a évidemment deux solutions. La première consiste à réunir cinq personnes ayant une bonne formation politique et à leur demander de rédiger un programme, de formuler des revendications immédiates qui paraîtront solides et de dire: «Voici la position du mouvement étudiant, faites-en ce que vous voulez!» C’est la mauvaise. La seconde consiste à essayer de faire comprendre la situation non pas à la totalité des étudiants ni même à la totalité des manifestants, mais à un grand nombre d’entre eux. Pour cela, il faut éviter de créer tout de suite une organisation, de définir un programme, qui seraient inévitablement paralysants. La seule chance du mouvement, c’est justement ce désordre qui permet aux gens de parler librement et qui peut déboucher sur une certaine forme d’auto-organisation. Par exemple, il faut maintenant renoncer aux meetings à grand spectacle et arriver à former des groupes de travail et d’action. C’est ce que nous essayons de faire à Nanterre.
Mais la parole ayant été tout à coup libérée à Paris, il faut d’abord que les gens s’expriment. Ils disent des choses confuses, vagues, souvent inintéressantes parce qu’on les a dites cent fois, mais ça leur permet, après avoir dit tout cela, de se poser la question: «Et alors?» C’est cela qui est important, que le plus grand nombre possible d’étudiants se disent: «Et alors?» Ensuite seulement, on pourra parler de programme et de structuration. Nous poser dès aujourd’hui la question: «Qu’allez-vous faire pour les examens?», c’est vouloir noyer le poisson, saboter le mouvement, interrompre la dynamique. Les examens auront lieu et nous ferons des propositions, mais qu’on nous laisse un peu de temps. Il faut d’abord parler, réfléchir, chercher des formules nouvelles. Nous les trouverons. Pas aujourd’hui. (…) »
Il y a donc libération de la parole, mais et c’est Raymond Aron qui a trouvé cette formule : « Une révolution introuvable »
Et le grand philosophe de conclure par une autre formule qui symbolisera Mai 68 : « L’imagination au pouvoir » et il donnera l’injonction suivante aux étudiants : « Ne renoncez pas »
« Ce qu’il y a d’intéressant dans votre action, c’est qu’elle met l’imagination au pouvoir. Vous avez une imagination limitée comme tout le monde, mais vous avez beaucoup plus d’idées que vos aînés. Nous, nous avons été faits de telle sorte que nous avons une idée précise de ce qui est possible et de ce qui ne l’est pas. […] Vous, vous avez une imagination beaucoup plus riche, et les formules qu’on lit sur les murs de la Sorbonne le prouvent. Quelque chose est sorti de vous, qui étonne, qui bouscule, qui renie tout ce qui a fait de notre société ce qu’elle est aujourd’hui. C’est ce que j’appellerai l’extension du champ des possibles. N’y renoncez pas. »
 Aujourd’hui Romain Goupil (lors de l’entretien avec Daniel Cohn Bendit à France Inter déjà cité) prétend que dès cette époque Cohn-Bendit ne croyait pas à la révolution et appelait ce mouvement « une révolte culturelle ».
Aujourd’hui Romain Goupil (lors de l’entretien avec Daniel Cohn Bendit à France Inter déjà cité) prétend que dès cette époque Cohn-Bendit ne croyait pas à la révolution et appelait ce mouvement « une révolte culturelle ».
C’est-à-dire non pas un changement de régime politique mais une nouvelle culture qui était justement symbolisé par la libération de la parole et l’inventivité des slogans dont on se souvient encore aujourd’hui.
<Sur le site du Monde, des journalistes ont essayé d’en faire la liste>
En tout cas, ce positionnement du mouvement étudiant, en dehors de l’opposition du Parti Communiste qui était très puissant encore et qui considérait les trotskystes, maoïstes et anarchistes qui menaient la révolte comme des ennemis pires que le Général de Gaulle ou Pompidou, ne pouvait pas non plus rencontrer l’adhésion du mouvement ouvrier en grève. Les ouvriers souhaitaient des évolutions concrètes concernant leurs salaires et leurs conditions de travail. Ce qu’ils vont obtenir, en partie, à l’issue des négociations de Grenelle.
Edouard Balladur qui était un des principaux conseillers de Pompidou, le premier ministre, a raconté dans un livre <L’arbre de mai> et l’a répété lorsqu’il fut interrogé par France Culture <Le 4 mai 2018> : Pompidou n’avait qu’une stratégie pour obtenir la fin du mouvement et rétablir l’ordre au profit de sa majorité : diviser et séparer le mouvement étudiant du mouvement ouvrier.
Ce qu’il a magnifiquement réussi, et le mouvement étudiant l’a grandement aidé.
Ce fut, en effet une révolution introuvable.
Une fois de plus Raymond Aron et Jean-Paul Sartre n’était pas dans le même camp.
Et en 1968, le 22 mai, dix millions de salariés ne travaillent pas (en grève ou empêchés de travailler).
Le 21 mai, Daniel Cohn Bendit avait été frappé en tant que ressortissant étranger par un arrêté d’expulsion du ministre de l’Intérieur ; il en est informé alors qu’il se trouve à Francfort
<1073>
-
Vendredi 18 mai 2018
«La femme de 1968 est à la fois contrainte et aspire à la liberté»Michelle PerrotHier j’ai essayé de développer la face noire de mai 1968, c’est-à-dire une déculpabilisation de la pédophilie et même une ode à l’amour mais il faut plutôt écrire les choses de manière explicite : une ode au sexe avec les enfants.
Aujourd’hui, je voudrais esquisser la présence et le rôle des femmes dans les évènements de mai 1968.
Mon butinage m’a cette fois rappelé que le Mouvement de Libération des Femmes ( MLF) est né en 1970. Certes très peu de temps après mai 68 et certainement dans l’élan pris par mai 68, mais en 1968 il n’existait pas et na pas été créé.
 Plusieurs livres, plusieurs émissions ont été consacrés à ce sujet des femmes dans le mouvement de mai 68.
Plusieurs livres, plusieurs émissions ont été consacrés à ce sujet des femmes dans le mouvement de mai 68.
« L’émission la fabrique de l’histoire » sur laquelle je m’étais appuyé pour écrire ma série de mots du jour sur Lyon, a bien sûr consacré plusieurs émissions à mai 68 et celle du <25 avril 2018> posait la question : «Mai 68, où sont les femmes ? ». Dans cette émission une des intervenantes explicite la réalité en quelques mots : « Les hommes qui menaient ce mouvement, voulaient changer le monde mais pas toucher à la domination masculine »
Mais dans ce mot, je vais surtout évoquer l’Historienne Michelle Perrot.
Elle est née le 18 mai 1928 et fête donc aujourd’hui ses 90 ans. En 1968 elle était dans le corps enseignant à la Sorbonne et a participé à l’occupation de la Sorbonne.
Michelle Perrot est une des grandes historiennes de France et elle a particulièrement contribué à l’émergence de l’histoire des femmes et du genre. Elle a notamment dirigé, avec Georges Duby, l’Histoire des femmes en Occident (5 vol., Plon, 1991-1992) et a publié l’ensemble de ses articles sur la question dans Les femmes ou les silences de l’histoire, Flammarion, 2001. Pour elle, le féminisme est une liberté universelle.
<Elle était invitée par RFI pour parler des femmes en 1968>
C’est lors de cet entretien qu’elle a cette formule « La femme de 1968 est à la fois contrainte et aspire à la liberté ». On dirait presque Emmanuel Macron : « en même temps ». Elle explicite :
« Contrainte, parce que la société est très conservatrice, famille etc. Mais il y a des quantités de signes d’émancipation. D’abord parce qu’il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dès cette époque-là.
Et puis, en 1949, 20 ans avant, Simone de Beauvoir a quand même publié le deuxième sexe. Et la génération féminine qui est là en 1968 connait ce livre.
Il y a des aspirations et des contraintes les femmes ne sont pas au premier rang quand même »
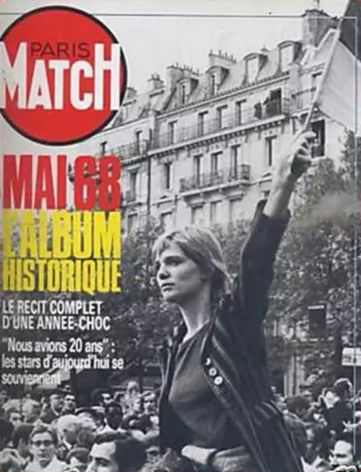 Michelle Perrot est aussi interrogée sur mai 68 par l’OBS qui justement parle du rang des femmes dans ce mouvement où les héros : Cohn-Bendit, Sauvageot, Krivine, Geismar sont tous des hommes.
Michelle Perrot est aussi interrogée sur mai 68 par l’OBS qui justement parle du rang des femmes dans ce mouvement où les héros : Cohn-Bendit, Sauvageot, Krivine, Geismar sont tous des hommes.
Michelle Perrot répond :
« En réalité, les femmes étaient là. Dans les défilés, les amphis, les rassemblements, elles sont partout si l’on prend la peine de regarder les photos de l’époque. Mais leur présence passe inaperçue. D’ailleurs, en vous parlant, je me rends compte que moi aussi je l’avais occultée. Les filles étaient pourtant nombreuses dans la Sorbonne occupée. Je pense notamment à une étudiante très déterminée, la jeune Françoise. Elle prenait souvent la parole, je revois sa silhouette et ses interventions… Je l’avais totalement oubliée ! […]
Elles avaient beau être mêlées aux hommes dans les amphis ou les AG, les femmes restaient plutôt discrètes, peinaient à intervenir…
Et lorsque certaines, comme cette Françoise, osaient s’exprimer, on tendait toutes et tous à les minimiser. Leur parole a si peu été entendue et recueillie que l’histoire n’a pas retenu leurs noms. Les femmes étaient cantonnées au rôle de figurantes, comme la fameuse Marianne de 68, magnifique mannequin britannique, juchée sur les épaules d’un camarade et brandissant un drapeau vietnamien. Photographiée dans les cortèges, elle est devenue l’icône du mouvement dans «Life» ou en une de «Paris-Match» sans que personne ne se demande qui elle était, ni ce qu’elle avait en tête. Les femmes ont joué les allégories de 68 mais n’en ont pas été les actrices principales. On restait dans la hiérarchie des sexes. C’est d’ailleurs un geste masculin qui a tout déclenché, ces garçons revendiquant le droit d’aller dans les chambres des filles à la cité U de Nanterre. »
Elle parle aussi de la fraternité, aujourd’hui on dirait la sororité, de l’enthousiasme pendant les évènements de mai et du retour désabusé à la vie quotidienne de la société patriarcale après ces évènements. Pourtant elle utilise le terme de brèche dans les représentations traditionnelles, brèche qui ouvre la voie vers d’autres combats et une émancipation plus large :
« A la faveur de 68, les femmes ont fraternisé entre elles. C’est un aspect rarement évoqué, mais ce fut une période de maturation considérable et pour certaines un ébranlement existentiel. Elles se considéraient comme égales, mais, au fond, qu’attendait-on d’elles, sinon faire le café?
Passé l’ivresse des cortèges, le retour à la maison était parfois rude… les filles de Mai n’avaient pas toutes des parents soixante-huitards! A la fin du printemps, quand tout est rentré dans l’ordre, elles se sont demandées ce qui avait vraiment changé. De Gaulle – et avec lui l’ordre patriarcal – était de retour, et dans une France encore largement rurale, les hommes tenaient la politique et décidaient de tout dans les familles.
Mai-68 ne fut pas un mouvement féministe mais une brèche dans ces représentations traditionnelles du couple, de la famille, de la sexualité, comme l’a très bien décrit Edgar Morin. Une brèche dans laquelle les femmes se sont engouffrées, comme lors des précédentes révolutions, en 1789, en 1830, en 1848, ou pendant la Commune… Sauf que, pour une fois, elles ne sont pas rentrées sagement à la maison. Elles se sont organisées, décrétant: «le privé est politique». Ensuite, tout s’est cristallisé assez vite, et le MLF est né. »
Mai 68 fut aussi, comme je l’ai écrit hier et n’en déplaisent à l’armée de sociologues qui constatent que lors des assemblées générales on en parlait peu, la libération du corps et du désir. On en parlait pas mais on faisait. Et dans cette libération c’est encore le désir de l’homme qui était prégnant et la femme devait se débrouiller, souvent seule. La contraception existait dans les textes mais peu dans la réalité :
« Ces années-là étaient traversées par une intense ascension du désir, y compris sexuel. Sa libération fut à la fois très puissante et douloureuse pour les femmes et a posé avec bien plus d’acuité la nécessité pour elles de prendre des précautions. La liberté sexuelle, oui, mais pour qui?
Les hommes étaient ravis mais peu concernés par la hantise des femmes de voir leur vie bouleversée par une naissance, ou d’avorter clandestinement.
Le planning familial existait depuis 1960 et la loi Neuwirth de 1967 avait légalisé la pilule mais les contraceptifs n’arrivaient pas encore dans les pharmacies et il faudra encore des années avant qu’elles puissent les demander sans être regardées de travers. La société demeure très corsetée, de nombreux étudiants portent encore la cravate. Sur le plan des mœurs, l’époque reste frileuse: les mères n’osent pas aborder ces sujets, les pères encore moins… Le qu’en-dira-t-on reste dominant. »
La libération de la femme passera par le contrôle des naissances et la maîtrise de la fécondité :
« Même si, comme je l’ai dit, la société connaissait des évolutions importantes pour les femmes – accès aux études, au monde du travail – l’indépendance passait avant tout par cette question brûlante du corps et de la conception. La condition première de leur émancipation, «l’habeas corpus des femmes» comme a dit Geneviève Fraisse, c’était l’accès au contrôle des naissances. Et c’est bien le sens d’un grand slogan de l’après 68, venu des Etats-Unis: «Our bodies, Ourselves», «notre corps, nous-mêmes», qui renversait des millénaires de représentation du monde. Comme l’a montré Françoise Héritier, les hommes ont longtemps conçu les femmes comme des vases destinés à recevoir leur semence, seule fécondante. Au XIXe siècle, on s’était bien aperçu du rôle des ovules, mais cela n’avait pas fait bouger les lignes. »
Plusieurs livres ont été écrits, le site de RTL en présente 4.
Le premier de ces livres est « Filles De Mai. 68 – Mon Mai à Moi» aux éditions du bord de l’eau. C’est un livre collectif, dont la préface a été écrite par Michelle Perrot.
Sur le site de l’éditeur, ce livre est introduit par ce petit texte :
Elles
ont entendu Michelle Perrot
parler du silence des femmes dans l’histoire
Elles
ont voulu dire Mai 68
Elles se sont réunies
Elles ont parlé et beaucoup ri.
Elles se sont souvenues.
Elles ont écrit
et les écrits ont voyagé
de l’une à l’autre
de toutes à toutes
échos croisés
de l’avant, du pendant et de l’après
Et puis
des mots ont pris le pouvoir
des mots mémoire, des mots passion
et l’abécédaire est né
de la mémoire de ces filles de mai
« Le Monde des Livres parle aussi de ce livre : « Mai 68 : le printemps contrarié des femmes » et aussi d’un autre « L’Autre Héritage de 68, La face cachée de la révolution sexuelle» de Malka Marcovich chez Albin Michel
Anne Both (Anthropologue et collaboratrice du « Monde des livres ») écrit à ce propos
« Tout paraissait possible. Oui, tout paraissait possible pour les femmes en ce doux printemps de 1968. Telle est la première impression que donnent deux livres remarquables qui leur sont consacrés. Pourtant, à leur lecture, on se demande si, en définitive, cette révolution n’était pas une révolution d’hommes menée par et pour des hommes. Le premier, Filles de Mai, résulte d’un atelier d’écriture composé de 22 citoyennes ordinaires, âgées à ce moment-là de 15 à 54 ans ; il se présente sous la forme d’un abécédaire avec 68 entrées, d’« Adolescence » à « Vérité ». Le second, L’Autre Héritage de 68, conçu comme un voyage dans le temps depuis l’immédiat après-guerre jusqu’aux années 1980, dévoile les dérives de ce que son auteure, l’historienne Malka Marcovich, nomme une « fausse liberté ».
Aucun doute cependant : un changement était attendu, sinon désiré. Des récits des « filles de Mai », membres de l’Association pour l’autobiographie, qui ont accepté de se confier avec une sincérité parfois crue, il ressort qu’elles étouffaient dans une culture de soumission à l’autorité masculine, à travers la figure du père, puis du mari, du patron et aussi du grand Charles, général et père de la nation.
On sait quels interdits spécifiques aux femmes s’appliquaient alors : le port du pantalon, considéré depuis 1800 comme un travestissement, les rapports sexuels avant le mariage, déshonorants, le droit de se mêler de politique ou de revendiquer quelque ambition professionnelle – un bon mariage suffisait amplement. L’insurrection de 1968 arrivait, en quelque sorte, à point nommé. […]
Dans un livre comme dans l’autre, les illusions se dissipent. Certaines évoquent la déplaisante sensation d’avoir été consommées comme une friandise ou considérées comme le jouet d’un soir ; l’injonction à être libre pouvant devenir, au fond, des plus aliénantes. « Et la fameuse libération sexuelle, prônée en 68, cache bien des pièges dont je suis victime : donjuanisme, peur de l’engagement, non-écoute du désir de l’autre sous couleurs de liberté », se souvient Chantal (Filles de Mai). »
LE site du magazine ELLE consacre aussi un article à ce sujet : « Mai 68 : où étaient les femmes ? »
Et en 1968 que se passait-il ? Je m’appuie toujours sur l’article de l’Obs les dates à connaitre pour être incollable sur mai 68
18 mai. : Les RG dénombrent une centaine d’usines occupées.
19 mai : De Gaulle : « La réforme, oui, la chienlit, non! »
20 mai. : La grève s’étend toujours.
<1072>
-
Jeudi 17 mai 2018
« Mai 1968 et le sexe »Butinage et réflexions sur mai 68Mai 68 en France est aussi une histoire qui parle de sexe… surtout de sexe ?
L’obs le rappelle : « et tout commença par une histoire d’accès aux chambres des filles »
Le livre de Ludivine Bantigny « 1968. De grands soirs en petits matins » (Seuil, 2018) rapporte même que dès la fin de l’année universitaire 1967 des résidences universitaires sont occupées à Nanterre et à Lyon parce que les étudiants protestent contre le règlement intérieur qui interdit les visites des garçons chez les filles.
Le Monde rappelle cette même réalité : « La mixité à la cité U, premier combat de Mai 68 »
A cette époque la majorité était à 21 ans, les étudiants étaient donc en grande partie des mineurs. Par ailleurs le poids des traditions et de la morale religieuse toujours très présente même si la Foi l’était moins entraînait que le sujet du sexe était tabou, refoulé, contraint.
Le premier esclandre de Daniel Cohn Bendit est selon les médias son interpellation du Ministre de l’Education nationale. L’article de l’Obs précité donne le détail de l’échange :
A Nanterre, cette année 1968 commence par l’épisode de la piscine. Le 8 janvier 1968, lors de l’inauguration d’installations sportives à Nanterre, le ministre de la Jeunesse et des Sports François Missoffe et un étudiant en sociologie (il aura 23 ans début avril), Daniel Cohn-Bendit, échangent des propos acerbes.
Daniel Cohn-Bendit : « Monsieur le ministre, j’ai lu votre Livre blanc sur la jeunesse. En 300 pages, il n’y a pas un seul mot sur les problèmes sexuels des jeunes. »
Puis, le ministre : « Avec la tête que vous avez, vous connaissez sûrement des problèmes de cet ordre. Je ne saurais trop vous conseiller de plonger dans la piscine. »
Daniel Cohn-Bendit : « Voilà une réponse digne des Jeunesses hitlériennes. »
Cet échange vaut au jeune anarchiste de comparaître devant la commission spéciale d’expulsion de la Préfecture de Police, le samedi 17 février. Il est menacé d’expulsion du territoire français «pour avoir tenu des propos offensants à l’égard de M. Missoffe, lors de l’inauguration de la piscine de Nanterre, et pour avoir fait de l’agitation politique dans un mouvement anarchiste à la faculté», rapporte «le Monde» (17 février 1968).
Finalement cette polémique va se calmer :
Cohn-Bendit a envoyé à Missoffe une lettre « lui exposant qu’il n’avait pas eu l’intention de l’insulter personnellement et expliquant le sens de la réflexion qu’il lui avait faite au sujet du Livre blanc sur la jeunesse. En réponse, le ministre lui a écrit qu’il ne retenait pas l’incident et l’a invité à venir le voir afin d’avoir avec lui une discussion générale sur la jeunesse. »
La procédure d’expulsion, initiée par le doyen de l’université, Pierre Grappin, n’aboutira pas (c’est à la suite des événements du printemps qu’il sera frappé, le 21 mai, par un arrêté d’expulsion, qui ne sera levé que fin 1978).
Alors bien sûr mai 68 fut l’explosion de la libération sexuelle. « Jouissons sans entraves », « Faites l’amour pas la guerre », les slogans libertaires fleurissent sur les murs.
Le site <Sciences Humaines> écrit :
« Les spécialistes s’accordent pour faire démarrer la « révolution sexuelle » au milieu des années 60. La première génération du baby-boom va bientôt avoir 20ans. Dans tous les pays occidentaux, on constate des évolutions convergentes.
Le corps féminin se dévoile. Les minijupes font leur apparition en 1965, tandis que les premiers seins nus se montrent au cinéma. La pilule contraceptive mise en circulation en 1960 aux Etats-Unis arrive en Europe en 1967. A la radio, dans les magazines féminins, on parle plus librement des relations hommes/femmes. La littérature sulfureuse d’Henry Miller et d’Anaïs Nin circule partout. On commence à percevoir une nette augmentation des divorces et l’essor de l’union libre.
Mai 1968 précipite ce mouvement. Le temps est à la contestation de l’ordre bourgeois et patriarcal. Le mouvement hippie, apparu sur la côte Ouest des Etats-Unis à la fin des années 60, se répand en Europe. Les slogans « Faites l’amour pas la guerre », « Peace and Love », « Jouissons sans entrave » s’affichent sur les murs des universités. Les ouvrages de Wilhelm Reich ( La Révolution sexuelle ) et d’Herbert Marcuse ( Eros et civilisation ) deviennent des manifestes. Des communautés libertaires expérimentent la promiscuité sexuelle et l’amour libre. »
Tout ne commença pas en Mai 68. Ainsi, date très importante : 19 décembre 1967, adoption de la loi Neuwirth qui autorise l’usage des contraceptifs, et notamment la contraception orale. Nommée d’après Lucien Neuwirth, le député gaulliste qui la proposa, cette loi vient abroger celle de 31 juillet 1920 qui interdisait non seulement toute contraception, mais jusqu’à l’information sur les moyens contraceptifs. Promulguée le 28 décembre 1967, son application sera cependant lente, les décrets ne paraissant qu’entre 1969 et 1972.
Michel Bozon sociologue, directeur de recherche à l’INED affirme cependant :
« Pour autant, la sexualité ne sera pas une préoccupation centrale de la révolte étudiante et ouvrière du printemps 1968. « Jouir sans entraves », le célèbre slogan des situationnistes et libertaires de Nanterre, décrivait en réalité l’aspiration à un mode de vie plus intense, plutôt qu’il n’évoquait une sexualité débridée. Il faudra attendre quelques années après les événements pour que s’installe le discours sur une « libération sexuelle liée à Mai-68 ».
Cette notion de « libération » correspond assurément au vécu de certaines personnes. Mais pas à celui de tout le monde : dans son fameux Rapport sur le comportement sexuel des Français paru en 1972, Pierre Simon, auteur de la première enquête nationale sur la sexualité, ne mentionne en effet ni Mai-68 ni la notion de libération. On peut difficilement affirmer que les transformations de la sexualité dont nous sommes aujourd’hui les témoins prennent leur source dans les bouleversements de Mai-68. »
Cette nuance peut être entendue mais il n’en reste pas moins que Mai 68 a lancé un mouvement de libération du corps du plaisir et donc de la sexualité.
J’ai beaucoup apprécié ce film aigre doux qui parle de ce moment « La parenthèse enchantée », période où tout semblait devenir simple mais sans l’être vraiment. L’expression est de Françoise Giroud. Elle désigne cette brève période, les années 70, où le bonheur – et le plaisir – semblait possible. Après la pilule et avant le sida. Et il faudra revenir sur ce mouvement en y intégrant le regard des femmes.
Mais aujourd’hui je vais développer un autre aspect de cette histoire : la face noire de mai 68.
J’ai déjà écrit que je n’avais pas vécu mai 68 et que je n’en gardais aucun souvenir personnel. Il y a pourtant un aveuglement que je me reproche et que j’ai déjà développé dans un mot du jour ancien et dont je parlerai à la fin de celui-ci. Et je fais un lien direct entre ce vécu et la morale issue de mai 1968.
L’historienne Anne-Claude Ambroise-Rendu, auteur de l’<Histoire de la pédophilie> lance cette accusation « L’apologie de la pédophilie, face noire de Mai-68 » :
« Mai-68 avait appelé à la libération des corps. Mais la « révolution sexuelle » proprement dite sera l’œuvre de la décennie 1970. Le réexamen incessant, sous un angle résolument politique, de la sexualité et du droit qui la gouverne aura pour effet de bousculer les a priori et de faire vaciller le conformisme.
Une partie de la presse se met alors à dénoncer les tabous, explorer les silences de l’intimité et interroger les sexualités dites alternatives. Dans le paysage politico-culturel qui se dessine, la notion même de déviance est niée ; et bientôt la parole est donnée à une revendication nouvelle : la pédophilie.
A l’orée des années 1970, les défenseurs de la pédophilie s’arriment au militantisme homosexuel et spécialement au Front homosexuel d’action révolutionnaire (Fhar), fondé en 1971, qui combat tout à la fois l’oppression des homosexuels et appelle à la reconnaissance des « sexualités autres ». Ce « cousinage » est favorisé par le Code pénal et ses dispositions discriminatoires qui punissent les rapports homosexuels en-deçà de 21 ans, tout en permettant les rapports hétérosexuels dès 15 ans. Michel Foucault, qui participe aux travaux de la commission de révision du Code pénal, n’hésite pas à signer une pétition invitant à tenir compte du consentement des mineurs. Il réfléchira même à la possibilité de supprimer toute infraction sexuelle du Code.
Si le mouvement homosexuel, notamment sous l’impulsion des féministes, se désolidarise rapidement des voix pédophiles, un petit nombre d’intellectuels médiatisés continuent de défendre la « cause » dans les colonnes de « Libération », très en pointe, et, dans une moindre mesure, du Monde. Leur plaidoirie se poursuit autour de trois axes empruntés partiellement au fonds de l’antipsychiatrie. Le premier, cher à l’écrivain Gabriel Matzneff, invoque l' »amour des enfants » et le rôle positif que peut jouer une « initiation » sexuelle et intellectuelle dans une éducation bien conçue.
L’éros enfant ou adolescent est placé sous les auspices d’une esthétique et d’une éthique héritées de la pédérastie de la Grèce antique. Le second axe s’appuie sur l’idée d’une altérité radicale de l’enfant qui reste à comprendre et à aimer convenablement, loin des figures naturalistes de la doxa. Tel est en substance le propos de « Co-ire. Album systématique de l’enfance », publié en mai 1976 par le philosophe René Schérer et le fondateur du Fhar, Guy Hocquenghem. Pour les auteurs, l’enfant est celui qui « est fait pour être enlevé […], sa petitesse, sa faiblesse, sa joliesse y invitent », mais aussi celui dont la liberté et l’autonomie sont impossibles.
Les catégories à partir desquelles penser la relation adulte-enfant doivent donc au minimum être repensées. Le troisième axe de la défense pédophile insiste plus directement sur la menace que la sexualité des enfants fait peser sur l’institution familiale. Effrayante, elle est castrée au prix d’un abus de pouvoir scandaleux.
L’écrivain Tony Duvert (prix Médicis 1973) met violemment en cause l’éducation répressive qui brime les désirs et les pulsions des enfants au nom des droits exclusifs de la famille ; il dénonce la prééminence de mères castratrices et le « matriarcat qui domine l’impubère ». »
Doan Bui journaliste qui a reçu le prix Albert-Londres 2013 a écrit dans l’Obs : < Libérer le plaisir de l’enfant», disaient-ils… >
« C’était il y a quarante ans, avant que le mot « pédophile » ne devienne synonyme de « monstre ». De nombreux intellectuels militaient pour autoriser les rapports sexuels avec les plus jeunes. Alors que le débat sur le consentement des mineurs resurgit, retour sur une folle dérive sociétale et culturelle.
[…] Si je suis solidaire de Polanski ? S’il ne s’agit que de relations sexuelles avec mineur, de coït buccal et de sodomie, bien sûr ! » C’est ainsi que feu Jean-Louis Bory, écrivain et critique de cinéma réputé, répondait au « Quotidien de Paris » en 1977 quand on l’interrogeait sur le cinéaste, accusé d’avoir violé Samantha, 13 ans. La presse, unanime à l’époque, plaignait Roman Polanski, « victime du puritanisme américain », en conspuant les parents et la jeune fille, « tout sauf une oie blanche ».[…]
En 1977, l’affaire ne suscite pas l’ombre d’une controverse en France, y compris chez les féministes. Ni quand le cinéaste fuit en France, en 1978, ni quand sort « Tess » l’année suivante, acclamé par la critique, avec la toute jeune Nastassja Kinski, laquelle avait 15 ans quand elle rencontra le cinéaste et qu’il devint son amant.
Martine Storti, militante féministe, était journaliste à « Libération » dans ces années-là. « C’est fou, mais je n’ai aucun souvenir de cette affaire, que j’ai découverte en 2009, quand Polanski a été arrêté en Suisse. » Elle poursuit :
« A l’époque, nous, les féministes, étions sur d’autres combats : la pilule, la criminalisation du viol, pour qu’il soit jugé aux assises… Là-dessus, on se faisait insulter et traiter de réacs. ‘Libé’, c’était quand même un journal de mecs. »
Dans ses pages cinéma, « Libération » consacra juste un petit article à l’affaire : « Au cinéma, les enfants sont là pour séduire les adultes. » C’est la ligne du journal de ces années-là, qui publie des articles titrés : « Centre aéré : je continuerai à jouir avec des impubères si tel est mon plaisir et si tel est le leur » ; des caricatures pour choquer le bourgeois : « Apprenons l’amour à nos enfants », avec le dessin d’une gamine faisant une fellation à un adulte ; ou encore le plaidoyer de Jacques D., incarcéré pour « attentat à la pudeur sur mineur », expliquant que « l’enfant est capable d’aimer sexuellement » et qu’il a la « satisfaction d’être agréable à celui qui le sodomise ».
[…] On comprendrait peut-être les raisons du culte voué à feu David Hamilton. Le photographe (accusé depuis de viols sur mineures) est alors une vedette qui vend ses calendriers par millions. Le magazine « Vogue Homme » le sollicite pour un dossier de couverture mettant en scène des adolescentes peu vêtues, puis récidive en commandant une série plus « réaliste » sur les adolescentes à Polanski, d’où la fameuse séance avec la jeune Samantha.
[…] Brooke Shields fait la une du magazine « Photo », elle a 10 ans, est nue, maquillée, sort du bain. Deux ans plus tard, elle joue une prostituée dans « la Petite », de Louis Malle. Irina Ionesco, elle, fait prendre à sa fille, Eva, des poses pornographiques, dès ses 5 ans. Eva Ionesco l’a narré dans un film et dans « Innocence », magnifique roman autobiographique paru à l’automne. Elle raconte sa mère lui demandant d’écarter les jambes devant l’objectif, vendant les clichés à des clients émoustillés, comme l’écrivain Alain Robbe-Grillet, connu pour son goût des fillettes (il écrivit d’ailleurs le texte du premier livre d’Hamilton, « Rêves de jeunes filles »). Il offrira un stylo Montblanc à Eva pour la convaincre de jouer nue dans son film. »
Etc., je vous invite à lire l’article de Doan Bui, vous lirez aussi des propos de Gabriel Matzneff, de Leo Ferré, Aragon, Beauvoir, Barthes, Ponge, Michel Foucault, Guy Hocquenghem, et tant d’autres…
Et puis il y a Daniel Cohn-Bendit qui a été accusé lors d’un débat politique par François Bayrou d’avoir défendu la pédophilie dans un ouvrage ancien. L’Obs a publié des <Extraits de ce livre>
« Dans son livre « Le Grand Bazar », publié en 1975 chez Belfond, Daniel Cohn-Bendit évoque son activité d’éducateur dans un jardin d’enfants « alternatif » à Francfort :
« Il m’était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais : ‘Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble, pourquoi m’avez-vous choisi, moi, et pas d’autres gosses ?’ Mais s’ils insistaient, je les caressais quand même ». « J’avais besoin d’être inconditionnellement accepté par eux. Je voulais que les gosses aient envie de moi, et je faisais tout pour qu’ils dépendent de moi » ».
Plus tard, Daniel Cohn-Bendit, a démenti tout acte pédophile et soutenu que ses écrits reflétaient l’esprit de l’époque de « provocation contre le bourgeois ». « Ce qui est écrit dans « Le grand bazar » n’est « pas une réalité », mais « un condensé de faits observés », avait déclaré Daniel Cohn-Bendit. «J’ai raconté ça par pure provocation, pour épater le bourgeois » (…) et « sachant ce que je sais aujourd’hui des abus sexuels, j’ai des remords d’avoir écrit tout cela ».
Récemment, j’ai trouvé cette petite vidéo, dans laquelle Daniel Cohn-Bendit est invité par Bernard Pivot dans apostrophes, probablement que là aussi il veut «épater le bourgeois», en l’occurrence Paul Guth qui est en face de lui et il dit : «La sexualité d’un gosse, c’est absolument fantastique, faut être honnête. J’ai travaillé auparavant avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c’est fantastique, c’est un jeu érotico-maniaque… ». Je ne voudrai pas accabler Daniel Cohn-Bendit qui a bien changé depuis, mais nous pouvons constater qu’après mai 68 on pouvait tenir de tels propos dans des émissions culturelles de l’ORTF….
Et j’en reviens au mot du jour ancien dans lequel j’avais utilisé comme exergue ce mot de Raymond Aron, à propos du génocide des juifs par les nazis : « Je l’ai su, Mais je ne l’ai pas cru. Et parce que je ne l’ai pas cru, je ne l’ai pas su. ». Dans ce mot du jour j’ai raconté que je connaissais les responsables de l’École en bateau et que j’avais lu le livre qu’avait écrit le fondateur. Dans ce livre, la pédophilie était décrite mais je n’ai pas su la voir et la comprendre parce que l’esprit du temps issu de ces excès de mai 68 nous avait aveuglés, m’avait aveuglé et perverti mon sens du jugement.
Tout ceci ne signifie pas que la libération des mœurs issue de mai 68 ne doit pas être vue de manière positive, mais je trouve l’expression « La face noire » pertinente sur ce sujet où la perversion de certains hommes a pu non seulement s’exprimer sans tabou mais aussi le faire en le justifiant par des théories de libération pernicieuses et dévoyées. Car si la pédophilie s’inscrit dans la nuit des temps, il y eut dans le mouvement de 68 des intellectuels qui exprimaient des théories qui la justifiait et même l’encourageait.
<1071>
-
Mercredi 16 mai 2018
« Mai 1968 et la guerre du Viet Nam»Poursuite du butinage de maiDans le mot du jour de lundi, j’avais précisé qu’en Allemagne et bien sûr aux Etats-Unis, les étudiants manifestaient d’abord contre la guerre du Viet-Nam.
Mais la France et le mai 68 sont aussi liés étroitement à la guerre du Viet Nam.
Tout le monde l’écrit aujourd’hui : « Mai 68 a commencé le 22 mars à l’Université de Nanterre».
Il faut même remonter au 20 mars 1968, lorsqu’à l’appel du Comité Vietnam, 200 à 300 personnes brisent les vitrines d’une agence parisienne d’American Express. Plusieurs manifestants, dont Xavier Langlade (futur dirigeant de la Ligue communiste révolutionnaire), étudiant très populaire à Nanterre, sont arrêtés.
Les étudiants de Nanterre veulent les faire libérer. C’est alors que le 22 mars, aucune libération n’étant survenue, entre 400 et 500 personnes se retrouvent à 17 heures pour une AG.
Et c’est Paris-Match qui raconte la suite :
« Plutôt que d’occuper l’habituel bâtiment de sociologie, il est décidé, «pour démontrer [leur] volonté de lutter contre la répression», dixit Daniel Cohn-Bendit, déjà à la manœuvre, de s’installer dans une salle interdite, celle des conseils d’université, au 8e étage de la tour centrale du campus. «J’avais participé à la tentative d’occupation de la Sorbonne en 1964, se souvient Prisca Bachelet, une participante. Ça avait échoué, et pourtant ça avait été tellement préparé! Ce 22 mars, il y avait un rapport à la parole, à l’action et à la décision radicalement nouveau, qu’on devait beaucoup aux anarchistes et aux libertaires comme Jean-Pierre Duteuil ou Daniel Cohn-Bendit. Les gens parlaient librement. Pour moi qui avais l’habitude des groupements politiques et syndicaux, c’était extraordinaire.» Une partie des présents s’attelle à l’écriture de ce qui deviendra le «manifeste des 142», qui appelle à une journée de réflexion la semaine suivante. La séance se termine à 1h20 après une «Internationale» chantée le poing levé. Et l’on se quitte sans savoir que le germe de mai vient d’être planté.
Le mouvement du 22 mars se transforme en une plateforme construite par l’action et emmenée par ceux qu’on appelle les «enragés». Pour la première fois, les groupuscules gauchistes réussissent à dépasser leurs divergences. »
Le premier acte de mai 68 avait pour objet de faire libérer des étudiants qui ont été arrêtés suite à une manifestation contre la guerre du Viet Nam.
Nous sommes en pleine guerre froide, pour les Etats-Unis il s’agit d’empêcher l’expansion communiste. Le Nord Viet Nam est communiste mais le Sud Viet Nam se trouve sous la protection américaine car sinon il ne pourrait résister aux assauts des troupes du Nord Viet Nam et de la guérilla locale qui ont pour nom « Le Viet Cong ». Pour les Etats-Unis c’est avant tout un combat politique.
Mais pour les vietnamiens communistes, le combat est aussi nationaliste il faut chasser les troupes d’occupation.
A l’occasion de la mort du célèbre général vietnamien GIAP, j’avais lors d’un mot du jour de 2013 rapporté cet entretien qu’avait dévoilé le général GIAP, lui-même lors d’une interview de l’Humanité :
« Une autre fois, j’étais à Moscou pour demander une aide renforcée et j’ai eu une réunion avec l’ensemble du bureau politique. Kossyguine m’a alors interpellé : » Camarade Giap, vous me parlez de vaincre les Américains. Je me permets de vous demander combien d’escadrilles d’avions à réaction avez-vous et combien, eux, en ont-ils ? » » Malgré le grand décalage des forces militaires, ai-je répondu, je peux vous dire que si nous nous battons à la russe nous ne pouvons pas tenir deux heures. Mais nous nous battrons à la vietnamienne et nous vaincrons. »
Et c’est ce qu’ils ont fait. L’Amérique s’est vraiment engagé dans cette guerre à partir de 1961 quand le président John F. Kennedy envoya plus de 15 000 conseillers militaires. Mais la présence des Etats-Unis est antérieure. En 1998, le gouvernement fédéral des États-Unis détermine que les militaires américains tombés après le 1er novembre 1955 — date de la création du premier groupe de conseillers militaires américains au Sud Viêt Nam — peuvent être considérés comme morts durant la guerre du Viêt Nam.
Et Lyndon Johnson qui succéda à Kennedy après son assassinat le 22 novembre 1963 en sa qualité de vice-président, fut contraint à encore augmenter l’effort de guerre. Il terminera la présidence de Kennedy, puis sera élu sur son propre nom, l’emportant largement à l’élection présidentielle de 1964. 1968 est année d’élection présidentielle aux Etats-Unis et Lyndon Johnson peut et veut se représenter, mais il en sera empêché en raison de la guerre du Viet Nam .
Terrible année 1968 aux Etats-Unis, pendant laquelle d’abord Martin Luther King fut assassiné le 4 avril 1968 à Memphis et puis ce fut le tour de Robert F. Kennedy, le 6 juin 1968 alors qu’il venait de remporter la primaire de Californie, ce qui faisait alors de lui le candidat le plus probable du parti démocrate.
Jamais l’engagement américain n’a été aussi fort qu’au Vietnam en 1968. Les GI’s débarquent par vagues entières pour atteindre le chiffre record de 500 000 soldats
 Le président Johnson annonça son renoncement lors d’un discours le 31 mars 1968, discours dans lequel il annonce également l’arrêt immédiat et sans condition des raids au Viêt Nam et appelle Hô Chi Minh à négocier la paix.
Le président Johnson annonça son renoncement lors d’un discours le 31 mars 1968, discours dans lequel il annonce également l’arrêt immédiat et sans condition des raids au Viêt Nam et appelle Hô Chi Minh à négocier la paix.
Car en janvier 1968, avait commencé l’offensive du Tết. Le gouvernement américain avait promis la « lumière au bout du tunnel » et la victoire.
Mais le 30 janvier 1968, l’ennemi, supposé être sur le point de s’effondrer, lança l’offensive du Tết en combinant les forces du Front national de libération du Sud Viêt Nam (ou Việt Cộng) et de l’Armée populaire vietnamienne. L’offensive commence prématurément le 30 janvier 1968, un jour avant la nouvelle année lunaire, le Têt. Le 31 janvier, 80 000 soldats communistes attaquent plus de 100 villes à travers le pays dans la plus grande opération militaire conduite à ce point de la guerre
Le général Giap, mobilisa la quasi-totalité de ses effectifs dans la bataille.
Les buts poursuivis étaient le soulèvement de la population sud-vietnamienne contre la République du Viêt Nam, démontrer que les déclarations américaines selon lesquelles la situation s’améliorait étaient fausses, et dévier la pression militaire pesant sur les campagnes vers les villes sud-vietnamiennes.
Du point de vue militaire, cette offensive, la première guerre ouverte à grande échelle des communistes, fut un échec. Face à la puissance de feu américaine, ils furent massacrés, et il leur fallut deux ans pour reconstituer leurs forces. Mais du point de vue politique, ce fut une victoire. Aux États-Unis, on prit soudain conscience de la force des communistes du Sud. Une grande majorité d’Américains eut le sentiment d’avoir été trompée et la victoire semblait désormais impossible. Le 29 février 1968 le secrétaire à la Défense, Robert Macnamara, démissionna.
9 jours avant les vietnamiens avaient engagé un autre front la bataille de Khe Sanh qui fut la plus longue de la guerre du Viet Nam.
La population américaine perdit la foi en la vict
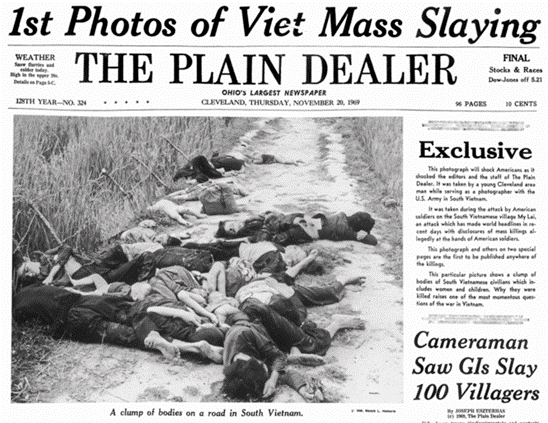 oire.
oire.
En outre, les médias commençaient à montrer des images et des exactions des soldats américains excédés et devenant fous.
C’est aussi en 1968, le 16 mars 1968 qu’eut lieu le massacre de Mỹ Lai, en plus de ne pas parvenir à gagner la guerre, l’Amérique était en train de perdre son âme. Les jeunes d’Amérique, comme les jeunes des autres pays occidentaux ne pouvaient qu’être révoltés par cette guerre sale devenu incompréhensible.
Ici un journal de Cleveland relate cette tuerie et montre aux américains une photo de la réalité : des civils massacrés.
Depuis le Viet Nam, les occidentaux n’ont plus vraiment pu gagner de guerres, de ces guerres que l’on dit asymétriques.
La plus grande armée du monde peut encore gagner des batailles contre des armées régulières comme celle d’Irak, mais elle ne peut plus gagner la guerre car les politiques n’arrivent plus à gagner la paix.
Contre l’Allemagne nazi et contre le Japon impérialiste, les alliés y étaient parvenus. Depuis ils n’y arrivent plus.
En 1968, ce fut Nixon qui gagna les élections et ce fut lui aidé par Henry Kissinger qui se résolut à arrêter cette guerre par les Accords de paix de Paris en 1973. Mais ce ne fut pas la paix mais simplement le retrait militaire américain.
La guerre continua et se termina en 1975 par la victoire totale du Nord Viet-Nam.
La guerre du Viet Nam hantait les nuits des soldats américains et révoltait la jeunesse du monde entier.
Le secrétaire d’état à la défense, lors de la guerre du Viet Nam, Robert McNamara écrivit un livre « Avec le recul. La tragédie du Vietnam et ses leçons »
On peut y lire cet aveu :
« Nous, membres des administrations Kennedy et Johnson parties prenantes aux décisions sur le Vietnam, avons agi selon ce que nous pensions être les principes et les traditions de notre pays. Nous avons pris nos décisions à la lumière de ces valeurs. Pourtant, nous avons eu tort. Terriblement tort.»
Dans cet ouvrage Mac Namara révèle aussi que de 1965 à 1968, l’opération Rolling Thunder (tonnerre roulant), nom de la campagne de bombardement va « déverser sur le Vietnam plus de bombes qu’on n’en avait lâché sur toute l’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale »
Cette guerre aura coûté la vie à plus de 58.000 soldats américains, 250 000 morts sud-vietnamiens et 1 300 000 morts nord vietnamiens. Je ne commente pas. Quelquefois, rarement, les chiffres parlent d’eux mêmes.
Les manifestations contre la guerre du Viet nam fut un grand catalyseur des colères étudiantes en 1968.
L’historien Laurent Jalabert écrivit en 1997 un article sur ce sujet : « Aux origines de la génération 1968 : Les étudiants français et la guerre du Vietnam » que vous pourrez lire <Ici>.
Et en France le 16 mai 1968 les grèves s’étendent dans le mouvement ouvrier : chez Renault à Flins, à Billancourt, au Mans et à Sandouville, à la manufacture d’armes de Bayonne, chez Kleber-Colombes et Rhône-Poulenc à Elbeuf, chez Dresser-Dujardin au Havre, chez Unelec à Orléans. Et à Renault-Billancourt, le cortège venu du Quartier latin trouve porte close, la CGT voulant éviter tout risque de « provocation ». Les ouvriers et les étudiants manifestent, mais pas ensemble !
<1070>
-
Mardi 15 mai 2018
« Ce qui s’est passé en 1968 dans le monde, en dehors de mai 68 »Poursuite du butinage et des réflexions autour de mai 1968Le mot du jour d’hier avait vocation à montrer que le mai 1968 des étudiants et de la jeunesse, n’étaient pas que français. Il était aussi allemand, italien, espagnol, brésilien, tchécoslovaque, brésilien, mexicain.
Mais que se passait-il d’autres en 1968 qui n’était pas le mouvement de mai 68 ?
 Il y avait la guerre du Viet-Nam, mais j’y reviendrai par un article spécifique.
Il y avait la guerre du Viet-Nam, mais j’y reviendrai par un article spécifique.
En 1968, au Stanford Research Institue de Californie, dans le cadre de la première vidéo conférence de l’histoire, L’ingénieur Douglas C Engelbart exhibe un petit cube en bois. Le public, médusé, découvre un boitier capable de déplacer un pointeur sur l’écran de l’ordinateur. L’aïeul de la souris allait révolutionner l’usage de l’informatique.
Grâce à cette photo, vous voyez à quoi cela ressemblait. <Le mot du jour du 5 juillet 2013>, célébrait cette invention car 2 jours avant Douglas Engelbart était mort à l’âge de 88 ans
En février 1968, Grenoble accueillait les jeux Olympiques d’hiver, car à cette époque les jeux olympiques d’Hiver et d’été avaient lieu la même année Olympique. La fin de l’année 1968 verrait les jeux olympiques d’été de Mexico.
Lors de ces jeux Jean-Claude Killy gagna les trois médailles d’or en descente, slalom spécial et slalom géant. Mais ces jeux comptaient 10 disciplines et 35 épreuves. Lors des derniers jeux d’hiver, ceux de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud, il y eut 15 disciplines et 102 épreuves. Constatant une certaine inflation permettant probablement un meilleur business.
Pour les esprits curieux vous saurez que la dernière année olympique qui rassembla les jeux d’hiver et d’été fut 1992 où les jeux d’hiver eurent lieu à Albertville et les jeux d’été à Barcelone.
C’est aussi en 1968, en plein pendant les évènements, le 12 mai 1968 que le Père Boulogne 57 ans, religieux, se voit greffer le cœur d’un jeune douanier décédé. C’est la première transplantation de cœur en France. La première dans le monde fut réalisée par le professeur Christian Barnard en décembre 1967 en Afrique du Sud. Le 6 janvier ce sera au tour du Professeur Norman Shumway à Stanford en Californie de pratiquer la première greffe du cœur aux Etats-Unis.
L’opération en France avait été dirigée par le Professeur Charles Dubost et le cœur greffé du Père Boulogne battra pendant dix-sept mois et 5 jours.
 Comment ne pas parler du « Concorde ». L’avion est présenté officiellement, le 11 décembre 1967. Il est ensuite présenté à la population toulousaine le 28 janvier 1968. Le premier vol d’essai de Concorde 001 eut lieu au-dessus de Toulouse, le 2 mars 1969
Comment ne pas parler du « Concorde ». L’avion est présenté officiellement, le 11 décembre 1967. Il est ensuite présenté à la population toulousaine le 28 janvier 1968. Le premier vol d’essai de Concorde 001 eut lieu au-dessus de Toulouse, le 2 mars 1969
Et puis peu avant Noël 1968, la NASA envoie Apollo 8 faire le tour de la lune. Six mois plus tard, Neil Armstrong posera le premier pied humain sur le satellite de la terre, lors de la mission Apollo 11. Elle avait été précédé par Apollo 7 (11 octobre 1968 – 22 octobre 1968) qui fut la première mission habitée du programme Apollo. Ce fut également la première mission américaine à envoyer une équipe de trois hommes dans l’espace et la première mission à diffuser des images pour la télévision.
Nous étions, en effet, en pleine conquête spatiale. Mon butinage d’aujourd’hui nous rappelle à quel rythme très soutenu cette mission avançait, car avant Apollo 11, il y eut encore deux autres fusées qui seront lancées, en quelques mois.
Si maintenant on s’intéresse aux œuvres de l’esprit :
Le 8 mai 1968, Marguerite Yourcenar publie « L’Œuvre au Noir » livre dans lequel elle crée un personnage fictif du XVIème siècle : Zénon auquel, selon l’express du 10 juin 1968 qui présente cet ouvrage, l’écrivaine a prêté les traits d’Erasme, de Léonard, de Paracelse, de Michel Servet, Campanella. Comme eux, il lutte contre la bêtise, la routine et les préjugés.
L’express du 22 juillet 1968 nous apprend que le grand écrivain Albert Cohen publie le troisième volet de sa trilogie consacrée aux Solal : « Belle du Seigneur »
L’express du 16 décembre 1968 annonce la traduction et la parution en français de « Sexus » d’Henry Miller, censuré neuf ans durant. L’article de l’Express donne la parole à Henry Miller : « Le sujet de mes livres, ce n’est pas le sexe, c’est la libération de soi » mais le journal de Servan Schreiber et Françoise Giroud ajoute : « Sexus contient les pages les plus scabreuses d’un auteur qui a franchi depuis longtemps le mur de la pornographie.
Au cinéma on trouve les sorties suivantes :
- 8 mars 1968 : Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone ;
- 17 mars 1968 : La mariée était en noir de François Truffaut avec Jeanne Moreau
- 1er avril 1968, le bal des vampires de Roman Polanski avec dans le rôle principal son épouse Sharon Tate qui sera assassinée l’année suivante
- 4 septembre 1968, le Lauréat qui révèle Dustin Hoffman et célèbre les amours post-adolescents (L’express du 9 septembre 1968)
Et surtout
-
Le 27 septembre 1968 : 2001 Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick dans lequel l’intelligence artificielle du robot qui avait pour nom « Hal » tentait de ne pas se faire débrancher par l’homme qui venait de constater qu’il était en train de prendre des décisions contraires aux intérêts des humains.
Et puis il y a d’autres choses qui se passent dans le monde qui sont moins réjouissantes :
D’abord la révolution culturelle en Chine.
Le 8 août 1966, le comité central du parti communiste chinois avait émis un projet de loi (sans doute rédigé par Mao) concernant les « décisions sur la grande révolution culturelle prolétarienne ». Ce texte constitue une forme de charte de la Révolution culturelle. La révolution culturelle, un moment d’une violence inouïe, chaotique atteindra son apogée en 1968.
Parmi ceux ont fait mai 1968 en France, il y avait un nombre important de maoïstes ou du moins des gens qui exprimaient une grande sympathie pour Mao. La Gauche Prolétarienne était une des structures qui regroupaient ces militants : Benny Lévy, Alain Geismar, Serge July, Gérard Miller, Marin Karmitz, André Glucksmann, Daniel Rondeau, Olivier Roy etc.
<Dans cet article : L’enfant et les gardes rouges> il est question de Xu Xing qui vit cette période à 12 ans, séparé des siens et qui est devenu écrivain et réalisateur. Il raconte la violence dont il a été témoin :
« La violence était partout Surtout entre 1966 et 1968. Tous les jours, des maisons étaient mises à sac. Lui est trop petit pour être visé par les Gardes rouges. Et sa famille, envoyée à la campagne, échappe à l’acharnement des petits soldats de Mao. Mais ma voisine a été battue à mort ou presque se souvient-il. Elle était propriétaire, dans ma ruelle d’une grande cour. La porte était toujours fermée et elle ne se mélait pas aux voisins. Un jour, un groupe de gardes rouges est entré. Tout à coup, on a entendu un cri terrifiant et ils ont fait sortir cette vieille femme, à laquelle ils avaient coupé les cheveux n’importe comment. Ils l’ont jetée dans un triporteur et, debout, les gardes rouges la frappaient avec une ceinture en cuir. Son corps était couvert de sang…Ses cris je m’en souviens encore ».
L’autre drame, outre le Viet Nam, dans le monde en 1968 était la famine au Biafra
Il s’agit d’une guerre civile entre ethnies au Nigeria dont l’origine plonge à la fois dans les frontières artificielles et les antagonismes qui ont été provoqués par les colonisateurs européens. L’ethnie des ibos, catholiques avaient longtemps été privilégiés par les blancs. Au début de l’indépendance du Nigéria, cette ethnie tenait plutôt les leviers du pouvoir, mais minoritaire elle va bientôt être rejetée et faire l’objet de massacres par les populations du nord, musulmanes, les Haoussas et les Fulanis. La population Ibos se retranche alors dans sa région d’origine qui va devenir le Biafra et va tenter par les armes d’obtenir son indépendance. Mais le Biafra dirigé par un chef intransigeant et rigide : le colonel Ojukwu lâché par les occidentaux et les autres pays africains qui ne veulent pas remettre en cause les frontières de l’Afrique, encerclé et soumis à un blocus par les troupes nigérianes fédérales beaucoup plus nombreuses, va d’abord mourir de faim avant que la rébellion ne s’écroule. Un article d’un journal suisse essaye d’expliquer la complexité de ce conflit et l’utilisation de la famine comme ultime arme de communication du colonel Ojukwu pour essayer d’obtenir l’indépendance.
Les images sont insoutenables. Il suffit de chercher sur un moteur de recherche « famine Biafra » pour en trouver de nombreuses.
C’est lors de ce conflit que les premières organisations humanitaires vont naître, des médecins dont Bernard Kouchner le plus médiatique d’entre eux vont d’abord sous l’égide de la Croix Rouge se rendre sur ce territoire où agonise un peuple et en réaction créer « médecins sans frontières » puis d’autres ONG analogues.
Voilà ce qui se passait dans le monde en 1968 pendant que les étudiants français écrivaient des slogans sur les murs comme : « Sous les pavés, la plage ». Il est vrai que Romain Goupil avec Daniel Cohn-Bendit, invité par France Inter, hier le 14 mai, pour leur film, présenté à Cannes, «la traversée» et présentant la France d’aujourd’hui, a transformé ce slogan au cours de l’émission en disant : « Sous les pavés, les sages ». Car il reconnaissait qu’en 1968 il était sectaire, bolchevique et gauchiste. Ce documentaire sera diffusé le 21 mai à 20h50 sur France 5.
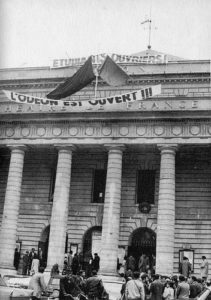
A Paris, le 15 mai 1968, le Théâtre de l’Odéon est occupé.
<1069>
- 8 mars 1968 : Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone ;
-
Lundi 14 mai 2018
« Mai 68 dans le Monde »Butinages autour de mai 68J’ai longtemps hésité avant de me lancer dans la rédaction d’une série de mots du jour sur mai 68.
En mai 68, je n’avais pas encore dix ans, je n’ai aucun souvenir dans ma mémoire de ce moment, sauf peut-être la tentative de Daniel Cohn Bendit de revenir en France après son expulsion, parce qu’il a essayé de le faire au poste frontière de la Brême d’or qui se situait à 2 km de ma maison familiale.
Par la suite je n’ai jamais été intéressé par cette pseudo-révolution.
C’est pourquoi quand Michelle nous a rendu visite vers le 22 mars et m’a suggéré: « j’espère que tu vas nous faire des mots du jour sur mai 68. » j’ai simplement répondu que ce n’était pas prévu..
Cependant c’est un sujet qui semble beaucoup occuper les médias.
Plus étonnant, le Président Macron s’est posé la question de commémorer cet évènement !
L’Obs nous apprend que Daniel Cohn Bendit et un de ses vieux complices du mouvement de mai 68, Romain Goupil s’entretiennent régulièrement avec le Président :
« Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, Cohn-Bendit et Goupil, que certains surnomment « le couple Dany » tant ils sont inséparables, sont des interlocuteurs réguliers du président. « Ils font partie des capteurs que le président aime voir », dit un de ses proches. »
Et c’est donc, toujours d’après l’Obs que par SMS, le président de la République a testé l’idée auprès du tandem : « Commémorer officiellement Mai-68 ? »
Et Dany le rouge devenu Dany le vert a immédiatement répondu, aussi par sms :
« Qu’est-ce que c’est que cette idée ? Rien à cirer ! »
C’est aussi simple et direct que cela…
Depuis quelques années, les présidents de la république semblent être très concernés par le mouvement de mai 68.
C’est le Figaro qui écrit :
« Une chose est sûre: il y a un avant et un après Mai 68. »
Et de rappeler que Nicolas Sarkozy, dans un discours de campagne, en 2007, voulait «liquider l’héritage de Mai 68», responsable d’un «relativisme intellectuel et moral», qui avait introduit «le cynisme dans la société et dans la politique», «liquidé l’école de Jules Ferry» ou encore «abaissé le niveau moral de la politique».
Et l’antépénultième président, au jour d’aujourd’hui, ajoutait :
«Les héritiers de mai 68 avaient imposé l’idée que tout se valait, qu’il n’y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid».
Le précédent président, en 2012, prenait évidemment une position inverse et revendiquait l’héritage de Mai 68. Dans un discours, François Hollande avait salué :
«Les piétons de Mai 68, qui marchaient la tête dans les étoiles et avaient compris qu’il fallait changer».
Une chose est certaine, ce sujet continue à déchainer les passions, 50 ans après. C’est toujours le Figaro qui cite Henri Guaino :
«Ces enfants gâtés [qui étaient sur les barricades et qui voulaient] «une société sans hiérarchie et avaient accouché d’un monde de l’argent fou et de la cupidité».
Ce même article cite Alain Duhamel qui rappelle une scène qu’on croirait tirée d’un western lorsque Jacques Chirac rencontre Henri Krasucky, syndicaliste CGT, pour préparer le sommet syndical et se rend dans une chambre de bonne avec un revolver dans la poche. Il confie aussi que Pompidou, le jour de la rencontre historique rue de Grenelle, avait demandé à Balladur de bien vérifier que les portes ne soient pas fermées à clef pour éviter d’être pris en otages.
Finalement j’ai pensé qu’il pouvait être intéressant de faire quelques recherches et butinages pour devenir un peu plus savant sur ce sujet.
Et dès qu’on s’intéresse à ce sujet, on constate que ce mouvement étudiant qui a par la suite entraîné des mouvements ouvriers et des grèves n’a pas été limité à la France en 1968. Dans d’autres parties du monde ce mouvement a pu avoir lieu d’autres mois de l’année et aussi présenter des caractéristiques différentes. Mais force est de constater que ce mouvement qui a fait vaciller le pouvoir en France a eu des échos dans d’autres parties du monde.
En quelques minutes ce <petit documentaire> est très pédagogique
A Berlin, les étudiants protestent contre la guerre du Viet Nam et demandent une réforme de l’université et un assouplissement de la société allemande. Le démarrage est plus violent. Le 11 avril 1968 un homme tente d’assassiner Rudi Dutschke qui est le leader le plus connu du mouvement étudiant, il fut très gravement atteint. Rudi Dutschke mourra en 1979 des séquelles neurologiques de cette tentative d’assassinat.
L’Express dans un article du 1er mai 2008 fait remonter en Allemagne, Mai 68 au 2 juin 1967.
 C’est le 2 juin 1967 que Mai 68 a commencé en Allemagne. Ce soir-là, des étudiants se rassemblent devant l’opéra de Berlin-Ouest, pour protester contre la visite officielle du chah d’Iran. Accompagné de sa femme, celui-ci assiste en effet à une représentation de La Flûte enchantée, lorsque, peu après 20 heures, les forces de l’ordre chargent les manifestants. Un étudiant de 26 ans, Benno Ohnesorg, tombe sous la balle d’un policier. La photo du jeune homme, allongé à terre, les yeux fermés, a fait le tour du monde. A ses côtés, une jeune femme accroupie lui a glissé son sac en tissu sous la nuque. Ses yeux à elle expriment la colère et semblent chercher de l’aide. Le cliché est devenu aussi célèbre que celui du sourire de Daniel Cohn-Bendit défiant les CRS français, mais la version allemande de la rébellion étudiante est nettement plus dramatique que la version française.
C’est le 2 juin 1967 que Mai 68 a commencé en Allemagne. Ce soir-là, des étudiants se rassemblent devant l’opéra de Berlin-Ouest, pour protester contre la visite officielle du chah d’Iran. Accompagné de sa femme, celui-ci assiste en effet à une représentation de La Flûte enchantée, lorsque, peu après 20 heures, les forces de l’ordre chargent les manifestants. Un étudiant de 26 ans, Benno Ohnesorg, tombe sous la balle d’un policier. La photo du jeune homme, allongé à terre, les yeux fermés, a fait le tour du monde. A ses côtés, une jeune femme accroupie lui a glissé son sac en tissu sous la nuque. Ses yeux à elle expriment la colère et semblent chercher de l’aide. Le cliché est devenu aussi célèbre que celui du sourire de Daniel Cohn-Bendit défiant les CRS français, mais la version allemande de la rébellion étudiante est nettement plus dramatique que la version française.
Tous ceux qui avaient participé à la manifestation du 2 juin 1967 racontent avoir été profondément choqués de voir un étudiant «descendu» en toute impunité (le policier sera acquitté) alors qu’il n’avait rien fait d’autre que de protester pacifiquement. Ils vont dès lors s’engager en masse dans l’action politique, à l’image de la jeune femme accroupie sur la photo, Friederike Hausmann, qui déclare aujourd’hui: «A partir de ce jour-là, je ne me suis pas politisée: je me suis radicalisée.» La mort de Benno Ohnesorg, puis en avril 1968, l’attentat contre le leader étudiant Rudi Dutschke (il mourra des suites de cette agression en 1979) vont en effet marquer le début d’une confrontation sociale qui tournera à l’hystérie collective et culminera dix ans plus tard avec la vague terroriste de l’ «automne allemand»
L’article de l’Express a pour titre « Génération Baader ».
Le mouvement de révolte s’abimera dans le sang quelques années plus tard.
A l’époque, la série « Holocauste » n’avait pas encore été produite et vue par les allemands. Ce sera le cas 10 ans plus tard. L’Allemagne ne s’était pas encore plongé dans son histoire macabre et des jeunes s’interrogeaient sur ce que leurs pères et leurs grands-pères avaient fait 25 ans auparavant. J’ai appris récemment que « Hans Martin Schleier », le président du syndicat des patrons allemands en 1977, dont j’avais appris l’existence parce que le 5 septembre 1977, la fraction Armée rouge d’Andreas Baader l’avait enlevé à Cologne puis assassiné, que cet homme donc avait été le bras droit de Heydrich en Tchécoslovaquie et qu’il a ainsi fait partie des responsables de la politique d’extermination en Tchécoslovaquie occupée.
Et dans les autres pays, en Italie, les étudiants demandent la réforme de l’enseignement. En Espagne, les étudiants manifestent contre le régime de Franco, parce qu’en 1968 l’Espagne était une dictature. La dictature réagissant avec les moyens dictatoriaux, créant par exemple une police secrète à l’Université.
Aux Etats-Unis, les étudiants sont surtout engagés contre la guerre au Viet-Nam mais aussi contre le racisme omniprésent.
 En Tchécoslovaquie, les étudiants veulent faire tomber le stalinisme qui survit à la mort de Staline.
En Tchécoslovaquie, les étudiants veulent faire tomber le stalinisme qui survit à la mort de Staline.
C’est ce qu’on appellera le printemps de Prague qui débute le 5 janvier 1968, avec l’arrivée au pouvoir du réformateur Alexander Dubček et s’achève le 21 août 1968 avec l’invasion du pays par les troupes du Pacte de Varsovie.
Les étudiants participent ardemment à ce mouvement.
Jan Palach, jeune étudiant de 20 ans s’immolera par le feu sur la place Venceslas à Prague le 16 janvier 1969.et mourra le 19 janvier 1969. Il deviendra le symbole du désespoir de la jeunesse tchécoslovaque.
Un mémorial sera réalisé sur les lieux de son sacrifice.
Au Japon, les étudiants protestent contre l’emprise des Etats-Unis sur la politique japonaise. La lutte est violente entre les étudiants et les forces de l’ordre. Presque partout dans le monde la police est plus brutale que la police française. Le mouvement s’achèvera au Japon en janvier 1969 après une dernière évacuation de masse d’une université par plus de 8000 policiers.
Au Brésil, il y a aussi une dictature, comme en Espagne, elle a débuté en 1964. Ils protestent contre les violences policières. Lors d’une manifestation, le 28 mars 1968, la police tire et tue des étudiants. Cette répression envenime encore la révolte étudiante comme la répression de la dictature qui n’aura jamais été aussi dure qu’à la fin de 1968.
Au Mexique, la jeunesse demande la démocratisation du pays. Mexico va accueillir les jeux olympiques de 1968. L’armée va là aussi réprimer violemment les étudiants et faire en sorte qu’il n’y ait plus d’agitation lorsque les jeux s’ouvrent le 12 octobre. Ainsi le 2 octobre, une manifestation vire au massacre : la fusillade dure 2 heures contre une foule désarmée. Ce sera le bilan le plus désastreux, au niveau humain, de l’ensemble des mouvements étudiants dans le monde.
Je vous redonne le lien vers ce petit documentaire : <Mai 68 dans le monde>
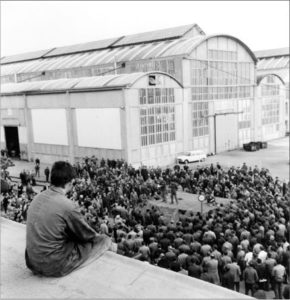 Si vous voulez savoir ce qui s’est passé, en France, le 14 mai 1968, vous avez cette page de l’Obs qui <donne les éléments pour être incollable sur mai 1968>,
Si vous voulez savoir ce qui s’est passé, en France, le 14 mai 1968, vous avez cette page de l’Obs qui <donne les éléments pour être incollable sur mai 1968>,
A Sud-Aviation Nantes, les ouvriers séquestrent le directeur dès le 14 mai, imités le lendemain par ceux de Renault-Cléon. Les occupations s’étendent très vite : Dès le soir du 14 mai, un millier d’étudiants nantais rejoignent Sud-Aviation et y passent la nuit en discussions avec les ouvriers. Leurs camarades de Caen font de même le 24 mai à Radiotechnique, Moulinex et Citroën. Sur de nombreux piquets de grève comme dans des facultés occupées s’ébauchent entre ouvriers et étudiants des rapprochements spontanés qui ne sont pas toujours bien vus par les syndicats.<1068>
-
Vendredi 11 mai 2018
« Heb’di »« Accroche-toi », journal alsacien qui a mis en ligne l’échange entre le Samu de Strasbourg et Naomi MusengaA moins que vous ayez décidé de vous isoler de toutes informations et de tous médias, il n’est pas possible que vous ignoriez le destin tragique de Naomi Musenga qui a appelé le Samu de Strasbourg en se sentant mourir et qui au lieu d’être prise en charge, a fait l’objet de moqueries au téléphone et a été abandonnée à son sort. Quand quelques heures plus tard elle a enfin été amenée à l’hôpital public, elle est morte d’une hémorragie interne.
 Avant de continuer, une photo, tant il est vrai que lorsqu’on voit une image de cette jeune femme rayonnante, on perçoit une part encore plus grande d’empathie.
Avant de continuer, une photo, tant il est vrai que lorsqu’on voit une image de cette jeune femme rayonnante, on perçoit une part encore plus grande d’empathie.
Ce drame a eu lieu le vendredi 29 décembre 2017, et on n’en parle qu’aujourd’hui, 6 mois après !
Le journal « LE MONDE » publie un communiqué des hôpitaux Universitaires de Strasbourg le 3 mai 2018 dans lequel on peut lire :
« La Direction générale des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg a pris connaissance vendredi 27 avril, d’un article paru dans le journal Heb’di, relatif aux conditions de traitement d’un appel réceptionné au SAMU 67.
Avant toute chose, les HUS s’associent à la peine de la famille et des proches de la patiente et leur présentent leurs sincères condoléances.
Les HUS diligentent dans la foulée une enquête administrative destinée à faire toute la lumière sur les faits relatés dans l’article »
Car c’est bien un tout petit journal alsacien, lanceur d’alerte, qui a eu de la compassion et a fait confiance à la famille de Naomi Musenga pour faire éclater cette histoire 6 mois après les faits.
Aujourd’hui tout le monde s’émeut de cette histoire, mais au-delà du dérapage de deux opératrices (la première des sapeurs-pompiers qui passe la communication à l’opératrice du samu) plante un décor de suspicion et de moquerie :
« Elle m’a dit qu’elle ‘va mourir’. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre, (…) elle a de la fièvre, et ‘elle va mourir’ « ,
Tout cela dit sur un ton manifestement incrédule et la seconde opératrice va continuer dans ce sens.
J’ai découvert l’existence, le rôle et aussi les difficultés de ce petit journal Hebdi par la revue de presse de France Inter du 9 mai 2018 qui va un peu plus loin dans l’interrogation :
« Naomi Musenga qui appelait le Samu de Strasbourg le 29 décembre dernier parce qu’elle se sentait mourir, et elle est morte effectivement, après avoir été moquée et retardée par l’opératrice de la plateforme d’urgence…
« Le scandale qui secoue le Samu » est la Une du Parisien, qui rappelle que Naomi n’est pas seule à avoir été maltraitée en urgence, Thomas en témoigne qui fut amputé de la jambe droite après avoir été invité à réduire lui-même sa fracture avant d’aller à l’hôpital.
Mais pour que toute cette compréhension nous arrive, il a fallu d’abord que l’on entende la voix de Naomi parlant au Samu, et il a fallu qu’un journal le publie en premier… Il s’appelle Heb’di, ce qui est un jeu de mots, heb’di signifie accroche-toi en alsacien… Journal impoli, de dessins caustiques et de papiers fâchés, et un mensuel qui dans sa dernière édition dénonçait l’agonie d’un centre anti cancer à Strasbourg… Heb’di avait mis en ligne l’enregistrement de Naomi le 27 avril… Il a fallu plus de dix jours que le scoop des dissidents devienne un scandale confirmé et authentifié par les media légitimes…
Mais qui est légitime? Heb’di est porté par son fondateur Thierry Hans… Un ancien électricien passé à la presse parce que les journaux qu’il lisait ne le satisfaisaient pas… il a lancé Heb’di en autoentrepreneur et le maintient en dépit des banques… Il a raconté tout cela sur un site, capital investissement, consacré aux PME… Car Heb’di ne va pas bien et pétitionne pour vivre, il reste 75 jours pour sauver le journal qui nous a fait connaitre l’agonie de Naomi…
Et c’est donc une histoire de journalisme aussi que l’on raconte ce matin, quand les grands journaux veulent éclairer l’inquiétante obscurité de la planète… »
C’est donc Heb’di qui sur <cette page> va publier l’enregistrement audio et va révéler cette affaire incroyable :
« Le 29 décembre 2017, 11 heures. Prise de très fortes douleurs, Naomi, à bout de force appelle le SAMU de Strasbourg.
Comme l’indique l’enregistrement les deux opératrices, manifestement de bonne humeur, ricanent. Elles ont un comportement étonnant, moqueur voire méchant.
Elles ne donnent pas suite à la demande d’assistance de la jeune femme, qui est renvoyée vers SOS-Médecins….
La jeune femme de 22 ans arrivera à contacter SOS-Médecins, qui demande… au SAMU d’intervenir !
À l’arrivée des secouristes, Naomi est consciente mais son état se dégrade fortement. Son rythme cardiaque baisse de façon inquiétante lors du transfert aux urgences du Nouvel Hôpital Civil (NHC) de Strasbourg.
Sur place, la jeune maman passe rapidement un scanner, lors duquel elle présente un arrêt cardiaque. Dix minutes de massage cardiaque seront nécessaires. Elle est transférée au service de réanimation où elle décède à 17h30.
Une autopsie sera pratiquée 5 jours après sur un corps « en état de putréfaction avancée ». La cause annoncée est une défaillance multi-viscérale : un ensemble de symptômes comprenant des difficultés très importantes de l’appareil pulmonaire (du type détresse respiratoire) associés à une insuffisance de fonctionnement de plusieurs organes comme le cœur ou le système nerveux. Les rapports médicaux et d’autopsie n’indiquent pas les origines de cette défaillance multi-viscérale.
La famille de Naomi souhaite connaître les réelles causes du décès et savoir si une intervention directe du SAMU aurait pu sauver Naomi. Le procureur a été saisi.
Naomi devait fêter son vingt-troisième anniversaire le premier avril. Sa fille aura deux ans en juillet.
Nous avons contacté les services du SAMU de Strasbourg .
Il nous a été demandé de faire une demande écrite par mail et, à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse. »
Aujourd’hui selon les propos de différentes autorités du SAMU et de la Santé, l’opératrice a commis une faute professionnelle en ne faisant pas appel à un médecin régulateur.
Ainsi on peut lire sur site de <France Info> :
« Christophe Gautier, directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, a indiqué que l’enquête s’achemine « vers un élément de faute personnelle » […] Dans les premiers éléments que nous avons pu mettre en avant, il m’est apparu que la présomption d’une faute grave de manquement à une procédure avait été constatée. Cela m’a conduit à prendre la décision de suspension à titre conservatoire, qui ne préjuge pas des conclusions définitives, mais qui est nécessaire dans le contexte de ce drame. »
Et sur <cette autre page> de France Info on peut lire
Les propos qui sont tenus par l’opératrice du Samu ne sont « pas acceptables », confirme François Braun, président de Samu-Urgences de France, sur franceinfo. Selon lui, l’opératrice n’avait pas à prendre seule la décision de rediriger Naomi vers SOS Médecins. « Ce qui est encore moins acceptable, poursuit-il, c’est que normalement tout appel est transmis à un médecin régulateur. C’est ce médecin qui prend les décisions après un interrogatoire médical et, dans ce cas, l’appel n’a pas été transmis au médecin. Ce n’est absolument pas la procédure. Ce n’est absolument pas ce que l’on apprend à nos opératrices. On ne demande pas aux gens de rappeler, on le fait nous-mêmes et on transmet l’appel éventuellement à un autre service. »
Mais au-delà de cette faute,
- Comment se fait-il que l’autopsie ait été si tardive ?
- Comment est-il possible qu’il n’y ait pas immédiatement d’enquête interne pour comprendre ce qui s’est passé ?
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a insisté ce jeudi sur France Info :
« Quand il y a un événement indésirable grave qui aboutit au décès, on doit obligatoirement en référer à l’Agence régionale de santé (ARS) qui doit mener une enquête, voire le faire remonter au ministère. » Or, suite à la mort de la jeune femme, l’ARS n’a rien reçu. »
C’est finalement la famille qui a obtenu après de nombreuses démarches l’enregistrement du SAMU et c’est ce petit journal HEB’DI qui a relayé l’information et non les grands journaux alsaciens « Les dernières nouvelles d’Alsace » ou « L’Alsace » qui ont d’ailleurs publiés l’information encore beaucoup plus tardivement que les autres journaux nationaux qui n’avait pas été rapide (10 jours !) comme s’en étonnait le journaliste de la Revue de Presse de France Inter.
C’est pourquoi, il est important qu’il existe des journaux indépendants, des journaux lanceurs d’Alerte.
Vous pouvez, comme moi, faire un don pour que ce journal puisse continuer à vivre et à agir contre l’indifférence et chaque fois que les institutions et les autres médias sont aveugles, sourds, fainéants ou peut être pire, complice…
<1067>
- Comment se fait-il que l’autopsie ait été si tardive ?
-
Mercredi 9 mai 2018
« La musique est dans tout. Un hymne sort du monde »Victor Hugo, « Les contemplations »Mon ami Gérald est en Vendée et il est allé dans une crêperie.
Je n’ai pas l’habitude d’écrire des faits surtout depuis le mot du jour du 9 octobre 2017 :
«L’homme médiocre parle des personnes,
L’homme moyen parle des faits,
L’homme de culture parle des idées »
Citation attribuée quelquefois à Jules Romain d’autre fois à Eleanor Roosevelt
Mais dans le cas particulier du mot d’aujourd’hui, il me faut une introduction.
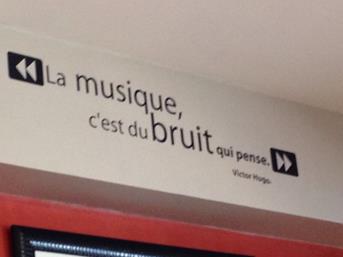 Donc Gérald est dans une crêperie et prend une photo qu’il m’envoie.
Donc Gérald est dans une crêperie et prend une photo qu’il m’envoie.
Cette photo reproduit la phrase suivante « La musique c’est du bruit qui pense » Victor Hugo
Et il pose la question : « As-tu déjà fait un mot du jour sur cette réflexion affichée dans une crêperie de Noirmoutier ? ». La réponse est négative, mais je trouvais l’idée intéressante après « Mass » de Bernstein : pourquoi ne pas écrire un mot du jour sur la musique issue du grand Victor Hugo ?
Bien sûr, il faut vérifier.
Sur Internet on trouve beaucoup de sites qui publient cette citation mais jamais en donnant une source sérieuse et vérifiable.
<Même le site du Figaro> cite cette phrase en donnant pour source « / Fragments »
Sur d’autres il y a mention « Les contemplations. »
Il y a en France des personnes passionnées de poésie, jusqu’à créer des sites entièrement dévoués à cet art.
J’ai trouvé celui-ci : http://www.poesie-francaise.fr/
Et ce site permet même de faire une recherche de poèmes à partir d’un mot. Alors j’ai cherché : « La musique »
Le moteur de recherche renvoie 67 poésies dont 9 de Victor Hugo.
1 « Sagesse » – Recueil : Les rayons et les ombres (1840).
2 « Que la musique date du seizième siècle » – Recueil : Les rayons et les ombres (1840).
3 « Littérature » – Recueil : Les quatre vents de l’esprit (1881).
4 « Psyché » – Recueil : Les chansons des rues et des bois (1865).
5 « À un riche » – Recueil : Les voix intérieures (1837).
6 « Georges et Jeanne » – Recueil : L’art d’être grand-père (1877).
7 « Écrit sur la plinthe d’un bas-relief antique » – Recueil : Les contemplations (1856).
8 « Melancholia « . – Recueil : Les contemplations (1856).
9 « Bièvre « – Recueil : Les feuilles d’automne (1831).
J’ai vérifié, l’expression dite ne se trouvait dans aucun de ces poèmes.
J’ai continué mes recherches pour finalement trouver un blog qui avait déjà fait des recherches sur cette citation. Et l’auteur écrit :
« « La musique, c’est du bruit qui pense ». Cette célèbre formule, très galvaudée, et sans doute un peu facile, est généreusement attribuée à Victor Hugo. On ne prête qu’aux riches !
La plupart de ceux qui reprennent (en chœur !) cette formule se contentent de nommer l’auteur, dont la réputation suffit à apporter la garantie d’une profondeur géniale. Aucune source n’est généralement précisée. Un ou deux sites prétendent qu’il s’agit d’une citation extraite des Contemplations, ce qui est faux.
D’autres avancent que l’aphorisme est tiré des fragments réunis dans Tas de pierres, un ouvrage posthume. C’est un ouvrage curieux que ce Tas de pierres, consultable sur le site Gallica : ce sont de simples notes manuscrites jetées sur des bouts de papier. Personnellement, je n’y ai pas retrouvé notre citation. La belle formule reste introuvable. Selon Sébastien Mounié (L’école aujourd’hui – élémentaire de janvier 2012), on peut s’interroger sur l’existence même de cette phrase sous la plume de Victor Hugo, en l’absence de toute référence vérifiable. Il pourrait s’agir d’une formule inventée, ou seulement transmise oralement. La citation pseudo hugolienne rendrait « clairement hommage à la musique symphonique de l’époque, à la force évocatrice des idées et des émotions se dégageant d’une mélodie. » Pourquoi pas… »
Mais il me fallait un mot du jour pour le lendemain du 8 mai et il n’était pas question de mettre une citation non labellisée. Je suis donc revenu vers les poèmes trouvés et j’ai préféré le 7 qui est extrait des contemplations :
Titre : Écrit sur la plinthe d’un bas-relief antique
Poète : Victor Hugo (1802-1885)
Recueil : Les contemplations (1856).
La musique est dans tout. Un hymne sort du monde.
Rumeur de la galère aux flancs lavés par l’onde,
Bruits des villes, pitié de la sœur pour la sœur,
Passion des amants jeunes et beaux, douceur,
Des vieux époux usés ensemble par la vie,
Fanfare de la plaine émaillée et ravie,
Mots échangés le soir sur les seuils fraternels,
Sombre tressaillements des chênes éternels,
Vous êtes l’harmonie et la musique même !
Vous êtes les soupirs qui font le chant suprême !
Pour notre âme, les jours, la vie et les saisons,
Les songes de nos cœurs, les plis des horizons,
L’aube et ses pleurs, le soir et ses grands incendies,
Flottent dans un réseau de vagues mélodies ;
Une voix dans les champs nous parle, une autre voix
Dit à l’homme autre chose et chante dans les bois.
Par moment, un troupeau bêle, une cloche tinte.
Quand par l’ombre, la nuit, la colline est atteinte,
De toutes parts on voit danser et resplendir,
Dans le ciel étoilé du zénith au nadir,
Dans la voix des oiseaux, dans le cri des cigales,
Le groupe éblouissant des notes inégales.
Toujours avec notre âme un doux bruit s’accoupla ;
La nature nous dit : « Chante ! » et c’est pour cela
Qu’un statuaire ancien sculpta sur cette pierre
Un pâtre sur sa flûte abaissant sa paupière.
Juin 1833.
Oui la musique est dans tout, mais il faut savoir ouvrir ses oreilles et encore plus son cœur pour l’entendre.
<1066>
-
Lundi 7 mai 2018
« Mass »Léonard Bernstein (1918-1990)Léonard Bernstein est né le 25 août 1918. C’est encore un peu tôt pour fêter son centième anniversaire, mais les circonstances font que je voudrais aujourd’hui vous parler d’une œuvre qui à mon avis est absolument géniale : « Mass ».
Et j’ai découvert qu’ARTE a retransmis le remarquable concert qui avait eu lieu à la Philharmonie de Paris le 22 mars 2018 et qu’il est possible de voir et d’écouter ce spectacle en replay pendant quelques mois.
Donc pour tous celles et ceux qui sont pressés et aiment aller à l’essentiel :
Voici le lien vers le site de la Philharmonie : <Live.philharmoniedeparis.fr – Bernstein : MASS>
La Philharmonie ne permet plus de voir qu’un extrait. Si vous voulez voir l’intégralité il se trouve après une page de publicité derrière ce lien <Bernstein : MASS à la Philharmonie de Paris>.
Le programme de la Philharmonie introduit cette œuvre de la manière suivante :
« Mass de Bernstein est une des partitions les plus foisonnantes de l’histoire de la musique, passant dans l’instant de l’expérimentation ludique à une comédie musicale, d’une fanfare à un gospel. Cette grande messe est un objet musical peu identifié qui mêle jazz, rock, classique aux sons de batteries, de guitares électriques, de synthétiseurs, portée par une liberté de ton donnant l’impression d’un happening sans limites. »
ARTE la présente ainsi : «
« Œuvre aussi grandiose qu’iconoclaste, […] cette messe pas comme les autres se situe à la frontière de l’oratorio et de la comédie musicale. »
ARTE annonce que la vidéo sera disponible jusqu’au 21/03/2020, ce qui m’étonne mais donne à chacun le temps de visionner cette « OVNI ». (Œuvre Vocale Non Identifié)
Si vous souhaitez en savoir un peu plus et me donner le temps de tenter d’expliquer pourquoi, cette œuvre assez méconnue jusqu’ici, est exceptionnelle, je vous invite à lire la suite de ce mot du jour.
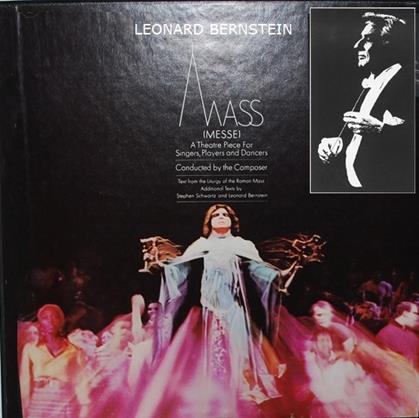 J’ai découvert cette œuvre il y a environ quinze ans par l’enregistrement qu’en a fait le compositeur lui-même à la suite de sa création en 1971.
J’ai découvert cette œuvre il y a environ quinze ans par l’enregistrement qu’en a fait le compositeur lui-même à la suite de sa création en 1971.
Il faut d’abord parler de Léonard Bernstein.
Il est né dans le Massachusetts, de parents juifs ukrainiens. <TELERAMA> nous apprend que son père voulait en faire un rabbin. Mais la musique le saisit d’abord comme interprète puis comme compositeur.
Il devint, bien sûr, mondialement célèbre en composant la musique de la comédie musicale « West Side Story »
C’était un homme charismatique, plein de fougue et d’excès, j’y reviendrai dans un mot du jour ultérieur, plus proche de sa date anniversaire.
Mais c’était un musicien extraordinaire. La grande cantatrice allemande Christa Ludwig qui a beaucoup travaillé avec le musicien dit en toute simplicité :
«Leonard Bernstein ne faisait pas de la musique, il était la musique!»
(Propos rapportés par le Figaro du 18 mars 2018)
Lors de sa disparition subite, le 14 octobre 1990, des suites d’une crise cardiaque, le New York Times titrait : « Music’s Monarch, Dies » (Le seigneur de la musique est mort).
Il était surtout très éclectique et s’intéressait à toutes les musiques, le jazz, le rock.
Et <France Musique> nous apprend que dans une émission diffusée en 1967 sur CBS, Inside Pop – The Rock Revolution, Léonard Bernstein a osé cette comparaison :
« Les Beatles sont les Schubert de notre temps »
Je ne partage pas cette vision …
D’ailleurs je pense que les mélomanes spécialisés dans la musique classique auront plus de mal à entrer en résonance avec « Mass » que ceux qui se sentent plus proches du jazz et du rock. Il n’est pas rare que des musiciens de rock aient introduit dans leurs spectacles des morceaux de musique classique, le contraire est quasi inexistant. Léonard Bernstein l’a fait pour la première fois, à ma connaissance
Mais si les habitués de la musique classique auront du mal, il est aussi possible que les croyants catholiques aient du mal : car Mass n’est pas une messe, mais un « oratorio scénique » pour chanteurs, musiciens et danseurs qui se base sur le texte liturgique catholique mais pour en faire une chose très différente : une interrogation sur la spiritualité, une interpellation très vive de Dieu.
<Le site Qobuz> explique :
« Difficile de classer Mass de Bernstein, créée en 1971. Il ne s’agit pas vraiment d’une messe à proprement parler, […] et l’argument pourrait être celui d’une sorte de service divin qui tournerait au vinaigre avant de retrouver, finalement, la paix universelle. Au début, tout le monde semble d’accord, puis les « musiciens de rue » commencent à questionner la nécessité, voire même l’existence, d’un dieu. La cacophonie qui s’installe jusqu’à l’Élévation catastrophique est finalement apaisée après que le serviteur de la messe rassemble tous les esprits autour de la divinité et un dernier « allez en paix ». Bernstein a rassemblé dans sa partition tous les éléments possibles et imaginables de la musique du XXe siècle : jazz band, blues, ensemble de rock, Broadway, expressionnisme, dodécaphonisme, modernisme qui n’est pas sans rappeler Britten, musique de rue, fanfare, voix classiques mêlées aux voix de rock et de jazz et aux récitations du Gospel : une véritable Tour de Babel qu’il n’est pas nécessairement facile de rassembler autour d’un même souffle. »
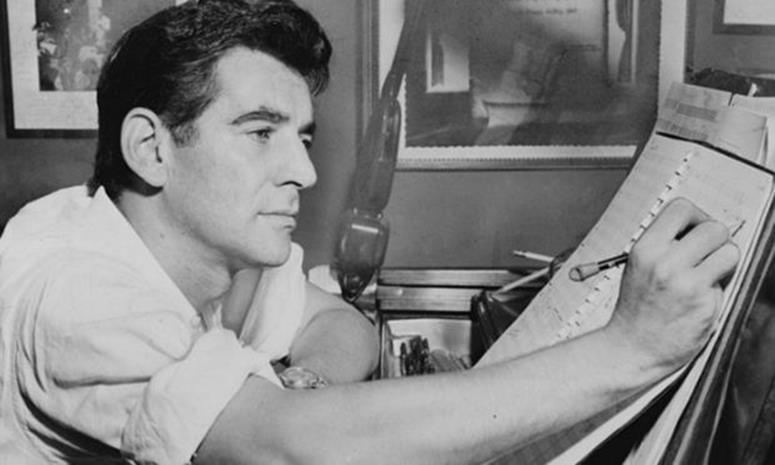 Mais revenant au commencement. Léonard Bernstein, de nombreux signes le montrent est profondément ancré dans la tradition juive et hébraïque. Par exemple dans ses œuvres plus académiques : ses symphonies, la première est consacrée au grand prophète juif « Jérémie » et la troisième porte pour titre « Kaddish », la prière juive par excellence.
Mais revenant au commencement. Léonard Bernstein, de nombreux signes le montrent est profondément ancré dans la tradition juive et hébraïque. Par exemple dans ses œuvres plus académiques : ses symphonies, la première est consacrée au grand prophète juif « Jérémie » et la troisième porte pour titre « Kaddish », la prière juive par excellence.
Donc cela peut sembler une incongruité que Jacqueline Kennedy demande à Léonard Bernstein de consacrer une œuvre « religieuse » en l’honneur du président assassiné, premier président et il me semble toujours seul président des États-Unis catholique. Car il faut quand même rappeler qu’au centre de cette liturgie catholique, plus précisément dans le « Credo » se trouve cet acte de Foi « Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. » prompte à éloigner tous ceux qui ne partagent pas cette croyance
Et c’est ainsi que « Mass » est né et a été interprété pour la première fois au John F. Kennedy Center for the Performing Arts, le 8 septembre 1971
Il faut noter que Léonard Bernstein fut très ami avec la famille Kennedy.
Bernstein s’entoura d’un groupe de collaborateurs dont certains illustres pour créer cette pièce de théâtre pour chanteurs, comédiens et danseurs comme par exemple Alvin Ailey, Gordon Davidson, Roger LM. Stevens. Les textes complémentaires au texte liturgique furent écrits par Léonard Bernstein lui-même mais aussi en partie par Stephen Lawrence Schwartz.
MASS commence par un Kyrie sur le texte traditionnel dans une musique très moderne et assez chaotique mais très vite remplacé par un chant de l’officiant qui joue un rôle central dans cette pièce.
Le livret qui accompagne l’enregistrement de Bernstein écrit :
« Il existe pour accéder à cette œuvre une clé qui réside dans les toutes premières paroles chantées par le célébrant : « Chantez au Seigneur un chant simple ».
Vous pouvez entendre dans la version de Bernstein ce « Simple song »
« Mass était probablement « un chant simple » pour Léonard Bernstein, cet homme au génie créateur le plus complexe que l’Amérique ait jamais produit. Il voulait s’exprimer sur la nécessité pour chacun de nous de posséder et de cultiver une vie spirituelle au sein de notre vie de tous les jours. »
<Le site de la Cité de la Musique donne aussi des clés> :
« 1971 : les États-Unis sont en pleine guerre du Vietnam et Leonard Bernstein compose sa messe. Pour l’anecdote, le chef du FBI aux États-Unis, J. Edgar Hoover, envoya un message au procureur général du président Richard Nixon pour l’informer que cette œuvre, programmée pour l’ouverture du nouveau centre d’arts et concerts de Washington – le Centre Kennedy – pouvait contenir un texte subversif. Faisait-on allusion au texte « Dona Nobis Pacem » ? Toujours est-il que Richard Nixon n’est pas venu à la première.
Mass est une œuvre complètement liée à son époque. […] On sent, d’un côté, le désespoir de ceux dont les repères moraux et religieux ont été bousculés, mais aussi l’optimisme de ceux qui cherchent un nouveau chemin spirituel. […]
Les véritables intentions de Bernstein étaient d’une part d’ouvrir la messe catholique à un œcuménisme spirituel et musical, d’autre part de protester contre l’indifférence de Dieu face aux horreurs de la guerre en cours au Viêtnam.
La crise de foi du jeune célébrant qui, après le « Dona nobis pacem », jette violemment par terre les sacrements et, vêtements liturgiques et linge de l’autel arrachés, saute sur l’autel et commence à danser, exprime l’inquiétude et la rage de la génération soixante-huitarde. Dans le contexte socio-politique de l’époque, il était évident que la contestation du jeune célébrant ne concernait pas seulement Dieu et le formalisme liturgique, mais aussi les responsables de la guerre du Viêtnam, le président Nixon en tête qui, à l’occasion de la création de Mass, laissa volontiers sa place à la veuve du président assassiné, Jacqueline, désormais épouse d’Onassis. »
Le Monde est très élogieux sur l’interprétation qui a été produite à la philharmonie de Paris : « « Mass », de Bernstein, une œuvre pop, classique et hippie »
Les deux acteurs principaux de cette réussite sont « Jubilant Sykes » qui incarne le « célébrant et le chef d’orchestre anglais « Wayne Marshall ».
Le replay d’ARTE n’est plus actif, mais vous pouvez trouver des extraits : <ICI> ou <ICI>
Et si vous avez besoin d’un aperçu plus court (2mn) écoutez cet extrait du Gloria dans une autre interprétation au Prom’s de Londres : « Mass – Gloria – BBC Proms 2012 ».
Je pense cependant que toutes ces versions, très bonnes du point de vue musicales, restent un peu statiques par rapport à la version initiale dont la chorégraphie était l’œuvre d’Alvin Ailey. J’ai trouvé des extraits d’un spectacle sur un site entièrement consacré à léonard Bernstein, je pense que l’organisation scénique est plus proche de ce qu’avait imaginé Bernstein et Ailey : <Trailer de Mass>
<1065>
-
Vendredi 4 mai 2018
« Et, j’ai décidé que j’allais consacrer ma vie à aimer mon prochain par contraste avec ce que je voyais !»Danielle MérianLe monde de l’information est en plein bouleversement. Il doit se réinventer, trouver de nouveaux formats et arriver à trouver un public.
BRUT est un de ces médias.
C’est un média en ligne français fondé en novembre 2016 et exclusivement diffusé sur les réseaux sociaux.
Au départ le choix était de s’intégrer à Facebook, mais désormais on le trouve aussi sur Youtube, sur Dailymotion, Instagram etc..
Le format est toujours vidéo et les reportages sont très courts.
Wikipedia nous apprend que BRUT a été fondé par :
« Renaud Le Van Kim, Guillaume Lacroix et Laurent Lucas. Guillaume Lacroix est le fondateur de Studio Bagel et Renaud Le Van Kim l’ancien producteur du Grand Journal de Canal+ d’où vient également le directeur des rédactions de Brut Laurent Lucas. Une quarantaine de personnes travaillent pour Brut et produisent deux heures de direct diffusées sur Facebook Live et des courtes vidéos d’analyse et d’entretiens. […] Selon Lacroix, les fondateurs voulaient « créer un média qui soit un point d’entrée sur l’actualité pour toute une génération qui s’éloigne des acteurs traditionnels ». Selon lui, 80 % de ceux qui les suivent sur Facebook ont moins de 35 ans.
Entre le lancement en novembre 2016 et février 2017, les vidéos de Brut ont été visionnées plus de 100 millions de fois dont 29 millions pour le seul mois de février. À cette date, Brut ne gagne pas encore d’argent. »
Souvent ces courtes vidéos me paraissent intéressantes.
Et je voudrais aujourd’hui en partager une avec vous.
Peut-être vous souvenez vous de Danielle Mérian, vieille dame très digne qui avait été interviewée, par hasard, par une chaine de télévision le lendemain du massacre du bataclan du 13 novembre 2015 alors qu’elle venait déposer un bouquet de fleurs devant la salle de spectacles ?
Elle avait alors dit :
« C’est très important d’apporter des fleurs à nos morts.
C’est très important de voir [lire] plusieurs fois « Paris est une fête » d’Hemingway. Parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs.
Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment. Et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent soi-disant au nom d’Allah. »
Après la diffusion de ce petit entretien, la vente de « Paris est une fête » a explosé.
Aidé par Tania de Montaigne, elle a, suite à ce bref moment où un micro s’est approché d’elle et où elle a trouvé les mots qui devaient être dits en cet instant, écrit un livre racontant sa vie : « Nous n’avons pas fini de nous aimer ».
Car ces mots ne sont pas venus par hasard. Ils étaient à la conclusion d’une vie, d’expériences, de réflexions et de combats.
BRUT reprend cet extrait devant le bataclan, mais ajoute que Danielle Mérian a encore des choses à dire :
« J’ai été très contente de voir se lever « Me Too », « Balance ton porc ».
Ce n’est pas élégant « balance ton porc », n’est-ce pas ?
Mais le viol est ce élégant ? Et la main à la cuisse est ce que c’est élégant ? Et les propos salaces est ce que c’est élégant ?
Je suis une féministe depuis l’enfance, pourquoi ?
Parce que je suis née en 1938, à une époque où on préférait les garçons aux filles.
Donc mes parents quoique forts intelligents, préféraient mon frère aîné à moi-même.
Je me disais : nous sommes dans un monde de fou, il va falloir changer tout ça.
Donc si vous voulez, j’étais déjà une révoltée de naissance, du fait qu’il n’y avait pas égalité entre mon frère et moi, ce que je trouvais aberrant.
Et il se trouve que mon père […] qui était journaliste comme mon grand-père a terminé la guerre comme correspondant de guerre dans l’armée canadienne et a ouvert les camps de concentration. Il avait une grande enveloppe dans les mains et il dit à ma mère : « Il ne faut pas que les enfants voient ça »
Donc dès qu’il a eu le dos tourné, j’ai fouillé son bureau. Je suis tombé sur les photos de l’abomination et j’en suis émue encore quand j’y pense…
Et, j’ai décidé que j’allais consacrer ma vie à aimer mon prochain par contraste avec ce que je voyais que l’homme est un loup pour l’homme »
 Aujourd’hui son grand combat est celui de la lutte contre l’excision.
Aujourd’hui son grand combat est celui de la lutte contre l’excision.
C’est encore Wikipedia qui nous apprend que Danielle Mérian est née Danièle Savarit, en 1938 et qu’elle est avocate honoraire au barreau de Paris. Elle se revendique comme militante chrétienne et féministe. Elle étudie le droit durant la guerre d’Algérie et se fiance à cette période. À partir de 1975, elle milite avec son mari au sein de l’ACAT, l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, notamment en soutien aux Grands-mères de la place de Mai ou pour l’abolition des exécutions capitales, ainsi que pour la libération ou l’amélioration des conditions de détention des prisonniers politiques.
Après la mort de son mari en 1995 , elle continue à militer ; ses principaux terrains d’engagement sont outre l’ACAT, avec PRSF (PRisonniers Sans Frontières) l’amélioration des conditions de détention en Afrique de l’Ouest, avec PARCOURS D’EXIL le soin aux torturés, avec SOS Africaines en Danger la lutte contre l’excision et le mariage forcé.
Encore une belle âme qui donne confiance en l’humanité.
Pour retrouver cette vidéo, je donne à dessein le lien vers le site français dailymotion plutôt que vers la créature de Google : Youtube.
<Danielle Mérian sur Dailymotion>
<1064>
-
Jeudi 3 mai 2018
«Ne pas devenir les spécialistes de l’éthique tandis que les Chinois et les Américains deviennent des spécialistes du business.»Antoine Petit, président du CNRS à propos du rapport VillaniCédric Villani a donc produit un rapport sur l’intelligence artificielle (IA) : « Donner du sens à l’intelligence artificielle »
Je ne l’ai pas lu, j’ai entendu et vu plusieurs interventions de Cédric Villani qui parlait de son rapport et de sa réflexion sur le sujet.
Un spécialiste de l’intelligence artificielle Olivier Ezratty a écrit un article critique très complet sur ce sujet et que vous trouverez derrière ce lien : <Ce que révèle le Rapport Villani>
Mais le mot du jour d’aujourd’hui va insister sur un autre article concernant ce sujet et plus précisément le lien que fait ce rapport entre l’intelligence artificielle et l’éthique.
Cet article m’a été suggéré par Daniel qui me fait le plaisir de commenter très souvent les mots du jour.
Cet article se trouve sur le site dédié à l’innovation : https://www.frenchweb.fr et a été écrit par Philippe Silberzahn, professeur à EMLYON Business School et chercheur associé à l’École Polytechnique.
Il a pour titre : « IA et éthique: le contresens navrant de Cédric Villani »
Et voilà ce qu’il dit en substance :
Il attaque assez fort dès le départ :
« Avec le rapport Villani sur l’intelligence artificielle, la France a renoué avec une vieille tradition: demander à quelqu’un d’intelligent d’écrire un rapport idiot. Enfin idiot, on se comprendra: le rapport que notre Médaille Fields vient de rédiger n’est pas tant idiot que convenu. »
S’appuyant sur des exemples historiques récents et moins récents, bien connus de nous tous, Philippe Silberzahn conteste fondamentalement la possibilité de donner, a priori, un jugement éthique sur une innovation :
« Le titre-même du rapport « Donner un sens à l’IA » est problématique. Quand on regarde l’histoire de l’innovation, le sens a toujours été donné a posteriori. Et ce pour une raison très simple: les ruptures technologiques présentent toujours des situations inédites sur le plan légal, social et éthique. Il est très difficile, voire impossible, de penser ces ruptures avant qu’elles ne se produisent, et avant que les effets ne soient visibles. On risque de penser dans le vide. Lorsque McKinsey conduit une étude de marché pour AT&T en 1989 pour évaluer le potentiel de la téléphonie mobile, les résultats sont désastreux: personne ne voit l’intérêt d’avoir un téléphone mobile. Personne ne peut simplement imaginer ce qu’on ferait avec. Seule l’utilisation effective a révélé les possibilités de la technologie, de même qu’aujourd’hui seule l’utilisation de Facebook en révèle les dangers pour la vie privée.
Plus généralement, les applications d’une nouvelle technologie sont impossibles à anticiper. Lorsque les ingénieurs français et autrichien découvrent les ultra-sons en 1911, ils s’en servent pour détecter les sous-marins. Quarante ans après, cette technologie est utilisée en médecine, c’est l’échographie. Cette utilisation est totalement imprévue et d’ailleurs, il était initialement question que ce soit pour la détection des cancers. Aujourd’hui, l’échographie est devenue banale et peu chère, à tel point qu’elle est utilisée dans les pays pauvres, en particulier en Chine et en Inde. Utilisée pour l’avortement sélectif, elle est directement responsable du fait notamment qu’environ 25 millions de femmes ne sont pas nées en Chine, causant un déséquilibre des sexes qui entraîne de lourds problèmes sociaux et donc politiques. Qui aurait pu penser qu’une technologie mise au point en Europe pour la lutte anti sous-marine soit la cause, un siècle plus tard, d’un bouleversement social en Asie? Penser les conséquences de l’échographie a priori aurait été totalement vain. »
Il nous pousse ensuite dans nos contradictions et pose la question subtile du constat éthique de l’automobile :
« Mais il y a pire. Toute technologie est duale, au sens où elle peut servir à faire le bien comme le mal. Imaginez que vous soyez ministre de l’environnement dans un pays éthique qui a mis le principe de précaution dans sa constitution (exemple fictif bien-sûr). Un groupe d’industriels vient vous voir pour obtenir l’autorisation préalable nécessaire à la commercialisation de leur nouvelle technologie. Elle apportera de toute évidence des bienfaits immenses, facilitant la vie de nombreux habitants. Son seul défaut: elle tuera environ un million de personnes par an dans le monde.
Que faites-vous?
Vous l’interdirez probablement et mettrez un comité d’éthique sur le dossier.
Cette technologie? C’est l’automobile. »
Michel Serres cite souvent <la fable de la langue> écrit par Esope, le fabuliste grec, au VIème siècle avant notre ère.:
« Le maître d’Ésope lui demande d’aller acheter, pour un banquet, la meilleure des nourritures et rien d’autre. Ésope ne ramène que des langues ! Entrée, plat, dessert, que des langues ! Les invités au début se régalent puis sont vite dégoûtés.
– Pourquoi n’as-tu acheté que ça ?
– Mais la langue est la meilleure des choses. C’est le lien de la vie civile, la clef des sciences, avec elle on instruit, on persuade, on règne dans les assemblées…
– Eh bien achète-moi pour demain la pire des choses, je veux de la variété et les mêmes invités seront là.
– Ésope achète encore des langues, disant que c’est la pire des choses, la mère de tous les débats, la nourrice des procès, la source des guerres, de la calomnie et du mensonge. »
La conclusion de Philippe Silberzahn qui cite le patron du CNRS, citation dont j’ai fait l’exergue de ce mot du jour, constitue un questionnement fort et complexe :
« En plaçant l’IA au service de l’éthique, le rapport commet donc deux erreurs: d’une part il ne se donne aucune chance de penser l’éthique de l’IA correctement, car nous penserons dans le vide – nous ne pourrons penser qu’en faisant, et d’autre part il condamne la France à regarder les autres danser depuis le balcon. Antoine Petit, le patron du CNRS lors de la conférence AI For Humanity où était présenté le rapport Villani, nous invitait ainsi à éviter un écueil: « Ne pas devenir les spécialistes de l’éthique tandis que les Chinois et les Américains deviennent des spécialistes du business. »
C’est tout l’enjeu et à vouloir mettre l’IA d’entrée de jeu au service de la diversité, de l’égalité homme-femme, du bien commun et des services publics, c’est sacrifier aux modes du moment en se trompant de combat.
On demandait à Cédric Villani de nous dire comment la France pouvait rattraper son retard en IA, c’est à dire de poser un raisonnement industriel, pas de signaler sa vertu à l’intelligentsia post-moderniste qui gouverne la pensée de ce pays.
Sans compter que comme souvent dans ces cas-là, le sens que l’on donne à éthique est bien restreint. Il peut être éthique de ne pas vouloir développer une IA aux conséquences négatives, mais il peut être également éthique d’essayer pour voir, car ce n’est qu’en agissant que nous saurons. Les entrepreneurs savent cela depuis longtemps, nos savants intelligents et ceux qui nous gouvernement l’ignorent, et se condamnent peu à peu à la paralysie par excès de prudence et, au fond, par peur du futur.
Nous devenons un vieux pays, et laissons progressivement les autres développer l’avenir.
Au fond, le rapport Villani est un rapport de vieux, la hype de notre ami Cédric en plus. »
Les craintes exprimées ne peuvent que nous interpeller.
Cela étant, au fur à mesure de l’utilisation de l’IA nous devrons rester vigilants.
En serons-nous capable entraînés par le vertige de la modernité ?
<1063>
-
Mercredi 2 mai 2018
« Grandeur et servitude du système de retraite par répartition »Réflexion sur notre système de retraiteQuand il m’arrive de discuter avec nos aînés ou de les entendre parler, je me pose parfois la question mais ont-il bien compris comment fonctionne notre système de retraite par répartition ?
Dire par exemple : « J’ai cotisé pendant toute ma vie pour ma retraite et j’ai maintenant le droit de toucher mon dû » n’est pas tout à fait exact même si on peut comprendre que c’est un sentiment légitime de prétendre que lorsqu’on a cotisé toute sa vie de travail, on a droit aussi de s’arrêter de travailler et de percevoir une pension de retraite.
Mais dire « j’ai cotisé pour ma retraite » est faux, dans notre système. Il faut bien s’en rendre compte.
On peut dire : « j’ai participé au système de retraite en tant que cotisant » et ajouter : « En tant que participant au système, j’ai le droit d’en bénéficier et d’obtenir une pension pour ma retraite. »
Dans le système de répartition dans lequel nous sommes, les gens qui travaillent cotisent pour payer les retraites de leurs aînés qui ne travaillent plus.
Un ministre allemand a dit un jour à un homologue asiatique : « Et en Europe nous sommes tellement riches que nous pouvons même payer des gens à ne pas travailler ».
C’est fondamentalement un système de solidarité. Un système qui ne peut être mis en place que dans une société que le grand sociologue Emile Durkheim a décrit ainsi :
« Pour que les hommes se reconnaissent et se garantissent mutuellement des droits, ils faut qu’ils s’aiment et que pour une raison quelconque ils tiennent les uns aux autres et à une même société dont ils fassent partie. »
J’ai évoqué cette solidarité lors de deux mots du jour : celui du < Vendredi 12 septembre 2014> et aussi celui plus récent que j’ai intitulé « Réflexions sur l’Etat social »
Avant de continuer, je voudrais affirmer ma communauté d’intérêts avec les retraités, car vu mon âge j’espère pouvoir entrer dans peu d’années dans cette nouvelle partie de la vie.
Mais parler en terme de « droit », me semble délicat et même inapproprié car ce terme ne révèle pas totalement la situation de solidarité et de confiance qui fonde ce système.
Soyons clair : Celles et ceux pour qui les retraités d’aujourd’hui ont cotisé lorsqu’ils travaillaient sont pour une grande part d’entre eux morts. La confiance dont je parle ne les concerne pas. La confiance concerne les jeunes et les « actifs » d’aujourd’hui qui cotisent pour que les ainés puissent ne pas travailler. Et la confiance signifie d’abord que ceux qui cotisent peuvent croire qu’eux-mêmes bénéficieront un jour de ce système et ensuite que la cotisation qu’il verse est acceptable par rapport à leurs revenus. »
Poser les faits de cette manière nous amène à ce constat inquiétant que révèle le schéma suivant :
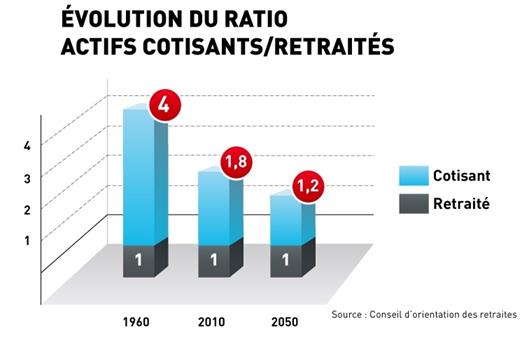
Ceci signifie qu’en 1960 : 4 actifs cotisaient, en moyenne, chacun 25 euros pour qu’un retraité puisse toucher 100 euros. Selon cette projection en 2050, un actif devra cotiser 83,33 € pour arriver au même résultat que le retraité puisse toucher 100 euros.
Grandeur de la solidarité.
Mais servitude aussi.
Le système social a été mis en place par la rencontre de deux pensées :
- La pensée sociale : il fallait permettre aux ainés de vivre dignement et de manière apaisée la dernière période de leur vie !
- La pensée économique : les aînés sont moins productifs et consomment donc moins, ce n’est pas bon pour le PIB. Leur donner une pension leur permet de continuer à consommer et donc de contribuer à la prospérité générale du système économique.
Dans ce système quand j’entends des retraités dirent je vais aller vivre au Portugal, je vivrai mieux, la vie est moins chère, je suis encore une fois inquiet du manque de compréhension ou d’appréhension de ceux qui agissent ainsi. Si je cite le Portugal, ce n’est pas un hasard mais une réalité : «Le Portugal séduit de plus en plus de retraités français».
Ce sont des motivations égoïstes et individualistes qui ne sont pas très compatibles avec le système de solidarité.
Evidemment s’il n’y a que quelques individus qui font ce choix, l’équilibre du système ne sera pas affecté même si l’esprit en est un peu dévoyé.
Mais si ce comportement devient massif, les actifs français vont cotiser pour des retraités qui vont abonder l’économie portugaise et non l’économie des actifs.
Ceci ne poserait pas de difficultés si de manière réciproque un nombre équivalent de retraités portugais venaient dépenser leurs retraites en France. Mais vous savez bien que ce n’est pas le cas, si des portugais poursuivent la même ambition ils vont aller vivre dans un autre pays ayant un niveau de vie inférieure que celui du Portugal.
Quand on sort de la solidarité et qu’on devient pleinement individualiste le système par répartition n’est plus approprié il faut opter pour le système de fonds de pension. Dans ce cas vous ne cotisez plus pour vos ainés, mais vous investissez pour vous-même en confiant une partie de votre argent d’actif à une institution financière.
Mais alors, vous ne pourrez plus vous plaindre que seuls les raisonnements financiers à court terme sont à l’œuvre dans l’économie. En effet, les fonds de pension du monde entier investissent et demandent aux entreprises dans lesquels ils investissent un rendement suffisant pour pouvoir payer les pensions des retraités qui leur ont fait confiance. Il faut connaître les priorités : les salariés de l’entreprise ou les retraités clients de l’actionnaire ?
En outre, ce système peut poser de grands problèmes aux retraités en cas de crise financière, car dans ce cas les fonds de pension ne peuvent plus payer les retraites au même niveau et ils peuvent même faire faillite.
Une grande part de ces problèmes provient d’une merveilleuse nouvelle : nous vivons de plus en plus vieux.
Une autre part vient du fait que la génération des baby-boomers pour des raisons de confort et d’évolution sociétale ont fait moins d’enfants que leurs ainés.
Et c’est ainsi que les baby-boomers de l’après-guerre réussissent cet exploit à la fois d’avoir été nombreux en tant qu’actifs par rapport aux retraités d’alors et maintenant d’être aussi nombreux en tant que retraités par rapport aux actifs.
La France a en outre ce privilège d’avoir plus d’une quarantaine de systèmes différents qui fragilisent encore le système d’ensemble.
Pendant de longues années les gouvernements n’ont fait que du paramétrage jouant sur les 3 leviers dont ils disposaient :
- Les montants des cotisations ;
- Le niveau des retraites ;
- L’âge de départ à la retraite.
Emmanuel Macron entend aller plus loin et refonder le système. Il a dit qu’il souhaite conserver le système par répartition en le rendant universel et probablement par points.
Voici comment un blog de mediapart présente ce système avec sa variante « à compte notionnel »
« La retraite à points, qui se base sur la répartition, où la solidarité nationale joue pleinement son rôle, offre aussi une grande transparence. Chaque Français possède un compte alimenté par ses cotisations, la valeur des points acquis étant revalorisée chaque année. Cela permet à chaque assuré de connaître le montant de sa pension s’il devait partir à la retraite.
Il existe une variante du système à points, dit « à compte notionnel ». Dans ce type de régime, en vigueur en Suède par exemple, chaque personne se trouve à la tête d’un « capital », alimenté par les cotisations qu’elle verse pour sa retraite. Lorsqu’elle fait liquider ses droits, un coefficient de conversion est appliqué à ce capital pour déterminer le montant de sa pension. On est donc proche d’un régime par points. Mais l’idée novatrice du système de « comptes notionnels », c’est que ce coefficient peut être établi en fonction de l’âge mais aussi de l’espérance de vie de la génération concernée.
Rappelons qu’un système par points attribue des droits à pension mais ne fixe pas le niveau des pensions, qui dépend de la valeur des points, laquelle n’est pas donnée a priori. Un tel système joue sur la distribution des pensions au sein d’une même génération mais ne résout pas vraiment la question du financement des retraites, en tout cas il reste un déficit initial à amortir (qui va le payer ?) et au lieu de déficits futurs, le système visant un équilibrage oblige à un ajustement (baisse de pensions ou allongement de cotisations ou hausse de cotisation) mais au choix du cotisant. […]
La Suède, qui avait un système proche du système français, est le premier pays à avoir adopté un tel régime en 1999, dans une version « comptes notionnels » tenant compte de l’espérance de vie. Le système suédois est souvent montré en exemple. Il serait transposable en France à condition d’unifier l’ensemble des régimes de retraites (spéciaux, fonctionnaires etc.). »
Tout ceci sera forcément compliqué mais repose à peu près sur ce principe : les retraités touchent ce que les actifs sont capables et acceptent de cotiser.
L’exergue du mot du jour fait bien sûr référence à « Servitude et grandeur militaires » qui est un recueil de nouvelles d’Alfred de Vigny publié en 1835.
Et pour rester taquin, je vous donne un lien vers un site qui organise la fraude à la retraite, je veux dire l’expatriation des retraités au Portugal : <Maison au Portugal>. J’espère que vous saurez résister…
<1062>
- La pensée sociale : il fallait permettre aux ainés de vivre dignement et de manière apaisée la dernière période de leur vie !
-
Vendredi 20 avril 2018
« Dire, ne pas dire »Site créé par l’Académie française pour répondre aux questions des personnes qui veulent bien parler françaisL’émission « Répliques » d’Alain Finkielkraut du 31 mars 2018 avait pour sujet : « La langue française : état des lieux »
Il avait deux invités Alain Borer qui a écrit : « De quel amour blessée » et Jean-Michel Delacomptée qui a publié « Notre langue française ».
L’état des lieux rapporté par cette émission est assez préoccupant.
Parallèlement, en entrant dans une librairie j’ai trouvé un de ces petits livres édités par l’hebdomadaire « Le Un », dans une collection appelée les « 1ndispensables » et ayant pour titre « Le Français a-t-il perdu sa langue ? »
Ce livre est une suite d’articles de linguistes, de lexicographes, de philosophes ou encore d’écrivains sur la langue française.
Il commence par un article provocateur de Nancy Huston. Nancy Huston est née en 1953 au Canada, c’est une femme de lettres, d’expression anglaise et française. Son article s’intitule « la morgue de la reine » et le rôle de la reine est joué par la langue française.
Elle raconte comment elle avait réagi au discours d’une élue municipale qui s’était adressé à un groupe d’enfants : « Quelle chance vous avez, d’apprendre notre si belle langue ! ».
« Comme je dois prendre la parole ensuite, j’en profite pour expliquer aux enfants que, certes, le français est une belle langue mais qu’on peut en dire autant de toutes les langues ; que disposer d’une belle langue ne suffit pas, encore faut-il s’en servir pour dire des choses intelligentes ; qu’il est tout à fait possible de se servir d’une belle langue pour dire des choses débiles ; et que , plus on connait de langues, plus on est susceptible de dire des choses intelligentes. »
Elle cite aussi Mme de Staël qui trouvait nulles les soirées mondaines à Berlin, car en allemand il faut attendre la fin de la phrase pour en connaître le verbe : « pas moyen de couper la parole à son interlocuteur, vous imaginez, cher comme on s’ennuie. »
Un des invités de Finkielkraut avait aussi relevé cette particularité du français qui met le verbe immédiatement après le sujet donnant plus rapidement le sens à la phrase et permettant à l’interlocuteur d’interrompre immédiatement celui qui parle. Selon cet invité cela créait des échanges plus dynamiques, pleinement en phase avec la remarque de Mme de Staël.
Pour ma part, cette manière de faire montre surtout une grande impatience et un manque de savoir-vivre de ne pas laisser son interlocuteur terminer ses phrases. Mais il est vrai que je suis presque germain.
Un des invités, Alain Borer, a aussi commis un article dans cet ouvrage, dans lequel il reprend les critiques qu’il a exprimé dans l’émission de Finkielkraut. Il prend soin d’abord de préciser que la langue anglaise est très belle et que ce qu’il combat n’est pas l’anglais mais « L’anglobal » ce que d’autres appellent « le globish ». Et sur ce point, il écrit :
« Les Anglo-Saxons n’ignorent pas leur dette envers les « Normands » mais ils refusent massivement, au fond, de savoir que leur langue procède du français à hauteur de 63% et à travers 37 000 mots (plus que l’intégralité du Dictionnaire de l’Académie française en 1835). La plupart s’étonnent à la façon de George W Bush : « The problem with te French is that they don’t have a word for entrepreneur ». […] Toutefois il y eut échange millénaire entre la langue française et sa bouture anglaise, une forme de tennis (du français tenez). Or, tel est le phénomène en cours : les francophones ne renvoient plus la balle. Pour la première fois dans l’histoire de la langue française, les mots anglais ne sont plus usinés sur place et renvoyés, mais au contraire ils se substituent aux mots français existants.
Air France au téléphone : « Vous avez fait un non-show » Comprendre je ne me suis pas présenté au départ.
Le Premier ministre qui appelle au « patriotisme alimentaire », parle de « France bashing ». »
Mais pour défendre le français, il faut le parler et l’écrire correctement.
Et c’est un autre article « Mais que fait l’Académie ? » de l’académicien Yve Pouliquen qui m’a appris l’existence d’un site simple et ouvert que l’Académie a mis en place pour aider à mieux parler et à mieux écrire le français.
http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire
Et sur ce site les internautes que nous sommes peuvent même poser des questions.
Ainsi un internaute a demandé, laquelle de ces deux formules est juste : 1. « Nous avons pensé À lui offrir… » ou « Nous avons pensé lui offrir… ».
Et l’Académie a répondu :
« Les deux formes sont correctes. Il y a entre elles une nuance de sens. Nous avons pensé lui offrir signifie « nous avons l’idée de lui offrir telle ou telle chose », alors que Nous avons pensé à lui offrir souligne « nous n’avons pas oublié de lui offrir… » »
La semaine prochaine je serai en congé, le mot du jour reviendra le 2 mai 2018.
<1061>
-
Jeudi 19 avril 2018
« Sperme rouge »Nouvelle initiative de chinois communistes et zélésIl ne faut pas se limiter à parler de la France sinon nous risquons le nombrilisme. Nous pouvons nous intéresser aussi à l’Empire du Milieu. La Chine n’en finit pas de nous surprendre et pas forcément en bien.
Il y a peu de temps, le Président Xi Jinping est parvenu a faire accepter qu’il pouvait ne plus y avoir de limites à sa reconduction en tant que Président de Chine, alors que ses prédécesseurs avaient décidé de ne plus faire que deux mandats pour éviter la dérive du culte de la personnalité maoïste.
Beaucoup plus inquiétant encore : le développement de l’application Crédit Sésame qui a pour finalité d’évaluer le crédit social individuel de chaque citoyen chinois. Le score de chacun est basé sur des facteurs, comme la loyauté envers le gouvernement chinois, la fidélité aux marques chinoises, à partir de ses interactions sur les médias sociaux et des achats effectués en ligne. Avoir un score élevé permet un accès plus facile à des prêts, simplifie l’accès à l’emploi et donne priorité lors de démarches administratives. Un faible score, ou le fait d’être associé à quelqu’un avec un score faible peut avoir une série de conséquences négatives : la baisse de la vitesse de l’internet, l’accès plus difficile à des offres d’emploi, des prêts ou des démarches administratives.
<Le Monde du 9 avril> nous fait part dans un article d’une nouvelle initiative de membres du Parti Communiste particulièrement zélés.
Cet article nous apprend que la Chine dispose de 23 banques de sperme chinoises dont l’« Hôpital n° 3 de l’université de Pékin ».
Cette institution a innové et via la messagerie chinoise, WeChat, mercredi 4 avril a précisé qu’elle voulait :
Des donneurs dotés « de la plus haute qualité idéologique ». Ceux-ci doivent « défendre le rôle dirigeant du parti, faire preuve de loyauté envers la cause du parti et être des citoyens honnêtes, respectueux de la loi, et libres de tout problème politique ».
<Le FIGARO> qui reprend cette information précise que les chauves et « d’autres caractéristiques » sont également exclus :
« L’annonce, qui s’adresse aux hommes de 20 à 45 ans, précise par ailleurs que les donneurs potentiels souffrant d’une maladie génétique ou infectieuse seront écartés. Ceux présentant des signes de surpoids, de daltonisme…et même de calvitie sont également priés de passer leur chemin. »
Le Figaro précise que :
« Cette publicité a été lancée alors que les banques de spermes peineraient à attirer suffisamment de donneurs. La demande pour des inséminations artificielles aurait en effet augmenté depuis que les familles ont été autorisées- il y a un peu plus de deux ans – à avoir deux enfants, explique un article paru dans la presse officielle en 2016. »
<Le site des inrocks> publie aussi un article sur ce sujet.
Malgré tout l’encadrement et la normalisation du Parti les réseaux sociaux chinois gardent une capacité certaine de réagir et le Monde nous apprend que :
« Le message publicitaire a toutefois été effacé vendredi après une volée de quolibets sur les réseaux sociaux chinois autour de ce « sperme rouge » au fort relent d’eugénisme. »
<1060>
-
Mercredi 18 avril 2018
« Je n’ai pas d’amis »Le président de la République, Emmanuel Macron, pendant l’interview du Palais de ChaillotEt Jean-Jacques Bourdin, parlant de l’évasion fiscale avec verve lança au Président de la République c’est « ce que fait votre ami Bernard Arnault ».
Le chef de l’Etat n’a pas aimé cette allégation et l’a coupé aussitôt :
« Pardon, moi, je n’ai pas d’amis, M. Bourdin. De là où je suis, je n’ai pas d’amis. »
Et, il a ajouté
« Vous savez, les insinuations dans la vie, ce n’est pas une bonne chose. »
Et Jean-Jacques Bourdin a alors répondu :
« Ce ne sont pas des insinuations »
Et encore quelques échanges aigres doux vont se poursuivre en raison de cette affirmation qui a déplu au Président de la République.
« Je n’ai pas d’amis »
Est-ce là un sujet personnel, intime, lié à la personnalité d’Emmanuel Macron ?
En septembre 2017, l’écrivain Philippe Besson publie « Un personnage de roman », récit intime de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron qu’il connaît et pour qui il avoue une sympathie certaine.
Pour présenter son livre il avait été invité par Léa Salamé à France Inter .lors de son émission du 8 septembre 2017.
Et dans cette émission il a dit ceci :
« Il n’a pas d’ami, très peu d’ami. Il a du mal avec l’intimité, il est intime avec très peu de gens, et il cite souvent cette phrase de Diderot, qui est une façon de prendre de la distance : « Partout où il n’y aura rien, lisez que je vous aime. » Il est dans l’impossibilité de dire les choses. Et puis parce que sans doute, l’essentiel se joue dans l’intimité familiale. Ce sur quoi il se replie, c’est son épouse, sa famille. Et c’est là que l’essentiel se joue, l’intimité est là, la fragilité aussi. » »
Même si cette description peut être intéressante montrant ainsi des fêlures de l’humain ce n’est évidemment pas cet aspect qui nous intéresse.
D’ailleurs dans la réponse d’Emmanuel Macron, il y a une autre proposition dans la même phrase :
« De là où je suis, je n’ai pas d’amis. »
De là où il est… donc en tant que Président de la République …
En serait-il de même des Présidents de la République que des Etats, dont le Général de Gaulle disait :
« Les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts. »
J’aimerai à croire ou à espérer que le Président de la République n’a pas que des intérêts mais a plutôt l’intérêt général chevillé au cœur et à l’esprit quand il propose, agit et décide.
Guillaume Erner a consacré son billet d’humeur du 16 avril 2018 à cette privation présidentielle d’amis :
« Une vraie rupture avec les présidents précédents.
Vous savez que chacun de nos présidents pourrait se caractériser par son rapport à l’amitié : François Mitterrand avait des amitiés très encombrantes, je pense bien évidemment à René Bousquet, et une règle, ne jamais renier ses amis. Jacques Chirac n’avait lui que des amis parmi ses compatriotes, donnant l’impression qu’il était toujours l’heure de l’anisette. Nicolas Sarkozy a parfois donné l’impression qu’il aurait aimé avoir 40 amis, avec un 40 comme CAC 40. François Hollande a eu cinq ans pour faire le plan de table du PS, l’art de la synthèse étant de conserver tous ses amis. Et Emmanuel Macron, lui, donc, n’aurait pas d’amis.
Une manière bien entendu de dire que l’on est inaccessible au conflit d’amitié, que l’on est le président de tous, et l’ami de personne, mais aussi une manière d’évoquer la solitude du pouvoir, celui qui isole et esseule. A moins, à moins qu’il y ait une manière encore plus noire d’entendre cet aveu, une manière de dire « je n’ai pas d’amis, je n’ai que des obligés, je n’ai que des courtisans ». »
Peut-être, est-ce la lucidité d’Emmanuel Macron de comprendre qu’il est surtout entouré de courtisans.
Mais il pourrait aussi avoir des amis qui ont des intérêts et sur lesquels il aurait pu compter pour arriver là où il est et qui sauront aussi être là le jour où il ne sera plus Président de la République et vu son jeune âge cherchera d’autres occupations ?
Le Huffington Post tente de répondre de manière factuelle à cette question : Existe-t-il des raisons objectives permettant de penser que Bernard Arnault et Emmanuel Macron sont amis, non pas amis de cœur ce qui ne nous regarderait pas, mais amis d’intérêts ?
« Si le chef de l’État n’est pas un « intime » du milliardaire, il existe plusieurs éléments de rapprochement entre les deux. Dans l’entre-deux-tours de la présidentielle dans Les Echos, journal dont il est propriétaire, Bernard Arnault avait publié une tribune pour appeler, comme d’autres, à voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Dans ce billet, le milliardaire saluait « un programme de liberté et de stimulation du succès économique ». Un programme « bâti sur la conviction que l’entreprise privée constitue le seul levier efficace de création durable, saine et massive d’emplois en France », louait-il sans pour autant mettre en avant d’éventuels liens personnels avec le futur président de la République. »
Le Huffington Post cite ensuite un article du journal Capital du mois d’avril 2017.
« Entre les Arnault et les Macron, c’est peut-être une longue amitié qui commence. Elle a démarré au lycée privé Franklin, dans le XVI e arrondissement de Paris, où Brigitte fut la prof de français de Frédéric et Jean. Puis la Picarde a sympathisé avec Delphine lors d’un déjeuner à New York à l’été 2014, accompagnées de leurs conjoints respectifs, Emmanuel et Xavier (Niel). Depuis, l’épouse du candidat à la présidentielle porte du Vuitton à chacune de ses sorties officielles ».
Alors là il faut décrypter pour que le commun des mortels se retrouve dans ces liens croisés et ces familles :
Delphine, est Delphine Arnault fille de Bernard, né en 1975. Elle est diplômée de l’EDHEC Business School, à Lille et de la London School of Economics, elle a travaillé, à ses débuts, pour le cabinet de conseil en stratégie McKinsey & Company. Elle rejoint, en 2000, le groupe LVMH fondé par son père. Depuis 2013 elle est directrice générale adjointe de Louis Vuitton. Elle est la compagne de Xavier Niel, une fille est née dans ce couple en 2012.
Frédéric et Jean sont ses frères ou plus précisément ses demi-frères car issues du second mariage de son père. Je suis un peu gêné que mon mot du jour devienne brusquement une chronique mondaine. Je n’avais pas imaginé cela.
Le huffington Post poursuit :
« Il y a quelques jours à peine, lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du groupe de luxe réunie au Carrousel du Louvre le 12 avril, Bernard Arnault ne s’en est pas caché. « Nous sommes très fiers d’habiller la première dame », a-t-il lancé, précisant que « aucun impact commercial » n’était constaté depuis cette collaboration.
Ces informations n’ont pas été démenties par l’Elysée même si, là encore, elles ne constituent pas une preuve d’une amitié directe entre le fondateur du géant du luxe et le chef de l’Etat. »
Ce journal ne peut donc conclure que prudemment et sans certitude.
Il serait éthique que le président de la république n’ait pas des amis qui ont des intérêts à défendre face à l’État.
J’espère que c’est le cas.
Pouvons-nous le croire ?
<1059>
-
Mardi 17 avril 2018
« La convergence des luttes »Réflexions sur ce concept manié par certains aujourd’hui en FranceDans un article qui n’est qu’à l’état d’ébauche, Wikipedia donne comme définition : « La convergence des luttes est une démarche syndicale en usage dans le syndicalisme de lutte, mais aussi parfois dans le monde associatif militant, qui tend à faire converger dans un mouvement social commun des luttes différentes mais proches. »
Le mouvement Nuit debout a créé un site Convergences des luttes : http://convergencedesluttes.fr/, mais ce site semble bloquer à la date du 20 avril 2016. Il est vrai que « Nuit Debout » avait beaucoup utilisé ce slogan de la convergence des luttes.
Sur un autre site créé par un mouvement appelé Pôle de Renaissance Communiste en France. La page d’accueil de ce site réagit à l’édito politique de Thomas Legrand sur France Inter du 3 avril 2018 :
« Sur France inter ce matin Thomas Legrand s’inquiète de la convergence des luttes qui montent … décrète son illusion et préconise au pouvoir enfin … de la pédagogie en mettant l’accent sur ce qu’il n’y aurait pas de commun entre :
Les cheminots qui veulent garder leur statut, des hospitaliers qui n’arrivent pas à soigner leurs patients … les employés de la grande distribution, les retraités qui craignent pour leur pouvoir d’achat … les étudiants qui ne veulent pas de sélection »
Mais ce qu’ignore ou feint d’ignorer l’éditorialiste au quotidien c’est que la diversité des effets et des situations est le résultat diversifié d’une même politique.
Cette politique et celle de ceux qui l’ont précédé consistant à privilégier les privilégiés, à désorganiser les services publics, à remettre en cause TOUS les conquis de la Libération sous le mensonge récurrent de la nécessité de la « réforme » et de la modernisation, de l’adaptation à la mondialisation …
Mais il arrive toujours un moment où les mensonges craquent et où les efforts de « pédagogie » des classes dominantes échouent comme les épaves et les détritus sur les rivages de nos plages.
Et que la question d’une autre politique, d’un autre pouvoir, d’autres forces dirigeantes … soit posée ! »
Une autre politique ! Oui mais laquelle ?
Ce même jour, le 3 avril, l’autre radio du service public, les matins de France Culture avaient pris comme sujet de débat : « La convergence des luttes : un rêve général ? »
Le sociologue, invité par Guillaume Erner, Manuel Cervera Marzal avait résumé dans une phrase le malaise d’aujourd’hui :
« Quand on parle de réforme aujourd’hui, on parle en réalité de contre-réforme : il s’agit de revenir sur des acquis sociaux. »
Sommes-nous dans un moment de convergences des luttes, comme en mai 68 où les ouvriers ont rejoint les étudiants dans un mouvement où les revendications sociales ont rejoint les revendications sociétales et de libération des mœurs et des idées ?
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, n’y croit pas. Le journal Libération publie un article : Laurent Berger: «je ne crois pas à la convergence des luttes». Il s’oppose sur ce point avec la CGT :
«Je ne crois pas à la convergence des luttes», a déclaré le patron de la CFDT sur RMC et BFMTV, soulignant qu’il s’agissait d’un «point de désaccord» avec la CGT.
Dans l’autre camp, celui qu’on appellerait dans un langage bienveillant, le partenaire gouvernemental on n’y croit pas non plus :
Cette fois il faut lire le Figaro ou le Journal du dimanche pour entendre l’avis d’Agnès Buzyn :
« La ministre de la Santé balaie dans une interview au Journal du dimanche le scénario d’une « convergence des luttes », au moment où s’exprime le mécontentement des retraités, des cheminots et des fonctionnaires face aux choix du gouvernement. »
Dans l’interview du Palais de Chaillot de dimanche, Emmanuel Macron a utilisé une autre terminologie : « La coagulation des mécontentements » pour préciser qu’il n’y croit pas non plus.
Nous disposons d’un gouvernement d’experts, du moins il se présente ainsi, c’est pourquoi le Point fait appel à des « experts » de l’analyse politique et sociologique pour en arriver à la conclusion :
« La « convergence des luttes »: on n’y est pas encore ».
Dans le corps de l’article, l’hebdomadaire est plus prudent et substitue au terme « expert » le terme « spécialiste » :
« D’abord, il faudrait un objectif politique commun comme faire tomber le gouvernement. Or, personne dans les syndicats n’a cette vision », souligne le politologue Philippe Braud. Ensuite, selon lui, il n’y a pas de « figure charismatique » qui incarne la mobilisation. Enfin, il rappelle la désunion syndicale. […]
Selon l’historienne Danièle Tartakowsky, « la convergence » est « avant tout un slogan pour cristalliser des espoirs et le symptôme de l’absence de stratégie unifiante ».[…]
De son côté, le politologue Jean-Marie Pernot se montre « moins catégorique » sur l’impossibilité d’une « convergence » des luttes, une « stratégie syndicale qui a du sens ». Il rappelle qu’en 1995 aussi, personne ne croyait à l’émergence d’un « grand mouvement ». « Or, les rancœurs sociales aujourd’hui sont très grandes et il y a une vie propre à ces mouvements de mobilisation que les syndicats ne maîtrisent pas », explique-t-il. […]
Quant à créer un éventuel mouvement d’entraînement, c’est celui des cheminots qui est considéré comme « stratégique » par les trois spécialistes. . […]
« Les cheminots sont sur le devant de la scène. Il faudrait vraiment qu’ils gagnent pour que les autres fronts prennent de l’ampleur », affirme Philippe Braud.
Toutefois, il se montre pessimiste sur ce scénario, estimant qu’il y a un « alignement des planètes en faveur de l’acceptation des réformes » par le grand public. « Le taux de soutien aux grévistes est faible alors qu’en France d’habitude, les gens soutiennent majoritairement les mouvements sociaux », ajoute-t-il. »
La convergence des luttes !
Si nous essayons de reprendre un peu de hauteur et d’essayer de comprendre ce qui se passe, que peut-on dire ?
Une phrase de Thomas Legrand dans son édito précité ouvre une piste de réflexion :
« Ces mécontentements ne dessinent pas un modèle alternatif cohérent »
Et il ajoute une phrase tout aussi importante :
« Il peut naître un front du refus. »
Dit plus simplement cela signifie que les NON peuvent s’ajouter pour bloquer le système mais que pour pouvoir s’inscrire dans la durée et dans une organisation viable et pérenne, il faut se mettre d’accord sur un OUI.
Alors évidemment on peut partir de la réflexion de Manuel Cervera Marzal : « Quand on parle de réforme aujourd’hui, […] il s’agit de revenir sur des acquis sociaux. »
Exprimé ainsi, il semble que l’essentiel du problème provienne d’une volonté explicite de ce que les militants de gauche pourraient appeler, « des forces du capital » de rogner toujours davantage les droits, les acquis, les protections des salariés.
Il s’agit évidemment d’un des aspects du problème : l’omnipotence du capitalisme financier sur l’économie mondiale, le refus des plus riches et notamment des grandes multinationales de participer à l’effort commun pour préserver L’État social.
Mais il faut comprendre qu’une grande partie du monde ne veut pas de cet État social. Que la plus grande part de celles et ceux qui participent à la révolution de la Silicon Valley sont des Libertariens qui fustigent l’interventionnisme de L’État.
J’ai découvert tout récemment Ayn Rand qui est une Philosophe, scénariste et romancière américaine d’origine russe, juive athée(1905-1982) qui a écrit La Grève ou La Révolte d’Atlas (titre original en anglais : Atlas Shrugged, littéralement : « Atlas haussa les épaules »). Selon une étude de la bibliothèque du Congrès américain et du Book of the month club menée dans les années 1990, ce livre est aux États-Unis le livre le plus influent sur les sondés, après la Bible. Il a été publié en 1957 aux États-Unis. Elle y développe sa pensée critique de la démocratie sociale interventionniste en envisageant ce que deviendrait le monde si ceux qui le font avancer, les « hommes de l’esprit », décidaient de se retirer : en l’absence de ceux qui soutiennent le monde (tel le légendaire titan grec Atlas), la société s’écroule.
C’était le livre de chevet de Ronald Reagan et de ses principaux conseillers, c’est encore cette pensée qui irrigue les détenteurs du pouvoir dans les entreprises américaines numériques qui dominent le monde. Mais j’y reviendrais dans d’autres mots du jour.
Mais bien au-delà de cette réalité du monde dans laquelle la pensée individualiste est extrêmement puissante, la conservation des acquis sociaux se heurtent à bien d’autres contraintes :
Nos acquis sociaux occidentaux ont reposé pour une grande part sur l’exploitation de nos pays et de nos entreprises sur le reste du monde. J’avais consacré le mot du jour du 21 février 2017 au politologue Zaki Laïdi qui avait cette formule : «La mondialisation c’est la fin de la rente que l’Occident avait sur le monde depuis la révolution industrielle.». Nous ne sommes plus dans cette position avantageuse, dont nous ne devrions d’ailleurs pas être fiers, mais plutôt dans une position beaucoup plus compliquée pour nous de la concurrence avec le reste du monde.
Dans ce contexte quel est notre OUI ?
C’est une question qui me préoccupe depuis longtemps et qui me plonge dans un océan de perplexité, notamment quand je discute avec certains collègues, voisins, connaissances ou que j’entends par voie de presse ou de réseaux sociaux s’exprimer car j’ai le sentiment qu’il y a beaucoup d’illusions et de contradictions dans ce qui est espéré et exprimé.
.
J’ai acquis une conviction, c’est que si des idées comme celles que défend Mélenchon arrivaient au pouvoir, nous serions conduits à une alternative :
- La première serait qu’au bout de très peu de temps, il suivrait la voie d’Alexis Tsipras et son parti grec SYRIZA c’est-à-dire qu’il renoncerait à son programme et se soumettrait aux diktats des puissances financières ;
- La seconde serait qu’il ne soumette pas, et mette en œuvre contre vents et marées son programme qui déplairait donc très fort aux puissances financières et mondialisées.
Dans cette seconde hypothèse et pendant longtemps, tous les français qui resteraient en France perdraient énormément de pouvoir d’achat. Il y a des denrées indispensables comme le pétrole dont la France ne dispose pas, d’autres biens services qu’elle ne sait plus faire surtout pas au coût que lui offre la mondialisation.
Je ne dis pas qu’il n’y a pas d’alternative, mais la politique qui conduirait à réaliser une politique en France totalement décalée avec l’économie mondiale ne conduit pas à une augmentation du pouvoir d’achat. Le prétendre est un mensonge, le croire est une naïveté.
L’alternative crédible est plutôt dans ce cas celle que propose un homme comme Pierre Rahbi : « Vers la sobriété heureuse » pensée qu’il développe aussi lors de sa conférence à l’université de Lyon 3 dont je vous donne le <lien>.
Dans ce type de société, vous vivez sans doute plus sainement, mieux en harmonie avec la nature, mais vous consommez beaucoup moins. Moins de produits de toute sorte, moins de services achetés, moins de voyages, moins de soins etc. La société française y est-elle prête ?
J’entends surtout : « On veut plus de pouvoir d’achat ! ».
Bien sûr que ce n’est pas la consommation qui rend heureux ou alors quelques minutes simplement et encore ce n’est pas du bonheur, plutôt du plaisir ou de la satisfaction.
Mais sortir de cette société de consommation et de concurrence demande une révolution personnelle et sociétale.
Je ne crois pas qu’on soit prêt à cette révolution, ou qu’il y a suffisamment de volontaires pour créer cela au niveau d’un pays.
Et cela pose d’autres questions :
- Comment payer les dépenses de santé de plus en plus onéreuses ?
- Comment payer les retraites dans une société de plus en plus vieille ?
- Comment payer les études des enfants, alors que là aussi cela coute de plus en plus cher surtout s’il faut faire un passage à l’étranger ?
Et puis il existe un certain nombre de nos concitoyens qui seraient viscéralement contre ce type d’évolution et qui irait mener leurs affaires ailleurs, les destinations ne manquent pas.
Ajouter les « Non » ne suffit pas il faut se retrouver sur un « Oui »
Et encore faut-il penser que ce serait une évolution franco française, alors que le reste du monde continuerait sa course folle vers la consommation et le progrès technique. Au moins aussi longtemps que la nature et la terre ne disent stop à ce désir de démiurge.
<1058>
- La première serait qu’au bout de très peu de temps, il suivrait la voie d’Alexis Tsipras et son parti grec SYRIZA c’est-à-dire qu’il renoncerait à son programme et se soumettrait aux diktats des puissances financières ;
-
Lundi 16 avril 2018
« Mais sans la confiance du peuple, aucun Etat ne saurait tenir ! »ConfuciusPeut-être que certains pensaient que je réagirais aujourd’hui à l’entretien d’hier entre le Président de la République avec Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Entretien qui a été tenu au Palais de Chaillot où fut proclamée, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Je ne le ferai pas !
Quoi que …
Je vais aujourd’hui vous parler de l’émission du 5 avril 2018 «du Grain à moudre» d’Hervé Gardette qui posait cette question surprenante : «Platon, Confucius : qu’ont-ils encore à nous dire ?»
Platon (né −428/−427 et mort en −348/−347 à Athènes) est probablement le plus célèbre philosophe de la Grèce classique, au temps de la démocratie athénienne. Il est un élément central de la pensée occidentale et a marqué l’Histoire de la Philosophie
Confucius n’est pas de notre culture. Il a vécu un siècle avant Platon (né – 551 et mort en – 479), plus précisément d’après ces dates, toujours sujets à caution à cette époque, il serait mort environ 50 ans avant la naissance de Platon. Confucius est évidemment le philosophe chinois le plus connu. Selon beaucoup, il est le personnage historique qui a le plus marqué la civilisation chinoise, et est considéré comme le premier « éducateur » de la Chine. Son enseignement a donné naissance au confucianisme, doctrine politique et sociale érigée en religion d’État dès la dynastie Han et qui ne fut officiellement bannie que dans la Chine communiste et maoïste du XXe siècle.
Mais, dans la Chine contemporaine, post maoïste, on observe un retour massif vers Confucius comme l’explique Anne Cheng, titulaire de la chaire « Histoire intellectuelle de la Chine » au Collège de France
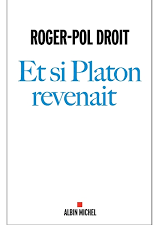 Je pense que le journaliste, Hervé Gardette, a eu l’idée de cette émission en raison du livre que vient de publier, l’un des deux invités de l’émission : Roger-Pol Droit. Son livre a pour titre : « Et si Platon revenait »
Je pense que le journaliste, Hervé Gardette, a eu l’idée de cette émission en raison du livre que vient de publier, l’un des deux invités de l’émission : Roger-Pol Droit. Son livre a pour titre : « Et si Platon revenait »
Ce livre est présenté ainsi :
« Platon observe nos smartphones, croise nos migrants, découvre les attentats terroristes, scrute nos dirigeants politiques. Roger-Pol Droit lui fait rencontrer Teddy Riner, Bob Dylan, Thomas Pesquet, l’emmène à la COP 21, au MacDo, à Pôle Emploi, au Mémorial de la Shoah, l’incite à visionner House of Cards, à écouter Emmanuel Macron et Donald Trump. Entre autres. Pour jouer ? Evidemment. Mais pas seulement.
Cette promenade dans notre actualité du père fondateur de la philosophie permet de découvrir des traits essentiels de sa pensée, en expérimentant des écarts entre nous et lui, en testant ce qu’il comprendrait aisément, ou pas du tout. Finalement, ce périple montre ce que Platon nous indique d’essentiel, que nous ne verrions pas sans lui. »
Dans l’émission Roger Pol Droit, revisite la célèbre allégorie de la caverne exposée par Platon dans le Livre VII de La République :
« Si Platon revient et qu’il voit nos smartphones, il pensera que c’est la caverne portable. »
C’est donc cette proposition de Roger Pol Droit de tenter de regarder le monde contemporain à travers le regard de Platon, du moins le regard de Platon revisité par Roger Pol Droit qui a été à l’origine de cette émission..
Selon la présentation de Roger Pol Droit, Platon est quand même un penseur problématique en cela qu’il se méfie énormément de la démocratie et qu’il prône l’émergence d’un homme nouveau, comme certains régimes totalitaires ont voulu réaliser cette utopie assez perverse selon les leçons de l’Histoire.
Roger Pol Droit explique que Platon a vécu un traumatisme dans sa vie : il a assisté à la condamnation à mort par la démocratie athénienne, de son maître, de celui qu’il respectait et aimait plus que tout au monde, l’homme qu’il considérait comme le plus sage : Socrate. Platon a tiré comme conséquence qu’un régime qui arrive à un tel résultat ne peut pas être bon. Il a donc cherché à trouver d’autres voies.
L’intelligence d’Hervé Gardette a été d’inviter à côté de cette vision de Platon qui prône un « homme nouveau », le grand penseur chinois « Confucius » qui lui ne suit pas cette voie et préfère s’inscrire dans la réalité et la tradition.
 Pour ce faire, Anne Cheng déjà évoqué au début de l’article a été le second invité de l’émission.
Pour ce faire, Anne Cheng déjà évoqué au début de l’article a été le second invité de l’émission.
Anne Cheng qui a publié en 1997 : « Histoire de la pensée chinoise » au Seuil s’était notamment fait remarquer par une traduction, accompagnée d’une introduction et de notes pour présenter la Pensée de Confucius : «Entretiens de Confucius» .
Lors de cette émission passionnante, Anne Cheng m’a appris que le rapprochement entre Confucius et Socrate était beaucoup plus judicieux qe celui avec Platon, car le grand sage chinois n’a jamais rien écrit, ce sont ses disciples qui ont recueilli ses pensées.
Lors de l’émission, c’est la pensée de Confucius qui m’a paru la plus féconde et peut être même la plus adaptée au monde moderne.
Par exemple quand Anne Cheng dit :
« Pour Confucius l’important c’est de ne jamais oublier que nous sommes humains. »
C’est quand même une belle idée à l’époque des transhumanistes ou de ces gouvernants publics et privés qui croient que l’homme se résume à un homo économicus.
Mais ce que je voudrai surtout partager avec vous, c’est un petit extrait des entretiens de Confucius qu’Hervé Gardette a cité : Un homme Zigong pose des questions à Confucius :
« Zigong – Qu’est-ce que gouverner ?
Le Maître – C’est veiller à ce que le peuple ait assez de vivres, assez d’armes et s’assurer de sa confiance.
Zigong – Et s’il fallait se passer d’une de ces trois choses, laquelle serait-ce ?
Le Maître – Les armes.
Zigong – Et des deux autres, laquelle serait-ce ?
Le Maître – Les vivres. De tout temps, les hommes sont sujets à la mort. Mais sans la confiance du peuple, Aucun État ne saurait tenir
Anne Cheng a dit sa satisfaction d’avoir cité cet extrait qui lui paraît particulièrement important et elle a ajouté :
« Je regrette que les hommes politiques d’aujourd’hui ne lisent pas davantage Confucius. Il leur apprendrait à mieux comprendre les priorités. »
« Sans la confiance du peuple… »
Je vous propose d’écouter cette émission très intéressante : « Platon, Confucius : qu’ont-ils encore à nous dire ? »
Je finirai par une autre citation de Confucius, cité dans un autre entretien par Anne Cheng :
« Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Confucius »
<1057>
-
Vendredi 13 avril 2018
« Ni vues ni connues »Collectif Georgette SandVendredi dernier, le mot du jour évoquait Hedy Lamarr, cette femme remarquable à la fois actrice et inventrice dont on reconnait aujourd’hui la qualité d’inventeur puisque le Wifi et le GPS utilise son invention.
Hedy Lamarr fait partie des 75 femmes dont traite le livre « Ni Vues ni connues » qui a été écrit par un collectif de femmes qui a pris pour nom Georgette Sand.
Ce livre a été publié en 2017.
 Ce collectif dispose d’un site : http://www.georgettesand.org/
Ce collectif dispose d’un site : http://www.georgettesand.org/
Mais ils ont aussi publié sur la plate-forme Tumblr des pages qu’ils ont appelées les invisibilisées : http://invisibilisees.tumblr.com/ qu’ils présentent ainsi :
« Les femmes d’exception ne sont pas au Panthéon, rarement dans les livres d’histoire, peu souvent dans les mémoires. Désormais elles ont leur tumblr. Le collectif Georgette Sand souhaite imposer une légitimité qui découle des compétences et non de la perpétuation de l’endogamie. « À en croire nos manuels scolaires aujourd’hui : une société dans laquelle plus de 90 % des citoyens et des citoyennes seraient des hommes. Une société dans laquelle les grandes découvertes, l’art, la philosophie, les mathématiques seraient des domaines réservés aux garçons. Une société dans laquelle nous apprendrions que des métiers sont dédiés aux femmes et d’autres aux hommes, ou que les femmes sont avant tout des «femmes de…» avant d’être des individus à part entière. Est-ce là le message que nous voulons transmettre ? Sommes-nous mêmes conscient-e-s que ces représentations vont à l’encontre de l’égalité entre les femmes et les hommes qui est pourtant une valeur de l’école républicaine ? » (Extrait du guide du Centre Hubertine Auclert « Faire des manuels scolaires »). »
Le site Terra Fémina a publié un article dans lequel des représentantes des 21 auteures du livre « Ni vues ni connues » ont pu s’exprimer :
« Terrafemina : Comment avez-vous sélectionné les 75 femmes dont vous avez tiré le portrait ?
Elody Croullebois & Sophie Janinet : Cela a été un travail de longue haleine. Nous avions déjà toute une liste de femmes sur le Tumblr Les Invisibilisées que nous avons créé en 2015, mais nous n’avons pas cessé d’en découvrir d’autres au fur et à mesure de nos recherches. Il fallait déterminer qui avait ou non sa place dans la sélection finale. C’était très dur de faire ce choix. Nous avions toutes des héroïnes qui nous tenaient particulièrement à cœur et que nous voulions raconter, réhabiliter à tout prix. Il y a eu pas mal de discussions passionnées. Et c’était sans fin, elles sont tellement nombreuses à mériter de retrouver la notoriété qu’on leur a volé. Nous avons donc arbitré pour avoir un panel suffisamment large de profils, origines et époques afin de montrer l’étendue du problème de l’invisibilisation. Renoncer à certaines nous a coûté mais au final, nous sommes heureuses des choix qui ont été faits. »
Elles parlent de mécanismes d’invisibilisation qui reviennent toujours :
« Au fur et à mesure que nous nous intéressions à ce phénomène, nous avons découvert des mécanismes récurrents dans l’histoire de ces femmes. Les hommes de leurs vie avaient souvent un rôle dans leur invisibilisation, ce besoin irrépressible de les abaisser à un niveau inférieur au leur, de les maintenir dans l’ombre coûte que coûte. Certains l’ont fait ouvertement, sans complexe, parce que les codes de la société leur donnaient raison, d’autres ont été plus subtiles, voire même inconscients de ce qu’ils étaient en train de faire. Pour d’autres, c’est l’État ou la religion qui ont joué ce rôle d’effacement. A cause de cela, de grandes femmes n’ont pas eu le destin et la reconnaissance auquel leur talent leur donnait droit. Et même les plus bravaches d’entre elles, qui se sont battues jusqu’à obtenir cette reconnaissance, l’ont perdu dès qu’elles n’étaient plus là pour se défendre. Prenez un manuel scolaire et vous aurez l’impression qu’il n’y a eu aucune femme reine, résistante ou politique qui a tout fait basculer à un moment donné de l’histoire avec un grand H. C’est pourtant bien le cas. Il est temps de le rappeler. »

Ainsi on pourrait évoquer <Rosalind Franklin> dont on sait aujourd’hui qu’elle eut une place prépondérante dans la découverte de l’ADN mais ce fut ses trois collègues masculins qui obtinrent le prix Nobel de médecine en octobre 1962 : James Watson, Maurice Wilkins et Francis Crick. Cette découverte n’aurait pu se faire sans les clichés de diffraction aux rayons X effectués par Rosalind Franklin et communiqués à son insu à Watson par Wilkins.
Pour en savoir plus et entendre raconter cette histoire vous pouvez écouter l’émission de France de Culture du 5 avril 2018 <La Méthode scientifique >. Sur la page de l’émission vous verrez une copie du fameux cliché 51B avec cette légende : «En octobre 1962, le prix Nobel de médecine est remis à trois hommes : Francis CRICK, James WATSON et Maurice WILKINS, « pour leurs découvertes sur la structure moléculaire des acides nucléiques et sa signification pour la transmission de l’information pour la matière vivante » – c’est-à-dire pour avoir mise au jour la structure en double hélice de l’ADN, et ce, en grande partie grâce à un cliché : le cliché 51, obtenu par diffraction de rayons X. Or l’histoire montrera que ce cliché n’a été pris par aucun de ces trois hommes, mais par une femme, Rosalind FRANKLIN, morte 4 ans plus tôt et dont le travail a été pillé, en toute impunité.» Elle est décédée le 16 avril 1958, à 37 ans, d’un cancer de l’ovaire, probablement lié à la surexposition aux radiations lors de ses recherches. Ce lundi 16 avril, ce seront les 60 ans de sa mort.
La gloire de certains hommes est passé par des chemins obscurs souvent en niant le rôle des femmes et parfois, comme dans ce cas, en les spoliant.
<1056>
-
Jeudi 12 avril 2018
« Enquête au Paradis »Merzak AllouacheMardi nous parlions des imams algériens qui viendront participer au ramadan des musulmans français pour prier.
Je n’ai pas souvent cité le journal de Lyon « Le Progrès », mais cette fois un de ses articles m’a interpellé surtout dans la continuité du mot du jour de mardi et même de hier.
Cet article parle d’un documentaire « Enquête au Paradis », tourné en Algérie, et primé dans plusieurs festivals internationaux.
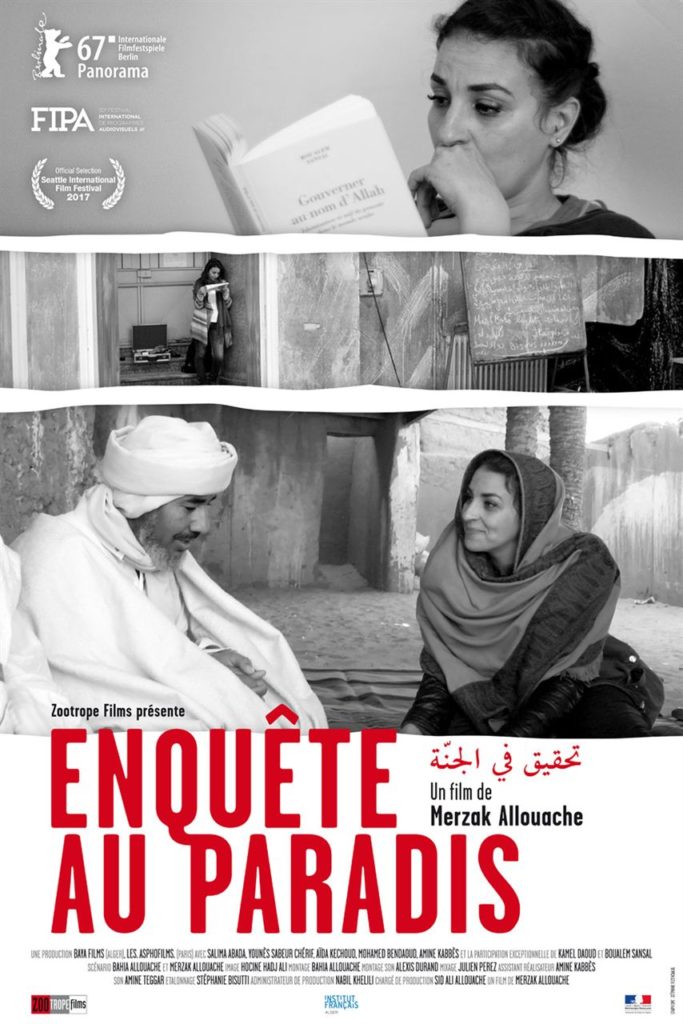 Ce documentaire s’intéresse à l’intégrisme religieux dans la religion islamique, et notamment au salafisme que Manuel Valls voudrait faire interdire en France sans préciser toutefois comment en pratique cela pourrait se réaliser. Car si des mosquées sont régulièrement fermées et des imams étrangers expulsés c’est parce leurs prêches sont contraires aux lois de la France, qu’ils appellent à la violence, à la discrimination. Mais parmi les salafistes il en existe qui appelle seulement à du piétisme sans violence et même si cela a pour conséquence de partager le monde entre croyants et mécréants et qu’à l’intérieur du cercle privé les relations homme/femme ainsi que les règles de vies observées sont assez éloignées de nos standards, une interdiction semble compliquée.
Ce documentaire s’intéresse à l’intégrisme religieux dans la religion islamique, et notamment au salafisme que Manuel Valls voudrait faire interdire en France sans préciser toutefois comment en pratique cela pourrait se réaliser. Car si des mosquées sont régulièrement fermées et des imams étrangers expulsés c’est parce leurs prêches sont contraires aux lois de la France, qu’ils appellent à la violence, à la discrimination. Mais parmi les salafistes il en existe qui appelle seulement à du piétisme sans violence et même si cela a pour conséquence de partager le monde entre croyants et mécréants et qu’à l’intérieur du cercle privé les relations homme/femme ainsi que les règles de vies observées sont assez éloignées de nos standards, une interdiction semble compliquée.
Le documentaire montre d’abord une vidéo d’un prédicateur salafiste :
« Le prêche est ahurissant. Un concentré de haine et de misogynie, vu des dizaines de milliers de fois par des Internautes du monde entier. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux – y compris dans la région de Lyon -, un imam salafiste d’Arabie saoudite évoque les «72 Vierges du Paradis» (houris) promises à chaque bon musulman de sexe masculin après sa mort. Le barbu ajoute, sans s’étrangler, que ces houris auraient une peau si douce qu’avec elles, « pas besoin de crème ou de vaseline ». Cet extrait que l’intellectuel Kamel Daoud qualifie de « pornographie sacrée », sert de support à l’exceptionnel documentaire « Enquête au Paradis » […] l’un des très rares en France à programmer ce travail à la fois critique, drôle et édifiant. Une comédienne y joue le rôle d’une vraie journaliste. Munie de son ordinateur portable, elle fait visionner cette séquence extrémiste en Algérie à des femmes et des hommes de tous les milieux sociaux pour recueillir leurs réactions, très diverses. »
Le Progrès interviewe le réalisateur, Franco-algérien, Merzak Allouache et pose la question de la découverte de cette vidéo : .
«Des personnes l’avaient partagée sur Youtube. J’ai été choqué en découvrant son contenu. De telles vidéos peuvent être vues par des millions d’individus. Internet est un vecteur très important et incontrôlable pour des gourous de ce genre. Leur discours profondément patriarcal et misogyne provient, à mon avis, de trois sources : la tradition, la religion et le confort qu’il procure à ces hommes qui trouvent intérêt à vivre avec des femmes soumises. »
L’article prend soin de préciser que ce documentaire ne dit pas – loin de là- que la majorité des musulmans s’abreuve aujourd’hui de telles vidéos et montre au contraire la diversité des points de vue, la contestation, le débat et l’humour…
Puis Merzak Allouache parle de l’Algérie :
« Mon film traite exclusivement de l’Algérie. Ce mouvement a quelque chose de paradoxal dans ce pays. Nous avons vécu des années terribles, atroces… La « décennie noire » s’est terminée par des massacres dans des villages. Des bébés, des enfants des femmes étaient égorgés par des terroristes islamistes. Pourquoi, 20 ans après, assistons-nous à un retour en force de l’intégrisme religieux ? Je me pose la question. Je pense qu’en imposant un silence, la loi d’amnistie a favorisé une sorte amnésie qui permet aujourd’hui aux islamistes – entre autres raisons – de reprendre du poil de la bête. Depuis la fin des années 1990, nous n’avons eu aucun véritable débat sur ce qui s’est passé durant les années de plomb. Le slogan qui prévalait, c’était : «Nous devons oublier. Nous sommes tous des frères ! » Mais ça ne marche pas comme ça… »
Ce film n’a pas été encore vu en Algérie.
TELERAMA a également consacré un article à ce film :
« Au centre de son film, Nedjma, jeune journaliste d’investigation, choisit d’enquêter sur le paradis. Celui qu’agitent à tout va sur internet les prédicateurs salafistes du Maghreb et du Moyen-Orient. Sillonnant le pays, croisant les propos de citoyens lambda et d’intellectuel(elle)s, elle interroge la prégnance de cette croyance dans la population, ses conséquences. Sobre, d’une redoutable efficacité et non dénué d’humour, le dispositif permet tout à la fois de déconstruire le discours wahhabite et de dresser un état des lieux de la société algérienne. De pointer le recul de la condition des femmes, de mettre à nu le malaise d’une jeunesse sans perspective tentée par les sirènes djihadistes, de radiographier un pays comme sans projet mais qui résiste encore…. »
Le réalisateur a également accordé un entretien à TELERAMA :
« En fait, l’Algérie recueille les fruits de la disparition de l’école républicaine. Quelques années après l’indépendance, le choix a été fait de son arabisation. Les coopérants, venus de France et d’Europe, aider le pays ont été remplacés par des professeurs du Moyen-Orient, en particulier des Egyptiens. Dont, semble-t-il, beaucoup de Frères musulmans. Dès lors, les choses se sont gâtées. La ministre de l’Education Nouria Benghabrit (une sociologue francophone nommée en 2014, ndlr) essaie de réformer tout cela. Elle doit faire face à un travail de sabotage des forces obscurantistes, des islamistes pour l’en empêcher. Elle est devenue la bête noire des conservateurs. Chaque année éclate un scandale au moment du bac, les sujets fuitent… pour la mettre en difficulté. Elle est très courageuse, elle résiste. Le pouvoir n’en finit pas d’envoyer des signaux contradictoires. Les démocrates qui s’expriment dans le film analysent la complicité qui existe entre le pouvoir et les salafistes, leur pas de deux incestueux. »
Et il dit autre chose sur la relation à Dieu dans ce courant et le rapport de certains musulmans d’origine algérienne en France avec la patrie de leurs ancêtres :
En Algérie, le rapport à Dieu est particulier. On ne dit pas : « J’aime Dieu » mais « J’ai peur de Dieu. » Et partout, dans les mosquées, les écoles, les salafistes travaillent sur la peur.
« Tout est interdit, tout est pêché. Après la mort, tu auras les filles que tu n’as pas eues dans la vie martèlent les prêches salafistes. La frustration dans la vie quotidienne ne peut générer que de la violence. Ce discours salafiste fait aussi des émules en France. Je crois qu’il y a une relation directe entre ce qui se passe en Algérie et les immigrés qui se trouvent en France. Il y a un va-et-vient continuel entre les deux rives de la Méditerranée. Je suis étonné de voir qu’entre Alger et Paris, quelle que soit la période, les avions sont toujours blindés. Et il faut bien l’admettre, entre ceux du bled et ceux qui vivent en France mais ne sont pas intégrés, c’est la mentalité, l’idéologie du bled qui a gagné. Ils subliment le pays d’origine sans vraiment venir vivre ici. On pouvait penser que ce serait l’inverse, mais non. Ce qui se passe dans les banlieues est le fruit de la relation directe avec le bled par Internet, par les allers-retours incessants. »
Le journaliste finit par une observation positive : « Votre film fait malgré tout du bien en ce qu’il donne la parole à des Algériens dont les mots sont souvent étouffés. Qu’il fait affleurer une parole collective qui bouscule l’image d’une Algérie immobile. »
Slate consacre aussi un article à ce film, comme le Monde qui révèle :
« Place aurait ainsi été faite, à compter des années 1990, à l’arrivée massive de l’argent et des médias d’Arabie saoudite au service du wahhabisme (1 200 chaînes satellitaires religieuses diffusent en Algérie, contre 30 chaînes laïques). Soit l’instrumentalisation délibérée de la stagnation et de la frustration sociales pour mieux conforter les pouvoirs en place ; la mise entre parenthèses du monde réel au profit d’une rétribution post mortem ; l’enseignement d’une théologie de la mort qui sape l’envie de vivre et de se battre pour améliorer l’ici-bas. L’inverse, on l’aura compris, de ce que fait ce documentaire pétri de vitalité, qui propose in fine, histoire d’en sourire quand même, la possibilité d’une mauvaise interprétation du texte sacré sur le paradis, où attendrait en réalité pour chaque homme non pas 72 jeunes vierges, mais une seule vierge de 72 ans… »
Une seule vierge de 72 ans me parait plus conforme au projet de ces illuminés qui ont tellement de difficultés avec des relations équilibrées entre femme et homme.
<1055>
-
Mercredi 11 avril 2018
« 300 imams de France sont des fonctionnaires d’Etats étrangers »Réalité de la France contemporaine et acceptée dans le cadre d’accord bi-nationauxNos politiques parlent toujours d’islam de France. La réalité est un peu moins franco-française.
Nous savons qu’il existe des financements étrangers de l’Islam de France, on parle beaucoup du Qatar et aussi de l’Arabie Saoudite. Mais concernant les responsables religieux, les imams, trois pays, pour l’essentiel, se chargent d’envoyer des imams en France : La Turquie, l’Algérie et le Maroc et de les rémunérer.
Ces situations existent dans le cadre d’accord bilatéraux avec la France.
Et <le site BFM TV> nous apprend en outre que ces religieux sont des fonctionnaires des pays qui les envoient :
« Parmi les imams exerçant en France, 300 sont des fonctionnaires d’Etats étrangers qui les rémunèrent: à savoir la Turquie, l’Algérie et le Maroc. Ces expatriations de fonctionnaires de la foi musulmane se font dans le cadre de conventions bilatérales signées par ces trois pays. […] On peut partir du principe qu’il y a 3000 mosquées en France. […] Dans ce schéma, les imams détachés, fonctionnaires turcs, algériens ou marocains, représenteraient 10% environ de l’ensemble.
Parmi ces fonctionnaires religieux déployés par des Etats étrangers, on trouve ainsi […] « 151 imams turcs, 120 Algériens, et 28 Marocains ». L’addition de ces trois groupes n’atteint pas la barre des 300. La raison? Le départ récent de deux imams marocains. »
Le JDD du 11 février 2018 dans un article « Islam de France : ce que veut faire Macron » précise quelques points supplémentaires :
« [Macron] n’a guère apprécié que son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, profite d’une visite à Paris pour s’entretenir avec les dirigeants du Conseil français du culte musulman (CFCM) et afficher outrageusement le poids de son pays au sein de l’islam français. […]
Désormais, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a pour mission de préparer la réforme du CFCM, institution créée en 2003 sous l’égide de Nicolas Sarkozy, mais qui n’est jamais parvenue à s’imposer – à peine un tiers des musulmans connaissent son existence […] Tous les experts consultés ont livré le même diagnostic : le mode de désignation des membres du CFCM est en soi un facteur d’immobilisme, une sorte de péché originel. Ils sont élus dans les mosquées selon une répartition des sièges proportionnelle à la surface des bâtiments et dans un scrutin où l’influence des pays étrangers (Algérie, Maroc, Turquie, Arabie saoudite, Qatar) se révèle déterminante.
Capital qui a consacré un article à ce sujet : « Comment sont financées les mosquées en France ? » explique :
« S’il est effectivement difficile d’obtenir des données précises sur le sujet, un rapport parlementaire publié le 5 juillet estimait que le financement des mosquées par des pays étrangers restait « marginal », l’essentiel étant assuré grâce aux dons des fidèles (la loi interdisant aux pouvoirs publics de subventionner les cultes). « Le financement du culte musulman se rapproche de celui des autres cultes, notamment du culte catholique, qui provient à 80 % des dons des fidèles », soulignent les auteurs.
Le rapport cite notamment le président de l’Union des organisations islamiques de France, Amar Lasfar, pour qui « hormis une vingtaine de mosquées financées par des organisations ou des États étrangers, l’immense majorité est financée par la communauté musulmane ».
Parmi les pays concernés, figure l’Arabie Saoudite qui affirme avoir « participé au financement de huit mosquées françaises : les aides ont varié entre 200.000 et 900.000 euros par projet. Au total, nous avons versé 3.759.400 euros ». Il s’agit principalement de lieux situés en banlieue parisienne (Cergy, Nanterre, Asnières…), à Strasbourg ainsi qu’à Givors près de Lyon.
L’Algérie, de son côté, évoque une subvention de 2 millions d’euros par an allouée à la Grande Mosquée de Paris, qui l’utilise pour son fonctionnement et les répartit ensuite vers des dizaines d’associations ou lieux de culte affiliés. Le Maroc, lui, est propriétaire de la mosquée d’Evry et a participé à la construction ou la restauration de celles de Saint-Étienne, Strasbourg et Mantes-la-Jolie. Le Royaume chérifien a consacré 6 millions d’euros en 2016 à cette activité ainsi qu’à la rémunération de 30 imams envoyés en France. […]
Par ailleurs, l’Arabie Saoudite a indiqué prendre en charge le salaire d’environ 14 imams exerçant dans des mosquées en France, sans que ces derniers soient détachés par les Saoudiens.
Reste la question des financements par des particuliers étrangers, pour lesquels c’est beaucoup plus flou : seule l’Arabie Saoudite indique « 3 dons privés » versés pour la construction de mosquées. « Ces dons privés étrangers, éclatés, ne peuvent faire l’objet d’une collecte statistique exhaustive. Ils sont pourtant, sans nul doute, ceux qui suscitent, dans l’opinion publique, le plus de suspicion, quant à l’orientation idéologique qui les anime », regrettent les auteurs du rapport. L’initiative de Manuel Valls permettra peut-être, à terme, d’améliorer la transparence sur ce point… »
La Loi de séparation de l’église de l’Etat interdit à l’Etat de financer les activités cultuelles ou la construction des édifices religieux. Mais cette loi était destinée aux églises chrétiennes qui avaient eu le temps et l’argent pour s’implanter dans le pays au cours des siècles.
Rien de tel pour l’Islam.
Or comme le proclame le titre du livre d’Hakim El Karoui « L’islam, une religion française », nous ne pouvons pas nier cette réalité que l’islam existe et est pratiquée dans notre pays.
Il est probable que la loi de 1905 n’est pas adaptée à cette situation.
<1054>
-
Mardi 10 avril 2018
« 100 imams algériens envoyés en France pour le ramadan »Arrangement entre Le ministre des cultes français Gérard Collomb et le ministre des Affaires religieuses algériens, Mohamed Aïssa.J’ai été étonné lorsque, lors d’une émission de radio, un des intervenants a évoqué ce sujet d’un accord de notre ministre de l’intérieur avec le ministre algérien des affaires religieuses.
J’ai fait des recherches internet, peu de grands médias français en ont parlé.
Le Figaro a donné la parole à Jeannette Bougrab «On nous casse les oreilles avec l’islam de France et on fait venir des imams d’Algérie !»
LCI aussi en fait mention en évoquant un propos de Manuel Valls : « De quoi parle Manuel Valls ? »
Sur ce site nous pouvons lire :
« Une dépêche de l’agence officielle de presse algérienne reprend en effet cette citation du ministre annonçant : « Nous avons choisi 150 imams, parmi les meilleurs qui ont exprimé le vœu d’aller à l’étranger pour diriger les prières durant le mois sacré de Ramadhan. » Parmi ces 150 imams, la France en recevra 100 « vu la forte concentration de la communauté algérienne qui y est établie et les 50 autres seront répartis à travers plusieurs pays, comme l’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne, la Belgique et le Canada »
[…] Djelloul Seddiki, directeur de l’institut Al-Ghazâli de la grande mosquée de Paris, chargé d’accueillir les imams étrangers [a expliqué] : « Ces imams « viennent pour 29 jours. Nous les accueillons, leur réservons une nuit d’hôtel et nous occupons des affectations en amont. Ils n’ont pas de formation en arrivant car ils vont simplement réciter les 60 chapitres du Coran en arabe, ils n’ont pas besoin de savoir parler français. »
Le directeur fait ainsi une distinction avec d’autres imams, venant eux aussi d’Algérie – mais pour quatre ans cette-fois – dans le cadre d’un accord passé à l’époque avec Bernard Cazeneuve. « Ceux-là, nous les accueillons à l’institut pendant 3 semaines car ils doivent savoir parler français et prendre des cours sur les institutions françaises, la laïcité… Ils passent également un diplôme universitaire par la suite dans le cadre d’un accord avec l’université Paris1 La Sorbonne »
Et cet accord, passé entre la France et l’Algérie à l’occasion du Ramadan, est loin d’être nouveau, ou même isolé. Déjà en 2011, par exemple, le Conseil français du culte musulman (CFCM) annonçait la venue de 180 imams marocains : « C’est devenu une tradition. Chaque année, le Maroc nous envoie en renfort des imams pour assurer la lecture du Coran et les prêches durant le mois sacré du Ramadan où les fidèles sont plus nombreux à se rendre sur les lieux du culte musulman » expliquait alors Mohamed Moussaoui, le président. […]
Toujours dans l’agence de presse algérienne, on peut lire que ces imams ont été « sélectionnés pour la maîtrise des règles de la psalmodie et les aptitudes à diffuser un discours religieux ‘modéré et éclairé’, à être les « ambassadeurs de la paix » et à faire valoir la véritable image de l’Islam dans le monde. »
Djelloul Seddiki explique par ailleurs qu’ils ont été choisis aussi sur le critère de leur savoir-faire : « Ils ont été choisi pour leur belle voix », nous dit-il, « pour faire plaisir aux fidèles ». »
J’ai aussi trouvé le site Atlantico qui a donné la parole à Alexandre del Valle qui est un géopolitologue et essayiste franco-italien et qui soutient plutôt cette initiative. « Un des pôles les plus modérés de l’Islam de France est depuis longtemps l’Islam algérien de la Grande Mosquée de Paris. »
Il précise que :
« La Mosquée de Paris avant cela était marocaine mais est depuis des décennies algérienne. Les imams de la Mosquée de Paris sont souvent nommés par l’Algérie, elle est co-financée par l’Algérie. Il est vrai, et on le constate, que ce n’est pas parce qu’un Islam est français qu’il est modéré. Il y a des salafistes, Français de troisième génération qui ne sont pas particulièrement financés par l’Arabie Saoudite, et inversement, des immigrés algériens qui sont parmi les plus modérés qu’on ait en France. Il n’y a donc pas de règles : ce n’est pas parce qu’on est Français qu’on est modéré et parce qu’on est étranger qu’on est radical. Aujourd’hui le plus grand lieu représentant d’un Islam tolérant et correct (même s’il y a des choses à critiquer), c’est la Mosquée de Paris et le réseau qu’elle dirige en France. »
Gérard Collomb parie sur la promotion d’un islam de «modération » et du « juste milieu» en France. Ce sont ses mots.
Plusieurs sites algériens parlent de cet accord.
Si les grands médias français, mis à part le Figaro n’en parle pas, en revanche les sites d’extrême droite comme résistance républicaine ou français de souche en parle abondamment pour dénoncer cette ingérence étrangère.
La réalité c’est qu’il n’y a pas suffisamment d’imams en France et qu’il faut donc faire appel à une main d’œuvre étrangère ou des voix étrangères.
Peu de publicité est faite sur ce sujet, le gouvernement a probablement peur d’aggraver les tensions.
Gérard Collomb a-t-il raison de parier sur la modération des imams algériens ?
Alexandre del Valle sur le site Atlantico nuance son propos optimiste à la fin de son entretien :
« C’est souhaitable. Mais les faits sont relativement différents. Autant je vous ai dit que la Mosquée de Paris est un pôle relativement modéré, en revanche en Algérie, la situation est différente. Les athées sont persécutés, on s’en prend à ceux qui ne fêtent pas le Ramadan, des lois sont venues renforcer la ségrégation des chrétiens, la conversion à une autre religion que l’Islam est interdite… Si l’Algérie était un havre de tolérance républicaine, cela se saurait. Cette volonté de l’Islam de Cordoue est peut-être la volonté de quelque personnes, mais dans les faits, même si l’Algérie combat l’islamisme politique et le terrorisme (et ce depuis la guerre civile), elle a connu un durcissement des conditions de vie des musulmans non-pratiquants, des autres croyants, des apostats.
Je pense donc que malheureusement, dans ces propos [du ministre algérien], il y a une part de double-jeu qui m’ennuie. »
<1053>
-
Lundi 9 avril 2018
« Nous allons vers une humanité à deux vitesses »Jacques TestartJacques Testart, né en 1939, est un biologiste français célèbre puisqu’il fût celui que Le MONDE appelle le père scientifique du premier bébé-éprouvette français né en 1982 et auquel on a donné le nom d’Amandine.
Il vient de publier un livre avec Agnès Rousseaux aux Editions du Seuil : « Au Péril de l’humain : les promesses suicidaires des transhumanistes »
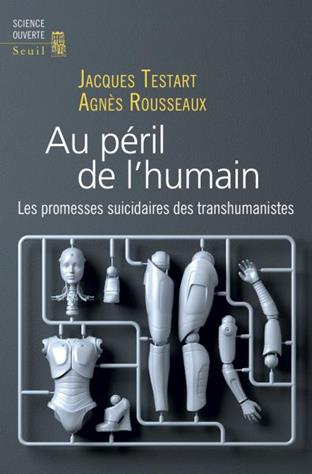 Ce livre est présenté ainsi sur le site des Editions du Seuil :
Ce livre est présenté ainsi sur le site des Editions du Seuil :
« Fabriquer un être humain supérieur, artificiel, voire immortel, dont les imperfections seraient réparées et les capacités améliorées. Telle est l’ambition du mouvement transhumaniste, qui prévoit le dépassement de l’humanité grâce à la technique et l’avènement prochain d’un « homme augmenté » façonné par les biotechnologies, les nanosciences, la génétique. Avec le risque de voir se développer une sous-humanité de plus en plus dépendante de technologies qui modèleront son corps et son cerveau, ses perceptions et ses relations aux autres. Non pas l’« homme nouveau » des révolutionnaires, mais l’homme-machine du capitalisme. »
Le MONDE a publié le 8 avril un entretien avec cet homme de science qui avoue sa méfiance à l’égard du libéralisme, on peut lire par exemple cet article de 2007 qu’il a rédigé : L’eugénisme au service du libéralisme, par Jacques Testart
Dans son nouvel ouvrage il s’attaque au transhumanisme et à ce qu’il appelle : « Les promesses suicidaires ».
Dans l’entretien avec du MONDE, il parle de sa première expérience dans laquelle il a été confronté aux dérives de la technoscience :
« . A la fac de biologie cellulaire où je suivais des cours, un prof qui s’appelait Charles Thibault m’avait à la bonne. Il m’a proposé de venir travailler sous contrat dans son labo de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), à Jouy-en-Josas (Yvelines). J’y suis entré en 1964, j’étais ravi ! […]
L’idée était de trouver un moyen de multiplier rapidement les vaches de haute qualité laitière. J’ai mis au point une méthode pour extraire des embryons de l’utérus de vaches « donneuses », puis pour les transplanter dans celui de « receveuses » – autrement dit de mères porteuses. Et en 1972, au moment où sont nés les premiers veaux issus de ces techniques, je me suis aperçu que c’était complètement idiot : la surproduction de lait européen provoquait la ruine des éleveurs, et on me payait pour augmenter la production laitière ! Je suis allé voir le directeur de l’INRA pour lui dire que j’étais scandalisé par ce qu’on m’avait fait faire. […].Plus encore qu’être en colère, j’avais honte. Pour les paysans. Et pour la science, qui s’écrivait pour moi avec un grand S. La science, cela se rapprochait de la philosophie, c’était une compréhension du monde. En fait, ce que j’aurais voulu faire, c’est le travail de Jane Goodall, observer les grands singes… C’est magnifique, ça ! Mais faire faire des petits à des vaches pour avoir plus de lait ? C’était de la technique, pas de la science. »
Il revient aussi sur la naissance d’Amandine ainsi que son conflit avec le Professeur gynécologue René Frydman avec lequel il a réussi cette avancée scientifique majeure. Cet évènement s’est déroulé à l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP), à Clamart (Hauts-de-Seine). L’équipe était dirigée par le chef de service Émile Papiernik, le professeur René Frydman en est le responsable clinique et le biologiste Jacques Testart le responsable scientifique. Jacques Testart raconte cette expérience et les leçons qu’il en a tiré ainsi :
« [J’ai eu] la chance de rencontrer Emile Papiernik, le patron du service de gynécologie de l’hôpital Antoine-Béclère, à Clamart, qui montait un laboratoire de recherche sur la stérilité. Il m’a proposé de venir travailler avec lui. Cela me permettait de fuir la recherche productiviste ! On était en 1977, et personne ne parlait alors de fécondation in vitro.
Et l’année suivante, en Grande-Bretagne, on annonce la naissance de Louise Brown, le premier « bébé-éprouvette »…
Et les gynécologues de Béclère, René Frydman au premier chef, me demandent de mettre au point la fécondation in vitro (FIV) chez l’humain, en m’appuyant sur mes connaissances en reproduction animale. J’ai dit oui tout de suite ! Utiliser la FIV pour pallier certaines stérilités, cela me semblait une belle mission. Dans ces années-là, j’ai publié comme jamais dans ma vie, jusqu’à deux articles par mois !
Mais déjà, il commençait à y avoir des tensions entre Frydman et moi. Il essayait de s’approprier le laboratoire comme si j’étais son technicien, ce que je ne supportais pas du tout. Et puis, il y a eu la grossesse d’Amandine. Et l’accouchement, je ne l’ai pas vécu. Je l’ai appris à 3 heures du matin par un coup de fil de Frydman, qui m’annonce que le bébé est sorti, que ça s’est très bien passé et qu’on a une conférence de presse à midi ! C’est comme ça que j’ai appris la naissance d’Amandine.
[…] Le battage médiatique qui a suivi la naissance d’Amandine nous a transformés – abusivement – en héros. On en rigolait ensemble, on allait dans des congrès à l’autre bout du monde… C’était assez confortable, bien sûr – sortir de la masse, c’est quelque chose qui fait plaisir à tout le monde. Mais en même temps, je trouvais que ce n’était pas mérité. Entre Frydman et moi, les choses ont continué de se dégrader au fil des ans. Nous avions monté un vrai laboratoire hospitalier, avec du bon matériel, mais nous étions de moins en moins souvent d’accord. Frydman voulait qu’on congèle les ovules, moi j’étais contre car, à l’époque, cela créait des anomalies chromosomiques… Nous avions beaucoup d’autres sources de conflits. Jusqu’à ce que j’apprenne, en 1990, que j’étais viré de l’hôpital Béclère. »
Malgré leurs divergences ils se sont retrouvés récemment dans les colonnes du Monde en cosignant une tribune avec une quarantaine de personnalités contre la gestation pour autrui (GPA).
Dans l’article du MONDE il raconte que très rapidement après la naissance d’Amandine il a commencé à s’inquiéter des retombées de la procréation médicalement assistée (PMA).
« J’ai été effaré du bruit qu’a fait cette naissance, je trouvais ça très exagéré. A la même époque, il y avait des recherches sur des souris ou des mouches beaucoup plus importantes ! Nous avions fait du beau boulot, cela nous avait demandé beaucoup de dévouement et un peu de jugeote, d’accord. Mais au niveau de la science, cet événement ne valait rien, d’autant que Robert Edwards l’avait fait quatre ans avant nous avec Louise Brown. Je me suis donc mis à cogiter. Et j’ai compris que l’événement, c’était de pouvoir voir ce futur bébé neuf mois avant sa naissance. De pouvoir voir à l’intérieur de l’œuf et d’intervenir au stade le plus précoce, avec la possibilité de modifier ou de trier les enfants à naître. J’ai écrit L’Œuf transparent (Flammarion, « Champs », 1986) pour raconter cela. Pour dire que ce que nous venions de réussir ouvrait la voie à un nouvel eugénisme, consensuel et démocratique.
[Après] les vaches laitières à l’INRA […] je me suis fait avoir deux fois de suite. J’avais travaillé pour des femmes dont les trompes étaient bouchées de manière irréversible, j’avais fait de la plomberie, et je n’avais pas réfléchi aux perspectives que cela ouvrait : faire naître des enfants qui non seulement n’ont pas certaines maladies graves, mais qui sont éventuellement choisis parmi plusieurs embryons pour certaines qualités.
Je me suis alors mis à lire des ouvrages sur l’eugénisme. Pas l’eugénisme bête et méchant du nazisme, mais un eugénisme « intelligent » à la Francis Galton, tel qu’il fut promu durant le premier tiers du XXe siècle en Scandinavie et aux Etats-Unis, avec la stérilisation massive d’individus considérés comme déviants… Cela faisait un peu froid dans le dos. Mes craintes n’étaient pas très partagées, beaucoup considéraient comme impossible de réaliser un diagnostic génétique sur un embryon de quelques cellules, mais l’avenir se chargea vite de leur donner tort : le diagnostic préimplantatoire fut mis au point par les Britanniques en 1990, et fut accepté par la première loi française de bioéthique dès 1994 ! »
Tout en dénonçant les dérives qu’il constatait, il a continué à aider des couples à avoir l’enfant qu’ils ne parvenaient pas à faire tout seuls, mais pas contribuer à faire autre chose que des bébés du hasard.
Et pour lui Le transhumanisme, c’est le nouveau nom de l’eugénisme :
« C’est l’amélioration de l’espèce par d’autres moyens que la génétique. C’est la perspective de fabriquer de nouveaux humains plus intelligents qui vont vivre trois siècles, quand les autres deviendront des sous-hommes. Et cette perspective, qui créera une humanité à deux vitesses, est en passe d’être acceptée par la société. »
Jacques Testart est devenu un lanceur d’alerte qui nous interpelle.
Je n’ai cité que des extraits de l’article du Monde qui devrait être lu entièrement : <LIEN>
Il a rédigé aussi une tribune dans <Le Parisien du 8 avril 2018>
<1052>
-
Vendredi 6 avril 2018
« Hedy Lamarr »Actrice, productrice de cinéma et inventrice autrichienne et américaineJe ne sais pas si vous connaissez Hedy Lamarr ou si vous en avez déjà entendu parler.
Hedy Lamarr était une femme extraordinaire dont le destin fut romanesque, flamboyant et finalement tragique.
Elle a fait l’objet de plusieurs articles de journaux récents parce qu’un documentaire retraçant sa vie vient de paraître.
 Mais commençant par une photo d’Hedy Lamarr au temps de sa splendeur rayonnante.
Mais commençant par une photo d’Hedy Lamarr au temps de sa splendeur rayonnante.
Pour ma part, j’ai entendu parler la première fois d’Hedy Lamarr lors d’une chronique de Xavier de la Porte, le 20 janvier 2017, consacrée au numérique.
Dans cette chronique, Xavier de la Porte a lui-même avoué qu’il avait découvert l’existence de cette femme étonnante que depuis peu.
Xavier de la Porte a commencé son propos en constatant et regrettant le peu de femmes connues dans les technologies et dans l’informatique pour introduire son sujet sur cette figure féminine époustouflante.
Pour présenter son apport à la technologie, Xavier de la Porte a dit :
« Hedy Lamarr est restée dans l’Histoire des technologies pour avoir inventé un système dont je vous livre la meilleure description que j’ai trouvée : « Elle proposa en 1941 un système secret de communication applicable aux torpilles radioguidées qui permettait au système émetteur-récepteur de la torpille de changer de fréquence, rendant pratiquement impossible la détection de l’attaque sous-marine par l’ennemi. Il s’agit d’un principe de transmission (étalement de spectre par saut de fréquence) toujours utilisé pour le positionnement par satellites (GPS…), les liaisons cryptées militaires, les communications des navettes spatiales avec le sol, la téléphonie mobile ou dans la technique Wifi ».
Le GPS et le Wifi se servent de l’invention d’Heddy Lamarr.
Notre ami Google, l’a bien compris et lui avait consacré un de ses fameux <doodle> pour son 101ème anniversaire le 9 novembre 2015.
Hedy Lamarr avait pour nom de naissance Hedwig Eva Maria Kiesler. Elle est née le 9 novembre 1914 à Vienne dans ce qui était encore l’Empire d’Autriche-Hongrie, puisqu’elle est née 2 jours avant la fin de la première guerre mondiale.
Elle est née dans une famille de religion juive, d’une mère roumaine et d’un père ukrainien. C’est une famille bourgeoise : son père est banquier et sa mère est pianiste. Elle attire vite l’attention par sa fascinante beauté.
Un documentaire de France Culture de février 2017 <la dame sans passeport d’Hollywood> nous apprend que « .Dès son enfance, elle a une révélation en voyant Metropolis de Fritz Lang et veut devenir actrice. Elle abandonne l’école pour travailler en Allemagne avec un metteur en scène de théâtre Max Reinhardt. »
Puis elle gagne Berlin en 1931 où elle commence à tourner un certain nombre de films, jusqu’à un film où une scène l’a rendue célèbre. C’est un film tchèque « Extase », elle a 18 ans et elle simule un orgasme à l’écran. C’est la première fois que le cinéma montre une telle scène qui bien sûr fait scandale, provoque la condamnation du Pape Pie XII, mais lui confine une immense notoriété.
On trouve tout sur internet, il est donc possible de visionner ce premier orgasme au cinéma : <Hedy Lamarr in Ekstase>
Elle fait un premier mariage avec un autrichien fasciste et important fabricant d’armes. Elle se forme alors technologiquement pour comprendre comment fonctionne les torpilles. Par la suite dégoutée des nombreuses visites de nazis qu’accueille son mari, elle s’enfuit et rencontre alors Louis B. Mayer, producteur de cinéma et fondateur de la célèbre Metro-Goldwyn-Mayer.
Voici comment Wikipedia raconte cette rencontre :
« Apparemment peu intéressé par Hedy, gêné par sa prestation dans Extase (selon l’intéressée), le magnat d’Hollywood lui propose un contrat peu avantageux (six mois d’essai et 150 dollars par semaine) qu’elle refuse. D’après ses propres dires, la future Hedy Lamarr travaille comme gouvernante du jeune violoniste prodige Grisha Goluboff avec qui elle s’embarque sur le Normandie. Durant la croisière (Cole Porter, qui écrira une chanson sur elle, figure entre autres parmi les passagers) Hedy Lamarr convainc Mayer de l’engager aux conditions qu’elle souhaite. »
C’est Louis B. Mayer qui lui demande de changer de nom pour celui d’Hedy Lamarr en hommage à une actrice du cinéma muet, Barbara La Marr.
Au cours de sa carrière cinématographique, elle a joué sous la direction des plus grands réalisateurs : King Vidor, Jack Conway, Victor Fleming, Jacques Tourneur, Marc Allégret, Cecil B. DeMille ou Clarence Brown.
Et c’est un journal Suisse, « Le Temps » qui en dit davantage sur son invention : <Hedy Lamarr, l’étoile d’Hollywood qui inventa les bases du Wi-Fi et du GPS> :
« Lors d’une soirée à Hollywood, le chemin d’Hedy Lamarr croise celui du compositeur et écrivain George Antheil. De leur rencontre naîtront des échanges non pas sur le cinéma mais à propos d’armement. Une industrie que l’actrice a côtoyée lors de son premier mariage et que le musicien maîtrise, ayant travaillé comme inspecteur des munitions aux États-Unis. Tous deux discutent des techniques de transmission radio avec les torpilles qui, à l’époque, n’étaient pas encore téléguidées. Le signal était sur une seule fréquence et pouvait donc être facilement brouillé ou intercepté.
Hedy Lamarr, âgée de 26 ans, et George Antheil réfléchissent pendant leur temps libre à une nouvelle technique qui permettrait un téléguidage plus sécurisé. En s’informant auprès d’un professeur en électronique de l’institut technologique Caltech à Los Angeles, l’idée leur vient d’envoyer le signal sur plusieurs bandes de fréquences entre l’émetteur et le receveur. Ils mettent au point une technique dite d’étalement de spectre qui émet l’information non pas sur une, mais quatre-vingt-huit fréquences, le nombre de touches du clavier d’un piano. La séquence d’émission est pseudo-aléatoire et reconnue par le récepteur qui la reconstitue. Le système est déposé au Bureau des brevets des USA le 10 juin 1941 et enregistré le 11 août 1942.
Sensibles à l’effort de guerre, les deux co-inventeurs cèdent immédiatement le brevet à l’armée américaine. Mais c’est seulement au début des années 1960, lors de la crise de Cuba et de la guerre du Vietman, que l’armée américaine a développé des applications pratiques de cette technologie dans la transmission radio. Le brevet est depuis tombé dans le domaine public et il a été utilisé pour mettre au point les techniques de base des signaux Wi-Fi ou de la géolocalisation par satellite, le fameux GPS! »
Le journal présente une reproduction de la première page du brevet US 2292387 déposé par Hedy Lamarr et George Antheil.

Le documentaire France Culture précise qu’Hedy Lamarr a rétroactivement reçu le prix de l’Electronic Frontier Foundation américaine en 1997 et a été admise avec George Antheil au National Inventors Hall of Fame en 2014.
Xavier de la Porte précise :
« Par ailleurs, elle était très belle, et grande séductrice. La liste des hommes avec lesquelles elle a eu des aventures est impressionnante. En sus de ses 6 mariages, je vous en donne une idée : Howard Hugues, John Kennedy, Franck Capa, Marlon Brandon, Errol Flynn, Orson Welles, Charlie Chaplin, Billy Wilder, Otto Preminger, James Stewart, Spencer Tracy, peut-être Clark Gable (mais il nie) et…. Jean-Pierre Aumont… Elle avait d’ailleurs quelques théories sur la question amoureuse et on lui attribue cette phrase : « En dessous de 35 ans, un homme a trop à apprendre, et je n’ai pas le temps de lui faire la leçon. »
Et sa carrière cinématographique ?
En 1946, la star se lance même dans la production indépendante. Elle connue alors des hauts et des bas. En 1949 elle joua son rôle le plus célèbre Dalila dans le péplum Samson et Dalila de Cecil B. DeMille inspiré du récit biblique. Elle tourna encore des films mais sa carrière s’acheva en 1957, l’année de la mort de Mayer qui la soutint beaucoup.
Et la fin ?
Un naufrage : ruinée par une succession d’échecs dans la production cinématographique et par sa vie dispendieuse, elle est condamnée pour vol à l’étalage à répétition et meurt dans le quasi anonymat en 2000, à l’âge de 85 ans.
Entretemps elle se soumit à des opérations de chirurgie esthétique qui l’enlaidirent beaucoup.
Un diaporama de photos montrent la beauté de cette femme jusqu’à une dernière où la chirurgie esthétique l’a abimé.
Elle fut élue « femme la plus belle du monde » mais elle dit : « N’importe quelle femme peut avoir du glamour. Il suffit de se tenir tranquille et d’avoir l’air idiot ».
J’ai trouvé aussi cette bd qui raconte une partie de sa vie sur un blog du Monde : http://lesculottees.blog.lemonde.fr/2016/09/19/hedy-lamarr-actrice-inventrice/
<Sciences et Avenir évoque le documentaire récent> qui justifie les nombreux articles consacrées à cette femme intelligente, belle et tragique.
<1051>
-
Jeudi 5 avril 2018
« Mais peu m’importe ce qui va m’arriver maintenant, car je suis allé jusqu’au sommet de la montagne. Je ne m’inquiète plus. »Martin Luther King, le 3 avril 1968 à MemphisIl s’en est passé des choses en 1968…
Le 4 avril 1968 à18h01, Martin Luther King est assassiné à Memphis dans le Tennessee. Il avait 39 ans.
Un article de Wikipedia est consacré à cet assassinat dont on n’a jamais trouvé les vrais coupables :
« Fin mars 1968, Martin Luther King se déplace à Memphis (Tennessee) pour soutenir les éboueurs noirs locaux qui sont en grève depuis le 12 mars afin d’obtenir un meilleur salaire et un meilleur traitement. Les Afro-Américains étaient payés 1,70 dollar de l’heure et n’étaient pas payés quand ils ne pouvaient pas travailler pour raison climatique, contrairement aux travailleurs blancs. Des violences éclatent autour des marches pacifiques, un jeune Afro-Américain est tué.
Le 3 avril, au Mason Temple, Martin Luther fait le discours prophétique « I’ve Been to the Mountaintop » (« J’ai été au sommet de la montagne ») devant une foule euphorique. […]
Le 4 avril 1968 à 18 h 1, Martin Luther King est assassiné alors qu’il se trouve sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis dans le Tennessee.[…] Il est déclaré mort au St. Joseph’s Hospital à 19 h 05.
L’assassinat provoque une vague d’émeutes raciales dans 60 villes des États-Unis (125 au total5) qui fait de nombreux morts et nécessite l’intervention de la Garde nationale.
Cinq jours plus tard, le président Johnson déclare un jour de deuil national, le premier pour un Afro-Américain, en l’honneur de Martin Luther King. 300 000 personnes assistent à ses funérailles. […]
[…] La ville de Memphis négocie la fin de la grève d’une manière favorable aux éboueurs après l’assassinat.
D’après le biographe Taylor Branch, l’autopsie de King révéla que bien qu’il ait seulement 39 ans, son cœur paraissait celui d’un homme âgé de 60 ans, montrant physiquement l’effet du stress de 13 ans dans le mouvement des droits civiques. Entre 1957 et 1968, King avait voyagé sur [des] millions de kilomètres, parlé en public plus de 2 500 fois, été arrêté par la police plus de vingt fois et agressé physiquement au moins quatre fois. »
Beaucoup d’émissions et d’articles ont été consacrés à la commémoration de cet évènement. Notamment les matins de France Culture du 4 avril ont été consacrés à Martin Luther King.
La situation des noirs a un peu évolué depuis 1968, mais il reste aux Etats-Unis toujours d’immenses inégalités dont les noirs sont les victimes, comme ils sont les victimes de la violence des blancs et des policiers. Le titre de l’émission était : « 50 ans après l’assassinat de Martin Luther King, le retour de la question noire ? »
Une des invités de l’émission a dit justement :
« La représentation du corps noir comme source d’angoisse et de criminalité est permanent dans l’histoire américaine. Le problème n’est pas le policier qui tue, le problème est l’ensemble des Blancs derrière leur bureau qui considèrent qu’il n’y a pas d’injustice. »
Christiane Taubira qui était une des invités de cette émission a expliqué :
« L’Amérique est toujours travaillée par ses vieux démons. On a cru que l’élection de Barack Obama correspondrait à une Amérique postraciale, lui-même a reconnu s’être trompé »
Mais ce qui m’a marqué lors de cette émission c’est d’avoir entendu un extrait du dernier discours de Martin Luther King : « J’ai été au sommet de la montagne », prononcé un jour avant son assassinat.
Ce discours vous le trouverez en intégralité traduit en français sur ce site : https://nofi.fr/2018/02/suis-alle-jusquau-sommet-de-montagne-dernier-discours-de-martin-luther-king/37614
<Vous trouverez ici une version audio de ce discours>
<Ici un extrait vidéo de la fin de ce discours>
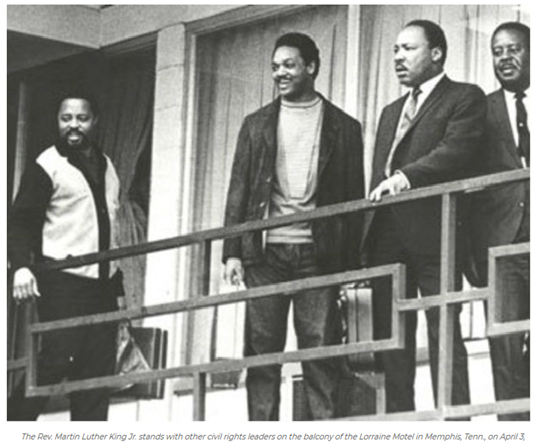 Martin Luther King est un militant de la non-violence, il est révolté par les injustices et il est du côté de celles et ceux qui combattent pour leurs droits sociaux.
Martin Luther King est un militant de la non-violence, il est révolté par les injustices et il est du côté de celles et ceux qui combattent pour leurs droits sociaux.
Mais il est aussi un Pasteur, il est croyant et sa Foi chrétienne se rencontre souvent dans son discours dont je voudrais partager quelques extraits aujourd’hui :
« Notre nation est malade. Le pays est en proie à des troubles. La confusion règne partout. C’est là une demande bizarre. Mais d’une façon ou d’une autre, vous ne voyez les étoiles que s’il fait assez noir pour cela. Et je vois Dieu à l’œuvre, en cette période du XXè siècle.
Quelque chose est en train d’arriver à notre monde. Les masses populaires se dressent. Et partout où elles s’assemblent aujourd’hui – que ce soit à Johannesburg, en Afrique du Sud, à Nairobi, au Kenya, à Accra, au Ghana, dans la ville de New York, à Atlanta, en Géorgie, à Jackson, au Mississippi, ou à Memphis, dans le Tennessee – le cri est toujours le même: « Nous voulons être libres. » Et une autre raison pour laquelle je suis heureux de vivre à notre époque, c’est que nous nous trouvons, par force, à un point où il faudra nous colleter avec les problèmes que les hommes ont tenté d’empoigner pendant toute leur histoire, sans que l’urgence soit telle qu’ils s’y trouvent forcés. Mais il y va maintenant de notre survie. Les hommes depuis des années déjà parlent de la guerre et de la paix.
Désormais, ils ne peuvent plus se contenter d’en parler; ils n’ont plus le choix entre la violence et la non-violence en ce monde; c’est la non-violence ou la non-existence. Voilà où nous en sommes aujourd’hui.
Il en va de même pour ce qui concerne la révolution en faveur des droits de l’homme: si rien n’est fait de toute urgence dans le monde entier pour sortir les peuples de couleur de leurs longues années de pauvreté, des longues années pendant lesquelles ils ont été maltraités et laissés à l’abandon, c’est le monde entier qui ira à sa perte. Aussi suis-je heureux que Dieu m’ait permis de vivre à notre époque pour voir ce qui s’y passe. Et je suis heureux qu’il m’ait accordé de me trouver aujourd’hui à Memphis.»
Et puis il évoque le sujet pour lequel il se trouve à Memphis : la défense des éboueurs noirs et il en appelle au combat social :
« Nous devons nous donner à ce combat jusqu’au bout. Rien ne serait plus désastreux que de nous arrêter en chemin, à Memphis.
Nous devons en finir. Quand nous aurons notre manifestation, il faut que vous y participiez. Même si cela signifie que vous devez planter là votre travail, même si cela signifie que vous devez sécher l’école, soyez présents. Pensez à vos frères. Vous pouvez ne pas faire grève.
Mais ou bien nous progresserons tous ensemble, ou bien nous coulerons tous ensemble. »
Puis il évoque la parabole du bon samaritain à laquelle j’avais consacré le mot du jour du 8 mars 2017. Et il conclut à la fin du récit évangélique :
« Vous savez, il est possible que le prêtre et le lévite aient vu cet homme allongé et se soient demandé si les brigands n’étaient pas encore dans les parages. Peut-être même ont-ils cru que l’homme faisait seulement semblant. Qu’il feignait d’avoir été dévalisé et blessé pour les piéger sur-le-champ, les tromper pour se saisir d’eux tout soudain et plus aisément. (Oh oui.) Aussi la première question que le lévite avait posée était-elle: «Si je m’arrête pour aider cet homme, que va-t-il m’arriver? »
Mais le Bon Samaritain était alors passé. Et il avait posé la question à l’envers: «Si je ne m’arrête pas pour aider cet homme, que va-t-il lui arriver ? » Telle est la question qui se pose à vous ce soir. Ce n’est pas: «Si je m’arrête pour aider les éboueurs, que va-t-il en être de mon travail ?» Ce n’est pas: «Si je m’arrête pour aider les éboueurs, que va-t-il en être de toutes ces heures que j’ai l’habitude de passer à mon bureau de pasteur chaque jour et chaque semaine? » La question n’est pas: «Si je m’arrête pour aider cet homme dans le besoin, que va-t-il m’arriver ? » Elle est: «Si je ne m’arrête pas pour aider les éboueurs, que va-t-il leur arriver? » Voilà la question.
Dressons-nous ce soir avec plus encore d’empressement. Levons-nous avec une plus grande détermination. Marchons, en ces jours décisifs, en ces jours de défi, pour faire de l’Amérique ce qu’elle doit être. Nous avons une chance de faire de l’Amérique une nation meilleure. Et je veux remercier Dieu, une fois encore, de m’avoir permis d’être ici avec vous. »
Il raconte alors un épisode de sa vie, une des premières tentatives d’assassinat et une lettre d’une jeune fille qui l’a ému :
« Vous savez, il y a plusieurs années, j’étais à New York, en train de dédicacer le premier livre que j’avais écrit. Et pendant que j’étais assis, en train de dédicacer des livres, une femme noire, une démente, a surgi. La seule question que j’ai entendue de sa bouche a été: «Êtes-vous Martin Luther King? » Sans lever les yeux de ce que j’étais en train d’écrire, j’ai répondu: «Oui. » Et la minute d’après j’ai senti un coup dans la poitrine. Avant même de m’en rendre compte, j’avais été poignardé par cette démente.
J’ai été rapidement expédié à l’hôpital de Harlem. C’était par un sombre après-midi de samedi. Et cette lame m’avait traversé. Et les rayons X ont révélé que la pointe de la lame avait frôlé l’aorte, la principale artère. Une fois que celle-ci est perforée, votre propre sang vous étouffe; c’en est fini de vous. Le New York Times du lendemain matin disait que si j’avais éternué, je serais mort.
Eh bien, quatre jours plus tard environ, après l’opération, après que ma poitrine eut été ouverte et que la lame eut été extraite, on me permettait déjà de me promener dans une chaise roulante à l’intérieur de l’hôpital. On me permettait de lire une partie du courrier qui me parvenait; de tous les États-Unis et de toutes les parties du monde me parvenaient des lettres pleines de gentillesse. J’en ai lu un bon nombre, mais il en est une que je n’oublierai jamais. J’avais reçu des messages du président et du vice-président. J’ai oublié ce que disaient ces télégrammes. J’avais reçu la visite et une lettre du gouverneur de l’État de New York, mais j’ai oublié ce que disait sa lettre.
Mais il y avait une autre lettre qui venait d’une petite fille, d’une jeune fille, une élève du lycée de White Plains. Et j’ai regardé cette lettre, et je ne l’oublierai jamais. Elle disait seulement: «Cher pasteur King, je suis en seconde au lycée de White Plains. » Elle disait: « Bien que cela ne devrait pas compter, je voudrais mentionner que je suis blanche. l’ai appris par le journal le malheur qui vous est arrivé et combien vous souffrez. Et j’ai lu que si vous aviez éternué vous seriez mort. Et je vous écris simplement pour vous dire que je suis bien heureuse que vous n’ayez pas éternué. » Je veux vous dire que je suis heureux, moi aussi, de ne pas avoir éternué. Car si j’avais éternué, je n’aurais pas été là en 1960 quand les étudiants ont commencé à occuper, dans tout le Sud, les comptoirs des lieux de restauration. Et je savais que s’ils s’asseyaient devant ces comptoirs, ils n’en étaient pas moins debout, dressés pour ce qu’il y avait de meilleur dans le rêve américain; et je savais qu’ils ramenaient toute la nation aux grandes sources de la démocratie, profondément creusées dans le sol par les pères fondateurs, auteurs de notre Déclaration d’indépendance et de notre Constitution. »
Et enfin, il conclut dans un message prophétique et prémonitoire quand on sait ce qui va se passer un jour après :
« J’ai quitté Atlanta ce matin; au moment du décollage de l’appareil, nous étions six, le pilote nous a dit par l’interphone: «Nous sommes désolés d’avoir du retard, mais nous avons le pasteur Martin Luther King à bord. Et pour être sûrs que tous les sacs avaient été examinés, pour être sûrs que rien de mal n’arriverait à l’avion, il nous a fallu tout vérifier soigneusement. Nous avons fait surveiller l’appareil toute la nuit. » Et je suis arrivé à Memphis. Certains commençaient à énumérer ou à commenter les menaces qui circulaient. Et ce que voulaient me faire certains de nos frères blancs dont l’âme était malade.
Eh bien, je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Nous avons devant nous des journées difficiles. Mais peu m’importe ce qui va m’arriver maintenant, car je suis allé jusqu’au sommet de la montagne. Je ne m’inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. La longévité a son prix. Mais je ne m’en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Et il m’a permis d’atteindre le sommet de la montagne. J’ai regardé autour de moi. Et j’ai vu la Terre promise. Il se peut que je n’y pénètre pas avec vous. Mais je veux vous faire savoir, ce soir, que notre peuple atteindra la Terre promise. Ainsi je suis heureux, ce soir. Je ne m’inquiète de rien. Je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. »
C’est admirable ! Ce combat continue.
Aujourd’hui c’est probablement le mouvement « Black Lives Matter »(BLM), qui se traduit en français par « les vies des Noirs comptent » qui poursuit le chemin entamé par ce grand homme qu’était Martin Luther King.
 Tombe de Martin Luther King et de son épouse Coretta à Atlanta sur laquelle on peut lire « Free at last » (Enfin libre).
Tombe de Martin Luther King et de son épouse Coretta à Atlanta sur laquelle on peut lire « Free at last » (Enfin libre).
<1050>
-
Mercredi 4 avril 2018
« La hausse de la morbidité et de la mortalité des Américains blancs non hispaniques à mi-vie au XXIe siècle.»Anne Case et Angus DeatonPlusieurs intellectuels ont souligné ce phénomène régressif aux Etats-Unis : l’augmentation de la mortalité d’une certaine partie de la population des Etats-Unis.
Deux articles du journal « Les Echos » ont attiré mon attention :
- Un article récent du 22 mars : « L’effroyable délitement de la société américaine » écrit par Thomas Philippon / professeur de finance à la Stern Business School ;
- Un article un peu plus ancien du 16/11/2017 : « L’inquiétante augmentation de la mortalité aux Etats-Unis » écrit par François Bourguignon qui est professeur à Paris School of Economics.
Ces deux articles renvoient vers un article américain de 2015 d’un couple de professeurs de Princeton Anne Case et Angus Deaton : « La hausse de la morbidité et de la mortalité des Américains blancs non hispaniques à mi-vie au XXIe siècle »
Angus Deaton avait obtenu le Prix Nobel d’Economie de 2015. C’est un spécialiste de la consommation, la pauvreté, le développement et la mesure du bien-être
Cet article avait été commenté par Sylvie Kauffmann dans le Monde : « La vague de morts de désespérance a continué de déferler sur l’Amérique blanche »
Vous disposez ainsi de toutes mes sources…
Le point de départ est que parmi les pays développés, les Etats-Unis se singularisent par un phénomène surprenant : une hausse de la mortalité à des âges intermédiaires depuis le tournant du millénaire, hausse suffisamment importante pour affecter négativement l’espérance de vie.
Beaucoup font le rapprochement entre cette évolution et une autre particulièrement marquée aux Etats-Unis : le niveau élevé et en progression continue de l’inégalité des revenus.
Anne Case et Angus Deaton font remarquer que cette évolution touche une partie précise de la population : des Blancs âgés de 45 à 54 ans dont l’éducation ne dépasse pas le secondaire.
La mortalité se situe autour de 400 pour cent mille et augmente régulièrement depuis la fin des années 1990. Case et Deaton font marquer qu’à tout âge, la mortalité poursuit sa diminution séculaire pour les populations afro-américaines et hispaniques et pour les personnes disposant d’un niveau supérieur d’éducation. Il ne s’agit donc pas d’un effet direct de revenu puisque les Noirs et les Hispaniques ont connu les mêmes chocs économiques que les Blancs moins éduqués.
D’ailleurs, dans tous les autres pays riches, au contraire, le taux de mortalité de cette population diminue et se situe aujourd’hui entre 200 et 300 pour cent mille, notamment grâce aux progrès de la lutte contre le cancer et les maladies cardio-vasculaires. Dans les années 1990, elles étaient de 30 pour cent mille en Amérique contre 60 en France ; elles sont maintenant de 80 pour cent mille contre 45 en France.
Case et Deaton émettent l’hypothèse que « La hausse de la mortalité se doit principalement à une augmentation des décès qualifiés de mort par désespoir ». Les causes de décès sont le suicide, l’alcoolisme et la drogue.
Thomas Philippon évoque le fonctionnement du système de santé et la surprescription d’opioïdes. Cette surprescription est en partie responsable d’une épidémie pire que celle du crack des années 1980. La mortalité due au crack était de 2 pour cent mille, celle due aux opioïdes dépassent 10 et atteint 40 pour cent mille en Virginie-Occidentale. Certes, les morts de désespoir existaient avant l’introduction de l‘OxyContin, mais les opioïdes ont dramatiquement accéléré le processus. « La participation au marché du travail a plus chuté dans les régions où la sur-prescription d’opioïdes est plus forte »
François Bourguignon est plus précis sur les raisons profondes de ce phénomène tel que l’analyse Case et Deaton :
« Ce n’est pas l’inégalité croissante des revenus mesurée en chaque point du temps qui est cause de la hausse de la mortalité, mais plus probablement une modification de la distribution des perspectives professionnelles et sociales d’une génération à une autre, elle-même possiblement le résultat de la mondialisation et du changement technique. »
Et François Bourguignon conclut son article de la manière suivante :
« Dans ce cadre intergénérationnel, l’analyse statistique révèle un facteur évolutif commun à la progression des suicides, de l’alcoolisme, de certaines affections physiques, notamment les douleurs articulaires et les sciatiques, des dépressions, de l’isolement familial, mais aussi, et surtout, au retrait du marché du travail et à la baisse des salaires non-qualifiés. […] Au total, Case et Deaton voient cet ensemble de phénomènes comme l’expression de l’effondrement au début des années 1970 de la classe ouvrière américaine, alors à son apogée.
Ils ont probablement raison et l’on ne peut s’empêcher de rapprocher cette conclusion du populisme de Donald Trump clamant sa volonté de rapatrier l’industrie américaine et ses « jobs » disparus. Il a réussi à convaincre une large part de la classe ouvrière par ce discours. Mais, bien sûr, ces jobs ne reviendront pas.
Alan Krueger a récemment analysé le déclin de la participation sur le marché du travail américain. Le taux de participation, qui était de 67,3 % en 2000, est tombé à 62,4 % en 2015. Parmi les pays de l’OCDE, seule l’Italie a un taux de participation plus faible que celui des Etats-Unis. Si l’on se penche sur les hommes en âge de travailler mais qui sont sans emploi, on observe que la moitié d’entre eux prend tous les jours des médicaments contre la douleur.
Globalement, la participation au marché du travail a plus chuté dans les régions où la surprescription d’opioïdes est plus forte. Chez les femmes, la participation a cessé d’augmenter et stagne à un niveau plus faible que dans les autres pays développés. La crise du travail et l’épidémie d’opioïdes s’entremêlent.
On s’aperçoit aujourd’hui de la difficulté immense à faire machine arrière. Confrontées à la crise sanitaire, les autorités ont limité l’accès aux opioïdes. Mais ces restrictions ont poussé les usagers à se tourner vers d’autres drogues. On estime que plus d’un demi-million d’Américains sont accros à l’héroïne et que 80 % d’entre eux ont commencé par abuser des opioïdes. De fait, des chercheurs ont pu relier l’augmentation spectaculaire des overdoses par héroïne aux restrictions imposées sur l’OxyContin.
Et la cerise sur le gâteau empoisonné s’appelle fentanyl, un opioïde de synthèse beaucoup plus puissant que la morphine, souvent mélangé avec l’héroïne. Les overdoses par fentanyl ont augmenté de 540 % depuis 2015, dont celle du chanteur Prince en 2016. Un kilogramme de fentanyl s’achète entre 3.000 et 5.000 dollars en Chine, transite par le Mexique et se revend pour 1,5 million de dollars. Dans ces conditions, briser le cercle vicieux est très difficile.
La leçon politique est claire : surtout ne pas mettre le doigt dans l’engrenage. Les pays européens sont mieux protégés par leurs traditions sociales et leurs systèmes de santé, mais la vigilance est indispensable. »
Que retenir de tous ces éléments ?
Que dans une société de consommation et du travail être privé ou se sentir privé d’utilité sociale est une cause de désespoir. La société de consommation a encore une solution à proposer à ce désespoir : des drogues et des médicaments.
Ce sont les blancs qui avaient été habitués à dominer le monde, même par procuration d’autres blancs plus fortunés pour qui cette situation est la plus pénible.
Dans ce cadre, l’élection de Trump par ces catégories de blancs n’est pas un accident mais une conséquence logique d’un système social à la dérive et d’un individualisme forcené.
Mais les électeurs de Trump sont-ils conscients de la part que l’individualisme libéral joue dans leur malheur ?
<1049>
- Un article récent du 22 mars : « L’effroyable délitement de la société américaine » écrit par Thomas Philippon / professeur de finance à la Stern Business School ;
-
Mardi 3 avril 2018
« La liberté se confond avec le bonheur et le courage avec la liberté ! »Périclès rendant hommage aux morts athéniens pendant la guerre du PéloponnèseLe Président de La République, Emmanuel Macron a décrit, dans son hommage aux Invalides, les conditions dans lesquelles le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a accepté de prendre la place de l’otage que détenait le terroriste islamiste :
«Il était environ onze heures ce vendredi 23 mars 2018, lorsque le lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME s’est présenté avec ses hommes devant la grande surface de Trèbes dans l’Aude. Un quart d’heure seulement leur avait suffi pour être sur les lieux. Que savait-il à ce moment-là du terroriste qui s’y était retranché ? Il savait qu’il avait un peu plus tôt tué le passager d’un véhicule, Jean-Michel MAZIERES, et grièvement blessé son conducteur Renato GOMES DA SILVA. Qu’il avait fait feu sur des CRS aux abords de leur caserne et blessé l’un d’entre eux à l’épaule, le brigadier Frédéric POIROT. Que dans ce commerce où il s’était retranché il avait abattu deux hommes à bout portant : Hervé SOSNA, un client, et Christian MEDVES, le chef boucher. Nous pensons en cet instant à ces blessés, à ces morts, nos morts, et à leurs familles dans le recueillement.
Il savait aussi que le terroriste détenait une employée en otage. Qu’il se réclamait de cette hydre islamiste qui avait tant meurtri notre pays. Qu’avide de néant ce meurtrier cherchait la mort. Cherchait sa mort. Cette mort que d’autres avant lui avaient trouvée. Une mort qu’ils croyaient glorieuse, mais qui était abjecte : une mort qui serait pour longtemps la honte de sa famille, la honte des siens et de nombre de ses coreligionnaires ; une mort lâche, obtenue par l’assassinat d’innocents.
L’employée prise en otage était de ces innocents. Pour le terroriste qui la tenait sous la menace de son arme, sa vie ne comptait pas, pas plus que celle des autres victimes. Son sort sans doute allait être le même. Mais cette vie comptait pour Arnaud BELTRAME. Elle comptait même plus que tout car elle était comme toute vie la source de sa vocation de servir.
Accepter de mourir pour que vivent des innocents, tel est le cœur de l’engagement du soldat. Être prêt à donner sa vie parce que rien n’est plus important que la vie d’un concitoyen, tel est le ressort intime de cette transcendance qui le portait. Là était cette grandeur qui a sidéré la France. Le lieutenant-colonel BELTRAME avait démontré par son parcours exceptionnel que cette grandeur coulait dans ses veines. Elle irradiait de sa personne. Elle lui valait l’estime de ses chefs, l’amitié de ses collègues et l’admiration de ses hommes.
A cet instant toutefois d’autres, même parmi les braves, auraient peut-être transigé ou hésité. Mais le lieutenant-colonel BELTRAME s’est trouvé face à la part la plus profonde et peut-être la plus mystérieuse de son engagement. Il a pris une décision qui n’était pas seulement celle du sacrifice, mais celle d’abord de la fidélité à soi-même, de la fidélité à ses valeurs, de la fidélité à tout ce qu’il avait toujours été et voulu être, à tout ce qui le tenait. »
Arnaud Beltrame est un héros.
Certains voudraient faire de toutes les victimes du terrorisme des héros, mais ce n’est pas le cas. Les victimes sont des victimes, elles sont assassinées parce que les terroristes islamistes les considèrent comme faisant partie de la communauté de leurs ennemis.
La nation française doit leur rendre hommage parce que c’est en raison de leur appartenance à notre nation qu’elles ont été tuées, qu’à travers leur mort chacun de nous a été atteint. Il faut entourer leurs proches, aider les blessés, accompagner positivement les uns et les autres dans la compassion, dans l’entraide et dans la fraternité de notre devise, car elles ont été atteints dans leur chair en tant que frère dans la nation.
Mais ce ne sont pas des héros. Arnaud Beltrame est un héros.
C’est un héros, parce que sachant ce qu’il savait, il a agi pour prendre la place d’une otage et connaissant l’instinct de mort de l’ignoble individu qui se trouvait dans le supermarché, il savait que le risque pour lui de mourir était immense.
Il a accepté ce risque, parce qu’il croyait à des valeurs qui étaient plus importantes que sa vie, que la conservation de sa vie.
<Mohammed Merah a dit : moi la mort je l’aime comme vous aimez la vie>
Il semblerait que Ben Laden dans une de ses diatribes contre l’Occident aurait écrit : « Nous vous avons préparé des hommes qui aiment la mort autant que vous aimez la vie. »
Toujours est-il que dans l’idéologie de ces criminels illuminés leur premier objectif est de donner la mort fusse-ce au prix de leur mort. Ils prétendent aimer la mort.
 Arnaud Beltrame aimait la vie jusqu’au point de donner la sienne pour en sauver une autre. C’est une réponse immense, extraordinaire à la folie de nos ennemis : « Vous recherchez la mort pour donner la mort, il en est parmi nous qui sont capable de mourir pour sauver des vies ».
Arnaud Beltrame aimait la vie jusqu’au point de donner la sienne pour en sauver une autre. C’est une réponse immense, extraordinaire à la folie de nos ennemis : « Vous recherchez la mort pour donner la mort, il en est parmi nous qui sont capable de mourir pour sauver des vies ».
Parce qu’il existe des combats qui sont plus grands que nous, des causes plus grandes que notre vie.
Nous ne savons pas individuellement si nous serions capables de ce courage dans de telles circonstances.
Celui qui prouve ce courage est un héros.
C’est pourquoi le Colonel Arnaud Beltrame en est un.
C’est Thierry Pech, directeur général du think tank Terra nova, lors de l’émission l’Esprit Public du dimanche de Pâques qui a cité les mots de Périclès mis en exergue de ce mot du jour :
« La réponse que cet homme a apportée aux islamistes est la plus terrible qui ait été apportée jusqu’à présent.Ils croient que nous ne croyons en rien. Ils pensent qu’eux seuls ont le courage de sacrifier leur vie pour leur cause.
Et ils ont eu devant eux un sacrifice démocratique. Ils ont eu un martyr pour la vie, non pas un martyr pour la mort.
Il faut bien sûr célébrer le courage de cet homme.
Il faut célébrer cette idée que la démocratie est plus grande que nous et qu’elle mérite qu’on aille jusqu’à là, jusqu’au sacrifice ultime. »
Et il cite Périclès qui rend hommage aux morts athéniens :
« Sachez que chez nous la liberté se confond avec le bonheur, et le courage avec la liberté ! »
Propos rapportés par le grand historien grec, Thucydide, dans la Guerre du Péloponnèse.
Et vous pouvez trouver l’intégralité de la traduction de la Guerre du Péloponnèse de Thucydide sur Internet.
L’extrait dont parle Thierry Pech se trouve dans le Livre II au chapitre XLIII. Voici ce chapitre : . –
« C’est ainsi qu’ils se sont montrés les dignes fils de la cité. Les survivants peuvent bien faire des voeux pour obtenir un sort meilleur, mais ils doivent se montrer tout aussi intrépides à l’égard de l’ennemi ; qu’ils ne se bornent pas à assurer leur salut par des paroles. Ce serait aussi s’attarder bien inutilement que d’énumérer, devant des gens parfaitement informés comme vous l’êtes, tous les biens attachés à la défense du pays. Mais plutôt ayez chaque jour sous les yeux la puissance de la cité ; servez -la avec passion et quand vous serez bien convaincus de sa grandeur, dites-vous que c’est pour avoir pratiqué l’audace, comme le sentiment du devoir et observé l’honneur dans leur conduite que ces guerriers la lui ont procurée. Quand ils échouaient, ils ne se croyaient pas en droit de priver la cité de leur valeur et c’est ainsi qu’ils lui ont sacrifié leur vertu comme la plus noble contribution. Faisant en commun le sacrifice de leur vie, ils ont acquis chacun pour sa part une gloire immortelle et obtenu la plus honorable sépulture. C’est moins celle où ils reposent maintenant que le souvenir immortel sans cesse renouvelé par les discours et les commémorations. Les hommes éminents ont la terre entière pour tombeau. Ce qui les signale à l’attention, ce n’est pas seulement dans leur patrie les inscriptions funéraires gravées sur la pierre ; même dans les pays les plus éloignés leur souvenir persiste, à défaut d’épitaphe, conservé dans la pensée et non dans les monuments. Enviez donc leur sort, dites-vous que la liberté se confond avec le bonheur et le courage avec la liberté et ne regardez pas avec dédain les périls de la guerre. Ce ne sont pas les malheureux, privés de l’espoir d’un sort meilleur, qui ont le plus de raisons de sacrifier leur vie, mais ceux qui de leur vivant risquent de passer d’une bonne à une mauvaise fortune et qui en cas d’échec verront leur sort complètement changé. Car pour un homme plein de fierté, l’amoindrissement causé par la lâcheté est plus douloureux qu’une mort qu’on affronte avec courage, animé par l’espérance commune et qu’on ne sent même pas. »
Jean-Luc Melenchon a eu des paroles lumineuses, comme il sait parfois les porter, à l’Assemblée nationale :
« Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a remis le monde humain en ordre. Il a assumé la primauté d’un altruisme absolu : celui qui prend pour soi la mort possible de l’autre, illustrant ainsi les valeurs de foi et de philosophie auxquelles il était attaché personnellement. En ce sens, le lieutenant-colonel Beltrame est un héros de la condition humaine. »
 Robert Badinter, du haut de la sagesse de ses 90 ans a rendu cet hommage au Colonel Beltrame
Robert Badinter, du haut de la sagesse de ses 90 ans a rendu cet hommage au Colonel Beltrame
« Que le colonel Beltrame soit mort en héros, les hommages et les larmes de tant de Français de toutes origines et de toutes conditions l’ont proclamé. Un héros est en effet celui qui accepte de donner sa vie pour servir son idéal. Mais au-delà de cette grandeur, on doit s’interroger sur le sens de ce sacrifice, sur la cause pour laquelle il choisit de mourir, car il est des causes qui font horreur.
Ainsi en est-il du terrorisme. Le jihadiste qui se fait exploser au milieu de ces victimes innocentes commet un acte monstrueux. Mais pour les partisans de son idéologie, il est un martyr. Assassin pour nous, martyr pour les siens : c’est pourtant du même homme et du même acte dont il s’agit.
Dès lors, s’agissant de notre héros le colonel Beltrame, il faut, pour prendre la mesure de son sacrifice, dégager le sens de son action. Le colonel Beltrame est mort parce qu’il a donné sa vie pour sauver d’autres vies. C’est la plus noble expression de la fraternité. Son sacrifice est à l’opposé du crime du jihadiste, qui meurt pour que d’autres êtres humains périssent avec lui ou à cause de lui.
Comme les fascistes espagnols, hurlant jadis dans les ruines de Tolède « Viva la muerte ! », c’est au culte de la mort que le jihadiste se voue. Le colonel Beltrame, lui, agit à l’opposé. C’est pour épargner la vie d’innocents qu’il a donné la sienne. Que son souvenir demeure vivant à travers les générations. Il a servi la cause de l’humanité toute entière. Merci, mon colonel ! »
Oui Merci mon colonel, d’avoir remis le monde humain en ordre.
<1048>
-
Jeudi 29 mars 2018
« Carême »Période de jeûne et d’abstinence de quarante joursPour tous ceux qui ont une culture religieuse chrétienne « le temps de carême » est bien connu. Mais pour les autres ?
Le plus simple serait, semble t’il, de comparer : Le carême est le ramadan des chrétiens.
Mais comment dire ou écrire cela, aujourd’hui en France …
- Certains réagiront de manière sereine :il faut bien expliquer les choses avec des notions actuelles, des références connues !
- D’autres seront effarés, scandalisés : Comment peut-on, en terre chrétienne, définir un des moments forts du calendrier chrétien par une référence islamique !
Alors parlons de Carême, sans faire référence à l’Islam.
Nous sommes Jeudi 29 mars 2018, dimanche ce sera Pâques et donc demain nous serons vendredi saint, jour férié en Allemagne, dans les pays protestants et en Alsace Moselle.
Le jour précédent Vendredi Saint est aussi saint. Nous sommes donc Jeudi Saint, dernier jour de Carême comme le dit le site des Évêques de France.
Ce qui contredit ce site et même le journal « La Croix » et beaucoup d’autres sites qui prétendent que Carême s’arrête le dimanche de Pâques.
Nous savons donc que le carême finit Jeudi Saint, mais quand commence t’il ?
Cette année, selon le site des évêques de France, Carême a commencé le 14 février. A quoi correspondait ce 14 février ?
Dans l’année liturgique chrétienne, c’est le Mercredi des Cendres. Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle.
C’est encore le site des Évêques de France qui donne des explications sur la symbolique des cendres:
« On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l’être. On peut y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence.
[…] La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, précisément par le chemin de l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s’est emparé. Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit. C’est l’image de notre pauvreté. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les cendres. »
Avant mercredi des cendres, il y a mardi gras. Mardi gras est une période festive, qui marque la fin de la « semaine des sept jours gras ». La semaine des sept jours gras qui, elle, termine la période Carnaval. Carnaval qui est un emprunt à l’italien carnevale ou carnevalo. Il a pour origine carnelevare, un mot latin formé de carne « viande » et levare « enlever ». Mais je ferais probablement un mot du jour sur carnaval.
Ici ce qui est important c’est de faire le lien entre la nourriture grasse et la viande jusqu’à mardi gras qui est le summum de cette période et auquel succède le Mercredi des cendres et le carême, où les chrétiens sont invités à « manger maigre » en s’abstenant de viande.
Carême a commencé le 14 février et se termine donc aujourd’hui le Jeudi 29 mars 2018. Si vous comptez le nombre de jours vous aboutirez à 44 jours. Pourtant, il est écrit partout que le Carême dure 40 jours.
Mais, si on en revient au site de référence des Évêques nous pouvons lire :
La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier référence aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements.
Nous comprenons donc qu’il faut enlever les dimanches. Seulement vous constaterez que pendant cette période il y a 6 dimanches. 44 – 6 donne 38, nous ne sommes toujours pas à 40.
Fernand Braudel disait : «en Histoire les choses sont toujours vraies à peu près», probablement qu’en religion il en va de même.
Pourquoi Quarante ? Comme l’explique le site des évêques cette durée fait référence aux quarante jours où Jésus serait resté dans le désert pour résister aux tentations de Satan. C’est ainsi que l’histoire chrétienne le raconte. Et ce chiffre quarante fait lui-même référence à un autre épisode mythique de l’histoire biblique : les quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise.
Rappelons que la Pâque juive, « Pessa’h », célèbre justement l’Exode des juifs hors d’Égypte. Or le Christ serait venu à Jérusalem pour fêter la Pâque Juive et c’est ainsi qu’il aurait institué la « Sainte Cène » où il a partagé le pain et le vin avec ses disciples. Cet épisode se serait passé Jeudi Saint. Léonard de Vinci a immortalisé ce « moment culte » comme on dirait aujourd’hui. Il me semble que cette expression est particulièrement appropriée pour ce que De Vinci a peint.
Cette peinture murale a été réalisée de 1495 à 1498 pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan et était une commande de Ludovic Sforza, Duc de Milan.
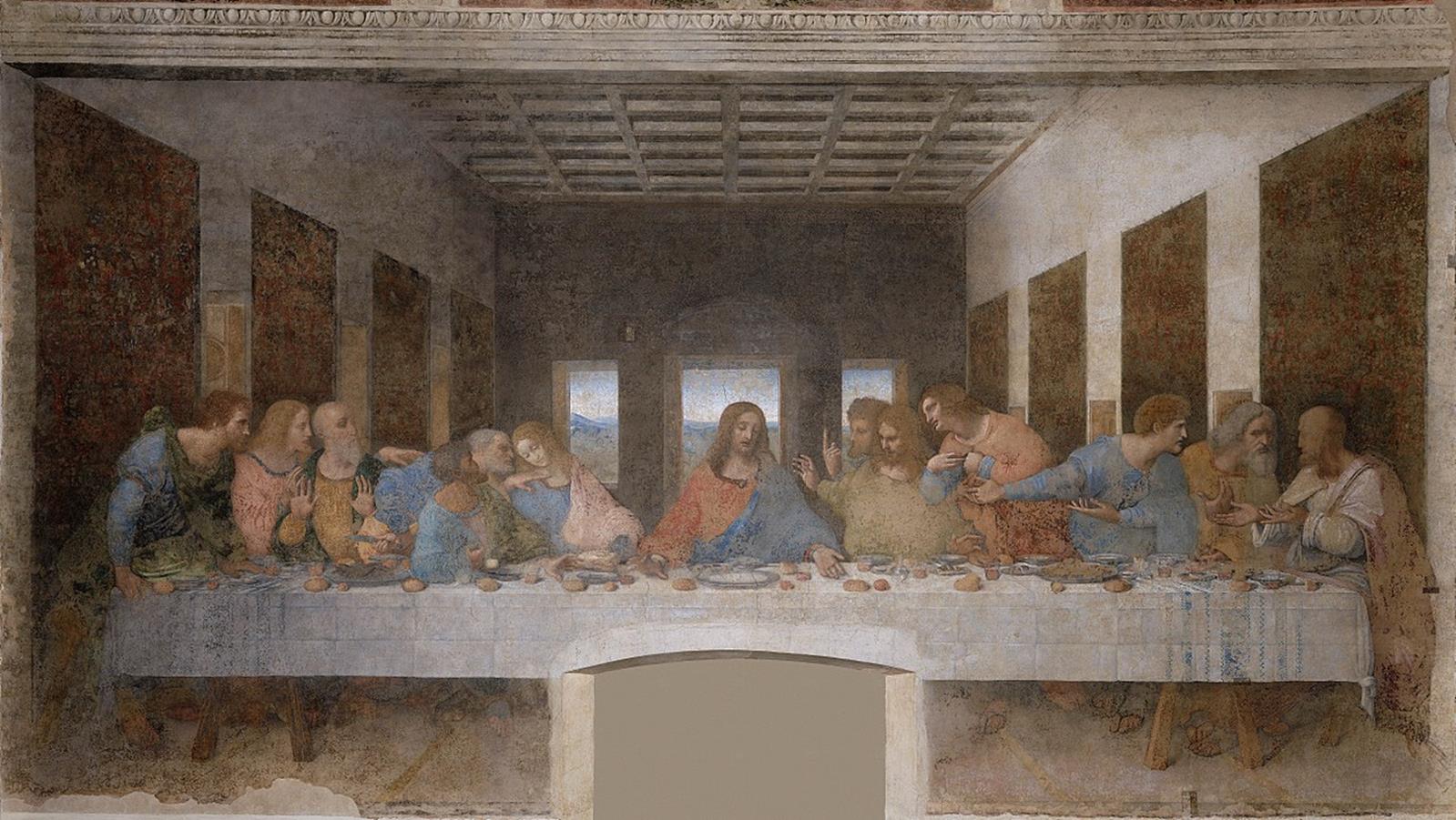 Les chrétiens reprendront le terme de Pâque pour célébrer la « résurrection du Christ » qui constitue le centre de leur croyance et de leur Foi.
Les chrétiens reprendront le terme de Pâque pour célébrer la « résurrection du Christ » qui constitue le centre de leur croyance et de leur Foi.
Mais le sujet principal de ce mot du jour est « Carême ».
Le site savant Lexilogos précise :
Le carême vient du latin quadragesima (dies) : quarantième (jour). En ancien français, on écrivait quaresme. On devrait même plutôt dire : la carême, comme l’italien quaresima et l’espagnol cuaresma. Autrefois, on employait aussi le terme de (sainte) quarantaine pour désigner le carême.
C’est un calque du grec ecclésiastique : τεσσαρακοστή (tessarakostè). Si le carême évoque à l’origine le 40e jour avant Pâques , il s’oppose à la Pentecôte qui évoque le 50e jour après Pâques. La Pentecôte vient du grec ancien πεντηκοστή (pentèkostè) : cinquantième (jour).
Nous apprenons qu’il faut dire : « la Carême » et que carême a une racine latine qui signifie quarante. Constatons aussi que le polygone à quatre côtés s’appelle un carré. Alors que celui à cinq côtés est un pentagone, et que donc Pentecôte vient de la même racine et signifie cinquante.
Selon Wikipedia le catholicisme a institué la carême au IVème siècle.
Et si nous revenons à la première comparaison problématique entre le ramadan et la carême, le journal « La Croix » pose explicitement la question : Le (la) carême est-il le ramadan des chrétiens ?
Et y répond négativement de la manière suivante :
« Disons-le tout de suite, carême et ramadan sont des réalités différentes qui, pour l’essentiel, ne peuvent être comparées. Le ramadan n’est pas le carême des musulmans et le carême n’est pas le ramadan des chrétiens. Dans la tradition chrétienne, le carême désigne les quarante jours de préparation à la fête de Pâques. Il s’inspire du temps que Jésus a passé au désert pour se préparer à sa mission. (Matthieu 4, 2). Pour vivre ce temps, l’Église propose aux chrétiens trois moyens pour se garder disponibles envers Dieu et les autres : la prière, le jeûne et l’aumône.
Si le carême chrétien est jeûne et privations, aumône et prière, il n’est pas simple obéissance à une loi « promulguée par Dieu dans sa sagesse ». Il est un temps de marche vers un objectif précis : la Résurrection de Jésus. Dans le carême, il y a une démarche personnelle de conversion individuelle (se tourner vers) et un mouvement collectif de l’ensemble des chrétiens en vue de l’édification du Corps du Christ qui est l’Église.
Le ramadan est le 9e mois de l’année musulmane, année lunaire comportant 11 ou 12 jours de moins que l’année solaire. Le jeûne rituel du mois de ramadan, quatrième pilier de l’Islam, fut décrété deux ans après l’Hégire. C’est au cours de ce mois que la tradition musulmane fixe la transmission du Coran à Muhammad par l’ange Gabriel. Globalement, le jeûne du mois de ramadan consiste à s’abstenir de toute nourriture et boisson, de relations sexuelles et à ne pas fumer du lever au coucher du soleil. La validité du jeûne exige un état de pureté légale. Parmi les anniversaires de la vie du Prophète célébrés au cours du mois de ramadan, la 27e nuit est le plus important.
On y commémore la Nuit du Destin, nuit solennelle au cours de laquelle le Coran est descendu parmi les hommes. « Elle est meilleure que mille mois » et « elle est un Salut jusqu’au lever de l’aurore » (Q. 97, 3.5.). Temps de partage, le mois de ramadan l’est à double titre. Pendant la journée, celui qui possède partage le sort du pauvre en se privant. Pendant la nuit et lors de la fête de la rupture du jeûne, il doit veiller à ce que son voisin pauvre ait le nécessaire pour rompre le jeûne. Si le jeûne du ramadan est obéissance à la Loi que Dieu a donnée à l’humanité dans sa sagesse et un temps de partage, il est aussi un moyen de purification et de lutte contre les convoitises. »
Ce n’est donc pas la même chose, il en reste pas moins qu’il s’agit dans les deux cas d’un exercice spirituel pendant lequel le croyant doit s’abstenir de faire des choses que son corps et sa chair désirent.
Résumons : nous sommes jeudi saint, jour de la Sainte Cène, j’ai donc opportunément ajouté une photo du chef d’œuvre de Léonard de Vinci.
Jeudi Saint étant aussi la fin de la Carême, il paraissait donc pertinent de consacrer un mot du jour à ce terme.
Enfin, étant donné mes racines mosellanes, j’ai été habitué à ce que vendredi saint soit férié, je m’octroie donc une trêve pascale.
Le prochain mot du jour sera publié mardi 3 avril, après lundi de Pâques.
<1047>
- Certains réagiront de manière sereine :il faut bien expliquer les choses avec des notions actuelles, des références connues !
-
Mercredi 28 mars 2018
« They’ll squash you like a bug »
« Ils vous écraseront comme un insecte »Un ex salarié de Facebook, propos rapporté par le guardianC’est le journal « Guardian » qui a publié cet article « They’ll squash you like a bug », « Ils vous écraseront comme un insecte » dans lequel il révèle comment les entreprises de la Silicon Valley font régner la loi du silence au sein de leurs salariés.
Marie Slavicek a traduit une partie de cet article dans Le Monde du 17 mars 2018 :
« Tables de ping pong, canapés moelleux, bars à smoothies… La plupart des géants de la tech rivalisent d’inventivité pour transformer leurs sièges sociaux en espaces de travail ultramodernes où il fait bon vivre. Le but : stimuler l’innovation en chouchoutant les employés. Voilà pour la façade. Mais derrière ce cadre idyllique se cache une culture du secret poussée à l’extrême. Et gare à ceux qui brisent la loi du silence.
Le récit et les témoignages [que rapportent le Guardian] sont glaçants.
Facebook a ainsi mis en place une équipe de « chasseurs de taupes ». « Ce qu’ils savent sur toi est terrifiant », affirme un ancien salarié sous couvert d’anonymat. Accusé d’avoir divulgué des informations anodines à la presse, ce dernier a été confronté à ce qu’il appelle « la police secrète de Mark Zuckerberg », le patron de l’entreprise. Ses employeurs savaient tout, dit-il : les enregistrements d’une capture d’écran qu’il avait prise, les liens sur lesquels il avait cliqué… Ils lui ont aussi expliqué qu’ils avaient eu accès à sa conversation par tchat avec le journaliste.
Officiellement, cette surveillance – et les menaces de poursuites judiciaires qui vont avec – sert à détecter et prévenir la violation des droits de propriété intellectuelle. Mais, dans les faits, elle sert aussi à empêcher les employés de parler librement en public, y compris de leurs conditions de travail.
Si Apple entretient avec ferveur le culte absolu du secret, à l’inverse, des entreprises comme Google et Facebook prétendent, elles, jouer la carte de la transparence avec leurs salariés. Ainsi, Mark Zuckerberg organise chaque semaine une réunion pour faire le point sur sa stratégie et parler de ses nouveaux projets devant des milliers d’employés. Mais cette confiance a un prix : trahissez-la, et « ils vous écraseront comme un insecte », résume l’ex-salarié à l’origine de fuites. […]
[Google] pousse ses employés à être le plus corporate possible et à agir selon la fameuse Google way – une devise, presque un mode de vie. La firme fait tout pour créer une sorte de « mentalité tribale » propre à l’entreprise et décourager les trahisons. Le silence des salariés peut aussi être récompensé par des primes annuelles. Mais surtout, comme le résume Justin Maxwell, un ancien de chez Google, « vous ne ferez jamais quelque chose qui bousillerait les chances de succès de l’entreprise parce que vous serez directement affecté ». Travailler chez Google, c’est aussi, en quelque sorte, faire partie d’un clan, d’une communauté. […]
D’après un ancien employé ayant travaillé au siège européen de Facebook, à Dublin, les équipes de sécurité laisseraient des « pièges à souris » – des clés USB contenant des données « oubliées » sur des bureaux pour tester la loyauté du personnel. La bonne attitude : la remettre immédiatement à la direction. La mauvaise attitude : la brancher à un ordinateur. La dernière option étant synonyme de licenciement immédiat.
« Tout le monde était paranoïaque », conclut-il. »
Peut-être que certains lecteurs trouveront normal cette manière de pratiquer, afin d’assurer l’intérêt supérieur de l’entreprise.
Pour ma part, je m’interroge, car ce dont il est question ici ce ne sont pas des secrets industriels, mais simplement une réputation, de pratiques souvent limites. Bref nous avons affaire à des paranoïaques, des apprentis dictateurs. D’ailleurs dans l’Histoire on nous a appris que tous les dictateurs ont été de grands paranoïaques, particulièrement Staline…
<1046>
-
Mardi 27 mars 2018
« Nier la mort »Tentative de certains humains à l’aide d’outils numériques et d’intelligence artificielleC’est le journal <Les Echos> dans son édition du 5 mars 2018 qui l’écrit : « L’intelligence artificielle commence à faire parler les morts »
C’est ainsi qu’un américain et qu’une russe ont programmé des « chatbots » à partir d’anciennes conversations avec leurs proches décédés :
John James Vlahos est mort d’un cancer en février 2017. Son fils, James, continue pourtant de discuter avec lui via Facebook Messenger. Il a intégré sur le réseau social une intelligence artificielle (IA) de sa confection, le « dadbot ». Pour le programmer, ce journaliste américain a profité des derniers mois de vie de son père pour enregistrer leurs conversations. Sa passion pour le football américain, les origines grecques de sa famille, l’histoire de son premier chien… Les souvenirs de John James Vlahos, comme son sens de l’humour et sa façon de lui demander « How the hell are you ? », lui survivent désormais artificiellement dans le « dadbot », sollicitable à chaque instant, comme n’importe quel contact Facebook.
Et une femme russe a eu une idée analogue, elle habite San Fransisco. Cela reste donc une histoire américaine :
« Alors qu’elle pleurait son meilleur ami, décédé brutalement dans un accident de voiture, Eugenia Kuyda a tenté de l’immortaliser dans une IA baptisée « Replika ». Ce robot conversationnel, qu’elle a mis en route en 2016, s’est nourri des milliers de messages que les deux amis s’échangeaient en ligne. »
C’est un sociologue Patrick Baudry auteur de « La Place des morts, enjeux et rites » (L’Harmattan, 2006) qui dit :
« Avec ces technologies, on fait comme si la personne pouvait encore être là. C’est une tendance assez logique de notre culture contemporaine dans ses relations à la mort et aux morts ».
Perdre un être cher, c’est se retrouver face à une absence radicale, irréversible. James Vlahos et Eugenia Kuyda ont tous deux bricolé des « chatbots » pour se soustraire à cette réalité insupportable. Patrick Baudry explique :
« On a tous un penchant naturel à nier qu’une personne est partie […].
Mais là où, jadis, des rites funéraires accompagnaient la mort d’une personne, où les conventions sociales nous imposaient d’entrer en deuil et d’en sortir, notre société contemporaine laisse chacun se débrouiller à sa manière, et même rapproche de plus en plus le vivant et le mort. Bientôt, dans les entreprises de pompes funèbres, on proposera des hologrammes ! »
Les Echos donnent aussi la parole à une psychologue spécialiste du deuil : Véra Fakhry :
« Après une période de choc liée au décès, la phase suivante est de rechercher la personne décédée. On va croire qu’on la croise dans la rue, on va relire ses messages… Cette phase est normale la première année, mais si elle continue, elle devient pathologique »
Le réseau social Facebook avait déjà semé les germes de cette immortalité artificielle. En effet des profils de personnes défuntes, changées en mémorial sur Facebook, sont quotidiennement inondés de messages.
James Vlahos se fixe pourtant une limite à ce jeu bizarre :
« Pour moi, il y a une limite morbide à ne pas dépasser. Il ne faut pas essayer de créer quelque chose de trop réaliste »
Mais il avoue cependant :
« Essayer d’améliorer ‘dadbot’ tous les jours ».
Il comprend que son invention virtuelle ne remplacera jamais son père mais il voit dans cette technologie un bon moyen de « se souvenir de lui » et de transmettre ce souvenir à ses enfants.
Il est toujours compliqué de faire son deuil, mais être à la limite de nier la mort et se créer une illusion virtuelle simulant la présence de l’absent, me parait une réponse inappropriée et peu sage.
Il est à craindre cependant que dans l’avenir, des entreprises avides de business nouveaux proposent de telles béquilles virtuelles pour simuler la continuation de la présence d’un être cher en profitant de la détresse de celles et ceux qui sont dans le deuil.
Parfois, je viens à me demander si la religion n’est tout compte fait pas une solution plus sage que ces délires numériques.
<1045>
-
Lundi 26 mars 2018
« Claude de France »Achille Claude DebussyLe 25 mars 1918, mourait Claude Debussy. Tous les journaux lui rendent hommage.
Le Figaro titre : « Il y a 100 ans, la mort du génial compositeur Claude Debussy »
Le Monde : « Claude Debussy, ce moderne méconnu »
La Croix : « Debussy, un moderne mort il y a cent ans »
Ou encore la voix du Nord : « Centenaire de Claude Debussy, père de la musique des «sens» »
Dans un autre article du Monde : « Debussy, le musicien de toutes les guerres », nous apprenons :
« Le 25 mars 1918, à 6 h 50, le premier obus de la journée tombe sur Paris. Un autre suit, puis un deuxième, un troisième. « Le gros canon boche n’est plus qu’un ennuyeux personnage de faits divers », commente Le Figaro. Vers 22 heures, Claude Debussy pousse son dernier soupir, terrassé par un cancer, à l’âge de 55 ans. La nouvelle est rapportée dans les journaux, qui consacrent l’essentiel de leurs maigres pages à la bataille qui fait rage en Picardie. L’hommage prend un tour antigermanique. « C’est la musique de Debussy qui nous a délivrés du prestige maléfique de Wagner, assure Louis Laloy, à une heure où nos meilleurs artistes en étaient victimes. » »
Mais c’est probablement la page d’hommage du site « Culturebox » qui est la plus intéressante parce qu’elle présente des vidéos remarquables par exemple celle où Boulez explique la modernité du ballet « Jeux » ou une vidéo d’animation qui présente « Pelleas et Mélisande » et aussi parce qu’il donne la parole au grand pianiste Philippe Cassard qui a écrit un livre sur Debussy qui vient d’être publié :
« Au départ admirateur du génie de Richard Wagner, Claude Debussy se révolte rapidement contre l’ornière romantique et la musique allemande. « Quelle était la vague en 1885 à Paris? C’était Wagner, Wagner, Wagner, tous les compositeurs succombaient à cette espèce de tsunami wagnérien. « Le Prélude à l’après-midi d’un faune » était « la réponse d’un compositeur français à l’invasion sonore allemande […] C’est intime, c’est lyrique, avec beaucoup de poésie et de délicatesse […] Il est né le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye, à l’ouest de Paris, au sein d’une famille de petits commerçants. Alors qu’on ne discutait pas culture en famille, on l’a confié à la belle-mère de Verlaine », la pianiste Antoinette Mauté, elle-même élève de Chopin. »
On constate donc que s’il n’est pas né dans une famille d’artiste, il a rapidement été baigné dans un univers culturel particulier
 Il est vrai comme l’écrit ce site qu’on compare Debussy non pas à d’autres musiciens mais à plutôt à d’autres artistes de son époque, notamment les Impressionnistes et les Symbolistes. « Prélude » est une interprétation musicale très libre d’un poème de Stéphane Mallarmé, tandis que « Fêtes galantes » et le célébrissime « Clair de Lune » sont à l’origine des poèmes de Paul Verlaine. Bertrand Dermoncourt qui a été nommé conseiller artistique pour le centenaire de Debussy par Emmanuel Macron explique :
Il est vrai comme l’écrit ce site qu’on compare Debussy non pas à d’autres musiciens mais à plutôt à d’autres artistes de son époque, notamment les Impressionnistes et les Symbolistes. « Prélude » est une interprétation musicale très libre d’un poème de Stéphane Mallarmé, tandis que « Fêtes galantes » et le célébrissime « Clair de Lune » sont à l’origine des poèmes de Paul Verlaine. Bertrand Dermoncourt qui a été nommé conseiller artistique pour le centenaire de Debussy par Emmanuel Macron explique :
« C’est un peu le Claude Monet de la musique (…) car ses œuvres sont très proches de la nature », comme « La mer » Ce sont les mêmes impressions qu’on peut retrouver dans les tableaux de Monet, de petites touches qui créent des ambiances. […] Il annonce toute la musique du 20e siècle, tous les compositeurs après se réclament de lui»
Emmanuel Macron qui a dit cette phrase énigmatique « On a tous en nous quelque chose de Johnny », surtout depuis qu’on en sait davantage sur la grande propension de cet artiste de vouloir pratiquer l’évitement fiscal et le refus de se soumettre au droit français concernant l’héritage, joue aussi du piano et a fait part, dans une déclaration transmise à l’AFP, de son admiration pour le maître de musique français :
« J’accorde une place toute particulière aux Préludes pour piano, dont on ne finit jamais de sonder la nouveauté radicale ».
Certainement Debussy fut un compositeur de piano tout à fait étonnant, avec de petites pièces ciselées, toute en poésie et en finesse.
Parmi les préludes évoqués par le Président de la République, il y a cette délicieuse pièce « La Fille aux cheveux de lin »
D’abord pour votre culture et développer votre capacité de jugement, je vous invite à regarder cette pitrerie : « Lang Lang joue La fille aux cheveux de lin »
Cet acteur de théâtre du nom de Lang Lang que certains prétendent pianiste fait semblant d’interpréter l’œuvre de Debussy.
Ici, beaucoup plus mal enregistré, vous écouterez un vrai pianiste, Arturo Benedetti Michelangeli jouer cette œuvre avec grâce et musicalité
Vous pouvez aussi écouter une belle interprétation à la harpe par Sasha Boldachev
<Le quatuor à cordes opus 10> est aussi un chef d’œuvre de la musique, le lien vous emmène vers une interprétation du 1er mouvement par le Jerusalem Quartet.
Et encore une œuvre moins connue que j’aime particulièrement <Danse sacrée et profane pour Harpe et orchestre à cordes>
Et puis aussi cette œuvre surprenante, pleine de poésie <Syrinx> pour flûte solo jouée par Emmanuel Pahud.
Enfin le chef d’œuvre, unique, absolu, celui dans lequel Claude Debussy atteint au sublime : son opéra « Pélléas et Mélisande » dans une interprétation de l’Opéra de Lyon sous la direction de John Eliot Gardiner.
Il aimait signer ses partitions du nom de « Claude de France » et il est vrai qu’il est par essence le musicien français comme le décrit superbement Wikipedia que je cite :
« D’une audace imprévisible, mais d’une sûreté de goût absolue, harmoniste inclassable et dramaturge subtil, Debussy est comme Rameau auquel il a rendu hommage dans ses Images pour piano, un compositeur d’esprit très français (il signait d’ailleurs certaines de ses partitions Claude de France). Mais grâce à la révolution qu’il opère dans l’histoire de la musique, à travers les ponts qu’il lance en direction des autres arts et des multiples sensations qu’ils éveillent (les sons et les parfums, les mots et les couleurs), il fait accéder sans doute mieux qu’aucun autre la musique française à l’universalité : celle du corps, de la nature et de l’espace. »
<Vous trouverez ici un site entièrement consacré à l’œuvre de Claude Debussy>
<1044>
-
Vendredi 23 mars 2018
«Je danse chaque jour pour que la journée ne soit pas perdue.»Nadia Vadori-GauthierC’est par l’émission « L’Invité culture » que présente Caroline Broué que j’ai entendu parler une première fois de Nadia Vadori-Gauthier. Cétait l’émission du 24 février 2018.
Nadia Vadori-Gauthier est danseuse et chercheuse. Elle a été, comme beaucoup, choquée en janvier 2015 par l’attentat contre Charlie Hebdo.
Et c’est en voulant réagir à ce crime, à cette violence qu’elle a eu l’idée de danser chaque jour une minute dans un endroit particulier et de poster la vidéo de cette danse sur Internet.
 Caroline Broué l’a invité car elle vient de publier un livre Danser, résister : une minute de danse par jour publié aux éditions Textuel, où elle raconte ces performances.
Caroline Broué l’a invité car elle vient de publier un livre Danser, résister : une minute de danse par jour publié aux éditions Textuel, où elle raconte ces performances.
J’ai beaucoup aimé l’énergie positive qui se dégageait de ses réponses et de sa personnalité. Elle a cette belle phrase :
« Je danse chaque jour pour que la journée ne soit pas perdue »
Et elle dispose d’un site Web qui reproduit toutes ces danses : http://www.uneminutededanseparjour.com/
Et où elle décrit son projet et son inspiration :
Le 7 janvier 2015, date de l’attentat à Charlie Hebdo, j’étais très affectée. Ce soir-là, j’ai mis au point le projet de Une minute de danse par jour, pour agir une présence sensible dans le monde. Je voulais agir en m’assignant une action quotidienne petite mais réelle et répétée, qui œuvre pour une poésie en acte, en me mettant réellement en jeu, seule ou en relation à d’autres. Les attaques des jours suivants ont renforcé cette détermination.
C’est dans ce monde qui est le nôtre que, depuis le 14 janvier 2015, je danse chaque jour, sans autres armes que celles du sensible, pour ne pas céder à l’anesthésie, la peur ou la pétrification et créer des connexions vivantes aux autres, aux environnements. Comment agir de façon locale, infinitésimale, à sa mesure, afin de contribuer à la création de liens et au décloisonnement ?
 […] Depuis le 14 janvier 2015, Je danse une minute et quelque, tous les jours, simplement, sans montage avec les moyens du bord, dans les états et les lieux dans lesquels je me trouve, sans technique, ni mise en scène, ni vêtement ou maquillage particulier, rien d’autre que ce qui est là. Et je poste la danse en ligne le jour-même.
[…] Depuis le 14 janvier 2015, Je danse une minute et quelque, tous les jours, simplement, sans montage avec les moyens du bord, dans les états et les lieux dans lesquels je me trouve, sans technique, ni mise en scène, ni vêtement ou maquillage particulier, rien d’autre que ce qui est là. Et je poste la danse en ligne le jour-même.
Je danse en intérieur ou en extérieur, dans des endroits publics ou privés, seule ou avec d’autres, des inconnus ou des gens que je connais et parfois des amis.
Je danse comme on manifeste, pour œuvrer à une poésie vivante, pour agir par le sensible contre la violence de certains aspects du monde.
C’est la réponse que j’ai trouvé pour m’impliquer en acte à ma mesure, dans une action réelle, répétée, qui puisse déplacer les lignes, faire basculer le plan ou osciller la norme.
J’ai été également inspirée pour ce projet d’une phrase de Nietzsche tirée de Ainsi parlait Zarathustra et qui dit : « Et que l’on estime perdue toute journée où l’on n’aura pas dansé au moins une fois. ». Ca veut dire pour moi qu’il s’agit de vivre, qu’il s’agit de vivre en mouvement, de rester en mouvement.
J’ai été également accompagnée dans l’élaboration de ce projet par un proverbe chinois : « Goutte à goutte l’eau finit par traverser la pierre. ». Cela veut dire qu’une action minime et répétée peut finir par avoir un grand effet.
La goutte d’eau, ce sont les danses, quotidiennes, interstitielles, sans armes ni sans boucliers. et la pierre, c’est un certain durcissement du monde (communautarismes, hiérarchies, consumérismes, dogmatismes), et aussi la désolidarisation d’avec la nature (environnement, animaux, végétaux) et le manque d’une dimension poétique active au quotidien.
Alors pour moi, Une minute de danse par jour, c’est un engagement esthétique, c’est à dire de la sensibilité, un engagement poétique, éthique et microlitique, qui est radical à la petite échelle qui est la mienne.
Je continue à danser tous les jours, pour œuvrer à une place plus sensible dans le monde, pour qu’il y ait des circulations entres les cases, les catégories, les corps.
Je parie que c’est possible.
Chaque jour, tout recommencer à zéro, comme s’il n’y avait jamais eu aucune danse ; tout est à refaire, le corps, la danse ; tout est à danser, à redanser, pour une minute et quelque.
Danser la vie qui passe et qui vibre dans les interstices du quotidien, qui vibre, dans les intervalles entre les images brillantes qui prétendent nous tenir lieu de monde.
<Le Monde lui a aussi consacré un article>
<Cette danse est la numéro 509, elle danse avec un handicapé> c’est beau et émouvant.
Une bien belle personne …

Ici devant le Palais de Tokyo.
<1043>
-
Jeudi 22 mars 2018
« Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie »Albert Londres dansTerre d’ébènePour répondre à question d’hier : « Comment lutter contre les fake news ? », la meilleure solution n’est certainement pas une loi nouvelle mais des journaux indépendants en qui on peut avoir confiance et des journalistes rigoureux et intègres.
 Celui qui devant l’Histoire a incarné ce journalisme est Albert Londres. Et c’est d’ailleurs le prix Albert-Londres qui couronne chaque année, à la date anniversaire de sa mort, le meilleur « Grand Reporter ».
Celui qui devant l’Histoire a incarné ce journalisme est Albert Londres. Et c’est d’ailleurs le prix Albert-Londres qui couronne chaque année, à la date anniversaire de sa mort, le meilleur « Grand Reporter ».
Albert Londres n’a jamais pris en considération les pouvoirs publics, les gouvernements pour écrire ce qu’il voyait pendant la première guerre mondiale, dans la Russie bolchevique, dans le bagne de Cayenne, en Chine.
Il part une première fois en Chine en 1920 et écrira :
« La Chine : chaos, éclat de rire devant le droit de l’homme, mises à sac, rançons, viols. Un mobile : l’argent. Un but : l’or. Une adoration : la richesse. »
Quelques années plus tard, il meurt dans le paquebot qui le ramenait de Chine, dans la nuit du 15 au 16 mai 1932, dans l’incendie du navire. Beaucoup pensent qu’il s’agissait d’un assassinat car il était sur une enquête d’ampleur, un scandale international. Ses notes ont brulé dans le même incendie. Il avait 48 ans
Et l’exergue de cet article est celui le plus souvent cité d’Albert Londres, sorte de devise du journaliste idéal.
C’est encore grâce à Mediapart et Edwy Plenel que nous savons que ces mots sont
« les premiers de Terre d’ébène, le grand reportage d’Albert Londres sur l’Afrique occidentale française, paru en 1929. Un livre en forme de réquisitoire sur la servitude coloniale, le travail forcé, le déni de la justice, l’inégalité instituée, etc. « Tout ce qui porte un flambeau dans les journaux coloniaux est venu me chauffer les pieds », ajoute Londres.
Or c’est dans le même avant-propos de ce livre qu’on trouve la formule désormais canonique, communément citée par les journalistes pour défendre leur indépendance professionnelle et leur liberté critique – la plume dans la plaie. Rappel qui mérite une citation intégrale :
« Je demeure convaincu qu’un journaliste n’est pas un enfant de chœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de roses. Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie ».
Entêté, Albert Londres y revient dans l’épilogue, élargissant le propos au-delà du journalisme professionnel pour viser à la responsabilité civique : « Flatter son pays n’est pas le servir, et quand ce pays s’appelle la France, ce genre d’encens n’est pas un hommage, mais une injure. La France, grande personne, a droit à la vérité ».
<1042>
-
Mercredi 21 mars 2018
« S’il y a bien un producteur de fake news à contrôler c’est l’Etat. Et l’Etat de son propre pays »Emmanuel ToddEmmanuel Macron a annoncé le 3 janvier, lors de ses vœux à la Presse, qu’un « texte de loi » allait être déposé « prochainement » pour lutter contre les fausses infos sur internet en « période électorale ».
Il estime avoir été victime de campagnes de désinformation sur Internet lorsqu’il était candidat à l’Elysée. D’après le chef de L’État, cette Loi serait nécessaire pour protéger la vie démocratique
Il semble que, comme sur les autres sujets, il veut aller très vite. Plusieurs Media affirment que la Loi est prête.
Est-ce vraiment une bonne idée, et devant un problème réel penser que la meilleure réponse est une Loi ?
C’est justement la question que pose l’Express : « Une loi sur les « fake news » est-elle utile ? » qui rappelle qu’il existe déjà des lois :
La volonté de légiférer sur les fake news n’est pas tout à fait nouvelle. La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse permet de poursuivre les auteurs d’injure ou diffamation [soit le fait d’imputer un fait qui nuise à l’honneur d’un individu]. Elle sanctionne également ceux qui tentent de « troubler la paix publique » en faisant de la désinformation.
Depuis les années 2000, le code pénal, lui, permet de condamner une personne qui diffuse des fausses informations dans le but de faire croire à un attentat (article 322-14), ou de compromettre la sécurité d’un vol ou d’un avion (article 224-8). Le code monétaire et financier punit les fake news dont l’objectif est d’influencer le cours en bourse d’une entreprise. Enfin, le code électoral, à l’article L97, indique que quiconque a « surpris ou détourné » des suffrages en relayant des fausses nouvelles dans le contexte d’une élection encourt une peine d’emprisonnement.
Emmanuel Todd a de nouveau commis une petite provocation lors d’un entretien accordé à l’Obs et publié le 11 mars 2018 : « Le principal producteur de fake news, c’est l’Etat »
A la question de savoir ce qu’il pense de ce projet de Loi, Emmanuel Todd Répond :
«Je suis très inquiet. Ce qui me frappe dans la période actuelle, alors que nous sommes censés vivre l’apothéose de la démocratie libérale après l’effondrement des totalitarismes, c’est le rétrécissement des espaces d’expression et de la liberté de pensée. La liberté, depuis le Moyen Age, s’est d’abord définie contre l’Église et puis contre L’État.
Dire que L’État va assurer la liberté d’expression, c’est un oxymore historique !
Et je suis plus particulièrement inquiet pour la France, en tant qu’historien, parce qu’elle est ambivalente dans son rapport à la liberté: elle est à la fois l’une des trois nations qui ont construit la démocratie libérale, avec l’Angleterre et les Etats-Unis, et le pays de l’absolutisme de Louis XIV, de Napoléon Ier et Napoléon III, de Pétain et de l’ORTF.
Or nous sommes en train de vivre une désintégration des partis et de la représentation politique. Les groupes culturels et idéologiques antagonistes qui assuraient un pluralisme structurel de l’information (le PC, l’Église, le socialisme modéré, le gaullisme…) ont implosé. Le pluralisme n’est donc plus assuré et les médias représentent de plus en plus une masse indistincte. Typiquement le genre de situation dans laquelle l’Etat peut émerger comme une machine autonome et se mettre au-dessus de la société, pour la contrôler.
La séparation des pouvoirs est de moins en moins assurée. La menace que je vois se dessiner ce n’est donc pas celle des fake news, mais celle de l’autoritarisme de l’État et son autonomisation en tant qu’agent de contrôle de l’opinion. Il sera d’autant plus autoritaire sur le plan de l’information qu’il s’avère impuissant sur le plan économique: la société est bloquée, avec son taux de chômage tournant autour de 10%, et de plus en plus fragmentée en groupes qui se renferment sur eux-mêmes (les Corses, les habitants de Neuilly, autant que les musulmans). »
Et lorsque le journaliste cherche à détourner Emmanuel Todd de l’Etat vers la responsabilité des GAFAM, il conteste et revient vers l’État :
« Que les Gafam ne paient pas les impôts qu’ils devraient, qu’ils aient des stratégies monopolistes, oui, bien sûr. Mais je ne crois pas que ces moyens d’échange entre individus, par ailleurs extraordinaires quant à leur capacité à faire circuler l’information, soient les puissances occultes qu’on nous décrit. Ce que je sais en revanche, c’est qu’il y a des pays où l’accès à internet est contrôlé, comme la Chine, un Etat semi ou post-totalitaire où la police est reine.
Attirer l’attention sur les Gafam, c’est détourner l’attention de l’acteur majeur et producteur principal de fake news dans l’histoire, qu’est l’Etat. Parce que nous sommes en économie de marché, les Français surestiment le libéralisme intrinsèque de leur société et ils sous-estiment la puissance de désinformation de l’Etat. La guerre d’Irak a pourtant commencé par des fake news qui venaient de l’Etat américain sur les armes de destruction massive en Irak, avec Colin Powell qui agitait son petit flacon devant le conseil de sécurité de l’ONU…
C’est l’État qui a la puissance financière, l’avantage de la continuité, le monopole de la violence légitime: s’il y a bien un producteur de fake news à contrôler c’est l’État. Et l’État de son propre pays, pas les États extérieurs. Le principe fondateur de la démocratie libérale, c’est, en effet, que si la collectivité doit assurer la sécurité du citoyen, le citoyen doit être protégé contre son propre Etat.
En outre, les fausses nouvelles, les délires et les rumeurs mensongères, c’est l’éternité de la vie démocratique. Et l’idée même de la démocratie libérale, c’est de faire le pari que les hommes ne sont pas pour toujours des enfants. Contrôler l’information, c’est infantiliser le citoyen.
Au fond, ce débat évoque des classes dirigeantes en grande détresse intellectuelle. Comme elles ne comprennent plus la réalité qu’elles ont elles-mêmes créée, le comportement des électorats, Trump, le Brexit…, elles veulent interdire. Non content d’avoir le monopole de la violence légitime, l’Etat voudrait s’assurer le monopole des fake news. »
<Edward Plenel est sur ce même registre : La liberté n’a pas besoin que l’Etat s’en mêle> et le patron de Mediapart de rappeler :
« Que Nicolas Sarkozy avait accusé Mediapart de « faux et usage de faux » après la publication de révélations sur le financement de sa campagne électorale de 2007. Ces révélations étaient sorties entre les deux tours de la présidentielles de 2012, mais Edwy Plenel se défend de toute « gestion partisane de nos informations ». Il souligne que, malgré ses accusations, Nicolas Sarkozy avait choisi de ne pas poursuivre Mediapart en justice, « à la loyale », ce qui aurait permis au pure player d’apporter des éléments de preuves pour étayer ce qu’ils avaient publié.
Un « contournement » que faciliterait la nouvelle loi, selon le fondateur de Mediapart. Il s’inquiète du risque de pression politique et partisane du pouvoir exécutif sur d’éventuelles poursuites judiciaires, qui stopperait la diffusion de révélations pendant la période de campagne électorale. »
Probablement que cette loi sur les fake news est une fausse bonne idée qui risque d’avoir plus d’effet pervers que d’effet positif.
Il est certain comme le fait remarquer Emmanuel Todd qu’au cours de l’Histoire, dans tous les pays du monde, le plus grand producteur de fake news fut l’État à l’égard de ses nationaux.
<1041>
-
Mardi 20 mars 2018
« La valeur de l’information »Edwy PlenelUn pré-projet avait été mis en ligne le 2 décembre 2007, mais le lancement du journal en ligne : Mediapart date du 16 mars 2008, il y a dix ans.
Mediapart a dix ans !
 A son lancement Alain Minc avait été catégorique : « Cela ne marchera jamais ».
A son lancement Alain Minc avait été catégorique : « Cela ne marchera jamais ».
Soyons précis : <Aller voir cette vidéo sur Youtube> et reprenons ce qu’il dit :
« La presse sur le net ne peut être que gratuite, la presse payante sur le net ne peut pas marcher »
Vérité des textes, lien vers les sources, il n’y a que cela de vrai !
Mediapart a réalisé une presse payante sur le net et cela marche.
Pour ces 10 ans, Edwy Plenel a publié un livre : « La valeur de l’information » qui est paru le 8 mars 2018.
La valeur cela signifie qu’il est important de disposer d’une information de qualité dont on peut raisonnablement penser qu’elle est juste et vérifiée.
L’information peut aussi être révélée et avoir cette valeur qu’elle nous permet de mieux comprendre les enjeux, les comportements de certains et aussi leurs intérêts. Il est fondamental dans une démocratie de savoir que le Ministre du budget, le patron des services du contrôle fiscal est un fraudeur.
Certains jeunes dont mon fils pensent que les journaux et probablement les journalistes sont inutiles dans le monde qui vient. Le réseau, le réseau des amis sur lesquels on peut se fonder suffisent pour être bien informé. La masse des individus saura toujours plus que quelques journalistes et quelques précautions de recoupement permettraient alors de s’assurer d’une information solide et sérieuse.
Je n’y crois pas un seul instant.
Qu’est-ce qu’un bon journaliste ? C’est une femme ou un homme qui cherche de l’information et qui la vérifie.
Un journaliste, un vrai c’est une femme ou un homme courageux qui va défendre la liberté non pas pour lui mais pour la démocratie, pour les autres.
Un journaliste, un vrai peut avoir beaucoup d’ennui. On parle beaucoup de mai 1968 en ce moment, mai qui a commencé le 22 mars 1968, ou peut-être même le 18 mars et après mai il y eut une vraie purge des journalistes à la télévision et à la radio de l’époque, ils ont perdu leur emploi s’ils avaient été trop critiques par rapport au gouvernement ou trop bienveillants par rapport au mouvement de mai.
C’était il y a cinquante en France.
Aujourd’hui la Turquie porte le nom peu enviable <de plus grande prison de journalistes du monde>
Des journalistes perdent la vie lors de conflits qu’ils veulent suivre pour informer le monde.
 Mais des journalistes sont aussi assassinés parce qu’ils font leur métier et qu’ils le font bien.
Mais des journalistes sont aussi assassinés parce qu’ils font leur métier et qu’ils le font bien.
Et cela est même le cas dans notre douce Union européenne : Daphne Caruana Galizia a été assassinée sur l’ile de Malte en 2017, et en 2018 c’est en Slovaquie que Jan Kuciak a été tuée.
Un journaliste peut donner sa vie pour produire ce minerai d’une valeur inestimable pour la liberté et la démocratie : l’Information.
Alors la valeur de l’information c’est aussi un prix qu’il faut payer.
Quand vous voulez un service de qualité ou un produit de qualité vous faites appel à un professionnel, et ce professionnel vous le payez.
Quand vous voulez une information de qualité, vous faites appel à un professionnel et ce professionnel est un journaliste.
Pour ma part, je suis abonné à Mediapart depuis le scandale Cahuzac,
Edwy Plenel m’énerve souvent, il a parfois des réactions totalement disproportionnées notamment lors de son conflit avec Charlie Hebdo. Mais il a créé un site de qualité, indispensable à la démocratie et à la liberté. Mais pour y accéder il faut payer, parce que ce que vous y trouvez possède de la valeur.
Il était invité de Laurent Ruquier du 17 mars 2018.
Et il est revenu sur l’affirmation péremptoire d’Alain Minc :
« Alain Minc est une boussole qui montre toujours le Sud. Il nous a servi. Nous avons fait de la pub : Comme il [Alain Minc] s’est toujours trompé, abonnez-vous à Mediapart. Et en fait cela nous a ramené beaucoup d’abonnés…»
Mais il a été juste, Minc n’était pas seul : « Personne n’y croyait, Laurent, Personne !» a-t-il lancé à Ruquier.
Il a aussi insisté sur l’intérêt du numérique qui permet de créer une relation de confiance entre les journalistes et les lecteurs qui peuvent réagir et aussi écrire, critiquer bref participer.
Mediapart a aujourd’hui 140 000 abonnés, 45 journalistes..
C’est eux qui étaient en pointe sur l’affaire Bettencourt, Cahuzac et maintenant sur l’affaire que Plenel désigne comme le plus grand scandale d’Etat, c’est-à-dire le financement par le dictateur de Lybie, Kadhafi, de la campagne présidentielle de 2007 de Sarkozy, affaire que Plenel affirme être certaine.
Dans toutes ces affaires il est question d’énormes sommes d’argent détournées du bien public, de fraude fiscale, c’est-à-dire toutes ces dérives qui affaiblissent la solidarité et la démocratie.
Edwy Plenel donne cette mission aux journalistes : « Apportez des informations d’intérêt public » et il cite un autre journaliste qui dit :
« Ce sont les journalistes qui lèvent des lièvres mais c’est à la société de s’en emparer ».
L’échange lors de l’émission de Ruquier fut très intéressant et même émouvant quand il fut question du père : Alain Plenel qui fut vice recteur en Martinique et fut aussi persécuté par le pouvoir en raison de son esprit de liberté et de justice.
Alors oui l’information a de la valeur et il faut savoir la payer.
<1040>
-
Lundi 19 mars 2018
«Un sentiment de lassitude et de souffrance » »Martin Hirsch directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, parlant des personnels hospitaliersVous trouverez en commentaire le témoignage de Florence qui apporte la réalité du vécu à cet article issu du travail de journalistes
Dans le journal le Monde du 17/03/2018 j’ai lu un article : « Les urgences hospitalières confrontées à une surchauffe inhabituelle sur l’ensemble du territoire »
Et voici ce que j’ai lu :
« Confrontées à un afflux de patients âgés et à un manque de lits d’hospitalisation, les urgences explosent.
Selon des chiffres fournis par le ministère de la santé vendredi 16 mars, 97 hôpitaux sur les 650 – publics ou privés – comportant une structure d’urgences avaient, au 13 mars, activé le plan « hôpital en tension », un dispositif qui permet notamment de libérer des lits dans les différents services en reportant des opérations programmées. Une saturation inhabituelle à cette époque de l’année.
Depuis le début du mois, dans les services d’urgences adultes des établissements de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le taux d’occupation est aussi en augmentation, selon l’heure de la journée, de 15 % à 25 % par rapport au taux moyen en 2016, soit « pratiquement le niveau observé au pic des épidémies hivernales ». Par comparaison, ces deux dernières années, le taux d’occupation en mars était proche du taux moyen annuel (soit + 5 % environ).
Un autre indicateur a également viré au rouge : le nombre de passages de personnes de plus de 75 ans dans les hôpitaux de l’AP-HP a enregistré ces sept derniers jours des hausses comprises entre 8 % et 20 % par rapport à la même période l’année dernière. Dans un prestigieux hôpital parisien, un médecin urgentiste explique avoir été ce mois-ci « en situation de crise permanente ». « Nous n’avons plus de salle d’examen disponible et nous examinons donc les patients dans les couloirs », raconte-t-il sous le couvert de l’anonymat.
Le phénomène touche toute la France. « On a l’impression de revivre la canicule de 2003, témoigne Pierre Mardegan, le responsable des urgences à l’hôpital de Montauban. Devoir hospitaliser entre 25 et 30 personnes âgées par jour, je n’ai jamais connu ça en vingt ans d’exercice. » Signe de la gravité de la crise, au centre hospitalier de Bourges, il a été expressément demandé aux habitants « de ne venir aux urgences qu’en cas de nécessité absolue ».
A Strasbourg, les syndicats FO et CFTC ont dénoncé une situation « extrêmement critique » et ont lancé un appel à la grève à partir du 20 mars.
« Depuis une semaine, c’est la catastrophe », assure Mathias Wargon, le chef des urgences de l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). « On ne prend pas de risque vital avec les patients, mais ce n’est pas de la bonne médecine », regrette-t-il.
« Ça craque de partout, l’hôpital est en train de s’écrouler », juge Christophe Prudhomme, porte-parole de l’association des médecins urgentistes de France et membre de la CGT.
« Cette situation est le signe que le modèle hospitalier est au bout du bout et qu’il doit se réorganiser », abonde François Braun, le président de Samu-Urgences de France. Pour mesurer l’ampleur du phénomène, son organisation a mis en place un dispositif de comptage quotidien – sur la base du volontariat – du nombre de personnes admises aux urgences ne trouvant pas de lits d’hospitalisation.
Le résultat est édifiant : entre le 10 janvier et le 9 mars, sur une centaine de services d’urgences (sur un total de 650), plus de 15 000 patients ont passé la nuit sur un brancard, faute de lit d’hospitalisation. « En extrapolant à tous les services, cela représente près de 100 000 patients en deux mois », précise M. Braun. Cette surcharge « entraîne une augmentation de la mortalité de 9 % pour tous les patients et de 30 % pour les patients les plus graves », affirme Samu-Urgences de France, dans un communiqué. La médiatisation de décès survenus ces derniers jours dans plusieurs services d’urgences saturés ont d’ailleurs mis en lumière la situation de crise dans ces hôpitaux. A Reims et à Rennes, des enquêtes judiciaires ont même été ouvertes.
A quoi attribuer cette fréquentation inhabituelle ? La direction de l’AP-HP fait valoir que « ces derniers jours, l’épidémie de grippe saisonnière, marquée par une proportion plus importante de souche virale B, impacte davantage la population âgée, ce qui a entraîné une augmentation des hospitalisations pour pathologies respiratoires ».
L’hypothèse d’un effet grippe ne suffit pas aux urgentistes. « Le pic de l’épidémie était mi-janvier », assure M. Braun. « On est en dehors de tout épisode épidémique, la situation n’est donc pas liée uniquement à cela », complète M. Mardegan, à Montauban. Pour ces médecins, un tel degré d’engorgement est d’abord la conséquence de toute une série de « dysfonctionnements » de l’hôpital. Alors que la population est vieillissante et que les médecins de ville sont de moins en moins nombreux et accessibles, ils font valoir que l’hôpital ne s’est pas réorganisé en conséquence et ne dispose pas de suffisamment de lits d’hospitalisation générale pour accueillir des personnes âgées polypathologiques. »
Frédéric Pommier qui a consacré une grande partie de sa revue de presse de dimanche à ce sujet, a commenté : « Les services des urgences sont donc au bord de l’explosion, et les hôpitaux parisiens sont à bout de souffle eux-aussi. Le personnel soignant, comme les chefs de service dénoncent un manque de moyens. »
Et Martin Hirsch, le directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris reconnaît lui-même dans le même journal « un sentiment de lassitude et de souffrance ». Il appelle à une transformation profonde de l’hôpital. Sachant qu’on est sans doute au-delà de la lassitude.
Et puis le Monde a publié un autre article : <« Ras-le-bol », « découragement », « perte de sens » : le malaise de l’AP-HP>
On lit :
L’hôpital public, pour elle, c’est terminé. A la fin du mois, après douze années comme infirmière de bloc opératoire dans un hôpital de la banlieue parisienne de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Agathe (tous les prénoms ont été modifiés) va raccrocher la blouse. A 43 ans, elle se dit « fatiguée » et « triste » d’avoir dû se résoudre à ce choix. Il y a huit ans, le service d’obstétrique où elle travaille effectuait 2 800 accouchements par an. Il en fait aujourd’hui 900 de plus, à effectif constant. « Ils ont fait de notre service une usine, raconte-t-elle. On nous presse, on nous stresse, on nous demande du rendement… La chef de service nous rappelle constamment que, si on ne fait pas tel chiffre d’activité, on nous réduira les postes… »
A quelques kilomètres de là, dans un établissement parisien de l’AP-HP, Pascale, une aide-soignante de 35 ans, songe, elle aussi, parfois, à démissionner. Elle dénonce l’évolution « négative et dangereuse » du métier qu’elle exerce depuis treize ans. « Pour payer mes études, j’avais bossé à McDo. Toute la journée, on entendait : « On y va ! On y va ! » J’ai retrouvé ça au bloc ces dernières années. On n’a plus le temps de discuter avec les patients angoissés avant une opération… »
Et pendant ce temps, où les infirmières n’ont plus le temps de s’occuper vraiment des malades, de leur parler, de les toucher, bref exprimer de l’humanité, les scientifiques nous disent :
« Des études de plus en plus nombreuses prouvent les bienfaits du contact corporel.
La dernière en date publiée la semaine dernière dans la revue PNAS a étudié les effets analgésiques induits par le toucher. […]
Parce qu’on sait à quel point le lien tactile est important dans les interactions entre les humains. Le toucher pouvant diminuer le stress et l’anxiété et renforcer l’attachement à tous les âges de la vie.
C’est le cas bien sûr entre le bébé et sa maman avec les effets du « peau à peau » qui sont bien connus mais aussi chez les personnes âgées dont le corps est pourtant souvent repoussé et mis à distance. Des études ont montré que le toucher faisait baisser la peur et l’angoisse de la mort chez des patients en fin de vie.
Le philosophe du corps Bernard Andrieu regrette cette perte du lien tactile dans nos sociétés.
Il observe que le toucher et ce besoin d’être touché, disparaissent au profit du virtuel et de l’immatériel. Et il nous invite sans tarder à une reconquête sensorielle pour découvrir ces pouvoirs immenses. »
Ces informations vous les trouverez dans cette émission : <le pouvoir du toucher> dans la chronique de Mathieu Vidard du 15 mars 2018.
Une émission de Mathieu Vidard plus ancienne, de 2016, expliquait tout cela plus longuement <La tête au carré du 3 février 2016>. Et il suggérait :
« Le toucher pourrait bien être celui de nos cinq sens qui nous connecte le plus directement à nos semblables. »
A force de rendement, de compétition, de productivité nous allons vers plus d’inhumanité.
Dans le mot du jour qui parlait des abeilles qui pollinise avant de produire du miel, Yann Moulier Boutang rappelait :
« Qu’est-ce que fait l’humain principalement ? Un output marchand à partir de marchandise ?
Non ! il produit essentiellement du vivant à partir du vivant.L’humain ne fait pas que se reproduire, il met au monde des enfants mais qu’il élève et en cela il crée quelque chose de nouveau !
Il produit son environnement, il produit des relations, il produit du lien etc.
Mais pour des humains, en dehors des sociologues qui faisait de grandes déclarations qui disaient « le lien social c’est important », les assistantes sociales qui disaient « il ne faut pas couper dans les dépenses publiques », « il ne faut pas couper dans l’éducation parce que c’est la base de la société, parce que c’est la richesse de la société ». Parce que c’est aussi la possibilité pour les entreprises de ne pas avoir des employés qui sont totalement malades ou totalement handicapés sur tous les plans. »
<1039>
-
Vendredi 16 mars 2018
« Cet Univers ne serait pas grand-chose, s’il n’abritait pas les gens qu’on aime »Stephen HawkingStephen Hawking étaient le père de trois enfants : Lucy, Robert et Tim. Ce sont eux qui ont publié un communiqué où ils ont écrit :
« Nous sommes profondément attristés par la mort de notre père aujourd’hui. C’était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont l’œuvre et l’héritage vivront de nombreuses années. […]. Il avait déclaré un jour : « Cet Univers ne serait pas grand-chose s’il n’abritait pas les gens qu’on aime. » Il nous manquera toujours. »
Vendredi dernier, j’avais entendu la chronique de Sonia Devillers sur France Inter consacré aux Jeux Paralympiques où elle décrivait la place des handicapés dans la société. Au moment de l’écoute j’avais l’intention d’en faire un mot du jour et puis… je suis passé à autre chose.
Et ce mercredi 14 mars 2018, l’immense scientifique, Stephen Hawking dont j’avais lu avec passion « Une brève histoire du temps » peu de temps après sa sortie dans les années 1990, est mort. Cet homme était terriblement handicapé : un esprit exceptionnel dans un corps détruit. Lui est même arrivé à faire de son handicap un atout, une marque de fabrique. Il a dit :
« Je suis certain que mon handicap a un rapport avec ma célébrité. Les gens sont fascinés par le contraste entre mes capacités physiques très limitées et la nature extrêmement étendue de l’Univers que j’étudie ».
Lors de la chronique de Sonia Devillers, j’ai appris que 12 millions de français sont handicapés.
Elle exprimait les progrès de la télévision par rapport à la visibilité des handicapés notamment grâce aux jeux paralympiques :
«Mais souvenez-vous, succès d’audience totalement inattendu lors de Rio 2016. Un plébiscite du public. Et du beurre dans les statistiques carrément honteux de la télévision en général. Seulement 0,8% des gens vus à l’écran sont en situation de handicap. Et sans les Jeux Paralympiques ce serait encore moins. […]
Exit animateurs et journalistes handicapés
Souvenez-vous : la télé reste un spectacle visuel qu’on ne veut pas gâcher. Dans les talk-shows, les invités handicapés viennent témoigner du handicap. Ce qui est débile. Ils peuvent intervenir dans tous les champs d’expertises comme n’importe quel valide.
Côté fiction, c’est pareil. Soit, on cause du handicap, soit on montre des héros qui le surpassent en permanence. Mimie Mathy et ses super-pouvoirs sur la Une. « Cain », le commissaire en fauteuil sur la deux. On manque de personnages ordinaires : employés de mairies, médecin, profs… handicapés, mais on s’en fout, leur fonction n’étant pas du tout celle-ci dans le récit. Juste, on s’habitue à voir leur corps à l’écran.
Reste le divertissement. Là, ça bouge, vraiment
Et comme souvent, en matière de diversité, ça vient de « The Voice », sur TF1, qui sélectionne les candidats uniquement à la voix, pas au physique.
On se souvient de Jane, toute jeune malvoyante, face caméra, sans lunettes noires, alors que ses yeux – strabisme et pupilles blanchies – sont très marqués par le handicap. Pas de lunettes, exactement comme le réclame une nouvelle génération d’aveugles qui se bat d’ailleurs pour faire autre chose que de la musique, pour ne pas ressembler à Gilbert Montagné, pour faire des études et du sport. Bref, pour que les modèles de réussite changent. Regarder un champion paralympique triompher à la télé, c’est comme filmer un aveugle sans lunettes. C’est accepter la différence et mettre scène ses espérances »
Lors de sa revue de presse de mercredi, Claude Askolovitch a introduit le sujet du handicap et de l’œuvre de Stephen Hawking par cette phrase :
« La victoire de la pensée sur la chair »
 Stephen Hawking est né à Oxford le 8 janvier 1942. Son père, biologiste, souhaite qu’il suive ses pas en étudiant la médecine à Oxford. Il opte pour la physique avant de partir pour Cambridge, afin d’y poursuivre des recherches en astronomie.
Stephen Hawking est né à Oxford le 8 janvier 1942. Son père, biologiste, souhaite qu’il suive ses pas en étudiant la médecine à Oxford. Il opte pour la physique avant de partir pour Cambridge, afin d’y poursuivre des recherches en astronomie.
Peu après son 21e anniversaire, il apprend qu’il souffre d’une maladie dégénérative paralysante. Les médecins ne lui donnent que deux ans à vivre. Son corps décline inexorablement. En 1974, il est incapable de se nourrir ou de sortir de son lit par lui-même. En 1985, il perd définitivement l’usage de la parole après avoir subi une trachéotomie à la suite d’une pneumonie. Mais son esprit est intact. Et son but simple : « Comprendre complètement l’Univers, pourquoi il est comme il est et pourquoi il existe. »
Le Monde précise la maladie dont était atteint Stephen Hawking :
Stephen Hawking était atteint d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative paralysante aussi appelée maladie de Charcot. Une maladie rare, décelée chez environ 2 500 personnes par an en France. Elle fait partie du groupe des maladies des neurones moteurs, qui dégénèrent progressivement et font perdre aux malades le contrôle de leurs muscles.
« La perte de motricité est la conséquence d’une dégénérescence, c’est-à-dire d’une mort cellulaire, des motoneurones, les cellules nerveuses [neurones] qui commandent les muscles volontaires. »
Concrètement, cela commence par une perte de la capacité à bouger les bras, les jambes. Puis lorsque les muscles du diaphragme et de la paroi thoracique sont atteints, les patients perdent leur capacité respiratoire et sont placés sous assistance. C’était le cas depuis des années de Stephen Hawking.
Les médecins continuent à considérer la longévité de l’astrophysicien comme un mystère, la maladie étant incurable. Selon les statistiques médicales, la mort survient habituellement vingt-quatre à trente-six mois après le diagnostic. Le plus souvent, c’est l’incapacité à respirer qui emporte le patient.
Wikipedia nous apprend que les médecins avaient proposé à sa femme d’éteindre la machien qui le raccrochait à la vie mais que cette dernière a refusé et qu’il a donc encore vécu, réfléchi et publié pendant 33 ans :
« En 1985, il a contracté une pneumonie et a dû subir une trachéotomie pour mieux respirer, ce qui l’a rendu définitivement incapable de parler.
C’est à cette époque qu’il est proposé à Jane Wilde Hawking [son épouse] d’éteindre la machine qui le raccroche à la vie. De fait, les médecins n’estiment pas possible que Stephen Hawking puisse un jour se porter mieux. Pour autant Jane Wilde Hawking refuse et les médicaments font peu à peu effet et permettent à Hawking de se remettre partiellement de sa pneumonie.
Walt Waltosz, un informaticien de Californie, a construit un dispositif permettant à Hawking d’écrire sur un ordinateur avec un commutateur dans sa main, tandis qu’un synthétiseur vocal parle pour lui, lisant ce qu’il vient de taper.
Ayant perdu l’usage de ses mains, il utilise à partir de 2001 les contractions d’un muscle de sa joue détectées par un capteur infrarouge fixé à une branche de ses lunettes, pouvant ainsi sélectionner les lettres une par une sur un clavier virtuel d’une tablette dont un curseur balaie en permanence l’alphabet, puis sélectionner des mots grâce à un algorithme prédictif. Ce système lui permet d’exprimer cinq mots à la minute et de donner des cours à l’université de Cambridge jusqu’en 2009.
Face à l’aggravation de son état, Intel met au point depuis une nouvelle interface de contrôle basée sur la reconnaissance faciale des mouvements de ses lèvres et sourcils ».
Le Point a tenté de sélectionner <douze citations inspirantes de Stephen Hawking>
J’en choisis deux parmi elles :
« L’intelligence est la capacité de s’adapter au changement. »
et
« Au fond, j’aurai eu une belle vie. Les personnes handicapées devraient se concentrer sur les choses que leur handicap ne les empêche pas de faire, sans regretter ce dont elles sont incapables. »
Mais c’est celle que j’ai mis en exergue que je préfère, car elle correspond profondément à ce que je ressens : « Cet Univers ne serait pas grand-chose s’il n’abritait pas les gens qu’on aime ».
Qu’un homme de l’intelligence, de la fragilité corporelle de Stephen Hawking, un homme à qui on avait annoncé à 21 ans qu’il ne vivrait pas plus de 2 ans et qui a vécu par sa volonté et par la science jusqu’à 76 ans ait pu dire cela, constitue une immense leçon d’humanité pour chacun de nous.
<1038>
-
Jeudi 15 mars 2018
« Cela va de toute façon craquer. Je pense qu’on va aller un jour vers une catastrophe sociale ! »Sylviane AgacinskiOlivier Besancenot était l’invité de Ruquier dans l’émission « On n’est pas couché » du 3 mars 2018.
Comme souvent, il a été très brillant !
Il a répété cette phrase qui me semble plein de justesse :
« Le comble du comble, c’est qu’on vit dans un monde où ceux qui gagnent 150 000 € par mois en exploitant les autres arrivent à convaincre ceux qui vivent avec 1 500 que la cause de leur problème sont ceux qui vivent avec 2 000 ou avec 500 »
Vous pouvez retrouver tout l’entretien derrière ce <Lien>
Mais ce n’est pas de son intervention que je voudrais parler aujourd’hui mais de celle de la philosophe Sylviane Agacinski ;
Sylviane Agacinski est née en 1945. Elle fut un moment proche de Jacques Derrida. Elle a enseigné à l’École des hautes études en sciences sociales de 1991 à 2010.
Même si ce détail est peu important, je note qu’elle a fait ses études au lycée Juliette-Récamier de Lyon et passé sa licence de philosophie à l’université de Lyon.
Elle est très active actuellement sur un sujet d’importance : la lutte contre la marchandisation du corps des femmes et la gratuité du don d’organe.
Elle vient de publier, au Seuil un livre : « Le tiers-corps – Réflexions sur le don d’organes »
Telerama a consacré un article à ce livre « Le don d’organes solidaire et gratuit est la seule option pour éviter la marchandisation du corps »
Outre « On n’est pas couché » elle avait été invitée sur France Inter : « Personne ne va vendre l’un de ses reins s’il n’est pas dans une grande misère » et sur France Culture à l’émission <La Grande Table> du 9 mars 2018 où elle avait notamment dit :
« Le don est un élan, un geste par essence non commercial et qui peut ne pas être payé en retour. La réciprocité n’est pas un automatisme. Dans le cas du don d’organes, elle est indirecte, car le donneur rend ce qu’il a reçu par ailleurs de la société. »
Mais le point central de ce que je veux partager aujourd’hui, c’est son intervention vers la fin de l’entretien des chroniqueurs de Ruquier avec Olivier Besancenot.
Laurent Ruquier l’interpelle et lui demande ce qu’elle pense de ce que dit Olivier Besancenot. (Cela commence à 29:30) <Je redonne le Lien>
« Je suis très touché par ce discours.
D’abord, on vient de fermer la Poste à côté de chez moi, je sais que dans les villages c’est une catastrophe quand la Poste disparait.
Et avant qu’elle ferme il y a de plus en plus de machines.
J’avais une banque, il y avait plein d’employés, on avait des rendez-vous facilement.
Maintenant on se trouve dans un petit hall de gare affreux avec 4 machines et une employé et on fait la queue pour obtenir quelque chose.
Ce n’est pas toujours plus pour l’usager, c’est toujours moins.
C’est aussi toujours moins pour les gens qui travaillent. Ce n’est pas toujours plus.
C’est un discours qui me touche […]
Vous parlez justement sur la sécurité du travail. Je regardais à la télévision différents reportages.
J’ai vu des choses…
On nous donne parfois l’Allemagne en modèle, on s’aperçoit que pour arriver à avoir autour de 1000 euros ou un peu plus, des millions d’allemands ont 2 ou 3 jobs.
Ils se lèvent très tôt le matin et se couche très tard le soir, ils ont 3 emplois pour en arriver là.
Après on va dire, oui mais ils ont moins de chômage que nous.
Oui mais à quel prix, ils ont moins de chômage ?
J’ai vu un autre reportage sur les « Work campers » aux Etats-Unis.
Il y a des industries qui ferment, ce ne sont pas les politiques qui sont en cause c’est le système capitaliste et la logique du profit à tout prix.
Ce sont des travailleurs endettés qui vendent leurs maisons et achètent un camping-car. Ce ne sont pas les plus déshérités.
Ces gens vont sillonner l’Amérique avec leur camping-car pour ce que certains vont appeler la mobilité, la fluidité et ils vont d’une ville à l’autre chercher du travail.
Un couple, le dernier travail qu’on leur propose c’est un travail de 12 heures par jour, 7 jours consécutifs pour ramasser les betteraves. [..]
Nous sommes quand même effarés, il y a là une telle abolition des droits élémentaires que chacun essaye de sauver sa peau comme il peut. C’est une catastrophe. [..]
Il y a derrière tout cela aussi l’Europe, les institutions européennes, l’ouverture au marché, l’Europe est l’ensemble le plus ouvert au marché et à la concurrence, il y a la mondialisation.
Alors qu’est-ce que vous voulez que les politiques fassent ?
- Ou ils suivent la logique économique telle qu’elle est
- Ou ils essayent de lutter avec des gens qui se raccrochent désespérément à leurs dernières [elle ne finit pas cette phrase et ajoute] de toute façon cela ne pourra pas tenir.
Je sens une impuissance du politique dans l’histoire
Normalement on devrait penser que l’économie est au service des êtres humains, ce n’est pas le cas.
Ce sont les humains qui sont tous au service de l’économie, c’est-à-dire au service des profits du capitalisme financier qui pressent, qui pressent pour plus de taux de profit.
Cela va de toute façon craquer.
Je pense qu’on va aller un jour vers une catastrophe sociale.et là ça sautera. »
Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas Sylviane Agacinski a épousé Lionel Jospin en 1994 …
<1037>
- Ou ils suivent la logique économique telle qu’elle est
-
Mercredi 14 mars 2018
« Qu’est-il arrivé à la gauche européenne ?»Jan RovnyIl y a 18 ans nous étions l’an 2000.
- La France était gouvernée par le Parti socialiste et Lionel Jospin qui était premier ministre. Lors des dernières élections du 1er juin en 1997, le Parti Socialiste avait obtenu 38,05%.
- En Grande Bretagne, le pouvoir était exercé par le Parti Travailliste de Tony Blair vainqueur des élections du 1er mai 1997, avec 43,2% des voix
- En Allemagne, le pouvoir était exercé par le SPD. Le Chancelier était Gerhard Schröder il avait gagné les élections fédérales du 27 septembre 1998, avec 40,9% en battant le mythique Helmut Kohl et son CDU.
- En Italie, la coalition au pouvoir était le centre gauche de Romano Prodi élu le 21 avril 1996 avec 43,39% des voix. Il est vrai que dès le 13 mai 2001 Silvio Berlusconi et sa « Maison des Libertés » battaient la coalition social-démocrate.
- En Espagne c’était la droite qui était au pouvoir, le premier ministre était José Maria Aznar. Il avait battu le dirigeant historique du Parti Social Ouvrier Espagnol Felipe Gonzalez qui avait quand même obtenu 37,63% aux élections du 3 mars 1996.
- Et en Grèce, c’était le Parti socialiste le PASOK qui avait remporté les élections du 9 avril 2000 avec 43,79% des voix. Il faisait l’objet d’une reconduction.
Aujourd’hui, en Espagne la droite est toujours au pouvoir et dans tous les autres pays les partis sociaux-démocrates ont perdu le pouvoir, sauf en Allemagne où ils sont partenaires de la Droite qui gouverne.
La chute la plus impressionnante est celle du PASOK grec qui est passé de 43,79% à 6,28% aux dernières élections remportées par Syriza. La France est quand même très proche passant de 38,05% à un peu plus de 8% en 2017.
Il y a 18 ans, la social-démocratie gouvernait donc la grande majorité des pays européens, elle est aujourd’hui en recul voire en effondrement partout.
Pourquoi ?
Philippe Meyer cite souvent l’ancien secrétaire général de FO André Bergeron qui disait : « Pour négocier il faut qu’il y ait du grain à moudre ». Et il semble bien que dans le cadre de la mondialisation, du libre-échange, de la liberté de circulation des capitaux, il n’y ait plus grande matière à négocier. Du moins c’est l’idée qui s’est imposée à la sociale démocratie. Des partis plus à gauche que les sociaux-démocrates contestent absolument cette idée : ils pensent qu’il y a toujours du grain à moudre. Le seul Parti se réclamant de cette mouvance, le Parti Syriza de Grèce qui est arrivé au pouvoir, a au bout de quelques mois cédé pour revenir à l’orthodoxie où il n’y a pas de grain à moudre.
Brice Couturier qui continue ses rubriques qui s’intéressent à ce que des penseurs et des journalistes d’autres pays que la France pensent et écrivent a consacré une émission le 9 mars à cette question <La sociale démocratie se meurt>
Et a posé cette question : Où est passée la social-démocratie, qui faisait partie du code génétique de la plupart de nos nations européennes ?
Il complète d’abord le panorama que j’ai dressé ci-avant par d’autres exemples sur la même période :
- Le Parti social-démocrate Tchèque est passé de 30 à 7 %
- Les sociaux-démocrates néerlandais, de 15 à 5 %.
Tous ces faits doivent rassurer mes amis socialistes : Le PS français n’est pas seul à avoir des problèmes et la chute de la social-démocratie n’est pas une question française, mais une question européenne.
Pour essayer de donner un éclairage, Brice Couturier cite Jan Rovny, un politologue d’origine tchèque, formé au Canada et aux Etats-Unis, qui enseigne également à Science Po.
Il a publié une étude intitulée «What happened to Europe’s left ? » c’est-à-dire « Qu’est-il arrivé à la gauche européenne » et qui a été mise en mise en ligne sur le site de la London School of Economics le 22/02/2018. Et que pouvez lire dans son intégralité si vous êtes familier avec la langue de Shakespeare et que vous cliquez sur ce <Lien>.
Brice Couturier résume cette étude de la manière suivante :
« Jan Rovny observe en premier lieu que cette baisse tendancielle s’est s’accélérée. Les résultats des élections de 2017 ont enregistré là où elles ont eu lieu un véritable effondrement. Il s’agit donc bien d’un processus et il est général.
La première cause qui vient à l’esprit, c’est la crise de 2008. Mais comment expliquer que cette crise, due aux dérèglements de la finance, et présentée parfois – on s’en souvient – comme « la crise finale du capitalisme » – ait bénéficié plus souvent aux populistes de droite que de gauche ?
L’électorat de la gauche n’a pas tant basculé vers d’autres partis qu’il ne s’est « volatilisé ».
Certes, il y a eu des transferts d’allégeance vers l’extrême-droite ou la gauche radicale, mais les partis socialistes et sociaux-démocrates ont surtout vu leurs électorats naturels fondre comme neige au soleil. »
La première cause évoquée par le politologue tchèque est l’évolution de la classe ouvrière en raison des évolutions technologiques
Les vraies causes, selon Jan Rovny, sont à chercher, en effet, du côté des changements technologiques.
La classe ouvrière, qui constituait le socle électoral des partis de gauche, a énormément diminué en nombre. La contre-culture ouvrière, à travers laquelle les travailleurs prenaient conscience de leur identité et de leur force transformatrice, a disparu.
L’ancienne classe ouvrière a été remplacée par un précariat de travailleurs peu qualifiés, affectés aux emplois de services – restauration, nettoyage, surveillance, transports.
Cette classe nouvelle, issue en grande partie de l’immigration, a peu de moyens d’organisation et pas d’appartenance politique fixe.
La seconde idée peut être résumée par ce constat contradictoire : la gauche a été victime de son succès et de l’émancipation qui ont conduit à un plus grand individualisme.
Ensuite, c’est le succès de la gauche qui a paradoxalement entraîné sa propre disparition. Les gens se sont émancipés – y compris des cadres structurels de la gauche…
L’accès généralisé aux études supérieures, couplé avec les possibilités d’information offertes par les nouvelles technologies, a provoqué une individualisation de la société.
Les partis de gauche ont tenté de coller à l’aspiration à de nouveaux droits individuels, épousant le désir d’autonomie et de mobilité des jeunes générations diplômées.
Ce faisant, ils sont devenus des partis de classes moyennes en ascension.
Convertis au social-libéralisme et appuyés sur le noyau dur électoral de la fonction publique, ils ont abandonné les classes populaires aux populistes, qui leur promettent « protection économique et traditionalisme culturel ».
Mais en fin de compte jan Rovny revient sur une dichotomie qui me semble fondamentale : une économie entièrement tourné au bénéfice des consommateurs et au détriment des producteurs. C’est pourquoi la mondialisation a provoqué une fracture entre « cosmopolites » et « traditionalistes ».
Les partis de gauche ont accompagné un autre processus dont ils sont devenus les victimes, la mondialisation. Le « transnationalisme », expression préférée par Jan Rovny, a remplacé les travailleurs et les produits locaux par – je cite « des alternatives moins coûteuses ». Cela a, certes, bénéficié aux consommateurs, mais au détriment des producteurs, victimes de la concurrence étrangère dans les secteurs exposés.
Le transnationalisme est en outre un phénomène culturel. D’un côté, il permet aux classes favorisées de voyager à une échelle sans précédent, tant pour leurs affaires que pour le tourisme. Les familles transculturelles vivent dans un monde riche de potentialités multiples dont ils peuvent faire bénéficier leurs enfants.
Mais ceux dont les ressources sont limitées vivent « dans un monde défini par des frontières nationales, des mœurs spécifiques, une seule langue. » chez eux, l’arrivée massive de migrants, culturellement différents, aggrave le sentiment d’aliénation.
Du coup, les sociétés se divisent dorénavant en « cosmopolites », favorables à l’ouverture des frontières et à la liberté des échanges et « traditionnalistes », favorables au protectionnisme et au respect des souverainetés. La vieille alliance entre les cadres et intellectuels, d’une part et la classe ouvrière, de l’autre, alliance sur laquelle reposaient les partis de gauche, est fracturée.
L’ancien clivage, qui opposait la gauche et le droite, est supplanté par d’autres, fondées sur des critères ethniques et culturels, ou encore entre habitants des métropoles et des périphéries.
Les partis de gauche sont mal équipés pour y faire face.
Pour ma part je pense, en outre que cette fracture remonte de plus en plus dans les couches sociales de la classe moyenne : je veux parler de ce phénomène que le bénéfice tiré des prix bas de la consommation ne compensent plus ce qui est perdu en tant que producteur pour toutes ces personnes. Ce phénomène me semble toucher de plus en plus de gens.
On comprend bien que derrière tout cela se pose la question du libre-échange.
Mais mettre fin au libre-échange, même en partie, cela aurait pour conséquence de pénaliser le consommateur, les prix seront plus élevés et certains produits ne seront plus accessibles.
Il n’est pas certain que le plus grand nombre sera en accord avec cette perspective.
PS : Jean-Philippe a ajouté un commentaire très intéressant que je conseille à chaque lecteur d’aller consulter.
<1036>
- La France était gouvernée par le Parti socialiste et Lionel Jospin qui était premier ministre. Lors des dernières élections du 1er juin en 1997, le Parti Socialiste avait obtenu 38,05%.
-
Mardi 13 mars 2018
« Les démocraties détruisent tous les leaderships. C’est un grand sujet, ce n’est pas un sujet anecdotique ! »Nicolas Sarkozy lors d’une conférence à Abu DhabiHier, j’opposais la démocratie allemande à ce que nous vivions en France.
Soyons juste, au regard de l’Histoire l’apport à la démocratie libérale de l’Allemagne n’est pas déterminante.
Le pays qui est à la source de la démocratie libérale moderne est indiscutablement la Grande Bretagne, puis les Etats-Unis ont aussi fait leur part.
La France a également joué son rôle mais beaucoup plus par la parole, les concepts, les déclarations, les idées que par la froide réalité des faits.
Si on remonte à 1780, jamais ni aux Etats-Unis, ni en Grande Bretagne, il n’y a eu le régime de terreur de la Convention, ni un Napoléon Ier, ni un Napoléon III, ni un Charles X, ni bien sûr un Pétain. Et aujourd’hui encore notre système démocratique est largement inachevé : manquant de contre-pouvoir, beaucoup trop centré sur le Président et sa cour de l’Elysée.
Mais si on parle de L’Allemagne : Avant 1945, la démocratie est inexistante et, lors de la petite période de la République de Weimar, vacillante et surtout conduisant au mal absolu.
La démocratie allemande actuelle a été imposée par les alliés et notamment les Etats-Unis. Mais depuis, ayant appris de leur terrible Histoire, les allemands ont peu à peu construit un système démocratique assez exemplaire, en tout cas beaucoup plus que le système français où il y en a encore qui discute de l’intérêt du non cumul des mandats ou de la limitation du nombre de mandats successifs…
Mais pour toujours parler de la démocratie, j’ai lu des articles qui relataient des propos de l’ancien Président de la République, qui puisant dans son expérience accepte des emplois de conférencier dans le monde.
Il a donc été invité par les Émirats arabes unis il y a une semaine pour tenir une conférence dans laquelle il était question des différents leaders politiques mondiaux actuels et de la…fragilité ? des démocraties.
Vous trouverez derrière <ce lien un article du Point sur la conférence tenue par le président Nicolas Sarkozy à Abu Dhabi> :
L’ancien président de la République participait donc à la conférence « Abu Dhabi Ideas Week-End », samedi 3 mars 2018, et a tenu un discours de près d’une heure devant environ 150 personnes.
Des journalistes notamment du Monde se sont procurés l’enregistrement audio de son intervention, axée sur les grandes problématiques du monde.
La vision de Nicolas Sarkozy met en avant le rôle prépondérant de la Russie et de la Chine. Il développe aussi son point de vue sur les démocraties, menacées, selon lui par manque de grands leaders.
Pour Nicolas Sarkozy, les grands leaders du monde actuel ne sont pas les dirigeants des démocraties.
« Quels sont les grands leaders du monde aujourd’hui ?
Le président Xi, le président Poutine – on peut être d’accord ou pas, mais c’est un leader –, le grand prince Mohammed Ben Salman [d’Arabie saoudite].
Et que seraient aujourd’hui les Emirats sans le leadership de MBZ [Mohammed Ben Zayed] ? »
Il donne les raisons pour lesquelles, selon lui, les démocraties ne parviennent plus à dégager des grands leaders :
« Quel est le problème des démocraties ? demande l’ancien président. C’est que les démocraties ont pu devenir des démocraties avec de grands leaders : de Gaulle, Churchill…
Mais les démocraties détruisent tous les leaderships. C’est un grand sujet, ce n’est pas un sujet anecdotique ! […]
Les démocraties sont devenues un champ de bataille, où chaque heure est utilisée par tout le monde, réseaux sociaux et autres, pour détruire celui qui est en place. Comment voulez-vous avoir une vision de long terme pour un pays ?
C’est ce qui fait que, aujourd’hui, les grands leaders du monde sont issus de pays qui ne sont pas de grandes démocraties. »
Puis il oppose le grand leader et le leader populiste. Il m’étonne un peu quand il prétend que le dirigeant actuel de la Hongrie n’est pas populiste. Voilà ce qu’il dit :
« D’abord pour moi, M. Orban en Hongrie [le premier ministre], c’est pas un populiste. Mais là où il y a un grand leader, il n’y a pas de populisme !
Où est le populisme en Chine ? Où est le populisme ici ? Où est le populisme en Russie ? Où est le populisme en Arabie saoudite ?
Si le grand leader quitte la table, les leaders populistes prennent la place. Parce que la polémique ne détruit pas le leader populiste, la polémique détruit le leader démocratique. »
Et enfin, encore plus surprenant il défend l’idée du mandat prolongé du président chinois Xi Jinping, certains disent « mandat à vie ». C’est d’autant plus étonnant que c’est lui qui a œuvré, en France, pour que le Président de la République ne puisse être réélu qu’une seule fois pour une présidence donc limitée à 10 ans :
« Le président Xi considère que deux mandats de cinq ans, dix ans, c’est pas assez. Il a raison ! Le mandat du président américain, en vérité c’est pas quatre ans, c’est deux ans : un an pour apprendre le job, un an pour préparer la réélection. Donc vous comparez le président chinois qui a une vision pour son pays et qui dit : « Dix ans, c’est pas assez », au président américain qui a en vérité deux ans. Mais qui parierait beaucoup sur la réélection de Trump ?
Ce matin, j’ai rencontré le prince héritier MBZ. Est-ce que vous croyez qu’on construit un pays comme ça, en deux ans ? Ici, en cinquante ans, vous avez construit un des pays les plus modernes qui soient. La question du leadership est centrale. La réussite du modèle émirien est sans doute l’exemple le plus important pour nous, pour l’ensemble du monde.
J’ai été le chef de l’Etat qui a signé le contrat du Louvre à Abou Dhabi. J’y ai mis toute mon énergie. MBZ y a mis toute sa vision. On a mis dix ans ! En allant vite ! Sauf que MBZ est toujours là… Et moi ça fait six ans que je suis parti. »
Le concept du mandat à vie fait aussi rêver Donald Trump comme le raconte le journal « Les Echos ». « Il est président à vie, président à vie. Il est formidable », a lancé Donald Trump face à ses partisans lors d’une levée de fonds en Floride.
Le président américain faisait référence à l’annonce dimanche dernier, de la fin de la limitation du nombre de mandats présidentiels en Chine et il a ajouté :
« Vous voyez, il a été capable de le faire. Je pense que c’est super. Peut-être que nous devrions tenter le coup, un de ces jours ».
Quelle horrible perspective : Donald Trump, président à vie !
Mais pour revenir au propos de Nicolas Sarkozy …
On ne peut qu’être d’accord avec son constat que pour faire bouger un pays, il faut une vision à long terme.
Je pense que sur ce point il n’y a pas débat.
Evidemment que dans les pays non démocratiques, avec donc des dictateurs (je trouve, dans ce cas, le terme de leader inapproprié) une vision à long terme est plus facile à mettre en œuvre.
Mais est-ce que le sort des citoyens de ces pays non démocratiques est enviable ? Y a-t-il moins de corruption ? Moins d’inégalité ? Plus de bonheur et de joie ? Plus de vie ?
Alors le problème est-il celui du leadership qu’on « dézingue » sans cesse dans les pays démocratiques ?
Je vais reprendre l’exemple de l’Allemagne depuis 1945. Il y a eu des chanceliers sérieux et respectables, mais était-ce des leaders dans le sens évoqué par Nicolas Sarkozy ?
Je ne pense pas, je pense qu’il y avait une classe politique de qualité et même s’il y avait des alternances, un parti ne passait pas son temps à détruire ce qu’avait fait son prédécesseur, surtout pour des motifs idéologiques. Il y avait une certaine continuité sur les problèmes fondamentaux, rendant ainsi possible une vision à long terme.
Plus que jamais je ne crois pas un seul instant, surtout dans le monde aujourd’hui, au besoin d’un chef omnipotent qui sait tout ou presque et qui décide de tout.
Je crois dans le besoin d’un travail en équipe, dans l’écoute et l’enrichissement mutuel. Bien sûr il faut à un moment qu’une femme ou qu’un homme (à dessein je l’écris dans ce sens) qui porte le programme, le travail de l’équipe. Mais ce rôle doit être précaire, l’intelligence du projet et de l’organisation se trouve justement dans la capacité de pouvoir remplacer assez facilement le leader par un autre membre de l’équipe. Et c’est excessivement dangereux pour l’équilibre des pouvoirs et même la santé mentale du leader précaire de se croire indispensable et irremplaçable.
Le fait qu’on a du mal à remplacer le leader ou même qu’on ne voit pas qui pourrait remplacer le leader est révélateur, selon moi, d’un grave problème.
La continuité se trouve dans l’équipe pas dans le leader à qui il peut arriver tant de choses, la mort par exemple.
Par ailleurs, l’idée que le leader puisse être remplacé par sa fille, son fils ou son épouse est elle aussi totalement incongrue, vestige d’une époque monarchique ou féodale qui n’a plus aucune pertinence aujourd’hui. L’idée que dans une équipe, la personne la plus appropriée pour succéder au leader est un de ses enfants n’a jamais pu être prouvée par la génétique et constituent certainement une insulte aux probabilités sur la répartition des compétences entre les gens.
Voici donc ce que m’inspirent ces propos de l’ancien président dont je partage le diagnostic, mais dont je récuse absolument la thérapie.
Je m’inscris tout simplement dans l’héritage de Mendès-France. Je vous renvoie à l’un des mots du jour consacré à ce grand visionnaire : <Celui du 1er octobre 2015>
<1035>
-
Lundi 12 mars 2018
«Die GroKo »Nom de la coalition CDU-CSU et SPD qui va gouverner l’Allemagne après l’accord obtenuNos amis allemands ne m’ont pas trahi.
J’avais lors du mot du jour du Lundi 25 septembre 2017 posé cet acte de foi :
« Personne n’imagine un seul instant qu’il ne sera pas possible de créer une coalition. Pour ma part, je suis persuadé que si en fin de compte cela s’avère très compliqué, le SPD reviendra sur sa décision de ne pas participer à la coalition.
Car en Allemagne, les politiques considèrent toujours qu’il faut préférer l’intérêt du pays à l’intérêt de son parti. »
Et c’est ce qui vient de se passer !
Pour celles et ceux qui ne suivent pas précisément la vie politique allemande, un rappel des faits, pour les autres vous pouvez sauter ce paragraphe.
Lors des dernières élections législatives allemandes, la liste CDU-CSU d’Angela Merkel arrivée en tête a recueilli 33 33% (pour comparer Emmanuel Macron a obtenu au premier tour des présidentielles 24 %).
Quand on représente 33% du corps électoral en Allemagne on ne peut pas gouverner seul, il faut donc réaliser une coalition.
Les socialistes, c’est-à-dire SPD, sont en coalition avec le CDU-CSU depuis 2013 sous la direction de la chancelière Merkel, il l’était déjà de 2005 à 2009 qui fut le premier mandat de Merkel. Les résultats du SPD depuis dégringolent lors de chaque élection. Après les élections du 24 septembre, le SPD a décidé de ne pas entrer dans une nouvelle coalition qu’il jugeait contre-productive du point de vue de son audience électorale.
Merkel s’est donc tourné vers deux autres partis : les Ecologistes et le parti libéral (FDP). En Allemagne les partis ont des couleurs (CDU noir, Ecologistes vert, FDP (jaune), SPD (rouge) et les coalitions prennent le nom des couleurs.
Ainsi la coalition que tentait Merkel était Noir, Jaune et Vert qu’on désigne sous le nom de coalition jamaïcaine puisque ce sont les trois couleurs du drapeau de la Jamaïque.
A ce stade, les partis allemands négocient pour se mettre d’accord sur un programme de gouvernement comme je l’expliquais dans le précédent mot du jour
Et les libéraux finalement ont dit Non et ont arrêté de négocier. « Il est préférable de ne pas gouverner que de mal gouverner », a déclaré à la presse à Berlin, le président des Libéraux du FDP Christian Lindner, fin novembre, après deux mois de négociations.
Et comme je l’avais intuitivement prévu : je suis persuadé que si en fin de compte cela s’avère très compliqué, le SPD reviendra sur sa décision de ne pas participer à la coalition. Le SPD est bien revenu sur son refus de négocier.
Et c’est là qu’il faut suivre et comprendre ce que c’est qu’une vraie démocratie, pour nous autres français qui avons l’habitude de donner les clés à un homme et ensuite de voter ou de s’abstenir pour que l’homme qui a les clés puissent disposer d’une assemblée avec une majorité absolue dévouée à le satisfaire.
- Donc le SPD est d’abord revenu vers ses militants pour obtenir le droit de négocier.
- Puis ils ont négocié pendant 3 mois (décembre – février) pour parvenir à un programme de gouvernement qu’ils vont fidèlement mettre en œuvre ;
- Et Angela Merkel est revenu vers les 1000 délégués du CDU pour obtenir leur approbation, sans laquelle elle ne pouvait faire la coalition. Et, la CDU a approuvé.
- Pour le SPD ce fut encore plus compliqué, il fallait que les militants du SPD votent et acceptent cette coalition. Ce que les militants du SPD ont fait. Le SPD a annoncé que le « oui » l’a emporté à plus de 66% et 78,4% des 463.000 membres du parti ont participé au vote.
C’est ainsi que fonctionne les vraies démocraties libérales : un parti est élu sur un programme. S’il a la majorité absolue, il met en œuvre son programme. Si ce n’est pas le cas des partis ayant ensemble la majorité absolue négocient pour élaborer un programme à partir de leurs programmes respectifs en accordant une priorité au programme arrivé en tête. Et en plus, on revient vers les représentants et les militants pour avaliser l’accord de gouvernement.
En France cela ne marche pas ainsi, il y a des élections présidentielles, puis une succession d’évènements étranges pour finalement parvenir à ce que les 24% des électeurs puissent imposer leur politique aux 76% restants. Bien sûr, vous me direz : les français sont complices, personne ne les obligeait à donner la majorité absolue aux députés présentés par l’homme qui a obtenu moins d’un quart des voix.
Alain Duhamel, affirme que le peuple français est querelleur et qu’un système comme celui des allemands, c’est-à-dire un système vraiment démocratique ne peut pas fonctionner. Selon lui, il nous faut un régime quasi bonapartiste, un césarisme, bref les institutions de la Vème République.
C’est ce qu’il a écrit avec Edouard Balladur dans un livre à la gloire de la 5ème République : « Grandeur et décadence de la Vème République » et qu’il a réaffirmé dans cette émission de RTL.
Je me permets de ne pas être d’accord et de préférer un régime vraiment démocratique, même s’il faut du temps pour se mettre d’accord sur un programme de gouvernement.
En principe cette coalition devrait avoir pour nom « la coalition noir rouge », mais les allemands, s’agissant des deux partis les plus importants, ceux qui ont donné tous les chanceliers à l’Allemagne depuis la guerre, préfèrent parler de la « Große Koalition » c’est-à-dire « Grande Coalition » ce qui donne en abrégé « GroKo »
La Groko va permettre à Angela Merkel d’entamer un quatrième mandat à la tête du gouvernement : elle devrait être formellement élue chancelière par les députés mi-mars.
<1034>
- Donc le SPD est d’abord revenu vers ses militants pour obtenir le droit de négocier.
-
Vendredi 9 mars 2018
« Doudou et Zizi »Deux maires de Lyon, ayant dirigé la ville pendant plus de 70 ans !Il s’agit du dernier article consacré à Lyon et inspiré par les émissions que la Fabrique de l’Histoire a consacré à la capitale des Gaules.
Normalement ce mot devrait être consacré à la dernière émission : <1562, Lyon capitale protestante>
Quelques mots sur ce point d’histoire toutefois. Lyon est une ville catholique. Jamais la ville, ni la province qui l’entourait : le Lyonnais n’ont été dirigé par un Prince, un Duc, un Comte. Lyon était dirigé par l’Église et l’autorité était celui de l’Archevêque de Lyon. Mais en pleine guerre de religion, dans la nuit du 29 au 30 avril 1562, les protestants s’emparent militairement de Lyon. C’est notamment un chef de guerre protestant : le baron des Adrets qui imposa un pouvoir brutal jusqu’au 15 juin 1563. Tout ceci peut être approfondi en écoutant l’émission précitée.
Mais pour ce dernier article j’ai préféré, sur un mode plus léger, évoquer des maires de Lyon.
L’idée initiale est venue de la lecture d’un article de Slate consacré à la dernière campagne municipale où l’actuel Ministre de l’intérieur a conservé son mandat de maire de Lyon. C’était un article politique très sérieux qui essayait de démontrer que Lyon voulait être dirigé au centre pas forcément par un centriste.
Mais c’est un paragraphe qui a attiré mon attention et m’a révélé l’existence de Doudou et Zizi ! Slate donnait la parole à un historien Bruno Benoît qui disait à propos de Gérard Collomb :
« recueillant les fruits d’une popularité qui, remarque Bruno Benoît, lui vaut le rare privilège de se voir attribuer un surnom tout en finesse par les Lyonnais: après «Doudou» pour Edouard Herriot, puis «Zizi» pour Louis Pradel, c’est «Gégé» qui devrait être réélu fin mars pour un troisième mandat
Ma fréquentation des socialistes à partir de 2003, m’avait appris que certains d’entre eux disait « Gégé » en parlant du maire de Lyon, une impression de connivence était immédiatement perceptible avec l’édile, une sorte d’affection presque… quoique dans le monde politique les intérêts personnels ne laissent guère de place à l’affection toujours précaire et susceptible d’être révoquée.
Mais cet article m’apprenait que c’était un privilège des maires de Lyon au long cours d’avoir un « surnom ». Et je vais donc m’intéresser à « Doudou » et « Zizi ».
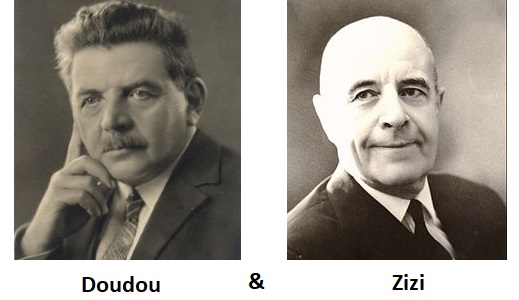
Pour ma part je trouve ces surnoms plutôt ridicules que « tout en finesse ».
Edouard Herriot a été maire de Lyon de 1905 jusqu’à sa mort en 1957. Pour être précis, il fut révoqué par le gouvernement de Vichy le 20 septembre 1940 et ne redevint maire qu’à la fin de la guerre le 18 mai 1945.
Louis Pradel lui succéda. Il fallait désigner un intérimaire à la mort de Doudou, il était l’adjoint aux sports et aux beaux-arts. On raconte que les principaux ténors politiques du conseil municipal n’arrivant pas à se mettre d’accord, il fut choisit car il ne faisait d’ombre à personne et qu’il pourrait être facilement manipulé. Tel ne fut pas le cas, il s’imposa et resta lui aussi maire jusqu’à sa mort.
A sa mort, Francisque Collomb.un de ses adjoints lui succède. Mais à partir de là ce fut plus compliqué : Francisque Collomb nomma Michel Noir comme 1er adjoint. Et Michel Noir se présenta contre lui et le battit aux élections de 1989. Michel Noir fut lui-même écarté pour des raisons d’affaires judiciaires. A contre cœur Raymond Barre vint lui succéder. Raymond Barre qui en affirmant que « Gérard Collomb serait un excellent maire de Lyon » saborda son camp politique. Et depuis grâce à « Gégé » la vie politique lyonnaise est redevenue stable et prévisible.
Mais mon sujet est Doudou et Zizi. L’amplitude de leur règne est donc de 1905 à 1976, soit 72 ans quasi ¾ du XXème siècle. C’est quelque chose 72 ans !
Les dernières années d’Edouard Herriot ont été des années de stagnation, le vieux maire n’entreprenant plus grand-chose.
Louis Pradel lui succédant engagea toute une série de travaux, pour les partisans il fut un bâtisseur, pour ses opposants il fut un « massacreur urbain » pour tous il était « Zizi le béton »
Il s’en moquait lui-même. : Aux municipales de 1965, les gaullistes présentèrent contre lui Maurice Herzog. Maurice Herzog était né à Lyon en 1919, il était le ministre de la Jeunesse et des Sports mais sa célébrité venait surtout de son exploit d’avoir été le premier européen à avoir vaincu l’Annapurna le 3 juin 1950. Cet exploit fut largement médiatisé, depuis plusieurs proches dont sa fille ont remis en cause sa légende. Mais en 1965, il était auréolé de la lumière de son exploit et du soutien de Gaulle. Mais il n’impressionna pas Pradel qui déclara : « On m’appelle « Zizi », c’est sympathique mais lui, c’est un « Zozo » qui n’a pas sa place ici ».
En 1965, Zizi créa son propre parti, le P.R.A.D.E.L. : « pour la réalisation active des espérances lyonnaises », et investit, sous cette étiquette, une liste dans chacun des arrondissements. Il gagna, dès le premier tour, la totalité des arrondissements. Zozo, dépité, s’en alla et devint maire de Chamonix en 1968 et le resta jusqu’en 1977. Il y avait donc de la place en Rhône Alpes pour Zizi et pour Zozo.
Donc Zizi est parti à New York, il fut émerveillé et revint à Lyon avec de belles idées : « il faut pouvoir traverser Lyon sans aucun feu rouge ». Il ordonna donc la traversée du centre de Lyon par l’autoroute Paris-Marseille, grâce au
 tunnel de Fourvière et au centre d’échange multimodal de Perrache, surnommé le plat de nouilles, en raison des nombreux tunnels (autoroute, métro, bus) qui s’y croisent. C’est aujourd’hui sa réalisation la plus contestée, qualifiée de connerie du siècle par Michel Noir, maire de Lyon de 1989 à 1995.
tunnel de Fourvière et au centre d’échange multimodal de Perrache, surnommé le plat de nouilles, en raison des nombreux tunnels (autoroute, métro, bus) qui s’y croisent. C’est aujourd’hui sa réalisation la plus contestée, qualifiée de connerie du siècle par Michel Noir, maire de Lyon de 1989 à 1995.
Je ne montre pas ce que lPerrache est devenu, mais une image de la Gare de Perrache telle qu’elle a été conçue. Lors du mot du jour précédent j’avais écrit qu’elle était inspirée de l’architecture du Palais impérial prévu pour Napoléon et jamais construit.
Par ailleurs et sans être exhaustif, Lyon doit à Zizi le béton :
- Le développement du tout-à-l’égout et assainissement des vieux quartiers ;
- En tant que Président des Hospices Civils de Lyon, les Hôpitaux de Neurologie et de Cardiologie ;
- Installation à Lyon du Centre international de recherche sur le cancer
- Un Palais des Congrès jouxtant la roseraie du Parc de la Tête d’Or, inaugurée avec la Princesse Grace de Monaco (Annie me fait justement remarquer que ce palais a été détruit lors de la construction de la Cité internationale par Renzo Piano. Elle le sait d’autant plus qu’à l’époque de sa démolition elle travaillait dans le cabinet Piano) ;
- Le quartier de la Duchère ;
- Le quartier de La Part-Dieu, sur les 35 ha d’une ancienne caserne de cavalerie, quartier destiné à attirer des centres de décision, incluant un centre commercial et la nouvelle Bibliothèque municipale de Lyon ;
- Le développement du métro de Lyon et après les travaux de la ligne A, la rue de la République et la rue Victor Hugo ne furent pas rendues à la circulation automobile, pour devenir les premières rues piétonnes de Lyon, ce qui peut relativiser sa passion de la voiture.
Atteint d’un cancer, il meurt quelques mois avant la mise en service du métro.
Zizi est resté concentré sur son mandat local, affirmant et respectant sa parole de ne jamais prétendre à un poste de ministre ou des responsabilités nationales.
Tel ne fut pas le cas de Doudou, l’inoubliable inventeur de cette formule :
« La politique, c’est comme l’andouillette. Ça doit sentir un peu la merde, mais pas trop. »
Après avoir été élu Maire de Lyon en 1905, il devient sénateur en 1912 et embrasse ainsi une carrière politique nationale qui fait de lui l’un des principaux représentants du parti Radical.
<Ce site parle de tous les maires de Lyon> (D’ailleurs vous trouverez une photo de Gérard Collomb jeune assez étonnante)
Et concernant Doudou, il dit les choses suivantes :
« Il s’engage dans l’affaire Dreyfus aux côtés d’Émile Zola et Anatole France, et fonde la section lyonnaise de la Ligue des droits de l’homme. Il s’affirme comme un orateur exceptionnel.
Le 12 décembre 1916, il obtient son premier poste ministériel comme Ministre des Travaux publics, des Transports et du Ravitaillement, […]
En 1924, Il est appelé [une première fois] à la présidence du Conseil […],.
Fervent défenseur de la laïcité, il veut alors introduire les lois laïques en Alsace-Lorraine et rompre les relations diplomatiques avec le Vatican mais il est désavoué par le Conseil d’État et la résistance populaire sur le premier point et se heurte à l’opposition du Sénat et au risque de velléités indépendantistes locales sur le second. »
Sous la IIIème République il est Président du Conseil des ministres à trois reprises, c’est une figure du Cartel des gauches, coalition gouvernementale et parlementaire des années 1920, il présida aussi la Chambre des députés, sous la IIIe République, et même l’Assemblée nationale, sous la IVe République.
Bref, il est une des personnalités principales de la IIIème république.
Georges Clemenceau aura sur lui ce trait ironique :
« Le Vésuve se borne souvent à fumer sa pipe comme Herriot, tout en ayant sur celui-ci l’avantage de se faire parfois oublier ».
Le site précité raconte aussi un épisode où Doudou manquera manifestement de jugement :
« À l’invitation de Staline, Édouard Herriot se rend en 1933 à Moscou. Ce voyage s’inscrit dans la tentative de rapprochement franco-soviétique qui débouchera sur le pacte franco-soviétique de 1935. À cette occasion, Herriot visite l’Ukraine où sévit alors une famine dramatique. Abusé par la propagande soviétique et les figurants se dressant sur son passage, Édouard Herriot ne se rend pas compte de la famine qui sévit dans le pays et déclare n’avoir vu que « des jardins potagers de kolkhozes admirablement irrigués et cultivés […]. Lorsque l’on soutient que l’Ukraine est dévastée par la famine, permettez-moi de hausser les épaules. », dans son récit de voyage publié l’année suivante, « Orient »
Après la guerre, il est même élu membre de l’Académie française le 5 décembre 1946.
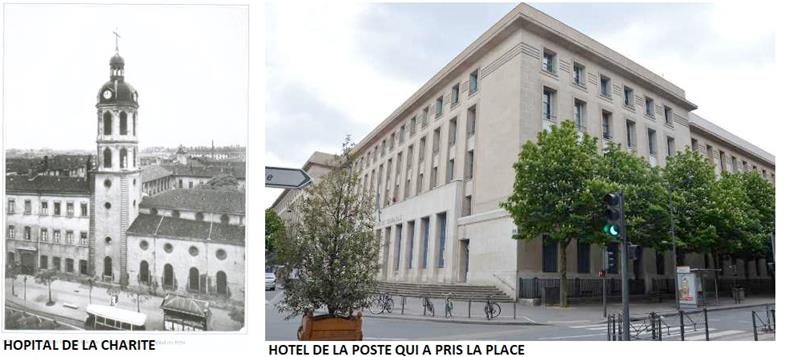 En tant que maire de Lyon, il a marqué durablement la ville de Lyon. Beaucoup de son empreinte de bâtisseur est lié à sa relation avec l’architecte lyonnais : Tony Garnier. A eux deux, ils vont marquer le territoire de la ville par la réalisation de grands équipements : les abattoirs et le marché aux bestiaux de Gerland (1913-1928), l’hôpital de Grange-Blanche (1914-1933), le stade municipal de Gerland (1913-1926), la salle des fêtes de la Croix-Rousse (1934) et surtout la construction d’un nouveau quartier : les Etats-Unis (1920-1935).
En tant que maire de Lyon, il a marqué durablement la ville de Lyon. Beaucoup de son empreinte de bâtisseur est lié à sa relation avec l’architecte lyonnais : Tony Garnier. A eux deux, ils vont marquer le territoire de la ville par la réalisation de grands équipements : les abattoirs et le marché aux bestiaux de Gerland (1913-1928), l’hôpital de Grange-Blanche (1914-1933), le stade municipal de Gerland (1913-1926), la salle des fêtes de la Croix-Rousse (1934) et surtout la construction d’un nouveau quartier : les Etats-Unis (1920-1935).
Mais en 1935, il décide de la démolition de l’hôpital de la Charité pour y faire construire un grand Hôtel des postes, dans le plus pure style stalinien. Montrant une absence totale de souci de sauvegarde du patrimoine.
<L’hôpital de la Charité> est un hôpital historique construit à partir de 1617.
Ce fut un personnage considérable mais qui probablement resta trop longtemps sur le devant de la scène et ne sut pas se retirer à temps
Il avait aussi la magie de la formule . J’en citerai deux :
« C’est à Nice que j’ai lu à la devanture d’un restaurant du Vieux-Nice : Restaurant Ouvrier – Cuisine bourgeoise. C’est bien le programme de certains de mes amis socialistes ».
« Le Sénat est une assemblée d’hommes à idées fixes, heureusement corrigée par une abondante mortalité. »
Le lecteur curieux et attentif posera cependant la question mais pourquoi les a-t-on appelé Doudou et Zizi ?
Pour Doudou c’est simple, c’est la syllabe d’Edouard, répété deux fois.
Mais pour Zizi ?
Je compte sur vous pour trouver des hypothèses…
<1033>
- Le développement du tout-à-l’égout et assainissement des vieux quartiers ;
-
Jeudi 8 mars 2018
« Lyon fit la guerre à la Liberté ; Lyon n’est plus»Décret de la Convention du 12 octobre 1793La révolution française fut très cruelle pour Lyon, surtout en 1793.
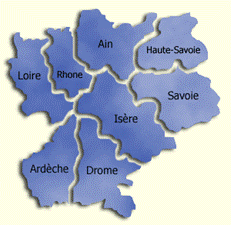 Si vous regardez de manière attentive la carte des départements de l’ancienne Région Rhône-Alpes, une anomalie saute tout de suite aux yeux.
Si vous regardez de manière attentive la carte des départements de l’ancienne Région Rhône-Alpes, une anomalie saute tout de suite aux yeux.
La Loire et le Rhône ne ressemblent pas aux autres départements, ils sont plus petits. On dirait même qu’ils sont chacun la moitié d’un département comme l’Ain, l’Isère ou les Savoies.
Et c’est vrai, à l’origine Le Rhône-et-Loire fut l’un des 83 départements créés à la Révolution française, le 4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre 1789, à partir du territoire de la Généralité de Lyon elle-même constituée des anciennes provinces du Lyonnais, du Beaujolais et du Forez.
Mais ce département fut divisé en deux pour punir Lyon qui avait eu la mauvaise idée de chasser les montagnards et de prendre le parti des girondins, alors qu’à Paris les montagnards de Robespierre étaient en train de vaincre les Girondins.
Rappelons que les Girondins avaient pour nom Vergniaud, Brissot, Roland et Condorcet.
En face les montagnards s’appelaient Robespierre, Danton, Marat, Saint Just.
Les premiers qui attaquèrent, furent d’abord les Girondins qui, pour cause de dénonciations calomnieuses, firent décréter l’arrestation de Marat par la Convention nationale le 13 avril 1793 ; mais celui-ci fut acquitté par le Tribunal criminel extraordinaire et regagna l’Assemblée triomphalement le 24 avril 1793.
Ce fut le début du déclin des girondins.
Deux articles de Wikipedia détaillent les évènements lyonnais : <Lyon sous la Révolution> et <Soulèvement de Lyon contre la Convention nationale>
Au début de la révolution les lyonnais sont très favorables à celle-ci.
Nous pouvons lire dans Wikipedia :
« En 1789, Lyon est avec Paris la seule agglomération à dépasser de façon certaine les 100 000 habitants. Ville de banque, de négoce et de manufactures, elle vit surtout de la soierie, qui occupe un tiers de la population. Mais la France est alors plongée dans une crise économique très grave, et cette industrie est en crise. Selon Arthur Young, agronome britannique qui visite la ville en décembre, 20 000 personnes vivent de la charité et souffrent de la disette, et les couches populaires sont confrontées à la misère. […] Le peuple de la ville espère que les États généraux de 1789 vont supprimer les droits d’octroi, établis par l’oligarchie marchande pour acquitter le loyer des emprunts sans imposer les propriétés. Toutefois, la nouvelle municipalité issue des élections maintient l’octroi. Cette mesure provoque une nouvelle émeute, qui contraint les édiles à reculer ; mais l’Assemblée constituante rétablit provisoirement les barrières. Cette décision déclenche une nouvelle émeute, accompagnée du pillage des maisons des plus riches et de la demande de la taxation des denrées de première nécessité. »
Par la suite ce sont plutôt des modérés ou des monarchistes constitutionnels qui détiennent le pouvoir à Lyon.
En fin de compte l’affrontement à Lyon se fera entre le girondin Roland et ses partisans restés à Lyon et le montagnard Marie Joseph Chalier.
Roland ou plus précisément « Jean-Marie Roland de La Platière » est né le 18 février 1734 à Thizy, dans le Beaujolais.il occupe le poste d’inspecteur des manufactures à Lyon, lorsqu’éclate la Révolution. Il est le mari de la célèbre Madame Roland qui a pour prénom Manon et sera guillotiné en 1793 à Paris. Son mari se suicidera deux jours après.
Roland est élu en 1790 au conseil général de la commune de la ville de Lyon, qui l’envoie à Paris l’année suivante. Dans la capitale, il se fait connaître grâce notamment à Manon qui reçoit tous les hommes influents. Il deviendra ministre de l’intérieur du gouvernement girondin en mars 1792, toujours grâce à l’influence de son épouse.
A Lyon se sont ses amis girondins qui se succèdent comme maire de Lyon, ils ont pour nom Vitet, Nivière-Chol, Gilibert.
Mais tous ces maires sont contestés par Marie Joseph Chalier et ses alliés.
Chalier se bat pour une révolution sociale mais c’est un extrémisme brutal. Son partisan Bertrand accède enfin à la mairie de Lyon le 9 mars 1793.
Le pouvoir des Chaliers va durer 80 jours. Le 29 mai, une assemblée des sections réunie à l’Arsenal décide de renverser la municipalité. Dans la nuit, les « Chalier » sont arrêtés. Le juge Ampère (père du physicien André-Marie Ampère) est désigné pour instruire le procès de Joseph Chalier et de ses amis.
Chalier est condamné à mort le 16 juillet et guillotiné le lendemain.
La Convention montagnarde décide d’envoyer une armée à Lyon qui bombardera la ville et fera son siège du 9 août au 9 octobre 1793, date de la reddition.
La répression sera féroce.
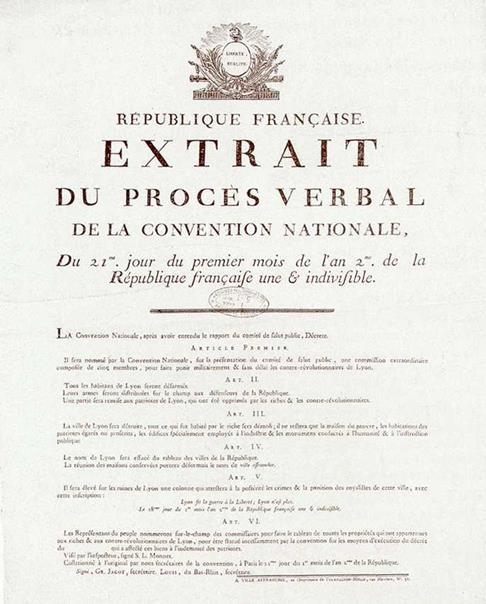
La convention produira son célèbre décret du 12 octobre 1793.
Dont je donne les principaux passages :
« La ville de Lyon sera détruite, tout ce qui fut habité par le riche sera démoli […]
Le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la République.
La réunion des maisons conservées portera désormais le nom de ville affranchie.
Il sera élevé sur les ruines de Lyon une colonne avec cette inscription :
Lyon fit la guerre à la Liberté ; Lyon n’est plus. »
Toutefois, ce décret ne fut que modérément appliqué. Le 26 octobre, on commença la démolition des Façades de la place Bellecour. Bonaparte, Premier Consul, en ordonnera la reconstruction en 1800, et viendra en poser la première pierre.
Parallèlement quelques appellations révolutionnaires furent imposées : à l’instar de la ville de Lyon devenue Ville-Affranchie, divers quartiers, places et rues sont rebaptisés. C’est ainsi que le quartier Bellecour devient le « Canton de la Fédération » ou « Canton Égalité », la place Bellecour devient « place de la Fédération » ou « place de l’Égalité », le quartier de La Croix-Rousse devient « Commune-Chalier », le quartier de l’Hôtel-Dieu devient « Canton-sans-Culotte », le quartier de la Halle aux Blés devient « Canton Chalier »
Mais le 14 pluviôse an III (2 février 1795), la Convention d’après Thermidor suspend l’application du terrible décret et restitue à la Ville ses droits et son nom.
En revanche, la partition du département de Rhône et Loire qui fut officialisée par l’approbation de la Convention nationale le mardi 19 novembre 1793 ne fut, lui, jamais remis en question. Ainsi Saint Etienne est une préfecture au même titre que Lyon.
Le plus terrible fut cependant les exécutions en masse par la guillotine et des fusillades
La Convention décide la formation d’une « Commission extraordinaire » de cinq membres chargée de « punir militairement et sans délai les criminels contre-révolutionnaires de Lyon ».
Cette « Commission révolutionnaire extraordinaire » qui siège du 30 novembre 1793 au 6 avril 1794, présidée par le général Parein, décide d’emblée de substituer des mitraillades collectives aux fusillades individuelles et à la guillotine. Les 4 et 5 décembre, 60, puis 208 ou 209 condamnés sont tués par trois pièces de canon chargées à mitraille dans la plaine des Brotteaux, près de la grange de Part-Dieu.
La responsabilité de ces massacres a été imputée non seulement à la Commission Parein, mais aussi aux représentants Collot d’Herbois et Fouché, nommés le mois précédent.
 Pour commémorer ces massacres dans la plaine des Brotteaux, des lyonnais ont instauré un mémorial dans la crypte de la chapelle sainte Croix des Brotteaux (147 rue Créqui, Lyon 6)
Pour commémorer ces massacres dans la plaine des Brotteaux, des lyonnais ont instauré un mémorial dans la crypte de la chapelle sainte Croix des Brotteaux (147 rue Créqui, Lyon 6)
Près de 2000 personnes ont ainsi été exécutées selon ces diverses « méthodes » révolutionnaires
Vous trouverez derrière ce lien une vidéo présentant <La crypte des Brotteaux> , monument et ossuaire à la mémoire des victimes de la répression de 1793 à Lyon.
Edouard Herriot, le maire de Lyon de la première moitié du XXème siècle a écrit un livre d’Histoire, « Lyon n’est plus » en 3 tomes :
- Tome 1 « Jacobins et les modérés »
- Tome 2 « le siège »
- Tome 3 « la répression ».
On peut comprendre qu’après de tels épisodes, une certaine tension puisse exister entre Paris et Lyon.
Par la suite Napoléon Bonaparte a apporté du baume au cœur des lyonnais.
Ce site <Napoléon et Lyon> raconte cette histoire.
Il existait par exemple le projet de construire un palais impérial sur la Presqu’ile. Il paraitrait que les plans de la gare de Perrache ont été inspirés par ceux du projet de palais impérial de Napoléon.
En revenant de l’ile d’Elbe, Napoléon a fait une dernière fois halte dans l’ex ville affranchie et a écrit ce mot que vous pouvez retrouver au Musée Gadagne et aussi sur le site précité :
« Lyonnais je vous aime »
Cet écrit date du 13 mars 1815.
La 3ème émission de la fabrique de l’Histoire consacrée à Lyon portait sur ce sujet et avait pour titre : <Lyon n’est plus>
<1032>
- Tome 1 « Jacobins et les modérés »
-
Mercredi 7 mars 2018
« Morand et Perrache »Deux urbanistes lyonnais du XVIIIème siècle qui ont joué un immense rôle dans l’évolution de la ville de LyonJe choisis cette semaine de consacrer 5 mots à la ville que j’habite, Lyon. Limiter ce défi à 5 articles nécessite des choix arbitraires.
Les deux premiers articles se situaient à l’époque romaine, celui d’aujourd’hui nous amène au XVIIIème siècle, juste avant la révolution française.
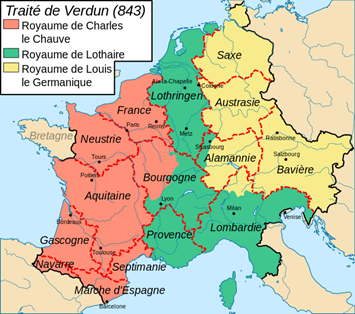 L’empire romain s’est effondré au IVème siècle. Les aqueducs romains qui alimentaient la colline Fourvière se sont abimés, les habitants sont descendus de la colline pour s’installer au bord de Saône.
L’empire romain s’est effondré au IVème siècle. Les aqueducs romains qui alimentaient la colline Fourvière se sont abimés, les habitants sont descendus de la colline pour s’installer au bord de Saône.
Ils vont créer un quartier qu’on appelle aujourd’hui « Le vieux Lyon » qui est le quartier renaissance le plus étendu d’Europe après Venise.
Avant cela, il y a eu l’Europe carolingienne, avec la tentative de Charlemagne de recréer un empire. Ses successeurs vont par le « Traité de Verdun de 843 » partager cet empire en 3 parties.
L’aîné, Lothaire, va obtenir les territoires du centre qui vont s’appeler la Lotharingie, racine de la Lorraine qui est ma région natale. Sur la carte que je joins, il est écrit « Lothringen » nom allemand de la Lorraine. Vous voyez que Lyon se trouve en Lotharingie, au même titre que Metz et Milan et la capitale de Charlemagne « Aix la Chapelle ».
Aix la Chapelle, lors d’une discussion j’ai compris que pour certains, c’était forcément une ville française à cause du nom. C’est absolument faux, Aix la Chapelle c’est « Aachen », une ville allemande. La capitale de Charlemagne est une ville allemande !
Dans le traité de Verdun, la France ou plutôt l’embryon de la France est confié à Charles le Chauve.
Pendant longtemps Lyon sera ville du Saint empire romain germanique.
C’est en 1312, sous Philippe le Bel que Lyon devint française.
Avant de parler des deux urbanistes qui ont métamorphosé la ville de Lyon, il est encore nécessaire de donner quelques précisions.
Lyon a été construit sur un confluent. Il semble d’ailleurs que peu de grandes métropoles disposent ainsi, en leur sein, d’un confluent de deux grands fleuves. Il n’y aurait aucun autre cas en Europe et un seul autre cas aux Etats-Unis pour la ville de Pittsburgh. Je remercie par avance le lecteur qui infirmera cette affirmation pour faire progresser ma connaissance.
Toutefois, même si Lyon se trouve sur le site d’un confluent, il faut comprendre que dans l’Histoire, les deux fleuves n’ont pas le même statut. Le fleuve de Lyon est « la Saône ». Pendant longtemps le Rhône constituait la frontière de Lyon et du Lyonnais. Après que Lyon soit devenu française, la rive gauche du Rhône, l’est du lyonnais était territoire du Dauphiné, c’est-à-dire la terre donnée en apanage à l’héritier du trône de France : le dauphin.
Un seul pont sur le Rhône à la hauteur de Lyon permettait d’entrer dans le lyonnais, le pont de la Guillotière mais qui pendant longtemps était simplement : « Le pont ». Aujourd’hui encore si vous lisez sur un plan de Lyon, la place Gabriel Péri juste avant le Pont de la Guillotière, les « vrais » lyonnais continuent à désigner cet endroit comme « La Place du Pont ».
Dans la suite de cet article, il sera question plusieurs fois du « Consulat ». Il faut savoir que le Consulat de Lyon est une institution qui détient le pouvoir municipal à Lyon entre 1320 et 1790. Issu de la volonté de la bourgeoisie lyonnaise au XIIIe siècle d’imiter de nombreuses villes d’Europe qui obtiennent de larges privilèges de gestion, le consulat ne naitra effectivement qu’après de longues décennies de lutte contre le seigneur ecclésiastique de la ville, l’archevêque, en 1320.
La source de ce qui va suivre se trouve pour l’essentiel dans le catalogue de l’exposition « Lyon sur le divan » déjà évoqué ce lundi.
Je vais donc évoquer deux personnages emblématiques qui ont contribué à la métamorphose de la cité : Jean–Antoine Morand et Antoine-Michel Perrache.
Mais avant ces deux visionnaires, il faut évoquer Soufflot qui avant Paris avait œuvré sur Lyon.
Catalogue pages 33-36 :
« C’est Jacques Germain Soufflot (1713–1780) qui tient le rôle essentiel dans une certaine normalisation de la production architecturale lyonnaise. Originaire de Bourgogne, il effectue deux séjours à Lyon à partir de 1738 qui orientent sa carrière et son succès auprès des instances de la monarchie. Les aménagements du palais de l’archevêché, le couvent des Chartreux, l’agrandissement de l’Hôtel-Dieu (1741–1749) avec la monumentale façade sur le Rhône et l’élévation du dôme, le rehaussement et agrandissement de la Loge du change (1750), le théâtre (1754–1756), constituent un répertoire diversifié d’édifices publics, dont on ne retrouvera d’équivalent à Lyon qu’au XXe siècle, avec l’œuvre de Tony Garnier. […]
La dimension urbaine des réalisations lyonnaises de Soufflot attire l’attention à commencer par l’Hôtel-Dieu dont la façade démesurée (400 m, 51 travées à arcades), inachevée du vivant de l’architecte, accompagne la démolition de la fortification du Rhône (1738–1778). […]
Si Soufflot, après 1755, poursuit sa carrière à Paris et restera plutôt célèbre pour la mise en chantier de la basilique de la montagne Sainte-Geneviève, futur Panthéon, son impact sur l’urbanisme lyonnais est donc considérable.
Catalogue page 37
« Parmi les proches de Soufflot, on trouve Jean–Antoine Morand (1727–1794) grand nom de l’urbanisme lyonnais. Cet artiste et décorateur, plus qu’architecte, est le premier développeur des terrains des Brotteaux, demeurés inondables et coupés de la ville historique par le Rhône, fleuve alors très large et dangereux que l’on ne franchit que par un seul pont, celui de la Guillotière.
Le projet ambitieux que Morand présente au consulat en 1764 ne se limite pas à la rive gauche du Rhône, bien que la demande initiale émane des recteurs de l’Hôtel-Dieu qui désirent lotir leurs terrain. Publié en 1766 il prétend « donner à la ville une forme circulaire, la seule capable de faire une ville d’une vaste étendue, en même temps qu’elle rapproche tous les citoyens les uns des autres et qu’elle rend leurs besoins moins onéreux ».
J’ai reproduit ce plan circulaire dans cet article. En haut à droite, sur la rive gauche du Rhône vous voyez, un quartier d’immeubles figurés en rose, avec des rues à angle droit : cela correspond à l’aménagement du terrain des Brotteaux. La place, près du Rhône est l’actuel Place Lyautey et le pont qui est le second pont sur le Rhône (le premier étant celui plus bas : le Po
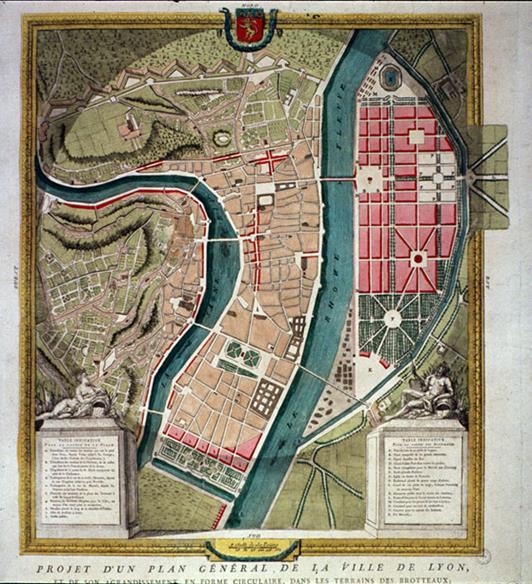 nt de la Guillotière) s’appelle aujourd’hui le pont Morand.
nt de la Guillotière) s’appelle aujourd’hui le pont Morand.
Voici donc l’idéal de la cité imaginé par Morand : Une ville circulaire avec des rues qui se coupent à angle droit. Les rues qui se coupent à angle droit constituent encore largement la réalité de Lyon.
Le centre du cercle est tracé à partir de l’église Saint–Nizier, au cœur du quartier le plus dense de Lyon, précise le catalogue cité.
« Le projet de plan général de la ville de Lyon et de son agrandissement en forme circulaire, exceptionnel dans l’histoire de l’urbanisme français. Il peut être considéré comme le premier plan général de Lyon, puisqu’il ancre l’histoire de la planification lyonnaise mieux que celle de toute autre ville du royaume dans le siècle et les idéaux des lumières. Même si le plan Morand est combattu par les échevins et par l’Hôtel-Dieu propriétaire d’une grande partie des terrains de la rive gauche et jaloux de ses prérogatives sur les droits de péage, la société par actions créée en 1770 réussit, grâce à l’appui du roi, à construire un second pont sur le Rhône (inauguré en 1775) pont en bois à péage, face à la rue Puits-Gaillot qui va prendre le nom de son créateur [Morand]. »
Catalogue page 41
« Mais l’affaire s’enlise car elle bute autant sur les réticences de l’Hôtel-Dieu à vendre ses terrains que sur celles de l’élite lyonnaise à franchir la barrière du Rhône. Morand qui a acheté un lot en 1765 s’y installe avec son épouse, mais ils y restent seuls. Leur maison est bientôt vendue à l’une des nouvelles loges maçonniques de Lyon.
Le projet va pourtant se réaliser, mais plus tard. Morand ne sera plus là pour le voir. Car :
Morand, guillotiné en 1794, ne verra pas le développement de son quartier, qui interviendra plus tard, à partir de la seconde décennie du siècle suivant.
L’exergue du jour mais face-à-face Morand et Perrache. Les lyonnais et ceux qui passent par Lyon associent ce nom avec « la gare Perrache » gare historique de Lyon. Perrache est le contemporain de Morand, il est né un an avant, en 1726. Il ne sera pas guillotiné, puisqu’il meurt bien avant la révolution, en 1779. Je redonne la parole au catalogue de l’exposition Lyon sur le divan (page 42)
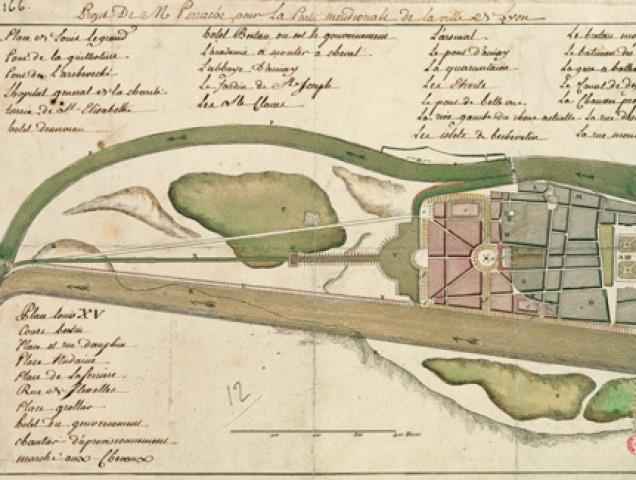 « Alors que le plan Morand est paralysé, le sculpteur et dessinateur Perrache se fait lui aussi entrepreneur, en présentant en 1766 aux notables municipaux un autre projet d’extension urbaine, le plan pour la partie méridionale de Lyon, dont l’objet principal est de reporter le confluent jusqu’à la Mulatière en y rattachant l’île Mogniat, qu’avait acheté le consulat en 1735. »
« Alors que le plan Morand est paralysé, le sculpteur et dessinateur Perrache se fait lui aussi entrepreneur, en présentant en 1766 aux notables municipaux un autre projet d’extension urbaine, le plan pour la partie méridionale de Lyon, dont l’objet principal est de reporter le confluent jusqu’à la Mulatière en y rattachant l’île Mogniat, qu’avait acheté le consulat en 1735. »
Rappelons où nous en sommes. A la création de Lugdunum, le confluent se trouvait en bas de la colline de la croix rousse. Au sud de la colline, au milieu du Rhône augmenté de la Saône, se trouvait l’île de Canabae. Cette île par l’action humaine et les fluctuations du Rhône va être rattachée à la terre et à la colline de la Croix Rousse pour devenir la célèbre presqu’ile de Lyon.
Au moment du plan de Perrache, le confluent du Rhône et de la Saône se situe au niveau de la magnifique basilique d’Ainay.
Sur le plan de Perrache, vous voyez en vert l’île Mogniat qui va donc être englobée par les aménagements de Perrache, ce qui aura pour conséquence de porter le confluent jusqu’à sa situation actuelle, c’est-à-dire au nord-est de la commune de Mulatière. Aujourd’hui le Pont de la Mulatière relie la Presquile à la commune du même nom.
« Les travaux envisagés par Perrache demeurent colossaux, car c’est une véritable reconfiguration du site fluvial avec endiguement des fleuves qui est proposé. «
Perrache imagine même une voie appelée la chaussée du Languedoc ou chaussée Perrache qui emprunte l’axe qui sera, deux siècles plus tard, celui de l’autoroute A7…
Catalogue page 44-45
« Perrache essuie d’abord un refus face à l’immensité de la tâche prévue. Mais il présente un second plan en 1769, finalement accepté, après passage par Paris pour y trouver des appuis. Le 13 octobre 1770, un arrêt du conseil d’État autorise Perrache à entreprendre les travaux. […] Il souhaite construire dans la partie nord un « quartier neuf » pour les ouvriers obligés de vivre dans des logements insalubres en ville, et leur promet de respirer « l’air le plus pur ». Sur les rives du Rhône et de la Saône dans la « presqu’île Perrache » au sud, il prévoit des ateliers de manufacture, des terrains pour les chantiers, un grand bâtiment contenant des moulins et des greniers ; enfin, une promenade et un jardin public fermé « comme celui des Tuileries » […]
Comme son concurrent Morand, Perrache semble avoir vu trop grand, et le développement du projet ne se fera, là aussi, qu’après l’épisode révolutionnaire. Faute de financement municipal, il crée en 1771 une compagnie par action d’une vingtaine d’associés (dont Soufflot), la compagnie des associés aux travaux du Midi de Lyon. […]
Perrache a cinq années pour mener à bien son ambitieux projet. Mais il meurt en 1779, des années avant sa réalisation. Sa sœur hérite du projet, mais les difficultés s’accumulent, notamment à cause des crues; celle de la Saône provoque l’écroulement du pont de la Mulatière en 1783, quelques mois après sa construction. Le chantier est un tel gouffre financier que le roi vient à la rescousse en échange des terrains, qui seront repris par les associés à la faveur des troubles révolutionnaires. La révolution marque un temps d’arrêt. […]
Le quartier ne se développera que dans les années qui suivent l’empire, malgré la permanence de la compagnie du Midi dédiée aux travaux après la mort de Perrache, et malgré aussi l’intérêt personnel de Napoléon pour le site et le zèle de son préfet a y créer un palais impérial. […]
C’est au XIXe siècle que le quartier participe pleinement à l’aventure industrielle de Lyon à partir des nouveaux programmes d’aménagement des maires de Lyon, le baron Rambaud (1818-1826) puis Jean de Lacroix–Laval (1826–1830) qui fait dresser le plan définitif, approuvé par une ordonnance royale en 1828.
Pour conclure ce mot du jour consacré à ces deux visionnaires qui ont beaucoup marqué la ville de Lyon je voudrais partager la conclusion du catalogue de l’exposition : « les métamorphoses d’une ville » que je préfère aux spéculations psychanalytiques : « Lyon sur le divan » :
« Les points communs des deux propositions, Perrache et Morand, attirent l’attention. Emblématique d’une volonté d’anticiper et de rationaliser l’extension de la ville, elles prétendent faire sauter deux verrous du site lyonnais. D’initiative privée, elles sont concurrentes pour capter les bénéfices de l’essor urbain. […]
Mais elles marquent aussi une profonde rupture dans les habitudes d’un urbanisme dominé par des améliorations ponctuelles, négociées au jour le jour et à contenu plus architectural qu’urbanistique. La mémoire lyonnaise, finalement bienveillante à l’égard de ces deux urbanistes avant la lettre, n’en garde pas le souvenir d’échecs, ni même de projets utopiques, dispendieux ou démesurés, mais plutôt l’idée qu’une anticipation raisonnée n’est jamais perdue, et que le développement spectaculaire du XIXème siècle n’en aura été que mieux préparé. . […]
Enfin, les deux opérations révèlent l’intrication des acteurs à l’origine des changements urbains : la municipalité, le créateur du projet, une compagnie financière, et, quand la situation est bloquée localement, des appuis parisiens jusqu’au roi. Les projets lyonnais sont ainsi placés dès cette époque au cœur d’enjeux nationaux. »
<1031>
-
Mardi 6 mars 2018
« Les Arêtes de Poisson »Galeries mystérieuses situées sous la colline de la Croix RousseLa ville de Lyon est connue pour son quartier renaissance, « Le vieux Lyon », ses célèbres « traboules » qui ont d’ailleurs donné le verbe lyonnais « trabouler » qui signifie traverser un quartier en empruntant une traboule, ou plus simplement et par extension traverser un quartier.
Lyon est aussi connue pour sa gastronomie et ses célèbres « bouchons lyonnais ».
Elle est enfin célèbre parce qu’elle est ville de foire, et qu’elle a eu le privilège à partir de 1463 par décision de Louis XI d’en organiser 4 par an, qu’elle a été un des principaux centres d’imprimerie d’Europe et un lieu du travail de la soie avec les canuts.
Mais elle n’est pas connue pour les « arêtes de poisson ».
Or la deuxième émission de la Fabrique de l’Histoire, évoquée hier a été intégralement consacrée à ces galeries étonnantes : « Les arêtes de poisson : un mystère sous la Croix Rousse »
Je vous conseille vivement d’écouter ce documentaire qui est très sérieux contrairement à de nombreuses spéculations ésotériques qui sont élaborées par des passionnés qui recherchent des pistes mystiques ou soupçonnent le complot.
 Evidemment si vous faites partie de celles et ceux qui espèrent que tout mystère trouve toujours sa solution à la fin du film ou de la série, vous allez être surpris : On ignore quasi tout et on ne sait presque rien.
Evidemment si vous faites partie de celles et ceux qui espèrent que tout mystère trouve toujours sa solution à la fin du film ou de la série, vous allez être surpris : On ignore quasi tout et on ne sait presque rien.
Les arêtes de poisson, sont un réseau de galeries souterraines de Lyon composé d’une galerie principale et trente-quatre galeries latérales, partant du Rhône et creusé sous la Croix Rousse.
La galerie principale mesure 156 mètres de long et se situe 25 m sous la surface ; de celle-ci partent 16 galeries latérales mesurant 30 m chacune, ce qui donne à l’ensemble une forme d’arêtes de poisson. Une seconde galerie se trouve 8 m sous la principale, sans artères latérales. Ces constructions partent du Rhône et s’étendent jusqu’à la rue Magneval.
L’accès et la construction des galeries se faisaient par les puits alentours ; ceux-ci servaient également pour l’évacuation de matériaux du creusement.
Ce réseau souterrain est composé de galeries d’une longueur totale de 1,4 km : 960 mètres pour les arêtes, 312 m pour les galeries principales, 144 m de galeries supplémentaires placées sous la rive du Rhône ; seize puits menant à ces galeries ont été recensés, ajoutant 480 m de longueur au réseau. Les galeries ont toutes 2,2 m de haut et 1,9 m de large.
Pour les archéologues du service archéologique de la ville de Lyon
« [l]’homogénéité de la maçonnerie comme l’absence de trace de reprise montrent que le réseau en arêtes de poisson forme un ensemble architectural cohérent qui, de la rive du Rhône au plateau de la Croix-Rousse, relève d’une seule et même campagne de construction. »
En 2011, le Lyonnais Walid Nazim publie un livre et depuis réalise de nombreuses conférences en émettant l’hypothèse que ces galeries auraient dû servir aux templiers pour cacher leur fameux trésor.
Il a créé un site : http://aretesdepoisson.free.fr/ pour valoriser son livre, ses hypothèses et aussi pour éviter que le creusement du second tuyau du tunnel de Croix Rousse n’abime ces galeries.
Georges Combe autre lyonnais a fait un film qu’il a appelé « Les souterrains du temps » et pour lequel il a aussi créé un site :
Pour introduire le sujet, il écrit :
« Le monde des Anciens, le Temple de Salomon, le souvenir du Graal, l’ombre des Templiers, la magie du « Songe de Poliphile », l’esprit de la Renaissance et les mystères de la franc-maçonnerie.
Un voyage dans le temps où le monde se perçoit sous d’autres dimensions !
Ces souterrains s’ouvrent sur une nouvelle conception de notre univers, sur la physique de demain, sur les ressources insoupçonnées de la conscience, sur une approche différente des mondes antiques. »
C’est, en effet, une pensée très ouverte vers d’autres vérités et une vision mystique voire magique.
En 2013, la ville de Lyon a décidé de faire procéder à une datation au carbone 14 réalisées en plusieurs points par deux laboratoires distincts. Le service d’archéologie de la ville de Lyon a publié les résultats qui ont révélé une origine antique : « Sur les quatre échantillons analysés, trois datent du changement d’ère et le dernier du IIIe ou IVe siècle av. J.-C. ». Des graffitis à consonance latine ont par ailleurs été retrouvés dans le mortier.
Donc ces galeries datent de l’époque antique peut être tout début de la présence romaine sur le site, voire avant la présence romaine.
Sur ce site Anne Pariente, la directrice du service archéologie de la ville de Lyon qui est aussi invitée dans l’émission de France Culture fait un constat humble :
« On ne sait absolument pas à quoi servaient ces souterrains. Des galeries aussi étonnantes, on en trouve au Proche-Orient, mais de cette structure-là, nulle part ».
Mais tous ces mystères attisent les thèses complotistes, car les défenseurs de ces thèses ne comprennent pas que la ville mette aussi peu en œuvre pour valoriser cette structure unique et trouver des hypothèses crédibles sur son utilité.
Pour des raisons de sécurité, ce réseau souterrain est interdit au public par la ville de Lyon depuis 1989 ce qui génère de nouvelles thèses complotistes.
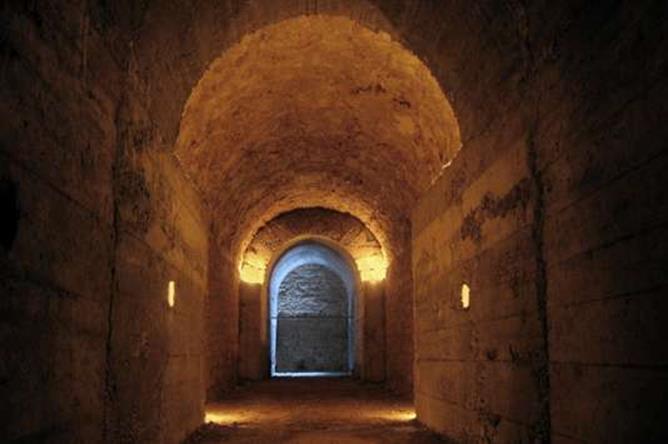 A priori, ces galeries ont été redécouvertes en 1959, lors d’un l’affaissement de rue à la rue des Fantasques, ce qui leur vaut parfois le nom de réseau des Fantasques. À partir de 1959, des travaux de confortement y ont lieu, les galeries sont bétonnées par endroit, et 4 à 5 m3 d’ossements sont découverts en 1959.
A priori, ces galeries ont été redécouvertes en 1959, lors d’un l’affaissement de rue à la rue des Fantasques, ce qui leur vaut parfois le nom de réseau des Fantasques. À partir de 1959, des travaux de confortement y ont lieu, les galeries sont bétonnées par endroit, et 4 à 5 m3 d’ossements sont découverts en 1959.
Il semble donc que ces galeries aient pu servir, en partie, de catacombes.
Mais le service archéologique de la ville de Lyon évoque une première redécouverte des arêtes en 1651 due à un fontainier lors du creusement de la galerie d’alimentation de la fontaine de l’hôtel de Ville
Il m’apparaît que le plus rationnel est de dire qu’on ne sait pas. Le Monde a publié un article « Lyon s’étrangle autour des arêtes de poisson. » dans lequel il écrit :
« La conception des « arêtes de poisson » est unique au monde. Deux tunnels centraux sont superposés, parsemés de puits et de salles voûtées, à partir desquels partent perpendiculairement trente-deux galeries de trente mètres de longueur, parfaitement identiques. La date de construction reste incertaine et la fonction inexpliquée. Dans une ville à forte culture ésotérique, les « arêtes de poisson » agissent comme une caisse de résonance, mêlant arguments scientifiques, théories historiques variées, fantasmes personnels, dans une joyeuse liberté de penser, sans oublier un enjeu archéologique majeur, peu exploré, voire menacé. […]
Les galeries voûtées, plongées dans un profond silence, donnent une impression de cathédrale. Les pierres calcaires, au teint jaunâtre, importées de carrières probablement situées en Saône-et-Loire, sont soigneusement jointées à la chaux vive. Les tunnels sont de dimensions régulières de bout en bout : 1,90 m de largeur, 2,20 m de hauteur.
Au début des années 1960, les galeries sont bétonnées à certains endroits, probablement nettoyées, vidées d’indices précieux et interdites d’accès. L’heure n’est pas à la curiosité archéologique. A Lyon, les collines sont instables ; les autorités gardent en mémoire la catastrophe de Fourvière, avec quarante morts dus à un glissement de terrain, en 1930. Mis à part quelques visites clandestines, le site des « arêtes » sombre dans l’oubli. […]
Un autre événement pourrait nourrir le débat. La ville de Lyon prévoit de transformer d’ici à 2019 l’église Saint-Bernard en « centre d’affaires et de détente ». Inachevée, fermée en raison de l’instabilité du terrain, désacralisée, cette église a été construite à l’aplomb des arêtes de poisson.
Un puits s’ouvre exactement sous sa nef. Il est question d’y aménager trente-deux espaces de bureaux. Trente-deux, le nombre des galeries mystérieuses. Les défenseurs des arêtes de poisson y voient un mauvais présage. Celui d’une logique économique qui oublierait en chemin l’imaginaire et la richesse d’un lieu trop longtemps ignoré. »
En 2013, le service d’archéologie qui venait d’obtenir les résultats de la datation au carbone 14 a publié ce rapport détaillé et rationnel : <Dossier Archéologie janvier 2013 – arêtes de poisson>
Et puis je redonne le lien vers l’émission de la Fabrique de l’Histoire : « Les arêtes de poisson : un mystère sous la Croix Rousse »
<1030>
-
Lundi 5 mars 2018
« Lugdunum et Condate »Lyon est une ville doubleMa famille et moi sommes arrivés à Lyon en 2002. Depuis j’ai adopté cette ville. Je ne suis pas sûr qu’elle m’ait adopté. J’avais déjà raconté cette rencontre entre Annie et un commerçant lyonnais à qui elle avait eu l’imprudence de dire que « maintenant nous étions lyonnais » et s’entendre répliquer « Vous habitez Lyon, vous n’êtes pas lyonnais ».
Il faut donc avoir des quartiers de noblesse pour pouvoir se dire lyonnais…
La ville de Lyon est cependant une de ses villes qui a une âme, tout en ayant une Histoire.
Récemment, l’émission de France Culture « La Fabrique de l’Histoire » a consacré 4 épisodes sur Lyon qui ont retenu mon attention et que je voudrais partager.
 La première de ces émissions était consacrée à < L’identité lyonnaise au fil de son histoire>. Elle a notamment évoqué une exposition temporaire dans le merveilleux musée Gadagne, le musée de l’Histoire de Lyon.
La première de ces émissions était consacrée à < L’identité lyonnaise au fil de son histoire>. Elle a notamment évoqué une exposition temporaire dans le merveilleux musée Gadagne, le musée de l’Histoire de Lyon.
Cette exposition a pour nom : « Lyon sur le divan, les métamorphoses d’une ville » et se terminera le 17 juin 2018.
Car Lyon va beaucoup évoluer pendant l’Histoire, elle va gagner des terres sur le Rhône et sur les marécages qu’avait créés ce grand fleuve fougueux.
Lyon a été installé sur le confluent de deux fleuves : la Saône et le Rhône. Mais ce confluent va évoluer au cours des siècles à cause de l’action des hommes.
Au début de notre ère, quand les romains sont venus s’installer le confluent se trouvait en bas de la colline de Croix Rousse.
Les romains se sont installés en 43 avant Jésus-Christ.
Mais mon professeur d’Histoire, Jean-Pierre Gutton, dont j’ai suivi les cours à l’université de Lyon II en 2004, écrit dans son petit ouvrage « Histoire de Lyon et du Lyonnais » (Que Sais-je N°481 au PUF) :
« L’histoire de Lyon et, moins encore, celle du Lyonnais ne commencent pas à la fondation de la colonie en 43 avant Jésus-Christ comme on l’a naguère affirmé. […] A Lyon même, l’antériorité de l’occupation à la fondation de la colonie est maintenant bien établie. Depuis les années 1980, de multiples travaux de restructuration du quartier de Vaise (au nord de la cité) ont montré que les hommes sont présents dès le néolithique au moins sur la rive droite de la Saône. »
Jean-Pierre Gutton explique que c’est par un historien grec, Dion Cassius, que nous connaissons les circonstances de cet évènement qui est la création de Lugdunum sur la colline de Fourvière. Et Jean-Pierre Gutton raconte :
« Le texte montre bien le climat de luttes partisanes. Le Sénat souhaite retenir hors d’Italie des chefs militaires qui peuvent lui être hostiles : il faut fixer des vétérans »
Un peu de rappel historique est certainement nécessaire même pour les plus fervents lecteurs d’Astérix ; Jules César a soumis la Gaule lors d’une série de campagnes militaires contre les tribus gauloises de 58 avant JC jusqu’en 52, date à laquelle se situe la bataille d’Alésia. Il faut savoir que des tribus gauloises avaient rallié César et que la « guerre des Gaules » fut aussi une guerre entre gaulois.
Mais fort de son succès en Gaule qui va devenir province romaine, Jules César va s’emparer du pouvoir à Rome et veut mettre fin à la République et au pouvoir du Sénat.
Il se fait évidemment beaucoup d’ennemis et avant qu’il ne puisse accomplir son dessein ; il est assassiné aux ides de mars, ce qui correspond à mi mars, de l’année 44 avant JC.
Et c’est donc à la fois pour assurer la gestion de la Gaule et pour éloigner de Rome un certain nombre de partisans de César dont Lucius Munatius Plancus que le Sénat ordonne à ce dernier de créer une nouvelle colonie en Gaule pour jouer un rôle de capitale de la nouvelle province. Il faut savoir que Province vient du latin pro vincia qui signifie vaincu, c’est en effet les territoires conquis par Rome qui sont les provinces.
C’est ainsi Lucius Munatius Plancus qui devient proconsul de Gaule et fonde « Lugdunum » un an après l’assassinat de Jules César.
 Lugdunum se trouve donc sur la colline de Fourvière, sur la rive droite de la Saône.
Lugdunum se trouve donc sur la colline de Fourvière, sur la rive droite de la Saône.
Sur la rive gauche se trouve l’autre colline, la Croix Rousse, sur cette colline il y avait un village gaulois : « Condate » qui signifie confluent.
Grâce au Tour de Gaule d’Astérix, vous savez que Condate était aussi l’ancêtre de Rennes. On peut comprendre que comme aujourd’hui où beaucoup de villes portent le même nom (comme par exemple Montreuil), à l’époque il y avait plusieurs villes qui avaient le nom de Condate.
Et le nom de Condate était juste puisque le confluent de la Saône et du Rhône se trouvait précisément en bas de la colline de la Croix Rousse.
Ce site de Condate était donc, habité bien avant Lugdunum et sera bien sûr rapidement colonisé par les romains qui vont y édifier le sanctuaire des 3 Gaules..
Vous pouvez voir la Maquette de Lugdunum sur ce site et que je reprends dans cet article.
Vous voyez donc le Rhône qui rejoint la Saône, en bas de la Croix Rousse.
Un peu plus loin, après le confluent et sur le fleuve résultant une île qui porte le nom de « Canabae » qui porte aujourd’hui le quartier d’Ainay.
Plus tard, les lyonnais vont rattacher cette île à la terre et le confluent se déplacera jusqu’au quartier d’Ainay au bout de l’île de Canabae qui forme donc le cœur de la Presqu’ile.
Vous trouverez <Cet article du Point> qui désigne Lyon comme « une ville double : Lugdunum et Condate »
« En ce temps-là, celui de la Gaule romaine, il y avait deux villes à Lyon. D’abord Lugdunum (mot gaulois : la colline-ou la forteresse, c’est selon-du dieu Lug), sur la rive droite de la Saône. Ensuite Condate (autre mot gaulois qui signifie confluent), sur la rive gauche de la Saône, légèrement en amont, justement, de son confluent avec Rhodanus, le puissant et violent Rhône.
Voyons Lugdunum. Munatus Plancus, proconsul, c’est-à-dire gouverneur de la Gaule Chevelue conquise huit ans plus tôt, avait choisi un endroit excellent, l’actuelle colline de Fourvière, pour créer la nouvelle colonie de Lugdunum. Il installa, en 43 avant notre ère, sur cette hauteur qui domine la Saône et le Rhône, ses colons, des citoyens romains expulsés un an plus tôt de Vienne, la ville principale des Allobroges, sujets de la Narbonnaise.
C’est sur cette colline et à ses pieds, au bord de la rivière, rive droite, que prospéra cette cité précédemment consacrée, pense-t-on, au très gaulois dieu Lug. Prospérité due à cet inestimable confluent Rhône-Saône, qui ouvrait aux bateliers, aux nautes, ces armateurs fluviaux, de riches perspectives. »
Le remarquable catalogue de l’exposition « Lyon sur le divan », je dirai même plus remarquable que l’exposition explique l’étymologie controversée de Lugdunum :
« Le nom romain de Lyon , sous- tend deux caractéristiques de la ville , celle d’une ville dédiée au dieu gaulois Lug, un dieu extrêmement besogneux, très travailleur et qui rencontrera beaucoup de difficultés pour se faire accueillir à la cour des dieux et celle d’un dédié à Lux, en latin la lumière. »
« dunum » lui serait issu du celtique –duno, qui signifie soit « forteresse » ou « colline » ce serait donc la colline ou la forteresse du dieu Lug.
Cependant d’autres propositions existent pour définir l’étymologie de « Lug », soit par le nom du corbeau, en effet Lugus a été rapproché du gaulois lugos ou lougos, qui aurait signifié « corbeau », soit par le nom du « lynx ».
Lugdunum deviendra rapidement une ville essentielle de l’empire romain. Condate sera oubliée.
Le site de l’Inrap, « Institut national de recherches archéologiques préventives » précise :.
« Lugdunum devient la capitale de la province de Gaule lyonnaise, le siège du pouvoir impérial pour les trois provinces gauloises (Belgique, Lyonnaise, Aquitaine), et la Caput Galliarum, ou « Capitale des Gaules ».
Cette ville gallo-romaine se développe sur la colline de Fourvière, au confluent de la Saône (l’Arar) et du Rhône (Rhodanus). Elle devient très vite un important port fluvial. C’est aussi un nœud routier stratégique, relié au sud de la Gaule (la Narbonnaise), à l’Aquitaine, la Bretagne, la Germanie et bientôt l’Italie grâce aux routes construites par Agrippa.
En contact avec tout l’Empire, Lyon est une plaque tournante commerciale. Elle accueille les empereurs en visite et, très vite, s’agrandit, s’embellit et s’enrichit. Au Ier siècle, elle dispose du droit de battre monnaie, situation unique dans l’Empire romain à cette période.
Au IIe siècle, sa population est estimée entre 50 000 et 80 000 habitants, ce qui en fait l’une des plus grandes villes de la Gaule.
Deux empereurs romains sont nés à Lyon : Claude, né en 10 avant notre ère, et Caracalla, né en 188.
C’est à Lyon que chaque année, le 1 er août, se réunissent et siègent les délégués des soixante cités des trois Gaules. Ce rassemblement se déroule dans un vaste sanctuaire (installé sur les pentes de l’actuelle colline de la Croix-Rousse). On y élit le prêtre chargé des cérémonies dédiées au culte de Rome et de l’Empereur. Cette fonction constitue la plus haute charge administrative à laquelle les notables gallo-romains puissent accéder en Gaule. Le « Conseil des Trois Gaules » a pour fonction de représenter les intérêts gaulois auprès de Rome. »
C’est ainsi que commence l’Histoire de Lyon…
<1029>
-
Vendredi 2 mars 2018
« Imhotep est mort »Le chat qui a inspiré Joann Sfar pour ses BD : « Le chat du rabbin »Aujourd’hui je vais vous parler de chats. Mais je préviens : la fin de cet article n’aura rien à voir avec le début.
Les chats sont les héros des réseaux sociaux. Des femmes et des hommes du monde entier passent une partie de leur temps à interagir avec des chats, à les filmer et à publier ces films sur internet
<Dansons la capucine> 12 millions de vue !!
<Et puis il y a des compilations…> en voici une vue 49 millions de fois.
Et … il y a le chat du rabbin
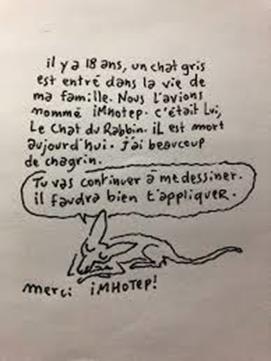 Le Huffington Post nous apprend que, le chat de Joann Sfar qui lui a inspiré ses planches « Le chat du rabbin » est mort.
Le Huffington Post nous apprend que, le chat de Joann Sfar qui lui a inspiré ses planches « Le chat du rabbin » est mort.
Le dessinateur a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, vendredi 23 février.
Dans le Parisien Joann Sfar confie :
« Il vivait aujourd’hui avec mon ex-compagne et mes enfants. Mais je le voyais souvent… Il a été un compagnon fidèle pendant 18 ans »,
La famille Sfar avait adopté en 2000 ce félin de race Orientale, long, maigre, aux oreilles en pointe.
« Nous sommes allés chez une éleveuse. J’avais un grand manteau et ce chat a quasiment sauté dans ma poche. C’était le plus moche et le plus étrange chat que j’avais jamais vu… Je me suis dit, c’est celui-là ».
Le chat du rabbin est un chat très particulier il parle la langue des humains.
Son maître est un rabbin, c’est pour cela qu’il s’appelle ainsi.
Mais cette manière de présenter les choses est ethno-centrée, c’est-à-dire exprimée dans le monde des hommes. Car un chat n’a pas de maître, un chat est libre. Dans le référentiel des chats, il serait plus juste d’écrire : « L’humain qui vit avec ce chat est un rabbin ».
Alors quand un chat qui pense et qui parle observe des humains monothéistes, c’est très drôle et très étonnant.
Nous en sommes à 7 albums, à des adaptations au théâtre et un film d’animation.
Moi je l’avais d’abord découvert par un feuilleton radio où en dix épisodes ses aventures étaient déclinées.
Ces émissions ne sont plus en ligne mais il reste la page de présentation :
« Le chat du rabbin n’est pas un chat comme les autres. Non seulement il est doué d’un esprit critique décapant dans cette Algérie du début du XXe siècle, mais en plus la faculté de parole lui vient après qu’il a soudain dévoré le perroquet de son maître. Le voilà plus décidé que jamais à utiliser son savoir et sa verve pour mieux faire vaciller les hommes dans leurs certitudes… et susciter l’admiration de sa très chère et ravissante maîtresse Zlabya.
Au fil de ses aventures, le chat va successivement affronter le rabbin du rabbin dans un duel théologique de haut vol faire la rencontre du légendaire cousin Malka et de son lion fidèle voir un jeune rabbin prétentieux lui ravir le cœur de sa maîtresse adorée ; croiser le cheikh Messaoud Sfar et son âne sur la route d’un pèlerinage découvrir Paris aux côtés de Raymond « El Rebibo », le neveu du rabbin venu faire carrière dans la capitale voir ressusciter un peintre russe idéaliste et partir avec lui aux confins du désert à la recherche de la Jérusalem d’Afrique…
Adaptée de la bande dessinée éponyme de Joann Sfar parue aux éditions Dargaud, Le Chat du rabbin est une fable colorée et truculente qui nous fait découvrir la culture juive séfarade à travers une pléiade de personnages aussi farfelus qu’attachants.»
Joann Sfar explique :
« J’ai vraiment eu l’idée de ces albums en l’observant. Avec ses grands yeux, il regardait tout le monde avec tellement d’intensité que l’on avait l’impression qu’il voulait parler. En plus, il miaulait tout le temps
[…] Il a été un compagnon fidèle pendant 18 ans, celui de mes histoires les plus intimes, glisse le dessinateur. Il s’est d’ailleurs passé une chose étrange la nuit dernière : une boîte à musique que j’ai chez moi ne marchait plus depuis des années. Et elle s’est mise en route toute seule. Je crois que c’était sa façon à lui de me dire au revoir
Oui, Je vais continuer [à le dessiner]. Fred, le dessinateur de Philémon me disait: ‘il y a des personnages qui finissent par se dessiner tout seul car ils ont une âme.’ Je crois que c’est le cas de mon chat du rabbin »
Un article de « la Croix » cité ci-après nous apprend que la domestication du chat, à partir de chats sauvages africains ou asiatiques, remonte à la préhistoire, à au moins 4 000 ans avant Jésus-Christ, au Proche-Orient et en Égypte. En France, sa présence est attestée à l’époque romaine mais elle ne s’impose dans les fermes qu’au Moyen Âge, pour y chasser les petits rongeurs.
Les chats sont donc mignons, drôle, intelligents, utiles et attachants.
Mais…
Si on réfléchit sur la présence des chats dans le monde, une sorte de géopolitique du chat on est surpris et la réalité apparaît un peu différente.
C’est la revue de Presse de France Inter du 27 février qui cite la <Croix>
«Un chasseur impitoyable aux yeux pourtant innocent, et qui tient en sa gueule le cadavre d’un merle noir. Le chat donc, ce carnassier que la Croix expose comme une menace pour la biodiversité…
Des dizaines milliards d’oiseaux, de reptiles, de petits mammifères exterminés chaque année sur le continent américain. En France, les chats font des millions de victimes chaque année: 13 millions et demi de chats domestiques plus quelques millions de chats errants, c’est trop pour des oiseaux déjà fragilisés par la disparition des insectes. Les moineaux parisiens ont quasiment disparu. Le chat a déjà rayé de la planète 63 espèces animales, et il faut donc le contrôler; stériliser les chats errants, comme en Belgique. Ne souriez pas…
La guerre contre les chats, est un enjeu planétaire.
En Australie, des robots aspergent les chats de poison, pour qu’ils meurent en se léchant. Mieux encore, on injecte des implants toxiques dans les proies du chat, qui meurt de sa gloutonnerie.
On lit cela dans Usbek et rica, qui raconte la lutte l’Australie contre les « espèces invasives »… Il n’y a pas que les chats et les Australiens pratiquent la guerre bactériologique, on mobilise contre les lapins des virus importés d’asie, le virus de l’herpès est répandu dans les rivières pour exterminer une carpe indésirable. Les Néo-Zélandais, eux arrosent le paysage de pesticides pour détruire les mammifères qui menacent le kiwi.
Usbek et Rica donc. La civilisation dérape chez les apprentis sorciers que nous sommes, l’espèce humaine, qui extermine des animaux d’un côté, et de l’autre prend le deuil d’espèces menacées.
Dans l’article de la Croix on lit encore :
« Dans les jardins, le rouge-gorge, l’accenteur mouchet et le merle noir sont les victimes préférées du chat en embuscade. « Sous les mangeoires, les chats n’ont qu’à se mettre à table ! » Jean-François Courreau, fondateur du centre d’accueil de la faune sauvage à l’école vétérinaire de Maisons-Alfort, voit régulièrement arriver, parmi les milliers d’animaux apportés au centre de soins, des oiseaux blessés par des chats, des juvéniles fraîchement sortis du nid ou des adultes qui se regroupent en hiver autour des lieux de nourrissage artificiel, proies de choix pour les chats aux aguets.
« Ils survivent rarement à leurs blessures, la plupart meurent avant même d’arriver au centre », précise-t-il. Les chauves-souris – une cinquantaine apportée au centre l’an dernier – ont, elles, un taux de survie quasi nul. »
Et aussi :
« Pour l’écologue australien Tim Doherty de l’université de Deakin, le chat est, après le rat, l’espèce invasive la plus responsable de perte de biodiversité, tout particulièrement sur les îles où, une fois introduit, il ne fait qu’une bouchée des espèces endémiques naïves.
Ses travaux, publiés dans la revue de l’Académie des sciences américaine (PNAS) en septembre 2016, concluent à 430 espèces de mammifères, oiseaux et reptiles en voie d’extinction à cause du chat. »
<Ici vous trouverez l’article de la Croix évoquant la stérilisation en Belgique>
Car il faut savoir que :
« la prolifération du chat est exponentielle. Il suffit de quatre ans pour qu’un couple donne une descendance de 20 000 chats ! »
En conclusion, il est donc possible de dire que les chats jouent un grand rôle dans la vie des humains. Toutefois qu’ils sont peut être trop nombreux sur la planète. En revanche que ce qui se passe en Australie et que relate le média Usbek et rica me semble extrêmement préoccupant.
Je ne finirai pas par la photo du chat tenant dans son bec un merle noir que vous trouverez dans l’article de la Croix mais la photo d’Imhotep que Joann Sfar a publié sur twitter.

<1028>
-
Jeudi 1 mars 2018
« Tout se sait toujours »Henry Alleg qui répond à son tortionnaire qui lui dit que jamais personne ne saura ce qui se passe dans les chambres de torture de l’armée française en Algérie.Maurice Audin était un jeune mathématicien de l’université d’Alger. Il était aussi militant communiste et partisan de l’indépendance algérienne.
Il est arrêté le 11 juin 1957 par des militaires français, au cours de la bataille d’Alger et on n’a jamais retrouvé sa trace. Il avait 25 ans au moment de son arrestation.
La version officielle de l’armée était qu’il s’était évadé.
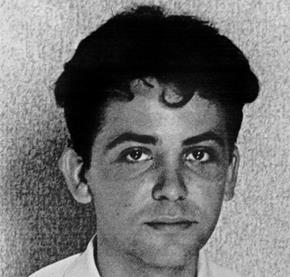 Au moment de son arrestation, la thèse de Maurice Audin était presque terminée et la soutenance était prévue pour le début de 1958. À la fin de 1956, Maurice Audin était venu quelques jours à Paris pour prendre contact avec les mathématiciens Gaston Julia, Henri Cartan et Laurent Schwartz.
Au moment de son arrestation, la thèse de Maurice Audin était presque terminée et la soutenance était prévue pour le début de 1958. À la fin de 1956, Maurice Audin était venu quelques jours à Paris pour prendre contact avec les mathématiciens Gaston Julia, Henri Cartan et Laurent Schwartz.
Le 2 décembre 1957, à la demande de René de Possel, directeur de recherche, a lieu une soutenance in absentia, à la faculté des sciences de Paris et devant un public nombreux Maurice Audin est reçu docteur ès sciences, avec mention « très honorable ».
Très rapidement il y a une mobilisation pour soutenir Maurice Audin.
En mai 1958, l’historien Pierre Vidal-Naquet publie une enquête dans laquelle il affirme que l’évasion était impossible et que Maurice Audin est mort au cours d’une séance de torture, le 21 juin 1957, assassiné par des soldats du général Massu.
Jusqu’en 2012, l’Armée, la Justice et l’Etat français sont dans le déni ou l’évitement continuant à nier l’évidence.
En 2012, le président Hollande se rend devant la stèle élevée à la mémoire de Maurice Audin à Alger et fait lancer des recherches au Ministère de la Défense sur les circonstances de sa mort
Le 8 janvier 2014, un document est diffusé en exclusivité dans le Grand Soir 3 dans lequel le tristement célèbre général Aussaresses (mort le 3 décembre 2013) déclare au journaliste Jean-Charles Deniau qu’il a donné l’ordre de tuer Maurice Audin
Et enfin en juin 2014, le président Hollande, dans un message adressé à l’occasion du prix de mathématiques Maurice Audin, reconnaît officiellement pour la première fois au nom de l’État français que Maurice Audin ne s’est pas évadé, qu’il est mort en détention, comme, explique-t-il, les témoignages et documents disponibles l’établissent.
Mais il y a aujourd’hui un fait nouveau le 14 février 2018 le journal « L’Humanité » publie le témoignage d’un vieil homme. <Vous trouverez cet article derrière ce lien>
La communauté des mathématiciens s’était mobilisée pour que la vérité éclate. Cédric Villani, le célèbre député macroniste et médaille Fields 2010 est en première ligne. La fille de Maurice Audin, Michèle Audin est aussi une grande mathématicienne. Elle avait refusé, en 2009, la Légion d’honneur, en raison du refus du président de la République, Nicolas Sarkozy, de répondre à une lettre de sa mère à propos de la disparition de son père.
Le 12 janvier 2018, Cédric Villani a dit qu’après avoir parlé de l’affaire Audin avec le président de la République, Emmanuel Macron, il pouvait déclarer que : « Maurice Audin a été exécuté par l’Armée française », tout en affirmant qu’il n’y avait aucune trace de cette exécution dans les archives.
L’humanité révèle que c’est l’entretien publié dans ses colonnes, le 28 janvier, avec le mathématicien Cédric Villani qui a convaincu, cet homme de 82 ans qui habite Lyon de venir à Paris porter témoignage.
« Il a fait le voyage depuis Lyon pour soulager sa conscience et « se rendre utile pour la famille Audin », assure-t-il. Son histoire est d’abord celle du destin de toute une génération de jeunes appelés dont la vie a basculé du jour au lendemain. En 1955, après le vote « des pouvoirs spéciaux », le contingent est envoyé massivement en Algérie. Il n’a que 21 ans. Fils d’un ouvrier communiste, résistant sous l’occupation nazie en Isère, il est tourneur-aléseur dans un atelier d’entretien avant d’être incorporé, le 15 décembre 1955. Un mois plus tard, le jeune caporal prendra le bateau pour l’Algérie, afin d’assurer des « opérations de pacification », lui assure l’armée française. Sur l’autre rive de la Méditerranée, il découvre la guerre. Les patrouilles, les embuscades, les accrochages avec les « fels », la solitude, et surtout, la peur, permanente. Cette « guerre sans nom », il y participe en intégrant une section dans un camp perché sur les collines, sur les hauteurs de Fondouk, devenue aujourd’hui Khemis El Khechna, une petite ville située à 30 kilomètres à l’est d’Alger. […] »
Témoignage terrible, car au-delà de ce qu’il relate à propos de Maurice Audin, il décrit d’autres scènes du sale combat qu’a mené l’armée française en Algérie. Pour les mêmes raisons, risque d’attentat ou vengeance, une partie de l’armée française s’est comportée en Algérie, pays que la France occupait, de la même manière que la Gestapo en France que l’armée allemande occupait.
A priori, Maurice Audin n’a pas commis d’attentat.
Le vieil homme a gardé l’anonymat dans l’article de l’Humanité et il a dit :
« Je crois que c’est moi qui ai enterré le corps de Maurice Audin. »
Dans la ville de Fondouk […] un après-midi du mois d’août, un adjudant de la compagnie lui demande de bâcher un camion : « Un lieutenant va venir et tu te mettras à son service. Et tu feras TOUT ce qu’il te dira. » Le lendemain matin, le temps est brumeux et le ciel bas quand un homme « au physique athlétique » s’avance vers lui, habillé d’un pantalon de civil mais arborant un blouson militaire et un béret vissé sur la tête. C’était un parachutiste. « On va accomplir une mission secret-défense, me dit le gars. Il me demande si je suis habile pour faire des marches arrière. Puis, si j’ai déjà vu des morts. Puis, si j’en ai touché, etc. » « Malheureusement oui », relate l’ancien appelé. « C’est bien », lui répond le para, qui le guide pour sortir de Fondouk et lui demande de s’arrêter devant une ferme. « Est-ce que tu as des gants ? Tu en auras besoin… » Jacques s’arrête à sa demande devant l’immense portail d’une ferme assez cossue qui semble abandonnée. Il plisse les yeux pour en décrire le moindre détail qui permettrait aujourd’hui de l’identifier. « Descends et viens m’aider ! » lui lance le para, dont il apprendra l’identité bien plus tard : il s’agirait de Gérard Garcet (lire l’Humanité du 14 janvier 2014), choisi par le sinistre général Aussaresses pour recruter les parachutistes chargés des basses besognes. Le même qui fut, plus tard, désigné par ses supérieurs comme l’assassin de Maurice Audin…
Le tortionnaire ouvre une cabane fermée à clé, dans laquelle deux cadavres enroulés dans des draps sont cachés sous la paille. « J’ai d’abord l’impression de loin que ce sont des Africains. Ils sont tout noirs, comme du charbon », se souvient Jacques, à qui Gérard Garcet raconte, fièrement, les détails sordides : « On les a passés à la lampe à souder. On a insisté sur les pieds et les mains pour éviter qu’on puisse les identifier. Ces gars qu’on tient au chaud depuis un bout de temps, il faut maintenant qu’on s’en débarrasse. C’est une grosse prise. Il ne faut jamais que leurs corps soient retrouvés. » « C’est des gens importants ? » lui demande le jeune appelé. « Oui, c’est le frère de Ben Bella et l’autre, une saloperie de communiste. Il faut les faire disparaître. » Un sinistre dialogue que Jacques relate des sanglots dans la voix. C’est qu’il est aujourd’hui certain qu’il s’agissait bien de Maurice Audin. Quant à l’autre corps, il est impossible qu’il s’agisse d’un membre de la famille d’Ahmed Ben Bella, l’un des chefs historiques et initiateurs du Front de libération nationale (FLN). Sans doute un dirigeant du FLN, proche de Ben Bella[…]
Après vingt minutes de trajet environ, on s’est arrêtés devant un portail. Il n’était pas cadenassé, celui-là. Ça m’a étonné. Au milieu de la ferme, il y avait une sorte de cabane sans toit avec des paravents, comme un enclos entouré de bâches. Il m’a demandé d’attendre. Quand il a ouvert la bâche : quatre civils algériens avaient les yeux bandés et les mains attachées dans le dos. Ils leur avaient fait creuser un énorme trou, qui faisait au moins 4 mètres de profondeur. Dans le fond, j’ai aperçu des seaux, des pioches et une échelle. Il m’a demandé de recouvrir les deux cadavres. Ce que j’ai fait. D’abord il m’a félicité. Puis, me dit de n’en parler à personne, que j’aurais de gros ennuis si je parle. Et ma famille aussi. Il me menace. On est rentrés à Fondouk et il me demande de le déposer devant les halles du marché. »
Et puis, [celui que l’Humanité a appelé Jacques] a oublié, pour continuer à vivre. Comme toute une génération marquée à vie, murée dans le silence et la honte, il n’a pas parlé. Ni de cette nuit-là, ni du reste.
Dans la Question, Henri Alleg relate un dialogue avec ses bourreaux à qui il dit, épuisé par la torture : « On saura comment je suis mort. » Le tortionnaire lui réplique : « Non, personne n’en saura rien. »
« Si, répondit Henri Alleg, tout se sait toujours… »
<1027>
-
Mercredi 28 février 2018
« Le patriotisme, c’est l’amour des siens. Le nationalisme, c’est la haine des autres. »Romain Gary «Éducation européenne»Il faut des mots du jour plus courts à la fois pour les lecteurs, mais aussi pour le rédacteur.
J’ai glané lors d’une émission de radio cette phrase inspirante de Romain Gary que j’ai mis en exergue et que je partage aujourd’hui.
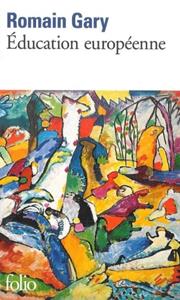 J’ai bien sûr vérifié.
J’ai bien sûr vérifié.
Il s’agit bien d’une citation de Romain Gary qu’il a fait figurer dans son premier roman « Éducation européenne » écrit en 1943 et paru en 1945 (qu’on trouve en Folio, n° 203). Voici le passage en question (page 246, à la fin du chapitre 31) :
– J’aime tous les peuples, dit Dobranski, mais je n’aime aucune nation. Je suis patriote, je ne suis pas nationaliste.
– Quelle est la différence ?
– Le patriotisme, c’est l’amour des siens. Le nationalisme, c’est la haine des autres. Les Russes, les Américains, tout ça… Il y a une grande fraternité qui se prépare dans le monde, les Allemands nous auront valu au moins ça…
Roman Kacew, devenu Romain Gary est né le 21 mai 1914 à Vilna dans l’Empire russe (actuelle Vilnius en Lituanie). Il se suicide le 2 décembre 1980 avec un revolver. C’était un aviateur, militaire, résistant, diplomate, romancier, scénariste et réalisateur français, de langues française et anglaise.
Il est le seul romancier à avoir reçu le prix Goncourt à deux reprises, sous deux pseudonymes : en 1956 « Les Racines du ciel » avec le pseudonyme Romain Gary et le 17 novembre 1975 « La Vie devant soi » sous les pseudonyme Émile Ajar.
Je m’arrête là sinon le mot ne serait pas court et je trahirai ma promesse.
En revanche, rien n’empêche celles et ceux qui le lise d’écrire ce que leur inspire cette phrase du grand écrivain.
<1026>
-
Mardi 27 février 2018
«Nous avons été de la viande à charbon. »François Dosso, porte-parole de la cellule maladies professionnelles de la CFDT des mineurs de charbon de LorraineJe suis né à Forbach et ma maison parentale se trouvait dans la ville voisine de Stiring-Wendel. Ces deux villes faisaient partie du bassin houiller de Lorraine, les mines de charbon. Si mon père n’y a travaillé que pendant une très petite période, la plus grande partie de ma famille : oncles, cousins, petits cousins y ont travaillé toute leur vie.
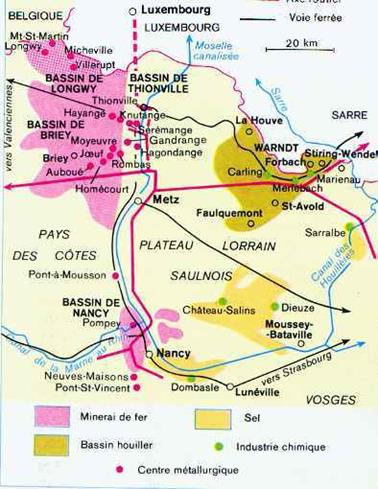 La Lorraine était une région industrielle de mines, les mines de fer près de Thionville, les mines de charbon autour de Forbach, Freyming Merlebach et aussi des mines de sel près de la ville bien nommée Château-salins.
La Lorraine était une région industrielle de mines, les mines de fer près de Thionville, les mines de charbon autour de Forbach, Freyming Merlebach et aussi des mines de sel près de la ville bien nommée Château-salins.
En avril 2004, le dernier puits du bassin houiller lorrain a fermé, il s’agissait du puits de la Houve à Creutzwald. Le siège de Merlebach avait fermé au mois d’octobre 2003.
Mais c’est bien l’arrêt de la production, le 23 avril 2004, du puits de la Houve qui marque la fin de l’exploitation du charbon en France.
Wikipedia nous apprend que la présence du charbon dans la région fût connue dès le XVIe siècle, mais que c’est au début du XIXe siècle que l’exploitation du bassin lorrain va connaître son développement. Ainsi, c’est en 1810 que deux ingénieurs du corps impérial des Mines dressent le premier atlas du bassin houiller lorrain dans la continuité du bassin de la Sarre qui se trouve au-delà de la frontière du côté de l’Allemagne qui n’a pas encore opérée son unification.
Nous apprenons aussi que le bassin houiller lorrain s’étend sur une superficie de 49 000 ha, qu’il peut être délimité par le triangle Villing (près de Creutzwald) – Faulquemont – Stiring-Wendel et qu’il regroupe environ 70 communes. Enfin on y dénombra plus de 58 puits construits entre 1818 et 1987.
En 1946, au lendemain de la guerre les mines de charbon furent nationalisées et on créa les Houillères du bassin de Lorraine (HBL), un établissement public à caractère industriel.
L’exploitation est donc désormais arrêtée depuis 14 ans, mais de graves problèmes demeurent dans ma région natale.
D’abord un problème économique, cette région est sinistrée depuis cette fermeture qui correspond à une désindustrialisation que rien n’a su compenser pour donner des emplois stables et rémunérateurs. J’avais esquissé cette problématique en évoquant le documentaire de Régis Sauder <Retour à Forbach>
Ensuite des problèmes géologiques, en effet, l’eau s’engouffre dans les galeries et cause des affaissements de terrain et des effondrements miniers qui endommagent les immeubles et les routes.
Mais la technique n’est rien sans les hommes explique « l’Humanité » dans ce bel article de 2003 < Freyming-Merlebach, ou la vie après la mine>. Vu à hauteur d’homme, cet article raconte comment dans ce lieu de labeur se sont côtoyés des travailleurs venant de pays différents :
« Des convois d’Italiens, de Polonais surtout, arrivent en gare de Toul. On leur pend un écriteau autour du cou. Ils s’ajoutent par dizaines aux Slovènes, aux Hongrois, et bien sûr aux Allemands. Depuis le début du siècle, ils acceptent de descendre aux côtés des paysans de Freyming. Du coup, les effectifs salariés progressent de 13 500 à 24 775 de 1920 à 1938. »
Mon grand-père maternel faisait partie du contingent polonais qui est venu renforcer la force de travail dans les mines de charbon de Moselle dans les années 1920.
Dans cet univers aussi se côtoyait ceux qui ne croyaient pas et ceux qui croyaient. Après un article du journal l’Humanité, je suis tombé sur un article de 2013 du journal « La Croix » : <La retraite contrastée des mineurs de Lorraine> :
On pourrait penser que le destin d’un mineur de charbon était enviable :
« Dans le charbon, on cessait le travail à 50 ans pour les mineurs de fond et à 55 ans quand on travaillait au jour. Mais quand les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) ont progressivement cessé leurs activités, entre la fin des années 1990 et 2008 (l’exploitation avait pris fin en 2004), l’âge a encore été avancé à 45 ans. »
Mais la journaliste de la Croix raconte aussi la perte de sens, l’ennui et le vide :
« Heureusement, j’habite dans une maison et il y a du travail, poursuit Stanislas. Mais beaucoup sont en appartement, ils n’arrivent pas à s’occuper, passent leurs journées dans leur canapé, devant la télévision, à boire et à fumer. J’en connais un, pourtant bon vivant, qui a divorcé, puis s’est suicidé. Un autre a fait une tentative, récemment. Ils avaient pourtant tout pour avoir une vie extraordinaire. Mais ce qui manque le plus, c’est le contact. […]
En tant que médecins du travail, nous aurions voulu continuer à les suivre au-delà de 2008, témoigne Pierre Heintz, ancien médecin des Houillères, mais cela n’a pas été validé par Charbonnages de France. La direction estimait que ça ne pouvait que bien se passer. Nous, nous avions le retour des premiers mineurs partis, dont certains s’étaient mis à boire, avaient un sentiment de perte d’identité car leur métier n’existait plus. »
Et la journaliste rappelle « Le Pacte charbonnier », un accord inimaginable aujourd’hui :
« En 1994, alors que les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) emploient 12 000 personnes, le « Pacte charbonnier » est signé sous la houlette de Gérard Longuet, alors ministre de l’industrie. Cet accord, inimaginable aujourd’hui, est justifié par la crainte de ne pas réussir à reclasser les « gueules noires », dont beaucoup sont victimes de maladies professionnelles (amiante et silicose) et envers qui la Nation se sent redevable d’une dette.
Un « congé charbonnier de fin de carrière » (CCFC) est ouvert à tous les ouvriers et agents de maîtrise de plus de 45 ans ayant au moins vingt-cinq ans d’ancienneté (vingt ans pour ceux ayant plus de 20 % d’invalidité) »
Ils touchent 80 % de leur salaire, ne peuvent travailler en parallèle (plus tard, ils auront la possibilité de toucher un faible revenu) et conservent tous leurs avantages (gratuité des soins, du logement, du chauffage), y compris pour les veuves».
Mais si j’écris aujourd’hui un mot du jour à ce sujet, c’est en raison d’un article « des Echos » du 15 février 2018 écrit par Pascale Braun : <La dernière bataille des mineurs de Lorraine> :
« Exposés à des conditions de travail dangereuses et insalubres dans les années 1980, plus de 3.000 mineurs tentent aujourd’hui de faire reconnaître la faute inexcusable des Houillères à leur encontre. […]»
« Nous avons été de la viande à charbon. Les houillères ont envoyé au casse-pipe des jeunes de vingt ans. Nous ne cesserons pas de nous battre tant que nous n’aurons pas obtenu la reconnaissance collective de cette ignominie », expose sans ambages François Dosso, porte-parole de la cellule maladies professionnelles de la CFDT. »
Car avant de partir à la retraite les mineurs de charbon qui travaillaient au fond de la mine ont été soumis à des poussières, des gaz, la terrible silice, l’amiante et d’autres produits dangereux :
« A partir du choc pétrolier déclenché en 1973 par la guerre du Kippour et jusqu’à la catastrophe du puits Simon de Forbach en 1985, les houillères du bassin de Lorraine (HBL) ont imposé aux mineurs une productivité très élevée.
Les rendements ont progressé de manière spectaculaire, passant de 4,4 tonnes par homme et par jour en 1974 à 6 tonnes par homme et par jour en 1990. Les embauches ont repris à un rythme soutenu – jusqu’à 3.000 mineurs par an, avec un turnover atteignant parfois les deux tiers – jusqu’à l’arrêt brutal des recrutements en 1983. […]
Sur le plan sanitaire, cette période s’est avérée funeste. Les syndicats se sont d’abord inquiétés des accidents – 16 morts lors de la catastrophe de Merlebach en septembre 1976, mais aussi 15 morts et 600 blessés graves en moyenne chaque année hors accidents collectifs. Le souci des maladies n’est apparu que plus tard. […]
Les mineurs sont tombés malades. Pour l’année 1992, considérée comme ordinaire, les affiliés au régime minier présentent un taux de prévalence de maladies professionnelles 144 fois plus élevé que pour les affiliés au régime général. Au fond des puits, ils utilisent massivement des huiles minérales ou bitumineuses et du trichloréthylène. Ils respirent des vapeurs de gazole, des fumées de tirs d’explosifs et des fibres de roche.
En fonction des sites et des métiers, ils ont pu entrer en contact avec 24 produits cancérigènes ou pathogènes. [Ils] ont été exposés en moyenne à 11 d’entre eux au cours de leur carrière.
La dernière mine de Lorraine ferme en 2004 . Quatre ans plus tard, Charbonnage de France est liquidé et relayé par l’Agence nationale pour la garantie des mineurs (ANGDM). Disparaît ainsi un employeur qui régna en maître dans le bassin houiller durant un siècle et demi. Les langues se délient.
Peu avant la liquidation, certains médecins et cadres communiquent aux syndicats des informations jusqu’alors inédites sur la toxicité des produits utilisés. S’engage alors la troisième bataille du charbon, visant à faire reconnaître et à indemniser les victimes sanitaires d’une exploitation hors norme.
Le combat sans concession commence par l’amiante. Dans un premier temps, CDF conteste l’exposition elle-même. Déboutée jusqu’en cassation, l’entreprise attaque systématiquement toutes les demandes de reconnaissance de faute inexcusable, mais se voit presque immanquablement condamnée, au terme d’une guérilla juridique évaluée à 5.000 euros par cas, soit un coût de plus de 15 millions d’euros.
Aujourd’hui, entre 10 et 15 dossiers sont plaidés et gagnés chaque semaine au tribunal des affaires sanitaires et sociales de Metz.
A ces quelque 3.500 plaintes en cours se sont ajoutés au moins 500 dossiers portant sur la silicose et les maladies respiratoires inscrites aux tableaux 30 et 30 bis de la Sécurité sociale . »
L’avocat spécialisé en santé et sécurité au travail, Michel Ledoux explique :
« Pendant des décennies, nous avons échoué à contrer le raisonnement communément admis selon lequel on ne peut extraire du charbon sans générer de la silice. Nous sommes ensuite parvenus à démontrer que les houillères n’avaient pas respecté les mesures de sécurité qu’elles avaient elles-mêmes mises en place. Mais chaque dossier constitue un gros travail, car les mineurs ont exercé à des époques différentes, dans différents puits et à différentes tâches ».
C’est donc une bataille juridique qui s’est engagée. Elle est très incertaine pour les mineurs
« En juillet 2017, 755 anciens mineurs de l’Est mosellan ont pourtant encaissé une sévère déconvenue : la cour d’appel de Metz les a déboutés à la fois de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété et de leur plainte contre Charbonnages de France (CDF) pour violation de l’obligation de sécurité.
Les plaignants avaient obtenu partiellement gain de cause le 30 juin 2016 devant le tribunal des prud’hommes de Forbach , qui leur a accordé un préjudice d’anxiété – jusque-là réservé aux victimes relevant du dispositif spécifiquement dédié aux victimes de l’amiante – avec une indemnisation de 1.000 euros contre les 15.000 demandés.
Ils ont décidé de se pourvoir en cassation, mais tous ne seront peut-être pas au rendez-vous. Entre juin 2013, date de la première instance aux prud’hommes, et le lancement de la procédure en appel en septembre 2015, 14 des 844 plaignants sont morts, à l’âge moyen de 61 ans. La décision de la cour est attendue courant 2019. »
Tout récemment sur des motifs analogues, des mineurs de fer de Lorraine ont été déboutés par la Cour de Cassation le mercredi 21 février 2018.
Nous sommes ici au cœur de la complexité du monde industriel dans lequel des ouvriers étaient fiers de leur travail et donnaient du sens à leur action tout en perdant leur vie à la gagner.
Pour celles et ceux que cela intéresse, j’ai encore trouvé <Un diaporama montrant le travail dans les mines de charbon lorraines et son évolution>
Et <Ici> toute une collection de photos du patrimoine minier.
Il y a énormément de ressources sur Internet. Ainsi sur ce blog on trouve une page décrivant chacun des 58 puits de l’Histoire des charbons de Lorraine, du puit de Schoeneck (1818) à La Houve (Creutzwald), le puits ouest (1987)
<1025>
-
Lundi 26 février 2018
« Un homme est venu et a pris les empreintes digitales de tous les villageois. Il nous a dit que les entreprises d’extraction de sable avaient le droit d’opérer dans cette zone et que cela ne servait à rien de protester. »Un employé d’industrie d’extraction du sable opérant à Koh Sralao au CambodgeCe n’est pas la première fois que j’évoque le problème d’une ressource qui devient rare et qui est surexploitée dans le monde : Le sable
J’avais mis en exergue, une phrase de Coluche : «Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans cinq ans il faudrait qu’ils achètent du sable ailleurs.» Cette phrase était d’ailleurs en contradiction avec l’article, car le sable du Sahara n’est pas utilisable pour les besoins de la construction et autres activités économiques dans lesquels les humains utilisent du sable. Dans ce mot du jour vous trouverez beaucoup de liens vers des émissions ou des articles montrant le problème écologique considérable qui est provoqué par cette surexploitation.
Aujourd’hui, je fais référence à un problème local qui se trouve au Cambodge dans un lieu appelé Koh Sralao selon l’article cité plus loin mais que j’ai trouvé avec l’orthographe suivante sur google maps : « Koh Sralau ». C’est un village de pécheurs de crustacés et de cabanes sur pilotis, près d’une mangrove féerique où l’eau se mêle à la terre, mais ce paradis est un malheur, parce que le sol des rivières est tapissé de sable et que le sable de rivière, est l’ingrédient indispensable du capitalisme.
 J’ai été informé sur ce sujet par la revue de presse de France inter <du 16 février 2018>
J’ai été informé sur ce sujet par la revue de presse de France inter <du 16 février 2018>
Revue de presse qui renvoyait vers un article très détaillé de la journaliste Julie Zaugg publié par le « magazine des Echos » le 15 février 2018. Article que vous trouverez derrière ce lien : <La guerre du sable>
J’en tire les extraits suivants :
D’abord une analyse assez générale sur l’exploitation du sable, notamment en Asie :
«La consommation de cette ressource est telle que s’est développé un vaste trafic. Des pays pauvres sacrifient plages et rivières pour alimenter la croissance de puissances émergentes. […]
Un jet d’eau brunâtre s’élance vers le ciel. Il sort d’un tuyau formé de morceaux de tube rouillés grossièrement assemblés. Deux barils vides, accrochés de part et d’autre, lui permettent de flotter. Cette structure de fortune, reliée à une plate-forme en bois sur laquelle s’activent trois ouvriers torse nu et en tongs, est alimentée par deux moteurs de tondeuse à gazon pétaradants. Elle aspire le sable au fond de l’estuaire, puis le rejette sur la berge. Une fumée noire et nauséabonde s’en échappe. Elle se trouve à quelques mètres au large de Koh Kong, cité cambodgienne nichée près d’une immense réserve naturelle abritant l’une des mangroves les mieux préservées d’Asie. Cette ville aux rues jonchées de déchets est devenue un des points chauds d’un vaste commerce de sable, dont les ramifications s’étendent aux quatre coins de l’Asie.
Produit par des siècles d’érosion, ce matériau est la ressource naturelle la plus utilisée au monde. « Chaque année, il s’en consomme entre 40 et 50 milliards de tonnes », note Pascal Peduzzi, un géographe qui a réalisé une étude dans le cadre du Programme des Nations unies pour l’environnement. Cette industrie, qui pèse environ 200 milliards de dollars par an, est en pleine effervescence, tirée par le boom de la construction en Asie. En Chine surtout : « Ce pays consomme 58% du sable extrait au niveau mondial, dit le chercheur. Entre 2011 et 2013, il a utilisé autant de ciment que les Etats-Unis durant tout le siècle dernier. » Le développement accéléré de cités tentaculaires comme Shanghai, Shenzhen ou Chongqing, les mégaprojets comme le barrage des Trois-Gorges et les centaines de milliers de kilomètres de route construits par l’empire du Milieu ces vingt dernières années… tous se sont nourris de gigantesques quantités de sable, composante principale du ciment, du béton, de l’asphalte et du verre. L’Inde voisine n’est pas en reste.
[…]
Si l’industrie de la construction absorbe 70% du sable extrait dans le monde, il a d’autres usages. Des micro-Etats, comme Singapour, Dubaï ou Hong Kong, s’en servent pour gagner des terres sur la mer ; les îles menacées par la montée des eaux, comme les Kiribati ou les Maldives, l’utilisent pour bâtir des digues ; Pékin le met au service de ses ambitions territoriales en rehaussant des îlots contestés en mer de Chine méridionale. « Il existe aussi une série d’applications industrielles, comme la fracturation de la roche pour en extraire du pétrole, la fabrication de puces informatiques, de panneaux solaires, de papier de verre, de détergents, de cosmétiques et de dentifrice », précise Pascal Peduzzi. Ces utilisations nécessitent une variété à base de silice, presque blanche et d’une grande finesse. En général, ce matériau n’est pas exporté sur de grandes distances, car ce ne serait pas rentable, vu son prix (entre 5 et 10 dollars la tonne). La majeure partie du sable utilisé en Chine et en Inde est ainsi extrait sur place. Mais quelques pays asiatiques – Cambodge, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Philippines – en ont fait une industrie d’exportation. Un choix lourd de conséquences pour leurs habitants et leurs écosystèmes.
Puis il y a la situation particulière du village de Koh Sralao :
L’eau salée a pénétré dans la mangrove – les arbres morts, aux racines blanchies par le sel, en témoignent. Le village de Koh Sralao apparaît au détour d’un méandre de la rivière. Des maisons sur pilotis, aux toits de tôle, reliées par des pontons en bois. Au sol, paniers à crabes, filets de pêche et crustacés qui sèchent au soleil. La ressource, ici, c’est le crabe. Mot Sopha, une jeune femme de 33 ans […] se remémore l’arrivée des mineurs : « Les barges sont apparues un jour et personne ne nous a expliqué ce qu’elles faisaient ici. Un peu plus tard, un homme est venu et a pris les empreintes digitales de tous les villageois. Il nous a dit que les entreprises d’extraction de sable avaient le droit d’opérer dans cette zone et que cela ne servait à rien de protester. »
On leur promet un hôpital, une route et une école… ils ne se matérialiseront jamais. Au début, les habitants de Koh Sralao se contentent d’observer l’étrange ballet de grues et de barges qui se déroule juste devant leur village. Très vite, ils comprennent que quelque chose ne tourne pas rond. « Avant leur arrivée, je ramenais trois filets remplis de crabes chaque jour, ce qui me rapportait 25 dollars environ, détaille le mari de Mot Sopha, […]. Aujourd’hui, je dois déployer dix filets et cela ne me permet pas de gagner plus de 20 dollars. »
La population de crustacés et de poissons dans cet estuaire s’est effondrée. De l’ordre de 70 à 90%, selon un rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature. En raclant le fond de l’eau, les grues soulèvent un plumet de boue et de sédiments qui étouffe la vie marine. « Cela décape aussi le fond, riche en nutriments », pointe Alejandro Davidson-Gonzales, le fondateur de Mother Nature. À Koh Sralao, l’impact a été dévastateur. « Nous gagnons moins d’argent et avons dû acheter plusieurs nouveaux filets, détaille Mot Sopha. Cela nous a obligés à emprunter 500 dollars. » Les prêts sont fournis par des villageois fortunés à des taux exorbitants, qui peuvent atteindre 30%. « La saison suivante, nous avons de nouveau dû emprunter 500 dollars, juste pour pouvoir payer les traites », dit-elle. À plusieurs reprises, la situation s’est tendue. Les habitants de Koh Sralao ont tenté, en vain, de chasser les mineurs, notamment après le décès de l’un des leurs lorsque son embarcation est entrée en collision avec une barge.
L’article évoque la corruption, la complicité des autorités politiques avec les industriels qui profitent de cette activité lucrative et destructrice de l’économie locale et bien sûr de la nature. Les berges des rivières s’effondrent :
« «Seak Ky, une femme de 36 ans aux bras ornés de bracelets dorés, vend du jus de canne à sucre le long de la route, à S’ang, un hameau au sud de la capitale. En février, elle a découvert une fissure dans le sol de sa cuisine. Quelques jours plus tard, en pleine nuit, la moitié de sa maison est tombée dans le Bassac, un bras du Mékong. « Tout s’est passé en moins de 30 minutes, raconte cette mère de trois enfants. Je n’ai eu le temps que de me saisir de quelques casseroles. J’ai perdu tout le reste. » Ce n’était pas la première fois. « J’ai dû déplacer ma maison quatre fois vers l’intérieur des terres, car plus de 20 mètres de berges se sont effondrées », livre-t-elle.
Sa demeure est désormais collée à la route. Une dizaine de maisons du village ont subi le même sort. En cause : une plate-forme munie d’un tuyau qui aspire le sable au milieu du fleuve, à une petite dizaine de mètres des habitations. Il y en a plusieurs autres le long de la rive. « Elles sont arrivées à l’été 2016, indique Ly Raksmey, un militant de Mother Nature. Le sable alimente un chantier de logements pour les fonctionnaires, à quelques kilomètres d’ici. » Lorsqu’on extrait du sable au milieu d’une rivière, cela en accélère le flux, favorisant l’érosion des berges et les inondations en aval. […]
À S’ang, la colère gronde. « Je n’ai reçu aucune compensation financière, s’emporte Seak Ky. On m’a dit que l’effondrement était dû à une catastrophe naturelle.»
C’est une catastrophe qui s’étend à beaucoup d’autres pays asiatiques :
« Le Cambodge n’est pas le seul pays ravagé par les effets de l’extraction de sable. En Inde, plusieurs ponts menacent de s’effondrer car leurs fondations ont été mises à nu. Des lacs et des rivières au Kerala ont vu leur niveau chuter dramatiquement, asséchant les puits aux alentours. La même chose s’est produite aux Philippines, au Sri Lanka et en Indonésie. Mais le pays le plus affecté, c’est le Myanmar. « L’extraction s’opère dans la rivière Irrawaddy, dans les estuaires du sud-est du pays et sur les plages de l’Etat du Rakhine, détaille Vicky Bowman, qui dirige l’ONG Myanmar Centre for Responsible Business. Résultat, les côtes marines ne sont plus protégées contre les tempêtes, les berges des rivières s’érodent et l’eau est devenue trouble. » Certains hôtels, sur la plage de Ngapali, ont commencé à s’effondrer. Et des bâtiments construits avec ce sable rempli de sel, tel l’hôpital de Sittwe, risquent aussi de s’affaisser. »
Il existerait pourtant des alternatives au sable :
« Il existe des solutions pour utiliser moins de sable. L’asphalte, le ciment et le verre se recyclent. En Grande-Bretagne, près de 30% des matériaux utilisés dans le BTP sont générés ainsi. « L’incinération de déchets produit une cendre très compacte qui peut servir à fabriquer des revêtements de parking ou des dalles », précise en outre Pascal Peduzzi, géographe affilié au programme des Nations unies pour l’environnement. Singapour se sert pour sa part de la terre excavée lors de la construction des lignes de métro pour gagner du terrain sur la mer. La cité-Etat a également lancé un ambitieux projet, inspiré par les polders néerlandais, pour agrandir l’île de Tekong, tout à l’est du territoire, de 8,1 km2. « Nous construisons un mur circulaire long de 10 kilomètres qui affleurera à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer, détaille Wong Heang Fine, le PDG de Surbana Jurong, entreprise qui travaille au projet. L’eau retenue par cette digue sera ensuite drainée et nous pourrons construire directement sur le sol marin. » »
Homo sapiens continue sa folle quête de la croissance en prélevant des ressources de notre planète au-delà du raisonnable et supérieures à ce qu’elle est capable de régénérer.
Je vous redonne le lien vers l’article du magazine des Echos : <La guerre du sable>
<1024>
-
Vendredi 23 février 2018
« En privant un homme de son travail, on le prive de son humanité et c’est une forme encore plus générale de l’esclavage.»Martin Luther King Discours prononcé à la bourse du travail de Lyon le 29 mars 1966Il y a 50 ans, le 4 avril 1968, le Pasteur Martin Luther King était assassiné.
Pour commémorer cet évènement, la Bibliothèque de Lyon Part-Dieu a décidé à lui rendre hommage par une exposition : «Martin Luther King le rêve brisé ? » qui se tiendra jusqu’au samedi 28 avril 2018.
C’est 5 ans
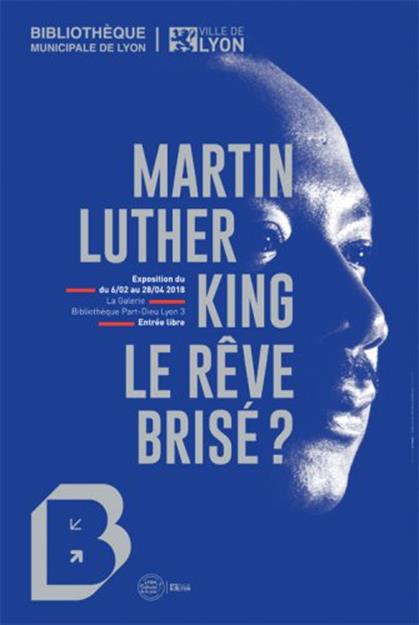 avant son assassinant que Martin Luther King, le 28 août 1963, lors de la marche pour les droits civiques sur Washington, prononça la célèbre phrase «I have a dream».
avant son assassinant que Martin Luther King, le 28 août 1963, lors de la marche pour les droits civiques sur Washington, prononça la célèbre phrase «I have a dream».
3 ans après ce discours, Martin Luther King est venu à Lyon et a tenu un discours à la bourse du travail de Lyon, le 29 mars 1966 dans une salle comble.
Ce discours a été publié dans « Topo » le journal des bibliothèques de Lyon
Il commença son discours par ces mots :
« C’est un grand réconfort pour moi d’être en France, berceau des libertés et des idéaux, pour réfléchir avec vous sur les problèmes que nous affrontons. Nous sommes réunis ce soir, motivés par le souci de faire disparaître les barrières. Aux Etats-Unis qui constituent une sorte de condensé du monde d’aujourd’hui, nous connaissons des difficultés spécifiques provenant de l’incomplète assimilation des différents groupes ethniques qui composent la Nation. »
Puis il a continué son discours en faisant l’histoire de l’esclavage et le combat contre les discriminations aux Etats-Unis..
Sa conclusion est la suivante :
Si, en ce moment, nous luttons pour mettre fin au colonialisme interne qui interdit aux Noirs d’avoir accès au développement économique et les confine dans un ghetto de pauvreté, nous n’ignorons pas que cette lutte contre les forces de domination politique appartient à l’histoire de notre temps et concerne l’univers tout entier.
En privant un homme de son travail, on le prive de son humanité et c’est une forme encore plus générale de l’esclavage.
C’est pourquoi notre combat est un immense encouragement pour le reste du monde car il contribue à faire naitre l’aurore d’un monde nouveau où tous, communistes, capitalistes, noirs, blancs, jaunes catholiques, protestants, riches, pauvres pourront se respecter réciproquement et coexister dans la paix.
Ce jour viendra où l’on fera un soc de charrue avec les épées et où les nations ne se dresseront plus les unes contre les autres. Ce sera le jour où les nations ne se dresseront plus les unes contre les autres. Ce sera le jour où le lion et l’agneau pourront se tenir l’un près de l’autre sans s’effrayer l’un et l’autre.
Ce jour approche.
Vous me permettrez de dire en terminant, combien j’apprécie le soutien moral et financier que vous apportez au combat que nous menons. En le faisant, vous reconnaissez que toute menace contre la justice, quelque part dans le monde, est une menace partout dans le monde.
Assuré de votre aide et de votre prière, je me sens d’autant plus fort pour chanter avec vous : We sall Overcome. Nous triompherons un jour. »
J’aurai pu choisir d’autres exergues que celui que j’ai choisi dans ce discours, mais j’ai mis en avant cette phrase dans laquelle il parle de la pauvreté, de la domination économique qui est marqué par la privation de travail des dominés.
Le commissaire de l’exposition est Michel Chomorat qui a été interrogé par un journal lyonnais.
Il nous révèle que si la venue de Martin Luther King était un évènement, certains avaient préféré s’abstenir de leur présence.
« Les élus[lyonnais] étaient aux abonnés absents, ils étaient à l’inauguration de la Foire, ils saucissonnaient et buvaient du beaujolais.
Martin Luther King avait choisi Lyon en France car c’est la capitale de la résistance, de l’humanisme social. Et en dehors des politiciens qui n’étaient pas là, le cardinal était là, le grand rabbin et le responsable protestant de Lyon aussi »
En 1966, le maire de Lyon était Louis Pradel.
<Ce site décrit de manière détaillée l’exposition lyonnaise>
<1023>
-
Jeudi 22 février 2018
« Modifier son rapport au temps, pour beaucoup d’entre nous, c’est d’abord réinvestir le présent. »Christophe AndréJe poursuis et termine mon butinage du numéro 185 du mercredi 17 janvier du « le un » qui posait cette belle question : « Est-il urgent de ralentir ? »
Ce numéro m’a appris aussi que la réflexion féconde qu’avait jadis popularisée François Mitterrand : « Il faut laisser du temps au temps » est de Miguel de Cervantés.
Mais c’est sur un article de Christophe André que je m’arrêterai aujourd’hui : « Renoncer et savourer »
Christophe André, commence d’abord par une histoire vécue :
« La scène se passe en il y a quelques années. Nous avons fait halte dans un hôtel, au petit déjeuner, je fais la queue avec d’autres clients pour obtenir une omelette double. Un cuistot les prépare sous nos yeux, et elles ont l’air délicieux. Mais que l’attente est longue ! Je m’impatiente et je me penche pour comprendre. C’est clair : le cuisinier est très minutieux, ajoute de nombreux ingrédients, épices, les uns après les autres, bavarde avec les clients…
Mais un détail me frappe : alors qu’il dispose de deux feux : devant lui, il n’en utilise qu’une. « Il pourrait aller deux fois plus vite, s’il se servait des deux feux », me chuchote mon cerveau d’occidental pressé.
Aussitôt, je réalise à quel point je suis intoxiqué : je suis en vacances, je n’ai pas d’horaires à respecter ce matin-là, et me voilà agacé d’attendre une délicieuse omelette, souhaitant que ce brave cuisinier accélère, ne parle plus aux clients, bâcle son travail, pour servir mon appétit absurde de vitesse et d’accélération !
Cet auto-allumage spontané de mon logiciel cérébral d’accélérite me montre à quel point le mal est profond, en moi, comme en beaucoup de mes contemporains…
Il fait alors une analyse et utilise ce nouveau concept « d’accélérite »
Nous souffrons d’accélérite, ce besoin que tout aille vite, ce sentiment constant que nous n’avons pas de temps à perdre. […]
Il y a ce constat simple et terrifiant : le monde est d’une richesse inépuisable, et une vie humaine entière ne suffira jamais à en explorer et à en savourer toutes les merveilles. Nous ne pouvons jamais lire tous les livres, visiter tous les lieux, rencontrer toutes les personnes, satisfaire toutes nos curiosités. Ce jamais nous fait trembler, et induit en nous ce sentiment absurde qu’en accélérant le pas, nous en ferons au moins un petit peu plus qu’en prenant notre temps. Notre monde est infini, nous sommes mortels, alors nous accélérons…
Puis, il nous incite à prendre garde et à interroger la notion d’« opportunité » ou de « potentialité » que le monde moderne nous conditionne à ne jamais laisser passer :
« [Dans notre] société de consommation : une société de pléthores et d’incitation, qui nous pousse à avaler le plus grand nombre possible de nourritures, de loisirs, d’informations, de distractions, de rencontres, de voyages…
Toutes ces potentialités comme les nomme le jargon moderne (plutôt que possibilités, plus paisible, moins excitant) sont des incitations à ne rien laisser passer : aucun achat, aucun plaisir, aucune opportunité (ah ! L’angoisse du consommateur de rater une opportunité !) »
Et il remet en cause de la même manière le terme de « réactivité » qui semble unilatéralement positif dans notre univers contemporain :
« Si la réactivité est devenue une valeur, au lieu de rester un simple comportement, parfois adapté et utile, mais parfois aussi stupide : réagir vite conduit souvent à faire ou dire des bêtises. »
Et c’est donc vers cette sagesse qui est de renoncer parfois que nous incite Christophe André : renoncer et savourer
« La pression du temps est désormais l’un des grands facteurs de stress moderne. […] Nous avons alors à le dégager de son emprise, en apprenant notamment à renoncer. Renoncer ? Cela semble tout bête : se dire qu’on n’aura jamais le temps de tout faire et de tout voir. Et pas seulement celui de se le dire, mais s’y entraîner.
[…] Savourer ? Trop souvent, nous regardons ailleurs : vers d’autres choses que celles que nous possédons, vers d’autres temps (passés ou futurs) que ceux que nous vivons. Modifier son rapport au temps, pour beaucoup d’entre nous, c’est d’abord réinvestir le présent. Non que le présent soit supérieur au passé ou au futur, mais il est tout aussi précieux et important. Or, c’est lui qui est en général bousculé et rongé par le consumérisme, qui souffle sur les braises de nos désirs et de nos regrets. »
Et puis il conclut par une réflexion sur notre finitude :
« La conscience que nous avons de notre mortalité est à l’origine de beaucoup de nos angoisses et de nos comportements aberrants. Pourtant en psychologie expérimentale, quand on écarte l’idée de mort de l’esprit des gens, en induisant chez eux l’idée qu’ils ont encore beaucoup de temps à vivre, il se montre désireux de faire le plus grand nombre possible de nouvelles expériences. Mais si on leur rappelle que leur vie aura un terme, il se montre alors beaucoup plus désireux de savourer ce qui existe déjà (relations, source de satisfaction), d’approfondir plus que de courir. Ainsi, la solution à nos angoisses humaines de mort n’est pas dans la fuite de l’accélération ou de la dispersion, mais dans la lucidité du ralentissement et de l’approfondissement. […]
En terme de règles de vie, c’est remplacer le : « Pourquoi courir ? Parce que je vais mourir ! » Par : « Pourquoi courir, puisque je vais mourir ? »
La lucidité du ralentissement et de l’approfondissement.
Réinvestir notre présent, quelle savoureuse leçon de vie !
<1022>
-
Mercredi 21 février 2018
« Mais la réalité, c’est qu’on n’a jamais eu autant de temps et de très loin ! »Jean ViardL’hebdomadaire « Le Un » du 17 janvier qui pose la question de la nécessité de ralentir a donné la parole au sociologue Jean Viard qui a consacré beaucoup d’études et d’ouvrages au temps libre, notamment en 2015 <Le triomphe d’une utopie, la révolution des temps libres>
Trois mots du jour lui ont été consacrés jusqu’ici (13 avril 2015, 10 avril 2015, 4 septembre 2014).
Il a l’habitude de mesurer le temps de vie, le temps libre, le temps de travail en heures. C’est parfois déstabilisant, mais c’est très explicite.
A la question pourquoi parler en heures ? il répond :
« Si je [parle] en termes d’âge, vous allez imaginer de vieilles personnes chenues. 700 000 heures, c’est une quantité homogène à « consommer » ».
700 000 heures ? C’est l’espérance de vie moyenne en Europe aujourd’hui.
Contre 500 000 heures avant 1914. Aujourd’hui, une petite fille qui vient de naître devrait vivre 800 000 heures. On a gagné plus de dix ans d’espérance de vie depuis 1945, on en avait déjà gagné dix depuis le début du XXeme siècle.
Mais la question qui nous occupe est le manque de temps que nous ressentons parfois si intensément, de sorte que nous courrons tout le temps, que nous voulons tout faire très vite.
Alors quand on se penche réellement sur ce sujet avec l’aide de Jean Viard, nous nous heurtons à un paradoxe.
« Il y a un siècle on vivait 500 000 heures, on dormait 200 000 heures, un ouvrier ou un paysan travaillait 200 000 heures. Il restait 100 000 heures pour faire autre chose.
Nous, on vit 700 000 heures, on travaille environ 70 000 heures – une base de 42 ans de travail à 35 heures donne même 63 000 heures – et on fait environ 30 000 heures d’études. Résultat : après le sommeil, les études et le travail, il reste 400 000 heures pour faire autre chose.».
Je sais, dès ce moment d’écriture, que des lecteurs attentifs vont protester en remarquant que ce résultat de 400 000 heures est obtenu en laissant les heures de sommeil à 200 000 alors que le temps de vie a augmenté de 7/5 et qu’en principe le temps de sommeil devrait augmenter de 7/5. Mais non ! Nous dormons beaucoup moins que nos aïeux. Et 200 000 heures de sommeil pour 700 000 heures de vie, représente 7 heures de sommeil par jour, ce qui est bien la moyenne contemporaine admise.
Nous sommes donc passés de 100 000 heures à 400 000 heures de temps dont nous pouvons disposer et nous avons de moins en moins de temps !!!
Pourquoi ?
Jean Viard répond d’abord :
« Nous sommes entrés dans une société d’hyperconsommation du temps : l’offre de choses à faire augmente plus vite que celle du temps disponible qui est pourtant […] en rapide augmentation. On peut allumer 36 chaines de télévision, lire quantité de livres, prendre l’avion pour voyager partout et la pression d’Internet est constante…
Mais la réalité, c’est qu’on n’a jamais eu autant de temps et de très loin.»
L’article de Jean Viard est particulièrement intéressant je ne peux qu’en picorer quelques fulgurances comme ce constat qui me semble affligeant mais que lui positive :
« On s’est inventé de nouvelles contraintes. Souvent sous la pression des « marchands de temps libre ». La télévision, c’est 100 000 heures. Autant que le travail et les études. Depuis que la télé a été inventée, l’espérance de vie a été prolongée de 100 000 heures. Toute cette vie nouvelle, on la passe devant la télé. Or on nous dit que la télé tue le lien social : c’est faux. Elle ne prend pas sur le lien social, mais sur le cimetière. Et on est mieux devant la télé qu’au cimetière… »
A la question fondamentale : comment se manifeste la collision de la vitesse et du temps ? il répond :
« Il faut établir le lien entre la vitesse et la polyactivité : l’enjeu est d’aller plus vite et de faire plusieurs choses en même temps. Le phénomène de l’accélération est intéressant. […] La vitesse s’allie à la densité. Notre temps libre a acquis une densité comparable à celle de notre temps de travail. Si un enfant n’est pas occupé par trois activités en plus de l’école, on considère qu’il « va rater sa vie »…On empêche les enfants de s’ennuyer. Or les moments d’ennui font partie de ceux où l’on se met à réfléchir ! »
En plus de la télévision et aujourd’hui de tous les autres écrans les gens passent leur temps supplémentaire à de multiples activités :
« Des millions de français peignent, font de la musique, voyagent, jardinent, s’engagent dans une association, bricolent, voire construisent leur maison. A ne s’intéresser qu’à ce qui se vend, on oublie que l’autoproduction domestique est un enjeu majeur de qualité de vie. Voyez aussi tous ceux qui écrivent. En vérité, ils le font moins pour être publiés que pour reprendre le pouvoir sur leur propre temps.
Historiquement, le temps a appartenu à Dieu, puis au travail après 1789. Maintenant le temps est à nous.
[…] Comme le temps est à nous, nous n’acceptons plus de le perdre, […] que l’autre nous prenne ce qui nous appartient. […]
La société numérique relie les individus autonomisés et les reprend dans ses rets en les bombardant de messages, en recréant un sentiment d’urgence. On se croit sommé de répondre. C’est là qu’il faut savoir reprendre le pouvoir. Vivre en somme. »
Au terme de cette démonstration et de ces réflexions, nous n’avons aucune raison de douter que les humains que nous sommes, n’avons jamais eu autant de temps pour nous.
Et comme le disait Giono, cité hier : « Nous avons oublié que notre seul but, c’est vivre et que vivre nous le faisons chaque jour »
Vivre et ralentir pour savourer davantage le goût de la vie qui nous est offerte.
<1021>
-
Mardi 20 février 2018
« Nous avons oublié que notre seul but, c’est vivre et que vivre nous le faisons chaque jour et tous les jours et qu’à toutes les heures de la journée nous atteignons notre but véritable si nous vivons. »Jean Giono « rondeur des jours »L’hebdomadaire « le Un » du mercredi 17 janvier 2018 posait cette question d’une grande actualité : « est-il urgent de ralentir ? »
Julien Bisson, Rédacteur en chef du UN introduisait le sujet, en citant Jean Giono dans un livre appelée « Rondeur des jours » :
« Les jours commencent et finissent dans une heure trouble de la nuit.
Ils n’ont pas la forme longue, cette forme des choses qui vont vers des buts : la flèche, la route, la course de l’homme.
Ils ont la forme ronde, cette forme des choses éternelles et statiques : le soleil, le monde, Dieu.
La civilisation a voulu nous persuader que nous allons vers quelque chose, un but lointain.
Nous avons oublié que notre seul but, c’est vivre et que vivre nous le faisons chaque jour et tous les jours et qu’à toutes les heures de la journée nous atteignons notre but véritable si nous vivons.
Tous les gens civilisés se représentent le jour comme commençant à l’aube ou un peu après, ou longtemps après, enfin à une heure fixée par le début de leur travail ; qu’il s’allonge à travers leur travail, pendant ce qu’ils appellent « toute la journée »; puis qu’il finit quand ils ferment les paupières.
Ce sont ceux-là qui disent : les jours sont longs. Non, les jours sont ronds. »
Jean Giono oppose donc à la flèche du temps une expression de rondeur, la « rondeur du jour », autrement dit un cycle.
Julien Bisson explique :
« Cette forme éternelle et statique qui seule nous offre un sentiment de complétude ».
Et il conclut son article par cette injonction : « il est urgent de ralentir ».
Probablement a-t-il raison.
<1020>
-
Lundi 19 février 2018
« D’abord, on devait s’écraser pour entrer, il fallait que, de la rue, on crût à une émeute »Emile Zola «Au Bonheur des dames»J’avais consacré le mot du jour du 1er février aux émeutes qui avaient été provoquées par des promotions de 70% sur le Nutella.
Ces évènements ont été largement commentés.
Certains pour s’étonner qu’on fasse autant de bruits autour de cette expression du consumérisme exacerbé parce qu’il touche des classes très modestes, alors qu’on fait moins de cas quand il se passe à peu près la même chose pour acquérir le dernier iphone, le type de consommateur n’étant pas le même.
Mais c’est à nouveau Michel Serres qui a éclairé pour moi, de la manière la plus intelligente, ces évènements. Il l’a fait au cours d’une émission sur LCI animé par Pujadas : Débat Finkielkraut-Serres avec Pujadas
Et il a expliqué que ce n’était pas nouveau et que l’émeute était connue depuis bien longtemps comme une technique de vente particulièrement performante. Et pour le prouver il a fait appel à un des 20 romans de la série des Rougon-Macquart d’Emile Zola : « Au bonheur des dames »
« Au bonheur des dames » est un livre publié en 1883. Ce titre fait référence à un grand magasin parisien qu’Émile Zola a imaginé dans son livre en s’inspirant du célèbre magasin parisien « Au Bon Marché », situé 24 rue de Sèvres dans le 7ème arrondissement et qui avait été fondé en 1838 par Aristide Boucicaut.
Et c’est en se référant aux techniques de vente d’Aristide Boucicaut que Zola décrit son personnage de fiction : Le directeur du magasin « Au bonheur des dames » : Octave Mouret.
Au Bonheur des Dames Zola page 298 / 544 :
« La grande puissance était surtout la publicité. Mouret en arrivait à dépenser par an trois cent mille francs de catalogues, d’annonces et d’affiches. Pour sa mise en vente des nouveautés d’été, il avait lancé deux cent mille catalogues, dont cinquante mille à l’étranger, traduits dans toutes les langues. Maintenant, il les faisait illustrer de gravures, il les accompagnait même d’échantillons, collés sur les feuilles. C’était un débordement d’étalages, le Bonheur des Dames sautait aux yeux du monde entier, envahissait les murailles, les journaux, jusqu’aux rideaux des théâtres. Il professait que la femme est sans force contre la réclame, qu’elle finit fatalement par aller au bruit.
Du reste, il lui tendait des pièges plus savants, il l’analysait en grand moraliste. Ainsi, il avait découvert qu’elle ne résistait pas au bon marché, qu’elle achetait sans besoin, quand elle croyait conclure une affaire avantageuse ; et, sur cette observation, il basait son système des diminutions de prix, il baissait progressivement les articles non vendus, préférant les vendre à perte, fidèle au principe du renouvellement rapide des marchandises. Puis, il avait pénétré plus avant encore dans le cœur de la femme, il venait d’imaginer « les rendus », un chef d’œuvre de séduction jésuitique. « Prenez toujours, madame : vous nous rendrez l’article, s’il cesse de vous plaire. »
Et la femme, qui résistait, trouvait là une dernière excuse, la possibilité de revenir sur une folie : elle prenait, la conscience en règle. Maintenant, les rendus et la baisse des prix entraient dans le fonctionnement classique du nouveau commerce.
Mais où Mouret se révélait comme un maître sans rival, c’était dans l’aménagement intérieur des magasins. Il posait en loi que pas un coin du Bonheur des Dames ne devait rester désert ; partout, il exigeait du bruit, de la foule, de la vie ; car la vie, disait-il, attire la vie, enfant e et pullule. De cette loi, il tirait toutes sortes d’applications.
D’abord, on devait s’écraser pour entrer, il fallait que, de la rue, on crût à une émeute ; et il obtenait cet écrasement, en mettant sous la porte les soldes, des casiers et des corbeilles débordant d’articles à vil prix ; si bien que le menu peuple s’amassait, barrait le seuil, faisait penser que les magasins craquaient de monde, lorsque souvent ils n’étaient qu’à demi pleins.
Ensuite, le long des galeries, il avait l’art de dissimuler les rayons qui chômaient, par exemple les châles en été et les indiennes en hiver ; il les entourait de rayons vivants, les noyait dans du vacarme.
Lui seul avait encore imaginé de placer au deuxième étage les comptoirs des tapis et des meubles, des comptoirs où les clientes étaient plus rares, et dont la présence au rez-de-chaussée aurait creusé des trous vides et froids. S’il en avait découvert le moyen, il aurait fait passer la rue au travers de sa maison. »
Dès cette époque, il était clair que l’émeute constituait une technique permettant d’attirer les clients et de vendre davantage.
<1019>
-
Mercredi 14 février 2018
« Je préfère aux biens
dont s’enivre L’orgueil du soldat ou du roi,
L’ombre que tu fais sur mon livre
Quand ton front se penche sur moi. »Victor Hugo «Les contemplations»Pour la saint Valentin, ce poème de Victor Hugo :
Aimons toujours ! Aimons encore !
Quand l’amour s’en va, l’espoir fuit.
L’amour, c’est le cri de l’aurore,
L’amour c’est l’hymne de la nuit.
Ce que le flot dit aux rivages,
Ce que le vent dit aux vieux monts,
Ce que l’astre dit aux nuages,
C’est le mot ineffable : Aimons !
L’amour fait songer, vivre et croire.
Il a pour réchauffer le cœur,
Un rayon de plus que la gloire,
Et ce rayon c’est le bonheur !
Aime ! qu’on les loue ou les blâme,
Toujours les grands cœurs aimeront :
Joins cette jeunesse de l’âme
A la jeunesse de ton front !
Aime, afin de charmer tes heures !
Afin qu’on voie en tes beaux yeux
Des voluptés intérieures
Le sourire mystérieux !
Aimons-nous toujours davantage !
Unissons-nous mieux chaque jour.
Les arbres croissent en feuillage ;
Que notre âme croisse en amour !
Soyons le miroir et l’image !
Soyons la fleur et le parfum !
Les amants, qui, seuls sous l’ombrage,
Se sentent deux et ne sont qu’un !
[..].
Moi qui ne cherche dans ce monde
Que la seule réalité,
Moi qui laisse fuir comme l’onde
Tout ce qui n’est que vanité,
Je préfère aux biens dont s’enivre
L’orgueil du soldat ou du roi,
L’ombre que tu fais sur mon livre
Quand ton front se penche sur moi.
<Si vous voulez lire le poème en intégralité>
Pour Annie et moi, la Saint Valentin ne se fête pas le 14 février, mais le 15.
Le 15 février, il y a 30 ans, nous nous sommes rencontrés à Paris et quelques mois plus tard, nous ne nous quittions plus.
Il n’y aura pas de mot du jour le 15 et le 16 février.
<1018>
-
Mardi 13 février 2018
« Le smartphone permet à ses utilisateurs compulsifs de devenir une synthèse des 3 singes de la sagesse, ils ne regardent plus, ils n’écoutent plus et ne parlent plus.»Dessin de Durol ?Nous savons que les trois singes (celui qui ne regarde pas, celui qui n’écoute pas, celui qui ne parle pas), appelés aussi les singes de la sagesse est un symbole d’origine asiatique.
C’est un thème originaire de la Chine de Confucius et qui a été repris par les autres civilisations comme la civilisation japonaise.
J’ai trouvé sur les réseaux sociaux ce dessin qui m’apparait à la fois drôle, et révélateur.
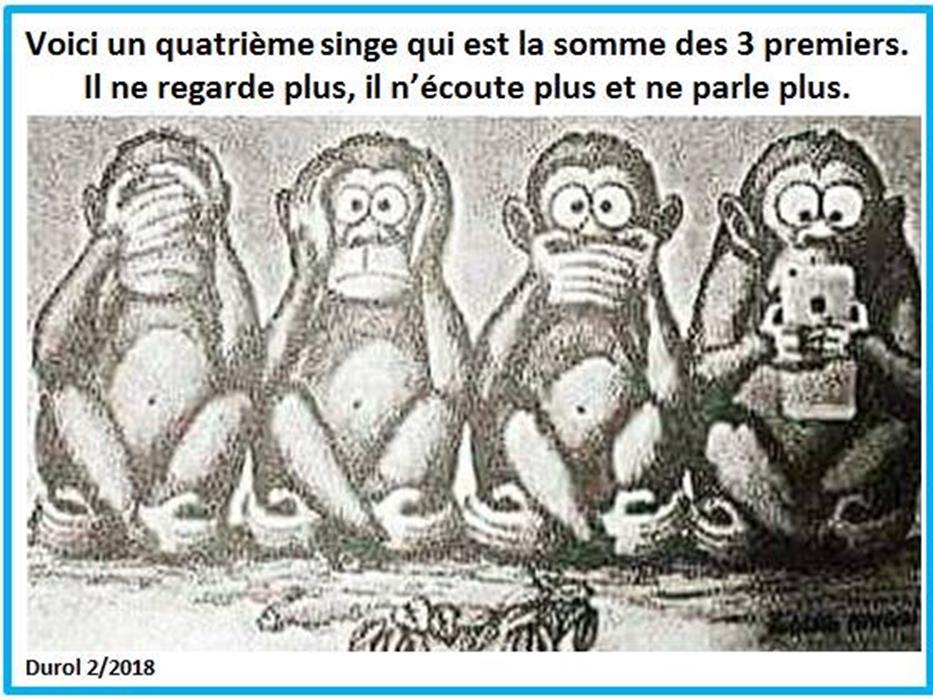
A l’origine, ces 3 singes exprimaient une vision de sagesse : « Ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal». À celui qui suit cette maxime, il n’arriverait que du bien.
Mais une autre signification a aussi été donnée à ce symbole : « ne pas vouloir voir ce qui pourrait poser problème, ne rien vouloir dire de ce qu’on sait pour ne pas prendre de risque et ne pas vouloir entendre pour pouvoir faire « comme si on ne savait pas. »
Le smartphone permet une nouvelle vision : celle de l’homme qui s’isole tellement dans son monde virtuel que ses sens de la communication du réel sont annihilés.
<1017>
-
Lundi 12 février 2018
« Toute femme désirant s’habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l’autorisation et que celle-ci ne peut être donnée qu’au vu d’un certificat d’un officier de santé »Ordonnance du 16 brumaire an IX (7 novembre 1800) qui n’a jamais été abrogée formellement et qui interdisait aux femmes de porter un pantalonCette ordonnance de 1800 prévoyait aussi que les femmes qui portent un pantalon sans autorisation devaient être « arrêtées et conduites à la préfecture ».
Par la suite, deux circulaires datant de 1892 et 1909 ont « assoupli » cette règle, en tolérant le port du pantalon : « si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d’un cheval ».
Cette « règle débile » a fait l’objet de maintes demandes d’abrogation au cours du XXème siècle
Contrairement à ce que vous trouverez sur Internet, cette règle n’a jamais été une loi mais une simple ordonnance du Préfet de Paris et c’est donc le Préfet de Paris qui aurait dû l’abroger.
La plus curieuse des réponses est sans doute celle de Maurice Grimaud, le célèbre préfet de Paris de mai 1968, encensé dans un autre mot du jour, mais qui en 1969, à la demande d’abrogation de l’ordonnance répond qu’il « croit sage de ne pas changer des textes auxquels les variations prévisibles ou imprévisibles de la mode peuvent à tout moment rendre leur actualité ».
Si vous voulez en savoir davantage sur cette histoire vous pouvez aller sur ce site : http://www.laviedesidees.fr/Le-droit-au-pantalon.html
La fin de cette histoire incroyable se trouve sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120700692.html
Le député de la Côte d’Or, Monsieur Alain Houpert, avait posé une question écrite le 12/07/2012 à la Ministre des droits des femmes.
Cette dernière qui était à l’époque Najat Vallaud-Belkacem lui répondit le 31/01/2013 par le texte suivant que je cite in extenso :
« La loi du 7 novembre 1800 évoquée dans la question est l’ordonnance du préfet de police Dubois n° 22 du 16 brumaire an IX (7 novembre 1800), intitulée « Ordonnance concernant le travestissement des femmes ». Pour mémoire, cette ordonnance visait avant tout à limiter l’accès des femmes à certaines fonctions ou métiers en les empêchant de se parer à l’image des hommes. Cette ordonnance est incompatible avec les principes d’égalité entre les femmes et les hommes qui sont inscrits dans la Constitution et les engagements européens de la France, notamment le Préambule de la Constitution de 1946, l’article 1er de la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme. De cette incompatibilité découle l’abrogation implicite de l’ordonnance du 7 novembre qui est donc dépourvue de tout effet juridique et ne constitue qu’une pièce d’archives conservée comme telle par la Préfecture de police de Paris. »
Il y a donc abrogation implicite, mais n’aurait-on pas pu réaliser une abrogation explicite ?
Ce sujet m’a été inspiré par les spectacle F(l)amme, dont j’avais fait le sujet du mot du jour du 4 décembre 2017 et que nous sommes allés voir, avec Annie, à l’Espace Camus de Bron le mardi 6 février 2018. Spectacle où 10 jeunes femmes qui vivent dans des quartiers périphériques et qui ont des parents qui sont venus d’ailleurs racontent une part de leur histoire et de leur vérité.
C’est fort, drôle, émouvant et d’une grande sincérité.
A un moment, une des jeunes femmes a dit :
« et je vous rappelle que jusqu’à tout récemment les femmes ne pouvaient pas porter le pantalon à Paris, sauf si elles étaient en bicyclette ou à cheval »
J’ai vérifié cette assertion, et c’est ainsi qu’est né ce mot du jour.
Mais ce ne fut pas le moment le plus fort du spectacle.
 Ce moment eu lieu lorsque toutes les femmes se sont rassemblées au milieu de la scène, entourant l’une d’entre elle qui va raconter comment à l’âge de 4 ans on emmène une jeune enfant dans un village africain et tout en étant très gentille avec elle, on la met entre les mains d’une vieille femme qui va l’exciser. L’enfant n’a pas compris ce qui s’était passé, car personne ne parle de cela dans la famille. Elle l’a compris alors qu’elle était adolescente et qu’elle a vu une émission de télévision traitant de cette pratique. Elle a alors accédé à la compréhension ce qui s’était passé plus de 10 ans auparavant, entraînant chez elle colère et révolte.
Ce moment eu lieu lorsque toutes les femmes se sont rassemblées au milieu de la scène, entourant l’une d’entre elle qui va raconter comment à l’âge de 4 ans on emmène une jeune enfant dans un village africain et tout en étant très gentille avec elle, on la met entre les mains d’une vieille femme qui va l’exciser. L’enfant n’a pas compris ce qui s’était passé, car personne ne parle de cela dans la famille. Elle l’a compris alors qu’elle était adolescente et qu’elle a vu une émission de télévision traitant de cette pratique. Elle a alors accédé à la compréhension ce qui s’était passé plus de 10 ans auparavant, entraînant chez elle colère et révolte.
La photo que j’insère dans cet article se situe à ce moment.
La salle était pleine, mais une chose a interpellé Annie et moi.
Par esprit rigoureux nous avons fait le compte de notre rangée et de celle qui la précédait, chacune comptant 20 places toutes occupées :
Les deux rangées avaient une répartition identique 18 femmes et 2 hommes.
Parmi les femmes, il y en avait beaucoup de jeunes, les 3 autres hommes étaient proches de mon âge.
Le reste de la salle confirmait cette constatation avec quelques traces d’hommes un peu plus jeunes.
<1016>
-
Vendredi 9 février 2018
« A quoi est utile le système hiérarchique ? »Réflexions personnelles après des années de butinage.Laurent Wauquiez, le chef que la droite s’est choisie, aime à rappeler cette injonction de Jacques Chirac : « Un chef c’est fait pour cheffer ! »
Mais un chef ne suffit pas à faire un système hiérarchique, il a fallu du temps aux humains et développer des sociétés sophistiquées pour que le système hiérarchique se mette en place.
Car dans un système hiérarchique, il n’y a pas qu’un chef, il faut une collection de chefs avec un numéro 1 et puis des grands chefs, des moyens chefs et des petits chefs.
L’organisation qui a développé les pyramides hiérarchiques les plus rigoureuses est bien sûr l’armée. L’Histoire comme on la raconte est souvent l’Histoire des grands chefs avec leurs collections de sous-chef, d’Alexandre le Grand jusqu’à Napoléon Ier. Et il faut bien reconnaître que cela a souvent plutôt bien fonctionné.
Et cela a pu aussi conduire à de terribles dévoiements des horreurs, comme seul homo sapiens, parmi les espèces, a pu provoquer.
Nous commémorons cette année, la dernière de la première guerre mondiale. Guerre qui a mis en œuvre une hiérarchie de fer du côté allemand, comme du côté français. Du général en chef, en passant par tous les niveaux hiérarchiques des ordres absurdes ont été donnés pour s’emparer de telle ou telle colline, au prix de milliers de morts. A l’époque déjà des soldats n’étaient pas convaincus de l’intérêt stratégique de beaucoup de ces lieux de combats qui passaient parfois d’un camp à l’autre dans la même journée. Aujourd’hui, les analyses le confirment, beaucoup de ces « boucheries » étaient parfaitement inutiles du point de vue stratégique, du point de vue humaniste la question ne se pose même pas. Il suffit de s’intéresser aux exploits du tristement célèbre Général Nivelle pour approcher cette réalité.
Mais Nivelle tout seul n’aurait rien pu faire. Il fallait une chaîne de commandement, où chacun à son niveau relayait l’ordre du supérieur et le mettait en œuvre sans jamais le remettre en cause.
Nous avons donc une première réponse à la question posée : Un système hiérarchique est utile pour mettre en œuvre des ordres terribles et pousser l’aveuglement jusqu’aux dernières extrémités.
N’oublions pas que les régimes nazis et communistes s’appuyaient aussi sur un système hiérarchique très dur, où le problème ne repose pas que sur le numéro un mais sur tous les sous chefs.
Le système hiérarchique, bien au-delà de l’armée s’est imposé dans toutes les organisations humaines qui comptaient un nombre important de membres
Loin de moi l’idée, de prétendre qu’un système hiérarchique n’a pas d’atout pour permettre à des organisations de bien fonctionner car il apporte, quand tout se passe correctement, de l’ordre, de la lisibilité et un cadre plutôt rassurant.
Dans un premier mot du jour <celui du 18 décembre 2014> il était question d’entreprises qui imaginaient que d’autres organisations étaient possible.
Mais c’est bien Frédéric Laloux avec son livre « Vers des communautés de travail inspirées », qui est le plus incisif.
Il parle de croyance :
« depuis la nuit des temps toute l’idéologie humaine tournait autour de cette croyance : pour qu’une organisation fonctionne il faut un « boss », un seul qui décide ! »
On pourrait peut-être émettre l’hypothèse que l’invention d’un Dieu monothéiste relève de cette même croyance, il faut un organisateur, un chef unique et omnipotent.
Il fait aussi son développement sur nos trois cerveaux pour en venir au fait principal qui a augmenté ma connaissance :
L’organisation hiérarchique gère très mal la complexité. Si notre corps humain fonctionnait selon un système hiérarchique, nous pourrions être très inquiets. Le corps humain fonctionne par la coopération entre tous les organes et à l’intérieur des organes par la présence d’autres corps vivants selon une symbiose. Nous savons aujourd’hui qu’il y a 100 fois plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Et il a été démontré dans de nombreuses études que ces bactéries, si elles ont bien un rôle dans notre bien-être digestif, seraient aussi responsables de la manière dont nous « digérons » nos émotions.
Peter Wolhlleben que j’ai cité dans le mot du jour du 22 décembre 2017 pour son merveilleux livre « La vie secrète des arbres » ne dit pas autre chose. En parlant de l’organisation de la forêt, il dit il n’y a pas hiérarchie :
« Cela fonctionnerait très mal dans la nature »
D’ailleurs quand les humains veulent vraiment organiser des réponses adéquates à la complexité ils agissent autrement. Car l’économie a démontré que l’organisation pyramidale, au niveau étatique, est bien trop rigide pour faire face aux défis de l’innovation et de l’efficacité. Ce fut le grand échec des systèmes soviétiques. Tout le monde a compris que la multiplication des acteurs et la décentralisation des centres d’initiatives que sont les entreprises et particulièrement aujourd’hui les start-up sont bien davantage en capacité de résoudre la complexité et de trouver des solutions qui fonctionnent. Or, des patrons qui vous expliquent cette capacité d’un marché libre à trouver des solutions innovantes et efficaces, dès qu’ils retournent dans leurs entreprises reviennent au dogme du cerveau unique et de l’organisation hiérarchique.
Frédéric Laloux évoque ainsi des entreprises qui ont fait le choix d’une organisation non hiérarchique, dans son développement.
Le système hiérarchique reste cependant toujours largement dominant et peut même dans certains cas, être efficace. C’est ce qu’affirme François Dupuy, sociologue des entreprises qui a publié plusieurs livres qui ont marqué, notamment « Lost in management ». Pourtant sur la 4ème page de couverture de cet essai, on lit :
« Dans de nombreuses entreprises, le problème est aujourd’hui de reconstruire une maîtrise minimale de la direction et de ses managers sur l’organisation et ses personnels en redécouvrant les vertus de la confiance et de la simplicité. »
Mais dans cet article, François Dupuy reconnait que l’organisation hiérarchique reste omniprésente dans le monde économique et le titre de l’article est assez péremptoire : « Pourquoi la hiérarchie reste la plus efficace des organisations du travail ». Il dit notamment :
« Les évolutions des modes d’organisation des entreprises sont très lentes. Ainsi, quoiqu’on en pense, le mode taylorien est encore dominant avec ses deux caractéristiques: le découpage en « territoires » et le fonctionnement hiérarchique. On a pu montrer que même les entreprises de la « nouvelle économie », dès lors qu’elles grandissent, ont tendance à se structurer comme toutes les autres.
On peut donc produire les technologies nécessaires à un fonctionnement plus « ouvert », ce n’est pas pour cela qu’on l’adopte.
Jeffrey Pfeffer, dans une étude relative à la place de la hiérarchie en entreprise, estime qu’il s’agit du modèle le plus efficace. […]
C’était aussi l’argument de Max Weber. Il y a donc longtemps que les vertus du système hiérarchique ont été mises en avant. L’idée est celle de la clarté et de la lisibilité des organisations ainsi que celle d’une définition connue des responsabilités. Mais la réalité est bien sûr plus complexe car il n’y a pas qu’un type de fonctionnement hiérarchique. Les organisations dites « plates » c’est à dire à niveaux hiérarchiques réduits sont en effet efficaces. Mais à l’inverse, plus on multiplie les niveaux et plus l’organisation se « brouille » et offre aux acteurs des multiples opportunités de jeu.
Pour autant, celui-ci peut poser problème dès lors qu’il doit faire face à de l’instantané. »
Vous constaterez que la dernière phrase de François Dupuy apporte une autre limite aux organisations hiérarchiques : elles ont du mal à faire face à de l’instantané. Autrement dit une organisation hiérarchique réagit lentement et a beaucoup de mal à faire face à l’imprévu.
Et lorsqu’on regarde le monde, qu’on en perçoit la complexité, et aussi un temps qui s’accélère avec des fractures disruptives qui entraînent de l’imprévu, on se dit que l’organisation hiérarchique n’est plus très adaptée.
Dans un monde stable et conservateur une organisation hiérarchique peut s’épanouir et fonctionner parfaitement.
Sommes-nous encore dans un tel monde ?
Mon expérience aussi de la hiérarchie montre que cette organisation a pour effet de déresponsabiliser les acteurs qui d’une part sont dans l’attente des décisions et des initiatives de la hiérarchie qui devient aussi le plus souvent le bouc émissaire commode pour expliquer toute difficulté ou désagrément.
Dans les solutions proposées par Frédéric Laloux, les acteurs sont bien davantage responsabilisés. Et pour tous ceux des acteurs qui ne joueraient pas le jeu, les pressions exercées contre eux seraient bien plus fortes que dans un système qui reposerait sur la hiérarchie.
Ainsi la deuxième réponse à la question, c’est qu’un système hiérarchique permet d’avoir des boucs émissaires commodes.
Alors bien sûr, cela remet en cause le concept et la notion de chef.
Souvent j’ai le soupçon que beaucoup pensent encore que « le responsable » est à la fois un manager et un expert qui connait mieux le métier que celui qu’il est censé commander.
Dans un monde de la complexité et de la technicité c’est une vaste blague.
A ce stade je crois utile, pour approcher la réalité du ressenti des personnes qui se trouvent dans un système hiérarchique de faire appel à une BD, et d’en tirer deux extraits :
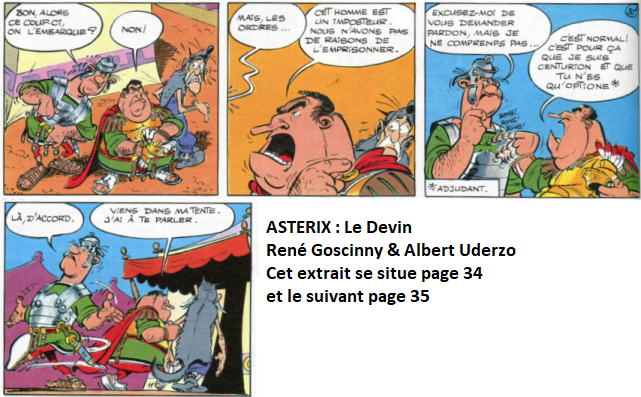
D’abord le centurion explique tranquillement à son sous-chef, l’optione, qu’il comprend forcément moins bien que lui, son supérieur hiérarchique. L’optione accepte ce verdict.
Dans l’extrait suivant, l’optione va être confronté à un problème inverse, un légionnaire veut l’aider à comprendre parce qu’il a exprimé son incompréhension devant une question qu’il se pose.
L’optione est alors cohérent : si lui comprend moins que le centurion, le légionnaire ne peut pas comprendre ce que l’optione ne comprend pas
Quelquefois, j’ai le soupçon que des optiones contemporains sont encore dans cette croyance.
Il peut arriver que dans certains domaines l’optione en sache davantage, mais certainement pas dans tous les domaines du métier.
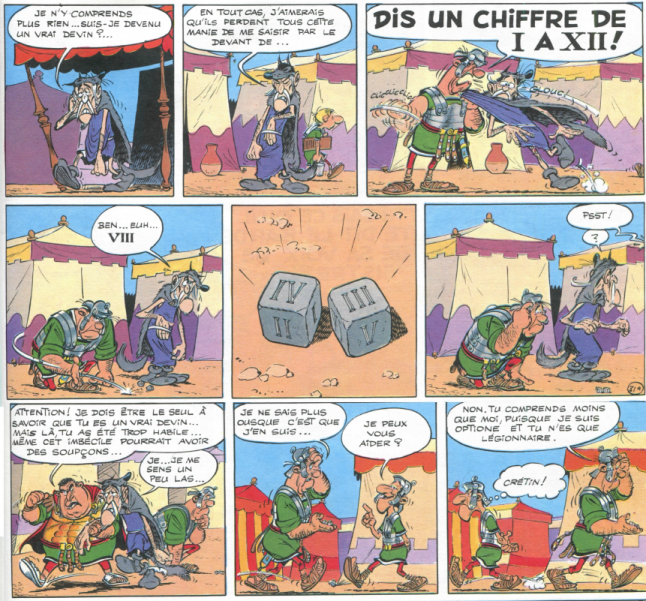
Mais même dans un système hiérarchique, il n’est pas interdit d’avoir de l’intelligence et de la lucidité.
Dans cette disposition d’esprit, on se rend compte qu’on n’a pas besoin de chef.
- On a besoin de personnes capables de faire travailler des gens ensembles, que les compétences coopèrent et non s’affrontent, que la confiance augmente et que les tensions s’apaisent. Une personne qui joue le même rôle dans une équipe, qu’un catalyseur dans une réaction chimique.
- On a aussi besoin de décideur, quand c’est difficile, quand la décision ne coule pas de source. A ce moment là pour faire avancer il faut que quelqu’un se dévoue comme serviteur de l’équipe pour faire un choix, pas comme un chef qui aurait la science infuse et toujours raison quelle que soit les circonstances.
- On a enfin besoin de gens qui savent dégager ou comprendre les priorités et en tirer les conséquences dans l’attitude quotidienne.
Certains d’entre vous diront : mais c’est cela un bon chef. Peut-être, mais je ne crois pas très pertinent de conserver ce terme de « chef qui est là pour cheffer », je crois beaucoup plus intelligent de faire référence à ce que les américains appellent : « the servant leader » et que j’appellerai le responsable au service de l’équipe.
Et prenons comme une connaissance qu’un système hiérarchique n’est ni efficace pour gérer la complexité ni pour réagir rapidement devant l’imprévu.
Nous sommes au terme de cette semaine, où j’ai essayé de faire un point sur mon butinage de plus de 5 ans.
Ce fut difficile pour vous car les articles étaient très longs.
J’aurais encore eu le goût d’aborder le thème des sciences qui sont remises en question, la santé qui se trouve devant tant de choix exaltants et pourtant inquiétants, l’évolution de la société à l’égard des femmes, les réflexions sur le travail et l’emploi, la relation complexe entre les humains et la nature et tant d’autres sujets.
Mais si c’est difficile pour vous lecteurs, l’écriture aussi est astreignante, consommatrice d’énergie.
Lundi, je reprendrai un butinage plus ciblé et un peu moins ambitieux.
<1015>
- On a besoin de personnes capables de faire travailler des gens ensembles, que les compétences coopèrent et non s’affrontent, que la confiance augmente et que les tensions s’apaisent. Une personne qui joue le même rôle dans une équipe, qu’un catalyseur dans une réaction chimique.
-
Jeudi 8 février 2018
« La croissance et la vie »Réflexions personnelles après des années de butinage.La croissance a atteint 1,9 % en France en 2017, soit son plus haut niveau depuis 6 ans. Et <certains annoncent 2,1% pour 2018>
Mais la banque mondiale estime entre 6,7 et 6,8% la croissance de la Chine en 2017 et l’Inde bénéficie encore de meilleures perspectives. Et l’OCDE a annoncé, fin novembre, une prévision de 3,7% de la croissance mondiale en 2018.
La performance de la France reste donc modeste par rapport à cette vision globale.
La croissance entraîne de l’euphorie, tout le monde va vivre mieux semble t’on dire.
- Quand on est parent, on aime voir ses enfants croitre.
- Quand on est jardinier on aime voir ses plantes croitre.
- Quand on est commerçant, on aime voir ses affaires croitre.
Mais LA CROISSANCE ! C’est le chiffre de l’économie et aussi des hommes politiques : ils veulent, ils annoncent, ils se réjouissent de la croissance.
La croissance est bien sûr la croissance du Produit Intérieur Brut.
Et cela constitue déjà un problème.
Le Monde du 31 janvier 2018 a publié une chronique du président du conseil d’administration de Crédit Suisse, Urs Rohner : « Le PIB ne doit pas être l’unique obsession des décideurs »
Il fait une critique sérieuse et économique du PIB
« De nombreux économistes respectés ont depuis longtemps souligné que le produit intérieur brut (PIB) est une mesure inadéquate du développement économique et du bien-être social, et ne devrait donc pas être l’unique obsession des décideurs. Pourtant, nous n’avons fait aucun progrès vers une alternative réaliste à cet indicateur.
L’une des lacunes bien connues du PIB est qu’il ne tient pas compte de la valeur du travail domestique, y compris les soins aux enfants et aux membres âgés de la famille. Plus important encore, l’attribution d’une valeur monétaire à ces activités ne réglerait pas un défaut plus profond du PIB : son incapacité à refléter de manière adéquate l’expérience vécue par les membres de la société. Mesurer les travaux ménagers gonflerait le PIB sans pourtant modifier réellement les niveaux de vie. De plus, les femmes, représentant la plus grande part des personnes qui effectuent des travaux domestiques, continueraient à être considérées comme bénévoles plutôt que contribuant véritablement à l’activité économique.
Un autre défaut bien connu du PIB est qu’il ne tient pas compte de la destruction de valeur, par exemple lorsque les pays gèrent mal leur capital humain en négligeant l’éducation, ou en épuisant leur capital naturel pour obtenir des avantages économiques immédiats. Au final, le PIB tend à mesurer les actifs de façon imprécise, et pas du tout les passifs. ».
La question qu’il faudrait se poser est que détruit-on pendant que nous croissons ?
Et si on revient aux grands mythes d’homo sapiens, on lira les textes saints du Monothéisme, Genèse 1:28 :
« Et Dieu les bénit, et leur dit : Croissez, et multipliez, et remplissez la terre; et l’assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur toute bête qui se meut sur la terre. »
L’homme prudent dira : c’était un bon plan marketing quand les hommes étaient quelques millions sur la terre. Mais il posera aussi la question : Est-ce toujours le cas depuis que nous sommes 7,5 milliards et que nous allons vers les 10 milliards voire au-delà ?
Les économistes orthodoxes sont des gens rigoureux, ils n’aiment pas qu’un pan de l’activité marchande leur échappe. L’activité bénévole ne les motive pas trop, mais dès qu’il y de l’échange de monnaie…
Et c’est ainsi que nous apprenons que l’INSEE va intégrer le trafic de drogue au PIB.
Un article du Monde, nous explique les problèmes techniques que cela pose à l’INSEE et sur lesquels je ne m’arrêterai pas. Il semblerait que l’INSEE réalise cette évolution à l’insu de son plein gré. Elle le fait sur une demande de l’Europe.
En France, assure l’Insee, cette prise en compte entraînera « une révision en très légère hausse du niveau du PIB ». Le chef du département des comptes nationaux de l’institut public, Ronan Mahieu, évoque le chiffre de « quelques milliards » d’euros, à rapporter aux 2 200 milliards d’euros du PIB français.
Dans cet article nous apprenons que l’Allemagne inclut la prostitution dans son PIB, ce que ne fait pas la France et lorsqu’en 2013 notre voisin germanique a intégré le trafic de drogue, il a noté une amélioration de 0,1 point de pourcentage.
Comment dire ?
A ce stade, je ne voudrais pas développer de nouvelles théories économiques, tâche dont je suis d’ailleurs incapable. Ni faire des leçons morales, mais simplement parler de la vie.
Le 700ème mot du jour donnait la parole à un économiste sortant un peu des sentiers battus : Yann Moulier Boutang
Il nous parlait des abeilles :
« Je vais vous parler des abeilles.
Qu’est-ce que fait l’abeille ?
L’économie politique qui s’intéresse aux produits, aux produits vendables, vous répond : l’abeille produit du miel. L’apiculteur va remplacer l’essaim sauvage où l’abeille produit du miel, pour elle-même et pour ses larves, par des ruches avec des rayons.
Puis il va subtiliser le miel des rayons, car l’abeille ne produit pas naturellement du miel pour les humains. Et en lui retirant le miel des rayons, l’abeille va produire, produire et encore produire du miel. […]
Cela c’est le PIB, la croissance. La production du miel, de la farine, des smartphones, du tourisme, les maillots au nom des millionnaires du football, des poudres de perlimpinpin comme dirait notre Président, des armes et donc aussi de la prostitution, de la cocaïne et tout ce qui peut se vendre…
Mais Moulier-Boutang nous montre le vrai rôle de l’abeille et pose un autre regard sur le rôle de l’abeille dans la nature et dans notre écosystème :
Mais maintenant que fait vraiment l’abeille maintenant que nous savons un peu plus de complexité.
Eh bien fondamentalement, je vais vous dire : le miel on s’en fiche !
L’abeille, elle pollinise ! […]
L’abeille pollinise, cela veut dire que 80 % de la production agro-alimentaire en termes de légumes et de fruits est produite grâce aux abeilles. Il faut aussi rajouter des choses comme le tournesol pour lequel la pollinisation de l’abeille prend la plus grande part.
L’abeille pollinise !
Nous pouvons mesurer, puisqu’un économiste doit pouvoir mesurer des quantités et des prix, l’impact des abeilles. Si l’on prend les États-Unis d’Amérique, si vous faites l’hypothèse qu’il n’y a plus de pollinisation, vous pouvez compter entre 30 et 35 milliards de dollars par an, qui disparaissent. Et je ne parle même pas de la flore, des parcs sauvages, je parle simplement de la production agricole.
Donc qu’est-ce que produit l’abeille, en termes de valeur économique ?
D’un côté elle produit aux États-Unis pour 100 millions de dollars de miel et de l’autre côté elle participe à la production d’une valeur entre 30 et 35 milliards de dollars.
En conséquence, ce que fait fondamentalement l’abeille du point de vue économique, au niveau de l’écosystème elle produit 350 fois plus que le miel, en valeur.
Voilà les proportions.
D’un côté il y a ce qui est calculé par un output marchand, simple, clair : l’abeille produit du miel.
Et de l’autre côté, elle pollinise et nous savons qu’on peut se passer de miel, mais on ne peut pas se passer de pollinisation.
Nous comprenons donc que l’abeille fait du miel pour vivre et se nourrir, mais qu’en vivant, elle circule, elle pollinise et que sa véritable contribution productive, c’est ça !
En tout cas, en terme de valeur, c’est ça l’étalon principal.
En économie traditionnelle, on voit l’abeille qui consomme et l’abeille qui produit. Un input et un output.
Mais, ce qui est fondamental, c’est son rôle dans la reproduction du vivant et ça elle le fait même sans s’en apercevoir, puisqu’elle fait cela en même temps qu’elle consomme, comme un produit annexe de sa consommation : elle répand le pollen.
Le plus important c’est qu’elle circule en se nourrissant, ce n’est pas son travail industrieux dans la ruche ou elle transforme le nectar en miel ou en gelée royale.
Et ce raisonnement est en terme de valeur, de richesse économique !
Retour à l’être humain.
Qu’est-ce que fait l’humain principalement ? Un output marchand à partir de marchandise ?
Non ! il produit essentiellement du vivant à partir du vivant.
L’humain ne fait pas que se reproduire, il met au monde des enfants mais qu’il élève et en cela il crée quelque chose de nouveau !
Il produit son environnement, il produit des relations, il produit du lien etc.
Mais pour des humains, en dehors des sociologues qui faisait de grandes déclarations qui disaient « le lien social c’est important », les assistantes sociales qui disaient « il ne faut pas couper dans les dépenses publiques », « il ne faut pas couper dans l’éducation parce que c’est la base de la société, parce que c’est la richesse de la société ». Parce que c’est aussi la possibilité pour les entreprises de ne pas avoir des employés qui sont totalement malades ou totalement handicapés sur tous les plans.
En dehors de cela, ce n’était pas tellement connu et surtout pas des économistes, parce que je peux vous dire que mes confrères ont une propension à ne pas s’intéresser à la pollinisation et à se focaliser sur la production du surplus de miel qui est notoirement connu. »
Ce que nous raconte Moulier-Boutang, ce n’est pas la poésie, ni de l’utopie, mais la réalité du vivant. De quoi ébranler des certitudes bien ancrées.
Alors bien sûr, la croissance ce n’est pas rien dans l’Histoire humaine. C’est encore Yuval Noah Harari qui décrit cette révolution dans l’Histoire de Homo Sapiens
«Si l’on veut comprendre l’histoire économique moderne il n’y a en vérité qu’un seul mot à comprendre. Et ce mot, c’est « croissance ». Pour le meilleur ou pour le pire, malade ou en bonne santé, l’économie moderne a cru tel un adolescent gavé d’hormones. Elle avale tout ce qu’elle trouve et pousse sans même qu’on s’en rende compte.
Pendant la majeure partie de l’histoire, l’économie a gardé largement la même taille. Certes la production mondiale s’est accrue, mais cette croissance fut essentiellement l’effet de l’expansion démographique et de la colonisation de terres nouvelles. Tout cela changea cependant à l’époque moderne. En 1500, la production mondiale de biens et de services se situaient autour de 250 milliards de dollars ; aujourd’hui, elle tourne autour de 60 billions de dollars. Qui plus est, en 1500, la production annuelle moyenne par tête était de 550 $ alors qu’aujourd’hui chaque homme chaque femme et chaque enfant produit en moyenne 8 800 $ par an. Comment expliquer cette prodigieuse croissance ? »
La croissance a alors pu donner aux humains, surtout à certains humains dans certaines nations des bienfaits indiscutables, des travaux moins pénibles, une augmentation de la productivité qui a augmenté le temps de loisir, une explosion de l’espérance de vie et des progrès extraordinaires de la santé.
C’est la croissance qui a mis fin définitivement aux thèses malthusiennes qui pensaient que la production croissait toujours moins vite que la population humaine et que cela créait toujours des phénomènes très pénibles de famines et de mortalité massive avant que la population redevienne compatible avec la production.
Mais aujourd’hui, ne sommes-nous pas allés trop loin ?
La croissance actuelle ne donne même plus d’emplois, comme le précise un article des Echos du 21 janvier 2018 :
C’est un paradoxe. La croissance mondiale n’a jamais été aussi élevée depuis 2010 si l’on en croit le Fonds monétaire international. Mais, le taux de chômage stagne. C’est le constat dressé par l’Organisation International du Travail (OIT) dans son rapport « Emploi et questions sociales dans le monde » publié lundi.
Je ne développe pas la captation des fruits de la croissance par un très petit nombre, comme le démontre des études successives.
Le plus préoccupant c’est que nous sommes en face de la raréfaction des ressources, dans le défi climatique, probablement dans la pénurie d’eau potable.
<La ville de Cap n’aura plus suffisamment d’eau dans 3 mois>
Nous comprenons bien que comme les arbres qui ne croissent pas jusqu’au ciel, la croissance ne pourra se poursuivre indéfiniment. Ou existe-il quelqu’un qui croit le contraire ? Ceci me fait remarquer que, par le hasard de notre langue, le verbe croitre et le verbe croire se conjuguent quasi de la même manière au singulier du présent : seul un accent circonflexe distingue croire et croitre.
Alors certains pour sauver le concept de croissance, qu’ils jugent indispensable à la civilisation humaine, ajoutent le mot « verte ».
La croissance, ce n’est pas bien, mais la croissance verte nous sauvera.
Encore une fois, pouvons-nous le croire ?
Pensons-nous vraiment que la croissance pourra continuer dans le monde fini de la terre ?
Ou croyons-nous, comme les « visionnaires » de la silicon Valley que nous saurons trouver les moyens d’abandonner la terre et trouver une autre planète accueillante que l’homme saura rejoindre ?
La certitude que le génie de l’homme trouvera les solutions à ces problèmes, même aidé par l’intelligence artificielle, n’existe pas.
La connaissance de la finitude des ressources de la terre et de l’impossibilité de continuer avec notre modèle de développement actuel, sur la seule terre, est acquise.
Je finirai par une réflexion que j’ai lue dans un livre de Raymond Aron du temps de ma jeunesse et que je cite de mémoire : « Tout se passe comme si nous étions dans une machine qui va de plus en plus vite et que personne ne sait arrêter ».
<1014>
- Quand on est parent, on aime voir ses enfants croitre.
-
Mercredi 7 février 2018
« Réflexions sur la démocratie libérale »Réflexions personnelles après des années de butinage.Quand je suis né en 1958 : L’Espagne, le Portugal, la Grèce n’étaient pas des démocraties.
La Russie soviétique, bien qu’en pleine déstalinisation 2 ans après le rapport Khrouchtchev, restait un État totalitaire sans liberté, où les camps du goulag continuaient à être très actifs et ou des opposants pouvaient être enfermés dans des asiles psychiatriques dans lesquels ils étaient soumis à des tortures psychologiques. Car dans cet État, il n’y avait pas d’opposants mais uniquement des dissidents qui en contestant le régime pouvaient être considérés comme des fous.
Et que dire de la Chine ?
En 1958, Mao allait lancer ce qu’il a appelé le « grand bond en avant », un programme économique désastreux qui allait provoquer environ 45 millions de morts et ouvrir une crise de régime. Et c’est ainsi qu’allant toujours plus loin dans la terreur et la tyrannie Mao allait lancer la révolution culturelle en 1966.
Dire que la Chine n’est pas une démocratie constitue une litote.
Un des premiers mots du jour avait été consacré au premier article surréaliste de la constitution de la Chine.
« La République populaire de Chine est un État socialiste de dictature démocratique populaire dirigé par la classe ouvrière et fondé sur l’alliance entre ouvriers et paysans. Le système socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine. Il est interdit à toute organisation ou tout individu de porter atteinte au système socialiste. »
Mais mis à part la Chine, aujourd’hui tous ces pays sont devenus des démocraties après plusieurs étapes jusqu’à l’effondrement de l’Union Soviétique en 1991.
C’est alors que le politologue américain Francis Fukuyama publie, en 1992, « The End of History and the Last Man », donc « La Fin de l’histoire et le Dernier Homme ». Dans cet essai, il affirme que la fin de la Guerre froide marque la victoire idéologique de la démocratie et du libéralisme (concept de démocratie libérale) sur les autres idéologies politiques. Pour lui, si des troubles pouvaient surgir de la dislocation du bloc de l’Est, la suprématie absolue et définitive de l’idéal de la démocratie libérale était certaine. Il était donc certain que la démocratie libérale s’imposerait effectivement dans tous les pays du monde.
Et la Chine ?
La Chine s’étant lancé dans l’économie de marché, il était inéluctable qu’elle évolue par étape vers la démocratie libérale.
En 2018, 26 ans après l’essai de Francis Fukuyama où en sommes-nous ?:
1° La chine n’a pas fait le moindre pas vers la démocratie libérale. Son système économique florissant, de plus en plus innovant, c’est en Chine qu’a été réussi le premier clonage de primate, évoqué lors d’un mot du jour récent, semble mener de manière inéluctable l’Empire du milieu vers la place de premier du classement économique du PIB mais sans passer par la case démocratie libérale.
Bien au contraire, j’ai évoqué à deux reprises ce système que le gouvernement appelle « Le Crédit social » et qui constitue un système national de réputation des citoyens. Chaque citoyen se voit attribuer une note, dite « crédit social », fondée sur les données dont dispose le gouvernement à propos de leur statut économique et social.. Le système repose sur un outil de surveillance de masse et utilise les technologies d’analyse du big data. Il est également utilisé pour noter les entreprises opérant sur le marché chinois. Ce que cela dit c’est que la République Populaire de Chine, prend exactement le sens inverse de la démocratie libérale et réalise pleinement le cauchemar de Big brother imaginé par George Orwell.
2° Un certain nombre d’États dont on pouvait penser qu’ils allaient évoluer vers la démocratie libérale ont inventé un nouveau concept : « la démocrature »
La démocrature est un néologisme qui associé le mot « démocratie » et le mot « dictature ». Il semble être apparu à travers le nom d’un ouvrage de Max Liniger-Goumaz, économiste et sociologue suisse: La démocrature, dictature camouflée, démocratie truquée publié en 1992. Notons que la Chine avait déjà associé ces deux mots dans sa constitution cité en début d’article : « État socialiste de dictature démocratique »
Viktor Orban, le chef de l’exécutif hongrois, dont le régime est un exemple de démocrature avait utilisé un autre terme : « La démocratie illibérale ». <Un mot du jour de mars 2015> avait été consacré à ce concept et à Viktor Orban.
Cet article débutait ainsi :
« La Hongrie est depuis 4 ans gouvernée par un Premier ministre, Viktor Orbán, et son parti le Fidesz. […] Le 26 juillet 2014 lors de l’université d’été de son parti il a inventé ce concept d’un Etat« illibéral » qu’on peut aussi traduire par « non libéral ». Viktor Orban n’a pas dit ce qu’il entend par « Etat non libéral («illiberális») », mais il a cité ses modèles : la Russie, la Chine et la Turquie. »
Ce mot est plus juste que démocrature, il dit clairement que ce régime entend être démocrate, c’est-à-dire continuer à convoquer des élections pour que le Peuple désigne ou semble désigner ses gouvernants.
Mais pour le reste, il n’est pas libéral. Ce qui signifie que les contre pouvoirs sont neutralisés (Cour constitutionnelle, Justice, Journaux) et que l’opposition ne trouve pas de place pour s’exprimer et n’est tout simplement pas respectée.
La démocratie libérale constitue un régime agréable à vivre, parce la liberté de penser est assurée, que des contre pouvoirs empêchent le pouvoir exécutif et l’administration d’agir sans contrôle contemporain et que l’opposition, c’est-à-dire les représentants de la minorité qui a été battue aux élections sont respectés et trouvent leur place dans l’organisation du pouvoir.
Les conséquences :
En Turquie <Reporter sans Frontière> explique ce que cela signifie :
« Avec 72 professionnels des médias actuellement emprisonnés, dont au moins 42 journalistes et 4 collaborateurs le sont en lien avec leur activité professionnelle, la Turquie est la plus grande prison du monde pour les journalistes. »
La Turquie qui était une démocratie dont on avait salué la dynamique et la remarquable évolution, notamment en permettant à l’opposition représentée par Erdogan d’arriver au pouvoir en 2003 contre le parti des kémalistes.
En Russie, Le régime de Poutine interdit de manière fallacieuse aux principaux opposants de se présenter aux élections contre lui, ne laissant que des faire-valoir se présenter. C’est aussi en Russie que des journalistes faisant trop d’investigations sont assassinés. Ainsi de Anna Politkovskaïa auquel j’ai consacré un mot du jour : « Qu’ai-je fait ?…J’ai seulement écrit ce dont j’étais témoin.»
Poutine, Erdogan, Orban sont rejoints maintenant par le gouvernement polonais qui prend le même chemin.
L’économie pour la Chine, l’ordre pour les autres constituent en interne un ferment d’adhésion fort et même dans certaines fractions de nos démocraties qui restent libérales quelque chose comme une envie de régime fort…
Et même nos gouvernements, notamment pour « lutter contre le terrorisme » commence à attaquer la liberté de penser et à mettre des « coins » dans la séparation des pouvoirs.
C’est ce qui a fait dire à François Sureau devant le Conseil Constitutionnel
« La liberté de penser, la liberté d’opinion, […] n’existent pas seulement pour satisfaire le désir de la connaissance individuelle, le bien-être intellectuel de chaque citoyen. […] Elles [existent] aussi parce que ces libertés sont consubstantielles à l’existence d’une société démocratique »
C’est très inquiétant.
3° Les peuples de l’Union européenne semblent toujours en démocratie libérale, mais une démocratie dévitalisée
Quand j’évoque l’Union européenne, le paragraphe précédent limite tout de suite ce propos pour en écarter les régimes hongrois et polonais et même tchèques qui prennent aussi une voie problématique.
Nous sommes face à un dilemme dans l’économie de la mondialisation, chacun des États européens ne pèsent plus grand-chose, seule l’Union européenne peut jouer un rôle déterminant devant la puissance des Etats-Unis, de la Chine et des GAFA.
Mais l’Union européenne n’est pas une démocratie.
C’est Philippe Séguin dans son discours du 5 mai 1992 sur la ratification du traité de Maastricht qui l’a dit de la manière la plus tranchée :
« Pour qu’il y ait une démocratie il faut qu’existe
un sentiment d’appartenance communautaire suffisamment puissant pour entraîner la minorité à accepter la loi de la majorité ! »
Nous votons dans la circonscription nationale mais les décisions structurantes ont été prises auparavant non par « L’Europe » mais par les exécutifs nationaux dans le cadre de négociation européenne, et ont été figés dans des traités.
Dès lors, le vote national ne peut plus guère avoir de conséquences et la population semblent se résoudre qu’une même politique économique se poursuivent malgré les alternances.
Quelquefois, les technocrates européens se trahissent et dévoilent cette réalité :
- «Ne vous inquiétez pas, en Europe nous avons le système qui permet de ne pas tenir compte des élections.» a dit un fonctionnaire européen à Raphael Glucksmann <mot du jour du 25 mars 2015>
- « Doit-on déterminer notre politique économique en fonction de considérations électorales ? » avait questionné Manuel Barroso et dans son esprit la manière de poser la question manifestement conduisait vers une réponse négative. Notre politique économique ne doit pas tenir compte des élections <mot du jour du 5 mars 2013>
- «Je voudrais également savoir comment la France prévoit de se conformer à ses obligations de politique budgétaire en 2015, conformément au pacte de stabilité et de croissance. » a exigé Jyrki Katainen, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires du gouvernement désigné suite à des élections en France <mot du jour du 27 octobre 2014 >
Croire que cette situation n’abime pas la démocratie libérale me semble particulièrement naïf.
Les conséquences sont simples : une augmentation de l’abstention et une montée des partis extrémistes.
4° Et nous arrivons à la quatrième menace contre la démocratie libérale qui devait triompher selon Fukuyama : les GAFA et les entreprises numériques.
Je vous renvoie vers tous ces mots du jour :
18 mai 2016 : « Une course à mort est engagée entre la technologie et la politique. » Peter Thiel un des fondateurs de Paypal, cité par Marc Dugain et Christophe Labbé dans leur livre « L’Homme nu »
10 mai 2016 « Il faut considérer la Silicon Valley comme un projet politique, et l’affronter en tant que tel. » Evgeny Morozov
2 mars 2016 « Le pouvoir des GAFA c’est d’être la porte d’entrée du monde vers vous, « individu » et la porte d’entrée de l’individu sur le monde » Olivier Babeau
Et bien sur ce que Yuval Nopah Harari dit sur ce sujet : <Sapiens>
Et pour finir, cette analyse du sociologue Zygmunt Bauman :
3 mars 2016 : « S’enfermer dans […] une zone de confort, où le seul bruit qu’on entend est l’écho de sa propre voix, où la seule chose qu’on voit est le reflet de son propre visage.».
Cette zone de confort qui nous interdit de plus en plus le débat, beaucoup n’écoutent plus que celles et ceux avec qui ils sont d’accord.
Les matins de France Culture sont allés à Chicago, un an après la victoire de Trump. Une femme politique américaine, adversaire de Trump, faisait ce constat :
« Nous n’avons plus rien de commun avec ce peuple qui vote Trump, nous ne nous parlons plus, nous ne nous écoutons plus, nous ne regardons pas les mêmes sources d’information, quand l’un parle l’autre croit qu’il s’agit de fake news »
Ma certitude que la démocratie libérale s’imposerait forcément sur la planète a beaucoup régressé.
Ma compréhension et ma connaissance des éléments qui mettent en danger la démocratie libérale ont progressé.
Mais mon souhait de continuer à vivre dans une démocratie libérale reste intact.
<1013>
- «Ne vous inquiétez pas, en Europe nous avons le système qui permet de ne pas tenir compte des élections.» a dit un fonctionnaire européen à Raphael Glucksmann <mot du jour du 25 mars 2015>
-
Mardi 6 février 2018
« Réflexions sur l’Etat social »Réflexions personnelles après des années de butinage.Comme je l’avais annoncé hier, je vais examiner certains sujets par rapport à ces trois axes de la connaissance qu’il faut augmenter, des certitudes qu’il faut savoir abandonner et de la complexité qu’il faut savoir accepter.
Je préviens que je ne vais pas, au cours de cette semaine, tenter d’être consensuel mais écrire ce que je crois avoir compris, sans pour autant m’interdire d’évoluer et de douter.
Nous sommes nés, je suis né dans un État social, on parle aussi d’un État providence.
Je venais à peine d’entrer en classe préparatoire au Lycée Kléber en 1976 que mon père a été hospitalisé d’urgence, son pronostic vital était engagé. Il a passé une semaine en soins intensifs. Je le sais encore, un jour en soins intensifs coutait à l’époque 10 000 Francs, 1 500 euros. Mes parents étaient très modestes, il était absolument impossible pour nous de payer de telles sommes. Mais nous n’avons rien payé, tout était pris en charge par la Sécurité Sociale.
Non parce que nous étions pauvres, mais parce que la solidarité était en œuvre. Non pas la charité, la solidarité. Nous trouvions cela normal et cela ne pouvait que s’améliorer.
De grandes tensions se font jour et cette amélioration n’apparait plus comme évidente.
Je voudrais ajouter qu’à la suite de ces soins mon père a encore vécu et dans de très bonnes conditions 33 ans. C’est un exemple personnel et privé, mais il dit simplement ce que l’État social apporte.
C’est un des grands ennemis de la France, Otto von Bismarck qui semble avoir été un des premiers à avoir eu cette initiative d’une sécurité sociale.
Il l’a mis en œuvre dans l’Allemagne qu’il venait d’unifier autour de la Prusse et du Roi de Prusse qui est devenu L’Empereur Guillaume 1er. Il a d’abord maté l’Empire d’Autriche à Sadowa puis il a humilié la France de Napoléon III à Sedan puis à Paris. L’Allemagne était devenue une puissance militaire et économique considérable.
Le XVIIIème siècle avait consacré l’hégémonie française, le XIXème l’hégémonie Anglaise, le XXème était promis à l’Allemagne. L’Histoire s’est écrite un peu autrement.
Mais dans l’Allemagne puissante, unifiée, le chancelier Bismarck a créé un système de protection sociale contre les risques maladie (1883), d’accidents de travail (1884), de vieillesse et invalidité (1889) pour le peuple allemand, réunie autour de son empereur et son attachement à sa patrie, « Vaterland » en allemand.
C’est après deux terribles guerres, guerres civiles européennes dans lesquelles le peuple anglais a connu de terribles souffrances surtout lors de la seconde, où le peuple anglais s’est rassemblé pour se battre et gagner finalement contre les nazis qu’est apparu un système social très sophistiqué qu’on a appelé le système « beveridgien » du nom de William Beveridge, économiste à qui en 1942, le gouvernement britannique a demandé de rédiger un rapport sur le système d’assurance maladie qui va fonder le système social britannique.
Et en France, c’est à l’issue de cette même guerre, 39-45, où la France a d’abord été humiliée puis s’est redressée que le Conseil National de la résistance, où se trouvait ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas, des bourgeois riches et des prolétaires ou des représentants du prolétariat qu’a été élaboré le programme du Conseil National de la Résistance qui va conduire aux bases de l’Etat social.
Dans le mot du jour du mardi 29 novembre 2016, j’ai rappelé cette phrase d’Ambroise Croizat, ministre du travail de 1945 à 1947 :
« Mettre définitivement l’homme à l’abri du besoin, en finir avec la souffrance et les angoisses du lendemain ».
Concrètement la mise en place de la Sécurité Sociale au lendemain de la guerre a été réalisée juridiquement par les ordonnances du 4 octobre 1945.
Voilà comment cela s’est passé : des peuples unis au-delà des religions et des différences sociales qui ont mis en place un système de solidarité.
Car c’est autre chose que d’être ému, par exemple, par la situation terrible d’une population qui a subi un tremblement de terre à Haïti et de verser des dons quelquefois conséquents pour aider par compassion ou par charité, de manière ponctuelle, des hommes dans la détresse. Nous parlons ici d’un système de solidarité où toute sa vie on va payer des cotisations pour aider ses proches mais aussi des inconnus à surmonter les aléas de la vie et les difficultés de la vieillesse. Mais ces inconnus font partie d’une société particulière, la même que la nôtre, celle dont nous avons conscience de faire partie.
C’est Emile Durkheim qui donne la clé de compréhension de ce phénomène et que j’ai cité lors du mot du jour du Vendredi 12 septembre 2014 :
« Pour que les hommes se reconnaissent et se garantissent mutuellement des droits,
ils faut qu’ils s’aiment et que pour une raison quelconque ils tiennent les uns aux autres
et à une même société dont ils fassent partie. »
Cela peut heurter certaines et certains d’entre vous. Tous les humains du monde sont frères, il faudrait créer une sécurité sociale mondiale. Certainement ! peut-être qu’un jour on y arrivera…
Mais pour l’instant ce n’est pas ainsi que cela se passe.
Dans Wikipedia, on lit non la version sociologique d’ Emile Durkheim mais la version des économistes :
« Dans les sociétés occidentales, la période des Trente Glorieuses a permis le développement des systèmes de protection sociale.
Le vieillissement démographique et la crise économique ont ensuite entraîné un accroissement des dépenses et une diminution des recettes. Les systèmes de protection sociale ont alors essuyé des critiques de plus en plus vives, notamment de la part des économistes de l’école néoclassique. Selon eux, la protection sociale est une des causes de la crise car les cotisations sociales entraînent des surcoûts salariaux qui freinent l’embauche et incitent au travail au noir. De plus, ils affirment que la protection sociale déresponsabilise les individus et les incite à l’oisiveté.
Selon l’approche keynésienne au contraire, la protection sociale, outre son rôle de réduction des inégalités et de maintien de la cohésion sociale permet de soutenir la demande, considérée par cette théorie comme un moteur de la croissance. »
La complexité signifie que nous devons accepter qu’une situation ou une évolution ne soit pas la conséquence d’une seule cause.
Dès lors, l’explication économique représente certainement une dimension explicative.
Le système social mis en place a tellement bien fonctionné que les populations sont devenues de plus en plus vieilles, que la médecine est devenue de plus en plus performante et donc que le système social est devenu plus onéreux. En plus la crise économique qui est plutôt une rupture de l’organisation du travail et de l’emploi dans le monde a conduit la gestion des allocations chômage au bord de l’implosion. Ce qui entraine une augmentation de la redistribution et une crispation de la part de celles et de ceux qui sont les plus ponctionnées.
Mais prétendre que ce n’est qu’un problème de sécession des riches est un aveuglement devant la réalité du comportement des sociétés humaines.
Dans une étude américaine, dont j’ai entendu parler lors d’une émission de radio mais dont je n’ai, hélas, pas gardé la source que je ne peux donc fournir, il est apparu qu’il y avait de grandes différences de politiques de solidarité entre les états fédérés des Etats-Unis. Et que cette étude a révélé que la solidarité était d’autant plus grande que la population de l’état était homogène du point de vue ethnique et religieux.
A cela s’ajoute cette réflexion de Jean-Paul Delevoye, le dernier Médiateur de la République qui apportait cette évidence : « L’économie est mondiale mais le social est local !».
Or l’économie qui s’est développée depuis les années 1980 dans le cadre de la globalisation insiste davantage sur la compétition que sur la coopération, préfère l’individualisme à la solidarité.
Les frontières ouvertes, les migrations économiques sont absolument compatibles avec cet individualisme qui pousse chacun à être responsable et donc à s’assurer soi-même.
Les gagnants de la mondialisation n’ont aucune peine à assurer leur protection sociale dans la sphère privée. Et en outre plus leurs assurances leur coûtent chers et leur assurent une protection de grande qualité, moins ils seront enclins à accepter de financer les mécanismes de solidarité qui ne leur servent plus ou de manière dégradée.
Parce que dans cette organisation décrite ci-avant, dans une société qui acceptent d’organiser la solidarité entre ses membres, même ceux qui contribuent le plus doivent bénéficier et surtout avoir conscience de bénéficier de cette solidarité.
C’est pourquoi certaines réformes, qui a première vue peuvent être analysées comme raisonnables, apparaissent délétères pour l’Etat social. Il en est ainsi de cette idée de vouloir réserver les allocations familiales au plus modestes. Il faut comprendre ce que cela signifie : ce n’est plus une solidarité dans une société de l’empathie mais exactement les mêmes ressorts que lorsque les habitants des pays riches font un don pour aider les habitants de Haïti dans des circonstances compliquées. Nous ne sommes plus dans des mécanismes de solidarité, mais de charité qui obéissent à d’autres ressorts des sentiments de l’humain.
L’Etat social c’est vraiment ce que Durkheim décrit :
« Pour que les hommes se reconnaissent et se garantissent mutuellement des droits,
ils faut qu’ils s’aiment et que pour une raison quelconque ils tiennent les uns aux autres
et à une même société dont ils fassent partie. »
Dit autrement, il faut un « Nous ».
Ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas possible de créer une solidarité avec des humains venant d’autres continents, d’autres cultures, d’autres religions, mais ce n’est pas possible dans une société qui se divise en communautés et en groupes qui créent dans la société la dichotomie entre « Nous » et « Eux ». L’Etat social n’est possible qu’à l’intérieur d’une société dans laquelle il existe un « Nous » prédominant, même si à l’intérieur de ce « Nous » il peut exister des « nuances ».
Le problème est donc loin de n’être qu’économique !
Mais il y a bien un problème économique de fond, dans un monde de la globalisation, de l’ouverture des frontières et notamment de la libre circulation des capitaux. Et ce problème, Angela Merkel l’a décrit en quelques chiffres qui sont ce que nous appelons des chiffres durs :
C’était l’exergue du mot du jour du Mercredi 19 novembre 2014 :
« L’Europe, c’est 7% de la population mondiale
25% de la production mondiale,
et 50% des transferts sociaux mondiaux.»
Enoncé ainsi, on comprend l’ampleur du problème !
Voici ce que j’ai compris sur les conditions de l’Etat social et les défis qu’il affronte aujourd’hui.
Certes, comme le disent mes amis de gauche, il faut que les riches contribuent davantage.
Mais cela n’arrivera pas si on ne sait pas créer les conditions d’une société telle que la décrit Durkheim.
Ni d’ailleurs si le reste du monde ne se rapproche de nos standards de redistribution ou que nous soyons prêts à nous retirer de la mondialisation avec toutes les conséquences que cela entraineraient.
Et dans ce cas les perdants de la mondialisation deviendront de plus en plus les obligés des associations caritatives ou de la philanthropie des gagnants. Cette évolution est à l’œuvre aux États-Unis. Un mot du jour de février 2016 avait évoqué ce sujet en se fondant sur un livre de Nicolas Duvoux, «Les oubliés du rêve américain. Philanthropie, État et pauvreté urbaine aux États-Unis». Ce sociologue avait réalisé une enquête dans la ville de Boston sur l’action d’une fondation américaine philanthropique en faveur des habitants d’un quartier défavorisé et en avait tiré ce livre. J’avais donné ce commentaire sur les philanthropes :
«Ce sont des gens immensément riches parce qu’ils ont eu une idée géniale qui correspondait à l’air du temps, ils ont beaucoup travaillé et entrepris et aussi … pour un petit peu… profiter d’une diminution considérable des impôts aux États-Unis et peut être aussi profiter des opportunités que leur offraient le système financier et quelques paradis fiscaux.
Bref, les impôts ou cotisations qu’ils n’ont pas payés et qui aurait permis d’alimenter un système redistributeur public, ont conduit leur fortune d’importante à devenir gigantesque. Et ils sont devenus philanthropes. Bref un système de redistribution privé.»
<1012>
-
Lundi 5 février 2018
« Augmenter nos connaissances, diminuer nos certitudes, accepter la complexité »Réflexions personnelles après des années de butinage.Mais finalement, au bout du bout, à quoi servent tous ces efforts pour trouver et écrire des mots du jour ?
Vous pourriez me poser cette question, mais Alain que retiens-tu de tout cela ? Qu’est-ce que tu as appris ? Compris ?
Quelle quête poursuis-tu ?
La quête est ambitieuse, je l’ai expliquée à plusieurs reprises : « Essayer de comprendre le monde ». Sur la page d’accueil de ce blog, une phrase est mise en exergue : «Comprendre le monde, c’est déjà le transformer !»
Cette phrase est celle de Guillaume Erner qui l’a prononcée pour le premier matin de France Culture qu’il a animé.
Je l’avais repris dans le mot du jour du 9 septembre 2015. Guillaume Erner avait ajouté :
«[Il faut lutter contre ceux] qui ont intérêt à la mésintelligence du monde.
C’est contre eux qu’il faut se réveiller pour interrompre le sommeil de l’intellect.
Tous les verbes qui nous arrachent à la nuit de la pensée : comprendre, expliquer, réfléchir sont des verbes militants.»
Comment faire concrètement ?
Quels sont les piliers de cette ambition ?
Rachid Benzine qui en même temps a été champion de France de kickboxing et qui est un intellectuel formé à l’école des sciences humaines, après avoir fait des études d’économie et de sciences politiques puis des études d’histoire et de philosophie peut donner des clefs.
Il est musulman il avait accédé à la notoriété en lançant avec le père Christian Delorme, le dialogue islamo-catholique aux Minguettes, dans la banlieue de Lyon, qui a donné lieu à un livre : Nous avons tant de choses à nous dire, paru en 1998. »
En octobre 2016, il avait écrit un roman épistolaire <Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?>, dans lequel un père échange des lettres avec sa fille partie faire le djihad en Irak. Dans une des lettres, il écrit :
« Notre mission en tant qu’humains n’est pas de trouver des réponses, mais de chercher. Les musulmans sont appelés à être d’humbles chercheurs, et pas des ânes qui ânonneraient sans cesse des histoires abracadabrantes. Tu le sais bien, ma petite Nour : Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes. Ces certitudes qui vous mènent aujourd’hui tout droit en enfer. »
J’en avais tiré un mot du jour : « Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes. »
C’est en partant de là que probablement il existe un chemin :
- Augmenter nos connaissances ;
- Diminuer nos certitudes ;
- Et finalement, accepter la complexité.
Pendant tout ce butinage quelles sont les connaissances qui ont augmenté ?
Certainement la compréhension de l’extraordinaire intelligence de la nature et du vivant.
Quand on se plonge dans le livre de Peter Wohlleben sur la vie secrète des arbres, on ne peut plus regarder les forêts de la même manière, on ne peut plus apprécier l’intervention des humains dans la forêt avec les mêmes critères.
Quand on écoute ou lit Franz de Waal on ne peut plus voir les animaux avec les yeux de l’humain qui fait à l’image de Dieu est maître de la nature. Il faut alors se rendre compte que la frontière entre l’homme et l’animal devient de plus en plus ténue, que ce qui permet de différencier l’un de l’autre devient de plus en plus faible.
La connaissance de l’asservissement et de la violence que les hommes ont par le passé et continuent encore trop à exercer à l’égard des femmes dans toutes les civilisations, tous les milieux sociaux a aussi énormément progressé grâce à mes lectures, recherches et aussi réflexions personnelles dans l’expérience de la vie.
Ma connaissance s’est aussi développée sur l’abus et la perversité de l’utilisation incontrôlée, irrationnelle, déshumanisante de la gouvernance par les nombres.
Ma compréhension qu’une des choses fondamentales qui est en train de se dérouler devant nos yeux est une remise en cause des avantages des classes moyennes et populaires occidentales qui étaient le fruit de l’hégémonie et disons-le de la prédation qu’exerçaient les pays occidentaux sur le reste du monde.
Et les certitudes qui ont diminué ?
La certitude qu’il existe des valeurs universelles que l’ensemble des humains partage : la liberté de penser, la démocratie, la valeur de la vie humaine et la prise en compte de l’individu. J’ai compris que ces valeurs universelles étaient issues de notre monde occidental.
Le mot du 17 juin 2015 donnait la parole à Jean-Louis Beffa qui expliquait :
«On a cru que les valeurs de type occidental, celles qui viennent de la révolution française, des vertus chrétiennes et des lumières avaient une valeur mondiale. on disait les droits de l’homme c’est [universel]. Je ne le crois pas. Je crois que le monde asiatique, en particulier, a des valeurs confucéennes qui sont des valeurs complétement différentes.»
Dans ma vision d’homme de gauche, beaucoup de certitudes issues de cette pensée ont été balayées :
- Les conditions sociales expliquent une partie du fonctionnement de la société et des individus, mais pas tout. Il y a aussi les mythes, les religions, les affects, les cultures familiales qui ont une importance considérable dans l’explication des phénomènes sociaux.
- La Loi ne peut pas tout, ne peut pas régler tous les problèmes, interdire tout ce que l’on rejette et par sa seule promulgation faire évoluer les mentalités et la société. »
La certitude aussi que le progrès technique entraîne forcément une amélioration de l’égalité des humains et de leur bien-être est mise à mal.
Accepter la complexité ?
La complexité est le grand mot d’Edgar Morin.
L’acceptation de la complexité doit aussi conduire à accepter qu’on ne peut pas tout comprendre tout maîtriser. L’Univers est infini, sommes-nous pauvres humains capable d’appréhender l’infini ?
De façon plus prosaïque, la complexité peut simplement se détecter dans le gouvernement des humains et le cadre légal de la société.
La GPA, gestation pour autrui, elle est interdite en France, mais pas aux Etats-Unis, ni au Canada, ni en Grande Bretagne.
Dès lors des parents français utilisent cette méthode pour avoir des enfants à l’étranger et ils reviennent en France.
Ces enfants n’existent pas, ils sont hors la Loi.
Si on les légalise, en réalité on accepte le principe de la GPA. Principe de la GPA qui va dans notre monde cupide aboutir forcément à ce que des femmes pauvres louent leur ventre à des riches pour que ces derniers puissent assouvir leur désir d’enfant.
Mais peut-on laisser ces enfants qui ne sont pas responsables de cette situation, ne pas accéder pleinement à la citoyenneté et aux droits sociaux ?
Celui qui dit que la réponse est simple, n’a rien compris à la question.
J’essaierai dans les prochains mots du jour de continuer sur des sujets particuliers à développer selon ces trois axes ce que toutes ces réflexions et lectures ont pu m’apporter.
<1011>
- Augmenter nos connaissances ;
-
Vendredi 2 février 2018
« Ce ne sont plus exactement des homo sapiens, mais des humains 2.0, des surhommes crispérisés »Frédéric BeigbederCe mot du jour renvoie vers certaines découvertes concernant la santé et notamment la capacité d’intervenir sur l’ADN. Vous retrouverez en fin d’article des liens et des explications montrant que le propos de Frédéric Beigbeder n’est pas vraiment humoristique mais plutôt questionnant le monde de demain.
Avant de commencer il faut quand même parler de <crispr> et plus précisément de « CRISPR-Cas9 » (prononcez « crispère »)
L’acronyme CRISPR vient de l’anglais : « Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats », en français (« Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées ». Et Cas9 est une enzyme.
« CRISPR-Cas9 » constitue une innovation révolutionnaire qui permet de cibler une zone spécifique de l’ADN, la couper et y insérer la séquence que l’on souhaite remplacer. Dans le langage courant on parle de « ciseau génétique ».
Le journal du CNRS explique de manière un peu plus technique cette invention : https://lejournal.cnrs.fr/articles/crispr-cas9-des-ciseaux-genetiques-pour-le-cerveau
Après cette courte introduction, revenons à Frédéric Beigbeder qui est un écrivain ayant déjà eu deux prix littéraires. Il réalise une chronique sur France Inter à la fin du 7-9.
Le jeudi 18 janvier 2018, il a fait son intervention après Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d’éthique, qui était l’invité de Nicolas Demorand pour le lancement des Etats généraux de bioéthique, qui se dérouleront jusqu’au 7 juillet. Le sujet de l’élargissement de la procréation médicalement assistée (PMA) promis par Emmanuel Macron lors de sa campagne, la reconnaissance des enfants nés grâce à la gestation pour autrui (GPA), l’arrivée de l’intelligence artificielle dans la médecine ou les interventions sur le génome ont notamment été évoqués.
Frédéric Beigbeder a joué, dans sa chronique, le rôle d’un médecin qui s’adresserait à son confrère, c’est-à-dire à Jean-François Delfraissy.
Et il lui a tenu ce langage :
« Pourquoi tous les génomes français ne sont-ils pas séquencés, ce qui permettrait de détecter les cancers avec 30 ans d’avance ?
Pourquoi le sang artificiel créé par Luc Douai est-il interdit en France ?
Et quid de la congélation des cellules pluripotentes induites également réprimées chez nous ?
Comme le stockage des cordons ombilicaux ?
On a l’impression de vivre dans un monde à deux vitesses.
Une large majorité de mortels peu informés. Et puis nous l’élite mondiale qui sait comment repousser la mort, mais garde le remède secret. […]
En 2015, la grande déclaration du comité international de bioéthique réuni à Paris, à L’Unesco était la suivante :
La révolution génétique soulève de graves inquiétudes, en particulier si l’ingénierie du génome humain devait être appliquée à la lignée germinale…
Donc on ne comprend rien
Une superbe déclaration consultative puisque des thérapies génétiques n’ont cessé d’être testées depuis sur les humains en Grande Bretagne, aux Etats-Unis, en Chine avec des modifications de l’ADN.
Parfois elles ont sauvé des vies, celle de Leila Richards, un bébé leucémique à Londres dont l’espérance de vie était d’une semaine et qui vit toujours. Cet enfant peut être considéré, comme le premier HGM, « humain génétiquement modifié », va-t-on par souci éthique lui interdire de faire des EGM « enfant génétiquement modifié »
Je traduis en français pour les non spécialistes : Vous avez entendu parler des OGM, organisme génétiquement modifié mais vous ignorez probablement qu’il existe désormais des Humains génétiquement modifiés des HGM, et il en existera de plus en plus. Ce ne sont plus exactement des homo-sapiens, mais des humains 2.0, des surhommes crispérisés, crispr étant le nom des ciseaux génétiques, permettant de faire les manipulations génétiques.
Sachant que pour guérir du cancer on va passer par cette crispérisation qui coute des millions de dollars.
Quelle tête feront les gens quand ils sauront qu’un pauvre atteint du cancer devra en mourir et qu’un RGM, riche génétiquement modifié pourra en guérir ?
Si j’ai gaffé, ne répétez à personne cette information confidentielle »
Jean-François Delfraissy, interpellé par Demorand pour répondre à Beigbeder a fait cette réponse :
« Beaucoup de choses intéressantes [ont été dites] et qui montre que ce confrère suit parfaitement les données de la science, les avancées scientifiques. Et qui soulève en effet toute une série de questions, en particulier je retiens la notion de médecine à deux vitesses. Je retiens la question qui pourra y avoir accès. Les problèmes éthiques soulèvent un certain nombre de questions économiques d’accès à la santé et aux nouvelles techniques.
Parlons-en. Sortons du débat d’expert et parlons aux citoyens. »
Vous trouverez la chronique de Beigbeder, derrière <ce lien> et l’émission avec Jean-François Delfraissy derrière <celui-ci>
C’est par la série sur Sapiens de Yuval Noah Harari que j’ai commencé à aborder ce sujet. Dans le mot dont l’exergue est « La singularité ». Je cite Harari qui écrit :
« Si cette question ne vous donne pas le frisson, c’est probablement que vous n’avez pas assez réfléchi».
Mais il va probablement plus loin dans Homo Deus où il évoque une nouvelle religion le dataisme, autrement dit la confiance dans les big data et où il explique que nous allons laisser faire ces évolutions précisément parce qu’elles nous promettent une meilleure santé.
Bien évidemment les parents de Leila Richards ne peuvent qu’être immensément reconnaissants devant toutes ces techniques.
Mais la crainte que cette évolution avec celle de l’« homme augmenté » va créer deux types d’hommes : « l’homo sapiens canal historique » dont nous faisons partie et « homo 2.0 » comme l’appelle Beigbeder dont la chance, si c’en est une, d’en faire partie parait très mince.
Ces évolutions posent aussi des questions de société qui donnent le frisson comme dit Harari.
Au départ, la raison de ces recherches est bien sûr médicale pour guérir, reculer les limites de la mort et de la souffrance.
Mais une fois qu’un petit groupe d’humains aura cette technique faustienne de créer des Hommes Génétiquement Modifiés, qu’adviendra t’il ?
La cupidité de certains est si grande, notamment parmi les puissants et les hyper riches.
L’esprit d’entraide existe aussi saura t’il être le plus fort ?
Jean-François Delfraissy a raison : « Parlons-en. Sortons du débat d’expert. »
Post Scriptum :
Après la chronique de Frédéric Beigbeder, j’ai fait quelques recherches.
J’ai ainsi trouvé le <Rapport du 2 octobre 2015 du Comité international de Bioéthique>. Dont voici des extraits :
Page 8
De nouveaux outils expérimentaux permettent aux scientifiques d’insérer, de retirer et de corriger la séquence de gènes, ouvrant la possibilité de traiter, voire de guérir, certaines maladies monogéniques telles que la béta-thalassémie et la drépanocytose, ainsi que certaines formes de cancer. Si ces procédures s’améliorent et que leur innocuité pour les patients est démontrée, elles permettront le succès longtemps attendu de la thérapie génique somatique. Dans plusieurs pays, la thérapie génique somatique a reçu une approbation éthique et réglementaire parce que les modifications génétiques obtenues ne se transmettent pas à la génération suivante. Les préoccupations des éthiciens et des scientifiques ont précisément été soulevées par la possible application de ces technologies à la modification de la lignée germinale, à des fins thérapeutiques ou à des fins d’amélioration des particularités d’un individu. En conséquence, des appels à un moratoire sur ces technologies ont été lancés, au moins jusqu’à ce que leurs conséquences à long terme et leur sécurité soient mieux évaluées. Certains pays ont interdit toute modification de la lignée germinale chez l’homme alors que d’autres n’imposent pas d’interdictions légales, mais ont élaboré des réglementations administratives ou éthiques (« soft law ») interdisantces expériences sur les gamètes ou les embryons humains.
Page 29
En même temps, cette révolution nécessite des précautions particulières et soulève de graves inquiétudes, en particulier si l’ingénierie du génome humain devait être appliquée à la lignée germinale en introduisant des modifications héritables, qui seraient transmises aux générations futures.
Et si vous voulez en savoir davantage sur le traitement qui a été appliqué à Layla, dans Sciences et avenir j’ai trouvé l’article : « Leucémie : la guérison « miracle » de Layla Richards », pour la première fois, un enfant atteint d’une leucémie aiguë lymphoblastique est entré en rémission grâce à un traitement expérimental utilisant des cellules immunitaires génétiquement modifiées.
Un article sur les recherches du docteur Luc Douay : < On a fabriqué du sang artificiel>
Les cellules pluripotentes évoquées sont des cellules qui dans le processus embryonnaires sont des cellules avant différenciation, c’est-à-dire des cellules qui sont capable de se différencier par la suite en de nombreux types cellulaires différents. Ces cellules existent dans un embryon, on les appelle « les cellules souches embryonnaires »: ces cellules souches sont obtenues à partir d’un embryon de 5 à 7 jours ; pour des questions éthiques, leur utilisation est très réglementée. Mais les scientifiques ont pu fabriquer des « cellules souches pluripotentes induites », dont parle Frédéric Beigbeder. Ces cellules souches sont obtenues à partir de cellules adultes différenciée. Elles sont reprogrammées de manière génétique et peuvent alors se multiplier à l’infini et donner différents types cellulaires.
Sur le site Futura Science j’ai trouvé une vidéo de 2 minutes où un chercheur explique ce qu’il espère réaliser à partir de ces cellules pluripotentes.
Et puis, vous l’avez certainement entendu on vient de créer le premier primate cloné : Et c’est des chinois qui l’on fait.
Techniquement il n’y a plus rien qui empêche qu’on crée le premier humain cloné.
<1010>
-
Jeudi 1 février 2018
« Les bagarres du Nutella »Synthèse des réactions et réflexions personnelles sur ces faits diversEt voici donc que des gens a priori « normaux » viennent à créer une émeute et se bagarrent dans des intermarchés, parce que ces derniers ont décidé de faire une <promotion sur le Nutella>.
La promotion était importante, il s’agissait d’une réduction de 70 %, ce qui mettait le pot de 950 grammes à 1,41 euro au lieu de 4,70 euros.
Certains affirment que parmi eux il y avait des professionnels de la restauration qui voulaient acquérir cette pâte à peu de frais.
Immédiatement les réseaux sociaux se sont déchainés pour se moquer de « ces abrutis » ou « cassoc » qui se battaient pour du Nutella.
Assez vite Jean-Luc Mélenchon s’est insurgé contre ces réactions de moqueries contre « des personnes très modestes » qui voulaient profiter d’une bonne affaire. « Quand l’émeute montre la misère, l’idiot regarde le #Nutella », a-t-il dit, dénonçant ainsi la misère dans laquelle vivaient ces personnes.
Une employée d’un Intermarché de ma ville natale, Forbach, a décrit à l’AFP :
« Les gens se sont rués dessus, ils ont tout bousculé, ils en ont cassé. C’était l’orgie ! »
Ceci me fait aussi penser à <La fermeture du Virgin Megastore de Lyon> en 2013 qui avait conduit à des soldes énormes et des comportements indignes de la part de certains acheteurs. Des vendeurs qui allaient perdre leur travail étaient confrontés à des personnes ayant perdu tout savoir vivre dans leur recherche de produits à prix bas.
Le ministre de l’Agriculture Stéphane Travert rejoint l’explication de Jean-Luc Melenchon. Il a déclaré dimanche 28 janvier sur BFMTV :
« Ce sont des gens qui vivent de peu, ce sont des gens qui se ruent sur une pâte à tartiner qu’ils ne peuvent pas offrir à leurs enfants »
Le Parisien ne dit pas autre chose
«Samedi, à l’Intermarché Beauvais-nord (Oise), sous un ciel sans couleur, le calme est revenu. Mais les scènes de cohue, provoquées par une promotion à -70% sur le Nutella, font honte aux habitants. Chacun s’interroge : comment un pot de 950 grammes à 4,70€, soldé 1,41€ du 25 au 27 janvier, a pu créer une telle bousculade au sein des rayons ? « Bêtise », « cinglés », « sauvages ». Les insultes pleuvent. Mais, très vite, certains chuchotent un autre mot « précarité ». Comme si cette guerre pour 3€ n’était que la photographie d’une détresse sociale, que l’on préfère ignorer.»
Pierre Rondeau, Professeur d’économie développe une analyse plus nuancée : ce n’est pas la misère qui pousse à de tels comportements, mais la peur d’y entrer . Son article a été publié par Slate :
« Ce ne sont donc pas les inégalités ou la grande précarité qui expliquent les heurts violents, la destruction de la solidarité et la fragilisation de la cohésion sociale, puisque ces causes semblent disparaître depuis une trentaine d’années. Le problème est plus complexe: c’est le sentiment d’insécurité économique, la peur du déclassement et la croissance de la méfiance collective qui semblent expliquer ces comportements.
Nous en venons à nous jeter sur les promotions pas forcément parce que nous sommes pauvres mais parce que nous avons le sentiment que cela pourrait nous arriver. Le sociologue Eric Maurin expliquait déjà ce phénomène dans son livre « La peur du déclassement », en 2009:
[…] Et certains en viennent alors à se battre pour du Nutella … »
Un autre angle d’analyse rapporte le propos d’un employé d’un Intermarché à Revigny-sur-Ornain (Meuse) :
« A – 70%, c’est un pousse-au-crime et on casse l’échelle de valeur. Le client se dit que si le pot de Nutella peut être vendu à – 70%, c’est que le reste de l’année, on marge énormément, alors qu’il est vendu à marge zéro toute l’année… ».
D’ailleurs l’administration et <Le journal Libération posent la question si le rabais de 70% était légal> :
En droit français, la vente à perte (c’est-à-dire le fait de vendre un produit à un prix moins cher que celui auquel on l’a obtenu) est interdite Soit Intermarché achète son Nutella pour un prix inférieur ou égal à 1,41 euro… ce qui implique que le supermarché se fait une belle marge de 233% en vendant les pots de 950 g à 4,70 euros en temps normal. Soit Intermarché achète son Nutella à Ferrero pour un prix supérieur à 1,41 euro et il aurait alors pratiqué de la vente à perte avec sa promotion
L’article cependant nuance, il existe des exceptions qui autorisent la vente à perte. Dans le cas qui nous occupe, ce serait possible si cette vente correspond à des soldes, ce qui est permis pour des produits alimentaires
Un autre point de vue s’exprime par « des dentistes et des médecins » qui rappellent à juste titre que désormais les autorités publiques sont convaincus de la nocivité de la trop grande consommation de sucre et s’étonnent qu’on tolère de tels agissements :
« De quoi aurait l’air la campagne anti-tabac actuellement menée si demain des bureaux de tabac pouvaient faire une réduction de 70% sur un simple coup de tête? », s’interroge l’Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire (UNECD) dans un communiqué.
Les futurs dentistes ou chirurgiens interpellent le groupe Intermarché, à l’origine de cette opération, ainsi que les autorités, pour « entamer une réflexion sur la taxation des produits sucrés », après l’instauration d’une taxe soda sous la présidence de Nicolas Sarkozy »
Les goûts et couleurs ne se discutent pas. Ma fille Natacha affirme que le Nutella a très bon goût.
Peut-être, mais ce n’est certainement pas bon pour la santé

Cet article nous apprend que la composition du Nutella diffère d’un pays à l’autre, Ferrero tenant compte des préférences exprimées en fonction des régions et des législations en vigueur concernant le chocolat. En France, le Nutella est d’abord composé de sucres (>50 %) puis d’huile végétale, c’est-à-dire d’huile de palme (17 %). Viennent ensuite les noisettes (13 %), le cacao maigre (7,4 %), le lait écrémé en poudre (6,6 %), puis le lactosérum en poudre.
Enfin, on retrouve dans le Nutella des émulsifiants : des lécithines de soja et de la vanilline.
Bref, surtout du sucre, beaucoup de gras, un peu de noisettes et encore moins de cacao.
J’ai trouvé cette illustration qui essaye de représenter la composition du Nutella de manière encore plus explicite.

Enfin plus récemment il est apparu qu’en outre le Nutella contenait du phtalate DEHP qui est une substance chimique qui permet d’augmenter la flexibilité des matières plastiques. Les phtalates sont des perturbateurs hormonaux qui provoquent des dérèglements induisant notamment la stérilité chez l’homme. Il est estimé que, dans les pays industrialisés, un homme produit deux fois moins de spermatozoïdes que n’en produisait son grand père au même âge. Les phtalates sont également soupçonnés d’être cancérigènes. En 2008, après avoir fait une étude sur le développement de testicules in vitro, l’INSERM a affirmé que les phtalates étaient « délétères pour la mise en place du potentiel reproducteur masculin dans l’espèce humaine ».
La Croix nous apprend qu’avec 26% de la consommation mondiale La France est championne du monde de la consommation de Nutella>. Je ne suis pas certain que nous devons nous enorgueillir de ce titre.
Pour ma part je crois, même si les arguments développés ci-avant peuvent présenter quelques intérêts, le problème que cela pose est avant tout notre enfermement dans le consumérisme.
Le consumérisme est très présent dans les mille premiers mots du jour.
Et le mot du jour du 4 avril 2017 s’efforçait d’en faire une synthèse. Mais le mot qui est allé le plus loin dans la dénonciation de cette pulsion incontrôlée est certainement la phrase du philosophe allemande Peter Sloterdijke :
«La liberté du consommateur et de l’individu moderne, c’est la liberté du cochon devant son auge. »
Nul besoin de nous enchainer pour que nous perdions notre liberté. Il suffit que la publicité et le comportement des autres nous fassent croire que c’est par notre consommation que nous sommes reconnus par nos pairs. Il y a même des messages subliminaux qui veulent nous faire croire que la consommation rend heureux.
Le mot du jour du 14 avril 2014 citait Annie Arnaux : «Je suis de plus en plus sûr que la docilité des consommateurs est sans limite.». Car bien entendu, le Nutella n’est pas indispensable à notre alimentation. Il n’est même pas bon pour la santé. Ce n’est donc pas un besoin vital qui pousse les gens à vouloir l’acheter. Ce sont d’autres mécanismes qui sont à l’œuvre : l’image du plaisir, le prestige de la marque, une publicité alléchante, une once de luxe par rapport à d’autres pâtes à tartiner moins prestigieuses (et probablement pas meilleurs pour la santé) et notre formidable addiction au sucre que des décennies de pratiques des professionnels de l’alimentaire ont su développer.
Au fait, Intermarché vient de récidiver avec des promotions sur les couches culottes pampers qui semblent aussi avoir déclenché des désordres.
<1009>
-
Mercredi 31 janvier 2018
« Vous vous étonnez que les autres aient encore quelque choses à dire quand vous avez fini de parler. »Philippe Meyer à propos de Valéry Giscard d’Estaing «Pointes sèches, page 118.»Cette phrase qui se trouve dans l’ouvrage cité, avait été initialement prononcée par Philippe Meyer lors du portrait qu’il réalisait de l’invité qui était reçu dans L’Heure de Vérité, émission politique de la télévision que les moins de 35 ans ne peuvent connaître puisqu’elle s’est achevée en 1995. Elle avait débutée en 1982.
En réalité, l’exergue est une antithèse à ce que je souhaite développer aujourd’hui dans ce mot du jour. Je me sens dans une disposition d’esprit totalement différente de celle de Valéry Giscard d’Estaing :
Je suis heureux et je trouve stimulant que les autres aient encore quelque chose à dire quand j’ai fini d’écrire.
Je suis donc très satisfait quand je lis les commentaires que certains font l’effort de poster sur le blog des mots du jour.
Je veux particulièrement remercier Daniel qui accompagne fidèlement beaucoup d’articles de ses remarques, observations et pensées.
J’ai aimé son commentaire au mot du jour récent : « C’était mieux avant » ?
« Si on remplace « c’était mieux avant » par « je comprenais mieux le monde d’avant » la réplique retrouve du sens. Je crois qu’il y a rien de plus déstabilisant que de ne pas comprendre le monde dans lequel on vit au regard de sa propre culture et de ses valeurs fussent-elles très relatives, ne pas savoir quel sera son avenir même très proche dans un contexte d’emballement du changement, d’entendre quotidiennement tout et son contraire… il y a largement de quoi masquer les bienfaits de la nouvelle société. »
Lucien a réalisé un commentaire sur ce même mot et son propos interpelle :.
« J’y étais aussi, et vraisemblablement j’ai peu de chance de participer à un avenir au-delà d’une dizaine d’années en étant optimiste.
Mais quand même ce qui est curieux, c’est que les partisans d’un futur différent (forcément différent si avant ce n’était pas mieux) nous proposent les solutions du dix neuvième siècle, avant les premières mises en pratiques des avancées sociales, comme si le progrès était dans la régression.
C’était tout de même mieux quand on ne licenciait pas à pleine porte au nom du progrès, quand on transformait les cochers pour les former en chauffeurs d’automobiles, ( beaucoup plus d’emplois à l’époque, la destruction créatrice à fond)
on nous dit, et je le crois, que le nombre de pauvres diminue globalement dans le monde, sur la base d’un seuil minimum, mais en même temps s’étend une grande pauvreté relative , telle que quelqu’un en France aujourd’hui, qui gagne sa vie en travaillant mais pas suffisamment pour être accepté dans une location , peut être amené à coucher dehors, ou dans sa voiture , ce qui est la même chose.
J’ai connu un temps ou on disait qu’il fallait aider les vieux dont les retraites était maigres, mais ils avaient au moins un toit,
même si leur logement n’était pas toujours de qualité.
J’aimerais que ce soit mieux maintenant ».
Michelle a répondu au mot du jour sur le « polygourouisme » et qui parlait un peu de Finkielkraut :
« Oui c’est intéressant cette posture qui consiste surtout à ne pas se fermer. Moi qui suis très éclectique et alors même que j’avais du mal avec certaines positions de Finkielkraut , j’écoute avec bq d’intérêt certaines de ces émissions « répliques » le samedi matin. En fait je me dis pour toi Alain qui cherche à penser le monde que » penser c’est avant tout penser contre soi » . Exercice difficile s’il en fut. »
Jean-Philippe a quant à lui relativisé l’importance que je pouvais donner au millième mot :
« Il est toujours étonnant de voir comment les multiples de 10 génèrent pour nous des dates anniversaires importantes. Le 1000ème mot n’est en soi pas le plus important, pas plus que le 927ème ou le 146ème. Mais c’est ainsi, nous associons aux multiples de 10 des moments de commémoration. Ce sont des jalons, des événements, des repères.
On compte en base 10 certainement du fait de nos 10 doigts. On pourrait compter en base 20 en comptant en plus nos doigts de pied. C’est certainement la base de numération des singes et c’était celle des celtes (quatre-vingt). Apparemment, au cours de l’évolution, on a perdu des doigts, on avait 7 doigts en sortant de l’eau, on aurait donc pu compter en base 14.
Dans certains domaines, on compte en base 60 (les minutes et les secondes), en base 20 (les sous) et en base 12 (les deniers, les mois, les heures). Dans d’autres civilisations, on a compté en base 5 (les grecs anciens). De fait, la base la plus logique est la base 2, la base des ordinateurs. Elle s’appuie sur les notions de logique (vrai et faux). Par extension, les bases 8 et surtout16 (hexadécimal) sont des bases de référence pour l’informatique. Dans le monde numérisé vers lequel nous courrons à grand pas, il faudrait fêter le 1024ème mot. Pour information, 1024 correspond à 2^10 octets, soit un kilo octets, la base de mesure de la mémoire informatique. 1024 c’est 400 en hexadécimal, ou 10 000 000 000 en binaire (soit 10 zéros). Il faudrait peut être aussi penser à viser le 1000ème (en hexadécimal) mot , c’est à dire le 4096ème (en décimal) mot, cela nous laissera le plaisir de lire encore plus de mots. »
Fabien a justement réagi au millième mot : « Venue du cœur… »
« Essayer de comprendre la complexité du monde et de l’humain. « Essayer » est le terme juste car il n’y a pas de compréhension définitive possible où en d’autres termes le « sujet » ne peut par définition être épuisé . Nous sommes donc conviés de par notre condition et si nous en avons le désir à un cheminement parsemé de retours, de détours et d’imprévus. Oui il peut y avoir une certaine « vanité » au sens étymologique du terme, à vouloir progresser dans cette voie, MALRAUX fait dire à un personnage de la Condition Humaine que « connaître par l’intelligence est la tentation vaine de se passer du temps », ce à quoi Nietsche aurait pu répondre que « seuls les lambins de la connaissance se figurent qu’il faut du temps pour connaître » (Le Gai Savoir) .
Dans tout cela n’oublions pas la part occupée par nos instincts, nos expériences, nos passions et plus largement par nos affects, parts d’ombre et de lumière consubstantielles à notre être et à notre devenir et qui ont leur pleine part dans nos goûts, nos idées et nos aspirations.
Aussi transmettre et partager ce que l’on aime, ce que l’on découvre c’est transmettre qu’on le veuille ou non un peu de soi-même. »
Philippe a réagi au mot de Pablo Servigné : « Mais je suis persuadé qu’on arrive dans l’âge de l’entraide parce que ce sont les plus individualistes qui crèveront les premiers. » :
« Nos grandes métropoles nous donnent l’illusion qu’in vivre (nombreux) ensemble harmonieux est possible. Il reste un fond d’artificiel par l’éclatement geographique des structures affectives , famille ou amis éloignés … on se côtoie dans les bus, la rue, en ignorant au mieux ceux qui y dorment, ou y quémandent une solidarité perdue …. on a même du mal à se trouver un créneau pour partager un repas !!
On a tous envie de son village en Ardèche …
Sauf à retrouver la force de le bâtir ici. »
C’est aussi à l’entraide mais dans la phrase de Pierre Kropotkine, « Et de nos jours encore, c’est dans une plus large extension de l’entraide que nous voyons la meilleure garantie d’une plus haute évolution de notre espèce. » qu’Etienne réagissait :
« Mais la question qui demeure irrésolue est celle du périmètre de cette entraide sauf bien entendu à rester au niveau des principes » Je ne dirais pas que la question du périmètre est irrésolue. Il y a d’abord une loi naturelle, que l’entraide est proportionnelle au degré de proximité (clan, ami, famille, couple mère-enfant.) Mais elle peut s’en affranchir (exemples des sauvetages inter-espèces).
Et chez l’homme, l’entraide est une réalité. Voir ONG, Emmaüs, suites de tsunami, téléthon, comportements des gens en cas d’accident, de catastrophes… »
Et bien d’autres, je ne peux les citer tous, j’ai plutôt choisi les plus récents.
En tout cas merci pour tous ces enrichissements, ces questionnements, ces critiques positives qui permettent d’avancer et de faire la chose la plus essentielle pour progresser : douter..
Surtout continuez et n’hésitez pas à en mettre davantage encore.
Quelquefois j’en ajoute moi-même, comme celui-ci pour compléter le mot du jour : Nous devrions tous être féministe, après le fait divers qu’on continue à appeler le meurtre de la joggeuse.
Les commentaires font partie du blog et constituent un enrichissement de celui-ci.
<1008>
-
Mardi 30 janvier 2018
« Un environnement de terrorisme sexuel »Natalie PortmanSi en France, le ralliement des femmes contre le comportement des hommes s’est fait autour du hashtag « balance ton porc », les américains utilisent « #Metoo » c’est-à-dire « moi aussi ».
Ce mouvement s’est étendu en Chine. C’est la revue de presse assurée par Claude Askolovitch sur France Inter qui renvoie vers un article du Monde :
C’est à lire dans LE MONDE, « Les universités chinoises gagnées par le hashtag metoo ». En chinois, ça donne « wo ye shi » et si, dans un tout premier temps, les témoignages se sont faits rares, ils se multiplient désormais sur les réseaux sociaux chinois. Il s’agit donc d’étudiantes, des jeunes filles qui ont le courage de parler, et qui racontent les agressions sexuelles et les viols qu’elles ont subis au sein de leurs établissements. Ce sont, pour l’essentiel, des professeurs qu’elles accusent.
Une soixantaine d’universités serait concernée. Et certains estiment qu’on assiste ici à l’émergence d’un important mouvement féministe, le plus grand que la Chine n’ait jamais connu…
Mais c’est à un évènement des Etats-Unis que je voudrais revenir.
Le 21 Janvier 2017, quelques heures après l’investiture de Donald Trump, des centaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues du monde entier. A New York, Washington, Los Angeles, Portland, Chicago, etc ces manifestants voulaient protester contre les propos et l’attitude sexiste de Trump. On a appelé cela <la Marche des femmes>.
Il semblerait que cette manifestation devienne un évènement annuel. En effet, il y eut une nouvelle « women march » le samedi 20 janvier 2018, portée par le mouvement #Metoo. La plus importante manifestation a eu lieu à Los Angeles, deuxième ville du pays, avec quelque 600 000 manifestants, a tweeté le maire démocrate Eric Garcetti.
Plusieurs personnes ont pris la parole et le discours qui a suscité le plus d’intérêt fut celui de Natalie Portman.
Peut-être qu’il faut rappeler que Natalie Portman, née en 1981 à Jérusalem, est une actrice israélo-américaine. Wikipedia nous apprend qu’elle est née Natalie Hershlag. Elle est devenue très célèbre en interprétant, dans la saga de Star Wars, le rôle de la reine Padmé Amidala. Mais elle fait ses débuts au cinéma en 1993, à douze ans, en interprétant le rôle de Mathilda dans le film Léon de Luc Besson, aux côtés de Jean Reno.
L’introduction de son discours est consacrée aux conséquences pour elle de ce film.
La vidéo du discours de Natalie Portman se trouve derrière ce lien : <Discours de Natalie Portman Woman march>
Et voici le début de ce discours :
« J’ai eu 12 ans sur le plateau de mon premier film Léon […] Je découvrais moi aussi ma propre féminité, mes propres désirs et ma propre voix.
J’étais tellement enthousiaste à 13 ans quand le film est sorti, que mon travail et ma performance artistique touche le public.
J’ai ouvert avec enthousiasme ma première lettre de fan : un homme m’écrivait qu’il rêvait de me violer.
Une radio locale a organisé un décompte des jours jusqu’à mon 18e anniversaire, date à laquelle ça deviendrait légal de coucher avec moi.
Les critiques de cinéma faisaient référence à ma poitrine naissante. J’ai rapidement compris, même à l’âge de 13 ans, que si je m’exprimais sexuellement, je ne me sentirais pas en sécurité et que les hommes se sentiraient autorisés à discuter et considérer mon corps comme un objet, quitte à me rendre mal à l’aise […]
J’ai rejeté tous les rôles où il y avait ne serait-ce qu’une scène de baiser. Je faisais exprès de parler de ces choix dans les interviews, je mettais surtout en valeur mon côté sérieux. Je faisais attention à être élégante, je me construisais la réputation d’être quelqu’un de prude, conservatrice, cultivée, geek, sérieuse […]
Face à ces petits commentaires sur mon corps, face à des déclarations délibérées et menaçantes, je me suis imposée de contrôler mon comportement dans un environnement de terrorisme sexuel »,
Elle conceptualise le message que lui a envoyé le monde du réel à l’enfant de 13 ans qu’elle était :
« A seulement 13 ans, la société m’envoyait un message clair. J’ai ressenti le besoin de cacher mon corps et d’inhiber mes propos et mon travail. Tout ceci dans le but d’envoyer mon propre message au monde : que j’étais quelqu’un qui méritait la sécurité et le respect ».
Je trouve le terme de « terrorisme » particulièrement bien choisie. Le terrorisme a pour objet de créer un climat de terreur, de peur qui paralyse.
Dans beaucoup de témoignages, on ne comprend pas certaines réactions de femmes qui justement sont tétanisées par leur prédateur sexuel, non seulement en raison de ce monstre mais aussi d’un environnement qui tolère cela et qui quelque part ne dit pas : « Ceci est anormal ».
Brigitte Bardot qui fut un temps l’égérie de la liberté sexuelle des femmes critique la dénonciation du harcèlement sexuel dans le monde du cinéma français :
« Concernant les actrices, et pas les femmes en général, c’est, dans la grande majorité des cas, hypocrite, ridicule, sans intérêt. […] Il y a beaucoup d’actrices qui font les allumeuses avec les producteurs pour décrocher un rôle. Ensuite, pour qu’on parle d’elles, elles viennent raconter qu’elles ont été harcelées… »
Peut-être que certains d’entre vous approuvent ces propos
Peut-être même est-ce vrai dans certains cas.
Mais alors je vous pose la question : « Qui assume la responsabilité la plus importante ? la jeune fille qui aspire à devenir actrice ou l’homme de pouvoir installé qui profite de sa position dominante, de faire ou défaire des carrières et qui s’inscrit dans un environnement où seul le désir masculin compte et que la femme n’est qu’objet qui participe à cette recherche du plaisir égoïste.
Vous comprendrez que mon opinion n’est pas de condamner les jeunes actrices qui ne disposent pas du réseau ou des intermédiaires d’influence pour accéder à l’accomplissement de leur objectif artistique mais de m’élever contre les mâles dominants qui profitent, abusent, salissent.
Ce que j’aime chez Chimamanda Ngozi Adichie, cité vendredi et Natalie Portman c’est leur discours sur le désir et le plaisir partagé.
Natalie Portman, dans le discours du 20 janvier 2018, s’insurge contre les critiques qui voudraient enfermer la parole des femmes dans le puritanisme, la pruderie, alors que la demande est simplement celui d’un désir partagé, d’un plaisir réciproque, d’une écoute de l’un envers l’autre.
Elle rêve d’un monde
« dans lequel je pourrais m’habiller comme je le veux, dire ce que je veux et exprimer mes désirs de la façon dont je le souhaite, sans craindre pour ma sécurité physique ou ma réputation : voilà ce que serait le monde dans lequel le désir des femmes et leur sexualité pourraient s’exprimer pleinement »,
C’est donc à « une révolution du désir » qu’appelle Natalie Portman comme le fait aussi Chimamanda Ngozi Adichie.
Car tous ceux qui veulent couvrir que ce soit les extrémistes islamiques dans la démesure, que ce soit les bourgeois occidentaux dans ce qu’ils appellent la décence et qui disent « elle l’a bien cherchée » sont prisonniers d’un schéma où le désir masculin est premier et souvent excusable.
Alors qu’« un homme ça s’empêche ou alors ce n’est pas un homme ».
Mais un monde où le désir est réciproque, partagé et consenti est un monde où la civilisation a beaucoup progressé.
<1007>
-
Lundi 29 janvier 2018
« Faire de la musique ensemble »Réflexions personnelles sur un week-end musicale et sur la musique en général.Qu’écrire comme mot du jour pour le lundi quand on a passé le week-end à l’auditorium de Lyon pour écouter de la musique, samedi soir, dimanche à 16 heures et même le mercredi précédent où j’ai eu la chance d’assister entre 20 heures et 22 heures 30 à la répétition du concert de samedi ?
Parler des émotions et de musiciens qui jouent ensemble et créent de la beauté.
J’avais déjà consacré un mot du jour à une artiste exceptionnelle : Hillary Hahn, le 19 mai 2017.
Et c’est une autre soliste exceptionnelle, la violoncelliste Sol Gabetta qui s’est associée au chef Alan Gilbert pour réaliser un concert d’une qualité rare.
Il y a un domaine où le « c’était mieux avant » est manifestement totalement faux, c’est la qualité des musiciens classiques et des orchestres.
Les orchestres d’aujourd’hui sont techniquement bien meilleurs que ceux d’hier. L’Orchestre de Lyon n’échappe pas à cette règle.
Bien sûr il faut un catalyseur.
Souvent on pose la question, mais à quoi cela sert un chef d’orchestre ?
Celles et ceux qui se sont trouvés à l’Auditorium samedi et ont entendu l’Orchestre de Lyon, son engagement, la profondeur de la respiration musicale, la chaleur des cordes, la qualité des bois et l’éclat des cuivres, ne se posent pas la question, un grand chef d’orchestre sert à ce que l’Orchestre se dépasse et sonne comme il n’a jamais sonné.
Ce fut le cas de la magnifique 3ème symphonie de Brahms dirigé par Alan Gilbert.
Le troisième mouvement de cette œuvre doit être connu par le plus grand nombre car elle a souvent été utilisé hors des circuits classiques par exemple dans le film « Aimez-vous Brahms » d’Anatole Litvak., et aussi dans la chanson de Serge Gainsbourg, Baby Alone in Babylone, par Yves Montand pour Quand tu dors près de moi, par Frank Sinatra pour Take My Love.
Alan Gilbert fut le directeur du New York Philharmonic pendant 9 ans.
Les mélomanes du monde entier connaissent la qualité des orchestres états-uniens et distinguent ceux qu’on appelle les fameux Big Five (les Cinq Grands): Chicago, New York, Cleveland, Boston, Philadelphie. Depuis quelques années le Los Angeles Philharmonic tente d’entrer dans ce cercle fermé.
 Avant Alan Gilbert , ce poste au New York Philharmonic fut occupé par Gustav Mahler, Arturo Toscanini, Bruno Walter, Léonard Bernstein, Pierre Boulez, Lorin Maazel. Même si vous n’êtes pas très connaisseur vous devriez être impressionné. Aucun chef n’a jamais été nommé sur ce poste sans avoir été précédé d’une solide réputation.
Avant Alan Gilbert , ce poste au New York Philharmonic fut occupé par Gustav Mahler, Arturo Toscanini, Bruno Walter, Léonard Bernstein, Pierre Boulez, Lorin Maazel. Même si vous n’êtes pas très connaisseur vous devriez être impressionné. Aucun chef n’a jamais été nommé sur ce poste sans avoir été précédé d’une solide réputation.
Alan Gilbert était pour les mélomanes du monde entier, un total inconnu au moment de sa nomination en 2009, à 42 ans.
Tout au plus savait-on que ses deux parents avaient été musiciens dans l’Orchestre et au moment de sa nomination, sa mère était toujours membre de l’orchestre. Il est probable que c’est la première fois de l’Histoire de la musique que le directeur musical d’un des plus grand orchestre symphonique du monde dirige sa mère.
Mais ceux qui l’ont choisi, ne se sont pas trompés.
Après cette symphonie, la solaire Sol Gabetta a interprété le très difficile concerto N°1 de Martinu avec une aisance et une flamboyance qui laisse pantois.
Et puis, dimanche l’immense soliste Sol Gabetta et le grand chef d’orchestre sont descendus de leur podium, pour interpréter avec 4 autres musiciens de l’Orchestre un autre chef d’œuvre le premier sextuor de Brahms.
Encore une œuvre qui a été utilisé comme musique de film dans Les Amants de Louis Malle.
Ils ont alors simplement fait de la musique ensemble, et le chef d’orchestre a pris modestement la place de second altiste.
La répétition s’était déroulée dans cette même ambiance que je décrirai par cette phrase : faire de la musique ensemble.
Il y a une précision que je n’ai pas donnée jusqu’ici c’est que la violon solo de l’orchestre de Lyon est Jennifer Gilbert, la sœur d’Alan Gilbert.
Quelques liens :
Vous trouverez derrière ce lien, la 3ème symphonie de Brahms interprétée par Alan Gilbert et le New York Philharmonic
<Le troisième mouvement du sextuor à cordes de Brahms>
Ce concert à Berlin a été enregistré et il est possible d’acquérir le CD du live :
<1006>
-
Vendredi 26 janvier 2018
« We should all be feminists Nous devrions tous être féministes ! »Chimamanda Ngozi AdichieHier nous parlions de lynchage. Pour lutter contre les violences faites aux femmes, des personnes égarées ont agi de manière désordonnée et violente engendrant d’autres injustices.
Mais ces excès, ces dévoiements ne changent rien au fond : une terrible violence s’exerce à l’égard du féminin, depuis des siècles, dans toutes les régions et cultures du monde, dans tous les milieux sociaux et professionnels.
Ce sujet de l’injustice et de violence à l’égard des femmes est omniprésent dans mes mots du jour.
J’ai consacré d’abord, début 2016 une série de cinq mots du jour à <La violence faite aux femmes dans l’espace public> à la suite de la vague d’agressions délinquantes pour voler mais aussi à caractère sexuel contre des femmes qui avait été perpétrée dans la ville de Cologne le 31 décembre 2015.
Bien des fois, par la suite je suis revenu sur cette fracture fondamentale de nos sociétés que beaucoup peinent à admettre, à voir et à comprendre.
C’est d’abord dans les mots.
<Dans une vidéo d’une minute Catherine Arditi le montre de manière évidente>
Il suffit de comparer les substantifs dans leur version masculine et dans leur version féminine :
- Un courtisan, c’est un homme que l’on voit auprès du roi. Une courtisane ? C’est une prostituée.
- Un entraîneur est valorisé, une entraineuse ? C’est une prostituée.
- Un professionnel, c’est un homme qui connaît son métier. Une professionnelle ? C’est une prostituée.
- Un homme facile, c’est un homme agréable à vivre, une femme facile ? C’est une prostituée.
- Un homme public, c’est un homme connu, une femme publique ? C’est une prostituée.
Nul ne peut penser que ces différences soient le fruit d’un hasard malencontreux.
Mais si les mots traduisent une oppression, un état de fait, ils peuvent aussi être le remède. Les outils qui dévoilent, qui racontent, qui expliquent et qui font progresser.
C’est l’espoir de Chimamanda Ngozi Adichie qui est une écrivaine nigériane, née en 1977.
<Elle est intervenue dans l’émission La grande Table d’hier>
Dans cette émission elle a donné cette définition du féminisme que je partage :
« C’est permettre à chacun de vivre comme un individu à part entière. C’est élever les petits garçons pour qu’ils deviennent des êtres humains, pas des « vrais hommes » »
<Elle était invitée le même jour dans une émission de France Inter>
Elle était de passage à Paris parce qu’elle a été désignée comme marraine de « La nuit des idées » qui est ce rendez-vous dédié à la pensée contemporaine et au partage international des idées initiée par l’Institut français et qui réunit intellectuels et chercheurs. Cette année, le 25 janvier, la troisième édition était consacrée à « L’imagination au pouvoir ».
<L’express l’a également interviewé>
Parce que cette femme africaine est devenue une icône mondiale du féminisme depuis qu’en décembre 2012 elle a prononcé une conférence TEDx, d’une remarquable consistance qui ressemble un peu pour les femmes au discours que Martin Luther King a prononcé pour les noirs « I have a dream ».
La parole qu’on a retenue de cette conférence est celle que j’ai mise en exergue.
Sur Internet, on apprend qu’elle intervient dans l’album de Beyoncé en 2013 sur le titre Flawless dans lequel une partie de son discours We should all be feminists est utilisé.
Vous trouverez une traduction française de cette conférence derrière ce <Lien>
Et si vous préférez l’écouter en version originale en anglais : We shouls all be feminists. Cette version est sous-titrée en français.
Je n’en tire que quelques extraits, mais je pense qu’il est sage de lire l’intégralité de ce discours :
« Les hommes et les femmes sont différents. Nous avons différentes hormones, différents organes sexuels, différentes capacités biologiques. Les femmes peuvent enfanter, pas les hommes. En tout cas pas encore.
Les hommes ont de la testostérone et sont en général plus forts que les femmes. Il y a un peu plus de femmes que d’hommes dans le monde, environ 52% de la population mondiale sont des femmes. Mais la plupart des positions de pouvoir et prestige sont occupées par des hommes. La défunte lauréate kenyane du prix Nobel de la paix, Wangara Maathai, l’a bien dit de façon simple : « Plus vous allez haut, moins il y a de femmes. » […]
De façon littérale, les hommes dirigent le monde et cela avait du sens il y a 1 000 ans car les êtres humains vivaient alors dans un monde où la force physique était l’attribut le plus important à la survie. Une personne plus forte physiquement avait plus de chances de diriger et les hommes, en général, sont plus forts physiquement. Bien sûr, il y a beaucoup d’exceptions.
Mais nous vivons aujourd’hui dans un monde très différent. La personne ayant le plus de chances de diriger n’est pas la plus forte physiquement ; c’est la plus créative, la plus intelligente, la plus innovante et il n’y a pas d’hormones pour ces attributs. Un homme a autant de chances qu’une femme d’être intelligent, d’être créatif, d’être innovant. Nous avons évolué, mais il semble que nos idées du sexe n’ont pas évolué.
[…]
 Je suis en colère. Le sexe tel qu’il fonctionne aujourd’hui est une grave injustice. Nous devrions tous êtes en colère. Ma colère a une longue tradition d’entraîner le changement positif, mais en plus d’être en colère, j’ai aussi espoir. Car je crois profondément en la capacité des êtres humains à s’inventer et se réinventer pour le meilleur.
Je suis en colère. Le sexe tel qu’il fonctionne aujourd’hui est une grave injustice. Nous devrions tous êtes en colère. Ma colère a une longue tradition d’entraîner le changement positif, mais en plus d’être en colère, j’ai aussi espoir. Car je crois profondément en la capacité des êtres humains à s’inventer et se réinventer pour le meilleur.
Le sexe compte partout dans le monde, mais je veux me concentrer sur le Nigeria et sur l’Afrique en général car c’est ce que je connais et c’est là que mon cœur est. Aujourd’hui, j’aimerais demander à ce que nous commencions à rêver et prévoir un monde différent, un monde plus juste, un monde d’hommes et de femmes plus heureux et plus eux-mêmes. Voici comment démarrer : nous devons élever nos filles différemment. Nous devons aussi élever nos fils différemment. Nous faisons beaucoup de tort aux garçons en les élevant ; nous étouffons l’humanité des garçons. Nous définissons la masculinité de façon très étroite, elle devient cette petite cage rigide et nous mettons les garçons dans cette cage. Nous apprenons aux garçons à craindre la peur. Nous apprenons aux garçons à craindre la faiblesse, la vulnérabilité. Nous leur apprenons à cacher qui ils sont vraiment car ils doivent être, comme on le dit au Nigeria, « des hommes durs ! » Au collège, un garçon et une fille, tous deux adolescents, ayant tous deux autant d’argent de poche, sortiraient et on s’attendrait à ce que le garçon paye toujours pour prouver sa masculinité. Et on se demande pourquoi les garçons risquent plus de voler leurs parents.
Et si les garçons et les filles étaient élevés pour ne pas lier l’argent à la masculinité ? Et si l’attitude n’était pas « le garçon doit payer » mais plutôt « celui qui a le plus d’argent doit payer » ? Bien sûr, du fait de cet avantage historique, ce sont surtout des hommes qui auront plus d’argent, mais si nous commençons à élever nos enfants différemment, dans 50 ou 100 ans, les garçons n’auront plus la pression de devoir prouver leur masculinité. De loin la pire chose que nous faisons aux hommes, en leur donnant l’impression de devoir être durs, est de les laisser avec des egos très fragiles. Plus un homme croit devoir être « dur », plus son ego est faible.
Nous faisons encore plus de tort aux filles car nous les élevons pour restaurer l’ego fragile des hommes. Nous apprenons aux filles à se rétrécir, à se diminuer, nous disons aux filles : « Tu peux avoir de l’ambition, mais pas trop. »
« Tu devrais avoir pour objectif de réussir, mais pas trop sinon tu menacerais l’homme. » Si tu es le gagne-pain dans ta relation avec un homme, tu dois prétendre ne pas l’être, surtout en public, sinon tu vas l’émasculer. Et si nous remettions en question le postulat ? Pourquoi le succès d’une femme devrait-il menacer un homme ? Et si nous décidions de nous débarrasser de ce mot ? Je ne crois pas qu’il y ait un mot que j’apprécie moins qu’« émasculation ».
[…]
Au Nigeria, les hommes et les femmes diront — c’est une expression qui m’amuse beaucoup — « Je l’ai fait pour avoir la paix dans mon mariage. » Quand les hommes le disent, il s’agit en général de quelque chose qu’ils ne sont pas censés faire.
Ils le disent parfois à leurs amis, ils le disent à leurs amis d’une façon profondément exaspérée, qui, ultimement, prouve leur masculinité, qu’ils sont nécessaires, aimés. « Ma femme m’a dit de ne pas sortir tous les soirs. Pour la paix dans mon mariage, je ne sors que le week-end. »
Quand une femme dit « Je l’ai fait pour avoir la paix dans mon mariage », elle parle souvent de laisser tomber un emploi, un rêve, une carrière. Nous apprenons aux femmes que dans les relations, les femmes font des compromis. Nous apprenons aux filles à se considérer comme rivales — pas pour un emploi, des accomplissements, ce qui peut être positif, mais pour l’attention des hommes. Nous leur apprenons qu’elles ne peuvent pas être sexuées comme les garçons. Avoir connaissance des copines de nos garçons n’est pas gênant. Mais les copains de nos filles ? Dieu nous en préserve.
[…]
Je veux être respectée dans toute ma féminité parce que je le mérite. Le sexe n’est pas une conversation facile. Pour les hommes et les femmes, aborder le sexe est parfois reçu avec une résistance immédiate.
[…]
Je suis une féministe. Quand j’ai cherché le mot dans le dictionnaire ce jour-là, voici ce que cela disait : « Féministe : une personne qui croit en l’égalité sociale, politique et économique des sexes. » Mon arrière-grand-mère, de ce que j’en ai entendu, était une féministe. Elle a fui la maison de l’homme qu’elle ne voulait pas épouser et a fini par épouser l’homme de son choix. Elle a refusé, protesté, s’est exprimée quand elle se sentait privée d’un accès, d’un terrain, ce genre de choses.
Mon arrière-grand-mère ne connaissait pas le mot « féministe » mais cela ne veut pas dire qu’elle n’en était pas une. Nous devrions être plus nombreux à reconquérir ce mot. Ma propre définition de féministe est : « Un féministe est un homme ou une femme qui dit : « Oui, il y a actuellement un problème avec le sexe et nous devons y remédier. Nous devons faire mieux. » Le meilleur féministe que je connais est mon frère Kene. C’est aussi un homme gentil, beau et adorable et il est très masculin. »
Chimamanda Ngozi Adichie est une femme d’une intelligence rare, d’une humanité irradiante.
Dans l’émission de France Inter elle a dit :
« Aux garçons […] Il faut donner les mots de l’émotion, il faut les autoriser à être vulnérable. »
On a appris aux jeunes garçons : « Sois un homme », ce qui signifie : « Ne pleure pas, ne montre pas ton émotion ».
Alors qu’il faudrait leur apprendre les mots du Père de Camus : « Un homme ça s’empêche ».
Et dans cette expression, l’homme signifie « l’humain », pas seulement les mâles de l’espèce
Chimamanda Ngozi Adichie dispose d’un site internet : https://www.chimamanda.com/
<1005>
- Un courtisan, c’est un homme que l’on voit auprès du roi. Une courtisane ? C’est une prostituée.
-
Jeudi 25 janvier 2018
« Le premier porc »La journaliste Sandra Muller désignant ainsi Eric Brion pour inaugurer un hashtag qui va avoir une énorme résonance sur les réseaux sociaux.Le 13 octobre 2017, j’avais poussé l’égocentrisme jusqu’à écrire comme mot du jour « un anniversaire » et à disserter sur cet évènement annuel le jour de mes 59 ans. Mais mon mot du jour n’enflamma pas les réseaux sociaux.
En revanche, le 13 octobre 2017 fut le jour de naissance du hashtag « balance ton porc », ce qui s’écrit sur les réseaux sociaux de la manière suivante « #balancetonporc » qui lui parvint à cette fin.
C’est la journaliste Sandra Muller qui l’a créé sur twitter. Avec #balancetonporc, elle souhaitait encourager les femmes victimes de harcèlement sexuel à dénoncer leur agresseur.
Mais pour inaugurer ce nouveau concept, il fallait qu’elle en désigne un.
Et c’est ainsi qu’il y eut un premier porc sur les réseaux français.
L’hebdomadaire « Le Point » s’est intéressé à ce « phacochère domestique » et a publié un article « L’édifiante histoire du premier « porc » »
En effet, ce premier porc possède un nom social et patronymique : « Brion » et un prénom « Eric »
Je vous propose dans ce mot du jour de vous intéresser à ce porc et même, peut être, avoir de la compassion pour lui.
Nous sommes donc le 13 octobre et tous les médias parlent de l’affaire Weinstein et de ses suites.
On parle de la libération de la parole des femmes et des comportements inacceptables des hommes à l’égard des femmes, dans tous les milieux sociaux et professionnels.
Beaucoup disent, à juste titre, qu’il faut que ça cesse !
Dans ce contexte, la journaliste Sandra Muller prend une initiative sur twitter :
- Elle invente le hashtag « balance ton porc »
- Désigne son porc : Eric Brion
- Et raconte ce que ce porc a fait : il lui a dit un soir, alors qu’il était éméché : « Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit. ». Ce qui n’est ni élégant, ni fin, ni malin, ni bienveillant, ni rien …seulement très vulgaire.
- Puis toujours avec ce hashtag « #balancetonporc » elle invite celles qui la lise de faire de même : « toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends »
Cette invitation aura un grand succès, la parole sera libérée, totalement libre, follement libre.
Le mot du jour du 17 novembre 2017 aura pour exergue : « C’est l’époque qui veut ça. ». Cette Réflexion est la réponse d’une journaliste qui avait réclamé avec insistance à Nicolas Bedos de lui donner le nom d’un homme ayant dérapé un jour avec une femme, devant le refus et même l’agacement de ce dernier.
Le porc en question, le 13 octobre, est en train d’accrocher guirlandes et ballons pour l’anniversaire de sa fille cadette quand un ami lui signale le tweet. Le Point raconte alors :
« Tout à son joyeux événement familial, Brion ne prête au départ à l’affaire qu’une attention distraite… Puis, les heures passant, il découvre peu à peu, abasourdi, les innombrables reprises sur Twitter, sur Facebook, les insultes qui commencent à pleuvoir et il mesure enfin, avec effroi, la force inouïe de l’emballement viral. La machine est en route, impossible à stopper. Il contacte Sandra Muller, sans succès. Peine à se souvenir de la date exacte du cocktail cannois durant lequel, ivre, il lui tint ces propos. « Je sais seulement que nous avions ensuite échangé sur Messenger et que, désolé, je lui avais présenté mes excuses », dit-il dans le café où il a accepté, après mille réticences, de nous rencontrer, exigeant que la conversation soit enregistrée. « Cela va sans doute passer, mais je suis pour le moment dans un état de grande paranoïa. Je ne veux pas que mes phrases soient détournées, transformées. »
Et le Point décrit le déchainement contre cet homme qui un jour, ivre, a été grossier et stupide. Il lui donne la parole :
« Durant ces quelques semaines où cette affaire a tourné en boucle partout, seuls deux médias ont pris la peine de m’appeler pour avoir ma version des faits. Il était pourtant facile de vérifier certaines informations, comme le fait que je n’avais jamais travaillé avec Sandra Muller. Certains ont été prudents, mais beaucoup ont donné mon nom ou m’ont désigné par mes anciennes fonctions, ce qui me rend aisément reconnaissable. Quoi que je fasse, la « tache » est là, donc… » Des photos de lui grimé en porc circulent, Éric Brion voit commenter son physique ou ses capacités sexuelles dans des tweets ou des posts Facebook qui n’ont pas grand-chose à envier, sur l’échelle de la vulgarité, à ses propres propos. ll s’astreint, malgré la colère, à ne pas répondre, à ne pas entrer dans la mêlée délirante des réseaux sociaux, et ne publie qu’un droit de réponse, le 16 novembre, dans L’Obs, qui l’avait à tort désigné un mois plus tôt comme l’« ancien patron » de Sandra Muller. « De toute façon, quoi que je dise, cela allait se retourner contre moi. Et, pour ma famille, je ne voulais pas m’exposer plus encore. »
À poil devant le monde entier, devant ses proches, surtout, qui ont brutalement accès à cette part de lui-même, sa sexualité, qu’on ne dévoile évidemment jamais en famille, il n’ose bouger de peur de focaliser à nouveau l’attention sur lui et assiste impuissant à son lynchage virtuel. Il est nu devant sa sœur. Ses vieux parents. Ses deux filles, qu’il tente comme il peut de préserver de cette violence symbolique terrible que peut constituer l’exposition aux détails d’une sexualité paternelle. « J’ai tout de suite pensé à ses filles, dit son amie la productrice Alexia Laroche-Joubert. Je connais suffisamment de cas autour de moi pour savoir que le harcèlement sexuel est une réalité et pour approuver que la parole des femmes se libère. Mais pas comme ça. Les propos d’Éric sont d’une incroyable goujaterie, mais Sandra Muller et lui n’avaient aucun lien de dépendance professionnelle. Et puis, dans un tribunal, on peut se défendre, mais Twitter, ce sont des armées invisibles contre lesquelles on ne peut rien. »
Cette campagne contre lui va avoir des conséquences immédiates :
« À l’automne 2017, après une carrière à France Télévisions puis au PMU et à la tête de la chaîne Equidia, Éric Brion était consultant indépendant pour plusieurs médias, en même temps qu’en recherche d’emploi. À partir du 13 octobre, une à une, les trois missions qu’il menait ont été annulées ou non reconduites : il n’a plus de travail. Il était membre d’un jury : son nom en a été radié. Peu à peu, tous les rendez-vous programmés dans le cadre de sa recherche d’emploi ont été, les uns après les autres, annulés ou reportés sous divers prétextes. Il a 51 ans et son agenda est vide. Il dort mal. Ne sait plus comment envisager son avenir professionnel. Se mord les lèvres en évoquant la manière dont ses vieux parents ont été touchés par cette affaire. « Je suis bien entouré, j’ai eu la chance de pouvoir partir à l’étranger pour prendre du recul, mais songe-t-on à l’effet que peut produire ce genre de déferlement sur une personnalité fragile ? Je me suis beaucoup interrogé sur moi. »
Le journaliste du Point précise deux éléments, essentiels :
- Éric Brion n’a jamais travaillé avec Sandra Muller, ce qui rend le rapprochement de ses propos avec l’affaire Weinstein littéralement hors sujet.
- Et il n’a pas réitéré ses avances, stoppant net aussitôt que Sandra Muller lui signifia son refus, contexte qu’elle-même ne nie pas et qui rend là encore l’idée d’un « harcèlement » sujet à caution. Pourtant, sur les sites d’information de la plupart des grands médias qui reprennent le tweet, ces précisions utiles sont passées à la trappe. « Cela fait vingt-cinq ans que je travaille dans les médias mais je ne suis pas journaliste, et loin de moi l’idée de donner des leçons d’éthique journalistique ni surtout de me faire passer pour une victime. Mais j’ai tout de même été surpris…
Sandra Muller a été adoubée « silent breaker » (briseuse de silence) par Time en décembre, reçue par la ministre Marlène Schiappa, Sandra Muller, dont le mouvement a pris une ampleur considérable et qui est en train de déposer les statuts d’une association d’aide aux victimes, justifie a posteriori le fait d’avoir donné le nom d’Éric Brion par le nombre de témoignages similaires le concernant reçus par la suite.
« Si je ne l’avais pas fait, personne n’aurait osé le signaler, s’emporte-t-elle. J’ai levé un lièvre. »
Lever un lièvre, c’est un terme de chasse, non de justice.
Un combat peut être juste et pourtant se pervertir dans des batailles incertaines et nauséabondes qui le salissent tout en faisant de grands dégâts et en semant, à la fin, l’injustice.
Un des livres de chevet d’Eric Brion est « La tâche » de Philip Roth dont Marc, dans un message privé, m’a dit le plus grand bien après le mot du jour qui évoquait ce grand auteur américain.
<1004>
- Elle invente le hashtag « balance ton porc »
-
Mercredi 24 janvier 2018
« Qu’est-ce qui s’était passé depuis dix ans pour qu’il y ait soudain tant de choses à dire, à dire de si urgent que çà ne pouvait pas attendre ? »Philip Roth, dans son livre « Exit le Fantôme »J’évoquais dans le millième mot ma perception de l’incommensurabilité de mon ignorance. Philip Roth est selon plusieurs commentateurs un des plus grands écrivains vivants, or je n’ai jamais rien lu de cet auteur.
C’est encore Alain Finkielkraut qui a cité à deux reprises un extrait d’un de ses livres : « Exit le Fantôme ».
Cet extrait évoque cet incroyable évolution de notre monde où tout le monde possède un téléphone portable et surtout où un nombre incroyablement important de personnes trouvent normal de téléphoner à tout moment et de révéler dans un bus, un métro un train ou même dans la rue des détails intimes qui ne regardent pas les autres. Et surtout qui quand les autres me ressemblent n’ont en strictement rien à faire et plus encore sont extraordinairement gênés de cette situation.
Comme je suis effaré quand je vois des parents pendus à leur téléphone, alors que leurs enfants qui leurs donnent la main n’ont qu’un souhait qu’ils reviennent dans la vraie vie, daignent les regarder et parler avec eux.
Je trouve l’invention du téléphone portable tout à fait utile et intéressant pour beaucoup de situations dans la vie. Mais pour autant cela ne m’empêche pas de constater les dérives et les conséquences fâcheuses d’une trop grande addiction à cet outil. J’ai évoqué ces sujets lors de plusieurs articles.
Lors du mot du jour Mardi 10 février 2015 je découvrais le mot «nomophobie » contraction de l’expression anglaise « no mobile phobia » qui correspond à la peur panique de se retrouver sans téléphone portable. J’évoquais l’étude d’un doctorant américain :
« Pendant un déjeuner avec une amie, Russell Clayton, doctorant à l’université du Missouri, a la surprise de voir sa convive le laisser précipitamment parce qu’elle a oublié son téléphone portable. Interloqué, il a l’idée de se pencher sur le sentiment de manque, voire de peur, qui habite certaines personnes lorsqu’elles sont séparées de ces petits objets devenus visiblement indispensables.
Dans une étude intitulée « The Impact of iPhone Separation on Cognition, Emotion and Physiology » (« L’impact de la séparation d’avec son mobile sur la cognition, l’émotion et la physiologie »), publiée le 8 janvier, Russell Clayton, doctorant à l’université du Missouri, s’étend sur cette « nomophobie » et arrive à deux conclusions :
- Le téléphone portable est devenu « une extension de nous-même », à la manière du sonar de certains animaux, si bien qu’on peut parler d’ «iSelf », de « soi connecté ». »
-
Privé de son mobile, la personne souffrant de « nomophobie » a l’impression d’avoir perdu une part d’elle-même, et cela « peut avoir un impact négatif sur ses performances mentales ».
Le mot du jour du Jeudi 20/10/2016 évoquait un livre du philosophe italien Maurizio <Mobilisation Totale ; L’appel Du Portable>, paru en août 2016 et où il arrivait à cette conclusion :
« Avoir le monde en main, [signifie à coup sûr] automatiquement aussi, être aux mains du monde »
Ce livre se penchait sur ce phénomène de société engendré par les smartphones qui est la connexion permanente au monde et montrait comment cette sollicitation permanente se transformait en dispositif de mobilisation asservissante.
Mais l’extrait du livre de Philip Roth que m’a fait découvrir Finkielkraut est encore plus explicite, en raison de la qualité de plume de l’écrivain américain.
En faisant des recherches sur Internet j’ai appris que dans plusieurs de ses romans on retrouve le même héros emblématique qu’on présente comme son double littéraire, Zuckerman.
Dans le livre « Exit le Fantôme », Zuckerman est âgé, il a plus de soixante-dix ans et s’est fait opéré d’un cancer de la prostate. Cette opération a eu pour conséquences la perte du désir sexuel et l’incontinence. Il a passé onze ans de solitude dans sa maison perdue dans la campagne du Massachusetts, pour ne pas avoir à subir l’humiliation citadine qu’il craint en raison de ses handicaps.
Et dans ce livre, il revient à New York pour une intervention chirurgicale.
Or, pendant ces onze ans a eu lieu l’explosion de l’utilisation des téléphones portables.
Philip Roth décrit sa stupéfaction devant cette évolution par ce morceau de littérature :
« Qu’est-ce qui m’étonna le plus pendant ces premiers jours passés à arpenter la ville ?
La chose la plus évidente : les téléphones portables.
Là-haut dans ma montagne le réseau ne passait pas et en bas, à Athéna, où il passe, je voyais rarement des gens parler au téléphone en pleine rue sans le moindre complexe.
Je me rappelais un New York où les seules personnes qu’on voyait remonter Broadway en se parlant toutes seules étaient les fous.
Qu’est-ce qui s’était passé depuis dix ans pour qu’il y ait soudain tant de choses à dire – à dire de si urgent que çà ne pouvait pas attendre ?
Partout où j’allais, il y avait quelqu’un qui s’approchait de moi en parlant au téléphone, et quelqu’un derrière moi qui parlait au téléphone.
A l’intérieur des voitures, les conducteurs étaient au téléphone. Quand je prenais un taxi, le chauffeur était au téléphone.
Moi qui pouvait passer souvent plusieurs jours de suite sans parler à personne, je ne pouvais que me demander de quel ordre était ce qui s’était effondré, qui jusque-là tenait fermement les gens, pour qu’ils préfèrent être au téléphone en permanence plutôt que de se promener à l’abri de toute surveillance, seuls un moment, à absorber les rues par tous les sens et à penser aux millions de choses que vous inspirent les activités d’une ville.
Pour moi, cela avait aussi quelque chose de tragique.
Éradiquer l’expérience de la séparation ne pouvait manquer d’avoir un effet dramatique.
Quelles allaient en être les conséquences ?
Vous savez que vous pouvez joindre l’autre à tout moment, et si vous n’y arrivez pas, vous vous mettez en colère comme un petit dieu stupide.
J’avais compris qu’un fond de silence n’existait plus depuis longtemps dans les restaurants, les ascenseurs et les stades de base-ball.
Mais que l’immense sentiment de solitude des êtres humains produise ce désir lancinant, inépuisable, de se faire entendre, en se moquant totalement que les autres puissent surprendre vos conversations, tout cela me frappait par son côté étalage au grand jour. »
Il faut le regard étonné d’un homme qui n’a pas connu, au jour le jour, cette évolution pour nous révéler le ridicule, la vacuité, l’incongruité de ces situations d’aujourd’hui.
<1003>
- Le téléphone portable est devenu « une extension de nous-même », à la manière du sonar de certains animaux, si bien qu’on peut parler d’ «iSelf », de « soi connecté ». »
-
Mardi 23 janvier 2018
« C’était mieux avant »Michel SerresMichel Serres vient de publier un nouveau livre « C’était mieux avant » qui est présenté comme la suite de Petite poucette.
J’avais évoqué « Petite Poucette » lors d’un tout premier mot du jour, il portait le numéro 23 et avait été envoyé le 21 novembre 2012. A l’époque, mes mots étaient courts.
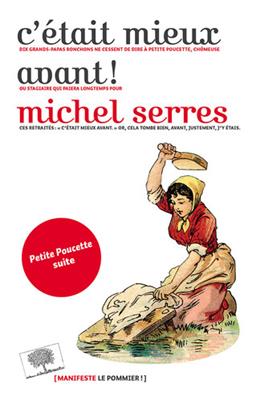 Le sous-titre de ce livre est le suivant :
Le sous-titre de ce livre est le suivant :
« Dix Grands-Papas Ronchons ne cessent de dire à Petite Poucette, chômeuse ou stagiaire qui paiera longtemps pour ces retraités : « C’était mieux avant. » Or, cela tombe bien, avant, justement, j’y étais.»
Bien sûr, Michel Serres ne croit pas un seul instant que c’était mieux avant, mais il a choisi comme titre ce qui se dit beaucoup par tous les nostalgiques qui se sentent étrangers dans le monde d’aujourd’hui.
Alain Finkielkraut est de ceux là
Je parlais, hier, d’Alain Finkielkraut et de son émission « Répliques », or justement il avait, ce samedi, invité Michel Serres.
Cette émission je l’ai écoutée et je vous conseille de faire de même. Vous la trouverez <ICI>
Par rapport, à ce que j’écrivais hier, vous entendrez un débat respectueux où deux intellectuels qui ont de grandes divergences, laissent s’exprimer l’autre, reconnaissent quand l’autre le convainc et surtout s’écoutent et dialoguent. Et non pas comme, si souvent, tiennent deux discours parallèles qui s’ignorent et même qui entrent dans une compétition pour savoir qui coupera le plus souvent la parole à l’autre.
Car Alain Finkielkraut, dès le départ se sent visé par la description de « Grand papa ronchon ».
Michel Serres explique simplement qu’avant il y était et qu’il peut dresser un bilan d’expert :
« Avant nous gouvernaient Franco, Hitler, Mussolini, Staline, Mao… rien, que des braves gens ; avant, guerres et crimes d’État laissèrent derrière eux des dizaines de millions de morts. Longue, la suite de ces réjouissances nous édifiera. »
Michel Serres reprend son argumentation qui avait déjà été développée dans les mots du jour que je lui avais consacré en mars 2017 et notamment <le mardi 7 mars 2017> :
« Le premier âge est plus long qu’on ne le croit ;
Le deuxième pire qu’on ne le pense ;
Le dernier meilleur qu’on ne le dit. »
Mais ce qui a de nouveau grâce à cet entretien, c’est qu’Alain Finkielkraut lui donne la réplique et que Michel Serres lui répond.
Alain Finkielkraut reconnait qu’en ce qui concerne la santé il ne peut que lui donner raison, mais il parle de la violence dans les cités, sur les réseaux sociaux, sur la difficulté de faire classe aujourd’hui pour les professeurs.
Dialogue apaisé, intelligent fécond que je vous laisse écouter.
Evidemment ce n’était pas mieux avant !
J’ai consacré plusieurs mots du jour à cette évidence, plusieurs auteurs m’ont convaincu.
Le plus récent le 21 novembre 2017 où j’évoquais un livre de Steven Pinker : « La part d’ange en nous. Histoire de la violence et de son déclin » dans lequel l’auteur démontre que la violence n’a fait que régresser depuis les premiers temps de l’humanité, qu’il s’agisse de la violence guerrière ou de la criminalité.
Une année auparavant, le mot du jour du 19 décembre 2016 s’intéressait au livre du suédois Johan Norberg «Ten Reasons to Look Forward to the Future Progrès : dix raisons de se réjouir de l’avenir» qui dans un panorama plus large que la seule histoire de la violence montre que nous n’avons jamais vécu à un moment plus heureux de l’Humanité.
J’ai pensé un moment faire un mot du jour sur le livre de Jacques Lecomte : « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ! », mais je n’ai pas trouvé le temps de le faire.
Alors je sens évidemment la question irrépressible que vous souhaitez poser : « Enfin Alain, tu écris à longueur d’articles et à de rares exceptions comme ces deux mots que tu cites ci-dessus, que nous avons toutes les raisons de nous inquiéter sur le climat, sur les inégalités et les déséquilibres économiques, sur la limite des ressources terrestres, sur le retour des nationalismes, sur les projets fous des transhumanistes, et les délires tout aussi terrifiants des extrémistes religieux etc. Comment concilier tous ces avertissements avec ce constat optimiste ? »
C’est à peu près la question qu’Alain Finkielkraut pose vers la fin de l’émission à Michel Serres.
Et ce dernier répond :
« Mais mon cher Alain, je vous dis qu’aujourd’hui est mieux que hier, mais je n’ai jamais dit que demain serait mieux qu’aujourd’hui »
En effet le philosophe optimiste avoue son incapacité de prévoir de quoi demain sera fait.
Demain sera ce que nous et nos enfants en feront.
<1002>
-
Lundi 22 janvier 2018
« Le poly-gourouisme »Concept inventé par Annie et moi pour signifier qu’il faut savoir diversifier ses référentsReprenons donc le cours des mots du jour, celui-ci étant donc dans une numérotation en base 10 (pour comprendre cette incise il faut aller lire le commentaire de Jean-Philippe), le 1001ème.
Il se peut que dans la suite de cette « aventure », il m’arrive de ne pas trouver l’énergie ou le temps de rédiger un article pour un jour, dans ce cas je suivrai le conseil de Daniel et je renverrai un simple lien vers un mot ancien, en expliquant qu’en ce jour je ne suis pas arrivé à écrire un mot nouveau.
Mais tel ne fut pas le cas la semaine dernière, contrairement à ce que certains d’entre vous m’ont fait remonter selon divers canaux.
J’ai voulu, en insistant, rappeler qu’il y a 1000 mots du jour sur le blog et que probablement certains méritent relecture.
D’ailleurs, dans les semaines qui suivent, tout en écrivant des mots du jour nouveau, je continuerai à puiser, à rappeler et à approfondir des articles déjà écrits.
Je commence aujourd’hui par un mot, certes peu élégant, mais qui a du sens : le polygourouisme.
Wikipedia nous donne les définitions d’un « Gourou », mot qui vient du sanskrit guru qui signifie « enseignant », « précepteur », « maître ».
Ce terme peut prendre des définitions positives : maître spirituel qui se réclame d’une tradition religieuse orientale ou un expert dans un domaine particulier notamment en informatique ou en management.
Il peut aussi avoir une connotation négative et désigner un manipulateur ou le chef d’un groupe religieux sectaire.
Vous comprendrez que ce terme de polygourouisme s’inspire de la dichotomie entre polythéisme et monothéisme. Les peuples polythéistes adorent plusieurs dieux, cela ne leur posent donc pas de problème que d’autres peuples adorent d’autres dieux, ils peuvent même les faire entrer dans leur propre panthéon s’ils y trouvent un intérêt. Rien de tel pour les monothéistes qui selon les termes de Régis Debray, un de « mes gourous », ont fait la confusion entre « la croyance » et « la vérité » et il ajoute et « cela c’est de la dynamite !».
Annie et moi avons conçu ce concept dans le cadre de l’évolution de nos habitudes alimentaires. Mes soucis de santé, notre santé générale à tous deux dans un corps de plus en plus expérimenté mais toutefois vieillissant ; dans un contexte de suspicion par rapport aux aliments qu’on nous propose, nous ont conduit à consulter des médecins, des spécialistes certains même de culture non occidentale et aussi de lire des articles et des ouvrages. Nous n’avons pas trouvé de référent, mais des conseils très diversifiés voire contradictoires. Dans ce domaine nous cherchions un référent, un gourou donc. Nous y avons renoncé, toutefois nous suivons des conseils et des réflexions de plusieurs dans une logique de polygourouisme.
Revenons maintenant au monde de l’esprit et de la réflexion, tout en n’oubliant pas l’intelligence du cœur.
Récemment, le 12 janvier 2018, un historien des idées, Daniel Lindenberg est mort. En 2002, il avait publié un essai intitulé « Le Rappel à l’ordre : Enquête sur les nouveaux réactionnaires ». Dans cet ouvrage, il attaquait des personnalités intellectuelles qui venaient comme lui des milieux de gauche et qu’il accusait d’être devenues réactionnaires. Son propos conduisait à vouloir ostraciser ces personnes, faire une sorte de liste noire d’intellectuels à qui il ne fallait plus accorder aucune confiance, ne plus lire, et même s’opposer qu’il puisse disposer de tribunes pour s’exprimer.
Parmi ces intellectuels, il y avait Marcel Gauchet. Et vous pouvez lire par exemple dans cet article de slate, comment certains ont tenté d’empêcher Marcel Gauchet de s’exprimer au Rendez-vous de l’Histoire de Blois en 2014.
Il faut bien comprendre ce que cela signifie.
Ce n’est pas un débat où on laisse Marcel Gauchet exprimer ses idées et dans lequel on argumente pour critiquer ou nuancer celles avec lesquelles on n’est pas d’accord. On refuse le débat ! On intime l’ordre de ne pas laisser « ce renégat » s’exprimer. Parce qu’on est contre certaines de ses idées, on rejette globalement la personne, on refuse de l’écouter.
Ceci m’est absolument insupportable !
En outre, je trouve que Marcel Gauchet est un homme d’une très grande consistance et très intéressant. Il a d’ailleurs inspiré plusieurs de mes mots du jour, par exemple celui du 14 juin 2016 :
«En haut on parle technique et en bas on ressent le changement du monde et on ressent l’absence de perspective à l’égard de ce changement.»
Est-ce que je suis d’accord avec toutes les réflexions, toutes les propositions de Marcel Gauchet ? Bien sûr que non. Mais je l’écoute avec attention et cette écoute m’apporte beaucoup de connaissances et, ce qui est plus important encore, de questionnements.
Alain Finkielkraut fait aussi partie des intellectuels que Lindenberg voue aux gémonies. Je suis beaucoup plus réticent devant les idées et les peurs développées par Alain Finkielkraut que devant les réflexions de Marcel Gauchet, mais cela signifie-t-il que l’auteur de « la Défaite de la pensée » ne dit que des choses inintéressantes, qu’il ne peut rien m’apporter, qu’il ne mérite même pas que je l’écoute ?
Bien sûr que non. J’irai plus loin, son émission « Répliques » constitue un exemple de lieu de débat sans concession dans l’honneur et le respect des idées. J’y reviendrai d’ailleurs.
Emmanuel Todd est également un intellectuel qui m’intéresse et m’inspire, mais il n’est pas question d’être d’accord avec tout ce qu’il dit, il est raisonnable de ne pas le suivre dans certains de ces excès, pour autant je continue à l’écouter.
Ecouter les idées avec lesquelles on est d’accord, mais aussi les autres. Accepter d’être bousculé, remis en question. Mais pour ce faire il faut écouter et lire des personnalités et des intellectuels qui ont des idées différentes, l’essentiel étant qu’ils argumentent, qu’ils fondent leurs réflexions sur des sources, des faits, un raisonnement.
Voici comment je définirai le polygourouisme.
Mais faut-il parler de gourous ?
Cela peut se discuter, mais je trouve ce terme amusant et aussi pertinent.
Souvent on l’utilise plutôt pour le dénigrement.
Personne qui lit régulièrement ce mot du jour ne peut ignorer que Yuval Noah Harari l’auteur de « Sapiens » et de « Homo Deus » fait partie des intellectuels qui m’inspirent et m’aident à poursuivre cette quête d’essayer de comprendre le monde.
Or <Valeurs actuelles traite explicitement Yuval Noah Harari de gourou>
Et cela me va, il fait partie de mon panthéon polygourouiste, comme Edgar Morin, Michel Serres et bien d’autres.
La disposition d’esprit d’accepter d’examiner et de se nourrir de réflexions différenciées voire antinomiques constitue d’ailleurs le meilleur moyen d’approcher la complexité du monde.
Pour finir et donner un exemple, accepter la complexité de l’union européenne, c’est faire appel à Jacques Delors :
« Notre union repose, selon l’inspiration de l’Acte Unique, sur trois principes :
la compétition qui stimule,
la coopération qui renforce,
la solidarité qui unit.
11 février 2013
Mais aussi à Philippe Seguin
« Pour qu’il y ait une démocratie il faut qu’existe
un sentiment d’appartenance communautaire suffisamment puissant pour entraîner la minorité à accepter la loi de la majorité ! »
8 juillet 2015
Et même à Philippe de Villiers,
« Avec le recul, je pense que nous [les anti maastrichtiens de droite] nous sommes trompés, trompés de cible et d’argumentaire : nous combattions le « Super État » [Européen].
La construction européenne n’est qu’un affichage.
En réalité, elle est une déconstruction. Le but n’est pas de faire émerger une nouvelle entité politique, mais d’en finir avec la politique. »
5 avril 2016
J’avais cité le 4 septembre 2013, Georges Bidault qui parlant des résistants et des trotskystes décrivait très bien le comportement des Lindenberg et consorts
« Les résistants c’est comme les trotskystes
Avec un, tu fais un Parti
avec deux, tu fais un congrès
avec 3, tu fais une scission »
<1001>
-
Vendredi 19 janvier 2018
« Encore une fois pas de mot du jour aujourd’hui, mais vous pouvez en lire 1000 déjà écrits »L’après mille 5Les mille mots du jour écrits depuis octobre 2012 sont répertoriés (exergue et auteur) sur cette page : <Liste des mots>.
Pour en signaler un dernier aujourd’hui : hier j’ai rappelé l’hommage au grand musicien classique Claudio Abbado, il m’est aussi arrivé de parler de musiciens qui n’étaient pas classiques.
Le 7 janvier 2014 j’ai cité John Lennon :
« Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand.
J’ai répondu « heureux ».
Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question,
j’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie. »
Evidemment, Jean-Philippe a raison, c’est une convention que de marquer un point particulier au niveau de 1000. Mais nous avons l’habitude de calculer en base 10 et de ce fait 1000 parait approprié. Il a fallu 5 ans pour arriver à mille, un quinquennat.
Alors cette première semaine, j’ai voulu faire un simple retour vers ces 5 ans, en reprenant des mots qui illustrent le 1000ème mot : venu du cœur…et rappeler qu’il existe une page qui les regroupe tous. J’avais participé à un stage de lecture rapide où on m’avait expliqué comment aborder un livre qui n’est pas un roman, mais un essai, un livre technique ou peut être un livre d’articles. Il ne faut pas commencer à la première page et finir à la dernière. Il faut commencer par la table des matières, puis lire le début, puis la fin et quelques pages du milieu. Ensuite si ce test a été concluant on peut tout lire.
La page internet vers laquelle je vous incite à aller depuis le début de cette semaine ressemble à une table des matières…
<Article sans numéro>
-
Jeudi 18 janvier 2018
« Persévérance dans l’absence de mot du jour nouveau, mais vous pouvez en lire 1000 déjà écrits Exemple : La culture c’est la vie et la vie est belle »L’après mille 4Les mille mots du jour écrits depuis octobre 2012 sont répertoriés (exergue et auteur) sur cette page : <Liste des mots>
Plusieurs fois j’ai rendu hommage à des artistes. Aujourd’hui je voudrais revenir sur le mot du jour du 3 février 2014
Claudio Abbado est mort Lundi 20 janvier 2014 et ce mot du jour lui rendait hommage
J’écrivais que très jeune Claudio Abbado a été un chef d’orchestre remarquable et brillant et qu’il a dirigé les plus grandes institutions musicales.
Mais en 2000, un terrible cancer l’assaillit, un cancer de l’estomac. Il revint au bout de quelques mois, émacié et transfiguré.
Il dit alors : « J’ai souffert et j’ai lutté de toutes mes forces. Mais comme toujours, du mal peut naître quelque chose de bon ».
A partir de ce moment, Il devint un chef génial et unique.
Je renvoyais alors vers une interprétation du Requiem de Mozart par Abbado Festival de Lucerne 2012
A la fin de cette interprétation bouleversante, le public est resté silencieux pendant presque une minute avant d’applaudir.
Le silence était si intense qu’il était encore musique.
Nos mots sont trop pauvres pour décrire l’indicible et le sublime.
C’est un journal suisse dont je donne la référence qui a rapporté ce propos de Claudio Abbado
« La culture c’est la vie et la vie est belle ».
Si vous voulez retrouver le mot du jour initial : le mot du jour du 3 février 2014
Claudio Abbado parvient à faire sonner l’ensemble de l’orchestre dans un souffle de son dont il définit ainsi le niveau sonore : «Il faut atteindre le niveau sonore de la neige qui tombe sur de la neige.»
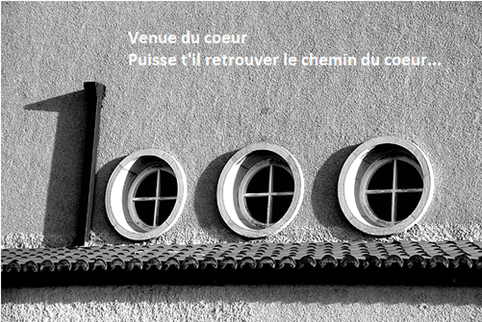
<Article sans numéro>
-
Mercredi 17 janvier 2018
« Toujours pas de mot du jour aujourd’hui, mais vous pouvez en lire 1000 déjà écrits Exemple : Ne renoncez à rien ! surtout pas aux amis, surtout pas à la vie.»L’après mille 3Les mille mots du jour écrits depuis octobre 2012 sont répertoriés (exergue et auteur) sur cette page : <Liste des mots>
Parmi ces mille, je voudrai revenir sur celui du 23 novembre 2015, il portait le numéro 601.
Le 13 novembre 2015, de terribles actes terroristes commis par des fous de Dieu se réclamant de l’Islam ont tué 130 personnes et ont en blessé 413 (dont 99 grièvements). Des français et des étrangers présents à Paris, dans la salle de spectacle du Bataclan ou assis à des terrasses de café ou se trouvant au stade de France ont été la cible des obscurantistes qui veulent lutter contre la musique, la joie de vivre, la mixité, la liberté de penser, de croire ou non.
Le vendredi 20 novembre 2015, une semaine plus tard, à 8:58, sur France Inter, à la fin du 7-9, Patrick Cohen donne la parole à François Morel, sous les regards pleins d’émotions de Bernard Pivot, Pierre Arditi et Jérôme Garcin.
La musique de la romance sans parole opus 67 N° 4, appelée « la fileuse », de Mendelssohn démarre.
Et François Morel se lance dans une harangue, prononcée d’une seule traite, presque sans reprendre son souffle :
«Ne renoncez à rien !
Surtout pas au théâtre, aux terrasses de café, à la musique, à l’amitié, au vin rouge, aux feuilles de menthe et aux citrons verts dans les mojitos, aux promenades dans Paris, aux boutiques, aux illuminations de Noël, aux marronniers du boulevard Arago, aux librairies, aux cinémas, aux gâteaux d’anniversaire.
Ne renoncez à rien !
Surtout pas au Chablis, surtout pas au Reuilly, surtout pas à l’esprit. Ne renoncez à rien ! Ni aux ponts de Paris, ni à la Tour Eiffel, ni Place de la République à la statue de Marianne […].
Ne renoncez à rien !
Surtout pas à Paris, surtout pas aux titis, surtout pas à Bercy.
Ne renoncez à rien !
Ni à Gavroche, ni à Voltaire, ni à Rousseau, ni aux oiseaux, ni aux ruisseaux, ni à Nanterre, ni à Hugo.
Ne renoncez à rien !
Ni aux soleils couchants, ni aux collines désertes, ni aux forêts profondes, ni aux chansons de Barbara, ni à la foule des grands jours, ni à l’affluence des jours de fête, au Baiser de l’Hôtel de Ville, aux étreintes sous les portes cochères, ni aux enfants qui jouent sur les trottoirs, ni aux cyclistes, ni aux cavistes, ni aux pianistes.
Ne renoncez à rien !
Surtout pas aux envies, surtout pas aux lubies, surtout pas aux folies, ni aux masques, ni aux plumes, ni aux frasques, ni aux prunes, ni aux fiasques, ni aux brunes, ni aux écrivains, ni aux éclats de voix, ni aux éclats de rires, ni aux engueulades, ni aux files d’attente, ni aux salles clairsemées, ni aux filles dévêtues, ni aux garçons poilus, ni à la révolte, ni à la joie d’être ensemble, ni au bonheur de partager, au plaisir d’aimer, ni à la légèreté, ni à l’insouciance, ni à la jeunesse, ni à la liberté.
Ne renoncez à rien ! Ne renoncez à rien ! Ne renoncez à rien ! Ne renoncez à rien !
Surtout pas à Paris, surtout pas aux amis, surtout pas à la vie.»
Dans ce cas lire est bien mais écouter François Morel est encore mieux : http://www.franceinter.fr/emission-le-billet-de-francois-morel-ne-renoncer-a-rien
Si vous voulez retrouver le mot du jour initial : le mot du jour du 23 novembre 2015
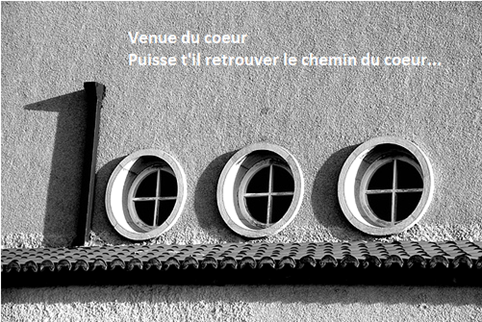
<Article sans numéro>
-
Mardi 16 janvier 2018
« Encore pas de mot du jour aujourd’hui, mais vous pouvez en lire 1000 déjà écritsExemple : Je me suis concentré sur la vie, sur continuer à croitre, à grandir »L’après mille 2Les mille mots du jour écrits depuis octobre 2012 sont répertoriés (exergue et auteur) sur cette page : <Liste des mots>
Je vous invite à dérouler rapidement cette page et de vous arrêter sur un ou deux mots qui vous interpellent et de cliquer sur la date de ce mot. Ce qui vous renverra vers l’article.
Et n’hésitez pas à laisser un commentaire pour approfondir, nuancer, critiquer bref enrichir l’article.
Aujourd’hui cependant je souhaite rappeler le mot du jour du 7 mai 2014 , il portait le numéro 282.
J’avais entendu une émission sur France Inter qui avait invité un homme Damien Echols.
Il avait été accusé par erreur du meurtre de trois enfants aux Etats-Unis, alors qu’il avait 18 ans.
Il avait été condamné à mort et avait passé 18 ans dans le couloir de la mort.
Les faits remontaient à 1993 : Trois enfants de huit ans avaient été retrouvés sauvagement assassinés à West Memphis, dans l’Etat de l’Arkansas. Très vite, trois jeunes marginaux sont soupçonnés : Jessie Misskelley Jr, Jason Baldwin et Damien Echols.
Au terme d’un procès arbitraire qui accumule faux témoignages et preuves falsifiées, ces trois jeunes sont lourdement condamnés : Misskelley et Baldwin à la prison à perpétuité, Echols à la peine capitale.
Finalement, en 2011, à la faveur d’une longue campagne de soutien (des personnalités comme Johnny Depp y ont participé), la justice accepte de rouvrir le dossier et examine de nouvelles preuves scientifiques. Les trois hommes obtiennent leur libération mais ne sont pas totalement innocentés. Ils restent coupables aux yeux de la justice.
Pour être libéré, il fallait qu’ils ne puissent attaquer l’Etat qui les avait condamné parce que sinon il pouvait réclamer 60 000 000 de dollars de dommages-intérêts. Alors ils ont dû conclure un accord avec la justice qui acceptait de les libérer mais sans reconnaître leur innocence. S’ils avaient voulu faire reconnaître leur innocence ils auraient dû se lancer dans une longue procédure contre l’Etat et continuer à rester en prison pendant ce temps.
Damien Echols a raconté son cauchemar dans un livre, « La vie après la mort » (éditions Ring), traduit en français.
La journaliste avait posé cette question :
« Quand on est condamné à mort, est ce qu’on vit chaque jour comme le dernier ? »
Et Damien Echols avait répondu :
« Je me suis concentré sur la vie, sur continuer à croitre, à grandir, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, j’ai essayé de continuer à aller de l’avant, là où je pouvais. »
Qu’un homme injustement condamné, risquant l’exécution capitale, puisse exprimer une telle force positive et humaniste me semble admirable.
Depuis j’ai trouvé un autre entretien, vidéo cette fois, sur TV5MONDE où Damien Echols s’entretient avec Patrick Simonin
Si vous voulez retrouver le mot du jour initial : le mot du jour du 7 mai 2014
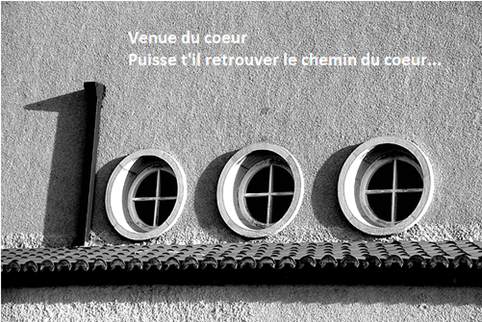
<Article sans numéro>
-
Lundi 15 janvier 2018
« Pas de mot du jour aujourd’hui, mais vous pouvez en lire 1000 déjà écrits »L’après mille 1Les mille mots du jour écrits depuis octobre 2012 sont répertoriés (exergue et auteur) sur cette page : <Liste des mots>
Je vous invite à dérouler rapidement cette page et de vous arrêter sur un ou deux mots qui vous interpellent et de cliquer sur la date de ce mot. Ce qui vous renverra vers l’article.
Et n’hésitez pas à laisser un commentaire pour approfondir, nuancer, critiquer bref enrichir l’article.
Merci par avance.
<Article sans numéro>
-
Vendredi 12 janvier 2018
« Von Herzen – möge es wieder zu Herzen gehen
Venue du cœur puisse t’elle retrouver le chemin du cœur »Ludwig van Beethoven, phrase mise en exergue de sa « Missa Solemnis »A plusieurs reprises des collègues et amis, que j’avais connus lors de mon passage dans l’administration centrale de la direction générale des impôts à Bercy entre 1987 et 2002, m’ont écrit pour exprimer un avis positif sur la qualité globale des mots du jour. Mais ils ajoutaient immédiatement une nuance en la justifiant par la crainte que « je prenne la grosse tête ».
Il me semble que cette crainte est injustifiée : tous mes butinages, mes lectures, mes découvertes que je tente de présenter et d’expliquer ne me montre qu’une chose : l’incommensurabilité de mon ignorance à laquelle j’ajouterai la vanité d’essayer de comprendre la complexité du monde et de l’humain. Ce constat ne peut que me pousser à une très grande humilité.
J’aime pourtant l’image que donne Michel Serres pour définir le verbe vieillir : monter un escalier chaque jour pour aller vers un plus d’intelligence, de sagesse, de simplicité et de modération.
Un des mots du jour le plus porteur de sens pour moi est celui qu’a écrit Rachid Benzine : « Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes.»
Je n’aime plus beaucoup mon métier. Je suppose n’être pas seul dans ce cas. J’essaye pourtant de l’accomplir au mieux par devoir et par éthique. Il puise beaucoup de mon énergie et me donne assez peu en retour. Je suis injuste, il me donne un revenu confortable qui me permet de vivre matériellement sans peur du lendemain et m’autorise ainsi à être libre, libre de m’intéresser à bien des choses qui dépassent les contingences matérielles.
Mais du point de vue intellectuel le métier que j’exerce occupe ma journée mais ne la remplit pas.
Ma quête de mots du jour la remplit.
Depuis que jeune, il m’arrivait de comprendre les mathématiques un peu plus vite que certains camarades, j’ai appris que dans l’acte d’explication celui qui en profitait le plus était celui qui expliquait. Confucius aurait dit : «Ce qu’on me dit je l’oublie, ce que je vois je m’en souviens, ce que je fais je le sais.»
Lire, écouter, regarder permet d’approcher une connaissance, mais ce qui permet de l’approfondir est l’acte de vouloir l’expliquer donc écrire. Car écrire demande d’interroger, de poser questions, d’éclairer des points obscurs ou d’avouer qu’on ne comprend pas. Mais s’avouer à soi-même qu’on ne comprend pas accroit paradoxalement la connaissance contrairement aux certitudes pour revenir à cette lumineuse phrase de Rachid Benzine.
Récemment j’ai entendu Hubert Reeves développer le raisonnement suivant : Nous pouvons rationnellement penser qu’un chat comprend moins de choses qu’un humain et qu’il existe donc une limite à sa compréhension. Cet exemple doit nous pousser, nous autres humains de l’espèce homo sapiens, d’admettre qu’il existe des choses que nous ne pouvons pas comprendre et que notre intelligence connaît des limites.
L’homme augmenté cher aux transhumanistes, s’il existe un jour, aura aussi ses limites, peut-être pas les mêmes.
Mais il fallait trouver un exergue à ce 1000ème mot du jour.
Dans notre vie nous rencontrons des personnes, des lieux, des œuvres de l’esprit et aussi des mots.
Parfois, on se souvient de la première rencontre avec un mot. C’est le cas pour moi avec le mot « exergue » qui rappelons le, signifie selon Le Larousse : « Inscription placée en tête d’un ouvrage » mais le CNRS dans son outil lexical en ligne donne une définition plus précise : « Formule, pensée, citation placée en tête d’un écrit pour en résumer le sens, l’esprit, la portée, ou inscription placée sur un objet quelconque à titre de devise ou de légende ».
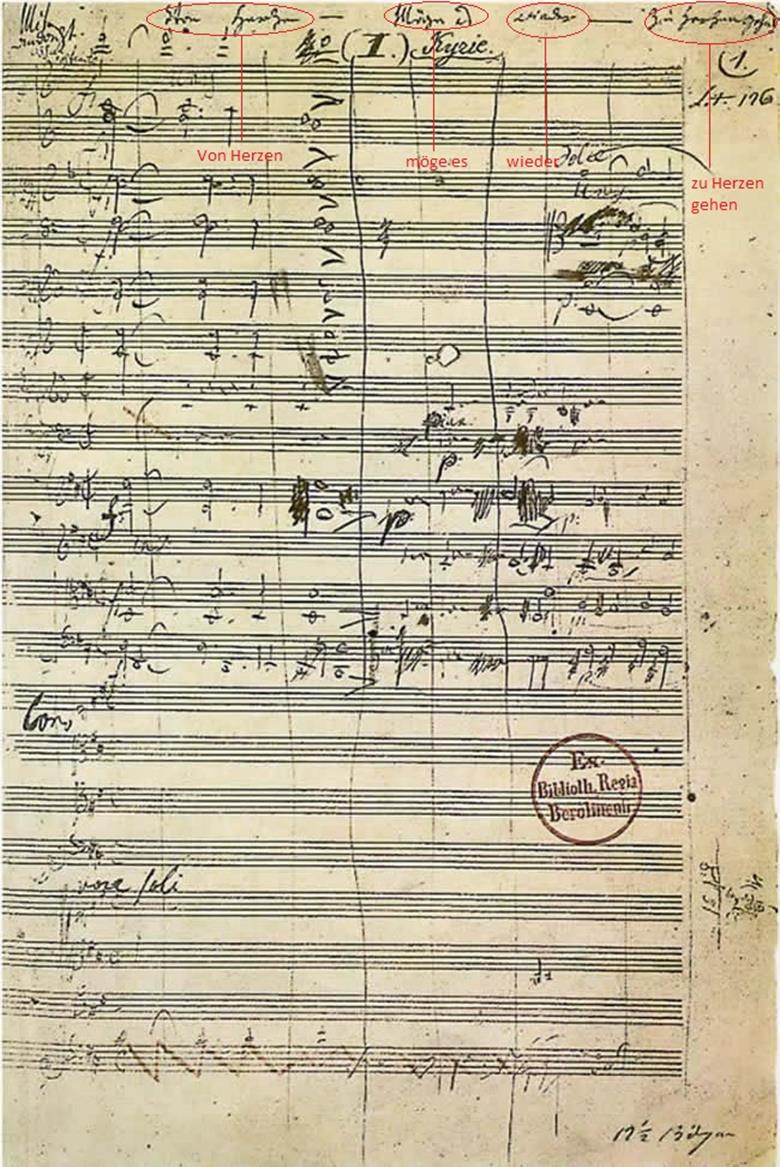 Ma première rencontre avec ce mot a eu lieu lors de la lecture d’un livret d’un coffret microsillon et je peux encore citer de mémoire cette rencontre qui a eu lieu il y a environ 45 ans :
Ma première rencontre avec ce mot a eu lieu lors de la lecture d’un livret d’un coffret microsillon et je peux encore citer de mémoire cette rencontre qui a eu lieu il y a environ 45 ans :
« Venue du cœur, puisse t’elle retrouver le chemin du cœur » c’est l’exergue que Ludwig van Beethoven a mis en marge de sa partition de sa Missa Solemnis dont il disait qu’elle était son œuvre la plus accomplie.
Sur internet, j’ai d’ailleurs pu trouver une reproduction de la page de la partition annotée de la main de Beethoven. En haut de la page, comme il s’agit du Kyrie, c’est le tout début de la partition. Sur cette reproduction, j’ai réécrit en rouge lisible en renvoyant vers l’écriture de Beethoven.
C’est donc un juste retour des choses que de mettre en exergue, la phrase qui m’a appris ce qu’était un exergue.
Mais il y a une deuxième raison.
J’ai placé ce millième mot du jour dans l’univers de la pensée complexe, de l’effort de comprendre, du travail de l’intelligence et de l’approfondissement.
Or, si en effet, la Missa Solemnis est une des œuvres les plus achevées de Beethoven et de la musique occidentale, c’est une œuvre difficile d’accès.
Si vous avez du mal avec la musique classique, ce n’est certainement avec la Missa Solemnis qu’il faut commencer.
Commencez avec les quatre saisons de Vivaldi qui est un authentique chef d’œuvre, la flute enchantée de Mozart, le concerto de violon de Beethoven, pas avec la Missa Solemnis.
La Missa Solemnis est exigeante, il faut être prêt à affronter la complexité et l’âpreté de son écriture pour en tirer la beauté immatérielle et extatique qu’elle révèle.
Et il y a une troisième raison.
Un des mots du jour récent nous apprenait que nous possédions en réalité trois cerveaux : l’organe qui porte ce nom, les intestins et le cœur.
J’écrivais que pour le cœur, la question restait ouverte. Mais acceptons cette hypothèse que nous agissons aussi par ce que le cœur nous ordonne.
Notre intuition, notre expérience nous pousse à croire que le cœur l’emporte parfois sur la raison.
Alors dans un monde où l’intelligence artificielle a vocation à devenir de plus en plus omniscient, certains prédisent même qu’elle va supplanter l’intelligence humaine, nous gardons, nous autre homo sapiens non augmenté, ce privilège sur la machine de savoir penser avec le cœur.
Je pense qu’il n’est pas difficile de trouver dans les 999 mots du jour précédents, un certain nombre qui sont le fruit de l’intelligence du cœur.
Et je crois plus généralement que quasi dans chacun d’entre eux, il y a une part plus ou moins importante de l’intelligence du cœur.
C’est pourquoi, écrire pour ce millième mot du jour : « Venu du cœur, puisse t’il retrouver le chemin du cœur » me semble une expression adaptée à cette circonstance.
J’avais écrit un mot du jour qui avait fait réagir : « L’homme médiocre parle des personnes, l’homme moyen parle des faits, l’homme de culture parle des idées ». Mais j’avais reconnu les limites et l’incomplétude de cette affirmation lors du mot du jour hommage à Barbara : en écrivant : Barbara me rappelle que j’ai oublié le plus l’important : « L’homme de cœur et en l’occurrence la femme de cœur parle de la vie et de l’amour. »
Il est d’usage quand je parle d’une œuvre musicale de donner des liens ou des indications discographiques. Si je ne le fais pas, je suis d’ailleurs rappelé à l’ordre pour que je m’exécute.
Peut-être que le meilleur moyen d’entrer dans cette œuvre se trouve dans l’Agnus Dei dont Beethoven a confié l’introduction à la voix de basse dans une atmosphère de grande profondeur. Vous trouverez <ICI> cette partie de la messe chantée par Gérald Finley, en 2012, au Concertgebouw d’Amsterdam sous la direction inspirée de Nikolaus Harnoncourt.
Pour une interprétation complète de l’œuvre, vous trouverez <ICI> dans un autre haut lieu de la musique classique européenne, à Dresde, avec l’orchestre de la Staatskapelle de Dresde une interprétation dirigée par Christian Thielemann.
Si votre curiosité vous pousse plus loin, je peux vous donner la version audio qui depuis sa sortie fait l’unanimité :
La version d’Otto Klemperer enregistrée en 1966
Mais j’ai un faible pour une version plus récente de Philippe Herreweghe paru en 2012
.
<1000>
-
Jeudi 11 janvier 2018
« Les trois filtres de Socrate »Attribué à Socrate ou à la sagesse SoufiOn trouve sur internet et dans beaucoup de livres cette histoire :
Un homme vient voir Socrate et veut impatiemment lui rapporter une nouvelle sur un de ses amis. Alors Socrate, l’interrompt et lui demande s’il a passé cette information par les trois filtres. Dans d’autres versions il est question de tamis ou de passoires en lieu et place de filtres.
Et Socrate énumère ces trois filtres :
1° Le filtre de vérité : As-tu vérifié cette information ? Es-tu certain que ce que tu vas me dire est vrai ?
2° Le filtre de l’intentionnalité : Est-ce que ce qui te pousse à me le dire est une intention bienveillante ou non ?
3° Le filtre de la nécessité ou de l’utilité : Ai je besoin de savoir cette information, est-elle utile pour moi ?
Souvent, pour le second filtre, les récits parlent du filtre de la bonté : Ce que tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon ?
Cette version me semble stupide. Si vous avez un ami en qui vous avez toute confiance et qu’un tiers vient vous apporter une information qui passe par les deux autres filtres, c’est-à-dire qu’elle est vraie et qu’elle m’est utile, il peut s’agir d’une information qui n’est pas « bonne » au sens qu’elle décrit cet ami sous un jour qui ne lui est pas favorable. Mais si elle m’apporte un élément qui va me conduire à interroger ma confiance envers mon ami, elle m’est éminemment utile.
Donc le second filtre est bien celui de la bienveillance de l’intentionnalité et non celui du regard candide qui ne voit que ce qui est bon.
Une connaissance d’Annie m’a parlé un jour de ces trois filtres comme ayant pour origine la sagesse soufie.
Vérification faite, aucun écrit de Platon relatant les paroles de Socrate n’évoque cette histoire et cet enseignement du philosophe. Je n’ai pas poussé très loin la vérification concernant l’origine soufie de cet enseignement.
Me voilà bien embarrassé puisque je me trouve confronté à un acte contradictoire ou paradoxal :
D’une part je prétends que pour donner une information il faut d’abord s’assurer qu’elle est vraie et ensuite j’annonce que l’information concernant les trois filtres de Socrate n’est pas vérifiée puisqu’on ne trouve pas trace d’une source fiable qui permettrait d’affirmer que Socrate a bien tenu ces propos.
Sur le fond, ce conseil est pourtant très pertinent et cela devient une facilité de langage de parler des « trois filtres attribués à Socrate ».
Et il apparaît, dans ce monde où règne les « fake news » de non seulement examiner avec circonspection les informations qui nous sont apportées, mais aussi de ne pas les colporter plus loin.
J’ai trouvé sur le site du journal des Echos, un article intéressant dont le titre est : « Comment les trois filtres de Socrate peuvent-ils nous aider à traiter l’information ? »
L’auteur développe les idées suivantes :
« La société de l’information est aussi la société de la désinformation. Dans nos vies professionnelles et personnelles avec les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication), nous croulons sous l’information. Cela a notamment deux conséquences :
Paradoxalement, la surinformation, conduit à la sous-information, car nous n’avons pas la possibilité de tout traiter et nous laissons nécessairement filer des informations utiles, importantes parfois vitales. En fait, la surabondance informationnelle constitue un risque majeur, trop d’informations tuent l’information.
Pour les informations que nous captons, nous ne les traitons pas toujours avec suffisamment de rigueur et prenons pour argent comptant des informations non vérifiées, non analysées qualitativement… C’est sur ce deuxième aspect qualitatif que les filtres de Socrate interviennent.
Le filtre de la vérité […] On comprend aisément les risques liés à cette dérive informationnelle quand il faut prendre par exemple une décision d’investissement, de choix stratégique, ou tout simplement apporter une réponse. S’assurer de la véracité, de la fiabilité de l’information reste bien un impératif fondamental. Des questions basiques doivent être utilisées. Qui dit quoi ? Qu’est-ce qui est précisément dit, écrit, rapporté… ? D’où tient-on cette information ? Quelle est la source de cette information ? Quelle est la fiabilité de cette source ? Par quels canaux différents cette information est-elle passée ?… […]
Le filtre de l’intentionnalité […] nombre d’informations sont loin d’être neutres. Ce n’est pas forcément un hasard si une information sort à un moment donné, qu’elle soit vraie ou fausse. La récente campagne présidentielle est venue nous le rappeler avec force. Nous parlerons d’intentionnalité (plutôt que de bonté) de celui ou de ceux qui véhiculent l’information. Derrière la dimension informative apparente, l’information est aussi là pour convaincre, faire adhérer, choquer, faire agir… Elle peut donc se faire propagande, endoctrinement, manipulation, écran de fumée, dérivation… Il est donc essentiel, là aussi, de poser un certain nombre de questions. Pourquoi me communique-t-on cette information ? Pourquoi cette information sort-elle maintenant ? Qui la communique avec quelles intentions possibles ? Que vise cette information en termes d’action, de réactions… ?
Le filtre de l’utilité […] Sous réserve de la fiabilité de l’information et du décryptage de l’intentionnalité, il faut effectivement s’interroger sur l’utilité, la valeur ajoutée de cette information. À quoi cette information peut-elle nous servir ? Que nous apprend-elle que nous ne savions pas ? Que va-t-elle nous permettre de dire et/ou de faire que nous n’aurions pas fait sans elle ? Que va-t-elle nous éviter de faire que nous aurions fait ? Si nous n’en tenons pas compte quelles seront les conséquences ?… »
En conclusion, je pense que ces trois filtres attribués à Socrate sont surtout utiles pour nous quand nous voulons diffuser une nouvelle et donner une information à quelqu’un.
Albert Camus aurait dit « « Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde »
Mais après vérification ce n’est pas ce qu’il a écrit. Dans un essai de 1944, paru dans Poésie 44, (Sur une philosophie de l’expression), Albert Camus a écrit : « Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. »
Je suis persuadé que transmettre des informations dont on ne sait pas si elles sont exactes à quelqu’un qui n’en a pas l’utilité, c’est ajouter au malheur de ce monde.
<999>
-
Mercredi 10 janvier 2018
« Les trois utopies humaines à l’œuvre aujourd’hui : La religion, l’écologie et le transhumanisme »Réflexions personnelles après l’écoute de deux émissions de radioYuval Noah Harari, Régis Debray et bien d’autres nous rappellent l’importance des utopies dans les sociétés humaines.
Si on observe le monde, on constate qu’il y a essentiellement trois utopies à l’œuvre aujourd’hui :
- La première est la plus ancienne, elle fait appel à la spiritualité, à Dieu pour espérer d’une manière ou d’une autre un monde meilleur.
- La seconde est celle qui dresse le constat que l’évolution de notre société basée sur la croissance et le consumérisme amène à une impasse. Elle considère que la terre est pour nous le seul horizon et que pour sauver l’humanité il faut rendre l’homme compatible avec la nature.
- La troisième ne nie pas les problèmes qui se posent aux humains mais elle prédit que les humains disposent des ressources techniques et intellectuelles pour surmonter les difficultés.
Toute classification est toujours réductrice, mais elle permet d’esquisser une réflexion. Dans chacune de ces catégories, il existe des nuances, des courants différents mais il existe quand même une homogénéité de comportement et de discours pour chacune d’entre elles.
Pour simplifier nous pourrions nommer la première Religion ; la seconde Ecologie et la troisième Transhumanisme.
Il y a certainement de nombreuses personnes qui ne se raccrochent à aucune de ces utopies et cherchent simplement à vivre au jour le jour ou même à s’amuser pour ne pas penser à toutes ces choses. L’Histoire nous apprend cependant que ce ne sont pas ces gens-là qui font l’histoire, mais bien celles et ceux qui s’inscrivent dans les utopies.
La religion est la plus ancienne de ces utopies. Nous avons du mal, en tant que français qui voyons nos églises vides et qui vivons au quotidien la sortie de la religion, à prendre cette utopie au sérieux. Je veux dire d’estimer que la religion pourra avoir une importance stratégique pour l’avenir de l’humanité. Mais nous sommes probablement assez différents du reste du monde et même des Etats-Unis où la religion reste extrêmement prégnante. Savez vous que le Vice Président des Etats-Unis Mike Pence est un créationniste, il est certain que la création de la terre a été faite comme cela a été décrit dans la bible.
Et lorsqu’un journaliste essaye de savoir ce qu’il pense de la théorie de l’évolution de Darwin, il répond :
« ça, je ne peux pas le dire. Je le Lui [Dieu] demanderai. Mais je crois en cette vérité fondamentale [de la création divine] ».
Il est vice-président des Etats-Unis !
Vous pouvez aussi vous intéresser à un autre membre du gouvernement des Etats-Unis : Ben Carson. Je ne prends qu’un de ces propos qui avait été rapporté par le Washington Post :
« En 1998, il considère, en se référant à la Bible que les pyramides d’Egypte n’ont pas été construites pour abriter les pharaons défunts mais que Joseph (de l’ancien Testament) les a bâties pour stocker du grain »
Vous trouverez aussi dans cet article des Echos des témoignages qui montrent l’influence des évangélistes auprès des Républicains et de Donald Trump, et notamment sur la décision de transférer l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.
Parmi ces évangélistes, il en est un certain nombre qui sont millénaristes. C’est-à-dire qu’ils attendent la fin du monde et le retour du Christ. Et que dans cette perspective, accélérer la fin des temps est une solution envisageable. L’Église adventiste du septième jour fait partie de cette mouvance, or Ben Carson, cité précédemment, appartient à cette église.
J’aurais pu parler des fondamentalistes dans d’autres religions. Mais j’ai trouvé plus pertinent de mettre en avant des chrétiens dans le pays le plus riche et le plus développé de la planète. Parce que ces gens sont puissants, il y en a beaucoup qui sont riches et globalement ils ont une grande influence aux Etats-Unis.
Ces gens croient que de toute façon tout est entre les mains de Dieu, même l’apocalypse et qu’il suffit de prier pour que finalement tout se passe bien pour les croyants. Si vous avez lu les mots du jour consacrés à Luther, vous comprendrez certainement un peu mieux ces croyances.
Cette utopie peut-elle l’emporter ?
A priori non. Mais qui sait, si l’Humanité est confrontée à d’immenses problèmes écologiques dont on ne voit pas d’issue. La pensée magique peut redevenir une option pour des désespérés.
La seconde qu’on appellera, par facilité, utopie écologique mais qui peut mieux se définir comme la tentative de rendre compatible la vie des humains avec la nature terrestre et les ressources de notre planète. Elle n’a pas pour l’instant la puissance de la première. Cette utopie est probablement la plus raisonnable et c’est cela peut être sa faiblesse. Elle part du constat simple qu’il n’est pas possible de croitre à l’infini dans un monde fini. Elle ne croit pas à la toute-puissance de la technique humaine pour trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent à nous. Elle ne croit pas non plus que nous pourrons nous échapper de notre vaisseau terrestre pour pouvoir continuer à vivre avec la même soif de consommation et nos besoins énergétiques sur d’autres planètes de l’univers.
Cette utopie entrainerait l’humanité vers des ruptures de comportement auxquelles aujourd’hui il ne semble pas que la plus grande part des humains soit prête. Il existe, de plus en plus nombreuses, des initiatives encourageantes. Le film « Demain » en a montré certains. Mais pour entraîner la masse est-ce suffisant ?
Car il y a la troisième qu’il est commode de nommer le transhumanisme. Cette utopie croit à la toute-puissance de la technique. Et si l’intelligence humaine est manifestement insuffisante, il suffit de faire appel à l’intelligence artificielle.
Si dans l’utopie écologique il s’agit de rendre l’homme compatible avec la nature, ici il s’agit, ici, de rendre l’homme compatible avec l’intelligence artificielle. Et elle promet tant de choses, une meilleure santé, la diminution du risque. Il faudra que je revienne sur ce que la Chine réalise dans le domaine de la reconnaissance faciale, le big data et la notation généralisée des citoyens. Je pourrais appeler ce futur mot du jour « l’œil de Pékin ». Cet univers de contrôle généralisé permet de vivre en bien meilleure sécurité puisque cette technique a pour ambition la prédiction des crimes et donc de les éviter. Et puis avant d’entreprendre une quelconque relation économique, sentimentale ou de travail avec quelqu’un vous pourrez d’abord consulter la base de données des chinois pour connaître la note qui lui est attribuée. C’est cela la diminution du risque !
Mais pour l’instant les plus grandes évolutions se trouvent en Californie.
Elon Musk, né en 1971, PDG de la société Tesla et maintenant de Space X. Il réalise des prodiges et pense que l’homme et l’intelligence artificielle sont en capacité de réaliser des performances que nous ne pensons pas possible aujourd’hui. Il est tout à fait d’accord avec les écologistes : la terre ne pourra bientôt plus supporter l’empreinte humaine sur ses ressources. Lui ne croit pas que l’humanité est prête à des ruptures de comportement. Il est même probable, que pour sa part il ne le souhaite pas. Donc lui envisage très sérieusement de créer les instruments, les vaisseaux et l’infrastructure permettant aux humains, à quelques humains seraient plus juste, de quitter la planète pour coloniser d’autres endroits de l’espace. Dans sa réflexion actuelle il pense possible de créer des conditions de vie sur mars.
Je ne sais pas jusqu’où ira cette utopie, mais pour les prémices elle est en marche et même dans un rythme soutenu. L’outil de contrôle général de la population chinoise a des probabilités fortes d’être mis en œuvre et assez rapidement. L’intelligence artificielle est dans une phase exponentielle de développement, le domaine de la santé et toute l’activité humaine vont être bouleversés.
Ces réflexions m’ont été inspirées par de nombreuses lectures, mais particulièrement par deux émissions :
- La première mettait face à face Laurent Alexandre et le mathématicien Olivier Rey. Laurent Alexandre qui a écrit « La guerre des intelligences » et dont j’avais évoqué une présentation au Sénat sur l’intelligence artificielle est ambigüe. Dès qu’il s’exprime on le sent enthousiasmé par les perspectives que révèlent l’intelligence artificielle. Mais dès qu’on le contredit qu’on le pousse dans ses retranchements, il prétend qu’il n’aime pas du tout ces évolutions et qu’il s’en méfie beaucoup. La position mathématicien Olivier Rey, auteur notamment de «Quand le monde s’est fait nombre» est plus claire, il est très méfiant. Cette confrontation est très féconde. Voici cette émission : <Répliques du 23/12/2017>.
- La seconde avait pour sujet l’exploitation spatiale, sa privatisation, le concept du « new space ». Il était question de l’accélération technique, de la rencontre entre le spatial, le numérique et l’intelligence artificielle et aussi d’Elon Musk. Voici cette émission <Affaires étrangères du 30/12/2017>
Et puis si vous voulez en savoir davantage sur l’évolution de la Chine, vous pouvez utilement lire cet article : <le big data pour noter les citoyens>
<998>
- La première est la plus ancienne, elle fait appel à la spiritualité, à Dieu pour espérer d’une manière ou d’une autre un monde meilleur.
-
Mardi 9 janvier 2018
« Pour la première fois de l’histoire de l’aviation : le transport aérien commercial de passagers n’enregistre aucun décès à bord des avions de plus de 20 sièges en 2017. »Aviation Safety Network, agence qui recense les accidents d’avionVous savez qu’il faut se méfier des chiffres, les interroger et surtout se demander s’il s’agit d’un chiffre dur ou d’un chiffre mou comme je l’avais développé lors du mot « des chiffres et des hommes ».
Cette fois nous sommes dans un chiffre dur, qui a du sens, qui est indiscutable et qui est positif.
C’est un chiffre révélé par Aviation Safety Network, l’année 2017 a été la plus sûre pour le transport aérien depuis 1946 et l’établissement de statistiques sur les accidents d’avions.
Un article du Point du 1er janvier 2018 détaille un peu cette statistique.
Quatre milliards de passagers ont voyagé en 2017.
Si des blessés sont à déplorer lors d’une centaine d’accidents en 2017, le transport aérien commercial de passagers n’enregistre aucun décès l’année passée à bord des avions de plus de vingt sièges. Une première dans l’histoire de l’aviation. […] Le premier accident avec des morts impliquant des avions assurant le transport de passagers à titre commercial et payant s’était produit le 7 avril 1922 avec la collision en vol de deux appareils assurant des liaisons entre Londres et Paris.
Depuis, la sécurité du transport aérien n’a cessé de progresser. En 2016, les statistiques montraient déjà qu’aucun accident n’avait touché les passagers des compagnies occidentales. Ce qui met en valeur l’efficacité des mesures de sécurité des vols concernant la formation des équipages, la maintenance et les opérations aériennes mises en place notamment par la Federal Aviation Administration (agence fédérale américaine) et l’Agence européenne de la sécurité aérienne.
[…] La moyenne annuelle de ces dix dernières années est de 32 accidents avec 676 morts, faisant du transport aérien le moyen de déplacement le plus sûr. Quatre milliards de passagers ont pris l’avion l’an dernier, et ce chiffre devrait doubler d’ici à 2036. En 2017, les accidents mortels ne concernent que des vols cargo ou des avions de moins de vingt sièges, comme hier encore avec le crash d’un hydravion en Australie et aussi d’un vol touristique au Costa Rica.
Comme commentaires de cet article on peut lire :
« Ne parlez pas de malheur !
Ce n’était pas la peine de communiquer sur ce statistique.
Vous allez nous porter la poisse pour les mois à venir. »
Ou encore
« Stupidité de journaliste
Pourquoi annoncer une telle chose, vous voulez porter la guigne et nous annoncer un crash demain ? »
Que dire de tels propos ?
Que ces gens ne savent ce qu’est un chiffre dur ?
Qu’ils sont superstitieux et peu rationnels.
Et que même s’il y avait des morts, par malheur, dans des avions commerciaux en 2018, l’aviation commerciale reste le moyen de transport le plus sûr qui existe.
Et cela parce qu’il y a beaucoup de régulation, de règles et de contrôles de sécurité.
Cela pourrait donner des idées à d’autres domaines de l’économie…
<997>
-
Lundi 8 janvier 2018
« Soyez heureux ! »Le père d’Ivan Jablonka à ses enfantsC’est une tradition. Un acte incontournable : en début d’année, il faut souhaiter les vœux.
Mais que dire ?
Comment ne pas tomber dans l’ennui, la routine ?
Vendredi, 5 janvier à 7h50, j’écoutais France Inter et Ivan Jablonka était l’invité d’Ali Baddou pour présenter son dernier livre : « En camping car »
Dans ce livre, il raconte ses vacances familiales avec ses parents en combi Volkswagen :
« Sans doute le moment de mon enfance où j’ai été le plus heureux, le plus libre ».
Quelquefois bien sûr, il y avait des disputes entre les enfants, alors :
« Notre père nous engueulait en disant : Soyez heureux ! »
« Soyez heureux ! »
Présenté comme cela, cela semble un peu banal, presque niais. Mais pour comprendre la force de cette injonction paternelle il faut aller un peu plus loin. Ivan Jablonka, né en 1973, est un historien. Il est professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-XIII-Nord. Il est aussi écrivain et il a eu le Prix Médicis en 2016 pour « Laëtitia ou la fin des hommes ».
Mais, c’est avant tout un historien, après des études en khâgne au lycée Henri-IV, il intègre l’École normale supérieure et est reçu à l’agrégation d’histoire en élève d’Alain Corbin, l’historien de toutes les sensibilités qui avait fait l’objet du mot du jour du 30 Juin 2016 pour son livre : « Histoire du silence »
En 2012, il avait écrit un livre sur sa famille : « histoire des grands parents que je n’ai pas eus ».
Télérama résume cette histoire :
« Matès Jablonka, son grand-père, né en 1909, habita dans le shtetl de Parczew. Une bourgade de Pologne où les Juifs, isolés par l’antisémitisme, vivent, travaillent, prient. […] Matès, artisan du cuir, homme joyeux et obstiné, cherche à s’échapper des superstitions religieuses comme des persécutions en devenant communiste. Militant clandestin, il fera de la prison. Sa femme, la belle Idesa, née en 1914, sera également militante. Chacun de leur côté, en 1937 et en 1938, ils gagnent la France, le pays de la liberté pour tant d’immigrés politiques. Mais là, ils seront vite les victimes d’une législation suspicieuse. Fichés comme étrangers illégaux, ils se réfugient entre Belleville et Ménilmontant, travaillent à domicile, esquivant les contrôles d’identité et bataillant pour nourrir leurs deux enfants.
A la déclaration de guerre, une nouvelle fois humilié par la hiérarchie militaire, Matès s’engagera dans la Légion étrangère. Puis, le 25 février 1943, Matès et Idesa seront pris lors d’une rafle, expédiés à Drancy par la police française et déportés à Auschwitz II-Birkenau. Ce sont des faits avérés. Mais les rapports de police sur papier carbone suffisent-ils à résumer la vie de Matès, 1,62 m, et d’Idesa, 1,56 m ? Quels sont les pensées et les espoirs d’Idesa quand elle gagne la France ? Matès reste-t-il communiste ? Impossible de le savoir. « Faire de l’histoire, c’est prêter l’oreille à la palpitation du silence », écrit Ivan Jablonka. C’est tisser la grande Histoire avec les histoires humaines, identifier tous les leviers qui infléchissent les itinéraires personnels. »
Les grands-parents Matés et Idesa, seront assassinés à Auschwitz. Leur fils, le père d’Ivan Jablonka, celui qui quelques années plus tard engueule ses enfants p
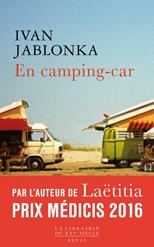 ar ces mots : « Soyez heureux ! », a grandi dans les institutions réservées aux orphelins de la Shoah, dirigées par la Commission centrale de l’enfance, une organisation juive communiste.
ar ces mots : « Soyez heureux ! », a grandi dans les institutions réservées aux orphelins de la Shoah, dirigées par la Commission centrale de l’enfance, une organisation juive communiste.
Ivan Jablonka explique :
« Pour mes parents, le bonheur était une question de vie ou de mort […] Il fallait être heureux parce que nos ancêtres ne l’avaient pas été. […] ce bonheur qu’il n’ont pas eu, ils nous l’on donné, comme leur manière de résister, «un extraordinaire cadeau», poursuit l’écrivain, qui a raconté l’histoire de ses grands-parents juifs lors de la Seconde Guerre Mondiale. »
C’est donc à l’issue d’une histoire tragique et terrible que ce père a donné à ses enfants cette clé : « Soyez heureux ! »
Existe-il un vœu finalement plus exaltant pour l’année nouvelle ? : « Soyez heureux ! »
<996>
-
Lundi 25 décembre 2017
« L’œuf alsacien pèse 50 grammes ! »Solution donnée par une vieille alsacienne à un lorrain qui loupait les gâteaux de noël alsaciensNoël est une fête chrétienne, puisqu’elle célèbre la naissance de leur Messie.
Nous savons que la date qui a été choisie permettait de remplacer une fête païenne située autour du solstice d’hiver, moment particulier de l’année solaire où les jours recommencent à croitre. C’est le recul de la nuit !
Notre civilisation occidentale, avec son consumérisme exacerbé, en a fait une immense fête commerciale, jusqu’à la nausée.
C’est pourquoi certains, dont je fais partie sont très mal à l’aise avec cette fête.
Ce malaise est d’ailleurs plus général, dans la mesure où toutes forces politiques qui gouvernent et les forces économiques qui dominent n’ont qu’une solution à proposer : la croissance. La croissance, cela signifie l’extension sans fin de la marchandisation du monde et une consommation de plus en plus étendue.
J’entends bien, de ci delà quelques prophètes de la décroissance s’exprimer ou d’autres célébrer la sobriété heureuse. Mais ils ne décrivent pas un monde crédible sans une intervention d’une administration mondiale régulatrice et contraignante. Sans compter que pour l’instant, dans l’histoire de l’humanité, de telles bureaucraties ont toujours dérivé vers des régimes d’oppression et encore plus corrompus que nos régimes libéraux, la division du monde ne permet pas de croire à échelle humaine à une telle gouvernance mondiale.
Et puis, tout dans le comportement des masses mondiales et françaises ne va pas dans ce sens, je veux dire d’une moindre addiction à la consommation frénétique.
Noël est aussi une fête où, dans nos contrées, les familles se réunissent. Cet aspect de Noël est positif et bienveillant. Ce fondement de la fête est dur à vivre pour celles et ceux qui sont privés de famille ou dont la famille est désunie et non accueillante.
 Pour le lorrain que je suis, il y a encore une autre joie de noël, c’est la période où on fait et on mange des gâteaux de Noël. Gâteaux de Noël dont beaucoup relèvent de la tradition de la région voisine et rivale : l’Alsace.
Pour le lorrain que je suis, il y a encore une autre joie de noël, c’est la période où on fait et on mange des gâteaux de Noël. Gâteaux de Noël dont beaucoup relèvent de la tradition de la région voisine et rivale : l’Alsace.
Munis de recettes j’essayais vainement de réussir les gâteaux à l’anis et les macarons comme les faisaient ma mère.
Le plus souvent j’échouais.
Jusqu’à avoir entendu, via notre amie Françoise, l’avis d’une vieille cuisinière alsacienne.
Les recettes traditionnelles alsaciennes nécessitent un savant équilibre entre la farine, le sucre, le beurre, les noisettes, les amandes etc… ET LES ŒUFS.
Quand on vous écrit qu’il faut 600 grammes de farine et 500 grammes de sucre et 6 œufs entiers. Les 6 œufs pèsent chacun 50 g, et donc les 6, 300g. Si vos œufs pèsent 400 g ou 220 g, l’équilibre de la recette est rompu. Dans ces cas vos gâteaux s’effondrent lamentablement ou sont trop secs, en tout cas présentent un aspect dégradé.
Les alsaciens sont des gens rigoureux et normés, c’est pour cela que nous autres lorrains avons parfois du mal avec eux.
En tout cas, dans les recettes alsaciennes : un œuf pèse 50g, le blanc 30g et le jaune 20.
C’est ainsi, cela ne se discute pas.
Pour être complet, dans certains gâteaux les œufs n’ont pas la même importance et dans ces cas-là l’approximation n’est pas dirimante.
Mais pour les macarons aux amandes ou les gâteaux à l’anis aucune dérive n’est acceptée !
Avec les gâteaux de Noël, la fête de Noël redevient un enchantement.
<995>
-
Vendredi 22 décembre 2017
« La vie secrète des arbres »Peter WohllebenLe mot du jour va s’interrompre pour une sorte de trêve de Noël que je préfère à la formule « la trêve des confiseurs ».
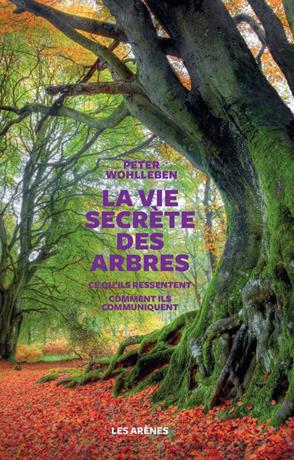 Juste avant Noël, je voudrais partager avec vous un livre que nous avons acheté, Annie et moi, pour nous l’offrir « La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben
Juste avant Noël, je voudrais partager avec vous un livre que nous avons acheté, Annie et moi, pour nous l’offrir « La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben
J’ai découvert Peter Wohlleben parce qu’il avait été invité aux « matins de France Culture » du 8 décembre 2017.
Peter Wohlleben est un ingénieur forestier qui a cherché à comprendre la forêt et à décrire la vie des arbres, tout en précisant souvent qu’il y a beaucoup de choses qu’on ne sait pas encore. Selon lui, les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec leurs enfants, et les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité aux dangers. Leur système radiculaire, semblable à un réseau internet végétal, leur permet de partager des nutriments avec les arbres malades mais aussi de communiquer entre eux. Et leurs racines peuvent perdurer plus de dix mille ans…
Dans l’émission, Peter Wohlleben remet les choses en perspective et donne une leçon d’humilité aux hommes :
« Nous avons toujours considéré les arbres comme au service de l’humanité, qui produisent pour nous de l’oxygène. Ce n’est pas ça qu’ils font. Les arbres existent depuis 300 millions d’années, les hommes depuis 300 000 ans, les forestiers depuis 300 ans. »
Emission et recherches passionnantes !
J’ai trouvé une interview dans Libération où il explique son parcours et ce qu’il a appris et aussi compris grâce aux travaux des biologistes :
Enfant, Peter Wohlleben voulait protéger la nature. Devenu forestier, il s’est mis à martyriser les arbres, appliquant les consignes de son employeur, l’administration forestière d’Etat allemande. La forêt qu’il exploitait n’était qu’une source de matière première pour les scieries. Il en savait «autant sur la vie secrète des arbres qu’un boucher sur la vie affective des animaux», se souvient-il. Les visiteurs de sa forêt, située sur la commune de Hümmel, au sud de Bonn, ont tout changé. Leur émerveillement a réveillé sa passion et remis en cause sa façon de travailler.
Les arbres ont tant de facultés :
« Il y en a tant ! On sait qu’ils sont connectés les uns aux autres via les racines et nourrissent ainsi les plus faibles. Une étude de l’université de Vancouver a même montré qu’une «mère-arbre» peut détecter ses jeunes plants avec ses racines. On a mesuré qu’elle soutient davantage ces derniers. Les arbres décident bel et bien avec qui ils se connectent. Et ils ont une mémoire. En cas de sécheresse, le bois se déshydrate, se fissure. L’arbre blessé s’en souvient toute sa vie et change de stratégie dès le printemps suivant en réduisant sa consommation d’eau. Les vieux seraient même capables de partager cette information avec les plus jeunes, de les «éduquer». »
Nous apprenons donc que les arbres communiquent :
« Oui, ils peuvent avertir leurs congénères d’une attaque d’insectes, appeler à la rescousse les prédateurs des parasites. Les ormes se débarrassent des chenilles en émettant des substances attirant des petites guêpes qui pondent dans celles-ci. Les arbres sont capables d’identifier la salive des chenilles en la distinguant de celle d’un cervidé et ainsi adopter la stratégie de défense adaptée. Si c’est une biche qui les croque, ils envoient dans leurs rameaux des substances toxiques ou amères. Ce qui prouve qu’ils ont le sens du goût. Ils peuvent aussi «voir» la longueur des jours, «sentir» des messages olfactifs ou la température de l’air. Ils sont peut-être même dotés de l’ouïe : il a été prouvé que les racines de céréales émettent un son et que celles des plantes alentour se dirigent alors dans cette direction. »
Peter Wohlleben parlent aussi des nombreuses questions non résolues, par exemple de la mémoire :
« En premier lieu, où les arbres stockent-ils leur mémoire ? Ils n’ont pas de cerveau tel que le nôtre. Mais nous savons qu’ils stockent les connaissances acquises. Par exemple, ils comptent les journées chaudes au printemps pour éviter de fleurir trop tôt. Ils savent que trois jours chauds ne suffisent pas, qu’il faut encore attendre. Sans mémoire, chaque jour serait compté comme étant le premier. Ensuite, j’aimerais savoir s’ils communiquent sur d’autres sujets que les dangers détectés. Je rêve d’un dictionnaire chimique permettant d’analyser leurs messages olfactifs. Peut-être parlent-ils de la météo, de ce qu’ils ressentent. Notre nez peut déjà déceler certains signaux. Une odeur aromatique, l’été, dans les forêts de conifères signifie qu’ils s’avertissent : il fait trop sec, trop chaud, des insectes attaquent… Ces forêts sont le plus souvent plantées, donc vulnérables. Malgré la senteur agréable et même si nous n’en avons pas conscience, notre corps perçoit l’appel à l’aide. Des recherches ont montré que notre pression artérielle augmente dans ce type de forêts et baisse dans celles de feuillus intacts, qui échangent sans doute des signaux de bien-être. Nombre de visiteurs de notre réserve de hêtres me disent qu’ils s’y sentent chez eux, dans leur élément. »
Il insiste aussi beaucoup sur la solidarité qu’ils manifestent les uns à l’égard des autres. C’est encore la culture de l’entraide.
La journaliste de Libération lui pose la question de son excès d’anthropomorphisme pour parler des arbres. Il y répond simplement :
Quand j’ai commencé à animer des visites guidées, j’abordais des notions trop ardues, je décrivais les arbres sans langage imagé, les gens s’ennuyaient. J’ai appris à parler de façon compréhensible, en faisant appel aux émotions. Et on ne peut comparer qu’avec ce qu’on connaît. Quand je dis qu’une mère-arbre allaite ses plantules grâce à la connexion de leurs racines, chacun comprend.
Parce que bien entendu les arbres sont très différents des humains par exemple il communique de manière très différente de nous. Ils ne parlent pas mais cela n’empêche pas les arbres de communiquer. En émettant des substances odorantes, ils échangent chimiquement, et électriquement aussi. Il suffit de soulever un bout de terre en forêt pour découvrir des filaments blancs. Il s’agit d’hyphes de champignons, qui participent, avec les racines, à la transmission d’informations sur la sécheresse du sol, une attaque d’insectes ou tout autre péril. Ces fils, qui fonctionnent sur le même principe qu’Internet, forment un réseau souterrain si dense que des scientifiques l’ont baptisé le « Wood Wide Web ». Difficile de déterminer le type et le volume d’informations communiquées tant la recherche est embryonnaire sur le sujet.
Il aborde encore beaucoup d’autres aspects celui du temps des arbres qui n’est bien sûr pas celui des humains et celui de l’interventionnisme des hommes dans les forêts qu’il juge contre-productive :
« Moins on intervient, plus une forêt est équilibrée, saine, résistante aux maladies ou aux tempêtes. Protéger une forêt ne nous fait pas perdre en qualité de vie, au contraire. Seule l’industrie du bois y perd. L’idée n’est pas de les protéger toutes – nous en sommes d’ailleurs très loin : en Allemagne, à peine 1,9 % des forêts le sont. Car nous aurons toujours besoin de bois, ne serait-ce que pour produire du papier. Mais nous pouvons changer nos pratiques. Une forêt exploitée subit toujours des dommages, mais on peut les minimiser. Pour sortir les troncs, mieux vaut des chevaux de trait que des engins qui tassent le sol. Quand ce dernier est détruit, il l’est pour toujours et ne peut plus stocker assez d’eau. Il faut aussi bannir les pesticides, car un écosystème est comme une horloge : si vous en détruisez un rouage, il ne fonctionne plus. Or c’est ce que font les produits chimiques. […]
Le temps des humains ne correspond pas à celui des arbres. On veut des résultats rapides, d’où toutes ces plantations où les arbres grandissent vite mais sont fragiles. Restaurer une forêt primaire prend cinq cents ans. Cela paraît énorme, mais c’est la longévité normale d’un arbre. Or, quand vous laissez les forêts vieillir, elles régulent le climat. Leur microclimat local, mais aussi le climat mondial, en absorbant beaucoup de CO2. Des recherches ont été faites sur des forêts de hêtres. Les chaudes journées d’été, celles laissées intactes sont plus fraîches de 3,5°C en moyenne que celles exploitées. Les forêts peuvent nous aider à lutter contre le changement climatique, à condition que nous leur permettions de faire leur job. »
Un autre article rapporte la solidarité et la « la vie sociale » des arbres :
« Par ailleurs, l’arbre a tendance à créer des colonies. Sexué, dans la forêt, il distribue des graines autour de lui et parvient ainsi à se reproduire. Dans le même temps, ses racines grandissent et s’étendent alentour, permettant à ses descendants de pousser. Le Dr Suzanne Simard, professeur d’écologie forestière à l’université de la Colombie-Britannique, parle même d’«arbres-mères qui allaitent leurs enfants», leur assurant un approvisionnement régulier à travers les champignons mycorhiziens qui entretiennent des relations avec leurs racines. Ces champignons, véritables partenaires des arbres, poussent sous la surface du tapis forestier et créent des interconnexions, donc des échanges d’une plante à l’autre même lorsqu’elles appartiennent à des espèces différentes. »
Tout un monde ignoré. Un monde d’intelligence partagée et de solidarité.
Un film a été réalisé à partir du livre : « L’intelligence des arbres ».
Vous en trouverez un extrait <ICI> et vous pourrez enchainer sur 4 autres.
Le prochain mot du jour sera publié, sauf force majeure, le lundi 8 janvier 2018
<994>
-
Jeudi 21 décembre 2017
« Donald Trump est toujours président des Etats-Unis »Constatation de la réalité alors que son biographe nous avait donné l’espoir qu’il démissionnerait à l’automne.Aujourd’hui j’exerce un droit de suite.
Le mot du jour du 28 août 2017 donnait cette prédiction :
« Mais si on peut croire le biographe de Trump, nous serons bientôt débarrassés de cet <histrion>, car comme <Le Point> le relate l’écrivain américain Tony Schwartz qui est l’auteur des mémoires du milliardaire, The Art of the Deal (1987) est persuadé que l’affaire russe aura raison de la présidence du 45e président des États-Unis et que ce dernier démissionnera dès l’automne. Le 21 décembre, nous serons à la fin de l’automne et nous examinerons si cette prédiction hardie s’est révélée exacte. »
Nous sommes le 21 décembre, jour du solstice d’hiver, donc fin de l’automne. Force est de constater que Donald Trump est toujours président des Etats-Unis. C’était donc encore une fake news !
Donald Trump, récemment, pour garder le soutien des évangélistes, a accepté que l’ambassade des Etats-Unis soit transférée de Tel-Aviv à Jérusalem.
Mais ce n’est que l’écume des choses.
En profondeur et en plein accord avec la majorité républicaine, il a fait passer une baisse énorme des impôts.
Vous pouvez lire cet article de « Nouriel Roubini »
Parallèlement un groupe d’économistes dont Thomas Picketty ont publié un nouveau rapport sur les inégalités mondiales, dont vous trouverez une synthèse : <ICI>.
Les inégalités croissent au niveau des revenus, comme au niveau des patrimoines.
Elles ne croissent pas dans les mêmes proportions dans toutes les régions du monde, elles croissent davantage aux Etats-Unis qu’en France et en Europe.
Résumons la situation en quelques mots :
Trump a été élu par les blancs et même les blanches qui ont oublié le machisme de cet homme. C’étaient les blancs de la classe moyenne qui ont constaté que leurs revenus stagnaient depuis 30 ans.
Dans le rapport sur les inégalités on comprend que les Etats-Unis sont toujours en croissance mais que cette croissance profite à un très petit nombre d’individus.
Les Etats-Unis, par les brevets, la recherche et le développement, la créativité continuent à dominer largement le monde. Mais des entrepreneurs avisés ont compris que pour faire davantage de profits il faut délocaliser la partie matérielle et industrieuse de l’activité.
Le problème essentiel est donc, pour les classes moyennes blanches américaines, un problème de répartition des richesses entre américains, en amont sur les revenus, en aval de redistribution par les impôts.
Non seulement Donald Trump ne règle pas le problème, mais il l’aggrave. Mais je rappelle qu’il n’est pas seul, sur ce point le Parti Républicain le soutient pleinement.
Le pire c’est que je suis persuadé qu’à terme ce processus est aussi délétère pour les plus riches.
<993>
-
Mercredi 20 décembre 2017
« Mais je suis persuadé qu’on arrive dans l’âge de l’entraide parce que ce sont les plus individualistes qui crèveront les premiers. »Pablo ServigneAvant d’écrire le livre sur l’entraide évoqué lundi, Pablo Servigne associé à Raphaël Stevens avait écrit en 2015 : « Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes »
Ils avaient inventé à cette occasion le mot «collapsologie» du latin collapsus «qui est tombé en un seul bloc » et qui a pour définition : « Étude multidisciplinaire de l’effondrement des civilisations industrielles et de ses suites. »
Pablo Servigne et ses collègues voudraient en faire une discipline scientifique. Ils ont d’ailleurs consacré un site à cet effet : http://www.collapsologie.fr/
Pour poursuivre la réflexion de lundi et de mardi, je voudrai partager un article auquel Pablo Servigne a participé à la suite de la publication de son livre et de ses réflexions sur la collapsologie.
Dans cet article il écrit par exemple :
« On croit souvent que le progrès est naturel. En fait, ce sont des choix politiques. Des élites au pouvoir ont imposé le pétrole, par exemple. Ça a créé des monopoles et on a détruit les trains, les trams et les autres sources d’énergie. Un régime énergétique fait émerger un régime politique. C’est bien montré dans Petrocratia (Editions Ere, 2011), de Timothy Mitchell. Le charbon a permis l’émergence de la démocratie de masse et des mouvements ouvriers ; l’arrivée du pétrole a détruit ces mouvements par la qualité même de cette énergie et a mis au pouvoir une élite technocratique. Le changement climatique est connu depuis longtemps. Les élites ont décidé de l’ignorer pour faire plus d’argent. Par ailleurs, des théories disent que notre cerveau n’est pas façonné pour voir les problèmes à long terme et à grande échelle. »
Son propos parle d’effondrement et il l’analyse de la manière suivante :
« Certains scientifiques parlent de limits (« limites »), d’autres de boundaries (« frontières »). Prenons la métaphore de la voiture. Notre société ne va pas dans le mur, mais elle a deux problèmes. D’abord, le réservoir (les limites). Une fois qu’il n’y a plus d’essence, on ne peut pas aller plus loin. L’autre, ce sont les frontières, la transgression de certains seuils qui dérèglent le système-terre. Ça, c’est le bas-côté. On est sortis de la route goudronnée, on navigue à vue dans un monde incertain, avec la possibilité de grands chocs. On est sortis des conditions normales. C’est ça dont il faut prendre acte. Parmi les frontières, il y a le climat, la biodiversité, le cycle de l’azote, celui du phosphore… Les entomologistes parlent d’effondrement des insectes – pas seulement des abeilles –, il y a un effondrement des populations d’oiseaux, de poissons, des grands mammifères…
[…]
Il peut y avoir des étincelles climatiques ou dues au manque de ressources, mais il est plus logique de penser que les crises financières jouent un rôle moteur et qu’elles peuvent se transmettre à l’économie. Ça peut ensuite muter en effondrement politique. Avec une crise financière, il n’y a plus rien dans les distributeurs de billets ; avec une crise économique, plus rien sur les étalages. L’effondrement politique, c’est l’apparition de mafias, de l’économie informelle, de la corruption et la machine de l’Etat se déglingue. C’est le bloc soviétique dans les années 1990. »
Il explique aussi que les interconnexions de notre monde conduisent à sa fragilité :
« En un sens, notre monde est assez résilient : en cas de choc économique dans une région, il y a tellement de commerce et de réseaux qu’il est finalement rapidement absorbé. Mais on a découvert récemment que, quand un système devient hyperconnecté et très homogène, comme notre économie mondiale, il est résilient au début mais se fragilise en silence, jusqu’à dépasser un seuil qui provoque un effondrement brutal. Alors que les systèmes très peu connectés et très hétérogènes, comme ceux d’avant la mondialisation, encaissent moins bien les chocs, mais sont plus résilients à long terme. Avec la mondialisation est né le risque systémique global. Pour prendre un exemple, imaginons qu’un champignon ravage la production de blé d’une année dans la Beauce. Au Moyen-Age, ça n’aurait pas impacté beaucoup les autres régions, car elles étaient moins connectées et chacune avait ses céréales. Aujourd’hui, l’impact serait fort partout. Et il y a des effets en cascade. Il y a quelques années, des pluies torrentielles en Thaïlande ont provoqué l’explosion des cours des disques durs ! Notre système est beaucoup plus efficace… et plus fragile. »
Dès la rédaction de ce premier ouvrage, Pablo Servigne pensait que l’entraide devait être valorisée et prendre toute sa place dans notre imaginaire :
« On sait aussi que l’entraide et la coopération peuvent se créer contre un ennemi : une guerre, ça soude un peuple ! Mais je suis persuadé qu’on arrive dans l’âge de l’entraide parce que ce sont les plus individualistes qui crèveront les premiers. »
Lui-même a choisi de vivre dans un éco-hameau en Ardèche :
« Ce n’est pas la panacée ! J’ai fait ce choix du monde rural et du soleil parce que j’ai des jeunes enfants, que j’ai vécu vingt ans en Belgique et que j’en avais marre de la pluie ! Surtout, je voulais expérimenter la vie collective. C’est passionnant, mais c’est dur. Je pense qu’une grande partie de la résilience, c’est l’environnement affectif et social : la famille, les amis, les voisins, les élus communaux… C’est plus important que l’argent ou les stocks de nourriture. L’essentiel, c’est de retrouver du collectif. En ville ou à la campagne. La ville a des forces : beaucoup de gens, de culture… En temps d’incertitude, il n’y a pas un modèle à appliquer, c’est l’intuition qui compte. »
Je trouve préférable d’entrer dans la réflexion de Pablo Servigne par son dernier ouvrage centré sur l’entraide que par celui-ci qui explique l’effondrement possible de notre civilisation.
Rappelons cependant que le pire n’est jamais certain.
<992>
-
Mardi 19 décembre 2017
« Et de nos jours encore, c’est dans une plus large extension de l’entraide que nous voyons la meilleure garantie d’une plus haute évolution de notre espèce. »Pierre Kropotkine dans « L’entraide, un facteur de l’évolution »Pablo Servigne a expliqué que le titre du livre qu’il a écrit avec Gauthier Chapelle : « L’entraide, l’autre loi de la jungle » doit beaucoup à Pierre Kropotkine que j’ai découvert à cette occasion.
Dans l’émission la Grande Table dont il était question hier, Pablo Servigne présente cet homme de la manière suivante :
« Kropotkine était un prince russe et quand il était jeune il a aimé la lecture de Darwin. Il a refusé un poste dans l’armée à Moscou et a préféré partir en scientifique en Sibérie, pour vérifier les idées de Darwin. Darwin était parti dans un pays d’abondance, alors que Kropoktine est parti en milieu hostile où régnait la pénurie. Et ce que Kropotkine a observé pendant des années, c’est plutôt que les êtres vivants s’entraident.
Et mieux, ceux qui survivent ne sont pas forcément les plus forts, ce sont ceux qui s’entraident. Et il en a écrit un livre qui s’appelle « l’entraide un facteur d’évolution.[…] Il a été oublié, mais aujourd’hui les scientifiques recommencent à le citer, depuis les années 2000, on va dire, parce qu’il avait apporté cette idée majeure : l’entraide n’a pas pour cause la génétique [on est dans l’entraide parce qu’on est proche génétiquement] l’altruisme et l’entraide émergent dans la nature par les conditions du milieu hostile Et c’est le fait qu’on s’associe qui permet la survie. Et c’est pour cela qu’on recommence à citer Kropotkine. »
Pablo Servigne explique aussi qu’il avait été oublié par les milieux politiques parce qu’il était anarchiste. Les marxistes n’aimaient pas les anarchistes et n’aimaient pas non plus les arguments biologiques. L’idée de Kropotkine était incroyable, il faut plutôt lutter contre l’Etat, car c’est en détruisant l’Etat qu’on pourra faire sortir les capacités altruistes de l’être humain. Les marxistes quant à eux pensaient pouvoir créer un homme nouveau sur une page blanche à partir de l’idéologie.
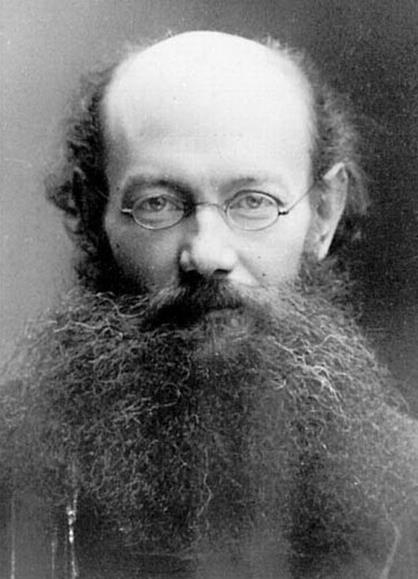 Cette introduction m’a conduit à essayer d’en savoir un peu plus sur cet homme qui a été confronté à la fin du régime tsariste, les révolutions russes et le début du régime Bolchevique.
Cette introduction m’a conduit à essayer d’en savoir un peu plus sur cet homme qui a été confronté à la fin du régime tsariste, les révolutions russes et le début du régime Bolchevique.
Quand on s’intéresse à Pierre Kropotkine, sa dimension d’anarchiste apparaît en premier. Il est très présent sur des sites libertaires et anarchistes.
Pierre Alexeïevitch Kropotkine est né le 26 novembre 1842 à Moscou (Russie) et il est descendant de la famille du grand-prince de Kiev. Il embrasse donc la carrière militaire et ayant conquis ses galons d’officier, demanda, comme nous l’a appris Pablo Servigne à être affecté à un régiment de Cosaques en Sibérie. Il peut ainsi explorer le bassin du fleuve Amour et la Sibérie orientale. Un évènement marquant va décider de son avenir et probablement de certaines de ses idées politique : l’insurrection polonaise de 1863 et la terrible répression qui s’en suit. Cet évènement provoque sa démission de l’armée impériale russe. Il s’installe à Saint-Pétersbourg où il suit des études de mathématiques et de géographie. Au début des années 1870, il voyage en Extrême-Orient puis en France et en Suisse. C’est au cours d’un ces voyages à l’étranger qu’il se rapproche des milieux anarchistes et surtout des Nihilistes. En 1872, il adhère à la Fédération jurassienne de la Première Internationale et se rallie au groupe révolutionnaire de Mikhaïl Bakounine, qui s’oppose alors à Karl Marx.
Wikipedia nous apprend en outre :
« Qu’en raison de son activité d’anarchiste, il est arrêté à Lyon en 1883 et puis condamné à 5 ans de prison. Une pétition pour sa remise en liberté est signée par Victor Hugo et il est amnistié en 1886.
Après des années d’exil, il retourne en Russie en 1917, après la révolution de Février. Fidèle à ses convictions anarchistes, il refuse un poste de ministre proposé par Aleksandr Kerenski, même s’il soutient son gouvernement.
Après la révolution d’Octobre, il critique ouvertement le nouveau gouvernement bolchévique, la personnalité de Lénine et la dérive dictatoriale du pouvoir.
Le 8 février 1921, Kropotkine meurt à l’âge de 78 ans, à Dmitrov, près de Moscou. Sa famille et ses amis refusent au gouvernement bolchevique des funérailles nationales, celles-ci sont organisées par une commission composée de militants anarchistes. Le 10 février, le cercueil est transféré à Moscou dans un train orné de drapeaux noirs et de banderoles arborant des slogans comme « Là où il y a autorité, il ne peut y avoir de liberté », « Les anarchistes demandent à être libérés de la prison du socialisme » ou « La libération de la classe ouvrière, c’est la tâche des travailleurs eux-mêmes ». Le cercueil est exposé durant deux jours dans la salle des colonnes de la Maison des syndicats, au fronton de laquelle est accroché un énorme calicot portant une inscription dénonçant le gouvernement bolchevique et sa répression.
L’enterrement a lieu le 13 février. Bravant le froid, 20 000 Moscovites suivent le cortège qui s’arrête une première fois au musée Léon Tolstoï où est jouée la Marche funèbre de Frédéric Chopin, puis une seconde fois au niveau de la prison de la Boutyrka où s’entassent nombre de prisonniers politiques qui manifestent en frappant sur les barreaux. Kropotkine avait demandé que ne soit pas chantée L’Internationale lors de ses funérailles, tant elle ressemblait déjà « à des hurlements de chiens faméliques ».
L’enterrement de Kropotkine est la dernière manifestation libertaire de masse sous un gouvernement bolchevique. Dès le mois de mars, toutes les organisations anarchistes sont interdites, leurs militants persécutés. »
Mais ce qui m’intéresse précisément chez cet homme c’est son étude qui nuance la théorie de Darwin sans la contredire. Il a donc écrit ce livre dont parle avec admiration Pablo Servigne : « L’entraide, un facteur de l’évolution »
Un article de Mediapart revient sur cet ouvrage en éclairant le nouveau livre de Servigne et Chapelle :
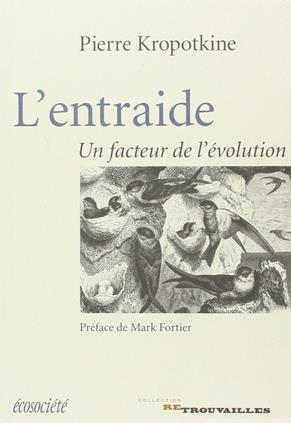 [..] un récit différent du passé, initié par la figure géniale de Pierre Kropotkine, prince de famille royale, géographe et scientifique, qui préféra, à un destin familial tout tracé, partir en Sibérie, l’année même où Darwin publie De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle (1859). Il « y observe surtout de l’entraide – des espèces animales, comme les loups, et des petites sociétés sans État, qui s’associent pour survivre dans des conditions climatiques difficiles, voire hostiles ». Kropotkine est ainsi le premier « à mettre en évidence le rôle fondamental des conditions environnementales dans l’évolution de l’entraide ». Il est d’ailleurs, jugent les chercheurs, « intéressant de constater que Darwin a effectué ses observations principalement sous les tropiques, un milieu de relative abondance et de confort thermique comparé à la Sibérie de Kropotkine ».
[..] un récit différent du passé, initié par la figure géniale de Pierre Kropotkine, prince de famille royale, géographe et scientifique, qui préféra, à un destin familial tout tracé, partir en Sibérie, l’année même où Darwin publie De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle (1859). Il « y observe surtout de l’entraide – des espèces animales, comme les loups, et des petites sociétés sans État, qui s’associent pour survivre dans des conditions climatiques difficiles, voire hostiles ». Kropotkine est ainsi le premier « à mettre en évidence le rôle fondamental des conditions environnementales dans l’évolution de l’entraide ». Il est d’ailleurs, jugent les chercheurs, « intéressant de constater que Darwin a effectué ses observations principalement sous les tropiques, un milieu de relative abondance et de confort thermique comparé à la Sibérie de Kropotkine ».
Toutefois, « une deuxième raison pour laquelle Kropotkine a plus facilement observé l’entraide que Darwin tient probablement à sa culture. Éduqué dans les valeurs humanistes des Lumières, il a ensuite beaucoup voyagé en Europe occidentale au contact de la classe ouvrière, qui développait une culture de la solidarité et de l’association ». En outre, sa vision « d’une nature coopérative ne collait pas avec celle de la biologie évolutive moderne, très majoritairement anglophone, imprégnée d’anti-communisme et travaillant de plus en plus sur les gènes et les individus ».
Mais l’originalité de Kropotkine tient surtout « au fait qu’il entre dans le débat politique avec des arguments naturalistes. Partant à la recherche des fondements biologiques de l’entraide, il prend à contre-pied la majorité de la gauche de son époque (dont les partisans de Marx), qui adopte au contraire une conception anti-déterministe de la nature humaine – une vision qui considère que l’être humain n’est pas soumis aux lois de la nature ». Une discordance qui vaudra à Kropotkine des décennies d’oubli de sa pensée et de ses écrits […]
Un des points forts de l’ouvrage est de montrer que, […] c’est dans les conditions les plus difficiles que l’entraide se développe le mieux. Ainsi de la cohabitation entre pins et sapins, « des arbres qui entrent en compétition lorsque les conditions de vie sont bonnes, mais s’entraident lorsqu’elles se durcissent (froid, vent, pauvreté des sols…). Jusqu’à ce qu’une équipe américaine s’intéresse à cela dans les années 1990, on n’avait vu que la moitié du tableau ».
Quand on connaît le titre de l’ouvrage et l’auteur, il est possible de trouver beaucoup de références sur internet.
Mais encore mieux, l’ouvrage intégral est publié sur ce site : <https://fr.wikisource.org/wiki/L’Entraide, un facteur de l’évolution>
Je peux donc vous livrer une partie de la conclusion :
Attribuer le progrès industriel de notre siècle à cette lutte de chacun contre tous qu’il a proclamée, c’est raisonner comme un homme qui, ne sachant pas les causes de la pluie, l’attribue à la victime qu’il a immolée devant son idole d’argile. Pour le progrès industriel comme pour toute autre conquête sur la nature, l’entr’aide et les bons rapports entre les hommes sont certainement, comme ils l’ont toujours été, beaucoup plus avantageux que la lutte réciproque.
Mais c’est surtout dans le domaine de l’éthique, que l’importance dominante du principe de l’entr’aide apparaît en pleine lumière. Que l’entr’aide est le véritable fondement de nos conceptions éthiques, ceci semble suffisamment évident. Quelles que soient nos opinions sur l’origine première du sentiment ou de l’instinct de l’entr’aide — qu’on lui assigne une cause biologique ou une cause surnaturelle — force est d’en reconnaître l’existence jusque dans les plus bas échelons du monde animal ; et de là nous pouvons suivre son évolution ininterrompue, malgré l’opposition d’un grand nombre de forces contraires, à travers tous les degrés du développement humain, jusqu’à l’époque actuelle. Même les nouvelles religions qui apparurent de temps à autre — et toujours à des époques où le principe de l’entr’aide tombait en décadence, dans les théocraties et dans les États despotiques de l’Orient ou au déclin de l’Empire romain — même les nouvelles religions n’ont fait qu’affirmer à nouveau ce même principe. Elles trouvèrent leurs premiers partisans parmi les humbles, dans les couches les plus basses et les plus opprimées de la société, où le principe de l’entr’aide était le fondement nécessaire de la vie de chaque jour et les nouvelles formes d’union qui furent introduites dans les communautés primitives des bouddhistes et des chrétiens, dans les confréries moraves, etc., prirent le caractère d’un retour aux meilleures formes de l’entr’aide dans la vie de la tribu primitive.
Mais chaque fois qu’un retour à ce vieux principe fut tenté, l’idée fondamentale allait s’élargissant. Du clan l’entr’aide s’étendit aux tribus, à la fédération de tribus, à la nation, et enfin — au moins comme idéal — à l’humanité entière. En même temps, le principe se perfectionnait. Dans le bouddhisme primitif, chez les premiers chrétiens, dans les écrits de quelques-uns des docteurs musulmans, aux premiers temps de la Réforme, et particulièrement dans les tendances morales et philosophiques du XVIIIe siècle et de notre propre époque, le complet abandon de l’idée de vengeance, ou de « juste rétribution » — de bien pour le bien et de mal pour le mal — est affirmé de plus en plus vigoureusement. La conception plus élevée qui nous dit : « point de vengeance pour les injures » et qui nous conseille de donner plus que l’on n’attend recevoir de ses voisins, est proclamée comme le vrai principe de la morale, — principe supérieur à la simple notion d’équivalence, d’équité ou de justice, et conduisant à plus de bonheur. Un appel est fait ainsi à l’homme de se guider, non seulement par l’amour, qui est toujours personnel ou s’étend tout au plus à la tribu, mais par la conscience de ne faire qu’un avec tous les êtres humains. Dans la pratique de l’entr’aide, qui remonte jusqu’aux plus lointains débuts de l’évolution, nous trouvons ainsi la source positive et certaine de nos conceptions éthiques ; et nous pouvons affirmer que pour le progrès moral de l’homme, le grand facteur fut l’entr’aide, et non pas la lutte. Et de nos jours encore, c’est dans une plus large extension de l’entr’aide que nous voyons la meilleure garantie d’une plus haute évolution de notre espèce.
Il me semble que cette réflexion et notamment cette dernière phrase est encore plus juste de notre temps.
<991>
-
Lundi 18 décembre 2017
« L’autre loi de la jungle : l’entraide »Pablo Servigne et Gauthier ChapelleOn nous a appris que la nature obéissait à la loi de la jungle, c’est-à-dire la loi du plus fort, qui peut être traduite par la compétition de tous contre tous. On nous explique que la nature est ainsi faite.
Et c’est vrai, cette loi de la nature existe.
Mais ce que les sciences dans de nombreux domaines ont démontré, c’est que n’est pas la seule loi qu’on peut observer dans la nature. Il existe une autre loi de la jungle et cette loi c’est l’entraide, la coopération. La compréhension, l’observation du vivant révèle que les humains, les animaux, les plantes, les champignons et les micro-organismes pratiquent l’entraide.
Et probablement que ceux qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas forcément les plus forts, mais ceux qui s’entraident le plus.
Pablo Servigne et Gauthier Chapelle viennent de publier un livre «L’entraide: l’autre loi de la jungle» aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Pour présenter son ouvrage, Pablo Servigne était l’invité de « La Grande Table » du vendredi 15 décembre.
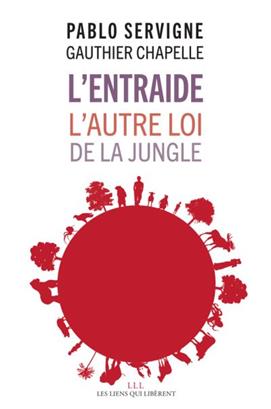 Il avait déjà été question de ce livre dans une autre émission de France Culture <Avis critique du 4 novembre 2017>. Dans cette émission, le présentateur Raphaël Bourgois introduisait cet ouvrage de la manière suivante :
Il avait déjà été question de ce livre dans une autre émission de France Culture <Avis critique du 4 novembre 2017>. Dans cette émission, le présentateur Raphaël Bourgois introduisait cet ouvrage de la manière suivante :
« [C’est un essai] du biologiste Gauthier Chapelle et de Pablo Servigne qui est ingénieur agronome. L’entraide. L’autre loi de la jungle est paru aux éditions Les Liens qui Libèrent… c’est un essai qui entend résumer les travaux scientifiques qui de l’éthologie à l’anthropologie en passant par l’économie, la psychologie et les neurosciences ont entamé l’idée, très ancrée dans la pensée occidentale, selon laquelle c’est la compétition entre les espèces qui est la matrice de l’évolution.
Par la multiplication des exemples, ils montrent sans nier le rôle de la compétition, qu’elle est en réalité trop risquée et consommatrice d’énergie et que la nature lui a bien souvent préféré la coopération ou l’entraide. C’est un véritable défi au cynisme et les auteurs s’en rendent bien compte, ils prennent la peine à plusieurs reprises de bien montrer que leur démarche n’a rien d’irénique… il ne s’agit pas de dire qu’il y a une supériorité morale à la coopération plutôt qu’à écraser son voisin… l’enjeu est aussi l’efficacité et la survie.
Le livre fait une place centrale à l’homme mais montre aussi comment les phénomènes de symbiose… à l’origine par exemple de la formation des barrières de corail… offrent une grille de lecture pertinente pour comprendre les comportements au sein d’un groupe, ou bien des groupes entre eux. »
Au début de l’émission « La Grande Table » Pablo Servigne a défini le concept d’entraide :
« L’entraide est, dans le vivant, tout ce qui associe les êtres : la coopération, le mutualisme, l’altruisme. Il y a tout une diversité de manière d’être ensemble.
On a choisi « entraide », parce qu’il […] a une connotation chaleureuse dans le langage courant. [Mais] c’est surtout un clin d’œil au géographe et anarchiste Pierre Kropotkine qui avait publié en 1902 « Mutual Aid: : A Factor of Evolution », un formidable ouvrage qui a été traduit en français et dont le titre traduit utilisait le terme « entraide » et c’est [ainsi] que ce mot a été offert à la langue française. »
Il y a deux ans, Pablo Servigne avait co-écrit avec Raphaël Stevens, au Seuil, un autre ouvrage qui montrait la situation de l’humanité sous un regard plus inquiétant : «Comment tout peut s’effondrer ». C’était un livre qui évoquait toutes les possibilités qui pouvaient conduire à l’effondrement de notre société. Ce nouveau livre constitue une réponse positive, un espoir pour ce qui s’annonce.
«On peut connecter les deux réflexions. Quand nous avons écrit le précédent ouvrage, nous avions fait une synthèse transdisciplinaire, comme nous le faisons maintenant pour l’entraide. […] C’est en lien avec l’entraide. Quand nous faisons des conférences, très souvent la question vient : « est ce que nous allons tous nous entretuer si notre ordre social venait à disparaître, ou allons-nous plutôt nous entraider ? » Avec Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens nous pensons plutôt que nous arrivons à l’âge de l’entraide.»
La thèse défendue par ces auteurs est qu’il faut combattre l’idée est que la nature est gouvernée par le seul égoïsme, la loi de la jungle, la loi du plus fort. Il y a moyen d’imaginer autre chose. Ils pensent, en fait, que nous ne sommes pas prédestinés à l’égoïsme préprogrammé de nous entretuer, en tout cas pas davantage qu’à l’option de nous entraider :
«Nous sommes toujours à l’heure des choix. […] Ce que l’on remarque surtout c’est que notre société est en train de se décomposer. Je prends la métaphore de l’arbre : Il y a un grand arbre qui s’effondre, mais c’est parce qu’il s’effondre que les jeunes pousses peuvent émerger. Nous sommes à ce moment, à ce carrefour. Il y a plein de jeunes pousses prêtes à se développer, il y a une nouvelle société qui émerge. On le voit avec la société de la collaboration, avec le peer to peer, l’économie collaborative tout cela est en train d’émerger, tout cela est très puissant. Cela ne fait pas encore société, mais on voit un vieux monde qui s’effondre.»
En écho au mot du jour de vendredi, il revient à la critique de l’organisation pyramidale en la confrontant à la nature et à l’organisation du vivant :
«Les entreprises à hiérarchie pyramidale sont des anciens modèles qui ne tiennent plus la route.
[…] La hiérarchie pyramidale peut être efficace à court terme, mais cela ne tient pas à long terme. Dès que les conditions du milieu changent, l’efficacité disparaît. C’est pour cela que dans la nature on ne voit presque pas de hiérarchie pyramidale.»
La thèse la plus porteuse d’espoir de cette pensée est le constat que si dans les sociétés d’abondance, la compétition est de rigueur, dans les périodes de rareté ou de pénurie l’entraide et la collaboration se développent davantage. Dans la catastrophe, les hommes montrent des signes positifs de résilience. Selon Pascal Servigne nous serions naturellement des êtres collaboratifs.
«Globalement l’idée du livre, ce n’est pas du tout de nier qu’il y a de la compétition. Au contraire, mais il s’agit d’arrêter de nier qu’il y a de l’entraide partout. C’est plutôt une invitation à rééquilibrer le curseur. D’ailleurs lorsqu’il y a de l’entraide ou de la coopération il y a toujours un peu de compétition. A l’inverse, quand on voit qu’il y a de la compétition, on s’aperçoit aussi qu’il y a de la collaboration derrière. […]
Quand on observe les autres êtres du vivant, c’est fascinant. Il y a énormément de découvertes, en ce moment. Par exemple des expériences économiques ont mis ensemble des individus pour participer au bien commun. Et ce que les chercheurs ont mis en lumière : quand on stresse les gens, on les force à répondre vite, de manière plus spontanée ils sont plus collaboratifs, plus pro sociaux et quand on les force à réfléchir et à utiliser la raison, ils sont plus égoïstes et participent moins au bien commun. Cela corrobore assez bien tous les récits des rescapés et des survivants des catastrophes, des tsunamis des tremblements de terre, des attaques terroristes etc., tous les récits convergent pour décrire qu’il n’y a pratiquement jamais de panique et qu’il y a de l’auto-organisation et des comportements extrêmes d’altruisme.
Et en fait avec Gauthier Chapelle, on est allé voir dans tout l’éventail du vivant, des bactéries, au phyto planctons, aux arbres etc et ce qui est fascinant est que l’entraide émerge quand il y a pénurie, quand le milieu est hostile.
Lorsqu’il y a de l’abondance, le milieu est riche alors la compétition peut émerger. C’est complétement contre intuitif avec l’idée qu’on se fait de la nature et c’est cela qui est fascinant.»
Car en effet, notre intuition surtout celle du consommateur compulsif que nous sommes devenus tendrait à croire que moins il y en a, plus on va se battre pour acquérir le peu qu’il y a.
C’est une grande leçon, c’est notre richesse qui nous pousse à l’égoïsme.
Pablo Servigne évoque sa démarche :
« Je suis plutôt issu d’une formation scientifique de biologie, d’écologie. J’ai étudié les fourmis pendant quelques années. La sociabilité de l’insecte. J’ai été voir ce que les sciences sociales faisaient, je n’étais pas formé à cela et j’ai constaté aussi que les sciences sociales n’étaient pas formées à la biologie non plus. Et ce qu’on a voulu faire, ce sont des ponts, des ponts entre disciplines. […] Cela fait dix ans que je me passionne pour le sujet, chaque discipline était un peu cloisonné et avançait avec ses hypothèses qui pouvaient apparaître contradictoires entre elles.. […] Depuis 5 ans, on arrive à faire des liens, il y a des découvertes majeures qui sortent, en particulier dans la théorie de l’évolution qui permettent d’avoir une vision cohérente de ce que nous avons appelé « l’autre loi de la jungle : l’entraide ».
Si on prend l’exemple des fourmis ou des rats : :
« Chez les rats ou les fourmis, il y a une sorte d’altruisme en famille, Il y a plusieurs types d’entraide dans le monde vivant. L’altruisme, c’est quand un individu se sacrifie pour sa famille. C’est le cas des ouvrières qui ne se reproduisent pas et qui participent donc à un super organisme pour le bien de leur famille. Et puis il y a de la coopération entre les lionnes, la chasse est une compétition, mais les lionnes coopèrent pour chasser. Il y a toujours un peu des deux. Et cela c’est au sein d’une espèce.
Mais il y a des milliers d’études désormais qui montrent la coopération entre les espèces. Les scientifiques appellent cela <les mutualismes>. C’est la pollinisation, la dispersion des graines, les oiseaux qui nettoient les tiques de certains mammifères, il y énormément d’exemples. Et nous avons voulu englober toute la diversité de ces manières de s’associer par le terme la « symbiodiversité ». Chez les humains aussi il y énormément de mécanismes très fins qui font appel à l’empathie, la réciprocité, la réputation, des normes sociales, des institutions, c’est très complexe parce que chez les humains il y a aussi une couche culturelle. Couche culturelle qui existe aussi chez les primates ou les orques. Nous avons tout un éventail de mécanismes et de processus évolutifs.
L’idéologie ambiante de l’hyper compétitivité n’est pas du tout représentatif du monde vivant. Gauthier Chapelle et moi-même avons une sensibilité du monde vivant, de naturalistes, ce n’est pas cela que l’on observe dans la nature.
On n’aurait même pas dû avoir à l’écrire ce livre, on devrait l’apprendre dès la maternelle. On naît dans un bain idéologique qui fait que l’on prend la compétition l’agression pour une donnée naturelle. »
Il ne s’agit pas de sombrer dans une vision utopique de bisounours car Servigne reconnaît que l’homme naît à la fois égoïste et altruiste mais qu’on ne peut ignorer la seconde qualité et que c’est à nous de faire bouger le curseur vers la position qui nous semble la plus pertinente.
«[Nous sommes à un moment où il existe] une opportunité de renaissance. Ce livre n’apporte pas un modèle de société. Ce que j’aime c’est de provoquer des déclics comme moi j’en ai eu à la lecture de tous ces travaux scientifiques. Des déclics qui font des fissures dans notre imaginaire, notre imaginaire ultra compétitif. […]»
Des fissures dans notre imaginaire ultra compétitif !
Il explique ainsi que le cœur du social ce n’est pas du tout le marché ou le dilemme du prisonnier mais c’est vraiment le don et la réciprocité. Mais la réciprocité entre personnes ne suffit pas, car elle peut se diluer dans un grand groupe où l’anonymat règne. Pour stabiliser l’entraide, les humains ont trouvé des mécanismes comme la réputation (je vais coopérer avec cette personne parce qu’elle a bonne réputation et lui j’ai entendu dire que c’est un tricheur qu’il est égoïste, je ne vais pas coopérer avec lui) Le mécanisme de la réputation est un des ciments de la société, c’est fondamental dans le fait social. Après il y a les normes sociales et la punition des tricheurs… Tous les principes moraux qui font société commencent par cette règle de punir les égoïstes et les tricheurs et récompenser les comportements pro-sociaux.
Mais la pensée de Pablo Servigne est d’une grande lucidité :
«Il y a aussi des écueils à l’entraide. On peut s’entraider pour massacrer ses voisins. Et plus on soude un groupe, plus il y a un risque d’exclusion de ce qui n’appartient pas au groupe. […] Pour souder un groupe on peut créer un ennemi commun.»
Mais il semble que les études scientifiques ont montré que les groupes aussi peuvent s’entraider comme les individus à l’intérieur d’un groupe.
Ainsi nous pourrions espérer que la question du climat pourrait fédérer les humains contre un ennemi commun : le dérèglement climatique. Mais pour l’instant cela a l’air compliqué en raison des différences de taille et d’intérêt entre les acteurs qui négocient.
Il conclut l’émission :
« C’est une boutade de dire que nous arrivons dans l’âge de l’entraide, cela ne signifie pas du tout que nous arrivons dans l’âge des bisounours.
Cela peut être difficile, cela peut être très conflictuel. Mais le pari d’une transition [..] c’est le fait de créer une culture de l’entraide, de coopération par anticipation.
Parce que le problème ce n’est pas vraiment les pénuries, cela fait des centaines de milliers d’années que les humains gèrent les pénuries. Le problème c’est d’arriver dans les pénuries et les tempêtes qui s’annoncent avec une culture de l’égoïsme. Et c’est là qu’on risque de s’entretuer. […] Et l’entraide doit s’élargir au monde vivant non humains si nous voulons continuer à vivre longtemps sur cette terre. »
Le problème c’est d’arriver dans les pénuries et les tempêtes qui s’annoncent avec une culture de l’égoïsme !
Matthieu Ricard commente ainsi ce livre :
« La coopération a été, au fil de l’évolution, beaucoup plus créatrice de niveaux croissants de complexité que la compétition. Il ne fait aucun doute que l’entraide est omniprésente dans la nature. Chez les humains, elle est l’une des manifestations les plus directes de l’altruisme. Elle mène au double accomplissement du bien d’autrui et du sien propre. L’étude pénétrante de Pablo Servigne & Gauthier Chapelle, qui dresse le portrait de cette autre « loi de la jungle », est donc plus que bienvenue à une époque où nous avons tant besoin de favoriser la coopération, la solidarité et la bienveillance, pour construire ensemble un monde meilleur. »
Etes-vous en mesure d’accepter de fissurer votre imaginaire ultra compétitif ?
Il me semble tout à fait convaincant de dire que l’éventail du vivant révèle que l’entraide est absolument partout, qu’elle fait partie des instincts humains, mais aussi qu’elle est là depuis la nuit des temps. Tout le monde est impliqué́ dans des relations d’entraide. Même les plantes, les animaux, les bactéries. Même les économistes. Mais notre société n’a pas voulu voir que dans la jungle, en réalité́, il règne un parfum d’entraide.
SI vous n’êtes toujours pas convaincu…
Napoléon disait un dessin vaut mieux qu’un long discours. Aujourd’hui, il remplacerait le mot dessin par vidéo.
Aller donc voir <cette vidéo filmée> dans le zoo de Budapest : Vous verrez un immense ours et un corbeau qui est tombé dans le bassin d’eau de l’ours. Ce corbeau essaye désespérément de sortir de l’eau et n’y parvient pas, il va mourir. L’immense ours s’approche, il va l’écraser probablement. Eh bien non, il plonge son bras dans l’eau, s’empare du corbeau et le sort du bassin et puis s’en retourne tranquillement manger. Pourquoi a-t-il fait cela ? Quel bénéfice en tire t’il ?
Il montre simplement aux humains figés dans nos certitudes que l’entraide toute simple entre les êtres vivants franchit la barrière de l’espèce.
Je vous rappelle aussi <le mot du jour du 22 septembre 2017> où une vidéo montrait une lionne qui épargnait un bébé gnou.
Peut-être pourriez aussi vous intéresser au « microbiote intestinal humain » où des milliards d’êtres vivants collaborent, sans organisation pyramidale, pour nous aider à vivre et à digérer.
<990>
-
Vendredi 15 décembre 2017
« Vers des communautés de travail inspirées »Frédéric Laloux.J’annonçais hier que j’allais parler de Frédéric Laloux et de sa « Conférence » qu’il a consacrée à son livre « Reinventing Organizations » avec pour sous-titre en français la phrase que j’ai mise en exergue.
Frédéric Laloux était partenaire associé chez McKinsey, le fameux cabinet de conseil auprès des directions générales. Il s’est beaucoup interrogé sur le management et a écrit un livre « Reinventing Organizations » paru en anglais en 2014.
Un article du New York Times l’a décrit de la manière suivante :
« Le livre de management le plus important et le plus inspirant qu’il m’ait été donné de lire »
Tony Schwartz

La version française est parue en 2015 chez les Editions Diateino.
Ce livre ne se trouve pas sur mon bureau, mais sur celui du bureau voisin car Annie le trouve très intéressant et c’est d’ailleurs elle qui m’a fait découvrir la conférence qui constitue le point d’entrée de cet article. Si j’ai regardé avec attention la conférence, je ne me suis pas plongé dans ce livre de 500 pages.
On trouve de nombreuses références sur Internet, par exemple cet essai d’en faire une synthèse en 9 pages : http://www.reinventingorganizations.com/uploads/2/1/9/8/21988088/chene_synthese_laloux2014.pdf
Frédéric Laloux introduit sa conférence notamment par sa question sur les cerveaux et sa réponse de l’existence, dans notre corps, de trois cerveaux dont le cœur.
Et il pose cette question :
« Ce n’est que dans les années 90 que les deux autres cerveaux ont été découverts et reconnus.Pourquoi ne pas les avoir trouvés avant, alors qu’un cadavre, un scalpel et un microscope basique le permettaient aisément ? »
Il fait d’ailleurs un rappel historique sur la découverte du système neuronal des intestins dès le XIXème siècle.
Et il répond à cette question de la découverte tardive :
«Nous n’étions pas capables d’envisager l’existence de plusieurs cerveaux parce que notre vision du monde nous en empêchait.»
Pour Frédéric Laloux, l’explication est simple depuis la nuit des temps toute l’idéologie humaine tournait autour de cette croyance : pour qu’une organisation fonctionne il faut un « boss », un seul qui décide ! Donc un seul cerveau ! Trois cerveaux seraient probablement le début de l’anarchie.
On pourrait peut-être émettre l’hypothèse que l’invention d’un Dieu monothéiste relève de cette même croyance, il faut un organisateur, un chef unique et omnipotent.
Il a l’intuition que la découverte des deux autres cerveaux dans les années « nonantes », comme il dit en langue franco-belge, a été rendu possible par l’avènement d’internet et des réseaux qui ont rendu crédible l’existence de plusieurs réseaux et donc de plusieurs centres de décisions.
C’est ainsi, selon lui, qu’une possibilité d’intelligence collective dans les entreprises, sans boss, est entrée dans les consciences.
J’avais déjà évoqué ce type de réflexion en 2014, plus exactement <Le mot du jour du 18 décembre 2014> où il était question de « l’entreprise libérée » dans laquelle la hiérarchie était remise en cause. Annie m’explique que le terme « L’entreprise libérée » est un terme qui ne s’est pas imposé.
Ce terme n’est d’ailleurs pas repris par Frédéric Laloux qui va utiliser des codes couleurs. Il envisage donc d’autres façons de faire fonctionner les organisations que par un centre de décision hiérarchique. A ce stade (à partir de la minute 13 de la vidéo) il évoque, en étudiant l’histoire du monde, l’évolution des organisations et les différents changements de paradigmes concernant les modes d’organisation et de management dans le cadre d’enjeux de plus en plus complexes.
Il associe des couleurs à ces paradigmes Rouge, Ambre, Orange, Vert, Opale.
Et puis, il développe une réflexion qui m’a interpellé. L’économie a démontré que l’organisation pyramidale, au niveau étatique, est bien trop rigide pour faire face aux défis de l’innovation et de l’efficacité. Ce fut le grand échec des systèmes soviétiques. Tout le monde a compris que la multiplication des acteurs et la décentralisation des centres d’initiatives que sont les entreprises et particulièrement aujourd’hui les start-up sont bien davantage en capacité de résoudre la complexité et de trouver des solutions qui fonctionnent. Or, des patrons qui vous expliquent cette capacité d’un marché libre (je précise cependant régulé et je l’oppose à des solutions bureaucratiques) à trouver des solutions innovantes et efficaces, dès qu’ils retournent dans leurs entreprises reviennent au dogme du cerveau unique et de l’organisation hiérarchique.
Je ne suis pas en mesure de résumer l’ensemble de cette conférence qui dure 1h40, mon ambition est simplement de vous donner envie de la regarder.
Frédéric Laloux évoque cependant plusieurs entreprises qui ont fait le choix d’une organisation non hiérarchique, dans son développement il parle d’organisation « Opale ».
Concrètement ces structures sont des organisations non pyramidales. C’est à dire que la structure hiérarchique a disparu. En règle générale il reste un dirigeant mais il n’a pas du tout le même rôle que dans une organisation classique. Ces organisations opales ont en commun d’avoir supprimé en partie ou complètement les managers d’équipe, les managers intermédiaires et les top-managers, d’avoir réduit drastiquement les fonctions supports centralisées et d’avoir supprimé les réunions de comité exécutif.
Il donne plusieurs exemples mais évoque particulièrement une entreprise néerlandaise : Buurtzorg de soins à domicile.
Ainsi chez Buurtzorg, les équipes de 10-12 infirmières fonctionnent sans chef, les coachs régionaux accompagnent 40 à 50 équipes et n’ont aucun pouvoir de décision sur celles-ci, et ils ne se réunissent que quatre fois par an avec le directeur. Comment fonctionnent ces entreprises ? L’absence de structure hiérarchique n’empêche pas l’existence d’une structure d’un autre ordre, qui ne repose plus sur l’organisation de postes à occuper mais sur l’articulation de rôles à remplir
Ainsi, chaque salarié remplit des rôles techniques opérationnels, mais également des rôles de management, qui sont répartis entre les différents membres de l’équipe au lieu d’être concentrés dans les mains d’une personne
De même, les fonctions de soutien, habituellement centralisées, sont réparties entre les membres des équipes
Les équipes se chargent elles-mêmes des ressources humaines (recrutements et licenciements, formation, évaluations, plannings, etc.), des finances (achats, suivi financier, investissements, etc.), des aspects techniques (maintenance, sécurité, qualité)
Lorsqu’il y a des responsables régionaux, ils ont un rôle de coach mais ils n’ont pas de pouvoir de décision et n’ont aucune autorité sur les équipes
Ils sont là pour les conseiller et les accompagner mais ne peuvent en aucun cas les contraindre à quoi que ce soit
Les relations sont fondées sur la confiance ce qui nous rappelle le mot du jour de lundi.
Ce nouveau modèle d’entreprise a vocation à réconcilier le travail salarié avec les aspirations des individus. L’entreprise devient un organisme vivant et réactif à tous les signaux internes et externes du marché et de la société. Ce modèle s’appuie sur l’autonomie des équipes et la conviction que chaque employé doit être pleinement lui-même pour apporter une valeur ajoutée à l’entreprise et que de cette manière l’entreprise saura mieux affronter la complexité du monde et trouver les moyens les plus efficaces.

Ce livre a aussi fait l’objet d’une version simplifiée et illustrée:
Le dessinateur, Etienne Appert, présente son travail et son apport de la manière suivante :
« Considérant que beaucoup de lecteurs pouvaient être intéressés par ce sujet, mais pas nécessairement prêts à lire 500 pages d’étude théorique sur le management, Frédéric m’a proposé de réaliser une version « grand public » du même livre. Nous avons co-construit un objet hybride, qui n’est ni un simple livre illustré, ni une pure bande dessinée, mais où textes et dessins ne cessent d’interagir pour un maximum de clarté et d’efficacité. Cela a amené Frédéric a réécrire entièrement son contenu, c’est donc bien un livre complétement nouveau que nous vous proposons. »
De nombreux articles évoquent l’intérêt de cet ouvrage :
Article dans l’OBS : «Nous n’avons pas besoin de patron»
Dans le Monde on insiste sur l’invention d’une autre façon d’organiser le travail
Ce site destiné au cadres en parle aussi
En tout cas, cet homme mérite d’être entendu et approfondi. Je vous renvoie vers la conférence en français : Conférence
<989>
-
Jeudi 14 décembre 2017
« Nous avons 3 cerveaux : le cerveau, l’intestin et le cœur »Frédéric LalouxJe partagerai demain des réflexions sur le management que fait Frédéric Laloux via cette vidéo où il présente son livre « Reinventing Organizations ».
Au début de cette vidéo, il pose la question à la salle : « Savez-vous combien vous avez de cerveaux ? ».
Cette question ne peut que nous interpeller alors qu’il y a peu, une semaine avait été consacrée à notre cerveau, celui qui est dans notre tête, et qu’on croyait unique.
Et puis il donne sa réponse : trois.
- Le premier est évident, c’est celui qui se trouve dans notre boite crânienne et qui porte précisément le nom de cerveau.
- Le second est désormais bien établi c’est l’intestin.
- Et le troisième est plus surprenant, il s’agirait du cœur.
En premier lieu, il s’agit de définir ce que signifie le terme de « cerveau » dans la question : combien avez-vous de cerveaux ?
Dans cette question ce terme signifie, « un centre de décisions ». Plus prosaïquement cela signifie que l’organe concerné donne des ordres et que nous agissons en suivant cet ordre.
La sagesse populaire ancienne avait annoncé cette réalité :
- On dit par exemple : « Cette décision, je l’ai prise avec mes tripes ! », donc l’intestin.
- Et bien sûr, « C’est une décision que j’ai prise avec le cœur ».
Ainsi, selon Frédéric Laloux, nous avons trois cerveaux, parce que nous avons trois systèmes nerveux indépendants, trois systèmes neuronaux indépendants et complémentaires. L’un piloté par le cerveau situé dans la tête, bien connu. Un deuxième centre neuronal, de la taille de celui d’un rat de laboratoire, est logé dans le cœur, tandis que le troisième, de la taille de celui d’un chien, est logé dans les intestins.
Mais la communauté scientifique est-elle globalement convaincue ?
Pour les intestins la chose semble établie :
<Un livre a d’ailleurs pour titre : l’intestin notre deuxième cerveau> . C’est un ouvrage de Francisca Joly Gomez, gastroentérologue et professeur en nutrition à L’Université Paris VII Denis Diderot.
Un livre a fait encore plus de bruit, il est l’œuvre d’une jeune allemande : Giulia Enders « Le charme discret de l’intestin »
Certains pensent, à raison probablement que nous avons certainement « digéré » avant de « penser ». Parce que notre système digestif abrite 200 Millions de neurones soit approximativement le même nombre de cellules nerveuses que dans le cerveau d’un chien, comme écrit ci-avant, ou d’un chat En outre, … il y a 100 fois plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Et il a été démontré dans de nombreuses études que ces bactéries, si elles ont bien un rôle dans notre bien-être digestif, seraient aussi responsables de la manière dont nous « digérons » nos émotions.
Je crois que c’est l’expérience de beaucoup que les émotions peuvent immédiatement impacter notre système digestif.
Mais concernant le cœur, il semble que selon mes recherches, les choses soient un peu moins établies.
Je n’ai pas trouvé de publication scientifique indiscutable.
Sur ce site : « alternative santé » qui est un site spécialisé dans la médecine non conventionnelle, il est affirmé que :
On a découvert que le cœur contenait un système nerveux indépendant et bien développé, avec plus de 40.000 neurones et un réseau complexe et dense de neurotransmetteurs, de protéines et de cellules d’appui. Grâce à ces circuits, il semble que le cœur puisse prendre des décisions et passer à l’action indépendamment du cerveau et qu’il puisse apprendre, se souvenir et même percevoir.
Il existe quatre types de connexions qui partent du cœur et vont vers le cerveau de la tête.
- Première connexion : neurologique
Entre cœur et cerveau il y a une communication neurologique au moyen de la transmission d’impulsions nerveuses. Le cœur envoie plus d’information au cerveau qu’il n’en reçoit, il est l’unique organe du corps doté de cette propriété, et il peut inhiber ou activer des parties déterminées du cerveau selon les circonstances. Cela signifie-t-il que le cœur peut influencer notre manière de penser ? Il peut influer sur notre perception de la réalité, et de ce fait sur nos réactions. - Deuxième connexion : biochimique
Le cœur envoie des informations biochimiques au moyen des hormones et des neurotransmetteurs. C’est le cœur qui produit l’hormone ANF, celle qui assure l’équilibre général du corps : l’homéostasie. L’un de ses effets est d’inhiber la production de l’hormone du stress, et de produire et de libérer l’ocytocine, connue comme hormone de l’amour. - Troisième connexion : biophysique
Elle se fait au moyen des ondes de pression. Il semble qu’au travers du rythme cardiaque et de ses variations, le cœur envoie des messages au cerveau et au reste du corps. - Quatrième connexion : énergétique
Le champ électromagnétique du cœur est le plus puissant de tous les organes du corps, 5.000 fois plus intense que celui du cerveau. Et on a observé qu’il varie en fonction de l’état émotif. Quand nous avons peur, que nous ressentons une frustration ou du stress, il devient chaotique. Et se remet-il en ordre avec les émotions positives ? Oui. Et nous savons que le champ magnétique du cœur s’étend de deux à quatre mètres autour du corps, c’est-à-dire que tous ceux qui nous entourent reçoivent l’information énergétique contenue dans notre cœur.
Et l’article continue :
« À quelles conclusions nous amènent ces découvertes ?
Le circuit du cerveau du cœur est le premier à traiter l’information, qui passe ensuite par le cerveau de la tête. Ce nouveau circuit ne serait-t-il pas un pas de plus dans l’évolution humaine ? Il y a deux types de variation de la fréquence cardiaque : l’une est harmonieuse, avec des ondes amples et régulières, et prend cette forme quand la personne a des émotions. L’autre est désordonnée, avec des ondes incohérentes. Elle apparaît avec la peur, la colère ou la méfiance.
Mais il y a plus : les ondes cérébrales sont synchronisées avec ces variations du rythme cardiaque, c’est-à-dire que le cœur entraîne la tête. La conclusion en est que l’amour du cœur n’est pas une émotion, c’est un état de conscience intelligente… N’est-ce pas, finalement, une confirmation supplémentaire de la théorie de la Médecine Chinoise, qui dit que le Coeur est le centre du Shen (terme chinois qui englobe les émotions, la conscience, l’esprit et le psychisme). »
Un autre article développe aussi cette thèse : http://www.epochtimes.fr/le-coeur-fonctionnerait-il-comme-le-cerveau-25065.html
Certains membres de la communauté scientifique sont, pour l’instant, fermés à cette hypothèse. Ainsi Jean-Didier Vincent, neurobiologiste, professeur à l’Institut Universitaire de France et à la faculté de médecine de Paris-Sud affirme avec netteté
« Le cerveau c’est l’origine de l’individuation, nous n’avons qu’un cerveau et nous sommes ce qu’est notre cerveau. Tout se passe dans notre cerveau. Ce n’est pas la raison qui est là, ce sont les sentiments. Si on parle encore du cœur : « Il a du cœur« , c’est toujours le cœur qui garde la prééminence. Pourtant c’est dans le cerveau que tout se passe et pas ailleurs.. »
Pour l’instant, il me semble donc que dire que le cœur est notre troisième cerveau n’a pas encore convaincu toute la communauté scientifique. Mais attendons, peut être que de nouvelles découvertes donneront encore davantage corps à cette belle théorie.
<988>
- Le premier est évident, c’est celui qui se trouve dans notre boite crânienne et qui porte précisément le nom de cerveau.
-
Mercredi 13 décembre 2017
«Les honneurs, je les méprise, mais je ne déteste pas forcément ce que je méprise »Jean d’Ormesson (16/06/1925 – 05/12/2017) dans «Dieu, les affaires et nous»Il faut des mots du jour court.
En voici un.
Le mot du jour a plusieurs fois fait appel à Jean d’Ormesson :
Le mot du mardi 2 février 2016 :
« La vie naturellement est une vallée de larmes
C’est aussi une vallée de roses.»
Jean d’Ormesson
C’est lui aussi qui avait accueilli Simone Veil à l’Académie française. Et j’avais cité la fin de son discours :
« Je baisse la voix, on pourrait nous entendre : comme l’immense majorité des Français, nous vous aimons, Madame. Soyez la bienvenue au fauteuil de Racine, qui parlait si bien de l’amour. »
Je l’avais aussi mobilisé pour décrire François Mitterrand :
«c’est un homme qui avait un rapport complexe avec la vérité».
Pour revenir à l’exergue de ce mot du jour et pour l’éclairer il faut peut-être faire appel à Nietzsche qui aurait dit selon Fabrice Lucchini :
« Ce sont nos contradictions qui nous rendent féconds »
<987>
-
Mardi 12 décembre 2017
« Le livre de la nature est écrit en langage mathématique »GaliléeJe m’aperçois que je n’ai encore consacré aucun mot du jour à la mathématique qui fut pourtant un amour de jeunesse.
Je me suis appuyé sur un article de « Pour la Science » pour trouver l’exergue de ce mot du jour.
Cet article débute ainsi :
« Pythagore et ses disciples pensaient que le secret du monde tenait en quelques mots : « Toute chose est nombre. » Aujourd’hui, la science est parfois tentée de reprendre l’idée pythagoricienne en l’étendant sous la forme « Tout est mathématique », ce que Galilée disait déjà : « Le livre de la nature est écrit en langage mathématique. » Le sens et la portée de ces liens entre la science et les mathématiques sont un permanent sujet d’intérêt. »
Notre Député mathématicien Cédric Villani ne dit pas autre chose : « L’univers est sous-tendu par des concepts mathématiques »
Grâce à Twitter et à un compte qui fait référence au grand mathématicien Fermat (Fermat’s Library), nous constatons une fois de plus que le monde s’explique par les mathématiques.
Alors suivez-moi pas à pas, c’est très simple :
1 jour = 24 heures donc 24 = 4 x 3 x 2
Et 1 heure = 60 minutes donc 60 = 5 x 4 x 3
Et de même 1 minute = 60 secondes, à nouveau 60 = 5 x 4 x3
Pour finir, une mesure un peu plus inhabituelle la milliseconde
Bien sûr 1 seconde = 1000 millisecondes donc 1000 = 10 x 20 x 5 donc (2 x 5) x (5 x 4) x 5 et si on remet dans l’ordre 1000 = 5 x 5 x 5 x 4 x 2
Si vous avez suivi jusqu’ici et que nous repartons au départ :
Nous pouvons écrire 1 jour = (4x3x2) x (5x4x3) x (5x4x3) x (5x5x5x4x2) millisecondes.
Et si vous remettez tout dans l’ordre et utilisez la notation des puissances
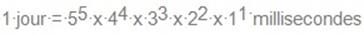
La mathématique c’est cela : ordre, rigueur et poésie…
<986>
-
Lundi 11 décembre 2017
« Nos parents sont d’un naturel vraiment très optimistes.
Ils nous ont montré que les rêves pouvaient se réaliser,
et que ça valait le coup de tout donner pour les vivre. »Alice Calvet en parlant des réussites de son frère François GabartLa course en mer constitue une activité très éloignée de mes centres d’intérêt.
Toutefois, j’ai entendu parler de François Gabart à la revue de presse de France Inter de ce dimanche du 10 décembre et j’en tire une réflexion très féconde sur la confiance et la réussite.
Avant ce dimanche, je ne savais rien de François Gabart, qui est pourtant quelqu’un de très connu, je l’ai compris depuis, dans le sport et notamment dans la voile.
Il a 34 ans, il est charentais et dans son domaine il réussit tout ce qu’il entreprend. En ce moment il fait un tour du monde en solitaire.
Ce <Site> nous apprend que ce dimanche il a franchi l’équateur et qu’il est très en avance par rapport au record du monde qu’il entend battre.
 Voici ce qu’en disait la revue de Presse de France Inter évoquée ci-dessus :
Voici ce qu’en disait la revue de Presse de France Inter évoquée ci-dessus :
« Jusqu’ici, tout réussit à ce surdoué. » Phrase à lire dans LE JDD… Alors, qui donc est ce « surdoué » qui réussit à transformer tout ce qu’il touche « en or » ? Eh bien c’est un navigateur de 34 ans, le Charentais François Gabart, qui, depuis plusieurs années, remporte toutes les courses auxquelles il participe : le Vendée Globe, la Route du Rhum, la Transat Jacques-Vabre, la Transat anglaise… Et il est actuellement en passe de battre le record du tour du monde en solitaire… Un record détenu par Thomas Coville – c’était il y a exactement un an, il l’on imaginait alors qu’il serait ancré pour longtemps, ce record… Thomas Coville avait mis un petit peu plus de 49 jours… Le tour du monde en 49 jours.
Or s’il poursuit au rythme auquel il s’est lancé, au tout début du mois dernier, François Gabart pourrait donc bien terminer son périple avec quatre à six jours d’avance… Il le raconte, son périple, dans LE JOURNAL DU DIMANCHE… La lutte contre la fatigue et le manque de sommeil, la peur et les souffrances physiques : « En baver, c’est ce que je recherche… Tout donner et puis terminer sur la ligne d’arrivée à bout de force. » Mais, dans LE PARISIEN, qui le présente comme « le petit Mozart de la voile », il dit aussi ses émotions : des instants où les larmes peuvent lui monter aux yeux… Un coucher de soleil ou quand la mer est belle… Des sensations très fortes, quatre ou cinq fois par jours. Et puis, ce qu’il aime surtout, c’est la vitesse… Tant pis si, par moments, par gros temps, des eaux agitées, il risque de casser son bateau… Il prend le risque, il aime le risque, parce qu’il a confiance… Une confiance qui, si l’on en croit sa sœur Alice, lui vient de son enfance – déjà, à l’époque, il se rêvait skippeur. « Nos parents, confie-t-elle, sont d’un naturel vraiment très optimistes. Ils nous ont montré que les rêves pouvaient se réaliser, et que ça valait le coup de tout donner pour les vivre. »
Comme une leçon de vie.
Confiance et optimisme… sur un trimaran. »
Je retiens de tout cela que la force qui anime ce jeune homme vient de la confiance et de l’optimisme que lui ont insufflés ses parents.
Cela n’enlève rien à ses mérites et certainement à une grande part de travail, d’entrainement et de volonté.
Mais au départ il y a la confiance.
La confiance qu’on possède, la confiance qu’on donne, la confiance qu’on reçoit.
J’ai trouvé aussi cette vidéo : <Alice parle de son frère et de son tour du monde>
Un des premiers mots du jour citait Eleanor Roosevelt, épouse du Président Franklin D. Roosevelt «L’avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. »
<985>
-
Vendredi 8 décembre 2017
« On a les héros qu’on mérite !»Didier RaoultDidier Raoult est né le 13 mars 1952 à Dakar au Sénégal. C’est un chercheur biologiste et professeur de microbiologie français, médecin de formation, spécialisé en maladies infectieuses. Il a découvert avec son équipe plus de soixante nouveaux virus dont les mimivirus (ou virus géants). Vous pouvez lire sa biographie dans Wikipedia
Il tient une rubrique santé dans l’hebdomadaire <Le Point>.
Le 22/06/2015 il avait écrit un article qui ne s’inscrivait pas vraiment dans le domaine de la santé : « D’Aristote à Zidane, on a les héros qu’on mérite ! »
Allez savoir pourquoi, j’ai eu envie de partager cet article aujourd’hui, 30 mois après sa parution :
« Chaque époque a ses héros, l’histoire classique qui est, hélas, menacée, nous éclaire sur notre époque. Chez les Grecs anciens, le héros qu’il faut imiter est un guerrier, celui de L’Iliade, que le théâtre grec ne cessera de conter.
Les héros mineurs sont les sportifs des Jeux olympiques. Les écrivains (Xénophon), les philosophes (Platon, Socrate, Aristote entre autres) sont aussi célèbres et deviennent parfois conseillers. Politiques (comme Platon fut celui de Denys, Tyran de Syracuse) ou éducateurs de princes (comme Aristote fut celui d’Alexandre), les historiens (Hérodote, Thucydide) sont aussi célèbres.
À Rome, les héros de la République sont les consuls, à la fois dirigeants et généraux, qui bâtissent la nation romaine par leur courage et brillent par leur austérité. Il ne viendrait à aucun d’entre eux l’idée de se déguiser en acteur, en chanteur ou en sportif. La première décadence de l’Empire est incarnée par Néron qui, chez Suétone, est décrit comme poursuivant les honneurs dus aux acteurs et aux chanteurs. Son prédécesseur Caligula en était encore à jouer au général. Néron signera la fin du premier règne des empereurs (les Julio-Claudiens). La deuxième décadence (selon Gibbon) est incarnée par l’empereur Commode, le fils de Marc Aurèle, caricaturé dans les films La Chute de l’empire romain et dans Gladiator, qui descend dans l’arène, pour y acquérir la gloire des gladiateurs, les héros de son temps.
Aujourd’hui, les vedettes, les stars, les plus célèbres et les mieux payées de nos contemporains, qui sont aussi les personnalités préférées des Français (selon le JDD) sont des chanteurs, des acteurs, des footballeurs, tous héros éphémères d’une époque consacrée aux loisirs. Il y a dix ans, c’était encore Cousteau et l’abbé Pierre. L’un héros de la découverte des fonds marins et de l’écologie, l’autre de l’œuvre au service des plus malheureux. Au début du XXe siècle en France, les places, les rues, les lycées portaient des noms de savants (Marie Curie, Pasteur…) ou d’écrivains auteurs d’œuvres durables (Hugo, Balzac…).
Un de mes proches amis tente de me rassurer en constatant que les graffitis de Pompéi, du premier siècle après Jésus-Christ, honorent surtout les gladiateurs. C’est vrai, mais c’est juste avant la première décadence de l’Empire. Dans l’histoire, lorsque le peuple et les dirigeants ont comme modèle les héros éphémères et l’art vivant, il n’est pas sûr que ce soit un bon signe, comme en témoigne l’histoire romaine, qui a vu suivre les règnes de Néron puis de Commode, de guerres civiles. »
<984>
-
Jeudi 7 décembre 2017
« Les pandas n’ont pas un mauvais fond, c’est encore pire : ils n’ont pas de fond du tout. »David PlotzDéjà nos vacances avaient été occupées par les médias qui nous racontaient par le détail la naissance d’un bébé panda au zoo de Beauval.
Voilà qu’il y a deux jours, nous avons eu droit à un nouvel épisode où l’épouse de notre Président de la République, Brigitte Macron, est allée solennellement baptiser le bébé panda du zoo de Beauval prêté par la Chine.
Si vous voulez en savoir davantage, il faut lire cet article <du Figaro> qui décrit cette visite avec précision et montre même la rencontre entre Madame Macron et le panda Yuan Meng, en français «la réalisation d’un rêve» en vidéo. Vous verrez ainsi Brigitte Macron un peu décontenancé par l’agressivité de ce petit animal si mignon. Elle était accompagnée et encouragée par Jean-Pierre Raffarin.
Le panda !
Est-ce vraiment un animal si mignon ? Gentil ? Bref la version vivante de la peluche, le doudou de notre enfance ?
<A la naissance de Yuan Meng, Slate avait publié une ancienne tribune> parue en 1999 dans laquelle David Plotz, journaliste puis rédacteur en chef de Slate.com, avait commis une nécrologie de Hsing-Hsing, panda géant offert aux États-Unis par le gouvernement chinois.
Je livre ce témoignage :
« Hsing-Hsing et moi, nous avons grandi ensemble. Je suis arrivé à Washington fin 1970, j’étais un bébé de six mois. Il a fait son entrée au Parc zoologique national un an plus tard. Enfant, avec ma famille, j’ai rendu visite à Hsing-Hsing et Ling-Ling, sa compagne de cellule, plus souvent qu’à mon tour. Ces six dernières années, j’ai été son voisin et une semaine s’est rarement écoulée sans que j’aille courir ou me promener dans les environs du zoo. D’ourson, j’ai vu Hsing-Hsing mûrir et devenir un panda géant et j’ai suivi, avec toute l’attention du monde, ses tribulations reproductives avec Ling-Ling.
Je connaissais ce panda. C’est donc du fond de mon cœur que je peux dire: bon débarras, sale demi-ours.
Ce qui fait de moi un cas isolé. D’ordinaire, Hsing-Hsing et Ling-Ling, morte en 1992, étaient du genre à faire hurler d’amour. Au moment de sa disparition, Hsing-Hsing était l’un des animaux les plus célèbres au monde. Plus de 60 millions de personnes lui avaient rendu visite durant sa détention à perpétuité au zoo de Washington. Une pandaphilie qui allait même transformer le Washington Post en organe de propagande. Selon les nécrologies, Hsing-Hsing «enchantait» et «captivait» les visiteurs. Il était un merveilleux «diplomate» entre la Chine et les États-Unis. Il était le plus «gentil», le plus adorable, le plus «câlin» de tous les animaux. «Il n’y aura jamais trop de peluches dans le monde», se lamenta le quotidien dans son hommage.
Pour George Schaller, éminent biologiste spécialiste de ces créatures, les pandas géants sont les animaux symboliques parfaits. Avec leur belle fourrure, leur démarche pataude et leur tête d’abruti, ils semblent incarner l’innocence, l’infantilité et la fragilité. Et c’est aussi l’image que les militants de la protection des espèces menacées leur ont soigneusement cultivée. Reste que sous ces abords affables se cache un ennui mortel. Tant qu’à anthropomorphiser ces bestioles, autant faire preuve de réalisme. L’idée que les pandas seraient mignons et géniaux est absolument ridicule.
Les pandas n’ont pas un mauvais fond, c’est encore pire: ils n’ont pas de fond du tout. Ce sont les animaux les plus emmerdants que vous puissiez imaginer. Ils sont profondément antisociaux et détestent les interactions, que ce soit avec des humains ou leurs congénères. Toutes les fois où j’ai pu me rendre dans leurs quartiers ou devant leurs cellules, jamais je ne les ai vus faire preuve d’espièglerie, d’affection, d’énergie ou même de violence. Par rapport à n’importe quel animal de zoo –les singes, les félins, les phoques, les chiens de prairie ou les serpents–, les pandas sont plus chiants que la pluie. Leur existence n’est qu’une longue et pénible plage de neurasthénie. Ce sont des mollusques à poils. Ils sont atrocement paresseux, tellement qu’ils rechignent à grimper aux arbres par peur de se fatiguer. Toute leur vie, ils ne font que dormir et manger du bambou. […]
En outre, Hsing-Hsing et Ling-Ling ne se contentaient pas d’être insipides, ils étaient mal-aimables. Le confinement déprime les animaux de zoo, et les pandas n’ont pas fait exception. Ils étaient plus proches du psychopathe que du doudou. Un jour, sans la moindre provocation, Ling-Ling a sauté sur un de ses soigneurs et l’a mordu à la cheville.
 Et si les tentatives coïtales du couple ont été présentées comme un opéra-comique, elles relevaient davantage du film d’horreur. Au départ, Hsing-Hsing n’avait pas réussi à féconder Ling-Ling parce qu’il avait voulu pénétrer son bras et son oreille. (Une gaucherie peut-être due au fait qu’il n’avait jamais appris à copuler dans son espace naturel). Ensuite, le zoo de Washington était allé chercher à Londres un nouveau compagnon pour Ling-Ling. Il l’avait tabassée (trop bien, l’amabilité des pandas).
Et si les tentatives coïtales du couple ont été présentées comme un opéra-comique, elles relevaient davantage du film d’horreur. Au départ, Hsing-Hsing n’avait pas réussi à féconder Ling-Ling parce qu’il avait voulu pénétrer son bras et son oreille. (Une gaucherie peut-être due au fait qu’il n’avait jamais appris à copuler dans son espace naturel). Ensuite, le zoo de Washington était allé chercher à Londres un nouveau compagnon pour Ling-Ling. Il l’avait tabassée (trop bien, l’amabilité des pandas).
Après dix ans d’efforts, Hsing-Hsing allait enfin réussir à trouver le bon trou et, entre 1983 et 1989, Ling-Ling donna naissance à cinq petits, qui moururent tous en quelques jours. Pour l’un, parce que Ling-Ling s’était assise dessus. Un autre a visiblement succombé à une infection urinaire transmise par Ling-Ling. Selon les soigneurs, Ling-Ling s’était elle-même infectée en s’introduisant des carottes et des tiges de bambou dans l’urètre. Un comportement pas du tout névrotique.
[…] le zoo projette d’empailler Hsing-Hsing. C’est parfait. Qu’ils lui mettent des bambous dans les pattes et le collent dans son ancienne cage en disant qu’il s’agit d’un nouveau panda. Personne ne verra la différence. »
<Vous pouvez encore lire cet article qui donne 5 raisons de mépriser le panda>
On apprend dans cet article que la libido du panda est une véritable catastrophe. Non seulement plus de la moitié d’entre eux ne montre aucun intérêt pour le sexe, mais si l’envie de flirter leur vient, encore faut-il tomber au bon moment pour la femelle. Cette dernière n’est en effet sensible au charme du sexe opposé que deux jours, trois maximums, par an.
On apprend également qu’un Panda a failli tuer le Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing qui avait voulu tester le caractère convivial de la bestiole.
J’ai aussi trouvé cette vidéo où on voit la manière avec laquelle cet animal paresseux devient brusquement hyperactif lorsqu’il s’agit d’embêter le personnel qui s’occupe de lui.
Bref un animal qui ne mérite pas sa réputation.
<983>
-
Mercredi 6 décembre 2017
« Amazon Go »Jeff Bezos, fondateur et PDG d’AmazonRécemment, en allant acheter chez mon boucher (Oui j’avoue je ne suis toujours pas végétarien et encore moins végan) j’ai eu un échange avec la jeune caissière qui me vantait l’intérêt de l’utilisation de la fonction sans contact de la carte bancaire, en disant « quand il y a une amélioration technique, il faut l’utiliser et y aller ».
Ce qui pourrait se traduire en langue française soutenue « Quand il y a une invention technologique, il faut l’embrasser ! »
Avec mon esprit plein de doutes, j’ai répondu : « Peut-être avez-vous raison, mais vous rendez vous compte que le « sans contact » n’est plus que la dernière étape avant le « sans humain » ? »
Et cet échange m’a conduit à revenir vers cette expérience d’Amazon qui a pour nom « Amazon Go ».
Jeff Bezos et Amazon sont des innovateurs hors pairs qui trouvent à chaque étape de leur développement des solutions disruptives. Mais le Monde que nous prépare Amazon m’inquiète.
Prenons le Black Friday, encore une invention américaine qui nous réduit à notre seule dimension de consommateur.
Pour le black Friday, 24 novembre 2017, Amazon a capté 40% des ventes sur Internet, nous annonce ce <site>.
C’est au mois de décembre 2016 qu’Amazon présentait son concept de magasins sans caisses baptisé «Amazon Go ».
Attention, il ne s’agit pas d’un magasin avec des caisses automatiques, il s’agit d’un magasin sans caisse. Vous avez un compte chez Amazon, avec un moyen de paiement, cela va de soi.
Vous faites le tour du magasin, vous prenez tout ce dont vous avez besoin et vous sortez du magasin et…. Amazon sait tout ce que vous avez acheté, donc sait vous facturer et prélever votre compte, cela va de soi…
Ce prototype, Amazon l’a Installé à Seattle et l’a réservé dans un premier temps aux employés Amazon. C’est à l’aide de technologies de pointe, de l’intelligence artificielle, des caméras et autres capteurs que le client pouvait quitter les lieux sans avoir à passer par la case du paiement en caisse.
Les nouvelles étaient bonnes jusque-là !
Un article du Point d’avril 2017 annonçait <Les déboires d’Amazon go>
Grâce à cet article, on apprenait :
« Mais ça ne fonctionne pas vraiment comme prévu. « Pas de file d’attente, pas de règlement, pas de caisse », promettait pourtant Amazon à propos de son magasin automatisé. Dans ce supermarché du futur, baptisé Amazon Go, le client est reconnu grâce à un smartphone, tracé par des caméras sans fil, avant de recevoir la facture à la maison.
Présenté en 2016 et expérimenté depuis à Seattle, Amazon Go devait être ouvert au grand public au début de l’année 2017. Pourtant, la firme américaine a confirmé les informations du Wall Street Journal et de Bloomberg annonçant un report sine die. En cause : l’impossibilité de faire fonctionner ce système en cas de fortes affluences.
Rapidement, les limites du concept avaient en effet été entrevues à Seattle. C’est là, dans le nord-ouest des États-Unis, qu’a été testé le « magasin » Amazon. Dans un local de taille modeste (177 mètres carrés), il était réservé, pour le besoin de l’expérimentation, aux salariés du groupe. Sauf que, dès qu’il y a plus de vingt clients dans le magasin, le système ne fonctionne plus. Et le dispositif est vite dépassé quand des enfants se servent dans les rayons !
L’objectif d’Amazon de figurer parmi les cinq plus gros distributeurs alimentaires aux États-Unis a donc du plomb dans l’aile. D’après Bloomberg, la supérette à la mode Amazon aurait un ratio de perte double en comparaison avec la moyenne des supermarchés ordinaires ! Dès la présentation de ce concept, la firme avait été fortement critiquée pour les conséquences négatives d’Amazon Go sur l’emploi. Mais, pour l’instant, Amazon ne semble pas prêt à supporter technologiquement la vie d’une supérette. »
J’en étais resté là, soulagé en me disant que ce monde cauchemardesque sans humain avec uniquement des consommateurs, des produits et des machines, (peut-être êtes-vous d’un autre avis et trouvez-vous ces perspectives réjouissantes) était retardé de quelques années.
Le soulagement fut de courte durée puisque plusieurs articles dont <celui-ci> du 15 novembre semblent indiquer, qu’hélas Amazon est sur le bon chemin.
Il reste des difficultés, mais il semble que l’ouverture de tels magasins aux Etats-Unis soit envisagée à court terme.
J’ai trouvé cet article sur le site spécialisé « News Informatique » particulièrement pertinent et visionnaire :
« Le succès d’Amazon réside dans sa capacité à faire appel à nos instincts primaires – ce qu’ont oublié des distributeurs comme Carrefour.
Nous aimons tous consommer, le plus facilement et le plus rapidement possible, sans prendre de risque. Amazon l’a compris est allé jusqu’au bout de la logique avec la commande « Zéro Clic », que ce soit dans ses magasins sans caisse Amazon GO, via son haut-parleur intelligent Echo/Alexa ou demain avec sa livraison d’office, dont les prémisses se trouvent dans Amazon WARDROBE.
Car l’objectif de Jeff Bezos est simple : nous libérer de la phase de choix pour les achats du quotidien en nous proposant le produit que nous souhaitons avant que nous y ayons pensé.
Avec l’Intelligence Artificielle, la plus grande offre au monde, une logistique sans faille et la marque de distribution à laquelle les consommateurs font le plus confiance, Amazon a su aller bien au-delà de ce que les autres distributeurs étaient prêts à faire pour leurs clients. […]
Cette capacité à faire appel à nos instincts primaires n’a été possible que par la capacité de storytelling hors pair de Jeff Bezos. Avec une vision gigantesque, Bezos a reconfiguré les relations entre les entreprises et leurs actionnaires. Amazon a levé 2,2 Mds $ avant d’être à peu près à l’équilibre. Amazon peut rater le lancement de n’importe quel produit (un smartphone par exemple), sans que son cours baisse. Dans une situation similaire Microsoft ou IBM verraient leur cours perdre 20% en une journée… Jeff Bezos a su remplacer la promesse de retour sur investissement par celle d’un storytelling porté par une vision et de la croissance. L’histoire : le magasin le plus grand au monde. Une stratégie : d’énormes investissements dans des bénéfices clients qui résistent au temps – coûts plus bas, plus grands choix, livraison plus rapide.
Ainsi, la valorisation d’Amazon est de 40 fois ses bénéfices alors que celle de ses concurrents est de 8 fois et la marque au sourire peut emprunter au même taux que la Chine.
[…]
D’ailleurs l’épicerie et les produits frais sont mûrs pour se faire Amazonner
Amazon teste depuis de nombreuses années la distribution physique car il sait que le client est canal-agnostique et il sait également qu’il doit faire baisser le coût du dernier kilomètre, aller et retour. Son avenir est bien sûr en multi-canal, tout comme les autres distributeurs. Mais arrimer des magasins physiques sur un site de e-commerce et bien plus aisé que l’inverse. Voyez les difficultés de Wall-Mart qui, à terme, ne pourra résister à Amazon.
Le « meilleur » de la distribution physique se trouve dans l’épicerie et les produits frais. Ce sont nos consommations de tous les jours, les plus massives et qui nous ennuient le plus, nous, consommateurs.
La technologie vocale d’Amazon, Echo/Alexa va faire trembler la terre sous les distributeurs et les marques. Bien des universitaires et des professionnels pensent que la construction d’une marque est toujours une stratégie gagnante. Ils ont tort. Directeurs Artistiques en Agence de Com’ et Brand Managers dans les entreprises vont pouvoir « décider de passer plus de temps avec leurs familles ». Le soleil se couche sur l’ère des marques. Car les attributs des marques, qui ont mis des générations et des milliards à se construire, disparaissent avec l’interface vocale. Amazon a décidé de privilégier ce canal pour y vendre ses marques en propre.
Avec le levier du Big Data et une connaissance sans pareille des schémas d’achat des consommateurs, Amazon va bientôt répondre à nos besoins de consommation sans la friction de la décision et de la commande. Vous n’aurez qu’à ajuster de temps à autre vos réceptions – moins de marchandise quand vous allez en vacances, plus de bière quand les copains viennent pour le barbecue et tout le reste se fera tout seul.
Des magasins sans caisses, des entrepôts peuplés de robots (c’est pour cela qu’il y a si peu de photos d’entrepôts Amazon, cela ferait peur), c’est le futur promis par Amazon et qu’il tente d’imposer à son secteur d’activité. Nous sommes les témoins du Jour du Jugement pour la Distribution.
Tout comme nous avons vu le pourcentage de la population agricole baisser de 50% à 4% au XXème siècle, nous verrons une chute similaire dans la distribution au cours des 30 prochaines années. En France cela concerne près d’1 million d’emplois. Bezos est arrivé à la conclusion qu’il n’y aura aucun moyen pour que l’économie soit capable de recréer suffisamment d’emploi pour remplacer ceux qui sont détruits. C’est pourquoi il milite activement pour le salaire minimum universel. Payé avec les impôts auxquels il fait tout pour se soustraire. »
Ce qui est techniquement possible, n’est pas toujours humainement souhaitable.
<982>
-
Mardi 5 décembre 2017
« L’enjeu de l’économie, l’enjeu de la globalisation, c’est la justice sociale. Sans justice sociale, il n’y aura plus d’économie »Emmanuel Faber Discours pour la remise des diplômes à HEC, juin 2016Emmanuel Faber est devenu, le 1er décembre 2017, le PDG de Danone, remplaçant Franck Riboud, qui avait succédé à son père à la tête du géant français de l’agroalimentaire. Danone c’est aussi Evian, Danette et Blédina.
Emmanuel Faber est âgé de 53 ans, il était directeur général de Danone depuis trois ans.
Je voudrais revenir sur un discours qui avait fait beaucoup de bruit et que j’avais évoqué de manière un peu étonnante au moment où il avait été prononcé en juin 2016.
J’avais, avant de partir en congé d’été en 2016 et en m’inspirant de la tradition de Charlie Hebdo : «Les unes auxquelles vous avez échappé » fait la liste des mots du jour que je n’avais pas écrit, mais pour lesquels j’avais préparé un brouillon. Il y en avait 20 et j’ai ajouté un 21ème qui était ce discours.
Mais aujourd’hui je voudrais revenir plus longuement sur ce discours, au moment où cet homme prend la tête de l’entreprise Danone.
Rappelons le contexte. Ancien élève d’HEC, Emmanuel Faber est invité, comme parrain de la promotion et comme cela se fait dans toutes Grandes Ecoles, à prononcer, lors de la cérémonie de remise des diplômes, un discours pour partager son expérience avec les étudiants qui viennent de finir leur cursus.
<Ce discours vous le trouverez en vidéo derrière ce lien>
Le début du discours est en français et commence par cette introduction :
«Si vous attendez un discours de référence intellectuelle, vous allez être déçus»
Puis il parle de son parcours personnel, de son frère malade, schizophrène, décédé depuis 5 ans au moment du discours. Et il va dire ce que son frère lui a appris de la vie, de la différence, de la beauté de l’altérité et «que l’on peut vivre avec très peu de choses et être heureux». Il révèle :
«Qu’est-ce qui m’a le plus marqué pendant mes trois ans ici [à HEC] ? C’est ce coup de fil que je n’aurais jamais voulu recevoir, à 21 heures (…) et où j’ai appris que mon frère venait d’être interné pour la première fois en hôpital psychiatrique, diagnostiqué avec une schizophrénie lourde. Ma vie a basculé»
Et puis, il va parler d’Economie, du monde futur qu’attend les brillants étudiants diplômés d’HEC.
«Après toutes ces décennies de croissance, l’enjeu de l’économie, l’enjeu de la globalisation, c’est la justice sociale. Sans justice sociale, il n’y aura plus d’économie […]
Les riches, nous, les privilégiés, nous pourrons monter des murs de plus en plus haut (…) mais rien n’arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec nous.
Il n’y aura pas non plus de justice climatique sans justice sociale»
Puis il y a la deuxième partie du discours prononcé en anglais dont voici la traduction :
« Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela ?
Parce qu’aujourd’hui vous êtes diplômés, vous vous tournez vers l’avenir. Je voudrais féliciter chacun d’entre vous. Vous avez désormais un outil très puissant dans vos mains.
La question est : qu’allez-vous en faire ? Pourquoi voulez-vous vous spécialiser en finance, en marketing, devenir avocat, entrepreneur social ou chef d’entreprise ?
Comment allez-vous prendre vos décisions dans ces domaines ?
J’en suis convaincu, après 25 ans d’expérience, que cette main invisible dont on vous a parlé n’existe pas.
Et s’il y en a une, elle est encore plus handicapée que mon frère. Elle est brisée.
En somme, nous avons seulement vos mains – mes mains –, toutes nos mains, pour changer les choses et les rendre meilleures.
Et vous avez beaucoup à faire pour cela. Vous allez devoir surmonter les trois principales épreuves qui arrivent facilement avec le statut que vous avez obtenu par votre diplôme, mes amis : la puissance, l’argent et la gloire.
Oubliez la gloire, c’est une course qui n’en finit jamais et qui ne mène nulle part. La liste de toutes les personnes renommées existe juste pour qu’elles regardent leur propre nom. Elles ne s’intéressent pas à ceux des autres.
L’argent : j’ai rencontré tant de personnes, quand j’étais banquier d’investissement dans la finance, quand j’ai voyagé dans le monde – j’en rencontre encore – qui sont prisonniers de l’argent qu’ils ont gagné. Ne devenez jamais esclaves de l’argent. Restez libres ! Peu importe la raison pour laquelle vous gagnez de l’argent, peu importe ce que vous en faites, restez libres !
Et la puissance : je pense que vous pouvez regarder autour de vous, il y a tant de personnes qui sont puissantes et qui ne font rien, juste pour garder cette puissance, pour qu’elle dure un jour encore. La puissance n’a de sens que dans le service rendu aux autres. Et c’est ce service qui vous fera devenir qui vous êtes en vérité. Le meilleur de vous-même, dont vous n’avez même pas conscience.
J’ai donc une question à vous poser, avec laquelle je vous laisserai, chacun d’entre vous : qui est votre frère ?
Qui est ce petit frère, cette petite sœur, qui habite en vous et qui vous connaît mieux que vous-même et qui vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même ? C’est cette petite voix, qui parle de vous étant plus grand encore que vous ne pensez l’être.
Qui sont-elles ?
Elles vous apporteront cette voix, cette musique interne, cette mélodie qui est véritablement la vôtre.
Votre mélodie transformera la symphonie du monde qui vous entoure, qu’elle soit grande ou petite, elle le changera !
Le monde en a besoin et vous méritez cela.
Trouvez votre frère, trouvez votre petite sœur et quand vous les rencontrerez dites-leur bonjour de ma part, nous sommes amis !
Portez-vous bien. »
J’entends, pendant que j’écris, certains d’entre vous s’écrier mais enfin c’est un discours absolument démagogique. C’est le patron de Danone, s’il croit ce qu’il dit, il ne peut rester à la tête d’une multinationale qui doit contenter ses actionnaires cupides et avides.
Je ne crois pas. Je pense qu’il a compris quelque chose de fondamental : Le creusement des inégalités dans le monde est une voie sans issue qui se retournera tôt ou tard contre ceux qui accaparent les richesses. « Sans justice sociale, il n’y aura plus d’économie », cette phrase n’est pas une réflexion dogmatique ou une croyance gauchisante, mais l’aboutissement d’une réflexion rationnelle.
Je ne le crois pas non plus parce qu’Emmanuel Faber est un esprit particulier que vous pourrez découvrir dans cet article de «La Croix ».
La découverte de la pensée phénoménologique, notamment grâce à un essai de George Steiner sur Martin Heidegger, lui fait entrevoir la possibilité d’un « passage » vers « l’humanité du réel » en quittant « la prison rassurante de la rationalité toute puissante ». Il parviendra progressivement à « faire une place à cette échappée » dans sa vie professionnelle en rejoignant Danone. Ironie de l’histoire, c’est un peu pour sa « part d’ombre », c’est-à-dire sa dureté en affaires, en tout cas sa réputation de redoutable négociateur, que le groupe fait appel à lui en 1997 comme directeur financier. Mais, en même temps, il pressent que, dans cette maison un peu différente des autres, il va pouvoir « essayer des trucs », expérimenter d’autres « réglages » du fonctionnement des entreprises.
Dès 1972, dans un discours resté célèbre, le bâtisseur du groupe Danone, Antoine Riboud, affirmait qu’il n’y a pas de richesse économique sans développement humain. Fidèles à cet héritage, son fils Franck (qui lui a succédé comme PDG), Emmanuel Faber et les équipes de Danone vont mettre au point plusieurs outils, développer des formes différentes d’activité économique. La plus célèbre est la filiale commune créée au Bangladesh avec la Grameen Bank de Muhammad Yunus, l’inventeur du microcrédit. Cette usine prototype produit des yaourts hautement nutritifs à très bas prix. Le lait est fourni par des éleveurs locaux, les produits sont commercialisés par des colporteuses travaillant à leur compte.
Emmanuel Faber le dit clairement : la rencontre avec le prix Nobel de la paix 2006 a été décisive : « Yunus nous a donné confiance. Il a été le déclic qui nous a fait dire : on va dans cette direction. » D’autres projets de cette nature, relevant de l’entrepreneuriat social, ont été lancés depuis, en partie financés par une sicav solidaire dénommée « danone.communities », auquel le groupe a souscrit ainsi qu’un tiers de ses salariés français. En 2009, les actionnaires ont aussi accepté de prélever 100 millions d’euros sur les bénéfices afin de créer un fonds soutenant « l’écosystème » de Danone, c’est-à-dire les petites entreprises qui fournissent le groupe. Ce qui a permis, en deux ans, de consolider environ 15 000 emplois dans le monde. Ainsi, selon l’expression d’Emmanuel Faber, se développe une « zone démilitarisée » qui montre qu’« un autre monde est possible ». Le manager ne craint pas de reprendre ce célèbre slogan, lui qui a participé au Forum social de Belém en 2009, tandis que Franck Riboud intervenait au Forum de Davos.
Alors, il ne s’agit pas d’être naïf et de croire que nous sommes sur le bon chemin.
Mais de se rassurer qu’il y a, peut-être de manière maladroite ou étonnante, des prises de conscience que la cupidité et la seule compétition ne pourront que nous mener au désastre, qu’il faut le plus vite possible songer à la coopération et aux possibilités d’aller vers plus de justice sociale.
<981>
-
Lundi 4 décembre 2017
« Une parole purement humaine qui fait du bien dans ce temps que nous traversons »Ahmed Madani,auteur du spectacle « F(l)ammes » lors de l’émission de France Culture du 2 décembre 2017La vie est jalonnée de rencontres.
Mais pour que la rencontre soit féconde, il faut bien sûr être mis en présence et surtout être disponible et ouvert à la consistance de l’échange.
Cela est vrai pour les rencontres entre humains pour lesquelles il faut avoir la sagesse de comprendre qu’elles ne peuvent pas avoir toujours la même intensité.
Cela est vrai pour les rencontres avec les œuvres d’art ou de l’esprit.
Plusieurs fois, mon butinage a croisé le chemin d’un spectacle : « F(l)ammes », mais je ne m’étais jamais arrêté pour ouvrir mon esprit à ce que ce spectacle avait à nous dire.
Et ce samedi matin, sur France Culture la rencontre d’éveil a eu lieu pour moi : Ahmed Madani était l’invité de Caroline Broué.
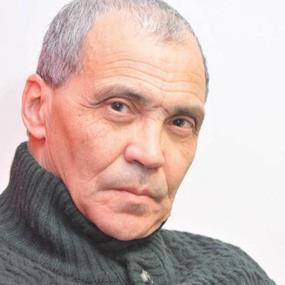 Ahmed Madani est metteur en scène et aussi auteur. C’est lui qui a conçu la pièce, F(l)ammes, qui met en scène des récits de vie de jeunes femmes issues de l’immigration. Sur scène elles sont dix jeunes femmes qui viennent raconter un bout de leur vie, faire part d’une petite brimade, d’une inégalité qui leur a été faite en raison de leur origine, de leur nature de cheveu, de leur couleur de peau ou de leur sexe.
Ahmed Madani est metteur en scène et aussi auteur. C’est lui qui a conçu la pièce, F(l)ammes, qui met en scène des récits de vie de jeunes femmes issues de l’immigration. Sur scène elles sont dix jeunes femmes qui viennent raconter un bout de leur vie, faire part d’une petite brimade, d’une inégalité qui leur a été faite en raison de leur origine, de leur nature de cheveu, de leur couleur de peau ou de leur sexe.
Au début de l’émission Ahmed Madani se présente et décrit le spectacle de la manière suivante :
« Je suis un auteur de mon temps.
J’ai commencé en 2012 avec « Illuminations », avec rien que des garçons. J’ai posé la question des classes populaires du point de vue des hommes. Et puis j’ai engagé la réflexion pour savoir ce qui se passe du côté des femmes. Qui pour la plupart du temps sont silencieuses, ne prennent pas la parole.
Elles ne sont pas souvent dans les espaces publics, mais qui en même temps ont beaucoup de choses à dire, pour qu’on prenne le temps de les écouter et de faire apparaître au grand jour cette parole. […] »
Ahmed Madani est né en 1952 en Algérie, il est psychothérapeute de formation. Wikipedia le présente ainsi :
Il réalise un théâtre dont la pierre angulaire est le rapport au sociétal et écrit aussi bien en direction de la jeunesse que des adultes. Il engage une recherche sur de nouvelles formes de création en milieu urbain en prenant en compte les diversités des composantes de la société française. Il s’adresse à tous les publics et prend en compte de façon significative la jeunesse. Dans cette démarche d’ouverture à tous les publics il inscrit ses réalisations dans les théâtres aussi bien que dans des lieux improbables : entrepôts, magasins inoccupés, immeubles abandonnés, haras. Son écriture se nourrit souvent de faits de société : le rapport à la terre, à la transmission, à la mémoire.
On apprend aussi que s’il travaille avec des acteurs professionnels, il réalise également des œuvres avec des non professionnels et même avec des enfants et des adolescents. Ce qui est le cas pour cette pièce : F(l)ammes. Dans un article de Telerama il fait remarquer que le titre met « l » ou « Elle » entre parenthèses. Il dit avoir choisi de « mettre le « l » entre parenthèses pour les désigner « elles » et leurs « ailes ». Car F(l)ammes, dit-il, c’est le feu de la vie ».
Dans l’émission de France Culture, il explique comment les actrices ont été choisies et le spectacle a débuté :
« J’ai passé deux années à organiser des petits ateliers de rencontre dans plusieurs villes et où je laissais entendre qu’il y avait une proposition de spectacle qui pourrait avoir lieu deux ou trois ans plus tard. Et le principe était de venir à ma rencontre en toute simplicité, sans avoir d’expérience théâtrale. Sans avoir de désir particulier d’être une artiste, mais simplement d’avoir envie de prendre la parole. J’ai envie de partager mon histoire avec d’autres. »
Cependant, pour choisir ces femmes il a dit lui-même qu’il a fait volontairement une discrimination. Il n’a choisi que des femmes qui vivent dans des quartiers périphériques et qui ont des parents qui sont venus d’ailleurs.
« On se rencontrait en petits groupes. Et souvent je me mettais presque en retrait. Je lançais des sujets et puis j’écoutais. Nous avons eu des moments d’échange d’une grande puissance qui aurait pu faire des spectacles à eux seuls.
Donc on parle, on parle on parle et puis de temps en temps on va sur le plateau et on va raconter une histoire à quelqu’un d’autre, on va imiter son père, imiter sa mère.
Je passe comme ça de groupe en groupe, ça dure deux ans. Et à un moment donné, il est temps de s’avancer pour lancer l’aventure proprement dite sur la scène. Et là je reviens vers un » trentaine d’entre elles (il avait auditionné plus d’une centaine) à qui j’écris, j’ai d’ailleurs écrit à toutes, une correspondance et nous avons échangé. Puis il en est resté d’abord quinze puis les dix qui font le spectacle. »
Le spectacle a été créé, en novembre 2016, à Sevran, ville sans théâtre et où le spectacle a été produit à la salle des fêtes avec des moyens précaires. Ville sans théâtre mais avec une vie associative magnifique dit Ahmed Madani. Elles ont créé ce spectacle dans cette ville pauvre avec le soutien du maire et du conseil municipal qui se déclaraient certains que la culture était une arme pour s’élever et s’en sortir.
Par la suite ce spectacle a été joué dans des salles parisiennes (Maison des Métallos) et dans toute la France, et en juillet 2017 au Festival d’Avignon. Et cela continue.
Dans l’émission de France Culture, Caroline Broué lui demande quels ont été les moments les plus marquants de cette expérience pendant l’année de tournée :
« Dans de nombreuses salles, il y a eu une volonté de prise de paroles et d’échange après la représentation. Par exemple, parfois, on se retrouve dans un théâtre où on a l’impression que le spectacle ne passe pas. Il n’y a aucune réaction dans la salle. Les filles donnent leur représentation et elles sont un peu inquiètes. Et à la fin du spectacle il y a une rencontre et là, les ¾ de la salle restent, et le débat s’engage et c’est très puissant ce qui se passe. Parce que dans cette représentation-là, il y avait plutôt une écoute, une attention où les paroles de chacune d’entre elles étaient bues par le public.
Et puis dans d’autres endroits, c’est une sorte de puissance à la fin de la représentation, la salle se dresse pour un standing ovation.
On a joué une série de représentations au « Grand T » à Nantes où on a répété le spectacle. C’était incroyable. C’est une ville extrêmement ouverte et au fur et à mesure qu’on donnait le spectacle, le bouche à oreille a fonctionné. De sorte que lors des dernières représentations, la salle savait ce qui se disait à la fin du spectacle et [réagissait par anticipation].
Ce qu’il y a d’extraordinaire avec les spectateurs, qu’ils soient jeunes, qu’ils soient vieux, qu’ils soient hommes, qu’ils soient femmes, qu’ils vivent dans les quartiers populaires ou au contraire qu’ils soient « bobos », on a l’impression qu’il y a une parole qui s’échange au-delà de la condition sociale, de la condition historique de ces jeunes femmes et qui est une parole purement humaine qui fait du bien dans ce temps que nous traversons. Ce temps qui est un temps trouble, difficile, qui est brumeux qui laisse penser qu’il n’y a pas beaucoup d’espérance. Or le spectacle est une ode à l’espérance, c’est une ode à la joie de vivre, c’est une ode à la capacité des femmes de pouvoir entreprendre, de pouvoir participer à la construction d’un nouveau monde.
Je pense que cela est vraiment perçu, par ceux qui viennent voir le spectacle. Et donc, le bouche à oreille est très fort.
 Il nous est arrivé de jouer dans un théâtre où on fait un premier spectacle et où on nous dit que pour le lendemain peu de places ont été vendues, cela n’a pas marché. On joue la première représentation et le lendemain, la salle est archi-comble, parce que très vite l’information se transmet et qu’on a envie de participer à ce moment-là qui est au-delà d’un moment de théâtre. C’est vraiment, un moment de vie, un moment de partage et un moment où en tant que spectateur on a envie d’être là, de dire qu’on existe aussi à travers les récits qui sont dits sur le plateau. »
Il nous est arrivé de jouer dans un théâtre où on fait un premier spectacle et où on nous dit que pour le lendemain peu de places ont été vendues, cela n’a pas marché. On joue la première représentation et le lendemain, la salle est archi-comble, parce que très vite l’information se transmet et qu’on a envie de participer à ce moment-là qui est au-delà d’un moment de théâtre. C’est vraiment, un moment de vie, un moment de partage et un moment où en tant que spectateur on a envie d’être là, de dire qu’on existe aussi à travers les récits qui sont dits sur le plateau. »
Caroline Broué exprime l’avis suivant :
« Ces dix femmes ne sont pas des actrices, elles ne sont pas des professionnelles, vous en avez fait des actrices. […] Elles ont une puissance volcanique et solaire absolument impressionnant. Le spectacle repose sur les textes, sur les récits, sur la mise en scène que vous faites et beaucoup sur ces dix femmes. »
Depuis qu’il existe, ce spectacle a fait l’objet des critiques les plus élogieuses : <Le Parisien> :
« F(l)ammes est un spectacle poignant et subtil, émouvant et drôle, devant lequel on ne cesse d’osciller entre allégresse et bouleversement. »
Le spectacle a aussi été donné à Genève :
« En ces temps particulièrement houleux, où les discours populistes se développent et où les replis identitaires, les peurs archaïques refont surface, la parole de ces « f(l)ammes », trop souvent confisquée, nous éclaire, nous embrase. »
Actuellement, le spectacle joue à la Cartoucherie de Vincennes, au théâtre de la Tempête jusqu’au 17 décembre puis repartira en tournée.
Annie et moi avons pris deux places à l’Espace Camus de Bron où le spectacle viendra en février 2018.
<Vous trouverez ici une page de France Culture plus ancienne avec des extraits du spectacle>
Un livre regroupant les textes est paru également à <Actes Sud>
<980>
-
Vendredi 1 décembre 2017
«A la naissance, un bébé humain distingue l’ensemble des phonèmes humains [mais un] mécanisme d’oubli progressif commence assez tôt avant l’âge d’un an»Lionel Naccache, « Le cerveau bilingue » 32ème émission de la série « Parlez-vous cerveau ? »Même ma mère, qui avait arrêté l’école à 14 ans, le disait : « Un enfant apprend mieux une langue étrangère qu’un adulte ». Elle le savait, mais elle ignorait pourquoi.
Lionel Naccache va nous l’expliquer :
« Parler une langue, requière déjà de reconnaître ses phonèmes, les unités de son élémentaire que composent ses mots parlés. Les linguistes ont dénombré plusieurs centaines de phonèmes distincts, à travers les milliers de langues parlées par l’homme.
Premier scoop : chaque langue n’utilise en général que quelques dizaines de phonèmes. 36 précisément en français.
C’est pourquoi un locuteur japonais adulte sera sourd à la différence des phonèmes « re » et « le » qui sont différenciés en français mais pas en japonais. »
Et Lionel Naccache de s’amuser en s’écriant : « palfaitement ».
« Inversement nous sommes sourds à des phonèmes distingués en japonais et non en français. »
Second scoop : merveilleux argument en faveur de l’universalité de l’espèce humaine : A la naissance, un bébé humain distingue l’ensemble des phonèmes humains.
Comment le sait-on ?
Par exemple en comptant le taux de succions d’une tétine par un bébé de trois mois, alors qu’on lui fait écouter des phonèmes. Ce taux de succion augmente, lorsque le phonème change. Ce qui permet donc de vérifier si le cerveau du bébé a fait la différence entre des sons que nous adultes sommes incapables de distinguer, avec ou sans tétine.
Moralité : l’apprentissage d’une langue repose sur un mécanisme de renforcement des sons utiles, mais également un mécanisme d’oubli des sons inutilisés. Ce mécanisme d’oubli progressif commence assez tôt avant l’âge d’un an.
C’est pourquoi notamment l’apprentissage d’une seconde langue sera d’autant plus efficace, qu’il surviendra tôt dans la vie.
Après 25 ans, par exemple, aucun espoir de la parler avec un accent parfait et ceci quelle que soit votre intelligence. »
En 1988, j’avais assisté au mariage d’un ami en Allemagne avec sa compagne allemande. Un moment, la mère de la mariée est venue me voir et m’a posé la question (en allemand bien sûr) : êtes-vous vraiment français ? Je lui ai répondu : Oui pourquoi ? Mais vous n’avez aucun accent ! Quand j’étais bébé, mes deux grands-mères ne parlaient qu’allemand et ce sont donc régulièrement adressées à moi dans cette langue. Je suis assez mauvais en grammaire allemande, j’écris avec pas mal de fautes, mais je parle sans accent. J’ai entendu un discours de Jean-Marc Ayrault, alors premier ministre de la France, lui est agrégé en allemand il connait beaucoup mieux cette langue que moi. Mais quand il parle, il n’y a aucun doute, il n’est pas allemand.
Ce constat : «A la naissance, un bébé humain distingue l’ensemble des phonèmes humains. » est très révélateur. Il signifie qu’un bébé humain ne naît pas français, allemand, espagnol, chinois, sénégalais, israélien, syrien, il le devient.
Lionel Naccache invite bien sûr l’éducation nationale à tirer toutes les conséquences de cette connaissance des neuro sciences :
« La plasticité cérébrale des réseaux impliqués dans la prononciation et la perception des phonèmes présentent donc des périodes critiques. Périodes critiques dont il faudrait s’inspirer pour élaborer les programmes d’apprentissage linguistique à l’école.
Il semble d’ailleurs que l’exposition précoce et la maîtrise de deux langues différentes soit à l’origine d’une meilleure flexibilité mentale. Comme si la gymnastique permanente de savoir jongler entre deux ou trois langues bénéficiait à notre agilité cognitive en général. »
Vous trouverez l’émission de Lionel Naccache derrière ce lien : <Le cerveau bilingue>
J’arrête ici, la série de mots du jour consacré aux 35 émissions de « Parlez-vous cerveau », mais il y en a beaucoup qui sont tout aussi passionnants.
Je citerai particulièrement avec entre parenthèse le numéro de l’émission
- La prise de conscience (24)
- La conscience de soi (25)
- La créativité (26)
- La société comme un cerveau (28)
- Le système de récompense (29)
- La matrice de la douleur (30)
- Les neurones miroirs (31)
- Le cerveau de demain (35)
Dans la société comme un cerveau, Lionel Naccache ose une analogie hardie entre la mondialisation et le cerveau humain :
« L’une des facettes de la mondialisation tient au contraste d’une part d’une accélération inédite des moyens de voyager et d’autre part une atténuation sans cesse croissante de l’expérience de dépaysement.
J’ai bougé sans difficulté et en même temps je n’ai pas vraiment bougé, à cause de l’uniformisation du monde.
Cet oxymore du voyage immobile peut être éprouvé à plusieurs échelles spatiales : entre les différents quartiers d’une même ville, entre les différentes villes d’un même pays, ou entre différents endroits du monde. Son illustration, la plus parfaite est <le mall>, le centre commercial identique à Los Angeles, à Paris et à Tokyo.
Ce voyage immobile associe donc l’uniformisation et l’appauvrissement des lieux avec l’augmentation massive de communication entre eux.
Une analogie s’imposa à moi.
Il existe dans le cerveau une situation de voyage immobile marquée par ces 3 propriétés : Excès de communication entre lieux cérébraux, uniformisation et appauvrissement de ces lieux, c’est une crise d’épilepsie.
Ce qui reviendrait donc à traduire en langue du cerveau, l’expression «méfaits de la mondialisation» par crise d’épilepsie.
Une crise d’épilepsie du monde.
Or, dès qu’une crise d’épilepsie s’étend dans notre cerveau et gagne le réseau cérébral de la conscience, que se passe t’il ?
Le patient demeure éveillé, il continue à agir de manière automatique, mais il perd conscience.
Si nous rebasculons du côté du macrocosme social, un nouveau concept apparaît alors :
Celui d’une perte de conscience épileptique d’une société. »
Il pousse l’analogie un peu loin, vous ne trouvez pas ?
En tout cas tout cela est passionnant vous trouverez les 35 émissions derrière ce lien
<J’ai trouvé aussi ce site qui a pour vocation de comprendre le cerveau et son fonctionnement>
<979>
- La prise de conscience (24)
-
Jeudi 30 novembre 2017
« Le cerveau vit dans un temps particulier : le futur du présent »Lionel Naccache, « Le cerveau parle au futur du présent» 33ème émission de la série « Parlez-vous cerveau ? »Dans cet épisode, il n’y a pas de révélation aussi étonnante que celles concernant la plasticité ou l’invention du monde que le cerveau réalise à partir des informations envoyées par ce que les yeux voient.
Ici nous sommes dans l’univers de l’intelligence et de la philosophie.
Car Lionel Naccache s’interroge sur le temps du cerveau. Notre cerveau vit au présent mais pas seulement. Il y a un temps particulier plus important pour notre vie.
Car le cerveau anticipe continuellement pour connaître l’univers immédiat futur vers lequel nous nous engageons :
« Contrairement à notre intuition immédiate, notre cerveau ne vit pas au présent. Ou plus exactement pas uniquement au présent.
Il vit dans un temps particulier que j’aime à appeler le futur du présent.
A chaque instant notre cerveau construit ce à quoi devrait ressembler notre futur immédiat. Ce que nous devrions percevoir et vivre dans l’instant qui suit : le futur du présent. »
Lorsque son anticipation est confirmée par la réalité, Lionel Naccache conclut : « le cerveau sourit silencieusement ».
Mais quand le cerveau se rend compte que son anticipation était erronée :
« Il chamboule son modèle du futur à venir. Et cela correspond à d’amples réponses cérébrales que nous enregistrons avec nos outils de neuro-imagerie.
Prenons un exemple.
Imaginons que j’enregistre l’activité de votre cerveau pendant que je vous fais écouter un même son (un bip assez agaçant à mon oreille) qui se répète inlassablement.
Voici la réponse que j’enregistrerai : Une première réponse très ample des zones auditives de votre cortex, liée à la surprise du premier son entendu, suivie de réponses de plus en plus atténuées au fil des bips. »
Lionel Naccache explique que cette atténuation vient de la partie du cerveau qui réfléchit au futur du présent. Car plus le même son se répète, plus le modèle prédictif mis en place constate la diminution de l’incertitude pour l’avenir immédiat. Il peut donc mettre au repos cette fonction.
Ainsi, la partie du cerveau qui pense au présent reste stable, alors que celle qui pense au futur du présent voit son activité tendre vers zéro.
« Bien entendu, si j’arrête brutalement le son. J’enregistrerai une réponse ample de votre cerveau, car il a dû chambouler son modèle du futur immédiat qui vient d’être contredit. »
Et puis Lionel Naccache va plus loin dans son analyse de cette fonction du cerveau à toujours anticiper le futur prévisible :
« Ce n’est pas du cerveau au singulier qu’il faut parler, En réalité il faut imaginer les réseaux de notre cerveau, comme une foule d’acteurs produisant des anticipations différentes de l’avenir. Des anticipations inconscientes mais aussi des anticipations conscientes qui peuvent se jouer, elles, sur des intervalles très long.
Même lorsque nous décidons d’effectuer un geste, nous simulons ce à quoi il devra ressembler et quelles seront les conséquences après son exécution.
En parlant au futur du présent, notre cerveau ne cesse donc d’anticiper ce qu’il va vivre.
Cela fait partie de notre condition humaine.
Une anticipation qui peut constituer un avantage de survie précieux dans un monde dangereux et mouvant.
Une anticipation qui permet aussi d’envisager que le monde puisse être autre qu’il n’est. De simuler mille et un scénarios possibles vers lesquels se projeter.
Une anticipation qui illustre comment le futur pensé par notre cerveau puise dans son passé et aussi dans les données les plus immédiates.
Cet infime décalage entre le présent et le futur du présent est précieux
C’est, en lui, me semble t’il que se joue la seule forme de liberté qui est à notre portée.
Si «time is money» pour certains.
Il n’est pas exagéré d’affirmer que « time is freedom » pour notre cerveau.
Il me semble que nous sommes plus savants de savoir et de comprendre que notre cerveau vit au futur du présent.
Vous trouverez l’émission de Lionel Naccache derrière ce lien : <Le cerveau parle au futur du présent>
<978>
-
Mercredi 29 novembre 2017
« Notre cerveau est une sculpture vivante ininterrompue »Lionel Naccache, « La plasticité cérébrale» 17ème émission de la série « Parlez-vous cerveau ? »Lors de la 16ème émission Lionel Naccache avait évacué scientifiquement le mythe selon lequel nous n’utilisions que 10% de notre cerveau. Les neuro-sciences montrent que nous utilisons bien 100% de notre cerveau.
Mais la plasticité du cerveau permet de dépasser les limites du 100%.
Le cerveau utilisé à 100%, ne cesse de se transformer, c’est ce qu’on appelle la plasticité cérébrale.
Lionel Naccache dit que contrairement au mythe des 10%, la plasticité cérébrale est une réalité quotidienne qu’il va pouvoir nous révéler par des exemples concrets.
Il commence son émission en faisant écouter plusieurs fois un enregistrement d’une phrase reproduite à une vitesse très accélérée. Il prétend qu’au bout de plusieurs essais vous arrivez à la comprendre grâce à la plasticité de votre cerveau.
Moi je n’y suis pas arrivé, mais Lionel Naccache en explique la raison, avec l’âge la plasticité diminue. Je comprends donc que je suis âgé.
Pour celles et ceux pour qui ça marche :
« La structure de votre cerveau s’est modifiée à chaque audition.
Notre cerveau est une sculpture vivante ininterrompue ».
Ce qui est vrai pour cette phrase, sans intérêt, est vrai pour chaque instant de votre existence, depuis votre vie utérine jusqu’à votre dernier souffle.
Notre cerveau est la sculpture de notre vie. Sculpture qui résulte certes de nos actions volontaires : pratiquer telle ou telle activité, apprendre telle ou telle langue, mais aussi de tout ce que nous vivons en relation avec les autres et avec l’environnement dans lequel nous baignons ; indépendamment de tout contexte d’apprentissage.
Si l’on devait choisir une devise pour la plasticité cérébrale, ma préférence irait pour la célèbre citation d’Héraclite : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». C’est-à-dire que le cerveau ne vit jamais deux fois la même expérience de manière identique.»
Et Lionel Naccache de préciser qu’Il n’existe pas un seul mécanisme de plasticité cérébrale mais de nombreux mécanismes qui mobilisent différentes structures du cerveau : synapse, récepteurs membranaires, neurones, réseau de neurones etc..
Il donne alors trois exemples :
1 – Une étude restée célèbre a montré que la mémoire des lieux et la matière grise des hippocampes, ces GPS du cerveau, sont plus développés chez les chauffeurs de taxi londoniens que chez le commun des mortels. Outre-manche comme ailleurs la structure du cerveau est affectée par l’expérience vécue.
2 – De la même manière les régions visuels du cerveau des aveugles congénitaux sont recyclés en région tactile. Lorsqu’ils lisent un texte en braille avec leurs doigts, ils utilisent la région du cerveau normalement utilisée pour la lecture visuelle.
3 – Le troisième exemple a été rapporté par mon collègue Laurent Cohen et concerne une petite fille à laquelle il a fallu retirer une région déterminante pour l’apprentissage de la lecture à un âge où elle ne savait pas encore lire. Contre toute attente, cette enfant a pu apprendre à lire. Et c’est la région de l’hémisphère droit, symétrique de celle qui lui a été retirée à gauche qui a pris en charge cette fonction qui normalement n’est pas de son ressort.
Les exemples pourraient être multipliés à l’envie.
Il existe des plasticités cérébrales de courtes et de longues durées. Certaines sont accessibles à notre conscience alors que la plupart ne le sont pas.
Pour approfondir ce sujet, je vous conseille cette vidéo de : < Philippe Fait qui fait une conférence TED à Montréal sur la plasticité cérébrale>
Il introduit, en outre, son propos par une présentation du cerveau par des comparaisons qui montrent le côté exceptionnel du cerveau.
Par exemple, le cerveau est irrigué par le sang. Pour ce faire il utilise un réseau de vaisseaux sanguins qui mit bout à bout représentent 160 000 km ce qui permet de faire 4 fois le tour de la terre.
Il compare aussi le diamètre d’un neurone par rapport à celui d’un cheveu : un cheveu c’est 0,1 mm, un neurone 0,004 soit 25 fois plus petit.
Il revient aussi sur l’étude concernant les chauffeurs de taxi londoniens.
Et il évoque une autre expérience où des tests ont été effectués sur le développement de la plasticité chez des sujets âgés. On leur a proposé des exercices intensifs de jonglerie . Même chez les vieux cela fonctionne, le cerveau continue à se développer. Dans l’expérience donnée c’est la partie du cerveau qui gère la coordination des mains qui s’est renforcée. Et quand on arrête pendant un temps les exercices, comme chez tous les individus, l’évolution est réversible et la partie du cerveau qui s’est développé régresse.
Philippe Fait prétend que trois pratiques sont indispensables, à tout âge, pour exercer la plasticité du cerveau
- Il faut être actif physiquement et aussi cognitivement. Ne jamais cesser d’apprendre des choses nouvelles.
- Il faut avoir une bonne hygiène du sommeil. Le sommeil réparateur va beaucoup servir à la neuroplasticité, comme d’ailleurs des micro-pauses au milieu de la journée.
- Enfin avoir une activité sociale, c’est-à-dire inter agir avec d’autres humains.
Vous trouverez énormément de vidéo sur internet parlant de cette plasticité cérébrale. Pour ma part j’ai encore regardé avec beaucoup d’intérêt : <Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche à l’Institut Pasteur>.
Vous trouverez l’émission de Lionel Naccache derrière ce lien : <Plasticité cérébrale>
<977>
- Il faut être actif physiquement et aussi cognitivement. Ne jamais cesser d’apprendre des choses nouvelles.
-
Mardi 28 novembre 2017
« Notre cerveau invente le monde qu’il ne voit pas selon ce qu’il suppose qu’il doit être »Lionel Naccache, « la perception est une construction » 20ème émission de la série « Parlez-vous cerveau ? »Pour tous ceux qui ont la chance d’être voyant, leurs yeux voient le monde et transmettent ces images au cerveau. Lionel Naccache, nous apprend que la réalité est beaucoup plus complexe. Le cerveau invente, reconstruit, sélectionne les informations qu’il reçoit pour nous offrir l’image que nous voyons.
Lionel Naccache décrit ce phénomène par l’expression : « La perception est une construction ».
« La perception est une construction
Dans cette expression on associe deux notions a priori contradictoires : la perception qui est passivité et la construction qui est action.
Mais les sciences du cerveau nous ont montré que la perception est une action.
Il ne s’agit pas d’un slogan politique mais d’un résultat spectaculaire et puissant des neurosciences de la perception. »
Première transformation : notre cerveau colore les images qu’il reçoit.
« Un exemple simple. Ouvrez grand les yeux et fixez votre regard droit devant vous. Que voyez-vous ?
Je ne prends pas trop de risque pour dire que l’image que vous voyez est colorée.
Oui et alors ?
Alors cela ne va pas de soi.
Les cellules qui tapissent la rétine transforment la lumière en impulsions nerveuses.
Mais il y a un hic.
Nos rétines contiennent deux types de cellules.
Les premières situées au centre sont sensibles aux couleurs, tandis que les secondes ne voient le monde qu’en noir et blanc.
Si le cerveau se contentait de recevoir passivement les informations envoyées par nos rétines nous devrions voir le monde en couleur autour du point que nous observons et tout le reste du monde devrait nous apparaître en noir et blanc.
Quelle implacable conclusion en déduisez-vous alors ?
Notre cerveau colore les images lumineuses qu’il reçoit en noir et blanc. »
Le cerveau efface des informations parasites.
« D’autre part les images qui proviennent de nos rétines contiennent une foultitude d’informations qui n’intéressent personne, comme par exemple les reflets des vaisseaux qui les vascularisent. A nouveau si notre cerveau recevait passivement les informations transmises par nos rétines, nous devrions tout voir à travers un réseau de vaisseaux. En réalité, notre cerveau visuel efface tout ce qui est immobile sur nos rétines, dont les vaisseaux en question. »
Le cerveau stabilise l’image tremblotante que les rétines lui envoient
« Lorsque nous marchons, nos yeux et notre cerveau n’ont de cesse de bouger, ce qui signifie qu’un visage perçu devant nous ne cesse de sauter sur la surface de nos rétines. Conséquence : notre perception visuelle devrait ressembler alors à un film de John Cassavettes tourné caméra à l’épaule
Conclusion : notre cerveau visuel stabilise en permanence les images brutes reçues de nos yeux. »
Le cerveau invente ce que le point aveugle lui cache
Faisons un pas de plus.
Sur le côté de chacune de nos rétines, il y a un trou par lequel passent des vaisseaux et le nerf optique en partance vers le cerveau.
Nous devrions donc percevoir le monde visuel avec deux tâches aveugles sur les côtés.
Conclusion : Notre cerveau remplit ce trou de la rétine par des inventions visuelles de son propre goût.
Ce phénomène de remplissage a été découvert par l’Abbé naturaliste Edme Mariotte dès le XVIIème siècle
Ce point aveugle ou tâche aveugle a été d’ailleurs appelé « tâche de Mariotte ». Il correspond à la partie de la rétine où s’insèrent le nerf optique qui relaye les influx nerveux de la couche plexiforme interne jusqu’au cortex cérébral, ainsi que les vaisseaux sanguins arrivant à l’œil et quittant l’œil. Dans la pratique, il s’agit donc d’une petite portion de la rétine qui est dépourvue de photorécepteurs et qui est ainsi complètement aveugle. (Citation de wikipedia)
« Notre cerveau invente le monde qu’il ne voit pas selon ce qu’il suppose ce qu’il doit être.
Il se passe donc énormément de choses en coulisse pour que nous soyons en mesure de voir ce que nous voyons. Le cerveau nous permet de voir ce qui nous intéresse, ce que nous cherchons, ce qui fait sens pour nous et pour ce faire il colorie, efface, stabilise, remplit, invente, sélectionne.
La conclusion de Lionel Naccache :
« La perception est une construction active permanente de notre cerveau.
Une construction qu’on pourrait presque dire qu’elle se joue les yeux fermés. »
Vous trouverez l’émission derrière ce lien : <La perception est construction>
<976>
-
Lundi 27 novembre 2017
« La double vie des hippocampes »Lionel Naccache, « L’hippocampe» 10ème émission de la série « Parlez-vous cerveau ? »Le cerveau est le siège des fonctions cognitives.
De manière plus empirique, il est l’organe qui commande, qui raisonne et qui donne des ordres. C’est un organe d’une complexité inouïe qui nous permet de percevoir, découvrir et agir sur le monde qui nous entoure.
Quand nous disons « Je », le cerveau joue le rôle principal dans cette manifestation de l’identité.
Cet été, sur France Inter, à 8h52, pendant 4 minutes et 35 chroniques le neurologue Lionel Naccache, a raconté le cerveau dans une émission qu’il a appelé « Parlez-vous cerveau ? »
En quelques minutes, il racontait le fonctionnement d’un des rouages de notre cerveau.
Les premières émissions ont conduit à présenter les différents éléments du cerveau : Le neurone, la glie, les neurotransmetteurs, les récepteurs membranaires, la synapse, les réseaux de neurones, le cortex cérébral, les ganglions de la base, le lobe frontal, le corps calleux, le cortex visuel, l’aire de Broca etc.
Il a résumé ces premières émissions par cette formule brillante mais austère :
« Le neurone communique avec ses congénères au niveau des synapses sous l’œil bienveillant des cellules gliales et ce grâce à des neuros transmetteurs qui se fixent sur des récepteurs membranaires. »
Le journal La Croix avait présenté cette émission de la manière suivante :
« C’est une des pépites de l’été. Tous les matins, sur France Inter, le neurologue Lionel Naccache raconte en quelques minutes le fonctionnement d’un des rouages de notre cerveau. »
Vous trouverez l’ensemble de ces 35 émissions derrière ce lien.
Pour ma part j’en ai choisis 5 pour cette semaine de mots du jour, pour partager les informations qui m’ont le plus étonné ou même fasciné.
Parmi les différentes structures étudiées celle qui m’a le plus intrigué est l’hippocampe qui existe en deux exemplaires présents, de manière symétrique, dans chaque hémisphère.
Lionel Naccache commence sa chronique de la manière suivante :
« Lové dans les profondeurs de nos lobes temporaux siègent effectivement deux hippocampes. L’un à droite, l’autre à gauche. C’est à dire deux petites régions dont la forme épouse fidèlement celle d’un véritable hippocampe. Ces mignons petits poissons du cerveau sont en réalité de véritables palais de la mémoire. »
Puis il nous apprend que les hippocampes mènent une double vie.
« Tout commence en 1953, lorsque un jeune canadien épileptique subi une intervention chirurgicale, terriblement efficace, qui consista à lui enlever ses deux hippocampes. Intervention efficace car il n’a plus jamais fait de crise d’épilepsie jusqu’à son décès à l’âge de 82 ans. Mais intervention terrible aussi, car il lui a été impossible depuis lors de mémoriser le moindre nouveau épisode de son existence. Les hippocampes sont tout simplement indispensable à la création de nouveaux souvenirs conscients. »
Vous trouverez dans la revue <Pour la science> un article sur cette opération et les conséquences scientifiques qu’elle entraîna. On apprend aussi que ce patient a été opéré à l’âge de 27 ans.
La capacité d’assimiler de nouveaux souvenirs constitue la première vie des hippocampes.
« En 1971, le biologiste John O’Keefe découvre que chez le rat des neurones de l’hippocampe code la position que l’animal occupe dans l’espace. Il baptise ces neurones « les cellules de lieu ». Ces cellules de lieu existent aussi dans nos hippocampes humains où ils jouent une véritable fonction de GPS cérébral.
A chaque instant :
– Nous savons où nous nous trouvons ;
– Nous pouvons nous orienter ;
– Nous souvenir des lieux ;
– Les imaginer grâce à ce système de navigation.
Voilà pour la deuxième vie de nos hippocampes. »
Outil de la mémoire et GPS, Lionel Naccache montre que ces deux fonctions sont reliées.
« Mais cette double vie sert la même cause.
Il s’agit ici d’une découverte scientifique majeure. La mémoire des épisodes de notre vie et notre orientation spatiale reposent sur le même système cérébral.
Une illustration ?
Lorsque nous déambulons et vivons des scènes de notre vie quotidienne, les GPS de nos hippocampes codent nos trajectoires.
La nuit, lorsque nous sommes plongés dans les profondeurs du sommeil, nos GPS se rallument et se mettent à jouer, en accéléré, ces trajectoires de la journée. Des centaines de fois !
Conséquence, ce replay nocturne permet de consolider les souvenirs des épisodes que nous avons vécus au cours de cette journée.
La mémoire des lieux sous-tend ainsi la mémoire des scènes que nous avons vécu.»
Et ainsi Lionel Naccache en appelle aux grands anciens qui connaissaient ce lien sans connaître l’hippocampe et son utilité :
« Dès l’antiquité, Cicéron avait remarqué qu’une excellente méthode pour apprendre, par cœur, une longue tirade consiste à imaginer une promenade dans un lieu familier, une rue, une maison et à déposer chaque fragment du texte en question sur une étape de cette navigation mentale. C’est ce qu’on appelle « la méthode des lieux » encore appelé « méthode des palais de la mémoire »
Vous trouverez plusieurs articles sur internet concernant la méthode des lieux appelés aussi « La méthode des loci », Wikipedia confirme que plus récemment on l’a appelé « palais de la mémoire ». C’est une méthode mnémotechnique, ou « art de mémoire », pratiquée depuis l’Antiquité.
Le comité Nobel a, attribué son prix 2014 de physiologie et médecine à John O’Keefe associé à un couple de Norvégiens, May-Britt et Edvard Moser pour les récompenser pour leurs découvertes sur les «cellules qui constituent un système de géoposition dans le cerveau», une forme de GPS biologique et cellulaire embarqué dans une précieuse région du cerveau. C’est ce qu’expliquait le comité Nobel dans son souci de vulgariser ce que peut être l’apport des sciences fondamentales au service, proche ou lointain, de la médecine. Vous pourrez lire ces réflexions dans cet article du site <Slate.fr>
Vous trouverez l’émission de Lionel Naccache derrière ce lien : <L’hippocampe>
<975>
-
Vendredi 24 Novembre 2017
« J’ai tellement besoin de ma mère, mais comment faire pour lui parler ? »Barbara,Dans ses mémoires posthumes, se remémorant son enfance trahie et violée par son père incestueuxNous sommes le 24 novembre. Il y a 20 ans mourait la dame en noir, Barbara.
Immense artiste, poétesse, musicienne, la beauté de ses mélodies, la profondeur de ses textes, l’émotion de sa voix, tout est à souligner.
Elle était aussi sensibilité et dévouement. Le professeur Pierre-Marie Girard est chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine à Paris. Il raconte l’action de Barbara pour les malades du sida. Il était alors jeune médecin qui, à Bichat, commence à soigner les malades du sida. Pendant dix ans, il fut celui qui permit à Barbara de les rencontrer et de les aider. Il raconte :
« C’est en 1988, au cours d’un dîner […] que j’ai fait connaissance de Barbara. […] Elle a exprimé son souhait de s’engager contre le sida. Je suis devenu son sésame pour qu’elle rencontre des patients à l’hôpital Bichat où je travaillais alors. Elle voulait donner de son temps. […]
Barbara était un être hypersensible […] Elle était profondément émue des visites à l’hôpital. Ces rencontres l’affectaient beaucoup. Ces visites ont duré près de 3 ans : pendant la période la plus terrible du sida. Les grandes avancées remontent à avril 1996, quand les premières tri-thérapies ont transformé la vie des patients. […] Elle donnait son numéro de téléphone aux patients qui pouvaient l’appeler à n’importe quelle heure. »
Hors-Série Barbara page 85
« La nuit Barbara ne mentait pas. Elle décrochait son téléphone dans sa maison silencieuse de Précy et elle écoutait les malades du sida. Ils lui disaient leur solitude, leur douleur, leur peur. Elle tremblait de ne savoir que leur répondre, mais n’en laissait rien paraître, câlinant l’un, morigénant l’autre, toujours attentive. Cela a duré presque dix ans. Le docteur Pierre-Marie Girard […] a attendu 20 ans avant de nous raconter cette expérience qui le bouleversa. »
Hors-Série Barbara page 77
Elle a créé la chanson « Sid’amour à mort » sur la scène du Chatelet en 1987. Elle dira : « ça c’est une chanson que j’aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite ».
Dans une interview à Libération du 28 novembre 1988 qui parle de cet engagement, elle répond :
« Bizarrement, on ne relève de mes chansons que la mort. Le morbide est quelquefois dans les autres, mais moi je parle complètement de la vie, parce que je parle de l’amour. […]. C’est justement parce que j’aime la vie que je peux parler de la mort et d’une telle maladie. J’ai chanté beaucoup de chansons d’amour. Or, cette maladie est arrivée là précisément par l’amour. Par le sang et par le sperme. Il n’y avait pas plus grave. »
 Elle dit « Je parle complètement de la vie, parce que je parle de l’amour ».
Elle dit « Je parle complètement de la vie, parce que je parle de l’amour ».
J’avais écrit un mot du jour : « L’homme médiocre parle des personnes, l’homme moyen parle des faits, l’homme de culture parle des idées ».
Barbara me rappelle que j’ai oublié le plus l’important : « L’homme de cœur et en l’occurrence la femme de cœur parle de la vie et de l’amour. »
Tant de belles chansons ont jalonné sa vie.
Après le triomphe remporté à Bobino en 1965, émue par l’accueil du public, elle compose pour le remercier « Ma plus belle histoire d’amour ».
En août 1965, alors qu’elle donne un concert à Chalons sur Marne, Barbara apprend la mort de Liliane Benelli, sa pianiste à L’Ecluse dans un accident de voiture au côté de son fiancé Serge Lama qui est gravement blessé. Dans la nuit elle lui écrit en hommage une chanson : « Une petite cantate »
En 1961, l’histoire d’amour entre Barbara et Hubert Ballay, diplomate mais aussi agent secret s’achève, après un dernier séjour orageux à Abidjan dans l’avion de retour elle écrit les premiers vers de « Dis quand reviendras-tu ? »
En juillet 1964, elle était invitée par des étudiants d’une petite ville universitaire de Göttingen. Il y avait grève des déménageurs, alors les étudiants lui ont apporté son piano sur leurs épaules. Elle leur compose le jour même une chanson pour les remercier. C’est une incroyable chanson de pardon et de réconciliation écrite par une jeune juive, 20 ans après la fin de la seconde guerre mondiale : « Göttingen ». En janvier 2003, le chancelier Schröder en lira un extrait lors du 47ème anniversaire du Traité d’amitié franco-allemand.
Et puis en 1970, elle écrit et chante l’ « aigle noir »
Chanson mystérieuse et merveilleusement belle
Un beau jour,
Ou peut-être une nuit
Près d’un lac, je m’étais endormie
Quand soudain, semblant crever le ciel
Et venant de nulle part,
Surgit un aigle noir.
[…]
De son bec, il a touché ma joue.
Dans ma main, il a glissé son cou.
C’est alors que je l’ai reconnu :
[…]
L’aigle noir, dans un bruissement d’ailes
Prit son vol pour regagner le ciel.
Quatre plumes, couleur de la nuit,
Une larme, ou peut-être un rubis.
J’avais froid, il ne me restait rien.
L’oiseau m’avait laissée
Seule avec mon chagrin.
Certains avaient cru que Barbara parlait de la menace nazi qu’elle avait connu quand jeune juive, elle était pourchassée par les allemands dont l’emblème était un aigle.
Mais ce n’était pas cela.
Et pourtant en 1967, Barbara revient à Saint Marcellin, le village où sa famille s’était cachée de juillet 1943 à octobre 1945. Elle en tire une chanson « Mon enfance » qui se termine par ces vers :
« et je reste seule avec ma détresse,
hélas.
Pourquoi suis-je donc revenue
et seule au détour de ces rues
j’ai froid, j’ai peur, le soir se penche.
Pourquoi suis-je venue ici,
où mon passé me crucifie,
où dort à jamais mon enfance ? »
Elle a même écrit en 1972 « Amours incestueuses » qui raconte une histoire d’amour entre une dame mûre et un jeune homme. Renversement du crime qu’elle a vécu et qu’on a pu lire dans ses mémoires posthumes qui paraissent en 1998 :
« J’ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent. Il le sait. J’ai tellement besoin de ma mère, mais comment faire pour lui parler ?
Et que lui dire ? Que je trouve le comportement de mon père bizarre ? Je me tais.
Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l’horreur. J’ai dix ans et demi.
Les enfants se taisent parce qu’on refuse de les croire.
Parce qu’on les soupçonne d’affabuler.
Parce qu’ils ont honte et qu’ils se sentent coupables.
Parce qu’ils ont peur.
Parce qu’ils croient qu’ils sont les seuls au monde avec leur terrible secret.
De ces humiliations infligées à l’enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j’ai toujours ressurgi.
Sûr, il m’a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d’être heureuse, une sacrée volonté d’atteindre le plaisir dans les bras d’un homme, pour me sentir un jour purifiée de tout, longtemps après.
J’écris cela avec des larmes qui me viennent.
C’est quoi, ces larmes ?
Qu’importe, on continue !»
Il était un piano noir… Mémoires interrompus, Fayard, 1998.
Dans ce texte, elle raconte simplement le désarroi de l’enfant victime de ce qu’il ne comprend pas mais dont il sent que c’est mal. Comment le dire à ma mère ?
Les enfants se taisent parce qu’on les soupçonne d’affabuler, qu’ils se sentent coupables…
Et tout devenait clair : l’aigle noir est l’histoire d’un inceste que Barbara raconte pour mieux se libérer.
Tous les enfants n’ont pas cette possibilité qu’évoque Barbara dans ses mémoires : « Tu peux dormir tranquille, je m’en suis sortie puisque je chante. »
Depardieu, son ami, a répondu à une interview de Telerama le 4 février 2017 :
« L’inceste a glissé sur elle dès qu’elle a commencé à chanter. Elle s’en est échappée. (…) Barbara était non seulement très joyeuse, mais elle avait en elle une force de vie formidable. Elle savait écouter, recevoir le malheur des gens, et ne se lamentait jamais sur son propre vécu. Avec Nantes, elle montre qu’elle a pardonné ».
Et en effet il y a <Nantes>. Le 21 décembre 1959 ; un coup de téléphone apprend à Barbara que son père Jacques disparu depuis plusieurs années est en train de mourir à Nantes. Elle arrive trop tard et va en tirer une chanson bouleversante qu’elle mettra plusieurs années à achever.
Boris Cyrulnik y voit comme un exemple extraordinairement abouti de résilience dans la poésie.
Barbara fut une immense artiste et poète et une très grande Dame
<Jacques Higelin qui était aussi son ami a dit : j’adore cette femme>. Il n’est pas le seul.
* J’ai pu donner toutes les précisions sur les chansons citées grâce au Hors-série le Monde la vie « Barbara une femme qui chante », numéro d’octobre novembre 2017
<974>
-
Jeudi 23 novembre 2017
« Une consommation quotidienne de [chocolat] [entraîne] 40% de risques en moins de présenter des valeurs anormales des enzymes hépatiques »Pr Philippe Sogni (hépatologue à l’hôpital Cochin) et Patrizia Carrieri, épidémiologiste à l’Inserm UMR 912 (Marseille)La revue de presse de France Inter du lundi 20 novembre a attiré mon attention sur une interview que le Figaro a réalisée de Lloyd Bankfein le PDG de la banque Goldman Sachs.
J’ai donc acheté Le Figaro de ce lundi pour pouvoir lire les propos de celui qui dirige « La banque » <selon le titre du livre de Marc Roche>
Mais mon attention a alors été attirée par un autre sujet publié dans le même journal et ce sujet concerne le chocolat.
Chaque français consomme, en moyenne, 6,7 kg de chocolat par an.
J’ai été un peu déçu, d’apprendre que nous ne sommes que 7ème en Europe derrière l’Allemagne (où la consommation est double), le Royaume-Uni, l’Autriche, le Danemark, la Belgique et la Finlande.
Mais les Français adultes consomment plus de chocolat noir que leurs voisins – 30%, contre 5% seulement en Allemagne.
Et là nous avons raison.
Car le chocolat est hépato protecteur, à condition d’être bien noir. « Hépato protecteur » qualifie un médicament qui protège le foie.
Le Professeur Philippe Sogni (hépatologue à l’hôpital Cochin) et Patrizia Carrieri, épidémiologiste à l’Inserm UMR 912 (Marseille) sont les coauteurs d’une vaste étude sur le chocolat.
Ils disent notamment :
« Le cacao, grâce à sa richesse en antioxydants, est un véritable protecteur du foie. Cela avait déjà été démontré chez des personnes en bonne santé. Cela vient d’être testé chez des personnes dont le foie est malade en raison d’une infection virale. Les personnes touchées par le VIH ou par le virus de l’hépatite C présentent une inflammation et un vieillissement plus précoce de leur foie. Cette mauvaise fonctionnalité hépatique est susceptible d’évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie. L’objectif de notre recherche a donc été d’étudier l’effet de la consommation de cacao sur la fonctionnalité du foie chez ces personnes. En effet, les antioxydants nous permettent de lutter contre l’inflammation de l’organisme qui est associée au vieillissement et à un mauvais fonctionnement de certains organes, dont le foie. Notre étude, basée sur les données cliniques et comportementales de 990 patients […] a permis de mettre en évidence que ceux qui avaient une consommation quotidienne de cacao (à travers le chocolat) avaient 40% de risques en moins de présenter des valeurs anormales des enzymes hépatiques (reflet de la santé du foie), ce qui n’est pas négligeable. »
Et ce n’est pas que bon pour le foie car les centaines de molécules contenues dans les fèves de cacao sont utiles aussi pour le sang, mais aussi le cœur et le cerveau.
Le cacao est riche en antioxydants utiles à la lutte contre le vieillissement des cellules et l’inflammation. La teneur en cacao d’un chocolat est donc essentielle. Or le chocolat au lait n’en contient pas suffisamment – les antioxydants y sont à l’état de traces – et le chocolat blanc en est dépourvu car il est à base de beurre de cacao et non de cacao.
La capacité antioxydante du cacao serait quatre à cinq fois plus élevée que celle du thé noir, deux à trois fois plus importante que celle du thé vert.
La fameuse « crise de foie » attribuée à tort au chocolat s’explique en réalité par les graisses qui sont présentes en plus grande quantité dans les chocolats au lait et les chocolats blancs. En cas d’abus, ce sont elles qui ralentissent la vidange de l’estomac et entraînent des nausées et des vomissements. Ce sont encore elles qui stimulent la vésicule biliaire et provoquent des douleurs abdominales.
Alors comme toujours, il ne faut jamais abuser, car même le chocolat noir apporte des calories. C’est pourquoi l’article conseille trente ou quarante grammes de chocolat noir (70% et plus) par jour – soit trois ou quatre carreaux par jour – qui pourraient permettre d’obtenir un effet hépato protecteur sans trop peser sur les calories.
J’ai privilégié le chocolat à la « Banque », il faut savoir gérer ses priorités.
<973>
-
Mercredi 22 novembre 2017
«Douter de tout ou tout croire,
ce sont deux solutions également commodes
qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir.»Henri PoincaréHenri Poincaré est un grand mathématicien français et universel, né le 29 avril 1854 à Nancy et mort le .
Il est un précurseur majeur de la théorie de la relativité restreinte et donc un précurseur d’Einstein.
Cedric Villani, le mathématicien qui est devenu député «en Marche» le cite souvent et il cite cette phrase <Ici>
Il me semble que c’est une phrase pleine de sens qui suffit à elle-même
<972>
-
Mardi 21 novembre 2017
« La part d’ange en nous. Histoire de la violence et de son déclin »Steven PinkerCe n’est pas la première fois que je m’intéresse à des scientifiques ou des études qui montrent que monde va dans le bon sens dans beaucoup de domaines.
Ainsi dans le mot du jour du 7 mars 2017 qui se situe dans la série consacrée à Michel Serres, ce dernier écrivait : « Le premier âge est plus long qu’on ne le croit ; Le deuxième pire qu’on ne le pense ; Le dernier meilleur qu’on ne le dit. », Michel Serres, « darwin, Bonaparte et le samaritain »
Plus explicite encore, le mot du jour du 19 décembre 2016 où j’évoquais un livre de Johan Norberg «Ten Reasons to Look Forward to the Future Progrès : dix raisons de se réjouir de l’avenir».
Cette fois il s’agit de l’évolution de la violence dans l’Histoire de l’humanité.
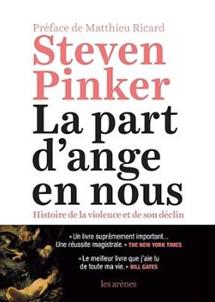 Steve Pinker, d’origine canadienne, est professeur de psychologie cognitiviste à l’université Harvard et vient de publier un livre : « la Part d’ange en nous » (Les Arènes)qui a pour sous-titre : « Histoire de la violence et de son déclin »
Steve Pinker, d’origine canadienne, est professeur de psychologie cognitiviste à l’université Harvard et vient de publier un livre : « la Part d’ange en nous » (Les Arènes)qui a pour sous-titre : « Histoire de la violence et de son déclin »
C’est un livre de 1000 pages qui nous apprend que la violence ne fait que régresser depuis les premiers temps de l’humanité, qu’il s’agisse de la violence guerrière ou de la criminalité.
Laurent Joffrin l’a interviewé dans <Libération du 17 novembre 2017>.
Mais avant d’en venir à cet entretien, je vous conseille de regarder une TED Conférence que cet auteur a tenu où il tente de démonter le <le mythe de la violence>
C’est une conférence de 2007, ses références sont le Darfour et l’Irak, aujourd’hui on parlerait des Rohingyas
ou des syriens
mais il dirait la même chose même si cela semble illogique voire obscène quand on pense à ces massacres d’aujourd’hui, nous vivons dans l’époque la plus paisible depuis que notre espèce existe.
Et comme premier exemple pour s’en convaincre, il en appelle au livre saint de notre civilisation, « la Bible » qui devrait nous enseigner l’amour, la paix et qui est a priori la source de nos valeurs morales.
Et il cite le livre des Nombres au chapitre 31 Nombres 31
« Moïse leur dit: Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d’Israël à l’infidélité envers l’Eternel, dans l’affaire de Peor; et alors éclata la plaie dans l’assemblée de l’Eternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui; 18mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n’ont point connu la couche d’un homme. »
Si le texte biblique n’est pas assez clair, Moïse dit simplement à ses hommes qui ont déjà tué tous les hommes parmi la troupe ennemie, de tuer tous les enfants mâles même les plus petits et de tuer toutes les femmes et filles non vierges et de violer les autres.
En dehors de la description probablement réaliste de la manière dont se passait la guerre au temps de Moïse, Steven Pinker cite une étude qui conclut que dans les pays occidentaux lorsque le taux d’homicide par an était de 100 morts pour 100 000 habitants au moyen âge, il est désormais à moins d’un mort pour 100 000. Il y a eu baisse de deux ordres de grandeurs entre le moyen-âge et notre période concernant le taux d’homicide.
Selon Pinker, le point de bascule est situé au début du 16ème siècle, donc à l’entrée dans la renaissance..
De la même manière si on se place sur les dernières décennies depuis 1950, la diminution des guerres inter étatiques et des guerres civiles est très importantes.
Alors il pose cette question : pourquoi l’impression est contraire ?
Il donne 4 raisons :
- Parce que nous avons d’excellents journalistes et des moyens d’information qui nous renseignent de mieux en mieux.
- Il y a aussi une illusion cognitive que connaissent les psychologues cognitif comme moi : Plus on est en capacité de se rappeler de quelque chose plus on lui attribue une probabilité forte.
- Des titres alarmants accompagnés de photos montrant des situations affreuses marquent bien davantage notre esprit que les statistiques qui donnent le nombre de gens morts de vieillesse dans leur lit.
- Il y a aussi une dynamique du marché : Personne n’a jamais attiré d’observateurs de défenseurs de donateurs en disant les choses vont de mieux en mieux..
On compare à nos standards du moment. Nous sommes scandalisés à juste titre qu’on mette à mort quelques individus par injection létale au bout de 15 ans de procédures. Il y a quelques centaines d’année on envoyait au bucher massivement après un procès de 10 minutes parce que ces individus avaient critiqué le roi.
Dans l’article de Libération il évoque le terrorisme qui est la forme de violence la plus spectaculaire et souvent la plus redoutée aujourd’hui. . Cette réalité vient-elle contredire votre diagnostic ?
Mais cette réalité ne contredit pas son diagnostic :
« Le terrorisme est un phénomène terrible. Mais son importance statistique est minime. Cela correspond d’ailleurs à sa définition : ce sont des actes peu nombreux destinés à produire un effet psychologique massif. Les terroristes visent avant tout à manipuler les médias pour attirer l’attention sur une cause particulière. Statistiquement, le terrorisme d’aujourd’hui est infiniment moins dangereux que la jalousie des maris qui assassinent leurs femmes, ou le mauvais fonctionnement de certains appareils ménagers qui causent des accidents domestiques. J’ajoute qu’en Europe, le terrorisme jihadiste, qu’on appelle parfois «hyperterrorisme», cause moins de victimes que les terrorismes des années 70, ceux de l’IRA, d’ETA ou des «années de plomb» en Italie. En fait, son effet psychologique est important parce que la population estime aujourd’hui que le seul niveau acceptable de violence politique se situe aux alentours de zéro, alors qu’on se résignait dans le passé à des niveaux très supérieurs. »
Il reconnait cependant que la sensibilité à la violence a augmenté alors que le nombre d’actes violents diminue :
« Parce que notre système de valeurs évolue. Nous accordons aujourd’hui à la vie humaine un prix très supérieur à celui du passé. C’est peut-être aussi parce que le nombre des accidents et des morts par maladie diminue lui aussi sans cesse. On meurt moins que par le passé de noyade, de chute inopinée, d’accident de voiture, d’incendies ou de maladie. Le monde est de plus en plus sûr, c’est un phénomène fondamental. Sauf bien sûr dans certains pays comme l’Irak ou la Syrie. Mais partout ailleurs, la sécurité de la vie quotidienne ne cesse de progresser. »
Maintenant nous pouvons continuer à critiquer le temps présent et trouver qu’il y a toujours trop de violences et de massacres, mais en reconnaissant que nous avons beaucoup progressé.
Je vous renvoie vers l’entretien de <Libération du 17 novembre 2017>.
<971>
- Parce que nous avons d’excellents journalistes et des moyens d’information qui nous renseignent de mieux en mieux.
-
Lundi 20 novembre 2017
«La théorie des 3D : Désastres, Découvertes, Décence.»Hans Joachim SchellnhuberHans Joachim Schellnhuber est un physicien allemand, climatologue et fondateur de l’institut de Potsdam de Recherche sur le climat.
Il fut un des premiers scientifiques à avertir sur le danger du réchauffement climatique, il est connu comme père du concept de la limite de 2°C
Il était bien sûr à Bonn, à la COP23, la 23e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été organisée conjointement par les iles Fidji et l’Allemagne du 6 novembre au 17 novembre. Il était déjà à la COP1 à Berlin en 1995
Après les espoirs de la COP 21 d’il y a deux ans à Paris, il y eut entretemps une COP 22 à Marrakech, les nouvelles ne sont pas bonnes.
Il y a bien sûr l’attitude irresponsable du Président des Etats-Unis mais aussi une nouvelle hausse de la production mondiale de CO2.
La situation est telle que 15 000 scientifiques de 184 pays ont signé un appel contre la dégradation de l’environnement qui a été publié dans la revue Bio Science de l’Université d’Oxford, le lundi 13 novembre. Vous trouverez une version française <ICI>. Cet appel rappelle qu’il y eut un premier appel il y a 25 ans. Il y a 25 ans, il n’était que 1500 scientifiques indépendants, dont la majorité des lauréats du prix Nobel dans les sciences qui avaient écrit l’avertissement des scientifiques du monde à l’humanité de 1992.
Ce nouveau texte base son analyse sur les évolutions de 9 indicateurs mondiaux, dont l’évolution est suivie depuis 1960 jusqu’à 2016.
Le site France Culture consacre une page « Alerte de 15 000 scientifiques » qui donne la liste des 9 indicateurs et renvoie vers plusieurs émissions consacrées à ces différents sujets.
Voici ces 9 indicateurs
1/ L’ozone stratosphérique : le seul indicateur au vert, grâce au protocole de Montréal (1987)
Ce qui prouve que si les humains agissent, ils ont la capacité de faire évoluer les choses
2/ L’eau douce : des ressources par habitant divisées de moitié par rapport à 1960
3/ La pêche : les limites d’une pêche soutenable sont dépassées depuis 1992
4/ Les zones mortes maritimes : plus de 600 en 2010. Les zones mortes maritimes, déficitaires en oxygène, voient la vie sous-marine asphyxiée (poissons, coraux…), dans des zones de plus en plus importantes, en taille et en nombre. Elles sont principalement dues au lessivage des engrais agricoles.
5/ La déforestation : une superficie de forêts de la taille de l’Afrique du Sud perdue entre 1990 et 2015
6/ Les espèces vertébrées : diminution de 58% entre 1970 et 2012
7/ Les émissions de CO2 : après une courte stabilisation depuis 2014, une nouvelle hausse
8/ La hausse des températures : les 10 années les plus chaudes depuis 136 ans ont eu lieu depuis 1998, c’est-à-dire au cours des 20 dernières années.
9/ La population : les humains pourraient être 11 milliards en 2100
Ces scientifiques qui plaident notamment pour la promotion de nouvelles technologies vertes et l’adoption massive des sources d’énergie renouvelables, considèrent aussi qu’il faut réviser notre économie pour réduire les inégalités et veiller à ce que les prix, la fiscalité et les systèmes incitatifs tiennent compte des coûts réels que les modes de consommation imposent à notre environnement.
Ils ont aussi cette proposition qui heurte un grand nombre de politiques et d’économistes qui dénoncent un retour aux théories de Malthus :
« Estimer une taille de population humaine scientifiquement défendable et durable à long terme tout en rassemblant les nations et les dirigeants pour soutenir cet objectif vital. »
La conclusion des scientifiques est préoccupante :
« Pour éviter une misère généralisée et une perte de biodiversité catastrophique, l’humanité doit adopter des pratiques alternatives plus durables sur le plan environnemental que les modalités actuelles. Cette prescription a été bien formulée par les plus grands scientifiques du monde il y a 25 ans, mais, à bien des égards, nous n’avons pas tenu compte de leur avertissement. Bientôt, il sera trop tard pour dévier de notre trajectoire défaillante, et le temps s’épuise. Nous devons reconnaître, dans notre vie quotidienne et dans nos institutions gouvernementales, que la Terre avec toute sa vie est notre seul foyer. »
C’est dans ce contexte que s’exprime Hans Joachim Schellnhuber :
« Le temps ne joue pas en notre faveur […]
Parfois je désespère. Vous vous levez le matin et vous vous sentez vraiment déprimé. Puis vous ouvrez votre ordinateur, vous regardez les nouvelles, et vous trouvez quelque chose qui vous redonne de l’espoir. Tant qu’il y a de l’espoir, il est de notre responsabilité d’expliquer encore et encore.
[…]
Mon moment […] a été quand j’ai réalisé que la machinerie planétaire – moussons, circulation océanique, écosystèmes… – ne fonctionnait pas de manière linéaire: vous avez de nombreux points de non-retour.
Prenez l’Antarctique, Si la barrière de glace est détruite, la glace arrive dans la mer. C’est comme déboucher une bouteille. En Antarctique il y a probablement une trentaine de ces « bouteilles », et on est en train de les déboucher les unes après les autres ».
Pourra-t-on tenir les 2°C quand les émissions de gaz à effet de serre continuent à croître?
Bien que le défi soit énorme, je pense que oui, si nous faisons tout notre possible. (Une étude récente) montre qu’on peut réduire un tiers des émissions en gérant mieux forêts et agriculture »
Il reste pourtant dans l’optimisme de la volonté car pour lui, le monde finira par agir plus fortement contre le réchauffement.
« « C’est ma théorie du « 3D »: désastres, découvertes, décence. Les gens auront peur, car des désastres naturels vont se profiler. Et il y aura des découvertes, comme aujourd’hui la révolution photovoltaïque, et d’autres, comme le bois « high tech » pour remplacer le ciment », très émetteur. Enfin, la décence, l’instinct humain élémentaire: nous ne voulons pas la fin des îles Marshall, nous ne voulons pas tuer nos descendants ! »
Après la Seconde guerre mondiale, « nous avons choisi le mauvais modèle pour une vie heureuse : confort, consommation… Mais ce mode de vie ne nous rend pas plus heureux […]
Mon espoir est que la jeunesse a envie de casser ce modèle. Mon fils a 9 ans. Je suis sûr qu’à 15 ans il ne priera pas le Dieu de la croissance du PIB ! Je pense que nous pouvons espérer que les prochaines générations, pour qui nous essayons de préserver le climat, contribueront elles aussi à le sauver ».
Il est facile de critiquer les politiques, mais il serait plus juste probablement de parler de l’impuissance des Etats à agir tant sont nombreux les contraintes et les désirs contradictoires des concitoyens des gouvernants.
« L’esprit Public » de France Culture de ce dimanche a abordé ce sujet dans la deuxième partie de l’émission.
J’ai trouvé très pertinente une intervention de François-Xavier Bellamy que j’essaie de résumer :
« Nous sommes devant un problème de nos démocraties qui sont structurellement constituées pour répondre aux besoins des citoyens dans un temps court.
Dans le temps d’un mandat et dans un espace limité par des frontières.
La question que pose l’écologie est : comment nous pouvons ajuster nos politiques à un défi qui ne se limite pas à des frontières et qui par ailleurs engage le temps long et même le temps très long ?
Il n’est pas juste d’invoquer le poids des conservatismes, nous ne sommes pas assez conservateur à cause de ce culte de la vitesse [qu’impose notre société].
Nous avons construit notre économie sur l’idée du progrès, sur l’idée de l’accélération, sur l’idée du mouvement.
Nous ne cessons de remplacer en permanence les produits de consommation que nous achetons et auquel nous substituons des versions nouvelles.
Notre économie de la croissance et de l’invention est une économie du remplacement permanent.
C’est une anti économie. C’est une économie qui s’est retournée contre elle-même. L’économie, au sens le plus classique consiste à économiser.
Or, on ne peut plus rien économiser aujourd’hui.
Si vous acheter un smartphone et que vous décidez pour l’économiser de ne pas en faire trop d’usage, vous le ranger et vous ne vous en servez pas. Même si vous n’en faites rien, deux ans plus tard il ne vaudra plus rien.
C’est à dire sa valeur marchande s’est effondrée.
Contrairement à un tableau peint il y a plus de 500 ans par léonard de Vinci et qui a battu le record de vente des œuvres d’art.
En réalité, ce culte du progrès nous appauvrit terriblement.
Puisqu’il fait faner, dans nos mains, tout ce que nous avons construit et que nous avons acheté.
L’économie de la consommation est en réalité une économie de la destruction.
Littéralement, puisque consommer c’est détruire. Une économie qui mesure son taux de croissance à l’intensité de la destruction des biens qu’elle produit ne peut pas aboutir à autre chose qu’à la crise économique que nous connaissons aujourd’hui. »
Et il donne ce conseil :
« Pour être capable de transmettre à nos descendants un monde qui reste vivable, nous ferions bien de devenir un peu plus conservateur. »
Il faut s’entendre sur le mot conservateur. Mais je crois qu’il a raison au fond.
Nous devons aussi compter sur les découvertes qu’évoque Hans Joachim Schellnhuber pour garder l’espoir, sans penser que celles-ci pourront nous permettre d’éviter de remettre en question notre modèle consumériste.
<970>
-
Vendredi 17 novembre 2017
« C’est l’époque qui veut ça. »Réflexion d’une journaliste à Nicolas Bedos qui après lui avoir demandé à tous prix le nom d’un homme ayant dérapé avec une femme, a réagi à l’étonnement de ce dernier devant cette insistance.Depuis l’affaire Weinstein la parole des femmes s’est libérée.
J’en suis, pour ma part, très satisfait.
La violence faite aux femmes reste immense, de petites violences comme des grandes. Et beaucoup d’hommes ne comprennent même pas certaines de ces violences, dans leur esprit il s’agit souvent d’humour ou de légèreté.
Mais je crois que comme dans toute chose, il peut exister des dérapages.
Souvent je ne suis pas très convaincu par le fils Bedos.
Mais pour une fois, j’ai trouvé un article qu’il a publié sur le <Huffington Post> plein d’intelligence et de mesure.
Je vous en donne les principaux éléments :
« Il se trouve qu’avant-hier, je reçois sur Facebook le message d’une journaliste que je connais un peu et qui, par ailleurs, a toute ma sympathie. Elle travaille pour le site d’un célèbre magazine et me demande, sans sourciller, si je n’aurais pas « en magasin quelques infos croustillantes concernant des agressions sexuelles commises dans le milieu du showbiz ». C’est la troisième journaliste à me poser cette question. Je lui réponds que « non, des types lourds, il y en a, oui, des producteurs un peu foireux obligés –croient-ils- de faire miroiter des rôles pour draguer les nanas, oui, à la pelle, sans doute, mais des agressions, des tentatives de viols, que je sache, non, pardon, je suis vraiment navré de ne pouvoir vous rendre service! ». Elle insiste, « Même pas un dérapage? Oh vous avez bien quelques noms… ». Par curiosité, je lui demande ce qu’elle range dans la case « dérapage ». « Je ne sais pas, m’explique-t-elle, vous avez plein de copines actrices, y en a bien une qu’un type connu aurait chauffée de façon insistante, ça va du pelotage de nichons à la grosse main au cul, des gestes déplacés, en boîte, quand vous sortez, des types qui proposent des partouzes… ». Et elle de conclure, comme s’il s’agissait d’un échange d’autocollants dans une cour de récré: « Votre nom ne sera pas cité et je vous revaudrai ça… Réfléchissez, je vous en supplie, un seul nom me suffira ».
Je dois avouer qu’à ce moment-là, j’ai été pris d’un petit vertige, mêlant colère et inquiétude face au monde qu’elle dessinait.
Après cette sollicitation qui le choque, il écrit à la personne qui lui demande un nom
« Chère X, à quoi jouez-vous exactement? S’agit-il pour vous d’un jeu? D’une chasse? Quel est le but? Libérer la parole des victimes d’agressions ou trafiquer du clic pour vos médias malades? Est-ce chipoter sur les vertus d’une parole libérée que de déplorer cette façon de tout mélanger avec une gourmandise obscène, prenant le risque de discréditer un combat salutaire et d’offenser les vraies victimes? Dans le même sac d’indignité: les agressions, les tentatives de viol et les dragues de lourdingues? Confondus: les traquenards de pervers et les soirées libertines, les prédateurs et les machistes? Sommes-nous prêts à salir l’honneur de gens dont le seul tort serait d’être pathétique? Va-t-on judiciariser la nullité et la connerie? Dans votre boîte à « porcs » célèbres, sautant à pieds joints sur le traumatisme des victimes, pourquoi n’iriez-vous pas jusqu’à dénoncer les infidèles notoires (l’infidélité n’est-elle pas ressentie par la personne trompée comme un profond traumatisme)? Et, partant de là, non contents de nourrir une guerre des sexes apparemment fort lucrative, que fait-on des drogués, des acteurs tyranniques et des metteurs en scènes obsessionnels, ceux-là qui vexent leurs équipes, leurs assistants, leurs proches (et –qui sait- leur conjoint)? Et les radins, chère X? C’est minable d’être radin, non? Voulez-vous que je vous dresse la liste de celles et ceux qui se font gifler pour lâcher trois euros alors qu’ils gagnent un max?
Pardonnez ma colère mais je ne supporte plus cette curée moyenâgeuse qui, sous prétexte d’un monde plus sain -plus juste, plus respectueux, plus égalitaire, bref, meilleur- nous monte les uns contre les autres et nous transforme, sinon en gibier, du moins en braconnier de son voisin ».
La journaliste lui répond :
« Après deux heures de silence, elle a fini par me répondre: « En gros, je suis d’accord avec vous. Mais c’est un cycle. C’est l’époque qui veut ça. »
Et Nicolas Bedos de livrer une analyse que je partage :
« Pour les milliers de pisse-froid qui m’intenteraient ce procès, je m’empresse de rappeler que j’applaudis à quatorze mains toutes celles dont la parole libérée a permis de libérer celles de nombreuses victimes anonymes, décourageant peut-être l’assaillant qui sommeille dans la caboche pervertie de petits et grand patrons tapis dans leur bureau. Ces femmes, je les soutiens avec d’autant plus de vigueur que certaines sont des amies et que je sais les supplices qu’elles ont pu endurer. Ni l’argent ni le pouvoir ne permet d’abuser du corps de quiconque sur cette terre. Un monde libre, c’est un monde où les femmes sauront que les hommes sauront qu’en tentant d’abuser d’elles ils seront punis. Un monde libre, c’est ce monde où les femmes devraient pouvoir refuser n’importe quelle proposition graveleuse sans que leur carrière professionnelle puisse en être affectée. C’est un monde où ma petite sœur, mes amies, ma fiancée et toutes les autres pourront se balader dans la tenue de leur choix sans qu’un connard s’arroge le droit de leur parler, de les regarder ou de les toucher comme si elles méritaient d’être traitées comme des jouets.
Un monde libre, c’est AUSSI un monde où on aurait le droit d’exprimer publiquement ses craintes quant aux dérives liberticides que semblent autoriser les combats de société. Il n’y a pas qu’un seul discours, jamais. Ceux qui le prétendent sont des tyrans[…]
Un monde libre, c’est d’abord un monde où un adulte ne cherche pas à se taper un adolescent, certes (quel taré dirait le contraire?), mais c’est aussi un monde où on ne condamne pas les gens sans enquête, sans procès, sur des déclarations balancées par un type vingt ans plus tard sur internet. […] »
Il existe des excès dans tous les domaines, il existe même des excès quand les causes sont justes.
<969>
-
Jeudi 16 novembre 2017
« Par rapport à l’intelligence artificielle : il y a les substituts qui seront remplacés et qui seront soit au chômage soit dans un emploi aidéet les complémentaires de l’intelligence artificielle qui seront très bien rémunérés »Laurent AlexandreLaurent Alexandre, est un chirurgien-urologue français. Il a créé le site de vulgarisation médicale très sérieux que toutes les personnes qui s’intéressent à leur santé connaissent : doctissimo
Il a aussi écrit un livre au titre très explicite : <La mort de la mort>
Il est très intéressé par l’intelligence artificielle et il a été invité par le Sénat le 19/01/2017 pour parler de l’impact de l’Intelligence Artificielle sur la société et l’économie française.
Vous pourrez écouter cette intervention qui me parait essentiel derrière ce lien : <Impact de l’Intelligence Artificielle sur l’économie>
Il a probablement une haute opinion de lui-même et s’exprime de manière un peu péremptoire. Son analyse me parait cependant très argumenté et notamment poser les bonnes questions.
Je vais essayer de résumer le propos à ma manière et avec mon intelligence humaine.
D’abord un sujet de définition : on distingue l’intelligence artificielle forte et l’intelligence artificielle (que je nommerai IA dans la suite de cette article) faible.
L’IA forte serait une intelligence qui comme homo sapiens aurait conscience de son intelligence, ou dit autrement de son existence. Elle saurait dire « JE » et saurait que ce « JE », c’est elle.
Cette forme d’IA entraîne tous les fantasmes, puisque si un tel sujet apparaissait, il y aurait concurrence entre deux intelligences conscientes qui pourraient entrer en compétition et entraîner à terme un assujettissement de l’une à l’autre, voire une destruction de l’autre. Dans cette hypothèse dans la mesure où l’intelligence artificielle serait arrivée à la hauteur de la conscience humaine, il est raisonnable de prévoir qu’elle nous dépassera. Cette hypothèse conduit donc à un assujettissement d’homo sapiens à cette entité créée par l’homme. En résumé dans un film de science-fiction, les robots prennent le pouvoir.
Ce fantasme n’est pas prêt à se produire selon lui. J’ai entendu d’autres gens très sérieux dire la même chose. Il faut savoir cependant que ce n’est pas l’avis d’Elon Musk, cofondateur de Paypal, directeur chez Tesla motors et cofondateur de OpenAI, une association de recherche à but non lucratif en intelligence artificielle, ni d’ailleurs de certains des grands esprits de Google.
Selon Laurent Alexandre, ce qui existe déjà et va se développer encore de manière exponentielle c’est l’intelligence artificielle faible qui n’a pas conscience de son intelligence, mais qui est un formidable calculateur adossé à d’immenses bases de données que l’on appelle dans le langage numérique les big datas.
Et cette annonce-là : que l’IA faible va se développer de manière exponentielle est aussi préoccupante, notamment pour nous européens.
Dans la géopolitique de l’IA et du big data, l’Europe est un pays du tiers monde, pour reprendre un concept économique connu. Nous exportons des ingénieurs, un des principaux directeurs de laboratoire d’IA s’appelle Yann Le Cun, auquel j’ai déjà consacré un mot du jour, il est français et il travaille pour Facebook.
Je vous demande déjà de nous arrêter à ce fait : Un des types les plus calés sur l’IA travaille pour Facebook.
Dans notre esprit cartésien de français, ce n’est pas sérieux.
Un type super intelligent qui travaille sur des sujets de pointe, il bosse pour l’armée, pour l’industrie aéronautique ou spatiale ou l’industrie financière pas pour ce café du commerce mondialisé qu’est facebook. Ce n’est pas sérieux !
Si vous réagissez comme ça, c’est qu’il y a quelque chose qui vous a échappé.
Facebook, n’a qu’un atout mais dans le contexte de l’IA faible décrit ci avant, c’est un atout gigantesque dans ce monde-là : c’est un collecteur de données, il est à la tête d’un big data immense.
Et Laurent Alexandre l’explique au cours de sa présentation, des tests ont été fait. On a mis en compétition des algorithmes très sophistiqués avec des petites bases de données et des algorithmes plus simples mais adossés à d’immense big data. Ce sont les seconds qui l’ont emporté très largement.
Dans ce monde-là, celui qui domine c’est celui qui possède le big data. L’Europe n’est pas dans ce cas, les Etats Unis et la Chine oui. C’est pourquoi nous serons un pays du tiers monde si nous ne parvenons pas à réagir rapidement.
Dans sa démonstration brillante, il ajoute un point essentiel : la zone Asie-Pacifique qui est au cœur de cette nouvelle révolution croit plus vite que nous et surtout est très transgressif par rapport à nos valeurs qu’il définit comme : « chrétiens-démocrate et sociaux démocrate de gauche que nous sommes tous par rapport à ces gens-là ».
Selon lui, l’IA faible a désormais un développement exponentiel, ce qui rend très difficile les prévisions. Les prévisions sont plus pertinentes quand on est en présence d’évolutions proche du linéaire.
L’évolution exponentielle ne touche pas les technologies robotiques qui nécessitent de la mécanique, ni la santé ou la biologie qui évoluent aussi mais à un rythme plus linéaire.
Pour être plus précis, ce qui évolue de manière exponentielle c’est l’IA faible adossée au big data des plateformes, c’est à dire Google, Apple, Facebook et Amazon. Apple et Facebook ont chacun 2 milliards d’utilisateurs. Nous n’avons pas la base industrielle pour rivaliser avec ces géants. En outre, nous sommes les idiots utiles de ces plateformes, puisque nous mettons chaque jour, gratuitement, des milliards de photos et de données sur ces plate-formes
Mais ce qui lui semble essentiel, c’est que l’intelligence artificielle sera quasi gratuite par rapport à l’intelligence biologique ;
Ce deuxième point va avoir un effet majeur notamment sur le marché de l’emploi et il donne une règle simple à comprendre mais pénible à entendre : Dans un marché où entre en compétition un bien gratuit et un bien onéreux, les substituts crèvent et les complémentaires voient leur prix augmenter
Nous devons donc très rapidement, en Europe, développer des plateformes de la dimension des américains et des chinois sinon nous serons le Zimbabwe du monde de demain.
L’école doit s’efforcer de prendre en compte cette dichotomie entre les substituts à l’IA, c’est-à-dire tous ceux qui pourraient faire le même travail que l’IA moins vite, plus chère et malgré tout probablement moins bien et les complémentaires qui travailleront en s’aidant de l’IA, en complémentarité de l’IA.
Il affirme d’ailleurs : qu’aucun emploi non complémentaire de l’IA n’existera plus en 2050.
Il présente cette affirmation sous une autre forme : si votre intelligence + l’IA est l’équivalent de l’IA, votre emploi disparaîtra.
On pense aux guichetier de banque, bibliothécaire, chauffeur de taxi, comptable, assistant juridique, contrôleurs aériens, agent de voyage, interprète et traducteurs, probablement énormément de travaux actuellement assurés par des fonctionnaires, mais aussi le médecin traitant qui ne saura rivaliser avec l’IA connecté sur les big data pour faire le diagnostic.
Pour le reste de son intervention je vous renvoie vers la vidéo : <Impact de l’Intelligence Artificielle sur l’économie>
Et pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore vu, je vous invite à regarder <cette vidéo> où on voit comment la manutention se réalise dans un entrepôt Amazon. On peut supposer que beaucoup des travaux humains qui subsistent aujourd’hui dans ces entrepôts seront aussi rapidement remplacés, substitués pour reprendre le langage de Laurent Alexandre.
<968>
-
Mercredi 15 novembre 2017
« « Paradise Papers » : y croire ou pas… »Marie ViennotLe samedi de 12h41 à 12h45, Marie Viennot fait une chronique appelée « La bulle économique »
Dans sa chronique du 11 novembre elle posait la question :
« Que peut-on attendre des nouvelles révélations de l‘ICIJ [Consortium international pour le journalisme d’investigation] sur la déloyauté fiscale des grands de ce monde ? Les « Paradise Papers » sont-ils un scandale de plus ? Est-ce qu’on avance ? »
Elle a commencé par faire un détour par l’Histoire, à une époque où le Maire de Lyon était Président du Conseil : Edouard Herriot :
« Avant que les îles paradisiaques ne se spécialisent dans la domiciliation de comptes cachées dans les années 20, il était une île bien plus proche, et sans accès à la mer : la SUISSE.
La Suisse est devenue une planque pour les grandes fortunes françaises au début du 20e siècle, parce qu’en 1902 a été créé en France un impôt sur les successions. Ainsi a commencé l’exode des grandes fortunes, et de leur capitaux dans l’indifférence relative des pouvoirs politique, jusqu’en 1932.
Le 27 octobre 1932, sur demande du ministère des finances, un commissaire perquisitionne un appartement loué à Paris par la Banque Commerciale de Bale, l’une des plus grandes banques suisses. Il saisit de très nombreux papiers, mais surtout un carnet, qui met en regard des numéros de compte et le nom et adresse de leurs bénéficiaires. Ce sont les Paradise Papers avant l’heure. On y trouve pas Bernard Arnault, Total, Apple, Madonna et Philippe Starck, mais tout le bottin mondain français : députés, sénateurs, anciens ministres, évêques, généraux, la famille Peugeot, la famille Coty propriétaire du journal le Matin etc..
A l’époque, on ne compte pas l’ampleur des fuites en kilo octet, mais 1 000 personnes sont dans ce carnet. L’affaire mettra 10 jours à s’ébruiter, mais elle arrive finalement au Parlement, et ce qu’on y entend alors ce n’est pas « honte à eux », mais plutôt :Il est normal que chacun prenne des mesures pour protéger le bien diminué qui lui reste, car la fiscalité est trop lourde.
Le Parlement refusera même de lever l’immunité des parlementaires impliqués et quelques semaines plus tard, il renversera le gouvernement Herriot pour que le scandale retombe dans l’oubli…
Côté politique, les mentalités ont donc légèrement évolué, en 1932, Jérome Cahuzac serait peut être resté ministre ! »
Et elle poursuit sur des affaires plus récentes, où il apparaît que celles et ceux qui se sont attaqués ont toujours eu beaucoup de problèmes, dépensé beaucoup d’énergie, d’argent. Il arrive même encore aujourd’hui que des journalistes soient assassinés dans des pays de l’Union européenne.
Elle évoque ainsi Denis Robert qui a mis à jour le rôle obscur de la société luxembourgeoise « Clearstream », chambre de compensation internationale située au Luxembourg, spécialisée dans l’échange de titres. Denis Robert pour ce faire a subi 10 ans de procédures et de harcèlement de la part de cette société et des avocats qu’elle avait lancé contre Le journaliste. Finalement, en février 2011, après 10 ans de procédures, Clearstream avait quand même perdu tous les procès contre Denis Robert. Se fondant sur l’article 10 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la Cour de Cassation a explicitement reconnu « l’intérêt général du sujet» et le « sérieux de l’enquête » de Denis Robert
En revanche, l’enquête qui avait été ouverte par la justice luxembourgeoise pour blanchiment d’argent et escroquerie fiscale à l’encontre de Clearstream a abouti en 2004 à un non-lieu en raison de l’insuffisance des preuves sur le blanchiment, de la non rétroactivité des lois (le Luxembourg n’ayant adopté une législation contre le blanchiment qu’à la fin des années 1990), de la double comptabilité et de la prescription de certains délits mineurs. En novembre 2004, le parquet grand-ducal a clôturé l’enquête principale portant sur le blanchiment de capitaux.
En 1997 Denis Robert avec Philippe Harrel ont réalisé un documentaire « Journal intime des affaires en cours »
Marie Viennot décrit ce documentaire de la manière suivante :
« C’est l’histoire d’un voyage de l’autre côté du miroir des « affaires », dans le monde de l’entremise et de l’argent occulte
Juges impuissants, intermédiaires qui font leur beurre de leur intelligence mise au service du contournement des règles, sociétés écrans, politiques qui utilisent l’opacité pour enfreindre les règles, tout y est, tout est dit. 20 ans plus tard, les noms ont changé, les pratiques se sont sophistiquées, mais quoi de neuf finalement ?
La différence de taille, c’est que cette fois, les révélations sont mondiales, or c’est à cet échelon que le problème se pose. C’est déjà un bon point. Aucun gouvernement ne peut étouffer durablement les affaires qui sortent. […]
La différence, c’est aussi que les journalistes qui ont travaillé sur les « Paradise Papers » sont plusieurs centaines, et qu’il sera plus difficile de les harceler judiciairement. Contrairement à Denis Robert, sorti blanchi par la justice après 10 ans de procès, et 150 000 euros de frais de procédure pour les procès intentés par CLEARSTREAM dont il avait dénoncé les pratiques occultes dans plusieurs livres et documentaires. Souvenons-nous aussi que Denis Robert n’avait pas eu reçu beaucoup de soutien. Cela a complètement changé.
 Et puis elle rappelle qu’une journaliste a été assassinée récemment à Malte : Daphne Caruana Galizia qui enquêtait sur les comptes cachés de la classe politique de son pays en s’appuyant sur les « Panama Papers ». Le premier ministre de Malte, Joseph Muscat l’avait appelée « sa plus grande adversaire ». Après son assassinat, il a expliqué que : « Tout le monde sait que Daphne Caruana Galizia me critiquait violemment, sur le plan politique et personnel. Mais personne ne peut justifier cet acte barbare de quelque manière qui soit ». Prenons acte de cette déclaration de ce gouvernant dont le pays appartient à l’Union européenne. D’ailleurs, la Commission Européenne s’est dite « horrifiée » et a réclamé une enquête indépendance.
Et puis elle rappelle qu’une journaliste a été assassinée récemment à Malte : Daphne Caruana Galizia qui enquêtait sur les comptes cachés de la classe politique de son pays en s’appuyant sur les « Panama Papers ». Le premier ministre de Malte, Joseph Muscat l’avait appelée « sa plus grande adversaire ». Après son assassinat, il a expliqué que : « Tout le monde sait que Daphne Caruana Galizia me critiquait violemment, sur le plan politique et personnel. Mais personne ne peut justifier cet acte barbare de quelque manière qui soit ». Prenons acte de cette déclaration de ce gouvernant dont le pays appartient à l’Union européenne. D’ailleurs, la Commission Européenne s’est dite « horrifiée » et a réclamé une enquête indépendance.
Marie Viennot donne une note d’espoir :
« En 2017, en Europe on tue donc encore pour des enquêtes mal venues, mais en 2017, les journalistes sont de plus en plus nombreux à s’intéresser aux pratiques déloyales des élites économiques et ceux qui trichent savent qu’ils ne sont plus totalement à l’abri des regards. »
Mais les faits sont têtus et il existe un cercle vicieux de la fraude, de l’affaiblissement des états et de la lutte contre la fraude.
Car cet argent qui échappe à l’impôt conduit les Etats et notamment la France à être plus impécunieux. Et quand l’Etat a moins de ressources financières, il a aussi moins de moyens d’action. Marie Viennot cite un article de Marianne où Eva Joly a fait le compte : « 27 juges d’instruction au pôle financier de Paris en 2001, 13 en 2007, 8 en 2012″… ». Marie Viennot rappelle cependant qu’il y a eu la création du Parquet National Financier après l’affaire Cahuzac.
Une chose reste certaine, cette lutte dépasse les limites de la seule France, le combat est mondial. Déjà au niveau européen, le consensus est très compliqué à réaliser en raison de l’intérêt de certains États et du bénéfice qu’ils tirent de la situation actuelle.
<967>
-
Mardi 14 novembre 2017
« Pour une entreprise, l’impôt est un coût comme un autre, qu’il faut réduire par tous les moyens légaux. »Bruno Bonnell député République en marche de la circonscription de VilleurbanneBruno Bonnell est un chef d’entreprise important de la région lyonnaise. Il a été notamment patron d’Infogrames. Dans une compréhension des intérêts réciproques, il était proche du maire de Lyon, Gérard Collomb. Ce fait a dû jouer un rôle important dans sa désignation comme candidat du parti présidentiel contre Najat Vallaud Belkacem dans la circonscription législative de Villeurbanne qui était un fief historique du Parti socialiste. Il a gagné et il est donc maintenant député et représentant de la nation.
Vous savez que la semaine dernière, 95 médias réunis dans un partenariat ont exhumé 13,5 millions de documents surnommés Paradise papers sur les pratiques d’optimisation fiscale de multinationales et de particuliers dans le monde.
C’est dans ce contexte que Bruno Bonnell était invité de RTL mercredi dernier.
Il trouve le terme « optimisation » positif, par voie de conséquence l’optimisation fiscale l’est aussi. Plus précisément il a dit :
« Le mot optimisation est intéressant parce qu’il est positif. Quand on optimise son énergie, on est quelqu’un de bien. Mais quand on y ajoute le mot fiscal, on est quelqu’un de mal. On mélange tout. L’optimisation n’est pas la fraude fiscale. Aux USA on demande à un chef d’entreprise d’optimiser les taxes qu’il doit payer. C’est une philosophie. »
La plupart des personnes mises en cause répondent par cet argument : « Tout ce que j’ai fait est légal ».
Bruno Bonnell est sur cette ligne : il fait une distinction nette entre la légalité de l’optimisation et l’illégalité de la fraude :
« Pour une entreprise, l’impôt est un coût comme un autre, qu’il faut réduire par tous les moyens légaux. Dans un État de droit, il y a des règles. Quand on est chef d’entreprise, il y a des règles et il faut jouer avec. On n’est pas dans la morale. Parce qu’au nom de la morale on a fait beaucoup de bêtises. »
Accordons lui qu’il souhaite promouvoir « une harmonie fiscale en Europe » :
« En tant que politique, on doit continuer de façon obsessionnelle à faire de l’Europe un bloc fiscal cohérent. On ne peut pas continuer de laisser des trous dans la raquette en Europe, avec une diversité fiscale portée par certains pays comme l’Irlande, les Pays-Bas, Malte, qui sont des pays microscopiques par rapport à l’Allemagne, la France, l’Espagne ou l’Italie. Aujourd’hui, de nombreuses multinationales viennent en Europe parce que le marché repart et font leur marché en demandant à chaque pays : « Que proposez-vous comme taxes ? » Ça, c’est une erreur. »
Sur ce point, je ne peux être que d’accord.
Mais avant d’interroger la notion d’optimisation fiscale et de légalité, <Vous trouverez sur le site lelab.europe1.fr, l’information suivante concernant Bruno Bonnell> : Mediacités s’est aperçu que Bruno Bonnell possède une société au Delaware, aux Etats-Unis, un État qui présente les caractéristiques d’un paradis fiscal – sans être reconnu comme tel par l’OCDE. On apprend également que l’homme d’affaires a restructuré son patrimoine pour échapper à l’impôt sur la fortune (ISF) et l’impôt sur le revenu pendant deux ans.
Sur le fond !
L’émission <L’esprit public de France Culture de ce dimanche> a consacré sa première partie à ce sujet.
Gérard Courtois, Directeur éditorial du journal « Le Monde » a clairement posé le problème, en balayant d’un revers de main, la distinction entre légalité et moral, pour affirmer :
« C’est un problème fondamentalement politique qui ébranle les piliers de notre contrat démocratique »
Un problème politique !
Dans le mot du jour d’hier il était également question d’un sujet dans lequel la Loi actuel heurtait notre raison, notre connaissance : « un enfant de 11 ans ne saurait consentir, en pleine conscience, à une relation sexuelle avec un adulte » Et nous en étions arrivé à cette conclusion qu’il fallait changer la Loi.
Dans le sujet de l’optimisation fiscale, le sujet est politique.
Le premier pilier de notre société qui est ébranlé est celui de l’égalité devant la Loi et donc par voie de conséquence devant l’impôt. Pourquoi chacun de nous accepterait-il à consentir à l’impôt, si les plus riches peuvent y échapper, grâce à l’optimisation ?
Cela constitue une fracture dans la société.
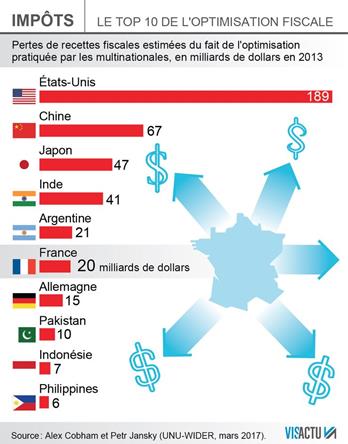 Mais le second pilier est encore plus important. Et il récuse totalement l’argument de Bruno Bonnell : « L’impôt est un coût comme un autre ». Affirmer cela comme chef d’entreprise est une erreur, le dire comme élu de la Nation est une faute.
Mais le second pilier est encore plus important. Et il récuse totalement l’argument de Bruno Bonnell : « L’impôt est un coût comme un autre ». Affirmer cela comme chef d’entreprise est une erreur, le dire comme élu de la Nation est une faute.
Pour le comprendre et l’expliciter, quoi de mieux que de citer l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 :
« Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
C’est la juste part à donner pour faire société, pour permettre à la société d’assurer pour l’ensemble de ses membres la sécurité publique, les services communs et la solidarité.
Ne pas donner sa part, c’est vouloir faire sécession, ne plus faire partie de la même société.
La mondialisation telle qu’elle s’est développée a surinvesti sur la compétition et n’a pas assez pris en compte la coopération pourtant indispensable devant les grands défis de l’humanité : le défi écologique, le défi de l’alimentation de l’humanité, de sa santé, de la paix entre les Etats et à l’intérieur des Etats.
Un des premiers mots du jour (c’était le n° 78) avait cité le secrétaire au Trésor du président Roosevelt qui disait : «Les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée, trop de citoyens veulent la civilisation au rabais»
Cet homme s’appelait Henry Morgenthau, ses propos datent de 1937.
A l’époque les taux d’imposition à l’impôt sur le revenu étaient beaucoup plus élevés, notamment aux Etats-Unis qu’aujourd’hui.
Lors de cette même émission, Gilles Finkelstein rapporte le chiffre suivant : « 40% des profits des grands groupes internationaux seraient localisés dans des lieux offshore dans lesquels ils ont une adresse mais pas de salariés »
Le schéma joint à cet article présente le palmarès délétère des pays les plus touchés par l’évasion fiscale selon une estimation réalisée par des organisations spécialisées dans la lutte contre l’évasion fiscale. La France est sixième et dans ce domaine dépasse l’Allemagne !
Ce qui est légal, n’est pas forcément juste.
Ce n’est pas juste si la conséquence en est une civilisation au rabais !
<966>
-
Lundi 13 novembre 2017
« Un homme de 22 ans a une relation sexuelle avec une enfant de 11 ansElle tombe enceinte puis l’enfant qui naît est placé dans une famille d’accueilCet homme vient d’être acquitté par la cour d’assisses de Seine-et-Marne »Un problème de Loi en FranceNon, je ne répète pas un mot du jour que j’ai déjà écrit le 27 septembre : « Un enfant de 11 ans peut consentir à une relation sexuelle avec un homme de 28 ans » et que j’avais complété quelques jours après avec ce jugement remarquable du père d’Albert Camus : «Non, un homme ça s’empêche. Voilà ce qu’est un homme, ou sinon… ».
Il s’agit d’une nouvelle affaire !
D’ailleurs l’affaire que j’avais déjà relatée n’est pas encore jugée, je m’étais élevé contre la position du parquet qui avait refusé de qualifier cet acte sexuel de viol.
Cette fois nous sommes un degré plus loin, il y a eu jugement alors que le parquet poursuivait pour viol.
Le Monde du 11 novembre titre : « Une cour d’assises acquitte un homme accusé d’avoir violé une fille de 11 ans. »
Je cite le Monde :
« Jugé pour le viol d’une fille de 11 ans en 2009, un homme de 30 ans a été acquitté mardi soir par la cour d’assises de Seine-et-Marne. Huit ans de prison avaient été requis contre lui, mais les jurés ont estimé que le viol n’était pas caractérisé, a-t-on appris de sources concordantes, samedi 11 novembre.
Au terme de deux jours d’audience, mardi soir, ceux-ci ont argué que les éléments constitutifs du viol, « la contrainte, la menace, la violence et la surprise, n’étaient pas établis », a expliqué la procureure de Meaux, Dominique Laurens. Le parquet général a fait appel de l’acquittement vendredi, selon Le Parisien.
Les faits se sont produits en août 2009, a raconté Laure Habeneck, l’avocate de la jeune fille, aujourd’hui âgée de 20 ans. Elle s’était rendue dans un parc avec un homme, âgé de 22 ans à l’époque, qui l’avait abordée alors qu’elle jouait avec sa cousine à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne).
Ils avaient eu une relation sexuelle, consentie selon l’accusé. Ce dernier affirme que la jeune fille avait menti sur son âge, en lui disant, selon son avocat, Samir Mbarki, « qu’elle avait 14 ans et qu’elle allait vers ses 15 ans », ce qu’elle conteste. La famille de la jeune fille avait eu connaissance des faits en 2010, en découvrant sa grossesse. Son enfant, 7 ans aujourd’hui, avait été placé dans une famille d’accueil.
La mère de la jeune fille s’est dite atterrée par le jugement, rapporte Le Parisien : « Cet homme a détruit la vie de ma fille, qui est tombée dans son piège. Après le viol, elle avait été placée dans une famille car elle était enceinte, c’était pour éviter les contacts avec les voisins. » « Pour ma cliente », ce verdict « est un deuxième traumatisme », a dit son avocate. « Je ne le comprends pas ».
« J’ai plaidé le droit, rien que le droit », a de son côté argumenté Me Samir Mbarki, avocat de la défense. « A charge pour le législateur de changer la loi. Ce n’est ni à l’avocat, ni à l’accusé de porter la responsabilité de cette défaillance légale ».
Si c’est cela la Loi, il faut la changer comme le dit d’ailleurs l’avocat de la défense.
Il semblerait que le gouvernement a l’intention de le faire
La secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa a tweeté : « Projet de loi en cours d’élaboration notamment sur la présomption irréfragable de non-consentement des enfants ».
Je vous redonne le lien, déjà donné lors des articles précédents, vers une pétition qui réclame une évolution de la Loi qui devrait mettre un âge en dessous duquel, le consentement ne peut pas exister <ICI>.
<965>
-
Vendredi 10 novembre 2017
« [Macron] est quelqu’un qui a beaucoup de confiance en lui-même.Mais ce poste nécessite de l’humilité. »David Axelrod, ancien conseiller principal de Barack Obama.On dit que David Axelrod a joué un rôle essentiel dans l’élection de Barack Obama. Il l’a ensuite suivi et a été son principal conseiller à la Maison Blanche.
Les matins de France Culture s’étaient délocalisés à Chicago, le 6 novembre, pour interroger l’Amérique après un an de présidence Trump.
Un des invités fut David Axelrod.
A la fin de l’entretien, Guillaume Erner lui a demandé ce qu’il pensait de Macron.
David Axelrod :
« Je pense que c’est une des personnes les plus surprenantes sur la scène mondiale.
Le monde manque de leadership. Il essaie de le remplir.
Angela Merkel a ses propres difficultés en Allemagne.
Nous avons ce jeune leader dynamique qui veut jouer un rôle
La question qui se pose est : comment va-t-il faire arriver le changement ?
Comment est-ce que cela sera reçu.
C’est quelqu’un qui a beaucoup de confiance en lui-même.
Mais ce poste nécessite de l’humilité. »
Voilà ce que le conseiller d’Obama dit à propos de Macron : il faut de l’humilité.
En manquerait-il, selon lui ?
<964>
-
Jeudi 9 novembre 2017
« Comment une société fait-elle pour que ses membres acceptent l’inégalité ? »Réflexions personnelles sur un sujet qui n’a rien perdu de son actualité.Cette question constitue un problème fondamental pour une société inégalitaire, ce qui dans l’Histoire de l’humanité est quand même le cas le plus fréquent. L’idée d’esquisser ce sujet m’est venue après le mot du jour de lundi, où Luther a rejeté violemment les prétentions des paysans allemands d’obtenir une meilleure situation par rapport à leurs seigneurs. Dans le cadre modeste d’un mot du jour, cette question ne peut être qu’esquissée.
Parce qu’évidemment, l’être humain qui se constate en situation d’inégalité éprouve normalement un sentiment d’injustice. Sentiment d’injustice qui conduit assez naturellement à de la violence. Sauf s’il existe des mécanismes qui maîtrisent ou évitent la violence.
Le premier mécanisme inventé dans les sociétés est certainement la force.
Souvent ceux qui avaient les positions dominantes dans la société étaient les spécialistes du maniement des armes. Ils pouvaient ainsi agir par la contrainte en amont ou une répression sévère en aval pour déclencher un mécanisme de peur chez ceux qui subissent l’inégalité et les dissuader ainsi de toute rébellion.
Il est possible de citer l’exemple de Spartacus qui ne fut pas qu’un film mais une vraie histoire de révolte des esclaves à Rome vers -73 avant Jésus Christ. Quand les légions romaines furent enfin mobilisées, ils battirent les esclaves moins bien organisés. Les survivants, 6000 esclaves furent crucifiés et exposés tout au long de la Via Appia. Voir sur une des principales artères de Rome une croix environ tous les 10 mètres sur laquelle était supplicié un de ses congénères pouvait, en effet, avoir pour effet de décourager d’autres esclaves de suivre le même chemin.
Mais c’est une méthode barbare, couteuse et qui peut même se révéler hasardeuse, à partir du moment où les privilégiés sont peu nombreux et les pauvres très nombreux.
Les sociétés trouvèrent d’autres moyens beaucoup plus efficaces, nécessitant un déploiement de force moindre et permettant une soumission volontaire. La religion permis ce prodige. Il n’y avait pas lieu de critiquer la répartition des richesses, c’était l’être suprême, Dieu qui l’avait voulu ainsi. Et puis la soumission volontaire et bienveillante permettrait d’être récompensé dans un autre monde ou une autre vie.
L’organisation la plus subtile qui fut mise en place est certainement celle des castes indiennes. Vous naissiez dans une famille qui appartenait à une caste, les castes étant hiérarchisées. Nul possibilité de sortir de cette caste. Mais des mythes permettaient d’expliquer d’abord qu’il existait la réincarnation et que vous passiez d’une vie à une autre vie. Et ainsi l’ordre du monde permettait de comprendre que si vous étiez dans une caste inférieure, c’est que dans votre vie antérieure vous n’aviez pas agi comme il faut selon les principes moraux édictés par ce même mythe. Aucune chance de se révolter, ce serait pire après votre mort vous vous réincarneriez certainement dans un animal et même dans les animaux il était possible de tomber plus bas. Notez que ce mythe permettait aussi de consoler un membre d’une caste inférieure victime d’un mauvais traitement d’un membre d’une caste supérieure. Il était consolé car il avait la certitude qu’en raison de son attitude cet homme vivrait bientôt dans un état inférieur.
Système absolument génial. La rébellion ne pouvait avoir que des conséquences désastreuses et la soumission ne pouvait que vous apporter du bonheur dans vos vies futures. Et nous savons combien il est difficile de penser différemment quand tout le monde croit un mythe. Raymond Aron avait eu cette belle formule qui m’a beaucoup guidé dans ma vie : « Les esprits capables d’affronter la désapprobation de leurs pairs demeurent toujours une élite, je veux dire un petit nombre.» Le monothéisme promet un autre monde, le système des castes d’autres vies. Dans un système monothéiste ou un système de caste, la démocratie libérale ne peut exister. Il faut un homme désigné par Dieu ou oint par Dieu ou encore une oligarchie qui organise et gouverne la société.
Mais nous n’en sommes plus là, dans nos sociétés modernes, sociétés démocratiques et libérales, les choses se passent autrement. Mais les inégalités existent toujours. Structurellement, on comprend bien que la démocratie décrète, dans ses fondements, l’égalité de chaque humain formant la société démocratique. Bien sûr les esprits subtils ont inventé de nouveaux concepts : l’égalité en droits et l’égalité sociale. L’égalité que promettait la démocratie libérale était la première pas la seconde. Les libéraux ont d’ailleurs un autre concept pour dénigrer ceux qui ont pour projet de réaliser l’égalité sociale : les égalitaristes qui prônent l’égalitarisme. La critique communiste avait pour analyser la même chose d’autres concepts celle de l’égalité formelle et l’égalité réelle. L’égalité formelle était celle préconisée par les libéraux et correspondait à l’égalité en droits. L’égalité réelle qu’ils promettaient s’apparentait à l’égalitarisme fustigé par les libéraux. Cette histoire a mal fini, certes il y avait moins d’inégalité que dans les démocraties libérales, mais au prix d’une restriction insupportable des libertés sans pour autant apporter la vraie égalité en raison de la corruption et de la nouvelle élite appelée «nomenklatura» qui disposait d’avantages que le commun n’avait pas.
Mais dans nos démocraties libérales, comment a t’on fait pour faire accepter l’inégalité ?
Car expliquer que l’égalité en droits était respecté ne pouvaient suffire à calmer la soif d’égalité réelle du plus grand nombre. Et pourtant, grosso modo, cela a fonctionné jusqu’à présent sans dégénérer dans la violence, au moins de violence dans la durée.Pour que les humains acceptent de vivre en commun et fassent société, il faut des mythes, des promesses, des lendemains qui chantent.
Je crois que la démocratie libérale mettait en avant une grande promesse et une règle qui a l’apparence de la justice.
La règle est celle de la méritocratie. J’ai réalisé une série de mots du jour, il y a un an, du 21 au 25 novembre 2016, qui interroge la réalité de l’application de cette règle qui selon la croyance libérale sélectionne les meilleurs pour diriger, gagner beaucoup d’argent, argent qui est aujourd’hui l’étalon de la réussite sociale.
Ce n’est pas que cette méritocratie soit un mythe, il y a eu dans nos sociétés un véritable ascenseur social pour des personnes issues de milieux modestes qui un peu par leur talent et beaucoup par leur travail ont su s’élever dans la hiérarchie sociale. Nous avons évoqué il y a peu de temps Albert Camus. Aujourd’hui encore le football autorise de tels phénomènes.
Mais les études sociales sérieuses notamment réalisées aux Etats-Unis montrent que ce qui prédomine, et ce phénomène s’accentue de nos jours, c’est que les enfants appartiennent grosso modo à la même classe sociale que leurs parents et même que leurs grands parents. Or il semble que l’intelligence ne soit pas génétique, c’est donc bien qu’il y a d’autres mécanismes en jeu.
Et c’est là qu’il y avait la grande promesse du progrès pour tous. Vous étiez peut être dans une catégorie sociale défavorisée, mais en étant sérieux et en faisant des efforts vous pouviez améliorer votre situation et surtout si vous éleviez sérieusement vos enfants et parveniez à leur inculquer le goût du travail et de la rigueur, ils seraient capable eux de faire un bond dans l’échelle sociale.
C’est cette grande promesse qui est en crise aujourd’hui. La globalisation, la concurrence des salariés, la cupidité du petit nombre qui accapare de plus en plus les richesses mondiales sont en train de tuer ce pilier de la démocratie. La démocratie a pour échelle le local : l’Etat. Elle ne sait pas lutter contre l’économie et la financiarisation qui ont pour échelle le monde.
Si la croyance en cette grande promesse s’évanouit dans la réalité de l’explosion des inégalités et à l’assignation définitive de groupes humains de plus en plus important soit dans une situation défavorisée, soit stagnante je ne donne pas beaucoup d’avenir à la démocratie.
On reviendra peut être alors au règne de la force. Il est imaginable que grâce aux progrès des technologies, aux robots, aux drones espions et tueurs un très petit nombre aura assez de puissance pour mater le plus grand nombre, surtout s’ils ne vivent plus avec les gens du commun. Probablement qu’ils se croiront alors des sur-hommes qui selon les rêves des transhumanistes de la silicon valley pourront toujours améliorer leurs performances grâce à l’apport de l’intelligence artificielle directement implantée dans leur corps et aussi vivre l’amortalité.
On reviendra aussi peut être à la religion, celle qu’imagine Harari : le dataisme. Les algorithmes travaillant sur des big data nous conseilleront pour chaque décision. Aujourd’hui nous vivons déjà cette réalité pour le guidage de notre voiture à travers le GPS et demain, très rapidement je crois, nous n’aurons plus de médecin traitant mais des connecteurs et une intelligence artificielle qui avec les données collectées sur notre corps et en interrogeant d’immenses bases de données sauront beaucoup mieux faire un diagnostic et trouver la thérapie adéquate qu’un pauvre médecin avec un cerveau humain, bref notre semblable. Harari pense que c’est justement à cause de la promesse de la santé que nous nous laisserons faire et ne nous opposerons pas à cette évolution.
Mais vous vous rendez bien compte que dans un monde où l’intelligence artificielle sait mieux que n’importe quel humain ce qu’il convient de faire, la démocratie devient un anachronisme. Il n’y aura aucune intelligence à demander aux cerveaux humains comment organiser la cité, alors que l’intelligence artificielle y répondra plus vite et avec plus de pertinence.
Ce dataisme qui saura sans doute même convaincre qu’il est normal que les pauvres soient pauvres. Bref une vraie religion comme dans l’antique.
Et pendant ce temps, le progrès technologique et l’augmentation des humains sur terre se heurtent à une dure réalité, les ressources de la terre ne suffisent pas à notre système de développement économique actuel qui a besoin des ressources de plusieurs terres pour continuer. Ressources dont nous ne disposons pas.
Le pire n’est jamais sûr et Edgar Morin cite souvent le poète allemand Hölderlin «Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve.».Mais pour cette fin il faut de la régulation, de la redistribution et un autre partage des richesses.
Ce que seule la Politique peut faire, car l’autorégulation de la cupidité ne fonctionne visiblement pas.
<963>
-
Mercredi 8 novembre 2017
« Avec plus de 500 portraits, [Luther] est l’homme le plus représenté de son temps, devançant même les monarques ! »Marion Deschamp dans un article dans la Revue Histoire (Hors série de septembre 2017)Je vais finir, aujourd’hui, avec cette série de mots sur Luther.
Luther ne peut se résumer ni à son antisémitisme que j’ai évoqué hier, ni sa soumission à l’injustice du monde que j’ai rapportée lundi.
Mais Luther, ce croyant irréductible, a aussi écrit ces textes assez terrifiants, haineux et manquant beaucoup de l’amour qu’il prêchait par ailleurs.
Il y aurait encore tant de choses à raconter sur lui. Notamment son conflit avec le grand humaniste Erasme qui fut avant tout philosophe, humaniste et théologien né à Rotterdam dans le comté de Hollande, bien qu’aujourd’hui il soit surtout connu parce que son nom a été utilisé pour le célèbre programme «Erasmus» de l’Union européenne.
Probablement que dans le conflit entre le réformateur intraitable et l’humaniste pondéré nous serions aujourd’hui beaucoup plus proche d’Erasme.
Lucien Febvre dans son ouvrage de référence cite encore un écrit de Luther :
« Je hais Erasme du fond du cœur »
Martin Luther un destin page 82
Et un peu plus loin : « En ces matières, Erasme est bien plus ignorant que Lefèvre d’Etaples. Ce qui est de l’homme l’emporte en lui sur ce qui est de Dieu »
En titre de ce chapitre, Lucien Febvre cite l’accusation principale de Luther à l’encontre d’Erasme :
« Du bist nicht fromm !»
Tu n’es pas pieux. Voilà le grand reproche, Erasme n’était pas assez illuminé par la Foi ! Il s’intéressait trop à l’homme et à l’humanité.
En creux, cela dessine encore une fois Luther en croyant radical, absolu. Je n’utilise pas à dessein le terme « intégriste » qui serait décalé et utiliserait un terme d’aujourd’hui pour décrire un monde qui était si différent. Le terme exact pour qualifier cette erreur est «anachronisme».
 Mais Luther a déclenché un mouvement d’une telle ampleur que probablement il n’avait pas imaginé et même pas voulu :
Mais Luther a déclenché un mouvement d’une telle ampleur que probablement il n’avait pas imaginé et même pas voulu :
- Il ne voulait pas le schisme avec l’église catholique, mais il l’a provoqué.
- Il voulait convaincre, faire évoluer la théologie catholique. Il a provoqué les guerres de religion, la terrible guerre de trente ans.
- Il pensait que l’alphabétisation générale servirait à l’unique but que chacun passe tout son temps disponible à lire et à commenter la Bible et les autres textes saints. Il ne pensait pas que cela permettrait aux ouvriers de lire Marx ou d’autres penseurs socialistes, par exemple.
- De même la liberté de penser devait permettre à chacun de mieux interpréter la parole divine et non pas de blasphémer, de réaliser des caricatures du Christ et d’appeler à la révolte contre les classes possédantes.
Mais il a aussi provoqué cela.
Avant que je ne m’intéresse de plus près à son destin et à ce qu’il a vraiment écrit et professé, je le trouvais plutôt sympathique. Notamment dans son évolution entre le moine rigide, austère passant son temps et son énergie à se soumettre à des contraintes disciplinaires dans l’espérance de plaire à Dieu au vieux bourgeois gras, aimant la bonne chère, le vin et aussi le sexe.
 Lucien Febvre cite une lettre à sa femme Catherine de Bore qui avait été nonne et qu’il a libéré de ses vœux puis épousé dans laquelle il reconnaît que l’âge l’a rendu impuissant et que s’il ne l’était pas, il lui ferait bien l’amour.
Lucien Febvre cite une lettre à sa femme Catherine de Bore qui avait été nonne et qu’il a libéré de ses vœux puis épousé dans laquelle il reconnaît que l’âge l’a rendu impuissant et que s’il ne l’était pas, il lui ferait bien l’amour.
De multiples convives ont rapporté les « Tischreden », « ses propos de table » pleins de verves, d’outrance et de vulgarité.
Il fait ainsi plusieurs fois l’éloge de l’alcool et même plus… :
« Il y a des fois où il faut boire un coup de trop, et prendre ses débats et s’amuser, bref commettre quelque péché en haine et en mépris du diable.»
Pour boire et pratiquer les choses du sexe, il évoque le diable pour mieux s’en moquer :
« Au moment des épreuves spirituelles les plus graves, j’ai souvent saisi les seins et les tétons de ma Käthe, mais cela ne m’a pas aidé et n’a pas chassé mes mauvaises pensées .»
Ou encore :
« Oh ! si je pouvais enfin imaginer quelque énorme péché, pour décevoir le diable et qu’il comprenne que je reconnais aucun péché, que ma conscience ne m’en reproche aucun ! »
Il allait parfois si loin dans ses extravagances que son plus fidèle collaborateur Philippe Mélanchthon s’est écrié « Utinam Lutherus etiam taceret » Ah si Luther pouvait seulement se taire !.
Pour comprendre comment avec un tel homme à l’origine, les protestants ont pu devenir des « puritains » dénoncés pour leur rigidité par Ingmar Bergman et tant d’autres cinéastes ou écrivains ayant vécu en terre protestante, il faut comprendre que d’autres influences, d’autres hommes comme Calvin par exemple ont joué un rôle essentiel dans le développement du protestantisme
Mais Luther ce n’est pas qu’un vieil homme autoritaire, aimant boire et faire la fête.
Lucien Febvre écrit page 182 de son ouvrage :
« Il ignore l’avarice, et même l’économie. Il aime donner. Il se montre très simple, très accessible à tous. Peu à peu, il reçoit dans son logis des pensionnaires. Des privilégiés, […] et qui, à table du grand homme, ouvre les oreilles pour bien tout écouter. Souvent Luther se tait. Il s’assied sans mot dire. On respecte son silence, lourd de méditation et de rêverie. Souvent aussi, il parle. Et des propos épais sortent de sa bouche : grossier mais, car le maître a pour un certain genre d’ordures, pour la scatologie, un goût qui ne fait que s’affirmer davantage, à mesure que passent les années. Mais parfois aussi, de ce gros corps qui s’enlaidit, un autre homme se dégage et surgit. Un poète, qui dit sur la nature, sur la beauté des fleurs, le chant des oiseaux, le regard brillant et profond des bêtes, toutes sortes de choses fraîches et spontanées. »
Et je voudrais finir par la grande modernité de Luther. Je tire cet extrait d’un article du hors série Histoire publiée par la Vie consacrée à Luther :
« Luther est instrumentalisé dès sa mort en 1546. Un dispositif mémoriel se met en place, et son discours est recyclé à des fins politiques. Le réformateur y a lui-même contribué en pariant de son vivant sur une diffusion de son message par l’image. Avec plus de 500 portraits, c’est l’homme le plus représenté de son temps, devançant même les monarques ! Cette culture du souvenir, alimentée sous toutes les formes possibles, traduit une modernité dans la communication : Luther parlait au peuple, pas seulement aux élites. »
<962>
- Il ne voulait pas le schisme avec l’église catholique, mais il l’a provoqué.
-
Mardi 7 novembre 2017
« En premier lieu, il faut mettre le feu à leurs synagogues et à leurs écoles,et enterrer et couvrir de saletés ce qui n’aura pas brûlé,de sorte qu’aucun homme ne puisse jamais en retrouver la moindre pierre ou cendre. »Martin Luther «Des Juifs et de leurs mensonges »Luther a écrit, a beaucoup écrit.
Il a eu un rôle primordial dans l’émergence de la modernité occidentale.
Il a aussi par son combat de 1517 et les années suivantes, peut-être à son corps défendant, libéré la parole, les énergies et le dynamisme occidental.
Mais il va vivre bien au-delà de 1517, jusqu’en 1546. Et en 1543 il a écrit l’ouvrage de trop : « Des Juifs et de leurs mensonges »
Les protestants et les luthériens peuvent expliquer et défendre Luther contre beaucoup des controverses, mais là ils ne peuvent plus.
Les historiens expliquent toujours qu’au début, Luther était très compréhensif à l’égard des juifs.
Wikipedia rappelle qu’il avait écrit un essai en 1523 « Que Jésus-Christ est né juif dans lequel il condamne le traitement inhumain des Juifs et presse les chrétiens de les traiter avec bienveillance.
Mais comme je l’ai écrit plusieurs fois, Luther était un homme de Foi, plus précisément un fondamentaliste, aujourd’hui on dirait un intégriste. Sa bienveillance à l’égard des juifs entraîne chez lui pour seul but de les convertir au christianisme.
Et Luther pense que si les Juifs entendent l’Évangile exprimé clairement, ils seront poussés naturellement à se convertir au christianisme. Et il écrit en 1523 :
« Si j’avais été un Juif, et avais vu de tels balourds et de tels crétins gouverner et professer la foi chrétienne, je serais plutôt devenu un cochon qu’un chrétien. Ils se sont conduits avec les Juifs comme s’ils étaient des chiens et non des êtres vivants ; ils n’ont fait guère plus que de les bafouer et saisir leurs biens. Quand ils les baptisent, ils ne leur montrent rien de la doctrine et de la vie chrétiennes, mais ne les soumettent qu’à des papisteries et des moineries […] Si les apôtres, qui aussi étaient juifs, s’étaient comportés avec nous, Gentils, comme nous Gentils nous nous comportons avec les Juifs, il n’y aurait eu aucun chrétien parmi les Gentils… Quand nous sommes enclins à nous vanter de notre situation de chrétiens, nous devons nous souvenir que nous ne sommes que des Gentils, alors que les Juifs sont de la lignée du Christ. Nous sommes des étrangers et de la famille par alliance ; ils sont de la famille par le sang, des cousins et des frères de notre Seigneur. En conséquence, si on doit se vanter de la chair et du sang, les Juifs sont actuellement plus près du Christ que nous-mêmes… Si nous voulons réellement les aider, nous devons être guidés dans notre approche vers eux non par la loi papale, mais par la loi de l’amour chrétien. Nous devons les recevoir cordialement et leur permettre de commercer et de travailler avec nous, de façon qu’ils aient l’occasion et l’opportunité de s’associer à nous, d’apprendre notre enseignement chrétien et d’être témoins de notre vie chrétienne. Si certains d’entre eux se comportent de façon entêtée, où est le problème ? Après tout, nous-mêmes, nous ne sommes pas tous de bons chrétiens. »
Bref, pour l’instant les chrétiens s’y sont mal pris, mais si les chrétiens se comportent bien, avec la foi de Luther et avec amour, nul doute que quasi tous les juifs se convertiront à la seule Foi, à la vérité, au christianisme.
Mais seulement cela ne s’est pas passé ainsi. Luther a compris que très peu de juifs accepteront de se convertir. Il le reconnait dès le début de son ouvrage « Des Juifs et de leurs mensonges » :
« Je me propose encore moins de convertir les Juifs, car c’est impossible. »
Cet ouvrage de 1543, dont la première phrase est :
« Je m’étais fait à l’idée de ne plus écrire à propos des Juifs ou contre eux. Mais depuis que j’ai appris que ce peuple méchant et détestable n’arrête pas de nous attirer à lui par la ruse, nous les Chrétiens, j’ai publié ce petit livre, afin d’avoir ma place parmi ceux qui s’opposent aux activités diaboliques des Juifs et qui recommandent aux Chrétiens de rester sur leur garde en ce qui les concerne. »
Et puis il parle d’eux comme « une portée de vipères et enfants du diable » , « misérables, aveugles et stupides », « des fripons paresseux », « des meurtriers permanents », et « de la vermine » et les apparente à de la « gangrène ».
Son ouvrage est encore un ouvrage théologique où sur la base des textes bibliques, il entend démontrer qu’il a raison et que les juifs sont dans l’erreur, du point de vue de la Foi.
A partir de la page 119, il commence à décliner un plan d’action :
En premier lieu, il faut mettre le feu à leurs synagogues et à leurs écoles, et enterrer et couvrir de saletés ce qui n’aura pas brûlé, de sorte qu’aucun homme ne puisse jamais en retrouver la moindre pierre ou cendre. Cela doit être fait en l’honneur de Dieu et de la chrétienté, pour que Dieu puisse voir que nous sommes Chrétiens, et que nous ne fermons pas les yeux ou supportons sciemment ces mensonges, malédictions et blasphèmes publics contre son Fils et ses Chrétiens.
[…]
En second lieu, je recommande de raser et détruire les maisons des Juifs. Car ils poursuivent là les mêmes buts que dans leurs synagogues. Ils devraient plutôt être logés sous un abri ou dans une grange, comme les bohémiens.
[…]
En troisième lieu, je recommande de leur retirer leurs livres de prières et les écrits talmudiques, qui enseignent cette idolâtrie, ces mensonges, ces malédictions et ces blasphèmes.
[…]
En quatrième lieu, je recommande que leurs rabbins soient dorénavant interdits d’enseigner sous peine d’être frappés dans leur corps et dans leur vie ; car ils ont trahi le droit à cette fonction.
[…]
En cinquième lieu, je recommande d’abolir complètement les sauf-conduits sur les routes principales pour les Juifs. Car ils ne font pas d’affaires dans la campagne, étant donné que ce ne sont pas des seigneurs, des fonctionnaires, des commerçants, etc.
[…]
En sixième lieu, je recommande qu’on interdise l’usure aux Juifs, et que toutes leurs espèces et leur fortune en argent et en or leur soient confisquées et mises de côté en lieu sûr. La raison en est que, comme nous l’avons dit plus haut, ils n’ont pas d’autre moyen de gagner leur vie que l’usure et que, de cette manière, ils nous ont volé et dérobé tout ce qu’ils possèdent.
[…]
En septième lieu, je recommande de mettre entre les mains des jeunes et solides Juifs et Juives un fléau, une hache, une houe, une bêche, une quenouille, ou un fuseau, et de les laisser gagner leur pain à la sueur de leur front, comme il se doit pour les enfants d’Adam (Genèse 3 [: 19]). Il n’est pas normal qu’ils nous laissent trimer en suant, nous maudits Goyim, tandis qu’eux, le peuple saint, passent leur temps dans l’oisiveté derrière le poêle, festoyant et pétant et, par-dessus tout, blasphémant et se vantant de leur pouvoir sur les Chrétiens par l’utilisation de notre sueur. Non, il faut jeter dehors ces gredins paresseux par leur fond de culotte
Violent, grossier, criminel voici comment apparaissent aujourd’hui les propos écrits par Luther.
Et cela se poursuit sur des dizaines de pages dans lesquelles alternent des citations de la bible, des controverses théologiques et des insultes à l’égard du peuple juif.
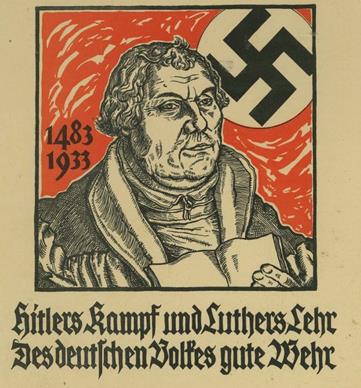 Ce texte a été relativement peu publié, même si selon Wikipedia des groupes antisémites ou le ku klux klan ont donné une certaine publicité à cet écrit.
Ce texte a été relativement peu publié, même si selon Wikipedia des groupes antisémites ou le ku klux klan ont donné une certaine publicité à cet écrit.
Mais bien sûr ce sont les nazis qui se sont emparés avec délice de ce texte.
L’Allemagne a eu deux pères fondateurs : Luther et Bismarck. Les outrances de Luther étaient pains bénis pour les nazis.
On voit à gauche, une affiche nazi.
Son commentaire : « Le combat d’Hitler et l’enseignement de Luther sont la bonne défense du peuple allemand »
Bien sûr, les racines de l’antisémitisme des nazis et de Luther ne sont pas les mêmes.
L’antisémitisme nazi est un antisémitisme génétique (pour ne pas dire raciale puisque les race n’existent pas). C’est pour cela qu’il y a génocide. Un juif même non croyant ne peut échapper à la haine des nazis.
L’antisémitisme de Luther n’est que d’origine religieux. Si le juif se convertit, Luther aurait probablement ajouté sincèrement, il devient un frère en foi et tout conflit est oublié.
Hier nous voyions Luther, dans sa croyance intransigeante faire une séparation nette entre deux mondes, notre monde réel et le second monde celui de la promesse de la religion.
Ici, Luther dans son délire antisémite montre la seconde faille des monothéismes : la certitude que sa croyance est la vérité.
« Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes.»
Dans son univers mental, Luther ne peut concevoir que les juifs pensent différemment de lui, possèdent d’autres croyances. Dans son univers, ils se trompent !
Et fait aggravant, alors qu’il leur explique calmement et de manière didactique, selon lui, ils persistent dans l’erreur.
Dès lors ils deviennent méchants, détestables et on peut user de violence à leur égard.
<961>
-
Lundi 6 novembre 2017
«La rébellion est chose intolérable.»Martin Luther,pendant la guerre des paysansJ’ai l’intuition que certains trouvent que j’exagère de consacrer autant de temps à Martin Luther. Car ils pensent que c’est de l’histoire ancienne.
Le croyez-vous vraiment ?
Boris Cyrulnik vient d’écrire un livre « Psychothérapie de Dieu », dans lequel il affirme :
« Aujourd’hui, sur la planète, 7 milliards d’êtres humains entrent plusieurs fois par jour en relation avec un Dieu qui les aide.
Ils sont mus par le désir d’offrir à Dieu et aux autres humains leur temps, leurs biens, leur travail et parfois leur corps pour éprouver le bonheur de donner du bonheur. »
C’est probablement mu par un fantasme quantophrénique, qu’il se sent obligé de citer un chiffre de 7 milliards, sans justifier comment il le détermine. Mais il dit une réalité, si nous autres européens largement agnostiques sommes sortis de la religion, il n’en va pas du tout de même pour les autres pays de la planète.
Et notamment aux Etats-Unis, il serait impossible à quelqu’un qui dirait qu’il ne croit pas en Dieu d’être élu Président. Les américains sont capables d’élire un Trump, mais incapable d’élire un incroyant assumé.
Les Etats-Unis sont un pays encore largement protestant, un pays très riche mais un pays très inégalitaire. Les croyants sont enclins à la charité, c’est-à-dire donner ce qu’ils jugent juste aux pauvres qu’ils ont choisis. La justice sociale n’est pas dans leur univers mental.
Je crois que la religion leur permet de vivre sereinement dans une société où l’injustice sociale est la norme. Et je pense pouvoir éclairer cette réalité à travers un exemple explicite de la vie de Luther.
Gérald Chaix, historien professeur à l’Université de Tours a écrit dans le numéro spécial de la revue Histoire : « Luther 1517, Le grand schisme » un article sur « la guerre des paysans » qui eut lieu en 1524-1525 en Allemagne.
« Tout commença en juin 1524, à Forchheim, au nord de Nuremberg, et dans le comté de Stühlingen au sud de la Forêt Noire. […] Suite à des abus, notamment fiscaux, les insurgés remettaient en cause les droits et les usages locaux. […] Au printemps 1525, les troubles avaient gagné toute la partie méridionale de l’Empire, de l’Alsace jusqu’au Tyrol et la région de Salzbourg, en passant par la Souabe supérieure et en s’étendant au nord vers la Franconie et la Thuringe.»
C’est une jacquerie pour reprendre le terme français dans laquelle les paysans se révoltaient contre leurs seigneurs parce qu’ils estimaient qu’ils subissaient trop de taxes et de corvées au profit des chefs féodaux.
Les paysans de Souabe ont notamment rédigés leurs revendications dans « douze articles ». L’article 3 réclamait notamment « la suppression du servage » ou l’article 5 « Le maintien des forêts communales », c’est-à-dire le refus de leur privatisation au profit des seigneurs.
Les auteurs de ces douze articles avaient mis résolument ces 12 articles sous la tutelle de la religion. L’article 12 disposait en effet :
« la Sainte Ecriture [est] la seule autorité que veulent suivre les paysans »
Mon objet, n’est pas de décrire précisément les péripéties de cette guerre des paysans, ni même de décrire plus précisément les revendications des paysans, mais de faire le lien entre ce soulèvement et Luther.
Si vous voulez en savoir davantage <Vous pouvez utilement lire ce qu’en dit Wikipedia>
Luther a déclenché un mouvement de liberté en prêchant que chaque chrétien peut accéder par lui-même au message biblique. C’était donc une invitation pour chacun à réfléchir par lui-même. Pour Luther cette réflexion était cependant très contrainte, contrainte par la foi et les commandements de Dieu. Mais certains ont voulu réfléchir sur les relations entre les paysans et leurs seigneurs et y ont constaté de grandes inégalités. Ancien partisan de Luther, Thomas Müntzer qui est un pasteur va prendre fait et cause pour les paysans et même prendre la tête de l’insurrection. Il souhaiterait mettre en place un ordre social équitable : suppression des privilèges, dissolution des ordres monastiques, abris pour les sans-logis, distribution de repas pour les pauvres.
Luther est directement confronté à la révolte, en Thuringe, les paysans voudraient qu’il agisse en tant que médiateur.
Ainsi il rédigea un opuscule : « Exhortation à la paix en réponse aux 12 articles des paysans de Souabe ». Dans cet écrit, il exhortait à l’apaisement mais surtout récusait aux paysans le droit de se soulever. Dans un raisonnement théologique il oppose la liberté spirituelle qui lui a permis de s’opposer au Pape à la soumission aux autorités temporelles, c’est-à-dire non religieuses. Il refusait notamment de tirer de l’évangile la suppression du servage.
Lucien Febvre résume dans son livre consacré à Luther (page 161), cet écrit de la manière suivante :
« L’Evangile ne justifie pas, mais condamne la révolte, Toute révolte. »
Son écrit se répandit à travers l’Allemagne mais ne ramena pas la paix. Au contraire l’insurrection, pris de l’ampleur. Et suite à cette aggravation, je cite à nouveau Gérald Chaix :
Luther se rendit à la cour de Weimar pour réclamer une intervention princière. L’Electeur y répugnait, mais il mourut le 5 mai 1525. Luther profita d’une réédition de l’Exhortation pour y ajouter quelques pages, achevées le 6 mai : « Contre les bandes criminelles et meurtrières des paysans : «C’est pourquoi, chers seigneurs, délivrez, sauvez, secourez, ayez miséricorde de ces pauvres gens. Poignardez, pourfendez et égorgez à qui mieux mieux […]. Si tout cela parait trop dur à quelqu’un, qu’il songe que la rébellion est chose intolérable, et qu’à tout moment il faut s’attendre à la destruction du monde. » »
Il fut fait selon les souhaits de Martin Luther et Gérald Chaix de préciser :
« En quatre batailles, les paysans furent écrasés : le 12 mai à) Böblingen, en Souabe, le 15 mai à Frankenhausen en Thuringe, un jour plus tard à Saverne, en Alsace, et le 2 juin à Königshofen, en Franconie. Le 27 mai 1525, Müntzer était exécuté. Au total, entre 70 000 et 100 000 révoltés perdirent la vie. »
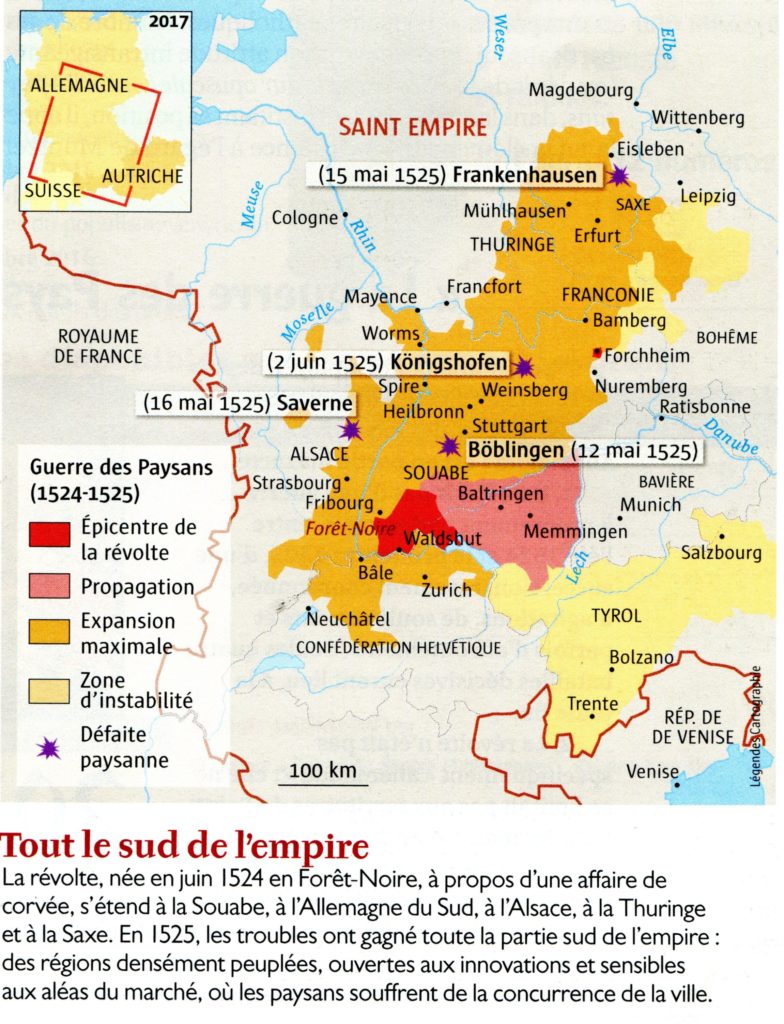
Probablement que sans Luther, les princes auraient également écrasé cette révolte dans le sang. Mais Luther a utilisé de sa plume et de son magistère pour soutenir pleinement la répression. Il nous a facilité l’analyse historique, en écrivant sur du papier explicitement son opinion : « Poignardez, pourfendez et égorgez ». Alors qu’auparavant, le mouvement qu’il avait déclenché avait justement pour fonction de conduire les masses à s’interroger et à réfléchir par eux même. Et cette prédication a conduit les paysans à considérer que leurs revendications étaient légitimes.
Comment expliquez cela ? Comment justifiez cela ?
Les marxistes ont une explication claire : « Luther était intiment lié aux princes et à leurs protections, il a donc pris fait et cause pour ses amis de classe ». L’ami, le confident de Marx, Friedrich Engels a écrit un ouvrage sur la guerre des paysans que vous trouverez sur internet derrière ce <lien>.
J’en tire ce paragraphe
« Avec sa traduction de la Bible, Luther avait donné au mouvement plébéien une arme puissante. Dans la Bible, il avait opposé au christianisme féodalisé de l’époque l’humble christianisme des premiers siècles à la société féodale en décomposition, le tableau d’une société qui ignorait la vaste et ingénieuse hiérarchie féodale. Les paysans avaient utilisé cet outil en tous sens contre les princes, la noblesse et le clergé. Maintenant, Luther le retournait contre eux et tirait de la Bible un véritable hymne aux autorités établies par Dieu, tel que n’en composa jamais aucun lèche-bottes de la monarchie absolue ! Le pouvoir princier de droit divin, l’obéissance passive, même le servage trouvèrent leur sanction dans la Bible. Ainsi se trouvaient reniées non seulement l’insurrection des paysans, mais toute la révolte de Luther contre les autorités spirituelles et temporelles. Ainsi étaient trahis, au profit des princes, non seulement le mouvement populaire, mais même le mouvement bourgeois. »
J’expliquerai, pour ma part, la position de Luther d’une manière plus simple et encore plus radicale.
Je prends acte que Luther est un croyant absolu dans sa Foi.
Nous avons déjà vu que son combat était un combat théologique, non un combat de morale.
Qu’applique t’il dans cet épisode ?
Je rejoins sur ce point Michel Onfray qui explique que les religions monothéistes ont théorisé l’existence de deux mondes, celui que nous connaissons et dans lequel nous vivons et l’autre monde dont nous ne savons rien sauf ce qu’en disent les religieux. Dans le monde que nous connaissons, nous savons que nous ne vivrons que quelques années, dans le monde mythique d’après la mort nous vivrons éternellement selon la croyance monothéiste.
Dès lors, le monde réel, celui que nous connaissons a beaucoup moins d’importance, une importance quasi négligeable.
Ici-bas nous devons vivre dans la soumission de l’ordre établi pour être récompensé dans l’autre.
Harari, l’auteur de « Sapiens » a eu cette formule saisissante : « Jamais vous ne convaincrez un singe de vous donner sa banane en lui promettant qu’elle lui sera rendue au centuple au ciel des singes. »
Et si la première fonction de la religion n’était pas celle-ci : « Faire accepter l’injustice sur terre et enseigner l’esprit de soumission ? »
L’Histoire de Luther me semble particulièrement révélatrice de ce point de vue.
<960>
-
Vendredi 27 octobre 2017
« L’Allemagne, le protestantisme et l’alphabétisation universelle »Emmanuel Todd Titre du chapitre 5 du livre « Où en sommes-nous ? Une esquisse de l’Histoire Humaine »Le protestantisme a joué un rôle majeur dans le monde occidental. Notamment parce qu’il a été la religion des pays les plus dynamiques de la révolution industrielle et économique : La Grande Bretagne, les Etats-Unis, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et les pays nordiques Suède, Danemark, Norvège.
Emmanuel Todd s’est surtout fait connaître ces dernières années comme polémiste, polémiste sur des options douteuses, notamment après l’attentat contre Charlie-Hebdo.
Mais c’est aussi un démographe et un chercheur rigoureux qui réalise des études sérieuses.
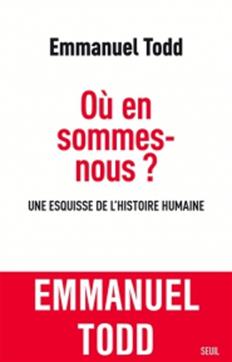
Son dernier livre plonge dans son domaine de recherche privilégié : « l’analyse des structures familiales ».
Ce livre <Où en sommes-nous ?> publié le 31/08/2017 par les éditions du Seuil, évoque l’Allemagne et le protestantisme.
Emmanuel Todd, d’abord centré sur son domaine de recherche, insiste sur la structure familiale de l’Allemagne qui est la famille souche.
Wikipedia nous apprend que le concept de famille souche a été forgé par Frédéric Le Play au XIXe siècle pour décrire un mode de dévolution préciputaire (c’est-à-dire à héritier unique) des biens, matériels et éventuellement non matériels, les enfants exclus de l’héritage étant dédommagés par différents moyens (par exemple la dot). La famille souche qui est donc une famille inégalitaire et autoritaire, concentre le plus souvent plusieurs générations sous le même toit avec application d’un droit d’aînesse masculine.
Mais au-delà de focus mis sur la structure familiale Emmanuel Todd dans son chapitre 5 « L’Allemagne, le protestantisme et l’alphabétisation universelle » s’intéresse aux conséquences du protestantisme en Allemagne, puis en Europe.
La conséquence majeure est l’alphabétisation universelle :
« Avant la révolution politique, scientifique et industrielle anglaise, il y avait eu Réforme protestante et l’alphabétisation de masse, venues d’ailleurs. Crise religieuse et décollage éducatif ont trouvé leur origine en Allemagne, disons à partir de 1517 si nous retenons les 95 thèses de Luther comme point zéro de ces bouleversements. »
Bien sûr, comme cela avait été souligné dans les mots précédents, avant l’alphabétisation il a fallu l’invention de l’imprimerie et sa généralisation :
Entre le XVIème et le XVIIIème siècle, la moitié des paysans du monde germanique sont devenus protestants ; répondant à l’injonction de Luther, ils ont appris à lire. La famille-souche, avec son autoritarisme interne et son principe de continuité, peut contribuer à expliquer le caractère « total » de l’alphabétisation protestante. […] L’existence, au XVIème siècle, de l’imprimerie est de toute évidence le facteur principal du succès de la Réforme dans son œuvre d’alphabétisation.
[…]
L’imprimerie en caractères mobiles fut mise au point à Mayence sur le Rhin par Gutenberg vers 1454 ; La Réforme protestante fut lancée par Luther en 1517, lorsqu’il afficha ses 95 thèses […] Le lien entre ces deux évènements et l’alphabétisation de masse est une évidence historique. L’imprimerie a permis un abaissement radical du coût de la reproduction des textes. La Réforme d’emblée a voulu instaurer, pour chaque homme, un dialogue personnel avec Dieu, sans l’intermédiaire du prêtre, exigeant, comme le judaïsme un millénaire et demi plus tôt, l’accès direct des fidèles aux textes sacrés.
Citons Egil Johansson, pionnier suédois de l’étude historique de l’alphabétisation :
« Ce ne fut qu’au XVIIème siècle que la capacité de lire, but des réformateurs, a atteint progressivement les masses. Alors apparut une différence claire entre l’Europe protestante et l’Europe non protestante. Si peu de gens savaient lire dans le sud catholique et l’est orthodoxe de l’Europe – moins de 20 % – une augmentation drastique était intervenue dans le centre et le nord protestants de l’Europe. L’Italie du Nord et certaines parties de la France occupaient une position intermédiaire, grâce à une tradition d’usage de l’écriture remontant au moyen âge, du moins dans les villes […].
Dans l’Europe protestante, on peut estimer de 35 à 45% de la population savait lire vers 1700.
 La Réforme a créé les protestants mais elle a aussi eu une conséquence sur les catholiques qui vont se lancer dans une réaction qu’on va appeler « la contre-réforme » et qui va se structurer dans le fameux <Concile de Trente>. Cette contre-réforme va aussi créer le corps des Jésuites qui va jouer un rôle majeur dans l’éducation des masses et sur l’alphabétisation. Emmanuel Todd insiste sur la concurrence, en Allemagne, entre catholiques et protestants sur ce terrain de l’alphabétisation.
La Réforme a créé les protestants mais elle a aussi eu une conséquence sur les catholiques qui vont se lancer dans une réaction qu’on va appeler « la contre-réforme » et qui va se structurer dans le fameux <Concile de Trente>. Cette contre-réforme va aussi créer le corps des Jésuites qui va jouer un rôle majeur dans l’éducation des masses et sur l’alphabétisation. Emmanuel Todd insiste sur la concurrence, en Allemagne, entre catholiques et protestants sur ce terrain de l’alphabétisation.
Dans l’Allemagne protestante, les seuils d’alphabétisation de 50% ne furent franchis qu’au XVIIème siècle, mais des résultats déjà substantiels avaient été obtenus dès le XVIème siècle. […] Dans l’espace germanique, la compétition religieuse a conduit à une alphabétisation à peine plus lente des régions qui n’avaient pas adopté la Réforme et étaient restées catholiques.
Pourtant, en 1930, la carte que donne Todd montre que l’Europe européenne protestante reste davantage alphabétisée que l’Europe catholique :
Vers 1930, la carte des taux d’alphabétisation européens restait centrée sur son pôle allemand initial et, plus généralement, sur le monde luthérien, auquel on peut ajouter l’Ecosse calviniste. Mais le mécanisme de diffusion ne s’est pas arrêté en Europe. Les Etats-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada anglophone, issus de l’Angleterre des XVIIème et XIXème siècles, ont bénéficié dès leur fondation de ses taux d’alphabétisation élevés. L’Amérique latine a, pour ce qui la concerne, hérité du retard et des rythmes plus lents de l’Espagne et du Portugal. Mais, toujours, la colonisation s’est accompagnée d’une diffusion de l’alphabétisation qui, partout, a avancé à partir des points d’entrée ou de pression européens.
Luther en conceptualisant l’idée que la vérité théologique, ce qui a son époque constituait la quête majeure des homo sapiens, pouvait être trouvée sans la médiation d’un prêtre par l’accès direct au livre sacré du christianisme a entraîné plusieurs conséquences :
- La première est ce besoin d’une alphabétisation générale ;
- La seconde est le développement d’un esprit critique puisque chacun va pouvoir se faire sa propre opinion ;
- La troisième est bien sûr que à travers l’alphabétisation et l’accès à la lecture et la culture, un formidable développement de l’innovation et du dynamisme économique va pouvoir s’épanouir
Concernant la deuxième conséquence, le développement de l’esprit critique, Luther va être confronté rapidement à un dilemme qu’il résoudra d’une manière qui nous apparaît aujourd’hui comme profondément condamnable. C’est ce que l’on va appeler « la guerre des paysans ».
Nous verrons cela au prochain mot du jour. Ce mot du jour ne sera pas publié lundi 30 octobre, parce que je prends une semaine de repos..
Au lundi 6 novembre donc.
<959>
- La première est ce besoin d’une alphabétisation générale ;
-
Jeudi 26 octobre 2017
« Les protestants »Nom qui a été donné à ceux qui ont quitté l’église catholique pour suivre la Réforme.Mais d’où vient le nom de protestant ? Pourquoi parle-t-on des protestants ?
Nous avons compris que Luther entendait réformer l’enseignement de L’Église catholique et que cette entreprise a mal tourné en raison de la réaction de la papauté et aussi un peu en raison des intérêts des élites allemandes.
Il parait, dès lors, rationnel de parler de Réforme et de réformateurs. Ces termes sont utilisés, mais un autre s’est imposé davantage : « Les protestants ».
Dans ma ville natale, à Stiring-Wendel, comme dans la ville centre de l’agglomération Forbach il y a une église catholique et un temple protestant.
Les livres savants expliquent simplement que ce mot est apparu une première fois, lors de la Diète de Spire en 1529.
Le mot « Diète » a plusieurs significations et il peut désigner une assemblée politique. Il semblerait qu’une des plus anciennes assemblées ayant porté ce nom et ayant duré sur une longue période se soit trouvée en Suisse. La Diète du Canton de Valais a existé de 1301 jusqu’en 1848.
Et dans le Saint Empire Romain Germanique « La Diète d’Empire », officiellement Diaeta Imperii était une institution chargée de veiller sur les affaires générales et de trouver une solution aux différends qui pourraient s’élever entre les États confédérés.La Diète ne fut jamais un parlement dans le sens contemporain ; c’était plutôt l’assemblée des divers souverains que comptait l’Empire. Longtemps la Diète n’eut pas de siège fixe et ce sont 3 diètes qui se sont réunies successivement et ont traité du conflit qui était en train de naitre entre les partisans de Luther et les partisans du Pape dont faisait partie l’empereur Charles Quint.
Il y eut d’abord en 1521, la « Diète de Worms » qui traita de plusieurs sujets qui n’avait rien à voir avec les 95 thèses de Luther. Mais elle entendit aussi en audience les 17 et 18 avril Martin Luther qui avait déjà été condamné par les instances religieuses catholiques, mais qui selon un texte ratifié par Charles Quint, avait le droit de présenter sa défense devant la Diète avant d’être mis au ban de l’Empire. Luther resta ferme sur ses principes. Sa réponse à l’invitation que lui faisait Charles Quint d’abjurer est restée célèbre :
«À moins qu’on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l’Écriture ou par des raisons évidentes — car je ne crois ni au pape ni aux conciles seuls puisqu’il est évident qu’ils se sont souvent trompés et contredits — je suis lié par les textes de l’Écriture que j’ai cités, et ma conscience est captive de la Parole de Dieu ; je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n’est ni sûr, ni honnête d’agir contre sa propre conscience.»
Un esprit fort droit dans ses bottes ! Dans ses sandales seraient probablement plus appropriées pour un moine.
Il remettait en cause l’autorité du Pape et réclamait le droit de juger par lui-même de ce qui convenait de faire et de penser à la seule lecture du texte biblique.
Bien sûr l’Église Catholique et son chef le Pape, comme l’Empereur son allié ne pouvait laisser cette rébellion en l’état et il y eut promulgation de l’édit de Worms qui condamna Luther et établit sa mise au ban de l’Empire. Mais son protecteur, le prince-électeur Frédéric III de Saxe, organisa l’exfiltration de Martin Luther pour le mettre en sécurité au château de la Wartbourg, à Eisenach, la ville qui vit naitre 164 années plus tard, le plus grand musicien de l’Histoire occidentale et fervent luthérien : Jean-Sébastien Bach.
Cette diète fut suivit par une autre en 1526, dans une autre ville : Spire (Speyer en allemand). Le mouvement réformateur ne s’était pas calmé après Worms, des princes continuaient à soutenir les idées de Luther et de nouveaux réformateurs vont se révéler, notamment Ulrich Zwingli et Thomas Müntzer qui va jouer un rôle important lors de la guerre des paysans sur laquelle nous reviendrons. Charles Quint ne participe pas à cette assemblée.
Et les grands princes de l’Empire décrètent une curieuse conception de la liberté religieuse pour nos esprits contemporains. Très simplement chaque Prince choisit la religion qui lui convient : la religion catholique ou les thèses réformatrices. Mais le Prince décide pour tout son Etat et toute sa population. Ainsi quand le Prince a décidé, tous ses sujets n’ont d’autres choix que d’adhérer à la même religion ou de quitter l’État du Prince.
Mais comme l’écrit Wikipedia :
L’historiographie considère que la Diète de Spire de 1526 constitue une ouverture non voulue par l’empereur Charles Quint dans la voie du libre choix des princes d’appliquer la religion de leur choix à leur territoire.
C’est pourquoi Charles Quint décida de réunir une seconde Diète à Spire en 1529 pour essayer de condamner les idées réformistes luthériennes, réinstaurer partout le culte catholique et la messe en latin et suspendre le compromis de la diète de 1526 et renforcer l’édit de Worms.
C’est cette prétention qui va entraîner le 19 avril 1529 la « protestation » de six princes et de quatorze villes.
Le 19 avril 1529 six princes : Jean de Saxe qui a succédé à Frédéric III le Sage décédé en 1525, Philippe de Hesse, Georges de Brandebourg-Ansbach, Wolfgang d’Anhalt-Köthen, Ernest de Brunswick-Lunebourg ainsi que 14 villes de l’empire (Strasbourg, Ulm, Nuremberg, Constance etc) déposent un acte de protestation devant l’empereur :
« Nous protestons devant Dieu, ainsi que devant tous les Hommes, que nous ne consentons ni n’adhérons au décret proposé dans toutes les choses qui sont contraires à Dieu, à sa sainte Parole, à notre bonne conscience, au salut de nos âmes »
L’empereur sera obligé de céder devant les Princes qui l’élisent.
Et c’est à la suite de cet acte de protestation que les réformés vont être appelés communément « Protestants ».
Mais on va tenter une explication plus savante en latin. Il sera alors expliqué que ce mot est la concaténation de deux mots latins pro (pour) et testare (témoigner) ce qui peut être décliné comme « professer sa foi »
<958>
-
Mercredi 25 octobre 2017
« Ce n’est pas de Luther qu’il s’agit, c’est de nous tous ; le pape ne tire pas le glaive contre un seul, il nous attaque tous. Ecoutez-moi, souvenez-vous que vous êtes germains »Ulrich von Hutten<Ulrich von Hutten> était un chevalier et aussi un polémiste qui soutint Martin Luther dès le début de son aventure de la Réforme.
Il faut savoir que sans qu’il ne l’ait excommunié le Pape a publié, en 1520, une bulle « Exsurge Domine » condamnant ses opinions, livrant au feu ses ouvrages et lui laissant 60 jours pour se soumettre.
Mais Luther n’est pas un moine isolé, il va obtenir des soutiens en Allemagne et notamment celui de ce Ulrich von Hutten.
Je tire ce discours de la page 102 de l’ouvrage de Lucien Febvre <Martin Luther, un destin> :
[Hutten] mène alors contre Rome une campagne enragée. En avril 1520 à Mayence […] paraissent des écrits violents contre les romanistes :
« Ce n’est pas de Luther qu’il s’agit, c’est de nous tous ; le pape ne tire pas le glaive contre un seul, il nous attaque tous. Ecoutez-moi, souvenez-vous que vous êtes germains »
Hutten est parmi les soutiens de Luther, un des plus virulents, des plus intransigeants, refusant tout compromis avec le Pape et Rome. Mais il exprime ici un point essentiel, la Réforme, le combat de Luther sont intimement lié à l’Allemagne, l’Allemagne désunie en nombreux États mais voulant se libérer de la tutelle romaine et aussi de l’Empereur du Saint Empire Germanique qui était le représentant temporel du Pape, dans les terres germaines.
Et dans la suite de cette campagne, Luther va rédiger et publier toujours à Wittenberg en 1520 un ouvrage qu’il va simplement appeler « À la noblesse chrétienne de la nation allemande », dans lequel il va attaquer le Pape, la curie, Rome et demander au peuple de soutenir les réformes notamment celle qui consiste à permettre à chacun de lire la bible et de s’en nourrir sans faire appel aux prêtres ;
Et je cite Lucien Febvre page 104 :
Ainsi ce petit livre, écrit en allemand à l’usage de tout un peuple, qu’il se soit enlevé chez les libraires avec une rapidité inouïe; qu’en 6 jours, on en ait débité quatre mille exemplaires, chiffre sans précédent : rien d’étonnant. Il visait tout le monde, tout le monde l’acheta.
Quand il vint en Allemagne publier la bulle [Le représentant du Pape] pu noter : « Les neuf dixièmes de l’Allemagne crient : Vive Luther ! et tout en ne le suivant pas, le reste fait chorus pour crier : Mort à Rome ! »
Et le 1er novembre 1521, dans une lettre Luther écrit : (Febvre page 137)
« Je suis né pour mes Allemands et je les veux servir. »
Et à partir de 1525 Febvre fait remarquer que Luther n’écrit plus qu’en allemand (page 181)
« Il renonce au latin, langue universelle, langue de l’élite. Ce n’est pas à la chrétienté qu’il s’adresse : à l’Allemagne seule, même pas, à la Saxe luthérienne. »
Les relations avec Rome et le Pape vont empirer, il faut dire que Luther est très intransigeant. Il est mis au ban de l’empire ce qui signifie que n’importe qui peut le mettre à mort impunément. Mais son protecteur, l’électeur de Saxe, Frédéric le Sage continue à le protéger. Et Aussitôt sa condamnation prononcée, l’électeur de Saxe Frédéric III le Sage, craignant qu’il ne lui arrive malheur ordonne à des hommes de confiance de l’enlever alors qu’il traverse la forêt de Thuringe le 4 mai 1521. Pour le mettre à l’abri dans le château de la Wartbourg.
Dans ce château, Luther demeure jusqu’au 6 mars 1522 sous le pseudonyme de chevalier Georges. Et c’est là qu’il va accomplir une autre tâche fondamentale le rattachant à l’Allemagne, il commence sa traduction de la Bible, en langue allemande.
On dit souvent que c’est la langue allemande qui a fait l’Allemagne. Mais cette langue n’était pas unique, de multiples patois coexistaient et c’est Luther qui va unifier cette langue, notamment par ce travail sur la bible il va créer une sorte de langue officielle. On parle désormais, pour désigner cette langue, de « la langue de Luther ».
La réforme de Luther est donc une réforme théologique.
Mais ce que nous apprenons ici, c’est qu’elle est aussi une révolte des allemands, sinon du peuple, au moins de l’élite et de la noblesse allemande contre l’hégémonie de Rome et de la papauté.
Et pendant ce temps, l’allié du Pape, l’empereur du Saint Empire Germanique, Charles Quint qui devrait rétablir l’ordre dans son empire et mettre à la raison Luther est paralysé. Il l’est parce qu’il est en guerre contre François 1er, le roi français, et qu’il ne dispose pas des ressources pour mener deux batailles à la fois. En outre, il soit ménager les nobles allemands qui soutiennent Luther et qui parallèlement sont ses électeurs.
La réforme va par la suite s’étendre rapidement à d’autres pays : la Suisse, les Pays bas et l’Angleterre qui dans sa réforme anglicane va se rapprocher du mouvement réformateur. Mais du point de vue de Luther elle est avant tout un combat du peuple allemand dont il se sent l’étendard.
A cela va s’ajouter, mais nous le verrons dans un autre mot du jour, un antisémitisme très virulent de Luther à la fin de sa vie.
Les nazis utiliseront dès lors la figure tutélaire de Luther pour cautionner leur système et leurs actes.
« Souvenez-vous que vous êtes germains » disait Ulrich von Hutten, le soutien de Luther.
<957>
-
Mardi 24 octobre 2017
« Une dispute qui termine mal ? »Didier Poton de Xaintrailles, titre d’une conférence à la Rochelle à propos des 95 thèses de Luther.Trouver l’exergue qui introduit ce que je souhaite partager dans le mot du jour est parfois compliqué. Pour aujourd’hui, j’ai trouvé le titre d’une conférence qui a eu lieu le 17 octobre 2017, dans une ville qui a été longtemps une place forte du protestantisme en France : La Rochelle. C’était une conférence de de Didier Poton de Xaintrailles, professeur émérite à l’université de la Rochelle, président du musée rochelais d’histoire.
Le titre de cette conférence : « 31 octobre 1517 : une dispute qui tourne mal ? »
Je n’ai pas trouvé de compte rendu, ni de vidéo sur cette conférence. Je n’en connais donc pas le contenu. Mais le titre de cette conférence correspond exactement à la conclusion que j’ai tiré du livre de Febvre sur Luther et des différents articles ou émission que j’ai écoutés sur ce sujet.
J’ai vu une émission qui me semble particulièrement pertinente sur ce sujet, sur la chaine de télévision catholique KTO et qui explicite ce que je vais raconter ici.
<Emission de KTO qui fait dialoguer un catholique et un Luthérien>
Le 31 octobre 1517, Luther a donc publié ses « 95 thèses », il y a 500 ans. Et on fixe à ce moment fondateur le début du mouvement réformateur.
Rappelons de manière simplifiée la version officielle :
Luther est scandalisé par « les indulgences » qui sont utilisées par les ecclésiastiques catholiques pour financer leurs dépenses somptuaires. « Les indulgences » sont en terminologie contemporaine une taxe payée par les catholiques, surtout riches, pour racheter leurs fautes morales ou contre la religion. Le terme faute était remplacée par « péché ». A cette époque, les gens étaient saisis d’effroi de ce qui pourrait arriver après leur mort : l’enfer, le purgatoire et les tourments etc. Donc ils étaient très enclins à accepter de payer. Et les spécialistes marketing de l’Église de l’époque ont alors même imaginé de faire payer pour des péchés futurs. Donc Martin Luther, religieux austère et rigoureux part en guerre contre ces abus et va clouer sur les portes du château de Wittenberg en Saxe ses 95 thèses contre les indulgences, le 31 octobre 1517. La Papauté ne va apprécier, il va s’en suivre des conflits et une scission dans l’Église catholique romaine (Rappelons qu’il y a eu une précédente scission avec l’Église d’Orient, historiquement de Constantinople dont est issu l’Église orthodoxe) et la création des églises protestantes ou réformées.
Fernand Braudel disait qu’en Histoire les choses sont toujours vrai à peu près. Mais cette version est à peu près fausse.
D’abord les historiens d’aujourd’hui doutent beaucoup du fait que ce long texte aurait été placardé sur les portes du château de Wittenberg, le 31 octobre 1517.
Ce qui est certain c’est que ce texte a été écrit par Luther et imprimé. Ce qui est aussi certain c’est qu’il a été envoyé à certaines autorités ecclésiastiques et universitaires.
Ensuite la vision morale de l’Histoire qu’on nous a apprise est largement fausse.
Luther ne s’est pas élevé contre l’Église catholique parce que les mœurs de cette dernière étaient moralement condamnables. Cette version « L’église catholique est corrompue et en contradiction avec son message christique, il faut remettre de la morale et de l’ordre dans tout ça », nous convient bien, à nous autres hommes modernes, parce que nous la comprenons.
Il faut savoir par exemple que Le Prince Electeur de Saxe, Frédéric III dit le « sage », qui sera le protecteur de Luther tout au long de la controverse était lui-même un utilisateur des indulgences, parce qu’elles lui permettaient de financer des reliques très prisées à l’époque et dont il a été un grand collectionneur.
La vérité c’est que cette controverse est totalement incompréhensible à la plupart d’entre nous. Je vais quand même essayer de vous l’expliquer, j’en appelle à votre indulgence.
La controverse déclenchée par Luther est d’essence théologique. Il est bien question des indulgences, mais non pour une question de morale, pour une question théologique.
C’est incompréhensible aujourd’hui pour les européens que nous sommes, peut-être pas pour le reste de l’Humanité qui est encore largement influencé par la religion.
A cette époque on s’entretuait pour ces questions !
Des questions aussi extraordinaires que :
- Est-ce que l’hostie que l’on vous donne à l’Eglise symbolise le corps du Christ ou est-ce vraiment physiquement le corps du Christ ?
- Que signifie exactement la Trinité, est-ce un seul être ou 3, existe-t-il une hiérarchie entre eux ?
A cette époque, selon votre réponse vous pouviez être un homme respecté ou un hérétique qui devait être torturé puis brulé. Et s’il existait suffisamment de personnes pour défendre des réponses antagonistes, ces groupes se faisaient la guerre, une guerre totale.
Nous autres européens sécularisés ne comprenons pas cela même si l’actualité et d’autres religions que la chrétienne devraient nous interpeller.
Les religions monothéistes ont apporté quelques bienfaits à l’humanité, notamment les moines qui ont beaucoup travaillé, asséché des marais et réalisé d’autres choses utiles. Mais le fondement du monothéisme qui entraine la confusion entre « une croyance » et « la vérité unique » a une fabuleuse capacité à crétiniser ceux qui se laissent happer par ces mythes.
Le plus simplement possible je dirai que Luther prétendait que l’enseignement de l’église catholique se trompait en prétendant que c’est le comportement, les actes (il disait les œuvres) des croyants, notamment les mortifications (les jeûnes, se donner la discipline ce qui signifiait se fouetter soi-même ou se faire fouetter ce qui n’était pas vue comme une manifestation de masochisme mais une preuve de foi) permettaient de « se faire bien voir » par Dieu, « d’obtenir la grâce » selon le vocabulaire d’époque.
Selon lui, pour plaire à Dieu il fallait simplement avoir la Foi, croire très fort et la grâce de Dieu faisait le reste.
Alors bien sûr, les indulgences cela n’allait pas du tout puisque cette manière d’agir laissait entendre qu’un acte de la part du croyant : « payer » pouvait conduire à ce que Dieu sois content !
Ce qui est vrai, c’est que Luther n’avait pas pour intention de créer une nouvelle église. Ses 95 thèses étaient l’expression de son désaccord avec l’enseignement de l’Université qui essentiellement consacrait son enseignement à la théologie. Il voulait déclencher un débat, à l’époque on parlait de « dispute », pour débattre avec d’autres de ce qu’il avançait.
Mon propos d’aujourd’hui se moque totalement du contenu des 95 thèses qui sont 95 affirmations d’une vingtaine de mots chacune. En revanche, je vais vous citer, in extenso, l’introduction de ce texte historique :
«Par amour pour la vérité et dans le désir de la mettre en lumière, nous débattrons à Wittenberg des 95 thèses ci-après sous la présidence du Père Martin Luther, Maître ès Lettres et Docteur en Théologie, Professeur ordinaire en ce lieu. Nous demandons à ceux qui ne peuvent être ici présent en ne pourront par conséquent pas prendre part oralement au débat, de le faire par écrit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen.»
Il s’agit pour prendre des termes modernes, d’un débat intellectuel, de la confrontation d’idées dans l’espace universitaire.
Luther eut deux surprises :
- La première c’est ce que ce débat n’a pas eu lieu ;
- La seconde, c’est que son texte a eu un écho énorme, notamment en Allemagne et que pour différentes raisons dont certaines politiques, il avait enclenché un mouvement qui allait secouer l’Occident et mener à des guerres.
Ce que je vous ai raconté dans ce mot du jour est vrai à peu près, mais c’est très vrai à peu près. En tout cas beaucoup plus que la thèse officielle apprise dans nos livres d’Histoire et que j’ai rappelé ci-avant.
<Et je vous renvoie vers cette émission de KTO citée précédemment>
Vous conviendrez que l’exergue sous forme de question « Une dispute qui termine mal ? » est particulièrement adapté à ce que j’ai développé dans cet article.
<956>.
- Est-ce que l’hostie que l’on vous donne à l’Eglise symbolise le corps du Christ ou est-ce vraiment physiquement le corps du Christ ?
-
Lundi 23 octobre 2017
« La Réforme »Mouvement religieux né en 1517 en Allemagne et conduisant à la création des églises protestantes2017 est une année pleine d’anniversaires et de commémorations. Le mot du jour du 13 octobre en a rappelé certains.
J’avais omis de citer l’anniversaire qui a motivé notre jeune président improbable et cultivé à inviter pour notre fête nationale le vieux président improbable et inculte des Etats-Unis. Il n’y a que le caractère improbable de leurs élections respectives qui permet de trouver un point commun entre ces deux hommes. Il y a cent ans les Etats-Unis entraient en guerre au côté des anglais et des français contre les allemands et les empires centraux. Ce point de départ de l’hégémonie militaire et économique américaine a continué tout au long du XXème siècle pendant lequel les américains se sont occupés des affaires européennes, un peu pour préserver leurs intérêts, beaucoup parce que nous autres européens nous nous sommes très mal comportés et avons entraîné le monde dans des guerres mondiales apocalyptiques et des totalitarismes meurtriers qu’ont été le nazisme et le communisme bolchévique.
Et justement, un autre centenaire est à commémorer, les cents ans de la révolution russe d’abord celle de février qui renversa le Tsar, puis la vraie, la tragique celle qui allait permettre aux bolcheviks de prendre le pouvoir, d’essayer de mettre en place un système productiviste alternatif au capitalisme, de nier les libertés, et d’assassiner des millions de leurs concitoyens pour s’écraser dans la déroute économique : la révolution d’octobre qui a eu lieu selon notre calendrier le 7 novembre 1917. Cette révolution aura duré moins de 75 ans puisqu’elle s’acheva avec la fin de l’Union Soviétique le 25 décembre 1991.
Mais j’entends parler cette semaine non d’une révolution (quelqu’un saurait-il m’expliquer pourquoi on utilise ce mot qui signifie tourner autour d’un astre pour revenir au même point pour qualifier des bouleversements politiques, cela signifierait-il que forcément les révolutions tournent en rond ?) mais de la Réforme.
On oppose souvent la révolution et la réforme. Mais la Réforme fut un bouleversement religieux, politique et même économique selon Max Weber qui écrivit : « L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme »
Selon l’excellent outil du <CNTRL> du CNRS le verbe « Réformer » est lié à la racine « former » et signifie « ramener à sa forme primitive », ce sens existerait depuis la fin du XIIème siècle.
La Réforme a 500 ans et s’inscrit dans le temps long, plus long que la révolution bolchevique.
Les humains aiment dater le début d’une période, d’un phénomène de temps long.
Et on date le début de la Réforme au 31 octobre 1517. Ce jour-là, un moine augustin, professeur de théologie à l’université de Wittembourg en Thuringe sur les terres du Prince électeur de Saxe, Martin Luther a rendu public et envoyé à certains interlocuteurs un document qui a gardé pour nom dans l’Histoire : « Les 95 thèses » contre les indulgences et le fonctionnement de l’église en vue de provoquer un débat théologique, une bataille d’idées à l’intérieur de l’Eglise Catholique. Par un concours de circonstances, des malentendus mais aussi des postures politiques et nationalistes ce débat d’idées va s’abimer dans des guerres, des affrontements et une rupture au sein de la chrétienté occidentale. Nous y reviendrons pendant quelques jours pour éclairer ce moment de l’Histoire européenne et mondiale, car les Etats Unis sont imprégnés par cette révolution luthérienne qui va générer le mouvement protestant.
Pour ce premier mot de la série, je vais m’intéresser au Monde « européen » dans lequel ce document de controverse théologique allait mener à une explosion de rivalités, de haines et aussi de dynamisme intellectuel, politique et économique.
Nous disons donc 1517.
Tous les élèves ayant fréquenté des classes d’Histoire de l’école française ont au minimum une date gravée dans leur mémoire : « 1515 » donc 2 ans avant 1517.
<1515> donc François 1er, donc Chambord, donc la Renaissance dans sa flamboyance.
Luther (1483-1546) et François 1er (1494-1547) sont des contemporains, Luther un peu plus âgé, 11 ans quand François 1er naît. Mais à partir des 95 thèses et pendant tout le reste de la vie de Luther, la France n’eut qu’un seul roi, un roi catholique mais qui par sa politique aida grandement la diffusion du protestantisme en Europe et notamment au sein des Etats du Saint Empire Romain germanique où régnait son ennemi principal l’empereur Charles Quint.
1515, donc <la bataille de Marignan> en Italie à 16 km au sud-est de Milan. Pour les plus savants la bataille eut lieu les 13 et 14 septembre 1515 et opposa le roi de France François Ier et ses alliés vénitiens aux mercenaires suisses qui défendaient le duché de Milan.
Donc l’Italie …au cœur des rivalités européennes, siège de la papauté et de rivalités internes fortes entre Venise, Gènes, Milan et Rome.
Et Florence… <Laurent de Médicis dit le Magnifique> (1449-1492), donc un aîné pour Luther qui avait 9 ans quand Laurent le Magnifique est mort. Mais en 1513, le Pape qui est élu à Rome a pour nom Léon X, ce fut le Pape qui dirigeait l’Eglise catholique en 1517. Qui est Léon X en réalité ?
<Léon X> eut pour nom de baptême Giovanni Médicis, c’est le second fils de Laurent de Médicis. Il fut Pape de 1513 à 1521.
Léon X, comme tous les souverains européens et particulièrement italiens fut un grand protecteur des arts. Il fit notamment travailler pour lui Raphaël (1483-1520) né la même année que Luther. Il peignit le portrait de Léon X, que l’on peut admirer de nos jours à la galerie des Offices de Florence.
Léon X succéda au pape Jules II, le pape de Michel Ange (1475-1564) qui naquit donc avant Luther et mourra après. Jules II fut aussi le Pape qui entreprit l’édification de la <basilique Saint Pierre> qui fut financée en partie par les <Indulgences> qui jouèrent un rôle certain mais toutefois limité dans le combat théologique de Luther.
Le successeur de Léon X, Adrien VI ne régna qu’un peu plus d’un an. Il était originaire d’Utrecht ville des futurs Pays-Bas. Il est surtout connu comme étant le dernier pape non italien avant Jean-Paul II !
Et après ce Pape de transition, il y eut Clément VII (1523-1534) en pleine expansion du protestantisme, il était en réalité le fils illégitime de Julien de Médicis, frère de Laurent le Magnifique.
Pour rester avec les Médicis et Florence, nous devons rappeler que les Médicis seront renversés par la conquête française en 1494. Un frère dominicain du nom de Savonarole va alors jouer un rôle essentiel dans la cité des Médicis. Il rencontre le roi de France Charles VIII, négocie les conditions de la paix et évite le sac de la ville. Les Florentins sont autorisés par le roi de France à choisir leur propre mode de gouvernement. Savonarole devient alors dirigeant de la cité. Il institue un régime qu’il décrit comme une « République chrétienne et religieuse ».
Homme intransigeant, voulant lutter contre toute corruption il va instituer un pouvoir totalitaire, dans le sens qu’il veut tout contrôler de la vie des florentins même la vie intime. Il finira très mal puisqu’il mourut pendu et brûlé à Florence le 23 mai 1498, Luther avait 15 ans. Certains citent Savonarole comme un précurseur de Luther car il voulait lutter contre la corruption et les abus de l’Eglise, mais nous verrons que ce ne fut pas le combat principal de Luther.
Savonarole fut donc l’allié du roi de France et l’ennemi du Duché de Milan qui était au main de la famille Sforza, ce qui était encore le cas lorsqu’en 1515, à Marignan, François 1er vainquit les troupes alliées au duché de Milan.
Un autre grand ennemi de Savonarole était le pape Alexandre VI, pape de 1492 à 1503, de la famille romaine des Borgia, père de Lucrèce Borgia et César Borgia (1475-1507). Ce dernier est mort 10 ans avant les 95 thèses, il avait 8 ans à la naissance de Luther.
Qui dit César Borgia, pense à Machiavel (1469-1527) un autre contemporain de Luther, même s’il est un peu son aîné. Je n’ai vu nulle part que Luther aurait lu Machiavel, d’ailleurs <Le Prince> est paru en 1532. Mais dans le monde européen de Luther existait la pensée de Machiavel sur le pouvoir.
Revenons à François 1er et l’Italie, dans ce cas un autre nom illustre d’entre les illustres nous revient en mémoire : <Léonard de Vinci> (1452-1519), il est mort 2 ans après 1517, il faisait partie du panthéon culturel de l’Europe de Luther.
François 1er eut pour principal ennemi Charles Quint, pour lutter contre lui il se chercha des alliés. Et dans un épisode fameux <Le camp du Drap d’or> qui est le nom donné à la rencontre diplomatique du 7 au 24 juin 1520, dans un lieu situé dans le Nord de la France, près de Calais il rencontra le roi Henri VIII d’Angleterre. Cette rencontre n’aboutit pas à l’alliance souhaitée.
Mais Henry VIII de la famille Tudor (1491-1547) qui fut roi d’Angleterre et d’Irlande de 1509 à sa mort, fut aussi un grand contemporain de Luther. Il devint roi alors que Luther avait 26 ans. Ce dernier ne connut à partir de cet instant aucun autre roi d’Angleterre jusqu’à sa mort.
<Henry VIII> avait épousé Catherine d’Aragon mais souhaitait l’annulation de ce mariage pour épouser une des dames de compagnie de la reine : <Anne Boleyn>. Mais pour ce faire il avait besoin de l’appui du Pape, et Clément VII dont nous avons déjà parlé a refusé obstinément de céder à l’injonction du roi. C’est pourquoi Henry VIII entreprit, à sa façon, une réforme pour donner naissance à l’église anglicane dont le chef est le souverain britannique. Sans le mouvement lancé par Luther en Allemagne, probablement qu’Henry VIII n’aurait pas eu cette initiative qui s’inscrit immédiatement dans la Réforme.
Wikipédia affirme à propos d’Anne Boleyn que :
« Sa réputation d’être favorable à la réforme religieuse se répand dans toute l’Europe, elle est adulée par l’élite protestante ; même Martin Luther voit d’un bon œil son accession au trône. »
Vous savez que cette pauvre Anne Boleyn fut décapitée sur ordre de Henry VIII mais que leur fille fut reine d’Angleterre et que cette reine fut la Grande <Elisabeth 1ère> (Reine de 1558-1603), début de l’âge d’or de la Grande Bretagne. Elle consolida l’Eglise anglicane et l’inscrivit dans le protestantisme. Fort de cet héritage l’Acte d’établissement de 1701 exclura de la succession des rois d’Angleterre, les catholiques. Ce qui explique l’avènement comme roi d’Angleterre, du Prince électeur de Hanovre sous le nom de Georges 1er (roi de 1714 à 1727). Car à la mort de la reine Anne de Grande-Bretagne, si plus de 50 nobles avaient des liens de parenté plus étroits avec la reine Anne que lui, ils étaient tous catholiques. George était donc le plus proche parent protestant d’Anne. C’est ainsi que la maison allemande des Hanovre s’empara de la couronne britannique.
La couronne britannique a toujours ses racines allemandes. La reine Victoria fut la dernière des souverains de la Maison de Hanovre. Mais ayant épousé, en outre, un allemand : le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, lorsque Édouard VII, fils de la reine Victoria, monte sur le trône, il portera le nom de son père et la maison royale prend dès lors le nom de Saxe-Cobourg-Gotha. Et c’est en pleine première guerre mondiale, il y a 100 ans, en 1917, que ce nom trop clairement lié à l’ennemi allemand fut changé. Ainsi, cette dynastie toujours au pouvoir pris le nom d’un château, situé dans le Berkshire à l’ouest de Londres : le château de Windsor.
Ceci nous éloigne de Luther mais il fallait bien expliquer les conséquences de la décision de Henry VIII de créer l’église anglicane pour épouser Anne Boleyn et le lien avec le protestantisme issu de la Réforme luthérienne
Mais venons maintenant au cœur de la réforme luthérienne. Luther est allemand. Il est professeur à l’université de Wittemberg, en Thuringe. Le souverain de ce lieu, est en 1517, le Prince électeur de Saxe : Frédéric le Sage. Il est électeur de l’Empereur du Saint Empire Germanique. Car l’Allemagne a un semblant d’unité représentée par l’Empereur.(Le premier Reich, le deuxième sera celui créé par Bismarck pour Guillaume 1er, le troisième est tristement célèbre) .
En 1517, l’Empereur est Maximilien 1er de la maison des Habsbourg. Il va mourir en 1519 ouvrant une nouvelle période électorale incertaine dans laquelle vont s’affronter François 1er qui veut devenir empereur et le futur Charles Quint de la maison des Habsbourg. On sait que ce fut <Charles Quint> qui l’emporta mais la rivalité entre la France et la maison Habsbourg ne gagna qu’en intensité. Le début de la réforme après 1517 émergea dans un empire affaibli par un jeune empereur non encore aguerri, des Etats allemands souhaitant de plus en plus d’indépendance par rapport à l’Empereur et la Papauté et un roi de France qui trouva dans cette fracture en train de naître entre catholiques et protestants un germe fécond de division de nature à affaiblir son ennemi, voire le vaincre. Cette division allait cependant s’emparer quelques années après de la France s’abimant dans les guerres de religion.
Luther et la Réforme auraient été anéantis aussi sûrement que les tentatives précédentes de réformer l’Eglise et la papauté de <Jan Hus>ou de <John Wyclif> s’il n’avait pas pu bénéficier du soutien sans faille même s’il fut ambigüe de Frédéric le Sage et de cette rivalité fondamentale entre François 1er et Charles Quint.
Mais cette description du Monde de Luther et de la Réforme ne serait pas complète, si on ne rappelait pas 3 dates :
- 1453 : L’empire Ottoman s’empare de Constantinople et met fin à l’Empire romain d’Orient. Luther naîtra 30 ans après.
- 1492 : Luther a 9 ans et Christophe Collomb découvre l’Amérique. Les 95 thèses sont publiées le 31 octobre 1517, ce même mois d’Octobre 1517, à Séville, Fernand de Magellan commence les préparatifs du premier tour du monde. <Magellan>, (1480-1521) est un autre contemporain immédiat de Luther.
- Et probablement la plus importante pour la réforme : 1451 : Le premier livre européen est imprimé par Gutenberg avec des caractères mobiles « la grammaire latine de Donatus ». Puis la première édition latine de la Bible est celle dite de la « Bible à quarante-deux lignes » en 1453 par Gutenberg. Des presses s’installent rapidement dans les grandes villes d’Europe : Cologne (1464), Bâle (1466), Rome (1467), Venise (1469), Paris (1470), Lyon (1473), Bruges (1474), Genève (1478), Londres (1480), Anvers (1481) et des centaines d’autres. En 1500, on comptait plus de 200 ateliers d’imprimerie dans la seule Allemagne. Sans l’invention de l’imprimerie, Luther et les Réformés n’auraient jamais pu diffuser leurs idées avec une telle puissance et vitesse.
Il faut bien arrêter cet exercice d’érudition présentant le monde où Luther a agi et proclamé ses thèses réformatrices. Mais je ferais une impasse trop importante si je ne citais un autre immense penseur de la culture européenne, contemporain de Luther, d’abord son allié puis son adversaire, l’humaniste hollandais <Erasme> (1467-1536)
Luther est le contraire d’un penseur isolé dans un coin obscur de Thuringe. Il nait et prêche dans un monde en plein mouvement, en plein dynamisme avec de grands artistes, de grands penseurs et de grands découvreurs. Un dernier : 10 ans avant la naissance de Luther, naissait Nicolas Copernic (1473 – 1543) qui défendra la théorie de l’héliocentrisme.
<955>
- 1453 : L’empire Ottoman s’empare de Constantinople et met fin à l’Empire romain d’Orient. Luther naîtra 30 ans après.
-
Vendredi 20 octobre 2017
« Le Taj mahal doit être retiré des brochures touristiques indiennes parce qu’il est musulman »Les responsables de l’Etat indien de l’Uttar PradeshOù s’arrêtera la bêtise de certains religieux ?
Je reste prudent et mesuré : tous les religieux et croyants ne sont pas des sectaires débiles.
Mais force est de constater qu’aucune religion n’est épargnée de la présence d’obscurantistes crétinisés.
Après les bouddhistes qui s’attaquent aux musulmans rohingyas, voici que des hindouistes s’attaquent au Taj Mahal parce qu’il est l’œuvre d’un musulman.
<Le Monde> nous apprend à propos du Taj Mahal que :
Les extrémistes hindous au pouvoir dans l’Etat indien de l’Uttar Pradesh l’ont sorti de leur brochure touristique. Le monument du XVIIe siècle avait le malheur de porter la signature d’un empereur moghol, Shâh Jahân, qui, selon la légende, l’a érigé en mémoire de son épouse défunte, Mumtaz Mahal. Dans la nouvelle Inde des extrémistes hindous, les monuments construits par les musulmans ne font pas partie du patrimoine national.
En juin, « Yogi » Adityanath, le prêtre hindou à la tête de l’Uttar Pradesh, s’en est pris à tous ceux qui avaient l’outrecuidance d’offrir aux hauts dignitaires étrangers des « répliques du Taj Mahal » ou « de minarets » qui ne sont pas en « consonance avec la culture indienne ». Depuis l’arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014, les chefs d’État étrangers évitent d’ailleurs soigneusement de visiter le Taj Mahal, encore plus de se faire prendre en photo devant.
Avneesh Awasthi, le directeur du tourisme pour l’Uttar Pradesh, a voulu désamorcer les critiques en expliquant que le guide intitulé « Tourisme en Uttar Pradesh : son haut potentiel » ne comprenait que les projets du gouvernement dans le secteur touristique. Une défense qui n’a pas vraiment convaincu, puisque le Taj Mahal est justement l’un de ces monuments indiens au « potentiel » touristique important et qu’il souffre d’un manque d’investissements.
Le mausolée de marbre blanc attire 6 millions de visiteurs chaque année et fait travailler des dizaines de milliers d’Indiens. Après avoir décimé l’industrie de la viande et du cuir – en fermant les abattoirs soupçonnés de tuer des vaches –, le gouvernement de « Yogi » Adityanath n’est sans doute pas à quelques dizaines de milliers d’emplois près.
Quels sont les lieux touristiques que le gouvernement de l’Uttar Pradesh veut promouvoir à la place du Taj Mahal ? Des fonds ont été débloqués pour appâter les touristes dans le village natal de Deendayal Upadhyay, idéologue des extrémistes hindous, grand défenseur du système des castes et ennemi du sécularisme. Pas sûr que le personnage, et encore moins la maison où il est né, attirent les foules du monde entier.
Les autorités veulent aussi promouvoir des circuits touristiques « spirituels », autour de l’épopée mythologique du Râmâyana par exemple, ou du bouddhisme – bref, autour de toutes les traditions spirituelles ayant traversé le nord de l’Inde, sauf l’islam.
Les touristes pourront, sinon, visiter un ravissant petit temple qui se trouve à une bonne dizaine d’heures de route du Taj Mahal. Laxmi Narayan Chaudhary, le ministre de la culture de l’Uttar Pradesh, en a fait la promotion lui-même : « Le Taj Mahal a été sorti du guide touristique à juste titre et devrait être remplacé par le Guru Gorakhnath Peeth. »
Malgré sa structure en marbre blanc, ou plutôt grisâtre, ce temple ne présente aucun intérêt historique ni architectural. Mais il est géré par « Yogi » Adityanath, nouveau dirigeant de l’Uttar Pradesh, et mériterait à ce titre de devenir la septième merveille du monde.
Le Taj Mahal aurait une chance de figurer dans la brochure touristique si seulement il était déclaré comme un temple hindou. Le plus sérieusement du monde, quelques extrémistes ont saisi le tribunal d’Agra afin que le Taj Mahal soit considéré comme tel. Ils prétendent que le mausolée a été construit à l’emplacement du temple Tejo Mahalaya, dédié au dieu Shiva. La justice leur a donné tort, fin septembre.
Pour les touristes intéressés par la découverte de l’extrémisme hindou plutôt que par l’architecture moghole, l’Uttar Pradesh est devenu la destination idéale. »
Les « cons ça osent tout, c’est même à cela qu’on les reconnaît. »
Ça c’est du Michel Audiard.
Mais même à Audiard on ne peut plus faire confiance, nous apprenons qu’il a écrit des choses ignobles dans les journaux collaborationnismes.
Alors contemplons la beauté du Taj Mahal

<954> -
Jeudi 19 Octobre 2017
« Dès que [Jacqueline Du Pré] commença de jouer, je fus comme hypnotisé. »Placido DomingoCette chronique quotidienne est partage.
Je ne peux partager que ce que je comprends, ce qui m’interpelle, qui résonne en moi, qui m’émeut.
Je suis né dans une famille de musiciens. Mon père, mon frère ainé en ont fait leur beau métier.
Le destin, les circonstances, mes envies ne m’ont pas conduit vers ce même chemin.
Mais la musique occupe une place essentielle dans ma vie, parce qu’elle me fait du bien, parce qu’elle me nourrit, parce qu’elle m’apaise, parce qu’elle me donne de la joie.
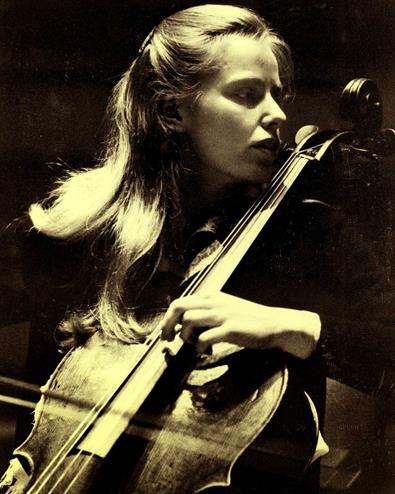 Et dans ce monde de la musique, je me suis construit un panthéon.
Et dans ce monde de la musique, je me suis construit un panthéon.
Une des plus belles places dans ce panthéon est occupée par la violoncelliste Jacqueline Du Pré.
Elle était lumineuse, passionnée, elle dégageait une émotion immédiatement perceptible.
Elle eut un destin tragique.
Elle nous a quittés il y a exactement 30 ans, le 19 octobre 1987. Elle avait 42 ans.
Mais en réalité, elle nous avait quittés bien avant. En 1971, elle avait 26 ans, ses capacités de jeu avaient entamé un déclin irréversible car l’artiste avait commencé à perdre la sensibilité et la mobilité de ses doigts. Elle a dû, alors très vite, arrêter sa carrière. Elle était atteinte de sclérose en plaques, maladie qui, par ses complications, a causé son décès.
Ce fut une comète, une musicienne extraordinairement précoce, pleine d’intensité comme si dès le début elle savait qu’elle aurait si peu de temps pour s’exprimer.
Le grand violoniste Yehudi Menuhin a dit :
« Lorsque je la regarde, lorsque je l’écoute, je me sens tout petit devant tant d’esprit, honteux de la moindre indulgence vis-à-vis de moi-même et particulièrement fier d’avoir, aussi peu que ce soit, fait de la musique avec elle. »
Et j’ai mis en exergue ce propos du chanteur Placido Domingo :
« Dès qu’elle commença de jouer, je fus comme hypnotisé. J’ai été immédiatement convaincu par sa maîtrise, sa concentration, qui faisait chanter son violoncelle comme je n’en ai entendu chanter aucun autre. »
Vous trouverez sur Youtube <Cette interprétation magistrale du Concerto d’Elgar>.
Et puis, réalisé par Christopher Nuppen un reportage et un concert extraordinaire où 5 jeunes artistes dont Jacqueline Du Pré interprètent la plus belle version du <quintette la Truite de Schubert>
Et si vous voulez des propositions de CD, j’en propose deux :
Et je finirai par une rose, car le nom de Jacqueline Du Pré a été donné à une rose :

<Vous trouverez plus de précisions derrière ce lien>
<953>
-
Mercredi 18 octobre 2017
«Notre rôle est encore plus important quand le système légal ne remplit pas sa mission auprès des vulnérables confrontés aux puissants. Souvent les femmes ne peuvent pas ou ne veulent pas porter plainte. » Ronan FarrowRonan FarrowRonan Farrow est l’auteur de l’enquête de dix mois, publiée dans le New Yorker, qui a provoqué la chute du producteur de Hollywood : Harvey Weinstein.
Ronan Farrow est le fils de Woody Allen et Mia Farrow, ce qui explique sans doute pour partie, selon la correspondante du Monde à San Francisco, Corine Lesnes, la facilité avec laquelle les victimes se sont confiées à lui.
Dans l’Express on peut lire :
« [Ronan Farrow] n’est pas le premier à raconter l’envers fétide du rêve hollywoodien. Mais pour lui, c’est une affaire de famille. Celle d’un père prestigieux, Woody Allen, dont il ne cesse de dénoncer, de tweets en tribunes ou en plateaux télé, les dérapages sexuels, notamment commis selon lui aux dépens de sa soeur, Dylan Farrow. Et s’il voue une rancune particulière au milieu du cinéma, s’il l’observe avec une telle défiance et y a plongé ses antennes, c’est parce que le tout Hollywood a pris fait et cause pour son père au moment de son divorce d’avec sa mère, la non moins prestigieuse Mia Farrow.
[Rappel des faits] : en 1997, après 12 ans de mariage, Mia Farrow et Woody Allen se séparent, dans une ambiance électrique. Le réalisateur a quitté la mère pour épouser sa fille, Soon-Yi Previn, que Mia Farrow a adopté avec son mari précédent, le chef d’orchestre André Previn.
L’affaire déchire les Etats-Unis, les proches du couple et la famille elle-même. Les uns prennent parti pour Woody Allen, les autres pour l’épouse trahie et abandonnée. Parmi les premiers, une grande majorité des comédiens, metteurs en scènes et producteurs américains. Parmi les seconds, Ronan Farrow, qui ne leur pardonnera jamais, pas plus qu’il ne pardonnera à son père.
[…] Depuis le divorce, Ronan Farrow est le plus acharné détracteur de son père officiel. En 2012, pour la fête des pères, il poste sur twitter ce commentaire corrosif: « Bonne fête des pères. Ou, comme on dit dans ma famille, bonne fête des beaux-frères » – ce qu’est devenu Woody Allen pour lui en se mariant à sa demi-soeur.
Comme lorsque, avocat fraîchement émoulu de la Yale Law School, il défendait à l’Unicef les droits des femmes et des enfants au Darfour, puis auprès du couple Obama au Pakistan et en Afghanistan, c’est donc sans doute à son histoire familiale que Ronan Farrow doit son irrépressible besoin de dénoncer les abus de pouvoir des obsédés sexuels d’Hollywood.
Bizarrement, sa dernière croisade, comme journaliste de luxe pour la chaîne de télévision MSNBC ou le très chic magazine New Yorker, lui a causé plus de désagréments que tous ses engagements précédents réunis. En s’attaquant au « mogul » Weinstein, il a dû résister à la pression de la très efficace machine à dissimuler les scandales lancée contre lui par l’industrie cinématographique américaine. Celle-là même qui, jusqu’à très récemment, en les achetant ou en les menaçant, avait privé de parole les nombreuse victimes du baron pervers d’Hollywood. »
Une autre affaire de famille que ce mariage entre Woody Allen et sa fille adoptive qui constitue selon la morale commune un inceste, oppose Rian Farrow et son père.
Une autre fille adoptive de Woody Allen et Mia Farrow, Dylan Farrow accuse son père d’avoir pratiqué des attouchements sexuels à son encontre, à l’âge de 7 ans et de l’avoir violé.
Nous lisons dans le Figaro :
« Ces mêmes agissements qui dénoncent Dylan Farrow, sa sœur et l’autre fille adoptive du réalisateur. Celle-ci avait décrit dans Vanity Fair des scènes d’attouchements causées par son père lorsqu’elle avait sept ans.
En 2014, Ron joue d’ailleurs les trouble-fête lors de la cérémonie des Golden Globes, qui récompense alors son père pour l’ensemble de carrière. Il publie ce tweet cinglant: «J’ai raté l’hommage à Woody Allen. Ont-ils évoqué la fois où une femme a publiquement confirmé qu’il l’avait agressée à 7 ans avant ou après avoir cité Annie Hall?». L’affaire atteint son paroxysme avec la publication, un mois plus tard, d’une lettre ouverte de Dylan Farrow qui affirme publiquement avoir bel et bien été violée par son père.
Dans une tribune publiée dans le Hollywood Reporter en mai 2015, juste avant l’ouverture du festival de Cannes assurée par le cinéaste avec L’Homme irrationnel, Ronan Farrow dénonce la «culture du silence et de l’impunité qui entoure son père». Il s’attaque aussi aux médias, incapables selon lui de révéler la vérité au grand jour.
«Ce soir, écrit-il alors, le Festival de Cannes s’ouvre avec un nouveau film de Woody Allen. Il sera entouré de stars, mais ils peuvent tous être tranquilles et faire confiance à la presse pour ne pas leur poser de questions dérangeantes. Ce n’est pas le moment, ce n’est pas l’endroit, ça ne se fait pas.»
Il faut rester prudent, Woody Allen a toujours nié les faits de viol contre Dylan Farrow et il n’a pas été prouvé qu’il a réellement pratiqué ces actes. Il ne peut être définitivement écarté que ces accusations aient été « fabriquées » par le clan Mia Farrow après la première transgression de Woody Allen qui a épousé la fille adoptive de sa compagne.
Dans le monde cependant, Ronan Farrow estime que la presse ne saurait s’exonérer de l’écoute des victimes au motif qu’il n’y a pas de plainte.
« Notre rôle est encore plus important quand le système légal ne remplit pas sa mission auprès des vulnérables confrontés aux puissants, écrit-il. Souvent les femmes ne peuvent pas ou ne veulent pas porter plainte. Le rôle d’un reporter est celui de porteur d’eau pour elles. »
Selon lui, une nouvelle génération de médias, « libérés des années de journalisme d’accès », commence à enquêter sur les agressions sexuelles commises par les « moguls » d’Hollywood ou d’ailleurs. « Les choses changent », assure-t-il.
Il y a peu, un échange avec mon ami Albert rappelait aussi les actes de viol de Roman Polanski à l’égard de femmes mineures. Ils continuent à jouir de la plus grande estime des milieux culturels français.
Il est essentiel de sortir de cette culture de l’impunité et de la culture du viol qui est resté longtemps une réalité tue et niée.
<952>
-
Mardi 17 octobre 2017
« Notre rencontre fut celle d’un homme et d’une statue »Pablo NerudaPablo Neruda est un des plus grands écrivains de l’histoire d’Amérique du sud. Il obtient le Prix Nobel de littérature le 21 octobre 1971. Homme de gauche, il soutint Salvador Allende et mourut le 23 septembre 1973, 12 jours après le coup d’état qui renversa le gouvernement légitime du Chili. Certains soutiennent la thèse qu’il a été assassiné par une injection létale pendant un séjour à l’hôpital pour soigner son cancer de la prostate.
C’est une référence dans le camp de celles et ceux qui se réclament de gauche ou du camp du progrès pour prendre une terminologie actuelle.
Il a écrit un livre autobiographique « J’avoue que j’ai vécu » qui est paru en 1974, à titre posthume.
Dans ce livre, « l’homme moyen », Pablo Neruda raconte un fait :
« Mon bungalow était situé à l’écart de toute vie urbaine. Le jour où je le louai j’essayai de savoir où se trouvaient les lieux d’aisances, que je ne voyais nulle part. En effet, ils se cachaient loin de la douche, vers le fond de la maison.
Je les examinai avec curiosité. Une caisse de bois percée d’un trou en son milieu les constituait, et je revis l’édicule de mon enfance paysanne, au Chili. Mais là-bas les planches surmontaient un puits profond ou un ruisseau. Ici la fosse se réduisait à un simple seau de métal sous le trou rond.
Chaque jour, par je ne savais quel mystère, je retrouvais le seau miraculeusement propre. Or un matin où je m’étais levé plus tôt qu’à l’accoutumée, le spectacle qui s’offrit à moi me confondit.
Par le fond de la maison et pareille à une noire statue en mouvement, je vis entrer la femme la plus belle que j’eusse aperçue jusqu’alors à Ceylan, une Tamoul de la caste des parias. Un sari rouge et or de toile grossière l’enveloppait. De lourds anneaux entouraient ses pieds nus. Sur chacune de ses narines brillaient de petits points rouges, verroteries ordinaires sans doute mais qui prenait sur elle des allures de rubis.
D’un pas solennel elle se dirigea vers les cabinets, sans me regarder ni même avoir l’air de remarquer mon existence, conservant sa démarche de déesse, s’éloigna et disparut avec sur la tête le sordide réceptacle.
Elle était si belle qu’oubliant son humble fonction, je me mis à penser à elle. Comme s’il se fût agi d’une bête sauvage, d’un animal venu de la jungle, elle appartenait à un autre monde, à un monde à part. Je l’appelais sans résultat. Plus tard, il arriva de lui laisser sur son chemin un petit cadeau, une soierie ou un fruit. Elle passait indifférente. Sa sombre beauté avait transformé ce trajet misérable en cérémonie obligatoire pour reine insensible.
Un matin, décidé à tout, je l’attrapais avec force par le poignet et la regardait droit dans les yeux. Je ne disposais d’aucune langue pour lui parler. Elle se laissa entraîner sans un sourire et fut bientôt nue sur mon lit. Sa taille mince, ces hanches pleines, les coupes débordantes de ses seins l’assimilaient aux sculptures millénaires du sud de l’Inde. Notre rencontre fut celle d’un homme et d’une statue. Elle resta tout le temps les yeux ouverts, impassible. Elle avait raison de me mépriser. L’expérience ne se répéta pas. »
Pages 151 et 152 dans la collection Folio
Que raconte cet épisode ?
C’est un viol, c’est un crime !
Les deux dernières phrases semblent indiquer que Pablo Neruda n’est pas très fier de ce qu’il a fait.
Mais ce qu’il exprime, dans cette modeste contrition, pourrait se comprendre si voyant un gâteau particulièrement appétissant, il l’avait volé et mangé sans le payer.
Nous ne sommes pas ici, à ce niveau de « chapardage ».
Il raconte tranquillement son crime, il a violé cette pauvre femme qui n’a pas réagi devant cet homme blanc comme une esclave devant son maître.
Et Pablo Neruda ne se rend absolument pas compte de l’immensité de sa faute.
C’est cela la « culture du viol », il n’y a pas de juste appréciation de l’acte, un vague remord d’être allé un peu trop loin.
La rencontre d’un homme et d’une statue… d’un objet.
C’est cela aussi le viol, réduire dans son comportement la femme à un objet de plaisir.
Après avoir subi ce crime, qu’est devenue cette femme ?
Comment vit-on dans sa culture quand on est une femme et qu’on a été violée ?
<951>
-
Lundi 16 octobre 2017
« La zone grise du consentement et la culture du viol»Jean-Raphaël Bourge, chercheur à Paris-VIIITous nos journaux sont pleins du scandale du producteur Harvey Weinstein qui était tout puissant à Hollywood et qui en profitait pour contraindre des actrices à des relations sexuelles dont elles ne voulaient pas.
Ce scandale éclabousse beaucoup de monde, Barack Obama qui a accepté le soutien financier du prédateur, la France qui lui a décerné la légion d’honneur.
Ces contraintes, ces actes non consentis sont des viols, le viol est un crime.
Mais certains introduisent la notion de « zone grise du consentement ». Je vous rappelle que concernant le viol de la jeune enfant de 11 ans que j’ai évoqué le mercredi 27 septembre, les policiers et le procureur n’ont pas voulu utiliser ce terme approprié parce que le refus de l’enfant n’était pas explicite, c’est au cœur de cette « zone grise ». Le producteur prédateur peut aussi tenter cette défense devant des femmes qui attendaient de lui d’obtenir le rôle qui les rendrait célèbre et n’osaient pas repousser cet homme si puissant.
Des journaux libèrent la parole pour mettre des mots derrière cette réalité que le male de l’espèce homo sapiens a un problème de comportement à l’égard de son alter ego féminin.
Le site Rue 89 publie un article très instructif : « J’ai fini par céder » > :
L’article décrit d’abord un évènement qui ne peut avoir d’autre qualification que « viol »
Mais, étant donné des siècles de culture et de culpabilisation de la femme, souvent les femmes ont du mal à définir le fait par les termes appropriés :
« Pour elle, ce ne sont pas des viols, « plutôt des énormes malentendus » avec « des gens qui n’étaient pas violents, plutôt très axés sur eux et qui ne se posaient pas la question de mon consentement ».
Un problème de consentement ! Oui c’est tout à fait cela, mais en agissant ainsi l’agresseur renvoie la victime à un statut d’objet et cela est un crime !
Et la femme qui a été victime du viol cité ci-avant, racontait cette histoire en rigolant et avec une bonne dose de culpabilité :
« Ils devaient se dire ‘tant qu’elle est là dans mon lit c’est open bar’, et je n’ai pas bataillé beaucoup pour le convaincre de l’inverse. Parce que je me disais ‘ça va être chiant, il va gueuler’, etc. »
Les journalistes ont alors lancé un appel à témoignage et exploré le concept de « la zone grise du consentement ». Les journalistes expliquent très justement :
« Disons-le tout de suite. Ce terme nous pose un problème, car il sous-entend que le consentement est quelque chose de compliqué, alors que quand ce n’est pas oui, c’est non. On a utilisé ce terme parce que si on avait sollicité des témoignages de viols, tous ces cas considérés comme limites, flous, auraient été passés sous silence. Plus de 200 histoires nous sont parvenues, écrites dans une écrasante majorité par des femmes, dans des relations hétéros. »
Et beaucoup des témoignages recueillis ont du mal à mettre le mot « viol » sur les faits racontés, elles inventent même un concept paradoxal : « viol consenti ».
L’article explique très justement :
« On ne le dit peut-être pas assez : un viol n’est pas qu’un acte sexuel imposé face auquel la victime a crié « non ». Il peut y avoir viol sans manifestation explicite d’un refus, parce que la victime est paralysée par ce qui lui arrive, inconsciente ou pas en état de donner un consentement éclairé (droguée, alcoolisée…). Ce qui compte pour la justice est le consentement au moment des faits (et pas deux heures avant).
Un viol n’est pas non plus ce qu’en dit l’imaginaire collectif (une ruelle sombre ou un parking souterrain, par un inconnu menaçant d’un couteau). 83% des femmes victimes de viol ou de tentative de viol connaissent leur agresseur. »
La zone grise du consentement est avant tout un leurre, une supercherie utilisée pour obtenir une sorte de « circonstance atténuante ».
La zone grise, en creux, nous amène à la méconnaissance qui entoure la définition du viol et de sa représentation.
Jean-Raphaël Bourge, chercheur à Paris-VIII qui travaille sur le consentement sexuel, parle d’une « zone de refuge pour les violeurs, qui s’abritent derrière une ambiguïté ».
Pour [lui], la véritable « zone grise », ce flou du consentement concerne des « cas très rares », « mais elle est considérablement étendue par ceux qui veulent empêcher les femmes de disposer de leur corps, et on la laisse exister en rendant par exemple très difficile le fait de porter plainte pour viol ». Car la « zone grise » profite à la « culture du viol », et la nourrit.
« J’en ai tellement marre des zones grises », lâche la réalisatrice féministe Lena Dunham, dans un génial épisode de la saison 6 de « Girls », illustrant la culture du viol.
Nous sommes dans une mystification qui s’inscrit dans ce que ce chercheur appelle : « la culture du viol »
Pour illustrer la culture du viol, Jean-Raphaël Bourge parle des manuels d’éducation à la sexualité du XIXe siècle, où on conseillait aux femmes « de résister pour mieux céder ». Citons aussi le porno ou les scènes de film et de série où « la fille finit par céder sous les baisers de son agresseur… hum… séducteur ».
L’article est intéressant, détaillé et s’appuie sur de nombreux témoignages pour vider de sa substance cette zone grise du consentement pour en arriver à une conclusion qui me semble simple et pertinente :
« Qui ne dit mot ne consent pas !
Au moindre doute sur les envies de l’autre, ce n’est pas compliqué : il faut poser la question. »
Les journalistes qui ont écrit <cet article> sont Emilie Brouze et Alice Maruani
Et puis, il faut toujours revenir à la définition d’un homme donné par le père d’Albert Camus : «Non, un homme ça s’empêche. Voilà ce qu’est un homme, ou sinon… »
<950>
-
Vendredi 13 octobre 2017
« Un anniversaire »Retour annuel d’un jour marqué par un événementAvant qu’homo sapiens puisse fêter un anniversaire, il a fallu qu’il invente plusieurs choses.
- Il lui fallait d’abord la capacité de décrire le temps dans une période cyclique. Le cycle de l’année qui accompagne une rotation complète de la planète des homos sapiens autour de son étoile constitue la première pierre de cet édifice.
- Il fallait ensuite être capable de décrire un cycle par petites périodes repérables et identifiées. Le jour, période pendant laquelle la terre tourne autour d’elle-même fut la seconde pierre.
- Et la troisième pierre est constituée par la capacité à marquer un évènement dans le calendrier ainsi créé. Cette dernière faculté nécessitait la création de l’écriture.
L’étymologie illustre parfaitement le sens d’anniversaire. C’est encore un mot qui vient du latin anniversarius (« qui revient tous les ans »), formé de annus (« année »), et de versus participe passé du verbe vertere (« revenir »).
On fête l’anniversaire d’un évènement, cet évènement peut être une naissance.
Depuis quand fête t’on les anniversaires ?
On apprend sur cette page du CNRS que :
Plutarque raconte qu’après la bataille de Platée les guerriers morts ayant été enterrés sur le lieu du combat, les platéens s’étaient engagés à leur offrir chaque année le repas funèbre. En conséquence, au jour anniversaire, ils se rendaient en grande procession, conduits par leurs premiers magistrats, vers le tertre sous lequel reposaient les morts. (Fustel de Coulanges, La Cité antique,1864, p. 14.)
* Platée fut une bataille des guerres entre les grecs et les perses appelés guerres médiques et eut lieu en 479 avant JC.
Wikipedia fait référence à la bible pour montrer que dans ce livre des monothéismes, il est question d’anniversaire.
Ainsi dans l’Ancien Testament, un festin d’anniversaire est cité en Genèse 40, 20, dans l’histoire de Joseph :
« Et il arriva, le troisième jour, jour de la naissance du Pharaon, qu’il fit un festin à tous ses serviteurs ; et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs : il le rétablit dans son office d’échanson(…). Mais le chef des panetiers, il le pendit. »
Dans le Nouveau Testament, un festin d’anniversaire est cité en Marc 6, 21 quand la fille d’Hérodiade obtient la tête de Jean le Baptiste :
« Or vint un jour propice, quand Hérode, à l’anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée : – la fille d’Hérodiade entra et dansa, et plut tant à Hérode qu’il promit avec serment de lui donner ce qu’elle demanderait. Et elle de dire, endoctrinée par sa mère: ‘Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste.’ (…) il envoya décapiter Jean dans la prison. »
C’est l’histoire dont Oscar Wilde fit la pièce de théâtre « Salomé » et Richard Strauss un opéra. Mais, en France c’est à partir de la révolution et de l’institution du registre d’état civil que l’on a vraiment commencé pour le commun des mortels de connaître avec précision la date de naissance et qu’on a pu fêter l’anniversaire de chacun. Certains, diront mais avant le registre d’état civil, il y avait les registres des églises. Mais le registre des églises enregistrait le baptême, non la naissance. D’ailleurs, avant le registre d’état civil, le commun des mortels fêtait plutôt le jour du Saint dont il portait le prénom et qu’on appelle encore aujourd’hui «la fête». Le 13 octobre correspond à la Saint Édouard, c’est donc la fête de tous les Édouard.
2017, est une année particulièrement féconde en anniversaires d’évènements de dizaines, voire de centaines d’années :
- Il y a quelques jours, on commémorait l’anniversaire des 50 ans de l’exécution du Che le 9 octobre 1967 à la Higuera, Bolivie
- Et puis il y a la date anniversaire des 100 ans de la révolution bolchevique, la révolution d’octobre qui a eu lieu selon notre calendrier le 7 novembre 1917
- Le 7 janvier 1957 a eu lieu le début de la bataille d’Alger.
- Et puis nous fêterons aussi les 500 ans de la Réforme sur laquelle je reviendrai bientôt plus longuement.
J’ai trouvé taquin d’écrire ce mot sur « un anniversaire » le 13 octobre puisque c’est le jour où je suis né, en 1958.
Je partage cette caractéristique avec Margaret Thatcher (1925), mais aussi Yves Montand (1921) et Raymond Kopa (1931).
J’ai aussi eu la joie, lorsque j’étais à Bercy de travailler avec la pétillante et sympathique Chantal qui est née le même jour que moi, un peu plus tard et qui parfois lit ce mot.
Je souhaite donc un bon anniversaire à Chantal.
<949>
- Il lui fallait d’abord la capacité de décrire le temps dans une période cyclique. Le cycle de l’année qui accompagne une rotation complète de la planète des homos sapiens autour de son étoile constitue la première pierre de cet édifice.
-
Jeudi 12 octobre 2017
«Le Syndrome du bien-être»,Carl Cederström et André Spicer,« Le syndrome du bien-être » est un livre de Carl Cederström et André Spicer qui a été publié, traduit de l’anglais, aux éditions de l’Echappée.
A priori ce livre et les questions qu’ils posent prennent plutôt à rebrousse-poil beaucoup de thèmes que j’ai évoqués lors de mes mots du jour.
En effet, je suis plutôt sensible à privilégier le bien-être, une alimentation saine et une hygiène de vie susceptibles d’avoir des conséquences bénéfiques sur notre santé, notre espérance de vie et une vieillesse aussi sereine que possible avant que notre corps se retrouve dans son destin de la finitude.
Mais il est fécond d’entendre et d’essayer de comprendre des points de vue divergents. Cette méthode que j’ai appelée prosaïquement « tourner autour du pot » pour examiner le pot sous tous ces aspects.
Tournons donc autour du pot du « bien-être » avec Carl Cedestrom et André Spicer.
Les révélations commencent toujours par une expérience fondatrice. Nous savons que Paul Claudel a eu la révélation de la Foi chrétienne un soir de Noël alors qu’il assistait à une messe dans notre Notre Dame de Paris.
Carl Cederström raconte sa révélation de ce que j’appellerai « le côté obscur du bien-être » dans le récit suivant :
« Un beau matin, Carl Cederström allume tranquillement sa cigarette en attendant le bus. Assise sur un banc voisin, son petit chien tenu en laisse, une dame l’apostrophe en lui reprochant d’intoxiquer son animal de compagnie avec sa fumée. Pour le chercheur suédois, enseignant à la Stockholm Business School et spécialisé dans l’étude du contrôle social et de la souffrance au travail, c’en est trop. Ses voisins sont antitabac, ses amis désertent l’heure de l’apéro pour aller au fitness et ses collègues mangent sans gluten tout en méditant»
A partir de ce moment fondateur il va s’interroger avec son confrère André Spicer, professeur à la prestigieuse Cass Business School, à Londres sur ce qu’il estime être un «culte du bien-être».
Le journal suisse Le Temps développe l’analyse suivante :
« L’ouvrage part d’un constat quelque peu commun: notre société a érigé la santé au rang de valeur primordiale. Il vaudrait mieux arrêter de fumer, diminuer sa consommation d’alcool, manger cinq fruits et légumes par jour, éviter les graisses et cuisiner des aliments sains riches en vitamines. Il faut aussi faire du sport, car c’est bon pour la forme, pour l’équilibre et contre le stress. L’image d’une personne saine et mince qui fait son jogging tous les matins est érigée en modèle, et tous ceux qui n’atteindraient pas cet idéal, notamment les obèses, sont soupçonnés de manquer d’hygiène, d’être paresseux, voire incapables de se prendre en main.
Si, en soi, être en forme et bien dans son corps est un objectif louable, les deux auteurs montrent que la tendance a dégénéré en une forme d’injonction morale dont il devient très difficile de se libérer.
Aux Etats-Unis, une douzaine d’universités font désormais signer à leurs étudiants des «contrats de bien-être», dans lesquels ils s’engagent à avoir une hygiène de vie impeccable.
Rassurant pour leurs parents, sans aucun doute. Mais dommage pour ces jeunes gens muselés, car ce sont bien les erreurs qui forment la jeunesse, rappelle Carl Cederström.
Sur le site de Libération Virginie Ballet a publié un article « Le bien-être fait suer »
Elle précise que les auteurs ne sont pas des illuminés qui ne se préoccupent pas de leur santé :
« Evidemment, il n’y a aucun mal à être en bonne santé. Ce qui coince selon eux ? «S’occuper de son bien-être est devenu une obligation morale qui s’impose à chacun d’entre nous.» Il y aurait même une «logique à l’œuvre partout, dictant aussi bien notre façon de travailler et de vivre, que d’étudier et de faire l’amour.» Au secours, les gourous du bonheur prolifèrent, et ils pourraient bien faire des dégâts, avertissent les auteurs. »
Le site slate.fr publie un article sur le même sujet : Pour être heureux oubliez vous ! » .
Il va plus loin dans l’analyse de la problématique qui tend à démontrer que le culte de la poursuite du bien-être est un déclencheur d’angoisse :
Pour les auteurs du Syndrome du bien-être, le meilleur indice que celui-ci n’est plus une option personnelle mais s’est mué en morale se lit d’ailleurs dans la culpabilité attachée aux comportements «déviants». Ce n’est plus la sexualité qui fait l’objet de réprobations et fait naître la culpabilité, mais plutôt les atteintes au capital physique comme le fait de fumer, de boire, de manger gras ou sucré, de ne pas faire d’exercice ou d’être confronté à des idées négatives alors qu’on devrait se sentir bien, s’aimer soi-même et être à l’écoute de ses émotions…
Carl Cedeström et André Spicer s’inquiètent, à la suite d’une longue lignée d’auteurs critiques des dérives de l’individualisme radical, d’un paradoxe apparent de la recherche frénétique de l’état de bien-être: «loin de produire les effets bénéfiques vantés tous azimuts», cet investissement dans notre moi profond «provoque un sentiment de mal-être et participe du repli sur soi.
[…] Le syndrome du bien-être résulte pour une grande part de la croyance selon laquelle nous sommes des individus autonomes, forts et résolus, qui devons-nous efforcer de nous perfectionner sans relâche. Or c’est précisément le fait d’entretenir cette croyance qui entraîne l’émergence de sentiments de culpabilité et d’angoisse.»
Un étrange phénomène de rétroaction s’est mis en marche: l’anxiété augmente à mesure que les professionnels censés nous en débarrasser se multiplient. Rien de surprenant dans la mesure où la mécanique de la quête du bien-être et de ses médiateurs consiste à rendre le client, le lecteur, l’auditeur, le coaché ou le patient «responsable de son propre bonheur» et donc, comme mécaniquement, de son échec à y parvenir.
«Le revers de la médaille est que celui-ci doit dorénavant se sentir coupable chaque fois qu’un problème survient dans sa vie: rupture amoureuse, perte d’emploi ou maladie grave. Accéder au bonheur relèverait donc d’un choix: le nôtre, et, par extension, engagerait notre responsabilité. Par ce qu’elle comporte de déplaisant, une telle prise de conscience ne peut que faire naître un sentiment d’intense anxiété chez l’individu.»
A ce stade, je suis modérément convaincu. Pour ma part je trouve intelligent d’en appeler à la responsabilité des individus pour s’occuper de leur santé et de ce que j’appellerais leur « paix intérieure ». Je vois trop dans mon expérience de vie cette facilité utilisée par beaucoup de désigner des boucs émissaires pour expliquer toutes leurs difficultés et expériences négatives, sans jamais interroger leur propre responsabilité.
C’est pourquoi dans la vie personnelle, je suis assez rétif devant les développements de ces deux intellectuels.
En revanche, quand ils évoquent le monde de l’entreprise et concluent, sous l’apparence de la modernité, au triomphe sans partage du néo-libéralisme je deviens beaucoup plus réceptif à leurs arguments :
Libération explique :
« Et puis il y a surtout ces entreprises, de plus en plus nombreuses, qui s’immiscent dans la santé de leurs salariés, et où est récemment apparue la fonction de «directeur du bonheur» (le service public fédéral de la sécurité sociale belge dispose par exemple de l’une de ces créatures). Près de la moitié des boîtes américaines de plus de 50 salariés disposeraient ainsi d’un programme pour l’hygiène de vie des employés. Ainsi, chez Google, on pratique la méditation depuis la fin des années 90 lors d’ateliers baptisés «search inside yourself» («cherchez à l’intérieur de vous»). Certaines cantines font appel à des chefs spécialistes de la nourriture saine. »
Et le journal « Le Temps » évoque :
Tout en poussant les salariés à travailler le plus possible, dans des conditions de plus en plus précaires, les firmes leur proposent des séances de méditation en pleine conscience afin de se détendre, ou leur installent des tapis de course au bureau, pour pianoter sur l’écran tout en perdant des calories. Cette tendance gagne depuis plusieurs années les bords du Léman, où les multinationales encouragent leurs salariés à manger des légumes et pratiquer régulièrement du sport.
Une hypocrisie totale, expliquent Carl Cederström et André Spicer, qui n’hésitent pas à en référer à Orwell pour décrire ce monde où l’homme doit être le plus performant possible, tout en gardant le sourire. Pour une raison simple: «Un travailleur heureux est un travailleur plus productif»!
En Angleterre, l’entreprise suédoise de poids lourds Scania surveille les constantes vitales de ses employés 24h/24. Ceux-ci sont pénalisés s’ils ne font pas assez d’exercice et si leur système cardiovasculaire est un peu à la traîne. Il y a quelques jours, la société d’assurance américaine Aetna annonçait fièrement offrir des bracelets connectés Fitbit à ses salariés. «S’ils prouvent qu’ils enchaînent 20 nuits de 7 heures de sommeil ou plus, nous leur offrirons 25 dollars par nuit, plafonnés à 500 dollars par an», a déclaré son PDG Mark Bertolini.
[…] Le fonds d’investissement américain GLG Partners a mis en place un programme qui analyse les heures de sommeil ou l’alimentation de ses traders. Le syndicat des enseignants de Chicago soumet ses membres à un suivi personnalisé les contraignant à surveiller leur cholestérol et à pratiquer une activité sportive, sous peine de quoi ils doivent payer une amende de 600 dollars…»
Libération précise concernant le fond d’investissement :
Ce hedge fund (fonds d’investissement spéculatif) qui a mis au point un programme pour surveiller de près le sommeil et les assiettes de ses traders. En cas d’anomalie ou de performances moyennes, des séances de coaching leur sont proposées. «Actuellement, si nous nous maintenons en bonne santé, c’est parce que nous associons cela à tout un tas d’autres qualités, comme être un bon employé, dynamique, explique Cederström. On attend de nous que nous mettions à profit chaque moment pour être plus productifs, et que nous prétendions y éprouver du plaisir.»
L’article de Slate montre la supercherie de cette démarche à l’intérieur des entreprises dans un marché de l’emploi de plus en plus précarisé.
Si cet égoïsme pouvait au moins les rendre heureux, on pourrait en discuter. Selon les chasseurs de mythes du «syndrome du bien-être», il n’en est rien. Et pour cause. Ce n’est pas parce qu’on décide de devenir indifférent aux pressions du monde extérieur que celui-ci nous laisse tranquille en retour. C’est pourquoi vouloir gérer le mal-être au travail par la pratique de la méditation, comme cela est encouragé dans certaines entreprises, risque d’entraîner de grandes désillusions. Ces méthodes «ne traite[nt] jamais le stress, l’angoisse ou la dépression comme des troubles résultant de [notre] cadre de travail […] Si nous éprouvons du stress parce que nous croulons sous le travail, ou si nous ne sommes pas rassurés quant à l’issue du prochain plan de restructuration de notre entreprise, nous n’avons qu’à chasser toutes nos pensées négatives, respirer profondément et nous concentrer sur nous-mêmes. Et le tour est joué !», moquent-ils à propos des guides de conduite de développement personnel, qui placent l’individu souverain et sa volonté toute puissante au centre de la vie sociale.
Cette évolution est d’autant plus cynique que, plus le marché du travail se précarise, plus il semble que le «jargon positif» qui valorise l’authenticité, la créativité et l’individualité au travail se popularise dans les entreprises, les cabinets de recrutement, les livres de management sur le bonheur et même les agences de recherche d’emploi. Plus vulnérable que jamais sur un marché incertain ou le travail est en rareté, les salariés doivent «dissimuler leurs peurs et renvoyer en permanence une image positive d’eux-mêmes.»
Et puis, il y a une autre dérive dans cette quête « néo libérale » du bien-être, c’est que l’Etat abandonne de plus en plus la santé publique aux entreprises privées et cette dérive a pour conséquence de creuser de plus en plus la faille entre les riches qui peuvent se payer les outils du bien-être alors que les autres en sont privés toujours davantage :
« Une idéologie très dangereuse, insiste Carl Cederström au téléphone. «Car dire cela, c’est oublier que la santé est avant tout une affaire publique et politique, explique le chercheur. Toutes les études montrent que les classes défavorisées ont moins la possibilité de manger sainement. En stigmatisant les obèses, l’Etat ne joue pas son rôle. De même, faire croire aux chômeurs qu’ils peuvent trouver du travail en mincissant, en faisant un joli CV et en suivant des formations contre le stress est un mensonge. La vérité, c’est que l’industrie du bien-être est encore un domaine réservé aux riches.» Et de qualifier de «stupide» le projet du républicain Paul Ryan, aux Etats-Unis, qui proposait aux pauvres d’engager des coachs de vie en contrepartie des aides sociales. »
Slate en revient à une analyse marxiste des auteurs :
En bons marxistes, les auteurs voient dans cet investissement du corps et ce repli sur soi «des solutions séduisantes et auxquelles de plus en plus de gens ont recours pour ne plus avoir à se préoccuper du monde qui les entoure.» Le syndrome du bien-être serait l’autre nom de l’effondrement des espoirs collectifs de changement social, un tournant associé aux désillusions politiques et au refuge dans les pratiques new age de la génération des années 1970.
«Pendant ce temps, qu’advient-il du reste de la population –sous-entendu celle qui ne peut pas se payer le luxe de boire des smoothies frais tous les matins, de faire appel aux services d’un coach minceur ou de prendre des cours particuliers de yoga?»
[…] «Le syndrome du bien-être ne fera que renforcer le fossé entre riches et pauvres, avertit Cederström. Tous ces nouveaux produits sains, ces retraites de yoga, sont destinés aux riches, qui sont plus prompts à être déjà en bonne santé.»
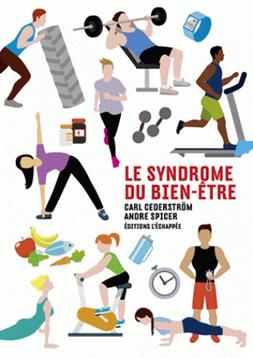 En conclusion, Carl Cederström estime :
En conclusion, Carl Cederström estime :
«Le monde se porterait mieux sans ces gourous du bonheur [qui] font fortune sur le malheur des autres».
Et l’article du Temps poursuit :
Loin d’être un livre léger, Le Syndrome du bien-être dresse au fil des pages un constat glaçant. Mis sous pression, l’individu se sent coupable s’il ne parvient pas à dompter son corps. Pour les deux chercheurs, le culte de la santé tient de l’ultralibéralisme: l’homme est seul responsable de son état – sous-entendu de ses performances. S’il échoue à mincir, à courir, à se muscler et à faire du yoga, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même.
[…] S’ils n’étaient pas réels, ces exemples pourraient bien passer pour de la science-fiction. Les auteurs sont implacables: «Surveiller sa vie comme s’il s’agissait d’une véritable entreprise correspond en tout point de vue à la mentalité de l’agent idéal du néolibéralisme.»
[…]Carl Cederström voit-il une solution à la dérive du bien-être? «Il faut juste que ça s’arrête, conclut-il.
Si vous voyez un coach dans votre entreprise vanter les effets de la psychologie positive, dites-lui que c’est du n’importe quoi.» La «quête paranoïaque du bonheur» est une fausse piste.
Encore un long mot du jour mais qui me semble fécond car il illustre, comme je l’ai écrit au début de ce mot, « le côté obscur de la chose ». Le monde n’est pas écrit en blanc et noir, rien n’est simple et certainement pas l’injonction du bien être qu’on nous assène dans le monde professionnel et probablement aussi dans notre vie personnelle.
J’ai tiré le contenu de ce mot du jour de ces trois articles :
http://next.liberation.fr/culture-next/2016/05/18/le-bien-etre-fait-suer_1453485
http://www.slate.fr/story/118467/etre-heureux-oubliez-vous
<948>
-
Mercredi 11 octobre 2017
« Sur les modifications des nuages »Luke HowardUn scientifique, Lamarck, avait proposé de nommer les nuages « diablotins », « coureurs », « demi-terminés ». Mais ce ne sont pas ces désignations qui ont été retenues.
Je ne le savais pas, mais la chronique d’Aurélien Bellanger du 6 octobre, sur France Culture le matin, me l’a appris.
C’est un anglais Luke Howard (1772-1864) qui a inventé le nom des nuages.
C’était un pharmacien et aussi un météorologue amateur. Cet homme leur a donné des noms, les noms que nous connaissons :

CUMULUS : Un cumulus (du latin cumulus «amas»), est un nuage de forme boursouflée appartenant à l’étage inférieur (base : 2 km d’altitude) mais peut s’élever jusqu’à l’étage moyen et atteindre ainsi plusieurs kilomètres d’épaisseur. Voir sur Wikipedia.
 STRATUS : Un stratus est un genre de nuage bas dont la base se trouve à des altitudes inférieures à quelques centaines de mètres. Lorsque cette base touche le sol, cela correspond à du brouillard. Voir sur Wikipedia
STRATUS : Un stratus est un genre de nuage bas dont la base se trouve à des altitudes inférieures à quelques centaines de mètres. Lorsque cette base touche le sol, cela correspond à du brouillard. Voir sur Wikipedia

CIRRUS : Le cirrus est un genre de nuage présent dans la couche supérieure de la troposphère (entre 5 000 et 14 000 mètres d’altitude, dépendant de la latitude et de la saison), formé de cristaux de glace. Ces nuages ont l’apparence de filaments blancs et ne causent pas de précipitations. On le compare souvent à des cheveux d’ange. Voir sur Wikipedia
Aurélien Bellanger :
«Un soir de décembre 1802, à Londres, Luke Howard prononce une conférence sur les modifications des nuages.
L’année suivante, le contenu de cette conférence est publié dans un essai illustré de poétiques gravures : modifications simples, intermédiaires, composées.
Le grand écrivain allemand Goethe est très intéressé, il veut rencontrer « l’homme qui sut distinguer les nuages ». Ils ne se rencontreront pas, mais ils s’écriront. Goethe conseillera ensuite aux peintres d’Allemagne du nord, ceux qu’il connaît bien, Carus, Caspar David Friedrich, de peindre des nuages « d’après Howard ». Friedrich, le célèbre peintre du Voyageur au-dessus de la mer de nuages, refusera : ce serait, dira-t-il, « la mort du paysage en peinture ». Mais dans le pays de Luke Howard, vers 1822, Constable ira chaque jour sur la colline de Hampstead peindre des « cloud studies » en nommant ses nuages d’après la classification de Howard. On pourrait s’arrêter là, sur cette belle alliance de la science et de l’art, sur ce moment européen où les nuages quittent le ciel divin pour devenir objet scientifique et esthétique : parfois, comme dans les tableaux de Constable, il n’y plus que des nuages, sans référent terrestre, sans personnage.
Mais l’histoire de la classification des nuages raconte encore autre chose.
La même année 1802, Lamarck, le « naturaliste » français, celui qui anticipa l’évolutionnisme, invente lui aussi, sans connaître Luke Howard, une classification de nuages, en français.
Il en invente même plusieurs, trois au moins : ses nuages s’appellent « diablotins », « coureurs », « demi-terminés », « en balayures », « en lambeaux »…
Pourquoi la classification de Howard l’a-t-elle emporté ? Parce que, dit-on, elle est en latin : langue alors transparente à la communauté scientifique. Je crois que ce n’est pas la bonne raison. Je crois que Lamarck a été pris de vertige devant ces formes mobiles, devant ce réel en perpétuelle transformation. Alors saluons Luke Howard qui, écrit Goethe dans son poème « En l’honneur de Luke Howard », « définit l’indéfinissable ».»
Il est toujours possible d’acheter le livre de Luke Howard « Sur les modifications des nuages » qui dans cette édition est suivie d’un essai de Goethe « La Forme des nuages selon Howard »
Et pour finir ce mot sur les nuages, je vous apprends probablement que l’Organisation météorologique mondiale a annoncé onze nouvelles espèces de nuages dont la moitié a des origines humaines plus que climatiques.
Vous trouverez des précisions derrière ce lien.
<947>
-
Mardi 10 octobre 2017
« Le fait est : un poulet a traversé la route. La question est : Pourquoi ? »Mise en perspective du mot du jour d’hierL’humour est essentiel dans la vie, comme le fait de savoir ne pas se prendre trop au sérieux. Alors quand j’avais fini d’écrire le mot du jour d’hier celui qui donnait une sorte de morale en affirmant que les esprits cultivés parlaient des idées et non seulement des faits, je me suis souvenu d’un message d’humour que j’avais reçu il y a quelques années.
Je le reprends ici, après avoir mis à jour certaines références, car il y a aujourd’hui des hommes bien oubliés, mais nous pouvons être rassurés, ils ont été remplacés par d’autres.
Cette suite d’affirmations est aussi une leçon de pédagogie.
Nous avons un fait simple, peu ambigüe : un poulet a traversé la route.
Et…
Nous allons faire appel au Monde des idées pour essayer de répondre à la question : Pourquoi ?
Voici les réponses :
RENE DESCARTES : Pour aller de l’autre côté.
PLATON : Pour son bien. De l’autre côté est le Vrai.
ARISTOTE : C’est dans la nature du poulet de traverser les routes.
KARL MARX : C’était historiquement inévitable.
DONALD TRUMP : Le poulet n’a pas traversé la route, je répète, le poulet n’a JAMAIS traversé la route.
GEORGES LUCAS : Pour aller là où aucun autre poulet n’était allé avant.
HIPPOCRATE : A cause d’un excès de sécrétion de son pancréas.
NICOLAS MACHIAVEL : L’élément important c’est que le poulet ait traverse la route. Qui se fiche de savoir pourquoi ? La fin en soi de traverser la route justifie tout motif quel qu’il soit.
SIGMUND FREUD : Le fait que vous vous préoccupiez du fait que le poulet a traversé la route révèle votre fort sentiment d’insécurité sexuelle latente.
BILL GATES : Nous venons justement de mettre au point le nouveau « Poulet Office 2017 », qui ne se contentera pas seulement de traverser les routes, mais couvera aussi des œufs, classera vos dossiers importants, etc.
OLIVER STONE : La question n’est pas : « Pourquoi le poulet a-t-il traverse la route ? » mais plutôt : « Qui a traversé en même temps que le poulet, qui avons-nous oublié dans notre hâte et qui a pu vraiment observer cette traversée ? »
CHARLES DARWIN : Les poulets, au travers de longues périodes, ont été naturellement sélectionnés de telle sorte qu’ils soient génétiquement enclins a traverser les routes.
BOUDDHA : Poser cette question renie votre propre nature de poulet.
MARTIN LUTHER KING, JR.: J’ai la vision d’un monde où tous les poulets seraient libres de traverser la route sans avoir à justifier leur acte.
MOISE : Et Dieu descendit du paradis et Il dit au poulet : Tu dois traverser la route. Et le poulet traversa la route et Dieu vit que cela était bon.
TOMAS DE TORQUEMADA : Tout poulet ayant traversé la route et qui reviendra en arrière sera considéré comme relaps et sera remis entre les mains de la Sainte Inquisition.
GALILEO GALILEI : Et pourtant, il traverse…
ERNEST HEMINGWAY : Pour mourir. Sous la pluie.
UN MEMBRE DU MEDEF : Parce que les taxes sont trop lourdes de ce coté de la route !
EMMANUEL MACRON :Parce que contrairement aux fainéants et aux fouteurs de bordel, ce poulet a la volonté d’entreprendre et c’est pourquoi il est allé de l’avant et a traversé la route.
EDOUARD PHILIPPE : Le gouvernement travaille pour que des milliers de poulets puissent traverser la route !
CANTONA : Le poulet, il est libre le poulet. Les routes, quand il veut il les traverse.
L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE : La raison est en vous, mais vous ne le savez pas encore. Moyennant la modique somme de 10 000 € par séance, plus la location d’un détecteur de mensonges, une analyse psychologique nous permettra de la découvrir.
MELENCHON : Parce que ce poulet est un insoumis !
POUTOU : Poulettes, poulets, ne vous laissez plus spolier par le patronat qui vous oblige à traverser les routes.
MANUEL VALLS ou GERARD COLLOMB: Parce qu’il n’avait pas de titre de séjour.
BILL CLINTON : JE JURE sur la constitution qu’il ne s’est rien passé entre ce poulet et moi.
ALBERT EINSTEIN : Le fait que le poulet traverse la route ou que la route se déplace sous le poulet dépend de votre référentiel.
Vous pourrez peut être compléter cette énumération par d’autres idées …
<946>
-
Lundi 9 octobre 2017
«L’homme médiocre parle des personnes,
L’homme moyen parle des faits,
L’homme de culture parle des idées »Citation attribuée quelquefois à Jules Romain d’autre fois à Eleanor RooseveltCette citation que j’ai choisie entre en résonance avec mon expérience de la vie, mais elle doit être expliquée et nuancée.
Je l’ai entendue citer et aussi trouvée à plusieurs reprises sur internet.
Force est de constater qu’on ne sait pas à qui l’attribuer. Même le journal « le Monde » l’attribue à Jules Romain <Ici> mais l’attribue à l’épouse de Franklin Roosevelt <Ici>
Quelquefois, les « faits » sont remplacés par le mot « les évènements ».
Mais ce qu’il y a de plus problématique c’est de désigner les hommes qui ne sont ni moyens, ni médiocres.
Les uns parlent « des grands esprits », d’autres « d’esprits supérieurs ou d’élite ».
Pour ma part, j’ai préféré utiliser le terme plus neutre et probablement plus juste d’homme qui s’inscrit dans une culture et donc qui cherche à comprendre, à expliquer, à mettre en perspective.
Si cette citation entre en résonance avec mon expérience, c’est que j’ai souvent entendu, notamment dans le monde professionnel, des collègues parler d’autres collègues, des collègues absents cela va de soi et en parler pour en dire du mal.
Un jour, j’ai même entendu une personne dire : « Moi si je ne peux pas dire de bien de quelqu’un, je m’abstiens d’en parler. Et notamment de X et Y je n’ai rien à dire ! ». Sorte de stratégie d’évitement.
Je n’ai pas la prétention d’avoir toujours échappé à cette faiblesse, je pense cependant que c’est devenu très rare aujourd’hui. Mais après de tels échanges, je n’ai jamais été satisfait.
D’autres parlent des faits, ils racontent ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont entendu, ce qu’ils ont vécu et encore avec les plus infimes détails. Ce sont des conversations qui entraînent chez moi le plus grand des ennuis.
Ce qui me semble intéressant c’est de parler des faits en en tirant des enseignements donc d’aller vers le monde des idées. Ce qui me parait important c’est ce que l’on apprend des faits, ce qu’ils peuvent signifier.
Donc Oui je préfère échanger sur les idées.
Mais c’est là qu’il faut nuancer.
D’abord, je ne crois pas qu’il y ait trois populations distinctes : l’une des médiocres, l’autre des moyens et la dernière des idées.
Je pense plutôt que cette fracture se situe en chacun de nous, parfois nous sommes médiocres, parfois nous ne sommes que moyens et quelquefois nous arrivons à nous hisser au niveau des idées.
L’intelligence serait alors d’augmenter, dans nos conversations, la part des idées et de faire diminuer celle qui ne nous rend que moyen, voire médiocre.
Ensuite, il faut quand même se méfier des idées et des concepts qui peuvent conduire à des constructions hors sols et quelquefois à des résultats parfaitement inhumains. Par exemple, le soviétisme c’était des idées non confrontées à la réalité et à la critique et conduisaient à des aberrations.
Cette dérive que Brassens avait expliqué dans cette chanson : « Mourir pour des idées, d’accord, mais de mort lente ».
Cela étant, je préfère parler des idées que de m’arrêter aux simples faits ou de parler des personnes.
Quand j’ai échangé avec Annie sur ce mot du jour, elle m’a simplement répondu avec son intelligence et sa sensibilité toujours vive : « Et le cœur et les sentiments dans cette énumération, où se trouvent-ils ?».
Car Oui, on peut exprimer brillamment des idées et ne pas savoir parler des sentiments, être incapable de laisser parler son cœur.
« L’intelligence ne sert à rien dans les rapports humains. » disait Françoise Giroud (mot du jour du 16 avril 2013)
Ou comme l’exhortait la famille de Yannick Minvielle, une des victimes du bataclan : «Dîtes aux gens que vous aimez, que vous les aimez.» (mot du jour du 11 décembre 2015)
Car en effet, dans la vie, les idées ne suffisent pas, il faut aussi savoir laisser parler son cœur.
J’espère qu’ainsi cette citation inspirante a été suffisamment nuancée pour insuffler un peu de sagesse.
<945>
-
Vendredi 6 octobre 2017
« Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé »Albert CamusJ’ai commencé cette semaine par un propos écrit par Albert Camus dans le livre posthume « Le premier homme ». Et je voudrais finir avec lui.
En postface de cet ouvrage, la fille d’Albert, Catherine Camus a publié la lettre qu’Albert Camus a adressée à son instituteur juste après avoir reçu son prix Nobel et la réponse de son instituteur :
19 novembre 1957
Cher Monsieur Germain,
 J’ai laissé s’éteindre un peu le bruit qui m’a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n’ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j’ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d’honneur mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève.
J’ai laissé s’éteindre un peu le bruit qui m’a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n’ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j’ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d’honneur mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève.
Je vous embrasse, de toutes mes forces.
Albert Camus
Et puis il y a la réponse de Monsieur Germain qui est beaucoup plus longue que la lettre d’Albert Camus et dont je ne cite que des extraits :
Mon cher petit,
(…) Je ne sais t’exprimer la joie que tu m’as faite par ton geste gracieux ni la manière de te remercier. Si c’était possible, je serrerais bien fort le grand garçon que tu es devenu et qui restera toujours pour moi « mon petit Camus».
(…) Qui est Camus ? J’ai l’impression que ceux qui essayent de percer ta personnalité n’y arrivent pas tout à fait. Tu as toujours montré une pudeur instinctive à déceler ta nature, tes sentiments. Tu y arrives d’autant mieux que tu es simple, direct. Et bon par-dessus le marché ! Ces impressions, tu me les a données en classe. Le pédagogue qui veut faire consciencieusement son métier ne néglige aucune occasion de connaître ses élèves, ses enfants, et il s’en présente sans cesse. Une réponse, un geste, une attitude sont amplement révélateurs. Je crois donc bien connaître le gentil petit bonhomme que tu étais, et l’enfant, bien souvent, contient en germe l’homme qu’il deviendra.
 Ton plaisir d’être en classe éclatait de toutes parts. Ton visage manifestait l’optimisme. Et à t’étudier, je n’ai jamais soupçonné la vraie situation de ta famille, je n’en ai eu qu’un aperçu au moment où ta maman est venue me voir au sujet de ton inscription sur la liste des candidats aux Bourses. D’ailleurs, cela se passait au moment où tu allais me quitter. Mais jusque-là tu me paraissais dans la même situation que tes camarades. Tu avais toujours ce qu’il te fallait. Comme ton frère, tu étais gentiment habillé. Je crois que je ne puis faire un plus bel éloge de ta maman.
Ton plaisir d’être en classe éclatait de toutes parts. Ton visage manifestait l’optimisme. Et à t’étudier, je n’ai jamais soupçonné la vraie situation de ta famille, je n’en ai eu qu’un aperçu au moment où ta maman est venue me voir au sujet de ton inscription sur la liste des candidats aux Bourses. D’ailleurs, cela se passait au moment où tu allais me quitter. Mais jusque-là tu me paraissais dans la même situation que tes camarades. Tu avais toujours ce qu’il te fallait. Comme ton frère, tu étais gentiment habillé. Je crois que je ne puis faire un plus bel éloge de ta maman.
J’ai vu la liste sans cesse grandissante des ouvrages qui te sont consacrés ou qui parlent de toi. Et c’est une satisfaction très grande pour moi de constater que ta célébrité (c’est l’exacte vérité) ne t’avait pas tourné la tête. Tu es resté Camus: bravo. J’ai suivi avec intérêt les péripéties multiples de la pièce que tu as adaptée et aussi montée: Les Possédés. Je t’aime trop pour ne pas te souhaiter la plus grande réussite: celle que tu mérites.
[…]
Avant de terminer, je veux te dire le mal que j’éprouve en tant qu’instituteur laïc, devant les projets menaçants ourdis contre notre école. Je crois, durant toute ma carrière, avoir respecté ce qu’il y a de plus sacré dans l’enfant: le droit de chercher sa vérité. Je vous ai tous aimés et crois avoir fait tout mon possible pour ne pas manifester mes idées et peser ainsi sur votre jeune intelligence. Lorsqu’il était question de Dieu (c’est dans le programme), je disais que certains y croyaient, d’autres non. Et que dans la plénitude de ses droits, chacun faisait ce qu’il voulait. De même, pour le chapitre des religions, je me bornais à indiquer celles qui existaient, auxquelles appartenaient ceux à qui cela plaisait. Pour être vrai, j’ajoutais qu’il y avait des personnes ne pratiquant aucune religion. Je sais bien que cela ne plaît pas à ceux qui voudraient faire des instituteurs des commis voyageurs en religion et, pour être plus précis, en religion catholique. A l’École normale d’Alger (installée alors au parc de Galland), mon père, comme ses camarades, était obligé d’aller à la messe et de communier chaque dimanche. Un jour, excédé par cette contrainte, il a mis l’hostie « consacrée» dans un livre de messe qu’il a fermé ! Le directeur de l’École a été informé de ce fait et n’a pas hésité à exclure mon père de l’école. Voilà ce que veulent les partisans de « l’École libre » (libre.., de penser comme eux). Avec la composition de la Chambre des députés actuelle, je crains que le mauvais coup n’aboutisse. Le Canard Enchaîné a signalé que, dans un département, une centaine de classes de l’École laïque fonctionnent sous le crucifix accroché au mur. Je vois là un abominable attentat contre la conscience des enfants. Que sera-ce, peut-être, dans quelque temps? Ces pensées m’attristent profondément.
Sache que, même lorsque je n’écris pas, je pense souvent à vous tous.
Madame Germain et moi vous embrassons tous quatre bien fort. Affectueusement à vous.
Germain Louis
Voilà un bel échange entre un « hussard de la république » et un élève modeste qui a pleinement profité de ce que l’Ecole a su lui donner.
J’espère qu’il peut encore exister aujourd’hui de telles échanges. Pour ma modeste part j’ai rencontré beaucoup de bons professeurs et quelques enseignants extraordinaires dont je me souviendrai toute ma vie.
Des jeunes personnes issus du monde de l’enseignement et du secteur privé ont créé en octobre 2014, l’Institut Louis Germain, en référence à l’instituteur d’Albert Camus. C’est une association de loi 1901 qui a pour projet de «donner à chacun la chance qu’il mérite.»
Vous trouverez le site de cette association derrière ce lien : https://www.institutlouisgermain.org/
<944>
-
Jeudi 5 octobre 2017
«L’anxiété démographique des pays de l’Europe centrale».Ivan KrastevL’évolution des pays d’Europe centrale qui ont intégré l’Union européenne nous inquiète. Ces pays qui mettent à leur tête des responsables qui comme Viktor Orban sont des adeptes de la « démocratie illibérale » ou des gouvernants qui comme en Pologne entendent changer les livres d’Histoire, se révèle en outre xénophobes.
Brice Couturier qui continue à s’interroger sur les cultures du monde en sortant de la seule préoccupation franco-française, a commis une chronique sur ce sujet.
Il explique que notamment ces petites nations, traumatisées par une histoire tragique, avaient intégré l’Union européenne pour s’arrimer solidement à une alliance d’Etats démocratiques et intégrer un bloc commercial prospère et solidaire. A l’époque où elles ont fait ce choix, elles venaient d’échapper à plus de quatre décennies de dépendance envers l’empire soviétique et elles se félicitaient d’avoir récupéré leur souveraineté nationale.
Elles ignoraient le « trilemme d’incompatibilité de Rodrik »….
Et Brice Couturier de nous expliquer la théorie de cet économiste de Harvard :
« vous ne pouvez pas avoir en même temps ces trois choses : la démocratie, la souveraineté nationale et une intégration économique poussée. Il y en aura toujours une qui sera sacrifiée. C’est exactement la logique qui a poussé les Anglais au Brexit : de leur expérience de l’Union européenne, ils ont conclu que l’intégration dans l’UE était incompatible soit avec leur souveraineté soit avec leur démocratie et ils sont partis dans l’idée de récupérer l’une et l’autre. »
Mais ce qui m’a surtout intéressé c’est le livre d’Ivan Krastev dans lequel il développe ce concept de l’anxiété démographique des pays de l’Europe Centrale :
Le politologue bulgare, mais pan-européen Ivan Krastev vient de publier un nouveau livre qui s’inspire de cette thèse pour expliquer pourquoi les Etats-membres d’Europe centrale sont en train de se détacher de l’UE.
Le titre en anglais « After Europe », en allemand, c’est encore pire « Europadämmerung », « le Crépuscule de l’Europe »…
Pour Krastev, les peuples d’Europe centrale connaissent ce qu’il appelle une « anxiété démographique ».
Depuis 1989 et l’ouverture de leurs frontières, la Pologne a vu partir vers l’Ouest 2 millions et demi de ses habitants, partis chercher des emplois mieux rémunérés. 3 millions et demi de Roumains. La population de la minuscule Lituanie est passée de 3 millions et demi à 2 millions 900 000. 10 % de la population bulgare a quitté le pays.
Or, ce sont des pays qui connaissent des taux de fécondité très faibles, très éloignés du niveau de maintien de leur population : 1,3 en Pologne, en Bulgarie, 1,4 en Hongrie ou en Slovaquie.
« Qui lira encore de la poésie bulgare dans cent ans ? », se demande Krastev lui-même.
Les jeunes diplômés, en particulier, choisissent Londres ou Francfort.
La partie de la population qui n’est pas mobile, qui ne possède pas les diplômes qui lui permettrait de profiter de l’ouverture ressent très mal cette situation. C’est elle qui constitue l’électorat du PiS, au pouvoir en Pologne, du FIDESZ au pouvoir en Hongrie.
Sentir que le monde dont on vient est en train de s’effondrer crée rarement des pensées positives. Et c’est probablement ce qui arrive aux polonais, aux hongrois, aux bulgares.
Et Brice Couturier continue de rapporter les développements de Krastev :
« Dans ces pays, la crise des migrants a constitué un tournant et un immense traumatisme.
Elle les a ramenés à leur déclin démographique et a relancé leur « anxiété démographique ».
Viktor Orban, le dirigeant hongrois, a déclaré « la question historique à laquelle nous sommes confrontés, c’est de savoir si l’Europe va demeurer le continent des Européens ». Les centre-Européens, selon Krastev, se sentent « trahis » par l’UE, qui ne comprend pas leur anxiété et les traite de populistes.
Et il conclut sur de sombres prophéties : la désintégration de l’Union européenne serait inéluctable… »
<Lien vers l’émission de Brice Couturier>
On peut ne pas approuver les dérives de ces pays de l’Europe centrale. Mais si on veut trouver des solutions, il est nécessaire de comprendre ce qui se passe au sein de ces peuples.
<943>
-
Mercredi 4 octobre 2017
« Un geste de domination insensé. »Charles Dantzig décrivant Emmanuel Macron tapotant la joue de Gérard CollombJ’espère que vous êtes convaincu, après les réflexions de Pascal Picq d’hier, que nous sommes proches des singes et combien dans notre comportement et dans nos attitudes ce fond animal surgit, notamment dans les relations politiques.
Si vous observez le comportement de Donald Trump à travers ce prisme, du singe mâle alpha qui veut montrer sa domination, par exemple par la manière dont il sert la main de ses interlocuteurs et qu’il les tire vers lui, cela en devient même caricatural.
Emmanuel Macron a été loué de sa manière dont il a serré la main de Trump et a su montrer son refus de la domination. Deux singes n’auraient pas fait autrement.
Yann Barthès avait présenté la première visite de Justin Trudeau à Donald Trump. Vous trouverez cette épisode derrière ce lien : <Visite de Justin Trudeau à Donald Trump>
Vous pouvez aller immédiatement à 1:45 et vous verrez le mâle alpha des singes humains du Canada bondir sur le mâle alpha des singes humains des Etats-Unis pour s’emparer de sa main de manière virile et lui montrer qu’il n’accepte pas sa domination animale.,
Charles Dantzig est un écrivain français qui fait paraître en octobre 2017 un livre : « Traité des gestes » (Grasset).
Il était invité le 29 septembre de l’émission la Grande Table : <Pour la beauté du geste avec Charles Dantzig>
Il a évoqué deux gestes.
Le premier est un geste de soumission.
Lors de la présentation du nouveau Pape François, Charles Danzig a vu un jeune prêtre s’approcher du nouveau Pape et délicatement lui épousseter l’épaule, car il venait de voir une poussière sur l’habit papal. Puis le jeune prêtre s’est retiré avec un sourire extatique de courtisan.
Le second geste est celui que j’ai mis en exergue et que vous avez vu si vous avez regardé l’investiture d’Emmanuel Macron.
Charles Danzig le raconte ainsi :
«Après avoir prononcé son discours, il s’approche de Gérard Collomb, de 30 ans son aîné et lui tapote la joue.
Un geste de domination insensé, alors qu’Emmanuel Macron est un homme bien élevé qui connait les bonnes manières.
Il a montré ainsi par ce geste de domination qui était le chef.»

Nous sommes toujours dans une similitude de comportement avec des chimpanzés qui font de la politique !
<942>
-
Mardi 3 octobre 2017
«Il n’y a que deux espèces qui font de la politique : les hommes et les chimpanzés !»Pascal PicqIl y a quelques temps déjà, le paléoanthropologue Pascal Picq avait été l’invité de la matinale de France Inter du 5 mai 2017. Quand je l’ai entendu je me suis tout suite dit qu’il y avait là vraiment matière à un mot du jour parce qu’on apprend beaucoup de choses, parce que c’est drôle et parce que nous nous comprenons mieux quand Pascal Picq décrit nos cousins les singes et regarde les hommes à travers ce qu’il a appris des singes.
Il avait été invité, entre les deux tours des présidentielles, pour présenter le livre qu’il venait de publier : « Qui va prendre le pouvoir ?: Les Grands singes, les hommes politiques ou les robots ? »
Le journaliste le présentait comme un scientifique qui jette des ponts entre les singes et les hommes et particulièrement les hommes politiques. Le paléoanthropologue portait alors un regard scientifique sur la campagne présidentielle et sur le monde politique en général. Il expliquait simplement : « Quand on a pas accès aux discours, avec de réels éléments de discussions, ce qui va dominer, c’est le comportement ».
« Il faut regarder les comportements.
[…] On a beaucoup de discussion sur l’absence de débat sur les programmes.[…] A partir du moment on n’a pas vraiment accès aux discours, aux enjeux [et aux idées], ce qui va dominer c’est le comportement. On connait beaucoup de choses sur les mimiques, les attitudes etc. »
Il décrypte le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, en insistant sur les postures plutôt que sur les discours.
« Ce sont des éléments que l’on partage avec les grands singes.
Il n’y a vraiment que deux espèces qui font de la politique : les hommes et les chimpanzés.
[…] Si un chimpanzé était devant notre télévision et [regardait] le débat il ne comprendrait pas le discours, c’est une évidence, mais il comprendrait ces comportements.
C’est pourquoi, on est capable de détecter chez différentes espèces, notamment chez les chimpanzés différents types de leadership, comme chez nous. Il y a des dominants, des tyrans, des magnanimes, ceux qui sont prêts aux compromis. Et ces personnalités ne s’expriment pas par des programmes et des idées mais par leurs attitudes. »
Il parle dans son livre, à propos des singes, des luttes pour la conquête du pouvoir, des intrigues, de la violence, la place accordée aux femelles, les privilèges. Les chimpanzés acceptent que les puissants aient des privilèges.
« « Dans toutes les sociétés humaines, c’est le cas, cela a été parfaitement décrit par Claude Levi-Strauss, mais c’est vrai aussi dans la société des chimpanzés. Quand on accepte un leader, on consent à ce qu’il ait quelques privilèges.
Mais tant que le leader remplit le contrat, qu’il agit pour le bien du groupe, qu’il a un comportement suffisamment magnanime. A partir du moment où ce contrat tacite n’est pas respecté, on va [remettre en question son leadership].
[Chez les chimpanzés], il y a des coups d’état, des changements de coalition, ce qui est plus doux. On a des exemples que je décris. […] Je ne cherche pas à savoir quels sont les singes qui sont les proches de l’homme. Ce qui m’intéresse ce sont les comportements généraux qui nous unissent par nos évolutions communes. J’évoque un chimpanzé qui s’appelait « Mac » qui avait été décrit par la grande Jane Goodall. Il y avait deux groupes de chimpanzés dominants dont ne faisait pas partie Mac. Il y avait des alternances constantes parce que les deux groupes étaient très équilibrés. Il est très futé et il s’aperçoit que lorsque les chercheurs font le plein de leurs voitures avec des jerry cans en acier, cela fait du bruit et les chimpanzés ont peur. Et qu’a fait Mac, qui n’est pas soutenu par un clan ni d’un côté ni de l’autre ? Il arrive avec deux bidons dans le dos [qu’il a dérobé] et il menace les leaders de chaque camp. […] et d’un seul coup il prend les deux bidons et s’en sert comme de monstrueuses castagnettes et cela fait peur à tout le monde. Et c’est comme ça qu’il va prendre le pouvoir sur les deux clans. En plus il va rester longtemps parce que cela arrange tout le monde, il va arriver à faire l’objet d’un compromis intéressant qui réconcilie les deux groupes. […]
Bon cherchez l’allusion où vous voulez, mais vous voyez c’est assez universel. »
Petit aparté, j’avais évoqué cette grande scientifique de 83 ans qui a tant appris aux humains sur le comportement de leurs cousins chimpanzés. J’avais partagé une vidéo <un geste de tendresse> dans laquelle on voyait un chimpanzé « Wounda » qui avait été recueilli dans un état proche de la mort et avait été longuement soigné dans l’institut de Jane Goodal, être réintroduit dans la forêt. On voit alors Wounda revenir vers Jane Goodal ; pour l’enlacer longuement avant de repartir vers son milieu naturel. Geste d’une empathie extraordinaire où la barrière qui sépare l’homme de son cousin se réduit à presque rien.
Pour revenir au dialogue entre Patrick Cohen qui était encore sur France Inter à ce moment et Pascal Picq, le journaliste a résumé ce passage par cette formule : « Les primaires observés à travers les primates ». Puis il a interrogé le primatologue sur la campagne présidentielle qui en était au lendemain du débat d’entre deux tours, au moment de l’entretien :
Les grands enjeux n’ont pas été discutés. Je ne suis pas anthropologue, je vous l’accorde, mais je m’intéresse à notre société je fais partie de l’observatoire de l’ubérisation de la société. Et à part Benoit Hamon qui a abordé le sujet de l’allocation universelle autour du travail et de la taxation des robots, aujourd’hui le monde est en train de changer à l’échelle mondiale avec les vagues du numérique et ces questions n’ont pas du tout été abordées. Cela m’a complétement consterné. L’erreur de Monsieur Hamon c’est d’avoir présenté l’allocation universelle et la taxation des robots comme une assistance. […] Cette question de l’allocation universelle devra être abordée dans le cadre d’un nouveau projet de société que nous attendons à l’échelle mondiale. […] Ce monde a changé en 5 ans, le temps d’un quinquennat avec quasiment les mêmes candidats d’un quinquennat à l’autre, à part M Hamon et M Macron, avec quasiment les mêmes idées.
Je vais être un peu brutal, on essaie de répondre aux enjeux de société, du travail, de la redistribution des richesses avec des éléments de réponse à gauche et à droite qui datent […] de la deuxième révolution industrielle, alors que nous sommes déjà dans la quatrième avec des bouleversements qui sont connus dans le monde du travail, de la répartition des richesses. »
Et quand Patrick Cohen lui demande sa vision du monde de demain de la postmodernité, le paléoanthropologue répond :
« Aujourd’hui tous les éléments de nos vies ont été largement modifiés. Et d’ailleurs ne nous ont pas été imposés. Quand vous utilisez votre smartphone et que vous décidez d’utiliser telle ou telle application pour vous déplacer, pour consommer, pour vous loger, pour chercher des informations, vous modifiez l’espace digital darwinien […] vous modifiez le marché ou l’activité [des domaines dans lesquels vous intervenez de manière numérique]. C’est un système parfaitement darwinien […].
[…] Comment cela fonctionne t’il ?
Les gens qui ont créé twitter, c’était des garçons et des filles qui ont fait un hackaton […] et qui se sont dit : j’aimerais avoir une messagerie courte pour échanger avec mes amis. Premièrement ça ne coute rien, ce que Jeremy Rifkin appelle le cout marginal zéro, on se réunit on est ensemble, on s’amuse bien. Si l’application n’est pas sélectionnée ce n’est pas grave on a passé un bon moment ensemble. Mais si elle est sélectionnée, ça peut complétement changer le monde.
Vous pensez que ces dizaines de jeunes gens allaient imaginer les printemps arabes, les logiciels big data qui jugent de nos émotions sur la valeur de la city et de la spéculation […] qui allait imaginer que ce serait la première campagne d’Obama où grâce à des algorithmes on allait pouvoir déterminer les personnes indécises pour pouvoir les appeler et les convaincre de voter Obama, ou les fake news [Et j’ajouterai pour ma part que personne n’imaginait que le Président des Etats Unis, à savoir Trump, utiliserait ce petit outil pour informer le monde de ses décisions politiques ou de sa stratégie diplomatique].. Personne ne pouvait imaginer cela.
C’est pour cela qu’on est dans un changement de société énorme où des personnes partout dans le monde sont capables de créer des applications qui ne coutent pas grand-chose et qui peuvent modifier des marchés entiers et même menacer la stabilité économique des très grands groupes. Et ça nous en sommes les acteurs. Je ne suis pas en train de culpabiliser, de moraliser. Mais il faut bien être conscient que les enjeux de pouvoir sur l’économie, la politique, la culture et même les informations sont aux mains de tout le monde et deviennent imprévisibles. »
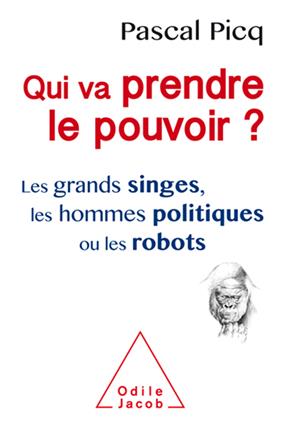
Et en conclusion, par son expérience avec les singes capucins et à par la conceptualisation du jeu de l’ultimatum, il explique le Brexit. [C’est à partir de 7 :30] dans cette partie de l’émission .
J’essaie de résumer. Le jeu de l’ultimatum est utilisé en économie expérimentale et se joue de la manière suivante : une première personne (joueur A) se voit attribuer une certaine somme d’argent, et doit décider quelle part elle garde pour elle et quelle part elle attribue à une seconde personne (joueur B). La seconde personne doit alors décider si elle accepte ou refuse l’offre. Si elle la refuse, aucun des deux individus ne reçoit d’argent.
Pascal Picq explique que les singes capucins comprennent très vite et entrent dans la logique de la coopération profitable au plus grand nombre.
Les technocrates qui trouvent stupide la réaction des britanniques qui ont voté pour le Brexit, parce qu’ils ont profité de fonds structurels et qu’ils vont perdre au Brexit, ne comprennent pas ce que comprennent les singes capucins. Selon Pascal Picq ceux qui ont voté pour le Brexit ont le sentiment, exact, que dans la répartition du jeu de l’ultimatum où il fallait partager 100, ils ont peut être reçu 20, mais d’autres ont reçu 80. C’est la réalité des classes moyennes dont les revenus stagnent alors que ceux des plus riches explosent. Dans ces conditions ils préfèrent jouer la politique du pire, personne n’y trouve avantage.
C’est encore un problème de collaboration intelligente que les singes capucins pourraient enseigner aux hommes du capitalisme contemporain. Pascal Picq développait aussi ces idées dans un article ancien du journal des Echos : «Il faut accorder plus de place à la collaboration et au partage»
Car indiscutablement nous avons des comportements qui peuvent être expliqués par l’observation des singes. Et Pascal Picq de rappeler cette expérience déjà citée dans le mot du jour consacré à Franz de Waal, où des singes font la grève parce qu’ils estiment être victime d’une injustice : on leur donne des concombres, alors qu’à leurs voisins qui font le même travail on donne des raisins ou des bananes, récompenses plus valorisées par les singes.
Réflexion donc très féconde de ce paléoanthropologue qui dans une autre émission explique la différence entre Emmanuel Macron et Manuel Valls par ce langage simiesque : « Manuel Valls ne sait pas bien épouiller ». Les singes manifestent l’empathie et la volonté de collaboration en épouillant le congénère qu’il rencontre. Les hommes n’épouillent pas, mais il y a ceux qui comme Jacques Chirac et aussi, reconnaissons le, Emmanuel Macron savent aller vers les autres avec empathie ou au moins l’apparence qu’ils s’intéressent aux autres (ils savent épouiller) et ceux qui comme Manuel Valls se fâchent avec quasi tout le monde et passent leur temps à engueuler les autres.
Ce mot du jour est déjà fort long et je n’ai pas encore parlé des robots évoqués par Pascal Picq, mais vous trouverez cet article du monde où il s’exprime à ce propos : « La parade face à la robotisation est la créativité »
Et pour finir, parce qu’Annie m’a dit après le mot du jour d’hier, tu ne peux pas parler que de choses horribles, il faut aussi parler de belles choses, d’empathie, de ce qui nous pousse à la bienveillance.
Pour ce faire j’en reviens aux singes et au geste de tendresse de Wounda que vous retrouverez derrière ce lien.
<941>
-
Lundi 2 octobre 2017
« «Non, un homme ça s’empêche.
Voilà ce qu’est un homme,
ou sinon… » »« Le père d’Albert Camus
Cité par Albert Camus dans « Le premier homme » page 65 et suiv. »Je veux revenir sur ce fait divers d’une enfant de 11 ans qui a été la proie de la perversité d’un prédateur.
A la suite du commentaire de Benoit, j’ai mis un lien vers une pétition qui réclame une évolution de la Loi qui devrait mettre un âge en dessous duquel, le consentement ne peut pas exister. Je redonne le lien vers cette pétition : <ICI>
Alors, j’ai lu des réactions qui mettent en cause les parents de cette enfant qui auraient manqué de prudence, qui auraient du intervenir plus tôt après ce qu’a raconté leur enfant et la protéger du prédateur. C’est certainement vrai.
Mais pour moi, ce n’est en aucune façon ni une excuse, ni un argument qui peut s’entendre par rapport à la question fondamentale d’un homme de 28 ans qui abuse d’un enfant de 11 ans.
Si une femme ou un homme se promène nu dans la rue, il faut la ou le couvrir, peut-être lui mettre une amende pour atteinte aux bonnes mœurs. En aucune façon cela constitue le début du commencement d’une justification d’une agression sexuelle.
Et si la femme, car il faut quand même constater que c’est le corps des femmes qui posent problème à un certain nombre de mâle de l’espèce homo sapiens, est habillée de quelque manière que ce soit, il en va exactement de même.
Dans ce monde, où des penseurs commencent de plus en plus à développer les thèses de l’antispécisme, c’est-à-dire cette théorie qui consiste à ne plus faire de différence entre les espèces, donc entre les humains et les autres animaux, il me parait particulièrement important d’essayer d’esquisser ce que doit être un homme ou alors d’abdiquer et rallier les thèses de ces associations comme « L214» .
C’est alors que m’est revenu cet épisode dans lequel Albert Camus raconte la réaction de son père lors d’un acte ignoble d’hommes sur d’autres hommes : « Un homme ça s’empêche ! »
Albert Camus est mort à 46 ans, le 4 janvier 1960, sur le trajet de Lyon à Paris, au lieu-dit Le Petit-Villeblevin, dans l’Yonne, dans un accident de voiture.
Trois ans auparavant, le 16 octobre 1957, le prix Nobel de littérature lui avait été décerné.
Son père, Lucien Auguste Camus est mort au début de la première guerre mondiale, le 11 octobre 1914, alors qu’Albert n’avait pas encore un an.
« Le Premier Homme » est un roman autobiographique inachevé d’Albert Camus, publié par sa fille en 1994 aux éditions Gallimard. Albert Camus n’avait pas encore mis un titre à son nouveau manuscrit.
Le premier chapitre de ce livre s’intitule : « Recherche du père »
Dans ce livre, Albert Camus désigne son père sous le nom de Cormery et lui-même avait pris pour prénom Jacques.
Et il cite un épisode dans la vie de son père, en pleine période colonialiste dans lequel des hommes colonisés attaquent les soldats du colonisateur et agissent de manière ignoble, ce qui va entraîner la réplique du père d’Albert Camus :
Cet épisode met en scène le père de Camus et un autre soldat appelé Levesque qui trouve des excuses à ceux qui ont commis l’ignoble.
« Il était dans les zouaves.
Oui. Il a fait la guerre au Maroc.
C’était vrai. Il avait oublié. 1905, son père avait 20 ans. Il avait fait, comme on dit, du service actif contre les marocains.
Jacques se souvenait de ce que lui avait dit le directeur de son école lorsqu’il l’avait rencontré quelques années auparavant dans les rues d’Alger. Monsieur Lévesque avait été appelé en même temps que son père. Mais il n’était resté qu’un mois dans la même unité. Il avait mal connu Cormery selon lui, car ce dernier parlait peu.
Dur à la fatigue, taciturne, mais facile à vivre et équitable.
Une seule fois, Cormery avait paru hors de lui.
C’était la nuit, après une journée torride, dans ce coin de l’Atlas où le détachement campait au sommet d’une petite colline gardée par un défilé rocheux.
Cormery et Lévesque devaient relever la sentinelle au bas du défilé. Personne n’avait répondu à leurs appels.
Et au pied d’une haie de figuiers de barbarie, ils avaient trouvé leurs camarades la tête renversée, bizarrement tournée vers la Lune. Et d’abord il n’avait pas reconnu sa tête qui avait une forme étrange. Mais c’était tout simple. Il avait été égorgé, dans sa bouche, cette boursouflure livide était son sexe entier. C’est alors qu’ils avaient vu le corps ou jambes écartées, le pantalon de zouave fendu, et au milieu de la fente, dans le reflet cette fois indirect de la Lune, cette flaque marécageuse. À 100 m plus loin, derrière un gros rocher cette fois, la deuxième sentinelle avait été présentée de la même façon. […]
À l’aube, quand ils étaient remontés au camp, Cormery avait dit que les autres n’étaient pas des hommes.
Lévesque qui réfléchissait, avait répondu que, pour eux, c’était ainsi que devaient agir les hommes, qu’on était chez eux, et qu’ils usaient de tous les moyens.
Cormery avait pris son air buté. « Peut-être. Mais ils ont tort. Un homme ne fait pas ça. »
Lévesque avait dit que pour eux, dans certaines circonstances, un homme doit tout se permettre et tout détruire.
Mais Cormery avait crié comme pris de folie furieuse : « Non, un homme ça s’empêche. Voilà ce qu’est un homme, ou sinon… ».
Et puis il s’était calmé. « Moi, avait-il dit d’une voix sourde, je suis pauvre, je sors de l’orphelinat, on me met cet habit, on me traîne à la guerre, mais je m’empêche.»
Il y a des Français qui ne s’empêchent pas avait dit Lévesque.
Alors, eux non plus, ce ne sont pas des hommes. » »
Alors, ce ne sont pas des hommes.
Parce qu’un homme, ça s’empêche !
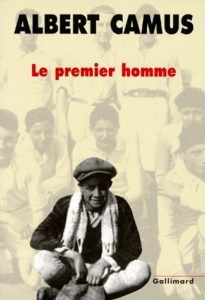
<940>
-
Vendredi 29 septembre 2017
« La science ne sait pas à quoi sert le sommeil ! »David LouapreDavid Louapre est un jeune (34 ans) physicien qui a réalisé sa thèse à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon dans le domaine de la gravité quantique. Il est aujourd’hui employé par Saint Gobain dans son centre de recherche de Boston où il est responsable « recherche et développement » pour la mise au point de nouveaux matériaux.
C’est son emploi officiel.
Mais comme beaucoup d’autres de sa génération il a un autre travail : il est vulgarisateur scientifique :
Cette mission il la développe sur sa chaine youtube : <Science Etonnante>
Et sur son blog : https://sciencetonnante.wordpress.com/
Et enfin, il écrit aussi des livres. Son dernier a pour titre : <Insoluble mais vrai !> Livre édité par Flammarion et paru le 31/05/2017.
C’est pour parler de ce livre qu’Etienne Klein l’a invité dans son émission : « La conversation scientifique du 9 septembre 2017 » : < Que reste t’il à comprendre ?>
Etienne Klein a introduit ce livre et ce sujet de la manière suivante :
« [Ce] nouveau livre « Insoluble mais vrai ! » […] s’interroge sur vingt phénomènes que la science peine encore à expliquer.
La connaissance et l’ignorance se tiennent par la barbichette : ignorer qu’on ignore, c’est ne rien savoir ; mais savoir qu’on ignore, c’est vraiment savoir, car cela suppose de savoir tout ce qui est déjà établi et d’être capable de détecter ce qui fait encore trou dans la connaissance. Voilà pourquoi l’ignorance est la grande affaire des savants. […]
De telles situations sont-elles nombreuses ? Quels sont les problèmes scientifiques qui demeurent ouverts, sur lesquels on bute depuis longtemps sans jamais faire de grandes percées malgré de gros efforts ? »
Cette émission a abordé plusieurs de ces questions. Mais celle qui m’a le plus interpellé est la question du sommeil.
Pourquoi dormons-nous ?
L’homme simple que je suis, pense que cette question est réglée depuis longtemps : Nous dormons parce que nous sommes fatigués et que notre corps doit se reposer.
David Louapre explique très justement que cette assertion confond le symptôme et la cause, c’est-à-dire la fonction biologique.
Nous mangeons quand nous avons faim, la faim c’est le symptôme non la cause. En fait, la science a compris que s’alimenter c’est donner des nutriments à notre corps qui à travers tout un système de transformation lui donne de l’énergie et des éléments sans lesquels notre corps ne peut vivre et se développer.
La science n’a pas trouvé à quoi sert le sommeil !
Renversant non ?
Cette question abordée dans l’émission et donc dans le livre dont google donne un extrait sur ce sujet est développé sur le blog que j’ai cité ci-avant :
En voici des extraits :
Nous passons en moyenne 8 heures par jour à dormir, ce qui sur l’ensemble d’une vie représente environ 25 années au lit. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, on ne sait pas vraiment pourquoi nous avons besoin de dormir. […]
Il existe ainsi plusieurs hypothèses crédibles pour expliquer le rôle du sommeil, mais aucune ne s’est encore définitivement imposée. […]
Pour essayer de comprendre le rôle fondamental du sommeil, il existe une méthode simple : arrêter de dormir et regarder ce qui se passe ! On connait quelques cas attestés de personnes ne dormant pas pendant plus de 10 jours, mais il est évidemment problématique de réaliser des expériences bien contrôlées sur l’homme. Alors comme d’habitude, on va se tourner vers nos amis les animaux.
David Louapre explique qu’une expérience pratiquée sur des rats, publiée en 1983 par Allan Rechtschaffen a montré que les effets de la privation de sommeil entraînent une mort dans les deux semaines, ce qui est plus rapide que pour une privation de nourriture. Au cours de l’expérience, ils développent des lésions sur la peau, ils ne mangent plus et pourtant maigrissent beaucoup.
Mais les scientifiques, après l’autopsie, ne sont pas parvenus à déterminer la cause exacte de la mort.
Cette expérience semblait démontrer que la privation de sommeil entrainait la mort mais on ne comprenait pas quelles fonctions biologiques étaient en cause.
Des expériences postérieures ont remis en question la causalité entre la privation de sommeil et la mort. Car des expériences sur la souris ou le pigeon n’ont pas eu le même effet et d’autres chercheurs ont pu réitérer l’expérience avec des rats sans entrainer la mort. Les analyses les plus récentes ont donc remises en causes les conclusions de l’expérience de Rechtschaffen en mettant la cause de la mort sur les conditions stressantes de cette expérience et non la privation de sommeil.
David Louapre poursuit :
[…] il existe de nombreux animaux se privant parfois volontairement de sommeil. C’est le cas de certains oiseaux lors de la migration, et même des dauphins. Ces derniers peuvent rester éveillés plusieurs jours d’affilé si on les stimule avec des jeux. Encore plus fort, la maman et le bébé dauphin ne dorment presque pas pendant les 6 semaines qui suivent la naissance ! De manière intéressante, ces privations volontaires ne s’accompagnent pas d’un besoin de récupération de la dette de sommeil. […]
Bref, le sommeil n’est pas forcément indispensable, mais quand même avantageux pour la survie !
Et David Louapre examine dès lors les différentes hypothèses :
1
La première fonction à laquelle on peut penser, c’est la conservation de l’énergie, puisque quand on dort on dépense moins de calories. Mais cette explication n’est pas totalement satisfaisante, car un état d’éveil calme remplirait presque aussi bien cette fonction, tout en étant beaucoup moins risqué que le sommeil.
[…]
2 La piste métabolique
Une des explications les plus en vogue est celle de la protection du cerveau contre ce qu’on appelle le « stress oxydatif ». En effet, quand notre organisme produit de l’énergie en brûlant des nutriments, la réaction chimique fabrique parfois ce qu’on appelle des radicaux libres. Il s’agit de molécules contenant des atomes d’oxygènes disponibles (comme l’eau oxygénée H_2O_2), et pouvant donc réagir avec leur environnement selon une réaction d’oxydation.
On sait que ces radicaux libres causent des dommages à nos cellules et à notre ADN, et que cela constitue d’ailleurs une cause importante du phénomène de vieillissement. Heureusement notre organisme sait se défendre (via des enzymes) contre ce stress oxydatif, d’où l’importance des anti-oxydants. On suspecte ainsi que l’un des rôles du sommeil serait de réduire l’activité du cerveau, afin de diminuer son attaque par les radicaux libres, et de permettre à des phénomènes de réparation d’avoir lieu.
A l’appui de cette hypothèse, il a été récemment montré que chez le rat, la privation de sommeil conduit à des dommages accrus dans les cellules du cerveau via un mécanisme de stress oxydatif.
3 Le rêve
Jusqu’ici nous avons parlé du sommeil en général, mais laissé de côté le fait qu’il existe un état particulier : le sommeil paradoxal. C’est dans cette période, appelée Rapid Eye Movement (REM) par les anglo-saxons, que se produisent les rêves. On entend parfois que la privation de sommeil paradoxal conduirait à la folie, mais il semble que cela soit une légende.
Plusieurs théories intéressantes existent pour expliquer le sommeil paradoxal. L’une constate que certains neurotransmetteurs ne sont plus émis pendant le sommeil paradoxal, ce qui expliquerait le caractère assez désinhibé des rêves, mais permettrait un certain « repos » des communications dans le cerveau.
4 Le simulateur de vie par le rêve
Une autre théorie audacieuse a été proposée par le français Michel Jouvet. Elle se base sur une observation étonnante : la quantité de sommeil paradoxal dans le règne animal semble corrélée au niveau de maturité des bébés à la naissance. Le dauphin, qui est complètement fonctionnel dès sa naissance, n’en possède pas du tout ! Au contraire l’ornithorynque, qui nait aveugle et totalement, rêve en moyenne 8 heures par jour !
Une explication possible serait alors la suivante : les rêves servent à accélérer notre maturation cérébrale en nous présentant une simulation de la réalité. Lors des rêves, notre cerveau travaille et se développerait un peu comme lors d’expériences réelles. Le rêve serait donc à la vie ce que le simulateur de vol est au pilotage : un moyen de s’entraîner plus souvent, et sans danger.
Il existe beaucoup de théories sur le rêve, celle-ci a l’air de nous dire que nous en avons besoin pour accélérer notre maturation cérébrale et nous aider à nous préparer à la vraie vie.
Si vous voulez lire son article complet, <c’est ici>
En conclusion, ce soir j’irais me coucher et dormir sans savoir pourquoi ! J’espère que l’incertitude de la réponse à cette question ne m’empêchera pas de trouver le sommeil !
En tout cas, David Louapre me semble être un très bon vulgarisateur et un remarquable pédagogue.
Pour des motifs que chacun peut comprendre j’ai été très intéressé par cette vidéo d’une vingtaine de minutes où il explique les mécanismes du cancer : <Le cancer>
Remarquable je vous dis.
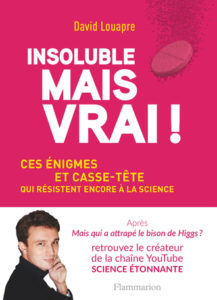
<939>
-
Jeudi 28 septembre 2017
«Pour sauver la mondialisation, il faut passer du partage de la pauvreté à celui des profits»Kaushik BasuKaushik Basu est un économiste indien, né en 1952 à Calcutta et il est présenté comme un disciple d’Amartya Sen .
A cette occasion je constate que je n’ai jamais consacré de mot du jour à ce grand économiste indien, Amartya Sen, né en 1933,prix Nobel d’économie en 1998 qui travaille sur des sujets aussi féconds et utiles que la théorie du développement humain, l’économie du bien-être ainsi que les mécanismes fondamentaux de la pauvreté, ainsi que des réflexions sur la famine dans le monde. Il est aussi à l’avant-garde des études sur les inégalités entre les hommes et les femmes.
Mais revenons au disciple : Kauskik Basu a été conseiller du gouvernement fédéral indien, puis économiste en chef de la Banque mondiale de 2012 à 2016. Depuis cette date, il est professeur d’économie aux Etats-Unis dans l’État de New York. Sa réflexion est très influencée par la théorie des jeux. Ainsi, il insiste sur les bienfaits de la coopération et sur l’impact des normes sociales sur l’économie. Il explique en quoi la coopération peut être une solution pour l’économie mondiale
Son ouvrage de référence : « Au-delà du marché : vers une nouvelle pensée économique » écrit en 2010 vient d’être publié en français en 2017.
Gaël Giraud, jésuite et directeur de recherche au CNRS a écrit la préface de la version française.
Contrairement à Amartya Sen, Gael Giraud a fait l’objet de deux mots du jour : en mars 2014, «La collusion entre la haute finance publique et la haute finance privée qui, aujourd’hui, paralyse notre société.» et juillet de la même année, « une réflexion sur la manière dont les autorités européennes, auraient dû sanctionner Goldman Sachs pour avoir truqué les comptes publics grecs de la même manière que les Etats-Unis ont sanctionné BNP-Paribas. »
J’ai compris l’intérêt de cet ouvrage et de Kauskik Basu par un article entretien publié sur Mediapart.
Mais je commencerai par un article de la Tribune dont le titre est : « L’économiste humaniste » et qui explique en introduction :
« […] Kaushik Basu engage un combat de fond contre les fondements de l’orthodoxie économique et de ce courant qui prétend faire de l’économie une « science dure ». Ce combat est radical, au sens où il s’engage à la racine même de cette pensée : le mythe de la « main invisible », celui qui prétend que la somme des égoïsmes individuels procure le bonheur collectif. Mais, disons-le d’emblée, cette critique radicale ne s’accompagne pas de solutions « faciles ». Kaushik Basu est méfiant vis-à-vis d’un Etat qui sert souvent les intérêts des plus puissants et est souvent largement impuissant dans le cadre de la mondialisation. »
Cet article continue en précisant que les solutions proposées par cet économiste sont loin d’être simples :
Aucune vraie révolution, de celles qui changent le monde, ne se définit à l’avance selon des plans précis. Mais toutes se construisent sur une critique radicale de l’existant et sur une prise de conscience des insuffisances du présent. Et c’est en cela que Kaushik Basu est un vrai révolutionnaire.
On comprend donc que la critique radicale de Kauskik Basu concerne à la fois la main invisible du marché qui aurait vocation à faire évoluer la situation économique vers une solution optimale pour le plus grand nombre et le fantasme des modèles mathématiques qui devraient expliquer le monde économique alors que ces théories négligent un point central : la complexité humaine.
« Ramener l’activité humaine à un simple réflexe égoïste, à un simple calcul d’intérêt, est l’erreur fondamentale de la pensée classique. C’est une erreur que l’auteur met en relief en rappelant que la pseudo-rationalité de la méthode classique fait l’économie des éléments normatifs, moraux ou sociaux. Une même situation ne saurait donner partout le même comportement : les lois elles-mêmes ne sont que des acceptations normatives issues d’un processus complexe.»
N’existe-t-il qu’une vision possible du développement économique ? Est-ce que ce que nous vivons est naturel, inéluctable comme le prétendent certains ? Celles et ceux qui affirment « There is no alternative », la fameuse « TINA ». L’économiste indien regarde les choses autrement :
« il est aisé de saisir pourquoi l’actuelle logique économique est viciée : elle repose sur des fondements qui profitent à certains, et les effets théoriques bénéfiques de la libre concurrence ne sont que des contes, des « normes » que l’on accepte. Logiquement, ceci débouche inévitablement sur la victoire des intérêts les plus puissants, et donc sur l’accroissement des inégalités. On prétend que les « perdants » de cette libre concurrence le sont « naturellement », mais en réalité, rien n’est moins naturel. […] Mais si nous pouvions prendre un peu de recul et l’analyser, nous nous rendrions facilement compte que notre société se rapproche beaucoup, et de façon inquiétante, des sociétés reposant sur les castes et l’exclusion, qui ont pu exister à travers l’histoire.»
Comme je l’ai écrit au début de cet article Kaushik Basu a accordé un entretien à Mediapart, réalisé le 18 mai dernier et qui a été < publié sur Mediapart.fr le 26 mai 2017>.
Il revient d’abord sur la critique du « théorème de la main invisible » qui établirait que la poursuite de l’intérêt égoïste garantit la réalisation de l’intérêt général. Théorie qui a été attribuée à Adam Schmith :
« Je pense que beaucoup d’injustice a été faite à Adam Smith. À mon avis, lui-même n’a pas pris conscience du message que ce théorème de la main invisible pouvait délivrer in fine. Il était beaucoup plus intéressé par les questions d’économies d’échelle sur le marché du travail. J’en veux pour preuve que ce théorème n’était même pas présent dans l’index de l’édition originale de La Richesse des nations, cette entrée ayant été ajoutée par l’éditeur après la mort d’Adam Smith. Mais progressivement, parce que cela s’est révélé commode idéologiquement pour les puissants, on a mué ce théorème en un ordre naturel, donc en un « ordre bon ». Cela me fait penser au système des castes en Inde qui se concevait également comme un ordre naturel et bon. […] Cela ne signifie pas que cette théorie soit fausse en soi, mais que son utilisation concrète est dévoyée. »
Il peut alors préciser sa critique que je résumerai ainsi : l’illusion d’un homo economicus universel qui aurait toujours les mêmes raisonnements et intuitions. Cette universalité ou unicité est fausse d’abord en raison des cultures des différentes civilisations qui peuplent la planète et ensuite en raison de ce que j’appellerai la complexité de l’âme humaine. Lui parle plutôt de liens entre normes sociales et culturelles et l’économie.
« Je rappelle souvent un cas qui me paraît éclairant. En 1755, en Caroline du Sud, des Indiens Cherokees rencontrèrent des colons. On sympathisa et les Cherokees déclarèrent vouloir « donner toutes leurs terres au roi de Grande- Bretagne ». Ce don était pour eux symbolique et une façon d’honorer leurs hôtes et leur chef. Mais les colons les prirent au mot, leur remirent une somme d’argent et leur firent signer un document de vente. Et ils devinrent légalement propriétaires des terres cherokees, sans que les Indiens, qui avaient une autre conception de la propriété, ne l’aient compris. Cette divergence de paradigmes mentaux est fondamentale, parce qu’elle ne permet pas d’établir qu’un contrat « volontaire » est effectivement réellement volontaire. C’est un élément à prendre en compte dans la science économique.
De même, on constate que, dans la vie quotidienne, les gens ne sont pas tentés de voler le portefeuille de leur voisin. Ce serait pourtant, dans une logique de poursuite de l’intérêt personnel, une méthode facile d’enrichissement. Or ce n’est pas une démarche commune. Les économistes classiques nous expliquent que c’est la peur de la punition qui est le premier levier de ce comportement. Mais dans la plupart des cas, ce n’est pas vrai et, en réalité, les gens ne songent même pas à voler le portefeuille. La norme est intériorisée sans calcul. Et si tout le monde calculait, la société ne pourrait pas fonctionner. Que retenir de cela ? Que l’économie doit être insérée dans les sciences humaines et doit prendre en compte les éléments culturels et sociologiques. Et que la raison pour laquelle les politiques économiques échouent, c’est qu’elles ne prennent pas en compte ces éléments de normes sociales dans le fonctionnement de l’économie. »
Et c’est ainsi qu’il peut développer ses théories sur la coopération Coopération qui implique bienveillance et esprit d’équipe. Alors qu’on voudrait nous faire croire que l’alpha et l’oméga de la performance est la compétition et l’égoïsme.
« C’est un fait que l’on ignore trop souvent. Non seulement la coopération est un élément important en économie, mais c’est aussi un mode de fonctionnement possible. Un ménage, par exemple, est une structure coopérative. Le réfrigérateur y est ouvert et chacun y a accès sans recours à un système de prix et de marché. On retrouve ce type de comportement dans de nombreuses communautés et de nombreux groupes humains. Des formes de coopérations économiques ont lieu chaque jour un peu partout. Par exemple, ne pas fumer dans un lieu public est une forme de coopération. En Inde, personne ne pensait qu’une telle norme pouvait être appliquée. Le comportement des Indiens a pourtant changé. On est passé d’un comportement non-coopératif à un comportement coopératif qui est devenu désormais une norme sociale. Ce type d’évolutions doit être pris en compte en face de la vision orthodoxe qui considère que l’égoïsme généralisé est la seule vérité humaine. »
Sa vision de l’Etat est aussi d’une grande nuance. Vision méfiante parce que s’il prend trop de place il est probable que quelques groupes d’intérêt vont capter les leviers du pouvoir pour leur plus grand profit. Mais certitude de la nécessité d’un Etat régulateur et redistributeur :
« Des régulations imposées par l’État sont absolument nécessaires. Certes, il faut agir prudemment, car réguler est un travail sensible et difficile qui peut causer parfois de graves dysfonctionnements économiques. Les régulations agissent cependant souvent comme une incitation décisive. Une fois qu’elles sont entrées dans les mœurs, il n’y a plus besoin d’y penser, elles sont devenues des normes sociales. Au début du XIXe siècle, il a fallu légiférer contre le travail des enfants. Aujourd’hui, plus personne n’a besoin de consulter des livres juridiques pour savoir que le travail des enfants est interdit : c’est devenu une évidence. Il en va de même de l’interdiction de fumer dans les lieux publics que j’évoquais à l’instant. Il n’y a pas besoin d’un État autoritaire, les normes sociales agissent plus efficacement.
L’action de l’État est également nécessaire dans un autre cas, celui de la redistribution des revenus. Une telle redistribution n’est pas possible de façon autonome, elle a besoin de l’intervention de l’État. Et cette intervention doit être large. Les impôts sont un moyen de redistribuer les revenus, mais il faut aussi beaucoup investir dans le capital humain, dans l’éducation notamment. L’essentiel des inégalités sont en effet des inégalités de départ. Lorsque vous naissez dans un bidonville, sans richesse ni éducation, quelles que soient vos actions, il y a d’immenses chances que votre situation ne change pas. C’est ici que l’État doit agir pour rendre par l’impôt l’héritage des richesses plus difficile et pour favoriser l’accès à la santé et à l’éducation de ces populations. »
Et c’est au bout de ces constats qu’il arrive à sa proposition du partage des profits :
« Dans le fonctionnement actuel de la mondialisation, les gens les plus pauvres sont en compétition entre eux. Mais le résultat de cette compétition est que le profit augmente, et donc les inégalités. Le revenu médian des ménages aux États-Unis n’a pratiquement pas changé entre mon arrivée aux États-Unis en 1998 pour mon premier poste à la Banque mondiale et aujourd’hui. La croissance américaine a pourtant été très importante, ce qui signifie qu’elle a profité aux revenus les plus élevés avant tout. Le problème n’est donc pas celui d’un combat entre les forces de travail des pays développés et des pays émergents, mais bien celui d’un combat classique entre le travail et le capital. Prendre conscience de ce fait permet de changer de perspective concernant la mondialisation.
Il y a un besoin de redistribution immense dans la mondialisation et par conséquent je propose de passer d’une conception où l’on partage la pauvreté, comme aujourd’hui, à une forme de partage des profits. Cela peut prendre la forme d’une taxe de 10 % sur les profits qui seront redistribués aux travailleurs des pays où s’opèrent les délocalisations. Ce serait une forme de droit universel au profit qui permettrait d’intéresser les populations des pays riches au développement des pays émergents.
Cela passera naturellement par des confiscations au début, les gens fortunés perdront une partie de leur fortune, mais ce serait le début de la coopération et le début de la fin de l’identité entre mondialisation et égoïsme. »
 Sa conclusion est à la fois déprimée et optimiste :
Sa conclusion est à la fois déprimée et optimiste :
« La concurrence entre les nations conduit à une compétition dangereuse. Les pays les plus égalitaires sont obligés de creuser les inégalités pour survivre dans le contexte actuel de la mondialisation. […] Je suis néanmoins optimiste, parce que je crois que la nécessité va pousser à la mise en place de mesures de redistribution et de coopération. Face au défi du changement climatique et de systèmes sociaux impossibles à tenir, il faudra trouver des solutions, y compris celles qui paraissent aujourd’hui utopiques.
Il faut quand même rappeler que l’homme qui développe ces idées n’est pas un hurluberlu gauchiste mais celui qui fut économiste chef de la Banque Mondiale, cette institution du libéralisme économique.
<938>
-
Mercredi 27 septembre 2017
« Un enfant de 11 ans peut consentir à une relation sexuelle avec un homme de 28 ans »Le parquet de PontoiseC’est une information publiée le 25/09/2017 par Mediapart.
C’est un fait divers.
Il ne se passe pas dans un pays éloigné, il se passe en France.
Plus précisément dans la Région Ile de France, dans le département du Val d’Oise.
D’abord une précision quand on est dans le domaine du Droit Pénal ; c’est-à-dire le Droit qui punit des crimes ou des délits, si vous êtes victime vous pouvez porter plainte mais seul l’Etat peut poursuivre et faire en sorte que l’affaire soit portée devant un tribunal pour être jugé. Le bras armé de l’Etat, pour ce faire, s’appelle le parquet et le nom du magistrat qui a cette mission est le Procureur avec ses adjoints substituts etc.
Résumons d’abord cette affaire dans laquelle Mediapart donne le nom d’emprunt de Sarah à une jeune fille de 11 ans. Dans le Val-d’Oise, Sarah a eu une relation sexuelle avec un inconnu de 28 ans. Elle l’a suivi, puis a subi l’acte sans protester. Le parquet a conclu qu’elle était consentante. Seule le Parquet peut poursuivre !
Et cette conclusion du Parquet a pour conséquence que l’homme de 28 ans va être jugé pour « atteinte sexuelle », et non pour «viol.»
Mediapart appelle cela ironiquement : « Une spécificité française. »
Un viol sur mineur peut entrainer jusqu’à 20 ans de prison, ce qui n’est absolument le cas d’une atteinte sexuelle.
Voici plus précisément le récit que fait Mediapart de cette sordide histoire :
« Le 24 avril 2017, Sarah, 11 ans, scolarisée en sixième dans le Val-d’Oise, accepte de suivre un homme de 28 ans qui l’a abordée dans un square. […]
Cet après-midi-là, le cours de sports est annulé. Sarah sort donc du collège plus tôt, à 15 heures. Elle rentre doucement chez elle, fait une pause, quand « l’Homme » l’aborde dans un petit parc, avec « un ton rassurant, affable, aimable, rien qui n’incite à la méfiance », rapporte la mère de Sarah. Ce n’est pas la première fois. Dix jours, plus tôt, il l’a déjà accostée : « Eh ! belle gosse, tu habites dans le quartier ? Comment ça se fait que je ne t’ai jamais vue ? » Elle parle le soir même de cet homme à sa mère, qui lui conseille de rentrer en transports pour plus de sécurité. Quatre jours plus tard survient une nouvelle rencontre, lors de laquelle Sarah, qui fait un peu plus que son âge, finit par sortir son carnet de liaison scolaire pour lui prouver qu’elle a bien 11 ans. « Quand il a vu le carnet, il a dit : « Ha ! mais tu es un bébé ! » », raconte la mère de Sarah. Il s’agit toutefois d’un des seuls points que L’homme conteste : il assure qu’il ne connaissait pas l’âge exact de Sarah, et a déclaré à l’expert-psychiatre qu’il lui donnait entre 14 et 16 ans.
Lors de la troisième approche, dans le parc donc, il la complimente de nouveau : « Qui tu attends ? Ton petit copain ? », « Quoi ? Une belle fille comme toi n’a pas de petit copain ? », « Est-ce que tu veux que je t’apprenne à embrasser ou plus ? ». Sarah n’a jamais embrassé un garçon de sa vie. D’après sa mère, elle « a dû se sentir flattée, reconnue dans ce corps nouveau », que la puberté lui a donné. « Le piège s’est tissé sans qu’elle s’en rende compte, car elle n’avait pas la maturité pour comprendre. Elle n’a pas vu la manipulation. L’embrassade, elle l’a prise comme une plaisanterie. C’est une enfant : elle entend, mais ne comprend pas ce qui se cache derrière les propos. »
Sarah a alors une réaction que sa mère qualifie d’« atypique : elle n’a dit ni oui ni non, elle a haussé les épaules, sans donner de réponse claire et nette. » Sarah dira : « Il a insisté, et il m’a retourné le cerveau. » Elle accepte de le suivre, sans qu’il exerce la moindre violence physique.
Tous deux montent dans l’ascenseur, et dès que la porte se referme, il essaie de l’embrasser. « Elle a compris à cet instant que le piège s’était refermé sur elle, qu’on avait endormi sa conscience. Mais elle était tétanisée, elle n’osait pas bouger, de peur qu’il la brutalise. Elle a pensé que c’était trop tard, qu’elle n’avait pas le droit de manifester, que cela ne servirait à rien, et elle a donc choisi d’être comme une automate, sans émotion, sans réaction », relate sa mère.
Arrivés au 9e étage, il exige d’elle une fellation. Elle s’exécute. « Il lui demandait de manière pressante, mais en gardant le sourire », rapporte sa mère, infirmière de profession. Puis il essaie de la pénétrer, mais le gardien de l’immeuble passe par là. L’homme se cache. Sarah ne saisit pas le moment pour crier ou appeler au secours, ce qui participera à l’imperméabilité des policiers. « Elle était tétanisée, gênée, et avait honte », explique son avocate, Me Carine Diebolt.
L’homme lui propose alors de rentrer dans son appartement. Elle le suit. Il lui demande une deuxième fellation, puis d’enlever en partie son pantalon, et la pénètre. Ensuite, il l’embrasse sur le front. Et une fois qu’elle s’est rhabillée, lui dit de ne rien dire à personne. Il lui demande son numéro de portable, avant de lui proposer de la raccompagner chez elle. Elle décline.
À peine sortie, paniquée, elle appelle sa mère. « Elle était dans une peine immense, complètement désespérée. C’était comme si la vie avait perdu son sens. Une des premières choses qu’elle m’a dite, c’est : « Papa va croire que je suis une pute. » »
Ensuite Mediapart relate les propos de la mère de Sarah après qu’elle ait appelé la police qui auditionne la jeune fille et qui lui font ce retour :
« Ils m’ont expliqué qu’elle l’avait suivi sans violence, sans contrainte, que la seule chose qui jouait en sa faveur, c’était son âge. C’était comme si on me martelait un message pour que ça s’imprime. C’était complètement en décalage avec la tragédie. »
Mediapart rapporte aussi des propos tenus par le prédateur, puisqu’il m’est interdit par la justice française, pour l’instant, de l’appeler le violeur :
Pendant l’enquête, [Cet homme] a livré son sentiment sur les femmes : « Vous savez, maintenant, les filles sont faciles. Avant, à mon époque, il fallait rester au moins un an avec une fille pour la baiser, mais maintenant c’est en dix minutes. » L’homme peut difficilement plaider qu’il est incapable de déterminer l’âge d’un enfant : il est père d’un bébé, mais aussi d’un enfant de 9 ans. En outre, l’examen aux unités médico-judiciaires mentionne que « l’allure physique de Sarah peut laisser penser qu’elle est plus âgée, mais que ses mimiques de visage et sa manière de parler montrent rapidement qu’elle n’a que 11 ans ».
Mediapart explique que le parquet de Pontoise n’a pas souhaité répondre à ses questions sur la qualification choisie dans cette affaire.
L’avocate de Sarah va tenter de faire requalifier, lors de l’audience prévue en février, les faits d’« atteinte sexuelle » en « viol » et rappelle que l’article 227-25 du Code pénal définit ainsi l’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans : « Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » Il s’agit donc d’un rapport sexuel consenti, moins répréhensible qu’une agression sexuelle (pas de pénétration) ou un viol (avec pénétration), tous deux non consentis.
Le journal précise et analyse :
A contrario, pour qu’un viol (punissable de 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans sur mineur) ou une agression sexuelle soient caractérisés juridiquement, il doit être démontré que la victime a subi une contrainte, une violence, une menace ou une surprise (art. 222-22 et 222-23 du Code pénal). Il n’existe dans le Code pénal aucune atténuation à ce principe lorsque la victime est un enfant. Depuis 2005, la Cour de cassation considère cependant que la contrainte est présumée pour les enfants en « très bas âge ».
La loi du 8 février 2010 est seulement venue préciser que « la contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut désormais résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ».
La plupart des législations occidentales ont pourtant adopté une « présomption irréfragable d’absence de consentement du mineur victime d’actes sexuels » : 14 ans en Allemagne, Belgique, Autriche ; 16 ans pour l’Angleterre et la Suisse, 12 ans en Espagne et aux États-Unis. À chaque fois, avant que cet âge soit atteint, il ne peut y avoir consentement.
En se fondant sur ces comparaisons, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a préconisé dans son avis de novembre 2016 d’instaurer « un seuil d’âge de 13 ans en dessous duquel un enfant est présumé ne pas avoir consenti à une relation sexuelle avec un majeur ». Pour Ernestine Ronai, une des rapporteures de l’avis, et responsable de l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, « l’âge de 13 ans paraît adapté car c’est un âge en dessous duquel les relations sexuelles ne nous paraissent pas souhaitables. C’est aussi un âge couperet, qu’on retrouve souvent dans le droit français ».
Emmanuelle Piet, présidente du collectif féministe contre le viol, préférerait que ce soit 15 ans. Quand on lui parle de la situation de « Sarah, une jeune fille de 11 ans » (le terme employé par les policiers dans leur rapport au procureur), elle explose : « 11 ans ! Mais ce n’est pas une jeune fille ! C’est une petite fille ! » Puis elle se désespère : « C’est honteux. On a dû batailler 20 ans pour que l’âge légal du mariage soit le même pour les filles que pour les garçons [18 ans et non plus 15]. Mais que voulez-vous ? Les vieux garçons aiment la chair fraîche.
Je suppose que vous êtes aussi surpris que moi de cette affaire judiciaire et de la manière dont elle est actuellement traitée par le ministère public.
Il faut attendre que les juges du siège s’en emparent pour savoir s’ils vont requalifier les faits.
Mais pour l’instant et par rapport à ce que vit cet enfant, elle ne peut que se trouver dans un état de sidération et de culpabilité si l’autorité qui représente la société traite ces faits de cette manière.
Pour revenir à l’exergue de ce mot du jour qui tire les conséquences de la qualification du parquet, je ne peux pas être d’accord.
Un enfant de 11 ans ne peut être en situation de consentir à une relation sexuelle avec un adulte.
J’ai comme l’impression que nous nous retrouvons en pleine régression.
Non cet enfant n’est pas coupable, elle est la victime d’un pervers, d’un prédateur qu’il faut punir sévèrement et dissuader de recommencer.
C’est cela que j’attends de la société dans laquelle je vis et de l’autorité qui la représente.
<Voici le lien vers l’article de Mediapart>
<937>
-
Mardi 26 septembre 2017
« En France, on pense le concept en haut lieu,
on s’en tient à une idée globale qui peut parfois tenir sur le seul verso d’un ticket de métro »Philippe Oddo qui essaye d’analyser la différence entre les français et les allemandsL’Allemagne est un modèle pour certains et un repoussoir pour d’autres.
Mais connaissons-nous vraiment les allemands ?
Je me souviens, alors que je travaillais encore dans l’administration centrale de la Direction Générale des Impôts, je participais à un séminaire où intervenait un industriel français dont j’ai oublié le nom et qui nous parlait de son expérience en Allemagne :
Il venait de prendre la tête d’une filiale française en Allemagne et venait d’être invité à une réunion de patrons de la ville dans laquelle il était installé. Il nous a alors raconté un échange avec un patron allemand qui était venu vers lui et lui a posé la question : « Que faites-vous dans votre entreprise pour l’emploi des jeunes ? »
Notre patron français était un peu déconcerté par cette question et il a répondu comme un français raisonne :
« Je viens d’arriver, je ne connais pas toute la réglementation que vous mettez en œuvre ici, mais soyez assuré que nous respecterons strictement ce qui nous sera demandé ! »
Le patron allemand lui a répondu alors :
« Mais enfin il n’y a pas de réglementation spécifique sur ce sujet en Allemagne, c’est simplement pour chacun de nous une ardente obligation ».
Je ne peux pas assurer que le terme qu’il avait utilisé fût « une ardente obligation » que nous autres français avons liée au fameux « Plan » français. Mais ce qui est certain, c’était que la réponse contenait bien cette idée que le patron allemand poursuivait cet objectif de penser à l’emploi des jeunes parce qu’il considérait que c’était bon pour tout le monde d’agir ainsi et qu’il n’attendait pas une quelconque injonction de l’administration ou du gouvernement.
J’ai donc été intéressé par cet article du Point du 21/09/2017 qui donne la parole à Philippe Oddo, patron du groupe Oddo BHF qui a un pied en France et l’autre outre-Rhin.
L’article a pour objectif d’analyser les similitudes et les différences des deux pays.
J’en tire les extraits suivants :
Philippe Oddo : « […] Ce qui frappe d’abord en Allemagne, c’est combien l’entrepreneur est important et respecté. Faisons un peu de linguistique : là-bas, employeur se dit « Arbeitgeber », littéralement « celui qui donne un travail » ; quant à l’employé, « Arbeitnehmer », à savoir « celui qui prend le travail. Voilà qui en dit long sur le rôle de l’entrepreneur dans la culture allemande : chacun comprend que sa réussite bénéficie à tous… »
Philippe Oddo raconte d’abord sa vie en Allemagne et en tire de premiers enseignements :
« Je passe trois jours par semaine en Allemagne : deux à Francfort en moyenne, au siège, et au moins une journée un peu partout dans le pays à la rencontre de nos clients. Très souvent, je vais dans de petits villages, des bourgs, des villes moyennes où se trouvent de grosses entreprises et même des leaders mondiaux. Car l’entrepreneur reste fidèle à son village et à sa région, quoi qu’il arrive, qu’il reste petit, devienne moyen ou numéro un mondial, et cela de génération en génération. Ses enfants vont dans la même école que ceux de ses salariés, il s’implique souvent fortement dans la vie locale, crée une fondation d’entreprise – elles sont quatre fois plus importantes là-bas qu’en France – pour financer des musées, des infrastructures sportives, des programmes sociaux ou d’intégration des immigrés… Bien sûr, ce maillage territorial s’explique par le fait que l’Allemagne n’est absolument pas un pays centralisé. Elle n’a pas eu de Louis XIV ! […]
En fait, il n’y a que très peu d’endroits en Allemagne où les gens n’ont pas de perspectives. Alors qu’en France la seule issue, c’est bien souvent de partir vivre dans une grande ville – Lyon, Marseille ou Paris… »
Et il explique d’où vient son analyse parce qu’il a été contraint de faire travailler ensemble des français et des allemands. Il a donc fait usage de méthode pour arriver à cet objectif :
«Pour réussir la fusion, nous avons fait appel à des consultants pour bien comprendre les écarts culturels. Car ils existent et il faut parvenir à les gérer.
Parfois, c’est anecdotique, comme la ponctualité : pour un Français, arriver cinq minutes en retard, c’est être à l’heure, quand un Allemand est toujours en avance.
Mais d’autres différences peuvent avoir de lourdes conséquences. En France, on pense le concept en haut lieu, on s’en tient à une idée globale qui peut parfois tenir sur le seul verso d’un ticket de métro, puis les équipes se débrouillent pour la mettre en œuvre ; en Allemagne, à l’inverse, on ne prend aucune décision si toutes les implications n’ont pas été étudiées en détail et avec précision. Un processus de décision certes plus lent et plus méticuleux, mais parfaitement adapté à l’industrie, car rien n’est laissé au hasard.
D’autant que jamais un Allemand ne mettra en œuvre une décision venue de plus haut si lui-même n’est pas convaincu de sa pertinence.
Les Français pensent souvent que l’Allemand est discipliné, c’est une grave erreur ! S’il n’est pas d’accord, il ne bouge pas… Mais, une fois convaincu, plus besoin d’être derrière lui, plus besoin de s’en préoccuper, il agit. Parfaitement et sans jamais dévier. Voilà pourquoi les Allemands sont les meilleurs industriels au monde. N’oublions pas qu’ils exportent trois fois plus que nous ! Ce n’est pas une question de dumping social : les Allemands ne sont pas moins payés que les Français, ils ne travaillent pas beaucoup plus, d’ailleurs peut-être même ne travaillent-ils pas davantage, ce sont avant tout des industriels hors pair. »
Un processus de décision plus lent, une implication du « terrain » pour le dire vite, moins de technocratie, moins de concept …
Et ce jugement : «jamais un Allemand ne mettra en œuvre une décision venue de plus haut si lui-même n’est pas convaincu de sa pertinence. ».
Alors qu’il reconnait qu’en France, les injonctions viennent d’en haut et sont en réalité des concepts dont la vacuité est décrite par l’étalon d’un ticket de métro. Cette image m’a beaucoup plu, c’est pourquoi j’en ai fait l’exergue de ce mot du jour.
Peut-être que Macron devait méditer sur ce point…
Du point de vue de la question controversée du coût du travail, il affirme :
« Certes, quand on regarde le coût du travail là-bas par rapport à la France, l’écart de charges sociales est quand même énorme. Je suis bien placé pour l’observer. Pour 40 000 euros net dans la poche du salarié avant impôt, cela nous coûte, à nous employeurs, 30 % plus cher en France qu’en Allemagne. Si on monte à 100 000 euros de revenu net, l’écart grimpe à 50 %. Et même à 70 % de plus pour 400 000 euros. Dans l’autre sens, il faut avoir en tête également que les rémunérations sont plus élevées en Allemagne qu’en France alors même que le coût de la vie y est très souvent inférieur – à Francfort, le logement, le transport, l’alimentation, tout est moins cher. Mais ces rémunérations plus élevées ne compensent pas, pour l’employeur, l’écart de charges sociales. »
Concernant le droit du travail qui est une autre cause de crispation en France, il explique qu’il n’y a pas forcément moins de rigidité en Allemagne, mais l’extraordinaire force des entreprises vient aussi d’une relation patronat-syndicat basée sur une confiance et une écoute réciproque qui semble aujourd’hui totalement hors de portée en France :
« Attention, l’Allemagne a aussi ses rigidités, par exemple la durée des préavis : quand les gens démissionnent, ils doivent rester encore dans l’entreprise au moins six mois, ce qui peut freiner le recrutement de compétences à l’extérieur. Contrairement à ce que beaucoup croient, il n’est pas plus facile d’y licencier qu’en France. Il faut absolument obtenir l’agrément du comité d’entreprise. Ah, le Betriebsrat ! [Comité d’entreprise] Dès qu’on est entré en négociations pour acheter BHF, j’ai vite rencontré la présidente du comité d’entreprise pour connaître son état d’esprit ; elle m’a alors expliqué que l’intérêt des salariés était que la banque retrouve son prestige. Aujourd’hui encore, je la vois très régulièrement, c’est presque un second département des ressources humaines : sa démarche est toujours constructive, elle n’est pas dans la négociation permanente, elle peut dire : « Là, il y a un problème à résoudre pour que l’entreprise marche bien » ; et donc je l’écoute attentivement. C’est la fameuse cogestion à l’allemande. Au conseil de surveillance de la filiale allemande, trois des sept membres sont des élus du personnel, avec absolument le même pouvoir que les autres. »
Toutes ces réflexions me poussent à dire que ce n’est probablement pas les qualités les plus fécondes de l’Allemagne que mettent en avant les politiques qui veulent réformer la France et donnent l’Allemagne en exemple.
<936>
-
Lundi 25 septembre 2017
« L’Allemagne a été gouvernée quasi sans exception par une coalition depuis 1949 ! Toutes ces coalitions, sauf une, ont conduit la politique jusqu’au terme de la législature. C’est une stabilité absolue. »Olivier DuhamelDonc Angela Merkel sera très probablement Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne pour la quatrième fois !
Probablement, parce que l’élection de ce dimanche, en Allemagne, n’était pas l’élection du chancelier allemand, mais une élection pour élire des députés pour le Bundestag selon leur appartenance à un Parti Politique.
Et maintenant, la tête de liste du parti arrivé largement en tête 33% (pour comparer Emmanuel Macron a obtenu au premier tour des présidentielles 24 %) va négocier pendant plusieurs mois avec d’autres partis pour former une coalition et un accord de gouvernement dans lequel ces partis vont se mettre d’accord sur ce qu’ils vont faire.
Et croyons-nous cela, nous autres français, ils vont appliquer pendant la législature ce qu’ils auront négocié dans le pacte de gouvernement !
Mais les « ravis de la crèche » français vont dire : mais c’est ce que fait Macron !
Macron c’est moins du quart des électeurs qui se sont exprimés, et il gouverne tout seul entourés de députés qui suivent aveuglément ses ordres.
Angela Merkel qui part de 33% va se mettre d’accord avec d’autres pour pouvoir mettre en œuvre une politique ! Et encore elle devra tenir compte de ses amis du CDU et surtout du CSU bavarois pour accepter les conditions et l’accord avec les Verts et les Libéraux, si finalement c’est cette coalition qui finalise l’accord.
Si vous ne comprenez pas l’immense différence avec le système français, c’est que vous ne comprenez rien à la démocratie et au gouvernement des hommes en démocratie libérale !
Personne n’imagine un seul instant qu’il ne sera pas possible de créer une coalition.
Pour ma part, je suis persuadé que si en fin de compte cela s’avère très compliqué, le SPD reviendra sur sa décision de ne pas participer à la coalition.
Car en Allemagne, les politiques considèrent toujours qu’il faut préférer l’intérêt du pays à l’intérêt de son parti.
Le politologue Olivier Duhamel a poussé un « coup de gueule, lors de son émission de ce samedi sur Europe 1 : <Mediapolis>
(Un peu après 20 mn d’émission) :
« C’est très important de comprendre comment fonctionnent les élections allemandes.
Les uns ne regardent qu’une chose : est-ce que Merkel va être chancelière ou pas ?
Alors certains font un petit effort et regardent une deuxième chose est ce que l’extrême droite va entrer au Parlement et à quel niveau ?
Mais rare sont ceux qui regardent la troisième chose : qui est la chose fondamentale : avec qui va-t-elle gouverner ?
Parce que je veux dire à nos auditeurs monarchisés, césaro-papisés au dernier degré par la culture française comme nous le sommes tous :
- Que ce n’est pas une élection présidentielle ;
- Que c’est une élection à la proportionnelle, non un scrutin majoritaire ;
- Et qu’il y aura une coalition.
Alors en France quand on vous dit qu’il y aura une coalition, on dit : « c’est l’horreur, ils ne pourront pas gouverner ! Il y aura une instabilité ! »
C’est débile de dire cela !
L’Allemagne a été gouvernée quasi sans exception par une coalition depuis 1949 !
Toutes ces coalitions, sauf une, ont conduit la politique jusqu’au terme de la législature.
C’est une stabilité absolue.
Une chancelière qui va être réélue une quatrième fois. C’est le sommet de la stabilité, avec proportionnel et coalition.
Alors si cela pouvait ouvrir un peu l’esprit de nos amis monarchistes, c’est-à-dire quasi tout ceux qui nous écoutent, ce serait une très bonne nouvelle »
Pour donner plus de résonnance à cette analyse tranchée, comparons un peu nos pays depuis 1974.
Il faut évidemment tenir compte du régime « bâtard » français : quand l’élection législative confirme l’élection présidentielle et transforme la chambre des députés en simple chambre d’enregistrement, celui qui gouverne la France est le Président de la République. Quand ce n’est pas le cas, nous appelons cela « la cohabitation » et celui qui gouverne est le premier ministre.
En Allemagne celui qui gouverne est le chancelier.
En 1974, Helmuth Schmidt est devenu chancelier le 16 mai 1974 et Valéry Giscard d’Estaing devient président le 27 mai 1974, 11 jours plus tard.
Et puis voilà ce qui va se passer :
FRANCE ALLEMAGNE 1974 : Valery Giscard d’Estaing (1) 1974 : Helmut Schmidt (1) 1981 : François Mitterrand (2) 1982 : Helmut Kohl (2) 1986 : Jacques Chirac (cohabitation) (3) 1988 : François Mitterrand (4) 1993 : Edouard Balladur (cohabitation) (5) 1995 : Jacques Chirac (6) 1997 : Lionel Jospin (cohabitation) (7) 1998 : Gerhard Schröder (3) 2002 : Jacques Chirac (8) 2005 : Angela Merkel (4) 2007 : Nicolas Sarkozy (9) 2012 : François Hollande (10) 2017 : Emmanuel Macron (11) D’un côté 11 gouvernants, 8 si on compte que Chirac apparait trois fois et Mitterrand deux fois. De l’autre 4 !
Coalition, accord de gouvernement voici les recettes allemandes !
Les recettes françaises sont en devenir ?
- Que ce n’est pas une élection présidentielle ;
-
Vendredi 22 septembre 2017
« Le bébé gnou protégé par la lionne »Histoire naturelleDans la nature il y a des prédateurs et des proies.
Et la loi de la nature est la loi du plus fort
De nombreuses théories humaines politiques et économiques se fondent sur ce constat pour élaborer des analyses qu’ils essayent d’appliquer au monde des humains.
Franz de Waal, nous explique que les choses sont plus complexes. Il ne dit pas que la nature n’est pas peuplée de prédateurs et de proies mais qu’il arrive que d’autres phénomènes puissent exister.
Des cinéastes animaliers avaient le projet de tourner un film sur la migration des gnous du Serengetti dans le nord de la Tanzanie. C’est ce qu’ils vont faire. Mais pendant leur tournage, ils vont assister et filmer un épisode incroyable.
Une petite femelle gnou vient de naître. Dans la journée de sa naissance elle va être chassée par une lionne, la mère gnou ne peut pas la sauver. La lionne renifle la petite gnou de quelques heures, on pense qu’elle va la dévorer. Et cela ne se passe pas ainsi
L’empathie dont parle Franz de Waal se produit devant la caméra et par voie de conséquence devant nos yeux.
Le commentateur évoque la thèse que peut être la lionne a perdu ses petits et exprime ses instincts maternels sur un petit de substitution.
Peut-être que se rendant compte que cet animal porte encore toutes les traces de sa naissance, la lionne considère-t’elle qu’elle ne doit pas le tuer.
Toujours est-il que la lionne et la petite gnou se font des câlins que la présence de la lionne fait renoncer des hyènes de faire de la petite gnou leur repas. Par la suite la lionne laisse partir le bébé gnou rechercher et retrouver sa mère.
Le documentaire continue alors sur son projet initial : montrer les migrations de ces animaux qui reviennent régulièrement vers le Serengetti mais doivent s’en éloigner lors de la saison sèche.
C’est ce que nous montre la nature.
La violence existe, le conflit, la mise à mort des proies par leurs prédateurs.
Mais l’empathie, la protection même inattendue entre espèces peut exister aussi.
C’est une leçon de vie, c’est une leçon de complexité.
Ce film s’appelle « sauvée par la lionne », vous le trouverez derrière <ce lien>.
L’épisode dont je parle commence vers la sixième minute.
<934>
-
Jeudi 21 septembre 2017
« Dulcie September »Femme politique sud africaine assassinée à ParisDulcie September était une militante anti-apartheid sud-africaine qui a été assassinée le 29 mars 1988 à Paris, à l’âge de 54 ans..
L’ANC, le mouvement de Nelson Mandel, n’est plus considéré comme une organisation terroriste par la France après 1981 et peut ouvrir un bureau à Paris.
C’est Dulcie September qui en prend la direction au début de 1984.
Wikipedia nous rappelle :
« qu’après une agression dans le métro à l’automne 1987, Dulcie September demande une protection policière qui lui est refusée. Craignant pour sa sécurité, elle déménage pour Arcueil, rue de la Convention.
Le 29 mars 1988, peu avant 10 heures, elle est assassinée sur le palier des bureaux de l’ANC au 4e étage du 28 rue des Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement de Paris, de cinq balles tirées à bout portant avec un calibre 22 équipé d’un silencieux. »
Et puis…
« Aucun coupable n’a jamais été identifié. En 1992, un non-lieu est prononcé, et l’affaire classée. »
Dans un article de 1997, <Libération> donnait la parole à Peter Hermes, le directeur de l’Institut néerlandais pour l’Afrique australe qui affirmait :
«Dulcie September a été tuée le 29 mars 1988 par les services secrets sud-africains avec la complicité passive des services secrets français»
Pourquoi parler de cette affaire aujourd’hui ?
Parce qu’un journal sud-africain a pu consulter des archives qui ont été rendues publiques.
J’ai pu accéder à cette information par la <Revue de Presse du 14 septembre 2017 de François Cluzel sur France Culture> :
« Le journal de Johannesburg DAILY MAVERICK, repéré par le Courrier International, nous apprend cette semaine comment la France a armé le régime de l’apartheid. Grâce à des archives inédites, un chercheur sud-africain raconte comment des agents du pouvoir raciste, installés dans les locaux de l’ambassade sud-africaine à Paris, ont pu acheter illégalement des armes et des bombes, avec l’aide des services français. Tout cela semble inouï et digne d’un roman d’espionnage. Et pourtant, telle est la banalité du mal.
Le gouvernement de l’apartheid, lui, avait besoin d’armes et l’industrie française de l’armement, elle, avait besoin d’argent. Bien évidemment, consciente de l’existence de l’embargo (que les Français étaient censés faire respecter en tant que membres du Conseil de sécurité de l’ONU), la DGSE a suggéré des solutions simples, comme le transfert clandestin des armes par le Zaïre (l’actuelle République démocratique du Congo).
Et l’article de préciser encore que dans les années 80, déjà, une militante courageuse, Dulcie September, représentante de l’ANC, avait osé enquêter sur ce commerce d’armes illégal entre la France et le régime de l’apartheid, avant d’être assassinée en 1988 à Paris. »
Cet article reproduit par Courrier International est disponible sur internet : <ICI>
Vous y lirez que la compagnie Thomson-CSF (devenue Thales) a été l’un des principaux bénéficiaires de ce trafic illégal d’armes.
Et puis on apprend qu’en plus des services secrets le vin permettait de mettre du « liant » :
PW Botha, ministre sud-africain de la Défense, puis Premier ministre [1978-1984], a joué un rôle crucial dans cette relation.
Selon un itinéraire daté des 8-10 juin 1969 et intitulé « Voyage de M. Botha », nous savons qu’il s’est rendu dans le sud de la France à l’invitation de l’entreprise française d’armement Thomson-CSF pour tester des missiles et déguster du vin.
Cette visite a permis la rencontre du PDG Paul Richard avec PW Botha, des généraux et des ambassadeurs sud-africains et français à l’hôtel La Réserve, près de Bordeaux. Dans la journée, ils ont testé le nouveau missile Cactus que Thomson-CSF avait conçu avec l’aide de l’Afrique du Sud.
Le soir, ils sont passés à la dégustation de vins et ont fêté leur collaboration. Le gouvernement de l’apartheid avait besoin d’armes et l’industrie française de l’armement avait besoin d’argent, d’où la création d’une alliance durable, dont les répercussions sont encore visibles aujourd’hui.
 Et cet article se conclut ainsi :
Et cet article se conclut ainsi :
« Une militante courageuse a toutefois osé enquêter sur le commerce d’armes illégal entre la France et le régime de l’apartheid, et elle l’a fait dans les années 1980, point culminant de ce trafic. Dulcie September, représentante de l’ANC à Paris, a entrepris cette tâche aussi difficile que dangereuse avec des moyens extrêmement limités. »
En mars 1988, le président était François Mitterrand, mais le premier ministre était Jacques Chirac. Nous étions en cohabitation. Et c’est ce gouvernement de cohabitation qui a refusé une protection à Dulcie September.
Et cet article du journal sud-africain, révèle que Jacques Foccart entretenait d’excellentes relations avec les services sud-africains. Faut-il le rappeler, Jacques Foccart était le personnage incontournable du concept et de la réalité de la « Françafrique » et il était un ami de longue date de Jacques Chirac.
Ainsi meurent courageusement des femmes et des hommes qui veulent dénoncer les sombres manœuvres des marchands d’armes et de leurs complices, les services secrets et les gouvernements qui les protègent.
Et dans ces cas, bien sûr, les assassins ne sont jamais inquiétés.
<933>
-
Mercredi 20 septembre 2017
« Je suis donc venu ce soir pour remercier
la terre et l’âme de ce peuple qui m’a tant donné »Léonard Cohen Remerciant l’Espagne et les espagnolsUn soir de juin, Annie est rentrée à la maison et m’a dit, il faut qu’on regarde quelque chose sur internet…
Alors nous avons regardé une vidéo.
La vidéo d’un discours de remerciement, de gratitude.
Celui qui faisait ce discours était Léonard Cohen.
J’ai eu envie de partager avec vous, après Maria Callas, ce récit, ce discours d’un autre musicien, d’un poète, d’un artiste qui nous a quitté il y a moins d’un an, le 7 novembre 2016.
Ce discours avait pour raison d’être une récompense : le Prix Prince des Asturies dans la catégorie Littérature.
Le Prince des Asturies est dans la monarchie espagnole le titre que porte l’héritier du trône.
Le prix Prince des Asturies est le plus prestigieux prix espagnol, délivré par une Fondation espagnole et récompensant des travaux d’envergure internationale dans huit catégories : arts, sports, sciences sociales, communication et humanités, concorde, coopération internationale, recherche scientifique et technique et lettres.
Et, le 21 octobre 2011, Léonard Cohen monta à la tribune et de sa voix grave et profonde prononça un discours et révéla un secret de sa vie, secret pour lequel il remercia la terre d’Espagne.
Voici la fin de ce discours :
« J’ai une guitare Condé, qui a été fabriquée en Espagne dans le formidable atelier du 7 de la rue Gravina [à Madrid]. Un superbe instrument, que j’ai acheté il y a plus de quarante ans. Je l’ai sorti de son étui, l’ai soulevé – il paraissait empli d’hélium tellement il était léger. Je l’ai porté à mon visage, que j’ai approché de la rosace superbement dessinée, et j’ai humé le parfum du bois vivant. Vous savez que le bois ne meurt jamais.
J’ai humé le parfum du cèdre, aussi frais qu’au premier jour, le jour où j’avais acheté cette guitare.
Et une voix a alors semblé me dire : « Tu es un vieil homme et tu n’as pas dit merci, tu n’as pas rendu ta gratitude à la terre d’où ce parfum a levé. » Je suis donc venu ce soir pour remercier la terre et l’âme de ce peuple qui m’a tant donné.
Car aussi vrai qu’une carte d’identité ne fait pas un homme, une notation financière ne fait pas un pays.
Vous connaissez le lien profond et confraternel qui m’associe au poète Federico García Lorca. Quand j’étais jeune homme, adolescent, je désirais ardemment trouver une voix. J’ai étudié les poètes anglais, je connaissais bien leurs œuvres, j’ai copié leurs styles ; mais je n’ai pas pu trouver de voix. Ce n’est qu’en lisant les œuvres de Lorca que – même par le biais d’une traduction – j’ai compris qu’il y avait là une voix. Non pas que je l’ai copiée ; je n’aurais pas osé. Mais Lorca m’a donné la permission de trouver une voix, de la localiser, c’est-à-dire de localiser un moi – un moi qui ne soit pas figé, qui lutte pour sa propre existence.
En prenant de l’âge, j’ai compris que cette voix portait des instructions.
Quelles étaient-elles ? Ces instructions disaient de ne jamais se lamenter avec désinvolture.
Et qu’à exprimer la grande et inévitable défaite qui nous attend tous, autant le faire dans les strictes limites de la dignité et de la beauté.
J’avais donc une voix ; mais je n’avais pas d’instrument. Je n’avais pas de chanson.
Je vais maintenant vous raconter très brièvement comment j’ai trouvé ma chanson.
J’étais un guitariste quelconque. Je ne connaissais que quelques accords. Avec mes amis de l’université, j’aimais m’asseoir et boire en chantant des folk songs et les chansons populaires du moment ; mais jamais au grand jamais je ne me serais considéré comme un musicien ou un chanteur.
Un jour, au début des années 60, j’étais en visite chez ma mère, à Montréal. Sa maison se trouvait le long d’un parc qui comprenait un court de tennis ; beaucoup de gens s’y pressaient, pour regarder les beaux jeunes joueurs qui pratiquaient leur sport. Je suis allé traîner dans ce parc que je connaissais depuis mon enfance. Il y avait là un jeune homme qui jouait de la guitare. C’était une guitare flamenco, et il était entouré par deux ou trois filles et garçons qui l’écoutaient. J’ai adoré sa façon de jouer, j’étais captivé. C’était ainsi que je voulais jouer ; et c’était ainsi, je le savais, que je ne serais jamais capable de jouer.
Pendant un moment, je suis resté assis au côté des autres auditeurs. Et quand vint un silence, un silence adéquat, j’ai demandé à ce garçon s’il voulait bien me donner des leçons de guitare. Il était originaire d’Espagne, et nous ne pouvions lui et moi communiquer que dans un mauvais français – il ne parlait pas anglais. Il a accepté de me donner des cours. J’ai montré la maison de ma mère, que nous pouvions voir depuis le court de tennis, et nous avons convenu d’un rendez-vous et d’un tarif.
Le lendemain, il s’est présenté chez ma mère et m’a dit : « Joue moi quelque chose ». J’ai essayé de jouer quelque chose, et il a ajouté : « Tu ne sais pas jouer, n’est-ce pas ? » « Non », ai-je répondu, « je ne sais pas. » « D’abord », a-t-il dit, « laisse-moi accorder ta guitare. Elle sonne complètement faux. » Il a donc pris la guitare et l’a accordée. « Ce n’est pas une mauvaise guitare », a-t-il dit. Ce n’était pas la Conde, mais ce n’était pas une mauvaise guitare. Il me l’a rendue. « Et maintenant, joue ».
Je ne pouvais pas mieux jouer.
Il m’a dit : « Laisse-moi te montrer quelques accords. » Il a saisi la guitare, et de cette guitare a jailli un son que je n’avais jamais entendu auparavant. Puis il a joué une suite d’accords avec un trémolo, avant de me dire : « A toi, maintenant ». « C’est hors de question », ai-je répondu, « j’en suis incapable. » « Laisse-moi poser tes doigts sur les frettes. » Une fois que ce fut fait, il a répété : « Maintenant, maintenant, joue. »
Ce fut un désastre. « Je reviendrai demain », me dit-il.
Il revint le lendemain, posa mes mains sur la guitare, et plaça la guitare sur mes genoux de la manière la plus appropriée. Je rejouai à nouveau les mêmes accords – une progression de six accords, sur laquelle reposent beaucoup de chansons de flamenco.
Ce jour-là, je fus un peu meilleur.
Au troisième jour, il y eut une amélioration – un semblant d’amélioration. Mais maintenant, je connaissais les accords. Et je savais que, même si je ne pouvais pas coordonner mes doigts avec mon pouce, de façon à produire le trémolo correctement, je connaissais les accords ; je les connaissais très, très bien.
Le jour suivant, le jeune homme ne vint pas. Il ne vint pas. J’avais le numéro de téléphone de sa pension à Montréal. J’ai appelé pour savoir pourquoi il avait manqué notre rendez-vous.
On m’a répondu qu’il avait mis fin à ses jours. Qu’il s’était suicidé.
Je ne connaissais rien de cet homme. Je ne savais pas de quelle région d’Espagne il était originaire. Je ne savais pas pourquoi il était venu à Montréal. Je ne savais pas pourquoi il avait séjourné là-bas, pourquoi il était apparu vers ce court de tennis. Je ne savais pas pourquoi il s’était donné la mort.
J’étais profondément affligé, bien sûr. Mais je vais divulguer maintenant quelque chose dont je n’ai jamais parlé en public. Ce sont ces six accords, ce sont ces motifs de guitare qui ont fourni la base de toutes mes chansons et de toute ma musique. Vous comprendrez dès lors dans quelles proportions s’exprime la gratitude que j’éprouve pour ce pays.
Tout ce que vous avez trouvé digne de vos faveurs dans mon travail provient d’ici.
Tout, tout ce que vous avez trouvé digne de vos faveurs dans mes chansons et ma poésie, a été inspiré par cette terre.
Je vous remercie donc infiniment pour la chaleureuse hospitalité dont vous avez fait preuve à l’endroit de mon œuvre ; car elle est vraiment la vôtre, et vous m’avez permis d’apposer ma signature au bas de la page. »
Si vous voulez entendre ce discours, en anglais, avec la belle voix de Léonard Cohen : <Discours de Léonard Cohen de 2011>
J’ai repris la traduction que propose <ce site>
Gracias à la vida de nous avoir donné Maria Callas.
Gracias à la vida de nous avoir donné Léonard Cohen
Et Gracias à la vida qui a rendu possible qu’un mystérieux espagnol ait su, en 3 jours, avant de quitter cette terre, permettre à Léonard Cohen de trouver son instrument.
<Leonard cohen Bird On The Wire>
 Comme l’oiseau sur le fil
Comme l’oiseau sur le fil
Comme l’ivrogne dans une église
J’ai tenté d’être libre à ma façon
Comme le ver au bout du fil
Comme le chevalier d’un ancien livre
J’ai gardé pour toi ma chanson
Si vous voulez lire les paroles et la traduction intégrale <Bird on the wire>
Et si vous voulez comprendre pourquoi Léonard Cohen est éternel, il faut écouter ces quatre enfants russes chanter Halleluyah, comme l’ont fait 14 millions d’internautes avant vous.
-
Mardi 19 septembre 2017
« J’ai vécu d’art, j’ai vécu d’amour »Puccini, Tosca, Vissi d’arteJ’ai fini le mot du jour d’hier, consacré à l’artiste Maria Callas, par son interprétation de la Tosca.
Aujourd’hui pour parler de la femme, de sa vie de femme je trouve pertinent d’utiliser, comme exergue, les premiers mots de ce qu’on appelle la prière de la Tosca, dont vous trouverez le texte intégral derrière <ce lien>.
Maria Callas est née le 2 décembre 1923 à New York sous le nom de Sophia Cecelia Kalos alors que sont père avait pour nom patronymique Kaloyeropoulos. Wikipedia écrit :
« On ignore la date exacte à laquelle le nom de Callas remplaça Kalos, qui lui-même avait remplacé Kaloyeropoulos, ni même s’il l’a réellement remplacé »
L’enfance de Maria Callas se passa dans une famille désunie dont le père fut d’abord absent puis séparé de sa mère.
Les relations de Maria Callas avec sa mère furent conflictuelles. Sa mère est décrite comme une personne au proie à des crises d’hystérie ou de dépression et d’un caractère irascible. L’attitude volage et peu responsable du père explique certainement en partie cette situation.
Maria Callas a toujours déclaré qu’elle avait le sentiment que sa mère lui préférait sa sœur Jackie.
En 1957, au cours d’un entretien télévisé, elle confia :
« À l’âge auquel les enfants devraient être heureux, je n’ai pas eu cette chance. J’aurais souhaité l’avoir. ».
Wikipedia cite Time Magazine en 1956 :
« Ma sœur était mince, belle et attirante si bien que ma mère l’a toujours préférée à moi. J’étais un vilain petit canard, grosse, maladroite et mal-aimée. Il est cruel pour un enfant de ressentir qu’il est laid et non désiré… Je ne lui pardonnerai jamais de m’avoir volé mon enfance. Pendant toutes les années où j’aurais dû jouer et grandir, je chantais ou gagnais de l’argent. J’avais toutes les bontés pour elle et tout ce qu’elle me rendait était du mal… »
Dans son ouvrage « Maria Callas », Jacques Lorcey rapporte ces propos de Maria Callas, à propos de ses débuts de cours de chant :
« J’ai chanté parce qu’on m’a fait chanter ! Je n’en avais pas spécialement envie… »
Les musicologues Roland Mancini, John Ardoin et Arianna Stassinopoulos expriment la conviction que sans la détermination de sa mère, il n’y aurait probablement pas eu de Maria Callas.
Dans l’émission de la télévision française citée hier, Maria Callas exprimait cet éthique de sa part de faire bien ce qu’elle devait faire. Elle s’est donc appliquée à bien apprendre à chanter.
Ainsi, elle eut une enfance où manquait un père et la tendresse maternelle.
Comment expliquer autrement que par la recherche d’un père son mariage en 1949 avec le terne Giovanni Battista Meneghini, un industriel italien mélomane, qui non seulement était de vingt-huit ans son aîné, mais avait à cette date plus du double de son âge. D’ailleurs il semble bien que très rapidement Meneghini s’occupa surtout de gérer la carrière de son épouse plutôt que de jouer un rôle de compagnon et d’époux.
La rencontre en 1959 avec Aristote Onassis, grec comme elle, flamboyant et séducteur, fut un vrai bouleversement dans sa vie de femme.
M’intéresser à cette relation m’a conduit à examiner de plus près cet homme extravagant qui s’appelait Aristote et avait pour père Socrate Onassis et comme oncle Homère Onassis. Il appela son fils Alexandre. Seule sa fille eut un prénom qui ne revendiquait pas de glorieux ancêtres grecs : Christina.
Sa relation avec Maria Callas fut celle à la fois du séducteur, puis d’un persécuteur et disons d’un malotru pour finalement toujours revenir chercher l’affection et le soutien de Maria Callas.
Sa rencontre et le début de cette relation amoureuse eu pour conséquence de l’éloigner de la scène. Entre 1959 et 1965, elle n’apparaît que dans quelques rares productions à Paris, Londres et New York. Elle s’installe à Paris, donne de rares récitals et essaye de se convertir dans l’enseignement.
D’ailleurs, Onassis ne faisait pas partie de ses admirateurs fervents car il n’aimait pas particulièrement l’opéra.
Gala ne fait pas partie de mes lectures habituelles, mais j’ai trouvé cet article qui, écrit bien sûr dans le style de Gala, me semble assez proche de ce que j’ai lu dans des ouvrages plus sérieux sur Maria Callas.
Ce journal rapporte notamment un échange entre l’immense artiste et le milliardaire. Onassis s’offrit une île grecque Skorpios, ile sur laquelle il est d’ailleurs enterré ainsi que son fils. Un jour, alors qu’elle lui faisait remarquer qu’il dépensait beaucoup trop pour son île, il se mit en rage. :
«N’oublie jamais que tout ce qui touche à mon plaisir et à mes distractions doit être prêt à l’emploi. C’est la même chose avec mes maîtresses. Je m’assure qu’elles sont rodées avant de les prendre.
– Je ne comprends pas? Que veux-tu dire?
– Exactement ce que j’ai dit.»
Encore un de ces mâles malveillants qui ne peut que nous rendre, nous autres hommes, peu fier d’appartenir à notre genre.
Et puis il y eut la trahison finale, car Maria Callas dans son échelle des valeurs voulaient épouser l’homme qu’elle aimait. Toujours dans l’émission de la télévision française citée hier, Maria Callas exprimait sa vision du monde :
«Dans notre société, les hommes sont polygames, pas les femmes !»
Bien qu’elle fusse rebelle et eut du caractère, elle accepta cependant cette relation déséquilibrée avec un mâle alpha de l’espèce homo sapiens. C’est ainsi selon ce qu’elle rapporta par la suite, elle apprit le futur mariage sur l’île de Skorpios de son homme aimé avec Jackie Kennedy par les journaux, comme le reste du monde.
Cependant le mariage d’Aristote Onassis avec Jackie Kennedy tourna rapidement au désastre. Et très vite, Onassis repris contact avec Maria Callas. L’ancienne secrétaire privée de l’armateur et le journaliste américain Nicholas Gage racontent qu’ils continueront de se voir jusqu’à la fin, au 36 de l’avenue Georges-Mandel à Paris.
Aristote lui confia ses déboires sentimentaux et aussi ses déboires financiers. On a beau être un mâle dominateur on a quand même besoin d’une femme de confiance pour être écouté et consolé.
Toutefois, Maria Callas montra quand même du caractère semble t’il et même du mauvais car lors de ses dernières années de leur vie, si leurs relations furent continues, elles furent orageuses ;
Jacque Lorcey dans son livre Maria Callas, écrit par exemple page 340 :
« Elle refuse de lui ouvrir. Sans se soucier des voisins, Aristote crie pendant de longs moments. :
- Si tu n’ouvres pas, je fais défoncer la porte par ma rolls !
- Si tu entres, je te jette par la fenêtre ! Espèce de petit marchand qui se prend pour Jupiter !… »
Mais ce fut bien Maria Callas qui fut sa dernière visite à l’hôpital de Neuilly, le 15 mars 1975, jour de son décès.
Après cette mort elle dit :
« J’ai perdu tout ce qui me rattachait à la vie »
 La diva se retira de plus en plus du monde dans son appartement parisien. La mort d’Onassis en 1975 achève de la murer dans sa solitude. Épuisée moralement et physiquement, prenant alternativement des barbituriques pour dormir et des excitants dans la journée, elle meurt le 16 septembre 1977, à l’âge de 53 ans.
La diva se retira de plus en plus du monde dans son appartement parisien. La mort d’Onassis en 1975 achève de la murer dans sa solitude. Épuisée moralement et physiquement, prenant alternativement des barbituriques pour dormir et des excitants dans la journée, elle meurt le 16 septembre 1977, à l’âge de 53 ans.
La cérémonie funèbre a lieu, le 20 septembre 1977. Maria Callas est incinérée au cimetière du Père-Lachaise où une plaque lui rend hommage.
Après le vol de l’urne funéraire, retrouvée quelques semaines plus tard, ses cendres (ou ce que l’on pense être comme telles) seront dispersées en mer Egée, au large des côtes grecques, selon son vœu.
La Bible de l’opéra comme l’avait baptisée Leonard Bernstein ne survécut donc que deux ans à cet homme auquel elle sera resté attacher jusqu’au bout.
L’amour est aveugle. Maria Callas fut aussi tragédienne dans sa vie privée.
Mais il me semble qu’il y avait là une sorte de soumission de la femme, un peu comme Anne Pingeot à l’égard de François Mitterrand qui comme je l’ai rapporté dans le mot du jour du 27/10/2016 a dit finalement : «En même temps, ce côté de soumission a fait en sorte que j’ai accepté l’inacceptable. »
Accepter l’inacceptable ! Accepter même quand la femme est une des plus grandes artistes que la terre ait porté et qu’elle le savait et qu’en face il n’y avait qu’un marchand, un homme d’affaires cynique dont la seule réussite fut l’argent et dont la trace dans l’Histoire reste médiocre surtout comparé à Maria Callas.
Je finirai par la sagesse de Cocteau :
«Surtout, surtout… sois indulgent,
Hésite sur le seuil du blâme.
On ne sait jamais les raisons
Ni l’enveloppe intérieure de l’âme,
Ni ce qu’il y a dans les maisons,
Sous les toits, entre les gens. »<931>
- Si tu n’ouvres pas, je fais défoncer la porte par ma rolls !
-
Lundi 18 septembre 2017
« La diva, c’est celle qui apporte l’exemple d’un travail, d’une discipline et d’une grande maîtrise du métier »Maria Callas dans un entretien accordé à L’Express le 19 janvier 1970Ce week-end, tout le monde était invité à visiter le patrimoine de la France.
Je vous invite à échanger sur un monument du patrimoine de l’art et de la musique de l’humanité.
En effet, ce samedi nous étions le 16 septembre. Or, il y a 40 ans, le 16 septembre 1977, Maria Callas décédait brutalement à l’âge de 53 ans, dans son appartement au no 36 de l’avenue Georges Mandel dans le 16ème arrondissement de Paris.
Beaucoup de choses ont été dites, écrites sur elle, sur son caractère, ses caprices, sur son ego, sur ses faiblesses, sur ses déchirures.
Mais revenons aux fondamentaux. Éloignons-nous de ce qui est futile pour nous centrer sur l’essentiel.
L’essentiel c’est quoi ?
Maria Callas était unique. L’opéra a changé à partir d’elle, il y avait l’opéra avant Maria Callas et il y a l’opéra après Callas.
D’abord l’opéra était devenu le lieu de la performance où les divas et les ténors rivalisaient pour chanter une note non écrite dans la partition mais très haute dans la tessiture ou tenir une note périlleuse pendant beaucoup plus longtemps que le compositeur ne l’avait prévu. Et la salle attendait ces moments de « bravoure » et éclatait dans des vivats exubérants ou des sifflets si la chanteuse ratait le « contre ut ».
Maria Callas savait faire cela mais elle y renonçait pour la musique, car elle n’était que musicalité. Elle était musique et émotion.
Et puis elle rencontra Luchino Visconti et elle devint aussi une exceptionnelle tragédienne, une actrice de théâtre.
J’ai trouvé sur internet un extrait d’une heure d’une émission de la télévision française du 20 avril 1969 « Invitée du dimanche » de Pierre Desgraupes qui outre des chroniqueurs musicaux français avait invité l’ancien administrateur de la scala : « Siciliani » et surtout Luchino Visconti.
<Ici> vous trouvez l’extrait, plus précis, où Luchino Visconti parle de Callas. Et qu’apprend-t ‘on ?.
 Que Maria Callas était l’artiste qui venait la première répéter et qui quittait le théâtre la dernière. Et c’était elle qui avant de venir avait le plus travaillé le rôle.
Que Maria Callas était l’artiste qui venait la première répéter et qui quittait le théâtre la dernière. Et c’était elle qui avant de venir avait le plus travaillé le rôle.
Luchino Visconti dit qu’elle était l’artiste la plus docile et la plus sérieuse qu’il a eu à diriger.
Et quand dans l’émission, Armand Panigel était allé interviewer la professeure de la Callas, Elvira de Hidalgo cette dernière dit la même chose : la plus travailleuse, la plus sérieuse, celle qui écoutait le mieux sa professeure et qui comprenait aussi très vite.
Et lorsqu’on se tourne vers tous les grands artistes qui ont travaillé avec elle, c’est toujours la même version : une perfectionniste, une professionnelle.
Et c’est ainsi qu’elle se présente dans un article de l’express du 19 janvier 1970 que j’ai choisi comme exergue de ce mot du jour
« Suis-je une diva ? Oui ! Mais dans le bon sens :
La diva, c’est celle qui apporte l’exemple d’un travail, d’une discipline et d’une grande maîtrise du métier »
Dans cette même interview elle dit aussi :
« Je ne suis qu’une interprète : une interprète s’empare du personnage qu’elle doit interpréter. […] Je fais mon travail le plus sérieusement possible mais je suis un être humain. »
Et dans un entretien avec le magazine « Elle » le 9 février 1970 elle va encore plus loin :
« Je ne crée rien : j’interprète. Je suis venue au monde pour cela. Je donne vie à ce que le compositeur a créé avant moi. »
Et dans la revue « Les Arts » en 1958 :
« Je ne suis pas parfaite. Je ne prétends pas l’être, mon seul désir est de lutter pour l’art… quoi qu’il m’en doive coûter. Même la plus simple mélodie peut doit être chantée avec noblesse. »
Et dans une émission de l’ORTF en février 1965 de Micheline Banzet
« Dans notre métier, il faut beaucoup de choses, le physique, le jeu scénique, la diction, le respect de la musique. On ne prend plus le temps nécessaire à tout cela. On veut gagner de l’argent, faire des notes aigües, impressionner le public « épater le bourgeois »… Mais ce n’est plus de l’art ! J’accepte les conseils, je les recherche […] avec de la bonté on peut tout obtenir de moi » »
Dans l’émission précitée Luchino Visconti raconte que la première fois qu’il a entendu Maria Callas chanté dans la maison de Tullio Serafin (le chef qui a le plus souvent dirigé Callas) il a été bouleversé car il n’avait jamais entendu chanté comme cela. Et c’est pour Maria Callas qu’il commença à réaliser des mises en scène pour l’opéra, avec notamment une « Traviata » à la Scala de Milan sous la direction de Giulini qui n’a jamais été égalée.
Je ne crois pas qu’il existe une vidéo sur ce spectacle mais on trouve sur internet des extraits audio avec des photos de la mise en scène, <par exemple ici>
Visconti raconte aussi un spectacle à la Scala de Milan où il était venu à la dernière minute et avait pu obtenir une place dans la loge de l’intendant de la Scala. Il ne s’était pas aperçu que s’était installée dans la loge après lui et derrière lui une femme. A la fin de l’acte, il s’est retourné et a vu cette femme pleurer. C’était Elisabeth Schwarzkopf qui était l’équivalent pour Mozart et Richard Strauss de Maria Callas dans Verdi ou le bel canto. Elle a dit à Visconti : « Cette femme est un miracle »
Voilà donc Maria Callas une artiste entièrement dévouée à son art et qui a développé toute son énergie pour servir l’art, jamais pour que l’art ne la serve. Alors oui, elle ne supportait pas quand ses confrères ne donnaient pas autant, quand ils ne travaillaient pas assez, quand ils se contentaient d’approximations ou même arrivaient en retard aux répétitions. Alors elle se mettait en colère.
Et puis quand sa voix la lâchait, son exigence de qualité l’obligeait à renoncer et alors on le lui le reprochait.
Parfois elle essayait pourtant de chanter et sa voix la trahissait et on le lui reprochait encore.
Tout au long de sa carrière, un noyau d’imbéciles l’a poursuivie notamment à la Scala pour la déconcentrer avant les grands airs en lançant des cris ou des insultes et puis en sifflant à la fin du spectacle et en balançant même des légumes à la place des fleurs attendues. Bien sûr, la plus grande partie du public l’acclamait. Mais elle a toujours été l’objet d’une hostilité malveillante de certains.
Après sa mort, comme le relate <Le Point>, on apprend qu’en réalité elle était malade et victime d’une maladie dégénérative qui a affecté ses cordes vocales.
Ce sont deux médecins italiens spécialistes en orthophonie qui soutiennent cette thèse :
Selon ces experts, Franco Fussi et Nico Paolillo, qui ont présenté les résultats de leurs recherches avec l’université de Bologne (nord) à l’occasion d’une table ronde, la soprano était atteinte de dermatomyosite, une maladie qui affecte les muscles et les tissus en général, y compris ceux du larynx.
Ils soulignent que cette maladie est traitée avec de la cortisone et des immunodépresseurs, ce qui peut entraîner à la longue une insuffisance cardiaque et que, selon le rapport médical officiel, la Callas est morte d’un arrêt cardiaque.
L’information, révélée mardi par le quotidien La Stampa, dément que la Callas se soit suicidée après la perte graduelle de sa voix à la suite d’une déception amoureuse dans sa relation avec l’excentrique milliardaire grec Aristóteles Onassis, qui l’a quittée en 1968 pour épouser Jacqueline Kennedy.
Les orthophonistes ont étudié avec des instruments ultra modernes les enregistrements de la cantatrice dans les années 50, sa période la plus achevée, dans les années 60, quand elle commença à avoir des problèmes, et dans les années 70, marquées par une brusque perte de poids et l’altération de sa voix.
« Fussi, un des orthophonistes les plus renommés du pays, et Paolillo ont analysé les dernières vidéos de la Callas qui montrent que les muscles ne répondaient plus car la cavité thoracique ne se gonflait pas quand elle respirait », soutient le journal de Turin.
« Le déclin de l’icône de l’opéra n’est pas dû à des efforts sur sa voix ou à des causes externes » comme des tensions émotives, affirment les experts, qui ont étudié un des moments les plus critiques de la carrière de la diva, lorsqu’elle ne put pas chanter l’opéra Norma à Rome, le 2 janvier 1958, en l’honneur du président italien de l’époque, Giovanni Gronchi, et de sa femme.
A la fin du premier acte, à l’issue duquel la moitié de l’assistance était déçue, la Callas s’était échappée par une porte dérobée : « cela n’a pas été un caprice, elle était vraiment malade, elle avait une trachéite, les muscles lâchaient. C’était le début de la fin », disent-ils.
Que de choses ont aussi été écrites sur sa perte de poids en 1953, 30 kilos en un an. Certains osent encore écrire que c’était pour plaire à Onassis alors qu’elle ne le rencontra qu’en 1959. Cette perte de poids elle la désira pour pouvoir mieux jouer ses rôles et parfaire sa silhouette de tragédienne.
Alors d’autres prétendent que cette perte de poids altéra sa voix, alors que probablement c’était cette maladie dégénérative qui était déjà à l’œuvre.
De toute façon même si voix est si particulière et qu’on la reconnait entre toutes, ce n’est pas la plus belle voix du siècle comme l’écrivent des journalistes superficiels et incompétents.Ainsi, Zinka Milanov, Leontyne Price ou même celle dont a voulu faire sa rivale Renata Tebaldi avaient des voix plus somptueuses.
Mais aucune n’avait cette émotion, cette théâtralité dans la voix, dans le jeu, dans l’expression.
Même quand elle donnait un récital, ses yeux, l’expression de son visage, ses mains, son corps tout exprimait l’émotion et la vérité théatrâle.
J’ai rencontré cette émotion à tous les instants pendant ce week end où j’ai écouté et regardé des vidéos de Maria Callas, en préparant l’écriture de ce mot du jour.
C’était une artiste exceptionnelle, unique et merveilleuse.
La femme fut plutôt malheureuse, mais j’y reviendrai demain.
<ARTE a consacré une émission à sa dernière Tosca à Paris en 1964>. Elle sait dompter sa voix rebelle et l’émotion reste unique.
<Ici sur Youtube la prière de la Tosca de ce même spectacle>
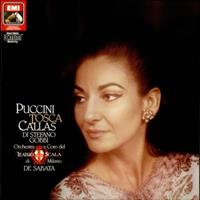
Les spécialistes se déchirent pour savoir quel est le meilleur disque de Maria Callas.
Pour moi, il s’agit de la Tosca justement, celle de 1953 avec Victor de Sabata comme chef d’orchestre.
C’était Maria Callas, dont je ne saurais dire que du bien.
<930>
-
Vendredi 15 septembre 2017
« Un homme imaginaire montre le sexisme »Penelope Gazin et Kate DwyerDepuis le début de la semaine j’ai parlé de la manière dont les mâles de l’espèce homo sapiens considéraient et traitaient les femelles de l’espèce.
Hier, j’ai évoqué le futur d’homo sapiens tel que l’imagine ou le prédit Harari en essayant de comprendre où vont nous mener les projets et le « progrès » annoncés par les sociétés qui ont les plus grands moyens financiers et les plus remarquables intelligences humaines pour réaliser (ou essayer de réaliser) leurs rêves.
Aujourd’hui je vais simplement vous relater une histoire qui concerne des femmes entrepreneuses dans la silicon valley confrontées à la bêtise masculine. Car la silicon valley accueille peut être beaucoup d’intelligence, mais l’intelligence ne semble pas suffisante pour éviter le sexisme.
Cette histoire est racontée dans le journal « Le Parisien » du 2 septembre.
L’année dernière, Penelope Gazin et Kate Dwyer lancent Witchsy, un site internet permettant d’acheter des objets d’arts produits par de petits créateurs, à mi-chemin entre objets mignons et créations gores. Un an après, l’entreprise fonctionne bien, a vendu pour 200 000 dollars de marchandise et les deux jeunes femmes annoncent même des profits
Malgré cette réussite, elles sont toujours confrontées aux mêmes comportements sexistes : manque de considération, réponses irrespectueuses et tardives, remarques condescendantes… Le plus souvent de la part de collaborateurs masculins. Une situation profondément désagréable entravant l’évolution de leur entreprise.
Alors elles ont une idée : s’inventer de toutes pièces un troisième co-fondateur masculin. Un homme virtuel en quelque sorte.
Baptisé Keith Mann, ce membre imaginaire de l’entreprise est utilisé par Kate Dwyer et Penelope Gazin pour communiquer par e-mail. Il leur suffit de se faire passer pour lui. Une technique aux résultats flagrants : «C’était le jour et la nuit. Il pouvait s’écouler des jours avant que j’ai une réponse. Keith, lui, n’avait pas seulement une réponse rapidement mais on lui demandait s’il avait besoin de quelque chose d’autre ou d’aide à propos de quoi que ce soit» a expliqué Kate Dwyer, déplorant le sexisme de leurs collaborateurs : «On a compris que personne ne nous prenait au sérieux et qu’ils pensaient tous que nous étions idiotes».
Au fil du temps, les réponses toujours aussi sympathiques et efficaces poussent les deux jeunes femmes à poursuivre leur stratagème. Pour rendre le personnage plus crédible, elles inventent une vie et une histoire à Keith Mann : «Le genre à jouer au football à l’université, marié à sa femme depuis cinq ans et impatient de devenir père»
Vous pouvez lire cette histoire avec plus de détails dans l’article du Parisien <Lassées du sexisme, elles inventent un co-fondateur masculin à leur entreprise>
Finalement, malgré toute la modernité, nous n’avons finalement pas tellement évolué depuis l’époque victorienne anglaise où Charlotte Brontë pour que son chef d’œuvre « Jane Eyre» puisse être publié en 1847 et surtout reconnu, était obligée de cacher sa féminité sous le pseudonyme masculin de Currer Bell.
<929>
-
Jeudi 14 septembre 2017
« Homo deus »Yuval Noah HarariLa traduction française est parue mercredi 6 septembre. Et le 6 septembre à 14:00 le livre était sur mon bureau.
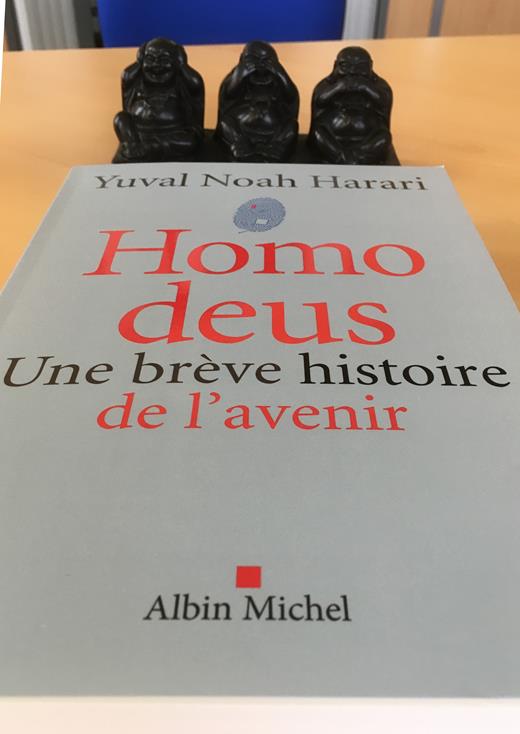 J’étais en effet impatient de lire la suite du passionnant Homo sapiens.
J’étais en effet impatient de lire la suite du passionnant Homo sapiens.
Si vous n’avez toujours pas lu homo sapiens, vous pourrez utilement vous reportez à la série de 13 mots du jour que j’ai consacré à ce livre étonnant.
Homo sapiens avait pour sous-titre : « Une brève histoire de l’humanité » et parlait du passé.
Le livre se terminait par un épilogue dont le titre est : « un animal devenu Dieu ? ».
Le questionnement sur ce qui se trame à la silicon valley, les projets fous des GAFAM, la généralisation de l’intelligence artificielle et des big data, l’annonce de la singularité où l’homme et l’intelligence artificielle s’interpénétreront se terminait par cette assertion : « Si cette question ne vous donne pas le frisson, c’est probablement que vous n’avez pas assez réfléchi. »
« Homo deus » était donc annoncé. Il parle de l’avenir, des futurs possibles.
Je vais me plonger dans cette lecture et je ne peux que vous conseiller de faire la même chose.
Le Point a traduit un billet que Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a écrit sur son blog :
« Qu’est-ce qui donne un sens à nos vies ? Et que se passerait-il si, un jour, ce qui nous fournissait ce sens disparaissait ? Je continue à penser à ces questions importantes après avoir fini Homo deus, le livre provocateur de Yuval Noah Harari. Melinda et moi avons adoré Sapiens, qui tentait d’expliquer comment notre espèce a réussi à dominer la planète. (…)
Le nouveau livre de Harari est aussi stimulant que Sapiens. (…) Je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’avance l’auteur, mais il fournit une vision sérieuse de ce qui attend peut-être l’humanité.
Homo deus explique que les principes qui ont organisé la société vont subir un bouleversement au XXIe siècle, avec des conséquences majeures pour la vie telle qu’on la connaît. (…) Nous nous sommes organisés pour satisfaire nos besoins : être heureux, en bonne santé, et contrôlant notre environnement. Mais, en menant ces objectifs à terme, Harari affirme que l’humanité va tout faire pour parvenir à « la félicité, l’immortalité et la divinité ». (…)
Je suis plus optimiste que lui […]
Je trouve passionnante la question des buts humains. Si nous résolvons les grands problèmes comme la faim et la maladie, et si le monde devient plus pacifique, quels objectifs aurons-nous ? (…) Harari a fait le meilleur travail que j’aie jamais vu pour exposer ce problème. Il suggère que, pour trouver un nouveau sens à nos vies, nous développerons une nouvelle religion. Hélas, je ne suis pas satisfait par cette réponse (pour être franc, je ne suis pas non plus satisfait par les réponses de penseurs brillants comme Ray Kurzweil ou Nick Bostrom, ou par mes propres réponses).
[…] C’est un livre passionnant avec beaucoup d’idées stimulantes et peu de jargon. Il fera réfléchir au futur, autre façon de dire qu’il fera réfléchir au présent. »
Yuval Noah Harari a accordé un long entretien au Point, dans lequel il définit plus précisément ce concept d’homme-dieu :
« Déjà, il faut se demander ce qu’est un dieu. Si vous regardez les mythologies, et notamment la Bible, l’une des caractéristiques primordiales des êtres divins est de fabriquer du vivant. Or nous sommes en train d’acquérir ce pouvoir. Je ne dis pas que les humains seront des superhéros volant dans l’air. Mais nous sommes capables de quelque chose de bien plus incroyable : remodeler la vie, avec l’aide du génie biologique et de l’intelligence artificielle. […] Le passage d’Homo sapiens à Homo deus est un processus évolutif qui a déjà commencé ! La revue Nature vient d’annoncer que des chercheurs, pour la première fois, sont parvenus à modifier des gènes malades dans des embryons humains. Nous sommes en train de refaçonner le code de la vie, et dans cinquante ou cent ans, cela sera la routine. En ce sens, les humains seront comme des dieux. »
Et
« Une fois que vous êtes capable de refaçonner la vie, il n’y a aucune raison que vous ne puissiez pas aussi remodeler la mort. Dans les mythologies anciennes, la mort était considérée comme un phénomène métaphysique. Vous mouriez car telle était la volonté de Dieu. Mais, pour la science, la mort n’est plus qu’un simple phénomène biochimique, un problème à résoudre. Nous mourons du fait d’un pépin technique, et nul besoin d’attendre le Second Avènement pour tenter de trouver une solution. Il est clair que la guerre contre la mort sera le projet phare de notre siècle. Bien sûr, nous ne deviendrons pas immortels, mais a-mortels. Même en allongeant de plus en plus l’espérance de vie, les surhommes du futur ne seront pas à l’abri d’un accident. Mais on peut envisager, comme le prédit Ray Kurzweil, qu’on se rende tous les dix ans dans une clinique pour bénéficier du dernier traitement technologique et gagner une nouvelle décennie de bonne santé. La vie humaine n’aura plus de limite claire, mais se transformera en un processus indéterminé. »
Alors quand il réfléchit sur le libre-arbitre, la liberté de choix, les décisions qui nous engageront et l’avenir de la démocratie, il argumente de la manière suivante :
« L’humanisme est en crise, car ses fondements sont en train d’être sapés par les découvertes scientifiques comme par les nouvelles technologies. L’hypothèse la plus importante de l’humanisme libéral est le libre-arbitre de l’individu. Or la science explique que les sentiments, les choix et les désirs des humains sont le simple produit de la biochimie. Une fois que nous aurons une connaissance biologique suffisante, et assez de puissance informatique, un algorithme pourra parfaitement comprendre, prévoir et manipuler ces choix et sentiments humains. […] Vous pensez voter librement pour tel candidat ou acheter de votre plein gré telle voiture, mais ce n’est pas le cas.
[…], nous savons de mieux en mieux comment manipuler les individus, mais, de l’autre, cela a aussi de plus en plus de sens de faire confiance au big data et aux algorithmes, car ils vous comprendront bien mieux que vous n’en êtes vous-mêmes capable. À une question comme « que dois-je étudier à l’université ? », plutôt que de faire confiance à vos propres sentiments, il vaudra mieux interroger Google, de la même façon que quand, tout à l’heure, vous avez atterri sur un aéroport en pays étranger, vous avez fait confiance à Google Maps. Nous allons prendre de moins en moins de décisions dans nos vies. Et, au fur et à mesure que la croyance en l’individu s’effondrera et que l’autorité sera transmise aux algorithmes, la vision humaniste du monde – fondée sur le choix individuel, la démocratie et le libre marché – deviendra obsolète.»
Vous espérez peut être le contraire, sans doute. Mais avez-vous des arguments sérieux pour défendre votre point de vue ?
Il me faudra du temps pour lire et approfondir cet ouvrage.
Sauf immense déception de ma part à la lecture de ce livre, j’en reparlerai dans quelques mois.
<928>
-
Mercredi 13 septembre 2017
«En Occident, nous avons nié, oublié, nous avons excisé mentalement le clitoris »Pierre FoldèsQuand j’étais jeune, j’ai eu droit à des cours d’éducation sexuelle. Dans ces cours on parlait de beaucoup de choses et on représentait de manière banale un pénis au tableau.
Mais le clitoris… non ! On n’en parlait pas.
Même dans ce domaine les femmes et les hommes ne sont pas traités de manière égale !
Et cette <page de France Culture> nous apprend que pour la première fois un manuel scolaire des Sciences de la vie et de la Terre représente correctement un clitoris. Il s’agit du manuel des éditions Magnard. C’est la première fois et c’est la fin d’une longue omerta datant de 1880. Mais les sept autres éditeurs que sont Belin, Bordas, Didier, Hachette, Hatier, Le livre scolaire et Nathan, continuent à faire une présentation erronée de l’organe ou n’en définissent qu’une petite partie.
Vous trouverez sur la page de France Culture la représentation incluse dans ce manuel.
Mais le titre sous forme de question posée par cette page demande des explications :
Pourquoi avoir attendu 2017 pour le représenter dans les manuels scolaires ?
Ainsi : « le clitoris a été correctement dessiné dans le nouveau livre de SVT des éditions Magnard, destiné à entrer dans le cartable des collégiens à la rentrée prochaine. Avec sa double arche interne de 10 cm de long. Cette représentation vient briser un tabou anatomique de longue date. Pourtant, les premières représentations anatomiques correctes du clitoris remontent à 1600… »
<Cette page nous apprend qu’on peut même imprimer en 3D la représentation d’un clitoris>
Et voici ce que cela donne :

La <page de France Culture> déjà citée nous donne plus d’explications et vous pouvez utilement vous y reportez.
Ainsi on apprend que :
En 2010, la gynécologue et obstétricienne Odile Buisson avait consacré une conférence de 15 minutes à l’organe clitoridien et à sa mise au ban par la médecine sexuelle. […] « Le clitoris est probablement la terreur des Homo sapiens, car il faut savoir que 130 à 150 millions de femmes ont été excisées dans des conditions épouvantables », lançait-elle en guise d’introduction. Et ce depuis la nuit des temps, puisque des momies excisées ont été retrouvées, précisait-elle. Et en Occident ? « On a fait moins sanglant mais on n’a pas fait moins sournois, car le clitoris a été un organe complètement oublié des traités d’anatomie. »
Durant ses études de médecine, Odile Buisson a très vite noté que lorsque le clitoris était représenté, ou traité, il l’était de façon erronée : «Je me rappelle que quand j’ai fait ma gynécologie, c’était deux petites pages, vite expédiées, et du reste on ne l’apprenait pas parce qu’on n’était jamais interrogés dessus et qu’en fait, tout le monde s’en foutait.»
Je travaille avec le docteur Pierre Foldès, qui est spécialiste de la réparation des mutilations sexuelles (…), [qui] me dit toujours, «En Occident, nous avons nié, oublié, nous avons excisé mentalement le clitoris ». Odile Buisson
Jean-Claude Piquard, sexologue clinicien, auteur de La fabuleuse histoire du clitoris, a vécu la même expérience lors de ses études : « Lorsque j’ai fait ma formation de sexologue clinicien à la fac de médecine de Montpellier, à ma grande surprise : point de clitoris. On avait posé la question aux profs qui étaient des médecins sexologues : ils refusaient de répondre, ils bottaient en touche, c’était très surprenant. »
D’autant plus surprenant que, suite à ses recherches basées sur les encyclopédies médicales et autres traités d’anatomie, le sexologue s’aperçoit que jusqu’au XXe siècle, le clitoris avait toujours été connu et reconnu comme l’organe du plaisir féminin.
Au début du XXe siècle, il occupait quatre pages dans les traités d’anatomie, et dans les années 1960 qui sont les points culminants de l’omerta clitoridienne, il n’occupait que quatre lignes. On démontre ainsi que ce n’est pas une absence de connaissances, c’est un recul de connaissances.
La première omerta sur le clitoris, c’est à des médecins protestants qu’on la doit, vers 1750, date avant laquelle la masturbation n’avait jamais été mentionnée, explique Jean-Claude Piquard : « Brutalement, elle devient une pratique funeste, potentiellement mortelle, ou en tout cas très dangereuse. » Pourquoi ? Parce que la semence est chose précieuse destinée à la procréation pour les religions, il s’agit donc de ne pas la perdre .
« Quelque part en France, on a été protégés par les catholiques, il n’y a quasiment pas eu d’excision thérapeutique en France. Les catholiques ont fait du suivisme mais étaient beaucoup moins intégristes. […] Dans tous les pays protestants, la répression de la masturbation a été violente, sauf en Angleterre peut-être. »
Par la suite cet article parle aussi du rôle de Freud, mais si cela vous intéresse je vous propose de vous reporter directement à < France Culture>
Enfin, je vous engage à regarder cette animation : <Le clitoris>
La présentatrice canadienne introduit le sujet en disant : « les femmes sont chanceuses, elles disposent du seul organe qui sert uniquement au plaisir »
Alors vous pourriez poser la question pourquoi parler du clitoris ?
Parce que je pense qu’il s’agit d’un révélateur de la manière dont la société traite les femmes.
Dans certains pays la tradition patriarcale a imposé l’excision, c’est à dire l’ablation de la partie externe du clitoris et de son capuchon.
Wikipedia nous apprend que l’excision est la plus courante en Afrique subsaharienne et dans quelques régions du Proche-Orient (Égypte) et de l’Asie du Sud-Est (Indonésie et Malaisie). Dans les pays occidentaux, ces pratiques se retrouvent dans les communautés issues de ces pays. Selon les pays, la proportion de femmes excisées varie de façon importante, allant de 1,4 % au Cameroun à 96 % en Guinée au début des années 2003. On considère qu’environ 100 à 140 millions de femmes ont subi une excision (principalement en Afrique). Environ 2 millions de fillettes sont susceptibles de subir une telle mutilation tous les ans. Selon une étude de l’INED, 50 000 femmes ont subi des mutilations sexuelles et vivent actuellement en France.
Si dans ces sociétés on désire priver les femmes de leur clitoris c’est parce qu’on sait à quoi il sert : donner du plaisir.
Dans nos sociétés, on est beaucoup moins brutal mais nous constatons d’après les informations de cet article qu’il y a eu longtemps une omerta. Il faut être juste Il y eut une époque où le clitoris était davantage à l’honneur dans notre pays et selon les spécialistes qui s’expriment le moment culminant de l’omerta se situe dans les années 1960.
Mais pourquoi se méfie t’on du plaisir féminin, pourquoi le corps des femmes constitue-il autant un problème qui préoccupe les hommes et les sociétés patriarcales, pourquoi enferme t’on les femmes dans certaines sociétés ? Pourquoi punit-on avec une telle rage les femmes adultères dans tellement de civilisation ?
Parce que lorsque l’enfant nait, il est facile de connaître la mère, mais qui est le père ?
Depuis des siècles et peut être des millénaires les hommes, les patriarches voudraient être certains qu’ils sont bien le père à l’enfant à qui il lègue leur patrimoine, leur pouvoir parfois, et leurs noms. Pour cette raison prosaïque, il faut contrôler le corps des femmes, les relations des femmes. Et bien sûr le plaisir est dangereux parce qu’il peut entraîner le désir de l’infidélité, de chercher le plaisir en dehors des liens du clan ou de la famille.
Ce qui est navrant c’est que sans qu’ils en soient l’auteur, les monothéismes se sont emparés de ces traditions pour le plus grand bénéfice des sociétés patriarcales et l’asservissement des femmes. Au cœur des mythes monothéistes, il y a ce don du plaisir qu’Eve avait donné à son compagnon pour croquer la pomme.
Alors oui ! le clitoris et surtout la manière dont on le cache, on l’ignore ou on le mutile dit beaucoup de nos archaïsmes et de nos sociétés malades de l’égoïsme des mâles.
<Pour finir vous trouverez ici une présentation d’Odile Buisson>
<927>
-
Mardi 12 septembre 2017
« Tant qu’une femme sur terre sera discriminée parce qu’elle est une femme, je serai féministe»Leïla SlimaniLeïla Slimani est née en 1981 au Maroc à Rabat
L’année dernière, en 2016, elle a eu le Prix Goncourt pour « Chanson douce », l’histoire d’une nourrice parfaite, indispensable qui fait partie de la famille, mais qui peu à peu va sombrer dans la folie et la haine et va tuer les deux petits enfants dont elle s’occupe.
C’était son second roman.
Le premier, en 2014, «Dans le jardin de l’ogre » avait pour sujet l’addiction sexuelle féminine.
Elle vient de publier cette fois un essai « Sexe et Mensonges » qui décrit la vie sexuelle au Maroc, accompagné d’un roman graphique <Paroles d’honneur>.
Le journal <Les Inrocks> présente cette plongée dans l’intime au Maroc de la manière suivante :
« Il sera donc question de la vie sexuelle des femmes marocaines[…] Or, l’ennemi est avant tout un système : un Etat, une culture, une religion, les trois confondus pour imposer des lois liberticides – pas le droit de se toucher en public ou d’aller à l’hôtel pour un couple non marié, interdiction du sexe hors mariage, de l’avortement, de l’homosexualité.
Le résultat est glaçant : cadavres de bébés trouvés dans des poubelles, filles violées obligées d’épouser leur violeur, ou alors montrées du doigt et rejetées par leur clan, ou suicidées, liaisons clandestines, femmes qui ne seront jamais épousées car elles ne sont plus vierges, peur constante d’être découverts, arrêtés, culpabilité, solitude. Sans parler de la misère qui pousse les filles à se prostituer pour subvenir aux besoins de leur famille, tout en portant sur elles la honte. »
J’ai découvert cette parution parce que Leila Slimani était l’invitée de France Inter du 28 aout 2017 .
Dans cette émission elle a expliqué comment lui est venue l’idée de cet essai qui parle de la vie sexuelle au Maroc :
« C’est une question que je me posais depuis longtemps, la question de la misère sexuelle comme on le résume aujourd’hui dans les pays arabes.
Quand j’étais journaliste et que j’ai couvert les révolutions arabes, je me souviens avoir beaucoup parlé avec les jeunes en Tunisie, en Algérie, en Egypte au Maroc.
Et on parlait beaucoup de sexualité, de harcèlement sexuel. On parlait des viols pendant les manifestations. C’est un sujet qui commençait à devenir très important [pour moi] et que j’avais absolument envie d’aborder, mais je ne trouvais pas l’angle qui m’intéressait vraiment.
Et c’est en publiant mon premier roman : « Dans le jardin de l’ogre » et en allant faire la tournée au Maroc pour le présenter que j’ai rencontré des femmes qui me racontent ça.
C’est ce que j’avais envie de faire, faire entendre des voix qu’habituellement on n’entend pas. »
Beaucoup de journaux lui ont donné la parole, ainsi l’Obs : <Les femmes, le sexe et l’Islam>
Dans cet entretien elle explique un peu plus précisément ce moment déclencheur :
Quand je suis allé présenter mon premier roman au Maroc. Là, un jour, une femme s’est assise à côté de moi. Elle m’a raconté sa vie. Pour elle, j’avais probablement [dans mon roman] eu le courage d’une parole crue et franche… En tout cas, elle m’a fait confiance. Ca m’a bouleversée. Elle n’avait pas le vocabulaire pour parler de l’intime, du plaisir. Elle n’en avait sans doute jamais parlé. Je me suis dit que c’était, le plus important : donner à entendre la voix des femmes. »
Dans l’émission de France Inter, Nicolas Demorand explique qu’à la lecture de cet essai, on découvre que la sexualité des femmes n’est pas une affaire privée au Maroc. Leila Slimani répond :
« La sexualité se retrouve au carrefour de beaucoup de choses : le pouvoir de l’Etat, le pouvoir du père, du patriarcat, du foyer, c’est la question du rapport du corps de la femme avec la rue, la religion évidemment. Tout cela en fait une question très complexe.
Mais la citoyenne marocaine reste contrainte par le groupe. Elle n’est pas encore considérée comme un individu à part entière. »
« La mixité dans l’espace public reste un combat. Elle ne va pas de soi. Elle date de la fin des années 1960. […] Même si elle est un état de fait sur les lieux de travail, dans les transports, elle n’est ni véritablement défendue, ni véritablement expliquée ni par les pouvoirs publics, ni par les intellectuels, ni par les élites, ni par la société dans son ensemble. […]
La femme est encore un intrus dans l’espace public. [Certains pensent] qu’on lui fait déjà une fleur quand on lui permet de se rendre au travail, d’avoir un travail et d’avoir une vie en dehors du foyer.
Le problème, c’est que l’évolution remet en cause le pouvoir de l’homme et toute une culture qui est fondée sur la prédominance de la masculinité, de la virilité. Ce sont ces valeurs-là qui sont mis en avant. »
On constate lors de l’entretien que l’hypocrisie est un problème mais aussi la solution. Ainsi on peut faire beaucoup de choses dans le domaine sexuel, en se cachant, en ne disant rien, dans le silence et aussi en ayant la chance de ne pas se faire dénoncer par ses voisins.
Kamel Daoud avait déjà abordé ce sujet après les viols du 31 décembre 2015, évènement qui m’avait poussé à écrire une série de mots sur la violence faite aux femmes. Il a été dès lors la cible de groupes d’anti racistes ou d’individus qui considèrent qu’analyser ou décrire sans complaisance les mœurs ou les sociétés maghrébines ou arabes ne peut être analysé que comme une stigmatisation coupable et oppressante.
Fort de cette expérience, Nicolas Demorand a prédit que Leila Slimani serait attaquée comme Kamel Daoud et lui a demandée comment elle entendait se défendre :
Et à ses futurs critiques, elle dit
« Venez avec moi dans les bars de Tanger, où il n’y a que des hommes avec 2 ou 3 femmes qui sont toutes des prostituées. Regardez cette absence de mixité. Cette difficulté de vivre avec l’autre, d’accepter le désir. Des plaisirs aussi simple, j’en parlais avec Kamel Daoud, on se baladait dans Paris et on regardait les jeunes sur les quais de Seine, les jeunes couples, les garçons, les filles assis. On disait ça, ça parait banal, tout à fait normal. Mais quand vous êtes au Maroc que vous avez 17 ans ou 18 ans et que vous prenez la main de votre compagnon ou de votre compagne et qu’un policier vient et vous dit : Vous n’avez pas le droit, c’est extrêmement humiliant pour un jeune garçon ou une jeune fille. Et en plus ça vous met dans la tête que cette chose qui est très simple qui est la tendresse, qui est l’amour, qui est un des plus grands bonheurs qu’on puisse vivre dans la vie, cette chose elle est interdite, elle est sale, elle n’est pas bien. […]
Il n’y a pas de discours sur la sexualité, on vous dit « il faut vous taire »
Nicolas Demorand ne s’est pas trompé : la première à dégainer a été Houria Bouteldja, porte-parole des indigènes de la république qui a traité Leila Slimani de «Native informant» qui je pense en langage courant pourrait se traduire par « collabo ».
Dans l’entretien publié dans l’Obs, Leila Slimani cite Malek Chebel qui expliquait que la misogynie est la chose la mieux partagée du monde. Pas besoin d’être musulman pour être machiste, les religions monothéistes sont à peu près à égalité sur la misogynie. Enfin la culture islamique a aussi être été une grande culture de l’érotisme et de la célébration de l’autre.
Elle cite souvent Simone Veil notamment lorsque :
Simone Veil disait : « il suffit d’écouter les femmes. » je le dis aussi !
Et aussi quand Simone Veil stigmatisait ceux qui disaient « Et pourquoi ne pas continuer à fermer les yeux ? » et Leila Slimani d’ajouter :
Chacun devrait se poser cette question. Peut-être que notre dignité c’est aussi à ne pas continuer à fermer les yeux. Ni sur les femmes qui se font avorter à coté de nous. Ni sur les homosexuels qui se font tabasser.
C’est aussi dans cet entretien qu’elle raconte les « délires ? ou folies ? » de certains imams, elle cite l’imam Zamzami qui dit qu’on peut coucher avec sa femme jusqu’à trois heures après sa mort pour lui dire au revoir et qui préconise la masturbation comme « solution provisoire pour les jeunes musulmanes et musulmans »
C’est enfin dans ce même article qu’elle a cette formule que je partage totalement et que j’ai mis en exergue de ce mot du jour :
« Tant qu’une femme sur terre sera discriminée parce qu’elle est une femme, je serai féministe »
<Ici vous trouverez en vidéo un entretien sur le livre sur RFI>
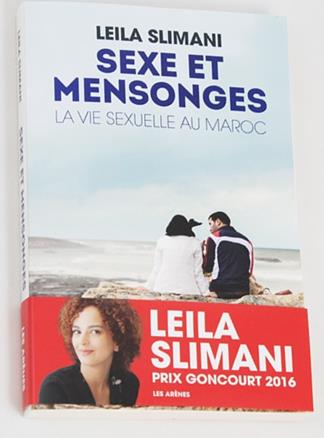
<926>
-
Lundi 11 septembre 2017
« La politique du mâle »Kate MillettKate Millett vient de mourir, le 6 septembre 2017 à Paris, où elle était venue fêter son anniversaire, avec sa femme, la photojournaliste Sophie Keir. Elle était née le 14 septembre 1934 dans le Minnesota.
Dans la première partie de sa vie, elle avait été mariée à un sculpteur japonais Fumio Yoshimura pendant 20 ans (1965-1985).
Pour ceux et surtout celles qui pensent que le progrès va suivre son cours que l’égalité réelle entre la femme et l’homme dans nos sociétés modernes n’est qu’une question d’un peu de patience encore ou que le droit de la femme de disposer librement de son corps et notamment de pratiquer l’avortement lorsqu’elle le juge nécessaire est acquis: Libération cite un constat que cette grande féministe avait fait, il y a quelques années, pour son pays, les Etats-Unis :
«Rien n’a changé dans ce pays depuis vingt ans, le féminisme n’apporte plus rien dans la vie quotidienne. Et les Américaines risquent toujours de perdre le droit à l’avortement.»
Kate Millett est une des grandes féministes américaines qui a fait avancer les droits des femmes en dénonçant avec force et perspicacité les traditions, les évidences et aussi les théories de certains pseudo scientifiques qui essayaient de cacher, derrière un rideau de fumée conceptuelle, la banalité de leur combat médiocre pour préserver le patriarcat et la domination des mâles.
Dans ce registre, le docteur Sigmund Freud fut une cible particulièrement prisée par Kate Millett.
L’Obs dans son article d’hommage qu’il a intitulé <Kate Millett la grande féministe qui remettait Freud à sa place> la cite :
« Selon elle, en affirmant que le destin psychologique de la femme est irrémédiablement lié à son «envie de pénis», Freud n’a fait que «rationaliser l’odieuse relation entre les sexes, ratifier la répartition des rôles et valider les différences de son tempérament». Et de trancher: S’il est extrêmement regrettable que Freud ait choisi […] de se concentrer sur les distorsions de la subjectivité infantile, son analyse aurait pu cependant présenter un intérêt considérable s’il avait été assez objectif pour reconnaître que la femme naît femme dans une culture dominée par les hommes, portée à étendre ses valeurs jusqu’au domaine de l’anatomie elle-même et capable, par conséquent, d’investir les phénomènes biologiques d’une force symbolique.»
Son grand ouvrage qui la rendit mondialement célèbre fut écrit en 1970 et avait pour titre original : « Sexual Politics », traduit en français et publié en 1971 sous le titre « La politique du mâle »
« La Politique du Mâle » fut d’abord sa thèse à l’Université de Columbia avant de devenir un livre. Son idée principale est que la relation entre les sexes est avant tout une question politique et par voie de conséquence une question de pouvoir et d’organisation sociétale pour préserver le pouvoir mâle.
L’Obs l’avait rencontrée à l’occasion de la sortie française de son livre en 1971 et elle avait résumé ainsi la situation :
« Chaque petit garçon est élevé dans l’idée qu’il peut, s’il a du mérite et de la chance, devenir président des Etats-Unis. Pour les petites filles, le but proposé, c’est d’être élue Miss America. […]
Je me suis crue obligée de parler haut. Je craignais que personne n’écoute. Mais je n’ai fait que mettre en batterie un vieux cliché: le monde appartient aux hommes.»
Dois-je rappeler que les américains malgré leur racisme latent sont parvenus à élire un homme noir à la Présidence, mais pas une femme. Ils ont préféré Donald Trump !
C’est encore cet ouvrage que l’Obs a cité dans le numéro contenant aussi le «Manifeste des 343 salopes» cité dans le Mot du jour de vendredi dernier.
C’est ainsi que l’hebdomadaire cita le jugement sévère de Kate Millett contre Freud, déjà évoqué en début d’article.
Et en continuant à citer son propos sur Freud, le journal écrivait :
« Plus loin, elle critique l’idée selon laquelle l’enfantement trouve également sa base dans le désir de pénis.
Donner le jour finit par devenir une prérogative masculine, puisque le bébé n’est que le substitut du pénis. La femme se fait battre à son propre jeu, celui de la reproduction, le seul que la théorie freudienne lui recommande.»
Ainsi, «donnerait-elle naissance à tout un orphelinat, que ce serait encore autant de petits godemichés.»
Kate Millett remet le psychanalyste autrichien à sa place avec une démonstration implacable :
Il semble que les filles fassent connaissance de la suprématie masculine bien avant d’avoir vu le pénis de leur frère. Elle est si bien intégrée à leur culture, si présente dans le favoritisme de l’école et de la famille, dans l’image que leur présentent de chaque sexe les médias, la religion, tous les modèles du monde adulte perçus par elle, que l’associer à un organe génital du garçon ne leur apporterait rien de plus, puisqu’elles ont déjà appris mille autre signes de différence sexuelle. Devant tant de preuves concrètes de la situation supérieure qui est faite au mâle et sentant de toutes parts le peu de cas que l’on fait d’elles, les filles envient, non le pénis lui-même, mais les prétentions sociales auxquelles le pénis autorise.»
Libération, comme les autres journaux, lui a consacré également un article dont je cite un extrait ci-après :
« Kate Millett a commencé à s’intéresser au féminisme quand elle a découvert le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir pendant ses études à Oxford, «une révélation» (le Monde du 2 avril 1971). Son Sexual Politics, traduit sous le titre la Politique du mâle au printemps 1971 chez Stock, suit d’une poignée d’années l’essai de Betty Friedan la Femme mystifiée (1964), qui analysait comment les bénéficiaires de la société de consommation, les magazines féminins et la publicité, ont recréé une nouvelle mystique de la femme au foyer.
Dans les semaines qui suivent la parution de Sex Pol aux Etats-Unis, Kate Millett se retrouve propulsée sur le devant de la scène. Son essai mêle l’analyse littéraire à la sociologie, la psychologie, l’anthropologie et définit les objectifs du mouvement féministe. C’est une critique du patriarcat dans la société et la littérature occidentale qui pointe le sexisme de romanciers modernes comme DH Lawrence, Henry Miller et Norman Mailer. «Etre femme ou être homme, écrit-elle, c’est appartenir à deux cultures différentes.» Pour elle, l’explosion de la famille traditionnelle permettra de dynamiter l’oppression politique et culturelle fondée sur le sexe. «Notre mouvement s’étend non seulement dans les universités mais aussi dans les classes moyennes et chez les femmes au foyer, mais il est vrai que nous avons des difficultés à toucher les milieux ruraux et ouvriers», expliquait notamment la porte-parole du mouvement féministe en 1971 au Monde. »
Si vous êtes à l’aise avec l’anglais vous pouvez également aller sur <son site personnel>
Son combat doit continuer et même si sous nos latitudes la situation s’est améliorée, une régression est possible et puis il reste tant à faire dans tant de pays dans le monde.
Le mot du jour du 9 septembre 2014 citait la journaliste Annick Cojean :
« C’est juste pas de chance d’être une femme dans la plupart des pays du Monde »
Puisse toutes les femmes de nos pays et tous les hommes respectables garder cette réalité présente dans leurs esprits.
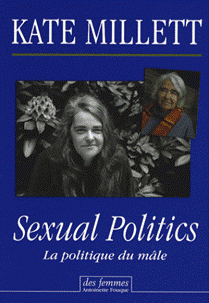
<925>
-
Vendredi 8 septembre 2017
« Mémoire et Histoire du droit à l’avortement »Mise en pratique pédagogique sur un thème concret de l’opposition entre la Mémoire et l’Histoire.Je pense que la loi de novembre 1974 concernant l’interruption volontaire de grossesse constitue un excellent exemple permettant de comprendre la différence entre la Mémoire des faits et l’Histoire des faits.
La mémoire est affective et subjective. L’Histoire s’efforce à l’objectivité.
La mémoire associe cette Loi à Simone Veil. Beaucoup, par exemple ce site exprime cela de la manière suivante :
« Nous sommes toutes les filles de Simone Veil : nous lui devons cette loi essentielle qui a transformé la vie des femmes. »
« Les femmes, la France doivent cette Loi à Simone Veil ». C’est la mémoire collective, ce n’est pas l’Histoire.
Certes, elle a défendu la Loi devant l’Assemblée Nationale et avec quelle force, intelligence, humanité.
Mais sans Simone Veil, cette Loi serait probablement quand même entrée en vigueur en 1974.
Simone Veil n’était pas dans le combat pro-avortement avant 1974 ; comme par exemple l’avocate Gisèle Halimi ou ces femmes qui se sont fait appeler les 343 salopes, dont faisait partie Catherine Deneuve ou Françoise Sagan et qui se sont accusés publiquement dans une tribune, en 1971, dans le Nouvel Observateur., du délit d’avortement.
Elle est entrée presque par hasard au Gouvernement au Ministère de la Santé alors qu’elle était juriste. Et même au gouvernement, ce fut un concours de circonstances qui fit que finalement ce fut à elle qu’incomba la tâche de défendre la Loi.
Que dit l’Histoire ?
L’Histoire dit que les femmes doivent cette Loi à Valéry Giscard d’Estaing qui a pris l’engagement de cette Loi pendant sa campagne présidentielle et a mis en œuvre son engagement dès le début de son septennat.
C’est parce que le Président de la République nouvellement élu, l’a voulu que le projet de Loi a été déposé et discuté au Parlement.
D’ailleurs cette loi n’est en rien une Loi « du droit à l’avortement ». C’est une loi de « dépénalisation de l’avortement ». Il s’agissait de modifier le code pénal et de supprimer un article qui qualifiait l’interruption volontaire de grossesse de délit.
Une Loi qui doit modifier le code pénal est de la compétence du Ministre de la Justice. Ce fut le cas avant 1974, et c’est toujours ainsi que cela se passe.
Mais quand Valéry Giscard d’Estaing se tourna vers son Ministre de la Justice, ce dernier le pria de l’épargner et de ne pas lui confier cette tâche. Le Ministre de la Justice était démocrate-Chrétien et se nommait Jean Lecanuet. Il argumenta en disant que sa Foi et sa morale lui interdisait de défendre cette Loi.
Alors Valéry Giscard d’Estaing eu l’idée de confier ce projet à la Ministre de la Santé qui justement était juriste et qui ne refusa pas.
Valéry Giscard d’Estaing aurait pu tenir le même discours que Jean Lecanuet étant donné sa foi et ses convictions. Il savait en outre que la majorité des français qui l’avaient élu, étaient en très grand nombre contre « cette abomination » disaient-ils. Les défenseurs de cette évolution se trouvaient dans l’autre camp, celui de la Gauche. D’ailleurs dans la nuit du 28 au 29 novembre 1974, la loi fut votée par 284 députés, un tiers des voix de droite et la totalité des voix de gauche, contre 189 voix de Droite.
Mais il avait fait le constat que la situation était devenu intolérable entre les familles aisées et cultivées qui pouvait financer une opération médicale avec peu de risque à l’étranger et toutes les femmes modestes qui tentaient d’interrompre leur grossesse dans des conditions indignes, dangereuses et souvent atroces.
Valéry Giscard d’Estaing a, dans ce domaine, agi en Homme d’État allant contre ses convictions intimes, contre son intérêt politique puisqu’il déplut à la majorité qui l’avait fait président, pour imposer ce qui lui paraissait juste et nécessaire pour l’intérêt de ses concitoyens et particulièrement ses concitoyennes.
C’est lui qui décida et qui imposa cette loi. Mais une fois ce flambeau confié à Simone Veil, cette dernière sut trouver l’énergie, les mots et la force de conviction pour obtenir le vote positif.
Et quel combat !
Vous trouverez dans les liens que je donne en fin d’article, cette anecdote que des personnes que Simone Veil considérait comme des amis refusèrent de la voir et de l’inviter à cette période.
Elle dit aussi :
« Je savais que les attaques seraient vives, car le sujet heurtait des convictions philosophiques et religieuses sincères. Mais je n’imaginais pas la haine que j’allais susciter, la monstruosité des propos de certains parlementaires ni leur grossièreté à mon égard. Une grossièreté inimaginable. Un langage de soudards. »
Mais voici ce que l’Histoire dit : Cette Loi fut voulu et imposé par Giscard d’Estaing, Simone Veil l’accompagna et mit en œuvre la volonté présidentielle.
Ce qui n’enlève rien à la grandeur de Simone Veil.
Voici les liens promis :
http://www.politique.net/annees-giscard/reformes.htm
<924>
-
Jeudi 7 septembre 2017
« L’évolution des mémoires après la 2ème guerre mondiale »Suite du mot du jour d’hierLes déportés n’ont pas pu exprimer leurs douleurs et leurs expériences à la sortie de leurs effroyables épreuves. C’est ce qu’a dit, avec force, Simone Veil. Ce n’est heureusement plus le cas, mais cette mémoire refoulée ne s’est vraiment révélée qu’après 1970.
La professeure d’Histoire, Sylvie Schweitzer, que j’ai évoquée dans le mot du jour d’hier, présentait la position dominante des historiens qui interprétaient cette évolution en quatre phases :
- 1°Le mythe de l’Union Nationale (1945/1947)
- 2°L’affrontement des mémoires (1947 – fin des années 1950)
- 3°Le silence – (fin des années 1950 à 1970)
- 4°Le retour du refoulé – Après 1970
J’insisterai surtout sur cette 4ème phase et particulièrement dans cette 4ème phase sur la compréhension et l’appréhension de la shoah.
1° Juste après la guerre (1945/1947) : le mythe de l’Union Nationale.
C’est le moment de la domination des résistants qui cultivent l’unanimité. Il s’agit d’un mythe qui a pour objectif de faire penser que les Français ont été dans leur très grande majorité des résistants qui se sont opposés aux nazis et à Vichy et de minorer, voire oublier la collaboration de Vichy avec les nazis. Vichy n’est qu’une parenthèse dans la glorieuse histoire de France.
Ce mythe est entretenu par :
- Les gaullistes qui exaltent la résistance extérieure,
- Les communistes qui mettent l’accent sur la résistance intérieure du peuple et le rôle du PC dans la résistance, « le parti des 75 000 fusillés »
Le but est de recréer l’unité nationale, de reconstruire une identité française honorable, digne de passer à la postérité, la faire reconnaître et respecter par nos alliés américains qui avaient d’abord envisagé de placer la France libérée sous l’administration militaire.
Il y a bien le châtiment des traîtres (épuration), mais finalement minoritaire, et qu’il fallait vite oublier.
2°Affrontement des mémoires 1947 – fin des années 1950
En 1947, le Parti communiste fait rupture avec le gouvernement. Il y a affrontement entre le PC et les gaullistes.Les collaborateurs relève la tête et dénonce l’épuration. On avance le chiffre de 10 000 fusillés. Les résistants ne sont plus vus de manière aussi positive.
3° Le silence – (fin des années 1950 à 1972).
On ne parle plus de la guerre, c’est une époque de refoulement. On dit peu de choses sur les camps et la résistance. C’est l’époque du début de la Vème République et de la présidence du Général de Gaulle.
4°Le retour du refoulé Après 1970,
il y a un quatrième temps : le retour du refoulé.
Après le départ puis la mort de De Gaulle (1970) il y a en mode mineur les retombées de la contestation de 1968 et la critique de la bienséance et en mode majeur les travaux d’historiens et de journalistes sur la période trouble de Vichy.
C’est un américain Robert Paxton qui déboulonne le mythe d’une France majoritairement résistante et d’un esprit de Vichy minoritaire. Il publie en 1973 « la France de Vichy » et finit de réveiller la mémoire des Français en montrant que Vichy n’était pas une simple parenthèse dans l’histoire de France mais qu’il révélait des tendances profondes de la société française. Il montre la réalité du régime de Vichy qui était collaborateur, xénophobe, antisémite, réactionnaire… La guerre a fortement divisé les Français : une minorité a collaboré, une autre minorité a résisté, l’immense majorité est restée attentiste et occupée à survivre.
Et en comparant la France des années d’occupation aux autres pays occupés d’Europe occidentale, il dresse un bilan globalement négatif. La France de Vichy a fait pire que les autres pays occupés.
A côté du travail d’Historiens, un film a aussi constitué une rupture du mythe de l’Union Nationale : « Le Chagrin et la Pitié » de Marcel Ophüls même s’il a fait l’objet d’une censure larvée en France. S’il a été diffusé, dès sa sortie en 1969 en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis, « Le Chagrin et la Pitié » n’a été projeté en France qu’en 1971, dans une petite salle du Quartier latin. Et ce n’est qu’en 1976 qu’il a été admis dans le circuit commercial restreint des salles » Art et Essai. Et pour le voir à la télévision française il a fallu attendre 1981 pour que FR3 le mette au programme.
Mais pour revenir au point central de notre propos autour de la mort de Simone Veil et la mémoire refoulée des déportés dans les camps de concentration pour des motifs raciaux, il faut évoquer :
La pleine révélation de la Shoah.
Un point fondateur est certainement le procès Eichmann en Israël en 1961, il permet de prendre conscience de la spécificité du génocide juif. Ce procès libère enfin la parole des survivants juifs, rares témoins qui disparaissent peu à peu.
On constate alors la création d’associations juives militantes (Simon Wiesenthal, Serge Klarsfeld), publication de livres, de documentaires (« Shoah » de Claude Lanzmann en 1985), de films ou téléfilms sur le sujet : « Holocauste », « Le pianiste », « La vie est belle ».
Par ailleurs, les recherches sur le génocide des juifs sont d’autant plus poussées qu’au début des années 70, certains cherchent à minorer (les révisionnistes), voire à nier (les négationnistes) le génocide.
Ainsi en 1978, Darquier de Pellepoix (ancien commissaire aux questions juives sous Vichy) déclare: « A Auschwitz, on n’a gazé que des poux ». Parallèlement en 1978, Serge Klarsfeld publia la liste par convois des 75 721 Juifs déportés de France
C’est ainsi qu’on s’intéresse enfin à la responsabilité de Vichy dans la shoah : ce qui aboutit à des procès et des inculpations pour complicité de crimes contre l’humanité dans les années 80-90 : Papon (Ministre sous Giscard), Bousquet (ami de Mitterrand), Touvier ami de milieux catholiques.
En 1983, le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, repéré en Bolivie par Beate Klarsfeld dès 1971, fut extradé, ramené en France, et condamné à Lyon en 1987 à la détention perpétuelle. Il est mort en prison en 1991.
Et enfin, l’Etat français commence à évoquer ce sujet et fait lui-même repentance à partir des années 1990 :
- 1990 : loi Gayssot qui condamne tout propos négationniste ;
- 1993 : un décret fait du 16 juillet (jour anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv) la journée nationale de la commémoration des persécutions raciales et anti-sémites
- 1995 : J Chirac reconnaît « la responsabilité de l’Etat français » dans le génocide qu’il qualifie de « faute collective »
- 1996 : indemnisation par l’Etat des descendants des familles juives spoliées pendant la guerre.
- 2000 : fondation pour la mémoire de la Shoah dont la présidente fut Simone Veil
- 2005 : rénovation du mémorial de la Shoah qui rappelle que 79 000 juifs de France ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale pour seulement 3000 survivants.
Conclusion
Le monde est complexité, tous les Français n’étaient pas vichystes et beaucoup de juifs ont été sauvés par des Français qui ont fait de remarquables efforts pour les cacher et les nourrir. 25 % des juifs vivant en France sont morts pendant la guerre contre 92% en Pologne, 80 en Grèce et 73 en Yougoslavie.
Il est heureux qu’il a enfin été possible de faire la lumière et de parler de la réalité de la shoah. On peut regretter que cette lumière qui révèle pleinement le crime contre les juifs n’ait pas encore pleinement éclairé les crimes des nazis contre les tsiganes, les homosexuels et d’autres déportés.
L’Historienne Annette Wierworka a publié en 1992 le fruit de ses recherches sur ce sujet, livre essentiel : « Déportation et génocide, entre la mémoire et l’oubli »
J’ai écrit ce mot du jour et le précédent en m’inspirant du Cours d’Histoire que j’avais suivi à la faculté d’Histoire de Lyon 2, en me référant à ma connaissance et compréhension du sujet acquis par mes lectures. J’ai aussi cité des réflexions et des développements trouvés sur ces 2 sites très pédagogiques.
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/enseigner/memoire_vichy/menu.htm
http://ww3.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/memoire_philatelie/pages/coursmemoire.htm
Au bout de ce rappel des faits, on se rend compte qu’après la guerre il y eut beaucoup de mythes (parenthèse Vichy, France unie et résistante), un immense déni et un silence pesant sur les génocides et la réalité des camps d’extermination.
Ce n’est finalement que tardivement qu’il a été possible d’en parler et de dévoiler, ce crime immense qui a été perpétré par des hommes d’une nation occidentale, chrétienne, probablement la nation la plus civilisée, celle de Kant, de Goethe, de Beethoven, d’Einstein. Dans cette horreur, il a existé des hommes dans d’autres nations comme la nation française qui ont aidé, participé à cette horreur.
Aujourd’hui nous dénonçons les barbares à l’œuvre ailleurs qu’en occident et d’une autre religion que la chrétienne. Notre civilisation a fait pire, il n’y a pas très longtemps.
<923>
- 1°Le mythe de l’Union Nationale (1945/1947)
-
Mercredi 6 septembre 2017
« Si nous n’avons pas parlé c’est parce que l’on n’a pas voulu nous entendre, pas voulu nous écouter. »Simone VeilSimone Veil a été transportée avec sa mère et sa sœur dans un wagon à bestiaux vers Auschwitz. Le 71ème convoi dont elle était une des victimes comptait 1500 déportés, elle fit partie des 130 personnes qui revinrent.
Des atrocités se sont passées dans ces camps. Mais ce qui est inimaginable, c’est qu’au retour personne ou si peu ont voulu entendre ou écouter ce que ces rescapés de l’horreur avaient à raconter.
Simone Veil s’est plusieurs fois exprimé sur ce sujet.
<France Culture> a publié une page avec des extraits radiophoniques de Simone Veil parlant de ce refoulement.
Il y a notamment ces propos de Simone Veil :
« Aujourd’hui, on refait beaucoup l’Histoire. On essaye de comprendre pourquoi on n’a pas plus parlé. Je crois que ça vaut la peine d’essayer de comprendre pourquoi mais qu’il ne faut pas refaire l’histoire autrement qu’elle n’a été en disant que c’est parce que les déportés n’ont pas voulu en parler, parce que les déportés ont cherché l’oubli eux-mêmes. Ce n’est pas vrai du tout. Il suffit de voir le nombre de rencontres qu’ils ont entre eux. Si nous n’avons pas parlé c’est parce que l’on n’a pas voulu nous entendre, pas voulu nous écouter. Parce que ce qui est insupportable, c’est de parler et de ne pas être entendu. C’est insupportable. Et c’est arrivé tellement souvent, à nous tous. Que, quand nous commençons à évoquer, que nous disons quelque chose, il y a immédiatement l’interruption. La phrase qui vient couper, qui vient parler d’autre chose. Parce que nous gênons. Profondément, nous gênons. ».
Ce fait historique : on ne voulait pas entendre les rescapés des camps : juifs, tziganes et homosexuels, je l’ai vraiment compris lors de mes études d’Histoire en 2004 à l’université de Lyon 2 lorsque la professeure d’Histoire, Sylvie Schweitzer, nous a parlé du conflit des Mémoires et du refoulement de certaines d’entre elles après la 2ème guerre mondiale.
En préambule, il faut faire une distinction radicale entre deux termes : L’Histoire et la mémoire.
L’Histoire est une discipline rigoureuse qui a l’ambition d’analyser scientifiquement le passé. La mémoire n’est ni rigoureuse, ni scientifique mais affective et donc subjective.
Quand on examine de manière rationnelle les mémoires après la seconde guerre mondiale, on constate un entrecroisement des mémoires, des conflits de mémoires et des mémoires refoulées comme celles des déportés.
Voici une esquisse de typologie de ces mémoires :
1°La mémoire triomphante des résistants. Des héros positifs, fascinants d’abord rebelles puis vainqueurs.
Nous savons désormais que la situation était très complexe, pendant longtemps il y eut peu de résistants, puis près de la victoire un grand nombre de résistants.
2° Parmi ces résistants, il y eut les résistants gaullistes et les résistants communistes. Le Parti communiste parvint à faire croire au mythe du parti des 75 000 fusillés. Il occulta totalement l’histoire du début de la guerre, de la soumission au pacte germano soviétique, ainsi que les sombres règlements de compte qu’il y eut entre diverses tendances du parti à la fin de la guerre, assassinats qui furent maquillés en exécution pour trahison. Ce n’est pas qu’il n’y eut pas de traitres, ni qu’il y eut beaucoup de communistes résistants à partir de l’invasion des nazis en Russie et qu’il n’y eut pas de communistes fusillés. Mais cette mémoire a longtemps été sélective et exagérée.
3° La mémoire repliée des prisonniers de guerre (1,4 millions de personnes) 100 000 morts dans les premières semaines. Ils ont perdu la guerre, ce sont des anti-héros.
4° La mémoire défensive des STO (service de travail obligatoire). Ils ont tenté après la guerre de faire reconnaître un statut de déporté du travail, mais ce statut a été refusé en raison d’une hiérarchie de la souffrance et de leur refus d’aller dans le maquis.
5° Il y eut aussi la mémoire controversée des « malgré-nous » que les allemands ont obligé à combattre à leurs côtés, notamment en Russie où il y eut de nombreux morts. Beaucoup d’entre eux se sentaient victimes, mais la majorité triomphante les classait dans la catégorie des traitres et des collaborateurs. Cette confusion entre le rôle de victime et de bourreau s’est particulièrement révélé lors du procès de Bordeaux où ont été jugés des soldats ayant participé au massacre d’Oradour sur Glane auquel participèrent des alsaciens. Cet épisode vit s’affronter une mémoire Limousine et une mémoire alsacienne comme le montre ce documentaire : Le procès d’Oradour
6° Il y eut la mémoire cachée des vichystes et des collaborateurs, dont beaucoup subirent d’abord une épuration sauvage et violente puis une épuration juridique plus maîtrisée. Ils ne disparurent pas mais restèrent cachés et silencieux quelques années.
7° Et enfin il y eut la mémoire blessée des déportés dont parle Simone Veil. Les signes de sollicitude furent peu nombreux. Et pendant de trop longues années l’oubli tomba comme un caveau sur cette mémoire douloureuse et terrible de peuples que les nazis ont voulu anéantir après leur avoir dénié leur humanité.
Ces mémoires entreront en compétition et au cours des années évolueront.
Mais ce mot du jour est déjà très long, je raconterai la suite demain.
<923>
-
Mardi 5 septembre 2017
« On ne construit rien sur la haine, c’était ça la leçon de Simone Veil »Robert BadinterLe 30 Juin 2017, Simone Veil a quitté la communauté des vivants.
Elle fut une sorte de conscience, de référence de la vie politique française tout au long de sa vie.
Je me souviens comme les gens de mon âge, quand le 26 novembre 1974, Simone Veil était montée à la tribune de l’Assemblée nationale pour défendre le projet de dépénalisation de l’avortement.
Je me souviens de sa dignité, de sa force de conviction et de cette phrase :
« Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme. Je m’excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d’hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. C’est toujours un drame, cela restera toujours un drame ».
<Vous trouverez ici ce discours>
Chaque fois qu’elle s’exprimait on ressentait sa dignité, ses convictions et ses grandes qualités humaines.
Robert Badinter avait été invité le 5 juillet par France Inter pour lui rendre hommage.
Et en peu de mots il a dit l’essentiel.
La guerre était à peine finie et elle a accepté de suivre son mari Jean pour aller vivre en Allemagne quelques années. Par la suite, elle a invariablement agi pour la réconciliation entre l’Allemagne et la France et pour la construction européenne.
Robert Badinter a dit :
« Elle avait compris encore adolescente qu’il n’y avait pas de place pour la paix, s’il n’y avait pas d’abord l’apaisement intérieur. On ne construit rien sur la haine, c’était ça la leçon de Simone Veil.[…]
Elle a œuvré pour la réconciliation franco-allemande. La construction pour l’Europe, et la réconciliation avec l’Allemagne a été sa grande cause, et « cela transcende tout le reste ».[…]
Elle était pro européenne, une européenne, c’est-à-dire les enfants des assassins ne doivent pas porter le crime de leurs parents ; cette démarche n’est pas si facile que de l’énoncer. Ce travail sur soi c’est la vraie grandeur de Simone Veil. »
En 2010 elle entra à l’Académie française, elle fit graver son numéro de déportée sur son épée. Elle occupera le treizième fauteuil qui fut celui de Racine.
Jean d’Ormesson l’accueillit par un très beau discours qu’il finit par cette phrase :
« Je baisse la voix, on pourrait nous entendre : comme l’immense majorité des Français, nous vous aimons, Madame. Soyez la bienvenue au fauteuil de Racine, qui parlait si bien de l’amour. »

A l’extérieur une centaine de militants anti-IVG manifestaient pour protester contre cette élection, contre la femme qui symbolisait le droit à l’avortement. A sa mort, plusieurs d’entre eux exprimaient encore leur haine à son égard.
Pour ma modeste part, je fais partie de l’immense majorité des français
<921>
-
Lundi 4 septembre 2017
« « Gracias a la vida Merci à la vie
Que me ha dado tanto Qui m’a tant donné
Me ha dado el sonido Elle m’a donné le son
Y el abecedario Et l’alphabet
Con él las palabras Avec lui les mots» »Violeta ParraC’est la rentrée !
« Gracias à la vida » est une chanson d’amour souvent chanté par Mercedes Sosa la célèbre chanteuse argentine ou par Joan Baez la chanteuse américaine à la voix de velours. Et même une fois <par les deux>.
Mais cette chanson a été écrite et mise en musique par Violeta Parra, une immense chanteuse chilienne. Une de ses dernières chansons. Elle l’a enregistrée sur son dernier album en 1966. Le 5 février 1967, à quarante-neuf ans, et après plusieurs tentatives ratées, Violeta Parra met fin à ses jours. <Un billet sur un autre blog parle de cette magnifique chanson et de son auteure>
Quel lien entre l’école et cette chanson ?
Dans la 3ème strophe, l’auteur remercie la vie d’avoir donné le « son » pour parler, « l’alphabet » pour écrire et « les mots » pour s’exprimer. Et c’est la première mission de l’école apprendre à s’exprimer, à réfléchir, à s’interroger grâce aux mots.
Oui ; merci à la vie de nous avoir donné cela et de nous avoir donné l’école.
Quelquefois quand mes enfants trouvaient qu’aller à l’école était bien embêtant et contraignant, je leur répétais que le contraire de l’école n’était pas le jeu, mais le travail. Le travail des enfants qui existe encore dans trop de pays dans le monde. L’école permet d’émanciper les enfants, de les libérer, de leur permettre de se construire.
Ce n’est pas moi mais Véronique Decker, directrice de l’école Marie Curie de Bobigny qui a fait ce lien, à la fin de l’émission de France Culture de ce samedi dans laquelle elle était invitée pour parler de la rentrée scolaire.
Dans cette émission elle a notamment exprimé la chose suivante :
« J’ai un regard très critique sur tous ces zigzags.
Je suis directrice de cette école depuis 2000, cela fait 17 ans que je suis là.
En 17 ans j’ai tout vu, tout vécu, et chaque fois il a fallu s’adapter à des procédures qui n’ont jamais de durée :
On a eu des emplois jeunes, on a eu des auxiliaires de vie scolaire, on a eu des emplois de vie scolaire, on a eu des assistantes d’éducation.
Un 31 août on m’a dit d’annoncer aux assistantes d’éducation que leurs contrats n’étaient pas renouvelés, il y a quelques années. On avait 4 personnes qui nous aidaient dans l’école et du jour au lendemain plus personne.
A un moment j’ai eu une secrétaire, à un moment je n’ai plus eu de secrétaire, à un moment j’ai eu une secrétaire, à un autre moment je n’ai plus eu de secrétaire, et là j’en ai une. Tout va bien !
Ce qui est usant c’est qu’on a le sentiment que beaucoup d’argent parfois est dépensé pour faire des annonces qui ne sont pas celles de nos demandes. »
Elle insiste, par exemple, sur le fait qu’il n’y a presque plus de médecins scolaires en Seine Saint Denis qui est pourtant le département où probablement il serait le plus nécessaire d’en avoir.
Je vous conseille d’écouter <cette émission> où elle exprime très simplement et très pédagogiquement les problèmes auxquels l’école doit faire face et la manière « hors sol » avec laquelle les technocrates lancent des idées et des réformes qui ne répondent pas aux questions qui se posent.
Véronique Decker est une militante de l’école Freinet. Elle a écrit deux livres : « Trop classe ! Enseigner dans le 9-3 » en 2016 et « L’école du peuple » en 2017.
Vous trouverez derrière <Ce lien> un article sur le premier de ces livres et un entretien avec Véronique Decker qui dit notamment :
« Chaque école Freinet a sa particularité et son histoire. Ce qui nous caractérise c’est qu’on a monté cette école Freinet sans aucune aide. Par exemple, sans aide au mouvement particulière. On a fait une école ordinaire qui fonctionne selon les règles du mouvement ordinaire. Du coup il n’y a pas que des militants Freinet dans l’école. Les gens disent qu’on est une école Freinet . Mais nous on préfère parler d’une école avec des militants Freinet. Ce sont des enseignants militants qui ont choisi de venir enseigner là. Ce qu’on partage ce n’est pas tant des techniques Freinet que des valeurs morales. »
Plus loin dans cet article elle explique :
« Je vois le plancher social s’effondrer à la hauteur des enfants. Nous voyons des choses qu’on n’imaginait pas possible il y quelques années. Par exemple, des enfants qui ont faim. Des familles en errance. On a des enfants qui démarrent un CP dans le Tarn et Garonne, puis partent chez une tante à Lille. Puis vont dans le 93 pour 3 mois. A la fin de l’année, l’enfant a fait des bouts de CP mais il ne sait rien. Il y a 10 ans des parents à la rue avec 5 enfants auraient obtenu un logement passerelle en raison des 5 enfants. Maintenant ces enfants déscolarisés de fait ne déclenchent plus des services sociaux qui d’ailleurs sont submergés.
Il ya 10 ans on rencontrait les assistantes sociales tous les trimestres et on leur adressait des enfants. Maintenant il faut des semaines pour avoir un rendez vous et elles n’ont plus rien dans les mains. Les gens sont en train de se replier physiquement et psychiquement. Et dans nos écoles on voit émerger des pathologies et des souffrances dont les enfants sont les premières victimes.
On a essayé de médiatiser cela en vain. Mais on se heurte à l’indifférence et au repli. Chacun pense qu’il peut s’en sortir seul. J’ai l’impression que la guerre arrive. Qu’on va vers le désastre. Rien n’est fait pour nous sauver. Ce n’est pas l’ascenseur social qui est en panne mais le plancher social qui est troué. »
Elle explique cependant qu’il reste encore de belles journées
« On les appelle des « moments champagne ». Ce sont ces moments où les enfants progressent. Par exemple, le dernier moment que j’ai vécu c’était à un moment où je devais faire face à deux absences d’enseignants non remplacées. J’ai installé les enfants dans le préau devant mon bureau et je leur ai donné un test départemental à faire. Sans professeurs ils se sont entraidés. Je les regardais et je voyais une ruche bruissante, avec des enfants appliqués. L’ambiance était très sympathique Freinet c’est ça pour moi : que les enfants apprennent sans avoir besoin d’un policier pour les contraindre. Qu’ils soient conscients des enjeux. Ils ont fait la tache. C’était une vraie victoire. Champagne ! »
<Slate a consacré un article au second ouvrage « L’école du Peuple »>. Le titre de cet article : « Une enseignante extraordinaire raconte ce que les enfants et les familles vivent aujourd’hui »
<Médiapart a aussi consacré un article à cet ouvrage> (mais il faut être abonné)
Et Le Monde lui a consacré dans sa série « Ceux qui font » un article qu’il a intitulé « Véronique Decker, enseignante de combat »
Cet article débute ainsi :
« Mais où puise-t-elle toute cette énergie ? Véronique Decker, 63 ans, peut virevolter sur une paire de rollers pour la répétition de la fête de fin d’année en répondant au téléphone à une mère d’élève au sujet d’une absence puis, sans transition, raccrocher et reprendre sa leçon de géométrie improvisée afin d’expliquer au gamin de CM2 (cours moyen supérieur) qui l’écoute comment bien positionner ses pieds. Elle avance une réponse : « Directrice d’école, c’est être multitâches. » Et après un court instant : « Et avoir la capacité en permanence de passer d’une chose à l’autre. » Elle complétera plus tard : « C’est aussi monter des procédures sans cesse, qui s’effondrent sans arrêt. » Avant d’ajouter, avec un geste de la main : « C’est super varié comme métier. Elle rit, désigne un nuage, puis un autre. Chaque matin, tu ne sais jamais par quel côté les ennuis vont arriver ! » Le ton est donné. Véronique Decker est ainsi, elle donne le tournis. »
Cette femme, au terme de sa carrière qui voit et décrit la misère sociale de ses élèves, les problèmes de l’école reste une femme pleine d’énergie et de courage pour affronter la réalité, faire bouger les choses.
Et elle s’émeut devant cette chanson de gratitude : « Gracias à la vida »
<Derrière ce lien vous entendrez Violetta Parra chanter Gracias à la visa>
Il me semble que malgré Mercedes Sosa, malgré Joan Baez, c’est l’interprétation la plus bouleversante.
Voici le texte intégral de la chanson et sa traduction trouvée sur le site suivant ;
<http://www.paroles-musique.com>
Gracias a la vida
Que me ha dado tanto
Me dio dos luceros
Que cuando los abro
Perfecto distingo
Lo negro del blanco
Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las multitudes
El hombre que yo amo.Gracias a la vida
Que me ha dado tanto
Me ha dado el oído
Que en todo su ancho
Graba noche y día
Grillos y canarios
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos
Y la voz tan tierna de mi bien amado.Gracias a la vida
Que me ha dado tanto
Me ha dado el sonido
Y el abecedario
Con él las palabras
Que pienso y declaro
« madre, amigo, hermano »
Y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amandoGracias a la vida
Que me ha dado tanto
Me ha dado la marcha
De mis pies cansados
Con ellos anduve
Ciudades y charcos
Playas y desiertos, montañas y llanosY la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida
Que ma ha dado tanto
Me dio el corazón
Que agita su marco
Cuando miro el fruto
Del cerebro humano
Cuando miro el bueno tan lejos del malo
Cuando miro el fondo de tus ojos claros.Gracias a la vida
Que me ha dado tanto
Me ha dado las risas
Y me ha dado el llanto
Así yo distingo
Dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi canto
El canto de todos que es el mismo canto
El canto de todos que es mi propio cantoMerci à la vie
Qui m’a tant donné
Elle m’a donné deux étoiles
Et quand je les ouvre
Je distingue parfaitement
Le noir du blanc
Et en haut du ciel son fond étoilé
Et parmi la multitude
L’homme que j’aimeMerci à la vie
Qui m’a tant donné
Elle m’a donné l’ouïe
Qui dans toute son amplitude
Enregistre nuit et jour
grillons et canaris
Marteaux, turbines, aboiements, averses
Et la voix si tendre de mon bien-aiméMerci à la vie
Qui m’a tant donné
Elle m’a donné le son
Et l’alphabet
Avec lui les mots
Que je pense et déclare
»mère, ami, frère »
et lumière qui éclaire le chemin de l’âme de celui que j’aimeMerci à la vie
Qui m’a tant donné
Elle m’a donné la marche
De mes pieds fatigués
Avec eux j’ai parcouru
des villes et des flaques d’eau
des plages et des déserts, des montagnes et des plaines
Et ta maison, ta rue et ta courMerci à la vie
Qui m’a tant donné
Elle m’a donné un cœur
Qui vibre
Quand je regarde le fruit
Du cerveau humain
Quand je regarde le bien si éloigné du mal
Quand je regarde le fond de tes yeux clairsMerci à la vie
Qui m’a tant donné
Elle m’a donné le rire
Et elle m’a donné les pleurs
Ainsi je le distingue
bonheur et déchirement
les deux matériaux qui composent mon chant
et votre chant à vous qui est le même chant
et le chant de tous qui est mon propre chant.<920>
-
Vendredi 1er septembre 2017
« Un gite dans le Beaujolais »Un lieu pour éviter le tourisme de masseLe sujet de conversation qui a pour objet les vacances n’a pas ma prédilection. Mais lorsqu’on m’interroge, je suis bien obligé de répondre.
Et lorsque des collègues curieux m’ont demandé où nous allions passer nos 3 semaines de vacances avec Annie et que j’ai répondu le Beaujolais et que j’ai ajouté, en plus, comme l’année dernière, il y a eu comme un silence réprobateur.
Si encore nous disposions d’une résidence secondaire dans le Beaujolais, pourquoi pas, mais un gite ! et trois semaines !
« Mais enfin tu habites Lyon, dans le Beaujolais tu y vas quand tu veux, un dimanche par exemple. Un weekend, si tu veux faire des excès ! »
Mais pourquoi le Beaujolais ?
La première raison c’est parce que c’est près de là où j’habite et qu’ainsi je n’ai pas besoin d’aller loin pour me reposer, me ressourcer, marcher et surtout rencontrer un nombre raisonnable de touristes.
Dans le Beaujolais on fait des rencontres étonnantes. Par exemple, sur le marché du Bois d’Oingt, vous trouvez un boulanger bio : « L’ami du pain ». Dans sa jeunesse il était ingénieur, mais maintenant il fait des pains à se pâmer. Un jour, nous avions acheté plusieurs pains (« c’est quand c’est bon qu’il faut qu’il y en ait beaucoup » dit mon frère Gérard.) et nous sommes allés nous désaltérer à une terrasse près du marché. Brusquement, nous avons entendu monter le son d’un violoncelle jouant une suite de Bach de belle manière. Je me suis précipité, dans ma jeunesse à moi j’avais tenté aussi le violoncelle, pour rencontrer cet interprète. C’était le boulanger. Je lui alors dit : « Vous ne vous contentez pas de produire un pain divin, vous jouez aussi Bach à la perfection ». Il m’a alors répondu que l’émotion était la même pour faire du pain et jouer du Bach, que les deux avaient un lien avec le divin.
Cet homme surprenant a pour nom Didier Genetier.
Quand on est dans un lieu calme, c’est-à-dire loin de l’agitation, il est plus facile de se ressourcer, de se retrouver soi-même et même de poursuivre des activités intellectuelles. De ces activités qui n’occupent pas la journée, mais la remplissent.
Avant de partir, je m’étais promené sur les quai de Saône de Lyon, j’y ai trouvé un livre que je n’avais pas lu, mais que beaucoup m’avaient conseillé de lire. Le bouquiniste qui me l’a vendu a eu cette remarque : « Je vous envie de découvrir ce chef d’œuvre ». C’est ainsi que j’ai lu « Belle du Seigneur » d’Albert Cohen.
J’ai aussi lu le « Luther » de Lucien Febvre, le premier réformateur par le co-créateur avec Marc Bloch de l’Ecole des Annales.
J’ai pu, lors de longues ballades écouter la nature, échanger avec Annie et aussi écouter, entre autres, plus de 8 heures d’émissions de France Culture consacrées à l’Alimentation d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Autant de nourritures pour mes futurs mots du jour. Car écrire les mots me permet d’approfondir, de mieux comprendre, de mieux saisir ce que j’ai lu ou écouté. Et bien sûr le partager. L’objectif de le partager, m’incite et me pousse à approfondir et donc d’aller plus loin qu’une seule simple lecture ou écoute.
Tout ceci ne serait pas possible si Annie n’avait pas déniché un gite remarquable, remarquable par la qualité et les conditions de l’accueil.
La possibilité d’un échange marchand équilibré où chacun trouve son compte tout en conjuguant l’échange humain et le partage d’expériences. Ghislaine et Michel sont les acteurs de cet échange harmonieux et simple. Ce gite, ce lieu peu éloigné de notre résidence, cette campagne vallonnée et paisible correspondent à ce que nous attendons des vacances qui je rappelle vient du verbe latin « vacare » et qui peut se décliner par cette formule « caractère de ce qui est disponible ».
Chacun est libre de choisir ses vacances en fonction de ses moyens, bien sûr, mais aussi de ses envies, de ses besoins et de ses attentes. Les attentes des uns et des autres peuvent être très différentes. Mais il me semble important de se sentir libre, de ne pas se croire obligé de faire comme les autres ou pire d’être dans la crainte du regard de l’autre.
Alors évidemment, même s’il n’y a pas grand monde, il existe toujours l’altérité. C’est-à-dire des personnes qui entendent non seulement utiliser leur temps libre d’une manière très différente de la vôtre, mais qui en outre aime que leur activité soit connue du voisinage, en bien ou en mal, peu importe, connue est le mot essentiel. Il y a ainsi près du gite, sur une colline alentour, un groupe d’individus qui trouvent plaisant de pratiquer le ball trap le dimanche matin et le mercredi après-midi
Comme je l’ai dit, cela apprend l’altérité. La qualité du gite est telle que si vous vous réfugiez à l’intérieur, vous n’entendrez rien et pourrez lire tranquille ou faire autre chose. Ces moments bruyants peuvent aussi vous inciter, lors de ces deux demi-journées, de vous éloigner un peu du gite pour pratiquer d’autres ballades ou activités.
Nous retournerons encore dans ce gite que vous pouvez découvrir derrière ce lien : <Les Buis du Chardonnet>
<919>
-
Jeudi 31 août 2017
« Je crois que le tourisme est une des modalités de destruction de la vie intérieure. »Marin de ViryPour continuer la réflexion sur le tourisme de masse, je partage avec vous cet article du Figaro < Marin de Viry: «Comment le tourisme de masse a tué le voyage»>
Le Figaro nous apprend que Marin de Viry est écrivain et critique littéraire et qu’il est l’auteur d’un essai sur le tourisme de masse: <Tous touristes (Café Voltaire, Flammarion, 2010)>.
Probablement qu’il est rassurant de considérer que son propos est provocateur. Il peut aussi être accusé d’élitisme, car selon lui tant qu’un petit nombre d’aristocrates pouvaient s’adonner à ce loisir, les choses étaient acceptables. Ce serait donc les conquêtes sociales qui seraient en cause.
Son regard me semble quand même intéressant : il reparle du divertissement pascalien et bien sûr, en creux, du paraître et de la superficialité.
Marin de Viry explique notamment :
« Le tourisme n’a plus rien à voir avec ses racines. Quand il est né au XVIIIe siècle, c’était l’expérience personnelle d’un homme de «condition», un voyage initiatique au cours duquel il devait confronter son honneur – c’est-à-dire le petit nombre de principes qui lui avaient été inculqués – à des mondes qui n’étaient pas les siens. Il s’agissait de voir justement si ces principes résisteraient, s’ils étaient universels. Un moyen d’atteindre l’âge d’homme, en somme. Le voyage, c’était alors le risque, les accidents, les rencontres, les sidérations, autant de modalités d’un choc attendu, espéré, entre le spectacle du monde et la façon dont l’individu avait conçu ce monde à l’intérieur de sa culture originelle.
Au XIXe, tout change: le bourgeois veut se raccrocher à l’aristocrate du XVIIIe à travers le voyage, qui devient alors une forme de mimétisme statutaire. Le bourgeois du XIXe siècle voyage pour pouvoir dire «j’y étais». C’est ce qui fait dire à Flaubert lorsqu’il voyage avec Maxime Du Camp en Égypte: mais qu’est-ce que je fais ici ? […]
Avec l’époque contemporaine, on a une totale rupture du tourisme avec ses racines intellectuelles. Même chez ceux qui aujourd’hui veulent renouer avec le voyage, pour s’opposer au tourisme de masse, il n’y a plus de profonde résonance, de profond besoin, car le monde est connu, et le perfectionnement de leur personne ne passe plus forcément par le voyage. Là où le voyage était un besoin, au XVIIIe, pour devenir un homme, se former, parachever son âme et son intelligence, il devient quelque chose de statutaire au XIXe, puis une simple façon de «s’éclater» aujourd’hui. C’est devenu une modalité de la fête permanente, laquelle est devenue banale. Le monde est ennuyeux parce qu’il est le réceptacle de la fête, devenue banale. »
A la question, dans notre monde globalisé, est-il encore possible de voyager? Il répond :
«Toute la question est de savoir s’il reste des destinations ouvertes à la curiosité. Or, plus elles sont organisées, balisées par le marketing touristique de la destination, moins elles sont ouvertes à la curiosité. […]
Je vais être néo-marxiste, mais je crois que c’est le salariat, plus que la démocratisation, qui change tout. Les congés payés font partie du deal entre celui qui a besoin de la force de travail et celui qui la fournit. À quoi s’ajoute la festivisation, qui est d’abord la haine de la vie quotidienne. Et il est convenu que la destination doit être la plus exotique possible, car la banalité de la vie quotidienne, du travail, est à fuir absolument. Au fur et à mesure de l’expansion du monde occidental, la fête se substitue à la banalité, et la banalité devient un repoussoir. Il n’y a pas d’idée plus hostile à la modernité que le pain quotidien.
Autour de ce deal s’organise une industrie qui prend les gens comme ils sont, individualisés, atomisés, incultes, pas curieux, désirant vivre dans le régime de la distraction, au sens pascalien du terme, c’est-à-dire le désir d’être hors de soi. Le tourisme contemporain est l’accomplissement du divertissement pascalien, c’est-à-dire le désir d’être hors de soi plutôt que celui de s’accomplir. […]
Il nous donne, selon lui, le nom de l’inventeur du tourisme de masse, un puritain et en déduit le côté religieux du tourisme :
« C’est Thomas Cook qui invente le tourisme de masse. Cet entrepreneur de confession baptiste organise, en juillet 1841 le premier voyage collectif en train, à un shilling par tête de Leiceister à Loughborough, pour 500 militants d’une ligue de vertu antialcoolique. C’est la première fois qu’on rassemble des gens dans une gare, qu’on les compte, qu’on vérifie s’ils sont bien sur la liste, qu’on déroule un programme. Les racines religieuses puritaines ne sont pas anodines. Il y a comme un air de pèlerinage, de communion collective, dans le tourisme de masse. Le tourisme est très religieux. Et il y a en effet quelque chose de sacré au fait de pouvoir disposer de la géographie du monde pour sortir de soi. S’éclater à Cuba, c’est une messe ! »
Marin de Viry devient alors plus philosophe dans ses réflexions. J’en ai extrait l’exergue de ce mot du jour. Exergue qui aurait aussi pu être : « L’industrie du tourisme ne veut pas que ses clients abdiquent leur raison devant la beauté, mais qu’ils payent pour le plaisir. »
«Nous sommes dans la culture de l’éclate, de la distraction permanente, sans aucune possibilité de retour sur soi. Le monde moderne est une «conspiration contre toute espèce de vie intérieure», écrivait Bernanos. Je crois que le tourisme est une des modalités de destruction de la vie intérieure.
Prenons l’exemple du «syndrome de Stendhal». Stendhal s’est senti mal à force de voir trop de belles choses à Rome et à Florence. Trop de beauté crée un état de sidération, puis de délire confusionnel: en Italie, on est souvent submergé par le superflu. C’est l’expérience limite de la vie intérieure: la beauté vous fait perdre la raison. C’est exactement le contraire que vise l’industrie touristique, qui cherche à vendre la beauté par appartements, en petites doses sécables d’effusions esthétiques marchandisées. Elle ne veut pas que ses clients abdiquent leur raison devant la beauté, mais qu’ils payent pour le plaisir. Immense différence. »
Le journaliste se réfère alors à Michel Houellebecq qui décrit une France muséale, paradis touristique, vaste hôtel pour touristes chinois pour demander si c’est le destin de la France ?
«[…] Je ne suis pas totalement dégoûté par le scénario de Houellebecq. C’est une France apaisée, bucolique. On retournerait tous à la campagne pour accueillir des cohortes d’Asiatiques et de Californiens. On leur expliquerait ce qu’est une église romane, une cathédrale, une mairie de la IIIème République, un beffroi. Ce serait abandonner notre destin pour se lover dans un scénario tendanciel dégradé mais agréablement aménagé, et nous deviendrions un pays vitrifié plutôt qu’un pays vivant. Nous aurions été détruits par la mondialisation, mais notre capital culturel nous sauverait de l’humiliation totale: on nous garantirait des places de médiateurs culturels sur le marché mondial. Si on pense que Dieu n’a pas voulu la France, ou que l’histoire n’a pas besoin de nous, on peut trouver ça acceptable. »
C’est un avis ! Il bouscule un peu, c’est en cela qu’il peut être utile.
<918>
-
Mercredi 30 août 2017
« Le tourisme de masse »Conséquence de la démocratisation des congés et de l’augmentation du niveau de vie dans le monde.Un des moyens les plus commodes pour occuper son temps libre et notamment les vacances est de faire du tourisme.
Le tourisme est désormais une industrie extrêmement importante au niveau mondial et pour certains pays la première.
<Cet article du Parisien> nous apprend qu’en 2016, le nombre de touristes a progressé de 4% au niveau mondial, atteignant 1,2 milliard de visiteurs, grâce à la croissance du nombre de voyageurs provenant d’Asie (+8%).
L’Europe reste la région du monde la plus visitée, avec 620 millions de touristes, mais le nombre de visiteurs y a moins progressé (+2%) que l’année précédente en raison des craintes liées à la sécurité dans certains pays. Mais les résultats européens sont « très mitigés », certaines destinations ayant « un taux de croissance à deux chiffres et d’autres un taux plat » précise l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT).
Et en 2017, le tourisme mondial devrait continuer à croître de 3 à 4%, estime l’OMT. Le tourisme représente 10% du PIB mondial, 7% du commerce international et 30% des exportations de services, selon l’OMT. Un emploi sur 11 dans le monde provient du tourisme, si l’on tient compte des emplois directs, indirects et induits.
En France, le tourisme générait 7,1 % du PIB en 2015.
C’est donc une très bonne activité : elle donne de l’emploi, elle est a priori pacifique, elle permet de connaître d’autres pays autrement qu’en les envahissant par la guerre. Les allemands sont ainsi infiniment plus sympathiques depuis qu’ils viennent avec leur deutsch mark et maintenant leurs euros plutôt qu’avec leurs panzers.
Mais il y a pourtant un problème : le tourisme de masse.
- Peut-être que les destinations qui en valent la peine sont limitées. C’est une hypothèse.
- Le mimétisme constitue cependant un axe fort du comportement des humains qui aiment bien faire ce que font leurs voisins.
- Et puis, il faut accueillir les touristes et donc les industries touristiques investissent à cette fin. Et lorsqu’ils ont créé les infrastructures adéquates, ils font ce qu’il faut pour rentabiliser leurs investissements et inciter les vacanciers à venir. Et cela marche bien. Ce qui a pour conséquence d’envoyer de plus en plus de vacanciers dans les endroits où les infrastructures se sont déployées en grand nombre.
Toujours est-il que ce tourisme de masse pose beaucoup de soucis notamment aux autochtones qui ne se gênent pour le dire, pour protester et même pour manifester leur hostilité aux vacanciers, à Barcelone, à Venise, au Portugal.
Le Monde explique ainsi que <l’Espagne dit son ras le bol du tourisme de masse> :
Le journal montre par exemple un graffiti au parc Güell, à Barcelone, le 10 août :
« Touriste : ton voyage de luxe, ma misère quotidienne »
Puis pose la question :
« L’Espagne est-elle atteinte de « tourismophobie » ? Alors que leur pays s’apprête à battre de nouveaux records – il a déjà accueilli plus de 36 millions de visiteurs (11,6 % de plus qu’en 2016) et devrait dépasser les 80 millions avant la fin de l’année –, les Espagnols s’interrogent sur les méfaits induits par un secteur qui représente 11,2 % du produit intérieur brut (PIB) et qui fait vivre 2,5 millions de personnes. »
Il faut dire que certains vacanciers sont particulièrement atteints du syndrome : « Pour occuper mon temps libre, je fais n’importe quoi »
« L’hôpital universitaire de Palma de Majorque, Son Espases, est ainsi devenu une référence mondiale dans une spécialité assez particulière : soigner des vacanciers blessés lors d’un balconing, une pratique qui consiste à sauter d’un balcon à un autre, ou dans une piscine. Le profil des quarante-six personnes soignées par l’établissement entre 2010 et 2015 ? D’après un rapport publié en mars : jeune (environ 24 ans), majoritairement britannique (60,8 %) et complètement ivre.
Dernière victime en date, un Irlandais de 27 ans qui s’est jeté de sa chambre d’hôtel de San Antonio (Ibiza) début juillet. Le balconing aurait déjà causé la mort de trois touristes à Majorque depuis le début de l’été, selon les autorités locales.
Il y a aussi les booze cruises (les « croisières arrosées ») pour lesquelles on peut embarquer depuis la plage de Magaluf (Majorque) et qui offrent trois heures de musique et de boissons non-stop sur des bateaux bondés pour 55 euros… »
Alors il y a des réactions et une saine colère !
« Fin juillet, quatre personnes encagoulées ont subitement obligé un bus touristique de Barcelone à s’arrêter : elles ont crevé les pneus du véhicule avant de peindre sur son pare-brise le slogan « Le tourisme tue les quartiers ». L’attaque a été revendiquée par le collectif Arran, le mouvement de jeunesse du parti d’extrême gauche indépendantiste CUP.
Ses militants dénoncent « un modèle de tourisme qui génère des bénéfices pour très peu de personnes et aggrave les conditions de vie de la majorité ». Ils ont aussi lancé des confettis aux clients d’un restaurant du port de Palma de Majorque et collé des centaines de stickers sur des véhicules de location contre le « tourisme qui tue Majorque ». »
Et si cette industrie donne de l’emploi, il s’agit surtout de jobs de m… :
« Le secteur emploie 13 % de la population active en Espagne, et jusqu’à 20 % en Catalogne. Mais il requiert surtout une main-d’œuvre peu chère et temporaire, donnant l’impression d’un « pays de serveurs » comme le dénonce régulièrement la presse ibérique. « La précarisation des emplois touristiques est de plus en plus problématique », affirme un rapport de l’université Loyola Andalucia publié en avril. »
Dans la même veine, le journal <Sud-Ouest> publie un article : « Stop au tourisme massif, nous voulons des quartiers pour vivre ! ».
Et la <Dépêche>, le journal de Toulouse explique que les capacités d’accueil espagnoles frisent la cote d’alerte et notamment que le phénomène Airbnb fait flamber le prix du mètre carré pour les habitants locaux qui ont de plus en plus de difficultés pour se loger et notamment loger les jeunes qui quittent la maison parentale.
<Le Journal La Croix essaye d’esquisser des solutions> : aux Baux de Provence, au Portugal, en Corse, en Ligurie. Les solutions préconisées peuvent se résumer : étaler la saison de tourisme, encadrer strictement la circulation automobile, développer des circuits contraignants et des transports en commun compétitifs, mettre en place des interdictions.
Certaines initiatives sont à souligner ainsi à Lisbonne :
«Le mur est peint en jaune. D’une couleur commune à Lisbonne, il passerait totalement inaperçu si un petit panneau d’interdiction original n’attirait l’attention des passants. « Pipi ici, non ! », lit-on sur le bandeau qui barre le petit personnage en train de se soulager. « Nous avons fait recouvrir le mur d’enceinte du centre de santé de notre quartier d’une peinture hydrofuge. Le liquide retourne dans les jambes de l’impétrant. C’est très efficace », expose calmement [une fonctionnaire de la ville] »
Le journal évoque aussi les villages des Cinque Terre, en Ligurie où des générations de paysans ont façonné les versants montagneux pour cultiver la terre en terrasses où sont plantées vignes, oliviers et citronniers. Toutes les terrasses sont soutenues par des murets en pierre sèche qui constituent le trait identitaire des Cinque Terre. Depuis son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco en 1997, ce lieu est visité chaque année par plus de 2 millions de vacanciers. Le tourisme est devenu la première source de revenus, avec tous les risques que cela engendre pour l’environnement et les activités traditionnelles. Un responsable exprime clairement la contradiction de ce type de tourisme : « C’est l’histoire du serpent qui se mord la queue parce que le tourisme amène prospérité et dégradation […]. Le vrai désarroi des autochtones c’est la masse de croisiéristes qui n’ont pas le sens de l’écologie. Mais grâce au soutien des communes nous sommes les premiers en Italie à avoir pris des mesures originales pour préserver un site fragile. »
J’ai également écouté avec intérêt une émission de France Culture qui m’a paru équilibrée entre la dénonciation de dérives insupportables et la préservation d’une industrie soucieuse de maîtrise et de bien être pour tous : <Faut-il réguler le tourisme de masse ?>
Pour répondre à cette question, l’émission avait invité Josette Sicsic, directrice de l’observatoire Touriscopie et rédactrice en chef du journal mensuel Touriscopie et Jean Viard, sociologue et directeur de recherches au CNRS au CEVIPOF.
La réponse courte à la question, faut-il réguler, étant bien sûr : OUI. Car sinon on donnera raison à Jean Mistler :
«Le tourisme est l’industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux, dans des endroits qui seraient mieux sans eux »
Mais n’est ce pas déjà le cas dans les lieux où le tourisme de masse explose ?
<917>
- Peut-être que les destinations qui en valent la peine sont limitées. C’est une hypothèse.
-
Mardi 29 août 2017
« Le Ministre du temps libre »Création éphémère de François Mitterrand lors de son accession au pouvoir.Le temps libre constitue une question sérieuse.
En 1981, quand François Mitterrand est élu président, nous sommes alors dans le monde de l’utopie et du rêve, il crée un Ministère du temps libre. Le Ministre qui héritera de ce poste s’appelait André Henry. C’était un ancien instituteur né en 1934 dans les Vosges qui fut responsable syndical d’abord dans le Syndicat national des instituteurs, puis dans la Fédération de l’Éducation nationale.
Ce Ministère avait sous sa responsabilité deux secrétaires d’état : l’un chargé de la Jeunesse et des Sports et l’autre du Tourisme.
Résumons, il y a d’abord « du temps libre » et puis des conséquences : « Le sport » et le « tourisme ».
Tout ceci ne durera pas. En mars 1983, Mitterrand et son premier Ministre Pierre Mauroy décident d’un plan de rigueur, l’économie française n’a pas su faire face à l’utopie et aux rêves dans un monde ouvert et surtout aux désirs infinis de consommation pour l’essentiel de produits venant de l’étranger.
En avril 1983, le ministère du temps libre était supprimé. Il existe pourtant encore une trace de ce ministère éphémère : c’est celui des chèques vacances qui ont été créés à ce moment là. Toutefois, sa suppression ne peut qu’apparaître judicieuse à notre regard libertaire : que l’Etat songe à organiser notre temps libre ne peut que nous heurter !
Cependant avec ou sans ministère, le temps libre reste une vraie question.
Que faisons-nous de notre temps libre ?
Parce que nous en avons beaucoup.
J’avais déjà consacré le mot du jour du 4 septembre 2014 à ce sujet : « Nous vivons dans une société du temps libre »
Je donnais la parole au sociologue Jean Viard qui nous expliquait qu’en 1914, un homme vivait en moyenne 500.000 heures, il dormait 200 000 heures, il travaillait 200 000 heures et il lui restait 100 000 heures pour faire autre chose.
En 1914, il disposait donc de 20% de temps libre à occuper. A cette époque, les activités religieuses occupaient encore une grande place dans ce temps disponible.
Aujourd’hui, nous vivons en moyenne 700 000 heures (80 ans) et nous travaillons (si nous avons un emploi) 63 000 heures. On travaille donc à peu près 10% de notre vie. Les européens travaillent de 10 à 12%, les américains travaillent plutôt 16%. Désormais nos activités religieuses et peut être même spirituelles me semblent assez limitées dans le temps.
C’est très compliqué d’occuper autant de temps, surtout si on ne suit pas le conseil de Pascal que j’ai cité lors du mot du jour consacré au « divertissement Pascalien » : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre ».
Alors il faut jouer, regarder la télévision, surfer sur internet, jardiner, voyager, visiter, bref s’occuper l’esprit pour qu’il y ait toujours quelque chose qui chasse l’ennui.
Et puis, dans les rencontres il faut pouvoir dire quelque chose après « bonjour ».
Pour beaucoup, le redémarrage de la Ligue 1 constitue une aubaine : les derniers résultats de l’OL, de l’OM ou du PSG, l’arrivée de tel ou tel joueur contre un prix exorbitant quel que soit son art de manipuler un ballon de cuir constituent un moyen commode de lutter contre le silence.
Mais raconter ses vacances est aussi un excellent sujet qui peut être échangé assez facilement, avec quasi n’importe qui et sans trop d’implication personnelle.
Sujet de conversation donc idéal.
<916>
-
Lundi 28 août 2017
« Les vacances »Période pendant laquelle les gens qui ont du travail arrêtent de travailler.Il me semble pertinent après cette longue trêve estivale d’évoquer les vacances.
Commençons d’abord par l’étymologie. Comme souvent ce mot vient du latin : « vacare ». Le wiktionnaire nous apprend qu’il s’agit de l’infinitif du verbe « vaco » qui a pour traduction : « Être vide, inoccupé, vacant, être sans maître, être sans emploi. »
<Dans ce dictionnaire spécialisé en latin> on ajoute à « inoccupé » le terme « être oisif », une connotation morale !
Quand on consulte le dictionnaire du CNRS : http://www.cnrtl.fr/etymologie/vacances, les rédacteurs de cet ouvrage font remonter le mot français au XIVème siècle : « 1305-07 « état d’une charge qui est sans titulaire » (Recueil de lettres anglo-françaises, éd. Tanquerey, p. 93»; puis plus précisément au XIXème siècle : « 1884 « caractère de ce qui est disponible » (Huysmans, À rebours, p. 288: la vacance de son esprit). »
Tout ceci nous ramène au concept de « ne rien faire » que j’avais développé lors du mot de jour de rentrée de 2015 : « L’art difficile de ne presque rien faire ».
La lecture du Canard Enchaîné du 9 août 2017 nous apprend que l’inénarrable Président des Etats-Unis actuel exprime un avis tranché sur les vacances :
« Ne prenez pas de vacances. Quel intérêt ? Si vous n’aimez pas votre travail, vous avez le mauvais boulot ».
Mais le canard enchaîné nous rassure, le pitre grotesque que les Etats-Uniens ont élu Président est en réalité un « glandeur », car en ce début d’août 2017 Donald Trump avait quitté son lieu de travail de la Maison Blanche pour 17 jours au profit d’une de ses luxueuses résidences de vacances : le Trump National Golf Club de Bedminster. Et le Washington Post a recensé le nombre de jours de congé qu’il a pris depuis le début de son mandat : 53 jours. Le Canard enchaîné explique que l’américain moyen n’a droit qu’à 10 jours par an en moyenne.
Mais si on peut croire le biographe de Trump, nous serons bientôt débarrassés de cet <histrion>, car comme <Le Point> le relate l’écrivain américain Tony Schwartz qui est l’auteur des mémoires du milliardaire, The Art of the Deal (1987) est persuadé que l’affaire russe aura raison de la présidence du 45e président des États-Unis et que ce dernier démissionnera dès l’automne. Le 21 décembre, nous serons à la fin de l’automne et nous examinerons si cette prédiction hardie s’est révélée exacte.
Les vacances sont donc une période pendant laquelle une personne cesse ses activités habituelles.
Wikipedia nous rend plus savant :
« Le concept des vacances est lié à l’apparition des civilisations urbaines, contrairement au monde agricole, qui à cause du climat, ne dicte pas un rythme de travail continu tout au long de l’année. Au Moyen Âge, il existait déjà en Europe de l’Ouest des « vacances » qui correspondaient à la période des moissons en été où les universités fermaient pour permettre à tous d’aller travailler aux champs.
Au XIXe siècle, les vacances se répandent dans toute l’aristocratie et la bourgeoisie d’Europe occidentale. Elles correspondaient donc à la période où les classes supérieures de la société quittaient leurs demeures principales (elles les laissaient vacantes) pour rejoindre des résidences secondaires, profiter de la nature […] ou des bienfaits du climat marin ou montagnard pour la santé.
Les Britanniques, dont l’économie était la plus florissante au monde, ont été les premiers à se tourner vers les stations balnéaires, d’abord sur leurs côtes, puis de l’autre côté de la Manche (à Deauville, Dinard, etc.) puis enfin dans le sud de la France, sur la Côte d’Azur (la Promenade des Anglais à Nice doit son nom aux nombreuses résidences où les Britanniques venaient passer les mois d’hiver) mais aussi à Biarritz. »
L’encyclopédie en ligne nous apprend surtout que la durée des vacances est très différente selon les pays :
« À Hong Kong, Singapour et Taïwan, les vacances sont de sept jours par an. […]. En France, le nombre théorique de jours de congés payés annuels est de 25 (cinq semaines). En 2008, c’est légèrement moins que la moyenne de l’Union européenne (25,2 jours). La durée des congés payés atteint 30 jours en Allemagne et au Danemark, 33 jours en Suède »
Cette petite énumération montre, encore une fois, la différence entre l’Europe et le reste du monde. Elle me fait penser à cette réflexion qu’un ministre allemand a partagé un jour avec un homologue asiatique : « Et en Europe nous sommes tellement riches que nous pouvons même payer des gens à ne pas travailler ! ». Il pensait certainement aux retraites, aux congés maternité, aux congés maladies mais aussi au temps incroyablement long par rapport à la moyenne mondiale de nos congés européens de l’ouest.
La question légitime que nous pouvons poser est celle de savoir, dans l’univers d’une globalisation qui tend à ramener le plus grand nombre vers une moyenne, si les standards européens se généraliseront ou si au contraire l’Europe va tendre vers ceux du reste du monde.
La durée et je dirai la sérénité des vacances sont liées en grande partie au salariat et au droit du travail. L’idée qu’il est envisageable de sortir du salariat pour entrer dans une logique indépendante, d’auto-entrepreneur ou de multiples contrats de mini jobs ou encore de contrats de projet ou de CDI de chantier pourrait avoir pour effet de rendre le temps libre moins serein et aussi de diminuer la durée de vacances réelle.
Mais comment occupe t’on son temps libre ?
Cela pourrait être le sujet des mots du jour suivant.
<915>
-
Vendredi 30 juin 2017
« Le mot du jour d’Alain »Le blog qui regroupe tous les mots du jour écrits par Alain K.Pour garder de la consistance, de la pertinence et de la profondeur il faut savoir se taire, se reposer, se ressourcer.
Le flux quotidien de mots va donc s’interrompre quelque temps.
L’année dernière, j’avais initié cette pause par un mot sur « l’Histoire du silence » d’Alain Corbin.
Et puis j’avais ajouté, des « mots inachevés » qui avaient été imaginés mais non rédigés, pour éventuellement faire patienter celles et ceux qui étaient frustrés de mon long silence.
Cette année, je vous laisse avec le site sur lequel vous pouvez relire tous les 914 mots écrits jusqu’à présent et sur lequel je vais donner quelques précisions techniques dans le message d’aujourd’hui.
D’abord pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore l’adresse du blog est d’une grande simplicité : https://lemotdujour.fr/
Mais vous pouvez aussi le rechercher à l’aide d’un moteur de recherche, en cherchant « le mot du jour d’Alain »
Quand vous utilisez un moteur de recherche sérieux , c’est-à-dire pas celui qui appartient à une société qui a pour ambition de tout savoir sur vous et de ne surtout rien oublier, la recherche est immédiate.
Par exemple Qwant ou Lilo ou même Yahoo, la première réponse tombe sur ce blog.
L’autre malin, lui va vous renvoyer d’abord, vers une tentative de blog sur le site du Monde, mais ce blog n’existe plus. C’est bien d’avoir de la mémoire, mais actualiser ses connaissances est bien aussi.
1 Un peu de technique
Du point de vue technique sur ce blog il y a deux « type d’objets » : des articles et des pages.
Un message, ce que j’appelle « un mot du jour » est un article.
Quand vous allez sur le blog par l’adresse donnée ci-dessus vous vous trouvez sur la page « Accueil », sur cette page se trouve toujours le dernier article publié, c’est-à-dire le dernier mot du jour.
Chaque mot du jour possède un lien consubstantiel avec une date. Il n’est donc pas surprenant que le point d’entrée principal vers un article soit une date.
Vous trouverez, dès lors, comme entrée principale d’abord dans la rubrique « articles récents » les 5 dernières dates de publication d’articles et dans la rubrique « archives » une entrée par le mois de publication qui vous envoie vers une page qui comporte les derniers mots du jour de ce mois et au bout de la page vous trouvez un bouton précédent pour avoir accès aux mots précédents du mois.
Il faut comprendre, pour que l’accès immédiat soit vers les mots les plus récents, que le classement est par ordre chronologique inverse, ce qui quelquefois peut surprendre en naviguant entre les pages des archives.
Alexis a, sur ma demande, créé une page qui est appelée liste des mots. Cette page porte tous les éléments identifiants un mot du jour soit 3 éléments :
- La date
- L’exergue
- L’auteur ou l’explication de l’exergue.
Cette page est générée automatiquement grâce à l’ingéniosité d’Alexis.
C’est une page qu’on pourrait dire infinie, elle n’a, en tout cas, pas de limite. Tout au bout, vous trouverez le premier mot du jour envoyé. Et tant que j’écrirais des mots du jour, cette page se rallongera pour les contenir tous. Étonnant non ?
Grâce au monde virtuel, nous pouvons mieux appréhender la notion d’infini.
Et sur cette page, que vous pouvez faire défiler à grande allure, si un article a attiré votre regard, c’est encore sur la date qu’il faut cliquer pour aller vers l’article.
J’ai voulu créer un peu de chronologie dans le bon sens (en allant de l’ancien vers le récent) en créant une entrée au menu appelée : « Série de mots ». Cette fonction n’est pas générée automatiquement, elle demande donc plus de temps à être réalisée et se constituera au fil du temps.
Elle renvoie vers des pages comportant les séries de mots que j’ai écrites quelquefois.
A la date d’aujourd’hui, elle comporte deux séries :
Ces pages sont écrites dans l’ordre dans lequel les mots ont été écrits et comporte le début du message, c’est alors un lien <lire l’article> qui emmène vers l’article complet.
2 Pourquoi est-il plus pertinent de lire les mots du jour sur le blog que dans la messagerie ?
Pour de multiples raisons :
- D’abord parce qu’ergonomiquement, c’est beaucoup plus facile à lire sur tous les écrans et encore davantage sur les smartphones et les tablettes ;
- Ensuite parce que dès que je constate une erreur, je la corrige. Ce qui n’est pas le cas lorsque vous conservez le message envoyé, je ne peux pas le mettre à jour. Ainsi un lien qui ne fonctionne pas ne fonctionnera jamais
- Enfin, je mets à jour les articles publiés.
Dans un des derniers mots, une réponse de Marc m’a fait comprendre qu’il y avait une ambigüité. J’ai donc pu préciser les choses pour lever toute ambigüité.
Le mot du 15 juin évoquait le grand remplacement de Renaud Camus, or le 24 juin l’émission Répliques avait invité Renaud Camus mais aussi le démographe Hervé le Bras pour lui apporter la contradiction. J’ai donc pu compléter l’article par un lien vers cette émission que je vous recommande.
3 Bienvenue sur Internet
Voilà ce que m’a répondu Alexis quand je lui ai fait part de ce que je constatais sur mon blog.
Il y a un outil statistique et de suivi dans le tableau de bord du blog.
Et donc j’ai été surpris que le N° IP : 103.229.124.198 venait de consulter 867 articles de mon blog, en un seul jour, le 15/06/2017. A ce niveau de consommation, il était clair qu’il s’agissait d’un robot qui scannait le blog. En tentant de localiser ce N° IP, il est apparu qu’il était implanté à Hong Kong. Les chinois s’intéressent, enfin les robots chinois s’intéressent à mon blog.
Et puis j’ai, à nouveau, constaté qu’un même numéro IP a consulté 149 articles le 23 juin, 161 le 24, 166 le 25, 105 le 26.
C’était aussi probablement un robot, même si à ce niveau, un passionné peut éventuellement y arriver, en allant très vite sur certains articles.
Et où était implanté cette adresse IP, me demanderez-vous ?
La réponse est : le centre de la Serbie !
Sur les bons conseils d’Alexis, j’ai accepté les commentaires mais en les modérant, ce qui signifie qu’avant qu’il soit publié je dois donner mon accord. Il y a actuellement 3 commentaires sur le blog. Mais j’en ai refusé une vingtaine, un était écrit en allemand, tous les autres en anglais. Souvent pour dire que le blog était très bien mais invariablement pour donner des liens vers des sites dont l’adresse ne laissait pas de doute quant au caractère pornographique de leur contenu.
C’est probablement dans ce monde virtuel, que nous pouvons le mieux toucher cette réalité que nous cohabitons désormais avec les robots.
Nous vivons dans « un monde d’humains et de robots ». Franz de Waal dirait plutôt « un monde d’animaux et de robots ».
C’est sur cette pensée que je vous laisse.
Le prochain mot du jour est prévu lundi 28 août 2017.
D’ici là, bonnes vacances à tous.
<article sans numéro>
- La date
-
Jeudi 29 juin 2017
«L’homme, en jouant ainsi avec cette machine si compliquée, la nature, me fait l’effet d’un aveugle qui ne connaîtrait pas la mécanique et qui aurait la prétention de démonter tous les rouages d’une horloge qui marcherait bien, pour la remonter à sa fantaisie et à son caprice. »Eugène Huzar L’arbre de la science, Paris, Dentu, 1857On oppose souvent notre temps, qui est en plein doute par rapport au progrès, au XIXème siècle où il semble selon la légende que tous croyaient au Progrès, comme Auguste Comte fondateur du positivisme et dont la citation : «Ordem e Progresso» « Ordre et Progrès » orne toujours le drapeau du Brésil.
Comme toujours la réalité est plus complexe, ainsi au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle, un homme, avocat de métier, Eugène Huzar (1820-1890) écrivit deux essais : « La Fin du monde par la science (1851) » et « L’Arbre de la science (1857) » dans lesquels il .exprimait son scepticisme face à la science et à la technique des humains qui entendaient se rendre maître de la nature, et jouaient avec cette « machine si compliquée » sans la comprendre.
L’exergue est assez explicite !
J’ai découvert cet intellectuel dans l’émission de France Culture : la concordance des temps : http://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/la-fin-du-monde-par-la-science-genese-dune-angoisse
C’est l’historien des sciences Jean-Baptiste Fressoz, maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris qui a découvert cet homme étonnant :
Son lyrisme et son exagération prêtent à sourire, mais certaines mises en garde résonnent comme des prophéties aujourd’hui.
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-une-critique-du-progres-19065.php
Vous trouverez derrière ce lien : https://socio-anthropologie.revues.org/1566 une présentation par Jean Baptiste Fressoz de l’œuvre d’Eugène Huzar ainsi que les textes de cet homme surprenant.
Voici d’abord une introduction de Jean-Baptiste Fressoz
L’intérêt d’Eugène Huzar est de proposer la première philosophe catastrophiste de la technique. Dans deux livres curieusement oubliés, La fin du monde par la science(1855) et L’arbre de la science (1857), l’auteur synthétise les débats environnementaux et technologiques de son époque (la déforestation et le changement climatique, la vaccination et la dégénérescence de l’espèce humaine, les catastrophes ferroviaires etc.) pour objectiver d’une manière originale le progrès, non comme la maîtrise technique de la nature, mais comme la perte de maîtrise de la technique. Selon son système, l’humanité parcourt des cycles de progrès et de catastrophes la ramenant à un état de sauvagerie. Pour tenter de retarder la fin du présent cycle, Huzar propose d’établir une « édilité planétaire » chargée de veiller aux équilibres du globe.
Puis directement la prose d’Huzar.
D’abord son inquiétude devant « la cécité » de la science qui déclenche des effets qu’elle n’est pas en mesure de maîtriser :
« L’homme, en jouant ainsi avec cette machine si compliquée, la nature, me fait l’effet d’un aveugle qui ne connaîtrait pas la mécanique et qui aurait la prétention de démonter tous les rouages d’une horloge qui marcherait bien, pour la remonter à sa fantaisie et à son caprice.
Mais, me dira-t-on, ce que fait l’homme par rapport à la nature, ne peut-on le comparer à une simple égratignure faite à l’épiderme d’un homme vigoureux et bien portant ? Je le veux bien ; mais qui ne sait pas que, selon les occasions, par exemple au pied, une simple égratignure donne la mort. Voyez plutôt ce qui a lieu sous les tropiques. […]
Je comprendrais, encore une fois, qu’un sauvage de l’Amérique du Sud, qui n’aurait jamais quitté sa forêt, vînt me dire que la terre est infinie, et que l’homme, par conséquent, ne peut la troubler.
Aujourd’hui, avec la science, la proposition est entièrement renversée : c’est l’homme qui est infini, grâce à la science, et c’est la planète qui est finie. L’espace et le temps n’existent plus par la vapeur et l’électricité. La terre n’est plus pour nous, hommes du dix-neuvième siècle qui pouvons en faire le tour quarante ou cinquante fois dans notre vie, ce qu’elle pouvait être aux yeux des hommes de l’antiquité, qui n’en avaient jamais mesuré la circonférence.
Pour nous, elle est limitée, très limitée, puisque nous pouvons en faire aussi vite le tour qu’un Grec eût pu faire le tour de l’Attique.
L’espace, qui est la mesure des formes, n’étant plus rien pour nous, qu’est devenue la forme ? Rien.
Or, quand on voit une chose aussi limitée que la terre et une puissance aussi illimitée qu’est celle de l’homme armé du levier de la science, l’on peut se demander quelle action peut avoir un jour cette puissance illimitée sur notre pauvre terre si limitée et si bornée aujourd’hui.
Et puis il propose des solutions : une sorte de principe de précaution avant l’heure et une institution mondiale chargée de le faire respecter et de protéger l’Humanité :
« Tout mal appelle après lui un remède ; j’ai signalé le mal, c’est-à-dire la catastrophe, naissant un jour de notre raison insuffisante à la recherche de l’absolu. Je vais chercher le remède, c’est-à-dire le moyen de le combattre et de l’éviter s’il est possible.
Or, il y a deux sortes de moyens : Moyens palliatifs Moyens curatifs.
Les moyens palliatifs, comme on le sait en médecine, n’ont pas pour but de détruire le mal, mais de le retarder et de l’amoindrir. Les moyens curatifs ont pour but de déraciner, de détruire entièrement le mal.
Quels sont les moyens palliatifs que je propose ?
Les voici :
1° L’homme dans l’avenir ne doit pas tenter des expériences capitales, décisives, sans avoir l’assurance qu’elles ne peuvent en rien troubler l’harmonie des lois de la nature ;
2° Il faudra dans l’avenir créer des écoles spéciales ayant pour but de déterminer et d’étudier les lois qui constituent l’équilibre du globe ;
3° Il faudra aussi dans l’avenir créer une édilité planétaire qui réglemente le travail humain, de telle sorte que rien de décisif, de capital, tel que le déboisement d’une continent ou le percement d’un isthme, etc., ne puisse avoir lieu sans l’autorisation de l’édilité planétaire. Cette édilité aura son siège dans une des grandes villes du monde ; elle sera composée de l’élite de la science du monde entier. Chaque édile sera nommé par ses concitoyens. Les édiles seront les premiers magistrats du monde, et chaque fois qu’une nation voudra entreprendre une de ces tentatives audacieuses qui peuvent troubler l’harmonie du monde, elle devra s’adresser aux édiles, qui pourront lui donner ou lui refuser l’autorisation, car ils seront là pour veiller à la conservation de l’harmonie du globe.
La nation qui enfreindrait les ordres des édiles serait mise au ban des nations, comme s’étant rendue coupable du crime de lèse-humanité. Ainsi, un peuple veut-il déboiser ses forêts, il faudra que l’édilité le lui permette. Un peuple veut-il percer un isthme, il lui faudra encore la permission de l’édilité ; enfin, chaque fois qu’une nation devra entreprendre une de ces grandes choses qui peuvent troubler l’équilibre de la planète, il faudra qu’elle ait obtenu la permission de l’humanité tout entière, représentée par ses édiles.
Telle devra être la solidarité de l’homme dans l’avenir. Cette édilité planétaire que je vous propose paraîtra, à tous ceux qui me liront, absurde, et pourtant elle est déjà dans nos mœurs.
N’avons-nous pas en petit, en France, ce que je demande en grand pour le Globe ? N’y a-t-il pas un principe inscrit dans nos codes qui donne aux propriétaires le droit d’user, de jouir de la chose, mais non d’en abuser ? Ainsi, un homme a-t-il le droit de mettre le feu à sa maison ? Non.
Pourquoi ?
Parce que toute une ville pourrait être victime de cet abus de sa propriété. […]
Veiller sur l’harmonie du globe, faire en sorte qu’elle ne soit point troublée, tel serait le but de cette première institution du monde. »
Vous ne trouvez pas cette pensée, imaginée en pleine révolution industrielle triomphante, étonnante ? Prémonitoire ?
Certainement romantique et utopique.
Eugène Huzar était son nom.
<914>
-
Mercredi 28 juin 2017
« Est-ce que l’homme est plus intelligent que le poulpe ? On ne sait pas »Franz de WaalLes lecteurs de « Sapiens » de Yuval Harari ne seront pas surpris par le contenu de ce mot du jour.
Toutefois si on peut classer Harari dans la catégorie des vulgarisateurs ou des « compilateurs » de la science et de la recherche réalisés par d’autres, tel n’est pas le cas de Franz de Waal qui est un primatologue et éthologue néerlandais. Lui est un spécialiste qui travaille depuis de très longues années sur les animaux. Il travaille particulièrement sur l’empathie des animaux.
Je l’ai découvert lorsqu’il avait été invité par Patrick Cohen <en octobre 2016>, pour parler de son dernier ouvrage : <Sommes nous trop bête pour comprendre l’intelligence des animaux ?>
Il enseigne et exerce ses recherches dans l’université d’Atlanta aux Etats-Unis. C’est un scientifique passionnant et très sérieux même s’il est un peu provocateur, mais c’est pour mieux expliquer le fruit de ses recherches.
Déjà les titres de ses ouvrages précédents constituent un programme : « La Politique du chimpanzé », « De la réconciliation chez les primates » et « Le Singe en nous ».
A Patrick Cohen, il a tenu à peu près ce langage :
« Chaque semaine on trouve de nouvelles choses sur l’intelligence des animaux. Pas seulement sur les grands singes, moi je travaille avec les chimpanzés et les bonobos essentiellement, mais aussi sur les oiseaux les poissons, les rats , les chiens, les dauphins. »
Et quand Patrick Cohen lui demande un exemple précis dont il peut faire le récit, il raconte l’histoire suivante :
« Nous avons fait une expérience avec deux singes à qui on demandait de faire un travail, le premier on le récompensait avec des grains de raisin, le second avec des bouts de concombre. Il est très clair qu’un singe aime beaucoup plus les grains de raisin que le concombre. Au bout d’un certain temps, le singe à qui on donnait du concombre [et qui constatait qu’on donnait à l’autre du raisin], c’est tout simplement arrêté de travailler. Il s’est tout simplement mis en grève, il voulait être mieux payé ! Montrant par là sa perception de la justice. »
Franz de Waal, qui est né en 1948, explique que lorsqu’il était jeune il a eu beaucoup de mal à imposer ses buts de recherche. Les élites universitaires considéraient que les animaux c’étaient de l’instinct et un apprentissage rudimentaire.
Depuis, la science a beaucoup progressé et a montré que les animaux étaient intelligents, savaient faire des raisonnements, savaient utiliser des outils (Franz de Waal parlent non seulement des singes, mais des corbeaux qui utilisent des outils pour parvenir à leurs fins). Ils savent aussi se projeter dans le futur, des singes vont choisir un outil qu’ils utiliseront plusieurs heures après, ou encore privilégieront l’attente parce qu’ils savent que dans plusieurs heures ils auront une récompense plus grande que celle qu’ils auraient obtenu immédiatement.
Et puis ils sont capables d’empathie, particulièrement à l’égard de leurs proches. Des auditeurs ont appelé pour témoigner qu’ils ont vu des ânes pleurer parce que leur petit venait d’être écrasé par une voiture. Franz de Waal a confirmé qu’une telle situation a été observée plusieurs fois.
Franz de Waal conteste qu’il existe un seul type d’intelligence. Les animaux ont des fonctionnalités que les humains ne possèdent pas. Tout juste reconnaît-il que les humains sont uniques en raison de l’utilisation du langage symbolique, mais c’est tout. Pour le reste il y a des variations d’intelligence et l’atout de l’humain d’avoir un cerveau plus gros que la plupart des animaux.
L’homme est un animal qui a un cerveau ordinateur comme les autres animaux, peut-être juste un peu plus puissant. C’est une différence d’intensité mais pas de nature.
A propos du poulpe, il explique que cet animal appréhende le monde de manière très différente d’un homme car son système nerveux est complètement distribué sur tout son corps. C’est pourquoi il pose cette question provocante : « Est-ce que l’homme est plus intelligent que le poulpe ? On ne sait pas »
Pour lui l’erreur est de faire de l’homme la mesure de toute chose, de comparer le comportement de l’animal par rapport aux standards humains. Cette comparaison est évidemment défavorable à l’animal. Mais quand on observe l’animal de son point de vue de sa manière d’appréhender le monde, on constate qu’il est intelligent, qu’il a des raisonnements cognitifs et des émotions. C’est un animal comme nous.
Franz de Waal a approuvé un auditeur qui citait Boris Cyrulnik qui a dit :
« L’homme n’est pas le seul animal intelligent, mais c’est le seul animal qui croit qu’il est le seul à être intelligent »
Mais Franz de Waal a surtout œuvré dans le domaine de l’empathie, dans un entretien <Au Point de 2013>, il disait :
« En 1996, lorsque j’ai publié mon premier livre sur le sujet, Le bon singe, la notion d’empathie chez les animaux était très controversée. Elle a été depuis mise en évidence chez les souris, les rats, les éléphants… Tous les mammifères, en réalité, manifestent une sensibilité aux émotions des autres. »
Et cette interview à Libération en 2010 :
« Tout a commencé il y a trente ans, quand j’ai découvert un comportement dit de «consolation», de réconfort, chez les chimpanzés. Après une bagarre, celui qui a perdu est consolé par les autres, ils s’approchent, le prennent dans leurs bras, essaient de le calmer. Dix ans plus tard, j’ai entendu parler du travail de la psychologue Carolyn Zahn-Waxler, qui testait l’empathie chez les enfants. Elle demandait aux parents ou aux frères et sœurs de pleurer ou de faire comme s’ils avaient mal, et les enfants, même très jeunes, 1 ou 2 ans à peine, s’approchaient, touchaient, demandaient comment ça allait. Ce qu’elle décrivait était exactement ce que j’avais appelé le comportement de «consolation» chez les chimpanzés. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à regarder le comportement des chimpanzés, et des singes en général, en me posant la question de l’empathie.
Vous avez testé l’empathie chez les primates ?
«Il y a eu des dizaines d’expériences. Je vous citerai celle où des singes refusent d’activer un mécanisme qui leur distribue de la nourriture quand ils réalisent que le système envoie des décharges électriques à leurs compagnons. Leur sensibilité à la souffrance des autres était telle qu’ils ont arrêté de se nourrir pendant douze jours.
Vous affirmez que cela va bien au-delà des singes.
Depuis quelques années, on a en effet des exemples nombreux et troublants : des dauphins qui soutiennent un compagnon blessé pour le faire respirer à la surface, des éléphants qui s’occupent avec beaucoup de délicatesse d’une vieille femelle aveugle… Je pense que l’empathie est apparue dans l’évolution avant l’arrivée des primates : elle est caractéristique de tous les mammifères et elle découle des soins maternels. Lorsque des petits expriment une émotion, qu’ils sont en danger ou qu’ils ont faim, la femelle doit réagir immédiatement, sinon les petits meurent. C’est ainsi que l’empathie a commencé. »
La réponse à cette question : Vous évoquez la réticence des chercheurs à parler des émotions animales : leurs raisons seraient moins scientifiques que religieuses ? est aussi très troublante, car il en tire des conclusions pour cet animal qu’est homo sapiens :
« La psychologie vient de la philosophie et la philosophie vient de la théologie. Dans les départements de psychologie et de philosophie, il y a toujours eu une forte tendance à mettre l’accent sur la distinction homme/animal. On est tout le temps en train de s’y demander quel est le propre de l’homme. A la différence des biologistes, pour lesquels l’homme est un animal. Pour moi, c’est intéressant de regarder les psychologues : ils essaient toujours de tracer cette ligne de séparation et ils ne sont d’ailleurs jamais contents. Ils ont d’abord dit que la spécificité de l’homme tenait à l’usage des outils, puis à la culture… Au fur et à mesure que leurs arguments tombent, ils en proposent d’autres. Mais je ne pense pas qu’ils trouveront, parce que toutes les grandes capacités, comme la moralité, se divisent en petites capacités, présentes chez les animaux. Dans la morale, il y a de l’empathie, qui existe chez beaucoup d’animaux. Il est peut-être vrai que la morale, telle qu’elle existe chez l’homme, ne sera jamais trouvée chez un autre animal, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y en ait pas certains éléments ailleurs. Les différences sont moins absolues que les gens ne le croient.
En parlant des trois religions monothéistes, vous remarquez qu’elles sont nées dans le désert, dans des pays sans singes…
Les religions occidentales sont nées dans le désert. Dans le désert, à quel animal l’être humain peut-il se comparer ? Au chameau ? L’homme et le chameau sont de toute évidence très différents. Il est donc très facile de soutenir que nous sommes complètement différents des animaux, que nous ne sommes pas des animaux, que nous avons une âme et que les animaux n’en ont pas. Quand on lit le folklore de nos sociétés, les fables de La Fontaine par exemple, on y rencontre des renards, des corbeaux, des cigognes, des lapins… mais pas de singes. Alors que les folklores asiatiques sont pleins de gibbons, de macaques… En Inde, en Chine, au Japon, il y a toutes sortes de singes. Le développement des civilisations s’y est fait en compagnie des primates, c’est à cette sorte d’animaux que les Asiatiques se comparent. Du coup, la ligne de séparation n’est jamais très nette. Dans le livre, je raconte que, lorsque, pour la première fois au XIXe siècle, les habitants de Londres et de Paris ont vu des grands singes, ils ont été choqués, dégoûtés même. Dégoûtés en voyant un orang-outan ? Ça n’est possible que si on a de soi une idée qui exclut l’animal. Sinon, on voit un orang-outan et on se dit : si ça, c’est un animal, alors peut-être que moi aussi je suis un animal. Aujourd’hui, bien sûr, c’est différent. Les gens se sont habitués à l’idée qu’ils sont des grands singes et à se voir eux-mêmes comme des animaux. Jusqu’à un certain point, en tout cas, en dehors des départements de philosophie. »
Un scientifique, une réflexion et un bouleversement de notre perception du monde passionnant.
Il a aussi été invité à deux émissions de Radio France :
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-10-octobre-2016
Et vous trouverez cette page sur le site d’Arte avec des vidéos :
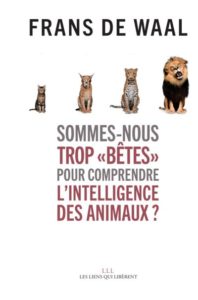
<913>
-
Mardi 27 juin 2017
« La chambre forte du Jugement dernier est-elle menacée par le réchauffement climatique ? »La réserve mondiale de graines, en Norvège, a été menacée par une inondation en raison de la fonte du permafrost naturelLes records sont synthétisés par des chiffres, ils ont vocation à être battus. C’est ce qui se passe pour les températures presque partout dans le monde et en France en particulier.
Ces derniers jours en France de nouveaux records ont été ainsi établis. Le problème c’est qu’il s’agit d’une évolution qui se confirme d’année en année.
L’article des Echos que je cite ci-après rappelle que l’année 2016 a constitué l’année la plus chaude sur Terre depuis le début des relevés de températures en 1880.
Mais c’est mon amie Martine qui a attiré mon attention sur un incident préoccupant qui s’est passé en Norvège. Les esprits curieux et attentifs sont probablement au courant. Je dois avouer, pour ma part, que j’ignorais l’existence, de la « chambre forte du jugement dernier » jusqu’à mes recherches récentes suite à l’information de Martine.
Ces informations montrent à la fois la prudence des homo-sapiens, en même temps leur angoisse devant l’avenir.
En février 2008, dans l’archipel de Svalbard, cachée sous une montagne sur l’île du Spitzberg, à 1000 km du pôle Nord a été inaugurée la réserve mondiale des semences de l’humanité.
Le site Huffington Post nous apprend que:
« Dans ce caveau enterré dans l’Arctique sont stockées des milliers de graines, mais aussi de documents. Au cas où le pire arriverait.
[…] La réserve de semences, créée en 2008, contient 541 millions de graines de plus de 843.000 espèces différentes de plantes et se situe dans une zone démilitarisée. Elle a d’ailleurs servi lors du conflit syrien, pour reconstituer les stocks dans les pays voisins de la Syrie, dévastés par la guerre. »
Cette réserve mondiale a été, en effet, conçue en 2006 sous l’égide de l’ONU, pour protéger des catastrophes les graines de toutes les cultures vivrières de la planète et préserver la diversité génétique.
Creusée dans le flanc d’une montagne, à 120 mètres de profondeur, Les graines sont stockées dans des caisses ou des caissons alignés sur des étagères dans des pièces où la température ne dépasse pas -18°C, pour une conservation optimale.
Ce lieu de stockage qui est une ancienne mine, est désigné par plusieurs appellations, « Banque des semences de l’humanité », « Arche de Noé souterraine » et ce nom un peu plus fantasmagorique : « La chambre forte du Jugement dernier » que j’ai eu la faiblesse d’utiliser dans l’exergue de ce mot du jour.
Cette réserve est entourée de glace permanente qu’on appelle le « permafrost » et a été conçue pour être autonome, c’est-à-dire qu’elle puisse fonctionner et perdurer sans intervention humaine. Au cas où le pire arrivait…
Les températures de 2006 ont fait fondre une grande partie du permafrost et l’eau a inondé le tunnel d’entrée, le mois dernier. La chambre forte et les semences ont été préservées. Mais cette information a inquiété les spécialistes qui ne s’attendaient pas à une telle évolution en 10 ans.
Je cite :
Huffington Post :
« L’État norvégien, qui a participé à la création de cette réserve de graines, n’avait pas prévu de devoir s’occuper du site en permanence. Ce qui explique qu’ils ne se sont pas rendu compte plus tôt de cette fuite d’eau.»
Libération :
« La hausse des températures a provoqué une fonte du permafrost naturel, censée rester gelé toute l’année, provoquant des inondations dans le hall d’entrée de quinze mètres de long. «L’Arctique et surtout Svalbard se réchauffent plus vite que le reste du monde », a expliqué Ketil Isaksen, de l’Institut météorologique norvégien, au journal Dagbladet, repris par The Guardian. Le climat change radicalement et nous sommes tous étonnés de la rapidité avec laquelle cela se passe.»
Le courrier international cite le Guardian qui a interrogé Hege Njaa Aschim, membre du gouvernement norvégien, propriétaire de la réserve :
«Nous n’avions pas prévu que le permafrost ne serait plus là et qu’il subirait un climat aussi extrême »
Il n’y a pas lieu de tenir des propos catastrophistes car l’eau fondue n’a pas atteint la réserve. Mais je cite les Echos :
« Les précieuses graines restent en lieu sûr dans l’entrepôt, stockées à une température de -18°C, optimale pour la conservation. Les variétés de semences sont stockées 100 mètres sous la montagne, dans des emballages sous vide. Censée protéger les graines pendant des centaines d’années. Mais cet incident sème le doute sur la capacité de cette « Arche de Noé végétale » à résister au changement climatique. »
Bien entendu le gouvernement Norvégien a pris des mesures pour l’amélioration de la sécurité du site
Par ailleurs il existe dans d’autres endroits du monde des banques de semence, moins importantes que la réserve de Svalbard, mais qui sont des compléments à cette prudence qui s’est emparée d’homo sapiens depuis qu’il sait que la nature et le climat terrestre sont en train de changer à grande vitesse.
J’ai écrit ce mot en m’inspirant ou en citant les articles suivants :
Les Echos : « La réserve mondiale de graines est menacée par le réchauffement climatique «
Huffington Post : « « L’arche de la fin du monde » prend l’eau avec le réchauffement climatique »
Libération : « En Norvège, la réserve mondiale de graines rattrapée par le réchauffement »
Le Courrier International : « Changement climatique. Le permafrost entourant la banque mondiale de graines a fondu »
France Inter : « La banque de graines prend l’eau »
https://www.franceinter.fr/emissions/la-une-de-la-science/la-une-de-la-science-22-mai-2017
<Lien vers le site de la réserve de Svalbard>
<912>

Entrée et intérieur de la réserve
-
Lundi 26 juin 2017
« Le vitiligo »Maladie de la peau qui a fait l’objet d’une journée mondiale ce dimanche 25 juin<Ce dimanche, il avait été décidé d’organiser une journée mondiale du vitiligo>
C’est le fait d’avoir entendu cette information qui m’a incité à m’intéresser à ce sujet.
Le <site doctossimo> explique qu’il s’agit d’une maladie de peau qui se caractérise par des zones dépigmentées plus ou moins étendues. Ce site précise qu’elle est connue depuis la nuit des temps.
C’est une maladie qui est analysée par les froids techniciens de la médecine comme bégnine sur le plan médical. Mais ce que ces techniciens feignent d’ignorer c’est l’aspect humain notamment dans sa relation à autrui, dans le paraître qu’on peut dénoncer philosophiquement, mais qui est pourtant si important dans la vie en société.
C’est toujours le site doctossimo qui explique que le vitiligo peut conduire à une détresse psychologique sévère et doit, à ce titre, bénéficier d’une prise en charge adaptée :
« Le vitiligo se manifeste par des plaques blanches correspondant à des zones de peau où les cellules fabriquant la mélanine – à l’origine de la pigmentation de la peau – ont disparu. Ces plaques n’ont pas d’autre spécificité : elles ne démangent pas ou très rarement, elles ne sont ni douloureuses, ni contagieuses. Pourtant, ces simples taches décolorées suffisent à provoquer le dégoût, voire le rejet. Mary, atteinte à l’âge de 8 ans, en a particulièrement souffert quand elle était enfant. « A l’époque, il y a 30 ans, on connaissait encore mal cette maladie, que l’on associait à la gale. Pendant des années, j’ai été rejetée, même par mes anciens amis ; ils pensaient que cela pouvait être contagieux et refusaient de m’approcher.»
Une <association française du vitiligo> a été créée avec pour objet d’informer des nouveaux traitements, mais aussi de créer un groupe capable de faire pression pour que cette maladie soit davantage prise en considération et aussi permettre à celles et ceux qui en sont victimes d’être en lien avec d’autres qui poursuivent le même combat.
Le journal <20 Minutes> a écrit un article à l’occasion de la journée mondiale :
« N’avez-vous jamais eu l’impression que l’on vous dévisageait ? Pour ceux qui vivent avec le vitiligo, cette impression est une réalité souvent pesante. Le vitiligo, tout le monde connaît sans vraiment savoir ce que c’est. Ce n’est pourtant pas une maladie rare. En France, entre 900.000 et 1,2 million de personnes vivent avec le vitiligo. Il s’agit d’« une maladie qui entraîne une disparition des mélanocytes de la peau, les cellules responsables de la pigmentation de l’épiderme, faisant apparaître sur le corps des taches blanches »
Pour ceux qui vivent avec le vitiligo, regards insistants et remarques désagréables ne sont pas faciles à supporter. […] Son vitiligo, Amandine, étudiante en licence de communication à Mulhouse, vit avec depuis l’âge de 2 ans. De larges taches dépigmentées parcourent une grande partie de son corps, qu’elle a longtemps caché. « Traverser l’enfance et l’adolescence a été très difficile, se souvient la jeune femme de 21 ans. Etre ado n’est déjà pas simple, mais quand vous y ajoutez les regards incessants, les moqueries et les réflexions déplacées, ça a été très difficile à vivre : j’éprouvais un grand mal-être et j’en avais marre de ne pas vivre comme tout le monde », se souvient-elle. A l’époque, rien n’aurait pu convaincre Amandine de porter autre chose que des vêtements très couvrants. Pantalon et pull à manches longues, sa garde-robe restait la même par tous les temps.
« Certains ne pratiquent aucun sport, d’autres sont dans un désarroi tel qu’ils sombrent dans la dépression, voire le suicide », ajoute Jean-Marie Meurant. Pour Amandine, le vitiligo est devenu une « obsession ». « Je ne suis pas allée à la piscine avant l’âge de 15 ans et dans le bus, je m’asseyais en posant les mains sur mes jambes, paumes en l’air, pour ne pas que l’on voie les taches sur le dos de mes mains ». Une époque difficile à vivre pour elle et son entourage, en particulier son grand-père, atteint lui aussi de cette maladie génétique.
Jusqu’au jour où, à 18 ans, la jeune femme a décidé qu’elle ne voulait plus vivre de cette manière. « J’ai voulu changer, être plus ouverte sur l’extérieur et m’accepter comme j’étais ». C’est alors qu’elle a rejoint l’association, où elle a fait la connaissance d’autres membres, atteints comme elle de vitiligo. Pour favoriser l’acceptation de la maladie, l’AFV propose régulièrement des ateliers de maquillage correcteur à ses adhérents. Objectif : se sentir plus à l’aise dans son corps, mais aussi « rompre l’isolement qu’entraîne le vitiligo », insiste Jean-Marie Meurant. »
Il existe de belles initiatives pour aider à changer le regard, ainsi <Un photographe sublime la beauté des personnes atteintes par le vitiligo> :
« Pour lutter contre les préjugés, le photographe australien Brock Elbank a choisi de réaliser une série de portraits autour du vitiligo. Interrogé par le site I-D, l’un de ses modèles explique : « certaines personnes ont des physiques plus singuliers que d’autres, en ayant des cheveux différents, des marques sur leur corps, ou bien des taches de rousseur… Mais dans tous les cas, chaque personne est unique. Pour s’accepter, il ne faut pas nécessairement avoir quelque chose d’aussi visible que le vitiligo. Aimez tout ce que vous avez ! La beauté est un mélange de qualités qui vous rendent unique, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. » »
Comprendre le monde, c’est aussi comprendre les autres dans leurs beautés, leurs créativités mais aussi leurs combats et leurs difficultés.
Comprendre, c’est permettre de changer notre regard.
Je trouvais pertinent de partager ces réflexions.
<911>
-
Vendredi 23 juin 2017
«Aujourd’hui dans toutes les grandes démocraties, nous avons le sentiment que le système a failli»Lawrence LessigLawrence Lessig est ce professeur de Harvard qui a écrit, en 2000, un article célèbre qui a fait date : « The Code is Law ». J’en avais fait le sujet du mot du jour du mardi 22 mars 2016. Dans cet article, il décrivait comment le code informatique, le matériel créatif du monde numérique, influe sur les règles et au sens le plus formel sur la Loi qui s’impose à nous.
Il continue à être à la pointe de la réflexion sur l’Internet où son combat est de garantir les libertés et défendre la licence libre.
Mais à Harvard il dirige aussi un centre de recherche sur la corruption.
<Mickaël Thébault l’a interviewé sur France Inter>
Dans cet entretien Lawrence Lessig revient d’abord sur la problématique de la liberté sur Internet :
« À l’époque, je travaillais beaucoup sur le droit et la loi autour d’Internet. Très peu de gens savaient véritablement comment fonctionnait l’interaction entre la technologie et l’idéal de liberté, la démocratie dans Internet.
Je faisais partie d’un groupe de personnes qui commençait à essayer de formuler des idées autour de ces thèmes
Une réalité assez déprimante, c’est que nos craintes de l’époque, notamment à propos de l’évolution d’Internet, autour de la tournure que pourraient prendre les choses, sont devenues une réalité. Alors qu’à la base, Internet était un endroit où on pouvait protéger la liberté et la vie privée, c’est devenu l’inverse : c’est un endroit où la vie privée n’existe plus et où l’opportunité de liberté d’expression est de plus en plus restreinte par des entreprises ou par des gouvernements. »
Lawrence Lessig juge la démocratie partout en danger, a fortiori aux États-Unis depuis l’élection de Donald Trump. Il nomme le principal ennemi de la démocratie : la corruption.
« « Dans toutes les grandes démocraties du monde, nous avons le sentiment que le système a failli.
À la fin de la Seconde guerre mondiale, l’idée était de propager la démocratie parce que cela permettrait la paix et la prospérité, génération après génération. Quelque part je crois que nous avons failli ; nous sommes en situation d’échec.
[…] La situation dans mon pays est corrompue, je ne parle pas simplement de pots de vin ou de corruptions mais de corruption de manière fondamentale, constitutionnelle.
Aux USA, nous avons un système où 30 à 70% du temps de nos parlementaires est utilisé à lever des fonds pour leurs campagnes, à générer des tonnes d’argent. C’est une toute petite fraction de l’Amérique qui discipline le reste ».
Ce n’est pas d’ailleurs un problème américano-américain. Qu’on parle du réchauffement de la planète ou des dépenses astronomiques en matière de défense : on ne pourra pas gérer ces problématiques si on ne gère pas la corruption d’abord. »
Il considère que pour protéger la démocratie le rôle des lanceurs d’alerte est fondamental. Il a même fait intervenir, en direct, Edward Snowden, à Harvard par téléconférence depuis son exil forcé en Russie.
Il dit :
« Il existe de nombreux lanceurs d’alerte. Certains peuvent être critiqués mais d’autres comme Edward Snowden méritent tout notre respect. Il paie très cher aujourd’hui son choix de rendre l’information publique : le gouvernement américain s’était lancé dans une opération d’espionnage de chacun ; personne n’était au courant et Edward Snowden a rendu ça public.
D’aucuns diront qu’il n’a rien changé. Le fait est qu’il y a d’énormes décisions, notamment dans les tribunaux américains, à propos de l’anticonstitutionnalité de ces surveillances et travaux d’espionnage menés par les autorités américaines.
C’est ainsi que le changement se produit. Le fait qu’il y a eu des conséquences profondes pour les Etats-Unis. »
D’abord nous comprenons que si la France est corrompue, les autres pays ne sont pas forcément meilleurs. Rappelons que dans la puritaine Allemagne le grand Helmut Kohl dont nous avons parlé cette semaine est aussi tombé sur une affaire de caisse noire.
Ensuite, je crois que Lawrence Lessig a profondément raison, les lanceurs d’alerte constituent une des solutions mais pour rendre cela opérationnel, il faut qu’ils soient protégés, ce qui est loin d’être le cas pour l’instant.
<910>
-
Jeudi 22 juin 2017
« Un gouvernement généralement mal inspiré, face à une angoisse générale totale, a cherché la chose la plus spectaculaire qu’il pouvait mettre en place et il a décidé de mettre en place l’état d’urgence »François SureauJ’ai déjà évoqué l’avocat François Sureau à deux reprises :
- Une première fois le 18 septembre 2013 : «Le Droit ne fait pas Justice.» où il expliquait qu’une de ses plus terribles expériences de justice fut lorsqu’il dut participer à une décision du Conseil d’Etat qui refusa l’asile politique à un militant basque Javier Ibarrategui qui se disait menacé de mort en Espagne. Ibarrategui retourna donc dans son pays où des groupes d’extrême droite, des anciens franquistes, l’assassinèrent comme il l’avait annoncé.
- Une seconde fois beaucoup plus récemment, lorsqu’il plaida devant le Conseil Constitutionnel avec une éloquence et une hauteur de vue exceptionnelles contre cette idée absurde de vouloir interdire et de sanctionner la liberté d’aller sur des sites djihadistes : « La liberté de penser, la liberté d’opinion, […] n’existent pas seulement pour satisfaire le désir de la connaissance individuelle, le bien-être intellectuel de chaque citoyen. […] Elles [existent] aussi parce que ces libertés sont consubstantielles à l’existence d’une société démocratique ». C’était le mot du jour du 13 février 2017. Pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus qu’une telle interdiction est à la fois stupide et liberticide, il faut relire cette plaidoirie.
Cette fois, il était invité par France Culture <aux matins de France Culture> lors d’une émission consacrée aux Libertés Publiques et à l’État d’urgence.
Oui ! Parce que nous avons un vrai problème en France aujourd’hui. Un problème grave : l’état d’urgence mis en place dans la nuit des attentats du 13 novembre 2015, c’est à dire un état d’exception, est toujours en place.
Emmanuel Macron semble avoir pour projet de sortir de l’état d’urgence, en inscrivant dans l’état du Droit commun, des dispositions de l’état d’urgence. Et cela est très grave.
Il faut rappeler d’abord quelques fondamentaux sur l’état de droit, les libertés et le combat des lumières.
Voltaire avait été embastillé par la seule volonté du régent à qui il avait déplu, il n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres de cette époque. Ce fut par la suite son combat de lutter contre l’arbitraire. Mais dans le domaine du Droit et des Libertés il faut bien reconnaître que nos amis anglais ont toujours eu beaucoup d’avance sur nous. C’est eux qui en 1215, ont imposé la <Magna Carta ou Grande Charte > au Roi pour asseoir la Liberté et les Droits individuels. Et notamment ne pas entraver l’application du droit en arrêtant les hommes libres de façon arbitraire, point qui sera appelé habeas corpus. Wikipedia nous apprend que ce texte avait été précédé par la Charte des Libertés, édictée en 1100 par Henri Ier. Mais cette charte des Libertés était tombée en désuétude.
Mais que dit la Magna Carta dans son article 39 ? : « Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelques manières que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus à l’emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs, conforme aux lois du pays ».
Comment fait-on cela ?
Par la séparation des pouvoirs !
Wikipedia rappelle que pour l’essentiel, la séparation des pouvoirs a été théorisée par Locke et non par Montesquieu ; qui dans De l’esprit des lois conceptualise surtout la limitation du pouvoir par le pouvoir :
Revenons à des choses plus pratiques. Vous êtes dans un pays de Liberté parce que le Gouvernement et son bras armé, l’Administration et la Police ne peuvent pas débarquer chez vous selon leur bon vouloir, ne peuvent pas non plus vous arrêter s’ils le jugent utile ou vous assigner à résidence chez vous parce que cela leur parait pertinent au maintien de l’ordre. Pour faire cela, parce que cela est nécessaire parfois, ils ont besoin qu’un Juge de l’ordre judiciaire les y autorise préalablement. J’insiste sur le préalablement.
C’est justement à cela que l’Etat d’urgence s’attaque. L’administration agit sans l’autorisation du Juge. C’est une régression fondamentale.
<Un autre avocat Patrice Spinosi a expliqué sur France Inter> comment le Gouvernement s’est fait piéger par manque de clairvoyance et aussi une attitude distante par rapport aux Libertés et à l’Etat de Droit, toujours cité mais peu inspirant.
Lorsque des bandes armées ont déferlé sur notre capitale en tirant sur la foule et dans une salle de concert, il fallait agir vite. L’état d’urgence permettait de le faire et de surprendre les criminels en pleine action ou en train de vouloir continuer leur besogne macabre. Mais dans la semaine, il aurait fallu arrêter l’exception pour revenir dans le Droit commun.
Mais le Gouvernement n’a pas osé. Et plus il attendait, plus cela devenait difficile. Car imaginons un attentat juste après la fin de l’état d’urgence, le gouvernement serait vilipendé et accusé d’inconséquence.
Pourquoi, parce qu’il a essayé de faire croire que l’état d’urgence permettait d’éviter les attentats et de lutter efficacement contre les terroristes.
C’est là qu’il faut être solide et clair dans sa tête et écouter ceux qui savent, pas ceux qui font de la propagande ou de la communication. L’état d’urgence ne sert à rien pour lutter contre le terrorisme dans la durée.
Et François Sureau est un homme solide et clair :
« [En France] nous avons un problème avec la liberté qui tient au fait qu’on aurait pu choisir Montesquieu ou Voltaire. On aurait pu penser [au début de la Révolution française] qu’à l’origine de tout il y avait l’existence d’un homme libre, d’un citoyen libre, d’une personne dont il fallait garantir l’existence, le cas échéant contre l’Etat. Ce n’est pas ce que l’on a choisi. On a choisi Rousseau et le culte de la volonté générale. Il en résulte que lorsque la volonté générale s’exprime par la voix du Parlement et qu’on nous explique que la sécurité vaut tout et la liberté ne vaut rien, tout le monde est d’accord avec cette idée. C’est à dire que le culte absolu de la volonté générale tend à faire disparaître l’idéal des libertés publiques.
Cela a pour conséquence que pendant très longtemps on n’a pas contrôlé les Lois par rapport aux normes constitutionnelles et qu’il a fallu attendre 1971 d’une décision célèbre du Conseil Constitutionnel, à propos de la Liberté d’association, pour que [cette instance] accepte de contrôler la constitutionnalité de la Loi par rapport aux grands principes de la déclaration des droits. Il ne le faisait pas avant. Cela montre quelque chose d’assez profond qui montre que chez nous le combat pour les libertés publiques est toujours à reprendre parce qu’il ne rentre pas vraiment dans l’ADN politique français. […] Nous ne sommes pas un pays libéral [au sens politique de Montesquieu et Tocqueville].
Il faudra probablement que j’écrive un mot du jour sur la fameuse « Volonté générale » de Rousseau que tout étudiant de Droit apprend pendant ses études et qui a servi de fondement aux soviétiques pour considérer que les personnes qui n’étaient pas d’accord avec la volonté générale exprimé par le Parti étaient des dissidents qui sombraient dans la folie et qu’il fallait soit « rééduquer » soit « enfermer » dans des hôpitaux psychiatriques. En effet, celui qui s’oppose à la volonté générale n’est pas un opposant qui exprime une autre opinion, mais un homme qui se trompe. Mais revenons au sujet principal, le diagnostic de François Sureau sur l’état d’urgence.
François Sureau insiste beaucoup sur le fait que nous ne parlons pas ici de libéralisme économique mais politique. En France le mot libéralisme est quasi exclusivement attaché au domaine de l’économie. Il y a d’ailleurs en France une méfiance assez généralisée à l’égard du libéralisme économique qui la distingue de beaucoup de ses voisins. Mais ce n’est pas de libéralisme économique qu’il est question mais bien de politique et de liberté des citoyens qu’il s’agit à la fois de garantir et de protéger. Et surtout de protéger de l’intrusion de l’Etat.
[Cette question des droits de la personne traverse les formations politiques. Il y a tout une partie de la gauche, la gauche de type Vallsiste pour laquelle ces mots n’ont absolument aucun sens exactement comme une partie de la Droite.
C’est alors que Guillaume Erner le relance pour poser la problématique de manière claire : le terrorisme actuel ne mérite t’il pas que l’on pose un mouchoir sur un certain nombre de nos libertés individuelles pour avoir la sécurité collective.
« La vérité est tout à fait l’inverse. […]
Premier point, quand nos pères fondateurs ont posé les principes de nos droits individuels, ils ne l’ont pas fait uniquement pour les situations où tout va bien. Et au moment où nos grands penseurs expliquaient qu’on ne pouvait pas perquisitionner chez quelqu’un sans le mandat d’un juge, qui est à peu près une garantie qu’on a suspendue au moment de l’état d’urgence, on ne pouvait pas traverser la forêt de Bondy sans escorte armée. Les gens qui ont réfléchi [aux exigences] d’une société libre ne l’ont pas fait quand tout allait bien.
Second point, qui est encore plus grave, il y a là-dedans une forme d’imposture. Plutôt que de s’organiser pour que la Police soit réellement efficace à l’égard des 400 personnes qui sont réellement dangereuses, car je suis tout aussi avide de sécurité que tout le monde, pour qu’elle travaille davantage, qu’elle ait plus de moyens pour qu’on recrée par exemple les renseignements généraux, on a préféré suspendre les libertés publiques de l’ensemble des français. Et c’est cela la problématique de l’état d’urgence. […] c’est l’effet de groupes de pression de la justice et de l’administration…]
Les conséquences de l’état d’urgence c’est qu’on s’est servi de l’assignation à résidence pour contraindre des corses à rester chez eux à propos de match de foot en Corse du sud ou encore des écologistes au moment de la COP 21.
C’est cela qui est inacceptable. ! »
L’état d’urgence n’est pas efficace pour ce à quoi on prétend l’utiliser :
« Personne de sérieux ne pense que l’état d’urgence a une quelconque efficacité dans la lutte contre le terrorisme. [La Grande Bretagne n’a pas fait comme nous] Il y a eu 7000 perquisitions administratives pour 4 mises en examen]. Tout le monde sait que cela ne fonctionne pas. Simplement qu’est ce qui s’est passé ? […] Un gouvernement généralement mal inspiré, face à une angoisse générale totale, a cherché la chose la plus spectaculaire qu’il pouvait mettre en place et il a décidé de mettre en place l’état d’urgence. Maintenant, faute de pédagogie ou plutôt avec l’effet de cette pédagogie négative, la plupart des français pense que l’état d’urgence est indispensable à leur sécurité. Il n’en est absolument rien. […] et tout le monde le sait parmi les spécialistes.
On n’a jamais vu un procureur refuser d’ouvrir une enquête préliminaire. On a jamais vu un magistrat anti-terroriste refuser de délivrer un mandat de perquisition.
L’idée de confier au Préfet les missions normalement dévolues aux magistrats est une idée totalement surréaliste.
Mais les gouvernements se sont laissés enfermer dans ce piège. Pourquoi l’ont-ils fait ?
Parce que c’était commode. Parce que c’était de pauvres hommes dépassés par les évènements. »
Sureau parle de la part de nos gouvernants depuis 20 ans d’une furie normative.
« Plutôt que d’avoir un Ministre de l’Intérieur capable de négocier un compromis d’efficacité avec les syndicats de Police, on a préféré faire passer une Loi anti-terroriste par an pour réduire les libertés de tout le monde. En réalité, il n’y a plus d’Etat et c’est pour cela qu’il y a de plus en plus de Lois. La lutte anti-terroriste nécessite de redonner à l’Etat un pouvoir effectif : la recréation de renseignements généraux, une police plus efficace, une police mieux équipée. Alors cela ne se voit pas, cela ne permet pas d’aller au Parlement et de dire : j’ai fait la Loi Tartemolle ! Mais c’est certainement ce qu’il faut faire. »
Sureau donne une explication peu rassurante sur ces errements normatifs de nos gouvernants en parlant de la disparition de la culture philosophique de la classe politique.
« Quand vous regardez les débats parlementaires de la 3ème ou de la 4ème République à propos des législations d’exceptions vous constatez qu’il y avait de vrais débats. […] Il y a des gens inspirés par la philosophie des droits. Ce qui est frappant c’est que ce débat a entièrement disparu du Parlement. Il faut attendre d’être devant le Conseil constitutionnel pour le tenir. […] C’est dû au progrès incroyable de l’inculture de la philosophie juridique chez les parlementaires et probablement à une culture uniquement instrumentale dans son rapport au Droit de l’Ecole Nationale de l’Administration. [Un exemple] quand le Conseil Constitutionnel a décidé de censurer l’interdiction de consultation des sites terroristes, la décision du Conseil Constitutionnel sort à 14h, à 18h on apprend que 4 mecs se sont réunis en commission pour tenter de contourner la décision du Conseil Constitutionnel. Ceci, il y a trente ans aurait déclenché un véritable scandale public »
Et bien sûr cela ne déclencha aucun scandale.
Il me semble que c’est la 3ème fois ou la 4ème fois que je me sens conduit à citer cet avertissement, qui n’a jamais fait l’exergue d’un mot du jour, de Benjamin Franklin, l’un des Pères fondateurs des États-Unis (1706-1790) : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux.»
<909>
- Une première fois le 18 septembre 2013 : «Le Droit ne fait pas Justice.» où il expliquait qu’une de ses plus terribles expériences de justice fut lorsqu’il dut participer à une décision du Conseil d’Etat qui refusa l’asile politique à un militant basque Javier Ibarrategui qui se disait menacé de mort en Espagne. Ibarrategui retourna donc dans son pays où des groupes d’extrême droite, des anciens franquistes, l’assassinèrent comme il l’avait annoncé.
-
Mercredi 21 juin 2017
« Le triomphe de Macron pose un problème d’éthique démocratique et de représentativité des partis. »Jean GarriguesLa semaine dernière, après le premier tour des législatives, mon ami Marc m’a écrit : « Je compte sur toi pour que tu inspires nos réflexions sur la représentativité d’un parlement quand plus d’un électeur (inscrit sur les listes électorales) sur deux a choisi de ne pas voter »
J’ai préféré me taire entre les deux tours. J’ai eu raison, il y a bien triomphe des Macronistes, mais un peu plus modeste que celui que prévoyait les sondeurs après le premier Tour.
Emmanuel Macron, avec beaucoup de talent, une vision d’entrepreneur de start up nous a joué cette pièce que les plus audacieux tentent : « sur un malentendu cela peut passer !».
Je ne rappelle pas toutes ces étapes qui ont conduit d’abord Macron à obtenir au 1er tour des présidentielles 24,01 % des suffrages exprimés ce qui représentait 18,19% des inscrits et ses candidats au premier tour des législatives 32,32% des suffrages exprimés (La République en marche (REM) 28,20 et MODEM 4,12). Mais si on rapporte ces suffrages par rapport aux inscrits, le taux n’est plus que de 15,39%.
Par la grâce du système électoral, du positionnement des candidats macronistes et des institutions de la 5ème République, à partir de 32,32% des voix, la majorité présidentielle (REM et MODEM) a eu au second tour 350 élus sur 577, ce qui représente 60,66 % des sièges. C’est ce que l’on peut appeler un coefficient multiplicateur de la 5ème république, il est ici de 1,88.
Nous aimons nous comparer.
En Grande Bretagne, viennent aussi de se dérouler des élections législatives. C’est comme chez nous, mais il n’y a qu’un tour, celui qui est arrivé en tête gagne. Le Parti Conservateur de Theresa May a eu 42,4% des exprimés et quand même 29,14% des inscrits. Toujours est-il qu’avec 42,4% des voix elle a obtenu 317 sièges des 650 ce qui représente 48,8% des sièges. Il y a un coefficient multiplicateur britannique mais modeste 1,15.
Celui qui est arrivé second était le Labour de Corbyn qui avec 40,0% des voix a obtenu 40,3% des sièges, on peut parler d’un coefficient de stabilisation.
Voilà comment cela se passe dans le pays qui a inventé la démocratie parlementaire moderne.
Chez nos amis allemands, le système électoral est plus compliqué mais en résumé il aboutit à une représentation proportionnelle pour tous les partis qui ont obtenu plus de 5% des voix. ¨Par construction ce système électoral conduit à une représentation proportionnée entre les voix exprimés et les sièges. Il y a un petit coefficient multiplicateur qui provient du fait que les partis ayant des sièges récupèrent la proportion abandonnée par les partis ayant obtenu moins de 5%
Bref, nous comprenons toute l’incongruité de notre système électoral en le comparant. Ce n’est pas un système démocratique, c’est une organisation qui vise à donner une majorité à un homme, même s’il a été élu sur un malentendu.
Ce phénomène était déjà à l’œuvre en 2012 avec François Hollande. La majorité socialiste avait obtenu 39,86% des voix exprimés et 57,37% des sièges avec un coefficient multiplicateur français de 1,44 toujours incongru par rapport à nos voisins mais largement inférieur au résultat de cette année. Je sais bien que techniquement cela s’explique très bien grâce au scrutin majoritaire à deux tours où il faut être en capacité d’attirer des électeurs qui n’ont pas voté pour vous au premier tour, ce qui est encore facilité si vous vous trouvez au centre de l’échiquier et qu’un électeur de gauche préférera un candidat « En marche » contre un candidat de droite et un électeur de droite un candidat en Marche à un candidat de gauche.
Nous pouvons être cependant rassuré puisqu’au lendemain du premier tour, les sondeurs avait prévu plus de 70 % des sièges pour la majorité présidentielle et que nous sommes en deçà. C’est sur cette base que l’historien Jean Garrigues avait répondu la phrase que j’ai mis en exergue, dans un entretien à Challenges. On constate, par la comparaison avec nos pays voisins, que cette opinion reste parfaitement exacte à 60%.
Le plus instructif est quand même qu’Emmanuel Macron a conceptualisé lui même l’incongruité de cette situation. Je cite le futur Président jupitérien : «Dans tous les sondages, aucun candidat ne fait résolument plus de 25%. Alors oui, y’en a qui ont des partis, des vieux partis, avec beaucoup d’intérêts. Mais est-ce que quelqu’un peut penser raisonnablement que, élu président, il aura une majorité présidentielle uniquement avec son parti?», s’interrogeait le futur chef de l’Etat. «Moi je n’y crois pas», ajoutait Emmanuel Macron. Avant de marteler: «Non seulement ça n’est pas possible, mais ça n’est pas souhaitable! Parce que ça serait un hold-up ! ».
Un hold-up ! rien que cela…S’il s’était arrêté simplement à «Moi je n’y crois pas», on aurait pu dire qu’il n’était pas assez optimiste. Mais avec le hold-up ! il condamne ce qui est arrivé à sa majorité présidentielle.
Il y a cependant des raisons pour se réjouir, comme le montre cet article du Monde, le nombre de sièges occupés par des femmes a progressé en grand nombre : elles seront 223 députées à siéger dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, ce qui représente 38,65 % des sièges, soit 68 femmes députées supplémentaires par rapport à l’Assemblée élue en juin 2012 (elles représentaient 27 % de la précédente Assemblée). En outre, ce que je trouve encourageant c’est que le différentiel entre le pourcentage de candidates et le pourcentage d’élues a fortement diminué. Ainsi il y avait 42,4% des candidats qui étaient des femmes pour obtenir 38,65% des sièges. Il y a 10 ans il y avait 41,6% de candidates mais que 18,5% de femmes ayant obtenu un siège. Bref on réservait les sièges gagnables aux hommes. C’est toujours le cas, mais en beaucoup plus faible proportion.
En outre, l’assemblée se rajeunit, avec une moyenne d’âge de 48 ans et 240 jours, la XVe législature est plus jeune de cinq ans que la précédente (53 ans et 195 jours).
Et puis, il y a vraiment des piliers du bar de l’assemblée nationale qui ont été enfin remerciés. Exemple emblématique : Gérard Bapt, 71 ans, membre du Parti socialiste a été sèchement battu après 35 ans de mandats cumulés, il aspirait à 40 ans de mandat jusqu’à 76 ans, considérant que l’expérience était la valeur suprême du représentant du peuple.
En même temps, l’inexpérience n’est pas forcément un atout surtout quand elle se cumule avec l’incompétence. Certains candidats, En marche, sont apparus lors d’émissions de télévision particulièrement ridicules. Je n’aurai pas l’indélicatesse de les nommer mais vous pouvez les trouver aisément sur internet.
En revanche, l’article du Monde montre que les élus ne sont pas représentatifs des profils sociaux et des professions des français. Ce sont, les professions aisées qui dominent la nouvelle Assemblée.
Ce sont les gagnants de la mondialisation. Sauront-ils penser aux perdants et améliorer leur situation ?
Car maintenant, il faudra gouverner et arbitrer. C’est une chose de savoir brillamment gagner des élections grâce à son talent, à une part importante de chance et un système électoral très favorable. Mais gouverner c’est autre chose.
Nous qui aimons la France, ne pouvant qu’espérer qu’Emmanuel Macron trouvera des solutions pour améliorer la situation des français, d’une grande majorité de français.
Il a certainement de bonnes idées comme la volonté d’unifier les systèmes de retraite à terme, d’autres me semblent plus problématiques, mais j’en ai déjà parlé.
Certains de mes amis de l’ex Parti socialiste continue à prétendre que François Hollande était un bon président. Ce n’est pas mon avis. Non qu’il soit un homme sans qualité, mais il fut un président médiocre. En revanche il est et restera probablement un très bon analyste politique.
La journaliste Françoise Degois vient de publier « Il faut imaginer Sisyphe heureux : les 100 derniers jours de François Hollande. » Pour cette raison, elle était l’invitée de Anne-Sophie Lapix dans l’émission C à vous du 09/06/2017. Vous trouverez cette émission derrière ce lien <Les 100 derniers jours de Hollande>.
Et dans cette émission (à 12:35) François Degois fait dire à François Hollande cette prophétie : « Le jeune roi sera nu, un jour »
<908>
-
Mardi 20 juin 2017
«Dans sa vie publique, il toucha le manteau de l’Histoire, sa vie privée fut un désastre. »Réflexions sur le destin d’Helmut Kohl, inspiré de deux articles du Point et de l’ExpressLorsque Helmut Schmidt est mort le 10 novembre 2015, j’avais écrit un mot du jour en son honneur et j’avais notamment cité un discours exceptionnel de 2011 au Congrès du SPD qu’il avait réalisé en chaise roulante à 93 ans <Vous trouverez ce mot derrière ce lien> .
Je n’avais pas l’intention de faire la même chose pour son successeur Helmut Kohl qui a eu la chance d’être chancelier au bon moment à savoir quand le mur de Berlin s’est écroulé et que Michaël Gorbatchev a laissé faire sans intervenir militairement. Il est donc désormais, devant l’Histoire, comme le chancelier de l’unification allemande.
Il a su faire les concessions nécessaires et prendre des décisions politiques qui ont contribué à ce que cette unité se réalise rapidement.
Mais il ne m’inspirait pas suffisamment avant que je lise cet article du Point qui raconte la face cachée ou les coulisses de ce colosse triomphant qui devrait avoir la statue d’un des pères de l’Allemagne puissante économiquement et pacifique politiquement.
Sort enviable !
Il remplaça Helmut Schmidt, le 1er octobre 1982, non lors d’une élection triomphante mais par un retournement d’alliance du Parti des Libéraux démocrates (FDP) de Hans-Dietrich Genscher qui formait une coalition avec le SPD depuis 69 et qui tomba à droite dans les bras de la CDU-CSU.
Lors de cet affrontement Helmut Schmidt eu cette formule assassine à son encontre : « Vous êtes très sympathique, mais le problème avec vous, c’est qu’on ne sait pas du tout ce que vous pensez. D’ailleurs, pensez-vous ? » .
Avec cette coalition il gagna cependant plusieurs fois les élections législatives et resta au pouvoir de 1982 jusqu’en septembre 1998, où le SPD remporta les élections législatives et Gerhard Schröder devint chancelier.
Par la suite de scandales politico financiers, autrement dit de caisses noires, il fut évincé de la tête du Parti par Angela Merkel qu’il avait pourtant soutenu tout au long de sa carrière et dont il considéra l’acte de le remplacer comme une trahison.
Ce rappel pour dire qu’Angela Merkel est le contraire d’une politique bienveillante et débonnaire.
Mais tout ceci ne m’incitait pas à écrire un mot du jour.
L’article du point que vous trouverez <ICI> donne un autre éclairage. Un éclairage sur ce que coûte le choix de faire de la Politique son seul métier, sa seule passion et ce qui se passe parfois dans l’intime, derrière les murs.
Helmut Kohl a deux enfants qu’il a eu avec sa femme Hannelore et pour le reste je vous livre des extraits de cet article publié le 18/06/2017 par la journaliste Pascale Hugues.
On apprend d’abord qu’à la fin de sa vie Helmut Kohl était très malade et totalement sous l’influence de sa nouvelle compagne de 34 ans sa cadette : Maike Kohl-Richter
«Walter Kohl, 53 ans, le fils aîné d’Helmut Kohl, […] l s’est contenté de déplorer qu’Helmut Kohl ait rompu depuis des années toute relation avec ses deux fils et ses petits-enfants.
[…] Walter Kohl confie pourtant qu’il a essayé à plusieurs reprises de rendre visite à son père, mais la police lui a interdit l’accès à la maison. Cloué dans un fauteuil roulant après avoir, en 2008, fait une mauvaise chute à la suite d’un AVC, incapable de parler distinctement, le visage figé, l’ancien chancelier vivait reclus dans son pavillon d’Oggersheim avec sa seconde épouse, une chrétienne-démocrate feu et flamme, ancienne collaboratrice de la section économie de la chancellerie, qui faisait office de garde-malade et de gouvernante. »
Et la journaliste raconte cette histoire qui vient de loin :
« Quel contraste en effet entre, d’un côté, l’homme public admiré et, de l’autre, le père de famille absent, dépourvu d’empathie, incapable d’apporter à ses enfants la sécurité émotionnelle dont ils ont besoin pour bien grandir. Walter Kohl estime n’avoir servi qu’à décorer l’image publique de son père. Les Allemands se souviennent du portrait de groupe harmonieux que présentait chaque été la famille Kohl sur les rives du Wolfgangsee : deux garçons en culottes courtes, une mère blonde et éternellement souriante, un père en sandales-chaussettes observant ses rejetons d’un œil bienveillant. Une famille modèle sur fond de paysage alpin idyllique.
C’est Walter Kohl qui a détruit une fois pour toutes cette belle façade. Dans un livre publié en 2011 et intitulé Vivre ou être vécu, qui n’est ni exhibitionniste ni un vulgaire règlement de comptes avec ce père inadéquat, Walter Kohl laisse parler enfin ce petit garçon solitaire, abandonné des adultes. Un de ces nombreux « fils de… » qui n’ont pas droit à une vie comme les autres et connaissent souvent des destins tragiques. Des pères téléguidés par leur agenda bourré d’obligations, de réunions au sommet, de voyages officiels. Ils sont omniprésents dans les médias et absents à la maison. […] À ce train-là, il ne reste guère de temps pour ses fils. « La famille de mon père, constate Walter Kohl, c’était son parti et sa vie, c’était la politique. »
Une enfance exposée aux médias et sous haute protection. Quand durant l’« automne allemand » de la sombre année 1977, les attentats et les enlèvements perpétrés par les terroristes de la Fraction armée rouge traumatisent l’Allemagne, le pavillon d’Oggersheim est transformé en forteresse. Un mur et des barbelés sont érigés autour du jardin. Des vitres pare-balles sont installées dans les chambres des enfants. Interdiction de sortir de la place forte sans être escorté par un garde du corps. […] Quand il ose confier son angoisse à son père, celui-ci se raidit et lui rétorque : « Tu dois faire face ! »
[…]
Walter Kohl décrit cette génération d’Allemands sévères, profondément traumatisés par la guerre, incapables d’avouer une faiblesse, de reconnaître la légitimité d’une inquiétude et de parler à leurs enfants. Helmut Kohl est adolescent à la fin de la guerre. Comme tous les jeunes de son âge, il vit les bombardements, les cadavres extirpés des maisons en feu. Dans les derniers mois de la guerre, cet « écolier-soldat» est réquisitionné comme auxiliaire dans la défense aérienne. Il apprend à enfouir sa peur, à cacher ses émotions et à « faire face ».
Le destin d’Hannelore Kohl est encore plus dramatique. À 11 ans dans sa ville natale de Leipzig, la petite fille accueille avec ses camarades de classe les trains de soldats blessés revenus du front russe. […] À 12 ans, elle est violée à plusieurs reprises par des soldats russes et – c’est ce qu’elle confie à l’un de ses biographes – jetée par la fenêtre « comme un sac de ciment ».
[…] Walter Kohl décrit une mère qui fit de l’autodiscipline sa ligne de conduite. Pas question de se laisser aller ou de se plaindre.
Mais la vie politique a une fin et notamment Helmut Kohl perd la chancellerie. La famille devrait pouvoir vivre plus paisiblement.
« Mais le répit est de courte durée. Quelques mois après le départ à la retraite du patriarche, le scandale des caisses noires de la CDU éclate. Helmut Kohl se retrouve propulsé au centre d’une très vilaine affaire de financement occulte de son parti. Il redevient pendant des mois la cible de la presse allemande déchaînée. La réputation de probité de la famille Kohl est souillée. Hannelore Kohl et ses enfants disent en avoir énormément souffert.
À partir de là, c’est la débandade. Helmut Kohl vit à Berlin, rentre rarement à Oggersheim. Hannelore se retrouve isolée dans le pavillon familial avec pour seule compagnie le fidèle chauffeur des Kohl et l’épouse de celui-ci employée comme gouvernante. Hannelore Kohl, douée pour les langues et qui parlait couramment le français, appartient à cette génération de femmes qui renonça à toute vie professionnelle et personnelle pour se mettre au service de la carrière de son mari.
La tragédie s’intensifie : Hannelore Kohl tombe gravement malade, une allergie rare à la lumière du jour. Elle vit recluse, volets baissés, rideaux tirés, dans la pénombre de son pavillon. Elle ne sort que la nuit et doit renoncer à assister au mariage de son fils Peter en Turquie. En 2001, le chauffeur appelle Helmut Kohl à Berlin : sa femme s’est suicidée.
Helmut Kohl vit avec une nouvelle femme, très jeune par rapport à lui.
« Peter Kohl raconte sa première visite dans l’appartement de Maike Kohl-Richter alors qu’elle n’était pas encore mariée à son père. Quand la porte s’entrouvre, il découvre un véritable musée à la gloire du chancelier, des photos de lui sur tous les murs. « C’était comme dans un film de propagande. J’en ai eu la chair de poule », confie Peter Kohl, qui a l’impression inquiétante d’avoir à faire à un stalker. Les choses ne tardent pas d’ailleurs à se gâter. Peter et Walter Kohl ne sont pas invités au remariage de leur père. La presse publie une photo qui montre la jeune femme portant un tailleur et des bijoux de famille ayant appartenu à Hannelore. Elle a dû se servir dans la penderie d’Oggersheim. »
L’article relate la dernière visite de Peter Kohl à son père :
« C’est sa femme qui lui ouvre la porte et le conduit dans le salon. « Mon père avait l’air heureux de nous voir, ma fille et moi. » Mais au bout de dix minutes, comme un enfant qui a peur d’être puni, le chancelier, jadis si puissant, chuchote à son fils : « Il vaut mieux que tu t’en ailles, sinon je vais avoir des ennuis. » Helmut Kohl, affirment ses fils, vivait comme « un prisonnier » ayant totalement perdu le contrôle de sa propre vie. C’est sa femme qui décide qui a le droit de lui rendre visite. […] Entre les fils et le père, le contact est rompu. Walter et Peter n’ont pas vu leur père depuis plusieurs années. »
L’article se termine par ses propos de Walter Kohl qui regrette de ne pas avoir pu faire la paix avec son père de son vivant.
« Les choses sont comme elles sont », soupire-t-il au bord des larmes, avant d’aller se recueillir sur la tombe de sa mère tout près de là.
Pourquoi raconter ces faits et dévoiler la vie privée de ces personnes ?
C’est d’abord pour montrer qu’il y a souvent une grande différence entre ce que l’on voit, ou qu’on nous montre et la réalité de la vie, notamment pour les Hommes politiques.
Je pense que si l’on s’intéresse de plus près à la vie et à la famille de Jacques Chirac, les choses ne sont pas évidentes non plus.
Ensuite, on critique beaucoup les politiques et on a raison. Il y a la soif du pouvoir, le goût des honneurs. Mais il est aussi important que notre univers de connaissance sache qu’il y a une servitude politique qui souvent présente une face sombre. Et que dans cette face sombre, des enfants, des épouses, des familles sont sacrifiées. La recherche du bonheur se trouve rarement sur ce chemin.
C’est l’article du Point que j’ai trouvé le plus précis sur la vie privée de Kohl mais <Vous trouverez ici un long article dans le journal l’Express> dont j’ai tiré l’exergue du mot du jour. Car l’Express nous apprend que les allemands ont cette expression : « Il a touché le manteau de l’Histoire » pour parler des hommes qui ont fait l’Histoire, mais cet article évoque brièvement ce qui est développé dans le Point sous le titre : « Sa vie privée est un désastre ».
<907>
-
Lundi 19 juin 2017
« Le baccalauréat »Premier diplôme universitaire en FranceQuand on regarde le taux d’abstention ce dimanche au deuxième tour des élections législatives, force est de constater que ces élections ne constituaient pas une préoccupation essentielle des français.
Il est clair, que ces derniers jours, la principale préoccupation des familles françaises ayant des enfants entre 15 et 18 ans, est le Baccalauréat dont les épreuves écrites sont en cours.
Il n’y a pas encore eu de mot du jour sur le baccalauréat, je vais donc tenter de combler cette lacune.
Quand on fait une recherche sur internet on tombe assez vite sur ce document : http://media.education.gouv.fr/file/200_ans_du_bac/42/3/200_ans_du_bac_28423.pdf qui date de 2008 et qui prétend que le baccalauréat avait 200 ans cette année-là.
Parce que cet opuscule prend comme date d’origine le décret du 17 mars 1808 qui organise l’Université impériale. Donc c’est encore une création de l’ère napoléonienne, comme le code civil, la légion d’honneur et tout ce qui compte dans notre bonne vieille France. Ce document nous apprend aussi qu’il y a eu 31 lauréats lors de la première session.
Mais si vous consultez Wikipédia vous avez une autre version qui nous emmène plus loin dans l’Histoire : les premiers baccalauréats datent en France du XIIIe siècle avec l’apparition de l’Université de Paris. Il s’agit dès cette époque, et c’est encore le cas aujourd’hui, du premier grade universitaire.
Mais d’où vient ce mot : « Baccalauréat » ? Quel est l’étymologie ?
C’est bien sûr du latin. La concaténation des deux mots « bacca » et « laureatus » c’est-à-dire « baie de laurier » ou « orné de laurier ». Comme Jules César dans Astérix qui couvre sa tête d’une couronne de lauriers.
Il faut reconnaître que Goscinny respecte l’Histoire, lors du <triomphe romain> le général vainqueur et plus tard l’empereur portent bien une couronne de lauriers.
Le baccalauréat constitue donc un triomphe.
Mais on lit aussi que « baccalauréat » pourrait venir de l’altération du bas-latin bachalariatus, désignant un chevalier débutant. Ce n’est plus le triomphe qui est au centre mais une sorte de cérémonie initiatique pour les jeunes pour entrer dans la vie adulte.
Vous trouverez ces éléments comme d’autres dans un extrait du Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition, 1932-1935 publié sur Internet
Parmi ces autres précisions vous trouvez par exemple cette réflexion : « En France on prend le baccalauréat pour en finir avec ses études, on fait sa première communion pour en finir avec la religion, on se marie pour en finir avec l’amour. » — (Ernest Bersot, Études et discours (1868-1878), (1879) p. 138)
Le document précité et qui parle des 200 ans du baccalauréat donne les précisions suivantes : Durant l’essentiel du XIXème siècle et au début du XXème siècle, le baccalauréat connaît de multiples réformes, mais son développement reste limité et réservé à une élite restreinte, admise dans un enseignement secondaire payant. Il faudra attendre 1861 pour qu’il y ait enfin une bachelière. Elle s’appelait : Julie-Victoire Daubié et c’est l’Académie de Lyon qui lui a accordé ce diplôme. Les filles ne recevront un enseignement secondaire identique à celui des garçons que dans les années 1920, un peu avant que l’ouverture sociale ne soit rendue possible par la gratuité des études secondaires (années 1930).
Quand les chiffres parlent du baccalauréat, il est souvent question du taux de réussite toujours très élevé. Mais ce qui me parait pertinent de mesurer c’est la proportion de bacheliers sur une génération.
Elle était de 3% en 1945 et était monté à 25 % en 1975 (Annie a eu son bac cette année-là et moi l’année suivante en 1976.)
C’était en 1985, le ministre de l’éducation était Jean-Pierre Chevènement que l’objectif de 80 % d’une génération au niveau du baccalauréat était promis pour l’année 2000. Pour ce faire, on crée le bac professionnel en 1987 qui fait bondir le nombre de bacheliers d’une génération. La « massification du lycée » dure dix ans. Mais à partir de 1995, le nombre de candidats au bac cesse d’augmenter, et la proportion de bacheliers dans une génération stagne autour de 62 %. Puis un pallier est franchi en 2009, celui des « 65 % » (65,5 % en 2009, 65,3 % en 2010) et en 2011 un bond de 6 points porte cette proportion à 71,6 %.
Je tire toutes ces informations de <cet article> du Monde.
Et ce site de <L’Education nationale> nous apprend que la part des bacheliers dans une génération est montée à 77,7 % en 2015 et de 78,6 % en 2016.
16 ans après l’an 2000, l’objectif de 80 % d’une génération n’est toujours pas atteint.
Mais à mon sens, le baccalauréat pose bien d’autres questions que nous avons connues en tant que lycéen et plus tard de parents.
Qu’est-ce que ce remue-ménage qui mobilise les salles de classes comme les professeurs des lycées pendant toute la seconde quinzaine de juin, fermant en réalité les établissement pour les classes non concernées par cet examen et amputant l’année scolaire déjà particulièrement court et dense en France ?
Qu’est-ce que c’est que ce leurre d’une première sélection universitaire en juin, alors que la véritable sélection se passe en début année et sur les résultats du premier trimestre et de l’année de première pour l’entrée dans les classes préparatoires des grandes écoles qui sont aujourd’hui encore la filière de l’excellence essentiellement pour les enfants des classes privilégiées ?
Enfin, cette promesse de 80% d’une génération au niveau du bac était aussi une promesse d’amélioration des métiers et des salaires de toute cette partie de la génération qui faisait l’effort de continuer les études. Et c’est le contraire qui s’est réalisé : la multiplication des boulots « débiles » (j’essaie ce mot pour éviter celui de boulots de merde) et une diminution assez générale des salaires perçus par les jeunes. Ce problème n’est pas que français, mais il montre aussi en France, quand on le place en regard de cet objectif de 80%, de l’échec des politiques à créer les conditions de l’amélioration de la société dans son ensemble.
<906>
-
Vendredi 16 juin 2017
«Il faut qu’une parole politisée fasse retour pour que le charme des mythologies économiques soit enfin rompu.»Éloi LaurentLa troisième et dernière partie du livre d’Éloi Laurent que nous examinons cette semaine concerne la mythologie écolo-sceptique. Il exprime d’abord la constatation du recul de l’écologie politique en Europe et en France. Il ne pense pas que ce recul s’explique parce que tout le monde serait devenu écologiste. Il inscrit plutôt ce repli dans une régression sous l’effet de la crise sociale qui n’en finit plus et d’une idéologie du dénigrement dans laquelle les mythologies économiques jouent un grand rôle.
Il parle d’une échelle graduée de mauvaise foi.
« On commence généralement par prétendre que les crises écologiques sont exagérées à des fins idéologiques, puis on affirme que, quand bien même leur gravité seraient avérées, elles trouveront leur résolution naturelle au moyen des marchés et par la grâce de la croissance, avant de soutenir que, si tel n’était pas le cas, le coût économique et politique de leur atténuation serait de toute façon prohibitif.
Cette stratégie rhétorique n’est pas sans rappeler la parabole du chaudron percé imaginé par Freud dans « le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient » : soit un individu qui a emprunté à un autre un chaudron et le restitue percé d’un grand trou qui rend l’objet hors d’usage. L’emprunteur se défend par ces arguments successifs :
- « je n’ai jamais emprunté de chaudron » (les crises écologiques n’existent pas) ;
- « j’ai rendu le chaudron intact » (elles existent, mais la croissance et le marché nous en préserveront) ;
- « le chaudron était déjà percé lorsque je l’ai emprunté » (les deux mensonges précédents sont dévoilés, mais dissimulés derrière un troisième : les crises écologiques sont bien réelles, le marché et la croissance ne suffiront pas à les atténuer, mais aller au-delà affaiblirait notre économie, voire notre démocratie).
[…]
Résultat : nous perdons un temps précieux à remonter le temps des arguments dépassés, sans jamais pouvoir poser les bonnes questions pour l’avenir, comme celle des causes et des conséquences sociales des crises écologiques. C’est précisément le but de la mythologie écolo sceptique : retarder par tous les moyens l’heure des choix, qui a pourtant bel et bien sonné.
Il démonte dans cette troisième partie deux autre croyances : « les marchés la croissance sont les véritables solutions à l’urgence écologique » et « l’écologie est l’ennemi de l’innovation et de l’emploi » .
Je finirai ce cinquième mot du jour consacré à l’ouvrage d’Éloi Laurent par son épilogue :
« Dans ses mythologies, Roland Barthes montre comment certains objets de consommation se nourrissent des grands mythes humains qui peuvent ainsi être instrumentalisés à des fins marchandes. Le pouvoir économique, depuis l’avènement de la société industrielle et aujourd’hui encore, utilise la mythologie comme sésame pour pénétrer et coloniser les imaginaires. Mais, nouveauté fondamentale, il peuple désormais les esprits de ses propres mythes.
Barthes s’attache aussi, en conclusion de son ouvrage, a dévoilé les fonctions du mythe, et il parvient à une conclusion particulièrement éclairante : « le mythe est une parole dépolitisée ». Les mythes forment ensemble de « fausses évidences » qui se présentent comme naturelles et organisent un monde « sans contradiction parce que sans profondeur ». La fonction du mythe est autant de mettre en lumière que de passer sous silence.
C’est précisément ce que l’on voit à l’aune des 15 illustrations proposées dans ce livre : les mythes économiques contemporains, qui ont colonisé les esprits, ont pour fonction principale de détourner l’attention des citoyens des véritables enjeux dont ils devraient se soucier et débattre. Nos mythologies économiques sont des mystifications politiques. On ne pourra donc pas les dissiper seulement en les démentant, ce que cet ouvrage a tenté de faire. De même qu’une théorie n’est pas démentie par des faits, mais par une autre théorie, il faut qu’une parole politisée fasse retour pour que le charme des mythologies économiques soit enfin rompu. […].
C’est pourquoi il est indispensable de s’atteler à la construction de nouveaux récits communs positifs, dans l’esprit de la mythologie grecque, où la raison et le rêve, sur un pied d’égalité, se nourrissent mutuellement pour donner sens à l’existence humaine. Vaste et beau programme. »
Quand on parle de politique, on veut dire qu’il est possible par des actes de gouvernement d’avoir une influence sur le cours des choses.
Mais pour qu’une pensée politique nouvelle puisse émerger, il faut créer de nouveaux récits, de nouveaux mythes.
Pour que tout cela puisse fonctionner, il faut aussi parvenir à investir (pacifiquement bien évidemment) un territoire sur lequel la Politique est en capacité de maîtriser les pulsions cupides de l’homo economicus et de parler d’égal à égal avec les forces économiques. Le territoire de la France est insuffisant à cette tâche.
<905>
- « je n’ai jamais emprunté de chaudron » (les crises écologiques n’existent pas) ;
-
Jeudi 15 juin 2017
« Le grand remplacement »Mythologie inventée par Renaud CamusPour celles et ceux qui ne le savent pas, Renaud Camus, né en 1946 est un écrivain et un militant politique français. Il a été un moment, dans les années 1970-1980, membre du Parti socialiste. Son cheminement politique l’a ensuite amené à l’extrême droite. Il crée en 2002 le parti de l’Innocence et publie en 2010 un livre dont le titre est « L’abécédaire de l’in-nocence » et dans lequel il introduit le concept du « grand remplacement ».
Dans ce concept, il théorise l’idée qu’à la faveur de l’immigration et des différentiels de fécondité, « des immigrés ou des Français administratifs issus de l’immigration », ou des peuples venus de l’Afrique et notamment du Maghreb, tendent à devenir majoritaires sur des portions en expansion constante du territoire français métropolitain, et que ce processus doit conduire à une substitution de population au terme de laquelle la France cessera d’être une nation essentiellement européenne. Il prétend même que ce phénomène doit s’effectuer en quelques décennies.
Qu’un penseur illuminé défende ce type de fantasme ne présente pas d’intérêt, mais cette pensée irrigue de plus en plus la pensée d’extrême droite et aussi toute une partie des républicains, celle qui est proche de la pensée identitaire.
C’est une des mythologies social-xénophobe qu’Éloi Laurent tente de démonter dans son livre « Nos mythologies économiques ». Il appelle ainsi l’évolution du discours xénophobe des extrêmes droites parce qu’elles ont ajouté à leurs fantasmes d’identité nationale le fait que l’immigration menacerait l’attachement des Européens à leur modèle social.
Il définit cette mythologie de la manière suivante : « les flux migratoires actuels sont incontrôlables et conduiront sous peu au « grand remplacement » de la population française. »
Il écrit :
« Le mythe peut être le mieux ancré dans le discours social-xénophobe veut que la mondialisation actuelle se distingue de toutes les périodes d’intégration économique antérieures par des flux migratoires considérables et incontrôlables. Disons-le d’emblée sans détour, c’est le contraire qui est vrai : alors que la période dite de « première mondialisation » (1870–1914) a connu des mouvements de populations massifs, notamment de l’Europe vers les États-Unis, les migrants ne représentent dans notre mondialisation qu’environ 3 % de la population mondiale (230 millions de migrants pour 7 milliards d’habitants sur la terre). Cela signifie que 97 % des habitants de la planète demeurent où ils sont nés (cette proportion étant stable depuis 25 ans). Les humains sont donc aujourd’hui infiniment plus sédentaires que nomades, ce qui ne fut pas toujours vrai. En revanche, bien entendu, la population de la planète a considérablement augmenté au cours du XXe siècle (d’un facteur quatre), d’où une progression des migrations en volume. Mais elles ont bien diminué en proportion.
Pour ce qui est de la France, par comparaison avec la période de forte émigration des années 1960, les flux ont régressé non seulement en proportion mais également en volume. Contrairement à la vulgate véhiculée par l’extrême droite et qui a contaminé une bonne partie des esprits conservateurs, et parfois même progressistes, les flux migratoires sont à un point historiquement bas : de l’ordre de 280 000 personnes par an, dont 80 000 d’origine européenne et 60 000 étudiants (dont un tiers environ ne restera pas en France). Ramenée à la population française, la proportion terrifiante de ces envahisseurs sur le sol national atteint 0,4 %.
Je vous épargne toute une autre série de chiffres que l’économiste donne à l’appui de sa démonstration à la page 59 de son ouvrage pour en arriver à sa conclusion qui ne nie pas les difficultés, mais pointe le véritable problème de la France dans ce domaine :
« Comme souvent, le discours mythologique est un écran de fumée toxique : la vraie question nationale n’est pas l’insoutenabilité de l’immigration actuelle, mais la défaillance de l’intégration sociale des immigrés d’hier et de leurs enfants. Quelle chance la République a-t-elle données et donne-t-elle aux quelques 12 millions de Français immigrés ou nés en France d’un parent immigré ? Comment la France cultive-t-elle la richesse d’une population devenu tranquillement diverse au cours du XXe siècle ? »
Cette question a été étudiée (d’ailleurs Éloi Laurent renvoie vers cet auteur) par François Héran qui a publié notamment : « Le Temps des immigrés. Essai sur le destin de la population française » (Seuil, « La république des idées », 2007).
Post scriptum :<Après la publication de ce mot : Alain Finkelkraut a invité, le 24 juin dans son émission « Répliques », Renaud Camus et l’a confronté à Hervé le Bras>. Le sujet de cette émission était bien le Grand Remplacement.
<904>
-
Mercredi 14 juin 2017
«La poursuite de l’efficacité crée nécessairement des inégalités. Et ainsi la société est confrontée à un arbitrage entre égalité et efficacité»Arthur OkunArthur Okun (1928-1980) était un économiste américain qui fut conseiller économique du président Kennedy. Il est surtout connu pour la loi qui porte son nom, la loi d’Okun, qui prétend qu’il existe une relation linéaire entre les taux de variation du chômage et du PIB. Le résumé simple qu’en donne Wikipedia est le suivant : « En dessous d’un certain seuil de croissance, le chômage augmente ; au-dessus de ce seuil, il diminue »
Éloi Laurent le cite pour une autre raison : le livre qu’il a écrit : < Egalité versus efficacité. Comment trouver l’équilibre?> dont il conteste la thèse centrale à savoir que la poursuite de l’efficacité ne peut que se réaliser par un creusement des inégalités.
Mais avant d’aborder ce sujet qu’il développe dans sa partie consacrée à la mythologie néolibérale : « Il faut produire des richesses avant de les redistribuer », Éloi Laurent pose une question :
« Ce modèle économique pose une question encore plus fondamentale : la privatisation des biens publics est-elle légitime quand elle s’accompagne de sécession fiscale ? »
Et puis il argumente à partir de la page 30 contre la thèse d’Okun :
« Une vision faussement naïve de notre système économique s’est répandue qui veut que la société civile et les entrepreneurs créent une richesse que l’État redistribue selon son bon vouloir aux « assistés » sociaux.
Ce discours à la fois élitiste et condescendant fait commodément abstraction des conditions sociales de la création de richesse. Les entrepreneurs ne viennent pas à la vie dans un monde économique qu’ils inventent en même temps que leurs produits et services. Ils bénéficient d’infrastructures de toute sorte financées par la collectivité sans lesquelles l’innovation resterait à jamais au stade de l’imagination : systèmes de formation, routes, ponts, institutions juridiques, mécanismes de financement, confiance sociale, etc., forment ce que l’on pourrait appeler l’écosystème de la création de valeur économique.
Comme ces biens communs ont un coût, le système de financement fiscal et social constitue la condition et le soubassement de toute activité entrepreneuriale. Ici aussi, la question est de savoir si les entreprises et leurs dirigeants paient leur juste part d’un effort collectif dont ils tirent à l’évidence un avantage considérable, ou s’ils se contentent de privatiser le patrimoine commun à leur profit sans contribuer à son entretien ni à son renouvellement. […]
Ne pas payer ses impôts et ne pas rémunérer le travail sont deux « modèles économiques» particulièrement prisés du capitalisme de passager clandestin.
Au-delà même de ces conditions sociales de la création de valeur, il faut s’interroger sur la primauté donnée, dans l’économie mythologique, à la production sur la répartition.
Et si la crise contemporaine des inégalités finissait par anéantir le dynamisme économique ?
Et si en d’autres termes, il fallait complètement renverser la logique de l’argumentation mythologique pour montrer que c’est la répartition des richesses qui conditionne les possibilités du développement économique ?
Pour des générations d’économistes, le « grand dilemme » entre efficacité et égalité postulé par Arthur Okun demeure la référence intellectuelle consciente ou inconsciente.
Le schéma de pensée qui émergea de son ouvrage de 1975 veut que les inégalités soient un mal nécessaire pour atteindre l’efficacité économique : « La poursuite de l’efficacité crée nécessairement des inégalités. Et ainsi la société est confrontée à un arbitrage entre égalité et efficacité. »
Comme c’est parfois le cas la traduction de cet ouvrage a conduit à une perte de sens : le mot trade-off (dilemme, arbitrage) est devenue dans l’édition française « équilibre ». Or le point-clé de l’analyse est la séparation et la hiérarchisation des enjeux d’efficacité et d’égalité. Okun est en cela fidèle à l’analyse néoclassique la plus conventionnelle […] : une politique économique doit d’abord viser l’efficacité économique, dont découlera naturellement, dans le cas idéal, la redistribution. […]
La recherche économique de ce début de XXIe siècle, par de très nombreux travaux empiriques, remet complètement en cause cette idéologie de l’efficacité naturellement juste : les inégalités sont non seulement injustes, mais elles sont tout autant inefficaces. Elles provoquent des crises financières. Elles substituent la rente à l’innovation. Elles empêchent l’essor de la santé et de l’éducation. Elles figent les positions sociales. Elles paralysent la démocratie. Elle aggravent les dégradations environnementales et nourrissent les crises écologiques.
Et Éloi Laurent illustre son propos par plusieurs exemples : Okun a proposé une image du « seau percé. Chaque politique de redistribution, comme l’impôt sur les revenus en France, serait comme un trou percé qui laisserait s’échapper un peu de dynamisme économique : au final, selon Okun, le seau parvient vide à la population, l’équité ayant tué l’efficacité. Mais Éloi Laurent inverse cette démonstration :
« Les inégalités sont autant de trous percés dans le seau de l’efficacité ; dès lors il ne sert à rien de remplir celui-ci, car son contenu ne parvient plus jusqu’aux citoyens. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui, aux États-Unis, 2 % de croissance du PIB se traduisent dans les faits par une décroissance du revenu de 90 % de la population : Entre l’accroissement du PIB et les revenus effectivement distribués à la très grande majorité des américains s’interposent les « fuites » du pouvoir de la finance, de l’inégalité salaire-profit et de l’accaparement des richesses par les individus parvenus, à l’aide de moyens largement publics, au sommet de l’échelle des revenus
Dans le cas français, on sait désormais que c’est l’ampleur des inégalités scolaires qui expliquent la faible performance d’ensemble des élèves aux tests internationaux. Les inégalités plombent l’efficacité de l’école française. »
Cette problématique de l’inefficacité de l’inégalité avait déjà été évoquée lors du mot du jour du Jeudi 16 mai 2013 : « Les perspectives de croissance économique stable et durable seraient bien meilleures, si nous ne vivions pas dans un monde où 0, 5 % des plus riches accaparent 35 % des avoirs de la planète » et cette affirmation était de Christine Lagarde Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI)
<903>
-
Mardi 13 juin 2017
« Qui assume les risques et les coûts de l’économie de marché ? Qui en possède les rentes ? »Éloi Laurent « Nos mythologies économiques » page 18Cette question qu’on ne met que rarement au-devant de la scène : Qui assume les risques ? me semble fondamentale.
Daniel Cohen avait mis en lumière cette question dans un entretien à Challenges en 2006 : <La rémunération et la protection du risque sont aberrantes>, en soulignant la supercherie actuelle : « Pendant longtemps, être salarié c’était justement profiter de la sécurité de la condition salariale, le risque étant laissé aux entrepreneurs qui avait en contrepartie la possibilité de s’enrichir. Le capitalisme contemporain a inversé cette équation. C’est désormais le salarié qui est exposé aux risques industriels et c’est l’entrepreneur, l’actionnaire, qui en est protégé. C’est un des éléments de la rupture du contrat implicite qui liait auparavant les salariés aux entreprises. »
Éloi Laurent place cette question dans une perspective plus large. Dans l’ouvrage « Nos mythologies économiques », cette problématique est explicitée dans la partie appelée « la mythologie néolibérale » et le point particulier qui a pour titre : « une économie de marché dynamique repose sur une concurrence libre et non faussée ».
« Le néolibéralisme connaît deux modalités fondamentales : il met alternativement en scène une économie asphyxiée par les régulations publiques et un État submergé par des marchés tout-puissants. Ces deux visions, en apparence contradictoires, sont aussi mythologiques l’une que l’autre : le marché n’existe que parce qu’il est régulé, et l’État en tire précisément sa puissance. […]
La vraie question, occultée par l’écran de fumée mythologique, est ailleurs : qui assume les risques et les coûts de l’économie de marché ? Qui en possède les rentes ? »
« […] L’union européenne est aujourd’hui simultanément la région du monde où le commerce est le plus régulé et celle où il est le plus développé (le marché unique européen représente à lui seul un tiers de ce que l’on nomme la « mondialisation »). Plus la régulation publique est forte, plus les marchés sont dynamiques. On voit bien ce paradoxe à l’œuvre dans les négociations actuelles, complexes et opaques, sur les traités commerciaux transatlantiques et transpacifiques : pour libéraliser, il faut réguler.
[…] La régulation publique du marché prend deux formes : l’intervention et la non-intervention, cette dernière étant souvent le pouvoir le plus puissant, à défaut d’être le plus visible. La fiscalité est certes un instrument majeur d’intervention publique, mais l’absence de fiscalité oriente tout autant, sinon davantage des comportements individuels. En France, le travail est lourdement taxé (pour financer les services publics et sociaux souhaités par les Français), ce qui peut décourager certaines décisions économiques, mais cette ingérence n’est rien face à l’encouragement des pollutions de toutes sortes qui résultent de la très faible fiscalité pesant sur l’usage des ressources naturelles. Si ces pollutions n’étaient pas subventionnées comme elles le sont, les consommateurs devraient en acquitter le véritable prix, et notamment payer le coût réel de l’extraction des ressources naturelles (dont le dommage environnemental se fait sentir en France et encore plus à l’étranger) ainsi que leur usage souvent dommageable pour la santé. Ce coût prohibitif, s’il n’était pas amorti par la puissance publique, aurait tôt fait de stimuler puissamment des comportements écologiquement responsables et la recherche d’alternatives économiques. La puissance publique peut certes encourager l’innovation, mais beaucoup plus sûrement encore la décourager. »
Cela nous amène à un point essentiel : les promoteurs du prétendu « libre » marché ne réclament absolument pas la fin de l’intervention publique dans l’économie, ils demandent simplement que celle-ci soit détournée en leur faveur ! En France, le MEDEF est parvenu ces dernières années à convaincre le gouvernement à la fois du caractère insupportable de l’intervention publique et de la nécessité absolue d’un transfert historique de cotisations sociales de 40 milliards d’euros des entreprises vers les ménages. Aux États-Unis, les milliardaires les moins scrupuleux (comme les frères Koch, qui possèdent aujourd’hui un véritable empire industriel) se sont faits un devoir de propager par tous les moyens le mythe de la libre concurrence tout en bénéficiant pour leur plus grand profit de centaines de millions de dollars d’exonérations d’impôts qui ne sont rien d’autre que des subventions publiques payées par les contribuables aux propriétaires du capital. Le « modèle économique » de ces « entrepreneurs » consiste à se spécialiser dans la captation des subventions publiques. […]»
Ces développements me font songer à cette réflexion de Henry Morgenthau, le secrétaire au Trésor américain de Franklin Roosevelt : « «Les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée, trop de citoyens veulent la civilisation au rabais» et que j’avais évoquée lors du mot du jour du Jeudi 21 mars 2013.
Éloi Laurent conteste le fait que l’État soit impuissant devant les marchés financiers. Il parle de fable. Il insiste sur le rôle central qui a été joué par la puissance publique dans la libéralisation financière des dernières décennies et le gain considérable qu’elle en retire au quotidien.
Il écrit :
« Le cas français est particulièrement éloquent. C’est la puissance publique en l’occurrence d’obédience socialiste, qui a organisé dans les années 1980 la libéralisation des marchés financiers, sur le territoire français et, par contrecoup, sur le continent européen, dans le but de financer sa dette publique sur les marchés ainsi rendus plus profonds. La mystification est complète lorsque, 30 ans plus tard, l’État français, à nouveau d’obédience socialiste, entend réduire sa dette publique et sabrer dans les dépenses sociales au nom d’impératifs qui lui seraient imposés par les marchés financiers !
S’il y a impuissance publique, elle est volontaire et réversible à tout moment. […]
De la même manière, la « crise » n’est en rien une illustration de l’impuissance de l’État, mais au contraire une saisissante révélation de sa toute-puissance : comme on l’a vu à l’automne 2008, notre système économique, sans la signature de l’État et sa garantie publique, se serait effondré en quelques semaines. La véritable question, ici comme ailleurs, est celle de la répartition des coûts : qui paye pour cette garantie apportée par l’État aux acteurs de l’économie, en priorité financiers, en période de récession ? Et pourquoi cette garantie ne bénéficie-t-elle pas ou plus aux autres acteurs du système économique, à commencer par les salariés ?
Derrière la question des coûts se cache donc celle des risques, et il semble bien que nous soyons passés en la matière, tandis que la mythologie économique faisait écran, d’une assurance sociale apportée aux travailleurs par la puissance publique (emploi, salaires, conditions de travail), de l’après-guerre jusqu’aux années 1980, à une garantie financière apportée aux banques et aux investisseurs depuis lors. La puissance économique de l’État est parfaitement intacte, elle a simplement été mise au service d’une autre cause que le progrès social. »
La puissance publique a été mise au service d’une autre cause que le progrès social !
C’est un peu brutal.
Dire que la puissance publique a accepté de reculer est exacte, mais il ne reste pas moins que la Politique a pour lieu d’expression des frontières nationales, alors que l’économie transcende ces frontières. Il apparait très compliqué de faire la révolution dans un seul pays, c’est-à-dire faire une politique qui remettrait en cause les positions acquises par les puissances financières et économiques au profit du plus grand nombre.
Il n’en reste pas moins que les questions initiales : Qui assume les risques et les coûts de l’économie de marché ? Qui en possède les rentes ?, sont fondamentales. Elles constituent une prise de conscience.
La solution doit être politique, mais elle est transnationale et doit se situer sur un territoire d’une dimension telle que la Politique puisse réellement discuter à armes égales avec l’Economie.
Dans l’idéal il faudrait que ce territoire soit le Monde, mais l’Union européenne constituerait une étape crédible.
Mais disposer, à ce niveau, d’un vrai consensus politique semble encore totalement hors de portée.
Il n’en reste pas moins qu’avant d’espérer arriver à ce stade, il faut être en capacité de déconstruire les mythologies qui sont à l’œuvre et les remplacer par d’autres plus orientées vers l’Humanisme et la préservation de notre mère nourricière : notre planète.
<902>
-
Lundi 12 juin 2017
« Nos mythologies économiques »Éloi LaurentJ’ai trouvé cet économiste tellement intéressant que, cette fois, j’ai acheté le livre dont il assurait la promotion lors de cette émission de France Culture du 16 novembre 2016 qui avait pour titre pertinent : « Comment sortir l’économie de la croyance ? ». Car c’est bien le centre de la question, l’économie se donne les apparences d’une science dure, d’une science du chiffre, de la rationalité, mais elle est avant toute chose une science sociale.
L’inoubliable, Bernard Maris disait : [l’économie] « C’est du jargon, c’est de la rhétorique, ce n’est pas de la science, c’est un peu de statistiques, c’est beaucoup de psychologie et pas mal de bavardages».
J’avais relaté ce propos dans le mot du jour du mardi 13 janvier 2015, quelques jours après son assassinat lors du carnage de Charlie Hebdo.<En mars 2016, Eloi Laurent avait été l’invité de Patrick Cohen à France Inter pour le même ouvrage>
Éloi Laurent, né en 1974 enseigne à Sciences Po. Il est aussi professeur invité à l’université Stanford ainsi qu’à Harvard. Il participe aussi à l’OFCE : Observatoire français des conjonctures économiques. Il possède donc des références sérieuses et sa parole peut être prise en considération même si elle peut et même doit être, bien sûr, contestée.
Dans le prologue de son livre « Nos mythologies économiques » il écrit notamment :
« L’économie est devenue la grammaire de la politique. […] Le politique parle de nos jours sous réserve d’une validation économique, et on le rappelle promptement à l’ordre dès que son verbe prétend s’affranchir de la tutelle du chiffre. Or cette grammaire économique n’est ni une science ni un art, mais bien plutôt une mythologie, une croyance commune en un ensemble de représentations collectives fondatrices et régulatrices jugées dignes de foi, aussi puissante que contestable.
Quelle est donc l’utilité de la mythologie économique ?
Qu’espère le politique en se soumettant à son empire?
Il croit vraisemblablement en tirer l’autorité qui, de plus en plus, lui file entre les droits. […]
Ce livre ne prétend pas rétablir la raison économique contre l’économie mythologique : il n’y a pas de vérité en économie. Il n’y a que des hypothèses en amont et des choix en aval, et, entre les deux, dans le meilleur des cas, une méthode et des instruments robustes. En revanche, il veut redonner aux lecteurs le goût du questionnement économique, dont la disparition progressive est lourde de menaces pour notre débat démocratique. »
Prologue (page 9 à 14 du livre)
Ce petit livre d’une centaine de pages, publié en février 2016, par l’éditeur : « les liens qui libèrent » est divisée en trois parties :
- 1 – mythologie néolibérale
- 2 – la mythologie sociale xénophobe
- 3 – la mythologie écolo sceptique
Chacune de ces parties est encore divisée en sous chapitres. Ainsi, la « mythologie néolibérale » comprend cinq points :
- une économie de marché dynamique repose sur une concurrence libre et non faussée
- Il faut produire des richesses avant de les redistribuer
- l’État doit être géré comme un ménage, l’État doit être géré comme une entreprise
- les régimes sociaux sont financièrement insoutenables
- les réformes structurelles visant à augmenter la compétitivité sont la clé de notre prospérité
Je développerai certains de ces points dans les prochains mots du jour.
Comme chaque fois, ces réflexions ne constituent pas la vérité, mais une vérité, un éclairage intéressant pour comprendre le monde et remettre en question le discours dominant qui prétend constituer une évidence, un consensus pour tous les gens raisonnables. Ce qu’Alain Minc a appelé « le cercle de la raison ». Ce qui aurait pour signification que tous ceux qui ne sont pas d’accord avec ce consensus sont forcément déraisonnables. Je ne conteste pas que certains discours, certains programmes politiques sont certainement déraisonnables. Mais tout ce qui remet en cause les pseudo évidences qui sont répétées à satiété par des économistes et des politiques qui prétendent à un discours de raison et d’intelligence, ne sont pas systématiquement en dehors du raisonnable et de la compréhension des forces d’intérêts qui sont à l’œuvre dans le monde aujourd’hui.
<901>
- 1 – mythologie néolibérale
-
Vendredi 9 juin 2017
« Retour sur les mots du jour du 801ème au 900ème (3 et fin)»RétrospectiveSouvent le mot du mot du jour aborde des sujets économiques. Quelquefois des sujets de fond comme celui évoqué par Louis Chauvel dans « La spirale du déclassement » ( jeudi 22 décembre 2016). Je reconnais que parfois ces mots et aussi les articles auxquels ils renvoient sont un peu longs. Après l’envoi de cet article mon ami Jean-François de Dijon m’a fait un reproche dans ce sens : « C’est pas gentil de m’envoyer des articles passionnants qui me détourne pendant 45 mn de mon travail…. ».
Souvent les réflexions que je mets en avant sont une contestation de la vision orthodoxe des économistes ou de la pensée dominante. Ainsi la contestation de la théorie du ruissellement qui prétend que pour que les gens modestes se portent mieux il faut permettre aux riches d’être de plus en plus riches. Il faut être honnête, il y eut un temps où cela n’était pas faux, mais la globalisation, l’automatisation et la financiarisation de l’économie ont rendu cette croyance vaine : « Trickle down Economic » ( mercredi 25 janvier 2017)
Beaucoup nous vante l’économie allemande mais Catherine Chatignoux nous explique qu’« Un salarié allemand sur quatre a un bas salaire, contre un sur dix en France » ( mercredi 1 février 2017).
Les orthodoxes continuent à « croire » à une vision Shumpeterienne de l’économie et à son concept de « destruction créatrice » mais de plus en plus d’économistes comme Christian Chavagneux ont des doutes : « Innovation Automatisation et emplois, et si cette fois c’était différent ? » ( jeudi 6 avril 2017)
Ces contestataires peuvent mettre en avant certains nouveaux emplois créés par le numérique et qui sont des « bullshit jobs » qu’on traduit en bon français par « boulots de merde » :«clickworkers ou les travailleurs du clic » ( vendredi 24 février 2017)
J’ai aussi, après avoir lu un article de l’hebdomadaire « Le Point », évoqué le concept de « La guerre civile globale » ( mercredi 22 février 2017) extrait de « Age of Anger » qui est un livre d’un romancier d’origine indienne, Mishra Pankaj qui serait l’essai le plus commenté, en début d’année 2017, dans le monde anglo-saxon et qui décrit comment l’économie crée des antagonismes au sein des sociétés et une grande colère de ceux qui estiment être les perdants de la compétition. Mishra Pankaj était l’invité des matins de France Culture, ce jour lors de l’émission réalisé à Londres, le lendemain des élections législatives britanniques : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-2eme-partie/pankaj-mishra-de-la-montee-des-populismes-la-guerre-civile .
Est évoqué de plus en plus souvent l’analyse de la fin de la rente de civilisation dont bénéficiait l’Occident au XIXème et XXème siècle et qui profitait à ses classes moyennes et populaires. Zaki Laïdi l’explique : «La mondialisation c’est la fin de la rente que l’Occident avait sur le monde depuis la révolution industrielle.» ( mardi 21 février 2017). Et Peter Sloterdijk dans l’article « [Cette élection] : voilà bien la preuve que la France possède encore un esprit ouvert à la surprise. » ( jeudi 11 mai 2017) explique la même chose.
Mais il n’y a pas que l’économie, l’Histoire est aussi inspirante. Nous sommes encore dans le centenaire de la première guerre mondiale et les cents ans de la bataille du chemin des dames ont conduit à rappeler «La Chanson de Craonne » ( mardi 18 avril 2017). Le cinéma fait aussi l’Histoire Thierry Frémaux a réalisé un documentaire sur le début du cinéma et a expliqué que « Le cinéma de Lumière avait pour fonction de dire qui nous sommes et ce qu’est le monde : c’est la même chose aujourd’hui » ( jeudi 16 février 2017)
Le billet quotidien peut aussi évoquer un récit, une personne ainsi de cette médecin qui avait vécu l’enfer dans son enfance à cause d’un père fou d’ambition et d’esprit de compétition : Céline Raphael «La Démesure» ( mercredi 21 décembre 2016) ou cette jeune artiste qui a brusquement été stoppée dans son ascension par un cancer : Marine de Nicola. « Le baiser de l’ouragan » ( vendredi 21 avril 2017) et qui évoque sa maladie comme un cadeau mal emballé qui lui a permis de murir et de grandir.
Depuis longtemps je portais l’idée de faire un mot sur « Le divertissement Pascalien » ( mercredi 17 mai 2017). Je l’ai réalisé au milieu de deux mots évoquant des émissions et un livre de Christophe André sur «La méditation en pleine conscience » ( lundi 15 mai 2017). J’ai particulièrement apprécié l’émission consacré à « Rien que » ( mardi 16 mai 2017)
Il est important de se rappeler aussi que les choses vont plutôt bien et qu’il y a des raisons d’espérer comme l’explique Johan Norberg «Ten Reasons to Look Forward to the Future Progrès : dix raisons de se réjouir de l’avenir» ( lundi 19 décembre 2016)
Lundi prochain, nous reprendrons le fil de nouveaux mots du jour.
<article sans numéro>
-
Jeudi 8 juin 2017
« Retour sur les mots du jour du 801ème au 900ème (2)»RétrospectiveComme d’habitude, dans cette série de mots du jour, plusieurs thèmes ont regroupé plusieurs articles. En général, ces thèmes durent une semaine.
Parfois comme pour les articles consacrés au « Sapiens » d’Hariri, c’est beaucoup plus long.
Ainsi, lors de cette série, un long moment a été consacré à Michel Serres et à plusieurs de ses ouvrages, principalement à « Darwin, Bonaparte et le samaritain ». Ces articles ont été envoyés entre le lundi 27 février 2017 et le vendredi 17 mars 2017.
Au cœur de ce livre qui distingue 3 âges, d’abord celui de l’apparition de la vie dans notre univers, le deuxième l’âge de la guerre et le troisième notre temps depuis la dernière guerre mondiale, se trouve ce constat de Michel Serres : « Le premier âge est plus long qu’on ne le croit ; Le deuxième pire qu’on ne le pense ; Le dernier meilleur qu’on ne le dit. » (mardi 7 mars 2017)
Cette fréquentation de l’œuvre et de la philosophie de Michel Serres m’a conduit aussi à deux digressions : la première pour évoquer le livre de Pascal Richet « L’âge du monde » (vendredi 3 mars 2017) qui relate la perception de l’âge de l’univers aux différentes étapes du développement des humains, et la seconde pour revenir sur le décryptage de « La parabole du bon samaritain » par Françoise Dolto (mercredi 8 mars 2017).
L’Histoire du Monde racontée par Michel Serres et qu’il appelle «Le Grand Récit » constitue une leçon d’intelligence. (jeudi 2 mars 2017)
Comme les deux pensées philosophiques finales : « Il n’y a pas qu’une vérité. Il y a des milliards de vérité» et « C’est le chemin le plus important.» mots des jeudi 16 mars 2017 et vendredi 17 mars 2017
La première semaine de mots du jour de 2017 fut consacrée au thème de la Paix.
En commençant par un ouvrage de Jean-Claude Carrière « La paix » (lundi 9 janvier 2017) pour finir par le livre de Belinda Cannone «S’émerveiller » (vendredi 13 janvier 2017)
Entre temps, j’avais évoqué le sombre destin de cet extraordinaire médecin obstétricien hongrois qui œuvra pour l’hygiène dans un grand climat d’hostilité (1818-1865) « Ignace Philippe Semmelweis » (mercredi 11 janvier 2017) et un article de la grande préhistorienne Marylène Patou-Mathis « Non, les hommes n’ont pas toujours fait la guerre » (jeudi 12 janvier 2017)
La semaine suivante, chaque mot du jour de la semaine était consacré à une photo réalisée en 2016 du lundi 16 janvier 2017 au vendredi 20 janvier 2017. La plus poétique étant celle du jeudi : « Homo sapiens d’hier et d’aujourd’hui : Solar Impulse survole les pyramides»
Et puis, sans être une thématique structurée et inscrit dans une semaine précise, beaucoup de mots du jour de cette série ont été consacrés à la présidentielle française dont le déroulement comme le résultat furent inattendus.
Si le plus souvent le mot du jour cite surtout des auteurs et leurs réflexions assorties de quelques commentaires de ma part, il m’arrive aussi de rédiger certains articles de manière plus personnelle. Il en fut ainsi d’un premier consacré à la « La cinquième République » (mercredi 8 février 2017) dans son ensemble. Puis un second consacré à « L’article 16 de la constitution » en particulier (mercredi 19 avril 2017).
Mais la présidentielle française conduisit les journalistes étrangers à poser des questions sur la France, questions dont Robert Zaretsky journaliste du Foreign Policy a fait la synthèse : « Why Is France So Corrupt ? » «Pourquoi la France est-elle si corrompue ?» (lundi 6 février 2017)
Cette présidentielle a montré que le clivage droite/gauche n’était plus aussi efficient que ce soit en France comme dans les autres pays occidentaux
C’est pourquoi l’article de Thomas Friedman dans le New York times « Web people vs wall people – Le peuple du web contre le peuple du mur», qui montrait qu’une partie des occidentaux est particulièrement à l’aise avec la mondialisation alors qu’une autre en a peur et veut s’en protéger, m’a paru particulièrement pertinent. (vendredi 14 avril 2017)
Cette présidentielle m’a conduit aussi à aller voir et à vous parler d’un documentaire que Régis Sauder a consacré à ma ville natale, particulièrement sensible aux sirènes du Front National : « Retour à Forbach » (jeudi 27 avril 2017).
Plusieurs fois j’ai fait appel, pendant cette période, à Edgar Morin qui fustige ces partis qui en appellent à la régression et à la xénophobie mais qui a des mots tout aussi durs pour le monde de l’argent roi et du libéralisme financier omnipotent : « Partout, deux barbaries se conjuguent, la vieille barbarie de la haine, du mépris, de la cruauté, et la barbarie glacée du calcul qui veut contrôler tout ce qui est humain. » (mardi 2 mai 2017)
Et je ne peux passer sous silence, cette intervention pleine d’énergie et de de passion de Fatou Diome lors de l’émission du Gros Journal de Canal + du 22 mars 2017 « Je crois à une France lumineuse qui se battra toujours pour ses valeurs. » (vendredi 5 mai 2017)
<article sans numéro>
-
Mercredi 7 juin 2017
« Retour sur les mots du jour du 801ème au 900ème (1)»RétrospectiveJ’avais débuté cette dernière série de 100 mots par une réflexion personnelle « Ce n’est qu’en tournant autour du pot qu’on peut en voir tous ses aspects !» qui a suscité des réactions étonnées et même réprobatrices.
L’existence du blog permet désormais de renvoyer systématiquement au mot concerné par un lien qui vous permet de le relire intégralement. C’était le mot du jeudi 8 décembre 2016
Donc surprise et réprobation, car dans le langage courant cette expression signifie la difficulté ou même la lâcheté de ne pas oser dire les choses clairement ou encore constitue une apologie de l’indécision. Mais ce n’est pas ce sens primaire que j’entendais donner à cette formule, mais bien la capacité de nuancer : tourner autour du pot permet d’observer le même pot sous différents éclairages.
Un jour, peut- être, j’essayerai de tourner autour du pot de la « dette » si présente dans le langage politique et économique contemporain.
Vous pouvez analyser la dette sous le regard de l’économiste classique : la dette est la conséquence d’un emprunt qui permet de différer le paiement d’un bien ou d’un service dont vous pouvez disposer immédiatement.
Et puis vous pouvez analyser la dette avec le regard du peuple allemand, ce peuple qui utilise dans sa langue le même mot pour dire « faute » et pour dire « dette », un mot du jour a été consacré à ce substantif germain : « Die Schuld » (lundi 4 novembre 2013). Pour les allemands, le prêt est avant tout une question de confiance, le prêteur prête parce qu’il a confiance en celui à qui il prête. Dès lors, envisager ne pas rembourser une dette constitue une trahison de cette confiance, une faute morale.
Et puis, vous pouvez suivre le regard de Paul Jorion qui vous expliquera que la dette c’est le fait que quelqu’un, qui dispose d’argent dont il n’a pas besoin, a prêté une somme d’argent à une autre personne qui en avait besoin et qui ne l’avait pas. La dette s’analyse de ce point de vue comme une mauvaise allocation des ressources dans le monde.
Vous pouvez aussi entendre l’analyse de David Graeber qui vous dira que l’expérience de l’Histoire montre que les très grosses dettes des Etats ne sont jamais remboursées. Soit la dette est annulée, soit l’inflation la réduit en peau de chagrin soit d’autres procédés sont mis en œuvre pour l’annihiler.
Le pot de la dette n’est pas simple à analyser, il ne peut se résumer à la seule vision allemande, ni à la seule vision « égalitaire » de Paul Jorion. Mais ces deux éclairages se fécondent et rendent davantage justice à la complexité du monde.
Notre Président a rendu populaire une expression qui exprime à peu près cette même nuance : « En même temps… »
Mais je m’égare, ce message avait pour objet de faire une rétrospective sur les 100 derniers mots du jour.
J’ai rapidement mise en œuvre cette faculté de tourner autour du pot en évoquant Fidel Castro qui venait de mourir.
D’abord en laissant Noam Chomsky expliquer que beaucoup de ce qui était arrivé à Cuba provenait de l’hostilité des Etats-Unis : «Imaginez ce que serait la situation aux États-Unis si, dans la foulée de son indépendance, une superpuissance avait infligé pareil traitement : jamais des institutions démocratiques n’auraient pu y prospérer. » (mercredi 14 décembre 2016)
Puis en rappelant un épisode rapporté par Jean Daniel, dans lequel Fidel Castro, après la crise des missiles, voulait exprimer un message de paix à John Kennedy et aux Etats-Unis : «Puisque vous allez revoir Kennedy, soyez un messager de paix. » (jeudi 15 décembre 2016. Hélas, cette invitation a été suivie quelques heures après par l’assassinat du Président Kennedy à Dallas, rendant cette proposition obsolète.
Mais j’ai aussi évoqué le cri de colère et de détresse d’Ileana de la Guardia, fille d’un des plus proches collaborateurs de Fidel Castro que ce dernier a fait exécuter pour de sombres manœuvres politiques, montrant ainsi la face sombre de ce régime : «On ne lui a même pas accordé un nom sur une tombe dans le cimetière de La Havane. Il est gommé de l’Histoire. Oublié, jeté dans la fosse commune. Comme les hérétiques du Moyen Âge. […] Aujourd’hui, je clame son nom, pour que jamais on ne l’oublie : Tony de la Guardia, mon père bien-aimé.» (vendredi 16 décembre 2016)
C’est encore dans cette recherche de la nuance que j’ai écrit l’article «« Des chiffres et des hommes » (lundi 30 janvier 2017) dans lequel j’essayais de montrer que si les chiffres sont indispensables pour décrire certaines réalités, la place qu’on leur donne aujourd’hui est exagérée et surtout perverse. Je concluais par cette phrase détournée de la Préface de La Dame aux Camélias (1848), d’Alexandre Dumas fils : « N’estime le chiffre ni plus ni moins qu’il ne vaut : c’est un bon serviteur et un mauvais maître ».
Cette mise au point était nécessaire après plusieurs mots consacrés à parler uniquement de l’aspect obscur du chiffre, notamment:
- Le concept du sociologue américain Pitirim Sorokin (1889-1968) «La quantophrénie» (jeudi 6 octobre 2016)
- Ou le thème développé par Alain Supiot : «La Gouvernance par les nombres» (vendredi 3 juillet 2015)
Et je conclurai la première partie de cette rétrospective par cette pensée d’une grande sagesse de Rachid Benzine : « Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes.» (mardi 24 janvier 2017)
Cette réflexion, qui se situe dans un échange entre un père et sa fille partie faire le djihad et qui est le sujet du roman de Rachid Benzine <Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?>, peut s’inscrire dans un contexte beaucoup plus large d’une compréhension du monde.
<article sans numéro>
- Le concept du sociologue américain Pitirim Sorokin (1889-1968) «La quantophrénie» (jeudi 6 octobre 2016)
-
Mardi 6 juin 2017
«Savoir, Savoir-faire, Faire savoir»Pierre Ferrari, Mon professeur de droit administratif à la faculté de droit de Metz (années 1982-1983)Pierre Ferrari était un excellent professeur de droit public. Je me souviens encore de ce conseil qu’il nous avait donné un jour au milieu de son cours : « «Savoir, Savoir-faire, Faire savoir»
Il faut d’abord acquérir le savoir et les connaissances. C’est le début, le commencement.
Nous sommes à l’heure des gens pressés et nous côtoyons souvent des personnes impatientes de « faire savoir » sans avoir pris le temps d’approfondir la première étape : le savoir qui est apprentissage, maturation et aussi expérience.
Mais le savoir ne suffit pas, il faut aussi le savoir-faire. Autrement dit la pratique. J’ai beaucoup aimé cette réflexion, un jour glané sur les réseaux sociaux : « Un jour j’irai vivre dans le monde de la théorie, dans ce monde tout se passe toujours bien ». Mettre en œuvre, voici la seconde étape.
Et puis on peut accéder à la 3ème étape : faire savoir.
Je vous l’avais écrit lors du précédent mot, vous lisez aujourd’hui le 900ème mot du jour. Vous êtes désormais plus d’une centaine de destinataires, encore tout récemment quelques esprits bienveillants se sont rajoutés à la liste.
Plusieurs m’ont conseillé de faire un blog qui semble un outil plus moderne pour diffuser quotidiennement ce billet qui essaye d’allier butinage, réflexion et pédagogie.
Je m’y suis refusé longtemps car j’aimais ce lien unique qui au-delà de la technique de diffusion revenait à écrire une petite lettre (quelquefois longue pourtant) qu’un nombre circonscrits de personnes que je connais et que j’apprécie reçoivent dans leur boite aux lettres virtuel, le matin avant de commencer leur journée.
Il faut être exact, de manière très limitée j’ai accepté qu’entre dans la liste des destinataires des personnes que je ne connaissais pas mais qui m’ont été recommandées par un abonné que je connaissais.
Certains m’ont dit qu’ils avaient institué une sorte de rituel de lire à leur réveil, à leur arrivée au travail ou en chemin dans les transports en commun le fruit de mon exercice quotidien.
Récemment notre ami commun, Google, nous a collectivement joué des tours en n’acheminant pas le message du matin ou avec beaucoup de retard. Sans aucune certitude je soupçonne notre ami de surveiller avec suspicion le nombre de destinataires de ces courriels. Vous savez que Google « offre » énormément de services gratuits aux particuliers. Il les offre parce que dans la relation commerciale subtile qu’il a créée. le particulier n’est pas un client, mais un produit. C’est nous, les particuliers, que Google vend à des professionnels.
Quand il soupçonne un particulier d’agir comme un professionnel, il va lui demander de passer à des services payants d’une manière plus ou moins explicite. Ceci m’a beaucoup contrarié. Mon fils Alexis me voyant dans l’embarras a alors pris les choses en mains.
Bien que la création de blog ne fasse pas partie de ses compétences et qu’il a la sagesse de savoir arrêter de faire de l’informatique après ses heures de travail, toutes entières consacrées à cette matière binaire, il a par affection accepté d’offrir de son temps et de son ingéniosité pour créer un blog dédié à mon mot du jour.
Et c’est le 6 juin, jour anniversaire du débarquement …d’Alexis dans la vie que je peux vous en annoncer la création.
Le domaine « lemotdujour.fr » avait été négligemment délaissé, j’ai donc pu l’acheter.
Désormais, chaque matin où un mot aura été écrit, l’article sera publié sur ce blog.
Grâce au travail d’Alexis tous les mots du jour déjà écrits sont présents sur cet espace. Tout n’est pas encore finalisé, car certains complétements manuels des articles doivent être réalisés. Mais ils sont tous accessibles.
Je continuerai à envoyer le mot par courriel, mais je n’ajouterai plus de destinataires à ma liste.
Celles et ceux qui considèrent que l’existence du blog rend inutile le message quotidien, voudront bien m’en informer, je les retirerais de la liste.
Et si vous vous attendiez à recevoir un message que vous ne recevez pas, il suffira alors d’aller sur la page d’accueil du blog.
Ce blog est public mais les commentaires sont modérés.
Vous êtes évidemment libre de donner l’adresse du blog à qui vous le souhaitez.
Mon souhait reste cependant que ce partage continue à se faire avec des personnes qui ne sont évidemment pas d’accord sur tout, heureusement, mais qui accepte le débat d’idées dans la bienveillance, le respect et l’argumentation.
Voici l’adresse : https://lemotdujour.fr
<900>
-
Mercredi 24 mai 2017
« Maman, tu es simplement jeune, depuis plus longtemps !»Laurine S.Mot du jour pour la fête des mères qui tombe cette année le dimanche 28 mai, au bout du pont de l’ascension.
Le plus souvent la relation d’une mère avec ses enfants est d’une grande intensité. C’est dans la nature des choses. Le début de notre existence se passe dans le corps de la mère. Pendant 9 mois il y a un partage absolu des sensations, des émotions, tout simplement de tout ce qui est vécu. Cette relation intime ne peut que déboucher sur un lien extrêmement fort. C’est au moins le cas, de loin, le plus fréquent.
Une mère ne peut alors que regarder l’épanouissement et la maturation de ses enfants avec un immense bonheur.
Par-delà cette expérience de la vie, il se peut de manière subtile et furtive que cette évolution puisse aussi amener la mère à sentir les années qui passent dans sa propre vie.
André et Lucie nous ont fait la joie de nous rendre visite lors du dernier été.
Et Lucie en évoquant cette sensation a rapporté cette magnifique parole de sa fille Laurine qui agit comme un baume, s’il est nécessaire : « Maman, tu es simplement jeune, depuis plus longtemps !».
Je me suis promis d’utiliser cette belle pensée pour la fête des mères.
Ce soir nous débutons donc le pont de l’ascension et avec Annie nous allons prendre quelques congés jusqu’au lendemain du lundi de la Pentecôte.
Le prochain mot du jour sera donc envoyé mardi 6 juin 2017.
Il s’agira alors du 900ème.
Le premier date du mardi 9 octobre 2012, quasi un quinquennat.
<899>
-
Mardi 23 mai 2017
«Il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace»DantonC’est le 2 septembre 1792 que Danton devant l’Assemblée Législative a prononcé ces paroles devenus célèbres.
La France révolutionnaire était très mal, attaqué de partout, Verdun était tombé aux mains des prussiens cette fois-là et Danton est monté à la tribune pour se lancer dans un discours enflammé qui finit par ces mots : «Il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ». Puis, le 20 septembre 1792, avec la bataille et la victoire de Valmy sur les Prussiens, l’armée française, commandée par le général Charles-François Dumouriez, a arrêté l’invasion.
Vous en lirez davantage sur cette page de l’Assemblée Nationale : <Danton 2 septembre 1792>
Le Président de la République nouvellement élu, Emmanuel Macron s’est exclamé dans son discours au Louvre :
« Oui ce soir nous avons gagné un droit, un droit qui nous oblige. Vous avez choisi l’audace. Et cette audace nous la poursuivrons. Et chaque jour qui vient nous continuerons à la porter, parce que c’est ce que les françaises et les français attendent. Parce que c’est ce que l’Europe et le Monde attendent de nous »
Ce passage du discours, vous le retrouverez (à 14:23) dans l’émission de France 5 « C Polémique », derrière ce lien : <ICI>
Le journaliste Bruce Toussaint se tourne alors vers Jacques Attali et lui pose cette question : « Moi je dirais que c’est du Attali non ? »
Jacques Attali se défend d’abord en disant « Je n’y suis pour rien dans tout ça », puis dit sa confiance en Emmanuel Macron qui appliquera enfin les réformes dont la France a besoin et que lui-même préconise depuis si longtemps. Il pense que Macron aura cette audace et raconte comment les prédécesseurs d’Emmanuel Macron réagissaient lorsqu’il leur demandait des réformes audacieuses : « Si je fais ce que tu dis, ils vont venir me couper la tête ». Il rappelle de manière malicieuse que si aucun n’a été décapité, ils ont tous été virés par les électeurs.
En résumé Jacques Attali pense que nous sommes enfin sur la bonne voie et qu’Emmanuel Macron est l’homme de la situation.
Mais après, Bruce Toussaint donne la parole à Edgar Morin qui est également invité dans cette émission. Et Edgar Morin tient un autre discours (17:00) dont je tente ci-après de vous donner la substance :
« La question de l’audace, c’est l’audace pour qui ? Pour quoi ?
Moi je crois que c’est quelqu’un qui est capable évidemment de faire des grandes choses. […]
Ce petit bonhomme tout seul, cette sorte de Tintin a fait sauter l’énorme édifice. Il n’y est pas arrivé tout seul, dès le début il a eu d’énormes ralliements. Il est arrivé à rassembler ces ralliements hétéroclites.
La question aujourd’hui est que ce côté hétéroclite va avoir une convergence ?
Est-ce qu’il va arriver à donner une convergence à ça ?
Il sera obligé de donner une voie, un chemin qu’il n’a pas encore donné.
Il reste dans le flou, peut-être qu’il aura intérêt à rester dans le flou.
Mais à supposer qu’il ait des véritables pouvoirs après avoir passé l’obstacle des législatives…
Reste à savoir, ce pays qui souffre, il a besoin d’une nouvelle voie, ce qu’il appelle la transformation.
Nous connaissons la direction qu’il faudrait prendre. Nous savons qu’il faut réduire le pouvoir du calcul, de l’argent. Nous savons qu’il faut profiter de problèmes écologiques [à surmonter] pour redonner de la santé, de la vitalité à notre société.
Nous savons qu’il faut donner de la véritable solidarité qu’il faut insuffler par tous les moyens possibles dans un monde où domine le pour soi et l’égoïsme.
Nous savons que la France n’est pas isolée dans le monde.
Il a d’ailleurs dit que le monde attend quelque chose de la France.
Il faudrait que la France renouvelle un message comme celui que Dominique de Villepin avait adressé à l’ONU, lors du refus de participer à la guerre en Irak.
Qu’on sente que la France existe autrement qu’à la remorque des Etats-Unis. »
Voilà ce que ce vieil homme de 95 ans dit avec passion au jeune Président de 39 ans :
L’audace pour qui, pour quoi ?
Dans quel sens allons-nous ?
Sommes-nous convaincus qu’il faut faire reculer le calcul et l’argent et redonner des lettres de noblesse à la solidarité contre l’égoïsme et l’individualisme forcené ?
Bien sûr il faut des réformes de fond, on ne peut continuer comme cela.
Mais quelles sont les valeurs en œuvre ?
Je partage les interrogations d’Edgar Morin.
Je redonne le lien vers l’émission : <ICI>
<898>
-
Lundi 22 mai 2017
« Pour nous c’est plus facile ! Moi, je fais un film quand je sens la crise venir, et vous, vous écrivez un roman. »Charlie Chaplin (lors d’un échange avec Georges SimenonNous sommes en plein festival de Cannes qui cette année a ouvert le 17 mai et finira le 28 mai.
Autour de mes 20 ans je lisais beaucoup Georges Simenon qui n’est pas, comme on le croit, un auteur de roman policiers mais un écrivain de la psychologie et des tourments de l’âme humaine. Wikipedia nous apprend qu’en 1941, Gide avait dit « Simenon est un romancier de génie ».
J’allais beaucoup au cinéma aussi et j’étais grand admirateur du cinéma italien et particulièrement de Federico Fellini.
En 1960, le Festival de Cannes avait réuni ces deux génies, le premier comme président du jury et le second comme compétiteur. Il semble que Georges Simenon a joué un rôle majeur dans l’attribution de la Palme d’or à « la dolce vita » de Federico Fellini.
Dans mes souvenirs, l’exergue de ce mot du jour était de Federico Fellini au cours d’un échange avec Simenon, lors de ce festival. Mais notre mémoire nous joue des tours. Je suis retourné à la source, un livre que j’avais acheté il y a bien longtemps et qui reprenait les entretiens d’une émission de la télévision française « Portrait Souvenir » diffusés le 30 novembre et les 7,14 et 21 décembre 1963.
Et si cette phrase a bien été prononcée, ce ne fut pas par Fellini mais par Charlie Chaplin. En toute hypothèse, elle est bien d’un immense créateur. Je vous livre le paragraphe entier :
« Nous [Charlie Chaplin et Georges Simenon] bavardions et nous disions que nous étions tous plus ou moins névrosés, que généralement les névrosés vont chez le psychanalyste, et Chaplin ajoutait : Pour nous c’est plus facile ! Moi, je fais un film quand je sens la crise venir, et vous, vous écrivez un roman. Alors en me tapant l’épaule : Mais nous, on nous paie pour cela, on nous paie pour nous soigner ! Au fond, c’est un peu la même chose. Je crois qu’on ne serait ni romancier, ni peintre, ni d’aucune profession si ce n’était pas une sorte de nécessité intime. »
Georges Simenon (entretien avec Roger Stéphane) page 141 publié en 1963.
Le dernier mot du jour racontait ce que pouvait vivre celui qui recevait l’œuvre créative, ici il est question de ce qui se passe chez le créateur. Ceci nous dit que l’art fait du bien à celui qui crée et à celui qui bénéficie de la création.
Pour la sortie du Casanova de Fellini, en 1977, l’Express avait demandé à Fellini de se prêter aux questions de celui qui était devenu son ami : Simenon. En 1993, l’Express a republié cet entretien et cet article se trouve toujours sur leur site.
La réponse de Fellini à la dernière question de Simenon était celle-ci :
« Vous et moi n’avons jamais raconté que des échecs. Tous les romans de Simenon sont l’histoire d’un échec. Et les films de Fellini? Que sont-ils d’autre? Mais, je veux vous le dire, il faut que j’arrive à vous le dire… Lorsqu’on referme un de vos livres, même s’il finit mal, et, en général, il finit mal, on y a puisé une énergie nouvelle. Je crois que l’art, c’est ça, la possibilité de transformer l’échec en victoire, la tristesse en bonheur. L’art, c’est le miracle… ? »
« L’art c’est le miracle », restons sur cette belle pensée.
<897>
-
Vendredi 19 mai 2017
« Vous avez la chance d’exercer un métier dont le but est de créer la beauté »Message aux musiciens de l’orchestre de Lyon après avoir assisté à un magnifique concert avec Hillary Hahn (Propos tenu initialement par le grand chef italien Carlo Maria Giulini)Rien que…
Le 29 avril 2017 nous avons assisté, avec Annie, à un concert à l’Auditorium de Lyon. C’était un concert consacré à deux œuvres de John Adams, compositeur américain qui était d’ailleurs présent dans la salle.
Au milieu de ces deux œuvres, la violoniste américaine Hillary Hahn a interprété le concerto de violon de Tchaïkovski avec l’Orchestre National de Lyon et Léonard Slatkin.
J’avais déjà entendu cette artiste que je considérais comme une bonne violoniste mais je ne m’attendais pas à ce niveau de qualité et d’émotion.
Les réseaux sociaux développent le pire, mais permettent aussi des choses positives.
J’ai pu exprimer mon enthousiasme sur la page facebook de l’Orchestre de Lyon :
« Ce soir moment de grâce avec Hillary Hahn qui jouait le concerto de violon de Tchaikovski avec L’ONL sous la direction de Léonard Slatkin.
Bien sûr il y a une technique sans faille et un son chaud et puissant mais il y a surtout la musicienne qui habite la partition, qui la transcende et remplit les auditeurs d’émotion et de joie.
En symbiose avec la soliste, Léonard Slatkin et le merveilleux orchestre de Lyon ont dressé un écrin somptueux dans lequel la soliste a su déployer son interprétation lumineuse.
Une des plus belles émotions musicales qu’il m’ait été donné de vivre. »
Mais comme j’ai aussi énormément apprécié l’orchestre qui a magnifiquement accompagné Hillary Hahn, j’ai alors posté un message pour les musiciens de l’Orchestre que je voudrais partager avec vous aujourd’hui.
« Aux musiciens de l’Orchestre
Je voudrais écrire ici un message de reconnaissance à tous les musiciens de l’Orchestre National de Lyon et leur directeur musical Léonard Slatkin.
Vous avez, comme l’avait dit Carlo Maria Giulini à ses musiciens du Los Angeles Philharmonic, alors qu’il y a tant de gens qui ont une profession pénible ou futile et quelquefois même vide de sens, la chance d’exercer un métier dont le but est de créer la beauté.
Cette beauté qui est présente jusque dans vos instruments : un violon est une véritable œuvre d’art.
Alors ma reconnaissance vient du fait que vous réalisez parfaitement cette quête de créer la beauté. […]
Hier j’ai entendu une artiste exceptionnelle, Hillary Hahn, j’avoue que je ne savais qu’elle pouvait être à ce niveau de musicalité et d’intensité. Je l’avais déjà entendu et je n’avais pas eu cette révélation.
Mais vous l’orchestre avait été exceptionnel, et je voulais vous l’écrire. Tous les solistes des vents, les cordes, les cuivres les bois vous avez été à un niveau extraordinaire qui ont fait de cette interprétation quelque chose de magique.
J’ai quasi 60 ans, ce que j’ai entendu hier, je le mets au panthéon de mes émotions musicales au niveau de la 8ème de Bruckner que j’avais entendu avec Celibidache et sa Philharmonie de Munich ou le quintette en ut de Schubert par les Alban Berg et Heinrich Schiff.
Les mots sont faibles, on tombe rapidement dans les superlatifs, il suffit probablement de dire que mon temps et mon existence ont été remplis par cette beauté, tout simplement que cela fait immensément du bien.
Je suis abonné depuis 6 ans et j’entends que vous réussissez de mieux en mieux dans votre quête de la beauté.
Léonard Slatkin est le catalyseur qui a permis cela, sa complicité avec Hillary Hahn, son goût pour Tchaïkovski ont bien sûr étaient un atout considérable dans l’accomplissement de l’interprétation.
Vous êtes des femmes et des hommes comme les autres, vous avez vos joies mais aussi vos difficultés, vos doutes mais n’oubliez jamais le bien que vous faites aux autres. Vous nourrissez les âmes et les cœurs.
Voilà pourquoi je tenais à vous dire ma reconnaissance. »
Ce que j’essaie d’exprimer dans ce message, c’est qu’il y a d’une part la perfection technique et la capacité de créer de l’émotion, mais surtout que l’art, et la musique particulièrement, peuvent faire du bien à tout notre être. Il faut cependant que pour arriver à ce résultat, nous soyons en capacité d’être totalement présent.
Rien que…
Rien qu’écouter et se laisser pénétrer par la musique.
Sur le Web j’ai trouvé, mais avec une piètre qualité technique, le troisième mouvement du concerto évoqué, dans la même distribution, Hillary Hahn, Orchestre National de Lyon et Slatkin, en 2011 à Lucerne :
<Concerto violon Tchaikovski 3ème mouvement Hahn Orchestre de Lyon Slatkin en 2011>
Si vous souhaitez écouter cette œuvre avec une autre magnifique artiste et dans des conditions techniques correctes : <Janine Jansen Philharmonie de Paris chef d’orchestre Paavo Jarvi en janvier 2015>
Mais pour retrouver Hillary Hahn, voici un petit extrait de Bach par cette artiste : <La gigue de la 3ème Partita de Bach à Frankfurt le 9 décembre 2016>
En décembre 2016, Hillary Hahn était déjà venu à Lyon, mais le concert où nous devions nous rendre avait été annulé en raison de la grève des personnels techniques. Et Hillary Hahn avait organisé une rencontre originale dans un bar lyonnais, qu’elle avait intitulé l’apéro tricot. Elle avait invité des personnes à venir faire du tricot pendant qu’elle jouait du violon. Vous trouverez un court extrait derrière ce lien : <Concert Apéro Tricot avec Hilary Hahn>
Hillary Hahn a enregistré en 2011 le concerto de violon de Tchaïkovski mais pas avec l’orchestre de Lyon
<896>
-
Jeudi 18 mai 2017
« Pour qu’une chose se termine, il faut qu’une autre chose commence – et les commencements, c’est impossible à voir»Christian BobinChristian Bobin est un écrivain né en 1951 et c’est avec cette citation de Christian Bobin que Christophe André finit ses 40 émissions ou chapitres de 3 minutes à méditer.
Et Christophe André écrit : « J’aime beaucoup cette phrase, mais il est aussi possible de dire exactement l’inverse : « Pour qu’une chose commence, il faut qu’une autre se termine » »
Christophe André parle bien entendu de sa série d’émissions.
Mais on pourrait appliquer cela à bien d’autres choses…
Peut-être même à ce qui se passe dans notre pays en ce moment ?
Pour la méditation en pleine conscience, Christophe André écrit encore :
« C’est beau, les choses qui se terminent.
C’est beau, les crépuscules.
Mais ce qu’il y a de plus beau encore ce sont les aurores. »
Je vous redonne le lien vers cette série d’émissions et le livre.
-
Mercredi 17 mai 2017
« Le divertissement Pascalien »Blaise PascalEntre 1976 et 1979, je me suis égaré dans les classes de mathématiques supérieures au Lycée Kléber de Strasbourg.
Mon professeur de mathématiques de Terminale, M Wilhem, m’avait prévenu ainsi que tous mes camarades qui envisageaient le même choix après le baccalauréat : « Vous êtes fous de vouloir aller là-bas ».
A la fin de ces 3 années qui furent clôturées par un échec cinglant, j’ai lu l’avis du grand professeur de mathématiques Laurent Schwartz que je cite de mémoire sans trahir sa pensée : « Cette sélection des ingénieurs par les concours des classes préparatoires est absurde. C’est comme si pour sélectionner des futurs médecins vous organisiez un concours de musique et que vous décidiez que les meilleurs à cette sélection seraient aptes à devenir médecin »
Laurent Schwartz (1915-2002) était un esprit autorisé pour exprimer son avis sur ce point : il était l’un des grands mathématiciens français du XXe siècle, le premier de ceux-ci à obtenir la médaille Fields, en 1950 et professeur emblématique à l’École polytechnique de 1959 à 1980, il avait été élève en classes préparatoires et avait intégré à l’issu de cette période l’Ecole Normale Supérieure.
Il voulait exprimer l’idée que ce que les étudiants apprenaient pendant ces 2 ou 3 années (selon qu’on redoublait la seconde, ce qui fut mon cas) ne leur servirait que très peu pour leurs futures fonctions professionnelles, l’essentiel de ce qui était appris devait servir à nourrir les épreuves qui permettraient la sélection par voie de concours.
Ces trois années furent assez pénibles mais ce que je conserve particulièrement en mémoire est une œuvre littéraire et philosophique.
Chaque année, deux œuvres littéraires étaient étudiées. La première année ce fut d’une part les petits poèmes en prose de Baudelaire et surtout les Pensées de Pascal qui m’impressionnèrent énormément et m’apprirent surtout beaucoup de leçons de vie.
On sait que cette œuvre de cet autre grand mathématicien a pour objet central la foi et la croyance en Dieu.
Mais il y avait bien d’autres réflexions comme celle-ci par exemple
« Quand on veut reprendre avec utilité, et montrer à un autre qu’il se trompe, il faut observer par quel côté il envisage la chose, car elle est vraie ordinairement de ce côté-là, et lui avouer cette vérité, mais lui faire découvrir le côté par où elle est fausse. » (Pensée N°9)
C’est une autre façon de « tourner autour du pot » comme j’aime exprimer cette manière d’analyser des concepts ou des faits par des regards différenciés.
Pour ma compréhension des humains ce qu’il m’a appris en priorité c’est son explication du besoin de divertissement de l’homme, ce qu’on résume par le concept de « divertissement pascalien »
La Pensée N° 139 est toute dédiée à ce concept de divertissement.
Une des premières phrases marquantes souvent citées est celle-ci :
« Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre »
Un peu plus loin dans ce chapitre se trouve ce développement :
« Tel homme passe sa vie sans ennui en jouant tous les jours peu de chose. Donnezlui tous les matins l’argent qu’il peut gagner chaque jour, à la charge qu’il ne joue point, vous le rendez malheureux. On dira peutêtre que c’est qu’il recherche l’amusement du jeu et non pas le gain. Faitesle donc jouer pour rien, il ne s’y échauffera pas et s’y ennuiera. Ce n’est donc pas l’amusement seul qu’il recherche, un amusement languissant et sans passion l’ennuiera, il faut qu’il s’y échauffe et qu’il se pipe luimême en s’imaginant qu’il serait heureux de gagner ce qu’il ne voudrait pas qu’on lui donnât à condition de ne point jouer, afin qu’il se forme un sujet de passion et qu’il excite sur cela son désir, sa colère, sa crainte pour l’objet qu’il s’est formé, comme les enfants qui s’effraient du visage qu’ils ont barbouillé.
D’où vient que cet homme, qui a perdu depuis peu de mois son fils unique et qui accablé de procès et de querelles était ce matin si troublé, n’y pense plus maintenant ? Ne vous en étonnez pas, il est tout occupé à voir par où passera ce sanglier que les chiens poursuivent avec tant d’ardeur depuis six heures. Il n’en faut pas davantage. L’homme, quelque plein de tristesse qu’il soit, si on peut gagner sur lui de le faire entrer en quelque divertissement, le voilà heureux pendant ce tempslà. Et l’homme, quelque heureux qu’il soit, s’il n’est diverti et occupé par quelque passion ou quelque amusement qui empêche l’ennui de se répandre, sera bientôt chagrin et malheureux. Sans divertissement il n’y a point de joie.
Avec le divertissement il n’y a point de tristesse. Et c’est aussi ce qui forme le bonheur des personnes de grande condition qu’ils ont un nombre de personnes qui les divertissent, et qu’ils ont le pouvoir de se maintenir en cet état. »
Dans la pensée 143, Pascal montre que ce choix du divertissement occupe l’homme tout au long de sa vie et prend toutes les formes : les affaires, l’apprentissage, les soins, et toutes ces choses qui occupent l’esprit.
« On charge les hommes, dès l’enfance, du soin de leur honneur, de leur bien, de leurs amis, et encore du bien et de l’honneur de leurs amis. On les accable d’affaires, de l’apprentissage des langues et d’exercices, et on leur fait entendre qu’ils ne sauraient être heureux sans que leur santé, leur honneur, leur fortune et celle de leurs amis soient en bon état, et qu’une seule chose qui manque les rendrait malheureux. Ainsi on leur donne des charges et des affaires qui les font tracasser dès la pointe du jour – Voilà, direz-vous, une étrange manière de les rendre heureux ! Que pourrait-on faire de mieux pour les rendre malheureux ? – Comment ! ce qu’on pourrait faire ? Il ne faudrait que leur ôter tous ces soins ; car alors ils se verraient, ils penseraient à ce qu’ils sont, d’où ils viennent, où ils vont ; et ainsi on ne peut trop les occuper et les détourner. Et c’est pourquoi, après leur avoir tant préparé d’affaires, s’ils ont quelque temps de relâche, on leur conseille de l’employer à se divertir, à jouer, et à s’occuper toujours tout entier. »
Dans la pensée 171 il donne l’explication centrale, mais pas encore finale. Nous nous divertissons pour éviter de songer à nous. Nous occupons, nous remplissons notre cerveau de choses plus ou moins futiles pour que l’essentiel ne trouve pas de place :
« La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant c’est la plus grande de nos misères. Car c’est cela qui nous empêche principalement de songer à nous, et qui nous fait perdre, insensiblement. »
La pensée suivante rattache toutes ces réflexions sur le divertissement au « Rien que » de Christophe André :
« Nous ne tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l’avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours; ou nous rappelons le passé, pour l’arrêter comme trop prompt: si imprudents que nous errons dans des temps qui ne sont pas nôtres, et ne pensons pas au seul qui nous appartient ; et si vains que nous songeons à ceux qui ne sont rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. » (172)
La pensée 166 donne l’explication finale, le divertissement est ce que l’homme a inventé pour ne pas à avoir à penser à sa finitude :
« Divertissement – la mort est plus aisée à supporter sans y penser, que la pensée de la mort sans péril »
Pourquoi avons-nous tant besoin de faire tant de choses, d’activités ?
Pourquoi est-il si compliqué pour certains de se poser, simplement gouter le moment présent et vivre l’instant. Vivre l’instant, vivre la relation ou la solitude. Vivre l’échange ou se pacifier dans le silence ?
Le silence cher à Alain Corbin qui est si compliqué aujourd’hui à obtenir. Beaucoup sont drogués à ce besoin de bruit de fond : la radio ou la télévision sont allumés en permanence alors même qu’on n’écoute pas, qu’on ne regarde pas mais qu’il y a quelque chose qui remplit le silence.
L’explication de ce besoin de faire toujours quelque chose se trouve dans le divertissement pascalien qui en d’autres mots est une fuite.
Quand on se retrouve, faut-il faire quelque chose ou simplement se poser pour échanger ?
Et quand on est seul, faut-il toujours aller vers de multiples occupations ou simplement ne rien faire ou faire une seule chose, « Rien que »…
C’est sur ces questions que je vous laisse aujourd’hui.
Vous trouverez de larges extraits des Pensées sur ce site : http://www.croixsens.net/pascal/section11.php
Et aussi sur celui-ci : http://www.penseesdepascal.fr/Divertissement/Divertissement4-moderne.php
-
Mardi 16 mai 2017
« Rien que »Christophe André, une des émissions de la série « 3 Minutes à méditer »Toutes les émissions de cette série dont j’ai parlé hier m’ont intéressé, mais celle qui a ma préférence est celle que Christophe André a intitulé « Rien que ».
Parce que je crois qu’il y a dans cette toute petite expression : « Rien que » un enseignement de vie fondamental.
C’est particulièrement vrai dans l’échange, l’échange à deux…rien que …davantage que disponible, être présent, présent à l’autre. C’est une discipline que je tente toujours de m’appliquer.
Parfois, je m’y efforce aussi quand je marche dans la rue, regarder les gens que je croise, la nature ou la ville, le ciel et les nuages, être présent dans l’instant. Non pas penser à ce qui va se passer dans une heure, dans une semaine, dans un mois etc., vivre le moment entièrement… rien que.
Quand j’écoute la musique que j’aime, je suis particulièrement attentif, sans toujours y arriver il est vrai, à simplement écouter, embrasser intégralement le son, reconnaître les instruments, les thèmes, les détails. Ne pas laisser les pensées s’échapper vers d’autres pensées et préoccupations. Elles viendront bien assez tôt, rien que me nourrir de la musique.
Christophe André cite Montaigne :
« Quand je danse, je danse; quand je dors, je dors ; et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. »
Il commence le chapitre consacré à « Rien que » de la manière suivante :
« Il y a une imposture contemporaine qui m’agace, c’est celle du cerveau multitâche. Certains vendeurs d’écrans voudraient nous faire croire que dans notre nouvel environnement très sollicitant (écrans et téléphones, multiconnexion et musique à flots), notre cerveau aurait évolué et serait capable de faire plusieurs choses en même temps : travailler ou lire en écoutant la radio, téléphoner en conduisant, etc.
Cela arrivera peut-être un jour, dans quelques dizaines de milliers d’années. En attendant, ça ne fonctionne pas : chaque fois que nous faisons deux choses en même temps, d’une part, nous les faisons moins bien et d’autre part, cela nous fatigue et nous stresse. L’équation est simple : multitâche = risque d’erreur + risque de stress.
C’est sans doute pour cela que de tout temps, les sages, comme Montaigne, comme les maîtres orientaux, ont encouragé la pratique régulière du « rien que » : rien que manger, rien que marcher, rien que lire, rien que conduire…
Malgré les apparences, le « rien que » est difficile : nous avons souvent la tentation de faire plusieurs choses en même temps : manger en lisant, parcourir ses mails en téléphonant ou de faire quelque chose en pensant à autre chose :prendre sa douche en pensant à sa journée de travail, être à table en famille en songeant à ses soucis. Ainsi, on fait tout en pleine absence et non en pleine conscience. On se fatigue, on commet des erreurs, des oublis…
http://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter/rien-que
-
Lundi 15 mai 2017
«La méditation en pleine conscience »Christophe AndréLes 12 derniers mots du jour concernaient la politique, avec simplement une respiration le lendemain du débat calamiteux du second tour de la présidentielle avec le poème d’Eluard «Et un sourire ».
La période est particulière, il est vrai.
Mais il me semble qu’il faut aussi savoir s’extraire des contingences de l’actualité, prendre du recul, s’élever peut être, en tout cas savoir s’extraire de la pression du quotidien.
L’été dernier, Christophe André avait, sur France Culture, fait chaque jour une émission qu’il a appelé 3 minutes à méditer que j’ai écoutée avec beaucoup d’intérêt et de plaisir. J’ai même téléchargé toutes ces émissions et je les ai réécoutées avec mon lecteur mp3. Annie a d’ailleurs fait de même.
Toutes ces émissions se trouvent toujours derrière ce lien : https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter
En février 2017 un livre reprenant ces émissions a été publié avec quelques ajouts et un CD reprenant l’ensemble de ces émissions.
L’expression « La méditation en pleine conscience » n’a pas été inventée par Christophe André qui n’a pas non plus inventé cette pratique.
En introduction de son livre il écrit :
La méditation est une pratique très ancienne. Voilà plus de 1500 ans que l’on médite, en Orient comme en Occident. Aujourd’hui, elle connaît un engouement qui tient à plusieurs facteurs : nous disposons de méthodes de méditation laïques (pas besoin d’embrasser telle ou telle religion pour la pratiquer), faciles d’accès (on peut s’y initier en huit semaines environ, sans qu’il s’agisse d’une approche au rabais) et dont les bénéfices ont été confirmés par de nombreuses études scientifiques ».
Il explique son itinéraire personnel qui l’a conduit à la méditation :
« Je suis médecin psychiatre, spécialiste des troubles émotionnels, c’est-à-dire es maladies liées au stress, à l’anxiété, à la dépression.
Je me suis d’abord orienté vers leur traitement, par les médicaments, et, surtout, par les thérapies cognitives et comportementales, qui consistent à associer des mises en situation concrètes aux discussions avec le thérapeute.
Puis je me suis peu à peu intéressé à la prévention de leurs rechutes, car dans ces troubles émotionnels, les récurrences sont, hélas, très fréquentes : les patients doivent apprendre à réguler leurs émotions durant toute leur existence, c’est-à-dire à introduire dans leur quotidien des modifications durables de mode de vie, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de vivre. Cela concerne l’alimentation, l’exercice physique, mais aussi leur style psychologique : leur façon de voir le monde, de traverser leurs émotions, de rencontrer les moments de bonheur et les moments d’adversité. C’est dans ce cadre que j’ai commencé à utiliser la méditation de pleine conscience avec mes patients.
Une précision importante : la pleine conscience est la méthode de méditation que nous utilisons aujourd’hui dans le monde des soins. Elle est d’origine bouddhiste mais a été modifiée et laïcisée pour être utilisée dans des contextes de soins (je n’ai rien contre le bouddhisme, au contraire, mais nous n’utilisons tout simplement pas d’approche religieuse pour soigner). […]
À titre personnel, la méditation a joué un rôle très important dans ma vie. Si je vous en parle, c’est parce que mon histoire, me semble-t-il, est proche de celle de beaucoup d’autres personnes. J’avais peut-être quelques facilités : j’étais un enfant contemplatif, avec le goût du silence et de la solitude. Mais en grandissant, j’ai oublié cette dimension, pris par les rythmes et habitudes de la vie adulte : agir et réa gir, s’agiter et entreprendre. Puis j’ai traversé un drame personnel. Car l’on vient rarement à la méditation par hasard ou par simple curiosité. Il y a toujours en amont des souffrances à alléger, des problèmes à résoudre. Je me souviens d’une collègue qui, lors d’un séminaire, demandait : « Y a-t-il quelqu’un, ici, qui n’a aucun problème, aucune souffrance ? » Personne ne lève le doigt, bien sûr. Puis elle relance le public : « Et parmi celles et ceux qui ont des problèmes, qui préfère les garder tels quels plutôt que les alléger ou les résoudre ? » Pas davantage de doigts levés. Chaque humain connaît la souffrance, et chaque humain souhaite en être soulagé. Un drame personnel, donc : la mort de mon meilleur ami dans mes bras, après un accident de moto. Choqué, j’ai pris refuge dans un monastère près de Toulouse, dont m’avaient parlé plusieurs de mes patients, qui allaient s’y retirer pour s’apaiser. J’y ai découvert la vie contemplative, le recueillement, le silence, l’oraison. Je me souviens que ce n’était pas évident au début ; j’avais perdu l’habitude de ne rien faire et de ne pas fuir mes épreuves dans l’action ou la distraction. J’étais dans une situation personnelle douloureuse, j’arrivais avec des tas de souffrances. Les premiers jours, je me confrontais à des montées d’angoisse et de détresse, des doutes sur ce que ma présence ici pouvait m’apporter. Exactement ce que vivent beaucoup de nos patients, lors des premières sessions de méditation… Puis en persévérant, cela s’est doucement décanté. J’ai fait l’expérience d’une transformation intérieure, alors qu’à l’extérieur, le monde n’avait pas changé : c’est moi, mon regard, qui s’étaient modifiés. Je suis sorti du monastère avec le pressentiment que j’avais vécu quelque chose d’important qui allait m’être précieux, et vital. […]la méditation est sans doute l’outil psychologique qui m’a apporté le plus sur un plan personnel. Elle m’offre par exemple une très grande aide dans les moments de détresse émotionnelle : ils sont désormais moins intenses, moins durables. De sorte que je sais mieux affronter les mauvais passages et l’adversité. Elle m’a aussi apporté une aptitude à mieux savourer les bons moments, à comprendre qu’il ne suffit pas que les sources de bonheur possible soient là, mais qu’il faut leur ouvrir son esprit, leur accorder de l’attention, leur ouvrir son cœur. Qu’il ne faut pas se contenter de regarder le ciel ou une fleur en passant, mais s’arrêter, ne serait-ce que quelques secondes, respirer, savourer l’instant que nous vivons… »
Et pour commencer, la première émission comme le premier chapitre de son livre s’intitule : <Le souffle>
Car la première étape est de se centrer sur sa respiration, respiration par le nez non par la bouche. Il s’agit du moyen le plus puissant pour se connecter à l’instant présent.
Respirer profondément et se concentrer sur ce souffle qui révèle que nous sommes en vie et qui va nous permettre, en étant attentif, à la fois de prendre conscience de notre corps, de notre environnement et de l’instant présent.
En exergue de ce chapitre il cite Lamartine : « Je chantais, mes amis, comme l’homme respire, Comme l’oiseau gémit, comme le vent soupire (…) »
Je ne peux que vous conseiller d’essayer comme l’écrit Christophe André : « Prendre plusieurs fois dans la journée le temps de respirer, seulement respirer, en pleine conscience, pendant deux ou trois minutes… »
-
Vendredi 12 mai 2017
« Un monopoly amélioré »Invention de l’Observatoire des inégalitésAujourd’hui je vous propose un jeu.
En fait il s’agit d’une vidéo montrant des enfants jouant à un jeu bien connu, mais avec des règles particulières.
Je vous renvoie vers cette vidéo que vous trouverez derrière ce lien : http://www.videobuzzy.com/Quand-des-enfants-jouent-au-Monopoly-avec-des-regles-injustes-14445.news
Je vous la décris brièvement :
Des enfants sont installés autour d’une table pour jouer au Monopoly.
Mais il y a un maître du jeu qui fixe les règles :
Une moitié des joueurs commencent le jeu avec 1500 euros, l’autre avec 750.
Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début du jeu
Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison.
Etc..
Vous comprenez.
Les enfants protestent, disent c’est injuste, ça ne va pas. Mais le jeu continue.
En fait ce n’est pas un jeu.
C’est ainsi que cela se passe dans la vraie vie !
La séquence a été réalisée par l‘Observatoire des inégalités, un organisme indépendant qui collecte des données et des statistiques sur les inégalités sociales pour les rendre public.
Peut-être qu’ainsi il est plus facile d’appréhender la réalité du monde, du marché libre et concurrentiel où tout le monde a sa chance…
Cela ne contredit pas le mot du jour d’hier et les réflexions de Slotedijk, cela les complète.
-
Jeudi 11 mai 2017
« [Cette élection] : voilà bien la preuve que la France possède encore un esprit ouvert à la surprise. »Peter Sloterdijk
Peter Sloterdijk est un philosophe et essayiste allemand né en 1947. Il est d’usage de voir en lui une figure importante de la pensée européenne.
Le Point lui donne la parole pour réagir à l’élection de notre jeune président. Sa pensée n’a pas pour vocation d’être consensuelle mais d’apporter un éclairage décapant et qui peut sans doute heurter quelques sensibilités de gauche. Mais on ne peut progresser qu’en entendant et en comprenant des pensées alternatives qui nous obligent à sortir de notre quiétude de pensée et nos certitudes indolentes.
Vous trouverez cet article derrière ce lien : <Les français ont choisi Macron pour se renouveler eux-memes>
J’en livre quelques extraits :
« [Cette élection] : voilà bien la preuve que la France possède encore un esprit ouvert à la surprise. Ce qui est déjà un constat remarquable dans un pays où politique et administration se sont confondues depuis cinquante ans et où tout se réglait, précisément, par l’élimination de la surprise : partis puissants, candidats ayant fait carrière dans ces outils en place que la philosophe Simone Weil voulait d’ailleurs, notons-le, supprimer chez vous dès la Seconde Guerre mondiale. « Si on confiait au diable l’organisation de la vie publique, il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux », écrivait-elle de ces appareils à reproduire le même… Ce qu’on peut déduire du succès du « marcheur » Macron, c’est que les Français eux-mêmes ont compris que la France ne pouvait pas continuer dans cette voie sans issue.
[…] Du point de vue psychopolitique, c’est une personnalité qui fonctionne comme un émetteur-récepteur : c’est un collecteur de rayons de soleil et de séismes encore peu perceptibles dans le pays, ces « grands événements » qui « arrivent toujours sur des pattes de pigeon », comme disait Nietzsche. Macron me semble incarner le désir de la majorité des Français de sortir de cet état de dépression et d’hystérie qui caractérise les hommes et les femmes de l’Hexagone depuis un bout de temps. Ils l’ont choisi, lui, un représentant si frais, si neuf, afin de pouvoir se renouveler eux-mêmes. […]
Lors d’une émission de radio j’ai entendu cette réflexion d’un commentateur qui m’a interpellé : « Cette campagne pénible et déprimante a finalement accouché d’un vainqueur optimiste »
Mais ce philosophe ose des éclairages s’appuyant sur l’Histoire européenne plus ancienne. Car rappelons que la Réforme n’a pas pu s’imposer en France et que Louis XIV a rompu avec l’Edit de Nantes de Henry IV ce qui a eu pour conséquence de faire fuir les protestants français hors de France pour enrichir la Suisse, la Prusse et aussi les Pays Bas. Max Weber avait théorisé un lien étroit entre le développement du capitaliste libéral et le protestantisme.
« L’élection de Macron pourrait être une réponse inconsciente à l’expulsion des protestants par Louis XIV, qui a fermé à la France la voie de la Réforme. Aujourd’hui, on parlerait « des » réformes… C’est le même mot. La France a oublié que le catholicisme a concentré un énorme pouvoir politique et idéologique jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le catholicisme a été le troisième élément dans le trio infernal des antilibéraux qui a marqué l’histoire du XXe siècle, le national-socialisme et le communisme étant les deux autres pôles. En France, on a cru éliminer le catholicisme en le remplaçant par une laïcité acharnée, mais l’attitude antilibérale restait intacte. Vous aurez noté que la Conférence des évêques de France a refusé d’appeler à voter expressément contre le Front national, et encore moins pour Macron. Les démons de l’antilibéralisme sont encore en embuscade. Mais la tragédie de la France remonte à un passé plus profond. Dans ce pays, il a toujours existé deux peuples différents qui malheureusement portent le même nom : les Français enfants de la Révolution et les autres Français, enfants de la France catholique éternelle. La grande force de De Gaulle, c’était d’avoir réconcilié ces deux peuples français. Aujourd’hui, les effets de la réconciliation se délitent, et c’est sans doute pour cela que l’ensemble du petit monde politique, chez vous, en appelle aux mânes de votre Général et prétend même enfiler son costume mythique, au risque de le salir. Oui, c’est cette rupture que l’on sent encore aujourd’hui faire gémir et convulser le pays, et c’est beaucoup plus profond que le clivage gauche-droite, qui n’est pas totalement obsolète mais qui représente, pour moi, plutôt une « façade » folklorique.
Il exprime ensuite des mots très durs pour Mélenchon dont il dit :
« La touche personnelle de Mélenchon, c’est son invention d’un national-anarchisme, et son antigermanisme primaire, son programme économique d’un romantisme vénézuélien qui mise sur un miracle économique artificiel par l’explosion de la dette publique, sa haine de l’argent même gagné par le travail, ce ne sont pas des traits révolutionnaires, mais plutôt fascisants ! Et je ne parle pas, chez ce fonctionnaire issu du cercle des courtisans de Mitterrand, de son narcissisme hologrammique, »
Et puis il explique avec ses mots sa vision de l’Europe et de la France quant à l’ultralibéralisme qui est exagéré et nous renvoie à notre difficulté de perdre ce qu’il appelle notre « rente de civilisation. »
« Soyons réalistes ! L’Europe continentale n’a jamais été ultralibérale, et encore moins la France, qui est une nation profondément étatisée reposant sur une fiscocratie ultraperformante. Avec un taux de prélèvements obligatoires de 44 % du PIB, il serait tout simplement aberrant de prétendre que le néolibéralisme est au pouvoir. L’agitation contre le néolibéralisme prétendument dominant n’est qu’une ruse de la rhétorique de gauche pour aller encore plus loin dans la direction du semi-socialisme réel. Le populisme de gauche et de droite qui sévit en France et dans le reste de l’Europe est l’expression d’un ressentiment devant la perte d’un certain nombre de privilèges qui ont été ceux de l’Européen des classes populaires depuis les années 1950. On profitait d’une sorte de « rente de civilisation » qui faisait que, quand on naissait en France ou en Allemagne, on avait des avantages considérables sur un compétiteur né en Inde ou en Chine. À l’époque, des ouvriers peu qualifiés pouvaient se permettre une maison, une voiture, une famille. On pourrait dire, à un moment précaire et intenable de l’évolution économique, qu’on se faisait payer pour le simple fait d’être français ou allemand. Comme le maître de Figaro chez Beaumarchais, on ne s’est longtemps donné que la peine de naître… au bon endroit ! Avec le progrès de la mondialisation, la rente européenne se dissout. Les masses se mettent en colère contre leurs dirigeants, qui ne peuvent rien au fait que les autres nous rattrapent. L’anomalie de la rente de civilisation va disparaître peu à peu, c’est dans la logique des choses, même si vous me dites que vous êtes insoumis.
Tant mieux, mais expliquez : insoumis à quoi ? À la compréhension de la situation globale. »
Et il finit par une citation de Goethe :
« Notre sage de Weimar, le vieux Goethe, avait remarqué, le 8 mai 1830, face à un savant polonais : « La nation française est la nation des extrêmes; elle ne connaît en rien la mesure. Équipé d’une énergie puissante, morale et physique, le peuple français pourrait soulever le monde s’il découvrait un point d’appui ; mais il ne semble pas savoir que, lorsqu’on veut soulever de lourdes charges, on doit trouver leur centre de gravité. » Alors, Français, encore un effort si vous voulez être à la hauteur de l’époque ! » »
-
Mercredi 10 mai 2017
« Le choc des légitimités »Autres réflexions et regards sur cette présidentielle qui vient de s’acheverMon neveu Grégory qui a répondu au mot du jour d’hier avec cette constatation étonnée : « le président est plus jeune que moi ! » avait eu cette belle formule, il y a 5 ans à propos de François Hollande : « Il faut laisser sa chance au produit »
Cinq ans plus tard, la chance est passée…
Nous repartons donc avec un nouveau produit pour 5 ans !
Je vais tenter une analyse froide, neutre de ce qui me semble être la problématique de fond de ce qui va suivre dans notre vie politique nationale.
Emmanuel Macron avait émis deux critiques sur la manière dont François Hollande avait conduit la réforme du code du travail dite « Loi El Khomri » : La première critique était qu’elle arrivait trop tard dans le quinquennat et la seconde qu’elle n’avait pas été annoncée lors de la campagne présidentielle. Et il expliquait que les électeurs de François Hollande pouvaient se sentir trahis parce qu’on ne leur avait rien dit et que dans leur esprit ils ne l’avaient pas élu pour ça.
Sur le fond Emmanuel Macron considère qu’il faut aller beaucoup plus loin dans la dérégulation du droit du travail en permettant de très larges marges de manœuvre au niveau de la négociation dans l’entreprise.
Mais en pleine cohérence avec sa critique de François Hollande, il a, dans sa campagne, annoncé très rapidement qu’il voulait faire évoluer le code du travail dans le sens qu’il souhaitait. En outre, pour aller plus vite il prévoyait de réaliser cette loi par voie d’ordonnances.
Ce qui signifie que l’assemblée nationale donne l’autorisation au gouvernement dans un domaine précis et dans un cadre défini d’écrire la Loi dans le détail, ce qui est normalement du seul ressort du pouvoir législatif. Une fois la loi écrite, le Parlement doit vérifier si le domaine et le cadre ont été respectés et ratifier les ordonnances. Il y a donc bien intervention du parlement, mais le travail de fond et bien sûr les débats qui sont la raison d’être du Parlement lui ont totalement échappé.
Emmanuel Macron considère que le problème principal de la France est le chômage de masse et que l’assouplissement des contraintes du droit de travail constitue une solution essentielle à ce problème.
Il n’a jamais varié sur ce point.
Les Français l’ont élu. Ils ne pouvaient ignorer qu’au centre de son projet il y avait cette réforme à réaliser en toute urgence. Il a voulu être élu pour faire cela, il n’a trompé personne. Devant les demandes explicites de Jean-Luc Mélenchon de renoncer à cette réforme ou au moins de renoncer de la faire par la procédure des ordonnances comme prix ou compromis pour qu’il appelle à voter pour lui, le futur Président a encore répondu négativement.
Il est donc totalement légitime de mettre en œuvre cette réforme puisqu’il a été élu.
Mais face à cette légitimité, celles et ceux qui refusent cette réforme en opposent une autre en expliquant qu’au premier tour Emmanuel Macron n’a obtenu que 24% des voix et qu’une grande partie de ces électeurs n’ont pas fait un vote d’adhésion mais un vote d’évitement : éviter que face à la candidate d’extrême droite se trouve un candidat dont il voulait encore moins que Macron.
Le second tour étant quant à lui un véritable vote de rejet de l’autre candidate et d’aucune manière une approbation du programme proposé par notre jeune Président.
Il y a donc choc des légitimités.
Mais comment reprocher à Emmanuel Macron de vouloir appliquer le programme qu’il a annoncé et qui selon lui règle une grande part du problème qui est posé à la France à savoir le chômage de masse.
Comment sort-on d’une telle contradiction ?
Très simplement en allant voter aux élections législatives et non pas en s’abstenant comme cela s’est toujours passé lors des épisodes précédents de ce feuilleton qui n’existe qu’en France où il faut voter 4 fois avant d’avoir un pouvoir exécutif et législatif en capacité de fonctionner. Ce feuilleton auquel s’ajoutent 2 autres tours si on participe à des primaires.
Donc il faut voter aux législatives :
Si vous voulez qu’Emmanuel Macron puisse mettre en œuvre le programme auquel il croit, il faut voter pour la ou le candidat qui soutient le Président.
Si vous voulez le contraire, il faut voter pour la ou le candidat qui veut le contraire.
Et après cet exercice démocratique, le choix des français s’imposera dans un sens ou dans l’autre.
-
Mardi 9 mai 2017
« Tu te sens très vieux le jour où tu t’aperçois que le président de la République a 20 ans de moins que toi »Réflexions personnelles après l’élection de dimancheLa première fois que j’ai eu conscience de la politique c’était en 1969, j’étais un très jeune enfant, et les français avaient élu Georges Pompidou qui évidemment m’apparaissait très vieux.
En 1974, j’avais 16 ans et je n’avais pas le droit de vote mais je me suis très intéressé à cette bataille électorale.
A partir de 1974, jusqu’en 2007, c’est-à-dire 33 ans, donc pour l’instant plus de la moitié de ma vie, la Présidence de la République a été accaparée par 3 hommes Giscard d’Estaing né en 1926, Mitterrand né en 1916 et Chirac né en 1932.
Même si Giscard est arrivé au pouvoir jeune, à 48 ans, il était beaucoup plus vieux que moi. Le plus jeune des 3 avait 26 ans de plus que moi.
Mitterrand et Chirac, lors des grandes cérémonies mondiales étaient souvent les vieux de ces aréopages.
En 2007 et 2012, les élus devenaient davantage mes contemporains, Sarkozy était né 3 ans avant moi et Hollande 4 ans.
Tout ceci était fort raisonnable, je ne m’attendais donc pas en 2017 à une telle rupture générationnelle.
D’ailleurs Emmanuel Macron, sera le benjamin lors du prochain G20.
Les politiques français ne m’avaient pas préparé à un tel choc, et le monde n’était pas habitué que la France puisse apparaître aussi jeune.
Jusqu’à présent c’était eux qui se moquaient de notre incapacité à renouveler notre personnel politique.
Mais maintenant avec un Président de 39 ans, c’est la France qui fait rayonner sa jeunesse.
Tony Blair est devenu premier ministre anglais à 44 ans, comme David Cameron.
Comme José Zapatero, premier ministre espagnol à 44 ans, battu par son prédécesseur José Maria Aznar 43 ans.
Le premier ministre canadien Justin Trudeau l’est devenu à 44 ans aussi.
Et c’est finalement en Italie qu’on trouve Matteo Renzi qui était devenu premier ministre à 39 ans.
Mais maintenant la France peut dire, nous avons élu un président de 39 ans.
Sa jeunesse est un atout, il peut certainement mieux comprendre le monde du XXIème siècle que ceux qui sont restés dans leurs schémas du XXème siècle !
Saura t’il pour autant trouver les voies pour réconcilier les français et faire évoluer l’Europe dans le sens de la protection de ses habitants ?
Ce sont des défis énormes, il faut bien l’enthousiasme et l’énergie d’un jeune homme brillant et cultivé de 39 ans pour espérer s’approcher de ces objectifs.
-
Vendredi 5 mai 2017
« Je crois à une France lumineuse qui se battra toujours pour ses valeurs. »Fatou Diome lors de l’émission du Gros Journal de Canal + du 22 mars 2017Mon ami Philippe a mis en lien sur facebook cet extrait du Gros Journal de Canal+ où le journaliste Mouloud Achour reçoit l’écrivaine et universitaire franco-sénégalaise Fatou Diome et lui pose la question : « Vous avez peur de Marine Le Pen ou pas ? »Et qu’elle répond : « Je n’ai peur d’elle, c’est elle qui a peur de moi ! »Cette réponse déclenche un fou rire chez le journaliste. Quand le journaliste arrive enfin à se calmer et demande à Fatou Diome d’expliquer, cette dernière se lance dans un plaidoyer remarquable, prononcé d’une seule traite, qui conduit le journaliste à rester en suspens et puis effacer une larme à l’œil.Fatou Diome, c’est cette femme noire qui a été découverte par la France entière alors qu’elle était invitée par Frédéric Taddei à l’émission de France 2, le 24 avril 2015, après un nouveau naufrage à Lampedusa de migrants cherchant refuge en Europe : http://www.dailymotion.com/video/x2o4vivDans cette émission elle se lance aussi dans une harangue qui cloue le bec à ses contradicteurs et elle dit notamment :« Ces gens-là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c’était des blancs, la terre entière serait en train de trembler ! Mais là, ce sont des noirs et des arabes (…) Si on voulait sauver les gens, on le ferait, mais on attend qu’ils meurent d’abord ! Et on nous dit que c’est dissuasif, mais ça ne dissuade personne, car celui qui part pour sa survie, considère que sa vie (qu’il peut perdre lors du voyage) ne vaut rien, celui-là n’a pas peur de la mort !”A la réponse d’un invité sur l’importance de fermer les frontières pour éviter l’arrivée massive de migrants, Fatou Diome a présenté l’homme “blanc” comme un poisson rouge : « Monsieur, vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse Européenne ! A l’heure d’aujourd’hui, l’Europe ne sera plus jamais épargnée, tant qu’il y aura des conflits ailleurs dans le monde (…) Alors il faut arrêter l’hypocrisie, on sera riche ensemble ou on se noiera tous ensemble ! »Vous trouverez un article de l’Humanité où elle répond à un entretien après cette émissionMais revenons à sa réponse à Mouloud Achour où elle explique qu’elle n’a pas peur de Marine Le Pen :« Non je n’ai pas peur d’elle !Vous savez le rejet a toujours peur de l’amour.Moi je suis une fille, je suis venu en France par amour. Donc rien, aucune haine, aucun rejet ne me fera rejeter la France.Et quand vous dites cela, vous faites peur aux sectaires, vous faites peur aux populistes.Parce que moi, quand je dis cela, je m’accroche aux lumières européennes.Quand je dis cela, je dis vos idées ténébreuses ne peuvent pas enterrer Montesquieu.Vos idées ténébreuses ne feront pas enterrer Marianne.Vos idées ténébreuses n’empêchent pas que cette République a mis Marie-Antoinette au trou et Victor Hugo au Panthéon, il y a des raisons à cela.L’amour est plus fort que la haine.Et la culture est toujours plus forte que l’ignorance.Je crois à une France lumineuse qui se battra toujours pour ses valeurs.C’est pour cela que je la respecte.Et je la somme de me donner une preuve que tout ce qu’elle m’a enseigné est absolument véridique.Je la somme de me montrer qu’elle est à la hauteur de son histoire lumineuse et humaniste.[…]Je veux que la France de Victor Hugo me dise que le simple rejet des misérables d’aujourd’hui ne justifie pas le racismeLa liberté gagné à la guerre, cette liberté-là n’est pas que pour que les enfants blancs de Marianne.Cette liberté là c’est pour tous les enfants de Marianne et tous ceux qui sont morts au front pour la défendre et pour la léguer à leurs enfants.Je suis une de ces enfants »Le journal l’Humanité, déjà cité, raconte son histoire :Fatou Diome est une enfant de l’amour et du scandale. Ses parents avaient (?) 18 ans, ils s’aimaient et n’étaient pas mariés. Elle naît en 1968 à Niodior, (?) une île de pêcheurs du Sénégal. Élevée par sa grand-mère, Aminata, sa référence, elle fréquente l’école en cachette et devra se débrouiller pour aller au collège.Commencent les petits boulots, elle n’a pas encore 14 ans.Fatou veut être professeur de français. Elle va à l’université de Dakar. En 1994, elle arrive en France, suivant l’homme qu’elle aime et a épousé. Rejetée par sa belle-famille, elle divorce et poursuit ses études à l’université de Strasbourg. À nouveau les galères: ménages, gardes, cours … pour payer son agrégation ? de français et sa thèse de lettres.En 2001, Fatou publie un recueil de nouvelles, « la Préférence nationale».Elle connaît la consécration, dès 2003, avec son premier roman, « le Ventre de l’Atlantique », traduit dans plus de 20 langues. « Je n’étais pas une femme de ménage devenue écrivain, j’étais une étudiante qui faisait des petits boulots », répond-elle à ceux qui veulent faire de son parcours un conte de fées.Si vous voulez voir l’émission du Gros journal de Canal dans son intégralité : http://www.dailymotion.com/video/x5fpitw_le-gros-journal-avec-fatou-diome-l-integrale-du-22-03-canal_tvElle vient de publier un nouveau livre dont parle l’émission de Canal + : <Marianne porte plainte !>, il est paru en mars 2017Voilà ce que j’avais envie d’écrire comme mot du jour avant le vote du 7 mai 2017.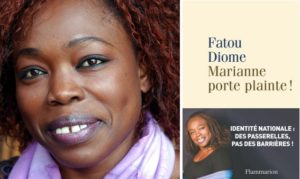
-
Jeudi 4 mai 2017
«Et un sourire»Paul EluardPour mot du jour d’aujourd’hui, un poème d’Eluard.«La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin
une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie la vie à se partager.»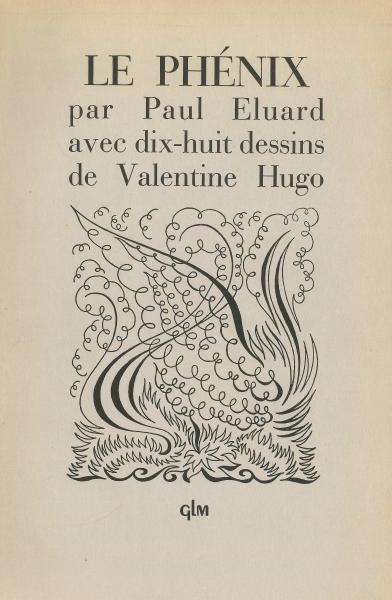 Et un sourirePaul ÉLUARDRecueil : « Le Phénix »Ce fut le poème que Jean-Luc Melenchon déclama à la fin de son dernier meeting avant le premier tour des présidentielles 2017.C’est ce poème qui me vient à l’esprit après le chaos (1) du débat d’hier soir.(1) Il s’agit du débat d’entre deux tours entre Emmanuel Macron et la représentante de l’extrême droite qui a donné à ce moment une teneur très médiocre.<886>
Et un sourirePaul ÉLUARDRecueil : « Le Phénix »Ce fut le poème que Jean-Luc Melenchon déclama à la fin de son dernier meeting avant le premier tour des présidentielles 2017.C’est ce poème qui me vient à l’esprit après le chaos (1) du débat d’hier soir.(1) Il s’agit du débat d’entre deux tours entre Emmanuel Macron et la représentante de l’extrême droite qui a donné à ce moment une teneur très médiocre.<886> -
Mercredi 3 mai 2017
« C’est […] en Emmanuel Macron que s’expriment le mieux les affres d’une époque mourante mais qui ne veut pas mourir. »Frédéric LordonHier, j’ai fait appel à un vieux sage, Edgar Morin, pour parler de cette élection qui fait l’objet de toutes les conversations du moment.Aujourd’hui, je vous livre les réflexions d’un plus jeune philosophe, moins apaisé qu’Edgar Morin mais déployant aussi une réflexion riche et assez loin de la pensée dominante des technocrates : Frédéric Lordon.Ce n’est pas la première fois que je le cite.Frédéric Lordon sur son blog du Monde diplomatique a écrit le 12 avril une chronique : <Macron, le spasme du système>Le grand mot d’ordre de cette élection est d’être contre le « système ».Ils se présentent d’ailleurs tous contre le système.Je commence par une anecdote : j’ai vu lors d’une émission de télévision Rachida Dati répondre simplement à la question, Connaissez-vous Emmanuel Macron ?, « Oui nous avons un ami commun : Jean-Pierre Jouyet. »Jean-Pierre Jouyet est né à Montreuil en 1954, il a fait l’ENA dans la fameuse promotion Voltaire : Hollande, Royal, Villepin et quelques autres.Il est un ami de François Hollande et il est maintenant son principal collaborateur comme secrétaire général de la présidence de la République.Avant cela, il fut Secrétaire d’État aux Affaires européennes du gouvernement de François Fillon entre 2007 et 2008, puis président de l’Autorité des marchés financiers de 2008 à 2012. Il a occupé ensuite les fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et de président de la banque publique d’investissement (BPI) entre 2012 et 2014.J’en avais fait le sujet principal du mot du jour du 9 octobre 2014 « La Bourgeoisie d’Etat » à la suite de la lecture d’un article du Monde de de Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin consacré au couple Jouyet : Jean-Pierre Jouyet et son épouse Brigitte Taittinger issue de la famille champenoise célèbre dans le monde entier. Je remets, une seconde fois, en pièce jointe, cet article.Lors de ce mot du jour j’écrivais : « Cet article qui rapporte des faits et des comportements, des amitiés et des connivences, des trahisons et des réconciliations, provoque chez le citoyen de base que je suis comme un malaise. Le fait que l’élite, quel que soit son bord politique, discute entre elle peut paraître plutôt positif. « Chez les Jouyet, les soirs d’élections, que la gauche ou la droite l’emporte, on trouve toujours une moitié de convives pour fêter la victoire au champagne rosé… Taittinger. »Mais il y a autre chose qui se dégage, un entre soi, un groupe homogène qui vit comme en autarcie.Ils n’ont pas l’air méchant, plutôt affable et sympathique. Mais vivent-ils ou ont-ils le sentiment de vivre un destin commun avec les français que nous sommes ? Ou vivent-ils ailleurs ? »Je fais cette incise pour vous rappeler ou vous apprendre qu’Emmanuel Macron avait intégré en 2004, à l’issue de ses études à l’ENA, le corps de l’Inspection générale des Finances (IGF). Et…Celui qui dirigeait cette honorable maison était M Jean-Pierre Jouyet.Wikipedia nous apprend qu’il va devenir le protégé de cet homme affable à l’aise avec les femmes et hommes du système de droite et les femmes et hommes du système de gauche et aussi du centre…Il sera son vrai mentor.Et c’est probablement grâce à Jean-Pierre Jouyet, alors dans le gouvernement de Fillon/Sarkozy qu’il est nommé, en août 2007, rapporteur adjoint de la fameuse Commission pour la libération de la croissance française dite « commission Attali ». Attali deviendra aussi un de ses principaux soutiens.<Jacques Attali qui avait prophétisé, dans l’Express le 17/09/2015 : le prochain président sera un inconnu>. En septembre 2015, Macron n’était ministre de l’économie que depuis 1 an.Existe-t’il une meilleure institution que l’Inspection des Finances qui puisse symboliser le fameux « Système français » ?En 2004 Ghislaine Ottenheimer leur avait consacré un livre : « Les Intouchables » : grandeur et décadence d’une caste : l’Inspection des Finances, Albin Michel, 2004Mais revenons à Frédéric Lordon, la chronique dans son entier est longue et touffue (comme d’habitude). Elle se trouve <ICI> :Je vais essayer d’en picorer quelques extraits particulièrement incisifs :««Je vais être très clair »… Probablement ignorant des logiques élémentaires du symptôme, Emmanuel Macron semble ne pas voir combien cette manière répétitive de commencer chacune de ses réponses trahit le désir profond de recouvrement qui anime toute sa campagne. « Entre le flou et le rien, continuez de baigner », voilà ce qu’il faut entendre en fait à chacune de ses promesses de clarté.[…] la plupart des candidats finissent par s’accommoder de ce long et mauvais moment à passer, et que le mensonge de campagne est un genre bien établi qui ne devrait plus rien avoir pour surprendre quiconque. Le problème pour Emmanuel Macron prend cependant des proportions inédites car il ne s’agit plus simplement de faire passer en douce une ou deux énormités, fussent-elles du calibre de « la finance, mon ennemie » : c’est sa campagne dans son intégralité, et jusqu’à sa personne même comme candidat, qui constituent une entreprise essentiellement frauduleuse. […]C’est pourtant en Emmanuel Macron que s’expriment le mieux les affres d’une époque mourante mais qui ne veut pas mourir. Il était certain en effet qu’un monde pourtant condamné mais encore bien décidé à ne rien abandonner finirait par se trouver le porte-voix idoine, l’individu capable de toutes les ambivalences requises par la situation spéciale : parler et ne rien dire, ne rien dire mais sans cesser d’« y » penser, être à la fois parfaitement vide et dangereusement plein. […][…] il fallait en effet impérativement un candidat du vide, un candidat qui ne dise rien car ce qu’il y aurait à dire vraiment serait d’une obscénité imprésentable : les riches veulent rester riches et les puissants puissants. C’est le seul projet de cette classe, et c’est la seule raison d’être de son Macron. En ce sens, il est le spasme d’un système qui repousse son trépas, sa dernière solution, l’unique moyen de déguiser une continuité devenue intolérable au reste de la société sous les apparences de la discontinuité la plus factice, enrobée de modernité compétitive à l’usage des éditorialistes demeurés. […]De là ce paradoxe, qui n’en est un que pour cette dernière catégorie : Macron, auto-proclamé « anti-système » est le point de ralliement où se précipitent, indifférenciés, tous les rebuts du système, tous les disqualifiés qui se voyaient sur le point d’être lessivés et n’en reviennent pas d’une telle faveur de la providence : la possibilité d’un tour supplémentaire de manège. […]Il faudra bien en effet toute cette entreprise de falsification à grande échelle sous stéroïdes médiatiques pour recouvrir comme il faut l’énormité de ce qu’il y a à faire passer en douce : politiquement le pur service de la classe, « techniquement » l’intensification de tout ce qui a échoué depuis trois décennies. Ironie caractéristique de l’hégémonie au sens de Gramsci, le parti de ceux qui se gargarisent du « réalisme » se reconnaît précisément à ceci que son rapport avec la réalité s’est presque totalement rompu, alors même qu’il parvient encore invoquer la « réalité » comme son meilleur argument.À l’époque du néolibéralisme, « réalisme » nomme la transfiguration continuée de l’échec patent en succès toujours incessamment à venir. Ce que la réalité condamne sans appel depuis belle lurette, le « réalisme » commande non seulement de le poursuivre mais de l’approfondir, donnant pour explication de ses déconvenues qu’elles ne sont que « transitoires », qu’on « n’est pas allé assez loin », qu’on s’est contenté de « demi-mesures » et que la « vraie rupture » est toujours encore à faire – et ça fait trente ans que ça dure. La parfaite identité argumentative dans ce registre entre Fillon et Macron devrait suffire à indiquer où le second se situe réellement et, de son « de droite / de gauche », quel est le terme surnuméraire. […]Ainsi les traités de libre-échange, européens et internationaux, s’ils détruisent la base industrielle et disloquent des régions entières, ont-ils surtout l’insurpassable avantage de tenir le salariat en respect par la pression concurrentielle et la menace permanente de la délocalisation. L’eurozone fait montre des mêmes excellentes propriétés disciplinaires quoique par des voies différentes, il importe donc de n’y surtout pas toucher : la fermeture organisée de tous les degrés de liberté des politiques économiques ne laisse plus que l’instrument de « la dévaluation interne », c’est-à-dire de l’ajustement salarial par le sous-emploi, pour tenter de survivre dans le jeu idiot de la compétitivité (et en fait d’y périr presque tous) — mais c’est cela même qui la rend désirable. Le « réalisme » étant affranchi depuis longtemps de toute réalité, il tient pour rien le désastre social qui s’en suit, mais n’omet pas au passage d’encaisser, sur les gravats, les bénéfices réellement poursuivis — que de variations possibles autour du « réel »… —, à savoir la mise au pas des salariés.La facticité générale commande cependant de feindre le mouvement. On ira donc donner un entretien à Libération pour expliquer qu’en Europe la meilleure stratégie du changement, c’est de ne rien changer : « la France ne peut entraîner l’Allemagne que si elle a une crédibilité sur le plan économique et financier». Comprenons : pour obtenir de l’Allemagne l’autorisation de faire autre chose, il faut d’abord lui montrer que nous sommes décidés à ne rien modifier. Laurent Joffrin, entièrement séduit par « l’originalité » de la méthode Macron qui consiste à perfectionner deux décennies à se rouler par terre en s’aplatissant davantage encore, commente : « Commençons par donner des gages de bonne gestion et de sages réformes, alors nous pourrons demander des concessions». Oui, commençons par ramper, c’est ainsi que nous apprendrons la liberté — bonheur parfait de la rencontre d’une complexion et d’une idéologie. »Si vous voulez tout lire, je vous redonne le lien : <Macron, le spasme du système>Je mesure bien que les destinataires de ce mot, électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, sont convaincus par cette lecture.Que celles et ceux qui au contraire se méfient de Mélenchon ou même l’abhorrent, sont scandalisés.Mais qui peut prétendre que l’analyse de Frédéric Lordon ne rencontre pas une grande part de la réalité du monde ?Il y a cependant un point qui ne me convainc pas dans cette analyse, car Lordon ne parle que de la responsabilité de l’élite oligarchique, alors que nous sommes aussi grandement responsables.Nous aimons tellement consommer des objets technologiques, des voyages, des loisirs et toutes ces choses que le système nous vend que nous ne pouvons-nous exonérer trop rapidement du système.Personne n’a contraint des milliards de terriens d’acheter des smartphones pour le plus grand bénéfice d’Apple, de Samsung, de Foxconn.Ce n’est pas non plus suite à un complot ou un pistolet sur la tempe que des millions de gens modestes, pour la plus grande part, payent cher pour aller au stade voir jouer des millionnaires qui courent après une balle de foot ou s’abonnent à des chaines télés payantes ou encore achètent à des prix fous des maillots ou d’autres colifichets de leurs idoles de cette nouvelle religion des temps modernes. Ce n’est que parce qu’il y a des consommateurs qui achètent tout cela qu’il existe des footballeurs millionnaires et des agents de joueurs qui le sont aussi.Je me souviens d’avoir lu Raymond Aron dans les années 80 qui disait à peu près : tout se passe comme si nous étions dans un véhicule qui va de plus en plus vite vers quelque chose qui nous effraie mais que nous ne savons arrêter.Lordon n’exprime pas la vérité, il donne une part de vérité. Nous avons à l’entendre aussi pour approcher la complexité de la réalité du monde. -
Mardi 2 mai 2017
« Partout, deux barbaries se conjuguent,
la vieille barbarie de la haine, du mépris, de la cruauté,
et la barbarie glacée du calcul qui veut contrôler tout ce qui est humain. »Edgar MorinEdgar Morin est un de nos plus grands penseurs contemporains.Il est né le 8 juillet 1921, vous pouvez calculer il a 95 ans, presque 96.Wikipédia le définit d’abord comme le penseur de la complexité.Il fut un grand résistant. C’est à cette époque qu’il a pris le nom de Morin, car son nom de naissance est Nahoum, il est d’origine juive séfarade, descendant d’un père commerçant juif de Thessalonique.Le journal Le Monde vient de publier un entretien avec cet homme qui m’inspire beaucoup : « Cette élection est un saut dans l’inconnu » que vous trouverez en pièce jointe.Il ne fait aucun doute que cet homme profondément humaniste, votera sans ambigüité pour Macron.je trouve particulièrement intéressant la deuxième partie de cet entretien, lorsqu’il répond à la question du journaliste : « Quels sont les grands problèmes et les grands thèmes absents de cette campagne ? »« Le premier grand absent est le monde qui nous enveloppe et nous emporte dans des conflits et des régressions qui s’aggravent. Les Etats-Unis et la Russie accroissent leur arsenal nucléaire. Trump et Kim ne sont pas Kennedy et Khrouchtchev, qui avaient évité le conflit nucléaire. L’organisation Etat islamique prépare des attentats partout, y compris chez nous.Partout, deux barbaries se conjuguent, la vieille barbarie de la haine, du mépris, de la cruauté, et la barbarie glacée du calcul qui veut contrôler tout ce qui est humain.Partout, y compris en Europe, la régression politique a fait naître des postdémocraties autoritaires, que le mot « populisme » qualifie très mal, et nous sommes nous-mêmes ici menacés en ce moment historique.Les politiques sont somnambules comme l’ont été les politiques de 1933 à 1940. La France ne devrait-elle pas prendre des initiatives pour la paix ? Beaucoup attendent le retour d’une diplomatie française dans le monde telle que l’avait exprimée Dominique de Villepin dans son célèbre discours à l’ONU. La France ne devrait-elle pas chercher une nouvelle voie pour résister aux régressions qui nous envahissent ?Pour vraiment « barrer la route au FN », il faudrait prendre une autre route. La politique de Macron a d’autant plus besoin d’une pensée sur ce monde qu’elle se veut d’ouverture ; la politique de fermeture sur soi de Marine Le Pen n’a pas besoin de penser le monde car pour elle l’extérieur est une menace (mondialisation, Europe, étranger, immigré) et la solution est la fermeture sur soi. »Et à cette autre question : « Les débats sont-ils à la hauteur de ces enjeux historiques et de cette dépression politique ? », il répond :« Le mythe de l’Europe est faible. Le mythe de la mondialisation heureuse est à zéro. Le mythe euphorique du transhumanisme n’est présent que chez des technocrates.Nous sommes dans un creux historique d’incertitudes et d’angoisses, qui provoquent les régressions de repli. Seule la conception d’une voie salutaire pourrait ressusciter une espérance qui ne soit pas illusion.Macron devrait à mon sens mettre en question les cadres classiques dans lesquels il semble se situer naturellement : la subordination de la politique à l’économie, la réduction de l’économie à l’école néolibérale, l’excroissance du pouvoir de l’argent.Une des causes profondes du mal contemporain est l’hégémonie de la finance et des lobbies économiques non seulement sur la société, mais aussi sur la politique.Une nouvelle voie économique est possible qui ferait reculer progressivement l’omnipotence du profit, du calcul, de la standardisation, et nous conduirait vers un mieux-être : la menace écologique a ouvert la perspective de la généralisation des énergies propres, de la dépollution des villes (développement des voitures électriques, piétonisation, parkings aux portes de villes), de la dépollution de notre consommation alimentaire par la régression de l’agriculture et de l’élevage industrialisés et le redéploiement des exploitations fermières et agroécologiques.Le développement de la conscience des consommateurs urbains, qui a commencé, favoriserait l’alimentation saine et savoureuse. Du coup, les progrès de la santé dans toute la nation susciteraient d’énormes économies budgétaires.En même temps, l’Etat devrait favoriser l’économie sociale et solidaire, l’entreprise citoyenne, l’économie collaboratrice (qui s’ébauche dans les Blablacar, les AMAP, etc.), l’économie circulaire, l’artisanat. Il devrait favoriser la production du durable et faire régresser celle du jetable. Il devrait favoriser la compétitivité qui s’obtient par la débureaucratisation et l’humanisation au sein de l’entreprise, plutôt que par les contraintes qui conduisent aux burn-out.Enfin, l’union des Français à laquelle aspire Macron nécessite la prise de conscience de la réalité multiculturelle de notre nation, composée d’abord de cultures provinciales issues de peuples hétérogènes au départ, ensuite de cultures d’origine immigrée se symbiotisant dans la grande culture nationale. Il faudrait inscrire dans la Constitution « la France est une République une et multiculturelle ».De manière plus immédiate, il fait cette analyse du combat électoral en cours :« Macron bénéficie d’un élan propre pour le renouveau et d’un fort antilepenisme. Mais il a éveillé un antimacronisme de gauche et un antimacronisme de droite qui iront vers l’abstention ou vers Marine Le Pen.Cela dit, il y aura encore des aléas et des surprises.Les forces profondes de régénération qui travaillent le pays, en même temps que le travaillent les angoisses, les peurs et les colères (qui favorisent Le Pen), sauront-elles se décanter et trouver un chemin en Macron ?Le dynamisme de la marche risque d’être stérile si on ne sait pas quel espoir se trouve dans l’« en avant ». De toute façon, nous sommes dans l’aventure, cette élection est un saut dans l’inconnu.D’un côté, le déjà-connu, de l’autre, l’incertain. Il faut savoir que tout vote sera un pari risqué.L’abstention est elle-même un pari. Cette conscience doit nous donner vigilance et éviter bien des illusions et des déceptions. »Je voterai Macron.Je ne condamnerai pas celles et ceux qui s’abstiennent.Emmanuel Macron n’a fait aucun effort, pour l’instant, pour rassembler sauf à dire qu’il est le candidat anti-Le Pen, ce qui est beaucoup, mais ce qui n’est pas tout.Il faut lutter contre la marchandisation du monde.Car comme l’écrit Edgar Morin il existe bien sûr la la vieille barbarie de la haine, du mépris, de la cruauté.Mais si on ne lutte pas contre la barbarie glacée du calcul qui veut contrôler tout ce qui est humain nous aurons tôt ou tard la vieille barbarie. -
Vendredi 28 avril 2017
«C’est un peu rapide [de dire ] que deux France se feraient face ! »Frédéric GilliTourner autour du pot, pour voir le pot sous tous ses aspects…Osons un peu de complexité, car la vie est complexité.C’est l’arme des démagogues de tous bords de prétendre que les choses sont simples et que des solutions simples peuvent être trouvées.Nous aussi sommes complexes :Faisons-nous partie du peuple du web ou du peuple du mur ?Sommes-nous libéraux ou non en matière économique, culturelle ou sociétale ?Sommes-nous des « gens de n’importe où » ou appartenons au « peuple de quelque part ». ?Mon ami Daniel répondait au mot du jour d’hier fort judicieusement : « j’ai du mal à me retrouver dans [cette] distinction. J’ai le sentiment d’être de quelque part culturellement mais pas physiquement par ailleurs j’aime l’ouverture aux idées tout en conservant mon sens critique. »Pour ma part, je me sens plutôt faisant partie du peuple du web que du peuple du mur. Mais quand je discute avec mon fils Alexis je n’en suis plus si certain. Je fais certainement beaucoup moins partie du peuple du web que lui ou j’adhère beaucoup moins aux valeurs du peuple du web que lui. Suis-je pour autant du peuple du mur, sans le reconnaître ?Et je ne me sens certainement pas de n’importe où, je suis plutôt de quelque part.Je comprends et j’adhère à cet avis que Christophe Guilluy a émis et que j’ai repris dans le mot du jour du 7 octobre 2016 : « Personne au monde, ni en Algérie, ni au Sénégal, ni en Chine, ne souhaite devenir minoritaire dans son village. »Les raisonnements binaires sont simplistes, or la vie, l’humanité est complexité.Dans une tribune au « Monde » que vous trouverez en pièce jointe, Frédéric Gilli, chercheur à Sciences Po, estime que la géographie du vote ne dessine pas une claire opposition entre une France des villes vivant bien la mondialisation et une France périphérique en train de dépérir.Je vous en livre quelques extraits :« Deux France se feraient face. Une double fracture même, territorialement caractérisée à grand renfort de cartes synthétiques : d’une part les centres-villes s’opposant aux zones pavillonnaires et rurales et d’autre part des régions aux valeurs très différentes démarquées par une ligne Normandie-Provence-Alpes-Côte d’Azur…C’est peut-être un peu rapide ! […]Les instituts nous le disent, les électeurs d’Emmanuel Macron sont plus diplômés, plus urbains, plus optimistes… Le yuppie serait ainsi le candidat des bobos béats et de la mondialisation heureuse avec, face à lui, la France périphérique, repliée, xénophobe et fragile ?[…] en 2017, la présence de Marine Le Pen en tête dans plusieurs départements et dans une majorité de communes occulte la grande diversité des municipalités dans lesquelles Emmanuel Macron réalise des scores très importants : il est arrivé largement en tête à Paris (35 %), la belle affaire ! Il est aussi arrivé en tête dans un département rural traditionnellement de droite comme l’Aveyron (26 % contre 17 % à Le Pen) et un département voisin traditionnellement de gauche comme le Puy-de-Dôme (27 % contre 18 % à Le Pen) et dans des villes moyennes fragilisées comme Bourges (Union des démocrates et indépendants, 28 %), Bar-le-Duc (Parti socialiste, 25 %) ou Châteauroux (Les Républicains, 25 %)…Creusons donc un peu !Marine Le Pen en tête dans 19 000 communes C’est indéniablement dans les coeurs des grandes agglomérations que Macron réalise ses meilleurs résultats : il y capitalise 26 % des scrutins exprimés, quand Marine Le Pen n’en recueille que 18 %. Pour autant, si l’on compare les résultats des deux candidats arrivés en tête au premier tour en suivant les grandes catégories territoriales de l’Insee (les grandes aires urbaines, leur périphérie, les villes petites et moyennes, le rural), force est de constater que le paysage électoral est bien moins binaire que celui d’une France à moitié bleu Marine (la candidate FN arrive en tête dans 19 000 communes). Le vote FN croît bien à mesure que l’on s’éloigne du centre : 18 % dans les grandes agglomérations, 25 % à leur périphérie et 27 % au-delà ; 17 % dans les villes petites et moyennes, 22 % à leur périphérie, 29 % au-delà…Le rural résistant mieux à cette poussée frontiste avec moins d’un quart des suffrages pour Marine Le Pen. On notera toutefois que, si ces chiffres sont indéniablement élevés, elle ne dépasse pas la barre des 30 % dans aucun de ces territoires (en moyenne, il est évident que cela peut masquer des situations municipales variables).Et Macron dans tout cela ? Uniformité des résultats Eh bien, ses résultats sont particulièrement constants quel que soit le terrain. Il rassemble entre 20 % et 23 % des électeurs dans tous ces territoires : 21 % des ruraux, 22 % des électeurs des petites villes, 23 % des périurbains des grandes agglomérations…Evidemment cela varie en fonction des communes et de leur composition sociale mais, si deux France se font face à travers Le Pen et Macron, ce ne sont de toute évidence pas la France des villes et celle des campagnes, puisque le candidat d’En marche ! brille plutôt par l’uniformité de ses résultats.Le constat mérite aussi d’être affiné par grandes régions : une carte nationale montre en effet la nette prééminence du FN dans la moitié nord-est du pays, au-dessus d’une ligne Caen-Grenoble, ainsi que le long du littoral méditerranéen. En Normandie, dans les Hauts-de-France, le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté ou dans le Centre, Marine Le Pen arrive en tête, y compris dans les plus grandes aires urbaines (sauf dans l’hyper-centre de plusieurs d’entre elles, disputé par Macron et Mélenchon). Les communes rurales du nord et de l’est de la France composent d’ailleurs la seule grande catégorie territoriale où Marine Le Pen dépasse 30 % des votes en moyenne (31 %), et c’est en même temps les seuls endroits où Emmanuel Macron ne recueille pas en moyenne plus de 20 % des scrutins (et 14 % des inscrits, soit 260 000 bulletins recueillis sur 1 800 000 possibles).[…] Si le vote FN est plutôt typé géographiquement, cela ne se traduit pas par une France coupée en deux, ni entre le Nord ou l’Est et le Sud ou l’Ouest, ni entre les villes et les campagnes. Et à tout prendre, au vu des cartes, si un vote répond nationalement à celui de Le Pen, ce serait plutôt celui en faveur de Mélenchon. Au contraire, le principal signe de continuité entre ces territoires, c’est précisément le vote Macron, qui est très stable à travers tout le pays, quels que soient les endroits.Ces raccourcis seraient sans conséquences s’ils ne risquaient pas d’induire des erreurs de jugement.En l’occurrence, deux erreurs sont possiblesLa première serait, pour les analystes, de se méprendre sur l’état du pays. Le pays n’est pas traversé par une guerre de civilisation, ni coupé en deux entre des territoires aux trajectoires opposées. Si Macron est réellement le candidat de la modernité et de la mondialisation que nous présentent les médias, cela voudrait dire que l’on trouve dans ces territoires des gens ouverts au monde, à la création de richesse… ce que démontrent les nombreuses initiatives locales partout en France mais que les politiques de concurrence territoriale et de métropolisation s’obstinent à nier.[…]La seconde erreur serait, pour Emmanuel Macron, d’oublier d’ici au second tour mais surtout pendant son mandat qu’il est aussi l’élu de cette France-là. Au total, les quartiers pavillonnaires, les petites villes en déprise, les zones rurales lui donnent 3,6 millions de voix, soit près de la moitié de son électorat !»Vos idées sont moins claires après avoir lu cette chronique ?C’est normal, c’est cela la complexité.Mais c’est beaucoup plus proche de la réalité. -
Jeudi 27 avril 2017
« Retour à Forbach »Régis SauderJe suis né à Forbach en 1958, j’habitais la ville voisine de Stiring-Wendel. Mais que ce soit le lycée Jean Moulin où j’ai étudié, le conservatoire de musique où mon père enseignait le violon, les librairies que je fréquentais, les cinémas, tous ces équipements se trouvaient dans la ville centre de l’agglomération : Forbach.Retour à Forbach est un documentaire de Régis Sauder, un forbachois qui montre cette ville aujourd’hui, en laissant parler les habitants de toute origine et expliquer ce qui s’est passé dans cette ville depuis les années 1980.Ce lundi, après les élections présidentielles, j’ai lu quelques journaux, mais surtout, surtout je suis allé voir ce documentaire qui est sorti en salle le 19 avril 2017.La Croix écrit : « Le retour vers les origines figure souvent parmi les aventures les plus périlleuses d’une vie d’homme. Celui de Régis Sauder vers la ville mosellane de son enfance ne fait pas exception à la règle, quant au remuement intérieur qu’il occasionne. Retour à Forbach, le documentaire qui résulte de ce périple aux mille embûches, n’en est que plus fort, impressionnant dans ce qu’il laisse percer de l’admirable éthique de son auteur. »Les Inrocks parle de la «La désagrégation d’une ville lorraine scrutée par un œil rigoureux. »A Forbach, Marine Le Pen a atteint 29,65% des voix du vote de dimanche.Et dans la ville voisine où j’ai passé mon enfance, Stiring-Wendel, encore plus désespérée que la ville centre, la représentante de la France du mur pointe à 37,30%.Dans mon enfance, les Houillères du Bassin de Lorraine ou HBL régnaient sans partage sur cette agglomération de 80 000 habitants dans laquelle toutes les communes étaient accolées les unes aux autres.Les mines de charbon étaient la mono industrie, on y travaillait ou on travaillait en sous traitance pour les HBL ou encore on travaillait pour vendre des services ou des biens pour ceux qui y travaillaient.Tout était pris en charge par les HBL qui avaient leur propre hôpital, leur sécurité sociale spécifique. Les ouvriers étaient logés gratuitement dans des maisons appartenant aux HBL.La vie culturelle, sportive étaient financées par les HBL.Et puis, les mines ont fermé et l’économie locale s’est effondrée sur elle même. De nombreux retraités, avec des revenus honorables mais plus de perspectives pour les jeunes générations.Ma terre natale a toujours été terre d’immigration, immigration italienne, immigration polonaise. Si mon ascendance paternelle est ancrée dans ce lieu de l’est de la Moselle, ma mère est née polonaise et a accédé à la nationalité française par le mariage. Son père polonais était d’abord venu travailler en Allemagne dans la Ruhr, à Essen où est née ma maman. Puis des recruteurs venant de Lorraine l’ont convaincu de venir travailler en France, de s’installer à Stiring Wendel en bas de la Rue Croix dans des maisons spécialement construites pour accueillir l’immigration polonaise. 400 m plus haut se trouvait la maison familiale de mon père. Et après les épreuves de la guerre mon père lorrain de souche donc français a épousée l’immigrée polonaise.A la fin de la période des mines, une immigration maghrébine a aussi été appelée pour venir travailler dans les mines et les métiers autour de la mine. Et les choses se passaient relativement bien.Mais lorsque l’économie locale s’est effondrée, la cohabitation est devenue plus compliquée.Le documentaire le montre remarquablement avec des personnages truculents comme la femme qui tient le café du marché, lumineuse comme cette femme qui travaille dans les oeuvres sociales et aussi ces personnes émouvantes d’origine maghrébine qui racontent la difficulté d’aujourd’hui. L’un dit : « Avant quand j’avais besoin d’aide je demandais à mon voisin qui était d’une origine différente de la mienne. Mais aujourd’hui cela ne fonctionne plus alors je vais à la mosquée et c’est là que je trouve de l’aide »Et puis cet ouvrier qui explique qu’il a un emploi salarié et qu’il a un prêt sur 15 ans pour sa maison, alors selon ses propos : « il courbe l’échine. Quand il esquisse une révolte, son patron lui dit : tu peux partir il y en a 15 qui attendent ». La fierté s’est envolée.Et je me souviens de mes cousins qui travaillaient au fond de la mine. Travail dur, éprouvant pour la santé mais lorsqu’ils parlaient de leur métier, leurs yeux brillaient de fierté. Ils arrachaient la pierre de la terre pour chauffer les maisons, pour faire tourner les usines. Il y avait l’évidence immédiate de l’utilité de leurs efforts.La fierté d’hier heurte la résignation d’aujourd’hui.Le centre ville de Forbach est déserté, un grand nombre de commerces sont fermés. Des panneaux « à louer » sont collés, mais personne n’est dupe ces commerces n’ouvriront plus.Et les communautés s’observent, probablement avec un peu de peur et en soupçonnant vaguement que c’est l’autre qui est responsable de ce gâchis.Et les mines qui ont fermé continuent cependant à hanter la région : les nombreuses galeries creusées dans le sous sol entraînent des dégâts miniers et fissurent les maisons nécessitant soit de lourds travaux soit de quitter ces maisons.Heureusement qu’à 10km se dresse Sarrebruck, la capitale de la Sarre le plus petit des länder de l’opulente Allemagne.Bien sûr, ce document qui parle de la terre où je suis né me touche particulièrement. Mais je crois que chacun pourra y trouver un début de réponse à cette question mais pourquoi le Front national recueille t’il tant de voix ?Le documentaire annonce qu’une librairie va rouvrir au centre ville. C’est une note d’espoir. -
Mercredi 26 avril 2017
« Les fractures politiques françaises »Réflexions après le premier tour des présidentielles de 2017La décision du peuple français conduit donc à un second tour où s’affronteront le peuple du web contre le peuple du mur ou au moins le représentant de chacun de ces peuples.Mais le premier tour montre ces fractures françaisesD’abord une fracture géographique qui est montrée par cette carte où le département porte la couleur du candidat ayant reçu le plus grand nombre de suffrages .Il y a donc une ligne de fracture Est/ouest principalement et plus précisément Nord-Est / Sud-Est pour Le Pen et Ouest / Sud-Ouest pour Macron avec quelques tâches supplémentaires pour ce dernier :D’abord la région parisienne sauf la Seine Saint Denis où Mélenchon a réalisé un score de 34% contre 24% pour Macron et 13,5 pour Le Pen.Et puis il y a une partie de la Région Rhône-Alpes : Le Rhône, l’Isère et la Savoie ainsi que les Hautes Alpes. Et puis Macron a aussi gagné le centre de la Bourgogne : La Côte d’Or.La seconde Fracture est celle des métropoles contre la France périphérique qu’a décrite Christophe Guilluy, même si dans le détail cette fracture est peut être plus complexe comme l’explique la géographe Béatrice Giblin et le démographe Hervé Le Bras lors des matins du France Culture de ce lundi. Ainsi Béatrice Giblin a dit lors de cette émission :« Les pauvres, les chômeurs votent Front national, les gagnants, ceux qui sont dans la mondialisation votent Macron. Il faut sortir de cette vision simpliste. Si on veut comprendre les choses, il faut rentrer dans une complexité un peu plus forte et dans des analyses plus fines. Vous pouvez à l’intérieur des métropoles, avoir des gens qui vivent très mal, qui sont aussi au chômage, qui ont du mal à boucler leurs fins de mois mais qui se trouvent au sein d’une dynamique sociale et culturelle qui fait qu’ils vont avoir les outils pour résister au vote Front national. En revanche, quand vous êtes dans une petite ville, dans une zone à 50 habitants au km2, où les activités sont à l’extérieur de la ville, là vous avez un sentiment d’abandon. Mais ce qui ne veut pas dire que vous allez forcément mal !»Toujours est-il qu’on voit les résultats suivants dans les grandes MétropolesLe Pen toujours inférieur à 10% et même en dessous de 5% à Paris.Il y a l’exception de Marseille mais où Mélenchon arrive en tête.Et quelques autres du Sud Est comme Nice.Une autre quantification donne un repère : Le Pen a été en tête dans 18 845 communes et Macron que dans 7 222 communes : Les petites contre les grandes.Vous trouverez en pièce jointe un article du Monde du journaliste Patrick Roger qui précise cette double fracture<Sur cette page du Monde réservée aux abonnés> vous trouverez des éléments de sociologie électoraleOn constatera que les cadres votent à 34% pour Macron et 13% pour Le Pen, concernant les autres candidats ils votent comme le reste de la France 19% pour Mélenchon et 20 % pour Fillon et un peu plus que la moyenne pour Hamon 8%.En revanche les ouvriers qui votent le font à 36% pour Le Pen (24% pour Melenchon) et 17% pour Macron.Les retraités votent à 37% pour Fillon et 26% pour Macron et que 14% pour Le Pen.Lorsqu’on s’intéresse aux retraités de plus de 70 ans, le vote va à 46% pour Fillon.Inversement les jeunes de 18-24 ans ont voté pour Mélenchon à 31% et Le Pen à 20% et Emmanuel à Macron qu’à 18%.Macron est en tête pour les 25-34 ans mais pour les 35-49 ans, c’est-à-dire le centre de la vie professionnelle Marine Le Pen est nettement en tête avec 29% contre 22% et 21% pour Mélenchon et Macron et que 12% pour Fillon.Tous ces éléments montrent bien des fractures françaises.Le défi d’un futur Président est en principe de réunifier les français et de parler à la France dans sa globalité. -
Mardi 25 avril 2017
« La plupart des hommes politiques ne manquent certainement ni d’intelligence ni de volonté, mais ils manquent beaucoup de sagesse. »Christophe AndréLa semaine de l’émission de France Culture « A voix Nue » du 3 au 7 avril 2017 était consacrée au psychiatre Christophe André interrogé par Xavier de la Porte.
Lors de la 5ème et dernière émission, ils ont eu cet échange :
A partir de la 10ème minute :
« Il y a un concept que j’aime beaucoup : c’est le concept d’intériorité citoyenne.
Le premier qui l’a proposé est un psychothérapeute belge qui s’appelle Thomas D’Ansembourg (*) […]
[Sa thèse en simplifiant est que ] Vous ne pouvez pas être un bon citoyen, si vous n’avez pas fait le ménage à l’intérieur de vous-même. C’est-à-dire que si vous êtes quelqu’un de profondément égoïste, impulsif, coléreux […] c’est compliqué pour vous de vous comporter de façon juste, cohérente, constructif avec votre environnement immédiat.
Notre comportement avec nos proches, c’est le début de la politique. Comment je me comporte en public, quels buts je privilégie etc… »
Xavier de la Porte :
« Mais l’Amérique a élu Donald Trump […] Nous sommes dans une époque politique un peu étrange, on se demande si nos dirigeants politiques ne sont pas fous ? »
A cela Christophe André répond :
« En tout cas, ils ne sont pas sages. Je ne sais pas s’ils sont fous, mais ils manquent de sagesse. La sagesse ce n’est pas seulement de l’intelligence ou de l’habileté. Dans la sagesse, il y a la notion d’avoir pacifié son tumulte émotionnel, son tumulte égotique, d’avoir de la bienveillance pour les autres.
Très clairement la plupart des hommes politiques contemporains manque de sagesse. Ils ne manquent certainement ni d’intelligence ni de volonté, mais ils manquent beaucoup de sagesse, sans être fou pour autant. »
Voici les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous au lendemain de cette élection présidentielle française de 2017.
(*) Thomas d’Ansembourg avait déjà été évoqué lors du mot du jour du 10 janvier 2017 : « La paix ça s’apprend » car il était le coauteur avec David Van Reybrouck du petit ouvrage dont le titre complet est : « La paix ça s’apprend : comment guérir de la violence et du terrorisme » paru à Actes Sud, en novembre 2016.
<880>
-
Vendredi 21 avril 2017
« Le baiser de l’ouragan »Marine de Nicola.Je me demandais quoi écrire comme mot du jour, ce vendredi, à 2 jours du premier tour d’une élection présidentielle qui pourrait être le début d’une époque compliquée et je suis tombé sur un article du Huffington Post consacré à un livre « Le baiser de l’ouragan » qui vient de paraître le 7 avril 2017.
Ce livre est celui de Marine de Nicola qui raconte son histoire. Dans les moments de trouble, il faut revenir à notre humanité et à ce qui est grand dans l’humain.
Marine de Nicola est toulousaine de naissance et elle a eu, au début de sa jeune vie, un parcours étonnant, ponctué de succès. C’est une française passionnée de la Chine qui a appris le mandarin.
A la suite d’un concours elle avait obtenu : « une bourse «Confucius » qui lui permet de défendre ses chances à Pékin dans un télécrochet très populaire. Finaliste, elle décide de rester sur place et de tenter sa chance comme chanteuse. Sélectionnée pour l’équivalent de «La nouvelle Star », elle travaille son image pour gagner en popularité, interprète des chants patriotiques chinois dans des stades remplis de 20 000 personnes. «Je vivais à Pékin, j’étais riche d’un seul coup, populaire, j’allais d’hôtels de luxe en restaurants étoilés, je roulais dans des supers voitures, je partais au bout du monde en voyage, c’était une vie facile. Et puis… »
Alors qu’elle est en Chine, elle ne se sent pas bien et va consulter. Les médecins chinois diagnostiquent un terrible cancer : un cancer du système lymphatique qui a pour nom : « lymphome de Hodgkin ».
Elle explique «Je ne comprenais pas ce que me disaient les médecins, mon mandarin n’était pas assez technique » Et elle est retournée à Toulouse pour se faire soigner et elle a ouvert un blog dont elle a repris le nom comme titre de son livre « Kiss of a hurricane » qui raconte son combat.
Et c’est ce qu’elle écrit et dit que je voudrais partager avec vous, parce que cela permet de distinguer l’essentiel du futile, que cela donne de la force et que c’est un exemple pour chacune et chacun de nous devant les épreuves que nous avons ou que nous pourrons avoir à affronter pour ne jamais renoncer, ne jamais se rendre, ne jamais se démettre de son énergie, de sa confiance et de son esprit d’optimisme et de conquête.
A la Dépêche du midi elle explique : «J’ai souffert, j’ai cru mourir, j’ai pleuré, j’ai mûri. J’ai été envahie de regrets, comme si j’avais 50 ans. Sans ce cancer, ma vie aurait été moins intéressante sur le long terme. On se sent plus heureuse après, on sourit de tout, même d’un petit vent qui souffle dans les cheveux ou du simple fait de ne rien ressentir parce qu’il n’y a plus de souffrance».
Et voici ce que reproduit l’article du Huffington Post :
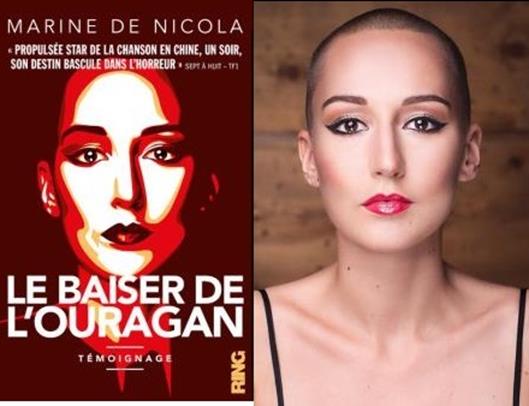 « Je n’aurais jamais cru que la mort puisse me rendre si vivante.
« Je n’aurais jamais cru que la mort puisse me rendre si vivante.
Jamais la bise du matin n’a été si agréable, les fleurs si odorantes, le ciel si bleu. Les bruits du quotidien sont comme une musique enchanteresse, chaque conversation au détour d’une ruelle devient poésie. Même la laideur devient éclatante de beauté.
Combien de temps me reste-t-il? Peut-être plus beaucoup. Je dois vivre chaque instant pleinement, aimer comme je n’ai jamais aimé, vivre à en crever. Les masques tombent. Je n’ai plus rien à prouver. Plus rien à critiquer, plus rien à haïr. Je n’ai plus rien à posséder. J’ai juste à… être.
J’ai compris que nous sommes tous égaux face à la maladie. Elle est impartiale. Elle frappe au hasard, nous délestant de nos parures scintillantes, de nos chevelures et de nos prises de tête du quotidien. Ses victimes sont catholiques comme musulmanes, gays comme hétéros, riches comme pauvres.
Elle nous oblige à regarder la vérité en face, retourner à la base, à ce qui nous est essentiel. Elle nous emmène au pays où les biens matériels, la reconnaissance sociale sont superflus. Désormais, tout ce qui compte, c’est l’instant présent, et puis l’amour.[…]
Je voudrais dire à toutes les personnes qui se battent qu’elles sont belles.
Je fais tout sauf pitié. Je n’ai honte de rien. Je marcherai dans la rue le menton haut et le crâne au vent. Aux regards des curieux, je répondrai avec un grand sourire. Ce sera ma manière à moi de changer le regard sur la maladie. Pour qu’on n’ait plus peur de prononcer le mot « Cancer » et qu’on puisse même en rire.
Je voudrais dire à toutes les personnes qui se battent qu’elles sont belles. Leur histoire, leur humanité, leur fragilité les rend beaux. Je voudrais leur dire qu’ils n’ont pas besoin de se cacher, qu’ils ne sont pas obligés de rentrer dans le moule. Ils ont le pouvoir de transformer leur faiblesse en véritable force.
Si je dois être malade, je le serai avec tout le panache dont je suis capable.
Je m’appelle Marine, j’ai 24 ans, je suis humaine, chauve et belle. J’ai décidé de raconter mon histoire en regardant le monde droit dans les yeux.
Vous qui la lirez peut-être, je vous invite à vous décentrer et à vous mettre, pour quelques heures, dans la peau d’une canc-heureuse. »
« Je voudrais dire à toutes les personnes qui se battent qu’elles sont belles. »
La vraie beauté, celle qui vient de l’intérieur et qui rejaillit à l’extérieur.
En 2015, elle avait été invitée à TF1 le 28 juin 2015 pour raconter ses combats et elle dit cette phrase pleine de joie et de philosophie de vie :
«Quand on s’en sort, on se rend compte que c’était un cadeau, un cadeau mal emballé, mais un cadeau. Je n’ai plus rien à voir avec la personne que j’étais avant. »
La tumeur a été vaincue, elle se trouve en période de rémission c’est à dire sous surveillance car cette maladie sournoise peut resurgir.
<879> -
Jeudi 20 avril 2017
«Pourquoi mes rêves ne seraient-ils pas vos rêves ?»J.M.G. Le Clézio, écrivain
Écrivain français d’origine mauricienne, J.M.G. Le Clézio a reçu le Prix Nobel de littérature en 2008http://le1hebdo.fr/journal/numero/1/vos-reves-ne-seraient-pas-mes-reves-55502-79.html
J’ai plusieurs fois parlé de ce journal étonnant et intéressant : «Le Un».Fin 2016, a paru un petit livre qui reprenait certains des articles parus dans ce journal : «Le malaise français»Aujourd’hui, je voudrais partager avec vous le premier article repris dans ce livre.Il s’agit d’un article écrit le 13 février 2014 par le prix Nobel de littérature Le Clézio :«J’ai grandi dans un pays imaginaire. Je ne savais pas qu’il l’était à ce point.Mes lectures, c’était Capitaine Corcoran, Barnavaux, soldat de France, et bien sûr l’Histoire de France de Lavisse.D’un autre côté mon père, citoyen britannique (alors on ne parlait pas des Mauriciens comme d’une identité réelle), lisait des livres sur le vaudou, était assuré que Jeanne d’Arc n’était rien qu’une sorcière, cruellement mise à mort par l’Inquisition, et que de Gaulle avait menti aux Français.Ma mère avait vécu la guerre, elle avait une sorte de vénération pour celui qu’elle avait écouté à la radio lancer son appel à la résistance, parce qu’elle avait haï absolument la voix du Führer.Être adolescent en France, cela voulait dire découvrir Sartre, Huysmans, Lautréamont, Rimbaud (ah, Un cœur sous une soutane, merveilleux petit roman), et bien sûr lire Les Fleurs du mal comme tout le monde. On pouvait nous faire croire à l’école que Racine était un grand tragédien et que Hugo était un libertador. La vérité c’est que le grand tragédien était William Shakespeare, par quelque bout qu’on le prenne, et que les abolitionnistes étaient tous anglais, voire anglaises.Je ne dis pas que la France aura été le plus accompli des pays colonialistes : l’Angleterre, la Belgique et la Hollande n’ont rien à lui envier. Mais il se trouve que c’est en France qu’on a eu le plus de mal à se guérir de cette maladie infantilisante.Le monde a tourné : quand j’avais dix-huit ans, un jeune homme, qui aimait l’art et la fête, parce qu’il travaillait mal en classe, était envoyé en Algérie pour se battre contre un peuple qui voulait être libre. Il pouvait déserter, aller en Suède, feindre la folie, il a préféré partir puisque c’était son devoir. Il l’a payé de sa vie.Dans ce même pays, l’Algérie, l’armée française pratiquait la torture et les exécutions sommaires, et balançait sur les villages rebelles ce qu’on appelait pudiquement les « bidons spéciaux » – le napalm. Les rebelles d’ailleurs ne s’appelaient pas des rebelles, ils s’appelaient officiellement des HLL – des hors-la-loi.À cette même époque (1960), une jeune fille, parce qu’elle attendait un bébé dont elle ne voulait pas, confiait son corps à une matrone qui la transperçait d’une aiguille à tricoter, et on appelait ça une faiseuse d’anges.La France d’aujourd’hui, Dieu merci, a changé. On n’y cultive plus le racisme ordinaire – juste un peu honteux, ce qui est un abîme de progrès. On ne croit plus guère à la mission civilisatrice des Blancs sur le reste du monde – si peu, ce qui est miraculeux. On y pratique une certaine tolérance, à condition de ne pas exagérer. On y invente la parité, dans la douleur bien sûr. Bref tout va sans doute pour le mieux. Pourtant, la faillite du système pour ce qui concerne le chômage des jeunes, l’exclusion des pauvres, l’expulsion des métèques, tout cela ne s’améliore pas. Tout d’un coup on se prend à imaginer : et si l’on changeait ?La faute est à la crise. La crise, parlons-en : des économistes donnent chaque jour leur précieux avis. La relève serait pour demain. Le bonheur pourra bientôt reprendre. Mais quel bonheur ? Celui d’un retour en arrière, d’une France identifiée comme l’héritière d’une longue culture, bénéficiant d’un « art de vivre ». Le modèle du village français résistant aux barbares n’existe pas. Il n’a jamais existé. Au début du xxe siècle, quand Bécassine la Bretonne vient travailler comme domestique à Paris (en ce temps les Bretonnes sont les Mauriciennes et les Philippines de la France), elle perçoit comme salaire, logée et nourrie, environ un franc par an. Le chemin de fer entre Paris et Nice coûte deux fois cette somme. Il est vrai, l’on est alors « entre soi ». La police ne fait pas de contrôles « au faciès », et tout le monde, peu ou prou, se retrouve le dimanche à la messe.J’aimerais une France dont la puissance ne reposerait pas sur les armes, sur le joujou atomique, sur la réserve d’or dont on dit qu’elle dépasse celle de Fort Knox. Une France dont la puissance serait celle des idées, des idéaux, des œuvres, des cerveaux. Elle en a les moyens : qu’on songe seulement à ce que représentent la poésie de Christine de Pisan, les nouvelles de Marguerite de Navarre, les romans de George Sand. Qu’on pense à Colette, à Nathalie Sarraute, à Sartre, à Camus. Ou si l’on préfère, qu’on se souvienne de Jacques Cazotte, de Lautréamont, d’Artaud, de Paul Éluard. Ou encore d’Impressions d’Afrique ou du Captain Cap. Est-ce que tout cela a été dit pour rien ? Est-ce que tout cela ne constitue pas un trésor, notre seul trésor ?Je songe à un pays – mon pays, puisque j’y suis né et que j’ai sucé le lait de sa langue – qui cesserait de se bercer dans son sommeil hypnotique avec les airs mélancoliques du passé. Un pays qui déciderait de mettre fin une fois pour toutes à son pouvoir régalien, à son aristocratie et à ses privilèges exorbitants. L’histoire coloniale ne pourra pas être réécrite : elle est inhérente à la fortune de la France, comme la richesse de ses grandes cités portuaires est due au trafic d’esclaves.En revanche, s’ouvrir au monde, s’ouvrir au partage et se reconnaître comme culture plurielle pourraient donner à notre nation la confiance qu’elle a perdue.Aujourd’hui, la France connaît de grandes difficultés à abandonner l’ère de l’uniculturel. Le racisme a officiellement disparu, mais cela reste toujours aussi difficile pour un Français d’origine antillaise ou africaine de trouver un job et un logement. Le paysage culturel est en train de changer mais la France reste un club fermé.Il faut admettre qu’elle n’est plus seulement le pays de Voltaire et de Condorcet, de Michelet et de Lamartine. C’est aussi le pays d’Aimé Césaire et d’Édouard Glissant, le pays de Boualem Sansal et de Laabi, par la langue le pays d’Yambo Ouologuem et d’Abdourahman Waberi. La langue française est un être vivant, qui change et se modifie sans cesse. Elle n’existe que par ses adaptations, ses rencontres, ses inventions. Sa force n’est pas dans on ne sait quel « rayonnement », elle est dans ce changement. La reconnaissance des torts causés aux minorités – en vérité majoritaires dans tous les lieux névralgiques de notre pays – n’est pas un fantasme caritatif, ni une expiation : ce serait la seule chance pour cette culture ancienne, largement métissée, de continuer son aventure dans la complexité du monde. Nous y sommes, c’est le point de non-retour : ou bien l’on ouvre les ghettos, et l’on partage le bon air de la mixité, ou l’on se dessèche sur les ruines archéologiques d’une histoire devenue imaginaire.Je suis un binational franco-mauricien qui vit une partie de son temps comme un émigré. Pourquoi mes rêves ne seraient-ils pas vos rêves ?Albuquerque, le 13 février 2014 » -
mercredi 19 avril 2017
« L’article 16 de la constitution »Un article liberticide de la constitution qu’il ne faudrait pas mettre entre toutes les mains.Grâce à Manuel Valls nous connaissons l’article 49-3 de la constitution, article qui permet d’obliger l’Assemblée Nationale d’accepter qu’un texte de Loi soit adopté sans le discuter, sauf à voter une motion de censure qui renverserait le gouvernement et très probablement conduirait à une dissolution de l’Assemblée ce qui aurait comme conséquence fâcheuse de ramener chaque député devant ses électeurs.Grâce à François Asselineau qui est ce candidat qui à chaque question dégaine un article d’un Traité ou de la Constitution, nous sommes familier de l’article 5 de la constitution qu’il cite le plus souvent, celui qui donne au Président de la République l’injonction d’être « le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.»Mais l’article le plus problématique de la Constitution n’est pas beaucoup cité.François Mitterrand a écrit au moment de la création de la Vème république un livre : « Le coup d’Etat permanent » dans lequel il fustigeait la 5ème république et dénonçait notamment l’article 16 de la constitution.Il a été 14 ans au pouvoir sous cette constitution et il n’a pas voulu ou pas pu abroger cet article.Tout à fait à la fin de son mandat, il a eu cette sentence : « Les institutions ont été dangereuses avant moi et le redeviendront après moi ».Vous trouverez ces information sur l’excellent site de l’Institut François Mitterrand : http://www.mitterrand.org/Qu-est-ce-que-le-mitterrandisme.htmlAvant de continuer, citons in extenso cet article qu’aucun pays démocratique libéral et sérieux ne nous envie :« Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés (1) d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.Il en informe la Nation par un message.Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.Le Parlement se réunit de plein droit.L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »L’historien François Durpaire et le dessinateur Farid Boudjellal, ont fait une BD dont vient de paraître le 3ème tome : « La Présidente » où ils imaginent Marine Le Pen élue présidente le 7 mai 2017.L’historien prévient que Marine Le Pen ressemble à Donald Trump, mais Donald Trump a contre lui un vrai pouvoir judiciaire qui l’arrête, stoppe ses décrets, un Parlement qui ne vote pas comme il le souhaite bien que son parti dispose de la majorité. Et même les membres du gouvernement qu’il nomme peuvent être récusés ou devoir démissionner dès qu’on s’aperçoit qu’il existe des conflits d’intérêts Enfin c’est un Etat fédéral et les états fédérés comme la Californie peuvent largement s’éloigner des injonctions du pouvoir fédéral et disposent d’une large autonomie.Il n’y a rien de tel pour arrêter Marine Le Pen qui en outre dispose de l’article 16.Une fois au pouvoir, il y aura probablement de grands désordres.Elle pourra alors considérer que les conditions de la mise en œuvre de l’article 16 sont réunies.<Un journaliste de Challenges développe cette hypothèse>
Il y a deux dispositions de nature à freiner ce pouvoir absolu :Un avis public du Conseil constitutionnel.Le Parlement est réuni et l’Assemblée ne peut être dissoute.Notez qu’il n’est pas prévu qu’une autorité mette fin, de manière autoritaire, aux pouvoirs exceptionnels contre l’avis du Président de la république !Tout ceci me paraît bien léger … aucune comparaison possible avec les Etats-Unis…Vous trouverez d’ailleurs sur ce thème et en pièce jointe, une tribune parue dans « Le Monde » le 11 avril et rédigée par un collectif composé de juristes qui estime que la Ve République permet au président de cumuler les pouvoirs législatif et exécutif et que confier une telle autorité à Marine le Pen ferait courir un grave danger à la démocratie. -
Mardi 18 avril 2017
«La Chanson de Craonne »Chanson des soldats de la bataille du chemin des damesLe dimanche 16 avril 2017 était le jour de la Pâques chrétienne. C’était Pâques parce qu’il s’agissait du premier dimanche qui suivait la première pleine lune après l’équinoxe de printemps.
Lundi 20 mars 2017 fut le jour de l’équinoxe de printemps.
La pleine lune eut lieu mardi 11 avril (la précédente était le 12 mars, vous trouverez toutes les informations sur les phases de la lune sur ce site).
Et donc le dimanche suivant était le 16 avril et c’est ainsi que chaque année est déterminée Pâques.
Et chaque année, les catholiques et les protestants fêtent la «résurrection du Christ» le premier dimanche qui suit la première pleine Lune après l’équinoxe de Printemps.
En 1917, le 16 avril tombait un lundi, 8 jours après le dimanche de Pâques.
Ce lundi 16 avril 1917, un criminel qui ne fut jamais jugé, même si le tribunal de l’Histoire le condamne, a ordonné à 6 heures du matin le début de la bataille appelé la bataille du chemin des dames. Ce criminel avait pour nom Robert George Nivelle, il ne fut jamais jugé parce qu’il portait l’uniforme de général de l’armée française et qu’il avait agi dans ces fonctions.
La bataille du chemin des dames !
Le chemin des dames est une route qui se situe dans le département de l’Aisne et qui relie, d’ouest en est, les 25,9 km séparant les communes d’Aizy-Jouy et de Corbeny.
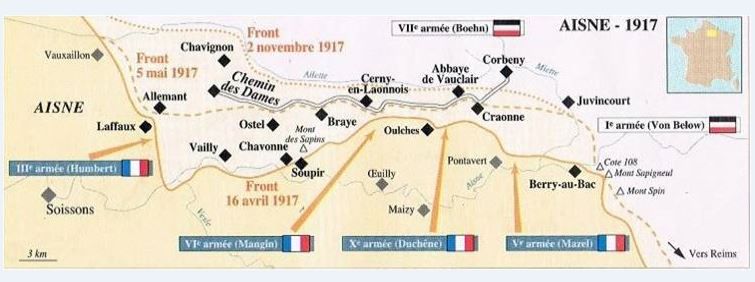 Cette route fut baptisée ainsi à la fin du XVIIIème alors qu’il ne s’agissait que d’un petit chemin, peu carrossable parce qu’il fut emprunté entre 1776 et 1789 par Adélaïde et Victoire, filles du roi Louis XV, également appelées Dames de France qui, venant de Paris, se rendaient fréquemment dans un château des environs.
Cette route fut baptisée ainsi à la fin du XVIIIème alors qu’il ne s’agissait que d’un petit chemin, peu carrossable parce qu’il fut emprunté entre 1776 et 1789 par Adélaïde et Victoire, filles du roi Louis XV, également appelées Dames de France qui, venant de Paris, se rendaient fréquemment dans un château des environs.
Cette route traverse le village de Craonne qui fut un lieu particulièrement meurtrier de cette bataille qui se déroula du 16 avril jusqu’en juin 1917.
Craonne fut déjà le nom d’une bataille de Napoléon Ier en 1814 où les français battirent les Prussiens et les Russes, au prix de 5 400 morts parmi ses jeunes recrues que l’on appelait les Marie-Louise.
 Mais « l’offensive Nivelle » fit beaucoup plus de morts : on estime à près de 200 000 hommes côté français tués au bout de deux mois d’offensives et un chiffre équivalent du côté allemand. Et l’armée française n’avança quasi pas. Tous ces jeunes ont été envoyés à la mort pour aucun résultat. On appela Nivelle « le boucher » du fait de son obstination et son peu de considération pour la souffrance et la mort de ses hommes.
Mais « l’offensive Nivelle » fit beaucoup plus de morts : on estime à près de 200 000 hommes côté français tués au bout de deux mois d’offensives et un chiffre équivalent du côté allemand. Et l’armée française n’avança quasi pas. Tous ces jeunes ont été envoyés à la mort pour aucun résultat. On appela Nivelle « le boucher » du fait de son obstination et son peu de considération pour la souffrance et la mort de ses hommes.
Les hommes exaspérés se révoltèrent, on appela cela des mutineries.
Il y eut de nombreuses condamnations et 43 mutins furent fusillés.
Ils furent fusillés parce que des officiers le décidèrent et parce qu’il y eut suffisamment d’hommes de troupes qui plutôt que de tourner leurs fusils contre leurs officiers, acceptèrent cette décision parce qu’ils croyaient que l’amour et la défense de la Patrie justifiaient ce sacrifice pour l’exemple et la poursuite des combats.
Et c’est à cette occasion que des soldats écriront et chanteront « la chanson de Craonne » une des chansons les plus anti militaristes qui soit.
 Elle fut interdite jusqu’en 1974.
Elle fut interdite jusqu’en 1974.
Et encore, le 1er juillet 2016, lors de la cérémonie d’anniversaire commémorant les 100 ans de la bataille de la Somme, un secrétaire d’État aux anciens combattants, parfaitement inconnu, Jean-Marc Todeschini refusa que soit entonnée la Chanson de Craonne.
Mais en ce dimanche de Pâques, lors de la commémoration officielle de la bataille du chemin des dames, présidée par François Hollande, la chanson de Craonne put enfin être entonnée en mémoire des soldats morts encore plus inutiles que les autres morts de la première guerre mondiale.
Si le boucher Nivelle subit un moment de disgrâce avérée, en décembre 1917, il fut pleinement réhabilité après la guerre puisqu’il est nommé au Conseil supérieur de la guerre, élevé à la dignité de Grand’croix dans l’ordre de la Légion d’honneur et décoré de la médaille militaire. Il est mort dans son lit en 1924 aux n°33-35 rue de la Tour dans le 16e arrondissement de Paris où une plaque lui rend hommage. 7 ans plus tard, il est même transféré aux Invalides lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Guerre qui était alors André Maginot qui devint célèbre pour une autre immense erreur militaire française.
Voici un lien vers l’interprétation de la <chanson de Craonne par Marc Ogeret>
Et voici ce texte :
Quand au bout d’huit jours le repos terminé
On va reprendre les tranchées,
Notre place est si utile
Que sans nous on prend la pile
Mais c’est bien fini, on en a assez
Personne ne veut plus marcher
Et le cœur bien gros, comm’ dans un sanglot
On dit adieu aux civ’lots
Même sans tambours même sans trompettes
On s’en va là-haut en baissant la tête
– Refrain :
Adieu la vie, adieu l’amour,
Adieu toutes les femmes
C’est bien fini, c’est pour toujours
De cette guerre infâme
C’est à Craonne sur le plateau
Qu’on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous condamnés
Nous sommes les sacrifiés
Huit jours de tranchée, huit jours de souffrance
Pourtant on a l’espérance
Que ce soir viendra la r’lève
Que nous attendons sans trêve
Soudain dans la nuit et dans le silence
On voit quelqu’un qui s’avance
C’est un officier de chasseurs à pied
Qui vient pour nous remplacer
Doucement dans l’ombre sous la pluie qui tombe
Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes
C’est malheureux d’voir sur les grands boulevards
Tous ces gros qui font la foire
Si pour eux la vie est rose
Pour nous c’est pas la même chose
Au lieu d’se cacher tous ces embusqués
F’raient mieux d’monter aux tranchées
Pour défendre leurs biens, car nous n’avons rien
Nous autres les pauv’ purotins
Tous les camarades sont enterrés là
Pour défendr’ les biens de ces messieurs là
– Refrain :
Ceux qu’ont le pognon, ceux-là reviendront
Car c’est pour eux qu’on crève
Mais c’est fini, nous, les troufions
On va se mettre en grève
Ce sera vot’ tour messieurs les gros
De monter sur le plateau
Si vous voulez faire la guerre
Payez-la de votre peau
Le mot du jour du 28/07/2014 citait Paul Valéry « La guerre, c’est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas ».
<Ali Baddou a reçu sur France Inter Nicolas Offenstadt qui a parlé de cette bataille et de la chanson>
<Patrick Cohen a aussi évoqué cette chanson ce même vendredi>
Et <ICI> vous trouverez un site commémoratif de la bataille du chemin des Dames
<876>
-
Vendredi 14 avril 2017
« Web people vs wall people
Le peuple du web contre le peuple du mur»Thomas Friedman article du New York timesC’est lors de l’émission du Grain à moudre du 7 avril que j’ai été orienté vers un article du Point de Brice Couturier qui analysait le point de vue d’un journaliste du New York Times qui avait essayé d’expliquer la victoire de Trump par cette opposition entre celles et ceux qui font partie du peuple du Web et celles et ceux qui appartiennent au peuple du mur.L’article du New York Times se trouve derrière ce lien : https://www.nytimes.com/2016/07/27/opinion/web-people-vs-wall-people.html?_r=0L’émission du Grain à Moudre avait pour objet ce sujet : <Le non au référendum de 2005 sera-t-il entendu en 2017 ?>Et la chronique du Point peut être lue à cette adresse : http://www.lepoint.fr/chroniques/brice-couturier-peuple-du-mur-contre-peuple-du-web-11-03-2017-2111125_2.php#Thomas Friedman que Brice Couturier présente comme le chantre de la mondialisation (La terre est plate, Saint-Simon, 2006) a caractérisé les récentes élections américaines comme une lutte politique entre le « peuple du mur » (Wall People) et le « peuple du Web » (Web People).De manière intuitive on comprend bien cette opposition entre ceux qui souhaitent construire des murs pour se protéger ainsi que leur espace territorial des influences étrangères, de la concurrence de tout ce qui peut remettre en cause leur manière de vivre, leurs traditions, leurs nations et ceux qui à l’aise dans le monde numérique s’attachent moins à l’adresse territoriale qu’à l’ouverture vers le monde, les échanges et au destin individuel.Thomas Friedman décrit les membres du peuple du mur comme«revendiquant des communautés d’appartenance stables, l’insertion dans le cadre d’une histoire et d’une géographie particulières qui confèrent à leur vie un horizon de sens. Ils veulent « vivre et travailler au pays ». Et en compagnie de gens qui leur ressemblent…» alors que les membres du peuple du web « comprennent qu’à une époque de changements rapides les systèmes ouverts sont plus souples, plus résilients, qu’ils confèrent de l’élan.»Et il ajoute :«Les premiers rêvent de se protéger par de hauts murs. Les seconds répliquent que toutes les lignes Maginot de l’Histoire ont été contournées.»Si le premier tour des présidentielles est conforme aux sondages actuels, nous aurons un second tour qui n’opposera pas un candidat de gauche et un candidat de droite mais un représentant du peuple du web contre une représentante du peuple du mur.De sorte que ce ne serait plus le classement droite/gauche qui est déterminant mais le rapport à la mondialisation qui redéfinirait les clivages politiques. Cette vision est partagée par Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui tous deux estiment le clivage droite/gauche obsolète alors qu’il reste le ciment de François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoit Hamon.Brice Couturier écrit :«Marine Le Pen appelle « les patriotes de gauche et de droite » à la rejoindre. Contre « la mondialisation dérégulée » et « l’immigration massive », elle présente un programme souverainiste intégral : priorité nationale, monnaie nationale, solidarité nationale. Pour elle, le clivage droite-gauche a perdu toute signification. Celui qui compte oppose désormais les élites mondialisatrices et les peuples, en mal de sécurité et de protection. La PME lepéniste a achevé sa mue. Sous la férule du couple Marine Le Pen-Florian Philippot, le Front national est parvenu à s’emparer de l’espace politique que convoitait Jean-Pierre Chevènement (qui fut le premier modèle de Florian Philippot) il y a quinze ans : « ni de droite ni de gauche », comme le « pôle républicain » du « Che ». La preuve, c’est que l’antipode de son programme ne se situe plus à l’extrême gauche, chez Jean-Luc Mélenchon, mais bien du côté d’Emmanuel Macron. Celui-ci est, en effet, le seul candidat à présenter l’intégration européenne et la mondialisation comme autant de chances pour la France.Le fondateur de la start-up politique En marche ! fait le constat que la droite et la gauche sont divisées en leur sein quant aux réponses à apporter aux révolutions du XXIe siècle : robotisation, ubérisation, nouvelle donne internationale. À ses yeux, le conflit politique central oppose désormais ceux qui veulent accompagner ces bouleversements, afin d’en tirer parti, à ceux qui croient possible de s’y opposer. Les progressistes et les conservateurs, selon sa typologie. L’affrontement droite-gauche ? Une survivance. Une manière pour les professionnels de la politique de justifier une rente de situation.La fin du cycle historique ordonné à la distinction droite-gauche.»Dans son article Brice Couturier fait une revue des idées et des livres sur ce sujet :« Cette distinction recoupe en bonne part celle qu’établit Alain de Benoist dans son dernier livre, Le Moment populiste. Droite-gauche, c’est fini ! (Pierre-Guillaume de Roux). Selon lui, nous vivons la fin du cycle historique ordonné à la distinction droite-gauche. Et le « moment populiste » est « le révélateur d’une crise ou d’un dysfonctionnement grave de la démocratie libérale ». Les « élites libérales », sûres de la supériorité morale de leur programme « d’ouverture », préféreraient « gouverner sans le peuple – et finalement contre lui », selon Alain de Benoist.» Nos gouvernements ne nous représentent plus, ils nous surveillent « , déplore, de son côté, le libéral-conservateur Pierre Manent. En effet, généralement acquises au multiculturalisme, les élites dirigeantes des démocraties occidentales ont longtemps fait la leçon à des populations réticentes. Elles ont été relayées par des médias peuplés de directeurs de (bonne) conscience qui instrumentalisent l’antiracisme pour imposer le politiquement correct. […]Alain de Benoist estime que la gauche et la droite se sont trahies toutes les deux. La première, en faisant exploser le « front de classe » en une myriade de mouvements revendicatifs identitaires qui n’aspirent plus à transformer la société, mais à s’y faire une meilleure place au détriment des autres. Il rejoint ainsi Marcel Gauchet, pour qui la transformation de la gauche en un « parti des droits » est une manière, dégradée, de « recycler son projet d’émancipation ». La seconde, parce qu’elle s’est donnée, par méfiance envers le peuple, au libéralisme. Or celui-ci provoque, selon Benoist, la destruction de tout ce qui aurait mérité d’être conservé. Et en particulier les peuples en tant que communautés culturellement homogènes et corps politiques se gouvernant eux-mêmes. Le capitalisme mondialisé provoque la désaffiliation des individus (Robert Castel) ; il liquéfie les liens sociaux (Zygmunt Bauman) ; il sape toutes les identités, en particulier celles qui, émanant des appartenances de classe (Jean-Claude Michéa), soutenaient les grands ensembles politiques – libéralisme versus socialisme. […]L’historien des idées Arnaud Imatz, auteur de Droite-gauche. Pour sortir de l’équivoque (P.-G. de Roux, 2016), montre que, sur la plupart des grands thèmes, gauche et droite n’ont cessé d’échanger leurs positions au cours du temps. Le colonialisme, en France, a été une entreprise de gauche, que la droite dénonçait comme une diversion dans la nécessaire revanche contre l’Allemagne. La défense de l’individu est née à gauche, avant de passer à droite. Aujourd’hui, des questions fondamentales comme la place de l’islam et la laïcité, les rapports avec la Russie ou la forme que doit prendre la poursuite du projet d’intégration européenne divisent non la gauche et la droite, mais chacune d’entre elles. […] »En réalité il peut exister deux lectures négatives de la mondialisation celles par les classes sociales et celle par l’identité.Celles par les classes sociales met en avant l’effet de la mondialisation dans le creusement des inégalités dans nos pays en créant des gagnants et des perdants. Cette lecture avantage la Gauche car c’est une analyse qui met en avant l’étude des revenus et des patrimoines.La lecture par l’identité. Elle met l’accent sur la perte de repère en raison de l’ouverture des frontières, des migrations du bousculement des habitudes par l’étranger. Cette lecture avantage la Droite.Et Marine Le Pen qui a bien compris cette dichotomie est naturellement attirée par la lecture identitaire mais ne néglige pas la lecture par classe sociale.Et en face il y a la lecture positive et optimiste de l’ouverture que présente Emmanuel Macron.Cette confrontation a déjà eu lieu une fois, en France : c’était le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005.Cette fois-là, ce ne fut pas les partisans de l’ouverture qui l’emportèrent mais bien l’union de la lecture de la mondialisation par les classes sociales avec ceux de la lecture par l’identité. Ce fut la victoire du peuple du mur selon la terminologie de Friedman.Les choses ont elles tellement évolué, la détestation de Marine Le Pen est-elle si grande que la victoire du peuple du Web, prédit par les sondages, va se réaliser cette fois ? -
Jeudi 13 avril 2017
« La tentation Mélenchon »Réflexions personnelles sur une dynamique de campagneContrairement à ce qui est répété à satiété, les sondages ne se trompent pas systématiquement. Même en 2002, les instituts de sondage avaient perçu, particulièrement lors de la dernière semaine de campagne (mais les résultats n’étaient plus publics), le tassement de Lionel Jospin et la dynamique du vote Jean-Marie Le Pen.De la même manière, pendant les primaires de Droite et de Gauche récentes, alors que la population à sonder était particulièrement difficile à saisir, les instituts de sondage avaient détecté la dynamique Fillon ainsi que la dynamique Hamon.C’est faux de dire que les sondages se trompent systématiquement, le vrai problème c’est qu’ils influent sur le vote et cela pose une question démocratique. Mais je ne développerai pas ce point aujourd’hui.Car ce qui est mon propos aujourd’hui, c’est de m’intéresser à ce que détecte en ce moment les instituts de sondage : la dynamique du vote pour Jean-Luc Mélenchon, et c’est l’évènement de cette présidentielle désespérante et confuse. Si cette dynamique continue, Jean-Luc Mélenchon sera au second tour.Je ne développerai pas non plus les circonstances particulières de cette élection qui favorise aujourd’hui cet homme qui est de très loin le meilleur des tribuns de cette compétition et probablement le plus cultivé, celui qui a le plus de consistance humaine.La meilleure preuve que cette dynamique est réelle et inquiète certains se trouve dans le fait que l’hôte en fin de bail au Palais de l’Elysée qui voulait rester en retrait avant le premier tour pour ne pas trancher entre le candidat désigné par la Primaire de gauche et son ancien conseiller, a décidé de sortir du silence qu’il s’était imposé pour dire d’abord « Cette campagne sent mauvais » puis exprimer sa véritable crainte celle d’un second tour Le Pen / Mélenchon. François Hollande a toujours eu des relations plus que conflictuelles, quasi haineux avec Jean-Luc Mélenchon. Il attaque ainsi son vieil et irréductible ennemi : « Il y a un péril face aux simplifications, face aux falsifications, qui fait que l’on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte »Le président du MEDEF exprime aussi un avis très tranché : «Voter Mélenchon, Le Pen, Hamon, c’est ruine, désespoir et désolation»L’héritier Gattaz priorise, il préfère le programme de François Fillon, il s’accommode de celui d’Emmanuel Macron mais rejette les autres dont celui de Mélenchon.Et hier, <Le Figaro> a sorti l’artillerie lourde pour dénoncer un projet dévastateur pour la France.Les autres articles de ce même journal sont dans le même esprit, explicites dès le titre :« Le programme de Mélenchon, un big bang social d’un autre temps »« Castro, Chavez… Mélenchon, l’apôtre des dictateurs révolutionnaires »« Éditorial: «Maximilien Ilitch Mélenchon»Ce dernier faisant bien sûr référence et l’amalgame entre Maximilien Robespierre et Vladimir Ilitch Oulianov dit Lénine, qui il y a exactement 100 ans était en train de préparer la révolution qui allait mener les bolcheviks au pouvoir.Même le jeune candidat qui reste le favori des sondages perd sa bienveillance pour l’attaquer sur son âge et le traiter de révolutionnaire communiste : «Nous avons le révolutionnaire communiste. Il était sénateur socialiste, j’étais encore au collège.» Et il le caricature sur la politique internationale :«Si la paix que défend Jean-Luc Mélenchon c’est la paix de Vladimir Poutine, très peu pour moi. Si la paix que propose Jean-Luc Mélenchon, c’est de désarmer la France de manière unilatérale devant celles et ceux qui nous attaquent, très peu pour moi.»Heureusement qu’au milieu de cette violence, Ségolène Royal, toujours décalée par rapport à son ancien compagnon et son entourage ose cette réponse à la question de savoir si la percée de Jean-Luc Mélenchon l’inquiète « Non, pourquoi? Pourquoi une inquiétude? Non, au contraire, je pense que c’est mieux une percée de ce côté-là que du côté de l’extrême droite! Et puis, c’est une authenticité, une passion, je pense, que les Français trouvent dans son message. Et la politique a besoin de passion…»La politique a besoin de passion ! Sacré Royal !Ce que nous aimons dans Mélenchon c’est en effet sa passion, et qu’il parle de Politique, de rapports de force, d’injustice, il parle des gens. Et puis qui d’autre que lui est capable à la fin d’un meeting de lire un poème de Victor Hugo devant un public attentif et à l’écoute ? A la fin du meeting de Marseille, il a lu un poème sur la paix d’un écrivain grec : Yannis Ritsos dans la même communion avec la foule de son meeting.Et le 29 mars, il a déclamé l’albatros de Baudelaire lors de son meeting du Havre.Mais ce n’est que la conclusion de son meeting, auparavant pendant une heure il construit son discours clair, pédagogique avec très peu de notes mais un immense travail préparatoire.Alors oui il fascine. Il écrase la concurrence sur ce plan du discours, du charisme et je dirai plus de l’Humanité.Cela se voit d’autant plus qu’en face il y a de la médiocrité, celui qui se prétend l’assistant de Paul Ricoeur s’égosille et gesticule, le fils du notaire sarthois est incapable d’empathie avec des infirmières qui lui expliquent la difficulté de leur travail et je ne parle pas de celle qui éructe à longueur de meeting à la recherche de boucs émissaires et pour qui la France est une vierge qui n’a jamais commis le mal. Il y a bien Benoit Hamon pour sauver quelque peu le niveau, car lui aussi parle et s’intéresse aux gens. Il se trouve hélas dans une position politique intenable et il n’a pas le talent de jean-Luc Mélenchon qui s’est en outre assagi par rapport à la dernière campagne.La France est le pays de la politique et la tentation Melenchon se comprend ainsi.Le point révèle dans un article du 12 avril un sondage dans lequel Jean-Luc Mélenchon « recueille 56 % de bonnes opinions. […] sa popularité actuelle relève de l’improbable : 61 % chez les cadres (devant Macron, à 57 %), 76 % auprès des sympathisants PS (dont il devient le nouveau champion). Même chez les sympathisants LR, Mélenchon enregistre une percée inattendue : 39 % (+ 17 points). Il y a cinq ans, lors de sa première campagne présidentielle, celui qui était alors le candidat du Front de gauche totalisait 47 % de bonnes opinions lors de la dernière mesure précédant le scrutin.»Evidemment <Les marchés financiers réagissent très négativement à cette dynamique>, ils n’aiment pas du tout cette volonté de Jean-Luc de Mélenchon de rediscuter les traités européens et de vouloir faire voler en éclats l’Europe «libérale». Je crois qu’ils prennent très au sérieux la menace de Jean-Luc Mélenchon qui instruit des leçons du premier ministre grec Tsipras annonce que s’il ne parvient pas à faire infléchir suffisamment la politique européenne mettra en œuvre son plan B qui est de sortir de l’Euro et de l’Union européenne.Le pari qu’exprime Jean-Luc Melenchon est que les autres pays européens et en particulier l’Allemagne céderont en raison de poids de la France car elle ne veut pas la dislocation de l’Union européenne qui ne pourra survivre à la sortie de la France.Il n’est pas évident que l’Union européenne ne survivrait pas à la sortie de la France mais ce ne serait plus la même Union qui ressemblerait de plus en plus à une Allemagne élargie.Jean-Luc Melenchon compare son plan B à la dissuasion nucléaire, la menace suffit pour obtenir des résultats il n’est pas nécessaire de l’utiliser.C’est un pari audacieux.Il aura contre lui quasi tous les gouvernements des autres pays européens ainsi que l’ensemble des forces économiques mondiales.Il faudrait aussi pour qu’il puisse mettre en œuvre son plan qu’il dispose d’une majorité parlementaire. Car c’est une chose de pouvoir obtenir 20% disons 22 ou 23% des votants puis de gagner l’élection au second tour en raison du rejet de l’autre candidat et de disposer d’une majorité de députés élus par la majorité des français.Le reste de son programme s’appuie sur une augmentation des salaires, des retraites plus généreuses et plus précoces, une augmentation de la fiscalité et de la redistribution qui s’opposent totalement aux règles de fonctionnement du système économique actuel et semble peu crédible. Il prend aux Etats-Unis l’idée d’un impôt universel : tout membre de la nation française doit l’impôt sur les revenus à la France même s’il est expatrié. Il doit alors payer la différence entre l’impôt qu’il aurait payé en France et celui qu’il acquitte dans son pays de résidence.Enfin, il veut mettre en œuvre une constituante qui va permettre à mettre en place une autre constitution transformant la 5ème république en une vraie république parlementaire avec de nouvelles règles d’intervention et de participation des citoyens à la décision publique et aussi de possibilités de révoquer les élus.On peut s’interroger sur la pertinence de mettre tant d’énergie sur nos règles constitutionnelles alors que la France sera en pleine tumulte économique en raison de l’affrontement du gouvernement français avec les forces économiques mondialisées.Il est aujourd’hui, et de loin, le meilleur candidat, serait t’il le meilleur président ? C’est la question.Jean-Luc Melenchon avait accusé François Hollande d’être un capitaine de pédalo.La situation internationale et économique est de plus en plus tendue, et étant donné sa personnalité et son programme s’il devait être élu, nous serions dans un navire au milieu d’une immense tempête.Serait t’il capable d’être le capitaine du bateau pour affronter cette tempête ?Et nous ?Sommes nous prêts à de telles tempêtes ?C’est la question que pose la tentation Mélenchon.Mais si nous en avons vraiment marre du système actuel, cette tentation est certainement plus désirable que celle de l’héritière d’extrême de droite.Vous trouverez ci-après un <Un documentaire de Gérard Miller : L’homme qui avançait à contre-courant> que j’ai regardé avec beaucoup d’intérêt et de plaisir. -
mercredi 12 avril 2017
«Il manque à Emmanuel Macron la logique globale du modèle scandinave, fondé sur l’égalité »Bruno PalierEmmanuel Macron et l’économiste Jean Pisani-Ferry ont déclaré que le programme qu’ils préconisaient était inspiré du modèle scandinave.Le Monde a interrogé Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS à Sciences Po et coauteur, avec l’économiste danoisGosta Esping-Andersen, de Trois leçons sur l’Etat-providence (Seuil, « La République des idées»,2008), sur l’authenticité de cette comparaison.Nous apprenons d’abord que le chercheur danois Gosta Esping-Andersen a identifié trois modèles de protection sociale :l’Etat providence social-démocrate scandinave,
les systèmes anglo-saxons, qui privilégient le marché sur l’intervention de l’Etat
les systèmes d’assurances sociales de l’Europe continentale qui sont en vigueur en France et en Allemagne.
Le modèle français s’inscrit dans la continuité des mutuelles créées au XIXe siècle. Il s’agit d’un système contributif fondé sur le travail : pour avoir droit à des prestations sociales, il faut payer des cotisations. Il vise moins la réduction des inégalités que la protection de l’emploi et la sécurité du revenu en cas de problème – maladie, chômage ou vieillesse.L’universalité de la couverture sociale dépend donc de la capacité de la société à assurer du travail à tout le monde. Ce modèle présente le défaut majeur de ne pas protéger les personnes qui ne sont pas encore entrées dans le monde du travail, ni celles qui en sont restées longtemps exclues. Il protège en outre mal les femmes qui travaillent dans des conditions d’emploi atypiques et qui dépendent de leur mari.Dans les pays nordiques, [prétendument inspirateur d’Emmanuel Macron] que ce soit en Suède, au Danemark, en Islande, en Finlande ou en Norvège, la protection sociale est garantie à tous les citoyens par l’Etat.Il s’agit de droits sociaux universels, comme l’accès aux crèches et à l’éducation, la formation, la santé, la sécurité et la retraite de base. Leur financement se fait principalement par l’impôt : ils ne sont pas, sauf exception, liés au versement de cotisations, comme en France. Tous les citoyens bénéficient de ces droits, quelle que soit leur situation sur le marché du travail.Bruno Palier explique : « Gustav Möller, le « père » social-démocrate de l’Etat-providence suédois, disait : « Seul le meilleur est assez bon pour le peuple. »Dans les pays scandinaves, la protection sociale promeut une société active et entreprenante. Elle cherche à soutenir la productivité et la qualification de la population, et donc à garantir des emplois de qualité et de bons salaires à tous.Les pays scandinaves ont pris conscience que, pour être prospères et donner du travail à tout le monde, il fallait produire des biens de qualité innovants que l’on peut vendre cher et exporter. Pour arriver à ce résultat, ils garantissent la qualification de la main-d’oeuvre et la qualité des emplois, un système d’éducation et de formation professionnelle efficient, un niveau de vie élevé, en plus d’une aide sociale accessible à tous. Il faut beaucoup d’impôts pour le financer – donc des emplois bien rémunérés. »Je vous laisse lire l’article dans son intégralité, mais je retiens que si Bruno Palier reconnaît que beaucoup des propositions de Macron se rapprochent du système nordique. Notamment « il a compris la nécessité, pour l’Etat, de protéger les personnes et d’accompagner les parcours de vie ; il propose de mettre en place une assurance universelle pour tous les chômeurs et toutes les professions ; il entend réformer le système opaque du financement de la formation professionnelle, ce qui serait une avancée importante, car les plus âgés et les moins éduqués y accèdent peu ou pas du tout. »Il montre aussi qu’Emmanuel Macron s’éloigne des fondements et de la logique de ce système admirable en bien des points :« il ne semble pas avoir saisi que l’un des fondements du modèle, c’est l’égalité – pas seulement l’égalité des chances, mais aussi l’égalité des conditions. Une des conditions de la réussite est la compression de la fourchette des salaires. Ce n’est pas seulement un principe éthique égalitaire : il faut mettre en place une politique redistributive.Quand les hauts salaires ne sont pas trop élevés, les secteurs les plus productifs engrangent des surplus, qui alimentent l’investissement et autorisent de meilleurs revenus dans les secteurs moins efficients. Et quand les bas salaires sont rares et les minima sociaux élevés, les activités à valeur ajoutée se développent, pas les boulots inutiles et mal payés dont personne ne veut.Même si elles ont augmenté ces dernières années, les inégalités de revenus, au Danemark et en Suède, sont les plus basses du monde. Cette philosophie favorise une mobilité sociale ascendante et garantit une plus forte cohésion sociale. Je ne vois pas ce type de proposition chez Emmanuel Macron. […]Pour créer des emplois, Emmanuel Macron veut baisser les cotisations sociales, notamment en pérennisant le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Mais il ne fait que reprendre les recettes mises en œuvre depuis trente-cinq ans en France. Selon lui, la baisse des coûts du travail va sauver l’emploi.Nous sommes effectivement trop chers pour ce que nous produisons, mais la solution n’est pas de réduire nos cotisations : elle est de monter en qualité. […] En présentant la baisse des cotisations sociales comme sa façon de défendre le travail, Emmanuel s’éloigne du modèle scandinave. »Et en s’éloignant du modèle scandinave, Il se rapproche du modèle anglo-saxon dont je pense que nous autres français ne voulons pas. -
Mardi 11 avril 2017
«Ici, on ne prend pas les candidats au poste suprême avec des pincettes, mais plutôt avec un chariot élévateur. »Vincent Montgaillard journaliste
lors de sa visite dans le hangar où sont stockés presque un million d’affiches des candidats à la présidentielleLors de la revue de presse de dimanche sur France Inter, Frédéric Pommier a rapporté quelques informations sur l’intendance des élections présidentielles et notamment sur les panneaux qui se dressent devant les bureaux de vote et les affiches qui seront collés dessus :« Il ne reste que deux semaines avant le premier tour, et c’est ce soir, à minuit [C’était le 9 avril] que va débuter la campagne officielle. A partir de cette nuit, les portraits des 11 [candidats] vont donc être collés sur les panneaux en fer installés près des bureaux de vote.Des affiches stockées jusqu’ici dans un hangar, à Gonesse, au nord de Paris. Visite du lieu dans LE PARISIEN-DIMANCHE, avec le reportage de Vincent Montgaillard. « Ici, raconte-t-il, on ne prend pas les candidats au poste suprême avec des pincettes, mais plutôt avec un chariot élévateur. »– « Faut mettre Le Pen sur la palette ! », ordonne un manutentionnaire.– « Enlève-moi le Mélenchon ! », enchaîne son collègue.– « Et Macron, il est où ? »– « Dans la benne ! », blague un camarade dans un gilet jaune fluo.Bienvenue au cœur de la machine, dans cet entrepôt de 3.000 m², abritant un million de posters à la gloire des 11 concurrents. Quelques 700 personnes seront mobilisées pour aller les coller aux 80.000 emplacements de la métropole. C’est l’entreprise ‘France Affichage Plus’ qui pilote les opérations. Elle perçoit environ 2 euros par affiche collée, sachant que le collage officiel, comme l’impression des bulletins de vote, est pris en charge par l’État. Les frais n’entrent pas dans les comptes de campagne, et ils sont réglés par les préfectures, quel que soit le score électoral. « C’est ce qu’on appelle le coût de la démocratie », résume un responsable de la société, précisant que d’un département à l’autre, la tâche est inégale : en Lozère, par exemple, chaque candidat est placardé à 262 reprises, mais dans Nord, c’est 13 fois plus. D’ici une semaine, tout devrait être prêt. Cela dit, légalement, indique mon confrère, « les petites mains ont jusqu’à la veille du scrutin pour achever leur marathon ».Mais lors de cette revue de presse, j’ai appris autre chose, certains prétendent que le score pourrait être influencé par le numéro du panneau :« C’est en tout cas ce qu’estiment différents experts : d’après eux, les portraits aux deux extrémités bénéficient d’une meilleure visibilité – il s’agit donc du panneau 1 et du 11, avec une préférence pour le number one, le panneau tout à gauche, censé être celui qu’on distingue le mieux. C’est par tirage au sort, au Conseil Constitutionnel, que les 11 panneaux ont été attribués à chaque candidat. Et Nicolas Dupont-Aignan peut se réjouir : c’est lui qui a hérité du panneau number one. Autre vainqueur de la loterie : celui, donc, dont le portrait va figurer tout à droite, sur le panneau 11 – il s’agit de François Fillon. »Et à la fin de sa chronique Frédéric Pommier en s’appuyant sur le Figaro annonce pour les prochaines présidentielles de 2022 la naissance d’une nouvelle étoile dans le ciel, étoile qui serait aussi brillante que l’étoile polaire :« une nouvelle étoile en 2022 ! Chose rarissime, mais les astronomes semblent vraiment y croire : une nouvelle étoile, aussi brillante que l’étoile polaire, devrait donc apparaître dans cinq ans . Ce sera pile-poil au moment de la prochaine élection présidentielle en France.»<Cette annonce avait faite dans un blog du Monde dès janvier 2017>
Dans cet article on apprend que cette annonce a été faite par Larry Molnar astronome américain du Calvin College du Michigan qui avec son équipe suit de près deux étoiles invisibles à l’œil nu, situées à quelque 1 800 années-lumière de nous dans la constellation du Cygne.Ces deux étoiles se rapprochent et pourraient fusionner. Ce qui ne constitue pas pour des étoiles un mariage durable mais plutôt un baiser de la mort. On apprend dans cet article que la fusion crée en effet des chocs entre différentes couches de matière et, en fonction de la masse des étoiles et de la dynamique du processus, une bonne partie de la matière est susceptible d’être éjectée du système dans un véritable feu d’artifice. La nova pourrait être visible pendant des semaines voire des mois.Larry Molnar annonce cela pour mars 2022.Mais d’autres scientifiques sont sceptiques.Dans quel monde vivons-nous si désormais les promesses des scientifiques sont aussi peu crédibles que celles des politiques ?En tout cas, en mars 2022 nous pourrons juger de la réalisation des promesses de celle ou celui qui sera élu le 7 mai 2017 et de la promesse de Larry Molnar en regardant dans le ciel l’apparition d’une étoile aussi brillante que l’étoile polaire. -
Lundi 10 avril 2017
« Pas pauvre, mais modeste Oui ! »François MorelJ’écoute les analystes politiques, les économistes, les intellectuels pour m’éclairer sur notre société, sur ces élections présidentielles invraisemblables, désespérantes et qui révèlent des comportements et des « traditions » probablement très anciens mais qui nous paraissent de plus en plus choquants.Mais ce sont souvent les poètes et quelquefois les humoristes qui expriment de la manière la plus forte, la plus limpide la réalité et le fond des choses de la vie.J’ai plusieurs fois cité, François Morel qui est à la fois humoriste et poète.Sa chronique de vendredi : a fait la synthèse de 3 faits :L’affirmation de Brigitte Fontaine qui réfutait le qualificatif de modeste en affirmant qu’on l’utilisait pour le substituer à celui de pauvre.
L’aveu de François Fillon qu’il ne parvenait pas à mettre de l’argent de côté ;
Et enfin parmi toutes les affaires qui révèlent le personnage, l’épisode du costume sur mesure offert par un ami et qu’il a rendu, selon ses affirmations.
Comme François Morel, je suis issu d’un milieu modeste, je n’en fais plus partie mais je garde la mémoire de mon enfance et ce que dit François Morel me parle.Certainement à beaucoup de vous aussi :« Monsieur Fillon n’arrive pas à mettre de l’argent de côté.Et moi je ressens de la sollicitude, je comprends ce que signifie ne pas mettre de l’argent de côté, car je viens moi-même d’un milieu modeste.Récemment, Brigitte Fontaine s’énervait en disant qu’elle détestait le mot « modeste » que l’on employait selon elle par fausse pudeur quand on n’osait pas prononcer le mot « pauvre ».Mais je ne suis pas d’accord Brigitte. Je ne dirais jamais que je viens d’un milieu pauvre, mais d’un milieu modeste Oui !Ce n’est pas une hypocrisie, c’est une exactitude.Je viens d’un milieu modeste. Je ne m’en flatte pas, je ne m’en cache pas non plus, c’est comme ça. Je n’ai pas à m’en prévaloir, je n’ai pas à en avoir honte c’est ainsi il faut bien être de quelque part.Laissez-moi ce repère ou je perds la mémoire.Modeste, c’est presque la définition que donne François Fillon : c’est ne pas pouvoir mettre de l’argent de côté. Si on a déchiré son pantalon, on fait une reprise. […] Si on a un costume trop petit parce qu’on a grandi des jambes, des bras, de partout, c’est le petit frère qui hérite du costume.Ce n’est pas la misère, pas du tout, c’est la vigilance. Ce n’est pas le dénuement, l’indigence, c’est l’économie nécessaire, obligatoire.Modeste, ce n’est pas pauvre, non Brigitte !Pauvre c’est quand on n’a pas assez à manger, quand tout le monde vit dans la même pièce, […] quand le présent est incertain, quand l’avenir est sans lendemain, ce n’est pas pareil !Modeste c’est ric rac, c’est sur le fil, c’est comparer les prix, c’est faire attention à tout, c’est être sur le qui-vive.Modeste cela demande des talents d’ingéniosité, d’économiste, d’équilibriste. Modeste ça veut dire qu’on ne roule pas sur l’or, mais qu’on arrive quand même à payer les factures.Modeste ça veut dire qu’on doit faire attention tout le temps, sinon la pauvreté [qu’on redoute, qui fait peur] celle dans laquelle on pourrait tomber [pourrait en être la conséquence].Dans les milieux modestes, on ne connait personne qui pourrait nous offrir des costumes [neufs, sur mesure], jamais, cela n’existe pas !.On peut avoir des amis qui viennent avec une bonne bouteille. On peut avoir des copains qui viennent avec des fleurs cueillis dans le jardin, des légumes ramassés dans le potager. Mais qu’ils viennent avec un costume neuf en cadeau, ça non, non …Dans un milieu modeste on peut avoir une tante ou un oncle plus argenté, qui à Noël fait des cadeaux somptueux : une Nintendo switch, un smartphone, une machine à café ou même une salière électrique !Dans un milieu modeste quand on achète une salière électrique, cela s’appelle faire une folie. Après tout le reste de sa vie, la salière électrique, on la regarde de travers.Et même le parrain, celui qui a une bonne place [qui travaille dans une entreprise où tout le monde rêverait de travailler], il ne pourrait pas offrir un costume. D’abord les costumes c’est personnel, c’est comme les slips, on en achète soi-même quand c’est nécessaire. Mais moi je n’ai jamais vu quelqu’un offrir un costume, surtout un costume sur mesure.C’est pourquoi, quand les gens modestes ont entendu que Monsieur Fillon avait rendu son costume sur mesure, ils ont trouvé que c’était dommage puisque le costume avait été fait spécialement pour Monsieur Fillon […] et que forcément sur quelqu’un d’autre il ne tombera pas si bien.Vu qu’il était fait […] autant le porter. Surtout que maintenant il va peut-être rester sur un cintre et personne ne voudra le porter. C’est dommage, un costume qui a couté de l’argent, fait travailler tout un tas de petites mains.Les gens modestes, pas les pauvres Brigitte ! Les pauvres ils considèrent cette histoire comme de la science-fiction. Les gens modestes, ils se disent comment voulez-vous mettre de l’argent de côté quand lorsqu’on vous fait un cadeau vous ne l’utilisez pas ?Les gens modestes, ils n’en reviennent pas ! Il aurait mieux valu le porter et le rembourser à son copain. Parce qu’un costume c’est toujours utile […]On ne peut pas prévoir le résultat des élections…Les chances de Monsieur Fillon d’entrer à l’Elysée ne sont peut-être pas pauvres, mais modestes Oui ! »Dans aucun autre pays comparable, François Fillon ne pourrait continuer à se présenter !Mais le problème n’est pas Fillon, il est que presque 20% et peut être davantage de français sont prêt à voter pour lui !Les français sont vraiment étonnants.Vous pourrez me dire : Tu as peut être raison, mais si on considère qu’aucun autre candidat n’est sérieux, il faut bien voter pour lui !Cette élection montre combien il devient nécessaire de prendre en compte le vote blanc, ce qui signifie que les électeurs peuvent voter majoritairement « blanc » et que cela a pour conséquence de renvoyer tous les candidats à l’élection en cause à la maison et qu’il faut appeler à une nouvelle élection avec d’autres candidats !Elle montre aussi que l’élection présidentielle qui désigne un monarque républicain devient totalement décalée par rapport à notre société moderne. Sur ce point Mélenchon a raison ! Mais s’il était élu fera t’il ce qu’il dit ?Philippe Meyer dans son émission d’hier <L’Esprit Public> a cité deux de ses anciens invités habituels :Et Jean-Louis Bourlanges : «Avant, les élections c’était des salauds élus pas des cons, aujourd’hui c’est le contraire.» -
Vendredi 7 avril 2017
« Le wagon plombé »Stefan Zweig : Dernier récit du livre <Les très Riches Heures de l’Humanité>Dimanche prochain nous serons le 9 avril 2017.Le mot du jour du 15 mars rappelait que le 15 mars 1917, le tsar de Russie Nicolas II avait abdiqué au profit de son frère, le grand-duc Michel qui avait décliné l’honneur. La Russie allait devenir pour quelques mois une République démocratique. C’est l’aboutissement de la révolution de Février (calendrier russe) qui a commencé le 8 mars (23 février) 1917.Et ce qui va se passer, le 9 avril 1917 entre la Suisse et la Russie est l’objet du dernier récit de l’ouvrage « Les très riches Heures de l’Humanité » de Stefan Zweig : « Le Wagon plombé ».Stefan Zweig est un immense écrivain autrichien, pacifiste et humaniste qui a vécu la première guerre mondiale puis la montée du nazisme comme une tragédie personnelle qui l’a conduit au Suicide au Brésil le 22 février 1942 à l’âge de 60 ans. Il est l’auteur étranger le plus lu en France. Il travaille durant plus de vingt ans à son recueil de nouvelles <Les Très Riches Heures de l’humanité> qui retracent les douze événements de l’histoire mondiale les plus marquants à ses yeux.La première de ses nouvelles est la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453 et la dernière « Le Wagon plombé »Voici comment commence ce récit :« Le wagon plombéLénine, 9 avril 1917L’homme qui habite chez le cordonnierLa Suisse, petit havre de paix, contre lequel se brisent de tous côtés le raz-de-marée de la guerre mondiale, ne cesse d’être en ces années 1915, 1916, 1917 et 1918 la scène d’un passionnant roman d’espionnage. Dans les hôtels de luxe, les employés des puissances ennemies se croisent froidement, comme s’ils ne s’étaient jamais rencontrés, alors que, un an auparavant, ils jouaient encore amicalement au bridge et s’invitaient les uns chez les autres.[…]Tout est signalé, tout est surveillé ; à peine un allemand – quelque soit son rang – est-il arrivé à Zurich qu’on le sait déjà à l’ambassade ennemie à Berne, et une heure plus tard Paris. […]Seul un homme fait l’objet de peu de rapports en ces jours-là, peut-être parce qu’il est trop insignifiant et qu’au lieu de descendre dans les grands hôtels, être assis dans les cafés, d’assister aux manifestations de propagande, il habite, complètement retiré, avec sa femme chez un cordonnier. […]Ce petit homme trapu est discret et vit de façon aussi discrète que possible. Il évite la société, les habitants de la maison croisent rarement le regard perçant et sombre de ses yeux légèrement bridés, il reçoit très peu de visites. Mais régulièrement, jour après jour, il se rend à neuf heures du matin à la bibliothèque et il reste assis la jusqu’à ce qu’elle ferme à midi. À 12h10 exactement il est à nouveau chez lui, à une heure moins dix il quitte la maison pour être de nouveau le premier à la bibliothèque, et il y reste jusqu’à six heures du soir. Or les informateurs ne prêtent attention qu’aux gens qui parlent beaucoup, ils ne savent pas que lorsqu’il s’agit de révolutionner le monde, les plus dangereux sont toujours les individus solitaires qui lisent beaucoup et s’instruisent ; c’est pourquoi ils n’écrivent pas de rapport sur l’homme insignifiant qui habite chez le cordonnier. […]Mais personne n’accorde importance à ce petit homme au front sévère, il n’y a pas trois douzaines de personnes à Zurich qui jugent utile de retenir le nom de ce Vladimir Illitch Oulianov, […] Lénine.Un jour, le 15 mars 1917, le bibliothécaire de la bibliothèque de Zurich s’étonne. L’aiguille marque neuf heures et la place occupée chaque jour par le plus ponctuel de tous les usagers est vide. 9h30, 10 heures : le lecteur infatigable ne vient pas, il ne viendra plus. En effet, sur le chemin de la bibliothèque un ami russe l’a abordé ou plutôt assailli en lui annonçant que la révolution a éclaté en Russie. […]. »Stefan Zweig explique alors le désir de Lénine de regagner la Russie, mais sa difficulté de traverser la France ou l’Italie pays allié de la Russie qui l’arrêterait en tant que révolutionnaire ou de traverser l’Allemagne pays ennemie de la Russie qui l’arrêterait en tant que ressortissant de l’ennemi.Mais l’Allemagne va accepter que ce révolutionnaire qui pourra déstabiliser la Russie passe sur son territoire pour regagner son pays natal. Et Lénine, en fin stratège qu’il est, ne demandera pas au ministre plénipotentiaire allemand l’autorisation de traverser le territoire allemand mais lui donnera les conditions dans lesquelles il acceptera de passer par l’Allemagne pour regagner la Russie.Le négociateur de Lénine sera Fritz Platten, un Suisse alors membre du parti socialiste ouvrier zurichois. Les conditions du « transfert » de Lénine en Russie seront :Fritz Platten accompagnera les « émigrés » russes et sera le seul interlocuteur des autorités allemandes lors du voyage,
Le droit d’exterritorialité sera reconnu au wagon et l’identité de ses occupants ne sera pas contrôlée,
Le transit sera effectué sans interruption et personne ne pourra descendre de la voiture.
L’Allemagne est pressée, le 5 avril 1917, les Etats-Unis ont déclaré la guerre à l’Allemagne.Le 6 avril, Fritz Platten, reçoit cette réponse : « Affaire réglée dans le sens souhaité »Et je redonne la plume à Stefan Zweig :« Le 9 avril 1917, à 2h30, un petit groupe de gens mal habillés, portant des valises [se dirige] vers la gare de Zurich. Ils sont en tout 32, on comptant les femmes et les enfants. En ce qui concerne les hommes, seuls les noms de Lénine, de Zinoviev et de Radek sont passés à la postérité. […]Leur arrivée à la gare ne fait nullement sensation. Aucun reporter n’est venu, aucun photographe. […]À 3h10, le contrôleur donne le signal. Et le train se met en route pour Gottmadingen, la gare frontière allemande. 3h10 : à partir de cet instant la pendule du monde tourne différemment.Le train au wagon plombéDes millions de projectiles destructeurs ont été lancés au cours de cette guerre mondiale, les ingénieurs ont imaginé les engins balistiques les plus puissants, les plus violents, à la portée la plus grande. Mais dans l’histoire contemporaine aucun projectile n’eut plus de portée et ne fut plus décisif que ce train, chargé des révolutionnaires les plus dangereux les plus résolus du siècle, et qui, une fois franchie la frontière suisse, file à travers l’Allemagne pour gagner Saint-Pétersbourg où il fera voler en éclats l’ordre du monde. »Et Stefan Zweig termine ainsi son texte :« Lorsque le train pénètre dans la gare de Finlande à Saint Pétersbourg, l’immense place devant la gare est remplie de dizaines de milliers d’ouvriers, des gardes d’honneur de toutes les armes attend celui qui revient d’exil, l’internationale retentit. Et au moment où Vladimir Ilitch Oulianov s’avance sur la place, l’homme qui avant-hier encore habitait chez le cordonnier est aussitôt saisi par des centaines de bras et hissé sur une automobile blindée. Des toits des maisons et de la forteresse, des projecteurs sont braqués sur lui et du haut de l’automobile blindée, il adresse son premier discours au peuple. Les rues frémissent : les « dix jours qui ébranlèrent le monde » vont bientôt commencer. Le projectile a atteint son but, et il va détruire un empire, un monde. »On connaît la suite : l’insurrection est lancée dans la nuit du 6 novembre au 7 novembre 1917 (24 et 25 octobre du calendrier julien russe), les bolcheviks sous la direction de Lénine vont s’emparer du pouvoir et créer l’URSS.L’Allemagne a fait le bon choix de laisser passer le wagon plombé : Les bolcheviks signent l’armistice avec l’Allemagne dès le 15 décembre 1917 et le 3 mars 1918, les bolcheviks signent le traité de Brest-Litovsk qui ampute la Russie de 26 % de sa population, 27 % de sa surface cultivée, 75 % de sa production d’acier et de fer.Les Bolcheviks et le Léninisme resteront au pouvoir moins d’un siècle. Mikhaïl Gorbatchev démissionnera de la présidence de l’Union soviétique le 25 décembre 1991 et la dissolution de l’Union Soviétique sera effective le 26 décembre 1991, 74 ans après 1917.Des millions de morts furent la conséquence de ce rêve fou et totalitaire.Et que devinrent les autres voyageurs du wagon plombé ?Karl Radek, deviendra commissaire à la propagande et sera fusillé en 1939.Zinoviev, qui dirigea le Kominten sera fusillé en 1936.Quant à Fritz Platten, il sera fusillé en 1942PS : Il faut cependant noter que la date du 9 avril donnée par Stefan Zweig pour le début de ce voyage est controversée, il apparait certain que Lénine est revenu en Russie en avril 1917,Dès son retour il a écrit les thèses d’avril, il fallait donc qu’il soit en Russie ce mois.Sur ce site, il est affirmé que Lénine est rentré en Russie le 3 avril.Mais en raison du récit de Stefan Zweig, la date du 9 avril 1917 reste dans l’Histoire. -
Jeudi 6 avril 2017
« Innovation Automatisation et emplois,
et si cette fois c’était différent ? »Christian ChavagneuxUne des grandes questions de l’avenir est celle de savoir s’il y aura du travail inséré dans l’économie pour tout le monde.Benoit Hamon a abordé cette question. Tous les autres rejettent cette question et la considère comme presque obscène.La grande masse des économistes, avec cependant des exceptions comme Daniel Cohen par exemple, reste dans la croyance de la pensée de l’économiste Schumpeter (1883-1950) : « La destruction créatrice », c’est à dire que les évolutions technologiques détruisent des métiers et des emplois anciens mais en créent parallèlement plus dans de nouveaux secteurs. Ces nouveaux emplois sont plus productifs et donc potentiellement plus rémunérateurs.C’est la « leçon de l’Histoire » disent ces croyants.A vrai dire, on n’en sait rien !Mais ce que j’entends et je lis, c’est qu’en face de cette croyance, les personnes qui pensent le contraire présentent des arguments plus convaincants pour l’instant.Un nouvel exemple se trouve dans un article d’Alternatives économiques du journaliste Christian Chavagneux qui présente un livre d’un britannique Ryan Avent : « The Wealth of Humans: Work and its Absence in the Twenty-First Century »En voici de larges extraits :« L’innovation s’accompagne toujours d’un processus de « destruction créatrice » : oui, des emplois sont perdus lors d’une révolution technique, mais d’autres sont créés et, une fois les pertes compensées par les créations, tout rentre dans l’ordre et l’emploi global progresse. Telle est la vision des technoptimistes. […]Il existerait une sorte de loi naturelle de l’économie qui ferait que le nombre d’emplois créés finit toujours par compenser – et bien au-delà – le nombre d’emplois détruits.Sauf que les mécanismes stabilisateurs habituels qui ont accompagné ce mouvement lors des précédentes révolutions industrielles pourraient ne plus être présents demain, explique le Britannique Ryan Avent dans un livre récent.Hier, une révolution technique s’accompagnait de la création de nombreux postes de travail non qualifiés : fabriquer des voitures dans des usines mécanisées contribuait à créer ce type de postes. Aujourd’hui, Uber dit au grand public qu’il crée des emplois pour des non qualifiés… mais explique aux investisseurs qu’ils doivent lui prêter leur argent, car elle sera la première entreprise de taxi sans chauffeurs. Rien ne nous dit que les services vont créer une masse importante d’emplois non qualifiés.Hier, l’innovation technique était riche en gains de productivité. Si l’on en croît certains économistes, de Robert Gordon à Patrick Artus en passant par Paul Krugman ou Daniel Cohen, nous sommes peut-être entrés dans une période de stagnation séculaire, une longue période d’innovations à faibles gains de productivité. Passer de la diligence au TGV accroît la productivité. Passer de la réservation d’un billet de TGV dans une agence de voyage à celle sur Internet aussi mais beaucoup moins, sans parler d’envoyer des vidéos sur Snapchat ou de jouer au dernier jeu à la mode…Hier, les gains de productivité liés à l’innovation étaient redistribués. Henry Ford a doublé les salaires et réduit le temps de travail. Aujourd’hui, les richesses se concentrent entre les mains de quelques-uns, bénéficiant de dividendes ou de rentes de la propriété intellectuelle. Google fait d’importants progrès dans la voiture sans chauffeur et dans la prévention médicale. L’entreprise ne se transformera pas pour autant en producteur de voitures ou en labo pharmaceutique. Elle vendra ses innovations techniques pour capter la valeur ajoutée produite par d’autres secteurs dont les bénéfices seront donc concentrés entre les mains de quelques-uns.Enfin, hier, on a pu redonner des emplois à ceux qui les perdaient en les formant, en accroissant le niveau d’éducation. C’est d’ailleurs l’argument traditionnel des technoptimistes : face à une révolution technique, il n’y a qu’à former les gens aux nouvelles façons de faire. Or, aujourd’hui avec 80 % d’une génération au bac, la progression du niveau scolaire sera plus limitée. De plus, comme l’indiquait The Economist récemment, la part des très qualifiés dans l’emploi est en train de baisser aux Etats-Unis. Mieux vaut un diplôme pour avoir un emploi, mais une formation n’est plus la garantie d’en avoir un avec certitude.Au final, il est clair que le travail non qualifié – et peut-être aussi en partie qualifié – appartient aux perdants de l’automatisation. Si la destruction a bien lieu mais pas la création, il y aura alors abondance d’offre de travail pour une faible demande. Les prix et les salaires diminueront, incitant à une sortie du marché du travail et à une montée des inégalités.Les gagnants sont les actionnaires, les rentiers de la propriété intellectuelle, mais aussi les rentiers du foncier et de l’immobilier.Savez-vous que la Silicon Valley connaît une diminution de sa population ? La masse des habitants ne peut suivre le niveau de vie des quelques start-upers.Dès lors, est-ce si idiot de chercher les moyens de redistribuer les gains de l’automatisation dont on peut penser qu’elle fera plus de perdants qu’avant pour un petit nombre très concentré de gagnants ? » -
Mercredi 5 avril 2017
«J’essaye d’expliquer à un ami américain comment, dans un pays qui a organisé des primaires, il peut y avoir un débat à 11 candidats à la télé »Thomas Snegaroff sur twitterEt évidemment l’américain ne comprend pas.Notons qu’un français ne comprend pas qu’un candidat peut être élu président alors que son adversaire a près de 3 millions de voix de plus.C’est la relativité de toute chose et la difficulté pour les nations de se comprendre… -
Mardi 4 avril 2017
« Quand on pense… Qu’il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende pas ! »Coluche «Misère, Coluche, album Coluche : l’intégrale, vol. 3, 1989 chez Carrère.»Cette pensée de Coluche a été citée par Thierry Marx lors de l’émission évoquée hier dans laquelle il était question de la manière dont nous nous nourrissions et de de l’importance que nous accordions à l’alimentation.
Dans le domaine de l’alimentation, et des conséquences que cela implique pour le modèle agricole, notre responsabilité, notre influence, notre capacité d’agir se trouve, beaucoup moins dans notre «droit de vote» que dans nos «actes de consommation». Mais cette pensée dépasse la seule alimentation.
Je suis de plus en plus convaincu que notre plus grand pouvoir, celui dont nous disposons pour influer sur le monde, est celui de notre choix de consommer ou de ne pas consommer, tel ou tel produit, tel ou tel service.
Dans plusieurs mots du jour ce sujet de ce que nous consommons, de ce que notre consommation dit de nous, ce qu’elle signifie pour le monde dans lequel nous vivons, a été abordé.
Le mot le plus terrible a été celui du philosophe allemand Peter Sloterdijke qui écrivait : «La liberté du consommateur et de l’individu moderne, c’est la liberté du cochon devant son auge. » (Mot du jour du 30 octobre 2013).
Dans le même esprit, mais un plus doux, le mot du jour du 14 avril 2014 citait Annie Arnaux : «Je suis de plus en plus sûr que la docilité des consommateurs est sans limite.»
Annie Arnaux avait écrit un livre à teneur sociologique sur un Hypermarché qu’elle fréquente souvent : «Regarde les lumières mon amour», il s’agit des paroles d’une maman à son enfant en montrant des lumières de Noël qui illuminaient les escalators du temple de la consommation décrit par Annie Arnaux
Le 14 mai 2013, après le drame de l’usine textile du Bengladesh, (l’immeuble de neuf étages qui s’est effondré près de Dacca le 24 avril, avait fait 1 127 morts), deux chercheurs en sciences humaines, Michel Wieviorka et Anthony Mahé, posaient cette question terrible : « Sommes-nous capables de regarder en face (la vie de) ceux qui nous permettent de consommer comme nous le faisons ? »
Nous voulons consommer beaucoup et le moins cher possible.
Lors du mot du jour du 11 février 2016, j’avais tenté une analyse sur notre trouble de la personnalité :
«En réalité nous sommes chacun 1/3 de producteur 1/3 de consommateur et 1/3 d’être social. Ce dernier tiers correspondant à celui qui contribue à l’Etat providence et qui bénéficie aussi de l’Etat providence.
C’est à ce dilemme que Jean-Paul Delevoye, le dernier Médiateur de la république, apportait cette évidence : « L’économie est mondiale mais le social est local !»
Eh bien nous avons accepté, comme une évidence, que celui qui devait être privilégié dans notre être oeconomicus c’était le 1/3 consommateur.»
Et le mot du jour du 20 Janvier 2016 citait le concept décrit par l’économiste et sociologue américain Thorstein Veblen décédé en 1929 : « La consommation ostentatoire »
Veblen expliquait que la consommation est statutaire, elle sert à celui qui en fait un « usage ostentatoire » à indiquer un statut social.
« Le besoin de consommer et de posséder compense la peur de ne pas être reconnu et d’être faible.»
Dans cette explication l’acte de consommer est destiné à se sentir exister par le regard des autres, qu’on imagine envieux et admiratifs.
Je finissais cette chronique par cette conclusion : « Le mot du jour n’a aucune vocation de prêcher une morale mais simplement poser des questions auquel il appartient à chacun, s’il le souhaite, de répondre pour sa part.»
Le mot de Coluche a fait revenir dans ma mémoire ces quelques réflexions distillées lors de l’aventure des mots du jour. Descartes avait édicté cette sentence «Je pense donc je suis !». S’il revenait parmi nous aujourd’hui probablement qu’il dirait : «Je consomme donc je suis !».
<Vous trouverez cette citation et d’autres de Coluche derrière ce lien>
<867>
-
Lundi 3 avril 2017
« Le coq à deux culs »Expression dont vous comprendrez la pertinence à la fin de ce messageAprès le mot du jour de vendredi, nous continuons sur ce sujet fondamental : la bonne alimentation. Pour beaucoup la solution est le bio. Ce n’est pas faux, mais il est probable que ce n’est pas suffisant. Et il semblerait même que la situation risque de se dégrader.J’ai entendu une excellente émission sur France Inter qui donnait des pistes sur ce sujet : <Comment soigner son alimentation ?>Cette émission, le téléphone sonne du 23 décembre 2016 avait invité trois chefs cuisiniers : Thierry Marx, Flora Mikula et Arnaud Daguin pour essayer de répondre à cette interrogation.Arnaud Daguin : « La réponse à comment soigner son alimentation est collective, on ne peut pas laisser ce sujet à une instance ou à une association. Le marché de l’alimentation est entre les mains des consommateurs. On vote avec son caddy et sa carte bleue. »Flora Mikula, rejoint d’ailleurs par les deux autres, privilégie les produits et les producteurs locaux : « Il faut aller sur les marchés où viennent les vrais producteurs afin de savoir d’où viennent les produits que l’on mange. » Et elle dit simplement : « il ne faut pas vouloir des tomates en hiver » et Arnaud Daguin ajoute « Ou des tomates qu’on a transformé en été et qu’on a mis dans des bocaux » Mais Flora Mikula insiste : « Nous sommes dans un pays qui regorge de légumes, tous les mois il y a un légume nouveau qui sort de terre. Il faut que les gens sachent ce qu’ils consomment et décident de ce qu’ils ne veulent pas consommer. Cela demande aussi de lutter contre l’opacité des industries de l’agro-alimentaire.. »Arnaud Daguin parle « des 3 axes de valeur de notre alimentation : écologique, nutritionnel et économique. Le premier concerne l’écologie, le dérèglement climatique et la nature, ce produit est-il produit et transporté de manière compatible avec l’écosystème ? Le deuxième concerne la santé et la nutrition, bref la performance nutritionnelle et de santé. Le troisième c’est l’économie, la vraie pas celle de la finance. C’est-à-dire le prix qu’on paie au producteur lui permet-il de vivre et de se projeter dans l’avenir ? »:Ils ont ensuite abordé le sujet du label « bio » qui est aujourd’hui un label très visible et qui a vocation à désigner des produits de grande qualité nutritionnelle et produit selon une certaine éthique. Mais ce point commence à poser de plus en plus problème.Thierry Marx : « Le bio ce n’est pas l’avenir. Quand vous projetez le bio dans 10 ans, on peut penser que le bio aura été entièrement phagocyté par les industries agro-alimentaires qui ont les moyens d’investir, d’acheter les parcelles. »Et plus grave que cela les 3 chefs sont unanimes pour dire que les grands de l’agro-alimentaire sont avec la force de leur lobbying, en train de faire évoluer le cahier des charges du bio pour leur plus grand intérêt et s’assurer le contrôle de plus en large sur le marché du bio. L’augmentation de leurs profits étant directement liée à la diminution des contraintes exigées pour le label bio.Thierry Marx : « La grande distribution est de plus en plus acteur dans le marché du bio. Dans 10 ou 15 an, [le bio] ne sera plus une valeur sure. »Arnaud Daguin : « Le cahier des charges bio a eu une influence très positive sur les aliments, notamment en luttant contre les pesticides. Il est allé dans le bon sens, mais il ne suffit plus pour respecter les valeurs évoquées avant. »Flora Mikula parle « d’une agriculture raisonnée. Car aujourd’hui la motivation principale pour passer au bio c’est le revenu : la capacité d’augmenter le prix des produits »Pour Arnaud Daguin « Le bio ce n’est pas mauvais, c’est presque un pré-requis il faut aller plus loin. »Et il nous donne un moyen mnémotechnique pour s’interroger de manière utile et précise sur l’alimentaire et ce moyen est « Le COQ à deux Q » c’est-à-dire « Comment, Où, Qui, Quoi ? Dès qu’un client se pose ces questions, il commence à avoir des éléments de réponse sur ce qu’il est en train de manger. »Bref, on peut continuer à manger bio et aller dans les magasin bio mais en étant très attentif et en privilégiant les producteurs locaux et les circuits courts. -
Vendredi 31 mars 2017
« Les citoyens doivent exprimer leurs souhaits pour savoir ce qu’ils ont envie de manger »Bruno ParmentierSortons un peu du monde du concept politique pour aller vers la vraie vie. Pour vivre nous devons nous alimenter, nous nourrir.J’avais déjà fait appel à Bruno Parmentier pour le mot du jour du 7 avril 2015 «Nourrir l’Humanité», livre dans lequel il expliquait qu’il faut faire de l’agriculture autrement pour nourrir le monde.France Culture l’a invité pour parler de la crise de l’élevage et de l’agriculture française : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-idees-de-la-matinale/bruno-parmentier-passer-dune-agriculture-de-quantite-unSes explications claires et sa vision à long terme sont toujours rafraichissantes.« L’agriculture est à un véritable tournant. […]Il faut savoir qu’au XXème siècle, depuis l’arrivée de la richesse, nous n’avons cessé d’augmenter notre consommation de viande, en suivant les millésimes. Dans les années 20, on ne mangeait que 20 kilos de viande par tête de pipe [et par an], puis dans les années 50, 50 kilos de viande, dans les années 80 80 kilos de viande et au moment du tournant du siècle 100 kilos de viande. Seuls les naïfs pouvaient considérer que cela allait continuer. Raisonnons par l’absurde : on ne va manger 200 kilos de viande en 2100 et 300 kilos en 2200 ?Donc on voit bien que prolonger les courbes indéfiniment cela n’a pas de réalité.Et la viande est devenue moins à la mode et on a rebaissé de 200 kilos à 85 kilos. Et la baisse n’est pas finie […].L’appétence pour ces produits n’est plus ce qu’elle était au XXème siècle. Parce qu’on rêve de manger ce que nos grands parents ne pouvaient pas manger ou les ouvriers rêvaient de manger comme le patron, mais aujourd’hui le patron est végétarien. On voit bien que c’est passé de mode.Il y a de nombreuses manières d’aborder le problème : l’obésité, les maladies, le bien-être animal etc..»Il parle aussi du lait qui est aussi en surproduction, parce que les gens consomment moins de lait et donne comme perspective le vin :« Dans les années 50 on consommait 140 litres de vin par personne et par an, maintenant 40, on a divisé par plus de 3. Est-ce qu’il y a encore des viticulteurs ? Oui il y en a même à Carcassonne. Mais c’est fini la piquette. C’est fini la vente du vin au litre à moins d’un euro. Maintenant on vend du vin de 75cl à 4, 5, 10, 12 euros. On est passé de l’industrie de la quantité à une industrie de la qualité avec des signes de reconnaissance. Le consommateur a dit j’en prends moins mais je le paie. C’est un changement global du système de production.C’est une erreur de penser que l’on mange toujours pareil : on mange 3 fois moins de pain et 5 fois moins de pommes de terre. […]Penser que dans 30 ans on mangera exactement pareil, c’est évidemment faux. Si on n’anticipe pas ces changements de consommation et on n’accompagne pas …[on va vers de grandes désillusions].Quand l’Europe a constaté qu’on mangeait moins de viande en Europe, elle a financé de grandes campagnes de publicité pour encourager à manger du porc. Cela ne fonctionne pas. On mange moins de viande, c’est tout ![Si on n’accompagne pas] cette transformation, les éleveurs [ne peuvent être que] désespérés.»Je ne peux pas reproduire l’ensemble de ses propos tous très intéressants mais je voudrais insister sur cette vision comparative de la relation à la nourriture et à l’agriculture des habitants des divers pays européens ainsi que de la mise en garde qu’apporte sa conclusion..« On est 28 en Europe c’est très compliqué. Et il faut savoir que le rapport à la nourriture est très différent selon les pays.Dans l’entreprise que je dirigeais, il y avait un règlement intérieur qui disait : pas moins de 45 minutes pour déjeuner. Dans une entreprise en Angleterre, c’est pas plus de 10 minutes pour déjeuner. Et moyennant quoi, le rapport à la nourriture est très différente. Dans un cas on mange un sandwich au pain de mie avec du jambon carré et du fromage carré et on s’en fout du goût puisqu’on mange ça devant l’ordinateur et de l’autre côté on a envie de bien manger.Du côté où on a envie de bien manger et où on veut une agriculture de qualité c’est les pays latins : La Grèce, l’Espagne, l’Italie, la France, le Portugal. Mais on est très minoritaire. On l’a vu pendant la crise du porc, la majorité des européens, ils veulent des tranches de jambon carré pas cher. Pour faire des tranches de jambon carré pas cher, on fait de l’industrie [sans se soucier de la qualité].En Angleterre on utilise 9% de son salaire pour manger. En France c’est 14%, aux Etats-Unis c’est 7%. Mais en France c’était encore 40%, il y a 30 ou 40 ans.Les citoyens doivent aussi dire qu’est ce qu’ils veulent.Est-ce que la gastronomie anglaise et américaine nous fait tellement envie qu’on a encore envie de diviser par 2 notre coût pour l’alimentation ? et avoir des coûts de santé absolument fou parce qu’on mange n’importe quoi ?Ou est-ce qu’on se dit : bien manger en France aujourd’hui, c’est consacrer un peu plus de temps et un peu plus d’argent à cette activité essentielle.Cet argent nous permettra d’être en meilleur santé et d’avoir plus de plaisir et de convivialité.Mais quand on négocie en Europe c’est très difficile d’avoir une unanimité, puisque la majorité des pays veulent du jambon carré.Et le jambon carré, c’est de l’élevage de 2000 à 3000 porcs, complètement industriel, avec en Allemagne des bulgares payés au prix de la Bulgarie, des roumains payés au prix de la Roumanie et puis quand on est dans l’industrie c’est toujours les allemands qui gagnent pas les français.On pensait que l’Europe c’était les Français qui faisaient à manger pour les allemands et que les allemands nous vendaient des voitures. Mais maintenant les allemands nous vendent aussi des tranches de jambon carré.Bref : les citoyens doivent exprimer leurs souhaits pour savoir ce qu’ils ont envie de manger »Dans ce domaine comme dans d’autres, la question fondamentale est : dans quel monde voulons nous vivre ? -
Jeudi 30 mars 2017
«La confusion est un signe qu’on vit un moment de bascule»François Hartog, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences socialesManuel Valls est accusé d’être un traitre.Il me semble que du point de vue du français, « parjure » serait plus juste.Le parjure est celui qui viole un serment, or Valls a fait le serment en entrant dans la compétition des primaires de soutenir celui qui gagnerait.Il ne le fait pas.Le PS est très proche de l’explosion.François Fillon n’a pas encore perdu. Rien ne dit non plus que dans un second tour où François Fillon serait opposé à Marine Le Pen, cette dernière ne gagnerait pas.Mais si les prévisions s’avèrent juste, au lendemain de la défaite de François Fillon au premier tour, le parti des républicains explosera aussi.Il n’est pas certain non plus que Macron battra Marine Le Pen au second tour.Certains diront, il n’est pas certain que Marine Le Pen soit au second tour. Peut être, mais je n’y crois pas un instant, je pense plutôt que les sondages sous-estime le vote Front National.Nous sommes donc dans un moment de grande confusion.Si nous restons optimiste nous pouvons espérer que la confusion conduira à une reconstruction.Mediapart a invité un historien, François Hartog, pour qu’il jette son regard d’intellectuel sur notre moment présent que le journal présente avec les assertions suivantes :- Épuisement de la Ve République ;
- Désagrégation du bipartisme ;
- Possibilité de voir l’extrême droite accéder à la plus haute fonction du pays
Vous trouverez cet article, si vous êtes abonné, derrière <ce lien>J’en tire les extraits suivants :« Mediapart : Est-on en mesure de cerner ce qu’est un « moment historique » et si nous sommes en train d’en vivre un ?François Hartog : […] Il me semble alors qu’un des indices négatifs qui signale que l’on vit un « moment historique », c’est précisément l’aveuglement, le fait qu’on n’y voit rien, qu’on n’y comprend rien. Dans ce que nous vivons aujourd’hui d’un point de vue politique, on est frappés par la confusion généralisée, qui ne cesse de favoriser Marine Le Pen.Si on cherche à comparer avec des moments de bascule, comme la Révolution française, on constate a posteriori que c’était un moment d’extrême confusion. Les contemporains étaient complètement perdus, ne comprenaient pas ce qui se passait, refusaient de comprendre, croyaient comprendre et se trompaient…La perte des repères, les références qui n’ont plus de prise sur le moment, la désorientation et la confusion sont symptomatiques de moments de bascule. […]Quand on n’a que le présent comme base sur laquelle reposer, il est logique qu’on se retrouve perdus.Même ceux qui regardent vers le passé, et qui ont toujours existé, à savoir les réactionnaires et les nostalgiques, ne savent plus trop vers quel passé se retourner, vers quoi regarder. Les électeurs de Trump lorgnent vers l’Amérique d’après-guerre, de la grande expansion, qui était précisément une Amérique tournée vers l’avenir, alors même que l’idée d’aller vers l’émancipation, le progrès ou la croissance, sous la conduite des avant-gardes artistiques ou politiques, a du plomb dans l’aile depuis des décennies. . […]Hollande a été élu sur le slogan « le changement c’est maintenant », c’est-à-dire un slogan présentiste qui ne donne pas place au temps. Le changement est pourtant déjà un terme moins chargé et ambitieux que « progrès » ou « développement ». Dans la campagne présente, Benoît Hamon tente de réintroduire une perspective future avec l’idée d’un revenu universel qui, quoi qu’on pense de la proposition elle-même, renoue avec un des grands éléments structurants du socialisme, c’est-à-dire un certain idéalisme ou une part d’utopie. Le revenu universel, ce n’est pas pour maintenant, c’est un horizon, même si on peut se questionner pour savoir si c’est le bon. Ce rapport au temps fait place au futur, mais tombe immédiatement sous les critiques de ceux qui pensent que c’est irréaliste.Plus généralement, le problème est que les politiques qui font aujourd’hui campagne ont été élevés dans l’idée que leur raison d’être était de guider leur peuple vers le futur et de marcher vers la terre promise ou l’avenir radieux : une affaire qui a commencé avec Moïse… Mais, se retrouvant dans un univers où ce type de position et de posture n’est plus tenable, ils s’avèrent complètement perdus. On leur reproche tout le temps de ne pas avoir de vision, mais qui a une vision aujourd’hui ? La plupart des politiques ont donc théorisé le fait qu’il valait mieux de ne pas avoir de stratégie de long terme, pour se permettre d’être le plus réactif possible, comme dernière attitude politique payante dans un moment présentiste.Cette impossibilité de sortir du présent n’existe pas seulement en matière politique, elle domine également désormais le champ économique, avec la flexibilité à outrance, l’organisation de la production à flux tendus…[…]Marine Le Pen propose en réalité un retour à un avenir très daté, vers un monde mythifié. François Fillon promet un redressement dans la douleur qui me semble moins être une ouverture qu’une rupture avec ce qu’il estime être les calamités du socialisme. Mais Fillon et Le Pen n’utilisent pas le mot de « révolution », que Macron emploie. Même s’il y a une dimension marketing, cet usage est intéressant car il veut signifier la possibilité de regarder vers le futur. Il n’est d’ailleurs pas anodin que les deux candidats – Macron et Mélenchon – qui proposent une véritable vision du futur (numérique pour le premier, écologiste pour le second) soient aussi les deux candidats qui entretiennent un véritable rapport à l’Histoire. Ils montrent quelques capacités à s’affranchir du présent immédiat.[…]À ce titre, le parcours du mot « réforme » est intéressant. Le terme a été un grand mot de la politique au XIXe siècle, comme substitut de « Révolution », revendiqué par ceux qui se trouvaient du côté du mouvement, et contesté par ceux situés du côté de la réaction. Mais, désormais, la « réforme » est devenue quelque chose qui ne signifie qu’ajustement, remise à plat, adaptation, et qui aurait dû intervenir plus tôt. Ce mot est donc immédiatement et légitimement compris par tous les intéressés comme une régression. Alors que la « réforme » était porteuse d’espérance et d’un projet social et politique, c’est devenu un slogan. La « réforme » n’ouvre plus aucun avenir et a été rattrapée et s’est engluée dans le présentisme, au point qu’on vote des réformes qu’on n’a pas le temps d’appliquer avant la prochaine réforme…[…]Ce qui nous menace est-il davantage du registre de la catastrophe ou de l’apocalypse ? Et sur un plan politique, comment pourrait-on qualifier une victoire de l’extrême droite à la prochaine présidentielle ?L’apocalypse, c’est la fin du temps ou des temps, mais c’est aussi le début de tout autre chose, d’un nouveau ciel, d’une nouvelle terre. Au contraire de la catastrophe, l’apocalypse donne un sens à ce qui est enduré. La catastrophe est dénuée de sens ; elle vous tombe dessus et il n’y a pas grand-chose à comprendre.Pour les politiques, l’important est de tenter de prévenir les catastrophes, mais surtout de réagir rapidement lorsqu’une catastrophe se produit, sans essayer de comprendre mais seulement de compatir.Les catastrophes viennent se loger dans le temps, elles sont présentes dans le paysage.À ce titre, une victoire du Front national est désormais dans le paysage et Marine Le Pen ne promet ni un autre ciel, ni une autre terre. Cela relève donc davantage du registre de la catastrophe, de celles sur lesquelles on a préféré s’aveugler et qui nous paralysent au fur et à mesure qu’elles s’approchent.[…] »S’affranchir du présent immédiat, regarder vers le futur et peut être oserais-je ce mot : réenchanter la réforme qui aujourd’hui n’est plus vécu que comme une régression. -
Mercredi 29 mars 2017
«Macron»Nom patronymique dont les médias parlent beaucoup ces derniers temps.Que dire de cette présidentielle française 2017 ?Je vous propose de commencer par un éclairage un peu plus léger aujourd’hui.Il semblerait que Monsieur Macron, Emmanuel est son prénom aurait des chances selon les derniers oracles d’accéder à la présidence de la république pour succéder à François Hollande qui l’avait appelé auprès de lui d’abord pour le conseiller puis pour occuper le poste de Ministre de l’Économie.C’est une revue de presse qui donne cette information parue dans le bimestriel « CA M’INTERESSE »Le bimestriel ÇA M’INTERESSE HISTOIRE nous apprend que deux Macron se sont déjà illustrés dans le passéAu 2ème siècle avant Jésus-Christ, un certain Ptolémée Macron travaillait ainsi au service d’Antiochos IV, le gouverneur de l’empire perse séleucide. Un jour, son maître le charge d’envoyer une armée en Judée. Mais une fois arrivé sur place, Ptolémée Macron choisit de rejoindre les Juifs ; il passe donc dans le camp de l’ennemi. Imaginez un peu la tête d’Antiochos IV !Deux cents ans plus tard, en 37 après Jésus-Christ, un Macron romain cette fois-ci – Sutorius Macro, travaillait au service du vieil empereur Tibère. Mais il en avait marre – marre du vieux, grand besoin de changement – et pour accélérer l’accession au pouvoir du jeune Caligula, Sutorius Macro a décidé de tuer Tibère, en l’étouffant sous ses couvertures.L’empereur, pardon le président François Hollande n’a, heureusement, pas eu à subir le même sort de la part du Macron moderne.N’empêche, résume la revue : « Depuis 2.000 ans, Macron rime avec trahison. »Cela étant, doit-on vraiment détester les traîtres ? « Non », répond Manuela France qui signe le papier. On ne doit pas les haïr car les pros des coups bas ne sont pas tous d’affreux et vils calculateurs. Certains, au contraire, poursuivent un noble idéal, et ils sont finalement les moteurs de l’Histoire.Mais Emmanuel Macron fait-il partie de cette catégorie ? Lui qui a créé un mouvement qui a les mêmes initiales que son nom et qui a suscité cette belle interrogation de Frédéric Lordon : « En marche ! », soit ! Mais ne serait-il pas pertinent de s’interroger : en marche vers Où ?Le canard enchainé de mercredi dernier explique la modernité de cet O.P.N.I. : Objet Politique Non Identifié :« Mais comment fait Macron pour avoir l’air différent ? Fastoche : il suffit de commencer par le vocabulaire. Dans son QG de campagne, on ne parle pas de «bénévoles» mais de «helpers», qui causent «feedback» et «retour d’expérience». Waouh ! ça change tout ! Ou pas… Dans la start-up Macron, raconte le JDD (19/3) on ne cherche pas des slogans (beurk) : on «brainstorme» pour trouver des «messages snackables», c’est-à-dire «courts, qui vont attirer l’attention». A grignoter à tous les repas.Ici, le «business électoral» et le business tout court ne sont surtout pas des gros mots. «On organise des actions de terrain, puis on fonctionne beaucoup au feedback et on essaie d’améliorer très rapidement les process» raconte un «helper» qui adore sa nouvelle boite. «On a cette chance d’être nouveaux sur le marché» plane un autre, à l’autre bout de l’«open space». […]Dans cette novlangue pas du tout gadget, la star Macron n’a pas des supporteurs mais des «fans» qu’il s’agit de bichonner : ces veinards ont droit à des «live» (des vidéos) de leur idole, en toute «exclusivité».»On a compris, on présente et vend Macron comme un produit marketing.Faut-il donner sa chance à ce produit ?Florence Aubenas a fait une plongée dans les publics qui soutiennent Macron. Vous trouverez en pièce jointe le long article qu’elle a rédigé après cette enquête. -
Mardi 28 mars 2017
« Et alors ? »Expression ouverte ou fermée ?Michel Serres aime raconter des histoires à ses petits-enfants, le soir, avant le sommeil.Quand le lendemain, il demande « où en étions-nous ? », les enfants répondent invariablement, nous étions à « et alors… ».« Et alors » ouvre vers d’autres aventures, d’autres réflexions, d’autres connaissances.Dans le domaine scientifique chaque nouvelle découverte ouvre d’autres perspectives, conduit à s’interroger sur la suite, « et alors ? ».Mais certaines personnes entendent donner à l’expression « et alors ? » un effet de fermeture, de clôture de la discussion, sorte de « point à la ligne » et passer à autre chose.Ainsi François Fillon a répondu à un journaliste qui s’étonnait du cadeau d’un généreux mécène qui avait signé le 20 février un chèque de 13.000 euros pour le règlement de deux costumes achetés chez Arnys, un tailleur parisien des quartiers chics : « Un ami m’a offert des costumes en février. Et alors?»L’article du Parisien donné en lien continue : «J’ai payé à la demande de François Fillon», a affirmé cet «ami généreux» au JDD. A cela s’ajouteraient selon l’hebdomadaire près de 35.500 euros «réglés en liquide» chez ce tailleur, pour un montant de près de 48.500 euros au total depuis 2012. »« Et alors ? »Je ne voudrais pas m’acharner sur cet étonnant personnage qui reprochait à Nicolas Sarkozy, ses relations compliquées avec la Justice et les « Affaires » et qui avait, alors qu’il était Premier Ministre en 2007, commis <cette circulaire> où on peut lire : «Il est en conséquence normal que [les cadeaux] n’entrent pas dans le patrimoine personnel du ministre ou de sa famille. Ce principe doit être concilié avec la nécessité de ne pas désobliger les personnalités, notamment étrangères, qui souhaitent honorer des membres du gouvernement ou leur conjoint.» et pour lequel on apprend que précisément en 2009, toujours Premier ministre, François Fillon s’était fait offrir une montre de plus de 10.000 euros. Un cadeau « absolument désintéressé » de l’homme d’affaires italo-suisse, Pablo Victor Dana.« Et alors ? »Cette nouvelle révélation a conduit à ce commentaire d’un député LR désabusé : « François Fillon, c’est un peu comme un calendrier de l’avent, sauf qu’à chaque fois qu’on ouvre une case on ne trouve pas un chocolat, mais une nouvelle affaire. »Mais, il faut dépasser le cas de François Fillon, si on veut mener une réflexion honnête et intègre.Car le Canard Enchaîné nous apprend que l’ancien Ministre de l’Economie aujourd’hui commissaire européen, Pierre Moscovici, s’était aussi fait offrir des costumes par un ami chez Arnys, le même tailleur parisien que François Fillon, rapporte Le Canard Enchaîné. Selon l’hebdomadaire satirique, les faits sont antérieurs à 2012. A cette époque, les parlementaires n’étaient pas tenus de déclarer les dons qu’ils recevaient.Interrogé mardi à l’occasion d’un point-presse avec Benoît Hamon à Bruxelles , Pierre Moscovici a confirmé les informations du Canard Enchaîné et a déclaré :« Ce n’est pas tout à fait le lieu pour parler de cette affaire, mais je ne suis pas du tout embarrassé par cela, dès lors que ce sont de vrais cadeaux par de vrais amis, dans un vrai cadre privé».Version un peu plus longue, mais il dit de la même manière « Et alors ?»Et…L’hebdomadaire <Challenges> nous apprend que Brigitte Macron est habillée gracieusement par la marque Vuitton. Il ne s’agit cette fois pas de cadeau mais de prêt. Le point commun est que cela reste gratuit.« Et alors ? »Et si au lieu de clore la discussion par « Et alors ? », nous l’ouvrions…Et alors ? on s’étonne du peu de vigueur pour la lutte contre les paradis fiscaux, on constate sur les affaires financières comme sur les sujets de santé publique l’importance des lobbys et les décisions étonnantes qui sont prises au niveau européen et national. Le sentiment généralisé que les décisions prises ne le sont pas dans l’intérêt général mais dans l’intérêt particulier de certains.On nous explique que ces décisions sont nécessaires à cause de la mondialisation, de la liberté des échanges et que si nous n’avions pas une réglementation en phase avec cette situation les capitaux et le dynamisme économique fuiraient nos pays pour des contrées plus favorables.Peut-être …Mais tous ces cadeaux désintéressés d’amis fortunés créent la suspicion et racontent une autre réalité.Pourquoi, nous qui avons également des amis désintéressés, ne nous font-ils pas des cadeaux de 10 000 euros ?Parce qu’ils ne sont pas aussi riches ?Ou parce que nous n’avons pas le pouvoir pour influer sur des décisions ou des réglementations ayant un lien étroit avec le business ?Probablement que si nous étions dans une telle situation nous verrions rapidement surgir des «amis désintéressés riches».Tous ces responsables politiques devraient se souvenir de cette citation attribuée à Voltaire pour certains, à Gabriel Sénac de Meilhan pour d’autres :«Mon Dieu, protégez moi de mes amis [désintéressés]. Quant à mes ennemis, je m’en charge.» -
Lundi 27 mars 2017
« De l’art de dire des conneries »Harry Gordon FrankfurtEn me promenant dans la Bibliothèque de Lyon de la Part-Dieu, dans l’Espace Civilisation, mon regard a été attiré par un tout petit ouvrage : « De l’art de dire des conneries ».Comme dirait Annie, dire des conneries est banal, mais en faire un art est d’une toute autre ambition.L’auteur de cet ouvrage, dont le titre original est « On bullshit » est un philosophe américain Harry Frankfurt. Sa traduction française fut effectuée en 2006.Page 11, l’auteur nous apprend qu’il a écrit l’essai en 1984, à l’époque où il enseignait la philosophie à l’Université de Yale.Un de ses collègues avait alors affirmé que [dans la mesure] « où le corps professoral de Yale comptait dans ses rangs Jacques Derrida et plusieurs autres têtes de file du postmodernisme, il était fort approprié que cet essai ait été écrit à Yale qui est après tout la capitale mondiale du baratin ».Car page 17, cet essai commence par cette sentence « L’un des traits les plus caractéristiques de notre culture est l’omniprésence du baratin ».Le cœur de ce petit essai est la distinction entre le baratin et le mensonge.Et l’auteur explique « Le baratineur et le menteur donnent tous deux une représentation déformée d’eux-mêmes et voudraient nous faire croire qu’ils s’efforcent de nous communiquer la vérité. Leur succès dépend de notre crédulité. Mais le menteur dissimule ses manœuvres pour nous empêcher d’appréhender correctement la réalité, nous devons ignorer qu’il tente de nous faire avaler des informations qu’il considère comme fausses.Au contraire, le baratineur dissimule le fait qu’il accorde peu d’importance à la véracité de ses déclarations […].Personne ne peut mentir sans être persuadé de connaître la vérité. Cette condition n’est en rien requise pour raconter des conneries. » C’est-à-dire baratiner.Il me semble pertinent de s’intéresser à ce sujet en pleine campagne présidentielle française où la distinction entre les baratineurs et les menteurs me semble particulièrement décisive.Wikipedia nous apprend que Frankfurt, né en 1929, a utilisé l’essai « On Bullshit » comme base pour son livre suivant, publié en 2006, qui avait pour thème le désintérêt de la société pour la vérité et pour titre « On Truth (de la vérité) ».Un sujet d’une très grande actualité. D’ailleurs, la question «La vérité est-elle morte ? », est inscrite en grosses lettres rouges sur la couverture du dernier numéro du magazine américain TIME -
Vendredi 17 mars 2017
« C’est le chemin le plus important.»Michel SerresNous voilà au bout de 15 mots du jour, tous inspirés d’une interview de moins d’une heure de Michel Serres.
Et Emmanuelle Dancourt demanda (41:25 de l’interview) à Michel Serres de réagir à cette phrase :
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. »
Cette phrase attribuée au Christ et qui est énoncée au chapitre 14 verset 6 de l’Evangile selon Jean, m’apparait comme la phrase du totalitarisme religieux par excellence.
Il n’y a qu’une vérité dans ce monde-là, la vérité du dogme, la vérité du fondateur réel ou imaginaire.
Cette phrase a été enseignée pendant des siècles à des milliards de chrétiens. Pendant longtemps celles et ceux qui s’éloignaient de ce chemin, de cette vérité étaient persécutés et souvent tués.
J’étais curieux d’entendre la réponse de Michel Serres, celui qui affirme qu’il n’y a pas qu’une vérité.
Et il m’a à nouveau surpris, en examinant cette phrase sous un tout autre angle :
« Je crois que contrairement à ce que l’on croit, l’important dans cette phrase est le mot chemin.
Nous avons parlé des migrants. Nous sommes tout le temps en voyage. Et c’est le mouvement du voyage qui produit la vérité. Et c’est le mouvement du voyage qui révèle la vie.
Et je crois que le mot chemin est important : Homo viator »
L’être humain est un « Homo viator », un éternel itinérant poussé à quitter son sol natal pour aller toujours plus loin.
« L’homme est en train de voyager, l’homme est toujours en train de bouger.
C’est-à-dire que l’homme n’est pas ! il n’est pas là … Il est toujours en dehors de lui, il est hors là, il va quelque part. Il peut ! Il va quelque part.
Et je n’ai pas fini ma route. Et cette route-là, peu à peu, fera ce qui sera ma vérité si elle existe un jour. Mais ce sera certainement ma vie.
C’est le chemin le plus important »
 Dans un autre entretien, Michel Serres disait que vieillir, ce n’était pas une descente comme la décrivait certains mais bien un escalier où on montait, en apprenant chaque jour, en nous enrichissant de nouvelles connaissances et en nous délaissant toujours davantage de ce qui est futile et inutile.
Dans un autre entretien, Michel Serres disait que vieillir, ce n’était pas une descente comme la décrivait certains mais bien un escalier où on montait, en apprenant chaque jour, en nous enrichissant de nouvelles connaissances et en nous délaissant toujours davantage de ce qui est futile et inutile.
Et si sur notre chemin, nous pouvons faire, de ci de là, un peu de bien, ne nous en privons pas. Cela nous fait tellement de bien.
La semaine prochaine, nous allons prendre un peu de repos avec Annie, pour nous ressourcer. Le prochain mot du jour est prévu le 27 mars 2017.
<860>
-
Jeudi 16 mars 2017
« Il n’y a pas qu’une vérité. Il y a des milliards de vérité»Michel SerresTout à la fin de l’entretien (44:00), Emmanuelle Dancourt demande à Michel Serres :
« Pourquoi prenez-vous la nuit étoilée comme le modèle de notre savoir, alors que moi j’étais restée à la caverne de Platon. »
C’est, en effet, dans un ouvrage précédent « Yeux » que Michel Serres a développé cette contre-proposition à la Caverne de Platon
On se rappelle que selon cette allégorie, très importante dans la pensée occidentale, les humains sont enfermés dans une caverne et observent, sur une paroi, des ombres bouger. L’un d’eux s’échappe et découvre la vérité à la lumière du Soleil. Dans cette vision, « la vérité » se trouve en plein jour, le soleil est la vérité et il n’y en a qu’une.
Mais selon Michel Serres :
«La nuit est le modèle de notre savoir, pas le jour »
Alors quand Emmanuelle Dancourt repose sa question :
« Pourquoi vous faites-nous lever les yeux vers la nuit étoilée pour trouver la vérité ? ».
Michel Serres répond :
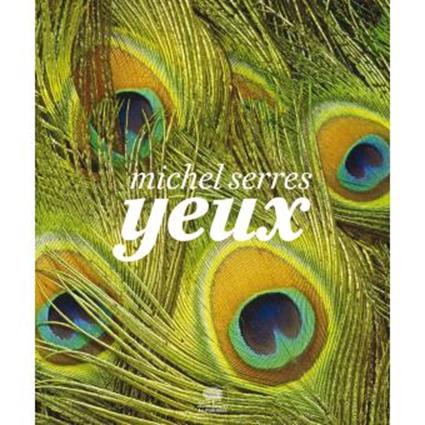 « Pour deux raisons :
« Pour deux raisons :
1° Si on prend le soleil et la journée comme modèle de la vérité. Il n’y a qu’une vérité, c’est le soleil. Et ce n’est pas vrai ! Il n’y a pas qu’une vérité !
Il y a des milliards de vérité, et ces milliards de vérité sont représentés par le ciel étoilé, par la totalité des constellations.
2° Et d’autre part si vous prenez la journée et le soleil comme modèle de connaissance, il n’y a pas de non-connaissance. Donc il n’y a pas de progrès, la connaissance vous est donnée d’un coup !
Tandis ce que dans la nuit, tous ces milliards de vérité sont sur un fond noir. Et ce fond noir c’est ce vers quoi je vais, pour essayer de comprendre.
Donc il y a du non savoir qui me promet encore un savoir nouveau.
C’est pourquoi le vrai modèle de la connaissance, c’est vraiment la nuit étoilée et pas le jour.
Le jour s’appelle l’idéologie. Et l’idéologie peut être cruelle, elle peut-être affreuse.
Le fait qu’il y ait qu’une vérité est abominable. Cela s’appelle l’intégrisme !
Et au nom de l’intégrisme, on tue, on massacre ! Alors qu’il y a des milliards de vérité.
On ne comprend pas, on n’estime pas assez l’avantage qu’a eu la religion chrétienne, d’avoir eu à se battre, sans arrêt depuis des siècles contre Galilée, contre Giordano Bruno, contre Darwin.
Et peu à peu elle a dû reculer et a dû s’apercevoir que Oui le soleil est au centre du système solaire, oui il y a des fossiles etc…Elle a dû feuilleter sa vérité. Elle est arrivée à dire : Oui il y a des vérités. […] Il y a un feuilletage de la vérité, c’est-à-dire le ciel étoilé.
Il s’agit d’un progrès gigantesque.
Les religions qui n’ont pas eu à se battre contre la science, n’ont gardé qu’une seule vérité et c’est pour ça qu’elles tuent. »
Régis Debray avait eu ce mot qui m’a beaucoup marqué :
« »Les religions monothéistes ont lié la notion de croyance et la notion de vérité et ça c’est de la dynamite ! »
Vu à l’aune de ces réflexions le passage du polythéisme au monothéisme ne fut pas forcément un progrès pour l’homme !
<859>
-
Mercredi 15 mars 2017
« La science c’est ce qu’un vieux apprend à un jeune.
La technologie , c’est ce qu’un jeune apprend à un vieux. »Michel Serres, dans l’interview de KTOLors de l’émission : Emmanuelle Dancourt a demandé à Michel Serres une citation.
Michel Serres a alors répondu ceci :
« A force d’avoir des relations avec mes étudiants que j’ai beaucoup aimé respectueusement, avec mes enfants, mes petits-enfants, je me suis aperçu de la phrase suivante que je vous livre :
Qu’est-ce la science ?
La science c’est ce qu’un vieux apprend à un jeune
Qu’est-ce que la technologie ?
C’est ce qu’un jeune apprend à un vieux.
Voilà ma citation !
Vous avez remarqué ? c’est tout à fait ça !
Nous sommes aujourd’hui dans une période très intéressante où le couple pédagogique, enseignant-enseigné est en train de se modifier finement par ce que je viens de vous dire.
Quand j’ai besoin d’avoir des éclaircissements sur la mécanique quantique, à laquelle je ne comprends rien, je demande à un vieux scientifique.
Mais quand j’ai un problème avec mon ordinateur j’appelle qui ?
Oh ! J’appelle mon petit-fils. »
Et le petit fils donne la solution au vieux philosophe…
Ce mot du jour est court, je peux donc ajouter une date mémorable : le 15 mars 1917, il y a exactement 100 ans, le tsar de Russie Nicolas II abdique au profit de son frère, le grand-duc Michel. Mais celui-ci décline l’honneur. C’en est fini de la dynastie des Romanov. La Russie devient pour quelques mois une République démocratique. C’est l’aboutissement de la révolution de Février (calendrier russe) qui a commencé le 8 mars (23 février) 1917.
<857>
-
Mardi 14 mars 2017
« Le fétiche rafistolé »Objet présent dans « L’oreille cassée » 6ème album de Tintin et sur lequel Michel Serres philosophe dans l’interview d’Emmanuelle DancourtEmmanuelle Dancourt a demandé à Michel Serres d’emmener un objet (34:30 de l’interview)
Michel Serres a répondu de manière virtuelle, c’est à dire qu’il n’avait pas un objet sur lui mais il a parlé d’un objet présent dans l’album de Tintin : « L’Oreille cassée » et cet objet est le fétiche arumbaya qui est au centre de cette histoire. Au début de l’aventure le fétiche est dérobé dans le musée ethnographique parce que les voleurs espèrent récupérer un diamant qui est dans la statuette. Au bout de l’histoire, le fétiche tombe sur le pont d’un navire et explose en plusieurs morceaux, le diamant tombe à la mer.
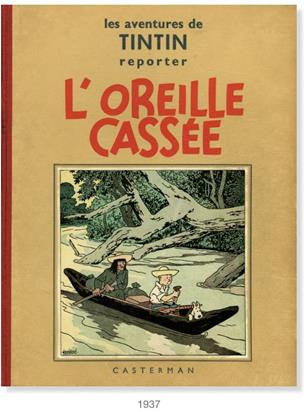 Et à la fin de l’Histoire, le fétiche retrouve son socle dans le musée, mais le fétiche est totalement rafistolé. C’est ce fétiche rafistolé sur lequel Michel Serres va philosopher :
Et à la fin de l’Histoire, le fétiche retrouve son socle dans le musée, mais le fétiche est totalement rafistolé. C’est ce fétiche rafistolé sur lequel Michel Serres va philosopher :
« Quand il reparait sur son socle, il est complétement rafistolé, bricolé, avec des fils de fer, avec du sparadrap, avec des éclisses, avec des plaques etc. et ça ça m’intéresse, cet objet m’intéresse.
Pourquoi ?
Parce que c’est ça l’organisme vivant.
L’organisme vivant, ce n’est pas contrairement à ce qu’on croit, un système harmonieux où tout serait parfaitement en place.
Pas du tout, pas du tout. L’évolution a amené l’œil à tel endroit, a amené le cerveau à tel endroit. Mais il vient d’où l’œil. Il y a des parties qui viennent de très très loin, qui sont très archaïques et d’autres qui sont beaucoup plus récents.
Notre corps est entièrement bricolé, rafistolé.
Le fétiche bricolé, rafistolé, à la fin de l’Histoire, c’est ça notre vie, c’est ça notre vie !
C’est pour ça qu’on devient malade parfois et qu’on meurt. Si nous étions parfait, nous serions éternel…
Le fétiche c’est ça ! Mais c’est plus que ça !
Il y a des gens qui critiquent beaucoup l’Europe, en ce moment. […]
Je repense toujours à mon fétiche, moi…Je pense toujours à cet organisme vivant tel qu’il est en réalité. Et je n’aime pas les systèmes politiques parfaits, bien faits, unitaires etc. Cela me rappelle trop le fascisme, le nazisme, Lénine, Staline etc. Le système parfait c’est ça.
Alors que les systèmes qui sont un peu bricolés, mal faits, qu’il faut rattraper… alors il y a le brexit, est-ce que ça va fonctionner ? On ne sait pas …
J’adore ça, c’est des systèmes humains. C’est des systèmes vivants, des vrais systèmes et qui ne prendront jamais la vie de personne.
Les systèmes unitaires sont des systèmes cruels, qui amènent à la mort, à la destruction.
Alors que les systèmes qui sont comme ça, un peu maladroits…
L’Europe c’est mon corps et mon corps c’est le fétiche rafistolé.
François Jacob disait un jour à côté de moi, à l’Académie française : « Tu sais Michel ce que c’est que le système nerveux ? C’est très simple : c’est un ordinateur porté par une brouette. » Et c’est exactement ça. Il y a des parties qui sont récentes, par exemple le cerveau, et des parties qui sont très archaïques et qu’on peut décrire par des brouettes.
Par conséquent, un ordinateur porté par une brouette, c’est ça le fétiche arumbaya. »
Dans son livre « Hergé mon ami », Michel serres consacre un long chapitre de la page 39 à 56 à l’oreille cassée et à des réflexions sur le fétiche et le fétichisme, qu’il conclut par cette question :
« Qu’est-ce qu’un fétiche, en vérité ? Tous le prennent-ils pour une même chose ou chacun pour autre chose ? ».
 Je sais bien que cette réflexion de Michel Serres, surprenante, décalée c’est-à-dire intelligente ne résout pas les problèmes de l’Union européenne.
Je sais bien que cette réflexion de Michel Serres, surprenante, décalée c’est-à-dire intelligente ne résout pas les problèmes de l’Union européenne.
Mais sa réflexion sur l’aspiration à des systèmes trop parfaits, alors que précisément les corps vivants sont des corps rafistolés, cicatrisés, résilients oriente notre réflexion vers d’autres horizons.
C’est aussi un avertissement pour le vieux gauchiste que je suis qui pourrait avoir la tentation que le système économique et politique soit totalement maîtrisé, régulé, encadré.
C’est probablement une des grandes forces du libéralisme d’être beaucoup plus bricolé, inventé au fur à mesure, stimulé par des initiatives multiples et privées. Il est plus proche d’un organisme vivant.
Ce qui ne signifie pas qu’il ne faut pas le réguler, en corriger les abus. Mais avoir le projet ou l’ambition de créer un système parfait, pensé intellectuellement et conceptuellement est certainement beaucoup plus dangereux qu’exaltant.
<857>
-
Lundi 13 mars 2017
« Michel, Michel, je ne suis pas aussi intelligent que tu ne le crois ! »Hergé à Michel Serres qui lui expliquait la profondeur philosophique des albums de Tintin (dans l’interview d’Emmanuelle Dancourt (23:55))Hergé, est le pseudonyme de Georges Remi (1907-1983). Il est surtout célèbre parce qu’il a été le créateur de Tintin, une des séries de bandes dessinées européennes qui a eu le plus de succès dans l’histoire de la BD.
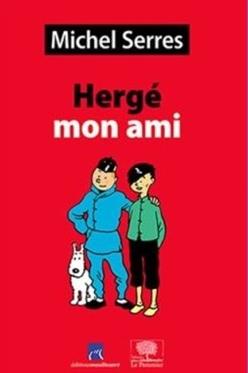 C’est le 10 janvier 1929 que paraissait pour la première fois les aventures de Tintin, « Tintin au pays des soviets », dans un journal illustré catholique pour les enfants qui s’appelait le petit vingtième.
C’est le 10 janvier 1929 que paraissait pour la première fois les aventures de Tintin, « Tintin au pays des soviets », dans un journal illustré catholique pour les enfants qui s’appelait le petit vingtième.
L’ensemble de la série compte 23 albums plus un inachevé « Tintin et l’Alph-Art », auquel Hergé a travaillé jusqu’à sa mort en 1983. Le dernier complet « Tintin et les picaros » est paru en 1976.
Dans une archive de l’INA on trouve cet extrait d’Apostrophe où Bernard Pivot interroge Hergé qui, modeste, comme le décrit Michel Serres, explique le parcours de Tintin qui au début est colonialiste et raciste et qui va évoluer, comme le monde européen, au cours de toutes ces années et devenir un personnage de plus en plus humaniste et ouvert au monde.
Michel Serres a rencontré Hergé, le créateur de Tintin tard dans sa vie, il l’appelle dans l’interview d’Emmanuelle Dancourt un « ami de vieillesse », par opposition à la notion plus répandue et plus connue d’ « ami de jeunesse ».
« Les meilleurs amis dit-on, reste de la jeunesse ; mais avez-vous eu des amis de vieillesse ? Quand le mot n’existe pas, doit-on douter de la chose ? » Page 31 du livre <Hergé mon ami>
Hergé était l’ainé de Michel Serres de 23 ans. Michel Serres introduit son ouvrage par ce texte :
« Un grand homme doux, est-ce possible ? Les grands hommes, faux ou vrais, le deviennent le plus souvent par la chamaille, la bataille, l’arrogance, le meurtre fourré, ce sont de grands fauves. Georges Rémi est un grand homme vrai, un grand homme rare, un grand homme doux. Ami délicat, fidèle, attentif, inusable comme les bandes qu’il a dessinées, ami gai, profond, modeste, retiré, le voici depuis si longtemps immortel d’avoir donné son œuvre aux enfants. Les enfants nés depuis avant les années 30 sont les enfants de son sourire et de son charme, vous comme moi et vos neveux comme les miens. Combien de grands hommes avons-nous depuis oubliés ? Tous peut-être, nous n’avons jamais oublié Hergé. […]
Paisible, profond, quotidien, inusable ami. Ai-je connu dans toute ma vie plus grand homme que lui, et plus respectable ? Ami admirable qui m’a aidé à vivre et à penser qui ne m’a jamais cru quand, les larmes aux yeux, j’essayais de lui dire qui vraiment il était. Il riait.
Il riait comme un enfant. Doucement. Il était un homme de bienfait. […]
J’ai plus appris en théorie de la communication dans les bijoux de la Castafiore que dans cent livres théoriques mortels d’ennui et stériles de résultats. J’ai plus appris, je le dirai longuement, sur le fétichisme dans l’Oreille cassée que chez Freud, Marx ou Auguste Comte […].
J’ai plus appris sur quasi objet dans l’affaire Tournesol que partout ailleurs. Je ne me suis pas seulement diverti, j’ai appris. Hergé donne à rire, à penser, à inventer : verbe unique en trois personnes.
Il disait : « je commence mon histoire et je la laisse aller. Elle se développe comme du lierre. » Qui a jamais écrit, cherché, inventé, dans nos métiers de langues, entend là une parole vraie. L’œuvre monte doucement, comme du lierre.
Toute seule. Oui, l’œuvre de génie. »
Dans l’interview d’Emmanuelle Dancourt, le livre « Hergé mon ami » est évoqué à partir de 20:13 et elle dit une chose que je partage : Quand on lit ce livre on ne lit plus Tintin de la même manière. Emmanuelle Dancourt parle de « La portée philosophique des albums de Tintin. »
Et c’est alors que Michel Serres évoque cet échange avec son ami où après lui avoir encore une fois expliqué ce qu’il y avait de génial dans un de ses albums Hergé a répondu :
« Michel, Michel, je ne suis pas aussi intelligent que tu ne le crois ! »
Dans l’interview Emmanuelle Dancourt et Michel Serres évoque « Tintin au Tibet », album dans lequel Tintin va sauver son ami Tchang qui a survécu à un accident d’avion dans le Tibet et qui a été sauvé et secouru par un immense singe appelé « le yéti »
Pour Michel Serres : L’abominable homme des neiges, de Tintin au Tibet est aussi un bon samaritain. Un être, a priori fruste et violent et qui se révèle un personnage plein de bonté qui va aider, secourir et nourrir l’ami de Tintin, Tchang. En réalité le Yéti a toutes les vertus.
La dernière image est déchirante. Le yéti n’a plus d’ami et il est infiniment triste. Par un dessin Hergé arrive à rendre l’immense humanité de ce moment
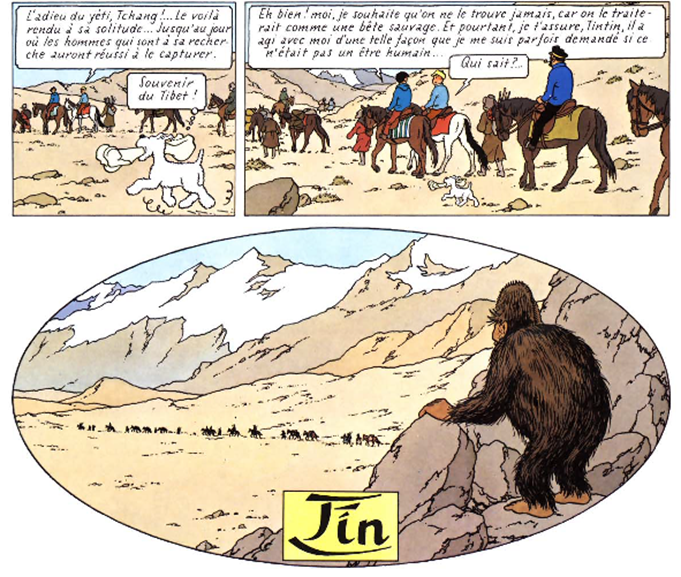
<856>
-
Vendredi 10 mars 2017
« Steve Job a fini par reconnaître que le logo de la pomme croquée d’Apple faisait référence à la pomme empoisonnée avec laquelle Alan Türing avait mis fin à ses jours »Michel SerresJ’ai écrit que j’ai acquis le livre « Darwin, Bonaparte et le samaritain » et j’ai donc pu vous en parler directement et non seulement à travers l’interview ou des articles qui lui sont consacrés. J’ai fait de même avec le livre sur Hergé et Tintin. En revanche, je n’ai pas fait de même avec le troisième ouvrage.
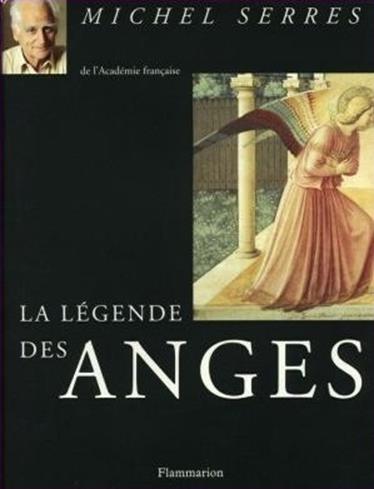 Le dernier livre de Michel Serres évoqué lors de l’entretien KTO est « La légende des anges », publié en 1993 et republié le 12/10/2016.
Le dernier livre de Michel Serres évoqué lors de l’entretien KTO est « La légende des anges », publié en 1993 et republié le 12/10/2016.
Les anges sont porteurs de messages, de nouvelles. C’est pour cela que Michel Serres utilise ce vecteur pour « raconter » notre monde de communication et de réseaux ou des milliers de messages sont transportés chaque jour.
Michel Serres désigne 3 anges :
<Hermès> qui dans la mythologie grecque est le dieu de l’Olympe chargé de porter les messages des dieux. Il correspond au Mercure des Romains.
<Gabriel> Gabriel est quant à lui le porteur de messages des 3 religions monothéistes . Il semble qu’il apparaisse d’abord, dans la Bible hébraïque dans le livre de Daniel où il apparaît au prophète Daniel pour que ce dernier puisse annoncer ses prophéties.
Dans le Nouveau Testament, il annonce à Zacharie que sa femme Elisabeth aura un fils qu’il appellera Jean, puis il annonce la naissance de Jésus à la Vierge Marie : c’est l’Annonciation des chrétiens.
Enfin dans l’Islam, c’est encore l’ange Gabriel qui révèle les versets du Coran à Mahomet dans la grotte de Hira.
Mais de manière plus surprenante le troisième ange de Michel Serres est <Alan Turing>
J’ai fait référence la première fois à Alan Turing, lors du mot du jour du 31/12/2013, il s’agissait du mot du jour N° 212 et celui qui a exprimé ce regret était Chris Grayling Ministre de la Justice britannique :
«Son apport a été décisif pour briser le code Enigma, contribuer à mettre fin à la guerre et sauver des milliers des vies Sa vie a plus tard été assombrie par sa condamnation pour homosexualité, condamnation que nous considérerions aujourd’hui comme injuste et discriminatoire, et qui est désormais annulée.»
La reine d’Angleterre avait accordé, enfin, le 24 décembre 2013, une grâce posthume à Alan Turing, 59 ans après sa mort.
Alan Turing est resté dans l’histoire comme l’homme qui a mis au point la machine électromécanique ayant servi à « casser » le code « Enigma » utilisé par les sous-marins allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cette invention avait donné un avantage considérable aux Alliés face à l’Allemagne nazie.
Certains considèrent même que Turing est le père de l’informatique moderne parce qu’il est parvenu à définir les critères de l’intelligence artificielle.
Malgré son apport immense à la victoire des alliés, il a été condamné pour homosexualité. Il a été contraint à subir une castration chimique en 1952.
Il est donc assez normal que Michel Serres qui avait pour objet de décrire le monde de réseaux d’aujourd’hui, de mettre en lumière celui qui est un des inventeurs de l’informatique.
Et Michel Serres lors de l’interview avec Emmanuelle Dancourt reprend l’aveu tardif du créateur d’Apple que le fameux logo est un hommage à Alan Türing.
<Le site de France Info reprend cette thèse> :
« D’abord, le logo est une pomme car c’est le nom de la marque, en anglais. […]
Mais pourquoi la pomme est-elle croquée? En fait, c’est un hommage à l’anglais Alan Turing, génial mathématicien, qui pendant la Seconde Guerre mondiale, a réussi à décrypter le code secret des nazis, généré par leur fameuse machine Enigma. Sans Turing, les Alliés auraient perdu la bataille de l’Atlantique, et peut-être la guerre contre le nazisme. Turing est un héros immense. On considère qu’il a inventé l’ordinateur et l’informatique. Oui, mais il était gay, et à l’époque c’était un délit. La justice britannique le condamna à la castration chimique. Officiellement, il fut inculpé « d’indécence manifeste et de perversion sexuelle « . Désespéré, humilié, il préféra se suicider en 1954, à 42 ans, en mordant dans une pomme empoisonnée au cyanure, comme Blanche-Neige, qu’il adorait.
En fondant Apple, Jobs et Wozniak lui rendirent cet hommage. Leur pomme (arc-en-ciel, signe du mouvement gay) porte la mortelle morsure. […]
Au passage, savez-vous pourquoi les ordinateurs portables Apple ont ils été baptisés « MacIntoch » (plutôt que s’appeler poétiquement D630 ou H-50-NF comme leurs concurrents) ? Parce que Jef Raskin, l’ingénieur d’Apple, qui a créé le premier modèle de Mac au début des années 80, adorait les pommes, et sa variété préférée était la MacIntosh… »
<Mais ce site donne une autre version> :
« Selon la légende, la pomme croquée serait un hommage au célèbre mathématicien anglais Alan Turing. […] Les fondateurs d’Apple se seraient donc inspirés de cette histoire pour honorer l’homme qui les a rendus milliardaires. Pourtant bien que cette version, plutôt favorable en termes d’image de marque, n’ait jamais été réfutée par la société, il semble que la réalité soit bien différente. Ainsi, selon Rob Janoff, le designer à l’origine du logo, la morsure dans la pomme serait seulement là pour montrer qu’il s’agit bien d’une pomme et non d’une cerise. La taille du croc donnant ainsi l’échelle du fruit. De plus, croquer une pomme est un geste universel, compréhensible par tous. Enfin, les couleurs arc-en-ciel de la pomme ne seraient pas un clin d’œil au drapeau gay, mais plutôt une référence au moniteur couleur qui équipaient à l’époque les produits Apple. »
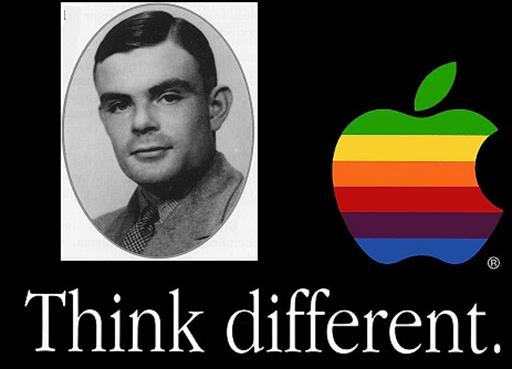 <Toujours est-il que le parlement britannique vient de voter une loi Alan Türing>
<Toujours est-il que le parlement britannique vient de voter une loi Alan Türing>
Par cette loi à qui on a donné le nom du mathématicien de génie des dizaines de milliers d’homosexuels, condamnés à une époque où leurs mœurs constituaient un délit, ont obtenu une grâce du gouvernement britannique. L’agence de presse britannique estime que la loi concerne 100 000 hommes condamnés entre 1885 et 2003, lorsque les dernières lois hostiles à l’homosexualité ont été abrogées. Parmi eux figure notamment Oscar Wilde (1854-1900), condamné en 1895.
Dans l’entretien de KTO, Michel Serres fustigeait cette morbide habitude… qui consiste à orner nos places de statues de chefs de guerre et de généraux responsables de carnage et de massacre, alors qu’il y a si peu de statue des vrais grands hommes comme Alan Türing ou aussi de grandes femmes comme <Emilie du Chatelet> par exemple
Un film <Imitation Game> sorti en 2014 a tenté de retracer l’histoire d’Alan Türing.
<855>
-
Jeudi 9 mars 2017
« De la manière de négocier avec les souverains »François de Callières (1645-1717)Ce qu’il y a de remarquable avec des hommes comme Michel Serres, c’est qu’ils ouvrent votre esprit et vous font connaître d’autres esprits féconds.
Je ne connaissais pas François de Callières, mais à partir du moment où j’ai appris à le connaître grâce à la lecture des pages 124 à 127 de son ouvrage sur une Philosophie de l’Histoire, une rapide recherche sur le « côté lumineux » d’Internet montre alors que cet homme compte et a compté dans l’histoire des idées et des relations internationales.
Michel Serres présente François de Callières comme symbole du deuxième héros de l’âge doux, le négociateur (le premier étant le médecin symbolisé par le samaritain).
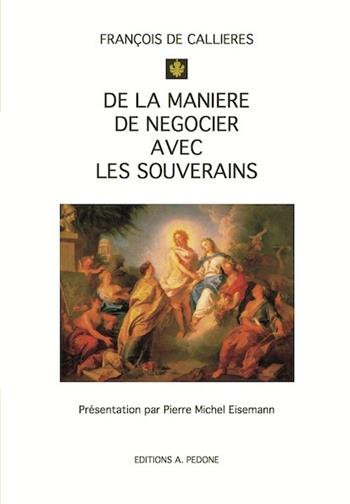 Je cite donc simplement Michel Serres :
Je cite donc simplement Michel Serres :
« Louis XIV ne cessa de faire la guerre, plus de 300 000 morts; à peine si son règne ensoleillé connus quelques mois de paix. De ces années la France sortit épuisée, exsangue, ruinée ; ledit grand siècle coûta un prix exorbitant. […]
Avant Louis XIV, Richelieu fonda l’Académie française. Nous conservons la liste de ceux qui occupèrent, tour à tour, les 40 fauteuils. Quelques gloires incontestables s’y noient parmi mille noms oubliés. Longtemps pris pour un auteur médiocre, l’un de ces académiciens de l’ombre écrit, dans son œuvre précise, le déséquilibre vie-mort, thème de ce livre et tente de l’inverser. Conseiller auprès de ce roi mortifère, François de Callières publia en effet, en 1716, année qui suivit la mort du monarque qui précéda la sienne propre, un livre décisif : « de la manière de négocier avec les souverains », texte qui sombra dans l’oubli pendant deux siècles avant de connaître, à partir de 1917, une résurrection imprévue. Je tiens désormais son auteur comme l’un des grands penseurs de ce temps et du nôtre, d’autant qu’il partage avec Vauban le mérite de prendre à rebours les usages pugnaces du roi.
Il n’eut pas le courage ou la possibilité, pendant un règne où régnaient, aux frontières, le bruit et la fureur, de publier ce livre paisible, qui resurgit à une date où la première guerre mondiale développait son inutile boucherie et avant que le traité de Versailles ne devînt le contrat léonin dont les conséquences néfastes entraînèrent les années suivantes à une guerre pire et se font encore sentir aujourd’hui.
À partir de 1917, donc en plein conflit, traduit en de nombreuses langues et mis au programme de maintes universités, même des écoles de commerce soucieuses d’enseigner la négociation. Cet ouvrage parcourt la planète, de la Chine au Portugal et du Japon à la Pologne. Considéré désormais comme un classique, traduit en anglais, par exemple, par le secrétaire de Sir Winston Churchill, l’ouvrage de François de carrière eut pour lecteurs assidus et admirateurs de hauts personnages de la politique ou de l’économie, comme Thomas Jefferson ou John Galbraith. Dans un livre récent, mon ami et collègue Amin Maalouf le remit en scène devant nos yeux et, pour mon bonheur, me l’enseigna.
À distance immense de Machiavel, avant, ou de Clausewitz après lui, François de Callières voit d’abord, son pays d’un œil lucide : notre nation est si belliqueuse, écrit-il, qu’elle ne connaît presque point d’autre gloire ni d’autres honneurs que ceux qui s’acquièrent par la profession des armes…, avant de définir le but du négociateur : éviter au maximum les conflits. »
Cette sentence de François de Callières me fait penser à un échange que j’ai eu un jour avec des jeunes Allemands.
Un ami, m’avait emmené à Sarrebruck rencontrer un groupe de jeunes Allemands. Et nous discutions des relations entre la France et l’Allemagne. Ces jeunes allemands décrivaient notre pays, la France, comme un des pays les plus belliqueux qu’il n’y eut jamais sur la terre et notamment en Europe, au cours des siècles. Je fus étonné, car mes cours d’histoire parlant de la guerre de 1870 de la première et la seconde guerre mondiale m’ont toujours conduit à penser que s’il y avait un fauteur de guerre en Europe c’était l’Allemagne ou la Prusse. Cette discussion m’avait troublé et je repartis vers les livres d’Histoire. C’était évidemment ces jeunes Allemands qui avaient raison.
Au cours des siècles, Louis XIV comme Napoléon ou la révolution sont particulièrement dans cette logique, la France a attaqué systématiquement tous les pays d’Europe pour asseoir sa suprématie, pour accroître son territoire. La France est la nation de la guerre par excellence.
Michel Serres cite encore François de Callières :
« Tout prince chrétien, doit avoir pour maxime principale de n’employer la voie des armes, pour soutenir et faire valoir ses droits, qu’après avoir tenté et épuisé celle de la raison et de la persuasion. Mieux encore, son livre comporte des pages qui décrivent quasi expressément la manière adoptée par ceux qui construisirent, passé la seconde guerre mondiale, notre Europe pacifiée. Existe-t-il meilleure preuve de génie qu’une telle prophétie ? Après François de Callières, Edgar Faure allait disant que la guerre coûte toujours plus cher que la paix, même acquise à n’importe quel prix. […]
Certains experts anglo-saxons disent de François de Callières qu’il inventa le soft power. Preuve en est ce texte dont les pages, conseillant le doux tout court et comment y parvenir, restèrent inouïes pendant deux siècles assourdis par le bruit des conflits, jusqu’à ce que ces derniers deviennent absurdes et monstrueux. Pour cette innovation héroïque, je salue François de Callières, initiateur de l’Europe actuelle et de mon petit livre, comme le deuxième héros de l’âge doux : le négociateur après le médecin, Schuman et Adenauer après Schweitzer et Monod. Je proclame cet homme de l’ombre comme l’une des gloires de l’Académie et de la France. […]
Je rêve que, dans un Panthéon réaménagé, soient transportées les cendres du grand homme et qu’avant ma mort je puisse fleurir sa statue érigée entre les Invalides et le Quai d’Orsay, après que l’on aurait fabriqué des cymbales et des casseroles avec les métaux fondus à partir des statues médiocres de Louis XIV sur la place desdites Victoires ou de Foch au Trocadéro. Nous agrémenterions la fête d’une musique accompagnée du son de ces percussions. »
Comme je l’ai écrit au début de cette chronique, on trouve sur Internet énormément de pages consacrées à cet homme qui devrait être illustre selon Michel Serres.
Il dispose bien sûr d’une page très documentée sur <Wikipedia>
<L’extraordinaire bibliothèque en ligne Gallica, permet de lire l’ouvrage cité>
Ainsi un nouvel homme remarquable entre dans notre panthéon de la connaissance grâce à Michel Serres.
<854>
-
Mercredi 8 mars 2017
« La parabole du bon samaritain »Evangile selon Luc Chapitre 10Michel Serres utilise la parabole du bon samaritain comme le symbole de l’âge doux et du « prendre soin », ce qui constitue un absolu de notre époque actuel. Le médecin est omniprésent et sauf quelques irréductibles, dès le moindre ennui nous allons voir un ou des médecins pour qu’ils prennent soin de nous. Et pour tous nos proches, à la moindre inquiétude, nous conseillons : il faut aller voir le médecin.
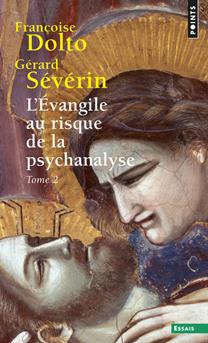 Il y a bien longtemps maintenant j’avais acheté un livre de François Dolto qui avait pour titre, « L’Evangile au risque de la psychanalyse » et je me souviens encore de son explication de cette parabole et surtout du décalage absolu avec ce que j’avais compris des cours de religion et des différents curés qui avaient un jour parlé de cette parabole.
Il y a bien longtemps maintenant j’avais acheté un livre de François Dolto qui avait pour titre, « L’Evangile au risque de la psychanalyse » et je me souviens encore de son explication de cette parabole et surtout du décalage absolu avec ce que j’avais compris des cours de religion et des différents curés qui avaient un jour parlé de cette parabole.
Et je crois que l’on soit croyant ou non, ce que Françoise Dolto a révélé par rapport à cette histoire qui s’inscrit dans notre culture judéo chrétienne et nos valeurs, me parait très intéressant.
D’abord voici cette parabole telle qu’elle est relatée dans la bible de Segond qui faisait autorité dans les années 80 dans les églises réformées.
Il y a au départ un docteur de la Loi qui selon cet évangile veut piéger Jésus, en lui posant une question :
« Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain?
Jésus reprit la parole, et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s’en allèrent, le laissant à demi mort.
Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre.
Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l’ayant vu, passa outre.
Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu’il le vit.
Il s’approcha, et banda ses plaies, en y versant de l’huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l’hôte, et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?
C’est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. »
Pour celles et ceux qui n’ont aucune culture religieuse, il convient au minimum de dire que dans cette parabole qui s’adresse disons « aux juifs bien-pensant » les samaritains sont des mécréants qui ne suivent pas les préceptes que suivent les juifs bien-pensants. Et que les personnages de sacrificateur et de lévite sont plus que des juifs bien-pensants, l’élite des juifs bien-pensants.
Dans mes cours de religion on m’avait appris que le samaritain, bien que vilipendé par la bonne société juive avait bien agi car il avait aidé son prochain, contrairement aux bien-pensants. Et qu’en plus, il était formidable il s’était super bien occupé de ce pauvre blessé, ce que Michel Serres traduit par l’humanité souffrante.
Et Françoise Dolto m’a fait remarquer que ce n’était pas du tout ce qui était écrit. Et que si on considère cette parabole comme une parole de sagesse, elle présente les choses sous un tout autre angle.
La question était : « qui est notre prochain que nous devons aimer ? »
Et si vous relisez ce qui est écrit vous verrez que le texte chrétien dit : le prochain de celui qui était blessé est le samaritain, c’est-à-dire celui qui l’a secouru.
Peut-être qu’ailleurs il existe d’autres injonctions !
Mais dans cette parabole, il est écrit qu’il faut aimer ceux qui vous ont fait du bien, et peut être aussi, pas forcément les biens pensants, les élites de la hiérarchie sociale, mais ceux qui ont manifesté de la bienveillance… Il n’y a pas une injonction à aimer tout le monde.
Et puis le samaritain que fait-il ?
Il ne prend pas toute la charge sur ses épaules ! Il prodigue les premiers soins.
Et alors ?
Il amène le blessé dans une hôtellerie et il charge quelqu’un d’autre de s’occuper du blessé contre une rémunération qu’il paie !
Oui, il ne prend pas en charge tout le soin, il passe la main à quelqu’un qui va le faire pour de l’argent et lui continue sa route.
Je n’en dis pas plus, j’ai simplement voulu partager cette lecture qui m’avait beaucoup impressionné à l’époque.
J’ai trouvé cette page internet qui semble faire référence à cette même lecture :
<Extrait de l’Évangile au risque de la psychanalyse>
<853>
-
Mardi 7 mars 2017
« Le premier âge est plus long qu’on ne le croit ;
Le deuxième pire qu’on ne le pense ;
Le dernier meilleur qu’on ne le dit. »Michel Serres, « darwin, Bonaparte et le samaritain »Le 3ème temps de la philosophie de l’Histoire de Michel Serres parle du temps actuel et il rappelle que cela fait plus de 70 ans que l’Occident est en paix.
Mon frère Gérard va avoir 70 ans cette année et il n’a jamais connu la guerre.
 Un jour Michel Serres est venu devant ses élèves et a montré cette photo de Bush, Blair et Aznar pris en 2003 aux Acores :
Un jour Michel Serres est venu devant ses élèves et a montré cette photo de Bush, Blair et Aznar pris en 2003 aux Acores :
Et il a demandé qu’est-ce que cette photo a d’unique dans l’Histoire de l’Humanité ?
Les étudiants ne savaient pas quoi répondre !
Alors Michel Serres a dit :
« Ces 3 hommes vont déclarer la guerre [A l’Irak] et ils n’ont jamais connu la guerre personnellement.
Il n’est jamais arrivé dans l’Histoire de l’Humanité que des responsables d’Etat déclarent la guerre sans jamais l’avoir connue. »
Vous trouverez un article récent en espagnol sur cette rencontre et duquel j’ai tiré cette photo et un article de l’époque en français.
Vous direz, ce propos est paradoxal : ces 3 déclarent la guerre et Michel Serres dit que nous sommes en paix.
C’est à dire que le continent européen qui a produit les plus grands massacres de l’âge de la guerre est en paix et que s’il y a encore des zones de violence dans le monde elles sont sans mesure avec ce qui existait dans l’âge de la guerre.
Et puis surtout, il y a eu une évolution extraordinaire des mentalités. Et il cite cet exemple et échange avec des amis à Stanford :
« Après l’attentat du 11 septembre 2001, j’ai pris, pour San Francisco, le premier avion disponible. [en arrivant] je fus invité chez des amis de la Silicon Valley à un dîner où se trouvaient plusieurs personnes de langues, de religions et de cultures diverses. La conversation roula sur les kamikazes dont les avions venaient de détruire une tour de Manhattan ; alors que l’un d’entre nous s’étonnait qu’ils fissent la queue pour se sacrifier, je cite de mémoire :
« Mourir pour sa patrie est un si digne sort
Qu’on briguerait en foule une si belle mort. »
Mais qui a écrit ces horreurs ? m’interrogèrent de concert les invités – je récite simplement une tirade d’Horace, la plus belle tragédie de Corneille, répondis-je.
J’ajoutai aussitôt le refrain de notre célèbre chant du départ :
« La république nous appelle
Sachons vaincre ou sachons périr,
Un Français doit vivre pour elle,
Pour elle un Français doit mourir.
[..] Demander par sondage ce que la population de nos pays pense désormais de cet héroïsme. L’immense majorité répondra et je l’approuve qu’elle n’a plus d’ennemis et que c’est une pure folie d’appartenir à un groupe qui exige le sacrifice de la vie. Malgré tous ses défauts, l’Europe que, au sortir de la seconde guerre mondiale, la génération qui précède la mienne fonda est peut-être la première communauté humaine dans toute l’histoire si orientée vers la paix qu’elle ne demandera jamais la vie de ses enfants. » (page 52)
Lors d’une autre intervention, Michel Serres fit remarquer que si nous trouvons les décapitations de DAESH si horrible, si contraire à la civilisation, dans notre beau pays on a décapité jusqu’en <1977>. Et avant la seconde guerre mondiale, les décapitations étaient publiques, c’étaient des spectacles auxquels on amenait même les enfants. Nous le faisions et maintenant cela nous fait horreur. Quelle évolution !
C’est pourquoi, Michel Serres parle de l’«âge doux» pour traduire le mot anglais « soft ».
Pour l’«âge de la guerre» Michel Serres avait décrit trois raisons évoquées pour justifier le conflit :
- l’hégémonie territoriale,
- religieuse
- et économique.
Et l’âge du doux se décline aussi de trois manières, portant sur la vie et l’esprit :
- médicale,
- pacifique
- et numérique.
C’est le médecin qui est l’emblème de cette époque, c’est pourquoi il donne le nom de samaritain à cet âge. Cet homme qui selon la parabole s’est penchée sur un blessé pour lui venir en aide. Il décrit notre époque comme celle de la compassion où on soigne, où les progrès de la science ont permis de faire reculer les limites de la mort et de la douleur.
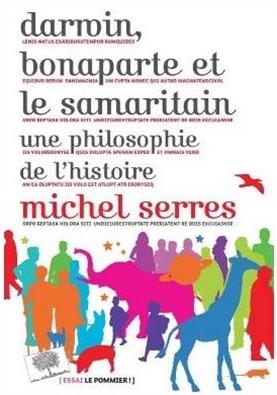 L’autre aspect de cet âge du doux est la paix, la création de l’ONU et surtout de l’Union européenne. Car comme le dit Michel Serres :
L’autre aspect de cet âge du doux est la paix, la création de l’ONU et surtout de l’Union européenne. Car comme le dit Michel Serres :
« En 1870, La France vaincue par la Prusse n’avait qu’une idée en tête : se venger. »
Je l’ai déjà écrit, et je partage ce destin avec d’autres personnes originaires de Moselle ou d’Alsace, mon arrière-grand-père : Jean-Pierre Klam avait 22 ans et était soldat français.
En 1918, l’Allemagne vaincue par la France et les alliés n’avait qu’une idée en tête : se venger. Mon grand-père Félix Klam né en 1874, était soldat allemand.
En 1940, mon père avait 21 ans, il fut incorporé dans l’armée française. Et au bout de l’horreur des morts, des génocides, d’Hiroshima, des hommes ont dit : il ne faut plus se venger, il faut construire ensemble.
Et c’est comme ça que mon frère, né 2 ans après la fin de la guerre n’a pas eu le même destin que ses ascendants : âge de la paix, âge doux.
Le numérique pour Michel Serres contribue aussi à l’âge doux, parce qu’il substitue à un monde hiérarchique un monde de réseau et qu’il met à disposition de beaucoup un savoir qui était limité à certains.
Il n’est pas dupe des défis du monde, sur les inégalités, les tensions économiques, la pression sur les ressources et surtout notre rapport au monde et au vivant que notre avidité peut souiller à un point tel que la vie humaine deviendra difficile ou même disparaîtra.
Mais il rappelle que contrairement à toute attente, les statistiques montrent que la majorité des humains pratiquent l’entraide plutôt que la concurrence et le destin du monde n’est pas écrit.
C’est une philosophie de l’optimisme et de la lucidité à laquelle nous invite Michel Serres.
<852>
- l’hégémonie territoriale,
-
Lundi 6 mars 2017
« Une nuit de Paris réparera cela. »Napoléon, propos qui lui sont attribués après le carnage de la bataille d’Eylau (1807)Après avoir parlé, du premier âge, l’âge de l’évolution du vivant jusqu’aux humains, le grand récit, Michel Serres décrit un deuxième âge. C’est l’âge de la guerre.
Après avoir entendu l’entretien dont je vous ai parlé dès le mot du jour du 27 février 2017 : <Michel Serres – 3 déc. 2016 – KTOTV>, j’ai acquis le livre lui-même et suis donc en mesure de parler directement de cet ouvrage.
Dans cette deuxième partie, Michel Serres parle d’abord de lui puis cite une suite d’évènements : (à partir de la page 44 du livre) :
« Mon âge propre commence en 1930. Fils d’un paysan marinier gazé à Verdun et rescapé de l’atroce boucherie de 14-18, je descends d’autre part de la seule jeune fille qui ait pu se marier, parmi ses amies de collège, puisque les fiancés possibles et les époux réels dormaient, alignés, dans les immenses cimetières militaires, ou, inconnus, sous la glèbe ordinaire. Né dans le sud-ouest de la France, mon premier souvenir date de la guerre civile d’Espagne, dont nous recevions les réfugiés qui racontaient les abominations qu’ils venaient de subir. […]
Depuis leur création en 1776, les États-Unis ont été en guerre 222 années sur les 239 de leur existence, soit 93 % de leur temps […]. Globalement et suivant l’évaluation de l’histoire mondiale, calculée, anciennement déjà, par Ivan Bloch, entre l’année 1496 av. J.-C. et l’an 1861 de notre ère, il y eut 227 années de paix et 3130 années de guerre. Moins de 10 % de ces 3357 années consacrées à la paix, c’est-à-dire à la vie – à peu près le même chiffre que celui des États-Unis.
[…] Ces estimations ne pouvaient prévoir que les deux guerres mondiales du siècle dernier, plus dix crimes d’État, feraient, en effet, baisser encore ce pourcentage. Jusqu’au point culminant d’Hiroshima, qui fuit, un moment, craindre notre propre éradication ou celle de la planète entière […] . Voici donc des millénaires qu’une mort, subie, certes, mais produite de nos mains, règne sur nous et ne cesse de nous menacer : non seulement notre mort propre, inévitable, mais une autre, collective, vers laquelle, hélas, nous ne cessions de courir, avec une cécité constante. »
La guerre de tous contre tous était perpétuelle. Cette proportion c’est en effet, encore accentué lors de la première moitié du XXème siècle qui a été le pire de l’Histoire de la violence qui a culminé avec le bombardement de Dresde qui porte le triste nom du plus grand bombardement de l’Histoire puis les bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki.
A ces massacres issues des guerres entre les Etats et les nations il faut ajouter les victimes internes des totalitarismes : du nazisme, du stalinisme et du maoïsme.
Pour caractériser cette terrible époque de plus de 3000 ans de guerre, Michel Serres a choisi Bonaparte. Il raconte qu’au soir :
« de la journée d’Eylau, escortés par ses généraux, Napoléon traversa le champ de bataille jonchée de cadavres par milliers et eut ce mot terrible : « une nuit de Paris réparera cela. ».
 Ce propos que rapporte Michel Serres avait déjà été transcrit dans la Revue des deux Mondes en 1915.
Ce propos que rapporte Michel Serres avait déjà été transcrit dans la Revue des deux Mondes en 1915.
En effet, cette revue rendue célèbre par la collaboration très rémunératrice de Pénélope Fillon existait déjà en 1915.
Un certain Docteur Émile Laurent, écrivit en 1891 un livre appelé <L’amour morbide> et dans l’introduction de ce livre <repris ici> il écrivait cette même citation :
« Au lendemain d’une sanglante bataille, au milieu d’une vaste plaine semée de morts et de mourants, Napoléon Ier fit cette réflexion : « Une nuit de Paris réparera tout cela. » »
Mais Wikipedia ne décrit pas la même chose sur la page consacrée à la bataille d’Eylau :
« Napoléon, très affecté par les pertes subies, et contrairement à son habitude, restera huit jours sur le champ de bataille pour superviser les secours aux blessés. Il se retire le soir même de la bataille au château de Finckenstein non loin de Preußisch Eylau. Il déclare alors :
« Cette boucherie passerait l’envie à tous les princes de la terre de faire la guerre. » »
Et l’excellent site consacré à l’histoire <Herodote> rapporte que 6 jours après la bataille, Napoléon 1er écrit à l’impératrice Joséphine :
«Je suis toujours à Eylau. Ce pays est couvert de morts et de blessés. Ce n’est pas la plus belle partie de la guerre. L’on souffre et l’âme est oppressée de voir tant de victimes»
On ne sait donc pas avec certitude que Napoléon aurait bien tenu ces propos obscènes à la bataille d’Eylau qui opposa son armée à l’armée russe. Et finalement peu importe, il est certain que pendant des siècles les hommes ont magnifié la guerre et ont minimisé l’horreur et la violence sur les champs de bataille.
Michel Serres rappelle d’ailleurs que :
« Les Français vouèrent aux guerres napoléoniennes et à la révolution de 1789, 1 500 000 morts alors que la première guerre mondiale, entre 14 et 18 pourtant considérés comme une boucherie, leur coûta seulement 1 350 000 victimes. »
Et partout, sur nos Places des statues célèbrent des généraux le sabre levé avec le récit de leurs exploits. Des avenues et des rues portent leurs noms alors qu’ils sont, avant toute chose, des hommes de la mort, qui ont poussé leurs hommes à s’entretuer avec d’autres hommes.
Terrible âge que cet âge de la guerre.
<851>
-
Vendredi 3 mars 2017
« L’âge du monde »Pascal RichetMichel Serres dit :
« Nos anciens avaient 4000 années comme passé, jusqu’à Abraham à peu près, nos contemporains ont un passé de plus de 13 milliards d’années. Et cela change tout »
Nous avons compris l’importance de dater. Et l’âge du monde est un sujet passionnant. Je ne parle même pas de la détermination de l’âge de la terre ou de l’univers par les méthodes scientifiques les plus modernes, mais de la perception, par les hommes, de l’âge du monde aux différentes époques historiques.
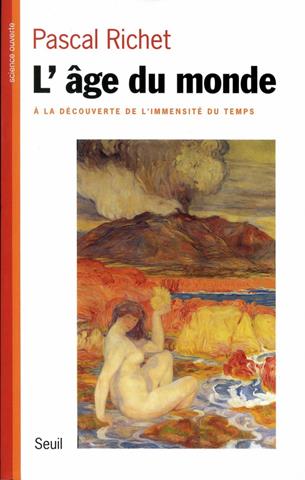 Lors de mes études d’Histoire à Lyon, en 2003, il m’a été conseillé d’acheter un livre qui fait autorité : « L’âge du monde – A la découverte de l’immensité du temps » de Pascal Richet qui fait le point sur cette question. Ce livre est donc dans ma bibliothèque et si je l’ai feuilleté, je ne l’ai pas encore lu de manière approfondie.
Lors de mes études d’Histoire à Lyon, en 2003, il m’a été conseillé d’acheter un livre qui fait autorité : « L’âge du monde – A la découverte de l’immensité du temps » de Pascal Richet qui fait le point sur cette question. Ce livre est donc dans ma bibliothèque et si je l’ai feuilleté, je ne l’ai pas encore lu de manière approfondie.
<Wikipedia> rappelle que si les grecs considéraient le temps comme infini et plaçaient la Terre comme faisant partie d’un cycle cosmique éternel, les trois religions monothéistes (juive, chrétienne et musulmane) ont introduit un temps limité démarrant avec une création du monde.
Ainsi dans ces 3 religions, l’âge du monde oscillait entre 3000 et 6000 ans.
Et les humains pendant des siècles ont inscrit leur univers, leur temporalité, dans cette petite période.
En 1650, l’archevêque James Ussher fait remonter la Genèse précisément au 23 octobre 4004 av. J.-C., à neuf heures du soir précisément.
Près de cinquante ans plus tard, le grand Isaac Newton l’estime à 3998 ans av. J.-C. en se servant de la précession des équinoxes pour caler l’âge des phénomènes bibliques avec des observations astronomiques babyloniennes ou des légendes des Grecs.
Cette chronologie d’Ussher fera autorité jusqu’au début du XXe siècle, la version officielle de la Bible affirmant que la Terre et l’humanité furent créées par la Trinité en 4004 av. J.-C
Mais au cours des siècles, il y eut des esprits libres qui ont étudié et compris que cette version issue de la lecture des textes sacrés était erronée.
Et c’est au XVIIIème siècle que différents intellectuels vont tenter par des méthodes scientifiques de déterminer l’âge de la terre
C’est l’astronome Edmond Halley (1656-1742) qui au bout de ses analyses scientifiques va affirmer que la terre est beaucoup plus vieille qu’on ne le pense.
Un peu plus tard, Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), à partir de la rotation des océans, propose une datation de 4 milliards d’années. Et ce n’est qu’en 1896 que Becquerel découvre la radioactivité, découverte qui permettra de déterminer l’âge de la terre qu’on connaît aujourd’hui : 4,54 milliards d’années.
Mais le plus grand nombre resta figé dans ses croyances et la version biblique de la création.
Aujourd’hui encore et particulièrement aux Etats-Unis les partisans du créationnisme sont nombreux.
<Ainsi le vice-président actuel des Etats-Unis est ouvertement créationniste>
Et parmi ces créationnistes, il en est une grande part qui continue à prétendre que l’âge du monde est celui qui est déduit des généalogies des textes sacrés.
On a même donné un nom à ce dogme : « Le créationnisme Jeune-Terre » qui interprète la Bible comme un livre de sciences naturelles et d’histoire, véhiculant la croyance selon laquelle le récit de la création de l’univers tel que fourni par les textes religieux, donne une description littéralement et scientifiquement exacte de l’origine de l’Univers.
Vous trouverez sur internet de nombreux sites qui continuent à essayer de nier les découvertes scientifiques et de continuer à rester calé sur quelques milliers d’années.
Et, il y aussi des tentatives de rendre compatible les religions monothéistes et la science.
<Ici on trouve une tentative de rendre compatible la Torah et les études scientifiques>
<Ici une tentative identique de la part de chrétiens>
<De telles tentatives existent aussi dans le monde de l’Islam>
Toujours est-il que la perception de l’immensité de l’âge du monde est récente et qu’il existe encore beaucoup d’humains qui semblent en douter.
<850>
-
Jeudi 2 mars 2017
«Le Grand Récit »Michel SerresL’Histoire commence avec l’écriture. Voilà un consensus général qui réunit tous les Historiens.
C’est ce que nous avons appris à l’école.
Michel Serres part de ce constat :
«Pour faire une philosophie de l’Histoire, il faut avoir une bonne définition de l’Histoire. Or tous les historiens sont d’accord pour dire que l’Histoire commence avec l’écriture. C’est l’invention de l’écriture qui constitue le commencement de cette discipline. »
Avant l’Histoire, il y a la période qui précède l’Histoire et à laquelle on a donné naturellement le nom de Préhistoire. Mais pour Michel Serres, les choses ne sont pas aussi claires.
«La plupart des historiens célèbrent, avec raison d’ailleurs, la mémoire, ils disent que l’Histoire est la mémoire collective des hommes. […]
Je trouve, quant à moi, que l’Histoire qui commence avec l’écriture peut se définir par une série d’oublis.
Et les oublis sont les suivants :
Si l’Histoire commence avec l’écriture, [qu’est-ce que cela signifie] pour les civilisations et les cultures sans écriture ?
Ce sont des hommes comme nous, ce sont des cultures comme les nôtres, avec des religions, quelquefois des comptages, quelquefois des sciences mais pas d’écriture. Ils seraient donc « Sans Histoire » ? Cette décision-là, de couper l’humanité entre ceux qui ont l’écriture et ceux qui n’en ont pas, fait que nous considérerons donc que ces gens-là sont en dehors de l’Histoire. Et c’est quand même assez grave de dire qu’ils sont préhistoriques alors qu’ils sont nos contemporains. Voilà le premier oubli.
Cet oubli est compensé par une science humaine au sens technique mais aussi humaniste qui est l’ethnologie qui s’occupe justement des populations sans écriture et pallie l’oubli de l’Histoire.
Mais si on remonte, que s’est-il passé lorsque les hommes ont émergé à l’Humanité elle-même ? On a longtemps oublié ces hommes. Mais une science humaine, au sens technique et humaniste, pallie cet oubli-là. Cette science, c’est la Préhistoire. La Préhistoire s’occupe de nos ancêtres en tant que personne et culture, antérieurement à l’écriture.
J’ai ainsi remonté de condition en condition. Et je remonte au moment où l’Homme est devenu homo sapiens sapiens et je vais au-delà vers les hominidés, puis nos ancêtres communs avec les bonobos et les singes. […] On s’aperçoit alors qu’on plonge dans une nouvelle discipline, une nouvelle science qui pallie les oublis des autres sciences, il s’agit d’une science qui selon Darwin étudie l’évolution de la totalité du vivant. Et là on remonte à plus de 3 milliards d’années jusqu’au premier être vivant, la première molécule qui a su se dupliquer. C’est aussi de l’Histoire.
D’ailleurs cette discipline on l’a bien nommé : « L’histoire naturelle » qui pallie les autres oublis.
Mais voyons un peu…
Cette molécule qui s’est dupliqué, elle était elle-même dans une mer de molécules qui ne se dupliquaient pas et qui était non du domaine du vivant mais du domaine de l’inerte. […]
Ces molécules qui ont jailli de la soupe primitive de molécules qui ne se dupliquaient pas, ont jailli parce qu’elles ont bénéficié d’un habitat favorable à cette activité et à cette existence. Et cet habitat, c’est la planète.
Et cette planète n’a pas d’histoire ?
Et bien si, elle a une histoire. La Géophysique s’occupe de cette Histoire.
Et ainsi de suite on peut remonter de la géophysique au système solaire qui lui aussi à une Histoire. Et du système solaire on remonte à la galaxie et de la galaxie on remonte au big bang etc.
Mais pourquoi dites-vous que vous parlez d’Histoire, puisque l’Histoire commence avec l’écriture ?
Nous y sommes, c’est maintenant qu’il faut bien réfléchir.
Toutes les sciences dont j’ai parlé, que ce soit la géophysique, que ce soit l’Histoire naturelle, la cosmologie, l’astronomie, comment ont-elles fait pour arriver au résultat dont j’ai parlé ?
Réponse : Toutes ont su, à un moment, dater leurs objets !
Et une des grandes découvertes de toutes ces sciences c’est cette datation. Toutes les sciences savent dater.
L’Histoire naturelle sait dater, l’apparition d’une espèce, la disparition d’une espèce. […].
Comment ces sciences font-elles pour dater leurs objets ?
C’est très simple : parce qu’elles découvrent des traces et que ces traces sont considérées comme une écriture et qu’il est question de la décoder. […]
Par exemple une roche volcanique était liquide au moment de l’éruption et lorsqu’elle se solidifie, elle conserve, en son sein, la trace du magnétisme de l’époque. Donc on peut lire sur la roche l’état du magnétisme de l’époque de sa création donc de l’époque en question.»
Michel Serres explique très bien que l’écriture est un code qui permet de transmettre une information. Pour pouvoir comprendre et assimiler cette information, il faut connaître ce code et donc savoir décoder.
Les traces que ces différentes sciences arrivent donc à décoder sont une écriture !
«Toutes les sciences s’adonnent justement à cet exercice-là, lire des traces et donc lire une écriture qu’il s’agit de décoder..
Quand on dit que l’Histoire commence avec l’écriture, alors les vivants ont une Histoire, alors les civilisations sans écriture ont une Histoire, alors la planète a une Histoire, la galaxie a une Histoire, l’Univers entier a une Histoire qui commence avec le big bang.
Une fois que ces sciences ont daté leurs objets, ces objets peuvent s’aligner dans une suite chronologique telle que je l’ai appelée le grand récit.
C’est-à-dire qu’à partir du big bang on peut raconter comment s’est développé l’Univers, puis comment en refroidissant il a donné des étoiles, puis des planètes, des vivants, des espèces de faune et de flore jusqu’à l’Homme. Cela fait donc un grand récit.
Ce grand récit a une particularité qui le rapproche de l’Histoire. C’est le suivant : c’est que les savants qui datent leur objet, ils ne croient pas à quelques finalités qui soient.
Cette Histoire dès qu’on la regarde en aval, il n’y a pas de finalité, on ne peut pas le prévoir.
Mais quand on regarde en amont on peut expliquer comment cela s’est passé. […]»
Pour expliciter cette manière de faire, Michel Serres prend l’exemple de l’élection de Trump qu’aucun politicien n’a prévu. Mais maintenant que l’évènement est arrivé, tous les analystes vont trouver les causes, voire les multiples causes qui ont conduit à ce résultat
«Cette encyclopédie qui relie toutes les sciences dans une datation continue, chronologique est un récit littéraire.
Quand je raconte une Histoire à mes petits-enfants et quand je les vois le soir et que je leur dit où en étions-nous hier ? Ils me répondent nous en étions à : « Et alors … ».
Qu’est ce qui va se passer ? Il n’y a pas de finalité à mon affaire.
La grande Histoire est ainsi ce récit, ce grand récit qui nous vient du début de notre univers jusqu’à nous.»
Et si des historiens veulent encore protester en disant à Michel Serres que tout ceci est un peu éloigné de la réalité humaine, il leur répondra que ce n’est pas exact.
«Notre être organique multi cellulaire et notre ADN est formé de molécules très anciennes. Notre corps est composé essentiellement de 4 ou 5 atomes qui ont été créés il y a très longtemps dans le début de l’évolution de l’Univers. Nous sommes donc tous un composé de ce grand récit.»
Et si vous voulez en savoir encore plus vous avez cette belle émission de France Culture dont le titre est justement « Le grand récit »
C’est la première partie de son livre sur la philosophie de l’Histoire. Il aurait pu l’appeler le Grand récit, mais il a voulu donner le nom d’un personnage et il a choisi Darwin qui est celui qui nous a révélé l’évolution des espèces.
<849>
-
Mercredi 1er mars 2017
« Une philosophie de l’Histoire »Michel SerresLe premier livre abordé dans l’interview d’EmmanuelleDancourt a pour titre : « Darwin, Bonaparte et le samaritain, une philosophie de l’Histoire »
Michel Serres divise son livre en 3 temps, chaque temps étant symbolisé par un nom ; deux personnages historiques Darwin qui a révélé l’évolution des espèces, Bonaparte qui était un homme de guerre et un personnage de fiction, personnage de la culture chrétienne qui apparait dans une parabole que le Christ aurait raconté selon les évangiles : le samaritain, plus connu avec un adjectif : « le bon samaritain ».
Mais pourquoi faire une philosophie de l’Histoire ?
Dans ma jeunesse je m’étais intéressé à un livre de Raymond Aron : « Introduction à la philosophie de l’histoire » dans lequel il s’intéressait aux limites de l’objectivité historique et menait une réfutation du positivisme qui était la pensée dominante. Raymond Aron avait ainsi dans les années 1970 dit de Giscard d’Estaing :
« Cet homme ne sait pas que l’Histoire est tragique »
Car depuis la philosophie des Lumière, on avait considéré que la science apporterait le progrès et donc que l’Histoire ne pouvait aller que vers un avenir meilleur.
Par des voies différentes et des objectifs différenciés, au XIXème siècle, des grands esprits comme Friedrich Hegel, Auguste Comte et Karl Marx avaient tous une vision de l’Histoire qui allait vers plus de lumière, de liberté pour l’homme et d’organisation bénéfique de la société.
Michel Serres comme toujours s’y prend différemment pour réaliser une philosophie de l’Histoire qui lui est propre et qui change forcément notre regard sur l’Histoire, notre Histoire.
Pourquoi faire une philosophie de l’Histoire ?
Il aborde ce sujet de manière encore plus explicite que dans l’interview de KTO, dans une conférence où il présente ce seul livre : « Darwin, Bonaparte et le samaritain » :
« Après les attentats j’ai entendu des voix politiques ou médiatiques dirent : l’Histoire nous rattrape. Comme si l’Histoire n’était jamais faite que d’attentats, de violences et de rapports de force. Vivons-nous vraiment un temps de l’Histoire hyper violent ? Tout le monde a l’air de le penser et tout le monde a l’air de le dire. Si sur notre ordinateur, nous tapons sur un moteur de recherche : cause de mortalité dans le monde et que nous consultons les sites les plus sérieux qui donnent ce type de dénombrement nous constaterons que le nombre de morts par violence est très largement minoritaire.
Jamais le monde n’a été aussi paisible. C’est la première question celle de la violence.
La seconde question qui se pose est notre conduite envers le monde. »
Il raconte que récemment, il marchait dans le bois de Vincennes.
« Et dans ces heures de la terminaison de l’après-midi, levant les yeux j’ai été foudroyé d’admiration devant la beauté du coucher du soleil. Il y avait une harmonie de bleu et de rose dans les nuages qui à travers le feuillage, qui était déjà devenu jaune, était d’une surprenante beauté. Je suis resté en extase un moment et baissant les yeux je me suis aperçu qu’il y avait beaucoup de monde autour de moi et que personne n’y attachait aucune attention. Alors j’ai arrêté une ou deux personnes pour leur dire : Vous avez vu cet extraordinaire coucher de soleil ? »
Alors la première personne m’a répondu : « Merde ! Je n’ai pas mon appareil photo ! »
Et la seconde m’a dit : « Ha Ha vous êtes bien poète vous ! » et… elle a passé vite son chemin.
Et il ajoute :
« Par conséquent personne n’y faisait attention. Et je me suis rendu compte qu’il y avait là une photographie intéressante de notre rapport au monde. C’est-à-dire que nous, habitants des villes, nous n’avons plus jamais l’habitude de regarder le monde.
Les philosophes appellent les hommes : « des êtres au monde » Eh bien ce n’est pas vrai ! Nous ne sommes pas dans le monde, nous ne voyons pas le monde. Et par conséquent si le monde est aujourd’hui en perdition aussi bien pour les espèces vivantes que pour le climat, c’est peut-être que nous n’y faisons pas attention. »
Ainsi pour rédiger mon livre [sur la philosophie de l’Histoire] j’avais deux préoccupations c’était :
· Les questions de violence et
· Notre rapport au monde. […] »
Et il conclut :
« Faire une philosophie de l’Histoire est aujourd’hui important [parce que] nous le savons et nous le vivons vraiment, aujourd’hui nous traversons un moment de transformation tout à fait extraordinaire. Les transformations viennent de toute part et sont très rapides. Et dans ce type de situation instable, il est intéressant de faire le point sur où nous en sommes et où nous allons. Comment lire, comme voir lucidement le contemporain. Les questions politiques qui nous agitent ne peuvent pas se comprendre sans au préalable une philosophie de l’Histoire. »
Ceci est un début, demain Michel Serres nous expliquera que pour faire une philosophie de l’Histoire, il faut définir ce qu’est l’Histoire.
<848>
-
Mardi 28 février 2017
« Je n’enseigne point, je raconte »Michel de Montaigne
Essais – Livre III – Chapitre II <Du repentir>Michel Serres cite souvent cette belle phrase de Montaigne.
Mais surtout il l’a met en œuvre dans sa manière d’aborder les sujets souvent complexes qu’il enseigne ou partage avec celles et ceux qui l’écoutent.
Mais je mets cette phrase en exergue, phrase que j’avais déjà citée dans le corps de deux mots du jour (vendredi 29 mai 2015 lors d’un mot du jour consacré à Bernard Maris et le jeudi 2 juin 2016 dans la série consacrée à Sapiens) pour engager une réflexion sur la technique de l’interview dans les médias.
Dans l’interview principal qui servira à alimenter la série en cours de mots du jour, Michel Serres est entretenu par une journaliste qui s’appelle Emmanuelle Dancourt et qui anime une émission sur la chaîne catholique KTO qui s’appelle <VIP Visages Inattendus de Personnalités>.
Dans cette émission, la journaliste ne se met pas en valeur mais laisse son interlocuteur, choisi parce qu’il a des réflexions à partager, parce qu’une profondeur peut s’exprimer, raconter ce qu’il a à dire et c’est ce que Michel Serres fait très bien.
Pour moi, baigné dans ma jeunesse, par Jacques Chancel dans « Radioscopie » ou Bernard Pivot dans « Apostrophes » c’est un environnement qui me convient, qui me permet d’accéder à la connaissance et à la compréhension.
Parce qu’il faut laisser aux esprits libres et féconds la capacité de raconter…
C’est de plus en plus rare.
Je sais que parmi vous il y a des supporters de Thierry Ardisson, ce journaliste toujours habillé en noir qui a conceptualisé le principe que les téléspectateurs ne pouvaient s’intéresser à un sujet sérieux que si celui-ci était entouré de deux bimbos, de nature à réveiller la libido vacillante du mâle affalé dans son fauteuil, devant sa télé. Cette vision qui s’intéresse peu, me semble t’il, à la moitié féminine de l’espèce humaine est aggravée en outre par l’apparition, au milieu de questions sérieuses, de « QAC (1) » par exemple lorsque Ardisson a demandé à Michel Rocard qui était venu présenter ses idées politiques si « sucer était tromper ».
Thierry Ardisson dispose de clones comme Ruquier ou Fogiel qui avec plus ou moins de succès essayent d’appliquer les mêmes recettes.
Sur le point strictement économique de l’audimat, il faut dire que le succès est au rendez-vous. Pour beaucoup, cela constitue une preuve de qualité.
Bien sûr, si on les prend pour ce qu’elles sont : de simples émissions de divertissement, il me semble qu’on peut être de cet avis. Mais si on veut vraiment apprendre ou comprendre quelque chose, ou encore se ressourcer, il vaut mieux se tourner vers des émissions comme celles d’Emmanuelle Dancourt.
D’ailleurs Thierry Ardisson, à qui je reconnais beaucoup d’intelligence, ne s’y est pas trompé puisqu’il a, pour présenter un de ses livres « Les fantôme des Tuileries », accepté de se faire interviewer par Emmanuelle Dancourt <Le 31 décembre 2016>.
Et dans cet entretien Thierry Ardisson est très intéressant et peut dire des choses qu’il ne pourrait dire ailleurs. Il a le temps de s’exprimer car il fait face à de la bienveillance et à des questions qui élèvent, non des QAC.
(1) QAC = question à la con
<847>
-
Lundi 27 février 2017
« Les gens qui nous permettent de nous ressourcer et les gens qui nous vident de notre énergie »Réflexions personnelles pour présenter des livres et des émissions de Michel SerresLa semaine dernière, il y a eu une série de mots du jour un peu …plombant ?
J’ai même été poussé à écrire à la fin de celui qui parlait de la guerre civile globale décrit par l’indien Pankaj Mishra que je le trouvais trop pessimiste.
Il n’est pas possible, ni raisonnable de rester dans cette seule vision sombre de l’Humanité.
Je vais m’inspirer, pour les prochains mots du jour d’une interview de Michel Serres qui avait été invité pour parler de 3 de ses livres publiés ou republiés récemment :
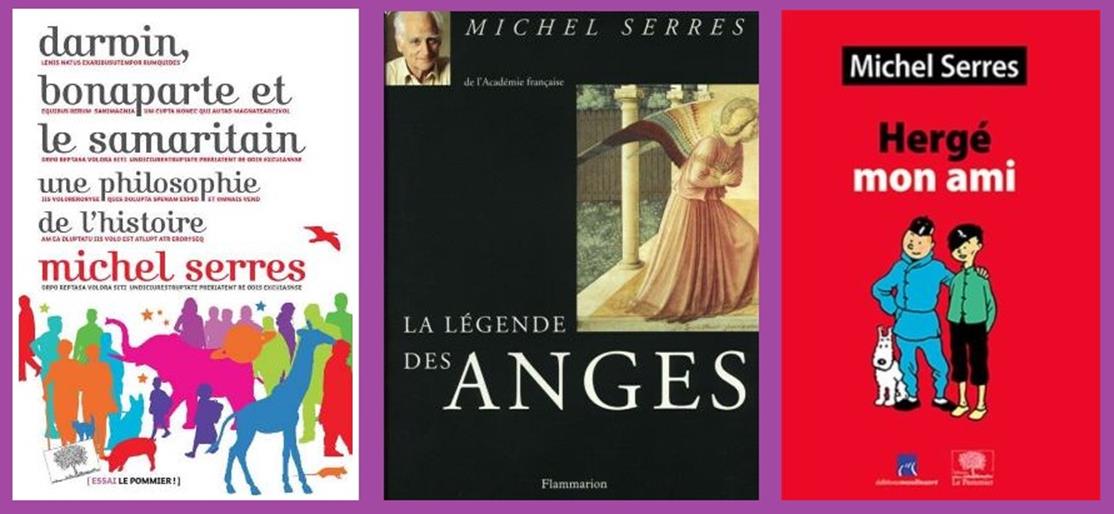
- Darwin, Bonaparte et le samaritain, une philosophie de l’Histoire
- Hergé Mon ami
- La légende des anges
Michel Serres que j’avais convoqué pour le 800ème mot du jour : « L’intelligence est imprévisible et mystique» pour expliquer que l’intelligence est cette faculté qui permet d’approcher un problème, une histoire sous un regard nouveau qui l’éclaire autrement, qui renouvelle notre vision.
Cela nous conduit à nous éloigner de l’actualité pour réfléchir sur notre contemporain : où en sommes-nous ? Quel passé, quelle Histoire nous a engendré ?
Vous pouvez dès à présent voir cette interview : <Michel Serres invité de KTO>
Mais aujourd’hui en préambule, je voudrais esquisser une réflexion qui s’appuie sur mon expérience de vie.
Le point initial vient du fait que lorsque j’ai regardé cette vidéo, cela m’a fait du bien. J’aime cette expression « m’a ressourcé ».
Et cela me conduit à réfléchir plus avant : nous avons tous connu et connaissons des gens, des proches auprès de qui nous arrivons à nous ressourcer. Au contraire nous connaissons des personnes, des situations qui nous vident de notre énergie, trivialement nous pompe.
C’est une chance, j’utiliserai une terminologie mystique, « une grâce » quand comme moi : dans le couple, la compagne que m’a offert la vie, est source de ressourcement.
C’est en effet une chance quand le couple est source de ressourcement ou encore les parents. Nous savons cependant que ce n’est pas toujours le cas.
En amitié aussi, il existe une telle dichotomie.
Des évènements de la vie peuvent conduire que pendant une période donnée, un ami a besoin d’énergie, de soutien et que nous sommes en capacité d’apporter cette énergie. Il se peut aussi que l’on soit dans la situation inverse où c’est nous qui avons besoin d’aide et que nous pouvons compter sur un proche pour nous apporter ce soutien.
L’expérience m’a appris que la période pendant laquelle ce déséquilibre est acceptable, est limitée.
Cela demande de la vigilance et de la lucidité, avant tout pour celui qui donne.
Au-delà, il faut savoir soit arrêter la relation déséquilibrée, soit passer la main.
Cette réflexion trouve particulièrement à s’appliquer, aujourd’hui, dans les nombreux cas où les enfants sont confrontés à des maladies dégénératives de leurs parents et où il faut trouver, en temps utile, des solutions autres que le seul dévouement affectif.
Il n’y a pas que la maladie qui conduise à se trouver dans de telles situations, il peut y avoir une expérience malheureuse ou un échec, mais aussi plus problématique la personnalité de celui qui « pompe ».
Mais ce qui me parait fondamental c’est surtout de reconnaître les personnes ou les moyens dont on dispose pour se ressourcer car il faut savoir se faire du bien, si on veut pouvoir faire du bien aux autres.
Nous voilà bien loin de l’actualité française, des présidentielles ou encore des dernières facéties de Trump.
Mais nous ne pouvons pas que nous nourrir de l’actualité, il nous faut aussi réfléchir sur la vie, sur les rencontres, sur notre humanité.
<846>
- Darwin, Bonaparte et le samaritain, une philosophie de l’Histoire
-
Vendredi 24 février 2017
«clickworkers ou les travailleurs du clic »Un de ses nouveaux emplois créé par le numérique et annoncé par les économistes libéraux et optimistesVous savez que les économistes sont divisés. Les uns constatant que le numérique et l’automatisation généralisée et algorithmisée produisent peu de croissance et suppriment massivement des emplois, pensent que le nombre d’emplois offerts ne suffira plus pour faire face à la demande d’emploi. Les autres que j’appelle « les libéraux optimistes », restent droit dans leurs bottes, en disant que cela a été chaque fois la même chose lors des révolutions technologiques et que nous pouvons toujours faire confiance à « la destruction créatrice » concept attribué à Schlumpeter, cet économiste autrichien qui théorisait justement le fait que les évolutions technologiques supprimaient des emplois anciens mais créaient tout autant d’emplois nouveaux.Cette seconde hypothèse est possible surtout que des économistes constatent qu’il n’y a jamais eu autant de personnes employées dans le monde.Peut être ont-ils raison et que le vrai problème n’est pas le nombre d’emploi, mais quel emploi ?Xavier de Porte est à l’affut de la modernité et du numérique et il nous parle de ces emplois que les anglais appellent les «clickworkers».Tous les géants du numérique ont créé des plateformes de travail payé à la tâche. Comment et à quoi travaillent ces gens ?«Les “clickworkers” ou travailleurs du clic sont des gens qui travaillent chez eux, derrière leur ordinateur, à des horaires qui sont dictés par les clients, pour des tâches simples et répétitives, sans aucun statut et pour une rémunération minuscule. Leur travail, ils le trouvent sur des plateformes qui ont été créées par les géants de l’Internet, dont la plus connue est le Turc mécanique d’Amazon, ce sont des place de Grève contemporaines. On estime leur nombre à 500 000, ils sont principalement américains (à 75%, avec une grande part de femmes) ou des hommes indiens (aux alentours de 20%).En décembre dernier, le site Tech Republic effectuait une plongée fascinante dans ce monde des travailleurs du clic. Pourquoi les appelle-t-on “travailleurs du clic” ? Parce que leurs tâches consistent essentiellement à identifier des motifs sur des images, à identifier des émotions sur des photos de visages, à mettre en ordre des données.Ces travailleurs se disent “enchaînés” à leur ordinateur. Les tâches peuvent apparaître n’importe quand, et il faut être rapide. Certains se créent des alertes qui les réveillent au milieu de la nuit. Ensuite, le temps pour réaliser le travail étant limité, il ne faut pas traîner. Avec les conséquences que l’on peut imaginer sur la vie familiale. Car, comme ces tâches sont très peu rémunérées, il faut en effectuer beaucoup. Une étude du Pew Research Institute estime que les travailleurs du clic perçoivent moins que le salaire horaire minimale aux Etats-Unis (une femme interrogée explique que quand elle touche 25 euros pour 8 heures de travail, c’est une bonne journée). D’ailleurs, la rémunération ne se fait en cash que pour les Américains et les Indiens, les autres sont payés en bons d’achat Amazon, ce qui les oblige à avoir recours à des combines pour récupérer leur rémunération. Sachant que certains clients sont mauvais payeurs (ils rejettent le travail effectué, sans explication). Les travailleurs les plus aguerris prennent le temps, avant d’accepter un travail, de se renseigner sur le client.Ce qui gêne aussi ces travailleurs du clic, c’est que tout le monde n’est pas égal face aux offres. Certains sont désignés “Master’s Level”, ce qui leur permet d’avoir accès à plus d’offres, mieux payées. Le problème : personne ne sait sur quels critères on est désigné “Master Level” (et Amazon refuse de le révéler). C’est l’objet de beaucoup de conjectures sur les forums où ces travailleurs – pour pallier le fait qu’ils ne se rencontrent jamais physiquement – partagent leurs questions, et leurs petits trucs.A quoi sert le travail de ces gens ? C’est là où on atteint un niveau d’absurde presque magnifique. Ce dont je vous parlais tout à l’heure – identifier des objets sur des images, classer des données etc. – ça sert essentiellement à nourrir en exemple les intelligences artificielles qui ne savent pas encore le faire toutes seules. Pour bien fonctionner une intelligence artificielle de reconnaissance d’image, par exemple, a besoin d’exemples, d’énormément d’exemples – il faut qu’on lui dise “ça c’est un chien”, “ça c’est une voiture” sous tous les angles possibles, afin qu’elle soit ensuite capable de reconnaître un chien ou une voiture. Eh bien qui fournit les exemples ? Principalement ces “travailleurs du clic”. C’est pourquoi toutes les grandes entreprises du numérique (Google, Microsoft, Facebook, Apple) – toutes celles qui se sont lancées dans l’intelligence artificielle – ont créé leurs propres plateformes de micro-tâches : elles ont créé ces plateformes pour que des travailleurs du clic humains nourrissent les machines. Et d’ailleurs, au départ, Amazon a créé sa plateforme pour améliorer l’automatisation de son circuit de distribution, pour les hommes aident les machines à s’améliorer, à mieux faire le travail que faisaient les hommes jusque là. En gros, les “travailleurs du clic” travaillent pour qu’un jour les intelligences artificielles remplacent d’autres travailleurs. La question est : combien de temps aura-t-on encore besoin des travailleurs du clic, avant que les intelligences artificielles ne les remplacent eux-mêmes ? On a le temps disent les spécialistes, les machines auront encore longtemps besoin des hommes.Il faut toujours se rappeler que le Turc mécanique auquel se réfère Amazon, c’est un faux automate du 18ème siècle à l’intérieur duquel était caché un homme. Aujourd’hui, c’est une mère de famille américaine ou un Indien qui sont cachés dans la machine. Demain, ça pourrait être beaucoup plus de monde.»Julien BRYGO et Olivier CYRAN ont conceptualisé ce type d’emploi et ont écrit un livre : <Boulots de merde !> -
Jeudi 23 février 2017
«La théologie de la prospérité »Courant de pensée protestante justifiant les inégalités de richesseLe samedi matin à 7h43, Isabelle de Gaulmyn présente une émission sur France Inter dont le titre est : « Faut-il y croire ? »L’émission du 28 janvier 2017 était consacrée à Trump : « Et Trump, il croit en quoi ? » où on apprend la connivence de cet homme étrange et de la théorie de la prospérité.«De fait, pour son intronisation, Donald Trump avait invité six personnalités religieuses, ce qui dans le contexte américain n’est pas incongru (un rabbin, un évêque, etc…). Parmi eux, une seule femme, et la seule aussi à avoir eu le droit de faire un discours, la pasteure évangélique, Paula White. On la présente comme sa conseillère spirituelle. Cette pasteure évangélique est responsable d’un important centre évangélique en Floride, qui appartient au courant de la « théologie de la prospérité », un mouvement issu du pentecôtisme américain.[Cette expression] sonne étrangement, peut-être, à nos oreilles de vieux européens marqués par la tradition catholique, pour lesquels l’Évangile est plutôt associé à la pauvreté. Mais c’est un courant très puissant aux États-Unis, qui repose sur une certaine interprétation du protestantisme, pour expliquer que la richesse, l’argent, est une bénédiction de Dieu.[…] Pour comprendre d’où cela vient, il faut remonter aux débuts du protestantisme, et à Calvin. Comme Luther, Calvin est parti de l’affirmation que l’homme est sauvé par Dieu, non pas pour ce qu’il fait, mais ce qu’il est, gratuitement sauvé (salut par la grâce et non par les œuvres). Mais contrairement à Luther, Calvin pensait que les hommes étaient soit élus par Dieu, de toute éternité, soit damnés, de toute éternité aussi. On appelle cela la double prédestination. Après sa mort, au XVIIe siècle, il y a eu toute une discussion chez les protestants calvinistes, pour savoir si certains étaient damnés, quoi qu’ils fassent. Cette conception n’est plus en cours chez les calvinistes français aujourd’hui (la majorité), mais elle a imprégné le protestantisme, en faisant parfois de la réussite matérielle, le signe de l’élection : vous êtes riche, prospère, cela signifie que Dieu vous a choisi. Vous n’êtes donc pas damnés. C’est ce qui a permis à un sociologue comme Max Weber de faire du protestantisme l’un des facteurs clé du capitalisme, dans les pays protestants, du fait de cette conception du Salut.Alors évidemment, c’est assez caricatural, car par bien des égards, le protestantisme prône la sobriété. Mais il est vrai que s’est greffé, auprès de l’une des branches du protestantisme, le Pentecôtisme, cette « théologie de la prospérité » qui prend à la lettre la phrase de Jésus de l’Évangile qui explique que celui qui donne recevra au centuple. Et s’appuie aussi sur l’Ancien Testament, où l’on parle souvent de la bénédiction des richesses par Dieu.Dans un aspect « soft », cela consiste à encourager les personnes à réussir leur vie, à croire en leurs talents. C’est une philosophie qui allie réussite matérielle et spirituelle, et qui est très positive. Si on est riche, bien portant, c’est que Dieu l’a voulu. C’est par exemple l’enseignement d’un autre pasteur, aujourd’hui décédé, qui a joué un rôle important dans la vie de Trump, Norman Vincent Peale, et qui avait une église sur la 5e avenue à NY, la reformed church in América. Les parents de Donald Trump, puis lui-même l’a fréquenté et s’y est marié (deux fois). Peale est l’auteur d’un best-sellers paru dans les années 1952, « le pouvoir de la pensée positive ».Dans un volet plus « hard », cette théologie assure que la richesse vient de Dieu, et culpabilise ceux qui ne réussissent pas. Elle promet aux fidèles de la réussite matérielle, de l’argent. Et s’ils n’en obtiennent pas, si cela ne marche pas, et bien, le pasteur peut toujours dire que c’est de leur faute, c’est qu’ils ne sont pas « bénis par Dieu »…Oui, la théologie de la prospérité est très répandue dans les milieux Pentecôtistes en Amérique latine et en Afrique, et aussi aux États-Unis. Elle est transmise par des télévangélistes, qui séduisent toujours plus. Dans les pays pauvres, elle donne lieu à de nombreuses dérives. Mais en France aussi, elle s’est répandue dans certaines églises évangéliques, au point que, il y a quelques années, les théologiens protestants évangéliques de France, dans un document très fourni, ont établi une mise en garde contre ce type de théologie : ils expliquent que cette théologie repose sur une conception erronée de la foi, et présente de réels dangers. Car si cette théologie peut rejoindre des personnes qui vivent dans la pauvreté, elle instrumentalise Dieu, expliquait ce document, qui soulignait aussi les contradictions avec le message de pauvreté de l’Évangile. Ce document fait écho à un autre texte, adopté en 2010 par 4200 responsables évangéliques du monde entier (la déclaration de Lausanne), qui lui aussi dénonçait les travers de la théologie de la prospérité. »Ce courant de pensée permet donc de rendre compatible la religion chrétienne avec les inégalités que produit le système économique afin que les gagnants puissent profiter de leur réussite économique sans aucune culpabilité. Le fait que pour l’essentiel les riches soient enfants de riches devient donc négligeable devant cette théorie qui explique ces inégalités par la bénédiction ou non de Dieu.L’utilisation de la religion par certains peut aussi servir à cela : justifier des situations, a priori choquantes, par des théories permettant d’éviter de réfléchir et d’analyser les processus en oeuvre qui expliquent ces situations. -
Mercredi 22 février 2017
« La guerre civile globale »Mishra PankajLe concept de guerre civile globale est extrait de « Age of Anger » (âge de la colère) qui est un livre d’un romancier d’origine indienne, Mishra Pankaj qui selon « Le Point » est l’essai le plus commenté en ce début d’année dans le monde anglo-saxon.
Ce livre dont le sous-titre est « Une histoire des temps présents » n’est pas encore traduit en français, mais le magazine Le Point a publié une longue interview de cet auteur qui analyse notre présent non comme un choc des civilisations mais comme une explosion de colère née d’une intense frustration : <vers la guerre civile mondialisée ?>
 Sa thèse c’est que symptômes que nous percevons (Election de Trump, éclosion des populismes, des régimes autoritaires et des manifestations de nationalismes et de xénophobie sont le signe d’une « guerre civile globale » opposant une élite cosmopolite et libérale à des masses frustrées de ne pas voir les fruits du progrès tant vanté.
Sa thèse c’est que symptômes que nous percevons (Election de Trump, éclosion des populismes, des régimes autoritaires et des manifestations de nationalismes et de xénophobie sont le signe d’une « guerre civile globale » opposant une élite cosmopolite et libérale à des masses frustrées de ne pas voir les fruits du progrès tant vanté.
Ses prévisions sont peu optimistes, il pense que la colère des masses ne va que s’accroître, car ses racines sont profondes.
Le Point commente :
« Dérangeant et pessimiste, rempli de bruit et de fureur, cet Age of Anger est éminemment discutable, mais personne, même pas le très libéral The Economist, n’a nié la puissance et l’ampleur [de cet] essai »
J’en tire quelques extraits :
« Selon Pankaj Misrah, c’est tout le programme des Lumières qui, dès le départ, contient un bug : en voulant façonner des individus libres, rationnels, mais soumis à la compétition et au désir mimétique, il porte en lui le virus du « ressentiment » ».
Tout se résume au fond à l’opposition entre Voltaire et Rousseau, réunis au sein du Panthéon, mais dont la rivalité n’a pas fini de faire des émules.
D’un côté, le chantre de la raison et du libéralisme anglo-saxon, qu’on qualifierait aujourd’hui de membre d’une « élite » coupée du peuple.
De l’autre, le rejeté de la bonne société parisienne, le paria paranoïaque qui a le premier annoncé toutes les passions négatives que pouvait susciter la société moderne.
« C’est triste de voir qu’on réchauffe [la] théorie de la guerre des civilisations qui se fonde sur des différences absolues culturelles et raciales… C’est ce genre de pensées qui motivent des personnes comme Stephen Bannon, le suprématiste blanc conseillant Trump. Au contraire, mon livre tente d’expliquer, en se basant sur le travail de René Girard, comment dans un monde moderne de plus en plus homogène l’individualisme et le désir mimétique sont la clé pour analyser une société marchande universalisée. Je cite Alexandre Herzen, le grand écrivain russe, et son affirmation que la civilisation occidentale moderne est une civilisation d’une minorité privilégiée, qui prend part au « festin de la vie », alors que les masses en sont les « invités indésirables ». Et cette guerre civile globale ne fait que s’intensifier du fait de l’uniformisation grandissante provoquée par la mondialisation.[…]
Mon livre se base sur une thèse historique : les pathologies politiques qu’a connues l’Europe à la fin du XIXe siècle en réaction au libéralisme, à la démocratie et à une croissance économique irrégulière sont aujourd’hui devenues universelles. Depuis la fin de la guerre froide, nous avons connu trois décennies d’un libéralisme extrême – souvent qualifié de néo-libéralisme – qui a pourtant été discrédité par les désastres de la première moitié du XXe siècle. Que ce soit aujourd’hui l’implosion des États-nations en Asie ou en Afrique, le ralentissement des économies ou la hausse des inégalités en Europe, ces pathologies rappellent ce qu’on a pour la première fois observé à la fin du XIXe siècle : des démagogues promettant le renouveau d’une communauté nationale ou des terroristes anarchiques trouvant dans la violence non seulement une expérience esthétique et existentielle, mais aussi une rédemption politique. Aujourd’hui, ces pathologies se sont répandues partout dans le monde. Elles touchent autant des Indiens déracinés, ayant migré de zones rurales aux métropoles, que la classe moyenne américaine délaissée par un capitalisme globalisé et opaque qu’elle ne comprend plus. Dans les deux cas, ces gens se cherchent un ennemi facilement identifiable et qu’on a sous la main : immigrants, femmes, élites…
[…] Les gens, en théorie, devraient être plus libres, riches et mobiles que jamais…
Qui dit ça ? Les idéologues du néo-libéralisme, qui ne cessent de nous répéter, alors que les inégalités grandissent, qu’une marée montante profite à tout le monde, yachts de luxe comme frêles esquifs. Ce sont les fantasmes véhiculés par les élites technocratiques, et leurs porte-voix dans la presse et sur les plateaux de télévision. Mais aujourd’hui, nous expérimentons les conséquences toxiques de ces promesses fausses et extravagantes faites par les bénéficiaires de la mondialisation.
[…] Aujourd’hui, l’ère de la mondialisation promet une citoyenneté cosmopolite pour tous, mais n’en délivre dans les faits qu’à des élites. Beaucoup se sentent donc floués. Du coup, l’attrait du concept « peuple » est à nouveau fort. Les gens recherchent une estime de soi à travers un groupe défini par l’ethnicité, la religion, la race ou la culture. Et les politiques sont à nouveau obsédés par l’idée de recréer une unité idéologique ou culturelle du peuple, et exclure tous ceux qui ne devraient pas y appartenir. […].
Le journaliste du Point essaye de ramener un peu de rationalité et de montrer qu’il y a quand même des progrès, en rappelant qu’ «En 1981, 54 % de la population mondiale était dans l’extrême pauvreté. Aujourd’hui, c’est moins de 10 %, selon la Banque mondiale. Les gens vivent plus longtemps, les maladies infectieuses ont connu des chutes remarquables et, alors qu’en 1900 seuls 21 % de la population mondiale savaient lire, ils sont aujourd’hui 86 %. N’est-ce pas là des succès spectaculaires du progrès, du libéralisme et de la mondialisation tant vilipendés ?». Le point appelle à la rescousse Steven Pinker qui a montré que nous vivons l’époque la moins violente et la plus tolérante de l’histoire, grâce à l’essor de la raison, du commerce, du cosmopolitisme et de la féminisation…et que j’avais évoqué lors du mot du jour du 19 décembre 2016 : « dix raisons de se réjouir de l’avenir » »
Ces arguments n’entament pas le pessimisme de Pankaj Misrah :
« Des pays comme l’Inde et la Chine ne pouvaient que se refaire une santé après ce qu’ils ont connu avec l’impérialisme occidental et la guerre civile. Et qu’est-ce que la croissance chinoise, à travers un capitalisme d’État, a à voir avec le libéralisme occidental ? De toute façon, il y a quelque chose de fallacieux dans ces succès quantifiables et ce progrès irréversible que vous présentez. Est-ce qu’une longue vie signifie qu’elle est obligatoirement meilleure et plus gratifiante ? Les taux de mortalité ont baissé, et ceux de l’alphabétisation sont en hausse, mais quid du chômage, du déracinement, de la dépossession et de la dégradation environnementale ? Une personne qui quitte son village pour aller travailler dans une métropole sort de la pauvreté selon les statisticiens, mais quelles mesures avons-nous pour évaluer sa vie dans des villes où la pollution est importante et les loyers élevés, tandis que les conditions dans les bidonvilles sont extrêmement brutales ? Ne soyons pas aveuglés par les statistiques et les graphiques. Au XIXe siècle, alors qu’il y avait très peu d’économistes et de journalistes pour faire œuvre de propagandistes, les romanciers ont décrit ce qu’ont vraiment coûté l’industrialisation et l’urbanisation. Cela vaut toujours la peine de lire Dickens et Zola pour comprendre ce qu’actuellement beaucoup de personnes vivent en Inde et en Chine dans leur marche au progrès. […]
L’idéologie de l’élite, les bénéfices de la mondialisation sont les mieux défendus depuis les verts campus de l’Ivy League, comme Harvard où travaille Monsieur Pinker. Des gens comme lui vous enrobent ça de statistiques nombreuses et impressionnantes, mais si vous regardez de plus près, l’analyse est très mince. Les dernières décennies semblent plus pacifiques essentiellement parce que les Européens ont arrêté de s’entretuer à large échelle en 1945. Mais les génocides, les nettoyages ethniques ou les guerres qui détruisent des millions de vies comme en Irak ou au Vietnam ne sont guère éloignés dans le passé. Et la probabilité que cela se produise à nouveau n’a jamais été aussi grande après l’arrivée à la Maison-Blanche de racistes et de suprématistes blancs. Je ne sais pas comment on peut croire à la vision rose d’un progrès constant de l’humanité, défendue par Steven Pinker, alors même qu’un « troll » sur Twitter a accès à l’arme nucléaire…[…]
Le projet moderne de l’individualisme, tel qu’il a été défini au XVIIIe siècle, est le projet utopique le plus radical de l’histoire. »
Il n’y a qu’une lueur d’espoir dans son développement quand il évoque le pape François.
« […] nous ferons très certainement un pas en avant en reconnaissant que la foi dans le progrès n’est nullement différente de la foi dans un dieu. Les deux nécessitent une soumission plutôt qu’un questionnement intellectuel. Par ailleurs, d’aucune façon je ne fais référence à une religion quand je salue le pape François. Je souligne simplement sa compassion pour les faibles et le fait de ne pas voir la vie comme une compétition sans fin pour un statut social ou la richesse, mais plutôt de s’ouvrir à la confiance et la solidarité. De telles aspirations sont l’objet de la dérision des élites technocratiques, alors même qu’une majorité frustrée et en colère succombe à la haine vomie par les démagogues… »
Nous avons compris que la mondialisation est la fin de la rente de l’occident. Les inégalités entre pays ont globalement diminué mais les inégalités à l’intérieur des pays occidentaux ont augmenté. D’où ce concept de guerre civile totale à l’intérieur des pays, mais dans tous les pays.
Je pense cependant que cet auteur est un peu trop pessimiste.
-
Mardi 21 février 2017
«La mondialisation c’est la fin de la rente que l’Occident avait sur le monde depuis la révolution industrielle.»Zaki LaïdiNous tournons depuis longtemps autour de ce concept de mondialisation, certains pour s’en enthousiasmer et il vrai qu’il y a beaucoup d’aspects très positifs à cette évolution et d’autres pour s’en méfier, voire de la rejeter.La mondialisation est un terme français, les anglo-saxons parlant de globalisation. Certains esprits français distinguent désormais la globalisation comme la partie économique de la mondialisation qui concerne outre l’économie, la culture, le village global dans lequel les gens échangent des idées, des appartements et voyagent.France Culture a invité, dans une émission qui avait pour titre <Peut encore défendre la mondialisation ?>, Zaki Laîdi qui est politologue et a beaucoup investi dans une réflexion sur ce changement de monde.Et à la question de Guillaume Erner : «Comment peut-on définir la mondialisation ?» Il a eu cette réponse qui me semble pleine de clarté et de pertinence :«Fondamentalement au niveau géopolitique globale, la mondialisation c’est la fin de la rente que l’Occident avait sur le monde depuis la révolution industrielle. C’est-à-dire que la position dominante de l’Occident dans le monde arrive aujourd’hui à son terme.Et ce que fondamentalement la mondialisation est, c’est un basculement du centre de gravité de la richesse du monde de l’Occident vers le reste du Monde. On voit bien le problème que cela pose à l’Occident, à l’Europe, aux Etats-Unis : ils ne sont plus dans la position dominante dans laquelle ils étaient et qui va les obliger à composer avec le reste de ce monde. Avant la révolution industrielle, la Chine et l’Inde représentait 40 % de la richesse du monde.»Nous ne sommes pas en déclin selon Zaki Laïdi, mais nous entrons dans un monde plus difficile, plus concurrentiel parce que nous avons perdu cette rente.La mondialisation produit des gagnants et des perdants. Emmanuel Todd avait eu cette image il y a quelques années, dans les années 70 quand vous alliez à Calcutta vous voyiez énormément de gens très pauvres vivre dans la rue en s’abritant dans des cartons. La mondialisation a fait en sorte que proportionnellement il y ait moins de gens qui vivent de la sorte à Calcutta mais que maintenant chez nous il y a aussi des gens qui dorment dans les rues, dans des cartons…Zaki Laïdi dit encore :«Derrière la mondialisation nous avons fondamentalement le changement technologique. Ce changement a eu pour conséquence que le coût de l’échange d’informations s’est effondré, le coût des transports aussi, c’est un effondrement des distances.»Une autre invité Virginie Raisson ajoutant cette évidence:«Si les inégalités entre pays ont diminué du fait de la mondialisation, elles ont augmenté à l’intérieur même des pays»La grande question politique qui se pose dès lors est : Comment aide t’on les perdants de la mondialisation ? Pour les gagnants, l’économie s’en charge. Pour qu’il y ait plus de gagnants, il faut probablement plus d’éducation et une éducation de qualité adaptée aux besoins du temps. Mais il y aura toujours des perdants. Et s’occuper des perdants c’est une question politique, d’organisation de la société.Or comme le dit un message que j’ai vu récemment circuler sur les réseaux sociaux : « Nous vivons dans un monde où ceux qui gagnent 100 000 € par mois persuadent ceux qui en gagnent 1800 que tout va mal à cause de ceux qui vivent avec 535 €. Et ça marche. »Tant que nous étions dans le système de la rente de l’Occident sur le reste du monde, nos élites économiques prélevaient sur le reste du monde de quoi, sans rien lâcher sur leurs profits, donner des emplois convenablement rémunérés au plus grand nombre des occidentaux. Sans cette rente comment faire ?Il me semble qu’il y a 3 solutions : la redistribution, la charité ou la relégation qui peut devenir élimination.Il va sans dire que pour moi seule la première est digne. -
Lundi 20 février 2017
« Une antonomase »Figure de style dans laquelle un nom propre est utilisé comme nom commun.Le dictionnaire Larousse explique que ce mot vient du grec « antonomasia », de anti, à la place de, et onoma, nom et donne pour définition : Figure de style consistant à remplacer un nom commun par un nom propre ou inversement.Mais selon Wikipédia, certains linguistes limitent le sens de ce mot à l’antonomase du nom propre qui consiste à employer un nom propre pour signifier un nom commun.Grâce à Wikipedia nous disposons d’une première liste d’exemples d’antonomase :Ainsi François Barrême était un mathématicien du XVIIe siècle. Le mot devenu « barème » apparut au XIXe siècle ;Eugène Poubelle était préfet de la Seine, où il généralisa l’usage de la poubelle à des fins de salubrité publique ;« Mécène » désigne un « généreux donateur protégeant les arts et les artistes », en souvenir de Mécène, général romain de l’époque de l’empereur Auguste, qui s’étant enrichi au cours de ses campagnes, s’était offert une villa somptueuse entourée d’artistes ;Et le mot « Atlas », vient du géant de la mythologie grecque condamné à porter le monde sur les épaules.Plus couramment on parlera d’un « Harpagon » pour parler d’un avare ou d’un « Don Juan » pour évoquer un séducteur compulsif.Je pense que bientôt on parlera d’un « Fillon » pour décrire une personne qui recommande des actions positives voire des sacrifices aux autres et se garde bien d’appliquer ces conseils à lui-même.Mais on pourra aussi vouloir exprimer le contraire : « Je n’ai pas fait mon Fillon ».C’est ce que peux dire à propos du conseil que je vous ai donné la semaine dernière d’aller voir « Lumière ! L’aventure commence » car vendredi en fin d’après-midi nous avons, avec Annie, suivi ce conseil pour nous même, et nous furent enchantés.Il y a d’abord la qualité de l’image de ces petits films restaurés de 50 secondes et puis il y a le commentaire de l’expert Thierry Frémaux qui sait se mettre au niveau des néophytes pour expliquer combien tous ces tournages, a priori pris sur le vif, ont été soigneusement mis en scène et combien les frères Lumière ont immédiatement compris où mettre la caméra, comment attirer l’attention, faire un travelling qu’ils appelaient alors panorama.Et puis pour les habitants de Lyon, comme pour ceux de Paris et de la Ciotat quelle émotion de voir vivre leurs villes et leurs aïeux dans les années 1900. Mais ces films ont été tournés aussi dans le monde entier.Découpés en chapitres, Frémaux montre 108 films sur les 1 422 référencées et attribuées aux Frères Lumière et à leurs assistants.En dehors des scènes tournées à Lyon, Paris, La Ciotat, Marseille, Jérusalem, Londres, New York, 3 scènes m’ont particulièrement marqué :La première, un peu comique montre des chasseurs alpins faire des exercices d’escalade avec une maladresse particulière et Frémaux d’émettre cette idée qu’en voyant ces soldats à l’exercice on peut comprendre qu’à cette époque l’armée française perdait beaucoup de batailles …La seconde est plus sociale, on voit une rivière et toute une rangée de femmes en train de laver le linge au lavoir. Et comme le fait remarquer le commentateur, le génie des frères Lumière est de montrer trois niveaux de scènes : au deuxième plan il y a trois hommes en costume qui observe la scène et au troisième plan qui est une route ou un chemin d’autres hommes se promènent. Thierry Frémaux a alors ce commentaire : « Quand on parle de la France au travail, dans ce film on parle exclusivement des femmes au travail !!! »Et puis la troisième…En Indochine, dans cette région qu’on appelait alors « Annam », on voit sur les marches d’une demeure occupée par des occidentaux deux femmes blanches qui jettent des poignées de pièces à des enfants annamites.Le propos récent de Macron : « Le colonialisme est un crime contre l’humanité » a fait polémique. Peut-être. Il est possible que cette qualification soit inappropriée.Mais ces 50 secondes montrent toute la violence de la colonisation et la réalité que dans ce rapport entre les occidentaux venus avec leur puissance guerrière et économique et les populations autochtones, il y a une inégalité telle qu’ils ne semblent pas appartenir à la même race humaine, un peu comme ces scènes où des humains jettent des aliments à des animaux.J’ai trouvé sur Internet cette photo de mauvaise qualité qui est un extrait du film qui montre la scène dans de bien meilleures conditions techniques.C’est tout cela qu’on voit dans ces 104 films qui montre le monde entre 1895 et 1905. -
Vendredi 17 février 2017
« On est bien peu de chose
Et mon amie la rose
me l’a dit ce matin »Françoise HardyOffrir une rose…«Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, aux rayons du soleil» fait dire à la rose, Françoise Hardy.<Le billet économique> de Marie Viennot a abordé le sujet de la production de la rose dans le monde à l’occasion de la Saint Valentin, ce début de semaine :«Car le plus souvent, ce n’est pas en France que la rose que vous offrez se sera épanouie, mais plus vraisemblablement en Hollande, en Equateur, en Colombie ou au Kenya…Les roses d’Equateur sont les plus haut de gamme, car elles sont hautes, résistantes, de multiples couleurs. Les roses de Colombie sont principalement destinées au marché américain; elles sont parait-il les préférées de Michelle Obama. Les roses du Kenya sont plus petites, et de moins bonne qualité, vous les trouverez dans les supermarchés.Ces pays se sont spécialisés dans ces plantations il y a 20 ans environ, ce qui ne va pas sans poser de problèmes.Ils ont l’avantage d’être situés près du parallèle zéro, où l’ensoleillement est maximum, et d’avoir une main d’oeuvre bon marché, et docile. Or la fleur coupée est une activité très intensive en travail humain, surtout féminin, et en produits chimiques.Les dégâts sur la santé des femmes qui les récoltent, et leurs enfants sont documentés dans de très nombreux reportages édifiants.Au Kenya, la production de roses se concentre autour du lac Naivasha, elle représente avec d’autres cultures autour du Lac 10% des exportations du pays, et comme elle pompe une grande partie de l’eau du lac, il y a des conflits récurrents avec les tribus Massai et Kikuyu qui n’ont plus accès au lac pour abreuver leurs troupeaux. […]»Mais «Où est la rose Made In France ? Elle est encore cultivée dans le sud, en région PACA, autour de Hyères, mais c’est minime.Toute fleur confondue, la France importe 85% des fleurs coupées vendues chaque année. La filière horticole se porte mal, entre 2005 et 2015, 40% des exploitations ont disparu. Il y en a encore 4000, ce qui représente 20 000 emplois.Il y a deux ans un label Fleur de France a été créée pour promouvoir cette filière mais pour le moment la provenance des fleurs n’est pas devenue la préoccupation des acheteurs.L’Union Nationale des Intérêts professionnels horticoles interpelle les candidats à la présidentielle. Elle leur demande notamment, que comme pour les légumes, la provenance des fleurs soit indiquée.C’est rarement le cas, vous le constaterez, mais si vous demandez à votre fleuriste, il sait très bien où sont produites les fleurs qu’il vend. Celles qui ne viennent pas des Pays Bas, sont acheminées par air. Leur bilan carbone est donc assez élevé, mais pas plus que le vôtre quand vous prenez l’avion puisqu’elles voyagent sous vos sièges, dans les soutes à bagages.[…] Une américaine a développé le concept de Slow flowers. Elle y a consacré un livre, et un site, où l’on peut trouver les adresses de fleuristes qui proposent des fleurs locales.L’idée est de privilégier les circuits courts, les fleurs produites localement et sans pesticide. Cette tendance existe aussi Outre Manche, où des producteurs proposent aux clients de venir cueillir eux même leur fleurs.[…] Cela doit exister en France, mais les informations ne sont pas centralisées sur un site, contrairement aux Etats Unis. D’ici là, si vous voulez privilégier la filière française, préférez aux roses– les mimosas,– les anémones,– les pivoines– les renonculesCe sont les variétés où vous avez le plus de chance de tomber sur des « fleurs de nos jardins ». »Comme le rappelle mon ami Gérald, il faut savoir cependant que Françoise Hardy n’est que l’interprète, l’auteure des paroles étant Bernadette Cécile Caulier. ». Vous lirez derrière le lien Wikipedia le destin de cette femme et de ses combats dans un monde artistique féroce.Mon amie la roseOn est bien peu de choseEt mon amie la roseMe l’a dit ce matinÀ l’aurore je suis néeBaptisée de roséeJe me suis épanouieHeureuse et amoureuseAux rayons du soleilMe suis fermée la nuitMe suis réveillée vieillePourtant j’étais très belleOui j’étais la plus belleDes fleurs de ton jardinOn est bien peu de choseEt mon amie la roseMe l’a dit ce matinVois le Dieu qui m’a faiteMe fait courber la têteEt je sens que je tombeEt je sens que je tombeMon cœur est presque nuJ’ai le pied dans la tombeDéjà je ne suis plusTu m’admirais hierEt je serai poussièrePour toujours demainOn est bien peu de choseEt mon amie la roseEst morte ce matinLa lune cette nuitA veillé mon amieMoi en rêve j’ai vuÉblouissante et nueSon âme qui dansaitBien au delà des nuesEt qui me souriaitCroit celui qui peut croireMoi j’ai besoin d’espoirSinon je ne suis rienOu bien si peu de choseC’est mon amie la roseQui l’a dit hier matin. -
Jeudi 16 février 2017
« Le cinéma de Lumière avait pour fonction de dire qui nous sommes et ce qu’est le monde : c’est la même chose aujourd’hui »Thierry Fremaux dans l’émission des matins de France Culture du 8 février 2017Le destin a voulu que lorsque nos activités se concentraient à Paris, Annie, moi et nos enfants ayons vécu plus de 10 ans à Montreuil avant de venir presque par hasard à Lyon. A Lyon, en cherchant un appartement nous sommes tombés aussi par hasard sur notre appartement qui se situe à exactement 350 m de la rue du premier film et de l’Institut Lumière. Nous habitons donc à 350 m de l’endroit où on a tourné le premier film : « la sortie de l’usine Lumière à Lyon » en 1895.Alors pourquoi je rapproche cela de Montreuil ? Parce que Montreuil est la ville <Où George Meliés, inspiré par les frères Lumière, a créé le premier studio de cinéma>Méliès ne parvint pas à s’entendra avec les Lumière et c’est par d’autres moyens qu’il créa les premiers trucages, les premiers effets qui inspirèrent cet art que deviendra le cinéma.Mais ce mot du jour est consacré du film : « Lumière ! L’aventure commence » qui est sorti, le 25 janvier dernier. C’est un film réalisé par Thierry Frémaux, présenté par Bertrand Tavernier et l’Institut Lumière, bref une affaire lyonnaise.Lors de cette émission, Thierry Fremaux a expliqué que « Le cinéma s’est conçu lui-même comme art plus tardivement. Pas plus Lumière que Méliès, qui certes était un homme de spectacle, Charles Pathé ou Léon Gaumont, n’avaient conscience de faire autre chose que de lancer une nouvelle industrie. » Beaucoup d’articles parlent de manière élogieuse de ce film : <Télérama parle d’un ravissement.>Bertrand Tavernier a publié ce texte sur le site de«Chers amis,Demain, mercredi 25 janvier, pour la première fois dans l’Histoire et hors les projections des années 1895/1905, le cinéma de Lumière retrouve le chemin des salles.La sortie de Lumière ! L’aventure commence est un événement considérable.Avec « des » films Lumière, Thierry Frémaux a composé « un » film Lumière. La restauration 4k révèle de somptueux trésors. La beauté de ces films est stupéfiante et, enchantés par la musique de Camille Saint-Saëns, ils offrent des sentiments inoubliables aux spectateurs, entre drôlerie et émotion.Lumière ! L’aventure commence a été produit par l’Institut Lumière et sa distribution est assurée par la société Ad Vitam, réputée pour son goût et son engagement, avec à sa tête une équipe de jeunes cinéphiles habitués aux meilleurs auteurs mondiaux (Bellocchio, Hou Hsiao-hsien, Jia Zhangke). De nombreuses salles l’accueillent, les salles d’art et essai comme les grands réseaux. Il sortira à Paris, dans de nombreuses villes de France, et à Lyon, au CNP Terreaux (récemment devenu, belle coïncidence, le Lumière Terreaux), à l’UGC Ciné Cité Confluence et au Pathé Bellecour.À l’étranger, où Wild Bunch assure les ventes, près d’une vingtaine de pays ont déjà acheté le film et le sortiront en 2017.C’est un grand aboutissement pour tous les amoureux du cinéma de Lumière, pour toute l’équipe de l’Institut, pour moi qui ai le privilège de le présider depuis ses débuts et pour Bernard Chardère qui en assura le lancement et fut le biographe des Lumière.Après avoir rencontré, lors des avant-premières de Lyon, Cannes, Paris, Orléans, Grenoble, ses premiers spectateurs, Lumière ! a fait vendredi dernier l’ouverture du festival d’Angers. Le miracle s’est opéré à nouveau, comme nous le constatons depuis les premières projections de presse. De nombreux messages nous parviennent. Vous le verrez, vous le lirez, les critiques sont unanimes.Le 28 décembre 1895, il y avait 33 spectateurs lors de la première séance au Salon Indien du Grand Café. À partir de mercredi, chaque séance sera historique, chaque projection rappellera la beauté d’un cinéma oublié.Avec toute l’équipe de l’Institut Lumière, avec celle d’Ad Vitam et avec toutes les salles qui nous font l’amitié de nous accueillir, nous espérons que vous serez nombreux à venir retrouver ceux à qui nous devons LE CINEMA !Merci à tous,Bertrand TAVERNIERPrésident de l’Institut Lumière»Bertrand Tavernier a aussi cette belle formule : « Ils ont offert le monde au monde »Il me parait indispensable d’aller voir ce film qui raconte l’Histoire et montre l’Histoire. -
Mercredi 15 février 2017
«La sieste en entreprise, c’est pour quand ?»Marina Al RubaeeCe n’est pas un journal de la gauche bobo, de cette partie de l’échiquier politique qui perpétuellement en appelle à la fainéantise (35h, maintenant 32h, retraite à 60 ans) s’éloigne de la société du travail (revenu universel) qui pose cette question mais un journal de droite : Le Figaro. Et pour être plus précis, le magazine Figaro madame : <La sieste en-entreprise c’est pour quand ?>Que raconte cet article ?«Si tout le monde en rêve, le sujet de la sieste en entreprise reste tabou. Pourtant, les bénéfices sont réels.Vous n’avez plus une minute à vous : vous courez tout le temps, à devoir tout gérer. Résultat, vous êtes sur les rotules, à bout de souffle en fin de journée. Une petite sieste vous aurait été profitable pour faire une pause et recharger les batteries. Malheureusement, cette pratique n’est culturellement pas admise en France alors qu’elle est pratiquée au Japon, en Espagne et même inscrite dans la constitution chinoise. «En France, on la concède volontiers aux enfants et aux personnes âgées. Mais pour les actifs, la fatigue semble ne pas exister. Pourtant, elles est bien réelle chez de nombreux collaborateurs», observe Guirec Gombert, content manager au sein de RegionsJob. En effet, la sieste aujourd’hui, plus qu’une tendance, est devenue une nécessité.Selon une étude commandée en juin 2016 à OpinionWay par Eve Sleep, une start-up fabricant des matelas, 80% des Français ressentent de la fatigue en journée de façon occasionnelle au travail. 72% des sondés en perçoivent les effets négatifs : augmentation du stress, perte d’attention et de la productivité. Pour 49% d’entre eux, la sieste resterait le meilleur moyen d’y remédier. Certains, de peur d’être mal perçus, la pratiqueraient en catimini (voiture, toilettes…). Un phénomène de société bien réel sur lequel les entreprises continuent à faire la sourde oreille. «Ce besoin de repos est encore perçu comme de la fainéantise. En termes de bien-être au travail, les entreprises pensent à mettre en place des crèches d’entreprise, des salles de « convivialité » ou favorisent le sport mais oublient la sieste», analyse Guirec Gombert. Selon une autre étude du cabinet Robert Half (2014), 36 % des entreprises françaises trouvent cette idée «farfelue». Cependant, 47% des chefs d’entreprise pensent que c’est «envisageable». Sans forcément passer le cap.Pourtant, la vertu de la sieste est avérée. Selon la Nasa, 20 minutes de sieste amélioreraient de 35% la productivité au travail. Toujours selon l’étude Opinion Way, seules 12% des entreprises y sont favorables. Certaines ont franchi le pas. C’est le cas de Renault. Depuis plus d’un an, le fabricant d’automobiles teste une salle de repos dans une annexe de son site de Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Les 1200 salariés peuvent ainsi accéder aux sept cabines dernier cri dédiées à la sieste (entre dix et vingt minutes). La fréquentation du lieu est passée de 40 à 60 personnes par jour, avec des pics de fréquentation situés entre 11 heures et 15 heures. Danone France s’y est mis aussi. Mais, les deux sociétés s’abstiennent de communiquer sur ce sujet.Léa Nature, PME de produits bio, propose aussi ce service à ses 450 salariés en mettant à leur disposition une salle «zen» avec transats, matelas, lumière tamisée et musique douce. «Il est généralement plus facile d’instaurer cette pratique dans des PME et des start-up que dans les grands groupes dans lesquels les rapports hiérarchiques sont davantage marqués», poursuit Guirec Gombert. Pour preuve, chez Orange, à Meylan (Isère), il aura fallu l’intervention d’un médecin du travail pour créer un «espace calme».Des start-up surfent sur la vague comme Nap Concept qui milite pour démocratiser le petit roupillon en entreprise ou Nap&Up qui loue des espaces de micro-sieste «clé en main». Des «bars à sieste» fleurissent également autour des quartiers d’affaires : ZZZen à Paris, My Cup of time à Lyon, Au petit répit d’Isana à Belfort… un petit «dodo» accessible pour un prix allant de 5 à 27 euros. Si tout le monde reconnaît les vertus indéniables de la sieste, l’idée mettra encore un peu de temps à faire son chemin.»La fin me rassure, le Figaro est bien un journal de droite, car la conclusion permet d’entrevoir la marchandisation de la sieste, donc c’est une idée qui peut avoir vocation à prospérer.Modestement j’avais proposé cette idée à mon chef alors que je venais de débuter dans l’administration centrale de la DGI dans la fin des années 80. Mon chef ne m’avait pas répondu et avait simplement levé les yeux au ciel, pour celles et ceux qui ont vécu cette époque avec moi, il s’agissait de Michel Gusthiot.Pourtant je continue à prétendre que cette idée est bonne, d’autant plus que le monde du travail notamment dans l’administration vieillit. (Dans les entreprises a priori aussi, mais dans ce monde là on les vire et on crée des seniors chômeurs) -
Mardi 14/02/2017
« Le jour où quelqu’un vous aime, il fait très beau »Jean GabinC’est le jour de la Saint Valentin. Je me souviens avec émotion le jour où j’ai entendu pour la première fois ce texte, j’étais bien jeune alors : 16 ans.Aujourd’hui plus près de l’âge de Jean Gabin de l’époque, je reste sensible à ce poème particulièrement à la phrase d’exergue et aussi cette belle vérité : «On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse !»Quand j’étais gosse, haut comme trois pommes,J’parlais bien fort pour être un hommeJ’disais, JE SAIS, JE SAIS, JE SAIS, JE SAISC’était l’début, c’était l’printempsMais quand j’ai eu mes 18 ansJ’ai dit, JE SAIS, ça y est, cette fois JE SAISEt aujourd’hui, les jours où je m’retourneJ’regarde la terre où j’ai quand même fait les 100 pasEt je n’sais toujours pas comment elle tourne !Vers 25 ans, j’savais tout : l’amour, les roses, la vie, les sousTiens oui l’amour ! J’en avais fait tout le tour !Et heureusement, comme les copains, j’avais pas mangé tout mon pain :Au milieu de ma vie, j’ai encore appris.C’que j’ai appris, ça tient en trois, quatre mots :« Le jour où quelqu’un vous aime, il fait très beau,j’peux pas mieux dire, il fait très beau !C’est encore ce qui m’étonne dans la vie,Moi qui suis à l’automne de ma vieOn oublie tant de soirs de tristesseMais jamais un matin de tendresse !Toute ma jeunesse, j’ai voulu dire JE SAISSeulement, plus je cherchais, et puis moins j’ savaisIl y a 60 coups qui ont sonné à l’horlogeJe suis encore à ma fenêtre, je regarde, et j’m’interroge ?Maintenant JE SAIS, JE SAIS QU’ON NE SAIT JAMAIS !La vie, l’amour, l’argent, les amis et les rosesOn ne sait jamais le bruit ni la couleur des chosesC’est tout c’que j’sais ! Mais ça, j’le SAIS… ! -
Lundi 13/02/2017
« La liberté de penser, la liberté d’opinion, […] n’existent pas seulement pour satisfaire le désir de la connaissance individuelle, le bien-être intellectuel de chaque citoyen. […] Elles [existent] aussi parce que ces libertés sont consubstantielles à l’existence d’une société démocratique »François Sureau devant le Conseil ConstitutionnelJ’ai déjà cité plusieurs fois, sans jamais en faire l’exergue d’un mot du jour, cette sentence de Benjamin Franklin, l’un des Pères fondateurs des États-Unis (1706-1790) : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux.»Nous sommes dans les pays occidentaux et particulièrement en France, dans cette dérive, cette faiblesse, cette lâcheté.Heureusement il existe des contre-pouvoirs comme le conseil constitutionnel et des défenseurs de la liberté comme Maître François Sureau qui est intervenu comme avocat de la Ligue des droits de l’hommeLe texte qui avait été porté devant le Conseil Constitutionnel était l’article 412-2-5-2 du code pénal, créé par la loi du 3 juin 2016 «renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement», et punissait «de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende» le fait de «consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes».Et voici cette remarquable plaidoirie de Maître François Sureau que je vous engage vraiment à lire :« Le 20 avril 1794, le comité de salut public institua à Orange, département du Vaucluse, une commission populaire de trois membres, sorte de tribunal révolutionnaire destiné à juger les ennemis du peuple trouvés dans ces régions reculées. A peine installé, son président, Fauvety, entreprit de dénoncer à Robespierre son premier assesseur, un nommé Meilleret. On trouve cette lettre aux archives et l’on peut y lire : « Meilleret ne vaut rien comme juge, il lui faut des preuves ».Remplacez le mot de preuves par celui d’intention, au moins dans le sens où le droit criminel l’entend depuis cinq siècles, et vous aurez à peu près l’affaire que vous avez à juger aujourd’hui. […]C’est à ma connaissance la première fois en France qu’une démarche purement cognitive fait naître la présomption d’une intention criminelle. Le délit d’éventuelle intention terroriste dont on parle ici repose sur une double supposition. D’une part, la supposition d’un endoctrinement « radical », comme on le dit aujourd’hui ; d’autre part, la supposition que cet endoctrinement est susceptible par nature de déboucher sur un projet terroriste effectif. La notion d’acte préparatoire devient liquide, nébuleuse, subjective, et recule dans le temps. […]Je le dis avec gravité : même l’inquisition de Bernardo Gui n’est pas allée aussi loin. Elle se fondait également sur le for interne, mais celui-ci n’était pas supposé, et sûrement pas d’aussi loin. Il fallait qu’il se soit vu traduit par des prises de position hérétiques explicites. Et d’autre part, il fallait que des manifestations tangibles de l’option hérétique aient pu être relevées par les inquisiteurs. En sens inverse, il pouvait suffire d’abjurer l’expression publique de l’opinion émise pour échapper aux poursuites.[…], le premier ministre parlant de la « première extériorisation d’une participation active à un endoctrinement terroriste » que manifesterait la consultation. Passons sur ce langage étrange, qui cache quelque chose d’assez simple. Aucune opinion n’est demandée pour poursuivre. La simple démarche intellectuelle suffit. La consultation seule. Nous avons à l’évidence passé les bornes du raisonnable. Cette guerre de perpétuelles surprises que fut, selon Marc Bloch dont je reprends ici les termes, celle de 1940, il jugeait, avant même d’entrer en résistance, que les Français l’avaient perdue par incuriosité intellectuelle. […]En réalité, l’incrimination en question a pour effet direct et nécessaire, et je ne parle même pas ici des chercheurs, ou des journalistes, d’empêcher radicalement, si vous me passez cet adverbe fâcheux, le citoyen d’une démocratie de se former une opinion justifiée sur l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur notre société, sur sa nature et sur ses formes. […] C’est un pan entier de la liberté de penser qui passe tout d’un coup dans l’ombre policière et répressive. Et l’on peut penser que ce naufrage est d’autant plus regrettable qu’il s’agit de combattre un fléau politique, culturel et social.C’est là-dessus que je voudrais en finir avec le droit, par mon troisième point. Je m’en voudrais de vous infliger un cours de philosophie politique, mais je ne détesterais pas que les grands principes pussent, à cette occasion être rappelés au gouvernement.La liberté de penser, la liberté d’opinion, et je n’aurai pas l’outrecuidance de citer la foule des grands auteurs, n’existent pas seulement pour satisfaire le désir de la connaissance individuelle, le bien-être intellectuel de chaque citoyen. Elles ne sont pas protégées seulement à ce titre par la déclaration que vous avez mandat d’appliquer. Elles le sont aussi parce que ces libertés sont consubstantielles à l’existence d’une société démocratique, dont le premier devoir de l’Etat est de garantir le perfectionnement incessant. C’est l’éducation de l’homme à la raison politique de Kant. Et c’est ce devoir que l’Etat méconnaît ici, ruinant, sous prétexte de sécurité immédiate, ce mouvement même de la connaissance et du choix à la fin, est seul susceptible de protéger notre société du péril qui la menace. Ce n’est pas en ôtant du cerveau du citoyen, selon le mot de Tocqueville, le trouble de penser, qu’on peut espérer triompher de ceux qui précisément veulent qu’on ne pense pas. Cette question est aussi vieille que la démocratie elle-même.Tous les auteurs l’ont vue, qu’ils se soient intéressés davantage à la liberté d’opinion ou à la qualité de la répression pénale. Tous les auteurs l’ont vue, sauf notre législateur. Comme s’il ne s’agissait pas de questions anciennes, et qu’il fallût à chaque fois réinventer le monde pour la satisfaction politique, électorale, ou d’opinion de la génération présente. Prenez Beccaria par exemple, dans son traité : « La vraie mesure des crimes est le tort qu’ils font à la nation et non l’intention du coupable (…). Celle-ci dépend des impressions causées par les objets présents et de la disposition précédente de l’âme, lesquelles varient chez tous les hommes et dans chacun d’eux selon la succession rapide des idées, des passions et des circonstances. Il serait donc alors nécessaire de rédiger un code particulier pour chaque citoyen et de nouvelles lois pour chaque crime ». Tout est dit. Il suffisait d’ouvrir les vieux livres et de réfléchir un peu.Et devant tout cela, vous ne pourrez que constater l’indigence de la défense du gouvernement. Je ne vois pas qu’en matière de liberté de pensée, de garanties individuelles ou de formation du citoyen libre, l’on puisse remettre toute notre tradition à la discrétion d’un policier ni même d’un juge, sous prétexte de bonne foi. Et je ne vois pas non plus comment on pourrait sauver ce texte par la notion de « consultation habituelle ». Il y a des esprits lents qui ont besoin et j’en fais partie, d’y revenir longtemps pour comprendre. Tout cela n’est pas le moins du monde sérieux.J’en viens à présent au contexte, c’est-à-dire aux excuses qu’on se donne. Car je sais bien ce qu’on dira, ce que le gouvernement dira, ce que la police dira : « Voilà bien des grands mots, et les temps sont si difficiles ». C’est une chanson souvent entendue et qui sert depuis quelques années à faire passer toutes les atteintes aux libertés : une réforme pénale par an, l’état d’urgence maintenu jusqu’à on ne sait quand, mettant notre genre de vie, pour employer un euphémisme, à la merci du moindre attentat.Mais si les temps sont difficiles, ce que personne ne conteste, les principes dont je parle ne sont pas réductibles à […] de grands mots. Il y va de ce que nous sommes, si nous ne voulons pas finir, une loi après l’autre, par ressembler à cette Russie dont parlait Custine en disant : « J’ai senti au fond de cet exercice une volonté de fer employée à faux, et qui opprime les hommes pour se venger de ne pouvoir vaincre les choses ». Et le soupçon peut, en effet, nous traverser l’esprit qu’il est plus facile de plaire à tout le monde en passant des lois excessives qu’en réformant la police pour la rendre mieux adaptée aux nécessités de l’heure.Les temps sont difficiles bien sûr, mais ceux de nos grands ancêtres ne l’étaient pas moins. L’idée informulée des gouvernements et des législateurs contemporains, c’est que les principes ne valent que par temps calme. C’est à l’évidence le contraire qui est vrai, et là-dessus nos prédécesseurs ne se trompaient pas. Quand Beccaria écrivait son traité célèbre dont j’ai cité tout à l’heure un passage, on ne pouvait pas traverser la forêt de Bondy sans escorte armée. Et quand, à l’inverse, le parlement meurtri par la bombe de Vaillant a fait voter des dispositions analogues dans leur nature à celles dont vous êtes saisis aujourd’hui, il a aussitôt subi l’opprobre d’avoir édicté ce que les historiens appelle encore aujourd’hui des « lois scélérates », qualificatif infamant qui dure. […]Non, rien n’a changé. Les temps, au fond, sont toujours difficiles pour ceux qui n’aiment pas la liberté. La tristesse de ce temps ne tient pas seulement à ce climat de violence civile […] pour notre génération de citoyens. Il tient aussi à l’évidente fragilité des grands principes dans notre conscience même. Il tient à la fréquence avec laquelle il nous faut désormais rappeler ces évidences qui renferment en elles-mêmes une part de notre honneur collectif.Les gouvernements ont cédé. Les parlements ont cédé. Personne je crois n’aurait pu, dans notre jeunesse nourrie des grands exemples et des drames du passé, imaginer qu’ils céderaient aussi facilement, par lâcheté, par inconséquence ou par calcul. Il est sûr que cela nous rendra moins sévères à l’égard de nos aînés, mais c’est une bien faible consolation.Vous êtes, et je voudrais le dire au-delà même de l’émotion, les derniers gardiens de cet honneur et de nos libertés. Permettez-moi d’espérer que vous les défendrez encore, alors qu’elles cèdent un peu partout dans le monde et que personne, ce qui est aussi grave que le reste, ne semble en faire un drame.Car ce qui est en jeu ici n’est pas seulement cette disposition particulière, mais cette disposition prise comme partie d’un mouvement qui s’étend et s’accélère partout, et qui chez nous a commencé voilà près de vingt ans. C’est ce mouvement lui-même qui est destructeur. « L’esclavage, disait Simone Weil dans l’un de ses derniers écrits, avilit l’homme jusqu’à s’en faire aimer ; la vérité, c’est que la liberté n’est précieuse qu’aux yeux de ceux qui la possèdent effectivement ». Par la médiocrité de son inspiration, par le vague de son contenu, la disposition en cause s’oppose à cette possession effective. Il est déjà infiniment surprenant, et infiniment triste, qu’elle soit arrivée jusqu’à vous. C’est la raison pour laquelle, au nom de la Ligue des droits de l’homme, je vous demande de la déclarer contraire à la Constitution.»Le Conseil Constitutionnel a suivi Maître Sureau et é écrit notamment : « Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte à l’exercice de la liberté de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. L’article 421-2-5-2 du code pénal doit donc, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs, être déclaré contraire à la Constitution. »Vous trouverez sur Youtube cette plaidoirie : https://www.youtube.com/watch?v=i1u16BdE8tQEt derrière ce lien vous trouverez la décision du Conseil Constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2016-611-qpc/decision-n-2016-611-qpc-du-10-fevrier-2017.148614.htmlDerrière ce lien sur le site du Conseil Constitutionnel vous verrez les différentes interventions pour éclairer la décision du Conseil : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/videos/2017/janvier/affaire-n-2016-611-qpc.148570.html« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux.»<836> -
Vendredi 10/02/2017
«700.000 euros, c’est ce que la moitié d’une génération va gagner en une vie de travail»Thomas PikettyThomas Picketty était invité de France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/emission-speciale-pour-une-declaration-universelle-des-ideesUn article de Slate reprend certains de ses propos et les rapproche de l’affaire Fillon : http://www.slate.fr/story/136709/700-000-euros-gagner-vie«700.000 euros: c’est un montant autour duquel tourne l’affaire dans laquelle le couple Fillon est empêtré depuis les révélations du Canard enchaîné. Après s’être expliqué devant la presse lundi 6 février, le candidat de la droite à l’élection présidentielle a publié les montants que son épouse aurait touchés lorsqu’elle travaillait comme assistante parlementaire à son service. À raison de 3.700 euros net mensuels, Penelope Fillon aura donc touché, selon cette version, 680.000 euros pour le cumul des quinze ans de travail qu’elle aurait effectués au service de son mari député. Mais 700.000 euros, c’est aussi un montant proche de la propriété sarthoise de François Fillon, évaluée à 750.000 euros selon les documents publiés par le candidat.Et 700.000 euros, c’est également le montant que touchera la moitié d’une génération pour une vie entière de travail. C’est l’économiste Thomas Piketty, spécialiste des inégalités et auteur d’un livre devenu célèbre sur le retour du patrimoine dans les sociétés occidentales, qui cite ce montant comme point de référence. Interviewé sur France Culture à l’occasion de la Nuit des idées le 26 janvier dernier, il a précisé pourquoi ce montant était important pour comprendre les inégalités sociales en France:«Il y a un indicateur que je calcule dans mes recherches et qui est assez parlant, c’est: quelle est la part d’une génération qui va recevoir en succession ou donation l’équivalent d’une vie au salaire minimum, ou si on prend un peu plus que le salaire minium, le revenu moyen gagné par leur travail par les 50% d’une génération qui gagnent le moins, donc c’est pas beaucoup au-dessus que le salaire minimum, c’est mettons 15.000 euros par an sur cinquante ans.»On aboutit donc à un montant de 750.000 euros. «C’est un peu ce qu’a gagné Pénélope Fillon comme assistante parlementaire si j’ai bien compris», s’amusait l’économiste sur l’antenne de France Culture. Pourquoi cet indicateur est-il important? Parce qu’alors que le poids de l’héritage avait quasiment disparu dans l’après-Seconde guerre mondiale, avec environ 1% d’une génération qui touchait un tel montant, pour les générations des années 1970-1980, environ 15% va recevoir ce montant en succession, en faisant une classe de quasi-rentiers de fait:«Évidemment c’est un montant qui n’est pas suffisamment important pour s’arrêter complètement de travailler, et de fait les personnes en question vont sans doute faire de très belles études et gagner des salaires importants, mais en même temps c’est quand même autant que ce que 50% de cette même génération va gagner sur toute sa vie par son travail en étant serveur, caissière de supermarché, en faisant des boulots pas très rigolos.»Une forme d’inégalité dérangeante, car ces moyens ou petits rentiers ne sont pas comparable au fameux –et unanimement décrié– 1% accusé de concentrer les richesses.«Aujourd’hui, il y a plus de moyen rentiers, et moins de très gros rentiers, analysait encore Piketty au micro de France Culture, et cette société des petits rentiers ou des moyens rentiers c’est une société qui est peut-être plus difficile encore à réguler politiquement que celle du XIXe siècle.» » -
Jeudi 09/02/2017
«Le népotisme»Mot utilisé dans l’actualitéLe terme a été emprunté en 1653 à l’italien nepotismo, lui-même dérivé de nepote qui signifie « neveu », par référence au favoritisme accordé par un pape à l’un de ses neveux par la cession indue de titres ecclésiastiques ou de donations réservés au Vatican.Au Moyen Âge, le mot désigne normalement dans ce contexte, les enfants des frères et sœurs des ecclésiastiques. Mais souvent, par euphémisme, les mots « neveux » et « népotisme » désignaient aussi les propres enfants des ecclésiastiques. »En politique, le népotisme est caractérisé par les faveurs qu’un homme ou une femme au pouvoir montre envers sa famille ou ses amis, sans considération du mérite ou de l’équité, de leurs aptitudes ou capacités.Un mot du jour court aujourd’hui.Il me semblait pertinent de rappeler la signification et l’origine de ce mot.<834> -
Mercredi 8 février 2017
« La cinquième République »(1958 – ?) Régime politique actuel de la FranceLe régime politique de la France, voulu par le Général de Gaulle et mis en place par lui, est un régime singulier.
En effet, les constitutionnalistes distinguent deux types de démocraties libérales :
- Le régime présidentiel ;
- Le régime parlementaire ;
Le régime présidentiel par excellence est le système existant aux Etats-Unis. Les spécialistes parlent d’une séparation rigide des pouvoirs.
Le Président est élu et désigne son gouvernement avec lequel il forme l’exécutif. Les membres du gouvernement doivent cependant se soumettre à une procédure constitutionnelle d’approbation de leur nomination par le Sénat américain.
Evidemment les représentants et les sénateurs sont élus au suffrage direct et sont totalement indépendants du président.
Je veux dire que la notion « de majorité présidentielle » bien connue sous notre 5ème république constituerait une incongruité aux Etats-Unis.
La séparation est rigide parce que l’exécutif n’a aucun moyen de contraindre le législatif et réciproquement.
Ce qui signifie que pour faire des lois et des réformes fondamentales il faut que le Président et le législateur se mettent d’accord et fassent des compromis.
Cela fonctionne assez mal, Obama a dû faire énormément de concessions pour faire passer sa réforme de l’obamacare.
Le régime parlementaire qui est dominant en Europe et qui est aussi le régime du Japon procède essentiellement du parlement c’est-à-dire de l’élection de la chambre basse du Parlement.
Des partis ayant à leur tête un chef parfaitement identifié se présentent avec un programme devant les électeurs. Des députés des différents partis sont élus à la chambre. Si un seul parti a la majorité absolue, le chef de l’Etat qui est souvent un monarque mais qui peut être un Président sans réel pouvoir nomme, premier ministre, le chef du parti majoritaire et le tour est joué.
Si aucun parti n’obtient la majorité absolue, il nomme le chef du parti arrivé en tête avec pour mission de discuter avec les autres partis pour constituer une majorité parlementaire. Pratiquement, systématiquement les partis se mettent d’accord sur un programme gouvernemental. Le gouvernement est alors constitué et doit obtenir la confiance du Parlement.
On parle de séparation souple parce que le parlement peut renverser le gouvernement, le gouvernement pouvant aussi dissoudre le parlement pour de nouvelles élections.
Ce type de régime permet aussi de créer de grandes coalitions capables de réformer leur pays.
Rien de tel en France.
La 3ème République était parlementaire comme la 4ème. De Gaulle reprochait à ces régimes parlementaires en France d’être trop instables, il fallait changer tout le temps de gouvernement.
D’où ce régime hybride de la 5ème république qui est avant tout un régime parlementaire dans la mesure où le Parlement doit accorder sa confiance au gouvernement et peut le renverser et réciproquement le Parlement peut être dissous, mais dissous par le Président qui lui ne peut pas être renversé, ce qui crée une inégalité forte entre l’exécutif et le législatif.
Et puis d’autres incongruités existent.
Nous avons récemment beaucoup débattu du 49-3 avec lequel l’exécutif contraint, sous peine de dissolution, le parlement de se soumettre à la volonté du gouvernement. Il y a aussi l’article 16, mais passons…
Du temps du Général de Gaulle, il y avait deux choses fondamentales : Il était intègre et s’il fixait les grandes lignes politiques il laissait son premier ministre gouverner.
Et même une troisième : Régulièrement il proposait un référendum pour lequel il annonçait que si le peuple français montrait son désaccord avec la proposition qu’il lui soumettait, il démissionnerait.
Mes bons professeurs de Droit répétaient que cela transformait le référendum en plébiscite et que le plébiscite c’était le mal !
Dans le concept on devait certainement les suivre.
Mais en pratique, à cause du pouvoir exorbitant du Président de la République en France, cette respiration démocratique permettait au moins au peuple de révoquer le monarque présidentiel. Ce qu’il a fait en 1969 en disant « Non » à la réforme du Sénat et la création des Régions proposés par le Général de Gaulle.
Aujourd’hui, le référendum est tombé en désuétude, les trois derniers présidents n’ont jamais utilisé cette possibilité constitutionnelle.
Et depuis, le Général de Gaulle, aucun président qui a utilisé l’outil du référendum, n’a promis sa démission en cas de rejet !
Et puis, la 5ème république a été victime d’abord d’un putsch constitutionnel puis d’une trahison.
Le putsch constitutionnel a été réalisé par le général lui-même qui a révisé la constitution en ne respectant pas les règles permettant cette révision et il a imposé l’élection du Président au suffrage universel en passant directement par le référendum ce qui n’était pas prévu.
En tout cas ce changement a rapidement, après Pompidou en tout cas, rendu les hommes politiques français fous, ils voulaient tous devenir président.
Et puis, Jospin a trahi. Il a trahi la Gauche et Mendés-France parce que la Gauche est viscéralement attachée au régime parlementaire et n’aime pas l’homme providentiel.
Or Jospin a par deux réformes encore davantage éloigné la 5ème république de la logique d’un régime parlementaire.
La première réforme a été d’aligner la durée du mandat présidentiel sur celui des parlementaires : 5 ans.
Mais la vraie trahison est la deuxième mesure : contrairement à ce qui se serait passé s’il avait laissé faire les institutions, il a imposé que les élections présidentielles se fassent avant les élections législatives.
Et ainsi les élections législatives sont devenues l’accessoire de l’élection présidentielle.
C’est une immense bêtise.
Et maintenant on y a ajouté des primaires.
Alors prenons l’exemple de l’Allemagne ou de l’Angleterre ou de l’Italie…
Dans chacun de ces pays, les électeurs votent 1 fois et le parlement est élu puis par le processus normal un chancelier ou premier ministre est désigné et un gouvernement se met en place avec une coalition parlementaire. En un vote les électeurs créent les conditions suffisantes pour que la démocratie représentative fonctionne.
En France, pour un électeur de gauche ou de droite il faut 6 votes, parce qu’en plus la France a cette particularité du vote uninominal à deux tours, pour arriver à ce qu’il existe un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif en état de marche, en passant par les primaires.
Pour celles et ceux qui sautent la primaire il faut quand même 4 votes pour un seul en Allemagne, en Angleterre etc…
Aux Etats Unis, il y a des primaires, mais à un tour pour chaque état et puis le même jour les américains élisent le Président et la moitié du Congrès. 2 ans plus tard l’autre moitié est renouvelée.
Ainsi François Fillon a été désigné par une primaire sur un programme très particulier qui lui est propre. Il l’a fait dans son coin avec quelques collaborateurs et probablement sa femme puisqu’elle participait sans cesse à son activité politique.
Mais voilà, s’il existe un problème qui conduirait à le remplacer, comment fait-on ?
On prend le second évidemment, mais le second n’a pas du tout le même programme. Cela ne va pas du tout.
Supposons qu’il arrive la même chose en Allemagne : Madame Merkel est empêchée. Pas de problème, la CDU désigne un autre, avec le même programme de la CDU, peut-être quelques nuances mais fondamentalement le même programme.
Et puis, si la CDU n’a pas la majorité elle discute avec d’autres même avec le SPD et ils font un panachage des deux programmes et le mettent en œuvre.
Avec le système d’élection débile à deux tours que nous avons, nous pensons que les thèses du président élus sont majoritaires : c’est totalement faux : en 2002 Chirac c’était moins de 20 % du corps électoral. On se souvient du second tour … Mais les français comme des moutons et avec le système électoral ont élu une assemblée conforme aux vœux du Président qui a gouverné avec les gens qui était d’accord avec lui au premier tour : 1/5ème de la France !
5 ans plus tard Sarkozy a fait beaucoup mieux 31,18% des voix. Mais il n’en reste pas moins qu’il s’agit de moins d’un tiers des électeurs. Valéry Giscard d’Estaing avait cette formule qu’il fallait que 2 français sur 3 soient d’accord avec la ligne politique du gouvernement.
Avec un tel système et une si petite portion de soutien, on ne peut pas réformer la France.
Et puis cela rend les candidats incroyablement égocentriques.
Vous avez lu cette exigence du candidat Macron ? :
« tous les candidats investis s’engageront à défendre le plan de transformation proposé en signant le contrat avec la Nation évoqué par Emmanuel Macron. »
Bref, il n’y a qu’une tête pensante, les députés ne sont là que pour la suivre.
Et avec ce candidat il n’y a même pas de programme précis, celui qui veut devenir parlementaire doit signer un chèque en blanc.
Il y aurait encore tant de dérives à dénoncer qui proviennent directement de cette organisation bancale, n’existant nulle part ailleurs.
Mais les français sont des veaux, comme disait De Gaulle, ils ne veulent surtout pas changer l’élection du Président de la République au suffrage universel.
Au moins pourrait-on faire coïncider les élections présidentielles et législatives et restreindre la possibilité de dissoudre l’Assemblée.
En tout cas le Président de la République joue un rôle trop important, du point de vue organisationnel, dans notre pays et nous ne trouverons plus des femmes ou des hommes capables de faire de cette fonction, telle qu’elle existe actuellement, quelque chose de positif pour la France.
C’est ma conviction !
<833>
- Le régime présidentiel ;
-
Mardi 7 février 2017
« Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c’est la vérité. »Talleyrand [1754-1838]Donc François Fillon continue à se défendre en plaçant son affaire sur le seul plan de la légalité. Il sait qu’il sera très compliqué de prouver, au niveau pénal, que l’emploi de son épouse était fictif.
Il a une explication étonnante pour justifier le montant des rémunérations : les diplômes de sa femme. Les surdiplômés qui peinent à trouver un emploi bien rémunéré seront ravis d’apprendre que ce n’est pas normal.
Les étudiants stagiaires seront ravis d’apprendre le montant des rémunérations versés par Papa Fillon à ses enfants sur des deniers publics.
C’est la loi ? mais ce sont les députés qui font la Loi, et les députés se doivent donc d’être exemplaires.
Et puis il y a les rémunérations à la revue des deux Mondes. Je vous invite à écouter l’assemblée de centristes réunis par Philippe Meyer commenter cette affaire et particulièrement La revue des deux Mondes : https://www.franceculture.fr/emissions/lesprit-public/laffaire-fillon-le-candidat-benoit-hamon
Philippe Meyer nous apprend que les auteurs prestigieux qui écrivent dans la Revue des deux Mondes, le font gratuitement et a des mots très durs sur le rôle trouble du propriétaire de ce journal.
Et puis nous savons que brusquement François Fillon a arrêté de rémunérer son épouse. Coïncidence ? Il l’a fait juste au moment de la mise en place de la Loi sur la transparence publique qui a suivi l’affaire Cahuzac.
Est-ce que quelqu’un peut croire qu’il l’a fait parce qu’il venait de se rendre compte que c’était choquant ?
On a du mal à le croire puisque le Canard enchaîné a rappelé qu’« A la suite de l’affaire Cahuzac, François Hollande annonce le 10 avril 2013, un projet de loi sur la transparence de la vie publique. Qui se précipite dans les studios de télé pour le critiquer avec véhémence ? François Fillon. Le député de Paris explique au 20 heures de France 2 qu’ »il n’y a pas besoin de projet de loi (…). Je récuse l’idée que les hommes politiques soient tous corrompus » Sur iTélé, il ajoute : « Je suis scandalisé que le gouvernement parle de loi de moralisation. Comme si la vie politique était immorale. Moi, je n’ai rien à cacher. Je ne voterai pas ce texte parce qu’il n’a aucun intérêt ». »
Sur ce point il a tenu parole, il n’a pas voté le texte.
Et évidemment il accuse tout le monde, les officines, les médias, le gouvernement…
Pour finir je vous montre une collection de tweets que cet homme a réalisé depuis quelques années :
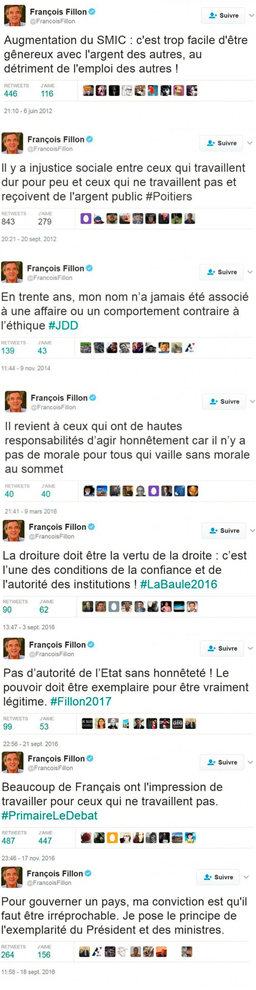
De la calomnie ?
Non la vérité : Faites ce que je vous dis, pas ce que je fais….
S’il parvient à se maintenir et à se retrouver au second tour contre Marine Le Pen, je pense qu’il sera battu.
Et s’il était quand même élu, il n’aura aucune légitimité de faire les réformes qu’il annonce, il sera rapidement plus impopulaire que François Hollande.
<832>
-
Lundi 06/02/2017
« Why Is France So Corrupt ? »
«Pourquoi la France est-elle si corrompue ?»Robert Zaretsky journaliste du Foreign PolicyForeign Policy est un bimestriel américain qui s’exprime sur les questions essentielles de la politique étrangère américaine. Le titre appartient à la Graham Holdings Company, ancien groupe du Washington Post, qui possède aussi le site Slate.Impossible de ne pas parler de l’affaire qui touche le candidat favori jusque là de l’élection présidentielle de mai. Personne ne saurait se réjouir de cette affaire qui affaiblit la France et affaiblit de débat politique.C’est extrêmement préoccupant.Ce qui me semble le plus pertinent c’est de sortir du bain hexagonal et de lire ou d’écouter ce que disent des journaux étrangers.Ainsi, le magazine américain Foreign Policy estime que la corruption est ancrée dans la Ve République. Il reprend la phrase : “Qui imagine le Général de Gaulle mis en examen ?” lancée par François Fillon au mois d’août 2016 en référence à son rival Nicolas Sarkozy et ajoute : Maintenant que les enquêteurs financiers ont entamé leurs recherches sur l’affaire Fillon, le Général semble plus seul que jamais.”“La France n’est pas un pays particulièrement corrompu au sens large, écrit-il, mais c’est un cas atypique en Occident.” En effet, d’après le classement 2016 de Transparency International sur la corruption, la France est classée 23e sur 170, juste derrière l’Estonie. Ce qui aggrave ce constat, c’est que la corruption française concerne avant tout ses élites : elle ne vient pas de ses policiers demandant des petits pots-de-vin ou d’entreprises achetant des bureaucrates. Au lieu de ça, grâce au système très français de monarchie républicaine, la corruption en France implique des sommes considérables et se déroule au plus haut sommet du pouvoir.”Pour le magazine américain, la raison de cette corruption des élites est due à l’exemple donné par le sommet de cette pyramide et aux fondements de la Ve République. “Le président, par principe, n’a pas à répondre de ses actes face au Parlement : il règne et ses ministres gouvernent à peine.” Et si de Gaulle avait montré l’exemple par “son autorité personnelle et son incorruptibilité”, ses successeurs ont conservé le principe de règne mais “ont saccagé l’incorruptibilité”, constate Foreign Policy. Et la revue de citer une série de scandales présidentiels français, des diamants de Bokassa au “kaléidoscope d’affaires judiciaires entourant Sarkozy”.Un remède bien timideForeign Policy reconnaît tout de même un début d’effort en France pour “remédier à ce problème” grâce à la loi Sapin 2, adoptée en 2014 et relative à la transparence et la lutte contre la corruption. Si elle va dans le bon sens, admet la revue américaine, “la majeure partie de cette loi vise des cibles bien en dessous de l’Élysée”.Et le magazine de conclure que, si la campagne pour la présidentielle est plus indécise que jamais en France, “une chose apparaît clairement : grâce au Penelopegate, une vieille tradition française semble destinée à se perpétuer.”Vous trouverez ces extraits de l’article sur le site du Courrier international : http://www.courrierinternational.com/article/vu-des-etats-unis-pourquoi-la-france-est-si-corrompueLibération a publié <ICI> un article où sont cités d’autres journaux étrangers qui parle de cette affaire :L’Orient le Jour (Liban). Pour le quotidien, l’affaire pourrait «finir façon Dominique Strauss-Kahn en 2012 ou façon Lionel Jospin en 2002». Peu confiant sur l’avenir politique de l’ancien Premier ministre, l’Orient le Jour souligne le climat de défiance dans lequel survient cette affaire. François Fillon s’est distingué de ses adversaires en faisant valoir sa probité. «Son « qui imagine le général de Gaulle mis en examen ? »» avait marqué les esprits et «est resté dans toutes les têtes», écrit le journal, qui ajoute que «sur le plan moral, le PenelopeGate semble difficilement défendable».The Independent (Royaume-Uni). La corruption «is busines as usual» («la routine habituelle») dans la vie politique française. C’est la conclusion que tire The Independent. Le quotidien en ligne britannique rappelle l’affaire des emplois fictifs de Jacques Chirac et s’étonne qu’«Alain Juppé était un candidat extrêmement populaire malgré le fait qu’il ait été condamné». Et de dérouler une liste non exhaustive des politiciens français et d’affaires. «Le fait est que l’enrichissement personnel s’est institutionnalisé», analyse le média. Sans concession.Le Temps (Suisse). Selon le quotidien genevois, l’affaire révèle le rapport difficile qu’entretient «la droite française avec la justice». L’affaire Bygmalion ou l’utilisation des fonds secrets par Claude Guéant alors ministre de l’Intérieur en sont des exemples. Le Temps souligne aussi la solitude dans laquelle se retrouve François Fillon. D’autant que «la plupart des ténors du camp conservateur n’ont pas digéré sa victoire». La tempête médiatique dans laquelle Fillon a «rouvert la foire aux ambitions» à droite.La Libre Belgique. Pour le quotidien, François Bayrou pourrait remplacer François Fillon, «mais pas encore», titre-t-il. La Libre Belgique s’appuie sur l’interview télévisée du président du Modem, où il déclarait vouloir «faire ce qu’il faut pour que la France s’en sorte». Pour le journal belge, «la porte Fillon est fermée», mais il reste «l’hypothèse Emmanuel Macron».Die Zeit (Allemagne). L’hebdomadaire allemand relate les déboires du «M. Propre» français. Die Zeit continue en assénant entre autres que «pour beaucoup, Penelope Fillon était déjà vue comme la future première dame : elle apparaissait non pas comme une collaboratrice politique mais comme une épouse sage et traditionnelle, qui s’occupe des enfants et des chevaux, sans rapport avec la politique». Pour ce média, c’est une affaire qui ne tombe pas au très bon moment : «Cette semaine, il voulait briller sur la scène internationale, en rendant visite à la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin et en demandant la fin des sanctions contre la Russie. Mais soudainement, on ne lui pose plus que cette unique question : qu’a fabriqué son épouse pendant toutes ces années ?»The New York Times (Etats-Unis). Le journal annonce d’entrée la couleur avec son titre : «Le scandale Fillon incrimine avant tout l’ensemble de l’élite politique française». Avant d’attaquer : «Le président de l’Assemblée nationale le fait, le président du Sénat le revendique, des douzaines de parlementaires le font également. Embaucher son épouse, sa sœur ou son enfant au Parlement français est parfaitement légal.» Et de poursuivre en constatant que «beaucoup de politiciens français se demandent donc où est le problème». Selon lui, la réponse qui serait revenue dans un «rugissement populo-médiatique» est tout simplement qu’«ils [les hommes politiques français, ndlr] ne peuvent pas comprendre». De plus, le journaliste considère la volonté de François Fillon de rester en course comme une preuve que «la classe politique française a progressivement été gangrenée et que qu’aucun de ses remplaçants potentiels n’est blanc comme neige».Je tenterai quand même une réponse à cette question «Pourquoi la France est-elle si corrompue ?». Parce que nous, les français, le tolérons. Jacques Mellick ou Patrick Balkany ont été condamnés par la Justice pourtant un corps électoral les a réélus. Chose inimaginable dans un pays nordique ou même l’Allemagne. -
Vendredi 03/02/2017
«Manterrupting»Tendance masculine à interrompre la parole féminineDans la continuité du mot du jour d’hier où certains milieux religieux défendaient cette idée, étonnante dans le monde tel qu’il est, qu’il y aurait un manque de testostérone dans les relations sociales, je partage avec vous ce nouveau concept qui nous vient des Etats-Unis.Dans <cet article de France Info> vous trouverez une video qui montre ce que signifie concrètement ce terme.Pour faire court, il s’agit de cette tendance qu’auraient plusieurs hommes à couper systématiquement la parole aux femmes lors de réunions publiques ou débats. Les féministes américaines se sont penchées sur le phénomène et lui ont donné un nom : le «manterrupting», une contraction des mots «man» et «interrupting».Dans le milieu du cinéma, en entreprise comme en politique, nombreuses sont les femmes restant silencieuses, agacées de se voir couper la parole. Parfois, certains hommes vont jusqu’à se réapproprier les propos de leur interlocutrice, ou essayer de leur expliquer ce qu’elle pense. Un phénomène nommé « mansplaining », ou « mecsplication » en français.Mais à la Maison Blanche, sous Obama bien sûr, une ancienne employée a expliqué au Washington Post que les femmes se sont alliées pacifiquement et ont commencé à utiliser une technique rhétorique simple pour stopper les interruptions incessantes et renforcer les idées formulées par d’autres femmes lors de la réunion quotidienne de 7h30 dans le bureau ovale.Celle-ci se présente sous la forme suivante : lorsqu’une femme propose une idée ou un argument, une autre femme doit la répéter, et donner du crédit à la personne (une femme en l’occurrence) qui l’a prononcé. Cela rend l’idée plus difficile à ignorer, ou même à voler. Elles ont appelé cette technique « l’amplification », qui se rapproche étroitement de l’anaphore (répéter le même mot au commencement de plusieurs phrases).« Nous avons commencé à l’appliquer et en avons fait un objectif à tenir » a raconté au Post l’une des anciennes conseillères du président Barack Obama. « C’était devenu une habitude journalière. » Et les résultats ne se sont pas fait attendre : elle a ajouté qu’Obama a davantage prêté attention et a commencé à solliciter les femmes plus souvent.Les femmes, peut-être inconsciemment, avaient remarqué deux choses. Tout d’abord, que la répétition est l’une des façons les plus simples de renforcer tout point de vue, ce qui peut être vérifié dans l’histoire à travers l’art oratoire et la poésie. Mais d’autre part, que marteler simplement une même idée en la répétant soi-même a ses limites, surtout dans un environnement concurrentiel où tout le monde réclame d’être entendu. Certains chercheurs ont émis l’hypothèse que les femmes sont plus interrompues parce que leur style de conversation a tendance à être collaboratif, là où les hommes ont tendance à être plus compétitifs.Ce qu’il y a d’utile avec un concept c’est qu’une fois qu’on le connaît on comprend plus facilement et on sait plus facilement analysé un phénomène que l’on perçoit, qui nous met mal à l’aise et surlequel jusque là on n’a pas su mettre des mots.Observez votre milieu professionnel ou familial à travers ce concept de «manterrupting» et vous verrez son degré de prégnance. -
Jeudi 02/02/2017
« l’homme ne sera véritablement sûr et doux que s’il assume la force que le Créateur lui donne. Il a besoin de se battre (…), d’un lieu où le guerrier qui est en lui peut reprendre vie »John EldredgeLe sur lendemain de Noël, le journal le Monde a publié un article qui a attiré mon attention : <Des catholiques veulent rendre à l’église sa virilité>Je vous donne de larges extraits ci-après :«Des catholiques veulent rendre à l’Eglise sa virilité. Des laïcs et des prêtres multiplient camps et stages pour aider les hommes à se réconcilier avec leur masculinité, jugeant que la société et l’Eglise sont dominées par des valeurs féminines. Lorsque Philippe Matron s’est inscrit au camp « Au coeur des hommes », il ne savait pas bien ce qui l’attendait. Trois jours plus tard, ce catholique pratiquant de 56 ans, père de six enfants dont cinq filles, est ressorti transformé de ces moments passés « entre frères » et avec le Christ. « J’ai découvert qu’on ne devient pas un homme grâce à une femme mais par son père ou par des références masculines », dit-il.Quentin Schaepelynck, 34 ans, lui aussi catholique pratiquant, se souvient de moments très forts où l’on peut se livrer, faire tomber le masque : « J’ai compris quelle était ma place en tant qu’homme au sein de ma famille, dans la société. Y aller, c’était un petit cadeau aux miens. »« Au coeur des hommes », « Optimum », association Pater… Depuis deux ou trois ans, les offres destinées spécifiquement à des hommes à la recherche de leur masculinité et de leur place dans l’Eglise catholique se multiplient. Comme si une inquiétude existentielle s’était emparée d’eux.Camps, retraites, expéditions, fraternités à l’ambiance « virile mais pas bourrin » sont venus s’ajouter aux quelques pèlerinages des pères de famille (Cotignac, Saint-Michel, Vézelay) déjà existants.Ce phénomène très nouveau est certes encore limité, mais le bouche-à-oreille lui donne du dynamisme. Le père Alain Dumont, pionnier des retraites pour hommes, créées à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) il y a une quinzaine d’années, témoigne de cet engouement : « Nous avons commencé avec des retraites de dix ou douze hommes et, depuis cinq ans, cela monte en force. Aujourd’hui, chacune rassemble entre 80 et 120 hommes, majoritairement des trentenaires et des quadragénaires. » Aussi les a-t-il fait essaimer ailleurs en France.A l’origine de cette réflexion sur la masculinité et de ces initiatives, on retrouve souvent des laïcs, parfois insatisfaits de leur place dans l’Eglise. Des prêtres s’y trouvent aussi impliqués, mais ces initiatives sont d’abord l’un des fruits du grand mouvement de réaffirmation catholique qui s’est produit en 2013 lors des manifestations contre la loi Taubira sur le mariage homosexuel. « Ça a créé des liens et des initiatives. On est sur la lancée de ce dynamisme », confirme le père Simon Chouanard, curé du Coeur-eucharistique-de-Jésus, dans le 20e arrondissement de Paris.La réflexion sur le masculin et le féminin conduite dans ce creuset a peut-être donné son impulsion à ce mouvement masculiniste. Il a pris forme dans la mouvance de la communauté de l’Emmanuel, qui a pour particularité de mélanger laïcs, laïcs consacrés et clercs, et autour de figures d’un catholicisme de réaffirmation, comme l’évêque de Toulon, Mgr Dominique Rey, aussi issu de l’Emmanuel. […]Un livre, au titre un peu boy-scout, fait figure de référence : Indomptable (Farel, 2015). Il est d’ailleurs fortement recommandé de l’avoir lu avant de venir au camp. Son auteur, John Eldredge, conférencier américain, pioche pêle-mêle dans son expérience personnelle, dans des scènes de films grand public (Gladiator, Braveheart, Un monde parfait…) et dans la Bible pour illustrer et révéler à ses lecteurs « le secret de l’âme masculine». La thèse qu’il défend – « l’homme ne sera véritablement sûr et doux que s’il assume la force que le Créateur lui donne. Il a besoin de se battre (…), d’un lieu où le guerrier qui est en lui peut reprendre vie » – a rencontré un énorme succès. […]Ces catholiques sont en plein questionnement sur la masculinité, qu’ils jugent aujourd’hui « blessée ». A leurs yeux, l’Église comme la société, baignées par la mixité, entravent l’expression de ces « désirs » profonds et laissent les hommes incertains de leur rôle. « Cela a un rapport à la force et à la violence » propres à l’homme, assure Clément Lescat. « C’est un sujet très épineux car la barbarie du XXe siècle a discrédité l’usage de la force. Aujourd’hui, l’homme se cherche entre deux caricatures : la soumission et la domination. Il a peur de ses désirs. Pourtant, il a un désir de combattre pour quelque chose qui le dépasse », résume-t-il. « Il y a une force, une animalité en l’homme qui le pousse à aller vers l’extérieur. Elle doit être canalisée dans le don et la grandeur. Les garçons ont besoin de grandeur », […]« Dans les camps, on perçoit que les hommes, parfois, ne se sentent pas autorisés à être des hommes à fond, note Gabriel Morin. La virilité est suspectée d’une façon générale. Ils ont parfois intériorisé l’idée que c’est dangereux ou mal vu. Nous leur disons que la masculinité est une vocation, un appel de Dieu, et qu’on peut être pleinement homme sans être machiste et dominateur. » […]Tous les acteurs de ce mouvement viriliste évoquent avec envie des rites de transmission religieuse masculine, comme la bar-mitsvah (la majorité religieuse chez les jeunes garçons juifs de 13 ans), ou d’initiation, dans les cultures africaines. Ils regrettent que les garçons n’aient pas le temps de construire leur masculinité parce qu’ils « passent des bras de leur maman à ceux d’une jeune fille ». […]Redonner du lustre à la masculinité, cela n’est pas destiné à entrer en compétition avec la place conquise par les femmes, assurent les artisans de ce réveil masculin. « Nous ne sommes surtout pas là pour réveiller la guerre des sexes », assure Clément Lescat. « Aujourd’hui, on tend vers une uniformisation des rôles, des façons d’être et de penser. […]Dans l’Église catholique aussi, au clergé diocésain pourtant intégralement masculin, les laïcs à l’origine de ces initiatives font le constat que les hommes ne sont pas toujours à l’aise et qu’ils éprouvent le besoin de se ménager un espace pour être entre hommes. L’effacement des communautés masculines pour les laïcs, l’omniprésence des femmes dans la vie paroissiale, des homélies jugées « asexuées », une liturgie post-concile Vatican II et ses cantiques qualifiés de trop « sucrés », tout cela contribue, selon eux, à une « féminisation de la vie en Église ». « Où sont les mecs dans nos églises ? », s’écrie ainsi l’abbé Chouanard. « Aujourd’hui, beaucoup d’hommes suivent leur femme à l’église et ils ne se sentent pas suffisamment rejoints comme homme par l’Église », abonde Gabriel Morin, des camps « Optimum ». « Ils n’ont pas besoin de discours gnangnan. L’Église doit faire un gros travail de conscientisation sur l’homme », tranche Clément Lescat. La virilité de Jésus serait édulcorée, la figure de Dieu présentée comme trop maternante. […].»Que dire ?Je ne vais pas sombrer dans l’essentialisme et dire : les catholiques ….Mais, il se trouve toujours au sein des différents religions des groupes de personnes qui par leur réflexion et leurs actes montrent que les religions sont surtout des réflexions du genre mâle de l’homo sapiens.Car il faut quand même oser penser et dire ce qui est relaté dans cet article, alors que tous les postes de pouvoir sont monopolisés par les hommes et que les femmes n’entrent dans ces cercles que de manière marginale.Si on ne se restreint qu’à la France et qu’on regarde les patrons du CAC 40 ou qu’on va dans les postes de responsabilité de l’Etat.Dans un contexte où la violence faite aux femmes reste immense partout et que plus que jamais ce sont des mâles qui veulent légiférer sur le corps, les désirs et même les habits des femmes.Et comme souvent un dessin ou une photo disent plus qu’un long discours.Cette photo montre Donald Trump, le 23 janvier 2017, entouré uniquement de mâles signant le décret sur la limitation du financement par des fonds fédéraux d’ONG internationales qui soutiennent l’avortement.Et le journaliste du Guardian, Martin Belam a commenté :« Aussi longtemps que vous vivrez, vous ne verrez jamais une photo de 7 femmes signant une législation sur ce que les hommes peuvent faire avec leurs organes reproducteurs »<Il y a 43 ans, le 26 novembre 1974, Simone Veil> introduisait le débat sur sa célèbre Loi par un discours d’une exceptionnelle humanité. Et elle disait notamment :« Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme, je m’excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d’hommes : aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement ».La photo montre la continuité d’un monde de décideur qui n’a pas changé de sexe dominant.Je ne crois pas que le monde manque de masculinité, ni d’ailleurs les religions où seuls les mâles ont le pouvoir.Je pense exactement le contraire. -
Mercredi 01/02/2017
« Un salarié allemand sur quatre a un bas salaire, contre un sur dix en France »Catherine ChatignouxOn nous raconte tant de choses. On nous explique surtout que l’Allemagne est un pays bien mieux géré que la France et que nous devrions nous en inspirer pour toutes nos politiques économiques.Et il est vrai que l’Allemagne est plus riche, est moins endettée et dispose d’une balance commerciale bien plus favorable que la France.Certes, mais cette politique économique a un prix ou disons son côté obscur qui est de plus en plus éclairé par des études internationales.Catherine Chatignoux est journaliste dans le journal « Les Echos ». Elle a écrit un article en s’appuyant sur une étude statistique produite par Eurostat qui a a calculé la proportion de « bas salaires » dans les différents pays de l’Union européenne.Vous trouverez cet article, derrière ce lien : <Un salarié allemand sur quatre a un bas salaire>Mais Grâce à cet article, ce mot du jour et les deux précédents, j’espère que plus personne ne pensera que je n’aime pas les chiffres. Mais un chiffre n’est pas neutre, je vous l’ai déjà écrit…Je cite l’article : « Si l’Union européenne est toujours considérée comme un îlot de prospérité relative dans le monde, les dernières données de l’office statistique Eurostat montrent que la précarité n’épargne aucune de ses économies et révèlent quelques anomalies. »Mais montrant d’abord le schéma :«Première indication : la proportion de bas salaires parmi l’ensemble des salariés de l’Union européenne atteint 17,2 %, la zone euro en compte un peu moins, 15,9 %, ce qui est logique compte tenu de sa plus grande homogénéité économique. Est considéré comme un bas salaire celui qui touchait en 2014 deux tiers ou moins du salaire horaire national brut médian. Il s’agit donc d’un niveau relatif et non en valeur absolue.S’il n’est pas étonnant de trouver le plus grand nombre de ces bas salaires en Lettonie (25,5 %), en Roumanie (24,4 %) ou en Pologne (23,6 %), leur forte proportion est plus inattendue en Allemagne (22,5 %), au Royaume-Uni (21,3 %), en Irlande (21,6 %), et même aux Pays-Bas (18,5 %). A noter que, pour des raisons liées à la réorganisation du système de collecte, les données de la Grèce n’apparaissent pas.A l’inverse, les pays scandinaves continuent de mériter leur réputation de pays plus égalitaires puisque moins de 10 % des salariés percevaient des bas salaires en Suède (2,6 %), en Finlande (5,3 %) et au Danemark (8,6 %). La France (8,8 %) et la Belgique (3,8 %) apparaissent également plus équitables tandis que les pays du sud de l’Europe, Espagne, Portugal et Italie, affichent un niveau de bas salaires intermédiaire, inférieur à 15 %.Concernant le niveau du salaire brut médian, les écarts restent très importants dans l’Union européenne puisqu’ils s’échelonnent de 1 à 15. Le niveau le plus élevé a été enregistré au Danemark (25,50 euros de l’heure), devant l’Irlande (20,20 euros) et la Suède (18,50 euros). A l’autre bout de l’échelle, le salaire médian le plus faible se trouve en Bulgarie (1,70 euro) et en Roumanie (2 euros). En Allemagne, il s’élève à 15,70 euros et en France à 14,90 euros. »L’étude d’Eurostat confirme par ailleurs que les femmes sont davantage concernées par les bas salaires (21,1 %) que les hommes (13,5 %) et les moins diplômés (28,2 %) bien plus que ceux qui ont un niveau d’éducation supérieur (6,4 %). Les faibles rémunérations concernent enfin davantage les CDD (31,9 %) que les CDI (15,3 %).Ces chiffres que nous disent-ils ?On nous dit que le Royaume-Uni et l’Allemagne ont un taux de chômage nettement inférieur à la France, c’est vrai !Mais parallèlement ils ont aussi le système qui produit une plus grande précarité et une plus grande inégalité des salariés.Bien sûr que la France a un grand problème avec le chômage, mais quand j’entends certains politiques dirent nous allons appliquer les recettes qui ont marché ailleurs en pensant à l’Allemagne et à la Grande Bretagne je ne peux être qu’inquiet. -
Mardi 31/01/2017
«Inverser la courbe du chômage»François HollandeRevenons à la France et à un objectif dont nous avons régulièrement entendu parlé au cours de ces 4 dernières années.Dès le 9 septembre 2012 dans le journal de TF1, François Hollande déclare solennellement: «Nous devons inverser la courbe du chômage d’ici un an.» Une volonté qu’il réitère quelques mois plus tard déclarant lors de ses voeux du Nouvel an: «Toutes nos forces seront tendues vers un seul but : inverser la courbe du chômage d’ici un an, […] coûte que coûte.»«Inverser la courbe du chômage»Pour l’ancien élève de mathématiques supérieures que je suis, cette phrase est d’abord d’une grande stupidité. Cela n’a pas de sens d’inverser une courbe. Personne ne saurait dessiner une courbe puis dessiner une courbe inverse. Cela n’existe pas.Ce qui est possible c’est de changer le sens de variation d’une courbe. La courbe du chômage avait un sens de variation positif, (pour un matheux cela signifie que la fonction dérivée est positive) l’objectif pouvait donc être de changer ce sens en un sens de variation négatif. En terme plus prosaïque la courbe montait, il faudrait qu’elle descende.Mais arrêtons là ce délire ! Ce technocrate que nous avons élu ne sait plus parler des choses de la vie, il parle de chiffres, de courbes, de mesures. Il ne parle pas d’êtres humains qui cherchent un emploi et qui en sont éloignés de plus en plus.Un humain ou un politique dit : «on va développer l’emploi, on va donner du travail à ceux qui n’en ont pas, on va orienter …».Un technocrate parle du sens de variation d’une courbe et en plus en parle mal avec une novlangue qui tente de manier des indicateurs, des abstractions plutôt que de parler de la vie .Et puis le technocrate s’étonne que l’humain, celui qui est en face de cette difficulté, de trouver sa place dans la société économique, de savoir de quoi demain sera fait le rejette violemment car il n’en a que faire des courbes inversées ou non. Il veut un job, un job qui lui donne une rémunération lui permettant de vivre. Il veut savoir si ses enfants pourront avoir un job ou s’il n’y a que du travail pour un tout petit nombre et que tout le reste sera fait par des automates ou des programmes informatiques : ces millions de boulots qui permettaient aux gens de vivre : chauffeur de taxi, conducteur de camion, comptables mais aussi cuisinier, assistant dans un cabinet d’avocats mais aussi caissiers dans un magasin ou vendeur ou manutentionnaire et peut être même médecin etc…Ces questions abyssales sont laissées sous silence pour parler de chiffres, de courbes et de réalités froides susceptibles de remplir un tableur certainement pas de motiver, d’engager et de convaincre. Faire de la politique autrement dit !Mais revenons un instant sur cette fameuse courbe.Grâce à l’INSEE nous avons tous les éléments pour voir de nos propres yeux. C’est sur ce site :Et pour que ce soit encore plus simple pour vous je vous envoie en pièce jointe le fichier qui retrace la froide réalité des chiffres depuis 1996.Alors cette courbe l’avez vous déjà vu ?Voici une courbe qui retrace l’évolution du nombre de chômeurs depuis le début du quinquennat de Hollande (entre mai 2012 et novembre 2016)Cette courbe comment la qualifier ? de « tourmentée » peut être ?Elle subit, bien sûr, des variations saisonnières qui correspondent par exemple à l’arrivée sur le marché du travail des jeunes qui ont fini leurs études.Encore faut-il savoir qu’elle ne représente qu’un type de chômeurs : la catégorie A, parce qu’il existe plusieurs types de chômeurs :Catégorie A Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi
Catégorie B Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois)
Catégorie C Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois)
Catégorie D Demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie…), sans emploi
Catégorie E Demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés).
Prenons la courbe de type A depuis janvier 1996 jusqu’à novembre 2016Il semblerait que l’on peut voir une baisse entre 1996 et 2008, mais après 2008 il y a inversion du sens de variation de cette courbe dans le sens non souhaité.Mais regardons donc la courbe en agrégeant l’ensemble des types de chômeurs (ABCDE) sur la même période :Quand nous analysons cette courbe (qui va au-delà de 6 000 000 désormais) il n’y a qu’une baisse légère entre 1996 et 2008 en revanche une progression inexorable entre 2008 et 2016.Cela signifie donc que si des chômeurs sortent de la catégorie A c’est plutôt pour aller vers les autres catégories que pour sortir du chômage.Mais les chiffres sont complexes au contraire de ce que voudrait nous laisser croire les communicants quantophrènes. Car la population sur laquelle s’applique ces courbes n’est pas immuable, mais fluctue car il y a tout au long de ces années une arrivée de nouveaux venus sur le marché de l’emploi, alors que d’autres en sortent par la retraite ou quelquefois le découragement. Pendant ce temps les règles concernant la retraite ont été modifiées entrainant d’autres phénomènes et comportements.Résumons le propos : un chiffre ne veut rien dire (ce qui ne signifie pas qu’il est inutile mais qu’il n’a pas de sens isolé, non contextualisé et expliqué) et « Inverser la courbe du chômage » est une formule stupide.Enfin ce qu’il est raisonnable de dire c’est que l’offre d’emploi sait de moins en moins répondre à la demande d’emploi.Vous pouvez lire aussi ce décryptage de Jacques Sapir <Le chômage et la honte de nos gouvernants> -
Lundi 30/01/2017
« Des chiffres et des hommes »Réflexions personnelles sur la grandeur et la misère de la quantificationMes incises répétées sur les crétins quantophrènes ont conduit certains lecteurs attentifs du mot du jour à craindre que je ne sois devenu « chiffrophobe », ayant peur ou n’aimant pas les chiffres.
Mon neveu avisé Grégory a exprimé cette idée pertinente qu’il peut être très dangereux de laisser prospérer des discours ou organisations qui n’expriment que des idées, des concepts sans jamais les confronter à la réalité d’un chiffrage méthodique et rigoureux.
Il a bien entendu totalement raison.
Je veux donc préciser ce que j’ai compris sur le danger de la « vérité des chiffres » de ce qu’Alain Supiot a désigné par « la gouvernance par les nombres » et qui a fait l’objet du mot du jour du 3 juillet 2015.
J’esquisserai cette réflexion selon 4 axes :
1/ Les chiffres durs et les chiffres mous
C’est Emmanuel Todd qui a développé cette distinction.
Les chiffres durs sont par exemple ceux de la démographie : l’espérance de vie dans un pays, la mortalité infantile, le nombre d’enfants par femme.
Ce sont des chiffres qui sauf manipulation sont incontestables et sur lesquels on peut appuyer des raisonnements sérieux. Ainsi quand Emmanuel Todd constate qu’en Iran, depuis la révolution islamique, le nombre d’enfants par femme a chuté et se rapproche des standards occidentaux, il en conclut que les dogmes des ayatollahs iraniens ne sont pas acceptés et respectés en profondeur par la société civile iranienne.
Le chiffre mou est par excellence celui issu des sondages. Dans un sondage on vous demande de répondre à des questions auxquelles vous étiez à mille lieux de penser 5 minutes auparavant. En outre la formulation des questions n’est jamais neutre.
Il y a évidemment tout un panel de nuances entre les chiffres durs et les chiffres mous.
2/ Le chiffre s’inscrit dans un système de valeurs idéologiques.
Un chiffre ne vient pas de nulle part, il est le fruit de raisonnements et de choix idéologiques, il s’inscrit dans un système de valeurs.
L’exemple le plus simple pour exprimer cette réalité est le PIB. Mettre en avant ce chiffre, c’est considérer que ce qui est essentiel pour décrire un pays ce sont les échanges marchands plutôt que les échanges bénévoles, c’est privilégier la production à l’éthique.
Ce n’est pas le PIB, en tant que tel, qui est problématique, c’est le fait de le mettre en avant qui est idéologique.
3/ Le chiffre est souvent une moyenne et une moyenne ne décrit pas la réalité, elle peut masquer des disparités énormes à l’intérieur de la population observée.
4/ Un chiffre indicateur n’est jamais neutre, l’organisation et le comportement des acteurs de l’organisation va se modifier pour que l’indicateur évolue dans le sens souhaité.
Exprimé autrement, au départ un dénombrement essaie de décrire l’état d’un système sur un point particulier. Quand il devient un indicateur, il n’est plus en mesure de faire cette description de manière neutre, car les agents concernés vont tout faire pour que le chiffre soit bon, non la réalité, le chiffre. A cela s’ajoute ce fantasme de la simplification : décrire la situation par un chiffre ou très peu de chiffres ! Ce type de simplification amène à toutes les dérives.
Beaucoup croient qu’en annonçant un chiffre ils concluent leur propos.
C’est le contraire qu’il faut faire, les chiffres sont au début du discours, il faut les interroger, les expliquer.
Quand on reçoit un chiffre, il faut comprendre d’où il vient, est-il plutôt un chiffre dur ou un chiffre mou, quel est le système idéologique qui le produit et le considère important, comment il est calculé, quel est sa fiabilité et enfin que signifie t’il vraiment ?
Je suis conscient qu’un simple mot du jour ne peut approfondir la perversité qui se cache derrière la dictature des chiffres pas plus qu’il ne peut développer l’intérêt du chiffrage et la bonne utilisation des chiffres.
Dans la conclusion au mot du jour concernant la gouvernance par les nombres j’écrivais : «Nous subissons tous plus ou moins ce fantasme de la gouvernance par les nombres de ceux qui croient que la vie d’une entreprise, d’une administration voire d’un être humain peut parfaitement se synthétiser par un tableau Excel. C’est une œuvre de déshumanisation à laquelle nous devons résister tout en utilisant de manière intelligente les dénombrements ou les statistiques dont nous pouvons disposer. »
Dans la Préface de La Dame aux Camélias (1848), Alexandre Dumas fils écrit:
« N’estime l’argent ni plus ni moins qu’il ne vaut : c’est un bon serviteur et un mauvais maître ».
Je crois qu’on peut remplacer le mot « l’argent » par « le chiffre », la formule reste juste.
<826>
-
Vendredi 27/01/2017
«It Can’t Happen Here »
Ça ne peut arriver iciSinclair LewisHarry Sinclair Lewis (1885 –1951) est un romancier et dramaturge américain. Il fut le premier Américain à recevoir le prix Nobel de littérature en 1930.Ces dernières semaines, il est souvent question de lui et surtout d’un de ses ouvrages : It Can’t Happen Here (« Ça ne peut arriver ici ») publié en 1935.L’épouse de Sinclair Lewis, Dorothy Thompson était journaliste. Elle parvint à approcher Adolf Hitler dès 1931 et était effrayé de ce qu’elle avait compris. A partir de cette rencontre, elle tenta par tous les moyens journalistiques de mettre en garde les Etats-Unis contre la possibilité que le fascisme traversât l’Atlantique. Il semble qu’elle n’eût pas droit à une grande écoute.Son mari décida alors de mettre sa plume romanesque au service de cette cause en racontant l’arrivée au pouvoir d’un pur démagogue aux Etats Unis. C’est le thème de ce livre (« Ça ne peut arriver ici »).Dans la revue de presse de France Inter, il a été fait référence à un article du journaliste des Echos : Pierre de Gasquet :« Qualifié d’effroyablement contemporain par la presse anglo-saxonne, ce roman conte l’histoire de l’ascension fulgurante d’un démagogue hors-pair, un certain Buzz Windrip, leader populiste très charismatique qui prend le pouvoir aux États-Unis. Il fait un tabac auprès ‘des mineurs affamés, des fermiers ruinés et des ouvriers au chômage’. ‘Leurs mains se levaient devant lui comme une troupe d’oiseaux effarouchés à la lueur des torches.’Se réclamant des vraies valeurs traditionnelles américaines, Buzz Windrip balaye littéralement Franklin Roosevelt et remporte l’élection de 1936.Il promet alors de restaurer la grandeur de l’Amérique, puis très vite, il laisse libre cours à ses pulsions autocratiques. Il nomme des banquiers à son cabinet, ordonne l’invasion du Mexique, et expédie ses opposants dans des camps d’internement. Impossible ici – It can happen here : un cauchemar politique imaginé, donc, par l’écrivain Sinclair Lewis il y a plus 80 ans. Né de l’urgence d’écrire face à la montée du totalitarisme et de l’antisémitisme, cette satire, explique mon confrère, n’a sans doute pas la puissance littéraire de 1984 ou du Meilleur des Mondes. N’empêche : elle prend aujourd’hui une résonance particulière, tant le parcours de Buzz Windrip évoque celui de Donald Trump. Très grand succès aux USA : l’édition américaine du livre est épuisée sur les sites de commerce en ligne. ».C’est bien l’arrivée au pouvoir de Donald Trump qui explique le succès contemporain de cet ouvrage qui a été réédité avec une préface écrite par Raymond Queneau.Le titre de l’ouvrage « Ça ne peut arriver ici », s’explique par le fait que les américains considéraient que dans leur grande sagesse les inventeurs de leur démocratie avaient mis en place une constitution les protégeant de telles dérives. D’abord en créant toute une série de contre pouvoir : le Congrès contre l’exécutif, le contrôle de la Cour suprême, les Etats fédérés contre l’Etat fédéral avec en outre une manière baroque d’élire le Président des Etats Unis.Ce dispositif des grands électeurs qui retire au seul vote populaire la désignation du président est souvent présenté comme la nécessité dans un état fédéral de donner du pouvoir à tous les états fédérés. Et cela est exact, en effet s’il n’y avait pas le vote par Grands Électeurs les petits états comme le Wyoming ne pèserait rien par rapport à la Californie et aucun candidat à la présidence ne s’intéresserait aux aspirations des citoyens de ce petit État.Mais il y a une autre règle de la constitution américaine que j’avais apprise en faculté de droit qui montre encore davantage la méfiance de ce système à l’égard de la démocratie directe. Les Grands électeurs doivent élire le Président et le Vice-Président à la majorité absolue, soit 270 voix sur 538. Et si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, la Chambre des Représentants désigne le vainqueur parmi les trois candidats arrivés en tête. Si le même cas se produit pour la vice-présidence, c’est le Sénat qui est chargé de choisir entre les deux candidats ayant obtenus le plus de voix.Or mon professeur de droit de l’époque prétendait que les rédacteurs de la constitution n’avaient probablement pas anticipé l’organisation pratique du système américain autour de deux partis écrasant la concurrence et trouvant le moyen de systématiquement résumer l’élection à une finale entre deux candidats issus des primaires de ces partis.Dès lors, pour ce professeur de droit, les concepteurs de ce système pensaient qu’il serait peu probable qu’une majorité absolue se dégage et que systématiquement la désignation de le tête de l’exécutif se ferait pas les deux chambres. Un système de « démocratie indirecte renforcée » de nature à éliminer tout risque d’arrivée au pouvoir d’un apprenti dictateur.Donc l’arrivée au pouvoir d’un dictateur aux Etats Unis n’était pas possible.Certains aujourd’hui émettent des doutes sur ce point à cause de l’élection de cet homme imprévisible et autoritaire qu’est Donald Trump.Il semble quand même que les contre pouvoirs s’exerceront.Vous trouverez derrière <ce lien>un article qui montre les limites de ce livre et de sa pertinence quant à décrire la situation d’aujourd’hui. -
Jeudi 26/01/2017
«Présenter des faits alternatifs »Kellyanne Conway, conseillère de Donald TrumpCela commence très fort. Pour l’instant on peut en rire. Je ne sais pas si cela durera.En tout cas, les conseillers de Trump ont l’intention d’élargir les éléments de langage pour communiquer et bien faire comprendre que Trump est le plus grand, le plus populaire, le plus tout.Les médias ont constaté qu’il y avait beaucoup moins de monde à l’investiture de Trump qu’à la première investiture d’Obama.Dans le système de valeur de l’équipe Trump cela ne peut être la vérité puisque Trump est le plus grand dans tous les domaines.Ainsi lors de sa première prise de parole, le porte-parole de l’équipe Sean Spicer a affirmé que la foule de vendredi « a été la plus importante à n’avoir jamais assisté à une prestation de serment, point final ».Et dimanche c’est une autre conseillère, Kellyanne Conway qui est entrée dans l’Histoire de la communication politique…Elle a déclaré sur NBC en répondant à un journaliste ayant le prénom de Chuck : « On ne peut jamais vraiment quantifier une foule. Nous savons tous cela. Vous pouvez vous moquer autant que vous voulez, je pense que cela symbolise la façon dont nous sommes traités par la presse (…) Ne surdramatisez pas, Chuck. Vous dites des choses fausses. Et notre porte-parole, Sean Spicer, a donné des faits alternatifs. »Ce à quoi le journaliste exaspéré a répondu :« Attendez une minute. Des faits alternatifs ? Des faits alternatifs ? Quatre des cinq faits qu’il a dits… sont tout simplement faux. Les faits alternatifs ne sont pas des faits, ce sont des mensonges. »Désormais quand vous souhaiterez ne pas dire la vérité, ne laissez surtout pas dire que vous mentez, affirmez que vous présentez des faits alternatifs.Remarquez que dans cette logique on pourra dire aussi que la vérité est une présentation de faits alternatifs aux mensonges.Ce concept a toute vocation à être rapidement importée en France.Les responsables de la primaire de gauche ont, semble-t’il, également présenté des faits alternatifs pour annoncer la participation au scrutin.Et désormais on attend la présentation des faits alternatifs de François Fillon justifiant les salaires d’attaché parlementaire versés à son épouse alors même que plusieurs interviews existent où Madame Pénélope Fillon affirme qu’elle n’a jamais participé à la vie politique de son mari. -
Mercredi 25/01/2017
« Trickle down Economic »La théorie du ruissellementCroyance économique qui justifie qu’on avantage les riches pour le plus grand profit des pauvresNous sommes dans une théorie économique qui est répétée à satiété par tous les économistes libéraux et les responsables politiques qui écoutent ces économistes.Il faut diminuer les impôts des plus riches et libérer les contraintes qui pèsent sur eux pour qu’ils puissent devenir plus riche et que par un système de ruissellement cette richesse irrigue le reste de la société jusqu’au plus modeste qui profiteront alors de cette manne.La richesse est dans cette hypothèse une source qui se divise en multiples petites rigoles et ruisselle jusqu’en bas, permettant à tous de profiter de la richesse créée en haut, y compris les plus pauvres. C’est une théorie libérale qui prétend que plus les riches sont riches, moins les pauvres sont pauvres.C’est sur cette théorie que Donald Trump s’appuie pour défendre sa politique de diminution des impôts des riches et aussi la politique de dérégulation.C’est aussi l’argument essentiel de François Fillon qui veut diminuer la pression fiscale à l’égard des hauts revenus et encourager les riches à être plus riche.Et c’est Marie Viennot qui dans son billet économique du 9 janvier 2017 fait le point des études économiques sur cette théorie :« Difficile de trouver des études qui valident la théorie du ruissellement. La période Reagan est une belle période pour étudier ce phénomène, mais comme, en plus des baisses d’impôts sur les plus riches, il y a eu une augmentation massive de la dépense publique, et la baisse vertigineuse des taux directeurs de la Fed, difficile d’isoler le seul facteur de baisse d’impôts des plus riches.Des chercheurs de Harvard ont étudié en 2009 la corrélation entre la baisse d’impôt pour les plus riches et la croissance dans 12 pays, dont la France entre 1905 et 2000… Avant 1960, il n’y a aucun lien selon eux, et après, ils trouvent un lien, mais il faut attendre 13 ans, avant que les 90% du dessous profitent du surplus de croissance liée à la baisse des taxes. Le ruissellement prendrait donc 13 ans, Mais si dans les 13 ans, il y a une crise ou une dépression, là c’est perdu nous explique cette étude.Autre analyse qui dément la théorie du ruissellement, celle que l’OCDE a publié cet automne sur les 35 pays les plus développés de la planète. L’étude montre que les inégalités de revenu sont à des niveaux historiques, depuis 30 ans que les données existent, et plus intéressant encore, que la légère reprise de croissance de ces 3 dernières années profite plus aux ménages les plus aisés…Les 10% les plus riches ont vu leurs revenus augmenter de 2.3% et les moins aisés de 1,1%. C’est moins vrai en France, note l’OCDE car les impôts des plus riches ont été augmentés, et les prestations sociales revalorisées, mais la tendance est la même. Les inégalités augmentent, et la croissance accroît ces inégalités.Si on regarde sur une plus longue période, en 30 ans les 1% les plus riches ont captés 50% de la création de richesse aux USA, 20% en Grande Bretagne, et 10% en France, selon des chiffres communiqués par l’OCDE.Le FMI partage le constat de l’OCDE. Comme l’OCDE, on ne peut pas soupçonner le FMI d’avoir un agenda marxiste caché. Dans un rapport en 2015, le FMI l’écrit noir sur blanc: quand les riches sont plus riches, les bénéfices ne ruissellent pas et la croissance est moindre que si on favorise les pauvres et les classes moyennes.Pourquoi la croissance ruisselle moins ?De fait, les riches ont une propension plus forte à épargner, et certains ont tendance à placer cette épargne dans des paradis fiscaux pour la soustraire au fisc, à la redistribution… et donc au ruissellement.L’autre explication, c’est que la reprise créée des emplois de mauvaise qualité, et s’accompagne d’une modération salariale généralisée. […]Depuis quelques années, le FMI, le Bureau International du Travail et l’OCDE cherchent à pousser le concept d’INCLUSIVE GROWTH, croissance inclusive qui prône la création d’emploi de bonne qualité et bien payés, met l’accent sur la formation, l’éducation, et les politiques de redistribution des revenus.Le sujet a été abordé pour la première fois par le G20, les pays les plus puissants de la planète cet été. C’était directement lié au Brexit. Il n’y a pas encore d’étude pour dire combien de temps cette idée mettra à ruisseler à contre-courant de l’apesanteur jusqu’en haut pour se traduire dans les politiques économiques et devenir une réalité. »Mais tout le monde n’est pas d’accord avec ces études et si vous souhaitez entendre la parole de la défense écoutez l’économiste libérale Agnès Verdier-Molinié chez Ruquier le 14/01/2017 : https://www.youtube.com/watch?v=EEPuWrYKYmAA vous de voir si elle vous convainc…Ce n’est pas mon cas, j’estime qu’elle est dans le domaine de la croyance et que les études contredisent cette croyance.<823> -
Mardi 24 janvier 2017
« Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes.»Rachid Benzine, <Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?>,Rachid Benzine est né en 1971 au Maroc et il est arrivé en France à Trappes à l’âge de 7 ans. En 1996, il devient champion de France de kickboxing.Il est aussi un intellectuel formé à l’école des sciences humaines, après avoir fait des études d’économie et de sciences politiques, il se dirige vers des études d’histoire et de philosophie.Selon Wikipedia qui le présente «comme une des figures de proue de l’Islam libéral francophone», il «accède à la notoriété en lançant avec le père Christian Delorme, le dialogue islamo-catholique aux Minguettes, dans la banlieue de Lyon, qui donne lieu à un livre : Nous avons tant de choses à nous dire, paru en 1998. »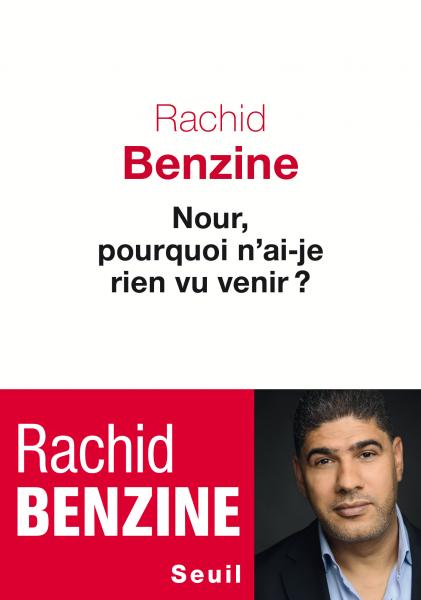 En octobre 2016, il a écrit un roman épistolaire <Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?>, dans lequel un père échange des lettres avec sa fille partie faire le djihad en Irak. <Vous trouverez ici un article de la Croix sur cet ouvrage>C’est de ce livre que j’ai tiré l’exergue du mot de ce jour. Cette phrase est extraite du paragraphe suivant :
En octobre 2016, il a écrit un roman épistolaire <Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?>, dans lequel un père échange des lettres avec sa fille partie faire le djihad en Irak. <Vous trouverez ici un article de la Croix sur cet ouvrage>C’est de ce livre que j’ai tiré l’exergue du mot de ce jour. Cette phrase est extraite du paragraphe suivant :« Notre mission en tant qu’humains n’est pas de trouver des réponses, mais de chercher. Les musulmans sont appelés à être d’humbles chercheurs, et pas des ânes qui ânonneraient sans cesse des histoires abracadabrantes. Tu le sais bien, ma petite Nour : Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes. Ces certitudes qui vous mènent aujourd’hui tout droit en enfer. »
« Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes.» Nous sommes au cœur de la sagesse, nous revenons à Socrate. L’ignorance n’est pas le souci quand elle est comprise, assumée : je sais que je ne sais pas. Ce qui est dramatique c’est d’avoir des certitudes et de ne pas les interroger, de ne pas les confronter à ce que l’on peut savoir, à la perception de la réalité, à l’expérimentation du génie scientifique ou aux recherches historiques.Cette sagesse est indispensable à l’heure- De la dérive islamiste mais aussi du renouveau des idées théocratiques ou moralistes d’activistes chrétiens.
- De l’arrivée au pouvoir de Donald Trump ;
- Mais aussi des affirmations répétées et pourtant erronées de cette pseudo science qui s’appelle l’économie et qui assène des certitudes qui sont avant tout la défense des intérêts d’un petit nombre (1)
A cet aveuglement des certitudes, j’opposerai « le germe fécond du doute » que j’ai découvert chez Raymond Aron.(1) Pour ma part je ne répéterai jamais assez que le monde est complexité et que le propos que je tiens ici sur l’économie ne rejette pas l’intégralité de cette discipline mais critique certains développements qui sont présentés comme une démonstration scientifique alors qu’ils sont au mieux une croyance, au pire un mensonge visant à défendre des intérêts privés. J’en développerai un demain.
<822>
-
Lundi 23 janvier 2017
« Il est toujours utile qu’une démocratie se renouvelle. […] Quelqu’un arrive avec de nouvelles idées qui sont peut être totalement contraires aux miennes. Peut-être y aura-t-il des reculs, mais cela donne la possibilité à une démocratie de tester des idées. »Barack Obama, s’exprimant sur l’arrivée de Donald Trump à la tête de la démocratie américaineEt Barack Obama est parti de la maison blanche, Donald Trump est Président des Etats-Unis !
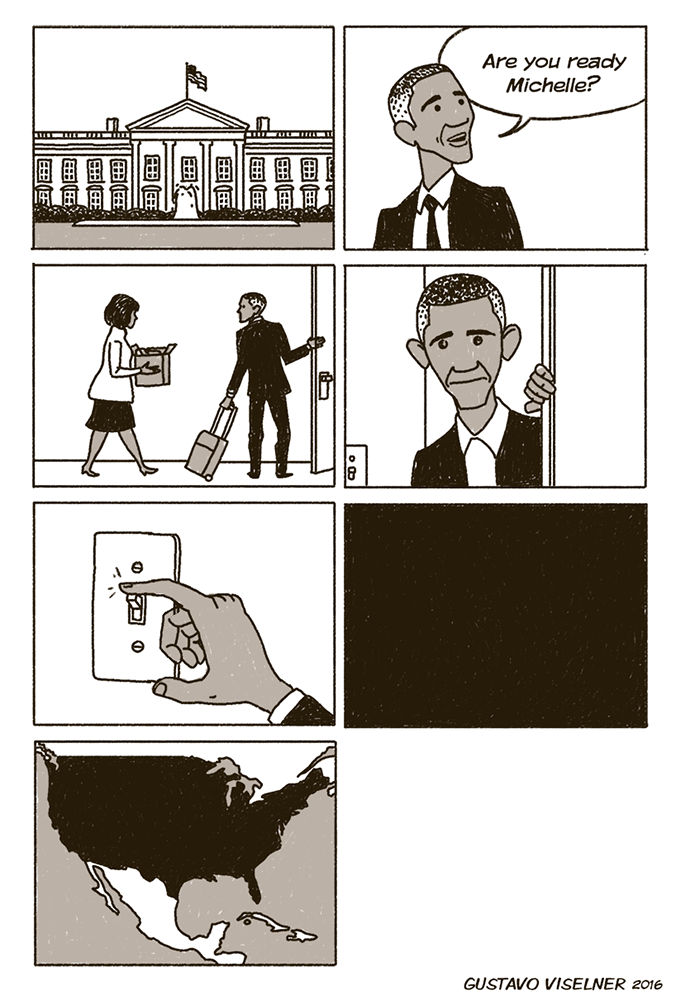 Et Barack Obama est parti de la maison blanche, Donald Trump est Président des Etats-Unis.
Et Barack Obama est parti de la maison blanche, Donald Trump est Président des Etats-Unis.
On peut examiner ce passage comme le montre ce dessinateur : http://www.koreus.com/image/barack-obama-quitter-maison-blanche.html
Mais Obama n’a pas tenu un discours dans ce sens, on lui a demandé de s’exprimer sur Donald Trump
« C’est quelqu’un qui ne manque pas de confiance en lui. C’est un bon point de départ pour ce job. Vous devez être suffisamment fou pour vous en croire capable. Je pense qu’il n’a pas passé beaucoup de temps pour peaufiner sa politique. Ce qui peut être à la fois une force et une faiblesse. Si cela lui donne un regard nouveau cela peut être profitable, mais il faut aussi avoir conscience de ce que vous savez et de ce que vous ne savez pas. Il me semble assez juste de dire que nous sommes des opposés d’une certaine manière. »
Et puis répondant à une autre question, Barack Obama élève encore une fois le débat et administre une leçon de démocratie :
« Il est toujours utile qu’une démocratie se renouvelle. Et c’est une partie du message que j’ai passé à mon équipe et à mes partisans après cette élection qui a provoqué beaucoup de déception. Ce que je leur ai dit c’est que nous avons fait du très bon travail. Quelqu’un arrive avec de nouvelles idées qui sont peut être totalement contraires aux miennes. Peut-être y aura-t-il des reculs, mais cela donne la possibilité à une démocratie de tester des idées. Et pour ceux qui ont perdu de reprendre leur souffle et de retrouver leur énergie pour offrir plus de progrès dans le futur. »
Vous pourrez entendre Barack Obama l’exprimer directement dans cette émission :
https://www.franceinter.fr/emissions/le-monde-de/le-monde-de-09-janvier-2017
Barack Obama s’est engagé plus qu’aucun de ces prédécesseurs pour influencer le résultat des élections présidentielles et éviter que Donald Trump ne gagne. Il a échoué.
Il a alors appliqué ce conseil de Shakespeare :
« Ce qui ne peut être évité doit être embrassé ».
La citation est une réplique de Page dans « Les joyeuses commères de Windsor » à la toute fin de la pièce (Acte V, scène 5) :
« What cannot be eschew’d must be embrac’d. »
J’entends et je lis beaucoup de critiques sur le bilan de Barack Obama.
Mais vous connaissez la différence entre le Dieu monothéiste et un homme providentiel ?
On ne sait pas si Dieu existe, mais on est certain qu’un homme providentiel n’existe pas.
Certes il n’a pas tout réussi de ce qu’il a entrepris, certaines décisions sont contestables.
Mais il a passé ces 8 ans à la Maison Blanche, sans qu’aucun scandale dans aucun domaine ne ternisse son image.
Chaque fois il a réagi avec calme, hauteur de vue.
Barack Obama fait toujours appel à l’intelligence en se basant sur des valeurs humanistes et positives.
Il l’a encore montré dans son dernier discours dont vous trouverez la traduction derrière ce lien : <Dernier discours d’OBAMA> et que vous pouvez écouter en anglais derrière <ce lien>.
Barack Obama n’est pas un homme providentiel, mais il est un homme qui donne espoir en l’humanité.
Il a à ces côtés une femme remarquable : Michelle Obama qui a également tenu un discours d’Adieu plein d’intelligence et d’émotion : <Discours de Michelle Obama>
Je suis heureux et optimiste parce que je vis cette période où les américains malgré tous leurs défauts ont su élire un homme de l’intelligence et de l’éthique de Barack Obama et selon les sondages d’opinion ont su lui garder une confiance incommensurable avec celle que savent conserver les autres gouvernants des pays occidentaux.
Trump est déjà impopulaire, il ne sera probablement qu’une parenthèse dans le temps long de l’Histoire.
<821>
-
Vendredi 20 janvier 2017
«Finalement !»Premier mot du pape François en s’approchant de Kirill Patriarche de l’église OrthodoxeNos médias parlent abondamment des dissensions et des conflits à l’intérieur de l’Islam entre les sunnites et les chiites.Mais on parle peu du grand schisme chrétien entre les Catholiques et les Orthodoxes qui date de 1054. Le 16 juillet 1054, le légat du Pape chef de l’Église de Rome dépose sur le maître-autel de Sainte-Sophie de Constantinople une bulle excommuniant le Patriarche de l’Eglise orthodoxe Michel Cérulaire, excommunication qui fut suivie de celle des responsables catholiques par le patriarche.Depuis cette date (962 ans) le Pape et le Patriarche ne se sont jamais rencontrés avant le 12 février 2016 à l’aéroport de La Havane, à Cuba. La photo montre l’accolade que se donne ces deux responsables religieux.« Finalement ». C’est le premier mot qu’a prononcé avec douceur le pape François en échangeant une longue et chaleureuse accolade avec le patriarche de Moscou, Kirill.Par la suite le Pape a dit : « Nous sommes frères ». Il a quand même fallu près de mille ans pour que cette « évidence ? » puisse être exprimée.Plusieurs articles ont relaté cette rencontre historique :- http://www.lemonde.fr/religions/article/2016/02/06/rencontre-historique-a-cuba-entre-le-pape-francois-et-le-patriarche-kirill_4860528_1653130.html
- http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/12/01016-20160212ARTFIG00449-tete-a-tete-historique-entre-le-patriarche-russe-et-le-pape.php
- http://www.la-croix.com/Religion/Pape/Finalement-rencontre-entre-pape-patriarche-russe-2016-02-12-1200739734
Cette série de photos a commencé par une photo montrant les dégâts de la guerre, elle finit par une photo de réconciliation d’un conflit de mille ans.Nous avons besoin d’espoir et de croire en l’avenir. Tout ce qui peut nourrir cette espérance doit être savouré avec délectation.<820> -
Jeudi 19 janvier 2017
« Homo sapiens d’hier et d’aujourd’hui : Solar Impulse survole les pyramides »
Une photo qui confronte le XXIème siècle et l’homo sapiens d’il y a 4500 annéesSolar Impulse est cet avion solaire réalisé à l’initiative des Suisses Bertrand Piccard et André Borschberg, à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.Cet avion vole de nuit comme de jour, sans carburant ni émission polluante pendant le vol, un avion monoplace à moteurs électriques alimentés uniquement par l’énergie solaire, jusqu’à effectuer un tour du monde. Sur leur site, il est indiqué qu’ils ont pu voler 40 000 km uniquement avec l’énergie solaire recueillie et stockée.Ainsi le 23 juin 2016 : au terme d’un périple de 6 272 kilomètres au-dessus de l’océan Atlantique, l’avion Solar Impulse 2 a atterri jeudi 23 juin à Séville, dans le sud de l’Espagne.Et puis du 11 au 13 juillet, André Borschberg vole de Séville au Caire, en survolant les Pyramides avant d’atterrir.Cette photo montre la rencontre du génie humain du XXIème siècle qui survole le produit du génie humain d’il y a plus de 4 500 ans.N’est-ce pas une raison d’émerveillement et aussi d’espoir ?<819> -
Mercredi 18 janvier 2017
«Un selfie»Pratique des temps moderneSelfie géant de Clinton, le 21 septembre 2016 à Orlando en FlorideEt à la fin de son meeting, dans une mise en scène savamment organisée, Hillary Clinton invite ses partisans de prendre un selfie « collectif et individuel » avec elle. Et on voit cette photo incroyable d’une leader politique qui salue une foule qui lui tourne le dos !Dans des cérémonies religieuses, il arrive que l’officiant tourne le dos aux fidèles, mais c’est pour regarder dans la même direction vers un Dieu ou un Lieu qui unit la communauté et manifeste son «Nous».Ici il y a une photo tournée vers son ego : «Moi et Hillary Clinton». L’individualisme poussé à son extrême : ils sont dans une manifestation politique où normalement ils devraient pouvoir créer un «Nous» autour de valeurs communes. Mais ce qui importe est de faire une photo où il n’y a que moi et la vedette de la soirée… qui aurait dû être la première femme présidente des États-Unis …Le Figaro a demandé à un philosophe et théologien, Bertrand Vergely d’analyser cette photo, je vous laisse le lire : <www.lefigaro.fr/vox/monde/2016/09/26/ selfie géant d’Hillary Clinton>Outre cette manifestation de l’égocentrisme, cette photo révèle aussi la tendance de prendre des photos à chaque instant et comme pour la photo d’hier de ne pas simplement regarder avec ses yeux.C’est pourquoi cette photo me fait également penser à une chronique de François Morel qui décrit l’émotion d’un enfant qui va se produire en spectacle avec sa classe devant des parents et ses parents. Il raconte combien ce moment est important pour lui et aussi sa peur que ses parents ne le regardent qu’à travers leurs appareils numériques pour faire des photos et des vidéos de ce moment, plutôt que de simplement le vivre.La supplique de l’enfant est : « Papa, maman, regardez-moi, mais avec vos yeux»Voici cette chronique : <Le-billet de François Morel du 16 décembre 2016><818> -
Mardi 17 janvier 2017
« Les hommes regardent la réalité virtuelle, un homme regarde rien qu’avec ses yeux »Mark Zuckerberg , photo prise à Barcelone à la veille de l’ouverture du Mobile World Congress de BarceloneMark Zuckerberg, traverse une foule assise et aveugle. Ceux qui la composent ont un casque de réalité virtuelle vissé sur le crâne, plongés dans un autre monde et ne voient pas le patron de Facebook déambuler parmi eux.Bien sûr cette photo peut techniquement s’expliquer , des journalistes sont en train de tester un casque de réalité virtuelle et Mark Zuckerberg traverse tranquillement la salle pour aller sur la tribune vanter les mérites de cette nouvelle technologie..Mais dans l’imaginaire cette photo peut être vue autrement. Ainsi, elle a été publiée dimanche 21 février sur le compte Facebook de Mark Zuckerberg et a été massivement partagée et commentée sur les réseaux sociaux.Un internaute a écrit : « Mark – ça ne te semble pas étrange d’être le seul à marcher avec tes propres yeux, alors que tous les autres sont des zombies dans la Matrice ? » . Les internautes rapprochent en effet cette photo de la trilogie de Matrix.Et si on la rapprochait plutôt de cette sentence de William Shakespeare dans le roi Lear: « Quelle époque terrible que celle où des fous dirigent des aveugles. » et qui avait fait l’objet du mot du jour du 01/04/2014.<817> -
Lundi 16 janvier 2017
«Alep»Une photo de l’année 2016Le mot du jour avait déjà plusieurs fois pour objet une photo.Cette semaine je vous propose 5 photos prises en 2016.La première concerne la ville d’Alep, des hommes marchent dans une rue jonchée de débris qu’on a cependant dégagé vers les côtés pour essayer de continuer à vivre. Des câbles pendent, les bâtiments sont en ruines, probablement qu’au moment de leurs destructions des enfants, des femmes et des hommes sont mortsJ’ai eu l’idée de faire une thématique sur des photos de 2016 en écoutant cette émission :https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/iconographie-de-lannee-2016Le titre de l’émission était : « Iconographie de l’année 2016 », l’émission a ciblé deux photos que nous verrons demain et après-demain.J’ai aussi été inspiré par deux articles :<Le Monde : Les images marquantes de l’année 2016> et <L’express.fr : Rétrospective de l’annee 2016 en images>Il faut cependant rappeler que la violence a reculé dans le monde par rapport aux siècles précédents et que la probabilité qu’un terrien meurt de mort violente aujourd’hui par rapport aux précédentes périodes historiques a diminué de manière considérable. Mais aujourd’hui grâce aux outils de communication, ces drames se sont rapprochés de nous.Pour finir je vous oriente vers cette chronique sur la chute d’Alep de Nicole Ferroni et où dans sa conclusion très émue elle partageait une réflexion de son père : « Autrefois, les hommes se mangeaient et on appelait cela du cannibalisme, eh bien, un jour, peut-être que la guerre sera si loin derrière l’humanité, qu’on pourra dire que les hommes se tuaient et qu’ils appelaient cela la guerre. »<816> -
Vendredi 13 janvier 2017
«S’émerveiller »Belinda CannoneJ’ai découvert Belinda Cannone en écoutant cette émission de France Culture :https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/resister-en-semerveillantNée en 1959, Belinda Cannone est romancière et essayiste. Elle a déjà publié plusieurs romans et <S’émerveiller est son dernier livre, un essai, qui vient de paraître>Pour Belinda Cannone, la société vit actuellement une forme d’enténèbrement. C’est pourquoi elle nous propose de tenter de retrouver les petits bonheurs simples de la vie, ceux qui ne sont pas grand-chose mais qui pourtant nous réjouissent, bref, elle nous invite à nous émerveiller d’avantage. Un paysage, une action de courage ou un éclat de rire, la possibilité d’une lumière plus joyeuse apportée sur nos quotidiens mornes est à portée de main de tout un chacun.Son ouvrage débute ainsi :« L’autre fois (l’automne) je notais : Ce matin, je contemple mon chêne, cette torche de temps pur qui se dresse à deux ou trois cents mètres devant la fenêtre du bureau, dans ma maison des champs, la vision est d’autant plus nette que l’herbe à son pied est rase, ultime fenaison faite, et le soleil dissipe lentement la couverture de nuages légers. À mon lever, la brume de chaleur (un si doux septembre) le dissimulait tout à fait. Tandis que l’arbre émergeait – le détail de sa ramure devenant de plus en plus net, la haie d’arbres du fond perdant son indistinction ombreuse –, j’observais, de l’autre côté du carreau, deux merles cherchant leur nourriture, et je me suis sentie émerveillée, par la beauté du chêne, du champ, des oiseaux noirs, par le silence ouaté et la solitude.Ce chêne, encadré par la fenêtre (je l’appelle mon chêne, bien qu’il ne m’appartienne pas), provoque souvent mon émerveillement. S’il est assez parfait (sa ramure arrondie, son tronc bien droit, sa taille vénérable), il a pourtant, dans les campagnes, des semblables par milliers. Mais sa position isolée dans un vaste champ, outre qu’elle lui confère une sorte de majesté, le désigne à mon attention qui lui fait rendre sa dimension merveilleuse : la beauté secrète du chêne apparaît sous mon regard assidu.Depuis que j’ai acquis un téléphone qui me le permet, je photographie le chêne chaque fois que se produit une variation (oiseau, renard, lumière, nuages, ombre). Si elle en vaut la peine, j’envoie la photo à des destinataires choisis selon mon cœur. Car l’émerveillement, rarement silencieux, aime à se dire, comme s’il s’agissait de remplir l’écart entre le spectacle et mon œil, ou parce que, animaux bavards, nous réagissons toujours ainsi à la commotion de la joie – par un faire-part.Le sentiment que j’aimerais ici décrire n’est qu’un aspect du vaste espace couvert par la notion d’émerveillement. Je pourrais le dire modeste, non parce qu’il manquerait de puissance mais parce que les objets susceptibles de l’éveiller le sont souvent. De même que le chêne que je contemple n’est qu’un arbre, l’être que j’aime n’est qu’un homme : rien de grandiose en eux mais dans mon regard, sous mon attention, ils sont l’aimé et mon chêne. Pour quelqu’un d’autre, tel jeu de lumière sur un mur en face de sa fenêtre, les variations du couchant sur un bâtiment, le chant des oiseaux juste avant la nuit – que sais-je ? –, pour quelqu’un d’autre l’émerveillement pourra être provoqué par un spectacle, des sons ou des êtres différents de ceux qui me touchent, mais il sera voisin de celui que je veux saisir s’il est lié à un objet simple, de ceux que nous croisons chaque jour sans toujours être capables d’en percevoir la beauté.Car s’émerveiller résulte d’un mouvement intime, d’une disposition intérieure par lesquels le paysage à ma fenêtre ou l’homme devant moi deviennent des événements. L’événement survient au présent pur, dans une épiphanie. Alors je ne me projette plus dans un avenir rêvé, ni ne m’abandonne, mélancolique, à la contemplation du chimérique passé : je suis entièrement requise ici et maintenant. Savoir se rendre disponible à ces événements qui émerveillent est une voie vers le bonheur, dans la mesure où la vie heureuse est celle vécue au présent. Mais parce que nous en sommes la plupart du temps incapables, submergés par les projets, les anticipations, les choses à faire, nous devons plus d’une fois admettre, comme Pascal (quoique d’une autre manière) : « Nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. » Vivre (intensément) exige de se tenir dans le présent pur, et rien n’est moins aisé. Je le puis dans la joie de la danse, de l’étreinte, du rire et de la contemplation.Le reste du temps, je vis légèrement en avant de moi-même, ce qui exclut l’émerveillement.»Dans l’émission évoquée elle a cette belle formule : il n’y a pas plus grande urgence que de partager son émerveillement.Je ne vous ai pas encore présenté mes meilleurs vœux pour l’année 2017,Qu’elle soit remplie, pour vous, de santé, de paix intérieure et d’émerveillement.Et que collectivement apparaissent des idées nouvelles pour faire progresser le monde dans lequel nous vivons.<815> -
Jeudi 12 janvier 2017
« Non, les hommes n’ont pas toujours fait la guerre »Marylène Patou-MathisLors de l’émission <du grain à moudre : pourquoi n’aimons-nous pas la paix ? > qui ont servi directement à inspirer les deux premiers mots du jour de la semaine et indirectement celui d’hier, Hervé Gardette, le journaliste responsable de l’émission a diffusé un enregistrement d’une émission ancienne où la préhistorienne Marylène Patou-Mathis intervenait pour révéler les découvertes récentes des scientifiques sur la préhistoire concernant l’entraide et l’empathie qui existait à l’intérieur des groupes humains. Elle cite l’exemple d’un squelette dont les anthropologues ont pu déterminer qu’il s’agissait d’un homme qui était né, privé d’un bras et qui est mort vers la cinquantaine, ce qui était extrêmement âgé à cette période. Ils ont donc pu en conclure que cet homme handicapé (trouvé en Irak, vers – 45000) a pu bénéficier de l’entraide du groupe dans lequel il était né. Sinon il n’aurait pas pu vivre si longtemps. [à partir de 33:50 de cette émission]Marylène Patou-Mathis a publié en 2013, un livre chez Odile Jacob : <Préhistoire de la violence et de la guerre> où elle tente de répondre à cette question : l’Homme a-t-il toujours été violent ?L’exergue de ce mot du jour est le titre d’un article qu’elle a consacré à ce sujet : « Non, les hommes n’ont pas toujours fait la guerre »Dans ce long article que je vous invite à lire, Marylène Patou-Mathis écrit notamment :« L’image de l’homme préhistorique violent et guerrier résulte d’une construction savante élaborée par les anthropologues évolutionnistes et les préhistoriens du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Elle a été gravée dans les esprits à la faveur du présupposé selon lequel l’humanité aurait connu une évolution progressive et unilinéaire. Dès la reconnaissance des hommes préhistoriques, en 1863, on a rapproché leur physique et leurs comportements de ceux des grands singes, gorilles et chimpanzés. Pour certains savants, cet « homme tertiaire » représentait le chaînon manquant entre la « race d’homme inférieur » et le singe. Puis la théorie dite « des migrations », apparue dans les années 1880, a soutenu que la succession des cultures préhistoriques résultait du remplacement de populations installées sur un territoire par d’autres ; elle a enraciné la conviction que la guerre de conquête avait toujours existé. […]Aujourd’hui, l’hypothèse selon laquelle l’homme, parce que prédateur, descendrait de « singes tueurs » est abandonnée, de même que celle de la « horde primitive » proposée par Sigmund Freud en 1912. Défenseur de la théorie de Jean-Baptiste de Lamarck sur l’hérédité des caractères acquis, le père de la psychanalyse soutenait que, en des temps très anciens, les humains étaient organisés en une horde primitive dominée par un grand mâle tyrannique. Celui-ci s’octroyait toutes les femmes, obligeant les fils à s’en procurer à l’extérieur par le rapt. Puis, un jour, « les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le père, ce qui a mis fin à l’existence de la horde paternelle », écrit-il dans Totem et Tabou, en 1912. Freud développe également les notions de « primitif intérieur » et de « pulsion sauvage » ; les conflits internes représenteraient l’équivalent de luttes extérieures qui n’auraient jamais cessé.[…] En outre, de nombreux travaux, tant en sociologie ou en neurosciences qu’en préhistoire, mettent en évidence le fait que l’être humain serait naturellement empathique. C’est l’empathie, voire l’altruisme, qui aurait été le catalyseur de l’humanisation.[…] D’après les vestiges archéologiques, on peut raisonnablement penser qu’il n’y a pas eu durant le paléolithique de guerre au sens strict, ce qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Une faible démographie, d’abord : en Europe, on estime à quelques milliers d’individus la population durant le paléolithique supérieur. Les communautés étant dispersées sur de vastes territoires, la probabilité qu’elles se soient affrontées est faible, d’autant qu’une bonne entente entre ces petits groupes d’au maximum cinquante personnes était indispensable pour assurer la reproduction.[…] au cours du néolithique, le besoin de nouvelles terres à cultiver entraînera des conflits entre les premières communautés d’agropasteurs, et peut-être entre elles et les derniers chasseurs-cueilleurs, en particulier lors de l’arrivée en Europe de nouveaux migrants, entre 5 200 et 4 400 ans av. J.-C. (à Herxheim, en Allemagne, par exemple). Une crise profonde semble marquer cette période, comme en témoigne aussi le nombre plus élevé de cas de sacrifices humains et de cannibalisme.[…]Ce n’est qu’au cours de la mutation socio-économique du néolithique qu’émergent en Europe les figures du chef et du guerrier, avec un traitement différencié des individus dans les sépultures et dans l’art. L’utilisation de l’arc se généralise ; pour certains préhistoriens, cette arme utilisée pour la chasse aurait joué un rôle dans l’augmentation des conflits, comme semblent l’attester les peintures rupestres du Levant espagnol.Le développement de l’agriculture et de l’élevage est probablement à l’origine de la division sociale du travail et de l’apparition d’une élite, avec ses intérêts et ses rivalités. »J’en arrive à la conclusion :« la « sauvagerie » des préhistoriques ne serait qu’un mythe forgé au cours de la seconde moitié du XIXe siècle pour renforcer le concept de « civilisation » et le discours sur les progrès accomplis depuis les origines. A la vision misérabiliste des « aubes cruelles » succède aujourd’hui — en particulier avec le développement du relativisme culturel — celle, tout aussi mythique, d’un « âge d’or ». La réalité de la vie de nos ancêtres se situe probablement quelque part entre les deux. Comme le montrent les données archéologiques, la compassion et l’entraide, ainsi que la coopération et la solidarité, plus que la compétition et l’agressivité, ont probablement été des facteurs-clés dans la réussite évolutive de notre espèce. »Je vous renvoie vers l’article complet : « Non, les hommes n’ont pas toujours fait la guerre »J’avais déjà évoqué Marylène Patou-Mathis lors du mot du jour du 6 juin 2016, dans la série de mots consacrée au livre « Sapiens : Une brève histoire de l’humanité »<814> -
Mercredi 11 janvier 2017
« Ignace Philippe Semmelweis »Médecin obstétricien hongrois qui œuvra pour l’hygiène dans un grand climat d’hostilité (1818-1865)Hier si j’ai écrit cette phrase « Au début, quand les premiers esprits éclairés ont voulu enseigner l’hygiène, on les a pris au mieux pour des rêveurs, au pire pour des fous. », c’est parce que dans une conférence consacrée aux inventeurs et aux découvreurs, Michel Serres m’a fait découvrir le médecin Semmelweis et son destin tragique.Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce médecin hongrois du XIXème siècle, né à Buda une des parties de Budapest le 1er juillet 1818.Je tire la suite de son histoire de Wikipedia :Au milieu du XIXème siècle il devint responsable d’une maternité de Vienne. Le problème le plus pressant qui se pose à lui est le taux de 13 % de mortalité maternelle et néonatale due à la fièvre puerpérale. En avril 1847, ce taux atteignit 18 %. Le fait est connu, et bien des femmes préfèrent accoucher dans la rue plutôt qu’à l’hôpital.Curieusement, un autre service, a, pour la même maladie, un taux de mortalité de 3 % seulement, alors que ces deux services sont situés dans le même hôpital et emploient les mêmes techniques. Le recrutement des soignants en est a priori identique. La seule différence est le personnel qui y travaille : le premier sert à l’instruction des étudiants en médecine, tandis que le second a été choisi, en 1839, pour la formation des sages-femmes. Le premier pratique des autopsies sur des cadavres, le second non.Semmelweis émet plusieurs hypothèses, successivement réfutées par ses observations et ses expériences. Et c’est en 1847, que la mort de son ami Jakob Kolletschka, professeur d’anatomie, lui ouvre enfin les yeux : Kolletschka meurt d’une infection après s’être blessé accidentellement au doigt avec un scalpel, au cours de la dissection d’un cadavre. Sa propre autopsie révèle une pathologie identique à celle des femmes mortes de la fièvre puerpérale. Semmelweis voit immédiatement le rapport entre la contamination par les cadavres et la fièvre puerpérale, et il étudie de façon détaillée les statistiques de mortalité dans les deux cliniques obstétriques. Il en conclut que c’étaient lui et les étudiants qui, depuis la salle d’autopsie, apportent sur leurs mains les particules de contamination aux patientes qu’ils soignent dans la première clinique. À l’époque, la théorie des maladies microbiennes n’a pas encore été formulée, c’est pourquoi Semmelweiss conclut que c’est une substance cadavérique inconnue qui provoque la fièvre puerpérale. Il prescrit alors, en mai 1847, l’emploi d’une solution d’hypochlorite de calcium pour le lavage des mains entre le travail d’autopsie et l’examen des patientes ; le taux de mortalité chute de 12 % à 2,4 %, résultat comparable à celui de la deuxième clinique.Il demande que ce lavage à l’hypochlorite soit étendu à l’ensemble des examens qui mettent les médecins en contact avec de la matière organique en décomposition. Le taux de mortalité chute alors encore, pour atteindre 1,3 %.Mais il y eut rejet par l’institution médicale des thèses de Semmelweis.Pour ne pas succomber aux critiques de mots du jour trop long je vous invite, si cela vous intéresse à continuer la lecture sur Wikipedia.Toujours est-il que Semmelweis fut rejeté, humilié, non reconnu et il devint fou. Il fut interné dans un asile privé de Vienne où il fut victime de mauvais traitements du personnel de l’asile au point de se faire battre par le personnel de l’asile et mourir de ses blessures quinze jours plus tard.Par la suite, d’autres médecins reprirent les thèses de Semmelweis, les approfondirent et imposèrent l’hygiène médicale que Semmelweis avait découvert.Je reprendrais le mot de Shopenhauer : «Chaque nouvelle idée passe d’abord par être ignorée, puis ridiculisée avant de devenir évidente »…Ignace Philippe Semmelweismort le 13 août 1865 (à 47 ans)Mon ami Fabien m’a rappelé que Louis Ferdinand Céline a réalisé sa thèse de médecine en 1924 précisément sur <La Vie et l’Œuvre de Philippe Ignace Semmelweis>À la suite du succès littéraire de ses deux premiers romans, Céline la publia, sous le titre de <Semmelweis>, dans une version à peine corrigée en 1936 ; elle fut rééditée plusieurs fois. -
Mardi 10 janvier 2017
« La paix ça s’apprend »David Van ReybrouckJ’évoquais, hier, le second invité de l’émission <du grain à moudre : pourquoi n’aimons-nous pas la paix ? > : David Van Reybrouck.
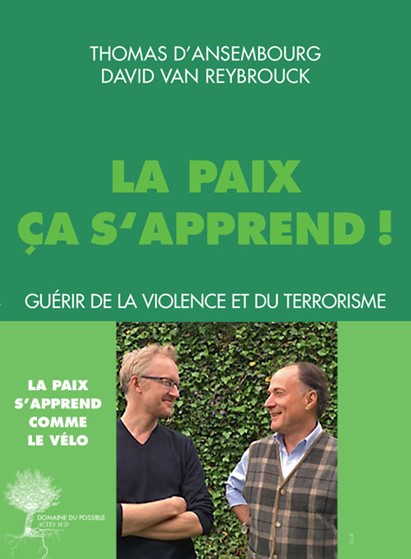 David Van Reybrouck est un auteur belge archéologue et philosophe qui s’est associé à un psychothérapeute spécialisé dans la communication non-violente : Thomas d’Ansembourg pour écrire un petit ouvrage de 96 pages : « La paix ça s’apprend : comment guérir de la violence et du terrorisme » paru à Actes Sud, en novembre 2016.
David Van Reybrouck est un auteur belge archéologue et philosophe qui s’est associé à un psychothérapeute spécialisé dans la communication non-violente : Thomas d’Ansembourg pour écrire un petit ouvrage de 96 pages : « La paix ça s’apprend : comment guérir de la violence et du terrorisme » paru à Actes Sud, en novembre 2016.
David Van Reybrouck compare la paix avec la santé en disant que celui qui est en bonne santé l’exprime rarement.
On parle de santé quand on est malade et il a cette expression : « la santé c’est le souvenir d’un malade » et il exprime la même chose pour la paix : « on ne se rend pas compte quand on est en paix, c’est banal presque un peu trivial, la paix c’est le souvenir de quelqu’un qui est en guerre »
Et il a ce constat qu’il existe des écoles de guerre où on apprend à faire la guerre, à tuer.
Ces écoles sont subventionnées par l’Etat et payées par nos impôts.
Mais il n’existe pas d’écoles de la paix, où on enseignerait la paix, l’empathie, la pleine conscience. Car selon lui avant de vouloir créer la paix à l’extérieur, il faut d’abord pacifier l’individu, la paix commence à l’intérieur de l’individu.
Or, selon lui, on peut enseigner la paix et il exprime ce curieux parallèle avec l’hygiène.
Au début, quand les premiers esprits éclairés ont voulu enseigner l’hygiène, on les a pris au mieux pour des rêveurs, au pire pour des fous.
Mais peu à peu, on a enseigné l’hygiène puis on l’a imposé.
Et l’Humanité grâce à cette prise de conscience et à l’enseignement de cette exigence a fait un remarquable bond en avant. En dehors de tout délire quantophrénique, la réalité lourde de la démographie nous le révèle : l’espérance de vie a explosé et l’hygiène plus que les progrès de la médecine a joué le rôle premier.
Et j’ai trouvé un article dans un journal belge où Van Reybrouk complète les propos tenus lors de l’émission précitée : http://www.alterechos.be/fil-infos/david-van-reybrouck-la-paix-mentale-contribue-a-la-paix-sociale/
J’en tire quelques extraits :
« […] Face au déferlement d’actes guerriers et barbares, appeler la paix de ses voeux ne suffit pas, il faut l’apprendre, la construire à l’intérieur de nous-mêmes et dans nos structures sociales. […]
Mais parler de la paix n’est pas si simple… On n’utilise plus jamais le mot « paix », c’est une notion qui semble gênante, et encore plus en néerlandais: «vrede».
Ça fait catho ou John Lennon. Pour nous, c’était une réponse évidente au lendemain des attentats. La violence est partout et la meilleure façon de pacifier une société est la démocratie. La meilleure façon de pacifier l’individu, c’est de lui accorder des moments de silence et de contemplation, choses qu’on a oubliées ou perdues depuis plusieurs décennies.
[…] Nous sommes convaincus qu’une partie de la paix sociale repose sur la paix mentale. C’est ça l’équilibre entre mon approche politique et l’approche psychologique de Thomas.
[…] Je vois mal comment on peut rendre une société plus pacifiste, moins violente, moins agressive, moins raciste si on ne travaille que sur les structures sociétales. Il faut aussi travailler sur l’individu. Je ne dis pas qu’il suffit que les jeunes radicalisés de Molenbeek méditent quelques minutes par jour. Ce serait de la fausse conscience. Mais je ne vois pas non plus comment régler le défi majeur de la radicalisation si on limite l’action à des mesures sécuritaires, militaire, juridiques et politiques. Et même si on lutte contre la discrimination au niveau du marché du travail, de l’éducation ou du logement, je ne pense pas que cela débouchera sur une paix sociétale durable. Il faut en fait travailler sur l’extérieur et sur l’intérieur. Le livre est un plaidoyer pour une double action : sur les injustices sociales et sur la pacification de l’individu. […]
C’est une question de recherche scientifique. Il y a une centaine d’années, la gymnastique était intégrée dans le cursus scolaire. Pour l’époque, cela paraissait très insolite dans un contexte où les enfants devaient être sages. Mais les recherches scientifiques de l’époque – fin XIX ème début XXème – ont montré que c’était important d’avoir des exercices physiques pour le développement du corps, de l’esprit et des mœurs de l’enfant… C’était devenu une chose normale et évidente. On peut parler du sport mais aussi du brossage des dents, exemple qu’on donne dans nos livres. Grâce aux études sur l’hygiène buccale ont montré la nécessité de se brosser les dents et la pratique est rentrée dans les mœurs, y compris dans des endroits où ça n’était pas du tout gagné comme dans la campagne profonde d’où provient Thomas.
Je prends ces exemples pour montrer qu’aujourd’hui, de multiples recherches démontrent qu’il est possible d’apporter de la santé physique et mentale à un enfant en lui permettant de respirer dix minutes par jour calmement. On voit que l’apprentissage de la communication non violente stimule beaucoup d’empathie vis-à-vis des autres enfants, que cela leur apprend à gérer les conflits, à vivre avec, avant qu’ils ne deviennent de vraies bagarres.
C’est l’essence de la démocratie. Il faut insuffler ce goût pour l’exercice psychique dès la maternelle. »
Et quand le journaliste l’interpelle :
« Vous comprenez qu’on peut vous prendre pour des «bisounours» pour reprendre vos mots, ou en tout cas que vous pouvez susciter le scepticisme …»
Il en appelle à Schopenhauer :
« Chaque nouvelle idée passe d’abord par être ignorée, puis ridiculisée avant de devenir évidente »…
Et pour compléter le propos de Van Reybrouck, vous pourrez lire un texte d’Edgar Morin publié dans le Monde le 5 février 2016 : « Éduquer à la paix pour résister à l’esprit de guerre » qu’il conclut ainsi :
« C’est ici qu’un humanisme régénéré pourrait apporter la prise de conscience de la communauté de destin qui unit en fait tous les humains, le sentiment d’appartenance à notre patrie terrestre, le sentiment d’appartenance à l’aventure extraordinaire et incertaine de l’humanité, avec ses chances et ses périls.
C’est ici que l’on peut révéler ce que chacun porte en lui-même, mais occulté par la superficialité de notre civilisation présente : que l’on peut avoir foi en l’amour et en la fraternité, qui sont nos besoins profonds, que cette foi est exaltante, qu’elle permet d’affronter les incertitudes et refouler les angoisses. »
<812>
-
Lundi 9 janvier 2017
« La paix »Jean-Claude CarrièreEn début d’année, les vœux que les humains échangent comprennent souvent le souhait de la paix.
Nous ne vivons pas la période la plus conflictuelle de l’histoire d’homo sapiens mais les médias rapprochent de nous tous les théâtres de conflits du monde et nous montrent des images insoutenables de guerre.
La menace terroriste, faible cependant au regard de tous les autres dangers qui peuvent nous faire mourir comme la voiture ou le tabac, nous entraîne aussi vers un désir de paix.
« La paix » est un ouvrage de Jean-Claude Carrière, le scénariste de Luis Bunuel, l’inoubliable collaborateur de Peter Brook pour le <Le Mahabharata>, l’auteur de <la controverse de Valladolid> et de tant d’autres œuvres érudites et passionnantes.
Pour parler de son livre, il était l’invité de l’émission <du grain à moudre : pourquoi n’aimons-nous pas la paix ? >
Jean Claude Carrière qui dit :
« On n’écrit jamais sur la paix comme s ‘il n’y avait rien à en dire, tandis que les ouvrages sur la guerre fleurissent de tout côté. Non seulement les ouvrages sur la guerre, mais les éloges de la guerre. Il y a deux chapitres dans mon ouvrage dans lesquels j’ai rassemblé des textes d’auteurs parfois très connus de Joseph de Maistre à Maurice Barrès, à Proudhon qui ont chanté l’aspect sublime de la guerre, l’aspect divin de la guerre d’une manière presque incroyable. Comme si la guerre était la plus belle et la plus souhaitable des activités humaines
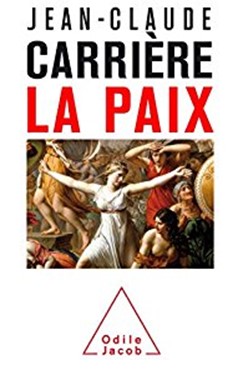 et comme si mourir à la guerre était le sort le plus beau. »
et comme si mourir à la guerre était le sort le plus beau. »
La Paix est d’ailleurs difficilement définissable, souvent on la décrit comme une période entre deux guerres. On la définit toujours de manière négative : « absence de perturbation, de trouble, de guerre et de conflit. »
Jean Claude Carrière est d’ailleurs optimiste :
« Ma génération a entendu pendant longtemps dire que toute paix était impossible en Irlande entre les protestants et les catholiques, or cette paix s’est établie et apparemment elle dure depuis plusieurs décennies […] Quand on dit que le conflit entre palestinien et israélien est insoluble, Non ! Certainement il y a une solution, il y a une possibilité pour les hommes de vivre ensemble.
Hitler disait : L’Allemagne a besoin d’une bonne guerre tous les 12 ou 15 ans. Or l’Allemagne est en paix depuis 70 ans, elle ne s’en porte pas plus mal, bien au contraire !
La paix n’est pas quelque chose d’impossible à atteindre. »
Et puis il évoque l’Histoire et porte un regard décalé sur la fin de l’empire romain, en évoquant la « Pax romana »
« L’empereur qui est mon favori est Antonin le Pieux qui a régné 25 ans au deuxième siècle de notre ère, à l’apogée de l’Empire romain. Il n’a pas connu une seule révolte dans un Empire qui allait de l’Ecosse à la Jordanie, Pourquoi ? […]
L’empire romain, à cette époque, accepte toutes les religions, toutes les croyances, toutes les manières de vivre à condition d’accepter les Lois de Rome.
Il y a même un temple à Rome « Au dieu inconnu » pour tous les dieux qui auraient été oubliés.
Quand un siècle plus tard, l’empereur Théodose édicte que toute la population de l’empire romain doit être chrétienne, sous peine de mort, quelques décennies plus tard l’empire romain est disloqué et disparaît ».
Il est vrai que l’évangile selon Matthieu (10-34) fait dire à Jésus : « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. »
L’émission de France Culture avait invité un autre auteur : David Van Reybrouck, mais j’y reviendrai demain.
La paix Odile Jacob, 2016 Jean-Claude Carrière
<811>
-
Vendredi 23 décembre 2016
« Noël »Fête chrétienne ou solaire ?Le solstice d’hiver est ce jour de l’année solaire pendant lequel la nuit est la plus longue.
Depuis 2006, le jour du solstice d’hiver a été désignée comme la journée mondiale de l’orgasme.
Le solstice d’hiver est tombé cette année, ce mercredi, le 21 décembre 2016. Il tombe, depuis la mise en place du calendrier Grégorien, à la fin du XVIème siècle, le plus souvent le 21 ou le 22 décembre.
Il est tombé un 23 décembre en 1903 et il faudra attendre le début du XXIVe siècle pour le voir se produire de nouveau à cette date. Il tombera un 20 décembre à la fin du XXIe siècle.
Sous l’empire romain, le calendrier julien permettait que le solstice d’hiver tombe le 25 décembre.
L’empereur Aurélien (270-275), au milieu des divinités multiples qu’honorait le peuple romain, a assuré une place particulière à une divinité solaire : <Sol Invictus> (latin pour « Soleil invaincu »).
Il proclame « le Soleil invaincu » patron principal de l’Empire romain et fait du 25 décembre, le jour du solstice d’hiver donc, une fête officielle appelée le « jour de naissance du Soleil » (du latin dies natalis solis invicti). Cette fête vient alors se placer au lendemain de la fin des Saturnales, une période de fête ancienne et la plus importante de Rome.
Plus anciennement le 25 décembre correspondait aussi au jour de naissance de la divinité solaire Mithra
La christianisation de l’empire romain va annexer cette fête.
Et pour ce faire, on décidera que la naissance de Jésus de Nazareth remplacera la naissance du soleil et on appellera cette fête « Noël » (du latin natalis).
La première mention de cette célébration chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à Rome en 336.
Il se passera la même évolution chez d’autres peuples. Ainsi, les peuples germaniques connaissaient aussi une fête du solstice d’hiver : <Yule> .
Suivant la même logique de syncrétisme que pour les Saturnales et le Dies Natalis Solis Invicti, Yule a été associée aux fêtes de Noël dans les pays nordiques depuis la christianisation de ces peuples.
Wikipedia nous apprend que dans la mythologie nordique, Yule est le moment de l’année où Heimdall (dieu nordique de son trône situé au pôle Nord) […] revient visiter ses enfants avec d’autres divinités.
Ils visitent ainsi chaque foyer pour récompenser ceux qui ont bien agi durant l’année, et laissent un présent dans leur chaussette.
Ceux ayant mal agi voyaient à l’aube leur chaussette emplie de cendres.
Yule est aussi une fête où les gens de leur côté, et les dieux du leur, se rencontrent pour partager un repas, raconter des histoires, festoyer et chanter.
 Si vous continuez à lire Wikipedia, dans son article Yule, vous comprendrez que les 4 bougies rouges que les allemands allument, au fur à mesure des 4 semaines de l’Avent, constitue aussi une tradition pré-christique où ce rituel célébrait la renaissance de la lumière.
Si vous continuez à lire Wikipedia, dans son article Yule, vous comprendrez que les 4 bougies rouges que les allemands allument, au fur à mesure des 4 semaines de l’Avent, constitue aussi une tradition pré-christique où ce rituel célébrait la renaissance de la lumière.
Je ne vous décris pas ce que Noël est devenu à notre époque vous le savez aussi bien que moi.
Noël avec Nouvel An constituent les fêtes de fin d’année où toute le monde prend congé, se retrouve en famille et fait la fête.
Il est donc pertinent de suspendre le mot du jour et comme je trouve efficient de commencer l’année par une semaine de congé, le prochain mot du jour sera envoyé le lundi 9 janvier.
<810>
-
Jeudi 22 décembre 2016
« La spirale du déclassement »Louis ChauvelLouis Chauvel est un sociologue français qui étudie l’évolution de la stratification sociale en analysant les inégalités de génération et les classes sociales en France ainsi que les changements de l’État-providenceIl avait écrit deux livres remarqués :<Le Destin des générations. Structure sociale et cohortes en France au XXe siècle>(2002 republié en 2010) et <Les Classes moyennes à la dérive> (2006)Il a publié un nouveau livre paru en 2016 : < La Spirale du déclassement> et dont le sous-titre est : « Essai sur la société des illusions »Avant de vous parler de ce livre et de son auteur, un petit mot d’introduction.Lundi je partageais avec vous un livre et une réflexion de Johan Norberg qui nous informait que malgré quelques difficultés, l’Humanité n’a jamais été aussi heureuse qu’aujourd’hui.Le présent mot du jour montre une autre réalité. Comment est-ce possible ? Qui de ces deux penseurs décrit la réalité ?Les deux probablement !Ils n’ont pas le même point de vue. L’un regarde le monde dans sa globalité et compare le destin de tous les humains d’aujourd’hui par rapport aux humains d’hier et d’avant-hier.Louis Chauvel regarde une toute petite partie de l’humanité, l’Europe occidentale et plus particulièrement la France.L’Europe après de terribles crises et guerres, car il faut le rappeler : jamais il n’y eut plus grands massacreurs dans l’Histoire que les européens du XXème siècle, a créé un Etat social.Une société dans laquelle le plus grand nombre pouvait compter sur la solidarité des autres membres en cas de maladie, d’handicap ou de vieillesse, où on pouvait commencer à ne plus avoir peur du lendemain.Cela n’existait pas ailleurs, en Asie, en Afrique, en Amérique du sud. Dans tous ces pays ce sont essentiellement les gens qui ont du patrimoine qui peuvent affronter des lendemains difficiles en raison de problème de santé où quand la vieillesse arrive, les autres comptent sur la solidarité familiale.L’Europe jusqu’à il y a peu a profité du reste du monde, des matières premières peu chères et le travail peu rémunéré d’autres populations qui en quelque sorte étaient au service du blanc occidental.La mondialisation, la stagnation, l’automatisation chacun pour une part heurtent le confort et la protection que la classe moyenne occidentale était arrivée à acquérir.C’est de ce confort et cette protection d’une petite partie de l’humanité, dont nous faisons partie, qu’il est question dans la description de Louis Chauvel et l’objet du déclassement dont il parle.J’ai entendu Louis Chauvel alors qu’il intervenait, sur France Culture, dans l’émission <La Grande Table du 16 décembre 2016>.Olivia Gesbert avait donné pour titre à son émission : « Le déclassement, spirale d’un déni » et a introduit l’intervention de Louis Chauvel de manière suivante :L’analyse de Louis Chauvel part d’un constat :« Le creusement des inégalités, évident si nous considérons le rôle du patrimoine, conduit une partie des classes moyennes et des générations nouvelles à suivre les classes populaires sur la pente de l’appauvrissement, entraînant une spirale générale de déclassement ». Dans cet essai, il entend prouver que le déclassement ne relève pas d’une peur irraisonnée mais d’une réalité qu’il convient de conjurer plutôt que de l’ignorer. Et que « le malaise des classes moyennes signifie plus qu’un déclin de notre modèle social. Il représente une menace pour la démocratie ».Les précédents livres de Louis Chauvel avaient suscité de vives réactions et polémiques. On l’a accusé d’être décliniste et de vouloir faire dresser les générations les unes contre les autres. Dans son dernier ouvrage, il part d’études chiffrées et détaillées pour montrer que ses analyses sur le déclassement sont confirmées par la réalité des faits. Pour lui le creusement des inégalités doit être regardé avant tout par le filtre du patrimoine plus que par celui des revenus. Dans un article joint au présent message, il conteste absolument un rapport de France Stratégie (l’ancien commissariat au Plan) qui minimise cette réalité et parle d’un sentiment plus que d’une réalité.Il exprime cette vision de la manière suivante :« Il existe un mur des réalités, la société française est en train de s’encastrer dedans à vive allure, dans une situation de choc social, particulièrement inquiétant. […] Si j’ai illustré mon livre de graphiques et de tableaux, c’est qu’il existe des choses que l’on peut démontrer. Parmi les choses qu’on peut démontrer c’est que les inégalités croissantes en France sont absolument évidentes, dès lors qu’on s’intéresse à la question du patrimoine. […] La société salariale prend l’eau. »Il parle de « Titanic social » parce qu’il existait une société « Où le patrimoine social des parents n’étaient pas nécessaire pour pouvoir se réaliser soi-même. Dans les années 70, la plupart des métiers ou des postes de la fonction publique, des cadres intermédiaires, des techniciens permettaient de se loger décemment jusque dans les années 1990. Et progressivement aujourd’hui, même un bon salaire ne suffit plus pour se loger dans une grande ville de région et a fortiori à Paris où la situation est devenue impossible. »Il ajoute au creusement des inégalités du patrimoine, un problème plus spécifique à la France qu’il désigne par la démonétisation des diplômes. Les dirigeants politiques ont voulu augmenter massivement la part d’une classe d’âge accédant aux diplômes avec la promesse d’emplois plus valorisant et mieux rémunérés. C’est le contraire qui est advenu.Dans son analyse il y a deux phénomènes qui se conjuguent d’une part le creusement des inégalités de classe d’autre part la fracture entre les générations, dans le cadre d’une économie stagnante ou en très faible croissance. Cette situation pourrait entraîner un glissement de tout notre édifice social vers le déclassement global et systémique, qui risque d’emporter avec lui l’idée même de progrès économique et social. En particulier pour les jeunes générations :« la baisse du niveau de vie, le rendement décroissant des diplômes, la mobilité descendante, le déclassement résidentiel et l’aliénation politique dont la jeunesse en France est victime s’accentuent de génération en génération au point d’atteindre le stade de leur irréversibilité ».La protection devant les risques économiques et de santé du plus grand nombre, permise par l’Etat providence, n’existait vraiment que dans nos démocraties occidentales et encore spécifiquement en Europe. Ailleurs, seul le patrimoine privé permettait de se prémunir devant les aléas de la vie. C’est cette inégalité qui peu à peu revient dans nos pays.J’en tire les extraits suivants : « la situation nouvelle n’est pas l’inégalité mais le passage d’un régime d’inégalités modérées à la situation qui prévalait précédemment : celle d’écarts extrêmes entre ceux qui ont et les autres ». […]Louis Chauvel énonce alors le triste constat que la formation de la classe moyenne, qui devait s’accompagner d’une mobilité ascendante généralisée, avec un effet d’entraînement et d’upgrading, évolue plutôt vers un effet de ruissellement vers le bas (trickle down) […] La période de l’après guerre avait vu la possibilité pour les membres de la classe moyenne ne disposant que de leur salaire de pouvoir épargner et se constituer un patrimoine : or avec le ralentissement économique, la fragmentation du salariat (avec un « noyau d’exclusion » et un « précariat ») et la stagnation salariale, on assiste plutôt aujourd’hui à une reconstitution des modèles dynastiques, où l’héritage et la transmission du patrimoine familial sont déterminants, face aux espoirs déçus de la mobilité sociale ascendante pour les jeunes générations.Louis Chauvel décrit ainsi ce qu’il appelle les sept piliers de la civilisation de la classe moyenne :1 une société fondée sur le salariat ;2 une société où le salaire est suffisant pour mener une vie confortable ;3 une large protection sociale dont les droits sont ouverts par la participation au salariat ;4 une démocratisation scolaire ;5 une croyance dans le progrès social, scientifique et humain ;6 un contrôle de la sphère politique par les catégories intermédiaires de la société (syndicats, mouvements sociaux) et non seulement par l’élite sociale ;7 Une démocratie sociale avec la promotion d’objectifs politiques..Or tous ces piliers qui ont porté le progrès économique et social et son partage équitable se sont grandement fragilisés à partir des années 1970. Nos sociétés, basées sur l’idéal des opportunités ouvertes à tous et sur la méritocratie, font en effet face aujourd’hui à un puissant mouvement de reproduction intergénérationnel des inégalités et de régression sociale. Et selon Louis Chauvel, loin des espoirs de la modernité, « ce mouvement « nous entraînerait dans un monde où la méritocratie serait progressivement remplacée par la loterie de la naissance dans une famille riche ou pauvre ».[…]Louis Chauvel évoque également, comme « aliénation politique » l’absence des jeunes générations du jeu politique institutionnel traditionnel, malgré Internet et les réseaux sociaux, d’autant que les réformes (ou leur absence) sont pensées par des élites vieillissantes qui n’auront guère à assumer les conséquences à long terme de leurs choix. La société française marche alors lentement mais surement vers ce que l’auteur appelle « le grand déclassement » :« un déclassement systémique où les inégalités générationnelles interagissent avec les inégalités de classes sociales (réelles et structurantes), pour générer des tensions de plus en plus fortes entre les groupes sociaux au sein des nations et fragiliser la cohésion sociale. Un phénomène encore aggravé par les forces de la mondialisation de l’économie qui mettent en concurrence les catégories déclassées des pays avancés, avec à la clé un appauvrissement des revenus inférieurs. […] Ces évolutions, où les catégories populaires ne peuvent espérer une progression de leurs niveaux de vie et l’accession à des biens et services de luxe réservés à une fraction de la classe moyenne supérieure, se doublent d’un affaiblissement des identités collectives et d’une crainte de la concurrence des catégories les plus défavorisées, parmi lesquelles les populations immigrées »Pour Chauvel Il est urgent […] de réfléchir et engager une réflexion sur la soutenabilité intergénérationnelle de nos politiques, au nom d’un principe de responsabilité, afin de ne pas léguer aux générations futures un monde social invivable, mais au contraire donner aux jeunes les moyens de leur autonomie : « c’est bien toute la limite de nos démocraties : les générations futures ne votent pas, alors qu’elles jouent leur avenir ».La grande question en France, selon lui, est celle de l’investissement. Sinon on ne préparera pas les emplois de demain pour les générations futures. Dans l’émission de France Culture il estime que les hommes politiques français qui gouvernent sont dans le déni et dans un optimisme irréel.Vous pourrez aussi lire cet article de Slate sur le livre de Louis Chauvel : -
Mercredi 21 décembre 2016
«La Démesure»Céline RaphaelD’abord, il y a ce témoignage bouleversant de Céline Raphaël en 7 minutes : http://www.dailymotion.com/video/x541m2c_celine-raphael-l-enfer-d-une-enfant_newsElle était une enfant née dans un milieu très favorisé, son père était Directeur industriel.Elle avait quelques talents dans la pratique du piano et un père que l’ambition, le goût de la compétition ont rendu totalement fou.Elle raconte comment son père avait établi un protocole de «dressage» où chaque fausse note entrainait des coups de ceinture dans un rituel sadique. Cette horreur a commencé à l’âge de 5 ans pour Céline.A cette violence brute s’ajoutait d’autres sévices comme la privation de nourriture et une terreur psychique.Dans ce témoignage elle dit : «si je dois résumer mon enfance, c’était une terreur, une peur panique de mourir seule»Le père voulait qu’elle remporte des grandes compétitions internationales et que sa fille devienne une des pianistes les plus renommées du monde, pour sa gloire !Daniel Barenboïm a cette formule : «Un enfant surdoué, est un enfant qui a quelques talents et des parents très ambitieux»Céline Raphaël s’en est sorti parce qu’elle a croisé une infirmière scolaire et aussi une enseignante qui a été interpellée par cette phrase que Céline Raphaël avait écrite sur la fiche de présentation du début de l’année scolaire : «Je fais 45 heures de piano par semaine». L’infirmière, madame Marion, a su peu à peu gagner la confiance de l’enfant apeuré. Elle a fugué et s’est réfugiée sous la protection de cette infirmière. Son père a été arrêté et condamné et Céline a été placée. Cette terrible histoire a duré 9 ans de 5 ans à 14 ans.Pendant toutes ces années la petite Céline s’est accrochée à son rêve à elle qui n’était pas de devenir musicienne mais de devenir médecin.Elle l’est devenue et elle est désormais médecin de la douleur et des soins palliatifs dans un grand hôpital parisien. « J’ai choisi cette spécialité car en matière de douleur, j’en connais un rayon, explique-t-elle en souriant. Je me suis dit que je pourrais peut-être mieux comprendre mes malades, et les aider. C’était très prétentieux de ma part. »Elle mène aussi un combat pour la protection de l’enfance maltraitée. Elle avoue qu’elle n’a plus le goût de jouer du piano, sauf à de rares occasions pour apaiser les malades dont elle s’occupe.Elle dit « Je n’y trouve aucun plaisir, mais j’ai compris que la musique peut aider les autres »<La démesure, soumise à la violence d’un père> est le titre du livre que Céline Raphaël a écrit pour témoigner de son parcours de vie.Je vous donne des liens vers trois articles où elle livre son histoire ou parle de son livre :Bien sûr son père était fou mais …Céline explique que son dernier professeur de piano a vu des hématomes un jour sur mon bras. Il savait combien mon père était dur. Il a dit «on a rien sans rien».Dans l’esprit de ce professeur le père n’était pas fou, juste un peu excessif peut être.La compétition, la recherche de la perfection dans la musique mais aussi dans le sport, je pense à la gymnastique par exemple peut rendre fou. Accroc aux drogues, aux produits dopants et à ce type de violence particulièrement vers des enfants.Maria Callas fut aussi maltraitée par sa mère pendant ses jeunes années d’apprentissage.C’est pourquoi l’esprit de compétition, comme beaucoup d’autres choses doit connaître des limites, des régulations. Il n’est pas bon, pas sain d’en appeler à l’esprit de compétition jusqu’à l’excès.Parallèlement l’enfance maltraitée existe dans tous les milieux et heureusement qu’il existe aussi des personnes comme Madame Marion qui prennent l’enfant par la main pour lui permettre d’échapper à l’enfer de la violence. -
Mardi 20 décembre 2016
« L’aliénation se définit par le fait d’être en vérité possédé par l’objet que l’on croit posséder».Pierre Zaoui, dans l’hebdomadaire « Le Un » N°134 du 14 décembre 2016 « Jamais sans mon smartphone »Je vous avais déjà parlé, lors du mot du jour du 23 juin 2016, de l’hebdomadaire dirigé par Eric Fottorino « Le Un » qui chaque semaine ne traite qu’un seul sujet sur une seule feuille pliée 3 fois.Le dernier numéro a pour titre : « Jamais sans mon smartphone »Et c’est Frédéric Pommier qui lors de sa revue de presse du week end relate sa lectureLa « chronique [est] signée Robert Solé dans l’hebdomadaire LE UN. Nous sommes en 2040, et quel est donc le principal souci des autorités ?C’est la dépendance au smartphone. Toutes les enquêtes l’ont confirmé : l’utilisation compulsive de cet appareil porte atteinte à la santé des individus. C’est même devenu l’une des premières causes de mortalité prématurées. Une taxe anti-dépendance a été mise en place. Taxe augmentée à trois reprises. Mais sans réussir à faire baisser les ventes. Pas plus de succès pour le patch anti-smartphone proposé dans les pharmacies. Quant au ‘smartophage’, machine de substitution disposant d’un clavier mais ne permettant pas d’appeler, il ne fut adopté que par une minorité de consommateurs. Nous sommes en 2040, et les campagnes de sensibilisation n’ont eu aucun effet. « Puisqu’il est établi que le smartphone tue, je l’interdirai », avait promis un candidat à l’élection présidentielle de 2037. Mais ce propos extrémiste avait beaucoup choqué, y compris dans son propre camp.Il s’agit donc d’une chronique d’anticipation, dans un numéro entièrement consacré à cette addiction qui touche de plus en plus de monde : […]Témoignage d’une enseignante d’un collège d’Aubervilliers : elle décrit des élèves totalement accros.« Lorsqu’il arrive que je confisque un portable, l’enfant martyr est prêt à tous les compromis »« Punitions, heures de colles, ce que vous voulez madame, mais pas mon téléphone, parce que sans, je vais faire comment ? » Sous-entendu : comment se réveiller sans son alarme préprogrammée, comment s’habiller sans avoir préalablement consulté une appli météo, comment marcher jusqu’au collège sans sa playlist musicale dans les oreilles, comment apprécier les moments entre copains sans les prendre en photo ? « Madame, je vous jure, mon portable, c’est ma vie ! » »Il cite aussi le philosophe Pierre Zaoui :« l’aliénation se définit par le fait d’être en vérité possédé par l’objet que l’on croit posséder ». Or, poursuit-il, « Il est assez facile de remarquer si l’on devient dépendant de son téléphone : quand on commence à le manipuler sans savoir d’avance à quelle fin spécifique l’utiliser, ou bien quand on commence à le consulter en plein repas de famille, alors même que quelqu’un est en train de nous parler… » Et l’on oublie souvent qu’il existe une petite touche sur laquelle il est facile d’appuyer : la touche où il est écrit ‘off’. »L’an dernier, en France, 20 millions de smartphones ont été vendus, et chacun consulte le sien en moyenne 200 fois par jour.« On peut déclarer sa flamme par SMS, rompre par SMS, ou licencier un salarié, et peut-être, bientôt voter. Jean Viard, le sociologue plusieurs fois cité dans des mots du jour, voit dans le smartphone l’objet culte de notre époque. Un objet qui, du reste, est également une arme. « Un instrument au service des actions terroristes, et un outil nouveau pour faire la guerre quand, à Alep ou Mossoul, les soldats communiquent avec les survivants cachés dans les ruines. Et puis, à l’arrivée de chaque groupe de prisonniers, on vérifie les derniers appels pour savoir de quel camp ils sont. Il ne faut jamais oublier, conclue-t-il, que le smartphone a une mémoire infaillible. » Passionnant dossier, et c’est donc à lire dans LE UN. »Je sais que parmi les destinataires de ce mot il y a de vrais résistants au smartphone. Des esprits libres, forts et indépendants !Mais pour les autres, estimez-vous consulter votre smartphone 200 fois par jour ?Et si vous croyez que c’est possible, pensez-vous qu’il y a un problème ? -
Lundi 19 décembre 2016
«Ten Reasons to Look Forward to the Future
Progrès : dix raisons de se réjouir de l’avenir»Johan NorbergLes troupes iraniennes et du hezbollah libanais, aidé par l’aviation russe et des débris de l’armée de Bachar el-Assad ont repris le contrôle d’Alep dans les ruines et le sang.Les troupes de « nos amis saoudiens » perpètrent des massacres identiques au Yemen.Il y a d’autres régions du globe : au Sud Soudan, en Somalie, en Erythrée où la violence et les massacres se multiplient.Et aux Etats-Unis… Bien que Hillary Clinton ait reçu 2,7 millions de vois populaires supplémentaires, Donald Trump s’apprête à devenir Président des Etats Unis, entourés de milliardaires, de militaires qui ont pour titre de gloire « le général enragé » ou d’avoir été responsable de la prison de Guantánamo . On y trouve des climato-sceptiques, un patron hostile aux salariés comme secrétaire au travail , des banquiers de Goldman Sachs et non pas un lobbyiste de l’industrie pétrolière mais mieux le patron d’une des plus grandes sociétés pétrolières.Pour ceux qui espéraient que les nominations de Trump apaiseraient les craintes qu’entrainaient son élection, ils ne peuvent être que déçus, c’est le contraire qui est vrai !Alors il faut savoir singulièrement changer son angle d’observation pour suivre le suédois Johan Norberg qui dit à peu près : que nous n’avons jamais vécu à un moment plus heureux de l’Humanité.C’est l’Hebdomadaire « Le Point » du 03/11/2016 qui en parle et qui affichait en couverture : « Non tout n’était pas mieux avant ».Pourquoi toujours envisager le pire ? Max Roser, économiste à Oxford, accuse les médias, plus prompts à évoquer la dernière catastrophe qu’à rappeler que l’espérance de vie a augmenté deux fois plus en un siècle qu’elle ne l’avait fait en 200 000 ans. Mais, au-delà de l’information en continu, le pessimisme occidental a des fondements plus profonds.Selon l’institut de sondages Gallup, le Vietnam et le Nigeria sont les champions de l’optimisme, tandis que la France est l’un des pays les plus dépressifs du monde. Serait-ce parce que le progrès, enfant des Lumières, a été abandonné par une partie de notre classe politique ? La gauche ne promeut plus que le progrès sociétal, défendant le statu quo économique face à la mondialisation.Les écologistes nous préparent aux fléaux eschatologiques. À droite, conservateurs et réactionnaires veulent des barrières contre la déculturation et les migrants. Seuls les libéraux et quelques réformistes osent encore invoquer « l’idée de progrès » qui, comme le rappelle le physicien Étienne Klein, « l’idée de progrès » a pour anagramme « le degré d’espoir ».Sur le plan éditorial également, le marché de la catastrophe est porteur :, déclin de l’Occident, invasions barbares, et maintenant « Far West technologique » (Bernard Stiegler). Mais, sur la longue durée, les prophètes de l’apocalypse risquent surtout le ridicule. En 1968, Paul R. Ehrlich annonçait, dans La bombe P (2 millions d’exemplaires vendus), que des « centaines de millions de personnes allaient mourir de faim ». Et en 1972, le Club de Rome avertissait d’une pénurie de cuivre en… 2008.Pourtant, les bonnes nouvelles sont là. L’époustouflant The Better Angels of Our Nature (2011), de Steven Pinker, attend toujours un éditeur français. Ce professeur de psychologie à Harvard y a regroupé les statistiques sur les génocides, les guerres, les homicides ou les violences domestiques. Sa conclusion : grâce à la raison, à la mondialisation ou à la féminisation, la violence n’a cessé de baisser au cours de l’Histoire.Angus Deaton, lui, a dû attendre de recevoir un prix Nobel d’économie en 2015 pour voir publier chez nous La grande évasion (PUF). À base de données économiques, médicales et démographiques, il y raconte la formidable quête de liberté de l’humanité pour sortir de la pauvreté, de la maladie et des oppressions. Deaton ne cache rien des inégalités, mais, optimiste tempéré, il montre que plutôt que la bonne conscience, c’est la diffusion des idées et l’innovation qui prolongeront cette extraordinaire amélioration de nos vies.Mais c’est de Suède que nous vient le livre le plus revigorant de l’année. Dans Progress : Ten Reasons to Look Forward to theFuture (Progrès : dix raisons de se réjouir de l’avenir), l’historien de l’économie Johan Norberg étend le travail de Pinker à tous les domaines de la vie. À travers une cascade de chiffres et d’anecdotes, ce libéral montre que l’humanité n’a jamais été plus riche, en bonne santé, libre, tolérante et éduquée. Oubliez le Prozac, savourez donc ces quelques évolutions.En 1990, il y avait 76 démocraties électorales, contre 125 en 2015. En 1950, plus d’un quart des enfants de 10 à 14 ans étaient économiquement actifs. Aujourd’hui, c’est moins de 10 %.Même en matière d’environnement, Norberg rappelle ce que la prise de conscience nous a déjà fait accomplir : l’air d’une métropole comme Londres est aussi propre qu’au début de la révolution industrielle et, loin des idées reçues, les forêts s’étendent en Europe.En attendant qu’un éditeur français suffisamment téméraire ose traduire ces bonnes nouvelles, Le Point est allé à la rencontre de cet optimiste scandinave pour ouvrir le débat : y a-t-il déjà eu une meilleure année que 2016 ?Johan Norberg accepte de reconnaître que l’air du temps est froid :« Je sais que l’époque a l’air horrible, mais cela a toujours été le cas quand vous regardez les problèmes dans le monde. Il y a cinquante ans, c’était le risque d’un désastre nucléaire imminent, les usines japonaises menaçant les nôtres, un niveau de crime élevé dans les villes… Le rôle des médias est d’en parler et de nous effrayer un peu. »Mais si on prend le recul qu’il nous invite à prendre et à se placer dans une perspective historique plus longue et confronter la réalité d’aujourd’hui à celle d’hier le constat est fort différent.Certains indicateurs baissent un peu et il y a de nouveaux risques. Le progrès n’a rien d’automatique. Le réchauffement climatique est un problème récent. L’essor du terrorisme sous cette forme est aussi inédit. Du point de vue du nombre de victimes, avec les groupes séparatistes et révolutionnaires, c’était pire dans les années 1970 en Europe occidentale. Aujourd’hui, Daech ne cible pas des officiels mais frappe au hasard. C’est ce qui nous terrifie. Face à ça, nous avons d’autant plus besoin de données objectives qui nous permettent de saisir que, même si les attentats sont terribles, c’est un petit risque pour notre vie comparé à d’autres. Il faut vaincre les terroristes, mais ne pas paniquer.Prenons le critère de l’extrême pauvreté dans le monde : Depuis 25 ans l’extrême pauvreté a été réduit de 1,25 milliard de personnes, alors même que la population mondiale a augmenté de 2 milliards de personnes.En 1950, il y avait 10,5 millions de lépreux. Il n’y a aujourd’hui plus que 200 000 cas chroniques. En 1900, seulement 21 % de la population mondiale savaient lire. Aujourd’hui, c’est 86 %… Parmi tous ces chiffres, voilà la meilleure nouvelle ! Car cela concerne notre capacité à affronter les problèmes du futur. »Il explique :« À chaque minute où nous parlons, 100 personnes sortent [de l’extrême pauvreté]. La Chine a eu un impact formidable, mais il y a aussi l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam, le Bangladesh, l’Amérique latine et aujourd’hui des pays de l’Afrique subsaharienne, qu’on considérait pourtant comme le continent sans espoir. Pour la première fois, l’extrême pauvreté est passée en Afrique subsaharienne au-dessous des 50 %. Aujourd’hui, on en est à 35 %. »Dans tous les pays du monde, sans exception, les gens vivent plus longtemps qu’il y a cinquante ans. Et si certains pays ont stagné ou régressé sur le plan économique, mais même eux ont connu des avancées considérables en termes de santé. […] En 1800, pas un seul pays au monde n’avait une espérance de vie supérieure à 40 ans. Aujourd’hui, pas un seul pays n’a une espérance de vie inférieure. En Afrique, c’est d’autant plus encourageant que, après les dégâts des guerres, de la malaria et du VIH, l’espérance de vie est plus élevée que jamais. L’Ouganda, le Botswana ou le Kenya ont eu un gain de dix ans ces dix dernières années.Tous ces problèmes environnementaux qui nous préoccupent sont réels : réchauffement climatique, éradication des espèces… Mais je me suis aussi intéressé à d’autres problèmes environnementaux complètement oubliés. En décembre 1952, le grand smog a tué près de 12 000 personnes à Londres. Aujourd’hui, l’air londonien est aussi propre qu’au Moyen Âge. Depuis 1990, la forêt européenne croît à un rythme annuel de 0,3 %. La déforestation continue en Indonésie ou au Brésil, mais le taux mondial de déforestation annuel a ralenti, passant de 0,18 à 0,0009 % depuis les années 1990. On a mesuré que, grâce à l’évolution des techniques agricoles, on a pu sauvegarder une surface forestière de deux fois l’Amérique du Sud depuis les années 1960. Bien sûr, on crée de nouveaux problèmes. Mais comment y faire face ? Plus un pays est riche, mieux il peut développer des technologies propres.Dans le classement des indices de performance environnementale, les pays scandinaves sont en tête, alors que la Somalie, le Niger ou Haïti sont en queue. Les problèmes environnementaux dans ces pays ne proviennent pas de la technologie, mais de l’absence de technologie. Autrement dit, nous devons accélérer le progrès plutôt qu’adopter la décroissance, qui signifierait un retour à la pauvreté pour des millions de personnes et serait plus néfaste pour l’environnement. Car le pire qui puisse arriver, c’est l’utilisation de vieilles technologies, ce qui se pratique dans des pays africains ou en Asie.Si vous pensez que le travail des enfants est quelque chose de nouveau, consultez les tapisseries et les témoignages du Moyen Âge, où les enfants font partie intégrante de l’économie. Aujourd’hui, ça paraît bénin, car nous avons une représentation romantique de la ferme, comme si c’était un plaisir. Mais je peux vous assurer que cela n’était pas le cas à l’époque. Le travail des enfants a continué sous la révolution industrielle, mais à travers des oeuvres comme celle de Dickens il y a eu une prise de conscience qui marqua le début du déclin. Aujourd’hui, en Inde comme au Vietnam, le travail des enfants baisse rapidement. Entre 1993 et 2006, la proportion des 10-14 ans travaillant au Vietnam est passé de 45 % à moins de 10 %. Au moment où les parents deviennent plus riches, la première chose qu’ils font est de ne plus envoyer leurs enfants travailler, car ils ne le faisaient pas par plaisir sadique, mais pour survivre. Historiquement, le capitalisme a donc permis de mettre un terme au travail des enfants, pas l’inverse.Pour Angus Deaton, le progrès crée toujours des inégalités. Depuis 1980, celles-ci sont grandissantes dans les pays de l’OCDE…Deaton a raison. Il y a deux cents ans, il y avait plus d’égalité dans le monde, mais c’est parce que l’immense majorité d’entre nous était pauvre. L’indice de Gini était donc très bas. Puis, dans une minorité de pays, les gens ont commencé à avoir plus de libertés, ils sont devenus beaucoup plus riches : leur PIB par habitant a été multiplié par 20. Évidemment, vous introduisez ainsi une énorme inégalité dans le monde. Mais, comme l’explique Deaton, ce n’est pas toujours une mauvaise chose. Serait-il préférable que tout le monde soit resté pauvre ? Prenez la Chine. Il y a trente ans, c’était un pays très égalitaire, mais 90 % de la population vivait dans l’extrême pauvreté, contre 10 % aujourd’hui. Si vous ne vous concentrez que sur les inégalités, vous aurez l’impression que ça a empiré. Le progrès n’est jamais égalitaire. Il se concentre plus sur les régions côtières, dans les grandes villes. Cela dit, l’inégalité peut devenir un problème, surtout quand certains groupes commencent à se garantir des privilèges et prennent le contrôle du pouvoir. C’est ce qui s’est passé en Russie, où un petit groupe a pris en otage le gouvernement, faute de transparence.il est utile de rappeler que, plus que votre salaire, l’important est ce que vous pouvez acheter. Même si vous n’avez pas augmenté vos revenus de manière importante depuis les années 1980, vous avez eu accès à des technologies et à des services qui n’existaient pas dans le passé. Avant, seuls les riches pouvaient s’acheter une encyclopédie. Maintenant, on y a tous accès pour rien ! Comment chiffrer ça ? Ça n’apparaît pas dans les statistiques. Sans parler de la médecine, qui nous a donné près de dix années supplémentaires de vie. Les taux de criminalité se sont réduits, l’accès à la technologie a augmenté pour tout le monde.Au-delà des chiffres, il y a les questions culturelles. La mondialisation et l’immigration font craindre à certains de perdre leur identité.C’est effectivement un facteur plus important que les données économiques. Les supporteurs de Trump ne sont pas au chômage, mais ils appartiennent à une classe blanche qui pense que son identité est en déclin car menacée par les minorités. Cela explique en grande partie l’essor des populismes en Europe et aux États-Unis. Les psychologues parlent d’un réflexe d’autorité. C’est un besoin de protection qui touche aussi l’éducation, la liberté sexuelle, les droits des minorités. C’est l’idée qu’on doit se reprendre en main. Je comprends ce sentiment, mais les conséquences en seraient terrifiantes, car tout le progrès dont nous parlons est dépendant de notre ouverture au monde.La réflexion de Johan Norberg n’est pas celui d’un simpliste béat qui pense que tout va bien, il suffit de laisser venir.»Il répond :« [Je n’ai pas écrit ] un livre sur le progrès […] pour dire : « Regardez, tout est génial, on peut être relax. » Non, je l’ai fait parce que j’ai un peu peur. Les risques sont là et ils sont bien plus dangereux quand les gens ne comprennent pas ce que la race humaine peut réaliser quand elle est libre. Je suis très effrayé par cette demande d’autorité, à droite comme à gauche, pour s’opposer à la mondialisation. […] Je suis donc un optimiste soucieux. Cela dit, je reste optimiste, car l’humanité a traversé dans l’Histoire des choses bien pires et est arrivée à ce monde où même les gens qui ont eu la malchance de naître dans des conditions difficiles vivent plus longtemps. L’humanité est résiliente et a beaucoup de pouvoirs. »Ses arguments sont forts et documentés.Vous trouverez en pièce jointe l’intégralité de l’interview -
Vendredi 16 décembre 2016
«On ne lui a même pas accordé un nom sur une tombe dans le cimetière de La Havane.
Il est gommé de l’Histoire. Oublié, jeté dans la fosse commune. Comme les hérétiques du Moyen Âge. […]
Aujourd’hui, je clame son nom, pour que jamais on ne l’oublie : Tony de la Guardia, mon père bien-aimé.»Ileana de la GuardiaPour Fidel Castro aussi je vais « tourner autour du pot ». Je ne vais pas le faire par une discussion conceptuelle ou morale.Je vais rester à hauteur d’homme, de la douleur et de la souffrance du témoignage :« Le 25 novembre dernier, Fidel Castro est mort à l’âge avancé de 90 ans. Tony de la Guardia, l’un de ses principaux lieutenants, lui, n’a pas eu la chance de connaître ses petits-enfants : un matin de juin 1989, il a été fait fusiller par Castro. Sa fille, Ileana, a fui son pays et s’est exilée en France. […]C’est l’aube à Paris, ce 26 novembre, le soleil est à peine levé. Dans mon sommeil profond, j’entends comme dans un rêve un téléphone sonner. Je ne veux pas décrocher, c’est mon mari que le fait. Sa voix me dit : « Il est mort, il est mort, réveille-toi ! Fidel est mort ! »Je réponds : « « Encore lui… Il va encore me sortir de mon sommeil. »Comme il y a 27 ans, quand on m’a annoncé l’arrestation de mon père. Un quart de siècle, déjà. Et pourtant, ce coup de téléphone me poursuit comme un fantôme. Non, je ne veux pas, il n’a pas le droit.Quelques heures plus tard, je sors de mon lit et vois de ma fenêtre, à l’horizon, la tour Eiffel, mon symbole de liberté, de « ma » liberté. Tous les mauvais souvenirs reviennent alors. Celui de mon père, surtout, et des quelques autres, qui ont payé de leurs vies l’aveuglement d’un tyran. Cette fois, il est vraiment mort ? Aucun doute. Je suis soulagée, comme libérée d’une ombre maléfique.Le « monstre » est mort dans son lit, sans être inquiété pour tous ses crimes. Les funérailles sont déjà bouclées. Rien ne sera laissé au hasard. Personne n’ira cracher sur ses cendres. Et pourtant.Mon père, Tony de la Guardia, lui est parti un petit matin du 13 juin 1989. Il n’a pas eu la chance de vivre vieux, ni de connaître ses petits-enfants. Il était un des hommes de confiance du tyran. Il avait servi Castro pour des missions difficiles, militaires et parfois secrètes. Il lui avait tout donné.Ce jour-là, la police l’a arrêté. Un mois plus tard, au terme d’un procès stalinien, Castro l’a fait fusiller, sans pitié. Il n’avait pourtant ni trahi, ni triché, ni volé. Il avait seulement exécuté les ordres de son chef : trouver des devises étrangères pour sauver Cuba du naufrage.Ce jour-là, le monde s’est effondré autour de moi. J’étais une jeune femme non politisée, persuadée que Fidel qu’on surnommait entre jeunes le « Cangrejo », (« le crabe »), parce qu’il reculait toujours le « moment des élections libres ». En même temps que mon père, il a fait fusiller Arnaldo Ochoa, le grand général de l’armée cubaine en Afrique, le Lion de l’Ethiopie comme l’appelaient les Africains, adoré par les Cubains. Un grand héros. Il a fait aussi condamner mon oncle Patricio, frère jumeau de mon père, à 30 ans de prison. Il est aujourd’hui en résidence surveillée. À Cuba, on dit en résidence « pyjama »…Tous ces hommes étaient soupçonnés d’avoir un faible pour la perestroïka de Gorbatchev. Castro n’avait strictement aucune preuve, seulement des doutes. Mais il devait faire un exemple. Empêcher la vague de s’étendre. Être impitoyable. Exercer la terreur pour perpétuer son règne. Toujours.Je ne peux pas m’empêcher d’être heureuse. À Paris, je pense à toutes ces familles cubaines qui ont vécu des tragédies similaires à la mienne. Elles aussi pleurent leurs morts en silence, la peur au ventre, avec l’espoir que peut-être, un jour, elles auront le droit de revenir chez elles. »Malgré ces souvenirs terribles, je sors me promener dans Paris. La ville qui m’a ouvert les bras. Je me rends compte de la chance que j’ai. Je suis arrivée en France en 1991, au pays de Voltaire, le chantre de la liberté d’expression. Voltaire, l’ennemi éternel des tyrans, que je chéris chaque jour, car je connais le prix de la liberté.Curieusement, je suis heureuse, même si, par principe, on ne doit pas se réjouir de la mort d’un être humain, même le pire des criminels. Je sais, je ne dois pas sauter de joie. Mais je ne peux pas m’en empêcher. Car, au-delà des funérailles qui se veulent grandioses et dociles, comme dans tous les régimes communistes, c’est le bourreau que je vois. L’homme de fer, implacable, prêt à sacrifier ses plus proches collaborateurs pour protéger son système.Et son pouvoir. Comment ne pas revoir mon père, pris au piège des mensonges du dictateur. Pour se débarrasser de lui, et de quelques autres, Castro lui a vendu une fable perverse et criminelle. Pour le bien du pays, de la Révolution, il lui a demandé de s’accuser de fautes qu’il n’a pas commises. Un classique, me direz-vous dans les régimes staliniens, où les enfants dénoncent leurs propres parents.À l’époque, Castro est soupçonné par la CIA de prêter ses aéroports aux narcotrafiquants colombiens comme zones de transit. Au prix fort. La Centrale a des preuves irréfutables, photos et témoignages de mafieux du cartel de Medellin.Comment se sortir du piège ? En faisant porter le chapeau à quelques officiers supérieurs suspectés de sympathies gorbatchéviennes. Mon père, comme les autres, persuadé que le grand Fidel lui demande un service et le fera libérer à la fin du procès, accepte cette mascarade.Le procès fut un simulacre, un cauchemar. À la fin des audiences, à notre grande surprise, le « monstre » les a fait fusiller comme de vulgaires traîtres. Je vis avec cette image d’horreur depuis 27 ans. Je revois le sourire de mon père, épuisé par son incarcération. Son dernier regard, plein de tendresse. On ne lui a même pas accordé un nom sur une tombe dans le cimetière de La Havane. Il est gommé de l’Histoire. Oublié, jeté dans la fosse commune. Comme les hérétiques du Moyen Âge. Et je n’ai pas le droit d’aller sur place me recueillir devant sa dépouille.Aujourd’hui, je clame son nom, pour que jamais on ne l’oublie : Tony de la Guardia, mon père bien-aimé. Que ma voix traverse l’Atlantique, jusqu’au Malecon, le boulevard du bord de l’océan, à La Havane, là où les rêves se perdent dans l’horizon. »Vous trouverez l’intégralité de l’article derrière ce lien :<Fidel castro a fait fusiller mon père sa mort ne m’attriste pas il restera un-bourreau>
Que dire ?Fidel Castro a certes mené des combats justes et eu des dénonciations judicieuses.Mais son histoire rappelle surtout que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument.Seuls les contre-pouvoirs institutionnalisés, ces instances qui arrêtent, critiquent et contrôlent le pouvoir permettent d’éviter ces dérives.Antonio de la Guardia et sa fille Ileana<805>Photo plus récente d’Ileana de la Guardia -
Jeudi 15 décembre 2016
«Puisque vous allez revoir Kennedy, soyez un messager de paix. »Fidel Castro
à Jean Daniel qui était venu le rencontrer avec un message de John F Kennedy après la crise des missilesJe ne sais pas si vous connaissez cet épisode raconté par le fondateur du nouvel Obs, Jean Daniel qui en 1963 avait rencontré John F Kennedy puis était allé voir Fidel Castro qui l’ a bien accueilli et exprimait des sentiments très bienveillants à l’égard de ce président américain. Peut être que la situation entre Cuba et les Etats-Unis aurait pu évoluer dans le bon sens dès 1963, mais Pendant le séjour de Jean Daniel à Cuba, Kennedy fut assassiné à Dallas.« Un mois après avoir été invité par J. F. Kennedy à la Maison-Blanche, Jean Daniel se rend à Cuba, et rencontre Fidel Castro. […] Fidel se révélant inaccessible, et malgré la tristesse de nos nouveaux amis, nous décidâmes de quitter La Havane. Nous devions prendre l’avion pour Mexico le lendemain. Raoul Castro et Armando Hart, deux des plus importants personnages du régime, m’avaient écouté. Je me dis que, après tout, le message dont je me croyais porteur devait laisser Fidel indifférent.Il était 22 heures. Nous étions occupés à faire nos bagages. Le concierge me téléphona du ton le plus naturel pour m’informer que le Premier ministre m’attendait à la réception. Je pris l’ascenseur où n’étaient marqués que quatorze étages alors que l’hôtel en avait quinze : le chiffre treize était interdit à La Havane, qui était, avant la révolution, et plus que Las Vegas, le rendez-vous de tous les joueurs du monde.Je n’eus pas à sortir de l’ascenseur. Fidel me dit : ‘Remontons. Pour parler, nous serons mieux dans votre chambre’. Fidel, le commandant Valejo, son aide de camp, le romancier-interprète Juan Arcocha, Marc Riboud, Michèle et moi devions rester dans cette chambre de 10 heures du soir à 4 heures du matin.Au début, Fidel m’a écouté – je veux dire a écouté Kennedy – avec un intérêt dévorant : frisant sa barbe, enfonçant et redressant son béret noir, ajustant sa vareuse de guérillero, jetant mille lumières pétillantes depuis les cavernes profondes de ses yeux.Un moment, nous avons touché au mimodrame. Je jouais ce partenaire avec lequel il avait une envie aussi violente de s’empoigner que de discuter. Je devenais cet ennemi intime, ce Kennedy dont Khrouchtchev pourtant venait de lui dire que ‘c’était un capitaliste avec qui on pouvait parler’. Si pressé qu’il fût de me répondre, Castro s’imposa de me laisser aller jusqu’au bout en me faisant préciser souvent trois fois une expression, une attitude, une intention. Juan Arcocha traduisait en virtuose.Sur quel ton Kennedy m’avait-il parlé du colonialisme de Batista et de ses alliés américains ? Quelle expression exacte avait-il employée lorsqu’il avait d’une coexistence possible avec des collectivismes comme ceux de Yougoslavie et de Guinée? Est-ce qu’il m’avait donné, à moi, Jean Daniel, une impression de sincérité? Etc.A la fin de cette nuit extraordinaire, Fidel m’a dit : « ‘Puisque vous allez revoir Kennedy, soyez un messager de paix. Je ne veux rien, je n’attends rien. Mais dans ce que vous m’avez rapporté il y a des éléments positifs. »Nous sommes enfin sortis de l’hôtel. Je dis « enfin » non pour moi – j’aurais encore pu écouter longtemps Castro -, mais pour Juan Arcocha épuisé, pour le commandant Valejo qui n’osait pas s’endormir tout à fait, et Marc Riboud qui avait depuis longtemps cessé de prendre toutes les photos possibles.»Et Jean Daniel et ses amis vont encore rester à Cuba sur l’invitation de Fidel Castro et ils seront ensemble quand ils apprendront l’assassinat de Kennedy. Et Jean Daniel rapporte encore deux propos de Fidel Castro :« Il faut que naisse aux Etats-Unis un homme capable de comprendre la réalité explosive de l’Amérique latine et de s’y adapter. Cet homme, ce pourrait être encore Kennedy. Il a encore toutes les chances de devenir, aux yeux de l’histoire, le plus grand président des Etats-Unis. Oui ! supérieur à Lincoln ! Moi, je le crois responsable du pire dans le passé mais je crois aussi qu’il a compris pas mal de choses et puis, en fin de compte, je suis persuadé qu’il faut souhaiter sa réélection. »Et puis après sa mort, il s’indigne devant certains reportages des médias occidentaux et dit :« Est-ce que vous êtes comme ça en Europe ? Pour nous, les Latins d’Amérique, la mort, c’est quelque chose de sacré. C’est non seulement la fin des hostilités mais aussi celle des injures, cela impose la dignité, vous savez ce que c’est que la dignité ? Il y a des voyous qui deviennent des seigneurs devant la mort !A propos, cela me fait penser à quelque chose, quand vous écrirez tout ce que je vous ai dit contre Kennedy, ne citez pas son nom, parlez de la politique du gouvernement des Etats-Unis. »Jean Daniel,« Le Temps qui reste »Gallimard, 1984<804> -
Mercredi 14 décembre 2016
«Imaginez ce que serait la situation aux États-Unis si, dans la foulée de son indépendance, une superpuissance avait infligé pareil traitement : jamais des institutions démocratiques n’auraient pu y prospérer. »Noam Chomsky à propos de la mort de Fidel Castro et de la politique des Etats-Unis à l’égard de cette île.Mon complice de toujours Albert m’a lancé un défi que je résumerai ainsi « Tu ne seras pas cap de consacrer un mot du jour positif à Fidel Castro parce que ce n’est pas politiquement correct ! »Mais si je suis capable de dire que Fidel Castro a libéré Cuba de la dictature mafieuse de Battista et que par la suite les Etats-Unis ont eu un comportement indigne avec ce petit pays ce qui a poussé le régime castriste vers l’Union soviétique , alors qu’à l’origine Castro n’était pas communiste. Que l’éducation et le système de santé mis en place à Cuba étaient remarquables.Les Etats-Unis est un pays plein de contradictions il y a des Donald Trump dont les différentes désignations aux postes clés de son administration n’annoncent rien de bon, mais il y a aussi des hommes comme Noam Chomsky, un des plus brillants intellectuels du monde, le New York Times a émis cette hypothèse : « Peut-être l’intellectuel vivant le plus important…Linguiste, philosophe, professeur au prestigieux Massachusetts Institute of Technology Et Noam Chomsky a rendu cet hommage à Fidel Castro :« Les réactions à la mort de Fidel Castro diffèrent selon l’endroit du monde où vous vous trouvez. Par exemple, en Haïti ou en Afrique du Sud, c’était une figure très respectée, une icône, et sa disparition a suscité une grande émotion. Aux États-Unis, l’ambiance générale a été résumée par le premier titre du « New York Times », lequel indiquait en substance : « Le dictateur cubain est mort ». Par curiosité, j’ai jeté un oeil aux archives de ce journal pour voir combien de fois ils avaient qualifié le roi d’Arabie saoudite de « dictateur ». Sans surprise, il n’y avait aucune occurrence…Il y a également un silence absolu sur le rôle joué par les États-Unis à Cuba, la manière dont Washington a œuvré pour nuire aux velléités d’indépendance de l’île et à son développement, dès la révolution survenue en janvier 1959. L’administration Eisenhower a tenté de renverser Castro, puis, sous celle de Kennedy, il y a eu l’invasion manquée de la baie des Cochons, suivie d’une campagne terroriste majeure. Des centaines, voire des milliers de personnes ont été assassinées avec la complicité de l’administration américaine et une guerre économique d’une sauvagerie extrême a été déclarée contre le régime de Fidel.Imaginez ce que serait la situation aux États-Unis si, dans la foulée de son indépendance, une superpuissance avait infligé pareil traitement : jamais des institutions démocratiques n’auraient pu y prospérer. Tout cela a été omis lors de l’annonce de la mort de Fidel Castro.Autres omissions : pourquoi une personnalité aussi respectée que Nelson Mandela, à peine libérée de prison, a-t-elle rendu hommage à Fidel Castro en le remerciant de son aide pour la libération de son pays du joug de l’apartheid ?Pourquoi La Havane a-t-elle envoyé tant de médecins au chevet d’Haïti après le séisme de 2010 ?Le rayonnement et l’activisme international de cette petite île ont été stupéfiants, notamment lorsque l’Afrique du Sud a envahi l’Angola avec le soutien des États-Unis. Les soldats cubains y ont combattu les troupes de Pretoria quand les États-Unis faisaient partie des derniers pays au monde à soutenir l’apartheid. […] Il faut également noter que le système de santé à Cuba s’est imposé comme l’un des plus efficaces de la planète, bien supérieur, par exemple, à celui que nous avons aux États-Unis.Et concernant les violations des droits de l’homme, ce qui s’y est produit de pire ces quinze dernières années a eu lieu à Guantanamo, dans la partie de l’île occupée par l’armée américaine, qui y a torturé des centaines de personnes dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme ».Vous trouverez les éléments de cet article derrière ce lien : https://www.les-crises.fr/ce-qui-a-ete-omis-a-la-mort-de-fidel-castro-par-noam-chomsky/<803> -
Mardi 13 décembre 2016
«Alors, tant mieux si Céline Alvarez a obtenu, avec des moyens considérables, de bons résultats. »Thierry Venot interrogé par Jean-Paul Brighelli dans le PointCertains se sont étonnés de mon dernier mot du jour et surtout de l’expression : « tourner autour du pot ». Dans l’esprit de beaucoup cette expression signifie soit le refus de décider soit de s’engager. Mais dans mon esprit, il ne s’agissait pas de cette faiblesse ou de la fuite que révèle une telle interprétation. Car je suis convaincu qu’il faut savoir décider et que le plus souvent une mauvaise décision vaut mieux que l’absence de décision.Pour ma part tourner autour du pot signifie qu’on regarde quelque chose, par exemple « un pot » sous des angles différents et que par ce fait on ne voit pas la même chose.Prenons le libéralisme économique. Si on regarde sous l’angle de l’égalité et la justice, on constate que ce système génère une augmentation exponentielle de l’inégalité parce qu’il donne une prime démentielle à ceux qui sont en tête du peloton pour prendre la métaphore cycliste. Ce système apparaît sous cet angle comme mauvais.Mais si on prend le filtre de la production de richesse, de la créativité, de l’inventivité, Fernand Braudel évoquait « la dynamique du capitalisme » aucun autre système créé par les humains ne lui est comparable que ce soit les régimes théocratiques d’hier ou d’aujourd’hui ou ces autres régimes de la religion terrestre du communisme.Ces deux points de vue sont exacts, même s’ils ne révèlent pas la même chose.Et le mot du jour d’aujourd’hui va donner un autre exemple. J’avais entendu Céline Alvarez en septembre et elle m’avait subjugué, j’avais parlé d’une femme lumineuse de celles qui suivent leur passion et croient en ce qu’elles font. Annie en avait parlé avec un voisin qui après de nombreux expériences professionnelles est devenu instituteur et qui a marqué son intérêt pour Céline Alvarez mais a souligné des conditions matérielles de l’expérimentation particulièrement favorables.Alors j’ai tenté de tourner « autour de ce pot » et je suis tombé sur un article de Jean-Paul Brighelli publié sur le site du Point au titre provocateur <Céline Alvarez une imposture ?>Notez le point d’interrogation !Jean-Paul Brighelli est un enseignant, un pédagogue respecté dans le monde de l’éducation.Il rappelle d’abord les prémices de l’expérience de Céline Alvarez : « qui a fait des études de linguistique et qui s’y connaît en communication, n’a passé le concours d’instituteur que pour expérimenter sa foi pédagogique. »Et puis il donne des précisions sur les conditions de l’expérimentation : «Elle a mystérieusement obtenu d’emblée auprès du ministère Chatel un poste et des conditions de travail idéales – 24 élèves de maternelle, pas un de plus, et une auxiliaire (Atsem) présente en permanence dans sa classe. Et trois ans durant, notre révolutionnaire a été au plus près de ses élèves, disposant d’un matériel coûteux qui lui arrivait dès qu’elle en formulait la demande. Les suppressions de poste et de budget des années 2009-2012 ne la concernaient pas. »Puis il nous apprend aussi que Céline Alvarez est soutenu par : « l’Institut Montaigne, think tank, comme on dit désormais en français, d’un libéralisme pur et dur, qui a contribué financièrement à l’expérience via l’association Agir pour l’école, dont le fondateur, en 2010, fut Claude Bébéar, fondateur aussi de l’Institut Montaigne. »La critique essentielle de Jean-Paul Brighelli est que l’expérience est coûteuse mais je crois comprendre aussi qu’il pense qu’une telle expérience demande une telle implication de l’enseignante qu’elle peut l’accomplir pendant 3 ans mais peut-être pas lors de toute une vie d’enseignant.Il manifeste aussi des réticences sur l’apport des neurosciences que met en avant Céline Alvarez en parlant « des acquis douteux des « sciences cognitives » – d’où l’appui inconditionnel de Stanislas Dehaene, gourou des neurosciences – dont l’évaluation reste à faire, et qui suscitent enfin un regard critique sans indulgence, tant elles nourrissent de faux prophètes en leur sein. »Enfin, Jean-Paul Brighelli fait appel à deux enseignants qui pratiquent et qui ont écrit des ouvrages pédagogiques :Muriel Strupiechonski, […] qui a écrit, selon lui, l’un des meilleurs manuels aujourd’hui disponibles d’orthographe-grammaire-rédaction pour le niveau CE1. Elle explique :« Céline Alvarez nous fait part des performances accomplies dans sa classe pendant trois ans. Elles sont assurément séduisantes et on ne peut que se féliciter de voir l’engouement que son livre provoque dans les médias, puisqu’un de ses chapitres décrit l’apprentissage alphabétique de la lecture et son efficacité. Heureuse nouvelle si le crédit qu’a acquis Alvarez provoque enfin une prise de conscience générale sur cette question si importante et aboutit à autoriser dans toutes les écoles l’emploi de la méthode alphabétique, ainsi que l’apprentissage simultané de la numération et des opérations !Car les journaux prêtent aussi à ses élèves la maîtrise des 4 opérations. Qu’on nous permette toutefois de douter : sur la jaquette de son livre Les Lois naturelles de l’enfant. La révolution de l’éducation, on ne trouve nulle trace de l’apprentissage des 4 opérations – et l’écriture, jugée trop difficile, y est dissociée de la lecture, alors que leur apprentissage concomitant est essentiel pour une acquisition efficace. »Et elle ajoute :« Il y a des années que des enseignants luttent contre les aberrations pédagogiques qui leur sont imposées, faisant appel à leur simple bon sens ou à l’observation tout empirique des résultats de leurs élèves, rejoignant souvent la « recherche » sur laquelle Céline Alvarez dit s’appuyer. Nous avons rassemblé les expériences les plus concluantes d’un grand nombre d’instituteurs – de vrais enseignants, pas des vedettes médiatiques, mais des praticiens qui œuvrent au jour le jour. Et par le travail, la répétition, la patience et le sourire, on obtient d’excellents résultats – sans passer forcément par les neurosciences ou des méthodes imaginées il y a un siècle pour l’apprentissage des enfants à retard mental. »L’autre enseignant est Thierry Venot auteur d’une méthode réelle d’apprentissage :« L’école ne fournit plus les outils nécessaires à l’autonomie intellectuelle des jeunes. Je ne pense pas que l’avalanche obscurantiste qui, actuellement, nous submerge dans de nombreux domaines soit le fruit du hasard. Alors, tant mieux si Céline Alvarez a obtenu, avec des moyens considérables, de bons résultats. Ce que je sais, c’est qu’avec les moyens réels de l’Éducation nationale, et avec de bonnes pratiques, on obtient d’excellents résultats avec tous les enfants – sans prétendre faire jaillir d’eux je ne sais quelle étincelle mystique, mais en gravant dans leur mémoire et dans leur pratique les réflexes et les savoirs –, et il n’y a pas d’autre méthode qui tienne ! »On sent l’irritation chez Brighelli et ses deux interlocuteurs. A mon sens ils sont probablement excessifs et manquent de bienveillance.Je ne crois pas que cela invalide les pistes explorées et la recherche de Céline Alvarez, mais offre des nuances et montre qu’il n’y a pas de miracles mais de la complexité qu’il faut approcher et tenter de maîtriser.Pour ma part je n’enlèverai rien à ce que disait Céline Alvarez « L’enfant apprend en étant actif et non passif, quand il est aimé et non jugé » et qui me parait l’essence de l’acte pédagogique.Enquête après enquête, on constate que l’éducation nationale française décline et si elle continue à être en capacité de produire une élite de qualité au sens des normes internationales, elle n’arrive plus à enseigner au plus grand nombre et à l’amener à un niveau compatible avec les exigences de notre temps.Céline Alvarez s’appuyant sur des méthodes anciennes (Montessori) mais aussi des recherches récentes explore des pistes, elle n’y arrivera certainement pas seule.Pour que vous puissiez vous faire votre propre jugement, je mets en pièces jointes le mot du jour consacré à Céline Alvarez et l’article de Jean-Paul Brighelli. -
Jeudi 8 Décembre 2016
Jeudi 8 Décembre 2016« Ce n’est qu’en tournant autour du pot qu’on peut en voir tous ses aspects !»Réflexions personnelles pour la suite des mots du jourQuand j’étais dans l’administration centrale de la défunte Direction Générale des Impôts, à Bercy dans les années 90, on me reprochait parfois de tourner autour du pot.J’avais alors trouvé une réponse : «Oui mais ce n »est qu’en tournant autour du pot qu’on peut en voir tous ses aspects»Un danger nous menace, nous ne nous confrontons plus vraiment à la contradiction. Les réseaux sociaux et ce qui en découle nous conduit de plus en plus à lire, écouter et échanger avec celles et ceux qui sont d’accord avec nous. Et on constate que dans nos groupes d’«amis» (ce mot «ami» pour les relations que l’on a sur les réseaux sociaux me semble totalement inapproprié.) si l’on souhaite exprimer une nuance ou présenter un autre éclairage, il n’y a que rarement d’échanges et on tombe rapidement dans l’invective.Or, c’est par la confrontation qu’il est possible de progresser. Tourner autour du pot pour l’observer sous un autre angle.Je vais donc tenter davantage de trouver le débat et lire ou présenter des points de vue divergents, pour sortir du confort intellectuel.Bousculer un peu, en quelque sorte.Mais je ne commencerai pas demain, car je me suis octroyé un week-end prolongé, à l’occasion de la fête des lumières à Lyon.Le 802ème mot du jour sera envoyé mardi 13 décembre.<801> -
Mercredi 7 décembre 2016
« Retour sur les mots du jour 701 à 800 (2) »RétrospectiveJe vous rassure, je ne ferais pas la liste de tous les mots du jour qui n’ont pas fait l’objet des 4 thématiques rappelées hier.
Mais il me semble qu’il y a eu 3 mots qui ont abordé des sujets de première importance dans notre monde économique et quotidien :
D’abord le concept de «quantophrénie» (763) inventé par le sociologue Pitirim Sorokin qui nous explique que le chiffre n’est jamais la vérité, au plus une simple indication. Et que la pratique qui consiste à remplacer l’argumentation et la réflexion par un chiffre constitue une perversion ou une maladie qui nous entraîne vers de mauvais rivages.
Puis me parait aussi très fécond pour notre compréhension du monde la réflexion que Nancy Fraser a développé lors de la 38ème conférence Marc Bloch « Les contradictions sociales du capitalisme contemporain » (769) où elle explique que pour que les échanges marchands puissent avoir lieu, il faut qu’en coulisse des personnes, le plus souvent des femmes s’occupent de ce qu’elle appelle « la reproduction sociale », c’est-à-dire l’éducation des enfants, les soins aux malades par exemple. Et elle montre que le capitalisme financier moderne s’attaque à l’équilibre qui avait été peu à peu obtenu pour s’abîmer dans des contradictions.
Enfin, le Brexit puis l’élection de Donald Trump ont conduit à l’émergence d’un mot que le dictionnaire d’Oxford a classé comme mot de l’année : « Post-truth » post-vérité (784). C’est la rédactrice en chef du Guardian, Katharine Viner qui a rendu populaire ce mot qui décrit un monde où la vérité n’est plus qu’une « opinion parmi d’autres ».
Cette période a encore était marquée par des attentats et la crainte du terrorisme, comme d’une cassure au sein de notre société.
J’ai consacré deux mots du jour à la première victime de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice d’abord simplement pour rappeler ce fait que la première victime de ce tueur se réclamant de l’islamisme était une musulmane «La première victime du carnage de Nice, le 14 juillet 2016, était une musulmane.» (760) ensuite pour revenir à hauteur d’homme et d’empathie pour parler de cette mère, croyante et citoyenne française : Fatima Charrihi racontée par ses enfants. Elle aimait dire cette parole de sagesse : « Il faut connaître le goût du vinaigre pour apprécier celui du miel. » (771)
Ces actes de violence aveugle font découvrir des fous et des assassins mais révèle aussi des gens formidables comme Antoine Leiris, journaliste qui a perdu au Bataclan l’amour de sa vie et mère de ses enfants et qui a écrit ce texte admirable d’humanité : «Vous n’aurez pas ma haine» (739).
Il existe ces voix qui s’élèvent ou écrivent comme Abdennour Bidar : «Les tisserands : réparer ensemble le tissu déchiré du monde» (724) pour recréer des liens là où la violence et le fanatisme les ont déchirés.
Et puis il faut chercher du côté de l’historien Patrick Boucheron qu’avant d’être un problème militaire et de police, ces combats relèvent prioritairement de la bataille des idées et qu’il faut placer des mots, des mots justes sur ce qui se passe. Et Boucheron fait appel à Machiavel : « Quand quelque chose arrive, quand ce quelque chose on n’en n’a pas idée, quand on ne l’a pas souhaité, ni espéré, ni craint, alors la première chose à faire, est [d’user] de l’exactitude des mots constater ce qui arrive sans se laisser intimider ni émerveiller par les mots anciens. » (738)
La politique n’a pas été absente notamment, dans le contexte de l’économie numérique, le conflit entre les multinationales et le pouvoir politique étatique : « Une course à mort est engagée entre la technologie et la politique. » (703) avis de Peter Thiel un des fondateurs de Paypal cité par Marc Dugain et Christophe Labbé dans leur livre «L’Homme nu ».
Et puis des regards critiques sur la vie politique française où des grandes voix s’expriment et constatent avec regret ou irritation que l’on ne parle des vrais enjeux ou que nos gouvernants ou ceux qui y aspirent n’expliquent pas ce qui se passe et quelles sont les perspectives pour les générations futures :
«Je suis énervé, je suis irrité, parce que je trouve qu’il y a une absence de conscience dans ce pays de ce qui est en jeu.» (720) Alain Touraine, lors de l’émission de France Culture « Dimanche et après du 29/05/2016 ». Le grand sociologue n’était pas très bienveillant pour le gouvernement dont faisait partie sa fille.
«En haut on parle technique et en bas on ressent le changement du monde et on ressent l’absence de perspective à l’égard de ce changement.» (721) Marcel Gauchet dans les matins de France Culture du 30/05/2016
Et aussi cette réflexion récurrente, ce conflit qui se situe autant à l’intérieur de notre personnalité qu’à l’extérieur entre le consommateur que nous sommes et le citoyen que nous aspirons être : « Le libre-échange et le protectionnisme : le consommateur contre le citoyen » (789) Jean-Marc Daniel et François Ruffin lors d’un débat
Et encore cette réflexion sociologique à hauteur d’homme et de la vie au quotidien : « Personne au monde, ni en Algérie, ni au Sénégal, ni en Chine, ne souhaite devenir minoritaire dans son village. » (764) Christophe Guilluy, lors des matins de France Culture du 13 septembre
Ces 100 mots ont aussi abordé plusieurs fois les fraudes ou les manquements des laboratoires ou d’autres acteurs dans la santé : «Malscience, De la fraude dans les labos» (766) Nicolas Chevassus-au-Louis
«Projet 226»(767) Nom d’une manipulation de l’industrie sucrière aux Etats-Unis en 1965
Et à l’occasion de la sortie du film « la fille de Brest » : «Ce que j’ai ressenti, ce n’est pas l’empathie habituelle du médecin : c’est l’effroi face au crime » (795) Irène Frachon pour l’affaire du Mediator
Quelquefois ce fut des livres qui ont été inspirants : « Histoire du silence » (733) d’Alain Corbin ou «Avant cela, avant qu’il ne faille quitter cette vie pour nous fondre dans l’autre, nous sommes responsables de notre destinée. Je ne serai pas accusée de m’être dérobée.» (759) Leonora Miano, Crépuscule du tourment
Ou un film « La tortue rouge » (736) de Michael Dudok de Wit
-
Mardi 6 décembre 2016
« Retour sur les mots du jour 701 à 800 (1) »Rétrospective
Voici donc une nouvelle série de 100 mots du jour, du 701ème qui concernait les accords Sykes – Picot qui ont durablement conditionné les relations entre les arabes et les pays occidentaux au 800ème qui caractérisait l’intelligence par son caractère imprévisible et novateur.
Mais cette série a surtout été marquée par deux séries thématiques :
La première, en mai, qui du mot N° 706 au N°718 avait pour objet unique un livre passionnant et érudit que plusieurs d’entre vous ont acheté ou emprunté, selon ce que vous m’avez dit ou écrit : « Sapiens » de Yuval Noah Harari.
Cet ouvrage qui a pour sujet l’histoire de notre espèce : « L’homo sapiens », comment sapiens s’est imposé par rapport aux autres espèces du genre « homo », puis s’est comporté avec les autres espèces du règne animal. Comment il a colonisé la terre, inventé l’agriculture, imaginé les religions, créé des villes puis les empires, développé le capitalisme, enfin, bouleversé la nature, la vie, la société par la révolution scientifique et industrielle.
La vision assez pessimiste de Harari nous conduit des premiers pas de sapiens qui colonise la terre à la vision des transhumanistes de la silicon valley, où cet homme étrange et inquiétant, Ray Kurzweil, un des hommes les plus influents de Google prédit la singularité technologique et rêve d’immortalité. J’ai pris pour premier exergue cette phrase prophétique d’Harari :« L’Histoire commença quand les humains inventèrent les dieux et se terminera quand les humains deviendront des dieux.»
Et pour clore cette série, j’ai fait appel à Kant : « «Sapere aude ! Ose savoir ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement !»
La seconde, en septembre, N° 750 à 754, consacrée à 5 conférences de Régis Debray sur la croyance, le sacré, la religion, Dieu, la Laïcité, réflexion d’une rare consistance.
Je relèverai deux propos tenus par le philosophe : « quand on dit à un croyant : c’est idiot ce que vous croyez, d’ailleurs ce que l’on croit n’est jamais vrai, c’est Valéry qui l’a dit, il vous répondra peut être : Je sais bien, mais quand même, j’ai un toit pour m’abriter et des frères et des sœurs pour me tenir chaud, j’ai un parti, j’ai une église, j’ai une confrérie […]. Votre vérité, elle est froide, elle ne me rapporte rien, alors que ma croyance m’augmente. Elle me rend fier d’être ce que je suis, parce qu’elle m’assure une appartenance. Elle m’insère dans un « nous » beaucoup plus grand et plus fort que moi, le « nous » de tous les croyants, à la même croyance que moi. »
Et cette phrase où, il donne ce conseil, plus exactement une injonction à tous les hérauts de la laïcité : « Il ne faut pas demander à la laïcité, ce qu’elle ne peut nous donner […] La laïcité est une construction juridique et une législation ne donne pas un sentiment d’appartenance, d’entraide mutuelle et de fierté collective. La laïcité ne répond pas aux questions fondamentales : d’où venons-nous, où allons-nous ? […] La laïcité ne peut pas remplacer la religion sinon elle devrait devenir elle-même une religion. Et si elle devenait une religion, elle ne serait plus ce qu’elle est : elle serait la religion de certains contre d’autres et non pas un cadre de coexistence de plusieurs valeurs, simplement une valeur parmi d’autres. »
Il y eut encore deux autres thématiques durant une semaine : Au retour des vacances d’été, une semaine consacrée à Michel Rocard (N°740 à 744) qui venait de mourir au début de l’été et qui était l’homme politique français dont je me sentais le plus proche depuis que j’ai accédé à la réflexion. Et enfin, il y eut 5 mots de jour (790 à 794) qui interrogeaient la méritocratie, ses limites et surtout ses dérives.
Mais il n’y eut pas que des thématiques, il y eut aussi des mots isolés qui à la relecture me semblent très intelligents au sens de ce que Michel Serres expliquait dans le 800ème mot du jour.
Mais je vous en parlerai demain.
<Message hors numérotation>
-
Lundi 5 décembre 2016
Lundi 5 décembre 2016« L’intelligence est imprévisible et mystique»Michel SerresNous sommes arrivés, ce matin, au 800ème mot du jour de cette série qui a commencé le 9 octobre 2012.Ce matin, je souhaite vous parler d’intelligence ou plutôt laisser Michel Serres en parler.Il participe chaque dimanche, sur France Info, à une chronique de quelques minutes qui s’appelle « Le sens de l’info » et dans laquelle, il déploie un regard décalé et analytique sur un sujet librement choisi.Dans l’une de ces émissions, il a essayé d’expliquer l’intelligence et a eu cette phrase : «L’intelligence est imprévisible et mystique.»Vous pourrez l’écouter avec beaucoup d’intérêt. Mais je me souviens d’une émission plus ancienne où il avait développé la même pensée d’une manière très originale qui m’avait beaucoup marqué. La preuve c’est que je m’en souviens encore :« Définir l’intelligence, ce n’est pas simple.Par contre il est plus simple de définir, la bêtise.La bêtise, c’est l’apanage des bêtes. Un chasseur connaît bien cela. Une bête réagit toujours de la même manière en face d’une stimulation définie. Dès lors, le chasseur sait ce qu’il doit faire pour que la bête réagisse d’une manière attendue. Ainsi, il peut l’abattre.L’intelligence cela doit être le contraire.L’intelligence est imprévisible, elle n’est jamais là où on l’attend.L’intelligence vous permet d’apprendre quelque chose de neuf même sur ce que vous pensiez connaître. Elle vous en montre un autre aspect, une autre manière d’aborder la question ou de la résoudre. »Je trouve cette distinction particulièrement féconde. Est bête, celui qui réagit de manière prévisible, dont on sait par avance quelle sera son action, sa réponse.L’intelligence, ce n’est certainement pas raconter n’importe quoi pour faire l’intéressant ou encore dire le contraire des autres pour surprendre.Quand l’intelligence nous parle, nous devons être interloqué parce qu’elle révèle quelque chose que nous n’avions pas exprimé ou réfléchi explicitement mais qui nous ouvre d’autres pistes de compréhension et de réflexion.C’est ce que je tente dans cet exercice quotidien qui constitue un vrai travail comme l’a dit, un jour, une des destinataires de ce mot.Et si cela peut vous apporter des éléments de réflexion et des perspectives nouvelles, j’en serai très heureux.Ce que je crois, de plus en plus, c’est que nous devons avoir le courage de sortir de notre confort intellectuel quotidien fondé sur des convictions fragiles, des intuitions erronées.L’autre jour j’ai entendu un scientifique dire cette évidence, nous devons nous méfier de nos intuitions, beaucoup de découvertes ou de lois scientifiques sont violemment contre intuitives.Prenons un exemple tout simple, la science nous dit : la terre tourne autour du soleil. Quand vous êtes sur terre et que vous regardez sans a priori le ciel, les jours et les nuits, intuitivement, ce n’est pas ce que vous voyez. Vous, vous voyez le soleil qui se lève et se couche à l’horizon et qui tourne autour de la terre !Vous savez que si on n’applique pas la théorie de la relativité, nos GPS sont tous faux. Il faut appliquer un correctif directement issu de la théorie d’Einstein pour que l’information sur votre géolocalisation soit moins fausse ou plus juste selon votre point de vue. Depuis notre enfance nous avons une connaissance intuitive de la notion de «temps». Dans la théorie de la relativité, le temps au sens de notre intuition : un instant origine puis un temps qui s’écoule en heures, minutes, secondes n’existe pas. Ce qui existe c’est une durée locale, pour les personnes et les choses qui se trouvent dans un même lieu et qui se déplacent à une vitesse comparable. C’est terriblement déstabilisant cela.Et je ne vous parle pas de la mécanique quantique où toutes nos représentations du réel sont anéanties. Or, mon professeur de l’Histoire des sciences, Girolammo Rammuni qui est intelligent au sens de Michel Serres, disait : je ne monte pas dans un avion qui a été conçu par une personne qui nie la mécanique quantique. Dans notre quotidien technologique, les conséquences des lois de la mécanique quantique sont encore beaucoup plus présentes que la théorie de la relativité.Nous devons donc nous méfier de nos intuitions et essayer de trouver l’intelligence, plus précisément les femmes et les hommes qui manifestent cette intelligence qui nous permet d’avancer. -
Vendredi 2 décembre 2016
Vendredi 2 décembre 2016«El Camino»Projet pédagogique mis en œuvre à Pau sur la base d’une éducation musicaleJ’ai entendu parler de cette initiative dans cette émission de France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/un-jour-en-france/un-jour-en-france-16-juin-2016Vous trouverez plus d’informations sur le site de l’association : http://elcamino-pau.org/ :«Elle est née à l’initiative de Jean Lacoste, adjoint à la culture, le projet El Camino a été soutenu et voulu par le maire de Pau : François Bayrou qui en a confié la réalisation à Fayçal Karoui.[Fayçal Karoui est chef d’orchestre et] ne cesse de transmettre sa passion de la musique à tous, y compris aux personnes les plus éloignées de la musique symphonique. Sous son impulsion, l’OPPB a tissé de nombreux liens avec les élèves des écoles paloises, les étudiants de l’Université ou encore les habitants des quartiers prioritaires de la ville. Plus de 10.000 enfants sont accueillis chaque année lors des répétitions et l’Orchestre n’hésite jamais à prendre ses quartiers dans les quartiers, à inviter sur scène des artistes des cultures urbaines et à créer des événements jusque dans les appartements où des concerts se partagent entre voisins, avec pour seule et magnifique ambition de faire partager l’émotion musicale au plus grand nombre.C’est dans cette continuité qu’est né El Camino, un orchestre de jeunes basé sur l’expérience de l’OPPB et les liens étroits de cet orchestre avec sa ville et ses quartiers. Mettant toute son énergie au service de ce projet, Fayçal Karoui a su fédérer et il a rencontré une formidable adhésion des familles, puisque 127 enfants issus de 9 écoles et 3 quartiers, dont 2 prioritaires, participent à cette aventure depuis le 5 octobre 2015.Basé sur une pédagogie alternative et innovante, par l’apprentissage collectif de l’instrument, les enfants s’initient à l’orchestre de façon intensive (7h30 par semaine) en étant encadrés par des musiciens de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn. […]Ce programme dépasse la pratique musicale pour offrir aux enfants l’opportunité de découvrir leurs capacités et s’approprier les valeurs d’El Camino.El Camino repose sur 5 piliers :– l’absence de sélection, tous les enfants sont accueillis– l’apprentissage de l’instrument par la pratique collective et ludique– l’intensivité obligatoire et exigeante (7h30 par semaine)– une pratique dans un lieu dédié au projet, havre de paix et lieu refuge– donner un premier concert dans les 4 premiers moisL’ensemble du dispositif, comprenant le transport depuis l’école, les instruments, les cours et répétitions, les concerts, le chœur des parents, est entièrement gratuit.»El Camino reprend les bases d’un programme d’éducation musicale fondé en 1975 au Venezuela <El Sistema>. Faire de la musique et jouer en groupe auraient des résultats fascinants en termes d’intégration, de discipline, de lutte contre l’absentéisme scolaire.Il y a même un site français et qui parle d’une initiative alsacienne : http://www.elsistema-france.org/El Sistema est une réalisation formidable dont est issu un des plus grands chefs actuels Gustavo Dudamel et surtout un orchestre incroyable : The Venezuelan Youth Orchestra Simón BolívarCet orchestre rivalise avec les plus grands et ce qui est extraordinaire c’est l’enthousiasme de ces jeunes qui n’enlève en rien leur professionnalisme et la qualité de leur interprétation -
Jeudi 1 décembre 2016
« La symphonie Pathétique »Piotr Ilitch TchaïkovskiLa symphonie Pathétique est la sixième et dernière symphonie de Tchaïkovski. Léonard Slatkin et l’Orchestre National de Lyon ont interprété toutes les symphonies du compositeur russe et ont terminé samedi 26 novembre par une interprétation exceptionnelle et bouleversante de la symphonie pathétique.
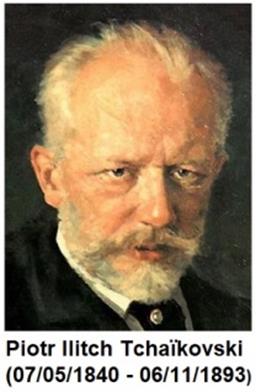 Mais l’objet de ce mot du jour n’est pas principalement la musique.
Mais l’objet de ce mot du jour n’est pas principalement la musique.
Ce que l’on sait et qui est certain, c’est que cette œuvre a été créée à Saint Pétersbourg, sous la direction du compositeur, le 28 octobre 1893 et que Piotr Ilitch Tchaïkovski est mort en pleine gloire le 6 novembre 1893, 9 jours après, à l’âge de 53 ans.
Ce qui n’est pas établi formellement mais très probable c’est qu’il soit mort du choléra, comme sa mère, alors qu’une épidémie s’était répandue dans la ville, ce que tout le monde savait.
Ce qui est aussi très documenté aujourd’hui mais a été caché longtemps c’est l’homosexualité de Tchaïkovski ainsi que son mal être et sa difficulté de vivre ses pulsions dans une société qui rejetait cette tendance sexuelle et la considérait comme une perversion insupportable.
La suite de cette histoire est plus trouble, mais la grande écrivaine russe Nina Berberova a, dans sa biographie du compositeur, développé une thèse qui se racontait de bouche à oreilles, comme un secret inavouable.
Selon Wikipedia, cette théorie fut aussi présentée par la musicologue russe Alexandra Orlova en 1979 après son émigration aux États-Unis, sur les bases de révélations qui lui furent faites en 1966 par Alexander Voitov, élève et historien du Collège impérial de la Jurisprudence de Saint-Pétersbourg.
Tchaïkovski aurait contracté le choléra en buvant en pleine conscience un verre d’eau de la Neva non stérilisée. Ce serait donc un suicide.
Cette théorie raconte l’histoire suivante : Tchaïkovski a eu une relation homosexuelle avec un jeune officier Victor Stenbock-Fermor qui était d’une famille princière liée au Tsar de Russie. L’oncle de cet officier, le prince Stenbock-Fermor, maréchal du palais a dénoncé le compositeur par une lettre au procureur.
Le scandale allait éclater, le plus grand compositeur russe vivant allait être arrêté et jugé pour cette dépravation extrême : l’homosexualité. Des amis de Tchaïkovski et des hauts dignitaires du Palais pour éviter ce scandale qui aurait touché un homme célèbre mais aussi toute la Russie ont alors trouvé la solution de réunir secrètement «un tribunal d’honneur» constitué d’anciens étudiants du Collège impérial de la Jurisprudence de Saint-Pétersbourg » pour juger Tchaïkovski. Ce tribunal aurait condamné le compositeur à se suicider.
Dans Wikipedia on lit :
« Après sa mort, il bénéficie de funérailles nationales à la cathédrale Notre-Dame de Kazan auxquelles assistent près de 8 000 personnes. Le cercueil de Tchaïkovski est porté par des proches, dont le prince Alexandre d’Oldenbourg (1844-1932), cousin de l’empereur, les frais des funérailles étant couverts par la Maison de Sa Majesté impériale. Le chœur de la cathédrale et le chœur de l’Opéra impérial russe accompagnent la cérémonie, en présence de son ami le grand-duc Constantin de Russie qui écrit le lendemain dans son Journal que « les murs de la cathédrale n’étaient pas suffisants pour contenir ceux qui voulaient prier pour le repos de l’âme de Piotr Ilitch ».
Cette histoire rappelle celle d’Alan Turing, le génial scientifique qui s’est suicidé en mangeant une pomme empoisonnée et qui avait fait l’objet du mot du jour du 31/12/2013.
En ce moment, au Maroc <Deux adolescentes sont jugées pour homosexualité parce qu’elles ont échangé un baiser>, elles risquent 3 ans de prison. Peine légère si on la compare à d’autres sanctions appliquées dans des pays théocratiques islamiques.
En France, des maires se sont opposés à l’affichage d’une campagne de prévention contre le sida, parce que les affiches montraient, de manière pudique, des homosexuels qui était la cible visée par cette campagne.
Depuis Tchaïkovski, la lutte contre la discrimination homophobe a certes progressé, parfois on a cependant le sentiment d’une régression dans notre pays, dans d’autres pays tout reste à faire.
Pour revenir à la symphonie Pathétique, Ken Russell a réalisé, en 1969, un film <The Music Lovers>, dont le titre français est «la symphonie pathétique» qui évoquait de manière explicite l’homosexualité de Tchaïkovski.
<Vous trouverez ici une belle interprétation de cette symphonie> par le grand chef russe Evgeny Svetlanov.
<798>
-
Mercredi 30 novembre 2016
Mercredi 30 novembre 2016«Les sœurs Mariposas»Minerva, Patria et Maria Teresa Mirabal assassinées le 25 novembre 1960Le 25 novembre est désormais chaque année, suite à une résolution de l’ONU, dédié à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.Plus précisément, c’est le 17 décembre 1999, par sa résolution 54-134, que l’Assemblée générale des Nations unies proclamait le 25 novembre Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. La date avait été choisie en Colombie, en 1981, par des militant-e-s des droits des femmes en hommage aux trois sœurs Mirabal, combattantes contre la dictature de Rafael Trujillo en République dominicaine, brutalement assassinées le 25 novembre 1960.C’est le Huffingtonpost qui raconte cette histoire : http://www.huffingtonpost.fr/2016/11/24/le-courageux-combat-des-soeurs-mariposas-que-celebre-la-journee/ :«Minerva, Patria et Maria Teresa Mirabal se faisaient appeler « Mariposas », papillons en espagnol. Derrière ce nom de code, il y a une lutte sans merci contre le dictateur Rafael Trujillo [qui exerçait en République Dominicaine]. […] Tout commence quand le dictateur tente d’approcher l’aînée, Minerva, qui le repousse invariablement. La jeune femme qui étudie le droit à l’université et se lie d’amitié avec des communistes est révoltée contre la terreur que fait régner Trujillo. Résultat, face aux refus de la jeune femme, son père est emprisonné et torturé. Minerva suivra le même chemin.Les années de lutte passent. Les trois sœurs se marient avec des hommes tout aussi révoltés qu’elles par les injustices de ce régime. En 1957, Minerva est la première femme doctorante de l’université de droit. Quand le dictateur Trujillo lui remet son diplôme, il lui fait la promesse qu’elle ne pourra jamais exercer.Coup d’état raté, arrestations fréquentes, tortures, voilà alors le quotidien des Mariposas et de leur entourage. Un soir qu’elles vont rendre visite à leurs maris emprisonnés (résistants, ils avaient tenté un coup d’état), sur une petite route de montagne, une voiture se met en travers de leur chemin. Les conditions dans lesquelles leurs corps ont été retrouvés sont particulièrement sanglantes: les trois femmes ont été massacrées à la machette puis replacées dans leur voiture qui a ensuite été poussée dans le vide.Les trois sœurs n’auront jamais connu la démocratie mais la nouvelle de leur mort révolte. Le 30 mai 1961, Trujillo est assassiné et il faudra encore patienter plusieurs années pour que le pays sorte de la guerre civile. Seule la quatrième sœur, Belgica Adela, leur a survécu, elle est la mémoire de leur histoire. […]La romancière Julia Alvarez a écrit un roman sur le sujet, « Au temps des papillons ». Un téléfilm avec Salma Hayek dans le rôle de Minerva a été réalisé en 2001, « In the time of butterflies ». En France, Elise Fontanaille a publié en 2013 pour un public jeunesse « Les trois sœurs et le dictateur ». En 2016, la dessinatrice Pénélope Bagieu a aussi raconté ce parcours dans son recueil de portraits de femmes, « Les culottées ».»Le 25 novembre de cette année, France Culture a rediffusé une émission de 1976 où avait été invitée Benoite Groult qui à travers l’histoire racontait l’oppression de la femme depuis l’Antiquité. Parmi les 10 exemples qu’elle donnait je rapporte le quatrième : XVIe et XVIIe siècles : la chasse aux « sorcières » : «Pendant 2 siècles on a brûlé [des milliers] de sorcières en Europe, parce que c’était un pouvoir féminin qui commençait à inquiéter la société. Chaque fois que [les femmes] ont essayé de sortir, de réagir, que ce soit les féministes aujourd’hui ou les sorcières hier, ç’a été une réaction frénétique pour les ramener à leur place. »Une autre émission de France Culture donne des précisions sur la situation actuelle en France : « En France, 15% des femmes se sont faites insultées au moins une fois, dans la rue, les transports ou les lieux publics, au cours de 12 derniers mois. Première cause de violence que subissent les femmes, les insultes les plus fréquentes sont : « salope », dans un quart des cas, « connasse », dans 19% des cas, « sale… », dans 16% et « pute », dans 13%. Les violences physiques ou sexuelles sont la seconde violence qu’elles subissent. On estime que chaque année, 84 000 femmes subissent des viols ou tentatives de viol, alors que seul 31 825 faits de violences sexuelles ont été comptabilisés sur un an, de novembre 2014 à octobre 2015, par les forces de sécurité.Dans la plupart des cas d’agressions, qu’elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, le conjoint de la victime est en cause. On dénombre, en moyenne chaque année, près de 216 000 femmes âgées entre 18 et 75 ans victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur ex ou actuel partenaire. Un chiffre qui ne tient pas compte des violences verbales, psychologiques, économiques ou bien administratives que les femmes subissent.»La journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes est donc une nécessité partout et aussi en FranceLes sœurs Mariposas -
Mardi 29 novembre 2016
Mardi 29 novembre 2016« Mettre définitivement l’homme à l’abri du besoin, en finir avec la souffrance et les angoisses du lendemain »Ambroise Croizat, ministre du Travail de 1945 à 1947C’est encore un film récent <La Sociale> de Gilles Perret qui est à l’origine de ce mot du jour qui concerne la mise en place de la Sécurité Sociale au lendemain de la guerre.
Ce sont les ordonnances du 4 octobre 1945 qui ont constitué la naissance juridique de cette magnifique institution.
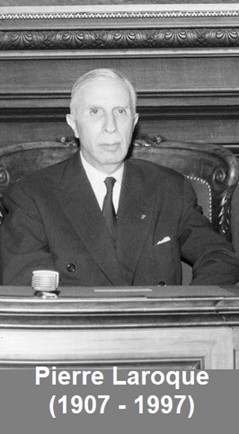 TELERAMA rappelle que l’on attribue toujours cette création à Pierre Laroque, haut fonctionnaire, le « père » officiel de la Sécu et qu’on laisse dans l’ombre, Ambroise Croizat, l’homme politique qui fut le ministre du Travail du général de Gaulle, certains prétendent que c’est en raison de son appartenance au Parti communiste. C’est aussi TELERAMA qui donne cette phrase d’Ambroise Croizat que j’ai utilisée comme exergue de ce mot du jour.
TELERAMA rappelle que l’on attribue toujours cette création à Pierre Laroque, haut fonctionnaire, le « père » officiel de la Sécu et qu’on laisse dans l’ombre, Ambroise Croizat, l’homme politique qui fut le ministre du Travail du général de Gaulle, certains prétendent que c’est en raison de son appartenance au Parti communiste. C’est aussi TELERAMA qui donne cette phrase d’Ambroise Croizat que j’ai utilisée comme exergue de ce mot du jour.
Comme les choses ne sont jamais simples et évidentes, il faut savoir que Pierre Laroque était aussi Haut fonctionnaire du Régime de Vichy.
Il était entré dans le cabinet du ministre René Belin dans le premier gouvernement du régime de Vichy, et a participé à la rédaction de la loi du 16 août 1940 sur la réorganisation économique et a suivi le dossier des assurances.
Avec Alexandre Parodi, qui fut par la suite le premier ministre du travail du gouvernement provisoire de De Gaulle, précédant immédiatement à ce poste Ambroise Croizat, Pierre Laroque rédige un projet de « réforme des législations sur les Assurances sociales, les Allocations familiales et les congés payés ». De ce projet aboutira l’allocation aux vieux travailleurs salariés qui instaure en France le régime de retraite par répartition, formant ainsi la base de ce que sera la Sécurité Sociale. Bref la sécurité sociale eut des prémices sous le Régime de Vichy et les hommes qui ont travaillé sur ce projet étaient les mêmes que ceux qui allaient le faire avec De Gaulle.
Il faut noter cependant que Pierre Laroque fut Révoqué en octobre 1940 pour des origines juives et qu’il participa à Lyon à l’organisation de résistance « Combat » et rejoignis Londres en avril 1943.
Parodi fut également résistant. Ce n’était pas deux collaborateurs, mais c’est le Régime de Vichy, si on veut respecter l’Histoire qui commença cette aventure.
Contrairement aux Ministres d’aujourd’hui, Ambroize Croizat avait un métier en dehors de la politique. Il travaille en usine dès l’âge de 13 ans lorsque son père est appelé sous les drapeaux en 1914. Apprenti métallurgiste, il suit en même temps des cours du soir et devient ouvrier ajusteur-outilleur dans la région lyonnaise. Il est mort à 50 ans d’un cancer du poumon.
Pour en dire un peu plus je voudrai revenir à une histoire que l’on attribue à Raymond Lulle philosophe, poète, théologien, apologiste chrétien et romancier majorquin (1232-1315).
« C’est l’histoire de 3 tailleurs de pierre. Ils sont côte à côte, et font exactement les mêmes gestes techniques. Mais le premier semble épuisé et triste. Je lui demande :
– Que faites-vous ?
Il me répond énervé : – ben ! Vous l’voyez bien ! Je taille une pierre !
Je regarde le deuxième, qui semble moins malheureux et moins épuisé que le premier. Je lui demande :
– Que faites-vous ?
Il me répond gentiment : – ben ! Vous l’voyez bien ! Je construis un mur !
Alors je regarde le troisième, qui lui, paraît très joyeux et lumineux. Il siffle en réalisant son ouvrage. Je lui demande :
– Que faites-vous ?
Alors il me répond avec passion : – ben ! Vous l’voyez bien ! Je construis une cathédrale ! »
C’est une histoire du moyen-âge, où on construisait des cathédrales en pierre pour la religion.
 AU XXème siècle on a construit des cathédrales non matérielles mais sociales pour L’Humanité, comme la Sécurité Sociale, pour « en finir avec la souffrance et les angoisses du lendemain » selon les mots d’Ambroize Croizat.
AU XXème siècle on a construit des cathédrales non matérielles mais sociales pour L’Humanité, comme la Sécurité Sociale, pour « en finir avec la souffrance et les angoisses du lendemain » selon les mots d’Ambroize Croizat.
Une partie des français a désigné François Fillon comme candidat à la Présidence de la République. Il est possible qu’il devienne Président. Constatons que lui contrairement à Ambroise Croizat n’a jamais eu un emploi autre que Politique. Il est devenu député à l’âge de 27 ans en 1981 et avant il était assistant parlementaire de Joël Le Theule.
Concernant la santé, il a un projet : « Offrir la meilleure couverture santé possible à tous nos concitoyens en redéfinissant les rôles respectifs de l’assurance maladie et de l’assurance privée : focaliser l’assurance publique universelle notamment sur les affections graves ou de longue durée, le panier de soin « solidaire », et l’assurance privée sur le reste, le panier de soin « individuel ». Les moins favorisés ne pouvant accéder à l’assurance privée bénéficieront d’un régime spécial de couverture accrue. Les patients seront responsabilisés par l’introduction d’une franchise maladie universelle dans la limite d’un seuil et d’un plafond.»
Je ne veux pas déformer, donc je cite intégralement et si vous voulez vérifier c’est après ce lien : https://www.fillon2017.fr/participez/sante/propositions-pour-les-patients/
En bon chrétien, les pauvres ont droit à la charité : « Les moins favorisés bénéficieront d’un régime spécial de couverture accrue.»
Mais pour les autres il y aura les affections graves prises en charge par la Sécurité Sociale publique et le reste par les assurances privées que vous paierez selon vos choix pertinents, vos moyens et votre tendance plus ou moins affirmée à la prudence par rapport à votre santé et votre volonté de sacrifier d’autres consommations à celle-ci.
Les États-Unis montrent, en grandeur réelle, ce que ce type de système produit : Une médecine de très haute qualité certes, mais une offre de soins très chers et une inégalité extrême par rapport à la santé, qu’Obama a tenté de réduire un peu.
C’est très simple à comprendre. C’est aussi évident qu’une équation mathématique.
Quand l’offre de soins est publique, l’objectif est de soigner le mieux possible au coût le moins élevé pour la collectivité.
Quand l’offre de soins est privée, l’objectif est de soigner le mieux possible en obtenant le meilleur profit pour la société privée qui assure le soin.
Je ne dis pas que le premier système ne peut pas être amélioré notamment en obtenant un coût moins élevé, mais je dis que le second système est tendanciellement plus onéreux pour la collectivité.
Quand on commence à s’attaquer aux cathédrales d’une civilisation, on peut penser que son déclin est proche.
<796>
-
Lundi 28 novembre 2016
Lundi 28 novembre 2016«Ce que j’ai ressenti, ce n’est pas l’empathie habituelle du médecin : c’est l’effroi face au crimeIrène Frachon pour l’affaire du MediatorLe film <La Fille de Brest>, consacré à l’affaire Mediator réalisé par Emmanuel Bercot est sorti le 23 novembre avec dans le rôle principal la remarquable actrice danoise Sidse Babett Knudsen qui a été révélé en France par la série danoise Borgen.Mais le vrai héros de cette histoire est Irène Frachon.Pour celles et ceux qui ne se souviennent pas précisément de cette question sanitaire, il me semble qu’on peut résumer le sujet de la manière suivante :Les laboratoires Servier ont mis au point un médicament appelé « Mediator » qui devait servir pour les diabétiques et qui a été commercialisé à partir de 1976. Mais un de ses effets a été utilisé beaucoup plus largement, car il servait de coupe-faim à tous ceux qui avait des difficultés de surpoids.Jusqu’à son retrait en 2009, 145 millions de boîtes ont été vendues et plus de 5 millions de personnes en ont consommé en France.Le problème du « Mediator » est qu’il comporte un composant : le benfluorex qui produit des dysfonctionnements des valves cardiaques.Les premières alertes à propos du benfluorex, sont apparues au cours des années 1990. Il est interdit dans les préparations en pharmacie dès 1995 mais le Mediator, lui, reste alors en vente en France, tandis qu’il est successivement retiré par Servier du marché en Suisse (1998), en Espagne (2003) ou encore en Italie (2004), « pour des raisons commerciales », argue le groupe. La France, elle, tarde. L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) ne publie d’abord en 2007 qu’une simple recommandation de ne pas prescrire le Mediator comme coupe-faim.Et c’est Irène Frachon, une pneumologue de Brest, qui alerte l’Afssaps en février 2007 sur les risques d’accidents cardiaques liés à la consommation du médicament. Ce dernier n’est retiré de la vente que le 30 novembre 2009. C’est ce combat d’Irène Frachon suivi de la lutte contre les laboratoires Servier pour reconnaitre sa responsabilité et indemniser les victimes qui est le sujet du film.Elle a beaucoup été invitée à l’occasion de la sortie de ce film. Notamment sur France Inter par Patrick Cohen, le 18 novembre 2016.Et c’est lors de cette émission qu’elle a déclaré : « Face à moi, ce n’était pas des malades, mais des gens empoisonnés. Ce que j’ai ressenti, ce n’est pas l’empathie habituelle du médecin : c’est l’effroi face au crime ».Elle a ajouté qu’elle a pu quand même compter sur la mobilisation autour de cette affaire : « l’engagement successif d’improbables citoyens, qui ont permis que cette histoire bascule », et pour aboutir à la condamnation au civil des laboratoires Servier.Le procès avait d’ailleurs été l’occasion de dénoncer les liens avec l’agence du médicament, où « Servier menait la danse et faisait la loi », selon Irène Frachon. Une institution réformée depuis, mais dont l’évolution est difficile : « recruter des experts qui ne soient pas issus de l’industrie pharmaceutique aujourd’hui, c’est quasi impossible ».Vous trouverez aussi en pièce jointe un entretien avec Mediapart dont le titre est explicite «Le Mediator, c’est l’histoire d’un déni sans fin»Irène Frachon est un exemple de ce qu’il convient de faire dans ce monde compliqué où tant de jeunes et de moins jeunes se sentent impuissants à faire évoluer les choses : Quand on est certain de détenir une vérité qui dérange souvent les puissances de l’argent quelquefois du pouvoir, il faut se battre pour que la vérité éclate et aider celles et ceux qui sont dans un tel combat.Si vous voulez en savoir plus sur Affaire du mediator le point si vous avez raté un épisodeIrène Frachon a aussi écrit un livre sur cette affaire : <Mediator 150 mg : Sous-titre-censure>.Le sous-titre censuré était celui de la première version : combien de morts ? Le laboratoire Servier est parvenu à faire interdire ce sous-titre. Mais en appel Irène Frachon a gagné le combat contre la censure. -
Vendredi 25 novembre 2016
Vendredi 25 novembre 2016« Ende der Meritokratie
La fin de la méritocratie»Alan Posener, dans le quotidien « Die Welt »Brice Couturier a donné pour titre à sa dernière chronique concernant la méritocratie : « Performants et désaffiliés : la nouvelle lutte des classes ». Et pour illustrer son propos il s’est appuyé sur un article paru en Allemagne dans le grand quotidien « Die Welt », car en Allemagne aussi, on observe une montée de la colère envers un système méritocratique qui exclut de plus en plus de personnes.Cet article a pour titre « Ende der Meritokratie » » et Brice Couturier prétend qu’il « résume de manière assez carrée toutes les critiques que suscitent en ce moment, par le vaste monde, nos démocraties méritocratiques. »Il nous apprend aussi qu’Alan Posener est connu comme biographe, il s’est intéressé à John Lennon, à Franklin Roosevelt, à John Fitzgerald et Jackie Kennedy et que son dernier livre en date, consacré à Benoît XVI, portait pour titre « Le pape dangereux ». « Posener y accusait ce pape de mener – je cite – « une croisade contre les Lumières ». Nous avons donc affaire à un intellectuel allemand réputé pour ne pas prendre de gants… »Dans la tribune qu’il a publiée le 23 juillet dernier, Posener écrit : « Michael Young l’avait bien vu : avec la méritocratie, les couches inférieures de la société allaient subir une domination plus efficace que celles connues antérieurement. »Et Brice Couturier d’ajouter : «Dans notre société où la place assignée à chacun dans la hiérarchie est théoriquement fixée par ses résultats dans le système d’enseignement, il suffit de rater une seule marche du cursus pour être éliminé. De cet échec, on déduira que font défaut chez l’intéressé l’intelligence ou le goût de l’effort – motifs suffisants pour être évincé. La nouvelle morale, celle que proclame la culture contemporaine, c’est : vous êtes seuls responsables de vos succès, comme de vos échecs. Cela rend les vainqueurs arrogants : ils n’ont pas conscience de ce que leur ascension doit à la société. Et cela rend les vaincus hargneux. Ils haïssent les élites, les bons élèves qui ont réussi à tous les examens. […] ils soupçonnent les élites d’avoir adopté sciemment des politiques qui les condamnent, eux, à l’échec : mondialisation, libéralisation, immigration…. »Et Posener utilise deux mots qui désignent les nouveaux rapports de classe : «les Leistungsträger» c’est à dire «les performants» et «les Abgehängten» qu’on peut traduire par «les décrochés».La chronique finit sur cette analyse :« Vous avez d’un côté les Leistungsträger. Un mot qui signifie normalement prestataire, mais qui renvoie dans le contexte aux gagnants. Die Leistung, en allemand, signifie en effet le bon résultat, le travail accompli, la performance. Les Leistungsträger, ce sont les champions de l’idée de bon résultat, les achievers en anglais, les gens vraiment performants.De l’autre côté, un mot nouveau, de plus en plus employé, ces derniers temps: les Abgehängten – littéralement les décrochés. Mais attention ! le verbe dont ce mot est le participe passé substantivé du verbe abhängen signifie aussi dépendre de… Les Abgehängten, cela paraît l’équivalent de celui forgé par Robert Castel : les désaffiliés. Ils ont décroché et dépendent des minima sociaux. La presse allemande l’emploie en particulier pour désigner les jeunes chômeurs.Et Posener poursuit : les Leistungsträger se réjouissent de l’ouverture des frontières, du progrès technique qui va rendre leurs compétences encore plus précieuses sur le marché du travail mondialisé. Les Abgehängten, au contraire, se considèrent comme des « indigènes » menacés par les cultures étrangères. Ils prônent la famille contre les célibataires, les valeurs contre les intellectuels.Aucune société, conclut Posener ne peut supporter longtemps qu’une importante minorité ait le sentiment de ne plus en faire partie.Signe des temps, alors que le néo-travailliste Tony Blair prônait une Grande Bretagne méritocratique, la conservatrice Theresa May veut une « Grande Bretagne qui fonctionne pour tous. » « Si nous ne voulons pas que notre démocratie se retourne contre nous, nous devons modérer la méritocratie et en élargir la base », conclut Posener.Justement est paru, cette année en français, l’ouvrage d’un universitaire italien, Giuseppe Trognon, spécialiste de philosophie politique, qui porte exactement sur ce sujet : comment rendre la méritocratie plus égalitaire ? Son titre : La démocratie du mérite. Il s’agit d’une analyse, disons rawlsienne, de la méritocratie en tant que système de récompenses des plus valeureux. Premier reproche : la méritocratie aggrave l’esprit de compétition au sein de la société démocratique. Ensuite : la méritocratie est un système de récompenses et de punition ancré dans une culture du travail et de l’effort productif ; ce qui exclut les chômeurs alors que le progrès technique chasse de plus en plus de personnes du marché du travail. Trognon constate aussi, et c’est très original, que la logique méritocratique a glissé de la sphère de la production à celle de la consommation.Au passage, Giuseppe Trognon égratigne la manière dont, en France, la méritocratie s’est glissée dans les mœurs de l’ancienne aristocratie. Il écrit : « la France raisonne encore comme un noble de la cour de Versailles : un diplôme dans les Ecoles d’excellence de l’Etat fournit des droits, comme jadis un titre nobiliaire donnait des privilèges. Il y a en France des noyaux familiaux dans lesquels tous les membres, parents et enfants, font partie de ce groupe de méritants de l’Etat. » Il a dû en rencontrer.»Vous trouverez ci-après les liens vers les 5 chroniques de Brice Couturier -
Jeudi 24 novembre 2016
Jeudi 24 novembre 2016«L’ancienne société de classe permettait du moins, quand on était en bas de l’échelle, à se sentir victimes d’une injustice. Aujourd’hui, le système méritocratique nous fait croire que nous sommes responsables de notre situation, quelle qu’elle soit.»Nick CohenLa question se pose : la méritocratie constitue t’elle une nouvelle aristocratie ?Nous sommes confrontés à ce paradoxe la méritocratie était censée favoriser la mobilité sociale, or il semble de plus en plus évident qu’elle la fige en grande partie.Brice Couturier cite encore la revue The Hedgehog Review :«Mais comme l’écrit Helen Andrews dans, « la méritocratie donna naissance à une classe entièrement nouvelle, provenant certes à la fois de la gentry et de la nouvelle classe commerciale, mais émancipée de l’une comme de l’autre. Sans affiliation. Et entre 1870 et la Première guerre mondiale, cette nouvelle classe allait prendre possession de tous les anciens piliers du pouvoir aristocratique – pas seulement la fonction publique, mais également l’armée, le barreau, le gouvernement local, les comités des partis, l’Eglise. »Mais si « la méritocratie a commencé sa carrière en détruisant une aristocratie. Elle l’a conclue en en créant une nouvelle », poursuit l’universitaire australienne. Elle fait référence aux nombreux essais qui, ces dernières années, ont pris pour cible la nouvelle méritocratie, issue de l’Ivy League. Vous savez les fameuses universités américaines MIT, Stanford, Yale, Harvard, etc. qui produisent une élite de plus en plus mondiale, puisque c’est là que les classes possédantes du monde entier tentent, désormais, de faire diplômer leurs rejetons.L’essayiste américain William Deresiewicz en a été l’un des premiers et plus véhéments critiques. L’essai qu’il publia, en quittant Yale, où il avait enseigné pendant dix ans, en 2008, était titré : « les inconvénients d’une éducation d’élite ». Il accusait les prestigieuses universités américaines de surprotéger leurs étudiants en les coupant du monde ; et surtout, de les formater en leur inculquant des idées, des connaissances et des méthodes de pensée extrêmement limitées. En sortant de ce moule à reproduire les élites, ils devenaient incapables de communiquer avec les gens ordinaires, la majorité des Américains qui n’ont pas le même background qu’eux.»Formatage, conformisme et séparatisme du reste de la population. C’est un peu le retour des «gueux» face aux «seigneurs». Cela pose un grave problème d’organisation en démocratie où les gueux ont le droit de vote.Et Brice Couturier de conclure son propos :« En 2014, Derisewicz a développé ces idées dans un livre intitulé Le troupeau excellent. Sous-titre : L’éducation ratée de l’élite américaine et la voie vers une vie pleine de sens. Deresiewicz a condensé ses critiques envers la méritocratie à travers une image : c’est « la classe mondiale des sauteurs de cerceaux ». Les « hoop jumpers », ce sont ces gens qui, imitant les animaux de cirque, s’ingénient à sauter au travers de cerceaux disposés en ligne. Eh bien, de la même façon, la méritocratie est entraînée à effectuer des opérations intellectuellement très complexes, mais selon des modalités prévues d’avance. Bref, elle est aussi conformiste que performante.Et la critique se fait plus précise : « notre nouvelle méritocratie, toute multiraciale et indifférente au genre soit-elle, a trouvé le moyen de se rendre héréditaire » écrit-il. Et c’est une des critiques qui revient le plus souvent sous la plume des méritocratophobes : la nouvelle élite, cognitive, tend à s’auto-reproduire. Elle était censée favoriser la mobilité sociale ; au contraire, elle la fige. Elle est en train de se constituer en aristocratie. Comme les anciennes aristocraties, elle vit selon des valeurs qui lui sont propres, possède une culture très particulière – culture, tout compte fait, extrêmement médiocre. Les brillants étudiants des grandes universités croient qu’on leur apprend à « penser large », sans s’encombrer de connaissances bien précises. « Le péché récurrent de l’élite actuelle, écrit Helene Andrews, c’est l’arrogance, tant au plan moral qu’intellectuel. Juste en-dessous, l’absence de sens de l’humour. »Le Britannique James Bloodworth a lancé récemment une attaque contre la méritocratie de son propre pays – sous l’angle de la mobilité sociale, dans un livre intitulé Le mythe de la Méritocratie. La méritocratie n’a-t-elle pas été préconisée d’abord dans le but de permettre aux enfants de milieux défavorisés de s’élever par le talent et le travail ? Comment se fait-il alors que dans la Grande-Bretagne « méritocratique », les chances d’un enfant de cadre d’accéder aux professions les plus prestigieuses et les mieux rémunérées soit 20 fois plus élevées que celles d’un autre, d’origine ouvrière ? D’autant qu’en Angleterre, comme en France, on constate que la massification de l’enseignement supérieur ne s’est pas traduit par une amélioration de l’égalité des chances. Bien au contraire. Les élites ont davantage tendance à s’auto-reproduire aujourd’hui que durant les années 60 et 70.Une première réponse : les occasions de promotion sont moins nombreuses aujourd’hui qu’à cette époque, qui a connu le phénomène des « cadres ». Aujourd’hui, « il y a plus de place à la base (qu’au sommet) », et moins au sommet. La seconde : plus une société est égalitaire, plus elle favorise la mobilité sociale. C’est le cas des pays scandinaves – où les destins ne sont pas écrits d’avance…Le génial éditorialiste britannique Nick Cohen fait cette remarque : l’ancienne société de classe permettait du moins, quand on était en bas de l’échelle, à se sentir victimes d’une injustice. Aujourd’hui, le système méritocratique nous fait croire que nous sommes responsables de notre situation, quelle qu’elle soit. On pouvait aspirer, avec John Lennon, à être un « working class hero». Qui voudrait être un « loser » ? » -
Mercredi 23 novembre 2016
Mercredi 23 novembre 2016«Le Modèle chinois : La méritocratie politique et les limites de la démocratie. »Daniel BellDaniel Bell est canadien et professeur à l’Université Tsinghua de Pékin. « Le Modèle chinois. La méritocratie politique et les limites de la démocratie. » est un livre qu’il a écrit et qui a été cité par Brice Couturier lors de ses chroniques sur la méritocratie. C’est un livre écrit en anglais et édité par l’éditeur de l’Université de PrincetonBrice Couturier rappelle que la méritocratie est, comme bien d’autres choses une invention de la Chine et non des européens : « Comme souvent, les Européens s’imaginent avoir découvert des institutions et des pratiques qui préexistaient depuis longtemps aux leurs. Ainsi, la méritocratie – au sens de sélection des employés de l’Etat par le biais d’examens est, en Chine, une idée aussi vieille que le confucianisme.Confucius l’avait préconisée, en effet, dès le 6° siècle avant Jésus-Christ. Et elle reçut un commencement de mise en pratique en l’an 136 avant Jésus Christ, par décision d’un empereur de la dynastie han, Wu. Huit ans plus tard, le même empereur Wu créait la première ENA de l’histoire : une Académie impériale, chargée de former et de sélectionner les mandarins à son service… Mais le système mandarinal moderne, avec son examen et ses 15 grades, date de l’an 605 de notre ère. Et il demeura en l’état en Chine jusqu’au début du XX° siècle. »Le maoïsme s’éloigna de ce modèle dans sa volonté de faire table rase. Mais la Chine actuelle se définit à nouveau comme un système méritocratique.Bric Couturier cite Daniel A. Bell qui a publié « Le Modèle chinois. La méritocratie politique et les limites de la démocratie. » et qui « définit la méritocratie, dans la tradition confucéenne, comme « un système destiné à sélectionner et à promouvoir des leaders dotés de capacités et de vertus supérieures. En Occident aussi, nous avons notre méritocratie, écrit Daniel A. Bell. C’est le service public, recruté généralement sur la base de concours d’aptitude. Mais ses membres doivent théoriquement obéir et rendre compte à des politiques qui sont, eux, des élus, choisis par le peuple. Le système chinois est différent en ce qu’on n’y fait pas de véritable distinction entre dirigeants politiques et fonctionnaires. Comme, de manière générale, dans les systèmes communistes de parti unique, c’est au sein du même personnel que se recrutent les responsables de la prise de décision et ceux chargés de leur mise en œuvre. »Brice Couturier explique que Xi Jinping, le numéro un chinois, aime opposer le système méritocratique chinois, incarnation des « valeurs asiatiques » au modèle des démocraties pluralistes occidentales, où la concurrence pour le pouvoir, est arbitrée par l’électorat. Les « valeurs asiatiques » sont censées favoriser l’harmonie par le consensus plutôt que le conflit régulé, la continuité de l’action gouvernementale plutôt que l’alternance, l’intérêt collectif et la famille plutôt que les droits de l’individu. Bref, elles sont présentées comme une alternative aux valeurs libérales démocratiques de l’Occident…Mais à côté de la Chine existe un autre modèle méritocratique asiatique qui semble beaucoup plus accompli, moins autoritaire et surtout moins corrompu : Singapour.Car le système méritocratique chinois est miné par la corruption qui atteint toute l’économie chinoise. Car nombre de promotions au sein de l’appareil du PPC ne sont pas fondées sur les mérites, mais sur l’achat pur et simple de la fonction dont le titulaire espère s’enrichir rapidement.La conclusion de Brice Couturier : « Pas très confucéen, tout ça ! »Vous trouverez la chronique intégrale derrière ce lien : <Le PCC, méritocratie confucéenne, ou Nomenklatura ?> -
Mardi 22 novembre 2016
Mardi 22 novembre 2016«A Distant Elite: How Meritocracy Went Wrong
Une élite éloignée: comment la méritocratie s’est trompée !»Wilfred M. McClay, , directeur du Centre d’histoire de la liberté à l’université d’OklahomaL’élection américaine continue à hanter nos jours et nos nuits. Il ne faut pas sur-interpréter la victoire du milliardaire mégalomane, puisqu’il se confirme que l’élection est avant tout la défaite d’Hillary Clinton. Pour être plus précis, la défaite d’Hillary Clinton dans ce qu’on appelle, les Etats pivots (swing state), ceux dont le vote n’est pas acquis à l’un des camps. C’est donc l’organisation « baroque » du vote qui a fait perdre le camp démocrate. La victoire d’Hillary Clinton au suffrage universel populaire est encore plus importante qu’on ne le pensait à la sortie des urnes : Elle dispose d’une avance de plus d’un million de voix.Une autre erreur d’interprétation serait de croire que ce sont les pauvres et les précaires qui ont voté pour Donald Trump. Le vote Trump est un vote avant tout blanc anglo saxon, des classes moyennes ayant peur d’être déclassées. Une autre constante apparaît, car qu’il s’agisse du Brexit ou du référendum français sur la constitution de l’Union européenne : un vote des campagnes et des petites villes oubliées de la mondialisation contre les métropoles où se trouvent les gagnants.Trump, qui fait partie des gagnants est arrivé à se poser en défenseur de ces populations face à Hillary Clinton qui apparaissait comme la candidate « méritocratique » qui se base sur cette croyance qu’il suffit d’être volontaire, de travailler très dur comme disent les américains, de faire des choix pertinents à certain moment de sa vie pour entrer dans le camp des « winner ». C’est cette croyance inhérente au rêve américain qui est remise en question.Brice Couturier cite :«Edward Luce, un journaliste et essayiste britannique, spécialiste des Etats-Unis, décryptait récemment pour le Financial Times, l’opposition entre Donald Trump et Hillary Clinton à travers ce prisme : la candidate démocrate, écrivait-il, est la « porte-parole de la méritocratie ». Au contraire, Trump, qui a réussi « une OPA hostile sur le Parti républicain », mise sur le ressentiment des blancs pauvres envers ce qu’ils perçoivent comme une trahison des élites. C’est le candidat anti-méritocratie. Le Parti démocrate est devenu, au fil des ans, le défenseur des femmes, des minorités ethniques et des jeunes diplômés. « De parti de classe, il s’est transformé en coalition ethnique, veillant sur la discrimination positive en faveur des non-blancs », écrit Edward Luce.Or, Obama lui-même a reconnu que « l’affirmative action » gagnerait à présent à prendre désormais pour critère les revenus plutôt que la couleur de peau. « Mes propres filles ne devraient pas en bénéficier », a dit le président sortant. Pour lui donner raison, Malia Obama vient d’être acceptée à Harvard où, Obama fut, rappelons-le, rédacteur en chef de la prestigieuse Harvard Law Review.L’éditorial de la revue The Hedgehog Review (en français Le Hérisson) est également consacré à ce sujet. La critique des élites joue un rôle essentiel dans le climat politique actuel aux Etats-Unis, y lit-on. Dans cette société traditionnellement méritocratique, où dominait l’idée qu’en se donnant du mal et en ayant un peu de chance, tout le monde pouvait réussir socialement, s’est fait jour, ces dernières années, un véritable désenchantement.Pourquoi ? D’abord parce qu’un grand nombre de gens ont le sentiment qu’au cours des années passées, les élites ont échoué. De la guerre d’Irak à la crise financière de 2008, leurs échecs se sont accumulés – sans que les responsables acceptent de reconnaître leurs responsabilités. En outre, ces élites méritocratiques ont elles-mêmes fort bien tiré leur épingle du jeu, maximisant leurs avantages, tandis que les revenus des catégories sociales moyennes et inférieures, au mieux stagnaient, au pire déclinaient.»Et puis, ces intellectuels anglo-saxons valident le diagnostic d’Emmanuel Todd :«Enfin, un système de sélection basé sur les compétences, attestées par des titres universitaires, était censé produire des dirigeants éclairés, recrutés de manière égalitaire parmi toutes les classes de la société. Ce n’est plus le cas. Les élites ont refermé la porte derrière les derniers entrants. La confiance envers la méritocratie est ébranlée.« Les membres de l’élite sont distants, toujours plus égoïstement à l’écart, lit-on dans La Revue du Hérisson. Ils sont déracinés. Leur horizon est global ; ils négligent le local et ne sont loyaux ni envers leur nation ni envers leurs concitoyens. En outre, à cause du système économique dit du « winner-take-all » (le gagnant rafle tout), les vainqueurs de la compétition sont exagérément récompensés.»Et Brice Couturier cite Wilfred McClay, dont vous trouverez l’article derrière <ce lien>, article dont j’ai utilisé le titre pour exergue de ce mot du jour :«[Wilfred McClay] rappelle que les Etats-Unis ont été fondés par des personnalités qui haïssaient les aristocraties européennes et entendaient créer une nation où les « hommes de mérite », quelles que soient leurs origines, pouvaient prétendre aux plus hautes responsabilités.»Et la conclusion documentée de Brice Couturier est la suivante :« L’historien Joseph F. Kett a étudié l’histoire de cette notion, dans le contexte américain, des Pères fondateurs jusqu’au XX° siècle. Et il en conclut que, par « mérite », les Américains ont toujours entendu deux choses assez différentes. Le mérite renvoie, pour les uns, à des capacités, – en particulier, à l’acquisition de compétences spécialisées. Pour les autres, le mérite s’acquiert par des accomplissements personnels, des prouesses qui démontrent une force de caractère. Dans un cas, un potentiel, dont on peut attendre des réalisations. Dans l’autre, des faits, des actes réellement accomplis.Si l’on suit bien Wilfred McClay, ce sont les seconds qui manquent aujourd’hui, aux Etats-Unis.Des caractères de la trempe d’Abraham Lincoln, né dans une famille très pauvre, garçon de ferme, mais autodidacte et dévoreur de livres. Des personnages qui pouvaient gravir les échelons de la vie politique en commençant par le bas, parce qu’ils démontraient, à chaque étape de leur carrière, leur capacité à prendre soin de la communauté dont ils avaient la charge.Or, la méritocratie actuelle est composée de « nomades du mérite », qui ne sent pas responsables de leurs concitoyens. Elle est recrutée par quelques grandes institutions universitaires sur la base de « tests standardisés ». Elle brandit ses diplômes comme des références l’autorisant à occuper les meilleurs postes, mais sa culture est vide et ses modes d’action, formalistes.En outre, comme l’a fait remarquer Christopher Lash, dans un livre devenu fameux, <La révolte des élites et la trahison de la démocratie>, [Dans ce livre l’auteur défend l’idée que la démocratie n’est plus menacée par les masses, mais par ceux qui sont au sommet de la hiérarchie]Les élites tendent à s’isoler du reste de la société dans des enclaves protégées. Elles refusent de prendre en considération les souffrances du reste de la population.» -
Lundi 21 novembre 2016
Lundi 21 novembre 2016«The Rise of the Meritocracy
Ascension de la meritocratic»Michael YoungLa semaine dernière la conférence d’Emmanuel Todd a pu choquer certains quand il met en avant le conformisme des élites en raison des méthodes de leur sélection, il utilise en outre le substantif péjoratif de « tri » à la place de « sélection ». Et quand il oppose à cette élite intelligente mais soumise à la norme castratrice de la pensée unique, des personnes intelligentes et créatrices qui ne font pas parties de cette élite, il ne faut pas mal le comprendre : Il ne prétend pas qu’il faille remplacer tous les membres de l’élite par des personnes tirées au sort du reste de la population pour que la situation s’améliore !Emmanuel Todd est un provocateur, il use, en outre souvent, d’une arrogance qui le rend très agaçant, mais il soulève de vraies questions. Et cette semaine je vais approfondir cette question en m’appuyant sur une série de chroniques de Brice Couturier dans son émission <Le tour du monde des idées> sur France Culture dans laquelle il quitte résolument la pensée hexagonale pour s’intéresser aux livres, aux articles, aux pensées dans d’autres pays, d’autres langues. Cette série de chroniques diffusées entre le 26 et le 30 septembre 2016 était consacrée à la méritocratie.Pour revenir à Emmanuel Todd, ce dernier a affirmé plusieurs fois sa conviction qu’une société ne pouvait pas fonctionner sans élite. Il faut une élite ! Mais plusieurs questions sont posées : Comment est recrutée l’élite ? Comment l’élite se comporte t’elle collectivement ? Quelles sont les objectifs qu’elle poursuit et quelles sont ses relations avec les membres de la société qui ne font pas partie de l’élite, comment les considère-t-elle ?Pendant des siècles, l’élite était constituée des chefs de guerre qui se reproduisaient génétiquement de manière endogène. On les appelait les nobles. Par la suite la noblesse a été remplacée, en partie, par la bourgeoisie la richesse s’est substituée à la naissance et puis on a combiné les deux méthodes : les bourgeois souhaitant également transmettre leur capital et leur pouvoir à leurs enfants.Mais peu à peu s’imposa l’idée qu’il fallait que l’élite soit désignée pour son mérite, son intelligence et son instruction. Cette idée nous parait aujourd’hui indiscutable, de bon sens !Ce système a désormais pris le nom de « méritocratie »Wikipedia donne la définition suivante :« La méritocratie (du latin mereo : être digne, obtenir, et du grec κράτος (krátos) : État, pouvoir, autorité) est un principe d’organisation sociale hiérarchique et inégalitaire qui tend à promouvoir les individus en fonction de leur mérite — démontré par leur investissement dans le travail, efforts, intelligence, qualité ou aptitude — et non d’une origine sociale (système de classe), de la richesse (reproduction sociale) ou des relations individuelles (système de « copinage »). »Brice Couturier nous apprend que« [dans] La revue américaine de critique culturelle The Hedgehog Review (La Revue du Hérisson) [On trouve] un article d’Helen Andrews, universitaire australienne, qui fait remonter le concept de méritocratie à une date et à un lieu précis : Londres, 1854. A cette époque, explique-t-elle, William Gladstone, le célèbre homme d’Etat libéral britannique, trouve sur son bureau le rapport qu’il a commandé pour une réforme du service public. La tradition du « patronage » (népotisme en français) voulait alors qu’on récompensât les plus éminentes personnalités de leur soutien aux élections en leur offrant – à eux ou à leurs protégés – des emplois publics. Des strates de fonctionnaires recrutés d’après ce principe s’étaient accumulées. Et les services de l’Etat étaient devenus couteux, désorganisés, incontrôlables.Les auteurs du Rapport, Northcote et Trevelyan, proposaient en conséquence l’organisation d’un concours annuel de recrutement de la fonction publique, sur la base de connaissances de type universitaire, portant sur des matières allant du grec ancien à la chimie. »Mais il fallait bien que quelqu’un inventa le terme de méritocratie. Et sur ce point, il ne semble pas qu’il existât de doute, l’inventeur est un sociologue et politicien britannique : Michael Young, Baron Young of Dartington (1915 – 2002).Brice Couturier explique :« Michael Young, sociologue britannique, […] aura été l’un des grands intellectuels organiques du Labour. Il est l’auteur du manifeste qui permit aux travaillistes de Clement Attlee de l’emporter, face au conservateur Winston Churchill, en 1945.Mais si son nom est revenu sur le devant de la scène dans les pays de langue anglaise, ces derniers temps, c’est à cause du livre qu’il a publié en 1958. « The rise of the Meritocraty». [Ce livre] se voulait satirique. C’était une dystopie dans le genre du roman « 1984 », qui avait valu tant de succès à George Orwell une décennie plus tôt.Michael Young avait décelé une tendance de fond à l’œuvre dans les sociétés occidentales : la tendance des élites à asseoir de plus en plus leur légitimité sur leur intelligence et leurs compétences. Or, cela ne les rendait ni moins arrogantes ni moins dominatrices, bien au contraire. A la fin de son livre, les masses, exaspérées par le mépris et l’autoritarisme de la Méritocratie, se révoltaient en l’an 2033…Michael Young combattait la méritocratie, explique aujourd’hui son fils, Toby Young, parce qu’il y voyait un moyen de perpétuer et d’accentuer l’inégalité sociale, en la légitimant par le diplôme. Mais, comme il l’écrit dans The Spectator, « une société plus méritocratique ne connaît pas nécessairement une plus forte mobilité sociale ». C’est que, dit-il, « les élites cognitives ont une fâcheuse tendance à l’auto-reproduction ».Au temps de mon père, écrit Toby Young, la gauche était égalitariste. Aujourd’hui, elle est devenue méritocratique. Or, beaucoup en conviennent: des élites recrutées sur la base d’une sélection par le diplôme peuvent se fourvoyer tout aussi allègrement que celles qui proviennent de la naissance.Et elles peuvent également privilégier leurs propres intérêts au détriment de ceux du reste de la population. C’est précisément l’idée qui nourrit les populismes d’aujourd’hui.» -
Vendredi 18 novembre 2016
Vendredi 18 novembre 2016« Le libre-échange et le protectionnisme : le consommateur contre le citoyen »Jean-Marc Daniel et François Ruffin lors d’un débatIl semblerait donc que les Etats-Unis qui ont été les chantres du libre-échange au cours des dernières décennies soient tentés par le protectionnisme.Cela me conduit à partager avec vous un débat organisé en septembre par l’émission du <grain à moudre> entre l’économiste Jean-Marc Daniel, défenseur du libre-échange et François Ruffin : journaliste, fondateur et rédacteur en chef du journal Fakir, surtout connu comme réalisateur de « Merci patron ! ». qui préconise des mesures protectionnistes pour protéger et faire revenir des emplois en France.Vous trouverez ce débat derrière ce lien : https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/le-protectionnisme-peut-il-inverser-la-courbe-de-la-mondialisationFrançois Ruffin rappelle qu’entre libre-échange et protectionnisme, il y a eu des allers retours. Et qu’il ne souhaite pas un protectionnisme général et pour toujours. Il parle plutôt d’un outil, d’un bricolage qu’il faut pouvoir utiliser de manière ciblée pour aider une politique industrielle ou de l’emploi.A cela, Jean-Marc Daniel explique que l’expérience a prouvé que l’ouverture des échanges crée de la croissance et que le protectionnisme protège des rentes et des situations acquises.Et puis il y eut ce dialogue très simple à comprendre, loin de toute technocratie et posant simplement une question fondamentale :Jean-Marc Daniel :« On vit une crise du lait. Quel est le pays qu’on montre du doigt en ce moment : C’est la Nouvelle Zélande. Parce que la Nouvelle Zélande produit 12 litres de lait par jour et par habitant. [Pourquoi arrive-t-elle à une telle productivité ?]Parce qu’il y a 30 ans, un premier ministre qui s’appelait David Lange, qui était travailliste, a supprimé toutes les aides et tous les droits de douanes en faveur de l’agriculture en Nouvelle Zélande. A l’époque la Nouvelle Zélande versait 4% de son PIB en subvention publique à l’agriculture Néo-Zélandaise. Il leur a dit : maintenant vous allez vous moderniser, vous allez vous spécialiser, vous allez répondre aux besoins des consommateurs et vous allez immédiatement pouvoir trouver des débouchés. »Alors le journaliste interroge Ruffin sur le concept du «Consommer français. » Pourquoi ne pas faire confiance au consommateur français, dans la mesure où il connait l’origine du produit, il va acheter français par conviction ?François Ruffin :« Je pense qu’il ne faut pas éliminer le citoyen au profit du consommateur. Il n’y a aucune conquête sociale dans notre pays qui ne soit passé par le consommateur ou même qui soit passé par les boycotts. C’est toujours passé par des Lois. Le repos dominical, la limitation du nombre d’heures de travail par semaine. […] Un moment il faut dépasser le cadre de l’individu et se demander qu’est-ce qu’on se fixe comme règles communes. Qu’est-ce qu’on souhaite faire ensemble.Je pense que passer par le consommateur, et s’en remettre à une démarche individuelle, en plus à un moment où il pousse son caddy […] c’est un moment ou malheureusement on réfléchit avec un porte-monnaie à la place du cerveau, surtout quand on a des moyens financiers limités. Je ne crois pas du tout qu’il faille s’en remettre au consommateur.[…Il faut du protectionnisme] pour pouvoir refaire de la politique dans le domaine industriel, se demander où produire, que produire : ces questions sont interdites selon moi, dans le régime de libre échange.»Et vous Jean-Marc Daniel vous contestez aux politiques le droit d’intervenir sur ce terrain ?«Non mais je refuse aux politiques le droit de me dicter ma conduite. Je leur refuse de me ponctionner mon pouvoir d’achat au nom d’un certains nombres de principes auxquels je n’adhère pas.Le choix d’acheter le litre de lait à 1,50 € produit dans le massif central ou le produit importé à 0,70 €, il faut le mettre sur la table. Le citoyen doit pouvoir être mis en possibilité d’être solidaire de ses concitoyens. Mais l’obliger à le faire par nécessité [non…] Le protectionnisme c’est le sacrifice d’une partie de son pouvoir d’achat. Une partie du pouvoir d’achat qui concerne, les classes les plus défavorisées.[…] On constate que les gens qui consomment le plus de produits d’importation, ce sont les ménages les plus défavorisés et les gens qui consomment le plus de produit nationaux ce sont les ménages les plus favorisés.Il y a un économiste américain qui dit la classe populaire vit en yuan, la classe moyenne vit en dollar et la classe supérieure vit en euro. […]Si on fait du protectionnisme ce sont eux qui vont être pénalisés. Le libre-échange c’est le moyen de conserver son pouvoir d’achat auquel nous tenons tous.»François Ruffin :«Je souhaite que le citoyen puisse le décider, mais pas le consommateur. Que le citoyen puisse décider quelle sera notre politique commerciale. Est-ce qu’on souhaite des paysans près de chez nous ou est ce qu’on souhaite du lait néo-zélandais. Qu’on pose cette question au niveau politique. Il y a d’autres moyens de décider qu’en laissant la décision aux gens qui poussent leur caddy.Par ailleurs, les classes populaires ce sont elles qui paient le prix de la mondialisation. Dire que c’est elle les grandes favorisées ! […].»Jean-Marc Daniel :« Le libre-échange c’est la garantie du pouvoir d’achat » […]Quand Nicolas Sarkozy a voulu instituer une taxe sur les produits chinois, il est simple de comprendre que ce n’est pas les chinois qui auraient payé cette taxe, mais les consommateurs.Le protectionnisme, c’est une ponction sur le pouvoir d’achat.On peut concevoir qu’on mette cette question au débat politique en demandant : « Etes-vous prêt à sacrifier votre pouvoir d’achat pour permettre d’avoir un autre type d’organisation sociale. Mais il faut le poser clairement dans ces termes-là. Il s’agit de sacrifier une partie de son pouvoir d’achat.»Tranquillement assis dans notre fauteuil, le ventre plein, entouré de tous nos accessoires de modernité nous pouvons adhérer intellectuellement aux propositions de François Ruffin.Mais dans l’action, dans notre comportement sommes-nous prêts à privilégier le citoyen que nous sommes censés être, par rapport consommateur que nous sommes ?Les fêtes de fin d’année s’approchent avec des magasins et des centres commerciaux qui vont être assaillis de meutes de consommateurs pour faire plaisir et se faire plaisir. Car la publicité et le discours économiste orthodoxe relayés par nos gouvernants associent la consommation avec le plaisir et se réjouissent de ce comportement de consommateur compulsif.Mon ami Jean-François de Dijon m’a envoyé ces paroles extraites d’une chanson de léonard Cohen qui vient de nous quitter la veille de l’élection américaine, paroles qui me paraissent particulièrement appropriées à notre temps :«There is a crack in everythingThat’s how the light gets in. »Il y a une fissure en toute choseC’est ainsi qu’entre la lumière. -
Jeudi 17 novembre 2016
Jeudi 17 novembre 2016«L’islam des lumières»Malek ChebelMalek Chebel était un musulman à la voix douce qui donnait une belle image de l’Islam, il vient de mourir à 63 ans, le 12 novembre 2016.
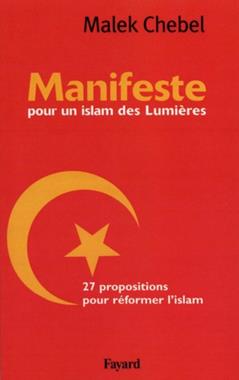 Il avait écrit notamment <Manifeste pour un islam des lumières>.
Il avait écrit notamment <Manifeste pour un islam des lumières>.
Il s’était aussi illustré pour écrire sur la sexualité dans le monde de l’Islam. En 2006, il publiait ainsi « le Kama sutra arabe » et il déclarait dans un entretien :
« J’ai pris le parti de chercher la lumière dans le monde arabe. Je suis tenu par un souci de vérité et je veux m’approcher au plus près possible de ce que je pense être cette vérité»
Sur ma tablette, je dispose de sa traduction moderne du Coran.
Le Figaro Magazine avait publié une interview qu’il avait accordée en septembre dernier.
FIGAROVOX. – Vous vous battez pour un «islam des Lumières». Quelles seraient selon vous les conditions de cet islam compatible avec la modernité? Que faudrait-il faire pour «réformer l’islam de France»?
MALEK CHEBEL. – En effet, depuis trente ans, je cherche à mettre en place ce que j’appelle l’«islam des Lumières» inspiré des Lumières occidentales, et dont la liberté de conscience, l’émergence de l’individu, la raison et l’égalité stricte de droits entre hommes et femmes sont les prérequis. Cet islam des Lumières est d’abord un islam de paix, principale garantie de son succès.
Comment le promouvoir?
Il nous faut mettre en place au profit de la France exclusivement un grand imam de France avec les attributs et/ou prérogatives suivantes :
– Être Français ;
– Être francophone ;
– Avoir suivi une formation théologique (entre la licence et le master, ou plus, si besoin est);
– Être laïc;
– Ne faire allégeance à aucune instance religieuse exogène;
– Être élu sur la base d’un programme défendu devant le plus grand nombre de musulmans français sans exclusive de sexe, d’âge ou d’origine.
Une commission indépendante se chargerait au nom de la République de donner un avis consultatif (ou de validation) pour que les musulmans trouvent le chemin du dialogue et de l’apaisement entre eux et avec les autres composantes de la nation. […]
L’islam traditionnel n’est-il pas en train de perdre la bataille au sein de l’orthodoxie sunnite, au profit d’une lecture littéraliste du Coran ?
Oui, en effet, l’islam apolitique de nos grands-parents et de nos parents a perdu la partie face à l’islam idéologisé des années 1980, puis 1990, puis 2000. Le changement structurel de génération – combien de jeunes qui «posent» problème ont moins de 30 ans actuellement? – a été un bouleversement dont les conséquences sont encore visibles aujourd’hui. Il s’agit d’un séisme profond, avec son immense faille autour de la cité. Depuis deux décennies, le combat était piloté par les fondamentalismes religieux, non seulement extérieurs à l’Hexagone, mais encore au sein même des associations périphériques. Combien de jeunes encadreurs dans le périurbain ont cherché vainement à tirer la
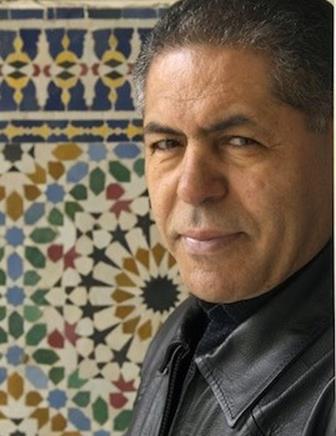 sonnette d’alarme ? […]
sonnette d’alarme ? […]
Que répondez-vous à ceux qui considèrent l’islam comme une religion intrinsèquement violente et hégémonique ?
Il y a au moins deux types d’islam, l’un violent, l’autre non. L’un est inscrit dans une longue durée. Il est vain d’en nier la dimension expansionniste et donc la violence. Cela commence par l’épopée dite arabe qui a porté le sabre jusqu’en Andalousie. Et je ne suis pas de ceux qui se voilent la face, les liens de cet islam violent avec le Califat et les chefs de l’EI sont publiquement affirmés. L’EI se réclame sans aucune ambiguïté de cet islam violent. Peu de musulmans normalement constitués l’aiment vraiment, ils l’exècrent sans ambages, et hors la peur viscérale qu’ils ruminent intérieurement, le déclameraient entre nation et République.
L’islam aujourd’hui, fait peur à nombre de Français. Comprenez-vous cette peur? Comment la désamorcer?
Cet islam fait peur à tous les Français, individuellement et massivement, car outre qu’il est foncièrement létal, il est aveugle et frappe sans discernement. À l’inverse, ce que les musulmans refusent d’admettre, c’est de considérer cette religion comme exclusivement violente, et la seule à en être «affectée». À cet effet, l’autocritique papale peut les soutenir. Enfin, pour désamorcer la peur, il faut la verser dans le grand chaudron national, en faire un travail d’appropriation national, le récit d’une tension à gérer mutuellement, tenir des forums, les animer sans les arrimer au chiffre trompeur d’une déradicalisation qui, hélas, n’a pas tenu ses promesses. Là encore, une autorité centrale de l’islam peut, avec le charisme de sa fonction, appeler au refus net et radical de la violence au nom d’Allah, ce Dieu qui est «beau et qui aime la beauté» (j’en ai fait le titre de mon dernier ouvrage), au dire même du Prophète ! »
Vous pourrez lire le reste de cette interview derrière ce <lien>.
Après ces trop nombreux mots sur Donald Trump, il fallait revenir à un homme qui portait haut les valeurs des lumières.
<788>
-
Mercredi 16 novembre 2016
Mercredi 16 novembre 2016«Jusqu’à très récemment, la folle inégalité de richesse entre les Américains était un sujet tabou.
Aujourd’hui, pour la première fois en quarante ans, on en parle, tant à droite qu’à gauche. Et là, peut-être, réside un espoir.»Philipp Meyer, écrivain, auteur de Un arrière-goût de rouille (éd. Folio) et Le Fils (éd. Albin Michel)TELERAMA a publié la réaction de 3 écrivains américains après la victoire de Donald Trump.L’un d’entre eux, Philipp Meyer, a écrit : « C’est une erreur de penser que Trump a gagné l’élection uniquement parce qu’il a fait appel au thème du racisme, à la crainte que l’Amérique devient moins blanche. Tous les candidats de droite ont toujours fait de même. Trump a gagné l’élection parce qu’il était le seul Républicain qui parlait constamment des dégâts que la mondialisation, les marchés financiers non régulés et le commerce complètement libre ont fait à l’Amérique et aux Américains. Les gens qui ont porté Trump au pouvoir sont ceux qui ont tout perdu lors des quarante dernières années passées sous le règne de politiques économiques déterminées par le marché. Les classes moyennes et populaires que la mondialisation a dévastées.De plus, Hillary Clinton n’était pas aimée. Les gens de droite la détestaient, mais ceux de gauche également. Wall Street la payait un quart de million de dollars pour chacun de ses discours. Et elle était censée remplacer Obama ? Ce ne pouvait être qu’une plaisanterie. Bernie Sanders aurait probablement gagné la nomination démocrate, mais le parti, avec l’aide de ses alliés dans les médias, y compris le New York Times, s’est assuré que ce ne soit pas le cas.Jusqu’à très récemment, la folle inégalité de richesse entre les Américains était un sujet tabou. Aujourd’hui, pour la première fois en quarante ans, on en parle, tant à droite qu’à gauche. Et là, peut-être, réside un espoir.»Le livre de Piketty sur le Capital a eu un énorme succès aux Etats Unis probablement pour cette raison : Ce pays inégalitaire et qui l’a toujours accepté commence à interroger cette réalité : N’est-on pas allé trop loin dans l’inégalité ?Cette question est très pertinente. Mais donner comme réponse Donald Trump constitue quand même un pari audacieux …D’autant que si Philipp Meyer cible dans son analyse les marchés financiers non régulés, il semblerait que Donald Trump annonce vouloir aller encore plus loin dans la dérégulation. -
Mardi 15 novembre 2016
Mardi 15 novembre 2016« Pour moi les éduqués supérieurs ne sont pas supérieurs »Emmanuel Todd conférence ISEGORIA du 8 novembre 2016Je l’avoue, j’ai eu un coup de froid avec Emmanuel Todd depuis son livre <Qui est Charlie ?> et l’invention du concept de catholique zombie.Mais, il a tenu une conférence le 8 novembre, avant de connaître les résultats de l’élection américaine, et il m’a paru à nouveau iconoclaste, brillantissime et particulièrement intéressant.Vous trouverez cette conférence derrière ce lien, Il faut immédiatement aller à la 41ème minute : https://www.youtube.com/watch?v=xZYgUwmWWVwDans une première partie, il revient sur le libre-échange dont il est un des pourfendeurs et explique l’émergence de Trump par le fait qu’il a mis en cause deux des dogmes des tenants de la globalisation : la liberté des échanges et la liberté de circulation des hommes.Il décrit la globalisation comme une vision individualiste des hommes, il n’y a que des individus qui sont soumis au marché mondial. La politique en est absente.Il reconnait l’intérêt du libre-échange au moins dans un premier temps mais rappelle que le premier moteur de ce libre échange est le désir des détenteurs des capitaux (pour ne pas utiliser le terme marxiste des capitalistes) d’augmenter le taux de profit, ce que font d’ailleurs remarquablement les multinationales américaines.Vous écouterez son développement avec intérêt.Mais le plus intéressant de cette conférence se situe à l’extrême fin de sa conférence quand il évoque la fracture entre l’élite intellectuelle et économique et le reste du peuple.Car pour revenir à l’élection américaine, comme d’ailleurs au Brexit, chaque fois on constate la même rupture entre une élite qui parle à travers les médias et le vote populaire qui ne va pas dans le sens souhaité par l’élite.Ainsi on apprend grâce au Figaro du 11 novembre que si 49% des blancs diplômés ont voté pour Trump, ce sont 67% des sans diplômes blancs qui ont voté pour le milliardaire qu’Alain Finkelkraut a simplement désigné sous l’expression <gros con>.Pour revenir à Emmanuel Todd, il se demande si les classes supérieures éduquées sont tellement supérieures intellectuellement (c’est vers 2h22). Car il conteste que l’élite prenne les bonnes options dans l’intérêt bien compris du plus grand nombre.« Nous sommes entre nous et nous pouvons le dire : le tri, la sélection des étudiants se fait sur l’intelligence peut-être mais pas seulement et vous le savez bien.Les études dont le but était initialement émancipateur, est devenu une formidable machine à trier et à tamponner la population jeune à un certain niveau pour son avenir social.Le mécanisme éducatif est devenu une machine à créer les classes sociales du futur. C’est une machine à fabriquer de l’inégalité. Et comme c’est une machine destinée à fabriquer de l’inégalité, c’est aussi devenu une machine à justifier l’inégalité.[Bien sûr], les bons élèves existent, je veux bien admettre que les gens sont plus ou moins intelligents, mais le mécanisme de tri par l’éducation et la machine sociale qui fabrique ce tri aboutissent sans doute à exagérer énormément, dans l’inconscient collectif, les différences supposées d’intelligence. […]Et le tri, particulièrement dans les études supérieures ne se fait pas que sur le critère de l’intelligence. Il se fait aussi beaucoup sur le critère de l’obéissance. Nous vivons dans un monde de concours où nous devons être le plus parfait possible.Pour être parfait, il faut être lisse, il ne faut pas penser [par soi-même].[Dans] tout le système des élites et des éduqués supérieurs, il y a de l’intelligence mais il y a aussi de la soumission comme critère de tri.Et au final, qu’est-ce qu’on obtient comme classe supérieure ?Est-ce qu’on obtient, une classe supérieure collectivement tellement remarquable par son intelligence. Cela ne me parait pas tellement évident.Qui oserait décrire la classe supérieure française comme intelligente collectivement ?Et pourtant c’est tous des super bons élèves.On peut dire la même chose de la classe supérieure de Washington. […]Il ne faudrait surtout pas croire que la stratification de la société par les niveaux d’études correspond à la description du niveau de capacité intellectuelle des populations.En haut de la société vous aurez une sur-accumulation de conformisme et de crétinisme par obéissance aux consignes reçues depuis la petite enfance.Et en bas vous aurez des gens parfaitement intelligents mais qui n’ont pas été pris dans le moule du système parce qu’ils ont un peu plus de mal à obéir. »Et il finit par cette conclusion « Pour moi les éduqués supérieurs ne sont pas supérieurs »Vous trouverez aussi une transcription de la fin de sa conférence sur ce blog : http://blog.europa-museum.org/post/2016/11/10/Une-sur-accumulation-de-conformisme-et-de-cretinismeJ’ajouterai à ce que dit Todd sur la soumission, la reproduction de plus en plus génétique des élites : on fait partie de l’élite de père en fils ou de mère en fille, car il y aussi transmission des codes, des réseaux et un meilleur apprentissage de la soumission.Cela dit je ne crois pas un seul instant que Donald Trump ait la volonté ni la possibilité de faire évoluer cet état de chose.Bien au contraire. -
Lundi 14 novembre 2016
Lundi 14 novembre 2016« Hillary Clinton n’a pas gagné les élections présidentielles malgré Donald Trump »Pensées personnelles sur les élections américaines.Et le 9 novembre au matin, nous apprîmes que le 45ème Président des Etats-Unis ne serait pas une femme, mais l’extravagant Donald Trump.Le 9, le 10 et bien sûr le 11 novembre il n’y eut pas de mot du jour.Certains m’ont écrit des messages et des questions inquiètes : La victoire de Trump m’avait-elle plongé dans un tel état de sidération que je m’étais réfugié dans le silence ?Cette hypothèse n’est en rien farfelue, mais elle est fausse.Le dernier mot du jour sur la « politique post vérité » dont l’intérêt ne vous a certainement pas échappé était fort long et il fallait lire jusqu’au bout pour arriver à cette phrase : « Je vais prendre quelques jours de congé, le prochain mot du jour sera envoyé le 14 novembre 2016. ».Il y a quelques années, j’avais fait un stage à Paris sur la lecture rapide. Une idée force que j’ai retenue pour appréhender un livre ou un texte long : il faut toujours lire le début et la fin, pour le milieu on se débrouille…Quand on a le temps et l’intérêt on le lit attentivement, sinon on le survole de plus ou moins haut.Donc pour ce premier mot du jour après l’élection que dire ?J’ai hésité, d’abord, entre un mot de Gramsci et le titre d’un journal conservateur iranien.La phrase de Gramsci est la suivante : « L’ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas à voir le jour, dans ce clair-obscur surgissent les monstres. ». (Les Cahiers de Prison, Cahiers 3, Ed. Gallimard Paris, 1983)Sidération est le mot qu’il convient d’appliquer aux gouvernants des pays occidentaux suite à cette élection qu’ils n’espéraient pas et à laquelle ils ne croyaient pas. Même la Russie de Poutine exprime beaucoup de réserves bien que Donald Trump ait exprimé sa volonté de sortir de l’opposition avec son pays et de trouver un « bon deal » (mot qui lui est cher) avec la Russie. Mais Poutine n’aime pas les personnes imprévisibles.Pour trouver des forces politiques qui se réjouissent il faut essentiellement chercher du côté des extrémistes comme Marine Le Pen, Beppe Grillo ou des conservateurs iraniens.Un autre mot du jour auquel vous avez échappé est ainsi : « La victoire du fou sur la menteuse ; un autre exploit de la démocratie libérale » qui est le titre d’un quotidien ultraconservateur iranien Kayhan.Beaucoup de choses ont été écrites sur cette élection depuis le 9 novembre.D’abord pour souligner le côté baroque d’une élection indirecte où Hillary Clinton, bien qu’ayant obtenu plus de voix que son rival, a été déclarée vaincue à cause du système des grands électeurs qui organise l’élection.Ensuite, certains affirment que Clinton a été vaincue parce qu’elle est une femme et qu’après avoir élu un noir, voter pour une femme c’était trop progressiste pour être acceptable. Peut-être…Le vote est un vote blanc affirme d’autres ! C’est vrai, les blancs ont voté à 58% pour Trump, alors que les noirs à 88% et les hispaniques à 65% ont voté pour Clinton.Il y a aussi eu un vote religieux, les protestants ont voté à 58% et les catholiques à 52 % pour Trump. Les chrétiens ont donc voté pour quelqu’un se situant très loin de leurs valeurs. Toutes les autres religions et les sans religions ont voté à moins de 30% pour Trump, les juifs à 24%.Toutes ces statistiques totalement impensables en France sont parfaitement acceptées et détaillées aux Etats Unis.Les femmes ont quand même voté à 54% pour Clinton, mais pas les femmes blanches qui ont voté majoritairement pour Trump !Trump aurait dû être battu, puisqu’il a eu des propos qui aurait dû dresser contre lui l’unanimité des femmes, des noirs et des hispaniques. Or ce ne fut pas le cas !En outre, ses compétences pour le job ne sont pas évidentes.Alors ont peu avoir une vision moraliste, comme beaucoup d’analystes mais je ne crois pas que cela permet de comprendre le monde et surtout pas cette élection.En 2008, Obama a battu Mac Cain en obtenant 69,5 millions de suffrage contre près de 60 millions pour le Républicain.Et en 2012, Obama obtint près de 66 millions de voix contre 61 millions à Mitt Romney.Hillary Clinton a obtenu, en 2016, 60 839 922 voix et Trump 60 265 858 voix soit moins de voix que Mitt Romney, il y a 4 ans. Trump a eu à peine quelques voix de plus que Mac Cain en 2008, alors que ce dernier a été largement défait par Obama.Ce qui s’est passé, ce n’est pas l’élection de Trump, c’est la défaite d’Hillary Clinton !Trump a juste su conserver le vote républicain traditionnel malgré ses positions iconoclastes par rapport aux valeurs des républicains fondamentalistes.Hillary Clinton a perdu alors qu’elle avait en face d’elle un homme qui aurait dû être rejeté par les femmes, les religieux, les minorités ethniques etc.Alors on peut revenir sur les défauts d’Hillary Clinton. Mais fondamentalement quelle était l’opposition entre Clinton et Trump ?Clinton avait une vision plus sociale mais surtout ne voulait rien changer sur les fondamentaux économiques et le libre-échange.Or Trump a eu un discours très clair pour le protectionnisme, l’arrêt de l’immigration et la diminution de la couteuse politique d’intervention militaire des USA dans le monde.Bernie Sanders, avec des moyens tout à fait différents et des solutions de redistribution très éloignées des conceptions de Trump, développait la même critique de fond sur le système économique.Les Etats-Unis sont toujours très en avance sur les autres pays.La globalisation est essentiellement l’œuvre des anglo-saxons et surtout des américains. Cette globalisation s’est basée sur le libre-échange, la libre circulation des marchandises et des capitaux, à un degré moindre la libre circulation des hommes.Le libre-échange permet une plus grande production de richesses et dans un premier temps elle permet aux classes moyennes des pays développés d’augmenter son pouvoir d’achat parce que les produits vendus sont moins chers.Mais maintenant, les choses sont claires, à moyen et long terme le libre-échange ne profite, dans les pays développés, qu’à une minorité.C’est ce dont s’aperçoivent les américains, les salaires stagnent voire régressent. Si des esprits « modernes », comme Alain Juppé par exemple qui dit vouloir appliquer en France des recettes qui ont marché ailleurs, se fondent sur le taux de chômage très bas aux Etats-Unis ils se leurrent ou ils nous trompent.Le taux de chômage officiel aux Etats-Unis est de 5% environ alors qu’en France il est de 10%. Mais le chômage s’analyse comme le nombre de personnes qui cherchent officiellement un emploi.Il existe une autre manière de quantifier, bien plus solide pour analyser ce qui se passe dans la société économique, c’est de mesurer dans la population des personnes en âge de travailler le taux d’individus qui n’ont pas d’emploi.Et dans cette mesure on verra que les Etats-Unis ne font pas mieux que La France et même plutôt moins bien. Vous pouvez, par exemple, lire cet article : http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2015/05/20/un-taux-de-chomage-plus-eleve-aux-etats-unis-qu%E2%80%99en-france/Quand on fait cette mesure, on inclut dans les sans emploi, des personnes qui ont choisi de ne pas travailler, peut-être des femmes, voire des hommes au foyer, mais on approche aussi le nombre de gens exclus, découragés et qui ne tentent même plus de trouver un emploi.Les blancs sont privilégiés aux Etats-Unis, vous constaterez cependant si vous lisez cet article réservé aux abonnés du Monde que le taux de mortalité a augmenté aux Etats-Unis au sein de la population blanche non éduquée.En dehors des positions moralistes qui se défendent car certains des propos de Trump sont odieux et inacceptables et son rejet du réchauffement climatique constitue un danger supplémentaire pour l’humanité, il faut constater cependant que des américains avaient des raisons sérieuses de rejeter le statu quo économique que leur proposait Clinton.Ont-ils pour autant eu raison de permettre à Trump d’accéder aux plus hautes fonctions ?Et Trump fera t’il ce qu’il a dit ?L’avenir nous renseignera sur ces deux points.Je dois l’avouer, je suis très pessimiste -
Mardi 08/11/2016
Mardi 08/11/2016« Post-truth politics »
La politique post-véritéKatharine Viner rédactrice en chef du GuardianC’est donc aujourd’hui que les états-uniens vont choisir leur 45ème président, Barack Obama ayant été le 44ème.Dans le mot du jour d’hier était évoqué le concept de « l’ère post-vérité » dont Donald Trump est un des meilleurs pratiquants. Mais ce sont des anglais qui ont inventé ce concept suite au Brexit, en constatant que les principaux arguments qui ont été utilisés pour convaincre les britanniques de voter pour le Brexit étaient des mensonges par exemple que l’intégralité de la contribution britannique à l’Union européenne pourrait être utilisé pour améliorer leur système de santé alors qu’aujourd’hui cette masse d’argent ne servirait à rien aux habitants de Grande Bretagne.<C’est par une émission des matins de France Culture que j’ai été sensibilisé à cette réalité> où la vérité ne semble plus présenter aucune importance. C’est à dire que l’homme politique peut dire n’importe quoi, que des sites nombreux et documentés prouvent que ce qu’il dit est faux, mais que cela ne présente aucune importance par rapport aux votes des citoyens.C’est pour moi une grande déception. J’avais pensé qu’Internet permettrait de combattre le mensonge notamment politique. Force est de constater que ce n’est pas vrai. Le journaliste Hubert Guillaud l’explique par cette formule : «la vérité devient une opinion parmi d’autres »L’émission de France Culture présente le sujet de la manière suivante : « L’alliance involontaire entre les populistes conservateurs et les géants de l’internet n’est pas sans conséquence sur notre vie démocratique : à l’heure de la politique en ligne, doit-on faire le deuil de la vérité ?Ce sont deux articles du quotidien londonien The Guardian et de l’hebdomadaire anglais The Economist qui ont fait grand bruit outre-manche et ont lancé ce débat. Alors qu’on pensait intuitivement que l’armée de commentateurs vigilants des réseaux sociaux et la mémoire infinie offerte par internet allait contraindre les hommes politiques à plus de prudence dans leur parole publique, il apparaît avec l’ascension de Donald Trump et la victoire surprise du Brexit en Angleterre qu’il n’en est rien. Mal surveillés par des journalistes, incapables d’allier l’info en continu et un travail approfondi de vérification, misant sur la liberté d’expression totale offerte par les réseaux sociaux, les populistes ne s’embarrassent plus de précautions et répandent dès qu’ils le peuvent exagérations, demi-vérités, rumeurs et mensonges. Aidés par des algorithmes conçus pour orienter les internautes vers des contenus susceptibles de leur plaire, ils bénéficient d’une caisse de résonance nouvelle et, à en croire les grandes tendances électorales, redoutablement efficace.Nous recevons pour en parler Gérald Bronner, sociologue, auteur de « La Démocratie des crédules » (Editions PUF) , et en deuxième partie d’émission, Cédric Mathiot, journaliste et créateur de la rubrique « Désintox » du journal Libération, qui a publié “Petit précis des bobards de campagne” (Editions Presses de la Cité) en 2012.»Katharine Viner, rédactrice en chef du Guardian a en effet publié un article analysant comment la technologie bouleverse la vérité (un article que vient de traduire Courrier International). Article que mon ami Jean-François de Dijon m’a également signalé. Il m’a d’ailleurs envoyé le scan de cet article que je joins à l’article.J’ai trouvé un autre long article qui approfondit ce sujet et dont je vous cite de très larges extraits :« L’article de Katharine Viner nous explique qu’à l’heure des réseaux sociaux, la vérité ne compte plus. La journaliste prend notamment l’exemple du Brexit détaillant le fait que les arguments de ceux qui ont fait campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l’Europe se sont écroulés le lendemain même de l’élection. « Le Brexit a été le premier scrutin d’une nouvelle ère, celle de la politique post-vérité. Les partisans du maintien du Royaume-Uni dans l’UE ont bien – mollement – tenté de démontrer les mensonges du camp adverse en s’appuyant sur des faits, mais ils ont vite découvert que les faits ne pesaient pas lourd dans les débats».Pour elle, la presse eurosceptique a fait feu de tout bord pour créer un lien émotionnel qui l’a largement emporté sur la présentation factuelle de l’autre camp. Et les réseaux sociaux notamment ont renforcé l’absence de consensus, l’absence de vérité partagée. Les rumeurs et les mensonges l’ont emporté sur les faits. « A l’heure du numérique, il n’a jamais été aussi facile de publier des informations mensongères qui sont immédiatement reprises et passent pour des vérités. » Pour la journaliste, combattre cette escalade de désinformation nécessite des organes de presse fiables pour parvenir à dissiper les rumeurs…C’est oublier peut-être que l’enjeu, en fait, n’est pas la vérité. Dans les conversations et les rumeurs que l’on colporte, la vérité n’a pas sa place…. « Les gens relaient les opinions des autres, même s’il s’agit de mensonges ou d’informations fallacieuses ou incomplètes, parce qu’ils ont le sentiment d’avoir appris quelque chose d’important », explique Danielle Citron spécialiste du harcèlement en ligne.Et les algorithmes des médias sociaux qui nous enferment dans nos bulles de filtres nous proposent une vision du monde soigneusement sélectionnée pour aller dans le sens de nos croyances et de nos convictions, nous éloignant de toutes réfutations. Sur Facebook, Tom Steinberg (@steiny), le fondateur de MySociety, au lendemain du Brexit, disait : « Je cherche activement des gens qui se réjouissent de la victoire des pro-Brexit sur Facebook, mais les filtres sont tellement forts et tellement intégrés aux fonctions de recherche personnalisées sur des plateformes comme Facebook que je n’arrive pas à trouver une seule personne contente de ce résultat électoral, et ce alors que près de la moitié du pays est clairement euphorique aujourd’hui »… Pour lui, il y a là un facteur de division extrêmement grave de la société : « nous ne pouvons pas vivre dans un pays où la moitié des gens ne savent strictement rien de l’autre moitié ».Pourtant, peut-on accuser seulement les réseaux sociaux et la personnalisation algorithmique de cette évolution ? Nos bulles de filtres et nos chambres d’échos sont-elles les seules responsables de cette évolution ?Pour Emily Bell, directrice du Tow Center for Digital Journalism de l’université de Columbia, les organes de presse ne contrôlent plus la diffusion de leurs contenus. Et les réseaux sociaux concentrent un pouvoir d’accès à l’information qui n’a jamais existé jusqu’à présent. A l’image de ce que révélait la récente grande enquête du New York Times Magazine montrant la puissance de nouveaux médias politiques qui fabriquent du contenu uniquement pour Facebook, dont le but n’est pas d’attirer les internautes vers des articles, mais de développer le partage et les revenus, sans aucune déontologie en faveur de la prudence ou la véracité de l’information. Comme le soulignait la lecture par Xavier de la Porte de cet article : « ces sites privilégient ce qui choque (…). Ils fabriquent des mèmes (c’est-à-dire des motifs que les internautes vont utiliser, détourner, partager). (…) Ils ne poursuivent pas tous un but politique », mais parfois seulement un but commercial, où le clic est le seul modèle d’affaires.Katharine Viner pointe la même dérive des contenus taillés sur mesure pour ces outils sociaux, cette junk food news… Pour elle « trop d’entreprises de presse mesurent leurs contenus en termes de viralité au détriment de la qualité ou de la vérité ». Les rumeurs et les mensonges circulent plus rapidement du fait de leur caractère sensationnel. L’important n’est plus que les histoires soient vraies, mais que les gens cliquent ! Pour Katharine Viner, « l’ère des faits est révolue ».[…] Katharine Viner analyse ce changement depuis la presse : la presse en ligne s’appuie sur un modèle fondé sur le nombre de clics, l’audience. Or, dans cette logique, face à des contenus conçus pour la viralité, la presse ne peut que perdre la bataille de la vérité. La solution repose-t-elle sur un nouveau modèle économique de la presse, comme l’appelle de ses vœux la journaliste ? C’est certainement croire trop rapidement que les nouveaux acteurs de l’information qui exploitent très bien ces outils sociaux relèvent d’un projet éditorial de type presse… Or, comme le montrait l’enquête du New York Times, l’objectif de ces nouveaux acteurs et la façon même dont fonctionnent les médias sociaux n’est pas exactement le même que ceux d’un média.L’enjeu ne semble pas tant de renforcer la déontologie de la presse que de laisser le champ libre à ces acteurs qui exploitent les médias sociaux, sans avoir toujours réellement des liens avec une forme de presse. Plus que de définir le rôle des médias dans un espace public fragmenté et déstabilisé, l’enjeu tient peut-être plus d’évoquer ces nouveaux objets médiatiques qui utilisent les réseaux sociaux pour démultiplier leur audience. […]Pour le spécialiste Jayson Harsin, c’est un ensemble de conditions convergentes qui ont créé les conditions de ce nouveau régime de post-vérité explique-t-il dans un article publié dans la revue Communication, Culture & Critique. Pour lui, ces changements ne relèvent pas seulement de la responsabilité des réseaux sociaux. Mais tiennent aussi du développement de la communication politique professionnelle et du marketing politique. Ils relèvent également du développement des sciences cognitives et comportementales et du marketing qui permet l’utilisation stratégique des rumeurs et mensonges de manière toujours plus ciblés, de la fragmentation des médias et des gardiens de l’information centralisée ; de la surcharge d’information et son accélération ; ainsi que des algorithmes qui régissent, classent et personnalisent l’information à laquelle on accède. Un ensemble d’éléments convergents qui empêche un retour à des formes antérieures de journalisme, comme l’appelle Viner.Comme le souligne Harsin, même l’explosion du fact checking, cette pratique de vérification des arguments, n’a pas été capable de rétablir l’autorité des médias. Pire, estime-t-il, les rumeurs prennent une place de plus en plus importante dans l’économie de l’attention… Pourtant, souligne le chercheur, la surcharge informationnelle et la démultiplication de l’information ne sont pas des explications suffisantes. « La géographie de l’information et de la vérité s’est déplacée comme la temporalité de la consommation de médias : elle n’est plus délivrée le matin ou le soir, mais elle est composée de millions d’alertes et de vibrations (…) et les informations se déplient dans une économie de l’attention de plus en plus chargée affectivement et constamment connectée ». Pour Harsin, c’est la marque d’un changement du régime de vérité au profit de marchés dédiés qui produisent, planifient et managent l’information par l’entremise de l’analyse prédictive. L’information tient désormais plus d’un marché que d’un espace public et citoyen. […]Dans le New York Times, l’économiste britannique William Davies (@davies_will), revient également sur ce sujet. Les acteurs de la production d’information se sont démultipliés, rappelle-t-il. « Si les journaux peuvent tenter de résister aux excès de la démagogie populiste, ils ont plus de mal à répondre à la crise des faits », c’est-à-dire à l’inflation des sources, des études… dont le niveau de crédibilité est trop insuffisamment évalué.[…] Or, souligne Davies, nous sommes au milieu d’une transition qui nous fait passer d’une société de faits à une société de données. Selon lui, la confusion règne autour de l’état exact des connaissances et des chiffres dans l’espace public, exacerbant le sentiment que la vérité elle-même est en train d’être abandonnée. Pour Davies, nous sommes confrontés à un volume sans précédent de données, mais celles-ci sont surtout utilisées pour recueillir le sentiment des gens. Les marchés financiers eux-mêmes ne sont plus tant des faits que des outils d’analyse des sentiments des investisseurs. « Une fois que les chiffres sont considérés comme des indicateurs de sentiment plutôt que comme des déclarations sur la réalité, comment pouvons-nous avoir un consensus sur la nature des problèmes sociaux, économiques et environnementaux ou pire encore, nous entendre sur les solutions à y apporter ? » Les mensonges et les théories du complot prospèrent donc. Et tandis que nous avons toujours plus de moyens pour mesurer combien de personnes croient en ces théories, il semble que nous ayons de moins en moins de moyens pour les persuader de les abandonner.[…]Dans une tribune livrée à FastCoExist, [l’essayiste Douglas Ruskoff] rappelle que les promoteurs des nouvelles technologies ont longtemps pensé que le numérique allait nous aider à nous connecter au monde entier, annonçant, un peu naïvement, une nouvelle communauté mondiale de pairs promettant de nous libérer des frontières entre les hommes… Ce n’est pas ce qui est vraiment arrivé.Loin de seulement abêtir les foules comme on le lui reproche facilement, la télévision a créé une société plus ouverte, plus globale. Grâce à la télévision, les gens ont pu voir pour la première fois comment la vie se déroulait ailleurs. « La télévision nous a tous connectés et a brisé les frontières nationales », estime-t-il. Or, pour Ruskoff, l’environnement des médias numériques est différent : il repose d’abord sur la polarisation et la distinction. Les médias numériques valorisent des choix binaires : ce que vous appréciez ou n’appréciez pas, ce avec quoi vous êtes d’accord ou pas, noir ou blanc, riche ou pauvre. Leur fonctionnement favorise une boucle de rétroaction qui auto-renforce chaque choix que nous faisons, qui personnalise nos contenus et nous isole davantage dans nos propres bulles de filtre. « L’internet nous aide à prendre parti » – pourtant, il faut rappeler que cette question de la polarisation reste discutée. Ce qui est sûr, c’est que les médias numériques offrent un environnement très différent de celui de la télévision.[…] Force est de reconnaître que pour l’instant, les solutions au problème sont plutôt rares. Certes, on peut améliorer la vérification des faits. Nombre d’entreprises développent des outils permettant de mesurer la fiabilité de l’information. Pas sûr pourtant que cela ait beaucoup d’impact sur tous ceux qui ont d’autres motivations que propager la vérité. Les appels à améliorer la qualité de l’actualité associent surtout des médias traditionnels qui sont, finalement, assez peu les moteurs de cette détérioration. Si la réponse est vertueuse, la cible ne semble pas être adaptée au problème, à l’image de la coalition récente First Draft News. En fait, comme le souligne Clay Shirky dans le New Scientist, nous ne sommes pas dans une guerre de l’information, mais dans une guerre culturelle. Le problème de ces réponses est qu’elles n’abordent qu’une partie du problème. Avancer un argument politique qui porte n’a pas grand-chose à voir avec la vérité. L’émotion et l’autorité comptent tout autant, sinon plus, que la vérité. Nous ne sommes plus à l’ère de la post-vérité, mais bien à celle du mensonge éhonté, où la vérité devient une opinion parmi d’autres…»Vous trouverez l’article complet écrit par Hubert Guillaud derrière <ce lien>Je vais prendre quelques jours de congé, le prochain mot du jour sera envoyé le 14 novembre 2016. -
Lundi 07/11/2016
Lundi 07/11/2016« Une par une, les digues ont sauté. »Sylvie Kauffman, à propos des élections américainesJamais nous ne pensions que ce personnage grossier qui passe son temps à insulter et à proposer des solutions anachroniques, qui dans sa longue vie d’affaires et personnelles a accumulé des casseroles, des faillites, des comportements odieux ne sortirait des primaires républicaines. Et pourtant Donal Trump l’a fait.Nous pensions qu’enfin après la vidéo montrant sa manière de considérer et de parler des femmes, il n’existait plus aucune chance qu’il puisse emporter l’élection présidentielle américaine.Les gens raisonnables continuent à penser, que ses chances pour l’emporter sont faibles, mais ils ne l’excluent plus depuis que par la décision du Directeur du FBI, l’enquête sur les courriels diplomatiques de Hillary Clinton a été relancée, même si hier soir, on apprenait que le FBI maintenait sa position de ne pas poursuivre Hillary Clinton. Cette position est a priori favorable à la candidate démocrate, mais Hillary Clinton reste très critiquée et détestée.Pour celles et ceux qui ne suivent pas l’actualité, rappelons les faits (les autres pourrons sauter ce paragraphe vert).Hillary Clinton a envoyé des mails diplomatiques alors qu’elle était Secrétaire d’État par l’intermédiaire d’outils personnels, alors qu’elle devait le faire par le canal des outils de l’appareil D’État des États-Unis. Selon le contenu des mails, cela peut constituer une faute très grave contre la sécurité des États-Unis. Il semblait que cette affaire était plus ou moins enterrée.Mais une et peut être même la plus proche collaboratrice d’Hillary Clinton, Huma Abedin de père Indien ayant travaillé pour l’Arabie saoudite et d’une mère pakistanaise, a eu la bonne idée d’épouser un politicien démocrate Antony Weiner qui s’est révélé être un personnage ayant des mœurs et des comportement sexuels que la morale et aussi la Loi américaine réprouvent.Dans le cadre d’une enquête pénale, car il est reproché à Antony Weiner d’avoir envoyé des messages sexuels à une adolescente de 15 ans, la police a découvert sur l’ordinateur de Weiner, un grand nombre des mails diplomatiques d’Hillary Clinton.C’est cette découverte qui a poussé le Directeur du FBI, James Comey a écrire à des élus, vendredi 28 octobre, pour les informer que ses équipes allaient de nouveau enquêter sur l’affaire de la messagerie privée d’Hillary Clinton, dans une lettre rendue publique par des élus républicains du Congrès.Barack Obama s’est exprimé et a fortement critiqué James Corney, qui est républicain et qu’il a nommé responsable du FBI (ce sont les mœurs américaines), d’être intervenu dans la campagne électorale si tardivement sans pouvoir présenter des accusations précises.L’article de la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann : « Le duel Trump-Clinton passera sans doute à la postérité comme la campagne qui a ébranlé la démocratie » que vous trouverez en pièce jointe m’a paru très intéressant et c’est pourquoi je le partage avec vous.« […] Dans les officines de propagande russes et chinoises, c’est la fête. Inutile de se creuser la tête pour dénicher des angles d’attaque contre la démocratie aux Etats-Unis : le spectacle offert par les chaînes de télévision américaines sur la campagne pour l’élection présidentielle du 8 novembre suffit largement. Il n’y a qu’à se baisser pour ramasser. Parfois très bas, mais le résultat n’en est que plus efficace.Le président russe, Vladimir Poutine, a donc beau jeu de relever, comme il l’a fait fin octobre à Sotchi, que le débat électoral américain se résume à « qui a pincé qui, et qui couche avec qui ». Chez lui, les campagnes ont quand même plus de tenue.Même souci de dignité dans le quotidien du Parti communiste chinois (PCC), Global Times, qui rappelle que les Etats-Unis aiment à voir dans leur système « l’étalon or de la démocratie ». « De plus en plus d’Américains ont honte de cette version de la démocratie, écrit un universitaire de Shanghaï. Les Chinois peuvent évaluer le système démocratique américain à l’aune de cette élection. » […]Le plus grave, c’est que les méthodes populistes du candidat républicain, Donald Trump, dans cette campagne, ont fini par attaquer les fondements mêmes du système. Des digues ont sauté.Traditionnellement, les Américains sont fiers de leur système : leur pays est, après tout, la plus grande démocratie du monde occidental, la fameuse « ville sur la colline » promise par les Pères pèlerins, chère au cœur de Ronald Reagan, qui devait servir de phare au monde libre.Cette image, déjà mise à mal par la relation entre l’argent et la politique, s’est brisée. Selon un sondage publié par le New York Times et la chaîne CBS à quelques jours du scrutin, 82 % des électeurs avouent que la campagne leur a inspiré du « dégoût ».[…]Désarçonnés par la méthode Trump, qui fait de l’insulte et du mensonge une arme tactique, débordés par les réseaux sociaux, les médias classiques se sont retrouvés plongés, et largement impuissants, dans ce qu’ils ont baptisé « l’ère post-vérité ».Percevant le candidat républicain comme un danger, voire un ennemi qui les désigne volontiers à la vindicte des militants dans ses meetings électoraux, les journalistes de presse écrite ont jeté aux orties la sacro-sainte règle de l’objectivité, pour passer au journalisme de combat.[…] Dean Baquet, le directeur de la rédaction du New York Times, [a expliqué que] « Ce mélange d’information et de divertissement peut être drôle, sauf que maintenant on a un candidat officiel du Parti républicain à l’élection présidentielle qui est un produit de ce monde.»Et je trouve cette conclusion de Sylvie Kaufmann très pertinente et inquiétante :« Il serait faux, toutefois, de croire que ce grand malaise démocratique est apparu comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu : en réalité, prélude à la tornade Trump, l’orage gronde depuis plusieurs années sur Washington, où les dysfonctionnements de l’Etat fédéral bloquent la vie politique. Mais comme dit l’adage, il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. »Car, en effet, Hillary Clinton est une très mauvaise candidate pour la présidence des Etats-Unis. Son seul atout finalement est d’être une femme, peut être la première femme présidente. Elle a, grâce à sa fondation, injecté des sommes beaucoup plus considérables que Trump dans cette élection. Elle est liée aux pires affairistes de Wall Street, c’est que lui a reproché Bernie Sanders d’ailleurs.Wikileaks a publié des emails dans lesquels apparaît sa duplicité : des discours publics très éloignés de ce qu’elle exprime dans des rencontres avec les grands établissements financiers dont Goldman Sachs.C’est pourquoi la grande majorité des américains ne l’aiment pas. Elle est le symbole de l’establishment qu’ils rejettent de plus en plus fort. Ce rejet de l’élite n’est d’ailleurs pas limité aux Etats-UnisBref en simplifiant, mais sans déformer, les américains ont le choix, le 8 novembre, entre un déséquilibré et une corrompue. C’est un choix compliqué.A priori, il vaut peut-être mieux la corrompue, c’est peut-être moins dangereux, mais c’est quand même une corrompue ! -
Vendredi 04/11/2016
Vendredi 04/11/2016«Les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d’une enquête sérieuse destinée à nourrir un débat d’intérêt général sur le fonctionnement d’un mouvement politique».Cour de Cassation à propos de l’enquête de la journaliste Claire Checcaglini sur le Front NationalJe crois que c’est la première fois que le mot du jour est un extrait d’un arrêt de la Cour de Cassation. Il s’agit de l’Arrêt n° 4638 du 25 octobre 2016 (15-83.774) de la chambre criminelle de la Cour de cassation que vous trouverez derrière ce lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/4638_25_35391.htmlCet arrêt a confirmé un jugement en appel qui avait lui-même était conforme au jugement de première instance.Pour décrire la question que devait trancher la Cour de cassation, Patrick Cohen posa cette interrogation «Est-ce que tromper, c’est enquêter ?»Il s’agit en réalité d’un vieux débat journalistique sur les méthodes d’enquête à base de caméras cachées et d’infiltration, qui vient de recevoir une réponse judiciaire.En 2011, la journaliste Claire Checcaglini prend sa carte au Front national et milite sous un nom d’emprunt.Pendant 8 mois, elle va participer à la vie de la fédération des Hauts-de-Seine, assister aux réunions, aux discussions entre militants.Et elle tire un livre «Bienvenue au Front», qui décrit une dédiabolisation de façade, et un racisme omniprésent.Hier, quatre ans après, la justice a définitivement enterré toutes les poursuites engagées par le Front National et donné raison à la journaliste infiltrée.L’arrêt de la Cour de Cassation rapporté par l’AFP souligne que « les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d’une enquête sérieuse destinée à nourrir un débat d’intérêt général sur le fonctionnement d’un mouvement politique ».Vous trouverez d’autres informations sur le site d’Arrêts sur Image : http://www.arretsurimages.net/breves/2016-10-27/La-journaliste-infiltree-au-FN-gagne-en-cassation-id20257Le livre n’est plus disponible car l’éditeur qui était un éditeur local de Hénin-Beaumont, ville emblématique du Front National, a fait faillite.Vous pouvez trouver encore le livre d’occasion mais très cher, mais vous pourrez certainement l’emprunter dans une bibliothèque, les bibliothèques de Lyon possèdent plusieurs exemplaires.Claire Checcaglini -
Jeudi 03/11/2016
Jeudi 03/11/2016« Et en l’hébergeant, j’ai semé de bonnes graines. C’était totalement gratos, mais ce que cela m’a apporté n’a pas de prix. »Farshad, parisien, franco-iranien ayant accepté d’héberger un réfugié syrien dans le cadre du programme CALMJ’écoute toujours avec attention la revue de presse du week end de Frédéric Pommier, moment de poésie et de découvertes toujours étonnant, souvent touchant.Ainsi la revue de presse du dimanche 30 octobre, où j’ai appris l’existence du mensuel NEON et du dispositif CALM : « Comme A La Maison . »Ainsi, Frédéric Pommier rapporte :«A ce propos, on estime du reste à 10.000 le nombre de Français qui ont aujourd’hui proposé d’ouvrir leurs portes aux réfugiés. 10.000 personnes l’ont proposé, et 250 l’ont fait à travers le dispositif CALM, signifiant « Comme A La Maison »… C’est dans ce cadre-là que Farshad, 35 ans, Parisien qui navigue entre l’animation et la production musicale, a accueilli chez lui un jeune Syrien pendant deux mois… Il raconte son expérience dans le mensuel NEON et, d’emblée, il prévient : « Je ne suis pas l’Abbé Pierre et pas un adepte de ce qu’on appelle les ‘bons sentiments’… »Mais au printemps dernier, un reportage à la télé lui « vrille » littéralement le cœur… On y voyait une mère syrienne pataugeant dans une rivière en serrant son môme dans les bras.Ses bras à lui, Farshad décide alors de ne pas les laisser croisés. Et sans doute parce qu’il est lui-même un exilé – ses parents ont quitté l’Iran quand il n’avait que quelques mois, il a donc contacté une association qui met en lien des réfugiés et des particuliers prêts à les héberger. Et c’est ainsi qu’on lui a présenté Rudi, journaliste syrien maintes fois écroué dans les geôles d’Assad pour délit d’opinion. Il y a connu la torture, a perdu des dizaines de proches. « On s’est regardé, et j’ai vu un mec épuisé. Epuisé mais digne et qui ne portait pas sa douleur en bandoulière. On s’est illico sentit ‘frérots’ », raconte-t-il…Bien sûr, la cohabitation a nécessité, au départ, quelques ajustements. « En propriétaire mesquin, j’avoue que j’ai d’abord craint qu’il me pique des trucs. Et Rudi, lui, avait tendance à se comporter chez moi comme une femme de ménage, pour s’excuser d’être là. » Ensuite, ce ne fut qu’une vie de partage. Le quotidien, les soirées, jusqu’à ce que Rudi trouve un appartement à louer. Deux mois de cohabitation, et une amitié devenue indéfectible. « Ce mec, c’est ma plus belle rencontre», reconnaît Farshad. « Et en l’hébergeant, j’ai semé de bonnes graines. C’était totalement gratos, mais ce que cela m’a apporté n’a pas de prix. » Parfois, certains laissent de jolie traces sans même s’en rendre compte.Témoignage simple et lumineux, à lire donc dans le mensuel NEON.»,Frédéric Pommier, évoque les traces qu’on laisse, parce qu’avant de parler du geste de Farshad, il a évoqué le journal LA CROIX et une chronique de Bruno Frappat :«Quelle trace laisse-t-on sur terre une fois qu’on n’y est plus ? C’est la question qu’on se pose à certaines étapes de sa vie… Quand on prend de l’âge, souvent… Un anniversaire de plus. Ou alors quand on tombe malade. Et parfois, on réalise que des traces, on n’en laissera aucune… Parce qu’on n’a pas été quelqu’un d’exceptionnel. Rien fait d’exceptionnel. Rien créé ni rien fait pour que le monde se porte mieux… Mais lorsque l’on meurt, il arrive tout de même que certains prennent la plume pour dire leur peine et dire qu’ils pensent à celle ou à celui qui s’est éteint. C’est ce que fait, ce week-end, Bruno Frappat dans LA CROIX, avec une chronique qu’il a très sobrement titrée « Le Monsieur du sixième ».« Le monsieur du sixième est décédé. Dans la discrétion. Comme il avait vécu. Enfin disons plutôt qu’il s’est éclipsé, comme on le voyait faire quand, par extraordinaire, il franchissait le seuil de l’immeuble cossu pour aller s’acheter des cigarettes, toujours la même marque mentholée, par cartouches entières… » De son voisin, Bruno Frappat ne savait pas grand-chose. Tout juste qu’il était le doyen de l’immeuble et que dans sa jeunesse, il avait exercé le métier de contorsionniste.Il n’était pas causant, excepté avec la gardienne. Il avait peu de famille. Juste une sœur dans le Sud-Ouest, mais ils étaient brouillés. Et puis il est tombé malade et il est mort à l’hôpital. « Il est sorti de la société et de nos vies par la petite porte », conclue le chroniqueur.Et son très joli texte est une forme d’hommage à tous ceux qui meurent sans qu’on s’en aperçoive. Un hommage à tous ceux qu’on n’a pas pris le temps de regarder. » -
Mercredi 2 novembre 2016
« Peter Sadlo»(27/06/1962 – 29/07/2016) Percussionniste génialJe partage avec Michel Rocard, l’idée et surtout l’expérience que les plus grands et beaux moments de notre vie ne sont jamais liés à l’argent.
Pour ma part que pourrais-je citer ?
- Ma rencontre avec ma douce compagne.
- La naissance de mes deux merveilleux enfants et des moments de partage avec eux.
- Et aussi de magnifiques moments artistiques.
Et parmi ces moments, il en est qui est toujours présent : c’est le concert que donna en 1987 à la salle Pleyel, Sergiu Celibidache avec son Orchestre Philharmonique de Munich dans la huitième symphonie de Bruckner.
Je me souviens encore du visage baigné de larmes d’émotion de la jeune femme qui était assis devant moi et qui se tourna vers ses amis à l’issue de l’adagio sublime.
Et puis, il y eut le 4ème mouvement, où à 3 reprises, pendant quelques instants, intervint le timbalier de l’orchestre philharmonique de Munich. Des moments de grâce, un artiste d’exception, inexplicable : comment peut-on avec une intervention aussi restreinte et avec aussi peu de moyens : 4 timbales c’est à dire 4 notes, dégager autant de charisme, de beauté et de force ?
A la fin du concert, il y eut bien sûr une standing ovation et lorsque Celibidache désigna, comme premier musicien à saluer, le percussionniste, une immense ferveur se manifesta dans le public.
C’était il y a 29 ans et j’avais 29 ans.
A l’issue du concert, j’appelais immédiatement mon grand frère Gérard, qui venait de quitter Paris et l’Opéra pour le poste de violon solo de l’Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire à Nantes pour lui dire mon émotion devant ce concert et particulièrement ce percussionniste dont j’ignorais le nom.
Récemment je découvris sur Youtube un enregistrement à Tokyo de cette symphonie de Bruckner avec Celibidache et je retrouvais ce percussionniste et les formidables sensations de l’époque.
Quand mon frère vint me rendre visite il y a quelques semaines, je lui montrais cet enregistrement en déplorant de ne pas connaître le nom de cet artiste.
Et ce week end, il m’annonça qu’il avait trouvé le nom du percussionniste : Peter Sadlo mais que malheureusement il venait de mourir le 29 juillet 2016, à l’âge de 54 ans suite à une opération chirurgicale.
 Alors ce week end, j’ai fait des recherches approfondies sur cet artiste et j’ai constaté qu’il faisait l’unanimité. Beaucoup parle de lui comme le percussionniste le plus génial de son époque et les vidéos que j’ai pu voir m’ont époustouflé : la diversité des instruments qu’il jouait, sa technique notamment sur un marimba (grand xylophone), sa musicalité, les nuances dont il était capable sont fascinantes.
Alors ce week end, j’ai fait des recherches approfondies sur cet artiste et j’ai constaté qu’il faisait l’unanimité. Beaucoup parle de lui comme le percussionniste le plus génial de son époque et les vidéos que j’ai pu voir m’ont époustouflé : la diversité des instruments qu’il jouait, sa technique notamment sur un marimba (grand xylophone), sa musicalité, les nuances dont il était capable sont fascinantes.
Suite à un malentendu, j’ai été entraîné à assister, le 17 octobre, à un concert à l’Auditorium de Lyon d’une pianiste : Hiromi accompagnée d’une basse et d’une batterie. Ce sont certainement des artistes de qualité, mais le son était tellement amplifié et saturé que je suis incapable d’en juger. C’est un son sans aucune nuance, en règle générale c’est très très fort quelquefois un peu moins fort, mais quasi toujours uniforme. La pianiste n’avait retenu du piano que le fait qu’il s’agit aussi d’un instrument à percussion et voulait donc rivaliser avec la batterie pour savoir celui qui était capable de produire le plus de décibels. Pour ce faire elle se levait pour pouvoir mieux cogner sur ce pauvre instrument qui est à percussion mais aussi à cordes. Je me suis efforcé de rester jusqu’au bout en essayant de comprendre l’enthousiasme du public fort nombreux qui m’entourait. En toute humilité, je n’ai toujours pas compris.
Peter Sadlo faisait de la musique, produisait un son non saturé même s’il était fort et était capable de faire des nuances. Son répertoire n’était pas forcément classique, et quelquefois il utilisait des objets improbables pour faire du rythme et des nuances.
Voici une vidéo où sont présentés différentes facettes de son talent et il y a notamment un des extraits de la 8ème symphonie (à 6mn42) dont je parlais tantôt : https://www.youtube.com/watch?v=eFj886x6q34
Ici il y a deux petites œuvres où il joue un marimba avec quelques autres amis percussionnistes : https://www.youtube.com/watch?v=xMPF8bGiUMs & https://www.youtube.com/watch?v=YOE272lWOtw
Et ici un moment d’anthologie une œuvre contemporaine qui est un concerto pour percussion et orchestre absolument époustouflant :
En live, je ne l’ai entendu qu’une seule fois mais je ne l’oublierai jamais.
<780>
- Ma rencontre avec ma douce compagne.
-
Vendredi 28/10/2016
Vendredi 28/10/2016«Nous sommes à la veille d’une mutation de l’espèce humaine.»Joël de Rosnay«Je cherche à comprendre », voilà un titre qui ne peut qu’attirer mon attention.«Je cherche à comprendre » furent les derniers mots prononcés par Jacques Monod, l’auteur du «hasard et la nécessité», avant de mourir.«Je cherche à comprendre » est le titre du dernier livre de Joël de Rosnay.Joël Rosnay est un scientifique mais on lui attribue aussi la qualité de prospectiviste, c’est à dire la capacité de prévoir les évolutions qui vont structurer notre avenir.Sa réflexion à la fois inquiète et optimiste s’oppose résolument aux transhumanistes de la silicon valley qui croient que l’intelligence artificielle va dominer l’homme. Il pense au contraire qu’avec l’intelligence artificielle, qu’il appelle «l’intelligence collective augmentée» nous pouvons devenir encore plus humain. Il met au cœur de sa réflexion, l’unité de la nature, pressentie par les philosophes comme Spinoza et démontrée par les scientifiques à la découverte des structures du vivant.Il a accordé un entretien à la Tribune : http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/nous-sommes-a-la-veille-d-une-mutation-de-l-espece-humaine-joel-de-rosnay-604669.htmldont voici quelques extraits :« […] Le mot-clé, c’est « codes ». Les codes qui semblent avoir été utilisés pour programmer la nature et lui conférer une telle unité, une telle harmonie, que je décris en évoquant notamment la suite de Fibonacci ou le nombre d’or. Mais aussi les codes qui programment la société, le code social, le Code pénal, le code des impôts, le Code de la route… et même le code PIN. Et encore, les codes sources qui ouvrent la possibilité de créer une intelligence artificielle et du deep-learning.La perspective du transhumanisme fait planer la menace d’un monde dans lequel l’homme se trouve en concurrence avec lui-même et crée les conditions de sa propre disparition. Mais il existe peut-être des solutions alternatives. Plutôt que l’intelligence artificielle, nous pouvons opter pour une intelligence augmentée collective nourrie de réflexion et de spiritualité. Plutôt que le transhumanisme, viser l’hyperhumanisme.[Ce livre] Je l’ai d’abord écrit pour moi. L’harmonie de la nature que j’y décris a changé ma façon de voir les choses et a conforté mon espoir dans un avenir positif. Mais il s’adresse à la fois au grand public, aux politiques, aux industriels – qui aujourd’hui, sont dans une vision catégorique, séquentielle, analytique, pyramidale… J’essaie de montrer pourquoi il faut briser ces catégories. La structure de l’organisation sociétale, pyramidale et hiérarchique, qui elle-même découle d’une volonté d’exercice solitaire du pouvoir -le « libido dominandi » de Machiavel-, constitue l’un des plus grands freins à l’avènement de cette société que j’appelle de mes vœux. […]Les villes et les entreprises, du moins certaines d’entre elles, sont très en avance sur les États. Par exemple, à l’instar de Copenhague, elles sont de plus en plus nombreuses à viser 100% d’énergies renouvelables d’ici à 2030 ou 2040. Malgré l’intermittence de certaines énergies renouvelables, elles y parviendront grâce à des économies d’énergie, de l’efficacité énergétique, des réseaux intelligents et un mix énergétique adapté aux ressources locales. Je ne pense pas qu’il faille continuer d’investir des milliards dans des modes de production d’énergie centralisés comme les EPR qui, en outre, sont de plus en plus coûteux, alors que le prix des énergies renouvelables, au contraire, n’en finit pas de baisser dans le monde entier. Dans le même temps, la France est un des pays les plus avancés d’Europe en matière de smart grids. On voit même, à Québec ou à Brooklyn, des habitants s’échanger l’électricité solaire qu’ils produisent en utilisant la Blockchain.De façon plus générale, les villes sont l’avenir du monde. Elles concentrent les crises économique, écologique, humaine, la crise de l’emploi, celle du logement… et donc les solutions pour y remédier. Une ville fonctionnant en économie circulaire est un modèle de sauvetage du monde. C’est sur ces principes d’écologie intelligente et d’économie circulaire que j’ai accompagné l’Île Maurice – où je suis né et où j’ai vécu – dans le cadre de « Maurice Île durable« . Si on peut le faire à Maurice, alors on peut le faire partout.[…] j’ai moins peur de l’intelligence artificielle que de la bêtise naturelle ! Mais je crois plus à l’« intelligence collective augmentée » que j’évoquais déjà dans mon livre « Le Macroscope », en 1975! Grâce aux smartphones, à l’intelligence artificielle, à la robotique, auxquels s’ajoute le pouvoir de l’interconnexion des uns avec les autres, nous devenons plus que nous-mêmes. Nous pouvons démultiplier nos capacités. Nous sommes à la veille d’une mutation de l’espèce humaine qui va advenir dans le siècle qui vient.Aujourd’hui, ce potentiel est occulté par la concurrence, la compétition, la volonté de pouvoir… mais l’empathie, l’altruisme, la reconnaissance de la diversité, le partage, l’art, l’amour… permettraient de faire émerger cette nouvelle espèce humaine.À l’inverse du transhumanisme – élitiste, égoïste et narcissique, qui s’adresse à l’individu et son rêve d’immortalité, l’hyperhumanisme parle à la société et peut conduire à une collectivité mieux organisée, respectueuse, capable de créer une nouvelle humanité.Je reconnais qu’il s’agit d’un pari. Plutôt qu’optimiste, je me considère comme positif, constructif et pragmatique. Dans ce livre, j’ai voulu témoigner de ma confiance en notre capacité de construction collective de l’avenir, grâce à l’intelligence augmentée qui nous incite à être encore plus humain qu’aujourd’hui. […]En effet, le « solutionnisme » de la Silicon Valley, qui veut changer le monde par la technologie, m’inquiète. Les Gafa, ce sont des entreprises-Etats, dont la capitalisation boursière équivaut à la richesse totale de certains pays. Ces véritables monopoles numériques transversaux se heurtent à des États-nations qui ne le sont pas du tout. Ce sont avant tout des plateformes d’intelligence collaborative, bien plus que des sites de e-commerce.Grâce au big data, ils créent de la valeur ajoutée à partir des informations que nous laissons chez eux et la revendent à d’autres. Cela crée une situation gagnant/gagnant très curieuse.Mais nous pouvons lutter contre ces conditions monopolistiques en utilisant les mêmes outils, grâce à la co-régulation citoyenne participative, qui permet de passer de la société de l’information à celle de la recommandation. C’est le « citizen feedback » dont je parlais dans Le Macroscope. Cela répond aux attentes de ces jeunes à la recherche d’un rôle plutôt que d’un job, et à celles des entreprises qui aspirent à endosser, elles aussi, un rôle sociétal. Ce changement va se faire par auto-évaluation. Au-delà des votes, des sondages, des référendums, les nouveaux outils permettent une auto-évaluation collective et en temps réel de nos actions collectives. […]Je parle en effet de spiritualité et d’émerveillement, deux mots étranges pour un vulgarisateur scientifique. Mais je ne suis pas le premier à être émerveillé par l’unité et l’harmonie de la nature… Einstein, Spinoza, Pythagore ou encore Jacques Monod l’ont été avant moi. Lorsqu’on observe cette perfection, on ne peut que se demander ce qu’il y a derrière. On dirait que tout a été fait pour aboutir à cette harmonie. Pour beaucoup, la réponse à cette question est « Dieu ». Mais je ne suis pas dans une approche religieuse, du rite, du dogme. Néanmoins, comme mes amis Hubert Reeves et Yves Coppens, je m’interroge sur cette forme d’organisation inexpliquée qui pose question. Le scientifique que je suis avoue ne pas connaître la réponse. C’est un « mystère inexplicable, mais présent ». Dans mon livre, je fais référence à la tapisserie de la licorne. La plupart des gens ne voient que le résultat, sublime. Mais les scientifiques ou les philosophes vont voir derrière la tapisserie pour essayer d’interpréter les motifs. Je ressens un sentiment de spiritualité laïque, émergeant de l’unité, qui m’incite à donner du sens à ma vie et à transmettre.»Il y aussi cette vidéo où il parle de son livre et comme il est un homme moderne, il a créé un blog http://www.chercheacomprendre.com/ qui accompagne son livre. -
Jeudi 27/10/2016
Jeudi 27/10/2016« Pardonne-moi mon Anne »François Mitterrand, dans « Les lettres à Anne » qui ont été publiées le 13 octobre.Et Mitterrand mourut. Plus précisément, on le sait maintenant, il demanda qu’on lui donne la mort parce que la souffrance était devenue trop grande et qu’il ne voulait pas que vivant, il perde le contrôle de lui-même.Quelques mois auparavant, poussé par les évènements, il accepta ou plutôt participa finalement au dévoilement de l’existence de sa fille cachée : Mazarine. Et il organisa ses funérailles, mettant en scène ses deux familles : l’officielle avec Danielle Mitterrand et ses deux fils Jean-Christophe et Gilbert, la secrète Anne Pingeot et sa fille Mazarine.Nous savons aujourd’hui, que Jean-Christophe et Gilbert rencontrèrent pour la première fois leur sœur Mazarine le matin de l’enterrement.Beaucoup s’en offusquèrent. Le monarque républicain qui condamne la polygamie, présente dans les faits en France à cause de l’immigration, montre au monde entier que lui-même a pratiqué cette culture de la soumission des femmes.J’étais dans ce camp.J’aimais cette réponse d’André Gide à l’interpellation : M Gide, il ne faut pas juger : « Je ne juge pas, je condamne ! ».Anne Pingeot a publié, 5 ans après le décès de Danielle Mitterrand, deux livres issus de la plume de François Mitterrand. Le plus imposant est le recueil de plus de 1000 lettres de François Mitterrand lui a adressées.Anne Pingeot a accepté de répondre dans l’émission <A voix nue>, aux questions de Jean-Noël Jeanneney pendant 5 émissions d’une demi-heure chacune. Il est annoncé que ces entretiens seront les seuls auxquels, elle acceptera de répondre.J’ai écouté ces 2 heures 30 d’émission, totalement sous le charme de cette femme de 73 ans à la voix jeune et enthousiaste, au rire cristallin. Irrésistiblement j’ai été poussé à entrer dans une librairie pour acheter ce livre, hélas pour moi un trop grand nombre avait déjà eu cette idée et il n’y avait plus d’exemplaire pour moi.Le monde binaire du manichéisme, constitue une facilité coupable. Le monde, la vie sont complexité.Nous apprenons donc qu’Anne Pingeot a rencontré pour la première fois François Mitterrand à l’âge de 14 ans alors que son père avait invité après une partie de golf, François Mitterrand et André Rousselet son grand ami et son exécuteur testamentaire, rencontre dont elle se souvient encore aujourd’hui.C’est autour de 19 ans que commencèrent leurs échanges épistolaires en 1962. Cette histoire d’amour dura donc plus de 30 ans.Au début des entretiens, Anne Pingeot révèle que c’est Hubert Védrine, président de l’institut François Mitterrand et Jean-Noël Jeanneney qui lui ont demandé si elle disposait de documents qui pourraient éclairer la vie de François Mitterrand, à l’occasion de son centième anniversaire. Et elle parle de ses doutes : « Fallait-il le publier ? (…) Je ne sais pas, je ne sais pas. Il savait que je conservais tout, par métier et par nature. Mais, est-ce qu’il voulait que ce soit publié… Vous voyez… Toujours, je me pose la question ».Elle parle de l’influence de Jean-Noël Jeanneney à qui elle a posé la question et qui bien sûr, en qualité d’historien toujours à la recherche de sources premières, ne pouvait dire que oui. Elle lui reproche un peu de l’avoir poussé à publier. Elle parle aussi de ce dilemme : laisser le soin d’ouvrir et de traiter ces archives à d’autres et à titre posthume avec le risque de trahir ou de mal comprendre, ou s’en charger soi-même avec le risque d’une publication prématurée et de devoir recevoir toutes les critiques de tous ceux qui à juste titre auraient préféré attendre.Elle explique comment a été possible pour une femme moderne et intelligente d’accepter cette vie dans l’ombre d’un homme pendant plus de 30 ans. Situation totalement révoltante à l’ère moderne et dans le contexte de l’émancipation féminine.Elle utilise, elle-même le terme «inacceptable» et évoque le monde «réactionnaire» dans lequel elle a vécu son enfance : « Quand on a eu le droit de parler à table, je n’ai qu’entendu… Par exemple sur la vision de la femme : la femme est quelqu’un qui doit être soumis, qui ne doit avoir aucune vie intellectuelle, et ça ça a compté beaucoup quand même. Ça empêche. Il va falloir l’aide de François Mitterrand pour essayer autrement, dans une autre direction. En même temps, ce côté de soumission a fait en sorte que j’ai accepté l’inacceptable. »Le reste de sa vie fut une suite de combats pour être indépendante, gagner sa vie, avoir son propre appartement. Elle évoque le début de son existence à Paris d’abord l’apprentissage des vitraux – qui ne mène à rien -, puis finalement du droit et l’Ecole du Louvre en parallèle, pour se retrouver dans le monde des musées. Rappelons qu’elle fut la conservatrice du musée d’Orsay.Et très rapidement, à Paris, Mitterrand sera très présent. Elle utilise pourtant, pour le qualifier, du terme de « prédateur ».Elle raconte cette liaison faite de crises et de réconciliations. Elle a voulu le quitter plusieurs fois, vivre sa vie avec des jeunes de son âge : « J’ai évidemment essayé de le quitter, beaucoup. Ces lettres sont souvent le reflet des essais. Mais pour simplifier, personne n’arrivait à être aussi intéressant. Personne n’était aussi fascinant. C’est tellement important de ne jamais s’ennuyer. »Mais « à la fin je lui reprochais ses lettres trop belles. Je trouvais que la vie, ça aurait été mieux. »Et François Mitterrand d’écrire : «Anne au cœur donné et à l’âme fière. Tu es ma lumière, mais que t’ai-je donné, plus que tu dis, moins qu’il ne faut. Notre histoire est si difficile qu’elle a bien le droit d’être unique.»Mitterrand était un homme secret qui disposait de plusieurs cercles de relations qui ne se rencontraient pas. Probablement qu’Anne Pingeot, fut au cours de ces plus de trente ans la personne qui le connaissait le mieux, à qui il a révélé le plus de choses.Anne Pingeot aussi raconte le François Mitterrand, homme politique : « Chaque hameau était marqué… C’était systématique. Il avait un vrai contact avec les gens. Et moi je l’ai suivi, au début. J’ai assisté aux réunions de conseil municipal. Il connaissait tout. C’est ça qui lui a donné cette connaissance que les autres n’ont plus maintenant. Ils ne savent plus ce que c’est. Ils ont des attachés parlementaires, il allait dans les champs, voir les gens. »Et puis il y a cette confidence lorsqu’elle avait pris la décision de le quitter pour se marier avec un ingénieur de grande école, il part en Inde, et se heurte de plein fouet à la misère du monde. Il lui raconte dans ses missives, et dans le « journal de bord » qu’il tient et lui rapporte à son retour.Anne Pingeot : « Lui, sa réaction, c’est de partir dans un slum [bidonville], en Inde, auprès d’un Père assez extraordinaire d’ailleurs. Moi ça m’a bouleversée. Et je suis restée. »François Mitterrand : «Le Père Laborde a peut-être 45 ans, est maigre, à forte mâchoire, des cheveux gris bien peignés, un rire frais, presque enfantin, des lunettes de fer. Il ne se déplace qu’à bicyclette, ou en train. Il sait tout faire, et n’est qu’humilité. J’irai demain m’installer avec lui dans son cagibi du slum, et je suis déjà embauché pour aider un jeune médecin libanais qui soigne comme il peut. (…) Pas d’air, pas d’arbres, des milliers de gens dans la rue. (…) Selon Christian, la moyenne de vie est de 30 ans. Il soigne des gens dans la rue, amassés le long des rigoles.(…) Je me force terriblement, je n’ai pas la vocation du malheur. »Mais c’est aussi la maternité qui fit rester Anne Pingeot dans le cercle intime de François Mitterrand. Elle évoque cette importance, pour elle, d’avoir eu un enfant avec lui : « Et au fond, je pensais que c’était le seul acte altruiste qu’il avait fait. Et le comble, c’est que cet acte altruiste a été un des bonheurs de sa vie. »Car elle raconte que l’enfance de Mazarine fut finalement très proche de son père qui passait, sauf quand il était en voyage, les soirées et les nuits avec elles. Elle raconte qu’il lui racontait des histoires et qu’il chantait pour l’endormir… Comme nous le faisions pour nos enfants.Dans ces émissions j’appris aussi que contrairement à ce qu’on a affirmé, François Mitterrand aimait la musique : Beethoven, Schumann, Dvorak mais aussi Leo Ferré et Barbara.Dans la dernière émission, Anne Pingeot lit quelques poésies qu’il lui a écrites. Je partage avec vous celle-ci :«Pour les fleurs que tu n’as pas reçusPour les livres que je ne t’ai pas lus,Pour les pays que nous n’avons pas vus,Pour les bonheurs perdus,Je te demande pardon, mon AnnePour l’amour que je t’ai mesuré,Pour la paix que je t’ai refuséePour les heures que je ne t’ai pas donnéesPour l’espérance délaisséeJe te demande pardon, mon AnnePour les paroles inutilesPour les silences distraitsPour les rendez-vous manquésPour les pas dispersésPour les prières oubliéesJe te demande pardon, mon AnnePour la ferveur de chaque jour,Pour l’attente de chaque nuitPour la pensée de chaque matinPour la passion de chaque étreintePardonne-moi mon Anne. »Lors de sa présidence, François Mitterrand partagea donc ses soirées et nuits parisiennes avec Anne Pingeot et sa fille. Les ultimes mois de sa vie, il les passa avenue Frédéric-Le-Play, dans le VIIe arrondissement de Paris, où Anne Pingeot était à ses côtés, chaque jour, chaque nuit.Le 22 septembre 1995, l’ultime lettre que François Mitterrand adresse à Anne Pingeot —se clôt par ces mots« Tu as été la chance de ma vie. Comment ne pas t’aimer davantage ? »Au terme de ce long mot consacré à un homme que j’ai longtemps détesté mais aussi à une femme qui m’émeut, j’abandonne le mot de Gide : « Je ne juge pas je condamne » pour celui de Jean Cocteau qui fut le mot du jour du 9 septembre 2013«Surtout, surtout… sois indulgent,Hésite sur le seuil du blâme.On ne sait jamais les raisonsNi l’enveloppe intérieure de l’âme,Ni ce qu’il y a dans les maisons,Sous les toits, entre les gens. » -
Mercredi 26/10/2016
Mercredi 26/10/2016«François Mitterrand»(26/10/1916 – 08/01/1996)François Maurice Adrien Marie Mitterrand est né le 26 octobre 1916 à Jarnac, il y a 100 ans.Jarnac est une ville du département de Charente, située sur la rive droite du fleuve Charente, entre Angoulême et Cognac et qui comptait en 2013, 4 449 habitants.Mais le nom de Jarnac est surtout connu en raison de l’expression « coup de Jarnac » qui désigne un coup violent, habile et imprévu. Il a pris une connotation de coup déloyal ou pernicieux, qui n’existait pas à l’origine.Car dans son sens premier et d’escrime, il s’agit d’un coup à l’arrière du genou ou de la cuisse, rendu célèbre par Guy Chabot de Jarnac, qui le porte lors d’un duel judiciaire en 1547.Vous trouverez, sur le site de la ville de Jarnac, une explication détaillée et historique dans laquelle les habitants de Jarnac tente de dissocier le nom de «Jarnac» de l’adjectif «déloyauté».Toujours est-il que François Mitterrand est né jarnacais, qu’il a toujours conservé des liens étroits avec sa ville natale et qu‘à la fin de quelques tergiversations, il décida d’y retourner pour sa dernière demeure.Si je ne me soumets pas à un profond et exigeant travail intellectuel, à l’appel de la raison la plus objective, je tombe tout naturellement dans un réquisitoire à charge qui dénonce le démagogue, l’homme assoiffé de pouvoir, aux relations sulfureuses.En 1981, plein d’espoir, j’ai voté pour celui qui disait et écrivait :«La droite n’a qu’une ambition c’est de conserver le pouvoir, moi je n’ai qu’un objectif vous le rendre», «L’Europe sera sociale ou ne sera pas»Son programme économique de 1981, notamment les nationalisations à 100%, dénoncées par Michel Rocard, a été une absurdité. Il a d’ailleurs dû y renoncer en 1983, sans l’assumer et sans l’expliquer.Il nous a entraînés dans une course à l’abime, en dissolvant la France dans une Europe du marché concurrentiel sans limite, sans structure, sans pouvoir politique, et élargie sans cesse vers de nouveaux entrants sans que les règles de prise de décision n’aient été adaptées à cette nouvelle configuration.Il a pensé que l’Euro serait une arme qui permettrait à la France de contraindre l’Allemagne, alors que c’est exactement le contraire. L’Euro est configuré sur le modèle du Mark en harmonie avec le grand pays industriel, composé d’une population vieillissante et rentière, l’Allemagne.L’Euro est avant tout une contrainte pour un pays ayant une jeunesse beaucoup plus vigoureuse et un tissu industriel beaucoup moins puissant que son voisin germanique.Il a décidé de la retraite à 60 ans, vécu certes par ceux qui ont en bénéficié comme un magnifique cadeau, mais qui dans cette extraordinaire et bienheureuse explosion de l’espérance de vie des humains et dans un contexte de système de retraite par répartition constituait un acte irresponsable contre notre jeunesse et son avenir.Il a aussi accompagné la dérive de l’individualisme :«Moi, moi seul et tout de suite» ce que Régis Debray qualifie du «tout à l’ego» au dépens du «nous», de ce qui fait société et prépare l’avenir.Dans un des premiers mots du jour, celui du 27 novembre 2012, je rapportais des propos privés que Jean-Pierre Chevènement citait dans son livre « La France est-elle finie » et que Mitterrand lui avait tenu en 1979«Je ne pense pas qu’aujourd’hui, à notre époque, la France puisse faire autre chose, hélas, que passer à travers les gouttes».C’était le propos lucide d’un homme politique habile et démagogue qui en public magnifiait la grandeur de la France et qui en privé n’y croyait pas.Ce à quoi il croyait c’est au pouvoir. Il restera dans le livre des records comme le Président de la République étant resté le plus longtemps dans ses fonctions, deux septennats. Personne ne pourra le dépasser désormais, puisque le quinquennat a remplacé le septennat et que le nombre de mandats est limité à deux.Et puis il y eut toute cette boue au cours de sa carrière, ses débuts dans l’extrême droite, son attitude ambigüe au début de régime de Vichy, des amitiés coupables avec des criminels de cette époque comme René Bousquet, son manque de clairvoyance lors de la guerre d’Algérie, son approbation active dans l’exécution des condamnés à mort algérien.Et encore son attitude versatile à l’égard de la 5ème république, écrivant un pamphlet flamboyant contre elle <Le coup d’état permanent> et dès qu’il est parvenu, après 3 tentatives, à s’installer sur le trône de ce régime honni, il s’y est plu et a profité de toutes les manettes que lui donnait ce régime qu’il dénonçait.Il a utilisé, pour protéger sa vie privée, des outils régaliens réservés pour l’intérêt supérieur de l’Etat et notamment fait écouter des dizaines de françaises et de français, en toute illégalité.Dans la plupart des pays équivalents, ces manœuvres auraient été dénoncées et conduit à sa destitution. Mais la France n’est pas le pays des droits de l’homme … La France est un pays monarchique qui croit en le pouvoir d’un homme et qui continue à y croire en profondeur, alors que même tout prouve que cela est devenu absolument contre-productif.Jean d’Ormesson l’a décrit de la manière suivante : «c’est un homme qui avait un rapport complexe avec la vérité».Finalement ce qui le caractériserait avant tout, dans son combat politique ce serait ce mot d’ordre : « l’essentiel c’est de durer».Voilà ce que j’écrirais si je me laissais aller.Mais tu l’as écrit !Oui …Je me suis laissé aller.Mais depuis nous avons eu d’autres présidents de la République et d’autres discours, et d’autres attitudes…Et alors, quand on lit les discours de Mitterrand, qu’on lit ses livres ou qu’on écoute ou lit ses interviews, la comparaison est accablante.C’était un homme de culture, de profondeur, d’esprit.On dit François Hollande très intelligent. Probablement, mais ce n’est pas l’intelligence de Mitterrand.Et malgré toutes mes réticences et critiques, si je peux me nourrir intellectuellement dans l’expression de l’intelligence de Mitterrand, je n’y arrive pas avec l’intelligence du président actuel.Lorsque François Mitterrand annonça à tous son cancer de la prostate en 1992, il eut cette phrase : «Dans la hiérarchie des choses agréables, ça ne vient pas en premier rang, c’est un combat honorable à mener contre soi-même.»«Un combat honorable» ce fut l’expression que j’ai utilisée, quand j’ai eu à annoncer à mes collègues de travail que j’allais devoir m’absenter, quelques temps, pour cette même raison qui tourmenta François Mitterrand à la fin de son existence.Dans ce type de circonstance, on devient brusquement moins critique.Et quand on regarde cette émission, Mitterrand face à la mort, on ne peut être que saisi par la profondeur et la richesse du personnage. Il y aussi ce témoignage de gens simples du Morvan où il avait été si longtemps député et qui l’avait aidé et soutenu pendant ses premières années et à qui il envoyait pendant toute sa présidence et au cours de ses voyages des cartes écrites de sa main avec des pensées amicales, car cet homme rusé et manipulateur était aussi fidèle en amitié et capable de gestes gratuits simplement par reconnaissance et fidélité.C’était un homme de culture et d’Histoire. Ses discours sont des moments habités où le verbe se fait chair et la technocratie n’a pas sa place.Son dernier discours des vœux le 31 décembre 1994 :« L’an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l’écouterai le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m’aura si longtemps confié son destin et plein d’espoir en vous. Je crois aux forces de l’esprit et je ne vous quitterai pas. Je forme ce soir des vœux pour vous tous en m’adressant d’abord à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont loin de chez eux. Bonne année et longue vie. Vive la République. Vive la France»Il y a aussi ce dernier discours au Parlement européen où on voit son état de santé fragile et pourtant son message reste plein de force et fascine son auditoire : «Le nationalisme c’est la guerre !»Et il y aussi cet entretien où il se livre à Jean-Pierre Elkabbach en septembre 1994 et où il parle de son parcours, de l’influence de son milieu et de son éducation et aussi de ses relations avec Vichy.Récemment j’ai entendu, lors de l’émission de France Inter consacré au livre d’entretiens de François Hollande avec deux journalistes, que le président actuel se sentait parfois bien seul dans le palais de l’Elysée et qu’il passait certaines de ses soirées avec un plateau repas devant les chaines d’info, devant des chaines d’info ! François Mitterrand, dans la même situation se serait réfugié dans la lecture, car les livres le nourrissaient et lui donnaient sa consistance et sa force. C’est Piketty qui dit : les hommes politiques d’aujourd’hui ne lisent plus.Que dire encore ?Probablement parler des lettres à Anne, je le ferai demain. -
Mardi 25/10/2016
Mardi 25/10/2016«Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.»Jean de la Fontaine (1621-1695)Nous vivons une époque moderne et formidable, dans laquelle malgré l’obscurantisme de groupes religieux débiles et archaïques, des savants continuent à chercher à comprendre.Nous connaissons tous la fable de La Fontaine : »Le lièvre et la tortue » qui aboutit à un résultat contre intuitif : la tortue bat le lièvre à la course.La science dit que la fable a raison. Vous trouverez ces éléments sur ce site :En effet, les Thaïlandais ont reproduit la course entre un lièvre (en fait, ici, un lapin…) et une tortue, lors d’un salon sur les animaux de compagnie nommé Pet Variety qui s’est déroulé à Bangkok le 8 octobre 2016. Plusieurs courses ont eu lieu, faisant s’affronter les animaux de différents propriétaires et à chaque fois la tortue a gagné. Vous verrez une vidéo où on voit clairement le lapin avancer mais se détourner de son objectif, contrairement à la tortue qui, elle, avance lentement, mais sûrement.Comment expliquer ce résultat ? Les savants expliquent qu’en raison des différences de sensibilité des sens de ces animaux. Le lapin possède une ouïe très fine mais également un odorat très développé. Le bruit et les différentes odeurs provoqués par la foule ont sans doute distrait le petit animal qui n’a pas cessé de s’arrêter pour « analyser » ceux-ci. La tortue, quant à elle, n’utilise que peu son ouïe et n’est donc pas perturbée par les sons extérieurs.Je vous rappelle la fable :Le Lièvre et la TortueRien ne sert de courir ; il faut partir à point.Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez pointSitôt que moi ce but. – Sitôt ? Etes-vous sage ?Repartit l’animal léger.Ma commère, il vous faut purgerAvec quatre grains d’ellébore.– Sage ou non, je parie encore.Ainsi fut fait : et de tous deuxOn mit près du but les enjeux :Savoir quoi, ce n’est pas l’affaire,Ni de quel juge l’on convint.Notre Lièvre n’avait que quatre pas à faire ;J’entends de ceux qu’il fait lorsque prêt d’être atteintIl s’éloigne des chiens, les renvoie aux Calendes,Et leur fait arpenter les landes.Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,Pour dormir, et pour écouterD’où vient le vent, il laisse la TortueAller son train de Sénateur.Elle part, elle s’évertue ;Elle se hâte avec lenteur.Lui cependant méprise une telle victoire,Tient la gageure à peu de gloire,Croit qu’il y va de son honneurDe partir tard. Il broute, il se repose,Il s’amuse à toute autre choseQu’à la gageure. A la fin quand il vitQue l’autre touchait presque au bout de la carrière,Il partit comme un trait ; mais les élans qu’il fitFurent vains : la Tortue arriva la première.Eh bien ! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?De quoi vous sert votre vitesse ?Moi, l’emporter ! Et que serait-ceSi vous portiez une maison ? -
Lundi 24/10/2016
Lundi 24/10/2016«Quelqu’un est en train d’apprendre comment détruire Internet»Bruce SchneierVendredi 21 octobre 2016, une panne géante a touché de nombreux sites (Twitter, Netflix, Reddit, LinkedIn, PayPal, New York Times, Pinterest et d’autres) pendant près de 12 heures.Cette panne n’est pas accidentel, elle est le fait de personnes, des hackers, qui ont attaqué ces sites comme l’explique le site Atlantico : http://www.atlantico.fr/decryptage/mega-panne-mondiale-internet-pourquoi-cyberattaque-actuelle-debut-daily-beast-kevin-beaumont-2859283.htmlCes évènements montrent au grand jour ce que le grand spécialiste de la cybersécurité Bruce Schneier a déjà révélé sur son blog en septembre : https://www.schneier.com/blog/archives/2016/09/someone_is_lear.htmlPour ma part, c’est encore une chronique de Xavier de La Porte pour l’émission « La Vie numérique de France Culture » qui m’a informé à la fois de l’existence de Bruce Schreier et de son avertissement.Cette émission a été transcrite sur le site d’agora vox:« Quelqu’un est-il en train de vouloir détruire Internet à un moment donné ?Le spécialiste de la cybersécurité Bruce Schneier a posté un article alarmiste sur son blog : des menaces pèseraient sur les structures de l’Internet.L’article de Bruce Schneier :Au cours des deux dernières années, quelqu’un a été sondé les défenses des entreprises qui exécutent des tâches critiques d’Internet. Ces sondes prennent la forme d’attaques précisément calibrées destinées à déterminer exactement comment ces entreprises spécifiques peuvent se défendre, et ce qui serait nécessaire pour les faire tomber. Nous ne savons pas qui fait cela, mais il cela semble être un grand État-nation. La Chine ou la Russie seraient mes premières suppositions.Tout d’abord, un peu de technique. Si vous voulez faire tomber un réseau sur l’Internet, la meilleure façon de le faire est avec une attaque distribuée par déni de service (DDoS). Comme son nom l’indique, ceci est une attaque destinée à empêcher les utilisateurs légitimes d’entrer dans le site. Il y a des subtilités, mais, fondamentalement, cela signifie un tel dynamitage de données sur le site qu’il est débordé. Ces attaques ne sont pas nouvelles : les pirates le font à des sites qu’ils n’aiment pas, et les criminels en ont fait une méthode d’extorsion. Il y a toute une industrie, avec un arsenal de technologies, consacré à la défense DDoS. Mais surtout, il est une question de bande passante. Si l’attaquant a un plus gros tuyau d’incendie d’envoi de données que le défenseur, l’attaquant gagne.Récemment, quelques-unes des grandes entreprises qui fournissent l’infrastructure de base qui font le travail de l’Internet ont vu une augmentation des attaques DDoS contre eux. De plus, ils ont vu un certain profil d’attaques. Ces attaques sont nettement plus importantes que celles auxquelles ils sont habitués. Elles durent plus longtemps. Elles sont plus sophistiquées. Et elles ressemblent à des sondes. Une semaine, l’attaque commence à un niveau particulier d’attaque, puis croit lentement avant d’arrêter. La semaine suivante, elle commencer à ce point supérieur et continue de monter. Et ainsi de suite, le long de ces lignes, comme si l’attaquant était à la recherche du point exact de l’échec.Les attaques sont également configurées de manière à découvrir ce que sont les défenses totales d’une société. Il existe de nombreuses façons de lancer une attaque DDoS. Plus des vecteurs d’attaque sont employés simultanément, plus le défenseur doit contrer ces différentes menaces. Ces entreprises voient désormais plus d’attaques utilisant trois ou quatre vecteurs différents. Cela signifie que les entreprises doivent utiliser tout ce qu’elles ont pour se défendre. Elles ne peuvent pas se permettre de ne rien retenir. Elles sont obligées de démontrer leurs capacités de défense à l’attaquant.Je suis incapable de donner des détails, parce que ces entreprises ont parlé avec moi sous couvert d’anonymat. Mais tout cela est conforme à ce que Verisign rapporte. Verisign est le registraire pour de nombreux domaines d’Internet très populaires, comme .com et .net. Si elle tombe, il y a une panne mondiale de tous les sites et des adresses e-mail dans les domaines de niveau supérieur les plus courants. Chaque trimestre, Verisign publie un rapport de tendance des attaques DDoS. Bien que sa publication n’est pas le niveau de détail que j’ai pu recueillir des entreprises avec lesquelles j’ai parlées, les tendances sont les mêmes : « Au deuxième trimestre 2016, les attaques ont continué à devenir plus fréquentes, persistantes, et complexes. »Et il y a plus. Une compagnie m’a parlé d’une variété d’attaques par sondes en plus des attaques DDoS : il s’agit de tester la capacité de manipuler des adresses et des routages Internet, de voir combien de temps prend la défense pour y répondre, et ainsi de suite. Quelqu’un a largement testé les capacités défensives de base des sociétés qui fournissent des services Internet critiques.Qui ferait cela ? Cela ne ressemble pas à quelque chose fait par un activiste, un criminel, ou à ce que ferait un chercheur. Le profilage d’une infrastructure de base est une pratique courante dans l’espionnage et la collecte de renseignements. Il n’est pas normal pour les entreprises de le faire. En outre, la taille et l’échelle de ces sondes – et surtout leur persistance – pointe vers les acteurs étatiques. Cela ressemble au CyberCommand militaire d’une nation qui essaye de calibrer ses armes dans le cadre d’une cyberguerre. Cela me rappelle le programme de la guerre froide des États-Unis qui consistait à faire voler des avions à haute altitude au-dessus de l’Union soviétique pour forcer leurs systèmes de défense aérienne à s’activer, et à cartographier leurs capacités de réaction.Que pouvons-nous faire à ce sujet ? Rien, vraiment. Nous ne savons pas d’où les attaques proviennent. Les données que j’ai suggère la Chine, et c’est une évaluation partagée par les gens avec qui j’ai discuté. D’autre part, il est possible de dissimuler le pays à l’origine de ces sortes d’attaques. La NSA, qui a plus de capacité de surveillance de la dorsale Internet que tout le monde combiné, a probablement une meilleure idée, mais à moins que les États-Unis décide d’en faire un incident international nous ne saurons pas qui est à l’origine de ces attaques.Mais cela se passe actuellement. Et les gens doivent le savoir.Bruce Schneier.Cette information est un peu inquiétante, mais pas si surprenante que cela. Il est évident que si une guerre se déclenchait (par exemple entre les États-Unis et la Chine ou les États-Unis avec la Russie), Internet serait l’une des cibles prioritaires. Alors certains se prépare à frapper en détectant certaines faiblesses du réseau et des infrastructures informatiques de l’ennemi.Si une guerre importante éclate, il faut se préparer à vivre sans Internet, ou tout du moins, avec un accès et une bande passante très limités. À voir ! »Je ne comprends pas tout, mais je crois que nous pouvons nous attendre à de grosses pagailles dans l’avenir -
Vendredi 21 octobre 2016
Vendredi 21/10/2016« La France n’est pas le pays des droits de l’Homme, elle n’est que le pays de la déclaration des droits de l’Homme »Robert Badinter, invité des matins de France Culture le 10 octobre 2016Le 9 octobre 1981, il y a 35 ans, la loi d’abolition de la peine de mort est promulguée en France.
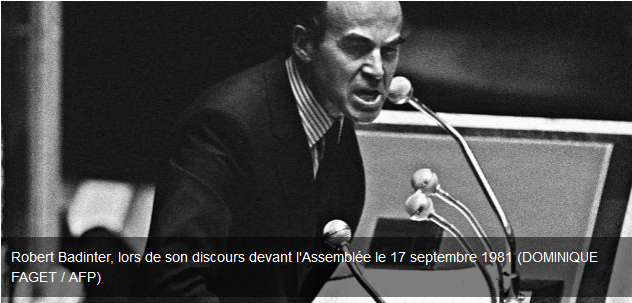 Le 10 octobre 2016 célébrait la 14ème journée mondiale d’abolition de la peine de mort.
Le 10 octobre 2016 célébrait la 14ème journée mondiale d’abolition de la peine de mort.
A cette occasion, Les matins de France Culture était allé rendre visite à Robert Badinter, le ministre de l’abolition pour un entretien.
Robert Badinter a 88 ans, sa voix est plus faible mais garde la force de la conviction qui est la marque de ce grand homme.
Dans cette émission, il a déclaré :
« Pour moi, l’abolition était inévitable. Elle a été trop tardive par rapport aux autres pays de l’Europe occidentale. […] La conscience des français que c’était fini a été plus lente que je ne le pensais. Aujourd’hui c’est terminé. »
A la question, du retour de la peine de mort que préconisent certains politiques en raison du terrorisme, il affirme d’abord que ce sont des démagogues qui prétendent que la France pourrait à nouveau recourir à la peine de mort :
« Ceux qui demandent le rétablissement de la peine de mort font preuve d’une prodigieuse méconnaissance des principes de notre Etat de droit. Ils oublient que l’abolition ne relève pas seulement de la loi de 1981, due à l’initiative de François Mitterrand.
Aujourd’hui, grâce à Jacques Chirac, à la fin de son mandat en 2007, l’abolition est une loi constitutionnelle. Il faudrait donc modifier la Constitution pour rétablir la peine de mort.
De surcroît, l’abolition est inscrite dans une série de conventions internationales dont la force juridique est supérieure à celle de la loi nationale. Je citerai, parmi d’autres, les 6e et 13e protocoles annexes à la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Sur le plan mondial, l’abolition est aussi consacrée par des protocoles de l’ONU auxquels la France est partie. Or les conventions internationales ont une valeur juridique supérieure à la Loi française.
Cette question est ainsi enserrée dans toute une série d’obligations, rendant juridiquement le rétablissement de la peine de mort quasi impossible.»
C’est l’Article 66-1 de notre constitution qui déclare simplement : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort.»
Ensuite, il montre avec lucidité combien la peine de mort contre les terroristes seraient contre productives :
«Plus que jamais il nous faut refuser la tentation de la peine de mort. On dit qu’elle serait une arme de dissuasion. Mais pour celui qui se fait exploser à l’aide d’une ceinture, la peine de mort ne peut le faire reculer car il aime la mort. La peine de mort, elle n’est pas dissuasive ici mais elle serait incitative.
Pendant le procès, le terroriste justifierait son action par ses convictions et ferait de ce moment une tribune de propagande.
Pour ceux qui partagent les mêmes convictions, le fait d’aller jusqu’à la mort pour défendre ses convictions donnerait un surcroit de foi dans leurs croyances morbides.
Le condamné deviendrait un martyr.
Et un commando de vengeurs recommencerait.»
Dans un article de l’Express il réaffirme avec encore plus de clarté ce point de vue :
«La peine de mort ne peut pas être dissuasive pour des terroristes qui périssent dans un attentat, en même temps qu’ils donnent la mort à des victimes innocentes. Il existe entre la mort et le terrorisme un rapport secret, une alliance névrotique. De surcroît, pour ceux qui partagent les convictions des djihadistes, celui qui meurt pour la cause qu’il sert est un héros. Le lendemain d’une exécution capitale, on verrait naître des commandos de militants portant le nom de celui qu’ils appelleraient martyr, et la peine de mort susciterait ainsi encore plus de vocations et d’attentats terroristes.»
Dans cet entretien il parle aussi de l’instinct de mort de l’homme, et c’est donc un immense pas vers la civilisation de renoncer à donner la mort. Selon lui, l’homme n’a, dans l’espèce animal dont il fait partie, qu’un seul exemple comparable d’un animal qui tue son semblable sans raison de nourriture, de défense de territoire ou de conquête d’une femelle. Cet instinct de mort, l’homme le partage avec le rat.
Badinter cite son ami Michel Serres qui a dit « L’homme est un rat pour l’homme. »
Robert Badinter montre aussi que l’abolition, même s’il y a des résistances : Chine, certains Etats des Etats-Unis, des dictatures et les pays théocratiques islamiques, est en progrès partout dans le monde.
L’optimisme de Robert Badinter peut se trouver dans ce document qui révèle l’évolution du monde vers l’abolition.
Mais l’exergue de ce mot du jour est une réflexion quant au fait que la France a été l’un des derniers pays d’Europe occidentale à abolir la peine de mort et que d’ailleurs la France est rarement en tête pour les avancées sociétales et les libertés.
Nos prisons ne respectent pas les droits de l’homme, notre traitement des migrants pas davantage et bien d’autres choses.
Hélas, la France n’est pas la patrie des droits de l’homme, elle n’est que le pays de la déclaration des droits de l’Homme comme le dit Robert Badinter
<774>
-
Jeudi 20 octobre 2016
« Avoir le monde en main, [signifie à coup sûr] automatiquement aussi, être aux mains du monde »Maurizio Ferraris dans son livre <Mobilisation Totale ; L’appel Du Portable>, paru en août 2016J’avais déjà évoqué Maurizio Ferraris, philosophe italien et son livre dont est extrait l’exergue du mot du jour. C’était lors du mot du jour du 16 septembre consacré au droit à la déconnexion pour les salariés reconnu par le paragraphe 7 de l’article L2242-8 du code travail et qui a été mis en œuvre par la fameuse Loi travail.
Mais il me paraissait pertinent d’approfondir la réflexion de Maurizio Ferraris, d’abord parce que j’ai écouté une émission, la Grande Table, qui posait la question <Smartphone, faut-il décréter l’état d’urgence ?> et dans laquelle il était invité.
Ensuite parce que cette réflexion constitue comme un miroir critique à celle de Michel Serres qui présentait l’aspect positif du smartphone :
« Les jeunes générations ont compris ce que signifiait le mot maintenant, qu’il faut lire main tenant, c’est à dire tenant dans la main. Avec les smartphones qu’ils tiennent dans la main, ils peuvent immédiatement échanger avec tous leurs proches ou personnes qu’ils connaissent quel que soit le lieu où les uns et les autres se trouvent dans le monde. Ils peuvent accéder à l’information et à la connaissance instantanément en surfant sur les outils de l’internet, ils peuvent envoyer, maintenant, des photos qu’ils viennent de prendre quelques secondes auparavant etc… »
Il s’agissait du mot du jour du 21 novembre 2012, le 23ème, alors que nous sommes aujourd’hui au 773ème.
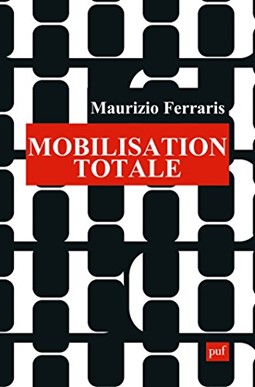 J’ai pu lire un extrait de ce livre <Mobilisation Totale ; L’appel Du Portable> sur internet. Extrait auquel vous avez accès en suivant ce <Lien>
J’ai pu lire un extrait de ce livre <Mobilisation Totale ; L’appel Du Portable> sur internet. Extrait auquel vous avez accès en suivant ce <Lien>
Ce livre se penche sur ce phénomène de société engendré par les smartphones et la connexion au monde et montre comment cette sollicitation permanente se transforme en dispositif de mobilisation.
Dans ce livre, Ferraris utilise le terme « arme » pour parler de l’ensemble de ces appareils mobiles qui nous asservissent parce qu’il a créé en italien l’acronyme « ARMI » qui a été traduit en français par Appareils de Registration (en réalité enregistrement) et de Mobilisation d’Intentionnalité.
Voilà ce qu’il écrit par exemple :
« Comment et pourquoi l’appel nous mobilise ?
L’appel est avant tout une responsabilisation : je réponds parce que je me sens apostrophé, moi, précisément moi. La responsabilité dont je me sens investi a un caractère incomparable de « première personne » : le message m’est adressé à moi, et je sens la nécessité de répondre avec le même naturel avec lequel le philosophe américain John Searle, dans l’anecdote qu’il rapporte au début de « la construction de la réalité sociale », sent la nécessité d’entrer dans un bar à Paris et de commander une bière. […]
L’absolu. Qu’est-ce qui rend d’autant plus puissant l’appel du portable par rapport à la bière de Searle ? Pour le dire en deux mots : si la bière a quelque chose à voir avec l’esprit, fut-ce avec celui du houblon, l’appel communique avec l’absolu. Pour la première fois dans l’histoire du monde, nous avons l’absolu dans la poche.
Le dispositif, dont le Web est la manifestation la plus évidente, est un empire sur lequel le soleil de se couche jamais, et le fait d’avoir un Smartphone dans la poche signifie à coup sûr avoir le monde en main, mais automatiquement aussi, être aux mains du monde : à chaque instant pourra arriver une requête et à chaque instant nous serons responsables
Même si l’on établissait par contrat de travail qu’on ne travaille qu’une heure par semaine, dans les faits s’appliquerait le principe selon lequel on travaille à toute heure du jour […].
Le mobile mobilise. Voilà ce qui a changé depuis l’époque de la bière de Searle. Que celui qui est encore en mesure de le faire, revienne en arrière, à l’époque où les téléphones étaient des appareils fixes et seulement capables de communiquer, sans aucun aspect lié à l’enregistrement. À cette époque, qui ne se trouvait pas physiquement dans les parages d’un téléphone fixe lié à son entourage (domicile ou bureau), était virtuellement soulagé de toute responsabilité. Le téléphone sonnait mais si cet individu avait un motif valide pour ne pas se trouver chez lui ou à son bureau, le fait d’être injoignable de pouvait en aucune façon lui être imputé. Ajoutons que le fixe était non seulement localisable, mais il était en principe amnésique (avant l’invention des répondeurs enregistreurs ou autres systèmes de mémorisation des appels), si bien qu’il ne restait pas de trace des coups de téléphone même quand on revenait dans les parages de l’appareil. Donc, là aussi, aucune responsabilité […].
Le seul téléphone mobile (mais sans mémoire) qui ait existé un bon nombre d’années fut le téléphone rouge, conçu en 1963. Enfermé dans une boite, il suivait comme une ombre ou un spectre le président des États-Unis et pouvait être utilisé pour communiquer directement avec le dirigeant de l’Union soviétique en cas de menace nucléaire. Cette évocation de la sphère militaire apparaît rétrospectivement prophétique. Les armes contemporaines sont des dispositifs mobiles et mobilisant qui tirent tout leur pouvoir du fait d’être toujours auprès de nous et éternellement muni de mémoire. Ce qui signifie justement qu’à la différence de ce qui se produisit avec le fixe, nous sommes responsables face aux messages qui peuvent nous arriver, et cela en tout lieu et à tout instant. Même si l’on se trouvait dans une zone sans réseau ou si nos « armes » étaient pour quelque raison déchargées, en très peu de temps la mémoire, se réactivant, nous mettrait face à nos responsabilités, c’est-à-dire aux messages qui nous seraient arrivés durant la période de déconnexion. […]
Action. Généralement l’appel ne se limite pas à requérir une réponse ; il exige une action. Dès l’instant où une grande part du travail se fait à travers les « armes », l’accès à ces « armes » équivaut à l’accès au travail : qu’on pense à la quantité de prestations fournies par les « armes » hors des horaires habituels de service. Ce travail est non rétribué et souvent même il n’est pas comptabilisé comme travail, ce qui implique une nouvelle frontière de l’exploitation, qui commence au moment où, comme cela se faisait en de nombreuses entreprises on oblige les employés à être toujours muni d’un smartphone.
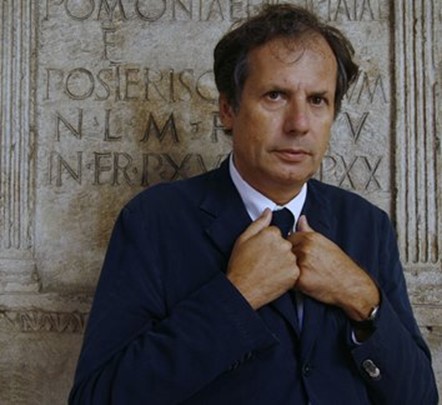 Les mobilisés acceptent d’être appelés à agir à tout moment et c’est aussi une diminution objective de liberté, qui n’est compensé par aucun avantage économique et qui même, le plus souvent, se transforme en un travail gratuit, que ne couvre aucune protection syndicale. […]
Les mobilisés acceptent d’être appelés à agir à tout moment et c’est aussi une diminution objective de liberté, qui n’est compensé par aucun avantage économique et qui même, le plus souvent, se transforme en un travail gratuit, que ne couvre aucune protection syndicale. […]
Responsabilité. Le message qui t’est destiné, est destiné à toi. Qui te l’as envoyé sait que tu l’as lu. L’ordre se présente comme un commandement individuel, de façon très différente de ce qui se passait avec les médias du siècle précédent. De ce point de vue, notre situation a changé par rapport à l’époque de la radio et de la télévision. On se lamentait alors du fait qu’on se trouvait submergé par un flot d’informations, surabondant et ingérable. Et alors ? Où était le problème ? Il suffisait de ne pas en tenir compte. Il est bien plus difficile d’affronter l’avalanche de sollicitations, de requêtes, de demandes impatientes qui sont adressés par l’armée mobile qui nous enserre. »
<Vous pouvez aussi lire cet article des Inrocks qui analyse ce livre>
Cette réflexion apparait très négative. A mon analyse, elle ne contredit pas la vision optimiste de Michel Serres, elle la complète.
Le smartphone est à la fois un outil formidable comme le décrit Michel Serres, et un outil d’asservissement comme le montre Maurizio Ferraris.
Il nous faut suffisamment de sagesse pour profiter de ses fonctionnalités et maîtriser ses excès.
Bref, il faut mater notre smartphone et savoir se déconnecter !
<773> -
Mercredi 19 octobre 2016
« Le roman de renart »Ensemble médiéval de récits animaliers écrits en ancien français et en versLa question qui semble première en France, dans l’esprit ou au moins dans les paroles de certains, est donc celle de l’identité de la France.
Or, dans l’identité de la France il y a eu, au long des siècles, des récits qui ont construit l’imaginaire des français. Il en fût ainsi du récit né au moyen âge le roman de renart, attribué à différents auteurs et notamment Pierre de Saint Cloud.
A cette époque, l’animal que nous connaissons sous le nom de renard, s’appelait goupil. Le roman de renart mettait en scène un goupil ayant pour nom «Renart» avec comme adversaire principal «Ysengrin», un loup. Et c’est depuis le roman de Renart qu’on appelle les goupils des renards.
Ce récit issu du roman mythique de la France mettait donc au premier plan un animal, voleur de poules, rusé, manipulateur.
Je me souviens, qu’enfant, donc dans les années 60, on m’avait offert un livre pour enfant qui avait pour titre le roman de renart et relatait certaines des aventures de Renart et Ysengrin. Preuve que ce récit du moyen âge avait bien traversé les siècles de l’Histoire de France.
C’est Raphaël Glucksman qui vient de publier un livre : <Notre France ; Dire et aimer ce que nous sommes> qui a remis ce poème issu du moyen-âge dans la longue histoire de ce qui a fait la France et les français.
Libération écrit :
«C’est ainsi à une promenade subjective mais véridique dans le passé de la vraie France qu’il emmène le lecteur. De manière inattendue, cette saga ne commence pas avec la Renaissance, les Lumières ou la Révolution. Elle remonte au Moyen Age, dans la première grande fiction française, plus populaire à l’époque que la plus populaire des séries d’aujourd’hui : le Roman de Renart. Ce conte animalier en vers, récité à haute voix dans les villes et les villages pendant de nombreuses décennies, est la première œuvre discrètement séditieuse qu’on connaisse dans la littérature française.
Renart (d’où viendra ensuite le nom commun «renard») est un «goupil», comme on disait à l’époque (un renard, donc), malicieux, insolent, rusé et rebelle aux autorités. Il est le premier exemple d’une longue série de héros réels ou imaginaires où l’on trouve Till l’Espiègle, Mandrin, Cartouche, Fanfan la Tulipe, Figaro ou Camille Desmoulins. Individualiste, farceur, moqueur, irrespectueux, Renart se rit des prescriptions de l’Eglise, se gausse des romans de chevalerie si prisés par l’aristocratie, tourne en ridicule les croisades, les guerres de la noblesse, la domination de l’aristocratie.
Ainsi, le peuple trouve dans le rire un remède à son infortune, une revanche toute symbolique sur les classes dominantes. Au fil des pages, par flash-back successifs, Glucksmann retrace la longue histoire d’une France qui aime la liberté, la révolte, les influences étrangères, l’indifférence religieuse, l’égalité et qui progresse peu à peu vers le régime républicain que nous connaissons : l’histoire de la France qu’on aime et que détestent en fait ceux qui s’en réclament avec le plus de clameurs.»
Quand on fait des recherches sur le roman de renart sur Internet, on trouve finalement beaucoup de pages qui l’évoque. Par exemple <Cette page qui à la fois l’analyse et en cite des extraits>
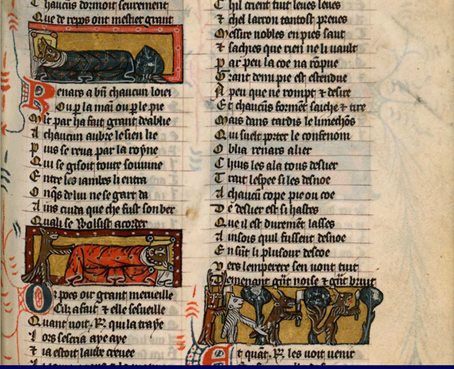
<772>
-
Mardi 18/10/2016
Mardi 18/10/2016« Il faut connaître le goût du vinaigre pour apprécier celui du miel. »Fatima CharrihiIl n’est pas nécessaire d’être érudit ou Philosophe, élève de la rue d’Ulm pour manifester de la sagesse.Dans mon expérience de vie j’ai rencontré des gens très simples qui possédaient ce que j’appellerais, l’intelligence du cœur.Qui est Fatima Charrihi ?Il se trouve que j’en ai parlé très récemment, dans le mot du jour du 3 octobre 2016 : «La première victime du carnage de Nice, le 14 juillet 2016, était une musulmane.». C’était Fatima Charrihi.Ce week end, il y a eu un hommage national aux victimes de Nice et le Parisien a donné la parole à son fils. Pour ma part je l’ai appris par la revue de presse de Frédéric Pommier :«Il s’appelle Ali Charrihi, et sa mère Fatima fait partie des 86 victimes de l’attentat perpétré le 14 juillet sur la promenade des Anglais. Il s’appelle Ali Charrihi, et comme ses frères et sœurs, il sera présent ce matin à l’hommage national rendu aux victimes du terroriste de Nice. Et, à Louise Colcombet, il explique, dans LE PARISIEN, l’importance qu’a pour lui la cérémonie d’aujourd’hui. « A travers le président de la République, c’est la nation toute entière qui va honorer la mémoire de ma mère. La nation toute entière qui va envoyer un message d’union et de paix. » Et puis, c’est aussi, avoue-t-il, une « indispensable » étape dans sa reconstruction. Il se dit hanté par cette nuit terrible du 14 juillet – des flashs qui lui reviennent quasi quotidiennement, malgré le soutien des psychologues et malgré les médicaments… Il est hanté, aussi, par le sentiment d’impuissance et de culpabilité des survivants.Si lui-même n’est pas mort ce soir-là, c’est parce que sa mère l’avait, avec son père, envoyé déplacer leur voiture qui était garée en double file. « C’est comme si elle avait su… Comme si elle m’avait protégé une dernière fois. Mais pour elle, je n’ai rien pu faire », ajoute-t-il en précisant qu’il a cependant ranimé deux femmes de 80 ans. Aujourd’hui, il décrit sa famille « en lambeaux », car Fatima était « le pilier de la maison ». Mais il a toutefois décidé de ne pas sombrer dans le chagrin : Ali Charrihi veut agir. Elevé dans le respect absolu de la République, il souhaite désormais s’investir pour relayer le message de paix que Fatima, à n’en pas douter, aurait elle-même professé si elle avait survécu.Il s’est ainsi rapproché de Latifa Ibn Ziaten, la mère de la première victime de Mohammed Mehra, dont l’association multiplie les interventions pour prôner le vivre-ensemble en milieu scolaire. « Je voudrais, dit-il, faire comprendre aux jeunes la chance qu’ils ont de vivre en France. Ce n’est pas un pays de mécréants qui leur veut du mal, c’est un pays qui nous propose un avenir commun. Mais pour s’intégrer, ils doivent se battre, comme l’ont fait nos parents. » Et Ali de citer un proverbe qui était cher à sa mère : « Il faut connaître le goût du vinaigre pour apprécier celui du miel. » Des paroles qui font du bien. Et un portrait qui fait du bien.»Tout le monde n’est pas bienveillant, ni sage. Dans la même revue de presse de ce samedi, on apprend :«[Les victimes], si l’on croit ce matin LIBERATION, suscitent parfois la convoitise de structures peu scrupuleuses… « La double peine pour les victimes » : c’est le titre à la Une… Enquête d’Ismaël Halissat qui s’est plongé dans le maquis des associations qui prennent en charge les rescapés du 14 juillet. Des associations rigoureuses pour la majorité d’entre elles, mais d’autres, en revanche, ont des pratiques un peu douteuses. Certaines prennent ainsi de grandes libertés avec les règles de déontologie, et orientent très rapidement les victimes vers quelques avocats qui se partagent les dossiers d’indemnisation. Des avocats qui pratiqueraient en outre des honoraires exorbitants, avoisinant les 20% – quand on sait que l’indemnisation peut atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros, 20% c’est donc colossal. Sachant que, selon le journal, des avocats se seraient déjà directement servis dans les premiers fonds d’urgence. « Et les victimes ne voient même pas que cela pose un problème », se désole une juriste.»Grandeur et bassesse de l’humanitéLe miel et le vinaigre… -
Lundi 17/10/2016
Lundi 17/10/2016« slasheurs »Expression venue du marketing américain et désignant la pluriactivité, le fait de cumuler plusieurs emploisAlors que je venais de finir l’écriture du mot du jour sur «la reproduction sociale» de Nancy Fraser, j’ai entendu l’émission <Le téléphone sonne du 10 octobre> de France Inter qui a parlé de ce phénomène social et de micro-économie qui prend de l’ampleur : le choix ou la nécessité pour certains de cumuler plusieurs emplois pour gagner leur existence.Ce nom, «slasheurs», vient du signe typographique « slash » c’est à dire « / ». Par exemple : Opticien / conducteur de VTC. Musicien / livreur de repas à domicile.La fureur quantophrène a encore frappé parce que si selon l’INSEE, le phénomène concerne deux millions de personnes en France [rapporté lors de l’émission de France Inter], une autre étude rapportée par Challenges, porte ce chiffre à 4 millions. Bref, on ne sait pas très bien, mais il y en a beaucoup.Pourquoi, ce cumul d’activités ?Il y a l’hypothèse optimiste : pour faire quelque chose d’intéressant, pour donner du sens à sa vie professionnelle.Et il y a l’hypothèse pessimiste, c’est le CDD, la précarité, les salaires bas qui obligent à cumuler les emplois pour survivre.Si on va chercher ses informations sur le réseau social professionnel, LinkedIn, créé en 2003 à Mountain View (Californie) et qui est en train de se faire racheter par Microsoft, cette évolution est présentée sous le regard optimiste :« Car la multi-activité est, pour le slasheur, un choix et non la résultante de difficultés économiques. C’est une manière de travailler permettant de répondre à sa volonté de concilier des impératifs autrefois contradictoires : la nécessité de gagner sa vie, l’envie de kiffer sa vie professionnelle et de s‘épanouir en général. […]Le premier point commun entre tous les slashers, c’est leur curiosité insatiable. Pour un slasher, la vie professionnelle (et la vie en général) c’est la possibilité d’explorer le champ des possibles.Ce qui les porte dans la vie, c’est d’acquérir des connaissances, surtout dans un monde où le savoir est à « portée de clic »*, être slasheur lui permet d’assouvir sa soif de connaissances. »Dans certains domaines comme le monde artistique cette pratique est ancienne. Un article d’un site belge donne des exemples très positifs d’artistes cumulant ainsi plusieurs activités.Cette pratique est aussi bien connue dans le monde agricole où les ouvriers agricoles avaient plusieurs employeurs et aussi des activités diverses selon les saisons.Un article de l’express montre que la pluriactivité est aussi un moyen à côté d’un « boulot stable » de pouvoir mener des activités plus précaires mais correspondant à des jobs plus passionnant :«J’ai commencé par travailler dans l’audit immobilier, par atavisme familial. Au sein de l’entreprise, j’ai mis sur pied un service de communication institutionnelle qui m’a permis de faire de la vidéo, ma vraie passion. Et, aujourd’hui, parallèlement à mon job, j’ai monté mon auto-entreprise, où je vends mes services à des maisons de production et des chaînes de télé en tant que réalisateur.»Le journal l’Opinion affirme que «le travail salarié ne concerne désormais que la moitié des travailleurs dans le monde. Dans le même temps, l’activité professionnelle indépendante gagne du terrain. Aux Etats-Unis, un tiers de la population active est à son compte.»Dès lors, dans l’activité indépendante, shlasher deviendrait la norme ?Le journal Challenge, déjà cité, publie un autre chiffre très rassurant : «Contrairement à une idée reçue, 70% d’entre eux le sont devenus non pas par obligation financière mais par choix.»Mais depuis les réflexions de Sorokin sur la quantophrénie, nous savons que nous devons nous méfier des chiffres. Ce même journal reconnait d’ailleurs que concernant les conséquences sur la vie personnelle, l’étude ne dit rien. Car après avoir été sensibilisé par Nancy Fraser à la reproduction sociale, il parait quand même légitime de se poser la question que devient la vie familiale et sociale dans cette multi activité qui peut devenir un planning ingérable et bientôt une suractivité ?En tout cas, pendant l’émission de France Inter, si certains intervenants ont présenté cette manière de pratiquer comme positive d’autres ont bien montré qu’il s’agissait d’un besoin de revenus qui les poussait dans cette voie. Ainsi, même une professeur certifié, a raconté qu’elle ne pouvait se contenter de son traitement pour vivre à Paris, elle cumulait avec des cours privés mais aussi un travail de serveuse.Je laisserai le mot de la fin, à une autre intervenante qui a simplement écrit, via les réseaux sociaux, que slasher était la manière normale de faire des femmes depuis des siècles dans nos sociétés. -
Vendredi 14 octobre 2016
« Les contradictions sociales du capitalisme contemporain »Nancy Fraser, 38ème conférence Marc BlochDepuis lundi les mots du jour tournent autour de l’économie, des affaires, du profit et de l’argent qui corrompt.
Hier nous parlions du « consensus de Washington » qui selon les spécialistes a imposé le néo-libéralisme au monde par l’action du FMI et de la banque mondiale, en imposant des solutions dogmatiques aux pays endettés. Parallèlement la financiarisation de l’Économie a progressé.
 Aujourd’hui je vous invite à une réflexion d’une autre consistance. Elle est l’œuvre d’une grande intellectuelle américaine, Nancy Fraser née en 1947. Elle est philosophe, enseigne la science politique et la philosophie à la New School de New York. C’est aussi une féministe affirmée, ce qui n’est pas pour me déplaire. Elle a été invitée par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à participer, le 14 juin 2016, à la 38ème conférence Marc Bloch.
Aujourd’hui je vous invite à une réflexion d’une autre consistance. Elle est l’œuvre d’une grande intellectuelle américaine, Nancy Fraser née en 1947. Elle est philosophe, enseigne la science politique et la philosophie à la New School de New York. C’est aussi une féministe affirmée, ce qui n’est pas pour me déplaire. Elle a été invitée par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à participer, le 14 juin 2016, à la 38ème conférence Marc Bloch.
Vous trouverez le discours de cette conférence <ICI>, je vous invite à le lire, vous apprendrez beaucoup.
Je vais essayer de vous en dire quelques mots, à ma manière, et d’instiller une saine curiosité.
On pourrait décrire ce dont nous avons parlé depuis lundi comme d’une pièce de théâtre qu’on voit se jouer devant nous. Beaucoup en parle, les journalistes, les économistes, les politiques. Mais il existe en coulisse des choses essentielles qui se passent. Si ces choses n’existaient pas, la pièce de théâtre ne pourrait se jouer. Sur scène, nous sommes dans le monde des échanges marchands, dans la recherche du profit, dans la vie économique telle qu’on la raconte dans les livres et les écoles de commerce. Dans ce monde, la partie mâle de l’humanité reste largement prédominante. Nancy Fraser ne parle pas de théâtre, c’est une invention personnelle pour présenter sa réflexion.
Dans les coulisses se trouve le monde du « Care » selon le terme utilisé par Nancy Fraser, du «prendre soin » si on parle français, mais Nancy Fraser utilise le concept de « Reproduction sociale ».
Nancy Fraser évoque :
« les « pressions qui, de nos jours s’exercent, de toutes parts, sur toute une série de capacités sociales essentielles, à savoir la mise au monde et l’éducation des enfants, la sollicitude envers amis et membres de la famille, la tenue des foyers et des communautés sociales, ainsi que, plus généralement, la pérennisation des liens sociaux. Historiquement, ce travail de « reproduction sociale », comme j’entends le nommer, a été assigné aux femmes, bien que les hommes s’en soient aussi toujours en partie chargés. Etant à la fois affectif et matériel, souvent non rémunéré, c’est un travail indispensable à la société. Sans cela, il ne pourrait y avoir ni culture, ni économie, ni organisation politique. Toute société qui fragilise systématiquement la reproduction sociale ne peut perdurer longtemps. Et pourtant, c’est aujourd’hui précisément ce qu’est en train de faire une nouvelle forme de société capitaliste »
Nancy Fraser inscrit cette réflexion dans 3 étapes historiques :
La première phase est celui du capitalisme libéral et concurrentiel au XIXe siècle. Le temps où massivement l’exode rural a poussé les pauvres vers les villes et les centres industriels. Dans un premier temps, les femmes et les enfants dès leur plus jeune âge étaient mobilisés pour le travail productif, pour des salaires de misère, dans un univers de pauvreté et de misère sociale incommensurable. Mais les combats sociaux ainsi que la pensée humaniste venant de la bourgeoisie ont abouti à des lois qui ont réglementé le travail des enfants et aussi des femmes.
« Le second régime est celui du capitalisme géré par l’État du XXe siècle. Fondé sur la production industrielle à grande échelle et le consumérisme domestique dans son centre, soutenu par la poursuite de l’expropriation coloniale et post-‐coloniale dans sa périphérie, ce régime a internalisé la reproduction sociale à travers l’engagement de l’État et des entreprises dans la protection sociale. Faisant évoluer le modèle victorien des sphères séparées, ce régime promut ce qui de prime abord pouvait sembler plus moderne : l’idéal d’un « revenu familial », » c’est-à-dire qu’un seul salaire devait permettre de faire vivre une famille. C’était bien évidemment celui de l’homme de sorte que la femme puisse s’occuper de la reproduction sociale. »
Elle ajoute cependant : « même si, encore une fois, un nombre relativement limité de familles pouvaient l’atteindre. ». Cette seconde étape se caractérise par l’émergence et la consolidation de l’Etat providence ou l’Etat social.
Et puis nous arrivons à notre époque :
« Le troisième régime est celui du capitalisme financiarisé et globalisé de notre époque. Les activités de production manufacturière sont délocalisées dans les régions à bas coûts salariaux ; les femmes ont été intégrées à la main-‐d’œuvre salariée ; enfin, le désengagement de l’État et des entreprises de la protection sociale est encouragé. Il y a bien externalisation des activités de care vers les familles et les communautés, mais dans le même temps leurs capacités à les mettre en œuvre ont été atrophiées. Dans un contexte d’inégalités croissantes, il en résulte une organisation duale de la reproduction sociale : marchandisée pour ceux qui peuvent payer, « familiarisée » pour ceux qui ne le peuvent pas – l’ensemble se retrouvant enjolivé par l’idéal encore plus moderne de la « famille à deux revenus » »
Nancy Fraser, à travers ce regard décalé de la « reproduction sociale » examine l’ensemble des questions économiques. Elle explique ainsi la dette :
« Le principal moteur de cette évolution du capitalisme, et le trait caractéristique du régime actuel, est la dette. La dette est l’instrument par lequel les institutions financières mondialisées font pression sur les États pour réaliser des coupes claires dans la dépense sociale, pour imposer l’austérité et plus généralement pour agir de concert avec les investisseurs afin d’extraire de la valeur des populations sans défense. A mesure que les emplois de service mal payés et précaires remplacent le travail industriel protégé par la négociation syndicale, les salaires tombent en dessous des coûts socialement incompressibles de la reproduction ; dans cette « économies des petits boulots », le maintien des dépenses de consommation impose d’accroître la dette des consommateurs, celle-‐ci augmentant donc de manière exponentielle. En d’autres termes, c’est de plus en plus à travers la dette qu’aujourd’hui le capital se nourrit du travail, discipline les États, transfère la richesse depuis la périphérie vers le centre et, tel une sangsue, extrait de la valeur des foyers, des familles, des communautés et de la nature.
Il en résulte une exacerbation de la contradiction intrinsèque au capitalisme entre production économique et reproduction sociale »
Nous entendons nos élites politiques et économiques parler d’adaptation, de compétitivité, d’auto entrepreneuriat, de travail du dimanche, ou même de ce nouveau concept de slasheurs qui serait l’avenir des emplois. Jamais, ils ne nous expliquent quel projet de société impliquent ces évolutions.
Quand Nancy Fraser analyse ces évolutions pour leurs conséquences dans la reproduction sociale, elle explique :
« Non content de diminuer l’investissement de l’État tout en intégrant les femmes dans le travail salarié, le capitalisme financiarisé a aussi réduit les salaires réels, ce qui oblige les membres du foyer à augmenter le nombre de leurs heures travaillées, et ce qui les pousse à une course effrénée pour se décharger sur d’autres des activités de care. Pour combler ces « déficits de care », ce régime emploie dans les pays plus riches des travailleurs migrants qu’on fait venir des pays plus pauvres. Sans surprise, ce sont les femmes racialisées et/ou issues du monde rural pauvre qui prennent en charge le travail reproductif et de soin qui était auparavant assuré par les femmes plus privilégiées. Mais pour ce faire, les immigrés doivent transférer leurs propres responsabilités familiales à des travailleurs de care encore plus pauvres qui doivent, à leur tour, faire de même, et ainsi de suite dans des « chaînes de care mondialisé » aux ramifications toujours plus étendues. »
Et si on regarde du côté des femmes les plus dynamiques de l’économie moderne, totalement intégrées dans la high tech et ayant la volonté de concilier leur carrière professionnelle et leur épanouissement familial, Nancy Fraser raconte deux exemples américains :
« Le premier est la popularité croissante de la « congélation d’ovules », une procédure coûtant normalement 10 000 $ mais qui est offerte à leurs employées femmes hautement qualifiées par des entreprises de l’informatique comme un des avantages négociés dans leur contrat. Désireuses d’attirer et de garder ces employées, des firmes comme Apple ou Facebook les gratifient ainsi d’une forte incitation à décaler leur grossesse. En substance le message est le suivant : « attendez d’avoir 40, 50 ans, voire 60 ans, pour avoir des enfants ; consacrez‐nous vos années les plus productives, les années où vous avez le plus d’énergie»
Un second développement aux États-‐Unis est tout autant symptomatique de la contradiction entre production et reproduction : la prolifération d’appareils mécaniques high-‐tech et très coûteux pour tirer le lait maternel. Eh bien oui : voilà la solution qu’on adopte dans un pays où il y a un taux d’emploi élevé des femmes, où il n’y a pas de congé maternité ou parental rémunéré obligatoire, et où l’on est amoureux de la technologie. C’est aussi un pays où l’allaitement est de rigueur, mais cela n’a plus rien à voir avec ce que c’était par le passé que d’allaiter son enfant. On ne fait plus téter le sein à son enfant, on « allaite » désormais en tirant son lait mécaniquement et en faisant des stocks pour que la nounou puisse ensuite donner le biberon au bébé. Dans le contexte actuel de pénurie chronique de temps, les appareils à double coque, fonctionnant en « kit mains libres », sont ceux qui sont le plus recherché car ils permettent de tirer le lait des deux seins en même temps, tout en conduisant sa voiture sur la voie rapide, en route pour le travail.
Au vu de ces pressions actuelles, est-‐il surprenant que les luttes autour de la reproduction sociale aient éclaté ces dernières années ? Les féministes du Nord disent souvent que le cœur de leurs revendications se trouve dans « l’équilibre entre la famille et le travail » »
Pour finir je cite sa conclusion :
« Plus précisément, j’ai voulu expliquer que les racines de la crise actuelle du care sont à chercher dans la contradiction sociale intrinsèque au capitalisme, ou, mieux, dans la forme exacerbée que cette contradiction revêt aujourd’hui dans le contexte du capitalisme financiarisé. Si cette interprétation est correcte, cette crise ne sera pas alors résolue en bricolant la politique sociale. La solution à cette crise ne pourra se faire qu’en empruntant le chemin d’une profonde restructuration de l’ordre social actuel Ce qui est nécessaire, avant tout, c’est de mettre un terme à la soumission de «la reproduction» à «la production» que le capitalisme prédateur a réalisée Par voie de conséquence, il faut réinventer cette distinction et ré-‐imaginer l’ordre de genre. Reste à voir si l’issue de ce processus pourra encore être compatible avec le capitalisme »
Nancy Fraser donne des clés pour que nous puissions réfléchir et nous demander dans quelle société voulons-nous vivre ? Et de manière plus immédiate, quelle société implique les choix économiques qui nous sont vendus comme ceux de la modernité.
<769>
-
Jeudi 13 octobre 2016
Jeudi 13 octobre 2016«Le consensus de Washington »John WilliamsonDans les émissions consacrées à l’économie que j’écoute, le «consensus de Washington» est souvent évoqué, rarement pour en dire des choses positives, presque toujours pour expliquer qu’il a gouverné les affaires économiques mondiales et qu’il continue encore grandement à les influencer.L’expression «consensus de Washington» trouve son origine dans un article de l’économiste John Williamson en 1989, très largement inspirées de l’idéologie de l’école de Chicago et de Milton Friedman, bref ce qu’on appelle le néo-libéralisme.Le consensus de Washington est un corpus de mesures standard appliquées aux économies en difficulté face à leur dette, notamment en Amérique latine, par les institutions financières internationales siégeant à Washington (Banque mondiale et Fonds monétaire international) et soutenues par le département du Trésor américain.En Amérique latine, [les] années 1980 avait été marquée par une profonde crise économique, une hyperinflation dévastatrice, la déstructuration sociale et des instabilités politiques. La crise de la dette extérieure, écartant le sous-continent des marchés financiers, le priva d’investissements extérieurs, avec un transfert net (négatif) de ressources financières, de près de 25 milliards de dollars en moyenne annuelle, en direction du Nord.Le « paquet » de réformes recommandées à ces États, est résumé dans l’article paru en 1989 sous la plume de l’économiste John Williamson, qui met en avant dix propositions :Une stricte discipline budgétaire ;
Cette discipline budgétaire s’accompagne d’une réorientation des dépenses publiques vers des secteurs offrant à la fois un fort retour économique sur les investissements, et la possibilité de diminuer les inégalités de revenu (soins médicaux de base, éducation primaire, dépenses d’infrastructure) ;
La réforme fiscale (élargissement de l’assiette fiscale, diminution des taux marginaux) ;
La libéralisation des taux d’intérêt ;
Un taux de change unique et compétitif ;
La libéralisation du commerce extérieur ;
Élimination des barrières aux investissements directs de l’étranger ;
Privatisation des monopoles ou participations ou entreprises de l’État, qu’il soit — idéologiquement — considéré comme un mauvais actionnaire ou — pragmatiquement — dans une optique de désendettement ;
La déréglementation des marchés (par l’abolition des barrières à l’entrée ou à la sortie) ;
La protection de la propriété privée, dont la propriété intellectuelle.
Il est possible de résumer cela en 2 mots : dérégulation et privatisation et une conséquence : l’augmentation des inégalités.L’un des arguments en faveur de ce programme était l’existence d’administrations étatiques pléthoriques et parfois corrompues et bénéficiait du contexte de crise idéologique globale lié à l’effondrement du communisme soviétique. Et le Fonds monétaire international et la Banque mondiale exigeaient la mise en place de politiques inspirées de ces principes pour l’octroi de prêts aux États qui leur demandaient de l’aide.Aujourd’hui, il y a peu d’articles qui continuent à défendre ces propositions. J’ai trouvé : http://www.captaineconomics.fr/-consensus-de-washington-liberaliste-williamson qui explique :«Le Consensus de Washington a donc une vision plutôt libérale certes, mais pas ultra-libérale ni impérialiste ! Par exemple si l’on regarde le point (1) sur la nécessité d’une discipline budgétaire et le (2) sur la redéfinition des dépenses publiques, le consensus de Washington ne prône ni nécessairement un équilibre budgétaire (type règle d’or) ni la nécessité de couper dans toutes les dépenses publiques, mais explique qu’il est important de restaurer un déficit à un niveau acceptable n’augmentant pas la dette en % du PNB à long-terme (bien qu’il existe plusieurs vues différentes sur les modalités exactes au sein même du consensus), et qu’il est nécessaire de réorienter certaines dépenses publiques « peu utiles » (subventions entraînant des distorsions économiques) vers les secteurs pouvant apporter de la croissance et réduire les inégalités, comme l’accès aux soins primaires et l’éducation.»Mais l’essentiel des articles d’aujourd’hui prétend que ces préconisations ne fonctionnent pas : http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/473965/le-consensus-de-washington-de-mea-culpa-en-mea-culpa : (article du 22 juin 2016) :«Trois économistes chercheurs associés au FMI, Jonathan Ostry, Prakash Loungani et Davide Furceri, ont effectivement pris une position pour le moins surprenante dans le dernier numéro de la revue Finance and Development (« Neoliberalism : Oversold ? »). Ils y remettent en question deux piliers du néolibéralisme : la libre circulation des capitaux et la priorité donnée à la réduction des déficits. En bref, comme très bien résumé par un chercheur de l’IRIS, le FMI conclut qu’une diminution majeure de la dette publique par des mesures d’austérité n’aurait que des effets limités sur la prévention de crises économiques.Ce n’est pas la première fois que le FMI ou la Banque mondiale rectifient leur discours après des conséquences désastreuses de leurs conditionnalités. Par exemple, la « décennie perdue » des années 1980 en Amérique latine n’était pas tombée dans l’oreille d’un sourd. La mise en place en 1999 de la Stratégie de réduction de la pauvreté en remplacement des Programmes d’ajustement structurels avait été qualifiée par certains commentateurs de « changement de paradigme », et certains entrevoyaient même la chute imminente du consensus de Washington.L’inclusion du concept de développement humain dans les politiques du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que l’accent mis sur l’empowerment des pays du Sud dans la rédaction de leurs programmes de développement sont autant de preuves d’un changement sinon idéologique, du moins rhétorique. […] En 2013, le FMI avait d’ailleurs déjà fait un mea culpa pour l’échec grec. Un rapport de l’organisation admettait alors que malgré les politiques d’austérité, « la confiance des marchés n’a pas été rétablie, le système bancaire a perdu 30 % de ses dépôts et l’économie a fait face à une récession beaucoup plus forte que prévu et à un chômage exceptionnellement élevé. […]En somme, le FMI a certes modifié substantiellement sa rhétorique récemment. Toutefois, il serait hâtif de crier à une remise en question des préceptes fondateurs du néolibéralisme : privatisation, libéralisation et stabilité macroéconomique. Ce que Stiglitz qualifiait de fondamentalisme de marché n’a pas tout à fait disparu dans les corridors du FMI. Personne ne peut nier que le discours émanant du FMI et de la Banque mondiale a évolué depuis les années 1980, mais les discours changent toujours plus rapidement que les pratiques. Les nombreuses critiques sur la nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté en font état.Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Nous ne sommes plus sous le consensus de Washington tel que formulé par Williamson en 1989. Toutefois, nous n’avons pas non plus dépassé cette forme de néolibéralisme qui appauvrit les pays débiteurs et enrichit les pays créditeurs. L’article publié dans la revue Finance and Development par les économistes du FMI ne signifie donc pas qu’ils ont coupé la ligne du téléphone rouge avec l’école de Chicago.».Et un des principaux pourfendeurs du consensus de Washington est Joseph Stiglitz : http://www.rfi.fr/france/20140604-joseph-stiglitz-savoir-inegalite-consensus-washington-tiger-forumJoseph Stiglitz :«La plus grande part de l’amélioration du niveau de vie qui a été réalisé au cours des 100 dernières années n’est pas liée à l’accumulation du capital ou même à une meilleure redistribution des ressources, mais au savoir. Au fait d’apprendre à mieux faire. Au fait d’obtenir plus, avec moins d’entrants. N’oublions pas que, pendant des milliers d’années, jusqu’aux années 1800, le niveau de vie stagnait. Et soudain, il y a une augmentation incroyable du niveau de vie, qui vient de l’acquisition des savoirs. […]Ce qui me préoccupe, c’est que produire juste des minerais, des hydrocarbures, ce n’est pas la base d’un développement durable. En partie parce que cela peut augmenter vos revenus, c’est important. Cela compte, l’argent, mais ça ne vous donne pas un accès direct à la connaissance. Une de mes critiques contre les politiques passées, issues du consensus de Washington, est qu’elles ont conduit à la désindustrialisation. Une idée importante, en Economie, est que les pays apprennent en faisant. La seule façon d’apprendre à produire de l’acier, c’est d’en fabriquer. Mais si vous désindustrialisez, vous n’allez pas apprendre à produire des marchandises. Et donc, les politiques issues du consensus de Washington ont maintenu l’Afrique au niveau d’industrie qu’elle connaissait il y a 40 ans. Ce qui a eu probablement un effet négatif sur l’acquisition des savoirs. […]Ce qui s’est passé ces cinq – dix dernières années est intéressant. Enfin, on reconnaît que la montée des inégalités est un problème. Les inégalités se sont accrues dans la plupart des économies développées, au cours de ces 30 – 35 dernières années. Elles ont atteint un niveau qu’on ne peut plus ignorer. Il n’y a pas seulement des inégalités de revenus, mais aussi des inégalités d’opportunités. Et c’est contraire aux principes de base de la démocratie moderne, à nos valeurs, qui sont de plus en plus partagées dans le monde. La question qui se pose maintenant dans le monde entier est de savoir comment on change les choses, comment on crée une société juste, une société qui offre plus de chances.»Un autre article très détaillé sur ce sujet : http://www.melchior.fr/notion/le-consensus-de-washingtonOn comprend donc que nous sommes ici dans le domaine de la croyance et du dogme, non dans le savoir. Que ces croyances continuent à influencer profondément la marche de l’économie et la politique des Etats, mais qu’elles semblent bien produire des conséquences fâcheuses et contre-productives.Il me semble comprendre que dans une analyse économique traditionnelle, le problème général de l’économie mondiale est un problème de demande : Il n’y a pas en face de l’offre, une demande suffisante et solvable. L’accumulation des richesses dans un trop petit nombre de poches et la stagnation générale des revenus ne permettent plus d’avoir une demande suffisante. Pour pallier cette situation, les consommateurs des pays riches et même des pays émergents se sont massivement endettés pendant des années. Aujourd’hui on parle de l’explosion de la dette mondiale et cela crée d’autres problèmes.Cette situation découle directement de ce qu’on a appelé le consensus de Washington.Et au-delà de ces difficultés considérables, d’autres penseurs affirment que nos défis écologiques devraient nous conduire à sortir de la pensée économique traditionnelle et de la recherche à tout prix de la croissance et donc de l’augmentation de l’offre et de la demande de consommation. Dans ce cas, le consensus de Washington serait non seulement nuisible dans le cadre du système de pensée dans lequel il raisonne, mais ne poserait même pas les bonnes questions pour l’avenir de l’humanité. -
Mercredi 12 octobre 2016
Mercredi 12 octobre 2016«Projet 226»Nom d’une manipulation de l’industrie sucrière aux Etats-Unis en 1965C’est toujours l’argent qui est la cause de cette manipulation qui a eu lieu aux Etats Unis dans les années 1960 et qui a été révélé récemment. La revue de presse internationale de Thomas Cluzel sur France Culture du 14/09/2016 a signalé un article du New York Times où on apprend que l’industrie du sucre a agi de la même manière que l’industrie du tabac pour essayer de cacher le fait qu’elle vendait un produit dont la consommation à haute dose était mauvaise pour la santé :«Au milieu de la masse d’informations et alors que circulent de plus en plus de théories du complot, c’est peu de dire que les partisans de la vérité doivent aujourd’hui redoubler d’efforts pour rassembler des preuves. C’est le cas, en particulier, de ce chercheur de l’université de Californie à San Francisco dont THE NEW YORK TIMES nous apprend qu’il a récemment découvert des documents internes à l’industrie du sucre. Ces documents inédits, datant de la fin des années 1960, révèlent comment un géant de l’agroalimentaire a faussé les règles en matière de nutrition, en prétendant que les risques de maladies cardio-vasculaires n’étaient pas liés à la consommation de sucre.Ces documents ont d’abord fait l’objet d’une publication, lundi, dans la revue JAMA INTERNAL MEDICINE avant d’être repris par l’ensemble de la presse anglo-saxonne. Et sans entrer dans les détails de cette vaste mystification (un scandale très proche, d’ailleurs, de ceux liés aux marchands de tabac), on retient que, des décennies durant, l’industrie sucrière a menti en vantant les prétendus mérites de ses produits.Elle a menti ou plus exactement elle a réussi à nous tromper et mieux encore, à nous convaincre. Car comme l’explique un professeur de psychologie à l’université d’Austin, interrogé par le magazine QUARTZ : «Si je commence à vous dire en quoi vous avez tort, cela ne crée aucune envie en vous de coopérer. Mais si je commence par dire “vous avez raison sur ce point, je pense que ce sont des problèmes importants”, alors vous donnez à votre interlocuteur une raison de coopérer.» Et c’est ce qu’a bien compris l’industrie sucrière qui, en 1965, a lancé ce qu’elle a appelé le «Projet 226», qui consistait à financer des scientifiques de Harvard pour publier une étude dans le prestigieux NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE sur le sucre, les graisses et les maladies cardiaques. Ce faisant, sans nier les risques liés aux maladies cardio-vasculaires, l’industrie a réussi le tour de force de faire dérailler la discussion à propos du sucre. Comment ? En se contentant de minimiser le rôle du sucre dans ces pathologies, tout en incriminant à sa place le rôle du gras. De telle sorte que pendant de nombreuses décennies, les responsables de la santé ont donc encouragé les Américains à réduire leur consommation de matières grasses, ce qui a conduit beaucoup de gens à consommer des aliments à faible teneur en graisses mais, en revanche, hautement sucrés.Parmi les plus de 700 commentaires liés à l’article du NEW YORK TIMES, LE TEMPS a notamment relevé celui-ci : ce scandale est «un exemple dégoûtant de plus du pouvoir du néolibéralisme capitaliste sur les populations». Mais surtout cette gigantesque arnaque donne raison, 350 ans plus tard, à l’inventeur de la machine à calculer et qui s’intéressait, aussi, à la psychologie humaine : Blaise Pascal. Dans “Les Pensées”, il donne en effet une méthode extrêmement efficace pour parvenir à faire changer d’avis une personne. La chose essentielle, explique le philosophe dans un fragment repéré par le site BRAIN PICKINGS, est de prendre en considération son interlocuteur et les arguments qu’il avance. Car le mépris ne fait que braquer la personne en face. En clair, il n’y a pas de raisonnement faux, dit en substance Pascal, il n’y a que des raisonnements incomplets. Envisager sous cet angle, personne ne se trompe totalement, vous vous contenter de faire entendre à votre interlocuteur qu’il ne détient simplement qu’un morceau de vérité. Et c’est ainsi qu’utilisé à des fins purement mercantiles et hautement dommageables sur la santé, un géant de l’agroalimentaire a réussi, tout en pointant les risques liés aux maladies cardiaques, à faire porter le chapeau sur les graisses saturées plutôt que sur le sucre, alors même que les deux sont des facteurs de risques tout aussi importants.Et le magazine SLATE d’en conclure : nous sommes entrés aujourd’hui dans l’ère du mensonge, où certains n’hésitent plus, désormais, à affirmer des choses qu’ils savent pertinemment fausses. Bref, une ère où nous avons, en réalité, plus que jamais besoin de Pascal, pour changer les esprits mais dans le bon sens, cette fois-ci, c’est-à-dire en les conduisant à penser de manière plus précise et plus vraie.Dans cette recherche de la vérité, Pascal ajoute qu’il peut être utile de bien connaître celui qu’on veut persuaderQuelle que soit la chose dont on cherche à persuader l’autre, il faut d’abord savoir à qui on s’adresse, connaître son cœur, son esprit, ses principes. Et ensuite seulement, chercher (dans la chose dont il s’agit), les rapports que cette personne entretient avec ses principes avoués.»Quand on parle d’industrie sucrière, on semble parler d’un concept éthéré, d’un objet virtuel comme lorsqu’on évoque le système financier ou l’industrie pharmaceutique ou encore l’industrie nucléaire.Ces entités sont des constructions juridiques qui cachent la réalité qui est simplement constituée d’un petit groupe d’humains qui n’ont aucun souci de l’intérêt général mais simplement le goût du seul profit et qui pour protéger cette soif sans limite, sont prêts quasi toujours à toutes les compromissions pour parvenir à leur fin.Et ces humains criminels ne sont jamais sanctionnés. Si la justice, dans de très rares cas, les poursuit quand même personnellement, des armées d’avocats arrivent à faire traîner les choses jusqu’à ce que la mort les fassent échapper à la justice humaine.Prenons simplement le scandale du Mediator qui a débuté en 1998, année où en savait qu’il était dangereux et que des gens sans scrupules et soucieux de continuer à gagner beaucoup d’argent n’ont pas agi conformément à l’éthique. Il a fallu des années pour convaincre la justice d’intervenir et elle fut tant empêchée que Jacques Servier a eu le temps de mourir en 2014 avant le procès qui devait le mettre en cause. -
Mardi 11 octobre 2016
Mardi 11 octobre 2016«Malscience, De la fraude dans les labos»Nicolas Chevassus-au-LouisC’est encore l’argent qui est au centre de ce scandale.L’argent me fait toujours penser à deux réflexions :La première me rend un peu triste et mélancolique quand on examine ce qui s’est passé après. C’était lors du Congrès fondateur du PS à Epinay, le discours de François Mitterrand :«l’argent qui corrompt, l’argent qui achète, l’argent qui écrase, l’argent qui tue, l’argent qui ruine, et l’argent qui pourrit jusqu’à la conscience des hommes !»La seconde est un peu plus équilibrée, elle fut le mot du jour du 26 octobre 2012, soit le 9ème mot :« L’argent qu’on possède est l’instrument de la liberté; celui qu’on pourchasse est celui de la servitude. » Jean-Jacques Rousseau.Un journaliste qui est aussi docteur en biologie, Nicolas Chevassus-au-Louis vient de publier le 01/09/2016 un livre <Malscience : De la fraude dans les labos>La quatrième de couverture explique :« […] D’apparence de plus en plus sophistiquée mais produite en masse, de plus en plus vite et de moins en moins fiable.Interrogés de manière anonyme, 2 % des scientifiques reconnaissent avoir inventé ou falsifié des données. Soit pas moins de 140 000 chercheurs fraudeurs de par le monde. Biologie et médecine sont, de loin, les plus touchées. Et ces fraudes manifestes ne sont rien à côté des petits arrangements avec la rigueur devenus fréquents dans les laboratoires. Est-ce grave ? Très grave. Car la biologie et la médecine traitent de la santé, de la vie, de la mort. Est-il acceptable que de nouveaux médicaments soient testés, et peut-être autorisés, sur la base d’expériences plus ou moins truquées ?Comme le secteur financier miné par ses créances irrécupérables, la littérature scientifique en biologie et en médecine, mais aussi en physique et en chimie, s’avère gangrenée par des articles toxiques. Ce livre revient sur une série de scandales internationaux – de la thèse des frères Bogdanoff à des cas moins médiatisés mais non moins fâcheux – et se propose de réfléchir aux causes d’une telle dérive et aux moyens d’y remédier.À la fois enquête de terrain et essai critique, il met en lumière un aspect fondamental et trop ignoré de l’évolution actuelle des pratiques scientifiques.»Mais c’est encore une chronique de Xavier de la Porte que vous trouverez derrière ce lien : http://rue89.nouvelobs.com/2016/10/06/lalgorithme-a-mis-foutoir-recherche-psychologie-265352, qui m’a conduit vers ce livre :«Dans un livre récemment publié aux éditions du Seuil et intitulé « Malscience – De la fraude dans les labos », le journaliste Nicolas Chevassus-au-Louis met au jour une pratique de plus en plus répandue dans le monde scientifique : la falsification des données. Le phénomène n’est pas récent, mais depuis une vingtaine d’années, le phénomène augmente et touche les revues scientifiques les plus prestigieuses. Bien sûr cette falsification ressortit plus souvent du petit arrangement avec les données que de l’invention pure et simple, bien sûr toutes les disciplines ne sont pas concernées au même titre, mais cela illustre selon lui – et il n’est pas le seul à le penser – un travers de la recherche scientifique contemporaine, où l’on est incité à publier vite pour occuper le terrain où le premier à publier emporte tous les bénéfices et où le résultat quantitatif est privilégié à la rigueur de la méthode.Cela n’empêche pas les découvertes, mais les ralentit parfois, et surtout peut avoir pour conséquence de détourner les chercheurs les plus scrupuleux. La question déprimante que l’on se pose en refermant le livre est la suivante : à part révolutionner l’écosystème de la recherche scientifique, que peut-on faire ?C’est là qu’on apprend l’existence d’un algorithme fabriqué par deux doctorants de l’Université de Tilburg aux Pays Bas, et qui répond au joli nom de « Statcheck ». A l’origine, ce petit programme a été écrit pour corriger les erreurs d’arrondis dans les statistiques souvent utilisées par les articles de psychologie (le fait qu’une célèbre histoire d’arnaque ayant touché en 2011 le département de psychologie sociale de l’Université de Tilburg n’est peut-être pas étranger à cette initiative).Quoi qu’il en soit, une fois écrit, le programme a passé en revue 50 000 articles, et ce qu’il a trouvé est assez inquiétant. Près de la moitié des papiers révisés par le robot contiennent au moins une erreur. Mais, plus étonnant, la plupart des erreurs ne sont pas le fruit du hasard puisqu’elles vont dans le sens du résultat annoncé par le papier.Et même, 13% des papiers contiennent une erreur qui aurait pu en changer la conclusion. Et les deux doctorants ont décidé de publier leurs résultats sur un forum scientifique très populaire dans la recherche, du nom de Pubpeer. C’est là que le foutoir a commencé.Parce que si certains chercheurs en psychologie ont vu dans cette démarche un moyen de corriger et améliorer leur travaux, d’autres ont réagi assez violemment. Susan Fiske, chercheuse en psychologie à Princeton et ancienne directrice de l’Association pour la science psychologique est particulièrement remontée.Elle a même parlé de « terrorisme méthodologique ». Ses reproches portent principalement sur la méthode, le fait que tout cela se joue dans un forum et sur les réseaux sociaux académiques, dans des lieux où les mécanismes traditionnels de la publication scientifique sont court-circuités pour une conversation à bâtons rompus, directe, moins policée, plus personnelle. Et de fait, manifestement, c’est dans ces espaces, mais aussi, par blogs interposés, que les chercheurs en psychologie du monde entier sont en train de s’écharper depuis quelques semaines.[…] »Suzan Fiske ne s’intéresse pas au fond, la falsification, mais au fait que ces pratiques soient dénoncées en dehors des circuits officiels maîtrisés par les mandarins de la recherche scientifique.L’argent qui pourrit jusqu’à la conscience des hommes…. -
Lundi 10 octobre 2016
Lundi 10 octobre 2016« Faussaires de génie »Wolfgang et Hélène BeltracchiPlusieurs articles évoquent ce sujet d’actualité dans le monde de l’Art : des musées, Sotheby’s, des experts auraient été abusés et des dizaines de tableaux présentés comme des tableaux de maître : de Frans Hals ou de Lucas Cranach seraient des faux : http://www.latribunedelart.com/adoubes-par-de-grands-musees-plusieurs-tableaux-soupconnes-d-etre-faux ou https://fr.sputniknews.com/societe/201610031028029289-tableau-faux/Ces scandales montrent la place qu’a prise l’argent dans le monde de l’art, apportant avec lui toujours son lot de perversité et de tromperie.Cette actualité m’a fait penser au destin d’un couple de faussaires qui ont agi plusieurs années sur ce marché.<Faussaires de génie> est un livre paru en 2015 où un artiste et son épouse, mot que je préfère à celui de faussaire, racontent de manière autobiographique leurs années de flamboyance où ils ont trompé le monde de l’art. Plutôt que monde de l’art, il serait plus juste de parler du business de l’art. En effet, des années durant, Wolfgang et Hélène Beltracchi leurrent le monde de l’art (experts, galeristes, collectionneurs) en créant des tableaux qu’il signe Max Ernst, Georges Braque, André Derain, Fernand Léger pour n’en citer que quelques-uns. Son stratagème ? S’imprégner du style du maître et peindre des tableaux n’ayant jamais existé ! Sa femme Helene l’aide avec culot et raffinement. Le marché a besoin de marchandise.Né en 1951, Beltracchi est initié, très jeune déjà, à la peinture par son père. Après quelques études artistiques, le jeune homme parcourt le monde, mène une vie de bohème, où alcool et drogues font partie de son quotidien. En même temps, il multiplie les visites de musées, les rencontres et les lectures. Son activité de faussaire démarre d’abord par quelques petits trafics, puis c’est avec Helene dont il tombe fou amoureux dès le premier regard que l’entreprise prend tout son ampleur. Il peint, elle se charge de vendre les tableaux par les circuits professionnels. Ils gagnent beaucoup d’argent, voyagent de longs mois, achètent des propriétés. Jusqu’au jour où tout s’écroule. Parce que Beltracchi a commis une négligence.La négligence commise est l’utilisation par Beltracchi d’un pigment « le blanc de titane » qui ne serait apparu qu’aux environs des années 1950 alors que la toile était datée de 1914. C’est un laboratoire scientifique, non les experts qui a découvert la supercherie. En 2010, un procès révèle au monde entier l’incroyable supercherieOnt-ils des regrets ? Helene répond :«On est en démocratie, il y a des règles. Si on commet une faute, il est normal d’être puni.»Wolfgang acquiesce :«Oui, c’est OK. Mais je tiens à dire quand même que je n’ai pas fait de copies. J’ai créé des œuvres en m’inspirant du style des artistes. J’ai beaucoup travaillé, j’ai fait des tas de recherches dans les livres d’art et les catalogues.»C’était là toute l’astuce du faussaire : repérant des œuvres réputées disparues, il les faisait revivre à sa façon. Son principal gisement fut les catalogues de la galerie d’un juif allemand, Alfred Flechtheim. Ayant fui Berlin dès 1933, ce grand amateur d’art mourut à Londres en 1937. Les Beltracchi imaginent alors un scénario, assurant aux marchands et galeristes que les tableaux qu’ils leur vendaient avaient été acquis par le grand-père d’Helene.[…] Leur procès les a rendus stars. Dans la presse allemande, Wolfgang le facétieux a été surnommé « Till l’Espiègle », quotidiens et magazines publiant à la une les photos du couple qui s’enlaçait tendrement avant de prendre place sur le banc des accusés.La sortie de leur autobiographie, « Faussaires de génie », les a placés à nouveau sous les projecteurs. […] sur le conseil de leur avocat, il a fallu faire des coupes. Pourquoi ? Helene affirme :«Des collectionneurs possèdent encore des tableaux de Wolfgang, ils ne veulent pas les déclarer comme des faux. Il y en a même qui en ont revendu à d’autres amateurs et, chaque fois, les prix montent.»La remarque amuse Wolfgang. Quand on lui demande si sa principale motivation n’a pas été de faire du fric, il rétorque, dans un franglais imparfait :«Au premier rang, le marché de l’art, c’est du business, au dernier rang, c’est encore du business. Alors, l’argent, oui, j’en ai gagné mais ce qui m’intéressait surtout, c’était de me glisser dans la peau des peintres. J’ai fait les tableaux qu’ils rêvaient peut-être de faire. Je les ai peints avec le plus grand soin.»Aujourd’hui il cherche à peindre sous son propre nom et trouve des galeries qui l’exposent mais l’article ajoute : «Avouons cependant qu’il semble avoir du mal à trouver un style réel.» -
Vendredi 7 octobre 2016
Vendredi 7 octobre 2016«Personne au monde, ni en Algérie, ni au Sénégal, ni en Chine, ne souhaite devenir minoritaire dans son village. »Christophe Guilluy, lors des matins de France Culture du 13 septembre 2016Christophe Guilluy est géographe et présente des analyses très intéressantes sur la France d’aujourd’hui, la répartition des richesses sur le territoire, le rapport qu’il définit comme « complexe » à l’autre et la distance de plus en plus grande qui devient une séparation entre la France d’en haut et la France d’en bas.L’exergue du mot du jour est sa réponse à la citation de Guillaume Erner qui reprenait une des affirmations de son dernier ouvrage < Le crépuscule de la France d’en haut> : « L’opinion, il n’y a pas trop d’étrangers en France, n’est majoritaire que chez les cadres !».Le rapport à l’autre constitue un vrai sujet selon lui, mais :« Avant d’aborder ce sujet je voudrais savoir :1° Combien tu gagnes ?2° Où vis-tu ?3°A quoi ressembles les gens qui habitent dans ton immeuble ?4° et où as-tu scolarisé tes enfants ?Après la réponse à ces questions, on peut parler. »Le clivage se fait selon classes supérieures et classes prolétaires.« Le multiculturalisme à 1000 euros par mois, ce n’est pas la même chose que le multiculturalisme à 10 000 euros par mois. »Mais il considère que cette fracture se trouve dans les discours pas dans les faits. Il explique ainsi que : « Les bobos qui aident les immigrés sont probablement et dans leur plus grande majorité sincère dans leurs démarches » mais quand il s’agit de choix résidentiel ou du choix de la scolarisation des enfants, le choix est celui du séparatisme.Et il élargit son propos en disant bien qu’il ne parle pas que du « petit blanc », il en va de même pour la population d’origine maghrébine bien implantée en France qui va aussi pratiquer l’évitement et la fuite lorsqu’elle constate que le quartier, dans lequel elle vit, voit affluer une nouvelle population d’immigration subsaharienne.Et il précise :« Ce que je critique c’est la condamnation des gens d’en bas par les gens d’en haut. Le rapport avec l’autre est plus complexe pour les gens d’en bas. »Avant son dernier ouvrage, Christophe Guilluy en avait publié 2 autres qui avaient fait grand bruit et déclenché des polémiques :D’abord : < Fractures françaises >, puis surtout <La France périphérique ; comment on a sacrifié les classes populaires>Dans ce dernier ouvrage, le géographe détaille sa vision de la fracture territoriale en France.Il oppose les grandes métropoles où sont produits les richesses et où vivent les dominants et les gagnants de la mondialisation et la France périphérique, c’est-à-dire le reste du territoire donc hors grandes métropoles où vivent la majorité des classes populaires.Plus précisément, il décrit trois territoires : la France périphérique, les Grandes métropoles et les banlieues des grandes métropoles qu’il décrit comme « les coulisses » ou « les vestiaires » des métropoles où vivent les émigrés qui travaillent dans le BTP, comme serveur ou dans les emplois de service au profit des dominants des métropoles. La Seine Saint Denis est le meilleur exemple de telles « coulisses ».Il montre cette évolution où les classes populaires ne vivent plus à l’endroit où se créent les richesses. Le besoin d’ouvriers dans les usines nécessitait leur présence. Paris était une ville remplie d’ouvriers et de classes populaires. Le marché immobilier, la logique économique s’est chargée d’évacuer les gens qui n’étaient plus utiles pour les besoins de l’économie. Aujourd’hui les classes populaires ne peuvent plus habiter près des grandes métropoles que dans le parc social, alors qu’au XXème siècle, les ouvriers étaient logés pour leur plus grande part dans le parc des logements privés.Ce découpage du territoire correspond d’assez près au vote pour ou contre le Front national.Cette pensée très riche aurait probablement mérité plusieurs mots du jour. Dans son dernier ouvrage il insiste sur la rupture et l’incommunicabilité entre la France d’en haut qui profite de la mondialisation et la France d’en bas qui est la perdante de la mondialisation. Je finirai par cette réflexion du géographe : « On a un système économique qui marche mais qui ne fait pas société ».Voici un lien vers un article qui <Qui développe et approuve les thèses développées dans La France périphérique>Et aussi deux articles plus critiques <Slate> et <Libération> -
Jeudi 6 octobre 2016
«La quantophrénie»Pitirim Sorokin (1889-1968)Aujourd’hui, je vais vous parler d’une maladie.
Ou disons plutôt un dérèglement des sens et du jugement dont la pathologie consiste à vouloir traduire systématiquement les phénomènes sociaux et humains en langage mathématique et en chiffre.
C’est un sociologue américain Pitirim Sorokin qui l’a conceptualisé, l’a nommé « la quantophrénie » et l’a défini par la fascination du chiffrage des phénomènes.
 C’est une chronique de Guillaume Erner qui me l’a faite découvrir, chronique qu’il a appelé les crétins quantophrènes, en abrégé les CQ.
C’est une chronique de Guillaume Erner qui me l’a faite découvrir, chronique qu’il a appelé les crétins quantophrènes, en abrégé les CQ.
C’était lors de la découverte du scandale des tests des moteurs diesels Volkswagen :
« Encore une fois les CQ sont au cœur de l’actualité. C pour crétin Q pour quantophrène.
La quantophrénie, la maladie qui consiste à croire qu’il n’y a de vérité que chiffrée. Que tout chiffre est une vérité.
Les crétins quantophrènes s’ébrouent dans le scandale Volkswagen. Des années à prendre des mesures bidons, à respirer des moteurs diesels en les décrétant bon pour le service. Crétinisme chiffrée de la mesure, qui ne croit qu’en la mesure, alors que tout test peut être biaisé ou contourné. Crétinisme endormi par deux chiffres après la virgule, équation somnifère concoctée tout exprès par une batterie d’ingénieurs automobiles.
Que les adorateurs du diesel, se rassurent, ils sont rejoints depuis hier par d’autres crétins quantrophènes selon lesquels les inégalités en France ont baissées […] pour dire que le taux de pauvreté a diminué de 14,3% à 14%. Encore une fois la magie hypnotique du chiffre. […] Les crétins quantophrènes veillent. Combien de temps encore, faudra t’il subir les méfaits de ces quantificateurs de l’absurde.
Car contrairement à ce qu’on pense, les gouvernements n’édictent plus de mesures, ce sont les mesures qui nous gouvernent.
Alfred Binet, l’inventeur des tests d’intelligence croyait que l’intelligence c’est ce qui est mesurée par ces tests. Et bien, la bêtise c’est ceux qui croient en ces mesures. »
Voilà, tout est dit !
Mais cela n’est pas suffisant, car exactement comme pour l’essentialisme que nous subissons et que nous pratiquons aussi, si notre vigilance est prise à défaut (quand nous les disons les jeunes sont ainsi et les musulmans sont comme cela, sans compter les auvergnats, les anglais etc.), nous subissons également et pratiquons cette bêtise quantophrénique au quotidien.
Nous sommes fascinés par les chiffres. A partir du moment où il y a un chiffre, il y a un début de vérité et nous pouvons raisonner. C’est une bêtise. Il faut en être conscient.
Dans notre quotidien professionnel, cela représente une autre réalité qui a pour nom «la gouvernance par les nombres». J’en avais fait le mot du jour du 3 juillet 2015, ce titre correspondant à un cours au Collège de France d’Alain Supiot.
Le chiffre ne représente aucune vérité. Il s’éloigne encore davantage de la vérité, quand on y attache une trop grande signification. Parce qu’alors il pervertit le jugement car on ne regarde plus que le chiffre sans essayer de comprendre ce que ce chiffre veut dire, ce qu’il compte ou même ce qu’il est sensé compter.
Le premier chiffre qui obscurcit le jugement est certainement le PIB. Dans des moments de lucidité, il arrive qu’on le critique. Même Nicolas Sarkozy, avait mis en place une commission, dont faisait partie Stiglitz, pour essayer de trouver un autre indicateur. Mais après le questionnement, on en revient bien vite à la mollesse et à tradition conformiste du PIB. Vous pouvez tous les écouter, de droite comme de gauche, ils n’ont qu’un mot à la bouche : croissance ! Or la croissance, c’est l’augmentation du PIB.
Le regretté Bernard Maris disait :
« Quand vous prenez votre voiture à Paris et que vous consommez pendant deux heures de l’essence inutilement parce que vous êtes dans un embouteillage, vous faites augmenter le PIB.
Si vous prenez un vélo pour éviter la pollution, vous n’abondez pas le PIB. »
Que compte le PIB ? Quand les industries produisent et vendent des armes, le PIB est impacté favorablement. Quand il y a des accidents et qu’il faut réparer les véhicules et les humains blessés le PIB augmente.
Quand une mère ou un père s’occupe d’éduquer, de jouer, d’enseigner leurs enfants pour en faire des citoyens et des humains capables de liens sociaux et de vivre selon une éthique, le PIB ne le voit pas.
Quand ces parents préfèrent payer des personnels pour s’occuper de leurs enfants, le PIB en tient compte.
Quand un humain tente de vivre de manière saine pour essayer de préserver sa santé, il participe moins au PIB qu’un autre qui vit sans tenir compte de tels principes et qui doit avoir recours aux médicaments, aux médecins pour soigner ses excès.
Le PIB est un de ces chiffres fétiches qui symbolise de manière remarquable la quantophrénie.
Mais ce n’est pas le seul.
Tout chiffre n’est cependant pas crétin !
Dans les sciences exactes, on a mesuré que la vitesse de la lumière était de 299 792 458 m / s. Ceci a un sens, des raisonnements exacts et des conséquences scientifiques peuvent être tenus à partir de ce chiffre.
Mais il n’y a pas que les sciences exactes.
Tous les chiffres des sciences humaines ne sont pas vains ou mous comme dirait Emmanuel Todd. Il existe des chiffres durs qui ont du sens : par exemple la mesure de la mortalité infantile dans un pays, ou le nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer, l’âge moyen de mortalité. Ces chiffres donnent de vraies indications sur l’état du système de santé ou des mœurs d’un pays.
Mais maintenant quand on lit <La pollution tue 7 millions de personnes par an dans le monde> quel crédit accorder à ce chiffre ? Quasi aucun. Je ne dis pas que la pollution ne contribue pas à augmenter la mortalité, mais je prétends que celui qui affirme que le nombre de morts de ce fait est de 7 millions est un CQ.
Récemment l’Institut Montaigne avec L’IFOP ont publié une étude sur les musulmans de France. Dans cette étude, un chiffre a été produit : <28 % des musulmans sont radicalisés et ont adopté un système de valeurs clairement opposé à celles de la République.> Ce chiffre a été répété à satiété par les médias. Les réseaux sociaux s’en sont emparés. Quand certains osent mettre en cause la méthode, d’abord se poser la question dans 28% quels sont les 100 %, quel est le dénominateur ? Quelle est exactement la population testée ? Et puis à partir de quelles questions, de quelles analyses classent-on la personne interrogée dans cette catégorie qui représente 28%.
De telles questions sont incongrues dans l’esprit de beaucoup, seul reste 28% et on ajoute «28% vous vous rendez compte !»
Je pourrais allonger ce mot du jour à l’envie par des dizaines d’exemple de chiffres qui nous sont assénées quotidiennement comme autant de vérités, de certitudes.
Quand on a enfin conscience de ce phénomène, de cette fascination maladive du chiffrage, il faut d’abord s’appliquer à soi-même cet enseignement et user de chiffres avec grande modération et sans y accorder trop d’importance. Le chiffre n’est jamais la vérité sauf dans ces cas très limités dont j’ai évoqué certains.
Et ensuite quand nous sommes dans la position du receveur, de celui à qui on assène un chiffre nous devons faire usage de la même intelligence et du même scepticisme.
La bonne question qu’il faut toujours se poser : d’où vient ce chiffre ? Quel peut être sa dose de crédibilité ? Sommes-nous en présence d’un crétin quantophrène ?
Ce crétin peut parfois être notre supérieur hiérarchique, lui-même victime de la fièvre quantophrène à l’insu de son plein gré. Dans ces échanges, le chiffre peut être utilisé pour tenter de clore tout débat, toute analyse, toute réflexion et il devient alors un totem ou le centre de la discussion alors que la raison ne devrait lui allouer, le plus souvent, qu’un rôle accessoire.
<763>
-
Mercredi 5 octobre 2016
Mercredi 5 octobre 2016«L’externalisation de notre vie amoureuse»Christopher Trout, journaliste sur le magazine en ligne EngadgetXavier de la Porte suit avec attention les dernières nouveautés qui nous viennent le plus souvent des Etats-Unis.Externaliser est le maître mot des grandes entreprises pour toutes les tâches peu rentables ou celles dont elles ne veulent pas s’encombrer.Et certains ont donc imaginé, d’externaliser aussi certaines des phases de la vie amoureuse…«Vous connaissez tous les sites et applications de rencontres amoureuses, de OkCupid à Tinder. Tous ces lieux, pour apporter satisfaction à celui ou celle qui les fréquente nécessitent, du temps et des compétences. Il faut savoir se présenter, bien choisir les profils des cibles potentielles, il faut discuter – même un minimum – il faut fixer un rendez-vous etc. D’aucun diraient que c’est un vrai boulot.D’où l’idée ingénieuse d’en faire un business, en proposant aux usagers de ces plateformes de le faire pour eux. Dans un papier tout à fait instructif du magazine Engadget, le journaliste Christopher Trout raconte ce nouveau business de l’externalisation de notre vie amoureuse. Il raconte donc ces entreprises qui s’appellent TinderDoneForYou ou Swagoo, qui vous proposent d’atteindre exactement votre but. Qu’il soit une rencontre d’un soir ou l’amour d’une vie, ces entreprises les promettent (TinderDoneForYou vous garantit qu’il vous faudra au maximum 12 rendez-vous pour trouver l’homme ou la femme de votre vie). Pour ce faire, il va d’abord s’agir d’optimiser votre profil. Il y aura d’abord de longues conversations avec un conseiller auquel vous direz tout. L’entreprise peut si vous le voulez, rédiger la présentation qui sera inscrite sur le site. Puis il faudra faire des photos qui vous avantagent (où l’on apprend au passage que des photographes se sont professionnalisés dans la photographie à destination des réseaux sociaux, et de Tinder en particulier) Celles-ci seront sélectionnées par un panel de conseillers humains (12 femmes si vous êtes un homme). Ensuite, ce sont encore des conseillers qui vont sélectionner les profils qui sont susceptibles de vous intéresser (en fonction de ce que vous leur avez dit) et qui vont même caler les rendez-vous. (Certaines entreprises vous faisant des propositions de lieux, de vêtements à porter, et même de sujets de conversation). Bref, vous payez (de 450 à 1300 dollars) et vous n’avez plus qu’à vous asseoir en face du sujet de votre désir.Mais cette économie de l’amour externalisé ne se limite pas à la rencontre. Il existe des sites qui promettent d’être un meilleur amoureux, en, par exemple, vous faisant parvenir un cadeau à destination de la femme aimée, dont vous avez forcément oublié l’anniversaire (ces sites visent un public masculin, allez savoir pourquoi). D’autres sites vous aident à quitter l’être anciennement aimé en rédigeant le texto ou le mail de rupture (voire en envoyant un cadeau de rupture, où l’on apprend aussi qu’il existe des cadeaux de rupture). Et il y a même des sites qui vous promettent la gestion la plus parfaite de votre divorce, depuis le choix de l’avocat jusqu’à la proposition d’agendas partagés pour la gestion des enfants.Notre premier réflexe serait de trouver cela complètement débile. Mais ce serait en négliger certains aspects. D’abord, malgré la grande naïveté de ces entreprises (et d’ailleurs, le journaliste se rit des choix qui sont faits pour lui), elles vont à l’encontre d’une algorithmisation des processus amoureux puisque à chaque étape, même si elles recourent à des data-scientists (des spécialistes des données), elles font une large part à l’humain. Ce qui est en soi intéressant.Malgré tout, on pourrait trouver étrange cette proposition de délégation de nos choix amoureux. Cela dit, je me souviens avoir discuté à Mumbai avec de jeunes indiennes appartenant manifestement aux classes les plus élevées. Elles parlaient un anglais parfait, se destinaient à de brillantes carrières et étaient, à leur manière, tout à fait entreprenantes. Pourtant, elles défendaient mordicus le mariage arrangé. A mes questions étonnées, elles répondirent : “eh bien nos parents sont ceux qui nous connaissent le mieux et ils ont une expérience que nous n’avons pas, ils feront le meilleur choix pour nous.” Après tout, tous ces sites et applications ne promettent pas autre chose, mais dans un autre horizon culturel, où la tradition cède la place à une marchandisation extensive.Bref, on accuse beaucoup les machines et l’informatique de prendre des décisions à notre place, mais il faudrait plutôt regarder notre paresse, notre crainte du choix, et l’aptitude de certains à en faire une économie.»Voilà, quand on pensait que les algorithmes allaient tout faire, on en revient à l’archaïsme des mariages arrangés par les parents ou à la modernité de la sous traitance de toutes les étapes qui mènent au couple, voire au-delà … -
Mardi 4 octobre 2016
Mardi 4 octobre 2016«Les Rohingyas forment une des minorités la plus persécutée au monde.»Selon l’ONUJ’ai déjà expliqué mon scepticisme quant à cette expression utilisée par tous les responsables religieux du monde : «Nous sommes une religion de paix.»Dans un monde de complexité, il faut être précis. Je ne nie pas que dans les textes sacrés des religions il existe des paragraphes concernant la paix, l’amour du prochain, le pardon. Je ne nie pas davantage que dans les diverses religions, il existe des femmes et des hommes qui aspirent profondément à la paix et vivent dans ce sens.Ce que je conteste c’est le fait qu’une communauté d’individus très croyants dans une religion soit forcément plus pacifique qu’une communauté non croyante. Et je pense même que c’est plutôt le contraire lorsqu’une religion dirige un Etat soit directement comme en Iran, soit possède une telle emprise sur la société que l’autorité politique est nécessairement soumise à elle, comme en Birmanie. Une religion n’apporte pas la paix, son but premier est de créer un «Nous» qui rassemble une communauté. Ce «Nous» devient souvent violent lorsqu’il se compare à «Eux» qui ne sont pas «Nous».Beaucoup pensaient peut être que si le christianisme et l’Islam pouvaient, par leur Histoire, donner de la consistance à cette thèse, il existait au moins une religion qui échappait à cette malédiction : le bouddhisme.Raté.Le dalai lama est certainement un homme de paix, mais la religion qu’il représente quand elle se trouve dans une position hégémonique, fonde un «Nous» qui trouve un «Eux» à qui s’opposer possède également dans ses rangs des hommes violents capable des pires atrocités.Nous sommes en Birmanie, la religion majoritaire est la religion bouddhiste. Et il existe une minorité qui est de religion musulmane : les Rohingyas.Les Rohingyas se considèrent comme descendants de commerçants arabes, turcs, bengalis ou mongols. Ils font remonter leur présence en Birmanie au XVe siècle. Le gouvernement birman estime pourtant qu’ils seraient arrivés au moment de la colonisation britannique et les considère comme des immigrants illégaux bangladais. En 1982, une loi leur a retiré la citoyenneté birmane. Après plus de 30 ans d’exactions, ils ne sont plus que 800.000 dans un pays de plus de 51 millions d’habitants.Dans ce pays, les bouddhistes birmans ne font pas simplement comme les autres religions, ils font pire car, selon l’ONU, les Rohingyas forment une des minorités la plus persécutée au monde.Je tire de cet article de <RFI> : « […] Selon les Nations unies, cette minorité souffre notamment de déni de citoyenneté, de travail forcé et de violences sexuelles. Le Haut-Commissariat des droits de l’homme de l’ONU a rendu un rapport [dans lequel il] dénonce « une série de violations grossières des droits de l’homme contre les Rohingyas […] qui laisse supposer une attaque de grande ampleur ou systématique […] qui pourrait déboucher sur une possible accusation de crimes contre l’humanité devant un tribunal . […]Le rapport de l’ONU souligne que les Rohingyas, apatrides, sont exclus du marché du travail, du système éducatif et de santé et soumis à des menaces pour leur vie et leur sécurité, au travail forcé, à la violence sexuelle. Les enfants rohingya ne reçoivent pas de certificat de naissance depuis les années 1990. […]Aung San Suu Kyi, qui évite soigneusement le sujet et qui ne semble pas avoir de programme pour faire respecter les droits des Rohingyas, rapporte notre correspondant à Rangoon, Rémy Favre. […]Aung San Suu Kyi refuse d’ailleurs d’utiliser le mot « Rohingya », une appellation très controversée en Birmanie. Les extrémistes bouddhistes la réfutent. Pour eux, la minorité n’existe pas. En visite officielle jusqu’à ce dimanche en Birmanie, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault n’a pas non plus prononcé publiquement le terme « Rohingya », mais il l’a utilisé en privé avec son homologue birmane, Aung San Suu Kyi.»Ce reportage de France 24 montre de manière plus concrète cette histoire de la haine ordinaire.Vous verrez Ashin Wirathu, un moine bouddhiste qui a l’air doux comme tout autre moine bouddhiste dire tranquillement :«Il y a dans notre pays deux problèmes qui nous préoccupent :Le premier est la transition démocratique.Le second est la propagation de l’Islam.Je vais vous dire […] les musulmans sont plein de haine».Ces moines bouddhistes parle de protection de leur race et de leur religion.Je vous rassure le Dalai lama condamne ces exactions. Aung San Suu Kyi est beaucoup plus ambigüe.Dès qu’on s’intéresse à ce sujet on trouve de très nombreuses pages sur Internet.J’ai consulté : -
Lundi 3 octobre 2016
Lundi 3 octobre 2016«La première victime du carnage de Nice, le 14 juillet 2016, était une musulmane.»Rappel d’un simple fait objectifComme, le journal le Monde l’avait fait pour la tuerie du Bataclan et de Paris, il publie un article par victime du 14 juillet 2016 à Nice.Ce 1er octobre, le journal a publié un article sur Fatima Charrihi qui fut la première victime du camion et de son conducteur meurtrier et haineux.Fatima Charrihi, la première victime était musulmane.Elle avait presque le même âge que moi, même un peu plus jeune, elle portait un voile qui lui couvrait les cheveux.Le lendemain, sa fille Hanane, qui porte aussi le voile, est venue sur la promenade des anglais accompagnée de sa sœur, pour se recueillir à l’endroit où sa mère a perdu la vie.Hanane raconte : «Lundi, sur la Promenade des Anglais, j’ai ressenti avec ma famille le besoin de venir déposer des fleurs en hommage à ma mère. Sur le chemin, nous avons été alpagués par un homme qui nous a dit : « On ne veut plus de vous chez nous.Ça m’a fait de la peine, mais j’ai préféré ne pas réagir. Plus tard, un homme assis à la terrasse nous a balancé : « Maintenant, vous sortez en meute. »Cette fois-ci, je n’ai pas pu m’empêcher de lui dire que nous étions en deuil, que notre mère faisait partie des victimes. Il nous a rétorqué : « Tant mieux, ça fait un en moins. »Je me suis mise à trembler de tous mes membres, mais j’ai réussi à garder mon sang-froid. Ma sœur a commencé à lui crier dessus. Lui s’est levé et nous a menacé de nous frapper. Nous sommes partis en vitesse. »L’article du Monde nous parle un peu de Fatima Charrihi :«Son petit-fils sur les genoux, bien installée sur une large balançoire, Fatima Charrihi énumère en riant les noms de ses nombreux petits-enfants tandis que le garçonnet de 6 ans les répète à tue-tête. Depuis la mort de leur mère, les sept enfants de Fatima, âgés de 14 à 37 ans, regardent souvent cette vidéo, qu’ils se sont partagée sur le groupe WhatsApp baptisé « Famille Charrihi ». Comme image d’illustration, ils ont choisi une photo de leur mère : visage poupon, regard nimbé de douceur, sourire éclatant qui donne à ses yeux une forme de demi-lune.« C’était le pilier de la famille », résume Ali, le fils aîné de 37 ans, qui voyait sa mère au moins trois fois par semaine. Fatima avait une attention particulière pour chacun de ses enfants. A la prière de l’aube, elle laissait ses chaussons encore chauds à Hanane, qui détestait les levers aux aurores. La fratrie tisse le portrait d’une femme « patiente », « humble », « douce », « tolérante », « généreuse » et « pieuse ».Hanane, 27 ans, que sa mère appelait quotidiennement, précise que Fatima était aussi une femme autoritaire, notamment lorsqu’il s’agissait des devoirs scolaires. Issue d’une famille de paysans berbères impécunieux, elle n’était jamais allée à l’école et ne savait pas lire. « Elle demandait aux plus grands de vérifier que tout le monde avait bien fait ses devoirs », se souvient Hanane, préparatrice en pharmacie pour la plus grande fierté de sa mère. « Elle savait que c’est grâce à l’école que l’on aurait une situation », ajoute Ali, la voix éteinte.[…] Comme des centaines de personnes qui ont croisé le chemin de Fatima, la femme qui l’employait depuis seize ans s’est rendue à la prière funéraire en son hommage. Elle a pleuré la mémoire de cette femme « pleine de bons conseils » qui « avait toujours un mot pour réconforter. » D’autres ont salué la bonté de cette mère de famille qui partageait volontiers les plats traditionnels qu’elle cuisinait. Tous se sont souvenus de la complicité inébranlable qui unissait Fatima et Hamed, son mari depuis quarante-trois ans. « Je ne les ai jamais vus se disputer mais ils se taquinaient tout le temps », abonde Latifa, la fille aînée, trouvant les mots à la place de son père, trop ému pour exprimer l’ineffable.Le soir du 14 juillet, le couple s’est justement chamaillé. Fatima voulait accompagner ses petits-enfants sur la promenade. Hamed, lui, aurait préféré observer le feu d’artifice de son balcon. Sa femme a eu le dernier mot. Alors qu’il garait la voiture, le camion a percuté Fatima, première victime de l’attentat.»Quelquefois raconter simplement les faits, la réalité, constitue la plus simple et grande leçon de philosophie.Fatima était une femme simple, taquine, mère, grand-mère, elle voulait que ses enfants réussissent dans la vie et elle était habitée de bons sentiments à l’égard des autres.Elle a rencontré la haine d’un musulman criminel.Le lendemain, ses filles ont aussi rencontré la haine, la haine de personnes qui veulent cultiver une communauté de « Nous » opposés à « Eux ».Posément, calmement et résolument, je m’inscris dans le « Nous » dans lequel se trouve Fatima Charrihi, femme musulmane voilée qui voulait que ses enfant réussissent en France. Et je ne veux pas faire partie du « Nous » imaginé par les gens haineux qu’ont rencontré les filles de cette femme qui a été la première victime de tuerie de la promenade des anglais.L’article du Monde se trouve derrière ce lien : http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2016/10/01/fatima-charrihi-55-ans-en memoire nice_5006637_3224.html -
Vendredi 30 septembre 2016
Vendredi 30 septembre 2016«Avant cela, avant qu’il ne faille quitter cette vie pour nous fondre dans l’autre, nous sommes responsables de notre destinée.
Je ne serai pas accusée de m’être dérobée.»Leonora Miano, Crépuscule du tourmentVoici ce premier paragraphe :« On étouffe comme avant l’orage. Il approche, prend son temps, strie le ciel d’éclairs soudains et espacés, lance sur nos existences d’indéchiffrables imprécations. J’en ai vu d’autres. Le tonnerre s’apprête en coulisse, on l’entend qui prépare ses grondements pour tout à l’heure, ce ne sont encore que des roulements sourds. La Mère du monde doit faire, en cet instant, quelques discrets gargarismes. Sous peu, sa voix se fera puissante, mais qui saura en décrypter les arrêts ? On a beau écouter, on n’entend que ce qui est au fond de soi. Le temps viendra, pour que la divinité révèle la vérité, approuve ou non notre conduite sur la terre des vivants. Avant cela, avant qu’il ne faille quitter cette vie pour nous fondre dans l’autre, nous sommes responsables de notre destinée. Je ne serai pas accusée de m’être dérobée.»Léonora Miano est une écrivaine de langue française franco camerounaise. Elle a été invitée à France Inter par Patrick Cohen le 23 septembre 2016.Pour comprendre le choix de ce mot du jour, il faut que je parle un peu de moi.Je suis très sensible aux sons, aux timbres. J’aime le beau son, l’orchestre philharmonique de Berlin avec Karajan délivrait une pâte sonore qui immédiatement enclenchait dans mon corps des réactions émotionnelles.La voix humaine se trouve pour moi dans ce même registre. Joan Baez ou Jean Ferrat pour quitter le monde de la musique classique possèdent de ces voix qui ouvrent immédiatement l’attention auditive.Et puis il y a la voix même sans musique.Marie-France Pisier, qui nous a, hélas, quitté en avril 2011, était une écrivaine, une actrice merveilleuse, une personne lumineuse et c’était une voix !Et ce matin du 23 septembre 2016, quand Leonora Miano a simplement répondu «bonjour» à Patrick Cohen, mon attention auditive bienveillante a été immédiatement captée.Très bien Alain… Mais on peut avoir une merveilleuse voix et dire des choses très banales, stupides voire répugnantes.Evidemment, mais une fois entré dans l’attention par la grâce du son, j’ai écouté ce que disait cette voix grave, douce, chaleureuse et enveloppante : et c’était très intelligent, rempli d’expériences critiques et positives.Et puis Augustin Trapenard a invité en fin d’émission Leonora Miano à lire le début de son <dernier livre : Crépuscule du tourment> paru en août 2016. Et cette lecture m’a touché et c’est pourquoi j’ai partagé cet extrait avec vous.Née au Cameroun, elle explique qu’il existe une sorte de déification de l’Occident [au sein des élites africaines] ce qui les a poussées à ne pas transmettre la culture ancestrale africaine à leurs enfants. Ce qui n’est jamais positif car cette rupture coupe les individus de leurs racines tellement importantes dans la construction de l’être.Elle a refusé d’aller au lycée français en 6e, car elle avait vu des jeunes y aller et « les a vu changer ». On comprend : « pas dans le bon sens ». J’ai cru comprendre qu’ils devenaient prétentieux et méprisants à l’égard de celles et ceux qui n’avaient pas le même parcours.Elle a pris la nationalité française parce que sa fille était française et que cette démarche simplifiait beaucoup sa vie administrative. Au début, elle ne se sentait pas française de cœur, mais au fur à mesure de sa vie en France son attachement à la France s’est peu à peu construit. Quelquefois sur des détails, elle avoue ne pas pouvoir se passer du « Comté » et plus généralement des fromages français.Mais son identité, elle la dit « frontalière, je me tiens là où les mondes se rencontrent en permanence »Et elle affirme :« Être français, c’est vouloir participer au projet ‘France’, ce qu’on va en faire, gaulois ou pas. La France est encore un projet, nous ne sommes pas encore en pleine époque de fraternité et d’égalité. La France est avant tout un projet qu’il faut faire passer de la virtualité à la réalité : faut bosser »Voici le lien vers l’émission de France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-23-septembre-2016 et la seconde partie : https://www.franceinter.fr/emissions/interactiv/interactiv-23-septembre-2016<J’ai trouvé cet article très intéressant de 2012 : Léonora Maino un auteur qui dérange> où elle évoquait l’intention de quitter la France, mais selon l’émission de France Inter ce n’est plus le cas. Dans cet article, est évoqué une de ses quêtes : travailler sur les non-dits.<759> -
Jeudi 29 septembre 2016
Jeudi 29 septembre 2016« Il y a deux mille ans la France s’appelait la Gaule »Ernest LavisseMichel Rocard disait «La France va très mal. Le cœur de ce malaise reste économique.» (mot du jour du 7 septembre 2016)L’ancien président qui projette l’idée de le redevenir parle peu d’économie et beaucoup de sécurité et d’identité.Il a donc déclaré le 19 septembre à Franconville, dans le Val d’Oise «Dès que l’on devient Français, nos ancêtres sont Gaulois».Les sondages semblent lui donner raison, il rattrapent son retard sur son concurrent le plus sérieux.La stratégie politique lui donne aussi raison puisque Alain Juppé ne parle plus d’économie et d’éducation mais réplique à Nicolas Sarkozy.Les grands stratèges militaires le disent tous : si vous parvenez à attirer votre adversaire sur le terrain que vous avez choisi, la victoire est en vue.Et ce grand stratège politique (nous savons cependant que les qualités pour gagner les élections sont assez éloignées de celles qu’il faut pour bien gouverner) continuent son récit :« Nos ancêtres étaient les Gaulois mais aussi les tirailleurs musulmans morts à Monte Cassino », a-t-il ajouté samedi 24 septembre.Mais revenons à nos ancêtres gaulois. Les gens de ma génération l’ont appris à l’école et nous qui sommes des gens raisonnables, nous savons que nous devons nous méfier de ce qu’on raconte à la télévision, dans les publicités et ce que disent les hommes politiques. Mais ce qu’on a appris à l’école, c’est la vérité et même dirait Régis Debray c’est « sacré ».Je n’avais pas beaucoup remis en cause cet apprentissage de l’école primaire. Mais vous savez que j’ai débuté des études d’Histoire à l’Université de Lyon 2 en 2003 et j’ai eu comme professeur Yves Roman qui était professeur d’Histoire romaine. C’était un homme érudit et qui a écrit de nombreux livres savants sur l’Histoire romaine.Bien qu’il fût érudit, il avait besoin de manger à midi et pour ce faire il fréquentait la cantine de la Direction des Finances du Rhône que j’utilisais également.Ainsi, si nos horaires coïncidaient, nous déjeunions ensemble pour parler de choses et d’autres et surtout d’Histoire.Et comme il avait aussi écrit un livre sur la Gaule, il m’initia aux mythes de la Gaule.Dans le monde des grands historiens, le premier à écrire une Histoire de France fut Jules Michelet (1798-1874).Le suivant fut Ernest Lavisse (1842-1922). Cet historien fut très affecté par la défaite de la France en 1870. Par la suite, il influença énormément l’enseignement de l’Histoire dans les écoles en France. Les manuels scolaires étant directement inspirés par ses ouvrages.Dans Wikipedia, nous apprenons ainsi que selon l’enseignement d’Ernest Lavisse :« Autrefois notre pays s’appelait la Gaule et les habitants s’appelaient les Gaulois » (cours élémentaire),ou « Il y a deux mille ans la France s’appelait la Gaule » (cours moyen).« Nous ne savons pas au juste combien il y avait de Gaulois avant l’arrivée des Romains. On suppose qu’ils étaient quatre millions » (conclusions du livre I du cours moyen).« Les Romains qui vinrent s’établir en Gaule étaient en petit nombre. Les Francs n’étaient pas nombreux non plus, Clovis n’en avait que quelques milliers avec lui. Le fond de notre population est donc resté gaulois. Les Gaulois sont nos ancêtres » (cours moyen).« Dans la suite, la Gaule changea de nom. Elle s’appela la France » (cours élémentaire).La formule emblématique « Nos ancêtres les Gaulois » se trouve chez Lavisse dans un passage du Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (commencé en 1878 et publié en 1887):« Il y a dans le passé le plus lointain une poésie qu’il faut verser dans les jeunes âmes pour y fortifier le sentiment patriotique. Faisons-leur aimer nos ancêtres les Gaulois et les forêts des druides, Charles Martel à Poitiers, Roland à Roncevaux, Godefroi de Bouillon à Jérusalem, Jeanne d’Arc, Bayard, tous nos héros du passé, même enveloppés de légendes car c’est un malheur que nos légendes s’oublient, que nous n’ayons plus de contes du foyer, et que, sur tous les points de la France, on entende pour toute poésie que les refrains orduriers et bêtes, venus de Paris. Un pays comme la France ne peut vivre sans poésie. »Alors ouvrons le dossier : d’abord « la Gaule » fut une invention de Jules César qui voulait prendre le pouvoir à Rome et qui pour ce faire avait besoin de prestige. Dans la Rome républicaine, le prestige venait de conquêtes militaires. Et la renommée était d’autant plus grande que l’adversaire vaincu était redoutable. César a donc décrit une Gaule unie contre les romains et des guerriers féroces que seul son génie stratégique et son courage a permis de vaincre. Seulement à Alésia, l’armée de César était composée de légionnaires romains, de guerriers germaniques et aussi de tribus gauloises. Car toutes les tribus gauloises n’étaient pas ralliées à Vercingétorix, il y en avait une bonne part du coté de César.Vous trouverez en pièce jointe, 2 articles tirés de la Revue Historia qui avait consacré un numéro spécial à la Gaule. Le premier est d’Yves Roman et le second de Christian Goudineau qui écrit : « Demandons-nous d’abord ce qu’est la Gaule. Et quitte à en décevoir plus d’un, on est forcé de constater que, dans l’Antiquité, la Gaule n’a jamais existé, si ce n’est par le récit de César. Comme il le dit lui-même, le territoire qu’il a conquis est occupé par des peuples qui diffèrent entre eux par la langue, par les coutumes et par les lois. Ce territoire, c’est aussi César qui lui assigne des limites : au sud, la Provincia romaine (notre Provence) et les Pyrénées, à l’ouest et au nord, l’Atlantique, la Manche et la mer du Nord et à l’est, le Rhin et les Alpes. Or, cela ne correspond à aucune réalité ni politique, ni ethnographique ni même géographique. César a isolé la partie occidentale de la Celtique, vaste ensemble traversé par le Rhin et par le Danube – fleuves larges certes, mais franchis aisément en tous sens depuis des millénaires -, séparant et regroupant arbitrairement des peuples de même origine en nommant les uns, Gaulois, et les autres, Germains. Il veut démontrer qu’il a conquis un ensemble homogène aux frontières imprenables. De tels découpages « pratiques », privilégiant les objectifs géopolitiques aux réalités des peuples, se répètent jusqu’aux périodes les plus récentes. L’artifice n’échappe d’ailleurs pas aux contemporains de César. Les Romains ne disent pas la Gaule mais les Gaules et les auteurs latins, comme Strabon, décrivent les Germains comme ayant les mêmes coutumes et les mêmes modes de vie que les Gaulois.»Yves Roman m’a expliqué que c’est lors de la révolution française qu’est né le mythe de nos « ancêtres les gaulois ». La révolution c’est le combat entre le tiers état et les nobles. Qui sont les nobles ? Issus de la lignée des mérovingiens, des carolingiens et des capétiens ? Ce sont les descendants des Francs ce peuple germanique qui a envahi « La Gaule » (avec d’autres) et a donné son nom à notre pays. Et dans un raccourci saisissant, ce mythe a conclu que ceux qui n’étaient pas nobles devraient être de la descendance du peuple autochtone mythique : les gaulois.Tout cela ignore superbement les extraordinaires mélanges de populations qui se sont réalisés dans notre beau pays. Avant les romains, il y eut les grecs à Phocée (Marseille), puis les romains et toutes les peuplades germaniques, les normands et tous les autres… Tous ces peuples ce sont, au fur et à mesure, mariés entre eux. Sans compter que tous les francs n’étaient pas nobles. Bref un mythe, basé sur des croyances éloignées de la réalité.Puis Napoléon III pris fait et cause pour ce mythe, il fut le grand ordonnateur des fouilles d’Alesia. Par la suite la défaite de 1870 contre les « tribus germaniques » raviva la flamme de la Gaule vaincue en raison de la trahison des nobles germaniques qui subsistaient en France. Ernest Lavisse alla étudier en Germanie, pardon en Allemagne pour comprendre la puissance de ce peuple. Et fit entrer dans l’enseignement des petits français, le mythe de nos ancêtres gaulois qu’il camoufla derrière une prétendue science historique qui en l’occurrence n’était pas à l’œuvre.Pourtant, Christian Goudineau nous apprend que les gaulois restent présents dans notre actualité et notamment parce que plusieurs noms de nos villes actuelles ont pour origine le nom de la tribu gauloise du lieu, ce nom ayant supplanté le nom latin donné par les romains : « Et ces noms sont restés bien vivants, nous les employons tous les jours puisqu’ils baptisent nos villes actuelles. Caesarodurum, capitale des Turons, est devenue Tours, Mediolanum, celle des Santons, est devenue Saintes, Lutetia, celle des Parisii, Paris.»Je finirai par un petit dessin humoristique du Courrier Picard qui dévoile un échange entrel’ancien président, descendant des Huns puisque d’origine hongroise et désormais descendant des gaulois puisque français avec son épouse, descendante des romains puisque Italienne… -
Mercredi 28 septembre 2016
Mercredi 28 septembre 2016« On ne peut pas interdire tout ce qu’on rejette »Thomas de Maizière, Ministre de l’Intérieur allemandC’est un invité de l’émission du Matin de France Culture du 29/08/2016 qui a rapporté cette phrase du Ministre allemand.Elle me paraît très appropriée pour ce temps où divers comportements de certains de nos concitoyennes et concitoyens nous heurtent.On ne peut pas, parce que nous sommes dans un pays de liberté, liberté que nous chérissons.Et que si nous retournions vers une société de normes dans tous les domaines nous perdrions notre liberté et notre âme.Pendant ce temps, en Iran qui s’est enfin ouvert au reste du monde – et au monde libéral. Mais cette libéralisation n’est, pour l’heure, qu’économique. Pas morale, pas sociale… Pour preuve, donc, cette « fatwa » lancée le 10 septembre par la plus haute autorité du pays : les Iraniennes n’ont plus le droit de faire du vélo. Et ce, parce qu’en montant sur une bicyclette – c’est ce qu’a dit Ali Khamenei : « elles attirent l’attention des hommes et exposent la société à la corruption ». Mais oui, mais oui, bien sûr… « Faire du vélo : le nouveau défi des Iraniennes », lit-on sur le site NOUVELLES NEWS, qui nous explique que certaines sont entrées en résistance : elles se montrent en train de pédaler – photos sur les réseaux sociaux… « Nous n’abandonnerons pas nos vélos », lance une mère avec sa fille. Sachant donc qu’elles risquent aujourd’hui d’être arrêtées par la police…L’Iran est le contraire d’un pays de liberté. La théocratie s’attaque toujours aux libertés et l’expérience montre que c’est d’abord aux libertés des femmes. -
Mardi 27 septembre 2016
Mardi 27 septembre 2016« L’essentialisme »Concept philosophique qui suppose l’existence d’une essence précédant l’existenceComme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous versons souvent dans l’essentialisme sans nous en rendre compte. Pourquoi ?Très simplement : nous affirmons « Les jeunes » sont … et nous y ajoutons une qualité ou une manière de se comporter que nous prétendons donc être partagées par tous les jeunes, parce qu’ils font partie de la catégorie « jeune ». Les jeunes qui se trouvent dans les grandes écoles d’ingénieurs, les jeunes qui poursuivent des études à l’Université et les jeunes qui ont quitté l’école sans diplômes…sont tous des jeunes. Il est donc possible de les rassembler dans un grand ensemble d’individus qui ont des points communs que nous savons décrypter et synthétiser.En philosophie, l’essentialisme s’oppose à l’existentialisme qui postule que l’être humain forme l’essence de sa vie par ses propres actions, celles-ci n’étant pas prédéterminées par des doctrines théologiques, philosophiques ou morales. L’existentialisme considère donc chaque personne comme un être unique maître de ses actes, de son destin et des valeurs qu’il décide d’adopter.Mais aujourd’hui, comme hier l’essentialisme est très présent.Ces jugements péremptoires sur les jeunes sont très réducteurs, manquent d’intelligence et de nuance.Mais il y a un essentialisme encore plus dangereux. Pendant longtemps ce fut une attitude à l’égard des juifs. Les juifs sont….Il y avait des juifs pauvres et des juifs riches, des juifs commerçants et des juifs musiciens, des juifs croyants et des juifs assimilés, mais tous les juifs possédaient des caractéristiques communes, pour l’essentiel très négatives au regard de ceux qui jugeaient.Ma fille Natacha qui est jeune mais unique, probablement comme tous les autres jeunes, possède de belles et fortes convictions humanistes, de justice et d’équité.Elle est toujours révoltée quand on parle des musulmans de manière globale et négative.Elle n’aime pas l’essentialisme et elle a raison.Le musulman, ça n’existe pas !Il existe des musulmans, dans leur diversité, pour les uns très croyants, pour les autres presque sortis de la religion, n’ayant plus qu’un lien distendu avec la communauté de leurs parents. Et bien sûr, il existe tous les stades intermédiaires entre ces deux extrêmes.Nous savons qu’il existe aussi quelques individus qui se déclarent musulmans et qui veulent du mal à ceux qui ne pensent pas comme eux, ou tout simplement comme à Nice veulent tuer sans distinction.Il existe aussi des Etats théocratiques et archaïques qui professent une religion obscurantiste, violente et sectaire. Je veux évidemment parler des monarchies du Golfe, du Pakistan et de l’Iran. Mais il ne s’agit pas « des musulmans », mais de certains musulmans. Ces Etats influent des rigoristes qui sont dans notre pays et prêchent de même façon un islam archaïque et sectaire. Mais ils constituent une minorité.Toutefois, l’obscurantisme est une tare bien répartie dans le monde, non réservée à des minorités du monde musulman.Et Natacha m’a guidé vers un reportage qui montre cet obscurantisme qui prétend que les musulmans sont… en résumé des gens qu’on ne peut avoir pour voisin et qu’il faut empêcher de construire des mosquées, de se réunir et vivre leur Foi en paix : https://youtu.be/WvMLOITnnzoCe reportage de Canal +, nous amène à New York, mais aussi dans l’Amérique profonde et en France, à Paris, à la Goutte d’or …Je laisserai le dernier mot à ma fille qui est jeune et déjà bien sage : « Il existe des lieux où croire est devenu un combat surtout quand on est musulman. Et comme ce fut un combat pour les juifs de croire pendant la seconde guerre mondiale.L’ouverture d’esprit doit se faire dans les deux sens. [L’acceptation des croyances et de la Foi de l’autre(*)] est le plus grand des combats qui devrait être mené par tous. »(*) Natacha avait simplement utilisé le mot de « tolérance », que je me suis permis d’exprimer autrement à la suite du mot du jour d’hier… -
Lundi 26 septembre 2016
Lundi 26 septembre 2016« Je ne viens pas prêcher la tolérance. »MirabeauLa réflexion de Régis Debray que j’ai tenté de synthétiser la semaine dernière sur la croyance, le sacré et le monothéisme me semble particulièrement riche et féconde. Et il faut constater que s’il aborde tous ces sujets avec une pensée et une démarche scientifique de l’agnostique qu’il est, il reste très empathique avec la croyance, le sacré et même Dieu. Dans la conclusion de sa quatrième émission, celle consacrée à Dieu, il récuse ceux qui voudraient faire du Dieu monothéiste un bouc émissaire et lui faire porter la responsabilité de nos malheurs actuels. A tout prendre, il pense même que le Dieu monothéiste est une solution bien meilleure que les autres religions que l’Homme a inventé pour essayer de le remplacer.Et que dire de la religion de l’argent ? Devenir milliardaire semble être l’objectif de vie de certains. Cette quête permet-elle de faire vivre les hommes ensemble ? Permet-elle de créer le « Nous » indispensable à cimenter une société humaine ?Pour finir, provisoirement, cette réflexion sur le religieux, je voudrai encore partager avec vous ce développement de Régis Debray sur la tolérance qu’il a mené dans l’émission sur la laïcité.Car, dans ce domaine de la cohabitation des croyances concurrentes, la tolérance me paraissait une valeur positive à encourager.Tel n’est pas l’avis de Mirabeau, ni de Debray qui en appelle au premier :« La laïcité n’est pas non plus la tolérance. La tolérance est un mot que Mirabeau jugeait injurieux.Pourquoi ?Parce que la tolérance c’est de l’indulgence. C’est une indulgence propre à l’ancien régime. C’est la condescendance d’un supérieur qui lève un interdit parce que cela lui parait bon ou qui octroie l’impunité à un inférieur.Disons, le maître tolère, le maître souffre la différence d’un obligé qui n’est pas son égal, il le fait mais il pourrait ne pas le faire. Ainsi de l’Edit de tolérance du 29 novembre 1787 qui fut une concession de Sa Majesté à l’égard de la minorité protestante.Un droit n’est pas concédé, il est reconnu.Et la tolérance est à la laïcité ce que la charité est à la justice »Oui, la sécurité sociale, les allocations chômage, les pensions d’invalidité sont chez nous des droits, non de la charité. La dérégulation générale, et si nous n’arrivons pas à stabiliser notre Etat social conduira très probablement à diminuer les droits et redonner beaucoup de place à la charité, autrement dit au bon vouloir des riches.Régis Debray fait une juste comparaison avec « la tolérance face à la laïcité ».Et vous trouverez le propos de Mirabeau page 166 dans ce livre « Chefs-d’œuvre oratoires de Mirabeau » qui a été numérisé par notre « ami Google » et dont je cite l’extrait complet :« Je ne viens pas prêcher la tolérance. La liberté la plus illimitée de religion est à mes yeux un droit si sacré, que le mot tolérance, qui voudrait l’exprimer, me paraît en quelque sorte tyrannique lui-même ; puisque l’existence de l’autorité qui a le pouvoir de tolérer attente à la liberté de penser, par cela même qu’elle tolère, et qu’ainsi elle pourrait ne pas tolérer. »Vous trouverez le travail de notre ami <ICI> -
Vendredi 23 septembre 2016
Vendredi 23 septembre 2016«Laïcité
Le cadre laïc se donne les moyens de faire coexister sur un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes convictions, au lieu de les juxtaposer dans une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et mutuellement exclusives »André Philip à l’Assemblée constituante de 1945D’abord une petite anecdote, quand je vais à mon travail le matin et que je prends le bus C25, j’emprunte la rue André Philip, car il fut député du Rhône et résistant. En outre, Le maire de mon arrondissement, le 3ème de Lyon, est Thierry Philip qui est le petit-fils de cet homme qui était d’origine protestante.
Régis Debray affirme que ce propos qu’André Philip a tenu à la Tribune de l’Assemblée Nationale en 1945, constitue la définition la plus sobre et la plus exacte du terme de laïcité dont il est beaucoup question ces temps-ci.
Car la laïcité ne fait pas l’objet d’une définition explicite dans nos textes fondamentaux. Notamment la loi de 1905, de la séparation de L’Église et de l’État, ne la définit pas et même le mot de laïcité n’y figure pas, pas plus que celui de religion remplacé par le mot de culte.
La laïcité est une « originalité française » affirme Régis Debray.
Et il introduit ce sujet de cette manière :
« Qu’avons-nous donc en commun, vous et moi ? à part le français pour s’exprimer et dans le meilleur des cas des papiers en règle dans la poche. Qu’est ce qui relie 60 millions de nombrils juxtaposés dans un même hexagone ? Qu’est ce qui peut, en cas de crise, empêcher un espace de solidarité de voler en éclat ? Comme cela se voit en ce moment même dans une dizaine de pays. Avec la centrifugeuse du tout à l’ego et les réclamations communautaires, c’est une question qu’on commence à se poser dans la France du chacun chez soi.
Nous cherchons tous un principe symphonique capable de faire un « Nous ». C’est d’ailleurs le cas de tous les agrégats humains, tant qu’ils rechignent à se désagréger. Oui ! L’unité d’un mille-feuille, c’est cela l’exploit à recommencer chaque jour et partout. […] faire d’une multitude de populations, un peuple […]. [La devise des Etats-Unis] résume cela très bien : « E pluribus, Unum » c’est-à-dire « Faire de plusieurs, Un » »
<Wikipedia>, nous apprend que cette devise empruntée à un poème attribué à Virgile fut considérée comme la devise des États-Unis jusqu’en 1956 quand le Congrès des États-Unis passa une loi (H.J. Resolution 396) adoptant « In God We Trust » (« En Dieu nous croyons ») comme devise officielle. Il me semble que cette évolution, qu’on pourrait qualifier de théocratisation des USA, est loin d’être neutre et explique beaucoup de malentendus ou d’incompréhensions entre les Etats-Uniens et les Français.
Mais pour revenir au propos introductif de Régis Debray, il pose cette question : « La question préalable qu’on pourrait poser aux 193 États réunis aux Nations-Unies : Comment faites-vous chez vous ? »
Et il ajoute pour la France : « la manière d’y répondre a un nom : laïcité »
Je ne doute pas que le texte de la constitution de 1958 constitue un de vos livres de chevet.
Toutefois, je me permets de vous en rappeler l’article 1 :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »
Ce mot ne figure pas dans la constitution fédérale américaine, ni la constitution fédérale allemande, ni dans aucune constitution d’un Etat européen. C’est Régis Debray qui l’affirme.
Dans les autres pays
« Ce que professe, l’état de Droit des pays occidentaux ordinaires c’est la liberté de croyance. [Ce qui est fort différent]. Cela n’exclut pas qu’une religion puisse être une religion d’Etat à condition qu’elle ne constitue pas une atteinte aux droits des autres citoyens qui n’adhèrent pas à cette religion.
En Allemagne, par exemple, l’Etat recouvre le denier du culte par l’impôt. En Grande Bretagne, le chef de l’Etat, aujourd’hui la Reine est le chef spirituel de l’Eglise anglicane, depuis Henry VIII. L’Eglise orthodoxe est reconnue comme religion principale en Grèce. En Italie où le blasphème (Comme en Grande-Bretagne) continue à constituer un délit, les crucifix ornent toujours les salles de classe et les salles des tribunaux.
On comprend, dès lors, que notre pays offre à tous les fous de Dieu une cible de choix. »
Notre pays n’est pas en odeur de sainteté, auprès de ses propres homologues.
[Ainsi] la France est dans un statut d’accusé dans une liste de 28 États où la liberté de conviction est dite maltraitée ou minorée.
C’est dans un rapport de l’ONU de 2004 traitant de la liberté de religion dans le monde.
Voici un article qui parle de ce rapport à l’égard de la France. <Ici> vous trouverez ce rapport dans son intégralité.
Régis Debray explique que « [dans notre pays] le contrôle et la répression des sectes et le fait de ne pas donner des droits particuliers à des minorités sont tenus aux Etats-Unis pour des atteintes aux droits humains. D’ailleurs le mot « secte » est tenu chez nous pour un terme péjoratif, ce qu’il n’est pas du tout dans le monde anglo-saxon. »
On se souvient que les autorités américaines s’étaient notamment émues, du « mauvais traitement » que la France infligeait à l’Eglise de la Scientologie.
Mais pour cette « secte » en particulier qui compte parmi ses rangs John Travolta, Tom Cruise, Chick Correa, la France n’est, pour une fois pas seule, et par exemple l’administration de Bill Clinton est intervenue auprès du gouvernement d’Helmut Kohl pour défendre cette organisation qui lui semblait malmenée en Allemagne.
Même le droit européen sous hégémonie anglo-saxonne et en particulier les derniers arrêts de la Cour Européenne des droits de l’homme mettent la France en difficulté par la création de ce nouveau concept « la libre jouissance des droits à la liberté religieuse ».
La définition et la traduction de la laïcité française, pose beaucoup de soucis dans quasi toutes les langues du monde.
Originellement le laïc s’oppose au clerc.
Le droit canon de 1983 de l’Église catholique définit précisément ces deux catégories (canon 207 §1) :
« il y a dans l’Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui en droit sont aussi appelés clercs, et les autres qui sont aussi appelés laïcs. ».
Le laïc est donc, au sens catholique, un croyant mais qui n’a pas été consacré dans un ministère et qui dès lors n’a pas, en principe, le droit d’administrer un sacrement de l’Eglise ou de tenir la messe.
C’est donc, comme le dit Debray, un contre-sens de faire de la laïcité un outil contre les religions :
« La confusion la plus navrante qui sévit dans le monde arabo musulman, c’est la traduction de « laïc » par « sans religion » ce qui dans ce monde est une insulte. C’est un lamentable contre-sens. [D’ailleurs] la laïcité qui fut créée par la 3ème République fut en grande partie l’œuvre de croyants protestants. […] La laïcité n’est pas un athéisme soft, elle n’est pas un parti pris anti religieux. »
C’est à ce stade qu’il en vient à l’intervention orale d’André Philip à l’Assemblée constituante de 1945 :
« Le cadre laïc se donne les moyens de faire coexister sur un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes convictions au lieu de les juxtaposer dans une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et mutuellement exclusives ».
Pour Debray : Tout est dit.
D’abord, un cadre qui peut se remplir comme on veut, par la sagesse et la spiritualité que l’on souhaite.
Ensuite un territoire, c’est-à-dire un ancrage territorial, une nation.
Nous n’avons pas affaire à une morale atmosphérique mais à un cadre juridique.
La coexistence qui évite la juxtaposition d’une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et qui risquent ainsi de se haïr les unes les autres.
Et il ajoute :
« La laïcité est un cadre de coexistence qui ne prétend pas au statut d’idéologie. La laïcité met la transcendance en autogestion, elle donne à chacun la liberté de remplir le cadre comme il l’entend tant qu’il respecte la règle du jeu.
Quand on a une foi, on a une conviction et une conviction ce n’est pas une opinion ! On ne prend pas le mors aux dents pour une opinion, il nous arrive d’en changer [d’opinion] et même d’en rigoler de bon cœur. […] Nous avons des colères mais elles sont courtes. […] Une opinion, ça ne se blesse pas et ça ne crie pas vengeance.
Mais il y a en Europe, des minorités et à nos frontières des peuples entiers quoi n’ont pas des opinions mais des convictions. […]
Une Foi religieuse cela engage le corps et l’esprit. Et certains croyants sont même capables de donner leur vie pour ce qu’ils croient être leur cause.
Et ceci pose un grand problème de coexistence, parce qu’il n’est jamais facile de vivre quand on a une conviction, au milieu de gens qui ont en d’autres, non moins fortes et susceptibles que les vôtres.
Et c’est encore plus difficile de faire cohabiter des « je m’enfoutiste » et des illuminés, des gens à sang froid et des gens à sang chaud. »
Et comme le fait remarquer le philosophe, l’accélération des migrations et des mélanges de population que nous vivons augmente encore la tendance naturelle de tout le monde animal, dont fait partie le genre humain, du rejet viscéral du dissemblable.
Mais le philosophe est vigilant est nous met en garde :
« Notre laïcité est un chef d’œuvre en péril qui non seulement doit faire face à l’isolement international mais aussi à des menaces à l’intérieur de notre pays. »
Pour la menace intérieure, il parle d’une triple crise d’autorité : 1/ le Vrai, 2/ l’Etat, 3/ L’Ecrit.
D’abord le Vrai :
« L’unité du peuple humain a pour preuve, pour garantie, l’universalité du savoir : Il n’y a pas de mathématiques luthériennes, il n’y a pas de physique hindouiste ou de chimie coranique. Or, le Savoir cela ne se transmet pas par des gènes ou par des prières. Cela se transmet par un enseignement. La république laïque, elle est enseignante ou elle n’est pas. Son pivot c’est l’Ecole. […] Les convictions sont particulières et la règle de trois, elle est universelle. [Et il faut que l’on sache séparer l’un et l’autre, que la création de l’univers en 7 jours ou l’infériorité congénitale de la femme n’aient pas le même statut que le raisonnement scientifique] »
L’apprentissage de la Raison rend l’individu libre des opinions, les siennes propres comme celle des autres. Mais probablement à cause d’Hiroshima et d’autres fractures de notre monde technologique, la confiance en la science et dans le progrès a reculé. […] Ainsi un ami de Régis Debray, professeur de SVT qui expliquait la formation de la croûte terrestre a vu au fond de sa classe, une main se lever pour lui dire que si telle était son opinion à lui (au professeur) et il en était libre, lui élève il en a une autre parce qu’il la tient de l’imam de son quartier…
Et Régis Debray de conclure :
« Quand le socle du savoir tremble, l’idée républicaine n’est plus sûre de ses bases ».
Je résumerai plus rapidement les deux autres facteurs d’inquiétude.
L’Etat : Le désarmement de la puissance publique par rapport à la privatisation du Monde. Toutes les mesures de laïcisation ont été le fruit d’une volonté politique, c’est-à-dire d’en haut vers le bas. De l’Etat vers la société. Ce fut le cas de la 3ème République en France, de l’Etat Kemaliste en Turquie ou de la volonté politique de Bourguiba en Tunisie.
Encore faut-il un Etat, ajoute t’il et d’expliquer que l’Etat a perdu peu à peu de sa consistance.
Enfin l’écrit. Aujourd’hui nous sommes entrés dans le monde des écrans.
Or l’écran préfère l’image à l’écrit.
Et l’image appelle davantage à l’émotion qu’à la réflexion, au court terme qu’au long terme qui s’inscrit dans l’écrit.
Or la laïcité s’inscrit dans la durée.
Et il ajoute « La partie n’est pas perdue mais il faut attacher sa ceinture parce que ça va secouer »
Et en conclusion, il se permet un avertissement :
« La laïcité n’est pas le laïcisme. La laïcité ne cherche pas à neutraliser, à aseptiser la société en la nettoyant de toute trace de religiosité.
Ce serait totalitaire et parfaitement idiot. [..]
Le religieux ce n’est pas le spirituel. Le spirituel cela concerne la vie intérieure. […]
Le religieux ça se professe en dehors et en public. Cela crée des processions, des associations, des journaux.
Le religieux c’est même fait pour cela, pour arborer des signes extérieurs d’appartenance.
Ne faisons pas de notre laïcité une anti-religion pour ceux qui n’ont en pas, dans le sens « ôte toi de là que je m’y mette ». Soyons plus modeste.
Il ne faut pas demander à la laïcité, ce qu’elle ne peut nous donner […]
La laïcité est une construction juridique et une législation ne donne pas un sentiment d’appartenance, d’entraide mutuelle et de fierté collective.
La laïcité ne répond pas aux questions fondamentales : d’où venons-nous, où allons-nous ? […]
La laïcité ne peut pas remplacer la religion sinon elle devrait devenir elle-même une religion.
Et si elle devenait une religion, elle ne serait plus ce qu’elle est : elle serait la religion de certains contre d’autres et non pas un cadre de coexistence de plusieurs valeurs, simplement une valeur parmi d’autres. »
Oui la laïcité n’a rien de comparable avec la religion, elle ne saurait prétendre à ce rang qu’en se reniant elle-même.
Je trouve la réflexion de Régis Debray sur ce sujet de laïcité encore, s’il est possible, plus accomplie que sur les autres sujets abordés cette semaine.
<754>
-
Jeudi 22 septembre 2016
Jeudi 22 septembre 2016«Dieu
C’est l’Infini qui dit « Moi, je » et qui de surcroit pense à moi.»Régis DebrayPour qu’il n’y ait pas d’ambigüité, Régis Debray précise toute de suite que son sujet est précis et délimité, il va parler de « Dieu » avec D majuscule, l’Unique.
Celui qui a émergé dans une région précise : le croissant fertile en Mésopotamie, entre l’Irak et l’Egypte d’aujourd’hui et qui dans le chapitre 3, §6 du livre de l’Exode s’est présenté à Moïse par ces mots :
« Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. »
Celui que les hébreux ont désigné par le tétragramme « YHWH », que les chrétiens ont plutôt appelé « Seigneur » ou « Mon Père » et qui a pour nom arabe et pour les musulmans du monde entier « Allah ». Car il y a bien continuité entre les 3 religions du Livre et qui tous parle de la même entité transcendante, universelle et unique.
Le Dieu du monothéisme ! Alors que Régis Debray précise
« Le terme de monothéisme ne figure pas dans l’Ancien Testament, pas plus que celui de religion dans le nouveau. ».
Et Régis Debray de définir :
« C’est l’Infini qui dit « Moi, je » et qui de surcroit pense à moi. Il allie ces deux qualités a priori incompatibles qui sont la Transcendance et la proximité. D’une part, le Créateur est radicalement supérieur et distinct du monde créé, du monde sensible qui m’entoure mais il m’est possible de l’interpeller, dans un rapport intime de personne à personne. Autrement dit c’est un dehors absolu qui peut me parler du dedans. Il nous entend, nous voit et nous console. Et on peut s’adresser à lui non seulement par un datif cérémonieux : « Deo Gratias », « Merci à Dieu », mais par un vocatif plein de reproches : « Mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné ? ». […] Tutoyer l’Absolu un peu rudement, c’est bel et bien une révolution dans l’Histoire de l’esprit…»
Et Régis Debray de nous inviter :
« Alors ouvrons le dossier »
Je vous avoue que cette émission est encore plus compliquée à résumer que les quatre autres, tant le cheminement intellectuel du philosophe sur ce sujet est fécond, imbriqué, large et laisse peu de place à la possibilité de simplement picorer.
Je vous en livre l’introduction :
« Ce Dieu majuscule n’est pas né de rien, ni n’importe où, il a donc une Histoire. Il a une écologie, c’est-à-dire un milieu… Il a une logistique, c’est-à-dire des moyens de transport et il a un medium, c’est-à-dire un support. Il a aussi des problèmes à résoudre, certains d’ordre intellectuel et il a des responsabilités d’ordre historique. L’affaire on le voit n’est pas simple.
L’Historique d’abord ! Car l’Eternel n’a rien d’éternel. Celui qui est entré dans l’Histoire des hommes a lui-même une Histoire toute fraiche. « Dieu » est un « tard venu » dans l’Histoire des entités célestes. L’homo sapiens a environ 100 000 ans d’existence, l’âge des toutes premières sépultures. »
Et il pose cette question et donne cette réponse : « Et Dieu quel âge a-t-il ? 2500 ans ! »
Et il continue
« C’est un parachuté de dernière minute sur les terres de sapiens sapiens et même sur ceux du peuple Hébreux. […] Cette tribu fut d’abord, comme tous les autres, polythéistes, puis monolâtre c’est-à-dire avec un Dieu national identitaire qui en tolère d’autres chez les voisins, avant d’embraser la cause d’un Dieu universel à tous les peuples et singulier, ayant conclu une alliance avec le seul peuple hébreux.
Ce Dieu dont nous parlons a émergé entre le 7ème et le 6ème siècle avant notre ère. Entre le règne centralisateur de Josias (-627) et l’exil à Babylone (-587). Sa première apparition incontestable, apparaît dans les derniers chapitres du Livre d’Isaïe dans la Bible, livre écrit après le retour des Judéens captifs à Babylone, après leur libération par le perse Cyrus.
Dieu le père, fut l’enfant d’une catastrophe, d’une catastrophe humiliante qu’a été la destruction du royaume de Juda et du Premier Temple de Jérusalem par Nabuchodonosor en -587.
C’est le fruit d’une grande construction rédactionnelle, d’une rédaction « ex post ante », faite après coup. Une reconstruction littéraire par une élite captive à Babylone et qui a voulu s’expliquer le pourquoi de sa défaite et de sa déportation, en réécrivant tout son passé, en s’inventant à titre rétrospectif un Dieu aussi protecteur que le puissant Dieu babylonien Mardouk, Dieu avec lequel cette élite avait fait alliance. Et c’est pour avoir rompu ce pacte d’alliance qu’est intervenu la punition divine et l’envoi en exil pour cause de désobéissance. Ce fut une terrible mésaventure qui est consignée dans le Deutéronome, non sans quelque mégalomanie propre à réparer une honte nationale »
Arrivé à ce stade vous êtes à la 11ème minute de l’émission qui dure 1 heure et dont vous trouverez l’intégralité derrière ce lien : <Allons aux faits : Que faut-il entendre par Dieu ?>.
<La datation scientifique de l’écriture de la bible hébraïque la situe bien autour de la déportation à Babylone>. Si la rigueur scientifique ne permet pas d’affirmer que le personnage de Moïse a été inventé à ce moment-là, [il faut cependant savoir qu’aucune source historique en dehors des textes bibliques ne fait mention de Moïse], on a écrit l’histoire de ce personnage à ce moment de l’Histoire. Pour Abraham et ses enfants qui sont encore plus éloignés de cette période, il en va de même.
 Régis Debray montre aussi que l’émergence de Dieu a dû attendre l’apparition de l’écriture, dans la même région du croissant fertile.
Régis Debray montre aussi que l’émergence de Dieu a dû attendre l’apparition de l’écriture, dans la même région du croissant fertile.
En outre, le Dieu monothéiste présente cet avantage par rapport aux dieux statufiés qu’il est facile de l’emmener avec soi. Les hébreux ont trouvé cette solution d’emmener avec eux, l’arche d’alliance c’est à dire les tables sacrés des commandements divins. Les autres peuples étaient incapables d’emmener avec eux la grande statue de Baal ou de Marmouk. Le monothéisme aime la dématérialisation.
Le croyant sincère peut être choqué que l’on écrive : ton Dieu a 2500 ans. En effet, si Dieu existe, il a toujours existé, sinon il ne serait pas Dieu.
Certes !
Mais ce que montre Régis Debray, c’est que Sapiens Sapiens a vécu 97 250 ans sur ses 100 000 ans d’existence sans Dieu monothéiste. Aujourd’hui encore, d’immenses civilisations comme la chinoise, l’indienne se passent très bien d’un Dieu unique et universel.
Régis Debray a écrit un livre, paru en 2003, que nous possédons dans notre bibliothèque et que je n’ai pas encore lu <Dieu un itinéraire>.
<753>
-
Mercredi 21 septembre 2016
Mercredi 21 septembre 2016«La religion
Le spirituel nous prépare à la mort, la religion prépare les obsèques»Régis DebrayRégis Debray nous apprend d’abord que le mot « religion » est une particularité locale, c’est-à-dire un mot créé dans l’Occident chrétien.
Selon lui, ce mot n’a pas d’équivalent dans les autres civilisations.
Il traque dans les grandes langues de l’humanité les différents mots que l’Occident a traduits par le mot « religion », en montrant que cette traduction est erronée et très approximative.
C’est le sociologue Emile Durkheim qui a tenté de définir de manière savante ce mot :
« Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. ».
On constatera, l’incongruité de l’utilisation du mot « église » qui ramène irrémédiablement au christianisme.
« Religion » vient du latin « Religio ».
Et dans la Rome antique, « Religio » signifiait le respect des institutions établies.
Et le christianisme, dans ses débuts, a été traité par les érudits romains face à la Religio, de superstition.
Ainsi Tacite (58-120) dans ses Annales, en évoquant les persécutions de Néron a écrit :
« Néron […] fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d’hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Réprimée un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non-seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d’infamies et d’horreurs afflue et trouve des partisans. »
Une exécrable superstition… écrivait Tacite.
On attribue à <Tertullien qui vécut autour des années 200> le fait d’être parvenu par son érudition et sa force de conviction à inverser le sens des termes et de rendre respectable le christianisme en lui attribuant le nom de « religio » alors que les autres pratiques romaines et notamment le paganisme devenaient des « superstitions »
Il existe deux étymologies du mot : la païenne – relegere, recueillir (Cicéron) – et la chrétienne : religare, relier (Lactance).
Régis Debray précise : « relegere, c’est relire avec attention, d’où vient l’expression accomplir religieusement une tâche ». Pour lui le contraire de ce sens est « distraction »
L’étymologie du mot nous enjoint donc à comprendre la religion comme rassemblement (religare) et recueillement (relegere), ou encore communauté et prière, lecture des textes saints.
Non seulement le mot religion n’existe pas dans les autres civilisations, mais on ne trouve pas trace, selon Régis Debray, du mot religion dans la bible hébraïque (ancien testament), ni dans les évangiles.
Au moment des débats sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, les républicains de 1905 ont choisi de ne pas parler de la religion mais des cultes.
Régis Debray écrit :
« Le mot de culte me paraît plus adéquat. Le culte c’est deux choses : une réunion (des assemblées) et des rituels.
Il y a culte dès qu’il y a une croyance qui réunit des gens et que cette croyance est une croyance en une réalité ou un sujet méta-empiriques.
Ce peut être un ancêtre, un événement passé, une déité, une personnalité. »
Mais si le mot « religion » s’est imposé dans le monde comme l’« étalon maître des croyances » c’est en raison de la colonisation occidentale et de la suprématie des nations chrétiennes pendant la phase de la révolution industrielle.
L’Islam en outre sur bien des points et notamment sur celui-ci s’est inscrit dans l’héritage chrétien. L’Islam ayant vocation de constituer la religion monothéiste qui accomplit les deux autres qui l’ont précédé.
Car le terme de religion est intimement lié à ces cultes monothéistes dont Régis Debray explique :
« Non seulement, ces religions [monothéistes] entendent régler nos mœurs et notre vie intime mais ce sont elles qui ont liées la notion de croyance et la notion de vérité et ça c’est de la dynamite. – vera religio veri Dei – « la vraie religion du vrai Dieu. »
Et je finirai par cette brillante étude comparative de civilisation :
« Cette idée que nous a rendu naturelle des siècles d’enseignement religieux dans notre culture, semblera totalement barbare ou idiote à un chinois, à un japonais ou à un indien.
Cette idée que parce qu’on a une religion on ne pourrait pas en avoir une autre.
Un japonais né en milieu shinto n’hésitera pas à se marier chrétien et à mourir bouddhiste. Un chinois han se promène en souplesse entre Bouddha, Confucius et le Tao, sans avoir à renier un « isme » par un autre.
[En outre] les mots « bouddhisme », « taoïsme » et « confucianisme » sont des inventions des intellectuels occidentaux, non des penseurs asiatiques.
D’ailleurs les temples en Chine sont la demeure de toutes les divinités, et l’encens ne fait pas le détail. Et en Inde, un fidèle de Vishnou ne trouvera pas répréhensible d’aller fleurir l’autel de Shiva »
Vous trouverez tous ces développements <Ici>
Vous y trouverez aussi la phrase qui sert d’exergue à ce mot du jour, tellement explicite et juste qu’il n’est pas nécessaire d’expliquer davantage.
<752>
-
Mardi 20 septembre 2016
Mardi 20 septembre 2016« Le sacré.
Il n’y a pas de sacré pour toujours, mais il y a toujours du sacré»Régis DebrayLa seconde émission de Régis Debray avait pour thème le sacré.
Dans notre monde sécularisé, nous pensons que le sacré s’est éloigné de notre univers, ou nous le pensions. Depuis le massacre de Charlie Hebdo, nous avons avec effarement eu des débats sur ce mot qui nous paraissait d’un autre temps : « le blasphème ». Mais Régis Debray nous montre qu’en réalité le sacré ne nous a jamais quitté. Ce n’était pas forcément un sacré religieux, mais il y a toujours du sacré. Le fait est que dans notre langage nous avons exclu de notre vocabulaire le mot « sacré » et ses dérivés mais pas sa réalité.
Régis Debray introduit le sujet de la manière suivante :
« Que faut-il entendre par sacré ?
Rien n’est sacré en soi, mais on ne connait pas de société même laïque qui n’ait en son sein un point de sacralité, quelque chose qui autorise le sacrifice et interdit le sacrilège. […]
Etrange destin que celui de ce mot. […]
Hier dans toutes les bouches […], il n’est plus bien porté, il n’a plus droit de cité.
« Sacré » est devenu tabou ou malséant. Le substantif fait peur par ce qu’un référent ainsi baptisé suppose de révérence et l’épithète « sacré » fait sourire par la nuance d’ironie admirative qu’on y met : oui parce que « une sacrée musique » n’est pas « une musique sacrée ».[Cette utilisation de l’adjectif veut probablement conjurer d’autres utilisations anciennes comme] « l’amour sacré de la patrie » qui fait trop sentir la terre et les morts, le cantique des armes et l’hécatombe des corps.
Ainsi le mot sacré s’est-il absenté des discours publics, il est proscrit de nos textes législatifs. On peut dire par exemple qu’une sépulture a été profanée, on peut écrire un texte contre l’outrage à la marseillaise ou au drapeau, on peut interdire la manipulation du génome de l’espèce humaine […].
Mais on ne peut revenir aux sources pour dire qu’une sépulture, qu’un drapeau, ou que le génome humain ont quelque chose de sacré en eux.
Oui, parce que c’est logique, s’il n’y avait rien de sacré dans tout cela, il n’y aurait ni profanation, ni outrage, […].
« Profaner » oui ! Cela se dit couramment. Sacralité, halte là !
C’est comme un livre de cuisine qui parlerait du cuit mais pas du cru ou d’un bulletin météo qui parlerait du froid mais pas du chaud. […]
Nous nous étonnerions sans doute d’entendre dans la bouche de nos politiques le mot de « sacré ». Ils utilisent le terme doucereux et sucré de « valeur ».
La valeur est molle, le sacré est dur.
La valeur ça plaît à tout le monde, c’est la fonction du kitsch.
Le sacré ça effraie !
Le sacré peut se définir comme cela : qui légitime le sacrifice et qui interdit le sacrilège.
Or nous n’avons aucune intention de nous sacrifier pour quoi que ce soit et nous détestons viscéralement les interdits, sauf pour avoir la gloriole de les enfreindre. […]
Nous nous vantons de ne plus rien tenir pour sacré, mais nous trouvons fort normal que des auteurs d’une BD ironisant sur les nazis et les déportés juifs soient condamnés à une forte amende et leur ouvrage interdit.
Nous estimons que la pédophilie est un crime sans pardon. Ou qu’aller se faire cuire un œuf sur la flamme du soldat inconnu à l’arc de triomphe ou pire ouvrir une crêperie sous le portique de l’entrée du camp d’extermination d’Auschwitz constitue plus qu’une incongruité ou un acte de mauvais goût. Mais surtout que le mot sacrilège ne soit pas prononcé !»
Ainsi Régis Debray raconte comment à Moscou, un policier est venu lui intimer l’ordre d’immédiatement éteindre la cigarette qu’il fumait non dans mais devant le mausolée de Lénine. Il en a tiré la conclusion que l’athéisme officiel n’est pas « sacrifuge » mais au contraire « sacrophile », il aime le sacré jusqu’à la manie.
Il affirme aussi que « le premier réflexe d’une société qui sent son délitement c’est de sacraliser, de consacrer pour consolider et affirmer. » L’exemple qu’il donne est dans toutes les mémoires, vous vous souvenez que la marseillaise a été sifflée lors du match de football France-Algérie, le 6 octobre 2001.
En réaction, le législateur a fait une loi qui se retrouve dans le Code Pénal article 433-5-1. :
« Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende. Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
Bref un sacrilège et une sanction pour celui qui le commet !
Il est toujours important de revenir à l’étymologie : Le mot « sacré » vient du latin « sacer » qui signifie « séparation ». Nos ainés en monothéisme, la religion juive avait structuré cette séparation dans le Temple de Jérusalem qui avait une structure concentrique, avec des parties publiques et des parties toujours plus sacrées et toujours plus rarement accessibles, jusqu’au centre, le « Saint des saints » ou était conservée l’Arche d’alliance et qui était l’endroit le plus séparé du reste.
L’antinomique du « sacré » est « profane », du latin « profanus » (de pro «devant» et fanum «lieu consacré»). Le profane est donc ce qui se trouve à l’extérieur du sacré.
Mais la religion juive, exprime encore de manière plus explicite cette équivalence entre le sacré et la séparation. Régis Debray nous explique :
« « Soyez Saint » enjoint le Lévitique aux Hébreux ! Traduction « écartez-vous ne vous assimiliez pas.» »
Le texte exact est Levitique 20:26
« Soyez saints, consacrés à mon service, parce que je suis saint, moi, le Seigneur. Je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous soyez à moi. »
Et Debray de continuer :
« Ne mélangez pas la laine d’origine animale avec le lin d’origine végétale (Deutéronome 22-11). Ne mélangez pas le lait avec la viande (Exode 23-19). Et, ne vous mélangez pas avec les goyims.
Ce qui vaut pour le textile et les aliments vaut pour l’humain et le territoire.
Israël doit rester séparer des autres nations et son territoire a été proclamé inaliénable par le peuple Juif. »
Le sacré fait frontière et les frontières c’est sacré.
<Ainsi le dieu latin Terminus était le maître des bornes et des limites>. Et on se souviendra que selon une légende, Romulus tua son frère Rémus parce que ce dernier avait sauté le sillon qu’il venait de tracer pour délimiter le mur, c’est à dire la frontière de la ville de Rome qu’il entendait créer.
Pour Debray, les églises chrétiennes, catholiques et protestantes préféreront la sainteté au sacré :
« Le sacré concerne les choses, la sainteté concerne les hommes. […] Le sacré est primitif, il est là avant le divin, le Dieu unique est encore postérieur. […] Rien n’est sacré par nature, mais n’importe quoi peut le devenir : un arbre comme pendant la révolution française, la source d’un fleuve, un parchemin. »
Vous savez sans doute que les saxons avaient un arbre sacré « Irminsul » qui fut abattu en 772 sur l’ordre de Charlemagne. A l’époque c’était des fanatiques chrétiens qui faisaient disparaître le patrimoine sacré d’autres peuples, mais cet épisode est souvent célébré dans nos livres d’Histoire. Pourtant, dans l’histoire de l’Humanité, ce fait n’est pas différent de celui où les talibans ont fait exploser les Bouddhas de Bamiyan. Certes l’Unesco n’existait pas à cette époque.
J’ai tiré l’exergue du mot du jour, de ce développement de Régis Debray :
« Le sacré se désacralise. Je peux proclamer dans la cité du Vatican que le Christ n’est pas ressuscité, le genre de propos qui m’aurait fait sentir le fagot il y a quelques siècles d’ici, mais si je venais proclamer sur les trottoirs du Caire que Mahomet n’a jamais rien reçu de l’ange Gabriel alors je risquerai ma peau. Notez qu’au Caire si il y a 3000 ans, si j’avais nié la résurrection d’Osiris, j’aurais été assez vite expédié au royaume des morts.
Le sacré d’aujourd’hui n’est pas le sacré d’hier, ils peuvent même se succéder sans grave difficultés. C’est pourquoi je dis qu’il n’y a pas de sacré pour toujours, mais il y a toujours du sacré.
Et il y a toujours en France des gens capable de donner leur vie pour une cause.
Certes, il n’en existe plus beaucoup qui réciteraient : « Mourir pour la patrie, c’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie »
Et rare sont les chrétiens qui seraient prêts, en France, de donner leur vie en l’honneur d Dieu et de la Foi. Même s’il y en eut, à Tibhirine en Algérie par exemple.
En revanche pour la maisonnée, pour les enfants ce ne serait pas impossible. Comme on dit « la famille c’est sacré ! » Il y a comme un retour sur le noyau dur, c’est-à-dire la famille.
Et je ne parle pas bien sûr des « humans bombs » qui impose leur martyr aux autres au nom de leur Foi.»
Une autre sacralisation moderne est celle du patrimoine culturel, les œuvres qui sont inscrits dans ce patrimoine sont inaliénables. Et Régis Debray de raconter :
« Le sacré ne se marchande pas, ainsi Fidel Castro visitant le Louvre a demandé devant « La Joconde » combien cela coûte ? Il lui fut répondu, ce tableau n’a pas de prix, il n’est pas sur le marché. De même si à Madrid, un prince Qatar souhaite acheter « Guernica » de Picasso, on lui expliquera fermement, cette œuvre « sacrée » ne peut s’acheter.
Enfin, on peut l’espérer et ce sera le cas tant que ces œuvres seront sacralisées. »
Et le philosophe d’expliquer :
« Le sacré c’est ce qui me rattache au passé et me fait la promesse d’un avenir. »
Même si ce mot du jour est encore très (trop ?) long, je suis incapable d’en présenter toute la richesse que vous trouverez derrière ce lien : <Réalités religieuses (2/5) : Que faut-il entendre par sacré>
Je finirai par cette conclusion qui est une quasi-prière :
« Sacralisons, ce qui nous fait tenir debout et ne profanons pas jusqu’à l’indispensable. En France, on peut se prendre à penser que la République aurait un avenir plus assuré du jour où le Chef de l’Etat oserait évoquer à voix haute, en haut d’une tribune, non des valeurs en carton-pâte mais notre Sacré laïque et républicain. »
<751>
-
Lundi 19 septembre 2016
Lundi 19 septembre 2016« La croyance
Je n’hésiterai pas à inscrire la croyance en tête de liste de nos nécessités vitales, en tête de liste des aides à la personne […] propre à l’entretien de ce qu’on appelle la vie, à savoir l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort. »Régis DebrayQue nous arrive-t-il ?
En Europe, nous pensions que le progrès, issu de la révolution des Lumières et des découvertes scientifiques et techniques permises grâce à elle, était en marche de manière irrésistible.
Cette évolution était accompagnée de manière continue et inexorable de la sortie du religieux.
C’est pourquoi, le retour du fait religieux nous laisse désemparé, dans l’incompréhension.
Dans ce questionnement, j’ai écouté, avec un immense, intérêt 5 émissions produites par Régis Debray, cet été, sur France Culture et qui avaient pour thème : les réalités religieuses <Allons au fait – les émissions>.
Il a interrogé successivement ces 5 notions :
- La croyance
- Le sacré
- La religion
- Dieu
- La Laïcité
Un livre est annoncé pour le 3 octobre : <Allons aux faits – le livre>
Commençons par la croyance.
Croire !
Pour philosopher sur la croyance, il introduit son sujet en montrant combien croire fait partie de notre quotidien :
« Le monde où on vit n’est pas le monde où on pense. Pour les têtes pensantes, il est mal vu de croire et conseillé de savoir !
Depuis Platon, le philosophe met la croyance sur la sellette. […] C’est le degré zéro de l’intelligence. […] La science est une machine à « décroire ».
Mais dans le monde où on vit ? Le vôtre, le mien ?
Chaque geste, chaque parole nécessite un acte de foi.
Quand je dépose un chèque à la banque, ou encore plus risqué quand je mets un bulletin de vote dans l’urne.
Quand je me rends à un rendez-vous qu’on m’a donné la veille, quand je lis dans le journal ou quand je m’adresse à mon fils comme étant véritablement mon fils, je fais confiance, spontanément !
Je tiens sur sa bonne mine, tel candidat comme crédible.
Je compte bien que le billet que j’ai en poche peut s’échanger contre un vrai paquet de cigarettes.
D’ailleurs sous la révolution, un assignat s’appelait un billet de confiance. »
Dans tous ces cas énumérés, il ne s’agit pas de savoir mais de croyance, « nous croyons que »…, sans nous rendre compte que dans ces cas, nous croyons. »
Après nous avoir montré que la croyance fait partie de notre vie, même si nous ne nous déclarons pas croyant, il va tenter de donner les raisons de la force de la croyance :
« A la croyance nous devons signer une reconnaissance de dettes, pour 3 motifs :
Si nous n’avions pas la faiblesse, mais la force de croire :
– nous n’aurions pas l’avenir devant nous ;
– nous n’aurions pas une société ou vivre et
– nous n’aurions pas d’actions à entreprendre.
Disons que l’incroyance absolue est un luxe de légume et que nous aurions tort d’en abuser.»
Et il développe et explicite ces trois raisons :
«1° La croyance fait respirer le temps, elle desserre l’étau du présent.
Credo vient d’une racine indo-européenne qui désigne le fait de donner une chose à quelqu’un avec la certitude de la récupérer plus tard. Je fais faire une offrande à un Dieu, auquel je crois, avec l’idée qu’il va me rétribuer, qu’il me le rendra un jour. Je prends une créance sur l’avenir.
De celui ou de cela auquel je crois, j’attends une rétribution en différé.
Autrement dit, le croyant c’est un homme en attente, qui met ses verbes au futur, comme Jaurès, ainsi que le lui reprochait Clemenceau. Oui parce que Jaurès était un croyant impénitent, croyant dans l’avenir et même peut être en Dieu. […]
2° Un croyant n’est jamais seul, en fait un croyant croit pour ne plus être seul […].
Ce n’est pas toujours facile de croire, en dépit des réalités, mais c’est un plus, malgré tout. Parce que c’est épouser une communauté et rentrer dans l’orchestre. […]
Alors quand on dit à un croyant : c’est idiot ce que vous croyez, d’ailleurs ce que l’on croit n’est jamais vrai, c’est Valery qui l’a dit, il vous répondra peut-être : Je sais bien, mais quand même, j’ai un toit pour m’abriter et des frères et des sœurs pour me tenir chaud, j’ai un parti, j’ai une église, j’ai une confrérie […]. Votre vérité, elle est froide, elle ne me rapporte rien, alors que ma croyance m’augmente. Elle me rend fier d’être ce que je suis, parce qu’elle m’assure une appartenance. Elle m’insère dans un « nous » beaucoup plus grand et plus fort que moi, le « nous » de tous les croyants, à la même croyance que moi.
Vous pouvez dire que les religions, les idéologies sont des mythes. Oui ! Mais des mythes au service d’une société d’entraide et d’admiration mutuelle.
Pour être savant : « La logique du collectif ne relève pas de critères cognitifs »
3° Croire c’est se mettre en mouvement. C’est sortir de sa passivité et de la résignation.
Dire que nous croyons en quelque chose, c’est dire que nous ferons quelque chose. […] C’est prendre des risques »
[…] L’homme de cœur va peut-être dans le mur, mais il y va, l’homme de pensée voit plus clair mais reste en arrière.
Il y a une preuve à contrario, il suffit de regarder autour de nous
La France qui n’y croit plus c’est un mélange de chacun pour soi et de maintenant c’est maintenant. On n’attend plus grand-chose, on prend plus beaucoup de risques et on ne se tient même plus les coudes. […]»
Et il ajoute ce que les lecteurs du « Sapiens » d’Hariri comprennent immédiatement :
« Un spermatozoïde et un ovule cela peut faire un fœtus, mais pour faire un petit homme il faut beaucoup plus. Il faut des prohibitions, des lois, des mythes, bref il faut du fantastique, [il faut du récit]. »
Et c’est sa conclusion que j’ai utilisé comme exergue de ce mot du jour :
« La croyance est à la fois nécessaire et dangereuse. Je n’hésiterai pas à inscrire la croyance en tête de liste de nos nécessités vitales, en tête de liste des aides à la personne […] propre à l’entretien de ce qu’on appelle la vie, à savoir l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort. »
C’est tout simplement passionnant.
Ce message ne donne qu’un petit aperçu de cette réflexion féconde et intelligente dans le sens où l’intelligence vous montre un aspect de la question qui vous surprend et change votre perception : <Réalités religieuses 1/5 Que faut-il entendre par croyance ? >
<750>
- La croyance
-
Vendredi 16 septembre 2016
Vendredi 16 septembre 2016« La négociation annuelle sur […] la qualité de vie au travail porte sur : Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. »<L’article L2242-8 du Code du travail a été modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 55>Le droit à la déconnexion pour les salariés à l’heure du numérique !Beaucoup a été dit sur la Loi « travail ». Il y a aussi des mesures innovantes et adaptées à notre monde moderne et numérique.Ainsi l’article 55 de la Loi a modifié l’article L2242-8 du code travail dont le paragraphe 7 que je cite ci-dessus dispose dans son intégralité :« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »Je l’avoue, ce n’est pas la lecture attentive de la Loi mais la revue de presse du 5 septembre d’Helene Jouan sur France Inter qui m’a informé de cette disposition :« Etre ou ne pas être…Connecté cette fois ! Le droit à être déconnecté de son smartphone, de ses mails, est inscrit pour la première fois dans la loi travail…en gros, est affirmé le droit de ne pas travailler…en dehors de ses heures de travail ! Quel progrès me direz-vous, sauf que c’est devenu une réalité pour beaucoup ; répondre à n’importe quelle heure du jour et de la nuit à des mails professionnels. Passionnant entretien du philosophe Maurizio Ferraris dans Libération ce matin qui nous révèle surtout comment en réalité cette servitude au smartphone est une servitude volontaire dit-il. Le smartphone dit-il c’est le bâton d’hier, l’arme dans la poche de l’homme, une arme qu’on dégaine parce qu’on est toujours en guerre. Alors l’homme reste cet animal soumis à sa pulsion de décrocher son téléphone, de répondre à un mail en pleine nuit. Une soumission docile difficile à rationaliser d’autant que tout est désormais enregistré…c’est toute une pratique du Web qui reste à inventer dit-il. Article 55 de la loi travail, passé assez inaperçu jusque-là. »Vous trouverez l’article de Maurizio Ferraris derrière ce lien : http://www.liberation.fr/debats/2016/09/04/maurizio-ferraris-le-smartphone-une-servitude-volontaire_1482631 dont voici des extraits :« Il est 3 heures du matin, une nuit entre le samedi et le dimanche. Maurizio Ferraris jette un œil à son téléphone et, s’apercevant qu’un mail professionnel est arrivé, y répond immédiatement. Donc, il travaille. Pourquoi n’a-t-il pas pu s’en empêcher ? C’est la question à l’origine de Mobilisation totale, l’appel du portable (PUF, 2016). Dans cet essai, le philosophe italien décrit l’ère post-Jobs comme celle de la militarisation de la vie civile, de l’hyperenregistrement. Le smartphone est une arme, une technologie qui nous mobilise, entraîne une servitude volontaire. Loin d’être une dérive technologique, il permet de révéler nos archaïsmes, notre inconscient social, une nature humaine imparfaite et dépendante. Le penseur travaille à construire une «raison pratique du Web», pour l’avènement d’un Internet heureux.[…]Nous avons plutôt découvert quelque chose de surprenant sur la nature humaine. L’ouvrier allant à l’usine pouvait rationaliser sa conduite : c’était pour gagner son salaire. Mais ce qui me pousse à répondre à un message professionnel pendant la nuit révèle une soumission docile et imprévue, une servitude volontaire difficile à rationaliser.La contrainte fonctionne par responsabilisation : tu as reçu mon message, je sais que tu l’as reçu (surtout si tu utilises WhatsApp). Tout est enregistré, il faut que tu me répondes, sinon c’est comme si tu détournais ton regard du visage de l’autre. Ou par rétorsion : si tu ne me réponds pas, la prochaine fois que tu m’appelles je ne répondrai pas. Ou par menace : si tu ne me réponds pas, il y a des dizaines (des centaines, des milliers) d’autres qui le feront à ta place. La base de l’efficacité est l’enregistrement. Autrefois, à l’époque du fixe, les appels téléphoniques ne laissaient pas de trace : je n’étais pas là, je n’ai pas entendu. Maintenant on est joignable partout, tout le temps. Tout appel laisse une trace, et beaucoup d’entre eux sont écrits – pas de justification possible, on est coupables. On passe de l’irresponsabilité à l’hyper-responsabilité. Le Web, avant d’être un moyen de communication, est un outil d’enregistrement, une grande archive qui garde tout et qui, en l’absence d’une raison pratique, privilégie les bêtises.»J’avais écouté, il y a quelques mois, une émission très intéressante qui abordait déjà ce sujet et qui avait invité Bruno Mettling, Directeur Général adjoint Orange l’auteur du rapport Mettling sur le droit à la déconnexion et aussi Joël Guerriau, sénateur-maire de St Sébastien-sur-Loire qui a lancé, le 17 décembre dernier, une journée sans e-mail dans sa mairie. -
Jeudi 15 septembre 2016
« Va, vis et deviens Français. »Ahmed MeguiniDans le mot du jour d’hier, la petite Mariam, originaire du Tchad, posait cette question et on sent l’importance qu’elle y accordait :
Madame, est ce que vous vous sentez française ? Qu’est-ce que vous avez fait pour devenir française ?
La France est vraiment un curieux pays, voici que le gouvernement met en place une «Fondation pour l’Islam en France» et y met à la tête un ancien ministre de l’intérieur Jean-Pierre Chevènement.
Ceci constitue une double incongruité. D’abord, je crois qu’aucun autre Etat démocratique et défenseur des libertés ne penserait faire créer par son gouvernement une institution pour une communauté. Et puis…Mais nul besoin de conceptualiser, imaginons que le gouvernement mette autoritairement à la tête d’une association juive, un catholique ou à la tête d’une association catholique, une personne d’origine musulmane…
J’ai écouté sur ce sujet, une émission très intéressante : <France Culture – Du grain à moudre les musulmans français ont-ils besoin d’être représentés ?>
De cette émission, outre la dénonciation de l’incongruité, il ressort surtout que « le musulman » et même « le musulman français » n’existe pas.
Il existe des musulmans et même beaucoup de personnes dont les parents étaient de confession musulmane et qui n’ont plus qu’un rapport très faible avec la religion.
Et je voudrais partager avec vous un témoignage trouvé sur le site de la règle du jeu : http://laregledujeu.org/2015/02/06/19074/va-vis-et-deviens-francais/
Je vous en donne de très larges extraits :
« Je m’appelle Ahmed et je ne suis pas Musulman. Habituellement, comme tous les athées, je le tais. D’abord parce que c’est intime, l’athéisme est une solitude et la solitude ça ne se partage pas. Il y a une autre raison : j’ai souvent eu peur de froisser mes ex- coreligionnaires. Pour un grand nombre de Musulmans, je suis ce qu’il y a de pire : un apostat. Dans la plupart des pays musulmans, je risquerais la mort pour cela.
Je suis un citoyen français et je n’ai pas d’autre identité à défendre que celle qui a permis mon émancipation. Je suis libre de croire ou de ne pas croire et pourtant, pour ma sécurité, jusqu’à aujourd’hui, j’ai cru bon de ne pas exposer ma non–foi.
Cette lâcheté, que j’assume comme telle, n’est plus permise aujourd’hui. En nous attaquant et en nous tuant, les assassins ont révélé une terrible faille sismique. Elle n’était pas nouvelle mais, comme vous, je me mentais à moi-même.
[…]
Je réponds à leur question : « l’Islam est-il compatible avec la République ? » en disant simplement que c’est la République qui ne sera jamais compatible avec l’Islam, comme avec n’importe quelle autre religion. C’est pourquoi il y a plus d’un siècle, nous avons assigné Dieu à résidence. Parce que c’est le concept même de Dieu qui n’a pas sa place dans la République. Je ne vois pas, je ne fréquente pas et je ne parle pas à des Musulmans, à des Catholiques et à des Juifs, et ça n’arrivera jamais.
Je ne reconnais que mes concitoyens, et qu’ils croient aux extra-terrestres ou à un homme qui change l’eau en vin, cela ne m’intéresse absolument pas. À ceux qui en réponse aux actes de terrorisme souhaitent débattre de l’Islam, je les invites à entamer au plus vite un cursus en théologie islamique, mais laissez-moi ma France !
Celle où je dois pourvoir vivre sans Dieu et sans me faire insulter dans ma non-foi. Frappez la République à coups de tête pour y enter en tant que Musulman, Catholique, Protestant, Bouddhiste ou Juif. Frappez encore, frappez plus fort et nous verrons bien qui de votre tête ou de la République cèdera en premier. Même si nous, Républicains laïcs, étions demain pris de panique, terrorisés par nos ennemis et prêts à tout céder, nous ne le pourrions même pas. Cette idée de liberté et de justice qui s’est affutée à travers le temps ne nous appartient pas, elle nous dépasse, un peu comme votre Dieu. La laïcité, c’est ce que nous avons trouvé de mieux pour vous permettre de vivre vos croyances tout en admettant la primauté des lois de la République sur vos lois divines. D’autres pays n’ont pas laissé ce choix à leur population. Les uns interdisent la religion, d’autres la rendent obligatoire. Si vous ne comprenez pas en quoi la laïcité vous protège, je ne vous l’expliquerai pas, je vous opposerai la loi, parce qu’elle me protège moi aussi. Si vous voulez comprendre, je vous invite à vous rendre dans une bibliothèque.
Je n’ai pas d’autre choix que d’engager un combat, que je promets féroce, contre ceux qui préfèrent s’adresser aux Musulmans plutôt qu’à leurs concitoyens. Comme d’autres, j’ai consacré toute ma vie d’adulte à devenir et à être admis en tant que Français. Je suis de la première génération à être né en France. Sur mon acte de naissance, il est écrit « père soudeur » et « mère femme de ménage », comprenez : « T’es plutôt mal barré dans la vie ». Aujourd’hui je suis père, chef d’entreprise et j’ai une vie relativement confortable. À l’école, j’ai fait le minimum, j’ai terminé mon parcours scolaire crashé dans une voie de garage au milieu d’un BEP grotesque. Cet enseignement minimum obligatoire m’a offert une barque et une paire de rames. Alors j’ai ramé, j’ai ramé la nuit et j’ai ramé le jour, scrutant inlassablement l’horizon à la recherche d’une terre, la France. […]
Je voulais devenir Français, parce que dans mon esprit, j’étais d’ici ; parce que contrairement à beaucoup de Français qui ont les mêmes origines que moi, mon père est enterré ici et c’est ici que je finirai ma vie. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, être Français. J’ai dû inventer, me jeter loin de moi, de ce que je croyais savoir. J’ai par exemple porté l’uniforme, je me disais qu’ainsi on ne pouvait pas penser que j’étais autre chose qu’un Français. Si je ne savais toujours pas ce que ça voulait dire au moins j’en avais l’air. Adolescent, j’étais jeune sapeur-pompier, je m’exerçais à des manœuvres incendie, au secourisme. À peine majeur, je suis devenu sapeur-pompier volontaire. Et puis il y a eu l’armée, je voulais absolument partir en opération à Sarajevo. Je pensais qu’en servant la France dans un pays en guerre, j’aurais alors un argument de poids à opposer à ceux qui pouvaient douter de mon attachement à mon pays. Le seul moyen de partir en opération extérieure dans mon régiment était de s’engager, je me suis donc engagé. Un mois plus tard, j’étais en territoire bosniaque et je regardais fièrement l’écusson tricolore sur mon épaule. Je m’appliquais sans le savoir ce mot de Kennedy : « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays ».
Oui, il a été sinueux ce chemin vers la France qui me fit faire un détour par la case prison. Arrêté dans une manifestation et condamné à tort pour violence sur agent des forces publiques, j’ai été incarcéré trois mois dans une maison d’arrêt alsacienne. Ce que j’y ai vu m’a profondément bouleversé. La première fois que j’ai vu une promenade, j’ai été choqué de n’y voir que « des Arabes et Noirs ». Je les regardais tourner en rond, ils étaient là, rassemblés, les pérégrins pérégrinaient. J’ai été très en colère, j’aurais pu sortir de là fou de haine si je n’avais pas eu le soutien de milliers de militants, de Français qui avaient pris fait et cause pour moi. Ils m’ont aidé à comprendre que la France c’est aussi une ambition qui appartient à ceux qui la défendent et comme dans les mariages, il n’y a pas que des jours heureux. Eh oui, bien souvent j’ai eu l’impression d’aimer la France comme un mari cocu.
Souvent je repense à cette promenade de prison comme la manifestation la plus évidente de notre échec. L’échec d’un pays tout entier, où chacun a sa part de responsabilité. L’État, bien sûr, mais aussi certains employeurs qui quand ils ne pratiquent pas ouvertement la discrimination à l’embauche, font preuve de peu de créativité. De nos préjugés, à chacun de nous, d’avoir cru que la police et la prison étaient la réponse à tout, faisant semblant d’oublier que les détenus ont vocation à sortir, et souvent, plus en colère encore que quand ils y sont entrés. C’est aussi l’échec des familles de ces prisonniers, et des prisonniers eux-mêmes, qui doivent assumer leur part de responsabilité.
Nous ne sortirons pas de cette impasse si chacun ne fait son autocritique. Si nous retombons dans ce débat stérile de la xénophobie à géométrie communautaire variable, l’auto-flagellation d’un côté et les revendications victimaires de l’autre. Nous serons condamnés à la guerre de tous contre tous. […]
Il faut encourager la prise de parole à l’initiative de ceux qui adhèrent pleinement aux valeurs de la République et qui se taisent aujourd’hui. Il faut réduire la capacité de nuisance de ceux qui ont le génie de la division, qui nous accablent en nous faisant éternellement le coup de la victime. Pour cela nous devons savoir être nous-mêmes, apprendre à être sereins et implacables avec nos valeurs. Cessons cet autodénigrement permanent. À être trop vigilant quant à notre propre xénophobie, on en devient un xénophobe bienveillant. Je rencontre parfois des gens qui ne m’aiment pas parce qu’ils n’aiment pas les Arabes et je ne peux rien y faire. Mais le pire pour moi, c’est de rencontrer des gens qui m’aiment bien parce qu’ils aiment bien les Arabes. La xénophobie bienveillante, qui au nom de la tolérance me voit, comme les autres, comme un Arabe. Alors pour me faire plaisir, pour être gentil avec moi, ils veulent discuter de la place que l’Arabe, maintenant le Musulman, mérite. Je vous le dis ici : je n’ai pas besoin de vous, par pitié arrêtez de vouloir m’aider. Je me suis fait une belle place de Français dans mon pays, grâce à mon pays et grâce à ma brave mère qui m’a élevé du mieux qu’elle a pu avant de me laisser partir avec pour seule consigne : « Va, vis et deviens Français. »»
Ce témoignage qui me semble être très équilibré entre les efforts nécessaires des uns et l’ouverture des autres, rappelle aussi qu’il existe encore des lieux où ne pas croire reste un combat.
Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je souligne que l’exergue fait référence à «Va, vis et deviens » qui est le titre d’un film magnifique réalisé par Radu Mihaileanu (2005) et qui parle de l’intégration en Israël d’un enfant d’Ethiopie.
<748>
-
Mercredi 14 septembre 2016
«U.P.E.A.A.
Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants »Acronyme que seule l’Éducation Nationale Française est capable d’inventerIl faut bien savoir être un peu léger parfois, quoique…
Dans ce cas, il suffit de faire un tour dans l’univers de la créativité de l’Education Nationale pour s’amuser et aussi se dire : Peut-on être pédagogue, c’est-à-dire selon ma définition rendre simple des choses complexes, quand on se complaît dans un tel vocabulaire ?
Rappelons qu’« allophone » a pour définition : « Personne qui parle une langue autre que celle(s) de la majorité. ».
Bref il s’agit ici d’une « classe à destination d’immigrés qui ne parlent pas le français ».
On pourrait même dire « classe à destination d’immigrés allophones », car le terme allophone est précis et signifie exactement ce de quoi on parle. Il ne s’agit pas de faire l’éloge d’une langue pauvre et de ne pas utiliser des termes précis et appropriés.
Ce qui est en cause ici et qui constitue la novlangue des technocrates ce n’est pas l’utilisation du mot « allophone » mais bien son association avec « unité pédagogique » et surtout « élèves arrivants ».
En outre si on lit rapidement l’acronyme d’« UPEAA », on entend « duper » qui a lien étroit avec tromperie.
J’ai appris l’existence des « UPEAA » grâce à cet article : <Madame vous avez fait quoi pour devenir francaise ?>
Cet article présente un autre intérêt : celui du témoignage d’une française d’origine vietnamienne : Doan Bui, journaliste qui a été invitée à retourner dans son ancien collège « Berthelot » au Mans où elle a rencontré des élèves migrants originaires de Syrie, du Kosovo, du Tchad.
Je cite quelques extraits de ce reportage :
« Fin avril, je suis donc retournée en classe, et j’ai vu mes « successeurs »… Cette fois, c’est moi qui étais au tableau.
Avec cette double casquette : journaliste à « l’Obs » et fille de migrants (ou plutôt l’inverse). […]
Erza, blonde aux yeux bleus, est kosovare (elle dit « albanaise » sur sa page Facebook), Aminata vient de Mauritanie, « où il y a la guerre », Rama de Syrie, Nawele d’Italie et de Tunisie, Mariam ou Jamilati du Tchad.
Derrière leurs grands sourires, elles traînent avec elles des histoires d’exils et de déchirements parfois terribles, et pourtant, quand on les voit, impossible de les distinguer de leurs camarades.
Ce ne sont pas des « migrantes ». Juste des ados, qui se taquinent, pensent à l’avenir, à l’amour, et pouffent quand elles évoquent les garçons.
Zain, 15 ans, est gêné quand les filles l’appellent pour poser. Il est plus timide. Il attendra la pause goûter pour me raconter son histoire. Zain est un Mineur Isolé étranger, un « MIE ». « Je viens d’Islamabad. Mes parents m’ont envoyé en France. A l’aéroport, j’étais tout seul. Mais j’ai rencontré un autre Pakistanais. Il m’a conseillé d’aller à Laval où il connaissait des gens. J’ai été dans un foyer, dans l’Aide Sociale, c’était le nom. Et puis après, je suis arrivé au Mans. […]
Zain est « très sociable » me disent ses professeurs. Scolarisé en troisième, il commence à se débrouiller. Derrière lui, souriant et mutique, Yannick, un autre « MIE » vient d’Angola. Hanh Baillat, professeur de Français : On a d’autres MIE qui sont arrivés cette semaine. L’éducateur ne savait rien d’eux, à part qu’ils ont été trouvés à Paris, qu’ils seraient originaires d’Egypte. Ils ne parlent pas un mot de français, pas un mot d’anglais. Ils sont « NSA », comme on dit. « Non scolarisés antérieurement »
Mais ça n’a pas l’air de lui faire peur à Hanh. Elle me désigne ainsi Aminata, vive comme du vif argent, qui est arrivée de Mauritanie, il y a moins d’un an. « Elle était NSA aussi, au départ, pour lui apprendre le français, on travaillait avec des images. » Aminata parle si bien français qu’on croirait qu’elle l’a appris depuis toute petite. En Mauritanie, par exemple. Aminata s’exclame : « Ah non, je n’ai pas appris le français là-bas !!!
L’école en Mauritanie, c’était pas bien. Ici, en France, tout est mieux. Même le froid, je m’y suis habituée. » […]
Qui se sent venir à 100% d’un endroit ? » demande Françoise Leclaire, qui a lancé le projet auprès des élèves de l’UEPAA. Personne ne lève le doigt…
Sur les murs, des cartes où sont épinglés tous les pays d’où viennent les enfants, leurs parents, leurs grands-parents. […]
Mariam, du Tchad, qui a également habité à Moscou, est très tracassée par ce que ça veut dire « devenir français » :
« Madame, est ce que vous vous sentez française ? Qu’est-ce que vous avez fait pour devenir française ? »
Hum… Qu’est-ce que j’ai fait pour devenir française ?
Moi qui suis née française (enfin presque, naturalisée à deux ans), j’ai toujours eu l’impression d’être française.
A cause des livres peut être : je me rêvais en petite fille modèle, façon Comtesse de Ségur. »
Voilà au-delà d’apprendre quelques acronymes amusants ou débiles, cet article parle d’enfants, de déchirures, de guerres, d’exil et de cette difficile quête : « devenir français »
<747>
-
Mardi 13 septembre 2016
Mardi 13 septembre 2016« Nous avons besoin d’intelligence et de bienveillance »Propos que je répète souvent ces derniers jours à mon travail.Après le mot du jour consacré à l’apprentissage et à Céline Alvarez hier, je voudrais faire part de quelques courtes réflexions professionnelles et personnelles qui font mon actualité.Je participe à la création d’une nouvelle structure, avec des moyens limités, une préparation insuffisante et une organisation en devenir.Bref, c’est un peu compliqué et des tensions peuvent surgir assez vite. C’est pourquoi je répète très fréquemment ces deux mots : « intelligence et bienveillance ».Au milieu de la semaine dernière j’ai rencontré une collègue dans l’ascenseur qui venait de changer de service. Et elle me disait que tout allait plutôt bien, parce qu’elle avait été bien accueillie par ses collègues qui l’aidaient beaucoup pour démarrer dans son nouveau métier.Ce témoignage m’a conduit à lui faire la réflexion suivante : «Audrey, c’est la situation la plus fréquente dans notre milieu de travail. La plupart des collègues sont bienveillants et aident spontanément. S’il n’en est pas toujours ainsi c’est parce qu’un management dévoyé cherche à créer la compétition entre les individus, de les dresser les uns contre les autres en pensant ainsi obtenir de meilleurs résultats d’ensemble. Et cette croyance est fausse. »Pour une fois, je ferai court.Je ferai court parce que je dispose d’un dessin.Ce dessin, je l’ai affiché dans mon bureau, la semaine dernière, c’est la première chose qu’on voit si on est attentif et qu’on passe la porte :Dans cette succession d’étapes, c’est la 4ème qui est la plus importante quand les ânes s’assoient et réfléchissent (enfin !) à la lumière de leur expérience, à la meilleure solution pour arriver à remplir leur objectif.Solution forcément coopérative.Coopération qui est facilitée par la bienveillance, sans oublier l’intelligence… -
Lundi 12 septembre 2016
Lundi 12 septembre 2016« L’enfant apprend en étant actif et non passif, quand il est aimé et non jugé »Céline AlvarezIl m’arrive de vous parler de personnes que je qualifie de lumineuses.Souvent, il s’agit de femmes. Je n’en tire aucune conclusion, je constate simplement que pour l’instant ce qualificatif m’est plus souvent venu pour des femmes.Récemment, je n’ai pas utilisé ce terme pour un homme, Antoine Leiris, mais j’aurais pu le faire, lui qui a expliqué que dans les retours qui lui ont été faits après son livre « Vous n’aurez pas ma haine », que beaucoup l’ont remercié pour l’élévation qu’il donnait par son témoignage.Oui, nous avons besoin d’élévation et aussi de lumière !J’ai entendu, Céline Alvarez dans le 7-9 de France Inter du 1er septembre 2016 et son message, son enthousiasme, son feu intérieur m’a immédiatement conquis.On rencontre aussi des « allumés », des personnes qui croient ce qu’ils disent, sans jamais interroger leurs croyances et leurs dogmes (et ces croyances ne sont pas limitées au domaine religieux). Eux aussi peuvent être enthousiastes et entraînant, mais pour mener dans des impasses.Céline Alvarez est le contraire d’une allumée, c’est une scientifique qui interroge l’apprentissage des enfants et confronte ses méthodes avec des analyses scientifiques des résultats de sa méthode et de sa pédagogie.Elle n’est que trentenaire.Télérama dans un article de <février 2016> écrit : « Souleyman, Clarisse, Emma et les autres n’oublieront jamais leurs années de maternelle, à l’école Jean-Lurçat de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). C’était de septembre 2011 à juin 2014, de la petite à la grande section – les enfants ayant eu, exceptionnellement, la même classe pendant trois années consécutives, ou les trois sections se trouvaient mélangées. Trois années enchantées, fondatrices, dans une école classée REP (Réseau d’éducation prioritaire). « J’ai vu, en quelques mois, ma fille reprendre confiance en elle, entreprendre des choses qu’elle n’aurait jamais faites, avant », témoigne Christelle Letourneur, la mère de Clarisse, petite fille « introvertie » au départ, qui bégayait, présentait des retards importants de langage. A la fin de son année de grande section, « Clarisse était déjà bien entrée dans la lecture, raconte sa mère. Et c’est elle qui venait en aide aux élèves en difficulté ou aux plus petits. » D’autres – la plupart des enfants de 4 et 5 ans – maîtrisaient parfaitement la lecture. Et certains pouvaient compter jusqu’à mille ou faire des additions à quatre chiffres ! Le tout dans la joie, avec facilité et fierté.La « maîtresse d’œuvre » de cette classe pas comme les autres – à défaut d’en être la « maîtresse » tout court, enseigner n’ayant jamais été un objectif professionnel – n’en a pas moins démissionné peu après. Originaire d’Argenteuil, banlieue du nord-ouest de Paris, Céline Alvarez, fille d’un ouvrier et d’une employée de banque […]. Titulaire d’un master en sciences du langage, elle n’a passé le concours d’enseignement, en 2008, que pour pouvoir « infiltrer » l’Education nationale, ponctuellement. Son intention ? « Y tester l’efficacité d’une démarche pédagogique nouvelle, uniquement construite autour des grandes lois naturelles de l’apprentissage, révélées par les neurosciences, afin d’aider l’école à évoluer. » Car, elle en est convaincue, « la connaissance du fonctionnement du cerveau, notamment celui des enfants, en bouillonnement permanent, avec ses millions de synapses produites chaque seconde, devrait être le dénominateur commun universel de toute initiative pédagogique. »L’Education Nationale lui donna donc les moyens de poursuivre son expérience pendant 3 ans puis interrompit brutalement l’expérience. Céline Alvarez démissionna.Patrick Cohen l’a invité parce qu’elle vient de publier un livre « Les Lois Naturelles De L’enfant ; La Révolution De L’éducation »Livre qu’elle a tiré de son expérience de Gennevilliers.Et que dit Céline Alvarez ?Que les méthodes d’enseignement actuellement pratiquées dans nos écoles publiques sont le fruit de croyances, de dogmes, de traditions qui ne tiennent aucun compte des avancées des sciences cognitives, des neuros-sciences et de la connaissance scientifique de l’apprentissage des enfants.Et elle exprime cette idée si simple que si on veut avancer, il faut tenir compte de ce que la science nous apprend et mettre en œuvre des pédagogies qui sont cohérentes avec ces connaissances.En deux mots, elle pourrait résumer sa méthode : « Autonomie et amour ».Elle explique « L’être humain n’apprend pas ce qui ne le motive pas. Tant qu’on impose les sujets, l’enfant ne peut pas apprendre. Les enfants doivent être autonomes pour choisir les activités qui les passionnent, dans un cadre donné ».Il faut un cadre, il faut une autorité, mais l’autonomie et le respect du rythme de l’enfant va le conduire naturellement à apprendre les savoirs fondamentaux.Elle a fait tester les résultats de ces méthodes par des analyses scientifiques, l’imagerie cérébrale a notamment été utilisée pour vérifier les résultats et pour orienter les méthodes.En pratique, et selon les parents eux-mêmes, les résultats ont été remarquables : les enfants ont appris à se concentrer, à grandir dans l’autonomie, à intégrer les savoirs fondamentaux, à lire spontanément etc…Ces analyses scientifiques ont, en très grande partie, confirmé les intuitions pédagogiques de Maria Montessori et aussi d’autres pédagogues comme Steiner et Freinet.Elle est convaincue qu’« Il faut arrêter les débats idéologiques stériles ! Pourquoi ne se base-t-on pas sur une démarche scientifique ? Tout le monde s’épuise avec ce système, les enfants sont à bout, les enseignants donnent tout, et les parents se fatiguent à la maison avec les devoirs. La démarche scientifique montre que l’enfant n’apprend pas quand il est passif, il apprend mal dans le stress. L’enfant apprend en étant actif et pas passif, quand il est aimé et pas jugé »Et notre vieille Education nationale ?Tout n’est pas perdu, Céline Alvarez a, peu de temps avant l’émission, été contactée par le cabinet de la ministre et son interlocuteur lui a dit que « Le ministère veut apporter une bienveillance institutionnelle« aux enseignants qui se basent sur ces méthodes pour construire leurs méthodes d’apprentissage.Bienveillance, un mot qu’utilise souvent Céline Alvarez.Voici le lien vers l’émission de France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-01-septembre-2016Et ici sa conférence TED’X où elle explique en 14 mn ses principes de pédagogie : https://www.youtube.com/watch?v=nwVgsaNQ-Hw (Je pense que c’est le meilleur résumé de sa démarche)Et enfin ci-après son site, extrêmement riche et qui ne peut que passionner celles et ceux qui s’intéressent à la pédagogie, à l’école et aux enfants. : https://www.celinealvarez.org/Elle réalise d’ailleurs de plus en plus de conférences devant des enseignants conquis par son message et sa démarche.Lumineuse je vous dis ! -
Vendredi 9 septembre 2016
«J’irai dormir en Corse»Michel RocardMichel Rocard a écrit deux ans avant sa mort un texte où il exprimait sa volonté d’être enterré en Corse, à Monticello, alors qu’il n’a «pas une goutte de sang corse».
Ce texte a été lu par son fils aîné lors de la cérémonie au temple de l’Etoile, un ami de la famille l’a transmis à Libération qui l’a publié : http://www.liberation.fr/debats/2016/07/17/michel-rocard-j-irai-dormir-en-corse_1466751
«Le temps viendra bientôt, pour moi, comme pour tous, de quitter la compagnie des vivants.
Enfant de la guerre, préservé presque par hasard des souffrances les plus atroces qu’elle a pu engendrer, j’en ai côtoyé le risque d’assez près pour avoir ensuite voulu découvrir, observer, savoir, analyser, comprendre, visiter aussi les lieux d’horreur d’Alsace, d’Allemagne, de Pologne, plus tard d’Algérie ou du Rwanda.
Toute mon adolescence, j’ai rêvé que ma trace soit porteuse de paix.
Je ne pense pas avoir manqué à ce vœu. Certains le savent encore en Algérie, tous en Nouvelle-Calédonie, je fus un combattant de la paix.
N’était la violence des hommes, la nature étant si belle, la vie aurait toutes ses chances d’être merveilleuse si nous savions y créer l’harmonie. Ce fut l’effort de mon parcours.
Reste un rêve un peu fou, encore un : que ma dernière décision, l’ultime signal, le choix du lieu où reposer, soit pour tous ceux qui m’ont aimé, ou même seulement respecté, une évidente, une vigoureuse confirmation.
Après tout, le déroulement de la vie elle-même a son rôle à jouer dans ce choix final.
Sylvie, ma dernière épouse, m’a fait, le temps de ce qui nous restait de jeunesse, redécouvrir l’amour, puis surtout rencontrer sérénité, tranquillité, confiance, le bonheur tout simplement.
A son père adoptif corse, elle doit le sauvetage de son statut social, mais pas l’affection.
Elle lui doit pourtant un lieu, celui de ses joies d’enfant, de ses premières et longues amitiés, de l’exubérance de la nature, de sa beauté et de ses odeurs, au fond le lieu de son seul vrai enracinement.
C’est un village, Monticello en Balagne.
Je n’ai pas une goutte de sang corse, et n’avais jamais mis les pieds sur l’île avant 1968.
Le mois de mai de cette année-là avait échauffé les esprits.
Je ressentis puissamment le besoin de rassembler pour une bonne semaine, la quarantaine la plus active d’étudiants et de cadres du PSU. La mutuelle étudiante rendit cela possible en Corse.
«De la violence en politique et dans l’histoire, pourquoi ? Jusqu’où ?».
Tous les jours exposés, découvertes de textes, réflexions, discussions… Tous les soirs et le dimanche, pour moi, découverte de cette merveille du monde, la Corse, qu’habitaient deux bonnes centaines de militants PSU… Paysans, historiens, chercheurs, animateurs du nationalisme non violent prirent à cœur d’être mes instructeurs.
Je découvris la violence de l’histoire corse, ne l’oubliai plus, j’appris surtout à la connaître et à la respecter. J’en parlai beaucoup, j’écrivis même.
Mais je m’occupais d’autre chose, longtemps d’Europe notamment sur la fin.Vint cette situation bizarre où la régionalisation des élections européennes, combinée avec les manœuvres internes au PS firent de moi la «tête de liste» socialiste pour les élections européennes de 2004 en Corse… J’avais sur ma propre tête 22 campagnes électorales de toutes dimensions de la France entière à ma commune.
La Corse m’honora de 28 %. C’est le record absolu de toute ma vie sur trente-cinq ans. C’est aussi le record régional du PS à ces élections-là. C’est enfin le record historique de la gauche sur l’île.
Et puis Monticello : 37,2 % tout de même.
 L’occasion ne m’avait jamais été donnée de remercier.
L’occasion ne m’avait jamais été donnée de remercier.
Ce sera fait. A Monticello, le cimetière est plein. Ne restait dans la partie haute, au-delà des caveaux, qu’une microparcelle trop petite pour une tombe, suffisante pour deux urnes, au ras de la falaise.
Arbres et tombeaux, tout est derrière nous. L’un des plus beaux paysages du monde. Et puis bien sûr, qui dit cimetière dit réconciliation… Le grand Pierre Soulages s’est chargé de pourvoir à ce que les objets à placer là, une urne puis deux, un support, une plaque puis deux, magnifient la beauté du lieu plutôt que de la déparer.
A l’occasion, venez nous voir, me voir : il faut garder les liens. Peut-être entendrez-vous les grillons, sans doute écouterez-vous le silence… A coup sûr la majesté et la beauté de l’endroit vous saisiront. Quel autre message laisser que de vous y convier.»
<Ici vous verrez une interview de sa compagne Sylvie qui raconte cette histoire du dernier repos>
Qui disait que Michel Rocard était compliqué à comprendre ?
Il allait toujours à l’essentiel, bien sûr il acceptait la complexité du monde ce qui signifie pour un politique de tourner le dos à la démagogie.
Il y a aussi dans ces propos sur sa finitude toute son humanité.
Ces paroles simples et émouvantes sont la meilleure conclusion à la cérémonie de l’Adieu d’un homme de qualité et de sincérité.
<744>
-
Jeudi 8 septembre 2016
Jeudi 8 septembre 2016« Pour diriger une société, il faut la comprendre. »Michel Rocard dans son ultime interview au PointLe 8 juin dernier, le journaliste Emmanuel Berretta rencontrait une dernière fois Michel Rocard et en tira un long entretien que le Point a publié et que vous trouverez en pièce jointe. Moins d’un mois après, Michel Rocard quittait la communauté des vivants.Je l’avoue, et vous l’aurez compris je suis orphelin, en politique, de Michel Rocard.J’aime beaucoup et j’approuve la dénonciation, de la gauche du PS et même au-delà, des dérives du système économique actuel, de la financiarisation du monde, de l’explosion des inégalités.Même Michel Rocard avait eu ce cri de colère : « Il est des moments où une cure de gauchisme est nécessaire.» dans une tribune du Monde dont j’avais fait le mot du jour du 12 décembre 2014.Mais je ne suis pas cette gauche dans les propositions de solutions qui soit me semblent irréalistes, soit néfastes. Ainsi, on ne peut pas faire de la France un territoire, tel le village Gaulois, épargné par la mondialisation. La fiscalité française ne peut pas s’éloigner de trop de celles de ses voisins. La France ne peut pas, seule, imposer sa loi aux multinationales et aux forces financières. Il faut donc trouver des partenaires et négocier avec eux, ne pas croire que la France est en mesure d’imposer son point de vue au reste du monde ni même aux européens et pour le reste tenir compte des contraintes mais aussi des opportunités de la mondialisation.Alors, on pourrait penser que le gouvernement actuel est un gouvernement conforme à la pensée que défendait Rocard, ainsi de Valls qui a fait partie du premier cercle de ses collaborateurs ou Macron qui se réclame de lui. Dans cet entretien, il essaie de ne pas être trop abrupt, mais il montre quand même que cette idée [de rocardiens au pouvoir] n’a pas vocation à prospérer :A la question : « Emmanuel Macron et Manuel Valls affirment que vous êtes leur mentor. Qu’est-ce que cela vous inspire ? »Il répond : « Ils le font tout le temps, c’est gentil à eux et je les en remercie… Mais ils n’ont pas eu la chance de connaître le socialisme des origines, qui avait une dimension internationale et portait un modèle de société. Jeune socialiste, je suis allé chez les partis suédois, néerlandais et allemand, pour voir comment ça marchait. Le pauvre Macron est ignorant de tout cela. La conscience de porter une histoire collective a disparu, or elle était notre ciment. Macron comme Valls ont été formés dans un parti amputé. Ils sont loin de l’Histoire. »Loin de l’Histoire …Il essaie cependant de rester gentil avec Macron : « Macron s’est totalement affranchi [du clivage droite/gauche], mais il reste du côté du peuple, donc de la gauche. Assurer un bien meilleur niveau d’emploi, Macron ne pense qu’à ça. »Mais il y met tout de suite une nuance : « Reste le vrai signal de gauche qui consiste à donner à l’homme plus de temps libre pour la culture, les choses de l’esprit, le bénévolat associatif, etc. Le capitalisme doit ménager cet espace. C’est le modèle du socialisme démocratique à la scandinave. »Et par rapport à tous les deux, Michel Rocard a toujours revendiqué son appartenance et son adhésion au mot de « socialisme ». Il dit dans cet entretien : « Nous sommes aussi vaincus par l’individualisme. J’en ai beaucoup voulu à Manuel Valls de vouloir changer le nom du parti. L’histoire nous a dotés du seul mot qui fait primer le collectif sur l’individu : le « socialisme ». C’est même la seule chose que le socialisme veuille dire, et surtout pas « appropriation collective des moyens de production » ! »Et alors que pense Michel Rocard de François Hollande ?« Le problème de François Hollande, c’est d’être un enfant des médias. Sa culture et sa tête sont ancrées dans le quotidien. Mais le quotidien n’a à peu près aucune importance. Pour un politique, un événement est un « bousculement ». S’il est négatif, il faut le corriger. S’il est positif, en tirer avantage. Tout cela prend du temps. La réponse médiatique, forcément immédiate, n’a donc pas de sens. Cet excès de dépendance des politiques aux médias est typique de la pratique mitterrandienne, dont François Hollande est l’un des meilleurs élèves.Or le petit peuple de France n’est pas journaliste. Il sent bien qu’il est gouverné à court terme et que c’est mauvais. »Et à la phrase suspendue du journaliste : « L’espoir de l’actuel président de la République de repasser… », il répond : « D’abord, je me demande pourquoi il ferait ça »…Il donne quelques circonstances atténuantes : « Les politiques sont une catégorie de la population harcelée par la pression du temps. Ni soirée ni weekend tranquille, pas un moment pour lire, or la lecture est la clé de la réflexion. Ils n’inventent donc plus rien. On sent venir l’élection sans projet de société d’un côté comme de l’autre. »… Mais peu encourageante pour l’avenir.Il ajoute : « [La parole du politique est aujourd’hui discréditée], et elle n’est pas près d’être recréditée ! Rien de ce que je peux vous dire ne se résume en une minute trente à la télévision. Comment réussir à redonner un espoir aux Français si cet espoir n’est pas inscrit dans une durée, au moins celle de la longévité de nos petits-enfants ? »Il fallait trouver une phrase exergue de ce mot dans ce long entretien, j’ai choisi le début de cette analyse : « Pour diriger une société, il faut la comprendre. Or on ne peut plus se comprendre. […] Le système fonctionne pour le divertissement. [J’avais esquissé l’idée, dans le mot du jour du 29 août, qu’aujourd’hui « Le Monde est un jeu »]. Comment, dès lors, comprendre le Moyen-Orient ou la crise économique ? Le monde du savoir ne produit plus de connaissances interdisciplinaires, les sociologues ne travaillent pas avec les économistes, qui ont peu ou pas de contact avec les politiques. »Dans ce long entretien énormément de questions sont abordées, les relations internationales, l’immigration, les problèmes sociaux, l’économie, la situation de la France dans le monde et les problèmes beaucoup français.J’en souligne encore quelques points :Sur le problème français du soutien de l’innovation et de la réalité de l’égalité dans notre pays : « Et notre système social tue les poules aux œufs d’or. Il naît tous les ans en France autant de start-up qu’en Allemagne, sauf qu’elles meurent dans les cinq premières années à cause de notre fiscalité et du poids excessif de l’administration. […]Nous parlons et écrivons le mot « égalité » partout, mais dans les faits la France est dans la moyenne de l’Europe, entre la Grande-Bretagne, clairement inégalitaire, et l’Allemagne, qui fait mieux que nous. Je le répète, les pays scandinaves montrent la voie, celle d’une organisation sociale plutôt harmonieuse, sans trop de conflits, et respectueuse des biens collectifs : éducation, santé, transports publics et environnement. »Il parle bien sûr de la gauche française tout en rappelant par ailleurs que toute la social-démocratie européenne est en crise et en panne d’idées. Mais : « La gauche française est un enfant déformé de naissance. Nous avons marié deux modèles de société radicalement différents, le jacobinisme et le marxisme.Pas de souveraineté des collectivités territoriales, pas de souveraineté des universités, tout est gouverné par le sommet, ça c’est le jacobinisme. Avec la prétention d’avoir une analyse rationnelle de la production, ça c’est le marxisme. Et, particularité française, la volonté révolutionnaire de travailler à la démolition du capitalisme, ce qui explique l’absence de dialogue social et de culture économique. Pourquoi voulez-vous comprendre le système puisqu’il faut en mettre un autre à la place ? « Les Allemands ont, après-guerre, envoyé Marx aux oubliettes de l’Histoire pour se rallier à l’économie de marché. Pas la France. »Et puis je voudrais aussi souligner son regard sur notre modèle d’intégration par assimilation :« C’est la mode actuelle de dire [qu’il y a une remise en cause de notre modèle d’intégration par assimilation ]. Gilles Kepel, grand universitaire, spécialiste de l’islam, a multiplié les observations. L’une d’entre elles est que le succès scolaire des enfants nés français mais issus d’une génération d’immigrés est meilleur que celui des Italiens ou Portugais d’entre les deux guerres. Je ne sais pas si notre modèle d’intégration a tant failli que ça, et je me suis toujours indigné des simplifications commodes, de celles qui désignent un bouc émissaire : les musulmans ; ou bien de celles qui préfèrent décider qu’on n’y peut rien. Je suis sûr d’une chose : lorsqu’on témoigne du respect aux gens, il n’y a pas d’exception au fait qu’ils vous le rendent formidablement. […]Les idées toutes faites sont reposantes. On n’a pas besoin de lire et de comprendre pour faire une campagne électorale, il suffit de recopier des discours écrits par d’autres. C’est de cela que la France crève. Mais, pour généraliser le respect, il faut une administration d’Etat suffisamment tolérante pour laisser faire, favoriser et même subventionner les initiatives locales, l’innovation. »Et je finirai par cette conclusion : « Le doute est l’accompagnateur infatigable du progrès. Sans le doute, une démocratie ne peut fonctionner. L’éthique, la générosité, la noblesse, l’intégrité n’ont pas leur place dans un système limité à la transmission de faits brutaux. »Mais tout l’entretien est à lire et à rapporter aux propos de ces nombreux hommes et quelques femmes qui briguent nos suffrages à travers les primaires puis les élections -
Mercredi 7 septembre 2016
Mercredi 7 septembre 2016«La France va très mal. Le cœur de ce malaise reste économique.»Michel RocardCe fut l’un de ses derniers passages à la radio, il fut l’invité de Léa Salamé sur France Inter, le 2 février 2016.C’était donc après les attentats du 13 novembre, en plein débat sur la déchéance de nationalité.C’est encore vrai alors que l’on débat du burkini et que Nicolas Sarkozy revient en mettant au centre du débat l’identité de la France.Lors de cet entretien il dit notamment :«La France va très mal. Le cœur de ce malaise reste économique. Il y a longtemps que je pense que le Gouvernement n’a pas assumé la crise économique, les multiples crises. Ils espèrent une amélioration de la crise économique capable de produire une diminution des tensions intellectuelles et psychologiques qui sont elles-mêmes à la source de la violence. Il y a un emballement médiatique autour des symboles. Les Français ça leur plaît de s’engueuler autour de ça. Pourquoi pas ?La vérité est que le malaise fondamental du capitalisme occidental est plutôt anglo-saxon d’origine et la République n’a pas grand-chose à y voir.Nous avons fait pire, nous avons confié la mission de nous défendre contre ça à l’Europe sans lui en donner les moyens. »Et il rappelle que le combat principal pour lui reste la lutte contre les inégalités :«La volonté de défendre les humbles, les pauvres, ceux qui n’ont pas eu de chance dans le capitalisme et de lutter contre la spéculation. Malheureusement, nous n’en avons pas toujours les moyens puisque le combat est de nature mondiale. Il y a des pays, la Grande Bretagne, les États-Unis, où les gagnants politiques du moment considèrent que le droit de s’enrichir doit être préservé absolument. C’est abominable.La France ne fait pas partie de cette école là mais elle fait partie de ces vaincus.»Et quand Léa Salamé le confronte aux propos de Macron « Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires » il répond simplement «Je reste partisan d’une autre lecture : la recherche contre les inégalités excessives. »Le mot du jour du 5 novembre 2012 avait aussi rapporté cette affirmation de sa part : « Dans les cinq plus beaux moments d’une vie, il y a un (ou des) coup(s) de foudre amoureux, la naissance d’un enfant, une belle performance artistique ou professionnelle, un exploit sportif, un voyage magnifique, enfin n’importe quoi, mais jamais une satisfaction liée à l’argent.»Lors de la crise 2008, il avait insisté plusieurs fois sur l’importance néfaste des idées de l’école de Chicago et de Milton Friedman en disant que «les idées peuvent tuer» par exemple ici https://www.youtube.com/watch?v=VFsTKmFny14Dans cet <entretien> il affirme qu’«Avec [l’idée de Milton Friedman] que le fonctionnement des marchés est parfait, il a laissé toute l’avidité, la voracité humaine s’exprimer librement»Et surtout il ancre son analyse dans la compréhension de l’Histoire :«L’équilibre entre partenaires du jeu économique a changé. C’est le résultat de deux siècles d’histoire du capitalisme. Quand il est né – dans les années 1810-1840 – on s’est aperçu que le système était cruel et injuste. Assez vite naît une riposte du monde du travail, qui prend la forme des coopératives, des mutuelles, des syndicats, du mouvement socialiste. Leur souci est de se débarrasser du capitalisme. Mais le capitalisme a gagné. Sous la pression ouvrière, mais pas seulement, son efficacité prodigieuse a été mise au service de la lutte contre la cruauté sociale.Le système est ainsi fait qu’il est instable. C’est même sa caractéristique principale. La crise des années 1929-1932, et la guerre qui a suivi, a rallié les cervelles à l’idée qu’il fallait le stabiliser. L’accord s’est fait dans le monde sur trois stabilisateurs. Le premier, c’est la sécurité sociale. L’Anglais Beveridge a théorisé qu’en faisant des retraites, de l’assurance chômage, de l’assurance maladie, des prestations familiales, on contribuait à stabiliser le système. Le deuxième régulateur, c’est celui de Keynes : au lieu de gérer les budgets et la monnaie sur la base de comptes nationaux, il faut les utiliser pour amortir les chocs extérieurs. Cette idée explique l’absence de crise pendant les trente années qui suivent. Le troisième régulateur, le plus ancien, c’est celui d’Henry Ford, et il tient en une phrase : « Je paie mes salariés pour qu’ils achètent mes voitures. » Mis ensemble, à la fin de la Second Guerre mondiale, ces trois stabilisateurs vont donner le compromis social-démocrate, qui a duré trente ans.Les actionnaires ont fini par considérer qu’ils étaient mal traités. Ils ne venaient pas aux assemblées générales – on en rigolait, d’ailleurs. Ça a changé quand se sont créés les fonds de pension qui regroupent des milliers, des millions d’actionnaires. Ils ont envahi toutes les assemblées, en se moquant des problèmes internes de l’entreprise, et en disant « je veux plus ». Dans la foulée se créent les fonds d’investissement, plus petits mais beaucoup plus incisifs, et les fonds d’arbitrage, les hedge funds.Ces fonds ont créé une vaste pression sur les managers. Ils disaient : « Si vous ne payez pas plus, on vous vire. » Puis il y a eu un mouvement plus puissant encore, celui des OPA. Celui qui ne distribue pas assez à ses actionnaires devient « opéable ». Il en a résulté une externalisation formidable de la main-d’œuvre, qui a rendu précaire un quart de nos populations. Au final, cela donne une économie fatiguée, minée par la méfiance, où l’idée de fidélité à l’entreprise commence à disparaître et où la croissance ralentit.Y a-t-il des moyens d’en sortir ?Tout commence par la prise de conscience et le diagnostic. Ce diagnostic doit être scientifique et internationalement partagé. Aussi longtemps que les chefs d’entreprises productives se laisseront intoxiquer par la propagande bancaire, alors que leurs intérêts sont souvent antagonistes, aussi longtemps que les médias nieront le diagnostic, il n’y aura pas de remède.Le repli national, c’est l’assurance déclin, l’assurance récession, parce que nos économies sont interdépendantes. L’économie administrée, on sait bien que ça ne marche pas. Interdire les produits dérivés, à mon avis ce n’est pas possible, car ils font fonctionner le système. Donc il faut une longue réflexion, qui doit comprendre un aspect éthique. La confiance ne peut pas revenir quand le PDG ou le banquier, qui gagnait 40 fois plus que ses salariés pendant les deux premiers siècles de capitalisme, gagne 350 à 500 fois plus. Il faut reconnaître que le moteur de la croissance, c’est la consommation des ménages. Cela implique le retour de la masse salariale à un niveau plus élevé : en moyenne, sa part dans le PIB a perdu 10 % en vingt-cinq ou trente ans.Il faudra aussi fournir un élément scientifique pour condamner l’espoir d’une rentabilité à 15 %, alors que le PIB croît de 2 % par an. Cet objectif de 15 % est un objectif de guerre civile. Or, il a été formulé par les professionnels de l’épargne et personne n’a rien dit. Aujourd’hui, si on ne trouve pas d’inflexion, on est dans le mur. Le déclin du Bas-Empire romain a commencé comme ça…»Et puis écoutez dans cette vidéo Michel Rocard expliquer la division syndicale française en remontant à la répression sanglante de la Commune de Paris par Adolphe Thiers, c’est à partir de 1h14:20Ainsi était Michel Rocard, inscrivant toujours sa réflexion dans l’argumentation, dans la compréhension de l’Histoire et de l’Economie.Il était aussi dans la lignée des Mendes-France qui ne croyait pas à l’homme providentiel, mais croyait en la réflexion partagée, à l’implication des gens et au travail d’équipe déployant l’intelligence collective.Je reste pour ma part convaincu de la justesse de cette pensée. -
Mardi 6 septembre 2016
Mardi 6 septembre 2016«Avant de réussir une grande carrière politique, Michel Rocard a été un audacieux militant anticolonialiste»Pierre JoxePierre Joxe a rendu un bel hommage à Michel Rocard dans Mediapart : https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070716/michel-rocard-par-pierre-joxeDans le combat Mitterrand/Rocard, Pierre Joxe avait clairement choisi le camp de Mitterrand. Dans son livre «Si la gauche savait», Rocard écrit qu’il faisait partie de la «la garde noire» de Mitterrand, ailleurs il dit qu’il faisait partie de «mes tueurs» que Mitterrand voulait absolument nommer au gouvernement dirigé par Rocard au poste stratégique de l’Intérieur pour le surveiller voire plus. Mitterrand voulait se débarrasser de Rocard et il avait dit à ses amis qui depuis l’ont répété, par exemple Ambroise Roux, qu’il fallait « lever l’hypothèque Rocard ».Pourtant à la fin de sa vie Rocard a exprimé cet avis nuancé sur Pierre Joxe : «Un drôle de zèbre, Joxe… Un ultra du mitterrandisme avec, en même temps, une énorme distance. Il est très cynique, mais il a beaucoup d’humour. Nous sommes très copains !»Mais Pierre Joxe est aussi issu d’une grande famille politique : son père Louis Joxe fut un grand résistant, ministre de De Gaulle et principal négociateur des accords d’Évian ayant abouti à l’indépendance de l’Algérie… Et c’est justement pour son comportement et l’action de Michel Rocard lors de la guerre d’Algérie qu’il lui a rendu hommage :«A l’annonce de la mort de Michel Rocard, la plupart des réactions exprimées par les hommes politiques au pouvoir – et par ceux qui espèrent les remplacer bientôt – ont été assez souvent purement politiques ou politiciennes. A gauche, l’éloge est de règle. A droite, l’estime est générale. Mais deux aspects de la personnalité de Michel Rocard semblent s’être volatilisés : avant de réussir une grande carrière politique, il a été un audacieux militant anticolonialiste et un talentueux serviteur de l’Etat.Il lui fallut de l’audace, en 1959 pour rédiger son Rapport sur les camps de regroupement en Algérie. Il fallait du talent en 1965, pour être nommé secrétaire général de la Commission des comptes et des budgets économiques de la Nation.Je peux en témoigner.Quand je suis arrivé en Algérie en 1959, jeune militant anticolonialiste d’une UNEF mobilisée contre la sale guerre coloniale, le prestige de Rocard était immense parmi nous. C’était comme un grand frère, dont on était fier.Car il avait rédigé[…] un rapport impitoyable sur les « camps » dits « de regroupement » que les « pouvoirs spéciaux » de l’époque avaient permis à l’Armée française, hélas, de multiplier à travers l’Algérie, conduisant à la famine plus d’un million de paysans et à la mort des centaines d’enfants chaque jour…Le rapport Rocard « fuita » dans la presse. L’Assemblée nationale s’émut. Le Premier ministre Debré hurla au « complot communiste ». Rocard fut menacé de révocation, mais protégé par plusieurs ministres dont le Garde des sceaux Michelet et mon propre père, Louis Joxe.Quand j’arrivai alors à mon tour à Alger, les officiers dévoyés qui allaient sombrer dans les putschs deux ans plus tard me dirent, avant de m’envoyer au loin, dans le désert : « … Alors vous voulez soutenir les hors la loi, les fellaghas, comme votre ami Rocard…? »Je leur répondis, protégé par mes galons d’officier, par mon statut d’énarque – et assurément par la présence de mon père Louis Joxe au gouvernement : « C’est vous qui vous mettez « hors la loi » en couvrant, en ne dénonçant pas les crimes commis, les tortures, les exécutions sommaires et les mechtas incendiées. » J’ignorais alors que ces futurs putschistes allaient tenter un jour d’abattre l’avion officiel où mon père se trouvait…En Janvier 1960, rappelé à Alger du fond du Sahara après le virage deDe Gaulle vers « l’autodétermination » et juste avant la première tentative de putsch – l’ « affaire des barricades » –, j’ai pu mesurer encore davantage le courage et le mérite de Rocard. Il avait reçu mission d’inspecter et décrire ces camps où croupissait 10% des paysans algériens, ne l’oublions jamais !Il lui avait fallu une sacrée dose d’audace pour arpenter l’Algérie en civil – ce jeune inspecteur des finances –, noter tout ce qu’il voyait, rédiger en bonne et due forme et dénoncer froidement, sèchement, ce qui aux garçons de notre génération était une insupportable tâche sur l’honneur de la France. Nous qui avions vu dans notre enfance revenir d’Allemagne par milliers les prisonniers et les déportés dans les gares parisiennes, nous étions indignés par ces camps.Car en 1960 encore, étant alors un des officiers de la sécurité militaire chargé d’enquêter à travers l’Algérie, d’Est en Ouest, sur les infractions, sur ceux qui désobéissaient aux ordres d’un De Gaulle enfin converti à l’« autodétermination » qui allait devenir l’indépendance, j’ai pu visiter découvrir et dénoncer à mon tour des camps qu’on ne fermait pas ; des camps que l’on développait ; de nouveaux camps… Quelle honte, quelle colère nous animait, nous surtout, fils de patriotes résistants ! […]Michel Rocard, et beaucoup d’autres serviteurs de l’Etat, nous avons été conduits à la politique par nécessité civique. Non pour gagner notre pain, mais pour être en accord avec notre conscience, nos idées, nos espoirs.Les exemples contemporains de programmes électoraux trahis, oubliés ou reniés, de politiciens avides de pouvoir, mais non d’action, « pantouflant » au besoin en cas d’échec électoral pour revenir à la chasse aux mandats quand l’occasion se présente, tout cela est à l’opposé de ce qui anima, parmi d’autres, un Rocard dont beaucoup aujourd’hui encensent la statue mais tournent le dos à son exemple en détruisant des conquêtes sociales pour s’assurer d’incertaines « victoires » politiciennes, contre leur camp, contre notre histoire, contre un peuple qui n’a jamais aimé être trahi.»Comme le dit justement Joxe, beaucoup se réclament de Rocard. Beaucoup pensent qu’en fin de compte ce sont ses idées qui auraient gagné à gauche et seraient au pouvoir. Mais c’est oublier que Michel Rocard a toujours voulu d’abord lutter contre les inégalités sociales et affermir les conquêtes sociales. La confiance régulée dans les marchés n’était que le moyen parce qu’il avait compris que l’économie administrée n’était pas efficace.Mais pour revenir à la guerre d’Algérie, Michel Rocard avait clairement choisi son camp, celui de l’éthique, des droits de l’homme et bien sûr le combat anticolonial. Je ne me lasserai pas de rappeler que François Mitterrand était, à cette époque, dans l’autre camp. -
Lundi 5 septembre 2016
Lundi 5 septembre 2016« Georges Servet »Alias Michel RocardAprès que ma belle-sœur ait attiré mon attention sur Michel Rocard, je me suis intéressé à lui et j’ai vite été conquis. J’ai même adhéré une première fois au Parti Socialiste en 1979, j’avais 18 ans, à l’époque du Congrès de Metz. Ce Congrès où Rocard avait défié Mitterrand et où Mitterrand allié à Chevènement a gagné. C’est lors de ce Congrès que Laurent Fabius a lancé à Michel Rocard « entre le marché et le plan, il y a le socialisme ». Après un an, je n’ai pas renouvelé ma carte.Mais qui était Michel Rocard ?Michel Rocard était un homme de convictions et un homme ancré dans l’Histoire. Et je voudrai commencer ces quelques mots que je lui consacre par cet acte qu’il a commis quand à partir de 1953 il a pris le pseudonyme de « Georges Servet » du nom d’un hérétique protestant, Michel Servet. C’est sous ce nom qu’il est connu au PSU avant 1967.Le local du PS de Villeurbanne se situe Rue Michel Servet. Un jour que je m’y trouvais avec d’autres membres du PS, l’un d’entre eux demanda mais qui était Michel Servet ? Et je constatais ce jour l’ignorance assez générale sur cette question. Les histoires de religion n’ont jamais beaucoup intéressé le commun des socialistes.Michel Servet est né en 1511 dans le Royaume d’Aragon et il a été assassiné le 27 octobre 1553 à Genève, à l’instigation de Jean Calvin, en étant brûlé vif parce qu’il avait été condamné pour hérésie. Il avait notamment osé interroger le dogme de la Trinité. Oui ! À cette époque le christianisme et le protestantisme aussi, tuait pour des idées. Il a été tué notamment parce qu’il contestait la conception d’un Dieu unique qui existait en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participant d’une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Les hommes de religion tuaient pour cela ! Pour une divergence d’idée sur un concept abscons !Michel Servet, outre, qu’il était théologien fut aussi médecin. En tant que médecin, il découvre la circulation pulmonaire. Wikipedia écrit : «Sa vaste intelligence et sa soif de connaissances l’incitent à s’intéresser à toutes les branches du savoir, incluant la géographie et les mathématiques. Il compte au nombre des martyrs de la pensée.»Michel Rocard a souhaité, pour ses obsèques, bénéficier d’une cérémonie au Temple protestant.Sa mère, Renée Favre, institutrice était protestante mais son père Yves Rocard, était de famille catholique.Ce père, avec qui il a eu des relations tumultueuses, avait été membre de la Résistance mais fut surtout un grand professeur et chercheur en physique. <Il fut un des pères de la bombe atomatique française>Son père voulait que le jeune Michel devienne scientifique comme lui, il détestait l’idée qu’il se lance dans la vie politique.Dans son livre «Si la gauche savait» Michel Rocard a écrit de son père : « C’était un personnage compliqué… Un génie aux facettes multiples… Un professeur Tournesol enfermé dans ses silences, maladroit de son corps comme pas possible. Il détestait sa femme. Ma mère était une petite institutrice de Savoie mariée à un immense savant ; d’une certaine façon, elle vivait une promotion sociale. Elle empoisonnait la vie de mon père. Il a fini par déserter le domicile conjugal pour échapper à son caractère dominateur. Et, surtout, elle m’accaparait. Il lui a beaucoup reproché de m’avoir soumis à elle ; et, de ce fait, de m’avoir éloigné de lui. Il disait: « Je ne comprends rien à mon fils. C’est un con, et à cause de toi. » Après cet épisode, il a passé sept ou huit ans sans guère m’adresser la parole.»Michel Rocard passe par le scoutisme où il porte le surnom d’« Hamster érudit » qui sera souvent rappelé lors de sa carrière politique.Très vite, il s’engage en politique, à gauche et c’est lors de la guerre d’Algérie qu’il montre publiquement la force de ses convictions. Il rejoint les socialistes en rupture avec Guy Mollet à propos de la politique algérienne. Il écrit : « Pendant plus d’un siècle, la France a prétendu mener en Algérie la politique dite de l’assimilation, qui seule justifiait l’intégration de l’Algérie dans le territoire de la République. En fait, cette politique fut proclamée et jamais appliquée […] L’égalité des devoirs existait, et notamment l’impôt du sang, mais point d’égalité des droits ». Il relève « une mentalité proche de la ségrégation raciale qui interdisait aux musulmans, sauf exception, l’accès aux fonctions de responsabilités, même mineures, dans leur propre pays ».Pendant cette guerre, il joue un rôle éminent sur lequel nous reviendrons demain.Mais rappelons que le ministre de la Justice, du gouvernement de répression que ces hommes inconséquents appelaient les évènements d’Algérie et non la guerre était François Mitterrand. Dans cette fonction, Mitterrand refuse 80 % des demandes de grâces des condamnés à mort algériens. Rocard écrira alors de Mitterrand qu’il est un « assassin ». Ainsi commencèrent leurs relations conflictuelles.Contrairement à Mitterrand qui adorait rester dans l’ambiguïté et que la démagogie ne dérangeait pas, Michel Rocard aimait ancrer ses raisonnements et sa pensée dans le réel, la vérité et l’Histoire.Dans son émission Mediapolis du 9 juillet 2016, Olivier Duhamel a fait la remarque suivante :Les mots utilisés par les hommes politiques pour lui rendre hommage sont surprenants :«C’était un homme d’idées … Ah bon, les hommes politiques n’ont plus d’idées ?C’était un homme de conviction … Ah bon, ils n’ont plus de convictions ?C’était un homme honnête … Ah bon,…Il y a, en creux un réquisitoire terrible contre les hommes politiques d’aujourd’hui.» -
Vendredi 2 septembre 2016
Vendredi 2 septembre 2016«Vous n’aurez pas ma haine»Antoine LeirisAprès ces nouveau évènements de juillet, je veux rattraper un oubli car j’aurais dû depuis longtemps déjà laisser la parole à Antoine Leiris. Antoine Leiris, journaliste, chroniqueur culturel à France Info et France Bleu, a perdu sa compagne Hélène, l’amour de sa vie, dans l’attentat du Bataclan, le 13 novembre 2015Alors il a posté le 16 novembre 2015 sur les réseaux sociaux ce message :«Vous n’aurez pas ma haineVendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon fils mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur.Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais répondre à la haine par la colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j’ai peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu.Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès.Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non plus.»Ce message est devenu l’un des chapitres de son livre, paru portant le même titre, publié aux éditons Fayard. <Vous n’aurez pas ma haine> et qui décrit les douze jours qui ont suivi la mort d’Hélène<Une lectrice de ce livre a publié ce billet sur son blog de Mediapart> : « On vit avec lui chaque instant de ses 12 journées qui ont suivi le 13 novembre, date à partir de laquelle « un père et un fils vont s’élever seuls sans l’aide de l’astre auquel ils ont prêté allégeance ».[…] Reconstruire une vie non pas « contre » (ceux qui l’ont détruite) mais ensemble, « avec » Hélène, l’absente, et son fils, à trois. […] Depuis quelques temps, des mots qu’on voudrait effacer, envahissent notre vocabulaire: barbarie, massacre, bain de sang, terrorisme, guerre, violence, mort, haine, peur, guerre civile, sécurité…L’auteur évite, de justesse le terme de « bouch… ». Nous ne le dirons pas non plus.Tous ces mots, témoins des évènements, sont, en permanence, utilisés sur les réseaux sociaux, les chaines d’info en continu (ou pas) qui jouent « le grand concours du titre le plus racoleur, le plus pervers, celui qui nous maintient captifs. » Ces mots sont ressassés aussi par les politiciens qui, en toute indécence, font souvent dans la surenchère du tout sécuritaire, échéances électorales obligeant.A tous, on a envie de dire ASSEZ ! « Taisez-vous et lisez ! »Lisez ce texte sobre, poétique, fort, magnifique qui nous ramène à la douceur, à la tendresse, à l’intelligence, l’apaisement.Parce qu’ « on ne sèche pas les larmes sur les manches de la colère ». […] C’est aussi un très beau plaidoyer pour la culture face à l’ignorance.« On ne se soigne pas de la mort, On se contente de l’apprivoiser ». Et de quelle manière !Admirable ! A lire avec un mouchoir à la main mais on en sort soulagé. »Si nous voulons combattre la haine et espérer la vaincre nous ne pouvons opposer la haine, mais la justice et une dose plus grande d’humanité.Que ce soit Antoine Leiris qui est dans la tristesse de la séparation et la blessure du crime le dise avec cette force est admirable. -
Jeudi 1er septembre 2016
Jeudi 1er septembre 2016« Quand quelque chose arrive,
quand ce quelque chose on n’en n’a pas idée,
quand on ne l’a pas souhaité, ni espéré, ni craint
Alors la première chose à faire, est [d’user] de l’exactitude des mots, constater ce qui arrive sans se laisser intimider ni émerveiller par les mots anciens. »Machiavel cité par Patrick BoucheronPatrick Boucheron est cet historien qui a une chaire au Collège de France et qui lors de sa leçon inaugurale «Que peut l’Histoire» a cité un extrait des Misérables que j’ai repris comme mot du jour du 5 février 2016 et qui commence ainsi : «Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait, ….»Dans une émission plus ancienne de 2013, il avait été invité pour présenter son ouvrage «Conjurer la peur» et il a fait cette citation de Machiavel.Voici cette citation remise dans son contexte :Avant son entretien, un journaliste a évoqué la revue Vacarme (n° 65) qui avait proposé un manifeste contre le fascisme et peut-être surtout contre le fascisme « qui est en nous ».et on a alors demandé à Patrick Boucheron d’intervenir :Je suis historien médiéviste, mais je suis aussi un disciple de Machiavel. Machiavel disait : « Quand quelque chose arrive, quand ce quelque chose on n’en n’a pas idée, quand on ne l’a pas souhaité, ni espéré, ni craint, Alors la première chose à faire, est [d’user] de l’exactitude des mots, constater ce qui arrive sans se laisser intimider ni émerveiller par les mots anciens. »[…] « Fascisme », sans doute, il a encore, malheureusement, de beaux jours devant lui. […] En tant que citoyen, ce dont j’ai vraiment peur, c’est que nous ne puissions pas inventer les mots de la riposte. C’est-à-dire que nous nous laissions à ce point déborder par ce mauvais gouvernement, par l’appauvrissement de la langue politique. Dès lors qu’on se met, faute de mieux, de guerre lasse, à employer les mots de l’adversaire, mots anciens ou nouveaux peu importe, Par exemple l’ « assistanat » [dans la réflexion sociale] ou l’ « étranger » dans la réflexion identitaire, ces mots empoisonnés, on a perdu ! Ce qu’il y a de plus machiavelien, de plus politique aujourd’hui c’est notre capacité ou non d’inventer les mots exacts du constat. »Patrick Boucheron a d’ailleurs, pendant cet été, parlé de Machiavel tous les jours sur France Inter <Un été avec Machiavel>Nos pauvres hommes politiques, ou plutôt communicants parlent de guerre, de fascisme, de laïcité, d’identité. Certains vont même jusqu’à prétendre qu’expliquer c’est déjà commencer à excuser.Comprendre ce qui nous arrive, pourquoi des jeunes peuvent être fascinés par une idéologie millénariste de la mort ?Constater que depuis la dernière guerre les pays occidentaux ont beaucoup bombardé des petits pays non occidentaux, le Viet Nam, l’Afghanistan, l’Irak et n’ont en fin de compte jamais gagné, c’est à dire atteint leurs buts de guerre.Et on continue à bombarder.Quand, pour se venger, pour se venger (la répétition est voulue) la France va bombarder des villes tenues par Daech, ne tuent-ils que des djihadistes ? S’il y a des abris anti bombardement qui sont les premiers qui les occupent ?Alors nos bombardements tuent des civils, des enfants, des femmes qui ont la malchance d’habiter la bas et de ne pouvoir fuir leurs tyrans.Parce qu’il s’agit d’armes sophistiqués et non de ceintures d’explosifs faut-il appeler cela d’un autre nom que terrorisme ?Ces bombes arriveront-ils à convaincre les victimes à la fois de DAESH et de nos bombes que notre camp est celui du Bien ?Comme parallèlement ceux d’entre eux qui s’échappent et veulent venir nous rejoindre pour échapper à leur sort sont en très grande partie refoulés et sinon très mal accueillis, je pense que nous pouvons concéder qu’ils doivent avoir du mal à croire que nous représentons le Bien ?Quels sont nos mots de la riposte ? Quelle est notre vision et notre explication du Monde ?Loïc Blondiaux, dans une émission récente de la <Grande Table> qui revenait sur ce développement de Patrick Boucheron parle de « corruption de la langue politique ». En effet, nos démocraties sont fragiles. Si on se penche sur le temps long, jamais nos sociétés n’ont été si peu violentes, au moins dans la violence physique, qui est aujourd’hui poursuivie, condamnée. Notre société éprouve, à juste titre, une intolérance de plus en plus grande à la violence. Mais parallèlement, on sent une élévation du seuil de tolérance aux atteintes à la Liberté. Liberté contre les autres, les suspects, les migrants et nos libertés elles-mêmes sont en cause. En agissant ainsi, nous ressemblons de plus en plus à ceux que nous prétendons combattre.Mettre des mots sur ce qui nous arriveBertrand Badie a écrit un ouvrage <Nous ne sommes plus seuls au monde> paru en mars 2016.Il a été l’invité de France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/un-jour-dans-le-monde/un-jour-dans-le-monde-09-mars-2016Pour présenter cet ouvrage Nicolas Demorand a expliqué :« « Nous ne sommes plus seuls au monde » est le nouveau livre du politologue Bertrand Badie . Il propose dans cet ouvrage des clés de lecture du monde actuel. Bertrand Badie incite dans son livre les Etats occidentaux à changer leur logique de polarisation et de puissance afin de considérer les exigences des sociétés et les demandes de justice qui émergent d’un monde nouveau, où les acteurs sont plus nombreux et plus rétifs aux décisions arbitraires. […] Bertrand Badie rompt avec les explications paresseuses ou consensuelles. Il nous rappelle que nous ne sommes plus seuls au monde, qu’il est temps de se départir des catégories mentales de la Guerre froide et de cesser de traiter tous ceux qui contestent notre vision de l’ordre international comme des «déviant» ou des «barbares». Il interpelle la diplomatie des États occidentaux, qui veulent continuer à régenter le monde à contresens de l’histoire, et en particulier celle d’une France qui trop souvent oscille entre arrogance, indécision et ambiguïté. Le jeu de la puissance est grippé. L’ordre international ne peut plus être régulé par un petit club d’oligarques qui excluent les plus faibles, méconnaissent les exigences de sociétés et ignorent les demandes de justice qui émergent d’un monde nouveau où les acteurs sont plus nombreux, plus divers et plus rétifs aux disciplines arbitraires. Pour cette raison, cet ouvrage offre aussi des pistes pour penser un ordre international sinon juste, en tout cas moins injuste. »Bertrand Badie répond aussi à un entretien dans Libération : http://www.liberation.fr/debats/2016/03/18/bertrand-badie-l-occident-doit-compter-avec-un-monde-qui-n-est-plus-exclusivement-le-sien_1440614Il explique la signification du titre : «Nous ne sommes plus seuls au monde»?«C’est à la fois une façon de souligner l’apparition des Etats qui ne comptaient pas auparavant, mais aussi de prendre en considération l’émergence des sociétés civiles dans l’ordre international. Ce dernier concept a été inventé à l’échelle continentale par les Européens lors de la conclusion du traité de paix de Westphalie [au XVIIe siècle, ndlr]. Les Européens ont fait en sorte que cet ordre normatif européen soit synonyme d’ordre international. La décolonisation, qui aurait dû réorganiser ce monde, a été tenue en lisière par la bipolarité du monde de la guerre froide. Ce n’est ni plus ni moins qu’un enchaînement de circonstances qui ont fait correspondre l’idée moderne d’«international» avec l’idée classique de «concert européen». A tel point que les Etats-Unis ne se sont véritablement internationalisés qu’en devenant une puissance européenne de plus, notamment en allant combattre lors des deux guerres mondiales sur le sol européen. Puis ils se sont inscrits dans un système d’alliances certes atlantique mais profondément ancré dans le vieux continent.Les Européens ont dominé le monde grâce à leurs empires coloniaux…La colonisation a durablement mis en place une division entre un monde dominant et un monde dominé. Cette logique a pérennisé le périmètre européen. L’idée d’un système inégalitaire s’est ainsi banalisée et s’est greffée sur un ordre institutionnel européen composé d’égaux. A cette évolution géographique s’ajoute l’effet du débordement social que provoque la mondialisation. Aujourd’hui, l’Occident doit compter avec un monde qui n’est pas exclusivement le sien, mais aussi avec l’apparition d’acteurs sociaux devenus globaux. Les sociétés elles-mêmes font irruption dans l’ordre mondial : celles du Sud, en particulier, viennent rompre «l’entre soi» occidental, tandis que la puissance classique ne peut rien sur elles.»Il donne aussi une autre vision de la mondialisation :«Nous avons commis, et de façon récurrente, une faute capitale, à droite comme à gauche, celle de confondre mondialisation et accomplissement d’un modèle néo voire ultralibéral. La mondialisation, à l’origine, n’est pas un phénomène économique. Elle tient à une transformation du système de communication. Aujourd’hui, cette communication immédiate est mortelle pour les relations internationales telles que nous les connaissions auparavant. Jusqu’à récemment, les frontières et les territoires permettaient à des souverainetés de s’exercer. Aujourd’hui, on assiste à une ascension irréversible des mobilisations transnationales. Une des principales conséquences de cet approfondissement de la communication est qu’aujourd’hui, le pauvre voit le fort et le riche: voilà qui renouvelle profondément les imaginaires et appelle aussi de nouvelles formes de solidarité. […] Il faut adopter une politique étrangère réellement mondialisée, qui s’appuie sur le relais des différentes organisations régionales et qui comprenne en outre que les modèles martiaux classiques ne sont plus opérants. Et enfin, il faut construire une véritable politique de l’altérité : reconnaître l’autre ne veut pas dire être d’accord avec lui mais admettre la pluralité pour négocier ensuite les modes de coexistence internationale au lieu de les décréter.Les nouvelles formes de confrontations qui nous attendent fabriquent des guerres à étages, des guerres qui ont certes un terrain de conflit, mais qui ont aussi des capacités à s’étendre par rhizomes partout dans le monde. Ainsi, la guerre en Mésopotamie [Irak et Syrie] est aussi présente par les attentats à Paris, à Molenbeek ou en Seine-Saint-Denis. Or, notre première réaction au lendemain du 13 Novembre a été d’annoncer des bombardements sur la Syrie : c’est une diplomatie anachronique de champ de bataille. Idem au Mali, où François Hollande a déclaré vouloir «détruire» les terroristes. On ne détruit pas des lambeaux de sociétés. Il y a dans le monde quelque 500 000 enfants soldats. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des enfants de sociétés qui se délitent. Face auxquels le choix martial est absurde. Le traitement qui s’impose n’est plus militaire, mais social. Réfléchissons donc à un travail de containment et de police internationale plus que d’action militaire internationale.»Bref, il y a du travail et les bombes, la déchéance de nationalité, les interdictions de burkini, la restriction des libertés ne sont pas de nature à résoudre nos problèmes et nos défis.Mais pour cela il faut d’abord trouver les mots qui expliquent nos maux. -
Mercredi 31 août 2016
Mercredi 31 août 2016«Le Grand Orchestre des animaux»Bernie Krause,
exposition à la Fondation Cartier pour l’art contemporain.Bernie Krause (né le 8 décembre 1938) est un homme étonnant, à l’origine il est un musicien et il s’inquiète de l’appauvrissement des sons du monde.Pour comprendre ce qui se passe dans le monde des sons sur la terre, il faut définir des concepts.Sur terre il existe d’abord la «géophonie» ce sont tous les sons qui sont issus de la terre, de la géographie: descente d’avalanche, tonnerre, foudre, bruit du vent dans les branches de sassafras, de l’océan qui roule les galets sur la plage. Bref tous les sons qui ne nécessitent aucune action des êtres vivants sur terre.La «biophonie», elle, regroupe tous les sons produits par les espèces animales sauvages. C’est à dire les sons produits par les êtres vivants sur terre à l’exception de sapiens.Enfin «l’anthropophonie», ce sont tous les sons dérivés de l’activité humaine, sons qui ont explosé en nombre, en puissance depuis la révolution industrielle.C’est bien sûr la biophonie qui est en plein déclin. Concernant, l’anthropophonie, quand la terre en aura marre de la folie des sapiens, elle se secouera comme un chien qui secoue ses puces, avec dans le rôle des puces, nous autres sapiens et la géophonie continuera encore très longtemps.Mais la biophonie est très menacée dès à présent.C’est dans la conscience de cet appauvrissement des sons, que Bernie Krause est devenu enregistreur de paysages sonores détenteur d’un doctorat en bioacoustique à l’Union Institute & University de Cincinnati.Il est à l’origine du terme « biophonie » et a contribué à définir le concept d‘«écologie du paysage sonore ».Si vous êtes parisien ou passez par Paris avant le 8 janvier prochain vous pourrez visiter l’exposition <Le Grand Orchestre des Animaux>En effet, du 2 juillet 2016 au 8 janvier 2017, la Fondation Cartier pour l’art contemporain (261, boulevard Raspail dans le 14ème) présente, cette exposition inspirée par l’œuvre de Bernie Krause. L’exposition, qui réunit des artistes du monde entier, invite le public à s’immerger dans une méditation esthétique, à la fois sonore et visuelle, autour d’un monde animal de plus en plus menacé.Bernie Krause a, depuis plus de quarante ans, collecté près de 5 000 heures d’enregistrements sonores d’habitats naturels sauvages, terrestres et marins, peuplés par près de 15 000 espèces d’animaux. Ses recherches offrent une plongée dans l’univers sonore des animaux, dans le monde de la biophonie. Avant de se passionner pour l’enregistrement des animaux loin du monde humain, Bernie Krause a travaillé dans les années 1960 et 1970 comme musicien et acousticien à Los Angeles, collaborant notamment avec les Doors et Van Morrison. Il a également contribué à la composition de musiques de films comme Rosemary’s Baby de Roman Polanski et Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.L’approche de Bernie Krause est unique. Il contemple le monde naturel en poète, écoute les vocalisations des animaux en musicien et, à travers ses enregistrements, les étudie en scientifique. Bernie Krause est ainsi passé maître dans l’art de révéler la beauté, la diversité et la complexité des langues des animaux sauvages, de plus en plus réduits au silence par le vacarme des activités humaines. Il nous implore d’écouter ces voix du monde vivant non-humain avant qu’un silence définitif ne s’abatte sur elles.Dans une conférence TED de 1973 , Bernier Krause est venu défendre cette idée d’«écouter les paysages pour y déceler ce qui ne va pas ou ne va plus : <Quand un paysage se tait, c’est qu’il y a un problème>On apprend ainsi qu’après avoir été un spécialiste de la musique synthétique il s’est converti comme Saint Paul sur le chemin de Damas «Il fut un temps où je considérais qu’un paysage sonore naturel n’était qu’un artefact sans valeur. Eh bien, j’avais tort. Ce que j’ai appris des rencontres avec la nature et ses paysages sonores, c’est que si vous les écoutez attentivement, ils vous donnent des instruments extrêmement efficaces afin d’évaluer la santé d’un habitat dans tout le spectre de son expression.»Si, pour les uns, un paysage est un relevé des courbes physiques du terrain, de la végétation qu’on y rencontre, des espèces qu’on y croise, du monde végétal ou animal qu’on y voit, pour Bernie Krause, un paysage est avant tout un agrégat de sons captés puis visualisés selon leurs longueurs d’onde. Cette visualisation, c’est l’empreinte sonore du paysage et chaque paysage a son empreinte sonore. En anglais, c’est ce qu’on appelle, mot forgé sur «landscape», le «soundscape»,[…]L’articulation la géophonie, la biophonie et l’anthropophonie constitue le «soundscape», le paysage sonore. Et, depuis quelques décennies, Bernie Krause bat la campagne et le monde pour en recueillir toutes les traces possibles. Après tant d’années, son constat est cependant mitigé: «Lorsque j’ai commencé à recueillir ces paysages, il y a une quarantaine d’années, je pouvais enregistrer pendant dix heures et collecter ainsi une heure de matériel utilisable pour un album, la bande sonore d’un film ou une installation muséale. Maintenant, à cause du réchauffement climatique, de l’extraction des ressources et des bruits humains, parmi d’autres facteurs, j’ai besoin de 1000 heures d’enregistrement pour obtenir le même résultat».Ce qui hante Bernie Krause, en l’espèce, c’est le silence ou la raréfaction d’un paysage sonore. : » Il en veut pour preuve l’exemple de Lincoln Meadow, dans les montagnes de la Sierra Nevada. En 1988, explique-t-il à TEDGlobal, une compagnie forestière convainc les résidents locaux de Lincoln Meadow que le programme d’exploitation sélective de la forêt qu’elle propose n’aura aucun impact notable sur le paysage. Avant que les habitants donnent leur OK, Bernie Krause prend l’empreinte sonore du paysage. Douze mois et une exploitation sélective de la forêt plus tard, il nous montre deux photos du lieu: aucun changement notable. Opération réussie? On pourrait le croire. Et que dit l’empreinte sonore? Krause nous fait entendre acoustiquement quelques dizaines de seconde du paysage, avant, puis après. Un enregistrement qu’il étaie de deux spectrogrammes comparatifs. Le résultat est tonitruant: le silence des oiseaux s’est abattu sur Lincoln Meadow, à l’exception d’un ou deux spécimens. Visuellement, l’impact écologique de l’exploitation forestière est négligeable. «Nos oreilles nous racontent cependant une tout autre histoire.» »[…] Bernie Krause: «Tandis qu’une image vaut mille mots, une image sonore vaut mille images». -
Mardi 30 août 2016
«La tortue rouge»Michael Dudok de WitQuand avant les vacances, j’ai déjeuné avec mon ami Fabien il m’a donné deux injonctions :
- En me prêtant le livre de Varoufakis « Et les faibles subissent ce qu’ils doivent » de le lire
- et d’aller voir le film la tortue rouge.
J’ai presque fini le premier travail et j’ai réalisé le second.
« La tortue rouge » est un dessin animé où les personnages n’échangent aucun mot, seule la musique et les bruits de la nature remplissent le silence.
C’est en effet un film très beau où un nouveau Robinson Crusoé à la suite d’un naufrage se retrouve seul humain sur une île.
Il veut quitter l’île, mais une tortue rouge l’en empêche.
Le reste est poésie, solitude, vie, nature avec sa bienveillance mais aussi sa violence, amour, séparation et par-delà tout beauté.
Le site de Challenges essaie d’expliquer <Pourquoi il faut absolument aller voir « La Tortue rouge »>
«La Tortue rouge est le parfait exemple d’une simplicité trompeuse. L’image est minutieuse et les animateurs que cela soit des personnages ou des décors sont des orfèvres. Les plusieurs années de travail que nécessite un tel film accomplissent le miracle. Les paroles sont inutiles, le film est quasiment muet car il emprunte un langage universel qui embarque le spectateur à travers cette délicate odyssée.
C’est un formidable cadeau poétique que nous offrent les studios Prima Linea. Basés entre Angoulême et Paris, ils ont collaboré pour l’occasion avec le studio Ghibli à qui l’on doit les pépites de Hayao Miyazaki de Mon Voisin Totoro à Princesse Mononoké en passant par Le Voyage de Chihiro. Face aux dessins de Michael Dudok de Wit comme à son scénario tout en finesse, on peine à croire qu’il s’agit d’un premier film tant il est maîtrisé. La Tortue rouge explore les grandes étapes de la vie d’un être humain dans sa simplicité et sa douceur. C’est un film délicat, une pièce rare et précieuse qui a enchanté notre 69e Festival de Cannes. »
L’Express lui affirme <A ce jour, La Tortue rouge est le meilleur film de l’année.>
«Visuellement parfait et d’une irrésistible poésie. Son premier long-métrage, La Tortue rouge, étant tout bonnement génial, on peut considérer Michael Dudok de Wit, 62 ans, un Néerlandais londonien parlant couramment le français, comme un génie. »
Et Les Inrocks <un conte touchant de simplicité et de beauté sur la vie humaine>
«La Tortue rouge marque une étape importante dans l’histoire du cinéma d’animation : la rencontre entre l’animation européenne (et des producteurs comme Arte, Why Not et Wild Bunch, entre autres) et les célèbres studios japonais Ghibli (qui n’avaient jamais travaillé avec un autre studio, pas même japonais). […]
La Tortue rouge, film sans aucun dialogue, […] raconte une histoire extrêmement simple, presque biblique, toute métaphorique : celle de la vie. Un naufragé (aux traits neutres, pas du tout dans la veine des studios Ghibli, avec ses grands yeux bien connus) se retrouve sur une île déserte. Il sympathise avec des crabes. Il tente d’abord de s’échapper de l’île en construisant des radeaux de fortune.
Mais ils se font tous détruire par une créature étrange, qui va s’avérer être une grande tortue rouge. Elle le ramène sans cesse vers l’île. Cette créature, l’altérité, se fait femme pour lui, et ils vont avoir un enfant. […]
Tout est simplicité et beauté, humanité et universalité dans ce récit d’une vie humaine à travers ses multiples étapes, obstacles et découvertes : la solitude, l’étrangeté du monde et de l’autre, l’amour, la vieillesse et mort, en passant par l’enfant qui grandit et qui lui aussi découvre le monde.
On notera, dans un geste d’une belle épure et comme on aurait pu s’y attendre, que jamais le duo puis trio ne s’installe, ne construit des infrastructures (même une simple cabane) ou ne colonise ce territoire sauvage, comme auraient pu le faire des Robinson Crusoé modernes. Non, ici tout reste inviolé, l’homme n’est que de passage. »
Et TELERAMA n’est pas en reste : http://www.telerama.fr/cinema/films/la-tortue-rouge,502197.php
Peut-être aurait-il suffit de dire qu’Annie et moi avons beaucoup aimé ce film.

<736>
- En me prêtant le livre de Varoufakis « Et les faibles subissent ce qu’ils doivent » de le lire
-
Lundi 29 août 2016
Lundi 29 août 2016« Revenir du silence »Quelques pensées personnellesNous avions terminé, il y a deux mois sur l’«Histoire du silence» d’Alain Corbin.J’avais à peine posé la plume, pardon le clavier, que Michel Rocard est entré dans le silence de la mort le 2 juillet. La première personne qui avait attiré mon attention bienveillante sur cet homme d’Etat fut la future épouse de mon frère Gérard. C’était au début des années 1970, j’étais encore bien jeune. Mais j’y reviendrai la semaine prochaine.La peur du silence… Nous avons assisté au quart de finale de l’Euro entre l’Islande et la France chez mon neveu Grégory et son épouse. Pour celles et ceux qui ont fait comme nous, vous avez constaté qu’ il avait été décidé de rendre hommage aux victimes de différents actes de terrorisme en début de match par une minute ….d’applaudissements. On applaudit aujourd’hui, on n’ose plus faire silence.L’Euro de football n’a pas été un moment de silence, surtout pas dans les fans zones et autour.Pour une fois ce ne sont pas les équipes les plus riches qui ont gagné : Le Pays de Galles a éliminé la Belgique et surtout l’Islande a éliminé l’Angleterre.Et il y a eu une suite de fin de bêtes noires, (certains disent chat noir) c’est à dire la victoire sur une équipe contre laquelle on ne gagne jamais.Ainsi L’Allemagne a été enfin vaincue par la France, effaçant ainsi les défaites de 1982, 1986 et 2014.L’Allemagne n’a pas apprécié, mais a été bien contente, elle-même, de battre enfin l’Italie dans une phase finale, depuis la 1/2 finale épique de 1970 (4-3 pour l’Italie), les latins avaient toujours gagné.Italie qui elle-même a battu l’Espagne qui depuis 2008 gagnait systématiquement.A ce niveau de constance dans une règle, personne ne devait être étonnée que le Portugal vainque enfin la France, qui l’avait éliminé en 1/2 finale de l’Euro de 1984 et de l’Euro de 2000 et en 1/2 finale de la coupe du monde de 2006.(*)L’Euro s’est terminé le 11 juillet et la France entière a poussé un soupir de soulagement, il n’y a pas eu de criminel qui s’est attaqué à la foule dans les fans zones ou ailleurs lors des rassemblements de supporters.Et le 14 juillet, un homme violent, menant une vie très éloignée des préceptes moraux recommandés par les rigoristes islamiques a voulu mourir de manière médiatisée en assassinant le plus grand nombre possible d’êtres humains, qu’ils soient enfants ou âgés, femmes ou hommes, athées, chrétiens ou musulmans, peu importe. Tuer ! Massacrer ! Voilà le moyen de finir sa vie banale en apothéose médiatique. Et les fous de Dieu de DAESH ne sont plus très regardants sur ceux qui se réclament d’eux, pour revendiquer tout massacre qui tue des occidentaux ou d’autres, mais en terre croisée, comme ils disent.Et Nice fut la fin de l’Union nationale, <Europe1 a décrit justement le piteux spectacle de la classe politique après l’attentat de Nice>Et puis, il y eut d’autres actes meurtriers en Europe et plus encore dans d’autres régions du monde. <323 morts à Bagdad>, <A Kaboul plus de 80-morts contre des chiites>, Mais on parle surtout des actes qui touchent des lieux qui sont proches de nous.Les sociologues des médias ont ainsi inventé le concept de <loi du mort kilométrique> qui démontrent que les médias accordent de l’importance aux victimes d’un drame en fonction de la distance qui les sépare du téléspectateur, auditeur ou lecteur.Des personnes, probablement révoltées par ce fait, ont créé une page sur <Wikipedia> qui recense tous les attentats importants dans leur ordre chronologique. Est-ce une bonne idée ?Mais un autre évènement planétaire a chassé toutes ces informations : les jeux olympiques de Rio. Et le monde, et nous de nous passionner pour telle épreuve, tel dénouement, tel vainqueur glorieux ou tel perdant magnifique ou simplement malheureux.Les jeux de Rio, les jeux de la paix se passent à côté des favelas que la police s’efforce de pacifier selon leurs éléments de langage <Quand le Brésil pacifie ses favelas, cela n’a rien de pacifique>.Il y a bien longtemps, j’étais jeune et j’écoutais déjà beaucoup la radio, j’avais entendu une pièce de théâtre qui m’avait beaucoup impressionné : <La vie est un songe>, écrite en 1635 par Pedro Calderón de la Barca. Aujourd’hui si un grand auteur dramatique voulait décrire la métaphysique de ce temps il écrirait : « La vie est un jeu ». Dans tous les domaines on parle, en effet, aujourd’hui de « challenge », de «performance », de «compétition ».Mais c’est l’arrivée dans notre pays, en juillet, d’un nouveau jeu créé par des ingénieurs issus de Google qui ont créé leur propre société qui m’a conduit à cette réflexion.Les aveugles voient, les paralysés marchent … Enfin, pas tout à fait…Mais des jeunes geeks, enfermés jusque-là tant qu’ils pouvaient dans leur chambre et devant leurs écrans, sortent à l’air libre, marchent, essayent de se repérer dans le monde réel pour trouver des objets virtuels. Ils rencontrent même d’autres jeunes pour échanger sur ce jeu avec ce moyen extraordinairement archaïque qu’est la parole en face à face.De moins jeunes, j’en connais personnellement, sont tout aussi intéressés par ce jeu étonnant et surprenant pour les gens comme moi qui nous trouvons en dehors de ce monde-là.J’ai vu l’une d’entre vous, passer devant moi à 2 mètres, un dimanche au parc de la tête d’or, sans me voir car happée par la vision virtuelle du monde.Des maires deviennent fous : ils veulent éradiquer de leur territoire municipal ces objets virtuels : Effacer ce qui n’existe pas ! Quelle quête étrange !Oui la vie est un jeu et <Pokemon Go> constitue l’ouvrage sacré du moment.Et la France a inventé une nouvelle polémique sur le burkini. Aujourd’hui on s’indigne parce que des femmes se couvrent trop à la plage, hier on criait au scandale parce que les femmes se dévêtaient trop. Le bikini par exemple fut l’invention d’un ingénieur français Louis Réard qui parfaitement conscient du choc que produirait sa nouvelle invention apparue sur les plages françaises à partir de 1947, décida de la baptiser « bikini« , en référence à un atoll du Pacifique où les Américains réalisèrent des essais nucléaires en 1946.Vous me direz, cela n’a rien à voir : le bikini était un progrès dans le sens de la liberté, alors qu’avec le burkini nous sommes en pleine régression de l’émancipation des femmes. On peut voir les choses comme cela, mais c’est une réflexion peut être trop centrée sur la minorité occidentale.C’est difficile de revenir du silence.Annick Cojean, la journaliste du monde qui parle si bien des combats des femmes dans le monde, elle que j’avais cité dans le mot du jour du 9 septembre 2014 : « C’est juste pas de chance d’être une femme dans la plupart des pays du Monde » a, pendant l’été, interviewé plusieurs femmes et quelques hommes, dans une série appelée : <je ne serais pas arrivé là si>Par exemple, l’écrivaine Eve Ensler : « Ce monde est miné par les fondamentalistes de toutes sortes », ou l’actrice Nicole Kidman : « On n’avancera que si les femmes soutiennent aussi les femmes »Parmi ces femmes il y a Joan Baez qui dit <Le silence m’est essentiel>Je joins l’article de l’interview de cette merveilleuse chanteuse et remarquable femme et personne humaine à ce message.(*) Je ne parle plus beaucoup de football, tant je trouve ce sport dévoyé par les pratiques financières voire mafieuses. Toutefois par ce développement je voulais signifier aux passionnés du ballon rond que je reste attentif à l’histoire de ce sport et de ses compétitions.
-
Vendredi 1er Juillet 2016
Vendredi 1er Juillet 2016«Les mots du jours inachevés»Charlie Hebdo publie dans chaque numéro les couvertures auxquelles les lecteurs ont échappé, ce journal publie alors les différentes propositions qui avaient été créées par les dessinateurs pour être publiées en première page et qui n’ont pas été retenues.Pour ce dernier mot avant un silence de 2 mois, 37 jours ouverts, je m’inspire de cette idée pour vous donner une liste de mots que j’avais imaginés écrire mais que je n’ai pas eu le temps, l’énergie et peut être l’inspiration de développer.Je vous en offre 21 classés en 6 catégories, sans détailler, dans l’état de brouillon dans lequel ils sont.En réalité il y en avait 20, jusqu’à hier. Et j’ai lu un article, mais il en existe beaucoup d’autres qui parlent du remarquable discours du DG de Danone lors de la remise des diplômes des étudiants d’HEC, le 24 juin. C’est le numéro 15 et il ne peut pas ne pas vous toucher.Les 6 catégories sont les suivantes.A – Philosophie – SociétéB – PolitiqueC – EconomieD – SantéE – Science et TechniqueF – ConsommationTous n’intéresseront pas tout le monde, mais je suis persuadé que de ci, de là cette énumération vous donnera l’occasion de picorer, butiner et approfondir.Je voudrais encore ajouter un point essentiel. Aucun de ces mots, aucune de ces formules, aucune de ces analyses ne représentent « La Vérité ». Chacune de ces réflexions apporte un éclairage, une interpellation, des questions, des parties de réponses qui nous permettent de mieux aborder la complexité du monde.A – Philosophie – Société
1 – « Alors s’assit sur un monde en ruines une jeunesse soucieuse » Alfred de Musset2 – « Quelle terreur en nous ne veut pas finir ?» Frédéric BoyerL’identité, en danger… ? C’est le thème du tout petit livre de l’écrivain français Frédéric Boyer, auteur de « Quelle terreur en nous ne veut pas finir? », publié chez P.O.L.En à peine 100 pages, l’écrivain met la question de l’identité au cœur du débat sur l’immigration. Une identité qui se sentirait en danger, un patrimoine, un terroir, une mémoire en perte d’influence… A lire les gros titres de presse, à entendre les discours ambiants, c’est une civilisation entière qui est en danger face à l’Autre, et plus précisément. aux Autres.« Nous défendons le droit à l’hospitalité (…) Et nous affirmons vouloir protéger un roman national, une histoire à nous, par le refus d’entendre la vie des autres. »De quoi avons-nous peur, et surtout, pourquoi avons-nous peur ? C’est la question que pose Frédéric Boyer dans cet écrit.D’un point de vue moral, éthique presque, comment coexistent une telle appréhension, une telle épouvante, et de tels discours sur l’hospitalité, la solidarité, la fraternité… l’humanité.3 – «Les gens dans l’enveloppe» Isabelle MonninAu départ, c’est une idée gonflée et excitante. A l’arrivée, Les Gens dans l’enveloppe est un objet inédit, à la fois roman, enquête et disque : en 2012, la journaliste romancière Isabelle Monnin achète sur le Net un lot de vieilles photos d’une famille qu’elle ne connaît pas. Fascinée par ces portraits d’anonymes sortis d’une enveloppe, elle décide de leur inventer une vie. Son ami Alex Beaupain, séduit par l’aventure, suggère d’accompagner le récit de chansons. L’histoire, déjà peu banale, pouvait s’arrêter là… Mais c’est à ce moment qu’elle va prendre tout son sel : une fois son roman bouclé, Isabelle Monnin se lance sur la trace de ces inconnus familiers, les retrouvant dans le Doubs, et confrontant son imaginaire à leurs destins réels.4 – «Les violences sournoises dans la famille» Isabelle LevertIsabelle Levert est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Après Les Violences sournoises dans le couple (Robert Laffont, 2011), Les Violence sournoises dans la famille est son deuxième livre.Alors qu’ils auraient dû être protégés, choyés, ils se sont sentis rejetés, humiliés, méprisés… Tous les auteurs et presque toutes les victimes de violence domestique ont subi, dans leur enfance, une maltraitance.Quand un mari dit à son épouse : « Quand je te vois, je vois juste une nana qui veut en foutre le moins possible, ça va vraiment pas le faire, nous deux » ; « Cette sculpture, c’est comme toi, ça sert à rien » ; quand un parent dit à son enfant : « Je ne t’ai pas sonné, tu parleras quand je te le dirai », « Ne fais pas ça, tu sais pas faire, tu vas tout casser », « Dégage, tu es la pire erreur de ma vie ! » ; quand une belle-mère dit à sa belle-fille : « Je peux être ta meilleure amie comme ta pire ennemie »… Quelles sont les paroles qu’ont entendues ces adultes dans leur enfance ?Après les violences sournoises dans le couple, l’axe horizontal de sa recherche, Isabelle Levert reprend aujourd’hui la plume pour s’interroger sur les violences sournoises dans la famille, son pendant vertical. Elle met l’accent sur le vécu infantile des auteurs et des victimes, et se penche sur leurs enfants qui, frappés par la violence, sont en risque de la reproduire à l’âge adulte. Car il faut en comprendre les rouages et les ancrages, en parler et entreprendre un travail de psychothérapie, pour éviter que cette violence se transmette de génération en génération.5 – «Les musées envahis par les aveugles photographes» Eric Dupin«Ils ont des yeux, mais ne voient pas», (Évangile selon Saint-Matthieu mais aussi, soyons œcuméniques, sourate 7 verset 179 du Coran). Leur index est incroyablement plus mobile et plus actif que leurs pupilles. Ce sont les touristes, fort peu regardants, qui préfèrent capturer une œuvre d’art à l’aide de leur smartphone plutôt que perdre leur temps à la contempler.Ce spectacle fascinant s’observe dans la plupart des grands musées de la planète. Mais j’ai vu, cet été aux États-Unis, jusqu’à quelles extrémités ce phénomène pouvait aller. La visite du MET ou du MoMA de New York, pour ne citer qu’eux, s’apparente dès lors à une rude épreuve.Appropriation technologique des œuvresCe n’est pas d’hier qu’un flot de touristes exténués par d’infernales cadences voyageuses tend à confondre salles de musées et halls de gare. Au bout d’un certain temps, les pauvres ne jettent plus que distraitement un coup d’œil aux œuvres majeures signalées par un pictogramme d’écouteur.La magie technologique n’en a pas moins porté à un stade inégalé la possibilité de s’approprier un musée en se dispensant de regarder vraiment les œuvres exposées. On peut tout d’abord les mitrailler consciencieusement (les plus scrupuleux photographient aussitôt après leur cartel) avec son Réflex numérique équipé d’un gros zoom (alors qu’une reproduction de qualité suppose l’emploi d’une focale fixe moyenne à grande ouverture –mais passons). Pas le temps d’observer entre deux déclenchements. On verra tout ça tranquillement à la maison…La majorité s’en tient néanmoins à l’usage d’un smartphone. Dans le meilleur des cas, pour photographier à la va-vite, généralement de biais et de travers, l’œuvre célèbre. Dans le pire, et c’est hélas de plus en plus fréquent, pour s’immortaliser soi-même devant l’une de ces manifestations du génie humain. Ou se faire prendre en photo, avec cet arrière-plan avantageux, par un ami ou un membre de sa famille.Ces diverses pratiques génèrent inévitablement leur lot de nuisances. Bipèdes au sourire forcé occultant une partie du tableau, bras inopinément tendus devant vos yeux, mouvements incessants destinés à mieux se placer avant de disparaître aussitôt le cliché pris: tout cela ne favorise guère l’observation sereine et attentive des œuvres d’art. Le visiteur qui reste plusieurs minutes immobile devant un tableau, pour l’analyser ou s’immerger dans son univers, est paradoxalement considéré comme un étrange gêneur par la majorité des touristes.B – Politique6 – « Hollande est dans un cul-de-sac politique » Thibaut Madelin / Correspondant à Berlin | Le 06/04Grand reporter au sein de l’influent magazine allemand « Der Spiegel », Ullrich Fichtner connaît bien la France, où il vit depuis 2003. Il a fait sensation la semaine dernière en appelant publiquement à la démission de François Hollande.Vous venez d’écrire que, politiquement, François Hollande était un homme mort qui devait démissionner. Pourquoi ?Je pense qu’il est dans un cul-de-sac politique. S’il veut le bien de son pays, il serait temps de tirer les conséquences de ses erreurs et de démissionner. Je sais que ce n’est pas dans la culture française, mais je trouve cela déplorable. Gerhard Schröder était lui aussi dans une situation difficile après les réformes de l’Agenda 2010 et il a mis son mandat en jeu. Pourquoi serait-ce impossible en France ?7 – «Après les pompiers, l’Europe attend les architectes.» Jacques Delors« Ces dernières années, les dirigeants nationaux et européens ont connu une sorte de gestion de crise au quotidien, prenant des mesures dans l’optique de survivre. Si les efforts en vue d’empêcher l’effondrement de la zone euro sont bienvenus, notre Union doit impérativement poursuivre des objectifs à long terme. Des objectifs qui portent sur le progrès social et la prospérité pour tous. En effet, comme je l’ai déjà mentionné à plusieurs reprises, après les pompiers, l’Europe attend les architectes. Ces derniers sont essentiels pour trouver ce sens de l’intérêt commun qui peut mobiliser à la fois les États membres et leurs citoyens. Nous devrions tirer un enseignement de ces années de crise financière, économique et politique ? si l’élaboration des politiques européennes compromet la cohésion et sacrifie des normes sociales, le projet européen n’a aucune chance de recueillir le soutien des citoyens européens. Ce rapport identifie clairement les trois objectifs qui peuvent contribuer à l’intégration européenne et rétablir la confiance et la reprise économique. Premièrement, la convergence socio-économique au sein de l’UEM et de l’UE, qui doit être réalisée, par exemple, grâce à des mécanismes de stabilisation automatiques ; deuxièmement, un véritable marché du travail européen, avec une mobilité accrue au sein de l’UE et des droits sociaux accessibles dans toute l’Europe ; troisièmement, un élan vigoureux en faveur des investissements sociaux pour fixer la base de la croissance inclusive et de la compétitivité.Créer un mécanisme de stabilisation sociale. »8 – « Le but suprême pour les libéraux que nous incarnons est que le Droit empêche les gros de faire du mal aux petits, les petits de massacrer les gros, mais surtout que le Droit empêche l’État d’enquiquiner tout le monde. » – Charles GaveLe comble de cet étatisme : la loi Macron et son vote bloqué grâce au fameux article 49.3. L’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin avait estimé que l’utilisation de ce 49.3 était comparable à celle d’un « bulldozer pour faire des pâtés de sable », tellement cette loi de 300 articles et de plusieurs milliers de décrets d’application n’était au fond qu’une « loi toile d’araignée ». Quand on l’examine de près, en effet, on voit bien que son but n’est pas de réformer réellement mais de régenter et suradministrer encore plus des professions déjà écrasées de charges, de contraintes, de réglementations et de contrôles.Emmanuel Macron, libéral ? C’est risible ! Au moment où il faudrait que l’État envahisseur recule, que les syndicats politisés reculent, que le Code du travail recule et que le communisme ambiant recule, le ministre ajoute une couche d’État supplémentaire – voyez Renault –, une couche de syndicalisme supplémentaire – pour ouvrir les magasins en soirée, par exemple, il faudra que les syndicats soient d’accord – et plusieurs couches de nouvelles contraintes qui vont finir par étouffer un pays déjà en respiration assistée.Charles Gave, qui s’était fait connaître du grand public il y a une douzaine d’années avec son best-seller Des lions menés par des ânes (éd. Robert Laffont), estime que, si l’économie française va si mal et depuis si longtemps, c’est à cause de « cette évidence accablante : plus la part de l’État dans l’économie est forte, plus la croissance est faible. Plus la croissance est faible, plus le taux de chômage monte. Plus le taux de chômage monte, plus les dépenses de l’État augmentent… Un cercle vicieux dans toute son horreur. » Et vous, quelle est votre analyse, monsieur Macron ?Le vrai libéralisme, en fait, n’est pas spécialement une théorie économique et n’a pas de couleur. Il n’est ni rouge ni bleu, ni de gauche ni de droite. C’est plutôt une philosophie. Les vrais libéraux sont des humanistes tolérants, opposés aux extrêmes et aux extrémistes. Ils sont avant tout des partisans de la liberté individuelle face à l’État quand celui-ci est envahissant. Ils veulent réduire les droits de l’État au profit d’un état de Droit. Ils veillent scrupuleusement à ce que le capitalisme, pour fonctionner à la satisfaction générale, soit régulé par des intervenants, à condition que ces derniers soient compétents.En exergue de la première page du site de l’Institut des libertés qu’il a créé et qu’il préside, Charles Gave a gravé ces mots simples et clairs : « Le but suprême pour les libéraux que nous incarnons est que le Droit empêche les gros de faire du mal aux petits, les petits de massacrer les gros, mais surtout que le Droit empêche l’État d’enquiquiner tout le monde. » Qu’en dites-vous, monsieur Macron ?9 – «La France peut évoluer vers un régime autoritaire » Yves SintomerYves Sintomer, professeur de sciences politiques à Paris 8, spécialiste de la démocratie participative et délibérative, a surpris son auditoire mardi 9 février, lors d’une conférence sur l’avenir de la démocratie à l’UCL (University College of London), en affirmant qu’il n’était pas à exclure de voir la France évoluer rapidement vers un régime autoritaire. Il déroule ici son raisonnement.Vous avez récemment déclaré, lors d’une conférence à Londres que, parmi les pays occidentaux, la France était celle qui risquait le plus de verser dans un régime autoritaire. Comment en arrivez-vous à une telle conclusion ?– Notre conférence portait sur l’avenir des démocraties. Nos vieilles démocraties, en Europe et en Amérique du Nord, traversent une crise de légitimité profonde, marquée par une défiance de plus en plus importante vis-à-vis des gouvernements et des élites. L’idée que nos systèmes, inventés au XVIIIe siècle, pourraient résister sans changement à cette crise n’est pas crédible, compte tenu de l’ampleur des mutations auxquelles la politique doit aujourd’hui faire face.Il est également illusoire de miser sur un retour en arrière, que ce soit vers un système fondé sur la compétition entre de grands partis de masse intégrant les couches populaires et dotés d’idéologies ou vers un système communiste, idée que caresse des philosophes en vogue comme Giorgio Agamben, Alain Badiou ou Slavoj Zizek. Ni statu quo, ni retour en arrière, nos démocraties représentatives vont donc muter.Muter dans quel sens ? Quels sont les scénarios possibles ?– Trois scénarios me semblent réalistes. Le premier est celui qu’on appelle « la post-démocratie », une notion développée par le sociologue et politologue britannique Colin Crouch. C’est un système dans lequel, en apparence, rien ne change : des élections libres continuent d’être organisées, la justice est indépendante, les droits individuels sont respectés. La façade est la même, mais la souveraineté réelle est ailleurs. Les décisions sont prises par les directions de grandes firmes, les acteurs des marchés, les agences de notation, ou par des organes technocratiques… En Europe, nous sommes déjà engagés dans cette direction.Second scénario, plus heureux, celui d’une « démocratisation de la démocratie » : on vivrait alors un renforcement du politique face à l’économique, avec une participation citoyenne plus active. La démocratie se renforcerait sous des formes participatives et délibératives variées.Troisième scénario, celui de l’autoritarisme. Il ne s’agit pas de dictature, mais de systèmes où, à la différence de la post-démocratie, la façade est remaniée : les élections existent mais la compétition électorale est restreinte ; les libertés (d’expression, d’association, d’aller et venir, de la presse…) sont amoindries par des lois liberticides ; la justice est moins indépendante… C’est la pente qu’ont pris les Russes, les Hongrois, les Polonais, les Turcs, et qu’on retrouve ailleurs, en Equateur ou au Venezuela par exemple. En Asie du Sud-Est, plusieurs régimes non-démocratiques sont allés ou vont, par une libéralisation très contrôlée, vers un tel modèle : je pense à Singapour ou à la Chine, deux pays où les droits y sont restreints.10 – «Notre conception du monde nous interdit le monde de demain » Yannick RoudautConférence de Yannick Roudaut, le 21/01/2013 à Nantes : https://www.youtube.com/watch?v=T6LODGLPR5UNous avons la chance exceptionnelle de vivre une période exceptionnelle de l’histoire de l’humanité : nous allons pouvoir changer le monde. Mais avant de changer le monde, ça c’est le côté enthousiasmant, je vais vous demander un petit effort. Il va nous falloir faire un travail de deuil, il faut tourner la page. Et tourner la page, c’est tourner la page du monde dans lequel nous vivons aujourd’hui et ça pour le faire je vais m’appuyer sur les travaux d’un américain qui s’appelle Jared Diamond, qui a publié « collapse » et vous allez voir que les cinq facteurs d’effondrement d’une civilisation sont réunis aujourd’hui. Ca c’est la mauvaise nouvelle. Après nous passerons aux bonnes nouvelles.Jared Diamond a identifié cinq facteurs que l’on retrouve dans l’effondrement des mayas, des vikings, des grandes civilisations de Mésopotamie. Et à chaque fois ces cinq facteurs étaient réunis.La mauvaise nouvelle est qu’en ce début de 21ième siècle, ces cinq facteurs sont réunis mais cette fois-ci, ce n’est pas une civilisation qui est menacée, c’est le village monde, c’est l’humanité, c’est nous tous. Voilà pourquoi c’est important d’en prendre conscience.Le premier facteur d’effondrement est le facteur environnemental : nous avons infligé depuis 2 siècles, surtout depuis une cinquantaine d’années, des dommages environnementaux parfois irréversibles.Deuxième facteur : le dérèglement climatique. Toutes les grandes civilisations ont fait face à ces dérèglements. Cela affaiblit les écosystèmes et qui dit affaiblissement des écosystèmes dit pénurie de ressources, déstabilisation d’une société, conséquences économiques, géopolitiques, sociales, vous connaissez la suite.Troisième facteur : la résurgence des conflits militaires qui découle des deux premiers facteurs. Quand les écosystèmes sont déstabilisés, quand la société manque de ressources, on renoue avec les conflits, on se fait la guerre et je vous rappelle qu’à l’heure actuelle la France est en guerre au Mali.Quatrième facteur : le délitement des alliances diplomatiques et commerciales. Plus cela va mal, plus les alliances d’hier volent en éclat. Et aujourd’hui, nous sommes tous conscients que l’avenir de l’Europe est vraiment mis entre parenthèses. Nous ne savons pas ce que cela va devenir.Et puis le cinquième facteur n’est pas le moins inquiétant : c’est l’aveuglement de nos élites. Dans tout effondrement de civilisation, les élites sont incapables d’expertiser la chute de leur monde, ils sont incapables de changer leurs prismes d’analyse. Résultat : elles mènent une politique de caste qui accentue, qui précipite l’effondrement d’un monde.C – Economie11 – «Les États-providence sont fondamentalement incompatibles avec la libre circulation des personnes d’un pays à l’autre» Hans-Werner SinnHans-Werner Sinn, professeur d’économie et de finances publiques à l’université de Munich, également président de l’institut de recherche économique Ifo, siège au Conseil consultatif du ministère allemand de l’Économie.L’enjeu est essentiel. Les États-providence se définissent par le principe de redistribution : ceux dont les revenus sont au-dessus de la moyenne paient plus d’impôts et cotisent plus qu’ils ne reçoivent en retour des services publics, tandis que ceux dont la rémunération est inférieure à la moyenne paient moins qu’ils ne reçoivent. Cette redistribution, qui draine les ressources publiques nettes vers les ménages à faibles revenus, apporte une correction sensible à l’économie de marché, sorte d’assurance contre les vicissitudes de la vie et la dure loi du prix de la rareté, qui caractérise le marché et n’a que peu à voir avec la justice sociale.Les États-providence sont fondamentalement incompatibles avec la libre circulation des personnes d’un pays à l’autre si les nouveaux arrivants ont immédiatement et pleinement accès aux prestations sociales de leur pays d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce pays fonctionne en effet comme une trappe à allocataires, où l’on s’installe en raison des prestations ; il attire les migrants en plus grand nombre qu’il ne le serait économiquement souhaitable puisque ces derniers y reçoivent, outre leur salaire, une subvention sous forme de transferts publics. On ne peut espérer d’autorégulation efficace des migrations que dans la mesure où les migrants ne perçoivent que leur salaire.12 – «L’économie sociale et solidaire pèse de plus en plus lourd» Marie-Cécile Renault journaliste du FigaroMal connu du grand public, le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les mutuelles, les associations, les coopératives et les sociétés commerciales à but social. Soit 200.000 entreprises au total, représentant 10% du PIB et 12% des emplois privés. Les entreprises de l’ESS emploient ainsi plus de 2,36 millions de salariés, soit un emploi privé sur 8 en France, selon un rapport de Bercy. L’entrepreneuriat social est une manière d’entreprendre qui place l’efficacité économique au service de l’intérêt général. «Quel que soit le statut juridique des entreprises, leurs dirigeants font du profit un moyen, non une fin en soi», explique le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves). Tout un esprit.13 – «L’Homme inutile» Pierre-Noël GiraudQu’y a-t-il de commun entre un chômeur de longue durée espagnol, un jeune peu qualifié à la recherche d’un premier emploi en France, un travailleur pauvre britannique, un précaire allemand, un habitant des favelas de Rio ou des bidonvilles de Bombay, et un paysan sans terre deMadagascar ? Ils font tous partie des superflus, des inexploitables, des exclus, des hommes et desfemmes inutiles aux autres et à eux-mêmes, car condamnés à survivre de l’assistance (publique ou familiale) et privés de moyens d’améliorer leur sort.Dix-neuf ans après la publication de L’Inégalité du monde (Folio, 1996), un livre fondateur dans lequel il prédisait que la globalisation accélérerait le rattrapage des « pays à bas salaires et à capacités technologiques », réduirait les inégalités entre les pays, mais accroîtrait les inégalités internes de revenus et laminerait les classes moyennes des pays riches, Pierre-Noël Giraud, professeur d’économie à Mines-ParisTech et à Dauphine, revient dans L’Homme inutile (Odile Jacob, 402 pages, 23,90 euros) sur son sujet de prédilection. La figure des « damnés de la terre » a changé, explique-t-il. Les colonisés et les surexploités des XIXe et XXe siècles ont cédé la place, au XXIe, aux hommes inutiles.Forme particulièrement grave et résistante d’inégalité parce qu’elle enferme dans des trappes d’où il est très difficile de sortir », insiste l’économiste. Il montre, de manière saisissante, l’errance des conflits économiques sur le partage des revenus entre travail et capital du fait de la globalisation des firmes, qui mettent en compétition des « emplois nomades » dans le monde entier, par exemple ceux de trader, d’ingénieur aéronautique ou encore d’employé de centre d’appels.Cette errance est dangereuse, « car elle pave la voie à d’autres conflits, identitaires, religieux, ethniques, qui renforcent les verrous des trappes d’inutilité et qui, organisés désormais par des partis politiques, menacent la paix civile », analyse Pierre-Noël Giraud.14 – « Le risqué et l’immoral font bon ménage avec la finance » Pierre-Yves Cossé ancien commissaire au PlanLes banques doivent elles prêter en devises à des particuliers? Faire croire à des emprunteurs des pays de l’Est qu’ils peuvent emprunter moins cher en devises, c’est immoral, et finalement risqué, comme le montrent les déboires actuels d’une filiale russe de la Société Générale. Par Pierre-Yves Cossé,15 – «Après toutes ces décennies de croissance, l’enjeu de l’économie, l’enjeu de la globalisation, c’est la justice sociale. Sans justice sociale, il n’y aura plus d’économie» Emmanuel Faber, DG de Danone
Le directeur général de Danone, Emmanuel Faber, s’est livré à un exercice de style émouvant le 24 juin dernier lors de la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de la grande école de commerce HEC. «Si vous attendez un discours de référence intellectuelle, vous allez être déçus», a lancé en guise de préambule ce patron du CAC 40, lui-même diplômé de HEC-Paris. Et c’est peu dire que ce fervent catholique a tenu sa promesse. Loin des thèses néolibérales régulièrement soutenues devant les futurs dirigeants des grands groupes français, Emmanuel Faber a, au contraire, prôné «la justice sociale» en se référant à son histoire personnelle, et plus particulièrement à son frère.«Qu’est-ce qui m’a le plus marqué pendant mes trois ans ici [à HEC, NDLR]? C’est ce coup de fil que je n’aurais jamais voulu recevoir, à 21 heures (…) et où j’ai appris que mon frère venait d’être interné pour la première fois en hôpital psychiatrique, diagnostiqué avec une schizophrénie lourde. Ma vie a basculé», a confié devant une centaine d’étudiants le patron de Danone d’une voix emplie d’émotion. Si cet éminent chef d’entreprise parle de ce frère décédé il y a cinq ans, c’est qu’il lui a fait découvrir «la beauté de l’altérité», «l’amitié des SDF», et lui a prouvé «que l’on peut vivre avec très peu de choses et être heureux». Cette expérience a façonné sa vision du monde et de l’entreprise.Emmanuel Faber indique ensuite aux étudiants présents qu’il est allé «séjourner dans les bidonvilles de Delhi, Bombay, Nairobi, Jakarta. Je suis également allé dans le bidonville d’Aubervilliers, pas très loin de Paris, et dans la ‘Jungle’ de Calais». Une expérience qui lui a inspiré une vision de l’économie qu’il décrit ainsi: «Après toutes ces décennies de croissance, l’enjeu de l’économie, l’enjeu de la globalisation, c’est la justice sociale. Sans justice sociale, il n’y aura plus d’économie». «Les riches, nous, les privilégiés, nous pourrons monter des murs de plus en plus haut (…) mais rien n’arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec nous. Il n’y aura pas non plus de justice climatique sans justice sociale», poursuit-il.Le patron de Danone en profite pour glisser, en anglais cette fois, une réflexion sur l’économie de marché en faisant référence à Adam Smith, un économiste du XVIIIe siècle. «Ce que je sais, après 25 ans d’expérience, c’est qu’on nous dit qu’il existe une main invisible, mais elle n’existe pas. Donc il n’y a que vos mains, mes mains, nos mains, pour changer les choses. Pour les améliorer. Et nous avons beaucoup de choses à améliorer».«Le pouvoir n’a de sens que si vous vous en servez pour rendre service», poursuit Emmanuel Faber devant un auditoire silencieux. «Avec les intentions qui vous feront devenir celui que vous êtes vraiment, qui feront sortir le meilleur de vous et que vous ne connaissez pas encore». Son discours est ponctué par une salve d’applaudissements, tous les élèves se levant pour lui rendre hommage.D – Santé16 – « Apple approche les mutuelles pour divulguer le comportement des assurés » Guillaume Champeau – 22 août 2014 – Sciences17 – « Le charme discret de l’intestin» Giulia EndersL’Allemande Giulia Enders est un petit miracle de l’édition. A 25 ans, cette étudiante en médecine a déjà vendu plusieurs millions d’exemplaires dans le monde de Darm mit Charme (le Charme discret de l’intestin), dont plus de 400 000 en France. Sorti dans l’Hexagone au printemps, l’ouvrage se classe depuis, semaine après semaine, sur le podium des meilleures ventes. Et pourtant, ce n’est pas une histoire à l’eau de rose légèrement érotique sur un intestin qui rencontrerait l’amour malgré les adversités, ou un récit scatologique rabelaisien, même s’il y a, de temps en temps, les mots «caca» et «prout». Non, Enders a écrit un ouvrage de vulgarisation scientifique, tout à fait sérieux, sur l’importance de l’intestin pour notre corps et notre mental avec l’idée que digestion bien ordonnée commence par soi-même.18 – «Toutes les affaires de santé publique ont été ouvertes contre l’avis du Parquet» Marie-Odile Bertella-GeffroyDans le livre « Le racket des laboratoires pharmaceutiques et comment en sortir » dont elle est co-auteur, Marie-Odile Bertella-Geffroy veut dénoncer le poids des géants de la santé sur la justice, l’administration et les associations. Entretien avec celle qui fut juge d’instruction, en charge des dossiers du sang contaminé et de l’amiante.Pour contrôler le lobbying des « big pharmas » et en finir tout à la fois avec les conflits d’intérêts, les scandales sanitaires et l’opacité dans la fixation des prix du médicament, Marie-Odile Bertella-Geffroy, coauteur du tout récent « Le racket des laboratoires pharmaceutiques et comment en sortir »(*), réclame, entre autres solutions, la mise en place immédiate d’une haute autorité de l’expertise.E – Science – Technique19 – «Hannah Herbst,» Une inventeuse de 14 ansHannah Herbst, une collégienne américaine de 14 ans, a mis au point une turbine capable de collecter l’énergie des courants maritimes. Son invention lui a permis de remporter 25 000 dollars.À cause du changement climatique, le courant océanique El Nino fait des ravages. Il pourrait notamment entraîner la plus grande extinction des récifs coralliens de l’histoire. Cependant, ce type de courant océanique peut également être la source de nouvelles alternatives énergétiques. C’est ce que Hannah Herbst, une collégienne américaine de 14 ans, a démontré lors du concours «Discovery Education et 3M Young Scientist».Cette jeune Floridienne originaire de Boca Raton a mis au point un prototype de turbine qui permet de générer de l’électricité grâce aux courants océaniques. Le dispositif, appelé «Beacon», lui a valu le prix du meilleur scientifique junior américain avec les 25 000 dollars qui étaient mis en jeu. L’idée du projet, elle se souvient l’avoir eue à la réception d’une lettre de sa correspondante en Ethiopie. «Elle m’indiquait qu’elle n’avait plus accès à l’électricité, plus d’eau fraiche à boire, en plus d’autres choses nécessaires. Je savais que sa situation n’était pas unique et j’ai pensé que je pouvais utiliser mes connaissances pour agir et tenter d’atténuer la crise de l’énergie dans le monde», a-t-elle expliqué sur son blog.F – La consommation20 – « Le saumonstre ou le frankenfish »21 – «Les traîtres qui vendent sur Amazon » Article de l’ExpansionVous ne le savez peut-être pas, mais Amazon n’est pas le seul à vendre sur Amazon. Mieux, des librairies, et même des particuliers, un peu partout en France, vendent des livres via le site américain. En toute légalité. En bon français, on appelle ça le « marketplace » (le marché grand public) d’Amazon – il représenterait 40% des ventes totales du site, mais sans doute moins pour ce qui concerne les seuls livres (la société de Jeff Bezos n’a pas pour habitude de communiquer ses chiffres).Méfiance, néanmoins, car, sur Amazon, certains noms omniprésents de librairies, qui fleurent bon la France – Les Livres du château, La Librairie du coin… – cachent en réalité de très puissantes officines, dont le siège social est en Irlande ou au Texas, et qui n’ont rien de librairies classiques. Une magistrate de la Cour des comptes, Laurence Engel, nommée depuis présidente de la Bibliothèque nationale de France, vient d’ailleurs d’achever une mission tendant à moraliser un peu cette jungle, via une charte que devait signer Amazon.Evidemment, pour un libraire, vendre sur le marketplace d’Amazon a un coût: un abonnement de 50 euros par mois et 15% de commission sur chaque vente. Sans compter que vous passez pour un « traître » auprès de tous vos confrères. « C’est suicidaire! Seule une minorité de libraires français vendent sur Amazon, assure Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française. La profession dispose de toutes sortes de plates-formes Internet qui permettent d’éviter Amazon. » Réponse de Virginie Rigot: « Je suis aussi présente sur le site Libraires en Rhône-Alpes, mais j’y vends vingt fois moins que sur Amazon! »Bonnes vacances, au 29 août, si vous le souhaitez ! -
Jeudi 30 Juin 2016
« Histoire du silence »Alain CorbinAlain Corbin, né en janvier 1936 est le grand historien français « de toutes les sensibilités qui a ouvert tellement de voies neuves à [l’Histoire] et à ses curiosités » comme le décrit Jean-Noël Jeanneney lors de l’entretien où il l’avait convié pour dialoguer sur son nouvel ouvrage <Histoire du silence>.
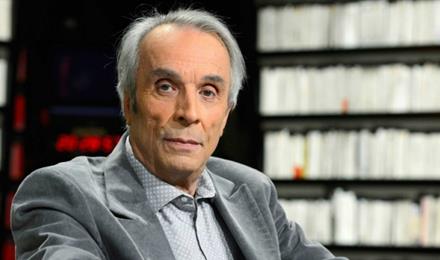 Anne Sinclair qui l’a reçu pour le même ouvrage, décrit cet homme de 80 ans : « il a écrit sur le corps, le bruit, l’odorat, le toucher, la sexualité, la pluie ou l’arbre. »
Anne Sinclair qui l’a reçu pour le même ouvrage, décrit cet homme de 80 ans : « il a écrit sur le corps, le bruit, l’odorat, le toucher, la sexualité, la pluie ou l’arbre. »
Son ouvrage le plus célèbre jusqu’à présent était consacré aux odeurs à travers l’Histoire, plus précisément l’odorat et l’imaginaire social <Le Miasme et la Jonquille, 1982 >.
Wikipedia relate que dans ce livre [Alain Corbin] « explique que le « seuil de tolérance » aux odeurs va évoluer, notamment sous l’effet de l’émergence d’une nouvelle perception des odeurs très clivée socialement. C’est l’époque où naissent les premières théories hygiénistes qui visent à « purifier » les villes en permettant à l’eau et à l’air de mieux circuler et d’emporter avec eux détritus et miasmes. ». Ce livre savant d’Histoire a inspiré le livre <le Parfum> de Patrick Süskind, chef d’œuvre de la littérature.
Alain Corbin a donc publié en avril 2016, aux éditions Albin Michel son dernier ouvrage : <Histoire du Silence>
L’éditeur présente cet ouvrage :
« Le silence n’est pas la simple absence de bruit. Il réside en nous, dans cette citadelle intérieure que de grands écrivains, penseurs, savants, femmes et hommes de foi, ont cultivée durant des siècles. À l’heure où le bruit envahit tous les espaces, Alain Corbin revient sur l’histoire de cet âge où la parole était rare et précieuse.
Condition du recueillement, de la rêverie, de l’oraison, le silence est le lieu intime d’où la parole émerge. Les moines ont imaginé mille techniques pour l’exalter, jusqu’aux chartreux qui vivent sans parler. Philosophes et romanciers ont dit combien la nature et le monde ne sont pas distraction vaine. Une rupture s’est produite, pourtant, aux confins des années 1950, et le silence a perdu sa valeur éducative. L’hypermédiatisation du XXIe siècle nous contraint à être partie du tout plutôt que de se tenir à l’écoute de soi, modifiant la structure même de l’individu.
Redécouvrir l’école du silence, tel est l’enjeu de ce livre dont chaque citation est une invitation à la méditation, au retour sur soi. »
Cet ouvrage a fait l’objet de multiples articles dans de nombreux journaux et je vous donnerai certains liens à la fin de ce message.
Le silence est en effet de plus en plus difficile à trouver dans le monde d’aujourd’hui et il est même en train de régresser.
Lors de manifestation sportive, on remplace de plus en plus en plus la minute de silence par une minute d’applaudissements.
Mais plus généralement les bruits de la ville et aussi les machines agricoles à la campagne, ainsi que la musique, la parole omniprésente grâce à tous ces appareils, radio, télévision, baladeur etc. font que l’homme moderne a quasi exclu le silence de sa vie.
Quand on interroge Alain Corbin pourquoi ce sujet, il explique :
« J’y songeais depuis une vingtaine d’années. Je l’avais proposé comme sujet de thèse à des étudiants, mais ils n’en voulaient pas. Le silence aujourd’hui semble faire peur », s’amuse ce jeune octogénaire. Du calme des chambres à coucher à l’immensité impassible du désert […] Corbin montre que le silence a obsédé les religions, les philosophes, les aventuriers et les traités de savoir-vivre.
Par contraste, l’historien laisse aussi entendre toute l’intensité du brouhaha contemporain…
« Je n’ai fait qu’esquisser le sujet […] J’ai voulu montrer l’importance qu’avait le silence, et les richesses qu’on a peut-être perdues. J’aimerais que le lecteur s’interroge et se dise : tiens, ces gens n’étaient pas comme nous. Aujourd’hui, il n’y a plus guère que les randonneurs, les moines, des amoureux contemplatifs, des écrivains et des adeptes de la méditation à savoir écouter le silence… »
Corbin cite aussi de nombreux grands auteurs qui parlent du silence :
Baudelaire clame la délectation que lui procure le fait d’être, le soir, enfin réfugié dans sa chambre. […]
« Enfin ! Seul ! On n’entend plus que le roulement de quelques fiacres attardés et éreintés. Pendant quelque heure, nous posséderons le silence, sinon le repos. Enfin ! La tyrannie de la face humaine a disparu, et je ne souffrirai plus que par moi-même. (…) Mécontent de tous et mécontent de moi, je voudrais bien me racheter et m’enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. » « Le Spleen de Paris »
Marcel Proust a fait recouvrir de liège les murs de sa chambre et soudoie les ouvriers pour qu’ils ne fassent pas les travaux qu’ils devaient effectuer dans l’appartement du dessus. Plus tard, Kafka exprime le désir d’avoir une chambre d’hôtel qui lui permette « de s’isoler, de se taire, jouir du silence, écrire la nuit ».
Mallarmé, poète acoustique, voyait naître un « grand plafond silencieux » dans l’accumulation soudaine des brouillards. Chateaubriand, au milieu des ruines de Sparte, entendait les pierres qui « se taisaient » autour de lui. Et Albert Camus, à Tipasa, disait distinguer « un à un les bruits imperceptibles dont était fait le silence ».
Dans son interview à l’Express, Corbin explique :
« Aujourd’hui, il faut réussir à échapper à la peur du silence, c’est-à-dire à la peur de la solitude ».
Il a aussi cette réflexion :
« La perception de l’intolérable a changé depuis le milieu du XIXe. Ainsi du bruit dans les villes. On ne tolérerait plus aujourd’hui les forges en appartement et les essieux sur les pavés, les cloches et les chiens trop bruyants. Cela dit, le nombre de cloches n’a pas diminué, mais on ne les entend plus, car on ne les écoute plus. Ce qui me frappe, c’est qu’un même individu a des degrés de tolérance très variables: il ne supporte plus les conversations dans un avion ou dans un train, mais va s’assourdir dans une boîte de nuit. »
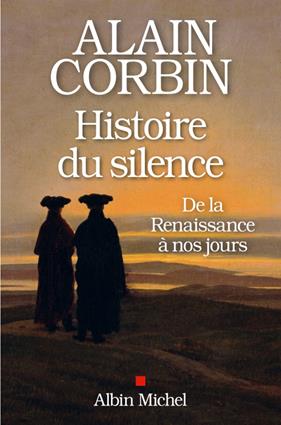 Finalement c’est Anne Sinclair qui semble donner le résumé le plus riche de ce livre :
Finalement c’est Anne Sinclair qui semble donner le résumé le plus riche de ce livre :
« L’importance de savoir se taire. Le silence est « multiple », selon l’historien. Il peut signifier paix, bonheur, peur comme ennui. Mais il explique que chaque période a une façon de concevoir le silence. « Dans les siècles passés, le silence était une richesse, le moyen d’approfondir son Moi, de méditer, se ressourcer.
Le silence du 17e siècle était destiné à l’oraison, à l’écoute de Dieu ». Le spécialiste indique aussi que « depuis la moitié du 16e siècle, dans la société de cour, prendre la parole est un risque, se taire est plus prudent voire bénéfique. Le Roi, comme toute personne qui a le pouvoir, dit Fénelon, doit se taire. On n’imagine pas les grands de la cour parlant à tort et à travers. » S’il est important de savoir parler, il l’est encore plus de savoir se taire.
Le silence de la nature. Aujourd’hui, avec la frénésie de la ville, des communications, la nature serait-elle le dernier ancrage du silence ? Il y a du vrai, selon l’historien. « Les marcheurs des sentiers de grande randonnée, c’est le reflet du siècle précédent. Mais ils ne cherchent peut-être pas la même chose », nuance-t-il, en y voyant davantage un besoin de « déconnexion » ou d’oubli de certains bruits qui n’existaient pas auparavant. Pour autant, il ne croit pas que les villes soient plus bruyantes qu’autrefois, à l’époque des crieurs ou des ateliers dans les étages.
Les silences intermittents d’aujourd’hui. De nos jours, les bruits de fond sont partout, des magasins aux ascenseurs. Mais il existe aussi une intolérance au bruit. Par exemple, on n’accepte pas que » son voisin de TGV parle, fasse de bruit alors que c’était même de la politesse de s’adresser à son voisin auparavant. » Pour l’historien, les enfants du 21e siècle ont davantage peur du silence. « Dans ma génération, on pouvait en profiter pour rêver, imaginer ». Désormais, pense le spécialiste, les enfants « identifient le silence à l’ennui, à un arrêt du rythme. »
Le Silence de la paix et de la mort. Le silence comme reflet de l’ennui… mais aussi de la paix. Alain Corbin renvoie à la Première guerre mondiale. « Dans ce vacarme effroyable de la guerre, le silence est celui de la paix, de l’interruption brutale de la canonnade. A la fois très inquiétant et rassurant. » Ce peut être également le silence de la mort. Car la mort, c’est le silence. « Déjà, le silence de la chambre du malade est tragique. Je ne parle pas de chambre mortuaire et de la tombe… »
Le silence des silences. Et s’il doit y avoir un silence final, il y a ni plus ni moins que celui de la fin des temps. L’historien s’appuie sur un poème de Leconte de Lisle, où le vrai silence sera celui de la Terre. « Non seulement de tous ses habitants, mais aussi de sa matière même, qui en explosant deviendra poussière. » »
Voici les liens promis :
TELERAMA : Histoire du silence de la renaissance à nos jours
LE POINT : Alain Corbin : Il était une fois le silence
L’EXPRESS : Alain Corbin à l’écoute du silence
LIBERATION : Alain Corbin : les archives du silence
Et pour les amoureux de la poésie un lien vers le poème de Leconte de Lisle cité par l’historien :< La dernière vision de Leconte de Lisle>
Il me semble que ce mot du jour sur le silence est approprié pour vous annoncer que le mot du jour va se régénérer dans le silence pendant 2 mois.
Demain, j’ai prévu un mot spécial, puis s’ouvrira pour moi et ma douce compagne un mois de congé.
Mais je souhaite prolonger le silence encore un mois, parce que j’ai besoin de ce silence, de laisser reposer l’esprit, le corps et la sensibilité.
<733>
-
Mercredi 29 Juin 2016
Mercredi 29 Juin 2016« Je vis une histoire d’amour avec les mots et ils me le rendent au centuple »Delphine Marang dans l’émission Bibliothèque Médicis(27/05/2016) (à 2:00)Bientôt les vacances !Certaines et certains m’ont dit qu’ils en profiteraient pour lire « Sapiens ». Je les encourage mais je préviens c’est du lourd !Alors pour équilibrer, ou pour d’autres, remplacer, je vous propose un livre léger.Rien que le nom de l’auteur de ce livre est évocateur : «Marang». Et il s’agit bien du nom de naissance de l’auteur qui est née à Colmar et qui affirme « sera enterrée à Bonifacio ».Elle vient de publier son premier livre « Dans tous les sens »Jean-Paul Enthoven, dans un article du Point <Sourire avec Mme Marang>, le présente ainsi : « Aphorismes, holorimes, pensées ou traits d’esprit… Dans ce premier livre, Delphine Marang jongle librement avec les mots… »Elle explique dans l’émission dont j’ai tiré l’exergue du mot du jour qu’elle était dyslexique et qu’elle a fait de cette difficulté une opportunité en se spécialisant dans les mots d’esprit.Dont voici un florilège :« Réussir ses parties d’échecs. »« Perdre en faisant des réussites. »«Devant une phrase désarmante, il sortait son silencieux. »«Âmes insensibles s’abstenir ! »«Faites la moue pas la guerre. »«Les vieux amants baissent ensemble. »« Être la muse fine bouche, loin des amuse-gueules. »« Un cercueil est une boite de nuit»« J’ai avancé contre vents et mari»« Refait et parfait, son visage est de la haute couture»« C’est un oiseau qui a l’air de tomber du lit»« ils se disputaient sur la plage, c’était leur dune de fiel» (des jeunes mariés)Jean-Paul Enthoven en disserte ainsi :« Des aphorismes de geisha (« Soigner le mâle par le bien »), des calembours plus ou moins pervers (« Sa maîtresse est une Domina triste »), des saillies de conversation (« Cette amoureuse est une héroïne en manque »), des méditations de haute volée (« Renaître nous rend d’or »), ainsi que nombre d’holorimes, de gags verbaux, de tête-à-queue ou à claques, y balisent un credo où, par principe, rien ne sera pris au sérieux. Ici, on babille par plaisir, on tend l’oreille au mot-valise qui en dit long, on surfe sur la métaphore, on glisse sur le toboggan des lapsus. Mme Marang – dont « les désirs sont désordre » – exige que l’on s’amuse en la lisant. Dociles, nous obéirons…Sur le fond, cette femme de lettres est une originale : à l’en croire, elle aurait pu militer pour que les enfants de divorcés obtiennent la garde alternée de leurs parents ; et se serait souvent moquée des « goys de cour » tout en se rendant coupable, par pure ambition, de quelques « crimes de lèche-majesté ». […] elle s’est tôt persuadée que « mieux valait un bon mot qu’une mauvaise phrase ».D’où sa drôlerie concise, ses embardées en forme de haïkus, ses verdicts sur la coquetterie (« Elle est si frivole qu’on ne sait pas si ses jumeaux ont le même père »), sur ses contemporaines (Ah, cette « roulure de printemps » !) et ses envolées sentimentales (« Je vis pour vous retrouver, je vous retrouve pour vivre ») ou sensuelles (« Merci pour ce don d’orgasmes ! »). Finalement, il ressort de cela que cette femme […] mérite sans conteste de solliciter son admission au CME (Club des moralistes d’envergure). »Ce qui distingue l’humain de l’animal ce n’est pas l’intelligence, c’est le rire ! -
Mardi 28 Juin 2016
Mardi 28 Juin 2016«Les secrets de la beauté»Audrey HepburnAujourd’hui, j’avais prévu de vous entretenir d’une utopie illégale dont avait parlé Xavier De La Porte lors d’une revue du numérique sur France Culture et qui concernait la mise à disposition de tous et gratuitement du savoir scientifique, comme du temps de Copernic, de Galilée ou de Newton, en quelque sorte. Si ce sujet vous intéresse vous trouverez la chronique derrière ce lien : la « Robin des bois de la science » (Nom donné à Alexandra Elbakyan une scientifique Kazakh)Mais hier, Mireille Delunsch qui est une des meilleures chanteuses d’opéra en France, a posté sur Facebook un message dont je veux faire un moment de partage avec vous. Car, Oui, comme pour toute création humaine, sur Facebook, il y a le pire et il y a le meilleur.Mireille Delunsch a publié un texte d’Audrey Hepburn.Audrey Hepburn est cette actrice britannique, née le 4 mai 1929 et décédée le 20 janvier 1993 qui a joué le rôle principal dans plusieurs films cultes Hollywood : My Fair Lady, Guerre et paix, Diamants sur canapé et Vacances romaines de William Wyler qui lui vaut l’Oscar de la meilleure actrice.Elle était, selon les canons occidentaux, belle.Un jour on lui a demandé de révéler ses secrets de beauté.A cette question, elle a répondu par un texte qui fut lu lors de ses funérailles :«Pour avoir des lèvres attirantes, prononcez des paroles de bonté.Pour avoir de beaux yeux, regardez ce que les gens ont de beau en eux.Pour rester mince, partagez vos repas avec ceux qui ont faim.Pour avoir de beaux cheveux, laissez un enfant y passer sa main chaque jour.Pour avoir un beau maintien, marchez en sachant que vous n’êtes jamais seule, car ceux qui vous aiment et vous ont aimé vous accompagnent.Les gens, plus encore que les objets, ont besoin d’être réparés, bichonnés, ravivés, réclamés et sauvés : ne rejetez jamais personne.Pensez-y : si un jour vous avez besoin d’une main secourable, vous en trouverez une au bout de chacun de vos bras.En vieillissant, vous vous rendrez compte que vous avez deux mains, l’une pour vous aider vous-même, l’autre pour aider ceux qui en ont besoin.La beauté d’une femme n’est pas dans les vêtements qu’elle porte, son visage ou sa façon d’arranger ses cheveux.La beauté d’une femme se voit dans ses yeux, car c’est la porte ouverte sur son cœur, la source de son amour.La beauté d’une femme n’est pas dans son maquillage, mais dans la vraie beauté de son âme.C’est la tendresse qu’elle donne, l’amour, la passion qu’elle exprime.La beauté d’une femme se développe avec les années.»Et voilà Audrey Hepburn dans sa jeunesseEt en 1982 -
Lundi 27 Juin 2016
Lundi 27 Juin 2016« L’abdication d’une démocratie peut prendre deux formes, soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel,
soit la délégation de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique. […] Il m’est arrivé souvent de recommander plus de rigueur dans notre gestion économique. Mais je ne suis pas résigné, je vous l’avoue, à en faire juge un aréopage européen dans lequel règne un esprit qui est loin d’être le nôtre.»Pierre Mendès France, 18 Janvier 1957Dans un article publié par Mediapart le 25/06/2016, on apprend qu’en 1957, lors du débat sur le Traité de Rome, Pierre Mendès France mettait en garde, en évoquant la construction européenne, contre un projet inspiré par « un libéralisme du XIXe siècle ». […]Le 18 janvier 1957, Pierre Mendès France (1907-1982) intervient à l’Assemblée nationale dans le débat sur le projet du Traité de Rome qui, signé deux mois plus tard, le 25 mars, instituera la première communauté économique européenne, composée de l’Allemagne, de la rance, de l’Italie et des trois pays du Benelux, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Alors figure du Parti radical, il avait quitté la présidence du Conseil deux ans auparavant, après sept mois et dix-huit jours de gouvernement dont la brièveté n’empêchera pas le souvenir durable, celui d’un homme d’État vertueux, averti en matière économique, soucieux des comptes publics, respectueux du débat démocratique et, de plus, en quête d’une issue à la crise coloniale.« L’harmonisation doit se faire dans le sens du progrès social, affirme le député Mendès France, dans le sens du relèvement parallèle des avantages sociaux et non pas, comme les gouvernements français le redoutent depuis si longtemps, au profit des pays les plus conservateurs et au détriment des pays socialement les plus avancés. »« Mes chers collègues, poursuit Mendès France, il m’est arrivé souvent de recommander plus de rigueur dans notre gestion économique. Mais je ne suis pas résigné, je vous l’avoue, à en faire juge un aréopage européen dans lequel règne un esprit qui est loin d’être le nôtre. Sur ce point, je mets le gouvernement en garde : nous ne pouvons pas nous laisser dépouiller de notre liberté de décision dans des matières qui touchent d’aussi près notre conception même du progrès et de la justice sociale ; les suites peuvent en être trop graves du point de vue social comme du point de vue politique.Prenons-y bien garde aussi : le mécanisme une fois mis en marche, nous ne pourrons plus l’arrêter. (…) Nous ne pourrons plus nous dégager.Nous serons entièrement assujettis aux décisions de l’autorité supranationale devant laquelle, si notre situation est trop mauvaise, nous serons condamnés à venir quémander des dérogations et des exemptions, qu’elle ne nous accordera pas, soyez-en assurés, sans contreparties et sans conditions. »À la lecture de ces anciennes paroles, Mendès France prend soudain stature de devin tragique, anticipant ce que ses contemporains ne voient pas, parce qu’ils sont aveugles ou parce qu’ils s’aveuglent. Car c’est peu dire que la suite, notamment celle vécue ces trente dernières années par des gouvernements de gauche, élus sur des promesses sociales alternatives, aura donné raison à cette prophétie.À la fin de son discours, Mendès France souligne le cœur du désaccord : ce projet de marché commun, résume-t-il, « est basé sur le libéralisme classique du XIXe siècle, selon lequel la concurrence pure et simple règle tous les problèmes». Autrement dit, un libéralisme économique qui ruine tout libéralisme politique, imposant la loi d’airain de la concurrence à la vie sociale, au détriment des solidarités collectives et des libertés individuelles.« L’abdication d’une démocratie peut prendre deux formes, conclut Mendès France, soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d’une saine économie on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement “une politique”, au sens le plus large du mot, nationale et internationale. »« Dire cela, ajoutait Pierre Mendès France, ce n’est pas être hostile à l’édification de l’Europe, mais c’est ne pas vouloir que l’entreprise se traduise, demain, par une déception terrible pour notre pays, après un grand et bel espoir, par le sentiment qu’il en serait la victime et, tout d’abord, ses éléments déjà les plus défavorisés. » Faute de l’avoir écouté, nous vivons aujourd’hui ces temps de « déception terrible » prédits par Mendès France.La clairvoyance de Mendés France, il y a près de 60 ans m’impressionne. Tout c’est bien passé comme il l’a dit : Les décisions sont prises sous l’appellation de décisions techniques par un aréopage européen.Mais sortir de cette impasse est tout sauf simple.Il est devenu évident qu’aujourd’hui et probablement davantage demain que la globalisation et la financiarisation de l’Economie ainsi que l’automatisation générale ne profitera plus à la majorité des populations du vieux continent qui avaient été habitués à vivre beaucoup mieux que tout le reste du monde à l’exception des pays où les européens s’étaient implantés et avaient remplacés les autochtones et à l’autre exception du Japon.En outre dans ces pays s’est mis en place un Etat social qui ne peut plus être financé étant donné ces évolutions et l’augmentation de l’espérance de vie.Pour éclairer mon affirmation précédente, je donne ces chiffres : la France représente 1 % de la population de la planète et 4 % du PIB mondial et concentre 15 % des dépenses sociales du monde.Dans ces conditions il est normal qu’en Démocratie, la majorité se rebelle et vote non.La technocratie européenne que l’on critique tellement aujourd’hui, comme le faisait Mendés France en 1957, a jusqu’à présent permis de faire semblant que la Démocratie s’exprime mais comme le disait justement Juncker s’arrête aux Traités signés.Pour sortir de cela, pour sortir des multiples non, il faudrait arriver à se mettre d’accord sur un Oui, c’est à dire un projet européen cohérent alternatif politique trouvant une majorité.Cela, ce n’est pas gagné, comme le montre cet article du Monde : http://allemagne.blog.lemonde.fr/2016/06/25/merkel-acte-la-fin-du-couple-franco-allemand/Et comme le dit, le ministre belge des affaires étrangères : « Il n’y a clairement pas d’unanimité pour davantage d’intégration en Europe » -
Vendredi 24 Juin 2016
«Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans cinq ans il faudrait qu’ils achètent du sable ailleurs.»ColucheSouvent les mots du jour se moquent des technocrates.
Mais ce n’est pas le cas de celui du jour. Cela étant, il n’en fera pas l’éloge non plus.
Coluche est mort il y a 30 ans, exactement le 19 Juin 1986 à 41 ans.
Coluche était drôle et souvent ses blagues cognaient juste.
Il voulait faire une nouvelle blague sur les technocrates et il a donc eu ce mot qui signifie que si on donnait un désert aux technocrates, ils ne pourraient pas exploiter intelligemment le sable qui s’y trouve à profusion.
Seulement Coluche se trompait, cette blague tombe à plat dès que l’on approfondit un peu ce sujet à savoir l’importance du sable dans l’activité humaine et la qualité du sable du désert.
Les anglais ont aussi une expression : « C’est comme vendre du sable aux arabes » qui veut signifier qu’un acte est inutile avec cette idée que vendre du sable aux arabes ne présente aucune pertinence économique puisque « les Arabes » sont en grande partie un peuple du désert et qu’ils ont donc du sable à satiété.
C’est tout aussi faux, d’ailleurs aujourd’hui les peuples arabes de Dubaï, du Qatar et des autres états pétroliers achètent massivement du sable ! Notamment aux Australiens.
J’ai été sensibilisé à cette problématique lors de cette émission de France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/un-jour-dans-le-monde/un-jour-dans-le-monde-23-septembre-2015-0
On y apprend trois choses :
- Le sable est une matière première essentielle pour l’économie contemporaine :
- Le sable du désert est inutilisable pour ces activités
- Le sable est surexploité et cette surexploitation constitue un problème écologique considérable dont on parle peu.
On y apprend en outre que le sable est la ressource naturelle la plus consommée après l’eau et les hydrocarbures.
<Un premier article donne des détails techniques :> :
« Le sable est la 3ème ressource la plus utilisée au monde, après l’air et l’eau. Il représente un volume d’échanges internationaux de 70 milliards de dollars par an. Plus de 15 milliards de tonnes utilisées dans le monde chaque année. Sur la planète, 2/3 de ce qui est construit est en béton armé et le béton est constitué de 2/3 de sable.
Chaque année en France, ce sont plus de 7 millions de tonnes de sable qui sont puisées dans l’océan Atlantique et dans la Manche. A 95 %, ce sable est destiné à la fabrication de béton pour la construction.
Il faut 200 tonnes de sable pour construire une maison de taille moyenne.
Un bâtiment comme un hôpital, consomme environ 3000 tonnes,
Chaque kilomètre d’autoroutes engloutit au moins 30 000 tonnes de sable,
Pour construire une centrale nucléaire, il faut compter environ 12 millions de tonnes.
Entre 75 et 90% des plages de la planète sont aujourd’hui menacées de disparition. Si on ne fait rien d’ici 2100, les plages du monde seront de l’histoire ancienne.
A Dubaï, la presqu’île artificielle autoproclamée « 8e merveille du monde » a coûté plus de 12 milliards de dollars et a ingurgité près de 150 millions de tonnes de sable pompé au large des côtes de Dubaï.
3500 sociétés australiennes exportent vers la péninsule arabique. Leurs bénéfices ont triplé en 20 ans et le sable représente aujourd’hui un jackpot annuel de 5 milliards de dollars pour l’Australie.
L’existence même de Singapour dépend de ses importations de sable. Sa superficie s’est agrandie de 20% ces 40 dernières années. »
Evidemment une telle ressource avec tant d’intérêts financiers suscite des convoitises et même des délinquants : « En Inde, les pirates du sable agissent au grand jour sur plus de 8000 sites illégaux d’extraction, disséminés sur les côtes et rivières du sous-continent. Au Maroc, le sable volé représente à ce jour, aux alentours de 40% à 45% des prélèvements. »
En outre, il y a des exemples de gabegie :
« En Chine, 65 millions de logements sont vides, pourtant la construction est florissante et engloutie 1/4 du sable extrait sur la planète <
L’Espagne détient le triste record du pays qui a utilisé le plus de sable en Europe… pour rien. Alors qu’elle connaît une crise du logement sans précédent, 30% des habitations construites depuis 1996 sont inoccupées. Des aéroports entiers ont été édifiés, mais n’ont jamais vu un passager. »
Mais d’où vient le sable ?
« Depuis 5 000 ans, les hommes ont extrait des roches que ce soit par l’exploitation de mines, la déforestation ou encore l’extraction de granulats.
L’extraction de granulats (sables, graviers et galets) est majoritairement effectuée dans des carrières de sable et de gravier (granulats roulés) et de roches massives (granulats concassés, roches ornementales). Mais face à l’épuisement des ressources terrestres en granulats alluvionnaires et aux désordres engendrés par la surexploitation dans les rivières (approfondissement du lit, déchaussement d’ouvrages d’art), les industriels se sont tournés vers des ressources de substitution, notamment les granulats marins.
L’exploitation de sable marin s’est développée depuis les années 1970 et est en plein essor depuis. Certains navires de drague peuvent pomper par jour entre 4 000 et 400 000 m3 de sable au fond de la mer.
Pour résumer, le sable provient de deux origines principales : d’origine éruptive dans les carrières et surtout le sable marin. »
Les impacts sur l’environnement sont immenses et alarmants. La disparition du sable est une question qui se pose.
Denis Delestrac a réalisé un documentaire pour ARTE : « Le sable : enquête sur une disparition ».
Documentaire que vous pouvez acheter sur la boutique d’Arte : http://boutique.arte.tv/f9016-sable_enquete_disparition
Et ci-après un autre documentaire : http://future.arte.tv/fr/le-sable-va-t-il-vraiment-disparaitre#article-anchor-14781
Le site écologiste terraeco : http://www.terraeco.net/Les-marchands-de-sable-menacent,51075.html donne les informations suivantes :
« Le biologiste Pierre Mollo s’inquiète d’un autre impact, plus immédiat, sur le plancton. En remuant les fonds marins, l’extraction de sable crée un panache dans lequel remontent des minéraux et métaux lourds enfouis depuis des millénaires, explique l’enseignant chercheur, cela peut contribuer à rendre le plancton toxique. »
De quoi ajouter à l’inquiétude des ostréiculteurs. Elle-même moindre que celle des pêcheurs.
Car, par sa seule présence, la bruyante élingue des extracteurs fait fuir les poissons, tout en aspirant leur alimentation. Alors à Lannion, les professionnels de la pêche crient au conflit d’usage. « C’est insoluble car les zones qui présentent le plus grand nombre de sédiments marins, généralement les estuaires, sont aussi des niches de biodiversité », soupire Pierre Mollo.»
Il y a encore les articles suivants :
http://www.rfi.fr/afrique/20130604-le-business-marchands-sable
http://www.humanite.fr/environnement/marchands-de-sable-les-autres-pilleurs-d-ocean-542170
Il existe donc bien des marchands de sable, peut-être même veulent-ils nous endormir pour qu’ils puissent faire leur business tranquillement, mais nous apprenons par toutes ces informations que ces marchands de sable ne sont pas de gentils bisounours.
<729>
- Le sable est une matière première essentielle pour l’économie contemporaine :
-
Jeudi 23 Juin 2016
Jeudi 23 Juin 2016« L’idée européenne n’est pas un sentiment premier […] mais elle naît de la réflexion, elle n’est pas le produit d’une passion spontanée, mais le fruit lentement muri d’une pensée élevée. »Stefan ZweigCe 23 juin les britanniques vont voter : être ou ne pas être dans l’Union européenne.A priori, tous les experts sont d’accord : économiquement la Grande Bretagne n’a pas intérêt à un Brexit.Alors si Napoléon qui aurait dit « Les anglais, c’est un peuple de boutiquiers » a raison, les britanniques vont vouloir rester dans l’Union.Mais s’il y a tant d’incertitudes c’est que probablement l’économie n’est finalement pas tout, même pas pour les britanniques.Ce journal étonnant qui s’appelle « Le Un » qui a été fondé par Eric Fottorino et qui chaque semaine ne traite qu’un seul sujet sur une seule feuille pliée 3 fois.Le dernier numéro du 15 juin a pour sujet le Brexit.Et c’est ce journal qui a publié ce texte de Stefan Zweig, cet immense écrivain viennois qui a vécu dans une période terrible de l’Europe et qui s’est suicidé en 1942 dans une Europe en ruine.Voici ce texte :« L’idée européenne n’est pas un sentiment premier, comme le sentiment patriotique, comme celui de l’appartenance à un peuple, elle n’est pas originelle et instinctive, mais elle naît de la réflexion, elle n’est pas le produit d’une passion spontanée, mais le fruit lentement mûri d’une pensée élevée.Il lui manque d’abord entièrement l’instinct enthousiaste qui anime le sentiment patriotique.L’égoïsme sacré du nationalisme restera toujours plus accessible à la moyenne des individus que l’altruisme sacré du sentiment européen, parce qu’il est toujours plus aisé de reconnaître ce qui vous appartient que de comprendre votre voisin avec respect et désintérêt.A cela s’ajoute le fait que le sentiment national est organisé depuis des siècles et bénéficie du soutien des plus puissants auxiliaires. Le nationalisme peut compter sur l’enseignement, l’armée, l’uniforme, les journaux, les hymnes et les insignes. »Appels aux Européens Stefan ZweigL’Angleterre et la France ont dominé le monde, l’Allemagne était aussi une puissance mondiale. Dans le monde d’aujourd’hui et plus encore de demain ils ne peuvent être que des nains. Ce monde qui est là sera dominé par les Etats continents.Si nous voulons jouer un rôle demain, il nous faut créer une Union européenne politique. Ce sera une Union de la raison. Cette Union ne se fera pas si la France pense que l’Union sera une France augmentée, il faudra faire de grandes concessions pour que nos partenaires puissent accepter de faire cette union avec nous. -
Mercredi 22 Juin 2016
Mercredi 22 Juin 2016« La différence entre la Politique qui est le concept et l’Administration qui est le moyen. »Edgar PisaniEdgard Pisani vient de mourir. Nous l’avons appris hier, mais il est décédé le 20 juin 2016.Il était né le 9 octobre 1918 et il est donc mort à 97 ans.Il fut Ministre sous De Gaulle et sous Mitterrand.Sous Mitterrand, il joua un rôle de premier plan pour trouver une solution au problème de la Nouvelle Calédonie et permettre à cette île de sortir du cycle de la violence.Mais c’est surtout sous De Gaulle qu’il joua un rôle essentiel puisqu’il fût nommé, Ministre de l’Agriculture 4 semaines avant le début de la négociation de la Politique Agricole Commune dans laquelle il porta la voix de la France.Il fut le grand ministre de l’agriculture de cette époque, d’abord dans les cabinets Michel Debré en 1961 et 1962, puis de Georges Pompidou de 1962 à 1966.J’étais évidemment beaucoup trop jeune à l’époque pour me souvenir de cette période.Mais, sa mort me fait penser à une émission que j’avais écouté et que j’ai bien sûr conservé sur un de mes supports de sauvegarde : La fabrique de l’histoire de France Culture du 04/05/2009.Il existe toujours trace sur le Web de cette émission mais plus le son.En 2009, il avait donc 90 ans, une voix chaude et grave.Dans cette émission, il a récusé le fait d’avoir été un homme politique en se qualifiant de commis de l’Etat qui a fait de la politique.Écouter cet homme m’a profondément marqué en raison de son intelligence, son sens de l’Etat et sa réflexion.Je vous livre un petit extrait de cet entretien :«[Je venais d’être nommé Ministre de l’agriculture] Le directeur général du Génie Rural, Charles David un grand bonhomme, me conduisait du Ministère de l’agriculture jusqu’à Matignon où Michel Debré m’attendait.Devant Matignon, il m’a mis la main sur mon avant-bras et m’a dit :« Ayez une vision, communiquez nous là, acceptez que nous en discutions, prenez une décision et nous l’exécuterons sans frémir.Mettre le pied dans la porte pour empêcher qu’elle se ferme, c’est notre métier, nous n’allons jamais au-delà. »J’ai appris là, la différence entre la Politique qui est le concept et l’Administration qui est le moyen.Hélas je constate aujourd’hui qu’on ne fait plus avec autant de clarté cette distinction pourtant essentielle. ».Evidemment le monde a beaucoup changé. L’Etat ne peut plus jouer le même rôle.Mais nous n’avons plus ce type d’homme capable d’une vision, d’un projet.Tout devient gestion, administration des choses et des hommes.La politique s’arrête à la capacité de gagner des élections, mais après on ne sait plus quoi faire.Quand on écoute un homme comme Edgar Pisani et qu’on le compare avec des ministres de 2009 ou de 2016 (ce ne sont pas les mêmes) on est frappé de la différence de ce que j’appellerais, la dimension humaine et la capacité de porter le poids de l’Histoire.Voilà les pensées qui me sont venues et que j’ai voulu partager avec vous quand j’ai lu sur mon téléphone, hier, Edgar Pisani est mort -
Mardi 21 Juin 2016
Mardi 21 Juin 2016« Ce qui compte, ce n’est pas que le mec soit dingue, mais qu’il mette sa folie au service d’une idéologie… »Raphael GlucksmannRaphael Glucksmann est le fils d’André Glucksmann qui a quitté le monde des vivants 3 jours avant les attentats du 13 novembre 2015.
Il est possible de lire des choses intelligentes sur Twitter. En effet, l’exergue du mot du jour vient de twitter, car je suis un « abonné twitter » de Raphael Glucksmann.
Et ce tweet renvoie vers un message (on dit un « statut ») publié sur Facebook, car on peut aussi trouver des messages intelligents sur facebook :
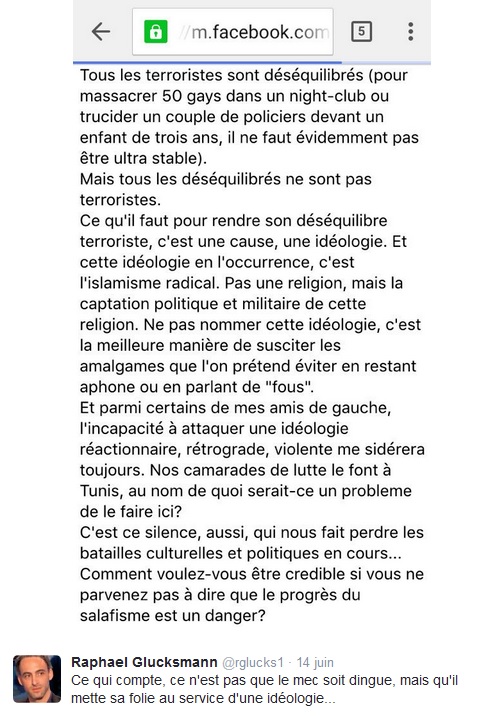
Tous les salafistes ne sont pas des terroristes !
Mais l’idéologie salafiste qui classe les humains et les actes des humains entre « purs » et « impurs » donne à ces déséquilibrés violents les outils de justification pour passer à l’acte et même pour en être fiers.
J’aime beaucoup lire sur ce sujet Céline Pina qui a écrit « Silence Coupable.»
Céline Pina est une socialiste, ancienne élue régionale qui explique à la fois le danger devant cette idéologie radicale qui remet en cause nos fondamentaux de démocratie, de liberté, d’égalité et du vivre ensemble et la réaction souvent molle voire la non réaction des responsables du PS.
Vous pouvez lire cet article où elle intervient sur le site de Marianne : « L’islamisme, ce n’est pas une invasion de barbus, c’est beaucoup plus insidieux ».
Elle n’est pas la seule à défendre cette position : Gilles Kepel dénonce aussi une « rupture salafiste de fond » qui est en arrière-plan des actes de terrorisme.
Il y a aussi, l’écrivain algérien qui a vu l’islamisme peu à peu s’imposer dans son pays : Boualem Sansal : «L’ordre islamique tente progressivement de s’installer en France. »
Cette question est très controversée en France, il y a notamment une opposition frontale entre « Gilles Kepel et Olivier Roy ». Le second parlant de l’islamisation de la radicalité et rejetant l’idée que l’islamisation salafiste soit un danger. Grosso modo il défend cette idée que certains jeunes sont radicaux et cherchent une cause pour laquelle ils peuvent trouver une raison pour tuer et se faire tuer et qu’aujourd’hui il n’y a que l’islamisme qui se trouve sur le marché…
Les tenants de la thèse d’Olivier Roy sont très nombreux dans la Gauche bien-pensante au pouvoir et universitaire comme l’a prouvé cette polémique qui a atteint cet homme remarquable qu’est Kamel Daoud.
« Ici » un article de Courrier International sur cette polémique ou cette émission de France Culture « Kamel Daoud : La polémique s’emballe »
« Ici » ce beau texte de l’écrivaine franco-tunisienne Fawzia Zouari qui défend Kamel Daoud.
D’habitude, je reste prudent dans mes analyses et j’essaie de rester à distance de points de vue opposés qui expriment un autre regard sur une même réalité. Car c’est de la richesse des regards différenciés qu’on peut le mieux approcher la compréhension de la complexité des choses.
Mais ici je ne le serais pas car je penche nettement du côté de Kepel, Céline Pina et Raphael Glucksmann, tant je pense avoir compris combien est dangereuse toute religion mise entre de mauvaises mains.
Dans mon analyse le nazisme et le communisme étaient aussi des religions, des religions sans Dieu, mais des religions car ils défendaient un dogme, une pensée qui n’acceptaient pas la contradiction et la mesure scientifique.
C’est cela même la maladie des religions qui n’acceptent pas l’altérité, pour qui celui qui n’est pas d’accord n’exprime pas une autre opinion mais se trouve dans l’erreur, dans l’impureté pour les salafistes.
Car pour que ces « criminels » puissent aller au bout de leur délire de destruction il faut qu’ils puissent s’appuyer sur une idéologie qui distingue « les vrais croyants » des « autres ».
« A partir du moment où l’autre est un Kouffar » ou un apostat, tout devient possible.
Il faut d’abord l’idéologie, comme celle des nazis qui distinguaient les aryens des sous hommes, pour que le reste devienne possible, les assassinats de masse, les camps et ces massacres d’aujourd’hui comme celui d’Orlando.
La première bataille est celle des idées et le refus des accommodements déraisonnables, pour reprendre ce concept cher à nos amis québécois !
Et si ce concept d’accommodements raisonnables vous interpelle voici plusieurs liens qui parlent de ce sujet :
- « Les accommodements raisonnables tombeau de la laïcité »
- « Au canada des accommodements raisonnables »
- Et la page « Wikipedia »qui parle de l’accommodement raisonnable.
<726>
-
Lundi 20 Juin 2016
« invisibilisation »Substantif pour exprimer le fait de rendre invisible une réalitéVoici un mot au destin singulier. Il y a d’abord un mot de la langue française « visible » dont la racine vient du latin « visibilis » qui signifie la même chose.
Quand on y ajoute le préfixe «in», en latin comme en français cela signifie « ce qu’on ne peut pas voir. »
La langue anglaise, comme très souvent, a emprunté ce mot à la langue française pour le même usage. Mais c’est la langue anglaise qui a ensuite inventé le mot « invisibilisation » que la langue française vient de récupérer.
Pourquoi ce mot du jour ?
A cause de la tuerie d’Orlando, où un criminel se réclamant de DAESH a massacré des homosexuels !
Or beaucoup d’élus comme les journalistes ont dans un premier temps, le temps où on révèle son inconscient et ses vraies valeurs et avant que n’apparaissent les éléments de langage, ignoré ce fait.
Florian Bardou, journaliste à Slate écrit ainsi : «Chers élus, la tuerie d’Orlando n’a pas frappé une boîte, mais une boîte gay »
C’est la revue de Presse du 13/06/2016 de Nicolas Martin sur France Culture qui a attiré mon attention sur ce sujet :
« Pas un seul gros titre de la presse du jour ne mentionne que le club visé par le tueur d’Orlando était un club homosexuel.
Il est assez surprenant quand on regarde le panorama des Unes de la presse française ce matin de constater à quel point il y a un grand absent… un mot, une expression qui ne figure dans aucun des grands titres… on va faire le test tous ensemble si vous le voulez bien… « Attentat islamiste à Orlando, la terreur et la haine » dans le Figaro… « Tuerie de masse dans une boite de nuit en Floride » dans l’Humanité. « Les Etats-Unis frappés par la pire tuerie de leur histoire » dans les Echos. « Nuit d’horreur en Floride » dans Le Parisien. « Orlando, nouvelle plaie béante » dans Libération.
Voilà… il ne manque pas quelque chose ?
Eh oui… pas un grand titre qui inclut cette information, qui n’est pourtant pas accessoire… cette discothèque, ce club… c’est un club gay. Une information qui ne figure même pas dans les sous-titres du Parisien, ou de l’Huma. Le fait que ce soit la communauté homosexuelle qui ait été visée par cet attentat est donc a priori, une information accessoire, pas essentielle, pas de celle que l’on met dans les gros titres. Et on pourrait presque sourire, si ce drame n’était pas si tragique, au fait que le Figaro a choisi pour sa photo d’illustration une femme qui pleure dans les bras d’un homme.
Cette pratique a un nom, elle est souvent d’ailleurs assez inconsciente… ça s’appelle l’invisibilisation… un peu comme si au lendemain des attaques de Charlie Hebdo, la presse avait évoqué des attentats contre des bureaux… ou après l’Hyper Casher, contre un supermarché. Sans préciser la nature de la cible de l’attaque terroriste…
Parce que, s’il reste à déterminer les motivations exactes du terroriste… il n’y a pas de doute sur la nature de l’endroit qui était visé. Sur la cible de l’attaque. Et le problème avec l’invisibilisation, c’est qu’elle permet de faire « comme si », de minimiser en quelque sorte la portée du geste… C’est ce qui permet, par exemple, à des personnes qui ont pris des positions notoirement hostiles aux personnes homosexuelles, de faire « comme si » et de se fendre de messages de compassion et d’oublier comme par magie la nature de la cible visée… La Manif pour Tous par exemple s’est fendu d’un petit tweet hier, signifiant « sa peine immense pour les victimes et leurs familles »… alors même que son porte-parole, en septembre dernier, parlait dans la presse du « lobby gay » comme du « Daech de la pensée unique ». On mesure aujourd’hui encore plus amèrement la profondeur de cette réflexion… Ou Christine Boutin, récemment condamnée pour avoir parlé de l’homosexualité comme une abomination, d’envoyer sans sourciller « sa compassion pour les victimes »… ces abominables victimes, donc.
C’est encore cette invisibilisation qui préside lorsque, dans les messages de soutien de plusieurs personnalités politiques – de François Hollande à Nicolas Sarkozy, de Bruno Le Maire à Marine Le Pen, de Jean-François Copé à Alain Juppé, ne figure pas une seule mention du fait que c’est bel et bien la communauté homosexuelle qui paye aujourd’hui le tribut de la barbarie terroriste. Et que, quelles que soient les conclusions de l’enquête, il est incontestable que les terroristes cherchent à atteindre des cibles précises, pour leur importance symbolique : la communauté juive, un journal satirique, la jeunesse multiculturelle d’un quartier parisien ou aujourd’hui, la communauté homosexuelle américaine, autant de symboles que leur idéologie meurtrière vomit et qui payent une fois de plus le prix du sang.
Et pour conclure sur cette notion d’invisibilisation… le Pulse, cette discothèque gay et lesbienne d’Orlando, n’est pas qu’une discothèque gay et lesbienne. C’est une discothèque fréquentée majoritairement par des noirs et des latinos. Et ça, pour le coup, tout le monde semble s’en moquer éperdument.
Le motif homophobe semble pourtant se dessiner dans le parcours du tueur […] »
Et je reviens sur l’article de Slate évoqué qui explique :
« La timidité des réactions pour qualifier le massacre homophobe du Pulse, en France comme aux Etats-Unis, démontre que les politiques et certains journalistes sous-estiment plus ou moins inconsciemment la violence structurelle envers la communauté LGBT.
Comment encore en douter?
Au lendemain de l’attentat revendiqué par Daech dans un bar LGBT d’Orlando, en Floride, qui a fait au moins 50 victimes et 53 blessés, le caractère homophobe d’un tel massacre est incontestable. Il est incontestable car viser un espace communautaire et revendiqué comme tel, qui plus est en plein mois des marches des fiertés à travers le monde, ne peut traduire qu’une volonté délibérée de s’en prendre ouvertement à la communauté LGBT pour ce qu’elle est –communauté par ailleurs habituée à être la cible de la violence gayphobe, lesbophobe, biphobe et transphobe dans ses propres espaces de refuge.
Pourtant, depuis dimanche, en France comme aux Etats-Unis, de nombreuses réactions occultent la dimension haineuse et LGBTphobe, de l’attentat comme si l’identité du lieu et des victimes n’était qu’une donnée secondaire… Dans les heures qui ont suivi l’attaque du Pulse, «qui n’est pas n’importe quel club gay» d’Orlando, rappelait par exemple USA Today, le New York Times a, dans un premier temps, omis d’évoquer la nature du club avant de progressivement modifier ses titres. Mais le quotidien américain ne souligne pas franchement le caractère homophobe de la tuerie.
En France, même topo. Sud-Ouest est l’un des rares journaux, très rares journaux à mentionner dans son titre la cible visée et la nature de la haine: un massacre homophobe liée à Daech.»
Il existe cependant des hommes politiques qui ont su dire les choses :
« Compassion et solidarité avec le peuple américain. En frappant la communauté gay, l’attaque effroyable d’Orlando nous atteint tous ».-
Manuel Valls (@manuelvalls) 12 juin 2016
«Toutes mes pensées vont vers #Orlando atteinte par l’abjecte et lâche violence homophobe. Unis contre la terreur et la haine.» –
Najat Belkacem (@najatvb) 12 juin 2016
« Soutien à tous les gays lesbiennes, bi et trans meurtris par une attaque qui vise à remettre en cause leur droit de vivre en paix » #
Lovewins – Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 13 juin 2016
Mediapart a également publié un article sur le même sujet : « En France, l’homophobie est soigneusement dissimulée. »
Cette « invisibilisation » révèle deux tabous :
- Le premier est la violence qui continue à s’exercer sur les homosexuels de manière atroce dans de nombreux pays du monde et de manière plus insidieuse dans notre beau pays.
- Le second est l’ « homophobie » constante et destructrice de l’Islam et des autres religions monothéistes. Il y a bien cette parole de sagesse récente du pape François : « Qui suis-je pour juger ? » mais elle est bien isolée dans un univers de condamnation et d’intolérance, tant il est vrai que les religions établies, paralysées dans leurs dogmes et leurs normes rejettent violemment tout ce qui est à l’extérieur.
<725>
- Le premier est la violence qui continue à s’exercer sur les homosexuels de manière atroce dans de nombreux pays du monde et de manière plus insidieuse dans notre beau pays.
-
Vendredi 17 Juin 2016
«Les tisserands : réparer ensemble le tissu déchiré du monde»Abdennour BidarAbdennour Bidar avait été évoqué lors du mot du jour du 14 octobre 2014 : «Une religion tyrannique, dogmatique, littéraliste, formaliste, machiste, conservatrice, régressive – est trop souvent l’islam ordinaire», c’était ce qu’il écrivait dans sa <Lettre ouverte au monde musulman>
C’est dans l’émission AGORA que j’ai entendu Abdennour Bidar parler de son nouveau livre «Les tisserands : réparer ensemble le tissu déchiré du monde»
Et puis il y a cet entretien dans LIBE : <abdennour-bidar-J’en ai marre de parler du voile>
Avec son dernier livre, «les Tisserands», le philosophe Abdennour Bidar met en lumière ceux qui, partout en France, travaillent à la recomposition des liens d’une société atomisée. […].
Depuis qu’il a écrit sa Lettre ouverte au monde musulman, en octobre 2014, Bidar est devenu le philosophe d’une société qui se déchire autour de questions sociétales ou religieuses, ethniques ou philosophiques et qui parfois se concentre caricaturalement sur un mot, un objet agité périodiquement : le voile. Il voudrait ne plus entendre parler de ce morceau de tissu, et tente de passer à autre chose : les Tisserands. Titre de son dernier ouvrage qui paraît, logiquement, aux éditions Les liens qui libèrent. «Tisserand», le terme désigne ces citoyens qui agissent un peu partout en France pour reconstruire des relations dans une société abîmée par une crise qui n’en finit pas. A l’expression de «Cultural Creatives» (1), groupe social inventé par le sociologue américain Paul Ray et la psychologue Sherry Anderson, Abdennour Bidar préfère l’image de ces artisans qui représenteraient en France 17 % de la population.
«Qu’est-ce qui peut relier sans aliéner ? C’est précisément la vie reliée qui passe parce que j’appelle le «Triple Lien» : à soi, aux autres et à la nature. Le lien à l’autre peut se cultiver dans la totalité de nos engagements sociaux, que ce soit au sein d’associations comme Primavera que je vais voir à Uzès, que ce soit à l’école comme professeur, parents d’élève, ou élève, que ce soit au travail ou dans l’espace culturel. J’ai voulu mettre l’accent sur ceux qui retricotent ce lien social et culturel à des toutes petites échelles, avec des buts très modestes. Faire que la communauté turque ou maghrébine discute à nouveau avec les bourgeois du centre-ville. Ces gens existent partout en France : vous en tant que journalistes, le commerçant, le professeur. Tous ces gens qui s’engagent socialement à partir d’une certaine éthique du partage.»
Vous critiquez la société individualiste et pointez un «super égoïsme» ambiant. Est-ce vraiment le problème quand on constate que les sociétés arabo-musulmanes souffrent justement du peu de place accordée à la liberté individuelle ?
«C’est juste. D’un côté, il y a l’individualisme de nos sociétés et de l’autre, l’enfermement dans une idéologie religieuse. Il reste à faire le trajet vers l’émancipation de l’individu et l’affirmation de la liberté de conscience qui a comme traduction politique la démocratie ou le règne d’un pluralisme politique. Cela dit, j’ai l’impression de me retrouver entre deux extrêmes avec d’un côté des individus hyperatomisés qui doivent réinventer ce que l’on appelle du vivre ensemble, et de l’autre côté, quelque chose de commun très fort, mais qui a pour prix l’aliénation des individus. Yadh Ben Achour (2) parle de «l’orthodoxie de masse». La grande équation contemporaine est : «Comment être libre ensemble». Les liens que nous tissons entre nous doivent précisément alimenter notre liberté. C’est l’obstacle devant lequel nous sommes.»[…]
Vous êtes très sévère envers les politiques. Tous les politiques ont-ils failli ?
«Je cherche un projet de société qui porte les aspirations des peuples et je n’en vois pas. Regardez Nuit debout, il y a de l’envie et aucune proposition politique capable de représenter un horizon d’espérance, de donner un sens à la vie collective, qui exalte l’individu. Cet échec n’est pas dû à la médiocrité des hommes ou des femmes politiques, il est lié à une époque qui se trouve au bout de son histoire. On a besoin de se réalimenter.»
C’est ce que proposent les tisserands. Une vie moins atomisée, une société qui prenne conscience de l’importance des interactions et qui retrouve du sens à partir de la reconstruction des liens. Une société plus équitable, plus solidaire. Il y a dans Nuit debout cette chaleur humaine. Cela a peut-être un côté «primitif», mais c’est le signe d’une énorme frustration, de la recherche d’espace de discussion qui n’existe pas. La langue des tisserands que j’appelle du «Triple Lien» peut parler à tout le monde, tout en laissant chacun libre de la parler comme il l’entend.»
Peut-on tisser des liens avec tout le monde ?
«Je passe mon temps à batailler avec l’islam fondamentaliste. Je ne vais pas tisser des liens avec cet islam-là. Mais il faut par ailleurs tisser assez de liens qui nous mettent à l’abri de cette gangrène. Nous devons construire une nouvelle culture de la restauration face à la déchirure du monde qui se manifeste par des fractures sociales ou des guerres culturelles.»
Que pensez-vous des propos de Michel Onfray sur l’inexistence d’un Spinoza musulman ?
«Cela veut dire qu’il ne lit pas, c’est dommage. Onfray devrait arrêter de croire qu’il peut avoir un magistère intellectuel sur tout et n’importe quoi. Je veux bien qu’il soit la grande conscience de notre temps mais le chapeau est peut-être un peu large.
Je peux lui dresser une liste de penseurs musulmans, il pourrait les lire, il serait dès lors un peu mieux informé sur cette question. Nous, les penseurs musulmans libres, nous sommes ostracisés de tous côtés. Ce qui me donne la force de continuer, c’est que je vois beaucoup de musulmanes et de musulmans me dire : «Vous dites tout haut ce que nous pensons tout bas. Continuez.»
(1) Les Créatifs culturels en France, éditions Yves Michel, 2006. Ce livre reprend une étude analysant cette famille socioculturelle.
(2) Juriste tunisien, opposant à Ben Ali, il a présidé la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, mise en place après la «révolution du jasmin».
Il y a aussi cet article des Inrocks : <Abdennour Bidar : « Les propositions politiques et religieuses demandent à être complètement réinventées »>
 Dans votre livre, vous écrivez que les « traditions religieuses (sont) de moins en moins adaptées au temps présent ». Pourquoi ?
Dans votre livre, vous écrivez que les « traditions religieuses (sont) de moins en moins adaptées au temps présent ». Pourquoi ?
«Abdennour Bidar – Qui dit religion dit système de croyances, c’est-à-dire quelque chose qui a historiquement imposé aux individus un ensemble de dogmes, de rites et une morale. C’est la première caractéristique pérenne et universelle des religions. La seconde est le caractère souvent clos de ces systèmes. Les religions ont une très forte puissance d’inclusion entre les membres de la communauté et une puissance d’exclusion des autres.
Ce sont ces deux aspects qui me semblent aujourd’hui absolument incompatibles avec les conditions de nos sociétés, de nos cultures et de nos mentalités. La civilisation contemporaine est fondée sur un très fort principe de liberté individuelle. Ainsi, l’individu est très réticent vis-à-vis de tout ce qu’il perçoit comme une vexation de sa liberté. Et ça ne s’applique pas seulement au domaine religieux. Dans nos sociétés, il y a une réelle crise de l’autorité. On a de plus en plus de mal à obéir à quelque chose d’imposé.
Ce qui se cherche aujourd’hui c’est la possibilité d’être libre ensemble. On ne prononce pas la fin du religieux mais on se demande si ça va suffire pour faire société, civilisation et sens ensemble. Car avant, chaque civilisation avait son périmètre et son espace vital. Aujourd’hui, c’est différent. Le monde est complètement connecté. On vit au quotidien avec des gens qui n’ont ni la même origine, ni la même religion, ni la même identité, ou les mêmes convictions que nous. Les frontières que trace la religion posent de plus en plus de difficultés par rapport à ces projets de vivre ensemble.
Si une personne assouvit son besoin de sens par une religion qui lui fait considérer que son système de croyance est meilleur que celui de l’autre, cela va imposer un plafond de verre à sa relation avec autrui. On se retrouve du coup cantonné à échanger de façon superficielle et extérieure.»
Mais est-ce que le collectif ne se construit pas par définition en réaction à quelque chose ? Toute mobilisation, même celle des « tisserands », n’est-elle pas condamnée à exclure ?
«La vertu de la proposition tisserande est de donner une définition très large à la notion de lien. Le problème c’est que nous sommes les fils des modernes, les fils de sociétés qui nous ont atomisés, individualisés et écartés les uns des autres. On a donc une très forte aspiration à la liberté. De plus, on a tellement vu et subi de mésaventures de »l’être ensemble » qu’on est devenu incrédule face à la réussite d’un collectif qui ne nous fait pas entrer dans un système d’endoctrinement. En réalité, il y a une multitude de façons d’être »tisserand ».
Pour créer un lien, il faut être deux. Si j’ai affaire à quelqu’un dont la croyance religieuse m’exclut et me dévalorise, évidemment ça ne va pas. Le lien entre nous sera alors abstrait puisqu’il n’est pas possible de s’entendre avec une personne qui ne vous reconnaît pas un droit égal à développer votre propre vision du monde. Mais si je rencontre une personne croyante mais non prosélyte, alors le partage devient possible.
La vie »tisserande » repose sur de bonnes volontés et la tolérance. Les tisserands sont des gens qui se disent : »Tu nourris ta vie comme tu l’entends, moi également, mais on se retrouve dans cette conviction qu’il faut développer un lien de qualité avec autrui ». Les tisserands renoncent au préjugé selon lequel on détient la vérité. C’est une sorte d’humanisme.» […]
Vous affirmez dans les Tisserands’ votre refus de la figure du maître et du directeur de conscience. Mais comment la jeunesse peut se former si elle n’est pas guidée ?
«L’école. Elle a été inventée paradoxalement à la place des maîtres. Son rôle est de mettre l’individu en situation d’être libre et autonome. L’école doit apprendre à l’individu à cultiver le lien à soi, ce que fait la philosophie par exemple, et à se questionner. Elle doit aussi lui apprendre à cultiver le lien à l’autre. En faisant ça, elle propose une pédagogie de la liberté. Grâce à cet apprentissage, on accède au fameux »libre-ensemble » dans des espaces sociaux dans lesquels on peut discuter de questionnements existentiels et fondamentaux. C’est exactement ce que fait Nuit debout. Les assemblées comme Nuit debout sont le remède pour s’extirper de l’alternative fermée : »soit j’ai des maitres soit je me retrouve seul ».
Il faut promouvoir et encourager tous les nouveaux espaces où l’on va se rasseoir pour discuter ensemble sur la meilleure façon de redonner du sens à nos vies. Les maîtres sont inutiles car on est dans un siècle d’irrémédiable égalité. Du moins je l’espère. On se dirige vers des sociétés où il y aura de moins en moins de relations hiérarchiques entre les hommes.»
Créer des liens à soi, aux autres et à la nature pour réparer ensemble le tissu déchiré du monde, quelle belle image !
Ce livre qui a pour ambition de relier les relieurs, me semble poursuivre un objectif nécessaire à notre temps.
<724>
-
Jeudi 16 Juin 2016
Jeudi 16 Juin 2016« J’ai le seum »David Kuhn & Violette DuplessierNouvelle expression de la jeunesseUn mot du jour un peu plus léger.David Kuhn, journaliste de 42 ans s’est associé à Violette Duplessier, collégienne francilienne de 16 ans pour écrire un livre pour les vieux comme nous afin que nous puissions comprendre la nouvelle langue des ados.<Ce livre a pour titre : J’ai le seum> et pour sous-titre : «Le guide indispensable pour les parents qui souhaitent communiquer avec leurs ados et vice-versa. Il est paru le 2 juin 2016 et coute moins de 10 euros.Avant de l’acheter vous pouvez aller sur ce site pour en comprendre un peu plus : http://que-signifie.org/langage-des-jeunes/que-signifie-avoir-le-seum/«Avoir le seum est une expression que les jeunes emploient pour exprimer leurs frustrations, leurs rancœurs vis à vis d’un événement. Avoir le seum signifie être dégoûté, frustré. Il y a quelques années encore, on aurait entendu « j’ai les boules » ou bien « je suis dégoûté » pour manifester la même sensation. Cette dernière version pouvait être complétée par un suffixe rajoutant à l’emphase linguistique et donnant « je suis dégoûté de la vie ».De la même façon, « avoir le seum » peut aussi être rendu plus intense par l’ajout du mot « trop » largement employé par les jeunes, voire les très jeunes, à la place du mot « très ». Vous savez, quand vos enfants vous disent d’un plat délicieux « c’est trop bon » au lieu de « c’est très bon ». »Plusieurs sources s’accordent pour indiquer que l’origine la plus probable du mot seum serait un dérivé du mot arabe « sèmm » qui signifie « venin ».Si vous voulez encore aller un peu plus loin avant d’acheter le livre, vous avez cet article sur le site de <Libération>Cela donne le langage suivant : « Alors les yeuves, on se croyait pépouze ? Oui vous, les croulants (au moins quadra), on pensait chiller OKLM pendant que d’autres taffent pour le bac ? Sérieux ? Le seum, grave.»L’article de Libé poursuit :Parce qu’il n’y a pas de raison qu’il n’y ait que les ados qui révisent en plein mois de juin, il en est deux qui ont décidé de remettre les parents au travail. Violette Duplessier, collégienne francilienne de 16 ans, et David Kuhn, journaliste, auteur de 42 ans («autant dire, un pied dans la tombe», plaisante-t-il) publient ce jeudi un guide (1) à l’usage des adultes qui souhaiteraient (enfin) comprendre leur progéniture. Au programme ? Une leçon de langage des 12-16 ans, et quelques clés pour se repérer au royaume du sébum.«Ce n’est surtout pas un dictionnaire», précise David Kuhn, pour qui «on est plus proche du guide touristique sans prétention». Destination : l’adolescence. «Pour y avoir séjourné au moins une fois, n’importe quel adulte sait à quel point ce pays est un « Mordor existentiel », écrivent les auteurs en guise de prologue. C’est loin, c’est cher, pas forcément beau, les conditions d’hygiène y sont douteuses et l’autochtone est assez peu avenant, quand il n’est pas carrément hostile.»[…] La dernière tentative marquante d’abaisser le pont-levis entre ces deux mondes remonte à 2014, lorsque parut le Dictionnaire des ados français, de Stéphane Ribeiro (lire Libération du 31 octobre de cette année-là). A ceux qui étaient trop saucés de se prendre pour de bons élèves parce que maîtrisant le swag, vous êtes trop des boloss. «C’est un langage évolutif, qui change rapidement», avertit David Kuhn. D’où les pages blanches à la fin du livre, pour compléter, personnaliser, ou procéder à une interro en règle. D’ici là, un cours de français stylé s’impose. A vos stylos, on ramasse les copies dans deux heures. Et silence dans les rangs. »L’article donne quelques clés :Règle 1 : abrégerLe Nokia 3310 a fait son temps, les smartphones et leurs correcteurs d’orthographe sont partout, et pourtant, l’abréviation continue, semble-t-il, de régner en maître dans les échanges virtuels : «TKT» («t’inquiète»), «SLT» («salut»), mais aussi GlaN («j’ai la haine») ou encore OKLM («au calme», sigle popularisé par Booba dans un single en 2014)… Mais pourquoi tant de flemme ?! La réponse est dans la question, bande d’insolents. «La flemme», souffle Violette Duplessier en levant les yeux au ciel. C’est cette même pulsion de glande qui poussera à lâcher un énigmatique «balec», plutôt que de s’échiner à écrire qu’on s’en frappe les parties ; à amputer «vas-y» de son «v» initial («azy»), ou encore à faire d’«askip» («à ce qu’il paraît») une poétique anaphore. C’est aussi cette délicieuse paresse qui leur fait parfois dire qu’un emoji vaut mieux qu’un long discours. «Moi, au moins, si un parent braque mon Facebook, il comprendra rien», dixit Violette Duplessier. «J’avoue !» («Je suis d’accord avec toi»).Cas pratique :«Azy, askip la prof de français est pas là. TKT on va être OKLM.» («Il semblerait que la professeure de français soit absente. Nous allons pouvoir passer du bon temps.»)Règle 2 : rester flou«C’est un langage volontairement flou, qui louvoie. Un peu comme le jeune, cette anguille», blague David Kuhn. Il n’empêche qu’à bien regarder certains mots présents dans le livre, on ne peut effectivement s’empêcher de se sentir un brin lost in translation : ainsi, si par malheur vous vous épanchez un peu trop sur les platitudes pénibles qui meublent évidemment votre vie de vieux, ne vous étonnez pas de vous voir stoppé(e) d’un «staive» («c’est ta vie»), ou pire, d’un «osef» («on s’en fout»). Plus étonnant encore, les adjectifs à double sens : «dar» peut tour à tour signifier «bien» ou son contraire.Cas pratique :«Gava, être en mode «soum soum» chez les ados, ça déchire.» («Mon gars, cette immersion en sous-marin dans l’adolescence est fort plaisante.»)Règle 3 : tacler«Faites pas crari vous avez tout compris au bouquin» ou sa variante «Crari, vous avez tout compris au bouquin», aurait pu nous lancer n’importe quel spécimen de 15 ans. Comprendre : «Ne prétendez pas avoir tout assimilé, nous ne sommes pas dupes.» Inutile d’essayer de leur «mettre des disquettes» (de les arnaquer, d’abuser de leur confiance) à ces fins limiers, sous peine de passer pour une bouffonne, ou pire : un Kevin. Soit «un individu d’une débilité profonde». L’héritier du mythique et peu enviable Régis des Nuls, en somme.Comprendre les ados, on l’avait pressenti, «c’est ghetto» (ça n’est pas simple), limite on se sent «gâtée». Mais pas comme à Noël quand Mamie tricotait des jolis pulls, plutôt comme une vieille tomate flétrie sur un étal, en fin de marché. «Hassoul» (mot arabe pour «bref»), on aura essayé. Précision importante en matière de survie : «ne vous faites pas de gifs» (de films), le «tête-à-tête» n’a rien de romantique, c’est une exhortation à la bagarre. Ayant renoncé à toute dignité, on se sent désormais «trop rincée». Traduction ? «Nulle, pourrie, qui ne sert à rien.» Merci Violette.Cas pratique :«Crari, tu vas me mettre une disquette ? Viens, on part en tête-à-tête.» («N’imagine pas pouvoir me berner, allons croiser le fer dans une ruelle.»)Règle 4 : être styléAvant la rencontre avec le doctissime spécimen adolescent auteure de cette bible, une collègue chébran a glissé dans notre besace cette interrogation existentielle : peut-on encore dire «chanmé» ? «Non merci», a tranché l’intéressée, intraitable. Quid du «swag» ? «Les gens qui disent swag, je les dénigre, je les bannis, c’est pas mes amis», répond Violette Duplessier (l’adolescence frôle parfois la dictature). Trois heures de colle pour quiconque oserait nous traiter de «has been». Avoir de l’allure de nos jours se dit donc être «frais», «stylé». Les plus séduisant(e)s sont qualifiés de «peufra», verlan de «frappe», employé dans le langage militaire pour évoquer l’envoi de bombes. Vous l’avez ?Les mecs craquants et un brin mauvais garçons (oui, on est restés québlo dans Hélène et les garçons) sont, pour leur part, des «bandidos», allusion, semble-t-il, au gang de bikers texans. Ce qu’on découvre là, c’est du «fat» (ça envoie du lourd). Alors pour fêter ça, «on s’enjaille» ? Selon le Robert, qui vient d’intégrer ce verbe venu de Côte-d’Ivoire et dérivé du enjoy anglais («Il a trahi en passant dans le dico, de l’autre côté», s’amuse David Kuhn), il s’agit là de «s’amuser, faire la fête». Variante : «On va se casser le crâne.» «Mais rien à voir avec l’alcool», jure Violette Duplessier.Cas pratique :«Téma le bandido trop frais de 3e C, il envoie du fat.» («Observe le bellâtre scolarisé en troisième C, il est absolument charmant.»)Je ne sais pas ce que donnerai la Loi travail dans ce langage… -
Mercredi 15 Juin 2016
Mercredi 15 Juin 2016«la réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu’il faut faire»Jean-Claude JunckerPour ce troisième éclairage sur la Loi travail je suis allé chercher mes sources dans le FIGARO, derrière ces liens :Et qu’apprenons-nous grâce à la journaliste Coralie Delaume ?Juncker […] a trouvé judicieux, dans un récent entretien au journal Le Monde de formuler ces quelques regrets: «à voir les réactions que suscite la «loi travail», je n’ose pas m’imaginer quelle aurait été la réaction de la rue, à Paris ou à Marseille, si votre pays avait dû appliquer des réformes comme celles qui ont été imposées aux Grecs». Ah, ces Français rétifs! Comme il est dommage de ne pouvoir vitrifier leur économie avec cette même brutalité joyeuse dont on a usé contre l’économie grecque!Ceci dit, rien n’est jamais perdu pour qui sait s’armer de patience. Durant l’été 2015, au cœur de la «crise grecque», le ministre hellène Yanis Varoufakis avait donné quelques clés pour comprendre la dureté des créanciers vis-à-vis de son pays. Selon lui, la véritable cible des «Européens» (et de l’Allemagne, plus encore que de l’Europe institutionnelle) était en fait l’Hexagone. «La Grèce est un laboratoire de l’austérité, où le mémorandum est expérimenté avant d’être exporté. La crainte du Grexit vise à faire tomber les résistances françaises, ni plus ni moins», avait-il osé. Pour lui, les cibles terminales étaient l’État-providence et le droit du travail français.Or pour Jean-Claude Juncker, il se trouve que «la réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu’il faut faire». Le minimum seulement. Et, avec un peu de chance, de constance et d’audace, une simple étape vers ce rêve éveillé que constitue l’idéal grec! […]«La loi El Khomri c’est la faute à l’Europe», affirme sur son blog Jean-Luc Mélenchon.Pour autant, Mélenchon n’exagérait-il pas en écrivant cela? De son côté, l’économiste Frédéric Farah ne caricaturait-il pas en expliquant à son tour: «comprenons-bien que la loi El Khomri a l’euro pour père, et pour mère la stratégie de Lisbonne de mars 2000»? Ne cédait-il pas à la facilité de «faire de l’Europe un bouc émissaire», selon l’expression consacrée?Hélas, ni l’un ni l’autre n’affabulait ni ne ‘’bouc-émissairisait ». Cette «Loi travail», nous la devons effectivement, pour une bonne part, à notre appartenance communautaire. Pour s’en apercevoir, encore faut-il quitter un instant le terrain des grands principes sur lesquels s’affrontent généralement «européistes» et «eurosceptiques». Il faut ajuster son masque, chausser ses palmes et consentir à plonger dans les eaux froides de la technique. On découvre alors le pot-aux-roses: l’Europe, c’est l’apnée.Il ne faut pas craindre de l’affirmer (d’autant moins qu’on ne risque guère d’être compris): la «Loi travail» nous vient des GOPE. Oui, des GOPE.Les GOPE, ce sont les «Grandes Orientations de Politique Économique». Plus précisément, ce sont des documents préparés par la direction générale des affaires économiques de la Commission européenne. Conformément à l’article 121 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ces documents sont ensuite transmis au conseil Ecofin (c’est à dire à la réunion des ministres européens de l’économie et des finances), puis au Conseil européen (les chefs d’État et de gouvernement). Après validation, les GOPE deviennent des recommandations du Conseil aux pays de l’Union et font l’objet d’un suivi. Toujours selon l’article 121, «le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États membres». Cette «surveillance multilatérale» est rendue possible grâce aux informations généreusement fournies par les États à la Commission. Bref, un joli petit traité de servitude volontaire que le Traité sur le Fonctionnement de l’UE.Au départ toutefois, les GOPE n’étaient que des textes vagues et peu engageants. Pour les rendre plus contraignants et dans l’espoir de donner enfin son plein potentiel à l’idée délicieuse de «surveillance multilatérale», la Commission de Bruxelles s’est chargée d’en accroître la portée au sein d’un document important publié en 1998, à la veille de la mise en place de l’euro.Ce document intitulé Croissance et emploi dans le cadre de stabilité de l’Union économique et monétaire s’intéresse au tout premier chef – comme son nom l’indique – à la question du marché du travail et à l’emploi. Il confère un rôle central aux GOPE et indique de manière claire ce qu’elles doivent contenir, en égrenant l’une derrière l’autre ces formules bien connues au doux parfum de schlague: «stabilité des prix», «assainissement des finances publiques», «modération des salaires nominaux», «renforcement des incitations à la discipline salariale». Bref, toute la panoplie.Depuis qu’elles existent, les GOPE ont toujours contenu des injonctions à réformer le marché du travail. Si l’on examine celles pour 2012 par exemple – parfaitement au hasard: il s’agit juste de l’année de l’élection de François Hollande – on voit que le Conseil recommande à la France de «revoir la législation, notamment la procédure administrative de licenciement». Ou de «veiller à ce que l’évolution du salaire minimum favorise l’emploi, notamment des jeunes, et la compétitivité», ce qui signifie, traduit du Volapük de Bruxelles en Français des Deux-Sèvres ou de Haute-Garonne, qu’il ne faut pas augmenter le SMIC. On notera au passage et juste pour rire qu’il est demandé la même année de «supprimer les restrictions injustifiées sur les professions (vétérinaires, taxis, notaires…) et secteurs réglementés»: bienvenue à toi, ô «loi Macron».Tout cela n’étant pas encore suffisamment abstrus, il a fallu qu’on en rajoute. En mars 2000, on a donc mis en place la «stratégie de Lisbonne», dont l’objet était de faire advenir en Europe [roulements de tambours]: «l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale» [Fermez le ban].La stratégie de Lisbonne – devenue depuis «stratégie Europe 2020» – se veut globale. Elle est surtout labyrinthique. Elle prétend faire superviser par les instances européennes tous les domaines de la vie de tous les pays. Et embrasser dans un même geste les questions liées aux marchés financiers, celles liées à l’éducation, les affaires de finances publiques, celles de protection sociale, de création de PME, d’emploi bien sûr, de veau-vache-cochon-couvée. On en passe, et pas des meilleures.Plus on simule la scientificité, plus ça fait chic et plus on est crédible. Avec la stratégie de Lisbonne, on s’est donc doté d’outils nouveaux et hautement techniques. Pour suivre la question de l’emploi, on a ainsi adjoint aux GOPE les Lignes directrices pour l’emploi (LDE). Les deux ensemble, GOPE et LDE, sont regroupées dans les LDI (lignes directrices intégrées), dont le site de la Commission européenne nous dit ceci: «les lignes directrices intégrées déterminent le champ d’action des politiques des États membres et la direction à suivre dans la coordination de celles-ci. Elles servent de base aux recommandations par pays».Aux recommandations par pays? Tiens donc. Et que recommande-t-on à la France, pour l’année 2016? […] Pour résumer, il est d’abord déploré que «la décélération récente des salaires réels reste insuffisante», que «la France affiche toujours des coûts salariaux parmi les plus élevés de la zone euro, principalement en raison «du niveau élevé des cotisations sociales patronales», ou que «les augmentations du SMIC induisent une compression des salaires vers le haut».A titre de solution, il a ensuite proposé de «maintenir les réductions du coût du travail découlant du CICE», d’œuvrer à limiter davantage «les rigidités du marché du travail» (ce qui signifie qu’il faut faciliter le licenciement), de «faciliter, au niveau des entreprises, les dérogations aux dispositions juridiques générales, notamment en ce qui concerne l’organisation du temps de travail». Dans cette dernière formule, on reconnaît immédiatement l’inspiration des nombreuses dispositions prévues dans la loi El Khomri pour accroître le temps de travail des salariés, tout en rémunérant moins bien, dans certaines conditions, les heures supplémentaires. ( http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/13-mesures-cles-de-la-loi-travail_1791715.html ).[…] La loi El Khomri est le résultat de tout cela, exactement comme le Jobs Act italien de 2015, et comme toutes les réformes du même acabit adoptées ces dernières années en Europe du Sud.En tout état de cause, le gouvernement français a bien travaillé. Le commissaire Valdis Dombrovskis l’en a chaudement félicité lors d’une visite à Paris fin mars. Comme rapporté par le site spécialisé sur les questions européennes EurActiv, le vice-président de la Commission «à l’euro et au dialogue social» (sic) a salué la loi El Khomri comme une heureuse initiative «destinée à répondre aux rigidités du marché du travail, et qui devrait relancer l’emploi».Je rappelle que ce texte se trouve sur le site du FIGARO que je pensais être un journal libéral.Le ton et l’esprit sont très polémiques, mais nous apprenons quand même un certain nombre d’informations étonnantes.Rappelons-nous que la France ne respecte toujours pas les critères qu’elle a promis, plusieurs fois, de respecter dans un délai sur lequel elle s’était engagée et n’a pas tenu.En toute normalité, elle devrait être sanctionnée, c’est à dire soumis à des amendes d’un montant de plusieurs milliards.Mettre en œuvre la Loi qui respecte les injonctions européennes est probablement une condition sine qua non pour pouvoir espérer continuer à bénéficier de la mansuétude de la Commission.Je crois qu’il est intéressant de lire ce point de vue.Cela étant, toutes ces règles qui nous sont imposées ont bien été acceptées par nos représentants légitimes auprès de l’Union européenne.L’Europe n’est pas une Autre, nous en sommes responsables.La mondialisation que nous avons accepté et dont nous profitons présente des effets collatéraux : notamment de remettre en cause des droits sociaux et l’Etat providence.Olivier Ferrand, le fondateur de Terra Nova avait eu cette analyse pertinente que je cite de mémoire : Quand on observe l’Union européenne et qu’on se demande quelle est sa spécificité dans le Monde ? On ne trouve pas le Libéralisme ou le Capitalisme qui se trouve dans bien d’autres pays du Monde. Non, ce qui distingue l’Union Européenne, c’est L’Etat social que personne n’a amené aussi loin. Mais cette spécificité n’a pas été confiée à l’Union !François Mitterrand avait promis : «L’Europe sera sociale ou ne sera pas !».Ces différents éclairages sur la Loi Travail, n’ont pas pour vocation de prétendre qu’il ne faut pas réformer le droit du travail en France, qu’il ne faut pas le simplifier, le rendre plus souple et permettre qu’il existe plus de marges de manœuvre au niveau de l’entreprise.Mais simplement de montrer qu’il faut sortir de la technique des technocrates pour entrer dans le sens et la vision de vrais réformateurs. Le réformateur explique où on va.Mais ce problème n’est pas limité à la France, la social-démocratie est partout en crise en Europe, en Grèce le PASOK a disparu, en Autriche il a été éliminé du second tour de la présidentielle comme la droite conservatrice d’ailleurs, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre les forces sociaux-démocrates sont dans un déclin continuel. Les droites de gouvernement, mis à part en Allemagne, ne vont guère mieux. Les forces politiques qui sont en expansion sont les mouvements nationalistes et le plus souvent xénophobes. Tant il est vrai que si les élites ne sont plus capables de donner un contenu à l’imaginaire collectif, c’est la théorie du bouc émissaire qui reprend le dessus. -
Mardi 14 Juin 2016
Mardi 14 Juin 2016«En haut on parle technique et en bas on ressent le changement du monde et on ressent l’absence de perspective à l’égard de ce changement.»Marcel Gauchet dans les matins de France Culture du 30/05/2016Pour continuer à entendre des gens raisonnables parler de la loi travail, Marcel Gauchet était l’invité de l’émission <les matins de France Culture>Dans cette émission, on a fait écouter à Marcel Gauchet un extrait de l’émission où Alain Touraine exprimait sa colère et dont nous avons parlé hier.Marcel Gauchet disait sa convergence de vue avec cette analyse et expliquait combien en France la valeur travail qui s’était reconstituée dans le monde industriel était importante en France et combien la désindustrialisation est vécue comme un cauchemar par beaucoup.Et il dit :« La technocratie est totalement décalée par rapport à ces enjeux, pour la technocratie, il s’agit de problèmes techniques, mais l’enjeu n’est jamais mesuré.Et c’est ce qui fait la récurrence de ces conflits. On ne parle pas de la même chose en haut et en bas !En haut on parle technique et en bas on ressent le changement du monde, et on ressent l’absence de perspective à l’égard de ce changement, on ne nous promet rien, il n’y a aucune perspective d’ensemble qui se dégage des mesures qui sont prises.Ce sont des ajustements qui ne paraissent avoir aucune prise sur la réalité du mouvement social en cours.La France a en effet une attitude singulière par rapport aux autres pays, qui tient à des racines particulièrement fortes et qui tient aussi à un divorce entre l’élite gouvernante et la population [..] qui a la perception d’une mondialisation aux effets particulièrement destructeurs»Et surtout il montre l’aspect simplement défensif : on dit Non et on ne sait plus à quoi dire Oui !«Ce qui est très frappant dans ces mouvements c’est leur caractère défensif. Et je dirais défaitiste. On ne part pas sur la base d’un projet contre-projet qu’il s’agirait de débattreMais sur la base d’un empêchement d’agir de la part des gouvernants.C’est un mot d’ordre de résistance, d’une résistance à un changement où on se résigne finalement puisqu’on n’a pas de contre-projet à mettre en face.On est dans une société qui est arc bouté dans une identité qu’elle ne veut pas perdre car elle a la conviction que ça ne peut être que pire.Et c’est cela qui est le plus désespérant dans ces mouvements, car le sentiment est que le mouvement va dans l’aggravation de ce qui existe déjà.On n’est plus dans la lutte sociale qui était la lutte pour un avenir meilleur, on est dans la résistance dans un avenir qui ne peut être que pire que le présent que nous vivons.Pendant longtemps on avait face à face un parti de l’ordre qui s’efforçait de céder le moins possible aux revendications sociales en maintenant l’ordre social et un parti de la révolution qui voulait remettre en cause l’ordre établi. C’était des conflits collectifs.Nous sommes entrés dans un marché individuel des intérêts où tout le monde est fondé à défendre « son bout de gras » comme on dit populairement et où à l’arrivée il s’agit d’opérer une sorte de compromis entre les intérêts des uns et des autres. C’est un scénario totalement différent.»Il parle ensuite du vide intersidéral des partis politiques français et des immenses carences de l’Europe qui n’a plus aucune vision stratégique de la place et du rôle que l’Europe doit jouer dans le monde d’aujourd’hui et de demain :«Il serait temps de se réveiller, de voir le monde tel qu’il est et de se mettre d’accord sur ce que nous devons y entreprendre.Toutes les discussions qui se basent sur les acquis sont dépassées par la situation et nécessitent que les choses soient reprises à la racine.Un pouvoir politique doit avoir un projet pour la société.La grande question est de choisir si on laisse la société se débrouiller toute seule ou s’il faut encore faire de la politique pour faire avancer la société.L’autre question est d’essayer de comprendre pourquoi la France est si réticente à se réformer, c’est que probablement la réforme manque de sens.Au centre de la réflexion politique doit être débattue la question de savoir quelles sont les conditions qu’il faut réaliser pour que des réformes nécessaires et utiles peuvent être acceptées par le corps social.»Quand on a l’ambition d’être un réformateur, il faut avoir un projet, savoir l’expliquer, convaincre qu’il est réaliste puis faire les réformes qui sont en cohérence avec ce projet.<En Juin 2011, François Hollande n’était pas encore président et il a écrit dans une tribune :> «S’il n’y a pas au départ des engagements qui permettent de comprendre quel va être le sens de l’action, le rythme des réalisations et la façon dont les urgences vont être hiérarchisées, elle (la gauche) sera emportée par l’ampleur des problèmes. À l’inverse, la clarté, la vérité et la responsabilité seront les gages de notre réussite».Cela rappelle la définition d’un projet.Mais a t’il su suivre ses bons conseils ? -
Lundi 13 Juin 2016
Lundi 13 Juin 2016«Je suis énervé, je suis irrité, parce que je trouve qu’il y a une absence de conscience dans ce pays de ce qui est en jeu.»Alain Touraine, lors de l’émission de France Culture « Dimanche et après du 29/05/2016 »La loi travail dit Loi El Khomri a créé une tension énorme en France, elle oppose notamment les syndicats avec dans le camp des défenseurs de la loi, seconde mouture, la CFDT et dans le camp des opposants la CGT et FO.Du point de vue étranger, personne ne comprend la crispation française devant une Loi qui leur semble très peu libérale au goût des standards internationaux. Elle accrédite l’idée que la France est irréformable.Pour ma part, elle me plonge dans un océan de perplexité.Dans un premier temps j’ai cru comprendre que Robert Badinter aidé du spécialiste du droit du travail Antoine Lyon-Caen a convaincu tout le monde que le code du travail devait être simplifié.Le résultat qui est la loi de la ministre El Khomri est un pavé de plus de 500 pages assez illisibles. C’est une curieuse manière de simplifier !Grosso modo, et c’est ce qui plait à la CFDT, cette loi s’efforce de séparer les droits des salariés de l’entreprise dont ils sont temporairement salarié (étant donné la disparition de l’emploi à vie dans la même entreprise). Cette évolution s’appelle le C.P.A.. Le Compte Personnel d’Activité permettra à chacun, grâce à un point d’entrée unique sur internet, d’accéder facilement à ses droits et de les mobiliser de façon autonome.Pour le reste, l’essentiel est de donner de la souplesse et de la flexibilité en permettant de réaliser des négociations et des compromis au niveau des entreprises par des accords entre des syndicats et le patron de l’entreprise, compromis qui peuvent sur certains points être plus défavorables aux salariés que les conditions standards prévus au niveau de la Loi ou de la Branche, tout en respectant cependant des minimums imposés quand même par la Loi.Les optimistes disent que les salariés et leurs représentants ne sont pas stupides, ils ne sont pas obligés de négocier et que s’ils négocient ils pourront céder sur certains points mais pour mieux obtenir d’autres avantages.Les pessimistes considèrent que la négociation au niveau de l’entreprise se passe dans un rapport de force très défavorable aux salariés et que cela entraînera un dumping social entre entreprises.Troisième point, il s’agit de faciliter et de simplifier les licenciements.Les optimistes disant que si les employeurs savent qu’ils peuvent facilement mettre fin à un CDI, à moindre frais, ils embaucheront d’autant plus facilement des salariés dès que leur activité le leur permet.Les pessimistes trouvant simplement que faciliter le licenciement, conduira mécaniquement à plus de licenciements et donc plus de chômage.Pour essayer d’éclairer ce débat je ne donnerai pas la parole à des libéraux qui trouvent cette Loi largement insuffisante surtout dans sa seconde mouture, ni à ceux qui à gauche estiment que cette loi constitue « le mal libéral absolu ».Je donnerai d’abord la parole au glorieux père d’une des ministres du gouvernement à savoir : Alain Touraine, grand sociologue proche de Michel Rocard et qui aura 91 ans en août prochain, bref le contraire d’un révolutionnaire ou d’un jeune excité.Il avait même soutenu avec vigueur François Hollande en 2012 en publiant cette tribune : < M. Hollande porte les valeurs d’une nouvelle gauche réformatrice>Il était l’invité d’Olivia Gesbert lors de l’émission <Dimanche et après du 29/05/2016>Et voilà ce qu’il a dit lors de cette émission :« Ce qui me fait pleurer, devant cette situation que nous vivons, c’est que j’ai l’impression d’assister en France à la fin de ce qu’on a appelé le mouvement ouvrier. Quand j’ai vu la première version du projet de loi, j’ai eu l’impression que tout ce qui a été fait et gagné pendant 50 ans a été perdu. On parle d’inverser les normes, tout ceci a l’air de détails techniques mais ce ne sont pas des détails techniques. Vous avez en ce moment un pays qui sort avec beaucoup de difficultés de ce qu’on a appelé le monde industriel. Il ne sait pas très bien dans quel autre monde on va entrer mais on sait ce qu’on a gagné à l’époque industrielle et soudain on nous le fout en l’air et c’est tout à fait inacceptable. […]Il s’agit de beaucoup plus que d’un modèle social, il s’agit de 100 ans de notre histoire. De 100 ans dont il faut sortir pour entrer dans un monde nouveau mais dont il faut sortir si on assure nos arrières, pas si on retourne à des situations insupportables. Or la première version de ce texte était insupportable pour des millions de gens. Je ne dis pas que c’était l’intention du gouvernement .Je dis que quand on parle du code du travail on ne parle pas du code de la route, c’est d’une toute autre importance, c’est des siècles de grèves, de luttes. Donner aux gens le sentiment qu’on va effacer tout ça pour être compétitif par rapport à tel ou tel pays c’est insultant.[…]C’est quand même une chose grave. Il y a une incompréhension dont il faut sortir. Le problème de la France c’est qu’elle est en désindustrialisation. La France est un pays moins industriel que l’Italie alors que c’était le contraire pendant 100 ans.Notre grande affaire [est que nous sommes entrés] dans un monde nouveau, dans un monde global, de l’ensemble de la planète […] il s’agit de faire que le monde du travail qui est la base de notre société comprenne qu’il ne s’agit pas de défendre des intérêts acquis […] mais de se battre contre autre chose, et de faire changer [la nouvelle] société qui se profile déjà devant nous. […]Ce n’est pas la gauche qui a perdu le sens de l’histoire du peuple, c’est toute la classe politique, la gauche, la droite et le centre, c’est tout le monde politique.L’Europe par exemple, il y a 30 ans on n’y croyait, on n’y croit plus.On a cru qu’on allait reprendre la croissance après la grande crise financière, il n’y a pas de reprise.Nous sommes aujourd’hui un continent qui n’a plus de sens, qui ne trouve plus de sens à rien, qui ne pense plus, qui n’agit plus.Aujourd’hui on ne parle plus que de l’économie avec ses bons et ses mauvais côtés. Comme s’il n’y avait pas d’acteurs, comme si les gens n’existaient pas, que les gens n’avaient pas de sentiments, pas d’émotions, des désirs, des colères.Nous faisons comme si le monde où nous sommes n’avait aucun sens. C’est ça le fond de l’affaire.[…]Il s’agit face à un monde où nous risquons d’être foutus en l’air, d’être jeté dans un trou il s’agit de savoir si nous allons arriver à nous entendre pour passer à l’étape suivante. Ce qui suppose qu’on ne fait pas reculer ceux qui ont déjà le moins. On n’entre pas dans l’avenir en ne tenant aucun compte de ceux qui n’ont pas eu la gloire du passé, la richesse du passé en leur disant simplement : attendez un peu, dans un siècle ou deux on essayera d’arranger tout ça.Je suis énervé, je suis irrité, parce que je trouve qu’il y a une absence de conscience dans ce pays de ce qui est en jeu.Parlons concrètement, parler aujourd’hui problèmes des Français n’a aucun sens. Tout ce qui se passe en France, comme en Allemagne, comme en Argentine tout ça, ça se joue au niveau mondial […]On se bagarre sur les choses du monde du passé et ces bagarres profitent à ceux qui ont été les profiteurs du passé. Nous sommes une société en petits morceaux alors que nous devons nous mettre à l’échelle du monde. Il ne faut pas renoncer aux droits sociaux il faut les élargir, il faut les repenserLes débats ne sont pas à la hauteur des problèmes extrêmement graves dans lesquelles nous nous trouvons. »Un autre supporter du candidat François Hollande et économiste raisonnable Daniel Cohen a dit <Au départ, la loi El Khomri était totalement déséquilibrée> et il ajoute <La loi Travail reste déséquilibrée>Daniel Cohen affirme notamment qu’un des manques de la loi celle qu’elle ne permet pas « de ressourcer le syndicalisme » car pour que les négociations au niveau de l’entreprise puisse être efficace et équilibrée il faut un syndicalisme fort.Mais je retiens surtout de la saine colère d’Alain Touraine, qu’il faut savoir donner du sens à une réforme, c’est cela l’essence du réformateur sinon on a affaire à un technocrate qui lui se cache derrière des mesures techniques… -
Vendredi 10 Juin 2016
Vendredi 10 Juin 2016« Sapere aude !
Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen !»
« Ose savoir !
Aie le courage de te servir de ton propre entendement !»Emmanuel Kant <Qu’est-ce que les Lumières ?> Essai de 1784Quel premier mot du jour écrire après la série de Sapiens ?L’idée m’est venu d’évoquer les philosophes des Lumières et notamment l’un d’entre eux, Emmanuel Kant, qui a essayé par un ouvrage, écrit en 1784, de répondre à cette question « qu’est-ce que les Lumières ?»Dans sa définition il fait d’abord référence à une locution latine à l’origine empruntée au poète latin Horace (-65,-8) (Épitres, I, 2, 40) qui signifie « Ose savoir ! ».Emmanuel Kant répond dans son essai à la question posée de la manière suivante : « Le mouvement des Lumières est la sortie de l’homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d’autrui, minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l’entendement mais dans un manque de décision et de courage de s’en servir sans la direction d’autrui. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Voilà la devise des Lumières. »Une autre traduction donne cela : « L’Aufklärung permet à l’homme de sortir de l’immaturité dont il est lui-même responsable. L’immaturité est l’incapacité d’employer son entendement sans être guidé par autrui. Cette immaturité lui est imputable non pas si le manque d’entendement mais si le manque de résolution et de courage d’y avoir recours sans la conduite d’un autre en est la cause. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! voilà donc la devise de l’ Aufklärung. »Et en version originale : « Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.» -
Mercredi 8 juin 2016
Mercredi 8 juin 2016« Malgré les choses étonnantes dont les hommes sont capables, nous sommes peu sûrs de nos objectifs et paraissons plus que jamais insatisfaits. »« Sapiens : Une brève histoire de l’humanité » les deux dernières pagesIl faut savoir s’arrêter, ceci est le 13ème et dernier mot du jour consacré à « Sapiens ».Le livre se termine par un épilogue dont le titre est : « un animal devenu Dieu ?« Voici 70 000 ans, Homo sapiens n’était encore qu’un animal insignifiant qui vaquait à ses affaires dans un coin de l’Afrique. Au fil des millénaires suivants il s’est transformé en maître de la planète entière et en terreur de l’écosystème. Il est aujourd’hui en passe de devenir un Dieu, sur le point d’acquérir non seulement une jeunesse éternelle, mais aussi les capacités divines de destruction et de création.Par malheur, le régime du sapiens sur terre n’a pas produit jusqu’ici grand-chose dont nous puissions être fiers. Nous avons maîtrisé ce qui nous entoure, accru la production alimentaire, construit des villes, bâti des empires et créés de vastes réseaux commerciaux.Mais avons-nous fait régresser la masse de souffrance dans le monde ?Bien souvent, l’accroissement massif de la puissance humaine n’a pas nécessairement amélioré le bien-être individuel des sapiens tout en infligeant d’immenses misères aux autres animaux.Pour ce qui est de la condition humaine, nous avons accompli de réels progrès au cours des toutes dernières décennies, avec la régression de la famine, des épidémies et de la guerre.Mais la situation des autres animaux se dégrade plus rapidement que jamais, et l’amélioration du sort de l’humanité est trop récente et fragile pour qu’on en soit assurés.En outre, malgré les choses étonnantes dont les hommes sont capables, nous sommes peu sûrs de nos objectifs et paraissons plus que jamais insatisfaits. Des canoës nous sommes passés aux galères, puis aux vapeurs et aux navettes spatiales, mais personne ne sait où nous allons.Nous sommes plus puissants que jamais, mais nous ne savons trop que faire de ce pouvoir. Pis encore, les humains semblent plus irresponsables que jamais.Self-made-dieux avec juste les lois de la physique pour compagnie nous n’avons de comptes à rendre à personne. Ainsi faisons-nous des ravages parmi les autres animaux et dans l’écosystème environnant en ne cherchant guère plus que nos aises et notre amusement, sans jamais trouver satisfaction.Y a-t-il rien de plus dangereux que des dieux insatisfaits et irresponsables qui ne savent pas ce qu’ils veulent ? » -
Mardi 7 juin 2016
Mardi 7 juin 2016« La singularité »« Sapiens : Une brève histoire de l’humanité » pages 483-489Le dernier chapitre du livre, juste avant l’épilogue de 2 pages que nous verrons demain, s’intitule « La singularité ».
J’ai hésité à utiliser comme exergue de ce mot du jour plutôt que le titre du chapitre, sa dernière phrase : « Si cette question ne vous donne pas le frisson, c’est probablement que vous n’avez pas assez réfléchi».
A ce stade il faut parler d’un homme Ray Kurzweil qui pour certains est un génie, pour d’autres un fou mais qui est le chantre de ce concept : « la singularité » ou pour être plus précis : « La singularité technologique ».Mais qu’appelle t’on singularité ?
En science, ce concept est surtout utilisé pour qualifier le « big bang ». Depuis le big bang nous disposons d’outils et de théories qui peuvent décrire et expliquer comment l’univers a évolué. Mais nous ne disposons d’aucun élément de compréhension pour décrire ce qu’il y avait avant. Le big bang est donc un point de singularité, c’est une rupture.
Du point de vue de la physique, « un trou noir » constitue également une singularité où nos outils de conceptualisation et de compréhension s’arrêtent, ne parviennent plus à concevoir.Kurzweil est appelé le pape du transhumanisme qui est ce mouvement intellectuel auquel adhère beaucoup des responsables de la silicon valley et qui était le sujet du mot du jour du 18 septembre 2014.
Ray Kurzweil qui est aujourd’hui directeur de l’ingénierie chez Google n’a pas inventé le concept de « la singularité technologique » mais l’a popularisé avec un autre intellectuel qui a joué un rôle de premier plan : le mathématicien Vernor Vinge. Ray Kurzweil a d’ailleurs participé à la création de l’Université de la singularité <qui arrive en France nous apprend cet article du site Philomag>
Mais en deux mots de quoi s’agit-il ?
D’abord de l’arrivée à maturité de l’intelligence artificielle, c’est-à-dire à une intelligence artificielle qui aurait conscience de son existence et de son intelligence.
Cette intelligence surhumaine produirait alors un progrès qui n’est plus linéaire comme du temps des humains mais exponentiel. C’est du moins ce que prédit Kurzweil. D’où la singularité, un point de rupture.
Si vous voulez en savoir plus, Wikipedia contient une page très documenté et aussi critique: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A9_technologique>
<Il y a aussi cet article de Rue 89 qui date déjà de 2013>
<Il y aussi cet entretien avec Kurzweil du Financial Times reproduit par Le nouvel economiste>/
Mais revenons à ce que dit Harari. Je commencerai par un entretien de Yuval Noah Harari avec un journal israélien : <Times of israel> :
« A travers l’histoire, il y a eu de nombreuses révolutions économiques, politiques et technologiques, mais une chose est restée inchangée : l’humanité elle-même. Nous avons toujours le même corps et le même esprit que nos ancêtres dans l’Empire romain et l’Egypte ancienne. Pourtant, dans les décennies à venir, pour la première fois dans l’histoire, l’humanité elle-même subira une révolution radicale. Non seulement nos outils et nos politiques, mais aussi nos corps et nos esprits seront transformés par l’ingénierie génétique, la nanotechnologie et les interfaces cerveau-ordinateur. Les corps et les esprits seront les produits de l’économie du 21e siècle ».Harari déclare que quand nous pensons au futur, nous pensons généralement au monde dans lequel les humains nous sont semblables pour toutes les choses importantes mais disposent d’une meilleure technologie : des armes lasers, des robots intelligents et des vaisseaux spatiaux qui voyagent à la vitesse de la lumière.« Pourtant, le potentiel révolutionnaire des technologies futures est de changer l’Homo sapiens lui-même, y compris nos corps et nos esprits, et pas seulement nos véhicules et nos armes. La chose la plus impressionnante du futur ne sera pas les vaisseaux spatiaux, mais les êtres qui les conduisent ».« Etant donné le rythme effréné des développements dans la biotechnologie et l’intelligence artificielle, je serai extrêmement surpris si d’ici 200 ans, la terre était encore peuplée par des humains comme vous et moi. Nous sommes probablement une des dernières générations d’Homo Sapiens. Nous avons encore des petits-enfants, mais je ne suis pas sûr que nos petits-enfants auront des petits-enfants. Ou du moins, des humains. Ils seront plus différents de nous que nous sommes différents des hommes de Neandertal ou des chimpanzés ».Cet article revient alors sur la notion de singularité« […] La Singularité est la notion que d’ici quelques générations, la technologie deviendra si sophistiquée qu’elle atteindra un point de basculement où elle changera l’existence humaine dans des manières inconcevables pour nous aujourd’hui.[…] Vernor Vinge prédit que cela aura lieu en 2030 tandis que Ray Kurzweil, un cadre de Google, penche plutôt pour 2045. La plupart croit que la Singularité arrivera avec l’intelligence artificielle, au moment où les robots prendront conscience d’eux-mêmes.Kurzweil prévoit une utopie où les humains, au moins certains humains, obtiendront l’immortalité en devenant des cyborgs. »L’article rappelle alors que certains scientifiques comme le physicien Stephen Hawking ou l’entrepreneur Elon Musk craignent que des robots d’intelligence artificielle puissent se retourner contre leurs créateurs humains et les tuer. Cette mise en garde avait fait l’objet du mot du jour du jeudi 5 février 2015 dont l’exergue était cette phrase de Rabelais : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »Mais Harari est plus proche de la vision de Kurzweil :« Je pense qu’il est beaucoup plus probable que nous fusionnerons avec les robots, plutôt qu’ils se révolteront et nous tueront. Le grand danger n’est pas qu’une intelligence artificielle (IA) nous assassinera, mais plutôt que l’intelligence artificielle supérieure rende la plupart des humains inutiles. Des algorithmes informatiques rattrapent les humains dans de plus en plus de champs cognitifs. Il est extrêmement improbable que les ordinateurs développeront quelque chose de proche de la conscience humaine, mais afin de remplacer des humains dans l’économie, des ordinateurs n’ont pas besoin de conscience. Ils ont seulement besoin d’intelligence ».Mais si on lit les pages 483 à 489 de « Sapiens » on verra que la vision de Harari est beaucoup moins optimiste et enthousiaste que celle de Kurzweil :« Tous ces dilemmes sont bien peu de choses au regard des implications éthiques, sociales et politiques du Projet Gilgamesh et de nos nouvelles capacités potentielles de créer des surhommes. La Déclaration universelle des droits de l’homme, les programmes médicaux officiels, les programmes nationaux d’assurance-santé et les constitutions des divers pays à travers le monde reconnaissent qu’une société humaine digne de ce nom doit assurer à tous ses membres un traitement médical équitable et veiller à ce qu’ils restent en relativement bonne santé. Tout cela était bel et bien tant que la médecine se souciait avant tout de prévenir la maladie et de guérir les malades. Que se passerait-il du jour où la médecine se souciera d’accroître les facultés humaines ? Tous les hommes y auraient-ils droit, ou verrait-on se former une nouvelle élite de surhommes ?Notre monde moderne se targue de reconnaître, pour la première fois de l’histoire, l’égalité foncière de tous les hommes. Il pourrait être sur le point de créer la plus inégale de toutes les sociétés. Tout au long de l’histoire, les classes supérieures ont toujours prétendu être plus intelligentes, plus fortes et dans l’ensemble meilleures que les classes inférieures. Généralement, elles s’illusionnaient. Le bébé d’une famille paysanne sans le sou avait toute chance d’être aussi intelligent que le prince héritier. Grâce aux nouvelles capacités médicales, les prétentions des classes supérieures pourraient bientôt devenir une réalité objective.Ce n’est pas de la science-fiction. La plupart des scénarios de science-fiction décrivent un monde dans lequel des Sapiens – pareils à nous – jouissent d’une technologie supérieure : des vaisseaux spatiaux qui se déplacent à la vitesse de la lumière, par exemple, ou des fusils-laser. Les dilemmes éthiques et politiques qu’on trouve au cœur de ces intrigues sont empruntés à notre monde et ils ne font que recréer nos tensions émotionnelles et sociales sur une toile de fond futuriste. En revanche, les technologies futures sont à même de changer l’Homo sapiens lui-même, y compris nos émotions et nos désirs, pas simplement nos véhicules et nos armes. Qu’est-ce qu’un vaisseau spatial en comparaison d’un cyborg éternellement jeune, qui ne se reproduit pas et n’a pas non plus de sexualité, qui peut partager directement ses pensées avec d’autres êtres, dont les capacités de concentration et de remémoration sont mille fois supérieures aux nôtres et qui n’est jamais en colère ni triste, mais qui a des émotions et des désirs que nous ne saurions même commencer à imaginer ?La science-fiction décrit rarement un avenir pareil, parce qu’une description exacte est par définition incompréhensible. Produire un film sur la vie d’un super-cyborg, c’est un peu donner Hamlet devant un public de Neandertal. En fait, les futurs maîtres du monde seront probablement plus différents de nous que nous ne le sommes des Neandertal. Au moins les Neandertal et nous sommes-nous humains ; nos héritiers seront pareils à des dieux.[…]Sauf catastrophe nucléaire ou écologique […] le rythme du développement technique conduira sous peu au remplacement d’Homo sapiens par des êtres entièrement nouveaux dont le physique sera différent, mais dont l’univers cognitif et émotionnel sera aussi très différent. La plupart des Sapiens trouvent cette perspective pour le moins déconcertante. Nous aimons à croire qu’à l’avenir des gens comme nous iront d’une planète à l’autre à bord de vaisseaux spatiaux. Nous n’aimons pas envisager la possibilité qu’il n’y ait plus d’êtres dont les émotions et les identités soient semblables aux nôtres, et que notre place soit prise par des formes de vie étrangères dont les capacités écraseront les nôtres.[…]Nous aurions du mal à admettre que les savants puissent manipuler les esprits aussi bien que les corps, et que les futurs Dr. Frankenstein pourraient donc créer quelque chose qui nous est réellement supérieur, un être qui nous regardera de haut, comme nous considérons les Neandertal.Toutefois, Harari est un homme sérieux, sage et prudent. Il rappelle que d’autres prophéties ne se sont pas réalisées non plus et que dès lors rien ne dit que « la singularité technologique » existera un jour :« Nous ne saurions savoir avec certitude si les Frankenstein d’aujourd’hui vont accomplir cette prophétie. L’avenir est inconnu, et il serait surprenant que les prévisions des toutes dernières pages se réalisent pleinement. L’histoire nous apprend que ce qui nous semble à portée de main ne se matérialise jamais en raison de barrières imprévues, et que d’autres scénarios qu’on n’avait pas imaginés se réalisent. Quand l’âge du nucléaire est arrivé dans les années 1940, on a vu se multiplier les prévisions sur le futur monde nucléaire de l’an 2000. Quand le spoutnik et Apollo 11 embrasèrent l’imagination du monde, tout le monde se mit à prédire que, d’ici la fin du siècle, on vivrait dans des colonies spatiales sur Mars et Pluton. Peu de ces prévisions ont été confirmées. Par ailleurs, nul n’avait prévu l’Internet. »Il envisage cependant, la possibilité de la singularité :« […]De combien de temps disposons-nous ? Nul ne le sait vraiment. Certains disent qu’en 2050 quelques humains seront déjà a-mortels. Des prévisions moins radicales parlent du siècle prochain, ou du prochain millénaire. Mais que valent quelques millénaires dans la perspective des 70 000 années d’histoire du Sapiens ?Si le rideau est effectivement sur le point de tomber sur l’histoire du Sapiens, nous, qui sommes membres de ses dernières générations, nous devrions prendre le temps de répondre à une dernière question : que voulons-nous devenir ?Cette question, parfois connue en anglais sous le nom de Human Enhancement Question – la question du « corps augmenté » ou du « développement humain artificiel » –, écrase les débats qui préoccupent actuellement la classe politique, les philosophes, les savants et les gens ordinaires. Après tout, le débat présent entre religions, idéologies, nations et classes est très probablement appelé à disparaître avec l’Homo Sapiens. Si nos successeurs fonctionnent bel et bien sur un niveau de conscience différent (ou, peut-être, possèdent quelque chose au-delà de la conscience que nous ne saurions même concevoir), il semble douteux que le christianisme ou l’islam les intéresse, que leur organisation sociale puisse être communiste ou capitaliste, ou que leur genre puisse être masculin ou féminin. […]La plupart des gens préfèrent ne pas y penser. Même dans le domaine de la bioéthique, on préfère se poser une autre question : « Qu’est-il interdit de faire ? » Est-il acceptable de faire des expériences génétiques sur des êtres humains vivants ? Sur des fœtus avortés ? Des cellules-souche ? Est-il éthique de cloner des moutons ? Et des chimpanzés ? Et qu’en est-il des humains ?Ce sont toutes des questions importantes, mais il est naïf d’imaginer que nous pourrions simplement donner un grand coup de frein et arrêter les grands projets scientifiques qui promeuvent l’Homo sapiens au point d’en faire un être d’une espèce différente. Car ces projets sont inextricablement mêlés à la quête de l’immortalité : le Projet Gilgamesh. Demandez donc aux chercheurs pourquoi ils étudient le génome, essaient de relier un cerveau à un ordinateur ou de créer un esprit à l’intérieur d’un ordinateur.Neuf fois sur dix, vous recevrez la même réponse standard : nous le faisons pour guérir des maladies et sauver des vies humaines. Alors même que créer un esprit dans un ordinateur a des implications autrement plus spectaculaires que soigner des maladies psychiatriques, telle est la justification classique que l’on nous donne, parce que personne ne peut y redire quoi que ce soit. De là vient que le Projet Gilgamesh soit le vaisseau amiral de la science. Il sert à justifier tout ce que fait la science. Le Dr. Frankenstein est juché sur les épaules de Gilgamesh. Puisqu’il est impossible d’arrêter Gilgamesh, il est aussi impossible d’arrêter le Dr. Frankenstein.La seule chose que nous puissions faire, c’est influencer la direction que nous prenons. Mais puisque nous pourrions bien être capables sous peu de manipuler nos désirs, la vraie question est non pas « Que voulons-nous devenir ? » mais « Que voulons-nous vouloir ? » Si cette question ne vous donne pas le frisson, c’est probablement que vous n’avez pas assez réfléchi. »Vous comprenez maintenant mieux, le premier mot du jour consacré à ce livre : «L’Histoire commença quand les humains inventèrent les dieux et se terminera quand les humains deviendront des dieux.» -
Lundi 6 juin 2016
Lundi 6 juin 2016« Le projet Gilgamesh »« Sapiens : Une brève histoire de l’humanité » pages 313-316L’Histoire de notre espèce, tel que la décrypte Yuval Noah Harari dans son livre « Sapiens » rencontre à la fin de son ouvrage notre modernité.Modernité sur laquelle travaillent les ingénieurs et les idéologues de la Silicon Valley.Les esprits ouverts et critiques qui se rendent dans la silicon Valley reviennent tous avec une grande surprise, car ils pensaient que dans la Silicon Valley ils trouveraient quelques financiers et pour le reste quasi exclusivement des informaticiens, la fine fleur du génie informatique. Certes, ils trouvent cela, mais la surprise vient du fait du nombre de médecins, de biologistes et de chercheurs dans tout le spectre de la médecine.Je n’ai jamais mieux compris cette réalité étonnante que lorsque j’ai écouté cette passionnante émission : <de France Culture, Du grain à moudre et qui posait cette question : Le numérique fait-il de nous une civilisation supérieure ?>Dans cette émission, outre, des spécialistes du numérique, une spécialiste de la Préhistoire était aussi invité : Marylène Patou-Mathis, et son regard décalé était absolument passionnant.Mais pourquoi tous ces chercheurs dans le domaine médical ?Car il y a bien une philosophie en œuvre dans l’imaginaire des penseurs des GAFA, le big data, les objets connectés, la capacité de fabriquer des organes humains, de remplacer des membres détruits par des objets créés etc… : La quête de l’immortalité.Il y a désormais de nombreux articles et livres qui ont abordé cette question de manière très sérieuse. Car cela est très sérieux, il ne s’agit pas de quelques paroles en l’air, mais d’un but de recherche où des entreprises privées injectent des milliards de dollars.Vous trouverez ci-après un article de 2013 : <L’homme qui vivra 1 000 ans est déjà né>Dans cet article, le journaliste s’entretient avec Laurent Alexandre,Laurent Alexandre, né le 10 juin 1960, n’est pas un farfelu. C’est un chirurgien-urologue français qui en outre a créé un site de vulgarisation médicale très sérieux que toutes les personnes qui s’intéressent à leur santé connaissent : doctissimoIl a écrit un livre au titre très explicite : <La mort de la mort>Luc Ferry vient de publier un ouvrage « La révolution transhumaniste : comment la technomédecine et l’uberisation du monde vont bouleverser nos vies » où il parle aussi de ces perspectives tout en restant plus prudent en parlant plutôt d’allongement de la durée de vie.Dans un échange très fécond il a dialogué avec Michel Onfray et Alain Finkelkraut dans <l’émission de ce dernier de ce samedi 4 juin 2016>.Mais que dit Yuval Noah Harrari de cette quête qu’il appelle « le projet Gilgamesh » ?Il rappelle d’abord le mythe<de l’épopée de Gilgamesh>« [Il s’agit ] du mythe le plus ancien qui nous soit parvenu : le mythe de Gilgamesh, de l’antique Sumer, dont le héros est l’homme le plus fort et le plus capable du monde : le roi Gilgamesh d’Uruk, qui pouvait vaincre tout le monde au combat. Un jour, meurt son meilleur ami, Enkidu. Gilgamesh resta assis à côté de son corps et l’observa plusieurs jours durant, jusqu’à ce qu’il vît un ver sortir de la narine de son ami. Saisi d’horreur, Gilgamesh résolut de ne jamais mourir. Il trouverait bien le moyen de vaincre la mort. Gilgamesh entreprit alors un voyage au bout de l’univers, tuant des lions, bataillant contre des hommes-scorpions et trouvant le chemin des enfers. Là, il brisa les mystérieuses « choses de pierre » d’UrShanabi, le nocher du fleuve des morts, et trouva Utnapishtim, le dernier survivant du Déluge originel. Mais Gilgamesh échoua dans sa quête et s’en retourna les mains vides, toujours aussi mortel, mais avec un surcroît de sagesse. Quand les dieux créèrent l’homme, avait-il appris, ils avaient fait de la mort la destinée inévitable de l’homme, et l’homme doit apprendre à vivre avec elle. »Et il introduit ce sujet de la manière suivante :« De tous les problèmes apparemment insolubles de l’humanité, il en est un qui est resté le plus contrariant, intéressant et important : le problème de la mort. Avant la fin des Temps modernes, la plupart des religions et des idéologies tenaient pour une évidence que la mort était notre inéluctable destin. De plus, la plupart des religions en firent la principale source de sens dans la vie. Essayons donc d’imaginer l’islam, le christianisme ou la religion de l’Égypte ancienne sans la mort. Toutes ces religions ont enseigné aux fidèles qu’ils devaient s’accommoder de la mort et placer leurs espoirs dans l’au-delà plutôt que de chercher à vaincre la mort pour vivre éternellement ici sur terre. Les meilleurs esprits s’employaient à donner un sens à la mort, non pas à essayer d’en triompher. »[…]« Les adeptes du progrès ne partagent pas ce défaitisme. Pour les hommes de science, la mort n’est pas une destinée inévitable, mais simplement un problème technique. Si les gens meurent, ce n’est pas que les dieux l’aient décrété, mais en raison de divers échecs techniques : crise cardiaque, cancer, infection. Et chaque problème technique a une solution technique. Si le cœur flanche, on peut le stimuler par un pacemaker ou en greffer un autre. Si un cancer se déchaîne, on peut le tuer par des médicaments ou des rayons. Les bactéries prolifèrent ? Les antibiotiques les soumettront. Certes, pour l’heure, nous ne pouvons résoudre tous les problèmes techniques, mais nous y travaillons. Nos meilleurs esprits ne perdent pas leur vie à essayer de donner un sens à la mort. Ils s’occupent plutôt à étudier les systèmes physiologiques, hormonaux et génétiques responsables de la maladie et du vieillissement. Ils mettent au point de nouveaux médicaments, des traitements révolutionnaires et des organes artificiels qui allongeront nos vies et pourraient un jour vaincre la Grande Faucheuse.Récemment encore, on n’aurait jamais entendu des hommes de science, ou quiconque, tenir un langage aussi péremptoire. « Vaincre la mort ? Sottise ! Nous essayons simplement de soigner le cancer, la tuberculose et la maladie d’Alzheimer », protestaient-ils. Les gens évitaient la question de la mort parce que l’objectif semblait trop insaisissable. Pourquoi susciter des espérances déraisonnables ? Mais nous en sommes à un stade où nous pouvons parler sans détours. Le grand projet de la Révolution scientifique est d’apporter à l’humanité la vie éternelle. »Bien sûr cet objectif peut être encore assez lointain. Mais Harari montre aussi comment ce projet ne vient pas de nulle part, mais est aussi le fruit de l’évolution récente de l’imaginaire de Sapiens :« Combien de temps prendra le Projet Gilgamesh – la quête de l’immortalité ? Cent ans ? Cinq cents ? Mille ? Quand on songe au peu que nous savions sur le corps humain en 1900, et à la masse de connaissances accumulées en un siècle, on est fondé à être optimiste. Des spécialistes de génie génétique ont dernièrement réussi à multiplier par six l’espérance de vie moyenne du ver Caenorhabditis elegans . Pourquoi ne pas en faire autant pour Homo sapiens ? Des spécialistes en nanotechnologie travaillent à un système immunitaire bionique composé de millions de nano-robots, qui habiteraient nos corps, ouvriraient les vaisseaux sanguins obstrués, combattraient virus et bactéries, élimineraient les cellules cancéreuses et inverseraient même le processus de vieillissement. Quelques chercheurs sérieux suggèrent qu’en 2050 certains hommes deviendront a-mortels (non pas immortels, parce qu’ils pourraient toujours mourir d’une maladie ou d’une blessure, mais a-mortels : en l’absence de traumatisme fatal, leur vie pourrait être prolongée à l’infini).Que le Projet Gilgamesh réussisse ou non, dans une perspective historique il est fascinant de voir que la plupart des religions et idéologies modernes ont déjà exclu la mort de l’équation. Jusqu’au XVIIIe siècle, la plupart des religions mettaient la mort et ses suites au centre de la question du sens de la vie. À compter du Siècle des Lumières, les religions et idéologies comme le libéralisme, le socialisme et le féminisme se désintéressèrent totalement de la vie après la mort. Qu’advient-il d’un communiste après sa mort ? D’un capitaliste ? Et d’une féministe ? Il est absurde de chercher la réponse dans les écrits de Marx, d’Adam Smith ou de Simone de Beauvoir. Le nationalisme est la seule idéologie moderne qui accorde encore à la mort un rôle central. Dans ses moments plus poétiques et désespérés, il promet à quiconque meurt pour la nation qu’il vivra à jamais dans sa mémoire collective. Mais cette promesse est si nébuleuse que même la plupart des nationalistes ne savent trop qu’en faire. »Deux réflexions encore sur ce sujet :D’abord du philosophe André Comte-Sponville qui devant cette perspective de la mort de la mort a dit qu’il détesterait une société issue d’une telle évolution d’abord parce que ce serait un monde uniquement de vieux et ensuite que ce serait un monde de trouillards.De vieux, inutile d’expliquer mais de trouillards ? Tout simplement parce que la mort serait repoussé mais vous pourriez quand même être tué dans un accident, une explosion, un feu etc. Aujourd’hui nous faisons des tas de choses sans trop y penser parce que nous avons intégré le fait d’être mortel. Mais dans un monde où l’immortalité serait le standard, nous n’oserions plus agir devant le moindre risque.Ensuite mon fils Alexis qui m’a dit simplement un jour quand nous discutions de cela : « Mais qu’appelle t’il « vie » ces gens-là ? Tu aurais mille ans mais rien de ce que tu es aujourd’hui n’aurait subsisté : tu aurais d’autres organes, probablement un autre cerveau, on aurait probablement remplacé tout ce qui fait ton être physique aujourd’hui ».Alexis, qui fête ses 25 ans aujourd’hui, possède déjà une bien belle sagesse.Souhaiterions-nous vivre dans ce monde d’a-mortel ? -
Vendredi 3 juin 2016
Vendredi 3 juin 2016« Les fonds de Alexander Webster et Robert Wallace »Une autre histoire racontée par Harari dans Sapiens pages 302 à 305Harari va nous raconter une nouvelle histoire de deux hommes de Dieu très prévoyants, si prévoyants que pour les choses terrestres ils font assez peu confiance à Dieu, mais beaucoup dans les mathématiques.« En 1744, deux pasteurs presbytériens d’Écosse, Alexander Webster et Robert Wallace, décidèrent de créer un fonds d’assurance-vie qui verserait des pensions aux veuves et aux orphelins des ecclésiastiques morts. Ils proposèrent que chaque pasteur verse une petite fraction de son revenu au fonds, qui placerait leur argent. Si un pasteur mourrait, sa veuve toucherait des dividendes sur les profits réalisés par le fonds. Ainsi pourraient-elles vivre confortablement pour le restant de ses jours.Mais pour déterminer à combien devait s’élever la cotisation des pasteurs pour que le fonds eut de quoi honorer ses obligations, Alexander Webster et Robert Wallace avaient besoin de pouvoir prédire : combien de pasteurs mourraient chaque année ; combien de veuves et d’orphelins ils laisseraient et combien d’années les veuves survivraient à leur époux. »A ce stade, l’auteur facétieux, relève l’attitude réservée des deux pasteurs devant la providence et les textes sacrés :« Remarquez bien ce que les deux hommes d’église ne firent pas. Ils n’implorèrent pas Dieu dans leurs prières pour qu’il leur révèle la réponse. Ils ne recherchèrent pas une réponse dans les saintes écritures ni dans les œuvres des anciens théologiens. Ils n’entrèrent pas non plus dans une dispute philosophique abstraite. »Quand on s’éloigne des livres sacrés, il est possible de faire appel à l’intelligence et au raisonnement scientifique :« Écossais, ils avaient le sens pratique. Ils contactèrent un professeur de mathématiques de l’université d’Édimbourg, Colin Mac Laurin. Tous trois recueillirent les données sur l’âge auquel les gens mouraient et s’en servirent pour calculer combien de pasteurs étaient susceptibles de trépasser chaque année.Leur travail se fondait sur diverses percées récentes dans le domaine des statistiques et des probabilités, dont la loi des grands nombres de Jacob Bernoulli. Ce dernier avait codifié un principe : sans doute était-il est difficile de prédire avec certitude un fait unique, comme la mort d’un particulier, mais il était possible de prédire avec une grande exactitude l’occurrence moyenne de nombreux événements semblables. Autrement dit, si Mac Laurin ne pouvait se servir des mathématiques » pour dire si Alexander Webster et Robert Wallace mourraient l’année suivante, avec suffisamment de données il pouvait leur dire combien de pasteurs presbytériens écossais mourraient très certainement l’année suivante ».Par chance, ils avaient des données toutes prêtes dont ils pouvaient se servir. Les tables de mortalité qu’Edmond Halley avait publiées un demi-siècle auparavant se révélèrent particulièrement utiles. Halley avait analysé les dossiers de 1238 naissances et 1174 décès obtenus auprès de la ville de Breslau, en Allemagne. Les tableaux d’Halley permettaient de voir par exemple, qu’une personne de 20 ans a une chance sur 100 de mourir une année donnée, mais qu’on passe à une chance sur 39 pour une personne âgée de 50 ans.Partant de ces chiffres, Alexander Webster et Robert Wallace conclurent qu’il y aurait en moyenne, à tout moment, 930 pasteurs presbytériens écossais vivants. Une moyenne de 27 mourrait chaque année, dont 18 qui laisseraient une veuve. Cinq des pasteurs sans veuves laisseraient des orphelins, et deux des pasteurs quittant une veuve éplorée laisseraient aussi des enfants nés de précédents mariages qui n’avaient pas encore atteint l’âge de seize ans. Ils calculèrent, en outre combien de temps s’écoulerait probablement avant qu’une veuve ne meurt à son tour ou se remarie (ces deux éventualités suspendant le versement de la pension).Ces chiffres permirent à Alexander Webster et Robert Wallace de déterminer le montant de la cotisation des pasteurs soucieux de pourvoir aux besoins des leurs. Avec 2 livres, 12 shillings et 2 pence par an, un pasteur avait la certitude que sa veuve toucherait au moins 10 livres chaque année : une somme rondelette en ce temps-là. S’il estimait que cela ne suffisait pas, libre à lui de cotiser davantage, jusqu’à six livres, onze shillings et trois pence par an, ce qui assurerait à sa veuve la coquette somme de 25 livres par an.En 1765, suivant leurs calculs, le fonds de prévoyance des enfants des pasteurs de l’église d’Écosse auraient un capital de 58 348 £. Leurs calculs se révélèrent d’une exactitude stupéfiante. Cette année-là, le capital du fonds s’élevait à 58 347 £, soit une livre de moins que prévu ! »Cette œuvre que les deux pasteurs ont démarré en 1744, existe toujours :« Aujourd’hui, le fonds de Webster et Wallace, connu simplement sous le nom de « Scottish Widows » est une des plus grandes compagnies d’assurance du monde. Avec des actifs d’une valeur de 100 milliards de livres sterling, elle assure non seulement les veuves écossaises, mais quiconque veut souscrire une police d’assurance. »Bien sûr, Harari raconte une histoire vraie pour mieux comprendre l’évolution de Sapiens« Les calculs de probabilité comme ceux qu’utilisèrent nos deux pasteurs écossais allaient devenir le fondement de la science actuarielle (qui est au centre du marché des pensions et des assurances), mais aussi de la démographie (elle aussi fondée par un homme d’église, l’anglican Robert Malthus). Et la démographie fut à son tour la pierre d’angle sur laquelle Charles Darwin (qui faillit devenir pasteur anglican) construisit sa théorie de l’évolution. […]Il suffit de regarder l’histoire de l’éducation pour mesurer où ce processus nous a conduit. Pendant la majeure partie de l’histoire, les mathématiques ont été un domaine ésotérique que même les gens instruits étudiaient rarement.Dans l’Europe médiévale, la logique, la grammaire et la rhétorique formaient le noyau dur de l’éducation, tandis que l’enseignement des mathématiques allait rarement au-delà de l’arithmétique élémentaire et de la géométrie. Personne n’étudiait les statistiques. La théologie était la reine incontestée de toutes les sciences. […]Les cours de statistiques font désormais partie des matières obligatoires de base en physique et en biologie, mais aussi en psychologie, en sociologie, en économie et en sciences politiques. […]Confucius, bouddha, Jésus et Mahomet eussent été interloqués si on leur avait dit que, pour comprendre l’esprit humain et guérir ses maladies, il fallait commencer par étudier les statistiques. »Je trouve cette histoire ainsi que le développement final de Harari extrêmement instructif : ce sont des hommes d’Eglise qui ont préféré faire appel à la rationalité des calculs et des lois statistiques expérimentées par les hommes pour faire progresser la connaissance humaine et aussi adoucir les épreuves que nous connaissons sur cette terre par des mécanismes de solidarité. -
Jeudi 2 juin 2016
Jeudi 2 juin 2016« En 1568, la Hollande était une simple province espagnole,
80 ans plus tard les Hollandais avaient évincé les espagnols pour devenir les maîtres des grandes routes océaniques et l’Etat le plus riche d’Europe.
Le secret de la réussite hollandaise : le crédit »Vraie histoire de l’Espagne et des Pays Bas racontée par Harari Sapiens pages 372 à 375Pour expliquer le capitalisme qui se base sur le crédit et la confiance, Harari prend un exemple historique qui se situe au début du XVIIème siècle : Le déclin et la montée en puissance, comme dans un miroir entre l’Espagne et les Pays-Bas :« On trouve un aperçu de la toute nouvelle puissance du crédit dans le combat acharné opposant l’Espagne au Pays-Bas. Au XVIe siècle, l’Espagne est l’état le plus puissant d’Europe, dominant un vaste empire mondial. Elle gouvernait une bonne partie de l’Europe, d’énormes morceaux de l’Amérique du Nord et du Sud, les Philippines et tout un chapelet de bases le long des côtes d’Afrique et d’Asie. Chaque année des flottes chargées de trésors américains et asiatiques regagnaient les ports de Séville et de Cadix. Les Pays-Bas n’étaient qu’un petit marais venteux dépourvu de ressources naturelles un petit coin des dominions du roi d’Espagne.En 1568, les hollandais, majoritairement protestants, se soulevèrent contre leur suzerain catholique espagnol. Au début, les rebelles ressemblaient à des Don Quichotte bataillant contre d’invincibles moulins à vent. 80 ans plus tard les hollandais avaient non seulement arraché leur indépendance à l’Espagne, mais aussi évincé les Espagnols et leurs alliés portugais pour devenir les maîtres des grandes routes océaniques et bâtir un empire mondial qui fit d’eux l’État le plus riche d’Europe.Le secret de la réussite hollandaise le crédit.Les bourgeois hollandais, qui n’avaient guère le goût du combat sur terre, recrutèrent des armées de mercenaires appelées à combattre les Espagnols pour leur compte.Pendant ce temps, eux-mêmes prenaient la mer avec une flotte toujours plus importante. Si les armées de mercenaires et les flottes équipées de canons coûtaient une fortune, les hollandais avaient plus de facilité à financer leurs expéditions militaires que le puissant empire espagnol, parce qu’ils avaient la confiance du système financier européen en plein essor quand le roi espagnol ne cessait de la compromettre par négligence.Les financiers accordèrent suffisamment de crédit aux hollandais pour qu’ils puissent monter des armées et des flottes, qui leur permirent de dominer les routes commerciales à travers le monde et leur assurèrent ainsi de confortables profits. Ces profits leur permirent de rembourser leurs emprunts, renforçant ainsi la confiance des financiers. Amsterdam devenaient à vue d’œil l’un des ports d’Europe les plus importants, mais aussi La Mecque financière du continent.Comment les hollandais gagnèrent-il la confiance du système financier ?Primo, ils veillèrent à rembourser les emprunts dans les délais et intégralement, rendant le crédit moins risqué pour les prêteurs.Secundo, le système judiciaire de leur pays était indépendant et protégeaient les droits des particuliers : notamment, les droits attachés à la propriété privée.Les capitaux s’éloignent des dictatures qui ne défendent pas les particuliers et leurs biens pour affluer dans les pays qui défendent l’état de droit et la propriété privée. »Pour expliquer cela, le génial auteur de Sapiens copie Montaigne qui disait « je n’enseigne pas je raconte »« Imaginez-vous en fils d’une solide famille de financiers allemands. Votre père voit une occasion de développer ses affaires en ouvrant des succursales dans les grandes villes européennes. Il vous envoie à Amsterdam et dépêche votre frère cadet à Madrid, vous donnant à chacun 10 000 pièces d’or à investir. Votre frère prête son capital initial avec intérêt au roi d’Espagne, qui en a besoin pour lever une armée afin de combattre le roi de France. Vous décidez de prêter le vôtre à un marchand qui souhaite investir dans la brousse, à la pointe sud d’une île désolée qu’on appelle Manhattan, certain que l’immobilier va monter en flèche tandis que l‘Hudson se transformera en grande artère commerciale. Les deux prêts doivent être remboursés dans un an.L’année passe. Le marchand hollandais vend la terre achetée avec un joli bénéfice et vous rembourse avec les intérêts promis. Votre père est content. À Madrid, cependant, votre petit frère commence à s’inquiéter. La guerre contre la France a bien tourné pour le roi d’Espagne, mais il s’est laissé entraîner dans un conflit avec les Turcs. Il a besoin de chaque sou pour financer la nouvelle guerre, et estime que c’est bien plus important que de rembourser de vieilles dettes. Votre frère envoie des lettres au palais et demande à des amis bien-être auprès de la cour d’intercéder. En vain, non seulement votre frère n’a pas touché les intérêts promis mais il a perdu le principal. Votre père est mécontent.Et, pour comble, le roi dépêche auprès de votre frère un officier du trésor qui lui signifie, sans détour, que le roi compte bien recevoir un autre prêt du même montant, tout de suite. Votre frère n’a pas d’argent à prêter. Il écrit à papa, essayant de le persuader que cette fois, c’est la bonne. Le roi s’en sortira. Le pater familias a un faible pour le petit dernier : le cœur gros, il consent. De nouveau, 10 000 pièces d’or disparaissent dans le Trésor espagnol. On ne les reverra plus.Pendant ce temps, à Amsterdam les perspectives sont brillantes. Vous accordez de plus en plus de prêts aux marchands hollandais, qui remboursent vite et intégralement.Mais votre chance ne dure pas indéfiniment. Un de vos clients habituels a le pressentiment que les sabots vont bientôt faire fureur à Paris et vous demande de quoi ouvrir un magasin de souliers dans la capitale française. Vous lui prêtez l’argent. Malheureusement, les galoches ne sont pas au goût des Françaises, et le marchand maussade refuse de rembourser son emprunt.Votre père est furieux. Il vous dit à tous les deux qu’il est temps de lâcher les hommes de loi. À Madrid votre frère engage des poursuites contre le monarque espagnol, tandis qu’à Amsterdam vous faites un procès au magicien des galoches d’antan.En Espagne, les tribunaux sont soumis au roi : son bon plaisir décide du sort des juges, et ceux-ci redoutent le châtiment qui les attend s’ils ne se plient pas à son bon vouloir. Aux Pays-Bas, la justice est séparée de l’exécutif, elle n’est tributaire ni des bourgeois ni des princes du pays.La cour madrilène rejette la plainte de votre frère ; la cour Amstellodamoise tranche en votre faveur et vous octroie un privilège sur les actifs du marchand de galoches afin de le forcer à vous rembourser. Votre père en a tiré la leçon. Mieux vaut faire des affaires avec les marchands qu’avec les rois, et mieux vaut en faire en Hollande qu’à Madrid. […]Les peines de votre frère ne s’arrêtent pas là. Le roi d’Espagne a désespérément besoin d’argent frais pour payer son armée. Il est certain que votre père a des réserves. Il forge de toutes pièces des accusations de trahison contre votre frère. S’il ne lui fournit sur-le-champ 20 000 pièces d’or, il le jettera dans un cachot et l’y laissera croupir jusqu’à ce que mort s’en suive.C’est plus que votre père ne peut supporter. Il paye la rançon de son fils chéri, mais se jure de ne plus jamais faire d’affaires en Espagne. Il ferme sa succursale madrilène et envoie votre frère à Rotterdam. Deux succursales en Hollande : cela semble être une bonne idée. Il s’est laissé dire que même les capitalistes espagnols sortent leur fortune en fraude du pays. Eux aussi comprennent que, s’ils veulent garder leur argent, et s’en servir pour acquérir plus de richesse, mieux vous l’investir dans un pays où prévaut l’État de droit et où la propriété privée est respectée : au Pays-Bas, par exemple.Le roi d’Espagne a dilapidé le capital de confiance des investisseurs au moment même où les marchands hollandais gagnaient leur confiance. Et ce sont les marchands hollandais, non pas l’État hollandais, qui ont construit l’empire hollandais.Le roi d’Espagne n’eut de cesse de financer et maintenir ses conquêtes en levant des impôts impopulaires.Les marchands hollandais financèrent la conquête en empruntant, et de plus en plus aussi en vendant des parts dans leurs compagnies qui permettaient aux détenteurs de toucher une portion des profits.Les investisseurs prudents qui n’auraient jamais donné leur argent au roi d’Espagne, et qui auraient réfléchi à deux fois avant de faire crédit au gouvernement hollandais se firent une joie d’investir des fortunes dans les compagnies par actions hollandaises qui furent le pivot d’un nouvel Empire. ».C’est un peu romancé, mais c’est bien ainsi que l’Empire espagnol déclina et que les marchands hollandais firent fortune, construisirent un Etat riche et prospère et bâtirent un Empire commercial.Confiance, état de droit, respect des contrats, furent les règles qui assurèrent leur prospérité. -
Mercredi 1er juin 2016
Mercredi 1er juin 2016«Si l’on veut comprendre l’histoire économique moderne il n’y a en vérité qu’un seul mot à comprendre et ce mot, c’est «croissance». »« Sapiens : Une brève histoire de l’humanité » pages 357-364Et Sapiens va inventer le capitalisme. Harari va nous expliquer l’essor du capitalisme, en insistant sur 3 notions :- La confiance
- Le progrès
- Le crédit
Ainsi, dans son chapitre 16 qu’il intitule « le credo capitaliste », il pose d’abord les bases de son raisonnement et de l’observation de l’évolution de l’économie des Sapiens :«Si l’on veut comprendre l’histoire économique moderne il n’y a en vérité qu’un seul mot à comprendre. Et ce mot, c’est « croissance ». Pour le meilleur ou pour le pire, malade ou en bonne santé, l’économie moderne a cru tel un adolescent gavé d’hormones. Elle avale tout ce qu’elle trouve et pousse sans même qu’on s’en rende compte.Pendant la majeure partie de l’histoire, l’économie a gardé largement la même taille. Certes la production mondiale s’est accrue, mais cette croissance fut essentiellement l’effet de l’expansion démographique et de la colonisation de terres nouvelles. Tout cela changea cependant à l’époque moderne. En 1500, la production mondiale de biens et de services se situaient autour de 250 milliards de dollars ; aujourd’hui, elle tourne autour de 60 billions de dollars. Qui plus est, en 1500, la production annuelle moyenne par tête était de 550 $ alors qu’aujourd’hui chaque homme chaque femme et chaque enfant produit en moyenne 8 800 $ par an. Comment expliquer cette prodigieuse croissance ? »Pour expliquer cela Harari ne va pas se lancer dans une conceptualisation théorique mais de manière très pédagogique va raconter une histoire qui réunit 3 personnages :Sam Cupide, un financier et un banquier ;
Pierre, un entrepreneur qui ayant déjà fait des affaires, possède un pécule ;
Jane Bonnepâte, une cuisinière de talent mais n’ayant, elle, aucun argent de côté.
Et voilà comment cette histoire va conjuguer désir d’entreprendre, crédit et confiance :« Sam Cupide, financier malin, fonde une banque à El Dorado en Californie.Pierre, entrepreneur d’El Dorado qui monte, achève son premier gros chantier pour lequel il reçoit 1 million de dollars en espèces. Il dépose cette somme à la banque de M Cupide. La banque détient maintenant un capital d’un million de dollars.Dans le même temps, Jane Bonnepâte, chef cuisinière expérimentée mais impécunieuse à El Dorado, pense avoir une opportunité de faire des affaires : la ville manque d’une boulangerie digne de ce nom. Mais elle n’a pas assez d’argent pour acheter une affaire bien équipée avec des fours industriels, des éviers, des couteaux et des casseroles.Elle va à la banque, soumet son projet à Cupide et le persuade que le placement en vaut la peine. Il lui accorde un prêt d’un million de dollars, créditant son compte en banque de cette somme.Bonnepâte fait alors appel aux services de Pierre, chargeant l’entrepreneur de construire et d’équiper la boulangerie. Il lui demande alors 1 million de dollars. Elle le paye avec un chèque tiré sur son compte, Pierre le dépose sur son compte à la banque Cupide. Combien d’argent Pierre a-t-il alors sur son compte en banque ? Exactement 2 millions de dollars.Mais combien d’argent, d’espèces, se trouve exactement dans le coffre de la banque ? 1 million de dollars.Ça ne s’arrête pas là. Après deux mois de chantier, c’est une habitude chez les entrepreneurs, Pierre fait savoir à Bonnepâte qu’en raison de problèmes et de frais imprévus, la facture de la construction de la boulangerie s’élèvera en fait à deux millions de dollars. Madame Bonnepâte est mécontente mais elle ne peut guère arrêter le chantier en plein milieu. Elle se rend donc de nouveau à la banque et convainc M Cupide de lui accorder un prêt supplémentaire : il dépose sur son compte encore 1 million de dollars qu’elle vire sur le compte de l’entrepreneur. »Et c’est là que je vous invite à bien suivre la démonstration, en réalité il n’y a qu’un million qui existe réellement, mais toutes ces opérations de crédit conduisent à ce que dans les comptes de la Banque il est inscrit 3 millions !« Combien d’argent Pierre a-t-il alors sur son compte en banque ? 3 millions de dollars. Mais combien d’argent se trouve réellement à la banque ? Toujours 1 million de dollars en fait, le même million de dollars qui est à la banque depuis le début. La loi bancaire actuelle, aux États-Unis, permet à la banque de répéter cet exercice encore 7 fois. […] Les banques sont autorisées à prêter 10 $ pour chaque dollar qu’elle possède réellement, ce qui veut dire que 90 % des sommes déposées sur nos comptes en banque ne sont pas couverts par des pièces de monnaie ou des billets de banque. […].Ça vous a tout l’air d’une pyramide de Ponzi ; n’est-ce pas ?Mais si c’est un montage frauduleux, alors toute l’économie moderne n’est qu’une fraude. Le fait est que ce n’est pas une duperie mais plutôt un hommage aux ressources stupéfiantes de l’imagination des hommes. C’est notre confiance dans le futur qui permet aux banques et à toute l’économie, de survivre et de prospérer. Cette confiance est l’unique support de la majeure partie de l’argent dans le monde.La boulangerie n’a pas encore cuit une seule miche de pain, mais Bonnepâte et Cupide anticipent que, d’ici à un an, elle vendra chaque jour des milliers de pains, de viennoiseries, de gâteaux et de cookies avec un joli profit. Madame Bonnepâte pourra alors rembourser son prêt avec les intérêts. Si M Pierre décide de retirer ses économies, Cupide sera en mesure de lui verser les espèces. Toute l’entreprise est donc fondée sur la confiance en un avenir imaginaire : la confiance de l’entrepreneur et du banquier dans la boulangerie de leurs rêves, mais aussi celle de l’entrepreneur dans la solvabilité future de la banque. […]. »Sans ce système inventé par les hommes, la boulangerie pourrait-elle être construite ? Bien sûr que non. Et l’auteur de « Sapiens » de montrer une fois encore la force de l’imaginaire et de la faculté de notre espèce de s’éloigner des objets réels :« Bonnepâte pourrait-elle faire construire sa boulangerie si la monnaie ne pouvait représenter que des objets tangibles ? Non.Pour l’instant, elle n’a que des rêves, aucune ressource tangible. La seule manière pour elle de la faire construire serait de dénicher une entreprise prête à travailler aujourd’hui et à être réglée quelques années plus tard, quand la boulangerie commencerait à gagner de l’argent. Hélas, les entrepreneurs de ce genre sont une espèce rare.Tel est le dilemme de la boulangère : sans boulangerie, pas de gâteau. Sans gâteau, pas d’argent. Sans argent, impossible de solliciter une entreprise. Et sans entreprise, pas de boulangerie.L’humanité est demeurée piéger par ce dilemme des milliers d’années durant.Harari représente ce dilemme par le schéma suivant :« De ce fait, l’Economie est restée figée. L’issue n’a été découverte que dans les temps modernes, avec l’apparition d’un nouveau système fondé sur la confiance dans l’avenir. Les hommes consentirent alors à représenter des biens imaginaires, des biens qui n’existent pas à l’heure actuelle, par une forme de monnaie spéciale qu’ils nommèrent « crédit ».Le crédit nous permet de construire le présent aux dépens du futur.Il repose sur le postulat que nos ressources futures serons à coup sûr bien plus abondantes que nos ressources présentes. Si nous pouvons utiliser des revenus futurs pour construire des choses à présent, de nouvelles opportunités merveilleuses s’ouvrent à nous. »Et un nouveau schéma décrit le cercle magique de l’économie moderne :Harari pose alors la question pourquoi n’a-t-on pas pensé au Crédit plus tôt dans l’Histoire de l’Humanité, et y répond de la manière suivante :« Les hommes pensaient que la quantité de richesse totale était limitée, si elle ne s’amenuisait pas. Ils estimaient donc que c’était un mauvais pari que de supposer qu’eux même, leur royaume, ou le monde entier produiraient plus de richesse dans 10 ans. Les affaires ressemblaient un jeu à somme nulle. […] Venise pouvait prospérer, mais uniquement en appauvrissant Gênes. Le roi d’Angleterre pouvait s’enrichir, mais à la seule condition de voler le roi de France. Il y avait de multiples façons de découper le gâteau, mais il n’était jamais plus gros. […] Si le gâteau total restait de la même taille, il n’y avait aucune marge de crédit. Le crédit, c’est la différence entre le gâteau d’aujourd’hui et celui de demain. S’il reste le même, pourquoi accorder du crédit ? »Qu’elle a été, le fait déclencheur ?« Puis survint la révolution scientifique, avec la notion de progrès. Cette notion repose sur l’idée que, pour peu que nous reconnaissions notre ignorance et investissions des ressources dans la recherche, les choses peuvent s’améliorer. Cette idée allait bientôt trouver une traduction économique. Croire au progrès, c’est croire que les découvertes géographiques, les inventions techniques et les développements organisationnels peuvent accroître la somme totale de la production humaine, du commerce et de la richesse. […]Au cours des cinq derniers siècles, l’idée de progrès a convaincu les hommes d’avoir toujours plus confiance dans l’avenir. Cette confiance a créé le crédit, et le crédit s’est soldé par une réelle croissance économique, laquelle a renforcé à son tour la confiance dans le futur et ouvert la voie à encore plus de crédit.C’est lumineux non ?En creux, cela explique aussi que si la notion de progrès est en crise ainsi que la confiance indispensable en l’avenir tout ce système est remis en question. -
Mardi 31 mai 2016
Mardi 31 mai 2016« Kushim »Premier nom d’un Sapiens, conservé sur un support écrit, de l’histoire des Sapiens. « Sapiens : Une brève histoire de l’humanité » pages 151-152L’écriture est née à Sumer, en Mésopotamie.Et c’est dans le livre « Sapiens » que j’ai appris que le premier nom de Sapiens conservé sur un support écrit est le nom de « Kushim ».Car Harari au milieu de théories et hypothèses qui nous interpellent, nous fait aussi découvrir des faits historiques que j’ignorais pour ma part.Harari introduit d’abord ce sujet en expliquant l’écriture sumérienne :« L’écriture est une méthode de stockage de l’information à travers des signes matériels. Le système d’écriture sumérien y parvint en mêlant deux types de signes, pressés sur des tablettes d’argile.Un type de signes représentait les chiffres. Il y avait des signes pour 1,10, 60, 600, 3600, et 36 000. (Les sumériens employaient une combinaison de système de numération de base six et de base dix.)Et nous apprenons ainsi l’origine de la journée de 24 heures, au lieu d’une journée de 10 heures ou de 100 heures par exemple. De même que les 60 minutes d’une heure, ou les 60 secondes d’une minute ou encore les 360° d’un cercle viennent de Sumer :« Leur système de base six nous a laissé plusieurs héritages importants, comme la division du jour en 24 heures est celle du cercle en 360°. »Mais à côté des chiffres, il y avait d’autres signes qui n’étaient pas encore des lettres :« L’autre type de signes représentait les hommes, des animaux, des marchandises, des territoires, des dates et ainsi de suite. En mêlant les deux types de signes, les sumériens réussirent à préserver plus de données que n’importe quel cerveau d’homme n’en pouvait mémoriser […]. »Mais à quoi servait l’écriture des chiffres et des « pseudo-lettres » ?« À ce premier stade, l’écriture était limitée aux faits et aux chiffres. Le grand roman sumérien, s’il exista jamais, ne fut pas livré aux tablettes argile. Écrire prenait du temps, et le lectorat était infime, en sorte que nul ne voyait de raison de s’en servir à une autre fin que la tenue des archives essentielles. Si nous recherchons les premiers mots de sagesse venue de nos ancêtres, voici 5000 ans nous allons au-devant d’une grosse déception.Les tout premiers messages que nos ancêtres nous aient laissés sont du style : « 29 086 mesures orge 37 mois Kushim.» Très probablement faut-il comprendre : « Un total de 29 086 mesures d’orge a été reçu en 37 mois. Signé, Kushim. »Il s’agit d’une tablette d’argile dont vous trouverez une reproduction dans le livre mais aussi sur Internet ce qui me permet de vous en montrer une photo :Les premiers textes d’histoire ne contiennent ni aperçus philosophiques, ni poésie, ni légendes, ni lois, ni même triomphes royaux. Ce sont de banals documents économiques enregistrant le paiement des taxes, l’accumulation des dettes et la propriété de tels ou tels biens. « Kushim » est peut-être le titre générique d’un dignitaire, ou le nom d’un particulier. Si Kushim était bel et bien une personne, c’est peut-être le premier individu dont le nom nous soit connu. « Grotte de Chauvet », « Neandertal », sont des inventions modernes. L’idée du nom que les constructeurs de [tel ou tel site préhistorique] donnait comme nom à ce site, nous est totalement inconnu.Avec l’apparition de l’écriture nous commençons à entendre l’histoire à travers l’oreille de ses protagonistes. Quand ses voisins l’appelaient, ils criaient réellement «Kushim ! ».Et Harari d’ajouter cette remarque pleine de facétie et de bon sens :« Il est significatif que le premier nom attesté de l’histoire appartienne à un comptable, plutôt qu’à un prophète, un poète ou un conquérant. »A travers les petites histoires vraies que l’auteur de « Sapiens » distille dans son ouvrage, il montre aussi les préoccupations premières et les points essentiels de nos ancêtres. En effet, à cette époque la plupart des humains sur terre étaient des agriculteurs. Ils avaient besoin de garder une trace de ce qu’ils possédaient et de ce qu’ils devaient – et c’est comme cela que l’écriture est arrivée. C’était une «technique» pour les gens normaux, pas, dans un premier temps, le support d’une philosophie ou d’une théologie.Vous trouverez aussi une réflexion sur ce sujet et le livre sur le site des échos derrière ce lien : -
Lundi 30 mai 2016
Lundi 30 mai 2016« L’histoire donne de l’Homo sapiens l’image d’un serial killer écologique »Yuval Noah Harari
Sapiens : Une brève histoire de l’humanité pages 83 à 97Nous avons commencé à butiner dans ce livre étonnant « Sapiens » en nous intéressant d’abord à ce fait historique que dans le genre « homo », Sapiens est resté seul, alors qu’il y eut une époque de cohabitation avec Neandertal et bien d’autres espèces du genre, ensuite nous avons suivi l’auteur dans sa thèse que ce qui a fait la force de sapiens c’était sa capacité à créer des mythes et un imaginaire fédérateur.Nous l’avons encore suivi quand il a montré la présence de l’imaginaire dans notre quotidien.Aujourd’hui je vais partager avec vous des faits et les hypothèses extrêmement réalistes montrant les effets de la présence de Sapiens sur les espèces animales et végétales.Il y a longtemps, c’étaient les dinosaures qui occupaient la première place dans la chaîne alimentaire. Il y a un consensus scientifique que ce fut un évènement extérieur, qui bouleversa la vie sur la planète et entraina la disparition du « genre dinosaure » sur la terre.Nous savons qu’au long de l’Histoire des milliers d’espèce ont disparu. Probablement, influencé par le destin des dinosaures, l’explication commune consistait à faire porter l’essentiel de cette responsabilité à des évènements extérieurs, notamment les transformations du climat. Dans nos mythes on a inventé des histoires comme le déluge.Aujourd’hui, des espèces continuent à disparaître massivement. Pour cette évolution contemporaine, le rôle de sapiens est évident, documenté et accablant.Harari nous dévoile que très probablement sapiens, dès qu’il est devenu « le maître des espèces », a été plus qu’un prédateur, un exterminateur !« Avant la révolution cognitive, toutes les espèces d’hommes vivaient exclusivement sur le bloc continental afro asiatique. Certes, ils avaient colonisé quelques îles en traversant à la nage ou sur des radeaux de fortune de petites étendues d’eau. […].La barrière maritime empêcha les hommes, mais aussi de nombreux autres animaux et végétaux afro asiatiques d’atteindre ce « monde extérieur ». De ce fait, les organismes de terres lointaines comme l’Australie et Madagascar évoluèrent isolément durant des millions et des millions d’années, prenant des formes et des natures très différentes de celles de leurs lointains parents afro-asiatiques. […]À la suite de la révolution cognitive, sapiens acquis la technologie, les compétences organisationnelles et peut-être même la vision nécessaire pour sortir de l’espace afro-asiatique et coloniser le monde extérieur. Sa première réalisation fut la colonisation de l’Australie voici 45 000ans.[…] Le voyage des premiers humains vers l’Australie est un des événements les plus importants de l’Histoire, au moins aussi important que le voyage de Christophe Colomb vers l’Amérique ou l’expédition d’Apollo 11 vers la Lune. Pour la première fois, un humain était parvenu à quitter le système écologique afro-asiatique ; pour la première fois, en fait, un gros mammifère terrestre réussissait la traversée de l’Afro-Asie vers l’Australie. […]L’instant où le premier chasseur-cueilleur posa le pied sur une plage australienne fut le moment où l’Homo sapiens ce hissa à l’échelon supérieur de la chaîne alimentaire et sur un bloc continental particulier, puis devint l’espèce la plus redoutable dans les annales de la planète Terre.Jusque-là les hommes avaient manifesté des adaptations et des comportements novateurs, mais leur effet sur l’environnement était demeuré négligeable. […]. »Yuval Noah Harari nous fait alors la description de la faune de l’Australie d’avant Homo sapiens :« [C’était] un étrange univers de créatures inconnues, dont un kangourou de 2 m pour 200 kg et un lion marsupial aussi massif qu’un tigre moderne, qui était le plus gros prédateur du continent. Dans les arbres évoluaient des koalas beaucoup trop grands pour être vraiment doux et mignon, tandis que dans la plaine sprintaient des oiseaux coureurs qui avaient deux fois la taille d’une autruche. Des lézards dragons et des serpents de 5 m de long ondulaient dans la broussaille. Le diprotodon géant, wombat de 2 tonnes et demie, écumaient la forêt. Hormis les oiseaux et les reptiles, tous ces animaux étaient des marsupiaux : comme les kangourous. Ils donnaient naissance à des petits minuscules et démunis, comparables à des fœtus qu’ils nourrissaient ensuite au lait dans des poches abdominales. Quasiment inconnus en Afrique et en Asie, les mammifères marsupiaux étaient souverains en Australie.Presque tous ces géants disparurent en quelques milliers d’années : 23 des 24 espèces animales australiennes de 50 kg ou plus s’éteignirent. Bon nombre d’espèces plus petites disparurent également. Dans l’ensemble de l’écosystème australien, les chaînes alimentaires furent coupées et réorganisées. Cet écosystème n’avait pas connu de transformation plus importante depuis des millions d’années. Était-ce la faute d’Homo sapiens ?Certains chercheurs essayent d’exonérer notre espèce pour rejeter la faute sur les caprices du climat. On a peine à croire, pourtant, qu’Homo sapiens soit entièrement innocent. Trois types de preuves affaiblissent l’alibi du climat et impliquent nos ancêtres dans l’extinction de la mégafaune australienne. Premièrement, même si le climat de l’Australie a changé voici 45 000 ans, ce bouleversement n’avait rien de remarquable. On voit mal comment le nouveau climat aurait pu provoquer à lui seul une extinction aussi massive. […]Apparu en Australie il y a plus de 1,5 millions d’années, le diprotodon géant avait résisté à au moins dix ères glaciaires antérieures. Il survécut aussi au premier pic du dernier âge glaciaire il y a environ 70 000 ans. Pourquoi a-t-il disparu il y a 45000 ans ?Si les diprotodons avaient été les seuls gros animaux à disparaître à cette époque, on aurait naturellement pu croire à un hasard. Or, plus de 90 % de la mégafaune australienne a disparu en même temps que le diprotodon. Les preuves sont indirectes, mais en imagine mal que, par une pure coïncidence, sapiens soit arrivé en Australie au moment précis où tous ces animaux mouraient de froid. […] »Est-ce une hypothèse parmi d’autres ?Sans doute pas, parce que ce scénario va se répéter à travers l’Histoire de Sapiens :« Les millénaires suivants ont connu des extinctions de masse proche de l’archétype de la décimation australienne chaque fois qu’une population a colonisé une autre partie du monde extérieur. Dans tous ces cas, la culpabilité de sapiens est irrécusable. Par exemple, la mégafaune néo-zélandaise qui avait essuyé sans une égratignure le prétendu changement climatique d’il y a environ 45 000 ans a subi des ravages juste après le débarquement des premiers hommes sur ces îles. Les maoris, premiers colons sapiens de la Nouvelle-Zélande, y arrivèrent voici 800 ans. En l’espace de deux siècles disparurent la majorité de la mégafaune locale en même temps que 60 % des espèces d’oiseaux locales.La population de mammouths de l’ile Wrangel, dans l’Arctique connut le même sort. Les mammouths avaient prospéré pendant des millions d’années dans la majeure partie de l’hémisphère nord. Avec l’essor d’Homo sapiens, cependant, d’abord en Eurasie, puis en Amérique du Nord, les mammouths ont reculé. Voici environ 10 000 ans, il n’y avait plus un seul mammouth au monde, hormis dans quelques îles lointaines de l’Arctique, à commencer par Wrangel. Les mammouths de cette île continuèrent de prospérer encore pendant quelques millénaires, avant de disparaître subitement voici 4000 ans, au moment précis où les humains débarquèrent.Si l’extinction australienne était un événement isolé, nous pourrions accorder aux hommes le bénéfice du doute. Or, l’histoire donne de l’Homo sapiens l’image d’un serial killer écologique. »Yuval Noah Harari donne des explications rationnelles aux moyens utilisés par sapiens pour chasser, tuer ces espèces est aussi les raisons pour lesquelles ces espèces ne se méfiant pas d’un petit singe qui n’avait pas l’air très dangereux ne surent pas se protéger. Vous trouverez ces explications aux pages 89-91.Je préfère m’attarder à un autre développement de Yuval Noah Harari sur la continuation du récit :« L’extinction de la mégafaune australienne [qui] est probablement la première marque significative qu’Homo sapiens ait laissée sur notre planète. Suivit une catastrophe écologique encore plus grande, cette fois en Amérique. Homo sapiens fut la seule espèce humaine à atteindre le bloc continental de l’hémisphère ouest, où il arriva voici 16 000 ans, autour de 14 000 avant notre ère. […]Jusque-là, aucune espèce humaine n’avait réussi à pénétrer les espaces comme la Sibérie du Nord. Même les Neandertal, adaptés au froid, se cantonnèrent à des régions relativement plus chaudes, plus au sud. […] Les terres arctiques grouillaient d’animaux savoureux tels que les rennes et les mammouths. Chaque mammouth était source d’une énorme quantité de viande (avec le froid, on pouvait même la congeler pour la consommer plus tard), de graisse goûteuse, de fourrure chaude et d’ivoire précieux. […] Autour de 14 000 avant notre ère, la chasse en entraîna certains de la Sibérie du Nord-Est vers l’Alaska. Bien entendu, ils ne surent pas qu’ils découvraient un nouveau monde. Pour le mammouth comme pour l’homme, l’Alaska était une simple extension de la Sibérie. […]Profitant du nouveau couloir, les hommes passaient au Sud en masse, se répandant à travers le continent. […] Certains se fixèrent dans le bassin de l’Amazone, d’autres s’enracinèrent dans les vallées des Andes où la pampa argentine. Tout cela en l’espace d’un millénaire ou deux ! […] Ce Blitzkrieg à travers l’Amérique témoigne de l’incomparable ingéniosité et de l’adaptabilité insurpassée de l’Homo sapiens. Aucun autre animal n’avait jamais investi aussi rapidement une telle diversité d’habitats radicalement différents–et ce, en utilisant partout quasiment les mêmes gènes. […]Voici 14 000 ans, la forêt américaine était bien plus riche qu’aujourd’hui. Quand les premiers américains quittèrent l’Alaska pour le sud, s’aventurant dans les plaines du Canada et de l’Ouest des États-Unis, ils trouvèrent des mammouths et des mastodontes, des rongeurs de la taille d’un ours, des troupeaux de chevaux et de chameaux, des lions géants et des douzaines d’espèces de gros animaux qui ont totalement disparu, dont les redoutables chats à dents de cimeterre et les paresseux terrestres géants qui pesaient jusqu’à 8 tonnes et pouvaient atteindre 6 m de haut. L’Amérique du Sud hébergeait une ménagerie encore plus exotique de gros mammifères, de reptiles et d’oiseaux. Les Amériques avaient été un grand laboratoire d’expérimentation de l’évolution, un espace où avaient évolué et prospéré des animaux et des végétaux inconnus en Afrique et en Asie.Mais ce n’est plus le cas. Deux milles ans après l’arrivée du Sapiens, la plupart de ces espèces uniques avaient disparu. Dans ce bref intervalle, suivant les estimations courantes, l’Amérique du Nord perdit 34 de ses 47 genres de gros mammifères, et l’Amérique du Sud 50 sur 60. »J’arrête ici cette longue énumération, bien que Yuval Noah Harari donne encore des exemples dans la grande île de Madagascar et dans d’autres îles du Pacifique.Que dire ?La thèse défendue par Yuval Noah Harari : celle d’un sapiens serial killer écologique semble très vraisemblable.Dans nos mythes religieux, l’homme est une espèce à part, l’espèce préféré des dieux ou de Dieu.Nous ne sommes pas des serial-killer puisque nous suivons les desseins de Dieu…Croire de tels mythes permet certainement de se déculpabiliser totalement de notre action sur les autres espèces, bien que dans ces mythes la nature et les autres espèces sont aussi création de Dieu ! -
Vendredi 27 mai 2016
Vendredi 27 mai 2016« L’ordre imaginaire façonne nos désirs. »Yuval Noah Harari
Sapiens : Une brève histoire de l’humanité pages 142-144Nous qui sommes les sapiens modernes poursuivons un bel objectif : « Nous faire du bien ! ».Voilà un but légitime. Mais comment nous faire du bien ? Probablement en allant autant que possible au bout de nos désirs, bien sûr dans les limites de la Loi et de la morale.Mais d’où viennent nos désirs ?Evidemment de notre imaginaire répondra Harari qui explique que « L’ordre imaginaire façonne nos désirs. »Et l’homme moderne se soumet à deux idéologies modernes dominantes : le romantisme et le consumérisme.Et lorsque l’auteur de « Sapiens » regarde nos mœurs et désirs modernes au regard de l’histoire de notre espèce cela donne cette analyse :« La plupart des gens ne veulent pas admettre que l’ordre qui régit leur vie soit imaginaire, mais en fait chacun nait dans un ordre imaginaire préexistant ; dès la naissance, les mythes dominants façonnent nos désirs. Nos désirs personnels deviennent ainsi les défenses les plus importantes de l’ordre imaginaire.Par exemple, les désirs les plus chers des occidentaux actuels sont façonnés par des mythes romantiques, nationalistes, capitalistes et humanistes en circulation depuis des siècles.Entre amis, on se donne souvent ce conseil : « Suis donc ton cœur ! » Or, le cœur est un agent double qui tient souvent ses instructions des mythes dominants de l’époque. Cette recommandation même nous a été inculquée par un mélange de mythes romantiques du XIXe siècle et de mythes consuméristes du siècle dernier. La société Coca-Cola, par exemple, a vendu son Coca Light dans le monde entier sous le slogan : « faites ce qui vous fait du bien. »Même ce que les gens considèrent comme leurs désirs personnels les plus égoïstes sont habituellement programmés par l’ordre imaginaire. Prenons l’exemple du désir populaire de prendre des vacances à l’étranger. Qui n’a rien d’évident ni de naturel.Jamais un mâle alpha (mâle dominant) chimpanzé n’aurait l’idée d’utiliser son pouvoir pour aller en vacances sur le territoire d’une bande voisine de chimpanzés.L’élite de l’Égypte ancienne dépensa des fortunes à bâtir des pyramides et à faire momifier ses cadavres, mais aucun de ses membres ne songea à faire du shopping à Babylone ou à passer des vacances de ski en Phénicie. De nos jours, les gens dépensent de grosses sommes en vacances à l’étranger parce que ce sont des vrais croyants, adeptes des mythes du consumérisme romantique.Le consumérisme romantique mêle deux idéologies modernes dominantes : le romantisme et le consumérisme. Le romantisme nous dit que, pour tirer le meilleur parti de notre potentiel humain, il nous faut multiplier autant que possible les expériences. Nous devons nous ouvrir à un large spectre d’émotions, expérimenter diverses sortes de relations, essayer des cuisines différentes, apprendre à apprécier divers styles de musique.Une des meilleures façons d’y parvenir est de rompre avec la routine de tous les jours, d’abandonner notre cadre familier et de voyager au loin, où nous pouvons « expérimenter » la culture, les odeurs, les goûts et les normes d’autres peuples. On ne cesse de nous ressasser les mythes romantiques sur le thème, « comment une nouvelle expérience m’a ouvert les yeux et a changé ma vie ».Le consumérisme nous dit que pour être heureux il faut consommer autant de produits et de services que possible. Si nous avons le sentiment que quelque chose nous manque où laisse à désirer, probablement avons-nous besoin d’acheter un produit (voiture, vêtements neufs,…) ou un service (heures de ménage, thérapie relationnelle, cours de yoga).Chaque publicité à la télévision est une petite légende de plus sur le thème « la consommation d’un produit ou d’un service rendra la vie meilleure ».Le romantisme qui encourage la variété, s’accorde parfaitement avec le consumérisme. Leur mariage a donné naissance à un « marché des expériences » infini sur lequel se fonde l’industrie moderne du tourisme. Celle-ci ne vend pas des billets d’avion ou des chambres d’hôtel, mais des expériences. Paris n’est pas une ville, ni l’Inde un pays, ce sont des expériences. La consommation est censée élargir nos horizons, accomplir notre potentiel humain et nous rendre plus heureux. Dès lors, quand un couple de millionnaires bat de l’aile, le mari emmène sa femme à Paris. Le voyage n’est pas l’expression de quelque désir indépendant mais traduit une croyance fervente aux mythes du consumérisme romantique.En Egypte ancienne, il ne serait jamais venu l’idée à un homme riche de résoudre une crise conjugale en emmenant sa femme en vacances à Babylone. Sans doute aurait-il fait construire le tombeau somptueux de ses rêves.Comme l’élite égyptienne, la plupart des gens, dans la plupart des cultures, passent leur vie à construire des pyramides. D’une culture à l’autre, seuls changent les noms, les formes et les tailles de ces pyramides : villa de banlieue chic avec piscine et pelouse ou penthouse étincelant avec vue imprenable.Peu contestent ces mythes qui nous font désirer une pyramide »Le « consumérisme romantique » et le « marché des expériences ».Je trouve fascinant comment Harari déshabille le discours moderne du sapiens contemporain et parvient à l’inscrire dans l’Histoire générale de notre espèce basée sur l’imaginaire et les mythes. -
Jeudi 26 mai 2016
«Une des règles d’airain de l’Histoire est que toute hiérarchie imaginaire désavoue ses origines fictionnelles et se prétend naturelle et inévitable.»« Yuval Noah Harari
Sapiens : Une brève histoire de l’humanité pages 163-165 »L’appel à l’imaginaire et où mythes constituent, selon Harari un point central de l’évolution de sapiens, notre espèce.
Dans son chapitre huit qu’il intitule « il n’y a pas de justice dans l’histoire », il remet en perspective à travers les exemples du code d’Hammourabi et de la proclamation d’indépendance de Philadelphie à la manière dont se sont structurées les sociétés des sapiens sur la base de ces textes et la manière dont ils se sont arrangés avec la réalité des faits.
Je cite :
« Comprendre l’histoire humaine dans les millénaires qui suivirent la Révolution agricole revient à répondre à une seule question : comment les hommes se sont-ils organisés en réseaux de coopération de masse, alors que leur manquaient les instincts biologiques nécessaires pour entretenir de tels réseaux ?
La réponse courte est qu’ils créèrent des ordres imaginaires et inventèrent des écritures. Ces deux inventions comblèrent les vides laissés par notre héritage biologique.
Pour beaucoup, cependant, l’apparition de ces réseaux fut une bénédiction douteuse. Les ordres imaginaires qui supportaient ces réseaux n’étaient ni neutres ni justes.
Ils divisèrent les gens en semblant de groupes hiérarchiquement organisés. Aux couches supérieures, les privilèges et le pouvoir, tandis que les couches inférieures souffraient de discrimination et d’oppression. Le code d’Hammourabi, par exemple, instaurait un ordre de préséance avec des supérieurs, des gens du commun et des esclaves. Les supérieurs avaient toutes les bonnes choses ; le commun devait se contenter des restes. Les esclaves étaient roués de coups s’ils se plaignaient.
Malgré sa proclamation de l’égalité de tous les hommes, l’ordre imaginaire instauré par les Américains en 1776 établit également une hiérarchie. Il créa une hiérarchie entre les hommes, qui en bénéficiaient et les femmes, qu’il laissa démunies ; mais aussi entre Blancs, qui jouissaient de la liberté, et Noirs et Indiens d’Amérique, considérés comme des hommes inférieurs qui ne pouvaient donc pas se prévaloir des droits égaux des hommes. Nombre des signataires de la Déclaration d’indépendance avaient des esclaves. Ils ne leur donnèrent pas la liberté à la signature, et ne se considéraient pas non plus comme des hypocrites. Dans leur idée, les droits des hommes n’avaient pas grand-chose à voir avec les Noirs.
L’ordre américain consacra également la hiérarchie entre riches et pauvres. En ce temps-là, l’inégalité liée au fait que les parents fortunés transmettaient leur argent et leurs affaires à leurs enfants ne choquait guère la plupart des Américains. […]
En 1776, [la liberté] ne signifie pas que les sans pouvoir (certainement pas les Noirs ou les Indiens ou, qu’à Dieu ne plaise, les Femmes) pouvaient conquérir et exercer le pouvoir. Elle voulait dire simplement que, sauf circonstances exceptionnelles, l’État ne pouvait confisquer les biens d’un citoyen ni lui dicter ce qu’il devait en faire. Ce faisant, l’ordre américain soutenait la hiérarchie de la richesse, que d’aucuns croyaient envoyée par Dieu, quand d’autres y voyaient l’expression des lois immuables de la nature. La nature, assurait-on, récompensait le mérite par la richesse et pénalisait l’indolence.
Toutes ces distinctions – entre personnes libres et esclaves, entre blancs et noirs, entre riches et pauvres – s’enracine dans des fictions.
Une des règles d’airain de l’Histoire est que toute hiérarchie imaginaire désavoue ses origines fictionnelles et se prétend naturelle et inévitable.
Ainsi, nombre de ceux qui estimaient naturelle et correcte la hiérarchie des hommes libres et des esclaves ont prétendu que l’esclavage n’était pas une invention humaine. Hammourabi la pensait ordonnée par les dieux. Selon Aristote, les esclaves ont une « nature servile » tandis que les hommes libres ont une « nature libre ». Leur place dans la société n’est qu’un reflet de leur nature intime. […]
Interrogez un capitaliste endurci sur la hiérarchie de la richesse, et il vous expliquera probablement qu’elle est le fruit inévitable de différences objectives de capacité. Dans son idée, les riches ont plus d’argent, parce qu’ils sont plus capables et plus diligents. Il n’y a donc pas à s’inquiéter que les nantis jouissent de meilleurs soins ou d’une éducation et d’une alimentation meilleures. Les riches méritent amplement tous les avantages dont ils jouissent.»
Et alors, direz-vous ?
Eh bien, on nous raconte des histoires, nous nous racontons des histoires, des fictions et nous y croyons. Tout cela est le fruit de notre imagination fertile. La réalité est tout autre, mais les fictions nous la cachent comme un filtre qui donne d’autres couleurs à la réalité.
Finalement, toutes ces histoires permettent aux sociétés de ne pas se désagréger, aux puissants de trouver une justification à leur prééminence et aux faibles d’accepter leur sort.
Décapant est un des premiers mots que j’avais utilisé.
Au fait, avez-vous acheté ou emprunté « Sapiens » ?
Je joins la photo pour que vous puissiez aisément le reconnaître<709>
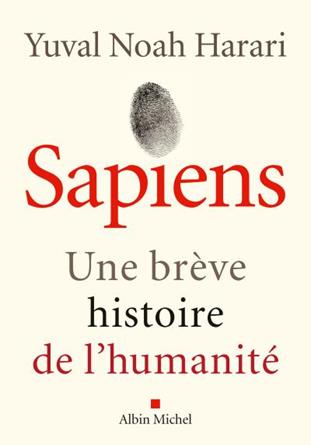
-
Mercredi 25 mai 2016
«Seul l’Homo sapiens peut parler de choses qui n’existent pas vraiment. […]Ces mythes donnent aux sapiens une capacité sans précédent de coopérer en masse et en souplesse.»« Yuval Noah Harari
Sapiens : Une brève histoire de l’humanité page 36, puis 133-138 »Comment sapiens s’est-il imposé ?
Quels furent ses talents, quelles capacités a-t-il mises en œuvre pour devenir « le maître des espèces sur terre » ?
Harari parle d’une révolution cognitive, de la capacité de notre espèce à développer le langage, l’échange verbal et…
Notre capacité à inventer des mythes, des histoires qui n’existent pas ou au moins des histoires qu’aucune observation neutre et matérielle ne saurait inscrire dans la réalité terrestre.
Il a cette belle formule que j’ai pensé un moment utilisé comme exergue de ce mot du jour : « Jamais vous ne convaincrez un singe de vous donner sa banane en lui promettant qu’elle lui sera rendue au centuple au ciel des singes. »
Et, c’est cette faculté d’inventer des histoires, des mythes, des religions qui ont donné à Sapiens les moyens de réunir des groupes, tribus, empires immenses liés par ces croyances communes. Aucune autre espèce n’a jamais été capable de réunir autant d’individus liés par un destin et des objectifs communs.
Il introduit ainsi son analyse page 36 :
« On conviendra sans trop de peine que seul l’Homo sapiens peut parler de choses qui n’existent pas vraiment et croire à six choses impossibles avant le petit-déjeuner. […] Mais pourquoi est-ce important ?
Somme toute, la fiction peut dangereusement égarer ou distraire. Les gens qui vont dans la forêt en quête de fées ou de licornes sembleraient avoir moins de chances de survie que ceux qui cherchent des champignons ou des cerfs. Et si vous passez des heures à prier des esprits tutélaires inexistants, ne perdez-vous pas un temps précieux qui serait mieux employé à fourrager, vous battre ou forniquer ?
Or, c’est la fiction qui nous a permis d’imaginer des choses, mais aussi de le faire collectivement. Nous pouvons tisser des mythes tels que le récit de la création biblique, le mythe du Temps du rêve des aborigènes australiens ou les mythes nationalistes des Etats modernes. Ces mythes donnent aux sapiens une capacité sans précédent de coopérer en masse et en souplesse. Fourmis et abeilles peuvent aussi travailler ensemble en grand nombre, mais elles le font de manière très rigide et uniquement avec de proches parents. Loups et chimpanzés coopèrent avec bien plus de souplesse que les fourmis, mais ils ne peuvent le faire qu’avec de petits nombres d’autres individus qu’ils connaissent intimement. Sapiens peut coopérer de manière extrêmement flexible avec d’innombrables inconnus. C’est ce qui lui permet de diriger le monde pendant que les fourmis mangent nos restes et que les chimpanzés sont enfermés dans les zoos et les laboratoires de recherche. »
Si vous êtes pressés, vous pouvez arrêter votre lecture ici, vous aurez compris l’essentiel de la thèse de Hariri.
Mais si vous avez un peu de temps ou d’envie d’en savoir plus je vous invite à lire le développement que l’auteur nous donne à partir de la page 133.
L’auteur confronte le code d’Hammourabi avec la déclaration d’indépendance des Etats-Unis.
D’abord de manière pédagogique, il explique le contexte et l’Histoire de l’un et de l’autre :
Le Code D’Hammourabi :
« En 1776 avant notre ère, Babylone était la plus grande ville du monde. Avec plus d’un million de sujets, l’empire babylonien était probablement le plus vaste du monde. […] Le roi de Babylone le plus connu de nos jours est Hammourabi. Sa gloire tient avant tout au texte qui porte son nom, le code d’Hammourabi : un recueil de ses lois et décisions de justice. Son propos est de présenter ce code comme le modèle du roi juste, d’en faire la base d’un système juridique plus uniforme à travers l’Empire babylonien et d’enseigner aux générations futures ce qu’est la justice et comment agit un roi juste.
Les générations suivantes y prêtèrent attention. L’élite intellectuelle et bureaucratique de Mésopotamie canonisa le texte, et les apprentis scribes continuèrent de le copier longtemps après la mort d’Hammourabi et la ruine de son empire. Ce code est donc une bonne source pour comprendre les mésopotamiens anciens et leur idéal en matière d’ordre social. »
La déclaration d’indépendance des Etats-Unis :
« Environ 3500 ans après la mort d’Hammourabi, les habitants de 13 colonies britanniques d’Amérique du Nord eurent le sentiment que le roi d’Angleterre les traitait injustement. Leurs représentants se réunirent à Philadelphie et, le 4 juillet 1776, les colonies décidèrent que leurs habitants n’étaient plus sujets de la Couronne britannique. »
Puis, pour nous rassurer et ne pas heurter notre sens commun, il explique les grandes différences entre ces deux textes fondateurs.
D’abord [le Code d’Hammourabi],
« Commence par dire que […] les principales divinités du panthéon mésopotamien, chargèrent Hammourabi « de proclamer le droit dans le pays, pour éliminer le mauvais et le pervers, pour que le Fort n’opprime pas le faible ».
Suivent près de 300 jugements, toujours rendus suivant une formule consacrée : « s’il se passe tel ou tel chose… le jugement est… » [voici quelques exemples] :
196. Si quelqu’un a crevé l’œil d’un homme libre, on lui crèvera l’œil
197. S’il a brisé l’os d’un homme libre, on lui brisera l’os.
198. S’il a crevé l’œil d’un mushkenu [entre hommes libres et esclaves] ou brisé l’os d’un mushkenu, il pèsera une mine d’argent.
199. S’il a crevé l’œil de l’esclave d’un particulier, ou brisé l’os de l’esclave d’un particulier il pèsera la moitié de son prix.
209. Si quelqu’un a frappé quelque femme libre et s’il lui a fait expulser le fruit de son sein, il pèsera dix sicles d’argent pour le fruit de son sein.
210. Si cette femme est morte, on tuera sa fille.
[…]
L’ordre social babylonien, affirme le code d’Hammourabi, s’enracine dans les principes universels et éternels de justice dictés par les dieux. Le principe de la hiérarchie est d’une suprême importance. Suivant le code, les gens sont divisés en deux sexes et trois classes : les hommes libres, les roturiers et les esclaves. Les membres de chaque classe de chaque sexe ont des valeurs différentes. La vie d’une femme de la catégorie intermédiaire vaut trente sicles d’argent, celle d’une esclave 20, tandis que l’œil d’un homme de la catégorie intermédiaire en vaut 60.
Le code établit aussi au sein des familles une hiérarchie stricte où les enfants ne sont pas des personnes indépendantes, mais la propriété de leurs parents. Dès lors, si un homme libre tue la fille d’un autre homme libre, la fille du meurtrier sera exécutée en châtiment.
Il peut nous paraître étrange qu’il ne soit fait aucun mal au tueur, dont la fille innocente est tuée à sa place, mais la chose était parfaitement juste aux yeux d’Hammourabi et des Babyloniens. Le code d’Hammourabi reposait sur l’idée que si, tous les sujets du roi acceptaient leur position au sein de la hiérarchie et agissaient en conséquence, le million d’habitants de l’Empire pourrait coopérer efficacement. »
La déclaration d’indépendance se présente de manière fort différente :
« La déclaration d’indépendance proclamait des principes universels et éternels de justice qui, comme ceux d’Hammourabi, s’inspiraient d’une force divine. Mais le principe le plus important édicté par le dieu américain était précisément un peu différent du principe édicté par les dieux de Babylone. Ainsi lit-on dans la déclaration d’indépendance :
« Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables, parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. »
C’est ensuite qu’il nous déstabilise en montrant leurs similitudes et surtout leur fondement totalement imaginaire qui ne repose sur aucun raisonnement scientifique sérieux. Ce que raconte le texte américain, les droits de l’homme dont il est question, nous est plus familier, plus en accord avec nos valeurs, mais repose de la même manière sur une histoire inventée, un mythe.
« Comme le code d’Hammourabi, le texte fondateur américain promet que, si les hommes se conforment à ses principes sacrés, ils seront des millions à pouvoir coopérer efficacement, à vivre en sécurité et paisiblement dans une société juste et prospère. De même que le code d’Hammourabi, la déclaration d’indépendance n’était pas simplement un document ancré dans une époque et dans un lieu : les générations futures devaient l’accepter également. Depuis plus de deux siècles, les petits écoliers américains la recopient et l’apprennent par cœur.
Les deux textes nous mettent en présence d’un dilemme évident. Le code d’Hammourabi comme la déclaration d’indépendance américaine prétendent tout deux esquisser des principes de justice universels et éternels, mais selon les Américains tous les hommes sont égaux, alors qu’ils sont résolument inégaux pour les Babyloniens. Bien entendu les américains diraient qu’ils ont raison, qu’Hammourabi se trompe. Naturellement, Hammourabi protesterait qu’il a raison et que les Américains ont tort. En fait, Hammourabi et les pères fondateurs américains imaginaient pareillement une réalité gouvernée par des principes universels immuables de justice comme l’égalité ou la hiérarchie. Or, ces principes universels n’existent nulle part ailleurs que dans l’imagination fertile des Sapiens et dans les mythes qu’ils inventent et se racontent. Ces principes n’ont aucune validité objective. »
Et c’est alors qu’il démolit scientifiquement le texte et les mots utilisés par la déclaration américaine :
« Il nous est facile d’accepter que la division en hommes « supérieurs » et en « commun des mortels » est un caprice de l’imagination. Pourtant, l’idée que tous les humains sont égaux est aussi un mythe. En quel sens les hommes sont-ils égaux les uns aux autres ?
Existe-t-il, hors de l’imagination humaine, une réalité objective dans laquelle nous soyons véritablement égaux ? Tous les hommes sont-ils biologiquement égaux ? Essayons donc de traduire en termes biologiques le fameux passage de la déclaration d’indépendance des États-Unis :
« Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. »
Pour la biologie, les hommes n’ont pas été « créés » : ils ont évolué.
Et ils n’ont certainement pas évolué vers l’ « égalité ». L’idée d’égalité est inextricablement mêlée à celles de création. Les Américains tenaient l’idée d’égalité du christianisme, pour lequel chaque homme est pourvu d’une âme créée par Dieu, et toutes les âmes sont égales devant Dieu. Mais si nous ne croyons pas aux mythes chrétiens sur Dieu, la création et les âmes, que signifie « tous les hommes sont égaux » ?
L’évolution repose sur la différence, non pas sur l’égalité. Chacun est porteur d’un code génétique légèrement différent et, dès la naissance, se trouve exposé aux influences différentes de son environnement. Tout cela se traduit par le développement de qualités différentes qui sont porteuses de chances de survie différentes. « Créer égaux » doit donc se traduire par « ont évolué différemment ».
De même que les hommes n’ont jamais été créés, de même pour la biologie il n’y a pas non plus de « Créateur » qui les « dote » de quoi que ce soit. Il y a juste un processus d’évolution aveugle, sans dessein particulier, qui conduit à la naissance d’individus : « doués par le créateur » doit se traduire tout simplement par « nés ».
Il n’existe rien qui ressemble à des droits en biologie, juste des organes, des facultés et des traits caractéristiques. Si les oiseaux volent, ce n’est pas qu’ils aient le droit de voler, mais parce qu’ils ont des ailes. Et il n’est pas vrai que ces organes, ces facultés et ces caractéristiques soient « inaliénables ». Beaucoup subissent des mutations constantes et peuvent se perdre totalement au fil du temps. L’autruche est un oiseau qui a perdu sa capacité de voler. Il convient donc de traduire les « droits inaliénables » en « caractéristiques muables ».
Et quelles caractéristiques ont évolué chez les êtres humains ? La « vie » assurément. Mais la « liberté » ? Il n’existe rien de tel en biologie. De même que l’égalité, les droits et les sociétés à responsabilité limitée, la liberté est une invention des hommes, et qui n’existe que dans leur imagination.[…]
Et le « bonheur » ? Jusqu’ici la recherche biologique n’a pas su trouver de définition claire du bonheur ni un moyen de le mesurer objectivement. La plupart des études biologiques reconnaissent uniquement l’existence du plaisir, qui se laisse plus aisément définir et mesurer. Il faut donc traduire « la vie, la liberté, la recherche du bonheur » en « vie et recherche du plaisir ».
Voici donc, traduit en langage biologique le passage de la déclaration d’indépendance :
« Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes ont évolué différemment, ils sont nés avec certaines caractéristiques muables, parmi ces caractéristiques se trouvent la vie et la recherche du plaisir. » »
Et il conclut, par cette interpellation :
« Cette forme de raisonnement ne manquera pas de scandaliser les tenants de l’égalité et des droits de l’homme, qui rétorqueront sans doute : « nous savons bien que les hommes ne sont pas égaux biologiquement ! Mais si nous croyons que nous sommes tous foncièrement égaux, cela nous permettra de créer une société stable et prospère. »
Je n’ai pas d’objection. C’est exactement ce que j’appelle ordre imaginaire.
Nous croyons un ordre particulier : non qu’il soit objectivement vrai mais parce qu’y croire nous permet de coopérer efficacement et de forger une société meilleure. Les ordres imaginaires ne sont ni des conspirations exécrables ni de vains mirages. Ils sont plutôt la seule façon pour les hommes de coopérer effectivement.
Mais ne perdez pas de vue qu’Hammourabi aurait pu défendre son principe hiérarchique en usant de la même logique : « je sais bien que les hommes libres, des hommes intermédiaires et les esclaves ne sont pas des espèces par nature différente. Mais si nous croyons qu’ils le sont, cela nous permettra de créer société stable et prospère. »
Génial et renversant !
<708>
-
Mardi 24 mai 2016
«La vérité est qu’entre 2 millions d’années et 10 000 ans, le monde a hébergé, en même temps, plusieurs espèces humaines.»« Yuval Noah Harari
Sapiens : Une brève histoire de l’humanité, Pages 15 à 30 »La première information étonnante que le livre « Sapiens » m’a apprise, est la cohabitation de notre espèce avec d’autres espèces humaines, alors que j’avais compris qu’il y avait eu succession des espèces.
Harari explique d’abord la classification utilisée par les scientifiques :
« Les biologistes classent les organismes en espèces. On dit d’animaux qu’ils appartiennent à la même espèce s’ils ont tendance à s’accoupler l’un avec l’autre, donnant naissance à des rejetons féconds. Juments et ânes ont un ancêtre commun récent, et partagent maints traits physiques. Sexuellement cependant ils ne s’intéressent guère les uns aux autres. Ils s’accoupleront si on les pousse, mais ils donneront des mules ou des mulets stériles. […] Les deux types d’animaux sont considérés comme des espèces différentes. […] En revanche, un bouledogue et un épagneul paraissent très différents, mais ils sont membres de la même espèce, partageant le même vivier d’ADN.
Les espèces issues d’un ancêtre commun sont réunies sous le vocable de genre. lion, tigre, léopard et Jaguar sont des espèces différentes du genre « panthera ».
Les lecteurs de ce livre sont vraisemblablement tous des Homo sapiens : de l’espèce sapiens (sage) et du genre homo (hommes).
Les genres sont à leur tour regroupés en famille : ainsi les [félins] : Lions, guépards, chats domestiques. »
Il poursuit en rappelant que l’homme a une famille :
« Homo sapiens appartient lui aussi à une famille. […] Homo sapiens a longtemps préféré se croire à part des autres animaux : un orphelin sans famille, privée de frères et sœurs et de cousins, et surtout, sans parents. Or, ce n’est pas le cas. Qu’on le veuille ou non, nous sommes membre d’une grande famille particulièrement tapageuse : celle des grands singes. Parmi nos plus proches parents vivants figurent les chimpanzés, les gorilles, et les orangs outans. Les plus proches sont les chimpanzés. Il y a 6 millions d’années, une même femelle eue deux filles : l’une qui est l’ancêtre de tous les chimpanzés; l’autre qui est notre grand-mère. »
Et puis il révèle un secret, au moins une réalité qui n’a pas été pleinement explicitée jusqu’ici, parce que il nous a été raconté une évolution du genre humain quasi linéaire, d’un homo très proche du singe jusqu’à l’homo sapiens. Depuis quelques années cependant, l’histoire de la cohabitation ou au moins de la présence simultanée sur terre de l’homme de Neandertal et d’homo sapiens a été révélée et interrogée. Mais Yuval Noah Harari va beaucoup plus loin dans cette description d’espèces voisines.
« Les humains sont apparus en Afrique de l’Est voici environ 2,5 millions d’années, issus d’un genre antérieur de singe, l’« australopithèque », qui signifie « singe austral ». Il y a environ 2 millions d’années, une partie de ces hommes et femmes archaïques quittèrent leurs foyers d’origine pour traverser et coloniser de vastes régions d’Afrique du Nord, d’Europe et d’Asie. La survie dans les forêts enneigées d’Europe septentrionale n’exigeant pas les mêmes qualités que la survie dans les jungles fumantes d’Indonésie, les populations humaines évoluèrent dans des directions différentes il en résulta divers espèces distinctes, auxquels les savants ont assigné des noms latins pompeux. […]
Les humains d’Europe et d’Asie occidentale ont donné l’Homo neanderthalensis (l’homme de la vallée de Neander), plus communément connu sous le nom de « Neandertal ». Plus trapu et plus musculeux que le sapiens, le Neandertal était bien adapté au climat froid de l’Eurasie occidentale à l’âge glaciaire.
Les régions orientales de l’Asie étaient peuplées par l’Homo erectus, ou «homme dressé, droit » qui survécut près de 2 millions d’années – ce qui en fait l’espèce humaine la plus durable qui ait jamais vécu. Il est peu probable que ce record ne soit jamais battu, même par notre espèce. […]
Sur l’île de Java, en Indonésie, vivait l’homo Soloensis, « hommes de la vallée de solo », mieux armés pour vivre sous les tropiques. […]
En 2010, un autre frère perdu fut arraché à l’oubli, quand les chercheurs fouillant la grotte de Denisova, en Sibérie, découvrirent une phalange fossilisée. La génétique prouva que le doigt était celui d’une espèce humaine encore inconnue, qu’on a baptisé du nom d’Homo Denisova.. »
et il en cite encore d’autres et conclut enfin :
« un sophisme commun est d’imaginer une ascendance linéaire, [d’un premier] qui engendre erectus, qui engendre Neandertal, qui lui-même mène à nous. Or, ce modèle linéaire donne l’impression fausse qu’à tout moment un seul type d’humains aurait habité la terre, et que toutes les espèces antérieures ne seraient que des modèles plus anciens de nous-mêmes, la vérité et qu’entre 2 millions d’années et 10 000 ans, le monde a hébergé, en même temps, plusieurs espèces humaines. […] Nous le verrons sous peu, nous, les sapiens, avons de bonnes raisons de refouler le souvenir de nos frères et sœurs. »
Il existe deux théories :
la théorie du métissage qui pense que sapiens se mêla à d’autres espèces
- la théorie du remplacement qui raconte une histoire très différente
[Histoire] « d’incompatibilité et de répulsion, voire de génocide. Dans cette optique sapiens remplaça toutes les populations humaines antérieures sans se mêler à elle. Si tel est le cas on peut faire remonter tous les lignages humains contemporains à la seule Afrique orientale voici 70 000 ans. Nous sommes tous de « purs sapiens »[…] dans les dernières années, la théorie du remplacement a été communément reçue. […] Mais cette situation a pris fin en 2010, quand ont été publiés les résultats de quatre années d’efforts pour dresser la carte du génome néandertalien. […]
Il est apparu que de 1 % à 4 % de l’ADN unique des populations modernes du Moyen-Orient et d’Europe est de l’ADN de Neandertal. Ce n’est pas énorme, mais c’est significatif. Un second choc survint quelques mois plus tard, quand il apparut que l’ADN extrait du doigt fossilisé de Denisova partageait jusqu’à 6 % de son ADN unique avec les mélanésiens et les aborigènes d’Australie actuels !
[…] On ne saurait parler de « fusion » entre sapiens et d’autres espèces humaines. [Il s’agit simplement de traces. La théorie du remplacement reste la plus vraisemblable.]
Au fil des 10 000 dernières années, Homo sapiens s’est si bien habitué à être la seule espèce humaine que nous peinons à envisager toute autre possibilité. […] Quand Charles Darwin expliqua qu’Homo sapiens n’était qu’une espèce d’animal parmi les autres, les gens poussèrent de hauts cris. Aujourd’hui encore, beaucoup refuse d’y croire. Si les Néanderthal avaient survécu, nous considérerions nous encore comme une créature à part ? Peut-être est-ce précisément ce qui incita nos ancêtres à effacer les Néanderthal. Ils étaient trop familiers pour que l’on feigne de les ignorer, trop différents pour qu’on les tolère. »
Et l’auteur sans, bien entendu, être capable d’expliquer comment ce phénomène se produisit, montre la coïncidence entre l’arrivée dans une région d’Homo sapiens et la disparition quasi concomitante de l’autre espèce humaine qui était présente sur ce lieu…
Peut-être qu’il y eut des génocides bien avant la folie nazi ?
<Cette hypothèse cependant n’a pas trouvé pour l’instant d’indice>
<707>
-
Lundi 23 mai 2016
Lundi 23 mai 2016«L’Histoire commença quand les humains inventèrent les dieux et se terminera quand les humains deviendront des dieux.»Yuval Noah HarariYuval Noah Harari est un jeune homme, il est né en 1976 et il a écrit un livre «Sapiens»Le Philanthrope, patron du laboratoire le plus performant sur l’intelligence artificielle et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg a invité ses milliers d’abonnés à lire ce livre et a écrit : « Ce livre est une grande narration historique de la civilisation humaine – à partir du moment où nous avons évolué de chasseurs-cueilleurs jusqu’à celui où nous avons organisé notre société et notre économie de nos jours.»Mais l’avis de Zuckerberg n’est pas déterminant pour moi, peut-être même qu’il pourrait avoir un effet répulsif.En revanche, mon ami Jean-François de Dijon a entrepris un vaste complot pour tenter de me faire débourser 24 € pour acheter ce livre de 500 pages dont le sous-titre est « Une brève Histoire de l’humanité »Il a tenté de convaincre Annie de l’acheter pour me l’offrir, puis il m’a incité directement à le faire en me promettant de le rembourser s’il ne me plaisait pas.Je l’ai donc acheté et profité de ma semaine de congé fin février, semaine pendant laquelle je n’étais pas obligé d’occuper ma journée par des tâches d’un intérêt intellectuel réduit et souvent consternant pour le seul motif de gagner ma vie, pour en débuter la lecture. Et je n’en ai achevé la lecture que lors du week-end de l’Ascension.Je vais donc vous entretenir pendant quelques jours de ce livre éblouissant.Je me suis d’abord intéressé à l’auteur : Docteur en Histoire médiévale et diplômé de l’Université d’Oxford, Yuval Noah Harari enseigne dans le département d’Histoire de l’université hébraïque de Jérusalem.Il a d’abord écrit son livre en hébreux puis l’a traduit, lui-même, en anglais, la traduction française date de septembre 2015.Cet ouvrage me semble unique. L’objet de son analyse n’est pas l’Histoire d’une civilisation, d’une Culture mais l’histoire de notre espèce : « L’homo sapiens ».Comment sapiens s’est imposé par rapport aux autres espèces du genre « homo », puis s’est comporté avec les autres espèces du règne animale.Comment sapiens a- Colonisé la terre ;
- Inventé l’agriculture ;
- Imaginé les religions ;
- Créé des villes puis les empires ;
- Développé le capitalisme ;
- Enfin, bouleversé la nature, la vie, la société par la révolution scientifique et industrielle.
Existe-t-il un sujet de nature à nous intéresser davantage que l’Histoire de notre espèce ?C’est, en effet, un livre d’une extraordinaire érudition où Harari mobilise les connaissances scientifiques et historiques pour non seulement décrire l’histoire de l’Humanité mais surtout analyser et jeter un regard décapant sur l’histoire de notre espèce. Car au départ, nous Homo sapiens, n’étions encore qu’une espèce insignifiante parmi d’autres. En 1500, nous étions environ 500 millions. Aujourd’hui, nous sommes 7 milliards. Exit l’homme de Neandertal, adieu l’Homo erectus. L’Homo sapiens est la seule espèce humaine qui a survécu et elle contrôle la planète et les autres espèces..Comment est-on passé de notre simple condition d’homme-singe à celle de maître du monde? C’est la question qu’il pose.Et il donne des explications, ouvre des hypothèses, donne des avis qui ne peuvent que nous interpeller et parfois nous heurter.Il nous heurte notamment quand il décrit la révolution agricole, comme la plus grande escroquerie de l’Histoire. (pages 101-117)Cette histoire qui débute vraiment il y a 70 000 ans et qui va jusqu’à aujourd’hui, dans le cœur de la silicon valley où des hommes, a priori sérieux, poursuivent ce rêve ou ce cauchemar de la recherche de l’immortalité.Le premier mot du jour consacré à Sapiens, est une pensée que Yuval Noah Hariri met en exergue sur son site : http://www.ynharari.com/fr/ et se trouve aussi sur la quatrième page de couverture.<706>
-
Vendredi 20 mai 2016
Vendredi 20 mai 2016«Cette photo m’a finalement sauvé la vie»Nidhi ChaphekarUne nouvelle réflexion sur une photo. Peut-on tout photographier ? Jusqu’où va la liberté de la photo de reportage ? Et où commence la vie privée ?Nidhi Chaphekar est une hôtesse de l’air indienne de 42 ans, mère de deux enfants. Un cliché d’elle assise sur un banc, couvert de sang et de poussière, lors des attentats de Bruxelles le 22 mars 2016, a fait le tour du monde sans que l’on ne lui demande son accordCe cliché a été pris quelques instants seulement après les explosions à l’aéroport Zaventem de Bruxelles. Dans le choc, cette femme a perdu une chaussure, et sa chemise jaune a été déchirée en lambeaux. Accrochée des deux mains à cette chaise qui la maintient, elle semble ne pas réaliser ce qu’il vient de se passer. Avec cette photo, Nidhi Chaphekar est devenu le visage de l’horreur de ces attentats meurtriers, qui ont fait 31 morts. Le cliché a notamment été repris en une de nombreux journaux, comme le Guardian, le New York Times, ou encore Le Parisien.Des journalistes ont retrouvé cette femme qui a déclaré «Cette photo m’a finalement sauvé la vie. Des gens du monde entier m’ont apporté du courage dans les moments difficiles. Ce n’est certainement pas la plus belle photo de moi, mais des milliers de personnes ont prié pour moi. Cela m’a donné beaucoup de force».Dans les différents articles, on apprend que cette femme avait été brûlée aux bras, aux jambes, au visage et au dos, et qu’elle a subi de multiples opérations chirurgicales. Outre de nombreuses fractures, les médecins lui ont également découvert un clou logé derrière l’oeil. Placée dans un coma artificiel pendant 22 jours, elle a finalement survécu à ses nombreuses blessures.Nidhi Chaphekar est reparti en Inde le 5 mai dernier en s’envolant pour Mumbai.Sur la photo, il y a une autre femme qui se trouve au premier plan. Cette seconde femme sur la photo, la main ensanglantée et au téléphone se nomme Stefanie De Loof et elle est Belge. Stefanie De Loof n’a, quant à elle, pas apprécié la photo. «Visiblement, tout le monde peut reprendre la photo car elle tourne sur Twitter. Maintenant, je dois essayer de passer au-dessus de ça, mais j’ai bien l’intention de repartir à Haïti pour Médecins sans frontières», conclut-elle.A t-on le droit de photographier dans ce type de situation ?En France, juridiquement non !En effet, s’il est tout à fait possible de reproduire et diffuser une image captée dans un lieu public et lors d’une manifestation si celle-ci ne présente pas un cadrage restrictif ou n’isole une personne aisément reconnaissable, tel n’est pas le cas lorsqu’on peut reconnaitre une personne, ce qui est le cas ici. Dans ce cas, il faut l’autorisation de la personne, ce qui ne fut pas fait pour ce cliché.Mais il me semble qu’ici nous sommes dans une situation très particulière, or cette photo symbolise toute la terreur des attentats de Bruxelles. En tant que telle, elle est information, elle devient aussi Histoire !Mais c’est une question délicate.À la suite des attentats du 11 septembre 2001 à New York, la photo de Nancy Borders avait également fait le tour du monde. Couverte de cendres, la jeune femme de 28 ans à l’époque des faits, avait alors été surnommée la «Dust Lady» («dame de poussière»). Cette femme avait vécu par la suite une véritable descente aux enfers marquée par une paranoïa maladive et des addictions multiples. Elle s’est éteinte le 24 août dernier d’un cancer de l’estomac à l’âge de 42 ans, sans être parvenue à dompter ses démons qui n’étaient pas la photo mais bien les attentats de New York. -
Jeudi 19 mai 2016
Jeudi 19 mai 2016«King Abdullah Economic City,»La ville privéeNous avons donc compris que les maîtres de la Silicon Valley voulaient faire disparaître la politique et l’Etat.
C’est encore le jeune patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a annoncé un projet urbain baptisé « Zee Town ».
Pour un montant estimé à 200 milliards de dollars, le roi des réseaux sociaux prévoit de construire sur 80 hectares, dans la Silicon Valley, rien de moins qu’une ville complète dédiée à ses 10.000 salariés, avec supermarchés, hôtels, villas et même dortoirs pour les stagiaires du groupe.
Mais ce n’est pas aux Etats-Unis, pas encore peut-être, mais dans ce « beau ? » pays, qui abrite les villes saintes de l’Islam, où l’alcool est interdit, où les femmes suivent la mode pudique, ce pays où toute autre religion que l’Islam est interdite sauf peut-être la religion de l’argent qu’est en train de se bâtir la première ville privée du monde : KAEC , King Abdullah Economic City.
Il est vrai que dans ce pays « saint », il est habituel de tout privatiser puisqu’ils ont même privatisé le nom de l’Etat qui porte le nom privé de la famille régnante.
Mais qu’est-ce que KAEC ?
 KAEC n’a pas de maire, elle est gouvernée par le PDG d’Emaar Economic City (EEC), Fahd Al Rasheed, qui juge le modèle « très bon pour les villes ».
KAEC n’a pas de maire, elle est gouvernée par le PDG d’Emaar Economic City (EEC), Fahd Al Rasheed, qui juge le modèle « très bon pour les villes ».
« Par définition, le secteur privé doit créer de la valeur : je dois donc vendre plus cher que le coût de revient, explique-t-il A l’inverse, les politiciens ont parfois du mal à créer de la valeur avec les services : ils en connaissent le coût, mais le prix qu’ils facturent à leurs administrés dépend de facteurs politiques. »
A Kaec, les habitants ne paient pas de taxes mais des « frais de services » pour la sécurité, l’eau ou la collecte des déchets, qui sont sous-traitées à différents entrepreneurs.
« Les habitants nous payent pour un service, pas pour financer une administration. Et comme ce sont nos clients, ils n’hésitent pas à se plaindre si les services sont mal rendus. Dans ce cas, la ville peut facilement changer de prestataire. »
Les concepteurs de ce projet visent près de 2 millions d’habitants, pardon de clients d’ici à 2035
Dans le cas de Kaec, un partenariat public-privé a été conclu entre le gouvernement saoudien et un groupe immobilier de Dubaï, Emaar Properties.
Vous trouverez toutes les informations utiles derrière ces liens :
Dans le Figaro : <Kaec, la première ville cotée en Bourse au monde>
Dans les Echos : <Villes privées : la nouvelle utopie>
Et sur un site spécialisé en urbanisme : <Kaec : une ville 100% privée>
Une ville privée !
Il est vrai que ville vient du mot latin VILLA qui signifie ferme agricole, domaine rural voir maison de campagne. C’est à dire, à l’origine, quelque chose de privée.
Le mot VILLA a donné d’abord village, comme une communauté de villa puis ville.
Le mot vilain vient aussi du latin VILLA car l’ancien français désignait sous le terme de vilain un « habitant du domaine rural », bref un paysan.
En latin VILLA ne désignait pas la ville ; Le terme latin pour désigner ville est «urbs». C’est à partir de cette racine que nous connaissons urbain, urbanisme, urbanité etc.
Lorsqu’il était employé avec une majuscule, l’Urbs désignait alors « la ville d’entre toutes les villes », Rome.
Ainsi la bénédiction papale le jour de Pâques est : « Urbi et Orbi », « À Rome et au Monde ».
Mais il y a un autre mot pour désigner la réalité de la ville : En Grèce antique on parlait de la « polis » qui est bien sûr la racine de « politique » dont les patrons des technologies numériques ne veulent plus.
Et dans l’étymologie latine « polis » est devenu « civitas » c’est à dire une cité-État, autrement dit une communauté de citoyens libres et autonomes.
Dans la pensée grecque antique, la cité préexiste à l’homme.
À titre d’exemple, la cité d’Athènes n’existe pas en tant que telle : c’est la cité des Athéniens, tout comme Sparte est la cité des Lacédémoniens.
Toutes ces informations sont tirées de Wikipedia qui rappelle aussi qu’Aristote disait :
« la cité est une communauté — une koinônia — « d’animaux politiques » réunis par un choix — proairésis — de vie commune (Politique, 1252 – 1254). »
En français, ce mot « la cité » a aujourd’hui mauvaise réputation. Ce n’est pas très valorisant de venir de la cité
Mais le mot cité eut son heure de gloire, il y avait les cités Etat : Venise, Gêne, il reste la cité du Vatican.
Aujourd’hui on garde une connotation historique pour certains quartiers ou centres historiques l’Ile de la cité à Paris ou encore la cité de Carcassonne.
On utilise aussi ce mot pour désigner un ensemble immobilier qui a une fonction particulière : La cité universitaire, La cité ouvrière ou encore comme un nom commercial « La cité de la gastronomie » ou à la Lyon « la cité internationale ».
Mais c’est bien à la racine latine de cité que s’attaque la ville privée car si cité vient du latin civitas (« état de citoyen, droit de cité, ensemble des citoyens d’une ville, cité, nation, État »), il est surtout apparenté à civis (« citoyen »).
Et de citoyen, il n’est plus question à KAEC !
A KAEC n’y a plus que des consommateurs !
 Il y a bien sûr des sites saoudiens qui vantent cet objet du futur déjà présent :
Il y a bien sûr des sites saoudiens qui vantent cet objet du futur déjà présent :
https://www.visitsaudi.com/fr/see-do/destinations/kaec/kaec-family-fun-in-the-sun
https://www.arabnews.fr/node/Economie
Et le site de <la ville en anglais>
<704>
-
Mercredi 18 mai 2016
Mercredi 18 mai 2016« Une course à mort est engagée entre la technologie et la politique. »Peter Thiel un des fondateurs de Paypal
Cité par Marc Dugain et Christophe Labbé dans leur livre « L’Homme nu »Le romancier Marc Dugain et le journaliste Christophe Labbé viennent de faire paraître, chez Plon, un livre : « L’Homme nu » qui a pour sous-titre : « La dictature invisible du numérique »Dans cet ouvrage ils expliquent en détail la force des « Big data » dans nos vies aujourd’hui et surtout ce que les maîtres de l’internet et des objets connectés seront capables de réaliser et de diriger demain.Sur le chemin de leurs ambitions, se dresse une structure qui les embarrasse et qu’ils qualifient tantôt d’inefficace, tantôt d’archaïque et quelquefois des deux : L’Etat.Cette vieille structure qui crée le Droit et la Loi, ces deux concepts qui ont pour ambition de protéger le faible contre le fort. Ce n’est pas toujours concluant, mais il suffit de voir ce qui se passe dans des pays dans lesquels l’Etat est chancelant, comme la Somalie ou l’Irak, dans ce cas plus rien ne protège le faible.L’Etat qui dans nos contrées a inventé l’Etat social ou providence comme le préconisait William Beveridge dans son célèbre rapport de 1942.L’Etat qui est dirigé par la politique, c’est à dire une assemblée de citoyens qui élit des parlementaires, donne son avis, choisit entre plusieurs propositions politiques.J’ai acheté ce livre et je partage avec vous cet extrait que je tire des pages 22 à 28 :«Depuis 2010, l’humanité produit autant d’informations en deux jours qu’elle ne l’a fait depuis l’invention de l’écriture il y a 5300 ans. 98 % de ces informations sont aujourd’hui consignés sous forme numérique.On assiste à une véritable mise en données du monde. […]Si 70 % des données générées le sont directement par les individus connectés, ce sont des entreprises privées qui les exploitent. C’est ainsi qu’Apple, Microsoft, Google ou Facebook détiennent aujourd’hui 80 % des informations personnelles numériques de l’Humanité. Ce gisement constitue le nouvel or noir. Rien qu’aux États-Unis, le chiffre d’affaire mondiale de la big data, le terme n’a fait son entrée dans le dictionnaire qu’en 2008, s’élève à 8,9 milliards de dollars. En croissance de 40 % par an il devrait dépasser les 24 milliards en 2016.Les GAFA ont réussi à conquérir en une dizaine d’années l’ensemble du monde numérique. Ces « sociétés du septième continent », comme on les appelle, sont la nouvelle incarnation de l’hyper puissance américaine. […]Les GAFA ont construit leur puissance au détriment des individus. L’exact inverse de ce qu’elles prétendent. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a ainsi expliqué ou 31 millions d’internautes qui le suivent sur le réseau social son coup de cœur pour The End of Power de Moisés Naim. Un livre qui, explique-t-il avec enthousiasme, raconte « comment le monde change pour donner davantage de pouvoirs aux individus aux dépens des grandes organisations comme les gouvernements ou l’armée ». Selon Zuckerberg, l’individu se libère puisque le véritable pouvoir n’est plus centralisé entre les mains d’un Etat, mais dépend des individus et des liens sociaux qu’ils tissent entre eux, ce que permet de faire notamment Facebook…Le voilà, l’ennemi : la puissance étatique. Pour la plupart des entrepreneurs de la Silicon Valley, l’État dans sa forme actuelle est l’obstacle à abattre. Leur crainte ce n’est pas Big Brother, mais Big Father. Patri Friedman, petit-fils du célèbre économiste libéral Milton Friedman et ancien ingénieur chez Google, considère le gouvernement comme « une industrie inefficace » et la démocratie comme « inadaptée ». Il explique à qui veut l’entendre que le système politique actuel est sclérosé, les règles de régulation du commerce de l’usage des données privées et publiques obsolètes, et que tout cela empêche le progrès. Patri Friedman milite en faveur d’une sécession des entrepreneurs de la high-tech. En 2008, il a mis sur pied le Seasteading Institude, dont l’objectif est de couvrir la planète de « villes nations flottantes » échappant à la souveraineté des Etats. Friedman a déjà levé 1,5 millions de dollars auprès du multimilliardaire Peter Thiel, à l’origine de PayPal, le leader mondial du paiement en ligne, aujourd’hui principal concurrent du réseau des cartes de crédit. Le même a déclaré en avril 2009, sur le site du libertarien think tank Cato Institute, qu’«une course à mort était engagée entre la technologie et la politique».À l’automne 2013, quand un conflit sur le budget a forcé le gouvernement fédéral américain à fermer provisoirement une partie de ses services, Peter Thiel a aussitôt taclé : « les entreprises transcendent le pouvoir. Si elles ferment, le marché boursier s’effondre. Si le gouvernement ferme, rien n’arrive, et nous continuons à avancer parce que cela n’a pas d’importance. La paralysie du gouvernement est en réalité bonne pour nous tous. » »Un monde dont on aura retiré toute politique pour ne laisser jouer que la loi du marché me semble quelque chose d’assez proche de la jungle.L’article du Point qui présente ce livre, finit son analyse par ces considérations :« Pour les big data, la démocratie est obsolète, tout comme ses valeurs universelles. Exit le concept de citoyen inventé par les Grecs ! Antoinette Rouvroy, chercheuse en droit de l’université de Namur, estime que ces firmes visent une « gouvernementalité algorithmique ». Un mode de gouvernement inédit « opérant par configuration anticipative des possibles plutôt que par réglementation des conduites, et ne s’adressant aux individus que par voie d’alertes provoquant des réflexes plutôt qu’en s’appuyant sur leurs capacités d’entendement et de volonté ».Le futur configuré par les big data risque donc d’être la déclinaison d’un mode de société où Etat-nation et classe politique vont s’évaporer jusqu’à disparaître. Les démocraties s’essoufflent, autant que leur système de représentation. Est-ce que voter tous les quatre ou cinq ans aura encore une signification quand, dans quelques années, les big data seront capables de connaître en temps réel la réaction de chaque individu à toute proposition sur l’organisation collective de la société ? C’est peu probable. »Marc Dugain était l’invité de France Inter : http://www.franceinter.fr/emission-linvite-du-57-marc-dugain -
Mardi 17 mai 2016
Mardi 17 mai 2016« La vie est une tragédie. Réaliser des films est la seule distraction que j’ai trouvée pour la supporter. »Woody AllenLe festival de Cannes a commencé le 11 mai et s’achèvera le 22 mai 2016.Le dernier film de Woody Allen : « Café Society » a été présenté, hors compétition.L’express a réalisé une interview du cinéaste, interview qui a été évoqué dans <la revue de presse de Frédéric Pommier du samedi 7 mai> :«Du film, on dira juste que c’est une histoire d’amour. L’histoire d’une femme qui doit choisir entre deux hommes. L’un qui lui propose la sécurité, tandis que l’autre lui propose plutôt l’aventure. Mais c’est aussi l’histoire d’une famille juive à New-York, ville adorée du cinéaste qui s’exprime cette semaine dans les colonnes de L’EXPRESS. Titre de cet article : « Dépressif heureux ». Vous l’avez reconnu ? Il s’agit de Woody Allen…Woody Allen, dont le nouveau film, Café Society, fera mercredi l’ouverture du Festival de Cannes. Et c’est donc à cette occasion que Stéphanie Chayet est allée le rencontrer, dans l’écrin de son studio fétiche new-yorkais. Une belle interview dans laquelle le cinéaste met à mal quelques rumeurs le concernant. Non, il n’est pas aussi névrosé qu’on le pense et il a une vie très normale. Non, il n’est pas du tout ce qu’on appelle un intello. Chez lui, il boit des bières devant des matchs de foot américain à la télé. Et à l’école, d’ailleurs, il était très mauvais élève. Il n’y a qu’en sport qu’il parvenait à faire des étincelles. « Enfant, explique-t-il sans rire, j’étais un athlète exceptionnel ».Mais aujourd’hui, là où Woody Allen continue de briller, c’est avant tout dans le regard qu’il porte sur le monde. Un regard corrosif, mais non dénué de facétie. Notamment sur la résurgence de l’antisémitisme. « Les Juifs sont une cible facile car ils sont peu nombreux, dit-il. Mais s’il n’y avait plus un seul Juif sur terre, on trouverait une autre minorité à persécuter. Et si toutes les minorités étaient éliminées, les bruns se retourneraient contre les blonds, les droitiers contre les gauchers. » Et le réalisateur ajoute, fataliste, que « l’homme n’est pas, à l’évidence, la plus noble des espèces ».Il commente également la politique américaine… Il commente et il pronostique l’échec de Donald Trump, qu’il connaît pour l’avoir fait tourner dans Célébrity. « Il essuiera, prédit-il, la défaite la plus cuisante qu’un républicain ait jamais connue, et ceci quel que soit son adversaire démocrate : Hillary Clinton, Bernie Sanders ou bien ma mère. » Et tant pis si sa mère est morte il y a plus de dix ans.Et puis, bien sûr, Woody Allen parle de cinéma. Un cinéma qu’il juge globalement de moins en moins bon. Et pourquoi donc certains de ses films ont-ils nettement plus de succès en France qu’aux États-Unis ? « Ma théorie, dit-il, c’est qu’ils gagnent à être traduits. Dans une autre langue, les gens, visiblement, ne se rendent pas compte de leurs défauts. » Et pense-t-il continuer longtemps à ce rythme effréné d’un long-métrage par an ? « Mais que faire d’autre ? », répond-il. « La vie est une tragédie. Réaliser des films est la seule distraction que j’ai trouvée pour la supporter. »L’entretien de l’Express se trouve derrière ce lien et a pour titre : «J’ai un public de déprimés fidèles (mais il faut être abonné)» : http://www.lexpress.fr/culture/cinema/woody-allen-j-ai-un-public-de-deprimes-fideles_1788603.htmlJ’adore Woody Allen, mais je ne suis pas déprimé, il est possible d’aimer Woody Allen sans être déprimé -
Jeudi 12 mai 2016
«Les accords Sykes-Picot»Accords secrets franco-britannique signés le 16 mai 1916Lundi, il y a 100 ans, le 16 mai 1916 ont été signés les accords secrets Sykes – Picot dont tout le monde parle encore aujourd’hui.
Quand les combattants de Daech ont ouvert la frontière entre l’Irak et la Syrie pour créer un territoire sur les deux pays, ils ont affirmé :
«Nous avons détruit la frontière Sykes-Picot.»
Dans une explication simpliste, on raconte que les Britanniques et les Français se sont mis d’accord pour se partager le Moyen-Orient et ont créé l’Irak la Syrie dans une réunion entre deux diplomates : un anglais Mark Sykes et un français François Georges-Picot.
Si Paris-Match, aborde ce sujet il vous précisera, en outre, que le diplomate François Georges Picot avait une sœur qui s’appelait Geneviève Georges-Picot. Que cette sœur a épousé Jacques Bardoux, un homme politique. Et que ce couple a eu plusieurs enfants, dont une fille Marthe Clémence qui est la mère de Valéry Giscard d’Estaing.
Mais les choses sont beaucoup plus complexes, les discussions entre Britanniques et Français ont été très longues et après l’accord il y a encore eu beaucoup de changements.
Prenons d’abord le plan de cet accord :
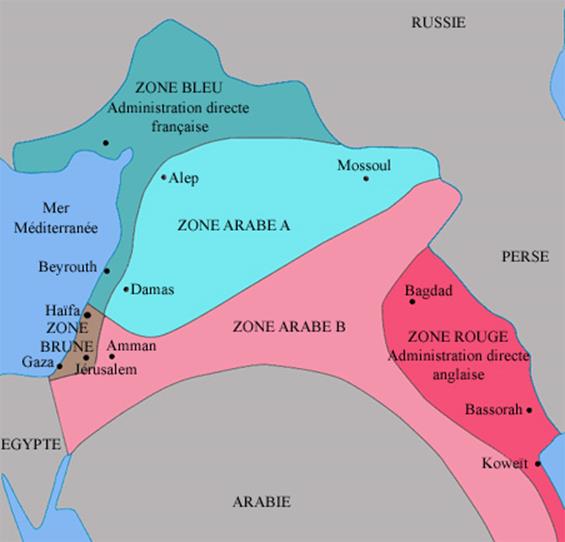 Si vous cherchez à retrouver les frontières actuelles de la Syrie, de l’Irak, de la Jordanie, du Liban, de la Palestine et d’Israël dans ce schéma, vous aurez beaucoup de mal.
Si vous cherchez à retrouver les frontières actuelles de la Syrie, de l’Irak, de la Jordanie, du Liban, de la Palestine et d’Israël dans ce schéma, vous aurez beaucoup de mal.
Je confirme cela ne correspond pas.
La carte comporte 5 zones :
– 2 zones bleus pour la France, une d’administration directe et une autre d’influence appelée zone Arabe
– 2 zones rouges pour le Royaume-Uni , organisées de la même manière.
– Et une cinquième zone, brune, comprenant la Palestine et Jérusalem qui devait selon les accords Sykes-Picot être internationale ou mixte.
Tout ceci va être défait et refait : ainsi la zone internationale ne sera administrée que par les britanniques et Mossoul ira également chez les britanniques et deviendra une ville d’Irak.
Mais fondamentalement, ce que révèlent les accords Sykes-Picot, c’est une superposition de conflits, assez semblable à ce qui se passe aujourd’hui.
Il y a d’abord le conflit central, la guerre 14-18. Les territoires dont nous parlons font partie de l’Empire Ottoman. Or, l’Empire Ottoman s’est allié à l’Allemagne et aux Austro-Hongrois, il est donc l’ennemi de la France et de la Grande Bretagne.
Mais à l’intérieur de l’Empire Ottoman, il y a aussi conflit, les Arabes n’ont pas beaucoup de considération pour les Turcs, les maîtres de l’Empire. L’Islam est né en leur sein, Mohammed était un des leurs, les Turcs ne sont que des mercenaires rustres. Ils veulent s’en débarrasser et devenir indépendant.
Alors les français et surtout les britanniques qui dominent l’Egypte essayent de convaincre les Arabes de se révolter contre les Turcs pour faciliter la victoire des alliés. C’est ici que se situe Lawrence d’Arabie qui va devenir l’ami des Arabes et se battre à leurs côtés contre les Turcs. Mais les Arabes ont des exigences : ils veulent battre les turcs avec les anglais mais après, ils veulent que ce soit créé un grand Etat Arabe unifié.
Et un autre conflit s’ajoute à tout cela : la rivalité entre l’empire colonial britannique et l’empire colonial français. Ce conflit doit être mis entre parenthèse, parce qu’ils sont alliés dans le conflit majeur, il reste pourtant omniprésent.
Et de la résultante de ces conflits sort cette carte bizarre, les français et les anglais ont chacun leur part des dépouilles de l’Empire Ottoman qui cependant n’est pas encore vaincu.
Et, il y a la zone Arabe, à cause de la promesse des Britanniques pour créer la grande entité Arabe mais restant cependant sous l’influence de la France et des Britanniques, pour les conseiller. Et aussi un peu pour le pétrole dont on perçoit toute l’importance lors de la première guerre mondiale.
Mais quand on parle des Arabes, ce n’est pas simple non plus. Car il y aussi conflit à l’intérieur des Arabes.
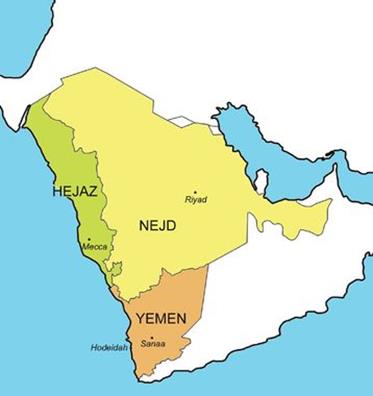 Le conflit oppose deux dynasties : la première descend du prophète, c’est la dynastie des Hachémites, Hachem était le grand père de Mohamed. Le chef de cette dynastie s’appelle Hussein, c’est le roi qu’on voit dans Lawrence d’Arabie et qui est joué par Alec Guiness. Son fils aîné est Ali, joué par le bel Omar Sharif. Il a encore deux autres enfants qui vont jouer un grand rôle dans cette partie du Monde. Hussein est le Chérif de La Mecque. En aidant les britanniques, il espère devenir calife d’une grande Arabie unifiée.
Le conflit oppose deux dynasties : la première descend du prophète, c’est la dynastie des Hachémites, Hachem était le grand père de Mohamed. Le chef de cette dynastie s’appelle Hussein, c’est le roi qu’on voit dans Lawrence d’Arabie et qui est joué par Alec Guiness. Son fils aîné est Ali, joué par le bel Omar Sharif. Il a encore deux autres enfants qui vont jouer un grand rôle dans cette partie du Monde. Hussein est le Chérif de La Mecque. En aidant les britanniques, il espère devenir calife d’une grande Arabie unifiée.
L’autre dynastie règne sur le centre de l’Arabie Saoudite, cette région appelée le Nejd avec pour capitale Ryad. Cette dynastie est celle d’Ibn Seoud, qui ne descend pas du prophète mais s’est alliée à la secte rigoriste des Wahabites
La zone côtière, de la mer Rouge qui comprend les villes religieuses de La Mecque et de Médine, s’appelle Hedjaz et c’est dans cette région que va se lancer la révolte Arabe vu dans Lawrence d’Arabie et qui va aller conquérir Aqaba puis Damas.
Et il y a même un autre conflit à l’intérieur de l’administration coloniale britannique, il y a le camp du Caire qui est pour Hussein et le camp de l’Inde qui est pour Ibn Seoud.
Au bout d’un certain nombre de négociations (Clemenceau va lâcher aux britanniques Mossoul et la zone internationale de Palestine) et de trahisons :
- Hussein va tenter de devenir Calife et régner sur le Hedjaz,
- Son fils Faycal va tenter de devenir roi de Syrie mais devra quitter ce trône et ira s’installer sur le trône d’Irak, il y restera jusqu’à sa mort en 1933. Son fils Ghazi lui succéda, puis son petit-fils mais qui fut renversé par un premier coup d’état militaire du général Kassem en 1958 et après une période d’instabilité Saddam Hussein pris le pouvoir en 1963.
- Son fils Abdallah devint roi de Jordanie, son petit-fils Abdallah II règne toujours
Ali, le prince joué par Omar Sharif resta avec son père et fut vaincu avec lui en 1924 par les troupes de Ibn Séoud qui instaura son régime wahhabite sur toute l’Arabie. Cette terre qui est prétendument sacrée pour les musulmans et qui est la seule au monde dont le nom de l’Etat comporte le nom de la famille régnante.
Aujourd’hui les descendants de Hussein, le roi Abdallah II de Jordanie et de Ibn Séoud, le roi Salmane continuent à régner, sans avoir jamais demandé l’avis des populations qu’ils gouvernent et en gardant toujours d’excellentes relations avec les pays occidentaux, la France et le Royaume-Uni.
C’est très compliqué je vous l’ai dit et pourtant j’ai beaucoup simplifié.
Le rôle des britanniques et des français dans toute cette histoire n’est pas très moral.
Mais le rôle des deux dynasties arabes ne l’est pas davantage.
Si vous voulez lire des articles plus détaillés, vous les trouverez ci-après :
<Comment l’Empire ottoman fut dépecé>
<L’ombre de l’accord Sykes-Picot continue à empoisonner le monde>
<Les 100 ans des accords Sykes-Picot>
<701>
- Hussein va tenter de devenir Calife et régner sur le Hedjaz,
-
Mercredi 11 mai 2016
Mercredi 11 mai 2016«Que fait l’abeille ?
Elle fait du miel ? Mais fondamentalement on s’en fiche !
L’abeille, elle pollinise !»Yann Moulier BoutangVous lisez ce matin le 700ème mot du jour.Pour chaque centaine, j’essaye de m’échapper un peu des contingences de l’actualité pour dévoiler une réflexion plus profonde et plus universelle.Si je puise une partie de l’inspiration de ces billets quotidiens dans mon butinage sur Internet, mes lectures de livres et ma culture passée ou présente, l’essentiel de ma matière première est constitué de podcast, c’est à dire des émissions radios ou des conférences que j’écoute le plus fréquemment avec un lecteur de mp3, le plus souvent possible en marchant.La plupart, je les écoute puis je les efface.Et puis, il y a certains enregistrements que je conserve sur un disque dur. Depuis 2009, j’en ai conservé plus de 2000.Une des toutes premières conférences qui m’a incité à adopter cette pratique est une conférence du mercredi 4 février 2009, où l’économiste Yann Moulier Boutang a présenté un de ses livres à la librairie Mollat de Bordeaux.J’ai pu constater que cette conférence était encore en ligne : http://www.mollat.com/audio/090204MOULIERBOUTANGpad.mp3Dans cette conférence, il a eu ce développement qui est un des moments d’intelligence dont je me souviendrai toujours :« Je vais vous parler des abeilles.Qu’est-ce que fait l’abeille ?L’économie politique qui s’intéresse aux produits, aux produits vendables, vous répond : l’abeille produit du miel.L’apiculteur va remplacer l’essaim sauvage où l’abeille produit du miel, pour elle-même et pour ses larves, par des ruches avec des rayons.Puis il va subtiliser le miel des rayons, car l’abeille ne produit pas naturellement du miel pour les humains. Et en lui retirant le miel des rayons, l’abeille va produire, produire et encore produire du miel.On va lui laisser juste ce qu’il faut pour se reproduire, elle et ses larves, et le surplus sera approprié par l’apiculteur.Cela ne vous rappelle rien ?Moi ça me rappelle la plus-value ou la survaleur de Marx.Mais maintenant que fait vraiment l’abeille maintenant que nous savons un peu plus de complexité.Eh bien fondamentalement, je vais vous dire : le miel on s’en fiche !L’abeille, elle pollinise !Et Einstein disait, un monde où les abeilles auront disparu ne laissera que 4 à 5 ans de survie à l’espèce humaine. [Cette disparition est d’ailleurs une question d’actualité]L’abeille pollinise, cela veut dire que 80 % de la production agro-alimentaire en terme de légumes et de fruits est produite grâce aux abeilles.Il faut aussi rajouter des choses comme le tournesol pour lequel la pollinisation de l’abeille prend la plus grande part.L’abeille pollinise !Nous pouvons mesurer, puisqu’un économiste doit pouvoir mesurer des quantités et des prix, l’impact des abeilles. Si l’on prend les États-Unis d’Amérique, si vous faites l’hypothèse qu’il n’y a plus de pollinisation, vous pouvez compter entre 30 et 35 milliards de dollars par an, qui disparaissent. Et je ne parle même pas de la flore, des parcs sauvages, je parle simplement de la production agricole. [Lire aussi cet article de Sciences et avenir sur la disparition des abeilles et ses conséquences]Donc qu’est-ce que produit l’abeille, en termes de valeur économique ?D’un côté elle produit aux États-Unis pour 100 millions de dollars de miel et de l’autre côté elle participe à la production d’une valeur entre 30 et 35 milliards de dollars.En conséquence, ce que fait fondamentalement l’abeille du point de vue économique, au niveau de l’écosystème elle produit 350 fois plus que le miel, en valeur.Voilà les proportions.D’un côté il y a ce qui est calculé par un output marchand, simple, clair : l’abeille produit du miel.Et de l’autre côté, elle pollinise et nous savons qu’on peut se passer de miel, mais on ne peut pas se passer de pollinisation.Nous comprenons donc que l’abeille fait du miel pour vivre et se nourrir, mais qu’en vivant, elle circule, elle pollinise et que sa véritable contribution productive, c’est ça !En tout cas, en terme de valeur, c’est ça l’étalon principal.En économie traditionnelle, on voit l’abeille qui consomme et l’abeille qui produit. Un input et un output.Mais, ce qui est fondamental, c’est son rôle dans la reproduction du vivant et ça elle le fait même sans s’en apercevoir, puisqu’elle fait cela en même temps qu’elle consomme, comme un produit annexe de sa consommation : elle répand le pollen.Le plus important c’est qu’elle circule en se nourrissant, ce n’est pas son travail industrieux dans la ruche ou elle transforme le nectar en miel ou en gelée royale.Et ce raisonnement est en terme de valeur, de richesse économique !Retour à l’être humain.Qu’est-ce que fait l’humain principalement ? Un output marchand à partir de marchandise ?Non ! il produit essentiellement du vivant à partir du vivant.L’humain ne fait pas que se reproduire, il met au monde des enfants mais qu’il élève et en cela il crée quelque chose de nouveau !Il produit son environnement, il produit des relations, il produit du lien etc.Mais pour des humains, en dehors des sociologues qui faisait de grandes déclarations qui disaient « le lien social c’est important », les assistantes sociales qui disaient « il ne faut pas couper dans les dépenses publiques », « il ne faut pas couper dans l’éducation parce que c’est la base de la société, parce que c’est la richesse de la société ». Parce que c’est aussi la possibilité pour les entreprises de ne pas avoir des employés qui sont totalement malades ou totalement handicapés sur tous les plans.En dehors de cela, ce n’était pas tellement connu et surtout pas des économistes, parce que je peux vous dire que mes confrères ont une propension à ne pas s’intéresser à la pollinisation et à se focaliser sur la production du surplus de miel qui est notoirement connu. »La richesse de cette compréhension de ce qui est important me paraît incommensurable.Bien sûr le miel n’est pas indifférent, puisque c’est pour produire le miel que l’abeille va butiner les fleurs, mais la grande valeur, le grand apport de l’abeille c’est bien la pollinisation.Je vous laisse à cette réflexion féconde pour l’Humanité qui tirerait tous les enseignements de ce constat que contrairement au raisonnement primaire de l’économiste et de l’épicier, ce que fait l’abeille de plus important c’est de polliniser pas de produire du miel.Yann Moulier Boutang a d’ailleurs écrit un livre : <L’abeille et l’économiste>Vous pouvez aussi voir cette vidéo : https://vimeo.com/49977836Et n’oublions pas notre rôle de pollinisateur… -
Mardi 10 mai 2016
Mardi 10 mai 2016« Il faut considérer la Silicon Valley comme un projet politique, et l’affronter en tant que tel. »Evgeny MorozovEvgeny Morozov est un chercheur et écrivain américain d’origine biélorusse, spécialiste des implications politiques et sociales du progrès technologique et du numérique.Il est né à 1984 et c’est probablement un des plus grands penseurs critiques du numérique et notamment de la silicon Web.Il a été invité, le 4 mai au Forum « European Lab » de Lyon, où il est intervenu sur le thème suivant : « Mirage du Numérique : pour une politique des Big Data ».Il avait été interviewé par Xavier de la Porte, pour Rue 89, en octobre dernier.C’est cet article que je souhaite partager avec vous aujourd’hui : « Internet est la nouvelle frontière du néolibéralisme »Xavier de La Porte le présente ainsi :« Evgeny Morozov s’est imposé en quelques années comme l’un des contempteurs les plus féroces de la Silicon Valley. A travers trois ouvrages – « The Net Delusion » (2011, non traduit en français), « Pour tout résoudre, cliquez ici » (2014, FYP éditions) et « Le Mirage numérique » (qui paraît ces jours-ci aux Prairies ordinaires) –, à travers une multitudes d’articles publiés dans la presse du monde entier et des interventions partout où on l’invite, il se fait le porteur d’une critique radicale envers la technologie en tant qu’elle sert la domination des Etats-Unis. A 31 ans, originaire de Biélorussie, il apprend toutes les langues, donne l’impression d’avoir tout lu, ne se trouve pas beaucoup d’égal et maîtrise sa communication avec un mélange de charme et de froideur toujours désarmant.L’écouter est une expérience stimulante car il pense largement et brasse aussi bien des références historiques de la pensée (Marx, Simondon…) que l’actualité la plus récente et la plus locale. »«[Ma critique de la Silicon Valley est ] plus radical qu’au début. Mais parce que j’étais dans une forme de confusion, je doutais de ce qu’il fallait faire et penser. J’ai aujourd’hui dépassé cette confusion en comprenant que la Silicon Valley était au centre de ce qui nous arrive, qu’il fallait comprendre sa logique profonde, mais aussi l’intégrer dans un contexte plus large.Or, la plupart des critiques ne font pas ce travail. Uber, Apple, Microsoft, Google, sont les conséquences de phénomènes de long terme, ils agissent au cœur de notre culture. Il faut bien comprendre que ces entreprises n’existeraient pas – et leur modèle consistant à valoriser nos données personnelles serait impossible – si toute une série de choses n’avaient pas eu lieu : par exemple, la privatisation des entreprises télécoms ou l’amoncellement de données par d’énormes chaînes de grands magasins.Cette histoire, il faut la raconter de manière plus politique et plus radicale. Il faut traiter cela comme un ensemble, qui existe dans un certain contexte.Et ce contexte, c’est, il faut le dire, le néolibéralisme. Internet est la nouvelle frontière du néolibéralisme.Le travail critique de la Silicon Valley ne suffit pas. Il faut expliquer que le néolibéralisme qu’elle promeut n’est pas désirable. […]Il faut travailler à l’émergence d’une gauche qui se dresse contre ce néolibéralisme qui s’insinue notamment par les technologies. […]La Silicon Valley va au-delà de tout ce qu’on avait connu auparavant en termes d’impérialisme économique. La Silicon Valley dépasse largement ce qu’on considérait auparavant comme les paragons du néolibéralisme américain – McDonald’s par exemple – car elle affecte tous les secteurs de notre vie.C’est pourquoi il faut imaginer un projet politique qui rénove en fond notre conception de la politique et de l’économie, un projet qui intègre la question des infrastructures en garantissant leur indépendance par rapport aux Etats-Unis.Mais si je suis pessimiste quant à l’avenir de l’Europe, c’est moins à cause de son impensée technologique que de l’absence flagrante d’esprit de rébellion qui l’anime aujourd’hui.[…] Je parle de choses fondamentales comme le travail, l’éducation, la santé, la sécurité, les assurances. Dans tous ces secteurs, des changements majeurs sont en train d’avoir lieu et cela va continuer. […]Ce qui m’intéresse, ce sont les discours de la Silicon Valley, ce sont les buts qu’elle se donne. Peu importe si, au moment où j’en parle, ce sont seulement 2% de la population qui utilisent un service. Il se peut qu’un jour, ce soient 20% de la population qui l’utilise. Cette possibilité à elle seule justifie d’en faire la critique. […]Il est intéressant de regarder ce qui s’est passé avec la reconnaissance faciale. Il y a presque quinze ans, dans la suite du 11 Septembre, les grandes entreprises sont allées vendre aux Etats le discours de la reconnaissance faciale comme solution à tous leurs problèmes de sécurité. Or, à l’époque, la reconnaissance faciale ne marchait absolument pas. Mais avec tout l’argent des contrats, ces entreprises ont investi dans la recherche, et aujourd’hui, la reconnaissance faciale marche. Et c’est un énorme problème. Il faut prendre en compte le caractère auto-réalisateur du discours technologique. […]Il faut considérer la Silicon Valley comme un projet politique, et l’affronter en tant que tel. […]Mais c’est un défi gigantesque parce qu’il comporte deux aspects :un aspect impérialiste : Facebook, Google, Apple, IBM sont très liés aux intérêts extérieurs des Etats-Unis. En son cœur même, la politique économique américaine dépend aujourd’hui de ces entreprises. Un réflexe d’ordre souverainiste se heurterait frontalement à ces intérêts et serait donc voué à l’échec car il n’existe aucun gouvernement aujourd’hui qui soit prêt à affronter les Etats-Unis ;un aspect philosophico-politique : on pris l’habitude de parler de « post-capitalisme » en parlant de l’idéologie de la Silicon Valley, mais on devrait parler de « post-sociale-démocratie ».Car quand on regarde comment fonctionne Uber – sans embaucher, en n’assumant aucune des fonctions de protection minimale du travailleur –, quand on regarde les processus d’individualisation des assurances de santé – où revient à la charge de l’assuré de contrôler ses paramètres de santé –, on s’aperçoit à quel point le marché est seul juge.L’Etat non seulement l’accepte, mais se contente de réguler. Est complètement oubliée la solidarité, qui est au fondement de la social-démocratie. Qui sait encore que dans le prix que nous payons un taxi, une part – minime certes – sert à subventionner le transport des malvoyants ? Vous imaginez imposer ça à Uber….Il faut lire le livre d’Alain Supiot, « La Gouvernance par les nombres » (Fayard, 2015), il a tout juste : nous sommes passés d’un capitalisme tempéré par un compromis social-démocrate à un capitalisme sans protection. C’est donc qu’on en a bien fini avec la social-démocratie.[Comment a-t’on accepté cela ?]Mais parce que la gauche en Europe est dévastée ! Il suffit de regarder comment, avec le feuilleton grec de cet été, les gauches européennes en ont appelé à la Commission européenne, qui n’est pas une grande défenseure des solidarités, pour sauver l’Europe.Aujourd’hui, la gauche a fait sienne la logique de l’innovation et de la compétition, elle ne parle plus de justice ou d’égalité.La Commission européenne est aujourd’hui – on le voit dans les négociations de l’accord Tafta – l’avocate d’un marché de la donnée libre, c’est incroyable ! Son unique objectif est de promouvoir la croissance économique. Si la vie privée est un obstacle à la croissance, il faut la faire sauter ! […]Car certains à gauche – notamment dans la gauche radicale – ont pu croire que la Silicon Valley était une alliée dans le mesure où ils avaient un ennemi commun en la personne des médias de masse. Il est facile de croire dans cette idée fausse que les technologies promues par la Silicon Valley permettront l’émergence d’un autre discours.On a accepté cela comme on accepte toujours les idées dominantes, parce qu’on est convaincus. Ça vient parfois de très loin. L’Europe occidentale vit encore avec l’idée que les Américains ont été des libérateurs, qu’ils ont ensuite été ceux qui ont empêché le communisme de conquérir l’Europe. L’installation de la domination idéologique américaine – de McDonald’s à la Silicon Valley – s’est faite sur ce terreau.Il y a beaucoup de confusion dans cette Histoire. Il faut donc théoriser la technologie dans un cadre géopolitique et économique global.[…] Il faut aller plus loin et voir comment nous avons succombé à une intériorisation de l’idéologie libérale jusque dans nos infrastructures technologiques.Et c’est peut-être en Amérique latine, […] qu’on trouve la pensée la plus intéressante. […] Ils se donnent la liberté de penser des alternatives.[Le marxisme], en tant qu’il permet de penser les questions liées au travail ou à la valeur, [reste un cadre de pensée opérant aujourd’hui]. Ces concepts doivent être utilisés. Mais il ne s’agit pas de faire une transposition mécanique. Tout ce qui concerne les données – et qui est essentiel aujourd’hui – n’est évidemment pas dans Marx. Il faut le trouver ailleurs.»Je pense qu’il est utile qu’il existe des penseurs comme Morozov. Je n’ai pas encore lu un de ses livres, mais cela ne saurait tarder. -
Lundi 9 mai 2016
Lundi 9 mai 2016«Je n’ai pas peur d’eux»Tess AsplundDéjà deux fois, «le mot du jour » était plutôt «une photo du jour ».
Voici la 3ème réalisée par le photographe David Lagerlof le 1er mai à Borlange, en Suède, lors d’une manifestation anti-immigration organisée par un groupe de néonazis, le Mouvement de résistance nordique :Tess Asplund se tient, poing levé à la manière du Black Power, face à trois hommes qui marchent en ligne face à elle. Ces der-niers portent un même uniforme, partagent la même coupe de cheveux à la mode skinhead, arbo-rent une expression peu avenante, bref, ils donnent plus envie de changer de trottoir que de leur barrer la route. Et pourtant, la femme se dresse devant eux les yeux dans les yeux.La terminologie contemporaine parle de photo virale, parce qu’elle a été vue et partagée rapidement des milliers de fois.On parle aussi de photo iconique ou de photo culte.Le premier mot du jour consacré à une photo fut celui consacré, sans la montrer, à la photo du petit réfugié Aylan qui était mort sur une plage, et où je partageais cette évidence : « Une vidéo capte un instant furtif, une photo fige une scène pour l’éternité » (mot du jour du 7 Septembre 2015)Cette force de la photo par rapport à la vidéo apparait évidente si vous aller voir la video qui filme le même évènement et qui se trouve <ICI>L’autre enseignement de cet incident est que le repli identitaire n’est pas un problème franco français, mais un problème beaucoup plus large qui touche l’occident, blanc et vieillissant.A longueur d’articles, on nous vante le modèle et l’humanisme nordique.Mais la photo a bien été prise en Suède, le modèle parmi les modèles, où l’extrême droite a récolté 13% des voix lors des élections législatives de 2014.Vous trouverez de plus amples développements dans cet article de l’Obs : http://tempsreel.nouvelobs.com/photo/20160504.OBS9836/une-femme-leve-le-poing-face-aux-neonazis-l-histoire-d-une-photo-symbole.htmlVous apprendrez notamment que Tess Asplund est agée de 42 ans. Elle a déclaré : «Je n’ai pas vraiment réfléchi, j’ai juste bondi […] Je me suis juste dit : ‘vous n’avez pas à être là’. Alors, l’un d’entre eux m’a fixé du regard, et je l’ai dévisagé en retour. Il n’a rien dit, je n’ai rien dit non plus.»Quand au photographe, David Lagerlof, il a simplement déclaré : «En tant que photographe, j’essaie de toucher les gens avec mes images. Et manifestement, cette photo a touché beaucoup de personnes.» -
Mercredi 4 mai 2016
Mercredi 4 mai 2016«Des pauvres, des cafards et des riches»Une histoire racontée par Philippe Pujol auteur du livre «la Fabrique du Monstre»Philippe Pujol est journaliste, prix Albert Londres 2014, il habite Marseille.Son dernier livre «La fabrique du monstre, 10 ans d’immersion dans les quartiers Nord de Marseille, la zone la plus pauvre d’Europe» il dresse le portrait des quartiers Nord de Marseille, de ses gamins et de leurs familles, en difficulté, qui pour s’en sortir doivent accepter des compromis et des compromissions. Il parle aussi du clientélisme des responsables politiques, de la pauvreté, la drogue, la violence sociale.Je l’avais entendu une première fois parler longuement de son livre dans l’émission <Un jour en France du 19 janvier 2016>. Lors de cette émission il a raconté une histoire vraie de cafards.
Plus récemment, il a été invité dans un format plus court <Périphérie du 17 avril 2016> et a raconté à nouveau la même histoire.C’est une histoire simple et sordide qui raconte une part de la vérité du monde tel qu’il fonctionne. Ce n’est qu’une part, car il existe aussi de belles histoires.Philippe Pujol s’est donc immergé dans les quartiers Nord de Marseille pendant 10 ans pour écrire son livre.Un jour, il voit des enfants qui ont l’air de jouer. Il s’approche et il voit à quoi joue ces enfants : ils attrapent des cafards.Il tente de les gronder et menace de le dire à leur mère. Alors ces enfants rient et appellent leur mère.Le journaliste est surpris et la mère explique que les enfants attrapent ces cafards et les lui donnent pour qu’elle puisse les vendre à des gens qui les achètent. Et elle ajoute qu’avec l’argent reçu, ils iront manger au Mac Do.Philippe Pujol est un peu choqué mais ne creuse pas davantage et n’y pense plus.Quelques années plus tard, il revient dans ce quartier qui a beaucoup changé. Il s’en étonne et il a alors un échange avec un ami policier qui lui explique que les précédents habitants ont du quitter les lieux parce que les immeubles étaient envahis de cafards et que les services sanitaires les ont obligé de partir en raison de l’insalubrité des lieux.Il a pu alors faire le rapprochement : des pauvres demandaient à des plus pauvres d’attraper des cafards qu’ils vendaient à des voyous un peu moins pauvres pour que ces derniers puissent ainsi infester les habitations d’autres pauvres.Tout cela pour le plus grand bénéfice de très très riches.La plus grande partie de ce quartier a été rachetée par <Lone Star Funds>, un fonds de pension américain qui a rénové les immeubles et les a vendu à la découpe.<Vous trouverez d’autres précisions sur ce blog de mediapart qui parle également de ce livre et de cette histoire> et j’en cite un extrait qui éclaire cette histoire à travers le projecteur du gain : «En 2004, un fond de pension américain, Lone Star, propose d’acquérir 50 % du patrimoine du précédent propriétaire, « de chasser les habitants et de rénover et de vendre à la découpe ». Rentabilité espérée du capital : 18% par an.»« […] L’essai de Philippe Pujol offre une plongée dans le Marseille de la misère et de la délinquance, grande et petite. […] Pujol, ex-journaliste à l’ex-Marseillaise (un journal longtemps inféodé au PC) a derrière lui un lourd passé de journalisme d’investigation, qui lui a valu le prix Albert Londres en 2014 pour une série d’articles, « Quartiers shit », dont le titre parle tout seul. […]Ce sont là les nouveaux carnets du sous-sol. À la recherche du lumpen, et même du lumpen du lumpen. Un prolétaire en job précaire trouvera toujours un sous-prolo sans travail, parce que « trop petit, trop faible, trop roublard, trop gros, trop noir, trop sans-papiers, trop seul ». Pujol nous entraîne dans le cadavre d’une Opel Astra, objet des convoitises d’un couple de Roumains (en dessous du sous-lumpen, toujours les Roumains) qui préfèrent louer ce déchet mécanique plutôt que « dormir à la mauvaise étoile ». Opel, « c’est une allemande », dirait Claudia Schiffer. Et quand vous voulez étaler votre réussite – à quoi ça sert d’arriver discret ? – vous passez au format allemand supérieur, BMW ou Audi. Ces deux marques – et aucune autre –témoignent de la réussite asociale des truands.[…] De toute façon, ce n’est pas ce bac que visent les héros de Pujol. Eux, c’est BAC (brigade anti-criminalité) plus sept – sept interpellations. La loi de la rue sans joie. L’élitisme républicain à l’envers. Sur le CV du bon caïd, des arrestations, des gardes à vue, quelques condamnations – bref, de vraies références. L’élitisme républicain, remarque Pujol avec une naïveté feinte, s’est niché dans les lois sécuritaires, qui permettent de sélectionner, via la case prison, les purs, les durs, les balafrés.Les portraits se succèdent – juste ce qu’il faut pour balayer le champ d’ordures (c’est l’image de couverture). Kader, qui a mal fini, sans que l’on sache bien pourquoi (une bonne justice, dit le milieu, doit être préventive), et le quartier se racontera en l’embellissant dans les jours suivants le geste de ce garçon perdu, tué sur un parking de Campanile : la vidéosurveillance a enregistré la scène avec le grain d’un film porno amateur. On a les épopées qu’on peut, mais pour les gosses qui vont peut-être encore au collège, c’est plus vivant et plus mortel que le combat du Cid contre les Maures. On tue « jusqu’à ce que les morts soient plus nombreux que les vivants » : « Et le combat cessa faute de combattants. » Sacré Corneille ![…]Après les portraits d’en bas, ceux d’en haut. Gaudin, par exemple. « Tant qu’ils se tuent entre eux, ce n’est pas grave. » Et Stéphane Ravier, élu FN, d’en rajouter dans la métaphore : « Les chacals se dévorent entre eux. » 280 morts en 20 ans, quand même – et les statistiques ne prennent en compte que ceux qui meurent sur le coup. Avec quelques unités de plus depuis la parution du livre.Ça ne risque pas d’arriver aux politiques, dont le livre narre par le détail les amitiés particulières, les oscillations de gauche à droite, les alliances contre nature (mais justement, il n’y a pas de nature en politique, sinon aller là où ça coule), et les petits intérêts arrachés en échange de services inavouables – comme une otarie à laquelle on donne un poisson pour la féliciter d’avoir réussi son tour. […]Marseille, conclut finement Pujol, est au fond le laboratoire de l’indifférenciation politique. Tous pourris, mais tous au pouvoir. S’il est une ville où la confusion gauche/droite est ancienne, c’est bien celle-là. S’il est une ville où l’ancienne fusion de tous les migrants a été remplacée par un communautarisme jaloux, c’est aussi celle-là – c’est tellement plus simple de jouer les Arméniens contre les Arabes, les Arabes contre les Gitans, et les enfants de rapatriés, juifs séfarades ou non, contre tout le monde.» -
Mardi 3 mai 2016
Mardi 3 mai 2016« Toutes les cultures ont inventé des rituels d’accueil des adolescents dans le monde adulte, sauf la nôtre. »Boris CyrulnikJe partage encore une réflexion de Boris Cyrulnik qu’il a tenu lors de son passage aux Matins de France Culture du 20 avril 2016.Guillaume Erner diffuse d’abord un témoignage d’une fille qui a été manipulée sur les réseaux sociaux et avait l’intention de partir en Syrie pour faire le djihad.Elle est interviewée lors d’une émission de mai 2015, d’une voix douce, avec un léger accent méridional elle raconte : :« Un garçon est venu me parler sur Facebook. Il m’a dit qu’il voulait se marier avec moi. On s’est vu sur Skipe, il m’a expliqué comment faire pour venir et m’a dit qu’il cherchait une femme pour se marier. Il m’a demandé en mariage, et j’ai accepté. » (À ce moment-là on entend la jeune fille prise d’un petit rire gêné, tant elle comprend au moment où elle parle que son attitude de l’époque était naïve et imprudente).Elle ajoute : « c’est ridicule !. Il avait les mêmes ambitions que moi : combattre et il acceptait que je combatte. En dot, il allait me donner une Kalachnikov (nouveau rire) j’en rêvais. Ça peut paraître absurde mais quand on est dedans… ça faisait rêver… C’était cette vie que je voulais, je voulais combattre, mourir en martyr, faire le djihâd. Pour la cause d’Allah, pour les Syriens, mais avant tout pour mourir en martyr. »Guillaume Erner demande alors à Boris Cyrulnik de s’exprimer sur ce témoignage :« C’est la caractéristique de l’adolescence, c’est la période de l’engagement.Toutes les cultures ont inventé des rituels d’accueil des adolescents dans le monde adulte, sauf la nôtre. La culture moderne occidentale n’accueille plus les adolescents. En Afrique, en Asie, et dans le passé en Occident il y avait toujours un moment où on accueillait les adolescents.Tu as douze ans, tu es un enfant et tu dois te taire. Mais par la suite, je vais t’accompagner dans la forêt, tu vas avoir à affronter les lions. Tu vas affronter les lions mais tu ne seras pas abandonné, on va t’accompagner. La culture sera à tes côtés. Tu sauras les gestes, les mots, les postures qu’il faut pour affronter le danger.Tu as surmonté l’épreuve d’initiation, tu as surmonté la mort, tu as vaincu la mort, tu as 13, 14 ans, maintenant tu es un homme, tu es un adulte, on t’écoute.Or ce besoin d’initiation les adolescents le cherchent et se le provoquent eux-mêmes.Il n’y a rien de pire que l’absence d’événement. Dans une vie on ne se connaît que par notre attitude dans les événements qui jalonnent notre biographie.Et pour un adolescent qui a pour seul événement de passer son bac c’est une initiation tragique. C’est une initiation fait d’angoisse et d’immobilisme. […].J’ai besoin d’événements, j’ai besoin d’orages, pour savoir qui je suis. J’ai besoin, moi adolescent, de me mettre à l’épreuve pour avoir la preuve de ce que je vaux.Notre culture a complètement oublié ça !Ce qui fait la sélection aujourd’hui c’est l’immobilité physique et la répétition de quelques règles de grammaire !Les pays du Nord ont trouvé une initiation moderne. C’est-à-dire qu’après l’équivalent du bac, les jeunes font une année sabbatique. Ils ont 18 ans, ils arrêtent de faire des études pendant un an ou deux. Ils sont entourés, comme les Africains sont entourés dans la forêt initiatique. Ils partent dans un pays étranger, souvent les États-Unis ils apprennent une langue, ils gagnent leur vie en faisant de petits métiers. Ils ne sont pas abandonnés, il y a une structure qui veille sur eux et qui est capable d’intervenir en cas de difficultés.Privés de rituels d’initiation, nos adolescents vont chercher eux-mêmes une initiation qui [peut alors être stupide]. Après cette période où ils ont appris une langue, fait un métier, gagner leur vie [dans un lieu différent du cocon familial] Ils sont fiers d’eux, fiers de ce qu’ils ont accompli.Et après ce moment-là seulement, ils reprennent leurs études.Je me demande pourquoi on fait sprinter nos enfants !.On les fait sprinter, alors qu’aujourd’hui une fille qui arrive au monde, une sur deux deviendra centenaire. Elle peut quand même perdre un an ou deux dans sa vie, un an ou deux pour construire sa vie, muscler sa personnalité.On les fait sprinter, puis on les assoit derrière un ordinateur ! Le contraire de ce qu’il faut faire !Beaucoup de pays du Nord crée les conditions d’une épreuve pour que les adolescents puissent être fiers d’avoir su la surmonter.C’est ce que voulait cette jeune fille avec sa voix fraîche. Cette fille sympathique qui parle certainement en souriant, avait besoin d’une épreuve pour prouver à elle-même qu’elle était courageuse.Et notre culture, [ne lui prévoit pas un tel évènement]. »En mots simples, Boris Cyrulnik éclaire ce qui nous semble obscur. -
Lundi 2 mai 2016
Lundi 2 mai 2016« La Résilience »Boris CyrulnikJe pense que tout le monde a entendu parler de Boris Cyrulnik psychiatre et neurologue français.Il vient de publier un nouveau livre, plus autobiographique que les précédents : « Ivres paradis, bonheurs héroïques » chez Odile Jacob. Dans ce nouvel ouvrage, il théorise la nécessité d’avoir des héros et aussi le risque qu’il existe à les laisser être pervertis.Il a été l’invité des matins de France Culture de Guillaume Erner du 20 avril.Boris Cyrulnik, c’est d’abord une voix enveloppante et douce capable d’expliquer et d’apaiser. Il est né en 1937 dans une famille d’immigrés juifs d’Europe centrale et orientale (son père était russo-ukrainien et sa mère polonaise) arrivés en France dans les années 1930. Il a vécu l’horreur nazi, ses parents ont été assassinés dans les campsLui-même a survécu dans des conditions extrêmement difficiles et il raconte combien il était difficile de raconter ce qui s’est passé dans les camps de la mort, les gens ne le croyaient pas.Je me souviens d’avoir entendu Simone Veil témoigner dans le même sens. Cyrulnik rapporte même que des psychanalystes qui recevaient des rescapés des camps qui racontaient leur vécu, leur auraient dit : mais où aller vous chercher tout cela ?Le procès Eichmann, puis Shoah de Lanzmann et peut être aussi « Au nom de tous les miens » de Martin Gray qui vient de disparaître, il y a quelques jours, ont peu à peu mis en lumière la réalité des camps.Et c’est à travers cette expérience terrible que Boris Cyrulnik a développé la résilience.Souvent on lit que la résilience est un concept qui a été inventé par Boris Cyrulnik, mais ce n’est pas le cas. Il a certainement médiatisé et popularisé ce terme. Mais Wikipedia nous apprend que : « Les premières publications dans le domaine de la psychologie datent de 1939-1945. Werner et Smith, deux psychologues scolaires américaines à Hawaï, travaillent avec des enfants à risque psychopathologique, condamnés à présenter des troubles. À l’occasion d’un suivi effectué pendant trente ans, elles notent qu’un certain nombre d’entre eux « s’en sortent » grâce à des qualités individuelles ou des opportunités de l’environnement.La notion de résilience s’oppose parfois à la notion de « coping (en anglais to cope = se débrouiller, s’en sortir). La résilience permet de dépasser son état actuel (un orphelin abandonné qui va trouver un métier) et de ne plus être dans une situation précaire (un orphelin qui va faire face en volant ou vendant de la drogue).»La résilience consiste, pour quelqu’un qui a vécu un très grand traumatisme, à prendre acte de l’événement traumatique pour ne plus, ou ne pas, avoir à vivre dans la dépression et se reconstruire.Du verbe latin resilio, ire, littéralement « sauter en arrière », d’où « rebondir, résister » (au choc, à la déformation).La résilience est, à l’origine, un terme utilisé en physique qui caractérise l’énergie absorbée par un corps lors d’une déformation (« Test Charpy »).La résilience est la voie du renouveau, la capacité à surmonter les traumatismes. C’est le meilleur chemin pour ceux qui ont vécu des drames comme celui des attentats, ou un acte de pédophilie ou de viol, bref énormément d’évènements qui ont occupé une place considérable dans nos médias, ces derniers mois. -
Vendredi 29 avril 2016
Vendredi 29 avril 2016« Le fort fait ce qu’il peut et le faible subit ce qu’il doit !»Thucydide
L’histoire de la guerre du Péloponnèse – Ve s. av. J.-C.Je vais encore évoquer l’émission de France Inter : AGORA du 17 avril 2016.Cette fois, Stéphane Paoli a invité Yannis Varoufakis, l’ancien Ministre de l’Economie grecque qui est venu présenter son dernier livre : «Et les faibles subissent ce qu’ils doivent ?»D’une voix calme, avec un argumentaire fort venant de sa grande culture économique, il démontre les erreurs d’analyse de la pensée néo libérale qui ont cours actuellement dans L’union européenne.Il explique pourquoi rien de ce qui est fait ne permettra d’améliorer la situation de la dette grecque, dette qui ne pourra et ne sera pas remboursée.Je l’ai trouvé très intéressant et très intelligent.Il développe aussi ces arguments dans cet article : http://lesakerfrancophone.fr/yanis-varoufakis-leurope-a-besoin-dun-nouveau-mouvement-pour-la-democratieEt aussi dans cette autre contribution : http://tempsreel.nouvelobs.com/debat/20160413.OBS8451/exclusif-yanis-varoufakis-pourquoi-il-faut-sauver-l-europe.htmlMais je voudrais, une nouvelle fois, partager la chronique d’Aurore Vincenti qu’elle a consacrée au mot «faible» qui se trouve dans le titre du livre.«En tant que seule femme autour de ce plateau, je suis bien placé pour parler du terme faible.Il y a surtout un sexe qui est dit faible. Pourquoi ? Parce que la femme n’a pas la même corpulence qu’un homme ! Elle ne peut pas rouler des mécaniques.Je lis dans mon dictionnaire : «on dit sexe faible par plaisanterie». Très bonne blague, vraiment super drôle.Alors qu’on ne devrait pas rire des faibles.Non, étymologiquement on devrait les pleurer. Parce que le mot vient du latin «flebilis», « digne d’être pleuré».Alors le titre de votre ouvrage Monsieur Varoufakis vient d’une phrase de Thucydide dans L’histoire de la guerre du Péloponnèse, si je ne m’abuse : « Les forts font ce qu’ils peuvent et les faibles subissent ce qu’ils doivent »La difficulté de cette définition, c’est qu’elle définit le faible par opposition au fort, par défaut.Le faible est la trace d’un manque, d’un manque de force.Et je dirais, définition plus actuelle : un manque de pouvoir.Et pourtant ce qui manque au faible, c’est surtout les larmes, les larmes qui étaient dans la racine latine. Il manque de la compassion, de la sympathie, mot grec qui signifie je prends part à ta souffrance, du moins je l’entends, je la reconnais pour ce qu’elle est.Mais il n’y a pas de larmes à verser pour les chiffres.Car les faibles, les pauvres, les démunis on les compte et puis c’est tout, sans les envisager, sans les dévisager.C’est pour cela aussi qu’il est difficile de dire qui sont les faibles.Cependant, une chose est certaine : numériquement ils sont en force, parfois on dit 99 % par rapport à 1 % de forts.Et s’ils subissent le pouvoir des forts, les forts ont aussi besoin d’eux pour exercer leur pouvoir du haut vers le bas.Mais ne laissons pas ainsi les choses figées !Vous posez une question Monsieur Varoufakis : «et les faibles subissent ce qu’ils doivent ?»On voit émerger des mouvements partout en Europe, même en France, des mouvements qui viennent du bas, des faiblesLes mots sont à la fois peu et beaucoup de choses.Je vous en propose quelques-uns pour conjurer le sort.Pour montrer l’immuable binarité entre le faible fort, en français, il y a le mot «révolution» qui va avec «révolte» et même «bouleversement». Ces trois mots véhiculent la même idée celle d’un renversement : du haut qui se retrouve en bas et du bas qui se retrouve en haut.Et puis j’ai un autre mot, en anglais : « Empowerment». Ce mot n’a pas vraiment de traduction en français, on a dit développement du pouvoir d’agir. Mais dans « Empowerment», il y a de l’émancipation, il y a l’idée que l’on se grandit hors de sa condition que l’on s’érige que l’on gagne, non en pouvoir d’écraser, mais en pouvoir d’agir, de faire.»En fin d’émission, Yannis Varoufakis répète ce propos du Ministre de l’Economie allemande Wolfgang Schaüble qu’il avait déjà rapporté et où ce dernier lui disait qu’il savait bien que la solution proposée ne résoudrait rien pour la Grèce, mais qu’il avait besoin de cette solution dans son combat avec les élites françaises pour leur imposer l’austérité.Je rapproche ce propos d’une récente chronique de Bernard Guetta <L’arroseur arrosé>, où ce dernier expliquait que Wolfgang Schaüble avait tenté d’influencer la BCE pour mettre fin à sa politique de taux d’intérêt très bas qui était très défavorable aux retraités allemands et à leurs fonds de pension. Maria Draghi en réponse lui a simplement rappelé que la BCE était indépendante et que c’était l’Allemagne qui avait voulu qu’il en soit ainsi. D’où le concept d’arroseur arrosé de Guetta.J’avais déjà dit que l’Europe avait un problème avec ses vieux, cet échange nous apprend que le problème est particulièrement vivace avec les vieux allemands… -
Jeudi 28 avril 2016
Jeudi 28 avril 2016«L’attention, est une ressource dont nous ne disposons qu’en quantité finie.»Matthew CrawfordC’est mon ami Jean-François, architecte de son métier et dijonnais de sa destinée qui a attiré mon attention sur un article de Telerama qui fait l’éloge d’un homme particulier qui a écrit un livre.
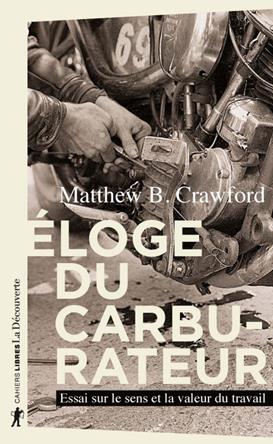 L’homme est Matthew Crawford qui est à la fois chercheur en philosophie à L’université de Virginie mais aussi réparateur de motos.
L’homme est Matthew Crawford qui est à la fois chercheur en philosophie à L’université de Virginie mais aussi réparateur de motos.
<C’est cette seconde activité qui lui a certainement inspiré son premier livre: Eloge du carburateur> Mais le sous-titre de ce livre donne une idée de quoi il parle : « Essai sur le sens et la valeur du travail »
Ce livre est décrit de la manière suivante sur le site de l’éditeur :
« Matthew B. Crawford était un brillant universitaire, bien payé pour travailler dans un think-tank à Washington. Au bout de quelques mois, déprimé, il démissionne pour ouvrir… un atelier de réparation de motos. À partir du récit de son étonnante reconversion professionnelle, il livre dans cet ouvrage intelligent et drôle l’une des réflexions les plus fines sur le sens et la valeur du travail dans les sociétés occidentales.
Mêlant anecdotes, récit, et réflexions philosophiques et sociologiques, il montre que ce travail intellectuel », dont on nous rebat les oreilles depuis que nous sommes entrés dans l’« économie du savoir », se révèle pauvre et déresponsabilisant. De manière très fine, à l’inverse, il restitue l’expérience de ceux qui, comme lui, s’emploient à fabriquer ou à réparer des objets – ce qu’on ne fait plus guère dans un monde où l’on ne sait plus rien faire d’autre qu’acheter, jeter et remplacer. Il montre que le travail manuel peut même se révéler beaucoup plus captivant d’un point de vue intellectuel que tous les nouveaux emplois de l’« économie du savoir ».
« Retour aux fondamentaux, donc. La caisse du moteur est fêlée, on voit le carburateur. Il est temps de tout démonter et de mettre les mains dans le cambouis… »
Mais le livre dont parle TELERAMA concerne un autre sujet : « Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde, et comment le retrouver »
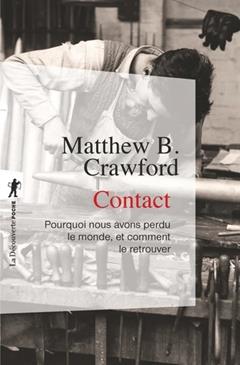 Et l’article de Telerama explique que :
Et l’article de Telerama explique que :
« Les technologies modernes nous sollicitent de plus en plus, et chacun semble s’en réjouir. Or, cela épuise notre faculté de penser et d’agir, estime le philosophe-mécano Matthew B. Crawford. « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre », écrivait déjà Pascal en son temps. Mais que dirait l’auteur des Pensées aujourd’hui, face à nos pauvres esprits sursaturés de stimulus technologiques, confrontés à une explosion de choix et pour lesquels préserver un minimum de concentration s’avère un harassant défi quotidien ? C’est cette crise de l’attention qu’un autre philosophe, cette fois contemporain, s’est attelé à décortiquer. […]
C’est en assurant la promotion de son [premier] best-seller que Crawford a été frappé par ce qu’il appelle « une nouvelle frontière du capitalisme ». « J’ai passé une grande partie de mon temps en voyage, dans les salles d’attente d’aéroports, et j’ai été frappé de voir combien notre espace public est colonisé par des technologies qui visent à capter notre attention. Dans les aéroports, il y a des écrans de pub partout, des haut-parleurs crachent de la musique en permanence. Même les plateaux gris sur lesquels le voyageur doit placer son bagage à main pour passer aux rayons X sont désormais recouverts de publicités… »
Le voyageur en classe affaires dispose d’une échappatoire : il peut se réfugier dans les salons privés qui lui sont réservés. « On y propose de jouir du silence comme d’un produit de luxe. Dans le salon « affaires » de Charles-de-Gaulle, pas de télévision, pas de publicité sur les murs, alors que dans le reste de l’aéroport règne la cacophonie habituelle. Il m’est venu cette terrifiante image d’un monde divisé en deux : d’un côté, ceux qui ont droit au silence et à la concentration, qui créent et bénéficient de la reconnaissance de leurs métiers ; de l’autre, ceux qui sont condamnés au bruit et subissent, sans en avoir conscience, les créations publicitaires inventées par ceux-là mêmes qui ont bénéficié du silence… On a beaucoup parlé du déclin de la classe moyenne au cours des dernières décennies ; la concentration croissante de la richesse aux mains d’une élite toujours plus exclusive a sans doute quelque chose à voir avec notre tolérance à l’égard de l’exploitation de plus en plus agressive de nos ressources attentionnelles collectives. »
Bref, il en va du monde comme des aéroports : nous avons laissé transformer notre attention en marchandise, ou en « temps de cerveau humain disponible », pour reprendre la formule de Patrick Le Lay, ex-PDG de TF1 ; il nous faut désormais payer pour la retrouver.
On peut certes batailler, grâce à une autodiscipline de fer, pour résister à la fragmentation mentale causée par le « multitâche ». Résister par exemple devant notre désir d’aller consulter une énième fois notre boîte mail, notre fil Instagram, tout en écoutant de la musique sur Spotify et en écrivant cet article… « Mais l’autorégulation est comme un muscle, prévient Crawford. Et ce muscle s’épuise facilement. Il est impossible de le solliciter en permanence. L’autodiscipline, comme l’attention, est une ressource dont nous ne disposons qu’en quantité finie. C’est pourquoi nombre d’entre nous se sentent épuisés mentalement. »
Cela ressemble à une critique classique de l’asservissement moderne par la technologie alliée à la logique marchande. Sauf que Matthew Crawford choisit une autre lecture, bien plus provocatrice. L’épuisement provoqué par le papillonnage moderne, explique-t-il, n’est pas que le résultat de la technologie. Il témoigne d’une crise des valeurs, qui puise ses sources dans notre identité d’individu moderne. Et s’enracine dans les aspirations les plus nobles, les plus raisonnables de l’âge des Lumières. La faute à Descartes, Locke et Kant, qui ont voulu faire de nous des sujets autonomes, capables de nous libérer de l’autorité des autres — il fallait se libérer de l’action manipulatrice des rois et des prêtres. « Ils ont théorisé la personne humaine comme une entité isolée, explique Crawford, totalement indépendante par rapport au monde qui l’entoure. Et aspirant à une forme de responsabilité individuelle radicale. »
C’était, concède tout de même le philosophe dans sa relecture (radicale, elle aussi) des Lumières, une étape nécessaire, pour se libérer des entraves imposées par des autorités qui, comme disait Kant, maintenaient l’être humain dans un état de « minorité ». Mais les temps ont changé. « La cause actuelle de notre malaise, ce sont les illusions engendrées par un projet d’émancipation qui a fini par dégénérer, celui des Lumières précisément. » Obsédés par cet idéal d’autonomie que nous avons mis au cœur de nos vies, politiques, économiques, technologiques, nous sommes allés trop loin. Nous voilà enchaînés à notre volonté d’émancipation.
[…] le philosophe offre une vision alternative, et même quelques clés thérapeutiques, pour reprendre le contrôle sur nos esprits distraits. Pas question pour lui de jeter tablettes et smartphones — ce serait illusoire. Ni de s’en remettre au seul travail « sur soi ».
 « L’effet combiné de ces efforts d’émancipation et de dérégulation, par les partis de gauche comme de droite, a été d’augmenter le fardeau qui pèse sur l’individu désormais voué à s’autoréguler, constate-t-il. Il suffit de jeter un œil au rayon « développement personnel » d’une librairie : le personnage central du grand récit contemporain est un être soumis à l’impératif de choisir ce qu’il veut être et de mettre en œuvre cette transformation grâce à sa volonté. Sauf qu’apparemment l’individu contemporain ne s’en sort pas très bien sur ce front, si l’on en juge par des indicateurs comme les taux d’obésité, d’endettement, de divorce, d’addictions y compris technologiques… »
« L’effet combiné de ces efforts d’émancipation et de dérégulation, par les partis de gauche comme de droite, a été d’augmenter le fardeau qui pèse sur l’individu désormais voué à s’autoréguler, constate-t-il. Il suffit de jeter un œil au rayon « développement personnel » d’une librairie : le personnage central du grand récit contemporain est un être soumis à l’impératif de choisir ce qu’il veut être et de mettre en œuvre cette transformation grâce à sa volonté. Sauf qu’apparemment l’individu contemporain ne s’en sort pas très bien sur ce front, si l’on en juge par des indicateurs comme les taux d’obésité, d’endettement, de divorce, d’addictions y compris technologiques… »
Matthew Crawford préfère, en bon réparateur de motos, appeler à remettre les mains dans le cambouis. Autrement dit à
« s’investir dans une activité qui structure notre attention et nous oblige à « sortir » de nous. Le travail manuel, artisanal par exemple, l’apprentissage d’un instrument de musique ou d’une langue étrangère, la pratique du surf [NDLR : Crawford est aussi surfeur] nous contraignent par la concentration que ces activités imposent, par leurs règles internes. Ils nous confrontent aux obstacles et aux frustrations du réel. Ils nous rappellent que nous sommes des êtres « situés », constitués par notre environnement, et que c’est précisément ce qui nous nous permet d’agir et de nous épanouir ».
Bref, il s’agit de mettre en place une « écologie de l’attention » qui permette d’aller à la rencontre du monde, tel qu’il est, et de redevenir attentif à soi et aux autres — un véritable antidote au narcissisme et à l’autisme. »…
Voilà, je vais maintenant retourner à des travaux manuels, j’ai une lampe à finir…
<693>
-
Mercredi 27 avril 2016
Mercredi 27 avril 2016«Stalker quelqu’un sur internet»Nouvelle expression né avec InternetXavier de la Porte a consacré <sa chronique sur France Culture> à « Mémoire de fille », le dernier livre d’Annie Ernaux qui est paru il y a une quinzaine de jours.Il n’évoque pas l’aspect littéraire du livre mais l’usage d’internet fait par l’écrivaine. Je cite :«[…] En revanche, j’ai été frappé par une chose qui me semble tout à fait symptomatique de notre temps et qui peut nous aider à réfléchir sur notre usage d’Internet.Pour faire ce travail qui consiste à tenter de retrouver cette « fille » qu’elle fut, Annie Ernaux a recours à plusieurs moyens, et à divers documents. Des photos de l’époque (photos prises par elle ou d’autres), des lettres envoyées à des amies, des cartes, les carnets qu’elle remplissait déjà à l’époque, ou même ses livres précédents, tout cela lui fournissant des éléments assez précis. Mais à plusieurs reprises, Annie Ernaux utilise Internet. Elle utilise Internet pour trouver des informations, pour revoir des lieux (en particulier le lieu de la colonie de vacances où elle passe l’été 1958, si fondamental), mais elle l’utilise surtout pour retrouver traces de certaines personnes (et en particulier l’homme, avec lequel, pendant ce mois d’été elle passe deux nuits, et dont elle devient follement amoureuse). Pourquoi c’est intéressant ?D’abord parce que c’est un signe des temps que la recherche Internet prenne place, tout à fait normalement, au milieu d’autres documents.Mais ce qui est passionnant ici, c’est le rôle que joue Internet dans un travail lié à la mémoire. Car le web ne fournit pas à proprement parler une archive, ou alors, une archive du temps presque présent. Internet vient combler un vide. Il vient combler un vide entre le passé et le présent. Par exemple, ce qu’Annie Ernaux trouve de cet amant de deux nuits, c’est une photo de famille, celle de cet homme fêtant ses noces d’or, entouré de toute sa descendance, à l’intérieur d’un article de la presse locale donnant les éléments d’une courte biographie. Et cette photo, l’auteure la scrute et s’écrit la scrutant avec toutes les limites visuelles de ce type de document trop pixélisé. Très différent des photos que nous avons gardées – dans des albums ou ailleurs.Avec, par ailleurs, le soupçon toujours porté : cette personne est-elle vraiment la bonne ?Ce que Google offre, c’est le plus souvent, aussi, une documentation qui est à mi-chemin entre le public (ce qu’on aurait trouvé auparavant en consultant les archives de la presse et des annuaires) et le privé (et qu’on peut trouver en allant des réseaux sociaux, ce que fait Annie Ernaux en s’inscrivant sur Copain d’avant).En faisant cela, en l’écrivant Annie Ernaux donne ses lettres de noblesse à une pratique répertoriée dans les réseaux, une pratique qu’on appelle « stalker ». Le verbe anglais to stalk signifie à la fois « roder » et « traquer ». Stalker quelqu’un sur internet, c’est guetter sa présence, les traces qu’il laisse, glaner des informations, et c’est ce qu’on fait en général pour un ancien amour.Vulgairement, on pourrait dire qu’Annie Ernaux stalke ses ex. Mais on pourrait tout en même temps défendre qu’elle fait avec les outils de son temps ce qu’aurait fait Proust s’il avait pu. Oui, Proust aurait sans doute stalké ses personnages et le temps retrouvé n’aurait-il consisté qu’en une longue recherche sur Internet. (Je précise juste que je m’appuie pour dire cela sur ce que m’avait annoncé de but en blanc Nathalie Mauriac-Dyer, grande spécialiste de Proust : « Proust aurait adoré Internet »).Mais, les autres ne sont pas seuls concernés.Car Annie Ernaux nous donne aussi une idée qui pourrait devenir un jour, par ce qu’Internet garde de nous sans même que nous y fassions attention, une expérience commune. Je suis frappé par les derniers mots de « Memoires de fille », quand Annie Ernaux dit avoir retrouvé en finissant d’écrire son livre, la note d’intention : « Explorer le gouffre entre l’effarante réalité de ce qui arrive, au moment où ça arrive et l’étrange irréalité que revêt, des années après, ce qui est arrivé. ». Et je me disais que bientôt, une plongée dans notre désormais vieux compte Facebook pourrait nous fournir pareille impression.»C’est une chronique de notre temps présent
Mardi 26 avril 2016
Le mépris du salarié, c’est dans nos règles comptables qu’il est inscrit.»
Lundi 25 avril 2016
«Comme il vous plaira», Acte 2, Scène 7, Réplique de Jacques à son ami le Vieux Duc qui a été proscrit et chassé du pouvoir par son frère
«Les misérables» de Victor Hugo
«David Copperfield» de Charles Dickens
«Guerre et Paix» de Tolstoï
et «Don Quichotte» de Miguel Cervantès
Vendredi 22 Avril 2016
Telles sont les conditions sine qua non de la paix. […] Cette offre ne peut venir que du plus puissant.»
|
|
Wilhem Furtwängler et Yehudi Menuhin
|
Jeudi 21 Avril 2016
Donc le Pape François s’est, à nouveau penché, sur le sujet des réfugiés et il a même ramené concrètement 12 réfugiés au Vatican.
Conversation est un site où on peut trouver des articles initialement en langue étrangère traduits en français.
Un article d’un universitaire anglais, Stéphane J Baele, University of Exeter, m’a interpellé car il rapproche la situation actuelle aux frontières de l’Europe à une réflexion de Michel Foucault développée à partir de 1974 : <la biopolitique>
Biopolitique est un néologisme pour identifier une forme d’exercice du pouvoir qui porte, non plus sur les territoires mais sur la vie des gens, sur des populations, le biopouvoir.
Le pouvoir va s’intéresser à la vie, à la santé, à la retraite et même à la fin de vie des citoyens de son territoire. En témoigne toutes les caractéristiques de l’Etat providence, de la sécurité sociale et de l’existence de toute une organisation visant à accompagner les citoyens de la naissance à la mort. Des campagnes financées par le pouvoir vont donner des injonctions à la population :
- Ne pas fumer ;
- Ne pas trop boire d’alcool ;
- Bien manger …5 légumes et fruits ;
- Avoir des activités physiques ;
- Se soumettre à des examens médicaux périodiques etc…
Parallèlement Foucault prévoyait aussi que ce biopouvoir aurait des incidences sur la manière de traiter les autres, ce qui ne sont pas « les citoyens protégés ». Ce pouvoir tenterait de protéger ses concitoyens des « autres ».
Et c’est ainsi que, l’universitaire anglais introduit son article : <Vivre et laisser mourir : Michel Foucault avait-il prédit la crise des réfugiés ?> :
« En mars 1976, le philosophe Michel Foucault décrivait, sous le terme de « biopolitique », l’avènement d’une nouvelle logique de gouvernance propre aux sociétés libérales occidentales, obnubilées par la santé et le bien-être de leurs populations.
Quarante ans plus tard, force est de constater que les pays occidentaux ont, plus que jamais, à cœur de promouvoir une alimentation saine, proscrire le tabac, réglementer la consommation d’alcool, systématiser le dépistage du cancer du sein ou informer leurs citoyens sur les risques de contracter telle ou telle maladie.
Michel Foucault n’a jamais prétendu que cette tendance était regrettable, après tout elle sauve des vies. Il estimait, en revanche, que le fait d’accorder autant d’importance à la santé et la prospérité d’une population excluait de fait ceux qui n’y avaient pas accès et étaient considérés comme susceptibles de les mettre en danger.
La biopolitique est donc la politique du « vivre et laisser mourir ». En se focalisant sur sa propre population, un pays augmente les conditions susceptibles « d’exposer à la mort, de multiplier pour certains le risque de mort ».
Ce paradoxe aura rarement été plus manifeste que durant la crise qui, ces dernières années, a vu des centaines de milliers de personnes chercher refuge en Europe. Il est frappant de constater à quel point les sociétés européennes investissent chez elles dans la santé, tout en érigeant des barrières juridiques et matérielles toujours plus étanches afin de maintenir les réfugiés à distance. De fait, elles participent activement à la mort d’êtres humains.
Le conflit au Moyen-Orient est meurtrier. À elle seule, la guerre civile en Syrie a déjà fait 300 000 morts, selon la plupart des estimations. Elle nous donne à voir quelques-unes des pratiques les plus effroyables, dont le gazage de plusieurs milliers de civils à Damas en 2013.
Des groupes extrémistes comme Daech affichent une cruauté inconcevable. Ils décapitent leurs victimes à l’aide de couteaux ou d’explosifs, les enferment dans des cages avant de les brûler vives, les crucifient, les jettent du haut des immeubles et, plus récemment, ont fait sauter une voiture dans laquelle se trouvaient des passagers (un enfant aurait déclenché le dispositif). Cette violence s’est exportée en Europe. Et certaines des grandes villes syriennes ressemblent aujourd’hui au Stalingrad de 1943.
Évidemment, les populations fuient, comme l’avaient fait avant elles les Belges – par exemple – au début de la Première Guerre mondiale : le Royaume-Uni en avait accueilli 250 000, parfois au rythme de 16 000 chaque jour.
Mener une vie normale étant impossible sur la quasi-totalité du territoire syrien, l’émigration se poursuivra inévitablement tant qu’il restera des civils dans cette région dévastée par la guerre. […]
Confrontés au drame qui se joue à leurs portes, que font les États membres de l’Union européenne ?
Exactement ce qu’avait prédit Foucault. Hormis l’Allemagne, ils rivalisent d’imagination pour mettre en place des politiques visant à se prémunir contre l’arrivée des réfugiés et envoient des messages dissuasifs toujours plus explicites.
L’Autriche a ainsi décidé unilatéralement de fixer des quotas sur le nombre de demandeurs d’asile qu’elle acceptera quotidiennement, laissant la Grèce, en faillite, gérer seule l’afflux d’immigrés.
Une semaine plus tôt, Manuel Valls avait déclaré que la France et l’Europe ne pouvaient « accueillir plus de réfugiés ». […]
Au Danemark, la police est désormais autorisée à saisir les objets de valeur appartenant aux réfugiés, les privant ainsi du peu qu’il leur restait. La Slovaquie a, de son côté, décrété qu’elle n’accueillerait que des réfugiés syriens chrétiens, et pas plus de 200, au prétexte que les musulmans « ne se sentiraient pas chez eux » et ne seraient de toute façon pas acceptés par la population locale. […]
Les pays occidentaux, dont la politique d’immigration est de plus en plus implacable, importent aussi des technologies militaires destinées à établir des dispositifs de contrôle sophistiqués et des barrières infranchissables en Grèce, en Bulgarie ou dans les enclaves espagnoles au Maroc. Les « conditions favorables à la mort des autres » sont ainsi réunies. Les Syriens n’ont désormais que le choix de survivre chez eux ou d’entreprendre un voyage périlleux vers des pays sûrs mais totalement verrouillés.
Les théories plus ou moins complexes échafaudées pour justifier cette politique sont facilement réfutables, tant sur le plan rationnel que moral. Le seul raisonnement qui tienne est celui de Foucault.
En expliquant pourquoi une société aussi obsédée par la santé est capable (plus ou moins indirectement) de tuer des gens capables de contribuer à cette santé, Foucault lance un mot fort : le racisme, au sens large du terme.
Sa théorie, confirmée depuis par des milliers d’expériences en psychologie sociale, est la suivante : pour que des individus acquiescent à des politiques extrêmes et qu’ils les parent d’arguments moraux, ils doivent considérer les gens qui en sont victimes comme différents, extérieurs à leur communauté.
C’est pourquoi le Royaume-Uni, qui avait accueilli 250 000 Belges avec du thé et des gâteaux entre 1914 et 1916, contribue aujourd’hui, avec la majeure partie des pays de l’Union européenne, à la mort de milliers d’êtres humains ayant fui une guerre dans laquelle s’affrontent un régime dictatorial et le groupe terroriste le plus violent (quantitativement et peut-être qualitativement parlant) de tous les temps.
Le peu de moralité qui subsistait chez les États européens est en train de s’évaporer. »
C’est un autre regard sur la crise des migrants qui sont aux frontières de notre espace européen.
Je peux aussi vous inciter à écouter cette belle émission où Philippe Meyer avait invité Pascal Brice, directeur de L’OFPRA (l’Office français de protection des réfugiés et apatrides) qui d’une voix calme, posée explique avec intelligence et humanité le rôle de l’établissement qu’il dirige, toujours en se référant aux valeurs que sous-tendent le droit de réfugiés. Il montre aussi le défi auquel nous sommes confrontés.
<688>
Mercredi 20 Avril 2016
Jamais […] la confusion des rôles n’a paru aussi évidente.»
|
|
Alors je rêve qu’ils deviennent, tous deux, lucides et réalistes et refassent ensemble une tribune dans laquelle ils diraient « Nous avons compris le message des français et nous comprenons aussi le besoin de renouvellement dont a besoin le corps politique français et nous avons décidé tous les deux de ne pas être candidat aux prochaines élections présidentielles pour permettre cette respiration démocratique »
Je fais partie de ces personnes qui ne désespèrent jamais de l’intelligence des gens, même si souvent je dois me résoudre à conclure ce n’est pas encore gagné.
|
Mardi 19 Avril 2016
Lundi 18 avril 2016 ou du 49 mars 2016
Ce matin nous sommes le 49 mars du calendrier du mouvement « Nuit debout ».
Ce mouvement étonnant a démarré le 31 mars et, probablement en référence au calendrier révolutionnaire, a voulu créer un nouveau calendrier. Ils ont fait simple, continuer indéfiniment le mois de mars qui a vu le début de ce mouvement.
Mais MEDIAPART a consacré une « soirée live » à ce mouvement et a invité des participants à s’exprimer, ce qui est difficile puisqu’ils refusent de nommer des porte-paroles et qu’ils se méfient énormément des médias. Finalement, MEDIAPART probablement en raison de son positionnement est arrivé à en convaincre quelques-uns. < C’est ici>
Parmi les invités, il y avait Leila Chaibi, membre du Parti de gauche et ancienne candidate aux municipales à Paris. Elle fait partie des initiateurs de ce mouvement, c’est ce qu’elle explique dans l’émission de Mediapart, avec le journal FAKIR d’Amiens qui annonce d’entrée :
« Journal fâché avec tout le monde. Ou presque »
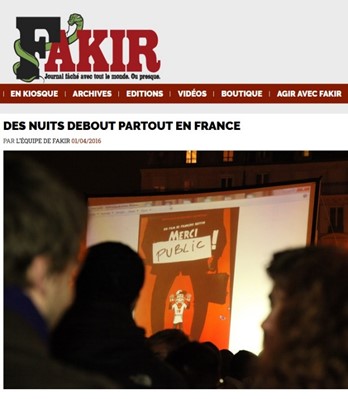 Wikipedia nous apprend que
Wikipedia nous apprend que
« Fakir est un journal indépendant et alternatif engagé à gauche. Il a été créé en 1999 à Amiens, en Picardie. Selon deux formules consacrées présentes au début de chacun de ses numéros, le journal se présente comme n’étant lié à « aucun parti politique, aucun syndicat, aucune institution » et comme « entièrement rédigé et illustré par des bénévoles ». Il connaît une diffusion nationale depuis le 26 avril 2009. Le magazine confectionné à Amiens diffuse entre 10 000 et 20 000 exemplaires par numéro.»
Le rédacteur en chef et fondateur de ce journal est <François Ruffin>.
Pour le situer un peu, on apprend qu’il a participé comme reporter plusieurs fois à l’émission de France Inter<Là-bas si j’y suis de Daniel Mermet> qui a été supprimé dans la polémique en 2014. François Ruffin a pris la défense de Daniel Mermet.
Et en 2015, il réalise son premier film, « Merci Patron ! », film critiquant Bernard Arnault, dont la sortie nationale a eu lieu le 24 février 2016. Ce film a aussi joué un rôle de premier plan, un rôle fédérateur dans le déclenchement de ce mouvement.
Je n’ai pas encore eu l’occasion de le voir, Bien que Pascale me l’ait vivement conseillé en précisant qu’il devrait me plaire.
Le mouvement DAL « Droit au logement » a également été présent dans le tout début du mouvement, notamment pour le conseil logistique.
Et enfin il y a l’intellectuel Frédéric Lordon, dont j’ai déjà parlé (en bien).
Tout ceci pour dire, comme le révèle Leila Chaibi, que ce mouvement n’est pas venu de nulle part, une création spontanée ex nihilo.
Au départ, il y a la mobilisation contre la Loi Travail et l’idée de quelques-uns dont notamment ceux cités précédemment qui ont eu l’intuition qu’il ne fallait pas manifester et puis rentrer chez soi. Mais qu’il fallait se réunir, parler ensemble, créer un élan démocratique, ce qu’ils appellent un mouvement horizontal dans un monde où la démocratie représentative est à bout de souffle en France, mais aussi dans tous les autres pays occidentaux.
Cela commence à 16′ de l’émission de Mediapart donné en lien en début de message.
Le mot d’ordre du noyau de ce mouvement était : on ne rentre pas chez nous après la manif.
Et puis ils se sont posés la question de Lénine <Que faire ?>
Une première idée était de réaliser un tract de revendication dans une perspective de «convergence des luttes », concept qui a été abondamment repris dans leurs discussions.
Cette première idée a été repoussée pour faire place à cette innovation qui me paraît très intéressante : Mettre en place une organisation (logistique, repas, concert, les règles de prise de parole…) permettant à tous ceux qui le souhaitent de débattre, sans que les initiateurs prennent un rôle prépondérant.
Cette position qui semble respecté, pour l’instant, constitue la force du mouvement mais aussi sa faiblesse pour aller plus loin et se structurer.
Pour revenir à Leila Chaibi, elle raconte donc que l’appel à se réunir « Place de la République » et à organiser les échanges, devait s’accompagner d’un site internet et qu’il fallait donc trouver un nom. [Se trouve à 33:30 de l’émission de Mediapart] :«Au départ on a pensé à « convergence des luttes ». Puis on a pensé aux « nuits blanches » qui sont organisées par la mairie de Paris et on a proposé « Nuit Rouge ». Et Lordon a dit : « attention, l’objectif n’est pas de se retrouver entre nous, entre militants [de la gauche de la gauche]. L’objectif est de faire un mouvement massif, alors attention au vocabulaire trop marqué mouvement ouvrier ou gauchiste. » Alors en référence à la citation de La Boétie « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » nous avons décidé d’appeler ce mouvement la nuit debout »
A ce stade de mon étude je suis retourné vers l’extraordinaire encyclopédie, Wikipedia à laquelle il faudra bien que je consacre un mot du jour, tant cette institution est une formidable et positive création de l’esprit collaboratif et de la modernité.
Donc Wikipedia nous apprend dans son article consacré à <La servitude volontaire de la Boétie> qu’«On attribue à tort, semble-t-il, la citation suivante à ce texte, car elle ne peut être trouvée dans aucun des principaux textes publiés : « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. ». En réalité, elle provient de Pierre Victurnien Vergniaud». Vergniaud qui fut un des leaders des girondins.
C’est toujours Wikipédia qui nous apprend que «Pierre Victurnien Vergniaud (31 mai 1753 à Limoges – guillotiné 31 octobre 1793 à Paris) était un avocat, homme politique et révolutionnaire français. Bien plus que l’orateur du parti girondin, il fut l’un des plus grands orateurs de la Révolution française. Il reste un des grands acteurs de la Révolution. Président à plusieurs reprises de l’Assemblée législative et de la Convention nationale, c’est lui qui déclara la « patrie en danger » (discours du 3 juillet 1792). C’est également lui qui prononça la suspension du roi au 10 août 1792 et le verdict qui condamna Louis XVI à la mort. Il fut pour beaucoup dans la chute du trône, et la levée en masse des citoyens pour la guerre. »
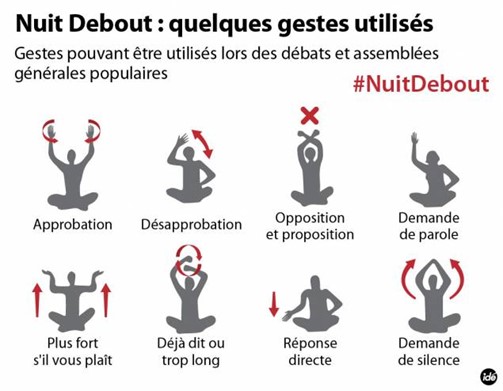 J’ai consacré, une grande partie de mon temps de cerveau disponible de ces derniers jours à m’intéresser à ce mouvement « Nuit debout », mais je m’aperçois que ce mot du jour va devenir de longueur exagérée si je ne m’interromps pas.
J’ai consacré, une grande partie de mon temps de cerveau disponible de ces derniers jours à m’intéresser à ce mouvement « Nuit debout », mais je m’aperçois que ce mot du jour va devenir de longueur exagérée si je ne m’interromps pas.
Alors je voudrais simplement faire part de la réflexion d’une amie qui m’a été rapporté par Annie et qui remarquait que l’échange de parole, la qualité de l’écoute sur la Place de la République était absolument remarquable, un vrai travail moderne de professionnel des débats.
Le symbole de cette organisation étant les gestes codifiés que vous trouverez ci-après et qui permettent à la foule de réagir immédiatement à ce que l’orateur dit :
Nuit debout a donc un site : http://www.nuitdebout.fr/
Et déjà une page Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_debout
J’en resterai à ce stade pour le mot du jour d’aujourd’hui.
Je regarde ce mouvement avec sympathie, étonnement mais aussi un peu d’incrédulité sur son devenir et sa capacité à faire bouger les choses.
L’exergue du mot du jour « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » est en revanche une formule qui me paraît plein de sens, dans ce monde où les 1% les plus riches accaparent une part de plus en plus extravagante des richesses produites.
Mais toute la question est aussi de savoir : pourquoi sommes-nous à genoux ?
Cette question pouvant se décliner sur deux modes : Qu’avons-nous à perdre ? Ou qu’avons-nous à gagner à la conservation du système actuel ?
<685>
Vendredi 15 avril 2016
Jeudi 14 avril 2016
Mercredi 13 avril 2016
Mardi 12 avril 2016
Lundi 11 avril 2016
Vendredi 8 avril 2016
Jeudi 7 avril 2016
Mercredi 6 avril 2016
|
|
C’est cette peur qui explique grandement le succès de Trump.
Normalement pour la présidentielle, vu qu’il s’est mis les femmes à dos, ainsi que les hispaniques, les noirs et les asiatiques, il ne devrait avoir aucune chance.
J’espère que le monde sera préservé d’un tel homme comme président des Etats Unis.
et Je finirai par une note d’humour inspiré par deux journalistes :
Le premier a dit ; jusqu’à Trump je trouvais le prénom Donald sympa parce que c’était le neveu désargenté de l’avare Picsou.
et le second a dit que Donald Trump a des relations coupables avec un Duke, David Duke. En effet, Trump, a refusé de prendre ses distances avec David Duke, l’ancien dirigeant du Ku Klux Klan qui lui a apporté son soutien et qui continue de professer la supériorité de la race blanche.
Donc finissions sur cette image d’un Donald Sympa : Donald Duck.
|
Mardi 5 avril 2016
La construction européenne n’est qu’un affichage.
En réalité, elle est une déconstruction. Le but n’est pas de faire émerger une nouvelle entité politique, mais d’en finir avec la politique. »
Lundi 4 avril 2016
Pour moi, c’est 1664… Kronenbourg »
lorsqu’il était premier ministre de cohabitation sous la présidence de François Mitterrand [1986-1988]
Vendredi 1er avril 2016
Jeudi 31 mars 2016
Mercredi 30 mars 2016
Mercredi 23 mars 2016
|
|
Mal nommer les choses, ajoute du malheur au monde disait Camus
Ce n’est pas la guerre, mais la Belgique et donc toute l’Europe est en deuil.
La Belgique qui est la patrie de la BD à laquelle elle a apporté ses plus grandes lettres de noblesse.
|
Mardi 22 mars 2016
Lundi 21 mars 2016
Vendredi 18 mars 2016
« La belle histoire » Page 38 & 39
Hubert Reeves écrit :
« Parfois les phénomènes les plus familiers s’avèrent être les plus étonnants.
Comme chacun le sait, la glace flotte à la surface de l’eau. Ce fait, qui a causé la catastrophe du Titanic en 1912, sa collision avec un iceberg, s’avère être d’une importance primordiale pour l’existence de la vie sur Terre.
La glace, à la surface des lacs, isole du froid les couches aquatiques profondes. Elle permet à l’eau d’y rester liquide à très basse température ambiante si la glace s’enfonçait, les lacs gèleraient entièrement et les organismes qui y vivent périraient sûrement.
En quoi cette propriété est-elle étonnante sur le plan de la physique ?
Il est bien connu que la chaleur dilate les corps et que le froid décontracte et augmente l’intensité. Ainsi, la plupart des corps sont plus denses à l’état solide qu’à l’état liquide. Quand l’huile se fige à cause du froid, elle coule au fond de la bouteille et le plomb fondu surnage sur le solide. Si la glace, plus froide que l’eau liquide était aussi plus dense, elle coulerait à basse température. Alors ? Pourquoi flotte telle ?
Effectivement, comme la presque totalité des substances, l’eau se densifie quand on la refroidit. Mais quand on approche du point de congélation, aux environs de 4 °C, cette tendance s’inverse et l’eau devient progressivement moins dense : la glace flotte.
Cette propriété s’explique en termes de physico-chimie, de façon complexe d’ailleurs. Rien de mystérieux jusque-là. Pourtant, en rapprochant la clarté de cette propriété exceptionnelle dans le monde des substances chimiques avec l’importance de l’eau pour l’élaboration de la vie, il est peut-être justifié de s’étonner.
Peut-on inclure ce phénomène dans la liste de nos « sans ça » ?
Encore une fois, j’observe le phénomène et je réserve mon jugement…»
Il y a encore bien d’autres coïncidences dans cette belle Histoire :
Ainsi l’orbite quasi circulaire de la terre autour du soleil alors que la grande majorité des orbites observées dans l’univers sont beaucoup plus elliptiques et dans ce cas les différences de température, selon la position par rapport à l’astre, sont beaucoup plus grandes rendant la vie beaucoup plus difficile ou impossible.
Il y a encore les neutrinos, la croissance de l’oxygène et la formation de la couche d’ozone …
Et puis après, au bout du bout, tout ce qui a permis à la complexité d’émerger et à homo sapiens de coloniser la terre.
Bref tout ce qui a permis la belle histoire de l’humanité, notre histoire.
Hubert Reeves va aussi développer, dans son livre, la moins belle histoire, celle où homo sapiens va énormément créer, inventer et imaginer.
Nous profitons de tout cela, la vie humaine est devenue moins dure, la santé s’est améliorée et des maladies peuvent être guéries et nous sommes souvent envahis d’émotion devant toutes les manifestations créatrices de l’homme dans les divers arts dans lesquels elles se sont épanouies.
Mais il a réalisé ces choses, en partant du postulat que la terre et la nature pouvaient être utilisées sans limite et qu’il était possible de prélever tous les éléments nécessaires à son confort, sans tenir compte des équilibres naturels et sans appréhender la disproportion entre le temps extraordinairement court dans lequel il consommait l’énergie fossile, au regard des millions d’années qui ont été nécessaire pour la fabriquer.
Arrivé à ce stade, nous sommes confrontés à deux positions très tranchées :
Celles de tous ceux qui expliquent que l’homme est en train, par son comportement, son industrie et sa technique de perturber si fortement l’équilibre naturel que les conditions qui ont permis l’apparition de l’humanité vont disparaître.
Celles de ceux qui dans les traditions religieuses
« Soyez féconds, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la terre »
(Genèse 1, 28)
ou scientifique comme René Descartes qui espère que le développement des sciences permettra aux êtres humains de devenir « comme maître et possesseur de la nature » ont mis l’homme au centre, les premiers considérant que toute la création a été faite pour l’homme sous la soumission de Dieu et les autres que l’intelligence et les « droits de l’homme » sont à un tel niveau que la nature et les ressources terrestres sont à sa seule disposition. Pour les seconds, en outre, la critique de la sauvagerie et du côté impitoyable de la nature, interdit de lui reconnaître une préséance à l’histoire de l’homme qui outre les guerres a quand même développé la compassion, la médecine, la science, l’art qui ont su embellir et corriger les rudesses de la nature.
Il existe des extrémistes dans ces deux thèses.
Les premiers pourraient déboucher sur un régime totalitaire où la religion de l’écologie justifierait des actes de contraintes et de restriction des libertés fondamentales.
Les seconds arcs boutés sur leur confort et leur égoïsme, ne croient pas aux avertissements des scientifiques ou pensent que le génie humain trouvera toujours de nouvelles solutions leur permettant ainsi de continuer à ne rien changer dans leur comportement de vie et de consommation.
Les premiers sont dangereux et liberticides et les seconds sont aveugles et tout aussi dangereux.
Car si les scientifiques poursuivent la quête de l’existence d’autres formes de vie dans l’univers, il est clair que si elles existaient elles ne seraient pas dans une proximité atteignable par nos moyens de transport.
Notre terre constitue donc une oasis entourée d’un immense désert stérile dans l’univers.
Et nous serions donc bien inspiré de nous en préoccuper vraiment, sans ça, nos descendants ne seront plus là pour en parler.
Je vous redonne le lien vers la conférence donné dans le mot du jour de lundi (il faut se positionner à 30 mn sur la vidéo) : <ici>
Et un lien vers le livre <La où croit le péril…>
<668>
Jeudi 17 mars 2016
« La belle histoire » Page 26 & 27
<Hubert Reeves écrit :
« Le centre de la Terre est situé tout juste sous nos pieds, à 6400 kilomètres (la distance Paris-Moscou).
C’est un des lieux les plus mal connus de la science contemporaine. Nous connaissons bien mieux le cœur du Soleil et des étoiles que celui de notre propre planète ! La raison ? Les étoiles sont des boules de gaz. Or la physique des gaz est relativement simple. Elle est aujourd’hui bien comprise. Mais les planètes rocheuses comme la Terre sont constituées d’une séquence de phases liquides et solides nettement plus difficile à modéliser. Tout y est plus compliqué. De grands progrès ont été accomplis, mais il reste encore beaucoup à faire dans ces chapitres de la physique. Pourtant nous savons déjà que ce qui se passe là, en bas, mérite à coup sûr de figurer sur la liste de nos « sans ça… ».
Au sujet du noyau terrestre, nous avons quelques informations crédibles. Il y fait chaud : environ 6 100 °C.
Nous connaissons l’origine de cette chaleur. Elle vient de deux sources différentes.
L’une provient des innombrables collisions de météorites de toutes dimensions qui ont frappé notre planète aux premiers temps du Système solaire. L’avalanche de matière, dont l’accumulation a fini par constituer la masse planétaire, y a déposé en même temps une grande quantité de chaleur.
Par ailleurs, ces pierres incorporent des atomes radioactifs à longue vie (uranium, thorium, calcium).
Ces atomes proviennent des explosions d’étoiles qui ont eu lieu dans le bras de la Voie lactée où la Terre est née, il y a 4,5 milliards d’années. Séquestrés dans ces météorites tombées du ciel, les noyaux de ces atomes se désintègrent progressivement, selon leur temps de vie spécifique, et entretiennent la chaleur interne de notre planète.
Cette énergie thermique se propage vers la surface planétaire pour se dégager ensuite dans l’espace. En passant, elle engendre des mouvements de matière de grande envergure. Cette agitation se manifeste à la surface par des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des tsunamis. Elle est également responsable de l’existence du champ magnétique terrestre qui oriente nos boussoles ainsi que nombre d’oiseaux migrateurs.
Comment ces phénomènes situés dans les strates les plus profondes et les plus inaccessibles de notre planète sont-ils reliés à notre existence ? Pourquoi figurent-ils
Sur notre liste des « sans ça » ?
En 1917 un physicien allemand, Victor Hess, et son équipe, grâce à des compteurs embarqués à bord d’un ballon, ont la surprise de constater que la radioactivité naturelle, loin de s’atténuer avec la hauteur atteinte par la nacelle, augmente progressivement. C’est que notre planète est continuellement bombardée de particules chargées de très grande énergie, appelée « rayons cosmiques ».
Issu des explosions d’étoiles massives, ces particules sillonnent en permanence l’espace interstellaire et bombardent les corps célestes qui orbite dans la galaxie.
À cela il faut ajouter une découverte plus récente : celle du vent solaire. Les premières sondes lancées dans l’espace vers les années 1960 ont été accueillies par un flux de particules d’énergie plus faible que les rayons cosmiques mais en beaucoup plus grand nombre. Elles proviennent directement des couches superficielles de notre étoile. Elles diffusent rapidement dans l’ensemble du système solaire.
Pourquoi ces particules rapides n’atteignent elles pas (ou peu) la surface de notre planète ? C’est le champ magnétique terrestre qui, en les déviants, les repousse dans l’espace et nous met à l’abri de leur influence délétère. Mais pas totalement, comme le savent les hôtesses de l’air qui doivent comptabiliser et limiter, en conséquence, leurs heures de vol. Sans ce bouclier magnétique qui entoure notre planète, la vie, telle que nous la connaissons n’aurait jamais pu naître sur les continents.
Notons que la lune et mars, qui n’ont pas de champ magnétique, subissent de plein fouet ce bombardement. La vie y serait impossible. Et pourquoi n’ont-elles pas de champ magnétique ? À cause de leur petite taille. Mars est 10 fois moins massive que la Terre et la Lune 100 fois moins massive. En conséquence, elles ont dégagé leur chaleur initiale beaucoup plus rapidement que la terre. Rappelons que cette chaleur est responsable des mouvements de convection qui engendre le champ magnétique. Leur cœur est maintenant refroidi. […]
[…]
Bien sûr, cela ne durera pas indéfiniment. Comme les chaleurs initiales de la Lune et de Mars celle de la Terre s’épuise avec le temps. Mais les évaluations les plus crédibles nous permettent de compter encore sur quelques centaines de millions d’années de loyaux services de la chaleur centrale véhiculée par la tectonique des plaques. »
Il fallait que le centre de la terre reste chaud suffisamment longtemps pour que nous puissions apparaître lors de l’immense chaîne de l’évolution et rester un peu de temps à l’échelle cosmique.
<667>
Mercredi 16 mars 2016
Aucune séquence de réactions ne semblait être en mesure d’expliquer sa population dans l’Univers, sauf à faire appel à des coïncidences assez étonnantes quant aux valeurs numériques de différentes propriétés du noyau de carbone [qui depuis ont pu être mesurées et sont exactement celles qui rendent la chose possible] »
« La belle histoire » Page 24 & 25
L’atome est le constituant fondamental de la matière.
Au départ lors du big bang se sont créés les premiers atomes, les plus légers l’hydrogène puis l’hélium.
Le carbone est un atome plus lourd et c’est un élément essentiel de la vie.
Le corps humain contient, en effet, beaucoup de carbone, comme tout organisme vivant sur Terre.
Car le carbone est la base de toutes les formes de vie connues à ce jour.
Combiné notamment à l’hydrogène et à l’oxygène, il forme l’ossature de tous les organismes vivants que nous connaissons : protéines, ADN, membranes, etc.
C’est pourquoi la chimie du carbone est si importante et s’appelle « chimie organique » (la chimie des organismes, la chimie du vivant).
Or le carbone n’a pas été créé lors du big bang et sa création a nécessité des conditions très spécifiques.
Hubert Reeves l’explique comme cela :
« Je vais raconter un événement qui a fait beaucoup de bruit, il y a un demi-siècle quand, grâce aux progrès de la physique nucléaire de laboratoire, on a commencé à découvrir l’origine des éléments chimiques dans l’Univers.
L’astrophysicien anglais, Fred Hoyle, a formulé vers 1948 l’idée que les brasiers internes des étoiles, là où les températures sont assez élevées pour amorcer spontanément des réactions nucléaires, sont les foyers où les noyaux des atomes du cosmos sont engendrés.
Pour accréditer cette thèse, il fallait d’abord identifier les chaînes de réactions nucléaires spécifiques qui seraient responsables de chaque variété d’atome puis identifier les types d’étoiles dans lesquelles ces atomes avaient été produits. C’est d’ailleurs sur un des thèmes de cette enquête que j’ai fait ma thèse de doctorat en astrophysique nucléaire.
Un problème se posa bientôt concernant l’origine du carbone. Les connaissances de l’époque en physique nucléaire ne laissaient entrevoir pratiquement aucune possibilité de sa formation dans les étoiles.
Aucune séquence de réactions ne semblait être en mesure d’expliquer sa population dans l’Univers, sauf à faire appel à des coïncidences assez étonnantes quant aux valeurs numériques de différentes propriétés du noyau de carbone, propriétés encore non mesurées à cette époque.
Prenant acte du fait que le carbone est un des éléments les plus foisonnants dans l’Univers, Hoyle prédit que les coïncidences requises devaient se vérifier dans la réalité.
Son ami, le physicien américain William Fowler, le confirma bientôt par des expériences de laboratoire en Californie. Les propriétés du noyau de carbone mesurées en laboratoire sont exactement celles que Hoyle avait estimées pour rendre compte de son abondance. Ces réactions se produisent surtout dans les étoiles géantes rouges, comme Antarès, visible au Sud dans notre ciel d’été.
Que penser de cette prédiction réussie et de ces coïncidences étonnantes ?
On peut, bien sûr, faire appel au hasard.
Mais on peut aussi rester sur sa faim en se disant que le hasard a souvent le dos large.
Et, de surcroît, il faut prendre en considération le fait que le carbone est l’enfant chéri de Dame Nature pour construire la complexité. Il est l’élément clef de toutes les architectures moléculaires et de la vie sur Terre. Il est bien difficile d’imaginer comment la vie aurait pu apparaître sans lui.
Voici une excellente occasion de pratiquer le jugement réservé. »
Et bien sûr sans ces conditions étonnantes et spécifiques le carbone n’aurait pas pu être créé en masse, et sans ça nous ne serions pas là pour en parler.
<666>
Mardi 15 mars 2016
[ sans ça,] nous ne serions pas là ! »
« La belle histoire » Page 16 et 17
Voici comment Hubert Reeves raconte cet ajustement précis sans lequel nous ne serions pas là pour en parler :
« Voici une information qui n’a pas fini de faire parler d’elle. Elle nous est arrivée, d’une façon inattendue, du monde de l’informatique, de ce qu’on appelle souvent les broyeurs de chiffres.
On part du constat que le comportement de la matière du cosmos est contrôlé par quatre forces différentes :
- la force de gravité,
- la force électromagnétique,
- la force nucléaire forte
- la force nucléaire faible.
Chacune est caractérisée par son intensité et sa portée (la distance sur laquelle elle se fait sentir).
Les physiciens, qui aiment s’amuser avec des modèles numériques sur ordinateur, ont tenté de calculer comment la matière cosmique se serait comportée depuis le big bang si les propriétés de ces forces avaient été un tant soit peu différentes.
Là, surprise !
Les moindres variations résultaient souvent en univers bien différent du nôtre : il s’avérait parfaitement stériles.
Pas de galaxie, pas d’étoile, pas de planète, et surtout pas de vie !
Convenant, par exemple, d’augmenter, même de façon minime, l’intensité de la force nucléaire forte. Lors du big bang, tout l’hydrogène se serait transformé en hélium. Résultat : il n’y aurait pas d’étoile de longue durée comme le soleil pour veiller à l’éclosion de la vie et partout dans l’univers. Un monde sec et stérile.
Convenons à l’inverse qu’elle ait été un peu, très peu, plus faible. Résultat : les noyaux atomiques seraient beaucoup moins stables. Un grand nombre se désintégrerait spontanément et la matière serait hautement radioactive, trop instable pour permettre la vie.
Supposons maintenant que la force de gravité soit un tantinet plus faible. Un univers soumis à ces conditions aurait suivi un parcours semblable au nôtre : expansion, refroidissement, obscurcissement.
Mais aucune galaxie, aucune étoile, aucune planète ne se serait formée. La matière serait restée indéfiniment dans son état de dispersion initiale.
À l’opposé, une minime intensification de la gravité aurait accru la vitesse de formation des étoiles qui se seraient par la suite rapidement transformée en stérile trou noir. Et la liste est longue des exemples d’effets semblables sur les autres forces.
En peu de mots les forces qui régissent la matière semblent finement « ajustées » pour l’apparition de la complexité, de la vie et de l’intelligence dans l’univers.
Étonnant non ?
Évidemment les réactions n’ont pas manqué, les interprétations sont nombreuses et les débats sont animés. Mais la réalité de ces concordances très généralement admises par les astrophysiciens. »
Et, bien sûr, sans ça, nous ne serions pas là !
<665>
Lundi 14 mars 2016
Récemment j’ai lu un petit livre très intéressant de ce grand pédagogue scientifique qu’est Hubert Reeves.
Comme exergue de ce mot du jour je ne peux pas utiliser son titre, car il s’agit du vers du poète allemand Hölderlin : « Là où croit le péril, croît aussi ce qui sauve » qui a déjà été utilisé comme mot du jour du Mardi 27 août 2013.
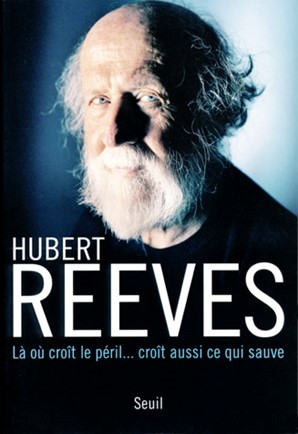 Alors j’ai pris la première phrase du livre qui est ce vers d’Aragon que j’ai évoqué dans un mot du jour récent (2 février 2016) consacré à Jean d’Ormesson mais que je n’avais pas utilisé comme mot du jour.
Alors j’ai pris la première phrase du livre qui est ce vers d’Aragon que j’ai évoqué dans un mot du jour récent (2 février 2016) consacré à Jean d’Ormesson mais que je n’avais pas utilisé comme mot du jour.
J’avais d’ailleurs cité le poème dans son intégralité et sa source : « Les yeux et la mémoire – Chant II – 1954 »
Hubert Reeves a écrit ce livre « Là où croit le péril …croît aussi ce qui sauve » en 2013, il avait déjà 81 ans et consacre désormais toute son énergie à œuvrer pour une prise de conscience écologique.
C’est le sujet de ce livre qui est divisé en 3 parties :
D’abord la belle histoire, histoire de l’émergence de la vie, de la complexité et de l’homme dans un monde qui, sans une accumulation de coïncidence, aurait dû être stérile.
Ensuite, la moins belle Histoire, celle d’une espèce, la nôtre, qui a eu, aujourd’hui comme hier, des rapports si conflictuels avec la nature qu’elle l’a progressivement détruit au risque de briser l’équilibre fragile auquel elle doit sa survie.
Car, même si tout s’est accéléré avec l’ère industrielle et la société de consommation, pour Hubert Reeves, l’affaire ne date pas d’hier, loin de là.
La 3ème partie s’appelle le réveil vert car l’astrophysicien pense déceler, dans une série d’évolutions sociétales, d’initiatives et d’expériences individuelles apparues depuis la première moitié du XIXe siècle, une prise de conscience qui pourrait constituer notre planche de salut.
Ce qui m’a le plus ébloui dans ce livre, c’est « la belle histoire ». Toutes ces choses pour lesquelles Hubert Reeves écrit
« Sans ça nous ne serions pas là pour en parler ».
Je reviendrai dans les prochains jours de la semaine à certains de ces « sans ça » avec cette belle philosophie du scientifique :
« J’observe le phénomène et je réserve mon jugement. »
Il présente l’ensemble de sa réflexion dans une conférence à Rennes que vous trouverez <ici>
( Attention la vidéo se déroule un long moment sans qu’il ne se passe rien, il faut se positionner à la 30ème minute.
<664>
Vendredi 11 mars 2016
Or l’intelligence humaine naît du baiser des Muses.»
Jeudi 10 mars 2016
Mercredi 9 mars 2016
Que si l’on se concentre sur quelque chose, cela devient beau et on peut en tirer de l’énergie.»
|
|
Aujourd’hui, elle comprend mieux ce qu’elle a vécu pendant cette « expérience » de huit jours dans la jungle qu’elle décrit comme étant « belle », étonnamment. Les lectures qu’elle a faites depuis le crash, sur le bouddhisme notamment, ont mis cet événement en perspective. Nommant régulièrement l’une de ses grandes inspirations, le médecin et penseur d’origine indienne Deepak Chopra, elle nous explique que ces penseurs décrivent ce qu’elle a vécu dans la jungle.
«J’ai appris qu’il faut être dans l’instant présent. Que si l’on se concentre sur quelque chose, cela devient beau et on peut en tirer de l’énergie ».
C’est pour ça qu’elle a écrit ce livre, nous dit-elle: pour faire comprendre qu’il faut se concentrer sur ce que l’on a et pas sur ce que l’on a pas. «C’est comme dans la jungle: au lieu de penser aux insectes, j’ai regardé les fleurs », insiste-t-elle. Elle avance même avec humour qu’elle a suivi « un cours intensif de méditation en huit jours ». […]
|
Mardi 8 mars 2016
|
|
« Le rire libère de la peur du diable, […] Le rire distrait, quelques instants de la peur.
Mais la loi s’impose à travers la peur, dont le vrai nom est crainte de Dieu. […]
Et que serions nous, nous créatures pécheresses, sans la peur, peut être le plus sage et le plus affectueux des dons divins ? »
« Jorge de Burgos »
Le nom de la Rose, Septième jour : Nuit
Umberto Ecco
.
|
Lundi 7 mars 2016
|
|
Et Christophe André précise :
« C’est drôle comme ce mot «acceptation» peut, en Occident, hérisser certains. L’acceptation est ce temps durant lequel on se met en contact avec le réel !
« Que se passe-t-il et que puis-je faire ? »
L’acceptation précède l’action juste, réfléchie et adaptée. Elle ne consiste pas à dire « c’est bien », mais « c’est la »
Certains les traitent de bisounours et par réaction ils se sont nommés eux-mêmes le commando des bisounours.
Mais ils ont profondément raison : le mal existe mais la bonté aussi. La bienveillance est partie de la solution. Bienveillance qui n’est pas faiblesse et bienveillance qui ne se soumet pas au mal, mais le combat fermement, avec dignité et sans jamais se mettre au niveau de bassesse et de destruction du mal.
|
Vendredi 4 mars 2016
|
|
Comme vous êtes lecteur d’Astérix et que vous voyez cette carte sur le site de Framasoft vous comprenez deux choses : la première c’est qu’il est question de résistance et la seconde c’est que l’âme de cette résistance (il y en a d’autres) est française : Framasoft est un réseau d’éducation populaire créé en novembre 2001 par Alexis Kauffmann, et soutenu depuis 2004 par l’association homonyme. Consacré principalement au logiciel libre, il s’organise en trois axes sur un mode collaboratif : promotion, diffusion et développement de logiciels libres, enrichissement de la culture libre et offre de services libres en ligne. Espace d’orientation, d’informations, d’actualités, d’échanges et de projets, Framasoft est une porte d’entrée francophone du logiciel libre. Sa communauté d’utilisateurs est créatrice de ressources et apporte assistance et conseil à ceux qui découvrent et font leurs premiers pas avec les logiciels libres.
|
Jeudi 3 mars 2016
Zygmunt Bauman est un sociologue remarquable auquel je n’ai pas encore consacré de mot du jour, alors que j’y pense depuis longtemps notamment en raison du concept fécond de « société liquide » qu’il a inventé.
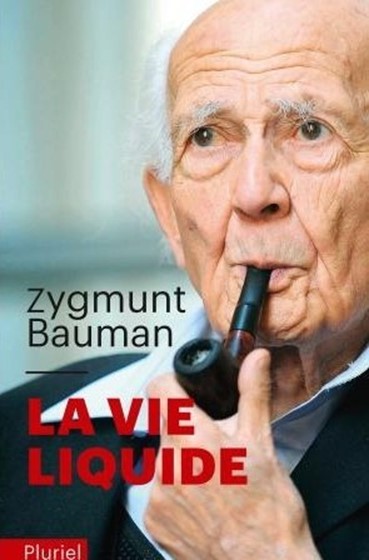 Il est né à Poznań en Pologne le 19 novembre 1925 et possède la double nationalité britannique et polonaise.
Il est né à Poznań en Pologne le 19 novembre 1925 et possède la double nationalité britannique et polonaise.
Il a écrit récemment un article dans « El Pais », le grand journal espagnol, qui a pour titre : «les réseaux sociaux sont un piège»
Il écrit notamment :
« La question de l’identité a été transformée, d’un élément donné c’est devenu une tâche : vous devez créer votre propre communauté.
Mais une communauté est créée de fait, vous l’avez ou pas ; ce que les réseaux sociaux peuvent créer est un substitut. La différence entre la communauté et le réseau est que vous appartenez à la communauté, mais le réseau vous appartient à vous.
Vous pouvez ajouter des amis et vous pouvez les supprimer, vous contrôlez les personnes avec qui vous êtes en lien. […] Mais sur les réseaux c’est si facile d’ajouter ou de supprimer des amis que vous n’avez pas besoin de compétences sociales, celles que vous développez lorsque vous êtes dans la rue, ou allez au boulot etc., et rencontrez des gens avec qui vous devez avoir une interaction raisonnable. Là, vous avez à faire face aux difficultés liées à un dialogue.
Le Pape François a choisi de donner sa première interview à Eugenio Scalfari, un journaliste italien qui se revendique publiquement athée. C’était un signal : le dialogue réel ce n’est pas de parler avec des gens qui pensent comme vous. Les réseaux sociaux n’apprennent pas à dialoguer, car il est si facile d’éviter la controverse…
Beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux non pas pour unir, non pas pour élargir leurs horizons, mais au contraire pour s’enfermer dans ce que j’appelle une zone de confort, où le seul bruit qu’on entend est l’écho de sa propre voix, où la seule chose qu’on voit est le reflet de son propre visage.
Les réseaux sont très utiles, rendent des services très agréables, mais sont un piège. »
Ce que Bauman décrit se comprend parfaitement pour le F des GAFA : Facebook. Au départ Facebook c’est la communauté de mes amis. A priori, il n’est que prévu de dire qu’on aime, les fameux « like ». Il n’est pas prévu de dire qu’on n’est pas d’accord. Tout ceci illustre parfaitement le propos de Bauman, mais Facebook va encore plus loin, car il trie aussi les informations que publient « mes amis ».
Dans un mot du jour précédent, je vous ai parlé de Yann Le Cun, le génie de l’intelligence artificielle qui travaille chez facebook. Et Le Cun explique que facebook a besoin de l’intelligence artificielle pour trier les informations pertinentes pour chaque utilisateur, sinon il serait noyé sous les informations. Bref, Facebook apporte à chaque utilisateur les informations qu’il pense intéressant pour lui et avec lesquelles il sera en phase. Non seulement on y rencontre que des amis, mais en plus on évite la controverse.
Et ceci m’amène à évoquer les moteurs de recherche et particulièrement Google. Mais comment faisait-on avant Google pour trouver une information sur Internet ?
Au départ les informaticiens étaient influencés par leur culture papier et la logique du classement des bibliothèques
Pour trouver un livre on devait aller dans la bonne salle, dans la bonne rangée d’armoire pour finalement arriver au bon endroit.
Alors sur Internet ils avaient inventé des portails ou annuaires où il fallait désigner le domaine dans lequel on cherchait et puis de proche en proche on arrivait à trouver quelque chose.
Avant Google, il y avait Multimania, Geocities, AOL, LYCOS et Alta Vista (littéralement « vue haute » en espagnol). Alta Vista fut mis en ligne à l’adresse web altavista.digital.com en décembre 1995 et développé par des chercheurs de Digital Equipment Corporation. Il fut le plus important moteur de recherche textuelle utilisé avant l’arrivée de Google qui le détrôna.
Google arriva en 1998. Et ce fut une innovation disruptive : On pose une question à Google et Google va trouver les réponses à cette question et les restitue.
On n’est plus dans la culture papier on bascule dans la culture numérique.
En outre Google trouva le graal économique : faire de gigantesques profits avec un service gratuit.
Avouons-le ! Google est génial.
Derrière tout cela il y a de l’intelligence artificielle et évidemment des immenses bases de données où des milliards de pages internet sont indexées, ainsi qu’une puissance de traitement phénoménale.
Si vous voulez en savoir plus et améliorez vos recherches, vous pouvez aller voir cette page : https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=fr
Tout cela est particulièrement utile et positif. Mais, ce serait une erreur que de croire que Google vous montre l’internet tel qu’il est, de manière neutre.
Grâce à Wikipedia on en sait un peu plus sur le moteur de recherche Google. Ainsi, on apprend que Les requêtes sont limitées à 32 mots. Seuls les 1 000 premiers résultats pertinents pour une requête sont accessibles, et ce même si les correspondances sont plus nombreuses. D’après Google, obtenir plus de 1 000 résultats entraînerait une lourde charge supplémentaire pour une demande finalement assez rare.
1000 résultats sauf si Google considère qu’il y a moins de résultats à la requête. Mille c’est énorme ! totalement disproportionné par rapport à nos capacités humaines.
Ce qui est essentiel c’est les premiers. En règle générale, l’internaute reste sur la première page de réponse, il semble même qu’il ne s’intéresse qu’aux toutes premières réponses.
Ce qui est essentiel, c’est le tri qu’opère Google.
En théorie, le tri assure que les références les plus utiles sont en premier. L’auteur de l’article de Wikipedia ajoute : «difficile à valider.»
Mis à part les ingénieurs de Google et encore je suppose qu’il ne s’agit que d’un petit nombre d’entre eux, personne ne sait comment fonctionne précisément l’algorithme de recherche et de tri.
On pourrait craindre que comme big brother, Google veut nous montrer le monde à sa façon. Comme le dit le poème d’Aragon :
« Et j’ai vu désormais le monde à ta façon.
J’ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines. »
Eh bien, il semblerait que ce n’est pas comme cela que cela se passe.
Ce serait plutôt : « et je vois le monde à ma façon »
Et je me retrouve avec mes semblables, avec celles et ceux qui pensent comme moi !
J’ai lu sous la plume d’un journaliste : L’algorithme, selon de nombreux facteurs pas tous connus, choisit les meilleurs sites, puis, dans une proportion de 20 % environ, les personnalise selon le profil de la personne qui a fait la recherche.
Tout ceci est merveilleux, mais manque singulièrement d’altérité et de contradiction.
Car c’est la contradiction qui nous rend intelligent, soit parce qu’elle permet de nous affermir dans nos convictions, soit parce qu’elle nous permet de changer d’avis.
Un monde où, le djihadiste ne discute qu’avec les djihadistes, le catholique avec les catholiques, le gauchiste avec les gauchistes est un monde stérile, je veux dire un monde qui ne progresse pas.
Il y a une solution dans Google, ne restez pas sur la première page, allez voir les suivantes. Ou encore, utilisez aussi d’autres moteurs de recherche …
En tout cas, ces remarquables outils ne nous montrent pas un internet neutre ou tel qu’il peut se développer dans sa complexité des contenus, c’est cela que je voulais partager avec vous : un monde où le seul bruit qu’on entend est l’écho de sa propre voix, où la seule chose qu’on voit est le reflet de son propre visage.
A propos : le nom Google vient du mot Gogol, nom donné au nombre  . Ce nombre a été choisi pour évoquer la capacité de Google à traiter une très grande quantité de données.
. Ce nombre a été choisi pour évoquer la capacité de Google à traiter une très grande quantité de données.
<657>
Mercredi 2 mars 2016
Mardi 1er mars 2016
L’innovation de rupture
L’innovation de soutien
Lundi 29 février 2016
|
|
|
|
C’est bien d’avoir un ami aussi riche et innovant !
Toutefois ne sommes nous pas la proie et ne sommes-nous pas en train d’aimer le prédateur ?
Et ce qui serait vraiment cool, c’est que Google paie ses impôts dus à la France : La DGFiP vient de réclamer 1,6 milliards à Google.
|
Vendredi 19 février 2016
à l’autel le plus redoutable que jamais l’homme eût élevé.»
Jeudi 18 février 2016
|
|
Je voudrais commencer par 5 Unes de journaux français le lendemain du remaniement gouvernemental qui vient d’avoir lieu. D’abord le Parisien, Libération et le Figaro qui manifestent de l’ironie et des critiques acerbes.
|
|
|
La plupart des journaux français ont fait la même chose, sauf deux : La dépêche du Midi et Midi Libre.
Il est bien normal que dans la diversité des médias français on trouve deux journaux bienveillants…
|
|
|
Mercredi 17 février 2016
Mardi 16 février 2016
Apprentissage profond
Vous n’avez qu’a écouté la leçon inaugurale de Yann LeCun, il vous l’expliquera.
Lundi 15 février 2016
Ingénieur en aéronautique japonais, concepteur des chasseurs bombardiers japonais Mitsubishi A6M, appelés « Chasseurs Zéro ».
Vendredi 12 février 2016
Nous rejetons les approches qui prennent pour acquis que tout type de croissance imprègne et fortifie les fondations et rejaillisse sur les pauvres»
Le président de la Banque mondiale
Jeudi 11 février 2016
Il ne s’étonnera pas que le 1/3 de pilote d’avion consommateur cherchera un dentiste dont le 1/3 producteur est moins cher !
<Pour illustrer mon propos vous pouvez écouter Sofia Lichani qui était hôtesse de l’air chez Ryanair, elle en a écrit un livre>. Dans cette entreprise, c’est l’employé qui paye sa formation initiale réalisée par son entreprise.
Mercredi 10 février 2016
Mardi 9 février 2016
|
|
Lundi 8 février 2016
Vendredi 5 février 2016
être fidèle à soi-même,
prendre corps à corps le destin,
étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait,
tantôt affronter la puissance injuste,
tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête ;
voilà l’exemple dont les peuples ont besoin,
et la lumière qui les électrise.»
Jeudi 4 février 2016
Mark Zuckerberg, le créateur de facebook, est devenu Papa il y a peu. Ceci l’a, bien sûr, rendu très heureux. Et ce bonheur l’a conduit à devenir philanthrope.
Il entre avec son épouse Priscilla Chan dans le cercle américain des milliardaires philanthropes qu’illustrent remarquablement Bill Gates et son épouse Melinda.
Ce sont des gens immensément riches parce qu’ils ont eu une idée géniale qui correspondait à l’air du temps, ils ont beaucoup travaillé et entrepris et aussi … pour un petit peu… profiter d’une diminution considérable des impôts aux Etats Unis et peut être aussi profiter des opportunités que leur offraient le système financier et quelques paradis fiscaux.
Bref, les impôts ou cotisations qu’ils n’ont pas payés et qui aurait permis d’alimenter un système redistributeur public, ont conduit leur fortune d’importante à devenir gigantesque. Et ils sont devenus philanthropes. Bref un système de redistribution privé.
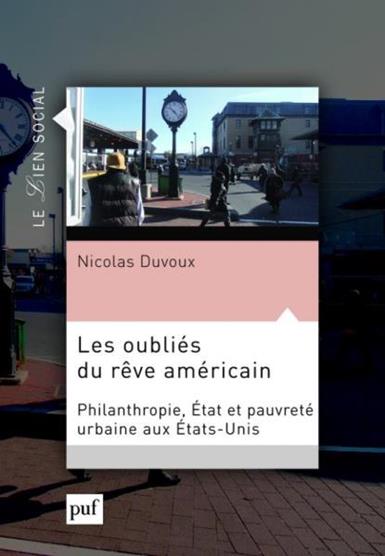 Le mot du jour correspond à un questionnement développé par le sociologue, Nicolas Duvoux, dans l’émission la grande Table du 30/09/2015 où il avait été invité pour parler de son enquête aux Etats-Unis et qu’il a formalisé dans ce livre paru en août 2015 :
Le mot du jour correspond à un questionnement développé par le sociologue, Nicolas Duvoux, dans l’émission la grande Table du 30/09/2015 où il avait été invité pour parler de son enquête aux Etats-Unis et qu’il a formalisé dans ce livre paru en août 2015 :
«Les oubliés du rêve américain. Philanthropie, Etat et pauvreté urbaine aux Etats-Unis»
Il s’est intéressé dans la ville de Boston à l’action d’une fondation américaine philanthropique en faveur des habitants d’un quartier défavorisé.
Cela pose bien entendu la coexistence, la complémentarité et dans l’exemple américain plutôt le remplacement dans l’action sociale de l’Etat par des organismes privés.
Il n’en a pas toujours été ainsi, les impôts sur les revenus aux Etats Unis ont été très lourd pendant longtemps et les Présidents Kennedy et Johnson ont développé un Etat Social.
Mais cette évolution a été stoppée, sous la présidence de Reagan. En effet, depuis le tournant néolibéral de la fin des années 1970, les politiques sociales américaines ont été progressivement déléguées à des organisations à but non lucratif et financées par des fondations privées.
Il faut se méfier, souvent ce qui se passe aux Etats-Unis est précurseur de ce qui va se passer en France. Aux Etats-Unis, l’Etat s’est désengagé, les inégalités ont explosé et une petite partie de la population est devenu excessivement riche. Pour des motifs religieux, moraux et peut être donner un peu de sens à leur vie certains riches se sont engagés dans l’action philanthropique.
L’hypothèse qu’il défend est que le « don philanthropique » et la participation des habitants aux actions financées ou organisées par les fondations contribuent à reproduire le système de représentations qui légitime les inégalités sociales. Les gens qui profitent de cette action privée n’ont pas le sentiment d’être des assistés parce qu’ils doivent se « prendre en main ». Ce côté apparaît à Duvoux plutôt positif, car le terme d’« assistés » est vécu de manière très négative aux Etats Unis.
En revanche dans ce contexte, il n’est plus question de droits sociaux, notamment dans leur aspect universalistes. En effet, ces actions privées ne touchent pas toutes les personnes dans le besoin. Il existe même un caractère discriminatoire des riches philanthropes qui distribuent leurs aides selon des critères qui leurs sont propres.
Libération a interviewé Nicolas Duvoux lors de la sortie de son livre.
Le titre de l’article est explicite : «Aux Etats-Unis, chaque pauvre doit être entrepreneur de lui-même»
Je vous en livre quelques extraits :
« […] La tradition de la philanthropie remonte au XIXe siècle, mais elle a connu un renouveau ces dernières années avec l’émergence du capitalisme financier. De nouveaux philanthropes sont alors apparus, souvent issus du secteur des nouvelles technologies. Ils ont accumulé des richesses colossales de manière extrêmement rapide, notamment grâce à des taux d’imposition très bas. Warren Buffet soulignait ainsi qu’il payait moins d’impôts que sa secrétaire. La redistribution à laquelle ils se livrent, à travers le secteur associatif, est si considérable qu’elle se substitue, en partie, aux prestations sociales publiques, qui, elles, ont été drastiquement réduites. A l’échelon local, ces nouveaux philanthropes possèdent une véritable force de frappe, désormais proche de celle des pouvoirs publics. […] Les Etats-Unis ont connu une phase de montée en puissance de l’Etat social dans les années 60-70, pendant les mandats Kennedy et Johnson. Ces politiques sociales visaient principalement les minorités. Il s’agissait notamment de compenser, par des prestations sociales, la pauvreté héritée de l’esclavage et des discriminations, après le mouvement des droits civiques. A partir des années 80, pendant l’ère Reagan, on assiste à un retournement complet : les protections sociales en direction des minorités sont en partie démantelées. Ce démantèlement n’est pas indifférencié : les prestations pour les mères célibataires, parmi lesquelles les femmes afro-américaines sont surreprésentées, sont presque supprimées. Au même moment, le taux d’incarcération augmente en flèche chez les Noirs pauvres. On a mis les mères célibataires au travail et les hommes en prison, pour schématiser. On est passé du welfare au workfare. L’Etat social a été pratiquement éradiqué. Durant cette même période, les inégalités de revenus augmentent fortement, et des acteurs privés s’approprient l’action en direction des pauvres, qui cesse d’être un droit. […]
Ce qu’il faut surtout souligner, c’est qu’aux Etats-Unis, la fonction sociale de l’Etat est extrêmement mal vue. On ne parle pas d’assistanat, comme en France, mais de «dépendance» – la coloration péjorative est la même. Dépendre de l’Etat est une catastrophe morale, économique et sociale. Je l’ai constaté pendant l’enquête, même des gens très pauvres qui vivent dans des ghettos peuvent être extrêmement critiques à l’égard de l’aide sociale d’Etat.
[… La fondation privée] veut aider les gens à s’aider eux-mêmes. L’association organise des formations pour apprendre aux habitants du quartier à prendre la parole en public, à monter un business plan. L’idée de base, c’est que donner de l’argent corrompt. Toute solution extérieure est considérée comme intrinsèquement mauvaise. Toute solution doit reposer non pas sur le savoir d’experts, mais, au contraire, sur celui des gens pauvres. Ce sont eux les plus à même d’identifier les vrais problèmes et les remèdes. Il faut semer les graines d’un progrès soutenable : c’est la même idée qui sous-tend l’aide au développement dans les pays du Sud. […]
[Cette vision] qui veut donner le pouvoir aux gens de s’en sortir par eux-mêmes, semble un principe intéressant… [Elle] répond aux limites de l’intervention publique qui, elle, ne donne pas de place à l’initiative des gens. C’est d’ailleurs pour cela que ces programmes suscitent une vraie adhésion. Les personnes pauvres ne veulent plus recevoir, de manière passive et méprisante, des prestations venues de l’extérieur. Mais la limite de ces programmes, c’est qu’on transfère la responsabilité de trouver une solution aux problèmes à des gens qui ont peu de ressources. Et ils contribuent à légitimer la richesse des riches ! La philanthropie a tout de même pour effet de transformer en générosité ce qui est avant tout de l’accumulation privée de richesse, exonérée de fiscalité.
C’est l’une des différences majeures entre les philanthropes d’aujourd’hui et ceux du temps de Rockfeller, qu’on surnommait les «barons voleurs» et qu’on accusait de corrompre les politiques et d’exploiter les ouvriers : Bill Gates ou Warren Buffet sont, eux, extrêmement populaires. […] Ils n’attendent rien de l’Etat. Que chacun puisse s’en sortir par ses propres moyens est leur seul espoir.»
Bon on France on va avoir des difficultés de basculer vers ce modèle.
Bill Gates était venu en France pour soutenir l’action philanthropique. Il avait été reçu sur France Inter par Patrick Cohen qui l’avait interrogé sur ce sujet. Il faut être juste, Bill Gates a répondu poliment et c’est Patrick Cohen qui a fini par cette conclusion qui a fait sourire l’américain : «Il existe des milliardaires philanthropes et des milliardaires français, mais on cherche des milliardaires français philanthropes»
Cela étant je soulignerai deux réflexions de Nicolas Duvoux :
- La philanthropie a tout de même pour effet de transformer en générosité ce qui est avant tout de l’accumulation privée de richesse, exonérée de fiscalité.
- Les philanthropes d’aujourd’hui sont extrêmement populaires alors qu’on traitait ceux d’hier de voleurs. (Ils ont probablement de meilleurs communicants …)
<642>
Mercredi 3 février 2016
Mardi 2 février 2016
C’est aussi une vallée de roses.»
La première fois que j’ai entendu parler de Jean d’Ormesson c’était par Jean Ferrat en 1975, dans la chanson « un air de liberté »
«Ah monsieur d’Ormesson
Vous osez déclarer
Qu’un air de liberté
Flottait sur Saigon
Avant que cette ville s’appelle Ville Ho-Chi-Minh»
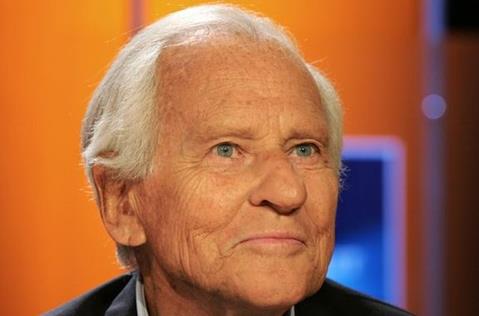 Depuis, beaucoup d’eau est passé sous les ponts et le communisme ne fait plus rêver grand monde.
Depuis, beaucoup d’eau est passé sous les ponts et le communisme ne fait plus rêver grand monde.
Aujourd’hui on se dit que D’Ormesson, qui était à l’époque Rédacteur en chef du Figaro, avait peut-être raison.
Jean d’Ormesson est désormais un vieil homme de 90 ans, plein de facétie et d’intelligence avec une immense culture.
Quand dans l’émission de Ruquier, il glisse à Manuel Valls qui tente de défendre la déchéance de nationalité :
«Je me demande s’il n’y a pas une ombre d’enfumage.»
On ne peut qu’être séduit.
Il a dit aussi : «M. Valls vous vous êtes droitisé». C’est un jugement qu’il faut prendre avec intérêt pour un homme qui sait ce que «droite» veut dire.
Il vient de publier en 2016 un nouveau livre «Je dirai malgré tout que cette vie fut belle».
Pour parler de ce livre il avait été invité à France 2 par Laurent Delahousse.
Dans cet entretien il a ces remarques :
«J’ai longtemps passé pour un écrivain du bonheur.
Après avoir vu et entendu tout ce qui a été dit pendant ce journal, il est très difficile d’être un écrivain du bonheur.
Je sais très bien que le monde est cruel, il est dur. Que les gens sont malheureux. Ils sont malheureux en France, ils sont malheureux dans le monde entier.
Je ne crois pas qu’il faut rire toujours, qu’il faut ricaner. Mais prendre avec une certaine gaieté même les catastrophes. Même les catastrophes…
La vie naturellement est une vallée de larmes, c’est aussi une vallée de roses.
C’est indiscernable.
C’est une fête
Et c’est un désastre.»
Même Mélenchon dit beaucoup de bien de cet homme.
Et pour revenir à Ferrat, Jean d’Ormesson partage avec lui une passion pour Louis Aragon
Et le titre de son dernier ouvrage «Je dirai malgré tout que cette vie fut belle» comme d’ailleurs son ouvrage de 2010 «C’est une chose étrange à la fin que le monde» et celui de 2013: «Un jour je m’en irai sans en avoir tout dit» sont tous extraits du même poème d’Aragon :
« Que la vie en vaut la peine
C’est une chose étrange à la fin que le monde
Un jour je m’en irai sans en avoir tout dit
Ces moments de bonheur ces midis d’incendie
La nuit immense et noire aux déchirures blondes.
Rien n’est si précieux peut-être qu’on le croit
D’autres viennent. Ils ont le cœur que j’ai moi-même
Ils savent toucher l’herbe et dire je vous aime
Et rêver dans le soir où s’éteignent des voix.
D’autres qui referont comme moi le voyage
D’autres qui souriront d’un enfant rencontré
Qui se retourneront pour leur nom murmuré
D’autres qui lèveront les yeux vers les nuages.
II y aura toujours un couple frémissant
Pour qui ce matin-là sera l’aube première
II y aura toujours l’eau le vent la lumière
Rien ne passe après tout si ce n’est le passant.
C’est une chose au fond, que je ne puis comprendre
Cette peur de mourir que les gens ont en eux
Comme si ce n’était pas assez merveilleux
Que le ciel un moment nous ait paru si tendre.
Oui je sais cela peut sembler court un moment
Nous sommes ainsi faits que la joie et la peine
Fuient comme un vin menteur de la coupe trop pleine
Et la mer à nos soifs n’est qu’un commencement.
Mais pourtant malgré tout malgré les temps farouches
Le sac lourd à l’échine et le cœur dévasté
Cet impossible choix d’être et d’avoir été
Et la douleur qui laisse une ride à la bouche.
Malgré la guerre et l’injustice et l’insomnie
Où l’on porte rongeant votre cœur ce renard
L’amertume et Dieu sait si je l’ai pour ma part
Porté comme un enfant volé toute ma vie.
Malgré la méchanceté des gens et les rires
Quand on trébuche et les monstrueuses raisons
Qu’on vous oppose pour vous faire une prison
De ce qu’on aime et de ce qu’on croit un martyre.
Malgré les jours maudits qui sont des puits sans fond
Malgré ces nuits sans fin à regarder la haine
Malgré les ennemis les compagnons de chaînes
Mon Dieu mon Dieu qui ne savent pas ce qu’ils font.
Malgré l’âge et lorsque, soudain le cœur vous flanche
L’entourage prêt à tout croire à donner tort
Indifférent à cette chose qui vous mord
Simple histoire de prendre sur vous sa revanche.
La cruauté générale et les saloperies
Qu’on vous jette on ne sait trop qui faisant école
Malgré ce qu’on a pensé souffert les idées folles
Sans pouvoir soulager d’une injure ou d’un cri.
Cet enfer Malgré tout cauchemars et blessures
Les séparations les deuils les camouflets
Et tout ce qu’on voulait pourtant ce qu’on voulait
De toute sa croyance imbécile à l’azur.
Malgré tout je vous dis que cette vie fut telle
Qu’à qui voudra m’entendre à qui je parle ici
N’ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle. »
Louis ARAGON
Les yeux et la mémoire – Chant II – 1954 –
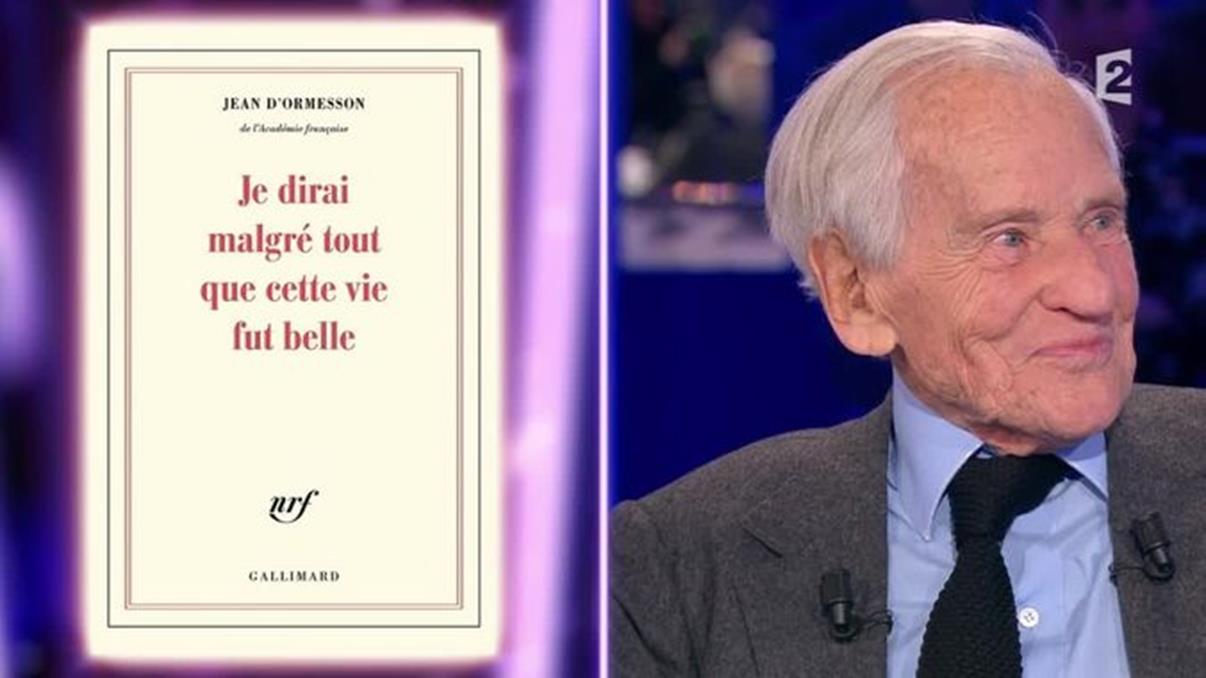
Il faut bien des moments de poésie
<640>
Lundi 1 février 2016
Le mot du jour correspond au titre d’un opéra, un des plus grands chefs d’œuvre de l’opéra du XXème siècle, de Dimitri Chostakovitch qui est actuellement à l’affiche de l’Opéra de Lyon.
Ce mot se décline à 3 niveaux :
 1/ Le premier est une déclaration d’amour à l’Opéra de Lyon quand cette maison accueille des metteurs en scène qui savent mettre en valeur un texte et une musique. L’orchestre, le chœur et les autres artistes font alors des merveilles.
1/ Le premier est une déclaration d’amour à l’Opéra de Lyon quand cette maison accueille des metteurs en scène qui savent mettre en valeur un texte et une musique. L’orchestre, le chœur et les autres artistes font alors des merveilles.
Cette maison d’opéra est, dans cette situation, comparable au plus grandes.
Je ferais court sur ce point, il suffit pour ce spectacle de lire Télérama : <Lady Macbeth de Mzensk embrase l’Opéra de Lyon>
Ou encore ce site spécifiquement consacré à la musique classique <Bouleversante Lady Macbeth à l’opéra de Lyon>
2/ Ce n’est pas le cas quand certains metteurs en scène se laissent aller à leurs instincts de machistes ordinaires. Et à ce deuxième niveau, nous revenons un peu à la thématique de la semaine dernière et de la manière de considérer la femme.
Beaucoup d’entre vous ne sont pas familiers du monde de l’opéra, pourtant vous connaissez tous « Carmen » l’opéra le plus joué au monde, opéra de Bizet sur un texte de Prosper Mérimée. Carmen est une femme libre qui a décidé de choisir ses amants et de décider à quel moment elle passerait de l’un à l’autre. Mérimée décrit ainsi une femme moderne, libre. Le metteur en scène qui a réalisé cet opéra à l’opéra de Lyon en 2013 a cru intelligent de la présenter comme une prostituée au milieu d’autres prostituées. Une femme libre ne saurait être qu’une putain, voilà la brillante idée qu’a soutenu, le connu et emblématique directeur du festival d’Avignon : Olivier Py. Un metteur en scène du genre mâle.
L’autre grand opéra français : « Pélléas et Mélisande » de Debussy sur un texte tout en finesse et en symbole de Maurice Maeterlinck, décrit une jeune fille apeurée, qui a fui un mari dont elle ne parle qu’en allusion et qui s’échappe dans les échanges avec le vieux prince Golaud qui l’a recueilli et épousé sans lui laisser trop le choix, par des mensonges qui restent sa seule défense. Maeterlink met en scène une femme qui a subi des violences avant que l’opéra ne commence et va continuer à être opprimé par Golaud. Soit par manque d’imagination ou par mimétisme avec Olivier Py, le metteur scène du genre mâle, Christophe Honoré qui a mis en scène cet opéra en juin 2015, à Lyon, a fait de Mélisande une prostituée.
C’est encore un metteur en scène du genre mâle, Stefan Herheim, qui avait la tâche de mettre en scène Rusalka de Dvorak en 2014 et qui va avoir la brillante idée d’en faire une prostituée.
Cet opéra est moins connu, mais l’histoire est connu de tous : c’est l’histoire de la petite sirène qui parce qu’elle est amoureuse d’un prince humain doit abandonner sa nature de sirène. Ce mâle-ci a trouvé particulièrement pertinent d’interpréter le symbole de la communauté des sirènes, comme un groupe de prostituées sous la domination d’un mac et a été particulièrement fier de pouvoir faire l’analogie entre la difficulté pour la sirène d’entrer dans le monde des humains, et la prostituée d’entrer dans le monde des bourgeois.
Et enfin, il y a la damnation de Faust de Berlioz inspiré du Faust de Goethe. Cette fois il s’agit de la pécheresse Marguerite abusée par Faust lui-même entraînée vers la perversion par Méphistophélès, personnification de Satan, qui va subir le même traitement. Cette fois c’est David Marton, metteur en scène du genre m…, qui va tout simplement ajouter du texte à l’opéra, texte certes uniquement parlé, où des enfants (comme c’est charmant) vont vociférer vers Marguerite et bien sûr la traiter de P..
Quand sur un peu plus de 2 saisons, des metteurs en scènes différents arrivent à concevoir le même type de représentation, il ne s’agit plus d’un hasard ou d’une malencontreuse coïncidence, il s’agit d’un système de pensée.
Une femme libre, une femme victime de violence, la petite sirène, la jeune fille abusée par un manipulateur : « toutes des putes ».
Nous sommes dans le même esprit que celui que j’ai dénoncé dans les 5 mots du jour de la semaine dernière.
3/ D’où cette divine surprise quand cette fois, le metteur en scène Dmitri Tcherniakov n’a pas succombé à cette facilité.
Car dans cet opéra, ce dont il est question c’est d’une femme frustrée dont le mari est impuissant et lâche, qui est martyrisé par son beau-père chef d’entreprise alcoolique et violent. Cette femme va tomber amoureuse d’un bellâtre et avec lui tuer son beau-père et son mari.
Le crime est dénoncé à une police décrite comme totalement corrompue et le couple finira au bagne où elle se suicidera parce que son amant la trahit.
A ce troisième niveau, je vais vous parler de Staline et de l’Union soviétique.
Cette œuvre extraordinairement réaliste, d’une modernité géniale au moment de sa création en 1934 est portée par une musique d’une force incandescente.
Dès sa création à Saint Petersbourg elle fut acclamée et connut un très vif succès pendant plusieurs mois.
Elle connut le succès jusqu’au 28 janvier 1936 où à la représentation du Bolchoi de Moscou, le camarade Staline avec ses sbires vinrent au spectacle.
Le lendemain matin la Pravda écrivit : « Le chaos remplace la musique » et tout l’article expliqua comment cette musique était dévoyée et que l’Union Soviétique et les masses populaires ne pouvaient accepter telle décadence.
Exactement comme les nazis qui ont développé le concept <d’art dégénéré>
Chostakovitch fut humilié en public, ses œuvres retirées du répertoire, et pour résister à la peur d’être déporté voire pire il augmenta sa consommation de vodka.
Un jour il faillit vraiment être envoyé au goulag, mais chance l’enquêteur du KGB qui s’occupait de réunir le dossier contre lui, fut lui-même mis en cause dans le cadre d’une autre procédure de purge, arrêté, condamné à mort et exécuté. Le dossier de Chostakovitch fût oublié alors dans les méandres de cette administration folle et chaotique.
Chaque fois que l’on creuse un peu on constate qu’il n’y a aucune différence de fond entre Hitler et Staline qui furent tous deux des criminels, des déséquilibrés, des tyrans pathologiques et aveuglés par la violence de leur pouvoir.
C’est tout récemment qu’Alain Minc, qui ne fait pas partie de mes inspirateurs, m’a dévoilé pourquoi des amis que je respecte n’ont jamais voulu mettre Hitler et Staline au même niveau.
Alain Minc a dit, du temps de Staline il y avait beaucoup de communistes qui étaient des braves types et qui avaient foi que le communisme apporterait le bien au plus grand nombre, les nazis qui croyaient à la supériorité de la race n’étaient jamais des braves types.
Ceci est certainement juste, mais les deux maîtres de ces idéologies, eux, étaient des sales types dont on ne peut départager la noirceur.
Mais tout ceci ne doit pas m’éloigner des deux messages principaux que je voulais dévoiler dans ce mot :
Lady Mac Beth de Mzensk est un chef d’œuvre

L’opéra de Lyon en réalise une interprétation admirable.
<639>
Vendredi 29 Janvier 2016
Il faut conclure cette semaine consacrée aux violences faites aux femmes dans l’espace public, même en France.
Dans l’esprit de beaucoup, le fait que les femmes doivent faire attention, éviter certaines tenues, éviter certains quartiers, ne pas sortir seule à partir d’une certaine heure est intégré et surtout semble normal.
Que dans le monde tel qu’il existe il vaut mieux être prudent, cela se comprend, mais que cela soit normal !
Non ce n’est pas normal !
C’est une vraie prise de conscience qu’il faut développer, mais aussi l’inscrire dans la réalité avec les moyens appropriés pour rendre l’espace public sur, sécurisé et apaisé.
Les évènements de Cologne pourraient conduire à une régression si la peur l’emportait.
Une autre régression à l’égard des femmes menace la France en raison du communautarisme qui s’est développé dans des populations issues de l’immigration de population venant de pays et de culture qui sont encore à un stade plus archaïque des relations femme/homme.
Mais Michelle Perrot, dans les matins de France Culture, reste optimiste :
« Il y a des stades dans le développement des « cultures » dans ce domaine. Toutes les cultures n’en sont pas au même stade et le facteur religieux est important. Les religions n’ont jamais été favorables aux femmes ni les unes ni les autres. Le christianisme a évolué, l’Islam peut le faire aussi. Ce n’est pas un fait éternel mais il peut y avoir des différences dans le temps. »
Bien entendu, sur certains points il faut être beaucoup plus ferme dans nos principes et à l’égard de certains mouvements salafistes qui n’acceptent pas certaines valeurs fondamentales de notre société.
Michelle Perrot a rappelé l’évolution dans notre société : « Au XVIIème siècle il se produit « une rupture d’évidence ». On pensait que les deux sexes étaient hiérarchisés et inégaux. Descartes dit : « la science n’a pas de sexe ». Ce qui veut dire, homme et femme sont égaux devant la science.
Et les disciples de Descartes produisent des traités sur le thème « De l’égalité des sexes » qui laissent entendre que les deux sexes pourraient bien être égaux. Et commence ainsi un long processus à travers les lumières.
L’occident va ainsi commencé à professer l’égalité des sexes mais c’est un processus très long.
« Très souvent cette prise de conscience s’accompagne de l’idée de la complémentarité. Ils sont égaux mais ils sont complémentaires et différents. De sorte que les hommes doivent toujours faire de la politique, gouverner, diriger. Et les femmes s’occuper de la maison etc.
Il faut encore conquérir l’idée que ce n’est pas la complémentarité mais que c’est l’universalité des individus qui est importante ».
Dans le monde des idées, une deuxième étape sera élaborée par Alexis de Tocqueville notamment dans son ouvrage « De la démocratie en Amérique »
Tocqueville parle de l’égalité des conditions, en fragilisant toutes les relations hiérarchiques de subordination notamment entre les hommes et les femmes.»
Wikipedia l’exprime de la manière suivante :
« Pour Tocqueville, il y a quasi équivalence entre la démocratie (au sens politique) et l’égalité des conditions. Il considère que tous les êtres humains possèdent comme attribut la liberté naturelle, c’est-à-dire la potentialité d’agir librement.»
Michelle Perrot ajoute :
«Puis il y a le XXème siècle qui sera pour les femmes le gain de la contraception qui permet le choix dans la naissance et par conséquence dans la sexualité.
Puis il y a eu cette rupture fondamentale du droit à l’avortement. Il y a eu une sorte de révolution qu’on a appelé l’Habeus corpus des femmes.
Cela est un vrai changement. La conquête de l’espace public par les femmes est très importante.
Le fait de pouvoir sortir seule, le soir, la nuit ce qui est encore considéré comme un danger pour les femmes, c’est quelque chose qui doit cesser, partout ! »
Une partie du chemin a été réalisée dans les pays occidentaux, il reste encore des terrains à conquérir, dans d’autres partie du monde, c’est des pays entiers qui doivent être conquis.
Encore deux points :
Une pensée qui me semble très juste :
Véronique Nahoum-Grappe, déjà cité et qui précise :
«La question de la domination masculine ne repose pas intégralement sur les individus homme et femme, dans leurs trajectoires de vie, dans leurs amours, dans leurs corps.
Des pratiques extrêmement cruelles à l’égard des femmes comme l’excision sont pratiqués par les hommes et les femmes, car la société est mixte à tous les niveaux.
On ne peut pas dire que les femmes soient plus gentilles que les hommes, au niveau éthique il y a des femmes qui sont aussi cinglées, aussi cruelles, aussi perverses [que certains hommes le sont] »
Cette réflexion ouvre vers d’autres perspectives où on doit constater que c’est plus largement le féminin qui a été et reste opprimé dans nos sociétés où ce qui est valorisé est la force, la virilité et les autres attributs que l’on prête au masculin.
Alors que la sensibilité et les attributs féminins sont dévalorisés. « Ne pleure pas, sois un homme ». Voilà une interjection, souvent entendu, et qui illustre cette réflexion. Le chemin que doivent parcourir les hommes, c’est aussi l’acceptation et la valorisation de leur part de féminin.
Ce sera peut-être l’objet d’un mot du jour futur.
Le second point est le témoignage d’Hélène après avoir lu les trois premiers mots du jour de cette semaine :
«Malheureusement je suis bien d’accord avec toi !
Hier j’étais à une soirée d’info professionnelle où était présent le Docteur Foldes le premier chirurgien à avoir proposé une chirurgie de reconstruction pour les femmes victimes de mutilations sexuelles « culturelles »
Avec d’autres personnes engagées il a ouvert un centre près de l’hôpital de Saint Germain en Laye, dans un local prêté par l ‘hôpital. [Ce centre est ouvert à toutes les violences faites aux femmes]
Ils essayent de prendre en charge la personne victime dans sa globalité avec une équipe pluridisciplinaire
En relation directe avec le parquet ils arrivent à avoir des mesures de protections d’urgences qui mettent plusieurs semaines lorsqu’une plainte est déposée en commissariat ! (Et on ne compte pas les plaintes sans suites car reçues par un policier qui n’a pas été formé à cela et qui rédige la plainte de façon irrecevable) […]
C’est le seul centre de ce genre en France ils n’ont aucune aide publique!!
Quand on pense que les violences touchent 1/4 de la population féminine et que la majorité des violences est perpétrée par des personnes proches de la victime et souvent avant sa majorité.
Le coût des violence faites aux femmes est estimé à plus de 4 milliards d’euros par an soit plus que le cancer du sein et ce genre d’institut a besoin d’un kilo de papier pour des subventions de l’ordre de 1000 euros !»
Mise à jour le 12/05/2020 après la constatation que le lien vers le site de cette association était devenu obsolète.
Le nouveau site de ce Centre : https://www.women-safe.org/
Voici la présentation de ce site :
En 2008, Frédérique Martz et le docteur Pierre Foldes font le constat que lorsque les femmes victimes libèrent enfin leur parole, elles déclarent cumuler plusieurs formes de violences (physique, psychologique, sexuelle, économique, rituelle…). Or, celles-ci étaient souvent traitées dans des dispositifs différents, morcelant la prise en charge. Il a fallu imaginer une nouvelle manière d’accompagner les victimes avec une approche globale et pérenne.
En 2014, ils créent ensemble l’association Institut en Santé Génésique, située à Saint-Germain-en-Laye, et s’engagent dans un vrai combat pour les victimes de toutes formes de violences.
En 2017, L’Institut en Santé Génésique devient WOMEN SAFE (Soigner, Accompagner, Femmes et Enfants) association spécialisée en victimologie et psychotraumatologie, et étend son action auprès des enfants victimes ou témoins de violences avec la création du pôle « Mineurs ».
<638>
Jeudi 28 Janvier 2016
Mercredi 27 Janvier 2016
Mardi 26 Janvier 2016
« L’erreur qui consiste à croire dans la supériorité morale des opprimés »
(Titre du chapitre 5 des « Unpopular Essays »(Essais impopulaires ouvrage de 1950)
Lundi 25 Janvier 2016
Vendredi 22 Janvier 2016
Jeudi 21 Janvier 2016
|
|
Nous sommes à mille lieux des effets spéciaux de la guerre des étoiles et autre machines à faire du fric de la plus grande part du cinéma américain. Je suis injuste, les américains ce sont aussi les frères Coen, Tim Burton ou Woody Allen.
Mais le cinéma il n’est pas nécessaire de trop en parler, il est plus pertinent de le regarder par exemple « Une journée particulière » ou « La Terrasse » ou encore « La Nuit de Varennes » tous réalisés par Ettore Scola qui fut aussi le scénariste du « Fanfaron » de Dino Risi encore une fois avec Vittorio Gassman.
« Nous nous sommes tant aimés » et aussi peut être l’histoire entre beaucoup de gens de ma génération et le cinéma italien dont Ettore Scola fut un des Grands.
|
Mercredi 20 Janvier 2016
Les soldes !
 Les soldes d’hiver 2016 ont été lancées le 6 janvier dernier.
Les soldes d’hiver 2016 ont été lancées le 6 janvier dernier.
Et on voit des grappes de personnes s’agglutiner dans des magasins, surtout des magasins de vêtements et être entraînées dans une fièvre consommatrice compulsive.
Mais qu’est-ce qui pousse tous ces gens à acheter, à consommer bien au-delà de leurs besoins ?
Le nouvel Obs a invité un docteur en sociologie politique et psychosociologue : Thierry Brugvin pour s’exprimer sur ce sujet.
Thierry Brugvin a dirigé l’ouvrage « Être humain en système capitaliste ? Psychosociologie du néolibéralisme » paru en septembre 2015.
Il prend appui sur ce concept de « consommation ostentatoire » de Thorstein Veblen
Wikipedia nous apprend que : Le concept de consommation ostentatoire est la traduction française de l’expression anglaise « Conspicuous consumption », forgée par le sociologue et économiste américain Thorstein Veblen et exposée pour la première fois en 1899 dans son ouvrage « Théorie de la classe de loisir. » Dans cette étude des classes supérieures, de la très haute bourgeoisie aux USA, Veblen note que celle-ci gaspille temps et biens. Lorsqu’elle favorise dans la vie le loisirs, elle gaspille du temps, et lorsqu’elle consomme de manière ostentatoire, elle gaspille des biens.
La consommation est statutaire, elle sert à celui qui en fait un « usage ostentatoire » à indiquer un statut social.
Thierry Brugvin explique :
« Le besoin de consommer et de posséder compense la peur de ne pas être reconnu et d’être faible. Le marketing capitaliste vise à inciter à la consommation infinie et repose sur plusieurs besoins et peurs de nature psychologique. Le sociologue Thorstein Veblen qualifie de « consommation ostentatoire », c’est-à-dire l’acte de consommer pour se sentir exister par le regard des autres, qu’on imagine envieux et admiratif.[…]
Le besoin de possession et d’accumulation est quasiment illimité chez certains milliardaires, qui accumulent plus qu’ils ne pourront jamais consommer ou dépenser. Car, le ressort profond de leurs besoins réside sur un besoin de puissance. Le niveau de leur consommation devient un indicateur de réussite.
L’autre aspect du besoin névrotique de possession consiste à se sécuriser, face à la peur de manquer au plan affectif et matériel. La sécurité matérielle relève des besoins essentiels physiologiques (de se nourrir et de se loger), mais aussi de posséder des technologies puissantes et multiples. Ces dernières visent à être en capacité de faire face à tous les besoins et problèmes éventuels, grâce à des instruments, à la technologie (automobile, ordinateur, outillage), mais aussi le besoin névrotique de connaissance. […]
Le besoin de consommer relève aussi d’un besoin de possession affectif et non pas seulement matériel. Le fait de consommer (de la nourriture, des vêtements, des voyages, de la culture…) s’avère nécessaire à la vie et à l’épanouissement de l’être humain. Mais à l’excès, cela manifeste le besoin de compenser une carence affective. Il s’agit à nouveau de la peur de ne pas être aimée suffisamment.
Plus le consommateur se nourrit, plus il se donne de l’amour par ce qu’il ingurgite, plus il compense alors sa peur de ne pas être aimé. C’est un comportement analogue aux boulimiques, mais eux à un degré extrême. […]
Le besoin de consommer s’alimente de la peur de manquer et de ne pas être reconnu. […] »
Et il finit par cette réflexion toute empreinte de simplicité épicurienne :
« Le détachement et l’acceptation vis-à-vis de ces peurs névrotiques permettent aux individus de retrouver une sécurité psychologique intérieure et finalement de se recréer de vraies valeurs, telles celles d’être heureux dans et par la sobriété. »
J’entends de façon prémonitoire des réactions offusquées.
Que cette réflexion psychologique puisse s’appliquer aux milliardaires qui accumulent des biens et des finances qui dépassent de très loin leur capacité d’utilisation et de jouissance peut être entendu.
Mais rapprocher cette réflexion des soldes n’est pas sérieux !
Du point de vue de la micro-économie, il s’agit d’une attitude pertinente pour le client d’attendre les meilleurs prix pour acheter et parallèlement les commerçants ont besoin de ces périodes pour leur chiffre d’affaire.
Du point de vue de la macro économie, il faut bien penser à la croissance du PIB et un emballement de la consommation ne peut qu’être bénéfique pour ce carburant nécessaire à l’emploi et aux performances économiques.
Certes ! Le mot du jour n’a aucune vocation de prêcher une morale mais simplement poser des questions auquel il appartient à chacun, s’il le souhaite, de répondre pour sa part.
<631>
Mardi 19 janvier 2016
Lundi 18 janvier 2016
mais je garderai ma dignité car c’est mieux que de vivre humiliée»
Elle s’appelait Ruqia Hassan, elle avait 30 ans et était connue pour son franc parler contre les djihadistes de Raqqa.
Depuis la fin de l’été, elle est la cinquième journaliste syrienne (connue à ce jour) tuée par l’organisation extrémiste dont elle dénonçait quotidiennement les exactions – et selon certains, probablement la première femme reporter assassinée par Daech.
D’après les témoignages émanant des réseaux sociaux, la jeune rebelle était une kurde syrienne de Raqqa, diplômée de philosophie à l’Université d’Alep. Quand l’organisation de État islamique imposa sa loi à Raqqa, en 2014, cette révolutionnaire anti-Assad de la première heure avait refusé de quitter sa ville.
Sous le pseudonyme de « Nissan Ibrahim », elle avait alors fait le courageux choix de raconter, notamment via Twitter et Facebook, le quotidien des habitants sous Daech. Sa mort remonte vraisemblablement à septembre, mais la nouvelle de son assassinat n’a commencé à circuler que ce week-end [du 3 janvier 2016].
Selon plusieurs media de l’opposition syrienne en langue arabe, l’EI aurait informé, en fin de semaine dernière, sa famille de son exécution pour « espionnage ».
« Même si la date exacte de sa mort demeure méconnue, l’activité de Hassan sur les réseaux sociaux s’est brutalement interrompue le 21 juillet 2015. Entre juillet et décembre, Hassan a disparu de la ville de Raqqa. »,
[…] Sous son compte Twitter, Abu Mohammed – un internaute connu pour être le fondateur du groupe « Raqqa est égorgée en silence » – a reproduit les derniers écrits que la jeune femme avait publiés sur Facebook :
«Là, je suis à Raqqa. J’ai reçu des menaces de mort. Et quand Daech va m’arrêter et me tuer, c’est OK parce qu’ils vont me décapiter, mais je garderai ma dignité car c’est mieux que de vivre humiliée par l’EI».
C’est le journal « Le Figaro » qui raconte cette histoire : <Ruqia Hassan une journaliste exécutée par l’état islamique>
Cette information vous a peut-être échappé.
Il est vrai qu’elle était en compétition avec la commémoration des attentats de Charlie et surtout de deux autres informations d’une grande importance : Michel Platini a renoncé à se présenter à la tête de la FIFA et Zinedine Zidane a été nommé entraîneur du Real de Madrid.
Mais cette information me conduit surtout à deux réflexions
La première est qu’aujourd’hui dans notre société, il apparait que la valeur suprême est la vie, la mort apparait comme un scandale. Même quand un militaire, dont la mort semble être un risque du métier, meurt, toute la nation est figée et en compassion devant ce fait inacceptable !
Un courant de pensée occidentale, « le transhumanisme » soutenu par Google et d’autres géants du Web tente même de mettre fin à la mort.
Il n’en a pas toujours été ainsi dans notre civilisation.
 Et cette manière de penser n’est pas généralisée sur la planète. Aujourd’hui des fous de Dieu, pour réaliser les noirs desseins de leurs gourous, sacrifient leurs vies dans des attentats meurtriers. Mais, il existe aussi d’autres femmes et hommes, parce qu’ils croient en des valeurs supérieures qui acceptent de risquer leur vie et de la sacrifier. « Plutôt mourir que vivre humiliée ».
Et cette manière de penser n’est pas généralisée sur la planète. Aujourd’hui des fous de Dieu, pour réaliser les noirs desseins de leurs gourous, sacrifient leurs vies dans des attentats meurtriers. Mais, il existe aussi d’autres femmes et hommes, parce qu’ils croient en des valeurs supérieures qui acceptent de risquer leur vie et de la sacrifier. « Plutôt mourir que vivre humiliée ».
Tel était le cas de Ruqia Hassan qui voulait informer le Monde de ce qui se passe dans la capitale du califat auto-proclamé.
La vie était certainement importante à ces yeux, mais elle n’était pas la valeur suprême.
Ils existaient des valeurs qui méritaient qu’on meure pour elles.
La seconde est celle de comparer la vie et les actes de cette femme avec ceux de ces jeunes filles qui vivent dans le même pays que nous et qui font exactement la démarche inverse.
L’express nous apprend qu’«un djihadiste français sur trois, sur le sol syrien ou irakien, est une femme. En effet, sur les 600 Français partis grossir les rangs de l’organisation Etat Islamique, les services de renseignements tricolores recensaient 220 femmes en décembre 2015, contre 164 en septembre 2015. Leur part est passée de 10% du contingent français en 2013 à 35% fin 2015, toujours selon France Info. La part de femmes converties à l’islam parmi elles est aussi plus importante que celle des hommes convertis (un tiers contre un sixième). »
Bien sûr tout n’est pas parfait dans notre pays, mais on y vit libre, surtout si on compare à Raqqa, on est soigné presque gratuitement quand on est malade, on peut dire à peu près ce que l’on veut, on peut danser, chanter, boire de l’alcool ou ne pas boire et tant de choses…
Et ces filles choisissent l’asservissement, le rôle d’épouse soumise et reproductrice de mâles violents et psycho-rigides.
Le plus simple et probablement le plus rassurant est de dire qu’elles sont folles et déséquilibrées.
Comme il est rassurant, dans nos réflexions, de considérer que le jeune adolescent de religion musulmane qui a attaqué et voulu tuer un autre homme qui portait la kippa est un fou, un déséquilibré.
J’ai peur que ces explications simples et « occidentalement convenable » ne suffisent pas à analyser ces actes qui directement ou indirectement constituent des actes de sauvagerie et de destruction.
Il existe bien des dogmes et des doctrines qui sont suffisamment attirantes aux yeux de ces jeunes pour les pousser à emprunter les chemins de la violence et du chaos.
Le nom et le destin de Ruqia Hassan sont très présents sur le Web. Voici quelques-uns des sites qui parlent de ce sujet :
http://www.huffingtonpost.fr/2016/01/07/ruqia-hassan-femme-journaliste-execute-daech
http://journaldesgrandesecoles.com/la-jeune-journaliste-syrienne-ruqia-hassan-executee-par-daesh/
http://femmesdumaroc.com/actualite/daech-execute-la-journaliste-syrienne-ruqia-hassan-25411
http://www.humanite.fr/une-journaliste-kurde-assassinee-par-daech-594936
Pour finir ce mot du jour, je fais appel à Camus et à cet extrait de l’homme révolté :
« La mesure n’est pas le contraire de la révolte. C’est la révolte qui est la mesure, qui l’ordonne, la défend et la recrée à travers l’histoire et ses désordres. L’origine même de cette valeur nous garantit qu’elle ne peut être que déchirée. La mesure, née de la révolte, ne peut se vivre que par la révolte. Elle est un conflit constant, perpétuellement suscité et maîtrisé par l’intelligence. Elle ne triomphe ni de l’impossible ni de l’abîme. Elle s’équilibre à eux. Quoi que nous fassions, la démesure gardera toujours sa place dans le cœur de l’homme, à l’endroit de la solitude. Nous portons tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos ravages. Mais notre tâche n’est pas de les déchaîner à travers le monde ; elle est de les combattre en nous-même et dans les autres.»
Vous trouverez cette réflexion ainsi que bien d’autres sur cette magnifique page de France Culture où cette radio a fait appel à ses formidables archives pour laisser parler des hommes de réflexion et de sagesse -Castoriadis, Camus, Krishnamurti, Michaud et Baudrillard – :
Nous portons tous en nous nos crimes et nos ravages. Mais notre tâche n’est pas de les déchaîner à travers le monde ; elle est de les combattre en nous-même et dans les autres.
<629>
Vendredi 15 Janvier 2016
Pierre Boulez est mort le 5 janvier 2016.
 Ce début d’année a été marqué par beaucoup de décès d’artistes célèbres. Cette accumulation a même eu pour conséquence que le compte twitter du président de la république est devenu un journal d’avis de décès, à force d’hommages.
Ce début d’année a été marqué par beaucoup de décès d’artistes célèbres. Cette accumulation a même eu pour conséquence que le compte twitter du président de la république est devenu un journal d’avis de décès, à force d’hommages.
Pour ma part, je ne saurai avoir un avis, un minimum original, que sur Pierre Boulez.
Pour moi, c’est d’abord un souvenir de 1987, je venais d’arriver à Paris pour travailler au Ministère des Finances.
Je m’étais abonné aux concerts de l’Orchestre de Paris, salle Pleyel.
A mon premier concert, Daniel Barenboim dirigeait l’orchestre. J’étais loin d’être convaincu, je ne trouvais pas l’orchestre très bon, ni d’ailleurs l’acoustique de Pleyel.
Et puis, moins d’une semaine plus tard, le même orchestre, la même salle et Boulez qui dirigeait Petrouchka de Stravinsky.
Je me souviens d’être allé à ce concert très fatigué et ma crainte de m’endormir. Dès les premières mesures j’ai été subjugué, un orchestre fabuleux, précis, dont le son remplissait la salle. Une expérience unique.
Mon frère qui avait joué sous sa direction à l’Opéra de Paris, m’avait confié que l’Orchestre de l’Opéra avait répété et joué le sacre du printemps de Stravinski avec lui. Expérience remarquable, mais c’est surtout la suite qui est intéressante :
« Lorsque nous jouions, par la suite, le sacre avec un autre chef, il n’arrivait pas à nous faire jouer le sacre autrement que de la façon avec laquelle Boulez nous avait appris à l’interpréter. »
C’est justement par l’interprétation du Sacre du Printemps de Stravinsky que Pierre Boulez fut découvert par le Tout-Paris mélomane. C’est à lui qu’il fut demandé, le 18 juin 1963, de diriger cette œuvre au Théâtre des Champs Elysées avec l’Orchestre National de l’ORTF.
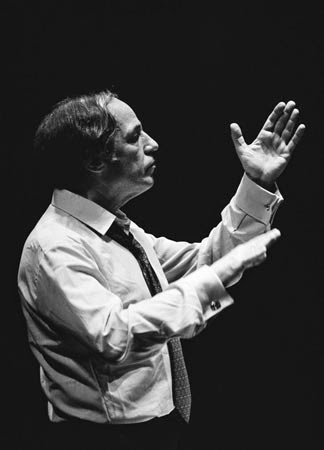 Le critique musical du Monde Jacques Lonchampt écrivit alors cet article dithyrambique : <Un grand chef d’orchestre : Pierre Boulez >
Le critique musical du Monde Jacques Lonchampt écrivit alors cet article dithyrambique : <Un grand chef d’orchestre : Pierre Boulez >
« Quel beau spectacle nous a donné Boulez ! Très droit, ramassé sur lui-même, toujours prêt à bondir mais dompté, la tête vigoureuse un peu écrasée sur l’encolure, il dirige sans baguette avec des gestes d’une pureté vraiment lumineuse, non pas en pétrisseur de glaise, mais avec une sorte de perfection, comme un vol d’oiseau dans ses vastes mouvements planants ou ses plus fines arabesques. Les doigts sont expressifs comme dans une étude de Durer ou de Léonard, et tantôt s’écartent en dégradé, le pouce et l’index se touchant en forme d’anneau, tantôt se rassemblant, la main très droite, coupante à la verticale, ou bien à l’horizontale pacifiante et protectrice.
En tout cela, pas l’ombre de contorsion, de cabotinage ou de recherche de l’effet ; c’est la beauté ferme du geste parfaitement harmonisé à sa fonction. La magie de l’art de Boulez est une poésie de l’exactitude, informée par une science extrême et une extrême sensibilité, où la subtilité et la force de la polyrythmie, les progressions et les ruptures dynamiques, et au suprême degré l’équilibre et le mélange des timbres, se recomposent comme par miracle dans une vision tantôt apollinienne, tantôt dionysiaque, et toujours vivante. »
Tel était Pierre Boulez un homme avec une autorité et une personnalité hors norme.
Un extraordinaire interprète de Stravinsky, de Bartok, de la nouvelle école de Vienne, de Debussy, de Ravel et aussi de Wagner et de Mahler.
Mais comme Gustav Mahler, ce n’est pas cet aspect de son art qui lui était le plus cher.
Lui se vivait, avant tout, comme compositeur, un compositeur à la pointe de la modernité. L’exergue du mot du jour est cité par <Par le site de France Culture>
Il était né à Monbrison à 40 km de Saint Etienne et à 100 km de Lyon.
Il était entré en mathématiques supérieures aux Lazaristes de Lyon, mais avait rapidement quitté cette voie pour aller apprendre la musique à Paris. Et dans la musique qu’il a défendu et créé, les mathématiques n’étaient jamais très loin.
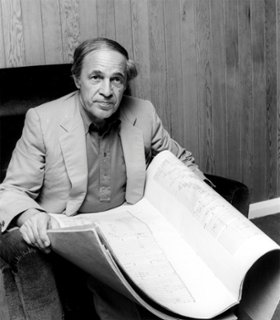 Il a été dans un courant musical dont il est devenu le chef de file. Pour ces compositeurs, les mathématiques, l’intellect, les expériences sonores étaient premiers.
Il a été dans un courant musical dont il est devenu le chef de file. Pour ces compositeurs, les mathématiques, l’intellect, les expériences sonores étaient premiers.
Et ces gens-là, dont Boulez considéraient que tous ceux qui n’étaient pas dans cette réflexion et dans cette recherche étaient dans l’erreur.
Ainsi Boulez n’a jamais interprété ni dit des choses positives sur les deux compositeurs que je considère comme les plus grands du XXème siècle à savoir Benjamin Britten et Dimitri Chostakovitch.
Par exemple en 1989, Pierre Boulez déclarait (dans des propos recueillis par la revue Diapason) :
« Quant à Chostakovitch, l’ombre de Mahler pèse lourdement sur lui, ce qui n’arrange rien. Je ne pense pas du tout qu’il y ait actuellement nécessité d’un retour vers la tonalité. Faire du pseudo-Mahler, est-ce bien nécessaire ? Ce qui est fait et bien fait, pourquoi le refaire dans l’inactualité et l’amoindrissement ? ».
Et même la musique de son maître Messiaen ne trouvait pas grâce à ses oreilles, il a traité sa Turangalîla–Symphonie (1946-1948) de « musique de bordel ».
Messiaen qui était un homme plus bienveillant a dit de lui :
« Lorsqu’il entra dans la classe pour la première fois, il était très gentil. Mais il devint bientôt en colère contre le monde entier. »
Il détestait aussi le compositeur André Jolivet, <Jacques Drillon rapporte> que son ire débordait même sur la femme de ce compositeur à qui il a dit :
« Madame, avec un chapeau comme le vôtre, on ne parle pas, on pète. »
Le même Drillon raconte aussi son humour : ainsi le percussionniste de son ensemble, arrivé en retard à la répétition parce qu’il ne s’était pas réveillé, donne son premier coup de timbale, et crève la peau de l’instrument. Boulez :
« Si je comprends bien, toi, tu n’as pas le sommeil réparateur ! »
Il avait synthétisé son attitude en affirmant : «préférer une bonne polémique avec les épées et les sabres qu’une espèce de politesse de convenance»
C’était ainsi un polémiste qui pouvait traiter les autres avec un souverain mépris, ce qui lui a créé bien des inimitiés.
André Malraux a nommé directeur de la musique Marcel Landowski, alors que Pierre Boulez considérait que ce poste lui revenait de droit.
Mais il ne faut pas s’arrêter à cet aspect de sa personnalité qui je pense s’était beaucoup adouci avec l’âge qui n’est pas toujours un naufrage.
C’était aussi un homme très intelligent, d’une très grande culture, un pédagogue et un bâtisseur.
 Il a créé l’IRCAM, l’ensemble intercontemporain et c’est grâce à son impulsion que la cité de la musique et il y a peu de temps la Philharmonie de Paris ont été bâtis.
Il a créé l’IRCAM, l’ensemble intercontemporain et c’est grâce à son impulsion que la cité de la musique et il y a peu de temps la Philharmonie de Paris ont été bâtis.
Selon de nombreux témoignages, il savait être très bienveillant et disponible pour tous ceux qui acceptaient d’entrer dans son monde.
C’était aussi un perfectionniste qui plutôt que de multiplier les œuvres, revenait sans cesse sur celle qu’il avait déjà écrite pour les modifier et les approfondir.
Comme j’étais en congé, j’ai écouté la musique de Boulez, je n’en avais jamais écouté autant.
Et finalement on peut y trouver du plaisir.
J’ai particulièrement aimé une œuvre assez courte (8mn) pour 7 violoncelles « Messagesquisse » dont vous trouverez une interprétation étonnante <ICI>.
Au premier rang se trouve la lumineuse flûtiste Emmanuelle Ophèle qui fut notre voisine lorsque nous habitions Montreuil sous-bois. Alors que je lui concédais mon peu de goût pour la musique de Boulez et de ses épigones, elle me répétait ce conseil :
« Alain, il faut que tu viennes nous écouter en live, l’expérience est alors complètement différente ».
Je n’ai pas suivi ce conseil, aujourd’hui je le regrette.
Quoi qu’il en soit Pierre Boulez restera un musicien et une référence incontournable de la musique même si la voie qu’il a creusée a peut-être mené vers une impasse.
<628>
Jeudi 14 Janvier 2016
Mercredi 13 Janvier 2016
Mardi 12 Janvier 2016
Je vous convie aujourd’hui à une réflexion sur la relativité. Réflexion qui n’a rien à voir avec la théorie d’Einstein sur l’espace et le temps.
Quoique …
Si nous revenons à cette question qui occupe tellement l’espace public ces derniers temps : la religion et que nous posons de manière rationnelle la question pourquoi un être humain a-t-il une telle religion ?
Du point de vue scientifique et donc statistique, l’explication quasi unique est : Parce qu’il est né dans une famille qui avait cette religion et plus largement dans un pays qui est majoritairement de cette religion. Les conversions existent mais sont, à l’aune de cette première réflexion, très marginales.
Je pense que cette prise de conscience ne peut qu’avoir une grande influence sur notre analyse de la croyance religieuse.
Mais ce n’est pas de cela que je souhaite parler aujourd’hui.
Quoique …
Bonne année, c’est le premier jour de la nouvelle année. Qui dit année, dit calendrier. Souvent le calendrier est lié à une religion.
Et nous sommes à nouveau plongés dans la relativité.
Notre bonne année est la bonne année de l’ère et du calendrier chrétien. Plus précisément le calendrier grégorien [du pape Grégoire XIII] qui a complété et modifié en 1582 le calendrier Julien créé sous Jules César.
La tentative des révolutionnaires français à modifier cette institution chrétienne a échoué.
Pour les chinois, les coréens et les vietnamiens, c’est-à-dire 1/5 de l’humanité, la bonne année se souhaitera le 8 février qui correspond au premier jour de leur calendrier.
Pour une beaucoup plus petite communauté, les sikhs, ce sera le 14 mars.
Et le 20 mars ce seront les iraniens et les kurdes qui souhaiteront la bonne année avec Norouz.
Le 15 avril ce sera le tour des thaïlandais, des birmans, des sri lankais et d’une partie des indiens.
Le Nouvel an juif, ce sera du deux au quatre octobre, à peu près en même temps que le nouvel an musulman, du premier au trois octobre.
Enfin, le trente octobre, ce sera Diwali, la fête des lumières, pour plus d’un milliard d’Indiens.
Je serai, comme toujours, franc avec vous, je n’ai pas vérifié l’exactitude de toutes ces dates, j’ai fait confiance à Anthony Bellanger sur France Inter qui a donné cette énumération.
Mais ce qui m’intéresse ainsi est la prise de conscience que ce que je pensais universelle, la bonne année pour tous les terriens, comme l’exprime souvent nos chaines de télévision notamment en annonçant le matin du 31 décembre en France, « C’est déjà la nouvelle année en Nouvelle-Zélande » avec ce postulat que tous les terriens vont passer, en suivant les méridiens, dans un même référentiel, à la nouvelle année, unique et universelle.
Ainsi, si je vous souhaite une bonne année, c’est une bonne année du calendrier chrétien.
Et encore pas de tous les chrétiens, car certains chrétiens orthodoxes ont conservé le calendrier julien.
Et si on souhaite aller encore plus loin dans l’érudition on constatera que le premier janvier n’a pas toujours été le premier jour de l’année en France et qu’il existait même des jours différenciés selon les provinces : à Lyon, c’était le 25 décembre, à Vienne [France], le 25 mars.
Et c’est l’édit de Roussillon de 1564 de Charles IX [le roi de la Sainte Barthélémy] qui harmonisa les pratiques et fixa le nouvel an au premier janvier.
En conclusion, dans un monde de relativité je vous souhaite une bonne année selon le calendrier actuel du plus grand nombre des chrétiens.
<625>
Lundi 11 Janvier 2016
La nouvelle année c’est le moment de fermer la porte à l’ancien et de penser à demain.
Alors je voudrais partager avec vous «Demain» qui est un film documentaire que je suis allé voir lors de mon abstinence épistolaire.
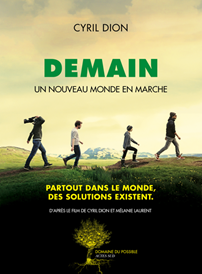 Beaucoup d’informations et de constats nous conduisent à nous inquiéter pour le demain que nous aurons à vivre ou que nous laisserons à nos enfants. Mais le film «Demain» apporte beaucoup d’optimisme. C’est un demain positif car Cyril Dion, Mélanie Laurent et quelques amis sont allés chercher dans le monde et même en France des expériences qui existent déjà et qui constituent une part de la solution aux défis que nous avons à affronter : diminuer notre empreinte carbone et notre dépendance aux énergies fossiles; être en mesure de nourrir de plus en plus d’habitants sur la planète bleue, surmonter l’impasse économique dans laquelle nous nous enfonçons et où la richesse produite est accaparée par une caste de plus en plus étroite.
Beaucoup d’informations et de constats nous conduisent à nous inquiéter pour le demain que nous aurons à vivre ou que nous laisserons à nos enfants. Mais le film «Demain» apporte beaucoup d’optimisme. C’est un demain positif car Cyril Dion, Mélanie Laurent et quelques amis sont allés chercher dans le monde et même en France des expériences qui existent déjà et qui constituent une part de la solution aux défis que nous avons à affronter : diminuer notre empreinte carbone et notre dépendance aux énergies fossiles; être en mesure de nourrir de plus en plus d’habitants sur la planète bleue, surmonter l’impasse économique dans laquelle nous nous enfonçons et où la richesse produite est accaparée par une caste de plus en plus étroite.
Le film s’ouvre sur les conclusions d’une étude de la NASA publiée dans la revue Nature et annonçant un effondrement probable de notre civilisation dans les 40 années à venir. Les savants de Stanford qui ont piloté cette étude sont d’ailleurs interviewés au début du film.
Le film est ensuite divisé en 5 chapitres qui abordent les défis, les dysfonctionnements actuels et les pistes d’ores et déjà trouvées :
Le chapitre 1 concerne l’alimentation et tend à démontrer qu’il est possible de produire plus de nourriture, sans engrais ni pesticides, avec peu de mécanisation et en réparant la nature plutôt qu’en la détruisant. Nous voyons comment nos villes peuvent réintégrer l’agriculture et nos campagnes se repeupler. On voit ainsi l’expérience de la ville de Détroit qui est passée de 2000 000 d’habitants à 700 000 habitants lors de la crise de l’industrie automobile et où, dans un premier temps pour survivre, les habitants qui sont restés ont développé le concept de l’agriculture dans la ville. Cette expérience a débouché sur une nouvelle manière de vivre la ville et son approvisionnement avec 1600 fermes urbaines. Le film présente aussi des expériences en Angleterre en particulier la ville de Todmorden près de Manchester (14 000 ha) dont les habitants sont en train de reconstruire leur autonomie alimentaire (objectif 2018).
Le chapitre 2 traite de la transition énergétique. Ainsi des villes et même des pays s’organisent pour se passer totalement de pétrole, de charbon et d’énergie nucléaire. Ainsi le film montre Copenhague qui vise à n’émettre plus aucun CO2 en 2025 et qui a construit un modèle d’urbanisme où 50% des habitants de la ville se déplacent en vélo et où ils habitent à moins de trois cent mètre d’un espace vert. En 2010, elle arrivait en première place des villes les plus résistantes au changement climatique, dans l’étude du chercheur américain, Boyd Cohen. À l’horizon 2025, 75% des tous les déplacements devront être effectués, à pied, en vélo, ou en transports publics.
Le chapitre 3 aborde la question de l’économie et nous apprenons l’existence de monnaies locales (complémentaires aux monnaies classiques) qui ont pour effet d’améliorer la circulation locale de l’argent et donc les circuits courts et l’économie locale. C’est d’abord, à ma grande surprise, La Suisse qui possède l’un des exemples les plus solides de monnaies complémentaires dans le monde et qui s’appelle WIR. Créé en 1934 par 16 entrepreneurs subissant de plein fouet la crise de 1929 et la frilosité des banques, elle propose un système de crédit mutuel, permettant aux entreprises de continuer à fonctionner même lorsque les crises paralysent le système bancaire et de réaliser leurs investissement à bien plus faible coût.
Aujourd’hui, 70 ans plus tard, elle est utilisée par une PME suisse sur cinq (75.000 membres). Une étude américaine qui a porté sur une quinzaine d’années démontre que cette monnaie contribue à la solidité de l’économie nationale. En effet, en cas de crise monétaire, les entreprises échangent davantage de WIR, échappant ainsi au phénomène d’assèchement du crédit. En revanche, quand l’économie va bien, les entreprises ont moins tendance à utiliser le WIR, et utilisent davantage le Franc Suisse. Le WIR montre donc, chiffres à l’appui, qu’une monnaie complémentaire peut non seulement se développer à grande échelle, mais que l’existence d’un véritable écosystème monétaire permettrait de mieux faire face aux aléas économiques et financiers. Mais de telles monnaies existent aussi aux Etats Unis et en Angleterre. Cette vision est complétée par les pratiques de l’économie circulaire : créer des chaînes de production sans déchets où le recyclage des matières est quasiment infini et où les déchets des uns deviennent les ressources des autres.
Le chapitre 4 donne des exemples d’éducation et d’enseignement innovants qui apprennent aux enfants à coopérer, à résoudre pacifiquement leurs conflits, à vivre harmonieusement avec eux-mêmes, les autres et la nature, à réapprendre des savoir-faire indispensables. C’est cette fois la Finlande qui démontre son excellence dans ce domaine.
Le chapitre 5 enfin parle du réenchantement de la démocratie par des initiatives qui impliquent vraiment les gens.
Je ne peux que vous inciter à aller voir ce beau film plein d’espoir et de pistes que chacun peut compléter par ses idées créatrices.
Gandhi disait :
« Soyez-vous même le changement que vous voudriez voir dans le monde »
En attendant il y a le site de crowfunding, c’est à dire de financement participatif qui a assuré une partie du budget du film qui présent cette belle réalisation et dont j’ai tiré une partie des précisions que je vous ai donné dans ce message : http://www.kisskissbankbank.com/demain-le-film
Et puis il y a le site spécifique au film qui est très riche d’enseignements : http://www.demain-lefilm.com/le-film
<Et ici la bande d’annonce du film>
<624>
Mercredi 23 décembre 2015
Je n’en finirai pas d’écrire ta chanson
Ma France »
Mardi 22 décembre 2015
Lundi 21 décembre 2015
Après des élections régionales qui ont montré, une fois de plus, la défiance du peuple des citoyens à l’égard des gouvernants politiques, ceux d’aujourd’hui et d’hier, une rencontre opportune entre deux hommes s’est déroulée dans le nord à Neuville-Saint-Vaast
Le premier est un Président de la république, dont la carrière s’est située à gauche et qui aspirait à une présidence normale mais qui n’arrive à émerger de la médiocrité que lorsque des évènements «anormaux» surgissent ;
Le second est un homme de droite mais qui n’a pu être élu que parce que des électeurs de gauche ont voté pour lui.
Je ne m’arrêterai pas sur cette rencontre pour répondre à des questions du type : s’agit-il d’une amorce d’une autre manière d’organiser l’échiquier politique ?
Ou encore est-ce une manœuvre politicienne ?
Je m’arrêterai à ce qui était peut-être secondaire dans l’esprit de ces deux hommes, mais qui révèle une aspiration humaniste d’une tout autre profondeur. C’est mon ami et complice Albert qui m’a fait, à l’occasion de cette commémoration, cette injonction :
«Alain, il faut faire un mot du jour sur les fraternisations de Noël 1914 »
Le sujet du mot du jour était donc décidé. Mais comment trouver l’exergue(*) introductive ?
Il y avait bien cette citation attribuée à Paul Valéry :
« La guerre, c’est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas ».
Mais elle avait déjà servi de mot du jour le 28/07/2014.
J’ai trouvé ce propos attribué à Confucius :
«Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l’éducation. » Livre des sentences – VIe s. av. J.-C.
Mais je me suis finalement arrêté sur une phrase d’Albert Cohen, l’auteur de « Belle de Seigneur» :
«Frères humains et futurs cadavres, ayez pitié les uns des autres. »
Le propos de ce livre ne concerne pas la 1ère guerre mondiale, mais la haine entre les gens, ce qui devait aussi être le ferment de la guerre 14-18. Le livre d’Albert Cohen est autobiographique. L’année 1905, il a 10 ans, et l’épisode se passe en France. Il est l’enfant d’une famille juive et il est insouciant comme un enfant de 10 ans.
En revenant du lycée il est attiré par un camelot qui vante la marchandise qu’il vend, un détachant pour habit, et il a beaucoup de succès. Le petit Albert a quelques sous et il veut acheter ce produit pour l’offrir à sa maman. Il s’approche alors du camelot qui l’aperçoit et qui change d’attitude et pointe l’index sur lui en disant : « Toi tu es un youpin, hein ? […] je vois ça à ta gueule, tu ne manges pas du cochon hein ? Vu que les cochons se mangent pas entre eux » et il continue à déverser, sur ce jeune enfant, des torrents de haine.
L’enfant fuit, la foule rit et le livre va narrer l’errance de cet enfant et toutes les pensées qui se bousculent dans la tête de l’innocent qui s’est heurté à la haine incommensurable.
Et puis au bout de l’errance, il y a le dernier chapitre qui commence par ces mots :
«Frères humains et futurs cadavres, ayez pitié les uns des autres. »
La guerre 14-18 est aussi celle de la haine, de la haine qu’on a essayé d’inculquer dans l’esprit des jeunes français à l’égard des allemands qu’ils appelaient systématiquement « les sales boches » et la haine qu’on inculquait dans le cœur et l’esprit des jeunes allemands à l’égard des français.
A Noël 1914, la guerre que chacun des camps avait pensé courte, durait déjà 5 mois, <Déjà plus de 300 000 morts français> et probablement autant du côté allemand.
Ils se massacrent et ne se connaissent pas et puis… il y a Noël.
Des deux côtés on est chrétien et on connaît les mêmes airs, les mêmes chants de Noël même si la langue est différente.
Et ils sortent des tranchées et se rencontrent et s’échangent de petits cadeaux.
Christian Carrion en a fait un film : « Joyeux Noël » en 2005 et ce fut une surprise, car nos manuels d’Histoire nous avait caché ces moments de fraternité, on nous avait parlé de la haine, de l’enthousiasme des soldats pour partir à la guerre contre l’ennemi.
On nous avait parlé aussi des souffrances de la guerre et de la terrible vie dans les tranchées.
Mais qu’il y eut des moments et des lieux de la guerre où les soldats ont laissé tomber les armes pour se parler et se comporter en frères humains, de cela on ne nous avait pas parlé.
Christian Carrion raconte dans un article du Monde :
« En 1992, j’ai découvert les fraternisations de Noël 1914, dans le livre d’Yves Buffetaut, Batailles de Flandres et d’Artois (Tallandier, 1992). J’apprends que des soldats français ont applaudi un ténor bavarois le soir de Noël, que d’autres ont joué au football avec les Allemands le lendemain, qu’il y a eu des enterrements en commun dans le no man’s land, des messes en latin. »
Les «ennemis », en effet, organisèrent même un match de football de Noël 1914 à Comines-Warneton.
Bien sûr, l’état-major, des deux côtés, n’a pas du tout apprécié ces épisodes de fraternisation, la haine est indispensable si on veut que des jeunes gens s’entretuent. On envoya ces cœurs attendris vers d’autres fronts où la destinée de futurs cadavres leur était promise rapidement.
Après la fin de la guerre, ces évènements furent enfouis sous le secret. Ce n’est plus le cas depuis le film Ici vous verrez un court extrait du film «Joyeux Noël» de Christian Carrion et notamment le moment de la fraternisation
On trouve aussi des sites consacrés aux témoignages des soldats qui parlent de ces évènements.
Ici vous pourrez entendre une émission de <2000 ans d’Histoire> qui évoque ces moments où l’humanité l’a emporté, pendant un court moment, sur la sauvagerie
Des gens du Nord soutenus par les participants au film « Joyeux Noël » ont créé un site et une association pour financer le monument qui vient d’être inauguré. Christian Carrion raconte que dans les nombreux témoignages qu’il a lu pour faire son film, un témoignage l’a particulièrement ému.
C’est celui du soldat français Louis Barthas qui a vécu ces évènements, les a raconté dans une lettre qu’il a fini par cette phrase :
«Qui sait ! Peut-être un jour dans ce coin d’Artois, on élèvera un monument pour commémorer cet élan de fraternité entre des hommes qui avaient horreur de la guerre et qu’on obligeait à s’entretuer malgré leur volonté ».
Et pour finir, je ne vous montrerai pas la poignée de main des deux hommes politiques, fugacement évoqué en début de message, mais la photo historique où sur le lieu de la bataille la plus meurtrière de 14-18, le Chancelier de l’Allemagne et le Président de la France se sont donnés fraternellement la main en 1984

(*) exergue du latin exergum (« espace hors d’œuvre ») = Citation placée hors-texte
<621>
Vendredi 18 décembre 2015
Jeudi 17 décembre 2015
12/11/2015 le billet de Guillaume Erner.
Si vous voulez aller voir leur site, c’est ici et c’est cool : https://www.airbnb.fr/
Mercredi 16 décembre 2015
Correspondante du Monde aux Etats-Unis basée à San Francisco
Mardi 15 décembre 2015
La droite est une langue morte ce soir, nous n’avons plus d’ossature idéologique.»
Lundi 14 décembre 2015
Vendredi 11 décembre 2015
Jeudi 10 décembre 2015
Travaillons et luttons pour que cette Union européenne historique puisse sortir de cette période de faiblesse actuelle, plus stable et plus confiante en ses propres capacités ! »
L’actualité se bouscule ces derniers temps à un tel point qu’il reste peu d’espace pour s’arrêter et se pencher sur des moments hors du temps.
Il y a quelques semaines Helmut Schmidt est mort à 96 ans.
Il était né en 1918 et il est décédé le 10 novembre 2015.
Il fut un grand chancelier d’Allemagne et participa énormément à la construction européenne, grâce à une remarquable entente avec Giscard d’Estaing.
Dans plusieurs des mots du jour, de manière explicite ou implicite, j’oppose l’homme d’État qui pense aux générations futures et l’homme politique qui pense aux élections futures.
Ici nous avons un homme d’Etat qui possède la compréhension de l’Histoire et qui réfléchit à l’action dans ce cadre.
Il a prononcé fin 2011, au congrès du SPD, à 93 ans, en chaise roulante, un discours exceptionnel que celles et ceux qui comprennent l’allemand trouveront <ICI>.
Pour ma part je l’ai découvert presque immédiatement après qu’il eut été prononcé et je souhaitais en faire un mot du jour. Mais il fallait traduire ce discours qui dure plus d’une heure, traduction que je n’ai pas trouvée alors.
Il était au-dessus de mes forces et disponibilités actuelles de la réaliser moi-même.
Mais après son décès, des traductions sont apparues, vous trouverez en <ICI le discours d’Helmut Schmidt traduit> l’une d’entre elles.
Je vous conseille de lire ce discours dans son intégralité et dans la force de l’argumentation intégrale sans passer par les quelques extraits que je vous propose ci-après pour convaincre celles et ceux qui ne le seraient pas spontanément de l’intérêt de lire un tel acte d’intelligence où il décrit la position de l’Allemagne au centre de l’Europe, des conséquences de cette géographie, de la responsabilité allemande et du manque de clairvoyance des politiciens actuels sur les déséquilibres qui avantagent à court terme l’Allemagne mais ne saurait être de bon augure pour l’avenir.
« […] Vue d’Europe centrale, l’histoire de l’Europe peut s’interpréter comme une succession quasiment interminable de conflits entre la périphérie et le centre et entre le centre et la périphérie.
Le centre de l’Europe ayant toujours été le champ de bataille prépondérant. Lorsque les dirigeants ou les peuples du centre de l’Europe s’affaiblissaient, leurs voisins de la périphérie se jetaient sur le centre affaibli. La guerre de 30 ans, entre 1618 et 1648, qui s’est déroulée essentiellement sur le sol allemand, s’est soldée par un bilan sans équivalent, tant en termes de destruction matérielle qu’en nombre de pertes humaines. A l’époque, l’Allemagne n’était qu’un terme géographique, les pays germanophones étaient mal délimités. Arrivèrent ensuite les Français, d’abord sous Louis XIV et une seconde fois sous Napoléon. Les Suédois ne sont pas revenus une seconde fois ; mais les Anglais sont venus à plusieurs reprises, tout comme les russes, la dernière fois en date ayant été sous Staline.
Mais lorsque les dynasties ou les États du centre de l’Europe étaient forts, ou lorsqu’ils pensaient l’être, ils se jetaient à leur tour sur la périphérie. Ce fut déjà le cas pour les croisades, qui étaient des campagnes de conquêtes, pas uniquement en direction de l’Asie Mineure et de Jérusalem, mais aussi en direction de la Prusse orientale et des trois pays baltes actuels. A l’époque des temps modernes, cela fut le cas lors de la guerre contre Napoléon et des trois guerres qui ont éclaté sous Bismarck, en 1864, 1866, 1870/71.
Il en fut de même lors de la seconde guerre de trente ans, de 1914 à 1945, mais aussi tout particulièrement lorsqu’Hitler entreprit des avancées jusqu’au Cap Nord, dans le Caucase, en Crète, jusqu’au sud de la France et même jusqu’à Tobrouk, ville située à proximité de la frontière entre la Lybie et l’Égypte. La catastrophe européenne provoquée par l’Allemagne englobe le massacre des juifs européens et la destruction de l’état national allemand.
Auparavant, les Polonais, les États baltes, les Tchèques, les Slovaques, les Autrichiens, les Hongrois, les Slovènes et les Croates, partageaient le destin des Allemands, souffrant depuis des siècles de leur position géopolitique centrale sur ce petit continent européen. Ou, pourrait-on dire : Nous, les Allemands, avons maintes fois fait souffrir d’autres peuples de par notre position de puissance centrale. […]
Il me semble primordial, pour nous Allemands, que quasiment tous les voisins de l’Allemagne, ainsi que tous les Juifs du monde, se souviennent de l’Holocauste et des infamies commises à l’époque de l’occupation allemande dans les pays de la périphérie. Nous, Allemands, ne sommes pas assez conscients du fait qu’il règne, chez presque tous nos voisins, et sans doute pour plusieurs générations encore, un sentiment latent de méfiance à l’égard des Allemands. Les générations nées après la guerre doivent elles aussi vivre avec ce fardeau historique. Et les générations actuelles ne doivent pas oublier que c’est cette méfiance à l’égard du futur développement de l’Allemagne qui a mené, en 1950, aux débuts de l’intégration européenne.
En 1946, le discours de Churchill prononcé à Zurich et invitant les Français à se réconcilier avec les Allemands et à constituer ensemble les États-Unis d’Europe, était motivé par deux raisons : premièrement, une défense commune contre l’Union soviétique jugée menaçante et, deuxièmement, l’intégration de l’Allemagne dans un réseau occidental plus vaste. Car Churchill prévoyait le renforcement de l’Allemagne. […]
Je me permets d’ouvrir ici une petite parenthèse personnelle. J’ai écouté le discours de Jean Monnet à l’occasion de son comité « Pour les États-Unis d’Europe ». C’était en 1955. Je considère Jean Monnet comme l’un des Français les plus visionnaires qu’il m’ait été donné de rencontrer, en particulier en termes d’intégration, par son concept d’une approche progressive de l’intégration européenne. Depuis ce jour, je suis devenu et je suis resté partisan de l’intégration européenne, par conscience de l’intérêt stratégique de l’Allemagne et non par idéalisme, un partisan de l’intégration de l’Allemagne. […]
Si, aujourd’hui, en 2011, l’on observe l’Allemagne depuis l’extérieur, avec les yeux de nos voisins proches et plus éloignés, on constate que l’Allemagne suscite, depuis une dizaine d’années, un certain malaise, et depuis peu, une inquiétude politique. Au cours des dernières années, des doutes importants sont apparus s’agissant de la continuité de la politique allemande. La confiance en la fiabilité de la politique allemande a été atteinte.
Ces doutes et ces inquiétudes sont également à mettre sur le compte des erreurs de politique étrangères de nos politiciens et gouvernements allemands. Ils reposent, d’autre part, sur la surprenante force économique de l’Allemagne réunifiée. A compter des années 1970, l’économie du pays, qui était encore divisée, s’est développée pour devenir l’une des plus fortes d’Europe. C’est l’une des économies les plus solides au monde sur le plan technologique, financier et social. Notre puissance économique et notre paix sociale toute aussi stable ont toutefois suscité des jalousies, d’autant plus que notre taux de chômage et notre taux d’endettement se situent dans la fourchette normale au niveau international.
Mais nous ne sommes pas suffisamment conscients du fait que notre économie, intégrée dans le Marché commun et mondialisée, est dépendante de la conjoncture mondiale. Il faut donc s’attendre à ce que les exportations allemandes n’augmentent pas particulièrement au cours de l’année à venir.
Cela a simultanément engendré une tendance désastreuse : des excédents à la fois énormes et durables de notre balance commerciale et de notre balance des opérations courantes. Depuis des années, ces excédents représentent 5% de notre produit national brut. Ils sont aussi importants que les excédents de la Chine. Nous avons tendance à l’oublier, car les excédents s’expriment non plus en DM mais en Euros. Il est toutefois temps que nos politiciens prennent conscience de la situation.
 Car tous nos excédents sont en réalité les déficits des autres. Nos créances sont leurs dettes. Il s’agit d’une fâcheuse atteinte à l’idéal légitime que, jadis, nous prônions : « l’équilibre des échanges extérieurs ». Cette atteinte ne peut qu’inquiéter nos partenaires. Et lorsque s’élèvent des voix étrangères, souvent américaines mais aussi d’autres pays, pour demander à l’Allemagne de jouer un rôle moteur en Europe, de nouvelles craintes s’éveillent chez nos voisins. Et ce n’est pas sans rappeler de mauvais souvenirs. […]
Car tous nos excédents sont en réalité les déficits des autres. Nos créances sont leurs dettes. Il s’agit d’une fâcheuse atteinte à l’idéal légitime que, jadis, nous prônions : « l’équilibre des échanges extérieurs ». Cette atteinte ne peut qu’inquiéter nos partenaires. Et lorsque s’élèvent des voix étrangères, souvent américaines mais aussi d’autres pays, pour demander à l’Allemagne de jouer un rôle moteur en Europe, de nouvelles craintes s’éveillent chez nos voisins. Et ce n’est pas sans rappeler de mauvais souvenirs. […]
Lorsque je repense à l’année 1945 ou à l’année 1933, je venais d’avoir 14 ans, les progrès réalisés jusqu’à présent me semblent presqu’incroyables. Les progrès accomplis par les Européens depuis le Plan Marshall en 1948, le Plan Schumann en 1950, grâce à Lech Walesa et Solidarnosc, grâce à Vaclav Havel et à la Charte 77, grâce à chaque Allemand à Leipzig et à Berlin Est depuis le Grand Tournant en 1989/91. Nous n’aurions pas pu nous imaginer en 1918, en 1933, ni même en 1945, que la majeure partie de l’Europe jouirait des droits de l’homme et de la paix. Travaillons et luttons pour que cette Union européenne historique puisse sortir de cette période de faiblesse actuelle, plus stable et plus confiante en ses propres capacités ! »
Un homme d’État, je vous dis. Mais il faut lire son discours dans son intégralité pour suivre le cheminement de sa pensée.
<614>
Mercredi 9 décembre 2015
Chloé Verlhac et Tignous
|
|
|
Mardi 8 décembre 2015
Lundi 7 décembre 2015
Vendredi 4 décembre 2015
Une autre histoire était possible. Un autre monde reste à construire. »
Jeudi 3 décembre 2015
Mercredi 2 décembre 2015
Les notions de bien et de mal, justice et injustice, n’ont pas leur place ici. Là où n’existe aucun pouvoir commun, il n’y a pas de loi.
Là où n’existe pas de loi, il n’y a aucune injustice.
La force et la ruse sont en temps de guerre les deux vertus cardinales. »
Mardi 1er décembre 2015
Lundi 30 novembre 2015
Le président de la république, lors de son discours, aux invalides en hommage aux victimes du 13 novembre, a eu cette phrase :
« Nous rassemblerons nos forces pour apaiser les douleurs et après avoir enterré les morts, il nous reviendra de réparer les vivants ».
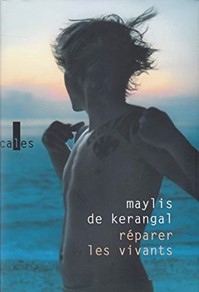 Cette formule « réparer les vivants » a, dans un premier temps, évoqué un ouvrage récent de Maylis de Kerangal qui retrace le parcours du cœur d’un jeune homme décédé le matin dans un accident de voiture, cœur qui sera transplanté dans la journée.
Cette formule « réparer les vivants » a, dans un premier temps, évoqué un ouvrage récent de Maylis de Kerangal qui retrace le parcours du cœur d’un jeune homme décédé le matin dans un accident de voiture, cœur qui sera transplanté dans la journée.
Le sujet principal du livre étant « le cœur » qui va du mort au vivant.
Mais l’origine de cette phrase se trouve dans une pièce de théâtre d’Anton Tchekhov « Platonov » qu’il a écrit à l’âge de 18 ans et qui n’a jamais été joué de son vivant. Wikipedia nous apprend que cette pièce a été retrouvée en 1921, alors qu’il était mort depuis 17 ans.
C’est une réponse à une question :
« Que faire Nicolas ? »
Et la réplique :
« Enterrer les morts et réparer les vivants. ».
C’est le chemin que doit emprunter toute personne qui est dans le deuil, qu’il s’agisse d’un deuil personnel intime de sa mère, de son père, de l’être aimé ou pire d’un enfant.
C’est bien sûr aussi ce qu’il faut faire quand une collectivité, comme la nôtre, est frappée par le deuil. François Hollande a su le dire.
Et il a fini son hommage par une autre phrase qui fait écho à l’Histoire. Lors de son fabuleux discours pour l’entrée au Panthéon de Jean Moulin, André Malraux avait lancé :
« Jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n’avaient pas parlé ; ce jour-là, elle était le visage de la France…».
Aux Invalides, la conclusion de François Hollande
« Malgré les larmes, cette génération est aujourd’hui devenue le visage de la France. »
Ce fut, en effet un discours de qualité, j’ai été ému.
Mais, il n’en reste pas moins que François Hollande, n’est pas un orateur du niveau d’André Malraux ni même plus récemment de François Mitterrand. Il y a la voix, le ton, les hésitations qui ont été cependant moins fréquentes lors de ce discours.
Mais j’ai compris quelque chose, grâce à ce discours, qui fut son meilleur. Il abuse souvent de la répétition.
Il commence par une belle introduction :
« C’est parce qu’ils étaient la vie qu’ils ont été tués. C’est parce qu’ils étaient la France qu’ils ont été abattus. C’est parce qu’ils étaient la liberté qu’ils ont été massacrés. »
 Dans cette accumulation, il ne se répète pas, chaque phrase dit autre chose de la même réalité. En cela, il y a un crescendo qui révèle de la force dans le discours.
Dans cette accumulation, il ne se répète pas, chaque phrase dit autre chose de la même réalité. En cela, il y a un crescendo qui révèle de la force dans le discours.
Mais quand il dit :
« C’est cette harmonie qu’ils voulaient casser, briser ». Briser n’apporte rien à casser et réciproquement.
Plus loin il dit :
« Que veulent les terroristes ? Nous diviser, nous opposer, nous jeter les uns contre les autres. »
Dans ces deux cas il aurait été beaucoup plus fort de dire simplement « C’est cette harmonie qu’ils voulaient briser » et « Les terroristes veulent nous jeter les uns contre les autres. »
C’est parce que ce discours était très bon et émouvant que j’ai pu comprendre cela.
Il s’agit de sa marque de fabrique, l’utilisation de plusieurs termes pour dire la même chose. J’interprète cela comme la révélation que cet homme ne sait pas choisir. Il ne sait pas décider, aller à l’essentiel, sélectionner le meilleur mot entre « casser » et « briser », alors il prend les deux.
Vous allez me répondre, mais comme chef de guerre, il sait décider !
Peut-être.
Mais sommes-nous vraiment en guerre ?
<606>
Vendredi 27 novembre 2015
|
|
Jeudi 26 novembre 2015
Mercredi 25 novembre 2015
Mardi 24 novembre 2015
Lundi 23 novembre 2015
Le mot du jour d’aujourd’hui est la conclusion de l’appel, du cri, de la harangue que François Morel a lancé lors de son billet hebdomadaire du vendredi, le 20 novembre :
«Ne renoncez à rien !
Surtout pas au théâtre, aux terrasses de café, à la musique, à l’amitié, au vin rouge, aux feuilles de menthe et aux citrons verts dans les mojitos, aux promenades dans Paris, aux boutiques, aux illuminations de Noël, aux marronniers du boulevard Arago, aux librairies, aux cinémas, aux gâteaux d’anniversaire.
Ne renoncez à rien !
Surtout pas au Chablis, surtout pas au Reuilly, surtout pas à l’esprit. Ne renoncez à rien ! Ni aux ponts de Paris, ni à la Tour Eiffel, ni Place de la République à la statue de Marianne […].
Ne renoncez à rien !
Surtout pas à Paris, surtout pas aux titis, surtout pas à Bercy.
Ne renoncez à rien !
Ni à Gavroche, ni à Voltaire, ni à Rousseau, ni aux oiseaux, ni aux ruisseaux, ni à Nanterre, ni à Hugo.
Ne renoncez à rien !
Ni aux soleils couchants, ni aux collines désertes, ni aux forêts profondes, ni aux chansons de Barbara, ni à la foule des grands jours, ni à l’affluence des jours de fête, au Baiser de l’Hôtel de Ville, aux étreintes sous les portes cochères, ni aux enfants qui jouent sur les trottoirs, ni aux cyclistes, ni aux cavistes, ni aux pianistes.
Ne renoncez à rien !
 Surtout pas aux envies, surtout pas aux lubies, surtout pas aux folies, ni aux masques, ni aux plumes, ni aux frasques, ni aux prunes, ni aux fiasques, ni aux brunes, ni aux écrivains, ni aux éclats de voix, ni aux éclats de rires, ni aux engueulades, ni aux files d’attente, ni aux salles clairsemées, ni aux filles dévêtues, ni aux garçons poilus, ni à la révolte, ni à la joie d’être ensemble, ni au bonheur de partager, au plaisir d’aimer, ni à la légèreté, ni à l’insouciance, ni à la jeunesse, ni à la liberté.
Surtout pas aux envies, surtout pas aux lubies, surtout pas aux folies, ni aux masques, ni aux plumes, ni aux frasques, ni aux prunes, ni aux fiasques, ni aux brunes, ni aux écrivains, ni aux éclats de voix, ni aux éclats de rires, ni aux engueulades, ni aux files d’attente, ni aux salles clairsemées, ni aux filles dévêtues, ni aux garçons poilus, ni à la révolte, ni à la joie d’être ensemble, ni au bonheur de partager, au plaisir d’aimer, ni à la légèreté, ni à l’insouciance, ni à la jeunesse, ni à la liberté.
Ne renoncez à rien ! Ne renoncez à rien ! Ne renoncez à rien ! Ne renoncez à rien !
Surtout pas à Paris, surtout pas aux amis, surtout pas à la vie.»
On peut le lire, mais il faut surtout l’écouter : http://www.franceinter.fr/emission-le-billet-de-francois-morel-ne-renoncer-a-rien
En fond sonore du billet de François Morel vous entendez la romance sans parole opus 67 N° 4 appelée « la fileuse » de Mendelssohn
Oui ne renonçons à rien !
Certes il faut se défendre avec tous les moyens dont dispose l’Etat de droit et avec les services de sécurité et de renseignement.
Certes, chacun de nous peut être atteint par un attentat de ces criminels aimant la mort, autant que nous la vie.
Mais en ayant conscience que le risque pour chacun est d’une probabilité très faible. En comparaison, nous prenons un risque beaucoup plus élevé en montant dans une voiture et pourtant nous le faisons.
Donc, oui ne renonçons à rien ! C’est leur défaite et notre victoire !
<601>
Vendredi 20/11/2015
je ne me suis pas laissé briser,
je n’ai pas capitulé. »
|
Quelle terrible période que la première moitié du XXème siècle !
Beaucoup ont été brisés quand ils n’ont pas été tués..
Mais il y eut heureusement des âmes fortes comme Maïa Plissetskaïa qui ne capitulèrent jamais
|
|
Jeudi 19/11/2015
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre»
Mercredi 18/11/2015
Dans émission spéciale de samedi soir le 14/11 de Demorand à France Inter
Mardi 17/11/2015
Lundi 16 novembre 2015
Il fait beau comme jamais
C’est un temps contre nature
[…]
Il fait beau comme jamais
un temps à rire et courir
Un temps à ne pas mourir
Un temps à craindre le pire»
|
Meine Damen und Herren, hinter uns liegt eine der schrecklichsten Nächte, die Europa seit langer Zeit erlebt hat. |
Mesdames et Messieurs, nous venons de vivre une des nuits les plus horribles que l’Europe a vécu depuis longtemps. |
|
Die Menschen in Paris müssen einen Alptraum von Gewalt, Terror und Angst durchleiden, und ich möchte ihnen und allen Franzosen heute von hier aus vor allem eines sagen: Wir, die deutschen Freunde, wir fühlen uns Ihnen so nah. |
Les personnes à Paris ont eu à vivre un cauchemar de violence, de terreur et de peur, et je voudrai avant tout, aujourd’hui, leur dire ainsi qu’à tous les Français : Nous les amis allemands, nous nous sentons si proche de vous. |
|
Wir weinen mit Ihnen.. |
Nous pleurons avec vous. |
|
Wir werden mit Ihnen gemeinsam den Kampf gegen die führen, die Ihnen so etwas Unfassbares angetan haben |
Nous poursuivrons avec vous, ensemble, le combat contre les responsables de ces actes inconcevables. |
|
Ich bin in Gedanken bei den mehr als 120 Menschen, denen das Leben geraubt wurde, und ich bin in Gedanken bei den Familien und Angehörigen. Seien Sie versichert: Deutschland fühlt mit Ihnen in Ihrem Schmerz und in Ihrer Trauer. |
Je suis en pensée avec les plus de 120 personnes, à qui la vie a été dérobée et je suis en pensée avec les familles et les proches. Soyez assurés que l’Allemagne partage votre douleur et votre chagrin. |
|
Ich denke auch an die Verletzten mögen sie genesen, körperlich und seelisch. |
Je pense aussi aux blessés, puissent-ils guérir dans leur corps et dans leur âme.. |
|
Die Menschen, um die wir trauern, wurden vor Cafés ermordet, im Restaurant, im Konzertsaal oder auf offener Straße. Sie wollten das Leben freier Menschen leben, in einer Stadt, die das Leben feiert und sie sind auf Mörder getroffen, die genau dieses Leben in Freiheit hassen. |
Les personnes dont nous portons le deuil, ont été assassinées au restaurant, dans une salle de concert ou dans la rue. Ils voulaient vivre une vie d’hommes libres dans une ville qui célèbre la vie et ils sont tombés sur des meurtriers qui justement haïssent la vie dans la liberté. |
|
Dieser Angriff auf die Freiheit gilt nicht nur Paris er meint uns alle und er trifft uns alle. Deswegen werden wir auch alle gemeinsam die Antwort geben. |
Cette attaque contre la liberté compte non seulement pour Paris, elle atteint chacun d’entre nous et nous touche tous. Voilà pourquoi nous agirons ensemble pour donner la réponse. |
|
Da ist zunächst die Antwort der Sicherheitskräfte: Die Bundesregierung steht dazu im engen Kontakt mit der französischen Regierung und hat jedwede Unterstützung angeboten. Wir werden alles tun, um bei der Jagd auf die Täter und Hintermänner zu helfen und gemeinsam den Kampf gegen diese Terroristen zu führen. |
C’est d’abord la réponse des forces de sécurité : Le gouvernement fédéral est en contact étroit avec le gouvernement français et a offert son assistance. Nous ferons tout notre possible pour aider dans la capture des auteurs et des commanditaires et pour mener conjointement la lutte contre ces terroristes. |
|
Ich werde heute im Laufe des Tages mit den zuständigen Ministern zusammenkommen, um die weitere Entwicklung der Lage in Frankreich und alle damit verbundenen Fragen zu erörtern |
Je vais réunir au cours de la journée les ministres compétents pour discuter du développement de la situation en France et de toutes les questions liées. |
|
Und dann geben wir auch als Bürger eine klare Antwort, und die heißt: Wir leben von der Mitmenschlichkeit, von der Nächstenliebe, von der Freude an der Gemeinschaft. Wir glauben an das Recht jedes Einzelnen an das Recht jedes Einzelnen, sein Glück zu suchen und zu leben, an den Respekt vor dem anderen und an die Toleranz. |
Et puis nous donnons aussi, comme citoyen, une réponse claire qui est celle-ci : Nous vivons par la compassion, par la charité, par la joie de la communauté. Nous croyons aux droits individuels, au droit de chercher son bonheur, de vivre dans le respect d’autrui et dans la tolérance. |
|
Wir wissen, dass unser freies Leben stärker ist als jeder Terror. |
Nous savons que notre vie libre est plus forte que le terrorisme. |
|
Lassen Sie uns den Terroristen die Antwort geben, indem wir unsere Werte selbstbewusst leben und indem wir diese Werte für ganz Europa bekräftigen jetzt mehr denn je |
Répondons aux terroristes en vivant dans nos valeurs, dans la confiance dans la vie, en fortifiant ces valeurs pour l’ensemble de l’Europe, maintenant plus que jamais |
|
Maintenant que la jeunesse
S’éteint au carreau bleui
Maintenant que la jeunesse
Machinale m’a trahi
Maintenant que la jeunesse
Tu t’en souviens souviens-t-en
Maintenant que la jeunesse
Chante à d’autres le printemps
Maintenant que la jeunesse
Détourne ses yeux lilas
Maintenant que la jeunesse
N’est plus ici n’est plus là
Maintenant que la jeunesse
Sur d’autres chemins légers
Maintenant que la jeunesse
Suit un nuage étranger
Maintenant que la jeunesse
A fui voleur généreux
Me laissant mon droit d’aînesse
Et l’argent de mes cheveux
|
Il fait beau à n’y pas croire
Il fait beau comme jamais
Quel temps quel temps sans mémoire
On ne sait plus comment voir
Ni se lever ni s’asseoir
Il fait beau comme jamais
C’est un temps contre nature
Comme le ciel des peintures
Comme l’oubli des tortures
Il fait beau comme jamais
Frais comme l’eau sous la rame
Un temps fort comme une femme
Un temps à damner son âme
Il fait beau comme jamais un temps à rire et courir
Un temps à ne pas mourir
Un temps à craindre le pire
Il fait beau comme jamais
|
Mardi 10 novembre 2015
Voilà le créneau qui nous intéresse. »
Lundi, le 09/11/2015
La violence et le sacré
éd. Hachette, coll. Pluriel, 2004 (ISBN 2-01-278897-1), p. 480
|
|
Cette attitude des élites françaises à l’égard de René Girard n’est-elle pas révélatrice d’un mal plus grand ?
Ne sont-elles pas simplement incapables de sortir de leur univers de clones ? Où on n’accepte que celles et ceux qui pensent comme les autres de la même caste, dans un moule rassurant mais aussi castrateur ?
Si cette hypothèse est exacte et s’il y a bien fuite des cerveaux elle pourrait avoir une cause bien plus profonde que celle si souvent évoquée du matraquage fiscal.
Pour prolonger cette réflexion je vous propose cet excellent article de Slate : http://www.slate.fr/story/109455/rene-girard-mort-violence-sacre
|
Vendredi, le 06/11/2015
|
|
Ainsi se termine les 5 reportages que j’ai choisis arbitrairement dans ce livre où Florence Aubenas raconte simplement les gens, en ne jugeant pas et plutôt avec bienveillance.
|
<593>
Jeudi, le 05/11/2015
Dans « En France » de Florence Aubenas, pages 225 à 228, 17 février 2014
<592>
Mercredi, le 04/11/2015
Dans « En France » de Florence Aubenas, pages 42 à 45, 20 mai 2013
<591>
Mardi, le 03/11/2015
Dans « En France » de Florence Aubenas, pages 25 à 30, 15 juin 2012
<590>
Lundi 2 novembre 2015
Dans « En France » de Florence Aubenas, pages 185 à 188, 6 mai 2013
|
|
En général, on apprend le vendredi pour le lundi que le contrat ne sera pas renouvelé et, afin de maintenir la motivation jusqu’à la dernière heure, on délivre un certificat de bons services nécessaire pour un nouvel intérim. […]
A la grille de l’usine, le bus des « embauchés » est déjà là. Un type à l’avant est en train de caler sa gamelle dans son sac. En 1975, quand lui a été recruté, « le terme ouvrier à la chaîne était synonyme d' »esclave moderne ». Aujourd’hui, on nous appelle « privilégiés » ». Il a fini par y croire. « Ce qui était une fatalité pour nous est devenu le rêve de nos enfants. »
Son fils est juste derrière, sur le parking du fast-food. Il monte dans la camionnette des intérimaires en faisant le V de la victoire, suivi des autres qui font pareil, pendant que le blond filme la scène sur son portable. Il est 4 h 58 quand le véhicule démarre, soulevant en gerbes éclatantes les flaques laissées par l’orage. »
|
<589>
Vendredi, le 30/10/2015
Jeudi 29 octobre 2015
C’était le 27 octobre 2005, un jeudi, il y a 10 ans : deux jeunes fuyant la police à Clichy sous Bois, Zyed Benna et Bouna Traoré, pris de panique, vont se réfugier dans un transformateur électrique et y mourir électrocuté.
Pourquoi fuyaient-ils ?
Les raisons ne sont pas claires comme l’explique cet article du monde joint: <Le dernier jour de Bouna Traoré et Zyed Benna>
Le plus vraisemblable est qu’ils n’avaient rien à se reprocher, mais qu’ils se méfiaient des policiers et qu’ils ne voulaient pas être arrêtés de peur d’être disputés par leurs parents.
Et la mort insensée de ces deux enfants (15 ans et 17 ans) va déclencher de terribles émeutes dans la banlieue alentour qui amèneront à ce que le couvre-feu soit déclaré dans certaines villes et que les médias anglo-saxons annoncent au monde qu’il y avait des scènes de guerre à Paris.
 C’est dans ces conditions, qu’un journaliste suisse, Serge Michel, récent lauréat du prix Albert-Londres (2001) pour son travail en Iran, envoyé par son journal suisse « L’Hebdo » vient enquêter. Il va s’immerger, pendant 3 mois, dans la ville voisine de Clichy, Bondy et va créer le Bondy Blog, media en ligne qui existe toujours aujourd’hui et qui a pour objectif de raconter les quartiers populaires et de faire entendre leur voix dans le grand débat national.
C’est dans ces conditions, qu’un journaliste suisse, Serge Michel, récent lauréat du prix Albert-Londres (2001) pour son travail en Iran, envoyé par son journal suisse « L’Hebdo » vient enquêter. Il va s’immerger, pendant 3 mois, dans la ville voisine de Clichy, Bondy et va créer le Bondy Blog, media en ligne qui existe toujours aujourd’hui et qui a pour objectif de raconter les quartiers populaires et de faire entendre leur voix dans le grand débat national.
Serge Petit en est parti, ce média poursuit aujourd’hui un partenariat avec Libération.
L’Obs a récemment interviewé Serge Michel pour revenir sur ces évènements et plus largement sur la banlieue de Paris et le rapport entre les médias et ces territoires.
Et Le regard distant du journaliste suisse nous fait découvrir un point de vue très critique et perturbant.
[Quand je suis arrivé à Bondy à l’automne 2005] « Pour moi, c’étaient ces zones un peu grises, un peu tristes, que je traversais en TGV depuis Genève avant d’arriver à la gare de Lyon. Et le plus curieux, c’est que cette méconnaissance semblait partagée. Pour un reportage à Bagdad ou à Kaboul, on obtient ou on prépare une pile épaisse d’articles qui donnent des idées sur les personnes à voir, les sujets à traiter. Là, sur Bondy, je n’ai rien trouvé, au mieux deux papiers du Parisien sur l’inauguration de la bibliothèque ou un coupage de ruban à la mairie. »
[Il décide d’ouvrir un bureau permanent trois mois durant à Bondy]
« On a cherché un mode de traitement pertinent. L’idée d’une correspondance dans la durée, d’une immersion s’est imposée. En venant au journal, le matin, j’avais entendu un son sur les émeutes de la Radio suisse romande […]. Je connaissais bien la journaliste. C’était LA reporter de guerre de la RSR. Deux ou trois semaines plus tôt elle intervenait en direct de Beyrouth. Une reporter de guerre dans les banlieues françaises, ça m’a frappé, et ça m’a fait réfléchir. C’est sans doute cela qui m’a donné envie de couvrir le sujet d’une autre façon. Plus comme un correspondant que comme un envoyé spécial. »
[…] « On s’est concentré sur des portraits, des récits de vie ; on a raconté le quotidien, les kebabs, les transports, le foot ; on a essayé de comprendre qui sont ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas – tous ces papiers que vous ne pouvez faire qu’avec du temps, et qui permettent de comprendre un peu mieux les racines du malaise. Notre chance, c’était d’être présents sur place le matin, le soir et les week-ends, les moments où les banlieues-dortoirs vivent, et où les journalistes, paradoxalement, ne sont pas présents.
[…] Je crois que la situation des banlieues, sur le fond, intéressait peu les rédactions. Une anecdote : entre mon arrivée à la gare de Lyon et mon départ en RER pour Bondy, je suis passé par les locaux d’une grande rédaction pour qui j’avais travaillé au Moyen-Orient et dans les Balkans. Je connaissais toute l’équipe du service Etranger. Ils m’ont dit : « Ah Serge, qu’est-ce que tu fais là ? ». Je leur ai dit : « Je vais en banlieue », et ils m’ont tous regardé avec des regards atterrés, du genre « mon pauvre ! ». Pour un grand reporter français, la banlieue, c’est ce que l’on traverse quand on va prendre un avion à Roissy pour aller faire son métier.
Bagdad, c’est noble, et Bondy, c’est pour les types qui ont raté leur carrière et végètent au service Société. »
Pourtant le Bondy blog a connu un joli succès. Dix ans plus tard, il est toujours là…
« Disons qu’il a toujours été encadré par des journalistes professionnels, et que cela a aidé. La direction de l’Hebdo avait accepté que l’expérience dure trois mois. A l’approche de la date butoir, en février 2006, elle souhaitait passer à autre chose. De mon côté, je sentais qu’il y avait quelque chose d’important qui s’était mis en branle. J’ai proposé, qu’au lieu de fermer, on prenne une dizaine de jeunes de Bondy et qu’on les forme. Entre temps, le Seuil m’avait contacté pour tirer un livre des billets publiés en ligne, et avec les à-valoir du livre, on a pu payer le séjour des futurs Bondy-bloggers à Lausanne et leur transmettre les clés.
Enfin pas toutes les clés, puisque justement, plusieurs journalistes ont continué de s’investir avec une équipe d’encadrement locale. » […]
« Je pense que la France est assez unique dans la place centrale qu’occupe Paris, et dans la création tout autour d’une ceinture qui lui est à ce point étrangère.
Pour moi, la banlieue, c’est un peu Berlin-est. Pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de travail, pas grand-chose dans les magasins et des gens dont la vie est plus difficile qu’intra-muros.
Paris, au contraire, c’est Berlin-ouest : la fête, l’argent, la légèreté… Ça peut paraître caricatural, mais cette frontière que représente le périphérique, je ne connais rien de similaire dans des pays développés. On ne retrouve pas ça à Londres, par exemple.»
Nommé N°2 du Monde, il raconte ses frustrations dans ce journal qui n’a en outre recruté aucun Bondy-Blogger, contrairement à TF1, France Inter, Canal + ou France 2. […et il ajoute]
« La France a un système très rodé de reproduction de ses élites, je n’invente rien sur le sujet, et être journaliste en France, contrairement à d’autres pays, notamment la Suisse, c’est appartenir à une élite.
La France, au-delà de ses proclamations d’égalité, c’est aussi une société attachée à ses privilèges, marquée par l’histoire du colonialisme, qui peine à s’ouvrir à l’autre. Et, oui, le banlieusard, dans cette configuration, reste un allogène.
Derrière les proclamations, le beur, le noir, pour beaucoup de journalistes français restent avant tout des sujets. Des collègues, non. Les rédactions font preuve d’une imperméabilité très forte aux gens venus d’ailleurs.»
Si vous voulez en savoir davantage sur cette expérience : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bondy_Blog
Et bien sûr le lien vers le bondy Blog : https://www.bondyblog.fr/
<587>
Mercredi, le 28/10/2015
alors pourquoi l’abandonnas-tu, donne m’en la raison »
Mardi, le 27/10/2015
Lundi, le 26/10/2015
Or ces données sont cruciales. Elles ont un impact considérable sur le débat public concernant la crise des migrants et les médias les reproduisent généralement très vite – d’autant plus quand elles révèlent une augmentation soudaine du nombre d’arrivées. Quant aux politiciens anti-immigration, prompts à considérer que l’Europe subit bel et bien une invasion, ils n’attendent que ce genre de chiffres pour appuyer leurs arguments en faveur d’une fermeture des frontières. Depuis quelque temps déjà, je nourrissais des doutes sur la façon dont Frontex collectait, agrégeait et présentait des données issues de diverses sources. Or je me suis aperçu, il y a peu, que l’agence confondait le nombre de passages de frontières avec celui des entrées effectives au sein de l’Union européenne (UE).
Or les deux ne se recoupent pas, comme le montre bien un examen attentif de l’itinéraire utilisé par les migrants depuis la Grèce à travers les Balkans. En effet, les personnes qui arrivent en Grèce sont comptabilisées par Frontex pour avoir franchi les frontières extérieures de l’Europe. Mais les mêmes quittent ensuite le territoire de l’UE pour traverser des pays comme l’Albanie, la Macédoine ou la Serbie, avant de « ré-entrer » en Hongrie ou en Croatie, et de rejoindre leur destination finale (par exemple l’Allemagne). Et si pour une raison ou pour une autre, un des pays européens les renvoie dans un pays de transit (comme la Hongrie l’a fait avec la Serbie voisine), les migrants vont traverser une troisième fois la frontière et être de nouveau comptabilisés par Frontex.
Je décide alors de questionner l’agence via Twitter : (@FrontexEU Comment pouvez-vous être sûrs de votre chiffre : tous les migrants ne sont pas identifiés et ils peuvent passer plusieurs fois la frontière ?)
À ma grande surprise, je reçois une réponse quelques minutes plus tard. Avec une remarquable honnêteté, Frontex admet avoir compté deux fois certains entrants dans l’Union. L’agence concède également que les migrants arrivant en Europe par des voies différentes sont probablement comptabilisés deux fois.
(@nandosigona Nos bilans mensuels incluent tous les franchissements des frontières extérieures de l’UE. Les personnes arrivant en Grèce seront de nouveau comptées si elles entrent en Hongrie.)
Je reste abasourdi de voir que l’agence rend publiques des données si politiquement sensibles (710 000 entrées) et de façon aussi légère. Frontex sait pourtant pertinemment que ces chiffres peuvent avoir des conséquences importantes sur la façon dont l’Europe réagit à la crise en cours. Je n’essaye pas ici de nier l’importance du flux migratoire auquel est actuellement confronté notre continent, mais simplement d’attirer l’attention sur les responsabilités qui incombent à l’agence chargée par l’Union européenne de coordonner la gestion de ses frontières.
En dépit de cette clarification et son aveu qu’une « grande partie » des personnes avaient été comptées deux fois, les gros titres de la presse ont continué à laisser penser que 710 000 migrants étaient bel et bien entrés au sein de l’Union européenne. Combien de journaux ont nuancé ce chiffre avec la mise en garde ajoutée à la hâte par Frontex ? Et combien l’ont tout simplement ignorée pour ne publier que le chiffre en question ?
Vendredi, le 23/10/2015
Le type I correspond à une civilisation qui aurait réussi à collecter l’ensemble de l’énergie disponible sur une même planète. Notre civilisation est presque à ce niveau, bien qu’il nous faudrait multiplier environ par 100 000 notre production énergétique pour y parvenir (de préférence avec des énergies renouvelables…)
Le type II, c’est une civilisation qui pourrait récolter toute l’énergie produite par une étoile.
Le type III, enfin, est celui d’une civilisation qui collecte l’énergie à l’échelle d’une galaxie.
Jeudi 22 octobre 2015
Aujourd’hui, je partage avec vous un article de Libération : <Perturbateurs endocriniens : comment les lobbys ont gagné>.
L’expression «perturbateur endocrinien» a été créée par Theo Colborn pour désigner tout agent chimique qui agit sur le système hormonal, et peut, de ce fait, être la cause d’anomalies physiologiques et de reproduction.
« Theo Colborn » est une femme comme son prénom ne l’indique pas. Américaine, elle était zoologiste et épidémiologiste. Née en 1927 à Plainfield, elle est décédée le 14 décembre 2014.
C’est en 1991, que Theo Colborn rassemble des scientifiques afin d’étudier l’effet des produits chimiques sur les hormones. L’expression perturbateur endocrinien est issue de leurs travaux.
Depuis lors, les effets des perturbateurs endocriniens sont recherchés puis observés : agissant à très petites doses, ils ont des effets sur la santé en altérant des fonctions telles que la croissance, le développement, le comportement et l’humeur, la production, le sommeil, la circulation sanguine, la fonction sexuelle et reproductrice.
Ces substances ont pour nom :
- parabènes,
- phtalates,
- bisphénol A,
- dioxines…
On les retrouve un peu partout, tant au travers des objets que nous utilisons quotidiennement, que par le biais de l’environnement. Ces perturbateurs endocriniens sont ainsi présents dans des produits aussi banals que des packagings de l’alimentation, des bouteilles en plastique, des lingettes pour bébés… et même dans les produits cosmétiques (crèmes, parfums, vernis, etc.).
L’article de Libération présente un livre qui décrit les méthodes des industriels pour obtenir de la Commission européenne l’inaction.
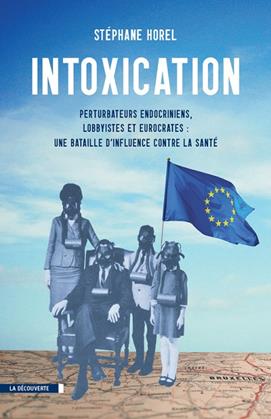 L’auteure est Stéphane Horel qui est journaliste indépendante et documentariste et qui explore l’impact du lobbying et des conflits d’intérêts sur les décisions politiques.
L’auteure est Stéphane Horel qui est journaliste indépendante et documentariste et qui explore l’impact du lobbying et des conflits d’intérêts sur les décisions politiques.
Son livre s’appelle <Intoxication> publié aux éditions de la découverte en octobre 2015.
Dans ce livre elle revient « sur un épisode récent (entre 2010 et fin 2013) et largement occulté, qui explique en grande partie l’immobilisme actuel : la guerre qui a eu lieu au sein des directions de la Commission européenne et qui a abouti à un enterrement du dossier. Ou plus exactement, dans le jargon, à lancer une «étude d’impact» qui a permis de repousser les échéances. Une histoire qui révèle les terribles batailles d’influence autour de la santé à Bruxelles.»
Stéphane Horel explique :
«Je passe des heures, des jours et des nuits à tout lire pour essayer de comprendre en direct ce qui se passe, et comment travaillent en direct les lobbys de toutes sortes».
En ce début octobre, dans la revue Endocrine Reviews (la plus ancienne revue et importante société savante spécialisée travaillant à la recherche sur les hormones et la pratique clinique de l’endocrinologie), un travail de synthèse a été réalisé, dont les conclusions sont sans appel :
«L’accroissement des données examinées enlève tout doute sur le fait que les perturbateurs endocriniens contribuent à l’augmentation de la prévalence de maladies chroniques liées à l’obésité, le diabète sucré, la reproduction, la thyroïde, les cancers, les problèmes neuroendocriniens et affectant les fonctions neurologiques du développement.»
Les chercheurs précisent même que
«Les cinq dernières années représentent un bond en avant dans notre compréhension des modes d’actions des PE sur la santé et la maladie du système endocrinien».
En 2006, la Commission a entamé sa révision de la réglementation des pesticides. Et elle a décidé d’y inclure les PE. Problème : comment les distinguer, comment les définir ? Le Parlement s’y penche, et demande à la Commission de présenter une définition scientifique des PE avant la fin 2013. […]
Au même moment, en 2006, les instances européennes adoptent Reach, un vaste programme dont le but est de protéger la santé et l’environnement en mettant un peu d’ordre dans le grand bazar chimique qu’est devenu le monde contemporain. «Les PE font-ils partie des substances préoccupantes
?» s’interroge alors Reach.
La question, là encore, reste en suspens, mais Reach demande à la commission de trancher, avec la même date limite : juin 2013.
L’industrie pétrochimique sent le danger.
«Elle se met, alors, sur le pied de guerre, écrit Stéphane Horel, l’industrie aurait souhaité que les politiques européennes se désintéressent du dossier. Elle a perdu cette première bataille, mais elle va se mobiliser pour faire en sorte que la définition des PE soit aussi limitée que possible, parce qu’elle veut continuer à mettre ses produits sur le marché sans que n’intervienne le moindre régulateur.» Commence donc une bataille d’influence. Homérique mais discrète, elle aura pour cadre les couloirs de la Commission européenne, à Bruxelles. Et c’est cet affrontement que nous décrit, dans son livre enquête, Stéphane Horel, et en particulier les derniers épisodes en 2012 et 2013. Un affrontement larvé, torve, terriblement féroce entre deux grandes directions de la Commission européenne, celle sur la santé et celle sur l’environnement. […] »
Pendant des mois et des mois, les deux directions vont s’invectiver en secret autour de la question d’une étude d’impact que pousse habilement l’industrie pétrochimique. Une étude d’impact, quoi de mieux, en effet, pour enterrer une décision ?
[…] «Le but des industriels est de techniciser à outrance le débat, pour arriver à le rendre incompréhensible, et surtout à le rendre indéchiffrable aux yeux des citoyens», analyse Stéphane Horel.
[…] Les médias ? «Pendant ces années de lobbying, ils ont joué un rôle très limité, constate Stéphane Horel, et puis en France, dès qu’il s’agit d’un sujet européen, les journaux ont peur d’ennuyer.»
Juin 2013, la date couperet. Le lobby des industries a gagné, comme le raconte Stéphane Horel. La Commission européenne a tranché.
Et a demandé une étude d’impact. Ceux qui s’alarmaient sur l’intérêt d’un tel travail ont eu raison : deux ans plus tard, rien n’a bougé.
On en est toujours là.
Et on attend toujours.
<582>
Mercredi, le 21/10/2015
La commissaire européenne chargée du commerce et donc des négociations du TTIP ou TAFTA
Mardi 20 octobre 2015
|
Cette photo montre une image du matériau le plus léger du monde : le micro-lattice en suspension au-dessus des aigrettes d’un pissenlit.
Un matériau 100 fois plus léger que le polystyrène et capable d’absorber de grandes quantités d’énergie.
«Nous avons réussi à créer le matériau le plus léger au monde», affirme la chercheuse Sofia Young. Il a été développé par les laboratoires HRL
|
lundi 19 octobre 2015
La violence n’a jamais cessé sur la terre de Palestine et d’Israël, mais <Une nouvelle étape a été franchie et on parle désormais d’une intifada des couteaux>
Samedi <Les Echos> comptaient 41 palestiniens et 7 israéliens tués en deux semaines.
Et hier dimanche, un attentat s’est produit à la gare des autobus de Beer Sheva, dans le sud d’Israël. Deux Palestiniens ont tiré dans la foule et poignardé plusieurs personnes, avant que les forces de sécurité ne répliquent.
Et en France, nous se sommes informés qu’en partie des faits de violence qui se déroulent sur ces lieux.
Avant ces faits, le conflit israélo palestinien était sorti des radars, on ne parlait plus que de la Syrie, de l’Irak et même du Yemen mais plus de la Palestine. Obama dans son discours à l’ONU, il y a quelques jours, n’a pas eu un mot pour la Palestine. Mahmoud Abbas a dit cette même tribune de l’ONU que les accords d’Oslo étaient enterrés et qu’il faudrait peut-être dissoudre l’Autorité Palestinienne.
Comment mieux dire qu’il n’y croit plus.
Depuis l’assassinat de Rabin, il n’y a plus d’homme d’Etat capable du côté israélien de mener son peuple à la paix et il faut bien le reconnaître il n’y a pas non plus d’homme d’Etat de ce niveau du côté palestinien.
Il y a quelques jours j’avais emprunté un mot du jour à une parole de Dominique Moïsi sur la guerre en Syrie et je fais à nouveau appel à lui aujourd’hui.
Il a, en effet, été l’invité de l’émission de Nicolas Demorand du 14 octobre 2015 :
Dominique Moïsi est juif, il a cru en l’Etat d’Israël et il a cru en la paix. Et aujourd’hui au bout des désillusions il se pose des questions existentielles et analyse les regards croisés et hostiles de ces deux peuples à l’aune de l’Histoire.
Dans le début l’émission, il fait d’abord parler son émotion et son désespoir en parlant de «la chronique d’une catastrophe annoncée»
Et il ajoute :
«Je ne suis pas surpris. On s’attendait à une telle explosion. Personne ne s’intéresse plus au problème israélo-palestinien. Les jeunes palestiniens en particulier ceux de Jérusalem ne croient plus à la politique, ni au Hamas, ni à l’autorité palestinienne. C’est une manière à eux de se rappeler à l’actualité. Il y a eu des événements qui ont attisé le ressentiment d’abord le bébé de 19 mois brûlé vif dans sa maison enflammée par des colons israéliens. Ses deux parents sont morts aussi. Et puis il y a ces rumeurs sur le changement de statut du Dôme du rocher, de la mosquée Al Aqsar. Cela ramène le conflit à un niveau qu’on avait oublié et qui le rend encore plus impossible à régler : c’est un conflit religieux.»
Demorand lui dit alors : «Je vous sens accablé»
Moisi :
« Oui ! Oui ! Il y a quelque chose de désespérant pour quelqu’un qui comme moi a cru profondément aux accords d’Oslo.
J’ai un souvenir : J’ai passé une nuit à boire du champagne avec le poète palestinien Mahmoud Darwich. Nous nous sommes embrassés. Nous avons cru qu’entre juifs et palestiniens, le problème pouvait être dépassé.
Et là…
Est-ce que nous avons rêvé ? Depuis le début ? Depuis l’assassinat d’Yitzhak Rabin ? Est-ce que nous avons continué à rêver en pensant que la communauté internationale et les Etats-Unis allaient imposer une solution ?
Aujourd’hui, il y a un sentiment de vide absolu. Il n’y a pas de petite lumière au fond du tunnel.
Il n’y a pas de pression qui va venir de l’extérieur.
Chacun est laissé, seul :
– face à sa peur du changement, sa volonté de préserver à tout prix le statu quo du côté israélien;
– face à son absence totale d’espoir du côté palestinien.»
Et il décrit « Une glaciation longue entre les deux parties, avec des murs des check points partout transformant Jérusalem en Berlin de la guerre froide.» Cela lui semble l’hypothèse la plus vraisemblable.
Il envisage ensuite le conflit du point de vue des Arabes et les solutions qui ont été envisagées :
« Une grande partie des palestiniens et des arabes rêvent que le problème israélien va disparaître. Qu’en gros les israéliens sont en Palestine, comme les Français étaient en Algérie et qu’à un moment donné, ils se retireront. Dans une partie du discours arabe : Ce sont les croisés du Royaume de Jérusalem ils vont partir et le sable du désert recouvrira leurs constructions arrogantes et intolérantes.
Mais ce n’est pas la réalité et le rapport des forces sur le plan militaire joue toujours majoritairement en faveur des israéliens.
Plus personne ne croit à la solution des deux Etats qui étaient la seule légitime et qui faisait sens.
Un Etat binational semble aussi totalement hors de portée étant donné les haines actuelles.
Certains imaginent une 3ème solution d’une confédération avec un 3ème acteur qui est la Jordanie. Cette confédération pourrait se réunir sur l’Economie. Mais cette solution ne semble pas non plus viable dans le contexte actuel.»
Il n’existe donc pas de solution aux yeux de Moisi.
Et c’est alors qu’il plonge dans le cœur du problème et dévoile une question existentielle. Voici la suite de ce dialogue entre Nicolas Demorand (ND) et Dominique Moïsi (DM)
« DM – Pas de solutions, c’est un échec absolu et qui bien entendu vous amène à vous poser des questions fondamentales, existentielles.
ND – Lesquelles ?
DM – Et si c’était une fausse bonne idée que d’avoir créé l’état d’Israël, dès le départ ?
ND – Vous dîtes cela vous ?
DM – Je dis qu’en réalité, c’est une question que les historiens se poseront. Parce qu’il y a un conflit de calendrier fondamental.
Quand Israël naît sur les fonts baptismaux de la communauté internationale en 1948, c’est au moment où commence le grand mouvement de décolonisation dans le monde. Pour le monde Arabe, c’est le dernier phénomène colonial de l’histoire européenne qui est anachronique.
Pour les Israéliens, c’est avec quelque retard, le dernier phénomène national de l’histoire européenne du 19ème siècle. Les Allemands ont un état, les Italiens ont un état.
Pourquoi pas les juifs ?
Et en fait ce conflit de calendrier n’a jamais été surmonté.
Dès le début, une immense majorité des arabes n’accepte pas que l’Europe paye ses péchés sur le dos des Palestiniens.
Et une grande partie des Israéliens a du mal à intégrer le fait qu’en réalité, il y a les Palestiniens sur ces territoires. (…) »
En 1950, Einstein publia la déclaration suivante sur la question du sionisme. Ce discours avait été initialement prononcé devant la National Labor Committee for Palestine (Commission national de travail pour la Palestine), à New York, le 17 avril 1938, mais Einstein l’avait ressortie en 1950, après la création de l’État d’Israël :
« Je verrais bien davantage un arrangement raisonnable avec les Arabes, sur base d’une coexistence pacifique, que la création d’un État juif. En dehors des considérations pratiques, ma connaissance de la nature essentielle du judaïsme résiste à l’idée d’un État juif avec des frontières, une armée et un projet de pouvoir temporel, aussi modeste soit-il. J’appréhende les dégâts internes que pourra provoquer le judaïsme – particulièrement à partir du développement d’un nationalisme étroit dans nos propres rangs et contre lequel il nous a déjà fallu nous battre sans État juif. »
Je finirais par Arun Gandhi, petit fils du Mahatma Gandhi qui vient de publier un livre «Mon Grand Père était Gandhi» et il dit : «Pour obtenir la paix, le pardon reste incontournable. Si nous ne pardonnons pas, nous ne grandirons pas».
Mais le pardon semble si loin.
Même si je comprends la peur et l’angoisse des juifs israéliens devant cette situation, il n’est pas possible de ne pas répéter que s’il faut être deux pour faire la paix, la plus grande part de la responsabilité est du côté d’Israël notamment par sa politique de colonisation insensée et intolérante qui rend impossible les deux États, seule solution légitime dit Moïsi.
L’existence de l’État d’Israël peut-elle rester légitime, en l’absence de son alter ego Palestinien ?
<579>
Vendredi 16/10/2015
cité par Stéphane Paoli dans son émission AGORA
Jeudi 15/10/2015
je suis descendu discuter avec ma famille.
Ils ont l’air sympa.»
Mercredi 14 octobre 2015
Mardi 13 octobre 2015
Ecrits sur l’histoire, Paris, Flammarion, 1985, p. 13. »
Quand j’ai commencé à lire Fernand Braudel, c’était dans les années 1980, pendant mes années de Droit que j’avais entamé après avoir échoué après 3 années passées en mathématiques supérieures et en mathématiques spéciales au Lycée 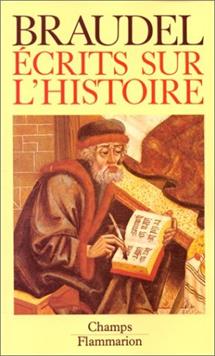 Kléber à Strasbourg, j’ai compris que je m’étais fourvoyé et que j’aurais dû faire des études d’Histoire.
Kléber à Strasbourg, j’ai compris que je m’étais fourvoyé et que j’aurais dû faire des études d’Histoire.
J’ai tenté cette aventure, après être arrivé à Lyon, en 2002, et j’ai même réussi la licence d’Histoire avec mention « Bien » à l’âge de 46 ans. Mais j’ai dû interrompre cette aventure, au niveau du master, en raison des contraintes de la vie qui ne m’autorisaient pas de continuer cette fantaisie.
Ceci pour dire que Fernand Braudel est important pour moi.
Braudel distingue les temps de l’Histoire : le temps de l’immédiateté, de l’événementiel dans lequel nous sommes plongés : des crises, des conflits, des réconciliations et des évènements de quelques mois ou de quelques années qui se déroulent dans notre vie.
Et puis il y a le temps des États, plus long qui dépasse notre temps humain.
Et enfin il y a le temps long, celui qu’il décrit par des grands courants sous-jacents.
Et dans le temps troublé d’aujourd’hui où on parle de la Syrie, de l’Irak, de la Turquie, de la Russie, de la France de l’Allemagne, du Pape je voudrais partager avec vous cet écrit de Braudel sur la Méditerranée en 1985 :
« Et la Méditerranée au-delà de ses divisions politiques actuelles, c’est trois communautés culturelles, trois énormes et vivaces civilisations, trois façons cardinales de penser, je crois, de manger, de boire, de vivre…
En vérité, trois monstres toujours prêt à montrer les dents, trois personnages à interminable destin, en place depuis toujours, pour le moins depuis des siècles et des siècles.
Leurs limites transgressent les limites des états, ceux-ci étant pour elle des vêtements d’Arlequin , et si légers !
Ces civilisations sont en fait les seuls destins de long souffle que l’on puisse suivre sans interruption à travers les péripéties et les accidents de l’histoire méditerranéenne.
Trois civilisations :
L’Occident tout d’abord peut-être vaut-il mieux dire la chrétienté, vieux mot trop gonflé le sens ; peut-être vaut-il mieux dire la romanité : Rome a été et reste le centre de ce vieil univers latin, puis catholique, qui s’étend jusqu’au monde protestant, jusqu’à l’Océan et à la mer du Nord, au Rhin et au Danube, au long desquelles la contre-réforme a planté ses églises baroques comme autant de sentinelles vigilantes ; et jusqu’au monde d’outre Atlantique comme si le destin moderne de Rome avait été de conserver dans sa mouvance l’empire de Charles Quint sur lequel le soleil ne se couchait jamais.
Le second univers, c’est l’islam, autre immensité qui commence au Maroc et va au-delà de l’océan indien jusqu’à l’Insulinde, en partie conquise et convertie par lui au XIIIe siècle après l’ère chrétienne. L’islam, vis-à-vis de l’Occident, c’est le chat vis-à-vis du chien. On pourrait dire un contre-Occident, avec les ambiguïtés que comporte toute opposition profonde qui est à la fois rivalité, hostilité et emprunt.
Germaine Tillon dirait des ennemis complémentaires. Mais quels Ennemis, quelle Rivaux !
Ce que fait l’un, l’autre le fait. L’Occident a inventé et vécu les croisades ; l’islam a inventé et vécu le djihad, la guerre sainte.
La chrétienté aboutit à Rome ; l’islam aboutit au loin à la Mecque et au tombeau du prophète, un centre nullement aberrant puisque l’islam court au long des déserts jusqu’au profondeur de l’Asie, puisqu’il est à lui seul, l’autre méditerranée, la contre-Méditerranée prolongée par le désert.
Aujourd’hui, le troisième personnage ne découvre pas aussitôt son visage. C’est l’univers grec, l’univers orthodoxe. Au moins toute l’actuelle péninsule des Balkans, la Roumanie, la Bulgarie, la Yougoslavie presque entière, la Grèce elle-même, pleine de souvenirs, où l’Hellade antique s’évoque et semble revivre ; en outre, sans conteste, l’énorme Russie orthodoxe.
Mais quel centre lui reconnaître ? Constantinople, direz-vous, la seconde Rome, et Sainte-Sophie en son cœur. Mais Constantinople depuis 1453, c’est Istanbul la capitale de la Turquie. L’islam turc a gardé son morceau d’Europe après avoir possédé toute la péninsule des Balkans au temps de sa grandeur. Un autre centre a sans doute joué son rôle, Moscou, la troisième Rome… Mais lui aussi a cessé d’être un pôle rayonnant de l’orthodoxie. Le monde orthodoxe d’aujourd’hui, est-ce un monde sans père ? »
Fernand Braudel : La Méditerranée : l’Espace et L’Histoire Collection Champs de Flammarion, 1985, page 157-160
Depuis 1985, il s’est passé des choses mais inscrites dans la longue durée on traduira : La Russie est redevenue orthodoxe et Moscou le centre du monde orthodoxe.
Nous voyons des conflits, nous voyons des islamistes qui revendiquent le califat et veulent abolir les frontières entre l’Irak et la Syrie et nous nous étonnons que la Russie ne se range pas spontanément à nos côtés.
Mais voilà, il y a autour de la Méditerranée 3 mondes, que la révolution industrielle, les guerres mondiales et le communisme n’ont pas effacé , l’Occident dont font partie les Etats Unis, l’Islam et le monde Orthodoxe qui s’épient, se jalousent, s’allient et s’affrontent.
Il n’est même pas certain que la révolution numérique aura raison de ce partage qui dure depuis des siècles et des siècles.
France Culture a diffusé pendant l’été 5 émissions consacrées à Fernand Braudel.
http://www.franceculture.fr/personne-fernand-braudel.html
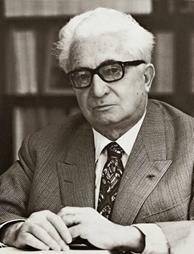 P.S. : Normalement vous savez tout cela, mais peut-être pour un rappel salutaire quelques dates :
P.S. : Normalement vous savez tout cela, mais peut-être pour un rappel salutaire quelques dates :
Le christianisme catholique peut être daté du moment où l’empire romain est devenu chrétien sous Théodose. C’est lui qui En 380 publia l’édit de Thessalonique : « Tous les peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l’apôtre Pierre, celle que reconnaissent le pontife Damase et Pierre, l’évêque d’Alexandrie, c’est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
Pour l’Islam, prenons comme date l’hégire qui désigne le départ des compagnons de Mahomet de La Mecque vers Médine, en 622.
Pour l’Orthodoxie qui a pris son envol à partir du moment où l’empire d’Orient avec pour capitale Constantinople s’est séparé de l’empire d’Occident. Mais la date symbole est certainement celle du Schisme de 1054 où le Pape de Rome et le patriarche de Constantinople se sont mutuellement excommuniés.
Enfin le protestantisme qui est analysé par Braudel comme un avatar du catholicisme et qui de toute évidence appartient à l’Occident, on peut revenir à la date du 31 octobre 1517 où Martin Luther aurait placardé sur les portes de l’église de la Toussaint de Wittemberg ses 95 thèses condamnant violemment le commerce des indulgences pratiqué par l’Église catholique, et plus durement encore les pratiques du haut clergé — principalement de la papauté.
Voici donc la profondeur historique des évènements auxquels notre monde et nos pays sont confrontés.
<575>
Lundi 12/10/2015
Une musette au pied de mon lit
Avec la peur au ventre, des humiliés
Des sans logis qui tremblent»
|
J’ai vécu
Au siècle des réfugiés
Une musette au pied de mon lit
Avec la peur au ventre
Des humiliés
Des sans logis
Qui tremblent
Les oubliés
Aux mal-partis
Ressemblent
Ils sont toujours les bras ballants
D’un pied sur l’autre mal à l’aise
Le cul posé entre deux chaises
Tout étonné d’être vivant
Ils sont souvent les en-dehors
Ceux qui n’écriront pas l’histoire
Et devant eux c’est la nuit noire
Et derrière eux marche la mort
Ils sont toujours les emmerdants
Les empêcheurs les trouble-fêtes
Qui n’ont pas su baisser la tête
|
Qui sont venus à contre temps
Dans tel pays c’est mal venu
Venir au monde t’emprisonne
Et chaque jour on te pardonne
Puis on ne te pardonne plus
On peut souvent les voir aussi
Sur les photos des magazines
Essayant de faire bonne mine*
Emmenez-moi au loin d’ici
Ils ont des trous à chaque main
C’est ce qui reste du naufrage
Ils n’ont pas l’air d’être en voyage
Les voyageurs du dernier train
Ils sont toujours les séparés
Le cœur perdu dans la pagaille
Les fous d’amour en retrouvailles
Qui les amènent sur les quais
Et puis parfois le fol espoir
Si elle a pu si elle arrive
De train en train à la dérive
Et puis vieillir sans la revoir
|
Vendredi 9 octobre 2015
Le mot du jour du 7 septembre 2015 parlait de photo. De ces photos pour l’éternité.
 Dorothea Lange fut une des plus grandes photographes, à ce titre.
Dorothea Lange fut une des plus grandes photographes, à ce titre.
Dorothea Lange est morte le 11 octobre 1965 à San Francisco, il y a cinquante ans, ce dimanche, dans deux jours.
Elle était née le 26 mai 1895.
Ses travaux les plus connus ont été réalisés pendant la Grande Dépression.
Elle avait collaboré avec John Huston dans le cadre du film « Les raisins de la colère ».
L’article lié explique qu’elle aura poussé si loin l’empathie et la compassion avec la chair blessée du peuple américain que son œuvre devient témoignage, amour du prochain et cri de révolte.
Elle aura eu une profonde influence sur ce qui deviendra le photo-journalisme, la photographie documentaire. Elle ne se souciait point de cadrage ou d’esthétisme, mais de rendre dignité et émotion aux gens ordinaires, à ceux qui sont le peuple, mot qui fait tant peur encore aujourd’hui.
Elle a sillonné les routes au volant de sa vieille voiture Ford, pour croiser les Indiens, les migrants, les déportés de la vie.
Son regard est unique, car comme si elle photographiait une scène biblique, une Pietà par exemple, elle donne à ses modèles une profondeur humaine qui touche à l’universel, à l’humanité toujours vivante même au plus profond de la misère.
Elle qui vivait au chaud dans sa carrière toute tracée, en 1920 à San Francisco, comme photographe de portrait des riches bourgeois, ressent très vite l’appel des routes et de la poussière du monde.
Elle s’échappe d’abord dans le sud-ouest de son pays, pour travailler sur les images des Indiens d’Amérique en voie de disparition lente.
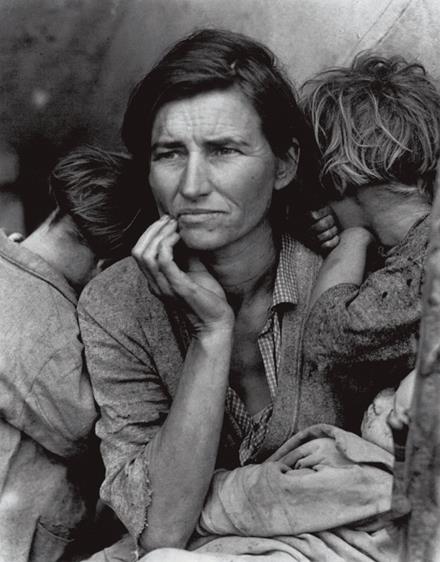 Son appareil photo devient un témoin, ses photographies preuves évidentes et convaincantes de l’immense misère, et du sort fait aux défavorisés. Son travail dès 1935 avec les administrations fédérales de réinstallation (plus tard la Farm Security Administration, connue sous le sigle FSA) est le plus puissant acte d’accusation dressé sur la souffrance des populations agricoles.
Son appareil photo devient un témoin, ses photographies preuves évidentes et convaincantes de l’immense misère, et du sort fait aux défavorisés. Son travail dès 1935 avec les administrations fédérales de réinstallation (plus tard la Farm Security Administration, connue sous le sigle FSA) est le plus puissant acte d’accusation dressé sur la souffrance des populations agricoles.
Son portrait de la mère migrante, « Migrant Mother, Nipomo, Californie, février 1936 », pris presque par hasard dans un campement de ramasseurs de pois, est devenu le symbole, un récit mythique, de ces migrations désespérées vers l’Ouest pour survivre, de ce qui fut un véritable exode américain. Cette photographie aura plus fait que tous les discours des politiques, et la conscience américaine en aura été changée et bouleversée. Les « vagabonds de la faim » avaient grâce à elle une existence digne et humaine.
Pour le reste lisez cet article sur cette photographe exceptionnelle http://www.espritsnomades.com/artsplastiques/langedorothea/lange.html
Il y a aussi cette page où sont reproduites ses photos
Ou encore cette page : <J’ai aussi trouvé ce blog>
<573>
Jeudi 8 octobre 2015
– il se mesure de manière objective
– il permet de séparer la vie professionnelle de la vie personnelle.
– le limiter, c’est protéger la santé.»
Il semblerait que la grande question du moment en France est celle «du carcan des 35 heures».
Je veux bien comprendre qu’il y a de ci de là des problèmes d’organisation.
Mais enfin, les réflexions de Daniel Cohen et d’autres montrent à l’évidence que nous avons un problème général d’emploi correctement rémunéré pour tous, dans tous les pays développés.
Alors il existe des pays, peut-être ont-ils raison, qui préfèrent des jobs très mal payés (Allemagne, USA, GB) que pas de job du tout et des allocations chômages coûteuses (France).
Mais s’il n’y a pas assez d’emplois pour tout le monde, j’ai du mal à comprendre que la solution est de faire travailler davantage celles et ceux qui ont déjà un emploi.
Mais ce n’est pas de cet aspect de la durée du travail que je souhaite vous entretenir aujourd’hui mais de la référence même au temps de travail comme mesure du travail.
Parce que la tentation, « la modernité » conduit toujours davantage à considérer que le temps de travail constitue une mesure archaïque du travail. C’est particulièrement vrai dans le monde numérique.
On est passé d’une économie de «main d’œuvre» à une économie de «cerveau d’œuvre» et le cerveau n’arrête pas de réfléchir. On réfléchit tout le temps.
Par quoi veut-on alors le remplacer ?
Certains parlent de «charge de travail» à laquelle l’employé doit faire face.
Plus généralisé est le management par objectif qui permet aussi de s’émanciper largement du temps de travail. Au début, cette convention « Tu as un objectif à atteindre, mais tu t’organises comme tu l’entends » constitue un hymne à la liberté, à l’ingéniosité et peut être même à la capacité de travailler moins si on « se débrouille très bien ». Et puis un objectif, en principe c’est objectif et rationnel.
Mais vous comprendrez bien que la quantification de l’objectif, comme la charge de travail, peut constituer un piège qui pour celui qui s’astreint ou même est contraint, sous peine de perdre son emploi, d’atteindre son objectif, peut dégénérer dans une explosion perverse de la durée consacrée au travail.
Pascal Lokiec, professeur de droit social à l’université Paris Ouest-Nanterre-La Défense invité à l’émission du grain à moudre du 15/09/2015 rappelle qu’en réalité seul le temps de travail, la durée qu’on consacre au travail constitue une mesure objective.
Il explique :
« Il faut être très vigilant quand on entend dire que demain le temps de travail ne sera plus la mesure du travail. Le temps de travail est protecteur à plusieurs titres :
D’abord il se mesure de manière objective
La charge de travail qu’on veut parfois substituer au temps de travail est très subjective
Ensuite le temps de travail permet de séparer la vie professionnelle de la vie personnelle.
Et enfin limiter le temps de travail c’est protéger la santé.»
C’est pourquoi la durée de travail reste un critère déterminant.
L’émission était consacrée à un rapport sur le droit du travail du DRH d’Orange à Myriam El Khomri consacré aux impacts du numérique sur la vie au travail.
Parmi les propositions, une redéfinition du salariat et une réflexion sur le temps de travail.
[…] Elles sont censées alimenter le projet de loi que la ministre du Travail présentera, au plus tôt, d’ici la fin de l’année.
Est-il nécessaire de légiférer sur le sujet ?
Ce qui est sûr, c’est que l’arrivée du numérique a profondément modifié notre rapport au travail. Au sein de l’entreprise en brouillant la frontière entre vie professionnelle et vie privée, au point de remettre en cause la notion –centrale- de temps de travail. Mais aussi en dehors, en favorisant l’émergence de nouveaux entrepreneurs, des travailleurs indépendants, plus autonomes mais aussi plus précaires puisque n’étant pas sécurisé par un contrat. Comment accompagner ces bouleversements sans renier les fondements du droit du travail ?
Sur ces sujets, Mediapart a déniché une intervention du PDG d’Air France qui se lance dans des réflexions «très libres et très ouvertes».
<572>
Mercredi 7 octobre 2015
La France n’est pas un pays de race blanche.
En 1789, les français étaient quasi exclusivement de peau blanche.
Aujourd’hui il existe bien davantage de diversité.
Mais il n’y a pas de race blanche, il n’y a qu’une race humaine.
Et si un un humain a besoin urgemment d’une transfusion sanguine, un humain de peau blanche n’aura pas forcément besoin du sang d’un autre humain de peau blanche, mais bien du sang d’un humain disposant du même groupe sanguin et dont la couleur de la peau n’a aucune importance.
Ça c’est dit !
Mais grâce à la revue de presse internationale de France Culture du 02/10/2015 j’ai appris qu’il avait existé une «Shirley card»
Pour les plus jeunes, il faut d’abord rappeler qu’avant les cartes mémoires et la photo numérique, il existait des pellicules photos qu’il fallait développer pour obtenir des photos. Et que le «microsoft» des pellicules photos s’appelait Kodak.
C’est dans ce domaine qu’il a existé la «Shirley card». La carte Shirley, est une photo représentant une jeune femme blanche, qui s’appelait selon toute vraisemblance du même nom. Et ce terme est ensuite devenu plus générique, désignant l’ensemble des photos de jolies femmes blanches, dont la carnation servait de base pour doser le rendu couleur des pellicules.
Parce qu’une pellicule photo est faite, en réalité, de plusieurs couches enduites de substances chimiques, qui ont chacune un rôle de capteur de lumière bien précis, pour produire un rendu couleur équilibré. Et jusqu’aux années 1990, elles étaient donc dosées pour un rendu dédié à des peaux blanches et non pour rendre des nuances de brun ou de noir. Des tests ont été réalisés à partir de photos des années 1970, prises avec un appareil Kodak. Résultat, quand les peaux blanches ressortent et sont nettes, les peaux noires, elles, sont uniformes et sans nuance.
C’est un article du magazine SLATE qui nous révèle ainsi que les pellicules photos n’ont pas été conçues pour les peaux noires. Et la manière dont les professionnels s’en sont aperçus est surprenante. C’est la difficulté d’obtenir un bon rendu pour les photos de chocolat ou de certains types de bois dans les publicités de meubles, qui a mis en évidence ce déséquilibre.
Kodak a été puni ! L’entreprise n’a pas vu venir la révolution numérique et le 19 janvier 2012, Kodak dépose le bilan. Kodak et ses filiales américaines demandent à bénéficier de la protection de la loi sur les faillites afin de pouvoir se restructurer. Pour sortir de sa mauvaise situation financière, le groupe vend des brevets, notamment à Apple et Google, et change son organisation. A priori en septembre 2013, Kodak parvient à sortir de sortir du processus de faillite. Elle comptait 145 300 salariés à son apogée en 1988, l’effectif mondial de Kodak est tombé en dessous de 20 000 depuis.
Les jeunes numérix boy et girls vont dire : c’est de l’histoire ancienne, grâce au numérique plus de manipulation pour rendre les blancs plus beau !
Que nenni !
Slate nous apprend qu’il existe des avatars modernes et numériques. «Un article du site américain RACKED explique ainsi que la plupart des filtres Instagram consistent surtout à blanchir le teint des personnes photographiées. Et l’article d’en conclure : c’est ce qu’on appelle le racisme silencieux.»
et voici un exemple de la Shirley card
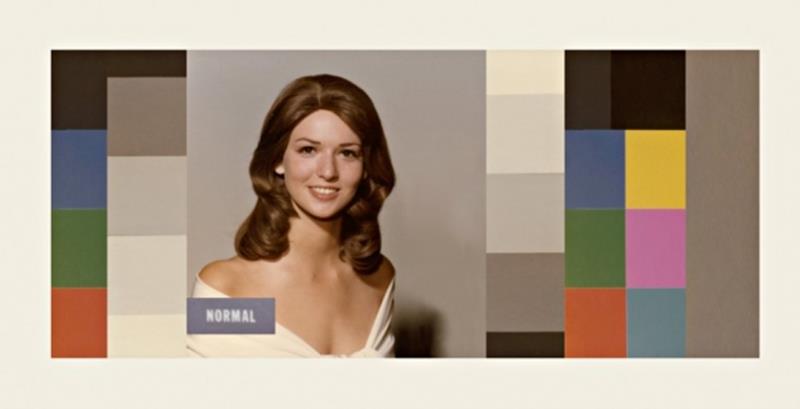
Vous apprécierez le mot «NORMAL» utilisé et je m’interroge sur ce qui peut bien être anormal ?
<571>
Mardi 6 octobre 2015
Les évènements en Syrie sont préoccupants.
Certains, dont Poutine, comparent la situation en Syrie à la 2ème guerre mondiale : DAESH c’est Hitler et Assad c’est Staline. Pour gagner contre DAESH, il faut s’allier à Bachar el Assad.
Dans cette situation, l’intervention de Dominique Moïsi au club de la presse d’Europe 1 m‘a semblé la plus éclairante.
D’abord comme référence historique, lui s’appuie sur la guerre d’Espagne. Ce qui n’est pas non plus très rassurant puisque tout cela a très mal fini.
Mais dans la guerre d’Espagne il y avait aux prises un bloc militaire fasciste et des républicains divisés. Le bloc militaire fasciste a bénéficié d’un appui militaire sans faille des nazis allemands et des fascistes italiens.
Les pays occidentaux, ennemis des fascistes ont soutenu mollement les républicains, parce qu’ils se méfiaient des communistes qui y jouaient un rôle important.
L’issue a été favorable au camp le mieux soutenu.
Force est de constater que dans l’affaire syrienne, la Russie, comme l’Iran sont très clairs : ils sont les alliés de Bachar el Assad et leurs ennemis sont les ennemis de Bachar el Assad.
L’Occident a pour ennemi DAESH mais ne trouve pas d’allié acceptable sur le terrain.
Il était question tout au début d’aider les démocrates. Moïsi dit :
« En Syrie, trouver des démocrates dans les groupes rebelles est un grand mot. Mais il existe des rebelles qui ne sont proche ni de l’Etat islamique, ni d’Al Qaïda »
Obama et Poutine se sont d’abord affrontés puis rencontrés à l’ONU.
Le fait qu’ils se parlent est positif. Même si certains prétendent que Poutine a berné Obama.
Les discours à l’ONU des deux protagonistes a montré non seulement des divergences de fond qui se synthétisent essentiellement dans le rejet ou l’alliance avec le tyran syrien, mais ont surtout montré la différence de stratégie.
Obama a fait un beau discours, ferme sur les principes et expliquant, grosso modo, ce que la morale devrait nous pousser à faire.
Poutine a réagi en chef de guerre. Il n’a pas changé de position depuis le début, il est allié du pouvoir syrien qui était en place avant les évènements et c’est avec ce pouvoir qu’il faut négocier.
Il propose son aide bienveillante aux européens qui doivent faire face à la crise des réfugiés et aux occidentaux en général pour lutter contre le terrorisme.
Bref le premier manie le concept, le second a ce que le grand penseur de la guerre « Clausewitz », considérait comme fondamental : un but de guerre clair et objectif : Aider Bachar El Assad à vaincre ses opposants et conserver ses positions stratégiques en Syrie.
Il faut dire que l’Occident a des alliés sunnites déconcertants et encombrants : L’Arabie Saoudite a pour premier ennemi l’Iran et les chiites. Elle a incontestablement soutenu tous les mouvements sunnites fondamentalistes partout dans le monde et même chez nous. Elle a un problème parce que Al Qaida d’abord puis DAESH ont totalement échappé à son contrôle. Quoique désormais il se rapproche du front Al Nosra qui est une créature d’Al Qaida pour essayer de contenir la progression de DAESH. Mais à la fin des fins, l’Arabie Saoudite aura toujours beaucoup de mal à combattre ces extrémistes sunnites si cela avait pour conséquence de donner la victoire aux chiites, par exemple à Assad.
La Turquie, notre allié, pièce maitresse de l’OTAN, est tout aussi ambigüe. Lors du siège de Kobané, il a empêché des Kurdes non syrien, d’aller combattre avec les kurdes syriens contre DAESH. Maintenant il bombarde en Syrie, mais pas les fiefs de DAESH mais les positions kurdes, car son principal ennemi est le PKK, le parti des Kurdes qui pourrait, selon les craintes d’Erdogan, faire sécession de la Turquie. Or, les kurdes sont quasi les seules troupes au sol qui se battent contre DAESH et qui constituent des interlocuteurs sérieux des Etats-Unis et des occidentaux.
En face les chiites et la Russie sont unis et ont une stratégie claire et univoque.
En outre Obama va vers la fin de son mandat, il est attentif à la trace qu’il laissera dans l’Histoire. Ses mandats ont été ceux de la stratégie inverse de GW Busch, à savoir, retirer les troupes américaines des bourbiers créés par son prédécesseur. La dernière chose que veut Obama c’est avoir des soldats combattants au sol. D’ailleurs, il semble qu’en privé il déclare que Poutine dans son intervention en Syrie est en train de commettre la même erreur que GW Busch.
Il faut dire que la dernière fois que la Russie qui était alors l’URSS a fait ce type d’intervention c’était en Afghanistan et que cela s’est très mal terminé pour elle.
Toujours est-il que si Poutine va peut-être devant de grandes difficultés, on ne comprend toujours pas comment les Etats-Unis, la France et ses alliés vont intervenir de manière opérationnelle, c’est à dire en étant en mesure d’influer sur les évènements.
Je finirai par ce propos clairvoyant rappelé par Moïsi :
Raymond Aron avait expliqué en son temps :
«Dans une guerre, vous choisissez votre ennemi, mais pas vos alliés.»
<570>
Lundi 5 octobre 2015
Le 15 septembre, les matins de France Culture avaient pour thème : La France une société bloquée ?
Le titre de l’émission fait référence à un livre que j’ai lu lors de mes études de Droit, début des années 1980, mais qui avait été publié en 1971, il y a près de 45 ans : «La France bloquée l» de Michel Crozier.
Le site de l’éditeur, le Seuil, donne ce résumé :
«Si l’on veut faire bouger cette société bloquée qu’est devenue la société française, il faut absolument secouer le carcan que fait peser sur elle la passion de commandement, de contrôle et de logique simpliste qui anime les grands commis, les patrons, les techniciens et mandarins divers qui nous gouvernent, tous trop brillants, trop compétents et trop également dépassés par les exigences de développement économique et social»
Dans cette émission, Guillaume Erner a invité Eric Maurin, directeur d’études à l’EHESS et auteur de «La fabrique du conformisme» (Seuil, 10 septembre 2015). Peter Gumbel, journaliste et auteur de «Ces écoles pas comme les autres : à la rencontre des dissidents de l’éducation» (La Librairie Vuibert, 14 août 2015). Le mot du jour du 18 juin 2013 était consacré à ce dernier : «Le bassin dans lequel on pêche l’élite française est minuscule» diagnostic qu’il avait explicité dans son livre «Elite Academy» Enquête sur la France malade de ses grandes écoles,
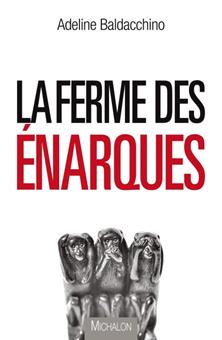 La dernière invitée était une pétillante jeune énarque issue de la promotion 2007-2009 et auteure de «La ferme des énarques» (Michalon, 3 septembre 2015) : Adeline Baldacchino. Le titre de son livre s’inspire du livre écrit en 1945 par George Orwell, «la ferme des animaux» où les animaux se révoltent contre les humains, les chassent de la ferme et prennent le pouvoir qui se transformera en dictature. C’est une satire de la révolution russe et du stalinisme.
La dernière invitée était une pétillante jeune énarque issue de la promotion 2007-2009 et auteure de «La ferme des énarques» (Michalon, 3 septembre 2015) : Adeline Baldacchino. Le titre de son livre s’inspire du livre écrit en 1945 par George Orwell, «la ferme des animaux» où les animaux se révoltent contre les humains, les chassent de la ferme et prennent le pouvoir qui se transformera en dictature. C’est une satire de la révolution russe et du stalinisme.
C’est cette énarque qui révèle le véritable mot d’ordre des énarques. Vous savez peut être que la devise de l’ENA est «servir sans s’asservir» certains ajoutant « et sans se servir».
Mais Adeline Baldacchino nous rapporte que dans son action quotidienne, l’énarque qui pense à sa carrière va plutôt mettre en œuvre ce conseil d’ancien, synthétisé par un acronyme :
«PDV MV PDV», «Pas de vague, mon vieux, pas de vague.»
Elle en ajoute un autre dans l’émission :
«MRVC», «Mon remplaçant verra ça».
Vous comprendrez donc aisément que sur cette base on ne peut aboutir qu’à une société bloquée puisque nous sommes, dans ce cas, dans un univers où tous les conservatismes sont préférables à la vraie réforme, à celle qui permet de se hisser aux défis de la modernité.
Pour illustrer son livre, Adeline Baldacchino a choisi les trois singes de la sagesse chinoise qui se cache les yeux, se bouche les oreilles et se ferme la bouche : Refuser de voir, d’entendre et de parler.
Dans un article du <Figaro> on lit : Dans cette école qui enseigne à «dé-penser», où l’on n’apprend rien que l’on n’ait déjà appris à Sciences Po – hormis pendant les stages – la culture se réduit à des fiches, des résumés, des condensés, des «petits pots de la pensée», plus digestes et surtout plus utiles. Car à l’ENA on ne lit pas. Ou à la rigueur la presse. «Le Canard enchaîné est le petit vice secret [de l’énarque], mais il ne circulera jamais en public avec autre chose que Le Monde ou Les Echos dans les couloirs de l’école. Alternatives économiques relève du domaine de la grande subversion. […] Le dernier BHL peut tout de même se lire en terrasse.»
Mais je trouve particulièrement révélateur cet entretien de Adeline Balacchino sur le <site acteurs publics> :
«Un jour, donc, je lançai l’idée d’accueillir une fois par mois à Strasbourg un écrivain, éventuellement ex ou actuel fonctionnaire si cela devait permettre d’amadouer l’école, de lui proposer de faire une conférence sur sa vision du service public, et de dîner avec eux en organisant le débat. Je pensais à Orsenna pour commencer, j’avais envie de le rencontrer à cause de sa belle histoire de la mondialisation, Sur la route du papier.
On me regarda avec des yeux ronds, très ronds. Pour quoi faire ?
Dans quel module cela s’inscrirait-il ?
Gestion et management public, sûrement pas. Légistique, encore moins. Finances publiques, ne plaisantons pas. Pour quoi faire ?
L’école, ce n’est pas la création, ce n’est pas l’innovation, c’est la gestion, on vous a dit. De l’existant. De ce qui est. Quant à ce qui devrait être…
J’imaginais bêtement en arrivant à Strasbourg que nous aurions de vastes débats sur l’économie du bien-être, les théories politiques post-rawlsiennes de la redistribution sociale, l’état des recherches sur la lutte contre la pauvreté, la fiabilité des techniques de sondage, les questions de responsabilité du fonctionnaire, les génocides, les théocraties, Foucault et l’Iran, la désobéissance civile, les minimas sociaux et les effets de seuil, les politiques éducatives, la transition énergétique…
J’imaginais follement un croisement entre le monde des intellectuels, chercheurs, scientifiques et celui des administrateurs, gestionnaires, managers. Je me disais que tout ce que j’avais lu pourrait enfin irriguer le vrai monde où l’on fait (…).
Or, non. Cela n’existe pas. Cela n’est pas fait pour ça. L’économie, par exemple, on l’étudie, non pour comprendre ses usages possibles mais pour savoir ce qu’il faut en dire.
Ainsi, l’énarque lambda sortira-t-il à la direction du budget. Il n’aura qu’une idée très limitée, parfaitement scolaire (au mieux, elle tient dans la lecture et la relecture du manuel de référence qu’on nomme le « Pisani-Ferry ») des mécanismes économiques.
Ne parlons pas de débats. Mais il sera sûr d’une chose, absolument. Il faut – parce que « c’est bien » –, dans le bon ordre : faire des économies, tenir le cap de la rigueur budgétaire, maîtriser la dépense, affamer la Grèce mais ils n’avaient qu’à payer leurs impôts plus tôt, proposer une trajectoire d’équilibre des comptes publics, ne pas fâcher la Commission européenne, ne pas parler, jamais, tabou, des keynésiens, de Joseph Stiglitz ou de Paul Krugman (…).
Mais tout cela, l’énarque n’en parle pas, c’est trop dangereux, car d’une part ce n’est pas « ce qu’il faut dire », d’autre part il n’y connaît rien, donc il ne prendra pas le risque d’affirmer l’inverse.
Il lui suffit de savoir que ce n’est pas ce qu’il faut dire. Il est fin prêt pour la direction du budget, ou pour le cabinet du ministre des Finances. Il y prêchera l’austérité, même contra-cyclique, même à contretemps, même contre toute évidence, parce que c’est ce qu’on lui a dit qu’il fallait dire, un jour.»
Les énarques sont sélectionnés par rapport à leur capacité de redire et de refaire ce qui a toujours été fait. «De l’existant. De ce qui est.» dit Adeline Balacchino. Il n’est pas impossible qu’ils soient créatifs ou innovateurs, mais force est de constater que ce n’est pas sur cela qu’on les juge et qu’on les recrute.
Je finirai par une photo, celle d’un éminent et brillant énarque qui est parvenu à se faire élire président de la République :
Le Président de la République dans son bureau, le 24 février 2015, entouré d’une montagne de papier
 Le décryptage de cette photo amène à plusieurs réflexions :
Le décryptage de cette photo amène à plusieurs réflexions :
- 1° Cela montre, combien de décisions relèvent du Président de la République. Cet homme n’a plus le temps de réfléchir, d’être stratège s’il faut que dans la journée il doivent se prononcer sur tant d’affaires particulières. Cette photo montre ainsi le blocage du fonctionnement de l’Etat, celui d’un Président qui ne sait pas déléguer, qui doit tout voir ou en tout cas plus qu’il n’est en capacité de maîtriser. Vous me direz, nul besoin de cette photo lorsqu’on se souvient de son intervention sur le cas particulier de Leonarda où le président stratège s’est rabaissé à un simple gestionnaire des affaires courantes.
- 2° Il n’y a pas d’ordinateur ou d’autre outil moderne d’accès à l’information. Cette photo dans les dorures du palais n’a comme seul élément de modernité visible utilisé, par rapport au 19ème siècle, que l’électricité de la lampe de bureau. Electricité généralisée au début du XXème siècle. rappelons que c’est la ville de Heilbronn (Allemagne) qui est en 1892 la première ville en Europe équipée d’un système de distribution en électricité par un réseau de distribution en courant alternatif. Il y a peut-être au premier plan un DVD ou un CD, élément de modernité déjà largement dépassé dans le monde des réseaux.
- 3° Cet homme est totalement structuré par la «culture papier» où on accède à l’information par le papier, on décide sur le papier, on communique par le papier. Je m’interroge : une organisation fonctionnant de cette manière permet-elle de comprendre la civilisation du numérique et de nous préparer au monde de demain. Cette incapacité de s’extraire de l’existant, de la manière de fonctionner du XIXème siècle me semble inquiétante, surtout si on intègre PDV MV PDV.
<569>
Vendredi 02/10/2015
Jeudi 1 octobre 2015
Et c’est cela qui doit déterminer les alliances. »
<Parmi ces émissions de Radioscopie rediffusées par France Inter, j’ai été particulièrement intéressé par celle où Jacques Chancel avait reçu en décembre 1973 : Pierre Mendès France : <Ne plus gouverner c’est encore choisir>
Pierre Mendès-France ne fut que quelques mois au pouvoir en tant que président du conseil entre avril 1954 et février 1955, mais on en parle encore comme d’une référence.
Il appartenait au parti radical-socialiste, il s’est toujours présenté comme un homme de gauche mais beaucoup de politiques de droite comme de gauche, le reconnaissent comme un modèle.
Michel Rocard s’est toujours réclamé de lui.
Il me semble que le gouvernement actuel de la France qui se réclame de la gauche et du réalisme économique et politique devrait s’en inspirer.
Toute l’émission est passionnante, tant cet homme parle de vérité et d’intelligence. Mais je mets l’accent sur trois développements
1° Jacques Chancel lui lance :
« Un homme politique au Pouvoir n’a pas le temps d’approfondir, il a trop de responsabilité. »
Et Mendès-France de répondre :
« C’est pourquoi il doit toujours travailler quand il n’est pas au pouvoir. Il doit arriver au pouvoir préparé. Dire quand j’y serai il sera toujours temps de décider, cela c’est une erreur »
2° Après avoir rappelé l’importance des Partis politiques dans une démocratie, il explique :
« Ce qui est critiquable c’est quand l’intérêt d’un parti passe au-dessus de l’intérêt général.
Les dirigeants d’un Parti au moment de prendre une décision au lieu de prendre en compte en priorité l’intérêt de la nation font prévaloir l’intérêt de leur formation politique, parce qu’il y a des élections prochaines ou qu’il y a une manœuvre parlementaire à réaliser.
C’est cela que j’ai critiqué non pas l’existence des partis. »
3°
« Ce qui est fondamental c’est que les hommes dans le cadre d’une action gouvernementale se soient mis d’accord préalablement sur ce qu’ils allaient faire.
Un gouvernement se constitue non pour distribuer des portefeuilles, non pas pour favoriser telle opération à l’horizon mais pour faire aboutir une réforme une amélioration qu’on estime dans l’intérêt du pays.
Et c’est cela qui doit déterminer les alliances. Si des hommes sont d’accord pour faire quelque chose, il n’y a pas de raison d’en exclure certains.
Si des hommes ne sont pas d’accord pour faire quelque chose je trouve que c’est une escroquerie de les réunir. Parce qu’arriver au gouvernement ils s’annulent, ils se paralysent.
Le critère déterminant c’est ce qu’on veut faire ensemble.
C’est pourquoi depuis longtemps l’idée d’un programme de gouvernement m’a paru absolument essentiel. »
 Je pense que tous ces propos et tous ces conseils restent très actuels.
Je pense que tous ces propos et tous ces conseils restent très actuels.
Mais il me semble qu’on s’en éloigne parfois ou même souvent.
Être préparé quand on arrive au pouvoir. Je pense que ce fut le cas en 1988 quand Michel Rocard pris la tête du gouvernement.
Fut-ce le cas en 2012 ?
Préférer l’intérêt de la nation à l’intérêt du Parti.
Il me semble avoir lu que des stratèges du PS bien que considérant qu’Alain Juppé serait préférable comme Président à Nicolas Sarkozy, souhaitent tout faire pour privilégier la victoire aux primaires de l’ancien Président car le Président actuel pense qu’il dispose de plus de chance de gagner contre l’un que contre l’autre.
Si tel est le cas, on ne suit pas le conseil de Pierre Mendès-France.
Enfin le dernier développement qui constitue encore une évidence : pour bien gouverner il faut mettre ensemble des gens qui sont d’accord sur l’essentiel et se mettre dans le cadre d’un programme de gouvernement que tout le monde aura accepté.
Force est de constater que ce n’est pas le cas.
On élit un président sur ses promesses.
Une fois au pouvoir l’élu fait ce qu’il peut au gré des événements et des lobbys.
Et si on trouve dans les deux camps des personnes qui seraient capable de gouverner ensemble, chacun des camps se trouvent très divisés sur ce qu’il y a à faire, et Mendès de dire «Si des hommes ne sont pas d’accord pour faire quelque chose je trouve que c’est une escroquerie de les réunir»
Le gouvernement de l’Allemagne est beaucoup plus proche de ce que décrit Pierre Mendès-France.
Certains diront, c’est à cause de la 5ème République et de l’élection du Président au suffrage universel.
Il est vrai que sur ce point Pierre Mendès-France était totalement opposé à l’élection du président au suffrage universel et cela dès le début.
On comprend mieux pourquoi la France a du mal à faire des réformes et les hommes au pouvoir à se faire réélire.
Sur la page de Radio France, sur laquelle cette émission est republiée, il y a une courte biographie de ce grand politique, surnommé PMF, né en 1907 et mort le 18 octobre 1982 :
Sa carrière en quelques lignes :
Il s’initie à la vie politique dès 1924 dans les mouvements étudiants d’opposition à l’extrême-droite puis est élu député de l’Eure en 1932, à 25 ans.
Radical-socialiste, il participe à la coalition du Front Populaire. Il est membre de l’éphémère second gouvernement Blum en mars et avril 1938.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été incarcéré par le régime de Vichy, il parvient à rejoindre la Résistance et s’engage dans les Forces Aériennes Françaises Libres. Il est commissaire aux Finances puis ministre de l’Économie nationale dans le gouvernement provisoire du Général de Gaulle de septembre 1943 à avril 1945.
Nommé Président du Conseil par le Président René Coty, en juin 1954, il cumule cette fonction avec celle de Ministre des Affaires Étrangères .
S’il parvient à conclure la paix en Indochine, à préparer l’indépendance de la Tunisie et à amorcer celle du Maroc, ses tentatives de réforme en Algérie entraînent la chute de son gouvernement, cible à la fois de ses adversaires colonialistes et de ses soutiens politiques habituels anti-colonialistes. Il quitte alors la présidence du gouvernement en février 1955, après avoir été renversé par l’Assemblée Nationale sur la question très sensible de l’Algérie française.
Ministre d’État sans portefeuille du gouvernement Guy Mollet en 1956, il démissionne au bout de quelques mois en raison de son désaccord avec la politique du Cabinet Mollet menée en Algérie.
Il vote contre l’investiture de Charles de Gaulle à la présidence du Conseil en juin 1958, puis abandonne tous ses mandats locaux après sa défaite aux élections législatives du mois de novembre de la même année.
Élu député de la 2e circonscription de l’Isère en 1967, puis battu l’année suivante, il forme un « ticket » avec Gaston Defferre lors de la campagne présidentielle de 1969.
Bien qu’il n’ait dirigé le gouvernement de la France que pendant un peu plus de sept mois, il constitue une importante figure morale pour une partie de la gauche en France. Au-delà, il demeure une référence pour la classe politique française, incarnant le symbole d’une conception exigeante de la politique.
<567>
Mercredi 30/09/2015
|
|
JACQUES CHANCEL
|
Mardi 29/09/2015
|
|
OLIVER SACHS
Michael Nyman a écrit un opéra sur le texte de « L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». Cet opéra sera produit cette année par l’Opéra de Lyon au Théâtre de la Croix Rousse et nous avons pris des places le 14 novembre.
|
lundi 28/09/2015
Et dis que c’est bien, que c’est beau, ils veulent être aimés. »
vendredi 25/09/2015
Son corps sera ensuite monté sur une croix
et exposé publiquement jusqu’au pourrissement de ses chairs.»
|
|
Qu’a fait d’horrible ce jeune homme de 21 ans pour mériter pareil sort ? Je cite le Figaro : [Il a] «participé en 2012 à une manifestation contre le régime saoudien dans la région majoritairement chiite de Qatif. Il était alors seulement âgé de 17 ans. Le jeune homme est également accusé de faire partie d’une organisation terroriste. Armé, il aurait jeté des cocktails Molotov contre les forces de l’ordre. »
A priori, il n’a tué personne.
«Selon l’ONG Reprieve, qui assure sa défense, les aveux signés par l’accusé ont été obtenus sous la torture. […]
|
D’abord obtenir des aveux par la torture
Ensuite pratiquer la peine de mort
Après pratiquer la peine de mort dans des cas défiant toute raison
Enfin appliquer la peine de mort de manière ignoble et barbare.
Jeudi 24/09/2015
|
Plusieurs m’écrivent pour me dire qu’ils ont du retard dans la lecture des mots du jour.
D’autres vont jusqu’à instiller la suspicion que les mots du jour seraient trop longs.
Écoutant les uns et les autres je fais court avec ce dessin partagé sur facebook par Rosemarie l’amie d’Annie et donc de moi.
Le père : Dans ton école, il y a des étrangers ?
La fille : Non, dans mon école il n’y a que des enfants !
Et puis c’est tout.
Merci Rosemarie
|
|
Mercredi 23/09/2015
La place des Hommes Debout !»
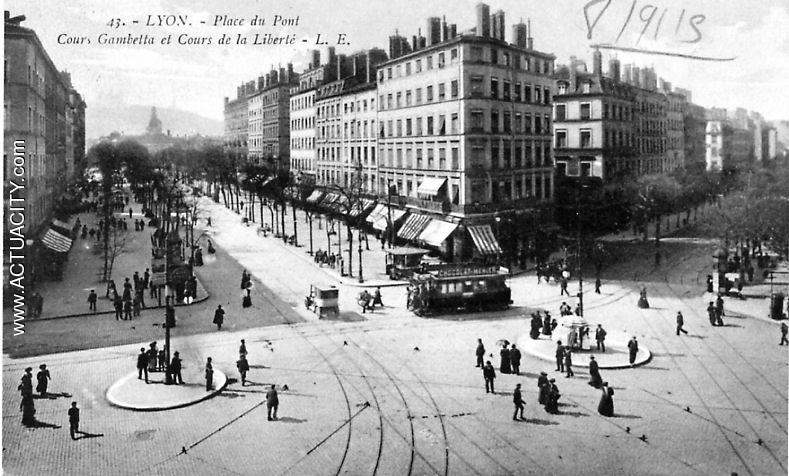
Mardi 22/09/2015
Lundi 21/09/2015
Vendredi 18/09/2015
Jeudi 17/09/2015
mais une insécurité historique »
Mercredi 16/09/2015
Mardi 15/09/2015
De tout temps, la fuite et l’expulsion ont été les conséquences de la violence. »
Lundi 14/09/2015
[…] Seid umschlungen, Millionen !
Diesen Kuß der ganzen Welt !»
Tous les hommes deviennent frères ;[..]
Soyez enlacés, millions !
Ce baiser au monde entier !
Un enchantement !
Ce samedi 12 septembre, l’orchestre National de Lyon faisait sa rentrée dans l’écrin de l’auditorium de Lyon.
Léonard Slatkin, qui a donc 70 ans, a choisi la 9ème symphonie de Beethoven qui se termine par l’Ode à la joie sur un texte de Friedrich Schiller pour ce début de sa 5ème saison à Lyon.
Léonard Slatkin est un grand chef qui dirige magistralement ce chef d’œuvre.
Si vous prenez une des grandes interprétations enregistrées de cette œuvre, vous trouverez des chefs comme Furtwaengler, Toscanini, Klemperer, Karajan qui ont encore une plus grande dimension que Slatkin dans l’art de l’interprétation.
Et même si les merveilleux musiciens de l’Orchestre de Lyon forment un bel orchestre, il n’a pas la qualité de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, de Vienne, de l’Orchestre du ConcertGebow d’Amsterdam, de la Staatskapelle de Dresde ou du Chicago Symphony Orchestra.
Pourtant, je vous le dis, jamais une musique enregistrée, même écoutée dans les meilleures conditions techniques ne pourra atteindre l’émotion et la somptuosité d’une belle interprétation en direct dans une salle de concert digne de ce nom.
Et comme Slatkin est non seulement un grand chef mais aussi un show man américain, il a eu l’idée à la fin du concert de faire chanter l’ensemble du public de l’auditorium Maurice Ravel, donc 2120 personnes (il ne restait aucune place de libre) un extrait de l’ode à la joie, car on avait distribué une partition à l’entracte.
Cela ajouta à l’euphorie du concert.
Vous allez me poser la question : Mais pourquoi est-il pertinent, mis à part le fait que tu sois allé à ce concert, de parler aujourd’hui de l’ode à la joie de Schiller mise en musique par Beethoven ?
D’abord parce que lorsqu’on est passionné, le besoin de partager sa passion est irréfragable.
Ensuite parce qu’il est toujours sage d’apprendre, même des bribes de savoir, d’un passionné.
Et puis vous n’êtes pas sans savoir que l’ode à la joie sert depuis 1986 comme base à <l’hymne européen>
En raison de la multiplicité des langues de l’Union, il s’agit d’un hymne sans parole, la musique étant un langage universel.
Et cette ode est un hymne à la fraternité que Beethoven, dans sa croyance panthéiste, a offert au Monde.
 La fraternité qui est aussi le troisième terme de la devise de la République française.
La fraternité qui est aussi le troisième terme de la devise de la République française.
La fraternité que Régis Debray a expliqué si justement :
«Être fraternel, c’est faire famille avec ceux qui ne sont pas de la famille.»
(Mot du jour du 13 février 2013)
Et c’est pourquoi je trouve ce rappel pertinent en pleine crise des réfugiés.
L’ode à la joie a aussi été utilisée par Léonard Bernstein pour célébrer la chute du mur de Berlin et il a interprété cette œuvre en remplaçant le mot de « joie » par celui de « liberté ».
En français, remplacer « joie » par «liberté» pose une difficulté de syllabes et de rythme.
Mais tel n’est pas le cas en allemand où remplacer « Freude » par « Freiheit » est aisée, on pourrait aussi le remplacer par «Friede» (paix).
Voici une belle interprétation de la 9ème symphonie de Beethoven : <Chicago Symphony Orchestra – Riccardo Muti>
Et voici la 9ème utilisée comme musique d’un ballet de Maurice Béjart. <Il s’agit d’un extrait – ici le 3ème mouvement>
Voici la version de la liberté à Berlin de Bernstein <Bernstein dirige à Berlin l’ode à la Liberté>
Et voici < l’hymne européen >
Voici le texte de L’ode à la joie :
Joie ! Joie ! Belle étincelle divine,
Fille de l’Elysée,
Nous entrons l’âme enivrée
Dans ton temple glorieux.
Ton magique attrait resserre
Ce que la mode en vain détruit ;
Tous les hommes deviennent frères
Où ton aile nous conduit.
Si le sort comblant ton âme,
D’un ami t’a fait l’ami,
Si tu as conquis l’amour d’une noble femme,
Mêle ton exultation à la nôtre!
Viens, même si tu n’aimas qu’une heure
Qu’un seul être sous les cieux !
Mais vous que nul amour n’effleure,
En pleurant, quittez ce chœur !
Tous les êtres boivent la joie,
En pressant le sein de la nature
Tous, bons et méchants,
Suivent les roses sur ses traces,
Elle nous donne baisers et vendanges,
Et nous offre l’ami à l’épreuve de la mort,
L’ivresse s’empare du vermisseau,
Et le chérubin apparaît devant Dieu.
Heureux, tels les soleils qui volent
Dans le plan resplendissant des cieux,
Parcourez, frères, votre course,
Joyeux comme un héros volant à la victoire!
Qu’ils s’enlacent tous les êtres !
>Ce baiser au monde entier !
Frères, au-dessus de la tente céleste
Doit régner un tendre père.
Vous prosternez-vous millions d’êtres ?
Pressens-tu ce créateur, Monde ?
Cherche-le au-dessus de la tente céleste,
Au-delà des étoiles il demeure nécessairement
<554>
Vendredi 11/09/2015
Jeudi 10/09/2015
|
|
Il avait tenu un blog pendant ses années de présence à Jérusalem : <http://geopolis.francetvinfo.fr/charles-enderlin/>
Je pense que son dernier reportage sur les fanatiques religieux israéliens est aussi d’un grand intérêt pour tous ceux qui tentent de comprendre ce qui se passe sur cette terre que la folie religieuse a proclamé sacrée : <Au nom du temple>
|
Mercredi 9 septembre 2015
Marc Voinchet a quitté les matins de France Culture pour prendre la direction de France Musique.
 Il a été remplacé par Guillaume Erner qui dans sa présentation a eu ces mots
Il a été remplacé par Guillaume Erner qui dans sa présentation a eu ces mots
«Voici le premier matin ensemble !
Cela compte un premier matin !
Une phrase s’est imposée pour définir les matins qui s’annoncent : comprendre le monde c’est déjà le transformer !
Il y a une foule d’individus qui pensent qu’il va de leur intérêt de maintenir la méconnaissance des choses : les dealers de temps de cerveau disponible, les poujadistes de tout pelage, ceux qui aimerait bien imposer la souveraineté du people sur celle du peuple.
En un mot tous ceux qui ont intérêt à la mésintelligence du monde.
C’est contre eux qu’il faut se réveiller pour interrompre le sommeil de l’intellect.
Tous les verbes qui nous arrachent à la nuit de la pensée : comprendre, expliquer, réfléchir sont des verbes militants.»
J’adhère à cette quête, tout en restant plus modeste : essayons de comprendre le monde…
<551>
Mardi 8 septembre 2015
1598 Henri IV donne à la France L’Édit de Nantes qui offre la liberté de culte aux protestants
1685 Louis XIV révoque l’Édit de Nantes par l’Édit de Fontainebleau qui interdit le culte réformé en France
1787 Louis XVI redonne un Édit de Tolérance à Versailles
Lundi 7 Septembre 2015
une photo fige une scène pour l’éternité »
Dans la difficile quête quotidienne du mot du jour, il faut trouver une citation et son auteur.
Je me souviens avoir lu cette formule qui me parait si exacte, dans la fin des années 1980, alors que je débutais dans la photographie, mais je ne me souviens pas de l’auteur.
Cette phrase m’avait marqué, je m’en souviens encore et j’ai toujours préféré faire des photos que des vidéos.
Les documentaires peuvent expliquer les situations de manière détaillée, argumentée, ils n’auront jamais la force d’une photo.
Aujourd’hui tout le monde ne parle que d’une photo, celle du petit Aylan Kurdi, enfant syrien noyé et trouvé sur une plage de Turquie par la photographe turque Nilüfer Demir.
Les journaux français ont hésité à la publier dans un premier temps, ils avaient peur que la photo fût choquante. Ils ont cependant compris que ce n’était pas la photo qui était choquante, mais la situation qu’elle révèle.
Cette photo va devenir historique comme la photo de l’enfant juif du ghetto de Varsovie, dans les années 40, les mains levées avec des soldats armés en arrière-plan. Ou la photo du Viet Nam d’une jeune fille nue brulée au napalm ou encore cet homme seul qui arrête une colonne de chars lors des évènements de la Place Tien an Men en Chine.
Que d’émotion !
Oui ! c’est un enfant blanc, couché sur la plage. Il est habillé avec un tee shirt rouge et un short bleu comme ceux qu’on peut trouver dans nos magasins.
Oui ! Cela pourrait notre enfant !
Nous n’avons alors aucun mal à nous projeter dans une compassion mimétique. Nous comprenons la douleur du père d’Aylan. Et nous trouvons cela bien sûr terrible et spontanément nous voulons aider.
Cette photo a vraiment renversé les opinions les plus tranchées Comme le journal anglais THE SUN qui se targue aujourd’hui d’avoir publié la photo du jeune Aylan et demandé au Premier ministre d’agir pour aider les réfugiés, mais qui quelque jours auparavant interpellait David Cameron, mais cette fois-ci pour exiger qu’il tire une ligne rouge sur l’immigration qui submerge le Royaume-Uni. Une journaliste du SUN avait comparé les migrants se rendant en Grande-Bretagne à des cafards. Certaines de nos villes, écrivait-elle à l’époque, sont des plaies purulentes couvertes de nuées d’immigrés et de demandeurs d’asile recevant des allocations comme des billets de Monopoly.
D’ailleurs, David Cameron ne voulait pas non plus de réfugiés syriens sur son territoire <avant la photo>, alors que la Grande Bretagne était au côté des Etats Unis de GW Busch lorsqu’il a décidé d’attaquer l’Irak.
En Hongrie on construit un mur pour arrêter les réfugiés, en Pologne on n’en veut pas. Ces deux pays qui alors qu’ils étaient sous le joug soviétique ont vu beaucoup de leurs ressortissants s’enfuir et se réfugier en Europe de l’Ouest.
Les slovaques veulent bien recevoir des réfugiés mais uniquement s’ils sont chrétiens, c’était du moins leur position avant la photo.
L’émotion oui. Il ne faudrait pas que notre cœur se ferme à notre capacité d’être touchée par les sentiments d’humanité. Il est rassurant que nous ne nous soyons pas qu’un cerveau et un portefeuille.
Mais l’émotion peut être suspecte, provoquée, dévoyée.
L’émotion est passagère aussi.
La raison nous ramène à l’Histoire. Pas à un évènement en particulier, mais l’Histoire dans la durée, celle qui permet de comprendre ce qui se passe.
Alors voilà en 1914, l’Irak, la Syrie, la Palestine, l’Arabie était territoire de l’Empire Ottoman.
L’empire Ottoman a été dans le camp des vaincus, il a donc été démembré.
La Grande Bretagne et la France étaient les vainqueurs triomphants.
En 1916 deux hommes un français François Georges-Picot, un anglais Mark Sykes vont se mettre d’accord sur un partage de zones d’influence entre leurs 2 pays. On parlera des accords de Sykes-Picot. La future Syrie est sous responsabilité française et le futur Irak sous protectorat britannique. Ce partage ne tenait pas compte des populations locales.
Et puis après la seconde guerre, le 17 avril 1946 pour la Syrie, sur la base de ce découpage et dans les limites décidées par les occidentaux, la Syrie est devenue un Etat. On a décidé que la population vivant sur ce territoire serait la nation syrienne.
Il a fallu des siècles aux Français pour devenir une nation. Ici, comme en Afrique on a décidé que toutes ces communautés, tous ces clans allaient former un Etat nation.
Bien entendu nos vieux pays, comme aurait dit Dominique de Villepin, connaissaient à merveille cette règle d’or : « diviser pour mieux régner ». Alors ils n’ont rien fait pour rapprocher les communautés bien au contraire.
Alors, comment ces Etats qui ne sont pas une nation sont arrivés à une organisation qui fonctionne à peu près ?
Par un pouvoir fort et dictatorial bien sûr.
L’Irak et la Syrie ont cela de commun que dans ces deux cas c’est toujours une communauté minoritaire qui gouvernait : En Irak des sunnites qui gouvernaient un pays majoritairement chiite et en Syrie une minorité chiite alaouite qui opprimait une majorité sunnite. Au milieu de cela des kurdes qui auraient pu peut-être constituer une nation mais qui n’avait pas eu la grâce d’intéresser suffisamment les occidentaux.
Et c’est dans ces conditions que GW Busch influencé par les néo-cons(ervateurs) a eu cette idée géniale, nous allons renverser Saddam Hussein et créer la démocratie en Irak. Et quand nous aurons réussi cette œuvre de civilisation, les autres peuples autour, comme la Syrie par exemple, par contagion, mimétisme et ferveur vont se convertir aussi à la démocratie.
Et arriva ce qui devait arriver : ils ont chassé Saddam Hussein (vous vous souvenez de cette fable : la 2ème et ou la 3ème armée du monde ?) sans difficulté mais avec beaucoup de bombes et beaucoup de victimes (mais pas occidentales).
Et puis ils ont imposé la démocratie.
Dans un Etat nation comme la France, un lorrain athée vote pour un candidat breton catholique parce qu’il est de droite et un électeur limousin protestant vote pour un candidat normand juif parce qu’il est de gauche.
Mais dans un état communautaire, un chiite vote pour un chiite, un sunnite pour un sunnite et un kurde pour un kurde etc…
Ce n’est alors pas difficile de savoir qui va gagner, en Irak ce fut les chiites.
Les chiites qui ont été opprimés sous Saddam ont souhaité montrer aux sunnites qui était la communauté dominante.
Les sunnites de l’armée de Saddam qui avaient été démobilisés par les américains ne se sont pas laissé faire. Eux qui étaient baasistes, peu intéressés par la religion ont trouvé stratégiquement pertinent de se rapprocher d’illuminés islamiques pour créer une force de défense qui allaient être en mesure de reconquérir des territoires pour les sunnites. Force qu’on appelle DAESH désormais.
L’Irak dont on a chassé le dictateur est un chaos dans lequel se déchaine la violence. Remarquez que depuis, dans ce bel esprit de contagion prophétisé par les néos-cons, il y a bien eu propagation à la Syrie. Mais propagation de ce qu’il y avait en Irak : le chaos et non la démocratie. Le Liban et la Jordanie commencent à être sérieusement menacés.
Dans ce désastre que l’on ait chassé le dictateur comme en Irak ou non comme en Syrie, la situation est à peu près la même.
Et puis les forces sunnites de DAESH remettent en cause les frontières imposées par les occidentaux, elles considèrent la frontière entre la Syrie et l’Irak comme parfaitement artificielle.
Pour se venger, pour qu’on parle d’eux, pour qu’on les craignent, ils règnent par la terreur.
Et voilà pourquoi le petit Aylan Kurdi qui est d’ailleurs un kurde comme son nom l’indique a fui avec sa famille la Syrie, dans des conditions désastreuses, qu’il est tombé à la mer et qu’il est mort.
La France, la Grande Bretagne et les Etats-Unis ne sont pas responsables de tous les malheurs du monde. Mais pour ce qui se passe au moyen orient, leur responsabilité historique est immense, écrasante.

Pour revenir à une photo, j’avais trouvé celle-ci sur Internet, il y a quelques mois. Les commentaires prétendent qu’elle a été prise en Syrie : un petit garçon protège sa sœur pendant des bombardements. Elle ne nous dit pas ce qui arrive à la fin du périple comme le montre la photo d’Aylan, mais pourquoi ils s’enfuient :
Cette photo se trouve sur des centaines de page d’internet. Je ne peux pas affirmer qu’elle soit authentique. Quoi qu’il en soit elle montre ce que les articles décrivant la situation en Syrie racontent.
Je vous rappelle qu’il y a eu déjà deux mots du jour qui ont parlé de ces réfugiés mais sans photo.
Celui du Jeudi 16 avril 2015 : <La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris d’autrui [et] aboutit à une globalisation de l’indifférence..> Pape François
Et le Mardi 28 avril 2015 : <parce que ce qui compte ici, c’est que ce sont des hommes, des hommes en danger de mort.> Jean-Paul Sartre
<549>
Vendredi 4 Septembre 2015
Notre société est nourrie à la croissance. Il s’agit d’une véritable addiction. Tout le monde affirme qu’en dessous d’un certain seuil de croissance il ne peut y avoir de recul du chômage, le financement de nos retraites est fondée sur une hypothèse de croissance continue et solide, l’homme politiques qui ne promettent pas son retour n’ont aucune chance d’être élus. Et surtout ce que la richesse ne peut nous apporter, la croissance en est capable : nous donner le sentiment de bien-être (Paradoxe d’Easterlin) ;
La révolution numérique est basée sur un doublement des performances à peu près tous les 18 mois (loi de Moore) ;
Grâce à ces performances, les programmes informatiques et la robotisation remplacent, dans des domaines de plus en plus large, les métiers des humains de la classe moyenne ;
Depuis 30 ans la croissance des pays développés diminue, pour l’instant la révolution numérique n’a pas provoqué un sursaut de croissance. Si on analyse ces choses de manière rationnelle on doit conclure à une grande incertitude sur le retour de notre drogue : la croissance. Il est possible que nous ne retrouvions pas de croissance avant longtemps.
Jeudi 3 Septembre 2015
Mercredi 2 Septembre 2015
cherche le logiciel qui fera la même chose à ta place »
Mardi 1er Septembre 2015
Lundi 31 Août 2015
Vendredi 28 Août 2015
Robert Lewis était le co-pilote de la superforteresse B-29 « Enola Gay » qui a largué « au-dessus de Hiroschima une bombe de 4,5 tonnes surnommée « Little Boy », avant d’effectuer un virage de 158 degrés pour s’éloigner.
Quarante-trois secondes plus tard, à 600 mètres d’altitude, l’engin explose.
A l’éclair foudroyant succède une boule de feu d’un kilomètre de diamètre, puis une terrible onde de choc, qui secoue violemment le bombardier. En quelques secondes, une gigantesque colonne de fumée s’élève jusqu’à 12 000 mètres d’altitude.
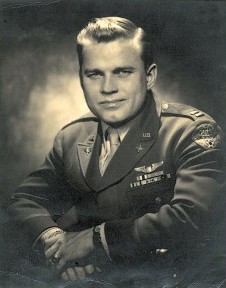
Terrifié, le capitaine Lewis s’écrie :
« Mon Dieu, qu’avons-nous fait ? »
Nous sommes en août 2015, c’était il y 70 ans que les américains ont largué le 6 août 1945 « Little boy » sur Hiroshima, et le 9 août « fat-man » sur Nagasaki. Du point de vue technique « fat-man » (au plutonium) était plus puissante que Little Boy (à l’uranium) mais la destruction fut toutefois moins importante à cause de la nature vallonnée du terrain à Nagasaki.
C’est un moment essentiel de l’Histoire, de l’Humanité et des sciences. C’est un moment de fracture. Car depuis ce mois d’août 1945, la science et le progrès qui étaient des valeurs uniquement positives depuis les Philosophes des Lumières, sont remis en question parce qu’ils ont leur part d’ombre : ils peuvent produire le mal absolu.
Un des physiciens qui avaient participé à l’élaboration de la bombe dans le projet Manhattan, Kenneth Bainbridge, avait dit au Directeur du projet Oppenheimer :
« Now we are all sons of bitches » (Maintenant nous sommes tous des fils de pute).
Par la suite, Bainbridge s’engagera pour mettre fin aux essais d’armes nucléaires et pour garder le contrôle des futurs développements de ce domaine.
Albert Camus écrivit son fameux éditorial du 8 août 1945 dans « Combat » :
« Nous nous résumerons en une phrase : la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation intelligente des conquêtes scientifiques.
En attendant, il est permis de penser qu’il y a quelque indécence à célébrer ainsi une découverte, qui se met d’abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l’homme ait fait preuve depuis des siècles. Que dans un monde livré à tous les déchirements de la violence, incapable d’aucun contrôle, indifférent à la justice et au simple bonheur des hommes, la science se consacre au meurtre organisé, personne sans doute, à moins d’idéalisme impénitent, ne songera à s’en étonner. […]
Devant les perspectives terrifiantes qui s’ouvrent à l’humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d’être mené. Ce n’est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l’ordre de choisir définitivement entre l’enfer et la raison. »
Michel Serres dans un entretien plein d’optimisme, dans une merveilleuse émission de France Culture : « Les racines du ciel » du 15 mars 2015, dit cependant :
«Je suis un enfant de Hiroshima et de Nagasaki. »
Il explique qu’il était étudiant en mathématiques et qu’il se destinait à la Physique, mais que l’explosion des bombes l’a fait changer de route et il s’est orienté vers la philosophie et l’Histoire des sciences.
Grâce au travail des historiens et à l’ouverture des archives, nous savons aujourd’hui que la version officielle : « L’utilisation de la bombe a permis d’abréger la guerre, d’économiser un million de morts car le Japon ne voulait pas mettre fin à la guerre » est un mensonge. Il fallait que la bombe explose parce que les américains voulaient pouvoir expérimenter, en réel, l’effet de la bombe notamment pour montrer à leur Congrès que son coût était justifié et surtout ils voulaient montrer leur puissance destructrice pour pouvoir mieux imposer leurs conditions à la sortie de la guerre. Il fallait même une deuxième explosion pour pouvoir tester une autre version de la bombe.
Un documentaire diffusé sur France 3 montre les véritables raisons de Hiroshima et de Nagasaki. Ce documentaire révèle aussi la censure et le silence qui ont été imposés sur les effets de la radioactivité des années après l’explosion. L’autre mensonge de 1945 étant que la bombe produit sa puissance destructrice pendant environ une minute et n’a plus aucune conséquence sur les humains après cette minute.
Pour finir, je voudrais aussi mettre l’accent sur cette petite phrase trouvée dans un article du Monde « Nagasaki, la ville catholique atomisée » décrivant le vol de la seconde bombe : Après avoir été béni par le chapelain de la base de Tinian dans les Mariannes, l’équipage du bombardier B-29 avec à bord « Fat Man », la seconde bombe atomique, prit la direction de Kyushu. Le chapelain, nous apprend le Larousse, est un prêtre chargé d’assurer le service religieux dans une église non paroissiale, une chapelle de communauté religieuse, d’hôpital, de l’armée…
Cette dernière incise pour revenir sur le concept éthéré de « religion de paix.»
Le représentant d’«une religion de paix.» a béni les hommes et la bombe qui allait donner la mort à des milliers de gens…

<543>
Jeudi 27 Août 2015
En ce qui concerne les choses de l’humanité, les belges ont souvent beaucoup d’avance sur les Français.
Une loi belge permet aux victimes de rencontrer leurs agresseurs dans un processus de résilience.
Je joins au présent message <un article> qui décrit ces rencontres et leurs effets je vous donne deux exemples :
Déborah 34 ans s’en prend à celui qui les a cambriolés :
« On travaille comme des damnés pour avoir ce qu’on a et vous, en 30 secondes, vous nous prenez tout ».
Elle raconte leur vie désormais sur le qui-vive, les réveils en sursaut la nuit. L’argent qu’il a fallu avancer pour réparer la porte du garage, la perte d’un DVD sur lequel son professeur de théâtre avait rassemblé cinq années de ses prestations sur scène.
« C’est comme si on avait pris une partie de ma vie, qu’on l’avait déchiré en petits morceaux et qu’on les avait mis à la poubelle. »
Car le Professeur est décédé et toute copie impossible.
Mais, le pire, ce sont les photos. Celle de sa petite fille d’un an stockées sur l’ordinateur depuis sa naissance et pas encore imprimée. Les seules qui existaient. Dans le box des accusés, Pascal 46 ans est sans réaction. Le juge ne parviendra pas à en tirer un mot. Et puis, des mois plus tard, Déborah et son mari reçoivent une lettre dans laquelle Pascal demande à les voir. Le courrier émanant du service Médiante, Habilité par le ministère de la Justice à organiser des rencontres entre auteurs et victimes d’infraction en présence de médiateurs.
[…] en fait, depuis l’audience, Pascal est rongé par les remords. Il est revenu furieux dans sa cellule.
Sa longue expérience de cambrioleurs lui a pourtant rendu familière les salles de tribunal, mais ce jour-là, pour la première fois, il s’est trouvé face à des parties civiles et a mesuré les dégâts causés. Il rumine pendant trois jours, son regard s’attarde sur les photos de ses trois enfants affichées au mur, il mesure qu’elle perte représenterait la disparition de ces clichés et ce que Déborah peut ressentir : « cela m’a anéanti. »
Après la rencontre, Déborah a expliqué : « nous voulions comprendre et nous sommes sortis rassurés. Nous avons eu en face de nous un être humain. Il peut changer et s’en sortir. »
Pascal, quant à lui, décrit l’une des plus belles rencontres de son existence :
« Ils m’ont apporté la paix, ils m’ont donné une nouvelle vie. »
La Belgique est le seul pays au monde, à avoir institué, en 2005, la possibilité, pour les justiciables victimes d’un délit ou d’un crime, d’en rencontrer l’auteur.
Le mot du jour est le propos d’un médiateur de ce type dans une rencontre très surprenante :
En août 2012, la femme la plus honnie de Belgique, Michelle Martin, l’ex épouse de Marc Dutroux, bénéficie d’une liberté conditionnelle qui soulève l’indignation.
Jean Denis le jeune père d’une des petites victimes, interpelle dans la presse celle qui pour lui est pire que Dutroux :
« Maintenant que vous n’êtes plus sous l’influence de votre ex-mari, allez-vous dire réellement ce qui s’est passé ? Madame, j’ai besoin de savoir pour continuer à vivre. Pourquoi ne pas avoir nourri les petites alors que Dutroux vous avez laissé de l’argent pour se faire ? Et surtout, c’est un père qui vous le demande : comment se comportait ma fille Julie ? Je n’ai pas envie de vous supplier comme les petites ont dû le faire. Ce n’est pas possible que vous restiez enfermée dans votre silence. Ou alors vous n’êtes pas un être humain. »
Madame Martin a répondu. La rencontre a duré quatre heures. Deux ans plus tard, Laurent Goffaux, un des deux médiateurs qui a officié durant cet incroyable face-à-face fait ce commentaire :
« La nature humaine et positivement étonnante. »
Il n’en dira pas plus, secret professionnel !
Le titre de l’article est « Je n’ai plus envie de me venger. »
<542>
Mercredi 26 Août 2015
|
|
La Maison Feuillette
|
|
|
Ce type de maison est souvent bâti en auto construction participative. Avec l’aide des copains, des amis qui mettent la main… à la paille tandis qu’un professionnel accompagne le chantier.
La paille est une machine à stocker le CO2, elle en consomme pour grandir puis le gaz est conservé pendant toute la durée de vie du bâtiment.»
|
Mardi 25 Août 2015
Lundi 24 Août 2015
Un jour sur Terre
|
|
Vendredi 21 Août 2015
Jeudi 20 Août 2015
Vendredi 17 Juillet 2015
Jeudi 16 Juillet 2015
Mercredi 15 Juillet 2015
Il implique que l’homme est au centre et que le reste est dans l’environ. »
Vendredi 10 Juillet 2015
On parle de rites, autour desquels les croyants se réunissent et manifestent publiquement leur Foi. Ces rites qui facilitent beaucoup la vie quotidienne et permettent souvent d’éviter de se poser trop de questions. Prenons par exemple le moment ultime, lorsque la vie s’arrête. Les humains finalisent alors ce moment de la séparation à travers une cérémonie de l’Adieu. Qu’il est simple, commode, rassurant de remettre les clés de cette célébration à un prêtre, un imam, un rabbin ou un moine. Ils savent faire, organiser, donner la solennité, les paroles et les gestes qui rendent ce moment apaisant et digne.
On parle aussi de la petite voix consolante quand les hommes sont dans la souffrance qu’évoquait Jaurès et dont j’ai parlé lors du mot du jour consacré à la cérémonie de Charleston «Amazing grace» du 29 juin.
On parle encore de spiritualité et de transcendance. Car bien sûr, la poursuite des biens matériels, de la richesse, du pouvoir, de l’occupation du temps par le travail, les jeux, les loisirs ne suffisent pas pour construire son humanité et se préparer sereinement à notre finitude.
Et j’aborde l’autre aspect des religions, celle dont je me méfie ou même que je combats tant je trouve la réflexion dominante molle, lâche et incapable de voir la vérité en face.
Jeudi 9 Juillet 2015
|
|
Vous trouverez plus d’informations sur ces sites
|
Mercredi 8 Juillet 2015
un sentiment d’appartenance communautaire suffisamment puissant pour entraîner la minorité à accepter la loi de la majorité ! »
Discours du 5 mai 1992 de Philippe Séguin sur la ratification du traité de Maastricht

Mardi 7 Juillet 2015
Pas de cette improvisation permanente»
Lundi 6 Juillet 2015
le premier qui dit que tout est de la faute des Grecs qui sont des tricheurs, des fraudeurs et appartiennent à un pays sans administration étatique digne de ce nom, incapable de conduire les réformes qui seraient de nature à remettre cet Etat dans une dynamique positive. Que la corruption généralisée se trouve à un niveau record et que leur position victimaire conduirait, si on leur cède, à faire payer leurs turpitudes par certains pays dont les habitants sont en moyenne plus pauvres que les grecs.
le second qui dit que tout est de la faute des autres pays européens, du FMI et des banques parce que la politique d’austérité appauvrit encore la Grèce et la rend d’autant plus incapable de rembourser la dette et l’amène dans une dynamique mortifère. Ce second camp insiste sur le rôle des banques qui ont prêté sans prudence puis pour récupérer leurs créances ont conduit à transférer cette dette vers les contribuables des autres pays européens puisque les Etats ont racheté la dette bancaire. Lehman Brothers a joué un rôle éminent dans la falsification des comptes ayant permis à la Grèce d’entrer dans la zone Euro. Enfin les grands pays européens ont profité plus que de raison de cette dérive des finances grecques puisqu’ils ont usé de l’explosion des emprunts pour leur vendre des choses aussi utile que de grosses voitures, des équipements coûteux et surtout des armes car la Grèce poursuit son fantasme de la peur d’être attaquée par la Turquie.
« refuser de s’identifier à la demande d’une autorité » ;
« ne pas respecter les restrictions de circulation » ;
« escalader des bâtiments ou des monuments sans autorisation » ;
« manquer de respect aux forces de sécurité » ;
« utiliser des lasers sous quelque forme que ce soit ».
|
|
[…] Ces derniers jours, Greenpeace a ainsi dénoncé cette nouvelle loi en bâillonnant des statues emblématiques de Madrid.
|
Vendredi 3 Juillet 2015
Alain Supiot est un juriste français spécialiste du droit social. Il est actuellement professeur au collège de France.

Fayard a publié en mars 2015, ses cours au Collège de France de 2012-2014, intitulé «La Gouvernance par les nombres» où il dénonce les dérives de cette nouvelle manière de diriger les affaires des hommes et de la société.
Il y a d’abord un glissement sémantique du « gouvernement » à la
« gouvernance ».
La raison du pouvoir n’est plus recherchée dans une instance souveraine transcendant la société, mais dans des normes témoignant de son bon fonctionnement.
Ces nouvelles techniques visent la réalisation efficace d’objectifs mesurables plutôt que l’obéissance à des lois justes.
Alain Supiot a été invité à plusieurs émissions dont la Grande Table pour parler de cet ouvrage :
<La Grande Table : gouverner par les nombres, comment en sortir 2015-04-06>
Il y a aussi cet entretien sur le site de l’Usine Nouvelle :
<Restaurer un travail réellement humain est, sur le long terme, la clé du succès économique>
J’en tire les extraits suivants :
« Pour comprendre les transformations à l’œuvre à une époque donnée il faut identifier l’imaginaire qui la domine. Cet imaginaire partagé imprègne en effet toutes nos façons de penser : les institutions, les arts, les sciences et les techniques.
Une des thèses de mon livre est qu’à la révolution numérique correspond un changement d’imaginaire.
Depuis la fin du Moyen âge, les Occidentaux se sont représenté le monde sur le modèle de l’horloge.
Depuis l’invention de la machine de Turing et les débuts de l’informatique, ils le conçoivent sur le modèle de l’ordinateur, c’est-à-dire comme une machine programmée et programmable. Cette représentation influence nos manières d’organiser les rapports sociaux et en particulier notre conception du droit et des institutions, c’est-à-dire les règles qui gouvernent et rendent possible la vie en société. […]
De grands historiens, comme Jacques Le Goff ou Lewis Mumford, ont montré la place centrale de l’horloge dans la naissance des temps modernes.
Notre civilisation est la seule à avoir hissé des horloges au sommet de ses lieux de culte, dans tous les villages. La philosophie des Lumières voyait Dieu comme un grand horloger et le monde comme un immense mécanisme régi par les lois de la physique classique, par un jeu inexorable de poids et forces, de masse et d’énergie […]
Le taylorisme a transposé d’une certaine façon ce modèle à l’entreprise. Des génies, tels Fritz Lang dans « Metropolis » ou Charlie Chaplin dans « Les Temps modernes », ont dépeint ce que cela impliquait : l’homme est pris dans un grand mécanisme, dans un jeu d’engrenages qui finit par le broyer. […]
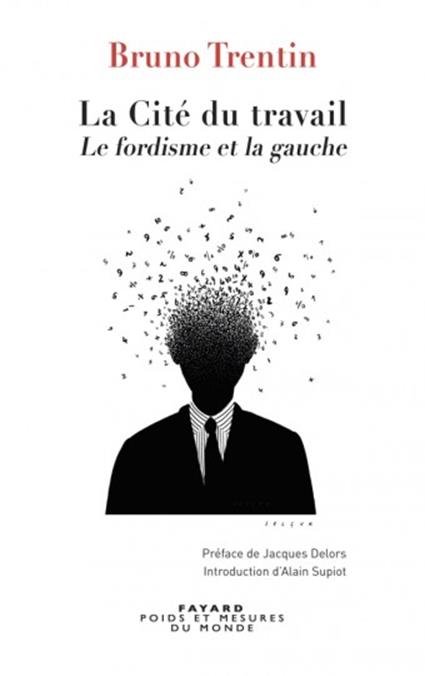 La planification soviétique a été une première tentative de gouverner par les nombres, mais elle participait encore de l’imaginaire mécaniciste. Comme l’a montré Bruno Trentin dans son grand livre sur « La cité du travail » », il y a eu un accord profond du capitalisme et du communisme pour placer le travail sous l’égide de la technoscience et l’évincer ainsi du périmètre de la délibération politique et de la justice sociale.
La planification soviétique a été une première tentative de gouverner par les nombres, mais elle participait encore de l’imaginaire mécaniciste. Comme l’a montré Bruno Trentin dans son grand livre sur « La cité du travail » », il y a eu un accord profond du capitalisme et du communisme pour placer le travail sous l’égide de la technoscience et l’évincer ainsi du périmètre de la délibération politique et de la justice sociale.
Mais Lénine est un précurseur dans sa façon de vouloir étendre à la société tout entière le modèle de l’entreprise, selon le credo aujourd’hui rabâché par les prédicateurs de l’ultralibéralisme et du New Public Management, qui pensent qu’un État doit être géré selon les mêmes méthodes « scientifiques » qu’une entreprise.
[…] Comme souvent, le changement d’imaginaire a commencé dans l’ordre juridique avant de s’exprimer au plan scientifique et technique. La perte de la foi dans l’existence d’un souverain législateur date du XIXe siècle et de la première crise de légitimité de l’État.
C’est cette crise qui a donné naissance à l’État social, mais aussi aux expériences totalitaires du XXe siècle qui ont cherché dans la science les « vraies lois » devant régir l’humanité. Au plan scientifique et technique ce sont dès les années 30, de grandes découvertes mathématiques – notamment celles de Kurt Gödel (1906-1978), puis l’invention de la machine de Turing et les débuts de l’informatique, qui marquent ce passage à l’imaginaire cybernétique.
Il faut lire à ce sujet les écrits visionnaires de Norbert Wiener (1894-1964), l’une des pères de la cybernétique. Selon lui, on peut penser de la même façon les hommes, les machines et le vivant. Tous sont des dispositifs de traitement de l’information.
Trois concepts jouent un rôle essentiel dans cette nouvelle vision de l’homme et du monde : le programme, le feedback (aujourd’hui nous dirions la « réactivité ») et la performance. « L’homme machine » des XVII-XVIIIe siècles disparaît, ou plus exactement il se métamorphose en « machine intelligente », machine programmable par des objectifs chiffrés.
C’est exactement à la même période de l’immédiat après-guerre que débute la « révolution managériale » avec notamment l’invention de la direction par objectifs, due notamment à Peter Drucker.(1909-2005). Il faut souligner que ce dernier mettait en garde contre les limites de sa méthode. Pour lui, l’évaluation devait demeurer une autoévaluation et ne pas servir à un « contrôle de domination » qui ruinerait ses effets. Bien sûr on s’est empressé d’oublier ces mises en garde et de s’engouffrer dans ces impasses. De la même façon que le taylorisme, cette nouvelle conception de la direction des hommes par objectifs chiffrés, après avoir été conçue pour les entreprises, a été étendue à la société tout entière. Avec pour effet une nouvelle restriction du champ laissé au politique et à la délibération démocratique. Ce n’est plus seulement le travail en tant que tel, mais aussi sa durée et son prix qui devraient être soustraits au politique pour être régis par les mécanismes autorégulateurs du marché.
[…] Le fantasme aujourd’hui poursuivi est celui d’une mise en pilotage automatique des affaires humaines, comme on peut le voir dans le Traité sur la gouvernance de l’Union monétaire européenne, qui prévoit des mécanismes « déclenchés automatiquement » en cas d’écart dans la réalisation de trajectoires chiffrées.
[…] On pense le travailleur sur le modèle de l’ordinateur au lieu de penser l’ordinateur comme un moyen d’humaniser le travail. […] à la fin de la Première Guerre mondiale.
Deux leçons passablement antinomiques ont été tirées de cette expérience épouvantable.
La première et je n’y reviens pas, fut la possibilité d’une « mobilisation totale » de la ressource humaine et l’extension du taylorisme à l’organisation de la société tout entière. Possibilité continuée en temps de paix et qui prend aujourd’hui la forme de ce que le Premier ministre britannique, M. Cameron, appelle le Global race, c’est-à-dire une course mortelle pour survivre sur un marché devenu total.
La seconde leçon fut inscrite par le traité de Versailles au fronton de l’Organisation internationale du travail : « il n’est pas de paix durable sans justice sociale », d’où la mission confiée à cette Organisation de garantir à l’échelle du globe l’établissement d’un « régime de travail réellement humain ».
Si l’on prend cette notion au sérieux au lieu de la cantonner aux seules conditions de travail (durée et salaire), on est conduit à identifier deux formes de déshumanisation du travail.
- La première est celle du taylorisme immortalisée par Chaplin : c’est un déni de la pensée et la réduction du travail à l’obéissance mécanique à des ordres. Ce qu’en droit du travail on a appelé à la même époque la subordination.
- La seconde est un déni de la réalité et l’assimilation du travail à un processus programmé de traitement d’information. C’est à cette forme de déshumanisation que conduit la gouvernance par les nombres, dès lors qu’elle asservit le travailleur à la satisfaction d’indicateurs de performance chiffrés, à l’aune desquels il est évalué indépendamment des effets réels de son travail.
L’indicateur se confond alors avec l’objectif, coupant le travailleur du monde réel et l’enfermant dans des boucles spéculatives dont il ne peut sortir que par la fraude ou la dépression.
À la différence du taylorisme, qui interdisait de penser et condamnait à l’abrutissement, la gouvernance par les nombres prétend programmer l’usage des facultés cérébrales en vue de la réalisation de performances quantifiables. Je donne ainsi l’exemple d’un réseau bancaire ayant donné pour objectif à ses salariés, non pas d’atteindre un certain chiffre d’affaires, mais d’atteindre un chiffre supérieur à celui des autres agences, qui s’affichait en temps réel sur leurs ordinateurs.
Cette déconnexion du travail de la réalité de ses produits met en péril, non plus la santé physique, mais la santé mentale, avec la montée depuis les années 90 de ce qu’on appelle les risques psychosociaux.
Se représenter l’être humain comme un ordinateur programmable n’est pas moins, mais encore plus délirant que de le représenter comme une pièce d’horlogerie, et cela fait courir des risques qui ne pèsent pas seulement sur les individus mais sur l’organisation tout entière, qu’il s’agisse de l’entreprise ou de la société dans son ensemble. […]
L’un des traits les plus préoccupants de la gouvernance par les nombres est que plus personne n’est responsable, au sens plein de ce terme. Car à la différence du taylorisme, elle affecte aussi les dirigeants, qui sont eux aussi « programmés » pour réaliser des objectifs quantifiés.
Autrement dit qui ne sont pas dans l’action, mais dans la réaction à des signaux chiffrés, qu’il s’agisse du cours de bourse ou des sondages d’opinion.[…]
L’entreprise est l’institution la plus menacée par la Gouvernance par les nombres. Les lois qui ont mis en œuvre les recettes de la Corporate governance — notamment dans le domaine comptable ou de la rémunération des dirigeants — ont permis d’asservir ces derniers aux objectifs de création de valeur pour l’actionnaire, plongeant les entreprises dans un court-termisme incompatible avec la véritable innovation.
C’est sur ce genre de réformes que devraient revenir ceux qui prétendent « aimer l’entreprise ». Plutôt que de s’acharner à faire disparaître le repos dominical, on ferait bien de s’inspirer de l’exemple des grandes entreprises allemandes, qui ont décidé de déconnecter leurs cadres de leur messagerie pendant leurs heures et jours de repos.
Restaurer un travail « réellement humain » est, sur le long terme, la clé du succès économique.»
 Alain Supiot dit aussi :
Alain Supiot dit aussi :
«La quantification est un outil puissant de la pensée humaine. Je critique en revanche le fait que, du fait de la logique ultralibérale, la loi est placée sous l’autorité d’un calcul. C’est une restriction du périmètre de la démocratie.»
La zone euro illustre parfaitement cette dérive : Elle est dirigée sur la base de 2 indicateurs :
- Le déficit des administrations publiques ne doit pas dépasser 3% du produit intérieur brut (PIB) ;
- Et la dette publique ne doit pas dépasser 60% du PIB. Et c’est tout ! Le taux de chômage, la qualité de la santé, de l’Éducation et tant d’autres choses essentielles ne sont pas prises en considération pour juger de la bonne gouvernance de la zone euro.
Nous subissons tous plus ou moins ce fantasme de la gouvernance par les nombres de ceux qui croient que la vie d’une entreprise, d’une administration voire d’un être humain peut parfaitement se synthétiser par un tableau Excel. C’est une œuvre de déshumanisation à laquelle nous devons résister tout en utilisant de manière intelligente les dénombrements ou les statistiques dont nous pouvons disposer.
Jeudi 2 Juillet 2015
Géographe–urbaniste
Mercredi 1er Juillet 2015
|
|
Mais qui sont ces femmes, ces hommes et ces enfants qui fuient ?
Ce sont des Syriens et des Libyens, je n’ai pas besoin de rappeler les crimes et atrocités de DAESH et autres extrémistes islamistes.
Ce sont aussi des soudanais. Voici un article du Figaro qui cite un rapport de l’ONU. (Les âmes sensibles devraient s’abstenir de lire cet article) http://www.lefigaro.fr/international/2015/06/19/01003-20150619ARTFIG00393-les-enfants-du-soudan-du-sud-victimes-de-massacres.php
|
Mardi 30 Juin 2015
et de ne pas entendre ce que nous avions à leur dire.»
Lundi 29 Juin 2015
|
|
Vendredi 26 Juin 2015
Jeudi 25 Juin 2015
Mercredi 24 Juin 2015
Xavier de La Porte nous apprend qu’« A partir du mois juillet, Amazon rétribuera ses auteurs (c’est-à-dire ceux qui ne passent pas par une maison d’édition mais s’autopublient en ligne sur le site) à la page lue.»
Olivier Ertzschied, sur son blog Affordance, envisage les implications de cette évolution, qui touchent aussi bien un modèle économique (celui de l’édition classique) que l’écriture (si on est payé à la page lue, autant faire en sorte que le lecteur ait envie de la tourner).
J’ai trouvé ce développement sur Rue89 : <Amazon : ce qu’implique le paiement des auteurs à la page lue>
« Imaginez un monde dans lequel les auteurs (tous les auteurs : BD, romans, polars, science, essais, etc.) seraient rémunérés non plus de manière forfaitaire en fonction du nombre de ventes mais en fonction du nombre de pages lues. Ou plus exactement, toucheraient une micro-rémunération à chaque fois qu’un lecteur lirait une des pages de leur œuvre. […] »
Amazon, qui, dans le cadre de la lecture numérique sur sa tablette Kindle, dispose d’une volumétrie de données considérable et considérablement détaillée sur notre activité de « lecteur », souhaite mettre en place le modèle disruptif suivant :
« Plutôt que de payer les auteurs pour chaque livre, Amazon commencera bientôt à payer les auteurs en fonction du nombre de pages lues – non pas en fonction du nombre de pages téléchargées mais du nombre de pages affichées à l’écran suffisamment longtemps pour pouvoir supposer avoir été lues. »
L’impact sur la littérature même pourrait être considérable comme le souligne l’article de The Atlantic :
« Pour la plupart des auteurs qui publient directement via Amazon, ce nouveau modèle pourrait changer les priorités et les choix d’écriture : un système avec une rémunération à la page lue est un système qui récompense et valorise en priorité les « cliffhangers » et le suspense au-dessus de tous les autres « genres ». Il récompense tout ce qui garde les lecteurs accrochés » (« hooked »), même si cela se fait au détriment de l’emphase, de la nuance et de la complexité. »
Pour l’instant – et on comprend bien pourquoi –, ce type de rémunération ne s’appliquera qu’aux auteurs « auto-édités » par le biais de la plateforme Kindle Direct Publishing. Et de jouer sur la corde incitative pour amener de plus en plus d’auteurs à se séparer de maisons d’édition « classiques » au profit d’une contractualisation directe avec Amazon. Classique et éternel (à l’échelle du numérique en tout cas) processus de désintermédiation. […]
Mais plus que cela, Amazon ouvre ici une boîte de Pandore dans laquelle il serait très étonnant que Google (avec l’écosystème Google Books) et Apple (avec iTunes) ne tentent pas à leur tour de s’engouffrer. […]
En ne payant plus les auteurs en fonction du nombre de pages écrites mais du nombre de pages lues, et les algorithmes et autres DRM et dispositifs propriétaires (d’Amazon) étant les seuls à pouvoir disposer des outils de mesure permettant ce fonctionnement, les auteurs se trouvent à leur tour en situation de travailler « pour » les algorithmes, à la manière de journaliers guettant la notification sur smartphone du nombre de pages lues de leurs ouvrages chaque jour. […]
La question est de savoir ce que deviennent les auteurs de ces livres avec un modèle de rémunération à la page lue, comment ils s’adapteront et adapteront leur production littéraire à ce nouveau modèle, tout autant porteur de nouvelles opportunités que de risques considérables. La question est aussi de savoir de quel nouveau sentiment de toute puissance – ou de culpabilité – se sentira investi le lecteur dans le cadre d’un système de rémunération à la page des auteurs, se trouvant pris dans les rets d’un nouveau « petit actionnariat » de la lecture. […]
Une chose est sûre, après l’angoisse de la page blanche, Amazon vient d’inventer l’angoisse de la page non lue. […]
Le modèle de rémunération des auteurs à la page lue transforme l’activité de lecture pour en faire un « indicateur », une « variable » permettant toutes les spéculations mais aussi tous les détournements.
Après avoir cassé ce droit fondamental qui est celui de la confidentialité de l’acte de lecture, Amazon s’apprête désormais à le monétiser. Pop économie et salariat algorithmique. Et toujours ces secteurs – celui de la langue –, toujours ces moments – celui de la lecture – que l’on pensait préservés de la sphère marchande et qui s’y trouvent systématiquement soumis et aliénés. Plus aucun espace-temps, pas même celui du jeu, qui ne fonctionne comme un système de remise à la tâche, qui ne soit un cheval de Troie marketing ou un salariat algorithmique à peine masqué.
<Ici un article publié sur le Monde sur ce sujet>
<521>
Mardi 23 Juin 2015
Lundi 22 juin 2015
traduction
«S’ils ne sauvent pas la Grèce, qu’ils aillent au diable»
Vendredi 19 juin 2015
Patrick Artus est chef économiste de Natixis, professeur à l’Université Paris I Panthéon- Sorbonne, membre du Conseil d’analyse économique auprès du Premier Ministre.
 Il a écrit un livre avec Marie-Paule Virard, paru chez Fayard : «Croissance zéro, Comment éviter le chaos ?».
Il a écrit un livre avec Marie-Paule Virard, paru chez Fayard : «Croissance zéro, Comment éviter le chaos ?».
Si nous restons simples, il y a deux grands types d’économistes :
Ceux qui pensent que nous ne pourrons nous en sortir que par la croissance, que seule la croissance permettra l’emploi et que sans emploi nos économies et nos sociétés vont imploser.
Ils attendent donc la croissance ou veulent la provoquer par tous les moyens.
Les moyens ce sont essentiellement l’initiative privée, la diminution du poids économique de l’Etat et « l’adaptation » de l’Etat providence ou social aux exigences d’aujourd’hui. Bref son rétrécissement. Certains ont foi dans la «croissance verte».
Le plus souvent ils sont Schlumpeterien, adepte du concept de « la destruction créatrice ». C’est à dire qu’étant donné le progrès technique, des emplois sont détruits par millions dans des branches obsolètes mais, dans d’autres branches qui émergent, des emplois au moins aussi nombreux sont créés et sont mieux rémunérés.
Ces économistes sont souvent appelés les orthodoxes.
Ce sont eux qui ont aujourd’hui, de très loin, le plus d’influence dans le monde du pouvoir politique et économique.
François Hollande, par exemple, est totalement dans cette ligne même s’il hésite beaucoup pour diminuer de manière drastique l’Etat social et y va donc par petit pas. Les prétendants de Droite (Sarkozy, Juppé et Fillon) sont exactement dans la même ligne mais veulent avancer plus vite.
Il y a une autre grande catégorie d’économiste qui s’oppose à cette vision. Il est plus difficile de résumer leurs pensées. Mais ils font essentiellement un constat : la croissance de la production sur toute la terre, pour que tous les humains puissent consommer comme les américains ou les européens se heurte inexorablement aux limites de ce que la Terre peut absorber. Beaucoup d’entre eux parlent de décroissance ou de limitation de la croissance. En tout cas, ils cherchent des alternatives à la croissance. Bernard Maris faisait partie de ces économistes.
Patrick Artus fait indiscutablement partie de la première catégorie.
Mais en faisant des analyses et des études sur plusieurs décennies et sur plusieurs régions économiques, il a compris quelque chose qui l’a beaucoup perturbé. Il a publié ses conclusions avec une collègue Marie-Paule Virard dans le livre cité plus haut.
Ce livre débute ainsi :
« Et si la croissance ne revenait pas ? La seule évocation d’une telle éventualité nous remplit d’effroi. N’avons-nous pas été nourris au lait de la croissance depuis notre plus tendre enfance ? En particulier cette génération gâtée qui est entrée dans la vie adulte pendant les Trente Glorieuses et qui tient, pour l’essentiel, aujourd’hui les rênes du pouvoir ? Une génération qui n’est manifestement pas « équipée » pour penser l’impensable : imaginer, accepter et gérer la rareté du produit intérieur brut. Une génération qui a organisé la société autour d’un mouvement continu d’expansion économique, mouvement devenu un facteur essentiel de la concorde sociale et de la vitalité démocratique. Et cette « divine croissance » se déroberait tout à coup sous ses pieds ? Depuis 1945, nous avions oublié que cela pouvait arriver. »
Et il avait été l’invité des matins de France Culture, où il a expliqué ses découvertes : http://www.franceculture.fr/emission-les-matins-chomage-un-mal-francais-2015-02-02
Je vous invite à l’écouter c’est très intéressant et aussi inquiétant.
Je résume ces propos ci-après :
Il distingue d’abord la croissance à long terme (sur plus de 10 ans) et la croissance conjoncturelle.
Actuellement, en Europe, il y a une conjoncture extrêmement favorable pour un économiste orthodoxe : le prix du pétrole est très bas, l’Euro est plus faible par rapport aux dollars, les politiques budgétaires sont plus souples et enfin les taux d’intérêt sont quasi nuls. On peut espérer un peu de croissance à court terme.
Mais ce n’est que la croissance à long terme qui peut créer des emplois de façon stable. Croissance à long terme qui est la conséquence de l’augmentation de la productivité et des innovations technologiques. Nous sommes dans la ligne la plus orthodoxe des économistes orthodoxes.
Mais Patrick Artus a constaté, dans ses études, que la croissance à long terme diminue et tend vers zéro dans tous les pays, pas seulement en Europe.
Les croissances qui existent sont soit la conséquence d’économies émergentes qui sont dans une logique de rattrapage qui va cesser, soit des croissances conjoncturelles reposant le plus souvent sur des bulles spéculatives ou sur des leurres.
Il existe un problème global pour créer de la croissance et du progrès technique.
Cela relativise grandement ce que l’on peut faire dans un seul pays, en améliorant les politiques du pays.
Il y a bien sur un problème de formation en France. L’étude PISA mesure les performances des jeunes, il y a l’équivalent pour les adultes, c’est à dire la formation professionnelle, la France est avant dernier de l’OCDE, l’Italie est dernière.
Mais le problème essentiel du progrès technique et de la croissance à long terme n’est pas un problème spécifique à la France.
Même si on faisait des grands progrès dans nos politiques de formation et d’Économie, nous ne serions pas en mesure de régler ce problème de croissance à long terme.
Patrick Artus parle d’un « problème angoissant » :
« Quand il y a eu l’invention du moteur à explosion on a fait une croissance à long terme extraordinaire.
Il y a une tendance lourde. Le numérique constitue une question énorme qui n’est pas assez étudié.
On pense que nous sommes dans une période d’innovation énorme.
On voit toutes ces start-up qui produisent tous ces produits incroyables.
On se dit, avec toutes ces innovations forcément il y a des gains de productivité incroyable.
Forcément non ! Quand on regarde les chiffres il n’y a pas de gain de productivité ! »
Trois explications :
- 1/Il faut attendre, le numérique va bientôt créer de la croissance et des emplois dans 10 ans ou 20 ans quand les outils seront plus matures.
- 2/ Ou bien ce ne sont pas de vraies innovations,
- 3/ Ou bien on ne mesure pas bien la nouvelle économie que cela produit, économie du gratuit, du non marchand, de l’échange (par exemple échange de maison de vacances par Internet) qui ne se trouve pas dans les chiffres que l’on mesure
Il faut que j’abrège et vous renvoie vers d’autres sources qui peuvent vous permettre d’approfondir cette question.
Mais Patrick Artus dit deux choses importantes :
« A l’exception de l’Allemagne le niveau moyen des emplois baissent dans tous les pays développés. Il donne cet exemple parlant, désormais un ouvrier de Général Motors qui est licencié trouve un boulot chez Mac Do. C’est la réalité de l’économie d’aujourd’hui. Il y a quelques créatifs pour qui les revenus et les patrimoines explosent et le plus grand nombre qui en moyenne subissent une régression de la qualité de leur emploi qui s’accompagne d’une baisse de leurs revenus. »
L’autre chose c’est que
« L’économie du gratuit et de l’échange et du troc ne permet pas le prélèvement d’impôts et de cotisations qu’autorisent les revenus marchands. Nous avons donc un grave problème de modèle économique pour conserver un Etat social, redistributeur capable notamment de prendre en charge les problèmes de retraite et de santé.»
Comme Patrick Artus reste un économiste traditionnel qui possède au fond de ses gènes l’optimisme de la volonté, il donne avec sa collègue des conseils aux gouvernants permettant d’éviter le chaos : «Ils préconisent un meilleur partage des ressources :
- entre les revenus du capital et ceux du travail,
- entre travailleurs précaires et travailleurs qualifiés,
- entre actifs et retraités,
- entre prêteurs et emprunteurs. »
Voilà le seul moyen, selon eux, de ne pas basculer dans un affrontement dévastateur. Pour obtenir ce nouvel équilibre, Artus et Virard prônent une thérapie d’urgence en 10 mesures-chocs, parmi lesquelles le recul immédiat de l’âge de la retraite, la baisse du smic ou encore la création d’un contrat de travail unique. Un manuel de survie à usage des gouvernants. »
Donc je vous redonne le lien vers les matins de France Culture : http://www.franceculture.fr/emission-les-matins-chomage-un-mal-francais-2015-02-02
<Ici un article sur le livre de l’Expansion> qui explique :
« [Les auteurs] portent un regard décapant sur les maux qui rongent les économies occidentales, celle de la France en tête. « Et si la croissance ne revenait pas? » interrogent-ils d’emblée. Une hypothèse sérieuse, qui fait écho à la thèse de la « grande stagnation », développée dès l’été 2012 par l’économiste américain Robert J. Gordon, soutenue par d’éminents confrères tels que Larry Summers ou encore James K. Galbraith, dont l’ouvrage The End of Normal est publié ce mois-ci en français, sous le titre La Grande Crise. »
<Laurent Joffrin parle de remède cheval à propos de ce livre>
Ce mot du jour est très long et très lourd.
J’ai la faiblesse de croire qu’il aborde un sujet essentiel.
J’exprime ma plus vive perplexité devant le paradoxe d’un économiste qui me parait intègre qui constate que le modèle qu’il défend ne fonctionne plus, que les chiffres auxquels il croie lui montre que cela ne marche plus mais qui persiste à raisonner dans son modèle et de croire (car il s’agit là de foi pas de rationalité) qu’il peut encore être sauvé par des mesures adéquates.
<518>
Jeudi 18 juin 2015
Mercredi 17 juin 2015
On disait les droits de l’homme c’est [universel]
Je ne le crois pas.
Je crois que le monde asiatique, en particulier, a des valeurs confucéennes qui sont des valeurs complétement différentes.»
Mardi 16 juin 2015
Hippocrate né vers 460 av. J.-C. et mort vers 370 av. J.-C., est un médecin grec du siècle de Périclès, mais aussi philosophe, considéré traditionnellement comme le « père de la médecine » car il est le plus ancien médecin grec sur lequel les historiens disposent de sources, même si celles-ci sont en grande partie légendaires et apocryphes.
Il a fondé l’école de médecine hippocratique qui a révolutionné intellectuellement la médecine en Grèce antique, en instituant cet art comme une discipline distincte des autres disciplines de la connaissance auxquelles elle avait traditionnellement été rattachée [source Wikipedia]
Mon amie Florence m’a fait découvrir ce morceau d’anthologie <Le Professeur Joyeux explique comment l’alimentation permet de lutter contre le cancer ou à le favoriser>
Vous rirez beaucoup et vous apprendrez un certain nombre de choses.
C’est lui qui à la fin de cette intervention cite le mot du jour et aussi un propos du biologiste Jean Rostand :
« Il vaut mieux un bon menu qu’une ordonnance»
Il affirme avec assurance que le lait de vache est très mauvais pour notre organisme ainsi que l’excès de gluten.
Il conseille de manger de bons aliments bio et de proximité et de préférer les aliments qui nécessitent une bonne mastication. Il faut d’ailleurs beaucoup mastiquer avant d’avaler.
Le professeur David Khayat, a publié en octobre 2014, <Prévenir le cancer, ça dépend de vous> où il insiste aussi énormément sur l’alimentation.
Il était l’invité d’Anne Sinclair et je l’ai écouté attentivement : http://www.europe1.fr/emissions/l-interview/david-khayat-linterview-integrale-941864
Avec la même assurance que le professeur Joyeux, il énumère les aliments qui préviennent le cancer :
- Le jus de grenade
- Le thé vert
- Le curcuma
- Le café
- La tomate
- Le brocoli
- Le vin rouge
Ces deux professeurs sont des sommités :
Henri Joyeux, né en 1945 est professeur des universités-praticien hospitalier de cancérologie et de chirurgie digestive à l’université Montpellier.
David Khayat (né en1956) est un oncologue français. Chef du service d’oncologie médicale de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris depuis 1990, il est également professeur de cancérologie à l’Université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI) et professeur adjoint au Centre médical MD Anderson à Houston au Texas (États-Unis). Il a été élu membre du conseil de direction de l’American Society of Clinical Oncology en 2013. Organisateur du Sommet Mondial contre le Cancer à l’Unesco, il est à l’origine de la Charte de Paris contre le Cancer.
Ils donnent de bons conseils : manger lentement, des bons produits, bien mastiquer etc…
Et ils établissent un lien direct entre la maladie et notamment le cancer et l’alimentation. Il est possible, probable (?) qu’ils aient raison et qu’une bonne alimentation, comme le disait Hippocrate, permet de prévenir des maladies.
Mais c’est ensuite qu’il y a un problème : Ils affirment et se parent de l’autorité de leur professorat que tel aliment a telle vertu et tel autre est nocif.
L’esprit fécond du doute (mot du jour du 3 mars 2015) m’oblige à vous révéler, si vous ne le savez déjà, que ces affirmations ne présentent aucune des garanties de la démarche scientifique.
La dernière fois que j’attendais dans la salle d’attente de mon médecin traitant, j’ai parcouru une revue scientifique qui dévoilait une enquête qui analysait les études alimentaires. Dans un premier temps elle comparait, selon les études, les effets positifs ou négatifs des aliments : le lait, le vin, le café, le thé et quelques autres. Cette enquête constatait que les études pour chacun de ces aliments qui trouvaient un effet bénéfique étaient de manière très équilibrée contredites par des études qui trouvaient un effet nocif. Je pense d’ailleurs qu’intuitivement vous aviez déjà constaté ce fait : que des études portant sur la nutrition se contredisaient.
Par suite cette revue révèle qu’en réalité pour pouvoir faire des études sérieuses sur la conséquence de la consommation de certains aliments, la durée d’observation, l’échantillon à examiner comme les conditions sont si contraignantes que ces études présentent un coût exorbitant que personne n’accepte de payer.
Les laboratoires n’y ont pas intérêt, ils veulent vendre leurs médicaments, s’il existe des aliments qui pourraient en partie s’y substituer il vaut mieux ne pas les connaître.
La recherche publique est de plus en plus pauvre, elle ne considère pas ce domaine comme prioritaire.
Je m’en suis ouvert à mon médecin et au nutritionniste que je fréquente désormais (pour élargir mon panel de médecins) qui m’ont confirmé ce point que les études qui sont faites ne présentent pas de caractère scientifique et c’est la raison principale pour laquelle elles se contredisent.
Mon nutritionniste a fait une réflexion qui me semble de bons sens et même avoir un caractère scientifique : Si une étude démontre que la consommation quotidienne d’un litre et demi de lait (c’est une des études qui a été faite) présente des effets négatifs sur la santé, cela ne peut que prouver que la consommation excessive de lait n’est pas bonne, mais pas la simple consommation de lait.
D’ailleurs tout excès est mauvais. Mon nutritionniste m’a appris qu’une vraie étude scientifique avait été réalisée par un laboratoire qui visait à démontrer que les suppléments alimentaires notamment en termes de vitamines que le laboratoire vendait, étaient bénéfiques pour la santé. Cette étude a montré le contraire, il n’est pas bénéfique pour la santé d’apporter un surplus de vitamines ou d’autres éléments nutritionnels. Combler les carences oui, mais donner plus non ! Il semblerait que cette étude a découragé toute étude sérieuse complémentaire.
Donc quand ces sommités parlent avec assurance sur ces sujets, ils expriment une croyance, une foi, une intuition non pas une connaissance scientifique.
<Ici un autre article critique notamment sur les thèses du Professeur Joyeux> sur un site qui a pour nom : «les pseudos sciences».
Tout ceci ne doit pas nous décourager de manger sainement et de bons aliments, diversifiés, équilibrés et sans excès.
Ce mot du jour n’a d’autre vocation que de dénoncer des propos excessifs et non démontrés que prononcent certaines blouses blanches du haut de leur réputation.
En attendant ils vendent des livres et d’autres prestations qui abondent leur patrimoine.
<515>
Lundi 15 juin 2015
|
|
Vendredi 12 juin 2015
Premier degré : le jeune ne fréquente plus ses anciens amis car ils sont impurs, ne sont pas dans le vrai.
Deuxième degré : le jeune arrête ses activités de loisirs – le sport, la peinture, la musique… –, car elles sont le produit de Satan.
Troisième degré : la rupture scolaire, car l’école enseigne les valeurs de Satan.
Quatrième degré : la rupture parentale, lorsque l’autorité du groupe se substitue à elle.
|
|
Certains articles sont plus critiques et montre la complexité du personnage tout en reconnaissant son travail positif sur la cause qu’elle défend. Par exemple : http://rue89.nouvelobs.com/2015/03/12/dounia-bouzar-lexperte-derives-djihadistes-arrangeuse-verites-258151
S’il existe des saints, ils ne sont pas sur terre. Ici il n’y a que des femmes et des hommes avec leurs forces et leurs faiblesses. Aimons à regarder leurs forces.
|
Jeudi 11 juin 2015
Sociologue allemand (1929-2009)
http://www.franceinter.fr/emission-un-jour-dans-le-monde-la-puissance-indienne-en-questions
Mercredi 10 juin 2015
Parole qu’il a dite au dernier condamné à mort en France après qu’il fut sûr qu’il ne serait pas exécuté.
Mardi 9 juin 2015
Lundi 8 juin 2015
Titre d’un article de l’humanité sur un procès à Annecy contre Laura Pfeiffer, inspectrice du travail
Vendredi 5 juin 2015
parce que « je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger » »
|
|
Jeudi 4 juin 2015
«une chose est absolument nécessaire : la compassion»
Daniel Barenboïm est un des plus grands musiciens vivants, pianiste et chef d’orchestre.
Il est juif de nationalité israélienne. Contrairement à Herbert von Karajan évoqué lors d’un mot du jour récent, il ne se réfugie pas dans son art pour rester sourd aux drames qui l’entourent.
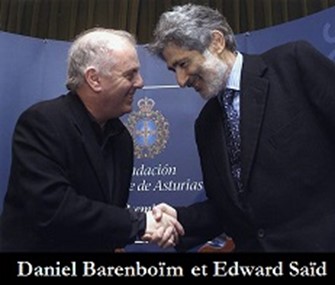 Il a créé un orchestre avec l’écrivain chrétien américano-palestinien Edward Saïd composé d’israéliens, de palestiniens et d’arabes de Syrie, du Liban, de Jordanie et d’Egypte.
Il a créé un orchestre avec l’écrivain chrétien américano-palestinien Edward Saïd composé d’israéliens, de palestiniens et d’arabes de Syrie, du Liban, de Jordanie et d’Egypte.
La création de cet orchestre a lieu en 1999 à Weimar à l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Goethe : le nom de l’orchestre vient d’ailleurs du recueil West-östlicher Divan (Divan occidental-oriental) du poète allemand.
Il prend en effet pour nom : Le West-Eastern Divan Orchestra (Orchestre du Divan occidental-oriental).
Edward Saïd est décédé en septembre 2003.
Chaque été environ ces 80 jeunes instrumentistes viennent en Europe se former et jouer ensemble.
Il s’assemble en Espagne, à Séville où il répète pendant le mois de juillet avant d’entreprendre en août une tournée mondiale (Europe, Amérique du Sud, …)
Daniel Barenboïm a été l’invité d’Anne Sinclair le 25 mai 2015 : http://www.europe1.fr/emissions/l-interview/daniel-barenboim-linterview-integrale-989228
Anne Sinclair l’interroge d’abord sur des sujets artistiques car il vient interpréter l’intégrale des sonates de piano de Schubert à la Philharmonie de Paris.
Mais dans la seconde partie de l’entretien elle l’interroge sur le conflit israélo-palestinien.
Il raconte d’abord un épisode de l’Histoire de l’orchestre.
Il était prévu de se réunir comme chaque année en juillet 2014 mais la guerre de Gaza venait d’être engagé par Israël.
Plusieurs jeunes musiciens ne voulaient pas venir.
Alors Daniel Barenboim leur a dit à chacun :
« Écoute en restant dehors tu n’aides pas la chose. Viens et on va en parler tous ensemble.
Si après que tu sois venu, tu ne te sens pas bien alors tu pourras partir, je ne t’en voudrai pas.
Le premier soir on a immédiatement fait une réunion et on a parlé de tout et tout le monde se disputait et chahutait.
Alors j’ai pris la parole et j’ai dit : Écoutez c’est complètement irréaliste d’attendre d’un israélien d’avoir de la sympathie avec le destin d’un Palestinien ou pour un Palestinien d’avoir de la sympathie pour un israélien.
Parce que la sympathie c’est une qualité émotionnelle.
Mais une chose est absolument nécessaire et ça c’est la compassion qui n’est pas une qualité émotionnelle mais une qualité morale.
Et si parmi vous, les musiciens, il existe des musiciens qui n’ont pas cette compassion, alors votre place n’est pas ici, vous pouvez partir demain.
Tout le monde est resté.»
Le mot « compassion » vient du latin : cum patior, « je souffre avec ».
C’est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d’autrui.
Cet extrait se situe à partir de 16:30 de l’entretien.
Et un peu plus loin il dit cette chose simple et tellement évidente :
« Ce n’est pas un conflit symétrique. Les Israéliens sont les occupants et les palestiniens sont les occupés.
Une partie nettement plus grande de la responsabilité repose sur les épaules des israéliens. »
En janvier 2008, l’Orchestre avait enfin reçu l’autorisation de jouer en Cisjordanie, à Ramallah
<Ici vous verrez et entendrez les mots que Daniel Barenboim prononce à la fin de ce concert exceptionnel :
« Ce projet qu’Edward Said et moi-même avons entrepris a parfois été décrit comme un orchestre pour la paix, un orchestre capable d’insuffler tel ou tel sentiment.
Mesdames et messieurs, je vous l’affirme, nous n’apportons pas la paix vous le savez.
C’est un fait, ces gens merveilleux qui jouent ensemble n’apporteront pas la paix.
Ce qu’ils peuvent apporter c’est la compréhension, la patience, le courage et la curiosité d’écouter ce que l’autre veut dire. C’est là toute notre ambition.
Dans ce contexte chacun a pu s’exprimer librement et ce qui est aussi important a pu entendre la version de l’autre.
C’est la raison de notre présence parmi vous pour apporter un message d’humanité pas un message politique, un message d’humanité, de solidarité pour la liberté qui fait défaut à la Palestine. Cette liberté dont toute la région a besoin.
Nous croyons qu’il n’existe pas de solution militaire à ce conflit.
Nous croyons que les destinées de ces deux peuples palestinien et israélien sont inextricablement liées.
Ainsi le bien être, le sentiment de justice et le bonheur de l’un dépendront inévitablement de ceux de l’autre.
Ils représentent notre objectif.
Nous œuvrons pour le changement du mode de pensée qui prévaut dans cette région.
Nombreux sont ceux qui comprendront bientôt que nous avons ici deux peuples pas un.
Deux peuples liés par un lien très fort philosophique, psychologique et historique à cette région du monde.
C’est notre devoir d’apprendre à vivre ensemble.
Nous avons le choix : nous entretuer ou apprendre à partager ce qui peut se partager.
C’est ce message que nous venons vous porter aujourd’hui. »
Depuis janvier 2008, Daniel Barenboïm a reçu un passeport palestinien de la part de l’autorité palestinienne.
Cette attitude ouverte ne lui attire pas que des sympathies en Israël.
Ainsi, un député du parti ultra-orthodoxe Shass affirme que « c’est une honte que le chef d’orchestre ait accepté la nationalité palestinienne »
Il demande que « son passeport israélien lui soit confisqué, puisque désormais, il en détient un autre, d’une entité ennemie ».
Nous entretuer ou apprendre à partager ce qui peut se partager, tout est dit.
 Et en 2009, je pense que l’académie Nobel aurait pu donner le prix Nobel de la paix à Barenboïm et à cet orchestre plutôt qu’à Obama.
Et en 2009, je pense que l’académie Nobel aurait pu donner le prix Nobel de la paix à Barenboïm et à cet orchestre plutôt qu’à Obama.
<507>
Mercredi 3 juin 2015
Kamel Daoud, né en Algérie, est un écrivain et journaliste algérien d’expression française. Selon Wikipedia
«S’il écrit en français et non en arabe, c’est, dit-il, parce que la langue arabe est piégée par le sacré, par les idéologies dominantes. On a fétichisé, politisé, idéologisé cette langue.»
Depuis 1994, il écrit au Quotidien d’Oran, il est aussi parfois chroniqueur dans des journaux français comme Le Point.
Il a acquis aussi un surplus de notoriété en écrivant un roman «Meursault, contre-enquête » sur lequel je reviendrai plus loin. C’est pour ce roman qu’il avait été invité le 13 décembre 2014, dans l’émission « On n’est pas couché sur France 2 ».
ll a parlé de son rapport à l’islam.
« Je persiste à le croire : si on ne tranche pas dans le monde dit arabe la question de Dieu, on ne va pas réhabiliter l’homme, on ne va pas avancer. La question religieuse devient vitale dans le monde arabe. Il faut qu’on la tranche, il faut qu’on la réfléchisse pour pouvoir avancer. »
Et suite à cette émission un imam salafiste, Abdelfattah Hamadache Zeraoui, a appelé à son « exécution », écrivant que « si la charia islamique était appliquée en Algérie, la sanction serait la mort pour apostasie et hérésie ». « Il a mis le Coran en doute ainsi que l’islam sacré ; il a blessé les musulmans dans leur dignité et a fait des louanges à l’Occident et aux sionistes. Il s’est attaqué à la langue arabe, écrit Abdelfattah Hamadache Zeraoui. (…) Nous appelons le régime algérien à le condamner à mort publiquement, à cause de sa guerre contre Dieu, son Prophète, son Livre, les musulmans et leurs pays. »
C’est cet homme qui était l’invité de France Inter du 27 mai 2015. <En France vous avez l’art de fabriquer des religions sans dieu>
C’est souvent l’œil extérieur qui sait porter le regard le plus pertinent sur une situation ou une société. Interrogé par un auditeur sur l’autocensure de certains intellectuels ou pratiquée dans les médias français sur la question de l’islamisme par peur de représailles ou lâcheté intellectuelle, il a eu ce propos :
« L’islamisme est le nouveau totalitarisme de notre siècle donc il pèse par la peur, par l’oppression, par la violence, par le meurtre. En Algérie, la dernière polémique visait une étudiante exclue parce qu’elle portait une jupe trop courte. En France, on a le contraire, une jupe trop longue. C’est assez symptomatique du siècle et de ces « maladies ». En France, j’ai été frappé du fait que vous n’arrivez pas à redéfinir facilement les choses : qu’est-ce que la liberté, qu’est-ce que dessiner, qu’est-ce que la laïcité. Vous avez une élite qui jacasse beaucoup mais qui est incapable de définir la liberté pour un écolier de 15 ans. Je pense que vous avez besoin d’un dictionnaire. Vous avez une collection de tabous extraordinaires. Je me sens beaucoup plus libre paradoxalement quand j’exerce mon droit d’intellectuel en Algérie qu’ici ».
Et puis il a ajouté ce qui est le mot du jour d’aujourd’hui.
Enfin il a eu ce rapprochement audacieux :
«Il y a finalement peu de différences entre les islamistes qui me menacent dans mon pays et la montée du Front national en France. D’ailleurs, le mot « salafiste » veut dire « souche »».
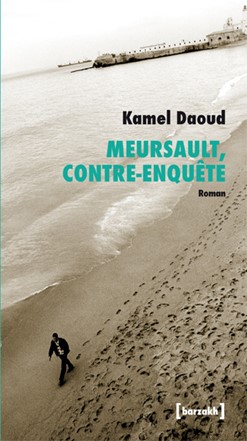 Kamel Daoud est devenu plus célèbre en France, en octobre 2013 quand sort son roman «Meursault, contre-enquête»
Kamel Daoud est devenu plus célèbre en France, en octobre 2013 quand sort son roman «Meursault, contre-enquête»
Il a loupé le prix Goncourt d’une voix : 4 contre 5 à Lydie Salvayrepour pour son roman « Pas pleurer »
Ce livre est une réponse à «l’Étranger» d’Albert Camus
L’Étranger d’Albert Camus, roman de 1942, met en scène un personnage-narrateur nommé Meursault, vivant à Alger en Algérie française. Dans la première partie du roman, il enterre sa mère, qu’il a internée à l’hospice de Marengo et il assiste aux funérailles, sans avoir l’air d’être triste, il ne veut pas simuler un chagrin qu’il ne ressent pas.
Par la suite il est mêlé à une dispute entre son voisin et sa maîtresse qui est arabe. Quelques jours après en se promenant sur la plage avec son voisin il croise deux Arabes, dont le frère de la maîtresse. Une bagarre éclate. Plus tard, Meursault, seul sur la plage accablée de chaleur et de soleil, rencontre à nouveau l’un des Arabes, qui, à sa vue, sort un couteau. Meursault tire sur l’homme, puis tire quatre autres coups de feu sur le corps.
 Dans la seconde moitié du roman, Meursault est arrêté et questionné. Ses propos sincères et naïfs mettent son avocat mal à l’aise. Il ne manifeste aucun regret. Lors du procès, on l’interroge davantage sur son comportement lors de l’enterrement de sa mère que sur le meurtre. Meursault se sent exclu du procès. Il dit avoir commis son acte à cause du soleil, ce qui déclenche l’hilarité de l’audience. La sentence tombe : il est condamné à la guillotine. Meursault voit l’aumônier, mais quand celui-ci lui dit qu’il priera pour lui, il déclenche sa colère. Avant son exécution, Meursault finit par trouver la paix dans la sérénité de la nuit.
Dans la seconde moitié du roman, Meursault est arrêté et questionné. Ses propos sincères et naïfs mettent son avocat mal à l’aise. Il ne manifeste aucun regret. Lors du procès, on l’interroge davantage sur son comportement lors de l’enterrement de sa mère que sur le meurtre. Meursault se sent exclu du procès. Il dit avoir commis son acte à cause du soleil, ce qui déclenche l’hilarité de l’audience. La sentence tombe : il est condamné à la guillotine. Meursault voit l’aumônier, mais quand celui-ci lui dit qu’il priera pour lui, il déclenche sa colère. Avant son exécution, Meursault finit par trouver la paix dans la sérénité de la nuit.
Camus décrit Meursault comme un étranger au Monde, il ne donnera jamais de nom à l’Arabe victime de Meursault.
Kamel Daoud écrit son roman en prenant pour narrateur le frère de « l’Arabe » tué par Meursault et le sort donc de l’anonymat.
Wikipedia nous apprend qu’en Algérie, le livre est l’objet d’un malentendu :
« Sans l’avoir lu, de nombreuses personnes ont pensé que c’était une attaque de L’Étranger, mais moi je n’étais pas dans cet esprit-là. […] Je me suis emparé de L’Étranger parce que Camus est un homme qui interroge le monde. J’ai voulu m’inscrire dans cette continuation. […] J’ai surtout voulu rendre un puissant hommage à La Chute, tant j’aime ce livre. »
Kamel Daoud est en tout cas un homme passionnant, et ce qu’il dit de la France est si juste :
Nous nous disons républicains mais nous sommes des monarchistes qui révoquons notre roi tous les 5 ans et des laïcs qui allons voter le dimanche dans notre maison laïque sacrée de l’École. Enfin nous disposons d’un Temple : Le Panthéon où notre roi décide quels sont les saints laïcs que nous pourrons vénérer.
Pour toutes les autres nations, nous autres français ne pouvons apparaître que bizarres et contradictoires.
<506>
Mardi 2 juin 2015
On n’a jamais connu tel bouleversement»
Directeur de la recherche clinique à l’institut Gustave-Roussy
Lundi 1 juin 2015
né le 28 juin 1934 à Tunis et mort assassiné le 7 janvier 2015 à Paris lors de l’attentat contre Charlie Hebdo
Cité par Philippe Val
|
|
Quand on cherche un peu on trouve des textes qui attribuent à Charlie Chaplin : « Le rire est le chemin le plus court entre deux personnes ».
Et aussi cette affirmation de Rabelais « Le rire est le propre de l’homme ».
|
Vendredi 29 mai 2015
– Maîtresse, c’est un champ de fleurs !
Et toi, maîtresse, tu es très belle ! »
Longtemps, j’ai lu beaucoup de livres. Aujourd’hui, j’en lis peu.
Je pourrais ajouter : et maintenant je me couche de bonne heure.
Ceux qui ont de la culture comprendront…
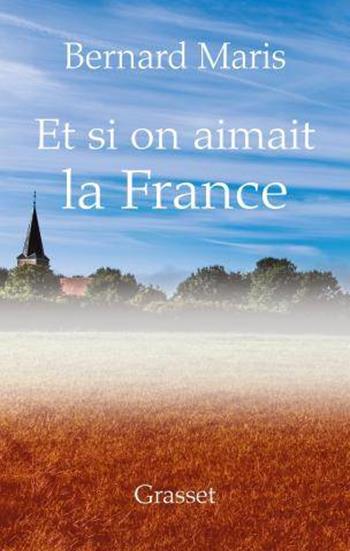 Toutefois, j’ai acheté «et si on aimait la France » de Bernard Maris et j’ai commencé à le lire.
Toutefois, j’ai acheté «et si on aimait la France » de Bernard Maris et j’ai commencé à le lire.
En voici un extrait :
« Nous sommes dans une école de banlieue, dans cette si joliment nommée Ile-de-France, qui fut autrefois le paradis des rois.
La maîtresse est douce, avec son museau pointu sous ses lunettes.
« Les enfants, savez-vous ce qu’est un champ lexical ? » Elle attend, souriante « Alors ? »
Elle n’espère pas de réponse, bien sûr….
La classe de CE1 est sage.
Mais une main de petit garçon se lève :
« Maîtresse, c’est un champ de fleurs ! »
Un champ de fleurs…Elle rit. Comme c’est mignon, un champ de fleurs, quel charmant petit garçon !
Elle secoue la tête, va pour expliquer, mais le petit crépu ajoute :
« Et toi, maîtresse, tu es très belle »
Cette histoire m’a été racontée par mon ami Michel Bernard, écrivain, et de belle langue.
J’ignorais ce qu’était un « champ lexical »
Renseignement pris, on parle de champ lexical pour désigner « un ensemble théorique de noms, de substantifs, d’adjectifs et de verbes appartenant à une même catégorie syntaxique et liés de branches par leur domaine de sens »
[et il donne un exemple] « Le médecin guérit le malade » est un champ lexical de trois substantifs. [D’après mon expérience récente, cette phrase est fausse, mais c’est un champ lexical].
Doit-on assener une telle horreur à des enfants ?
Des enfants qui ne demandent qu’à être ce qu’ils sont, des poètes, comme ce petit garçon qui voit d’abord un champ de fleurs, et dans ces fleurs une jolie maîtresse…»
« Doit-on assener de telle horreur à des enfants. »
Moi aussi je ne connaissais pas le champ lexical jusqu’à ce mes enfants entrent au collège et subissent des cours de français.
J’ai aimé lire la somptuosité des textes de Victor Hugo, j’ai été saisi par les poèmes de Baudelaire et tant de fois subjugué par la langue française, par Flaubert, Balzac, Zola et tant d’autres.
Mais je ne savais pas ce qu’était un champ lexical.
Et cela ne me manquait pas, comme tant d’autres concepts certainement intéressants, utiles, allons jusqu’à indispensables au niveau universitaire quand on veut étudier techniquement la langue.
Mais totalement inapproprié avant.
Et Bernard Maris de continuer :
« Dans notre classe de CM1, notre maître M. Vergniaud – c’était un maître très sévère- nous faisait la lecture chaque vendredi soir, en récompense d’une semaine studieuse. C’était la Guerre du feu de Rosny aîné, ou Un marin de Surcouf de Louis Garneray. Bras croisés, muets de terreur et d’émotion, nous écoutions les courses et les ruses du Malouin qui échappait toujours aux Anglais. Il n’usait pas de « champs lexicaux » ou autres inconvenances. Il nous donnait simplement envie de lire.»
« Il nous donnait simplement envie de lire. »
Vous savez ce que disait Montaigne ?
« Je n’enseigne pas, je raconte. »
Laissons la conclusion à l’inoubliable Bernard Maris qui écrit un peu plus loin, page 31,
« La réponse du petit garçon était très encourageante et… très française. Il charmait sa maitresse par une phrase poétique. Il tournait un compliment. Bref, il parlait à une femme.»
A propos, à Lyon ce weekend end il y a des champs de fleurs sur toute les places. <Des champs de roses>
Et si vous voulez appeler cela des champs lexicaux, comme le jeune garçon, personne ne vous en voudra.
 <503>
<503>
Jeudi 28 mai 2015
Mercredi 27 mai 2015
a sans doute fixé la barre trop bas.»
Mardi 26 mai 2015
c’est quelque chose que l’on construit»
Vendredi 22 mai 2015
deux transgressions françaises »
Jeudi 21 mai 2015
Fondatrice de l’Association internationale des victimes de l’inceste (AIVI)
Mercredi 20 mai 2015
Juge indien de la haute cour de New Delhi
Mardi 19 mai 2015
Rosae rosae rosa
Rosae rosae rosas
Rosarum rosis rosis»
|
Rosa rosa rosam
Rosae rosae rosa
Rosae rosae rosas
Rosarum rosis rosis (refrain)
C’est le plus vieux tango du monde
Celui que les têtes blondes
Ânonnent comme une ronde
En apprenant leur latin
C’est le tango du collège
Qui prend les rêves au piège
Et dont il est sacrilège
De ne pas sortir malin
C’est le tango des bons pères
Qui surveillent l’œil sévère
Les Jules et les Prosper
Qui seront la France de demain
(refrain)
C’est le tango des forts en thème
Boutonneux jusqu’à l’extrême
Et qui recouvrent de laine
Leur cœur qui est déjà froid
|
C’est le tango des forts en rien
Qui déclinent de chagrin
Et qui seront pharmaciens
Parce que papa ne l’était pas
C’est le temps où j’étais dernier
Car ce tango rosa rosae
J’inclinais à lui préférer
Déjà ma cousine Rosa
(refrain)
C’est le tango des promenades
Deux par seul sous les arcades
Cernés de corbeaux et d’alcades
Qui nous protégeaient des pourquoi
C’est le tango de la pluie sur la cour
Le miroir d’une flaque sans amour
Qui m’a fait comprendre un beau jour
Que je ne serais pas Vasco de Gama
Mais c’est le tango du temps béni
Où pour un baiser trop petit
Dans la clairière d’un jeudi
A rosi cousine Rosa
(refrain)
|
||
|
C’est le tango du temps des zéros
J’en avais tant des minces des gros
Que j’en faisais des tunnels pour Charlot
Des auréoles pour saint François
C’est le tango des récompenses
Qui vont à ceux qui ont la chance
D’apprendre dès leur enfance
Tout ce qui ne leur servira pas
Mais c’est le tango que l’on regrette
Une fois que le temps s’achète
Et que l’on s’aperçoit tout bête
Qu’il y a des épines aux Rosa
(refrain)
Paroles et Musique: Jacques Brel, 1962.
Texte soumis aux Droits d’Auteur – Réservé à un usage privé ou éducatif –
|
|
||
|
Mais si le texte de Brel est beau, l’interprétation est géniale : https://www.youtube.com/watch?v=v6rLLE48RL0
|
Dessin de Louison twitté lors des Matins de France Culture du 18/05/2015
|
||
Lundi 18 mai 2015
j’acquitterai, à mon tour, la dette que nous avons »
Mercredi 13 mai 2015
c’est le cœur des vivants. »
Essai sur la Germanie
(Quelquefois attribué à Jean Cocteau)
 La communauté formée de celles et de ceux que nous aimons, de celles et de ceux qui nous ont construit et avec qui nous avons partagé des moments de joie, de rire, d’approfondissement, de partage, compte des personnes vivantes et des personnes qui ne le sont plus.
La communauté formée de celles et de ceux que nous aimons, de celles et de ceux qui nous ont construit et avec qui nous avons partagé des moments de joie, de rire, d’approfondissement, de partage, compte des personnes vivantes et des personnes qui ne le sont plus.Mardi 12 mai 2015
Je crois que nous avons tous appris ou accepté comme une évidence que le monothéisme constituait un immense progrès par rapport au polythéisme.
Même les athées, les incroyants, les disciples des Lumières admettaient qu’il était plus rationnel de croire en un seul Dieu qu’en plusieurs Dieux.
C’était inscrit dans l’Histoire de l’Humanité : un progrès de l’intelligence.
Croire en plusieurs Dieux, c’était une manifestation de l’ignorance : tout ce que l’homme ne comprenait pas il en faisait un Dieu, que souvent il représentait par une idole, des statues.
Croire en un seul Dieu, c’était autre chose, cela ne relevait pas de cette même tentative d’explication du Monde que l’ignorance des hommes ne permettait pas de comprendre. Ce Dieu était plus difficilement représentable, souvent d’ailleurs il était ou il reste interdit de tenter de le représenter.
Il y a quand même quelque chose qui m’interpelle à travers le prisme d’une valeur qui me paraît très importante et que je pense que beaucoup partage : la tolérance.
Les romains étaient polythéistes, ils ont colonisé toute la méditerranée, imposé la « pax romana » et largement profité économiquement de toutes leurs colonies. Mais ils acceptaient que d’autres peuples adorent d’autres dieux que les leurs. Ils ont même admis que le peuple de Judée adore un Dieu particulier. Ils avaient un peu de mal d’abord parce que les habitants Judée ne voulaient pas rendre la politesse aux romains et adorer l’empereur, ensuite parce que cette religion a généré sans cesse des sectes et des conflits théologiques qui créaient de grand désordres dont les romains ne voulaient pas.
Mais au regard de nos valeurs, les romains étaient tolérants et les judéens intolérants.
Ceci nous amène à un second stade de réflexion : voilà un homme ou une femme [mais ce fut quand même plus souvent le fait des hommes], qui croit en un seul Dieu, le sien et qui par voie de conséquence croit que ceux qui ne croient pas dans ce Dieu sont dans l’erreur. Ils ne pensent pas que les autres pensent différemment, non ils sont persuadés que les autres se trompent.
Nous sommes donc dans le domaine de la pensée unique naturellement intolérante.
Quand de belles personnes avec de grandes idées humanistes disent que tel ou tel comportement est un dévoiement de telle religion monothéiste, il néglige ce fait structurel, consubstantiel au monothéisme que celui qui ne croit pas comme toi, ne pense pas différemment mais se trompe.
A cela s’ajoute une autre croyance de ces religions : le passage sur cette terre est temporaire, c’est une évidence. Mais pour ces religions il constitue surtout un épisode secondaire et plutôt une série d’épreuves qui doit préparer à l’épisode principal qui n’est pas sur cette terre.
Donc abréger la vie terrestre par le feu, le sabre ou d’autres mises à mort n’est pas important, dans la mesure où d’une part l’infidèle va pouvoir par le passage vers l’autre vie s’amender et comprendre qu’il s’est trompé et d’autre part parce que cela permet d’éviter qu’il contamine les autres croyants par ses pensées « malsaines ».
Le grand historien Maurice Sartre écrivait en 2009 :
« Les polythéismes antiques ne se pensaient pas détenteurs d’une vérité absolue. Quitte à surprendre, on pourrait affirmer que la différence principale entre les monothéismes et les polythéismes antiques ne réside pas tant dans le nombre des dieux que vénèrent les fidèles que dans la conception que les uns et les autres se font des dieux des autres.
Pour les trois grands monothéismes, il n’existe qu’un Dieu et un seul, le leur, et toute autre croyance relève de l’idolâtrie. Ils se fondent en quelque sorte sur l’exclusion, sur la séparation entre deux groupes antagonistes, fidèles et infidèles, croyants et incroyants, quel que soit le nom qu’on leur donne selon les époques.

En conséquence, l’Autre apparait comme un adversaire qu’il faut amener à croire de gré ou de force.
Même si le judaïsme a renoncé depuis longtemps à cette quête missionnaire, il ne la récuse pas et envisage la conversion de tous à la fin des temps. Quant au christianisme et à l’islam, il suffit de se retourner sur leur longue histoire de violences pour prendre conscience de leur volonté de domination universelle et exclusive.
A cette logique de l’exclusion et de l’hostilité (qu’il convient naturellement de nuancer en fonction des lieux et des temps), les polythéismes antiques opposent une conception du divin radicalement étrangère, qui me semble interdire la naissance d’un intégrisme ou, si l’on préfère, d’un fondamentalisme.
En premier lieu, les polythéismes se montrent ouverts aux autres : pour un Grec, un Romain, un Gaulois ou un Égyptien, les dieux des autres sont des dieux au même titre que les siens propres. Et il n’est pas rare que pour des raisons diverses, à titre collectif ou à titre individuel, les dieux étrangers s’intègrent à un panthéon qui n’est pas le leur. L’Egyptienne Isis, la Phrygienne Cybèle, l’Iranien Mithra, la Syrienne Atargatis trouvent des fidèles partout et dans tous les milieux.
De plus, Grecs et Romains ont su reconnaître spontanément dans les dieux des peuples voisins les équivalents, parfois approximatifs, de leurs propres dieux : tout maitre du panthéon devient facilement un Zeus ou un Jupiter. Mais ce qui compte et qu’il faut souligner, c’est que les polythéismes antiques, selon l’heureuse formule de Jan Assmann, sont « traductibles ». Loin d’être des ensembles clos, figés dans l’absolue certitude d’être seuls détenteurs de la Vérité, les polythéismes antiques se montrent au contraire largement ouverts à la vérité des autres.
Un second point est essentiel rend incompatible, me semble-t-il, l’intégrisme avec les polythéismes antiques. Alors que les monothéismes se fondent sur des textes réputés inspirés par Dieu, voire délivrés par Dieu lui-même (la loi de Moïse, le Coran incréé), interdisant toute remise en cause sous peine de sacrilège, les polythéismes antiques reposent sur des mythes aux contours mouvants : si la trame générale reste identique, les variantes de chaque mythe sont innombrables. Comme aucun de ces textes n’est considéré d’origine divine, il est loisible aux poètes ainsi qu’aux dirigeants des cités de les adapter à leurs besoins esthétiques ou politiques.
Nul ne peut se prévaloir d’un texte « sacré » immuable pour fonder une vision de la société et du monde qu’il prétendrait imposer à tous.
D’ailleurs – et c’est le troisième point essentiel qui interdit l’émergence d’un intégrisme – aucun dieu, au sein des polythéismes antiques, ne prétend imposer à ses fidèles une interprétation globale du monde et dicter les comportements individuels. La morale sociale ne découle pas d’un ordre divin, même si les dieux sont susceptibles de punir le fautif. Bien que le religieux soit omniprésent dans la cité grecque et romaine, il reste subordonné au politique : le fait que le prêtre soit un magistrat parmi d’autres et exerce généralement ses fonctions à titre temporaire interdit qu’il cherche à imposer une loi « divine » comme norme à l’ensemble de la société.
Les lois sacrées méritent le même respect que les autres, mais se bornent à établir les règles à suivre en matière de culte, et ne prétendent pas réguler les comportements individuels ou collectifs à chaque instant de la vie.
On trouverait sans doute d’autres raisons qui interdisent l’intégrisme dans les polythéismes antiques telles que la conception du divin, l’absence d’autorité religieuse centralisée ou l’ignorance de la notion de dogmes et donc d’hérésie. Mais la nature ouverte des polythéismes les conduit structurellement à la tolérance.»
Un monothéisme est naturellement intolérant.
C’est l’intelligence des hommes, des institutions politiques qui sont capable de faire vivre plusieurs religions ensemble qui permettent de surpasser ce germe intolérant du monothéisme.
Mais que l’on regarde dans l’Histoire chaque fois qu’une religion monothéiste s’est emparée seule du pouvoir politique ou s’est appuyée sur le pouvoir politique pour imposer une pensée unique à la société (comme par exemple l’inquisition espagnole), c’était l’intolérance, la violence, la répression et la délation qui régnaient sur cette société. C’était le cas de la France catholique avant le combat des lumières, c’était le cas de la Genève calviniste, c’est aujourd’hui, encore, le cas de l’Arabie Saoudite sunnite, de l’Iran chiite et du plus ignoble d’entre tous l’Afghanistan des talibans..
Cette violence, cette intolérance n’est pas l’apanage du judaïsme, du christianisme ou de l’islam, c’est le germe inscrit dans le monothéisme qui n’est pas régulé par l’intelligence et la tolérance des hommes.
Lundi 11 mai 2015
Jeudi 7 mai 2015
Ce 7 mai je suis en congé et normalement dans ce cas je n’écris pas de mot du jour.
Mais je fais une exception pour célébrer ce beau mois de mai où la France magnifie le droit à la paresse grâce à tous ces jours de congé, ces ponts, ces viaducs, inimaginables dans un autre pays du monde. Le monde entier se moque de ces français paresseux, même si l’envie et la jalousie ne sont pas loin.
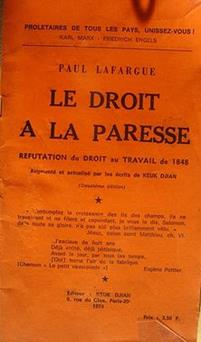 Mais pour comprendre, il faut se rappeler que c’est un français, Paul Lafargue, qui a écrit en 1880 « Le droit à la paresse »
Mais pour comprendre, il faut se rappeler que c’est un français, Paul Lafargue, qui a écrit en 1880 « Le droit à la paresse »
Wikipedia écrit que c’est « un manifeste social qui centre son propos sur la « valeur travail » et l’idée que les hommes s’en font.»
Dans cet ouvrage Paul Lafargue écrit :
« Pour qu’il parvienne à la conscience de sa force, il faut que le prolétariat foule aux pieds les préjugés de la morale chrétienne, économique, libre penseuse ; il faut qu’il retourne à ses instincts naturels, qu’il proclame les Droits de la Paresse, mille et mille fois plus sacrés que les phtisiques Droits de l’Homme concoctés par les avocats métaphysiques de la révolution bourgeoise ; qu’il se contraigne à ne travailler que trois heures par jour, à fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. »
Paul Lafargue est un socialiste français né à Santiago de Cuba, le 15 janvier 1842. C’est son essai Le Droit à la paresse qui a surtout assuré sa notoriété
En 1865, il vient présenter l’état du mouvement socialiste français au conseil général de l’Association internationale des travailleurs à Londres. Il rencontre Friedrich Engels et Karl Marx (en février 1865), dont il épouse la seconde fille, Laura Marx, en avril 1868. Après son exclusion de l’université en France, il retourne à Londres finir ses études. Il fut élu au conseil général de l’Internationale et fréquenta régulièrement les Marx.
Il rentre alors en France où il devient membre de la Première Internationale. Il participe à la Commune de Paris en 1871.
Il fuit la France pour l’Espagne afin d’éviter d’être arrêté.
Il fonde, à Madrid, une section marxiste (1871) de la première Internationale. Il y dirige des groupes ouvriers et combat les thèses anarchistes. Après s’être rendu au Portugal, Lafargue revient à Londres où il rencontre Jules Guesde. Il rentre en France après l’amnistie et fonde, avec Guesde, le Parti ouvrier (1880) et son périodique, Le Socialiste (1885-1904).
Il est incarcéré en 1883 à la prison Sainte-Pélagie pour propagande révolutionnaire, où il rédige le Droit à la paresse.
Gallica a mis en ligne l’intégralité de l’ouvrage : <Le droit à la paresse : réfutation du droit au travail, de 1848 / par Paul Lafargue>
Ouvrage qui commence par cette introduction :
« M. Thiers, dans le sein de la Commission sur l’instruction primaire de 1849, disait: «Je veux rendre toute-puissante l’influence du clergé, parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l’homme qu’il est ici-bas pour souffrir et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l’homme: « Jouis ».» M. Thiers formulait la morale de la classe bourgeoise dont il incarna l’égoïsme féroce et l’intelligence étroite.
La bourgeoisie, alors qu’elle luttait contre la noblesse, soutenue par le clergé, arbora le libre examen et l’athéisme; mais, triomphante, elle changea de ton et d’allure; et, aujourd’hui, elle entend étayer de la religion sa suprématie économique et politique. Aux XVe et XVIe siècles, elle avait allègrement repris la tradition païenne et glorifiait la chair et ses passions, réprouvées par le christianisme ; de nos jours, gorgée de biens et de jouissances, elle renie les enseignements de ses penseurs, les Rabelais, les Diderot, et prêche l’abstinence aux salariés. La morale capitaliste, piteuse parodie de la morale chrétienne, frappe d’anathème la chair du travailleur; elle prend pour idéal de réduire le producteur au plus petit minimum de besoins, de supprimer ses joies et ses passions et de le condamner au rôle de machine délivrant du travail sans trêve ni merci. »
À partir de 1906, il rédige régulièrement des éditoriaux pour l’Humanité.
À 69 ans, en 1911, proche de la limite d’âge de 70 ans qu’il s’était fixé, il se suicide à Draveil avec sa femme Laura Marx, en se justifiant dans une courte lettre : « Sain de corps et d’esprit, je me tue avant que l’impitoyable vieillesse qui m’enlève un à un les plaisirs et les joies de l’existence et qui me dépouille de mes forces physiques et intellectuelles ne paralyse mon énergie, ne brise ma volonté et ne fasse de moi une charge à moi et aux autres. »
Paul Lafargue et Laura Marx sont enterrés au cimetière du Père-Lachaise (division 76), face au mur des fédérés.
« Libération » prétend qu’il faut relire le droit à la paresse <d’urgence>
Moustaki a chanté une chanson lui rendant hommage : <Georges Moustaki – Le droit à la paresse>
<491>
Mercredi 6 mai 2015
Qu’est-ce que la vie ? Une longueur ou une intensité ? »
|
|
Mardi 5 mai 2015
Programme du collège qui vient de paraître
Lundi 4 mai 2015
Jeudi 30 avril 2015
[…] il y a fort à parier qu’une telle modernisation mettra [en France] un certain temps.»
Mercredi 29 avril 2015
Nous inversons la proposition : pour nous, la première sécurité est la liberté. »
L’expression complète de Mauroy est
« Pour la droite, la première liberté, c’est la sécurité. Nous inversons la proposition : pour nous, la première sécurité est la liberté. »
Sous le titre <« La sécurité est la première des libertés. » Ou l’inverse ?> Rue 89 a publié, le 23/04/2015, un article dont je cite ci-après quelques extraits :
« En 1981, quand Alain Peyrefitte faisait de la sécurité la première des libertés, Pierre Mauroy inversait la proposition. Depuis, la gauche, à commencer par Manuel Valls, a adopté cette posture hier affichée par le FN.
De la bouche d’un gaulliste à celle d’un Premier ministre socialiste. En passant par une affiche de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal-Le Pen dans les bras, pour les régionales en Paca, en 1992. « La sécurité, première des libertés » est une formule qui a fait du chemin, avant d’être reprise par Manuel Valls le 13 avril, dans l’hémicycle, pour défendre le controversé projet de loi sur le renseignement. […]
Associée à la droite et l’extrême droite jusqu’aux années 90, l’expression n’est aujourd’hui plus du tout discriminante et constitue, comme le notait Libération en 2013 après une sortie d’Estrosi sur le sujet, « un poncif du débat public » depuis vingt ans. […] ainsi, au gaulliste Alain Peyrefitte, qui répète que « la sécurité est la première des libertés » lors de l’examen de sa loi « Sécurité et Liberté », le socialiste Pierre Mauroy rétorque, en mars 1981 : « Pour la droite, la première liberté, c’est la sécurité. Nous inversons la proposition : pour nous, la première sécurité est la liberté. »
La loi portée par Peyrefitte, alors garde des Sceaux, comprenait, selon ses détracteurs, 95 fois le mot « sécurité » et 5 fois le mot « liberté ». Ce débat – passionné – est généralement utilisé pour dater le début du débat « sécuritaire ». Ce mot entre d’ailleurs dans le vocabulaire au début des années 80. A l’époque, la gauche, vent debout contre la droite « liberticide », demande son abrogation lorsqu’elle arrive au pouvoir. C’était un engagement de campagne de Mitterrand (n° 52).
Là, comme dans tant d’autres domaines, la frontière entre la droite et les socialistes va tendre à s’estomper.
[…] la déclaration de politique générale de Jospin, le 19 juin 1997, affirmait : « La sécurité, garante de la liberté, est un droit fondamental de la personne humaine. » […]
Pour justifier cette pirouette sémantique, la gauche fait appel à la fameuse Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, texte révolutionnaire s’il en est, qui fait figurer la « sûreté » parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’homme dans son article 2 : « Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »
Mais sécurité n’est pas sûreté. L’ancien ministre de la Justice socialiste Robert Badinter le rappelle dans un entretien au Monde, en janvier 2004 : « Ce qui est consacré dans la Déclaration des droits de l’homme, c’est la sûreté, c’est-à-dire l’assurance, pour le citoyen, que le pouvoir de l’Etat ne s’exercera pas sur lui de façon arbitraire et excessive. Le droit à la sûreté, c’est la garantie des libertés individuelles du citoyen. »
[…] Bref, pas très malin pour les socialistes. D’ailleurs, les meilleures critiques de la formule, ce sont eux-mêmes, les socialistes. Ainsi, Jean-Jacques Urvoas, président PS de la commission des Lois, a un jour (lointain) écrit sur son blog : « C’est l’occasion pour moi de dire que je ne comprends pas le slogan répété à satiété selon lequel « la sécurité serait la première des libertés ». […] Si je suis de gauche, c’est d’abord parce que je veux vivre dans un pays libre ! […] Et s’il faut conjuguer la sécurité avec notre devise républicaine, alors affirmons que » la sécurité est la garantie de l’égalité « . Voilà le combat historique de la gauche ! »
[…] Manuel Valls lui-même, dans son livre « Sécurité : la gauche peut tout changer » (éditions du Moment), sorti en avril 2011, écrivait que « l’opposition affichée systématiquement entre sécurité et liberté [lui paraissait] toujours un peu creuse. » Tout en moquant : « Ceux qui tentent d’échapper à ce piège idéologique en affirmant, rapidement, que la sécurité est la première des libertés. »
Je trouve cet article particulièrement rafraichissant dans ses rappels historiques et aussi dans sa capacité à mettre nos gouvernants face à leurs incohérences et contradictions.
<486>
Mardi 28 avril 2015
c’est que ce sont des hommes,
des hommes en danger de mort. »
|
|
Et Jean-Paul Sartre a déclaré :
« Personnellement, j’ai pris parti pour des hommes qui n’étaient sans doute pas de ceux qui étaient mes amis au temps où le Vietnam se battait pour la liberté. Mais ça n’a pas d’importance, parce que ce qui compte ici, c’est que ce sont des hommes, des hommes en danger de mort. Et je pense que les Droits de l’Homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise. »
|
Lundi 27 avril 2015
Les Turcs appelaient «restes de l’épée» (kiliç artigi) ces Arméniens, surtout des femmes et des enfants, qui ont échappé au génocide de 1915, enlevés ou protégés par des familles musulmanes. Le journaliste arménien de Turquie Hrant Dink parlait, lui, «d’âmes errantes» et a tenté, jusqu’à son assassinat à Istanbul en 2007, de retrouver cette mémoire engloutie, reconnaissant qu’en Turquie, «il est encore plus difficile de parler des vivants que des morts». Nul ne sait combien sont les descendants des rescapés restés en Anatolie orientale se cachant ou le plus souvent se convertissant à l’islam, tout en se fondant parmi les populations turque et kurde.
J’ai découvert cette terrible expression : « les restes de l’épée », c’est à dire ce qui reste quand on a passé « la plus grande partie au fil de l’épée » dans un documentaire de France 24 : Génocide arménien, le spectre de 1915.
Ce documentaire se focalise sur 3 destins :
Un absent, Hrant Dink qui fut assassiné, le 19 janvier 2007 à Istanbul, par un nationaliste turc. Il était turc arménien et l’a toujours su. Il a consacré sa vie à ce que le débat sur les massacres de 1915 s’ouvre en Turquie et que la Turquie et l’Arménie puissent se rapprocher. Le nationaliste turc qui voulait faire taire cette voix a échoué : 100 000 personnes, arméniens mais aussi turcs et kurdes ont assisté à ses funérailles en scandant « Nous sommes tous des Hrant Dink, nous sommes tous arméniens ». Cet assassinat a déclenché, dans la société civile turque, une vraie prise de conscience.
Le second destin est une femme : Fethiye Çetin, avocate. Elle fut l’avocate de Hrant Dink dans les procès que l’Etat turc a engagés contre lui. Elle ne se savait pas arménienne, elle a appris tard qu’elle faisait partie des « restes de l’épée », petite-fille d’une rescapée du génocide arménien.
Le troisième destin est celui d’un turc de haut lignage, journaliste et écrivain. Il devint l’ami de Hrant Dink. Il s’appelle Hasan Cemal.
Le mouvement jeunes turcs qui gouvernait l’empire ottoman en 1915 et a décidé du génocide, était dirigé par un triumvirat appelé les « Trois pachas ». : Talaat Pacha, Enver Pacha et Cemal Pacha.
Hasan Cemal est le petit fils du dernier. Dans le documentaire il raconte son long cheminement qui l’a amené à aller s’incliner devant le monument au génocide arménien d’Erevan et à reconnaître la réalité. Il dit que peu importe le nom qu’on donne à ces évènements mais ils étaient ignobles.
Il est bien sûr attaqué par les nationalistes turcs désormais, mais il poursuit sa route et dit
« Après avoir compris tout cela comment pourrais-je dire que mon grand-père était un homme bien, le pourriez-vous ? »
La fin du documentaire montre Fethiye Çetin arrivant à fédérer des turcs des kurdes et des arméniens pour restaurer un lieu historique : les fontaines du village où vivait sa grand-mère avant le génocide.
<Vous trouverez ici ce très beau documentaire de France 24>
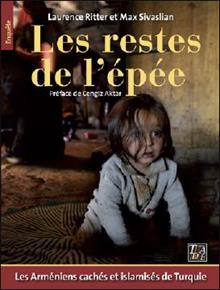
Le chemin de la reconnaissance des évènements par les turcs sera encore long, mais il est largement entamé notamment par la société civile.
<484>
Vendredi 24 avril 2015
« Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un Génocide qui s’est déroulé contre le peuple arménien. »
Les arméniens du Monde commémorent le génocide de leur peuple ce 24 avril, car le 24 avril 1915 le ministre de l’intérieur Talaat Pacha du gouvernement Jeunes-Turcs donne l’ordre de l’arrestation des intellectuels arméniens. L’opération débute à 20 heures à Constantinople. Dans la nuit du 24 au 25 avril 1915, 235 à 270 intellectuels arméniens sont alors arrêtés, en particulier des ecclésiastiques, des médecins, des éditeurs, des journalistes, des avocats, des enseignants, des artistes et des hommes politiques dont des députés au parlement ottoman.
Le mot du jour est un propos qu’a tenu le Sénateur Barack Obama en 2007, le Sénateur pas le Président. Car bien qu’il s’y soit engagé lors de sa campagne présidentielle, Barack Obama n’a pas fait reconnaître le génocide par les Etats Unis. Il est allé en visite officielle en Turquie, sans dire un mot de ce sujet.
Lors d’un rendez-vous hebdomadaire du « Breakfast briefing » organisé par les Sénateurs de l’Illinois, l’Armenian National Committee of America (Comité de Défense de la Cause Arménienne aux Etats-Unis) est intervenu pour interroger le Sénateur Barack Obama, sur la question du Génocide Arménien. Une intervenante a demandé s’il allait s’engager à défendre la résolution reconnaissant le Génocide Arménien (S. Res. 106). A cette question le Sénateur Obama a répondu :
« Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un Génocide qui s’est déroulé contre le peuple arménien. C’est l’une de ces situations où l’on a vu un déni constant d’une part du gouvernement turc ainsi que d’autres, c’est ce qui a eu lieu. C’est devenu un sujet diplomatique douloureux… ».
 La vidéo est là : <Obama parle du génocide arménien>
La vidéo est là : <Obama parle du génocide arménien>
Mais les Etats-Unis ne veulent pas fâcher la Turquie et restent donc très prudent.
Nous restons dans le déni, le négationnisme du génocide par la Turquie.
Mais pourquoi ?
Ces massacres ont été perpétrés par le gouvernement jeune-turc qui a été renversé par Mustapha Kemal. La Turquie Kémaliste pourrait donc reconnaître ce crime commis par d’autres. Les allemands parlent du crime des nazis et non du crime des allemands. Les turcs pourraient tenter cette même dissociation entre les jeunes turcs et la Turquie d’aujourd’hui.
Remarquons qu’en ce moment ce n’est plus le parti créé par Atatürk qui est au pouvoir mais le parti religieux d’Erdogan qui a pris le pouvoir contre le parti des Kemalistes.
Mais rien n’y fait, sur ce plan il y a continuité, la Turquie continue à nier, parlant de massacre, d’initiatives individuelles. L’objectif dans cette thèse n’était pas l’élimination du peuple arménien, mais simplement son éloignement des zones de combat qui se trouvaient en territoire arménien, parce que des arméniens auraient trahi l’empire Ottoman et se seraient alliés aux Russes. La déportation était donc un acte de sécurité nationale.
Cette thèse est balayée par des ordres qui ont été écrits par des membres du gouvernement, démentie par des témoignages notamment d’allemands alliés des ottomans rapportant des propos de leurs interlocuteurs. En outre, la trahison des arméniens en 1915 est aussi un mensonge
Les jeunes turcs comme plus tard les kémalistes étaient des nationalistes turcs. Ils voulaient d’abord à l’intérieur de l’empire ottoman puis, après son effondrement dans l’Etat turc, créer une nation turque pure et nettoyée des peuples chrétiens de l’empire qui ne rentraient pas dans ce projet. Car si on parle du génocide arménien, il y eut d’autres massacres de chrétiens à cette période à l’intérieur de l’empire ottoman, notamment les chrétiens syriaques. L’empire ottoman comptait 20% de chrétiens, aujourd’hui selon wikipedia il y a 0,4 % de chrétiens dans l’Etat turc.
Les kurdes n’étaient pas non plus turcs, mais ils étaient musulmans et ont beaucoup participé aux massacres des arméniens. Par la suite Atatürk a voulu en faire des turcs cela n’a pas fonctionné. Aujourd’hui encore les kurdes de Turquie sont en lutte contre l’Etat.
Un Etat nation turc, voilà ce qu’Atatürk et les jeunes turcs partageaient.
Le traité de Sèvres du 10 août 1920 qui met fin à l’empire Ottoman, évoque les massacres arméniens et des réparations.
Mais si l’empire Ottoman a perdu la guerre, la Turquie de Mustapha Kemal va la gagner contre les grecs et les alliés fatigués laisseront faire. Atatürk ne reconnaîtra jamais le traité de Sèvres et obtiendra le Traité de Lausanne en 1923, beaucoup plus avantageux. Dans ce traité il n’est plus question des arméniens et de leur massacre.
Quand des arméniens survivants voudront revenir en Anatolie où ils vivaient depuis des siècles, la Turquie Kémaliste refusera de leur délivrer un passeport turc : ils ne font pas partie de la nation turque et l’Etat nation choisit qui sont ses ressortissants.
Si Atatürk n’a pas été à l’origine du génocide, celui-ci a bien aidé ses objectifs nationalistes. Reconnaître le génocide serait aussi mettre en cause la structure même de l’Etat nation turc, sans parler des réparations que cela pourrait entrainer et l’abandon d’une fiction car il y avait d’autres peuples en Anatolie que le peuple turc.
Je suis beaucoup plus savant sur ce sujet depuis que j’ai écouté les 4 émissions de la Fabrique de l’Histoire de France Culture consacré à ce fait historique
Il y a aussi ce site remarquable consacré entièrement à ce sujet : http://www.imprescriptible.fr/
Devant cette horreur, cette fracture de notre humanité, il reste une bonne nouvelle : le génocide a échoué : le peuple arménien, la culture arménienne ont survécu et ont essaimé dans le monde.
<483>
Jeudi 23 avril 2015
Mercredi 22 avril 2015
Avouons que nous avons tous, d’abord un peu honteux, regarder des séries américaines. Et même nous y avons pris goût.
Nous n’osions le dire mais cela nous plaisait.
Maintenant nous pouvons nous rassurer.
De grands esprits, des philosophes, des universitaires et même des critiques de cinéma du Cahier des Cinémas, nous expliquent qu’il s’est passé un « truc » aux Etats Unis où est né un nouvel espace créatif qui est devenu un phénomène artistique de premier plan, un art majeur.
Si nous aimions, c’est parce que ce sont de vrais œuvres d’art dont certaines même sont géniales.
Il y a maintenant sans cesse des classements pour savoir quelle est la série la plus remarquable :
- « Mad men »,
- « Breaking Bad »,
- « Game of Thrones »,
- « True Detective »,
- « The Wire », et bien d’autres.
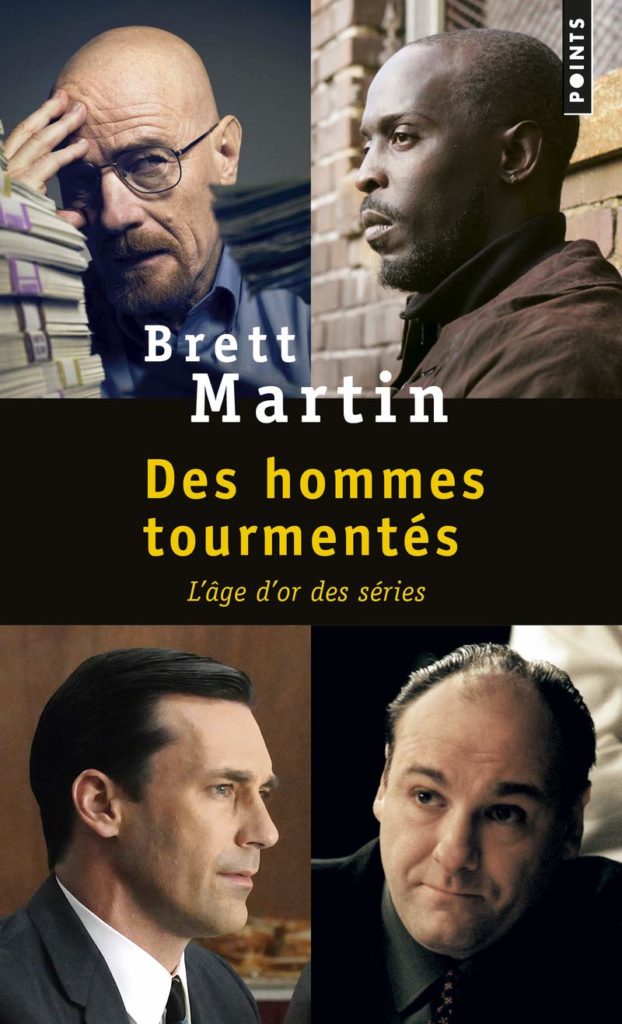 Brett Martin dans son ouvrage <Des hommes tourmentés> raconte cette histoire et parle de l’âge d’or des séries américaines, pour être plus précis, il parle du 3ème âge d’or.
Brett Martin dans son ouvrage <Des hommes tourmentés> raconte cette histoire et parle de l’âge d’or des séries américaines, pour être plus précis, il parle du 3ème âge d’or.
Il était l’invité de Nicolas Demorand <Hommage aux antihéros des séries américaines avec Brett Martin>
Il raconte cette révolution de la télévision américaine.
Avant les années 2000, la télévision était le cimetière des ambitions artistiques.
C’était un désert de platitude où régnait la publicité où il ne fallait pas froisser les annonceurs, les grandes marques étaient très conservatrices. Il fallait des héros positifs, des intrigues claires, avec des bons et des méchants et où à fin le bon devait toujours gagner.
C’est surtout une chaine de télévision Home Box-Office (ou HBO), chaîne de télévision payante qui va balayer tout cela.
C’était une chaine d’abonné sans publicité.
Cette chaîne a eu des patrons intelligents, intuitifs et téméraires pour croire et avoir foi en des artistes.
« Ce fut la source magique, faire confiance aux auteurs. » dit Brett Martin
Cela commence par « Les Soprano », histoire d’un mafieux violent mais dépressif et qui a des problèmes avec ses enfants adolescents.
Ils vont récupérer des cinéastes maudits, des scénaristes qui trainaient dans le milieu de la télévision sans jamais avoir eu la chance de se faire connaître et c’est avec eux qu’ils vont créer cet âge d’or.
Ces hommes tourmentés (les antis héros des séries) sont des hommes fragiles entre leur désir de faire le bien et leur tendance à faire le mal et un mal absolu.
Ces séries sont ouvertes et l’intrigue est inventée d’un épisode à l’autre.
Les personnages deviennent très complexes, le spectateur va suivre leurs évolutions pendant des dizaines d’heures et pas seulement 2 heures comme au cinéma.
Et pour que cela captive il faut de véritables auteurs comme David Simon (The Wire) ou Matthew Weiner (Mad Men).
On apprend qu’il a fallu sept ans à Matthew Weiner pour trouver un diffuseur à Mad Men.
Télérama décrit cette évolution :
« Une rage d’écrire autre chose, d’envoyer balader les codes et les bienséances, de rendre sa noblesse à un genre qui plante ses racines chez Dickens et Dumas, dans le feuilleton littéraire du XIXe siècle. Une envie, un besoin, qui renversera les logiques économiques classiques pour pousser HBO, FX, AMC et d’autres chaînes câblées américaines à développer des séries d’auteurs, à fouiller sans retenue la psyché humaine et les entrailles de la société contemporaine. »
Même les matins de France Culture s’y sont mis : <De Dallas à True detective la révolution des séries>.
Et les séries ont leur festival dont c’est la 6ème saison du 17 au 26 avril, donc en ce moment : < https://series-mania.fr/ > au Forum des images qui se trouve Forum des Halles.
Souvent dans l’Histoire, quand tant d’intellectuels émérites commencent à s’intéresser à un phénomène c’est qu’il touche à sa fin …
Mais Brett Martin pense que ce n’est pas encore la fin de l’âge d’or.
<481>
Mardi 21 avril 2015
Lundi 20 avril 2015
C’est pour mieux t’entendre. »
Le petit chaperon rouge, dialogue avec le loup
Vendredi 17 avril 2015
Le problème, c’est qu’il y ait des lecteurs pour les prendre au sérieux. »
Simon Leys, nom de plume de Pierre Ryckmans, est un écrivain belge, né en 1935 et mort le 11 août 2014 en Australie.
Sa grande œuvre fut de dénoncer la Chine maoïste, son grand combat fut celui contre les intellectuels maoïstes qui étaient très nombreux à l’époque et qui ont tenté par tous les moyens de le dénigrer.
Il a eu cette phrase, mot du jour d’aujourd’hui, dans une émission Apostrophes de Bernard Pivot de 1983 où il dit que le plus grave ce n’est pas que des gens qui ont le pouvoir médiatique ou littéraire, énonce des contre-vérités mais le plus grave c’est qu’il existe de nombreuses personnes qui les croient et considèrent que c’est la vérité.
 En 1971, sous le pseudonyme de Simon Leys, il publia un essai, «Les Habits neufs du président Mao», dénonciation de la Révolution culturelle chinoise. Il sera immédiatement la cible d’une grande partie des intellectuels parisiens dont beaucoup étaient maoïstes.Il sera attaqué par la revue «Tel Quel» dont Philippe Sollers est un des principaux animateurs et également le journal «Le Monde».
En 1971, sous le pseudonyme de Simon Leys, il publia un essai, «Les Habits neufs du président Mao», dénonciation de la Révolution culturelle chinoise. Il sera immédiatement la cible d’une grande partie des intellectuels parisiens dont beaucoup étaient maoïstes.Il sera attaqué par la revue «Tel Quel» dont Philippe Sollers est un des principaux animateurs et également le journal «Le Monde».
A l’époque, il était assez isolé, soutenu cependant par des intellectuels comme Jean-François Revel et René Étiemble.
Ils étaient peu nombreux à avoir raison devant la cohorte de ceux qui considéraient la Chine de Mao comme un eldorado de la pensée et de l’accomplissement humain.Sartre, Foucault, Barthes, Kristeva étaient dans le camp des idiots.
J’ai choisi cette phrase comme mot du jour, parce que nous sommes le 17 avril 2015 et qu’il y a 40 ans : le 17 avril 1975, alliés de la Chine, les Khmers rouges entraient dans Phnom Penh.<Et vous lirez dans cet article de 2012 de l’Express le même aveuglement d’intellectuels, souvent les mêmes maoïstes, face aux -crimes des khmers rouges>
Les estimations des victimes varient entre 740 000 et 2 200 000 morts sur une population d’un peu moins de 8 000 000 habitants.Vous lirez les noms de ces intellectuels qui ont dit des idioties : Noam Chomsky, Jean Lacouture, Vergés, Serge July et bien d’autres.
Le Monde et la plupart des organes de presse, y compris Le Nouvel Observateur seront du mauvais côté.
La Une de Libération, le 17 avril 1975 s’intitule «Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh»
et quelques jours après «7 jours de fête pour une libération.»
Simon Leys, avait raison à l’époque contre beaucoup.
La question qu’il est légitime de se poser : quelles sont les idioties d’aujourd’hui ? et qui sont les Simon Leys ?
Les idiots devraient être plus faciles à reconnaître : on les voit souvent et ils parlent avec l’assurance de la vérité révélée.
<478>
Jeudi 16 avril 2015
Mercredi 15 avril 2015
Mardi 14 avril 2015
Lundi 13 avril 2015
Jamais j’entends rêver d’une démocratie mondiale qui serait centrée sur l’Asie.»
Vendredi 10 avril 2015
Jeudi 9 avril 2015
il a pris mon dossier, il l’a mis à la poubelle
et il m’a dit : ce qui est compte ce n’est pas votre dossier, c’est le passé. Ce qui compte c’est ce que vous êtes et ce en quoi vous croyez !»
|
Le mot du jour est constitué des premiers mots qu’a tenus le directeur de cet établissement à Laetitia. Il avait sur son bureau le gros, le lourd, le « mauvais » dossier de Laetitia Sauvage.
«Le directeur m’a regardé droit dans les yeux, il a pris mon dossier, il l’a mis à la poubelle et il m’a dit : ce qui est compte ce n’est pas votre dossier, c’est le passé ce qui compte c’est ce que vous êtes et ce en quoi vous croyez !»
A la fin de cet entretien elle a fait cette réflexion : «C’est incroyable, jamais je n’ai été traitée ainsi »
Et elle a eu son bac.
Et elle est allée faire du bénévolat au Burkina Faso à 18 ans, expérience qui l’a incitée à reprendre des études en France.
|
|
Mercredi 8 avril 2015
La mort les a frappés sans demander leur âge puisqu’ils étaient fautifs d’être enfants d’Arménie.»
Il y a 100 ans commençait un des évènements du XXème siècle qui ont montré que la civilisation n’était qu’un vernis qui pouvait sauter en quelques instants pour dévoiler les abimes monstrueux que notre humanité cachait.
Les arméniens commémorent le génocide arménien le 24 avril. Parce que le 24 avril 2015 correspond à l’arrestation de 300 intellectuels et notables arméniens à Constantinople et a été suivi par tout le mécanisme génocidaire.
Mais le 8 avril 1915, il y a 100 ans, jour pour jour, à Zeitoun, ville de Cilicie au Nord l’Alep, les exactions commençaient : <Massacres à Zeïtoun>
Quelques semaines auparavant les russes venaient de battre les troupes turques.Le gouvernement « jeune turc » a alors accusé les arméniens chrétiens d’avoir trahi l’empire ottoman. D’autres raisons plus obscures existaient aussi.Le génocide fut d’abord une déportation des arméniens vers des régions hostiles.
Mais ces déportations qui déjà, en eux-mêmes, entrainaient ce peuple désarmé vers la mort, se sont accompagnés d’horreurs sans nom.
Comme dans tout génocide, les acteurs de ce crime ont d’abord regardé le peuple victime comme des sous hommes à qui on pouvait tout infliger.Les turcs ont beaucoup délégué d’atrocités à des supplétifs issus d’un autre peuple de l’empire : les Kurdes.
Si vous ne savez pas, regardez ce <Film documentaire d’Eric Friedler : Aghet le génocide arménien>
«Aghet» est un mot arménien qui signifie catastrophe.Mais pour mettre des mots sur cette faille de l’humanité, il faut comme souvent en appeler au poète et à l’artiste.Ici Charles Aznavour, enfant de ce peuple :
Ils sont tombés…
«Ils sont tombés, sans trop savoir pourquoi
Hommes, femmes, et enfants qui ne voulaient que vivre
Avec des gestes lourds comme des hommes ivres
Mutilés, massacrés, les yeux ouverts d’effroi.
Ils sont tombés en invoquant leur Dieu
Au seuil de leur église ou au pas de leur porte
En troupeau de désert, titubant, en cohorte
Terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu.
Nul n’éleva la voix dans un monde euphorique
Tandis que croupissait un peuple dans son sang
L’Europe découvrait le jazz et sa musique
Les plaintes des trompettes couvraient les cris d’enfants.
Ils sont tombés pudiquement, sans bruit,
Par milliers, par millions, sans que le monde bouge,
Devenant un instant, minuscules fleurs rouges
Recouverts par un vent de sable et puis d’oubli.
Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil,
Comme un oiseau qu’en vol une balle fracasse
Pour mourir n’importe où et sans laisser de traces,
Ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil.
Ils sont tombés en croyant, ingénus,
Que leurs enfants pourraient continuer leur enfance,
Qu’un jour ils fouleraient des terres d’espérance
Dans des pays ouverts d’hommes aux mains tendues.
Moi je suis de ce peuple qui dort sans sépulture
Qui choisit de mourir sans abdiquer sa foi,
Qui n’a jamais baissé la tête sous l’injure,
Qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas.
Ils sont tombés pour entrer dans la nuit
Eternelle des temps, au bout de leur courage
La mort les a frappés sans demander leur âge
Puisqu’ils étaient fautifs d’être enfants d’Arménie.»
<Ici Aznavour dans une de ses interprétations de sa chanson>
<471>
Mardi 7 avril 2015
|
|
On démarre le XXème siècle avec 1,8 milliards d’humains aujourd’hui nous sommes à 7,2 milliards mais il y a le même nombre de gens qui ont faim : 800 millions. L’agriculture est donc parvenue à nourrir un beaucoup plus grand nombre d’humains avec les mêmes terres cultivables.
Les démographes attendent encore l’arrivée de 2 milliards et demi d’humains au-delà de 2050, puis la population mondiale devrait stagner à 9,5 milliards.
Mais au XXème siècle « c’était facile », on a prélevé énormément de ressources non renouvelables pour produire de plus en plus : on a utilisé de plus en plus de terres, d’eau, d’engrais, de pesticides, d’énergie et de tracteurs.
Au XXIème siècle il faudra produire plus avec moins : moins de terre, moins d’eau et moins d’énergie : il faudra promouvoir une agriculture écologiquement intensive et non plus chimiquement intensive.
|
Ne plus rien gâcher ! tout est matière première
Modifier nos habitudes alimentaires
Inventer une agriculture écologiquement intensive qui fasse plus et mieux avec moins
Chercher « nos OGM » à notre manière
Promouvoir l’agriculture vivrière dans le monde
Vendredi 3 avril 2015
Le tourbillon de l’eau l’effraie.
Et s’il veut partager notre voyage,
Il doit s’aventurer bien au-delà du sable rassurant du rivage.»
|
|
Extrait de la quatrième de couverture : « Delphine Minoui raconte ses années iraniennes, de 1997 à 2009. Au fil de cette missive où passé et présent s’entrechoquent, la journaliste franco-iranienne porte un regard neuf et subtil sur son pays d’origine, à la fois rêvé et redouté, tiraillé entre ouverture et repli sur lui-même. Avec elle, on s’infiltre dans les soirées interdites de Téhéran, on pénètre dans l’intimité des mollahs et des miliciens bassidjis, on plonge dans le labyrinthe des services de sécurité, on suit les espoirs et les déceptions du peuple, aux côtés de sa grand-mère Mamani, son amie Niloufar ou la jeune étudiante Sepideh.
|
Jeudi 2 avril 2015
Mercredi 1er avril 2015
donc, oui, Monseigneur, vous avez raison, mais par vos esquives, ne seriez-vous point le premier et le plus grand responsable de l’immobilisme ? »
dans le roman « Le fantôme de l’Elysée » de Philippe Dessertine, .
Visite impromptue du baron Necker à François Hollande
|
|
– Retraites, c’est-à-dire pensions ? Croyez-en ma recette : réductions, coupes uniformes ne laissant aucun statut à l’écart des bouleversements. L’uniformité des régimes est la seule vraie grande idée, ce sera celle que combattent tous ceux bénéficiant d’une exception.
– Au-dedans de la fonction publique et à l’extérieur, nous sommes d’accord ?
– Certes. Il faut porter le fer partout à la fois. Monsieur Turgot n’hésita point à s’attaquer aux corporations, protégées par des textes et surtout par leur farouche volonté de ne point s’ouvrir
– Les corporations… Oui, nous avons changé la dénomination, “les professions réglementées”, mais nous avons conservé le problème. Dans cette direction aussi, vous me conseilleriez de passer à l’offensive ?
– En ayant bien consolidé vos arrières. Monsieur Turgot dut reculer en rase campagne pour avoir mésestimé les pouvoirs établis. Mais vous voyez que lui et moi n’étions point si éloignés. Je me suis attelé à mon tour au principe d’égalité de traitement, d’égalité de prélèvement.
|
Mardi 31 mars 2015
|
|
«Un tuteur malhonnête ou négligent, qu’il travaille dans un hôpital, une association, ou qu’il exerce en libéral, agit toujours avec la complicité active ou passive des «charognards de la tutelle» écrit l’auteur, notaire, marchand immobilier ou commissaire priseur, juge et autre directeur de pompes funèbres.
Tout un petit monde susceptible de prendre sa part de marché tutélaire, cet «or gris» si facile à ramasser, et encore plus si un médecin vient poser un diagnostic de paranoïa, coupant court à toute protestation. Siphonage d’une assurance-vie, maison de famille revendue à des prix sans rapport avec ceux du marché, vol de meubles : aucune statistique à ce jour sur cette pagaille lucrative.
Dans ce mal contemporain, qui s’abat sur l’handicapé psychique à qui on «oublie» de verser son pécule de survie comme sur le vieillard maltraité en maison de retraite, que son protecteur officiel ne défendra pas dans un réflexe de soutien à l’institution, Valérie Labrousse, en lectrice attentive d’Hannah Arendt, entrevoie les symptômes de la banalité du mal – servilité, relativisme de l’horreur, refus du jugement moral et rationalisme bureaucratique sur fond d’indifférence à la souffrance de l’autre.
|
Lundi 30 mars 2015
Pierre Le Coz est professeur de philosophie et dirige le département des sciences humaines de la Faculté de médecine de Marseille. Il a publié en 2014 un livre : «Le gouvernement des émotions»
Cette réflexion sur les émotions telles que la compassion, la peur, l’angoisse, l’indignation ou la complaisance morbide immergées dans un bain médiatique me paraît particulièrement appropriée à la fin d’une semaine d’hystérie médiatique autour d’un acte meurtrier produit probablement par un déséquilibré isolé et extrêmement rare.
Ainsi, sur tous les médias on n’entendait plus que cette histoire mille fois répétée, avec un ton anxiogène et l’impression que c’était devenu le problème le plus important de l’Humanité : comment éviter qu’une personne prise de folie meurtrière et suicidaire, aux commandes d’un avion, puisse le détruire avec tous ses passagers.
Dans l’émotion certains ont pris immédiatement des mesures : Il faut une deuxième personne dans le cockpit.
Un commandant de bord a expliqué combien cela apparaissait délirant :
On allait imposer une contrainte qui dans 99,9999% des cas est inutile.
Et si dans le cockpit le pilote ou celui qui le surveille ont décidé de faire cet acte insensé, il dispose d’une hache qui se trouve dans l’habitacle, pour sans crier gare, exécuter d’abord l’empêcheur de leur acte puis réaliser exactement le même délire. Et même sans la hache, d’autres moyens existent pour neutraliser l’autre.
En outre, on peut estimer qu’il y a dans ce cas un double risque : dans un groupe de deux personnes il y a rationnellement deux fois plus de chance qu’il y ait un fou que dans un singleton.
Il y a même un journaliste qui a émis cette idée géniale qu’on pourrait prévoir un système qui permette de prendre les commandes de l’avion à distance. Donc pour répondre à un risque extrêmement faible on ouvrirait une possibilité à des milliers de hacker, pour qui ce serait évidemment un défi exaltant de parvenir à prendre le contrôle d’un avion en vol pour jouer, obtenir une rançon ou plus brutalement perpétrer un acte terroriste.
Tout cela alors que, contrairement à l’impression que les médias peuvent donner : l’aviation civile entraîne de moins en moins de morts chaque année bien qu’il y ait de plus en plus de personnes qui prennent l’avion.
Vous prenez beaucoup plus de risque, quand vous prenez chaque matin votre voiture. Mais ce raisonnement est rationnel.
L’émotion permet la manipulation et entraîne des réactions souvent peu pertinentes comme le montre cette fausse bonne idée de doubler les personnes présentes dans le cockpit.
L’émotion de celles et ceux qui sont touchés par ce drame est naturelle et digne de compassion, mais l’émotion planétaire que veulent déclencher les médias n’est en aucune façon guidée par l’intérêt public ou la noblesse des sentiments. C’est uniquement un évènement qui leur permet de « faire de l’audience et donc du fric » alors que leur rôle devrait être de prioriser l’information pour l’intérêt de tous.
Et les politiques ! Que viennent faire dans ce lieu de l’émotion légitime des familles, le président français, la chancelière allemande et le premier ministre espagnol. Ils sont élus pour nous préparer au monde de demain, aux bouleversements que va créer dans l’économie les problèmes écologiques terribles qui sont prégnants, un monde où l’automatisation de plus en plus intense des processus intellectuels vont conduire à un monde avec de moins en moins d’emplois, sans compter un monde de vieux en trop grand nombre pour les capacités de nos systèmes sociaux. Et sur tous ces sujets ils sont absents, constants dans leurs recettes anciennes qui ne sont plus adaptées au monde d’aujourd’hui et de demain.
Face à leur vacuité devant les problèmes vraiment importants, ils se réfugient dans un rôle d’assistants psychologues pour drames médiatisés !
Et que dire du Ministre de l’intérieur qui débarque dans cet endroit pour annoncer devant la presse, (toujours la presse !) qu’il allait coordonner l’ensemble des services de sécurité et de secours.
Il n’y a pas de préfet ? Ce haut fonctionnaire est devenu incompétent ? Le ministre de l’intérieur va s’installer pendant 5 jours dans les Alpes de Haute Provence pour remplacer le préfet ?
Ecoutez donc Pierre Le Coz dans cette émission de France Inter : <La tête au carré : le gouvernement des émotions>
Sur la page de cette émission on peut lire la débauche «d’excitations sensorielles soulève des enjeux éthiques majeurs. Car, quand nos émotions sont dévoyées, ce sont nos jugements de valeur qui se trouvent pervertis.»
Ou plus court cette vidéo de 4 minutes : <Le gouvernement des émotions – Pierre Le Coz> . Il dit notamment que
« L’émotion a toujours été le cheval de Troie de toutes les manipulations»
<465>
Vendredi 27 mars 2015
Récemment j’ai assisté à la fin d’une discussion entre deux jeunes filles où l’une des deux avait cet argument définitif :
« Tu ne peux pas le contester, c’est scientifique ! »
C’est « scientifique » était, dans son esprit, la meilleure manière de clore la discussion.
Puisque c’est scientifique, il n’y a rien à ajouter, c’est la Vérité !
Et bien cette formule est une ânerie et ne vaut guère mieux qu’une autre formule entendue souvent :
« C’est vrai, puisqu’ils l’ont dit à la télé ! »
Il y a en effet, une idée absolument fausse qui consiste à croire que la démarche scientifique c’est élaborer conceptuellement une hypothèse et la vérifier par des expériences.
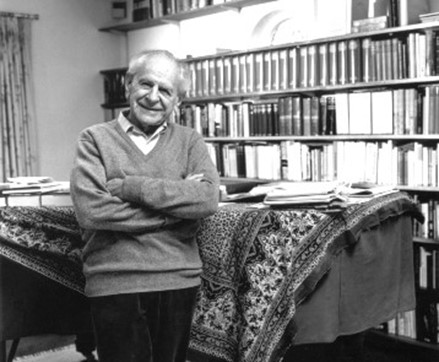 Karl Popper (1902-1994), philosophe de la science a montré que la seule démarche scientifique possible consiste à pratiquer des expériences susceptibles de montrer qu’une théorie est fausse.
Karl Popper (1902-1994), philosophe de la science a montré que la seule démarche scientifique possible consiste à pratiquer des expériences susceptibles de montrer qu’une théorie est fausse.
Ce qui signifie qu’une théorie scientifique n’est jamais exacte mais simplement la plus satisfaisante, à un moment donné, parce qu’on n’est pas encore arrivé à la réfuter, c’est à dire à prouver qu’elle était fausse.
Cette réalité ne peut rendre que le scientifique modeste et la science respectable.
Ce qui n’est pas toujours le cas, notamment dans le monde médical.
Pour Popper, la démarcation entre « la science » et la « non science » est justement la capacité de concevoir et de pouvoir réaliser des tests capables de réfuter une théorie.
Si de tels tests existent, nous sommes dans le domaine de la science, sinon nous n’y sommes pas.
Cette introduction pour partager avec vous, une conférence que m’a indiquée, il y a plusieurs mois mon ami Didier et où ce remarquable pédagogue qu’est Hubert Reeves illustre parfaitement la démarche scientifique :
Il nous explique qu’on n’est pas sûr que la théorie du big bang soit la bonne et il nous donne l’ensemble des observations et des tests (11) qui ont été réalisés et qui étaient en mesure de la réfuter.
Or pour l’instant, aucune de ces observations ou tests ne l’a réfutée.
Elle est donc la meilleure, pour l’instant car on n’a pas pu prouver qu’elle était fausse !
<La crédibilité de la théorie du big bang par Hubert Reeves>
<464>
Jeudi 26 mars 2015
Mercredi 25 mars 2015
Mardi 24 mars 2015
Lundi 23 mars 2015
Vendredi 20 mars 2015
Jeudi 19 mars 2015
Mercredi 18 mars 2015
Mardi 17 mars 2015
Les élections israéliennes ont lieu ce 17 mars 2015. J’ai appris en marge d’un reportage sur ces élections que la résidence du premier ministre israélien à Jérusalem jouxte la « rue Arthur Balfour ». Tout un symbole !
C’est l’occasion de revenir sur un des évènements de la guerre d’il y a 100 ans (14-18) qui aura un impact immense sur le monde de l’après-guerre et éclaire les évènements et les conflits d’aujourd’hui.
Ce sujet est si riche que seul un livre serait capable d’en expliquer la complexité, les racines et ses conséquences.
Je vais toutefois essayer en quelques mots de donner des éléments de compréhension.
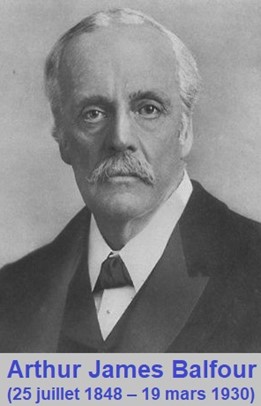 « La déclaration Balfour » est une lettre ouverte du Ministre des affaires étrangères, de la Grande Bretagne, Lord Arthur James Balfour, à la communauté juive, représentée par Lord Rothschild, pour soutenir l’objectif de créer « un foyer national juif » en Palestine.
« La déclaration Balfour » est une lettre ouverte du Ministre des affaires étrangères, de la Grande Bretagne, Lord Arthur James Balfour, à la communauté juive, représentée par Lord Rothschild, pour soutenir l’objectif de créer « un foyer national juif » en Palestine.
Pour comprendre l’impact de cet acte, il faut décrire plusieurs « dynamiques » ou « situations » qui s’entrecroisent dans cette déclaration.
1° La Palestine : En 1914, la Palestine fait partie de l’Empire ottoman. C’est l’une des dernières régions que garde l’Empire en déclin. En 1914, la population juive en Palestine est faible.<Wikipédia annonce 55 000 juifs pour 560 000 Arabes>, soit moins de 10%
2° Au sein de la communauté juive des pays européens, en raison de multiples persécutions et notamment de terribles pogroms en Russie, a émergé un mouvement sioniste. Le principal dirigeant de ce mouvement Theodor Herzl a également insisté dans ses mémoires sur l’importance de l’affaire Dreyfus dans son engagement dans ce mouvement, car si la France des droits de l’Homme a pu vivre une affaire Dreyfus c’est que les juifs ne sont en sécurité nulle part. Journaliste viennois, Theodor Herzl, publie « L’état des Juifs » (Der Judenstaat) dans lequel il promeut la création d’un état pour les Juifs et en détaille les institutions et le fonctionnement. Il crée aussi l’organisation sioniste dont le premier congrès se réunit à Bâle en 1897. En 1901, Herzl rencontre le sultan Abdülhamid II et lui propose, en vain, d’éponger les dettes de l’empire ottoman par un consortium bancaire international en échange du retrait des Turcs de Palestine. A la suite de cet échec, Herzl examina avec intérêt l’idée de Joseph Chamberlain, alors secrétaire d’État britannique aux colonies, d’installer la nation israélienne en Ouganda. Mais, un an après la mort d’Herzl, le congrès sioniste de 1905 rejeta finalement ce projet, estimant que la place d’Israël ne pouvait se situer qu’en Palestine, et se donna pour nouveau porte-parole Chaim Weizmann. <Plus de détails>
3° Au début de la guerre 14-18, la puissante communauté juive américaine soutient plutôt l’Allemagne et l’Autriche car le pays le plus anti-sémite est la Russie et les communautés juives en Autriche et en Allemagne, en 1914, sont plutôt bien intégrées et font partie de l’élite artistique, littéraire et aussi du monde des affaires de ces pays. Les Britanniques qui ont pour allié la Russie ont donc quelques difficultés à obtenir le soutien de la communauté juive américaine.
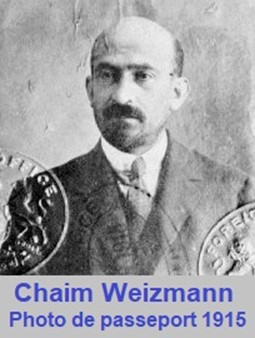 4° Et puis, il y a le rôle de Chaim Weizmann. Chaim Weizmann est très investi dans le congrès sioniste mais il est aussi un chimiste de grand talent.
4° Et puis, il y a le rôle de Chaim Weizmann. Chaim Weizmann est très investi dans le congrès sioniste mais il est aussi un chimiste de grand talent.
Or, devenu professeur à l’université de Manchester à partir de 1904, il s’installe en Grande-Bretagne. Il devient sujet de sa Majesté en 1910, et s’investit dans l’effort de guerre britannique durant la Première Guerre mondiale.
Au début du XXe siècle, la supériorité de l’industrie chimique allemande par rapport aux industries étrangères est écrasante. Après la stabilisation des fronts, à la fin de 1914, tous les belligérants sont confrontés à une pénurie de munitions, en particulier en ce qui concerne l’artillerie.
L’acétone avait une grande importance militaire, elle servait de solvant dans la fabrication de cordite, explosif employé par l’artillerie navale anglaise. Privée d’acétone, la marine anglaise aurait dû changer tous ses canons.
Or les allemands avaient coupé la route d’approvisionnement de ce produit. Instruit de ces circonstances, Weizmann tenta et réussit dans son laboratoire de Manchester une synthèse de ce corps par fermentation bactériologique et il réussit. Le gouvernement britannique demanda à Weizmann de produire 30 000 tonnes et ce dernier arriva à faire produire cette quantité. Il devint conseiller à l’Amirauté dont le chef était depuis peu Balfour (qui succéda à Churchill) et au ministère des munitions où le Ministre est Lloyd George.
Après la guerre, Lloyd George a complaisamment répandu la légende selon laquelle il avait été converti au sionisme par l’acétone.
Il est certain que si le gouvernement britannique en 1917 (avec Lloyd Georges comme premier Ministre et Balfour comme ministre des affaires étrangères) avait considéré que la déclaration Balfour n’était pas conforme à l’intérêt stratégique de la Grande Bretagne, il ne l’aurait pas faite.
Mais toute cette histoire a permis que Weizmann connaisse très bien ces hommes clés et lui donne les moyens de faire du lobbying très actif et du côté britannique la sympathie pour un homme qui a aidé leur effort de guerre ne peut être sous-estimé.
Il me faut abréger par 4 faits :
1° La déclaration Balfour va changer la répartition de la population en Palestine en encourageant l’immigration juive. Les juifs seront 84 000 en 1922 et 174 606 en 1931 et 608 000 pour 1 200 000 Arabes en 1948, soit quand même 1/3 et 2/3 au moment de la création de l’Etat d’Israël.
2° A la fin de la guerre 14/18, deux empires se sont écroulés :
L’Empire austro Hongrois pour lequel les alliés ont créés des états-nations dirigés par des nationaux : Yougoslavie, Tchécoslovaquie …
L’Empire ottoman où il n’y a pas eu création d’états nations mais des protectorats confiés à la Grande Bretagne et la France.
Or il est bien évident que si des Etats avaient été créés au moyen orient après 1918, la Palestine aurait été soit un Etat arabe indépendant soit plus probablement une région insérée dans un Etat Arabe plus vaste.
3° D’ailleurs, les Britanniques parallèlement à la déclaration Balfour ont fait des promesses aux Arabes qui ne pourront que se sentir trahis. Ainsi les Britanniques ont promis au chérif Hussein qui gouverne La Mecque tous les territoires arabes sous occupation turque…. y compris Palestine et Syrie.
Le colonel T.E. Lawrence a joué un grand rôle dans ces relations, notamment pour conseiller les soldats arabes à lutter contre les troupes ottomanes. Il y gagna le surnom de « Lawrence d’Arabie », sujet d’un film mythique de David Lean.
4° Le 9 décembre 1917, un mois après la déclaration Balfour, le général britannique Robert Allenby entre à Jérusalem sans coup férir. Son armée, venue d’Égypte, compte trois bataillons juifs.
C’en est donc fini d’onze siècles de domination musulmane sur la Ville sainte, arabe puis turque (mis à part l’intermède croisé). Commence le protectorat compliqué de l’empire britannique.
Mais ceci est une autre Histoire.
Il semble quand même incontournable de citer la déclaration Balfour :
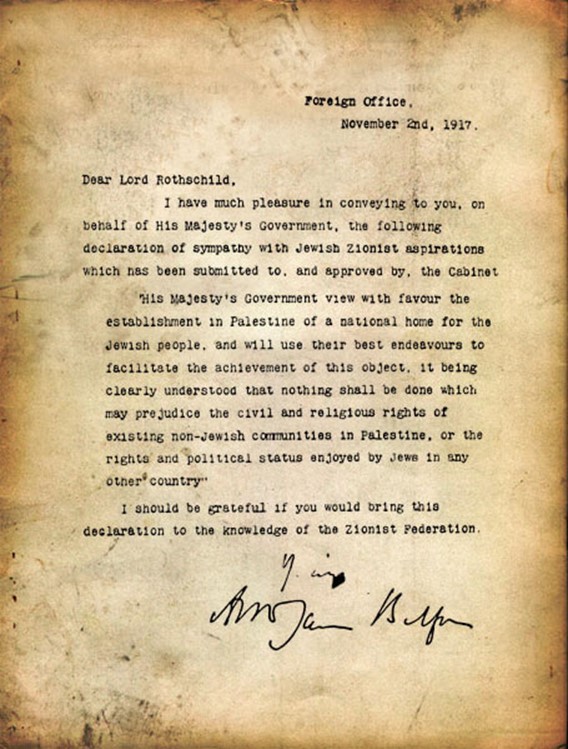 « Cher Lord Rothschild,
« Cher Lord Rothschild,
J’ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration ci-dessous de sympathie à l’adresse des aspirations sionistes, déclaration soumise au Parlement et approuvée par lui.
Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste.
Arthur James Balfour »
Je tire toutes ces informations d’un livre que j’avais lu il y a quelques années (c’était avant Internet) : « La déclaration Balfour aux sources de l’État d’Israël par Jean-Pierre Alem » aux éditions Complexe.
Par ailleurs l’Histoire de la Palestine depuis la fin du XIXème siècle est remarquablement décrite dans ces deux documentaires de la chaîne Histoire : < Palestine, Histoire d’une terre 1880 – 1950 Partie 1/2> et < Palestine, Histoire d’une terre 1880 – 1950 Partie 2/2>
L’Histoire nous explique le présent
<456>
Lundi 16 mars 2015
|
Car Tidjane Thiam est noir…
A Londres il a été nommé à la tête d’une entreprise de première importance : « Prudential » et maintenant la Suisse lui a fait confiance en lui confiant une de ses banques « Le Crédit Suisse »
Et en 2012, un peu honteux, Jean Claude Trichet remet la légion d’honneur à Tidjane Thiam et le décrit comme un banquier « que la France peut regretter d’avoir laissé partir ».
Vous trouverez en pièce jointe sa belle réponse à « Qu’est-ce qu’être français ? ».
|
|
Vendredi 13 mars 2015
Jeudi 12 mars 2015
Je suis sans problème
Ma vie est facile
Je ne pense plus du tout
Nous avons un roi qui pense pour nous
C’est L’ordinateur »
C’est en Juillet 1981 que sort le tout premier IBM PC, avec ms dos, 13 ans après la chanson
Le premier Macintosh, le Macintosh 128K, est lancé le 24 janvier 1984.
Le Global Positioning System (GPS) – a été rendu possible par une constellation de 24 satellites. Le premier satellite expérimental fut lancé en 1978, mais l’ensemble des 24 satellites ne fut opérationnelle qu’en 1995. Cette technologie était alors utilisée à usage exclusivement militaire. Et ce n’est qu’en 2000 que le président Bill Clinton confirme l’intérêt de la technologie à des fins civiles et autorise une diffusion non restreinte des signaux GPS, permettant une précision d’une dizaine de mètres et une démocratisation de la technologie au grand public à partir du milieu des années 2000.
Et même s’il y avait des prémices, il faudra attendre le début des années 1990 pour voir le développement d’Internet. Et encore, il faut savoir qu’il y avait 100 000 ordinateurs connectés en 1989, que la barre du million a été franchie en 1992. En 1996, 10 000 000 d’ordinateurs étaient connectés et c’est à l’aube du XXIème siècle qu’on recensait 200 000 000 d’utilisateurs dans le monde. C’est uniquement lors de cette dernière étape qu’on a vraiment pu parler d’un monde connecté.
Mercredi 11 mars 2015
Mardi 10 mars 2015
Lundi 9 mars 2015
Vendredi 6 mars 2015
Dimanche le 8 mars, on célèbrera la journée internationale de la femme.
Une des origines de cette date du 8 mars nous vient de Lénine, qui décrète la Journée internationale des femmes le 8 mars 1921, en honneur aux femmes qui manifestèrent les premières, le 8 mars 1917, à Petrograd, lors du déclenchement de la révolution russe.
J’ai plusieurs fois évoqué la violence faite aux femmes dans le monde, notamment lors du mot du jour du 9 septembre 2014 : « C’est juste pas de chance d’être une femme dans la plupart des pays du Monde » propos de la journaliste Annick Cojean.
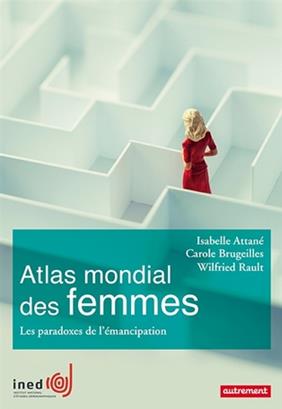 En collaboration avec l’INED, les Editions « Autrement » ont publié « L’Atlas mondial des femmes »
En collaboration avec l’INED, les Editions « Autrement » ont publié « L’Atlas mondial des femmes »
Une des directrices de cet ouvrage, Isabelle Attané était l’invité de l’émission de Christine Ockrent :
<Planète femmes>
Et elle a parlé d’une autre violence faite aux femmes : le déni de naître. Aidé notamment par les techniques modernes de diagnostic prénatal, des parents choisissent ouvertement de ne pas faire naître les filles pour privilégier les garçons.
<Un article> du Monde Diplomatique sur ce même sujet explique :
« Dans une population donnée, quand hommes et femmes sont traités sur un pied d’égalité et si les femmes n’ont pas une propension à migrer plus forte que celle des hommes, elles sont naturellement majoritaires. Si l’Asie se pliait à cette règle générale en enregistrant une légère prépondérance féminine, elle compterait quelque quatre-vingt-dix millions de femmes supplémentaires, une fois et demie la population de la France.
La Chine, qui, il y a encore trente ans, s’imposait comme l’un des fleurons du communisme mondial, fervent défenseur de l’égalité des sexes, est désormais l’un des pays où les discriminations envers les femmes, sur un plan démographique, sont les plus aiguës. Revers de la libéralisation économique et sociale dans ce pays, les rapports de pouvoir traditionnels, structurellement défavorables aux femmes, resurgissent. L’Inde, grande puissance économique émergente – actuellement au septième rang des puissances industrielles mondiales –, discrimine, elle aussi, ses femmes.
Avec ces deux géants, sont également touchés le Pakistan, le Bangladesh, Taïwan, la Corée du Sud et, dans une moindre mesure, l’Indonésie – pays qui, à eux seuls, regroupent trois des six milliards et demi d’habitants de la planète. Elimination des filles par les avortements sélectifs, traitements inégaux des enfants selon qu’il s’agit d’une fille ou d’un garçon, statut social secondaire et mauvaises conditions sanitaires à l’origine d’une surmortalité féminine dans l’enfance et à l’âge adulte représentent autant de particularités qui concourent à ce déficit.
La structure sexuée d’une population dépend de la proportion de chaque sexe à la naissance, d’une part, et de la fréquence des décès des hommes et des femmes à chaque âge de la vie, d’autre part. En temps ordinaire, c’est-à-dire lorsqu’aucune forme d’intervention humaine ne vient perturber l’effet de ces données, on observe une proportion de garçons à la naissance légèrement supérieure à celle des filles et une surmortalité des hommes à chaque âge de la vie, laquelle vient compenser de manière naturelle l’excédent de garçons à la naissance. Or, dans nombre de pays asiatiques, l’une ou l’autre de ces lois – voire, parfois, l’une et l’autre – sont contrecarrées par des pratiques sociales. Il naît donc moins de femmes qu’il ne faudrait, et il en meurt plus qu’il ne devrait, d’où des proportions accrues d’hommes.
Sur la planète, la norme biologique – environ 105 naissances de garçons pour 100 filles – s’applique avec une régularité remarquable. Et les écarts demeurent faibles : le niveau le plus bas est observé au Rwanda, où il naît 101 garçons pour 100 filles, et le plus élevé, hors pays asiatiques, au Surinam – 108 garçons.
Dans plusieurs pays d’Asie, la réalité est tout autre. Si l’influence des facteurs biologiques, génétiques et environnementaux, habituellement avancée pour expliquer les écarts entre pays, n’est bien sûr pas à exclure, elle ne suffit en aucun cas à expliquer l’évolution observée depuis vingt à vingt-cinq ans. En Chine, en Inde, en Corée du Sud et à Taïwan, garçons et filles naissaient dans des proportions normales au début des années 1980. Mais depuis, avec la baisse de la fécondité, la préférence traditionnelle pour les fils s’exacerbe et vient supplanter les lois biologiques, rompant ainsi l’équilibre naturel.
Désormais, les progrès technologiques permettent d’intervenir sur le sexe de sa descendance : au bout de quelques mois de grossesse, la future mère passe une échographie ou une amniocentèse. Si c’est un garçon, on peut rentrer chez soi et attendre patiemment l’heureux événement. Mais en cas de fille, c’est le dilemme : si on la garde, aura-t-on une nouvelle occasion d’avoir un fils ? Et, le cas échéant, sera-t-on en mesure de faire face à l’escalade des coûts d’entretien des enfants ? Bien souvent, plutôt que de devoir renoncer à un fils, on prend la décision de se débarrasser de la fillette indésirable, et la femme avorte. Ainsi, en Chine, l’excédent de garçons à la naissance est de 12 % au-dessus du niveau normal ; en Inde, de 6 %. En Corée du Sud, après le paroxysme du milieu de la décennie 1990 (115 garçons pour 100 filles), la situation s’améliore, avec 108 garçons en 2004.
Depuis peu, ce phénomène se propage à d’autres parties du continent. Ainsi, une province vietnamienne sur deux enregistre plus de 110 naissances de garçons pour 100 filles. Dans les pays du Caucase (Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie), cette proportion s’est brutalement accrue, à partir du milieu des années 1990, pour atteindre des niveaux comparables à certaines régions de Chine et d’Inde (voir « Déséquilibres démographiques »). Pourtant, l’équilibre demeure dans les pays voisins que sont la Russie, l’Ukraine, l’Iran ou la Turquie.
En Indonésie, la proportion de garçons parmi les enfants âgés de moins de 1 an, encore normale en 1990, est passée à 106,3 dix ans plus tard. Une masculinisation rampante qui se manifeste par l’apparition d’un déficit de femmes auquel, outre une émigration féminine massive, notamment vers l’Arabie saoudite, le déséquilibre des sexes à la naissance commence à contribuer. »
Un autre article du Monde sur ce sujet : <Une marche paradoxale vers l’émancipation des femmes>
Donnant encore une fois la parole à Ferrat qui déclare avec Aragon que : <la femme est l’avenir de l’homme>
Le problème c’est que dans ces pays, le peuple ne le sait pas.
<449>
Jeudi 5 mars 2015
Et souvent, ce que l’on présente comme des positions nobles sur ces problèmes n’a pour but que le développement d’intérêts commerciaux.»
Mercredi 4 mars 2015
|
|
Il m’a enseigné à me tenir toujours debout, à ne pas avoir peur de souffrir. Dans ma période de révolte, quand je nous voyais, les gamins de la cité, comme les damnés de la terre, je m’imprégnais du militantisme humaniste de Césaire dans son Discours sur le colonialisme. J’ai grandi avec ces auteurs comme avec des grands frères, ils sont devenus mes tuteurs : je me suis construit en prenant appui sur eux pour pousser droit.»
|
Mardi 3 mars 2015
C’est la seconde fois en 446 mots du jour que j’ai l’outrecuidance de m’attribuer un mot du jour.
Il faut reconnaître cependant que la seconde partie a été copiée de l’ouvrage de Raymond Aron « Le spectateur engagé » dans lequel il avait répondu aux questions de deux jeunes journalistes qui ne partageaient pas ses idées politiques et où sa dernière réplique fût
« Je ne les ai pas convaincu, mais je leur ai insufflé l’esprit fécond du doute »
En premier, je veux évoquer la graine fertile de la curiosité. C’est grâce à cette graine que l’humanité a progressé. C’est bien la curiosité des hommes qui a permis les recherches et les découvertes qui ont changé la condition des hommes. C’est aussi la curiosité des autres cultures et civilisations qui a permis aux hommes de se rapprocher et de s’enrichir mutuellement.
Le doute constitue aussi un chemin vers la curiosité. Ainsi l’esprit fécond du doute doit toujours nous inspirer devant des vérités trop souvent martelées comme des évidences alors même que notre vécu et notre intuition nous indiquent une réalité différente.
Cette interrogation des « évidences » peut concerner la médecine et la santé, mais aussi l’économie ou la politique ou d’autres domaines encore où la discussion semble impossible ou inutile parce que des experts, savants, économistes, prêtres, rabbins ou oulémas se sont exprimés.
Pour décrire cette position de l’expert, je pense à la réplique de Philippe Meyer à Valéry Giscard d’Estaing :
« et vous paraissez toujours vous étonner lorsque vous avez fini de parler que quelqu’un puisse encore trouver quelque chose à ajouter »
Mais une fois que la curiosité nous a entraîné vers d’autres voies, d’autres systèmes de pensée ou d’autres théories, l’esprit fécond du doute doit continuer à nous inspirer vigilance pour ne pas être abusé, ne pas succomber à la facilité de suivre d’autres dogmes tout aussi enfermant et réducteur que ceux qu’on voulait fuir.
C’est ainsi que des esprits, dont certains semblaient pourtant éclairés par la raison, n’ont pas expérimenté le doute alors qu’ils suivaient dans le passé le fascisme, le nazisme, le stalinisme, le maoïsme et aujourd’hui le djihadisme.
Ainsi le doute peut se situer avant la curiosité, mais il doit toujours accompagner la curiosité pour nous permettre de mieux comprendre le monde et l’humanité et nous préserver de tout aveuglement.
La curiosité pour s’ouvrir vers d’autres univers, le doute pour se préserver des mirages et des tromperies.
<446>
Lundi 2 mars 2015
Jeudi 19 février 2015
Mercredi 18 février 2015
d’un côté c’est la beauté, l’amour, la joie, la fête,
de l’autre c’est la honte, la colère, les crimes de sang, la couleur de la justice, l’enfer avec ses flammes
Mardi 17 février 2015
Lundi 16 février 2015
selon l’historien Suétone dans son ouvrage « La vie des douze Césars »
Vendredi 13 février 2015
Ailleurs que dans le rêve ailleurs que dans les nues
Terre terre voici ses rades inconnues »
Jeudi 12 février 2015
Étienne Klein & Jacques Perry-Salkow
Une anagramme (le mot est féminin) – du grec ανά, « en arrière », et γράμμα, « lettre », anagramma : « renversement de lettres » – est une construction fondée sur une figure de style qui inverse ou permute les lettres d’un mot ou d’un groupe de mots pour en extraire un sens ou un mot nouveau.
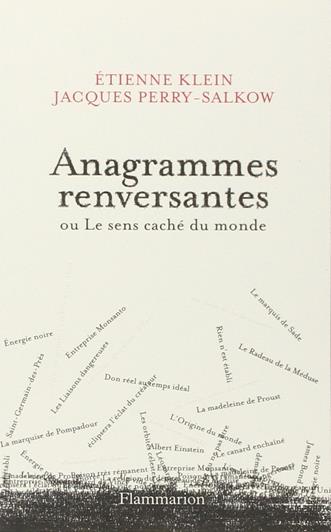 Étienne Klein, le physicien et journaliste est un adepte de ce jeu de l’anagramme mais il reconnaît bien volontiers la supériorité, dans ce domaine, de son ami Jacques Perry-Salkow avec lequel il a écrit le livre « Anagrammes renversantes ou Le sens caché du monde » parue en 2011 chez Flammarion.
Étienne Klein, le physicien et journaliste est un adepte de ce jeu de l’anagramme mais il reconnaît bien volontiers la supériorité, dans ce domaine, de son ami Jacques Perry-Salkow avec lequel il a écrit le livre « Anagrammes renversantes ou Le sens caché du monde » parue en 2011 chez Flammarion.
Il raconte dans <cet article> la genèse de ce livre et aussi que Flammarion était réticent de le publier jusqu’à ce que les deux compères dévoilent l’anagramme dont j’ai fait le mot du jour et qui révèle le sens caché des Éditions Flammarion.
Depuis que dans les différentes émissions qu’il anime, j’entendais Etienne Klein égrener des anagrammes, j’avais envie d’abord de parler de ce livre et plus généralement des anagrammes étonnantes et plein de sens.
En voici d’autres tirées de ce livre :
- pirate = patrie
- étreinte = éternité
- sportifs = profits
Après pour comprendre les autres il faut avoir un peu de culture, de connaissance scientifique et aussi de connaissance de l’actualité :
- le Médiator = la mort idéale
- Claude Levi Strauss = a des avis culturels
- la courbure de l’espace-temps = superbe spectacle de l’amour
- le chat de Schrödinger = le choc d’hier est grand
- La théorie de la relativité restreinte = vérité théâtrale et loi intersidérale
- Le Radeau de la Méduse = au-delà de la démesure
- Saint-Germain des Prés = matins nègres de Paris
- Hôtel des ventes de Drouot = un lot de vestes d’Hérodote
- L’origine de l’univers = un vide noir grésille
- Le marquis de Sade = démasqua le désir
- Être ou ne pas être, voilà la question = Oui, et la poser n’est que vanité orale
- Et les particules élémentaires = tissèrent l’espace et la lumière
- La gravitation universelle = loi vitale régnant sur la vie
- Léonard Bernstein = l’art de bien sonner
- Marie-Antoinette d’Autriche = cette amie hérita du Trianon = Reine, ta tête a dû choir matin
- «Le Président Barack Hussein Obama » [doit beaucoup] = « à Rosa Parks, à ce bien humble destin »
Et à mon sens les 3 les plus fabuleux :
- Le Maréchal Pétain = Place à Hitler, amen !
- Le commandant Cousteau = tout commença dans l’eau
Et :
- L’origine du monde, Gustave Courbet = ce vagin où goutte l’ombre d’un désir
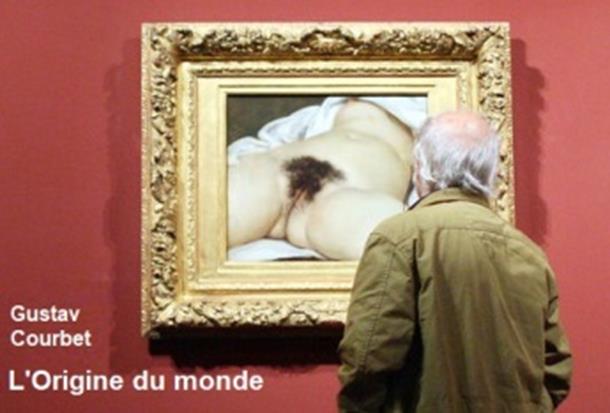
Voilà, voilà, je crois que vous allez courir acheter ce livre
<439>
Mercredi 11 février 2015
le « paradis fiscal » occupe fièrement la troisième place »
Mardi 10 février 2015
La « nomophobie » contraction de l’expression anglaise « no mobile phobia » est constituée par la peur panique de se retrouver sans téléphone portable.
Après la réflexion sur l’informatique (mot du jour du 4 février), puis sur l’intelligence artificielle (mot du jour du 5 février), voici une réflexion sur un autre outil particulièrement prégnant dans notre quotidien.
Pendant un déjeuner avec une amie, Russell Clayton, doctorant à l’université du Missouri, a la surprise de voir sa convive le laisser précipitamment parce qu’elle a oublié son téléphone portable. Interloqué, il a l’idée de se pencher sur le sentiment de manque, voire de peur, qui habite certaines personnes lorsqu’elles sont séparées de ces petits objets devenus visiblement indispensables.
Dans une étude intitulée « The Impact of iPhone Separation on Cognition, Emotion and Physiology » (« L’impact de la séparation d’avec son mobile sur la cognition, l’émotion et la physiologie »), publiée le 8 janvier, Russell Clayton, doctorant à l’université du Missouri, s’étend sur cette «nomophobie » et arrive à deux conclusions :
- Le téléphone portable est devenu « une extension de nous-même », à la manière du sonar de certains animaux, si bien qu’on peut parler d’ «iSelf », de « soi connecté ».
- Privé de son mobile, la personne souffrant de « nomophobie » a l’impression d’avoir perdu une part d’elle-même, et cela « peut avoir un impact négatif sur ses performances mentales ».
A chaque fois que les participants aux tests ont été déconnectés, les chercheurs ont constaté une augmentation significative de l’anxiété, du rythme cardiaque, des niveaux de pression artérielle et une diminution significative de la performance aux tests : les cobayes se sentaient psychologiquement diminués.
<Ici le blog du Monde qui parle de cette étude>

Un <article> et une photo ci-après montrent tous les ravages de la portable-dépendance : on regarde son portable alors que le spectacle de la nature, juste à côté est si beau :
Pour finir, cette histoire racontée par Michel Serres qui avait offert à une petite fille de sa famille le livre « Robinson Crusoé ». Peu de temps après il lui a demandé :
« qu’as-tu pensé de ce livre ? »
Elle a alors répondu :
« Bof ! C’est ce qui arrive quand on oublie son téléphone portable ».
Michel Serres, pour ne pas remettre en cause la représentation de l’univers de sa nièce qui ne pouvait concevoir un monde sans portable, lui a expliqué « Non, non, il ne l’avait pas oublié, mais il n’y avait pas de réseau sur cette île ! »
L’ordinateur est abruti, c’est entendu, mais le portable n’aurait-il pas pour effet de rendre son utilisateur débile ?
<437>
Lundi 9 Février 2015
N°3 de l’UMP et souhaitant répondre à la question fallait ‘il que dans le Doubs l’UMP appelle à voter socialiste ?
Vendredi 6 Février 2015
L’exception française c’est la non ouverture des bibliothèques»
Jeudi 5 Février 2015
Mercredi 4 Février 2015
L’homme est lent, peu rigoureux et très intuitif.
L’ordinateur est super rapide, très rigoureux et complètement con. »
Mardi 3 Février 2015
Lundi 2 Février 2015
Vendredi 30 Janvier 2015
|
|
Il n’y a rien à dire de plus, sinon montrer une photo de cette jeune fille pour qui la vie était devenue trop dure et qui n’a pas rencontré l’adulte qui aurait su lui tendre la main et la faire sortir de son enfermement et de sa souffrance.
|
Jeudi 29 Janvier 2015
Ce n’est pas un problème d’offre. »
Mercredi 28 Janvier 2015
Mardi 27 Janvier 2015
Ne nous ramenez pas uniquement à [la religion] »
|
|
La France reste pleine d’espoir quand on donne la parole à des françaises et des français comme Najoua Arduini-Elatfani.
|
Lundi 26 Janvier 2015
Vendredi 23 Janvier 2015
L’enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux »
Jeudi 22 Janvier 2015
|
|
Engagé volontaire en 1939, il s’embarque sur le Massilia en juin 1940 avec les parlementaires opposés à l’armistice pour rejoindre l’Afrique du Nord. En octobre 1940, Vichy le condamne pour désertion en présence de l’ennemi, à la déportation à vie et à la dégradation militaire. Sa peine est commuée en internement et il est incarcéré à Riom.
C’est dans sa prison qu’il est enlevé le 20 juin 1944 par des miliciens français déguisés en résistants. Ces derniers l’abattront à Molles, dans l’Allier, puis le jetteront dans un puits. Il avait 40 ans. Son corps ne sera retrouvé qu’en 1946.
Étant juif par son père, protestant par sa mère, franc-maçon et radical de gauche… Il suscitait la haine de la part des nazis et miliciens en raison de ses convictions et de son combat contre le nazisme
|
Mercredi 21 Janvier 2015
Si on veut dépasser les émotions et les propos simpliste, il faut tenter de comprendre.
Pour tenter de comprendre la complexité du Monde il faut s’en donner les moyens.
Si on se contente de regarder TF1 et consorts, ce n’est pas gagné.
Sur Internet il y a de tout : des sites conspirationnistes, des informations erronées mais aussi de vrais trésors d’intelligence et de science.
Tel est le cas du documentaire « La Maison des Saoud » de Jihan El Tahri.
 Jihan El Tahri est une journaliste franco-égyptienne qui a fait ce film en 2005 après les attentats du 11 septembre.
Jihan El Tahri est une journaliste franco-égyptienne qui a fait ce film en 2005 après les attentats du 11 septembre.
En effet, si on veut comprendre d’où viennent les djihadistes, il faut revenir à leur source religieuse des salafistes et des wahhabites.
Ils ont été financés et soutenus par l’Arabie Saoudite qui voulait imposer sa vision de l’Islam partout dans le monde.
Comme souvent, ces créatures ont échappé en partie à l’Arabie Saoudite qui n’aime pas cette publicité ainsi que le manque de distinction et de diplomatie de ces mouvements extrémistes.
Ces mouvements qui en outre risquent même de vouloir remettre en cause le pouvoir de la famille Saoud.
Evidemment pour appréhender ce documentaire, il faut y consacrer un peu de temps, il dure 1 h 43, mais on y apprend énormément de choses.
En synthèse j’ai retenu les choses suivantes :
1° D’abord il est étonnant que ce pays des lieux sacrés de La Mecque et de Médine et qui professe une soumission totale à Dieu, soit le seul pays du monde dont le nom intègre la référence à la famille régnante terrestre « Les Saoud ».
A cela une explication est donnée, à l’intérieur de l’empire Ottoman et au milieu de tribus rivales, c’est l’alliance entre des religieux, « les oulémas » issus de la secte des Wahhabites (de Ibn Abdelwahhab nom du prédicateur qui a créé cette secte fondamentaliste qui veut revenir au texte initial du Coran sans le faire évoluer) et d’un chef de guerre de la famille des Saoud qui ont permis à l’Arabie Saoudite de naître et de devenir ce pays à la fois florissant à cause du pétrole mais aussi archaïque et totalitaire.
Dès lors, la famille Saoud ne saurait, sans danger pour son pouvoir politique et économique, remettre en cause la stricte application de la charia voulue par ces religieux.
Les wahhabites sont très proches des salafistes qui s’inspirent aussi de Ibn Abdelwahhab (nom issu de salaf les ancêtres, c’est à dire les premiers compagnons de leur prophète et qui prônent de la même manière un retour absolu vers l’islam des premiers temps).
Distinguer les deux n’est pas aisé, sauf sur un point : les salafistes souhaitent un retour du califat, c’est à dire une autorité religieuse unique qui exerce le pouvoir religieux mais aussi politique sur la communauté des croyants : l’oumma. Vous comprendrez que la naissance particulière de l’Arabie Saoudite implique, pour les wahhabites, une séparation entre le chef politique et les docteurs de la loi religieuse.
2° Ce documentaire montre aussi les relations très fortes qu’il y a eu entre les Etats Unis et ce pays qui repose sur le contrat suivant : L’Arabie approvisionne les Etats Unis de Pétrole bon marché et en quantité importante, en retour les religieux et le roi font ce qui leur plait dans leur pays avec la protection extérieure de l’armée américaine.
Un accord qui permettra aux quatre plus grandes compagnies pétrolières américaines regroupées sous le nom d’Aramco de s’installer dès les années 30 au cœur du royaume. Evidemment les choses sont plus compliquées depuis les attentats du 11 septembre qui ont été réalisés par des ressortissants de ce pays.
3° Les Etats-Unis ont trompé l’Arabie Saoudite sur la création de l’Etat d’Israël.
Le 14 février 1945, le président Roosevelt et Ibn Saoud se réunirent à bord du croiseur Quincy, à cette occasion le Pacte de Quincy fut signé.
Ce pacte portait sur l’accord expliqué ci-avant. Mais lorsque Roosevelt tenta d’obtenir l’appui du roi pour la création d’un foyer national juif en Palestine, Ibn Saoud répondit que ce que Hitler avait fait aux juifs étaient abominable mais posait cette question :
« pourquoi prendre de la terre arabe pour la donner aux juifs ? Si vous voulez faire quelque chose pour les juifs, pourquoi ne pas leur donner une partie de l’Allemagne ? »
Sur ce, Roosevelt promis de ne pas aller contre l’avis de l’Arabie Saoudite. Mais son successeur, Truman ne tint aucun compte de cet accord et votera pour la création de l’Etat d’Israël. Ce qui sera vécu comme une trahison par les saoudiens.
Pour le reste je vous engage à regarder ce documentaire, lorsque vous aurez du temps de cerveau disponible pour l’Histoire (1) : <Maison des Saoud>
(1) je ne me lasse jamais de faire référence à ce magnifique aveu de Patrick Le Lay, ancien PDG de TF1 qui avait expliqué que le rôle des émissions de TF1 était de conserver du temps de cerveau disponible pour que par la publicité Coca Cola puisse vendre ses produits.
<423>
Mardi 20 Janvier 2015
il y a deux gagnants : les sectes et les mafias»
Interview d’Anne Sinclair le 10/01/2015 (vers la minute 17)
Lundi 19 Janvier 2015
Vendredi 16 Janvier 2015
Jeudi 15 Janvier 2015
Non ! Des citoyens »
Mercredi 14 Janvier 2015
Premier Ministre Norvégien au moment du massacre de Utoya
Mardi 13 janvier 2015
Dans l’émission ce soir ou jamais de Frédéric Taddeï du 07/11/2014 ayant pour thème : « L’entreprise peut-elle sauver la France ? »
|
|
Depuis son assassinat, j’ai appris qu’il avait épousé en 2007, la fille de Maurice Genevoix, Sylvie Genevoix décédé d’un cancer en 2012.
Et une information qui n’avait pas été révélée jusque-là : il était franc maçon dans la même loge que Jean-Luc Melenchon au Grand Orient de France (GODF).
Il aurait aussi dit : »Moi qui suis de gauche et athée, il n’y a aucune chance que je me retrouve à la Droite de Dieu>
Le rire est la meilleure part de l’humain
<417>
|
Lundi 12 janvier 2015
Le rire distrait, quelques instants de la peur.
Mais la loi s’impose à travers la peur, dont le vrai nom est crainte de Dieu. […]
Et que serions nous, nous créatures pécheresses, sans la peur, peut être le plus sage et le plus affectueux des dons divins ? »
Le nom de la Rose, Septième jour : Nuit
Umberto Ecco
Vous avez probablement vu le film « Le nom de la Rose » et peut être, même mieux, lu le livre d’Umberto Ecco.
 Vous vous souvenez que le moine Guillaume de Baskerville (joué dans le film par Sean Connery) enquêtait sur des morts suspectes de moines dans une abbaye bénédictine.
Vous vous souvenez que le moine Guillaume de Baskerville (joué dans le film par Sean Connery) enquêtait sur des morts suspectes de moines dans une abbaye bénédictine.
Au bout de son enquête, il se rend compte que ces moines étaient morts empoisonnés parce qu’ils avaient lu un livre de la bibliothèque et que les pages qu’ils tournaient après avoir mouillé leur doigt avaient été enduites de poison par le bibliothécaire aveugle de l’abbaye : Jorge de Burgos.
Le livre dont il s’agissait était le second tome « de la Poétique d’Aristote » qui faisait un éloge du rire.
Le mot du jour est la réponse du moine chrétien fanatique à la question de Guillaume de Baskerville :
« Mais qu’est-ce qui t’a fait peur dans ce discours sur le rire ? »
Les religions totalitaires et le totalitarisme de tout bord n’aiment pas le rire.
Le rire libère de la peur.
Le rire est une force, une résistance aux certitudes, un appel permanent au doute.
Le totalitarisme ne s’y trompe pas, celui qui rit conteste, ne croit pas ce qu’on lui dit, ce qu’on veut lui imposer.
Les soviétiques avaient développé toute une batterie de blagues pour supporter le régime totalitaire :
« Je fais semblant de travailler, pour que l’Etat puisse faire semblant de me payer ».
Ou encore plus sarcastique dans un camp du goulag :
« Tu as été condamné à combien ?
– 5 ans !
– Et tu as fait quoi ?
– Mais je n’ai rien fait, rien !
– Ça, ce n’est pas possible, quand on n’a rien fait c’est 3 ans ! ».
Et puis sur un autre plan je vous engage à regarder cette vidéo : <Nasser parle de son entretien avec les frères musulmans>
Cette vidéo montre Nasser lors d’un meeting politique expliquer qu’il a voulu discuter avec les frères musulmans, c’est à dire les salafistes, pour les associer au pouvoir. Et quand il dit que leur première exigence est que « nos femmes sortent dans la rue voilées » vous entendez, la salle qui éclate de rire.
Tout est dit. Il ne peut exister de réponse plus forte que ça. C’est beaucoup plus fort que si la salle criait « NON ». Vous pouvez écouter la suite de la vidéo, édifiant. Il faudrait pourvoir la comparer avec un meeting des frères musulmans.
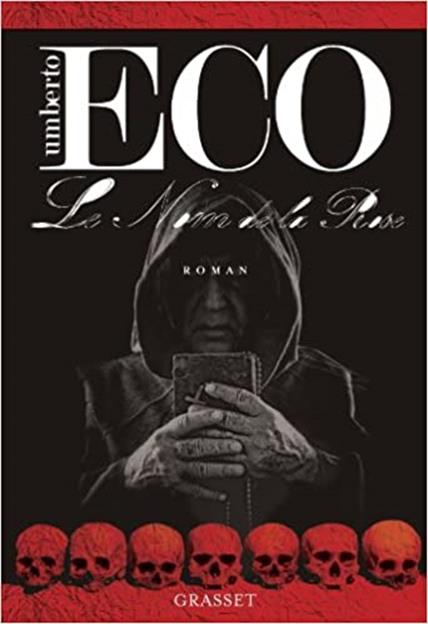 Et le rire qui est joie, dédramatise aussi.
Et le rire qui est joie, dédramatise aussi.
Dans ma modeste expérience, quand parfois, c’est plus dur au quotidien parce que mon corps est meurtri par des thérapies qui sont utilisées pour guérir un mal plus grand, c’est l’amour de mes proches, la musique qui apaise mais aussi l’humour et le rire qui redonnent force de vie et volonté de continuer le chemin, la tête haute.
C’est le rire qu’on a assassiné le 7 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo, parce que le rire est insupportable à certains, parce qu’il libère de la peur comme dit le personnage d’Ecco et que cela ce n’est pas possible pour ceux qui veulent imposer une loi totalitaire pour tous.
Tous les dessins de Charlie Hebdo ne m’ont pas fait rire.
Mais aujourd’hui je défends sans aucune restriction Charlie Hebdo, son droit de faire rire, de pratiquer la dérision.
Et puis le mot du jour insiste sur l’addiction des totalitarismes à la peur et c’est bien par la peur que ces fanatiques et les intellectuels qui les inspirent veulent imposer leur loi, leurs idées, leur vision du monde et de la société.
Charb a dit « je préfère mourir debout que vivre à genoux. » et il a ajouté « L’humour est un langage que les intégristes ne comprennent pas. Eux s’appuient sur la peur. (…) Je n’ai pas l’impression d’égorger quelqu’un avec un feutre. Je ne mets pas de vies en danger. Quand les activistes ont besoin d’un prétexte pour justifier leur violence, ils le trouvent toujours. »
<Les inrocks ont repris cette interview>
Charb qui était en train d’écrire un livre contre l’islamophobie.
Je m’incline devant ce héros et les autres qui étaient avec lui.
Les manifestations de ce dimanche sont une grande réponse du peuple français à cette tentative de faire peur.
Mais n’oublions pas de rire, même si quelquefois ce sont les larmes qui submergent.
Mercredi 7 janvier 2015

Je suis en congé mais je sors de mon silence pour cet hommage.
Mercredi 24 décembre 2014
L’Ethique est selon beaucoup de gens sérieux que j’ai entendu, une des œuvres de l’esprit la plus remarquable de l’humanité. Spinoza (1632-1677) l’a achevée peu de temps avant sa mort.
Dans ce monde où on zappe si facilement, où on nous assèche le désir par de multiples objets dont nous ne savions pas avoir besoin, et peut être particulièrement à Noël, Spinoza nous rappelle que nous ne pouvons aller à la quête du beau et du profond qu’avec effort et en sachant que ces instants sont rares.
Elle me parait aussi singulièrement appropriée après le mot du jour d’hier consacré à Zhu Xiao Mei.
Spinoza parlait surtout de la recherche spirituelle qui fût la quête de sa vie.
Voici la fin de l’Ethique :
« J’ai épuisé tout ce que je m’étais proposé d’expliquer touchant la puissance de l’âme sur ses passions et la liberté de l’homme.
Les principes que j’ai établis font voir clairement l’excellence du sage et sa supériorité sur l’ignorant que l’aveugle passion conduit. Celui-ci, outre qu’il est agité en mille sens divers par les causes extérieures, et ne possède jamais la véritable paix de l’âme, vit dans l’oubli de soi-même, et de Dieu, et de toutes choses ; et pour lui, cesser de pâtir, c’est cesser d’être. Au contraire, l’âme du sage peut à peine être troublée.
Possédant par une sorte de nécessité éternelle la conscience de soi-même et de Dieu et des choses, jamais il ne cesse d’être ; et la véritable paix de l’âme, il la possède pour toujours. La voie que j’ai montrée pour atteindre jusque-là paraîtra pénible sans doute, mais il suffit qu’il ne soit pas impossible de la trouver.
Et certes, j’avoue qu’un but si rarement atteint doit être bien difficile à poursuivre ; car autrement, comment se pourrait-il faire, si le salut était si près de nous, s’il pouvait être atteint sans un grand labeur, qu’il fût ainsi négligé de tout le monde ?
Mais tout ce qui est beau est aussi difficile que rare. »
Vous trouverez l’intégralité du texte de Spinoza ici : http://www.lituraterre.org/Spinoza-Ethique.pdf
Nous sommes à la trêve de Noël, après je vais prendre quelques congés et je reviendrai à mon travail le 12 janvier, date de mon prochain mot du jour.
Le silence est aussi, parfois, rempli de sens.
Passer de bonnes fêtes et si vous deviez vous ennuyer des mots du jour, lisez l’Ethique, cette œuvre est remplie de mots du jour.
<415>
Mardi 23 décembre 2014
|
|
Mais les mots ne peuvent exprimer ce que sait faire la musique, Arte a capté, dans de remarquables conditions, un concert de Zhu Xiao Mei où elle joue les Variations Goldberg.
Elle les interprète dans le temple de Bach, je veux dire l’Église Saint Thomas de Leipzig où il a été cantor de 1723 jusqu’à sa mort en 1750. Il est enterré dans cette église
|
Lundi 22 décembre 2014
Vendredi 19 décembre 2014
Jeudi 18 décembre 2014
Théorisé il y a plus de cinquante ans aux Etats-Unis, ce concept débarque en France dans les années 1980. La fonderie Favi, qui est le premier groupe à le tester, supprime les pointeuses et incite ses ouvriers à travailler sans hiérarchie.
« D’autres entreprises suivent, mais ce sont des cas isolés. Quelque chose change pourtant à la fin des années 2000 », estime Isaac Getz, coauteur de Liberté & Cie, Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises (Fayard, 2012).
L’entreprise Chronoflex a fait la même démarche. France Inter, dans son émission « On n’arrête pas l’Eco » du samedi 13 Septembre a fait un reportage de 10 min sur « Le mouvement de libération des entreprises » en s’intéressant à cette entreprise. Les journalistes sont allés en reportage à l »entreprise ChronoFlex et son leader libérateur Alexandre Gérard y témoignent et quelques autres personnes y donnent leur avis.
Vous pouvez réécouter ce reportage ici (il se situe dans l’émission entre 23′ à 33′).
Pour Chronoflex c’est l’histoire d’un beau rebond. En 2009, le chiffre d’affaires de Chrono Flex s’effondre. Frappée par la crise, la PME spécialisée dans le dépannage de flexibles hydrauliques sur engins de chantier subit deux plans de licenciements. « Une expérience traumatisante que je ne souhaitais pas revivre, raconte Alexandre Gérard. C’est pourquoi je me suis intéressé à d’autres formes d’organisation. »
Le PDG du groupe révolutionne alors le management de Chrono Flex. Les salariés sont réorganisés en petites équipes géographiques, chacune cooptant son capitaine. Exit les contrôles et les symboles de pouvoir, place à la prise d’initiatives. Quatorze mois après ce changement de cap et dans une conjoncture toujours aussi morose, le chiffre d’affaires a augmenté de 15 %. Le taux d’absentéisme a chuté. « Et 2013 a été notre meilleure année depuis la création de l’entreprise », s’enthousiasme M. Gérard.
Aux Etats-Unis, l’e-marchand de chaussures Zappos a supprimé tous ses postes de managers pour mettre en place des équipes auto-organisées. En France, des entreprises comme Poult, Lippi et Chrono Flex optent aussi pour la déhiérarchisation.
La crise semble, en tout cas, avoir joué en faveur d’une responsabilisation des collaborateurs et d’une déstructuration de la bureaucratie hiérarchique. Le succès des sociétés qui ont osé le pari de la déhiérarchisation fait le reste. L’entreprise libérée est dans toutes les bouches.
Jean-François Zobrist, ancien directeur de la fonderie Favi et porte-parole de l’entreprise libérée, se dit ainsi de plus en plus sollicité. « J’ai eu 112 demandes d’intervention, en 2013, par des groupements de patrons, des grandes écoles, et surtout des entreprises. » Des PME, mais aussi des grands groupes. A l’image d’Auchan, qui a annoncé une révolution de son modèle d’organisation au profit d’un management en pyramide inversée.
« En période de crise, ce sont ceux qui sont le plus près du terrain qui comprennent le mieux les besoins des clients et qui peuvent y répondre », explique Jean-André Laffitte, DRH d’Auchan France. Déhiérarchiser, c’est responsabiliser tous les collaborateurs, mais aussi supprimer des échelons.
Je tire ces informations d’un article du Monde > <ICI mais il faut être abonné>
En m’intéressant à Chronoflex j’ai aussi trouvé ce lien vers le site du blog qui raconte leur histoire d’innovation et l’explicacation de leur philosophie « <Sur le chemin de la libération>
< Et ici un site consacré à l’entreprise libérée>
En espérant bientôt l’Administration libérée
<411>
Mercredi 17 décembre 2014
tels que des informations concernant d’hypothétiques « bombes à retardement », dont beaucoup estimaient qu’elles justifiaient ces techniques. »
Mardi 16 décembre 2014
and French Socialists they are not »
[M. Macron] « doit convaincre Bruxelles que ses réformes sont libérales,
et les socialistes français qu’elles ne le sont pas
Lundi 15 décembre 2014
|
|
Elles mériteraient un minimum d’explication, on voit notamment des pieds dont on n’est pas certain que ce soient des pieds d’enfants attachés par une chaîne et un cadenas, le site de publication de la photo aurait été inspiré d’expliquer l’environnement de la photo. Cela étant, il s’agit d’un témoignage qui ne saurait laisser indifférent, même si notre esprit critique doit rester en éveil.
En pièce jointe le billet de mediapart qui m’a fait découvrir ces photos.
|
Vendredi 12 décembre 2014
Jeudi 11 décembre 2014
Mercredi 10 décembre 2014
Les autres vivent de la redistribution […].
C’est ce qui explique les impôts et les charges élevées en France, mais aussi le déficit persistant. »
Mercredi 3 décembre 2014
Mardi 2 décembre 2014
la voulez-vous droguée ? »
Lundi 1 décembre 2014
Le soir, quand ils rentrent chez eux, je suis sûr qu’ils parlent aux caméras du parking».
Vendredi 28 novembre 2014
Jeudi 27 novembre 2014
Ceci est le 400ème mot du jour.
Pour cet instant particulier je vous offre un moment d’Histoire, un poème politique écrit il y a 80 ans (81 pour ceux qui aiment la précision – novembre 1933) par un des grands poètes russes : Ossip Mandelstam
L’épigramme d’Ossip Mandelstam demeure, en seulement seize vers, l’un des textes les plus engageants jamais écrits. L’intransigeance du poète, face à Staline et à la Tchéka, font de lui un homme exceptionnel, un exemple de désobéissance civile et de courage contre la barbarie.
Voici ces seize vers :
« Nous vivons sans sentir sous nos pieds le pays,
Nos paroles à dix pas ne sont même plus ouïes,
Et là où s’engage un début d’entretien, —
Là on se rappelle le montagnard du Kremlin.
Ses gros doigts sont gras comme des vers,
Ses mots comme des quintaux lourds sont précis.
Ses moustaches narguent comme des cafards,
Et tout le haut de ses bottes luit.
Une bande de chefs au cou grêle tourne autour de lui,
Et des services de ces ombres d’humains, il se réjouit.
L’un siffle, l’autre miaule, un autre gémit,
Il n’y a que lui qui désigne et punit.
Or, de décret en décret, comme des fers, il forge —
À qui au ventre, au front, à qui à l’œil, au sourcil.
Pour lui, ce qui n’est pas une exécution, est une fête.
Ainsi comme elle est large la poitrine de l’Ossète. »
 D’abord, ce poème a été composé à la voix, de tête, puis Mandelstam livre cette épigramme à un cercle restreint de connaissances.
D’abord, ce poème a été composé à la voix, de tête, puis Mandelstam livre cette épigramme à un cercle restreint de connaissances.
En 1934, le poète confie à sa femme Nadejda Mandelstam : « Je suis prêt à mourir. »
Un jour, il croise Boris Pasternak et lui récite son poème.
Effrayé, Pasternak ajoute :
« Je n’ai rien entendu et vous n’avez rien récité. Vous savez, il se passe en ce moment des choses étranges, terribles, les gens disparaissent ; je crains que les murs aient des oreilles, il se pourrait que les pavés aussi puissent entendre et parler. Restons-en là : je n’ai rien entendu. »
Mandelstam, reçoit la visite de trois agents de la Guépéou dans la nuit du 16 au 17 mai 1934. Ils lui présentent un mandat d’arrêt et perquisitionnent jusqu’au matin et l’arrêtent.
Mandelstam quitte sa femme Nadejda et ses amis à 7 heures du matin pour la Loubianka.
Tous les manuscrits sont confisqués, lettres, répertoire de téléphone et d’adresses, ainsi que des feuilles manuscrites. Mais pas d’épigramme…
Ce poème ne fut écrit que devant le juge d’instruction de la Loubianka où « le poète coucha ces seize lignes sur une feuille à carreaux arrachée d’un cahier d’écolier. Il a défendu « sa dignité d’homme, d’artiste et de contemporain, jusqu’au bout. »
Cette épigramme sera plus tard cataloguée comme « document contre-révolutionnaire sans exemple » par le quartier général de la police secrète.
Pour Vitali Chentalinski, c’était « plus qu’un poème : un acte désespéré d’audace et de courage civil dont on n’a pas d’analogie dans l’histoire de la littérature. En réalité, en refusant de renier son œuvre, le poète signait ainsi sa condamnation.
<Un article de Wikipedia sur l’épigramme contre Staline>
<Ici la page Wikipedia sur Ossip Mandelstam>
<Un magnifique texte sur Mandelstam>
 Et puis il me semble indispensable aussi de dire quelques mots sur son extraordinaire épouse Nadejda Iakovlevna Khazina née à Saratov le 31 octobre dans une famille juive de la classe moyenne, Elle épouse en 1921 Ossip Mandelstam. Quand Ossip est arrêté en 1934 pour son Épigramme contre Staline elle est exilée avec lui à Tcherdyne, dans la région de Perm, puis à Voronej.
Et puis il me semble indispensable aussi de dire quelques mots sur son extraordinaire épouse Nadejda Iakovlevna Khazina née à Saratov le 31 octobre dans une famille juive de la classe moyenne, Elle épouse en 1921 Ossip Mandelstam. Quand Ossip est arrêté en 1934 pour son Épigramme contre Staline elle est exilée avec lui à Tcherdyne, dans la région de Perm, puis à Voronej.
Après la deuxième arrestation et la mort de son mari dans le camp de transit de Vtoraïa Rechka (près de Vladivostok) en 1938, Nadejda Mandelstam mène un mode de vie quasi-nomade, fuyant parfois à une journée près le NKVD, changeant de résidence à tous vents et vivant d’emplois temporaires.
Elle s’est fixé comme mission la conservation de l’héritage poétique de son mari. Elle a appris par cœur la majeure partie de son œuvre clandestine, parce qu’elle ne faisait pas confiance au papier.
Après la mort de Staline, elle achève son doctorat en 1956 et est autorisée à revenir à Moscou en 1958.
En 1979, elle fait don de toutes ses archives à l’Université de Princeton.
Nadejda Mandelstam meurt à Moscou le 29 décembre 1980 à l’âge de 81 ans.
<400>
Mercredi 26 novembre 2014
Dans son livre Debout-Payé
Mardi 25 novembre 2014
Lundi 24 novembre 2014
Vendredi 21 novembre 2014
Jeudi 20 novembre 2014
Mercredi 19 novembre 2014
7% de la population mondiale
25% de la production mondiale,
et 50% des transferts sociaux mondiaux »
Mardi 18 novembre 2014
«Miss Maggie»
|
Femme du monde ou bien putain qui bien souvent êtes les mêmes femme normale, star ou boudin, femelles en tout genre je vous aime même à la dernière des connes, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière car aucune femme sur la planète n’ s’ra jamais plus con que son frère ni plus fière, ni plus malhonnête à part peut-être madame Thatcher
Femme je t’aime parce que lorsque le sport devient la guerre y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters Ces fanatiques, fous-furieux abreuvés de haine et de bière déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en vert Y a pas de gonzesse hooligan, imbécile et meurtrière y’en a pas même en Grande-Bretagne à part bien sûr madame Thatcher
Femme je t’aime parce que une bagnole entre les pognes tu n’ deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut Y’en a qui vont jusqu’à flinguer pour sauver leur autoradio Le bras d’honneur de ces cons-là aucune femme n’est assez vulgaire pour l’employer à tour de bras à part peut-être madame Thatcher |
Femme je t’aime parce que tu vas pas mourir à la guerre parc’ que la vue d’une arme à feu fait pas frissonner tes ovaires parc’ que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les beurs, j’ai jamais vu une femelle pas une femme n’est assez minable pour astiquer un revolver et se sentir invulnérable à part bien sûr madame Thatcher
C’est pas d’un cerveau féminin qu’est sortie la bombe atomique et pas une femme n’a sur les mains le sang des indiens d’Amérique Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leurs tombeaux qu’un génocide c’est masculin comme un SS, un torero dans cette putain d’humanité les assassins sont tous des frères pas une femme pour rivaliser à part peut être madame Thatcher
Femme je t’aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux quand la force de l’homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue Et quand viendra l’heure dernière, l’enfer s’ra peuplé de crétins jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin moi je me changerai en chien si je peux rester sur la terre et comme réverbère quotidien je m’offrirai madame Thatcher. » Renaud |
Lundi 17 novembre 2014
|
|
Vendredi 14 novembre 2014
Jeudi 13 novembre 2014
La crise la plus importante depuis la fin de la seconde guerre mondiale c’est la crise du Congo : 2,5 millions de morts. Ce n’est pas celle là qui nous a mobilisé »
ancien haut fonctionnaire du Ministère de la Défense, spécialiste des questions stratégiques internationales, auteur de « Surtout ne rien décider » chez Robert Laffont.
les objectifs de guerre ne sont pas définis et nous n’avons donc aucune chance d’atteindre un résultat positif.
l’action des américains et de leurs alliés, dont nous sommes, n’a pas pour priorité première la défense des faibles et des droits de l’homme comme ils voudraient le faire croire. D’autres terrains de conflits, notamment en Afrique, révèlent des victimes et des désastres humanitaires encore beaucoup plus terrifiants où ils n’interviennent pas du tout.
Mercredi 12 novembre 2014
Ouvrage paru en 2009 Au Seuil
|
Elle a donné pour titre à son article « le poète qui faisait taire les fanatiques »
France Culture lui a consacré une émission hommage très intéressante à écouter : http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-2eme-partie-hommage-a-abdelwahab-meddeb-2014-11-06 dans cette émission, Benjamin Stora a expliqué « Abdelwahab Meddeb était un grand intellectuel, un grand érudit mais surtout un homme très courageux. Courageux par ses prises de position politique, contre l’extrémisme religieux par exemple. Mais il avait aussi un grand courage physique, il a affronté la mort jusqu’à hier soir. C’est un homme qui jusqu’au bout a regardé la vie et la mort en face. »
|
|
Vendredi 7 novembre 2014
|
Mais personne n’a dit cela de manière plus forte et poétique que Raymond Devos, mais je l’avais déjà pris comme mot du jour du 2 mai 2013 :
« Je hais les haies
Je hais les haies
qui sont des murs.
Je hais les haies et les mûriers
qui font la haie
le long des murs.
Je hais les haies
qui sont de houx.
Je hais les haies
qu’elles soient de mûres
qu’elles soient de houx !
Je hais les murs
qu’ils soient en dur
qu’ils soient en mou !
Je hais les haies
qui nous emmurent.
Je hais les murs
qui sont en nous ! »
|
|
Jeudi 6 novembre 2014
En France, nul ne peut être poursuivi devant un tribunal pénal sans l’autorisation de La Commission des Infractions Fiscales (C.I.F.) qui est une instance du Ministère des Finances à Bercy. C’est ce mécanisme qui est appelé «le verrou de Bercy».
Il s’agit d’une confusion entre l’exécutif et le judiciaire, puisque l’on met, pour ce type d’infraction, le procureur et le juge sous la tutelle préalable d’une émanation du pouvoir exécutif.
En Principe quand une infraction est commise, il faut prévenir un procureur et c’est à ce dernier, magistrat donc fonctionnaire de l’ordre judiciaire, qu’il appartient de décider de poursuivre ou non.
C’est un des principes de base que l’on apprend quand on fait des études de Droit et dont le fondement se trouve dans la déclaration des droits de l’Homme et des citoyens de 1789 dans son article 16.
Article 16. « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.»
Poursuivre, juger c’est le pouvoir judiciaire, si le pouvoir exécutif s’en mêle, il n’y a pas séparation des pouvoirs.
Les différents spécialistes de la corruption, qui s’expriment beaucoup ces derniers temps : Antoine Peillon, Edwy Plenel plaident pour qu’on fasse sauter le « verrou de Bercy ».
Lors de l’affaire Cahuzac cette question s’était déjà posée de manière très prégnante :
<Faire sauter le verrou de Bercy>
Pour l’instant les gouvernements de droite comme de gauche ont toujours refusé de remettre en cause ce mécanisme.
<387>
Mercredi 5 novembre 2014
« Procès du grille-pain et autres objets qui nous tapent sur les nerfs »
Mardi 4 novembre 2014
Conclusion de sa conférence à l’Ecole Polytechnique du 18/02/2014
Peut-on penser le monde en 2030 ?
Lundi 3 novembre 2014
Toi, l’Auvergnat qui, sans façon,
M’as donné quatre bouts de bois
Quand, dans ma vie, il faisait froid »
|
Elle est à toi, cette chanson,
Toi, l’Auvergnat qui, sans façon,
M’as donné quatre bouts de bois
Quand, dans ma vie, il faisait froid,
Toi qui m’as donné du feu quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
M’avaient fermé la porte au nez…
Ce n’était rien qu’un feu de bois,
Mais il m’avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encor’
A la manièr’ d’un feu de joi’.
Toi, l’Auvergnat quand tu mourras,
Quand le croqu’-mort t’emportera,
|
Qu’il te conduise, à travers ciel,
Au Père éternel.
Elle est à toi, cette chanson,
Toi, l’hôtesse qui, sans façon,
M’as donné quatre bouts de pain
Quand dans ma vie il faisait faim,
Toi qui m’ouvris ta huche quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
S’amusaient à me voir jeûner…
Ce n’était rien qu’un peu de pain,
Mais il m’avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encor’
A la manièr’ d’un grand festin.
|
|
Elle est à toi, cette chanson,
Toi, l’Auvergnat qui, sans façon,
M’as donné quatre bouts de bois
Quand, dans ma vie, il faisait froid,
Toi qui m’as donné du feu quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
M’avaient fermé la porte au nez…
Ce n’était rien qu’un feu de bois,
Mais il m’avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encor’
A la manièr’ d’un feu de joi’.
Toi, l’Auvergnat quand tu mourras,
Quand le croqu’-mort t’emportera,
Qu’il te conduise, à travers ciel,
Au Père éternel.
Elle est à toi, cette chanson,
Toi, l’hôtesse qui, sans façon,
M’as donné quatre bouts de pain
Quand dans ma vie il faisait faim,
Toi qui m’ouvris ta huche quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
S’amusaient à me voir jeûner…
Ce n’était rien qu’un peu de pain,
Mais il m’avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encor’
A la manièr’ d’un grand festin.
|
Toi l’hôtesse quand tu mourras,
Quand le croqu’-mort t’emportera,
Qu’il te conduise à travers ciel,
Au Père éternel.
Elle est à toi cette chanson,
Toi, l’Etranger qui, sans façon,
D’un air malheureux m’as souri
Lorsque les gendarmes m’ont pris,
Toi qui n’as pas applaudi quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
Riaient de me voir emmené…
Ce n’était rien qu’un peu de miel,
Mais il m’avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr’ d’un grand soleil.
Toi l’Etranger quand tu mourras,
Quand le croqu’-mort t’emportera,
Qu’il te conduise, à travers ciel,
Au Père éternel.
Brassens
|
Vendredi 31 Octobre 2014
Je ne vois pas en quoi c’est une crise. Depuis que je suis petit, c’est comme ça. »
|
|
|
|
Le taux d’homicides est près de quatre fois plus élevé dans les pays dans lesquels sévissent des inégalités économiques extrêmes que dans les nations plus égalitaires rapporte Oxfam.
Pour illustrer l’importance de certaines fortunes et le rapport entre celles-ci et les besoins de base de la population, Le taux d’homicides est près de quatre fois plus élevé dans les pays dans lesquels sévissent des inégalités économiques extrêmes que dans les nations plus égalitaires rapporte Oxfam.
Pour illustrer l’importance de certaines fortunes et le rapport entre celles-ci et les besoins de base de la population,
Oxfam a calculé les dépenses possibles d’un des hommes les plus riches de la planète. « Si Bill Gates décidait de retirer la totalité de ses avoirs et dépensait 1 million de dollars par jour, il lui faudrait 218 ans pour venir à bout de sa fortune », indique le rapport.
En réalité, il ne se retrouverait jamais à court d’argent: même un modeste retour d’à peine moins de 2% lui permettrait de percevoir 4,2 millions de dollars par jour uniquement en intérêts ».
Un petit tableau pour mieux comprendre ce que dit Oxfam :
|
Jeudi 30 Octobre 2014
le médecin congolais qui vient de recevoir le Prix Sakharov décerné par le Parlement européen.
Mercredi 29 octobre 2014
Je ne pense pas que ce soit intégré dans le modèle mental des gens ».
Fondateur de Microsoft
Bill Gates n’est pas le seul à le dire, mais lui le dit de manière très abrupte :
« Vous ne réalisez pas à quel point les robots prendront votre travail. »
Il dit en toute simplicité
« De grands changements auxquels les gens et les gouvernements ne sont pas préparés arrivent sur le marché du travail. »
Lors d’un discours à Washington D.C. auprès d’un groupe de réflexion économique The American Enterprise Institute on Thursday, Bill Gates a déclaré :
« La substitution logicielle, qu’elle concerne les chauffeurs, les serveurs ou les infirmières, progresse. Sur la durée, la technologie va réduire la demande en emplois, particulièrement au bas de l’échelle des compétences. Dans 20 ans, la demande de main-d’œuvre pour beaucoup de compétences sera substantiellement plus faible. Je ne pense pas que ce soit intégré dans le modèle mental des gens »
< Ici le journal du net qui parle de ce discours>
<Le JDD vient de publier un article : Les robots vont-ils tuer la classe moyenne ?>
Les libéraux optimistes reviennent toujours à ce concept de l’économiste autrichien de la « destruction créatrice » qui désigne le processus continuellement à l’œuvre dans les économies et qui voit se produire de façon simultanée la disparition de secteurs d’activité économique conjointement à la création de nouvelles activités économiques.
Dans la vision de Joseph Schumpeter du capitalisme, l’innovation portée par les entrepreneurs est la force motrice de la croissance économique sur le long terme. Schumpeter emploie l’image d’un « ouragan perpétuel » : dans l’immédiat, il peut impliquer pour certaines entreprises présentes sur le marché une destruction de valeur spectaculaire. Le phénomène affecte tout type d’organisations mêmes les plus importantes ou celles censées jouir jusque-là d’une position apparemment forte ou dominante (y compris sous la forme d’une rente de situation ou d’un monopole).
Il est possible, c’est une hypothèse raisonnable, que nous ne soyons plus à ce stade de l’évolution libérale.
<Bernard Stiegler défend aussi ce point de vue de la fin de l’emploi>
Si cette hypothèse crédible se réalise, c’est peu dire que nous ne sommes pas sur le chemin pour nous y préparer.
Dans ce que dit Bill Gates, ce n’est pas la première partie qui me parait la plus importante : la destruction massive de l’emploi, au sens actuel de l’économie, pour les humains.
C’est la seconde partie Je ne pense pas que ce soit intégré dans le modèle mental des gens.
Aujourd’hui quand ceux qui ont le pouvoir économique ou politique parle, il parle d’un modèle qu’il ne conçoive pas de dépasser. Ce modèle où le travail donne du travail.
Où les capitalistes investissent, où l’investissement donne de l’emploi rémunéré et de la croissance qui dans un cercle vertueux permet plus ou moins à chacun de trouver sa place dans un monde essentiellement mû par la cupidité et l’appât du gain.
Mais que devient ce modèle si le ressort se casse : la croissance ne donne plus suffisamment d’emploi rémunéré pour que le plus grand nombre trouve une place dans la société économique ?
Si vous êtes courageux voici une conférence très intéressante, plus longue mais assez mal enregistrée où Bernard Stiegler développe un concept en réponse à Schumpeter : <La destruction destructrice>
<381>
Mardi 28 octobre 2014
|
|
Lundi 27 octobre 2014
Vendredi 24 octobre 2014
Je suis médecin.
Aujourd’hui, ma vie prend fin.»
Jeudi 23 octobre 2014
[…] Disons non, tous ensemble, à l’ombre
et femmes et hommes de bonne volonté inventons une nouvelle lumière »
Mercredi 22 octobre 2014
que nous donnions notre force d’un jour à ce que nous croyons la justice,
et que nous fassions œuvre d’hommes en attendant d’être couchés à jamais dans le silence de la nuit »
Mardi 21 octobre 2014
Lundi 20 octobre 2014
Plus jamais nous ne serons mendiants, ni humiliés »,
|
|
Vendredi 17 octobre 2014
|
Un continent de la honte qu’il faudra des siècles pour dissoudre.
Voici cette émission : http://www.franceinter.fr/emission-ils-changent-le-monde-alexandra-ter-halle-et-le-continent-des-dechets
Si vous tapez 7ème continent sur un moteur de recherche vous allez avoir des liens vers des centaines de pages.
Un site est entièrement consacré à ce sujet : http://www.septiemecontinent.com/
Il y a aussi un article du Monde : http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/le-7e-continent-de-plastique-ces-tourbillons-de-dechets-dans-les-oceans_1696072_3244.html
Une vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=WDS4ukmNfaw
et beaucoup d’autres.
Qu’avons-nous fait de notre terre et de notre mer ?
|
|
Jeudi 16 octobre 2014
« De la France », de Cioran, L’Herne, 96 pages
Mercredi 15 octobre 2014
Mardi 14 octobre 2014
Lettre ouverte au monde musulman
Abdennour Bidar est philosophe de culture musulmane, il vient de publier chez Armand Colin « Histoire de l’humanisme en Occident ».
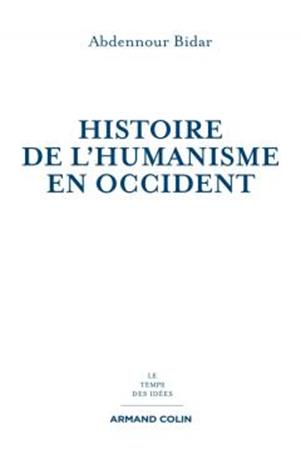 C’est pour cette raison qu’il était l’invité de la Grande Table du 10 octobre 2014. <Peut-on aller vers un-nouvel humanisme ?>.
C’est pour cette raison qu’il était l’invité de la Grande Table du 10 octobre 2014. <Peut-on aller vers un-nouvel humanisme ?>.
Il définit l’humanisme occidental par 3 piliers :
- La fraternité : je peux me sentir proche, être sensible au destin de tout homme, même s’il n’est pas de ma culture, pas de mon pays.
- La grandeur de l’homme car c’est l’homme qui a créé les Dieux et non le contraire.
- L’éducation qui libère.
Mais Abdennour Bidar vient aussi de commettre une Lettre ouverte au monde musulman publiée par Marianne.
Dont je cite quelques extraits :
« Cher monde musulman, je suis un de tes fils éloignés qui te regarde du dehors et de loin […]
Je te vois toi, dans un état de misère et de souffrance qui me rend infiniment triste, mais qui rend encore plus sévère mon jugement de philosophe ! Car je te vois en train d’enfanter un monstre qui prétend se nommer Etat islamique […]. Mais le pire est que je te vois te perdre, perdre ton temps et ton honneur dans le refus de reconnaître que ce monstre est né de toi, de tes errances, de tes contradictions, de ton écartèlement entre passé et présent, de ton incapacité trop durable à trouver ta place
[…]
La grande question : pourquoi ce monstre t’a t’il volé ton visage ? Pourquoi ce monstre ignoble a-t-il choisi ton visage et pas un autre ?
C’est qu’en réalité derrière ce monstre se cache un immense problème, que tu ne sembles pas prêt à regarder en face.[…]
Même les intellectuels occidentaux ont de la difficulté à le voir : pour la plupart ils ont tellement oublié ce qu’est la puissance de la religion – en bien et en mal, sur la vie et sur la mort – qu’ils me disent « Non le problème du monde musulman n’est pas l’islam, pas la religion, mais la politique, l’histoire, l’économie, etc. ».
[…]
Malgré la gravité de ta maladie, il y a en toi une multitude extraordinaire de femmes et d’hommes qui sont prêts à réformer l’islam, à réinventer son génie au-delà de ses formes historiques et à participer ainsi au renouvellement complet du rapport que l’humanité entretenait jusque-là avec ses dieux !
[Le monde musulman est] un immense corps malade, dont les maladies chroniques sont les suivantes : impuissance à instituer des démocraties durables dans lesquelles est reconnue comme droit moral et politique la liberté de conscience vis-à-vis des dogmes de la religion ; difficultés chroniques à améliorer la condition des femmes dans le sens de l’égalité, de la responsabilité et de la liberté; impuissance à séparer suffisamment le pouvoir politique de son contrôle par l’autorité de la religion; incapacité à instituer un respect, une tolérance et une véritable reconnaissance du pluralisme religieux et des minorités religieuses.
[…] tu as été incapable de répondre au défi de l’Occident. Soit tu t’es réfugié de façon infantile et mortifère dans le passé, avec la régression obscurantiste du wahhabisme qui continue de faire des ravages presque partout à l’intérieur de tes frontières – un wahhabisme que tu répands à partir de tes lieux saints de l’Arabie Saoudite comme un cancer qui partirait de ton cœur lui-même ! «
Et enfin il donne son explication
« […] Tu as choisi de considérer que Mohammed était prophète et roi. Tu as choisi de définir l’islam comme religion politique, sociale, morale, devant régner comme un tyran aussi bien sur l’Etat que sur la vie civile, aussi bien dans la rue et dans la maison qu’à l’intérieur même de chaque conscience. Tu as choisi de croire et d’imposer que l’islam veut dire soumission alors que le Coran lui – même proclame qu’« Il n’y a pas de contrainte en religion ». Tu as fait de son Appel à la liberté l’empire de la contrainte !
[…] Et il y a tant de familles où cette confusion entre spiritualité et servitude est incrustée dans les esprits dès le plus jeune âge, et où l’éducation spirituelle est d’une telle pauvreté que tout ce qui concerne la religion reste quelque chose qui ne se discute pas ! […] tout ce que je viens d’évoquer – une religion tyrannique, dogmatique, littéraliste, formaliste, machiste, conservatrice, régressive – est trop souvent l’islam ordinaire […] Je n’aurais pas été si sévère dans cette lettre si je ne croyais pas en toi. […] Je crois en toi, je crois en ta contribution à faire demain de notre planète un univers à la fois plus humain et plus spirituel ! Salâm , que la paix soit sur toi »
<La lettre intégrale sur Marianne>
<370>
Lundi 13 octobre 2014
International Business Editor of the Daily Telegraph.
Vendredi 10 octobre 2014
Seuls 42 de ses 109 eurofighter
seuls 38 de ses 89 chasseurs Tornado
seuls 10 de ses 31 hélicoptères Tigres sont prêts à décoller, les autres sont en maintenance ou en réparation.
Jeudi 9 octobre 2014
Mercredi 8 octobre 2014
en souvenir des soldats de la Grande Guerre
Charles Peguy est mort le 5 septembre 1914
Alain-Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes, est mort le 22 septembre 1914
Mardi 7 octobre 2014
Il n’y a pas d’embouteillages dans les films, il n’y a pas de temps morts. »
François Truffaut est mort il y a 30 ans, le 21 octobre 1984 à 52 ans, d’une tumeur au cerveau.
C’était une encyclopédie vivante du cinéma et aussi un très grand réalisateur.
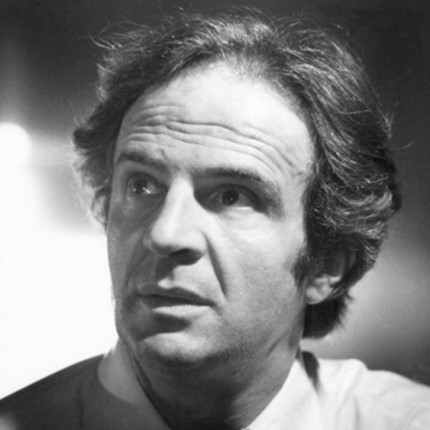 Dans la « nuit américaine » le sujet du film est un film en train d’être réalisé.
Dans la « nuit américaine » le sujet du film est un film en train d’être réalisé.
C’est dans ce film que Truffaut jouant le rôle du réalisateur dit à l’acteur principal de son film « Jean-Pierre Léaud », cette ode au cinéma :
« Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n’y a pas d’embouteillages dans les films, il n’y a pas de temps morts. Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail de cinéma ».
La « nuit américaine » est le nom d’une technique qui consiste à tourner des scènes nocturnes en plein jour.
Patrick Cohen dans la matinale sur France Inter du vendredi 3 octobre, à l’occasion du trentième anniversaire de la disparition de François Truffaut, a reçu Serge Toubiana, directeur de la Cinémathèque française qui consacre actuellement une exposition au cinéma de Truffaut, et l’actrice Nathalie Baye.
La nuit américaine fut le premier film important de Nathalie Baye qui a dit dans cette émission, combien Truffaut arrivait à mettre ses acteurs en confiance et créer une ambiance unique sur le plateau.
Elle a avoué qu’elle a dû répéter de nombreuses fois cette réplique qu’elle a dans le film
« Moi je quitterai un homme pour un film, jamais un film pour un homme » parce qu’elle la disait toujours à l’envers.
Voici le lien vers cette émission : <http://www.franceinter.fr/emission-linvite-le-cinema-de-francois-truffaut>
<365>
Lundi 6 octobre 2014
Juste pour qu’il ne soit pas oublié.
Juste pour répondre à votre sollicitation. »
Vendredi 3 octobre 2014
Le capitalisme hors la loi, Albin Michel, septembre 2011. ISBN 9782226230553.
La Banque – Comment Goldman Sachs dirige le monde, Albin Michel, septembre 2010. I
Jeudi 2 octobre 2014
Mercredi 1 octobre 2014
Mardi 30 septembre 2014
Dimanche on a renouvelé une partie du Sénat :
Lundi 29 septembre 2014
Vendredi 26 septembre 2014
Jeudi 25 septembre 2014
Un français ayant l’intention de faire de l’alpinisme en Kabylie, a été enlevé par un groupe de djihadiste puis a été décapité par ce groupe.
Ainsi le mot de république est banni parce qu’il vient de la révolution française que les djihadistes détestent et le djihad remplace le mot révolution dans nos banlieues comme dans celles de Bagdad. »
Mercredi 24 septembre 2014
J’ai adhéré à cette langue et elle m’a adopté…
C’est une question d’amour. Je l’aime et elle m’aime… ».
Une langue venue d’ailleurs,
Mardi 23 septembre 2014
«La France, elle va faire 50 milliards d’économie et ce n’est pas si facile. […] La France, elle ne fera pas davantage parce que ce serait mettre en cause la croissance.»
«L’Europe, elle a besoin de la France parce que nous sommes la deuxième économie de l’Europe. […] Alors la France, elle compte.»
«Les résultats, ils tardent à venir, je le sais, je le vois.»
«Le scepticisme, bien sûr qu’il est grand»
Lundi 22 septembre 2014
L’ancien Président qui voulait faire autre chose, revient, il veut agir.
Pour ce retour, ce mot mystérieux de Paul Valéry :
Vendredi 19 septembre 2014
mais je suis sûr que j’irai au bout »
Jeudi 18 septembre 2014
Mercredi 17 septembre 2014
Mardi 16 septembre 2014
Ensemble on va plus loin »
Je vais encore parler de quelque chose que je ne connais pas et que je n’ai pas vu. Alors, je vais essayer de le faire bien.
J’écoutais, hier, pendant la pause méridienne le journal de 13h de France Inter.
A la fin, il a été question de la biennale de la danse de Lyon.
 Dimanche a eu lieu le grand défilé (le 10ème) dans les rues de Lyon, plus grande parade chorégraphiée d’Europe et 300 000 spectateurs.
Dimanche a eu lieu le grand défilé (le 10ème) dans les rues de Lyon, plus grande parade chorégraphiée d’Europe et 300 000 spectateurs.
Une vidéo montre et évènement <Le défilé de la biennale de la danse 2014>
La biennale c’est 45 spectacles et cette année il y a une ouverture sur le monde du cirque incarnée par la compagnie XY.
Et pour décrire le spectacle de cette compagnie, la journaliste de France Inter a eu ces mots :
« Tout commence par un combat de corps au sol,
puis bien vite les artistes prennent de la hauteur,
des tours humaines s’érigent
2,3 ou 4 corps empilés les uns sur les autres,
sans aucun dispositif de sécurité.
Le spectateur retient son souffle,
puis les corps prennent leur envol
et virevoltent à 2, 4, 8 mètres de hauteur.
Les jeunes filles se transforment en anges,
Propulsées par des hommes puissants.
Leur bras font office de tremplin.
Le tout avec une facilité déconcertante [..]
Dans les différents tableaux se mêlent rire et poésie.
L’objectif est bien de transmettre des émotions au public.»
Puis Peggy, membre de la Compagnie, s’exprime :
« Les gens étaient beaucoup plus émus par ce que ça impliquait de faire des portés, de la solidarité entre les gens sur le plateau que des prouesses techniques elles-mêmes »
Et c’est alors qu’elle a énoncé ce proverbe africain :
«Tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin.»
Je l’ai trouvé beau dans le contexte dans lequel il était révélé et profond dans la sagesse qu’il dévoile.
Peggy a ajouté :
Je crois qu’il y a quelque chose comme ça chez nous»
Le spectacle s’appelle il n’est pas encore minuit….
Le site de cette compagnie <La compagnie XY>
Il n’y a pas encore de vidéo sur ce spectacle, mais voici un petit extrait d’un spectacle précédent <Le grand C>
Que l’art vous garde votre joie.
<350>
Lundi 15 septembre 2014
Moi aussi j’aimerai payer les taxis moins chers.
[Mais la vraie rente, c’est la rente du capital] »
Vendredi 12 septembre 2014
Émile Durkheim (1858-1917) est un des fondateurs et des plus brillants maître de la sociologie.
Je crois qu’il dit quelque chose de fondamental : pour que l’Etat providence puisse pleinement se déployer il faut qu’il existe ce que Durkheim dit.
Cette constatation a été rappelée dans la conclusion du livre publié en 2014 aux éditions de la Découverte sous la direction de François Dubet : « Inégalités et justice sociale »
François Dubet, sociologue moderne, directeur d’études à l’EHESS était l’invité de l’émission de France Culture La Grande Table du 30/06/2014 qui avait pour thème : « Est ce que toutes les inégalités se valent. »
François Dubet insiste beaucoup sur le fait que la seule dénonciation globale des inégalités sociales ne suffit pas, car toutes les inégalités ne se « valent » pas : certaines sont visibles, d’autres moins, certaines sont perçues comme injustes, d’autres non. Il faut donc pouvoir décrire et mesurer les inégalités sociales, mais aussi savoir ce que nous en faisons et comment elles affectent plus ou moins profondément la vie et l’action des individus.
Et il pose les questions suivantes :
« Que nous font les inégalités dans notre expérience de vie ? Comment se crée une économie morale autour des inégalités ? Comment les inégalités produisent de l’action ? »
Et il finit par un constat :
« Pour vouloir l’égalité des autres, il faut s’en sentir responsable car la seule dénonciation des inégalités ne suffit pas à vouloir leur égalité. »
La conclusion de l’ouvrage qu’il a dirigé a pour titre, « le chainon manquant : la solidarité ».
L’état providence et la formidable redistribution qu’elle sous-tend oblige la solidarité entre l’ensemble des humains qui y participe.
Et Dubet rappelle alors cette réflexion, constatation du grand sociologue Durkheim.
Force est de constater que les grandes avancées sociales et de redistribution se sont déployées dans les Etats européens au sortie des deux guerres mondiales où l’appartenance à une même société faisait très largement consensus.
L’esprit de solidarité s’est largement émoussé et Durkheim nous donne la clé.
Les ultras riches mais aussi les élites mondialisées ainsi que les fragments de la population qui se sont réfugiés, pour de multiples raisons, dans l’identité communautaire ne tiennent plus à la même société qui trace les frontières de la redistribution. Et bien sûr nous qui n’appartenons à aucun de ces groupes, avons aussi de plus en plus de mal à aimer les populations de ces groupes et de considérer que nous faisons partie d’une même société.
Et si nous ne faisons plus partie de la même société, comment se reconnaître mutuellement des droits et une solidarité du niveau auquel est parvenu notre système social ?
<348>
Jeudi 11 septembre 2014
Mercredi 10 septembre 2014
Mardi 9 septembre 2014
d’être une femme
dans la plupart des pays du Monde »
Annick Cojean, est l’une des grandes plumes du journal Le Monde. Elle a reçu le Prix Albert Londres en 1996, dirige la collection Duels sur France 5.
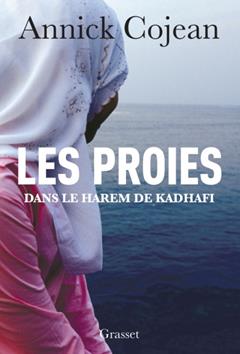 Elle a signé récemment « Les proies » un livre sur le système d’enlèvement et de viols systématiques mis en place sous le général Kadhafi. Le sous-titre est : « Les proies dans le harem de Kadhafi » (aux éditions Grasset).
Elle a signé récemment « Les proies » un livre sur le système d’enlèvement et de viols systématiques mis en place sous le général Kadhafi. Le sous-titre est : « Les proies dans le harem de Kadhafi » (aux éditions Grasset).
Elle a signé aussi une enquête très forte sur le viol comme arme de guerre en Syrie.
Elle était l’invité de l’émission « Ils changent le monde » de Caroline Fourest : <Ils changent le monde Annick Cojean>
Et c’est dans cette émission qu’elle a eu cette phrase que j’ai choisie comme mot du jour.
Kadhafi avait organisé un véritable harem dans son palais. Quand il allait visiter une école, le geste de caresser la tête d’une jeune élève indiquait à ses sbires qu’il fallait l’enlever pour son harem.
Kadhafi avait une autre pratique : la sodomisation de ses généraux pour les humilier et les soumettre totalement.
Annick Cojean explique que ce n’est tout simplement pas possible de regretter un tel monstre.
Elle raconte dans son livre le sort que Khadafi réservait à des fillettes de quatorze ou quinze ans dans les lupanars personnels qu’il avait organisés jusque dans l’enceinte de l’université de Tripoli, comme dans son QG de Bab el Azizia : il les faisait enlever, par dizaines, par centaines, les violait et les droguait, avec la brutalité d’un soudard fou. Et il les faisait ensuite assister à ses ébats avec des hommes. Puis il se servait du sang de la défloration pour des pratiques de magie noire. Des membres mâles de son gouvernement, avec lesquels il forniquait aussi, en faisaient autant avec les filles mises à leur disposition.
Sans l’audace et l’obstination d’Annick Cojean, ces faits n’auraient sans doute jamais été portés à la connaissance du public. En effet, « le sujet est tabou, » Les femmes violées ne peuvent pas le revendiquer. C’est un crime parfait, les victimes sont enfermées dans leurs silences. Elles risquent de mourir par un crime d’honneur dans ces sociétés et si elles ne sont pas tuées elles seront ostracisées par leur famille.
Une loi a été réalisée en Libye pour reconnaître les femmes violées comme des victimes. On en a peu parlé en France. Il y a quand même des choses positives en Libye.
Une autre émission de « Ils changent le monde » raconte cette évolution en Libye par la suite d’un combat d’une autre femme : Céline Bardet, qui enquête sur le terrain sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, après avoir été juriste au Tribunal Pénal international de la Haye : <Ils changent le monde : Céline Bardet>
Annick Cojean a raconté aussi ce qu’elle avait vu en Syrie et a eu cette réflexion plus générale sur la condition des femmes dans un trop grand nombre de pays où elles sont opprimées, brutalisées, humiliées, reléguées, exploitées. Elles n’ont même pas le droit de se plaindre quand on commet un crime comme le viol à leur égard, le résultat de leur plainte rendrait leur vie encore plus insoutenable.
La violence, sous toutes ses formes, faite aux femmes dans le monde, à travers les siècles et jusqu’à aujourd’hui est immense, ignoble et encore largement inavouée ou refoulée.

Le mot du jour d’Annick Cojean est terrible, parce qu’il se lit au présent.
Que le Ciel vous tienne en éveil et que le féminin qui est en vous, femme ou homme, vous permette de voir, de comprendre et de faire votre part, comme le colibri, dans l’évolution nécessaire de notre humanité.
<345>
Lundi 8 septembre 2014
L’architecture ne met pas en place des formes, elle met en place des scénarios »
http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/expositions_temporaires/25473-reenchanter_le_monde.html
Vendredi 5 septembre 2014
Jeudi 4 septembre 2014
A cette époque, les activités religieuses occupaient encore une grande place dans ce temps disponible.
Mercredi 3 septembre 2014
L’Ukraine a été envahie par la Russie ;
Le sinistre « Etat islamique » a augmenté son emprise en Irak et en Syrie et continue ses massacres odieux ;
Boko Aram continue à déstabiliser le Nigéria et les pays alentours ;
Gaza a continué son lot d’affrontements et de massacres ;
La propagation du virus Ebola s’étend ;
La situation économique française et européenne continue à se dégrader et contrairement à ce qu’affirme Montebourg l’économie du reste du monde ne va pas bien (Le Japon va plus mal : http://abonnes.lemonde.fr/japon/article/2014/08/29/les-japonais-consomment-toujours-moins_4478693_1492975.html, Le Brésil entre récession http://www.liberation.fr/economie/2014/08/29/le-bresil-en-recession-a-presque-un-mois-des-elections_1089657 etc…)
Robin Williams, le professeur génial et illuminé du cercle des poètes disparus, s’est suicidé, le regard hypnotisant de Lauren Bacall s’est définitivement éteint ;
et « last but not least », l’Unità, le journal fondé en 1924 par Antonio Gramsci, organe du parti communiste le plus intelligent de l’Europe occidentale est mort le 31 Juillet 2014.
|
Faouzia Charfi
|
Segenet Kelemu
|
|
|
|
|
Esther Duflo
|
Delphine Horvilleur
|
|
|
|
Mardi 2 septembre 2014
pour faire chier les mômes »
film de Louis Malle
|
|
Lundi 1er septembre 2014
Eh bien essayons de continuer cette discipline quotidienne du mot du jour. Pour m’en convaincre j’ai reçu les protestations de certains à l’idée de finir ce défi et ce 8ème poème du livre Un des contemplations de Victor Hugo :
« Car le mot qu’on le sache est un être vivant ».
Cette période de congé m’a permis de faire le point, depuis le 9 octobre 2012, le présent mot est le 339ème de cette série.
Que le ciel et les mots de Hugo vous tiennent en joie. Ce poème étant fort long je me permets d’en citer des extraits :
Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant.
La main du songeur vibre et tremble en l’écrivant;
La plume, qui d’une aile allongeait l’envergure,
Frémit sur le papier quand sort cette figure,
Le mot, le terme, type on ne sait d’où venu,
Face de l’invisible, aspect de l’inconnu;
Créé, par qui? forgé, par qui? jailli de l’ombre;
Montant et descendant dans notre tête sombre,
[…]
Oui, vous tous, comprenez que les mots sont des choses.
Ils roulent pêle-mêle au gouffre obscur des proses,
Ou font gronder le vers, orageuse forêt.
Du sphinx Esprit Humain le mot sait le secret.
[…]
Tel mot est un sourire, et tel autre un regard;
De quelque mot profond tout homme est le disciple;
Toute force ici-bas a le mot pour multiple;
[…]
Ce qu’un mot ne sait pas, un autre le révèle;
Les mots heurtent le front comme l’eau le récif;
Ils fourmillent, ouvrant dans notre esprit pensif
Des griffes ou des mains, et quelques-uns des ailes;
Comme en un âtre noir errent des étincelles,
Rêveurs, tristes, joyeux, amers, sinistres, doux,
Sombre peuple, les mots vont et viennent en nous;
Les mots sont les passants mystérieux de l’âme
Chacun d’eux porte une ombre ou secoue une flamme;
[…]
Le mot dévore, et rien ne résiste à sa dent.
A son haleine, l’âme et la lumière aidant,
L’obscure énormité lentement s’exfolie.
Il met sa force sombre en ceux que rien ne plie;
[…]
Oui, tout-puissant! tel est le mot. Fou qui s’en joue!
Quand l’erreur fait un nœud dans l’homme, il le dénoue.
Il est foudre dans l’ombre et ver dans le fruit mûr.
Il sort d’une trompette, il tremble sur un mur,
Et Balthazar chancelle, et Jéricho s’écroule.
Il s’incorpore au peuple, étant lui-même foule.
Il est vie, esprit, germe, ouragan, vertu, feu;
Car le mot, c’est le Verbe, et le Verbe, c’est Dieu.
<L’intégralité du poème se trouve ici avec l’intégralité des Contemplations>
<339>
Vendredi 01/08/2014
Après-midi, piscine.»
Journal, 2 août 1914
Jeudi 31/07/2014
Histoire d’une couleur
Mercredi 30/07/2014
Je ne vais rien faire ».
Mardi 29/07/2014
Ce démon très intelligent
Qui sut comprendre le premier
La valeur d’un bout de papier.
Ce démon était un banquier.»
|
Ce démon était un banquier
Et depuis dans le monde entier
L’argent circule
Et fait des bulles.
Gardez votre monnaie ;
La quête est terminée ;
Car d’un commun accord
C’est demain l’âge d’or :
LE FRIC
Magique ;
L’artiche
Fortiche ;
La banque
La planque ;
La paye ;
L’oseille.
Pognon
Mignon ;
Le blé
|
Gonflé ;
Les Louis
Inouïs
Les briques
Pratiques.
Affure ;
Carbure ;
Le pèze ;
La braise ;
Le jonc ;
Les ronds ;
Ferraille ;
Mitraille ;
Benèf
Besèf ;
Pourliche ;
Backchich ;
Les rentes ;
Ma tante,
|
Des sous ;
Des clous ;
Liquide ;
Solide ;
Osier ;
Rotin ;
Papier ;
Talbin ;
Galette ;
Pépettes ;
Fortune ;
Deux tunes ;
Ressources ;
La bourse ;
Le nerf
De guerre ;
Finance ;
Balance…
|
Lundi 28/07/2014
Vendredi 25/07/2014
Jeudi 24/07/2014
Mercredi 23/07/2014
le contrat de grille, où l’employé est embauché sur une période de dix mois et payé via un forfait de cachets mensualisés ;
l’intermittence basique, où l’employé est embauché pour des périodes de travail aléatoires.
Mardi 22/07/2014
Tout le monde sait comment on fait les bébés
Mais personne sait comment on fait des papas»
|
Dites-moi d’où il vient
Enfin je saurais où je vais
Maman dit que lorsqu’on cherche bien
On finit toujours par trouver
Elle dit qu’il n’est jamais très loin
Qu’il part très souvent travailler
Maman dit « travailler c’est bien »
Bien mieux qu’être mal accompagné
|
Pas vrai ?
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qu’il ne va pas
Ah sacré papa
Dis-moi où es-tu caché ?
|
|
Ça doit, faire au moins mille fois que j’ai
Compté mes doigts
Où t’es, papa où t’es ? etc. [Refrain]
Quoi, qu’on y croit ou pas
Y aura bien un jour où on y croira plus
Un jour ou l’autre on sera tous papa
Et d’un jour à l’autre on aura disparu
Serons-nous détestables ?
Serons-nous admirables ?
Des géniteurs ou des génies ?
Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables ?
Ah dites-nous qui, tient,
Tout le monde sait comment on fait les bébés
Mais personne sait comment on fait des papas
Monsieur Je-sais-tout en aurait hérité, c’est ça
Faut l’sucer d’son pouce ou quoi ?
Dites-nous où c’est caché, ça doit
Faire au moins mille fois qu’on a, bouffé nos doigts
[Refrain]
|
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qui ne va pas
Ah sacré papa
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que j’ai
Compté mes doigts
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qui ne va pas
Ah sacré papa
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que j’ai
Compté mes doigts
[Refrain]
Stromae
|
Lundi 21/07/2014
Vendredi 18/07/2014
« les autorités européennes, grecques, italiennes… pourraient sanctionner Goldman Sachs pour avoir truqué les comptes publics grecs qui ont permis à Athènes d’entrer dans la Zone euro, et JP Morgan pour avoir vendu des prêts toxiques en Italie. »
Jeudi 17/07/2014
Mercredi 16/07/2014
n’est pas humainement souhaitable»
Mardi 15/07/2014
|
|
Vendredi 11/07/2014
j’ai pensé au Roi Lion – « Souviens-toi d’où tu viens »«
Interview à Lyon Capitale N° 733 Mai 2014 page 24
Jeudi 10/07/2014
alors que j’avais l’impression d’être sans limite.>
Mercredi 9 juillet 2014
Latifa Ibn Ziaten est la mère d’Imad, le premier soldat tué à Toulouse en mars 2012, l’une des sept victimes de Mohamed Merah.
Le mot du jour est le nom de l’association qu’elle a créée et dont le nom complet est « l’association Imad Ibn Ziaten pour la jeunesse et la paix »
 Je dois même dire que j’ai été submergé par l’émotion, d’entendre cette femme simple, musulmane voilée, parler avec une langue limitée mais avec une intelligence du cœur incroyable de l’éducation, de la république, de la paix entre les religions, du respect que mérite chacun. J’ai été impressionné par sa dignité et son humanité.
Je dois même dire que j’ai été submergé par l’émotion, d’entendre cette femme simple, musulmane voilée, parler avec une langue limitée mais avec une intelligence du cœur incroyable de l’éducation, de la république, de la paix entre les religions, du respect que mérite chacun. J’ai été impressionné par sa dignité et son humanité.
Dans cette émission elle raconte d’abord le début de l’histoire pour elle : Un coup de fil en Turquie, où elle séjourne en vacances avec son mari, Ahmed, cheminot à la retraite, leur apprend la mort d’Imad, abattu d’une balle dans la tête, près d’un gymnase. Le couple arrive à l’aube à Toulouse. Latifa veut voir son fils à la morgue.
Mais la police l’en empêche et la soumet toute la journée à un interrogatoire d’où il ressort que la police soupçonne son fils d’être mêlé à de sombres trafics et d’avoir été victime d’un règlement de compte.
«Un policier m’a dit : « Madame, vous ne connaissez pas toute la vie de votre fils. » Parce qu’il s’appelait Imad et qu’il était arabe, la police a pensé qu’il était délinquant, s’indigne-t-elle. Mes enfants, je les ai les élevés dans le respect de l’autre, de la République. A la fin de l’interrogatoire, il est trop tard, la morgue est fermée et Latifa ne peut plus voir son fils.
Et elle raconte aussi comment, après la mort de son fils, elle a pris un taxi pour retourner à Toulouse dans le quartier des Izards, où a grandi l’assassin de son fils. Elle a approché des jeunes en train de fumer un joint, leur a demandé qui était Mohamed Merah : «Vous le connaissez pas, madame ? C’est un martyr, un héros !». Cette réponse l’a tuée «une seconde fois», dit-elle.
Mais elle, la musulmane voilée, va faire face, elle va leur dire qui elle est et ces jeunes d’abord méfiant, vont être ébranlés puis vont s’excuser et écouter cette femme leur dire qu’ils sont dans l’erreur et que l’Islam ne leur dit pas d’être violent, de faire du mal.
Puis elle créée l’association, pour faire de la pédagogie aller à la rencontre des parents et des enfants en train de se perdre. Elle sillonne les collèges, les lycées, les prisons, à la rencontre des jeunes.
«Si je peux éviter qu’une mère souffre comme je souffre, dit-elle, si je peux éviter un autre Merah, c’est un bon combat.»
Marie Huret écrit dans Marianne :
« On se dit qu’elle n’était pas préparée à ça, Latifa, la jeune Marocaine de Tétouan arrivée à 18 ans en France pour rejoindre son homme. C’est mal la connaître. Elle s’est toujours battue, a appris le français au centre social, pris le bus, fait du Solex. «Il fallait que je trouve ma liberté», dit-elle. Ses enfants grandissent dans une cité, des tours de 10 étages à Sotteville-lès-Rouen. Le couple achète un pavillon, ici, pas au Maroc. Chez les Ibn Ziaten, on ne dort pas jusqu’à midi, on range sa chambre, on partage le ménage, on fait ses devoirs. Mais on dialogue, on choisit son sport, ses petits amis, ses études. Ses cinq enfants ont reçu une double culture, tous ont un métier, standardiste, prof de sport, chargé de com… Imad était le second. «Mon fils, il faisait mieux les gâteaux que moi, confie Latifa. L’éducation, c’est la base. Ce n’est pas à l’école d’éduquer nos enfants. Le repas se prend en famille. « L’école, ça va ? Les devoirs, ça va ? » C’est ça, le dialogue. J’ai cadré mes enfants, quand j’ai senti qu’ils étaient capables, je les ai laissés trouver leur chemin.»
« Un autre article, dans l’Express qui lui est consacrée se finit par cette réflexion : «A 52 ans, Latifa qui cherchait « un peu de lumière » a trouvé sa voie: tenter d’oublier ses souffrances, les cantines et le musée de Rouen pour prôner la réconciliation universelle. Avec juste cette hantise: « Qu’on se serve de ma douleur comme un label et que je finisse par faire commerce avec ma souffrance ». Lucide jusqu’au bout.
Le monde reste beau, tant qu’il existera des femmes comme Latifa Ibn Ziaten
<322>
Mardi 08/07/2014
Lundi 07/07/2014
Vendredi 04/07/2014
ce que signifie vraiment le mot démagogie.»
Jeudi 03/07/2014
Mercredi 02/07/2014
Le crucifiement est une ancienne méthode d’exécution consistant à placer le supplicié sur une croix, un support en forme de T ou un arbre et à l’attacher par divers moyens (clous, cordes, chaînes, etc.). Il existe plusieurs variantes du supplice que l’on retrouve à différentes périodes (dès l’Antiquité) et dans différentes civilisations.
Plusieurs recherches semblent indiquer que la mort a lieu par asphyxie, du fait de la traction sur les muscles supérieurs qui entraîne une compression du diaphragme.
« Crucifixion » est réservée au supplice du Christ et des œuvres d’art qui décrive ce sujet.
Après le mot et la chose, voici le mot et le sujet.
Souvent pour mot du jour, je connais le sujet mais je dois chercher le mot.
Mot qui éclaire, mot qui explique, mot qui introduit, mot qui provoque.
Comment dénoncer les monstres qui sous le masque de la religion s’adonnent à la cruauté en Irak et en Syrie ?
Voilà un groupe qui fait la guerre, guerre de religion, s’empare d’une ville, sépare les chiites des sunnites et puis massacre tous les chiites.
Cela nous rappelle les méthodes nazies, mais ils vont encore plus loin dans l’horreur. Quand les nazis assassinaient en masse, ils le cachaient. Ils organisaient même des visites de la croix rouge dans des camps « modèles » de nature à tromper la vigilance du monde.
Rien de tel dans ce groupe de fou haineux. A l’instar de l’ONU ou de la Cour des Comptes, <Il publie son rapport annuel> Rapport de 400 pages où ils énumèrent et détaillent leurs exactions, bref ils se vantent de leurs crimes.
On apprend aussi que ce groupe <est très riche, On estime sa fortune à 2, 3 milliards de dollars>
Et pour tout cela nous pouvons continuer à remercier George W Busch qui par son intervention insensée a préparé le terrain pour ces guerres de religion. Il vit tranquillement dans son ranch du Texas où il peint et expose ses peintures…
<317>
Mardi 01/07/2014
Lundi 30/06/2014
|
« Madame quel est votre mot
Et sur le mot et sur la chose
On vous a dit souvent le mot
On vous a fait souvent la chose
Ainsi de la chose et du mot
Vous pouvez dire quelque chose
Et je gagerais que le mot
Vous plaît beaucoup moins que la chose
Pour moi voici quel est mon mot
Et sur le mot et sur la chose
J’avouerai que j’aime le mot
J’avouerai que j’aime la chose
Mais c’est la chose avec le mot
Mais c’est le mot avec la chose
Autrement la chose et le mot
A mes yeux seraient peu de chose
Je crois même en faveur du mot
Pouvoir ajouter quelque chose
Une chose qui donne au mot
Tout l’avantage sur la chose
C’est qu’on peut dire encore le mot
Alors qu’on ne fait plus la chose
Et bien voici mon dernier mot
Et sur le mot et sur la chose
|
Madame passez-moi le mot
Et je vous passerai la chose »
Et pour peu que vaille le mot
Mon Dieu c’est toujours quelque chose
De là je conclus que le mot
Doit être mis avant la chose
Qu’il ne faut ajouter au mot
Qu’autant que l’on peut quelque chose
Et que pour le jour où le mot
Viendra seul hélas sans la chose
Il faut se réserver le mot
Pour se consoler de la chose
Pour vous je crois qu’avec le mot
Vous voyez toujours autre chose
Vous dites si gaiement le mot
Vous méritez si bien la chose
Que pour vous la chose et le mot
Doivent être la même chose
Et vous n’avez pas dit le mot
Qu’on est déjà prêt à la chose
Mais quand je vous dis que le mot
Doit être mis avant la chose
Vous devez me croire à ce mot
Bien peu connaisseur en la chose
|
Vendredi 27/06/2014
Jeudi 26/06/2014
c’est ce peuple qui a réussi à faire croire que
Hitler était allemand et Beethoven autrichien.»
Mercredi 25/06/2014
|
Bref, voici réunis tous les ingrédients d’un nationalisme inquiétant.
Et voici une carte de cette grande Hongrie :
Nous voyons donc que la guerre 14-18 a 100 ans mais que ses conséquences sont toujours actuelles.
|
|
Mardi 24/06/2014
Lundi 23/06/2014
|
|
Vendredi 20/06/2014
Jeudi 19/06/2014
Parce qu’elle présuppose deux capacités qui n’ont aucun rapport intrinsèque.
La première, c’est d’accéder au pouvoir. […]
La deuxième capacité, c’est, une fois qu’on est au pouvoir, d’en faire quelque chose, c’est-à-dire de gouverner. »
Mercredi 18/06/2014
Mardi 17/06/2014
pourvu qu’il fasse ses affaires »
Lundi 16/06/2014
soit la première minute de réinsertion. »
Vendredi 13/06/2014
a un trou de plus de 1 million d’euros dans les caisses ;
que la direction est accusée de tricoter des partenariats douteux avec des multinationales et d’autres entreprises bien peu soucieuses de l’environnement ;
que les salariés de cette association sont traités de manière indigne etc.
Jeudi 12/06/2014
[que pour cette coupe du monde au Brésil]
l’arrogance de la richesse et du marketing
et l’urgence de la pauvreté et du développement»
Mercredi 11/06/2014
Mardi 10/06/2014
arrêtez-vous et pensez à ces hommes »
Vendredi 06/06/2014
cela veut dire que quelque chose ne va pas.»
Jeudi 05/06/2014
parce que sinon
j’empêcherai l’équipe d’avancer »
Mercredi 04/06/2014
Mais il est né bien avant. «
Mardi 03/06/2014
devant lui, dans son assiette,
un ballon de foot a remplacé les aliments »
|
|
Lundi 02/06/2014
Mercredi 28/05/2014
Mardi 27/05/2014
Lundi 26/05/2014
Surtout dans les pays de l’ancien Pacte de Varsovie, plus touchés que nous par les événements en Ukraine. »
Vendredi 23/05/2014
|
Ils étaient usés à quinze ans
Ils finissaient en débutant
Les douze mois s’appelaient décembre
Quelle vie ont eu nos grands-parents
Entre l’absinthe et les grand-messes
Ils étaient vieux avant que d’être
Quinze heures par jour le corps en laisse
Laisse au visage un teint de cendre
Oui, not’ Monsieur oui not’ bon Maître
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
On ne peut pas dire qu’ils furent esclaves
De là à dire qu’ils ont vécu
Lorsque l’on part aussi vaincu
C’est dur de sortir de l’enclave
Et pourtant l’espoir fleurissait
Dans les rêves qui montaient aux yeux
Des quelques ceux qui refusaient
De ramper jusqu’à la vieillesse
Oui not’ bon Maître oui not’ Monsieur
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
|
Si par malheur ils survivaient
C’était pour partir à la guerre
C’était pour finir à la guerre
Aux ordres de quelques sabreurs
Qui exigeaient du bout des lèvres
Qu’ils aillent ouvrir au champ d’horreur
Leurs vingt ans qui n’avaient pu naître
Et ils mouraient à pleine peur
Tout miséreux oui not’ bon Maître
Couvert de prêtres oui not’ Monsieur
Demandez-vous belle jeunesse
Le temps de l’ombre d’un souvenir
Le temps du souffle d’un soupir
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Jacques Brel
<292>
|
Jeudi 22/05/2014
Mercredi 21/05/2014
Mardi 20/05/2014
Lundi 19/05/2014
Vendredi 16/05/2014
Mercredi 14/05/2014
Mardi 13 mai 2014
Enfin un mot du jour qui est un «mot».
Peut-être savez-vous ce qu’il signifie, comme ça vous n’aurez pas à lire la suite.
Mal nommer les choses est ajouté du malheur au monde disait Camus (mot du jour du 22/08/2013). Donc nommons bien les choses : Anthropocène est le nom de l’ère dans laquelle vous et moi vivons.
«Anthropocène» est un terme proposé par Paul Crutzen, chimiste et météorologue néerlandais nobélisé pour ses travaux sur la couche d’ozone.
Il signifie que l’espèce humaine est devenue la principale force géophysique de la Terre, capable de modifier définitivement son environnement.
L’impact de ses activités l’emporte en effet, pour la première fois dans l’histoire de notre planète, sur toutes les autres, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs naturels.
Dans cet anthropocène –du grec anthropos, être humain–, l’homme modifie le climat planétaire ainsi que les grands équilibres de la biosphère, essentiellement par la masse de gaz polluants qu’il produit.
Nous voilà donc passés de l’ère de l’holocène, période géologique d’environ 10.000 ans, stable et relativement chaude, qui suit la dernière ère glaciaire et permet notamment l’agriculture et l’expansion des civilisations, à l’ère de l’anthropocène, qui débute à la fin du XVIIIe siècle avec les prémices de la révolution industrielle.
L’usine remplace alors le travail agricole et artisanal. Le volume de la production industrielle et fumante s’en trouve considérablement augmenté tandis que la révolution des transports tend à raccourcir les distances du marché mondial, bien avant Internet. Suit alors, dans les années 1950, ce que bon nombre de scientifiques appellent la «grande accélération» avec l’avènement de l’actuelle société de consommation au menu désormais bien connu: mondialisation, industrie, pub et tourisme.
Nos colocataires? On s’en fiche!
Bon. A supposer que nous prenions conscience de l’impact de nos faits et gestes industriels sur la nature qui, semble-t-il, n’a rien demandé, cette nouvelle ère à l’équilibre fragile nous expose à un défi majeur. Les premiers effets économiques de notre espèce sur la planète Terre sont loin d’être globalement positifs. Le bilan commence même à s’alourdir sérieusement.
Appauvrissement de la biodiversité, flux d’azote, pollution chimique, charge des aérosols dans l’atmosphère, surconsommation d’eau douce, diminution de la couche d’ozone, flux de phosphore, exploitation de sols, acidification des océans, changement climatique. Autant d’écueils causés par des activités humaines et reconnus par nombre de responsables scientifiques qui n’ont aucun intérêt à jouer les Cassandre (voir à ce sujet le dernier rapport du Giec…).
Si voulez en savoir plus sur ce sujet voici un <Article de Slate sur l’anthropocene>
Pour les plus curieux un matin de France Culture consacré au même thème <Les matins avec comme invité Christophe Bonneuil et Herve Le Treut 2013-11-14>
<285>
Lundi 12/05/2014
la marchandisation de la vie humaine
à l’ère de la bioéconomie.»
Vendredi 09/05/2014
Mercredi 7 mai 2014
sur continuer à croitre, à grandir,
intellectuellement, émotionnellement, spirituellement,
j’ai essayé de continuer à aller de l’avant, là où je pouvais. »
Damien Echols a été accusé par erreur du meurtre de trois enfants aux Etats-Unis, alors qu’il avait 18 ans.
Il a été condamné à mort et a passé 18 ans dans le couloir de la mort.
Aujourd’hui, il raconte son cauchemar dans un livre, « La vie après la mort » (éditions Ring).
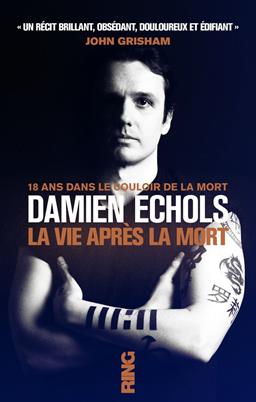 Damien Echols était l’invité de Clara Dupont-Monod, sur France Inter le 27/03/2014 dans son émission de 7h50.
Damien Echols était l’invité de Clara Dupont-Monod, sur France Inter le 27/03/2014 dans son émission de 7h50.
Le mot du jour est la réponse de cet homme à la question de Clara Dupont-Monod :
« Quand on est condamné à mort, est ce qu’on vit chaque jour comme le dernier ? »
Les faits remontent à 1993. Trois enfants de huit ans sont retrouvés sauvagement assassinés à West Memphis, dans l’Etat de l’Arkansas. Très vite, trois jeunes marginaux sont soupçonnés : Jessie Misskelley Jr, Jason Baldwin et Damien Echols.
Au terme d’un procès arbitraire qui accumule faux témoignages et preuves falsifiées, les « Trois de West Memphis », comme on les surnomme alors, sont lourdement condamnés : Misskelley et Baldwin à la prison à perpétuité, Echols à la peine capitale.
Finalement, en 2011, à la faveur d’une longue campagne de soutien (des personnalités comme Johnny Depp y ont participé), la justice accepte de rouvrir le dossier et examine de nouvelles preuves scientifiques. Les trois hommes obtiennent leur libération mais ne sont pas totalement innocentés. Ils restent coupables aux yeux de la justice.
Pour être libéré, il fallait qu’ils ne puissent attaquer l’Etat qui les avait condamné parce que sinon il pouvait réclamer 60 000 000 de dollars de dommages-intérêts. Alors ils ont dû conclure un accord avec la justice qui acceptait de les libérer mais sans reconnaître leur innocence. S’ils avaient voulu faire reconnaître leur innocence ils auraient dû se lancer dans une longue procédure contre l’Etat et continuer à rester en prison pendant ce temps.
Rester concentré sur la vie, continuer à grandir et aller de l’avant partout où c’est possible, quel beau programme !
<282>
Mardi 06/05/2014
Lundi 05/05/2014
Je ne peux pas le faire »
Mercredi 30 avril 2014
|
|
Mardi 29/04/2014
Une petite brise très gentille
Qui, imperceptible, subtile,
Légèrement, doucement,
Commence, commence à murmurer.
[…]
Et le pauvre calomnié,
Humilié, piétiné
Sous le fléau public,
Par grand malheur s’en va crever. »
|
Commence, commence à murmurer.
Piano, piano, terre à terre,
À voix basse, en sifflant,
Elle glisse, elle glisse
Elle rôde, elle rôde
Dans l’oreille des gens
Elle s’introduit, s’introduit adroitement
Et les têtes et les cervelles
Étourdit et fait gonfler.
En sortant de la bouche
Le tapage va croissant,
Il prend force peu à peu,
Vole déjà de lieu en lieu,
Il ressemble au tonnerre, à la tempête
|
Qui au cœur de la forêt
Va sifflant, grondant,
Et vous glace d’horreur.
À la fin elle déborde et éclate, se propage, redouble,
Et produit une explosion
Comme un coup de canon,
Comme un coup de canon,
Un séisme, un orage,
Un tumulte général
Qui fait retentir l’air.
Et le pauvre calomnié,
Humilié, piétiné
Sous le fléau public,
Par grand malheur s’en va crever. »
|
Lundi 28/04/2014
Vendredi 25/04/2014
Jeudi 24/04/2014
on parle de bien-être au travail,
[en France] on évoque la problématique de la souffrance au travail»
Mercredi 23/04/2014
Mardi 22/04/2014
pour stimuler mon imagination. »
Mardi 15 avril 2014
et la gloire qui s’attache à son nom avec cette récurrence de la tentation bonapartiste en France.»
Lionel Jospin a considéré important de publier un livre sur Napoléon ou plutôt « Le mal napoléonien » titre de son livre publié au Seuil.
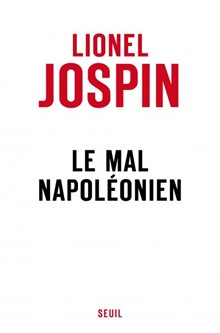 Important, parce que les français croient toujours à l’homme providentiel qui va régler leurs problèmes.
Important, parce que les français croient toujours à l’homme providentiel qui va régler leurs problèmes.
Probablement que dans un coin de vos réflexions et des miennes, il existe aussi cette tentation du « grand homme ».
Et les français sont restés fascinés par ce « grand homme » par excellence qu’était Napoléon.
Et c’est là que l’œil analytique et froid de Lionel Jospin démasque la réalité :
La France après Napoléon est moins puissante qu’avant lui, les élites intellectuelles européennes qui admiraient la France de la révolution, détestaient après lui ce peuple guerrier, arrogant et une France qui voulaient gouverner l’Europe.
Et enfin, pendant que la France faisait la guerre et envoyaient des milliers de ses enfants à la mort, l’Angleterre commençaient la révolution industrielle.
Le retard de la France est rapidement devenu énorme.
Laurent Joffrin interroge Lionel Jospin dans le Nouvel Obs.
Voici un extrait de cet entretien
« Le Nouvel Observateur
Un livre sur Napoléon. Etrange pour un socialiste… Vous avez été fasciné ?
Lionel Jospin
Non, intrigué. Intrigué par le contraste entre le bilan de Napoléon, désastreux, et la gloire qui s’attache à son nom avec cette récurrence de la tentation bonapartiste en France.
Napoléon a effectivement porté au plus haut la gloire française et il a répandu dans toute l’Europe les idées de la Révolution.
Napoléon n’a pas porté les idées de la Révolution, il les a détournées. Je ne sous-estime en rien le personnage. Mais je montre en quoi les quinze années du Consulat et de l’Empire ont été néfastes pour la France et pour l’Europe. Quant à son héritage, il reste quelques grandes institutions mais aussi une certaine nostalgie française de la grandeur factice, associée paradoxalement à un manque de confiance, qui conduit parfois nos compatriotes à soupirer après un pouvoir fort.
Vous avez donc écrit un réquisitoire…
Plutôt une démystification fondée sur les faits.
Quand vous observez la carrière météorique de Napoléon, vous vous apercevez qu’au bout de quinze ans le bilan de l’Empire est catastrophique ; la France sort de l’aventure avec une population stagnante, une puissance abaissée et un territoire amputé. Elle est détestée en Europe. Ses ennemis triomphent. Elle a entre-temps été dirigée par un pouvoir de plus en plus policier, emporté par la logique de la guerre et qui a cherché à dominer les autres peuples comme il a soumis le sien
[…]
Le bonapartisme est-il encore un danger aujourd’hui ?
Disons qu’on retrouve l’écho déformé de ses thèmes dans les partis populistes, en France et en Europe: la critique des «élites», l’appel au chef charismatique comme seul interprète des besoins du peuple. S’y ajoute la peur de l’étranger. Contre ces formes bâtardes du «mal napoléonien», l’antidote doit être une république exemplaire. »
<Article du nouvel Obs> et aussi <Ici l’émission du 03/06 des Matins de France Culture consacrée à ce livre>
<272>
Le mot du jour va de nouveau s’interrompre, au moins jusqu’au Mardi suivant le week end pascal.
Demain je vais à nouveau confier mon corps aux soins des médecins pour qu’ils puissent réparer les dommages qu’il a subis du fait de thérapies précédentes, visant à combattre un mal plus important.
Et si tout va bien je serai en mesure de reprendre rapidement mes activités.
Que les cloches de Pâques, en route vers Rome, illuminent votre weekend.
Lundi 14/04/2014
que la docilité des consommateurs
est sans limite.»
Vendredi 04/04/2014
Jeudi 03/04/2014
Mercredi 02/04/2014
Mardi 01/04/2014
« Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles. »
Vendredi 28 mars 2014
que tout ce qui se trouve au-dessus d’elles
est incapable et indigne de les gouverner »
Discours à la Chambre des députés : 27 janvier 1848
Alexis Tocqueville fut un grand penseur libéral et un des meilleurs observateurs de son temps ainsi qu’un visionnaire.
Il a produit en janvier 1848, il y a 166 ans un discours dont certaines expressions sonnent si actuelles :
 « […] Messieurs, je ne sais si je me trompe, mais il me semble que l’état actuel des choses, l’état actuel de l’opinion, l’état des esprits en France, est de nature à alarmer et à affliger. Pour mon compte, je déclare sincèrement à la Chambre que, pour la première fois depuis quinze ans, j’éprouve une certaine crainte pour l’avenir ; et ce qui me prouve que j’ai raison, c’est que cette impression ne m’est pas particulière : je crois que je puis en appeler à tous ceux qui m’écoutent, et que tous me répondront que, dans les pays qu’ils représentent, une impression analogue subsiste ; qu’un certain malaise, une certaine crainte a envahi les esprits ; que, pour la première fois peut-être depuis seize ans, le sentiment, l’instinct de l’instabilité, ce sentiment précurseur des révolutions, qui souvent les annonce, qui quelquefois les fait naître, que ce sentiment existe à un degré très grave dans le pays. […]
« […] Messieurs, je ne sais si je me trompe, mais il me semble que l’état actuel des choses, l’état actuel de l’opinion, l’état des esprits en France, est de nature à alarmer et à affliger. Pour mon compte, je déclare sincèrement à la Chambre que, pour la première fois depuis quinze ans, j’éprouve une certaine crainte pour l’avenir ; et ce qui me prouve que j’ai raison, c’est que cette impression ne m’est pas particulière : je crois que je puis en appeler à tous ceux qui m’écoutent, et que tous me répondront que, dans les pays qu’ils représentent, une impression analogue subsiste ; qu’un certain malaise, une certaine crainte a envahi les esprits ; que, pour la première fois peut-être depuis seize ans, le sentiment, l’instinct de l’instabilité, ce sentiment précurseur des révolutions, qui souvent les annonce, qui quelquefois les fait naître, que ce sentiment existe à un degré très grave dans le pays. […]
Si je jette, messieurs, un regard attentif sur la classe qui gouverne, sur la classe qui a des droits et sur celle qui est gouvernée, ce qui s’y passe m’effraie et m’inquiète. Et pour parler d’abord de ce que j’ai appelé la classe qui gouverne, et remarquez bien que je ne compose pas cette classe de ce qu’on a appelé improprement de nos jours la classe moyenne mais de tous ceux qui, dans quelque position qu’ils soient, qui usent des droits et s’en servent, prenant ces mots dans l’acception la plus générale, je dis que ce qui existe dans cette classe m’inquiète et m’effraye. Ce que j’y vois, messieurs, je puis l’exprimer par un mot : les mœurs publiques s’y altèrent, elles y sont déjà profondément altérées ; elles s’y altèrent de plus en plus tous les jours ; de plus en plus aux opinions, aux sentiments aux idées communes, succèdent des intérêts particuliers, des visées particulières, des points de vue empruntés à la vie et à l’intérêt privés. […]
Or, qu’est-ce que tout cela, sinon une dégradation successive et profonde, une dépravation de plus en plus complète des mœurs publiques ? Et si, passant de la vie publique à la vie privée, je considère ce qui se passe, si je fais attention à tout ce dont vous avez été témoins, particulièrement depuis un an, à tous ces scandales éclatants, à tous ces crimes, à toutes ces fautes, à tous ces délits, à tous ces vices extraordinaires que chaque circonstance a semblé faire apparaître de toutes parts, que chaque instance judiciaire révèle ; si je fais attention à tout cela, n’ai-je pas lieu d’être effrayé ? N’ai-je pas raison de dire que ce ne sont pas seulement chez nous les mœurs publiques qui s’altèrent, mais que ce sont les mœurs privées qui se dépravent ?
Et remarquez, je ne dis pas ceci à un point de vue de moraliste, je le dis à un point de vue politique ; savez-vous quelle est la cause générale, efficiente, profonde, qui fait que les mœurs privées se dépravent ? C’est que les mœurs publiques s’altèrent. C’est parce que la morale ne règne pas dans les actes principaux de la société, qu’elle ne descend pas dans les moindres. C’est parce que l’intérêt a remplacé dans la vie publique les sentiments désintéressés, que l’intérêt fait la loi dans la vie privée. […]
Messieurs, si le spectacle que nous donnons produit un tel effet vu de loin des confins de l’Europe, que pensez-vous qu’il produit en France même sur ces classes qui n’ont point de droits, et qui, du sein de l’oisiveté à laquelle nos lois les condamnent, nous regardent seuls agir sur le grand théâtre où nous sommes ? Que pensez-vous que soit l’effet que produise sur elles un tel spectacle ? Pour moi, je m’en effraye. On dit qu’il n’y a point de péril, parce qu’il n’y a pas d’émeute ; on dit que, comme il n’y a pas de désordre matériel à la surface de la société, les révolutions sont loin de nous. Messieurs, permettez-moi de vous dire, avec une sincérité complète, que je crois que vous vous trompez. Sans doute, le désordre n’est pas dans les faits, mais il est entré bien profondément dans les esprits. Regardez ce qui se passe au sein de ces classes ouvrières, qui aujourd’hui, je le reconnais, sont tranquilles. Il est vrai qu’elles ne sont pas tourmentées par les passions politiques proprement dites, au même degré où elles ont été tourmentées jadis ; mais ne voyez-vous pas que leurs passions, de politiques, sont devenues sociales ? Ne voyez-vous pas qu’il se répand peu à peu dans leur sein des opinions, des idées, qui ne vont point seulement à renverser telles lois, tel ministère, tel gouvernement, mais la société même, à l’ébranler sur les bases sur lesquelles elles reposent aujourd’hui ? Ne voyez-vous pas que, peu à peu, il se dit dans leur sein que tout ce qui se trouve au-dessus d’elles est incapable et indigne de les gouverner ; que la division des biens faite jusqu’à présent dans le monde est injuste ; que la propriété y repose sur des bases qui ne sont pas des bases équitables ? Et ne croyez-vous pas que, quand de telles opinions prennent racine, quand elles se répandent d’une manière presque générale, quand elles descendent profondément dans les masses, elles amènent tôt ou tard, je ne sais pas quand, je ne sais comment, mais elles amènent tôt ou tard les révolutions les plus redoutables ? Telle est, messieurs, ma conviction profonde ; je crois que nous nous endormons à l’heure qu’il est sur un volcan, j’en suis profondément convaincu. »
Rappelons que la révolution de 1848 a eu lieu du 22 au 25 février.
Ce discours fait partie des grands discours parlementaires que l’Assemblée nationale a mis sur son site.
Vous trouverez l’intégralité de ce discours à cette adresse : http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/alexis-de-tocqueville-27-janvier-1848
<266>
Mercredi 26/03/2014
Mardi 25/03/2014
Vendredi 21/03/2014
Jeudi 20/03/2014
Mercredi 19/03/2014
Mardi 18/03/2014
Lundi 17/03/2014
Vendredi 14 mars 2014
« L’erreur est humaine, persévérer [dans son erreur] est diabolique »»
On retrouve des formes semblables chez des auteurs antérieurs tels :
- Tite Live (Storie, VIII, 35) « Venia dignus est humanus error » (littéralement : « Chaque erreur humaine mérite le pardon ») ;
- Cicéron « Cuiusvis est errare: nullius nisi insipientis, in errore perseverare » (littéralement : « L’erreur est une chose commune ; seul l’ignorant persévère dans l’erreur »).
- Une autre forme assez proche fut publiée par Augustin d’Hipponedans Sermons (164, 14) : « Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere » (littéralement : « Commettre des erreurs est le propre de l’humain, mais il est diabolique de persister dans l’erreur par orgueil »).
Je tire ce moment d’érudition de <wikipedia>
Le mot du jour aurait pu être « Passer par 7 proxy » parce que Xavier Porte cité dans le mot du jour d’hier s’est trompé ou a été abusé.
Il explique cela dans une nouvelle chronique publiée aussi sur <rue89> : Passer par sept proxies » et autres expressions
Xavier de La Porte | France Culture :
« Mercredi, j’ai dit une bêtise.
[…] j’ai évoqué l’intervention d’Edward Snowden à la conférence South By South West à Austin (Texas).
L’ancien employé de la NSA à l’origine du dévoilement du système de surveillance mis en place par les Etats-Unis s’y exprimait en visioconférence depuis la Russie où il s’est réfugié.
Et, pour montrer les précautions prises par le jeune informaticien pour que l’origine de la communication ne soit pas identifiable, j’ai repris l’information donnée par son avocat qui a dit en introduction de la conférence qu’il serait « passé par sept proxies » (« through seven proxies »).
Et tout à fait doctement, je vous ai expliqué que les proxies étaient des intermédiaires entre des machines connectées, intermédiaires permettant l’anonymisation de la communication, et que Snowden était donc passé par sept de ces intermédiaires.
Et voici qu’un peu avant 17 heures Mercredi, le site Arrêt sur Image publie sous les doigts de Vincent Coquaz un petit papier instructif.
Où l’on apprend que « passer par sept proxies » (« trough seven proxies ») est une expression, qui ne signifie pas littéralement qu’on est passé par sept proxies, mais juste qu’on a été très prudent.
Bon, déjà, en soi, c’est assez vexant. Mais ce qui est encore plus vexant, c’est que cette expression est une sorte de blague pour se moquer de ceux qui ne comprennent pas grand-chose aux technologies
et qui vont être très impressionnés par le fait qu’on puisse être passé par sept proxies. Et qu’en plus, c’est une vieille blague. Triplement vexant donc.
Même le Guardian s’est fait avoir…
Toute proportion gardée, c’est un peu comme si je vous avais expliqué en détail comment on fait passer un chameau par le chat d’une aiguille ou que je vous avais décrit précisément la route qu’il faut prendre pour se rendre à Pétaouchnok.
Je ne sais pas s’il faut en être rassuré, mais je n’ai pas été le seul à reprendre littéralement cette blague comme s’il s’agissait d’une information : Le Monde, CNN, Forbes et même le Guardian se sont fait avoir.
Une fois passée la blessure d’orgueil, que dire de cela ?
D’abord que même pour ceux que ça intéresse au quotidien, les cultures numériques conservent leur hermétisme.
C’est encore le papier d’Arrêt sur images qui nous l’apprend, cette expression est née sur 4chan. 4chan, c’est un lieu passionnant.
Une sorte d’énorme forum, entièrement anglophone, entièrement anonyme, où des internautes discutent manga, jeux vidéo, musique, mais aussi sexe et politique
(4chan est un des points de ralliement des Anonymous, ces activistes numériques).
Je vous avouerai que c’est un lieu troublant, pour moi assez exotique. Mais s’y élabore une culture numérique, à la fois en termes de pratiques (le forum, le pseudonymat), mais aussi de représentations (la grande place de la culture japonaise) et de vocabulaire.
Avec des mots, des abréviations, et des expressions donc, qui naissent sur 4chan, s’y développent, et parfois en sortent. C’est manifestement le cas de l’expression « through seven proxies ».
« Ingooglelable », « bugger »…
Mais cette expression n’a manifestement pas encore franchi le cap, elle n’est pas encore entrée dans la langue, comme nombre d’autres mots et d’autres expressions provenant d’Internet. Elle a encore moins franchi cette étape supplémentaire, et signe de notre acculturation au numérique, qui consiste à sortir de la culture numérique pour être utilisée dans d’autres contextes que celui de l’informatique et d’Internet.
Regardez comme on parle couramment de « logiciel » pour désigner un corpus idéologique en politique (la droite doit « changer son logiciel ») ; de plus en plus on reproche à quelqu’un de « troller » une réunion ou une conversation (c’est-à-dire de s’y être comporté comme un troll sur un forum internet, en pourrissant la discussion), on dit aussi de quelqu’un qui se met soudainement à raconter n’importe quoi qu’il « bug ». Et tout le monde voit très bien ce qu’on entend par là.
Il faut se rassurer, ce phénomène n’est pas limité au français. En suédois, quand une personne est discrète au point qu’on a du mal à savoir quelque chose d’elle, on dit qu’elle est « ingooglelable ». En turc, j’aime beaucoup, les jeunes disent qu’ils ont « paramétré quelqu’un » quand ils l’ont remis à sa place, qu’ils lui ont cloué le bec (« paramétrer » quelqu’un sur un réseau social, c’est en gros lui limiter l’accès à une partie de nos contenus). En turc toujours, quand quelqu’un reste sans voix ou tient des propos incompréhensibles, on dit « Error vermek », mélange de turc et d’anglais qui signifie à peu près « il affiche erreur », comme un écran d’ordinateur. »
Bref nous sommes ainsi plus savant et nous ne répéterons pas avec « assurance » une expression qui ne correspond pas à la réalité.
Nous devons ce rectificatif à Vincent, heureux destinataire de ce mot du jour, et qui veillait au grain.
Que le ciel vous tienne en joie et vous éloigne de la persévérance dans l’erreur
<258>
Jeudi 13/03/2014
il vaut mieux être un ingénieur système
qu’un ancien président de la république »
Mercredi 12/03/2014
mine les sociétés d’ordres et de statuts.
[…] la montée en puissance des mécanismes de marché
a sa part dans l’établissement de la démocratie. »
Mardi 11/03/2014
Lundi 10 mars 2014
et forcément si on vous regarde comme ça,
vous devenez un diamant. »
Vendredi 07/03/2014
Cacher nos capacités
Et ne jamais revendiquer le leadership »
Jeudi 06/03/2014
Mercredi 05/03/2014
Mardi 04/03/2014
Voir les flammes devenir des cendres
Et savoir que le mieux à tout prendre
C’est d’être tendre »
Lundi 03/03/2014
Vendredi 28/02/2014
Pour tous ceux qui n’ont pas encore visionné l’entretien de Pierre Rahbi ou pour remémorer l’entretien à ceux qui l’ont vu cet autre mot de sagesse
Jeudi 27/02/2014
Mais vous ne pouvez pas acheter la joie »
Mercredi 26/02/2014
Mardi 25 février 2014
Si la progression permanente, depuis deux décennies, de l’inégalité sociale (une tendance empiriquement prouvée pour les pays industriels),
ne se laisse pas inverser, ce rapport se déchirera.»
Jürgen Habermas est né en le 18 juin 1929 en Allemagne.
 Il est assez unanimement reconnu comme un, sinon comme le philosophe politique le plus important en Europe.
Il est assez unanimement reconnu comme un, sinon comme le philosophe politique le plus important en Europe.
Le « Monde » vient de publier, le 23 février 2014, une tribune de sa part où il invite à re politiser le débat, sinon…pour aller vite « ça va mal finir… ».
Il met beaucoup en cause la politique allemande. La critique venant d’un allemand et même du plus grand intellectuel politique allemand n’en est que plus pertinente.
Lui aussi parle de l’inversion « d’une sorte de courbe » mais d’une autre ampleur que celle de notre Président, il déclare indispensable d’inverser la progression de l’inégalité, autrement dit d’amorcer la diminution des inégalités.
Notion scientifiquement plus explicite que l’inversion d’une courbe qui semble être l’invention d’un technocrate peu à l’aise avec des concepts mathématiques.
Ci-après un extrait de cette tribune que vous trouverez derrière ce lien : < Repolitisons le débat européen, par Jürgen Habermas >.
« Le modèle de société européen déploré par tant de monde repose sur le rapport interne de l’Etat social et de la démocratie. Si la progression permanente, depuis deux décennies, de l’inégalité sociale (une tendance empiriquement prouvée pour les pays industriels), ne se laisse pas inverser, ce rapport se déchirera.
Cette dérive vers une scission de la société se combine d’ailleurs à une tendance alarmante, à une paralysie politique croissante, ainsi qu’à un désintérêt prononcé des électeurs appartenant la plupart du temps aux couches les moins favorisées, c’est-à-dire à l’effritement de la représentation égale de l’électorat et du spectre entier de ses intérêts.
Il n’est nul besoin de partager les prérequis marxistes pour reconnaître dans le déchaînement du capitalisme des marchés financiers l’une des causes décisives de cette évolution – et pour en conclure qu’il nous faut mener à bien une re-régulation du secteur bancaire mondial se donnant toutes les chances de réussir, et avant tout dans un territoire économique ayant au moins le poids et la taille de la zone euro.
Le bon fonctionnement des banques européennes, qui ne peuvent plus investir de façon rentable un capital virtuel hypertrophié, coupé de l’économie réelle, exige justement en premier lieu une solution européenne commune. Et mis à part les sacrifices évidents consentis dans les Etats en crise visés au premier chef par les mesures d’austérité, sacrifices dont nous savons déjà aujourd’hui l’ampleur, ce n’est qu’à la fin de la crise que nous pourrons identifier ses victimes, qui aura payé les pots cassés. Tout cela dépend aussi de la politique que nous choisissons aujourd’hui.
[…]
Je me limite à justifier la nécessité d’un changement politique par trois problèmes urgents, mais jusqu’à présent largement niés. Le gouvernement fédéral allemand a, depuis mai 2010, et de façon tout à fait vigoureuse, fait avant tout valoir la position semi-hégémonique de l’Allemagne en Europe. Il a ainsi généré un effet déflagrant dans la politique intérieure européenne, qu’aucune rhétorique de l’apaisement ne vient juguler. En outre, la gestion de crise a conduit ces dernières années à une extension informelle des compétences du Conseil et de la Commission, qui aggrave de façon spectaculaire l’actuel déficit de légitimation de l’Union européenne, et provoque l’intervention de résistances nationales. Cette politique est véritablement inquiétante en ce qu’elle ne touche pas aux causes de la crise.
Le gouvernement fédéral, en raison de son poids économique et de sa puissance de négociation informelle, a imposé au Conseil européen les idées allemandes visant à surmonter les crises, des idées ordolibérales. Il a contraint les pays en crise à des « réformes » radicales, sans endosser la responsabilité, au niveau européen global, des conséquences plus que sévères de cette politique d’austérité manquant de tout équilibre en matière sociale.
[…]
La division de l’Europe entre pays payeurs et pays bénéficiant de ces paiements incite fortement, dans les vies publiques nationales, aux accusations mutuelles et à la désignation de boucs émissaires. La perception réciproquement déformée de destins inégaux dans la crise jusqu’à l’obscénité a aussi été renforcée en Allemagne par une fausse interprétation des causes de la crise.
Car, la Grèce exceptée, la cause immédiate du surendettement des Etats fut l’évolution de l’endettement privé, et non, comme on le prétend, la politique budgétaire des gouvernements concernés. Mais c’est avant tout la manière de se focaliser sur la problématique des dettes étatiques qui explique le refoulement actif, jusqu’à aujourd’hui, dans la gestion de crise, des problèmes structurels fondamentaux. »
<245>
Lundi 24/02/2014
Les cheveux de ma mère n’ont jamais blanchi.
Pissenlit, si verte est l’Ukraine
Ma mère aux blonds cheveux n’est pas revenue.
Nuage de pluie, menaces-tu au-dessus du puits ?
Ma mère silencieuse pleure pour chacun.
Étoile ronde, tu enroules la boucle d’or
Le cœur de ma mère fut transpercé par le plomb.
Porte en chêne, qui t’a soulevée de tes gonds ?
Ma douce mère ne peut revenir. »
Vendredi 21/02/2014
que le mot Etat n’a plus de sens,
que le mot ville n’a plus de sens, et quand on dit que L’Education Nationale
sert à augmenter l’égalité des chances, nous savons tous que c’est l’inverse qui est vrai »
Jeudi 20/02/2014
Mercredi 19/02/2014
un caractère particulier qui le rend à la fois plus solennel et plus sinistre : la gloire et le crime,
la victoire et la mort semblent entrelacés dans ses refrains.
Il fut le chant du patriotisme, mais il fut aussi l’imprécation de la fureur.
Il conduisit nos soldats à la frontière, mais il accompagna nos victimes à l’échafaud.
Le même fer défend le cœur du pays dans la main du soldat, et égorge les victimes dans la main du bourreau.
Lundi 17/02/2014
Vendredi 14/02/2014
Pour la Saint Valentin, cette chanson de Brassens :
En s’fouttant pas mal du regard oblique
Des passants honnêtes
En s’disant des « Je t’aime » pathétiques
Ont des p’tit’s gueul’ bien sympatiques »
Jeudi 13/02/2014
comme on a moins de temps pour y goûter, il offensera moins;
le bien doit se faire petit à petit afin qu’on le savoure mieux. »
Le Prince chapitre VIII
Mercredi 12/02/2014
Mardi 11/02/2014
Lundi 10/02/2014
Vendredi 07/02/2014
Jeudi 06/02/2014
En réponse au mot du jour d’hier consacré à ces religieux que le doute n’effleure pas.
Mercredi 05/02/2014
Les mystiques
Les saints
Les fascistes
Les soumis
Mardi 04/02/2014
tout est fait pour que plus personne ne voit l’autre. »
Lundi 3 février 2014
Claudio Abbado est mort Lundi 20 janvier 2014
 Très jeune Claudio Abbado a été un chef d’orchestre remarquable et brillant.
Très jeune Claudio Abbado a été un chef d’orchestre remarquable et brillant.
Il a dirigé les plus grandes institutions musicales.
A 35 ans, il devint Directeur de la Scala de Milan, il le restera pendant 18 ans.
Après, il dirigera l’Opéra de Vienne et lorsqu’il fallut trouver un successeur à Herbert von Karajan, les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Berlin le désignèrent à l’unanimité en 1989.
Et puis…
En 2000, un terrible cancer l’assaillit, un cancer de l’estomac.
Il revint au bout de quelques mois, émacié et transfiguré.
Il dit alors : « J’ai souffert et j’ai lutté de toutes mes forces. Mais comme toujours, du mal peut naître quelque chose de bon ».
Il devint alors un chef génial et unique.
 Il quitta l’institution de la Philharmonie de Berlin et recréa avec des musiciens venant de tous les horizons et notamment beaucoup de jeunes, l’Orchestre du Festival de Lucerne, qu’il dirigea tous les étés jusqu’en 2013.
Il quitta l’institution de la Philharmonie de Berlin et recréa avec des musiciens venant de tous les horizons et notamment beaucoup de jeunes, l’Orchestre du Festival de Lucerne, qu’il dirigea tous les étés jusqu’en 2013.
Celui qui n’a pas vu des vidéos de ces concerts, ne connait pas l’émotion que la musique peut déclencher.
Claudio Abbado a alors construit une relation unique avec ces musiciens.
Arte a diffusé le Requiem de Mozart par Abbado et Lucerne interprété en août 2012 et que vous trouvez sur Youtube :
Requiem de Mozart par Abbado Festival de Lucerne 2012
A la fin de cette interprétation bouleversante, le public est resté silencieux pendant presque une minute avant d’applaudir.
Le silence était si intense qu’il était encore musique.
Nos mots sont trop pauvres pour décrire l’indicible et le sublime.
<Ce journal suisse lui rend hommage> et présente sa carrière. L’article se termine par cette conclusion :
[Claudio Abbado] disait que « la culture est un bien commun et primaire comme l’eau » et que « La culture c’est la vie et la vie est belle ». Place au silence.
<230>
Vendredi 31/01/2014
Jeudi 30/01/2014
19 janvier 2014 sur le blog de Paul Jorion
Mercredi 29/01/2014
Quand on vieillit, il faut de l’argent. »
La chatte sur un toit brulant
Acte 1
Mardi 28/01/2014
et que le jeune hésite à naître.»
Membre fondateur du Parti communiste italien.
Lundi 27/01/2014
de lutter contre la précarité
de faire diminuer le chômage
de mettre fin à la stigmatisation de plus pauvres
d’émanciper l’individu en ne l’obligeant plus à travailler.
Vendredi 24/01/2014
http://www.youtube.com/watch?v=lf08i5vqIvQ
J’ai découvert ce moment de beauté ineffable grâce à un Article du Point : http://www.lepoint.fr/environnement/video-l-etonnant-elan-de-tendresse-d-un-chimpanze-rescape-pour-jane-goodall-23-01-2014-1783694_1927.php
C’est peut être l’occasion de faire remarquer, à celles et ceux qui ne l’auraient pas observé,
que ma signature se lit câlin.
<224>
Jeudi 23/01/2014
Les uns qui ne sont pas contents, jusqu’à ce qu’ils aient privatisé le dernier cimetière communal,
et les autres qui ne sont pas contents jusqu’à ce qu’on ait un règlement européen pour les enterrements.»
dans l’émission Tous Politique de France Inter du 12/01/2014
Mercredi 22/01/2014
Au milieu des évènements historiques, le livre est une histoire d’amour compliquée entre Tereza qui est jalouse et son mari libertin.
Mardi 21/01/2014
http://www.liberation.fr/medias/2001/07/05/le-monument-chaban_370424
Lundi 20/01/2014
et d’autres invités prestigieux de la fondation gorbatchev
fin septembre 1995
Hôtel Fairmont de San Francisco
Lundi 13/01/2014
Vendredi 10/01/2014
Jeudi 09/01/2014
Mercredi 08/01/2014
Pour continuer cette belle semaine de la pensée positive, je vous propose cette question posée par le texte de Michel Serres lors d’une conférence qu’il a tenu en 2007, lors d’une conférence sur les nouvelles technologies : révolution culturelle et cognitive.
Lors de cette conférence il analyse la révolution numérique et montre que nous perdons peu à peu notre mémoire qui est externalisée dans la mémoire informatique.
Pour analyser ce phénomène il montre les grandes évolutions de l’humanité :
1° Le passage du stade oral au stade de l’écriture
2° Le passage de l’écriture à l’imprimerie
3° et aujourd’hui le passage du livre au monde numérique
Chaque fois des humains et parmi les plus grands (Socrate pensait que passer de l’oral à l’écrit était une catastrophe) ont pensé qu’ils perdaient quelque chose d’essentiel.
Mais Michel Serres renverse cette question et se demande si nous avons perdu quelque chose, n’avons-nous pas gagné quelque chose?
Penser à ce qu’on gagne lorsqu’on perd, n’est-ce pas le summum de la pensée positive ?
Je vous en propose un extrait ci-dessous, pour vous permettre de percevoir la profondeur de cette question :
«Cette perte de la mémoire n’a rien à voir avec la catastrophe de la Renaissance où l’invention de l’imprimerie a totalement fait perdre la mémoire à ses contemporains. Nous en avons des preuves manifestes dans le texte de Montaigne où il affirme qu’il préfère « une tête bien faite à une tête bien pleine ». Il veut simplement dire qu’un historien de cette époque qui veut travailler sur sa discipline est contraint de savoir par cœur la totalité de la bibliothèque puisque celle-ci n’est pas accessible ailleurs que dans quelques bibliothèques dans le monde. Avec l’arrivée de l’imprimerie, il suffit de connaître l’endroit où se trouve le livre. C’est une catastrophe pour la mémoire. Par conséquence, avec la mise à disposition aujourd’hui de la totalité de l’information sur la toile, nous n’avons plus besoin de mémoire et nous n’en avons d’ailleurs plus. Comment se fait-il qu’une faculté, dont on nous a dit qu’elle était essentielle au cerveau humain, a une histoire telle que nous pouvons en mesurer la disparition ?
Nous devons analyser le mot « perdre » pour essayer de comprendre ce que signifie cette perte de mémoire et pour réaliser ce que nous avons gagné.
Pour expliquer la différence entre perdre et gagner du point de vue cognitif, j’en appellerais volontiers à ce qu’un de mes vieux professeurs de préhistoire racontait sur ce que veut dire « perdre ». Il disait que nous étions des quadrupèdes avant qu’un événement, qui a duré des millénaires, ne fasse perdre la fonction de portage à nos membres antérieurs. Nous avons alors inventé la main et avons gagné un outil universel.
Dans le même temps, la bouche a complètement perdu sa fonction de préhension au profit de la main. La bouche est donc à son tour devenue un outil universel par le biais de la parole. Les fonctions données que nous avons perdues nous ont donc permis de gagner des outils universels […] Si nous avons perdu la mémoire, voyons ce que nous avons gagné.
En revenant sur l’histoire, nous pouvons nous apercevoir que c’est précisément parce que nous avons perdu la mémoire que nous avons pu inventer à la Renaissance les sciences physiques. La perte de mémoire nous a libérés de l’écrasante obligation de « se souvenir » et a permis aux neurones de se consacrer à des activités nouvelles.
Voilà la différence qui peut exister entre perdre et gagner : perdre dans le domaine du reconnaissable pour gagner dans l’ordre inventif, indéfini, c’est-à-dire dans l’ordre humain. Si j’ai défini « perdre » par rapport à « gagner », le verbe « perdre » prend un tout autre sens dans la langue française. […]
Chaque fois que nous inventons un outil, l’organisme perd les fonctions qu’il externalise dans l’outil. Pour inventer la roue par exemple, il suffit d’externaliser la rotation de nos articulations. […]
L’écriture et l’imprimerie étaient des mémoires et aujourd’hui vous disposez de mémoires supérieures à celles de vos prédécesseurs. En effet, nous avons perdu la mémoire subjectivement, mais elle s’est externalisée objectivement. […]
Le support écrit a transformé la civilisation de telle sorte que nous avons complètement oublié le stade oral. Le support imprimé a complètement changé la civilisation telle qu’elle était avant. Je crains fort que nous soyons à un changement de culture tel que notre manière de connaître et de savoir tout entière, donc le cognitif en général, est sur le point de changer. […] »
Et puis, il finit par une histoire qu’il cite souvent, celle de Saint Denis :
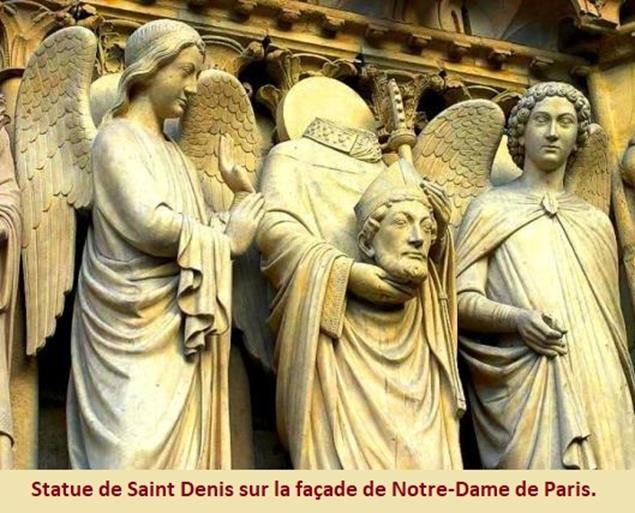 « Pour finir, je souhaiterais parler de toutes les facultés en général. Il était une fois une ville appelée Lutèce, au IIème siècle après Jésus-Christ. L’empereur romain d’alors décréta que les premiers chrétiens seraient persécutés, et exécutés, sur toute la surface de l’Empire. Or le christianisme apparaît à Lutèce dès le Ier siècle et, un soir, les premiers chrétiens, qui venaient d’élire un évêque du nom de Denis, se rassemblent dans une salle. Ils s’y barricadent dans le cas terrifiant où la légion romaine les interpellerait et les jetterait en prison. Alors qu’ils écoutent pieusement les entretiens de leur évêque Denis, le drame se produit. Les portes et les fenêtres volent en éclat, la légion romaine pénètre la salle et le centurion, qui est monté sur l’estrade, coupe le cou à l’évêque Denis dont la tête roule par terre. Stupéfaction, épouvante et angoisse, mais miracle. L’évêque Denis se penche, prend sa tête à deux mains et la présente à ses ouailles pendant que les légionnaires épouvantés s’enfuient devant ce que nous appelons depuis le miracle de Saint-Denis.
« Pour finir, je souhaiterais parler de toutes les facultés en général. Il était une fois une ville appelée Lutèce, au IIème siècle après Jésus-Christ. L’empereur romain d’alors décréta que les premiers chrétiens seraient persécutés, et exécutés, sur toute la surface de l’Empire. Or le christianisme apparaît à Lutèce dès le Ier siècle et, un soir, les premiers chrétiens, qui venaient d’élire un évêque du nom de Denis, se rassemblent dans une salle. Ils s’y barricadent dans le cas terrifiant où la légion romaine les interpellerait et les jetterait en prison. Alors qu’ils écoutent pieusement les entretiens de leur évêque Denis, le drame se produit. Les portes et les fenêtres volent en éclat, la légion romaine pénètre la salle et le centurion, qui est monté sur l’estrade, coupe le cou à l’évêque Denis dont la tête roule par terre. Stupéfaction, épouvante et angoisse, mais miracle. L’évêque Denis se penche, prend sa tête à deux mains et la présente à ses ouailles pendant que les légionnaires épouvantés s’enfuient devant ce que nous appelons depuis le miracle de Saint-Denis.
Voilà l’histoire par laquelle je voulais terminer. Lorsque, le matin, vous vous asseyez devant votre ordinateur, vous avez en face de vous votre tête, comme celle de Saint Denis. En effet, les facultés dont je viens de vous parler se trouvent dans votre tête : la mémoire, l’imagination, la raison, des milliers de logiciels pour accomplir des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête. Or votre tête est objectivée ; vous avez perdu la tête.
Pour parodier le titre du roman de Musil, j’appellerais volontiers l’homme moderne « l’homme sans faculté ». Vous avez perdu ces facultés, mais elles se trouvent toutes devant vous. »
Pour en savoir davantage sur cette légende vous pouvez consulter <ce blog>
Et tenter d’être heureux comme le souhaitait John Lennon
<216>
Mardi 07/01/2014
Lundi 06/01/2014
Ils en sont encore aux tout premiers chapitres d’une longue et fabuleuse épopée
dont ils seront, non pas les rouages muets, mais au contraire, les inévitables auteurs.»
Vendredi 03/01/2014
c’est que Monsieur Madoff est en prison, à part ça ils font la même chose (…) »
Mardi 31/12/2013
Sa vie a plus tard été assombrie par sa condamnation pour homosexualité,
condamnation que nous considérerions aujourd’hui comme injuste et discriminatoire, et qui est désormais annulée.»
La reine d’Angleterre a accordé, enfin, le 24 décembre, une grâce posthume à Alan Turing, 59 ans après sa mort.
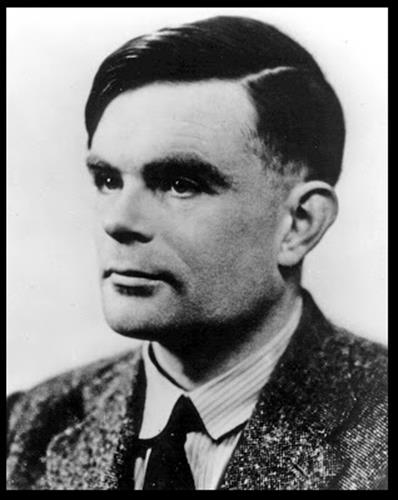 Alan Turing est resté dans l’histoire comme l’homme qui a mis au point la machine électromécanique ayant servi à « casser » le code « Enigma » utilisé par les sous-marins allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alan Turing est resté dans l’histoire comme l’homme qui a mis au point la machine électromécanique ayant servi à « casser » le code « Enigma » utilisé par les sous-marins allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cette invention avait donné un avantage considérable aux Alliés face à l’Allemagne nazie.
Certains considèrent même que Turing est le père de l’informatique moderne parce qu’il est parvenu à définir les critères de l’intelligence artificielle <Voir sur ce point l’article de l’express>
Malgré son apport immense à la victoire des alliés, il a été condamné pour homosexualité. Il a été contraint à subir une castration chimique en 1952.
2 Ans plus tard, il se suicida en mangeant une pomme trempée dans le cyanure. Il semble que c’était par référence à l’Histoire de Blanche Neige qu’il aimait beaucoup.
Il avait 41 ans.
Un long moment de silence et d’ignorance du grand public sur le rôle de cet homme dans la guerre et dans la science s’en suivit.
Mais des scientifiques britanniques dont Stephan Hawking se sont mobilisés pour le faire connaître et obtenir une réhabilitation de la part du gouvernement britannique.
En 2009, celui qui était alors Premier ministre du Royaume-Uni, Gordon Brown, avait présenté publiquement les excuses du gouvernement pour le « traitement écœurant » qui avait été réservé à Alan Turing.
Cette Histoire doit nous rappeler qu’aujourd’hui encore dans le monde beaucoup de pays traitent de manière ignoble les personnes qui vivent des amours homosexuels.
La répression est le fait de pays théocratiques, d’Etats totalitaires ou même d’exactions privées non condamnées par la Justice.
Ainsi, les actes homosexuels sont passibles de peine de mort dans sept pays de nos jours :
- Afghanistan,
- Arabie saoudite,
- Iran,
- Nigeria,
- Mauritanie,
- Soudan
- Yémen.
Ces législations sont effectivement appliquées. Ils sont aussi condamnés par des châtiments physiques, ainsi que des peines d’emprisonnements dans plus de 27 pays par le monde. L’homosexualité est illégale dans plus de 100 pays dans le monde, et les homosexuels s’exposent à des procès systématiques (source Wikipedia)
Lors du débat sur le mariage pour tous, des relents d’homophobie sont réapparus en France.
Rappelons quand même que ce n’est que Le 4 août 1982 que la France dépénalisait l’homosexualité lors d’un vote de l’Assemblée Nationale obtenue par Robert Badinter sous la présidence de François Mitterrand.
Et ce n’est qu’en 1990 que l’Organisation mondiale de la santé a supprimé l’homosexualité de la liste des maladies mentales, mettant fin à plus d’un siècle d’homophobie médicale.
<Voici un article du Figaro qui évoque aussi la grâce au mathématicien Alan Turing>
A bientôt en 2014
<212>
Lundi 30/12/2013
Alors qu’en Occident, le christianisme est à ce moment de l’année à l’heure des fêtes de fin d’année :
fondateur de la Communauté Sant’Egidio
La première est le radicalisme religieux, en bonne partie de groupes islamistes qui veulent vider leur pays de la présence chrétienne, mais aussi d’autres radicalismes anti-chrétiens, hindouistes et bouddhistes. Il y a aussi, tient à souligner John Allen, dans cette catégorie les chrétiens attaqués et tués par d’autres chrétiens, comme certains évangélistes américains par des traditionalistes catholiques au Mexique.
Un autre type de persécutions provient des systèmes totalitaires qui les voient comme des éléments idéologiquement non conformes, de la Corée du Nord à l’Erythrée. Ainsi des dizaines de milliers de chrétiens sont encore internés en Corée du Nord, mais aussi dans des containers en plein soleil en Erythrée, note l’expert.
Le troisième groupe de persécuteurs est formé d’intérêts économiques, de guérillas, de groupes criminels (narcos notamment) et de groupes paramilitaires, que les positions de justice sociale des Eglises dérangent.
Vendredi 27 décembre 2013
Le mot du jour du 27 décembre parle naturellement du cadeau de Noël, grâce à un ouvrage d’une sociologue consacré à ce sujet et dont le titre est le mot du jour.
Comme toute tradition, Noël fait partie des événements qui « vont de soi » : si l’on fête Noël cette année, c’est parce que nous l’avons fêté l’année dernière et parce qu’il sera fêté l’an prochain.
Theodore Caplow écrivait ainsi de la fête de Noël :
« Tout ethnographe qui découvrirait un rituel si important dans quelque culture exotique pourrait être tenté d’en faire la pièce maîtresse de sa description de la culture. ».
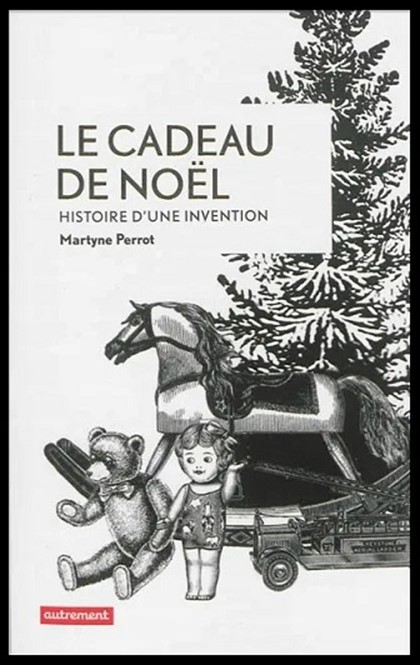 Dans cet ouvrage, on découvre l’émergence progressive de la version moderne de la fête de Noël à partir du XIXe siècle.
Dans cet ouvrage, on découvre l’émergence progressive de la version moderne de la fête de Noël à partir du XIXe siècle.
Martyne Perrot écrit :
« Le cadeau de Noël « s’invente » au milieu du xixe siècle. Il prend corps à cette période précise où l’industrie naissante laisse les enfants pauvres dans les rues et confine les plus riches dans des appartements cossus, truffés d’objets et boursouflés de tentures. Récente, en apparence, cette histoire s’enracine pourtant dans un récit très ancien. Celui de la période royale de la Rome antique. C’est là que s’origine le mot d’« étrennes », les strenae en latin, cette fête du Nouvel An, qui se déroulait aux calendes de janvier, en lien avec la déesse de la santé : Strenia. Au milieu du xixe siècle, ce vieux terme d’« étrennes » est omniprésent ; il cohabite avec celui de « cadeaux de Noël », avant que la suprématie de ces derniers ne s’impose dès la fin du siècle. Mais leur histoire recèle des étonnements bien plus grands. Car ils ont, en leur tréfonds, une particularité peu commune dans le monde des objets : ils tombent du ciel ! Et cette origine surnaturelle est d’importance. Elle renvoie à un monde légendaire, celui où, dans ce qui est aussi la dangereuse période du solstice LEVER DE RIDEAU 7 d’hiver, les enfants étaient menacés symboliquement, comme l’attestent le folklore et les croyances populaires. Tapi dans la grande nuit occidentale, le danger était parfois incarné par les donateurs eux-mêmes, dont la longue cohorte prend naissance dans la mythologie européenne et l’histoire de quelques saints chrétiens. Puis vint l’âge du Père Noël, le distributeur jovial, généreux et inconditionnel que l’on connaît aujourd’hui, et dont la physionomie est demeurée inchangée depuis les années 1950. Fait remarquable, la dimension magique et parfois inquiétante de ces cadeaux n’a pas découragé « les nouvelles cathédrales du commerce » que sont les grands magasins. Bien au contraire. Dès leur création au milieu du xixe siècle, en Angleterre, en Allemagne, en France et en Amérique du Nord, ils en ont fait un argument de vente, accordant subtilement sentimentalisme et consommation. »
L’éditeur présente l’ouvrage ainsi :
« Dès la Rome antique, les hommes célébraient Strenia, déesse de la santé. Cette fête, accompagnée de dons alimentaires, symbolisait l’abondance au cœur de l’hiver.
Voilà d’où viennent nos étrennes et l’orange de nos grands-parents !
Au fil des siècles, les cadeaux de Noël, récompenses des enfants sages, se parent de magie : ne tombent-ils pas du ciel ? Vers le milieu du XIX e siècle, ils « s’inventent » dans leur forme actuelle. C’est l’avènement des grands magasins, la naissance du père Noël et d’une tradition devenue sacrée : la fête familiale. »
D’une part, la fête de Noël passe de l’espace public à l’espace privé à mesure que les pratiques bourgeoises gagnent en visibilité et deviennent une source d’inspiration des pratiques sociales.
Ce passage du public au privé fait de Noël une fête de famille centrée de plus en plus sur l’enfant compris comme un individu en soi, avec ses particularités de comportement (dont son imaginaire ludique).
À cette occasion, le cadeau de Noël prend au fil du temps la place des « étrennes » offertes anciennement aux subalternes pour le Nouvel An.
Quant aux produits offerts, ils évoluent à mesure que s’inventent les grands magasins, hérauts des pratiques bourgeoises.
Leur touche finale fut de proposer l’emballage cadeau qui constitue de nos jours la norme pour la cérémonie des cadeaux lors d’une fête de Noël occidentale.
Et Martyne Perrot cite les Misérables de Victor Hugo :
« Dès le début du mois de décembre, sur les boulevards parisiens comme dans les villages alentour, on voyait aussi fleurir des petits étals, des baraques en plein vent, celles-là mêmes que le Jean Valjean de Victor Hugo découvre, à son grand étonnement, derrière l’église de Montfermeil, situé à quinze kilomètres à l’est de la capitale :
« Ils atteignirent le village ; Cosette guida l’étranger dans les rues. Ils passèrent devant la boulangerie, mais Cosette ne songea pas au pain qu’elle devait rapporter. […]
Quand ils eurent laissé l’église derrière eux, l’homme, voyant toutes ces boutiques en plein vent, demanda à Cosette :
– C’est donc la foire ici ?
– Non, monsieur, c’est Noël ! »
En 1862, lorsque Hugo publie Les Misérables, les réclames pour les étrennes sont monnaie courante. La plupart des almanachs et des journaux affichent les leurs en décembre. Écrit vingt ans plus tôt (entre 1843 et 1847), le roman, à travers cette scène d’anthologie, évoque pourtant déjà Noël. C’est derrière la vitrine d’une de ces bimbeloteries, on s’en souvient, que Cosette découvre, sur le chemin du retour, « la merveilleuse poupée à laquelle elle ne put s’empêcher de jeter un regard ».
D’autre part, dans ce mouvement de transformation, au croisement des évolutions de la bourgeoisie et du commerce, se configurent dans le même temps les symboles du Noël occidental moderne.
 La pratique du sapin de Noël s’étend à partir de la tradition allemande qui gagne en visibilité par les pratiques de cour, puis par leur usage croissant dans les vitrines inventées par les grands magasins.
La pratique du sapin de Noël s’étend à partir de la tradition allemande qui gagne en visibilité par les pratiques de cour, puis par leur usage croissant dans les vitrines inventées par les grands magasins.
Quant au Père Noël, sa généalogie est chaotique. En Europe, il apparaît épisodiquement au Moyen-Âge parmi d’autres personnages colporteurs de cadeaux (comme les « saints et les personnages bibliques, les fées et sorcières, et les vieillards »).
Son pendant le plus net est alors Saint-Nicolas, personnage ambigu pouvant aussi bien ressusciter les enfants qu’être le « Nicolas à la fourrure » (Pelzenickel), autre nom du Père Fouettard, qui utilise son sac pour capturer les enfants. La période de la Réforme luthérienne, en abolissant le culte des saints au XVIe constitue une date importante en déplaçant la fête des enfants du 6 décembre au 25 décembre, jour de la Noël où c’est le Christkindl (l’enfant Christ) qui devient le dispensateur des cadeaux.
Différentes traditions coexistent alors selon les traditions religieuses, catholiques ou protestantes, et selon les régions.
Aux Etats-Unis, où Noël correspondait au calendrier anglican, la figure du Saint Nicolas prend une valeur révolutionnaire.
C’est au début du XIXe siècle que les personnages du Bonhomme Noël et du Saint Nicolas commencent à converge, et parce que les Etats américains officialisent la célébration de la Saint Nicolas le jour de Noël à partir de 1836.
De ces influences éparses naît alors progressivement la figure du Père Noël sous sa forme contemporaine qui se diffuse en Europe occidentale tout au long du XIXe et du XXe siècle.
Enfin, la célébration du Noël occidental moderne s’accompagne de tout un ensemble de règles sociales émergeant progressivement.
Comme la fête est d’abord issue de la bourgeoisie et se fonde sur la privatisation de la célébration, une des valeurs l’accompagnant devient la charité faite aux pauvres (et aux inférieurs en général).
Les ouvrages destinés à la jeunesse bourgeoise utilisent la nuit de Noël comme un événement où l’enfant découvre les inégalités sociales, la compassion pour l’inférieur, mais aussi la nécessaire distance sociale (car jamais n’est offert à l’enfant pauvre des cadeaux hors de portée ou inutiles).
Dans le même temps, les cadeaux et la cérémonie de leur remise, autrefois mérités, deviennent progressivement un dû et même un droit de l’enfant.
Se développent tout au long des deux siècles les cadeaux typiques de la petite fille et du petit garçon aussi bien dans les catalogues publicitaires que dans les pratiques.
Quant aux adultes, ils ne sont pas en reste (avec notamment les cadeaux pour l’époux ou pour l’épouse), même si les règles de don et de contre-don fonctionnent sur un registre différent de celui des enfants (tandis que le cadeau aux enfants se fait sans contrepartie, la « règle de réciprocité » observée par Caplow laisse penser que tout cadeau entre adultes doit se faire dans les deux sens pour correspondre aux attentes des deux parties).
Et voici comment on peut intellectualiser autour du cadeau de noël qui fascine les uns et exaspère les autres.
Je fais partie de la seconde catégorie.
Ici l’article de Slate duquel j’ai extrait certains de ces commentaires : http://www.slate.fr/tribune/80741/jouets-noel
<210>
Vendredi 20 décembre 2013
Ces propos ont été tenus par Jean-Luc Hees lors des cérémonies des 50 ans de radio France.
Vous trouverez cette réponse sur une vidéo en bas de la page d’agora vox que je vous envoie. Sur cette page vous lirez aussi, avec perplexité (?), ce propos de notre président :
« Je préfère ne pas trancher »
Cela aurait pu être un mot du jour, mais la phrase aurait été sortie de son contexte. Dans le fond elle est probablement juste, mais dans la forme, le procédé eut été malhonnête. Je ne souhaite pas que le mot du jour soit malhonnête.
Mais revenons au mot du jour
« faire découvrir quelque chose qu’ils ne savaient pas vouloir », voilà la mission du service public. C’est une politique de l’offre pour élever l’esprit.
Et non une politique de la demande pour consommer, pour laisser du temps de cerveau disponible pour accueillir la publicité de coca cola et toutes ces autres émissions de l’apparence, du superficiel, de la vacuité…
Découvrir quelque chose que je ne savais pas vouloir, voilà un beau défi.
Le lien promis : http://www.agoravox.fr/actualites/medias/article/francois-hollande-aux-50-ans-de-la-145279#forum3900165
Ajout :
Ce lien ne fonctionne plus. Agora Vox a publié une autre page consacrée à cet évènement <ICI>. Malheureusement, cette page ne fait plus mention à la phrase de Jean-Luc Hees.
<209>
Mercredi 18/12/2013
– L’avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. »
Mardi 17/12/2013
Lundi 16/12/2013
Mercredi 11/12/2013
Lundi 09/12/2013
une haute colline, tout ce qu’on découvre, c’est qu’il
reste beaucoup d’autres collines à gravir. »
Vendredi 6 décembre 2013
Un des derniers mots du jour reprenait une fameuse réplique des tontons flingueurs : «les cons ça osent tout…»
Grâce à Denis Moreau, professeur de philosophie à l’université de Nantes, nous savons maintenant que Michel Audiard a copié Saint Thomas d’Aquin, l’un des Pères de l’église catholique qui avait écrit :
« Tous les imbéciles, et ceux qui ne se servent pas de leur discernement, ont toutes les audaces. »
Le texte est en latin :
« Omnes stulti, et deliberatione non utentes, omnia tentant »
Nous passons ainsi du comique de cinéma à la culture la plus profonde de notre civilisation chrétienne.
Cette découverte a été publiée par le sérieux journal économique des Echos. <Lien>
L’auteur de l’article, le philosophe Roger-Pol Droit ajoute :
«Faire preuve d’audace, c’est toujours se tenir entre confiance et prise de risque. Une décision assurée de réussir à 100 % n’a rien d’audacieux. En revanche, agir dans des circonstances où l’échec est pratiquement certain n’est plus de l’audace mais de la témérité imbécile, voire de la connerie pure et simple. C’est pourquoi le vocabulaire des Grecs possédait deux termes pour parler de l’audace. L’un (« tolmos ») désignait la bonne audace, celle qui fournit un tremplin à l’action, sans verser dans l’excès de témérité, l’absence de calcul ni l’obstination néfaste. Au contraire, « tharsos » parlait surtout de l’audace effrénée, excessive, proche de ce que les Anciens nommaient « hubris », la démesure aveugle.
Oser revient ainsi à prendre, sur le cours des événements à venir, un risque calculé. Ce calcul s’avère indispensable, sinon la décision est absurde, l’action fait preuve d’inconscience, d’imprudence ou de folie. Toutefois, on ne saurait tout calculer ni tout prévoir, le pari est lui aussi indispensable, et la part de risque irréductible. C’est en ce sens que Kierkegaard parle d’une « folie de la décision » : elle crée, au moins en partie, un avenir qui n’existe pas. La « délibération » dont parle Thomas d’Aquin, c’est bien le discernement, la recherche prudente des chances de réussir, l’examen du rapport de force, des aléas, des conséquences. Cette audace réfléchie, les imbéciles en sont dépourvus. Voilà pourquoi ils osent tout.»
Que le ciel vous tienne en joie comme dirait Philippe Meyer
<203>
Jeudi 5 décembre 2013
Après quelques jours passés loin de mon bureau, je vous propose un mot du jour qui raconte une belle et un peu longue histoire.
Cette réflexion, je l’ai entendue dans l’émission de France Culture : «Le monde selon Etienne Klein».
Etienne Klein est un grand scientifique mais surtout un génial pédagogue, c’est à dire quelqu’un qui arrive à rendre simple ce qui est compliqué.
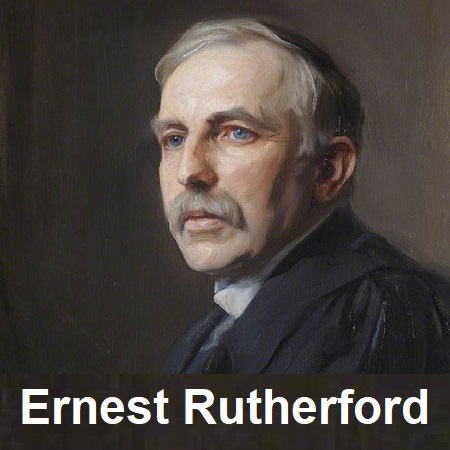 Un jour Ernest Rutherford, prix Nobel de chimie en 1908, reçut la visite d’un de ses confrères accompagné d’un de ses étudiants ; Ils voulaient faire appel à lui pour un arbitrage entre eux.
Un jour Ernest Rutherford, prix Nobel de chimie en 1908, reçut la visite d’un de ses confrères accompagné d’un de ses étudiants ; Ils voulaient faire appel à lui pour un arbitrage entre eux.
En effet, l’étudiant avait donné une réponse à une question du professeur qui lui avait donné 0, alors que l’étudiant prétendait mériter 20. Ils avaient conclu tous deux que leur différent n’était pas simple et méritait l’arbitrage du scientifique le plus renommé de leur université.
Le problème posé était le suivant : «Vous disposez d’un baromètre et vous devez mesurer la hauteur d’un immeuble, comment procédez-vous ? »
La réponse attendue était : «A l’aide du baromètre, je mesure la pression atmosphérique en haut de l’immeuble, puis je mesure la pression au niveau du sol. Puis avec un savant calcul je détermine la hauteur de l’immeuble en fonction de la différence de pression.»
L’étudiant avait répondu :
«J’attache le baromètre à une grande corde. Je monte sur le toit de l’immeuble et je laisse descendre le baromètre à l’aide de la corde jusqu’au sol. Arrivé au sol je fais une marque sur la corde puis je remonte la corde et je mesure du baromètre jusqu’à la marque, c’est la hauteur de l’immeuble.»
Le professeur a donné 0, parce qu’il prétendait que ce n’était pas une méthode scientifique. Ce que contestait l’étudiant qui rappelait qu’en outre il trouvait bien le résultat souhaité et qu’il avait utilisé le baromètre, la corde seule ne suffisant pas !
L’arbitrage de Rutherford a alors consisté à donner une seconde chance à l’étudiant et de lui demander s’il connaissait une autre méthode pour trouver la solution. L’étudiant s’exécuta et donna une dizaine d’autres solutions, mais jamais la solution attendue.
Etienne Klein présenta 3 de ces solutions :
1) On monte sur l’immeuble, on lâche le baromètre. On chronomètre la durée de la chute, on en déduit la longueur de la chute qui est la hauteur de l’immeuble.
2) On place le baromètre verticalement dehors quand il y a du soleil. On mesure la hauteur du baromètre, la longueur de son ombre et la longueur de l’ombre de l’immeuble. Et avec un simple calcul de proportion, on détermine la hauteur de l’immeuble.
3) Et celle qui a le préférence d’Etienne Klein, parce qu’elle est la plus rapide : on frappe à la porte du gardien de l’immeuble et on lui dit : «Monsieur, si vous me donnez la hauteur de votre immeuble je vous donne ce baromètre»
 Interloqué, Rutherford demanda alors à l’étudiant : «Mais dites-moi, connaissez-vous la réponse attendue par votre professeur ? »
Interloqué, Rutherford demanda alors à l’étudiant : «Mais dites-moi, connaissez-vous la réponse attendue par votre professeur ? »
L’étudiant répondit qu’il la connaissait bien sûr, mais qu’il en avez assez de l’université et de ses professeurs qui prétendait qu’il n’y avait qu’une bonne façon de réfléchir.
Cet étudiant s’appelait Niels Bohr, génie scientifique qui continua l’œuvre de Rutherford et arriva à comprendre le fonctionnement de l’atome ce que Rutherford n’avait compris que partiellement. Il fut lauréat du prix Nobel de physique de 1922.
L’émission d’Etienne Klein en dit beaucoup plus sur ce sujet : il a donné pour titre de son émission «L’atome et le baromètre.» .
<202>
Lundi 28 novembre 2013
En hommage au réalisateur de l’inoubliable film « les tontons flingueurs », Georges Lautner qui nous a quitté le 2 novembre, cette réplique si drôle et si juste.
<201>
Mardi 26/11/2013
|
|
Lundi 25/11/2013
Vendredi 22/11/2013
Jeudi 21/11/2013
Mercredi 20 novembre 2013
Mardi 19 novembre 2013
Lundi 18 novembre 2013
je n’aurai pas assez de mains,
de toile et de couleurs pour
peindre ce que je vois de beau. »
Jeudi 14 novembre 2013
Qui sait ce qui va suivre ? »
Mercredi 13 novembre 2013
Pas d’anticipation sur le vieillissement massif de la population européenne ;
Une faible ouverture du marché de travail rémunérateur aux jeunes ;
le fantasme d’une économie sans usine et sans industrie, c’est à dire d’une économie de service alors que les services sont peu rémunérateurs ;
un appel massif aux emprunts et en plus aux emprunts extérieurs à la nation, emprunts aux marchés financiers.
Mardi 12 novembre 2013
essayer la routine,
c’est mortelle. »
Jeudi 07 novembre 2013
elle se traduit par un plus une.
Elle ramène chacun d’entre nous à la fois à sa singularité et à son intégrité.
Mercredi 06 novembre 2013
Mardi 05 novembre 2013
Ce propos a été tenu par Daniel Cohn Bendit lors de son émission sur Europe 1 du 04/11/2013.
Il parle de José Mujica Cordano, surnommé « Pepe Mujica » qui est né à Montevideo le 20 mai 1935 et a été élu président le 29 novembre 2009.
Ex-guérillero des Tupamaros dans les années 1960-1970, il a été détenu en tant qu’otage par la dictature (1973-1985).
Dès son arrivée au pouvoir il a décidé de reverser 87 % des 250 000 pesos mensuels (9 400 euros) de son salaire de chef d’État à des organismes d’aide au logement social.
Son secrétaire, Julio Martinez, affirme :
«Pour Mujica, la carrière politique ne doit pas être un moyen de se servir des ressources de l’État, mais de rendre service au citoyen»,
Depuis qu’il est président, il a dépénalisé l’avortement, légaliser la vente de cannabis, autoriser le mariage homo sexuel.

Dans Courrier international : la presse d’Amérique du sud reste ébahie par le style de Pepe Mujica. Le président refuse d’habiter le palais présidentiel. Il préfère vivre dans une ferme, avec son épouse qui est sénatrice.
La maison est sommaire : une seule chambre et un toit en zinc.
Est-ce de la démagogie ? Apparemment non. Le seul « luxe » du président est une Coccinelle bleue, achetée en 1987. Pepe Mujica refuse la société de consommation. Il cite les philosophes de l’antiquité : « le pauvre, c’est celui qui a besoin de beaucoup ».
Le cinéaste et musicien d’origine serbe, détenteur de deux palmes d’or cannoises Emir Kusturica a décidé de consacrer un documentaire à cet homme étonnant.
Courrier international lui a consacré un numéro en août qu’il a intitulé déjà : « Le vrai président normal »
Il a tenu un discours très remarqué à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, le 24 septembre 2013, en disant notamment :
« Je suis du Sud, je viens du Sud » […] « Si l’humanité entière aspirait à vivre comme un Américain moyen, nous aurions besoin de trois planètes » [c’est ] « une civilisation contre la simplicité, contre la sobriété, contre tous les cycles naturels, et, ce qui est pire, une civilisation contre la liberté de disposer du temps de vivre les relations humaines, l’amour, l’amitié, l’aventure, la solidarité, la famille. »
Lien vers l’émission de Cohn Bendit : <Le président normal est uruguayen>
<188>
Lundi 04 novembre 2013
Mercredi 30 octobre 2013
c’est la liberté du cochon devant son auge. »
Peter Sloterdijke est un philosophe allemand né en 1947.
Je ne le connaissais pas, mais il a été cité par Hervé Juvin pendant les matins de France Culture du 16/10/2013.
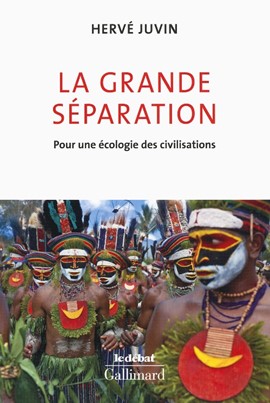 Hervé Juvin avait été invité pour la sortie de son livre : « La grande séparation. Pour une écologie des civilisations »
Hervé Juvin avait été invité pour la sortie de son livre : « La grande séparation. Pour une écologie des civilisations »
Intellectuellement très fin, difficile à classer sur l’échiquier politique, Hervé Juvin a une hantise : l’avènement d’un « homme nouveau » partout sur la planète, l’homo economicus, réduit à son seul pouvoir économique.
Il explique très simplement que nul n’a plus le droit de discriminer selon l’origine, la religion, l’orientation sexuelle, mais il reste un critère de discrimination unique et massif : la richesse.
Cette discrimination est réelle, elle sépare, elle fait vivre les individus dans des mondes différents, elle justifie des comportements et des traitements différents.
Et c’est alors qu’il dénonce l’illusion de la liberté individuelle poussée à son paroxysme qui n’est devenu rien d’autre qu’une liberté à consommer. Consommer des biens, des idées, des loisirs, des services, des droits (du type droit à l’enfant).
Toutes choses dont on tient à nous convaincre que sans ces biens de consommation nous ne sommes rien.
Pour illustrer cette liberté de consommer il cite Peter Sloterdijke
A cela il oppose la liberté collective, la liberté de la nation et tout ce qui nous réunit et nous dépasse et nous permet de connaître nos racines et de sentir la solidarité de ceux qui partagent la même culture.
<Faut–il redécouvrir le vrai sens de la politique afin de préserver nos diversités ?>
Hervé Juvin est très clivant. Les réactions des auditeurs de France Culture sur la page, dont je vous envoie le lien, sont aux deux extrêmes, les uns crient au génie les autres disent que France Culture se diabolise à inviter cet intellectuel proche de Raymond Barre et de Marcel Gauchet.
Mardi 29 octobre 2013
Lundi 28 octobre 2013
Vendredi 25 octobre 2013
Mercredi 23 octobre 2013
ce n’est pas la dernière tranche de fromage
qui fait la mauvaise analyse de sang. «
Propos tenu hier à l’Assemblée Nationale
Mardi 22 octobre 2013
Titre d’un livre paru en 2001 qui est la transcription d’un entretien, très libre, de Pierre Desproges avec Yves Riou et Philippe Pouchain en décembre 1986.
C’est aussi le titre d’un spectacle de textes de Desproges lu par Christian Gonon qui passe actuellement Du 19 au 27 octobre 2013 à Paris, au Studio-théâtre de la Comédie-Française et qui viendra du 5 au 16 novembre à Villeurbanne au Théâtre national populaire.
C’est surtout un mot plein de sens que l’on pourrait compléter par le mot suivant : « Les personnes pleines de certitudes me plongent dans le doute ».
http://www.rue89.com/rue89-culture/2013/10/20/desproges-a-comedie-francaise-etonnant-non-246778
Lundi 21 octobre 2013
le mot vous distrait, vous éloigne de l’observation»
Dans son livre « Aux Etudiants » paru chez Stock
Vendredi 18 octobre 2013
Mais nous nous battrons à la vietnamienne et nous vaincrons. »
Mercredi 16 octobre 2013
Mardi 15 octobre 2013
Lundi 14 octobre 2013
Vendredi 11 octobre 2013
production excessive,
attentes,
transport et manutention inutiles,
tâches inutiles,
stocks,
mouvements inutiles
production défectueuse.
Jeudi 10 octobre 2013
c’est une guerre de race, et elle durera très longtemps […]
c’est la force de ces nouveaux Goths qui m’épouvante.»
Mercredi 09 octobre 2013
Mardi 08 octobre 2013
J’ai seulement écrit ce dont j’étais témoin.»

Hier constituait le 7ème anniversaire de cet acte dont on ne connaîtra probablement jamais le(s) vrai(s) commanditaire(s)
<172>
Vendredi 04 octobre 2013
Mercredi 02 octobre 2013
Mardi 01 octobre 2013
Lundi 30 septembre 2013
Vendredi 27 septembre 2013
Le paragraphe dans son entier :
Je pense qu’aujourd’hui ce mot de Victor Hugo reprend tout son sens…
Lors de l’émission du 23/09/2013 de L’Eco du Jour de France Inter, Philippe Lefébure a montré une des faces du modèle allemand, ce modèle tant vanté, en racontant une histoire de l’économie quotidienne :
Jeudi 26 septembre 2013
Ce qu’elles révèlent est suggestif.
Ce qu’elles dissimulent est essentiel. »
Mercredi 25 septembre 2013
choisis toujours la troisième »
Mardi 24 septembre 2013
Ils ont […] pris des cimetières Pour des jardins d’enfants.»
|
Les enfants de la guerre
Ne sont pas des enfants
Ils ont l’âge de pierre
Du fer et du sang
Sur les larmes de mères
Ils ont ouvert les yeux
Par des jours sans mystère
Et sur un monde en feu
Les enfants de la guerre
Ne sont pas des enfants
Ils ont connu la terre
À feu et à sang
Ils ont eu des chimères
Pour aiguiser leurs dents
Et pris des cimetières
Pour des jardins d’enfants
Ces enfants de l’orage
Et des jours incertains
Qui avaient le visage
Creusé par la faim
Ont vieilli avant l’âge
Et grandi sans secours
Sans toucher l’héritage
Que doit léguer l’amour
|
Les enfants de la guerre
Ne sont pas des enfants
Ils ont vu la colère
Étouffer leurs chants
Ont appris à se taire
Et à serrer les poings
Quand les voix mensongères
Leur dictaient leur destin
Les enfants de la guerre
Ne sont pas des enfants
Avec leur mine fière
Et leurs yeux trop grands
Ils ont vu la misère
Recouvrir leurs élans
Et des mains étrangères
Égorger leurs printemps
|
Ces enfants sans enfance
Sans jeunesse et sans joie
Qui tremblaient sans défense
De peine et de froid
Qui défiaient la souffrance
Et taisaient leurs émois
Mais vivaient d’espérance
Sont comme toi et moi
Des amants de misère
De malheureux amants
Aux amours singulières
Aux rêves changeants
Qui cherchent la lumière
Mais la craignent pourtant
Car les amants de la guerre
Sont restés des enfants
|
Lundi 23 septembre 2013
Vendredi 20 septembre 2013
Jeudi 19 septembre 2013
la seule certitude raisonnable est le volontarisme.»
Mercredi 18 septembre 2013
Mardi 17 septembre 2013
est-il raisonnable de consacrer beaucoup d’efforts et d’intelligence à obtenir une meilleure cabine ? »
Lundi 16 septembre 2013
Vendredi 13 septembre 2013
c’est bon pour la croissance.»
Jeudi 12 septembre 2013
Mercredi 11 septembre 2013
Mardi 10 septembre 2013
Lundi 09 septembre 2013
Hésite sur le seuil du blâme.
On ne sait jamais les raisons
Ni l’enveloppe intérieure de l’âme,
Ni ce qu’il y a dans les maisons,
Sous les toits, entre les gens. »
Vendredi 06 septembre 2013
Parfois, le gris a du bon, c’est une planche de salut, un abri contre quelque chose qui aurait pu être bien pire. »
Jeudi 05 septembre 2013
Mercredi 04 septembre 2013
Avec un, tu fais un Parti
avec deux, tu fais un congrès
avec 3, tu fais une scission»
Mardi 03 septembre 2013
Lundi 2 septembre 2013
Le mot du jour fait référence à un livre qui montre le manque de crédibilité des occidentaux à vouloir se poser en défenseur et gardien des droits de l’homme.
 L’archipel des Chagos fait partie géographiquement de l’Ile Maurice et de ses dépendances.
L’archipel des Chagos fait partie géographiquement de l’Ile Maurice et de ses dépendances.
Ces îles étaient colonisées par la Grande Bretagne.
Les Etats Unis ont trouvé pertinent d’installer sur l’archipel des Chagos une grande base militaire.
Ils se sont mis d’accord avec le colonisateur et ont signé un bail avec la Grande Bretagne mais avec une condition : que ces iles soient vides d’habitants. La Grande Bretagne a scrupuleusement respecté la condition dans un premier temps en limitant le commerce avec les iles pour finalement en 1973 embarquer de force les habitants qui étaient restés, dans un bateau pour les déporter dans ce paradis du tourisme occidental : l‘ile Maurice, à plus de 2000 km, où ils vivent misérablement leur vie de déportés.

L’armée des Etats-Uniens a donc pu, en toute discrétion, installer une base et des équipements militaires sur l’île de « Diego Garcia »
 Dans un premier temps aucune compensation financière n’avait été proposée.
Dans un premier temps aucune compensation financière n’avait été proposée.
Dans un second temps parce que des bonnes âmes occidentales ont dénoncé ce scandale, quelques compensations furent distribuées.
C’est l’émission « Interception » de France Inter » de hier qui m’a rappelé opportunément cette histoire au moment où les États-Unis veulent punir la Syrie : <Chagos : les déracinés de l’Océan Indien>
La page de l’émission présente le sujet ainsi :
« C ‘est l’histoire des Chagos, un archipel de carte postale, un point sur la carte du monde quelque part dans l’Océan indien juste au sud des Maldives. C’est l’histoire d’îles tropicales aux lagons poissonneux, aux plages de sable blanc parsemées de cocoteraies. C’est l’histoire de descendants d’esclaves originaires du Mozambique et de Madagascar, esclaves débarqués sur ces îles par des navigateurs français pour y récolter le coprah qui fait l’huile de coco.
L ‘histoire de ces Chagossiens que l’on appelait aussi « îlois » aurait pu s’arrêter là jusqu’à ce que l’Empire britannique -qui avait annexé les Chagos à l’issue des guerres napoléoniennes- décide dans les années 60 d’y construire la base militaire de Diego Garcia et de la louer aux Etats-Unis d’Amérique. Les avions de l’US Air Force ont utilisé cette plateforme pour aller bombarder l’Afghanistan et l’Irak… L’Iran est à moins de 4000 kms de là.
Évidemment, une installation aussi stratégique est vouée au secret total. C’est pour cette raison que, de 1966 à 1973, les navires britanniques ont déporté les habitants des Chagos vers l’Ile Maurice, à plus d’un millier de kilomètres de chez eux. Les Chagossiens ont été débarqués sur les quais de Port-Louis sans une explication et sans espoir de retour. »
Mais c’est une autre émission, toujours très instructive, « Rendez-vous avec X » qui me l’avait fait découvrir. C’était l’émission du 22 juin 2013 :
< Les Chagos ou les oubliés de la guerre froide >
« Ce sont des oubliés de la Guerre froide … Des oubliés et des victimes. Un petit peuple purement et simplement expulsé de son habitat traditionnel pour faire place à une gigantesque base militaire. Et comme si cela ne suffisait pas, ces malheureux qui ont dû quitter leurs îles en toute hâte, sans même avoir le temps de rassembler leurs maigres biens, ont ensuite été relogés très loin dans des considérations misérables, sans réelles indemnités. Et avec interdiction de revenir chez eux ! »
Depuis j’ai lu un article de libération de Jean-Michel LE CLEZIO, le prix Nobel de littérature, d’origine Mauricienne qui parle de cette triste et honteuse histoire occidentale à l’occasion d’une décision qui ne fait pas honneur à la Cour européenne des droits de l’homme.
<Les îlois des Chagos contre le Royaume-Uni, suite et fin ?>
J’en tire l’entame et la conclusion dans lesquelles, le Prix Nobel exprime son indignation :
« La décision rendue en décembre 2012, par la Cour européenne des droits de l’homme, de ne pas recevoir la plainte des Chagossiens contre le gouvernement du Royaume-Uni restera comme une des grandes hontes et un déni de justice de l’époque contemporaine. Cette décision est loin d’être courageuse. Elle n’est sans doute pas non plus définitive, car le peuple chagossien a pris conscience depuis de nombreuses années de la solitude dans laquelle il doit livrer combat afin que soient reconnus ses droits au retour dans sa patrie d’origine. […]
Rappelons que la position du gouvernement britannique n’a pas changé depuis la création des Territoires de l’océan Indien, et que Colin Roberts, qui fut Commissionner desdits Territoires ne cacha pas son dédain pour la population chagossienne, (WikiLeaks publia en décembre 2010 son commentaire sur les îlois : «On ne verra plus les traces des pieds des Man Fridays – des sauvages – sur les plages de Diego Garcia.»).
Il affirmait aussi que la création éventuelle d’un parc marin aux Chagos pourrait servir à empêcher définitivement le retour des habitants sur les lieux.
Quant aux Etats-Unis, partenaire du Royaume-Uni dans la création de la base militaire de Diego Garcia, ils n’ont cessé de masquer l’iniquité du traitement infligé aux Chagossiens par les mesures prises en faveur des déportés – mesures qui ne servent qu’à farder la triste vérité. La réalité de la politique menée par les États puissants du monde s’affirme avec un certain cynisme dans la réponse que le gouvernement présent des États-Unis a donnée aux plaignants chagossiens (réponse de la Maison Blanche à la pétition We The People sur les torts infligés aux Chagossiens, 21 décembre 2012) : cette réponse qui reprend les arguments de la Cour européenne, conclut par la promesse du gouvernement américain de continuer à soutenir, comme par le passé, la compensation britannique pour les torts subis par les habitants des Chagos.
Il n’est pas indifférent que la réponse provienne, entre autres signataires, de M. Andrew Shapiro, adjoint au ministre des Affaires politiques et militaires. Ainsi la boucle est bouclée, et l’archipel des Chagos continuera sans doute, sauf élément imprévisible actuellement, à être le porte-avions de l’armée américaine au Proche et Moyen-Orient.
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu sa décision, dans l’indifférence des puissants de ce monde. Qu’importe une poignée d’îlois, petits agriculteurs, pêcheurs à la ligne dans leur lagon, quand les intérêts stratégiques et militaires sont en jeu, et que ces îles lointaines, perdues au milieu de l’océan Indien, peuvent être transformées à vil prix en une des bases les plus opérationnelles du monde – comme elle le fut pour les bombardiers de la guerre du Golfe ? Et que dire du soupçon de tortures infligées aux détenus de Diego Garcia, comme à Guantánamo ?
Certains des habitants se souviennent encore du jour tragique où ils durent embarquer de force sur le navire qui les déportait, sans pouvoir emmener avec eux leur bétail, ni même leurs chiens restés à aboyer sur la rive.
Les grands de ce monde qui ont rendu cette décision inique, le président David Björgvinsson et ses six assesseurs, devraient pourtant se soucier des gens qu’ils condamnent ainsi au non-retour et à l’exil éternel.
Peut-être devraient-ils – mais cette proposition sans doute amènera un sourire ironique sur leurs lèvres – visiter un jour la modeste maison à Gros-Caillou, un quartier déshérité de Maurice, qui sert en quelque sorte de refuge et de mémoire au peuple des îlois, où sur les murs, les enfants des Chagossiens nés en exil peuvent regarder les images de leur petite patrie qu’ils ne pourront jamais connaître, fût-ce pour fleurir les tombes de leurs ancêtres. »
J.M.G. Le Clezio
 L’émission de France Inter donne un certain nombre de liens pour approfondir cette triste histoire dans laquelle l’Occident joue un rôle indigne :
L’émission de France Inter donne un certain nombre de liens pour approfondir cette triste histoire dans laquelle l’Occident joue un rôle indigne :
Les Chagos, l’archipel convoité
Article d’Emmanuel Grégoire, géographe, directeur de recherche à l’IRD, membre du Centre d’études africaines (CEAf) de l’EHESS, paru dans la revue Politique africaine en 2005 (n°97). En ligne sur le portail Cairn.info.
Diego garcia : enjeux de la présence américaine dans l’océan indien
Article d’André Oraison, professeur de droit à l’université de la Réunion, paru dans la revue Afrique contemporaine, n° 207, automne 2003. En ligne sur le portail Cairn.info.
Des îles britanniques de l’océan Indien disputées : Diego Garcia et l’archipel des Chagos
Article d’Emmanuel Grégoire, géographe, directeur de recherche à l’IRD, paru dans la revue Hérodote, 2ème trimestre 2010. En ligne sur le portail Cairn.info.
The UK Chagos Support Association
Supporting the Chagos islanders in their struggle against British injustice
Chagos conservation trust
Organisation non gouvernementale britannique œuvrant pour la préservation de l’écosystème de l’archipel.
Cour européenne des droits de l’Homme
Décision d’irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Habitants des îles Chagos contre le Royaume-Uni (décembre 2012).
<148>
Vendredi 30 août 2013
Jeudi 29 août 2013
Mercredi 28 août 2013
Ce discours, prononcé le 28 août 1963, devant le Lincoln Memorial, à Washington D.C., est généralement considéré comme l’un des plus grands et des plus marquants du XXe siècle.
Selon le député américain John Lewis, qui prit également la parole ce jour-là au nom du Comité de coordination des étudiants non violents : « En parlant comme il l’a fait, il a éduqué, il a inspiré, il a guidé non pas simplement les gens qui étaient là, mais les gens partout en Amérique ainsi que les générations à venir » (source Wikipedia)
Le journal <Les Echos> raconte les secrets de ce discours : « Ce 28 août 1963, en s’avançant face au public massé pour le plus grand rassemblement pour les droits civiques jamais organisé, Martin Luther King sait qu’il doit marquer les esprits. La veille, des heures durant et jusque tard dans la nuit, il préparera son discours avec l’aide de ses fidèles compagnons de lutte.
Pourtant, le lendemain, aucune mention du passage mythique « I have a dream » ne figure sur ses notes. Et pour cause, la veille, son chef de cabinet, Wyatt Tee Walker, lui avait dit de ne pas utiliser cette expression : « Elle est banale, c’est un cliché. Tu l’as déjà utilisée trop de fois ». Car contrairement à une idée reçue, si Martin Luther King a bien improvisé ce passage, il avait employé cette expression, et les développements associés, lors de précédentes prises de parole publiques.
Mais, ce jour-là, à la douzième minute de son intervention, quand Mahalia Jackson, la chanteuse et amie de Martin Luther King, située debout derrière lui, crie « Martin, raconte-leur l’histoire à propos de ce rêve », le discours bascule dans la légende.
Sur les images télévisées, on observe très distinctement le moment où il se détache de ses notes et où sa tête se relève en affirmant : « Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que, oui, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd’hui et demain je fais toujours ce rêve ». A partir de ce moment, il regarde l’audience droit dans les yeux et se concentre non sur un effort de lecture mais sur le message qu’il souhaite faire passer.
Au début de son intervention, grâce à une métaphore filée, il évoque ainsi l’image d’un chèque de banque que les Noirs américains sont venus demander à l’Etat américain, chèque sur lequel figure le droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Cette proximité avec les besoins de l’audience fait écho à la vision et aux idéaux qu’il poursuit depuis son enfance. En partageant cette promesse de justice sociale, il appelle à changer le cours des choses et faire de ce rêve une réalité.
Sur la forme, le discours est aussi un chef-d’œuvre avec l’utilisation de procédés rhétoriques qui mettent parfaitement en valeur ses propos. Martin Luther King savait que la répétition, notamment via le procédé de l’anaphore qui consiste à répéter un ou plusieurs mots en début de phrase, permettait de marquer les esprits.
Ainsi, comme s’il récitait une poésie, il prononce huit fois de suite « I have a dream » ainsi que l’expression « Let freedom ring » (« Que la liberté retentisse », en français) à la fin de son discours. Provoquant le même effet qu’un refrain, ces mots rythment le discours et favorisent ainsi sa mémorisation. »
 Vous pouvez retrouver le texte intégral de ce discours sur ce site : <Jeune Afrique>
Vous pouvez retrouver le texte intégral de ce discours sur ce site : <Jeune Afrique>
« I have a dream » (extraits)
«Retournez dans le Mississippi, retournez en Alabama, retournez en Caroline du Sud, retournez en Georgie, retournez en Louisiane, retournez dans les taudis et les ghettos des villes du Nord, sachant que de quelque manière que ce soit cette situation peut et va changer. Ne croupissons pas dans la vallée du désespoir.
Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que, oui, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd’hui et demain je fais toujours ce rêve : c’est un rêve profondément ancré dans l’idéal américain.
Je fais le rêve qu’un jour cette nation se lève et vive la vraie signification de sa croyance : nous tenons ces vérités comme évidentes que tous les hommes naissent égaux.
Je rêve qu’un jour sur les collines rousses de Georgie les fils d’anciens esclaves et ceux d’anciens propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité.
Je rêve qu’un jour, même l’Etat du Mississippi, un Etat où brûlent les feux de l’injustice et de l’oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice.
Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd’hui un rêve !
Je rêve qu’un jour, même en Alabama, avec ses abominables racistes, avec son gouverneur à la bouche pleine des mots » opposition » et » annulation » des lois fédérales, que là même en Alabama, un jour les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main, comme frères et sœurs. Je fais aujourd’hui un rêve !
Je rêve qu’un jour toute la vallée sera relevée, toute colline et toute montagne seront rabaissées, les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux redressés, la gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair.
Telle est notre espérance. C’est la foi avec laquelle je retourne dans le Sud.
Avec cette foi, nous serons capables de distinguer dans la montagne du désespoir une pierre d’espérance. Avec cette foi, nous serons capables de transformer les discordes criardes de notre nation en une superbe symphonie de fraternité.
Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d’aller en prison ensemble, de défendre la cause de la liberté ensemble, en sachant qu’un jour, nous serons libres. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu pourront chanter ces paroles qui auront alors un nouveau sens : » Mon pays, c’est toi, douce terre de liberté, c’est toi que je chante. Terre où sont morts mes pères, terre dont les pèlerins étaient fiers, que du flanc de chacune de tes montagnes, sonne la cloche de la liberté ! »
Et si l’Amérique est une grande nation ceci doit se faire….
Que la cloche de la liberté sonne du haut des merveilleuses collines du New Hampshire !
Que la cloche de la liberté sonne du haut des montagnes grandioses de l’Etat de New-York !
Que la cloche de la liberté sonne du haut des sommets des Alleghanys de Pennsylvanie !
Que la cloche de la liberté sonne du haut des cimes neigeuses des montagnes rocheuses du Colorado !
Que la cloche de la liberté sonne depuis les pentes harmonieuses de la Californie !
Mais cela ne suffit pas.
Que la cloche de la liberté sonne du haut du mont Stone de Georgie !
Que la cloche de la liberté sonne du haut du mont Lookout du Tennessee !
Que la cloche de la liberté sonne du haut de chaque colline et de chaque butte du Mississippi ! Du flanc de chaque montagne, que sonne le cloche de la liberté !
Quand nous permettrons à la cloche de la liberté de sonner dans chaque village, dans chaque hameau, dans chaque ville et dans chaque Etat, nous pourrons fêter le jour où tous les enfants de Dieu, les Noirs et les Blancs, les Juifs et les non-Juifs, les Protestants et les Catholiques, pourront se donner la main et chanter les paroles du vieux Negro Spiritual : » Enfin libres, enfin libres, grâce en soit rendue au Dieu tout puissant, nous sommes enfin libres ! « . »
<Et voici la vidéo de ce discours mythique>
<145>
Mardi 27 août 2013
croît aussi ce qui sauve.»
Lundi 26 août 2013
Vendredi 23 août 2013
passons dans la rue à côté de personnes en grandes difficultés avec indifférence,
et que lorsque nous sommes au théâtre et qu’un acteur meurt sur scène, pour de faux, nous pleurons.»
Jeudi 22 août 2013
Les évènements de Syrie et d’Égypte m’ont fait penser à ce mot de Camus.
Souvent, on lit cette citation de Camus avec cette entame : « Mal nommer les choses…».
Mais la citation exacte n’est pas ainsi. Il avait rédigé un compte rendu sur un ouvrage de Brice Parain « Recherches sur la nature et la fonction du langage ».
Cet article avait pour titre « Sur une philosophie de l’expression »
Et dans cet article se trouve ce paragraphe :
« Mal nommer un objet c’est ajouter au malheur de ce monde, car le mensonge est justement la grande misère humaine, c’est pourquoi la grande tâche humaine correspondante sera de ne pas servir le mensonge. »
<141>
Mercredi 21 août 2013
que je ressens de la part de nos concitoyens»
Mardi 20 août 2013
Lundi 19 août 2013
les nuages qui passent… là-bas… là-bas…
les merveilleux nuages ! «
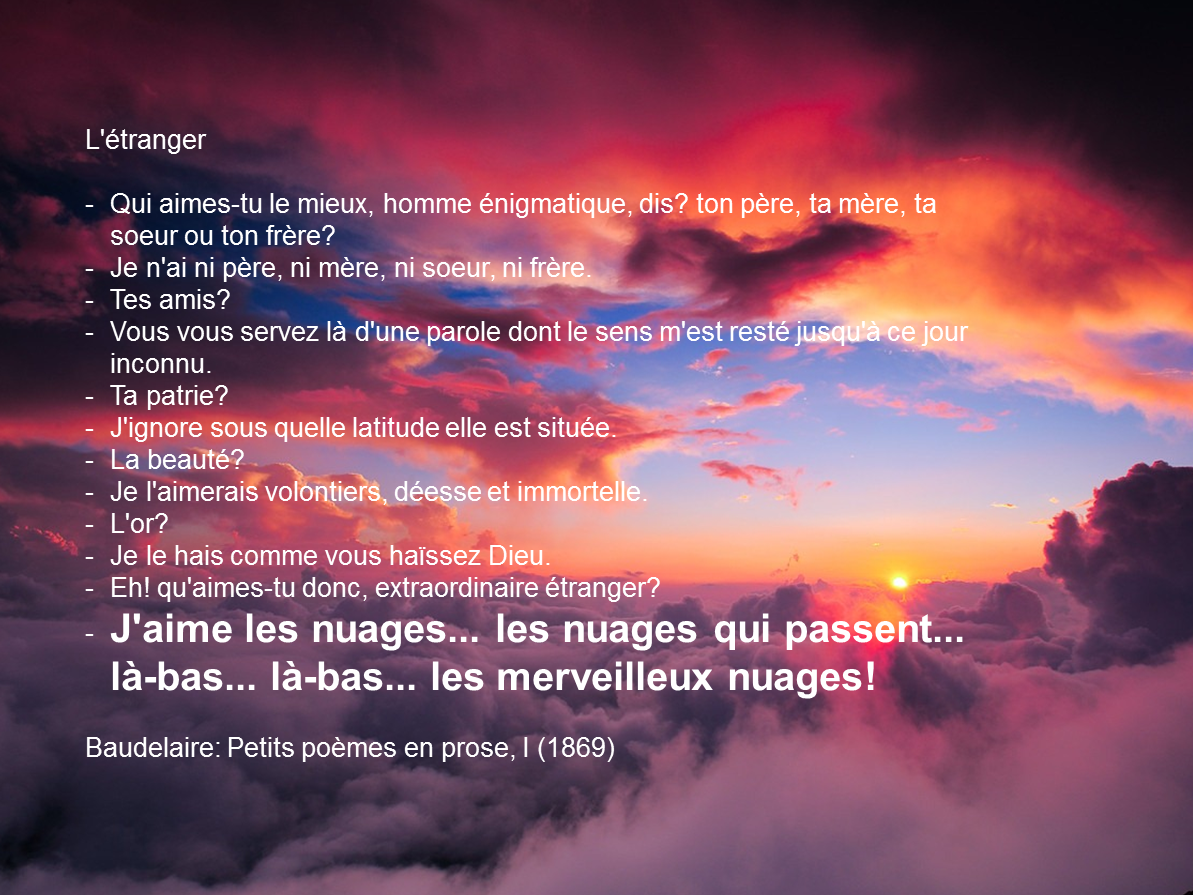
Mardi 16 juillet 2013
Lundi 15 juillet 2013
À notre époque, les enfants sont des tyrans. »
Vendredi 12 juillet 2013

Jeudi 11 juillet 2013
La dernière petite goutte nous fait encore vivre.»
Mercredi 10 juillet 2013
Mardi 09 juillet 2013
<132>
Lundi 08 juillet 2013
Il doit être exécuté. »
Vendredi 05 juillet 2013
Jeudi 04 juillet 2013
la musique militaire n’est pas la musique. »
Mercredi 03 juillet 2013
5 mars 1949
Mardi 02 juillet 2013
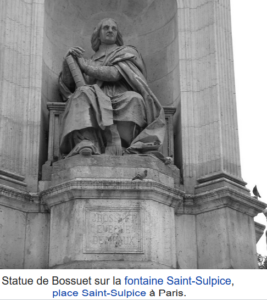 Le célèbre auteur des sermons et oraisons funèbre s’appelait Jacques-Bénigne Bossuet.
Le célèbre auteur des sermons et oraisons funèbre s’appelait Jacques-Bénigne Bossuet.
Il est né le 27 septembre 1627 à Dijon et décédé le 12 avril 1704 à Paris.
Il fut aussi membre de l’Académie française..
Il fut un temps lorrain : En 1652, reçu docteur en théologie, il est ordonné prêtre et devient l’archidiacre de Sarrebourg dans le même temps, puis, en 1654, celui de Metz, où il s’installe.
Il fut aussi précepteur du dauphin Louis de France, le fils du roi Louis XIV et de Marie-Thérèse en septembre 1670. Il semble que cette épisode fut difficile pour le maître comme pour l’élève.
En 1681, lorsque l’éducation du dauphin est achevée, il est nommé évêque de Meaux. Et c’est ainsi qu’on lui donnera aussi pour nom l’« Aigle de Meaux ».
La plupart de ses discours improvisés sont perdus. Quelques heures avant de monter en chaire, il médite son texte, jette sur le papier quelques notes et paroles du Christ, quelques passages des Pères de l’Église pour guider sa marche. Quelquefois il dicte rapidement de plus longs morceaux, puis se livre à l’inspiration du moment, et s’étonne de l’impression qu’il produit sur ses auditeurs.
Il ne nous est parvenu que deux cents des quelque cinq ou six cents sermons prononcés, car Bossuet ne les considérait pas comme des œuvres littéraires dignes d’être imprimées. C’est à la fin du XVIIIe siècle que certains sermons furent conservés, grâce au travail de Dom Deforis. Ce ne sont toutefois que des brouillons, alourdis par les ratures et les variantes, et qui ne nous offrent qu’une idée approximative de sa prédication.
Pour en savoir plus, je vous envoie vers <Wikipedia>
<127>
Lundi 01 juillet 2013
Vendredi 28 juin 2013
Vendredi 21 juin 2013
Mercredi 19 juin 2013
Mardi 18 juin 2013
Peter Gumbel est journaliste anglais vivant en France depuis une dizaine d’année et enseignant à l’IEP Paris. C’est probablement un observateur venant d’une autre culture qui peut le mieux analyser les problèmes de la France.
Voici des extraits de ce livre :
« Les élites françaises sont une obsession nationale qui a fait l’objet d’innombrables études. […] En France, la discussion sur les élites se focalise très souvent sur les milieux sociaux dont sont issus ceux qui ont grimpé l’échelle sociale. On cherchera alors à savoir dans quelle mesure ils sont, ou non, représentatifs de la population prise dans son ensemble. […] Toutefois, si vous construisez un système méritocratique qui repose entièrement ou très largement sur les performances scolaires, comme l’a fait la France, il y a peu de chances que ce système représente la population dans sa globalité. […]
Ce qui est surprenant, c’est que ce débat national si tourmenté en France n’ait pas abouti à une réforme du système. Ailleurs, notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, la question des origines sociales de l’élite a fait l’objet d’innombrables discussions débouchant sur de vrais changements. Il y a à peine 25 ans, l’élite financière britannique sortait dans son écrasante majorité d’Oxford ou de Cambridge après être passée par des écoles privées. […]
Aujourd’hui, l’influence d’Oxford et de Cambridge décline : alors que 67% des PDG étaient diplômés de l’une de ces deux universités en 1987, ce chiffre était tombé en 2007 à 39%, selon le Sutton Trust, une fondation qui fait campagne pour une plus grande ouverture sociale. Et il continue de chuter : en 2012, seulement 21% des PDG des 100 plus grandes entreprises britanniques étaient des diplômés d' »Oxbridge », selon une enquête menée par le chasseur de têtes Robert Half. La tendance est la même pour l’élite politique. […]
Et la France ? Le chemin vers les hautes sphères demeure une route en pente raide semée d’embûches, […] plus étroite qu’elle ne l’était il y a vingt ans, et qui passe nécessairement par le système typiquement français des grandes écoles, auquel seulement 5% des jeunes Français ont accès. Et même dans cet univers ultrasélectif […], deux institutions dominent. L’Ecole polytechnique […] et l’ENA. […]
Au début des années 1960, le professeur d’économie américain David Granick mena une étude comparative des pratiques managériales dans quatre pays. En France, il découvrit que 80% des patrons des entreprises les plus importantes étaient issus de cinq grandes écoles, dont 42% de l’Ecole polytechnique. […] Plus récemment, deux autres chercheurs, François-Xavier Dudouet et Hervé Joly menèrent une enquête similaire, en ciblant cette fois l’ensemble des dirigeants des quarante entreprises qui constituent le CAC 40. […] Parmi les 546 dirigeants dont le parcours avait été examiné, 84% étaient issus des grandes écoles, et trois établissements – Polytechnique, ENA et HEC – représentaient 46% du total.
En politique, le schéma est similaire. […] La présidence Hollande n’a rien d’extraordinaire : ces quarante dernières années, les énarques et les polytechniciens ont imposé leur présence dominante et permanente aussi bien à l’Elysée qu’à Matignon, quelle que soit la couleur politique du pouvoir. […] A cette époque [celle de Valéry Giscard d’Estaing, NDLR], 61% de l’entourage présidentiel était composé d’anciens élèves des deux écoles. […] Même Nicolas Sarkozy ne s’est pas rebellé contre le système : 55% de son équipe rapprochée avait fait l’ENA ou l’X. Avec François Hollande, nous sommes revenus à un pourcentage proche de ce qu’il était sous VGE. […]
De la même manière que la majorité des énarques sont issus de Sciences-Po, l’écrasante majorité des élèves de Polytechnique proviennent de cinq classes préparatoires, dont trois sont situées dans les 5e et 6e arrondissements de Paris, celles des lycées Henri-IV, Louis-le-Grand et Saint-Louis, les deux autres étant celles des lycées Hoche et Sainte-Geneviève (dite « Ginette »), à Versailles. […] Le bassin dans lequel on pêche l’élite française est minuscule. […] Aux Etats-Unis, ensemble, Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Dartmouth, Cornell, l’université de Pennsylvanie et Brown acceptent vingt-quatre mille étudiants de premier cycle tous les ans, cinquante fois plus que l’ENA et lX, pour un pays cinq fois plus peuplé. […] »
Il a aussi répondu à un entretien de l’Express dont le titre est « Les réseaux de pouvoir français sont incestueux et malsains »
A la question que Reprochez-vous aux grandes écoles françaises ? il explique :
« C’est un système étroit et rigide. Je ne suis pas contre les élites, mais en France on pêche dans un bassin qui s’avère minuscule! Aux Etats-Unis et en Angleterre, la diversité des élites est beaucoup plus importante. En France, l’ouverture sociale des grandes écoles est affichée comme un objectif politique, mais le système reste inchangé.
Deuxième reproche que je formule: les grandes écoles françaises sont dans une logique de sélection très forte. 96% de la population n’en est pas issu. C’est un système pour « happy few » qui génère un manque de confiance chez les étudiants, et des taux d’échec très élevés. De ce point de vue, le monde du travail agit comme un miroir de ce qui se passe à l’école: niveau de stress important, sentiment de frustration, manque de motivation. Autant d’éléments qui trouvent leur origine dans une logique de sélection.
Troisième élément, le principe de la méritocratie républicaine vanté par la France est très sympa… Simplement, il ne marche pas! Ce n’est pas parce qu’on est très performant à l’école, qu’on l’est tout autant en entreprise ou dans un cabinet ministériel. Il est d’ailleurs prouvé que les entreprises qui recrutent exclusivement dans le réseau des grandes écoles sont moins performantes que les autres. Autre élément d’interrogation, l’administration publique française. Si l’ENA était vraiment efficace, nous aurions une administration très performante et très moderne. Or la France a complètement raté depuis 20 ans les évolutions de son administration. Des rapports entiers consacrés à ce sujet encombrent les placards des ministères, mais les différents gouvernements sont incapables de les mettre en oeuvre. Si vous regardez les grands corps de l’Etat, tout cela n’est pas très étonnant… En France le corps le plus prestigieux est l’Inspection des Finances. Ce qui veut dire que les Français sont très forts dans la critique et le contrôle, beaucoup moins dans la mise en œuvre. »
A la question que préconisez-vous ? Il répond :
« Je pense qu’il faut casser le lien automatique entre les grands corps d’Etat et l’ENA. Ces réseaux sont aujourd’hui incestueux et malsains. Si ça fonctionnait, il faudrait les maintenir, mais ça ne marche plus!
Aujourd’hui nombre d’étudiants brillants partent faire leurs études à l’étranger. Mon espoir c’est qu’en rentrant en France, ils changent ce système, cet entre-soi qui prévaut dans les élites françaises. »
J’ai tiré extraits et réponses de ces deux articles qui donnent encore d’autres éléments :
<122>
Lundi 17 juin 2013
Jusqu’au jour où je me suis aperçu
que la plupart des gens à qui je donnais raison
avaient tort !»
Jeudi 13 juin 2013
quelque chose qui s’impose à vous, majestueusement.»
<120>
Mardi 11 juin 2013
Lundi 10 juin 2013
Jeudi 06 juin 2013
Tant est enracinée la soumission des gens du village aux messieurs du château.»
Mercredi 05 juin 2013
Mardi 04 juin 2013
Lundi 03 juin 2013
Avoir mauvais goût, ce n’est pas mal non plus,
Ce qui est tragique, c’est de ne pas avoir de goût du tout… »
Vendredi 31 mai 2013
Jeudi 30 mai 2013
Non, il n’est pas question de cette immense forêt, poumon de la terre, et qui est l’objet de beaucoup d’atteintes écologiques et aussi d’atteintes à l’égard des populations autochtones et sur laquelle beaucoup de choses seraient à écrire.
 Ce mot du jour fait référence au titre d’un livre d’un journaliste qui s’est fait embaucher dans l’entrepôt de Montélimar du site de vente en ligne AMAZON.
Ce mot du jour fait référence au titre d’un livre d’un journaliste qui s’est fait embaucher dans l’entrepôt de Montélimar du site de vente en ligne AMAZON.
Le mot du jour du 14/05/2013 évoquait le destin des ouvriers du Bengladesh qui travaillaient dans les locaux bas de gamme qui s’écroulaient et dans des conditions misérables pour que nous puissions acheter des vêtements à bas prix.
Ici nous sommes en France, les locaux ne menacent pas de s’écrouler, mais les conditions exigées par l’employeur à l’égard des salariés précaires sont incroyables.
Le plus extravagant c’est quand on recherche cet ouvrage sur Google, Amazon est le premier à vous proposer de vous le vendre.
Si vous voulez acheter ce livre, s’il vous plaît aller chez un libraire.
Vous pouvez aussi lire cet article sur le site du Nouvel Obs. : <Quand Amazon transforme ses recrues en « robots »>
J’en cite quelques extraits :
« Il n’y a que quatre types de postes, attribués une fois pour toutes, en trois équipes (5h50-13h10, 13h40-21h, 21h30-4h50) : ceux qui reçoivent la marchandise (les eachers), ceux qui la rangent dans les rayonnages de cette forêt métallique qui couvre le hangar de 36.000 mètres carrés (les stowers). Ceux qui prennent les produits dans ces casiers pour préparer les commandes (les pickers), ceux qui les emballent (les packers).
Il y a tout ce vocabulaire anglais à maîtriser : inbound, outbound, damage, bins, slam, associates, leaders… Il y a cette devise, sortie du « Meilleur des Mondes » : « Work hard, have fun, make history » (« Travaille dur, amuse-toi, écris l’histoire »).
La vie de « l’associé » est codifiée selon des « process » qui gèrent le moindre détail : la vitesse maximum des voitures sur le parking (15 km/h), la manière de se garer (en marche arrière), le tutoiement obligatoire (censé susciter la confiance), la manipulation des chariots (interdiction de reculer), la façon d’y empiler les articles (par taille, code-barres au-dessus).
Le travail est ultrapénible : même si son parcours est optimisé par un logiciel, le picker marche entre 20 et 25 kilomètres par vacation. Douleurs dans le dos, le cou, le poignet, les cuisses… « […]
Selon Malet, Amazon transforme ses recrues en « robots » hébétés, soumis à des objectifs de productivité croissants. Leurs machines à scanner sont les « flics électroniques » qui transmettent des informations, contrôlées en temps réel par des leaders, eux-mêmes sous la pression de managers.
Comme dans un mauvais jeu de télé-réalité, de semaine en semaine, seuls les plus performants sont gardés. Et les rares élus qui atteignent, dixit Amazon, « les standards élevés qui peuvent paraître irréalisables aux yeux de certains », décrochent un CDI. Un vrai Graal pour ces bataillons de chômeurs en galère. »
Ou simplement écouter la chronique de 3mn de Philippe Meyer qui m’a fait découvrir l’existence de ce livre : <Dans les coulisses d’Amazon>
Ou <cet extrait> publié par L’Humanité
<112>
Mardi 28 mai 2013
Lundi 27 mai 2013
Vendredi 24 mai 2013
Jeudi 23 mai 2013
Mercredi 22 mai 2013
Mardi 21 mai 2013
Jeudi 16 mai 2013
Mercredi 15 mai 2013
Mardi 14 mai 2013
Lundi 13 mai 2013
Oui je t’aime
Dans la joie ou la douleur
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon cœur »
(né le 18 mai 1913 à Narbonne – mort le 19 février 2001 à Créteil)
|
Il revient à ma mémoire
Des souvenirs familiers
Je revois ma blouse noire
Lorsque j’étais écolier
Sur le chemin de l’école
|
Je chantais à pleine voix
Des romances sans paroles
Vieilles chansons d’autrefois [Refrain : ]
Douce France
Cher pays de mon enfance
|
|
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon cœur!
Mon village au clocher aux maisons sages
Où les enfants de mon âge
Ont partagé mon bonheur
Oui je t’aime
Et je te donne ce poème
Oui je t’aime
Dans la joie ou la douleur
[Refrain]
J’ai connu des paysages
Et des soleils merveilleux
Au cours de lointains voyages
Tout là-bas sous d’autres cieux
|
Mais combien je leur préfère
Mon ciel bleu mon horizon
Ma grande route et ma rivière
Ma prairie et ma maison.
[Refrain]
Mon village au clocher aux maisons sages
Où les enfants de mon âge
Ont partagé mon bonheur
Oui je t’aime
Et je te donne ce poème
Oui je t’aime
Dans la joie ou la douleur
[Refrain]
|
Mardi 07 mai 2013
Nous fêtons la défaite de l’Allemagne nazi le 8 mai.
Cette date est la conséquence de la volonté de l’URSS de faire signer la capitulation allemande à Berlin.
Mais la véritable capitulation des autorités nazi a eu lieu le 7 mai 1945 à 2h41 du matin à Reims, l’acte de reddition de l’armée allemande étant signé par le général Jodl.
Pour l’anniversaire de la défaite de la barbarie nazi je cite la conclusion du livre de John Steinbeck : « Lune Noire » :
« Un sifflement strident hurla du côté de la mine. Une rafale de vent pulvérisa de la neige sur les fenêtres. Orden joua avec sa médaille et déclara d’une voix sourde :
– Vous voyez, colonel, on ne peut rien y changer. Vous serez écrasés et expulsés. Les gens n’aiment pas être conquis, colonel, et donc ils ne le seront pas.
Les hommes libres ne déclenchent pas la guerre, mais lorsqu’elle est déclenchée, ils peuvent se battre jusqu’à la victoire.
Les hommes en troupeau, soumis à un Führer, en sont incapables, et donc ce sont toujours les hommes en troupeau qui gagnent les batailles et les hommes libres qui gagnent la guerre. Vous découvrirez qu’il en est ainsi, colonel.
Lanser se redressa avec raideur. »
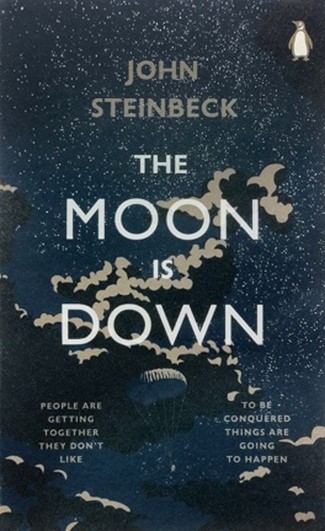 Lune noire (The Moon Is Down) est un roman de John Steinbeck écrit en 1942, il décrit une petite ville occupée par une armée étrangère.
Lune noire (The Moon Is Down) est un roman de John Steinbeck écrit en 1942, il décrit une petite ville occupée par une armée étrangère.
Les habitants se mobilisent peu à peu pour faire comprendre aux occupants qu’ils ne sont pas les bienvenus. Ceux-ci ressentent le rejet de la part des autochtones et commencent à craindre pour leur vie. Les actes de sabotage se multiplient et finalement certains occupants viennent individuellement supplier les habitants de les épargner.
La force de cette œuvre est de montrer que même dans une situation d’occupation, l’individu peut rester libre s’il est en accord avec sa conscience.
Les occupants quant à eux sont aliénés au régime auquel ils obéissent.
À la fin de l’histoire, les occupants, cernés par les explosions provoquées par la résistance qui s’est organisée dans la ville, prennent le maire en otage.
Le titre est inspiré d’un dialogue de Macbeth.
Au début du deuxième acte Banquo et Fleance rencontrent Macbeth qui est sur le point d’assassiner Duncan.
Banquo demande à son fils :
« How goes the night, boy? » (Où en sommes-nous de la nuit, mon garçon ?), celui-ci répond: « The moon is down; I have not heard the clock. » (La lune est couchée ; je n’ai point entendu sonner l’heure.). »
La citation suggère que les ténèbres ne vont pas tarder à s’abattre sur le royaume.
Par analogie, Steinbeck voulait montrer que l’Allemagne nazie faisait descendre sur l’Europe des ténèbres similaires.
L’ouvrage est traduit et publié clandestinement dans la plupart des pays européens occupés. (France, Editions de Minuit).
Il est traduit en Allemand par Humanitas Verlag à Zurich et le groupe du Schauspielhaus (composé en partie d’Allemands, communistes et antifascistes ayant fui l’Allemagne dans les années 1930, comme Wolfgang Langhoff) de cette ville le joue à presque deux cents reprises.
<101>
Lundi 06 mai 2013
Vendredi 03 mai 2013
Jeudi 02 mai 2013
|
« Je hais les haies
Je hais les haies
qui sont des murs.
Je hais les haies et les mûriers
qui font la haie
le long des murs.
Je hais les haies
qui sont de houx.
Je hais les haies
qu’elles soient de mûres
qu’elles soient de houx !
|
Je hais les murs
qu’ils soient en dur
qu’ils soient en mou !
Je hais les haies
qui nous emmurent.
Je hais les murs
qui sont en nous ! »
|
Mardi 30 avril 2013
Lundi 29 avril 2013
Mardi 23 avril 2013
Lundi 22 avril 2013
Le 16/04/2013 lors de son dernier discours de Président de la Conférence Episcopale de France
Jeudi 18 avril 2013
Mercredi 17 avril 2013
et non ceux qui se vantent de l’avoir trouvée. »
Mardi 16 avril 2013
Lundi 15 avril 2013
Vendredi 12 avril 2013
Jeudi 11 avril 2013
sont les fleurs du silence »
Mercredi 10 avril 2013
Mardi 09 avril 2013
Lundi 08 avril 2013
Vendredi 05 avril 2013
plutôt que l’arbre qui tombe »
Jeudi 04 avril 2013
mais ce n’est pas la réalité, en réalité ils promettent des choses contradictoires.
Or si on peut réaliser l’impossible, on ne peut atteindre des choses contradictoires. »
et continuer à accepter qu’il existe des paradis fiscaux.
Mercredi 03 avril 2013
Mardi 02 avril 2013
Jeudi 28 mars 2013
Vendredi 22 mars 2013
Jeudi 21 mars 2013
trop de citoyens veulent la civilisation au rabais»
Mercredi 20 mars 2013
Lundi 18 mars 2013
Jeudi 14 mars 2013
C’est une formule qui lorsqu’on la prononce, soi-même, possède un caractère jubilatoire. Plus encore si on y accole la phrase d’introduction :
 « Annuntio vobis gaudium magnum : habemus papam, »
« Annuntio vobis gaudium magnum : habemus papam, »
Je vous annonce une grande joie : nous avons un pape.
C’est une phrase séculaire et rare.
La dernière fois qu’elle avait été prononcée, Chirac était encore notre président.
Et la fois d’avant j’avais 20 ans, preuve que c’était il y a longtemps.
Ainsi le comité central du parti catholique qui revendique plus d’un milliard d’adhérents a désigné son secrétaire général, le même jour où la république communiste chinoise de plus d’un milliard d’individus a confirmé son nouveau président.
Pardon mais c’est très faux d’écrire les choses ainsi, puisque le parti communiste s’est inspiré de l’organisation de L’Eglise catholique et de son centralisme démocratique, non le contraire.
Donc ce qui est juste d’écrire : le conclave des cardinaux a désigné l’Evêque de Rome.
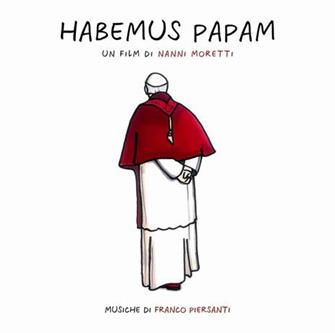 On ne rappellera jamais assez que si le christianisme est né en Judée, en Orient, il s’est développé dans l’Empire Romain dont il a repris l’organisation territoriale, la capitale et le vocabulaire comme « souverain Pontife » par exemple.
On ne rappellera jamais assez que si le christianisme est né en Judée, en Orient, il s’est développé dans l’Empire Romain dont il a repris l’organisation territoriale, la capitale et le vocabulaire comme « souverain Pontife » par exemple.
L’Église Catholique est donc la continuation de cet Empire disparu au Vème siècle.
« Habemus Papam » est aussi un très beau film de Nanni Moretti où Michel Piccoli joue le rôle du Pape nouvellement désigné et qui au moment d’aller sur le balcon saluer les fidèles est pris d’une violente crise d’angoisse et s’enfuit.
<75>
Mardi 12 mars 2013
Mais je ne l’ai pas cru,
Et parce que je ne l’ai pas cru,
je ne l’ai pas su. »
Vendredi 08 mars 2013
il faut l’y faire rentrer : donner pour contrepoids au droit de l’homme le droit de la femme. »
Jeudi 07 mars 2013
Mercredi 06 mars 2013
de vin, de poésie ou de vertu,
à votre guise,
mais enivrez-vous ! »
Mardi 05 mars 2013
en fonction de considérations électorales ? »
Mercredi 27 février 2013
mais je pense qu’elle m’accueillera avec la même gentillesse
que j’ai été accueilli tout au long de ma vie par les êtres que j’ai rencontrés.
Je lui fais confiance. »
Lundi 25 février 2013
il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »
Jeudi 21 février 2013
Mercredi 20 février 2013
J’annule tout ! »
Mardi 19 février 2013
cela n’est pas français. »
Lundi 18 février 2013
vous sortez avec un mastère de criminologie »
Vendredi 15 février 2013
Jeudi 14 février 2013
Bien que ses voies soient dures et rudes. »
J’avais déjà fait appel au Prophète de Khalil Gibran pour son poème sur les enfants qui ne sont pas « vos enfants [mais] les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même »
C’est la Saint Valentin
Alors je vous envoie ce mot du jour
Voici le texte intégral de ce poème
Alors Almitra dit : Parle-nous de l’Amour.
Et il leva la tête et regarda le peuple assemblé, et le calme s’étendit sur eux. Et d’une voix forte il dit :
« Quand l’amour vous fait signe, suivez-le.
Bien que ses voies soient dures et rudes.
Et quand ses ailes vous enveloppent, cédez-lui.
Bien que la lame cachée parmi ses plumes puisse vous blesser.
Et quand il vous parle, croyez en lui.
Bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord dévaste vos jardins.
Car de même que l’amour vous couronne, il doit vous crucifier.
De même qu’il vous fait croître, il vous élague.
De même qu’il s’élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil,
Ainsi il descendra jusqu’à vos racines et secouera leur emprise à la terre.
Comme des gerbes de blé, il vous rassemble en lui.
Il vous bat pour vous mettre à nu.
Il vous tamise pour vous libérer de votre écorce.
Il vous broie jusqu’à la blancheur.
Il vous pétrit jusqu’à vous rendre souple.
Et alors il vous expose à son feu sacré, afin que vous puissiez devenir le pain sacré du festin sacré de Dieu.
Toutes ces choses, l’amour l’accomplira sur vous afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur, et par cette connaissance devenir une parcelle du cœur de la Vie.
Mais si, dans votre appréhension, vous ne cherchez que la paix de l’amour et le plaisir de l’amour.
Alors il vaut mieux couvrir votre nudité et quitter le champ où l’amour vous moissonne,
Pour le monde sans saisons où vous rirez, mais point de tous vos rires, et vous pleurerez, mais point de toutes vos larmes.
L’amour ne donne que de lui-même, et ne prend que de lui-même.
L’amour ne possède pas, ni ne veut être possédé, car l’amour suffit à l’amour.
Quand vous aimez, vous ne devriez pas dire, « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt, « Je suis dans le cœur de Dieu ».
Et ne pensez pas que vous pouvez infléchir le cours de l’amour car l’amour, s’il vous en trouve digne, dirige votre cours.
L’amour n’a d’autre désir que de s’accomplir, mais si vous aimez et que vos besoins doivent avoir des désirs, qu’ils soient ainsi:
Fondre et couler comme le ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit.
Connaître la douleur de trop de tendresse.
Être blessé par votre propre compréhension de l’amour et en saigner volontiers et dans la joie.
Se réveiller à l’aube avec un cœur prêt à s’envoler et rendre grâce pour une nouvelle journée d’amour ;
Se reposer au milieu du jour et méditer sur l’extase de l’amour ;
Retourner en sa demeure au crépuscule avec gratitude ;
Et alors s’endormir avec une prière pour le bien-aimé dans votre cœur et un chant de louanges sur vos lèvres. »
<62>
Mercredi 13 février 2013
Mardi 12 février 2013
Lundi 11 février 2013
la compétition qui stimule,
la coopération qui renforce,
la solidarité qui unit.
Vendredi 08 février 2013
Ce brave Voltaire ajoutait quelques mots particulièrement peu sympathiques pour le christianisme.
Ce qui se passe actuellement en Tunisie déporte le sujet vers l’Islam. Mais finalement il y a probablement un problème inhérent à toutes les religions monothéistes.
En fait quand des gens prétendent qu’il n’y a qu’un Dieu puis très vite qu’il n’y a qu’une vérité, on va passer très vite à ce que nous appelons dans notre langage moderne « le totalitarisme ».
Tout le monde doit suivre le même chemin, avoir les mêmes comportements puisqu’il n’y a qu’une vérité. Nous autres qui avons été élevé ou au moins baigné dans des sociétés monothéistes, avons toujours appris qu’il s’agissait d’un grand progrès par rapport aux religions polythéistes ou animistes. Finalement en sommes-nous toujours aussi sûr ?
<58>
Mardi 05 février 2013
Seuls les enfants sans parents ont des parents de rêve. »
Lundi 04 février 2013
où l’homme combat pour sa santé et contre la maladie,
nous ne pouvons que gagner des batailles, et finirons toujours par perdre la guerre,
c’est pourquoi gagner le plus possible de batailles
constitue un défi noble et enthousiasmant qui mérite d’être affronté. »
<56>
Vendredi 01 février 2013
c’est qu’il accepte lui-même un jour de les porter. »
Mercredi 30 janvier 2013
Paru le 12 septembre 2012. Ed Albin Michel
l’économie guide le monde. Mais vers quelle destination ?
Mardi 29 janvier 2013
c’est vendre un bijou que l’on ne possède pas, à une femme qui ne le désire pas »
Lundi 28 janvier 2013
Maintenant qu’il peut les réaliser, il doit les changer, ou périr. »
Vendredi 25 janvier 2013
tandis qu’une majorité de plus en plus large a du mal.
La prospérité américaine repose sur les épaules larges d’une classe moyenne ».
Jeudi 24 janvier 2013
et fragile comme la fleur de pêcher.»
Vendredi 11 janvier 2013
Jeudi 10 janvier 2013
mais celui qui ne combat pas a déjà perdu »
Mercredi 9 janvier 2013
Peut-être avez-vous, lu l’article d’Edgar Morin dans le Monde du 1er janvier 2013 et dont le titre est : « En 2013, il faudra plus encore se méfier de la docte ignorance des experts ».
J’en tire ce mot du jour qui donne un éclairage saisissant sur la limite du jugement des experts :
Cet article débute de la manière suivante :
« Hélas, nos dirigeants semblent totalement dépassés : ils sont incapables aujourd’hui de proposer un diagnostic juste de la situation et incapables, du coup, d’apporter des solutions concrètes, à la hauteur des enjeux. Tout se passe comme si une petite oligarchie intéressée seulement par son avenir à court terme avait pris les commandes. » (Manifeste Roosevelt, 2012.)
« Un diagnostic juste » suppose une pensée capable de réunir et d’organiser les informations et connaissances dont nous disposons, mais qui sont compartimentées et dispersées.
Une telle pensée doit être consciente de l’erreur de sous-estimer l’erreur dont le propre, comme a dit Descartes, est d’ignorer qu’elle est erreur. Elle doit être consciente de l’illusion de sous-estimer l’illusion. Erreur et illusion ont conduit les responsables politiques et militaires du destin de la France au désastre de 1940 ; elles ont conduit Staline à faire confiance à Hitler, qui faillit anéantir l’Union soviétique.
Tout notre passé, même récent, fourmille d’erreurs et d’illusions, l’illusion d’un progrès indéfini de la société industrielle, l’illusion de l’impossibilité de nouvelles crises économiques, l’illusion soviétique et maoïste, et aujourd’hui règne encore l’illusion d’une sortie de la crise par l’économie néolibérale, qui pourtant a produit cette crise. Règne aussi l’illusion que la seule alternative se trouve entre deux erreurs, l’erreur que la rigueur est remède à la crise, l’erreur que la croissance est remède à la rigueur.
L’erreur n’est pas seulement aveuglement sur les faits. Elle est dans une vision unilatérale et réductrice qui ne voit qu’un élément, un seul aspect d’une réalité en elle-même à la fois une et multiple, c’est-à-dire complexe.
Hélas. Notre enseignement qui nous fournit de si multiples connaissances n’enseigne en rien sur les problèmes fondamentaux de la connaissance qui sont les risques d’erreur et d’illusion, et il n’enseigne nullement les conditions d’une connaissance pertinente, qui est de pouvoir affronter la complexité des réalités.
Notre machine à fournir des connaissances, incapable de nous fournir la capacité de relier les connaissances, produit dans les esprits myopies, cécités. Paradoxalement l’amoncellement sans lien des connaissances produit une nouvelle et très docte ignorance chez les experts et spécialistes, prétendant éclairer les responsables politiques et sociaux. »
Pour lire la suite de cet article : <Il faudra plus encore se méfier de la docte ignorance des experts>
<47>
Mardi 08 janvier 2013
Dans quelques années, nous aurons des vieilles avec des gros seins et des vieux à la verge dure mais aucun d’eux ne se rappellera à quoi ça sert ». »
Lundi 07 janvier 2013
ce n’est pas l’eau, c’est l’homme. »
Jeudi 03 janvier 2013
Demain n’est qu’une vision ;
Mais un aujourd’hui bien vécu
Fait de chaque hier un rêve de bonheur,
Et de chaque demain une vision d’espoir.
Fais donc grand cas d’aujourd’hui.
Jeudi 27 décembre 2012
Vendredi 21 décembre 2012
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même »
Mercredi 19 décembre 2012
Mardi 18 décembre 2012
Vendredi 14 décembre 2012
Il faut jouer notre rôle comme il faut,
mais comme le rôle d’un personnage emprunté. »
Jeudi 13 décembre 2012
Mercredi 12 décembre 2012
Mardi 11 décembre 2012
Ce que je vois, je m’en souviens
Ce que je fais, je le sais. »
Lundi 10 décembre 2012
Vendredi 07 décembre 2012
Jeudi 06 décembre 2012
Mardi 04 décembre 2012
Lundi 03 décembre 2012
Vendredi 30 novembre 2012
Jeudi 29 novembre 2012
Mercredi 28 novembre 2012
La France subira, hélas, plus qu’elle ne construira son destin.
Je le regrette, à l’avance. »
Mardi 27 novembre 2012
Lundi 26 novembre 2012
Vendredi 23 novembre 2012
Ancien Directeur de la Musique de Radio France
Jeudi 22 novembre 2012
Mercredi 21 novembre 2012
Selon Michel Serres, les jeunes générations ont compris ce que signifiait le mot maintenant, qu’il faut lire main tenant, c’est à dire tenant dans la main. Avec les smartphones qu’ils tiennent dans la main, ils peuvent immédiatement échanger avec tous leurs proches ou personnes qu’ils connaissent quel que soit le lieu où les uns et les autres se trouvent dans le monde. Ils peuvent accéder à l’information et à la connaissance instantanément en surfant sur les outils de l’internet, ils  peuvent envoyer, maintenant, des photos qu’ils viennent de prendre quelques secondes auparavant etc…
peuvent envoyer, maintenant, des photos qu’ils viennent de prendre quelques secondes auparavant etc…
Chaque année est organisée à Lyon, sur une journée, une rencontre échange animée par Michel Serres.
Cette année elle a eu lieu samedi 17 novembre et j’ai eu la chance d’y assister.
Lors de l’une de ses interventions pleines d’intelligence fulgurante et d’analyse lucide et prospective du monde il a fait référence à son livre « Petite Poucette » où il décrit la jeune génération et sa capacité à envoyer des SMS avec son pouce et où il explique que c’est un bouleversement considérable dans l’Histoire de la société humaine.
Le sous titre de ce livre est le suivant :
« Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer : une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d’être et de connaître… »
Si vous voulez en savoir plus, lisez un entretien dans le journal Libération avec cet homme qui s’est qualifié, lui-même, samedi, de vieillard au porte de la mort : <Petite poucette la génération mutante>
<23>
Mardi 20 novembre 2012
|
« Si tu ne sèmes rien ;
Que de vaines paroles ;
Que t’attends-tu à récolter ;
Que du vent dans tes voiles ;
Que tu n’auras hissées ;
Que de l’eau dans ton puits ;
Que tu n’as pas puisée.
Pourtant ;
|
Heureusement ;
Il n’est jamais trop tard ;
Pour dans la terre offerte ;
Déposer tienne graine ;
Même au cœur de la nuit ;
Même en pleine tempête ;
Même au seuil de la mort ;
Qui est vie éternelle. »
|
|
(Tom Eden)
|
Vendredi 16 novembre 2012
Jeudi 15 novembre 2012
Mercredi 14 novembre 2012
Non. »
Lundi 12 novembre 2012
Vendredi 09 novembre 2012
Jeudi 08 novembre 2012
Mercredi 07 novembre 2012
Mardi 06 novembre 2012
Lundi 05 novembre 2012
Mercredi 31 octobre 2012
Mardi 30 octobre 2012
Lundi 29 octobre 2012
Vendredi 26 octobre 2012
Jeudi 25 octobre 2012
Mercredi 24 octobre 2012
Vendredi 19 octobre 2012
Jeudi 18 octobre 2012
Mercredi 17 octobre 2012
Vendredi 12 octobre 2012
Jeudi 11 octobre 2012
Mardi 09 octobre 2012